
VICTOR SCHŒLCHER,
Des colonies françaises.
Abolition immédiate de l'esclavage (1842)

|
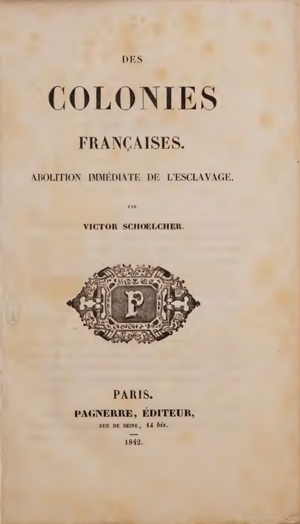 |
[Created: 17 November, 2024]
[Updated: 17 November, 2024] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage (Paris: Pagnerre, 1842).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Schoelcher/1842-ColoniesFrancaises/index.html
Victor Schœlcher, Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage (Paris: Pagnerre, 1842).
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Victor Schœlcher (1804-1893).
TABLE DES MATIÈRES.
- à mes hôtes des colonies françaises, p. v
- introduction, p. ix
- CHAPITRE I. — condition des esclaves. — Cases à nègres. — Habillement. — Nudité. — L’usage de marcher nu pied pouvant être une cause déterminante de l’éléphantiasis. — Mal-pieds. — Hôpitaux des habitations. — Nourriture. — Mal d’estomac. — Maladies cutanées aux Antilles. — Jardins. — Respect des maîtres pour la propriété des esclaves. — Bien-être matériel. — L’esclave suit le sort de son maître. — Esclaves des habitations vivrières., p. 1
- CHAPITRE II. — bien-être matériel des esclaves. — Familiarité des rapports entre le maître et l’esclave. — Sécurité des maîtres. — Accroissement de la population esclave. — Population générale des colonies françaises., p. 17
- CHAPITRE III. — travail des esclaves. — Journées. — Bons effets du travail en commun. — Plus de femmes que d’hommes dans les champs. — Amélioration du sort des nègres. — Cravates. — Abrutissement de quelques esclaves., p. 22
- CHAPITRE IV. — l’esclave n’a aucune garantie contre l’arbitraire du maître. — Le régime de l’esclavage est beaucoup adouci. — Quelques traits du passé. — Cruautés, violences. — Lettre d’un esclave de la Martinique. — Excès du pouvoir absolu. — L’arbitraire corrompt les meilleurs maîtres. — M. Douillard Mahaudière, M. Amé Noël, M. Brafin. — Ces grands coupables sont authentiquement des maîtres distingués entre tous par la bienveillance de leur administration. — Toute-puissance de l’habitant. — Les esclaves n’ont aucun moyen réel de défense. — Oublis de la loi. — Dépravation à laquelle l’usage du despotisme conduit quelques maîtres. — Tentative de traite de la Martinique aux États-Unis. — Les crimes d’exception n’en sont pas moins des crimes., p. 27
- CHAPITRE V. — l’esclave, le prolétaire. — Les garanties de la vie matérielle ne suffisent pas à l’homme. — L’esclave n’est pas soumis à un pouvoir public. — Il ne peut se défendre contre l’arbitraire. De fait, la loi n’existe pas pour lui. — Ses enfans appartiennent à son maître. — Il n’a pas d’état civil. — La loi le déclare chose mobilière. — Il est vendu aux enchères. — Une vente d’esclaves. — Le prolétaire. — Un mot du peuple sur l’esclavage., p. 45
- CHAPITRE VI. — mariages. — Le Mariage est incompatible avec la servitude. — Les blancs enseignent le concubinage. — On accuse à tort les maîtres de violenter leurs esclaves femelles. — Profonde corruption des esclaves. — Les maîtres sont loin de favoriser le mariage des esclaves. — Pourquoi beaucoup de nègres refusent le mariage. — La famille est impraticable pour l’esclave. — Fécondité ou stérilité sur les habitations. — Les esclaves ne vivent pas dans une promiscuité absolue. — Piété filiale chez les nègres., p. 72
- CHAPITRE VII. — le fouet. — Le fouet est l’âme d’une habitation. — Les femmes sont fouettées. — Nécessité des châtimens barbares dans un mode social contre nature. — Une exécution. — Avilissement de quelques nègres. — On juge les esclaves avec le code fait pour des hommes libres. — Il y a des colons qui résistent au contact de la servitude. — Les femmes même sont cruelles aux colonies. — La violence du châtiment dépend beaucoup de la volonté du bourreau. — Le fouet est-il nécessaire ? — Réforme de M. Arth. Clay. — Plusieurs habitans ont déjà supprimé le fouet au jardin. — Le jury d’esclaves chez M. Meat. — Suicides d’esclaves. — On croit aux colonies que la flagellation est dans le droit paternel. — Le fouet en Europe. — Suicide d’un soldat espagnol pour éviter de passer par les verges. — Les législatures des îles anglaises rayent le fouet de leurs codes. — Les tribunaux de nos îles ordonnent la peine du fouet moins souvent aujourd’hui qu’antérieurement., p. 83
- CHAPITRE VIII. — marronnage ; désertion à l’étranger. — Le cachot. — La chaîne de police. — La barre. — Les fers. — Le carcan. — Étymologie probable du mot marron. — Il y eut des marrons dès qu’il y eut des esclaves. — Législation atroce contre eux. — Receleurs de marrons. — Marrons reconnus libres après plusieurs années de guerre, à la Guyane hollandaise, à la Jamaïque et à Saint-Domingue. — Vie des marrons. — Les trois sortes de marrons. — L’exorcisme. — Jarrets coupés. — Le marronnage dépend de la bonne ou mauvaise administration du planteur. — Évasions. — La surveillance la plus stricte ne peut les prévenir, ni les périls de la traversée les empêcher. — Deux esclaves se faisant conduire à Antigues par leur maître. — Il n’est pas vrai que les nègres réfugiés veuillent revenir. — Le gouvernement anglais s’oppose à ce qu’on les enlève de force, mais non pas à ce qu’ils partent quand ils veulent. — Les esclaves danois s’enfuient à Tortola, ceux de Puerto-Rico à Saint-Domingue., p. 99
- CHAPITRE IX. — le poison. — Le poison est à l’esclave ce que le fouet est au maître, une force morale. — Si le maître a droit de battre, l’esclave a droit d’empoisonner. — Le poison n’existe que dans les pays à esclaves. — Il ne tient pas essentiellement au caractère de la race noire. — Caprices du poison. — Il se fait obéir. — L’esclave empoisonne quelquefois par amour pour son maître. — Organisation secrète. — Moyens d’empoisonnement. — Inefficacité des lois contre le poison. — Cours prévôtales. — Le poison disparaîtra avec l’esclavage., p. 121
- CHAPITRE X. — le catholicisme et l’esclavage. — Légitimité religieuse de l’esclavage de hommes noirs. — La servitude bonne aux nègres parce qu’ils y deviennent chrétiens. — Les propriétaires d’esclaves grands catholiques., p. 135
- CHAPITRE XI. — dans l’échelle des êtres, le nègre appartient au genre homme. — Doctrine de M. Viret. — Épine dorsale du nègre. — Trou occipital. — Sang noirâtre. — Cerveau noir. — Si la décoloration est le résultat d’une dégénération, l’homme noir devient le type humain par excellence. — Fontanelles cartilagineuses. — Les mamelles pendantes de M. Bory de Saint-Vincent. — Les hommes de l’art résidant aux colonies n’admettent aucune dissemblance essentielle entre le nègre et le blanc. — M. Virey et M. Bory, énergiques et généreux ennemis de l’esclavage. — La masse encéphalique. — Perfectionnement progressif des races. — Les Indiens. — Les Germains décrits par Tacite tout aussi sauvages que les Africains. — Le nègre est intellectuellement égal au blanc ; il n’y a de différence entre eux que celle de l’éducation. — Les souris blanches ne sont pas moins souris que les grises. — Le génie n’est pas dans l’épiderme. — Les révoltes souvent victorieuses des esclaves noirs confondent la prétendue supériorité des blancs. — Hypothèse sur l’origine des races., p. 139
- CHAPITRE XII. — de l’intelligence de l’homme noir. — Les hommes noirs furent les premiers civilisés. — Au point de vue religieux c’est une impiété de dire que les nègres ont toujours été dans la barbarie. — Quelques nègres qui se distinguent au milieu même de l’esclavage. — Rosillette. — Saillies. — Proverbes créoles. — Injustice du jugement porté sur les nègres. — Les serfs russes, polonais, valaques, aussi stupides que les esclaves noirs. — Dans les écoles des îles anglaises, les enfans nègres montrent autant d’intelligence que les enfans blancs. — Les colons ne connaissent pas les nègres. — Le défaut d’intelligence tient à l’esclavage et non pas à la nature des noirs. — Liberia., p. 155
- CHAPITRE XIII. — du préjugé de couleur. — Le préjugé de couleur était indispensable avec l’esclavage des hommes noirs. — Il a été fondé par les lois métropolitaines. — En Orient, où il y a des maîtres et des esclaves de toutes couleurs, il n’y a pas de préjugé de cette nature. — Les colons de tête faible sont arrivés à se croire réellement d’une race supérieure. — Prérogatives du bouvier blanc. — Lois avilissantes contre les sang mêlés. — Les créoles ne sont nullement responsables des vices de leur société. — La religion catholique elle-même a entretenu le préjugé. — Lettres de blanc., p. 168
- CHAPITRE XIV. — de la classe de couleur, esprit de vol attribué aux nègres. — Le préjugé de couleur est aussi vivace que jamais. — Charivari à un blanc qui se marie avec une demoiselle sang mêlée. — Rivalité actuelle et haine des deux classes. — Division de la propriété coloniale entre les blancs et les libres. — Causes de la pauvreté et des mauvaises mœurs des sang mêlés. — Les savonnettes à vilain blanchissent bien réellement. — Femmes de couleur. — Elles n’ont presqu’aucun moyen d’existence honnête. — Il est faux que les nègres soient voleurs. — État des prisons. — Les blancs s’opposent à toute expansion de lumières dont pourraient profiter les libres. — Éducation. — Le couvent des dames de Saint-Joseph et l’hospice des orphelins sont fermés à la classe de couleur. — Lâche faiblesse des autorités. — Les sang-mêlés n’ont pas moins de préjugés que les blancs contre les nègres. — Conduite peu digne, maladroite et coupable de la classe de couleur., p. 184
- CHAPITRE XV. — le préjugé de couleur se perdra dans la liberté ; les deux races s’assimileront. — Le préjugé de couleur n’est rien par lui-même, il disparaîtra avec l’esclavage qui l’a fait naître. — Il se modifie déjà dans les îles anglaises. — Familles libres distinguées. — La classe de couleur s’améliore depuis qu’elle possède des droits politiques. — La liberté moralise. — Les mariages de fusion nombreux au commencement des colonies. — L’antipathie des femmes blanches pour les nègres est un mensonge. — Mulâtres nés de demoiselles blanches. — L’amalgame futur des deux races est écrit dans la similitude de leur espèce. — Les Antilles formeront un jour une confédération indépendante., p. 206
- CHAPITRE XVI. — l’administration. — Les gouverneurs de nos colonies ne remplissent pas leur devoir. — L’administration est solidaire de la moitié des fautes et crimes qui se commettent dans les îles. — La magistrature coloniale. — Justice blanche. — M. Maraist, procureur du roi dans l’affaire Mahaudière. — Un colon jugeant des nègre et des sangs mêlés, est juge dans sa propre cause. — Les vieilles ordonnances elles-mêmes interdisaient à tous fonctionnaires et employés de posséder ou de se marier aux colonies. — Les tergiversations du gouvernement métropolitain entretiennent les résistances créoles. — Les esclaves de l’État sont moins bien traités que ceux de beaucoup de colons. — Épave vendue en 1838. — Inutilité des petites réformes. — Plusieurs des principaux fonctionnaires des îles sont hostiles à l’émancipation., p. 215
- CHAPITRE XVII. — état de la question. — Il ne faut pas tout-à-fait juger des colons par les discours de leurs députés gagés, ou les brochures de quelques-uns d’entre eux. — Les crimes du passé ne sauraient justifier les crimes du présent. — Les colons ne défendent pas l’esclavage pour lui-même. — Le courage civil manque aux colonies comme en Europe. — La censure est aussi une des plaies attachées à l’esclavage. — Belle contenance des créoles, lors des derniers bruits de guerre. — Leur folle haine contre les abolitionistes. — le mot philantrope est devenu une injure parmi eux. — L’Angleterre et les betteraviers sont les Pitt et Cobourg des créoles. — Les projets de monopole du sucre indien sont absurdes, les colons éclairés de disent eux-mêmes. — La France n’est pas ennemie des colonies. — La propriété esclave n’est défendue que par les propriétaires de nègres et leurs salariés. — Il y a des possesseur d’esclaves parmi les abolitionistes. — Que les colons approuvent ou n’approuvent pas l’émancipation, ils doivent céder au vœu universel qui la demande. — Les difficultés de l’affranchissement seront d’autant plus vite surmontées que les créoles l’accepteront avec moins de résistance. — Le titre de délégués des colonies que prennent les délégués des blancs, est une usurpation qui choque la justice et le sens commun., p. 232
- CHAPITRE XVIII. — indemnité. — Les propriétaires de Guatemala refusent l’indemnité lors de l’abolition de l’esclavage dans la république. — L’abolition est aujourd’hui une question d’argent. — L’indemnité est due, parce que si le fait de posséder des nègres est illégitime, il n’est est pas moins légal. — L’indemnité pour la terre et les bâtimens est irrationnelle et impossible. — Moyens de déterminer l’indemnité. — 1,000 fr. par tête d’esclave. — Le trésor rentrera dans ses déboursés., p. 258
- CHAPITRE XIX. — de la paresse native des nègres. — Fécondité des Antilles. — Les blancs ne sont pas moins indolens que les nègres aux colonies. — La paresse est le propre de tous les hommes encore non civilisés. — L’esclave ne peut prendre aucun intérêt au travail. — Pourquoi les affranchis ne travaillent pas. — Aux Antilles, l’esclavage a frappé l’agriculture d’ignominie., p. 267
- CHAPITRE XX. — les émancipés travailleront si on les dirige bien. — Fût-il vrai que les nègres, une fois émancipés, ne voulussent pas travailler, il n’en faudrait pas moins abolir l’esclavage. — Les affranchis ne s’enfuiront pas dans les bois. — Les nègres de traite libérés. — Si l’on rend le travail attrayant par un bon salaire, les nègres travailleront. — Tout labeur doit rapporter sa juste récompense. — De la question des sucres en Angleterre. — Travail libre et travail forcé. — On ne peut pas juger des dispositions laborieuses de l’homme libre par celles de l’homme esclave., p. 281
- CHAPITRE XXI. — comment l’intérêt présent des planteurs s’oppose à l’affranchissement. — Motifs de la suspension de l’expropriation forcée. — La plupart des habitans ne sont que les géreurs de leurs créanciers hypothécaires. — La saisie exécution, la saisie brandon et le déguerpissement sont illusoires aux colonies. — Dettes des colons. — Les séparations de corps. — les blanchissages. — Funeste état du crédit. — Urgence de rétablir l’expropriation forcée. — La moitié de l’indemnité devra être déclarée insaisissable., p. 296
- CHAPITRE XXII. — moyens transitoires d’arriver à l’abolition de l’esclavage.
- § Ier. — émancipation successive laissée à la libéralité des maîtres. — Les vices et les vertus des colons chargés de l’affranchissement. — Ce que sont les 34,000 libertés enregistrées depuis 1830 dans nos colonies. — Libres de savane. — Patronnés. — Épaves. — Interprétation sciemment vicieuse de l’ordonnance de 1832 sur les affranchissemens. — L’esclavage dans l’Amérique du Nord. — Les abolitionistes aux États-Unis., p. 303
- § II. — incompatibilité de l’instruction religieuse ou primaire avec l’esclavage. — Aucune utile modification à la servitude n’est possible. — Les lois existantes donnent à l’esclave la plus grande partie des garanties conciliables avec l’esclavage. — Ordonnance du 5 janvier 1840, et ses résultats. — Les esclaves ne peuvent rien comprendre au catéchisme. — Les colons ne veulent pas permettre que l’on traduise le catéchisme en créole. — Les nègres et beaucoup de créoles croient aux sortilèges et aux amulettes. — Clergé catholique. — Écoles primaires. — Elles sont instituées par la métropole, pour les esclaves, il est défendu par les autorités locales d’y recevoir des esclaves. — Toute éducation, soit religieuse soit morale des esclaves, est dangereuse pour les maîtres., p. 314
- § III. — affranchissement successif par le rachat des enfans. — Un enfant coûte cher à son maître. — Des esclaves ne peuvent élever des hommes libres., p. 334
- § IV. — rachat forcé par le moyen du pécule. — Les maîtres ne veulent pas du rachat forcé. — Tous les esclaves ne sont pas à même de se faire un pécule. — Le rachat par le pécule nuit à l’établissement spontané du travail libre. — Le maître, s’il le veut, peut empêcher un esclave de gagner de l’argent. — L’esclave ne doit pas payer sa liberté, on lui devrait plutôt donner une indemnité pour tout le temps où il a été retenu en servitude., p. 338
- § V. — rachat par l’état. — L’État possesseur et loueur d’esclaves est une conception profondément immorale. — Dans cette hypothèse, comment peut-on régler le sort des 45,000 esclaves de villes et de bourgs ?, p. 342
- § VI. — apprentissage. — Dangers de l’apprentissage. — Les magistrats rétribués des îles anglaises. — Les colons français aiment mieux l’abolition que l’apprentissage., p. 344
- § VII. — engagement au sol ; néant de tout moyen transitoire. — Lettre de M. Bovis sur l’engagement au sol. — Entre l’engagement au sol et la servitude, il n’y a d’autre différence que celle du travail forcé au travail esclave. — Le nègre ne voudra pas de la glèbe. — Les colons l’ont combattue d’avance. — La glèbe reculerait indéfiniment l’abolition., p. 349
- § VIII. — les maîtres sont incapables de l’œuvre de transformation et indignes d’en être chargés. — Sous de certains rapports les blancs ne sont pas plus civilisés que leurs nègres. — Le fait de la servitude a corrompu le maître aussi bien que l’esclave. — Il faut reprendre tout à nouveau. — Attitude de la population blanche durant les débats de l’affaire Mahaudière., p. 359
- CHAPITRE XXIII. — émancipation générale et immédiate. — Tout moyen partiel est mauvais, parce qu’il est partiel. — Il n’y a pas de transition qui puisse paralyser les embarras du passage de la servitude à la liberté. — Une certaine perturbation est inévitable. — L’affranchissement en masse peut seul permettre d’enseigner à des esclaves les devoirs de l’homme libre. — Les nègres sont aussi préparés pour l’indépendance, qu’ils le peuvent être. — L’affranchissement en masse et immédiat n’est pas un moyen sans dangers, c’est de tous les moyens celui qui en a le moins. — Il rend toute résistance impossible, il fait cesser l’incertitude et l’agitation qui ruinent aujourd’hui les colonies. — Révoltes continuelles des esclaves. — Les créoles eux-mêmes et les autorités, avouent que la société coloniale est en péril., p. 369
- CHAPITRE XXIV. — résumé. — Si comme le disent les colons on ne peut cultiver les Antilles qu’avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles. — La raison d’utilité de la servitude pour la conservation des colonies est de la politique de brigands. — Une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. — Périssent les colonies plutôt qu’un principe. — Il n’est pas vrai que le travail libre soit impossible sous les tropiques., p. 382
- CHAPITRE XXV. — essai de législation propre à faciliter l’émancipation en masse et spontanée., p. 388
- Notes. — Proverbes nègres., p. 417
- État des libertés données à la Martinique., p. 435
- Notes
[v]
À MES HÔTES DES COLONIES FRANÇAISES.↩
Vous connaissez mes principes, et quoique vous regardiez comme vos ennemis tous ceux qui les professent, partout vous m’avez ouvert vos portes. Vous avez tendu la main au voyageur abolitionniste, et il a long-temps vécu sous votre toit comme on vit chez un ami.
C’est pourquoi je vous adresse mon livre : aussi bien n’est-ce qu’une dette acquittée ; sans vous je ne l’eusse pu faire. Jamais je ne déposerai ma haine contre l’esclavage, mais je veux qu’on sache que je vous suis attaché par ces liens de grave fraternité qui, aux belles époques de l’antiquité grecque et romaine, unissaient l’hôte à son hôte.
J’aime vos esclaves, parce qu’ils souffrent. Je vous aime, parce que vous avez été bons et généreux pour moi.
[vi]
L’ambition est sans doute au-dessus de mes forces et de ce que j’appellerai mon talent, faute d’un mot plus humble, mais j’ai rêvé d’être un utile intermédiaire entre vous qui défendez la fortune de vos femmes et de vos enfans, et la métropole qui doit la liberté aux nègres.
Vos intérêts actuels et les imprescriptibles intérêts de l’humanité sont en lutte. Le problème à résoudre est de les concilier.
Tel est le but de mon livre.
Je voudrais entraîner votre plein consentement à l’abolition de l’esclavage, car abolition de l’esclavage, c’est justice. Je voudrais que la métropole vous donnât une indemnité, car indemnité, c’est justice. La résistance aveugle et folle de quelques-uns de vos frères, qui a tant nuit aux créoles vis-à-vis des honnêtes gens, se perdrait alors dans la paix et la sainteté de la grande œuvre accomplie.
Si, malgré mes efforts, l’invincible horreur que m’inspire l’état social des colonies avait quelquefois revêtu mes expressions d’une âpreté irritante, n’en tenez aucun compte. Imitez-moi. Je vous garde affection, quoique vous soyez maîtres, parce qu’il n’y a que cela de mauvais en vous ; reconnaissez-moi pour votre ami, quoique je me fasse le défenseur des esclaves, parce que je désire avec une égale ardeur le bien de tous.
Maintenant, si les déplorables passions qui agitent votre société finissent par vous dominer, si l’auteur vous [vii]fait regretter d’avoir accueilli l’homme, je m’en affligerai ; mais, quoi qu’il arrive, ma conscience restera calme, et je n’oublierai pas, moi, que je fus votre hôte.
Fais ce que dois, advienne que pourra.
V. Schœlcher.
[viii]
[ix]
INTRODUCTION↩
« Il n’est pas possible, dit-on, de cultiver les îles autrement que par des esclaves. Dans ce cas il vaudrait mieux renoncer aux colonies qu’à l’humanité. La justice, la charité universelle et la douceur sont plus nécessaires à toutes les nations que le sucre et le café. Mais tout le monde ne convient point de l’impossibilité prétendue de se passer du travail des nègres. Lorsque les Grecs et les Romains faisaient exécuter par leurs esclaves ce que font chez nous les chevaux et les bœufs, ils imaginaient et disaient que l’on ne pouvait faire autrement. »
Abbé Bergier,
Dictionnaire théologique.
§ Ier.
Émancipation des noirs, tel est notre premier vœu. Prospérité des colonies, tel est notre second vœu. Nous demandons l’une au nom de l’humanité, l’autre au nom de la nationalité, toutes deux au nom de la justice. Expliquons-nous.
L’intérêt exclusif de la métropole fut la loi suprême qui présida à la fondation de nos colonies. Elles étaient instituées pour offrir aux produits du sol et de l’industrie du royaume des débouchés constamment ouverts, pour assurer à ces produits des marchés à l’abri de toute concurrence étrangère, et pour obtenir sans numéraire des denrées coloniales. Les hommes d’état du siècle de Louis XIV ne cachèrent point ces vues véritablement barbares.
[x]
La France, comme toutes les nations modernes qui se copient les unes les autres, adopta dès le commencement le système de l’exclusion absolue du commerce. La première pierre de nos établissemens d’outre-mer fut posée en 1626, et la première loi prohibitive date du 25 novembre 1634. C’est dix-sept ans après, en 1651, que Cromwell lança le fameux acte de navigation qui interdisait par des moyens violens la liberté commerciale dont jouissaient l’Angleterre et ses colonies. Le privilège des transports pour nos îles fut accordé le 10 septembre 1668, à la compagnie des Indes occidentales. En 1670 nos ports coloniaux furent fermés aux navires étrangers ; en 1671 à toute espèce de marchandises étrangères ; en 1684 on retira aux colons eux-mêmes la faculté d’établir aucune manufacture, ils durent acheter tout de la métropole ; plus encore, on leur défendit de raffiner leurs sucres, le raffinage étant réservé à la métropole.
Un siècle passa sans rien changer à cette étroite économie politique, et les instructions adressées le 25 janvier 1765 au comte d’Ennery, nommé gouverneur-général de nos possessions dans les Antilles, disaient entre autres choses : « La troisième vérité qui fait la destination des colonies, est qu’elles doivent être tenues dans le plus grand état de richesses possible, et sous la loi de la plus austère prohibition en faveur de la métropole. Sans l’opulence elles n’atteindraient point à leur fin [1] ; sans la prohibition ce [xi] serait encore pis, elles manqueraient également leur destination, et ce serait au profit des nations rivales. » Dans ces instructions on va jusqu’à dire : « que les colonies ne sont pas provinces de France, que le colon est un planteur libre sur un sol esclave. » Quelques années avant 89 on n’était guère plus avancé, et Malouet écrivait : « Une colonie est établie pour le plus grand avantage de la métropole. Voilà sa fin [2]. »
Ceux qui font de la politique à ce point de vue d’utilité matérielle et immédiate, ont calculé la valeur des îles à culture pour la France ; ils se sont demandé brutalement s’il était profitable de les garder ou de les abandonner. — Les partisans des colonies ont affirmé qu’à elles seules, elles portaient presque la moitié de notre inscription maritime et de notre commerce extérieur. — La vérité sur ce point, la voici : Le président du conseil, dans la séance de la chambre des députés du 8 mai 1840, a prouvé que les colonies n’employaient pas plus de six mille matelots [3] sur [xii] un tiers du produit de nos pêches, ce qu’en consomment les colonies. Nos colonies ne représentent donc qu’un cinquième ou un sixième de notre puissance maritime, rien de plus.
Le commerce de France, d’après les tableaux annuels publiés par l’administration des douanes du royaume, importe pour 629 millions de francs et exporte pour 694 millions. C’est donc ensemble 1, 323 millions. Dans ce chiffre les colonies figurent pour 48 millions d’importation, et 47 d’exportation, en tout 95. C’est-à-dire que leur commerce spécial ne dépasse pas le treizième de notre commerce général.
On a dit encore que le principal élément de prospérité du Havre reposait sur les Antilles, autre exagération. Le Havre, Dunkerque et les petits ports environnans, n’emploient que cinquante-un bâtimens à la navigation des Antilles, de Bourbon et de la Guyane [4] ; le débouché du Havre d’après les statisti [xiii] ques industrielles, ne dépasse point soixante-dix mille barriques de sucre. C’est le frêt d’une centaine de navires. Le rapport de soixante-dix mille avec les cinquante-un bâtimens employés, est exact puisqu’il y a là dedans quelques sucres étrangers, et que la plupart des bâtimens font double voyage.
Enfin les droits perçus par la métropole sur les denrées provenant des colonies, ont été en moyenne de 1832 à 1838.
| Martinique | 10, 483, 191 | fr. | |
| Guadeloupe | 15, 143, 691 | ||
| Guyane française | 788, 376 | ||
| Bourbon | 8, 289, 813 | ||
| Total des colonies à cultures. | 34, 705, 071 | fr. [5] | |
En somme on voit que les colonies tiennent dans le commerce de France une place importante, mais pas aussi grande qu’il a été dit ; que leur apport au trésor public est peu considérable, surtout si l’on en déduit les dépenses faites pour elles par l’État. Elles seraient donc moins utiles à la métropole et à son trafic extérieur qu’elle ne l’espéra en les fondant, qu’on ne le croit généralement et qu’elles ne le pensent elles-mêmes. Leur perte, au point de vue d’intérêt égoïste pourrait être envisagée sans effroi. — Elles consomment nos produits manufacturés à l’exclusion de ceux des autres nations, auxquelles elles pourraient en acheter quelques-uns meilleur marché ; cela est vrai, mais nous achetons exclusivement leur den [xiv] rées, et c’est un fait connu que nous leur payons plus cher qu’elles ne nous coûteraient ailleurs. Au-dessous de 50 fr. les cent kilogrammes de sucre, la Martinique et la Guadeloupe perdraient ; on en peut tirer à 30 et 36 fr. des colonies espagnoles. Le consommateur est donc ainsi frappé d’un impôt indirect au profit de nos possessions d’outre-mer. Les colonies, en aussi petit nombre qu’elles sont, centralisent nos débouchés, limitent une portion de la navigation française dans les Antilles, et l’empêchent de se porter autre part, parce qu’on ne pourrait acheter autre part les denrées étrangères sur lesquelles pèsent des droits prohibitifs.
Les ports de mer, dont certes l’opinion est d’un grand poids, se sont déclarés, nous le savons, en faveur des colonies [6] ; mais on peut croire qu’ils ont été aveuglés par le désir de faire tomber le sucre de betterave, nuisible au trafic maritime, et qu’ils ont fait alliance avec les Antilles contre l’ennemi commun. Reste à savoir si l’ennemi abattu, ils continueraient à voir du même œil la protection accordée aux Antilles ? Ce nombre de navires et de matelots qu’occupe le commerce avec nos îles ne trouveraient-ils point d’emploi, si la marine marchande affranchie du privilège colonial pouvait aller faire échange sur tous les marchés du monde qui lui sont ouverts ? C’est une question fort admissible en présence de l’Amérique [xv] du nord, qui n’a pas une colonie, et dont la marine marchande cependant a pris plus d’extension que celles de toutes les puissances à établissemens d’outre-mer. Un moyen de favoriser notre navigation de commerce est assurément de lui donner à transporter des marchandises d’encombrement, comme le sucre ; mais parce qu’on n’en achèterait plus à la Guadeloupe ou à la Martinique, serait-ce à dire qu’on n’en pourrait acheter autre part ?
Ne discutons pas davantage, nous n’avons posé la question que pour nous éclairer. Nous n’appartenons point à l’école de la politique des gros sous, nous avons en haine les doctrines des hommes d’état du xviie siècle ; et que les colonies coûtent ou ne coûtent pas à la France, qu’elles lui soient ou ne lui soient pas onéreuses, nous les aimons ; nous voulons que l’on ne s’en sépare pas, et nous les défendrons toujours, parce qu’elles sont françaises. Il y a quelque chose de monstrueux à dire, comme il a été dit, que les colonies ayant été instituées pour l’avantage des métropoles, l’avantage des métropoles doit prévaloir au détriment de tout intérêt colonial. On oublie beaucoup trop, il nous semble, en tout ceci que les créoles ne sont pas des vaincus, que les colonies ne sont pas des pays conquis, mais bien des terres peuplées de nos parens et de nos compatriotes, qui sont allés s’y établir sous la foi du pacte commun. Le quart au moins de la population blanche des îles est composé d’Européens français, le reste de colons français. Traiter de l’abandon possible de la Guadeloupe et de la Guyane ou de [xvi] l’abandon des départemens des Vosges et du Cantal, à nos yeux c’est tout un. En parlant « de ces petites îles dont la majorité des habitans ne sont pas Français, » un général trop célèbre a proféré une hérésie politique ; les habitans de la Martinique sont aussi Français que les habitans de sa commune.
Celles des colonies que l’odieux régime impérial nous a laissées, par la raison seule qu’elles font partie de la France, ont droit à la prospérité ; et cette prospérité étant, à notre avis, uniquement dans la belle culture de la canne, nous nous déclarons ennemi du sucre de betterave. Un tel motif nous suffit, et nous ne nous croyons pas obligé de rentrer dans une discussion déjà épuisée. Le fait des cent mille hectares enlevés dans le département du Nord aux céréales, pour les livrer à la betterave, nous semble peu grave, quelqu’importance qu’on ait voulu lui donner, il n’entre pour rien dans notre opinion. La betterave ravirait cent mille hectares de plus aux céréales, si on la jugeait utile à nos intérêts, qu’il resterait toujours assez de terres bonnes au blé pour en obtenir la farine nécessaire à la nourriture du pays. Ce n’est point non plus parce que la France ayant le monopole de l’approvisionnement de ses possessions d’outre-mer, il est rigoureusement juste qu’elle leur conserve le monopole du sucre, parce que fermant à leurs produits les marchés étrangers, c’est un devoir impérieux de leur assurer un placement avantageux sur le marché métropolitain ; ce n’est point par de telles causes que nous sommes déterminé, car toutes ces barrières peuvent être levées ; [xvii] c’est parce que le sucre est le seul mode d’existence possible pour les colonies, parce que le cacao, le girofle, le café, le coton même et le mûrier qu’on tente d’introduire, n’y peuvent être qu’accessoires.
Les deux sucres rivaux en présence, se nuiront toujours l’un à l’autre, ils se ruineront l’un par l’autre, car ensemble, ils produiront toujours plus que la consommation. À quoi bon se troubler l’esprit pour chercher à pondérer leur concurrence ? L’égalité des droits n’est qu’une déception de transigeur timide. Quel avantage tirerait le pays de cette lutte funeste aux intérêts particuliers ? Veut-on entretenir la betterave pour s’en faire une barrière aux exigences impérieuses de la canne, ou pour combattre l’apathie routinière des planteurs ? Le sucre étranger suffit de reste à cette fonction, il ne laissera jamais les colonies maîtresses d’imposer à la France leurs produits aux taux qu’elles voudraient fixer arbitrairement. Ce n’est pas nous que l’on peut croire disposé à laisser peser sur le pays des taxes au profit d’un petit nombre de privilégiés ; il sera toujours temps, si cela devient nécessaire, de fixer le prix du sucre légalement comme on fixe celui du pain, pour maintenir cette indispensable denrée à portée du pauvre. Il faut se résoudre à tuer une des deux industries similaires, car il n’est d’aucune nécessité politique ni économique qu’elles subsistent toutes deux. Et comme le sucre indigène n’est pas une condition de vie pour la métropole, tandis que le sucre exotique est une condition de vie pour ses colonies, comme le sucre indigène ne peut que compro [xviii] mettre l’existence du sucre exotique ; nous disons qu’il faut détruire le sucre de betterave avec indemnité pour les fabriques métropolitaines [7]. Plus tard nous espérons prouver que la France, que le consommateur français, n’auront que profit à cette équitable mesure, rattachée à l’affranchissement et à un système colonial large, intelligent, bien entendu.
Les déclamations ignorantes et honteuses des anti-abolitionistes ne sauraient, en nous passionnant contre eux, nous empêcher de reconnaître la vérité. C’est une erreur de prétendre que les produits coloniaux sont des produits exotiques (ce mot pris dans le sens d’étrangers) qui doivent être sacrifiés en bonne économie aux produits nationaux. Encore une fois nos colonies sont des provinces françaises d’outre-mer, et leur industrie agricole est aussi nationale que celle de la fabrique de Paris. Le pavillon qui flotte sur les créneaux de la Pointe-à-Pitre, de Fort-Royal, de Cayenne ou de Saint-Paul, est le même que celui qui flotte aux tours de Notre-Dame. C’est donc bien une erreur que d’appeler les denrées coloniales des produits étrangers. Si l’on veut nommer les choses avec rigueur grammaticale, il faut les appeler des fruits exotiques na [xix] tionaux. En s’exprimant d’autre façon, on légitime une certaine prétention familière aux créoles, qui disent que leurs droits sont mal appréciés, parce qu’ils sont mal connus.
IL est une objection à la destruction des fabriques de sucre indigène, qui ne doit pas être dédaignée, parce qu’elle est venue d’amis sincères du pays. Qu’arrivera-t-il, ont-ils demandé, si une collision éclate en Europe et intercepte les voies à nos produits coloniaux ? Faudra-t-il encore, comme sous l’empire, payer le sucre six francs la livre ? Ne regrettera-t-on pas alors d’avoir ruiné une industrie nécessaire ? — Ce serait ici le cas de dire, puisqu’il est question du peuple français :
Je ne sais pas prévoir le malheur de si loin.
Mais ne soyons point si superbe, c’est d’économie industrielle qu’il s’agit ; disons simplement : de telles craintes sont vaines et sans fondement. — L’état actuel de l’Europe ne permet plus de redouter ces guerres désastreuses qui engageaient tous les peuples les uns contre les autres. Si notre marine militaire ne savait pas défendre et convoyer notre marine marchande, nous aurons les neutres, empressés à venir approvisionner nos marchés, parce qu’ils y trouveront intérêt ; et, en supposant le cas le plus extrême, on sera toujours à temps quoi qu’il arrive de rétablir les sucreries métropolitaines. Les champs sont là, les procédés sont connus, les machines ne sont pas longues à construire, et dans un pays comme le nôtre, une année ou deux [xx] suffiraient à mettre la production indigène en rapport avec la consommation.
Bonaparte à toujours sacrifié les intérêts maritimes de la France à son développement militaire ; égoïste comme il l’était, il n’a pas voulu de la gloire navale qui pouvait faire ombre à la sienne : il a fait déchoir là France, comme puissance maritime, et après avoir sordidement vendu la Louisiane, après avoir perdu Saint-Domingue, la reine des Antilles, par ses tentatives liberticides, il nous a mis hors d’état de revendiquer nos droits sur des îles qui ne sont plus à nous, quoiqu’elles nous appartiennent [8]. La France en est réduite aujourd’hui à quatre colonies à cultures [9]. Loin de les sacrifier, c’est un devoir pour elle de les conserver, car elles lui sont bonnes comme points militaires, comme asile et lieu de ravitaillement pour sa marine de guerre, aussi bien que pour sa marine marchande. Elles lui peuvent devenir d’un immense avan [xxi] tage commercial, si une fois l’on voulait s’en occuper, si l’on voulait y appliquer un système éclairé d’administration.
Les colonies grecques, on le sait, ne furent fondées que par des migrations de leurs métropoles, auxquelles on accordait toutes les faveurs de la cité. Le souverain et véritable principe des colonies n’est point d’être exclusivement utiles à leur métropole, mais bien d’être utiles et d’offrir un séjour propice à ceux des enfans de la mère-patrie qui vont s’y établir. Voilà leur réelle destination politique et économique ; voilà aussi la source la plus sûre de leur prospérité, de leur grandeur. Nos colonies n’ont pas le quart de la population qu’elles peuvent contenir ; l’esclavage a dévoré les masses énormes de nègres que la traite y avait jetées ; un tiers seul du sol cultivable est en exploitation. N’est-ce pas une chose qui ferait sourire de pitié le plus vulgaire citoyen d’Athènes, s’il en pouvait revenir un au monde, de voir que nous possédons là-bas des plaines immenses, ou la générosité de la nature sollicite des bras qui lui manquent, tandis que le trop plein continental arrive jusqu’à la pléthore avec tous ses symptômes de désorganisation et de souffrance !
Le pouvoir, au sein d’une nation mécontente, ne se soutient que par le moyen artificiel de la peur qu’inspirent les révolutions à une bourgeoisie égoïste. Il emploie toutes ses forces à se conserver. La France, loin de recevoir de lui les inspirations qui l’agrandiraient, est sans cesse occupée à combattre ses tendances envahissantes, Si nos hommes d’État avaient de l’am [xxii] bition pour elle, au lieu d’en avoir pour eux-mêmes, ils tourneraient les yeux vers les colonies. Nulle politique ne serait plus à propos que celle qui, encourageant et protégeant les émigrations d’outre-mer, dégorgerait la métropole d’une population dont le sort misérable fait sa honte et son inquiétude.
« Tous les ans plusieurs milliers des enfans de la France passent les mers ; les États-Unis les accueillent ; ils vont fertiliser, au profit des Américains ; les nouveaux États de l’ouest. C’est une recrue de consommateurs que nous fournissons aux manufactures anglaises ; quand il serait si facile de détourner l’émigration et de conserver à la France ses enfans, à notre industrie des consommateurs, à nos colonies des bras dont elles ont besoin. Chaque émigrant qui se dirigerait vers nos colonies, non seulement irait créer sur un sol français une richesse nouvelle, mais il augmenterait par ses consommations l’étendue du marché national. Et qu’on n’essaie pas d’opposer aux colonies le commerce étranger. Sans parler de la concurrence formidable que nous rencontrons sur toutes les places étrangères, et des caprices de la diplomatie commerciale ; il est prouvé qu’à part même tout monopole exclusif, les populations coloniales ont toujours une préférence marquée pour les produits de la mère-patrie, C’est ainsi que quelques colons français, malgré la triste condition que leur ont faites les institutions coloniales, l’état arriéré de leur industrie et l’absence complète de moyens de crédit, consomment tous les ans pour [xxiii] quarante-huit millions de marchandises françaises. C’est ainsi que malgré la scission politique qui a séparé les États-Unis de l’Angleterre, l’Amérique du nord est encore aujourd’hui le plus important débouché de l’industrie anglaise. »
Rien de plus juste, rien de plus vrai que ces réflexions, que nous empruntons à un autre [10], parce qu’elles expriment toute notre pensée mieux que nous ne le ferions nous-même. On ne peut envisager, sans en être saisi, les bénéfices d’une émigration bien réglée aux colonies. Elle développe les immenses avantages dont elles sont susceptibles, elle en fait des points sûrs, vigoureux, armés d’une population active en état de les défendre presque seule contre nos ennemis. Les émigrans attirent les compagnies financières avec leurs fertiles capitaux ; ils appellent la science, qui vient aider la culture tropicale des merveilleux procédés qu’elle découvre chaque jour [11] ; ils mettent en exploitation les terres délaissées ; ils doublent, triplent, quadruplent les produits coloniaux, le nombre des navires employés à leur transport, celui des matelots qui les portent, [xxiv] et par suite les revenus que la douane en extrait ; enfin recevant de leurs peines une rétribution plus équitable qu’en Europe, il deviennent pour l’industrie métropolitaine des consommateurs aisés, multipliés ; et les ouvriers de France ne gémissent plus sans travail devant des monceaux de produits sans issues. — L’industrie métropolitaine, la marine marchande, la marine de l’état, les hommes, les choses et la morale, trouvent à gagner dans cet heureux mouvement.
Hélas ! de long-temps encore, rien de ce splendide avenir ne se réalisera. Long-temps encore le gouvernement de France, livré aux mains qui l’avilissent, exercera vis-à-vis des colonies à peu près le rôle de ces proconsuls romains qui étouffaient les pays conquis sous leur inique protection ; et les Français ne pourront songer à leurs terres tropicales !
Il n’est pas plus dans le génie de la nation anglaise que dans le nôtre, d’aller peupler toutes les parties du monde, et de hasarder de gros capitaux en de lointains pays. Ce qui contribue à rendre nos voisins faciles à ces entreprises hardies, c’est que leur métropole fait tout pour les y encourager. Quelque part qu’ils aillent, il sont assurés de trouver des consuls et des agens pour les protéger, d’y sentir la main de la mère-patrie qui veille sur eux, d’y avoir des moyens de communication avec elle. Un Anglais établi au Mexique, à la Havane, au Brésil, aux Antilles, dans l’Inde, en Amérique, dans la Guyane, partout, sait à huit jours près quand il recevra ses journaux de Londres. Deux fois par mois, mille vaisseaux sillonnent les [xxv] mers, sans autre objet que de lui porter des nouvelles de sa ville. Il y compte, il s’appuie sur cette confiance, les relations intimes ne sont point brisées ; il sait ce qui se passe at home, et ces rapports continuels sont des soutiens qui ne l’abandonnent jamais.
On applique la vapeur à la navigation transatlantique, le commerce hasarde sur les vastes mers quelques steamships. À peine cette nouvelle voie est-elle ouverte que le gouvernement anglais s’en empare, passe rapidement des traités, et à l’heure où nous écrivons, un service à vapeur pour le transport des malle-postes et des dépêches de l’état sillonne déjà l’Océan, excite l’admiration des amis comme des ennemis, et par sa rapidité magnifiquement organisée met les principaux points du globe et les frères émigrés à quelque jours de distance de l’Europe !
Le Français qui s’embarque, au contraire perd tout ; il est perdu lui-même, il marche vers un long exil. Ceux qui dirigent nos affaires voient nos petits morceaux de chemin de fer centupler le nombre des voyageurs, un simple service régulier de voitures établi d’une commune à l’autre l’industrie, éclairer les hommes, améliorer tout, et ils ne comprennent pas de quel avantage de tels moyens nous seraient sur les mers. Le voudra-t-on croire, la France n’a pas même une ligne de paquebots avec ses colonies ! Ce sont les Anglais qui portent nos dépêches et nos lettres à Saint-Pierre ou à la Basse-Terre !! C’est par une telle ineptie administrative qu’il faut expliquer la médiocrité de notre commerce maritime. C’est par ce [xxvi] défaut de relations réglées et solides, par cette indifférence pour les enfans du pays qui vont tenter la fortune au dehors, que nous avons perdu (pour citer un exemple) l’immense débouché que nous offrait le Mexique. Nos nationaux à force de s’y voir livrés à eux-mêmes ont quitté la partie, et avant que la dernière expédition militaire, si tardivement entreprise, si détestablement conduite, eut achevé de nous ruiner pour toujours dans ces contrées, leur commerce était échu aux Anglais et aux Américains du nord, quoiqu’individuellement les Mexicains nous préférassent beaucoup à nos antagonistes, et pour notre caractère et pour notre qualité de christianissimos.
Le gouvernement a semblé vouloir jeter un instant les yeux sur cette grave question ; on a parlé de lignes à vapeur. Mais qu’a-t-on fait ? Selon l’usage, les choses ont été remises à l’examen d’une commission, et Dieu sait ce que font les enquêtes chez nous ! Les Anglais auront des steam-packets sur toutes les routes de l’univers, que notre commission n’aura pas rédigé son rapport. Et cependant Marseille, Bordeaux, le Havre, ont offert de créer des lignes à leur propre compte si l’on voulait seulement les aider ! Mais l’administration, avec ses désirs de tout absorber, veut conserver la direction et l’exploitation d’une pareille entreprise, et songe à disposer les paquebots en bâtimens de guerre pour s’en servir dans un cas donné. L’idée nous paraît mauvaise. Construisez des bâtimens de guerre à vapeur tant que vous pourrez, cela est sage, mais laissez au commerce ses navires de com [xxvii] merce avec leur rapidité nécessaire, que vous ralentirez en voulant les rendre propres au combat. Les choses à deux fins ne sont jamais bonnes. En diminuant la vitesse, vous perdez la possibilité d’entrer en concurrence avec nos rivaux. Mais quoi que vous décidiez, au nom du pays décidez promptement. Ce qui peut multiplier et régulariser nos relations avec l’étranger, mérite plus que jamais considération. Vivifiez par tous les moyens imaginables notre commerce extérieur pour augmenter notre force extérieure. Le pavillon anglais couvre une navigation de trois millions de tonneaux, le pavillon français n’en protége pas plus de six cent mille. Jugez. M. Reybaud qui est une autorité dans toutes ces questions, a démontré [12] que c’est dans le fait décisif des cent soixante mille matelots formés par la marine marchande des Anglais, que réside la supériorité de leur marine militaire. Nous n’en avons nous que cinquante-six mille bons à mettre sur les vaisseaux de l’état un jour de guerre [13] !
C’est ainsi que le développement de nos colonies qui [xxviii] sont des marchés tout créés, de larges débouchés tout ouverts, serait à la fois une œuvre nationale propre à nous mettre en état de reprendre notre niveau comme puissance maritime.
Ceci nous ramène à l’émigration tropicale qui peut, avec une protection éclairée, tripler rapidement l’importance de nos possessions d’outre-mer. Outre les moyens que nous avons déjà indiqués, pour l’encourager et la provoquer, il faut que le sort fait aux colonies ne leur rende point onéreux les échanges qu’elles feront avec la métropole, il faut qu’elles puissent y trouver avantage, et que le gouvernement veille lui-même à ce que les marchandises qui leur sont imposées soient toujours de la meilleure qualité.
Une servante de Fort-Royal qui attachait quelque chose devant nous, prit une feuille d’épingles, et deux ou trois de ces épingles s’étant courbées l’une après l’autre, se prit à dire : « Oh ! ce sont des épingles françaises ». Il n’est que trop vrai, c’est-là un cri spontané hors d’Europe. La manufacture française, même dans les colonies françaises, est déshonorée. Il suffit aux revendeuses foraines qui courent les habitations de dire à un nègre que telle marchandise est anglaise, pour qu’il la prenne de préférence à la nôtre. Les maîtres, de même. Houes [14], chaînes d’attelage, coutelas [15], ils achètent tout de contrebande à prix double, lassés [xxix] de payer à leurs compatriotes des instrumens qui se brisent ou se tordent après huit jours de service. Nous avons vu, en visitant les magasins de commission de la Dominique, des houes et des coutelas d’une forme spéciale que l’Angleterre fabrique exprès pour nos colonies, où elles entrent en fraude. C’est un fait honteux à dire, mais d’une triste authenticité. La détestable qualité des produits de fabrique française a considérablement nui à notre commerce d’exportation ; la pacotille nous cause sur les marchés étrangers un mal qu’on ne saurait imaginer, et le mot trop commun dans nos ateliers : « Bah ! c’est assez bon pour les colonies, » nous a ravi bien des millions. La mauvaise foi la plus effrontée, préside malheureusement aussi à nos envois au dehors. La parfumerie française est une branche considérable du trafic interlope de nos colonies avec les West-Indies, car les Anglais qui font de nous tous autant de petits maîtres musqués usent dix fois plus de pommades et de senteurs que les Français. J’ai vu sur leurs toilettes des pots de pommade fabriqués de telle manière qu’ils n’avaient pas six lignes de contenu, quoiqu’ils eussent en réalité trois pouces de hauteur. C’est vendre un morceau de faïence pour de l’essence de jasmin.
Il faudrait au contraire que toute marchandise qui sort de France fut particulièrement soignée et expédiée avec la plus rigoureuse probité. Il n’y a pas d’autres moyens de rétablir notre crédit. Puisque nos fabricans entendent si mal leurs devoirs d’honnêtes gens et leurs intérêts de manufacturiers, il serait opportun [xxx] d’établir aux frontières des bureaux d’examinateurs à la qualité des objets exportés, avec droit de détruire toute chose reconnue mauvaise, comme on coule chez les marchands de vin leurs liquides frelatés. Nous voudrions, en outre, que le nom de l’expéditeur déloyal fût signalé dans les journaux, comme celui des boulangers qui vendent à faux poids. Il y va tout ensemble des intérêts du commerce extérieur, et ce qui est plus précieux encore, de l’honneur national.
§ II.
Utopie, vont dire quelques-uns. Les Européens ne peuvent cultiver les pays tropicaux. Erreur, pouvons-nous répondre. Ceux qui la professent oublient ce que l’histoire rapporte sur la fondation des colonies. Un coup-d’œil jeté en arrière suffit pour expliquer ces craintes et les dissiper.
Lorsqu’en 1635, MM. D’énambuc quittant Saint-Christophe où les Français étaient établis depuis 1625, songèrent à la Martinique : comment y vinrent ils ? « Avec cent hommes braves, bien acclimatés, défricheurs expérimentés, et pourvus de tout ce qui était nécessaire pour y former des habitations. » Lorsque les lieutenans de MM. D’énambuc, Lolive et le chevalier Duplessis, prirent possession de la Guadeloupe la même année ; par qui étaient-ils accompagnés ? Par cinq cent cinquante personnes, dont quatre cents, est-il dit, « étaient des laboureurs qui, moyennant leur passage gratuit, s’étaient engagés à travailler pendant trois années pour [xxxi] le compte de la compagnie des îles de l’Amérique qui les avait embarqués. »
La canne à sucre fut mise en plantation réglée, à la Guadeloupe, vers 1644. Boisseret acheta cette île en 1649, pour une somme nette de 60,000 livres et six cents livres de sucre par an. À la Martinique, la canne à sucre fut introduite en 1650.
Lorsqu’en 1674 la Martinique fut réunie au domaine de l’État, elle était en pleine voie de culture, et produisait déjà du tabac, du coton, de l’indigo et du sucre.
Les colons, à cette époque, formaient deux classes. La première, composée de ceux qui étaient venus à leurs frais, on les appelait habitans ; ils possédaient des terres que le gouvernement local leur avait accordées en toute propriété, moyennant une redevance de tabac, de coton et de sucre.
La seconde classe se composait d’Européens pauvres, attirés aux îles par l’espoir d’y faire fortune. Sous le titre d’engagés, ils étaient contraints de travailler pendant trois années consécutives sur les plantations des colons qui avaient payé leurs frais de passage. À l’expiration de l’engagement, ils recevaient, pour la plupart, des concessions gratuites de terrain.
Ainsi, d’après ces détails, que l’on peut trouver dans le père Dutertre et le père Labat, on le voit très évidemment, les colonies furent défrichées et mises en culture par des Européens. Depuis 1625 à Saint-Christophe, depuis 1635 à la Guadeloupe et à la Martinique, jusqu’en 1738, c’est-à-dire un siècle durant, ce sont [xxxii] des blancs, et des blancs d’Europe qui exploitent ces terres plus redoutées que redoutables. Dans les lettres d’établissement de la première compagnie française d’outre-mer, celle dite des îles de l’Amérique, créée en 1626, il n’est aucunement question d’esclaves comme laboureurs ; on n’y parle que d’Européens.
On associa de bonne heure aux engagés, des nègres de traite, nous le savons. On en voit à Saint-Christophe, en 1659 ; à la Martinique, en 1642 ; mais ils étaient fort peu nombreux. Le trafic des noirs ne commença à prendre sa meurtrière extension que vers 1644, époque à laquelle l’édit du 28 mai, en constituant la Compagnie des Indes-Occidentales, lui octroyait le privilège exclusif de la traite, depuis le cap Vert jusqu’au cap de Bonne-Espérance. Mais la traite fournissait encore si peu de travailleurs en 1719, que les créoles ayant peine à trouver des engagés volontaires, une déclaration du roi, du 2 mai de cette année, ordonna que les vagabonds et gens sans aveu seraient transportés aux colonies pour y travailler comme engagés. Ce ne fut qu’en 1738 que le nombre des esclaves s’étant accru d’une manière suffisante, on mit un terme à ces expéditions que le roman de Manon Lescaut a rendues célèbres.
Mais si les Européens étaient propres à la culture des colonies, pourquoi songea-t-on à y employer des nègres ? C’est que la soif de l’or est insatiable, barbare, impitoyable, et qu’après avoir épuisé la race rouge dans des travaux excessifs, on voulut avoir d’autres instrumens dont les maîtres pussent disposer sans que per [xxxiii] sonne s’intéressât à eux, sans que l’Europe, en se voyant dévorer ses propres enfans, demandât compte de ce qui se passait aux îles.
Le sort des engagés était aussi affreux que celui des nègres ; on les battait comme les nègres, on excédait leurs forces comme celles des nègres, et le grand nombre d’entre eux qui périrent, moururent victimes des mauvais traitemens qu’on leur imposait, et non des fureurs du climat. — Au moment où le père Labat arrive à son couvent, il rencontre un engagé nommé Massonnier qui était venu aux îles sur le même navire que lui. « Guillaume Massonnier était fort épouvanté, il avait appris que la condition des engagés, dans les îles, était un esclavage fort rude et fort pénible, qui ne différait de celui des nègres que parce qu’il ne dure que trois ans. » Le père Labat n’eut pas dit de quelle façon étaient traités les engagés que les vieilles ordonnances nous attesteraient qu’à cette époque on ne faisait guères de différence entre eux et les esclaves. Nous trouvons dans un règlement du conseil de la Martinique, du 2 mai 1666, « qu’il leur est défendu de faire les mutins et les insolens, et qu’il est permis aux habitans de les châtier comme gens à leurs gages ; avec défense à ces gens de s’en plaindre et de discontinuer pour cela leur ouvrage. »
Les Anglais n’en usaient pas mieux avec leurs engagés. Labat, qui les vit lors de son voyage à la Barbade (1700), en parle de la sorte : « Leurs engagés sont en grand nombre, mais il n’y faudrait pas beau [xxxiv] coup compter dans une occasion, parce que la plus grande partie sont de pauvres Irlandais enlevés par force ou par surprise, qui gémissent dans une dure servitude de sept ou de cinq ans au moins, qu’on leur fait recommencer quand elle est finie, sous des prétextes dont les maîtres ont toujours une provision toute prête. »
Les engagés soumis à un pareil destin, après une traversée longue et très pénible, seraient morts bien vite, partout autre part qu’aux colonies. Les nègres succombaient en aussi grand nombre qu’eux. C’est une complète erreur de supposer que nos îles aient obtenu, sans sacrifices, à part même les exécrables forfaits de la traite, la population de travailleurs qu’elle possède aujourd’hui. Les nègres paient à une modification de température, à peu près le même tribut que nous, et malgré leurs vieilles relations avec le soleil, les nouveaux-venus noirs, lorsqu’on ne les soigne point avec ménagement, ne résistent pas plus que les nôtres à la chaleur humide des colonies. Nous avons l’autorité d’un médecin distingué de la Martinique, M. Rufz, pour affirmer que les nègres ne sont pas plus que les blancs à l’abri des influences des Antilles, et que leur acclimatement, mal dirigé, a coûté aussi cher que pourrait coûter celui des blancs. Les noirs sont peut être plus sensibles que nous encore à un changement atmosphérique ; ils se font au quartier où ils naissent, et lorsqu’on les déplace, ils ne réussissent pas, selon l’expression créole, ce qui veut dire en bon français qu’ils meurent. Les partisans les plus déterminés de l’escla [xxxv] vage reconnaissent que la mortalité des nègres nouveaux est considérable, et confessent que « malgré les dangers de la fièvre jaune, la mortalité des blancs qui viennent aux colonies est beaucoup plus faible, proportionnellement, que celle des esclaves importés d’Afrique [16]. »
Le climat des Antilles est-il aussi mauvais que sa réputation ? Nous avons des raisons de ne le pas croire. Les vapeurs de l’Océan, continuellement amoncelées autour des pitons et au-dessus des bois qui les couronnent, y occasionnent des pluies continuelles qui, jointes à l’ardeur d’un soleil brulant, y entretiennent une excessive chaleur humide. Cette moiteur en relâchant la fibre musculaire, a certainement une grande influence sur l’économie animale des Européens récemment débarqués. La subite transition de cette atmosphère à l’atmosphère sèche et froide dans laquelle ils vivaient, doit nécessairement agir d’une manière directe sur leurs organes ; mais la perturbation produite ne devient funeste que parce qu’ils ne savent pas en combattre les effets dangereux.
La vie humaine est détruite aux colonies par trois causes principales : la débauche, la peur et l’ignorance des soins hygiéniques indispensables.
Les gens qui arrivent négligent les moyens d’accoutumer leurs organes à la nouvelle température au [xxxvi] sein de laquelle ils fonctionnent. Loin d’entretenir une transpiration égale, la chaleur leur fait rechercher ces vifs courans d’air que ménage la construction des maisons combinée avec les brises, les pores se referment, la transpiration arrêtée amène la pleurésie, ils meurent, et l’on accuse le climat d’être pestilentiel. Non, c’est vous qui avez été maladroit en ne sachant point aider à votre constitution.
Une vieille erreur très commune, est aussi extrêmement funeste aux Européens. On est convenu que pour corriger la lassitude et la langueur que donnent les pays chauds, il est bon de boire quelque cordial. On prend le cordial appelé rhum qui est fort abondant aux colonies, et comme on y trouve plaisir, on en prend beaucoup, si bien que l’économie, maintenue dans un état de surexcitation continuelle, et la débilité s’accroissant par l’usage répété du tonique, l’homme est préparé comme à dessein, pour l’envahissement de la fièvre jaune. On a suivi le régime précisément opposé à celui qu’il fallait suivre. — En se rendant compte des législations, on y peut trouver des indications sûres pour certaines règles de conduite. Grand nombre des lois religieuses de l’antiquité qui paraissent fort ridicules à ceux qui n’y regardent pas de près, contiennent des préceptes hygiéniques appropriés aux climats, que les individus devraient observer. Moïse, en défendant aux Israélites de manger du porc, savait que l’usage de la chair de porc, en Orient, donne la lèpre. Mahomet en interdisant le vin et les liqueurs aux croyans, imitait sans le savoir une loi de Carthage [xxxvii] qui faisait la même défense aux Carthaginois [17]. Ceci veut dire que les législateurs avaient reconnu que dans les pays chauds les liqueurs sont contraires à la santé. Donc, au lieu de les rechercher, il est sage de s’en abstenir.
Or c’est l’intempérance surtout qui est le premier agent de destruction, c’est dans l’ivresse que le plus grand nombre des malheureux moissonnés par la fièvre jaune puisent le principe du mal qui les tue. Sur qui en effet sévit-elle particulièrement ? Sur les soldats de la garnison ; gens qu’un concours de circonstances déplorables, jointes aux mauvaises habitudes du peuple, semblent dévouer à la mort. — Par une fatalité extraordinaire, chez nos voisins comme chez nous, l’administration ne prend aucun soin de paralyser les dangers de la position. Plutôt que de choisir des hommes d’élite, d’un caractère fait et d’un esprit bien trempé, on n’envoie aux colonies que de jeunes soldats, encore sans expérience. Ils abordent, tremblans, la constitution ébranlée par les souffrances de la traversée, le moral affaibli par les impressions nostalgiques et par la terreur que leur causent les idées reçues sur le soleil meurtrier des Antilles. On croit avoir pris assez de soins pour leur acclimatement quand on leur a fait passer trois mois à la campagne, et on les jette ensuite dans les cités, seuls foyers de l’infection. En cet état le moindre excès ouvre entrée à la maladie qu’ils redoutent, et les voilà à l’hôpital, atteints de la [xxxviii] fièvre ou de la dyssenterie. L’hôpital, où est-il situé ? Au milieu des villes, où la chaleur, l’agglomération d’un grand nombre d’individus, les émanations d’un littoral insalubre rassemblent tous les principes constitutifs du fléau. Mais là, qu’arrive-t-il ? Par quelles causes ces terribles maladies deviennent-elles aussi souvent mortelles qu’elles le sont ? De quoi se plaignent tous les médecins ? C’est qu’au lieu d’y suivre un traitement régulier, les malades en s’y livrant encore à leurs grossiers appétits, rendent toute guérison impossible. Ces pauvres gens regardent la diète à laquelle on les condamne comme une économie que l’on veut faire à leurs dépens, ils demandent et reçoivent vivres et boissons du dehors ; ils mangent des fruits, boivent du tafia, meurent, et l’on dit : c’est le climat ! — Il y a des années que les médecins signalent le danger, mais l’apathie créole n’a pu découvrir jusqu’ici le moyen de prévenir l’introduction clandestine des vivres dans les hôpitaux.
À la Jamaïque, c’est mieux encore. Sous prétexte d’éloigner les soldats du danger de la capitale, on les a casernés à une lieue de là. Ils viennent en ville pendant le jour, ils boivent du rhum, toujours du rhum, jusqu’à la dernière minute qu’ils ont de loisir, puis ils courent afin d’être rendus à l’heure, ils arrivent tout échauffés, répondent à l’appel, ôtent ensuite leur habit pour se rafraîchir, prennent froid et le lendemain ils se réveillent mourans. Il faut les transporter à l’hôpital. Mais où a-t-on bâti ce magnifique hôpital qui a coûté 180,000 liv. sterl. ? À Fort-Royal, sur une lan [xxxix] gue de terre qui ferme la rade, entourée d’eaux stagnantes et de marais qui en font le lieu le plus malsain de la colonie. Le malade amené là aujourd’hui, expire le lendemain, et l’on dit toujours : c’est le climat !
Quand nous visitâmes cet hôpital, un régiment qui venait d’arriver y remplissait tous les lits, et chaque jour envoyait cinq morts au cimetière. Est-ce donc le climat qui les tuait ou bien les funestes circonstances dans lesquelles on les avait placés ? — Est-il étonnant que les régimens perdent ainsi un quart de leur monde en quinze mois ? Ne prépare-t-on pas ces hécatombes au Dieu fièvre pour le plus grand effroi de ceux qui en Europe entendent parler de ses ravages ? Si on les avait cherchés pourrait-on trouver de meilleurs moyens pour organiser les effets destructeurs des influences épidémiques.
Les gouvernemens ont trop accepté la fièvre jaune comme un mal inévitable, et ne l’ont pas assez combattue comme un mal guérissable. Ils y soumettent les populations sans préservatif, et le monstre dévore d’autant plus de victimes, qu’on lui en présente un plus grand nombre de désarmées. Une première mesure très importante serait de réagir contre cet esprit de concession.
Il n’est pas vrai que la nature ait condamné l’homme à payer un tribut humain au minotaure des Antilles.
« La mort que les Européens trouveraient en travaillant sous le soleil des tropiques, a écrit le docteur John Hancock, est une relique de l’antiquité. Les anciens croyaient que les régions équatoriales étaient [xl] absolument inhabitables, avec autant de raison qu’ils regardaient les îles britanniques comme les confins du monde occidental. Un séjour de vingt-cinq ans passés dans les colonies, m’a convaincu par expérience qu’il n’est pas de contrée où quelqu’un avec un régime approprié au climat et à sa constitution personnelle, puisse vivre avec plus de sécurité et meilleure santé qu’à la Guyane [18]. Jamais idée plus fausse n’a été accréditée, que celle de croire que les personnes du nord ne peuvent cultiver sous la zône torride [19]. »
La vérité est que l’on diminuerait singulièrement l’action malfaisante du soleil des Antilles, si l’on s’attachait à détruire dans l’esprit des populations occidentales les craintes qui leur deviennent mortelles, en débilitant leur esprit, et si l’on combattait les penchans vicieux qui affaiblissent leurs corps. Qu’on nous comprenne bien. Nous ne disons pas du tout que la fièvre jaune n’existe pas, au contraire, c’est un ennemi vigilant ; mais nous disons qu’elle a le plus ordinairement peur de ceux qui n’ont pas peur d’elle, et qu’il est possible de lui opposer la sobriété avec un succès presque toujours certain.
Cette opinion s’établirait solidement, si l’on voulait en outre secouer la vieille et funeste erreur qui fait de la fièvre jaune une maladie contagieuse. M. le docteur Chervin, un de ces martyrs de la vérité, qui consacrent [xli] une existence toute entière à la constatation d’un fait utile, a daigné nous communiquer la formule des propositions qu’il va soutenir dans un nouveau travail sur cette matière. Nous sommes heureux de pouvoir les mettre d’avance sous les yeux du public.
« 1o La maladie que l’on a désignée sous le nom de fièvre jaune dans l’Amérique équinoxiale, dans l’Amérique du nord et dans le midi de l’Europe, est identique et ne présente aucune différence essentielle.
2o Elle n’est point une maladie sui generis, mais simplement le maximum d’intensité des fièvres bilieuses automnales des pays chauds, ou des saisons chaudes dans les régions tempérées.
3o Elle n’est transmissible de l’individu qui l’a à celui qui ne l’a pas, d’aucune manière quelconque.
4o L’encombrement des hôpitaux par les malades de la fièvre jaune, quelque grand qu’il ait été, n’a jamais produit jusqu’ici une infection capable de donner naissance à cette maladie ; en viciant l’atmosphère il a seulement dans certains cas aggravé l’état des malades qui s’y trouvaient plongés.
5o La fièvre jaune ne tire donc son origine ni des malades, ni de leurs vêtemens, mais bien des effluves qui s’exhalent des substances végétales ou animales en putréfaction, secondés par certaines conditions météorologiques.
6o La cause de cette maladie ne paraît différer de celles des fièvres bilieuses ordinaires que par un plus haut degré de concentration. Elle nous est d’ailleurs tout aussi inconnue dans sa nature que celles de ces fièvres.
[xlii]
7o Cette cause locale productrice de la fièvre jaune, peut se rencontrer à bord des bâtimens qui couvrent les mers, tout comme à terre.
8o La fièvre jaune n’étant point contagieuse, toutes les mesures de précaution dirigées contre elle sont en pure perte, et doivent par conséquent être supprimées. On peut remédier à l’infection des bâtimens par des moyens hygiéniques très simples, qui offriront à la santé publique toutes les garanties désirables, et n’entraveront point le commerce comme les mesures dites sanitaires actuellement en vigueur. »
Ces huit propositions sont le fruit de dix années d’études aux colonies et dans les Amériques, elles résument la longue expérience d’un savant honnête, et ses nombreuses recherches sur l’origine, le mode de propagation et la nature de la fièvre jaune.
Combien le gouvernement ne sauverait-il pas de victimes, si par l’adoption ouverte de ces doctrines il rendait la confiance aux esprits ! « Les funestes effets produits par la crainte de la contagion, dit encore M. Chervin, ne se bornent point aux malades, ils s’étendent aux personnes saines que cette crainte prédispose à un haut degré à l’influence épidémique. Tel aurait résisté à l’action de l’agent délétère, s’il eut été persuadé que la contagion est nulle et que l’approche des malades n’augmente point le danger, qui a été victime de l’opinion contraire [20]. » [xliii]
Que l’on médite ces vérités, que l’on sache s’en convaincre et l’on aura, en menant une vie régulière, de grandes chances d’échapper au fléau ; nous le répétons, la fièvre jaune attaque surtout les gens d’une vie déréglée, celles qui se livrent à des excès. Les personnes fermes et de mœurs régulières, lui échappent presque toujours.
Ceux qu’elle abat sont les viles proies de la débauche, bien plus souvent que les innocentes victimes d’un fléau cruel.
Ce n’est pas à dire qu’il faille faire des émigrans autant de disciples de Pythagore ; ce que nous demandons c’est la modération qui, dans tous les pays du monde, est une sauvegarde de la santé.
En définitive, les hommes que nous appelons aux avantages de l’émigration, quittent une vie bien autrement dure que ne le peut être la privation de quelques misérables plaisirs de cabaret.
Nous avons vu à la Jamaïque, dans la paroisse Sainte-Anne, une compagnie de vingt-deux Américains, occupés à établir une magnanerie. Tous travaillaient avec l’ardeur tenace et sérieuse des Américains, tous depuis quatre mois étaient à l’ouvrage, la hache, le compas et la houe à la main. Quatre mille pieds de mûriers étaient déjà plantés, et pas un de ces hommes, depuis quatre mois, n’avait été indisposé. À la vérité ils sont au milieu des mornes, loin des rivages marécageux de la mer ; et tous, membres scrupuleux d’une société de tempérance, ne boivent que de l’eau.
À moins que la culture du sucre ne soit plus spécia [xliv] lement meurtrière qu’une autre, et que le soleil ne tue plus volontiers celui qui plante une canne que celui qui plante un pied de tabac ou de mûrier. Qu’a-t-on à objecter à cet exemple ?
On encourage beaucoup l’introduction des émigrans à la Jamaïque, il y en a déjà un certain nombre répandu dans la campagne, et ceux qui sont bien soignés ne courent aucun danger.
Sur une sucrerie de cette île, paroisse Clarendon, où cent soixante européens se livrent depuis deux ans à tous les travaux sans distinction d’un atelier, ils n’ont eu que dix-sept morts : quatre hommes, trois femmes et dix enfans. Nous le tenons d’eux-mêmes. Nous avons encore rencontré à la Jamaïque des émigrés sur la caféière de l’hermitage appartenant à M. le docteur Spalding, tous ces hommes se félicitaient de leur séjour dans l’île.
S’il était permis de se citer soi-même, nous dirions qu’à deux époques de notre vie, jeune et touchant à la maturité, nous avons parcouru les pays à fièvre jaune, autrefois la Havane, la Vera-Cruz, la Nouvelle Orléans, aujourd’hui les Antilles. Nous y avons passé les mois d’hivernage quand nos convenances de voyageur l’exigeaient ; nous ne nous sommes pas privé de visiter les hôpitaux, ni d’y étudier les cas qui se présentaient à nous, et jamais le mal ne nous a touché, jamais nous n’avons eu que des indispositions de fatigue. Nous ne changeâmes jamais rien, il est vrai, à nos habitudes de régime ; nous ne bûmes jamais ni vin, ni eau-de-vie, ni rhum, que pour ce que valent ces [xlv] cordiaux, dont l’excès fait des poisons, c’est-à-dire comme remède.
On peut le dire d’une manière presqu’absolue, la modération est un sûr préservatif contre la fièvre jaune.
Nous disions déjà en 1833, « c’est un préjugé de croire que les blancs ne peuvent pas supporter la chaleur du climat des Antilles, ne sont-ce pas des blancs, des européens qui ont défriché et fondé toutes les colonies sans le secours d’un esclave ? Comment seraient-ils devenus inhabiles à en continuer l’exploitation, aujourd’hui que tant d’améliorations pourraient être introduites si l’esprit routinier des planteurs cédait enfin aux progrès de l’Europe. »
Cet avis est encore tout-à-fait le nôtre. La vérité est qu’en toute hypothèse, il n’y a réellement que les plages qui soient fiévreuses et redoutables. L’intérieur des îles, grâce à l’élévation du terrain [21], est un séjour délicieux et le plus sain de la terre ; on y connaît à peine les maladies, les brises y rafraichissent l’air sans cesse et tempèrent les violences du soleil. Il nous est arrivé d’avoir froid dans les mornes des Antilles. M. Lacharrière, président de la Cour royale de la Guadeloupe, vieux créole, dont la bonne foi est à l’abri de tout soupçon et qui s’exprimait ainsi d’ailleurs, à une époque où il n’avait pas encore été question d’émigration, a dit : « Les montagnes des Antilles leur procurent une variété de températures qui permet d’accoutumer par degré [xlvi] et sans perte, les troupes européennes au climat des tropiques et de l’équateur. »
Ce ne doit donc plus être l’objet même d’un doute, l’émigration réussira si on l’entoure de quelques précautions d’ensemble, si on la prépare avec sagesse et qu’on la fasse avec prudence. Pour cela il est nécessaire que le législateur y mette la main, qu’il n’abandonne plus les émigrés à leur propre inexpérience et à la cupidité des traitans. Il est nécessaire qu’on ne laisse pas se renouveler les cruautés commises envers les trente-six mois [22].
Le gouvernement chargé de veiller d’une manière directe sur l’émigration, lui donnerait les garanties légales dont elle a besoin pour s’opérer en grand, établirait la confiance générale en tranquillisant la nation sur le destin de ses enfans, et pousserait vers nos possessions de la zone torride, non plus des célibataires, comme il est toujours arrivé dans les essais particuliers tentés jusqu’ici, mais des familles complètes.
Cette dernière circonstance est de la plus haute gravité, pour nous qui sommes convaincu que les excès sont les premiers meurtriers des Européens aux colonies. — Le célibataire, sans attache dans la vie, sans devoirs immédiats, sans autres obligations que celles à remplir vis à vis de lui-même et de la société, ne s’inquiétant guère de mourir, parce qu’il [xlvii] meurt tout seul, a trop d’occasions de se déranger et trop peu d’intérêt à éviter ces occasions. Un homme marié, en raison des devoirs intérieurs que lui impose son état, nous offre plus de chance de passions assouvies, de mœurs calmées, d’esprit d’ordre et de retenue. — Le mariage n’est mauvais que parce que l’on en a formé un lien indissoluble. Par lui-même il est excellent, il met un frein à nos folles ardeurs, et les habitudes de la famille donnent à la vie moins d’agitation et d’irrégularité.
Insistons sur ce point des émigrations par famille, il est capital ; et notre pensée entière demande à être bien comprise. Nous ne nous adressons pas du tout à la partie aventureuse de nos compatriotes. C’est aux tristes victimes que fait l’anarchie sociale dans laquelle on laisse marcher la France au hasard, c’est aux pauvres que vont nos paroles. Il ne s’agit plus d’aller jouer un quitte ou double sur le tapis chanceux des îles, d’aller risquer une existence mal entamée à Paris, contre une fortune rapidement amassée en Amérique. Rien de cela, il s’agit de renoncer à la vieille patrie pour la nouvelle, d’échanger un travail insuffisamment rétribué, une huche vide, un âtre glacé où des enfans transis pleurent de froid sous des haillons à jour, une vie misérable et douloureuse comme l’est celle d’un grand nombre d’ouvriers d’Europe, même des plus honnêtes. Il s’agit d’échanger tout cela, non pas contre des richesses prodiguées à un oisif par les fatigues de ses nègres, mais contre un travail rapportant son juste salaire, une abondance perpétuelle assurée à l’homme [xlviii] laborieux, une vie chaude et facile au sein de la nature la plus généreuse du monde où des enfans pleins de santé croissent tout joyeux sous un ciel délicieux.
Ces enfans que nous voyons grandir, lèvent les derniers doutes que pourrait rencontrer notre projet, et doivent faire tomber toutes les hésitations. Supposons même que les Européens ne puissent travailler au soleil, il reste encore assez d’ouvrages qu’ils peuvent exécuter à couvert pour justifier des émigrations opérées avec sagesse et humanité, comme le travail du moulin, la fabrication du sucre, la garde et le soin des bestiaux, les métiers de tonneliers, forgerons, charpentiers etc., dont on a besoin sur toutes les habitations. Ceux-là, dussent-ils réellement craindre les insolations, s’ils se joignent aux rangs des nègres, ce qu’encore une fois nous regardons comme erroné, leurs fils en tous cas pourront, sans aucun doute, s’employer à la terre puisqu’ils seront aussi fils du pays, et les îles doivent acquérir ainsi dans l’espace d’un demi-siècle une population qui leur assurerait, tôt ou tard, un brillant avenir. — Sur ce dernier point nous n’avons pas que des hypothèses à présenter. Si les Européens sont réellement incapables de cultiver les terres tropicales, du moins mille preuves abondent que les créoles s’y trouvent propres. À la Havane, à Puerto-Rico, nous avons vu, de nos yeux, des petits blancs [23] aux champs ; on nous a dit qu’à Bourbon [xlix] la classe de ces laboureurs était fort nombreuse ; à la Martinique, dans le quartier du gros Morne, où le sol n’est pas propice à la canne, on peut voir aussi des blancs et même des blanches soigner de leurs mains leurs jardins à vivres.
Ainsi les faits et la théorie, tout nous porte à croire, sert à nous convaincre que les blancs peuvent cultiver sous les tropiques.
L’abbé de Pradt a dit, dans son livre des colonies : « Que les établissemens à sucre des Antilles étaient impossibles sans nègres. » Mais ce n’est pas la faute des Antilles, c’est la faute du jugement de l’abbé de Pradt. La canne n’est pas plus difficile à cultiver que tout autre végétal, et l’application des agens mécaniques comme des procédés économiques que la science fournit tous les jours et que l’argent des capitalistes rassurés permettra d’acheter, ne peuvent que la rendre plus facile encore [24].
Conclusion. L’émigration réussira et sera possible, humaine, profitable pour tous, si l’on prend quelques [l] mesures pour obvier aux chances de péril qu’elle a de commun avec toutes les grandes entreprises [25].
Nous ne pousserons pas plus loin ces réflexions, que nous avons regardées comme l’utile préliminaire d’un livre qui conclut à l’abolition de l’esclavage.
Soutenant une cause dont le triomphe, au dire de ses adversaires, doit amener la perte des colonies, il nous [li] convenait de mettre en évidence tout ce qu’elles ont de valeur politique, présente et future ; de rappeler la gravité avec laquelle on doit peser tout ce qui les concerne. — Les intérêts les plus élevés, les plus précieux du pays, veulent qu’on ne les laisse point périr.
La régénération des colonies françaises, par l’abon [lii] dante infusion du jeune sang des émigrés dans les veines de ces corps plus malades que caduques, se lie à l’affranchissement des noirs, et viendra lui prêter un efficace secours. Nous ne sommes point tenté de nous faire une arme de l’une pour soutenir l’autre, car l’affranchissement, à nos yeux, est un fait moral absolu, dont la nécessité se manifeste en dehors de toutes considérations environnantes, mais nous sommes heureux qu’un projet, de bonne et de haute politique, puisse être mis au service des droits de l’humanité.
[1]
DES COLONIES FRANÇAISES.
ABOLITION IMMÉDIATE DE L’ESCLAVAGE.
CHAPITRE I.
CONDITION DES ESCLAVES.↩
Cases à nègres. — Habillement. — Nudité. — L’usage de marcher nu pied pouvant être une cause déterminante de l’éléphantiasis. — Mal-pieds. — Hôpitaux des habitations. — Nourriture. — Mal d’estomac. — Maladies cutanées aux Antilles. — Jardins. — Respect des maîtres pour la propriété des esclaves. — Bien-être matériel. — L’esclave suit le sort de son maître. — Esclaves des habitations vivrières.
L’esclavage ne peut plus, ne doit plus subsister, son abolition absorbe toute la question coloniale ; là est le présent plein de trouble, là est le difficile avenir qui agitent si profondément les colonies. L’émancipation est pour les propriétaires d’esclaves une épée de Damoclès qu’ils voient toujours suspendue sur leur tête.
L’édifice entier des colonies repose aujourd’hui, et reposera long-temps encore, sur la race nègre qui les cultive ; forcément il faut tout rattacher à eux ; c’est sur eux donc qu’il nous paraît opportun de fixer d’abord l’attention. En les suivant dans les diverses phases de leur existence actuelle, on doit pouvoir préjuger de leur existence future, et trouver la solution du problème colonial, Commençons par examiner leur condition présente.
Les nègres d’une habitation française sont rassemblés dans [2] des cabanes, non loin généralement de la maison du maître ; chacun a la sienne. L’établissement des cases à nègres, comme on appelle ces demeures, est soumis aux moyens qu’offre pour les construire le quartier où l’on se trouve. Nous en avons vu de très belles en roches taillées chez M. Cotterell (Macouba, Martinique), chez M. Perrinelle (près Saint-Pierre, Martinique), dont la magnifique habitation rappelle les splendeurs de Saint-Domingue ; elles représentent presque des maisons. Pour l’ordinaire, ce ne sont que de misérables huttes en bamboux, en treillages ou en lattes, grossièrement enduites de terre, et couvertes en feuilles de cannes. Les cases forment toujours une pièce carrée, séparée en deux par une petite cloison. La construction en appartient au planeur, mais l’ameublement à l’esclave. Il en est où nous avons vu chaises, tables, commode, miroir, très beau lit à colonnes en courbaril, avec oreillers, draps et matelas ; il serait aussi injuste de le nier, qu’il serait mensonger de soutenir que ce ne soit pas une très grande exception. Ce luxe relatif, on ne le rencontre guère que chez les commandeurs [26] et principaux ouvriers, hommes de choix qui, dans toutes les positions du monde feraient leur sort au-dessus de celui du vulgaire ; mais ce n’est là et ce ne peut être qu’une très faible minorité. Le reste habite des cases où l’on ne trouve qu’un bois de lit plus ou moins mauvais ; parfois un banc ou une chaise boiteuse, quelques pots de faïence pour le ménage, un ou deux coffres, et la terre pour plancher ; le tout nu obscur et enfumé par le feu du canari [27], qui brûle sans cheminée, dans un coin de la première pièce. Tous encore n’en sont pas là, il est bien des cases où l’on ne voit que le canari, une planche ou une [3] natte sur le sol pour dormir, un nœud de gros bambou en place de cruche à eau, une ficelle tendue en travers pour porter quelques lambeaux de vêtemens. C’est une absence totale de tout ce qui constitue le moindre degré de civilisation.
Le nègre, comme tous les membres de l’espèce humaine, porte en lui l’instinct du luxe, il recherche les beaux habits, et il fait des dessins sur les calebasses qui lui servent de plats, de verres, d’assiettes et de tasses ; mais il n’a point acquis, depuis trois cents ans, au milieu de ceux qui prétendent le perfectionner par la servitude, il n’a point acquis la plus petite intelligence du comfortable. Sa case est encore l’image d’une grossièreté de mœurs et d’habitudes qui touche à la sauvagerie. Un habitant du quartier Port-Louis (Guadeloupe), M. Beuthier, dont l’âme élevée a su se garder des pernicieuses influences que l’esclavage exerce d’une manière différente sur le maître et sur les esclaves, nous disait avec tristesse, en nous faisant visiter ses cases à nègres : « Je suis honteux de vous montrer la dégradation de ces pauvres gens ! mais que voulez-vous ; j’ai fait tout au monde pour les rendre plus soigneux ; j’ai été obligé d’y renoncer ; ils sont trop avilis par leur condition, ils ne comprenaient pas ce que je voulais leur dire. »
Cependant il est juste de le confesser, les nègres ignorant du mieux ne souhaitent pas davantage, ils ne conçoivent pas, ils ne désirent même pas autre chose. Nous, Européens, nous croyons qu’il faut la longue habitude de pareilles demeures et l’engourdissement moral de l’esclavage pour les supporter. Cela n’est vrai que jusqu’à un certain point, la clémence du ciel des Antilles fait le reste. Les planteurs français donnent d’ailleurs, sous ce rapport, un très mauvais exemple à leur monde, ils sont loin d’avoir la recherche du chez soi de leurs voisins les Anglais ; ils ne se logent pas, ils campent, et quelques-uns ne sont guère mieux meublés que leurs noirs.
En général, et cela dit une fois pour toutes, il ne faut pas raisonner sur les colonies par voie d’analogie absolue avec l’Eu [4] rope ; leur climat agit sur les êtres organisés comme sur les êtres inorganisés, et change les conditions de l’existence telles que nous les connaissons. Aux Antilles, le froid avec ses rigueurs et ses misères, à toujours été inconnu.
Les cases à nègres, dénuées de toute ouverture sauf une petite porte qui n’a jamais plus de quatre pieds de haut, restent plongées dans une obscurité profonde. Nous avons eu grand peine à persuader à des femmes en couche, étouffant sur leur grabat, de laisser pénétrer jusqu’à elles et leurs enfans un peu d’air et de lumière. Le nègre, dit-on, aime l’obscurité : nous n’en croyons rien, c’est chez lui une habitude contractée dans l’esclavage, et qui participe plus de la nature de l’esclave que de celle de l’homme. Il est facile de concevoir qu’il veuille se soustraire au moins pendant les heures qui lui appartiennent à l’inquisition du maître. Plusieurs habitans ne nous ont mené dans les cases qu’avec discrétion, précisément parce que les noirs n’aiment pas que les blancs y pénètrent. « Zié bequés boulé dos negues : » Les yeux des blancs brûlent les nègres, dit un proverbe des colonies.
Pour ce qui est de l’habillement : une casaque de drap, un bonnet, deux pantalons et deux chemises de grosse toile, souvent remplacés par d’affreuses et ridicules défroques de soldats, en font chaque année tous les frais. Un noir ne sait pas ce que c’est que raccommoder ou faire raccommoder, il ignore tout-à-fait ces adresses de la pauvreté, et nul ne paraît enclin à se charger de les lui apprendre. Il met une chemise, la nettoie souvent, la garde tant qu’elle peut lui tenir sur le dos ; mais d’y faire une reprise, ni lui ni sa femme n’en ont l’idée ; il est même fort curieux de voir jusqu’à quel point, malgré cela, il sait la conserver ; ce ne sont plus que des cordes, il n’en reste que les anciennes coutures, je dirais le squelette, si j’osais, et il faut toute son adresse naturelle pour arriver à reconstruire chaque matin la forme effacée de l’ancien vêtement. Cuvier ne devait pas avoir plus de peine à retrouver l’ostéologie d’un animal anti-diluvien, qu’un nègre à mettre [5] sa chemise. Ces loques peuvent émouvoir le philosophe, mais elles ne doivent point exciter notre sensibilité. Il n’y est attaché, dans l’esprit de personne aucune idée de blâme, et les habits sont presqu’une superfluité sous les tropiques. Nous nous rappelons un nègre auquel son maître dit, lui voyant les reins à peine enveloppés d’un bout de caleçon : « N’avez-vous pas honte d’être ainsi nu ! » et qui répliqua ingénuement : « Pouquoi moin honte ? Moin pas négresse. » « Pourquoi serais-je honteux, je ne suis pas négresse. » Et celui-là encore était fort avancé ! Il est beaucoup de femmes esclaves, en effet, qui n’ont pas acquis les notions de pudeur que la civilisation a créées pour leur sexe ; il n’est aucunement rare (à la Guadeloupe surtout) de voir des négresses le sein entièrement découvert, et des enfans déjà âgé de huit ou dix ans, tout-à-fait nus. « Je me souviens qu’autrefois, dînant à la Martinique chez une veuve âgée, je vis parmi les valets qui nous servaient à table un garçon de douze à treize ans entièrement nu. On me dit qu’apparemment son linge était à la lessive [28]. » Voilà comme la servitude a élevés les nègres au-dessus de la barbarie africaine !
L’extrême chaleur du climat ne peut servir d’excuse à ceux qui tolèrent ces désordres parmi leurs esclaves. L’habitation de M. Dupuy, au Macouba, où l’atelier est proprement vêtu, parce que le maître y tient la main, et l’emploi prolongé de la chemise dont nous parlions tout-à-l’heure, sont des preuves que le noir n’a pas pour la nudité le goût qu’on lui suppose, et qu’avec du soin on pourrait le rendre moins désordonné. Les maisons que se bâtissent déjà les émancipés anglais, les belles cases de commandeur, chez M. Perrinelle, ne laissent aucun doute sur ce point. Mais que la population en sa puissance prenne des habitudes régulières, c’est le dernier souci d’un planteur. Il ne voit, il ne peut voir que des instrumens de travail dans les nègres, et pourvu qu’ils lui fassent beaucoup de sucre, il est content, le reste ne l’inquiète pas ; au contraire, [6] moins ses esclaves s’éloignent de l’état brut de nature, moins ils sont à craindre, et moins ils paraîtront dignes de la liberté. — Tout ce que les esclaves ont acquis dans la servitude, ils le doivent uniquement à eux-mêmes ; jamais les maîtres n’y ont rien fait, de quelle utilité eût-ce été pour eux ?
Les nègres marchent nus pieds. D’anciennes ordonnances, tombées en désuétude, leur défendaient de porter des souliers. L’usage, comme il arrive, a fini par créer un goût, et bottes et souliers ne sont aujourd’hui pour les esclaves ou les libres [29], qu’un objet de luxe. Il n’est pas rare de rencontrer sur les chemins des hommes habillés pour se rendre à la ville, qui portent leurs souliers, en attendant qu’ils arrivent. La même chose, au reste, se présente dans les campagnes d’Europe. On cite de la sorte des libres qui, par vanité, portent toujours des souliers à la main et n’en ont pas usé une paire en leur vie. Grâce au climat, les blancs eux-mêmes ont de la peine à obliger leurs enfans à se chausser. Malgré cela, c’eût été, nous croyons, une utile réforme à introduire que de forcer les maîtres à chausser les esclaves. Lorsqu’on visite les hôpitaux des plantations, on y trouve un nombre considérable de mal-pied, comme ils disent. Ces maux de pieds ont pour principale cause, les chiques, petits vers imperceptibles d’abord, qui se logent dans la peau et y grossissent, de sorte que pour peu qu’on n’ait pas soin de les arracher, ils la désorganisent, et amènent des affections fâcheuses. Cela tient évidemment à l’usage de marcher nus pieds. En outre, les parties inférieures du corps, ainsi abandonnées à elles-mêmes, étant toujours exposées à l’humidité en traversant les rivières ; il arrive que les tissus se relâchent et donnent lieu à ces accidens de varices si répétés parmi les classes pauvres des îles. L’effet de cette prédisposition, combiné avec l’influence que doit avoir sur la [7] masse du sang l’usage prolongé des salaisons pour nourriture, doit nécessairement altérer la circulation. On peut voir là une explication admissible du triste phénomène des éléphantiasis dont tant de malheureux sont atteint aux colonies. L’habitude de marcher pieds nus entre encore pour une part dans les maladies de poitrine auxquelles succombent beaucoup de femmes de couleur. Naturellement d’une propreté excessive comme les noirs, elles ne voient jamais un ruisseau, une mare, un peu d’eau sans y tremper leurs pieds échauffés par le sol brûlant ou par la marche, et il est difficile avec ce régime d’échapper à de mortels refroidissemens. Nous n’ignorons pas combien d’obstacles l’introduction de la chaussure aurait à vaincre, on ne change pas sans peine des habitudes prises par une génération entière, mais encore avec le temps peut-on y parvenir. Ce serait rendre un véritable service à la basse classe des Antilles.
Nous parlions tout-à-l’heure des hôpitaux. La célèbre ordonnance du 15 octobre 1786, premier pas de la métropole vers l’amélioration du sort des nègres, a voulu que chaque habitation eût le sien. Les soins que les esclaves y reçoivent sont en rapport avec l’aisance et l’humanité du propriétaire, et trouvent une certaine garantie dans son propre intérêt ; mais presque partout les salles sont négligées, infectes, d’une malpropreté hideuse, et l’on peut répéter aujourd’hui, ce que le colonel Malenfant, créole planteur, écrivait en 1814 : « Même dans les meilleurs hôpitaux les nègres et les négresses ne couchent que sur des lits de camp [30]. »
L’esclave a droit pour sa nourriture à deux livres de morue et deux mesures de farine de manioc par semaine : c’est ce que l’on appelle l’ordinaire. Sur plusieurs habitations, la libéralité du maître y joint sans y être tenu au nom de la loi, une portion de sel ou de riz. La nourriture des nègres est composée ainsi depuis le premier jusqu’au dernier jour. Cette uniformité était [8] une des conséquences inévitables de l’esclavage. Tous les estomacs doivent s’y prêter, varier serait impossible. Mais ici encore l’habitude est venue en aide à la nécessité, les noirs et aussi les maîtres, aiment aujourd’hui les salaisons, et toute table créole a son plat de morue à déjeûner. Par malheur, l’esclave ne peut diversifier ses alimens comme le maître, et plusieurs hommes de l’art supposent qu’il faut attribuer en partie à l’usage exclusif du poisson salé la principale maladie à laquelle succombent les nègres. Cette maladie appelée aux Antilles le mal d’estomac, sans doute à cause de la perversité des appétits qu’elle amène, nous semble répondre à ce que les médecins d’Europe nomment la chlorose [31]. Les maladies cutanées et dartreuses, assez communes parmi les noirs, tiennent également sans doute, à quelque vice du sang gâté à la longue par cette alimentation insalubre. La science a reconnu que la nourriture habituelle de poisson déterminait des affections de la peau très tenaces. Les historiens des découvertes de Christophe Colomb rapportent que ces sortes de maladies étaient excessivement nombreuses chez les Caraïbes des Antilles, et l’on sait que ces Caraïbes étaient exclusivement ichtyophages. — Quant à la farine de manioc, c’est une substance très nourrissante, fraîche à la bouche, merveilleusement appropriée à l’usage des salaisons. Le nègre des colonies françaises la préfère à tout, et beaucoup de planteurs, beaucoup de dames blanches laissent le pain pour cette farine.
La case, les rechanges [32], l’hôpital, l’ordinaire ; le maître ne doit rien de plus à ses esclaves, pour le reste ils sont obligés de se le procurer par la culture d’un morceau de terre appelé jardin, auquel ils peuvent travailler à leurs heures. L’ordonnance du 15 octobre 1786 veut, article 2 « qu’il soit distribué à chaque nègre ou négresse une petite portion de l’habitation, [9] pour être par eux cultivée à leur profit, ainsi que bon leur semblera sans que les vivres recueillis dans ce jardin puissent entrer en compensation de ce qui est dû à chacun pour sa nourriture [33]. » Est-ce une propriété que l’ordonnance entend constituer à l’esclave ? Jusqu’à quel point le pouvait-elle ? Nous ne savons ; ce qu’il y a de certain, c’est que les habitans ont fait abandon en quelque sorte du terrain consacré aux nègres. Ceux-ci regardent leurs jardins comme leur appartenant, et il en est plus d’un à qui vous ne persuaderiez jamais le contraire. Ils se les transmettent de père en fils, de mère en fille ; ils en disposent en faveur de leurs proches ou même de leurs amis, s’ils n’ont pas d’enfans. Les maîtres ne se reconnaissent plus de droit sur les jardins de l’atelier, et l’on peut citer du respect qu’ils y portent, des exemples qu’on aurait peine à croire.
M. Latuillerie (Lamentin, Martinique) trouva en herbes au retour d’un long voyage une assez grande pièce de jardins ; les nègres l’avaient négligée préférant des terres de cannes en alterne qu’on leur avait livrées. Même en cet état, M. Latuillerie ne put reprendre la pièce dont il avait besoin ; il fut obligé de transiger, et ne la mit en culture pour son compte qu’après être convenu avec les occupans qu’il leur en rendrait une autre à première réquisition. Il y a des planteurs qui n’ont pas un des arbres fruitiers de leur habitation, parce que la tradition établit que tel ou tel arbre appartient à tel ou tel nègre, et ils ont peu d’espoir d’en jouir jamais, car l’esclave en mourant lègue son arbre comme le reste. Les créoles touchent si peu aux singuliers droits de ce genre, fondés chez eux, que nous vîmes une dame renoncer aux fruits d’un avocatier planté devant sa porte. Le propriétaire, ou plutôt le possesseur de l’avocatier, homme un peu bizarre à la vérité, refusa nettement de lui en [10] vendre. C’est un vieux esclave capricieux, du reste fort attaché à la dame à laquelle il a promis en grande confidence de laisser tout son bien lorsqu’il mourrait.
Nous avons vu au milieu des plantations, de gros manguiers qui nuisaient aux cannes placées dans le rayon de leur ombrage, l’habitant les aurait abattus depuis longtemps s’ils avaient été à lui, mais ils restaient debout parce qu’ils appartenaient à un esclave, qui certes ne les avait pas vu naître. En parcourant une sucrerie du Robert (Martinique), nous fûmes surpris de trouver dans un immense carré labouré, deux petites taches en manioc. « Ce manioc, nous dit le colon, M. Tiberge, appartient à des nègres qui l’ont planté à une époque où la pièce était abandonnée. Lorsque je voulus employer cette pièce, je demandai à acheter les récoltes qui me gênaient ; les propriétaires eurent des prétentions exorbitantes. Je fis estimer par plusieurs de leurs camarades, ils ne voulurent pas accéder davantage au prix fixé, il me faudra donc attendre six ou sept mois que ce maudit manioc soit mûr. »
Des meuniers de Sans-Souci, enclavés dans l’esclavage, des hommes qui ne respectent pas la liberté de leurs semblables et qui respectent les arbres de leurs esclaves ! voilà d’incroyables anomalies. Mais que l’on ne s’étonne pas encore, la société coloniale nous présentera des spectacles bien autrement bizarres. Tout y est étrange et rempli d’énormes contradictions.
Que de pareils actes attirent au maître l’amour de ses esclaves, et par conséquent soit de fort bonne politique, je le crois. Mais quelle action des hommes n’a pas un but personnel ? Que tous les maîtres ne soient pas aussi scrupuleux je le crois également ; mais toujours est-il qu’en voilà bon nombre qui le sont. « Eh bien ! monsieur l’abolitioniste, nous disait-on, lorsque j’avais sous les yeux ces beaux traits de modération et d’équité ; écrirez-vous cela ? » Pourquoi pas ? Qui a jamais douté qu’il se trouvât aux colonies comme ailleurs, des hommes chez qui le sentiment du devoir put l’emporter sur l’intérêt même ? Tout abolitioniste au contraire aimera à citer d’aussi [11] bonnes choses ; l’émancipation ne présenterait aucune difficulté, si tous les créoles avaient du juste et de l’injuste des notions aussi élevées.
Le jardin est la source principale du bien-être que les esclaves peuvent acquérir. Malgré l’article 24 du code noir, qui défend aux maîtres de se décharger de la nourriture de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte, il se fait sur un grand nombre d’habitations entre le propriétaire et ses gens, un échange de l’ordinaire ou du demi-ordinaire contre le samedi ou le demi samedi ; transaction favorable au maître, qui n’a plus de capital à débourser pour s’assurer des vivres, et acceptée de bon cœur par le noir qui en travaillant le samedi et le dimanche à son jardin, y trouve de grands bénéfices. Il le plante communément en provisions à son usage et en manioc, qu’il vend au maître [34], ou qu’il porte au marché des villes et des bourgs voisins. Les propriétaires cultivent très peu de manioc, la canne rapporte davantage. La majeure partie de ce pain des Antilles est dû au travail particulier des esclaves ; culture, arrachement, manipulation de la farine, ils font tout hors des heures du maître. La grage [35] a lieu le soir dans des veillées, souvent prolongées jusqu’à onze heures et minuit !
Et l’on dit que ces gens-là ne travailleront pas lorsqu’ils seront libres !
Quand l’esclave a le samedi il peut gagner, outre sa nourriture, 2, 3, ou 400 fr. ; les hommes plus, les femmes moins. Sur les habitations à grandes terres, les jardins sont quelquefois d’un et deux arpens, on en donne même aux enfans s’ils en demandent, dès qu’ils se sentent assez de force. Nous avons vu chez M. Meat-Dufourneau (Martinique), de très jeunes garçons [12] qui avaient déjà un petit bout de champ où ils faisaient récolte de leurs mains.
Et l’on dit que ces gens-là ne travailleront pas lorsqu’ils seront libres !
Nous ne voulons pas nier, cependant, qu’il n’y ait beaucoup de nègres qui montrent une grande indifférence pour le bienfait du samedi. Il faut les forcer de travailler ce jour-là pour eux-mêmes. — Il ne nous étonne pas que des êtres abreuvés de dégoûts, frappés de malédiction, s’inquiètent peu d’améliorer leur sort pendant les instans de relâche qu’on leur accorde, et préfèrent se livrer à la paresse ou s’enivrer jusqu’au délire, de la mélancolique agitation de leurs danses africaines.
Une nouvelle source de bénéfice pour les esclaves est l’habitude qu’ont prise les habitans, depuis le perfectionnement de l’art agronomique, de leur livrer les terres autrefois laissées en jachères. La canne épuise le sol, et l’on se croyait obligé de le laisser reposer. On a reconnu que ce repos n’était pas profitable, et qu’on bonifiait au contraire le terrain en alternant la culture. Le nègre, toujours à ses heures de liberté, plante là du manioc. Dans quelques quartiers, la récolte se fait de compte à demi avec le maître, qui fournit les instrumens d’exploitation, mulets, cabrouets (charrette), corvée d’hommes ; en d’autres, les habitans regardent ce partage comme au dessous d’eux, et abandonnent la terre en alterne aux esclaves qui veulent la cultiver. M. Gosset, à l’habitation Vallery-Garoux, près Saint-Pierre, nous a montré sur ses livres, des comptes à demi ouverts avec deux ou trois de ses esclaves, où il revenait à ceux-ci jusqu’à 1,200 francs !
Et l’on dit que ces gens-là ne travailleront pas lorsqu’ils seront libres !
Ils ne travailleront pas ! Voyez ceux des habitations voisines des villes, ils se chargent de fournir aux particuliers l’herbe dont les chevaux sont nourris. Ils font l’herbe, le matin de midi à deux heures, pour l’apporter en ville chaque soir après la [13] tâche. « Tout est pris sur leur repos, nous faisait observer M. Winter, de la Martinique, jeune avocat créole aux idées généreuses, et avec ce paquet de 75 livres pesant ils viennent quelquefois d’une lieue de distance, cela pour 20 francs par mois ! »
Les esclaves ont plusieurs autres moyens d’augmenter leurs profits ; ils élèvent des volailles, des porcs, des vaches, et même des chevaux. Chez M. Douville (Sainte-Anne, Guadeloupe), il y a un troupeau de cent têtes de moutons appartenant à ses nègres. Chacun y apporte les siens, et M. Douville, afin de les aider, leur donne un berger. On peut le dire en thèse générale, la richesse plus ou moins grande des esclaves dépend beaucoup des bontés du propriétaire, de même que leurs dispositions laborieuses dépendent de la manière dont ils sont dirigés. Des planteurs nous ont dit : « Je suis obligé de forcer mes nègres à travailler pour eux le samedi ; sans quoi ils mourraient de faim. » D’autres nous ont affirmé qu’ils n’avaient pour cela nulle contrainte à exercer. — On a fait du nègre une chose : il a dû tourner à l’état de chose et ne plus vivre que de la vie qu’on lui communique.
D’autres libéralités des propriétaires adoucissent encore la situation de l’esclave ; lors de la récolte de son jardin, par exemple, le maître lui permettra d’user des plantines de torrefaction, des grageoires ou du moulin pour le manioc ; lors de la roulaison [36], deux fois par jour chez certains habitans, à discrétion chez d’autres, chaque membre de l’atelier viendra prendre du vezou [37], et depuis le matin jusqu’au soir pourra manger de la canne à discrétion. — À la tuilerie de M. Chazel (Martinique), les nègres, outre leurs jardins, exercent une industrie particulière ; ils font avec la terre à tuile des poteries de toute espèce, qu’ils placent dans le haut du four, et dont le profit leur appartient [14] sans aucun prélèvement pour la cuisson. — Beaucoup d’habitans prennent le soin généreux de faire border les champs de cannes d’une haie de pois d’Angole [38], arbuste qui fournit en abondance et toute l’année une fève excellente. Les nègres ont le droit de la cueillir, et chacun au retour du travail trouve le long des chemins, et presqu’en se promenant, de quoi se faire un bon plat de légume. Le colon joue ici le rôle que les hommes religieux donnent à la Providence, qui partout montrant le bienfait et cachant le bienfaiteur, nous prodigue dans les fruits des bois, dans l’eau des sources, dans l’abri des arbres, mille dons toujours prêts, pour lesquels elle ne réclame de nous ni peine, ni reconnaissance, et qu’elle ne nous demande pas même d’employer.
Les esclaves arrivent par ces petits moyens, en s’industriant un peu, à une certaine richesse relative. Plusieurs ont assurément en propriété au-delà de la valeur de leur cadavre, comme ils disent, et peuvent se livrer au goût passionné qu’ils ont pour la parure. On en voit le dimanche en redingottes ou en habits très bien faits, avec gilet de satin, chemise à jabot, bottes, et l’indispensable parapluie ; ils adoptent complètement notre costume, et une fois habillés, deviennent presque méconnaissables, car ils ont naturellement bonne tournure. À les rencontrer ainsi, on ne se douterait pas que ce sont les mêmes hommes que l’on a vus la veille travailler en haillons. Les négresses habillées ne sont pas aussi riches que les colons se plaisent à le dire, elles ne sont pas chargées d’or et de dentelles, mais les grosses boucles d’oreilles et les gros boutons de manches de chemises ne manquent pas chez elles, et vont merveilleusement avec le costume pittoresque qu’elles ont conservé ! Les enfans sont aussi très bien tenus le dimanche ; parmi eux nous ne pouvions nous lasser de regarder des [15] petites filles qui, avec leur longue jupe traînante et l’éclatant madras rouge qui encadre leur visage noir, accentué, doux et sérieux à la fois, présentent un type d’un caractère extraordinaire. L’enfance nègre a toute la grâce charmante de la nôtre, et quand je me sentais émouvoir par ses cris joyeux, ses courses folles, sa gracieuse agitation, ses jeux naïfs et son franc rire, j’avais grand peine à croire que je n’eusse sous les yeux que de jeunes animaux bons à faire des esclaves.
Le lecteur voit, quoi qu’il y ait à dire de l’esclavage, qu’il a ses douceurs possibles. On a réellement peine à supposer que la somme de bien-être dont jouissent les esclaves soit compatible avec leur position. À la Basse-Pointe (Martinique), le jour de la fête du bourg, il nous fut dit que pour la célébrer, l’atelier de la sucrerie Gradis, où nous nous trouvions, avait tué dix-sept cochons et cinq cabris. Le commandeur donnait à dîner, sa table était de vingt couverts, avec nappe et verrerie un peu ramassée de côté et d’autre. M. Auguste Bonnet il est vrai qui dirige cette habitation, est un homme d’une haute et bienveillante humanité. — Quand on se figure ce que peut être la servitude, on éprouve une sorte de reconnaissance à la trouver ainsi changée en un état supportable par la bonté intelligente de quelques maîtres.
Ne l’oublions pas néanmoins, l’esclave comme le domestique en Europe, participe beaucoup de la richesse ou de la générosité du maître, avec cette seule différence que le domestique qui ne se trouve pas bien, peut s’en aller, tandis que l’esclave doit rester. On sait des hommes qui traitent durement leurs nègres, par caractère ou par avarice ; il en est d’autres que la misère oblige à les traiter mal. Au moment où nous visitâmes la Désirade (novembre 1840), ce petit rocher aride était privé de pluies depuis trois ans, il y régnait une misère désolante, la terre ne donnait pas même de quoi vivre à ses habitans, et les esclaves enchaînés là, quand ils auraient pu aller bien vivre à la Guadeloupe, y étaient en proie aux horreurs d’une véritable disette. Deux femmes esclaves nous voyant passer, sor [16] tirent d’une habitation pour nous demander l’aumône. Elles nous dirent qu’elles mouraient de faim, et à voir leur visage décharné, leur affreuse maigreur, leur sein flétri, on pouvait s’assurer qu’elles ne mentaient pas. Ces deux pauvres créatures, sauf quelques sales lambeaux autour des reins, étaient absolument nues. M. Jumonville Douville, créole, dont le bon cœur fut navré comme le nôtre de ce spectacle, pourrait attester le fait s’il en était besoin.
Sur les nombreuses habitations vivrières (celles ou l’on ne cultive que des vivres), petits biens de six, sept, huit arpens, exploités avec trois ou quatre noirs, il est clair que l’on ne peut donner à chacun d’eux un arpent de jardin ; ils sont dès-lors réduits à l’ordinaire et aux rechanges, qui leur manquent souvent, car elles manquent au maître lui-même. La maison de celui-ci tombe en ruine, le toit percé laisse passer la pluie et, il n’a pas littéralement de quoi acheter une essente (planchettes de bois qui tiennent lieu de tuiles) pour le réparer ; où prendrait-il de quoi faire bon gîte et bonne vie à ses nègres ? ses belles filles blanches tant aimées, élèvent de leurs mains aristocratiques des porcs et des volailles, de même que les pauvres esclaves, pour subvenir à leur propre entretien ; comment ferait-il pour donner le nécessaire à son monde ? J’ai vu ce que je rapporte, et j’ai vu bien d’autres choses. Où la condition du supérieur est si misérable, celle de l’inférieur ne peut qu’être fort triste. Ces chétives habitations étant toujours loin des villes, enfoncées dans les mornes, les nègres ne peuvent non plus vendre d’herbes, il leur est presque impossible de se procurer les petits gains avec lesquels ils s’aident à porter la vie ; plus de ressource, plus de pécule. Combien est grande l’infortune de ceux-là ! Peut-être non cependant, le labeur sans doute est excessif, mais il est humain, car le maître travaille aussi, ils vivent avec lui dans la familiarité de la misère, et il a trop d’intérêt immédiat et de chaque jour à les ménager, pour ne leur être pas pitoyable.
[17]
CHAPITRE II.
BIEN-ÊTRE MATÉRIEL DES ESCLAVES.↩
Familiarité des rapports entre le maître et l’esclave. — Sécurité des maîtres. — Accroissement de la population esclave. — Population générale des colonies françaises.
Malgré ces tristes exceptions le sort matériel, le sort animal des nègres, nous le confessons, n’est pas aussi affreux qu’on le suppose. L’aspect de l’esclavage, pris dans son ensemble, en dehors de ses exceptions dures, cruelles, atroces, ne donne pas les serremens de cœur que l’on craint d’éprouver en l’approchant. Les esclaves sont plus ou moins retenus, selon le caractère de l’habitant, mais ils n’éprouvent pas de contrainte ; la présence du chef ne les courbe point. Nous en avons vu plus d’un rester assis avec le chapeau sur la tête, selon qu’ils se trouvaient à l’instant où le maître leur adressait la parole ; et les femmes avec l’embarras de leur sexe, répondaient comme nos paysannes par un gros rire et en détournant le visage. À de jeunes nègres qui ont dépassé les limites de leur jardin et empiété sur les terres de M. Méat, celui-ci dit : « Mais coquins, vous m’en devez la moitié. — Ah ! monsieur, répliquent-ils sans façon, vous ne voudriez pas faire cela à de pauvres petits esclaves comme nous. » — M. Perrinelle voyant une bonne mère malade s’obstiner à nourrir son fils, exprime la volonté qu’elle le remette à une nourrice, « Ah ! che maite, (cher maître), reprend l’excellente femme, à son aise et assise durant toute la conversation ; ne veuillez pas cela. Je vais encore prendre une grosse médecine et vous verrez que mon lait sera meilleur. » Puis M. Perrinelle en s’en allant : « Vous verrez qu’elle me le tuera. » — Nous nous étonnions, un autre planteur et moi, de la blancheur du nouveau-né que tenait une nouvelle accouchée : « Mais çà, c’est un petit blanc, » dit le maître. « C’est un [18] enfant de vous, » répondit l’esclave en plaisantant. La vie enfin se formule chez ces malheureux, presque comme chez nous ; chacun obéit à son caractère et l’on voit les jeunes filles qui apportent les cannes au moulin, gaies comme leur âge, se les jeter en jouant. Ce tableau est vrai, et je n’hésite pas à le peindre, bien qu’il contrarie ce que j’écrivais, il y a un an à peine. J’avais été trop loin.
Les rapports entre le maître et l’esclave ont même un caractère plus intime qu’il n’arrive entre nous et nos domestiques. Le commandeur de l’habitation Gradis dont il est parlé dans le chapitre précédent envoya emprunter à la maison une grande table qu’il désignait ; il ne se donna pas même la peine de venir la demander lui-même. Tout ce monde-là, voyez-vous, me disait M. Brières, du Macouba, en parcourant ses cases à nègres, nous appartient de père en fils, nous les traitons comme une famille. Et je voyais effectivement les marmailles (les enfans) se pendre aux jupes des dames Brières qui nous accompagnaient. Dans un salon où l’on fait de la musique, où l’on danse, vous voyez nègres et négresses venir tout uniment à la porte, la dépasser et se mettre à regarder où à écouter. Cette liberté de commerce existe surtout entre les dames et leurs servantes, celles-ci à l’église sont toujours dans le banc, à la maison dans la salle où se tient leur maîtresse, elles se mêlent à tout ; c’est de la familiarité, nous allions dire de l’intimité. Rien n’est plus ordinaire que de les voir emprunter pour aller à une fête les plus beaux bijoux et les chaînes d’or de leur maîtresse. Les dames créoles sont douces, bonnes, d’un extrême laisser aller, elles se plaignent beaucoup de l’engeance noire et il n’en est pas une qui n’ait quelque gâtée noire ou de couleur dont l’unique service est de la tourmenter. Qu’est-ce que cette petite fille qui est toujours sur vos genoux ? demandions-nous à une dame, « C’est l’enfant d’une de mes servantes qui est morte ; la pauvre créature me l’a recommandée en mourant. » Il faut voir aussi le plaisir qu’elles prennent au luxe de leurs femmes, on détailla par curiosité devant nous le costume de l’une d’elles, ils se mon [19] tait à 100 gourdes (500 fr.) à part les colliers d’or et de grenat empruntés. Il y a des choses de la vie coloniale vraiment originales. Vous vendez un domestique, une servante, tant ils vous mécontentent, puis dès le lendemain, ils reviennent chez vous, comme s’ils n’en avaient pas été chassés, mangent à votre cuisine, et laissent dans la maison pendant des huit et quinze jours leurs enfans que vous voyez courir, que vous nourrissez et que vous soignez !
Nous parlons des dames, mais en vérité les hommes aussi ont de la bonté. Malgré leurs farouches passions, tout n’est que de premier feu et leur haine n’a aucune ténacité. Lors des fameuses affaires de 1823 (c’est un mulâtre même qui nous en fit l’observation), les blancs montrèrent un acharnement épouvantable ; à les en croire, il eut fallu déporter toute la couleur, elle conspirait, il n’y avait pas de repos possible à moins. Une fois la déportation décidée, tout-à-coup et comme par enchantement il ne se trouva plus que des innocens, chaque blanc venait à l’autorité recommander tel, tel, et tel. « Oh ! ceux-là je les connais, ce sont des hommes calmes, raisonnables ; » — « Ne renvoyez pas celui-ci il a toujours vécu dans ma famille, j’en réponds. » — « Ne craignez rien de ces deux autres, ils étaient j’en conviens, mêlés aux troubles, mais ils sont jeunes et m’ont promis meilleure conduite. » En un mot, parmi ces libres qui en masse méritaient tous la corde, pris un à un il n’y avait plus de coupables ! En vérité l’émancipation ne sera pas si difficile qu’on le croit. Les colons français ont la fibre fine.
Il n’y a pas moins à dire à la louange des nègres et des gens de couleur, toutes leurs conspirations ont avorté parce qu’il y en a toujours quelques-uns qui avertissent les blancs auxquels ils sont affectionnés, de se garder d’un danger prochain.
Un fait général encore qui plaide en faveur des maîtres, c’est la parfaite sécurité où ils vivent sur les habitations. Isolés, en haut de leurs mornes, au milieu des forêts, ils dorment fort tranquillement dans leurs maisons à jour, de niveau avec les cases à nègres, car on n’a guère que des rez-de-chaussée [20] sur ces crêtes de montagnes où les coups de vent des Antilles rasent un village en vingt minutes. Et notez que tous les noirs ont pris l’habitude de porter constamment avec eux, pour abattre les lianes ou se défendre des serpens le coutelas propre à couper la canne ! Si bien que dans ces îles où les maîtres disent tant de mal de leurs 80,000 esclaves, et où nous autres abolitionistes nous disons tant de mal des 9,000 maîtres, il n’est pas un esclave qui ne marche armé nuit et jour, et pas un maître qui le soit !
Si l’on était tenté de nier les heureuses modifications de l’esclavage actuel, les colons auraient une objection fort simple à présenter, c’est que, d’après les relevés statistiques officiels, les décès et les naissances sont aujourd’hui dans les mêmes rapports chez les noirs que chez les blancs, le nombre des sexagénaires est proportionnellement plus fort parmi les esclaves que parmi les libres, enfin le chiffre de la population nègre au lieu de diminuer comme autrefois, augmente maintenant d’année en année [39].
[21]
[22]
CHAPITRE III.
TRAVAIL DES ESCLAVES.↩
Journées. — Bons effets du travail en commun. — Plus de femmes que d’hommes aux champs. — Amélioration du sort des nègres. — Cravates. — Abrutissement de quelques esclaves.
Occupons-nous maintenant du travail. Sous ce rapport les esclaves font ce qu’ils doivent, et les maîtres aujourd’hui ne leur demandent pas plus qu’ils ne peuvent faire. L’esclave donne neuf ou dix heures selon la durée du jour, de cinq ou six à huit du matin, de neuf à midi et de deux à six du soir. Le reste du temps lui appartient, et si le chef le lui prend il est rare qu’il ne le paye pas. Cette proportion est raisonnable et convenablement calculée pour un pays où le climat défend d’abuser des forces de l’homme. Il y a d’ailleurs beaucoup plus de jeu dans la prise de l’ouvrage sur les habitations que chez les manufacturiers d’Europe, on ne poursuit pas trop l’atelier, et dix fois pendant notre séjour à la campagne nous l’avons vu partir à deux heures un quart, deux heures vingt minutes au lieu de deux heures. — Personne aux colonies françaises ne se presse et ne presse les autres.
On ne va jamais au jardin (aux champs) que par grandes bandes de trente, quarante et cinquante travailleurs (hommes et femmes), sous la direction d’un ou de deux commandeurs. Ce que ces escouades font d’ouvrage en un jour est énorme. Les campagnes des Antilles offrent de grandes et sérieuses réalisations de la puissance que les fouriéristes attribuent au travail en commun. On peut surtout mieux juger de cela en se plaçant sur une éminence d’où il soit possible de considérer le groupe des laboureurs. On les voit insensiblement avancer avec l’imperceptible rapidité du flux de mer, laissant derrière eux de [23] larges traces de leur passage sur la terre retournée à vif ou nettoyée d’herbes. — La besogne est en outre beaucoup adoucie par l’aide de la musique : c’est une importation africaine. À chaque atelier est attaché un chanteur ou une chanterelle qui, placé derrière les travailleurs et appuyé sur le manche de la houe fait entendre quelques airs d’un rhythme cadencé, dont les autres répètent le refrain. On ne saurait croire combien cette musique allège la fatigue. L’association a des vertus si puissantes que même le travail esclave fait ainsi en commun, présente un aspect moins triste que le travail solitaire et morne de nos paysans.
Il entre assez généralement dans la composition des rangs au jardin plus de femmes que d’hommes, voici comment cela s’explique. Une habitation est un village en petit. Souvent établie à une distance considérable des centres, elle doit être pourvue de tout, et avoir, tonneliers, maçons et forgerons, outre des gardeurs de bestiaux, des cabrouetiers [40], sucriers [41], ratiers [42] ; et canotiers, Tous ces gens qui ont des apprentis destinés à les remplacer, sont pris sur la masse de l’atelier comme aussi les commandeurs, et ils diminuent d’autant la population mâle qu’il est possible d’attacher spécialement à la terre. Or, depuis que la traite n’a plus lieu, depuis [24] que la reproduction est livrée aux forces de la nature, elle a repris son cours naturel et le nombre des femmes, va s’accroissant plus que celui des hommes [43]. Ainsi, d’un côté la population mâle d’un atelier est en partie occupée de travaux spéciaux, de l’autre, la population féminine dépasse un peu celle des hommes, il s’en suit donc forcément que le nombre des femmes doit être plus considérable aux champs. — Il est peu probable que l’on puisse continuer à avoir autant de femmes dans les rangs après l’abolition, déjà quelques-unes d’elles, aux colonies anglaises se sont retirées et c’est un progrès sur l’état barbare que leurs maris ne se croient pas permis de les forcer à y venir.
Bien que les femmes remplissent parfaitement leur fonction au jardin, il est permis de croire sans les réduire exclusivement comme fait la barbarie civilisé au rôle de mères de familles, ou d’ornemens de bal, qu’elles sont appelées à des travaux moins rudes et trouveront d’une manière utile leur place ailleurs.
En tous cas elles supportent facilement la tâche aux colonies, c’est une preuve que l’atelier n’est pas obsédé et que le commandeur n’use point trop de l’horrible fouet dont il est toujours armé.
Les colons disent avec raison que les ouvriers d’Europe dépensent incontestablement plus de force que les esclaves à l’ou [25] vrage. On ne voit pas dans nos Antilles, de nègre ni de négresse quelque soit leur âge, avoir l’épine dorsale brisée comme l’ont nos vieux paysans vignerons et terrassiers. Le travail même de la roulaison, époque à laquelle les nègres sont obligés de fournir des services de nuit, est compensé dans ce qu’il a de pénible par les avantages dont ils jouissent pendant sa durée. Et encore les planteurs de la Guadeloupe qui essayent plus volontiers des innovations que les Martiniquais ont déjà disposé leurs usines de manière à supprimer les veillées. Presque toutes les sucreries de cette île sont fermées à neuf heures du soir. — C’est un exemple à suivre pour la Martinique, qui apprendrait de bonnes choses chez son ancienne vassale, ne fût-ce qu’à jeter avec une admirable hardiesse scientifique des ponts sur ses rivières torrentueuses, à faire de magnifiques routes et à construire pour les terrains mouvans des chaussées auxquelles l’art de l’Europe n’aurait rien à reprendre.
Nous avons vu les choses, et nous le répétons, elles ont bien changé, l’habitant soigne aujourd’hui ses nègres avec le même intérêt qu’un éleveur met à soigner ses bestiaux, plus encore, car l’éleveur peut acheter d’autres animaux, tandis que l’habitant ne le peut pas. L’amélioration du sort de l’esclave tient en quelques points à des causes d’économie domestique, qu’il est facile d’apprécier. En effet, si l’esclave ne travaille pas on le fouette, mais quand on l’a taillé [44] à le rendre malade, il faut attendre pour recommencer ; jusque-là le récalcitrant ne fait rien. Supposez-le doué d’une certaine force d’inertie, et vous concevrez que le maître, plus observé d’un côté et dont les mœurs plus policées de l’autre répugnent aux extrêmes violences, se lasse de frapper avant que l’esclave se lasse de l’être. Quand on a épuisé contre lui tous les moyens, on est bien obligé d’en prendre son parti et de le laisser. Nous avons vu de ces rares incorrigibles sur quelques habitations ; maître, géreurs [45], économes, commandeurs, tout le monde a renoncé [26] à en obtenir, aucune besogne et selon l’expression militaire, ils se trouvent véritablement en subsistance sur l’habitation. Personne n’a su nous dire d’où vient le nom de cravates qu’on leur donne.
L’esclavage a engendré une autre sorte de cravates dont le caractère est fort curieux à observer, ce sont des nègres qui ont été tellement dépravés par la servitude, et ont si bien pris l’habitude de s’en remettre à leurs maîtres du soin de leur vie, qu’ils sont devenus incapables de quoi que se soit. Ils ont complètement perdu l’instinct de leur conservation, ils se déchargent de tout sur leur propriétaire : celui-ci est obligé de penser pour eux, d’exercer à leur égard une surveillance de chaque instant, de leur donner leur repas un à un, parce que sans cela ils gaspilleraient le premier jour la ration de la semaine ; de s’occuper de leurs pantalons et de leurs chemises, parce qu’autrement ils iraient nus ; et s’il leur vient une plaie, il faut aussi que le maître sache la découvrir et la soigner, car ils s’en laisseraient dévorer. Ce ne sont point des idiots, ce sont des insoucians, ils semblent avoir pris l’esclavage dans ses termes les plus absolus ; automates sans vices ni vertus, ils existent par la volonté des autres, et font ce qu’on leur dit de faire, mais le font mal, comme des automates. Quand cette atrophie du sentiment règne chez une femme, elle perd jusqu’à la pudeur. Pauvres victimes de la servitude !
[27]
CHAPITRE IV.
L’ESCLAVE N’A AUCUNE GARANTIE CONTRE L’ARBITRAIRE DU MAÎTRE.↩
Le régime de l’esclavage est beaucoup adouci. — Quelques traits du passé. — Cruautés, violences. — Lettre d’un esclave de la Martinique. — Excès du pouvoir absolu. — L’arbitraire corrompt les meilleurs maîtres. — M. Douillard Mahaudière, M. Amé Noël, M. Brafin. — Ces grands coupables sont authentiquement des maîtres distingués entre tous par la bienveillance de leur administration. — Toute-puissance de l’habitant. — Les esclaves n’ont aucun moyen réel de défense. — Oublis de la loi. — Dépravation à laquelle l’usage du despotisme conduit quelques maîtres. — Tentative de traite de la Martinique aux États-Unis. — Les crimes d’exception n’en sont pas moins des crimes.
Il ne s’agit déjà plus d’examiner les vices et les abus de la servitude, notre pensée du moins s’élève encore davantage ; nous plaidons au nom des droits imprescriptibles de l’homme ; nous poursuivons l’esclavage en dehors de toute considération, parce qu’il offense l’humanité. Ce n’est point tel ou tel acte de cruauté qui le constitue. La question n’est pas une question de traitement doux ou cruel. C’est une question de principe. Que des planteurs soignent bien leurs esclaves, ce n’est pas ce dont il s’agit : d’autres peuvent les traiter mal. Ce dont il s’agit, c’est du principe qui fait que de deux hommes, l’un se dit maître de l’autre et lui arrache ses droits d’homme. Le principe ! Là est tout le crime nommé esclavage. La bonté de certains possesseurs ne peut venir en expiation de ce crime principe, si elle n’équivaut à son entière destruction, autrement dit si le possesseur ne rend pas la liberté au possédé.
Toutefois il est consolant d’avoir à le reconnaitre, ce que nous avons exposé dans les chapitres précédens est l’exacte vérité sur l’ensemble du régime des esclaves. Ne nous lassons pas de rendre cette justice aux propriétaires coloniaux, la bienveillance et l’humanité se sont introduites dans les traitemens [28] dont ils usent envers les noirs. L’attention de l’Europe, l’extinction de la traite, l’intérêt personnel, l’éducation des créoles qui, plus soignée, a donné plus de délicatesse à leurs idées, le voisinage des îles libres, où un nègre mécontent peut s’enfuir sans se donner la peine d’être marron, peut-être bien aussi les importunes criailleries des abolitionistes, tout enfin a contribué à l’amendement de la servitude. Elle n’est plus sombre, tremblante, décharnée comme elle fut, comme on se la représente encore.
Lorsque nous ayons dit ces choses en présence des colons, ils nous ont répondu : « Voyez comme nous sommes calomniés ; on proclame notre barbarie, on nous met au ban de l’humanité, et vous, notre ennemi, qui venez voir par vos yeux, vous reconnaissez que nous sommes justes et bienfaisans. » — Oh ! pour cela, il est facile de justifier les abolitionistes. L’état actuel de l’esclavage n’est qu’un progrès récent sur un horrible passé. Les colons, eux-mêmes, avouent que la discipline des ateliers n’était pas comparable, il y a moins de quinze ans, avec ce qu’elle est aujourd’hui. Si nous avons vu de gros manguiers d’esclave respectés, nous ayons vu aussi un arbre, où en 1829 un nègre amarré eut tout le corps étrillé avec une étrille de cheval. Le propriétaire était fou, dit-on maintenant ; excuse plus terrible que l’accusation. Que dire en effet d’un régime où des hommes peuvent être possédés par des fous ! Un esclave (il s’appelle Nicolas, et appartient à une habitation proche Saint-Pierre) nous a raconté que, durant sa jeunesse, son maître le força, par partie de plaisir, à monter sens devant derrière un mulet indomptable. Remarquant une cicatrice sur la poitrine d’un nègre, nous la primes, tant elle était large, pour la suite d’un coup de sabre et lui demandâmes où il avait gagné cela. « C’est un coup de rigoise [46] que l’on m’a donné étant jeune, parce que je m’étais endormi dans la sucrerie. » Telle fut sa réponse faite devant la maîtresse de l’habitation où il est au [29] jourd’hui. Un maître allumait son bout (long cigarre du pays) au moment où il ordonnait une flagellation, et tant que le cigarre durait, le fouet cinglait. — Apparemment, lorsque les ordonnances commandaient aux nègres de remettre leur coutelas, après la roulaison ; lorsque le code noir, art. 15, faisait défense, à tout esclave, de porter aucune arme offensive, ni même un gros bâton, sous peine du fouet ; lorsqu’une ordonnance de l’administration de Saint-Domingue, du 1er juillet 1717, défendait aux esclaves de porter des couteaux flamands ; lorsque la déclaration du roi, du 1er février 1743, punissait de peines afflictives et de la mort, tout esclave coupable du vol d’armes blanches ou à feu ; lorsque la prohibition, pour eux, d’avoir des armes était renouvelée dans un règlement de police concernant les nègres de la Guyane, du 6 janvier 1750, et dans un arrêt du conseil souverain de la Martinique du 8 novembre 1781 ; apparemment à ces époques, l’esclave n’était pas si bien traité qu’on n’eut rien à craindre de lui.
Nous avons dit que l’esclavage, pris en masse, est devenu un état animalement tolérable, et nous n’en rétractons rien. Cela est vrai, puisque c’est un fait de très-grande majorité, mais ce fait n’empêche pas les cruautés d’exception, les violences accidentelles, exceptions et accidens qui suffisent pour mériter à l’esclavage la haine de tous les cœurs bons et honnêtes. Aujourd’hui encore, malgré l’adoucissement des mœurs, les nègres restent soumis à des chances d’arbitraire effroyables. C’est en 1831, qu’un colon a pu écrire : « Combien d’esclaves ont péri dans les cachots des habitations ou sous le fouet des commandeurs, sans que jamais l’autorité s’en soit douté, sans que le ministère public ait informé contre de pareilles cruautés ! Heureux encore ceux qui n’ont pas succombé à des supplices dont on ne devinerait pas l’horreur [47]. » Un colon du Robert (Martinique), nous expliquait qu’ayant eu le poison [30] chez lui [48], il était parvenu à l’éteindre, en contraignant ses nègres à travailler depuis cinq heures du matin jusqu’à onze heures du soir. Au bout de deux mois, ajoutait-il, ils crachaient tous le sang : et quand je lui fis observer que s’il avait pu faire cela pour éteindre le poison, un autre le pouvait de même pour obtenir plus de produits. — Non, dit-il, mes voisins m’auraient dénoncé s’ils n’avaient pas trouvé que j’agisse avec justice. Malgré les voisins, nous avons entendu quelqu’un, parlant d’une habitation mise en fermage, dire que le fermier y avait fait d’énormes quantités de sucre, mais au prix des bestiaux et de l’atelier qu’il avait ruinés. Nous discutions avec M. Arthur Clay (Lamentin, Martinique), la valeur de l’ordonnance du 5 janvier 1840, qui décrète les visites de procureurs du roi sur les habitations. Il voulait que les propriétaires fussent chargés de cette police, afin de lui enlever son caractère humiliant et dangereux, mais il la reconnaissait utile « sur certaines habitations pour trop de relâchement ; sur d’autres pour trop de sévérité. »
Une lettre, qui nous est parvenue au retour d’une tournée à la campagne (Martinique), dira ce que peut être ce trop de sévérité que confesse un créole pur sang ; mais de bonne foi. Cette lettre est un document capital, une pièce importante au procès de l’esclavage.
« Monsieur, c’est pour vous dire qu’on vous a trompé que j’écris. Vous êtes venu à *** pour savoir si les nègres sont bien, les blancs vous ont fait voir que les nègres sont bien, mais les nègres sont mal. Les blancs sont intéressés à vous tromper ; si vous voulez savoir la vérité, allez voir à la case de M. **, où les nègres sont malheureux. Ils sont nourris comme les poules, avec le maïs (blé de Turquie) et encore on donne pas toujours l’ordinaire. Quelquefois on reste plusieurs semaines sans donner d’ordinaire, si les nègres demandent l’ordinaire, on les bat avec le fouet ; nos poules, on les fait tuer par [31] les soldats qui gardent les canots, enfin, c’est là qu’il faut aller pour voir si les nègres sont bien. Nos enfans sont vendus avant l’âge de quatorze ans, je parle des enfans légitimes. Les femmes mariées, si elles ne font pas d’enfans, sont mises à la barre toutes les nuits, afin que le mari aille chercher d’autres négresses, et faire des enfans avec elles, enfin, nous sommes aussi malheureux que les nègres de M. *** [49], où l’on donne aux nègres que fouet et toujours fouet.
« Vous cherchez la vérité, et vous êtes bien loin de l’avoir trouvée, tous les blancs vous tromperont, et M. **** vous dira la vérité si vous la lui demandez. M. **** [50] seul est porté pour nous, il sait tout ce qui se passe sur les habitations ; si vous voulez savoir la vérité, écrivez-lui une lettre avant de partir. Tous les blancs disent qu’ils vous ont trompé, et M. ***** dit qu’on devrait vous doser dans un dîner [51]. Pauvres nègres, entre quelles mains sommes nous, quand et par qui nos fers seront brisés ? Tous les ans, M. **** dit l’année prochaine, et cette année n’arrive jamais.
« Je suis un nègre esclave à M. ***** ; je ne sais pas bien écrire, comme vous voyez, mais vous me comprendrez, je l’es [32] père ; ce que je sais, je l’ai appris en cachette, parce ma maîtresse nous défend d’apprendre à écrire et à lire : si vous ne me croyez pas, demandez à M. ****, et il vous dira si je ne vous dis pas la vérité. J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très-humble serviteur. (Ici la signature.)
« Ne m’écrivez pas ; si vous le faites, votre lettre me vaudra vingt-neuf coups de fouet sur l’échelle, un carcan, une chaîne et coucher tous les soirs au cachot.
« Sulpice, domestique à M. Fortier, est marié avec Té, esclave aussi. Ils ont plusieurs enfans légitimes, tous petits, eh bien on n’a pas valu les enfans au père et à la mère ; et M. Fortier en a vendu une à madame Benalde, de la Grande Anse, et en a donné deux en cadeau aux enfans de madame Paul Desgrottes, du Macouba, et ces trois petites filles de madame Sulpice n’ont pas encore quatorze ans [52]. » [33]
Aurions-nous été réellement trompé ? Nous ne le croyons pas, car nous avons passé des semaines entières sur des habitations ; sur quelques autres nous avons été présenté sans y être attendu. Tout au plus est-il vrai que nous n’avons vu que les bonnes. Il est certain que ce qu’il nous a été donné d’observer, nous le devons à l’hospitalité des planteurs, qui nous admirent chez eux, précisément parce qu’ils n’avaient rien à y cacher. Les mauvais, par une raison toute simple, se souciaient peu de notre visite. En tous cas nous avons dû nous borner à voir la surface. Ce devait être. Les meilleurs même ne pouvaient nous laisser pénétrer au cœur des choses, c’est-à-dire nous asseoir dans les cases pour y écouter les confidences et les vœux des nègres, ainsi que nous écoutions leurs discours à eux-mêmes. Ces rapprochemens entre l’abolitioniste et les esclaves, auraient eu leur danger comme effet moral sur des populations faciles à agiter. La servitude est pleine de douleurs latentes, c’est une plaie que l’on ne peut sonder sans faire éclater les imprécations du patient.
Mais, hélas ! il n’est pas besoin d’aller curieusement au fond des cases pour découvrir la vérité, elle se révèle d’elle-même par de sinistres événemens dont nulle censure ne parvient à étouffer le bruit. Quand les choses doivent finir, il semble que le hazard lui-même veuille concourir à accélérer leur chute. La servitude des nègres est attaquée de toute part, elle est prête à crouler, et ses derniers actes ne peuvent qu’exciter davantage les peuples éclairés à vouloir sa destruction. L’Europe ne vient-elle pas de retentir de l’affaire Douillard Mahaudière, lugubre histoire, mêlée d’adultère, de chaînes, de poison, de cachot tortionnaire, de vengeance impitoyable, de devineresse et de maléfices, qui semble dater du xiie ou xiiie siècle ? Quelle livide lumière cette nouvelle énormité de maître [34] à esclave ne jette-t-elle point sur la société coloniale ! Surtout lorsqu’on apprend que M. Douillard Mahaudière, riche, estimé, tenant par sa nombreuse famille et ses relations à tout ce qu’il y a de plus élevé dans la Guadeloupe, est un homme bon, généreux, d’une charité inépuisable, dont tous les pauvres, nègres, gens de couleur ou blancs (cela fut acquis aux débats de la manière la plus authentique, la moins équivoque), dont tous les malheureux, quels qu’ils fussent, trouvaient toujours l’oreille et la bourse ouvertes ! Oui, ce grand coupable, la Providence de son quartier comme plusieurs témoins l’appelèrent, lui qui tint, pendant vingt-deux mois au fond d’un cachot de quatre pieds de haut, une femme enchaînée, est innocent dans son cœur ; il ne croyait point du tout avoir dépassé les limites de son pouvoir ; il était fort surpris que la loi lui demandât raison de sa conduite. M. Amé Noël est aussi un homme de mœurs remarquablement douces. Il n’a pas même de cachots sur ses deux habitations, et cependant il n’est que trop certain, malgré le scandale de son acquittement, il a fait périr un esclave dans les tortures. — Une affaire jugée à la Martinique, au mois d’août 1836, montre encore par des résultats plus épouvantables dans leurs détails, le danger qui existe à laisser aux hommes l’arbitraire que les colons veulent garder.
M. Brafin, négociant à Saint-Pierre, est en même temps propriétaire d’une sucrerie dans la commune de la Rivière Salée. Cette sucrerie fatalement appelée Habitation de l’Abandon, est assise sur des terres basses, humides, à moitié noyées dans les grandes pluies de l’hivernage, coupées de canaux où l’eau reste stagnante. Les nègres placés sur l’Abandon ne sont en grande partie qu’une agglomération d’esclaves de toutes mains, achetés dans les diverses communes de l’île, originaires de lieux plus élevés, plus secs. — L’habitation fait des pertes considérables, ruineuses, soit en esclaves, soit en animaux. Dans l’espace de deux mois elle a dévoré presque tout un atelier ; cinquante nègres ont péri ! Le propriétaire en est réduit [35] à confier le poste de commandeur aux mains d’un enfant de quinze ans. Il se demande la cause de tant de malheurs. Est-ce le climat froid et humide ? Il fait venir de France des vêtemens de laine. Serait-ce l’insalubrité des lieux ? Il fait creuser des pentes d’écoulement pour les eaux. Peut-être une gestion trop sévère ? Il change de géreur et recommande la plus extrême bienveillance. Rien ne réussit. La mort plane toujours sur cette terre de l’abandon, elle ravage l’atelier et le bétail. Et cependant les habitations voisines, dans des conditions égales, ne perdent rien !
M. Brafin ne songe pas que les nègres sont extrêmement sensibles aux influences atmosphériques, aux changemens de température, et que les siens ramassés de tous côtés succombent peut-être à un climat insalubre et humide, quelque soin qu’il en puisse prendre d’ailleurs, tandis que les hommes des ateliers voisins, nés dans ces conditions les peuvent supporter. Que cette idée, qui est la nôtre, soit juste ou non, M. Brafin ne la partage pas. Avec la préoccupation ordinaire aux créoles, préoccupation qui s’explique d’ailleurs par de rudes épreuves, il croit que le poison a juré sa ruine. Ses soupçons tombent sur les esclaves Théophile, Camille, Zaïre et Marie-Josephe, trois femmes et un homme. Il les réunit, leur impose la responsabilité du mal, et leur annonce des châtimens sévères, s’il éprouve de nouvelles pertes. Les soupçons, sur quoi sont-ils fondés ? Ne le demandez à aucun maître, ils n’en savent rien, et n’en peuvent rien savoir. Ils soupçonnent celui-là plutôt que tel autre, voilà tout. Enfin le 5 et 7 juillet 1838, deux esclaves succombent encore à l’hôpital. Théophile précisément s’y trouvait malade, et sa concubine Zaïre communiquait avec lui. M. Brafin ne manque pas de leur attribuer un crime de plus. Il quitte Saint-Pierre où il habite, assemble l’atelier, rappelle les menaces faites aux quatre noirs désignés, et les condamne au fouet, ainsi qu’un autre esclave nommé Jean-Louis. L’exécution commence immédiatement ; à Zaïre, à Théophile, succède la femme Marie-Josephe. Mais Saint-Prix, le comman [36] deur, est un enfant, son bras qui vient de faire couler deux fois du sang est fatigué ; il n’a plus la force de diriger le fouet. Le maître ordonne au géreur de prendre l’instrument du supplice, celui-ci se hâte d’obéir ; inexpérience ou maladresse, les coups s’égarent. Alors Brafin, lui-même, s’empare du fouet et il frappe ; il frappe de sa propre main cette femme qui est restée nue pendant ces tristes épreuves, et qui ne se relève sanglante qu’après avoir passé sous le fouet de trois bourreaux : deux blancs et un enfant nègre ! C’est encore lui, le maître, qui taille Jean-Louis. Sur chaque victime les médecins au rapport constatent, plusieurs jours après, des plaies nombreuses ! — À la suite de ces exécutions Brafin met un carcan à chaque condamné hommes ou femmes.
Mais des quatre esclaves soupçonnés, restait Camille. Où donc est-elle cette présumée empoisonneuse des deux dernières victimes ? Elle est dans sa case ; la veille même, elle vient d’accoucher. Brafin va chez elle, lui rappelle ses menaces, lui promet un châtiment exemplaire. Ce n’est point encore assez pour une malheureuse femme qui allaite son enfant né d’hier, que la moindre émotion peut rendre folle, il lui attache un carcan au cou !! et se retire. Laissez passer la justice du maître ! Du maître juge et bourreau ! Du maître qui punit le soupçon !
Mais voici encore des victimes ! qui accusera-t-il de ces nouvelles pertes ? À qui en fera-t-il porter le châtiment ? Il a frappé le dimanche ; le lendemain lundi, Zaïre manque au travail. Alors on raconte les tristesses de cette infortunée, ses pleurs inconsolables de la veille, « le fouet, un carcan, c’est plus que je n’en puis supporter, » a-t-elle dit. On conçoit l’idée d’un suicide ; et en effet, vers midi, la Rivière Salée rejette le corps de Zaïre, qui s’est toute habillée de blanc pour le dernier sacrifice ! — Zaïre était, nous l’avons dit, la concubine de Théophile ; l’un et l’autre étaient africains, l’un et l’autre de la même nation. Quand Théophile apprend cette mort, il pousse des cris de désespoir, et court pour se jeter dans la rivière. On l’arrête, on cherche à le calmer. Le géreur, les autres esclaves [37] s’efforcent de le consoler. Il promet de ne pas se noyer, mais les trois jours suivans, sa douleur, son découragement ne cessent point ; le quatrième, on heurte à sa porte, encore fermée après le lever du soleil, il ne répond pas. On entre, on trouve son corps suspendu à une corde qu’il avait attachée à un chevron de la toiture. Comme son amie, Théophile s’était aussi vêtu tout de blanc !
Voilà de l’esclavage !
C’est à raison de ces deux suicides, attribués par la justice à des châtimens excessifs, qu’eut lieu le 28 août 1840, l’enquête dont nous avons tiré les faits. Le juge d’instruction, M. Fourniol, ne trouvant légalement ni crime, ni délit, avait conclu au renvoi de la plainte. La chambre d’accusation en jugea autrement, M. Brafin fut renvoyé en police correctionnelle et acquitté. L’arrêt faisait surtout valoir que le prévenu « avait été, et n’avait jamais cessé d’être un habitant bon et humain envers ses esclaves, que son administration était paternelle. »
Remarquons-le, presque tous ces coupables, qui à travers les complaisans arrêts de non-lieu arrivent devant les tribunaux, sont des maîtres connus pour la douceur de leurs mœurs ! Et cela est moins extraordinaire qu’il ne paraît d’abord. Forts de leur conscience, persuadés qu’ils agissent dans les limites de leur pouvoir, ne punissant que quand ils croient à une grande faute ; ils ne se cachent pas, ils agissent à ciel ouvert, et prêtent facilement de la sorte à la constatation du forfait. Mais que penser d’un état social où un homme d’habitudes humaines, prend lui-même le fouet et frappe une femme jusqu’à lui laisser vingt plaies saignantes sur le corps !! Si les bons peuvent en venir là, jugez de ce qu’inventeront les méchans.
Regardera-t-on long-temps encore à changer un régime aussi corrupteur de l’humanité des hommes les plus doux, aussi funeste aux maîtres qu’aux esclaves ? Des uns il fait des bêtes brutes, des autres il fait des bêtes féroces. C’est par la possibilité de tout oser impunément que les possesseurs d’es [38] claves deviennent des tyrans, des hommes impitoyables, et c’est dans la moralité des actes commis par les meilleurs d’entre eux qu’est la plus vive condamnation du système colonial. À considérer l’excellente renommée des Mahaudière, des Amé Noël, des Brafin, à considérer que ce sont des maîtres distingués par leur bienveillance, à considérer qu’ils n’avaient pas cru mal faire, comment ne pas arriver à cette conviction : qu’il faut à un maître plus de modération, plus de vertu que la nature n’en a départi à l’homme pour ne point abuser de ses droits. Quant à moi, la puissance illimitée me paraît si dangereuse qu’elle m’épouvante, et tout abolitioniste que je suis, malgré la responsabilité que m’imposeraient mes antécédens, je ne consentirais pour rien au monde à conduire des esclaves. Je craindrais de ne pas échapper à la fièvre de barbarie dont je vois saisis les meilleurs. Ayons une sainte peur du pouvoir absolu.
On ne peut être étonné que d’une chose, c’est qu’avec la toute-puissance dévolue au planteur sur ses domaines, il ne se commette pas plus de crimes de cette nature, que ceux dont le récit échappé de nos îles vient, en traversant les mers, épouvanter le monde.
Puisque la loi accordait au maître la faculté de punir l’esclave, elle aurait dû, comme le veut Montesquieu, en lui accordant les droits de juge, lui imposer des formalités qui ôtassent à ses arrêts le caractère d’une action violente. La loi n’a rien fait de cela. Elle-même autorise l’abus. Le maître peut tout ce qu’il veut. On lui a permis d’avoir un cachot, et l’on n’a fixé ni la forme, ni les dimensions de ce cachot ; on lui a permis de mettre un esclave en prison, et l’on n’a arrêté ni le nombre de jours ou de mois, ni les conditions de cet emprisonnement ; on lui a permis de le charger de chaînes, et l’on n’a déterminé ni le poids, ni la nature de ces chaînes. Son pouvoir est presqu’illimité. N’est-il pas tout simple alors que des gens d’une intelligence étroite se jugent dans leurs pleins droits en construisant ou en conservant des chambres [39] tortionnaires pour y détenir la victime de leur cruauté et plus souvent de leurs terreurs ? La cage de quatre pieds de haut où Lucile était enferrée, n’est point une exception à la Guadeloupe. L’autorité administrative chargée naturellement de protéger les esclaves, puisque les esclaves sont faibles, les gouverneurs, les chefs militaires, les directeurs de l’intérieur, les magistrats, en voient partout de semblables lorsqu’ils se promènent à la campagne, et n’ont jamais fait une observation ; plus d’un homme du roi même, juges, procureurs et substituts, propriétaires aux Antilles, ont chez eux de ces tumulus, que M. Lignières, créole, habitant, appela dans sa belle plaidoirie pour Amé Noël, « des tombes à l’usage des vivans. »
On n’a rien tenté pour prévenir le mal, on ne le punit pas lorsqu’il s’accomplit. La loi est muette ou d’une inqualifiable indulgence. Les plus grands excès du maître, dans le Code noir, se soldent avec un peu d’or, et Mahaudière eût-il été déclaré coupable, il n’était passible que d’une amende de 2,000 francs, prononcée par l’ordonnance réformatrice du 15 octobre 1786. Si bien que la condamnation eut été plus scandaleuse encore que l’acquittement ! Quel infernal cercle vicieux ! Que peut être, nous le demandons, une société abandonnée de la sorte à l’arbitraire de quelques-uns ?
Il existe bien quelques lois, quelques ordonnances protectrices des esclaves, mais elles sont presqu’inapplicables, et encore que d’oublis n’a-t-on pas à reprocher au législateur ! N’en citons qu’un exemple : Lorsqu’un maître laisse dix enfans, chacun de ces héritiers a-t-il le droit de correction sur les nègres qui font partie de l’héritage paternel ? Les cohéritiers peuvent-ils, chacun à leur tour, les commander et les fouetter ? Tous les dix ont-ils seulement un dixième de ce droit, ou bien l’ont-ils les uns et les autres en totalité ? Aucun article de la loi n’a réglé ce point essentiel. La jurisprudence coloniale s’est chargée d’y suppléer à sa manière. Un habitant de Marie-Galante, cité devant la Cour royale de la Guadeloupe, alors [40] présidée par M. Gilbert des Marais, pour avoir excédé de coups un nègre, fut acquitté, parce qu’on avait établi aux débats qu’il était propriétaire d’un cinquième de l’habitation à laquelle appartenait le malheureux esclave.
Les noirs sont, en fait, livrés tout entiers à leurs maîtres sans aucun moyen réel de défense. Aussi chaque plantation, quoique soumises toutes à un régime uniforme, par leurs bases légales, a des usages, des habitudes, une organisation particulière, qui tiennent à des traditions locales ou à la volonté du planteur. Celui-ci est seul arbitre privativement à la loi des actes de son serviteur. Il le juge, et condamne souverainement ; seigneur féodal, il administre la justice sur ses terres, et ses arrêts demeurent sans appel. Refus de travail, bris de porte, vol, tout est de son ressort, et nous verrons dans le cours de cet ouvrage qu’une tentative de viol ne dépasse point son tribunal. Véritable monstre en politique, il a une puissance plus étendue que la société elle-même, entourée de toutes ses garanties, ne s’en est réservée contre les coupables. Le code, dans ses punitions pour telle faute ou tel crime, a des bornes fixées d’avance et infranchissables, le maître, pour les fautes de ses esclaves, n’en connaît d’autres que son bon plaisir ! « Il ne relève que de Dieu et de sa conscience, » M. Lignières l’a dit dans sa plaidoirie pour Amé Noël. C’est la doctrine des colons. Elle est puisée dans l’esprit de leur législation, qui ne les arrête qu’aux sévices et au meurtre. Petits rois, ils sont devenus comme les grands rois, la puissance sans la tyrannie est pour eux un bien sans valeur. L’usage du despotisme a tellement gâté ces omnipotens, qu’ils ont perdu le sens du juste et de l’injuste, de l’humain ou de l’inhumain. Et si cela se produit parmi des hommes éclairés qui ont appris à se modérer, à dominer leurs passions ; quels pires effets l’esclavage n’aura-t-il pas chez ceux dont l’éducation n’a pas corrigé les instincts du despotisme, ni amélioré les sentimens ! Mistress Trollope l’a dit dans son ouvrage sur l’Amérique, car mistress Trollope elle-même est contre la servitude. « Les gens des classes infé [41] rieures, presque toujours aussi ignorans que leurs nègres, résistent moins à l’action démoralisante de ce pouvoir absolu, qui leur est donné sur des esclaves mâles ou femelles. L’autorité grossière, pour ne pas dire barbare, qu’ils exercent, est le spectacle moral le plus dégoûtant que j’aie vu. » Le fait est que, la dépravation à laquelle peuvent arriver quelques-uns d’entre eux, dépasse tout ce qu’il est possible de concevoir. Un de nos amis qui habite la Guyane anglaise, nous a raconté le trait suivant : Un esclave apporte une lettre au directeur d’une plantation, celui-ci, mécontent du contenu de la lettre, ordonne de saisir le messager, le fait fouetter et le renvoie en disant : « Va porter cette réponse à ton maître ! » Nous pourrions citer bien d’autres faits, car l’histoire de l’esclavage est toute gonflée de sang et de cruautés ; n’en prenons qu’un seul pour finir.
Pendant notre séjour au Moule (Guadeloupe), le juge-de-paix reçut la lettre suivante, dont une personne digne de foi nous a procuré copie. Nous la transcrivons dans tout son cynisme.
« Chigny, le 6 novembre 1840.
« Monsieur le juge-de-paix,
« Il y a quatre ans qu’un de mes nègres a été arrêté sur l’habitation Acoma. Ledit nègre a été mutilé de coups, et M. Éloy l’a forcé de manger de la m. Six mois après j’ai perdu le nègre. Dans la nuit d’hier soir un de mes nègres encore, nommé Saint-Jean, a été saisi par les nègres Jean, Germain et Alexis, esclaves de l’habitation Acoma ; ledit Saint-Jean a reçu plusieurs coups de bâton sur la poitrine et sur la tête, par les nègres de l’Acoma désignés plus haut. Après avoir satisfait leur férocité, ils ont conduit Saint-Jean au géreur de l’habitation Acoma, qui l’a fait mettre au cachot ; et ce matin avant de me l’envoyer, ce géreur a eu le soin de lui faire manger une grande quantité de m. Comme je suis persuadé que ces deux actes sont non-seulement arbitraires, mais encore [42] répréhensibles par la loi, veuillez, monsieur, le juge-de-paix, donner la suite nécessaire à cette affaire en commençant : 1o par vous assurer des assassins.
« En attendant une prompte justice de vous, veuillez agréer, monsieur, mes salutations bien affectueuses.
Signé, T. B. de Lamarre. »
Voilà ce que savent inventer des hommes grossiers, livrés au dévergondage de l’arbitraire ! Puis quand vous en exprimez votre aversion, il se trouve aux colonies des hommes cultivés, pour vous dire : « Ma foi je ne l’eusse pas fait, mais je ne blâme pas celui qui l’a fait ; c’est peut-être un bon moyen de dégoûter les voleurs de venir manger des cannes [53]. »
Et ces gens-là osent réclamer la tâche de la moralisation de leurs nègres !
L’esclavage est un crime qui, chaque jour, enfante de nouveaux crimes. Citons encore une de ses dernières inventions, et que l’on juge de quels dangers de toute nature sont entourés les esclaves, ces hommes sans défense individuelle, sans moyen de résistance, toujours passifs, toujours obligés d’obéir. On faisait, autrefois, la traite des nègres d’Afrique dans les îles, voilà qu’on imagine de faire la traite de nos colonies aux États-Unis, où le prix des esclaves est cinq ou six fois plus considérable que chez nous. En janvier 1840, une exportation de ce genre fut déjouée la veille même du jour où elle devait s’opérer. Vingt-quatre heures plus tard, il n’était plus temps. Des misérables avaient acheté, à la ville et à la campagne, quinze noirs ; et les avaient amenés frauduleusement à l’Anse aux Galets (Martinique), sur une habitation riveraine de la mer où le propriétaire, un nommé Beaupuy, les mettait successivement à la barre à mesure qu’ils arrivaient. Une goëlette américaine attendait les victimes dans le canal de [43] la Dominique, lorsque ce complot vint à la connaissance de l’autorité, dont l’attention fut éveillée par les plaintes des parens et des amis de ces pauvres gens, inquiets de leur disparition.
M. Pujo fit l’instruction de cette affaire avec une rare habileté, il en démêla tous les fils, plaça les charges dans la plus grande évidence, et ne demanda qu’à regret la mise en liberté de quatorze prévenus qui s’y trouvaient impliqués, parce qu’il ne découvrit dans la loi aucun article que l’on put leur appliquer. La chambre d’accusation ayant adopté ses conclusions, elles deviennent en quelque sorte un encouragement à ces odieuses spéculations ; puisque c’est un axiome de jurisprudence : que la loi autorise ce qu’elle ne défend pas. Deux des principaux acteurs, Linard et Metoyé, avec deux complices, Yoyo et Graham, le capitaine américain de la goëlette qui devait transporter les victimes, s’étaient cependant soustraits, par la fuite, au châtiment qu’ils croyaient devoir les atteindre. Ainsi le régime colonial peut inventer des forfaits que notre immense législation n’a pas prévus ! Une femme aussi trempa dans cette ignoble entreprise ; elle enchaîna deux esclaves mis chez elle en dépôt, en attendant que l’on put consommer l’attentat, et le juge d’instruction fit en ces termes l’appréciation du rôle qu’elle avait accepté. « La dame Lordat s’est faite geôlière, elle a enchaîné des esclaves qui ne lui avaient causé aucun mal, pour le bon plaisir d’un aventurier contrebandier de chair humaine ; elle a converti sa maison en un lieu de séquestration, en un repaire dont on a pu disposer pour y faire de l’infamie à plaisir. »
Les honnêtes gens des colonies ne sont pas moins indignés que nous en apprenant ces abominables choses ; mais on doit bien le reconnaître, la servitude seule peut les faire concevoir, parce que seule, elle peut les rendre praticables.
Nous le répétons sans peine, on a lieu de s’étonner que de pareils faits soient aussi rares ; mais il ne faut cependant pas oublier qu’ils sont plus nombreux qu’on ne l’apprend. Même [44] aujourd’hui que les mœurs, adoucies partout, ont amélioré le sort des esclaves d’une manière notable, les actes de cruauté partiels sont encore trop fréquens. Et puis, en vérité, le calme avec lequel on parle de ces terribles exceptions, nous épouvante ! Seraient-ce donc des arbres brisés par un orage, des choses détruites par un accident, que ces hommes et ces femmes frappés, déchirés, tués par une cruauté de hazard. Répondez, répondez-nous ? La victime souffre-t-elle moins en se disant : Ma souffrance est une exception ? Ces ouvertures que le fouet fait dans les chairs, sont-elles moins ignominieusement douloureuses, parce qu’elles sont exceptionnelles ? Oh ! si le parlement savait à quelles affreuses barbaries, à quelles infortunes les esclaves sont exposés, quoi que puisse coûter leur délivrance, il n’hésiterait pas à la décréter, en coûtât-il plus encore !
[45]
CHAPITRE V.
l’esclave ; le prolétaire.↩
Les garanties de la vie matérielle ne suffisent pas à l’homme. — L’esclave n’est pas soumis à un pouvoir public. — Il ne peut se défendre contre l’arbitraire. De fait, la loi n’existe pas pour lui. — Ses enfans appartiennent à son maître. — Il n’a pas d’état civil. — La loi le déclare chose mobilière. — Il est vendu aux enchères. — Une vente d’esclaves. — Le prolétaire. — Un mot du peuple sur l’esclavage.
Mais écartons ces horreurs, supposons, qu’en raison de leur caractère exceptionnel elles ne soient pas suffisantes pour nécessiter la transformation d’un état social où elles peuvent se reproduire chaque jour : supposons même qu’elles soient impossibles, et que tous les esclaves jouissent du bien-être matériel dont nous avons reconnu l’existence pour la majorité. Cela supposé, les esclaves sont-ils aussi malheureux moralement que nous le croyons, nous, surtout avec nos idées ? Non, ils sont misérables, mais pas malheureux ; ils s’ignorent eux-mêmes ; l’abrutissement de la masse l’empêche d’apprécier sa misère dégradée, ils ne souffrent véritablement pas. Élevés dans leur enfance, nourris dans leur vieillesse, soignés dans leurs maladies, on prévoit tout pour eux ; et en échange de cette sécurité de l’existence entière, ils n’ont à donner que neuf ou dix heures de travail par jour. Ils sont un peu moins bien traités que les animaux du Jardin des Plantes qui n’ont rien à donner du tout ; mais ils sont assurément mieux approvisionnés, et plus tranquilles que les ouvriers européens. C’est là le grand argument des créoles, ils appuient toujours sur ce point, qu’il n’y a pas en France un paysan aussi heureux que leurs esclaves. Parce que le prolétaire, dans le souverain exercice de son libre arbitre, dans la toute puissance de son individualisme, sous la glorieuse responsabilité de tous ses actes, [46] lutte avec douleur contre l’adversité au milieu d’une société mal construite ; ils disent que le sort de l’esclave est meilleur que celui du prolétaire. Parce que l’esclave est plus ou moins bien pourvu de farine de manioc et de morue, ils soutiennent à la face du soleil « la supériorité de l’esclavage sur la liberté, pour l’homme que la fortune n’a point favorisé de ses dons [54]. » Ne semble-t-il pas, en vérité, que toute la vie consiste à être assuré de manger du manioc et de la morue. Mais, à ce compte, messieurs des colonies, les chevaux de tel ou tel millionnaire sont plus heureux que vos esclaves, car ils sont bien soignés aussi dès leur enfance, on leur donne aussi du vin de Madère lorsqu’ils sont malades ; d’un autre côté, ils sont infiniment mieux nourris ; et pas un d’eux, s’ils parlaient, n’échangerait sa riche couverture contre les haillons de vos ilotes, ni son écurie de marbre blanc pour les ajoupas de paille où vous les logez. Mais songez-y donc ; parviendriez-vous à faire aux nègres une litière toujours aussi fraîche, à leur donner du grain toujours aussi choisi qu’aux vainqueurs d’Epson ou de Chantilly, vous n’en aurez fait encore que des animaux à deux pieds !
On ne voit point d’esclaves mourir de faim chez vous ; mais on ne voit pas non plus de bœufs mourir de faim en Europe. Si le prolétaire y expire de besoin, un aussi horrible accident condamne la société où il a lieu, mais ne justifie pas la permanence de l’infamie qui se commet dans la vôtre.
Au reste nous avons, sur ce point, une observation à présenter. Est-ce bien l’esclavage qu’il faut bénir des garanties données à la vie animale de vos esclaves ? Un des motifs qui vous servent à repousser l’abolition, n’est-il point fait pour susciter quelques doutes à cet égard ? Vous dites toujours que le nègre ne travaillera pas en liberté, parce que la fertilité du sol et la douceur du climat lui fournissant de quoi vivre sans [47] labeur, il ne trouvera point dans les nécessités de la vie, l’excitation nécessaire pour vaincre sa paresse naturelle. Mais alors où est ce bénéfice de l’esclavage dont vous parlez tant ? De votre propre aveu, il se réduit à rien, et nous nous assurons que la liberté nourrira l’émancipé, au moins aussi bien que la servitude nourrit l’esclave. — Que de choses d’ailleurs n’aurions-nous pas à dire sur cette alimentation, dont la garantie vous semble une ample compensation à la perte de la liberté ? L’esclave devant être toujours passif, il est certain que sa nourriture sur les habitations où l’on donne l’ordinaire est laissée à votre discrétion, et qu’il se doit contenter de ce qu’on lui accorde. Dès-lors, n’avons-nous pas droit de supposer pour lui de cruelles privations chez les propriétaires mauvais ou gênés. Nous nous souvenons des deux femmes de la Désirade. « J’ai vu des habitans, dit Léonard, le poète de la Guadeloupe, acheter des barils de harengs gâtés pour leurs nègres. Ils aimaient mieux les empoisonner à peu de frais que de payer plus cher une nourriture salubre, tant l’avarice connaît mal ses intérêts. » Ce que des maîtres ont pu faire il y a un demi-siècle, d’autres le peuvent encore. En admettant ces horribles calculs comme extrêmement rares, il arrive néanmoins que des ateliers souffrent malgré même votre volonté. Vous achetez comme de première qualité deux, trois tonnes de morue. On vous trompe ; la morue sans être gâtée est échauffée, rouge, inférieure ; le marchand reçoit de vifs reproches, vous le quittez, vous êtes très-chagrin, mais vous ne pouvez tout perdre, ou bien vos géreurs ne veulent point s’exposer à de justes réprimandes pour une double dépense, et jusqu’à ce que la provision soit épuisée, le pauvre noir pâtit.
Vous dites encore : on ne sait point aux colonies ce que c’est que la mendicité. Mais on ne voit pas non plus chez nous les moutons mendier ; et, en tous cas, il n’est pas moins vrai que vos esclaves reçoivent de la main qui veut leur donner, et quelquefois la provoquent. Vites-vous jamais cela dans les usines de Saint-Étienne ou de Birmingham ? Nous savons d’ailleurs [48] que l’art. 27 du Code noir, impose aux maîtres l’obligation de nourrir et entretenir leurs esclaves vieux ou infirmes, et en cas d’abandon, ordonne que ceux-ci soient placés à l’hôpital, aux frais du maître. Nous savons, de plus, que cette disposition a été fortifiée par une ordonnance des administrateurs de la Martinique, du 25 décembre 1783, qui fixe à trente sols par jour, les frais de l’entretien de l’esclave.
Vous insistez sur ce que vos esclaves sont traités quand ils souffrent, mais on n’a pas du moins à reprocher à la société européenne de laisser mourir ses pauvres de maladie. Il lui reste encore beaucoup à faire, sans doute, mais elle a déjà beaucoup fait. Le département de la Seine à lui seul compte trente-deux mille lits d’hôpitaux où les affligés sont vus par tout ce que la science médicale possède de plus éminent. Les pauvres d’Europe sont soignés dans leurs maladies, comme les esclaves des colonies ; les uns ont l’hôpital du maître, les autres, l’hôpital de la société. Mais quand vous entretiendriez mieux encore vos esclaves, quand vos salles d’infirmerie ne seraient point d’affreuses chambres à lits de camp ; un des malheurs de votre condition sera toujours que votre générosité ne puisse passer pour être sans alliage, et ne point toucher à l’intérêt bien entendu. Socrate disait il y a long-temps déjà : « J’en vois aucuns qui prennent la peine d’amener eux-mêmes le médecin visiter leur esclave souffrant, et donnent ordre soigneusement à tout ce qui lui est propre pour recouvrer la santé. Mais ils n’ont souci de leurs amis [55]. »
Que si l’on pense qu’une race d’hommes tout entière est faite rien que pour boire, manger, travailler et dormir ; que si l’on se juge autorisé à lui enlever à jamais l’usage de ses facultés pour la laisser livrée aux instincts ; que si l’on ne croit pas que toute race humaine noire ou blanche est appelée à jouir des bienfaits de l’intelligence, au prix même de douloureuses crises sociales, comme l’être humain subit les transfor [49] mations de croissance au prix de douloureuses épreuves physiques ; il n’y a point à s’occuper des nègres. Ils n’ont rien à désirer, et c’est très réellement, comme le disent les colons, une folie d’utopiste vaniteux que de troubler la société pour changer leur sort. Mais l’homme n’a-t-il dans le cerveau que des instincts ? L’homme est-il fait pour en rester là, n’est-ce pas un crime de lèse-humanité que d’imposer des limites à son développement ?
Vous parlez du bien-être matériel de l’esclave, nous n’en avons rien caché, vous nous rendrez cette justice, nous l’espérons et le désirons ; mais laissez-nous maintenant montrer l’autre face de sa destinée. Ce ne sont point des idées philantropiques qui vont être exposées, « de ces rêveries, tant méprisées, auxquelles les abolitionistes s’abandonnent dans leur cabinet » ; ce sont des faits, des faits pris sur nature.
On a vu page 38 comment les latitudes laissées au maître sont tellement étendues, que les lois en faveur des nègres ne sont plus que des mensonges dérisoires. La justice n’intervient guères dans ce qui les concerne que pour l’esclave coupable d’un crime capital. Les conditions où ils sont présentement placés dispensent les maîtres de livrer leurs nègres aux tribunaux, même pour un grand nombre de cas où il y aurait lieu à poursuites criminelles. On peut dire avec toute sûreté d’être moralement vrai, qu’un esclave n’est pas soumis à un pouvoir public : homme chose, il est abandonné à tous les caprices d’une volonté individuelle qui, de gré ou de force, peut en tirer le service qu’il lui plaît [56]. Un maître dur ou in [50] juste, dites-vous, est flétri dans l’opinion ; oui, cela est vrai, mais il n’en est pas moins dur ou injuste ; et ce n’est pas l’opinion qui en souffre, c’est le nègre. L’esclave vit dans l’abrutissement, au sein d’une déplorable promiscuité, avec un tel oubli de sa nature, qu’il ignore même son âge [57]. Ses enfans, ses enfans ! ne sont pas à lui ! il ne peut exercer aucune autorité paternelle ; ils sont les esclaves du maître avant d’être ses fils ; et celui-ci, dès qu’ils ont atteint l’âge de quatorze ans, peut les lui arracher, les donner, les vendre, en disposer à sa fantaisie, les jeter sur le marché public comme des veaux [58]. Le consentement du père et de la mère, dit le Code noir, n’est pas nécessaire pour le mariage de l’esclave, mais celui du maître seulement !
Et les sophistes disent que la servitude est purement et simplement un fait politique, qui ne blesse ni la morale ni la dignité humaine !
Lors même que l’esclave a fini sa tâche, il ne lui est pas permis d’user de son temps et de sa personne en toute liberté. Il est encore obligé de faire ce que le maître lui ordonne, sous peine du fouet, de la prison et de la barre. L’esclave des colonies, en effet, n’est pas seulement attaché à la terre, il l’est aussi au maître, qui peut disposer de lui à tout instant, qui peut entrer dans son domicile, le jour, la nuit, à toute heure. L’esclave reste privé du droit le plus naturel, du droit de locomotion ; il ne peut aller où il veut, et son maître peut le mener où il ne veut pas aller ; il ne s’appartient jamais tout entier ; être moral [51] mutilé, il appartient toujours à l’habitation, il ne s’en peut détacher sans une permission écrite du maître [59]. Le dimanche, il ne lui est pas plus loisible que les autres jours de venir aux marchés des villes et des bourgs sans cette permission, il doit toujours être prêt à la montrer aux gardes de police sous peine d’être conduit à la geôle. L’esclave n’a point une minute qui soit véritablement à lui. Le samedi, ce jour accordé, en remplacement de la nourriture qu’on lui doit, est généralement respecté de même que le dimanche ; mais rien ne les lui garantit intacts, rien n’empêche le maître d’en disposer en tout ou en partie. Le mode et la durée du travail sont réglés, il est vrai, par la loi ; mais l’esclave auquel on vole de son repos n’a point à faire d’observation, il faut obéir sans murmure. Où irait-il se plaindre ? Quel magistrat est institué pour l’écouter et voudrait l’écouter ? Les maires sont des colons qui se moqueraient de lui [60] ; les juges-de-paix habitent les villes, et les tribunaux sont fixés loin des campagnes. Le procureur du roi ordonnera-t-il une enquête, lorsqu’un esclave viendra lui dire : « On m’a fait travailler hier une heure de plus que la loi ne permet. » Disons-le, le nègre ne peut pas être protégé contre l’arbitraire. Privé du droit de résister directement à l’oppression ; privé aussi des moyens de faire observer la loi, sans protection efficace auprès d’elle, « réellement courbé sous un joug de fer, dont rien encore n’a diminué la pesanteur » comme un colon l’a écrit avant nous, il est rigoureusement vrai de dire qu’elle n’existe pas pour lui. Et il faut que cela soit ainsi, car s’il avait la faculté de se défendre contre l’arbitraire du maître, et que les magistrats lui prêtassent l’oreille, la société coloniale ne pourrait subsister [52] un mois ; l’autorité du maître serait ruinée en moins de quinze jours. Le fait de l’esclavage veut que l’esclave doive une obéissance passive, même lorsque son maître lui commande une chose contraire à la loi ou à la morale. On ne saurait admettre qu’il soit juge de ce qui est légal ou honnête ; s’il refuse, il recevra d’abord et avant tout la punition de sa résistance, et puis, quand il ira dire au magistrat : « J’ai été châtié pour n’avoir pas voulu aider un acte immoral », le magistrat lui demandera la preuve. Où la trouvera-t-il ? Supposons que le magistrat aille jusqu’à faire comparaître le maître, celui-ci niera tout, et le lendemain le pauvre esclave sera plus maltraité que jamais non pas, si l’on veut, pour avoir déposé contre son oppresseur, mais pour tel ou tel manquement à ses devoirs. Quel est le soldat que son officier ne puisse trouver en faute dix fois par jour, quand il lui plaît.
Triste, triste condition que celle de cet infortuné ! Demande-t-il justice comme victime, on le frappe du fouet comme rebelle ; parle-t-il au nom de l’équité faite pour tous les hommes, on lui répond au nom de la puissance morale nécessaire à l’autorité des maîtres ; succombe-t-il à l’excès du mal, on dit : c’est une exception… Et ceux qui élèvent la voix pour lui, sont des esprits chagrins ou des ambitieux égoïstes qui comptent bâtir leur fortune politique sur la ruine de la fortune coloniale !
L’esclave n’a de volonté que sous le bon plaisir de son maître. Lui prend-il même l’innocente envie de se livrer à sa passion favorite, à son seul délassement, de battre son tambour et de danser le soir ; l’économe peut le lui défendre, et il doit céder.
Nous avons donc eu raison d’affirmer qu’il est soumis à tous les caprices d’une volonté individuelle, qu’il n’a pas une minute qui soit véritablement à lui. Son maître, en effet, peut disposer de lui, à tout instant, d’une manière absolue. Il est toujours esclave, jamais libre ; esclave depuis la première heure jusqu’à la dernière heure du jour ; depuis la première heure jusqu’à la dernière heure de la nuit. À la campagne encore, il a la faculté de courir, après le soleil couché ; car il sait facile [53] ment éviter les gendarmes ; mais paraît-il dans une ville sans permis, on l’arrête, on le jette à la geôle : il est toujours en état de suspicion [61].
La loi ne reconnait pas d’état civil à l’esclave ; une circulaire du 6 nivôse an xvi (27 décembre 1805), renouvela cette déclaration de l’édit de 1685, lors de la promulgation du Code civil aux colonies. L’esclave existe, aux yeux de la loi, seulement par les recensemens du maître. En dépit des ordonnances de 1827 et 1828, qui font un devoir à l’autorité de tenir des registres de naissances et de décès des nègres, les naissances et décès de cette vile espèce ne sont constatés, bien souvent, que sur un morceau de papier ou sur le dos d’un vieux livre de compte de l’habitation, comme une note gardée pour mémoire [62]. Leur baptême se fait avec l’importance que la condition pécuniaire des parens peut y mettre, mais leur sépulture s’opère encore partout comme celle des animaux domestiques, [54] du moins selon les idées religieuses des maîtres qui ont tous de grandes prétentions à la piété. Presque toutes les habitations ont un cimetière à elles, du moins un champ appelé cimetière. Le noir qui meurt, est porté là par quelques camarades, sans prêtres, sans prières consacrées, sans aspersion, sans croix, sans avoir été introduit dans l’église comme l’exige le rite catholique ; enfin, sans aucune des cérémonies que commande la religion professée [63].
La servitude est l’annihilation de tous droits, comme de toutes facultés, une éternelle mutilation civile et morale. L’esclave possède, mais ce ne n’est que par tolérance du maître : légalement il n’a rien ; tout ce qu’il possède appartient à son propriétaire ; il ne peut ni contracter, ni vendre ; il ne lui est pas même loisible d’acheter sa liberté, si le maître ne veut pas consentir à la lui céder. Toujours rigoureusement tenu sous la machine pneumatique de l’ignorance, de crainte que son cerveau ne prenne une force dangereuse, il ne sait pas les élans sublimes de l’âme, les joies indicibles du cœur, et il est condamné à ne les savoir jamais. Quel que soit son génie, il ne peut sortir de sa position. Un esclave n’a presque plus rien de commun avec un homme, que l’organisation animale ; c’est un être à part qui n’a aucune relation légale avec les autres membres de la société, c’est une machine à cultiver ; c’est une chose, et il demeure soumis à toutes les misères, à fous les troubles, à tous les accidens qui peuvent suivre l’assimilation d’un homme à une chose possédée.
Lors de notre visite à la geôle de Fort-Royal, un noir attaché à la grande chaîne s’approcha de M. Lemaire, inspecteur [55] des prisons, qui nous faisait l’honneur de nous accompagner, et lui adressa la réclamation suivante : « Je ne suis pas condamné, je n’ai fait aucun mal, j’ai été pris un soir pour n’avoir point de billet. Mon maître eut précisément alors à se défendre contre un autre maître, qui prétend que je lui appartiens. On me laissa en dépôt ; et, depuis sept mois que dure leur procès, je suis en prison et à la chaîne. Les maîtres se disputant à qui m’aura, ni l’un ni l’autre ne veulent me vêtir ; détenu pour leur compte, l’administration ne veut pas non plus se charger de mon entretien, et vous voyez que je suis nu [64]. Je demande à être habillé ; je demande à n’être plus attaché à la chaîne ; je demande à n’être plus envoyé aux travaux publics ; je demande à sortir de prison. » Et il finit comme il avait commencé : « Je n’ai fait aucun mal ; je ne suis pas condamné. » Le réclamant avait l’air fort tranquille, fort peu exaspéré de l’épouvantable iniquité dont il était victime. M. Lemaire, qui a le cœur très-noble, mais qui habite les colonies depuis quinze ans, reçut sa déclaration tranquillement aussi. Nous lui donnâmes chacun quelque chose, et tout fut dit. Il est peut-être encore à la geôle.
Voilà à quoi un esclave est exposé !
Le Code noir dit : art. 44, « Déclarons les esclaves être meubles, et, comme tels, entrer dans la communauté. » Art. 46 : « Seront, dans les saisies des esclaves, observées les formes prescrites par nos ordonnances, et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Sauf les exceptions suivantes. » Et ici l’art. 48, qui défend de saisir pour dettes les esclaves d’une habitation ou l’habitation, les uns sans les autres. Cet article comme on voit est tout-à-fait exceptionnel, il ne repousse que les créanciers qui pourraient compromettre la propriété en la disloquant ; le principe reste debout, et le principe, c’est la qualité mobilière du nègre. Il faudrait être de la mauvaise foi la plus ignorante du monde, pour nier ce que nous disons ici. [56] Non-seulement l’esclave est un meuble, mais plus encore, son immobilisation n’est que fictive et accidentelle ; et son prix, lorsqu’il est vendu, ne revient au créancier, par privilège et hypothèque, qu’autant qu’il est vendu avec le fond. Quelques-uns ont audacieusement avancé que le nègre attaché à la terre ne peut être séparé de la terre. La commission du conseil colonial de la Martinique s’est chargée, elle-même, de confondre une telle affirmation, en disant dans son rapport du 1er octobre 1838 : « Les propriétaires se sont toujours entendus pour faciliter la conclusion des mariages projetés entre des esclaves de différentes habitations, en les affranchissant, ou en les réunissant par la vente ou par l’échange, sous l’autorité d’un seul maître. » Il a été de plus jugé, par un arrêt du tribunal de Fort-Royal (7 juin 1834), confirmé par arrêt de la Cour royale (10 août 1835), que le créancier d’un propriétaire d’esclaves n’avait aucune juste réclamation à faire sur le prix de l’esclave, lorsque celui-ci avait été vendu séparément du fond.
M. Sully Brunet, ancien délégué des blancs de Bourbon, confirme en ces termes tout ce que nous venons d’exposer. « La loi en vigueur fait de l’esclave un meuble. Elle défend cependant, qu’un bien rural soit saisi sans que la saisie ne comprenne les esclaves qui le cultivent. Le propriétaire est toujours libre de distraire de son immeuble tout ou partie des nègres qui y sont attachés. Cet état de choses n’a pas peu contribué à empêcher les progrès de la civilisation, et à entraver les mariages [65]. »
Que deviennent après cela les allégations de nos adversaires, et pourquoi les ont-ils émises lorsqu’il est si facile de les réduire à néant ?
C’est par ces défenses mensongères que l’on a si fort gâté la cause des colons. La servitude étant, ils ne peuvent empêcher qu’elle ne soit ce qu’elle est, ni paralyser ses conséquences forcées. La vérité est qu’il n’est pas permis de saisir [57] l’esclave d’une habitation sans l’habitation ; mais le maître lui, peut en disposer à son gré ; rien ne lui défend de le déplacer, de l’envoyer sur une plantation ou sur une autre, d’en faire enfin, ce qu’il veut comme d’un meuble, et par conséquent de le vendre, s’il lui plaît, ou de le livrer aux enchères publiques.
L’existence de l’esclave dépend toujours des chances attachées au sort de son maître. Il ne vit pas de sa propre vie. Aujourd’hui ici, il ne sait point s’il ne sera pas demain là-bas ; ses habitudes, ses goûts peuvent être violemment rompus chaque jour et malgré ses désirs, soit par la pure volonté, soit par une cause indépendante de la volonté de son maître, comme la faillite ou la mort.
Ouvrez le premier journal venu des colonies, et vous y pourrez lire, feuille des annonces :
« Au nom du roi, la loi et la justice,
» On fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra, que le dimanche 26 du courant, sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, à l’issue de la messe, il sera procédé à la vente aux enchères publiques de :
« L’esclave Suzanne, négresse, âgée d’environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans.
« Provenant de saisie-exécution. Payable comptant.
« L’huissier du domaine, J. Chatenay. »
Oui, oui, l’huissier du domaine ; nous ne nous trompons pas. Le gouvernement de France fait vendre, à son profit, des femmes avec leurs enfans sur les places publiques d’une terre française !
« Au nom du roi, etc.
« Le même jour, lieu et heure, il sera vendu divers objets, tels que chaises, tables, etc.
« Provenant de saisie exécution. Payable comptant.
« L’huissier du domaine, J. Chatenay [66]. »
[58]
Le gouvernement de France, comme on voit, assimile des femmes avec leurs enfans à des effets mobiliers !
« Le samedi 23 du courant, à onze heures, le commissaire-priseur vendra, au lieu ordinaire des ventes publiques :
« Une montre en or, provenant de la succession de M. Reynoir.
« Même jour et même heure, le commissaire-priseur vendra, au lieu ordinaire, etc.
Les esclaves suivans :
« Nontont, négresse, âgée de quarante-quatre ans ; Marie Rose, dite Rosalia, capresse, âgée de vingt-trois ans, avec son enfant, Stanislas, âgée de quatre ans ; Anne, mulâtresse, âgée de seize ans ; Zéphyrine, âgée de dix-sept-ans ; Catherine, capresse, âgée de vingt-trois ans, et Anne Victoire, capresse, âgée de quarante-huit ans.
« Le tout provenant de la succession de madame veuve Duvilliers.
« Saint-Pierre, 11 février 1840.
« Le commissaire-priseur, d’Éculeville. »
« Vente publique. — À la requête du sieur Pinel-Rochu, etc., etc., le commissaire-priseur soussigné vendra, au Fort-Royal, le vendredi 16 août courant, à dix heures du matin, en présence de qui de droit, savoir :
« 1° Le gros-bois neuf l’Éclair, avec tous ses agrès et apparaux, ainsi que l’équipage, composé de dix nègres nageans, un patron et son second ;
« 2° Dix autres nègres de gros-bois, un patron et son second ; Ciril, tonnelier ; Césaire, Boucher, et Petit-Laurence.
« Ces quinze derniers nègres seront vendus séparément et en quinze lots.
« Le tout dépendant tant de la société de commerce Pinel-Rochu et Glenie, que de la succession de ce dernier.
[59]
« La vente se fera au comptant.
« Fort-Royal, le 6 août 1839.
« Le commissaire-priseur Guyardin [67]. »
Encore une, car ces pièces qui nous révoltent jusqu’au fond des entrailles, plaident, à notre sens, pour l’abolition avec une force démonstrative invincible :
« Vente judiciaire. — En vertu d’une ordonnance de M. le juge royal du tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre, en date du 3 juillet courant, dûment enregistrée.
« Il sera procédé, le samedi 25 du présent mois de juillet, heure de midi, par le ministère de M. le commissaire-priseur, à l’encan de la Pointe-à-Pitre.
« À la vente au comptant au plus offrant et dernier enchérisseur.
« De divers effets mobiliers, consistant en linges de corps, deux fusils et une négresse.
« Le tout estimé 1,172 francs, et dépendant de la succession du feu sieur Félix, quand vivait, économe d’habitation, demeurant dans la commune du Port-Louis.
« Pointe-à-Pitre, le 9 juillet 1840.
« Grandmougin. » [68]
Qui sait si les peuples à venir voudront croire à cela, lorsqu’ils le liront ?
Nous avons voulu assister à une de ces ventes où l’on met à la criée, en 1841, des hommes, des femmes, des enfans. C’était une grande salle remplie de meubles et d’objets de toute espèce. Au milieu de ce fouillis, assise dans un coin sur des caisses de vin, était une fille de dix-sept ou dix-huit ans, la tête appuyée sur la main, mécontente, sombre, et surveillée [60] par un agent de police. Chacun venait l’interroger : Êtes-vous bonne fille ? Savez-vous blanchir ? travaillez-vous au jardin ? avez-vous jamais repassé ? pourquoi vous vend-on ? n’êtes-vous pas maronneuse (disposée à aller en marronnage), etc., etc. ? Elle répondait mal, de mauvaise volonté, et on lui disait alors : Ouvre donc la bouche, qu’on t’entende, imbécile ; et elle répliquait à peine quelques mots. Je suis persuadé, moi, qu’elle comprenait sa position. Après avoir vendu une baignoire, un lit, un canapé et une lampe, le commissaire-priseur dit : À la négresse. On s’approcha d’elle, il la fit tenir debout et la mit à prix. — 100 francs, la négresse une telle, âgée de seize ans !… Elle travaille au jardin, 100 fr., 110 ! — Elle, le visage froid et impassible, restait appuyée contre un meuble. — 120 fr., 150, 155 ! enfin elle fut adjugée à 405 francs ; et le commissaire-priseur lui dit, montrant le dernier surenchérisseur : Allez, voici maintenant votre maître. C’était un mulâtre. Elle leva les yeux, le regarda, s’approcha de lui, toujours du même air ; il lui adressa quelques paroles, et je les vis disparaître ensemble.
Quand nous racontions ce que nous vîmes-là, les créoles nous disaient, en baissant cependant un peu la tête : Que voulez-vous, c’est une propriété ; mais du moins ils vivent en paix, ils ne sont pas rongés par la misère comme vos paysans, leur existence est assurée.
Quel est le paysan, bon Dieu, qui voudrait assurer son existence à ce prix ? Ceux que la faim chasse de leurs froides demeures, ceux qui abandonnent la patrie et les doux souvenirs du berceau et de la jeunesse pour aller chercher la subsistance ailleurs, ceux-là vont-ils s’offrir à la servitude du sud de l’union américaine ? Non, c’est du travail qu’ils demandent au nord, du travail avec ses chances d’anciennes privations déjà connues, déjà cruellement éprouvées, mais du travail avec l’indépendance, avec la pleine jouissance de son être.
Le paysan, l’ouvrier qui a fini son ouvrage ne doit plus [61] rien à personne et rentre souverain chez lui ; il lui est loisible d’aller, de venir ; il a une famille et des enfans à lui ; il a une patrie, des intérêts de communauté ; il est citoyen ; il peut être maire, juré, électeur ; il est membre actif du grand corps social ; enfin, il est son propre maître et appelé comme tel à partager ce que l’exercice du libre arbitre et la faculté d’aspirer à tout peuvent amener de nobles et fécondes jouissances pour l’homme. Le domestique même garde la faculté de changer sa condition, de s’en aller lorsqu’il est mécontent ; l’esclave doit rester. L’esclave aux heures de repos n’a pas l’indépendance qu’il paraît avoir, le domestique, au moment où il s’aliène davantage, conserve l’indépendance qu’il ne paraît pas avoir. Sous la liberté du premier est toujours la servitude ; sous la servitude volontaire du second est toujours la liberté.
Parmi nous, le riche exploite encore le pauvre, cela est criminel ; mais il ne le possède pas. Leur contrat peut être rompu à volonté. Le pauvre en subissant la servitude de la nécessité, ne cesse pas d’être libre de choisir un autre exploitateur, il ne perd jamais les chances d’en trouver un plus doux. Entre esclave et prolétaire, il y a la différence d’un outil à un ouvrier. Si l’ouvrier est malheureux, c’est une raison pour améliorer son sort, mais non pas une raison pour se dispenser de faire passer l’outil homme à l’état d’ouvrier.
Ce bonheur attribué à l’esclavage… par les maîtres, n’est pas d’invention moderne ; on en disait autant dans le monde antique. Les guerres serviles ont donné les proportions de ce mensonge. Le magnat de la diète de Pologne n’a-t-il pas répondu aussi : « J’aime mieux une liberté périlleuse qu’une servitude paisible ? »
Il y a une chose péremptoire, il nous semble, à objecter à la perpétuelle comparaison de l’esclavage avec le prolétariat. Certes, l’état de soldat paraît beau en France, puisqu’on en voit qui le prennent par goût ; un soldat, comme un nègre esclave, est nourri, préservé du froid, de la misère ; il n’a rien à penser non plus ; on paie son médecin, on prévoit tout pour lui ; bien [62] mieux, on le revêt d’un costume qui plaît aux femmes, et à sa profession sont attachés des plaisirs de vanité et de gloriole dont les Français ont toujours été friands par dessus tout. Eh bien, il n’est pas un paysan, pas un ouvrier, tel affamé soit-il, qui ne fasse tout ce qui est humainement possible pour éviter la conscription, qui ne préfère la faim et les vicissitudes du prolétariat à la soupe et à la quiétude de la caserne. Pourquoi donc ? C’est qu’à la caserne, la liberté est gênée ; c’est qu’on n’y a plus la libre disposition de soi-même.
Voici un fait qui nous paraît caractéristique. Un ouvrier, mutilé par l’explosion d’une mine, devenu aveugle, réduit à la misère, atteint d’une maladie organique, résultat de son désespoir ; fut tiré d’affliction par les secours, les conseils et la sollicitude d’un de nos amis. Un jour qu’il lui voulait exprimer toute sa reconnaissance, il lui dit en lui baisant les mains. « Ah ! monsieur, vous m’avez sorti de l’esclavage. » Ainsi le misérable, frappé de toutes les douleurs, frappé dans son corps, frappé dans son âme, frappé comme père, comme mari, comme homme, résumait tant de souffrances par un seul mot : Esclavage. Et qu’on ne dise point que les paroles n’ont pas de sens ; les paroles représentent le cœur. Allez donc proposer à ce prolétaire de changer avec un esclave ! La liberté est comme l’argent. Avec elle, quand on est heureux, on est plus heureux ; quand on est malheureux, on est moins malheureux. Les nègres jouiraient de leur bien-être matériel, mieux encore s’ils n’avaient pas de maîtres.
En résumé, jusqu’à ce qu’un colon ait mis ses fils et ses filles en esclavage, personne ne croira à la sincérité de sa préférence pour ce régime. Il n’est pas un seul de ceux qui osent soutenir une pareille thèse auquel nous n’ayons fermé la bouche rien qu’à lui dire : « Un génie malfaisant a condamné le fils qui vient de vous naître à être ou esclave aux colonies, ou prolétaire en Europe : choisissez. » Tous répondaient : « Prolétaire en Europe. » Tous préféraient, pour ceux qu’ils aiment, [63] les inquiètes agitations de l’indépendance à la paix stupide et mortifère de la servitude [69].
Mais s’ils croient, s’ils sont persuadés qu’il y a plus de conditions de vrai bonheur pour leurs esclaves, que pour les pauvres de France, si « l’esclavage n’est en réalité que l’organisation du prolétariat [70]. » Pourquoi donc n’offrent-ils pas hardiment l’esclavage comme remède aux maux de nos classes inférieures ? Que ne nous proposent-ils, de rétrograder vers le moyen-âge ? Ô honte ! voilà pourtant quelle serait la conséquence rigoureuse de leurs doctrines, le retour à la servitude, comme amélioration du sort du plus grand nombre ! En vérité, colons, c’est pour nous un grand sujet d’étonnement, que vous vous contentiez de défendre votre propriété pensante, en vous efforçant de prouver qu’elle est fortunée. Si vous êtes réellement convaincu de l’heureux destin de vos nègres ; si vous le jugez réellement le seul bon pour des êtres aussi stupides ; si vous pensez réellement « qu’ils ne pourront jamais rien sans la tutelle de la race blanche. » Pourquoi donc, au lieu de faire retraite dans la légalité de vos droits, ne prenez-vous pas l’offensive qui serait si naturelle en pareil cas ? pourquoi ne nous attaquez-vous point comme des fous qui s’aviseraient, par philantropie, de vouloir soustraire le cheval au service de l’homme ? Car enfin il n’y a pas de milieu. Où les nègres font partie de l’espèce humaine, et alors sous tous les aspects possibles, leur servitude est une offense à l’humanité ; où ils appartiennent à l’ordre animal, et alors on a raison de [64] s’en servir comme des bœufs ou des chevaux, et ceux qui ne le veulent pas souffrir, ne méritent que le ridicule.
Maintenant, que cela soit vrai, que le sort matériel des esclaves coloniaux soit préférable à celui des ouvriers européens, que la servitude telle qu’elle est et sera toujours, vaille mieux que la liberté telle qu’elle est encore ; avons-nous jamais dit que le prolétariat fût le dernier degré de bien-être où les masses pussent atteindre ? Qui croit que l’on ait assez fait pour le peuple, sauf les grands coupables qui l’oppriment [71] ? Est-ce que la philosophie et la morale ne prêchent point et n’agissent point tous les jours pour lui ? Quel homme de cœur et d’intelligence ne demande pas l’abolition du prolétariat avec la même énergie que l’abolition de l’esclavage, l’émancipation des blancs aussi ardemment que l’émancipation des noirs ? Long-temps encore on oubliera le forçat dans son bagne infect, long-temps encore on oubliera le malheureux mourant de faim dans son grenier ! Nous ne l’ignorons pas ; cependant, nous avons trop perdu les illusions de la jeunesse pour n’avoir pas appris à espérer… Mais occupez-vous de ceux-là, nous répètent les créoles, au lieu de vous occuper de nos esclaves, qui ont du manioc en abondance. Savent-ils donc, les hommes qui parlent ainsi, mesurer l’expansion de leur charité, et n’ouvrir dans leur cœur qu’un crédit limité aux souffrances qu’ils rencontrent ?
Pourquoi ne pas faire marcher de front l’une et l’autre réforme ? Les créoles attendent-ils que leur fils aîné ait achevé sa rhétorique pour commencer l’éducation du plus jeune ?
Quant à nous, convaincu que la race noire des îles doit être [65] mise en position d’acquérir autant de bien-être que toute autre race que ce soit, nous nous sentons forcé d’obéir à l’entraînement qui nous rend sensible à ses douleurs ; nous pensons qu’il ne nous est pas permis de détourner les yeux du mal qui s’est fait, avant d’en avoir obtenu la réparation. Quiconque a sondé la plaie a pour devoir d’importuner la société de ses plaintes en faveur des esclaves.
Les colons disent encore : « Les nègres se trouvent bien ; ils ne veulent pas changer, et la preuve, c’est qu’ils n’amassent rien pour parvenir à la possession de leur personne ; ceux même qui ont de quoi se racheter, ne le font pas. »
D’abord, cela n’est point d’une exactitude rigoureuse. Les publications officielles du gouvernement évaluent à un dixième du total des affranchis depuis 1830 le nombre de ceux qui se sont rachetés eux-mêmes [72] ; mais ce dixième, non compris ceux auxquels les maîtres ont refusé le rachat, ce dixième ne vînt-il pas contredire l’assertion des créoles, qu’en faudrait-il conclure, sinon, pour quelques nègres, que, dégradés par la servitude, ils ont peur de la liberté comme nous avons peur de mourir, bien qu’on nous assure que le ciel vaut mieux que ce monde-ci ? Pour d’autres, qu’ils se sont accoutumés à leur sort comme les prisonniers de la Bastille, qui ne voulaient pas sortir des cachots ? Pour la très grande majorité, qu’ils ne savent point faire d’économies, et aiment mieux consacrer l’argent qu’ils gagnent peu à peu à satisfaire leurs passions ? Un motif vrai encore de cette fausse indifférence, c’est que, mieux traités qu’ils n’étaient autrefois et sachant, car on leur dit tout, qu’on parle d’abolition, qu’on s’occupe de leur rachat, ils sont moins disposés que jamais à y consacrer ce qu’ils se trouvent capables d’acquérir.
Ils attendent et il ne faudrait pas même les faire attendre trop long-temps.
[66]
Il est juste de noter encore que beaucoup d’esclaves, s’ils voulaient se racheter, ne pourraient gagner assez d’argent pour y parvenir ; qu’ils savent tous aussi que les maîtres ont droit de refuser le rachat, et que ce droit, bien qu’ils n’en usent pas généralement, on a vu des hommes très bons l’exercer lorsqu’ils y ont cru leurs intérêts engagés. Si les nègres ignoraient la valeur de l’indépendance, rachèteraient-ils donc leurs enfans comme on le leur voit faire, tout en restant esclaves eux-mêmes. Il nous serait facile d’en citer plusieurs exemples à notre connaissance. Ne vit-on pas aussi, lorsqu’il fut déclaré par l’acte d’abolition du parlement anglais, que les esclaves ayant été en Angleterre avaient droit à revendiquer la liberté ; ne vit-on pas beaucoup de vieux nègres inventer les histoires les plus incroyables et les plus embrouillées pour parvenir à prouver qu’ils avaient fait le voyage libérateur ? Ne vit-on pas plusieurs fois alors deux esclaves s’entendre pour témoigner faussement en faveur l’un de l’autre ?
Mais de telles choses, fussent-elles plus rares encore, la proposition des colons fût-elle d’une vérité absolue, elle ne serait pour nous qu’un irrésistible témoignage de plus contre le fait auquel on veut en forger un appui. Est-il rien en effet de plus épouvantablement criminel qu’un mode d’être dans lequel les hommes se dégradent à ce point par leur long et abject assujétissement qu’ils arrivent à l’insensibilité ? Moins le nègre souffre de son humiliation, plus il doit exciter notre pitié ; moins il désire la délivrance, plus c’est un impérieux devoir de le délivrer.
L’ignorance de sa propre nature, l’abrutissement bestial, sont les seules conditions où un homme esclave puisse trouver son état tolérable ; et il faut le dire, pour expliquer l’erreur des colons et l’existence des colonies, il est un certain nombre de nègres qui en sont là. Élevés dans l’atmosphère de la servitude, familiarisés depuis leur naissance avec leur destin, il ne font aucun doute que cela ne soit comme il était écrit, n’ait toujours été, et ne doive toujours être. Un bon vieux magistrat demandait [67] à une négresse, mère de sept grands enfans, si elle n’était pas exempte du fouet. « Moin maché draite, répondit-elle, mais si moin pas maché draite, moin trapé coups d’fouet comme zautes. » Je marche droit, mais si je ne marchais pas droit, j’attraperais des coups de fouet comme les autres. Elle trouvait cela fort juste, et il ne lui paraissait pas qu’on y put rien changer. Les esclaves arrivés à ce degré de perversité, respectent les blancs comme des hommes supérieurs faits pour être maîtres, de même qu’eux, pour être serviteurs. Ils ont un profond mépris pour les marrons, les arrêtent impitoyablement lorsqu’ils les trouvent, et les regardent à peu près du même œil qu’un bon ouvrier regarde un fainéant. Ils craignent leurs maîtres, mais comme on craint une puissance, sans effroi, sans haine ; plusieurs les aiment véritablement, et adorent avec stupidité, la bienfaisance qui daigne leur donner du bouillon lorsqu’ils sont malades. Sans doute il leur arrive bien quelque soupçon, quelque vague sentiment que cela n’est pas tout bon, ni tout juste pour eux, mais ils ne s’y arrêtent pas ; il en est d’eux, comme de nous, qui percevant le mal d’une manière fort distincte, l’acceptons comme une nécessité de fait, sans révolte ni colère, et bénissons la clémence divine qui témoigne son amour pour la race humaine jusque dans les pestes et les inondations. — L’esclavage a cela de funeste, qu’il enlève tout ressort à l’âme en l’avilissant. Ce terrible effet se produit sur les hommes blancs, comme sur les hommes noirs. N’a-t-on pas lu dernièrement, dans les journaux, l’horrible aventure qui vient de se passer en Russie. Un seigneur commande l’amour à une de ses esclaves, elle s’enfuit ; il ordonne à deux serfs qui se trouvent présens de courir après elle ; ils se mettent à sa poursuite, et la lui ramènent fort ponctuellement. Quels étaient ces deux hommes ? Le frère et le fiancé de la victime ! L’abrutissement peut-il aller plus loin ? Singulière façon de raisonner ! Parce que la servitude dégrade l’âme au point d’enlever à celui qu’elle frappe la volonté de s’y soustraire, on s’en fait un argument en faveur de la bonté du joug, comme si ce n’était pas, [68] au contraire, le plus palpable indice de son immoralité [73]. « Les hommes, a dit Montesquieu, s’accoutument à tout : à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Rien ne met plus près de la condition des bêtes, que de voir toujours des hommes libres, et de ne l’être pas. »
Les colons à courte vue se trompent à de tels symptômes, et demandent pourquoi l’on s’occupe de misérables qui ne paraissent rien désirer ? Les Israélites, non plus, ne voulaient pas sortir d’esclavage, ils étaient arrivés à un point plus horrible encore de dégradation, ils aimaient leur honte, ils disaient à Moïse : « Non, laissez-nous ; servons l’Égypte. » Leur sublime législateur les délivra, presque malgré eux, et à la moindre épreuve dans le désert, ils regrettaient leur servitude. Si Moïse avait consulté les Égyptiens, bien certainement on lui aurait répondu : « Ne vous occupez de ces êtres stupides. Ils sont paresseux par nature, on ne peut les faire travailler qu’à coups de bâton ; et vous voyez qu’ils les supportent, qu’ils n’ont pas [69] envie de changer. Il n’y a qu’un extravagant qui puisse songer à les émanciper, ce serait nous causer beaucoup de mal, sans leur apporter aucun bien, ils ne veulent pas de la liberté. »
Ils ne veulent pas de la liberté ! C’est une chose qui suffirait seule à faire aimer la vertu et la vérité, que de considérer dans quelles contradictions tombent toujours et infailliblement ceux qui soutiennent le vice et le mensonge. Écoutez une histoire ; elle nous fut contée un jour en pleine terre de Martinique par M. Arthur Clay, au moment où un nègre qui passait à côté de nous sur la route, arrêta le trot de son cheval pour le saluer fort respectueusement. « Mon père, dit-il, avait reçu d’un de ses amis à l’article de la mort, une somme de 20,000 fr. pour en faire un usage qu’il voulait cacher. Mon père était accompagné par ce nègre, son domestique favori ; il lui donna l’argent à serrer. L’ami revint à la santé ; mais il n’avait pas encore repris les 20,000 fr. que mon père, presque subitement, mourut lui-même. Rien ne constatait l’existence de la somme en sa possession, ni reçu, ni confidence tierce ; le donateur la chercha sans la trouver et la tenait pour perdue, lorsque, trois jours après, le nègre la lui rapporta, disant simplement : « Mon maître m’avait chargé de cacher cet argent pour un emploi secret, je sais qu’il est à vous, le voici [74]. »
Eh bien ! savez-vous ce que l’on donna au fidèle domestique pour récompense de sa bonne action ? La liberté… Pourquoi donc la liberté, s’il ne la demande pas, s’il ne la désire pas, s’il ne la comprend pas ? Et c’est ainsi qu’ils font tous. Ces créoles qui disent et écrivent à satiété « que l’esclave ne veut pas [70] être libre, que la liberté serait pour lui un présent funeste [75] » dans leur code, ils promettent affranchissement à l’esclave qui dénoncera une conspiration ; chez eux, un nègre leur rend-il un service de marque, ils le font libre ! Quelle logique ! Et il en est peu d’entre eux, les faux méchans, qui ne lèguent en mourant l’indépendance à quelque domestique de prédilection. Allez, nous ne voulons plus vous écouter, possesseurs d’hommes, vous seriez abolitionistes comme nous, si vous n’aviez pas d’esclaves, vous mentez à votre cœur en vous torturant l’esprit pour défendre la servitude…
Après tout, si les nègres sont contents de leur sort, si aucun de ces misérables ne veut se racheter, pourquoi avez-vous donc toujours refusé le rachat forcé [76], en faisant valoir pour une de vos principales raisons « que les nègres voleraient afin de payer leur rançon ! » Mais ce n’est là qu’une de vos moindres contradictions. Si vous êtes sûr qu’ils se trouvent bien, pourquoi ces nombreuses et vigilantes croisières à l’entour de vos îles ? Pourquoi toutes vos côtes sont-elles couvertes de petits postes avec des embarcations uniquement chargées de s’opposer aux évasions sans cesse renouvelées vers les îles anglaises ? Pourquoi tous les canots des riverains de la mer doivent-ils être enchaînés ou enfermés sous clefs ? Pourquoi ce ban publié à la Guadeloupe au mois de mars 1838, qui promet 200 fr. de récompense à quiconque ramènera un esclave déserteur ? Que de [71] soins pour empêcher de sortir des gens qui veulent rester ?… Ne combattons pas davantage des arguties. Tout esclave désire sa liberté, tout maître de bonne foi en convient, et personne aux colonies n’en ignore. Il n’est pas un de ces heureux de la servitude qui ne veuille changer son bonheur contre les misères du prolétariat. Ne cherchez plus à en imposer à personne, autrement nous vous répéterons ce que disait Mirabeau lorsqu’on lui peignit l’esclavage comme le prolétariat organisé. « Tout cela me rassure au sujet des bouleversemens que l’on craint à la suite de l’abolition, car, s’il en est ainsi, ces gens-là ne voudront pas de la liberté. Ils reprendront leurs chaînes, ils ne seront pas assez ennemis d’eux-mêmes pour changer les douceurs de la servitude contre les devoirs qu’a l’homme libre envers lui-même et envers ses semblables. »
[72]
CHAPITRE VI.
MARIAGES.↩
Le Mariage est incompatible avec la servitude. — Les blancs enseignent le concubinage. — On accuse à tort les maîtres de violenter leurs esclaves femelles. — Profonde corruption des esclaves. — Les maîtres sont loin de favoriser le mariage des esclaves. — Pourquoi beaucoup de nègres refusent le mariage. — La famille est impraticable pour l’esclave. — Fécondité ou stérilité sur les habitations. — Les esclaves ne vivent pas dans une promiscuité absolue. — Piété filiale chez les nègres.
Le degré de moralisation auquel des hommes esclaves peuvent atteindre, est en rapport exact avec les faits extérieurs qui ont été décrits dans les chapitres précédens. Il n’existe presqu’aucune union légitime parmi les nègres. Des habitations de deux cent-cinquante et trois cents individus, n’en comptent pas une seule. Dans les notices statistiques officielles déjà citées, il est dit que la proportion des mariages d’esclaves, relativement à leur population, est pour la Guadeloupe de un sur six mille huit cent quatre-vingt, et pour la Martinique, de un sur cinq mille cinq cent soixante dix-sept !
Nous croyons avoir prouvé dans un autre ouvrage [77] que le mariage est incompatible avec la servitude. L’esclave mâle ou femelle, au milieu de la vie animale qu’on lui a faite, au sein de la profonde obscurité intellectuelle et morale où on le laisse plongé, ne conçoit guère l’association matrimoniale, et encore moins conçoit-il, avec ses ardentes passions sensuelles que rien ne réprime, la pénible obligation de la fidélité. Le nègre prend une femme avec laquelle il vit maritalement, et dont il accepte les enfans pour siens, mais il veut se conserver la faculté de séparation, comme J.-J.-Rousseau, et cela ne l’em [73] pêche pas d’avoir autant de concubines qu’il peut en entretenir, comme beaucoup de ses maîtres.
De là les ennemis de la race noire ont pris texte pour la déclarer incapable de s’approprier nos liens sociaux, lui faisant honte de n’avoir pu acquérir depuis deux cents ans ni l’idée du mariage, ni celle de la famille. — Calomnie, et de plus calomnie inintelligente.
Les maîtres sont seuls responsables de toutes les ignorances de l’esclave. Les hommes sont ce qu’on les faits ; ils n’apprennent que ce qu’on leur enseigne, et nous sommes bien obligé de le dire, les blancs aux colonies, géreurs, économes, négocians, jusqu’aux propriétaires, sont les premiers à enseigner l’immoralité. La plupart passent leur vie en état de mariage libre. Ici nous devons ajouter que l’on accuse à tort les colons d’abuser de leur puissance vis-à-vis des esclaves femelles. Le planteur, malheureusement, n’a rien à forcer sous ce rapport ; tout est à sa disposition, le père et la mère d’une jeune fille à peine nubile, recherchent eux-mêmes pour elle presque comme un honneur les bontés du maître.
Lorsque vous arrivez sur une habitation, souvent des négresses touchant presque encore à l’adolescence se glissent chez vous sous un prétexte quelconque. Du temps de la servitude, c’était à la Jamaïque une des offres de l’hospitalité de vous proposer une compagne de nuit.
Une esclave assez belle
Est dans mon atelier, voulez-vous qu’on l’appelle ?
Nous tenons le fait du docteur Spalding, riche créole, dont la sévérité de mœurs s’en indignait en nous le racontant. Nous n’exagérons rien. La servitude engendre plus de vices encore que l’oisiveté ! — Mais nous le demandons, comment en pourrait-il être autrement ? Quelle pudeur chez les femmes, quelle retenue chez les hommes pourraient exister dans un pays ou un maître peut d’un signe obliger une vierge à se coucher par terre, à lever ses vêtemens, et à présenter son corps aux regards et [74] aux coups de son possesseur ? Cela, non-seulement le maître le peut faire, mais aussi le géreur, mais aussi économe, mais aussi le commandeur ; le commandeur ! un esclave qui a nécessairement des passions d’esclave, quelque soit d’ailleurs sa supériorité intellectuelle sur ses camarades ! Il y a quatre hommes sur chaque habitation des colonies qui ont le droit d’y mettre nues toutes les femmes, et de les exposer aux regards de tout l’atelier…
(Il n’existe pas en France une seule société de femmes pour l’abolition de l’esclavage des noirs !)
Comment les lois de la pudeur seraient-elles connues à de pauvres créatures, pour qui la pudicité est impossible ?
Voilà de quelle façon l’esclavage moralise la race noire ?
Tous les colons, mêm lorsqu’ils sont mariés, usent des facilités d’un aussi horrible régime ; car « les hommes ne sont pas du tout raisonnables dans ce pays », ainsi que nous disait une vieille dame créole. Aux colonies, les mœurs sont à la lettre véritablement patriarchales, le rôle de la femme, comme épouse, est encore plus sacrifié que celui de la femme européenne, elle ne s’offense pas même que son mari prenne une concubine dans la couleur, elle ferait presque pour lui ce que Sarah fit pour Abraham [78]. Le mari ne cache que fort peu ses amours étrangers, et augmente sans scrupule la population des sang-mêlés. Rien n’est plus commun aux îles que d’entendre parler, devant des jeunes filles de quinze et dix-huit ans, du bâtard de monsieur tel ou tel. Toutes les servitudes se touchent, et les mêmes causes produisent partout les mêmes effets.
À part cet exemple, que leur donne les sévères détracteurs de la race noire, les nègres sont loin d’être encouragés au mariage ; on a plutôt pris à tâche de les en éloigner. On pensa un [75] jour, en Europe, que l’autorisation de l’administration publique pouvait suffire, sans le consentement des maîtres, aux mariages des esclaves. Le ministère sourit la proposition en 1838, aux conseils coloniaux, ceux-ci la rejetèrent nettement. Le mariage gêne les maîtres dans leurs allures absolues, il restreint leurs droits ; car la loi ne permettant pas de séparer l’homme de la femme, il les empêche de disposer à leur fantaisie de leur propriété. Nous nous rappelons un planteur de Puerto-Rico qui disait : « Je ne voudrais point que mes nègres se mariassent autrement que derrière l’église, comme ils font ; j’aurais trop de peine à les envoyer chacun d’un côté, lorsqu’ils ne s’entendent pas. » Le Code noir a pris soin de placer sous la garantie de la loi cette délicatesse des colons ; il défend aux curés de marier les esclaves sans le consentement de leur maître. Le Code hollandais est plus naïf, il prononce une amende de 500 piastres et la destitution contre le curé qui marierait des esclaves.
« En Europe, un fils, une fille majeure, peuvent se marier malgré la volonté de leurs parens ; aux colonies, un esclave ne peut se marier malgré la volonté de son maître [79]. »
Il est de l’essence de la servitude de démoraliser l’esclave ; la conservation du maître veut que l’esclave soit un être avili, pour qu’il ne puise jamais d’idées généreuses dans la conscience d’une vie régulière.
On enlève aux femmes la pudeur ; aux pères le droit paternel, aux fils le respect filial. À ce nègre barbare qui vendait son enfant en Afrique, le maître arrache ce même enfant, qu’il vend à son gré et à son profit !
C’est ainsi que l’esclavage civilise le noir !
Et le conseil colonial de Bourbon dit, en style mystique, que « l’asservissement des nègres aux blancs est la première visite de Dieu à la race africaine ! » Ô blasphème !
Le petit nombre d’unions légitimes que l’on observe chez [76] les nègres, ne tient pas seulement aux raisons prépondérantes que nous venons d’exposer, il en est beaucoup d’entre eux qui refusent le mariage, bien qu’ils en connaissent la valeur. Pourquoi nous le refusons, disent-ils ? parce que nous ne voulons pas voir notre femme, pour une faute légère, pour un caprice du géreur, du maître, d’un grossier économe, livrée aux mains du commandeur, et taillée nue, en présence de tout l’atelier ; parce que nous n’aurions aucun droit de faire respecter sa pudeur, aucun moyen de nous opposer sans danger à l’agression des hommes blancs ; parce qu’on nous enlèverait nos enfans pour les vendre. J’atteste avoir entendu des nègres parler ainsi.
Les blancs ont pu avilir les nègres, et leur donner des vices, mais il n’ont pu leur enlever à tous l’intelligence et le sentiment que la nature leur accorde, comme aux autres hommes. Les noirs éprouvent la faim, comme nous ; ils éprouvent aussi la douleur et la jalousie comme nous. Il en est qui, jusque dans l’esclavage, pensent et sentent. Ceux-là, voyez-les chefs de famille, et flagellés en présence de leurs fils ; époux, pères, et ne pouvant défendre leur femme, leur jeune fille, les êtres de leur amour que l’on dépouille et auxquelles on inflige le profane supplice !
Tout concourt à éloigner l’esclave des unions durables. La famille n’est point praticable pour lui, jusqu’à un certain point ; le père n’y saurait avoir aucun caractère, l’autorité du maître est toujours au-dessus de la sienne ; quand il dit à son fils : « Vous ferez cela, » et que le maître dit : « Tu ne le feras pas, » le fils doit obéir, non point au père, mais au maître. L’enfant est esclave avant d’être fils.
Plaignez-vous encore que le mariage ne soit pas constitué parmi les esclaves ! Que peut-il être dans un mode d’existence où le père et la mère n’ont point les droits de père et de mère, où le mari et la femme ne sont point investis des droits de mari et de femme, où l’enfant, sorte de bétail doué de la parole, peut être détaché de la famille à un certain âge, comme [77] le poulain et le veau qui n’ont plus besoin du lait maternel ?
Une autre raison, qui s’oppose à la possibilité du mariage pour eux, c’est la presqu’impossibilité où est l’esclave d’une habitation, d’épouser tel ou tel esclave d’une autre habitation, car ils demeureraient alors toujours séparés. En effet, non seulement ils ne pourraient se réunir à leur gré, mais encore le maître ayant droit de vendre son esclave, cette vente pouvant avoir lieu sans sa volonté, par suite de saisie ou de décès, le mari ou la femme seraient toujours exposés à être envoyés à cent milles l’un de l’autre. Les embarras dont nous parlons renaîtraient sans cesse de l’habitude qu’ont la plupart des nègres d’aller chercher leurs fréquentations hors de l’atelier auquel ils appartiennent [80].
Les lois espagnoles qui prévoient tout, ont décrété que « si un esclave d’une habitation veut se marier avec une femme d’une autre habitation, le maître du mari doit acheter la femme, et le maître de la femme est obligé de la vendre, le prix étant fixé à l’amiable ou par arbitre [81]. » Malheureusement les lois espagnoles, en faveur des esclaves, ne sont que des mots. Il n’y a point de nation qui traite mieux ses nègres législativement ; il n’y a que les Américains chez lesquels les nègres soient plus maltraités en fait. Il serait peut être impossible de trouver quarante mariages dans la population esclave de Puerto-Rico. Chez nous, du moins, plusieurs maîtres excités par des sentimens de bienveillance où de pitié, sont arrivés à force de soins et de récompenses à faire légitimer quelques unions libres. Nous avons trouvé vingt-deux ménages réguliers [78] sur l’habitation Gradis. MM. Gradis, à la vérité, pour encourager leurs nègres, donnent 120 francs de dot et font les frais de la noce ; puis, en outre, comme hommage à la pureté du lien consacré, ils ont décidé que les femmes mariées qui mériteraient un châtiment ne seraient plus couchées par terre, ni déshabillées pour le subir, mais le recevraient debout par dessus les jupes.
Lorsqu’on admet le fouet, il faut considérer ces modifications comme un bienfait plein de lumière.
Il serait à désirer que MM. Gradis fussent plus imités qu’ils ne le sont, car il a été observé que les femmes esclaves changent de conduite dès qu’elles se marient, et conçoivent plus de respect pour elles-mêmes. L’idée du devoir qu’elles ont embrassé les relève et les fortifie. Toute idée du devoir est bonne, parce qu’elle amène le recueillement. Serait-ce ainsi qu’il faudrait expliquer la remarque faite, que le nombre des enfans d’une habitation est en rapport d’accroissement avec celui du nombre plus grand des mariages légitimes ? MM. Gradis, par exemple, qui ont vingt-deux mariages, possèdent quatre-vingt cinq enfans au-dessous de quatorze ans dans leur propriété de deux cent-vingt esclaves ; tandis que d’autres n’en peuvent obtenir la moitié sur une population souvent plus considérable. Doit-on croire que les mœurs régulières du ménage inspirent aux mères des soins plus éclairés pour leurs enfans ? Ce serait possible. Cependant, l’explication ne nous paraît pas suffisante, car des propriétés sans mariages sont également favorisées. Ici encore se présente une énigme, celle de la fécondité ou de la stérilité, plus ou moins grande, que l’on observe sur certaines habitations. On serait tenté d’attribuer ces différences à des influences locales, si l’on ne devait supposer plus rationnellement qu’elles tiennent à des traditions, et que sans doute il est des ateliers dont les négresses ne voulant pas avoir d’enfans, usent de moyens connus d’elles seules, pour étouffer le fruit de leur conception, ou détruire leur progéniture à sa naissance. Est-ce la peine de naître, disent ces malheureuses, dont le ven [79] tre donne la servitude avec l’existence, est-ce la peine de naître, pour vivre dans l’esclavage ? Le fait est que sur deux plantations voisines, de nombre égal, gérées uniformément et dont les femmes en couche sont traitées de même manière, il arrive que l’une a beaucoup d’enfans, et l’autre presque pas. Cet affreux état de l’esclavage est tellement anormal, que plusieurs de ses effets restent encore impénétrables, même pour l’observateur le plus sagace et le plus attentif.
En résumé, il ne faudrait pas conclure de ce que l’on vient de lire, que les nègres des colonies vivent dans une promiscuité absolue, sans lois, ni ordre. Ils n’ont pas le mariage comme leurs maîtres, mais ils ont des liaisons ou se retrouve la fixité des relations conjugales. « Leur concubinage est un lien puissant, auquel viennent le plus souvent se rattacher les obligations du mariage [82]. »
Même dans l’état bestial auquel ils sont condamnés, le sentiment de la famille s’est développé chez eux à un très haut degré. Ils conservent sur leurs enfans toute l’autorité compatible avec la servitude, ils honorent profondément leur père, leur mère ; surtout leurs parrain et marraine. Cette seconde paternité a beaucoup plus de force chez eux que chez nous, et constitue de véritables obligations. On voit souvent une mère remettre un enfant à sa marraine, parce que l’influence de celle-ci paraît plus capable de dompter le petit rebelle. Une femme est condamnée au fouet, on appelle le commandeur qui, en l’apercevant, se trouble et change de visage. « Qu’as-tu dit le maître ? » — « Je ne puis la frapper, c’est ma marraine. »
Les colons d’un esprit distingué ne s’abandonnent pas aux petites passions qui troublent le cerveau des autres, et ne dénient point au nègre ses qualités morales, celles même qui, par leur élévation, attestent plus directement la cruauté de l’esclavage ; ainsi nous tenons de M. Levassor Delatouche, [80] que la piété filiale citée par tous les voyageurs comme une qualité distinctive des Africains, ne s’est pas perdue dans la servitude. « Souvent, nous a-t-il dit, un nègre en mourant laisse à son fils des dettes à acquitter, et jamais le legs ne demeure en souffrance. » La dernière volonté du mort, que ne sanctionne ni testament ni notaire, est exécutée comme le serait celle d’un Dieu ; la parole est toute la loi, et quoique la parenté soit généralement fort étendue, les contestations entre héritiers sont tellement rares qu’il serait exact de dire qu’il n’y en a jamais. Les maîtres sont d’accord sur ce point. L’amour filial, dont nous parlons, va quelquefois jusqu’aux plus sublimes sacrifices. Lors des premières évasions qui suivirent l’affranchissement des îles anglaises, quatorze individus de la même famille, appartenant à l’habitation Caritan (de Sainte-Anne, Guadeloupe), résolurent d’aller chercher la liberté. Savez-vous ce qui compromit la fuite presqu’assurée de ces quatorze personnes ensemble ? C’est qu’elles emportaient leur aïeule attachée sur sa chaise ; une paralytique de quatre-vingt sept ans ! À ce propos, nous ne craignons pas d’ajouter que les nègres ont bien plus de considération pour la vieillesse que les blancs. Cinq ou six fois, dans le cours de notre voyage, nous avons vu des nègres rencontrant une vieille femme dans la rue, s’arrêter respectueusement, lui parler d’un air bon et soumis, avec les manières câlines qu’ils savent avoir, et baiser en forme d’hommage la main ridée qu’ils pressaient dans les leurs. La bonne vieille négresse recevait ces marques de vénération fort simplement, d’une façon presque digne et comme chose qui lui était due. Un peintre ferait avec ce que l’on voit aux îles, en ce genre, un beau tableau d’expression.
Dans toutes les colonies, chose bizarre, à quelque nation qu’elles appartiennent, on n’admet point que les gens libres puissent jamais avoir besoin de la charité publique, et les hospices ne sont ouverts qu’aux soldats et aux marins. Nous demandions à M. Lemaire, entrepreneur directeur des deux superbes hôpitaux-de la Martinique, qu’est-ce que devenaient les [81] libres trop pauvres pour se soigner. « Oh ! répondit-il, l’état n’a pas besoin de s’occuper d’eux ; dès qu’un homme de cette classe est malade, ses parens les plus éloignés accourent, se relaient pour le veiller, et trouvent moyen de lui procurer des médicamens. » — Parmi les nègres, on le voit, les liens de famille, tout illégitimes qu’ils puissent être selon le Code, sont légitimés et sanctionnés par la moralité naturelle de leur cœur. Les affections paternelles et filiales restent vivaces, quoiqu’elles ne soient pas fortifiées par l’idée d’une obligation réciproque. Que les amis des noirs aient pleine confiance au régime libre, les mœurs se régulariseront d’elles-mêmes et par la force des choses, comme il arrive déjà dans les colonies anglaises, ou les nègres se marient tous à l’envi. Il ne sera pas plus difficile chez nous qu’il ne l’a été chez nos voisins, de faire comprendre aux femmes noires que la promiscuité leur est dangereuse en cela surtout qu’elle rend la paternité incertaine. Entourées d’enfans, aux besoins desquels elles devront pourvoir, il sera facile de leur montrer, ainsi que l’a dit M. Dreveton, aujourd’hui juge-de-paix à la Pointe-à-Pitre [83], « combien il leur importe de s’attacher par des liens durables le père de leurs fils et de leurs filles, pour qu’il partage les charges de l’éducation. »
Ce sont des faits authentiques, à la connaissance des créoles, signalés par eux-mêmes, que nous avons cités, mais leurs défenseurs n’en répèteront pas moins que cette race est antipathique à l’esprit de famille, et incapable de concevoir le mariage ! Les créoles sont bien mal défendus !
Après tout, ce mariage indissoluble qui a causé depuis des siècles tant de douleurs, de désordres, de trahisons et de crimes, nous avons besoin de dire que nous sommes loin de le regarder comme la dernière formule des rapports de l’homme et de la femme, comme le nec plus ultra de la constitution sociale à venir, notre pensée est au contraire que la raison le réprou [82] vera, de même qu’elle réprouve maintenant les vœux de célibat que l’on eût la démence de regarder long-temps comme un acte méritoire. Le mariage indissoluble n’est pour nous qu’un élément de transition, propre à passer de la promiscuité ou de la polygamie à des attaches sévèrement régularisées par la loi, mais libres, qui purifieront les liens entre les deux sexes, de la contrainte, du mensonge et de l’adultère. Si nous conseillons, si nous souhaitons aujourd’hui pour les nègres le mariage tel qu’il est, c’est qu’ils en sont encore, comme hommes sociaux, à l’état de polygamie, presque de promiscuité, et que le mariage alors ne peut produire pour eux que des effets moraux salutaires.
[83]
CHAPITRE VII.
LE FOUET.↩
Le fouet est l’âme d’une habitation. — Les femmes sont fouettées. — Nécessité des châtimens barbares dans un mode social contre nature. — Une exécution. — Avilissement de quelques nègres. — On juge les esclaves avec le code fait pour des hommes libres. — Il y a des colons qui résistent au contact de la servitude. — Les femmes même sont cruelles aux colonies. — La violence du châtiment dépend beaucoup de la volonté du bourreau. — Le fouet est-il nécessaire ? — Réforme de M. Arth. Clay. — Plusieurs habitans ont déjà supprimé le fouet au jardin. — Le jury d’esclaves chez M. Meat. — Suicides d’esclaves. — On croit aux colonies que la flagellation est dans le droit paternel. — Le fouet en Europe. — Suicide d’un soldat espagnol pour éviter de passer par les verges. — Les législatures des îles anglaises rayent le fouet de leurs codes. — Les tribunaux de nos îles ordonnent la peine du fouet moins souvent aujourd’hui qu’antérieurement.
L’étude que nous avons faite du régime des esclaves veut, pour être complète, que nous examinions la discipline à laquelle ils sont soumis. Ce sera l’objet du présent chapitre.
Le père Labat dit, en rendant compte de son débarquement à la Martinique : « Il vint un grand nombre de nègres à bord. Beaucoup d’entre eux portaient sur le dos les marques de coups de fouet qu’ils avaient reçus ; cela excitait la compassion de ceux qui n’y étaient point accoutumés, mais on s’y fait bientôt. »
La chose est vraie, pour les soudards semblables au révérend père Labat et pour les gens qui arrivent aux colonies, sans avoir l’esprit préoccupé du fait social que nous étudions. Leur cœur s’étonne et s’émeut d’abord à la vue de l’avilissement imprescriptible de toute une race, leurs premières lettres accusent avec chaleur ces impressions, puis il se blasent comme on se blase sur tout, et peu à peu ils adoptent les mœurs et les idées du pays. On s’y fait, selon le mot cruel du père Labat.
Pour le philosophe, il n’en est pas de même. La sympathie que lui inspiraient les esclaves avant de les connaître, s’augmente de toute la douleur que doit produire en une âme élevée le tableau de la plus triste dégradation humaine. Une des choses qui l’afflige davantage, c’est le fouet qu’il entend résonner nuit [84] et jour. — Le fouet est une partie intégrante du régime colonial, le fouet en est l’agent principal ; le fouet en est l’âme ; le fouet est la cloche des habitations, il annonce le moment du réveil, et celui de la retraite ; il marque l’heure de la tâche ; le fouet encore marque l’heure du repos ; et c’est au son du fouet qui punit les coupables, qu’on rassemble soir et matin le peuple d’une habitation pour la prière ; le jour de la mort est le seul où le nègre goûte l’oubli de la vie sans le réveil du fouet. Le fouet en un mot, est l’expression du travail aux Antilles. Si l’on voulait symboliser les colonies telles qu’elles sont encore, il faudrait mettre en faisceau une canne à sucre avec un fouet de commandeur.
Le commandeur qui conduit, surveille et excite l’atelier aux champs, est armé d’un fouet, et l’un des plus ardens défenseurs des colonies, M. F. Patron, membre du conseil colonial de la Guadeloupe, n’a pas nié dans un de ses écrits « les coups qu’il en allonge, durant le travail, de temps en temps aux traînards et aux paresseux. »
Les créoles sont trop unanimes à affirmer qu’il n’y a pas de travail possible sans moyen coercitif, pour qu’on puisse croire que le fouet soit aux mains du commandeur un simulacre sans vitalité ; cependant, redisons-le, durant nos longues courses à travers les campagnes, nous l’avons vu peu remuer ; il est moins actif que nous ne pensions, et l’on n’éprouve, à le voir souvent enroulé sous le bras du chef, que l’horreur instinctive qu’excitent les choses hideuses. — Autrefois, à l’époque où la santé et la vie des esclaves avaient moins de valeur pécuniaire, tout était bon pour punir ces misérables ; depuis l’abolition, il a été donné aux créoles ce problème à résoudre : Faire souffrir un nègre coupable, sans le rendre sérieusement malade, ni le tuer ; et ils ont cru en trouver la solution dans le fouet. C’est aujourd’hui la punition infligée aux esclaves pour leurs fautes de toute nature. Les femmes, comme nous l’avons dit, n’en sont pas plus exemptes que les hommes, et c’est une chose qui augmente l’indignation contre les mœurs coloniales, de [85] penser que ce flétrissant supplice est infligé chaque jour à ces pauvres créatures, dont les propriétaires d’esclaves oublient la faiblesse et profanent la pudeur. Les propriétaires vont se récrier ; il n’importe. Nous serons toujours des premiers à nous défendre des rapports exagérés contre leur cruauté, mais nous voulons aussi nous tenir dans le vrai ; quelque mal sonnant qu’il soit aux oreilles des fustigateurs de s’entendre reprocher leur barbarie, ils doivent subir ce supplice fort doux, en comparaison de ceux qu’ils infligent à leurs esclaves. Nous disons leur barbarie, car fouetter, c’est commettre un acte barbare.
La flagellation peut être ordonnée par l’économe, le géreur et le maître ; au jardin, le commandeur a droit aussi de tailler. Le nombre des coups est proportionné à la faute ; mais dans aucun cas, aux termes de la loi, du moins, on ne doit dépasser celui de vingt-neuf ; telle est la jurisprudence de la Guadeloupe et de la Martinique. Les tribunaux de la Guyane n’ont pas voulu l’admettre ; ils professent que le maître a le droit de donner à son esclave autant de coups de fouet qu’il lui convient, et la métropole les laisse faire. « Considérant, dit un arrêt de la Cour royale de Cayenne, en date du 29 novembre 1840, considérant que le règlement local de 1777 et les ordonnances coloniales de 1825 et 1826, qui limitent le nombre de coups de fouet à vingt-cinq, sont relatifs à la police municipale, et ne s’appliquent pas à la police des habitations ; que dès lors, quelque soit le nombre des coups appliqués, l’appréciation de la légalité du châtiment appartient à l’arbitraire du magistrat, etc. » Avec ces considérant le prévenu impliqué dans la cause fut blâmé, mais non puni comme ayant agi dans le plein exercice de ses droits. Il s’agissait d’une femme de soixante-six ans, mère de onze enfans, qui avait reçu successivement cinq coups de fouet pour manque à l’appel, neuf pour injure envers le géreur, et vingt-neuf pour menace envers ce même géreur !
Lorsqu’on juge l’esclavage d’une certaine élévation, on prend au moins autant de pitié que d’horreur pour les auteurs de [86] telles cruautés ! Elles sont odieuses, mais ce n’est pas une des moindres raisons de la haine vigoureuse qui est commandée à tous les honnêtes gens pour l’esclavage, que la nécessité constitutionnelle de ces actes exécrables. Le droit du maître fondé sur la violence est fatalement condamné à la violence pour se maintenir. La logique veut qu’une société, quelle qu’elle soit, trouve les moyens de se conserver ; quand la société est contraire à la nature, elle ne se peut garder que par des lois contraires à l’humanité. Plus l’obéissance que l’on exige est difficile, plus la peine contre la désobéissance doit être impitoyable et l’on arrive à donner quarante-trois coups de fouet à une femme de soixante-six ans !
Nous avons assisté à une de ces ignobles exécutions ; c’est de visu que nous en pouvons parler. Nous nous trouvions chez M. Perrinelle, lorsqu’on vint lui porter une accusation des plus graves contre un de ses nègres. Cet homme était entré la nuit dans la case d’une femme appartenant à un petit habitant voisin ; il avait brisé la porte, et s’était jeté sur elle. Les cris de la négresse, en attirant du monde, l’avaient seuls préservée des violences du furieux. Il fut condamné au maximum de la peine.
On l’attacha sur une échelle couchée à terre, les bras et les jambes allongés ; on lui assujettit également le corps en travers des reins, précaution indispensable pour le préserver des accidens qui pourraient arriver, si en se remuant, il donnait facilité au fouet d’atteindre le bas-ventre. Ainsi amarré, et le corps mis à nu, l’exécution commença… L’instrument du supplice est un fouet à manche très-petit et à lanière très-longue, dont chaque coup faisait grand bruit. Ces coups furent-ils plus modérés que d’ordinaire, le commandeur en voulut-il ménager la force devant un étranger [84] ? Nous le pouvons croire, car le [87] patient ne faisait qu’un léger mouvement, et il ne sortit pas le moindre cri de sa bouche sauf cette ignoble exclamation : « Pardon, maître. »
Je me retirai avec M. Perrinelle, et nous étions encore dans une petite cour, non loin du lieu d’exécution, lorsque deux minutes après (le temps à peine de détacher les cordes qui le tenaient sur l’échelle), le nègre se présenta droit, ferme, la démarche tranquille, le visage calme, et dit d’une voix non altérée : « Maître, on a donné des rechanges aux autres, pendant que j’étais au cachot ; voulez-vous me faire donner la mienne. » Ce malheureux, évidemment, au physique ne souffrait pas, et au moral n’avait aucune idée de la dégradation qu’il venait de subir. Voilà ce que l’esclavage fait des hommes !
À prendre le fait dans sa nudité, on est tenté de dire que ce nègre fut puni bien légèrement pour un crime, qui à la cour d’assises le pouvait conduire aux galères, surtout quand on se représente que pour une faute à peine punissable selon la loi, il est exposé au même châtiment. Mais le degré de culpabilité de nos actes veut être apprécié en raison du milieu où ils se commettent. Cet esclave vivant dans la promiscuité bestiale à laquelle on les abandonne, n’était pas, cela est clair, la millième partie aussi coupable que nous l’aurions été en faisant ce qu’il fit. Il ne méritait pas le bagne ; c’est pourtant ce qui serait arrivé, si M. Perrinelle avait livré son noir à la justice, au lieu de le juger lui-même ! — En vérité, celui qui cherche à étudier cette société monstrueuse se perd à chaque pas en un dédale inextricable, et le désordre moral des institutions qu’il examine le jette lui-même de contradiction en contradiction. À peine vient-il de maudire l’arbitraire laissé au maître, qu’il lui faut se reprendre et s’en réjouir. Le pourrait-on croire, en effet, les esclaves qui comparaissent devant les tribunaux [88] aux colonies, y sont jugés avec le Code français ! on les tient à l’état d’animaux domestiques, ils ne sont rien par eux-mêmes, la loi les livre à leurs possesseurs, ne leur donne pas de garantie, ne leur sert en aucun cas de défense ; pour elle enfin, ils sont des choses mobilières ; puis commettent-ils une faute, un crime, elle s’empare d’eux, leur intente un procès en règle, et les condamne au nom de ce Code fait pour des citoyens qui ont la responsabilité de tous leurs actes, parce qu’ils en ont toute la liberté !
On vient de voir un propriétaire juger et condamner souverainement son nègre pour un crime capital. Il y a trois cents êtres humains dont M. Perrinelle peut ainsi disposer presqu’à son gré ! Mais nous n’hésitons point à confesser la vérité toute entière ; il instruisit la cause avec un soin extrême, et non pas en homme gâté par l’usage du pouvoir absolu. Il fit venir la négresse attaquée, celle que l’on prétendait aller trouver, et le petit propriétaire blanc aussi ; il les entendit contradictoirement avec l’accusé, et sa conviction put être complète !
IL est ainsi des colons qui ont résisté à l’horrible contact de la servitude. Un d’eux nous a dit, mais pourquoi ne pas le nommer, c’était M. Lejeune Delamotte : « Le propriétaire d’esclaves, monsieur, a de cruels soucis. Son oreiller est confident de bien des inquiétudes. Que de fois j’ai été troublé par la crainte d’infliger un châtiment injuste ! Et lorsque cela m’est arrivé ; honteux, chagrin, de ne pouvoir le reconnaître ; car, hélas ! nous devons être infaillibles à leurs yeux, que n’ai-je pas fait auprès de la victime pour réparer ma faute, et la lui faire oublier. » Ô mystère de notre âme, il peut conserver sa délicatesse, celui qui a toujours sous les yeux le spectacle de châtimens barbares, celui qui vit en présence d’une race avilie et réduite aux proportions de la bête de somme ! L’esclavage est cependant un tel dissolvant de toute sensibilité ; que les femmes mêmes, elles si bonnes, deviennent aux colonies d’une cruauté spéciale, s’il est permis de dire ; on en peut voir qui châtient de leurs propres mains, avec une corde ou une cravache, des en [89] fans qui pleurent et poussent des cris à briser Le cœur. — L’esclavage rend les femmes cruelles, vous voyez bien qu’il faut détruire l’esclavage. — Mme Letellier, dans ses Esquisses de mœurs coloniales, l’a dit avec la finesse propre à son sexe. « Il y a dans les rapports des créoles avec leurs esclaves une barbarie qui s’ignore elle-même et qui, si l’on peut profaner cette expression, à quelque chose de candide. » Pauvres enfans, ceux des noirs sont battus, ceux des blancs s’accoutument à battre ! « La manière dont on nous élève nous habitue à ne pas distinguer nos esclaves de nos chevaux. C’est une grande pitié de voir des marmots frapper de misérables domestiques dont ils connaissent déjà la dépendance, et se préparer par cette violence prématurée à la tyrannie d’un autre âge [85]. »
Les châtimens corporels furent autorisés dès les premiers temps de l’esclavage. À une époque où ils entraient dans l’éducation publique et particulière, ils ne pouvaient manquer d’être regardés comme indispensables au maintien de l’autorité du planteur, et l’on devait naturellement croire qu’un homme esclave ne donnerait point son travail et sa peine sans y être forcé par des moyens coercitifs. La toute-puissance du maître resta long-temps illimitée à cet égard, et plus d’une fois devint meurtrière. Ce ne fut qu’en 1783, qu’une ordonnance locale du 25 décembre, confirmée depuis par l’ordonnance réglementaire de Louis XVI, 15 octobre 1786, fixa à vingt-neuf le nombre de coups de fouet, que l’on ne peut dépasser dans une flagellation. L’idée est généreuse, mais la limite reste encore trop étendue, le mot d’un négrophile anglais contre l’esclavage s’applique très-bien ici : On ne peut pas plus régler humainement le fouet que l’assassinat. La force du bourreau répond à humanité du maître ; s’il le désire, vingt-neuf coups de fouet ne produiront aucun effet ; mais celui qui le voudra peut, avec quinze seulement, mettre l’homme le plus vigoureux sur le grabat pendant six mois, Nous avons lu au Moule (Guadeloupe), un procès-verbal de médecin appelé pour [90] constater l’état d’une négresse et de sa fille, qui toutes deux avaient porté plainte en châtiment excessif. Il y était dit : « La femme a reçu quinze à vingt coups de fouet qui ont opéré sur la partie gauche une solution de continuité de deux lignes de profondeur et de trois pouces de longueur. » Cette femme était déclarée ensuite hors d’état d’être transportée. Pour la jeune fille, on ajoutait simplement : « Elle a reçu douze à quinze coups de rigoise, qui sont en bonne voie de guérison ! » Dans l’affaire Brafin, dont nous avons parlé plus haut, deux médecins au rapport constatèrent sur la femme Marie-Josèphe, le docteur Frasque, « Seize ou dix-sept contusions avec excoriation ; » le docteur Regnier, « une vingtaine de plaies en partie cicatrisées, en partie en suppuration. » Sur Jean-Louis, le docteur Regnier constata « dix-huit à vingt excoriations, déjà en partie cicatrisées. » Le fouet avait lacéré et emporté la peau. Et cependant Brafin, dans l’un et l’autre cas n’avait pas excédé le nombre légal. Comme on l’a vu, c’est un homme sans cruauté, il n’avait frappé que vingt à vingt-quatre coups, quoique la loi lui permit d’en frapper vingt-neuf. Il s’était arrêté quand il avait cru avoir fait assez de mal, la loi lui permettait d’en faire davantage !
Le fouet est-il nécessaire ? Les créoles tombent dans de singuliers embarras sur cette question qui, grâce au ciel du reste, ne peut plus être admise qu’aux colonies. Presque tous s’accordent à répondre que sans le fouet ils ne pourraient obtenir de travail de leurs esclaves ; puis en même temps ils se moquent de notre sensibilité, et affirment que le fouet n’est pas ou est peu douloureux. Si cela est vrai, pourquoi donc y tiennent-ils ? Si la moitié au moins de leurs ateliers, selon leur propre parole n’a jamais été taillée, pourquoi donc représentent-ils la rigoise comme une force morale avec laquelle seule ils peuvent conduire leurs nègres ? N’est-ce pas une barbare contradiction que d’exalter la douceur du régime imposé aux esclaves, et de soutenir qu’on n’en peut rien tirer que par la violence ?
C’est aux colonies même, cependant, et parmi les créoles propriétaires que nous trouverons les meilleurs argumens contre [91] l’abjecte punition. M. Arthur Clay, connu pour bon administrateur, a supprimé le fouet chez lui depuis 1832 ; il l’a remplacé par la détention de nuit, qu’il regarde en raison des goûts de vagabondage nocturne qu’ont les nègres [86], comme une punition beaucoup plus sévère pour eux ; et il s’en trouve fort bien. Avant d’aller plus loin, hâtons-nous de le dire, M. Arthur Clay n’est pas du tout un philantrope ; triste, aigri, ce colon distingué ne nous à pas semblé faire grand cas des hommes, quelle que fut la teinte de leur peau. Ennemi de l’abolition, ce n’est point parce que le fouet est dégradant qu’il l’a brisé, c’est parce qu’il l’a trouvé peu efficace ; l’importante réforme dont il est l’auteur, est due à un raisonnement spéculatif, et bien qu’il soit peut-être le seul propriétaire qui ait tenté cette épreuve, sa réussite doit être d’un grand poids pour tranquilliser l’esprit des abolitionistes.
Fait remarquable : pendant que M. Arthur Clay supprimait complètement le fouet au Lamentin, M. Duminay, commissaire de police de Saint-Pierre, chargé de l’inspection de deux prisons de cette ville, y obtenait de grands avantages par la même voie. Il réduisait à l’obéissance avec le cachot solitaire, purement et simplement, des condamnés à la chaîne, voleurs incorrigibles [87] dont il n’avait jamais pu rien faire avec la rigoise.
Ajoutons que depuis 1826, époque à laquelle le parlement anglais admit le droit de rachat par le pécule, le fouet fut retiré des mains du commandeur dans toutes les colonies de la Grande-Bretagne, et que la culture n’en alla pas plus mal. Un jour, à la Dominique, pensant à cela, nous fûmes particulièrement frappé du soin que mettaient à leur tâche des laboureurs libres, « ainsi donc ces nègres travaillent bien sans con [92] trainte, dis-je à M. Johnson, géreur de l’habitation que nous visitions, « oh ! oui, nous répondit-il, décidément l’argent est un véhicule plus actif que le fouet. » Eh ! pourquoi aller chercher nos exemples à la Dominique, quand nos colonies mêmes en offrent à qui veut les voir, M. Lacharrière, M. Lignières, M. Alphonse Bouvier, M. Eggimann, tous créoles, tous propriétaires à la Guadeloupe, ont supprimé le fouet en partie sur leurs biens ; déjà leurs commandeurs ne le portent plus au jardin, leurs nègres ont cessé d’être conduits au travail comme des troupeaux de mulets. Plusieurs autres habitans m’ont déclaré qu’ils sont assez sûrs de leurs ateliers pour compter qu’une pareille amélioration ne nuirait aucunement à leur régime, et que s’ils conservaient encore l’ignoble instrument, si le commandeur taillait encore les heures à coups de fouet, plutôt que de sonner une cloche, c’était pour ne point blesser l’esprit général du pays qui sympathisait peu avec ces innovations !
Revenons aux réformes de M. Arthur Clay, il a également cherché à faire tourner les punitions à son profit. Vue en grand, la chose devient de très bonne économie politique ; ainsi, pour une légère faute qu’un autre fait payer de cinq ou six coups de fouet, il demande au coupable un paquet d’herbes de plus [88], ou bien il l’oblige à travailler hors d’heure [89]. Aujourd’hui cela est illégal, mais comme de pareils moyens ne blessent aucunement l’humanité, ils pourront être heureusement employés et seront sans doute profitables, car un propriétaire instruit, M. Guignod, à qui nous en parlâmes, nous répondit : « Oh ! si vous me permettez de faire travailler hors d’heure, je vous livre mon fouet volontiers ; je ne l’aime pas, et encore aujourd’hui je n’ordonne cette punition qu’avec répugnance. »
Un autre planteur, M. Meat Dufourneau, tout en pensant que le fouet est l’unique moyen de répression applicable à des [93] esclaves, a voulu se soustraire au dégoût personnel que ce moyen lui inspire. Pour cela, il a établi un jury composé des meilleurs sujets de l’habitation qui décide des châtimens à infliger ; toute faute est déférée à ce tribunal sans que le maître intervienne jamais, et M. Meat se loue extrêmement de cette institution. Elle a diminué le nombre des châtimens en diminuant celui des coupables. M. Meat a remarqué que les arrêts du jury esclave étaient d’une équité extraordinaire, et nous avons eu lieu d’être frappé nous-même, en causant avec quelques-uns des hommes récemment punis, de la droiture naturelle propre au caractère nègre ; tous convenaient naïvement qu’ils avaient mérité la peine. À Brest, il n’est pas un forçat qui ne dise avoir été condamné injustement, et ne présente mille causes d’excuse pour sa conduite.
La majorité des colons, nous avons regret de le dire, non-seulement ne partage pas les répugnances de M. Meat, mais ils conçoivent de la haine pour ceux qui les manifestent ; ils veulent le maintien du fouet, et défendent leur rigoise avec le même aveugle fanatisme qu’ils défendent l’esclavage ; ils sont tellement corrompus par l’atmosphère de servitude où ils respirent, qu’ils croient à la vertu de la force, à la morale du knout et à l’efficacité de la contrainte pour diriger les hommes. Ils ont poussé de pareils principes à l’état de théorie, nous en avons entendu nous dire que s’ils n’avaient pas été châtiés corporellement durant leur jeunesse, ils seraient devenus des scélérats ; que leurs mauvais penchans n’avaient cédé qu’à la terreur des coups ; et plusieurs d’entre eux jugent nécessaire et se croient encore permis de battre leurs enfans pour réprimer les fautes ou modifier le caractère de ces petits êtres délicats et impressionnables ! En étayant leur cause de moyens aussi outrageans pour la raison et l’humanité, ils ne rendent que plus sensible l’impossibilité où ils sont d’en trouver de meilleurs. Ils ont contre la réforme toutes sortes d’objections étranges, ils rapportent, par exemple, que des nègres offrent de recevoir vingt-neuf coups de fouet pour [94] dix sols. Que prouve cela ? sinon que ces nègres ont la sensibilité du système nerveux complètement émoussée ? Ne se présente-t-il pas quelquefois de pareils phénomènes dans les hôpitaux ; n’y voit-on pas des malades subir sans éprouver de douleur, des opérations fort douloureuses ? En tout cas, si le fouet ne fait pas de mal, à quoi bon le conserver ? On dit encore qu’un nègre aime mieux recevoir vingt-neuf coups de fouet, que d’être condamné à quatre nuits de prison [90], cela peut être du moins pour quelques-uns des plus abrutis [91]. Mais s’agit-il de ce que les esclaves préfèrent ? Non, non ; il s’agit de les [95] relever eux-mêmes de leur déchéance en leur infligeant pour leurs fautes des châtimens qui ne dégradent pas [92], il s’agit de leur apprendre que l’homme ne doit pas être assimilé à un animal, et qu’il est respectable par la raison qu’il est homme. — L’éducation morale des nègres est à faire comme celles des blancs ; les esclaves, il faut bien l’avouer, ne sentent point l’ignominie du fouet ; élevés sous la rigoise ils l’adoptent comme une aide naturelle de homme libre contre l’homme esclave, comme la conséquence nécessaire d’une position faite, comme un droit que dans leur ignorance ils supposent légitime, comme un agent régulier enfin de tout supérieur vis-à-vis de son inférieur. À peine ont-ils échappés à la servitude qu’ils veulent battre les esclaves à leur tour, et l’on en voit fréquemment venir demander à la justice de paix le châtiment d’un ancien compagnon d’infortune qui a manqué aux prérogatives du nouveau libre.
Ces habitudes de violence ont passé jusque dans la famille des esclaves, les enfans y subissent des corrections de toutes mains, et par suite leur naturel s’endurcit de génération en génération. — Nés pour être hommes, la servitude en fait des brutes, et quand ils en sont là, nous, avec la sécheresse et l’orgueil que donne la civilisation, nous les déclarons indignes d’être appelés à faire partie de humanité ! — Les esclaves ne mettent point de limites au droit paternel de flagellation, et il n’est pas rare qu’une [96] mère vienne prier le maître de faire tailler son fils ou sa fille âgée de vingt-cinq et trente ans « parce qu’ils ont failli au respect qu’ils lui devaient ! » Pourquoi s’étonnerait-on de pareilles choses ? les pauvres esclaves ne sont-il pas des hommes tout à fait ? Je reprochais à une vieille négresse d’avoir fait tailler ainsi son fils. Oh ! répondit-elle, comme aurait pu dire une de nos douairières : « Les enfans d’autrefois obéissaient mieux à leurs parens. » Que l’épiderme soit blanche ou noire, la matière cérébrale est toujours la même.
C’est pour cela qu’il arrive aux colons, dans ce débat, ce qui arrive à tous les avocats d’une mauvaise cause, ils cherchent à justifier le mal par le mal ; leur plus grand argument, pour repousser nos attaques contre le fouet, c’est qu’il est encore admis dans le code maritime de France, dans le code maritime et militaire de l’Angleterre, etc. Il est vrai, hélas, mais que ne fait-on point pour rayer de ces codes des articles aussi déshonorans ? En Angleterre, la presse entière ne s’indigne-t-elle pas à chaque application de la loi cruelle ; des pétitions collectives ne sont-elles pas envoyées chaque jour au parlement impérial contre cet horrible abus ? Et chez nous, que de restrictions viennent modifier l’horreur de ce qui en reste ! La peine ne peut être prononcée que par un conseil de guerre, on ne l’emploie que pour des crimes graves, comme le vol ou la révolte, et elle n’est applicable qu’en mer. Une fois à terre ou en rade, le matelot rentre sous l’égide de la loi commune, et ne peut plus recevoir de châtimens corporels, enfin, le nombre des coups, même pour un récidiviste, ne peut dépasser douze. Rien n’est laissé à l’arbitraire, pour ces actes ou la violence peut avoir tant de part, et malgré de telles garanties l’humanité et la civilisation qui les condamnent prévalent encore sur la loi qui les autorisent. Le ministère de la marine dans ses instructions confidentielles, nous le tenons de plusieurs officiers ; engage les états-majors des vaisseaux de l’état à n’user du hideux article de leur législation que dans les cas les plus extrêmes.
Au moment de notre visite à l’hôpital de San Juan (Puerto [97] Rico), nous trouvâmes une terrible protestation contre ces lois barbares, au nom desquelles on cherche à justifier un état social infâme. Trois chirurgiens entouraient un soldat qui allait expirer ; il avait la tête ouverte et les deux épaules brisées. Le malheureux, condamné à passer par les baguettes, s’était précipité du haut des remparts. Pour nous consoler de ce triste souvenir, disons qu’aux îles anglaises les lois prennent, d’année en année, plus de mansuétude, et se purgent des dernières traces de cruauté qu’elles conservaient. Le tread mill est partout livré aux vers et la législature d’Antigues par un act du 25 septembre 1840, celle de la Jamaïque, par un acte de la même année, viennent d’abroger pour toujours la peine du fouet. Les punitions barbares s’enfuient avec la barbarie propre à la servitude.
Pendant que nos créoles français disputent encore leurs rigoises aux progrès du siècle, les créoles anglais délivrés à peine depuis deux ans de l’esclavage, éloignent les châtimens corporels, même de leurs geôles et de leurs prisons !
Comparez les saintes inspirations de la liberté avec les sombres désirs de la servitude !
N’en faisons aucun doute, les peines ignominieuses et violentes seront effacées de notre code maritime et du code colonial, comme de toutes les législations du monde. Il faut que la vue ne soit plus affligée par l’affreuse rigoise que l’on trouve pendue à la muraille dans quelqu’habitation que l’on pénètre, Au reste, les mœurs générales qui s’épurent, attaquent sourdement la vieille puissance du fouet, elles le proscrivent en dépit des théories contraires. Nous avons entendu un avocat plaidant à Fort-Royal, dire en plein tribunal : « On aurait pu infliger la peine corporelle que nos codes autorisent encore, etc. » Il a été remarqué aussi que depuis plusieurs sessions, les tribunaux des îles ont assez souvent prononcé quinze jours, un mois, où trois mois de chaîne de police pour délits qu’ils punissaient autrefois de la rigoise. Ce sont là de bons symptômes, sur lesquels les réformateurs peuvent faire compte sans s’in [98] quiéter de la résistance des créoles aveugles. Le fouet s’en va. Il disparaîtra.
Avant d’abandonner ce triste sujet, il nous reste une observation à faire. Si nous l’avons traité aussi longuement, ce n’est point dans l’hypothèse que la servitude ait encore des chances de durée, et que la suppression des châtimens corporels puisse être un amendement à y introduire. Il n’y a plus à s’inquiéter de savoir si ce moyen de coercition est utile vis-à-vis des nègres, car c’est précisément parce qu’on fustige les esclaves, qu’il ne doit plus y avoir d’esclavage. Dans notre opinion, l’esclavage doit cesser et cessera avant peu par la volonté de la métropole avec le libre consentement des maîtres, ou par la seule volonté des nègres. Nous n’avons donc parlé du fouet que comme d’une des faces de la servitude, et si nous avons discuté sa valeur, c’est en vue des habitations pénitentiaires dont nous proposons l’établissement pour accompagner l’émancipation. Au sein de ces hideux repaires, que nous appelons bagnes, les gardes chiourmes ne peuvent plus se servir de leurs bâtons qu’en cas de défense personnelle. Pourquoi le fouet resterait-il toujours indispensable vis-à-vis des laboureurs de nos Antilles ?
[99]
CHAPITRE VIII.
MARRONAGE ; DÉSERTION À L’ÉTRANGER.↩
Le cachot. — La chaîne de police. — La barre. — Les fers. — Le carcan. — Étymologie probable du mot marron. — Il y eut des marrons dès qu’il y eut des esclaves. — Législation atroce contre eux. — Receleurs de marrons. — Marrons reconnus libres après plusieurs années de guerre, à la Guyane hollandaise, à la Jamaïque et à Saint-Domingue. — Vie des marrons. — Les trois sortes de marrons. — L’exorcisme. — Jarrets coupés. — Le marronnage dépend de la bonne ou mauvaise administration du planteur. — Évasions. — La surveillance la plus stricte ne peut les prévenir, ni les périls de la traversée les empêcher. — Deux esclaves se faisant conduire à Antigues par leur maître. — Il n’est pas vrai que les nègres réfugiés veuillent revenir. — Le gouvernement anglais s’oppose à ce qu’on les enlève de force, mais non pas à ce qu’ils partent quand ils veulent. — Les esclaves danois s’enfuient à Tortola, ceux de Puerto-Rico à Saint-Domingue.
Après avoir parlé du fouet, complétons l’examen de la législation pénale des ateliers d’esclaves, Le cachot dont il a été plusieurs fois question est, sur le plus grand nombre des établissemens, une salle convenable, quelquefois pas autre chose qu’un vieux magasin abandonné ; sur d’autres, et cela particulièrement à la Guadeloupe, c’est une chambre basse, étroite, à voûte arrondie, dont le séjour doit être évidemment funeste à la santé. Le cachot dans lequel Douillard Mahaudière enferma Lucile pendant vingt-deux mois n’avait que quatre pieds de haut, six de large et neuf de long, avec une porte de vingt-quatre pouces sur dix-sept.
Les habitudes de l’esclavage corrompent l’esprit à un point qu’on ne saurait dire, et familiarisent déplorablement le cœur avec ces détestables choses. Un propriétaire de la Martinique, vieil homme respectable et bon, que l’on étonnerait beaucoup si on lui disait qu’il commet une atrocité, tient de ses ancêtres, et conserve, sous le nom de prison, une cage en bois plein, haute tout au plus de trois pieds, véritable bière, dans laquelle on ne peut entrer qu’en rampant [93]. Un jeune [100] homme à qui je communiquais mes réflexions sur cet horrible boîte, lui faisant observer que l’air y pénétrait seulement au moyen de quelques trous, me répondit d’une manière fort calme : « Mais, monsieur, ils ne sont pas là pour avoir leurs aises ! » Il avait à peine vingt-cinq ans.
Comme nous l’avons déjà expliqué, on n’use guère du cachot que pour la nuit. Généralement le planteur qui veut infliger à son esclave une longue détention, l’envoie à la geôle où il est attaché à ce qu’on appelle la chaîne de police, avec les condamnés de la police correctionnelle. Les femmes, comme les hommes, peuvent être appliquées à cette chaîne. On les voit journellement dans les rues accouplés deux à deux, de même que nos forçats, affligeant l’oreille du grincement de leurs fers et occupés à des travaux de nettoyage sous la conduite de gardiens armés d’une grosse rigoise.
Les îles anglaises recueillent déjà plus d’un bénéfice de la liberté. Nous avons dit qu’elles n’ont plus de fouet, nous pouvons ajouter ici qu’elles n’ont plus de chaînes, ni au dedans ni au dehors de leurs prisons. On n’y entend plus nulle part ces bruits de l’enfer qui attristent encore des villes comme Brest et Toulon.
Outre le fouet et le cachot, il y a encore la barre [94]. Au pied d’un lit de camp est une poutre percée de trous où l’on enferme une jambe ou les deux jambes du condamné, à la hauteur de la cheville. On trouve des barres sur chaque plantation, dans presque chaque maison ; c’est un meuble de ménage à l’usage des colonies. Il n’y a pas d’hôpital qui n’ait sa barre pour les nègres attaqués de mal pied que l’on veut empêcher de marcher. Sous un régime de violence, tout doit revêtir des formes violentes, même le bien.
Le planteur a aussi le droit d’user de chaînes : elles sont [101] de diverses espèces, tantôt liées au-dessus de la cheville et retenues à la ceinture comme celles des forçats, tantôt attachées aux deux pieds, de façon à rendre toute course impossible. — Enfin on se sert du carcan, collier sur lequel sont quelquefois rivées pour les hommes dangereux, deux grandes branches ramifiées en forme de cornes de cerf, qui s’élèvent de chaque côté au-dessus de la tête, pour empêcher celui qui les porte d’entrer dans les bois.
Après ce lugubre énuméré, c’est notre devoir d’ajouter que pas une seule fois nous n’avons vu ce carcan à branches en application, et rarement les chaînes, quoique nos excursions à travers les campagnes des deux îles aient été nombreuses. Nous ne pouvons oublier toutefois une femme, le col enveloppé d’un épais et large collier auquel étaient attachés trois énormes anneaux sans autre destination, je pense, que d’augmenter la gêne par leur ballottement ! Elle n’en paraissait pas trop souffrir, et remplissait sa tâche au milieu des rangs [95]. Oh ! la servitude ! la servitude !
Toute peine infligée à un coupable inspire de la tristesse ; on ne visite jamais les prisons sans avoir le cœur serré, mais ce bruit de gros fers, ce carcan au col d’une femme particulièrement, firent naître en nous des sensations bien plus pénibles que la tristesse. Il faut persister à croire que la science économique trouvera des procédés moins hideux pour réprimer les mauvais.
Le crime de cette femme était grand : elle avait attaqué en elle-même la propriété de son maître, elle était coupable de ne pas vouloir rester esclave, d’être une incorrigible marronne. On venait de la reprendre pour la troisième fois.
On appelle marron l’esclave qui s’enfuit. Aucun auteur, à notre connaissance du moins, n’a donné l’origine, ni l’éty [102] mologie de ce terme. Il nous vient, sans doute à nous, des Espagnols qui appelaient cimarron le nègre fugitif. Ils appliquaient primitivement ce terme aux animaux qui, de domestiques, devenaient sauvages, lorsqu’un accident quelconque les éloignait du milieu des hommes, et c’est pour cela sans doute qu’ils l’ont étendu jusqu’à leurs nègres. Puisque l’on dit cochon marron, pourquoi ne pas dire nègre marron ?
Il y eut des marrons dès qu’il y eut des esclaves ; le père Dutertre et le père Labat, dans leurs histoires des premiers établissemens coloniaux, en parlent beaucoup. Le père Dutertre cite, dès 1639, une évasion d’esclaves assez considérable à Saint-Christophe, pour inquiéter l’île. Tous les inconvéniens, tous les vices, tous les crimes de l’esclavage, sont co-existans avec sa création ; on les voit naître avec lui et se perpétuer à travers les atrocités légales ou illégales que commettent les maîtres pour les prévenir.
Tout le monde a entendu parler du fameux arrêté du conseil de la Martinique, en date du 13 octobre 1671, qui permettait aux habitans de faire couper le jarret à ceux de leurs nègres pris en récidive d’évasion [96]. L’édit de 1685, connu sous le nom de Code noir, trouva le moyen bon, et régla, comme suit, la pénalité du marronnage : « Le nègre, marron pendant un mois, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur l’épaule gauche ; s’il récidive, il aura le jarret coupé et sera marqué sur l’autre épaule ; enfin, la troisième fois, il sera puni de mort. » Le Code noir prononce aussi la peine du fouet, de la marque et de la mort, contre tout attroupement de nègres de différens maîtres, soit chez l’un des maîtres, soit sur les grands chemins.
Les Espagnols, quoi qu’on en veuille dire aujourd’hui, n’étaient pas moins hideusement cruels que nous. Ils pendaient l’esclave dont l’absence s’était prolongée au delà de six mois [97]. [103] Ils le regardaient comme un pestiféré moral qui avait contracté, sous les arbres de la forêt, la maladie de l’indépendance, et la pouvait communiquer aux autres.
L’article du Code noir, qui nous épouvante, ne parut cependant pas assez énergique. Le 1er février 1743, une déclaration du roi y ajouta la peine de mort contre tout esclave surpris en marronnage, porteur d’armes blanches ou à feu !
On ferait presqu’un volume avec les dispositions réglementaires, les arrêtés de police, les actes des autorités locales et métropolitaines rendus au sujet de la fuite des esclaves ou contre ceux qui les cachaient, appelés par les décrets du nom de receleurs.
La pénalité pour le recel des esclaves est la même que pour le vol, elle prononce de plus une indemnité en faveur du maître, de 15 francs par jour pour tout le temps qu’il est demeuré privé de sa chose. « J’ai vu, dit un vieux magistrat, qui nous est connu, un père et un frère ainsi condamnés pour avoir caché, l’un, son fils, l’autre, son frère. Les deux receleurs qui avaient acquis quelques biens furent entièrement ruinés. »
Dans la loi coloniale du 10 juin 1802, il est dit : « S. M. a ordonné et ordonne que les nègres libres qui cachent dans leur maison des esclaves fugitifs, recèlent ce qu’ils volent, ou sont complices de leurs méfaits, seront privés de leur liberté et vendus conjointement avec leur famille ! » Lorsqu’on n’étudie pas ses actes, on ne peut imaginer tout ce qu’il y avait de barbarie et d’iniquité dans le cœur du grand Napoléon.
Mais rien peut-il vaincre l’esprit de liberté dans certaines âmes. Aucune colonie n’a échappé au fléau du marronnage, c’est un des mille maux attachés à leur constitution coloniale. On voit, en parcourant les annales des Antilles, que les marrons, réunis en bande, furent à toutes les époques, pour le repos du maître, des ennemis dangereux, quelquefois cruels, toujours habiles et redoutables. — La configuration montagneuse des îles, et les forêts encore inexplorées dont leurs pics sont couverts, offrent aux fugitifs des retraites impénétrables.
[104]
Il ne faut s’être qu’un peu occupé d’esclavage pour savoir qu’à Surinam et à la Jamaïque, les marrons devinrent si puissans que la Hollande et l’Angleterre, malgré leur science de la guerre et toute la force de nombreuses troupes réglées ne purent les réduire, et obligées à la fin de traiter avec eux, leur firent une part en reconnaissant leur indépendance.
1710, 1728, 1730, 1749, 1761, 1763 sont des années célèbres dans l’histoire de la vieille Guyane hollandaise. En 1761 les marrons appelés Oucas, furent sur le point de délivrer le pays de la domination européenne. Leur insurrection finit par un traité de paix signé entre les commissaires de la colonie et seize capitaines noirs. L’allocution que le nègre Araby, l’un d’eux, fit aux commissaire, mérite d’être rapportée : « Nous désirons que vous disiez à votre gouverneur et à votre conseil que s’ils ne veulent plus voir de révolte, ils doivent prendre garde que les planteurs traitent mieux leurs esclaves et ne les abandonnent pas à la conduite de commandeurs et d’intendans ivrognes qui punissent les nègres avec injustice, subornent leurs femmes et leurs filles, négligent ceux qui sont malades, et chassent de la sorte dans les forêts un grand nombre d’hommes laborieux qui vous gagnent votre subsistance, sans lesquels la colonie ne pourrait se soutenir, et à qui enfin vous êtes trop heureux de venir demander aussi désagréablement la paix. »
Il se passa dans la guerre qui avait précédé ce traité un incident curieux. Un détachement de troupes hollandaises s’étant avancé à travers les forêts jusqu’au près de l’Orénoque, fut rencontré par une tribu de nègres libres, qui en fusillèrent quelques-uns et firent les autres esclaves. Si la loi du talion pouvait être excusée, ce serait certainement dans un cas semblable.
Il s’était formé peu à peu derrière les établissemens hollandais et séparés d’eux par d’immenses savanes, sur une étendue d’environ cent lieues, une série de petites républiques [105] toutes totalement indépendantes, et dont le nombre des habitans était évalué en 1790 de quinze à vingt mille [98].
Un auteur anglais, M. Dalloz, a fait deux volumes des guerres des marrons de la Jamaïque [99]. En 1722, les habitans, après de vains efforts répétés pour dompter leurs esclaves déserteurs, transigèrent, afin de se mettre à l’abri de leurs déprédations, et leur accordèrent quinze cents acres de terrain au fond des montagnes bleues, où ils ont formé des établissemens qui subsistent encore aujourd’hui.
L’orgueilleuse Saint-Domingue, aux plus beaux jours de sa gloire et jusqu’à sa chute, ne cessa jamais d’être infestée de marrons dont les expéditions audacieuses firent bien souvent rêver les magnifiques créoles au milieu de leurs fêtes. Nous renvoyons en note une esquisse de l’histoire de ces marrons, tracée par un ancien habitant, qu’on lira sans doute avec curiosité. On y peut voir que Saint-Domingue recelait dans les montagnes de la Neyba une république de nègres indépendans, comme la Jamaïque dans les montagnes bleues [100]. [106] Les plus petites colonies eurent leurs marrons habiles et invincibles ; la Dominique même, qu’il est facile de parcourir en tous sens presqu’en un jour, n’échappa point au fléau, et l’on y conserve encore le souvenir d’une de bande cinq cents marrons qui sortirent en 1813 du morne où ils étaient retirés, attaquérent Roseau, la ville capitale, et menacèrent la race blanche de sa destruction.
Les îles anglaises, sont désormais affranchies de ces nouvelles invasions de barbares. Les fuyards de la servitude qui vivaient cachés dans l’ombre, ont reparu de tous côtés au grand [107] jour de l’indépendance. La liberté n’a point de marrons.
Chez nous, au contraire, comme à la Havane, il existe toujours un noyau de ces hommes perdus pour la société, que tous les moyens dont les créoles et l’autorité ensemble disposent, ne peuvent détruire. Encore aujourd’hui on fait monter pour la Guadeloupe à quinze cents et pour la Martinique à deux milles le nombre des esclaves que l’on sait dans les grands bois. Séparés en petits camps de quatre-vingt, cent, cent-cinquante, rarement plus de deux cents, établis sur la crête de pics inaccessibles, ils mènent, sous un chef plus ou moins despote, [108] une vie de sauvages avec femmes et enfans. Échappés des cases à nègres, ils n’ont apporté là que les impressions de leur étroit passé ; ils se contentent de vivre, et bornent leur existence à chasser, pêcher quand ils peuvent, cultiver quelques racines, et veiller à leur sûreté. On ne saurait, en bonne justice, demander beaucoup plus à ces pauvres anciens esclaves, séquestrés du monde entier, inquiets, privés de tout, et n’ayant de la civilisation que ce qu’ils lui peuvent voler dans leurs excursions nocturnes. Tout fondement de quelque chose de régulier est impossible pour eux, car on les poursuit de temps à autre, et le [109] premier acte des blancs qui dépistent un retraite de nègres, est de brûler les cases, abattre les bananiers et ravager les champs de manioc et de patates qu’ils rencontrent. Le camp, ainsi attaqué, laisse sur la place quelques uns de ses morts, s’enfonce plus avant dans l’obscurité des forêts encore vierges, où on ne peut l’atteindre, et tout est à recommencer d’une et d’autre part. On les découvre à la fin, parce qu’ils ne peuvent faire le vide autour d’eux, mais ils ont une adresse extrême à savoir se préserver des surprises ; leur place pour cela est toujours bien choisie, leurs approches sont hérissées de pièges mortels, [110] et faute de pouvoir les anéantir en masse, il a fallu se décider à les laisser jusqu’à ce que s’élève parmi eux un homme de génie qui, les faisant passer à l’état d’agresseurs, provoquerait une lutte générale et décisive. L’affranchissement, nous l’espérons avec confiance, préviendra ces sanglantes conséquences du fait esclave.
Il y a, l’on peut dire, trois sortes de marrons : leur caractère est fort distinct. Le premier est l’homme énergique, aux passions ardentes, à l’esprit résolu qui n’a pu se plier à la discipline de l’atelier, qui n’a pu supporter l’anéantissement de toutes facultés volitives, l’abnégation à laquelle un esclave est condamné. Celui-là s’enfuit pour toujours, son maître peut le regarder comme perdu. Il médite long-temps le projet, combine son départ, assure ses moyens de salut, se jette dans les bois, et sait à des marques amies, trouver la route d’un de ces camps dont nous parlions tout-à-l’heure.
L’autre marron est l’esclave qui s’échappe pour un sujet quelconque, la crainte d’une punition, un moment de lassitude, un vague besoin de liberté ; et qui, la cause cessant, revient de lui-même à la grand case au bout d’un certain temps : huit jours, quinze jours, un mois, deux mois. Il se nourrit de ce qu’il pille et des provisions qu’il reçoit la nuit des autres esclaves, car il conserve toujours ses relations. Lorsqu’il veut se rendre, il va assez généralement, pour éviter la punition méritée, chez un ami du maître qui le ramène ou le renvoie même avec un simple billet, demandant pour lui un pardon que les usages des planteurs entre eux défendent de refuser jamais. Les hommes de cette nature constituent une propriété difficile, mais pas essentiellement mauvaise. Ce sont des animaux d’ailleurs bien apprivoisés, qui ont des caprices. Il y a, par exemple, des nègres qui ne manquent jamais de s’en aller marrons sitôt que le propriétaire s’absente et met un géreur à sa place, puis qui reparaissent dès que le propriétaire reparaît. Ils sont actifs, intelligens, bons travailleurs, lorsqu’ils s’y mettent, et il suffit de les gouverner avec adresse, de savoir leur procurer un emploi [111] de leur goût pour les garder. Un planteur de la Guadeloupe, grand amateur de chasse et de bois, nous disait un jour : « Le nègre qui m’accompagnait dans mes courses vient de mourir ; il faut absolument que j’achète quelqu’enragé marron. » Une habitation au point de vue physiologique, offrirait des études curieuses. Pourquoi les romanciers ne vont-ils pas aux colonies, ils y trouveraient mille types tout à fait originaux.
Il est une troisième sorte de marron, c’est celui auquel les rigueurs de l’esclavage sont trop lourdes, qui n’a pas la force de les endurer, et qui, d’un autre côté, n’est pas doué de l’énergie nécessaire pour savoir prendre une résolution et s’exiler tout à fait. Ce malheureux est véritablement à plaindre ; il s’enfuit parce qu’il souffre, parce qu’il n’a pas assez de désespoir pour se suicider ; mais il n’a rien prévu, il se traîne sur la lisière des chemins, le long des plantations, afin d’y voler quelque chose à manger ; il dort et se cache dans les broussailles, dans les cannes, en proie aux angoisses de la peur : il erre de côté et d’autre, toujours près des lieux habités, il végète, et souvent repris il expie toujours par de cruels châtimens les quelques instans de douloureuse liberté dont il n’a pas su jouir.
Il est de ces pauvres gens qui ne comprennent pas eux-mêmes leurs désirs de fuite. Ils s’en trouvent fort coupables ; ils voudraient être de bons esclaves bien réglés, bien assidus à l’ouvrage : ils s’accusent avec sincérité de ne pouvoir résister ; il ne se rendent pas compte des victoires que l’instinct remporte sur leurs volontés ; ils croient qu’on leur a jeté un sort, et avec l’incomplète éducation chrétienne qu’ils reçoivent, ils viennent demander naïvement au maître de faire dire des messes sur leur tête pour chasser l’esprit du mal, pour les empêcher d’être marrons. Les créoles, qui ne sont guères moins superstitieux que leurs nègres, ne manquent jamais de leur accorder une telle grâce ; et ce que l’on aura peut-être peine à croire, les curés se montrent assez ineptes ou assez fripons pour prêter leur ministère à des conjurations auxquels eux seuls gagnent quelque chose. Le résultat de ces messes, en effet est facile à [112] prévoir ; le pauvre nègre devient plus marron que jamais, car il se repose sur l’enchantement, ne demande plus rien à sa volonté pour se corriger, et part bientôt, emportant avec lui tous les exorcismes possibles.
La législation barbare de Louis XIV fut réformée par l’ordonnance de Louis XVI du 15 octobre 1786. Quelques très vieux nègres ont bien encore les oreilles coupées, un arrêt portant peine des jarrets tranchés fut bien encore rendu et exécuté à Saint-Pierre Martinique le 4 décembre 1815 [101], mais cela ne peut empêcher de dire que les peines de la mutilation et de la marque sont abolies et inappliquées aux îles depuis longues années [102]. Un arrêté local de la Martinique du 2 floréal an xi qui condamne à la peine des galères l’esclave pris en marronnage pour la troisième fois, est tombé en désuétude. La loi coloniale est entièrement désarmée aujourd’hui contre les désertions à l’étranger et contre le marronnage. Le maître n’a plus que ses vingt-neuf coups de fouets avec le cachot et les chaînes à discrétion : c’est encore trop vis-à-vis d’hommes coupables seulement [113] d’avoir échoué dans la conquête de leurs droits. Des habitans cruels ont eu l’infernale idée de battre et maltraiter les enfans du nègre échappé, pour l’obliger à revenir. Cet affreux expédient n’a pas mieux réussi et ne pouvait pas mieux réussir que le reste. Le marronnage comme le poison est une plaie congénitale de la servitude, pour laquelle il n’y a de remède que dans l’émancipation.
Au-dessus des observations que nous venons de faire, et en accordant aux caractères tranchés ce qu’il faut toujours leur accorder, il est permis d’avancer en général qu’il n’y a de nègres marrons que chez les planteurs mauvais ou incapables. L’excès de la faiblesse comme l’excès de la sévérité amènent les fuites d’esclaves ; on connaît des habitations sur lesquelles on n’en vit jamais. C’est un habitant, M. Alphonse Bouvier, qui a dit : « Le marronnage est l’échelle à laquelle on peut mesurer l’administration douce, inintelligente, sévère ou cruelle d’une propriété. » Nous ne pouvons rien ajouter à cela.
Il est une autre sorte de marronnage auquel l’affranchissement des colonies anglaises vient de donner lieu. C’est la désertion à l’étranger [103]. À peine les esclaves ont-ils su qu’ils ne seraient plus esclaves, s’ils parvenaient à toucher la terre voisine, qu’ils ont avidement saisi tous les moyens d’y fuir, et les évasions aux îles émancipées se répètent chaque jour. Malgré la confiance que l’on feint d’avoir maintenant à cet égard, l’impuissance de la répression est douloureusement proclamée par les créoles eux-mêmes, on fatigue en vain la troupe de ligne « en l’associant à la surveillance des côtes confiée aux milices et à la gendarmerie. » Les postes multipliés du littoral ne suffisent pas, le gouverneur de la Guadeloupe est obligé de « de [114] demander de nouveaux bâtimens à la métropole, afin d’augmenter le service en mer destiné à la garde extérieure des côtes [104] », et le 5 octobre 1840 il prenait encore l’arrêté suivant :
« Les maires des communes feront un rôle des pirogues, canots et embarcations quelconques appartenant aux habitans. Les maires remettront aux chefs des postes établis sur tous les points du littoral un extrait du rôle indiquant les embarcations appartenant à la station. Pour l’exécution des articles 15 et 17, du décret du 14 novembre 1834, les canots, pirogues et embarcations quelconques, devront être rendus le soir au coucher du soleil aux lieux de stationnement qui ont été fixés par les arrêtés des maires approuvés par le gouverneur. Ils y seront enchaînés solidement et leurs voiles, avirons et gouvernails, déposés dans le corps-de-garde du poste, d’où ils ne pourront être retirés avant cinq heures du matin. Hors de ces heures, il faut une autorisation spéciale du maître. L’autorisation de faire stationner des pirogues pendant la nuit à un embarcadère particulier sous la responsabilité de droit, ne peut être accordée que par la décision spéciale du gouverneur etc., etc. »
Telle est la perversité du siècle, ces nègres ne se font plus aucun scrupule « de porter atteinte à la propriété, » selon l’expression de M. le gouverneur de la Guadeloupe [105] en cherchant par tous les moyens possibles à se sauver. Race naturellement mauvaise et sans honneur !
Nous ne savons s’il est exagéré, mais on estime à cinq milles le nombre des esclaves que nos deux îles ont déjà perdus par évasion. Hélas ! on ne les retrouve pas tous chez les Anglais. Plus de la moitié des fugitifs périssent dans les hasards d’une traversée sans guide et sans boussole ; engloutis par les flots qui submergent, en grossissant tout-à-coup, leurs barques fragiles, ou tués par la faim lorsque le voyage se prolonge [106]. Nous [115] avons vu, nous nous le rappelons, au pénitentier de l’île Sainte-Croix, trois pauvres nègres français qui s’étaient échappés quinze jours auparavant de la Basse-Terre, dans l’intention de gagner Antigues. Ils étaient quatre alors qui se mirent dans un canot avec une dame-jeanne d’eau et quelques pains. Dès le commencement de la nuit ils perdirent un de leurs avirons, et ne pouvant résister à des courans ils tombèrent en pleine mer, où ils voguèrent sans direction, jusqu’à ce que le hasard les vint échouer le douzième jour sur les côtes de Sainte-Croix. Ils étaient tous quatre privés de connaissance lorsqu’on les recueillit, on crut que la chaloupe n’apportait que des cadavres. Ils furent déposés à l’hôpital, où l’un d’eux expira le lendemain. Les trois autres à force de soins revinrent à la vie, mais faut-il s’en réjouir ? Lorsqu’ils furent rétablis on les jeta en prison, et le gouverneur général des possessions danoises écrivit au gouverneur de la Guadeloupe : « Quatre esclaves français, de tels noms, ont échoué sur nos côtes, l’un est mort, je suis prêt à vous rendre les trois autres. Vous jugerez, je l’espère, que les souffrances endurées par ces malheureux, sont une punition suffisante de leur faute, et vous obtiendrez de leurs maîtres qu’ils ne soient pas punis. Je désire, M. le gouverneur, que vous voyez dans ce que je fais aujourd’hui une nouvelle preuve de mon zèle à maintenir la bonne harmonie qui existe entre nos deux cours. »
M. Jubelin aura repris les trois nègres en promettant leur grâce, les maîtres ne les feront pas moins châtier pour l’exemple général, et n’alourdiront pas moins la chaîne pour leur sécurité personnelle ; trois hommes de plus seront esclaves, mais la France et le Danemark resteront amis. Ne voilà-t-il pas des échanges de bien beaux et bien nobles procédés entre deux puissances civilisées, entre deux peuples libres ! C’est toujours une sottise de dire : « Si j’étais à votre place, je ferais cela », mais je dirai pour mon compte : « Si j’étais gouverneur d’une [116] colonie, même d’une colonie esclave, je fermerais certainement les yeux sur de pareilles fautes. » Quand on vient écrire que la bonne harmonie de deux cours voulait qu’on rappelât à la vie, pour les rejeter en servitude, trois misérables déjà délivrés de leurs fers, et que ces trois pauvres hommes qui s’étaient exposés à la mort pour fuir l’esclavage fussent rendus à l’esclavage, il nous semble entendre parler de deux cours du temps des Babyloniens ou de nations Barbares, qui échangent amicalement le crime.
Ni la vigilance, ni les périls connus, ne peuvent arrêter les esclaves ; les insatiables désirs de liberté qui sont en l’homme, leur font tout affronter, et leur suggèrent des inventions admirables pour atteindre leur but. On nous a raconté en ce genre un trait si original, qu’il mérite d’être conservé, il nous vient de la bouche même d’un habitant.
Cinq nègres de la Guadeloupe forment un projet d’évasion du côté de la pointe d’Antigues, deux d’entre eux manquent l’heure du rendez-vous, et voient en arrivant leurs trois complices qui, par crainte d’une trahison, sont déjà en mer. Aussitôt de courir chez M. X leur maître, « Maître voyez, trois nègres s’échappent. » M. X donne un coup de rhum aux fidèles dénonciateurs, se jette avec eux dans une chaloupe et force de rames sur les évadés ; mais, quelqu’effort que fassent les deux rameurs, ils ne peuvent toujours que tenir en vue la barque fugitive. « Maître, ils sont trois contre deux. » M. X ôte sa veste blanche, il se met à ramer aussi. Enfin on arrive à Antigues, les trois nègres abordent les premiers, M. X touche à son tour, mais alors ses deux hommes : « Bon maître, nous ne savions comment faire pour rejoindre la pirogue que nous avions manquée, vous nous avez amenés vous même, merci ! » et ils s’enfuient. M. X fit des démarches, demanda l’extradition, et bien entendu ne put rien obtenir. Le lendemain, il fut piteusement obligé de louer du monde, afin de retourner à la Guadeloupe !
Pour des intermédiaires entre l’homme et la brute, le [117] tour n’est il pas bon ? Dites donc encore après cela, que les nègres ne sont pas suffisamment préparés pour la liberté ! Voilà pourtant deux nègres, dont l’un au moins est un homme de merveilleuse ressource, qui seraient restés esclaves toute leur vie si l’Angleterre n’avait prononcé l’affranchissement ! Ne fût-ce que pour sauver des hommes comme ceux-là des horreurs de la servitude, il n’y aurait pas à regretter les 500 millions de francs qu’elle a donnés à l’abolition.
Nous ayons vu beaucoup de noirs, réfugiés à la Dominique et à Antigues, ils s’y conduisent bien. On en trouve quelques-uns sur les habitations, plusieurs ont formé de petits établissemens sur lesquels ils cultivent des vivres, mais nous ne voulons pas le cacher, ils se tiennent plus volontiers dans les villes où ils s’emploient comme canotiers, ouvriers, garçons de magasins et domestiques. Voici ce que MM. Sturge et Harvey, disent de ceux qu’ils ont rencontrés à Sainte-Lucie : « À notre retour nous remarquâmes les cottages et les jardins de quelques-uns des réfugiés de la Martinique. Un d’eux, a une petite plantation de cannes dont il fait du sucre, avec un petit moulin grossièrement construit. Il y a six cents réfugiés à Ste-Lucie, et tout le monde s’accorde à dire qu’ils contribuent à la prospérité de l’île. Ils ont introduit à Castries la fabrication des tuiles et des jarres porreuses, dont l’usage est si étendu dans les West-Indies [107]. »
Les créoles disent que leurs nègres évadés aux colonies anglaises, sont plus malheureux dans l’indépendance que sous le joug ; qu’ils voudraient revenir, et que s’ils ne le font pas, c’est qu’ils en sont empêchés par le gouvernement anglais. Singulier aveuglement que nous donnent nos préoccupations, étrange faiblesse de l’esprit qui nous fait toujours croire ce que nous souhaitons, en dépit de ce qu’y peuvent objecter le bon sens et la logique. D’un côté, les nègres émigrés voudraient revenir parce qu’ils meurent de faim faute d’ouvrage, et du côté opposé, les colonies anglaises sont perdues, parce que les pro [118] priétaires n’y peuvent trouver de bras à aucun prix ! Ceux des colons qui savent la valeur de l’impossible et aiment mieux que les îles anglaises manquent de bras, disent que si les émigrés français veulent revenir, c’est que méprisés et maltraités par les nègres créoles, la vie devient pour eux insupportable. Erreur et inexactitude, nous le pouvons certifier pour la Dominique et Antigues. Les réfugiés français n’ont aucune difficulté avec les gens du pays, ils se fondent dans la masse presque sans être remarqués, ils ne sont l’objet d’aucune répulsion particulière, et dans ces îles où l’on se marie, beaucoup d’entre eux ont déjà épousé des femmes indigènes. Que le nom de passe par terre, qui leur est appliqué, soit devenu une sorte d’injure légère [108], cela est vrai ; mais il y va d’une autre injure et tout est dit, c’est ce que nous tenons de plusieurs réfugiés. Nous ne prétendons pas nier que huit ou dix d’entre eux ne soient retournés chez leurs anciens maîtres, et n’aient volontairement repris les chaînes de l’esclavage après les avoir brisées, mais c’est un fait complètement exceptionnel, facile à expliquer par le mal du pays, qui peut arriver chez le nègre à une puissance d’exaltation extraordinaire, par le regret d’avoir abandonné une femme aimée ou par quelques autres causes semblables ; et ces causes, en raison même de leur nature, doivent être fort rares.
[119]
Quant aux empêchemens que les administrations locales mettraient au retour d’un réfugié, c’est une erreur de propriétaires, blessés qu’on ne veuille pas leur rendre ce qu’ils appellent leur propriété. Le gouvernement de la Grande-Bretagne s’oppose à ce qu’un maître français puisse saisir son esclave sur les terres de la Grande-Bretagne, rien de plus. Les réfugiés, pour quitter l’île où ils se trouvent, n’ont à remplir que les conditions imposées aux indigènes, aucune restriction particulière ne leur est appliquée, et le colon français qui aurait un exemple catégorique à opposer à ce que nous venons de dire, nous mettrait en mesure d’accuser de déloyauté M. le major Mac Phail, gouverneur d’Antigues, et vingt planteurs anglais dont nous tenons nos renseignemens sur la matière. Une preuve, en tous cas, qui appuie ces renseignemens d’une manière assez forte, c’est que bien que le nombre des nègres français arrivés à Antigues monte au moins à six cents ; il n’en reste guère que deux cents. Ces hommes hardis et d’humeur entreprenante, se laissent embaucher pour Demerara, où on leur promet plus d’argent, lorsqu’ils ne s’embarquent pas de nouveau pour la Dominique, Saint-Christophe et la Trinité, où ils trouvent des populations noires dont la langue et la religion leur sont familières.
On a vu que toutes les îles à esclaves, à quelque nation qu’elles appartinssent, ont leurs marrons ; elles ont toutes de même leurs déserteurs à l’étranger. Chez les Danois, où l’esclavage est d’une mansuétude extraordinaire, on a peine à empêcher les évasions qui se font sur Tortola, tant il est vrai que si bien dorés que soient les barreaux de la cage, le captif aime encore mieux le grand air. Les propriétaires de Saint-Thomas et de Sainte-Croix disent, à la vérité, que les mauvais sujets seuls s’enfuient, mais ils tiennent apparemment beaucoup à leurs mauvais sujets, car ils insistent auprès du gouverneur pour que les navires en station fassent bonne garde, et les côtiers viennent de tuer, en novembre 1840, des déserteurs qui refusaient de se rendre.
[120]
Si les nègres danois veulent être libres, que sera-donc pour ceux de Puerto-Rico où l’esclavage semble daté du xviie siècle ? Dans tous les quartiers où ils ont chance de fuite par mer, entre autres du côté de Mayaguez et d’Aguadilla, ils cherchent à gagner la lointaine Saint-Domingue, qu’on leur a dit devant eux ; ils se lancent dans de petites chaloupes, presqu’au hasard, ils vont, ils vont, et rarement échappent à la mort sur cette grande mer dont ils ne savent pas lire les chemins tracés à la voûte céleste. Quelquefois après avoir erré plusieurs jours sur les flots, ils rencontrent terre, s’y précipitent joyeusement… Les courans les ont vaincus, la mer les a trompés, ils sont revenus à Puerto-Rico… Après le désespoir d’avoir échoué, ils sont châtiés jusqu’à la dernière rigueur en présence des ateliers réunis, et malgré l’apparat de ces violences qui épouvantent les faibles, il faut toujours recommencer les exécutions, car les tentatives de fuite recommencent toujours. Lors de notre séjour à Puerto-Rico (janvier 1841), un complot d’esclaves venait encore d’être découvert à Guanilla, qui consistait à s’emparer de deux petits navires : alors dans le port, et d’obliger les patrons à conduire les vainqueurs à Saint-Domingue. Plus de cent cinquante esclaves étaient compromis dans cette audacieuse entreprise, découverte et dénoncée par un homme de couleur libre. Dix ou quinze, sans doute, y laisseront leurs têtes, mais ils auront des successeurs qui un jour réussiront !
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les esclaves affrontent des dangers presqu’insurmontables pour reconquérir la liberté. Parny, dans sa lettre à Bertin, du 19 janvier 1775, dit en parlant des nègres de Bourbon :
« Leur patrie (Madagascar) est à deux cents lieux d’ici. Ils s’imaginent, cependant, entendre le chant des coqs, et reconnaître la fumée des pipes de leurs camarades. Ils s’échappent quelquefois au nombre de douze ou quinze, enlèvent une pirogue et s’abandonnent sur les flots. Ils y laissent presque toujours la vie, et c’est peu de chose lorsqu’on a perdu la liberté. »
[121]
CHAPITRE IX.
LE POISON.↩
Le poison est à l’esclave ce que le fouet est au maître, une force morale. — Si le maître a droit de battre, l’esclave a droit d’empoisonner. — Le poison n’existe que dans les pays à esclaves. — Il ne tient pas essentiellement au caractère de la race noire. — Caprices du poison. — Il se fait obéir. — L’esclave empoisonne quelquefois par amour pour son maître. — Organisation secrète. — Moyens d’empoisonnement. — Inefficacité des lois contre le poison. — Cours prévôtales. — Le poison disparaîtra avec l’esclavage.
Nous sommes à peine sorti des préliminaires, et combien de fois déjà ne nous a-t-on pas entendu parler de poison ? Le poison !… Voici un des plus horribles et des plus étranges produits de l’esclavage. Le poison ! c’est-à-dire l’empoisonnement organisé des bestiaux par les esclaves. Aux îles, on dit : le poison, comme nous disons : la peste, le choléra ; c’est une maladie de pays à esclaves : il est dans l’air, la servitude en a chargé l’atmosphère des colonies, de même que les miasmes pestilentiels la chargent de fièvre jaune. Le poison est une arme terrible et impitoyable aux mains des noirs, arme de lâches, sans doute, à laquelle l’esclavage les condamne. Vainement osera-t-on calomnier la liberté, vainement feindra-t-on de lui préférer la servitude ; jamais l’Europe libre ne voit les prolétaires user de cet exécrable moyen pour manifester leurs souffrances.
L’instrument de travail qui parle, pense et agit, est un redoutable instrument ; il a trouvé à son abjection un contrepoids digne de sa fortune ; il a rétabli jusqu’à un certain point l’équilibre entre lui et son possesseur, par le poison. Le poison est à l’esclave ce que le fouet est au maître, une force morale ; le noir travaille crainte du fouet, le blanc abuse moins, crainte du poison. Oh ! la souveraine puissance du maître a ses épines ! Le poison est là qui menace et rampe à l’entour des habitations ; [122] chacun tremble, car il n’est tel brave, on le sait, à qui le serpent venimeux ne fasse peur. Nous disions aux habitans : « Voyez quelle immense latitude d’arbitraire la loi vous laisse, voyez tout ce que vous pouvez ! — Et le poison ? nous répondaient-ils. » M. Levassor Delatouche possède deux habitations : l’une, sur la rivière Lamentin (Martinique), a la moitié plus de nègres qu’il ne lui en faut ; l’autre au Petit-Morne, non très loin, en a la moitié moins qu’il n’est nécessaire, et il est obligé d’y mettre des esclaves de location. « Que n’opérez-vous un déplacement ? — C’est impossible ; j’aurais du poison. »
Que dire de ce terrible satellite gravitant sans cesse autour de l’esclavage ? Pour moi, je hais le poison, comme je hais le mal, la calomnie, la lâcheté ; mais si j’étais esclave et que j’eusse perdu force et courage dans les hontes de la servitude, je le déclare très haut, je me réjouirais d’avoir trouvé le poison pour me venger, et je m’en servirais. Toute arme est bonne au faible contre le fort qui opprime. Et c’est parce que l’esclavage justifie tous les crimes qu’il faut l’abolir. Ceux qui professent que c’est le droit d’un maître d’emprisonner, d’enchaîner et de battre, pour soumettre un homme au travail forcé, sont les gens les plus illogiques et les plus méchans du monde, s’ils ne professent point que c’est le droit de cet homme d’incendier, d’empoisonner et de tuer, pour se soustraire au travail forcé. Par quel bizarre raisonnement, lorsqu’on proclame la force brutale comme pouvoir légitime, voudrait-on nier l’assassinat comme défense légitime ? Les empoisonnemens et les incendies nous représentent de solennelles leçons données par la barbarie esclave à la barbarie qui maintient l’esclavage. Des créoles, des planteurs, des hommes ayant l’expérience des choses coloniales, l’ont dit avant nous : « Le poison et l’incendie, armes invisibles dans la main des opprimés, attestent que le nègre, éveillé par ces cris d’indépendance que tous les vents lui apportent, a besoin d’une diminution graduelle dans le poids de sa chaîne… La classe des esclaves a eu ses progrès en intelligence et en civilisation, malgré les [123] efforts faits pour les empêcher. Elle supporte impatiemment un joug trop lourd, qu’elle cherchera à secouer par tous les moyens possibles, et elle aura recours au poison, dont déjà elle sait faire un si terrible usage. »
Pourquoi s’étonner de ces affreux effets de la servitude ? Nous en trouvons tous la raison d’être au fond de notre cœur, lorsque nous songeons à ce que nous ferions si l’on nous jetait dans les fers. C’est un habitant de la Martinique, habile et intrépide défenseur de l’esclavage, qui me disait : « Si les Algériens m’avaient fait esclave et qu’il m’eut fallu incendier l’Afrique pour sortir d’esclavage, j’aurais brûlé l’Afrique. » Bizarre aveuglement ! les créoles qui parlent ainsi ne se croient pas en contradiction avec eux-mêmes ; car ce qu’ils nous reprochent à nous, c’est de juger la servitude avec nos instincts d’hommes libres, de supposer qu’un esclave pense de la liberté ainsi que nous, comme si l’on ne devait plutôt leur faire reproche à eux-mêmes de supposer que leurs sentimens ne puissent entrer dans le cœur d’un Africain qui était chez lui père et maître, ou d’un nègre créole qui fait, depuis qu’il est au monde, comparaison entre la dépendance et l’indépendance.
Tous les maîtres cependant ne se montrent pas si peu justes. Il s’en rencontre parmi eux qui ont le courage d’avouer la terrible vérité. Il y a quatre ou cinq ans à peine qu’un de leurs enfans les plus distingués, dans un livre où l’on trouve du cœur et du talent [109], a confessé « la révolte comme le droit de l’esclave. » Et réellement l’esclave est réduit à un état si misérable, si abject, qu’il n’a d’autre moyen de résistance, d’autre représentation possible, que la violence à ciel ouvert ou l’empoisonnement dans l’ombre. — Parler ainsi, c’est faire l’apothéose du meurtre ; de l’incendie et du poison, disent les apôtres de la servitude, cela n’est pas plus vrai que de justifier le despotique arbitraire du maître par le fait de l’esclavage ; soit dresser l’apothéose de l’esclavage. Il serait aussi absurde de la part des [124] créoles de nous accuser de conseiller le poison contre eux, parce que nous l’expliquons, qu’il serait absurde de la part des nègres, de nous accuser de conseiller les cruautés du maître, parce que nous avons dit qu’elles tiennent à son pouvoir discrétionnaire, et que ce pouvoir discrétionnaire est indispensable, tant qu’il y aura un maître. Dans des études pareilles à celles-ci, les principes doivent être dégagés des faits immédiats, la vérité est la loi souveraine, et le publiciste a pour devoir de la dire toute entière. Chaque coup de fouet, chaque trait d’iniquité, sont des provocations au poison qui se crient tous les jours d’un bout à l’autre des colonies ; des appels à la révolte autrement énergiques que toutes nos paroles. Les journaux censurés des îles, les écrits des prédicateurs de mensonges, beaucoup de discours des conseils coloniaux, et les brochures des créoles rétrogrades, pervertissent plus l’esprit des planteurs, en les attachant avec la frénésie du désespoir à une propriété illégitime, que nos vérités énoncées ne peuvent faire sur l’esprit des noirs qui ne savent pas lire. Croit-on que ces arguties furieuses en faveur des colons, ces démonstrations acharnées de la prétendue férocité africaine, qui retentissent pour la défense de l’esclavage, soient étrangères au redoublement de barbarie dont quelques maîtres se rendent coupables ? Nous expliquons les crimes des esclaves, en les déplorant ; nos adversaires expliquent ceux des maîtres, en leur prêtant une sanction légale ; où est le provocateur ? Nous ne pouvons souffrir que par le bouleversement le plus étrange des notions du juste, on rende l’opprimé responsable du mal commis en vue de la délivrance ; que l’on exècre les sombres vengeances du nègre en révolte, et que l’on n’ait aucune parole de blâme pour ceux qui le pendent lorsqu’il est vaincu. Est-ce à dire qu’il y a justice de pendre un esclave rebelle ? Mais il faudrait d’abord prouver qu’il est injuste à l’esclave de ne point consentir à l’être. Cette pitié pour les tyrans (volontaires ou involontaires), ce mépris pour les victimes, nous donnent assez mauvaise opinion de ceux qui les éprouvent. Si, [125] au milieu de toutes les atrocités qui se commettent entre maîtres et esclaves, un côté peut inspirer plus d’horreur que l’autre, ne devrait-ce pas être celui des maîtres qui punissent de mort cruelle les hommes qui refusent d’être leurs premiers animaux domestiques ? Au surplus, nous ne craignons pas le moins du monde la responsabilité de nos principes, et nous les proclamerons toujours à pleine voix. La justice et la vérité sont au-dessus des faits. — Toute révolte d’esclaves est à nos yeux non seulement légitime mais respectable. Le nègre qui rompt ses chaînes, à quelque prix que ce soit, redresse une injustice ; il honore la morale universelle qui était offensée toute entière dans l’asservissement de sa personne.
Revenons. Le plus triste fléau des colonies paraît être une importation d’Afrique, et les planteurs avec leurs idées absolues, disent qu’il tient au caractère nègre ; que l’homme noir empoisonnera toujours, libre où esclave. Mais d’abord plusieurs îles, comme la Jamaïque et Antigues, où le poison ne s’est jamais introduit, attestent le contraire ; ensuite il n’est pas question d’empoisonnement dans le Code noir, d’où l’on doit conclure que ce crime n’avait point encore affligé nos colonies ; il ne parut même très probablement que beaucoup plus tard, puisque le premier acte législatif destiné à l’atteindre, ne remonte pas au-delà de 1724.
Ce que nous disons ici n’implique pas contradiction avec ce que nous avons dit plus haut. Il faut attribuer le poison exclusivement à la servitude, puisqu’on ne le trouve que dans les contrées où règne la servitude. C’est un mal qui leur est spécial, mais cela n’entraîne pas forcément qu’il devra servir partout de cortège à l’affreuse institution. S’il est des îles où le poison ne s’est jamais répandu, s’il ne s’est révélé aux colonies françaises que postérieurement à l’établissement de la servitude, on doit en conclure qu’il ne tient pas essentiellement à la nature de la race nègre, mais si on ne le trouve organisé que dans les pays à esclaves, comme la Martinique, la Guadeloupe, l’ancienne Saint-Domingue, la Trinité, la Grenade, on doit [126] aussi en conclure que l’esclavage seul peut le produire et le perpétuer.
De deux choses l’une ? ou le poison est un fils de l’esclavage, et alors il faut tuer le père pour tuer le fils, ou l’on doit accueillir les idées qu’à émises M. le capitaine du génie Villemain. M. Villemain, par suite de la position qu’il occupa aux colonies, ayant eu à juger des faits d’empoisonnement, s’en exprime de cette façon : « La plupart du temps, le crime existe, avéré, patent, confessé, sans aucun mobile intéressé ou passionné. C’est l’homme qui incendie pour incendier, qui empoisonne pour empoisonner ; c’est de l’instinct sans réflexion, et que la crainte seule peut contenir. Vainement je demandais au prévenu, dans le tête-à-tête du cachot, si son état d’esclavage n’était pas le point de départ et le moteur instinctif de son action criminelle ; si dans l’état de liberté, il eût succombé à une aussi horrible tentation : eh bien ! je le déclare avec sincérité, je n’obtins jamais la réponse que ma raison appelait, qu’elle désirait même au point de vue de la dignité humaine. L’état de servitude n’était pour rien dans la perpétration du crime ; et sous ce rapport, le coupable me rejetait sans cesse hors du terrain où je voulais l’amener. Tout ce que j’ai pu démêler dans cet impénétrable mystère de l’esprit des noirs, c’est que les plus grands bienfaits provoquent souvent la plus grande ingratitude et les crimes les plus pervers. »
Si cela est ainsi, l’humanité doit se voiler la face de désespoir, et le nègre n’aura jamais assez de haine pour le Dieu qui lui donna un cœur plus féroce que celui des plus féroces animaux. C’est une précaution de sûreté publique de rendre bien vite à ses brûlans déserts, cette race horrible dont le mal est l’instinct, dont l’ingratitude est la nature, et qui déshonore l’espèce humaine. Suivons le raisonnement : Il serait plus sage encore d’exterminer ces êtres malfaisans, comme les loups et les hyènes ; car depuis deux siècles qu’ils vivent avec les Européens on n’a pu les apprivoiser ; ils empoisonnent toujours. Depuis deux siècles, ni les coups de fouet, ni les pendaisons, ni le baptême, ni la douceur [127] de notre commerce n’ont pu les corriger, les adoucir ; ils empoisonneront toujours. Rien ne serait d’une immoralité plus odieuse que de persister sous prétexte de la nécessité de cultiver la canne à sucre ; que de persister dis-je à souiller notre société de la présence de ces hommes affreux. La loi ne peut permettre à celui qui tirerait un service quelconque des serpens à sonnettes, d’en entretenir chez soi au milieu de ses enfans et de ceux qui vont le visiter.
Quant à nous, jusqu’à ce que M. Villemain et les gens qui sont de son avis, nous aient fait savoir s’ils tirent ces inévitables conclusions de leurs prémices, nous penserons qu’ils ont mal vu, mal observé, nous ferons fort peu de cas de leur jugement, et nous continuerons à dire : Ce qui caractérise les pays à esclaves, c’est que le poison une fois connu s’y garde, s’y conserve et s’y entretient ; mais ce qui prouve qu’il ne procède pas du caractère africain, c’est qu’il a besoin d’être introduit par un accident quelconque pour s’y établir. — Là même où il règne, sa tyrannie a des limites, des circonscriptions ; il semble qu’il se lègue sur tel ou tel atelier, de génération en génération d’esclaves. Il y a quelques habitations qui n’en ont jamais eu, d’autres qui n’ont jamais pu l’extirper, cela quelquefois indépendamment de leur régime ; les meilleurs maîtres n’y peuvent échapper. M. Perrinelle, dont la riche administration est remarquablement douce et éclairée, perd chaque année, sans trouble, sans cause apparente, à l’état normal, de quinze à vingt bœufs. Nous avons vu un planteur réduit à trois bœufs et deux mulets. Parmi les témoins du procès Mahaudière, un vieillard de soixante-dix ans déclara qu’il avait perdu en sa vie, par le poison, deux cents bœufs, cent mulets et soixante nègres. Les planteurs, il est vrai, sont trop disposés à voir le maléfice partout où il y a mort de bestiaux ; selon les vétérinaires appelés à opérer quelques rares autopsies, ils n’accordent pas assez aux épizooties qui frappent des animaux en général fort mal soignés ; cependant il est impossible de se refuser à croire à une mortalité violente. [128] Le poison n’attaque habituellement que les bestiaux ; parfois des esclaves succombent aussi ; il se contente de frapper le maître dans sa propriété ; mais il ne s’arrête pas toujours là, il sait monter jusqu’aux enfans de la maison ; il ne craint pas de tuer le maître lui-même. Semblable aux mauvais esprits, fantôme insaississable, il vient et disparaît sans qu’on puisse jamais le surprendre ; on le trouve partout, on ne peut l’atteindre nulle part. Il a divers modes d’action ; tantôt il agit lentement, tantôt avec fureur ; souvent il est impossible de deviner pour quel motif. L’atelier paraît heureux ; tout-à-coup une bête est abattue. L’esclave craintif n’a pas osé parler lui-même ; il a fait parler son affreux interprète. Qu’y a-t-il ? c’est au maître à découvrir, non pas précisément le criminel mais la cause du crime ; elle lui est révélée quelquefois par un mot de ces chansons que les nègres improvisent au travail pour s’accompagner. Ce sera un nouvel économe qui ne plaît pas, tel changement qui n’a pas convenu. — M. Latuillerie fait un jour récolter par son atelier un champ de cannes que des nègres libres avaient planté de compte à demi chez lui. L’atelier récolte sans mot dire ; mais immédiatement M. Latuillerie, d’ailleurs très aimé de ses esclaves, parce qu’il est très bon, perd des bœufs et des mulets. Il faut renoncer à ce genre d’exploitation. Il n’y avait cependant pas surcroît de travail, car lorsqu’on fait cela on ne fait pas autre chose ; mais le poison a ses momens de despotisme capricieux et aveugle.
On accorde généralement à cet odieux visiteur ce qu’il demande, et il s’en va. On l’a aussi combattu à force ouverte, en sévissant contre l’atelier tout entier, que l’on rend alors responsable. Quelques-uns privent tout le monde du samedi, l’esclave qui ne vit que sur le travail de ce jour-là s’arrange ensuite comme il peut, « dénonce un frère où ne mange pas pendant quelques jours. C’est ma loi, je suis le plus fort. » D’autres s’y prennent avec un sang-froid impertubable ; ils assemblent l’atelier : — « Un bœuf est mort hier, mes amis, voilà ses entrailles, vous voyez qu’il a été em [129] poisonné. Je vous dois six cents francs pour le manioc que vous m’avez vendu l’autre jour ; mon bœuf vaut deux cent cinquante francs ; je retiens sur ce que je vous dois la valeur de l’animal. Tant pis pour vous, chacun paiera sa part : Un atelier connaît toujours celui qui fait le mal ; mes amis, à vous de l’arrêter. » Ce moyen a réussi.
Quelques nègres ont été pris, chez lesquels la rage d’empoisonner était arrivée jusqu’à la monomanie. L’un d’eux expliqua qu’il tuait des bœufs comme les blancs tuent des cailles, par caprice, par fantaisie, sans avoir à se plaindre ni à se venger. C’était quelque chose d’analogue à ce goût dépravé que les civilisés ont pour la chasse. Il avait autant de plaisir à voir tomber le bétail sous ses doses savantes qu’un chasseur peut en éprouver à tirer le gibier avec adresse. Quel abaissement intellectuel ne faut-il pas pour produire de telles aberrations ! Mais si affreuse qu’elle soit, peut-on s’étonner de la hideur des fruits d’un arbre appelé servitude ?
Il nous a été raconté des faits qui donnent une idée encore plus incroyable, s’il est possible, du degré de perversité que l’esclavage peut communiquer à l’intelligence. Un maître annonce son départ pour l’Europe ; aussitôt il a le poison dans son écurie : trois chevaux de son service personnel expirent l’un après l’autre. À force de recherches et de surveillance il atteint le coupable. Qui était-ce ? Son domestique, nègre avec lequel il avait été élevé, et sur lequel il comptait. « Quoi ! misérable, c’est toi qui me trahis ! — Dam ! maître, vous vouliez vous en aller sans moi, ça me causait trop de chagrin ; j’ai fait cela pour vous retenir. »
Il est de la dernière authenticité que le poison est à l’occasion pour le noir un moyen de manifester son attachement au maître. C’est de l’amour d’esclave : ; le tigre le mieux apprivoisé déchire en caressant. Nous sommes à même d’en citer un autre exemple assez curieux. M. Lherie, propriétaire au quartier Saint-Anne, (Guadeloupe) fait connaître qu’il va partir pour la France : le lendemain, dix bœufs de l’habitation meurent. Il [130] était aimé ; il comprend, annonce qu’il reste, et la mortalité ne va pas plus loin. Cependant, le voyage était indispensable ; il le combine en silence, et la veille du départ, il assemble l’atelier : « Mes amis, il faut absolument que je vous quitte, mais je serai ici dans dix ou douze mois, et durant mon absence rien ne sera changé au régime de l’habitation j’en prends l’engagement sur l’honneur ; voulez-vous me laisser aller ? » On lui donne mille témoignages de regret ; il part, et pas un bœuf, pas un mulet n’est touché. Quelle société que celle où il faut ainsi traiter de puissance à puissance avec le poison ! Un autre fait : depuis que M. Claveau, de la Guadeloupe, est en Europe, on a mis dix fois le feu à ses cases à nègres, cinq fois l’incendie a tout dévoré. Le géreur, M. Bellissime, est cependant un homme humain, dont la réputation de douceur est bien établie : qu’importe ? Il y a deux ou trois nègres dans l’atelier, peut-être un seul, qui aime mieux le maître et qui prétend le faire revenir sur ces traces de flammes. Pour la cent millième fois, détruisez donc l’esclavage, car il n’y a que l’esclavage qui puisse produire ces monstrueux phénomènes.
Dans cette société anormale, tout est anormal, tout renverse les lois de la logique et confond la raison [110]. Il y a beaucoup de maîtres, nous l’avons déjà dit, qui sont excellens, cela est positif ; il y a des esclaves, cela n’est pas moins positif, qui aiment leurs maîtres, qui leur sont dévoués à la vie et à la mort : il existe des Caleb noirs qui mettent leur orgueil dans l’orgueil de la maison à laquelle ils appartiennent. Quand M. Fereire du Port-Louis (Guadeloupe) apprit à son atelier qu’il allait se [131] marier, une vieille femme se détacha des rangs et lui dit : « Qui moune est ça ous qua marié ? » Quelle est la personne que vous allez épouser ? — Une demoiselle Lacharrière. — « Ben, nous qua contens, c’est bon famille. » Bien, nous sommes contens, c’est une bonne famille. Et que l’on n’attribue pas ces attachemens de l’homme possédé pour l’homme possesseur à la stupidité des nègres. Les nègres ne sont pas stupides ; mais toute servitude rend l’esclave stupide. Aux yeux de la raison et de la morale les esclaves sont justifiés d’aimer leurs maîtres comme de les empoisonner par leur avilissement même.
Le plus ordinairement, les empoisonneurs ne sont pas isolés ; les esclaves, si l’on peut dire, n’empoisonnent pas pour leur compte particulier, tout le monde s’accorde à penser qu’il existe une organisation secrète et supérieure à laquelle vont se joindre les nègres mécontens des habitations. Cette association paraît exercer une puissance surnaturelle et frapper de terreur l’esprit des agens qu’elle emploie ; elle donne, elle impose des ordres auxquels on ne désobéit pas. Des maîtres parfaits ont eu le poison chez eux, et l’on a vu les meilleurs serviteurs, ceux en qui on avait mis confiance depuis nombre d’années, empoisonner des enfans qu’ils avaient élevés, qu’ils aimaient réellement, et l’avouer avec d’abondantes larmes en criant au désespoir : « Le diable m’a tenté, le diable m’a tenté ! » — Soit vanité de bons maîtres, soit conviction, les habitans disent que le mal ne vient pas généralement de leurs ateliers ; il admettent que leurs nègres cèdent à des insinuations du dehors, aux conseils d’hommes libres, qui par vengeance ou méchanceté viennent les exciter au mal. Hélas, les instigateurs auraient-ils prise sur les noirs, s’ils ne trouvaient des cœurs aigris pour les écouter et des esprits d’esclaves pour leur obéir ? Qu’arriverait-il au misérable qui viendrait conseiller le poison aux ouvriers de nos manufactures ou aux laboureurs de nos fermes, quoique cependant, à en croire les colons, le sort de ceux-ci soit bien plus triste que celui des nègres !
Le moyen d’empoisonnement le plus usuel à la Martinique [132] est l’arsenic. Comment les esclaves se le procurent-ils ? On a lieu de croire que l’association a des affiliés à Saint-Pierre, qui obtiennent secrètement de quelques marins des navires cette cruelle marchandise. Les noirs, ceux de la Guadeloupe surtout, ont également la connaissance de plantes du pays dont ils savent extraire des poisons en poudre ou en liqueur, lents ou d’un effet spontané, et qui ne laisse presqu’aucune trace. Ils sont d’une habileté extraordinaire dans ces infernales préparations, dont les recettes se gardent on ne sait dans quelle antre terrible, sans qu’il ait jamais été possible d’en obtenir la révélation. À en juger d’après l’esprit superstitieux des esclaves, le diable doit entrer pour quelque chose dans l’impénétrabilité de ce mystère dont les plus effroyables tortures appliquées depuis deux siècles n’ont pu obtenir le secret, et que la liberté dévoilera, nous croyons, de sa propre volonté. — On connaît bien quelques-unes des substances employées : l’herbe commune appelée la Brinvilliers, la racine de pomme rose, etc. ; mais, ces connaissances sont très bornées, et il reste encore à faire une toxicologie de nos Antilles qui serait certainement fort intéressante pour la science.
On a tout essayé pour se défendre du poison. C’est dans le but de le prévenir que la déclaration du roi, du 1er février 1743, interdit aux esclaves, à peine de châtimens afflictifs ou même de mort, la composition ou la distribution de tous remèdes, et leur défend d’entreprendre aucune espèce de guérison, sauf celle des morsures de serpens. Peine de mort contre l’esclave qui fabriquerait, se procurerait ou garderait des substances vénéneuses [111], soustraction des accusés empoisonneurs aux formes ordinaires de la justice [112], institution de tribunaux spéciaux dont les jugemens étaient exécutoires immédiatement [113], rien n’a pu remédier au mal. Jamais aucun coupable, pris et avouant le crime, n’a avoué quoi que ce soit sur la puissance oc [133] culte qui le faisait agir, sur le lieu où elle réside, où elle conserve ses traditions ; et la difficulté de fournir des preuves certaines, entraîna presque toujours l’impossibilité d’une répression légale. Mécontens de s’adresser sans succès aux tribunaux, les maîtres ont fini par y renoncer et s’établissent juges de leurs nègres empoisonneurs. De là, souvent des attentats pareils à celui de Douillard-Mahaudière : sa victime était soupçonnée par lui d’empoisonnement.
En 1822, l’hydre avait exercé d’immenses ravages à la Martinique, on y institua, le 12 août de cette année, une cour prévôtale afin de l’exterminer. Un homme résolu, passionné, sanguinaire, comme il en faut pour être exécuteur des hautes-œuvres, nommé Davoust, et surnommé Coupe-têtes par les nègres, se mit à parcourir le pays avec une bande de sicaires. Il avait pouvoir absolu, se transportait où besoin était, prenait sur les habitations les nègres indiqués par ses dénonciateurs, les jugeait séance tenante, sans pourvoi, sans recours, et leur faisait trancher la tête, en forçant les planteurs à envoyer des députations de leurs ateliers pour assister à l’exécution. On voulait frapper les esclaves de terreur par ces formidables exemples de la justice du roi. Davoust, avant de partir, avait fait forger une grande hache pour les têtes et une petite pour les mains. Il se lassa de ces instrumens trop expéditifs, et fit un jour brûler seize noirs, l’un après l’autre sur la place publique du Lamentin, en présence de plus de vingt mille esclaves, appelés de tous côtés. L’autodafé dura la journée entière, avec une petite pluie fine, qui semblait tomber comme pour servir les desseins de l’inflexible juge prévôtal, et durant la journée entière, il ne sortit pas un mot de la bouche ni des seize suppliciés, ni des vingt mille spectateurs : ceux-ci s’en allèrent calmes et silencieux de même. Mais le lendemain il n’y eût pas une habitation où l’on ne trouvât des bestiaux frappés de mort [114] ! La cour prévôtale dé [134] ploya pendant deux ans ce luxe de fureur vengeresse, et ne diminua pas le mal : le poison fut plus fort qu’elle, et un ordre du département de la marine la supprima en 1827… C’est qu’un tel fléau ne se détruit ni par le fer ni par le feu, mais par la moralisation des masses. Il n’y a qu’un seul remède au venin qui désole nos îles : ce remède, c’est la liberté. L’histoire nous en est garant, le poison disparaîtra des colonies avec l’esclavage, comme il a disparu d’Europe avec la féodalité, comme il a déjà disparu de Saint-Domingue qui en eût beaucoup au temps de la servitude, et qui n’en a plus au milieu même de l’indépendance sans frein et sans morale, où la laisse se corrompre un pouvoir sans amour et sans vertu.
Avant de terminer, un mot sur Davoust-Coupe-Tête : il finit par perdre la raison, et mourut en voyant du poison partout ; lorsqu’il parlait des esclaves, il ne les désignait plus que sous le nom de travailleurs. Son énergique courage s’était noyé dans les flots de sang répandus : Il avait peur…
[135]
CHAPITRE X.
le catholicisme et l’esclavage.↩
Légitimité religieuse de l’esclavage des hommes noirs. — La servitude bonne aux nègres parce qu’ils y deviennent chrétiens. — Les propriétaires d’esclaves grands catholiques.
Nous avons exposé la condition des esclaves, et le régime des habitations. Il nous paraît nécessaire, avant d’aller plus loin d’examiner l’opinion des créoles sur la nature des nègres. Il est curieux de savoir comment ils se justifient. Les moyens qu’ils emploient pour soutenir la légitimité de leurs droits à garder les hommes noirs en esclavage, prendront bonne place un jour dans l’histoire des sophismes que les hommes ont toujours su trouver pour justifier leurs folies les plus extravagantes, ou leurs crimes les plus inouïs.
Il existe un créole de la Martinique qui a publié une brochure sur l’esclavage, où il démontre qu’il n’est pas seulement absurde, qu’il est irreligieux de parler contre la servitude de la race africaine, parce que la race africaine descend de Chanaan, fils de Cham, lequel fut maudit par son père Noé et condamné, lui et ses enfans, à être les esclaves des esclaves de ses frères Sem et Japhet. Il a été prouvé par un de ces savans allemands qui ont découvert et lu sans doute des livres publiés du temps de Noé [115], qu’au moment où le patriarche prononça cette malédiction les cheveux de Chanaan se tordirent, et que son visage devint tout noir, d’où il suit évidemment que les nègres sont les fils de Chanaan et doivent rester éternellement en esclavage, en vertu de cette parole : « Que Chanaan soit maudit, qu’il soit, à l’égard de ses frères, l’esclave des esclaves. » (Genèse, v. 25). Car Noé étant patriarche et parlant [136] comme tous les prophètes et tous les patriarches, « sous l’inspiration de l’esprit, sous l’inspiration de celui qui jure par lui-même et ne parle jamais en vain », avait droit d’appeler sur les races humaines des peines inabolissables, c’est-à-dire des peines temporelles, comme la douleur et la mort, par opposition aux peines abolissables, c’est-à-dire éternelles, mais rachetables par les mérites du Messie annoncé. Ainsi la mort de Jésus a bien pu racheter les nègres de l’enfer, où ils seraient allés comme les autres hommes, si le Christ n’avait été crucifié, mais non pas de l’esclavage dont le rédempteur ne pouvait pas plus les racheter qu’il ne pouvait racheter les autres de la douleur et de la mort. Voilà qui est clair. Or, Jésus-Christ est venu continuer la loi et les prophètes, la loi et les prophètes prononcent la servitude dans ce monde de la race de Cham ; donc, les nègres doivent être esclaves, et il est impie, schismatique, philosophique et philantropique de soutenir le contraire.
Tout cela est imprimé ; l’auteur, M. Huc, est un des membres les plus influens du conseil colonial de la Martinique ! On aurait tort, du reste, de penser que ces idées soient entièrement nouvelles. Les fauteurs de l’esclavage des nègres les avaient déjà émises au xviiie siècle, et l’abbé Bergier, dans son Dictionnaire de Théologie, admettant avec eux la condamnation, les avait sommés de prouver que Dieu leur eut donné l’honorable mission de faire expier le péché de Cham aux Africains, et qu’ils fussent, à cet égard, les exécuteurs accrédités de la justice céleste.
Pour ceux qui voient dans le Pentateuque et l’Évangile des livres révélés, il est certain que l’esclavage est d’institution divine comme la loi du talion ; mais le christianisme lui-même n’a-t-il pas fini en progressant par combattre cette institution, et aux textes de Moïse ou de saint Paul, qui la maintiennent, ne peut-on pas opposer le bref de Grégoire XVI (3 décembre 1839) qui, reprenant les paroles d’Urbain VIII, vient de déclarer « indigne du nom de chrétien celui qui ose avoir des esclaves ou même soutenir qu’il est permis d’en avoir. » [137]
Il ne nous paraît pas nécessaire d’entrer ici dans une discussion sur un sujet d’une telle gravité historique. Nous dirons seulement que des créoles en sont encore aujourd’hui à prétendre, plus ou moins sérieusement, que l’esclavage est bon aux nègres, parce qu’il sauve leurs âmes en les faisant chrétiens. Sur ces théories misérables, voici comment s’exprime Montesquieu : « J’aimerais autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas pour travailler plus aisément à sa propagation. Ce fut cette manière de penser qui encouragea les destructeurs de l’Amérique dans leurs crimes. C’est sur cette idée qu’ils fondèrent le droit de rendre tant de peuples esclaves, car ces brigands qui voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient très-dévots [116]. »
Les créoles, successeurs directs des brigands de Montesquieu, ont continué à être fort dévots. Et l’on peut s’étonner du sacrilège abus qu’ils osent faire du nom de Dieu. Ils croient, disent-ils, à un être suprême souverainement juste, et ils oppriment violemment l’homme fait à son image. Ils adorent profondément l’ineffable bonté du créateur, et ils avilissent à plaisir sa créature. Ils se vantent d’être catholiques, et ils font ce que le pape leur défend de faire. Est-elle donc bien pure la foi de pareils chrétiens ? Il y a des hommes que les niais accusent d’immoralité et appellent impies, parce qu’ils ne partagent point les idées communes sur les principes régulateurs du monde, sur les bases données à la société. Oh ! qu’il est bien fait pour inspirer d’amères réflexions, le spectacle de ces impies là, luttant avec effort pour relever le plus noble ouvrage de Dieu contre les pieuses personnes qui s’attachent à le vouloir dégrader jusqu’aux proportions de l’animal nourri en échange de son travail forcé ! Comment ceux qui ont foi à l’immortalité de l’âme, et tirent si grande vanité de ce don que Moïse ignorait avoir été fait particulièrement à la créature humaine, n’ont-ils point [138] de pitié pour les âmes de ces pauvres nègres, plongées et maintenues dans la nuit des superstitions de l’ignorance. Honte ! honte ! Qui nous délivrera de ces mensonges de croyans ! Quand donc l’Esprit-Saint viendra-t-il éclairer les maîtres et leurs défenseurs, puisque l’amour de l’humanité ne les peut émouvoir ! Que dirais-tu, ô ! Pascal, si tu entendais ces déites, ces catholiques romains, ces défenseurs de l’église soutenir leurs droits de propriétaires d’esclaves au nom de la religion, de Dieu et de l’église ; que dirais-tu de ces cruels meurtriers d’âme, toi qui t’écriais, en parlant de l’église : « La chaste épouse du Seigneur, qui, à l’imitation de son époux, sait bien répandre son sang pour les autres, mais non pas répandre pour elle celui des autres, a pour l’homicide une horreur toute particulière et proportionnée aux lumières que Dieu lui a communiquées. Elle considère les hommes non seulement comme hommes, mais comme images du Dieu qu’elle adore. Elle a pour chacun d’eux un saint respect qui les lui rend tous vénérables comme rachetés d’un prix infini pour être faits les temples du Dieu vivant. »
S’il était réellement un juge éternellement sage, éternellement juste, quel serait au jour des peines et des récompenses, quel serait le plus coupable, à son tribunal, de l’homicide ou du propriétaire d’esclaves ? De celui qui aurait renversé le temple du Dieu vivant, ou de celui qui l’aurait souillé de la promiscuité, de la violation des liens de famille, de l’ignorance de soi-même, en un mot de tous les vices et de toutes les profanations serviles ?
[139]
CHAPITRE XI.
DANS L’ÉCHELLE DES ÊTRES, LE NÈGRE APPARTIENT AU GENRE HOMME.↩
Doctrine de M. Viret. — Épine dorsale du nègre. — Trou occipital. — Sang noirâtre. — Cerveau noir. — Si la décoloration est le résultat d’une dégénération, l’homme noir devient le type humain par excellence. — Fontanelles cartilagineuses. — Les mamelles pendantes de M. Bory de Saint-Vincent. — Les hommes de l’art résidant aux colonies n’admettent aucune dissemblance essentielle entre le nègre et le blanc. — M. Virey et M. Bory, énergiques et généreux ennemis de l’esclavage. — La masse encéphalique. — Perfectionnement progressif des races. — Les Indiens. — Les Germains décrits par Tacite tout aussi sauvages que les Africains. — Le nègre est intellectuellement égal au blanc ; il n’y a de différence entre eux que celle de l’éducation. — Les souris blanches ne sont pas moins souris que les grises. — Le génie n’est pas dans l’épiderme. — Les révoltes souvent victorieuses des esclaves noirs confondent la prétendue supériorité des blancs. — Hypothèse sur l’origine des races.
Les colons ont adopté avec empressement les idées émises sur la condamnation originelle qui aurait été prononcée contre les nègres ; ils croient, comme leurs défenseurs religieux, à l’unité de la race humaine, proclamée dans les textes sacrés ; mais voyez la contradiction, ils montrent la même foi pour quelques-uns de leurs défenseurs physiologiques, qui affirment que la nature a mis entre le nègre et le blanc des différences d’organisation caractéristiques ! Ils soutiennent avec l’allemand Heidegger, que les nègres sont la postérité de Chanaan, fils de Cham, fils de Noé ; et avec M. Virey, que la structure de l’homme noir n’est pas la même que celle de l’homme blanc, fils de Japhet, fils de Noé !
Ce M. Virey, médecin incontestablement de haute science, quelquefois éloquent, mais animé d’une sorte de haine anatomique contre le nègre, a cherché à établir dans le Dictionnaire d’hitoire naturelle de Déterville, et dans le Dictionnaire des sciences médicales de Panckoucke, que le nègre est un intermédiaire entre l’homme et le singe.
Une fois propriétaire d’esclaves noirs et voulant les garder, la stupidité constitutionnelle des nègres devenait aux créoles un argument indispensable pour apaiser les cris de leur [140] conscience et les révoltes de leur bon sens. Les théories de M. Virey allaient donc trop bien à leurs désirs pour qu’ils ne les aient pas fort prisées. Tous les hommes de lecture parmi eux les citent. Pas un ne s’est donné la peine de vérifier les choses, de faire une dissection, mais n’importe, M. Virey l’a dit ! Sa parole vaut article de foi.
Nous sommes incapables d’entrer dans une discussion scientifique, et nous avons besoin de le déclarer d’avance, toutes les observations qu’on va lire sont faites avec une humilité extrême. Si nous nous permettons de les mettre sous les yeux du public, c’est que les créoles ayant adopté les doctrines de M. Virey, nous nous trouvons presque obligé d’en dire deux mots.
M. Virey affirme que l’épine dorsale du nègre est plus creuse dans sa longueur et plus cambrée à sa base que la nôtre. Ceux qui ont vu les noirs aux colonies où ils vivent presque nus, peuvent attester comme nous, que cette différence n’existe que dans les ouvrages des écrivains copistes de celui qui le premier a cru l’apercevoir.
Le trou occipital du nègre [117], selon M. Virey, est comme dans la brute, beaucoup plus rapproché de la partie postérieure du crâne, de façon qu’un Africain ne pourrait tenir sa tête perpendiculaire sur ses épaules. « L’homme blanc, dit le docteur, est parfaitement droit ; l’homme noir penche en avant. » Qui a jamais vu cela autre part que dans l’article du Dictionnaire des sciences médicales, non plus que la grosseur des nerfs cervicaux ? Cette grosseur ne pouvant avoir lieu qu’aux dépens de la masse encéphalique, amène la prédominance du système nerveux sur le système cérébral ; c’est bien pour cela que l’anatomiste blanc l’a trouvée chez les nègres ; il en résulte que chez eux comme chez les bêtes, la nature physique doit l’emporter sur la nature morale ; aussi M. Virey établit-il par esprit de conséquence que les nègres ont les sens plus développés, et plus actifs que les blancs. Il les fait gourmands quoique leur sobriété soit notoire pour tous ceux [141] qui les connaissent ; il leur donne une vue perçante et un odorat assez fin « pour flairer les serpens et suivre à la piste les animaux qu’ils chassent. » M. Virey, cela est bien clair, n’a jamais vu d’hommes noirs de sa vie, il en construit un à sa fantaisie dans son cabinet. On n’en fait aucun doute, lorsqu’on l’entend ajouter que le sang, l’humeur bilieuse, les viscères, etc., du nègre sont imprégnés d’une teinte noirâtre. Puisqu’il copiait Sommering, nous ne voyons pas pourquoi il n’a pas copié tout de suite Meckel, médecin prussien, qui lui copiant Hérodote et Aristote, osait écrire en 1757 que les nègres étaient une race d’hommes à part « parce que leur cerveau et leur sang sont noirs. »
C’est une chose affligeante de voir un homme sérieux accepter aussi légèrement les imaginations des anatomistes spéculatifs, et prendre la science à l’état où elle était il y deux siècles.
Qui ne sait aujourd’hui que la teinte noire des nègres provient du tissu réticulaire de Malpighi, que ce tissu placé sous l’épiderme et commun à tous les animaux, est ce qui nous donne une coloration plus ou moins foncée selon la propriété plus ou moins foncée de ses sécrétions ? Il n’y a de noir chez le noir, que son épiderme. Nous avons vu des cadavres de nègres gonflés par les gaz qui se dégagent après la mort, le plus léger frottement, qui suffit alors comme on sait pour enlever cette épiderme, laissait voir une peau parfaitement rosée.
Il y a ici une observation assez extraordinaire à présenter. Il est généralement admis par la science que la décoloration, partielle ou complète, d’acquisition ou de naissance, est le résultat d’une dégénération. La femme toujours plus claire que l’homme, est aussi toujours plus faible, l’homme blond est également plus faible que l’homme brun ; les individus frappés d’inertie par l’âge ou le froid, blanchissent en raison de leur épuisement comme l’homme en vieillissant, comme la marmotte en s’endormant de son sommeil hibernal ; la chlorose qui énerve celui qu’elle atteint est blanche, la leucose ou blafardise, ne laisse aucune force à celui qui en est attaqué ; les [142] Albinos sont tous des êtres infirmes et valétudinaires. Si donc le teint de la peau est en quelque sorte un thermomètre de vigueur au physique comme au moral, et c’est M. Virey lui-même qui nous fournit cette expression pittoresque, les philosophes comme Knight [118] qui firent de la couleur noire l’attribut de la race primitive dans tous les animaux, le firent avec raison, et logiquement, il nous semble, le nègre deviendrait le type par excellence, et devrait être placé au premier degré de l’échelle humaine.
Nous n’attachons aucune valeur d’argumentation à cette hypothèse, dont sans nul doute on n’eût pas manqué de faire usage au détriment des Africains, si le contraire avait eu lieu ; mais nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer qu’elle s’accorde avec les traditions d’une antiquité immémoriale, qui présentent les hommes noirs comme les premiers civilisés du globe.
Passons : si le sang des nègres et leurs viscères sont noirâtres, au dire de M. Virey, toujours à la suite de Sommering, leurs os en revanche sont plus blancs que les nôtres.
C’est là encore une opinion professée par les anthropologistes qui croient plus volontiers ce qu’ils trouvent dans les livres de leurs prédécesseurs, qu’ils ne se donnent la peine de lire dans celui de la nature.
Les Espagnols ont des cimetières fort étroits ; il ne s’y garde guère de terrains à perpétuité ; au bout de deux ou trois ans on déterre les morts, on brûle ce qui subsiste des linceuls, et l’on fait du reste un grand ossuaire. Il se voit dans les ossuaires de Puerto-Rico des os de maîtres et d’esclaves ainsi mêlés ensemble : tous ont la même couleur, impossible de distinguer deux espèces. L’égalité des squelettes est absolue.
Une autre opinion de M. Virey, qui assimilerait l’homme noir aux quadrumanes, c’est que l’enfant nègre naîtrait avec la fontanelle plus petite et plus fermée que l’enfant blanc. Nous devons l’avouer, M. Cotterell, jeune habitant du Macouba, fort [143] occupé d’histoire naturelle, nous a dit avoir vérifié l’exactitude du fait. Nous avons toutes sortes de raisons pour croire à sa bonne foi éclairée, et néanmoins nous sommes obligé de dire que notre attention ayant été fixée sur ce point, huit ou dix examens personnels ne nous ont amené à rien de positif. Chez les nouveau-nés noirs, comme cela arrive chez les nouveau-nés blancs, nous avons trouvé la fontanelle plus ou moins molle, plus ou moins étendue, les sutures plus ou moins fermées, mais rien d’essentiellement différentiel. Une négresse, sage-femme d’habitation, toujours chargée d’accoucher des esclaves, et à laquelle nous avons posé la question nette sans qu’elle pût présumer que nous désirassions telle réponse plutôt que telle autre, nous a dit qu’il n’y avait rien de précis à cet égard, et qu’elle avait vu des négrillons dont la fontanelle et les sutures étaient si fragiles, qu’il fallait soutenir la tête par des bonnets un peu serrés. Même, dans sa pensée à elle, les enfans qui naissent avec la tête solidifiée, deviennent plus vaillans, comme on dit en créole d’un homme fort et résolu.
En tout cas, si l’observation des fontanelles cartilagineuses était reconnue exacte, il faudrait pour en tirer des conséquences douées de rectitude, savoir si l’homme sauvage, rouge, jaune ou blanc, sortant d’une longue suite de générations incultes ne partage pas, de même que les noirs, ce rapport avec les quadrumanes ; il faudrait examiner également si le produit des esclaves créoles, c’est-à-dire des esclaves plus civilisés ne se rapproche pas du produit blanc ; et enfin si l’enfant d’une génération nègre ayant acquis tout son développement intellectuel, ne naîtrait pas avec des conditions analogues aux nôtres. Dans cette hypothèse, nous serions fort tenté de conclure qu’à l’époque où nous habitions les forêts de la Gaule, nous avions la fontanelle tout aussi peu gélatineuse que les nègres d’aujourd’hui.
M. Virey admet encore que les mamelles sont très basses et pendantes chez les négresses, dès la première nubilité. M. Bory de Saint-Vincent, le premier, si nous ne nous trompons, qui [144] ait admis ce fait comme général, a voulu, nous croyons, accumuler trop de preuves pour justifier sa nomenclature un peu bizarre du genre humain en quinze espèces différentes. Mais s’il a vu à l’Île-de-France des négresses du genre qu’il décrit, nous sommes à même de l’assurer qu’elles ne ressemblent point du tout à celles des Antilles, ce qui l’engagera peut-être à créer une seizième espèce.
Pour tout dire, les hommes de l’art résidant aux colonies, n’acceptent rien des propositions de quelques anthropologistes européens sur la structure des nègres. Je consultais, je me rappelle, sur ce point, M. Noverre, médecin établi depuis vingt ans à la Martinique, où il est devenu, de conviction, partisan de l’esclavage. « Tout cela, me répondit-il, ce sont des sottises d’homme à préjugés. » À la Jamaïque, le docteur Spalding, créole, qui n’a quitté l’île que pour ses études en Europe, et qui a long-temps professé à Kingston, n’a remarqué dans tout le cours de sa pratique, d’autre différence essentielle entre les blancs et les noirs que la couleur de la peau. M. Lestrade, jeune praticien de grande science, créole martiniquais, qui s’est beaucoup occupé de ces questions, n’a non plus rien observé de pareil dans le grand nombre de cas anatomiques que lui offre journellement sa pratique. La seule chose qu’il note est une ossification plus rapide de la tête dans l’enfant noir, et une épaisseur plus grande des os du crâne dans l’adulte.
Nous pouvons appuyer ces opinions de celle de Camper. « Comme ce fut en public que je disséquai ce cadavre (il parle d’un jeune nègre d’Angola, mort à Amsterdam), j’en examinai avec impartialité toutes les parties, pour reconnaître les différences qu’il pouvait offrir, et je dois avouer que tout s’y trouvait de parité avec l’homme blanc. » Le grand anatomiste hollandais, dit en terminant le discours [119] dont nous avons extrait ce passage : « Ceux qui voudront approfondir cette matière, peuvent consulter l’admirable ouvrage d’Albinus, sur la cause et le [145] siége de la couleur des nègres et des autres hommes. Qu’on lise aussi ce que Littré, membre de l’Académie royale des Sciences de Paris, a consigné dans les mémoires de cette société en 1702 ; la Vénus Physique, de Maupertuis ; mais surtout l’Histoire naturelle de l’Homme, de l’immortel Buffon. Joignez-y les observations du pénétrant Lecat, et vous ne ferez plus difficulté de tendre avec moi une main fraternelle aux nègres, et de les reconnaître pour véritables descendans du premier homme, que nous regardons tous comme notre père commun. »
Au reste, puisque tous les créoles prennent M. Virey pour arbitre, qu’ils l’acceptent donc tout entier ; lui-même ne peut échapper malgré ses doctrines acquises, à l’instinct qui rattache et ramène tous les hommes distingués au principe de l’indépendance de tous les êtres humains. Comme M. Bory de Saint-Vincent, il se montre énergique et généreux ennemi de l’esclavage des nègres, et voici comme il termine : « La nature nous avait formé libres et fiers ; elle nous avait rendus tous égaux à la naissance et à la mort. Quoique de longues habitudes puissent enseigner à des individus à se complaire dans leurs chaînes, quoique des races abâtardies par un constant esclavage, naissent peut-être, comme le pensait Aristote, esclaves désormais par nature ; le noble sentiment de la liberté ressuscite sans cesse au fond de tous les cœurs, c’est l’élément de toute vertu, de tout génie, et par conséquent, c’est le bien imprescriptible de la première créature, reine de toutes les autres… Ils sont paresseux, je le crois, ils n’ont point de religion, point de lois chez eux ; soit, mais est-ce donc un motif pour les asservir, les arracher des bras de leurs familles, du sein de leur patrie, pour les traîner chargés de chaînes en de lointains climats, les forcer à se courber sous un fouet menaçant, à engraisser de leurs sueurs une terre brûlante où ils multiplient sans récompense des richesses qui ne sont pas pour eux [120]. » [146]
Il nous reste encore quelque chose à dire. (Nous sentons notre insuffisance à traiter de pareilles matières, et cependant nous croyons devoir aller jusqu’au bout.) Les fontanelles solides sont fort du goût des hommes aux causes finales. Si la tête du fœtus nègre est ainsi faite, c’est qu’étant moins grosse que celle des autres hommes, les os du crâne n’ont pas besoin de jouer les uns vers les autres pour faciliter la délivrance. Sœmmerring en effet, a dit un jour que la masse cérébrale du noir était plus petite que celle du blanc ; et les savans de cabinet ont déclaré depuis que la capacité du crâne éthiopien diffère d’à peu près un neuvième en moins de celle du crâne japhétique. Rien de tout ceci n’est avéré, et nous avons entendu M. Jobet, docteur de la faculté de Paris, établi depuis dix-sept ans au Port-au-Prince, Haïti, où il vit avec des nègres, professer l’opinion que leur appareil cérébral est égal à celui du blanc.
Il est une remarque plus exacte que toutes les autres, et sur laquelle on n’insiste pas moins ; nous voulons parler de l’étroitesse du devant du crâne par rapport à la partie occipitale. Pour cela nous en tombons d’accord, mais si, comme la science moderne le reconnaît après Gall, la boîte osseuse est soumise à l’influence du développement du cerveau, il n’est aucune raison de se refuser à croire que, quand l’exercice des facultés intellectuelles aura grossi la masse antérieure de l’encéphale du nègre aux dépens de la masse postérieure, sa tête ne devienne aussi ronde que la nôtre. Il est tout simple qu’il n’ait que le cerveau de ses actes ; ce qui serait prodigieux c’est que son action morale étant comprimée par de longs siècles d’esclavage ou de sauvagerie, son cerveau fût pareil à celui de l’homme civilisé. Les serfs russes doivent avoir la partie antérieure du crâne non moins étroite que les nègres. Il se pourrait bien aussi que l’usage adopté dès leur enfance par les nègres, de porter tous les fardeaux sur leur tête, contribuât à leur infériorité actuelle. Des médecins cités par M. Virey, ont observé que cette vicieuse habitude contractée par des ouvriers en Europe, hébétait souvent les individus en déprimant leur cerveau. [147] « Et effectivement, ajoute M. Virey, la nature nous ayant attribué une tête sphérique, toutes les compressions qui changent cette forme, diminuent le libre développement de l’encéphale. »
Déjà, si l’on étudie phrénologiquement la population des colonies, on observe que chez l’esclave créole la bouche est moins avancée, l’angle facial plus ouvert que chez l’Africain. Ce museau du nègre dont M. Virey parle toujours, est un effet du reculement du front, qui disparaît lorsque le front s’avance. M. Lacharrière, de la Guadeloupe [121], n’hésite pas à reconnaître que « le moral des nègres s’est amélioré dans les colonies. » Pour léger qu’ait été le frottement avec la civilisation, ils ont montré combien ils sont perfectibles en en profitant ; et il n’y a pas de doute que la liberté faisant jouer leurs organes intellectuels laissés en repos dans l’esclavage, ne les amène au même degré que les plus fiers Caucasiques. Tout est affaire d’éducation et de pratique. Nous croyons beaucoup au perfectionnement progressif des races par la culture, et à la transmission d’une génération à l’autre d’un degré acquis d’intelligence. L’homme est modelé sur son père ; son esprit reflète avec facilité ; et cette disposition à se laisser impressionner par le mouvement continuel de l’extérieur, est un des principaux élémens de la sociabilité des créatures humaines. N’est-ce pas là ce qui forme le caractère distinctif de chaque nation, ce qui fait que l’homme français diffère de l’homme allemand, celui-ci de l’homme chinois, etc. ; ce qui fait que chacun de ces trois individus a un cachet et des idées françaises, allemandes, chinoises, auxquelles on le reconnaîtra partout pour ce qu’il est. Incontestablement un peuple long-temps civilisé doit produire des enfans plus capables que ceux d’un peuple barbare.
L’être humain est essentiellement perfectible, mais le principe du perfectionnement n’est pas en lui ; il s’instruit par le contact avec de plus instruits que lui. Il a du moins besoin d’une certaine initiation pour se comprendre lui-même. M. l’abbé [148] Frère a très bien démontré cette vérité, en disant que « si les peuples étaient soumis à une action naturelle qui déterminât leur développement, on ne pourrait concevoir comment tant de peuples sauvages qui existent encore, ne sont pas sortis de cet état depuis un si grand nombre de siècles [122]. »
Tout ce que l’on dit des Africains, les auteurs espagnols de la découverte l’ont dit des Indiens. Le père Charlevoix, s’exprime en ces termes sur les hommes du Paraguay : « Nous avons déjà vu plus d’une fois que ces Indiens ont naturellement l’esprit fort bouché, et ne comprennent rien à ce qui ne tombe pas sous les sens. Cela parut à nos missionnaires aller jusqu’à la stupidité [123]. »
Mais bien mieux, les inductions que l’on tire de l’état social de l’Afrique contre la nature essentielle des nègres, il y a deux siècles tout au plus, que les Romains auraient pu en tirer de pareilles contre les Gaulois et les Germains ; car le cerveau de l’homme noir ou blanc étant un, l’homme sauvage, blanc ou noir, est partout semblable, de même que l’homme civilisé partout se ressemble. Il est curieux de lire ce que dit Tacite des habitans de la Germanie ; on croirait que ce qu’on écrit aujourd’hui des habitans de la Guinée, a été copié du grand annaliste romain. « Les Germains ont des chevaux blancs sacrés, dont ils observent les henissemens ou le bruit des naseaux. Il n’est pas d’augure plus décisif, non-seulement pour le peuple mais pour les grands, qui croient que ces animaux sont les confidens des dieux dont les prêtres ne sont que les ministres [124]. » On voit que les hommes sont de tous temps les mêmes ; Tacite qui consultait les entrailles des victimes, a grande pitié des Germains qui consultent les henissemens des chevaux blancs ; de même que nous autres qui en étions encore à refaire une loi du sacrilége il y a quinze ans, nous nous moquons beaucoup des fétichistes de la cafrerie ! [149]
« Ils sont si follement acharnés au jeu, que quand ils n’ont plus rien ils jouent leur personne et leur liberté. Le vaincu va lui-même se livrer à la servitude, il se laisse enchaîner et vendre. On se défait par le commerce des esclaves de cette espèce, pour se délivrer en même temps de la honte d’une telle victoire [125]. »
« Ils ne bâtissent point de villes, ils vivent épars, isolés, ils n’emploient ni ciment ni tuiles, ils se servent uniquement de matériaux bruts sans penser à la décoration ni à l’agrément [126]. »
Les habitans de Tombouctou et de Jenné sont évidemment plus avancés que ne l’étaient les Germains. Et il y avait aussi des siècles que les Germains vivaient dans cet état de torpeur.
Reprenons. En tout ceci, nous avons voulu prouver que le nègre doit avoir place entière dans le genre hominal. Il est homme, bien véritablement homme. Il pense, il éprouve les émotions du bonheur et les angoisses de la peine ; le désir de l’approbation le porte à des traits héroïques, l’égoïsme à de mauvaises actions. Il faut être au moins fort paradoxal pour nier la valeur d’une telle identité d’organisation morale. Son mode d’être intellectuel, ses passions, ses goûts, tout proteste contre une assimilation entre lui et le singe ; l’Africain est un homme noir comme l’Indien un homme brun, l’Asiatique un homme jaune, l’Américain un homme rouge, l’Européen un homme blanc. Voilà tout. Nous ne reconnaissons de supériorité à une race sur l’autre que celle acquise par l’éducation, et nous ne reconnaîtrons de droits au titre de la première créature du globe, qu’à celle-là qui s’en montrera la meilleure et la plus généreuse !
Encore une fois le noir est homme. L’analyse anatomique de son être comparée à celle des autres hommes, ne présente aucune dissemblance essentielle. Ce sont des nuances dans une [150] unité ; et lorsque nous en avons contesté quelques-unes, nous n’avions en vue que l’exactitude scientifique, aucunement l’intérêt de notre cause. Même comme abolitioniste, nous ne tenons pas du tout à blanchir le noir ; nous n’avons pas besoin de cela pour exiger sa délivrance.
Il y a déjà long-temps que Montesquieu a écrasé de sa sanglante ironie les abominables sophismes au moyen desquels on tire de la couleur des noirs une induction pour la légitimité de leur esclavage.
« Si j’avais, dit-il, à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :
« Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique pour s’en servir à défricher tant de terres.
« Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.
« Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presqu’impossible de les plaindre.
« On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.
« Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité !
« On peut juger de la couleur de la peau par celles des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, était d’une si grande conséquence, qu’ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains.
« Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence.
« Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on [151] commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
« De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains : car, si elle était telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la piété [127]. »
Quoiqu’en puisse murmurer son orgueil, l’homme n’est qu’un des échelons du règne animal ; il ne pouvait être soustrait à la loi générale de la nature : puisqu’il y a des espèces dans le genre chien ou le genre crocodile, pourquoi n’y en aurait-il pas dans le genre homme ? Les souris blanches sont-elles moins souris que les grises ? De telles variétés ne compromettent en rien l’organisme, nous ne sommes pas du tout tenté de les révoquer en doute, de l’homme noir à l’homme blanc ; elles se multiplient à l’infini dans la nature ; le type nègre n’est pas plus universellement identique que les autres, il se modifie dans lui-même. Les Abyssiniens diffèrent autant des Cafres que les Kalmouks des Chinois.
Parce que le nègre et le blanc sont des rameaux divers de l’arbre humain, nous ne voyons pas pourquoi on ferait l’un supérieur à l’autre, ni que l’un doive être mis au dessus ou au-dessous de l’autre. Il ne nous est point encore clairement démontré qu’un tissu réticulaire à sécrétion noire, ait plus de génie qu’un tissu réticulaire à sécrétion blanche ; que des cheveux plats soient plus intelligens que des cheveux crépus ; des lèvres épaisses et brunes, plus sottes que des lèvres minces et rouges ; des sclérotides [128] jaunâtres, humides et injectées de sang, plus grossières que des sclérotides mates et transparentes ; des talons élargis plus incapables que des talons droits ; mais ces nombreuses infériorités fussent-elles encore avérées, il nous serait impossible d’y voir une démonstration bien évidente que [152] le nègre doive être esclave, car elles pourraient faire que ce soit un autre homme, mais elles ne l’empêcheraient pas d’être homme ; et cela étant, rien ne peut excuser son esclavage. Voilà pourquoi, selon nous, c’est une proposition exécrable au point de vue philosophique, impie au point de vue providentiel, que celle-ci : « Dieu n’a pas voulu que le nègre fut libre. » Le nègre a surabondamment prouvé qu’il voulait être libre, en tuant ceux qui le faisaient esclave. Qu’on ne s’enivre pas de folles rêveries d’orgueil. Jamais on ne vit les animaux domestiques se révolter contre la puissance de l’homme. Son ascendant sur eux continuel et perpétuel établit son droit de maître, tandis que les tentatives continuelles, perpétuelles, et quelquefois heureuses des noirs pour s’émanciper, confond chaque jour la prétendue supériorité des blancs.
Ainsi que nous le déclarions en commençant, nous avons traité de ces hautes matières, entraîné par le sujet et les nécessités de notre ouvrage ; mais nous sommes trop ignorans pour y apporter aucune prétention scientifique. Aussi nous embarrasserait-il beaucoup celui qui nous demanderait après nous avoir écouté : « Quel rang donnez-vous donc au nègre dans la généalogie humaine ? »
Quand et comment le nègre parut-il sur la terre ? Loin d’être une créature d’un ordre inférieur dans son espèce, est-il réellement, au contraire, un des trois types primordiaux [129] auxquels l’anthropologie moderne rattache, faute de mieux, toutes les variétés humaines ? Grand mystère sur lequel la science, à l’état imparfait où elle se trouve, n’a encore rien relevé. Par une circonstance singulière, de toutes les branches de l’histoire naturelle, celle dont l’objet est de décrire, classer et déterminer les différentes espèces d’hommes et les variétés dans chaque espèce, a toujours été la plus négligée, et demeure la plus incomplète. Serait-ce qu’elle est la plus difficile ? [153]
En observant aux colonies les nombreux types sortis de l’union du blanc et du noir, on entrevoit un fait qui jetterait peut-être quelque lumière sur ces doutes. Il se rencontre surtout parmi les femmes, des spécimens très caractérisés du type asiatique et du type indien : les premières, teint jaune, nez allongé, bas de visage maigre, yeux noirs un peu penchés à la chinoise, corps svelte, tempérament bilieux : il nous semblait voir les originaux de peintures persanes [130] ; les autres au contraire, tempéramentlymphatique, formes arrondies, teint brun et visage rond [131], en les considérant je croyais retrouver les odalisques qui ont figuré dernièrement sur les théâtres de Paris. L’Asiatique et l’Indou seraient-ils donc des espèces croisées, résultat d’un rapprochement inconnu à l’histoire entre le nègre et le blanc ? Deux sang-mêlés d’un même degré procréent constamment et absolument leurs semblables ; ne peut-on admettre que les populations de l’Inde et de l’Asie sont des hybrides isolés par une circonstance quelconque de leur souche, qui, au moyen de la transmission héréditaire de leurs formes acquises, perpétuèrent des variétés, lesquelles font supposer une race primitive et particulière. N’a-t-on pas vu les Égyptiens qui étaient encore nègres au temps où Hérodote écrivait leur histoire, finir par se fondre dans un moule intermédiaire entre le nègre et l’autochtone ?
Cette hypothèse prenant consistance, la pluralité des races si nombreuses et si diverses qui couvrent le globe s’expliquerait aisément, comme des modulations des deux souches primordiales unies, blanc et noir. Mais il resterait toujours alors à découvrir laquelle des deux engendra l’autre ; car, malgré les caractères différentiels qui les distinguent d’une manière tranchée, elles sont constitutionnellement si parfaitement identiques que notre raison veut qu’elles sortent d’un même tronc [154] originel, qu’elles procèdent l’une de l’autre. Sans nous charger de résoudre la question, ajoutons que la croyance instinctive à l’unité de la race humaine, touche à la certitude au tant qu’il est possible d’y toucher en ces matières, si l’on considère le témoignage des livres appelés sacrés et les traditions cosmogoniques, qui s’accordent toutes pour donner un seul père à l’humanité, traditions semblables elles-mêmes à notre espèce, variées à l’infini, mais au fond toutes pareilles et auxquelles, vu ce merveilleux accord, on est obligé de prêter une connexité qui se perd dans les ténèbres des premiers âges.
[155]
CHAPITRE XII.
DE L’INTELLIGENCE DE L’HOMME NOIR.↩
Les hommes noirs furent les premiers civilisés. — Au point de vue religieux c’est une impiété de dire que les nègres ont toujours été dans la barbarie. — Quelques nègres qui se distinguent au milieu même de l’esclavage. — Rosillette. — Saillies. — Proverbes créoles. — Injustice du jugement porté sur les nègres. — Les serfs russes, polonais, valaques, aussi stupides que les esclaves noirs. — Dans les écoles des îles anglaises, les enfans nègres montrent autant d’intelligence que les enfans blancs. — Les colons ne connaissent pas les nègres. — Le défaut d’intelligence tient à l’esclavage et non pas à la nature des noirs. — Liberia.
Les annales les plus reculées conservent des traces tellement nombreuses du rôle initiateur que la race nègre joua autrefois dans le monde, qu’il est impossible de le révoquer en doute, à moins de déchirer l’histoire tout entière. Les grandeurs de Carthage et de la Phénicie ont à la créance générale des titres moins authentiques que celles de l’Afrique. Si l’on ajoute foi à ce qu’Hérodote et Diodore de Sicile racontent des Perses et des Égyptiens, il faut croire ce qu’ils disent des Éthiopiens ; raisonnablement on ne peut nier l’un sans nier l’autre. Or, nous avons démontré dans un ouvrage déjà cité [132], leurs textes à la main, que les hommes noirs furent les premiers civilisés ; et Bruce il y a un demi-siècle, M. Hoskins il y a six ans [133] en nous faisant connaître les ruines immenses qu’ils ont trouvées dans leurs beaux voyages en Éthiopie (la Nubie actuelle), ont confirmé l’exactitude des leçons d’Hérodote et de Diodore.
On peut très bien aller plus loin, il nous semble, et dire aux hommes de la révélation que c’est une impiété de se refuser à admettre que les nègres soient un peuple dégénéré, et non pas un peuple encore sauvage. Noé avait déjà connaissance de toutes les sciences humaines ; l’esprit des livres saints veut [156] qu’on croie qu’il la communiqua à ses enfans chargés par la Providence de repeupler la terre ; et ses enfans avec leurs générations ayant reçu son héritage moral scientifique et industriel, doivent l’avoir perdu s’ils ne l’ont plus, ou la révélation a menti. Cette vue de l’abbé Frère [134], nous paraît fort juste dans la donnée religieuse. Les connaissances puisées au centre commun s’oublièrent de génération en génération, pendant le cours des longues migrations qui ne permettaient d’en cultiver aucune. — Nous n’avons pas dit cela sans but, car la barbarie des nègres étant ainsi un état de dégradation, ils remonteront à leur égalité primitive, dès que la cause de cette dégradation cessera.
Inutile de revenir sur ce qui vient d’être dit au chapitre précédent. Nous ne voulons pas celler qu’il y ait des nègres véritablement stupides, ceux particulièrement que les négriers amènent encore aux îles espagnoles, presque tous esclaves abrutis déjà dans leur pays comme le sont les serfs d’Europe. Il en est qui ne paraissent guère moins bornés que les conscrits auxquels on est obligé de mettre du foin dans un soulier et de la paille dans l’autre pour leur faire distinguer le pied gauche du pied droit, ou bien encore que les paysans alsaciens, pour la tranquillité desquels on a été obligé de faire bénir solennellement le chemin de fer de Strasbourg, parce qu’ils croyaient les locomotives animées du feu de l’enfer. Nous accordons enfin que la masse des nègres, tels qu’ils sont aujourd’hui, montrent une intelligence au-dessous de celle de la masse des blancs, mais nous sommes convaincu qu’une éducation égale les remettrait vite de niveau.
Déjà, même aux colonies, plus d’un parmi eux ont su vaincre l’immobilité intellectuelle à laquelle on les condamne. M. Meat Desfourneau a un noir pour commis et secrétaire. C’est lui qui est chargé de toute la comptabilité de l’habitation [135], il écrit et [157] cause très bien. Cet homme appelé Louisi, s’est fait tout seul. Un curé qu’il servait lui enseigna simplement à lire. « Comment avez-vous donc appris l’orthographe lui demandais-je ? — En lisant beaucoup me répondit-il, avec naïveté. » Un trait qui lui est relatif pourra donner un exemple des préjugés sous les quels étouffent ces pauvres gens. Je me trouvais avec trois blancs dans la rue, lorsque le voyant passer, je lui rappelai une note qu’il avait promis de me copier. « J’ai la chose dans mon bureau, dit-il, j’aurai l’honneur de vous la porter demain » ; puis il continua sa route. Et aussitôt les trois blancs à la fois : « J’aurai l’honneur… mon bureau… un nègre ! En vérité cela fait pitié. »
Un autre noir avec qui nous fûmes mis en relation (son nom nous échappe) a des facultés musicales extraordinaires. Lorsqu’on faisait de la musique à Saint-Pierre, les blancs daignaient l’admettre dans leur société de concert, tant il y tenait bien sa place. Il est en état d’écrire un morceau, rien qu’à l’entendre chanter. Il mourra à la Martinique sans se développer.
Il n’y a guère d’habitation où l’on ne trouve parmi les esclaves un homme qui ait su vivre intellectuellement, malgré l’atmosphère abrutissante où il végète. Un commandeur de M. Lejeune Delamotte s’étant par une circonstance fortuite trouvé à la tête de l’habitation pendant six mois, la dirigea supérieurement. Les préjugés ne permettaient pas à M. Delamotte de laisser à un noir les hautes fonctions que cet homme avait si bien remplies ; les esclaves prendraient d’eux-mêmes trop bonne opinion s’ils voyaient un des leurs gérer un bien. Le commandeur fut donc remplacé par un blanc, mais le poison se déclara peu après sur l’habitation, et il fut avéré que le nègre abaissé était seul coupable. Laissé chef, il eût continué à faire prospérer le bien, dégradé, il crût avec la perversité esclave qu’il pourrait regagner la place, en montrant que sous un autre venaient les fléaux.
Sur l’habitation Gradis il existe un nègre charpentier mou [158] linier [136] qui, sans aide, a construit le moulin et la roue hydraulique. Mathieu est un véritable mécanicien. Le forgeron étant venu à mourir, il le remplaça, et fit bientôt jusqu’à des vis. Il confectionne tous ses outils lui-même. Le géreur ne fait pas difficulté de dire que cet esclave représente pour l’habitation un capital de 10, 000 francs. M. Gambay en avait moins fait avant de se mettre en marche pour conquérir sa place à l’Académie des sciences, où il siège aujourd’hui parmi les sommités de l’Europe. Mathieu ne sait ni lire ni écrire, il sera fouetté s’il a le malheur de mécontenter même l’’économe, de manquer de respect à un blanc, celui-ci fut-il un goujat ; et si cela plaît à son maître on vendra ses enfans qu’il aime peut être plus que tout autre esclave n’aime les siens, car la sensibilité du cœur s’exalte avec le développement de l’intelligence et la révélation du moi. — Il y a quelques machines à vapeur dans les colonies françaises, il y en a beaucoup dans les colonies anglaises, partout ce sont des nègres qui les conduisent.
À la grande forge du Moule (Guadeloupe), le principal ouvrier est un esclave à peine âgé de vingt-sept ans. Le chef de l’établissement, M. Cadenet, nous disait que ce nègre avait pour lui une valeur de 20, 000 francs, et que le plus habile ouvrier d’Europe ne lui était point supérieur.
En allant visiter la léproserie de la Désirade, en compagnie de M. Jumonville Douville, nous nous arrêtâmes chez une négresse qui lui fit fête, se disant toujours heureuse de servir un grand terrier, parce qu’elle était elle-même de la Grande-Terre, Oui, dis-je, un homme de la Basse-Terre [137] à ce qu’il paraît ne serait pas très bien venu auprès de vous. — Pourquoi, monsieur ? Basse-Terre ou Grande-Terre, c’est toujours la Guadedeloupe, toujours mon pays. — Bon, alors si un homme de France arrive, il ne trouvera pas le même accueil. — Pardon, Français d’Europe ou Français de la Guadeloupe, ne sont-ce [159] pas les mêmes ? Nous formons tous ensemble une seule nation, je suis aux uns comme aux autres. — Voilà, repris-je, m’adressant à M. Jumonville, voilà le danger de toutes vos séparations de peuples, de toutes vos catégories humaines, cette brave femme vous recevra bien parce que vous êtes Français ; et moi, parce que j’ai le malheur d’être Turc ou Chinois, elle me fermera sa porte. — Mais pas du tout, monsieur, si vous êtes étranger, je vous devrai bien davantage ; car vous serez seul et exposé à trouver moins de secours.
Nous ne connaissons pas beaucoup de servantes d’auberge, fussent-elles blanches comme des cygnes, dont on puisse attendre cette subtilité, cette ressource d’esprit, ces droites et délicates répliques qui furent faites avec une merveilleuse promptitude.
Les négresses montrent, comme les nègres, les qualités de leur sexe. On en trouve, par exception il est vrai, mais en régime d’esclavage le bien se peut-il produire autrement que par exception ? On en trouve au milieu même des ateliers de jardin, douées d’une modestie naturelle pleine d’attraits ; d’autres dansant avec grâce, d’autres d’une parfaite réserve. Il y a aussi parmi elles comme parmi nous, de ces créatures faibles, délicates, fragiles, pour qui, dès qu’on les voit, on se sent porté d’un tendre intérêt. Nous avons rencontré dans l’hôpital de M. Meat une jeune fille, une enfant de neuf ou dix ans, prise d’une horrible fièvre pernicieuse ; son visage noir était doux et distingué, ses grands yeux brillaient d’un feu mortel, et l’angélique sérénité avec laquelle elle souffrait, ravissait tout le monde. Maître, esclaves, voisines de lit, infirmière, il n’était personne qui ne fut occupé de Rossillette, tel était son nom, et le médecin, captivé comme les autres, venait à cause d’elle deux fois par jour. Je n’ai vu cet aimable petit être que trois fois, et je garde mémoire de l’harmonie qu’il y avait dans ses gestes, lorsque me reconnaissant après la première visite, elle levait son pauvre bras amaigri pour me tendre la main. Le quatrième jour, le médecin en arrivant ; la trouva presque sans fièvre ; [160] depuis son réveil, elle demandait de l’eau fraîche que l’on n’avait osé lui donner, et que le médecin autorisa. « Vous voyez bien que le docteur y consent, » dit-elle à l’infirmière, de sa gracieuse petite voix. On la souleva pour boire ; et… elle expira, sans proférer une parole, sans jeter un cri, sans faire un mouvement. Elle mourut comme elle avait vécut, doucement. Le destin toujours favorable pour elle ne voulait pas qu’elle fut esclave, et l’affranchit de tous les liens de la terre.
Cette misérable négresse, née dans une case d’esclave, morte sur un grabat d’hôpital, enveloppée de linges en lambeaux ; elle, dont la mère ne connaissait peut-être pas le père, nous rappela ces beaux vers d’un poète Irlandais :
Full many a Gem of purest ray serene
The dark unfathomed cave of Ocean bear.
Ful many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air [138].
La saillie est loin de manquer parmi les esclaves, un d’eux à qui l’on demandait ce qu’il donnait à ses volailles pour les nourrir, répondit d’un grand sang froid : « Le samedi. » On se rappelle que le samedi est un jour de travail accordé sur beaucoup d’habitations en place de l’ordinaire. Leur langage fourmille d’images et de métaphores curieuses. « Ous qua doive enmancher nom-la », vous devez mettre un manche à ce nom-là, dit une fois un émancipé de la Dominique à quelqu’un de notre connaissance qui supprimait le Monsieur en lui parlant [139]. Nous nous souvenons encore d’un esclave, lequel répondit fièrement à un ouvrier qui lui reprochait, dans une dispute, de ne pouvoir bouger, d’être rivé à l’habitation comme [161] un chien : « Moin c’est savanne ous c’est bœuf. » Je suis immobile et fécond comme la terre, vous n’êtes propre, vous, qu’à aller de côté et d’autre comme le bœuf. — Parmi tous les sophismes des créoles sur l’esclavage en est-il beaucoup de plus subtil que celui-là ?
Nous renvoyons à la fin de ce volume une collection de proverbes nègres dans lesquels on en trouvera bon nombre d’un sens admirable, d’une tournure très originale et de la pensée la plus élevée (a). Nous y joignons un conte d’une ingéniosité charmante que nous avons pu nous procurer dans toute sa pureté créole. Ces contes sont des cadres à improvisation que le narrateur brode à sa guise. Il en existe beaucoup de ce caractère simple et fin qui rappelle la manière des contes Iolofs dont M. Roger a donné de ravissans échantillons dans ses fables sénégalaises. Ils protestent avec une force singulière contre le défaut d’attention, le manque de suite dans les idées, que les créoles, même ceux de bonne foi, disent avoir remarqués chez les nègres. Cette incapacité de réflexion doit-être attribuée, nous le croyons, au peu d’exercice des facultés réflectives que l’esclave a occasion de faire. — Son unique destin, dans ce monde, est de creuser des trous de cannes, de les sarcler, de les épailler et de les convertir en sucre ; après cela il est homme, il est père, il est chrétien, s’il veut et comme il peut. Lorsqu’il dit ma main, mon corps, moi-même, ce n’est pour lui qu’une figure car il appartient tout entier à son propriétaire et le profit de son propriétaire est l’unique fin de son être. — L’homme qui n’a à penser à rien, et ne vit point de sa propre vie, ne doit-il pas naturellement perdre l’attention ? On abandonne les nègres à leurs instincts sans qu’ils aient le moindre usage de leur intelligence, et puis après on reproche à leur nature intime d’être de l’instinct sans réflexion ; on les a dépravés par l’abrutissement de la servitude, et l’on dit que ce sont des idiots. Rappelez-vous donc ce que M. Czinski rapporte des serfs polonais. « J’ai vu cent fois de pauvres serfs suer sang et eau pendant une heure pour expliquer une commission dont ils [162] étaient chargés, et qu’un enfant libre, de cinq ans, aurait rendue en une minute. »
À priori, on peut dire que l’intelligence des esclaves est en rapport avec la manière dont ils ont été traités, pris en masse ils se montrent d’autant plus intelligens qu’ils sont moins esclaves. Sur deux habitations dont les maîtres ne se trompent pas aux signes de temps, et qui parlent ouvertement de l’émancipation devant leurs nègres, plusieurs esclaves avec lesquels nous avons causé et qui étaient parfaitement à leur aise, ne nous ont pas paru avoir moins de facilité que nos paysans. Tous, quand je leur demandais s’ils désiraient la liberté, répondaient oui, sans hésiter ; quelques-uns, je ne le cache pas, lorsque j’ajoutais : « Pensez-vous qu’il soit dangereux de la donner à tout le monde ? » répondaient encore oui. C’est le premier mouvement du cœur humain mal dirigé, le vieux cri de l’égoïsme : « Donnez à moi seul car seul je suis digne. »
En général nous avons très bien remarqué que ces hommes, malgré leur état inculte, ne disaient que ce qu’ils voulaient et savaient tourner une difficulté en vous adressant une question lorsqu’ils ne leur plaisait pas de vous faire une réponse. Leur intelligence est une force latente qui n’a besoin que d’exercice pour se manifester ; elle s’éteint autrement, comme elle est venue, à l’état rudimentaire.
Il n’est pas extraordinaire que la grande majorité des nègres s’arrête à un développement intellectuel fort resserré. Traités comme des animaux domestiques, assurés du gîte et de la pâture, où veut-on qu’ils aient pris des notions de vie sociale ? Ces choses-là ne se devinent pas, il faut avoir connaissance d’une vertu pour la pratiquer. Or, les nègres esclaves s’ignorent eux-mêmes, et devenus libres, leur isolement de tout foyer lumineux, l’état de compression éternelle où ils vivent, le préjugé de couleur qui les avilit à leurs propres yeux, mille causes refoulent en leur sein tout élan de leur âme, tout mouvement de leur esprit. On ne voit pas les serfs russes, polonais, valaques, produire beaucoup plus de grands hommes [163] que les serfs coloniaux ; mais grâce à quelques expériences heureuses fournies par le hasard, il est impossible de douter que la fréquentation du monde civilisé et la communion sainte des idées libres ne puissent mener les uns et les autres à un progrès assuré. Bien que nos adversaires nous l’aient assez sottement prêté, nous n’avons jamais eu l’absurdité de croire que la population esclave des îles fut actuellement égale en intelligence à la population blanche ; ce n’est point à ce titre que nous demandons son émancipation, mais bien parce que nous la croyons apte à devenir, avec le temps, ce que nous sommes devenus.
Quand nous parlerons des colonies anglaises dans un prochain livre, on verra avec quelle prodigieuse rapidité l’indépendance a déjà moralisé leurs nouveaux affranchis ; nous-même qui montrons tant de confiance en eux, nous en étions stupéfait. C’est surtout dans les écoles où il faut voir leurs enfans pour s’assurer que nos désirs ne nous font rien exagérer. Nous avons visité nombre de ces écoles, et partout nous avons trouvé la marmaille noire d’une vivacité extrême, d’un esprit très ouvert, et répondant aux questions d’une manière satisfaisante. Rien n’est plus commun aux West-Indies, que de voir le dimanche dans les chapelles, de petits nègres et de petites négresses de sept ou huit ans lire gracieusement leur office. Partout aussi nous avons demandé aux maîtres ce qu’ils pensaient des dispositions de leurs élèves, et nulle part nous n’avons recueilli une seule observation concordante, avec la prétendue stupidité native de la race africaine. J’ai posé cette question entre diverses autres à M. Parck, chef de la mission méthodiste, établie à la Dominique, « Les enfans nègres se montrent-ils généralement intelligens ou inintelligens dans les écoles ? » Voici sa réponse : « Tout-à-fait de même que l’enfant européen, quand il jouit des mêmes avantages [140]. » M. Davis, [164] archidiacre de l’église anglicane à Antigues, sur pareille demande a répondu : « Aussi loin que l’instruction est poussée, c’est-à-dire lecture, écriture, un peu d’arithmétique et connaissances religieuses, l’enfant nègre se montre d’une intelligence parfaitement égale avec tout autre race sous les mêmes conditions [141]. » M. Westerby, ministre moravien, à la tête du free settlement [142] de Libanon (Antigues), allait plus loin. « J’ai été maître d’école en Angleterre comme ici, nous dit-il, et d’après mon expérience, je dirais que les enfans nègres sont naturellement aussi intelligens et plus studieux que les blancs. »
En résumé il est permis de soutenir une chose qui paraîtra d’abord fort extraordinaire, mais qui n’en est pas moins vraie : Les créoles ne connaissent pas les nègres. Ils n’ont dans les colonies qu’une race dégradée par les misères de sa condition, avilie par le travail forcé, déprimée par la servitude. Bon nombre des habitans vivant sous le rapport de l’intelligence, au jour le jour, n’ayant jamais vu autre chose que la cheminée de leurs batteries ou la girouette de leur moulin, manquent de l’esprit d’observation, ne savent pas faire dans le caractère attribué au noir le départ de l’homme et de l’esclave, et ne lui reconnaissent que des vices ; les autres plus instruits, meilleurs juges, ne s’y trompent pas, mais affligés, dégoûtés, saisis du mal qu’ils voient à chaque heure du jour, ils finissent par s’abandonner aux fausses idées que fait naître le continuel tableau de la dégradation humaine qu’ils ont sous les yeux. Pour nous, persuadé que le nègre est un homme de la même complexion que la nôtre, et possède un cerveau de la même nature que le nôtre, nous sommes convaincu à priori qu’il suffira de le placer en des conditions analogues aux nôtres pour le rendre avec l’aide du temps égal à nous. Détruire l’esclavage [165] des noirs est le seul moyen de détruire l’objection capitale dont leurs ennemis abusent contre eux. Le défaut d’intelligence, ce vice qui existe jusqu’à un certain point, et que l’on dit propre aux noirs, n’est propre qu’à l’esclave, c’est l’esclavage qui en est responsable en ce sens qu’il empêche l’éducation de suppléer à la nature et de la corriger, si tant est qu’elle soit réellement mauvaise.
Ce qui se passe à la colonie américaine de Liberia sert de bonne démonstration à notre raisonnement et lui vient donner le relief d’un fait accompli. Un capitaine de la marine militaire des États-Unis, M. W. Ch. Bell, avec lequel nous nous trouvâmes à table chez M. Perrinelle, fournit sur Liberia des renseignemens que l’on jugea véridiques au caractère d’impartialité qui paraissait y présider. Tout ce que disait le capitaine Bell était de fraîche date, il relâchait à Saint-Pierre, au retour même du voyage qu’il venait de faire à la côte d’Afrique. Cette colonie, comme on sait, fut fondée par la société d’abolition de l’Amérique du nord, et est toute entière composée de nègres, anciens esclaves ou libres malheureux, qui ont été amenés là faute de moyen d’existence en Amérique. La civilisation s’y développe avec rapidité, on s’y occupe également d’industrie et d’agriculture, et tout le monde travaille. De nombreuses écoles gratuites sont situées en des endroits choisis de la ville, pour que les enfans de tous les quartiers puissent y venir sans être forcés à des déplacemens considérables. Le mécanisme gouvernemental de Liberia, est pareil à celui des colonies Anglaises, un congrès vote le budget et les lois qui doivent être soumises à l’approbation du gouverneur [143], et n’ont force légale qu’après avoir été sanctionnées par la société fondatrice. Le capitaine Bell qui s’était présenté à plusieurs séances du sénat noir, en citait la dignité. Il faisait aussi l’éloge de la tenue d’un jury qu’il avait vu administrant la justice. Il avait [166] entendu des avocats et des prédicateurs noirs, auxquels il reconnaissait de l’éloquence et de belles idées. Enfin les deux journaux de la colonie, qui sont également rédigés par des nègres, lui ont semblé fort bien faits. Mettant de côté les préjugés de peau si invétérés chez les Américains ; il avait dîné chez le gouverneur avec plusieurs personnages du pays, dont il louait les manières et la conversation ; l’un d’eux, disait-il, était un homme particulièrement instruit. En un mot, c’est une imitation heureuse de la civilisation européenne qui s’élabore là sur les côtes d’Afrique ; et le voyageur admettait que Liberia pouvait un jour devenir un agent de lumière pour l’intérieur. Il n’est pas jusqu’à la guerre ou la colonie noire ne se montre égale à tout ce que pourrait être une colonie blanche ; ayant eu quelques démêlés avec une peuplade voisine, cent de ses miliciens armés et manœuvrant comme nos soldats, suffirent à mettre en fuite une bande de quatre mille ennemis. Ainsi, l’excellence ne tient pas foncièrement à la race blanche, mais aux moyens qu’elle sait employer, puisque des mains noires instruites à savoir s’en servir, opèrent les mêmes prodiges.
Les rapports du capitaine Bell méritent d’autant plus de créance que personnellement il croit à la supériorité native des blancs sur les nègres. Il racontait pour preuve que les nègres la reconnaissent eux-mêmes, que les Africains des tribus nomment les colons de Liberia, les nouveaux blancs, the new white men. Des hommes qu’il rencontra dans la campagne occupés à des ouvrages d’agriculture, et auxquels il demanda s’ils ne se sentaient pas de disposition à gagner l’intérieur, lui répondirent : Oh ! non, nous sommes des hommes blancs, des white men. On peut voir là un hommage rendu par ces nègres à ceux dont ils reconnaissent avoir reçu la vie intellectuelle et industrielle, mais non pas l’attestation d’une infériorité imprescriptible dont ils auraient conscience. Il ne faut pas oublier non plus que toute cette population est imbue des préjugés de couleur au sein desquels elle vécut long-temps en Amérique. Pour aujourd’hui, d’ailleurs, la question est de mince importance.
[167]
Que cette civilisation noire se fonde, se constitue, et prenne de solides racines ; quelle s’étende, qu’elle grandisse, qu’elle fasse sortir de l’Afrique un nouveau monde, et quand les produits de leur industrie et de leur science viendront parmi nous, portés sur leurs navires, on se convaincra que les nègres peuvent marcher de pair avec les blancs. Laissez faire au temps, l’histoire l’a déjà vu accomplir bien d’autres miracles. Il a fait ce que nous sommes, des farouches habitans des Gaules et de la Germanie.
En définitive, admettez que l’organisation du nègre est moins heureuse, moins riche que celle du blanc, ne croyez pas que cette infériorité tienne à ce que son organisation n’a pas subi les perfectionnemens que de longs siècles de culture ont imprimés à la nôtre ; eh bien ! loin que cela prouve contre son amélioration possible, c’est précisément ce qui rend le travail de cette amélioration plus nécessaire. — Si l’on voyait dans l’infériorité intellectuelle des nègres un droit réel de les mettre en servitude, nous prendrions de graves inquiétudes pour beaucoup de blancs.
[168]
CHAPITRE XIII.
DU PRÉJUGÉ DE COULEUR.↩
Le préjugé de couleur était indispensable avec l’esclavage des hommes noirs. — Il a été fondé par les lois métropolitaines. — En Orient, où il y a des maîtres et des esclaves de toutes couleurs, il n’y a pas de préjugé de cette nature. — Les colons de tête faible sont arrivés à se croire réellement d’une race supérieure. — Prérogatives du bouvier blanc. — Lois avilissantes contre les sang mêlés. — Les créoles ne sont nullement responsables des vices de leur société. — La religion catholique elle-même a entretenu le préjugé. — Lettres de blanc.
Plusieurs fois, depuis le commencement de cet ouvrage, on nous a entendu parler du préjugé de couleur dont il vient encore d’être question dans le chapitre précédent. Avant de passer outre nous croyons utile d’envisager ce préjugé entièrement spécial aux colonies. — Il y a été fondé par des lois expresses qui, en raison de la nécessité où l’on fût de les renouveler souvent, contredisent un peu la prétendue répugnance naturelle du blanc vis-à-vis du noir. Ces lois étonnent comme une infamie d’autant plus monstrueuse, qu’elles semblent dénuées de motif, et qu’il est difficile au premier abord de s’en rendre compte ; mais si les hommes d’état qui les ont faites ne pouvaient sans danger les expliquer, la politique moderne ne nous commande point les mêmes réserves. Il est aussi aisé de les comprendre qu’il serait difficile de les justifier. En les dictant, les autorités métropolitaines obéissaient à la force impérieuse des choses, elles devaient vouloir ce qu’elles ont voulu, tout horrible que cela paraisse. D’une source impure, il ne peut découler que des impuretés.
Le préjugé de couleur était indispensable pour une société où l’on introduisait des esclaves d’une autre espèce d’hommes que celle des maîtres. Le salut de maîtres blancs, disséminés au milieu d’un nombre tricentuple d’esclaves noirs, résidait dans la fiction de leur supériorité sur ces derniers, et par suite [169] dans la seconde fiction de l’inhabileté des noirs à jamais acquérir cette supériorité. Il dérivait de là forcément que tout individu qui aurait du sang inférieur dans les veines, ne devait plus pouvoir aspirer à l’égalité avec ceux de la classe à sang noble : la dégradation du mulâtre n’était qu’un écho de l’asservissement du noir ; une nécessité de logique.
Afin d’échapper à l’ignominie, les gens de couleur qui ne se piquèrent jamais de réagir contre le mal tout d’imagination dont ils étaient frappés comme leurs mères, firent individuellement de grands efforts, dès le principe, pour se faire déclarer de race indienne (les Indiens n’étant point en esclavage on n’avait pas eu besoin d’avilir leur sang, et ils ne cessèrent jamais de jouir de tous les privilèges attribués à la race blanche) ; mais les mulâtres, à moins d’employer d’actifs moyens de corruption dans les bureaux de la métropole, ne parvenaient point à obtenir l’honneur d’avoir été portés dans les flancs d’une caraïbesse plutôt que dans ceux d’une négresse.
« J’ai rendu compte au roi, écrivait le ministre au gouverneur de Saint-Domingue, le 27 mai 1771 de la lettre de MM. de Nolivos et Bougars, du 10 avril 1770, contenant leurs réflexions sur la demande qu’ont faite les sieurs ** de lettres patentes qui les déclarent issus de race indienne. Sa Majesté n’a pas jugé à propos de la leur accorder, elle a pensé qu’une pareille grâce tendrait à détruire la différence que la nature a mise entre les blancs et les noirs, et que le préjugé politique a eu soin d’entretenir comme une distance à laquelle les gens de couleur et leurs descendans ne devaient jamais atteindre, parce qu’il importe au bon ordre de ne pas affaiblir l’état d’humiliation attaché à l’espèce noire, dans quelque degré que ce soit ; préjugé d’autant plus utile qu’il est dans le cœur même des esclaves, et qu’il contribue au repos de la colonie. Sa Majesté a approuvé en conséquence que vous ayez refusé de solliciter pour les sieurs ** la faveur d’être déclarés issus de race indienne, et elle vous recommande de ne favoriser, sous aucun prétexte, les alliances des blancs avec les filles des sang mêlés. » [170]
« Sa Majesté vient de révoquer le marquis de …, capitaine de dragons, pour avoir épousé en France une fille de sang mêlé ! S. M. est déterminée à maintenir à jamais le principe qui doit écarter les gens de couleur et leur postérité de tous les avantages attachés aux blancs. »
L’antiquité n’eut pas besoin de pareilles fictions pour maintenir sans danger la servitude, parce que la servitude chez elle était une condition reconnue d’existence sociale, et que le libre cessant de l’être, acceptait son sort comme un fait malheureux, mais normal. L’esclavage des nègres, au contraire, étant un fait exceptionnel avait besoin de les avilir à leur propres yeux pour les contenir. Le préjugé était une chaîne mise à leur esprit, plus solide encore que celles dont on chargeait leurs bras.
En Orient où il y a aussi des esclaves, mais de toutes couleurs, il n’existe pas de préjugés de cette nature. On n’en a pas besoin. S’il s’en trouve dans les États libres de l’Amérique du nord, c’est qu’ils ont eu des esclaves, c’est qu’ils en voient encore au sud qui sont tous exclusivement pris dans une race spéciale. Un moyen infaillible de détruire très vite le préjugé de couleur serait de mettre des blancs en esclavage. Mais si l’on voulait essayer de la recette, nous demanderions comme auteur, que l’on n’employât à l’expérience que des anti-abolitionistes.
La crainte morale que le blanc doit inspirer à son atelier, composé de deux ou trois cents noirs, est encore un des affreux malheurs de l’état de choses fondé aux colonies. La sûreté des maîtres veut qu’aucun membre de leur caste n’ait jamais tort contre un nègre.
Les hommes inintelligens ont oublié le principe de cette terrible loi de conservation ; beaucoup même ne s’en doutent point, et se croient réellement des êtres d’une nature privilégiée. Les hommes qui pensent savent ce qu’il en est, et maintiennent le fait existant comme une raison d’État à laquelle la justice même doit être sacrifiée ; mais il est impossible d’a [171] voir idée en Europe du zèle presque féroce avec lequel les uns et les autres défendent les prérogatives du plus mince d’entre eux, vis-à-vis de la classe sacrifiée. Un fait : M. Meat Dufourneau avait envoyé sur une sucrerie dont il est chargé, un de ses commandeurs, homme capable et propre à bien seconder le géreur déjà établi. On s’aperçoit un jour qu’un bœuf a passé sur l’habitation voisine. Le commandeur prend quelques esclaves pour aller le chercher, et préserver son maître de l’amende à payer si le bœuf eût été ramené par un autre. Au moment où il est prêt à le saisir, un petit blanc, gardien des bestiaux du voisin veut s’y opposer ; le commandeur insiste, et fait observer qu’il est dans son droit, le bouvier (il songeait sans doute à l’amende) réplique, puis voyant l’autre oser lui tenir tête, il finit par lui dire qu’un misérable esclave ne doit point parler comme il fait à un blanc. Le nègre répond avec l’insolence du siècle : « Je suis esclave et je veux ramener le bœuf de mon maître, vous êtes blanc et vous gardez ceux du vôtre ; je ne vois pas grande différence entre nous, » et il emmène le bœuf de force. Il faut connaître le pays pour imaginer la colère du gardien de bestiaux : il court se plaindre à son patron, qui était précisément le maire adjoint de l’endroit, et celui-ci aussitôt d’écrire la lettre suivante au géreur :
« 16 mai 1840, mon cher voisin, le nègre Beaubrun, appartenant à M. Meat Dufourneau, s’est permis hier d’insulter un blanc qui garde mes bœufs. Je viens d’abord en simple particulier et en voisin conciliant vous engager à envoyer cet esclave demander pardon à celui qu’il a offensé, faute par lui de remplir cette condition, mon gardien de bœuf est décidé à porter plainte au maire, et en cette qualité, la justice me commandera de faire arrêter immédiatement par les gendarmes et conduire à qui de droit l’esclave récalcitrant. Je me flatte donc que vous m’éviterez le désagrément d’employer ces moyens de rigueur, et vous prie, mon cher voisin, de recevoir l’assurance, etc. »
Beaubrun, fort de son droit, refusa et se cacha : le géreur, [172] craignant de mécontenter M. Dufourneau, ne voulut point le livrer. Les gendarmes furent mis en campagne ; et c’est grâce à la fuite, grâce au retour chez son maître que Beaubrun échappa au châtiment que M. le maire prétendait lui infliger s’il l’eût pris. Ainsi voilà un homme (précisément il était à la veille d’être affranchi pour ses bons services) qui eût été taillé impitoyablement, sans autre forme de procès, pour s’être permis de répondre peut-être quelques injures aux injures d’un gardien de bestiaux. — Il y a peu d’années « un nègre sexagénaire fut fouetté en public sur la place Bertin (à Saint-Pierre Martinique), pour moins encore. Il avait coudoyé, par inadvertance, le colonel de Sanois, en passant à côté de ce chef milicien [144]. »
Il ne faut point s’étonner de l’arrogance du bouvier blanc. C’est une chose surprenante que la facilité avec laquelle nous Passons tous demi-dieux. — Les créoles en général ne veulent pas de domestiques à peau blanche : il serait de mauvais effet de montrer en cette condition des hommes de leur couleur. Ils sont cependant si mal servis par les nègres, que quelques-uns d’entre eux ont essayé d’amener des laquais d’Europe ; mais il leur est toujours impossible de les conserver. Au bout de six mois, le laquais dit qu’appartenant à la race noble, il n’est pas fait pour être domestique, et laisse là son importeur.
Par rapport au préjugé, comme sur tout autre point, nous ne sommes ni plus ni moins avancés que les autres nations. Nous sommes même d’une mansuétude admirable, comparativement aux Américains, que l’on peut considérer, il est vrai, comme les maîtres les plus farouches de la terre. Dans l’état du Mississipi il y a environ cinquante prétendus crimes pour lesquels un esclave peut-être mis à mort ; il n’y en a que douze pour les blancs ! En Virginie, environ soixante-dix pour les noirs, pas un n’expose les blancs ! Dans le Code noir américain il y a soixante-onze crimes capitaux pour les nègres, et pour [173] les mêmes crimes les blancs sont exposés tout au plus à être mis au penitentiary. — En vertu d’un acte du 18 mars 1830, passé à la législature de la Louisiane. « Tout blanc convaincu d’avoir écrit ou imprimé des pièces, où tenu des propos tendant à affaiblir le respect prescrit aux gens de couleur, envers les blancs, où à effacer la ligne de démarcation que la loi a établie entre les diverses classes de la société, est condamné à l’amende, à l’emprisonnement ; et l’emprisonnement expiré, à l’exil. »
On a dit que les Espagnols ne connaissaient pas le préjugé de couleur ; c’est une erreur, et il faudrait que les mêmes causes ne produisissent pas les mêmes effets pour que ce pût être vrai. Ceux qui disent cela n’ont pas visité la Carcel de Puerto-Rico, pour ne parler que de cette île, où les détenus blancs sont mis à part et dans un lieu de préférence ; ils n’ont pas lu davantage un code de combats de coqs, fait et promulgué en 1831, par le capitaine général Señor de la Torre, qui s’exprime ainsi, art. 13, ch. II : « Afin de faire briller dans ces lieux l’urbanité et les déférences que les classes doivent observer entre elles, et qui forment la base du bel édifice social [145], il est ordonné, et le directeur de la Gallera fera observer inviolablement que les sièges de préférence soient occupés par les personnes auxquelles ils sont dus (les dignitaires), et le surplus donné aux personnes blanches plutôt qu’aux personnes de couleur, afin de faire cesser cet abus de voir les blancs debout et d’une manière incommode, tandis que les autres sont parfaitement assis. »
À Antigues, le président de l’île, sir Edward Byam, rendit il n’y a pas encore trente ans une ordonnance qui défendait de sonner la grosse cloche à la cathédrale de Saint-John pour les funérailles des personnes de couleur, et fit monter au beffroi une petite cloche à cet l’usage de ces dernières.
À la Jamaïque, aucun membre de la classe réprouvée n’était [174] admis à prêter serment devant les tribunaux ; même pour défendre sa personne. Une autre loi de la même île fait prohibition à tout homme blanc de donner à son fils de couleur plus de 2, 000 livres courantes (30, 000 fr.) Le but de cette loi, inutile de le faire observer, est de maintenir les affranchis dans la dépendance, en les maintenant dans la misère.
On le voit, partout l’esprit de la législation est le même, partout il commande le préjugé, et il résulte comme nous l’avons dit des prescriptions du législateur, cette évidence importante que le préjugé est loin d’être aussi naturel qu’on le prétend aujourd’hui, puisqu’il a fallu des lois réitérées pour le constituer autrefois. Les créoles qui se plaignent si amèrement d’être livrés au régime des ordonnances, ne veulent pas se rappeler qu’ils furent autrefois bien autrement soumis à la volonté absolue de la mère-patrie et au despotisme des bureaux ; il existe seulement pour la Martinique cinq gros volumes de décrets ou instructions, sous le nom de Code de la Martinique ; et tout n’y est pas. Étrange contradiction de l’esprit humain ! Peut-être alors les planteurs se cabraient-ils autant sous les ordonnances qui ont constitué leur société actuelle avec tous ses vices, qu’ils se révoltent présentement contre celles qui veulent les réformer !
La vérité est qu’un de leurs plus vifs griefs à l’encontre des abolitionistes, c’est qu’on les rende responsables de l’esclavage et de ses détestables suites. Sur ce point j’avoue que je partageais le tort, et j’en fais excuse publiquement. C’est la métropole, cela est avéré maintenant pour nous, qui imposa aux colons leurs mauvaises idées actuelles, qui les encouragea à l’esclavage comme à la traite. Nous n’eûmes pas un mot à répondre quand ils nous dirent : Vous nous accusez ! mais c’est vous qui nous avez donné l’esclavage. En fondant les colonies dans un but d’intérêt politique, et avec des vues d’utilité exclusive pour la mère-patrie, vous avez encouragé les colons à accroître leurs richesses par le travail des nègres. L’édit du 28 mai 1664 portant création de la compagnie des Indes occidentales [175] lui concède exclusivement le commerce des Antilles, y compris la traite des nègres. Ces hommes payaient un droit de cinq pour cent à l’entrée comme les autres marchandises. Un arrêt du conseil du 26 août 1670 nous exempla de ce droit. Deux années après une ordonnance du 13 janvier 1672 accorda une prime de 13 livres pour chaque tête de nègres importés aux colonies. Des lettres patentes de 1696 et 1704 confirment ces privilèges, et Voltaire écrit qu’en prenant un intérêt dans ce trafic « il a fait une bonne action et une bonne affaire. » Le 26 octobre 1784, le roi Louis XVI accorde de nouvelles immunités aux négriers. Le 21 octobre 1787, une dépêche ministérielle recommande de payer dans les colonies la prime de 13 francs qui avait été portée à 60. Ces faveurs se perpétuent sans interruption jusqu’à la révolution, et l’assemblée constituante, elle-même, y met le sceau par un décret qui déclare la traite « commerce national. » Il faut atteindre le 25 juillet 1793 pour voir supprimer ces primes, suppression bientôt suivie à la vérité de l’abolition de la traite et de celle de l’esclavage. (Décret de la Convention du 16 pluviôse an ii, 4 février 1794).
Ainsi c’est bien vous, vous qui nous avez donné la servitude, qui nous avez encouragés à la traite. Vous, vous seuls également nous avez imposé les préjugés qui vous inspirent aujourd’hui tant de dégoût. Nous avions commencé à nous marier avec des négresses, une ordonnance du 20 avril 1711, qu’il fallut même renouveler en 1778, prohibe même en France ces unions entre les deux races, qu’autorisait notre vieux Code noir de mars 1685 ; on nous les interdit comme dangereuses ; et un décret du premier consul (30 pluviôse an xi) réitère cette défense.
Nous étions disposés à confier notre santé aux soins d’hommes de toutes couleurs. Voici comme s’exprime un règlement du roi, du 30 avril 1764. « Art. 16. Défend très expressément S. M., aux nègres et à tous gens de couleur, libres ou esclaves, d’exercer la médecine ou la chirurgie, ni de faire aucun traitement de malades, sous quelque prétexte que ce soit, à [176] peine de 500 livres d’amende pour chaque contravention au présent article, et de punition corporelle suivant l’exigence des cas. »
Nous voulions employer des gens de couleur dans nos offices, il nous en est fait défense par un arrêt du conseil souverain du 9 mai 1765, conçu en ces termes : « Vu la remontrance donnée en la cour par le procureur-général du roi, contenant qu’il a été informé que Me Nior, notaire royal en l’île de Martinique, résidant au bourg du Lamentin, employait un mulâtre libre à faire les expéditions des actes qu’il passait en cette qualité ; que même il lui servait de clerc dans son étude ; que des fonctions de cette espèce ne devant être confiées qu’à des personnes dont la probité soit reconnue, ce qu’on ne pouvait présumer se rencontrer dans une naissance aussi vile que celle d’un mulâtre ; que d’ailleurs la fidélité de ces sortes de gens devait être extrêmement suspecte : qu’il était indécent de les voir travailler dans l’étude d’un notaire, indépendamment de mille inconvéniens qui en pouvaient résulter ; qu’il était nécessaire d’arrêter un pareil abus.
« La cour, etc., a fait très expresses inhibitions et défenses à tous greffiers, notaires, procureurs et huissiers, de se servir de gens de couleur, même libres, pour les employer à faire les expéditions des actes dont ils sont chargés par leur état, sous peine de 500 livres d’amende pour la première fois, et du double en cas de récidive, et pour les gens de couleur qui seraient employés, d’un mois de prison. Ordonne que l’arrêt qui interviendrait sera lu, publié et affiché partout ou besoin serait. »
Nous avions été plus loin que cela, mourant, nous avions laissé à des libres le soin, l’éducation, la vie de nos enfans ; un arrêt du conseil supérieur du 14 octobre 1726 nous en empêche, il ôte à un mulâtre la tutelle d’une blanche « attendu sa condition. » Une lettre du ministre, du 7 janvier 1767, porte contre le texte formel de l’édit de 1685, que tout homme de race nègre est incapable de fonctions publiques et de noblesse.
[177]
Vous avez abaissé ainsi cette race à nos yeux, par tous les moyens possibles ; vous avez défendu à ceux qui en font partie de porter des habits pareils aux nôtres [146], vous nous avez défendu à nous de leur donner le titre de monsieur dans aucune transaction écrite ou verbale ; vous leur avez fait du respect pour nous un devoir légal [147] ! Où pouvions nous prendre considération pour eux ? [178]
Ainsi notre éducation, nos idées, notre vie, nos principes, sont assis sur les lois que vous nous avez données. C’est à leur ombre, sous l’empire de leurs incitemens que nous avons acquis « la propriété de l’homme sur l’homme. »
C’est vous encore qui, à une époque où nous avions subi la crise de l’affranchissement et de ses troubles, avez rétabli la [179] traite par une loi du 10 prairial an x (30 mai 1802 [148] ). C’est vous, toujours vous, qui nous avez contraints par la même loi à reprendre la responsabilité de l’esclavage, à y replacer nos chances de fortune, nos moyens d’existence, à le considérer comme une chose utile à tout le monde [149]. Et puis tout-à-coup, parce que le siècle en marchant a créé de nouvelles doctrines pour le monde métropolitain, voilà que vous nous traitez de cruels, de barbares, et nous montrez une indignation pleine d’horreur ! vous oubliez que nous sortons de vous, que nous ayons été élevés au milieu de vous et avec [180] vous ; que nous avons étudié les mêmes sciences, pratiqué la même morale, appris le même respect pour les lois divines et humaines. Vous oubliez que nos sentimens, vous les partageriez si vous étiez à notre place ; vous oubliez que c’est vous en un mot qui nous avez faits ce que nous sommes, qui avez [181] aidé, protégé, consacré notre propriété actuelle, et vous parlez de la méconnaître, sous prétexte qu’elle est immorale ! Ô comble d’irréflexion et d’iniquité !
En tenant ce langage, les créoles ne disent pas un mot qui ne soit vrai. Ils ont été façonnés long-temps au mépris du nègre et de sa descendance. La religion catholique elle-même, malgré ses prétentions à la fraternité, s’est humblement mise au service de l’œuvre diabolique. Dans les cimetières qu’elle consacre, dans ce dernier asile des hommes, dans ces domaines du néant où la véritable égalité commence, elle a permis qu’il y eût le côté des libres et le côté des esclaves : elle a ouvert deux portes, celle des libres et celle des esclaves ! La destruction seule en réduisant tout en poudre au sein de son mys [182] térieux empire, parvient à rapprocher maîtres et serviteurs pour l’éternité. Et cependant non, à l’hospice des fous de Saint-Pierre aussi, chose caractéristique, tous les rangs, toutes les castes, toutes les classes sont confondus, on y voit blancs, nègres, sang mêlés, libres et esclaves se heurtant côte à côte. Triste, triste, affligeante société, celle-là où l’on ne trouve en vigueur que dans ces lieux de désolation, la première des lois qui doivent régir les sociétés humaines ! On n’a pas même une telle consolation à la léproserie de la Désirade, Outre la ration commune à tous les malades, les blancs y reçoivent aux termes du cahier des charges une livre et demie de beurre par semaine, et les libres une livre ; les esclaves rien. De par la science hygiénique créole, les pauvres lépreux blancs ont besoin d’un peu plus de beurre que les libres, et les esclaves n’en ont pas besoin du tout !
En parlant de la Désirade, nous ne pouvons nous empêcher de noter une de ces anomalies dont le lecteur a déjà pu voir plusieurs exemples dans la société coloniale, Il existe là et aux Saintes (dépendances de la Guadeloupe), une population mixte qui jouit du titre et des droits de blancs. C’est la descendance d’un certain nombre de familles de couleur qui furent déclarées blanches il y a un siècle environ, par arrêt de la cour suprême. Lorsqu’on demande la raison de ce singulier arrêt on vous répond que l’on avait sans doute besoin de blancs à cette époque !
Les blancs de la Désirade et des Saintes, comme on les appelle, quoique tous fort pauvres et généralement pécheurs et marins ne se montrent pas les moins jaloux des privilèges de caste.
Les trois cent mille Ibaros de Puerto-Rico, dont les ancêtres étaient le produit du mélange des Espagnols avec les Indiens, passent aussi pour blancs, malgré leur incontestable origine de sang mêlés établie par leur couleur olivâtre. Pour les distinguer des blancs (pure race), on les appelle quelquefois blancos de tierra, blancs du pays. Mais cela ne les empêche pas d’avoir [183] tout l’orgueil des privilégiés. Des mulâtres et jusqu’à des nègres se sont infusés dans cette population, en vertu de lettres de blanc, qu’ils conservent comme autrefois chez nous on conservait des titres de noblesse. Ces lettres étaient accordées pour des services rendus à l’État ; on en vendit aussi pour de l’argent. — Vous riez, altesse ; expliquez-moi pourquoi, vous qui vous dites noble, c’est-à-dire plus grand qu’un autre en vertu d’un acte de naissance où d’un morceau de parchemin signé par un roi, vous trouvez fort ridicule un noir qui se dit blanc en vertu d’un acte de naissance ou d’un morceau de papier signé par un gouverneur de colonies ? Ce n’est pas un des moins détestables effets du préjugé, que ceux-là même qui en sont victimes y croient comme les autres.
[184]
CHAPITRE XIV.
DE LA CLASSE DE COULEUR [150] ; ESPRIT DE VOL ATTRIBUÉ AUX NÈGRES.↩
Le préjugé de couleur est aussi vivace que jamais. — Charivari à un blanc qui se marie avec une demoiselle sang mêlée. — Rivalité actuelle et haine des deux classes. — Division de la propriété coloniale entre les blancs et les libres. — Causes de la pauvreté et des mauvaises mœurs des sang mêlés. — Les savonnettes à vilain blanchissent bien réellement. — Femmes de couleur. — Elles n’ont presqu’aucun moyen d’existence honnête. — Il est faux que les nègres soient voleurs. — État des prisons. — Les blancs s’opposent à toute expansion de lumières dont pourraient profiter les libres. — Éducation. — Le couvent des dames de Saint-Joseph et l’hospice des orphelins sont fermés à la classe de couleur. — Lâche faiblesse des autorités. — Les sang-mêlés n’ont pas moins de préjugés que les blancs contre les nègres. — Conduite peu digne, maladroite et coupable de la classe de couleur.
Puisque nous avons parlé du préjugé de couleur, il vient à sa place de parler ici de ses effets et de la population qu’il opprime.
Les blancs ont reçu le préjugé, cela vient d’être prouvé, il n’est pas venu d’eux ; mais ils l’ont accepté avec exagération, et le perpétuent avec acharnement. L’orgueil de caste, le plus intraitable de tous, est aujourd’hui de la partie.
Le préjugé de couleur est presqu’aussi vivace que jamais et porté à un point dont il faudra garder des preuves authentiques, si l’on veut que l’avenir y croie. On voit aux colonies des gens froids, calmes, éclairés, sans aucune bizarrerie d’esprit ; en un mot, dans tout leur bon sens, qui ne consentiraient pour rien [185] au monde à dîner avec un nègre, ou un sang mêlé, quel qu’il fût. Lorsqu’au théâtre de la Guadeloupe nous vîmes toute la salle battre des mains à l’Antony de M. Alexandre Dumas, nous ne pûmes réprimer un mouvement de pitié, en pensant que ceux-là même qui applaudissaient à l’œuvre, se croiraient déshonorés s’ils rencontraient l’auteur dans un salon, et que toutes ces femmes si émues à l’entendre peindre les passions qui les agitent, rougiraient de honte, seulement à l’idée de figurer avec lui dans une fête. Des créoles se sont engagés avec quelques capitaines de navires à ne passer que sur leurs bords, à condition que ces capitaines n’y prendraient jamais de gens de couleur. Un homme de cette classe ne saurait entrer dans un café sans que ce soit matière à scandale. Pendant notre séjour à la Guadeloupe, il y en eut un qui vint dîner à l’hôtel de la Pointe-à-Pitre, il était si blanc de peau que le restaurateur le tint pour un honnête homme, mais quelques habitués l’ayant reconnu, ils exigèrent qu’on l’engageât à ne plus revenir si l’on voulait les conserver eux-mêmes, Le lendemain du jour ou après 1830, un arrêté du gouverneur de la Martinique permit aux libres d’entrer au spectacle à la même place que les blancs, le théâtre fut fermé par ordre. Une indemnité de 20, 000 fr., prise dans les caisses publiques fut allouée aux acteurs pour qu’ils quittassent la ville avant la fin de leurs engagemens. On avait fait craindre au pauvre gouverneur, M. Dupotet, les désordres dont la comédie deviendrait l’arène si blancs et gens de couleur y étaient placés sur la même banquette. Aujourd’hui, il a bien fallu en prendre son parti, le plaisir l’emporte sur les répugnances pour la majorité, mais il y a encore des femmes blanches qui ne vont plus jamais au théâtre pour n’être pas exposées à voir une mulâtresse assise à côté d’elles ! Il se trouve aux barreaux des colonies des sangs mêlés pleins de mérite, il en est d’autres dans le commerce, également distingués et d’une probité intacte ; tous sont traités par leur confrères avec la réserve d’une excessive politesse, mais rien de plus ; il n’existe aucun rapport de société, l’usage [186] même ne permet pas qu’il leur soit donné une poignée de main, et comme jamais de pareilles sottises ne vont sans intolérance, le blanc qui fréquenterait un homme de couleur, serait immédiatement noté d’infamie et rayé du livre d’or colonial.
Un fait récent passé à Cayenne offre un exemple de ce qu’il y a encore de folie dans le préjugé de couleur parmi les colons. M. Brache ayant voulu se marier avec une demoiselle sang mêlé fit publier les bans ; son frère qui s’était marié précédemment sans songer que ses père et mère étant morts il lui restât des ascendans dont l’autorisation fut nécessaire, mit opposition au mariage sous prétexte qu’il avait entendu dire que son grand-père vivait encore. M. Brache jeune informa de cette difficulté le procureur-général M. Morel, celui-ci répondit que les tribunaux devaient en juger ! Un arrêt de la cour royale enjoignit à l’officier civil de passer outre. Mais M. Brache est commis de marine, il se transporte chez le gouverneur pour être autorisé. Le voudra-t-on croire, le gouverneur, son nom m’échappe, j’en suis fâché ; le gouverneur refuse ! M. Brache alors donne sa démission, il se marie, et le soir même les blancs furieux de cette mésalliance d’un des leurs, donnent un effroyable charivari aux jeunes époux… « Étranges mœurs ! dit judicieusement le Droit en racontant tout cela dans son numéro du 20 février 1842. Qu’un blanc vive en concubinage avec une fille de couleur, personne ne songe à le trouver mauvais, mais qu’il l’épouse, toute sa caste crie au scandale. »
Nous avons entendu un habitant qui avait trouvé un excellent moyen pour expliquer ou plutôt pour justifier son aversion contre les gens de couleur. « En refusant tout rapport avec eux, disait-il, j’évite des affronts forcés à leur faire, car les personnes de cette classe, ayant toutes des relations de parenté avec nos esclaves, ils retrouveraient en moi pour leur famille le mépris que je ne leur témoignerais pas à eux-mêmes. » Voilà où de tels préjugés peuvent conduire un homme de bon sens. C’est avec de semblables raisons que l’on perpétue les rivalités de caste, les inimitiés d’amour-propre blessé ; inimitiés sans frein [187] ni merci, qui ne sont peut-être pas toujours étrangères aux drames de poison qui se jouent dans les îles.
À la vérité, il y a aujourd’hui plus que du préjugé seulement dans le préjugé, il y a de la colère, de la haine. La loi du 24 avril 1833, en abolissant les distinctions établies par l’ancienne législation coloniale et en conférant les droits politiques aux libres de toutes couleurs, soit de naissance, soit par suite d’affranchissement personnel, a dessiné les instincts d’antagonisme qui subsistaient entre les deux classes. La loi est bonne, puisqu’elle prépare évidemment la fusion ; son bénéfice est assuré dans l’avenir ; mais elle n’a fait encore que développer les germes de rivalité existans. Il fallait que cela fut. Avant la reconnaissance de leurs droits politiques, les hommes de couleur libres étaient les clients des patriciens à peau blanche, ils en sont devenus les rivaux ; et comme tous les rivaux placés au rang inférieur, ils veulent, par la raison qu’ils ont les passions propres à l’homme, ils veulent plus que l’égalité, ils voudraient la domination. Aujourd’hui patrons et clients se haïssent et se méprisent : les uns parce qu’ils voient leurs anciens serviteurs aspirer à monter ; les autres parce que ce sentiment de légalité auquel on a permis de se manifester et la possibilité d’arriver à tous emplois, leur rendent plus insupportables l’éducation, la richesse, les places, la prépondérance accumulées dans les mains de leurs anciens patrons.
Aujourd’hui il y a séparation complète, à la Martinique surtout, ce sont deux partis en présence, et il est notoire que la milice de cette île, suspendue après les troubles de 1833, n’a pas encore été réorganisée, grâce à l’influence des blancs qui ont voulu éviter cette occasion forcée de contact avec leurs adversaires.
Les droits politiques accordés à la classe de couleur ne consistent guères cependant qu’à les rendre aptes au service de la milice, puisque la charte fait encore reposer ces droits sur les bases de l’impôt. Les Français ne sont dignes et capables de faire fonction de citoyen que lorsqu’ils paient une certaine [188] somme au fisc, ils sont égaux devant la loi quand ils sont égaux devant le percepteur des contributions directes ; or, mulâtres et nègres étant très pauvres se trouvent avoir acquis un droit presqu’illusoire. Il faut aux colonies payer 600 francs d’impôt ou posséder 60,000 francs de propriété pour être éligible, la moitié pour être électeur. Combien est petit le nombre d’affranchis qui peuvent arriver là ? Sur cinq cent sept éligibles de la Martinique il n’y en eut, en 1835, que quarante-quatre appartenant à leur classe ; sur huit cent dix-neuf électeurs, que cent vingt-huit. Ils remplissent là-bas le rôle de nos prolétaires. [151]
Leur misère s’explique par deux causes : d’abord leur naissance, leur déchéance sociale ; ensuite la politique de l’ancien système, qui voulant leur abjection et craignant qu’ils n’acquissent trop de force par l’argent, leur ferma les portes de l’éducation et des richesses, en les déclarant inhabiles à hériter des blancs, et à recevoir des donations (lettres patentes du [189] roi 5 février 1726). Quel abominable amas d’iniquités que tout cela !
Les grossiers instincts et le despotisme brutal de Bonaparte, ce méchant homme tant admiré des Français, fortifièrent cette législation barbare lors de la promulgation du Code civil dans les colonies. Son arrêté du 16 brumaire an xiv (7 novembre 1805), dit expressément : art. 3, « Les lois du Code civil relativement au mariage, à l’adoption, à la reconnaissance des enfans naturels, aux droits de ces enfans dans la succession de leurs père et mère, aux libéralités faites par testament ou donations, aux tutelles officieuses ou datives, ne seront exécutées dans la colonie que des blancs aux blancs entre eux, et des affranchis ou des descendans d’affranchis entre eux, sans que par aucune voie directe ou indirecte aucune des dites dispositions puisse avoir lieu d’une classe à l’autre [152]. »
Le sort précaire de la grande majorité des hommes de couleur l’est peut être devenu davantage encore depuis l’émancipation politique de leur classe. Avant ce grave événement il s’était formé, comme nous l’avons dit, une espèce de société romaine aux colonies : presque tous les libres étaient attachés sous forme de clientèle à quelque blanc qui les soutenait. Depuis les blancs irrités ont retiré leur protectorat, et ne font travailler qu’à la dernière extrémité cette caste rivale qu’ils redoutent, parce que le fait de son affranchissement la porte en haut. Le mulâtre M. Joannet, entrepreneur à la Pointe-à-Pitre, n’a presque plus d’ouvrage depuis qu’on l’a vu faire de ses trois fils deux médecins et un avocat. — Ne leur faisons point gagner d’argent, car ils l’emploieraient à nous former d’habiles ennemis. Les oligarches des Antilles comprennent que la prospérité de la couleur tournerait contre eux, et il est [190] tout simple, le milieu étant donné, qu’ils ne veuillent point y aider. — D’un autre côté les gens de couleur presque tous sans famille, fruits du concubinage ou de la débauche, plus ou moins abandonnés de leurs parens, pauvres, mais nécessairement infestés des vices du pays, se refusent à travailler à la terre, parce que c’est un travail d’esclaves. « Dans tous les pays à esclaves, disent avec infiniment de justesse MM. Sturge et Harvey, la liberté est une sorte de lettre de noblesse, et les classes les plus basses des personnes libres, blanches ou noires étant trop fières pour s’occuper, sont ordinairement plus misérables et quelquefois plus dégradées que les esclaves eux-mêmes ; les funestes influences de la servitude ne s’arrêtent pas à la caste infortunée qui en est immédiatement victime. » Il ne reste à vrai dire aux libres qui daignent travailler que des places de commis pour les lettrés, et pour les autres les emplois manuels ou les arts mécaniques ; encore de ces emplois, par malheur, n’y en a-t-il presque pas de possibles dans nos îles. Les colonies reçoivent tout de la métropole, jusqu’à des chaises, des habits et des souliers, il n’y existe véritablement d’autres manufactures que celles du sucre ; le régime prohibitif de toute industrie ne laisse ouverts pour occuper tant de bras, que les cadres des maçons, des charpentiers et des pêcheurs.
De là l’oisiveté qui dévore et avilit cette race victime d’une mauvaise organisation sociale. Sa médiocrité ; ses moyens d’existence toujours problématiques, son inutilité, ses mœurs répréhensibles, son manque de dignité et le peu d’estime que mérite la majorité de ceux qui la composent, expliqueraient jusqu’à un certain point l’orgueil des blancs, s’ils avaient assez d’intelligence philosophique pour séparer le bon du mauvais grain, s’ils ne se montraient pas aussi indulgens envers les dépravés de leur caste qu’impitoyables pour les autres. Et cependant que de raisons n’y auraient-ils pas pour que cette indulgence changeât d’objet ? Sous l’empire de l’éternelle flétrissure qui pèse sur eux, et par le fait de leur éloignement de toute fonction publique, le mal n’est-il pas pour ainsi dire im [191] posé aux gens de couleur ? Il leur arrive ce qui arrivait il n’y a pas encore bien long-temps en Europe aux comédiens. Voués au mépris, quoiqu’ils fissent, ceux-ci justifiaient l’anathème par leur conduite. On ne voulait pas comprendre que leurs vices venaient de l’anathème, et en effet depuis que l’absurde réprobation qui les démoralisait commence à s’effacer, on les voit femmes et hommes commencer tous à s’élever, à gagner les degrés de la considération qu’on leur rend. Allez, la société est toujours de moitié dans les crimes des individus. Les élémens sont bons, elle seule presque toujours est coupable quand ils se pervertissent.
À cet égard, il se passe aux Antilles mêmes, un fait qui nous semble mériter l’attention des hommes sérieux. Par suite du respect qu’il est de la politique coloniale d’inspirer aux noirs pour les blancs, il est arrivé que les blancs ont été obligés de se respecter les uns les autres. Quels qu’ils fussent ils avaient la noblesse de la peau ; ils étaient et ils sont tous égaux au nom de l’épiderme. C’est pourquoi l’on trouve partout sur les habitations, les économes, paysans émigrés, gendarmes retirés et soldats libérés, gens de rien enfin comme disent les aristocrates, assis à la table du maître. Ils savent tout au plus signer leurs noms ; mais ils sont blancs, ils ont droit au même pain et au même sel. On a vu, cela nous fut assuré par M. Ferry, négociant de la Pointe-à-Pitre, on a vu dans les tournées que font les gouverneurs, les gendarmes de leur suite manger avec leurs excellences chez l’habitant de vieille roche qui reçoit le vice-roi colonial, Or, plusieurs économes sont connus pour être de ces domestiques dont nous avons parlé, qui jettent la livrée aux orties par orgueil du tissu réticulaire, et les colons qui vous répondent toujours quand vous leur parlez du préjugé de couleur : « Dînez-vous en Europe avec votre cordonnier ? » ne trouvent aucun embarras à dîner avec un homme qui cirait leurs bottes six mois auparavant, Pauvre espèce humaine ! — Entendons-nous bien : ce n’est point de dîner avec les domestiques, voire avec les gendarmes, que je blâme les gouverneurs [192] et les maîtres ; je crois qu’un jour la société ne considérera gouverneurs, maîtres, domestiques y compris les gendarmes s’il en existe encore, que comme fonctionnaires divers, mais égaux dans la grande communauté ; ce dont je les blâme, c’est de ne point dîner avec les gens de couleur [153].
Il ressort des observations que nous venons de faire, et c’est où nous en voulions venir en les faisant, que les hommes ne sont vils qu’autant qu’on les avilit, et s’élèvent avec rapidité à toute la hauteur qu’on veut leur communiquer. Les savonnettes à vilain blanchissent bien réellement. Tous ces économes qui seraient restés de grossiers soldats, de rudes paysans, de plats valets, se civilisent en moins de quelques années ; ils apprennent tout de suite à lire et à écrire ; leurs manières se forment, leur langage se purifie au contact du maître ; et nous en avons vu qui, arrivés domestiques il y a dix ou douze ans, sont aujourd’hui tout-à-fait des hommes du monde. — Encore une fois la classe de couleur n’a de mœurs particulièrement reprochables que parce qu’elle est déclarée sans mœurs. Estimez les hommes, si vous voulez qu’ils soient estimables, respectez les femmes, si vous voulez qu’elles soient respectables.
Les femmes de couleur, par exemple, qui vivent toutes en concubinage ou dans la dissolution, parmi lesquelles les blancs viennent chercher leurs maîtresses comme dans un bazar, contribuent certainement par leur libertinage à entretenir l’abaissement de la race qu’elles déshonorent. Mais il faudrait savoir si le malheur qui les saisit en naissant n’est pas une des sources de la licence ? Ne pouvant espérer aucune considération, toujours méprisées, il est naturel qu’elles ne fassent rien pour [193] mériter le respect. Le préjugé enfante le mépris, le mépris la démoralisation, et la démoralisation la prostitution ; prostitution qui légitime le mépris par lequel s’entretient le préjugé. Affreux et cruel enchaînement où le mal s’explique par le mal. Les pauvres créatures, d’ailleurs, n’ont pu échapper à l’action délétère des idées au milieu desquelles elles sont élevées. Les hommages de la caste privilégiée les flattent, et elles aiment mieux se livrer à un blanc, vieux, sans mérite et sans qualité, que d’épouser un sang mêlé. Les exemples ne manquent pas de ce déplorable effet de la corruption, que certaines erreurs peuvent jeter dans notre esprit. Il entre beaucoup de vanité dans l’amour des femmes comme dans celui des hommes. Unies avec des gens de leur classe, tous méprisés, les femmes de couleur, quoi que cela tende heureusement à devenir chaque jour moins vrai, ne pourraient trouver aucune protection dans celui qu’elles aimeraient, tandis qu’au milieu de leur concubinage avec les blancs elles sont du moins sous la sauvegarde d’hommes en état de les faire respecter, et comme l’a dit M. Saint-Remy (d’Haïti), « elles rencontrent une sorte d’honneur dans leur déshonneur même. »
On est autorisé à se demander en outre si la pauvreté n’entre pas pour beaucoup en ces désordres. Les femmes libres aux colonies n’ont pas même le peu de ressource que possèdent leurs frères pour échapper à la misère. Leur principal moyen d’existence honnête, la couture, est fort limité, car mouchoirs, robes, bonnets, tout cela encore arrive confectionné d’Europe. Elles n’ont plus pour elles que les raccommodages et les costumes du pays, ou bien les fonctions de blanchisseuse, gardienne d’enfans, etc. ; mais comme en Europe, celles qui veulent et peuvent travailler sont si mal rétribuées [154] qu’elles se trouvent obligées de suppléer à ce qui leur manque par des moyens déshonorans. Aux femmes libres qui n’ont pas un esclave pour les [194] faire vivre de son labeur, il ne reste véritablement comme aux ouvrières d’Europe, n’hésitons pas à le dire, il ne reste que la prostitution ! ! ! Il est exactement vrai de dire que le fait social lui-même, organise la dépravation de ces belles et misérables créatures ?
Au milieu de tant de vices et de dépravation, au milieu de tant de misères et de mépris, aurais-je dû dire, car misère et mépris comportent tous les vices et toutes les dépravations, c’est un fait des plus remarquables et qui ne doit point nous échapper, que la prodigieuse sécurité avec laquelle on vit aux îles. À quelqu’heure de la nuit que ce soit, vous pouvez les parcourir d’un bout à l’autre sans crainte d’être arrêté. Il n’est aucun pays du monde où l’existence soit plus complètement abandonnée à la foi publique. Sur les habitations, les cases sont ouvertes, on y entre et l’on en sort sans trouver personne ; fermées même, un coup de poing en défoncerait les portes. À la ville, tout est au grand air, presque nuit et jour ; on pénètre dans les pièces de rez-de-chaussée qui sont les plus riches, parce que ce sont les pièces de réception ; on arrive jusqu’aux salles à manger, où les tables sont mises, et l’on reste là pendant des minutes entières, avant que les esclaves de service daignent venir avec la lenteur tropicale s’informer de ce que vous voulez. Pour notre compte, quelque part où nous soyons allé, notre fenêtre, notre porte et nos malles sont toujours restées ouvertes sans que nous ayons eu à le regretter.
Constater de telles habitudes, c’est, il nous semble, dire assez la probité native d’une race plongée, même lorsqu’elle est libre, dans une condition où doivent croître les vices comme en pleine terre. Pourquoi donc entendons-nous toujours parler du penchant irrésistible des nègres pour le vol, de leur naturelle inclination pour la maraude ? Assurément cela doit être un fait mal observé. Quelque soit le nombre des petits vols des esclaves, et quelque bien établie que soit l’opinion reçue, j’oserais soutenir que le nègre n’est pas voleur ; j’entends le nègre et non l’esclave ; de même que je ne croirais pas me compromettre [195] en disant que la race blanche n’a pas l’instinct de la friponnerie, quoique tous les domestiques de cette race, mâles et femelles, volent effroyablement. Expliquons-nous : le nègre ne se fait presqu’aucun scrupule de voler les produits de la terre chez son maître ; il regarde cela presque comme permis au moyen d’une certaine capitulation de conscience qui se retrouve dans nos cuisinières. Combien de ces femmes qui ne vous prendraient pas un sou et qui ne se tiennent nullement pour coupables de tromper sur les achats du marché ! Les jardins des nègres sont fort souvent aussi récoltés par des voleurs ; mais les marrons qui passent leur vie à se cacher ont besoin d’ignames et de patates. — Il en est du vol comme du travail ; tout cela dépend beaucoup de la manière dont les ateliers sont conduits, et des habitudes qu’une administration plus ou moins habile y laisse prendre, Nous avons vu des habitations où le maître avait été obligé de renoncer à entretenir des volailles, parce qu’on les lui prenaient toutes ; sur d’autres, comme chez M. Dhemé Ste-Marie (Lamentin), la grande case est entourée de poules, de lapins, de jardins à fruits et à légumes, sans que l’on dérobe jamais une pièce. Bien des vices des nègres, en dehors toutefois de leur premier générateur, l’esclavage, tiennent à ce qu’on ne sait pas manier ces hommes, à ce qu’on les dirige mal. En tous cas les pillards s’arrêtent aux fruits de la terre, aux larcins que l’on pourrait appeler ruraux. Les vols d’intérieur, de maisons habitées, ces grands vols avec effraction ou sur les routes, qui épouvantent la société européenne, on n’en a pas d’exemple aux Antilles. M. Pujo, juge d’instruction à Saint-Pierre, formula très ingénieusement son avis, lorsqu’il voulut bien répondre à nos questions, en disant : « Un numéro de la Gazette des Tribunaux de Paris, représente dans son ensemble de crimes et de délits trois mois de la Martinique. »
L’état-général des maisons de détention de cette île [155], au 1er juillet 1840 offrait :
[196]
arrondissement de Saint-Pierre
| Prison des peines, | 48 | condamnés libres pour crimes et délits. |
| 13 | idem. pour dettes à l’enregistrement. | |
| 3 | esclaves. | |
| 64 | ||
| Vieille geôle, | 29 | condamnés. |
| 93 |
arrondissement de Fort-Royal
| Prison civile et militaire, | 5 | crimes et délits. |
| Vieille geôle, | 23 | crimes et délits. |
| 17 | dettes à l’enregistrement [156]. | |
| 45 | ||
| En tout | 138. | Mais si l’on trouve juste de |
| déduire sur ce nombre les | 30 | détenus pour dettes, coupables |
| seulement de misère, il | ||
| ne restera en somme que | 108 | condamnés [157] pour une population |
| de 40,000 libres, parmi lesquels les blancs entrent pour 9,000 ! | ||
[197]
Le ministère dans ses Notices ne fait pas monter le nombre des condamnés de la Guadeloupe au-delà de 45 : 26 libres et 19 esclaves [158] pour l’année 1833. C’est un crime sur 3,447 individus de toute qualité. La même année, la Martinique a un crime sur 2,847 individus. Est-ce donc là une race naturellement perverse et méchante ? Il faut dire la vérité entière cependant, tous les coupables ne sont pas atteints. Il y a là-bas une plaie particulière encore au système colonial, c’est le vol que des gens libres commettent de complicité avec des esclaves, presque sûrs qu’ils sont de l’impunité. En effet, le maître pour les traduire serait obligé de traduire aussi son esclave ; mais comme celui-ci serait également condamné, il préfère manquer au devoir d’accuser l’homme dangereux et renoncer à la punition du coupable, plutôt que de perdre pour un certain temps l’instrument de travail appelé nègre.
En somme, le plus grand nombre des affaires portées devant les tribunaux des îles sont pour voies de fait. Dans les pays à esclaves on doit naturellement, et par habitude, finir volontiers toute discussion au moyen d’un soufflet. Sauf ces tristes facilités, la société politique coloniale voit peu d’excès. Durant les épidémies et à l’époque des hivernages, où l’on craint le séjour des villes pour la troupe ; tous les postes quelquefois sont vidés ; les cités se gardent elles seules, et l’ordre s’y maintient intact. Les plus grandes causes de troubles que l’on ait jamais à y réprimer, prennent naissance dans les collisions d’amour-propre entre les diverses races. Que la mollesse produite par le climat soit pour quelque chose dans cette tran [198] quillité, nous le voulons croire, mais n’est-ce point une injustice de ne pas en attribuer aussi une part au fond de moralité de la classe la plus nombreuse, classe pauvre et ignorante !
Ignorante par-dessus tout. Les enfans libres n’ont à leur portée aucun moyen d’éducation. Ils n’ont pour toute ressource que les trois ou quatre écoles gratuites des frères de la doctrine chrétienne, fondées depuis peu par le gouvernement dans chacune de nos colonies. La classe blanche oblige les maîtres des petites pensions du pays à refuser les enfans de couleur, sous peine de retirer les siens ; elle s’oppose avec soin à toute expansion de lumière dont pourrait profiter la classe libre ; il entre dans sa politique de conserver le monopole et le privilège de l’instruction.
Il n’existe aux colonies aucun établissement où l’on puisse trouver des élémens de fortes études. Les créoles sont obligés, ceux du moins assez riches pour cela, de faire élever leurs enfans en Europe. M. l’abbé Angelin, un de ces hommes hardis, remuans, qui n’ont d’abbé que le nom, avait eu l’heureuse idée de créer aux Antilles une maison de hautes études, et seul, était parvenu à faire ce que l’on ne croyait pas que le gouvernement pût faire avec 3 où 400,000 francs. Il avait monté le pensionnat Saint-François à la Basse-Terre Guadeloupe, où il était parvenu à réunir soixante où quatre-vingts élèves. C’était une entreprise véritablement utile au pays, et plusieurs colons éclairés la soutenaient de toute leur influence. Cependant les fonds nécessaires venant à manquer, on s’adressa au conseil où l’allocation tomba sous ce dilemme foudroyant du procureur-général : « Ou l’institution deviendra publique, et alors elle périra sous l’influence des répugnances sociales que le temps n’a point encore effacées, ou elle conservera le caractère d’une institution particulière ; mais alors comment justifier une avance faite dans l’intérêt d’une partie de la population sur un fond auquel tous contribuent ? » Hélas ! oui, une institution de la plus haute importance pour toutes les Antilles dut périr, parce que des enfans nègres où sang [199] mélés auraient voulu venir gagner là cette instruction que l’on fait un crime à leur race de ne pas posséder, et qu’ils ne peuvent aller chercher à grands frais en Europe ! M. Lacharrière avait pourtant dit à ses frères, courageusement et au risque de sa popularité : « Il est temps d’abjurer des considérations politiques devant lesquelles viennent toujours se briser les meilleures entreprises. Il est temps de ne plus combattre de vaines chimères et de voir les choses sous leur véritable aspect. Aujourd’hui les rangs se confondent, les assises, les collèges électoraux, contribuent tous les jours à les rapprocher ; une nouvelle organisation de milice vient y prêter son concours, et rien ne prouve que la pension de M. Angelin sera fermée à la classe dont on veut parler. » Trop inutiles paroles ! on ne voulait point les comprendre. La majorité refusa l’allocation et la Guadeloupe perdit un établissement dont une commission d’examen nommée par les parens avait dit : « Nous croyons être les fidèles interprètes de la pensée publique, en affirmant que le directeur du pensionnat Saint-François a satisfait aux grands devoirs qu’il avait à remplir. C’est maintenant à la colonie à payer sa dette. Un véritable collège national est enfin fondé, bien supérieur à tout ce qui avait existé jusqu’à présent dans les Antilles. Déjà plusieurs élèves distingués en sont sortis, et ont obtenu dès leur arrivée en France leur diplôme de bachelier ès-lettres. C’est un devoir sacré pour tous les pères de la colonie, de soutenir et de protéger une fondation à laquelle se rattachent les intérêts les plus chers de leur famille et de leur pays. » Signé, Beauvallon, chef principal des milices ; Lignières, avocat ; Nesty, notaire ; Comont, négociant ; Coquelle, négociant.
Cela est arrivé à la Guadeloupe, où le préjugé de couleur cependant a bien moins de violence que dans l’île voisine, où l’on ne se déshonore pas tout à fait à donner la main à un sang mêlé, où il y a dix-sept mulâtres parmi les conseillers municipaux, et seize parmi les officiers de milice !
Mais veut-on savoir jusqu’où peuvent aller les passions qui [200] agitent ces belles et malheureuses îles ! Le même conseil qui vient de refuser l’allocation parce que des jeunes gens de couleur pourraient s’instruire, ose voter tous les ans des fonds pris sur les contribuables de toutes couleurs (10, 000 francs, je crois), pour une espèce de couvent des dames de Saint-Joseph où ne sont élevées que des filles blanches, et dont il nous est assuré que les portes sont fermées aux filles sang mêlé ! Bien mieux, quoique ces couvens relèvent comme nos collèges de l’administration qui peut y disposer de dix bourses, l’action des blancs sur elle est si puissante, le vieux système colonial est encore si respecté, qu’à la Guadeloupe comme à la Martinique, l’autorité circonvenue, incertaine, pusillanime, n’a jamais eu le courage ni l’équité d’en donner une à quelque pauvre fille négresse. On ne sait vraiment de quoi s’étonner davantage, ou de voir les gouverneurs et directeurs des colonies se faire ainsi les complices des gothiques prétentions d’une caste peu généreuse, ou de voir la métropole ne leur pas imposer la justice au moins en cela.
Ces indignes faiblesses du pouvoir colonial vont jusqu’à l’inhumanité. À Saint-Pierre, l’hospice d’orphelins et d’enfans trouvés ne reçoit que des blancs, et repousse impitoyablement tout petit malheureux de couleur. « Ceux-là ont toujours, à quelqu’âge que ce soit, la ressource de se faire domestique. » C’est ce que nous répondit la sœur de Saint-Joseph qui nous accompagnait dans notre visite à l’hospice. Bonne sœur !
Revenons aux hommes de la classe libre : il faut qu’un abolitioniste le leur dise, il est urgent de l’avouer, dans la lutte sourde qui a lieu sur les terres des Antilles, ils nuisent eux-mêmes à leur propre cause ; ils ne se dirigent ni avec adresse ni avec courage moral, ni avec la dignité qui serait nécessaire dans leur position, Ce que les commissaires de la Convention écrivaient en juillet 93, aux hommes de couleur de Saint-Domingue, est encore vrai aujourd’hui pour ceux de la Martinique et de la Guadeloupe. « Vous avez parmi vous des aristocrates de la peau, comme il y en a parmi les blancs, aristocrates plus in [201] conséquens et plus barbares que les autres : car ceux-ci ne gardent pas éternellement leurs fils dans les fers ; mais vous, ce sont vos frères et vos mères que vous voulez retenir à jamais en servitude. » Il n’est que trop vrai, les mulâtres se sont courbés eux-mêmes sous les fourches du préjugé, ils n’ont pas moins de dédain pour les noirs, les insensés ! que les blancs n’en ont pour eux ; et un mulâtre se ferait autant scrupule d’épouser une négresse, qu’un blanc d’épouser une mulâtresse ! Quelqu’un l’a dit avec vérité : Un mulâtre hait son père et méprise sa mère. — Triste conséquence des erreurs humaines, elles se commandent, elles s’enchaînent ; on a sous les yeux aux colonies une série graduée de dédains d’une classe envers l’autre qui serait ridicule si elle n’était déplorable. Quiconque a des cheveux laineux, signe essentiel de la prédominance noire dans le sang, ne saurait aspirer à une alliance avec des cheveux plats. Les femmes de couleur qui ont la chevelure crépue s’imposent des tortures horribles en se coiffant pour la tirer de façon à laisser croire qu’elle est soyeuse.
Au point de vue que nous venons d’envisager, la position des hommes de couleur ne doit naturellement inspirer aucun intérêt. Nous savons bien qu’il y a une excuse pour eux, qu’ils sont aveuglés eux-mêmes par la maudite influence du préjugé ; mais n’importe, on doit leur reprocher de n’avoir pas mieux senti les leçons de la mauvaise fortune, de ne point aimer leurs frères en souffrance. Ils se chargent de justifier la répulsion des blancs pour eux par celle qu’ils éprouvent à l’égard des nègres. Pour mériter la sympathie des hommes de bon sens et de bon cœur, leur premier devoir serait de se mettre de niveau avec la civilisation et d’accorder aux autres ce qu’ils réclament pour eux-mêmes. Cet éloignement qu’ils montrent vis-à-vis du nègre est un scandale aux yeux de la raison, une joie profonde pour leurs ennemis ; et ce qui maintient la force des colons, ce qui perpétue leur supériorité, c’est précisément la haine que les sang mêlés ont créée par leur orgueil, entre eux et les noirs. Ceux-ci les détestent, et leurs proverbes toujours si admira [202] blement expressifs ne manquent pas contre leurs fils insolens : « Quand milate tini iun chouval, li dit négresse pas maman li [159] » — Les gens de couleur voudraient s’élever jusqu’aux blancs, mais sans faire monter les noirs avec eux ; ils ne réussiront pas. L’histoire de Saint-Domingue devrait leur être d’un meilleur enseignement qu’on ne le voit. Les sang mêlés d’Haïti prêtèrent en vain leurs coupables services à la classe blanche contre les esclaves, la classe blanche ne fit que les mépriser davantage ; ils ne se relevèrent qu’après s’être associés aux esclaves, et tous les malheurs qu’éprouve encore la jeune république haïtienne tiennent, on peut dire, à de vieux restans de l’aristocratie épidermique.
Au lieu de faire effort pour se rapprocher piteusement de la classe blanche, les hommes de couleur doivent se rapprocher fraternellement des noirs. C’est dans une telle alliance qu’est leur émancipation réelle. Une des raisons de la force des blancs est leur parfaite union dans une pensée commune ; les sang mêlés et les noirs au contraire sont divisés et se haïssent ; il faut que les sang mêlés se joignent étroitement avec les noirs libres, il faut qu’ils ne forment ensemble qu’un tout homogène, Il ne sera pas seulement généreux, il sera utile d’unir les deux [203] fortunes, et comme firent en 1817 les gens de couleur libres de Philadelphie avec le vénérable James Forten à leur tête, de signer le serment que nous allons transcrire. « Nous jurons de ne jamais nous séparer volontairement de la population esclave de ce pays. Les nègres sont nos frères par les attaches du sang et de la souffrance, et nous comprenons qu’il est plus vertueux d’endurer des privations avec eux que de jouir pour un temps de quelques avantages imaginaires [160]. » M. Mondésir Richard, un des esprits les plus distingués que possède la classe de couleur, l’a fort bien dit : « Nous ne devons attacher aucune importance à entrer chez les blancs, à les fréquenter. Notre rôle est de viser à une fusion politique réelle avec eux, pour obtenir notre part d’autorité locale. Quant à la fusion sociale, je ne la comprends à cette heure qu’avec la population noire. Pour mon compte je ne veux d’alliance qu’avec les nègres, parce que là et rien que là est notre force. » Ces idées sont très sages et très saines ; elles peuvent seules amener une solution pacifique des difficultés.
Les mulâtres, dans toutes leurs entreprises, ont toujours été battus, nous ne le regrettons pas parce qu’ils ont toujours abandonné et oublié les esclaves, leurs alliés naturels. Ce qu’ils ont à faire avant tout maintenant c’est de prendre part à la croisade contre l’esclavage, en s’interdisant de posséder des esclaves. Ils ont toujours mis d’ailleurs une insigne maladresse dans leurs efforts pour dompter l’orgueil des blancs ; ils n’ont pris la voie ni la plus sûre, ni la plus digne, celle d’avoir pour leurs antagonistes les mêmes rigueurs que ceux-ci leur témoi [204] gnaient, de former une société qui aurait vaincu l’autre en charité et en noblesse de sentimens, qui se serait montrée au monde plus douce et plus morale que l’autre, comme firent autrefois les chrétiens contre les payens ; ce sera toujours la meilleure ressource des persécutés pour tuer la persécution.
Les mulâtres acceptent encore aujourd’hui comme une sorte d’injure qu’on les appelle mulâtre, il faut qu’ils s’en fassent un titre et s’en glorifient jusqu’à ce qu’on ne connaisse plus de différence entre eux et les blancs. M. Bissette a constamment prêché cette excellente doctrine dans sa Revue des Colonies, il est fâcheux qu’on ne le veuille pas écouter.
Les hommes de couleur d’Europe qui ont gagné un nom, sont restés parmi nous au lieu d’aller l’offrir en exemple aux amis, en admiration aux ennemis. La postérité leur fera l’éternel reproche de ne l’avoir point mêlé aux luttes fraternelles, ce nom qu’il leur fut donné de rendre éclatant. Les autres, bien élevés au sein des collèges de France, capables de tenir un rang distingué dans le monde et de communiquer à leur classe l’éclat de leur mérite, sitôt qu’ils retournent aux colonies, se dégoûtent vaniteusement de l’infime condition où ils se trouvent, ne savent point se suffire avec l’élite de leurs semblables ; ils aspirent à ce qu’ils devraient mépriser, s’irritent de leur solitude, et peu à peu quittent le pays pour n’y plus reparaître. Ils veulent oublier qu’en abandonnant la patrie, ils abandonnent aussi la noble tâche qu’ils avaient à remplir pour la réhabilitation de leur race ; ils désertent une cause sacrée. On nous a cité un officier d’artillerie sang mêlé qui envoyé à la Martinique demanda vite à permuter, ne pouvant tolérer la situation gênante que lui faisait la couleur de sa peau. Et cependant, toujours bien avec ses camarades qui fermaient oreille aux murmures de leur caste en faveur d’un frère d’armes, ayant ainsi déjà des alliances avec l’étranger, il pouvait servir de premier lien à un rapprochement désirable. Sa position était magnifique, il recula devant quelques déboires passagers. Qu’arrive-t-il de cette insuffisance philosophique dans les aînés [205] de la couleur, c’est qu’il ne reste plus de leur classe aux colonies, sauf de bonnes exceptions, que des hommes inférieurs de rang, d’éducation, de tenue, et que les blancs les peuvent repousser avec une apparence de raison, sous prétexte d’inégalité morale !
[206]
CHAPITRE XV.
LE PRÉJUGÉ DE COULEUR SE PERDRA DANS LA LIBERTÉ ; LES DEUX RACES S’ASSIMILERONT.↩
Le préjugé de couleur n’est rien par lui-même, il disparaîtra avec l’esclavage qui l’a fait naître. — Il se modifie déjà dans les îles anglaises. — Familles libres distinguées. — La classe de couleur s’améliore depuis qu’elle possède des droits politiques. — La liberté moralise. — Les mariages de fusion nombreux au commencement des colonies. — L’antipathie des femmes blanches pour les nègres est un mensonge. — Mulâtres nés de demoiselles blanches. — L’amalgame futur des deux races est écrit dans la similitude de leur espèce. — Les Antilles formeront un jour une confédération indépendante.
Il est triste d’avoir à dire que les choses ne sont pas plus avancées, et néanmoins nous n’en sommes pas fort inquiété. Ce mal est de ceux contre lesquels il n’y a de remède efficace que le temps avec la liberté, et que le temps avec la liberté doivent infailliblement guérir. Le préjugé de couleur vu de près n’est rien, on y a mis trop d’importance ; il tient à des circonstances toutes politiques, toutes locales, il s’en ira insensiblement avec l’esclavage, c’est-à-dire avec la cause qui le fit naître. Il est si peu inné dans les individus, que durant un demi-siècle les colonies n’en eurent aucune idée. Il fallut le créer. Nous ne voulons pas nier qu’il n’en existe encore beaucoup aux colonies anglaises, que la ligne de démarcation n’y soit encore fort tranchée, et que l’hostilité des deux castes n’enferme encore des principes de désordre et d’animosité. Les hommes ne peuvent aussi vite dépouiller leurs passions, et surtout leurs passions de haine et d’orgueil. Cependant on ne saurait nier non plus que le mal ne commence à s’amoindrir. Il est arrivé ce que l’on pouvait prévoir, l’homme nègre n’étant plus esclave, et l’homme de couleur qui procède de lui ne tenant plus à un être dans l’opprobre, on devient embarrassé d’un mépris sans raison ni objet. L’entrée aux affai [207] res de la classe réprouvée a considérablement servi le progrès ; on voit aujourd’hui dans les colonies anglaises des nègres et des sang mêlés dans tous les emplois publics : sur le siége des juges, auprès des plus hauts fonctionnaires, parmi les magistrats spéciaux et dans les chambres législatives [161] ; enfin ils sont mêlés à toutes choses. Cette position que la sagesse et l’habileté du gouvernement anglais, aident beaucoup à leur faire, les met chaque jour en rapport forcé avec les blancs, et le travail de fusion s’opère sourdement. À l’extérieur, il n’y a plus de différence entre les deux classes, les relations publiques sont sur un pied de parfaite égalité ; le serrement de main est admis depuis long-temps, on en est déjà venu à reconnaître des liens de parenté. Nous avons vécu à la Dominique chez le chef même du parti conservateur, M. Blanc, homme à la vérité très spirituel qui avouait et recevait pour ses nièces deux jeunes filles d’un sien frère de couleur. Nous avons vu aussi à la Dominique, dans une des écoles de la campagne, la petite fille d’un riche propriétaire blanc (M. Bell, si je me rappelle bien le nom), confondue avec tous les enfans noirs et jaunes du quartier. À Antigues nous nous sommes trouvé à table avec des sang-mêlés au milieu de l’élite des planteurs. — La fusion de l’intérieur reste encore à s’opérer, celle des femmes surtout ; on ne voit pas plus de blanches dans un bal de sang mêlés que de femmes de couleur dans une réunion de personnes blanches, Les femmes, grâce au rétrécissement d’esprit que leur donne la mauvaise éducation qu’elles reçoivent, sont toujours les plus difficiles à vaincre, les plus résistantes aux réformes. Toutefois, sur ce point aussi les gouverneurs anglais ont fait faire un grand pas, en recevant dans leur salons des femmes de couleur. Et qu’on ne croie pas qu’ils n’aient pu tenter ce grand coup qu’en associant de force des élémens hétérogènes. Notre voyage nous met à même de certifier le contraire. Nous avons eu [208] l’honneur d’être admis dans plusieurs familles libres, dont la distinction ne le cédait à nulle famille blanche. À la Dominique nous avons assisté à un bal de cette classe, et nous pouvons assurer que dans aucune société de l’autre classe nous n’avons rencontré plus de jeunes filles dont la modestie et la retenue nous aient garanti la pureté du présent et la moralité de l’avenir. Les îles françaises de même où tant de causes pourraient s’opposer à ces heureuses exceptions, possèdent des familles de couleur qui ont droit à toute la considération imaginable.
Quelque sévère qu’ait été notre jugement, il n’en est pas moins vrai que les hommes de couleur, depuis qu’ils sont devenus citoyens se sont beaucoup améliorés [162], Le mariage légal qui leur était presqu’inconnu se répand, et, disent les impassibles Notices statistiques du gouvernement, « depuis leur émancipation civile et politique, la tendance à une vie régulière se manifeste d’une manière sensible parmi eux. » Dans les colonies anglaises, dont les neuf dixièmes de la population mixte sont comme chez nous illégitimes, le progrès a été plus étendu encore et plus perceptible ; il n’existe aucune sang mêlée à cette heure qui croie plus honorable de vivre en concubinage avec un blanc que d’être mariée avec un homme de sa caste ; tout le monde contracte des liens réguliers ; la vie s’épure, et dans les écoles gratuites du dimanche, ce sont des membres de la classe de couleur qui se distinguent par leur zèle et leur désintéressement à remplir les graves fonctions d’instructeurs auprès des pauvres. La liberté moralise.
À tout prendre, on peut s’étonner de la rapidité avec laquelle s’est opéré l’amendement. Un demi-siècle suffira peut-être à détruire les dernières traces de ces distinctions, qui après avoir été un crime politique ne sont plus qu’une sottise. Si la classe de couleur était assez riche pour envoyer élever en Europe beaucoup de ses enfans, la classe blanche perdrait plus vite encore la seule véritable supériorité qu’elle ait et qu’elle gar [209] dera long-temps avant que les émancipés enrichis puissent faire comme elle. Les richesses aussi aplaniront bien des difficultés. Le commerce a presque fait disparaître la guerre du monde, il fera disparaître également le préjugé des colonies par l’argent qu’il mettra aux mains des marchands nègres et mulâtres ; l’argent viendra porter là encore son niveau et diminuer les distances : des aristocrates blancs épouseront des héritières noires, comme autrefois les marquis ont épousé des financières.
En écrivant ces mots, nous voyons d’avance les créoles qui les liront, hausser les épaules. — En vérité, nous avons grand peine à nous rendre compte des prétendues répugnances que montrent les colons pour les unions noires, eux que l’on voit tous les jours déserter leurs femmes pour des négresses. Cet impossible, qu’ils prononcent au mot de mariage de fusion, fait, il nous semble, peu d’honneur à leur sincérité ou à leur jugement. La classe de couleur avec toutes ses variétés est-elle donc autre chose que le fruit d’unions entre blancs et noires, unions illégitimes plus ou moins prolongées, mais enfin unions indéniables ? Si la femme noire a des attraits bons pour une concubine, n’est-il pas clair qu’en l’élevant bien on lui communiquera les qualités bonnes pour une épouse. Quoi ! me disait-on, vous épouseriez une négresse ? et l’on paraissait incrédule lorsque je répondais affirmativement. L’histoire des Antilles nous affirme pourtant que les ancêtres de ces incrédules presque tous pères de petits mulâtres, que leurs ancêtres, disons-nous, n’auraient point eu de ces étonnemens. Labat a vu à la Martinique des marquises, de vraies marquises qui étaient de bonnes et franches négresses comme il dit et probablement nous en aurions encore si l’on n’avait plus tard expressément défendu ces mariages, nuisibles au mépris que l’on voulait maintenir contre la race des esclaves. Hillard d’Auberteuil [163] rapporte qu’en 1773, il existait à Saint-Domingue seulement plus de trois cents ma [210] riages légitimes entre blancs et femmes libres. Les européens même alors « s’adressaient de préférence aux mulâtresses, parce qu’elles étaient plus riches que les européennes. »
Valverde, créole espagnol de Saint-Domingue, dit que « parmi les Français, les comtes et les marquis se marient avec des mulâtresses, et que le luxe de ces femmes joint à leur considérable multiplication, témoigne du cas que les Français font d’elles, et prouve que la répugnance dont parlent leurs auteurs n’est qu’un mensonge [164]. » À vrai dire, Valverde qui a toute la morgue espagnole, a l’air de prendre en grande pitié ces comtes et ces marquis français qui épousent des mulâtresses.
Quant à l’indignation et au dégoût que manifestent les femmes blanches des colonies lorsqu’il est question de mariages, d’elles aux noirs, nous ne croyons pas du tout qu’ils soient invincibles. D’abord il existe plusieurs de ces mariages en Europe [165] ; ensuite le général Pamphile Lacroix, dans son Histoire de la révolution de Saint-Domingue, raconte l’épisode suivant : « Lorsque nous parcourions dit-il, avec le général Baudet, les documens secrets de Toussaint Louverture, notre cu [211] riosité venait de s’accroître en découvrant un double-fond dans la caisse qui les contenait. Qu’on juge de notre surprise lorsqu’en forçant ce double-fond, nous n’y trouvâmes que des tresses de cheveux de toute couleur, des bagues, des cœurs en or traversés d’une flèche, de petites clefs, des souvenirs et une foule de billets doux qui ne laissaient aucun doute sur les succès obtenus en amour par le vieux Toussaint Louverture. »
Toussaint ne fut pas le seul nègre qui fut aimé des blanches, en cessant d’être esclave ; cela était à la connaissance générale en France, et Bonaparte qui jouait l’homme moral comme on sait, dit niaisement à ce sujet dans les instructions pour la criminelle expédition de Saint-Domingue : « Les femmes blanches qui se sont prostituées aux nègres, quelque soit leur rang, seront renvoyées en France. » Au reste, sans aller à Saint-Domingue, nos colonies, au sein même de l’esclavage, nous pourraient présentement fournir d’autres exemples. On y connaît des mulâtres dont les mères sont des demoiselles blanches [166]. Une affaire d’infanticide sur deux jumeaux vient [212] d’être étouffée par le parquet de la Guadeloupe [167], sous prétexte de ne point révéler à la publicité un grand scandale.
On en reviendra un jour aux mariages fusionnaires que nous attestent unanimement tous les écrivains des premiers établissemens coloniaux, et qui serviront à réprimer la débauche des femmes de la classe mixte. Déjà quelques petits [213] blancs (on les pourrait compter il est vrai), ont eu le courage de se marier légitimement avec des femmes de couleur, Laissons au temps à achever l’œuvre de ces hardis novateurs. Quoi qu’en disent les vieux créoles qui voient la chose publique mise en péril par de telles témérités, c’est par là qu’elle sera préservée du mal ; c’est dans ce nouveau mélange des genres ! que se perdront les derniers vestiges du préjugé. Nous y voyons l’avenir des colonies. Un économiste renommé a jeté une parole de malédiction qui ne se réalisera pas : il n’est pas vrai que les deux races n’aient qu’un compte de sang à régler ensemble, et que l’une doive infailliblement exterminer l’autre, ou plutôt cela n’est vrai qu’autant que l’une resterait esclave de l’autre. La liberté les sauvera. « L’amalgame des races blanche et noire est contre nature ; leur fusion est impossible, Dieu n’a point voulu qu’elles s’assimilassent », a dit l’Américain M. Clay, à la grande approbation de M. Lepelletier Duclary. Que répondre à ces aveugles qui n’ont point apparemment rencontré un seul mulâtre dans leur vie ? Rien. Il n’y a pas à discuter avec eux.
Malgré les antipathies actuelles que l’esclavage a créées entre les deux races, on peut compter sur leur alliance future, elle est ineffaçablement écrite dans la similitude de leur espèce ! C’est encore du temps qu’il faut ici.
Et cette alliance produira peut-être de grandes choses. En examinant la position des Antilles au milieu de l’Océan, groupées toutes entre l’Europe et l’Amérique, en regardant sur la carte où on les voit presque se toucher, on est pris de la pensée qu’elles pourraient bien un jour constituer ensemble un corps social à part dans le monde moderne, comme les îles Ioniennes en formèrent un autrefois dans le monde ancien. Petites républiques indépendantes, elles seraient unies confédérativement par un intérêt commun et auraient une marine, une industrie, des arts, une littérature qui leur seraient propres. Cela ne se fera peut-être pas dans un, dans deux, dans trois siècles, il faudra auparavant que les haines de rivalité s’effa [214] cent pour qu’elles s’unissent et s’affranchissent toutes ensemble de leurs métropoles respectives ; mais cela se fera, parce que cela est naturel. Alors aussi, on n’en peut guères douter, les îles confédérées des Indes occidentales auront une population spéciale et particulière, une population mixte ; car la traite ayant cessé pour toujours, la race qui subsiste aujourd’hui devra se fondre à travers les âges dans la race de sang mêlé par ses continuelles alliances avec elle, de même que la race blanche qui sera, malgré ses émigrations, toujours trop peu nombreuse pour faire une espèce à part. Si l’homme blanc et l’homme noir formaient une dualité, si comme on l’a dit bizarrement l’homme noir et l’homme blanc étaient les mâle et femelle de l’humanité qui doivent par leur union et l’accord de leurs qualités propres créer un genre participant des mérites de ses deux générateurs, on pourrait s’attendre à voir sortir des Indes occidentales des prodiges nouveaux qui étonneraient l’univers. Dualité mâle et femelle à part, que l’on ne soit pas trop incrédule à ces destinées lointaines et cachées de la mer des Antilles, que l’on songe à tout ce que le petit îlot de Syracuse a fourni de lumière, de science et d’art, au profit du monde. Haïti n’est guères moins grande à elle seule que l’Angleterre.
Sortons de notre rêve pour passer au chapitre suivant.
[215]
CHAPITRE XVI.
L’ADMINISTRATION.↩
Les gouverneurs de nos colonies ne remplissent pas leur devoir. — L’administration est solidaire de la moitié des fautes et crimes qui se commettent dans les îles. — La magistrature coloniale. — Justice blanche. — M. Maraist, procureur du roi dans l’affaire Mahaudière. — Un colon jugeant des nègre et des sangs mêlés, est juge dans sa propre cause. — Les vieilles ordonnances elles-mêmes interdisaient à tous fonctionnaires et employés de posséder ou de se marier aux colonies. — Les tergiversations du gouvernement métropolitain entretiennent les résistances créoles. — Les esclaves de l’État sont moins bien traités que ceux de beaucoup de colons. — Épave vendue en 1838. — Inutilité des petites réformes. — Plusieurs des principaux fonctionnaires des îles sont hostiles à l’émancipation.
En revenant par la pensée sur l’importante question du préjugé de couleur qui nous occupait tout-à-l’heure, nous voyons que l’administration locale sur ce point, comme sur mille autres, n’a rien fait pour aider à la réforme nécessaire. Les gouverneurs que l’on envoie aux colonies ne paraissent pas se douter du côté moral de leur rôle ; à peine arrivés, ils se laissent capter par les blancs, vont là où leurs habitudes d’européens les conduisent naturellement, où les sympathies de mœurs les attirent ; ils ne réagissent pas, et pour ne point s’aliéner la considération des puissans, ils s’éloignent des faibles dont ils devraient être les premiers protecteurs. Ils prolongent et entretiennent ainsi des idées absurdes, dangereuses, plus funestes aujourd’hui qu’elles ne furent utiles autrefois, et qu’il faudrait détruire, ne fut-ce que pour rendre hommage au bon sens. Mais nos gouverneurs aux colonies semblent oublier qu’il est une loi au-dessus de toutes les questions de convenance, celle de la justice, et ils ne reçoivent point dans leurs salons la classe libre parce qu’ils savent que sa présence en ferait fuir les blancs. Est-ce comprendre avec intelligence la mission de ce [216] fonctionnaire suprême appelé à servir de lien à toutes les classes, précisément parce qu’il les représente toutes ? La maison d’un gouverneur ne doit-elle pas être un terrain neutre, où l’on ne connaisse ni sots préjugés, ni mesquines inimitiés de caste, où l’on fête tous les enfans honorables de la patrie ?
Bien des choses se peuvent dire à la décharge des colons. On conçoit qu’il faille un esprit vigoureux, une intelligence ouverte et un cœur d’une exquise bonté, pour se dégager comme font quelques-uns des erreurs politiques et philosophiques qui les compromettent tant aux yeux de l’Europe. Oui, certes, il y a bien des choses à dire en faveur des maîtres. Si leurs institutions sont solidaires de la moitié des erreurs où ils persistent, des fautes et des crimes qu’ils commettent, l’administration est solidaire de l’autre moitié, ses lâches complaisances ont assuré l’impunité aux propriétaires et avec le dessein « de ménager la délicatesse de tout ce qui se rattache à l’ordre intérieur des habitations, » elle a en définitive compromis la société coloniale.
La responsabilité d’aussi funestes désordres remonte à la métropole. Les fonctionnaires coupables, qui les nomme ? qui les maintient en place ? quelle prudence a-t-on mise à les choisir pour ces contrées livrées à des dissensions qu’il faut comprimer, à des antipathies qu’il faut réduire, en proie à un affreux échange de mauvais traitemens, qui excitent les représailles pleines de poison et de représailles pleines de poison qui excitent les mauvais traitemens ? Au milieu de ces difficultés locales et de circonstances qui demanderaient une administration si exquisement impartiale, à quelles mains sont remises les principales fonctions ? N’examinons que la Guadeloupe : le gouverneur, M. Jubelin, créole ; le procureur-général, M. Bernard, habitant ; le président de la cour royale, M. Lacharrière, créole habitant ; le procureur du roi, M. Marraist, habitant ; le juge royal, M. Des Îlets, juge unique, occupant le siége du tribunal de première instance, créole ; le substitut du procureur-général, M. Marcellin Mercier, créole habitant ; le direc [217] teur de l’intérieur, M. Billecocq, habitant ; le commandant militaire, M. Defitte, habitant ; le trésorier-général, M. Navaille, habitant, etc., etc. Quelle équité espérer d’une telle administration ? quelle sympathie pour les esclaves pourrait-elle avoir ? Nous n’accusons pas les individus, nous ne les connaissons pas ; mais au nom de la nature humaine nous sommes sûr de leur partialité. Ils sont hommes, ils obéissent à la loi commune qui nous enlève la force de condamner nos amis, qui nous pousse à persécuter nos ennemis.
Il y a aujourd’hui dans la magistrature des Antilles presqu’autant de créoles que d’européens, et comme bon nombre de ces européens se sont formés des liens de famille et de fortune dans le pays (contrairement à la loi organique de l’ordre judiciaire, 1828), il s’en suit que la justice de nos colonies est saturée de l’esprit colonial, esprit essentiellement blanc ; aussi est-ce de la justice blanche qui se rend dans toutes nos îles. L’oligarchie coloniale y est maîtresse des parquets et des tribunaux [168]. Que de dénonciations sont restées sans vérifications ; que d’enquêtes sans réponses ! Combien de crimes ont trouvé l’absolution du silence auprès de celui-là même qui devait les poursuivre ; ne citons qu’un exemple : Le 19 février 1840 l’esclave Adonis vient se plaindre à la gendarmerie d’avoir été soumis à des châtimens excessifs. On le renvoie au maire de la commune de son quartier, M. Belloc, maire de Saint-Fran [218] çois, qui pour lui apprendre à porter plainte fait donner un quatre piquets à ce malheureux, en présence même de la gendarmerie.
Le juge-de-paix du Moule dénonce le fait au procureur du roi, M. Marraist, par une lettre en date du 22 février 1840, rappelée dans une autre lettre du 4 mars 1840. Le procureur du roi ne répond pas. Une nouvelle lettre du 7 mai informe le procureur-général, M. Bernard ; le procureur-général ne répond pas davantage, et l’affaire en reste là.
Mais dans les poursuites qui arrivent au grand jour, quels jugemens, hélas ! Le 31 juillet 1840, le tribunal de Saint-Pierre condamne une femme, mademoiselle Noelise (mulâtresse) à cinq ans de réclusion, pour avoir repoussé et renversé un homme, M. Asselin Chambuert (blanc), qui est entré violemment chez elle, une rigoise à la main, et qui s’est blessé à la tête en tombant. Le 15 mai 1841, le même tribunal condamne M. Lalung fils (blanc), accusé de blessures volontaires, avec préméditation et guet-à-pens, blessures ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, sur la personne de M. Nelson (mulâtre), le même tribunal, disons-nous, condamne M. Lalung à deux mois de prison !
M. Mahaudière (blanc), accusé d’un crime barbare, reste malgré l’arrêt de poursuite, parfaitement libre chez lui, jusqu’à ce que la chambre d’accusation ordonne de le faire arrêter ; tandis que des miliciens (hommes de couleur) condamnés à la prison pour insubordination, sont transférés à pied et entre des gendarmes de la Pointe-à-Pitre au fort de la Basse-Terre [169] !
Quelle est l’âme qui ne se sentirait pas émue en présence de ces débauches judiciaires ! Jugez de l’amertume que ces cruelles distinctions doivent mettre au cœur des sang mêlés, et combien elles peuvent envenimer les haines de caste qu’il faudrait au contraire étouffer avec tant de soins ! Tout le monde [219] sait que les troubles qui ont eu lieu en 1841, à la Pointe-à-Pitre, naquirent du ressentiment qu’avait inspiré à la jeunesse de couleur la brutalité injurieuse du commandant militaire, M. Defitte. Mais M. Defitte n’est pas créole, va-t-on dire, nous le savons ; peut-être cependant en a-t-il pris quelques-unes des passions, en contractant des intérêts créoles et en entrant par mariage dans une famille créole. Qu’importe que vous ne soyez pas colon. Si vous êtes possesseur d’esclaves, vous acquerrez les idées des colons, et vous n’en serez que plus dur ; car vous n’aurez pas la vieille habitude des concessions à faire à l’esclavage.
Il suffit d’être désintéressé pour concevoir qu’il n’y aura jamais bonne justice, ni bonne administration aux colonies, tant que la magistrature et les agens de l’état y auront des intérêts. De quelqu’énergique probité qu’on soit doué, on subit alors malgré soi l’influence du milieu exclusif dans lequel on vit ; on se retire le libre examen. L’autorité domestique étant en perpétuelle opposition avec l’autorité publique, celle-ci ne veut pas agir, crainte de faire dommage à l’autre ; et quand elle ne viole pas ouvertement la loi, elle se tire d’embarras par des compositions où succombent l’ordre véritable, la morale, l’humanité ; disons en un mot la justice, car la justice, c’est toutes les perfections et tous les biens ensemble.
Qu’on se rappelle la position du procureur du roi, M. Maraist, dans l’affaire Mahaudière. Européen de naissance, mais marié à la Guadeloupe, sa conscience n’était-elle pas enchaînée malgré lui ? Devenu habitant, pouvait-il dire au monde du haut de son tribunal, les excès auxquels un habitant à la faculté de se livrer ? Aussi quelle lutte entre le magistrat chargé des intérêts de la justice, et le propriétaire obligé de ménager les intérêts de la communauté ! Il se transporte sur un établissement pour constater une séquestration de vingt-deux mois, il y reçoit l’aveu du propriétaire et il ne délivre pas immédiatement la victime, il ne la regarde même pas, il ne se fait point ouvrir le cachot ! Quoique seul, sans suite, sans appareil, il craint [220] encore de compromettre l’autorité du maître. « Envoyez-moi cette femme demain à tel endroit, dit-il, là je l’interrogerai ; les actes seront censés accomplis aujourd’hui. Nous demanderons son extradition. » Oh ! qu’il paiera cher cette fatale complaisance ! Le lendemain la pauvre esclave lui est amenée dans un cabrouet ; elle ne pouvait marcher. Il faut pourtant bien dresser un procès-verbal ; il le rédige, il le date… Il le date de la veille ! Il commet un faux… Fait-il arrêter le coupable ? non, il n’ose prendre l’initiative des poursuites, il considère le scandale que soulèvera un pareil crime ; il voudrait l’étouffer, il en réfère à son chef. Ce chef est trop habile pour se laisser prendre à un tel piége. Il juge que son inférieur veut Jli laisser toute la responsabilité du silence vis-à-vis de la métropole ; il ordonne de poursuivre.
On instruit donc. Arrive le jour des débats.
Le malheureux officier public se présente tout chargé de la haine des colons, car ils lui pardonnent d’autant moins que ses alliances faisaient davantage compter sur lui. C’est un transfuge, un traître ! À le voir on comprend bien qu’il n’a pas l’âme calme d’un magistrat, et qu’il est partie au procès. Son visage est d’une pâleur mate, ses traits sont sillonnés d’amertume ; sa voix est fébrile, quoiqu’il fasse ; et sous le calme que les hommes savent acquérir par une longue domination d’eux-mêmes, une profonde agitation intérieure se révèle aux yeux de celui qui observe. Quel affligeant spectacle ! Son réquisitoire commence par une apologie, une défense personnelle à l’endroit de la colonie ; il explique qu’il avait été mis en demeure par une dénonciation, qu’il ne pouvait se dispenser de procéder contre un coupable ; il cite des articles du Code pour prouver qu’il ne lui a pas été possible de reculer ! C’était une chose affreusement triste de l’entendre demander pardon de remplir son devoir. — La défense est impitoyable, elle profite de tous ses avantages ; elle ne lui épargne rien ; elle lui fait boire le calice jusqu’à la lie ; sur son parquet il est accusé de faux ; sur son parquet il est obligé d’avouer qu’il a rédigé le [221] procès-verbal de la descente sur lieu d’une manière inexacte, et à son tour il accuse le prévenu de lâche ingratitude ; car « si je n’ai pas fait ouvrir le cachot sur le champ, devant moi, c’est que l’atelier était présent, et que j’ai voulu ménager votre autorité. »
Sans doute l’acte de M. Mahaudière n’était point généreux ; il récompensait cruellement les premiers égards qu’on avait eus pour lui, mais l’humiliation publique subie par l’homme de la justice était méritée, et l’on voudrait qu’elle atteignit plus souvent le magistrat prévaricateur.
Voilà le sort du représentant de la loi qui ne s’est pas conservé dans un austère isolement !
Les créoles, s’ils lisent jamais ce livre, vont s’indigner et se plaindre d’être mis en suspicion. Qu’ils réfléchissent, ils se rappelleront que le premier président de notre cour suprême descend de sa place, s’il se présente aux pieds du tribunal quelqu’un des siens. Toutes les morales du monde défendent d’être juge dans sa propre cause ; or, il y a aux colonies des maîtres et des esclaves, des blancs, des nègres et des sang mêlés ; ce sont des classes malheureusement bien distinctes et ennemies. Le maître qui juge des esclaves, le blanc qui juge des nègres et des sang mêlés, sont donc juges dans leur propre cause. Les européens, libres des pernicieuses idées de caste et de couleur, seraient seuls propres à rétablir un peu l’équilibre. Et encore voudrions-nous les renouveler souvent. Les créoles sont si forts, leur cohésion par suite de leur petit nombre et des intérêts communs qu’ils ont à soutenir, est si grande, l’influence de la fortune et de l’éducation qu’ils possèdent exclusivement est si considérable, que l’on ne saurait s’entourer de trop de garantie contre les dangers de leur despotisme et de leurs propres passions.
Il faut le désordre et le manque de suite qui caractérisent notre administration et font tant de mal au pays, pour que l’écrivain occupé des questions coloniales ait encore à répéter de telles choses. On verra si l’on veut jeter les yeux sur l’extrait [222] suivant de Boyer Peyreleau, qu’il y a plus d’un siècle qu’elles sont passées à l’état de vérités reconnues.
« L’expérience avait démontré au gouvernement le danger d’appeler aux premiers emplois des colonies des créoles ou des propriétaires. Dès le mois de novembre 1719, il avait dû défendre aux chefs d’y acquérir des habitations [170], mais on laissa tomber cette défense en désuétude, et de nouveaux inconvéniens s’en suivirent. Une ordonnance rendue le 1er décembre 1759, défendit aux gouverneurs, aux intendans et aux officiers d’administration des colonies d’y contracter des mariages avec des créoles et d’y acquérir des biens fonds (Code de la Martinique, vol. Ier, p. 151 et suiv. ; v. II, p. 74 et suiv.). Un nouvel ordre du roi enjoignit, le 7 février 1761, de n’envoyer aux îles aucun chef ou sous-chef qui y serait propriétaire ou qui y aurait épousé une créole (archives de la marine, l’histoire politique fera connaître les motifs qui ont provoqué ces diverses ordonnances) ; mais on laissa de nouveau tomber dans l’oubli ces défenses préservatrices. Que de maux ont affligé les colonies de 1786 à 1822, qui n’auraient pas eu lieu si elles eussent été exécutées ? »
« L’homme est malheureusement toujours homme, c’est-à-dire faible, vain et intéressé. Quelqu’intègre que soit un chef trop intimement lié à la colonie où il commande, il ne résistera pas aux instances de sa famille, de ses parens, de ses amis, de ses créatures, ni à l’impulsion de ses intérêts, Les solliciteurs puissans et importans finiront par être écoutés, et c’est toujours aux dépens de la justice, au détriment du bien public et des intérêts des particuliers. »
L’organisation coloniale judiciaire de 1828, renouvela les défenses de 1719, 1759, 1761, mais on n’en tient pas plus compte que du reste.
[223]
C’est un grand malheur que le ministère de la marine perpétue les folles espérances des créoles, en leur montrant tant de faiblesse. Avec sa morale de juste milieu, le gouvernement joue dans cette grande affaire de l’émancipation, un rôle à tout perdre. Devant le pays, il se présente comme voulant l’abolition ; devant les créoles, il se présente comme entraîné par les chambres, et ils en jugent bien par le défaut de volonté, l’hésitation qu’il apporte dans toutes les choses coloniales. — Les colons, il est bon qu’on le sache en France, ne rendent pas du tout le gouvernement responsable de ce qu’on fait pour les nègres ; il n’obéit, disent-ils qu’aux menées et aux instigations des abolitionistes, il cède à l’activité pernicieuse de ces agens salariés de l’Angleterre, de ces amis gagés des betteravistes ; et il a même été question à un conseil colonial de dénoncer en forme la Société française pour l’abolition de l’esclavage, « de la traduire devant les tribunaux comme une association de mauvais citoyens réunis dans le but avoué d’opérer la spoliation et la destruction de cent mille de leurs concitoyens [171]. »
Si les créoles n’avaient point cette confiance que l’administration ne veut pas l’affranchissement, on trouverait en eux moins de résistance. Ce qu’il faudrait, avant tout, ce serait de la part du ministère une détermination bien arrêtée d’arriver à l’indépendance. Tant que les colonies le verront remettre la question d’année en année, la reculer comme s’il en avait peur, toute tentative de réforme sera reçue par elles comme une tentative d’assassinat ; quoi qu’on fasse, la liberté à chaque pas rencontrera de nouvelles difficultés. Ce m’est point ainsi qu’on gouverne ; veuillez où ne veuillez pas, mais décidez-vous.
Les colonies ont raison, elles demandent à sortir du provisoire, elles veulent savoir à quoi s’en tenir. Comment ne résisteraient-elles pas à ce qu’elles croient un mal, en voyant ces symptômes d’hésitation dans le pouvoir ? Comment penseraient-elles que la métropole veut réellement l’abolition, quand la métro [224] pole est plus arriérée même que les colons. Il est facile de nommer quelques créoles qui se sont dégagés des préjugés de leurs pays, M. Winter, de la Martinique, cet avocat créole, à l’esprit énergique et généreux, dont nous avons déjà parlé, s’est mis à la même table que son confrère sang mêlé, M. Porry Papy. Jamais directeur, procureur-général, préfet aspostolique n’osa en faire autant ; et MM. Boitel et Duquesne, fonctionnaires publics, qui le voulurent tenter il y a sept ou huit ans, furent renvoyés en France par le contre-amiral Dupotet, gouverneur, pour rendre compte de leur conduite au ministre ! Les colons emploient des gens de la classe libre dans leurs maisons de commerce, dans leurs études de notaires et d’avoués ; le gouvernement n’a pas encore eu assez de courage pour faire un magistrat d’un de ces nombreux affranchis que la faculté de droit a proclamés docteurs [172]. Combien cependant quelques fonctions élevées conférées à des hommes de couleur ne pourraient pas accélérer la fusion qui doit faire oublier les outrages du passé !
La France possède des habitations ! Nous avons visité celle du Trouvaillant près Saint-Pierre. Eh bien ! les esclaves de la France, les nègres du roi comme on les appelle, ne sont pas mieux traités que ceux du plus mince petit blanc. Aucun essai particulier n’a été tenté en leur faveur, aucune amélioration n’a été introduite dans leur régime ; il n’y a pour eux aucun avantage d’appartenir à la France ; point d’éducation, point de lecture, point de moralisation, aucun de ces enseignemens où l’homme au moins apprend à se connaître et à s’estimer. Des planteurs ont des usines moins délabrées, des cases plus belles, et une infirmerie mieux tenue que celles de la nation ! Et vous voulez que les colons vous supposent le désir [225] d’affranchir : — Quelle honte, d’ailleurs, que le gouvernement de France ait encore des esclaves ! Pourquoi ne donne-t-il pas le signal de l’abolition en élargissant tous ses nègres, comme fit la couronne d’Angleterre le 12 mars 1831 ? Il hésite, tandis que le bey de Tunis vient de proscrire l’esclavage dans ses états ! La France reçoit maintenant des leçons d’humanité des régences barbaresques ! Ne se refusera-t-on pas à le croire ? Non-seulement la France possède des esclaves, mais elle leur dénie jusqu’au droit de rachat ! Nous avons sous les yeux une lettre signée de M. Brache, en date de Cayenne, 20 novembre 1840, et adressée à M. Goubault, conçue en ces termes :
« Cher monsieur,
« Désirant affranchir la négresse du domaine colonial Monique, j’avais écrit à M. Roujoux, l’ordonnateur, et je proposais de donner en échange de cette femme, une négresse à moi appartenant. Ce chef de l’administration a rejeté ma demande, prétextant que le conseil colonial, dont le concours est indispensable en pareille matière, refuserait d’émettre son vote sur un projet de décret dont le but serait en définitive d’accorder à Monique la récompense de bons services, dont elle peut justifier.
« Je m’étais basé sur les services de cette négresse, j’avais expliqué que cette femme attachée à l’atelier de l’hôpital, où elle est assujettie à un travail extrêmement rigoureux, et ayant un enfant libre, ne pourrait s’acquitter envers lui de tout les devoirs de la maternité.
« La proposition que j’ai faite étant entièrement dans l’intérêt du gouvernement, je ne pensais pas qu’elle put être refusée, car au moment surtout où la question de l’esclavage est décidée et l’urgence de la liberté proclamée, elle offrait au gouvernement outre la satisfaction d’humanité, l’avantage d’avoir une esclave de moins à payer.
« Je viens vous prier, non pas en votre qualité de procureur du roi, mais comme ami, de faire accueillir ma demande ; ce serait un service dont je vous resterais reconnaissant. »
[226]
M. Goubault ne put rien obtenir de l’ordonnateur ; et Monique est encore esclave du domaine de France !
Il est permis de le dire, sans crainte d’exagération, les autorités des colonies ne sont pas moins impitoyables pour les noirs que les plus mauvais maîtres ; on peut à peine ajouter foi aux actes infâmes qu’elles commettent elles-mêmes. Une épave a encore été vendue en 1838, à la Guadeloupe, avec autorisation du directeur de l’intérieur !
La nommée Manette arrêtée divaguant [173], le 1er novembre 1836, resta à la geôle de la Basse-Terre jusqu’au 15 février 1838, quoiqu’elle se dit libre. Elle ne justifiait ses allégations, il est vrai, par aucun titre ; mais personne ne la réclamait, et nul durant ce long espace de temps ne fit valoir de droit sur elle. Toujours malade d’ailleurs, et causant de grands frais à la geôle, Manette embarrassait fort le concierge. Il rendit compte à l’administration, et sur autorisation il vendit l’épave à un M. Bourreau, habitant de la Capesterre, pour six barils de farine de manioc destinés à éteindre une partie des frais qu’elle avait causés à la geôle. M. Bourreau revendit la pauvre femme avec bon bénéfice à un M. Delaville, brave homme, chez lequel elle se trouvait encore au mois de décembre 1839 !
Comment la justice serait-elle respectée là où ceux mêmes qui en reçurent la garde, ont le cœur si rempli d’injustice ?
Si les actes de l’administration coloniale sont d’une iniquité révoltante ; ceux de l’administration métropolitaine à l’égard des îles, sont marqués au signe d’une incurie, d’une faiblesse et d’une incohérence inexplicables. On trouble la paix des colonies par de petites ordonnances timides qui ne remédient à rien parce qu’elles ne veulent réellement rien. Mieux vaudrait s’abstenir. Qu’est-il résulté de l’ordonnance du 5 janvier 1840, privée qu’elle était de toute sanction pénale ? Aucune amélioration pour les ateliers, et une violente irritation chez les créoles qui jugeant l’inutilité fondamentale de ces moyens de juste mi [227] lieu, n’y ont vu comme ils disaient « qu’un os à ronger, jeté aux abolilionistes pour les faire taire, » Les abolitionistes ne se taisent point ; les colons voyant qu’on craint de les attaquer franchement, s’indignent avec la chaleur de leur sang généreux, qu’on craigne de les défendre nettement, et le mal augmente.
Les coups terribles que le maître frappe quelquefois sur son esclave, émeuvent la sollicitude des bureaux de la marine, lorsqu’une circonstance quelconque les fait retentir jusqu’en Europe ; mais les réformes provoquées par les cris des victimes, sont toujours annihilées par l’inqualifiable timidité des réformateurs. Que peut produire l’ordonnance du 16 septembre 1841, issue de l’affaire Mahaudière ? Elle limite à trois jours l’emprisonnement disciplinaire par l’ordre immédiat du maître, elle fait obligation à celui-ci de livrer à la justice dans le même délai de trois jours l’esclave coupable d’un crime, elle commande en outre, que les cachots soient remplacés par des salles de discipline ; et ces mesures nouvelles une fois prescrites, elle ne pourvoit d’aucune manière à leur garantie et à leur efficacité, elle s’en remet sur ce point aux visites de patronage recommandées par l’ordonnance du 5 janvier. Or ces visites confiées à des magistrats presque tous créoles ou habitans, protecteurs d’esclaves bien choisis, personne n’ignore qu’un tiers des planteurs a refusé de s’y soumettre sans qu’il en ait été rien de plus. Quant à la nature des salles de discipline, l’ordonnance veut « que l’humanité n’ait rien à y reprendre », mais elle ne précise pas ce que l’humanité exige. Elle s’en rapporte encore aux magistrats, lesquels possédant des habitations par eux-mêmes ou par alliance, trouveront que les cachots sont très conformes à l’humanité puisqu’ils en ont chez eux, et se tiendront pour quitte vis-à-vis de la loi, en écrivant le mot salle de police sur les prisons actuelles. Tout le monde à leur place, et avec leurs passions en ferait autant. Puis, las d’un pareil effort en faveur de la population esclave, les bureaux se reposent et disent « qu’ils ont suffisamment restreint [228] les pouvoirs exorbitans autrefois concédés, que le retour de tout abus, de tout acte arbitraire est impossible. » Vain mensonge ! Quels que soient leurs pusillanimes ménagemens, ils ont agité une fois de plus les colonies sans profit réel pour les esclaves, en jetant un second os aux abolitionistes qui ne sont pas assez dupes pour perdre temps à le ronger ; ils n’ont rien éclairci de l’avenir désolant et lugubre qu’annonce un présent funeste.
Répétons-le : la métropole ou pour s’exprimer moins généralement, le ministère de la marine, et l’on pourrait dire mieux encore le directeur du département des colonies au ministère de la marine, M. Saint-Hilaire en un mot, mérite en tout ceci les plus graves reproches. Il est impossible qu’il ne sache pas ce qui se passe. En tolérant les abus il en devient complice ; en les provoquant par les tergiversations de sa politique, il en est le premier coupable. Les créoles, malgré l’influence que donnent toujours les richesses et la supériorité intellectuelle seraient moins audacieux, si les actes du gouvernement étaient mieux déterminés, si tous les pouvoirs des îles, toutes les branches de l’administration n’étaient, comme on l’a vu, remises à des hommes de leur caste, ou voués aux intérêts de cette caste par des intérêts pareils.
La direction du département des colonies au ministère de la marine, est évidemment enveloppée de l’atmosphère coloniale, autrement elle ne maintiendrait pas dans leurs places plusieurs des principaux fonctionnaires des îles qui sont d’une manière patente, hostiles à l’émancipation. — S’il est des colons qui s’en réjouissent, il en est d’autres plus sensés qui comprennent le mal et le déplorent. Nous avons entendu des habitans de la Guadeloupe se plaindre que l’administration locale n’aidât point au sensible mouvement de libéralisme éclairé qui distingue la Basse-Terre. Ils ne pardonnaient pas au gouverneur, M. Jubelin, d’avoir su la détention de la fille Lucile dans le cachot Mahaudière, et d’avoir fermé les veux. Il est avéré que M. Jubelin avait connaissance du crime ; s’il eût [229] fait son devoir, disent-ils, le retentissement de ce funeste procès n’aurait point précipité la destruction de l’esclavage de tout le temps que (dans leur opinion) il lui restait à mûrir. M. Jubelin, il est vrai, disait le 18 juin 1840, en ouvrant la session du conseil colonial : « Malgré de dangereuses excitations du dehors, malgré quelques imprudentes agitations au dedans, l’ordre règne dans le pays. Cette situation témoigne hautement de la sagesse qui a présidé à l’établissement d’une société, qui a pu résister à tous les ébranlemens que les circonstances ne cessent de lui imprimer depuis quelques années. » Le conseil colonial ne manqua pas de rappeler cette phrase dans sa réponse et d’y appuyer fortement. M. Jubelin cependant resta gouverneur ! Comment pourrait-il seconder la réforme, celui qui loue la sagesse de l’institution d’une société à laquelle on a donné l’esclavage pour base et pour pivot ?
L’autorité ecclésiastique s’accorde malheureusement avec l’autorité gouvernementale, pour trouver tout bien aux colonies telles qu’elles sont. Lors de la promulgation de l’ordonnance du 5 janvier 1840, M. Jubelin fit connaître qu’en ce qui concernait l’instruction religieuse, un arrêté prochain indiquerait les moyens de la mise à exécution ; l’arrêté était encore à venir au mois de novembre quand nous quittâmes la Guadeloupe, et M. Castelli préfet apostolique, l’attendait avec une patience toute chrétienne ! Non-seulement M. Castelli ne fait rien, mais il trouve que l’on fait trop, et s’en cache peu. Dans une lettre confidentielle aux curés, corrective d’une lettre publique, l’une et l’autre datées du 5 décembre 1839, il admet « que l’on peut choisir sur les habitations des personnes capables d’enseigner les premiers élémens de la foi. » Et il finit en disant : « Le plan que nous embrasserions en nous donnant ainsi d’utiles auxiliaires sur les habitations, serait aussi vaste que possible. L’on parle de doubler le personnel des prêtres dans toutes les paroisses de la colonie, ce projet serait abandonné comme inutile quand on verrait que notre nombre quelque faible qu’il soit, suffit néanmoins pour conduire [230] l’œuvre à des résultats tout aussi avantageux. » On ne peut dire avec plus d’adresse que les planteurs suffisent à l’instruction religieuse des esclaves, et l’on ne peut mieux servir leurs vues secrètes. Le préfet apostolique regarde trente ou trente-deux prêtres, qui sont dans la colonie, comme capables d’instruire une population de cent trente mille âmes, et c’est sans doute parce qu’il pense aussi qu’il y a assez d’églises, pour y rassembler de tous points les ateliers à catéchiser, qu’il ne demande pas l’emploi de 80, 000 francs votés par les chambres, pour bâtir dans les divers districts des chapelles que l’on ne bâtit point [174]. Il est certain que les fonctionnaires en tenant une telle conduite ne s’exposent pas à l’animosité des créoles, mais il est moins certain qu’ils méritent les louanges des gens de bien,
Veut-on apprécier après cela l’homme qui occupe à la Guadeloupe la place d’où l’on agit le plus efficacement sur la population, M. Billecocque, directeur de l’intérieur ; ouvrez l’almanach de cette île pour 1840, publié sous l’omnipotence de sa censure ; vous y verrez que dans une chronologie historique, il fait régner Louis XVII en 93, Louis XVIII le Désiré en 95, qu’il supprime complètement la république, le directoire, l’empire et ne nous accorde Louis-Philippe que sur l’abdication de Charles X. Ces idées là ne sont que ridicules dans un particulier, elles deviennent funestes dans un fonctionnaire public ! Le partisan outré de l’ancien régime, ne doit-il pas instinctivement contrarier tout ce qui est de l’essence du nouveau régime ?
Faut-il s’étonner maintenant qu’aucune impulsion libérale ne vienne d’en haut, que le fisc fasse encore vendre des hommes et des femmes à l’encan, que les planteurs aient encore des cachots de quatre pieds d’élévation, que pas une fille libre [231] n’obtienne une bourse dans les couvens des dames de Saint-Joseph, que l’état, propriétaire de plusieurs habitations domaniales, n’y ait jamais donné l’exemple de la moindre mesure progressive envers les nègres ? faut-il s’étonner surtout que les journaux des colonies censurés par l’administration ne rendent aucun compte des procès pour sévices contre les esclaves [175], ne publient que les faits contraires au succès de l’émancipation anglaise ; et jamais un de ceux, un seul de ceux qui pourraient modifier chez les créoles les idées fausses qu’ils ont sur la possibilité du travail libre, idées où prend naissance leur principal motif d’opposition à l’affranchissement ? Rien dans nos îles ne peut venir éclairer ni fortifier l’opinion publique, et les craintes de leurs habitans déjà trop prévenus s’augmentent et s’accroissent sans cesse à ce cri toujours répété de leur presse : « Les planteurs anglais sont ruinés, les nègres anglais tournent à la barbarie. » Si l’administration n’était amie de l’esclavage, les journaux censurés des colonies ne citeraient-ils que des documens opposés à l’abolition ?
Avant de terminer, qu’il nous soit accordé deux mots d’explication personnelle. Nous voulions tenir notre ouvrage à une hauteur toute politique, nous voulions éviter de descendre à attacher le blâme à des noms propres. Nous avons cependant été entraîné à le faire, nous le regrettons ; mais quand on voit ces magnifiques contrées menées au désordre qui les perdraient, entretenues dans les haines qui les tueraient, caressées dans l’aveuglement qui les ruinerait, si cela était possible, par ceux même qui devraient les sauver ; l’indignation avec la douleur ne se contiennent plus, et l’on ne peut s’empêcher de signaler les coupables, comme impropres à l’œuvre qu’il faut accomplir.
[232]
CHAPITRE XVII.
ÉTAT DE LA QUESTION.↩
Il ne faut pas tout-à-fait juger des colons par les discours de leurs députés gagés, ou les brochures de quelques-uns d’entre eux. — Les crimes du passé ne sauraient justifier les crimes du présent. — Les colons ne défendent pas l’esclavage pour lui-même. — Le courage civil manque aux colonies comme en Europe. — La censure est aussi une des plaies attachées à l’esclavage. — Belle contenance des créoles, lors des derniers bruits de guerre. — Leur folle haine contre les abolitionistes. — le mot philantrope est devenu une injure parmi eux. — L’Angleterre et les betteraviers sont les Pitt et Cobourg des créoles. — Les projets de monopole du sucre indien sont absurdes, les colons éclairés de disent eux-mêmes. — La France n’est pas ennemie des colonies. — La propriété esclave n’est défendue que par les propriétaires de nègres et leurs salariés. — Il y a des possesseur d’esclaves parmi les abolitionistes. — Que les colons approuvent ou n’approuvent pas l’émancipation, ils doivent céder au vœu universel qui la demande. — Les difficultés de l’affranchissement seront d’autant plus vite surmontées que les créoles l’accepteront avec moins de résistance. — Le titre de délégués des colonies que prennent les délégués des blancs, est une usurpation qui choque la justice et le sens commun.
Nous avons dit tout ce que nous avions à dire sur le régime des esclaves, sur leur caractère et leur nature, sur l’état actuel de la société coloniale ; maintenant que nous croyons avoir assez exploré le terrain, nous pouvons y marcher, sans trop de crainte de nous égarer, et aborder la question de l’esclavage.
En résumant d’une manière attentive et scrupuleuse les impressions recueillies auprès des créoles, pris individuellement, nous trouvons que, sur cette matière proprement dite, ils gagnent à être connus. Ce qu’ils disent vaut mieux que ce qu’ils écrivent, et ce qu’ils font vaut mieux que ce qu’ils disent. On les a chargés d’une responsabilité qui ne leur appartient pas, et il faut déplorer que la mauvaise manière dont ils se sont défendus par eux-mêmes et par leurs écrivains gagés, ait trompé l’Europe sur leur compte. [233] On aurait tort de juger de la majorité créole par des discours comme ceux de M. Mauguin, qui trouve fort mauvais que l’on attaque l’ilotisme, sous prétexte que les plus beaux génies de l’antiquité ont jugé l’ilotisme une fort belle institution ; par des brochures comme celles de M. Lepelletier Duclary, qui fait de la servitude un état paradisiaque ; ou celles de M. Huc, qui soutient la légitimité, qui veut la perpétuité de l’esclavage, et refuse à la civilisation le droit d’y porter la main. « On ne peut nous contraindre, dit ce dernier dans un travail où l’on a regret de trouver du talent, on ne peut nous contraindre à renoncer à ce que notre religion a fondé, d’accord avec la puissance temporelle et législative, et sous la garantie de toutes les lois constitutionnelles de notre pays. Depuis la célèbre déclaration du 5 août 1789 jusqu’aujourd’hui, il n’a pas été promulgué en France un seul acte constitutionnel, quel qu’il fût, qui n’ait uniformément renouvelé et maintenu, comme inviolable et sacré, le principe de la liberté de conscience. Or nos consciences, pour le moins aussi timorées que celles de nos adversaires, loin de nous faire apercevoir une immoralité dans la possession de nos esclaves, ne nous y montrent qu’une occasion d’exercer des vertus inconnues à nos détracteurs, et à la hauteur desquelles tout ce qui les entoure atteste qu’ils ne s’élèveront jamais. Donc on ne peut, sans violer le plus saint des droits, nous priver de nos propriétés ou seulement altérer le mode de leur possession, en accueillant la proposition de l’affranchissement des noirs. »
N’est-ce pas une chose étrange d’entendre sortir de ces lots, où l’un travaille et l’autre profite, où la majorité est conduite à coups de fouet par la minorité, où trône l’iniquité, où règne la terreur, n’est-ce pas une chose étrange vraiment d’entendre sortir de cette société barbare, le reproche d’injustice et de violence adressé à ceux qui la veulent réformer ? Jamais peut-être la civilisation n’a donné une plus grande preuve de son respect pour la propriété ; l’intérêt colonial, avec l’humanité, gagneraient à ce qu’on dépossédât les maîtres d’une possession [234] monstrueuse ; depuis un demi-siècle, on diffère l’œuvre d’utilité générale, parce que l’intérêt d’une poignée de colons en souffrirait ; et ils font retentir l’univers de leurs clameurs ! et ils crient à l’injustice ! et ils disent qu’on les veut dépouiller ; eux qui ne se sentent pas injustes de dépouiller le nègre de sa liberté ! Dans leur folie, pour soutenir la perpétuation de l’esclavage, ils invoquent les anciennes lois qui l’autorisent ; ils ne s’aperçoivent pas que cette immobilisation du Code qu’ils veulent créer pour couvrir leur odieuse propriété, est l’entière négation du progrès continu !
Avec les procédés déraisonnables de M. Huc, il n’est aucune infamie sociale qui ne se puisse défendre, qu’il ne soit permis de rétablir, et qui ne trouve sa justification moderne dans le fait de son existence passée. Quoi ! s’il avait plu à Louis XIII, fondateur de l’esclavage des nègres chez nous, de permettre aux colonies de fixer irrévocablement le nombre de leurs habitans à neuf mille, comme Lycurgue l’avait établi à Sparte ; si les créoles, d’après cette règle fondamentale de leur organisation, jetaient dans un précipice les enfans des hommes pervers, et ceux qui naîtraient vilains, contrefaits ou même faibles, comme le voulait expressément la loi lacédémonienne ; s’ils faisaient avorter les femmes pour maintenir le nombre des citoyens au terme convenu, ainsi que le prescrivirent Minos, Aristote et Platon ; on voudrait donc soutenir aussi que les ordonnances constitutionnelles l’ayant permise, l’autorité l’ayant pratiquée, et la conscience créole n’y répugnant pas, c’est violer le plus saint des droits que de vouloir purifier une telle république ? On viendrait donc dire aussi que les philantropes font plus de bruit qu’il n’y a de mal ; que les femmes ne se sont jamais révoltées ; que les enfans n’ont jamais porté plainte ; et l’on ferait de l’histoire et du Code des remparts sacrés à ce nid de serpens ? Oh ! la coupable action que de fortifier le malheur des colons par ces sophismes d’érudits ! N’est-ce pas provoquer une résistance folle, inutile, impardonnable, ouvrir les portes à une longue suite de désastres ; que d’autoriser le maître à se cramponner à [235] ses possessions humaines, en leur prêtant je ne sais quelle affreuse légitimité aristotélique et légale ?
Heureusement nos frères des Antilles, lorsque leurs passions ne sont pas excitées par l’effervescence de la place publique, n’épousent plus de telles doctrines.
Sans doute, il ne manque pas aux colonies d’êtres stupides et méchans, auxquels il paraît tout naturel d’abrutir des nègres pour gagner plus d’argent, et qui ne méritent aucune considération ; d’esprits faux et d’âmes sèches comme on en rencontre en Europe, qui trouvent que tout ce qui existe est bien, par la souveraine raison que cela est ; mais ceux-là exceptés, nous pouvons le dire sans crainte de nous être laissé trop impressionner par les souvenirs de l’hospitalité, l’esclavage n’a pas foncièrement, et pour lui-même d’amis parmi les colons. Ils le reconnaissent pour un mal, ils ne voudraient pas l’établir s’il ne l’était, et n’en demandent la continuation que parce qu’il le regardent « comme un mal nécessaire. »
« Nous concevons tout ce que l’esclavage a d’horrible, nous disait M. Dupuy, mais que deviendront nos fortunes, celles de nos enfans, de nos filles si vous nous enlevez nos bras. Les noirs libres ne travailleront pas ; leur liberté, c’est notre ruine et celle des colonies. » — « Mon Dieu, s’écriait M. Cotterell, je soutiens cet état de choses parce que j’y vois de grands intérêts engagés, parce que le bien-être de ma famille y est attaché, parce que sa destruction me semble devoir amener la destruction des colonies ; mais je comprends ce que vous dites. Si j’étais européen, si j’eusse vécu dans le centre d’idées où vous avez vécu, je penserais, je crois bien comme vous. »
« Je ne prétends pas certainement, nous disait un autre planteur, que l’esclavage soit bon en principe, mais trouvez moyen de le remplacer sans détruire notre société tout entière. Pour moi, je sympathise si fermement avec la moralité de votre réforme, que si vous pouviez me garantir le travail libre du tiers seulement de mon atelier, je ne vous demanderais au [236] cune indemnité, sûr de récupérer bien vite la perte de mon capital noir par les gains de la prospérité future. »
Un autre, M. Eggiman, de la Guadeloupe, avec lequel nous discutions, s’interrompt candidement : « Mais que voulez-vous que je réponde ? vous avez le beau côté. »
« Nous demandons indemnité, dit M. Guignod, de la Martinique, dans un mémoire encore manuscrit, et il nous la faut, c’est notre droit ; car nous n’avons défendu le principe esclave que comme synonyme du droit, et c’est notre droit de propriété seul que nous défendons. Qu’on ne dise donc plus que nous soutenons le principe de l’esclavage pour l’esclavage en lui-même. Nous soutenons notre droit tel que la loi l’a fait, pour ne point perdre la fortune qui repose sur l’esclavage. On nous commande des sacrifices à une opinion qui n’est pas la nôtre, et l’on s’indigne de notre résistance ; c’est au moins injuste. L’homme ne peut posséder l’homme, soit, vous avez raison ; mais vous m’avez permis d’acheter un homme, vous m’y avez encouragé, si vous voulez le reprendre pour le rendre à la société, payez-le moi. La réhabilitation du principe moral ne saurait détruire le droit créé, le droit que la loi a constitué. »
Nous sommes à même de l’affirmer, il est des créoles propriétaires de nègres qui sont abolitionistes. Leur âme bienveillante a brisé les entraves que l’éducation, habitude et l’intérêt personnel mettaient à leur propre affranchissement. Nous possédons plusieurs manuscrits que l’on nous a fait l’honneur de nous confier, et dont il ne nous est pas permis, à notre grand regret, de révéler les auteurs, où l’on rencontre des idées aussi profondément radicales que les plus radicales qui aient jamais été professées en France. C’est dans le mémoire d’un colon en faveur du rachat forcé par le pécule, que se trouve le passage suivant : « Par le temps où nous vivons, dans nos îles perdues comme dans l’Europe civilisé, il n’est pas un homme propriétaire ou non d’esclaves (homme de sens, de cœur et de lumière, s’entend), qui au point de vue théorique ne condamne radicalement l’esclavage. Examiné en principe, l’es [237] clavage, c’est-à-dire la propriété de l’homme sur l’homme, est une monstruosité en désaccord avec nos mœurs, nos sentimens et nos idées ; sous le point de vue moral, c’est une souillure de humanité où nul ne voudrait tremper les mains. La conscience répugne à en chercher la justification dans les mœurs ou l’esprit des siècles qui l’ont vu naître, elle a hâte de s’inscrire en faux contre cette grande violation de la dignité de l’homme, et l’âme indignée s’échappe en un vaste cri : Abolition de l’esclavage ! De tels sentimens appartiennent aux colons propriétaires d’esclaves comme aux abolitionistes européens, et nous ne craignons d’être désavoué que par les hommes à intelligence écourtée qui ont des préjugés et pas d’entrailles. » L’auteur de ces nobles pensées, si noblement dites, définit l’émancipation « déposséder les maîtres d’une propriété garantie par la loi dans un but d’utilité humanitaire. »
Un autre habitant de la Guadeloupe, dans des réflexions pour l’affranchissement, s’exprime en ces termes : « L’esclavage tel qu’il existe, pourrait être modifié, et il ne serait pas difficile de supprimer sans danger tout ce qui, dans cette affligeante institution, effarouche à bon droit les susceptibilités philantropiques de nos frères de la métropole… L’esclavage deviendrait alors une condition fort supportable, dans laquelle la race noire trouverait tout le bien-être matériel auquel on peut prétendre en ce monde.
« Mais cet état social, si heureux qu’il puisse être, n’en serait pas moins de l’esclavage ; or l’esclavage est une flétrissure qui pèse à l’humanité, et le moment est venu de rendre à celle-ci sa dignité méconnue depuis trop long-temps ; je crois donc que l’esclavage doit être aboli. »
Par malheur, ceux qui pensent ainsi n’ont pas encore tous, le courage de le proclamer comme l’énergique M. Lignières, dont le lecteur nous a déjà souvent entendu parler [176]. Il y a une opinion publique faite contre l’abolition, et ils se [238] jugent trop jeunes pour l’affronter ; nombre de colons disent en particulier bien des choses qu’ils n’osent avouer devant leurs compatriotes, crainte d’être accusés de trahir la communauté. J’en ai vu qui croyaient au travail libre et qui ne le confessaient pas, de peur de passer pour mauvais créoles ! L’émancipation a certes beaucoup d’ennemis dans les Antilles, mais elle en a moins que l’on ne suppose ; les colonies nous suivent involontairement, à dix-huit cents lieues de distance, cela est vrai, mais elles nous suivent [177]. La nouvelle génération, sérieuse et intelligente, est progressive ; il serait heureux qu’elle eût moins de respect pour les anciens, ou du moins [239] qu’elle arrivât aux conseils pour combattre les anciens. Elle sympathise avec l’affranchissement, comme tout ce qui est jeune, sympathise avec tout ce qui est bon ; et si, par exemple, on prenait l’avis en masse des barreaux de la Basse-Terre, de la Pointe-à-Pitre, de Saint-Pierre et de Fort-Royal, le monde aurait peut-être le grand étonnement d’y voir éclater une générosité non moins hardie que celle des abolitionistes. Pour tout dire, les colons ont plus peur du mot que de la chose. Faut-il l’avouer ? se fâcheront-ils de la révélation ; est-elle à leur louange ou à leur blâme ? Ils se redoutent les uns les autres, ils tremblent devant la tyrannie de leur propre opinion publique qui étouffe la voix des bons et des sages [178]. Réunis ensemble, ils se montent, s’échauffent, arrivent à une véritable glorification de leur société et refusent tout ; prenez-les tête à tête, ils accordent sans peine que l’être humain n’est pas destiné à vivre comme un animal, et que pour l’honneur de la France moderne il est à désirer que l’on détruise l’esclavage sans nuire au travail. — Le jour où les timides ne se laisseront plus terrifier par la majorité, ils la dépasseront, car ils attireront à eux la partie saine de la population ; malheureusement ce jour-là est loin encore.
[240]
Si les habitans par l’usage des mœurs politiques et d’une presse libre, par les féconds rapprochemens de l’association, avaient acquis plus de vertus civiques, nos îles y gagneraient de toute manière ; mais chacun redoute de se faire mettre à l’index, et le pays reste livré à l’influence des hommes stationnaires qui flattent ses passions cachées, en perpétuant la peur instinctive que nous inspirent tous les grands changemens même reconnus nécessaires. C’est ainsi que la faiblesse et le respect humain ont toujours tant retardé le progrès des sociétés ! — Puissent ceux qui méritent nos reproches comprendre, qu’ils manquent à leur pays en ne confessant pas tout haut leurs opinions ! Il n’est vertueux qu’à demi, celui qui se contente de faire le bien ; avoir en outre le courage d’empêcher le mal est l’impérieuse obligation du vrai juste. L’homme peut user sa vie à de telles entreprises, mais il grandit de leur grandeur ; il trouve dans le sentiment du devoir la consolation des rudes chagrins, des amères déceptions de la vie ; et quand vient l’heure suprême, quelque jour qu’elle arrive, comment qu’elle arrive ; vieux ou jeune, abattu par la fièvre ou par une balle de plomb, il rentre dans l’essence universelle, calme et sans regret. Ce fut là, n’en doutons pas, le secret qu’eurent ces nobles disciples du stoïcisme qui proclamaient la parenté de tous les hommes, et dont l’histoire nous raconte la mort facile et vaillante.
Oh ! si les créoles généreux voulaient ! S’ils exigeaient seulement qu’on rétablit aux îles la liberté de la presse, que de choses on pourrait dire, utiles à tout le monde, que de frayeurs mal raisonnées on parviendrait à calmer, que de lumières on jetterait sur ces questions ! comme on y accoutumerait insensiblement les esprits, comme on agirait avec facilité et sans les heurter sur les hommes rétrogrades ; combien la parole fortifiante d’un ami connu, donnerait de courage aux timides et rassurerait ceux qui doutent encore ! — La censure est aussi une des plaies attachées à l’esclavage. Pour ne point ouvrir trop de jour aux esclaves et à la classe des libres, les créoles [241] se sont tenus dans l’obscurité, et les voilà aujourd’hui victimes des ténèbres qu’ils ont faites ; le soleil les blesse et leur fait peur. Beaucoup de colons se plaignent du silence où ils sont condamnés. « … Aussi, un de mes plus forts argumens pour demander le renvoi à cinq ans du vote de l’abolition, nous écrivait M. Lignières, est-il de donner le temps de nous éclairer à la presse coloniale qui serait débaillonnée. » Hâtez-vous, hâtez-vous de rendre aux colonies la liberté de la presse. La censure, comme moyen de paralyser les dangers qui existeraient à y parler trop haut, est d’autant plus absurde, qu’il arrive tous les quinze jours de France des brochures et des journaux mille fois plus incendiaires que ne le pourrait jamais être la polémique locale.
Les colons ont trop de brillant dans l’esprit, et quand je me rappelle la noble hospitalité que j’ai reçue chez eux, moi qu’ils tenaient pour un ennemi, je pense aussi qu’ils sont trop chevaleresques pour ne pas devenir abolitionistes, si on pouvait les instruire fraternellement. Il fallait les voir alors qu’il fût question de guerre, ils se montrèrent universellement prêts à une vigoureuse défense ; ils parlèrent de leurs fusils et de leur adresse à les manier. Que tout l’honneur de leurs actes soit connu : ils savaient bien que la guerre une fois déclarée, l’Angleterre mettrait le feu à leurs îles en deux jours, en appelant les nègres à la liberté, et cependant nous les vîmes unanimes à désirer que la mère-patrie tirât vaillamment l’épée plutôt que de maintenir la paix aux dépens de sa dignité. Le vieux sang français se réveillait tout superbe, et ils ne songeaient guère à se donner à la Russie comme dans leurs mauvais momens [179]. Ce [242] n’est pas chez eux qu’on eût trouvé sept lâches pour faire le ministère de l’étranger. Il est impossible qu’avec de pareils hommes l’abolition ne soit pas plus facile qu’ils ne le croient eux-mêmes. Il ne s’agit, pour les faire entrer dans la voie, que de brûler d’un seul coup leurs vaisseaux d’anciens maîtres.
Il est à désirer, avant tout, que les passions s’apaisent un peu, et que l’on s’entende. Pour ce qui est de nous, nous souhaitons avec ardeur que le caractère de notre travail puisse contribuer à un heureux rapprochement. Je ne craindrais pas de dire que les colons ne soutiennent l’esclavage que parce qu’ils ont le malheur de posséder des esclaves, mais soit intérêt personnel aveuglé, soit le ressentiment que finissent par engendrer les longues luttes, on ne peut imaginer à quel degré d’irritation ils sont parvenus envers quiconque attaque leur propriété humaine ; leur exagération va si loin qu’un de leurs défenseurs les plus dévoués a pu dire : « Bons, généreux, hospitaliers en toute autre circonstance, les créoles deviennent des tigres contre celui qui élève la voix en faveur des victimes de leurs [243] priviléges. » Ils croient réellement que tout homme qui déteste l’esclavage est leur ennemi. « Ils l’accueillent avec leur cœur, comme a dit madame Letellier, ils le bannissent avec leurs préjugés [180]. » Le mot de philantrope est devenu pour eux la dernière expression de l’injure. Aux yeux d’un créole pur sang, philantrope ou scélérat sont deux choses parfaitement synonymes ; « un philantrope est un homme égoïste qui vise au renversement des fortunes sans prévoir aucune compensation, auquel peu importe la ruine ou la misère des familles, pourvu qu’il parvienne au but qu’il se propose. » Ce n’est pas nous qui prêtons de telles pensées aux créoles, c’est un créole même, M. Louis Fereire, qui les avait constatées depuis quatre mois qu’il était de retour en son pays, au moment où nous l’avons rencontré [181]. Eh ! M. Cicéron, membre du conseil [244] colonial, n’a-t-il pas, dans un article inséré au Courrier de la Guadeloupe, parodié ainsi un beau vers de Racine :
Je crains le philantrope et n’ai point d’autre crainte.
On déteste bien plus un abolitioniste aux colonies que nous ne détestons en France un possesseur d’esclaves, on l’exècre. Personnellement nous avons eu, pour nous maintenir parmi les créoles, les plus ardentes répugnances à surmonter, les plus violentes haines à affronter, et il n’a pas fallu moins que le fond de générosité de leur caractère pour vaincre les premières antipathies ; mais c’est précisément parce que nous eûmes à nous réjouir de les connaître que nous voudrions les voir jeter aux vieilleries, leurs mauvaises colères contres les abolitionistes. Ces haines détestables ne leur vont pas [182] quoiqu’elles ne doivent surprendre personne ni exaspérer l’Europe contre [245] eux. « Le créole ; ainsi que nous l’écrivait encore M. Fereire, ne peut concevoir des idées que sa position ne lui permet pas d’analyser, et c’est de là que vient tout son aveuglement. » Lorsqu’on aura changé le mode social, les hommes changeront ; ils valent mieux que l’institution à laquelle il est juste de rapporter leur perversité.
Ne nous indignons pas trop que les créoles résistent, l’intérêt personnel a toujours résisté aux réformes nécessaires. En Europe ceux qui possèdent résistent aux justes réclamations de ceux qui ne possèdent pas. Faisons la part des maîtres, et celle des circonstances où ils se trouvent. Soyons sans colère, tâchons de les éclairer ; mais qu’ils renoncent à faire des abolitionistes autant de niais ou de méchans. Nous acceptons volontiers l’épithète très injurieuse de philantrope, mais nous disons qu’il n’y a que les sots qui puissent accuser les philantropes de haïr et de calomnier les créoles. Calomnier un [246] possesseur d’esclaves ! à quoi bon ? la vérité suffit et au delà. Haïr les créoles, mais si nous aimons les nègres par amour de l’humanité, comment pourrions nous vouloir aucun mal aux blancs puisque les blancs sont hommes comme les nègres ? Les philantropes ne haïssent que l’esclavage et ne calomnient personne. Ils n’ont et n’eurent jamais de prévention contre les maîtres : ils n’eurent et n’ont que de la sympathie pour les esclaves. Considérez donc un peu, habitans des colonies ! La loi qui vous autorise à posséder des esclaves, aliène illégitimement la virtualité de l’homme esclave. Elle convertit des personnes en choses. Des hommes, des femmes, des enfans ! troqués, donnés en cadeau, loués, hypothéqués, légués, vendus, facturés, embarqués comme des tonneaux, emmagasinés comme des marchandises ! Nous en appelons à vous même, nous nous adressons à votre équité, à votre bon sens, à votre honneur, entre vous qui demandez le maintien de cette loi, [247] et l’esclave qui en demande le retrait : de quel côté est juste et bon de se tourner ? Au retrait, vous ne perdrez tout au plus qu’une partie de votre fortune, au maintien, l’esclave continuerait à perdre pour l’éternité la somme intégrale de ses droits naturels. Répondez, si vous étiez à notre place vous mettriez-vous comme Bonaparte avec les blancs par la noble raison que vous êtes blancs ? Non, vous vous mettriez avec les noirs par la plus noble raison que les noirs souffrent et se dégradent. Quant à nous personnellement, en vérité nos opinions politiques même ne sont pour rien ici ; nous ne sommes pas mus comme dans nos principes démocratiques par une aversion orgueilleuse de tout despotisme ; et si l’on fouillait en notre cœur, on ne le trouverait animé que par la conscience inflexible des devoir éternels de homme envers l’homme. — L’humanité tout entière doit enfin entrer dans les seules voies qui puissent conduire au bonheur, s’il existe, la modération et la charité. La France ne peut tolérer plus long-temps chez elle un état de choses qui par sa nature même exclut la modération et la charité. La puissance du maître comme celle de l’homme riche a son côté brillant, et qu’il leur est permis de regretter, mais elle est égoïste et mauvaise. Sachez donc, sachons donc tous, maîtres et bourgeois, princes de la terre, sachons y renoncer. Il n’y a de beau en morale que ce qui est bon.
Que vingt mille maîtres ne veuillent rien changer, cela se conçoit ; mais soyons justes et convenons que les âmes dévouées n’ont pas tort de désirer mieux pour deux cent soixante mille esclaves. On nous a dit un jour : « Mais, monsieur, pourquoi donc les philantropes de Paris s’occupent-ils tant des nègres des Antilles ? qu’est-ce que ça vous fait à vous que les nègres soient libres ou esclaves ? » La question nous était adressée sous un gros arbre, où l’interlocuteur et nous avions trouvé refuge contre un grain qui tombait. « Cet arbre qui nous abrite a peut être mis cent ans à pousser ; il ne put jamais prêter son feuillage contre le soleil ni contre l’orage à celui qui l’a planté. » Telle fut notre réponse.
[248]
Ceux qui s’étonnent aussi naïvement de l’attache des philantropes à la cause des esclaves sont rares aux colonies, il est généralement admis que tout abolitioniste est un imbécile, dupe de l’Angleterre, ou un fourbe, vendu aux betteraviers. L’Angleterre et les betteraviers sont les Pitt et Cobourg des colonies. Le cercle d’ignorance où la censure et leurs mauvais conseillers enferment les créoles, est d’une rigidité incroyable ; ils en sont encore à cette vieille erreur que l’Angleterre en donnant l’abolition aux West-Indies ne le fit que dans un intérêt égoïste. Ils vous disent imperturbablement que la philantropie britannique a joué le monde entier, leurs députés salariés sont chargés de répéter « que si les Anglais méthodistes, baptistes, quakers, ont poussé à l’abolition par principe religieux, le gouvernement a été mu par des calculs purement politiques [183] ; » que sachant bien qu’il est impossible de faire du sucre de cannes au Mexique, en Asie, ni dans les immenses plaines de la Guyane, ou du sucre [249] de betteraves en Europe, le cabinet de Saint-James a voulu détruire toutes les Antilles, pour accaparer le monopole de l’indispensable denrée qu’il fabriquerait dans l’Inde. Ainsi l’Angleterre aurait augmenté sa dette de 500 millions de francs, elle aurait sacrifié l’existence de quatre-vingt mille des propres enfans de la Grande-Bretagne établis dans le West-Indies, pour l’éventualité lointaine d’un avenir impossible ; elle aurait escompté d’avance à ce taux criminel ses douteux succès de l’Inde, dans l’espérance comme nous n’avons pas été peu surpris de l’entendre répéter à la tribune le 17 janvier 1842, dans l’espérance de concentrer en ses mains le monopole des denrées coloniales ! Et ces infâmes calculs elle s’y serait livrée, sûre que l’Europe entière ne pourrait deviner de pareils desseins, et se viendrait prendre à de gros piéges recouverts d’une fausse philantropie.
Nous sommes désolé d’en juger ainsi, mais nous n’avons qu’un mot contre un tel raisonnement c’est qu’il est absurde, aussi absurde que l’idée de domination des mers prêtée à la Grande-Bretagne. Où sont les niais ? parmi ceux qui rêvent ces folles et monstrueuses inventions, ou parmi ceux qui disent « vous faites le gouvernement britannique plus égoïste qu’il n’est. Il recula tant qu’il put l’affranchissement. Lui, en proposant l’abolition et les chambres en la votant, ne fit que céder à la force irrésistible de l’opinion publique. Une seule pétition des dames de la Grande-Bretagne fut présentée à la séance des communes du 15 mai 1833, chargée de cent quatre-vingt sept mille signatures. C’est même comme cela que s’explique d’une manière très simple, le phénomène autrement incompréhensible du législateur décrétant l’abolition du fouet pour les nègres des Antilles, tandis qu’il le maintient pour les soldats et les marins de la métropole. Le peuple en masse s’était saisi de la question de l’affranchissement, il le voulait, le parlement obéit. Le ministre des colonies, lord Stanley ne le dissimula point « en présence de l’unanimité du peuple anglais, disait-il aux communes (15 mai 1833), le temps [250] est passé où le parlement se pouvait demander si l’esclavage doit ou ne doit pas être maintenu. Ce qui est à décider aujourd’hui, c’est quel est le moyen le plus prompt et le plus convenable de l’abolir. » Le parlement sut très bien ce qu’il faisait, les hommes d’État les plus entrés dans la direction publique du pays étaient loin de lui en imposer. Le duc de Wellington, dans la séance du 4 juin 1833 déclara « que les Indes occidentales rapportaient par an à la métropole 12 millions sterlings (300 millions de francs), dont 5 (25 millions de francs) entraient comme droit de consommation dans les coffres de l’État, » plus tard le 25 juin, il dit encore « les rapports commerciaux existans depuis si long-temps et avec de tels avantages pour nous entre la métropole et les colonies, n’intéressent pas seulement au plus haut degré notre commerce ; leur importance touche jusqu’à notre puissance navale et de fait à tout ce qui peut ajouter à la gloire et à l’honneur de l’empire. »
Quand donc saura-t-on ces choses ? N’est-il point déplorable qu’il faille encore y revenir en 1842, et justifier les Anglais d’avoir jamais conçu un projet stupide ? Si les colons ne veulent pas nous en croire, qu’ils écoutent du moins les hommes les plus éclairés parmi eux, leurs propres délégués. Ceux-là, comme M. Lacharrière, leur diront avec nous : « Lors de la discussion du bill d’émancipation, le cabinet anglais n’était pas maître du terrain ni de la ligne de conduite qu’il eut dans cette affaire. Voici le langage qu’un ministre tenait en août 1833, à la chambre des pairs d’Angleterre. « Que cette ligne soit bonne ou mauvaise, qu’elle soit juste ou injuste, que les conséquences en soient heureuses, fâcheuses ou même fatales, c’est ce que je ne chercherai pas à discuter ; mais ce que je maintiendrai, c’est que le cabinet n’a point, de son chef, pris l’initiative de la mesure en délibération [184]. » [251]
M. Favard, délégué des blancs de Cayenne, délégué instruit, dévoué, doit également être une dupe ou un agent caché de l’Angleterre, car voici comme il s’exprime dans une de ses brochures, en faveur de ses commettans. « C’est une grande erreur de croire l’Angleterre peu intéressée à l’existence de ses colonies d’Amérique, et de supposer que son commerce de l’Inde suffirait pour entretenir sa marine marchande, et préparer les équipages qui montent ses flottes en temps de guerre. On ne réfléchit pas, en accueillant de pareilles idées, à l’importance du commerce des colonies de l’ouest ; lié avec celui du nord, il en est, en quelque sorte, comme l’aliment indispensable, puisqu’en effet c’est dans ses îles d’Amérique que l’Angleterre trouve le débouché des produits de ses pêcheries, véritable pépinière où se forment les équipages de ses vaisseaux. On oublie que ces mêmes colonies consomment annuellement pour une valeur de 120 millions de francs d’objets manufacturés dans leur métropole ; qu’elles alimentent un mouvement d’affaires de 250 millions, et qu’elles occupent une navigation de plus de 250 mille tonneaux. »
Mais si la perfide Albion n’a trompé personne dans l’affaire de l’affranchissement, comme l’abolitioniste ne peut avoir une bonne pensée, on le dit animé par de misérables désirs de vanité. La délivrance des noirs est un piédestal dont il se sert, faute de mieux, pour monter à la popularité ! Prenez garde, messieurs les colons, vous vous condamnez vous-mêmes. Le peuple est donc contre vous, si c’est lui plaire que de s’en prendre à ce que vous avez. L’opinion publique est un écho intelligent ; elle ne répète que les mots bien sonnans. Persuadez-vous donc enfin que l’humanité seule pousse la France à vouloir ce qu’elle veut. Si elle oublie parfois qu’il n’y a pas que des esclaves aux colonies, qu’il y a aussi des maîtres dont un changement doit modifier et peut bouleverser l’existence, c’est que l’acharnement avec lequel vous défendez l’esclavage lui fait oublier que vous n’en êtes pas responsables. Est-ce en vérité au moment où, dès le premier cri qui s’éleva des décom [252] bres du tremblement de terre de la Martinique, elle ramassa deux millions de souscription pour vous les offrir ; que vous avez bonne grâce à l’accuser d’être ennemie des créoles ? Mais la France ne vous aimât-elle pas, elle serait facilement justifiable ; car si vous n’êtes pas coupables de l’esclavage, vous êtes coupables de le vouloir garder, et en prétendant conserver des esclaves, vous vous montrez indignes d’elle qui ne veut plus même de nobles.
S’il pouvait rester quelque doute sur l’illégitimité de votre propriété pensante, il suffirait de faire remarquer qu’elle n’est défendue que par vous et vos salariés. Vous n’avez pas eu un député ni un journaliste qui vous prêtât sa parole ou sa plume pour rien ; aux colonies même on ne rencontre, disposés à soutenir jusqu’au bout l’esclavage, que ceux qui ont des esclaves. Toutes les villes, détestablement servies par vingt mille nègres de maison chèrement payés qui ne font pas l’ouvrage de cinq mille domestiques, verraient sans beaucoup de peine l’affranchissement [185]. L’intérêt seul veut donc maintenir la servitude, puisque ceux-là seuls qui en profitent la soutiennent, puisque, là où les hommes n’y sont pas pécuniairement engagés, ils en demandent d’impulsion spontanée la destruction. Il faut bien croire qu’il y a quelque chose de moral dans une destruction que tant de personnes d’âges divers et de sentimens politiques opposés voient tous du même œil, quoiqu’ils n’aient rien à y gagner ni les uns ni les autres. Si l’affranchissement était injuste, aurait-il tant de partisans ? une telle unanimité devrait vous ouvrir les yeux et calmer vos résistances.
Ceux qui n’ont rien à perdre ont beau jeu aux utopies, dites-vous ; mais ceux qui ont beaucoup à perdre, dirons-nous à notre tour, sont des juges trop prévenus pour apprécier [253] sainement la valeur des réformes. Pourquoi supposez-vous l’homme tellement dépourvu d’esprit de justice que votre cause lui soit indifférente, parce que ses rentes n’y sont pas compromises ? Que de choses d’ailleurs à répliquer là-dessus. Nous croyez-vous donc la vue si courte que nous ne sachions pas qu’en attaquant votre propriété coloniale, nous faisons large voie à ceux qui attaquent avec autant de justice notre propriété héréditaire ? À chaque jour son œuvre. En nettoyant les écuries d’Augias, Hercule dut commencer par les plus grosses ordures.
Au reste, nous ne permettons plus de dire que les abolitionistes en parlent à leur aise ; il n’est pas vrai que nous soyons tous désintéressés dans la question. Il y a parmi nous des propriétaires d’esclaves. Aux preuves assez claires que nous ayons données tout-à-l’heure il nous est facile d’en ajouter d’autres. M. Bovis, maître de deux cent cinquante noirs, conclut à l’abolition et à l’abolition immédiate dans une note motivée que nous mettrons bientôt sous les yeux du lecteur. En parcourant la Guadeloupe, nous y trouvâmes assez d’habitans tout acquis au souverain principe, pour qu’il nous vint l’idée de les réunir et de fonder à la Guadeloupe une société d’abolition exclusivement composée de propriétaires ; nous soumîmes le projet à M. Lignières qui, par sa position prise de longue date, en était le vulgarisateur naturel ; et voici textuellement sa réponse : « Une association, formée par des colons pour arriver à la liberté des noirs, serait assurément propre à faire faire des pas de géant à la question ; mais vous avez dû remarquer que les colons sont, pour me servir de leur expression, casaniers, ils ne bougent pas de chez eux ; nous autres abolitionistes colons nous nous prêcherions nous-mêmes, nous n’aurions que de rares auditeurs… La presse vaudrait mieux que cette association…
« Rassurez-vous, pourtant ; si une association n’est pas facile à former, le Cours, notre promenade de Tamarins est là, et c’est là, en placé publique, que je continuerai d’argumenter en [254] faveur de notre cause et de faire des prosélytes… N’êtes-vous pas tenté de rire des choses humaines, lorsque vous vous dites que celui qu’on vous signalait comme un mangeur de nègres ; tandis qu’on l’exposait à votre mépris, à votre haine implacable, obéissant à sa conscience, écoutant les inspirations de son cœur, s’exposait lui-même non pas au Lynch law (mes compatriotes ne sont point des barbares), mais aux abjurations de ses concitoyens, de ses amis ; et qu’aujourd’hui même, recueillant le fruit de ses efforts en faveur de l’humanité et de la justice, on le met au nombre des abolitionistes en qui l’on doit avoir confiance, parce qu’il a toujours été abolitioniste… »
Qu’il y eût ou qu’il n’y eût pas de propriétaires d’esclaves parmi nous, la cause n’en serait pas moins bonne ; mais nous espérons qu’après ce qu’on vient de lire les créoles de bonne foi, encore adversaires, renonceront à la négation de notre droit à parler d’abolition, sous prétexte qu’aucun de nous n’a rien à y perdre. En tous cas, peu importe, les abolitionistes veulent se rappeler toujours que le pain des planteurs ne doit point leur être arraché ; mais ils veulent n’oublier jamais que l’esclave a droit d’être mis en position de gagner librement le sien et non plus de le recevoir du bon vouloir d’un maître ; ils veulent se rappeler toujours que la fille du planteur ne doit pas perdre sa dot, mais ils veulent n’oublier jamais que l’esclave a droit d’être mis en position d’en gagner une pour la sienne. C’est méconnaitre son temps que d’envisager aujourd’hui la question coloniale sous une autre face, de se refuser à laisser monter de niveau l’homme esclave avec l’homme maître. La France a des colonies, elles sont habitées par trente mille blancs éparpillés au milieu de deux cent soixante mille noirs ; est-ce donc un crime et une folie de vouloir que les lois n’y soient plus faites en faveur des trente mille au détriment des deux cent soixante mille, d’exiger qu’il soit mis un terme à la perpétuation de cette incommensurable iniquité ?
On doit avoir souci des conséquences de l’abolition, et ne [255] pas y aller les yeux fermés ; mais il ne faut pas laisser de poursuivre l’établissement du souverain principe, sans donner trop de place aux craintes des colons. — Ils ont été malheureux jusqu’ici dans toutes leurs résistances et sur tous les points culminans du système colonial. Ils s’opposèrent avec violence à la suppression du commerce des nègres ; tous les argumens qu’ils emploient à cette heure contre l’émancipation, ils les épuisèrent contre l’abolition de la traite. Détruire la traite, c’était détruire les colonies. L’odieux trafic n’existe plus, les colonies subsistent, et les créoles conviennent aujourd’hui que son extinction a été un bienfait pour eux. Ils disaient que donner des droits politiques à la classe libre, c’était mettre les colonies à feu et à sang ; la classe libre est émancipée, et les colonies sont moins agitées qu’elles ne le furent jamais. Lorsque le gouvernement donna il y a huit ou dix mois, après sept années d’apprentissage, la liberté à quatre cents nègres de traite que l’on avait sauvés de l’esclavage et placés à la Martinique, ces échappés de la servitude devaient tout troubler et bientôt mériter la corde ; ils sont libres, et on n’entend pas parler d’eux. Il en sera, nous le croyons, de l’émancipation générale comme du reste. Qui sait ? peut-être les blancs nous béniront-ils un jour pour l’affranchissement qui aura rétabli leur fortune, tué le poison, et garanti leur tranquillité ; peut-être voudront-ils élever aux abolitionistes des statues d’ébène, comme disait avec une douce moquerie le pauvre Louis Maynard, ce jeune fils de la Martinique, qui s’était fait aimer en France, et qui est mort trop jeune, abattu dans un duel par le fusil d’un mulâtre.
En tous cas, que les colons approuvent ou n’approuvent point le principe, ils s’y doivent résigner ; il n’est plus aucune force au monde qui puisse empêcher son triomphe, il est porté par le courant des idées de réforme à une telle hauteur de vérité démontrée, que le nier aujourd’hui, c’est se perdre dans l’opinion publique. Au sein des chambres, hors des chambres, Partout, le sentiment général se prononce énergiquement et avec une sorte d’indignation contre le maintien de l’esclavage. [256] Les principaux membres de la société française pour l’abolition de l’esclavage portent noms Broglie, Passy, Lamartine, Odillon-Barrot, tous gens peu connus pour leur audace révolutionnaire. Il sera bien aux créoles d’accepter le vœu universel, non pas en se regardant comme sacrifiés par une métropole qui a grand intérêt au contraire à les voir prospérer, mais en se persuadant que c’est au nom du progrès de la moralité humaine qui abolit la torture, que la France exige l’abolition de la servitude ; au nom de la charité, que la nation à résolu de purifier un état social dont s’offensent la raison, la justice et l’humanité.
Nous ne savons sur quoi s’appuient ceux qui nous accusent de vouloir bouleverser les colonies à plaisir, ni de quelle nature serait ce plaisir, et encore moins quel serait son but ; mais nous savons, et nous l’avons prouvé, qu’il est au milieu de vous, créoles, parmi vos propres frères, beaucoup d’hommes qui sentent que ce qui est ne peut demeurer. Ceux-là veulent l’ordre, ils y sont intéressés autant que les autres, ils veulent que le travail, condition vitale de toute société, soit organisé ; mais sans se faire illusion sur les difficultés de la réforme, ils blâment les reculemens de la majorité ; ils veulent cette réforme, parce qu’elle est raisonnable, parce qu’elle est juste, parce qu’elle est humaine, et ce sera leur dévouement assuré aux mesures émancipatrices de la métropole qui préservera les colonies de tout mal.
Puissent ceux qui résistent aujourd’hui les aider alors ! Plus l’esprit public des créoles se modifiera dans ce sens, plus ils comprendront la nécessité philosophique de l’affranchissement ; et plus vite on surmontera, au profit des particuliers comme à la gloire du siècle, les embarras des premiers momens. Leur devoir de bons citoyens est de renoncer courageusement au passé. Sans leur concours volontaire, il sera difficile que l’émancipation ait promptement une issue favorable. On ne peut songer sans frémir aux troubles prolongés d’une société en reconstruction, si, avec la surveillance à exercer sur les nouveaux affran [257] chis, la métropole avait encore à renverser comme des obstacles les anciens maîtres rebelles à la loi de fraternité. Que les Français, propriétaires aux Antilles, ne se disent pas comme on les entend dire : le travail libre est impossible ; qu’ils répètent en s’unissant : il faut que le travail libre soit possible. Les peuples sont sortis victorieux de crises plus difficiles que celles par où ils doivent passer. Liberté, égalité, fraternité ; dans ces trois mots est l’inévitable destinée du genre humain. Qui voudra l’arrêter se brisera, aux Antilles comme en Europe.
[258]
CHAPITRE XVIII.
INDEMNITÉ.↩
Les propriétaires de Guatemala refusent l’indemnité lors de l’abolition de l’esclavage dans la république. — L’abolition est aujourd’hui une question d’argent. — L’indemnité est due, parce que si le fait de posséder des nègres est illégitime, il n’est est pas moins légal. — L’indemnité pour la terre et les bâtimens est irrationnelle et impossible. — Moyens de déterminer l’indemnité. — 1, 000 fr. par tête d’esclave. — Le trésor rentrera dans ses déboursés.
Un des premiers actes de l’assemblée constituante du Guatemala qui prit, en se séparant du Mexique, le nom de république fédérale de l’Amérique centrale, fut après la déclaration d’indépendance d’abolir l’esclavage (17 avril 1824). On stipula une indemnité pour les propriétaires, mais ceux-ci la refusèrent, disant « qu’ils ne voulaient pas souiller un acte de justice et d’humanité par des exigences égoïstes. » Le corps législatif justement fier d’une mesure si honorable pour la nation fit graver le décret avec la résolution des propriétaires sur une table d’airain, et la plaça dans le lieu de ses séances. La constitution de la nouvelle république du centre américain promulguée postérieurement à cette résolution la confirma d’une manière solennelle par un acte ainsi conçu : « Tout homme est libre dans la république, celui qui se soumet à ses lois ne peut être esclave, celui qui fait le commerce des esclaves ne peut être citoyen (art. 13, sect. II du citoyen.)
De telles résolutions sont grandes et nobles, mais elles ne sont prises que par des peuples livrés à l’enthousiasme d’une rénovation. Nous l’attendrions des créoles si la fortune de la France nous rendait une nuit du 4 août. Mais le temps n’est pas aux sacrifices généreux et d’élan, et la misère où sont plongées les colonies aussi bien que les appréhensions de l’avenir, excusent jusqu’à un certain point les créoles de ne point vouloir donner [259] la liberté à leurs nègres pour rien. Leur fortune est là. La plus grande partie de leur existence est engagée, il ne faut pas se le dissimuler, dans la transformation qui se prépare, leur position mérite intérêt. L’argent domine la vie et puisqu’ils jugent leur argent compromis dans l’affranchissement, on ne doit pas de sang-froid leur en vouloir beaucoup de le défendre. Il est difficile de faire comprendre à un homme la nécessité philosophique de sa ruine (ils croient à la leur), pour l’élévation d’une race qu’il est accoutumé de mépriser et de voir méprisable.
Les colons sentent bien tous, malgré leurs mauvais propos, que l’esclavage est un contre-sens politique. S’ils veulent le statu quo, c’est qu’ils ne croient pas à la possibilité de cultiver avec la liberté, et quand on a peur pour son pain on est pardonnable d’avoir des craintes exagérées.
Le conseil des délégués, plus sage que les conseils coloniaux, a reconnu « que l’affranchissement des noirs n’était plus qu’une question de temps et d’argent, » nous supprimons la première partie de la proposition au nom de la morale, et nous disons : « L’affranchissement n’est plus qu’une question d’argent. » L’argent ! Quand on regarde bien au fond de tous ces graves débats où sont en jeu la liberté et la fortune des Français d’outre-mer, on voit que là encore il domine tout. Les chambres qui savent que les nègres veulent être libres, effrayées de ce que coûterait l’affranchissement n’osent le prononcer, les colons qui savent que les nègres doivent être libres, disent le contraire, de crainte qu’on ne leur donne pas compensation.
De nos conversations avec les planeurs il résulte pour nous qu’ils ne se montrent si rebelles au progrès que parce qu’ils ont peur de tout perdre. Le jour où l’indemnité leur sera accordée, sauf quelques fous, ils se soumettront sans plus de résistance. Bien des fois nous leur avons entendu finir une discussion avec nous par ces mots : « Eh bien ! si vous voulez absolument faire votre expérience libérale, que ce ne soit pas à nos dépens. »
Que la France les désintéresse donc et ils abandonneront [260] assez vite leur chose humaine. Oui, qu’ils soient désintéressés et l’on n’entendra plus des Français répéter au xixe siècle que la servitude est un état social légitime. Laissons ces hideux restans de barbarie aux peuples, sur lesquels le soleil de la raison n’a pas encore versé sa lumière.
Nous dirons peu de mots sur l’indemnité : nous croyons et nous avons toujours cru qu’elle est due.
L’esclavage est le malheur des maîtres et non pas leur faute, la faute est à la métropole qui le commanda, qui l’excita. L’émancipation est une expropriation forcée pour cause d’utilité humanitaire, comme l’a dit un habitant. L’indemnité est donc un droit pour les créoles. Tout ce que l’on peut avancer pour soutenir le contraire ne peut être que de l’injustice et du sophisme.
Sur ce point, non plus que sur l’abolition, il ne nous paraît pas qu’aucune transaction soit admissible.
Sans doute, la servitude a toujours été un abus, un acte de violence, un crime, et le crime n’engendre pas de droit ; mais le crime politique engendre des faits qui ont leur valeur légale et commandent la réserve. Si l’on ne pouvait parvenir à la destruction du mal qu’au prix d’horribles déchiremens, il faudrait bien s’y résoudre, quoi qu’il en pût coûter ; mais puisqu’il est possible de les éviter, il n’y a nulle faiblesse à le faire. Il est beau à un homme d’être inflexible, de passer sur toute considération, amitié, famille, fortune, joie et repos, pour accomplir la vraie loi, pour satisfaire à un principe sacré ; mais un gouvernement veille sur tant d’intérêts, qu’il est dans son devoir de ménager des faits accomplis.
Ceux qui prétendent qu’il est permis d’arracher aux maîtres leur propriété noire, purement et simplement, parce que cette propriété est et a toujours été illégitime, méconnaissent qu’elle est et a toujours été légale, ils oublient que le pacte social qui la protége ne peut rien défaire violemment de ce qu’il a institué législativement.
Nulle personne dans le monde ne pouvait dépouiller les nègres de la liberté ; ils ont donc le droit de la conquérir par tous [261] les moyens imaginables, car ils n’ont pas souscrit au marché ; mais nous n’avons pas celui de la leur accorder, car nous l’avons ratifié ; de la leur accorder, je veux dire, sans compensation pour le possesseur qui les acheta sous la garantie des institutions du pays. Ce serait réparer un crime par un autre crime ; ce serait leur appliquer la loi cruelle dont ils se disent les exécuteurs à l’égard des Africains, les rendre responsables de la cruauté de leurs pères. « Le droit de posséder tel morceau de terre, a dit M. Guignod, n’est pas plus de droit naturel que celui de posséder un homme : ces deux droits sont ceux de la force légalisée par des nécessités sociales. Serais-je admis à prêcher contre votre propriété du sol en Europe ? Non. Je respecte votre droit, respectez le mien ; et si vous ne voulez point le laisser exister, payez votre fantaisie en espèces, au lieu de la payer en phrases sur la dignité humaine. » Rien à répliquer à cela.
Indemnité donc pour les créoles, indemnité raisonnable, loyalement débattue de part et d’autre, parce que, si les colons ont des esclaves, c’est la France qui l’a voulu ; indemnité, parce que les créanciers des colons dépouillés seraient subsidiairement dépouillés, eux qui prêtèrent sur la garantie d’un bien reconnu légalement ; indemnité, parce que de jeunes héritiers créoles qui ne mirent jamais le pied aux colonies, et ne peuvent en vérité passer pour des fauteurs d’esclavage, n’auraient plus d’héritage ; indemnité, parce que c’est assurer la réussite de la grande mesure, amoindrir la secousse inévitable, en donnant aux colons les moyens pécuniaires d’entretenir le travail libre ; et il existe une raison plus forte, plus haute, plus puissante, plus absolue, plus sainte que toutes celles-là ; indemnité, parce que c’est justice.
Notre conscience ne nous laisse aucune hésitation, et ne nous permet d’admettre aucune discussion sur ce point. Mais si l’indemnité est équitable en principe, il serait aussi inique de la comprendre comme la comprennent les colons, que de la refuser.
[262]
« Nous ne croyons pas, dit encore M. Guignod, que notre esclave soit malheureux, qu’il ait besoin de la liberté ; nous ne croyons pas au travail libre : on ne peut nous demander des sacrifices à une opinion qui n’est pas la nôtre. Si vous croyez au travail libre, prenez ma place ; si vous n’y croyez pas, abstenez-vous de créer un péril à ma propriété, ou payez le préjudice autant qu’il vaut. » Cela veut dire, nos bâtimens d’exploitation, nos terres, nos bestiaux n’ont de valeur que mis en rapport avec les esclaves qui les exploitent. Vous devez donc nous défrayer du prix des terres, des bâtimens et des bestiaux ; puisque les esclaves supprimés, terres, bâtimens et bestiaux ne valent plus rien.
Ce raisonnement nous mènerait directement à acheter et liquider les îles entières depuis le premier clou jusqu’à la dernière cheville, car les propriétaires des villes et des bourgs viendraient dire : nous ne pouvions louer nos maisons que parce qu’il y avait travail à la campagne, vous détruisez le travail nous ne pourrons plus louer nos maisons, achetez-les. Et bientôt les colons demanderaient qu’on leur payât le passage et le fret de leurs bagages pour revenir en Europe.
Quels cris de désespoir les créoles ne pousseraient-ils pas si on les obligeait, même par un tel moyen à vider le pays ! mais nul ne peut songer à cela sérieusement. L’état ne paie et ne doit payer que ce qu’il prend de la propriété dont il s’empare pour cause d’utilité publique, les colons ne peuvent espérer raisonnablement qu’on en agisse d’autre façon vis-à-vis d’eux. Ils ont une propriété mauvaise, c’est un malheur ; ils doivent en subir les conséquences. Seulement il est de la loyauté et de la générosité française de rendre ces conséquences aussi peu désastreuses que possible. Que l’indemnité soit large, dépassons le but pour être sûr de l’atteindre, car ne dut-on pas obtenir le travail libre, c’est notre opinion qu’il n’en faudrait pas moins affranchir ; mais restons dans les limites du possible. Les intérêts des colons sont respectables, ceux des noirs le [263] sont bien d’avantage, parce que les noirs sont plus malheureux que ne le seraient jamais les blancs, si même l’’émancipation ne réussissait pas.
Selon nous donc on ne doit que le prix du nègre affranchi. Le grand point est d’évaluer ce prix, de chercher avec tous les soins imaginables de prudence et de justice à trouver un chiffre qui réunisse l’assentiment général, en sorte que nul n’ait légitimement à se plaindre ? La voie la plus simple serait de nommer une commission ad hoc composée par moitié de délégués métropolitains et coloniaux ; six, huit, dix membres de chaque côté, qui tous ensemble devraient s’adjoindre à l’unanimité un membre dont la voix servirait à former une majorité, pour le cas ou les plénipotentiaires en nombre égal ne parviendraient point à s’entendre.
Si l’on craignait qu’un tel congrès n’entraînât des lenteurs interminables ; le parlement pourrait trouver dans le passé des antécédens propres à le fixer d’une manière précise. La valeur des esclaves pris en masse, a été depuis long-temps et à différentes époques déterminées par les colonies elle-mêmes, et mettent parfaitement en état de régler à coup sur les prétentions actuelles. Examinons :
Des esclaves ayant été enrôlés et armés à Saint-Domingue pour la défense de la colonie, il fut stipulé (ordonnance locale du 14 février 1759) que ceux qui périraient au service seraient payés à leurs maîtres à raison de 2000 livres coloniales par tête (1333, 33). Un arrêt du conseil colonial du Cap du 29 novembre 1769, prenant en considération l’augmentation du prix des nègres, éleva de 600 livres à 1200 le taux du remboursement à effectuer pour l’esclave justicié.
Un arrêt du conseil d’état du 1er mai 1778, fixa pour la Martinique l’indemnité à payer dans ce dernier cas à 1300 livres coloniales par noir, et 1200 livres coloniales par négresse. Enfin les indemnités pour esclave condamné à mort ou aux travaux forcés à perpétuité sont aujourd’hui fixées ainsi qu’il suit : à la Martinique, 1111 fr. 11 cent. par chaque esclave, sans dis [264] tinction d’âge ni de sexe (arrêté local du 11 avril 1807) ; à la Guadeloupe, 1081 f. pour un noir ; 972 f. pour une négresse, sans distinction d’âge (arrêté local du 1er février 1831) ; à Bourbon, pour un esclave de seize à quarante-cinq ans sans distinction de sexe, 1500 fr. ; pour un esclave au-dessous de cet âge, 1200 fr. (arrêté local du 12 décembre 1829) ; enfin à Cayenne, pour un noir, 1200 fr. ; pour une négresse 1000 fr., sans distinction d’âge (arrêté local du 23 octobre 1829).
Ce sont les créoles eux-mêmes qui ont fixé ces termes. En se renfermant dans leurs limites on doit atteindre la vérité. Ainsi donc, si l’on voulait une somme nette pour chaque tête de nègre de tout âge et de tout sexe, l’adoption du chiffre de 1000 fr. satisferait, il nous semble, aux plus larges désirs de l’équité [186]. 1000 fr. par esclave élève, nous le savons, considérablement le prix des individus valides, car les enfans, les infirmes et les vieillards coûtent à leurs possesseurs au lieu de leur rapporter ; les habitans conviennent que sur le chiffre total de leur atelier, ils n’ont guère que le tiers travaillant d’une manière effective ; mais il serait peu digne de la France de ne se point dégager de tout esprit de mesquinerie, de marchander dans une circonstance de cette nature. « L’abolition, mue par un principe aussi élevé que celui de l’humanité, ne doit pas s’effectuer au trébuchet d’un traitant, » comme nous l’écrivait avec originalité M. Bovis, planteur de la Guadeloupe. Il n’est pas mal non plus de payer les nègres un peu au-delà [265] de leur valeur, afin de compenser la moins value qu’éprouveront peut-être les bâtimens et la terre durant les premiers mois où il y aura sans doute diminution de travail. Sûr d’avoir été généreux, on pourra du haut de sa bonne conscience être insensible aux plaintes des déraisonnables, aucune douleur n’aura droit de maudire l’œuvre sainte, on aura fait plus que justice.
Le nombre total de la population esclave de toutes les possessions françaises s’élève à deux cent soixante mille [187]. Ce serait donc 260 millions que la métropole aurait à payer pour faire disparaître la servitude qui souille encore quelques terres françaises. La France doit donner cette somme et elle la donnera. Il ne s’agit pas du trésor, il s’agit de la morale. Il faudrait désespérer de la charité de la grande nation, si l’on pouvait douter d’obtenir des chambres l’argent nécessaire pour désinfecter les colonies. Elle a pu donner un milliard aux émigrés, elle a pu jeter 140 millions dans les fortifications, et elle ne pourrait payer l’affranchissement ! Nous ne le voulons pas croire.
Pourquoi tant se méfier des dispositions pécuniaires du parlement. L’indemnité une fois reconnue, légitime en droit et en fait, on ne peut pas, on ne doit pas supposer que nos chambres veuillent se déshonorer aux yeux de l’univers en refusant l’émancipation par un vil sentiment d’économie. Au reste, que les calculateurs se rassurent. L’argent donné pour faire un homme libre d’un homme esclave est de l’argent placé à bon intérêt, et la fortune publique ne peut qu’y gagner. Le travail intelligent rapportera le centuple du travail inintelligent. Le trésor retrouvera plus vite qu’on ne pense ses déboursés. L’É [266] tat, comme l’a dit M. Boyer, président du tribunal de première instance de Fort-Royal, dans un beau mémoire que l’on doit regretter de ne point voir publier, « L’État rentrera tôt ou tard dans ses avances par le rapport des impôts personnels frappé sur tous les nouveaux citoyens. Dix millions de rente n’augmenteraient pas le budget d’un centime par franc, et ce grand opprobre de la civilisation serait effacé, et dans moins d’un quart de siècle cette dépense, qui semble énorme, se trouverait n’avoir été qu’un placement productif. »
Il ne convient pas que la France en juge autrement.
[267]
CHAPITRE XIX.
DE LA PARESSE NATIVE DES NÈGRES.↩
Fécondité des Antilles. — Les blancs ne sont pas moins indolens que les nègres aux colonies. — La paresse est le propre de tous les hommes encore non civilisés. — L’esclave ne peut prendre aucun intérêt au travail. — Pourquoi les affranchis ne travaillent pas. — Aux Antilles, l’esclavage a frappé l’agriculture d’ignominie.
Maintenant que nous avons un peu éclairé notre marche, examinons les choses de plus près. La grande objection des créoles de sens et le grand embarras de quelques abolitionistes pour l’affranchissement, c’est que, dit-on, le travail libre est impossible. Ceux qui ne savent point ou ne veulent point savoir, croient ou feignent de croire que les massacres de Saint-Domingue furent le résultat de l’émancipation ; ils évoquent le sanglant fantôme et s’obstinent à considérer la mort des blancs comme la conséquence de la liberté des noirs. Pour d’autres, en plus grand nombre, c’est dans la fécondité même de la terre et dans la paresse naturelle du nègre qu’ils trouvent leur plus grand sujet de crainte.
Heureux pays que celui où l’on reproche au ciel ses magnificences, où trois mois d’hiver lèveraient tous les obstacles ! Là, en effet, le sol donne des fruits presque sans culture ; c’est une force, une végétation luxuriante qui produisent avec une largesse inouïe ; rien n’est moins rare que de voir aux Antilles sur un manguier, par exemple, des fleurs, des fruits verts, des fruits murs et de vieilles feuilles jaunissantes à côté de bourgeons entr’ouverts. Cette immense fertilité ne s’arrête jamais. La nature semble être embarrassée de ses trésors et les jeter à profusion, comme une mère laisse quelquefois s’épancher inutile le lait de son sein trop fécond. — Pour tout dire en un mot, [268] deux carrés de terre (six arpens) plantés en bananes ont donné à M. Bernard (du Robert), chaque lundi, pendant neuf mois, quinze cents livres de substances nutritives. M. Gosset a fourni l’ordinaire de manioc à cent dix nègres pendant neuf mois, avec une pièce de sept arpens et demi plantée de cette racine. On nous à cité un cadenatier [188] qui rapporte quinze cents francs annuellement à son propriétaire, et M. Brière (Macouba) nous a montré un arbre à pain qui lui donne tous les ans mille fruits, de chacun quatre livres, terme moyen ! — Bienfaisante jusqu’à la prodigalité, la nature ne prend pas même sur la récolte ses élémens de reproduction ; elle ne prélève pas la dîme sur la gerbe du moissonneur. Il suffit de mettre en terre la pointe supérieure de la canne, partie privée de sucre, pour obtenir une canne nouvelle. Les tubercules de manioc restent intacts au cultivateur, les plans se trouvent dans le petit arbuste qui les porte, et il en fournit douze ou quinze. La patate se reproduit aussi par un bout de sa liane sans avoir à sacrifier la moindre parcelle du fruit ; quand le bananier a donné son énorme régime, on le coupe, et il renaît de ses racines plus jeune, plus fécond que la veille !
Les maîtres placent le nègre émancipé, tel qu’il est, sobre, frugal, avec des besoins tellement restreints, qu’à vrai dire, il n’en a pas : habitué à se nourrir depuis le commencement jusqu’à la fin de l’année d’un peu de morue salée et de farine de manioc, à se passer presque d’habillement, à se loger dans une petite hutte enfumée qu’il peut construire et réparer tout seul, l’esprit sans aucun raffinement, le palais sans aucune délicatesse ; les maîtres, disons-nous, qui ont réduit à ce degré les bienfaits de la civilisation qu’ils ont révélée aux noirs, placent l’homme que nous venons de décrire [189] au sein des prodigalités de la nature tropicale, et ils s’épouvantent, supposant qu’il ne travaillera pas. [269] Rien ne pourra vaincre, disent-ils, la paresse native de l’homme noir ; « le travail lui est antipathique, et l’imprévoyance est dans sa nature [190]. » À cela nous ayons une première chose à dire : si vous êtes convaincus que le nègre est nativement paresseux, nous vous tenons pour dénués de sens commun de persister à vouloir faire travailler un être que la nature n’a pas destiné au travail ; d’un autre côté, si vous croyez que cette paresse native puisse être vaincue par des moyens coërcitifs et les douleurs du fouet, nous vous tenons pour mauvais logiciens de ne pas croire qu’elle puisse être vaincue par les passions humaines, les moyens moraux et les douces voies de l’éducation. Ainsi, sur votre propre terrain, nous vous battrions aisément ; mais à notre avis, vous vous êtes trompés : votre proposition, absolue comme vous la posez, est une complète erreur ; elle n’a quelque chose de vrai que relativement. Au lieu de s’appliquer au nègre seulement, elle s’applique à l’homme tropical et surtout esclave.
Le colon n’est pas moins indolent que le nègre, et l’européen lui-même si actif, si impétueux d’abord, quand au bout d’un an il a jeté son premier feu, subit l’influence du climat. Il n’échappe point à cette main brûlante des Antilles qui énerve tous les êtres vivans. Il y aurait mille contes amusans à citer pour donner une idée de la part qu’il faut faire au soleil dans les pays chauds. On voit aux colonies des garçons blancs de sept et huit ans auxquels il faut une négresse pour s’habiller ? Une créole assise laisse tomber son mouchoir à côté d’elle. — Elisia, crie-t-elle avec nonchalance. — Mame, répond l’esclave une minute après, et trois minutes se passent ; alors la maîtresse appelle encore sans humeur, sans colère, tant l’habitude est prise. Elisia ? — Moi qu’a vini, mame, reprend l’autre ; mais tout le monde sait qu’un moi qu’a vini des Antilles se prolonge toujours de cent vingt à cent cinquante secondes. Deux minutes [270] s’écoulent donc encore avant l’arrivée de l’indolente Elisia. — Ça ous v’lé, mame (que voulez-vous, madame) ? — Ous pas vois, ma ché ? ba moi mouchoi la qui tombé là (ne voyez-vous pas, ma chère, donnez-moi ce mouchoir qui est tombé). La négresse se baisse sans aucune marque d’étonnement et remet le mouchoir. — Ous pas vlé rien plus ché maîtresse (vous ne voulez rien de plus, chère maîtresse) ? — Non, Elisia, ous qu’a peut aller (non, vous pouvez vous en aller). — Près d’un quart-d’heure a été dépensé. La belle créole, en se donnant la peine d’allonger le bras, aurait ramassé son mouchoir.
Un de nos amis marié à Bourbon sort le matin de la chambre nuptiale et est tout surpris à l’heure du déjeuné de ne point voir sa femme réunie à la famille ; il monte et la trouve encore couchée. — Êtes-vous malade ? pourquoi ne vous levez-vous pas ? — Mais je ne puis, cette noce a bouleversé la maison apparemment, et la négresse qui me met ordinairement mes bas n’a point encore paru. » Cela ne vaut-il pas bien l’excellente histoire que nous raconta un habitant de la Martinique : « Je voulais, nous dit-il, montrer à un européen, ami presqu’aussi forcené que vous de la race noire, un échantillon de l’incurie caractéristique de vos protégés. Je plaçai mon chapeau en travers de la porte du salon où je le recevais, et je fis gageure que le domestique passerait par-dessus ou à côté mais n’y toucherait pas. J’appelai, un nègre vint, je lui demandai un verre d’eau qu’il me rapporta, et il s’en retourna enjambant quatre fois le malheureux chapeau. » L’aventure n’est pas vraisemblable, et cependant elle est vraie. Il règne aux Antilles, et bien plus chez nous que chez les Anglais, un énervement extraordinaire. Cette insouciance que les colons reprochent aux nègres, ils ne s’aperçoivent point qu’ils la partagent avec eux. Est-il un peuple plus imprévoyant au monde que les créoles et surtout que les créoles Français ? plus follement généreux, plus prodigue, moins occupé de l’avenir, pensant moins au lendemain, plus gaspilleur, plus dépourvu de tout esprit de conservation ? Ne sont-ils pas tous couverts des dettes que leur ont [271] léguées les dissipations de leurs pères ? Toutes leurs habitations ne sont-elles pas dans un désordre à faire honte à un européen ? Savent-ils y trouver un livre, un papier qu’ils cherchent ? Assurément il y a beaucoup de mauvaises habitudes en tout ceci, mais il y a bien un peu du climat. Doit-on s’étonner que les esclaves ressemblent aux maîtres ? — Ces faits posés, nous raisonnons ainsi : Le nègre n’est pas plus paresseux que le blanc. Le climat exerce sur tous les deux son influence donnée. Le blanc résiste et lutte davantage contre elle, parce qu’il est civilisé, parce qu’il est libre, parce qu’il a un intérêt dans le produit du travail. Le nègre cède à cette influence parce qu’il est ignorant, parce qu’il est esclave, parce qu’il n’a pas d’intérêt au travail, Aussi, toutes les fois que le blanc n’est pas placé sous le stimulant direct de son intérêt, le voit-on paresseux comme le nègre.
Les hommes sensés, parmi les colons, savent ce qu’il faut penser des vieux préjugés établis contre les nègres. C’est un créole d’un esprit fin et original, M. Chazel, propriétaire de cent cinquante esclaves au Lamentin qui nous disait : « Amenez ici douze enfans européens, et à vingt ans ils seront aussi paresseux que des nègres ; conduisez en France douze négrillons, et à vingt ans, ils seront aussi actifs que les ouvriers de vos manufactures. » M. Guignod a écrit la même chose en d’autres termes : « Envoyez aux colonies vos plus laborieux paysans, et au bout de six mois n’étant plus sujets aux besoins que crée le climat du nord, leurs forces physiques et partant leur énergie morale diminuant sous l’influence intertropicale, voyant que quelques heures de travail suffisent pour fournir à tous les besoins, ces hommes ne voudront bientôt plus prendre que la peine strictement nécessaire. » On voit que même aux colonies la paresse native des nègres est jugée à sa véritable valeur, et toute entière attribuée au climat.
Que l’on pèse bien la parole de ces hommes expérimentés !
Dire que la paresse et l’insouciance sont des vices indélé [272] biles au nègre, des inclinations innées chez lui, c’est ignorer les lois de l’humanité. La paresse n’est le mal de nature d’aucune race d’hommes, dès que la civilisation leur a montré les avantages du travail ; seulement leur activité reste à l’état virtuel jusqu’à ce qu’une circonstance plus ou moins heureuse la vienne développer. Les Caraïbes ne travaillaient pas, les Indiens de la Guyane ne travaillent pas. La paresse est commune à tous les hommes sauvages. Les Germains n’en faisaient pas plus que les Africains.
« Ils ont tous pour vêtement une saye qu’ils attachént avec une agraffe ou avec une épine, à cela près, ils sont nus et passent les journées entières auprès de leurs foyers [191]. Ils prolongent presque tous leur sommeil jusques dans le jour [192]. Le temps qu’ils ne donnent pas à la guerre, ils en passent un peu à chasser, beaucoup à manger et à dormir, sans s’occuper de rien. On voit les plus braves et les plus belliqueux abandonnant aux femmes, aux vieillards le soin de la maison, des pénates et des champs, languir eux-même oisifs et désœuvrés [193]. » N’est-ce pas textuellement ce que les écrivains espagnols nous disent des Caraïbes ? L’homme ignorant prend la paresse pour le repos.
Les Israélites au sortir des fers égyptiens, bruts et grossiers, avaient aussi la haine du travail, ils ne voulaient plus rien faire, et lorsque Josué eut disposé le partage des terres conquises, il y eut sept tribus des enfans d’Israël qui ne s’empressèrent pas du tout d’aller prendre possession de leurs lots ; ils jouissaient du far niente, et il y a grande apparence que cette disposition n’était pas nouvelle chez eux, car Josué leur disait en colère « jusques à quand croupirez vous dans la paresse [194]. » [273]
Si l’on daignait juger les nègres tels qu’ils sont encore, avec un peu plus de critique historique, on n’aurait pas d’eux l’opinion qu’on en montre ; on ne lancerait pas contre eux les paradoxes avec lesquels on espère couvrir le crime de la servitude. Les Germains n’avaient pas même l’excuse de la chaleur du climat pour expliquer leur fainéantise. Qui n’aurait pu dire alors, en se mettant au point de vue étroit des ennemis des nègres, que cette fainéantise était chez eux vice de nature ? Civilisez donc les esclaves, et ils deviendront ce que sont devenus les Germains et les Israélites. L’indolence n’est pas même d’une manière absolue le propre de l’abondance, elle tient au sommeil des facultés intellectuelles ; et nous prouverons, nous l’espérons du moins, que les influences du climat dont nous reconnaissons d’ailleurs la force peuvent être facilement combattues.
Lorsque la paresse se perpétue au sein de la civilisation, c’est la faute de la civilisation. Rien n’est donc moins philosophique que d’accuser l’Africain de fainéantise constitutionnelle, ce n’est pas l’Africain dans l’homme esclave qui est fainéant, c’est l’esclave ; de même que dans le lazzarone de Naples, le lepero du Mexique, l’Ibaro de Puerto-Rico, ce ne sont ni le Napolitain, ni le Mexicain, ni le Puerto-Ricain qui sont fainéans, mais bien le lazzarone, le lepero et l’ibaro. Changez le milieu et l’homme changera.
Ne nous occupons que du nègre des Antilles. Il ne montre aucune ardeur à l’ouvrage, il y répugne, précisément parce qu’il y est forcé ; il ne se presse pas, parce qu’il ne gagnera rien à se presser ; obligé de donner tout son temps, il le donne le moins serré possible, c’est tout simple ; dans les ateliers d’Europe n’a-t-on pas besoin d’un contre-maître pour activer et tenir en haleine les ouvriers à la journée. Ne préfère-t-on pas toujours les mettre à la tâche, quand cela est possible ? Il s’établit nécessairement une lutte entre le maître et l’esclave, celui-ci cherche à donner peu, car tout ce qu’il ne donne pas de fatigue est autant d’épargné pour lui ; celui-là cherche à avoir [274] beaucoup, car tout ce que l’autre fait en plus est autant de gagné à son profit. Comment s’étonner que le nègre n’aime point un travail régulier, perpétuel, au profit et au gré d’autrui ? Comment ce travail pourrait-il avoir le moindre attrait à ses yeux, puisque toute la récolte est pour un autre ? Le sentiment d’aucun avantage personnel n’étant attaché aux résultats de la tâche qui lui est imposée, il est tout naturel que cette tâche lui soit odieuse ou au moins indifférente. Nous nous expliquons très bien l’apathie où tombe l’homme qui n’a aucune volonté à exercer, qui doit toujours obéir. La plante qui végète s’intéresse-t-elle d’une manière active à la vie ? Le fouet ou plutôt la crainte du fouet est presque l’unique stimulant d’un esclave, il est très concevable qu’il fasse seulement juste ce qu’il faut pour échapper au fouet ; « celui qui manque d’un motif d’action, a dit M. Buxton, cesse d’agir aussitôt que s’arrête l’impulsion violente qu’il a reçue. » — La prospérité égaie ou attriste la grande case, l’habitation du maître va bien ou mal ; qu’importe à l’esclave, où est son intérêt ? Il devra toujours porter sa besace, elle ne sera ni plus ni moins lourde. Qu’il mette un ou deux arpens de terre de plus en culture ; je vois distinctivement l’augmentation de sa peine, mais je cherche en vain l’augmentation de son bien-être. Avouons-le, se courber chaque jour sur une tâche sans salaire, rester étranger à une plus grande abondance qu’on a créée, est une situation qui doit amener l’indifférence. Si dans de pareilles données il se trouve, comme on nous l’assure, des nègres zélés ou réellement laborieux, ces hommes là doivent être doués d’une activité naturelle bien extraordinaire. L’esclave à tout prendre, sauf les soins d’hôpital lorsqu’il est malade, n’a véritablement en récompense des cinq jours pleins de labeur donnés par lui à son maître, que le droit de travailler le sixième pour gagner sa nourriture de la semaine entière !
Et malgré tout, voyons donc. Cette paresse du nègre qui nous est sans cesse représentée comme un obstacle à nos projets libérateurs, est-elle bien réelle ? est-elle foncièrement aussi [275] grande qu’on le dit ? Les nègres paresseux ! mais qui donc fabrique les vingt-quatre millions de kilogrammes de sucre de la Martinique et les trente-quatre millions de la Guadeloupe ? sont-ce les blancs ? En définitive, quelque dur que soit le fouet, est-ce à coups de fouet, rien qu’à coups de fouet, que l’on pourrait faire les soixante-dix sept millions de kilogrammes de sucre que nos quatre colonies à culture exportent année commune en France ? Les propriétaires du Gros-Morne (Martinique), qui généralement ont plus de nègres que de terre, laissent leurs esclaves à eux-mêmes des semaines et des mois, leur disant d’aller se louer et de rapporter tant : les sucriers [195] du Lamentin et du Robert, qui ont plus de terrain que de bras en louent beaucoup, et l’on ne voit pas que ces hommes, qu’il faudrait bien toujours nourrir s’ils disaient n’avoir pas trouvé d’ouvrage, se montrent récalcitrans à cette exploitation de leurs forces. — Nous causions un jour avec un esclave que l’on nous avait donné pour guide, et qui nous montrant des cases couchées au fond d’une vallée nous dit : « Cases à libres mouché. » Il mit dans ces mots un accent qui, malgré la réserve dont nous nous faisions une loi, nous entraîna à cette question : — Que feriez vous si vous étiez libre ? — Moi je travaillerais. — Mais on craint que vous ne veuillez pas travailler. — Oh mouché ! un homme libre y est bien obligé pour vivre, si nous travaillons pour nos maîtres, à plus forte raison le ferons nous à notre profit. — Cela ne me paraît point évident, on dit que vous êtes naturellement paresseux, et que vous n’allez à l’ouvrage que par crainte du fouet. — Comment le croire ? si je refuse d’aller au jardin vous me battrez ce matin, ce soir, demain ; mais je n’irai pas davantage, si je ne veux pas. — Mais je vous battrai tous les jours. — Non, car j’en mourrais. Et il ajouta avec tristesse « c’est pas fouet, c’est bons sentimens qui fait travaié nègue, oh ! Matinique ben ben for injuste pou pauve nègues. » Je me tus car j’étais de l’avis de l’esclave résigné, et je me rappelai ce qu’avait dit un illustre créole de Bourbon. « Les noirs ont la [276] pioche à la main depuis quatre heures du matin jusqu’au coucher du soleil, mais leurs maîtres en revenant d’examiner leur ouvrage répètent tous les soirs, ces geux-là ne travaillent pas [196] ! » — La paresse native des Africains est une invention des blancs créoles pour épouvanter les blancs réformateurs.
Nous sommes complètement dans le vrai, du moins avons-nous tout lieu de le croire, en disant cela, car aux colonies anglaises les nègres nouveaux, les nègres pris sur des négriers et mis à la culture, se montrent généralement laborieux. N’ayant point été gâtés par l’esclavage, il ne se manifeste en eux aucune antipathie pour le travail. C’est un fait constaté par le capitaine Lahirle lors de sa visite à la Jamaïque, et l’on doit y attacher de l’importance, car cet officier de notre marine royale envoyé aux West-Indies pour étudier les résultats de l’émancipation, croit aussi d’ailleurs à la paresse innée des nègres. — « Les noirs d’Alger, dont un grand nombre sont libres, forment une race belle, laborieuse, sage, universellement aimée [197]. »
Ce qui par-dessus tout induit les colons à dire que les nègres ne travailleront pas, c’est le triste spectacle de la fainéantise de la classe libre aux colonies ! Cette classe reste en proie à l’oisiveté, aux mauvaises mœurs ; nous reconnaissons que cela est vrai, et qu’elle ne fait pas ce qu’on pourrait attendre d’elle. Mais n’est-ce pas voir bien courtement que de ne pas mieux mesurer la portée d’un fait social ? l’esprit qui préside à une association n’est-il pas toujours responsable des fautes de ses membres ? Nous avons déjà dit pourquoi les libres ne font rien, c’est qu’ils sont pleins d’ignorance, c’est que l’esclavage ayant toujours représenté pour eux le travail, il va de source que la liberté représente le repos ; c’est que le véritable tyran de l’esclave étant la houe, il est parfaitement naturel que l’affranchi la déteste ; c’est qu’ils sont méprisés, [277] voués à l’ignominie, et que la couleur de leur peau les empêche d’aspirer à rien, les décourage de tout ; et voici la plus grande raison, c’est que les conditions politiques n’y permettant aucune industrie [198], il n’y a plus d’autre occupation possible pour eux que celle de la terre, et celle-là, ils n’en veulent pas.
La servitude a frappé le sol d’infamie, qui s’y livre est vil, c’est pure œuvre d’esclave et d’esclave du dernier degré. « Les libres, a dit M. Lignières, travailleraient volontiers à la terre pour vivre, s’ils n’en étaient empêchés par l’esclavage. » Les maîtres n’ont que trop contribué eux-mêmes à dégrader l’agriculture ; car leur commune menace envers un domestique en faute, est de lui dire : « Je vous enverrai au jardin. » Les libres se refusent au labourage, parce qu’il est le signe le plus caractéristique de leur ancien abaissement ; et si vous en doutez, expliquez-nous pourquoi le nouveau libre, celui qui vient d’être affranchi, soit grâce à la faveur de son maître pour bons services, soit grâce au pécule qu’il aura péniblement amassé par des habitudes laborieuses qui deviennent nécessaires à celui qui les contracte ; expliquez-nous pourquoi ceux-là même qui [278] dans l’esclavage s’étaient nécessairement montrés des plus capables et des plus assidus, ne retournent plus à la terre, leur première et bienfaisante nourrice ? — Réellement la situation du travail libre actuel, et en particulier du travail agricole, ne peut être prise avec justice en considération. Dans ces pays criblés de préjugés, hiérarchisés depuis le premier jusqu’au dernier échelon, tout ce qui rappelle la servitude à l’affranchi lui est odieux, insupportable, répugnant au point que le bamboula, cette danse que le nègre aime de passion, il cesse souvent de s’y livrer dès qu’il est affranchi, parce qu’elle appartient exclusivement aux esclaves. Nous avons vu un esclave qui avait racheté sa fille lui interdire le bamboula comme indigne d’une femme libre. La pauvre enfant n’avait pas encore les vanités de sa condition et aurait bien voulu redevenir esclave pour une heure ou deux.
Plusieurs fois, depuis le commencement de cet ouvrage, la similitude des mœurs et des idées dans toutes les Antilles a été mise en évidence. Les mêmes causes ont engendré partout les mêmes effets. À Puerto-Rico, où les Ibaros, race indo-blanche et les nègres libres daignent se louer accidentellement pour couper de la canne lors de la récolte, on n’en trouverait pas un pour la planter et manier la houe, quand on lui donnerait une piastre par jour.
L’objection capitale des créoles raisonnables n’est pas précisément que les libres refusent tout-à-fait de travailler, ils reconnaissent assez volontiers qu’ils se louent pour des ouvrages de terrassement, de nettoyage de canaux, etc., emplois sur lesquels les stigmates de la dégradation sont moins profondément imprimés. La grande affaire est qu’ils ne veulent point se louer pour la canne, et que par conséquent, quelles que soient d’ailleurs leurs dispositions, les colonies sont toujours perdues, puisque la culture de la canne est la seule qui puisse les soutenir. Mais ne voit-on pas bien encore ici que l’antipathie ne porte que sur le travail plus particulièrement représentatif de l’abjection esclave ? Réhabilitez donc la terre flétrie par la ser [279] vitude, avant de dire que l’émancipé ne la voudra pas remuer ; ennoblissez la houe pour que les anoblis ne croient pas descendre en y touchant ; détruisez l’esclavage des laboureurs pour que faire œuvre de laboureurs ne soit pas faire œuvre vile. Tant qu’il y aura des esclaves au jardin, on ne trouvera point de libres pour les y accompagner. Le jour où la liberté donnera des lettres de franchise à la canne, les affranchis ne craindront pas de se mettre en contact avec elle. Le seul moyen de modifier les idées à cet égard est de changer de fond en comble le milieu où elles se faussent. Nous avons déjà cité une parole de M. Boyer, nous aimons à nous appuyer encore de l’opinion de cette forte tête. « Pour que le régime qu’on établira ne soit pas neutralisé par les circonstances laissées à l’entour, il faut soulever ensemble la masse entière. »
Il y a toute raison de croire aux succès d’une telle mesure ; car aujourd’hui même, parmi ces nouveaux libres encore enveloppés des ténèbres serviles, il s’en trouve quelques-uns d’esprit assez fort pour vaincre le préjugé et vivre de la terre. En parcourant les colonies, on rencontre beaucoup de petites cases entourées de champs cultivés par des libres. M. Latuillerie a plusieurs carrés loués à des nègres libres qui les exploitent en vivres. M. Bovis nous a montré sur son habitation du Marquisat (Guadeloupe) des jardins entretenus par des libres et même par des femmes de couleur. M. Portier, un des membres du conseil de la Guadeloupe les plus ennemis de tout progrès, a employé des hommes libres au jardin, et a soutenu devant nous contre son collègue M. Fel. Patron, « qu’on en trouverait autant qu’on en désirerait, si on voulait les bien payer. » Les bien payer ! il y a encore ici une explication de l’oisiveté des affranchis de nos îles. Plus d’une personne désintéressée nous ont dit qu’un bon nombre de libres ne travaillaient pas aux champs, parce qu’ils reçoivent souvent pour salaire des injures ou des coups sans pouvoir obtenir justice des autorités municipales qui sont toutes aux mains des blancs propriéfaires. Quoi qu’il en soit, le préjugé contre la canne lui-même [280] est déjà entamé jusqu’en face de l’esclavage. À notre connaissance, M. Nelson et M. Despointes (Robert, Martinique) ont employé des ouvriers libres à la houe ; le dernier a planté de la canne de compte à demi avec eux, et au moment où nous eûmes l’honneur d’être reçu chez lui, il avait à fabriquer six boucots de sucre pour un nègre libre. On a vu au chapitre IX que M. Latuillerie avait aussi fait de la canne, de compte à demi avec des libres. Il faut tout dire, la mesquinerie du salaire proposé aux libres, la difficulté de le recouvrer, entre pour quelque chose dans leur éloignement du jardin, et nos planteurs ne font aucun effort d’ensemble pour vaincre cet éloignement ; ils n’aiment pas le mélange des affranchis avec leurs esclaves, ils redoutent et peut-être pas sans motif, en raison des idées qui fermentent dans leurs ateliers, ils redoutent cette communion de la liberté avec la servitude.
En somme, nous avons rencontré plus d’un habitant qui croient au travail libre, nous y croyons fermement aussi, et l’on verra pourquoi, lorsque nous en serons à parler des colonies anglaises. Pour juger ce qu’il est permis d’attendre des nègres quand ils vivront à leur compte, il faut voir l’ardeur que le plus grand nombre d’entre eux montrent le samedi dans leurs propres jardins.
[281]
CHAPITRE XX.
LES ÉMANCIPÉS TRAVAILLERONT SI ON LES DIRIGE BIEN.↩
Fût-il vrai que les nègres, une fois émancipés, ne voulussent pas travailler, il n’en faudrait pas moins abolir l’esclavage. — Les affranchis ne s’enfuiront pas dans les bois. — Les nègres de traite libérés. — Si l’on rend le travail attrayant par un bon salaire, les nègres travailleront. — Tout labeur doit rapporter sa juste récompense. — De la question des sucres en Angleterre. — Travail libre et travail forcé. — On ne peut pas juger des dispositions laborieuses de l’homme libre par celles de l’homme esclave.
Le nègre une fois libre, nous assure-t-on, ira dans les bois manger les fruits des arbres au pied desquels il se couchera le jour pour danser la nuit. — Mais les forêts des Antilles, toutes puissantes qu’elles soient, n’ont pas de quoi nourrir spontanément deux cent mille hommes, il faudra bien travailler, à moins qu’on ne trouve moyen de vivre de feuilles et de branches.
On nous menace beaucoup des bois, c’est une chimère. En Haïti, où les nègres végètent dans la licence créée par un gouvernement immoral, aux îles anglaises où ils sont désormais libres, les voit-on aller chercher la vie sauvage au fond des forêts ? — Lorsqu’en visitant les habitations, nous voyions la familiarité des rapports entre le maître et l’esclave, nous disions aux maîtres : Comment me ferez-vous croire que ces gens-là, lorsqu’ils seront libres, n’aimeront pas mieux vivre en paix à vos gages sur une terre où ils ont leurs habitudes d’enfance, plutôt que d’aller courir les bois et se livrer à toutes les chances du hasard ? « Oh ! pour mon compte, m’était-il répondu, je ne crains pas l’affranchissement, pas un de mes nègres ne me quittera, et si je repousse vos projets, c’est parce que je pense aux autres qui perdraient tout leur monde. » Parmi les planteurs, huit sur dix nous tenaient ce langage, et se montraient persuadés que chez eux le travail serait peu compromis. Tout [282] en faisant la part d’un louable amour-propre, n’avons-nous pas droit de conclure que ce dont chacun a si peur n’est pas fort à craindre ?
Mais ils voleront. Il n’est guère possible de répondre sérieusement à une proposition si peu sérieuse ; toutefois, en la prenant même pour ce qu’elle vaut, nous n’aurions qu’une chose à dire. Quand tout le monde vole, il n’y a rien à voler, et le métier de brigand devient peu lucratif. Il faudra volontairement ou non s’assujettir à une tâche quelconque, et les premiers à l’œuvre seront les plus acharnés ennemis des coureurs de rapines.
Ce sont là des craintes qui ne méritent pas qu’on s’y arrête ; allons aux choses sérieuses.
Un nègre, dans l’état actuel de ses connaissances et de ses goûts, peut subsister avec 120 ou 130 fr. par an, et il lui est facile de gagner cette somme en se louant un jour ou deux par semaine. Il travaillera peut-être pour satisfaire aux premières nécessités de la vie, nous dit-on, mais pas davantage, et les colonies, faute de bras, tomberont en friche.
Certes, si cela arrivait, ce serait un grand mal, et cependant il n’en faudrait pas moins prononcer l’abolition ; car c’est un bien plus grand mal que des hommes soient contraints de travailler six jours de la semaine sans rémunération, pour tenir les colonies en culture, procurer des richesses aux créoles et du fret à notre marine marchande, tandis qu’ils peuvent vivre à leur guise en ne s’occupant que quarante-huit heures. On a déplacé la question. Le nègre n’a pas à donner des garanties d’aptitude laborieuse pour mériter l’affranchissement ; — le privilége de tout homme à l’indépendance est imprescriptible ; — il travaillera s’il lui plaît, c’est à vous de savoir l’y engager, l’y exciter, l’y encourager par des moyens que la justice et le droit public ne réprouvent pas.
Cependant, prenez confiance. Si la servitude, depuis deux siècles qu’elle s’est chargée de l’éducation de l’homme noir, n’a pu en faire qu’une brute dont vous ayez à redouter les [283] tristes penchans que vous déclarez être ceux de vos esclaves, la liberté, nous en sommes sûrs, saura en tirer meilleur parti. Il faut que la vue des dégradations de l’esclavage vous ait bien pervertis vous-mêmes pour que vous ignoriez à ce point les ressorts du cœur et des instincts humains. Le caractère essentiel de l’homme combat les funestes pronostics que vous portez sur l’affranchi ; l’homme livré à lui-même aspire toujours à mieux lorsqu’il a la connaissance du mieux, et travaille sans cesse pour l’obtenir. Les nègres sont hommes ; si l’on pouvait en douter encore, leur vanité, leur orgueil suffiraient à le prouver ; l’usage de la vie leur créera des besoins artificiels comme à nous, et ces besoins augmenteront comme chez nous avec les moyens de les satisfaire. L’éducation, la jouissance de leurs droits, le mariage, le développement de leurs facultés ne tarderont pas à leur en donner. La fréquentation des hommes civilisés les initiera aux nécessités factices qui soutiennent l’industrie. Comment croire que l’homme libre se satisfasse avec ce qu’il avait, esclave ? pensez-vous qu’alors les nègres se contentent de morue pour toute nourriture, de grosse toile pour tout habit, de calebasses pour toute vaisselle ? ne les voyez-vous pas, même dans la servitude, acheter des gilets de satin ? ne voyez-vous pas leurs femmes rechercher les bijoux d’or, les robes de soie et de mousseline ? Bientôt, dans un livre qui suivra celui-ci, nous vous ferons voir aux colonies anglaises des affranchis ayant déjà cabriolet.
Avec les dispositions qu’ils montrent à imiter les blancs, nous serions fort surpris que les nègres tardassent long-temps à prendre nos habitudes. Il y a chez eux, tels que nous les avons vus dans l’esclavage, une incohérence qui deviendra de l’imagination en se réglant dans la liberté. Le nègre peut passer des mois entiers en guenilles et se couvrir ensuite sans embarras des plus magnifiques habits ; il a un goût effréné pour la parure, pour le luxe, et une extrême aisance à s’y livrer quand il en a la possibilité. Un de nos paysans ne voudra pas porter telle ou telle chose, parce que c’est trop beau ; à un nègre jamais [284] semblable pensée ne viendra, rien ne lui paraît trop beau pour lui ; mais, à la vérité, il jette le lendemain avec indifférence le joyau dont il s’est amusé la veille. Le nègre est un peu philosophe, sans le savoir ; et à l’air narquois, dégagé, mais observateur, dont quelques-uns nous regardent, nous sommes assez disposé à croire qu’en attendant qu’ils aient nos besoins factices, ils nous prennent en pitié pour nous en être forgé des nécessités.
Il s’est passé à la Martinique deux faits isolés qui malgré leur peu de valeur intrinsèque, en acquièrent une grande par les circonstances présentes. Vingt-quatre noirs, arrachés à un négrier, avaient été placés en 1830 sur la plantation domaniale de Trouvaillant pour s’y former à nos mœurs et à nos usages par un apprentissage de sept ans ; libres en droit, ils étaient attachés à la terre et ne jouissaient pas de la faculté de sortir de l’habitation. Du reste, traités avec douceur, acclimatés avec soin, il n’en mourut que deux dans l’espace des sept années qui précédèrent leur liberté définitive. Il y a dix-huit mois, à l’expiration du temps d’épreuve, le géreur de Trouvaillant les exhorta à rester tous avec lui, il leur promit la continuation des soins matériels qu’ils avaient obtenus, la case, le jardin, l’hôpital et une légitime rétribution de leur travail. Mais on avait laissé ces pauvres gens dans la nuit intellectuelle où ils se trouvaient en arrivant, on ne leur avait rien appris que la nécessité de cultiver la canne pour vivre. Douze d’entre eux ne purent dominer une aussi insuffisante éducation morale, et préférèrent aller courir les chances d’une vie irrégulière plutôt que de continuer à travailler d’une manière libre, mais sûre ; ils quittèrent Trouvaillant et se lancèrent dans le monde. Déjà deux étaient morts lorsqu’on nous en parla ; la conduite des autres n’était pas précisément mauvaise, et pas un n’avait encouru les sévérités de la loi ; mais que font-ils ? Leur ignorance morale et leur isolement enlèvent à leur détermination ce qu’elle pourrait avoir de condamnable. Les dix restant ont fourni à l’esprit d’ordre plus qu’on ne pouvait espérer, autant qu’on pouvait dé [285] sirer ; ils ont eu la sagesse de demeurer, et ils remplissent leur tâche comme les ouvriers esclaves. Le géreur de l’habitation est assez content d’eux, et nous a dit qu’ils ne répugnaient aucunement à toutes exigences du travail continu.
Trois à quatre cents nègres et négresses, également sauvés de la traite, ont fondé, tout à côté de Fort-Royal, un petit village justement appelé le Misérable. Il n’est point d’établissement de cases sur les habitations, j’en conviens, qui ne soient au-dessus de ce qu’on voit là. Ces malheureux, sous le plus beau ciel du monde, végètent au milieu de flaques d’eau croupissante, de boue, et des fétides émanations qui s’élèvent des parcs à cochon attachés à chaque cabane. Leurs ruelles, appelées rues, sont tellement sales, qu’on se croirait dans un village de France. Ils vivent pauvrement, au jour le jour, des petits gains qu’hommes et femmes vont faire à la ville, en servant les maçons et les ouvriers, ou comme ouvriers eux-mêmes. Presque séparés du reste de la population, ils parlent les idiomes de leurs divers pays, et l’on prétend qu’ils veulent refaire l’Afrique. Ce qu’ils font, ce n’est ni l’Afrique, ni la civilisation : ce n’est rien de bon. Ils ne se conduisent pas d’une manière légalement répréhensible ; nul n’a à se plaindre d’eux ; leurs cases fermant à peine, sont respectées comme dans une grande famille : mais ne point faire mal est une vertu négative en socialisme. L’homme doit faire bien, et il est constant qu’au Misérable on ne fait pas bien, car il n’y existe ni organisation, ni société, ni avenir. La faute en est-elle à ces nègres qui n’étaient dans leur pays, sans doute, que des esclaves obéissans, comme presque tous les noirs de traite ? On n’a rien essayé en leur faveur ; on les a laissés à leur complète ignorance de toutes choses ; on les a livrés à eux-mêmes : la civilisation blanche les a vus s’agglomérer à côté d’une ville capitale, sans s’occuper de ce qu’ils faisaient, sans jeter les yeux sur eux, et ils existent au hasard. Ce n’est pas ainsi que la civilisation doit agir : elle a pour devoir d’éclairer les sauvages, de les instruire, de leur donner une direction, Tous les peuples ont été conduits par des hommes que la science [286] du passé avait perfectionnés eux-mêmes. Ouvrez-leur donc le livre, si vous voulez qu’ils apprennent à lire. Nos bourgs seraient-ils ce qu’ils sont sans les lois municipales et l’impulsion du chef-lieu ? Je m’assure que les blancs, dans une position analogue, ne feraient pas mieux que les nègres du Misérable, et cela est si vrai que ce village s’est augmenté de plusieurs cases habitées par des gens de couleur, et aussi par quelques femmes blanches, qui vivent tous dans le même désordre, qui tous ont leur part du foyer d’infection !
Nous n’avons nullement peur de fournir ces faits, où nos adversaires voudront prendre un argument en faveur de l’apprentissage préalable, car nous ferons voir, dans la suite de ce livre, que l’apprentissage ne peut rien produire, et l’on remarque, d’ailleurs, qu’il faudrait mettre aussi beaucoup de blancs en apprentissage. Ce que nous avons voulu prouver, c’est que les nègres abandonnés à eux-mêmes, loin de s’aller cacher dans les profondeurs des bois, restent auprès des villes, et loin de manifester les instincts de férocité qu’on leur suppose, montrent, au contraire, une douceur de mœurs extrêmes.
Après cela, c’est l’affaire d’un gouvernement animé de l’esprit de charité politique, de prévenir ces tendances à l’inertie, et cette disposition à la paresse, qui se forment tout à la fois des bontés du climat et de l’état intellectuel d’hommes encore incultes. Sans doute, de toutes les difficultés que nous lègue l’esclavage, la plus grande est une certaine aversion pour le travail que la servitude met au cœur de l’esclave, et cette difficulté s’augmente des splendides prodigalités de la nature. Mais un affranchissement instantané a encore cet avantage, qu’il permet de combiner des mesures générales, inapplicables à des cas particuliers, et d’agir en masse sur l’esprit et le moral des nouveaux libres. Il faut les entourer si bien qu’ils n’aient pas le temps de prendre de mauvaises habitudes. Puisque ces hommes sont neufs dans le régime libre, profitez de la position pour les anoblir d’un seul coup, et créer simultanément entre l’employeur et l’employé des rapports de fraternité, au lieu de rap [287] ports d’antagonisme. Attachez-vous particulièrement à rendre la loi de ces rapports simple et peu compliquée, à ce que les conventions de travail et de salaire soient précises et bien déterminées.
La seule véritable difficulté est là, et le génie de l’administrateur consistera à savoir prévenir tous débats, à établir du premier coup la bonne harmonie dans les transactions que les anciens maîtres et les nouveaux libres vont faire entr’eux. La sagesse des colons doit être invoquée, car, plus éclairés que les nègres, ils peuvent mieux comprendre les dangers de la rivalité entre pauvres et riches.
Le point culminant de la question à venir, c’est de savoir rendre le travail libre attrayant, et ils peuvent beaucoup en ceci par la douceur dont ils useront envers les émancipés. Ce sont les dispositions conciliantes des créoles qui ont fait à Antigues la fortune de la liberté. Ne cherchez point à obtenir le travail au taux le plus bas, mais bien le plus équitable. Réglez tout de suite honorablement le salaire pour que vos bras prennent goût fout de suite à des fatigues profitables. Abandonnez ces coupables désirs qu’a toujours le fabricant de réduire la paie de l’ouvrier. On se préoccupe trop à notre sens du bas prix du salaire. On voudrait l’assurer par tous les moyens possibles, et les planteurs représentent avec une insistance qui prouve combien les idées du juste sont faussées en tout ceci, que depuis l’émancipation, « ce n’est qu’à des prix excessifs que les colons Anglais ont pu décider les noirs à travailler. »
Quand je vois les ouvriers en Europe où les bras surabondent, se plaindre si justement qu’on ne les fait travailler qu’avec des gages insuffisans, je me prends à penser qu’aux Antilles, où les bras sont insuffisans et peuvent imposer leur prix, on ne se plaint qu’ils se taxent trop cher que parce qu’ils ne veulent point se donner pour rien. La cruauté des riches en Europe rend fort suspectes leurs lamentations en Amérique.
[288]
Nous avons bien entendu les maîtres anglais s’indigner d’être à la discrétion des laboureurs au lieu de les avoir à leur merci, gémir de ne point posséder le droit de fixer la journée des nègres, mais en les écoutant nous avions encore le cœur ému des cris de souffrances de nos prolétaires qui disent que ce droit, dont les maîtres jouissent ici, a réduit leurs gages au-dessous de ce qu’ils doivent être pour les faire vivres honnêtement.
Loin de nous est la pensée de vouloir remplacer une tyrannie par une autre, nous avons une haine vigoureuse contre tous les despotismes, qu’ils viennent d’en bas ou d’en haut. Ainsi nous ne voudrions pas justifier les exigences des nègres par celles qu’auraient les blancs, si les positions changeaient ; mais nous sommes entré chez les laboureurs anglais, nous avons regardé leur vie ; et la pauvreté de leur demeure, la modestie de leurs habitudes, la simplicité de leurs femmes, nous ont convaincu que les reproches des propriétaires étaient injustes. Le salaire peut être excessif, comparativement à ce que les conditions de l’esclavage avaient établi, il ne l’est assurément pas comparativement au bien-être de ceux qui le gagnent. Si ce peuple régénéré qui bénit chaque jour l’avènement de l’indépendance est assez heureux pour être assuré de la vie matérielle, pour échapper aux impositions sordides des capitalistes et ne travailler que quand il a besoin de luxe et de beaux habits, c’est une chose dont les anciens propriétaires peuvent être chagrins, mais dont les amis de l’humanité ne peuvent que se réjouir profondément. Qui ne préférera ce retour vers la barbarie, ces effets de la tyrannie du prolétaire à ceux de la tyrannie des riches qui ont amené les union houses à la suite de la loi des pauvres en Angleterre, et qui ont dressé le lugubre étendard des ouvriers de Lyon, sur lequel le monde a pu lire avec compassion et terreur : Du pain ou la mort ! Tant que l’association du travail et du capital ne viendra pas faire de l’employeur et de l’employé des compagnons également intéressés à la chose commune par un bénéfice proportionnellement égal, forcé de [289] choisir entre deux maux ; nous aimerons mieux que l’ouvrier fasse la loi au maître qui gardera toujours une bonne table ; plutôt que le maître à l’ouvrier qui souffre et pâtit, jusqu’à ce qu’il entre dans les demeures inconnues où nous allons tous et où personne n’a faim.
Tout labeur doit rapporter sa juste récompense. En bonne morale et aussi en bonne économie politique, la difficulté n’est pas de chercher à garantir, comme le veulent les propriétaires, le bas prix du salaire, mais de trouver un moyen équitable de rétribuer le travail sans dommage pour le capital. Nous ne nous inquiétons pas de savoir si l’objet fabriqué sera cher où bon marché, ou pour dire mieux, ce n’est là pour nous que la seconde partie du problème ; la première et la plus importante, c’est que l’homme qui fabrique retire de l’emploi de son temps et de ses forces un profit qui lui donne de quoi vivre sans privation. La Grande-Bretagne est la nation du monde européen dont les produits manufacturés sont les moins chers, c’est aussi la nation où la pauvreté de la classe ouvrière est la plus affreusement profonde.
L’esclavage a permis de donner le sucre à bon marché, lorsque celui qui le cultivait n’avait pour compensation d’un travail excessif qu’une mauvaise nourriture et un mauvais gîte, ce ne peut être un motif pour que la liberté s’y conforme. Si la culture libre de la canne doit la rendre plus coûteuse, il nous paraît tout simple que le consommateur s’y résigne ; si les denrées coloniales doivent augmenter de valeur, il nous paraît honorable qu’il se soumette à l’augmentation sans regret, comme à une loi d’équité. Si le sucre manufacturé par des hommes affranchis doit être plus cher que le sucre manufacturé par des hommes esclaves, eh bien ! il faut payer le sucre plus cher ; car il est contraire à justice que pour payer une livre de sucre deux sous, dix sous ou cent sous meilleur marché, on réduise l’homme qui la confectionne à l’état d’animal, Autrement il n’y aurait pas de raison pour que, retournant à la barbarie antique, on ne fit crever les yeux à cet homme comme faisaient [290] les Romains à leurs mouleurs de farine, et qu’on ne le mutilât si cela devenait une condition d’économie ou de perfectionnement dans son ouvrage.
La grande affaire est de mettre un terme au travail forcé ; s’inquiéter de ce que coûtera le travail libre ne doit venir qu’après.
Sous ce rapport, la question nous paraît avoir été très mal comprise et très mal posée en Angleterre par le ministère whig, lorsqu’il a voulu modifier le système de taxes qui garantit les marchés de la Grande-Bretagne au sucre des îles émancipées.
Il n’y a pas seulement à plaider ici dans l’intérêt égoïste des propriétaires coloniaux, mais encore dans l’intérêt universel du travail libre. En l’état actuel des choses, le système d’exclusion est seul convenable ; l’égalité des droits compromettrait la culture libre. Le peuple anglais ne saurait vouloir cela, et le peuple français ne le voudra pas non plus. Tant qu’il y aura du sucre esclave, il est humain et politique de ne point lui laisser faire concurrence au sucre libre. Nous disons humain et politique, parce que le sucre esclave anéantirait le sucre libre avec les intérêts d’humanité qui y sont attachés, et cela pour un avantage tout à fait éphémère : puisque la servitude devant finir partout, au nom de la dignité de homme, il faudrait, avant peu, revenir aux prix élevés qu’on aurait voulu fuir. Le surcroît de dépense dont on avait intention de soulager le peuple, est une dépense utile. Il est absolument impossible qu’au milieu surtout des premiers embarras inséparables de la transformation, les produits anglais puissent lutter avec les produits étrangers ; la main qui lèverait les droits presque prohibitifs qui frappent ces derniers [199], ouvrirait les portes de la Grande-Bretagne aux denrées coloniales de Cuba, de [291] Puerto-Rico, du Brésil, de la Louisiane, et tout en ruinant les planteurs des West-Indies, porterait un coup mortel à la civilisation des nègres émancipés, et à la grande épreuve que le parlement a l’honneur d’avoir commencée. Ce serait après avoir donné 500 millions, il y a huit ans pour créer la liberté payer aujourd’hui une prime pour perpétuer la traite et l’esclavage.
C’est déjà un grand malheur que le parlement et le gouvernement de la Grande-Bretagne n’aient point une idée formelle et arrêtée sur une matière aussi grave. L’indécision où on laisse les planteurs anglais sur leur avenir compromet leur présent. Ils ne pourront prendre de mesures décisives et marcher nettement dans les voies nouvelles, tant que la métropole ne leur garantira pas un état de choses stable et régulier, tant qu’ils ne sauront pas sur quelle base opérer, tant qu’ils auront toujours à craindre des mouvemens dans les droits qui assurent le placement de leurs produits.
Loin de partager les idées de nos frères radicaux d’Angleterre à ce sujet, nous sommes, au contraire, disposé à toutes les concessions qui pourraient faciliter le passage de l’esclavage à la liberté. Aucun sacrifice, à notre avis, ne doit être épargné pour que pas une voix sur la terre ne maudisse l’affranchissement. Tout doit être employé afin d’adoucir le choc qu’auront à supporter les fortunes coloniales, C’est pourquoi nous nous associons complètement au vœu que M. Alphonse Bouvier, jeune planteur, dont nous avons déjà eu l’occasion de louer les heureuses inspirations, a exprimé en ces ttermes, dans un mémoire encore inédit sur l’abolition.
« Pour éviter de compromettre la fortune des créoles dans les embarras et les ralentissemens des premières années d’indépendance, il faudrait que la France protégeât les produits du travail libre, comme elle protège la liberté ; qu’elle accordât aux produits obtenus des ouvriers émancipés des encouragemens et des franchises qui en excitassent les développemens ; en un mot, qu’elle modifiât ses tarifs de douane, en raison des difficultés que la production va rencontrer. Et n’est-ce [292] point justice que les fonds de l’État, que les fonds appartenant à tous, viennent en aide à ceux qui subissent une nécessité imposée par l’honneur de tous, pour la satisfaction de tous ? Si nos sucres ne se présentaient pas sur les marchés de France avec les mêmes avantages que le sucre des colonies anglaises trouve sur les marchés de leur mère-patrie, il en résulterait que le colon anglais pouvant offrir un prix plus élevé de la journée à ses travailleurs, attirerait chez lui nos nouveaux affranchis ; car nous ne comprendrions pas une liberté qui interdirait aux citoyens la faculté de chercher, en pays étranger, des avantages qu’ils ne rencontreraient pas toujours sur le sol natal. Nos îles seraient ainsi exposées à de fréquentes émigrations ; de là, diminution de la population active, cessation de travail, absence de revenus, embarras, misère. Les utiles compensations que nous réclamons étant le corollaire indispensable de l’émancipation, devant assurer en grande partie le succès de l’œuvre sérieuse et difficile que nous entreprenons, devraient être accordées concurremment avec l’affranchissement pour placer le remède à côté du mal. »
Nous voici un peu loin du point d’où nous sommes partis, mais le lecteur nous excusera : la question du salaire, dans la question de l’affranchissement, est une des plus importantes. Il était utile aussi que la France, en votant l’abolition, sût bien tout ce qu’il lui en devra coûter, et qu’elle ne pût regretter plus tard quelques sacrifices pour ne les avoir pas envisagés tout d’abord. La grandeur de notre cause s’accommoderait mal de rien cacher. Il faut, ou garder l’esclavage avec ses horreurs, où donner l’affranchissement avec ses conséquences.
Que les nègres émancipés reçoivent une juste rétribution de leur travail, et ils travailleront. Aimons nos frères, pensons à nous-mêmes en pensant à eux, et veuillons avec un sincère amour du prochain que le fruit de leurs peines leur procure une vie facile et légère. N’oublions pas que le supplicié du Golgotha à recommandé d’aimer la justice avec passion, qu’il n’y veut point de calme ni de restriction, qu’il nous a commandé à tous [293] d’en être altéré et affamé. Si l’on est à la fois bon et juste, il est impossible que l’opération ne réussisse pas ; car se faisant sur une grande échelle, chacun étant obligé de payer pour soi-même, il est impossible que le manque total de ressources du plus grand nombre, et l’embarras d’appuyer l’existence sur des moyens précaires et irréguliers, ne ramènent les individus à l’ouvrage aussi vite qu’il est possible de l’espérer.
Surtout que l’on ne se méprenne pas sur nos paroles, nous ne prétendons pas du tout que les nègres fourniront dès les premiers temps la même quantité de travail que par le passé, il nous paraîtrait aussi puéril de je vouloir, que d’y compter. Nous nous en sommes déjà expliqué en 1839, « rien n’exciterait plus notre dégoût que des efforts sans bonne foi, pour démontrer qu’un esclave produira le lendemain de son émancipation autant qu’il produisait forcément dans les fers. À quoi donc lui servirait la liberté si ce n’est à délier ce qui était lié, à mobiliser ce qui était immuable. » Les nègres feront ce qu’il est naturel qu’il fassent, ils voudront jouir de l’indépendance, et il y aura certainement une diminution momentanée dans la masse des produits, avec le froissement des intérêts particuliers qui peut en être la conséquence. Que promet le catholicisme aux adeptes dans le paradis ? Le repos. Les esclaves voudront certainement jouir un peu du paradis-liberté. Mais l’affranchissement encore une fois est une opération chirurgicale, les légers troubles qu’il fera peut-être éprouver au corps social ne doivent point être un obstacle à sa réalisation. Un homme peut dire j’aime mieux mourir que de subir l’opération ; il parle pour lui, mais les colons ne parlent pas pour eux seuls. C’est en prévision d’un déficit probable de travail, que nous avons insisté au commencement sur la nécessité d’une émigration qui serait aussi profitable pour les îles que pour la métropole. Peu à peu d’ailleurs les besoins se manifesteront, et pour y répondre on se remettra sans regret à l’ouvrage. Devant un produit réel, certain, palpable du labeur, les souvenirs du passé changeront infailliblement, Le travail trouvera [294] son encouragement dans la connaissance immédiate des avantages qu’il procure. C’est à vous de savoir exciter de telles dispositions, à vos bons soins d’initier ces profanes, de leur créer des idées qu’ils n’ont pu puiser dans la servitude ; vous y parviendrez vite si vous êtes équitables, doux et habiles.
Qu’en savent-ils en résumé, ceux qui répètent « rien ne pourra vaincre la paresse des nègres ? » peuvent-ils juger des hommes noirs par leurs nègres ? il est difficile d’induire des dispositions d’un esclave celles qu’il aura étant libre. L’homme libre et l’homme esclave deviennent des hommes différens, entre lesquels il y a peu d’analogie à établir. Il n’est pas plus permis aux colons de nier le travail libre, qu’il ne nous le serait à nous de l’affirmer si nous n’avions pour appuyer notre foi les colonies anglaises, ou malgré les agitations qui ont suivi la funeste mesure de l’apprentissage, le travail libre fait déjà la moitié des récoltes que faisait l’esclavage ; les expériences de tous les peuples qui ont tous travaillé, qui chacun à leur tour se sont tous policés, et enfin l’exemple de l’Afrique elle-même où les voyageurs écrivent en présence de ce qu’ils voient, « que l’on ne dise plus que les nègres livrés à eux-mêmes ne veulent pas travailler. C’est un préjugé suranné démenti par les faits [200]. » — Encore une fois, nous ne sommes nullement tenté de le dissimuler, il y a une difficulté à vaincre aux colonies, celle d’exciter au travail des gens qui n’ont pas besoin de travailler, parce que sous un ciel plein de clémence, ils ont peu ou point de goûts artificiels ; mais l’histoire du monde nous apprend que cette difficulté n’est pas insurmontable. C’est, de l’Éthiopie, de l’Inde, de la Chaldée, de l’Égypte, qu’est sortie la civilisation dans le monde antique. Les Perses, avant les Grecs, excellaient en tous arts et toutes sciences. Dans le monde moderne c’est également des pays chauds, de l’Arabie, de l’Espagne, de l’Italie, que l’on vit sortir la civilisation renaissante. Naples, si [295] indolente aujourd’hui, fut un des sièges les plus actifs de la régénération européenne.
Nous n’avons pas craint d’entrer dans la discussion, nous n’avons fui devant aucune objection, et par bonheur la tâche était facile, il n’y fallait que la vérité et une observation calme des choses. Mais cependant, qu’on le sache, tout en discutant nous n’abandonnons rien du principe souverain, et nous disons : S’il est vrai que les colonies ne se puissent maintenir qu’avec Le travail forcé, il faut les abandonner à l’état sauvage prédit, car cet état n’est un malheur que pour ceux qui s’y livrent, tandis que le travail forcé est un malheur pour ceux qu’il écrase et un crime pour ceux qui l’ordonnent. Le sauvage, un siècle ou l’autre peut naître à la civilisation, l’esclave ne le pourra jamais ; le sauvage est rayé du livre de la destinée humaine pour un temps, l’esclave pour toujours !
[296]
CHAPITRE XXI.
COMMENT L’INTÉRÊT PRÉSENT DES PLANTEURS S’OPPOSE À L’AFFRANCHISSEMENT.↩
Motifs de la suspension de l’expropriation forcée. — La plupart des habitans ne sont que les géreurs de leurs créanciers hypothécaires. — La saisie exécution, la saisie brandon et le déguerpissement sont illusoires aux colonies. — Dettes des colons. — Les séparations de corps. — les blanchissages. — Funeste état du crédit. — Urgence de rétablir l’expropriation forcée. — La moitié de l’indemnité devra être déclarée insaisissable.
Nous n’avons pas tout dit. IL faut pénétrer au fond des cœurs. Ce n’est pas seulement la crainte de la paresse des nègres qui entretient la résistance des colons à l’émancipation, l’intérêt personnel qui explique tant de choses de ce monde faites pour épouvanter le juste, y entre encore pour une large part. La condition actuelle de leurs fortunes exerce une fatale influence sur leurs résolutions. — Afin de se rendre mieux compte de cela, on est obligé de remonter un peu haut.
Lors de la fondation des colonies on n’y appliqua point, dans le dessein d’y favoriser les établissemens nouveaux, la législation qui soumet le débiteur insolvable à l’expropriation forcée ; on jugea nécessaire de protéger les spéculateurs qui allaient organiser une nouvelle industrie sur les terres tropicales. Cette législation ne manquait ni de sagesse, ni de portée de vue. Une habitation n’est pas une entreprise que l’on puisse créer aisément, elle demande de vastes terrains, des usines dispendieuses, des bâtimens considérables, des bœufs, des mulets, des travailleurs en grand nombre ; elle exige de gros capitaux. Tout cela ne pouvait se faire qu’avec du crédit, et la métropole qui fondait de riches espérances sur ces grandes machines nouvelles, ne voulut point qu’un créancier mécontent [297] put les arrêter au berceau, ni en compromettre l’avenir, si elle tombaient en quelqu’embarras d’argent. C’est dans cet esprit qu’un arrêt du conseil d’état du 5 mai 1681, défendit purement et simplement la saisie des nègres attachés à la terre ; que le Code noir ne l’autorisa qu’autant qu’il y avait à la fois saisie des nègres et de la terre. La terre ne pouvant prospérer sans les bras, on entendait ne pas les séparer. — Une propriété rurale aux colonies n’est pas un bien tranquille et de facile administration, c’est une manufacture, son achat ne fut jamais un placement de fonds, mais toujours une spéculation. On n’acquiert une plantation que pour y gagner de l’argent, et cela est si vrai, qu’au dire des hommes versés dans ces matières, « on ne citerait pas depuis la fondation des colonies jusqu’à nos jours un seul exemple de la vente d’une sucrerie faite au comptant [201]. »
Malheureusement il advint que la sagesse du législateur favorisa la fraude et la dissipation de ceux dont elle avait voulu seulement encourager le travail. Les colons sûrs de n’être jamais dépossédés, enivrés de leur prospérité, firent des dettes, qu’ils accumulèrent insoucieusement au milieu des plaisirs d’une vie effrénée. Leur luxe, leur passion du jeu, leur fêtes absorbèrent plus que les immenses bénéfices, et bientôt ils ne laissèrent à leurs enfans que de magnifiques propriétés insaisissables, mais grevées d’hypothèques énormes. Cette fâcheuse position des propriétaires créoles remonte déjà bien haut : Le général J. R disait en 1804 [202], « les colons ne sont aujourd’hui que les géreurs de leurs habitations, » aussi lors de la promulgation du Code civil, 16 brumaire an xiv (7 novembre 1805), les arrêtés coloniaux autorisés par la métropole, suspendirent-ils l’exécution du titre XIX relatif à l’expropriation [298] forcée, et celle des articles 2168 et 2169 relatifs au régime hypothécaire. Ils maintenaient les colonies sous l’empire de la déclaration du roi, du 24 août 1726, « considérant que cette exécution serait ruineuse pour les habitans à raison de leurs dettes anciennes, et que la nature des propriétés coloniales principalement composées d’esclaves et de fabriques, exige un mode d’expropriation différent de celui adopté en France. »
Les choses ne sont pas changées, aujourd’hui comme alors, les habitans sont criblés de dettes presqu’insolvables [203] ; aujourd’hui comme alors, le débiteur peut se jouer aux colonies de son créancier, les lois qui régissent les rapports entre eux sont les toiles d’araignée d’Anacharsis.
Ou la guêpe a passé le moucheron demeure.
La saisie exécution (saisie des objets fabriqués et des meubles) ; la saisie brandon (saisie de la récolte sur pied) ; le déguerpissement, accordé par la loi du 24 août 1726 (résolution de la vente, rupture du marché de vente lorsque l’acheteur ne paie pas), sont tellement impraticables et entourées de difficultés si insurmontables en raison des localités, qu’on n’en connaît pas d’application [204] ; et les créoles satisfaits de leurs [299] privilèges, bien assurés que le moindre changement les troublerait dans leurs propriétés, certains que leurs nègres convertis en argent par l’indemnité et devenus saisissables sous cette nouvelle forme, passeraient aux mains de leurs créanciers, veulent le statu quo, tout précaire qu’il soit.
Nous avons là un des motifs secrets de leur résistance à l’affranchissement, et la preuve qu’ils croient plus à l’abolition qu’ils ne le disent, c’est qu’ils cherchent déjà à se mettre à couvert de l’éventualité que nous venons de signaler, en obtenant des séparations de biens qui donnent ouverture aux droits des femmes. Les journaux des colonies de ces derniers temps sont remplis d’annonces légales qui laisseraient croire, si l’on n’en connaissait les raisons cachées, à une cause de trouble survenue spontanément dans tous les ménages.
Bien plus, un trop grand nombre de colons moins scrupuleux se sont liquidés depuis quelques années par une opération odieuse que l’on appelle blanchissage. Elle consiste à faire acheter par un prête-nom (souvent à terme) la première créance en ordre d’hypothèques grevant le bien, et puis à le mettre en vente aux enchères publiques. L’obligation de payer comptant éloigne les acquéreurs. La propriété est adjugée à vil prix au prête-nom, dont le remboursement comme premier créancier inscrit absorbe le montant de la vente, les autres n’ont rien ; et l’habitant est quitte envers tout le monde sans avoir à peine donné un sou. Marché trop onéreux encore, puisqu’il y perd l’honneur.
Effet cruel et fréquent du malheur de l’indigence ; la vieille et fière probité créole est compromise malgré la sauve [300] garde de l’éducation. La misère a fait un stellionataire de l’orgueilleux planteur !
Et il ne pardonne pas à ses esclaves de lui voler des bananes !
La suspension de l’expropriation forcée ne provoque pas seulement ces fraudes toujours, funestes à la morale publique ; elle a d’autres inconvéniens encore faciles à saisir du premier coup. Elle tue le crédit en lui enlevant toute base de sécurité, en ne laissant plus aucune garantie au créancier, et par suite agrandit sans cesse le gouffre où vient s’abîmer à jamais la fortune du débiteur honnête. Ce crédit put s’établir autrefois, parce que le commerce de la métropole ouvrait volontiers ses caisses aux planteurs qui avaient en ce temps-là des propriétés liquides, et qui expédiaient des sucres sur la vente desquels on faisait des bénéfices considérables ; mais à mesure que le registre des hypothèques s’est rempli, les caisses se sont fermées, et aujourd’hui le capitaliste répugne à aider une industrie sans responsabilité. Tant de vieilles créances d’un recouvrement désespéré rendent de nouveaux emprunts impossibles l’intérêt de l’argent grossit de tous les risques qu’il court et le propriétaire forcé de payer au poids de l’or les fonds dont il a besoin, voit tous ses bénéfices dévorés par l’usure. Il est de notoriété publique que le taux légal ou du moins commercial, le taux courant de l’argent est aujourd’hui de dix, douze et quinze pour cent aux colonies ! Dans un procès que nous entendîmes plaider au tribunal de première instance de Fort-Royal, procès où il s’agissait de l’exécution d’un bail, l’une des parties, M. Morel, procureur du roi, avait ouvertement stipulé à dix pour cent l’intérêt d’une somme employée par lui à des dépenses locatives ! Quand l’homme de la justice demande dix pour cent, que demanderont les autres ? Il n’y a pas d’industrie possible dans un pays où l’instrument de travail appelé capital, coûte si cher !
Le remède à ce mal effrayant est effrayant lui-même. C’est le retour à la loi commune, à l’expropriation forcée. [301] Quelques-uns y périront, sans doute ; on ne peut l’envisager sans douleur, mais nous ne voyons d’autre moyen de sauver les colonies qui languissent écrasés sous l’usure. C’est la situation extrême d’un grand danger où il faut sacrifier quelques hommes pour relever le vaisseau prêt à sombrer.
Afin de parer autant que l’humanité et la justice le désirent aux malheurs particuliers qu’entraînerait une telle mesure, nous proposerions que le décret d’affranchissement déclarât la moitié de l’indemnité insaisissable.
Les colonies n’eussent-elles pas à subir la crise de l’affranchissement, devraient toujours en venir à l’expropriation forcée, mais l’affranchissement prenant place, comme cela doit être, la mesure césarienne devient impérieuse. L’abolition a besoin pour réussir vite de tous les élémens de succès, et la première condition c’est que le propriétaire, quel qu’il soit, se trouve dans une position financière, franche et pure, qui permette à des banques coloniales de s’établir et de lui prêter l’argent dont il a besoin pour ses exploitations à un taux modéré, comme il arrive maintenant dans les colonies anglaises.
Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’expropriation forcée occupe les îles. En 1829 un projet d’ordonnance ayant pour but de prescrire la publication du titre XIX du Code civil, fut soumis inutilement aux administrations locales. Plusieurs fois saisis de la question, les conseils coloniaux y auraient donné leur consentement, si la plupart des membres liés par leur gêne pécuniaire, n’entraînaient le petit nombre qui se laisse aller, tout en sentant bien que le statu quo empire la plaie et mène à la ruine.
« Je ne conclus pas à l’abolition immédiate de l’esclavage, nous écrivait M. Lignières, mais bien à une abolition qui serait prononcée dans un certain temps que je réduirais à cinq ans pour en finir le plutôt possible…
« Ne trouvez point ce délai trop long, songez encore qu’il faut bien que vous nous laissiez nous débarrasser un peu de la lèpre qui nous ronge ! la dette. Vous compteriez ici des abolitionistes [302] par centaines si cette malheureuse dette n’était pas là pour resserrer tant de cœurs, rétrécir tant d’intelligence. »
Quand nous entendons parler ainsi un homme comme M. Lignières, nous ne pouvons qu’exprimer notre profond regret de ne point partager son avis. Plus nous méditons et moins le temps nous semble pouvoir rien faire à cela. Nous sentons tout ce que la vieille pauvreté des créoles leur donne de droit à être ménagés dans ce débat où l’humanité expose ses titres ; nous comprenons, comme on l’a dit, qu’il n’est pas indifférent que la réforme s’opère au milieu d’une société riche plutôt qu’au sein d’une population nécessiteuse et souffrante, cela est vrai de tous points ; mais ce qui nous semble aussi d’une vérité fatale, c’est que plus on reculera la solution, plus la société coloniale deviendra nécessiteuse et souffrante ; car ses dettes actuelles sont hors de proportion avec ses moyens de libération. L’affranchissement, par les motifs que nous avons déduits tout à l’heure, l’affranchissement avec l’expropriation forcée, sont les seules ressources contre son malaise.
[303]
CHAPITRE XXII.
MOYENS TRANSITOIRES D’ARRIVER À L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE.↩
§ Ier.
ÉMANCIPATION SUCCESSIVE LAISSÉE À LA LIBÉRALITÉ DES MAÎTRES.
Les vices et les vertus des colons chargés de l’affranchissement. — Ce que sont les 34, 000 libertés enregistrées depuis 1830 dans nos colonies. — Libres de savane. — Patronnés. — Épaves. — Interprétation sciemment vicieuse de l’ordonnance de 1832 sur les affranchissemens. — L’esclavage dans l’Amérique du Nord. — Les abolitionistes aux États-Unis.
Amené au point où nous en sommes, et analysé de la sorte, le droit de l’homme sur l’homme, aux yeux même des colons, n’est plus qu’un fait et un fait mauvais. Ils accordent qu’il est juste de le détruire, mais ils reculent indéfiniment l’heureux jour ; ils laisseraient volontiers le fardeau à leurs fils, et plusieurs nous disent : Ne vous occupez pas de cette destruction, n’en troublez point notre société ; elle s’opérera d’elle-même et par nous-mêmes, dans le temps et dans l’espace. Nous avons déjà émancipé plus de trente-quatre mille esclaves en dix ans, sans réclamer d’indemnité. Il n’y a jamais eu résistance systématique de notre part à l’abolition de l’esclavage, elle ne nous paraît impossible qu’à cause du mode d’exécution qu’on veut employer malgré nous. Laissez faire à nos vices et à nos vertus, laissez faire au temps ! — Comme si l’histoire ne nous apprenait pas que le temps n’accomplit rien tout seul, en morale comme en politique, et qu’il veut être aidé.
Expliquons ce qu’il faut entendre par ces vices et ces vertus étonnés de leur association, et chargés ensemble de la grande tâche qui nous occupe. Les vices affranchiront les enfans nés du libertinage, les négresses qui se seront livrées aux blancs ; [304] les vertus affranchiront les esclaves de bonne conduite, Peut-on bien vouloir livrer la régénération d’une race toute entière à de pareilles éventualités ? et n’est-il pas singulier de voir les hommes qui parlent toujours si haut de morale, s’en remettre à l’immoralité, du soin d’accomplir la sainte œuvre de la délivrance des captifs ? En tous cas, mille raisons s’opposent à ce que la générosité et la débauche puissent achever ce que l’on en espère : elles n’affranchiront que des individus ; puis, les créoles déclarant aujourd’hui « qu’il est impossible de cultiver le sol des colonies sans le travail forcé, en raison des dispositions naturelles de la race noire pour l’oisiveté et la vie anti-sociale », n’est-il pas certain que le jour où le nombre des bras nécessaires pour la culture se trouverait trop réduit par les affranchissemens vicieux et vertueux, les affranchissemens s’arrêteraient ? Nos passions bonnes et mauvaises conservent toujours trop de logique pour que les créoles oublient jamais cela ; l’équité, d’ailleurs, leur défendra de dépouiller leurs héritiers, même par grandeur d’âme. Une des milles raisons, en effet, dont nous parlions tout à l’heure, qui s’opposent à une émancipation successive par ces voies, malgré même les meilleurs désirs des propriétaires, c’est que la plupart d’entr’eux étant obérés, ils ne peuvent de bonne foi disposer d’un bien, seul gage de leurs créanciers. Toute émancipation que se permettrait la libéralité de leurs vices et de leurs vertus deviendrait criminelle, puisqu’elle serait un vol fait à leurs prêteurs.
Les trente-quatre mille libertés [205] prononcées dans nos colonies depuis 1830, ne doivent faire illusion à personne. À les prendre pour ce qu’elles sont, il est impossible de leur prêter la valeur qu’on cherche à leur donner. Voici pourquoi : une ordonnance du 1er mars 1831 à supprimé toute taxe sur les concessions de liberté ; un autre décret royal du 12 juillet 1832 a pourvu à la régularisation de toutes les libertés, qui n’avaient pas encore reçu la sanction légale. C’est en vertu de [305] ces deux actes que le nombre des affranchis de 1830 est devenu si considérable ; prouvons-le. Dans les trente-quatre mille libertés reconnues, la Martinique, au moment où nous nous y trouvions (avril 1841), entrait pour vingt mille quatre cent vingt-six ! Or, un relevé des affranchissemens martiniquais que nous avons fait faire et que nous présentons ici [206] ; établit de la manière la plus irréfragable que, sur les vingt mille quatre cent vingt-six nouveaux libres, il y en a quinze mille cent soixante-quatorze qui ne sont que des libres de fait, dont la position sociale n’était pas auparavant déterminée.
Pour que le lecteur européen comprenne ce qui vient d’être dit, il est nécessaire de lui donner une explication. Jusqu’à ce que l’ordonnance de 1831 le défendit, le fisc prélevait une prime d’abord de 3, 000 fr., plus tard de 1, 200 fr., versée dans la caisse coloniale, sur chaque patente d’affranchissement ; et l’administration, en outre, pour délivrer un titre légal d’émancipation, exigeait que le maître assurât les moyens d’existence de l’affranchi. Beaucoup de maîtres voulant émanciper un esclave, mais ne voulant pas contracter une aussi lourde obligation, disaient à l’esclave : « Vas, tu es libre. Je fais abandon de tous mes droits sur toi, » et généralement, dans ce cas, lui per [306] mettaient de s’établir sur les savanes de l’habitation où le manumissionné construisait une case, et pour l’ordinaire se faisait gardeur de bestiaux. C’est la jouissance de la savane accordée à ces hommes, qui leur fit donner le nom de libres de savane, Les planteurs, pour montrer l’ignorance où l’on est en France des choses coloniales, rappellent volontiers la fameuse bévue de M. Sébastiani, lequel, lors de son passage au ministère de la marine, dit naïvement à la tribune que ces prétendus libres étaient des esclaves parqués au milieu des savanes comme des bêtes de somme. Le fait est que de la part d’un ministre des colonies, le propos peut passer au moins pour léger.
Les affranchis de cette espèce n’étaient donc affranchis qu’aux yeux du maître, ils demeuraient inscrits sur ses dénombremens ; aux yeux de tout autre et de la loi ils restaient esclaves. Beaucoup d’entr’eux, ceux-là surtout qui s’étaient rachetés de leurs deniers, mécontens d’une situation aussi précaire allaient dans quelqu’île voisine faire constater leur état de libres et revenaient dans leur pays. Mais comme le gouvernement ne voulait point reconnaître ces titres de liberté étrangers, ils étaient obligés d’avoir un répondant. L’ancien maître consentait généralement à accepter cette charge, et devenait alors leur patron, d’où les affranchis de cette nature prirent le nom de patronnés.
Puisque nous sommes sur ce point, disons un mot sur les épaves. La liberté, dans tous les cas pour les noirs et les sang mêlés, était toujours regardée comme l’exception. Le libre de fait, dont le propriétaire était mort ; le patronné, qui avait perdu son patron, eux ou leurs enfans, bien que par suite d’une longue possession d’indépendance ils fussent très réellement libres, étaient tenus pour esclaves fugitifs lorsqu’ils ne pouvaient montrer, à première réquisition, un titre légal d’affranchissement, et n’ayant plus de maître, appartenait au roi qui avait faculté de les faire vendre au profit de l’État [207]. Le [307] Dictionnaire de l’Académie définit « Épave, adjectif des deux genres, qui se dit des choses égarées dont on ne connaît point le propriétaire, mais principalement des chevaux, vaches et autres bestiaux. » Par extension, les colonies appliquèrent l’adjectif des deux genres aux hommes et aux femmes qui avaient perdu leurs maîtres, de même que le mot marron désignant un animal domestique devenu sauvage, s’était appliqué naturellement aux hommes et aux femmes qui s’enfuyaient dans les bois. Ce mépris pour tout ce qui touche à la race esclave, se retrouve jusque dans le nom que les créoles ont donné aux fruits de leurs propres œuvres : C’est ainsi que le produit du blanc et du nègre a été appelé mulâtre, par assimilation au mulet produit de l’âne et du cheval.
Revenons à notre sujet. La position de tous ces libres de fait a été régularisée, comme nous le disions par l’ordonnance de 1831, c’est-à-dire qu’on leur a donné un titre de liberté en règle, en vertu duquel ils sont devenus citoyens Français reconnus. Ils étaient si nombreux que l’on en voit encore tous les jours sur les listes des nouveaux émancipés publiées officiellement. Le chiffre de quinze mille cent soixante-quatorze est considérable sans doute, mais il faut penser que l’existence de ces affranchis remonte à la création des colonies, que nombre d’entre eux étaient des mulâtres fils de blancs [208], et que tous ne devaient point leur indépendance à la libéralité des colons, car plusieurs s’étaient payés de leur argent, enfin il faut en outre comprendre dans le total beaucoup d’enfans dont la naissance avait suivi l’irrégularité du sort de leur père.
[308]
Quoiqu’il en soit, il n’y a donc en résumé, pour la Martinique, que cinq mille deux cent cinquante-deux affranchis depuis dix ans, nous pouvons même dire au point de vue qui nous occupe quatre mille sept cent trente, car les documens administratifs évaluent à un dixième le nombre des esclaves qui se rachètent eux-mêmes [209]. Mais jetez les yeux sur les listes, examinez la nature de ces affranchissemens, et vous les verrez principalement composés d’enfans nouveaux-nés qui pourront augmenter la population libre des sang mêlés, mais ne diminueront pas la population noire esclave, de jeunes esclaves femelles qui ont suivi l’heureux sort de leurs progénitures [210], puis, de vieillards, hommes ou femmes, qui étaient à la charge du maître avant comme après, de domestiques et nourrices qui ont capté l’affection des maîtres et des maîtresses qu’ils approchent chaque jour, enfin, de quelques mauvais sujets incorrigibles dont les propriétaires n’avaient pu obtenir l’exportation, et qu’on libéra sous les auspices de l’ordonnance pour s’en dé [309] barrasser et n’être plus responsable de leurs méchantes actions. En somme sur les quatre mille sept cent trente esclaves faits libres depuis 1830, nous croyons être exagérés en faisant monter à trois cents le nombre des nègres de jardin, de ces nègres d’atelier qui constituent véritablement le corps de l’esclavage. « J’ai vu ces choses de près, et je puis assurer qu’il est presque sans exemple que des concessions de liberté aient été faites à des esclaves prediaux [211]. »
Mais pourquoi tous ces calculs ? il y a une chose sans réplique possible qui les rend inutiles, c’est que la population esclave augmente d’année en année dans nos colonies ; ce qui constate, comme nous l’avons fait remarquer, les améliorations introduites dans le régime des ateliers par l’humanité des maîtres ; mais ce qui ne laisse aucun espoir de voir l’esclavage se fondre peu à peu dans leurs largesses.
Un autre moyen de juger ce qu’il faut attendre de l’avenir, en laissant le soin de l’abolition aux vices et aux vertus des créoles, serait de comparer par année le nombre des affranchissemens. On verrait que de 1837 à 1840, il est tombé successivement de huit cent quatre-vingt dix-huit à trois cent quatre-vingt. Jugés d’après cette échelle de proportion, les habitans ont chaque année moins de vices et de vertus, et l’on trouverait qu’ils n’en auraient plus du tout avant deux lustres, si l’on voulait appliquer à cette décroissance les calculs de probabilité. Décidément ils ne peuvent rien sous ce rapport, et ce serait une folie d’autant plus grande d’espérer laver par cette voie la tache qui souille encore leur société, que la loi elle-même recommence déjà à faire obstacle aux généreux.
On s’est aperçu que de méchans maîtres profitaient du bon principe pour se débarrasser des invalides, et que plusieurs nouveaux affranchis, en raison de leurs infirmités, se trouvaient hors d’état de pourvoir à leur subsistance. Dans le but d’impo [310] ser un frein à ces facilités, une ordonnance du 11 juin 1839 autorisa le ministère public à former opposition lorsque l’émancipé ne serait point jugé valide, et M. Bonnet, procureur du roi, s’armant de ce moyen, a formé opposition à l’affranchissement de nouveaux-nés, sous prétexte que les manumissionnaires ne leur assuraient pas une rente pour vivre le reste de leurs jours sans rien faire. Une interprétation aussi déplorablement vicieuse du texte et de l’esprit de l’ordonnance du 12 juillet 1832 [212], n’était pas seulement une entrave aux concessions d’affranchissement que le législateur voulait aider, elle ne contrariait pas seulement les nombreuses manumissions du même genre qui avaient été faites depuis 1832 sans que le ministère public eut songé à s’y opposer, elle équivalait à une prohibition complète d’émancipation pour les nouveaux-nés esclaves ; et cependant le tribunal de Saint-Pierre (Martinique) l’adopta en maintenant entre autre, par arrêt du 23 novembre 1839, la qualité d’esclave à un malheureux petit-être de trois mois que l’on voulait rendre à ses droits naturels. Il n’était pas du tout nécessaire de compromettre par cette détestable logique le principe d’affranchissement étendu, les décrets antérieurs fournissaient un remède efficace à ces cruautés de passage ; il suffisait de condamner le maître non pas à reprendre l’esclave impotent, mais à payer sa pension à l’hôpital. — Les tribunaux et les parquets des îles, un créole nous l’a déjà dit, sont dévoués aux colons et prononcent comme le désirent les colons. La loi entendait restreindre la faculté d’affranchissement, à l’égard des esclaves vieux et infirmes reconnus hors d’état de se suffire à eux-mêmes, on l’applique à l’enfant qui vient de naître, parce qu’il est hors d’état de payer sa nourrice et ne justifie pas d’une industrie ! Les mauvaises passions savent tout gâter.
[311]
Les créoles oublient qu’il n’y aurait pas un habitant dans les colonies si l’on avait demandé à eux ou à leurs pères de faire preuve de moyens d’existence pour y entrer.
Si l’affranchissement sans garantie n’est pas une bonne chose, exiger trop de garantie est une chose pire encore ; obliger le manumissionnaire à assurer les moyens d’existence du manumissionné, c’est lui demander un sacrifice dont peu d’hommes sont capables ; aussi voilà déjà les libres de fait qui reparaissent. Il existe sur les habitations, à l’heure qu’il est, des esclaves auxquels le maître, en récompense de leurs services, laisse tout leur temps et ne demande plus rien, mais qu’il n’affranchit point d’une manière légale, parce qu’il ne veut pas prendre un engagement qui dépasse les forces de qui que ce soit. Dans les mauvaises institutions, les améliorations mêmes souvent portent des fruits amers.
À l’occasion de l’abolition laissée à la charge du temps, nous voulons faire un rapprochement qui fera connaître la différence de caractère qui existe entre les colons français et les colons américains. Les plus arriérés d’entre nous, ceux qui veulent ajourner, fondent l’opération séculaire sur leurs vices et sur leurs vertus, qui ensemble achèveront graduellement la délivrance des hommes asservis. M. Clay, lui qui passe dans l’union américaine pour un des grands politiques de l’époque, a aussi déclaré que le plus sage moyen d’opérer la libération était de laisser aller les choses toutes seules, et la raison qu’il en donna en plein sénat fut celle-ci : « La race esclave procrée moins que la race libre ; prenant ensemble le chiffre total des deux races, européenne et africaine, l’européenne gagne lentement, mais constamment sur l’africaine. Le fait est constaté par les dénombremens périodiques de cette population. » Le lecteur voit tout ce que ces paroles renferment de froide, d’impitoyable, d’éternelle cruauté ! Ce que M. Clay a dit revient à ceci : « N’affranchissez pas les esclaves, car la servitude américaine est encore tellement meurtrière que nos trois millions de nègres, hommes, femmes et enfans, y [312] périront avec le temps, comme les populations d’Indiens que les planteurs et les mineurs espagnols ont dévorées tout entières. »
Il n’y a que des pays à esclaves qui puissent encore fournir à l’homme l’occasion de montrer et d’exercer ainsi les instincts de férocité que développent chez lui les conséquences du despotisme sous toutes les formes. Vous le voyez-bien, il faut faire disparaître l’esclavage de la terre.
Et puisque nous parlons de l’Amérique du nord, disons que ce qui s’y passe est à nos yeux un des spectacles les plus affligeans qu’ait jamais offerts le monde. Le sénat de Washington a déclaré crime de lèse-nation toute proposition tendant à détruire la servitude des noirs ! La république veut garder l’esclavage ! Elle ne se contente pas de violer à la face de l’univers la première loi sur laquelle repose son existence politique, le principe sacré au nom duquel elle a fait sa révolution, en abrutissant ses nègres par tous les moyens imaginables ; elle permet au lynch-law d’outrager chaque jour la civilisation en livrant aux plus ignobles tortures et à des morts dégoûtantes les hommes qui osent revendiquer la liberté pour tous les membres de l’espèce humaine. Il n’est aucune cruauté des âges les plus barbares dont les États à esclaves de l’Amérique du nord ne se soient rendus coupables envers les abolitionistes. On en peut lire le détail dans un article du London and Westminster Review [213]. Les chrétiens ne furent pas plus persécutés par les païens que les ennemis de la servitude ne le sont chez les faux républicains des États-Unis. On m’a demandé deux ou trois fois avec ironie pourquoi je n’allais pas prêcher mes doctrines dans la Virginie, la Caroline ou la Louisiane, comme dans nos colonies. J’ai répondu fort simplement : « Parce que je savais trouver aux colonies de nobles adversaires, et dans la Virginie, la Caroline ou la Louisiane d’atroces sauvages ; parce que je [313] n’ai pas peur d’un duel, le plus grand péril que je pusse courir au milieu des plus fous de nos colons, et que j’ai très peur d’être fouetté, goudronné et pendu. » — Pour moi, je comprime avec effort les sentimens de haine qui m’agitent en pensant à ceux qui défendent ainsi une propriété inique, et je n’hésite pas une minute à l’avouer, aux risques de ce que les hommes faibles penseront de mon âme, je souhaite que ces expéditifs pendeurs soient un jour tous pendus par des esclaves révoltés. À chacun selon ses œuvres. « S’ils ne vous écoutent pas, dit Jésus aux apôtres, secouez en sortant la poussière de vos pieds ; je vous dis en vérité qu’au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traitées moins rigoureusement que cette ville. » (Saint Mathieu, ch. 10, v. 15.)
Mais non, révoquons des paroles de colère, indignes d’une époque de lumière et de charité comme la nôtre. La France, qui donna au monde en 93 le signal de la délivrance des nègres, ne veut pas rester aujourd’hui au-dessous de l’Angleterre. L’évènement qu’elle prépare étouffera les crimes qui nous désolent, par la puissance de sa générosité, et c’est encore une des raisons qui doivent décider les législateurs à en accélérer l’heureux accomplissement. L’émancipation française aura une influence incalculable sur les destins de tous les esclaves noirs du globe ; elle entraînera infailliblement l’émancipation des îles danoises qui n’attendent que nous, et des petites propriétés hollandaises. Il ne restera plus dans l’Archipel que les deux possessions de l’Espagne encore livrées à l’esclavage ; mais comment l’Espagne se refuserait-elle à la voix des nations, la suppliant en faveur des nègres [214] ? Et quand il n’y aura plus d’esclaves dans les Antilles et les Guyane, quand [314]l’Europe entière ajoutera l’énorme poids de ses sympathies aux fervens efforts des abolitionistes des États du nord de l’union américaine, les États du sud pourront-ils, quelque soit leur cruel aveuglement, résister à l’entraînement universel ? Ils le pensent, nous croyons qu’ils se trompent.
§ II.
INCOMPATIBILITÉ DE L’INSTRUCTION RELIGIEUSE OU PRIMAIRE AVEC L’ESCLAVAGE.
Aucune utile modification à la servitude n’est possible. — Les lois existantes donnent à l’esclave la plus grande partie des garanties conciliables avec l’esclavage. — Ordonnance du 5 janvier 1840, et ses résultats. — Les esclaves ne peuvent rien comprendre au catéchisme. — Les colons ne veulent pas permettre que l’on traduise le catéchisme en créole. — Les nègres et beaucoup de créoles croient aux sortilèges et aux amulettes. — Clergé catholique. — Écoles primaires. — Elles sont instituées par la métropole, pour les esclaves, il est défendu par les autorités locales d’y recevoir des esclaves. — Toute éducation, soit religieuse soit morale des esclaves, est dangereuse pour les maîtres.
Personne ne peut se rallier aux moyens d’abolition que nous avons exposés dans le paragraphe précédent, ce serait prolonger indéfiniment l’esclavage, et l’on sait que la France veut autre chose. Cependant les colons effrayés du passage subit de la servitude à la liberté, et rejetant à priori la libération en masse comme inadmissible, flottent entre mille projets, ils cherchent des élémens de transition qu’ils ne parviennent pas à trouver et qu’ils ne trouveront pas parce qu’ils n’y en a pas. — Si l’on ne donne point la liberté complète et absolue, que serait-il possible de faire, législativement parlant, de mieux que ce qui est aujourd’hui ? Rien. Toutes les modifications que l’on pourrait introduire dans le régime de l’esclavage ne dépasseraient point ce qui est déjà fait. L’édit de 1685, connu sous le nom de Code noir, véritable base législative des colonies, n’a point du tout abandonné l’esclave au colon ; il s’est gardé la faculté [315] d’intervenir entre l’un et l’autre, il a toujours fait une distinction pour la chose humaine, parmi les choses dont un planteur a besoin. Il détermine les conditions dans lesquelles on pourra l’employer, il réglemente les pouvoirs du maître, il définit son autorité, avec sa responsabilité, il établit ses devoirs relativement à l’entretien, à la nourriture, à l’instruction religieuse, à la vieillesse, à la maladie des nègres ; il charge les officiers et procureurs de punir les traitemens barbares et inhumains, il pénètre despotiquement dans l’intérieur le plus intime des habitations, il leur fait défense expresse, par exemple, d’employer un économe qui ne serait pas catholique. L’ordonnance de Louis XVI, du 15 octobre 1786, va plus loin, comme nous l’avons déjà dit, elle impose un hôpital à chaque habitation, elle concède un jardin aux esclaves, elle défend de faire travailler les femmes enceintes et les nourrices. Enfin, elle prescrit de nouveau les visites domiciliaires et prononce la peine de mort pour le maître qui aura fait périr un esclave. — La servitude des nègres, il est donc bien certain, ne fut accordée aux colonies qu’avec restriction, on l’avait même colorée de l’utilité dont elle serait à ces malheureux par le moyen de l’instruction religieuse qu’ils devaient recevoir, et le Code noir s’était réservé et consacrait d’une manière formelle (art. 26) le droit de patronage et de visite. Mais c’est précisément le vice radical de la servitude que l’on ne puisse y veiller sans compromettre l’institution et la saper par la base. Aussi fut-on obligé de laisser la loi se taire et de finir par livrer l’esclave à l’autorité absolue du maître [215], C’est pour cela que les créoles oubliant [316] à quelles conditions il leur fut permis de posséder des hommes, ne voient plus dans leurs nègres qu’un meuble absolument identique à tout autre meuble, sur lequel ils ont des pouvoirs que l’on ne peut vérifier sans offenser la justice ; c’est pour cela qu’ils ne croient point que leur propriété pensante soit une propriété exceptionnelle, à laquelle on a mis des restrictions aux droits généraux de la propriété ; c’est pour cela qu’arrivés à ne croire à leur pouvoir domestiques d’autres limites que celles de leurs conscience, ils comparent leur omnipotence à celle du père de famille dans l’antiquité ; c’est pour cela que devenus hauts justiciers depuis des siècles sur leurs domaines, ne rendant de compte à qui que ce soit, accoutumés à un arbitraire dont l’éloignement assurait l’impunité, ils s’irritent orgueilleusement de la moindre intermission métropolitaine ; c’est pour cela qu’aujourd’hui ils se révoltent contre la surveillance ; c’est pour cela enfin qu’ils crièrent à la violation des lois lorsque parut l’ordonnance du 5 janvier 1840.
Que voulait cependant cette ordonnance ? Les parquets des colonies, toujours pleins d’obséquiosité pour leurs justiciables, démontrèrent clairement par un travail fort lucide et abondamment répandu, que ses dispositions ne faisaient que remettre en vigueur des dispositions analogues de la législation coloniale non abrogées, que 1840 n’avait rien innové sur 1685 ; mais la raison a-t-elle aucun empire sur l’esprit de gens prévenus ? Les créoles ne voulurent rien entendre. Retranchés derrière la loi du 24 avril 1832, dont ils font leur charte, parce qu’elle reconnaît leurs droits acquis ; ils arguèrent des consécrations du [317] passé pour légitimer et perpétuer le présent ; et nous les avons vu repousser énergiquement l’acte royal qui essaie une amélioration, bien que leur nouvelle charte (la loi du 24 avril) constate « qu’il existe des améliorations à introduire dans le régime des personnes non libres. »
Soyons juste pourtant, la tardive équité dont le gouvernement use en faveur des esclaves, trouble la sécurité des maîtres et l’on s’explique les répugnances qu’ils y montrent. Si j’étais colon, je ne voudrais pas non plus de l’ordonnance, car son application rigide porterait atteinte à la morne uniformité qui doit présider au régime des ateliers pour qu’ils restent calmes. « Mais va-t-on dire, la France peut-elle encore laisser des hommes à un maître sans veiller plus sur eux que sur des bœufs ou des mulets ? Les colons étant propriétaires d’hommes et pouvant abuser de leurs propriétés, n’est-il pas juste de les tenir en un perpétuel état de suspicion d’arbitraire ? qu’ils en accusent la nature seule de leur propriété. En Europe la régie soumet tous les vignicoles, tous les marchands de vin aux injurieuses vérifications de ce qu’on appelle les rats de cave, pourquoi un habitant s’offenserait-il de la visite d’un procureur du roi ? »
Ce sont là des idées naturelles, saines, qui viennent à tout le monde, et que tout le monde accepterait, mais les colons ne peuvent avoir de telles idées, leur éducation, leur orgueil et leur intérêt ensemble s’y opposent et protestent, en disant : « C’est une nouvelle loi des suspects. Pour protéger nos esclaves, qui n’ont pas besoin de protecteurs, on fait de nous des ilotes. Par ces inutiles mesures on excite l’insubordination des ateliers, on y proyoque et on y entretient des espérances d’émancipation qui ne fermentent déjà que trop pour notre sûreté. » Et les îles, avec ces raisons, se persuadent qu’elles sont victimes de la tyrannie métropolitaine. Aussi, un tiers des planteurs ont-ils complètement refusé de recevoir les visites officielles, et les deux autres tiers ne les ont-ils reçues qu’en protestant contre leur illégalité. Que serait-il arrivé si nous avions un gouvernement doué [318] d’une volonté suivie ? Si les bureaux de la marine savaient ce qu’ils veulent ? On aurait forcé les portes, appelé les gendarmes. Quel désordre alors ! n’était-ce point semer l’esprit de révolte chez les nègres, dont les impatiences se seraient augmentées à voir la loi dompter les maîtres à leur sujet ? Parmi les créoles qui ont résisté, les uns habitués à la mollesse de l’administration, savaient qu’il n’en serait pas davantage, les autres ne comprenaient pas la portée de leur résistance, pour le plus grand nombre, ils ne se dissimulaient nullement qu’ils échauffaient peut-être les germes d’une révolution dont les esclaves prendraient leur part, mais ils n’y voulaient point regarder. Nous avons vu la copie d’une association écrite en style furibond, où l’on jurait sur son honneur et sur celui de ses enfans de repousser à main armée tout ce que l’autorité pourrait tenter pour que force restât à la loi. — Les créoles ont dans la fougue de leurs passions une violence extraordinaire, ils aiment assez la bataille, plus encore le bruit de la bataille, et quelques-uns d’entre eux accepteraient volontiers la gloire de mourir bravement en pareille occasion pour la défense du seuil domestique. Ô folie de l’espèce humaine ! La cause de l’esclavage trouverait aussi des martyrs ! Est-ce bien avec de pareils hommes que réussiront les demi moyens, et peut-on compter sur eux pour favoriser les moindres mesures de transition ?
Maintenant, il nous est facile de prouver que si le ministère ne mettait pas une incurable légèreté dans tous ses actes pour les colonies, il n’aurait jamais décrété les visites de procureurs du roi. Il y a des circonstances de localité dans les îles qui s’opposent à ce que ces visites puissent être en l’état des choses de la moindre utilité. — L’hospitalité créole est si grande, si complète, si généreuse et si générale, qu’elle atteint toutes les classes : riche ou pauvre, artiste, ouvrier ou bourgeois, tout homme qui passe est reçu au salon ou à l’office du planteur, et y reste tant qu’il lui plaît. Il n’y a même presque pas besoin pour cela de lettre d’introduction, le titre de voyageur suffit, et vous pouvez parcourir le pays d’un bout à l’autre pendant des [319] mois entiers, sans avoir une piastre dans la poche. Aussi comme un aubergiste en serait pour ses frais d’installation, il n’existe pas une seule auberge hors des deux villes capitales. Il faut dormir au milieu des champs de cannes, et vivre des oranges qui pendent aux arbres, ou loger et manger chez les planteurs.
Que devient, avec ces nobles habitudes, l’homme de la justice ? Peut-il demander des comptes rigides à celui sous le toit duquel il a reposé ? Sortira-t-il de votre tente (souvent monté sur un de vos chevaux) pour aller exercer des sévérités chez votre frère ? Impossible. On n’a pas d’idée des mœurs des créoles. Cinquante fois il est arrivé que l’habitant, lorsqu’on lui annonçait le procureur du roi, s’avançait jusqu’au seuil et disait à l’officier public : « M. le procureur du roi, je vous défends de mettre les pieds sur mon habitation. Monsieur le voyageur, si vous daignez vous arrêter chez moi, ma maison est à vous. » Et le procureur du roi laissant sa toge à la porte, le voyageur entrait. Que vouliez-vous qu’il fît ? Il avait le soleil des Antilles sur la tête depuis cinq ou six heures, il se trouvait à dix heures de la ville, et il lui en aurait fallu faire encore deux ou trois avant d’atteindre une autre habitation, ou selon toute apparence, pareille réception l’attendait !
Ce ne sont pas des visites trimestrielles qui peuvent être efficaces. En passant, on ne voit rien, on ne peut rien entendre. Comment l’esclave prendrait-il courage à parler ? Il est toujours sous l’œil du maître, il sait qu’à peine le magistrat aurait-il tourné le dos, il serait châtié de son audace, que sa chaîne serait alourdie jusqu’à la prochaine visite, et qu’elle s’alourdirait encore davantage s’il portait plainte une seconde fois. Voilà pourquoi les officiers publics n’ont trouvé quoi que ce soit à reprendre sur les habitations ou on voulait bien les recevoir. Si l’esclavage ne devait cesser et qu’il y eut à examiner d’autre question que celle de son extinction, ce serait un magistrat spécial, à demeure et en permanence dans chaque commune qu’il faudrait établir pour la protection des esclaves. [320] Le patronage par les procureurs du roi et leurs substituts est impossible, et les abolitionistes de bon sens ne rongeront pas plus cet os là que les autres.
Comme appréciation d’une amélioration quelconque à espérer, concurremment avec l’esclavage, il n’est pas sans intérêt de considérer ce qu’à produit l’ordonnance tout entière du 5 janvier. Elle établissait d’abord les visites et le patronage des magistrats. Nous venons de voir de quelle manière il furent reçus, et comment ils pouvaient l’être. Elle disait en outre : « Les ministres des cultes, feront l’enseignement d’un catéchisme spécial au moins une fois par semaine aux enfans esclaves sur les habitations. Les maîtres devront faire conduire ces enfans à l’église le dimanche. » À part ce qu’il y a d’étrange dans un pays ou tous les cultes sont libres, à forcer les citoyens d’une province d’élever leurs serviteurs dans une religion plutôt que dans une autre, que signifie cette instruction religieuse avec les fausses idées qu’un esclave, misérable, abruti, peut prendre des choses spirituelles ? Tout ce qu’on lui expliquera sur la puissance d’un créateur et l’immensité de la création, ne dépassera-t-il point la portée circonscrite de son esprit ? disons-le sans périphrase, l’instruction religieuse pour des esclaves est une utopie, sa propagation est une impossibilité. Et nous allons le prouver.
Quel est le moyen employé pour instruire religieusement les nègres ? c’est de leur apprendre le catéchisme. Or, voici quelques phrases de ce catéchisme « fait exprès à l’usage des paroisses des colonies françaises, et approuvé par la sacrée propagande. »
« Qu’est-ce que Dieu ? — Dieu est un esprit éternel, infini, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et le souverain Seigneur de toutes choses. — Pourquoi dites-vous que Dieu est un esprit ? — Je dis que Dieu est un esprit, parce qu’il n’a ni corps, ni figure, ni couleur, et qu’il ne peut être aperçu ni touché par les sens. — Combien y a-t-il de personnes en Dieu ? Trois. — Ces trois personnes sont-elles trois dieux ? — Non, ces [321] trois personnes distinctes ne font qu’un seul Dieu qu’on appelle la Sainte-Trinité. — Comment ces trois personnes ne font-elles qu’un seul Dieu ? — Parce qu’elles ne sont qu’une même nature une seule et même divinité. — Pouvons-nous comprendre cela ? — Non, c’est un mystère, mais nous devons le croire parce que c’est Dieu qui nous l’a révélé. »
Tel est ce que l’on enseigne aux nègres, aux esclaves et à leurs enfans ! À de pauvres gens qui n’ont jamais usé de leurs facultés réflectives ! J’ai vu sur les habitations, les belles filles blanches se donner la peine de mettre tous ces mots dans la mémoire des marmailles assemblés autour d’elles, et quelques-uns d’eux les répéter assez couramment. Ces enfans noirs font ce que pour mon compte je me déclare incapable de faire, ils apprennent par cœur sept ou huit pages d’une langue qu’ils ne comprennent pas, car il ne faut point l’oublier, les nègres et surtout les négrillons n’entendent pas le français, ils ne parlent que créole. Voyez de quel profit le catéchisme à l’usage des colonies peut être pour leurs sentimens religieux ! Ils n’y trouvent qu’une lettre morte, pour eux privée de tout sens, et confondant par fois une réponse avec l’autre, ils répliquent lorsqu’on leur demande par exemple combien il y a de personnes en Dieu ? — Trois : la foi, l’espérance et la charité. »
Ce n’est pas que nous accusions les bonnes jeunes filles qui enseignent, de se borner à mettre des mots dans la tête de leurs élèves, elles ne peuvent autre chose. Le catéchisme est presqu’impossible à traduire en créole, les expressions d’un langage naturellement très borné et sans aucune formule métaphysique, font défaut pour rendre des idées si subtiles, que les hommes les plus forts d’entre nous deviennent insensés à vouloir les approfondir. Il nous a été dit que malgré ces difficultés le curé du Carbet (Martinique), M. l’abbé Goux, était parvenu à faire une traduction du catéchisme, mais on ne voudra peut être pas croire ce qui est arrivé, et pourtant cela est vrai, il lui a été interdit par l’autorité supérieure de la publier. — Les conseils coloniaux ont voté des fonds avec un certain éclat [322] pour l’instruction religieuse dans les colonies, ils demandent que l’on enseigne l’évangile à leurs esclaves, mais ils ne veulent pas que leurs esclaves le comprennent. Et nous serions créoles, nous aurions les habitudes et l’éducation créoles, nous serions soumis aux nécessités créoles, que nous ne le voudrions pas non plus. Tout-à-l’heure on verra pourquoi.
Une douzaine de prêtres accordés à des populations de cent mille âmes répandues sur des espaces considérables, peuvent prêter quelques phrases aux défenseurs des colons, mais ne sont en réalité d’aucune valeur effective, et le moindre défaut de l’ordonnance est d’être inexécutable [216]. Elle décrète que chaque atelier enverra le dimanche ses enfans à l’église de la paroisse pour y être examinés sur le catéchisme. Eh bien ! beaucoup d’ateliers se trouvent à deux et trois lieues du bourg où est l’église ! Fera-t-on faire six lieues par jour à des enfans de cinq à quatorze ans ?
En résumé, ce que les esclaves ont appris et pourraient apprendre du christianisme, n’a véritablement servi, et ne servirait qu’à leur fausser le jugement ; c’est l’effet que les pratiques religieuses ont produit dans les basses classes des peuples européens ; c’est l’effet qu’elles produiront sur toute race ignorante. Le dimanche, les églises regorgent de nègres et surtout de négresses ; ils ont toujours le nom de Dieu à la bouche, ils décrivent régulièrement un signe de croix sur le pain qu’ils entament ou l’ouvrage qu’ils commencent ; mais ils ne savent ce qu’ils disent, ni ce qu’ils font. Ils ont de la superstition au lieu de religion. Ils ne comprennent pas Dieu, et se servent de lui à peu près comme on se sert d’un charme ; ils le font intervenir dans leurs moindres embarras. — Nous nous souvenons d’une affaire de vol jugée, devant nous, à la Cour d’assise de Saint-Pierre. La première chose qu’avait faite la femme volée en s’apercevant du larcin, avait été de courir à [323] l’église et de commander une messe pour obtenir la découverte du voleur. Une jeune fille de couleur ayant à se plaindre d’un homme qui venait de s’embarquer, fit dire des messes pour demander au Tout-Puissant le naufrage du navire qui portait son parjure. Les habitans de plusieurs côtes sauvages d’Europe ne s’y prennent pas autrement, quand de leur rivage ils voient un vaisseau dont ils convoitent les dépouilles. Les nègres croient aux sortiléges, aux ombies (revenans), et aux maléfices, comme un paysan français : voilà le fait. Aussi ceux d’entre les blancs qui n’y croient pas, ceux qui ne se chargent point de grigris [217] pour aller se battre en duel, se moquent-ils beaucoup de l’instruction religieuse qu’on prétend donner au noir, et ne parlent-ils que de son naturel superstitieux ou de ses instincts d’idolâtre. — Cela n’empêche pas quelques nègres de faire assez souvent justice des choses bizarres qu’on veut leur mettre dans la tête, témoin celui auquel son curé disait : « Honorez Dieu, il fait pousser votre manioc » ; et qui répondit : « Temps pedu, pai Bautin ; si moin pas qu’a planté li, li pas qu’a jamais poussé. » Temps perdu, père Bautin, si je ne l’avais pas planté, il n’aurait jamais poussé.
En conscience, nous ne savons ce que l’on espère de cette prétendue éducation religieuse que l’on dit indispensable au nègre pour en faire un homme libre ; nous ne pouvons y voir qu’un moyen dilatoire de la part de ceux qui en font une condition préalable de l’affranchissement. Si, avant de l’appeler à l’indépendance, on tient à ce qu’il soit un peu moins ignorant que le matelot français, il en a pour dix-huit cents ans d’apprentissage ; car tous les matelots français portent des amulettes au cou, et sifflent encore quand il fait calme pour appeler la brise.
Ce ne sont point des instructions religieuses qu’il faut aux esclaves, ce sont des instructions morales. Ce qui est nécessaire, c’est de leur enseigner les devoirs de l’honnête homme et du [324] bon citoyen, de leur inculquer le sentiment de la dignité humaine, le goût du mariage avec la fidélité à une seule femme et réciproquement à un seul homme, comme progrès sur la promiscuité ; enfin l’amour de l’ordre, la tempérance et l’indispensabilité du travail régulier. Mais le clergé catholique n’est-il pas trop exclusivement occupé du dogme de sa croyance, pour remplir cette tâche véritablement sainte ? Le clergé catholique a perdu l’ardent amour du prochain, la sympathie profonde pour les affligés, qui fit sa gloire et son triomphe. Toute la religion pour lui se borne maintenant à de certaines pratiques de culte. Le clergé protestant s’est mis en Angleterre à la tête de la croisade contre les partisans de l’esclavage, et son infatigable zèle a fait descendre et pénétrer la haine du monstre jusque dans les rangs les plus obscurs de la société. Que firent alors et que font nos prêtres catholiques ? Quelle chaire a retenti d’anathème contre les brigandages de la traite et contre les corrupteurs de la population nègre des Antilles ? De tous ces éloquens et jeunes prédicateurs qui ont surgi, en est-il un seul qui se soit attaché à la cause des frères noirs opprimés, un seul qui se soit souvenu que le Seigneur l’avait tiré de la terre d’Égypte ? Non. Pas une voix consacrée ne s’est fait entendre en faveur des esclaves !!! La France a cependant trente mille ecclésiastiques, et la moitié de ces trente mille appartient à la génération nouvelle. Notre clergé a forfait au plus saint de ses devoirs, il a déserté l’étendard sur lequel le sublime fondateur de la religion de la majorité des Français avait écrit : Charité.
C’est malheureusement une chose trop certaine, les prêtres aux colonies ne remplissent pas leur mission, ils se laissent lier la langue par la servitude, ils se contentent de prêcher la résignation ; la résignation ! vertu d’esclave et d’invalide ; ils veulent toujours craindre d’ébranler par un mot le chancelant édifice de l’esclavage. Tout ce qui blesserait le système colonial, c’est-à-dire tout le côté moral de la foi, ils se l’interdisent : la parole de vérité n’est offerte aux esclaves que faussée et [325] tronquée ; car les colons, tout en soutenant la stupidité native des nègres, les supposent capables de saisir un mot dans un discours. — Nous avons entendu un curé demander en pleine église à un nègre auquel il faisait subir l’examen du catéchisme : « Quel est le commandement de Dieu qui ordonne à l’esclave de respecter son maître ? » On peut penser si le pauvre nègre fut interdit. Enfin le prêtre déclara que c’était le quatrième : « Tes père et mère honoreras ! » Jugez des autres par celui-là, car celui-là est un des plus progressifs ; c’est M. Lamarche, curé de l’église Saint-François à la Basse-Terre, homme si hardi, qu’il a eu la témérité de faire carillonner et de chanter le Veni Creator à des mariages d’esclaves. Jusqu’alors l’église coloniale ne pensait pas que les esclaves méritassent la peine qu’on sonnât les cloches à grandes volées, ni qu’on appelât sur eux l’esprit créateur.
Ce n’est pas qu’il n’y ait dans le clergé des colonies quelques hommes capables de comprendre leurs devoirs, et assez courageux pour faire entendre des vérités d’une rare audace, comme celles que prononça l’abbé Marchesi, curé de la Basse-Pointe, le jour de la fête. — M. Marchesi avait commencé depuis quelques semaines une histoire de l’Ancien-Testament, et il en était juste ce jour-là à la sortie d’Égypte. La sortie d’Égypte, c’est la première révolte d’esclaves dont l’histoire nous ait gardé le souvenir ; on y voit écrit par la main de Moïse, en lettres de colère, ce que l’on voit et verra dans toute révolte d’esclaves : la duplicité, le vol et l’assassinat. Un tel sujet était scabreux à traiter devant une assemblée de maîtres et d’esclaves. L’abbé Marchesi l’aborda avec une netteté sans réserve.
« Les Hébreux sortirent d’esclavage vainqueurs de leurs maîtres », dit-il d’abord, puis reprenant la fameuse proposition de saint Augustin dans ses commentaires du Pentateuque, il ajouta plus loin, « et Dieu qui dispose à son gré des biens de la terre envers qui il lui plaît, leur permit d’emporter les richesses des Égyptiens en compensation des douleurs qu’ils avaient éprouvées. » [326]
Les blancs qui assistaient à ce discours le tolérèrent, parce qu’ils étaient bien disposés, parce que M. Marchesi s’est fait une réputation de bonté et de fermeté, parce qu’il y a dix ans qu’il est dans le pays, mais qu’un seul colon s’en fut formalisé et M. Marchesi courait risque de la déportation. Toutes les âmes ne sont pas trempées de sorte à braver cette chance à laquelle n’ont point échappé MM. Perron, Aigniel et d’autres, qui pour avoir voulu être de véritables apôtres de la charité universelle, furent solitairement embarqués sans que le corps ecclésiastique se soit assemblé pour les défendre contre l’omnipotence blanche.
Le petit nombre d’hommes qui veulent être les serviteurs de Jésus et non pas les serviteurs des colons, sont ainsi expulsés par ordre ou s’éloignent pour ne point approuver même de leur silence, des actes contraires à la loi chrétienne. N’est-ce pas pour cette cause que M. Dugoujon, un homme calme cependant, réservé, modeste, ne demandant pas à faire de bruit, s’est retiré de la Guadeloupe ? M. Goubert n’a-t-il pas de même été forcé par l’animadversion des planteurs de s’embarquer. On prétend aujourd’hui que M. Goubert est un prêtre immoral, parce qu’il s’est marié depuis son retour en France, il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus, mais ce n’est point le lieu ; nous demanderons seulement pourquoi on ne s’était pas aperçu de son immoralité avant qu’il se prononçât à une instruction de première communion sur toute la vanité de l’aristocratie de la peau et sur la valeur de l’esclavage [218] ? [327] Nous avons regret de le dire, mais nous jugeons qu’il n’y a pas de bons prêtres aux colonies. Ils acceptent tous le fait es [328] clave [219]. Il n’y ont rien changé, rien modifié, ils ont tous peur de se faire embarquer, ils ne veulent point s’exposer à souffrir pour la vérité. Ils vivent tous chez les maîtres au lieu de vivre avec les esclaves, et quand on connaît les colonies, c’est une plainte qui paraît étrange de leur entendre dire qu’ils ne peu [329] vent rien faire, parce qu’ils compromettraient la sécurité des maîtres.
Vaut-il donc mieux laisser se perpétuer la misère et l’oppression des esclaves ? Sont-ce là les nouvelles doctrines des apôtres du Christ ? Nous comprenons très bien que les créoles veuillent empêcher les prêtres de parler, mais nous ne comprenons pas que les prêtres consentent à se taire. N’y a-t-il après tout que les esclaves qui puissent exciter le courage des missionnaires ? Ils ne peuvent leur dire la vérité ; eh bien ! que ne la disent-ils au moins aux maîtres ? Que ne leur enseignent-ils haut, fort, énergiquement, sans crainte, que le premier devoir d’un chrétien moderne est de renoncer à posséder des esclaves ? Les blancs sont en morale dans des ténèbres aussi profondes que celles où se trouvent les nègres ; l’éducation des maîtres est tout entière à faire, comme celle des esclaves. Pourquoi les prêtres l’oublient-ils ? Est-il donc vrai que la foi n’est plus, et que le temps des martyrs est passé !
Le zèle apostolique se trouvant réduit à de telles froideurs, tant que l’administration soumise aux influences locales comme elle l’est, conservera le pouvoir d’embarquer à son gré et sans jugement un prêtre pour un sermon ; on n’aura aux colonies que des ecclésiastiques, sinon ouvertement coupables, du [330] moins sans valeur et vite découragés par le mutisme auquel ils sont astreints.
Inextricables difficultés ! au milieu de ce monde à esclaves, de quelque côté qu’on se retourne, on se heurte contre d’invincibles obstacles. On désire que les prêtres ne se laissent pas imposer silence, et l’on conçoit que les créoles leur ferment la bouche. En fait, les créoles agissent rationnellement ; le jour où les nègres comprendraient la fraternité universelle du christianisme, où ils entendraient la parole égalitaire d’un Savonarola, ce jour-là l’empire des colons serait détruit, leurs esclaves ne consentiraient plus à rester esclaves !… Quelle association que cette association coloniale ! La morale de l’évangile y est dangereuse !
Liberté, liberté donc pour tous ! C’est dans l’intérêt de tous que nous la demandons, tous souffrent là où règne l’esclavage. « Quel salut, dit l’Hospital, peut-on espérer, la liberté étant ôtée à l’homme ? La liberté et la vie vont d’un même pas, la liberté est l’élément hors duquel nous ne vivons plus qu’en langueur. »
Rendons justice aux conseils coloniaux, s’ils ont voté des fonds pour augmenter le nombre des prêtres qu’ils savaient ne pouvoir rendre aucun service, ils ont aussi demandé des écoles primaires dont ils savaient l’établissement impraticable. Quatorze frères de Ploërmel venaient d’arriver aux Antilles françaises au moment où nous les visitâmes, ils fonctionnaient déjà à Saint-Pierre ; à Fort-Royal, à la Basse-Terre et à la Pointe-à-Pitre, cela est vrai. L’ordonnance dit que les maîtres auront la faculté d’envoyer là leurs enfans esclaves. Cela est vrai encore, mais ce qui est vrai aussi, c’est qu’il est défendu aux chefs d’écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave.
Est-ce parce que la classe de couleur a trop de préjugés pour consentir jamais à ce que ses enfans prennent place sur des bancs où seraient assis des esclaves ? Est-ce parce que des esclaves qui savent lire deviennent de mauvais esclaves ?
On y peut réfléchir, mais en tous cas, lors même que les colo [331] nies auraient des gouverneurs capables de faire exécuter la loi qu’ils sont chargés de maintenir, cela ne servirait à rien. À la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l’âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux, et les maîtres, pour cette raison comme pour mille autres, n’enverront jamais leurs négrillons à l’école.
L’ordonnance dit encore que les instituteurs d’enseignement primaire devront aller chez les planteurs quand ils en seront requis pour donner l’instruction aux esclaves. En vérité s’il ne s’agissait de choses éminemment sérieuses, de l’enfance et de son éducation, ne croirait-on pas que c’est une moquerie ? Que peuvent sept pauvres maîtres d’école pour des populations de cent et cent vingt mille âmes ?
En somme les frères de la Basse-Terre ont 160 élèves,
| Ceux de la Pointe-à-Pitre | 240 |
| Ceux de Saint-Pierre | 220 |
| Et ceux de Fort-Royal | 200 |
| 820 |
joignez à ce nombre un nombre peut-être égal qui se trouve dans les écoles mutuelles, voilà quinze à seize cents enfans qui reçoivent une éducation gratuite dans nos îles ! et parmi eux il n’y a pas un esclave, bien que l’on prétende que les gens de Ploërmel aient été envoyés pour préparer les esclaves à l’indépendance !
L’administration, au surplus, toujours d’accord avec l’esprit colonial, n’a aucunement aidé les jeunes instituteurs ; ils font des efforts dont leurs pupilles commencent à profiter [220], [332] surtout ceux de la Guadeloupe ; mais ils agissent dans l’obscurité la plus profonde. On ne s’est pas occupé de les établir convenablement, dans l’une et l’autre colonie ils sont si petitement logés, qu’ils ne peuvent recevoir tous les enfans qui se présentent. À Fort-Royal, leur classe donne sur la savane, et participe à tous les bruits de ce centre du commerce. Nulle part on n’a choisi de maison où il y eut une cour propre aux récréations. Rien n’a été fait pour donner quelqu’éclat à leur emploi. Jamais aucune autorité n’est venue en présidant une distribution des prix, rehausser aux yeux du peuple l’importance de créations aussi moralisatrices. Enfin, le ministère de la marine avait aussi envoyé pour les jeunes filles des deux îles quatorze sœurs de saint Joseph ; mais ces dames sont restées toutes les quatorze au couvent de la Guadeloupe où, à notre départ, elles attendaient encore, depuis sept ou huit mois, que les gouverneurs leur donnassent les moyens de s’utiliser !
On peut nous en croire, si l’on ne rend les nègres à eux-mêmes que quand ils seront perfectionnés par l’éducation, ils sont condamnés à demeurer éternellement esclaves. Et les colons le savent bien, c’est pour cela qu’ils nous répètent sans cesse. « Avant de les faire libres rendez-les aptes à la liberté. » Leur refusant la liberté parce qu’ils sont ignorans, ils ne veulent pas qu’ils cessent de l’être, et ils s’opposeront toujours à un système réglé d’enseignement, bien que leurs soins à le proscrire fasse naître de grands doutes sur la stupidité naturelle dont ils ont gratifié leurs esclaves. Il leur importe trop de pouvoir dire que le nègre n’est pas en état de jouir de la liberté, pour consentir à l’y préparer jamais.
Une chose même qui nous surprend, c’est que le ministère de la marine ait fait semblant de croire à la possibilité de préparations morales pour des hommes placés en servitude ; à la compatibilité de la culture de l’esprit avec la servitude ou toute autre condition analogue.
Comment les conseils de France peuvent-ils supposer que les propriétaires seront assez fous pour instruire leurs esclaves ? [333] Mais on ne leur a donc pas appris que les propriétaires du sud de l’union américaine, et ceux-là savent ce que c’est qu’esclavage, ont prononcé des amendes énormes ou des peines considérables [221] contre celui qui enseignerait à lire ou à écrire à des nègres. Bonaparte ne voulait pas être le cochon à l’engrais de Sieyès, un nègre fait homme par l’instruction primaire consentirait-il à rester bête de somme ? Dès qu’il penserait, le bien-être matériel ne lui suffirait plus ; sachant lire, il étudierait des faits historiques dont la résultante serait de ne point laisser deux jours d’existence à la servitude ; mis en état de réfléchir, d’apprécier la nature des droits qu’on a sur lui, il ne tarderait pas à battre de ses fers avec mépris celui qui aurait osé l’en charger. C’est dans ce sens que M. Levassor Delatouche nous disait : « Nous ne voulons pas, et il ne faut pas que nos esclaves sachent lire. » M. Levassor avait raison, non il ne faut pas que les esclaves sachent lire. Aucun élément de régénération approprié à leur situation ne peut être offert à des ilotes ; il n’y a point pour eux de régime intermédiaire ; leur état moral ne doit pas être changé, car c’est l’ignorance même où ils sont plongés, qui fait la garantie du maître : toute amélioration dans leur sort intellectuel ne peut être que de nature à diminuer leur indifférence, et par suite à compromettre la tranquillité générale. Nous avons eu cent fois l’occasion de le voir, c’est le propre d’un principe mauvais de n’offrir que des conséquences mauvaises. Il n’y a précisément rien entre l’esclavage et la liberté !
En résumé et quoiqu’on puisse penser d’ailleurs, l’inutilité [334]de petites mesures mesquines et privées d’ensemble, comme celles des ordonnances du 15 janvier ou du 16 septembre, insoucieusement ordonnées par le ministère et plus insoucieusement mises à exécution par le pouvoir colonial, est aujourd’hui démontrée pour tous les gens de bonne foi et de bon sens. Il vaudrait mieux ne rien faire. Elles ne servent qu’à échauffer les haines entre les diverses classes qui s’en fabriquent des brandons de nouvelles discordes.
Il n’y a que l’abolition en masse qui puisse étouffer les dissensions intestines dont nous venons de parler, et conjurer les malheurs qu’elles annoncent, c’est notre opinion et nous espérons pouvoir la faire partager au lecteur.
§ III.
AFFRANCHISSEMENT SUCCESSIF PAR LE RACHAT DES ENFANS.
Un enfant coûte assez cher à son maître. — Des esclaves ne peuvent élever des hommes libres.
Auparavant, examinons les autres modes d’état intermédiaire que plusieurs croient opportun d’instituer pour passer de l’esclavage à la liberté, analysons les diverses combinaisons que l’on suppose compatibles avec la justice et ce que l’on appelle la prudence.
Pour cela nous n’avons rien de mieux à faire que d’examiner les systèmes sur lesquels la commission, appelée Commission Broglie, a demandé des renseignemens au ministère.
Premier système : « Émancipation partielle, progressive. On affranchit d’avance les enfans à naître, moyennant une indemnité modique ; on les laisse aux soins de leurs parens dans la condition d’apprentis, leur travail étant acquis au maître jusqu’à un âge déterminé. On attribue en même temps à chaque esclave déjà né, le pécule dont les usages coloniaux lui assurent [335]la jouissance, on l’autorise enfin à racheter à prix débattu sa liberté au moyen de ses économies. Chaque esclave arrive ainsi successivement à la liberté pour prix de son travail et de sa bonne conduite. »
Nous avons toujours beaucoup de répugnance à raisonner dans le sens de l’esclavage. Cette loi qui frappe de servitude le sein d’une femme, et lui dit : « Le fruit de tes entrailles est maudit [222], » nous paraît hideuse. À nos yeux tout enfant qui vient au monde est libre, son maître n’a pas plus de droits véritables sur lui que sur sa mère. Mais nous sommes condamné à prendre les choses telles qu’elles sont. Allons donc jusqu’au bout. — D’abord on ne peut affranchir les enfans à naître moyennant une somme modique. Un enfant nouveau-né coûte assez cher à son maître, de même qu’un poulain à son éleveur. La négresse qui se déclare enceinte cesse de travailler comme les autres. Cinquante ou soixante jours avant et quarante jours après ses couches, elle ne fait absolument rien, elle reste à la case et reçoit l’ordinaire ; durant toute l’année qu’elle est nourrice, elle va au travail une heure après et en revient une heure avant les autres.
Ces usages aussi humains que conservateurs de la propriété nègre, nous les avons trouvés établis sur toutes les habitations [223]. Cela est si vrai que la fécondité des esclaves femelles [336] est une véritable charge, on peut dire une calamité pour les petits propriétaires nécessiteux. Ils ne veulent pas forcer la femme enceinte ou nourrice, de crainte de la perdre ; ils [337] doivent, bon gré mal gré se priver de son travail, et son fruit est trop long à mûrir pour être autre chose qu’un embarras. Le nègre est un outil quelque peu pareil aux machines à vapeur où il faut de grands capitaux pour en tirer profit. — Quel a été un des vices les plus signalés de l’apprentissage anglais ? Que reprochait-on le plus vivement aux maîtres ? C’est que sachant qu’ils perdaient leurs droits sur les esclaves au bout de sept années, ils ne craignaient aucunement de les excéder et voulaient obliger les femmes enceintes ou nourrices à ne pas abandonner leur tâche, pendant que celles-ci, de leur côté, abusant de même de l’état mixte où l’on se trouvait, prétendaient ne plus rien faire.
Le rachat au berceau ne donnera donc que fort peu d’économie d’abord, et deviendra fort onéreux ensuite. Effectivement, l’esclave ne pouvant nourrir ni vêtir son enfant, le projet en laisse la charge au maître, et c’est pour cela sans doute qu’on abandonne à ce maître le travail de l’apprenti ; mais alors, où ce jeune apprenti, ce nouveau citoyen prendra-t-il la faculté d’aller à l’école ? ne sait-on pas que sur les habitations, les marmailles, selon le terme d’usage, sont utilisés vers l’âge de six ans, à l’époque même où ils peuvent commencer leur éducation primaire. Supposons une minute qu’il soit possible de tourner ces embarras et qu’on achète l’enfant, supposons qu’on puisse parer à la fraude qui présentera comme esclaves des enfans nés libres, afin de gagner l’indemnité. Que va-t-on en faire ? Les laisser à la garde de leurs parens ! c’est-à-dire que l’on abandonne à des esclaves le soin d’élever des citoyens, et que le fils soustrait par ses prérogatives de libre à l’infamie des châtimens corporels, y verra son père et sa mère soumis tous les jours ! Ne serait-ce pas monstrueux ? Et remarquez encore que l’on donne à l’enfant par droit de naissance une liberté que le père et la mère ne peuvent acquérir que par le travail. Singulier moyen pour créer l’esprit de famille dans la race nègre ! quel autre pourrait-on employer si l’on tenait à faire naître l’envie du père contre le fils, et le mépris du [338]fils à l’égard du père ? Il y a lieu de s’étonner que la commission ait cru devoir demander des lumières sur le mode d’affranchissement auquel M. Passy a donné son nom, Depuis long-temps ce mode est réputé impraticable. Si l’on nous objectait que nous le proposâmes nous même il y a huit ans [224], nous répondrions en toute humilité qu’un examen plus mûr des circonstances environnantes nous y a fait renoncer. Une autre preuve encore que ce projet n’est pas bon, c’est que les créoles pur sang disent qu’il est le meilleur. Ils ont raison dans leur sens : de tous les moyens d’abolir, c’est celui qui abolit le moins.
§ IV.
RACHAT FORCÉ PAR LE MOYEN DU PÉCULE.
Les maîtres ne veulent pas du rachat forcé. — Tous les esclaves ne sont pas à même de se faire un pécule. — Le rachat par le pécule nuit à l’établissement spontané du travail libre. — Le maître, s’il le veut, peut empêcher un esclave de gagner de l’argent. — L’esclave ne doit pas payer sa liberté, on lui devrait plutôt donner une indemnité pour tout le temps ou il a été retenu en esclavage.
Le complément de ce premier système est le rachat forcé au moyen du pécule devenu légal. Tous les conseils coloniaux l’ont énergiquement repoussé. « Le pécule légal et le rachat forcé, a dit la commission de la Guadeloupe, n’auraient ni le concours du conseil, ni l’assentiment des colons. Imposés par la force, ils ne trouveraient d’appui que dans la force. » La principale raison que l’on donne de cette répugnance si formelle, c’est que le rachat forcé amènerait la ruine des ateliers, parce que les bons sujets, les hommes capables, se rachèteraient et qu’il ne resterait que les cravates. Peser la valeur d’une telle fin de non recevoir à l’égard d’un pauvre esclave, [339] qui par de rudes économies est parvenu à ramasser de quoi payer son cadavre, cela est inutile ici : il ne s’agit pas de savoir ce qui est bien, il s’agit de constater ce qui est. Les créoles ne voulant pas à tort ou à raison du rachat forcé, il faudra en venir à des arbitrages dans lesquels le maître perd le prestige dont il est entouré, ou bien arrêter un maximum et un minimum de prix dont la fixation ne peut satisfaire personne, et qui engendre des mécontentemens et des procès. N’oublions pas ensuite que toute mesure, mesure de détail s’entend, à laquelle les maîtres seront antipathiques, deviendra d’une exécution très difficile.
Dans l’espèce, il est aisé d’établir que l’application serait à peu de chose près impossible, et que jamais l’esclavage ne pourra finir comme on l’espère par le rachat forcé. Quoi qu’on dise de l’amélioration du sort matériel de l’esclave, quoi que nous en ayons dit nous même avec sincérité, il est un nombre infini d’esclaves qui seront toujours hors d’état de former un pécule assez gros pour se rédimer ; les femmes, la plupart des nègres de villes, ceux attachés au service des maîtres n’y sauraient atteindre ni par la culture du jardin ni par leurs profits. Rappelons en outre que le nègre suit la fortune de son possesseur, et qu’il est pauvre chez un propriétaire pauvre. Il y aurait donc un fonds de population qui resterait éternellement, invinciblement attaché à la servitude, et dont il faudrait craindre un jour le désespoir ou la jalousie. Que si vous dites : Il n’est pas indispensable d’attendre jusqu’aux derniers, on affranchira en masse lorsqu’on sera assez fort, vous n’échappez plus à la commotion tant redoutée d’un affranchissement simultané, et vous consacrez de plus une iniquité révoltante, celle de faire payer à de bons sujets ce que vous donnez gratuitement à des hommes moins intelligens ou moins laborieux. — Notons en passant que dans ce système, l’esclave qui a les habitudes les plus morales, celui qui, marié ou non, vit en ménage et soigne ses enfans, se trouve être précisément celui qui a le moins de moyens de payer [340] sa rançon, car il est obligé de faire des sacrifices pour l’entretien des enfans auxquels le maître ne donne que l’indispensable ; et s’il songe à la liberté pour lui-même, il lui faut amasser de quoi acquérir aussi celle de sa femme et des pauvres petites créatures qui lui doivent le jour. On a déjà aujourd’hui par l’expérience de ce qui se passe, la preuve de ce que nous disons. Plusieurs nègres jugeant impossible de se racheter eux et leur famille, se contentent généreusement de racheter leurs enfans.
Une chose nous effraie encore dans le rachat forcé, c’est qu’il dégarnit les ateliers de leurs plus utiles sujets, sans que la nouvelle discipline qui appliquée en grand maintiendrait le travail, puisse être employée. Il recule ainsi d’autant la solution du problème, la conciliation du travail avec la liberté. Tout ce qui détourne de la culture les libres actuels, saisirait à mesure les nouveaux émancipés ; il ne faut pas croire en effet qu’un affranchi consente jamais à manier la houe tant qu’il restera un esclave pour y toucher.
Il est un point sur lequel on ne s’appesantit pas assez lorsqu’on parle du rachat forcé, c’est que l’esclave ne peut y atteindre que par la voie du pécule, et qu’il sera toujours fort aisé à l’habitant de l’empêcher d’en faire un. Le pécule est sacré et il n’est pas besoin de lui créer un titre légal ; tout le monde le respecte, et celui qui ne le respecterait pas, serait déshonoré. Mais comment l’esclave le peut-il former ? En cultivant son jardin. Or, son jardin qui le lui donne, ou plutôt qui le lui prête ? Le maître. Le jour donc où le maître regardera le pécule de l’esclave comme funeste à ses propres intérêts, il lui retirera le jardin et l’esclave restera privé même des moyens qu’il avait d’adoucir sa triste et monotone destinée. La commission de la Guadeloupe ne s’en est pas cachée. « Dans l’état des choses, a-t-elle dit, il est de l’intérêt du maître que l’esclave soit riche (elle aurait pu ajouter que plusieurs y mettent leur amour-propre), aussi lui procure-t-il autant qu’il est en lui le moyen d’acquérir ; mais quand viendront le pécule légal et le rachat forcé, il aura un [341] intérêt contraire, et il s’efforcera d’empêcher que l’esclave ne puisse amasser. » C’est comme cela que les propriétaires espagnols ont annihilé la loi du rachat forcé qui est établi chez eux depuis plus d’un siècle. Ils ne donnent pas de jardin ni de samedi pour qu’il n’y ait point de pécule, et les esclaves, dans l’impossibilité de tirer aucun bénéfice de la loi, perdent les avantages de la tolérance.
Les propriétaires français feront comme les Espagnols. L’ordonnance du 15 octobre 1786 les oblige à concéder le jardin à leurs nègres, il est vrai, mais ce n’est et ce ne peut être qu’une concession appliquée à un cas spécial. Ou il faudra acheter la terre accordée aux esclaves, et probablement les maîtres ne voudront pas la vendre, ou il faudra les forcer législativement à la donner, et alors ils se plaindront avec raison d’être dépouillés injustement.
Mais, pour en finir, n’est-ce pas trop demander vraiment à un misérable esclave accoutumé depuis sa naissance à voir subvenir à ses besoins, livré sans contrepoids à l’entraînement de tous ses instincts, n’est-ce pas trop demander que d’exiger de lui assez d’énergie de volonté pour résister pendant des années à la voix de ces instincts mêmes, et pour économiser à force de privation l’argent qu’il gagnera ? Qui d’entre nous et je parle des meilleurs, ne mange pas souvent au-delà de ses revenus ? La modération, n’est-ce pas la plus éminente vertu des sages ? Comment oserait-on la demander à des esclaves ? Monseigneur, dit Figaro au comte Almaviva, aux vertus qu’on exige d’un serviteur, connaissez-vous bien des maîtres qui soient dignes d’être valets.
Nous sommes entré dans ces détails afin de montrer les difficultés matérielles de la proposition, nous aurions pu nous en dispenser : le rachat par le pécule, en dehors de tous ces raisonnemens doit être repoussé parce qu’il est profondément immoral. Nous regardons comme un attentat à l’équité de forcer un homme, dont on a disposé malgré lui, à payer pour reprendre la libre disposition de soi-même, de le forcer, [342] cet homme que la violence ou sa naissance ont fait esclave contre le droit commun, à donner de l’argent pour rentrer dans la jouissance du droit commun. Ô l’effroyable invention ! Obliger les nègres à se racheter eux-mêmes ! Mais qu’auriez-vous donc à répondre si un esclave montant à la tribune, furtivement, comme un esclave, et découvrant sa poitrine chargée des ignobles cicatrices du fouet, venait dire à la France parlementaire : « Vous exigez que je vous donne 1,000 francs pour ma liberté, et moi au nom de l’espèce humaine dont la majesté a été odieusement, lâchement violée dans ma personne, je demande 30,000 fr. d’indemnité pour les trente ans que j’ai passés en servitude ! »
§ V.
RACHAT PAR L’ÉTAT.
L’État possesseur et loueur d’esclaves est une conception profondément immorale. — Dans cette hypothèse, comment peut-on régler le sort des 45,000 esclaves de villes et de bourgs ?
Voyons maintenant le deuxième système proposé, celui de l’émancipation simultanée par voie de rachat et au nom de l’état ; c’est à peu près le système proposé par la dernière commission de la chambre des députés. « Les colons sont dépossédés avec indemnité ; l’état, pendant une période de temps déterminée, se substitue à leur place, loue aux anciens maîtres le travail des esclaves et prélève sur le salaire de ceux-ci une somme suffisante pour se couvrir peu à peu de ses avances, en établissant un amortissement. »
Quel autre qu’un avare, à la lueur de sa lampe sans huile, a pu trouver un pareil procédé ? Quoi ! parce que la philosophie, la morale et notre constitution ensemble réprouvent l’esclavage, voici la nation transformée en propriétaire d’esclaves ! « Le nouveau maître, ce sera l’État », comme l’a dit crûment et [343] ingénûment M. Janvier, ancien délégué des blancs de la Guadeloupe, dans une lettre du 10 juin 1840 au président du conseil colonial de cette île. La nation française loue des esclaves à qui en veut, et prélève la dîme sur le labeur de ses ilotes !
La dernière commission de la chambre n’a rien inventé de nouveau : beaucoup de vieilles filles n’ont aux colonies d’autre moyen d’existence que la location de deux ou trois nègres qu’elles possèdent. — Mais comment fixer la durée de cette servitude de nouvelle forme, le moyen de cette retenue avaricieuse, les conditions imposées aux locataires ? Comment déterminer l’état civil et politique de l’hermaphrodite social que l’on veut créer ? C’est ce qu’on ne dit pas, et c’est ce qu’il est peut-être impossible de dire. Si le nègre du gouvernement, l’affranchi d’État, ne gagne pas assez dans une période voulue pour couvrir son prix, restera-t-il toujours esclave ? Mille questions de cette nature se présentent sans qu’on y puisse imaginer une réponse. A-t-on seulement prévu l’insurmontable embarras qu’allaient donner les quarante-cinq mille esclaves de nos colonies qui ne sont pas groupés en atelier : domestiques, ouvriers de villes et de bourgs, gens isolés et formant chacun une unité distincte et essentiellement mobile ? En vérité, de tels projets sont plus que honteux, ils sont ineptes. Assurer le retour au trésor de l’indemnité par un prélèvement sur le salaire de l’esclave mal affranchi, c’est friponner mesquinement le maître et l’esclave tout à la fois ; le maître auquel on ne solde pas le bien qu’on lui prend, l’esclave auquel on fait payer la liberté qui lui est due. Ce serait là de l’économie politique d’usurier, un acte sordide et sans dignité, qui consacrerait un détestable principe. Non, non, il ne faut pas que les esclaves de nos colonies se rachètent ; l’exemple de la France fait loi pour le monde, et nous devons songer à l’avenir. Tous les esclaves qui sont sur le globe, noirs ou blancs, doivent être affranchis, et lorsque les peuples plus éclairés y songeront un jour, ils regarderont ce qu’a fait la grande nation pour les siens.
[344]
§ VI.
APPRENTISSAGE.
Dangers de l’apprentissage. — Les magistrats rétribués des îles anglaises. — Les colons français aiment mieux l’abolition que l’apprentissage.
Passons au troisième système, celui de l’émancipation simultanée avec apprentissage. « Les esclaves sont déclarés libres immédiatement et tous ensemble ; une indemnité est assurée aux colons. Les esclaves demeurent sous l’autorité de leurs propriétaires, mais sous la protection de l’état durant un espace de temps plus ou moins prolongé, en qualité d’affranchis, et leur travail est concédé au maître. » — C’est le système anglais : indemnité insuffisante, et pour la compléter, plusieurs années de l’affranchi accordées gratuitement à l’ancien maître, autrement dit, on donne au maître ce qui lui appartient, puisque l’esclave lui doit légalement toute sa vie, jusqu’aux derniers jours. Ne ménageons pas les termes : si vous n’indemnisez pas le colon de la valeur entière de la propriété hominale que vous lui enlevez, vous le volez.
Quant à l’apprentissage, il suffit de passer une heure dans une colonie de la Grande-Bretagne pour savoir ce qu’il vaut. Nous n’avons pas rencontré un créole anglais, même de ceux qui regardent en arrière, nous n’en avons pas rencontré un, sans exception, qui ne nous ait dit préférer mille fois l’émancipation à l’apprentissage ; sur ce point ils sont tous d’accord, ils disent que l’apprentissage ne fut qu’une dangereuse déception, avec autant d’assurance que nous le soutenons être une inutile transition. Le propriétaire n’y pouvait voir qu’un complément d’indemnité, il voulait en conséquence qu’il ne fût qu’une continuation de la servitude, et n’avait pas pour des hommes dont l’avenir ne lui appartenait plus, les sollicitudes d’autrefois. L’apprenti, lui, avec l’inflexible logique du bon sens, s’étonnait que sa condition ne fût pas changée, quoiqu’on lui eut [345] pompeusement annoncé sa délivrance, et s’irritait de ne pouvoir exercer sa volonté, comme il le voyait faire à tout homme libre. L’apprentissage enfin à ce vice fondamental que le maître, sachant qu’il n’a plus qu’un temps à jouir, veut demander beaucoup, tandis que l’esclave sorti de la dépendance absolue, ne veut plus rien donner du tout [225]. — D’un côté, les planteurs se trouvèrent si mal de l’état transitoire qu’ils y renoncèrent, et préférant les chances du travail libre, donnèrent eux-mêmes, le 1er août 1838, la liberté définitive qui ne devait éclater qu’en 1840 ; de l’autre, lorsque MM. Sturge et Hervey, en visitant les colonies anglaises pour y examiner l’état des affranchis, demandèrent aux nègres quelle différence ils trouvaient entre leur ancienne et leur nouvelle position, les nègres répondirent « qu’ils n’en avaient encore aperçu aucune [226]. »
Dans le discours d’ouverture de la session de 1838, le gouverneur de la Jamaïque, sir Lyonnel Smith, engageant les planteurs à voter l’abolition définitive, leur disait en parlant de l’apprentissage : « Dans le double intérêt de la tranquillité et de la production, je vous engage à supprimer une loi qui a été aussi tourmentante pour les travailleurs que décevante pour les planteurs [227].
[346]
On peut lire dans l’ouvrage de MM. Sturge et Hervey les haines que les violences des blancs, exaspérés par les résistances des noirs, engendrèrent dans cet état faux et anormal. Ne citons qu’un fait qui s’est passé à Montserrat. Une femme est amenée fort tard au magistrat spécial, celui-ci l’envoie d’abord en prison, remettant au lendemain à juger, et la femme saisie des douleurs de l’enfantement accouche au milieu de la nuit sur les nattes du cachot. Quelle était la plainte portée contre elle : « Une telle, apprentie, refuse de travailler ! » Sir Lyonnel Smith, dans son message à l’assemblée de la Jamaïque du 29 octobre 1837, après avoir indiqué des torts que la législature avait à réparer, finit en disant : « L’île mérite ce reproche que les nègres apprentis sont à certains égards dans une condition pire qu’ils n’étaient à l’époque de l’esclavage. » Toute faute, sans aucun doute, ne vient pas des maîtres, mais il n’est pas moins certain que l’apprentissage doit être regardé comme ayant la plus large part dans les discordes qui ont tant agité les îles anglaises. Loin d’avoir été une modification utile, il fut extrêmement nuisible, comme doit être toute mesure de juste-milieu, comme le sera toute institution que l’on voudra mettre entre la dépendance et l’indépendance. L’épreuve ne fut avantageuse à personne, les deux parties s’en plaignirent également. État mixte, ou la condition de chacun ne pouvait se dessiner nettement, tout le monde s’y trouva mal ; et c’est des luttes et des colères de l’apprentissage que sortirent les inimitiés et les défiances de l’émancipation. L’apprentissage fut en réalité non pas un amendement, mais une aggravation de la servitude. On alla jusqu’à priver les prédiaux du samedi par punition, ce qui équivalait non pas même à les condamner au pain et à l’eau, mais à ne pas manger du tout. Les duretés impitoyables dont ils disent avoir été victimes, le treadmill que l’esclave ne connaissait pas, le fouet qui frappa l’apprenti plus qu’il ne frappait l’esclave, ont laissé des traces profondes, et les noirs dont un trait distinctif de caractère est de ne rien oublier, de se souvenir toujours du bien comme du [347] mal, devinrent intraitables une fois qu’ils furent entièrement libres. Plus d’une demande exagérée de salaire imposée sur certaines habitations par les ouvriers, ne sont que la vengeance d’anciens prédiaux irrités. Ne craignons pas de nous répéter, car il faut qu’on le sache bien, la plus grande partie des troubles de la liberté doivent être considérés comme le retentissement des altercations de l’apprentissage. Une chose certaine, c’est qu’Antigues qui refusa l’apprentissage, qui passa de sa pleine volonté et d’un jour à l’autre, de la servitude à la liberté, n’eut aucun désordre à déplorer, et a marché depuis le 1er août 1834 vers une prospérité toujours croissante.
Quant aux stipendiary magistrats (magistrats rétribués) institués pour protéger les nègres, tiraillés entre des intérêts impossibles à concilier, ils ne faisaient que des mécontens d’une et d’autre part. Circonvenus et flattés dès leur arrivée, se laissaient-ils gagner au parti planteur, les apprentis les haïssaient ; résistaient-ils à la séduction, comme il arriva dans le plus grand nombre des cas, les maîtres les accablaient d’avanies. On en vit quelquefois, lors de leurs visites d’habitations, qui furent forcés de s’établir dans une écurie pour remplir leur office, parce que le propriétaire leur fermait la porte de la maison. Les magistrats rétribués ont été utiles aux nègres ; sous ce rapport ils ont fait infiniment plus de bien que de mal, et nous ne regrettons pas leur création ; mais en raison de leur mauvaise organisation et de l’arbitraire dont ils se trouvaient revêtus, ils ont certainement fait du mal, quelques gouverneurs les ont signalés comme la cause la plus efficiente des dissensions survenues entre les employés et les employeurs. Il était presqu’impossible qu’ils ne poussassent pas souvent leur entremise dans les affaires au-delà des strictes convenances, ne fut-ce que pour montrer l’urgence de leur place, et que bientôt chargés de la haine des colons, ils ne prissent point d’animosité contre eux. Appelés depuis à remplir en quelque sorte l’office de nos juges-de-paix, il est difficile qu’ils dépouillent le souvenir des vieilles injures, et que les maîtres ne conçoivent point de doute sur l’impartialité de [348] leur tribunal. — Ainsi de tous côtés les malheurs de l’apprentissage viennent compromettre l’épanouissement de la liberté. — Mais le plus grand vice de l’institution des magistrats spéciaux, vice radical, et qui les aurait empêché toujours, quelque noblesse de caractère qu’ils pussent avoir, de produire un bien sans mélange, c’est qu’ils étaient dans la dépendance de l’autorité locale. Le gouverneur les pouvaient casser sans jugement et sans rendre compte de ses motifs ; il en résultait qu’ils se faisaient ses agens au lieu d’être les agens de la loi, qu’ils obéissaient aux ordres de son pouvoir souverain, et non aux volontés de la justice ; que leur Code enfin était sur la grande table du chef de la colonie.
Maintenant, était-il nécessaire que cela fut ainsi ? Le parlement ayant voté une mesure transitoire, le gouvernement comprit-il la nécessité de revêtir des magistrats spéciaux d’un pouvoir discrétionnaire, et de les avoir à sa disposition pour dompter les puissantes résistances qu’il prévoyait ? C’est question. Et nous penchons entièrement pour l’affirmative.
Au surplus, nos colons eux-mêmes ne se soucient point de l’apprentissage, ils en ont appris les dangers, et par l’organe de leurs commissions ils déclarent n’en pas vouloir. Voici comment s’exprime M. Jollivet, délégué des blancs de la Martinique : « L’apprentissage anglais à démontré surtout d’une manière évidente, ce que l’absence de toute intervention directe de la part du maître pouvait entraîner de perturbation dans l’économie du travail. Une fois que les magistrats protecteurs se sont placés entre le maître et l’esclave, il n’a plus été possible de compter sur l’assiduité des apprentis. Les châtimens les plus sévères ont été impuissans ; des instrumens de coercition, inconnus jusqu’alors, ont été inventés pour combattre la force d’inertie. Tout a échoué. Les colons ont été forcés de renoncer aux délais que le gouvernement avait stipulés comme une part de l’indemnité. Ce sacrifice était commandé par la prudence la sécurité des personnes, et l’espoir d’empêcher la ruine totale [349] des fortunes. L’apprentissage, ou pour mieux dire, la substitution du gouvernement au maître, avait enfanté la plus désastreuse anarchie. »
§ VII.
ENGAGEMENT AU SOL ; NÉANT DE TOUT MOYEN TRANSITOIRE.
Lettre de M. Bovis sur l’engagement au sol. — Entre l’engagement au sol et la servitude, il n’y a d’autre différence que celle du travail forcé au travail esclave. — Le nègre ne voudra pas de la glèbe. — Les colons l’ont combattue d’avance. — La glèbe reculerait indéfiniment l’abolition.
Reste maintenant l’engagement au sol, celui de tous les modes de transition qui paraît sourire davantage aux colons qui sentent la nécessité de faire un pas quelconque vers l’affranchissement. Nous allons transcrire une longue lettre qui contient toute la théorie de ce système et résume d’une manière très pittoresque les idées généralement émises par les créoles pour l’appuyer. Notre correspondant, M. Bovis (de la Guadeloupe), est un homme progressif, mais à la fois ardemment dévoué à la cause coloniale, qui est la sienne propre.
« Tout ce qui a été écrit sur l’esclavage, soit en bien, soit en mal, me démontre que le monde a tort à l’heure qu’il est, de faire le procès à ceux de l’antiquité qui possédaient des esclaves, comme aux esclaves eux-mêmes qui s’acceptaient pour tels. Je ne dirai certainement pas que l’esclavage est de droit divin, je dis tout simplement que c’est un fait génésiaque, arrivé je ne sais d’où, ni comment, mais certainement le fait le plus anciennement constaté ; il se mêle aux instincts de sociabilité de l’homme, car à peine en voit-on quelques-uns de rassemblés, que déjà quelques-uns sont esclaves : c’est un parasite qui a cru dans la racine de l’arbre et a grandi avec lui.
« L’homme a reçu de Dieu ses instincts de sociabilité, mais [350] Dieu a laissé à l’homme de former sa société, et par conséquent de la modifier. De modifications en modifications, l’homme en est venu à reconnaître que l’esclavage était une injure faite à sa nature, aussi les sociétés les plus avancées ont-elles rejeté l’esclavage. Membre comme vous, monsieur, d’une de ces dernières sociétés, je rejette aussi l’esclavage ; mais en principe d’abord, parce qu’un principe généralise et embrasse tout, sans tenir compte des empêchemens : un principe est comme une course au clocher, il franchit haies et fossés comme une surface plane. Mais il n’en est pas de même de l’application, l’application procède par statistique ; elle note les obstacles, elle tient état des temps et des lieux : un principe agit abstractivement et l’application agit par réaction. Ainsi, humanitaire comme vous, je pourrais bien vouloir l’abolition d’une manière absolue ; mais sociétaire comme moi, vous ne devez la vouloir que d’une manière relative.
« La France a fait son émancipation lentement et graduellement : la révolution n’a été que le bouquet d’une illumination commencée dans la nuit de ses âges ! Sera-t-il dit que parce que la France était parvenue à la maturité nécessaire pour recueillir, d’autres peuples, sous des températures et des conditions différentes, y soient également parvenus ? C’est ce que je conteste, et ce que l’évidence nie avec moi.
« Si le mot de liberté était ineffaçablement écrit sur tous les fronts, il n’y aurait sans doute qu’à le faire lire à chacun sur le front de son voisin ; chaque homme l’y aurait lu lui-même depuis long-temps, il l’y aurait lu toujours, et dès-lors sa nature étant permanente devant ses yeux, il n’aurait jamais souffert l’esclavage. Mais il n’en a pas été ainsi ! c’est le développement de l’intelligence qui a fait trouver à l’homme ce titre caché en lui-même ; il y a donc un développement à produire, il y a une intelligence à former ; c’est là une étude, une éducation, et c’est là précisément mon affaire.
« Je reconnais le nègre perfectible, mais en même temps je le reconnais d’une race inférieure ou dégénérée : vous m’avez [351] accordé le fait, autant qu’il n’en souvient ; comment donc, le fait étant acquis entre nous, pouvez-vous penser que les préceptes de la civilisation la plus avancée du monde, de la civilisation française, soient applicables aux nègres de nos colonies ? et je ne m’engage pas trop en vous attribuant cette opinion, car vous m’avez dit que dans les Cinq Codes vous trouviez toute la formule de l’émancipation des nègres.
« Concordant avec vous, dans les principes généraux d’humanité, je déclare avec vous qu’il faut abolir l’esclavage ; mais quand ? Voilà où nous nous divisons.
« Comme homme social, membre d’une société dont les élémens constitutifs ne sont pas uniformes, je ne voudrais certainement pas établir une norme commune entre tous : l’esclavage, sous cette nécessité, pourrait bien encore mériter mon acquiescement, quelque soit l’anathème lancé contre lui et contre ceux qui le défendent ; seulement à la différence des temps ou les règles du Code noir ont été publiées, je ne voudrais pas faire de l’esclavage un mot éternel, un état impérissable, j’en voudrais faire une combinaison progressive comme toute autre.
« Rien n’a été fait dans ce sens par la métropole. Elle a fondé l’esclavage, et en le fondant elle a d’abord mis à son seuil une penture de fer, comme à la porte d’un bagne ; elle y avait écrit le mot fameux du Dante : Lasciate ogni speranza. Et voilà que tout-à-coup, par soubresaut, sans préparation, elle voudrait renverser ces portes, déchaîner ceux qu’elle avait abrutis et lancer au milieu de la société des êtres qu’elle a tout fait pour lui rendre hostiles ?
« Mais, me dites-vous, on ne peut pas préparer la liberté dans l’esclavage !… Et qu’en savons-nous, monsieur, puisque rien n’a été fait à cet égard ? Vous dites, non : je dis oui. La question reste au moins indécise, mais elle ne peut l’être, monsieur, pour des personnes qui jugent impartialement ! n’y a-t-il pas une induction qui m’est favorable, à moi ; celle de l’expérience de ces hommes et de ces choses.
[352]
« J’affirme que l’esclavage de nos nègres pourrait préparer leur émancipation. Mais ici ne voulant pas faire une thèse inutile, et lutter contre un parti pris, je fais une génuflexion vis-à-vis du désir humanitaire de la France, et je lui dis : Vous ne voulez pas la continuation de l’esclavage, mais au moins pourvoyez à la liberté pour n’en pas faire de la licence : pour y pourvoir, préparez-la, mais préparez-la dans un mode qui ne rompant pas tout-à-fait avec l’ordre établi, marquera le pas pour un acheminement à un mode meilleur ; ne votez pas une mesure absolue, définitive, mais votez une mesure transitoire.
« Vous avez complété votre émancipation en 89, mais vous savez par où et sur quoi il vous à fallu passer ! Les fins de la révolution légitiment sans doute ses moyens ; mais cette révolution si glorieuse pour nous, génération qui en recueillons les fruits, combien a-t-elle été torturaire pour la génération qui en a eu la gestation et le part ! Hommes égoïstes qui applaudissez à une lutte passée dont vous ramassez les dépouilles, voudriez-vous encore vous en renouveler l’émotion sur une partie contemporaine de votre société, sans être vous-mêmes exposés à la mêlée ? La révolution a eu ses horreurs, et cependant c’était une société homogène qui agissait dans et par elle même ; qui avait une intelligence et des sentimens communs. Que serait-ce d’une révolution aux colonies ou les races divergent, ou les sentimens et l’intelligence divergent avec elles ? croyez-vous être assez près pour voir le péril, assez dextres pour y obvier ? Aurez-vous une suffisante conscience des dangers à combattre, des intérêts à satisfaire ? Une révolution sociale, monsieur, ne se fait pas par de la pédagogie ; ce sont les acteurs qui sont les professeurs ? Eh bien ! nous, qui sommes parmi ces acteurs, et entre tous, les plus intelligens, il nous faut laisser le soin d’en être les professeurs : il faut que la France nous abandonne cet enseignement librement et entièrement, sous le contrôle de pure surveillance de ses agens.
[353]
« Mais, m’avez-vous dit : Quelles garanties donnerez-vous à votre œuvre ? Qui répondra à la France que votre bonne foi y présidera ? Si l’on vous donné un temps quelconque pour accomplir la transformation, qui assurera que l’échéance arrivée, la France pourra se présenter sa lettre de créance à la main, et qu’elle lui sera payée ?…
« Qui vous répondra de tout cela, monsieur ? l’intérêt des colons ! l’intérêt, lien qui n’est ni d’or ni de soie, mais qui tissé du fil le plus vil, est cependant le plus solide des liens. Avant d’aviser aux mesures de transformation, la France aurait définitivement statué sur le principe dont les soins de transformation ne seraient que le corollaire ; elle aurait prononcé l’abolition et arrêté l’indemnité, car ce ne serait qu’à cette première condition que nous pourrions nous entendre sur la question secondaire. Eh bien ! monsieur, l’abolition une fois prononcée, ce serait avoir définitivement coupé l’amarre qui nous retient au passé. Espérance et confiance en l’ordre ancien, tout aurait été immuablement laissé sur la rive, ce serait dans l’avenir seul que le colon aurait foi ; force donc serait au colon de se le préparer aujourd’hui pour se l’assurer demain, et s’il faillissait à sa tâche, il aurait sacrifié la sécurité de sa fortune future à l’inertie de son administration présente. Or, l’homme ne vit jamais précisément en lui-même, il s’immobilise à tout ce qui l’entoure : à sa propriété, à sa famille, et ce sont là des choses de long cours qui imposent l’abnégation du soi d’aujourd’hui, pour l’avenir des choses et des personnes dans lesquelles on veut se perpétuer. C’est là de l’étude du cœur humain, et cette étude vient en garantie à la France. Encore une fois le colon ayant définitivement rompu avec le passé, force lui serait de faire de son présent une préparation à son avenir.
« Cet avenir, monsieur, ne serait conquis que par le travail libre ; ce serait donc à l’ordre transitoire, qui succéderait à l’abolition de l’esclavage, de préparer le travail libre, et le colon serait invinciblement intéressé à user de cet ordre transitoire [354] pour amener ce résultat ; car s’il lui arrivait d’y manquer, il aurait sacrifié les intérêts permanens de sa propriété à un simple usufruit plus ou moins long.
« Vous le voyez donc, monsieur, en étant d’accord avec vous sur le principe de l’abolition, je ne le suis pas sur l’opportunité du moment, et je ne le suis pas non plus avec ceux qui disent comme vous que l’esclavage ne peut préparer la liberté. L’esclavage, monsieur, est un sillon plus fertile que vous ne croyez, et vous ne le croyez tel, que parce que vous ne le connaissez pas : jusqu’à présent il n’a rien produit, parce qu’on ne lui a rien demandé [228]. Mais semez-y l’émancipation future, donnez à nos mains expérimentées de l’y cultiver, et laissez le temps à la germination ; la récolte viendra. Mais si la France se refuse à attendre, et qu’elle demande à des voies plus hâtives et aussi plus compromettantes, une réalisation précoce ; eh bien ! que ce soit au moins celles qui rompent le moins avec l’ordre proscrit ! que la France remplace l’esclavage par l’en [355] gagement ; qu’elle substitue l’autorité de la loi à celle du maître [229], et sur toutes choses que les colons soient préposés à étudier cette loi, car eux seuls ils en ont l’intelligence.
« Encore une fois, monsieur, il faut vous défier des principes absolus ; Dieu a créé le monde par un principe absolu, universel, parce que dans une seule intuition il voyait tout et pourvoyait à tout, mais nous n’avons ni sa prévoyance ni ses moyens : nous sommes donc obligés de tenir compte des milieux, et dès-lors nous ne pouvons agir que par relation. Je conçois bien que la France, du haut de sa civilisation, dise : « Il faut que toutes les sociétés arrivent à mon principe. » Oui, monsieur, il faut qu’elles y arrivent, mais de la même manière que l’enfant dans la famille : l’aïeule lui tient la lisière et l’entoure du bourrelet ; tirez-les lui, il se casse le cou.
« Pourquoi de la défiance en nous ? Prenez garde ! nous serons ou des obstacles ou des auxiliaires ; si nous devons être des obstacles, la France se doit de les éliminer ; or, elle ne le peut que par une dépossession pleine et entière ; nous sommes prêts, l’est-elle ? Si elle nous veut pour ses auxiliaires, que le concordat soit signé entre nous, et que la mutuelle bonne foi y préside.
« Vous avez visité nos habitations et vous avez loué la sincérité qui vous en ouvrait les moindres recoins. Sont-ce là, monsieur, des hommes contre lesquels il faille prendre tant de garanties ? On connaissait vos principes, on connaissait la mission que vous vous étiez donnée, et la confiance d’un chacun vous a désarmé : aussi vous êtes-vous hâté de dire qu’une partie de vos préventions était tombée dès votre arrivée, et que nos esclaves que vous vous attendiez à voir pitoyables et souffreteux, vous les trouviez plus heureux, physiquement, que le paysan que vous avez laissé en France. C’est un cri arraché [356] à votre examen, et que nous revendiquons de votre loyauté pour prix de notre hospitalité ; j’ose espérer que vous le ferez entendre dans les publications auxquelles vous attacherez votre nom.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Donc, monsieur, résumant mes pensées, je conclus :
« Abolition immédiate ! Engagement au sol ! Indemnité d’au moins 1500 fr. par tête ! Transformation laissée aux colons. — »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainsi le parlement décrète l’abolition et l’indemnité d’abord, plus l’engagement des affranchis au sol, jusqu’à ce qu’ils soient en état de jouir de la liberté. Les colons restent chargés du soin de les préparer. Voilà bien les termes, si nous ne trompons, de ce brillant programme.
Je ne vois d’avantage là dedans que pour les maîtres qui touchent l’indemnité et qui gardent leurs anciens esclaves sous le nom d’engagés, avec leur ancien pouvoir, sous le nom de protectorat. C’est le travail forcé substitué au travail esclave. Les mots sont changés, pas les choses ; et nous nous étonnons qu’un esprit aussi sérieux, aussi éclairé que celui de M. Bovis s’y soit laissé tromper. L’engagement au sol, c’est la glèbe. La glèbe a été dans le passé un amendement à la servitude, que les temps barbares pouvaient accepter, mais que l’on n’est pas obligé d’adopter. Glèbe ou esclavage, en définitive, c’est tout un.
L’esclavage actuel n’est en réalité, par la force des choses et pour le plus grand nombre, qu’un état analogue à la glèbe. Ses crimes tiennent à sa nature même, et l’on ne pourra pas les prévenir avec la seule magie du mot glèbe, parce que glèbe et servitude ne sauraient exister sans arbitraire, et que l’arbitraire ne va jamais sans abus. Vous appelleriez l’univers entier en témoignage de votre abolition de la servitude, que si vous la remplacez par une institution semblable, vous n’aurez rien fait. Votre résolution aboutit à un déplacement d’autorité qui passe de vos mains dans celles d’un magistrat, car je suppose [357] que vous l’entendez ainsi ; mais la somme d’autorité exercée n’est point modifiée et l’esclave auquel pendant cette scène d’escamotage vous avez accordé, pour le distraire, le noble titre d’ouvrier, laisse toujours son libre arbitre en des mains étrangères et ne récupère aucun de ses droits d’homme. Or, rien de bon ne peut se faire sans vous, comme vous le dites ; c’est vrai, mais rien de bon non plus ne peut se faire sans le nègre. Pensez-vous qu’il ratifie un traité ou après lui avoir dit qu’il est libre, il retrouvera au fond de l’engagement le travail forcé, c’est-à-dire la servitude ? Pour moi, j’en doute. Le nègre ne tardera pas à comprendre qu’il a été dupe, il rejettera le marché, réagira d’autant plus vivement qu’il avait cru toucher au but ; vous aurez à lutter contre son mauvais vouloir, sa force d’inertie. Ne pouvant plus appliquer directement la punition, il vous faudra pour chaque faute avoir recours au magistrat, les difficultés deviendront de jour en jour plus inextricables, et vous ne les pourrez vaincre que par une compression qui ruinerait les espérances d’un avenir pacifique. Un organe de l’opinion du statu quo l’a dit à sa manière, « substituer à l’esclavage un travail coërcitif quelconque, est une absurdité grosse comme une montagne. Après l’émancipation il n’y a qu’une garantie, qu’un stimulant de travail possibles, c’est le salaire : seul il peut être légalement employé. La contrainte, sous quelque forme qu’elle se présente, est l’esclavage, et l’esclavage actuel est le mode de coërcition le plus convenable, le seul logiquement admissible, Nous le disons souvent : Malheur aux colons, s’ils se laissent prendre aux synonymes. »
Les esclaves ne s’y laisseront pas prendre non plus. C’est M. Lepelletier Duclary lui-même qui nous l’apprend : « L’opinion bien arrêtée des nègres est celle-ci : Point d’état intermédiaire possible entre l’esclavage et la liberté. »
M. Chazelles, dans l’habile rapport dont nous avons déjà parlé, fait aussi indirectement une vive critique du projet de l’engagement au sol, lorsqu’il dit : « Il s’agirait de créer pour l’esclave que la loi aurait affranchi avec solennité, une situation [358] analogue à celle que la loi elle-même aurait détruite et stigmatisée ! On oublie que l’obligation du travail est le but de l’esclavage. Abolir la servitude après l’avoir flétrie et vouloir maintenir la contrainte au travail, seule fin de l’esclavage qui en est le seul moyen, implique donc une contradiction choquante que la raison repousse ; c’est prétendre conserver l’effet après avoir détruit la cause. » M. Bovis et les hommes calmes qui partagent son opinion, voient qu’ils trouveraient jusque parmi leurs frères une forte opposition.
L’engagement au sol ne peut au surplus résister à aucune des objections capitales que nous avons présentées contre les autres moyens partiels. Il en a tous les vices, il n’en corrige aucun des inconvéniens. Dans ce mode, comme dans celui du rachat par l’État, on ne sait ce que deviennent les quarante-six-mille nègres de villes ou domestiques, population essentiellement mobile, et dont l’utilité est dans sa mobilité même. En un mot, tous les dangers de l’apprentissage se représentent sans qu’on puisse échapper à un seul, car toute forme d’abolition qui n’est pas l’abolition complète et absolue revient toujours à l’apprentissage.
L’engagement au sol ne se prête pas plus que les autres combinaisons à satisfaire nos désirs, il laisse tout en question. Ou l’on voudra agir directement sur les engagés, et alors les maîtres diront que l’on trouble leur manœuvre, ou on les laissera procéder seuls, et alors l’engagement leur étant aussi profitable que l’esclavage, ils ne se presseront pas de rien changer au moral de leurs nègres, pour que ces nègres restent indignes de passer au degré supérieur ; et comme, en conséquence du principe posé, il serait irrationnel d’assigner un terme à l’entreprise d’amendement, qu’eux seuls peuvent et doivent le fixer, ils le prolongeront indéfiniment. Soyons-en bien sûrs, quelle que soit l’échéance à laquelle on leur présenterait le billet de la glèbe, de même qu’ils disent aujourd’hui, après deux cents ans d’épreuve : « Le temps n’est pas venu d’abolir [359] l’esclavage ; » leurs législateurs assemblés répondraient encore : « Le temps n’est pas venu d’abolir la glèbe. »
Et ici nous ne prétendons pas infliger un blâme particulier aux colons ; ils suivent la loi de l’égoïsme humain. Pas plus chez nous que chez eux on n’a jamais fait convenir ceux qui profitent d’un abus, qu’il est temps de le détruire. C’est pourquoi nous disons et répèterons toujours qu’il faut en finir malgré leurs réclamations. L’esclavage est un nœud qu’aucune science ne pourra dénouer ; il faut se résoudre à le couper. Tout ce qui sera fait avant la complète et radicale extinction du pouvoir du maître, sera vain.
§ VIII.
les maîtres sont incapables de l’œuvre de transformation et indignes d’en être chargés.
Sous de certains rapports les blancs ne sont pas plus civilisés que leurs nègres. — Le fait de la servitude a corrompu le maître aussi bien que l’esclave. — Il faut reprendre tout à nouveau. — Attitude de la population blanche durant les débats de l’affaire Mahaudière.
M. Bovis, trompé par ses bons désirs, juge des autres par lui-même ; il dit que les planteurs doivent être chargés de la transformation, parce que seuls ils connaissent le terrain ; qu’ils voudront être bienveillans pour leurs engagés, et s’efforcer de les améliorer, parce que leur avenir serait attaché à cette transformation heureuse ; qu’à défaut de leur humanité, on peut compter sur leur instinct de conservation et leur intérêt.
À notre sens, c’est là méconnaitre le cœur humain : on ne peut compter sur l’intérêt des colons comme garantie de leur participation à la régénération de la race avilie, qu’en leur retirant toute chance d’éviter le grand but. Autrement, tant qu’il leur restera la moindre facilité d’exploiter le nègre, ils voudront toujours l’exploiter, ils ne lui accorderont rien [360] d’eux-mêmes, et ne cesseront de croire que ce qu’il y a de mieux à faire pour eux, c’est d’en tirer tout le parti possible jusqu’au dernier moment, de jouir de leur reste, selon le dicton populaire. — Il ne faut en appeler aux instincts que pour les animaux, dont les mouvemens naturels ne sont point troublés par les erreurs de la raison, et qui sont préservés de la plaie du sophisme. L’instinct de conservation, grâce à la perfection particulière d’entendement dont l’homme a été doué, lui fait quelquefois avaler, en vertu de son raisonnement, du poison qui le tue, en place du médicament qu’il croyait propre à le sauver. Une chose impossible à nier, c’est que l’on avait laissé à l’instinct de conservation des créoles anglais, sept ans pour assurer le succès d’une opération sublime d’où dépendait l’avenir de leurs familles, et qu’il fallut en venir bien vite à un affranchissement général, parce que l’instinct de conservation allait tout perdre. Si c’est la faute des propriétaires, on peut être sûr, par voie de psychologie comparée, que les nôtres n’échapperont pas aux mêmes erreurs ; si c’est la faute des nègres, on voit, ou que le moyen de transformation est mauvais, ou qu’il est raisonnable de renoncer à les transformer. Renoncer est la conclusion des créoles, ce n’est pas la nôtre.
M. Bovis, qui a l’intelligence des nécessités de l’époque, croit son projet bon, parce qu’à son avis les nègres sont perfectibles, et qu’il voudra les perfectionner ; mais la majorité ne consentirait jamais à le suivre dans cette route. La disposition présente des créoles dit assez quels seraient leurs sentimens futurs. Sous de certains rapports, les maîtres ne sont pas plus civilisés que leurs esclaves, j’entends qu’il y a des choses de la civilisation qu’ils ne comprennent pas plus que les nègres n’en comprennent d’autres. Pour qu’ils fussent capables d’accomplir le noble ouvrage auquel on les convie, pour qu’ils fussent dignes qu’on leur accordât cette belle tâche à exécuter, il les faudrait d’abord modifier eux-mêmes ; pour qu’ils fussent propres à entreprendre l’éducation des noirs, il faudrait auparavant faire la leur.
[361]
M. Lignières, dont l’avis est des plus précieux, parce que c’est à la fois un créole éclairé, un propriétaire d’esclaves et un abolitioniste dévoué, nous a dit : « Je ne conclus pas à l’abolition immédiate de l’esclavage, mais bien à une abolition qui serait prononcée dans un certain temps, que je réduirais à cinq ans pour en finir le plus tôt possible. Vous devez bien penser que je ne demande pas ce délai pour préparer les esclaves à la liberté, je ne puis pas croire que des esclaves nègres, placés par les préjugés un peu au-dessus du singe, méprisés à cause de l’infériorité de leur race, si soigneusement tenus dans un état de dégradation, d’abrutissement, puissent s’améliorer tant que durera l’esclavage ; il est clair pour moi qui suis témoin des progrès rapides qu’ont fait les gens de couleur depuis qu’ils sont devenus citoyens, que le noir ne deviendra meilleur que dans la liberté. Mais ce délai, je voudrais bien qu’on nous l’accordât, je ne dirai pas pour améliorer les blancs, car je les calomnierais, ils sont meilleurs, bien meilleurs qu’on ne croit ; ils sont dans l’erreur, voilà tout. Je voudrais donc ce délai pour les préparer à la transformation sociale que l’intérêt de mon pays réclame si impérieusement… Je tremble quand je songe aux malheurs qui fondraient sur mon pays, si la France était obligée de briser l’obstacle que nous opposerions à une mesure que son honneur commande, si elle était obligée, pour parler d’une manière plus claire, de prendre cette mesure sans nous, malgré nous. Jugez de quels soucis je suis tourmenté quand je vous dirai que plus je réfléchis sur le changement qui se prépare, plus je me fortifie dans l’opinion que si les colons le voulaient, le travail sans l’esclavage serait non seulement possible, mais facile. »
Persuadé, comme M. Lignières, que les colons sont dans l’erreur, nous différons avec lui sur ce point : qu’ils puissent être modifiés par un état transitoire. Cinq ans ne sont pas assez pour effectuer un changement utile dans les habitudes et la nature de toute une population ; demander plus de cinq ans serait impossible, l’esprit des esclaves est en trop grande [362] fermentation pour le permettre. Ils se croient eux-mêmes trop opprimés, pour qu’il soit prudent de leur montrer même de loin l’abolition sans la leur donner. Si parmi les possesseurs d’esclaves il y avait beaucoup d’hommes comme M. Bovis, comme M. Lignières, et quelques autres dont nous avons cité les généreux actes et les nobles paroles, on pourrait encore espérer. Mais quelle garantie la majorité a-t-elle jamais donnée de son bon vouloir, combien de fois au contraire n’a-t-elle pas manifesté son aversion pour toutes mesures de réforme ! Quelle disposition a-t-elle jamais montré à concilier l’intérêt des esclaves avec celui des maîtres ! Elle a toujours été résistante. Depuis des siècles elle s’est constamment renfermée dans un système de désapprobation à priori des moindres tentatives favorables aux esclaves. Les conseils coloniaux ont bien déclaré mauvais tous les projets d’émancipation, mais en ont-ils jamais proposé un qu’ils se déclarassent prêts à accepter ?
Et puis M. Lignières et M. Bovis oublient donc de quel fait ont été nourris les créoles ? Ils oublient donc que l’état social où les maîtres ont été élevés, où ils vivent, a exercé une action aussi délétère sur l’homme possesseur que sur l’homme possédé ? Le nègre, aux yeux des hommes libres, quels qu’ils soient, est un outil, rien qu’un outil. « Pourquoi ne travaillez-vous pas, demande-t-on à un petit mulâtre vivrier ? — Comment voulez-vous que je travaille, reprend-il, j’ai été forcé de vendre mes deux noirs ! » C’est un laboureur privé de sa charrue. « Je ne connais pas de bons nègres, a dit un grand propriétaire, je ne connais que des nègres forts et des nègres faibles. » — « Voyez quelle belle pièce, nous fait observer un autre, en désignant une vigoureuse négresse au milieu de son atelier ! » Nous nous souviendrons toujours de la candeur avec laquelle une jeune dame, fort douce, nous dit en parlant de deux esclaves femelles attachées à son service particulier : « Ce sont des femmes que mon oncle m’a données en cadeau, lors de mon mariage. » L’esclave est tout-à-fait passé à la condition de meuble dans les colonies. La lèpre y gagne rapidement tout le monde, et nous [363] avons entendu un européen, un magistrat très libéral, questionné sur ce qu’était devenu son cheval, répondre tranquillement : « Je l’ai troqué contre un noir et 200 francs. »
Jamais les hommes qui pensent ainsi ne consentiront, volontairement du moins, à traiter en élèves et en pupilles de leur famille, des hommes aussi dégradés à leurs yeux. Pour changer quelque chose à ces idées, il faut faire table rase et renverser le pacte social actuel afin d’en construire un autre entièrement nouveau sur ses ruines. Les profondes préventions des créoles leur enlèvent toute intelligence du bien possible, on n’obtiendra les suffrages de la majorité, on ne pénètrera les esprits de l’utilité de la réforme qu’en les entraînant. Elle sera nulle, si elle n’est entière. Les têtes sont tellement montées, les difficultés si grandes, que moins on compliquera les moyens, plus vite et plus sûrement on atteindra le but.
Arrivé où nous en sommes, le lecteur peut savoir si nous éprouvons le moindre sentiment de haine contre les colons, nous pouvons donc en toute sûreté d’être jugé sans passion, dire qu’en l’état actuel de leurs mœurs ils sont incapables de préparer les nègres à la liberté. Nous avons assisté au procès Mahaudière, et l’attitude de la population blanche durant le cours de ces longs et tristes débats, nous a consterné. Ce qui se passa alors, on ne le voudra pas croire en Europe. Lorsque les propriétaires du quartier de M. Douillard apprennent qu’il est arrêté, tout stupéfaits et indignés, ils signent ensemble une pétition au gouverneur pour demander sa relaxation. À la cour d’assises, l’accusé est entouré d’habitans accourus de toutes parts qui lui prodiguent mille témoignages d’amitié. Ils ne l’excusent pas, ils ne disent pas que c’est un maître qui s’est trompé sur ses droits, un homme doux, estimable, perverti une fois par la maladie et la peur. Non, ils le soutiennent, ils l’approuvent, ils transforment son crime en affaire politique coloniale ; ils n’y ont vu que l’exercice légitime de son autorité légale et ils revendiquent avec affectation la solidarité du forfait. Le prétoire pendant cinq jours est encombré de leur foule toute [364] entière à lui, il y règne une brûlante fermentation, les témoins à décharge exaltent celui à qui la loi demande raison de sa conduite, et l’un d’eux (pour que l’on puisse juger de tout par un mot), interrogé sur la nature du cachot, répond qu’il y est entré et qu’on y est mieux que dans l’enceinte où il se trouve avec plus de trois cents personnes. Enfin, il est avéré que M. Douillard Mahaudière a tenu une femme enfermée pendant vingt-deux mois, de même qu’il avait été acquis aux débats dans l’affaire Amé Noël, que l’esclave mort était depuis cinq jours les pieds enfermés à la barre et les bras liés derrière le dos, et cependant M. Douillard Mahaudière est acquitté comme M. Amé Noël l’avait été ? l’opinion publique le voulait ; le pays les avait absous avant que le tribunal prononçât. Qu’espérer d’une institution sociale dans laquelle de pareils faits, en se représentant, trouvent presque toujours une nouvelle absolution ?
Sans doute en France, nous avons par exception les époux Granger, mais l’opinion publique les réprouve avec énergie, elle veut leur condamnation et les juges qui la veulent aussi, la prononcent. Aux colonies, lorsque le verdict est rendu, à peine si quelques hommes sensés courbent le front et lisent la sentence de mort de leur société dans l’absolution du coupable ; l’assistance joyeuse au contraire entoure M. Douillard, le félicite, lui presse les mains. Ce n’est point un ami égaré qui échappe à la loi, c’est presqu’un triomphateur ; au moment où nous passons auprès de la sellette qu’il vient de quitter, nous entendons un planteur dire avec énergie : « S’ils avaient condamné Mahaudière, il aurait fallu nous mettre tous là, car il n’est pas un colon qui ne fasse ce qu’il a fait. » Et le lendemain plusieurs habitans, y compris l’accusé avec le général Faujas Sainte-Fond (depuis nommé président du conseil), à leur tête, s’en allaient complimenter, remercier l’avocat et lui dire : « C’est la cause du pays que vous avez défendu. »
En montrant cette ferveur de sympathie pour un vrai coupable, les créoles ont donné la mesure de leur esprit public, il se sont accusés tous ensemble au tribunal de la conscience [365] universelle ; en appuyant le criminel de leur sympathie, ils sont devenus complices du crime ; en l’acquittant avec éclat, ils ont prononcé leur propre condamnation. Ils disent les esclaves incapables de jouir de la liberté ; l’opinion européenne les déclarera, eux, incapables de jouir des prérogatives de maîtres ; puisqu’ils ne peuvent sentir là où commence la cruauté dans l’exercice d’un droit ; indignes de la mission d’instituteurs, puisqu’ils ne regardent pas la séquestration indéfinie comme un châtiment excessif. — Quel concours attendre, pour toute forme progressive, de gens auxquels la fièvre de maître peut donner ces vertiges, par lesquels les abus de pouvoir des maîtres sont défendus comme la cause générale, chez lesquels l’homme de la justice qui poursuit Mahaudière est attaqué à titre d’ennemi du pays ? De quelle insignifiance ne sera pas toujours tout moyen partiel au milieu d’une société ainsi faite, quand la grande majorité de ceux qui la dominent par la prépondérance de l’éducation, des talens, de la richesse, des places élevées et d’une antique supériorité, absorbe jusqu’aux autorités qui devraient la conduire ?
Des actes barbares pareils à ceux des subalternes Laffranque et Preschez, sans exciter moins l’horreur, peuvent être considérés comme des faits individuels ; mais lorsque des propriétaires, des hommes jouissant d’une bonne réputation bien acquise, semblables à MM. Amé Noël, Mahaudière, Brafin, Moyencourt, en arrivent aux tortures avouées que nous avons dites, lorsqu’ils sont excusés par leurs pairs, le crime sort de l’individualisme, il appartient à la société toute entière, il fait corps avec elle ; et le législateur, pour être conséquent, n’a d’autre moyen de le prévenir et de l’extirper que de changer les bases mêmes de la société.
[366]
CHAPITRE XXIII.
ÉMANCIPATION GÉNÉRALE ET IMMÉDIATE.↩
Tout moyen partiel est mauvais, parce qu’il est partiel. — Il n’y a pas de transition qui puisse paralyser les embarras du passage de la servitude à la liberté. — Une certaine perturbation est inévitable. — L’affranchissement en masse peut seul permettre d’enseigner à des esclaves les devoirs de l’homme libre. — Les nègres sont aussi préparés pour l’indépendance, qu’ils le peuvent être. — L’affranchissement en masse et immédiat n’est pas un moyen sans dangers, c’est de tous les moyens celui qui en a le moins. — Il rend toute résistance impossible, il fait cesser l’incertitude et l’agitation qui ruinent aujourd’hui les colonies. — Révoltes continuelles des esclaves. — Les créoles eux-mêmes et les autorités, avouent que la société coloniale est en péril.
Nous croyons avoir démontré le néant des moyens partiels et transitoires. Nous croyons avoir prouvé par l’exposition vraie des choses, que toute tentative de juste-milieu pour parvenir à briser les fers de l’esclave est incompatible avec l’existence de la société coloniale telle qu’elle est maintenant. La complète anarchie d’idées qui règne parmi les créoles dès qu’ils abordent cette question, confirme notre opinion. Si pour rendre la liberté due aux nègres on croyait devoir s’arrêter au principe d’un régime intermédiaire, si pour obtenir l’assentiment désiré et désirable des colons, on les chargeait d’indiquer ce régime, nous posons en fait qu’il n’en est pas un qui put réunir une majorité respectable, à moins que ce ne soit la prolongation de l’esclavage sous un autre nom.
Nous sommes convaincu de l’importance que l’on doit mettre à obtenir l’acquiescement des créoles ; un des plus grands malheurs qui put arriver à l’abolition serait qu’elle les eut pour adversaires déclarés. Nous l’avons déjà dit et nous ne demandons pas mieux que de le répéter ! La réforme ne se fera avec toutes les chances d’une réussite facile, qu’étayée de leur con [367] cours, mais nous en sommes également persuadés ; ce concours on ne pourra l’obtenir qu’en les soumettant à la nécessité fatale du succès. Aussi n’hésitons-nous pas à proclamer dangereux et funeste tout régime intermédiaire. Dangereux, parce que l’on ne saurait rien toucher à l’esclavage sans mettre aussitôt en péril le droit et l’autorité du maître, funeste parce qu’il ne peut être comme l’apprentissage britannique, qu’un esclavage continué.
Cette demi liberté, après les hautes espérances que la proclamation du principe fait concevoir aux nègres, ces distinctions composées, difficiles à saisir pour des esprits incultes, ces incertitudes de leur position, tout cela est pour eux une cause de mécontentement. Servitude déguisée, l’état mixte, comme nous le disait M. Salvage Martin, d’Antigues, « est bien plutôt la préparation de la fainéantise libre que du travail volontaire. » Il engendre mille tiraillemens, d’où naissent les colères et les rancunes. Il n’y a de bien possible, il n’y a d’initiation possible au bien, ni dans la servitude ni dans aucune situation analogue.
Plus nous analysons l’orgueil des propriétaires et la susceptibilité des esclaves, plus nous nous assurons que l’on trouvera tout avantage à en finir d’un seul coup, et à se donner vis-à-vis des nègres le mérite d’une libéralité sans condition, par un vaste affranchissement sans réticences. Les termes moyens ne sont propres qu’à tout aigrir, tout envenimer, en ne rendant personne heureux de son sort. Ne touchez pas à la servitude ou donnez la liberté complète : sachez renoncer à l’une ou accepter l’autre. Point de classe intermédiaire, point d’affranchis d’État, point de moitié de citoyens, cela détruit l’homogénéité que doit avoir une société pour marcher de ferme allure, cela ne sert qu’à susciter des collisions, provoquer mille petites lois spéciales, multiplier les complications, les écritures, les bureaux, les commis. Et tout ce mal ! pour aboutir en définitive à la solution de continuité que l’on redoute, et à laquelle il faudra cependant toujours arriver un jour ou l’autre dans [368] quelque lointain avenir qu’on veuille la rejeter. Ne craignons pas de nous répéter pour faire passer notre idée dans l’esprit du lecteur : tout mode d’affranchissement partiel nous semble mauvais essentiellement, surtout parce qu’il n’atteint pas le but cherché, car, pour prolongés que soient les atermoiemens, ils doivent avoir une fin, et à l’époque de cette fin on devra toujours subir le choc que l’on veut en vain amortir.
C’est la préoccupation où l’on est de vouloir conjurer les premiers momens de perturbation qui suggère des termes dilatoires ; il serait plus raisonnable de s’avouer nettement à soi et aux autres qu’il n’y a pas de transition praticable, et qu’on se doit résigner à l’ébranlement qui suit les grandes secousses dans les choses politiques comme dans les choses naturelles.
Il est puéril de s’obstiner à méconnaître cette nécessité fatale, il serait indigne d’un écrivain de bonne foi de la dissimuler, et nous y répugnons d’autant plus, que ne fut-elle point inévitable, nous nous croirions en droit d’examiner si les maux qu’entraînerait une réforme forcée seraient pires que la prolongation, même déterminée, du crime qu’elle effacerait.
Cette perturbation, pourquoi ne pas l’envisager face à face afin d’en prévenir les plus dangereux effets ? Quelque soin qu’on y donne, quelque retardement qu’on y apporte, à quelqu’époque et à quelque génération que l’on s’adresse, le jour où l’on fera passer des hommes de la non liberté à la liberté, des désordres prendront place. Lorsque vos fils sortent du collége, vous ne pouvez les retenir, ils vous échappent. Pendant un an, deux, trois ans, les voilà qui fuient les livres,courent la ville, inventent toutes sortes d’étranges plaisirs, s’abandonnent à la fougue de leurs passions ; et quand ces émancipés qui viennent d’achever leur philosophie, qui ont lu Socrate dans Platon et Xénophon, qui savent Homère par cœur, se livrent ainsi à la première furie de l’affranchissement, vous voulez que des esclaves n’aient pas aussi leurs jours d’ivresse ! Folie et injustice. Nous vous disons, nous, que pour aller du Havre à la Martinique il faut traverser les mers, [369] et que cherchassiez-vous mille ans à construire un chemin pour y arriver par terre, vous ne le trouverez pas.
Certainement l’émancipation ébranlera les colonies, mais il faut que l’émancipation soit. La révolte sanglante les ébranlerait bien davantage. Plus il est difficile de changer les bases d’une société, plus il y a de raisons pour en essayer l’entreprise législativement, et ne pas laisser tout faire à la violence.
En définitive, abolir l’esclavage, c’est opérer une révolution, sans aucun doute. Dites-nous seulement : en est-il une dans les annales du monde qui se soit accomplie aussi pacifiquement que celle dont les colonies anglaises viennent d’être témoins ? La nôtre aura ses difficultés comme la leur ; mais en présence de sa nécessité, c’est un fait dont chacun se peut réjouir d’avance jusqu’au fond de l’âme, qu’elle n’aura pas de dangers.
La raison et l’humanité voulant l’abolition, il n’est pas sensé d’en grossir les embarras, car on doit les subir, et ils s’agrandiront à mesure que l’on reculera ; il serait sage au contraire de calculer les moyens propres à les paralyser et à diriger des forces qui deviendront d’autant plus terribles qu’on les aura plus comprimées. — Il se condamne à l’immobilité, celui qui cherche les moyens d’opérer la réforme sans aucune secousse. Ce n’est pas la faute des esclaves si on les a changés en brutes, et le temps ne saurait aplanir des difficultés qui tiennent à la nature des choses. Fût-il possible d’initier des ilotes, on n’obtiendrait d’autre résultat que d’en faire des hommes raisonneurs, inquiets, mal disposés à l’engourdissement obligé de leur condition. L’expérience de l’apprentissage chez les Anglais a prouvé qu’aucune mesure d’amélioration n’était applicable à des esclaves ou demi-esclaves.
Pour tout dire, ces préparations que l’on sollicite et dont nous avons démontré plus haut l’impossibilité radicale, ne sont que des pièges tendus à la crédulité des âmes candides. Sauf d’honorables exceptions, nous estimons qu’il n’y a pas une entière bonne foi de la part des créoles à demander qu’on mette les nègres en état de jouir de la liberté avant de la leur [370] accorder. Voyez en effet : ils prétendent d’un côté qu’il est utile de préparer leurs esclaves comme l’Angleterre avait préparé les siens [230], et de l’autre ils s’efforcent de démontrer que les noirs anglais ne font rien du tout. En bonne logique, quelle conclusion tirer de là, sinon que l’institution est sans bénéfice ou que la demander est un échappatoire. Nous soutiendrons toujours, nous, que l’affranchissement en masse peut seul permettre d’enseigner à un esclave les devoirs d’un citoyen. C’est là une science pour laquelle on ne saurait faire d’étude au fond de l’obscurité nécessaire des cases à nègres. Apprendre la liberté à un être qui reste hors de la liberté ! autant vaudrait tâcher d’apprendre la natation à un enfant sans le mettre dans l’eau. Vouloir créer les vertus de l’homme libre dans l’homme esclave, c’est rechercher l’effet sans la cause.
Que parlez-vous du danger qu’il y aurait pour eux-mêmes à les livrer à leurs propres instincts ? Prétendez-vous donc absolument les comparer à ces animaux domestiques qui ne savent plus trouver leur pâture, lorsqu’un accident les rend aux bois. Est-ce que les nègres anglais que leurs maîtres présentaient aussi comme hors d’état de gravir la rude échelle de la civilisation, ne vivent pas très bien ? Le Code noir comptait si peu sur l’esclave, qu’il n’avait pas voulu s’en rapporter à lui du soin de sa subsistance, il défendait à l’habitant de se décharger de l’obligation d’y pourvoir. Aujourd’hui néanmoins, presque partout dans les colonies françaises, ce sont les nègres qui se nourrissent eux-mêmes avec le samedi. Les maîtres ont implicitement confessé que la très grande majorité de leurs serfs ne sont pas aussi dénués de l’esprit de prévoyance qu’on le dit maintenant. Puisque le nègre sait se nourrir dans l’esclavage, la responsabilité de la vie n’est donc pas au-des [371] sus de ses forces, il a donc le sentiment de l’avenir et les facultés d’économie qu’on lui refuse ? Bien mieux, il préfère le samedi à l’ordinaire ; l’initiative ne l’effraie donc pas ?
La situation morale des noirs, telle qu’elle est, nous paraît suffisamment avancée pour qu’il n’y ait aucun danger à les nommer citoyens. Ils se feront à leurs droits en les pratiquant, à leurs devoirs en les remplissant, de même que les bourgeois français deviennent bons jurés en exerçant les hautes fonctions du jury. Leur aptitude à comprendre l’indépendance ne peut se développer que dans l’indépendance.
De l’aveu de la commission de la Guadeloupe, « les déclamations des abolitionistes ont donné aux nègres des espérances dont il faut tenir compte [231]. » Il n’y a pas d’autre manière de régler ce compte que de leur donner la liberté ; et croyez-nous, ils y sont aussi préparés qu’on le puisse être, car ils la désirent, ils l’attendent ; car ils la veulent. Nous ne connaissons pas de meilleure préparation que celle-là, ni rien qui aille mieux contre les allégations de leurs ennemis. Quant au reste, ne craignez rien, les puissans moyens de la civilisation, les cinq Codes et quelques mesures spéciales fourniront les forces nécessaires pour maintenir l’ordre et conduire les affranchis, peu à peu, sans danger pour eux-mêmes ni pour personne, à la connaissance des obligations et à la jouissance des prérogatives de l’homme.
Abandonner aujourd’hui au terrible courant de notre monde anarchique des gens esclaves hier, nous ne disons pas que ce soit un moyen sans inconvéniens de les rendre à l’indépendance, nous disons comme publiciste et comme philantrope, que c’est de tous les moyens celui qui a le moins d’inconvéniens. Qu’il faille accomplir une telle œuvre avec calme, avec modération ; en détruisant le désordre servile qu’il faille assurer l’ordre libre et se garder d’imprudence, nous en sommes d’avis, mais que l’on puisse mettre quelque chose entre la servitude et la liberté, nous ne le croyons plus.
[372]
Et ici encore, que l’on me permette deux mots d’explication personnelle. Cette opinion que je manifeste, je ne l’ai pas prise parce qu’elle est la plus facile à prendre et dispense des peines d’une élaboration. Je ne m’enferme pas dans les hauteurs commodes de l’abstraction, je ne crois ni au droit divin, ni à toutes ces lois primordiales que chacun tourne à sa fantaisie, et dans lesquelles nos adversaires aux théories providentielles ont trouvé la servitude noire et blanche écrite tout au long. Ce n’est point d’un zèle fanatique que ma philantropie reçoit ses inspirations, ce n’est point d’enthousiasme que je demande l’abolition spontanée, ce n’est point pour obéir au principe sacré, qu’ému d’un désir passionné, je veux inflexiblement soumettre à l’heure même la société à ce principe, quelque déchirement qu’elle en puisse éprouver. De longues réflexions m’ont amené là, je ne suis pas arrivé du premier coup à l’émancipation immédiate et absolue, Dans la brochure de 1833, dont j’ai cité des extraits, je proposais un demi-siècle d’apprentissage. — Si je demande aujourd’hui la libération spontanée, c’est qu’en étudiant les choses, j’ai acquis la conviction que le problème de la conciliation du travail et de la liberté se peut résoudre avec moins de danger par cette voie que par toute autre.
L’élargissement en masse de tous les pauvres captifs noirs ne nous ravit pas seulement par son caractère d’immense charité, il se présente à nos yeux avec tous les avantages politiques et matériels d’une entreprise pratique. Il coupe court aux tâtonnemens douloureux, aux vains projets, à ce qu’il y a de faux, de malaisé, de précaire dans les situations mixtes. Il prévient ces inimitiés de l’apprentissage que l’épreuve faite aux West-Indies a dévoilées, et dont les suites troublent encore dans les îles de la Grande Bretagne les premiers jours de la liberté réelle. Fait accompli, irrévocable, absolu, sans retour, il ne laisse plus de prise aux résistances, chacun est intéressé à le voir triompher, à lui faire porter les meilleurs fruits, à en extraire toutes les vertus, à étouffer les répugnances qui pourraient ralentir sa marche ascensionnelle. [373] Plus d’opposition possible de la part des uns, plus de discours agitateurs de la part des autres, plus de fluctuations. Les nègres sont heureux, il ne leur reste aucun sujet valable de plainte, leurs maîtres sortent du provisoire, les voilà enfin fixés, ils peuvent bâtir sur un terrain solide. La propriété coloniale rentrée dans le droit commun devient inattaquable, et acquiert une sécurité que maintenant elle a perdue à jamais. Les créoles cessent de trembler pour le lendemain, car ils peuvent faire eux-mêmes leur lendemain, ils deviennent forcément les meilleurs auxiliaires de l’émancipation, car ils ont un intérêt véritable à ce qu’elle réussisse, et les abolitionistes deviennent les meilleurs aides des créoles, car ils ont un intérêt de conscience et de morale à ce que la grande œuvre prospère.
Qu’on le remarque bien encore, il ne faudra pas plus de force, il n’en coûtera pas plus d’argent pour fonder un ordre définitif, que pour soutenir un mode intermédiaire. L’affranchissement simultané a de plus l’immense avantage de réhabiliter la terre d’un seul coup ; il emporte ce préjugé contre la culture qui, autrement, voue toujours les libres successifs à l’oisiveté, Le travail agricole n’étant plus le signe de la servitude, l’émancipé n’a plus à craindre de déroger en s’y livrant.
Les colons par leurs inquiétudes, témoignent suffisamment de la mauvaise position ou ils se trouvent. Ils n’osent plus dire qu’il faut garder indéfiniment l’esclavage, et ils ne veulent pas entrer franchement dans l’émancipation. Ils se plaignent qu’on les tient depuis longues années dans un état qui ressemble à l’agonie, et ils veulent toujours temporiser ; puis lorsqu’avec la lenteur que la France gouvernementale met dans toutes choses, ils voient la commission de la chambre ajourner le fameux rapport Tocqueville, le ministère nommer une autre commission pour examiner des faits retournés sous toutes leurs faces depuis quinze ans, et enfin cette commission elle-même s’ajourner du mois de juillet au mois de janvier, et du [374] mois de janvier on ne sait à quand pour recueillir des documens ; ils s’écrient satisfaits : « Encore du temps de gagné. » Aveugles que vous êtes, c’est du temps perdu. Ne voyez-vous pas qu’au milieu de ces transes le mouvement a cessé. Tout le monde hésite, personne n’ose plus rien entreprendre, rien préparer, rien réparer même. Les bâtimens tombent en ruine, et la valeur des propriétés s’avilit sous l’incessante menace d’un changement qui effraye la majorité. L’état commercial subit ces tristes influences, le crédit s’altère chaque jour davantage, les embarras passés tournent à l’indigence ; les nègres s’impatientent, les irritations croissent, les passions s’enveniment, les évasions augmentent, les procès scandaleux se multiplient, enfin la possibilité d’une guerre avec les Anglais complète l’infortune de cette société malheureuse, placée entre les misères du présent ou les inquiétudes de l’avenir, et livrée à l’agitation maladive qu’éprouvent les populations dans l’attente d’un grand événement.
Nous espérons, pour le bonheur des colonies, que la session qui vient de s’ouvrir amènera quelque chose de définitif. La question de la liberté des noirs demande à être promptement résolue ; la régénération des îles en dépend. L’incertitude pour les masses comme pour les individus, est pire que la mort. Les colons sensés désirent que l’on en finisse. Si l’on ne fait rien, ils l’ont dit eux-mêmes, nous avons rapporté leurs paroles, tout est à craindre des ateliers en fermentation, si l’on s’arrête à quelqu’un des projets de juste-milieu, le malaise qui ronge les colonies ne cessera pas de les troubler ; on reviendra immédiatement aux interminables discussions d’aujourd’hui, et l’avenir sera de nouveau mis en jeu. Les vrais abolitionistes, ceux qui veulent changer autre chose que des mots, ceux qui ne se paient pas de phrases dogmatiques, ne croiraient pas le but atteint, et en continueraient la poursuite avec l’animation que donne un premier succès. Entre la France et l’esclavage il y a un combat à outrance : la France ne quittera les armes que le jour où les noirs seront véritablement libres. [375] Pour notre compte, telle est l’ardeur de notre foi, que nous ne nous contenterons jamais d’une réparation à demi.
Il ne s’agit plus de savoir si les nègres sont mûrs pour la liberté, ni de discuter métaphysiquement s’ils sont « naturellement subordonnés à la tutelle du blanc [232], » s’ils sont « propres à jouir de la vie sans appartenir aux blancs ; » il s’agit de leur donner la liberté qu’ils veulent, la liberté qu’il est équitable de leur rendre. Il ne s’agit plus d’examiner s’ils sont dignes des droits politiques, il s’agit de les en investir, parce qu’ils sont capables de s’en emparer eux-mêmes si l’on différait, et cela montre assez qu’ils le méritent. Quoi qu’on ait pu faire pour les abrutir, ils ont crû dans l’esclavage pour l’indépendance, et si on ne les émancipait pas de bonne grâce, ils ne tarderaient guère à s’émanciper tout seuls.
Les esclaves comprennent. Et les colons le savent bien, l’esclavage est un volcan prêt à ébranler leur société, comme ces feux souterrains qui font encore trembler leur terre. Oui, vous le savez, vous vivez dans l’inquiétude tout en ne voulant point avouer vos craintes, le mot liberté vous fait frémir, la terreur est à l’ordre du jour sur l’émancipation ; vous mettez à l’index celui qui prononce une parole libérale : aussi, je vous l’ai dit, plus d’un parmi vous cachent le fond de leur pensée, plus d’un savent qu’il faut en finir, et ne confessent point leur vérité. Vous vous trompez les uns les autres… vous êtes en péril.
C’est qu’on aura beau reconnaître la douceur du régime actuel des esclaves, il y a dans la servitude le fouet, la contrainte, l’abstraction de tous sentimens intellectuels, l’impuissance de tout développement moral. Sous son masque, sans grimace douloureuse, on voit constamment percer l’invincible désir de l’indépendance, et de temps à autres se manifeste le brutal réveil de l’homme, réveil d’esclave avec l’empoisonnement dans l’ombre et la révolte au grand jour, la révolte sans [376] la guerre, la révolte hideuse, accompagnée de l’incendie et de l’assassinat. Il ne s’écoule jamais dix années sans que les noirs, malgré la décomposition des plus nobles facultés humaines que la servitude opère dans leur âme, ne protestent par quelque violence contre leur prétendu assentiment volontaire à l’état où on les maintient. — Voyez à la Martinique seule, et sans remonter plus haut que 1811. Cette année-là, sous la domination des Anglais, révolte. En 1822, révolte ; vingt nègres du Carbet croient le moment opportun, ils tuent, ils brûlent, et sept d’entre eux paient de la vie leur espoir intempestif de secouer le joug. Vers cette époque, le poison fait tant de ravages qu’on en vient aux exécutions d’une cour prévôtale. En 1823, révolte ; c’est la célèbre affaire dite des hommes de couleur, d’où sortent les noms de MM. Fabien et Bissette, pour entrer à jamais dans l’histoire coloniale. En février 1831, révolte ; la conjuration est générale, elle éclate au cri de liberté ou la mort ! — Les meilleurs ateliers y prennent part, l’incendie est sur le point de triompher, un moment d’hésitation chez les insurgés arrête la guerre civile qui commence, les troupes s’emparent des plus coupables ; deux blancs, l’un créole, l’autre européen, l’un négociant, l’autre géreur, sont compromis, accusés, traduits devant la cour d’assises [233] avec cinquante prévenus, et bientôt vingt-trois esclaves marchent à la potence avec un courage héroïque en criant : Vive la liberté [234] ! Vers 1833, révolte [377] encore : nouvelle tentative des hommes de couleur et nouvelle répression. Mais qui peut dire que les maîtres et la garnison seront toujours les plus forts ? qui ne se rappelle qu’un parti d’esclaves de l’antiquité tint long-temps contre les Lucullus, les Pompée, et mit le grand empire romain à deux doigts de sa perte ? — En trente ans, quatre, cinq insurrections de nègres ! Si chez nous les vraies émeutes sont si rares, jugez ce qu’il faut d’exaspération à des esclaves pour arriver jusqu’à l’emploi de la force ouverte ! Les assassinats légaux n’empêchent pas le flot de la liberté de se soulever à de longs intervalles, et d’entraîner toujours dans son impitoyable courant quelques-uns de ceux qui sont assez fous pour vouloir faire digue.
Appelons la liberté, la consolante liberté, cherchons par tous les moyens imaginables à l’établir pacifiquement ; elle seule peut délivrer le xixe siècle de ces cruautés, de ces empoisonnemens et de ces massacres juridiques qui le déshonorent.
Les colons se vantent beaucoup de la tranquillité des îles, et la présentent comme un témoignage du bien-être des nègres. On ne peut nier le calme dont ils parlent ici, et notre surprise a été grande, avec les idées que nous apportions, de voir leur parfaite quiétude au milieu de leurs nombreux esclaves. Mais il est permis de penser que les deux mille hommes de troupes réglées, entretenues dans chaque colonie, outre la milice et la gendarmerie, ne sont pas étrangers à ce calme extraordinaire [235] ; la barbarie d’une législation dont les arrêts punissent l’esclave qui lève la main sur son maître, comme le fils qui frappe son père, doit encore être comptée avec l’influence du préjugé, pour justifier les esclaves. C’est aussi sur [378] des lois terribles qu’avaient établi leur repos, les Anciens vivant en paix au milieu de leurs esclaves, comme au milieu d’ennemis. Ce n’est assurément là qu’une paix de surface, et ils le sentent comme nous, ces hommes qui livrent pendant deux ans les ateliers aux fureurs d’une cour prévôtale, et se croient obligés d’offrir au dieu de leur sécurité des hécatombes de seize, dix [236] et vingt-trois têtes !
L’effet singulièrement opposé que les derniers bruits de guerre ont produit sur les Antilles françaises et anglaises donne à juger d’une manière très nette des différences de l’état libre à l’état esclave. Chez nous on fit beaucoup de préparatifs, on se mit vigoureusement en défense, et l’on regarda plus d’une fois du côté des cases à nègres en secouant la tête. Chez nos voisins, rien. Et comme nous paraissions choqué de cette tranquillité : « Tout le monde ici, nous fut-il répondu, est intéressé à défendre le pays, nous n’avons point d’esclaves à craindre ; vous aurez bien assez à faire, vous, avec les vôtres. »
Loin de nous la pensée mauvaise de vouloir acquérir l’abolition par la peur, de semer dans les esprits des craintes mal fondées, mais il n’est que trop vrai, la paix actuelle de nos îles, n’est due qu’à la persuasion où sont les esclaves qu’on s’occupe d’eux et qu’ils seront bientôt libres. Les hommes doués d’une oreille assez fine pour entendre ce qui se dit tout bas dans les cases à nègres, savent qu’il faut prendre garde. Les maîtres eux-mêmes en nous reprochant l’agitation qui existe dans les ateliers, annoncent explicitement un danger. — Que l’on ne nous accuse pas de juger la situation des colonies avec nos instincts d’abolitioniste, nous ne sommes pas les seuls à les croire en péril, ce n’est pas légèrement, sans doute, qu’un membre du conseil colonial de la Martinique, M. A. Fortier, a osé dire : « La société coloniale offre [379] aujourd’hui l’image de l’anarchie la plus complète, cette anarchie s’est formulée plusieurs fois en incendies et en révoltes ; l’autorité a rétabli l’ordre, mais l’anarchie n’en existe pas moins, elle s’est réfugiée dans tous les cœurs, elle se montre à la moindre occasion [237]. » Encore une fois que l’on y songe, les craintes que nous manifestons ne sont point celles d’un homme préoccupé de certaines idées. Il nous est facile de prouver que les nécessités de la position n’échappent pas aux créoles de bon sens. On vient d’entendre M. Fortier de la Martinique, voici maintenant ce que je trouve dans un mémoire qu’un habitant propriétaire de la Guadeloupe m’a fait l’honneur de m’envoyer. « Ainsi l’intérêt même des colonies réclame une solution immédiate de la question, cette solution ne peut être contraire à l’émancipation, si elle l’était, si la chambre des députés prononçait cet arrêt : l’abolition est indéfiniment ajournée, elle donnerait un signal de troubles et de désordres. La population esclave, dans l’attente de l’événement qui lui est annoncé, que le sentiment de la justice qu’elle porte en elle lui fait pressentir, frustrée dans ses espérances, éclaterait peut-être, et les terribles manifestations de sa colère seraient les conséquences de cette imprudente décision. » Écoutez maintenant un délégué des blancs de Bourbon : « La sourde fermentation qui se manifeste au sein des populations coloniales annonce que l’équilibre n’y existe plus. L’esclavage s’en va, il est condamné par l’opinion, et de cet état des esprits à la violence, il n’y a qu’un pas. Cette opinion a besoin d’être aidée et dirigée dans sa marche, si l’on ne veut pas exposer les colonies à toutes les éventualités de convulsions sociales [238]. »
Les autorités elles-mêmes proclament tout haut que le moment est venu. Le gouverneur de Bourbon, dans son discours d’ouverture au conseil colonial (27 avril 1840), a dit : « L’ordre public, d’accord avec l’humanité, exige que l’on s’occupe [380] d’améliorer le sort d’une partie de la population. » Enlevez à ces paroles les voiles obscurs du langage officiel, et il vous restera « si vous ne voulez pas que la tranquillité publique soit compromise, affranchissez les esclaves. »
Il faut donc en finir, il est temps. Et les demi-mesures, on le voit, seraient plus dangereuses qu’utiles.
Les nègres, comme l’a dit M. Gilland, ouvrier serrurier, pour les prolétaires [239] : Les nègres « ne demandent pas à souffrir moins, ils demandent à ne plus souffrir du tout. »
Quand nous songeons à tous les dangers qui entourent la propriété coloniale si l’on persistait à vouloir simplement modifier l’esclavage, nous sommes tenté d’affirmer que notre proposition d’émancipation immédiate contient seule les conditions de salut pour les colonies livrées aujourd’hui aux troubles d’une propriété réprouvée, et menacées dans un avenir prochain des catastrophes qui sont la fin de toutes violences.
Travaillons vite, travaillons sans relâche à cette œuvre de salut commun. Les nègres deviendront chaque jour plus faciles à remuer, plus impatiens du joug, à mesure qu’ils seront moins ignorans. Quelqu’abrutis qu’ils soient encore, le sentiment qu’ils ont acquis de leur misère est devenu un écueil pour la paix des colonies ; ils perçoivent confusément leur abjection et s’en indignent.
Donnez, donnez ce que vous devez pour qu’on ne vous l’arrache pas ; ne laissez point accomplir par les voies sanglantes de la violence ce que la justice et la raison peuvent faire avec profit pour tous. Le feu couve, il n’est pas éteint.
L’émancipation, telle que nous la comprenons, sera peut-être plus facile encore que nous ne pensons nous-même, elle s’opérerait à l’heure présente avec d’autant moins de désordre que tout le monde, maîtres et esclaves attendent une résolution grave de la métropole.
On peut donner à ces vastes inquiétudes une issue favorable, [381] heureuse, fortunée. Mais que l’on proclame le maintien de ce qui est, et elles auront certainement une issue ruineuse, sanglante, lamentable. Spectre de Saint-Domingue, sors de tes rouges linceuls, lève-toi et viens attester nos dernières paroles, pour épouvanter « ce peuple au col dur, » qui refuse d’écouter notre appel pacifique.
[382]
CHAPITRE XXIV.
RÉSUMÉ.↩
Si comme le disent les colons on ne peut cultiver les Antilles qu’avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles. — La raison d’utilité de la servitude pour la conservation des colonies est de la politique de brigands. — Une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. — Périssent les colonies plutôt qu’un principe. — Il n’est pas vrai que le travail libre soit impossible sous les tropiques.
De tous les moyens qui se présentent pour opérer le changement que doit indispensablement subir l’état social de nos îles, et pour donner à leur existence une autre base que la servitude, celui qui offre le plus de chances favorables est donc, à notre avis, l’émancipation en masse pure et simple. Cette émancipation a pour elle la convenance, l’utilité, l’opportunité ; ses résultats immédiats seront pour les nègres faits libres ; la probabilité de ses heureuses conséquences finales doit fixer le colon sur la réalité de ses avantages.
Établir l’ordre au milieu de la cohue momentanée des nouveaux libres n’est point ce qui nous embarrasse. La contenance admirablement calme et douce des huit cent mille affranchis de l’Angleterre ne peut laisser de ce côté aucune crainte dans les esprits sérieux et de bonne foi ; leur conduite a fait évanouir le lugubre fantôme des massacres que l’on prédisait pour le saint jour de la liberté. Organiser le travail nous paraît être la seule, la grande difficulté ! À ce sujet, avant d’aller plus loin, nous avons besoin de dire un mot sur l’ensemble de la question.
La commission du conseil colonial de Bourbon a dit : « Le travail libre sera toujours impossible à obtenir sous les tropiques [240]. » [383]
La commission du conseil colonial de la Guyane française a dit : « Le travail libre est une chimère aux colonies, parce que le climat qui énerve l’homme, favorise sa paresse en lui offrant sans effort de sa part tout ce qui peut suffire à ses besoins [241]. »
La commission du conseil colonial de la Guadeloupe a dit : « Le travail cessera dans les colonies, sitôt qu’il deviendra facultatif [242]. »
La commission du conseil colonial de la Martinique a dit : « C’est notre conviction profonde, notre foi sincère qu’il est impossible de maintenir sans l’esclavage un travail fructueux sur nos habitations [243]. »
Si l’on devait croire à l’infaillibilité des conseils coloniaux et à la rigidité de leurs formules, toute discussion serait inutile, il y aurait après de tels arrêts une seule chose à répondre : « Puisque l’on ne peut obtenir de sucre tropical qu’au moyen de l’esclavage, il faut renoncer au sucre tropical ; puisque les colonies ne peuvent être cultivées que par des esclaves, il faut renoncer aux colonies, à moins toutefois que vous tous partisans de la servitude vous ne consentiez à prendre la place des nègres par dévouement au sucre et aux colonies. Soumettez-vous volontairement au travail forcé, si vous le jugez utile pour fournir des marchandises d’encombrement à la marine de votre patrie ; mais n’espérez point que les honnêtes gens vous permettent plus long-temps d’y obliger des hommes qui s’inquiètent fort peu que votre marine et votre patrie aillent bien ou mal, par la raison qu’ils n’y ont aucun profit. »
Ce n’est pas là du tout l’opinion des planteurs. Au contraire, la chaleur des Antilles et ses influences énervantes étant données, ils en tirent la conclusion que les colonies ne pouvant être cultivées volontairement, il est juste d’y appliquer les [384] nègres par voie de contrainte. C’est quelque chose, nous l’avouons, qui dépasse la portée de notre tolérance et de notre sang-froid, qu’un raisonnement aussi sauvage. Voyez-vous ces quinze à vingt mille hommes blancs qui viennent soutenir devant le monde entier que leur prospérité est attachée à la misère et à l’avilissement de deux cent soixante mille hommes noirs !!! Celui qui prétend avoir le droit de garder des hommes en servitude, parce qu’on ne trouverait pas de bras libres pour planter des cannes, et celui qui soutiendrait qu’on a le droit de voler parce qu’on n’a pas d’argent, sont à nos yeux deux fous ou deux scélérats absolument pareils.
Lorsque j’arrive à réduire ce droit à son expression la plus concrète, lorsque m’isolant par abstraction du monde matériel et me retirant dans le monde intellectuel, je me représente que de deux hommes l’un se dit le maître de l’autre, maître de sa volonté, de ses mouvemens, de son travail, de sa vie, de son cœur, cela me donne tantôt un fou rire, et tantôt des vertiges de rage.
Que l’esclavage soit ou ne soit pas utile, il faut le détruire ; une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. La raison d’impossibilité n’a pas plus de valeur pour nous que les autres, parce qu’elle n’a pas plus de légitimité. Si l’on dit une fois que ce qui est moralement mauvais peut être politiquement bon, l’ordre social n’a plus de boussole et s’en va au gré de toutes les passions des hommes. La violence commise envers le membre le plus infime de l’espèce humaine affecte l’humanité entière ; chacun doit s’intéresser à l’innocent opprimé, sous peine d’être victime à son tour, quand viendra un plus fort que lui pour l’asservir. La liberté d’un homme est une parcelle de la liberté universelle, vous ne pouvez toucher à l’une sans compromettre l’autre tout à la fois.
Autant que qui que soit nous apprécions la haute importance politique et industrielle des colonies, nous tenons compte des faits, nous n’ignorons pas la valeur attribuée à ce qui se passe autour de nous, et cependant c’est notre cri bien [385] décidé, pas de colonies si elles ne peuvent exister qu’avec l’esclavage. L’esclavage viole le principe de la liberté, principe qui n’est pas seulement une convention faite entre les hommes, mais aussi une vérité naturelle parvenue à son évidence ; la liberté en effet renferme à la fois le bien matériel et le bien moral, c’est-à-dire la destinée suprême de l’homme. Liberté, c’est équité, comme a dit lord Coke, le l’Hopital de l’Angleterre. Le principe de liberté étant donc juste sous toutes les faces, il doit être souverain, absolu, despotique. C’est pourquoi nous qui aimons mieux nous passer de sucre que d’abandonner nos sentimens d’humanité, nous le déclarons, et cela avec toute la gravité qu’un homme puisse mettre à se prononcer, nous acceptons dans son entière portée un mot célèbre, et nous disons, nous aussi : « Périssent les colonies plutôt qu’un principe. » Oui, car un principe en socialisme c’est le cerveau en physiologie, c’est l’axe en mécanisme ; sans principes respectés il n’y a plus d’ordre, plus de société, plus rien, il ne reste qu’anarchie, violence, misère, chaos et dissolution.
Nous savons tout ce que les gens qui ne voient qu’un seul côté des choses, ont débité et débiteront encore contre cette pensée d’une forme abstraite, mais les injures ne sont pas des raisons, et leurs faux jugemens eussent-ils pu nous émouvoir, nous avions de quoi nous rassurer. Bien avant la Convention, dès 1765, les encyclopédistes avaient dit ce qu’elle n’a fait que répéter. « On dira peut être que les colonies seraient bientôt ruinées si l’on y abolissait l’esclavage des nègres. Mais quand cela serait, faut-il conclure de là que le genre humain doit être horriblement lésé pour nous enrichir ou fournir à notre luxe ? Il est vrai que les bourses des voleurs de grand chemin seraient vides, si le vol était absolument supprimé : mais les hommes ont-ils le droit de s’enrichir par des voies cruelles et criminelles ? Quel droit a un brigand de dévaliser les passans ? À qui est-il permis de devenir opulent aux dépens de ses [386] semblables ? Non !… que les colonies européennes soient donc détruites plutôt que de faire tant de malheureux [244]. »
Ne veut-on reconnaître l’autorité de l’Encyclopédie, que l’on prenne le Dictionnaire théologique de l’abbé Bergier, et l’on y pourra lire ce qui suit à l’article Nègre. — « Il n’est pas possible, dit-on, de cultiver les îles autrement que par des esclaves, dans ce cas il vaudrait mieux renoncer aux colonies qu’à l’humanité. La justice, la charité universelle et la douceur sont plus nécessaires à toutes les nations que le sucre et le café. » Quelle différence y a-t-il entre ces mots et ceux de Robespierre ? Et l’abbé Bergier n’était point un révolutionnaire, c’était un homme sans passion politique, très bon, très savant, zélé défenseur de la religion catholique, et, de plus, fort ennemi des philosophes. À ce que nous venons de rapporter il ajoute ensuite avec une grande pénétration : « Mais tout le monde ne convient point de l’impossibilité prétendue de se passer du travail des nègres. Lorsque les Grecs et les Romains faisaient exécuter par leurs esclaves ce que font chez nous les chevaux et les bœufs, ils imaginaient et disaient que l’on ne pouvait faire autrement. »
En définitive, tous les sophismes du monde ne peuvent aller contre le droit. Les nègres doivent être libres, parce que c’est justice. Si lorsqu’ils seront libres ils ne veulent pas cultiver au-delà de leurs besoins, comme on l’assure, de deux choses l’une, ou il faut les remplacer au moyen de l’émigration par une population qui ayant déjà des besoins acquis travaillera pour les satisfaire [245], ou il faut rendre les îles à la nature qui ne les a pas faites pour l’homme, puisqu’il ne lui est [387] pas possible de les exploiter sans user de violence envers quelques-uns de ses semblables. Il y a bien encore assez de sol en friche sur le globe, pour ne pas peupler celui qui ne le veut pas être. Tout en admirant l’humanité dans les prodigieux travaux qui ont transformé en terre-ferme les marais de la Hollande, nous avons grande pitié de la folie qui est venue là épuiser tant de force et de génie.
Mais que tous ceux qui comprennent l’immense valeur politique et industrielle des colonies se rassurent, les nègres voudront et les blancs pourront travailler. Alors que l’on n’aura plus à craindre de montrer aux noirs des blancs la houe à la main, ils se mêleront ensemble sur les champs des Antilles et de leur union, on verra sortir une activité nouvelle.
Les colonies ne doivent pas périr, elles ne périront pas, leur prospérité peut aller de front avec l’indépendance ; c’est dans l’indépendance que sera leur plus grande prospérité. Il n’est pas vrai que le travail libre soit impossible sous les tropiques, il ne s’agit que de savoir déterminer les moyens de l’obtenir ; et comme il n’est rien qu’il ne soit donné à l’homme de faire dans les limites de sa nature, on ne peut douter que cela soit possible. Toute la question pour nous se réduit donc là : organiser le travail libre.
Dans le chapitre suivant on verra ce que nous proposons pour atteindre ce grand but.
[388]
CHAPITRE XXV.
ESSAI DE LÉGISLATION PROPRE À FACILITER L’ÉMANCIPATION EN MASSE ET SPONTANÉE.↩
L’émancipation générale proclamée, il est important de dissiper les craintes des timides pour la paix publique, et de prévenir les tentatives des hommes pervers qui croient gagner quelque chose aux désordres.
Garnisons.
« Les garnisons des colonies seront donc augmentées du nombre de troupes que les autorités locales indiqueront comme nécessaires. »
« Un corps de troupes noires sera créé dans chaque colonie » [246]. »
Hospices et hôpitaux.
Les esclaves rendus à la dignité humaine, appelés à la vie de citoyens, ne peuvent en aucun cas être distraits de la loi commune. Ils [389] ne doivent plus rien à leurs anciens maîtres, ceux-ci ne doivent plus rien à leurs anciens esclaves. Cela étant, grand nombre de vieillards, d’infirmes, de malades qui se trouvent aujourd’hui à la charge de leurs propriétaires vont tomber à la charge de l’état. Un des premiers devoirs du législateur est d’ouvrir un asile à tous ces malheureux, nous entendons que la déclaration d’indépendance ne peut être prononcée sans la création simultanée d’hospices pour les infirmes et les vieillards, de fermes agricoles pour les orphelins abandonnés, et d’hôpitaux pour les malades pauvres.
[390]
Nos îles sont, comme on sait, partagées en arrondissement divisés en cantons qui se subdivisent en communes.
« Chaque arrondissement sera pourvu d’un hôpital, d’un hospice et d’une ferme agricole. »
« Le propriétaire conservera ses malades, ses invalides et ses orphelins deux mois pleins après la promulgation de la loi d’affranchissement ; et sera tenu d’avoir pour eux les mêmes soins que par le passé. Ce temps expiré, il a droit de les renvoyer. C’est la nation qui en devient responsable. »
Dépenses de l’espèce.
« La métropole fera l’avance des fonds nécessaires à l’érection de ces établissemens. »
On peut dire, ici, tout de suite que
« Les dépenses auxquelles donnera lieu l’émancipation seront à la charge de l’État, mais constitueront une dette de la colonie remboursable selon ses ressources postérieures. »
« Les amendes prononcées par les juges-de-paix et les tribunaux seront spécialement applicables aux hospices et hôpitaux. »
Toute réunion d’hommes doit se suffire à elle-même. Lorsqu’elle y manque, c’est qu’elle est mal constituée. Les colonies devront donc payer ce que l’on dépensera pour la reconstruction de leur état social, mais si après tout la métropole ne pouvait rentrer dans les fonds consacrés à l’émancipation, on doit convenir qu’elle n’aura jamais fait de perte moins regrettable.
Que l’on ne s’effraie pas surtout des dépenses que nous proposons ici et plus bas. Elles sont indispensables et elles rapporteront d’immenses bénéfices, en faisant d’une population malheureuse et presque brute, une population heureuse et intelligente. Il n’y a rien de meilleur marché que l’ordre ; il n’y a rien de plus coûteux que le désordre.
Sucreries pénitentiaires et sucreries criminelles.
Après avoir pourvu au sort des malheureux, il faut songer à donner à la société les garanties de sécurité dont elle a besoin pour fonctionner sans crainte. [391]
« Il sera installé dans chaque commune deux sucreries, dites pénitentiaires, une pour hommes, l’autre pour femmes. »
« Les détenus y sont occupés à tous les ouvrages d’une habitation sucrière. »
« Le travail s’obtient par les moyens employés dans les pénitenciers d’Europe. Dans aucune espèce de cas et sous aucune espèce de prétexte un détenu ne peut être soumis à un châtiment corporel. »
« La peine de la sucrerie pénitentiaire n’étant point une peine infamante, les détenus peuvent être employés selon que l’administration supérieure en jugerait l’urgence aux travaux des ponts et chaussées. »
« Les détenus reçoivent une rétribution, dont moitié est réservée pour leur être remise à l’époque de leur sortie. »
« Les prisons actuellement existantes seront converties en sucreries criminelles, dont le nombre sera aussi élevé que de besoin. »
« Là sont envoyés (hommes et femmes dans des établissemens différens) les condamnés des tribunaux pour délits graves, vols et crimes. »
« Toute peine corporelle est également interdite dans les sucreries crimielles. »
« La journée de travail des sucreries pénitentiaires et criminelles est de dix heures. »
« Les détenus et prisonniers sont conduits aux travaux par des gardiens, comme il arrive aujourd’hui sur les habitations. »
« Les détenus et prisonniers n’ont pas de jardins, ils sont nourris en commun. »
Le régime est plus sévère sur les sucreries criminelles que sur les sucreries pénitentiaires, mais pour les unes et les autres
« Il sera établi des écoles où les condamnés seront tenus de se rendre. »
Dans la nature humaine, les méchans sont des exceptions. Les coupables ne sont pas des êtres vicieux qu’il soit raisonnable d’enfermer comme les bêtes féroces, ce sont des malades à guérir. Pour cela ils doivent être gardés continuellement dans une atmosphère d’ordre et de moralisation. Il faut leur faire respirer la vertu. Depuis six mille ans que les hommes sont rassemblés, on a fait l’expérience que les coups, les tortures et la mort punissent, mais ne corrigent pas. Il est temps de cor [392] riger et d’amender. Toute l’installation des établissemens coloniaux de — détention que l’on va fonder, devra répondre à ce but. Afin de le mieux remplir, nous voudrions
« Qu’il fut fait deux fois chaque jour aux prisonniers une instruction d’une demi-heure, où l’on s’attacherait surtout à leur expliquer, à leur faire comprendre, à leur mettre bien en relief, soit par des lectures, soit par des discours, d’une forme très simple, les graves obligations du citoyen, les impérieux devoirs de l’honnête homme. »
« Les enfans condamnés seront enfermés dans des établissemens distincts. »
La colonie agricole fondée par M. Demetz, à Mettray, près de Tours, peut être prise comme un excellent modèle de ces établissemens. — Outre le travail, on devra particulièrement s’occuper de l’instruction primaire et morale des jeunes égarés.
« Tous les frais des sucreries pénitentiaires et criminelles ; fondation, achat de terrain et entretien, seront payés sur leurs produits, L’excédant des recettes sera versé à la caisse coloniale. »
« La loi étant pour tous, et ne reconnaissant plus aucune des anciennes distinctions de couleur, les blancs qui seraient condamnés à la sucrerie pénitentaire ou criminelle y devront être employés à tous les travaux de la maison, sans excepter celui de la canne. »
« Les sucreries pénitentiaires et criminelles sont placées sous la surveillance d’un inspecteur ad hoc, chargé d’y faire observer la lettre et l’esprit de la loi. »
Juges-de-paix.
L’administration judiciaire des colonies sera strictement rangée aux prescriptions du Code français ; cependant
« Outre les tribunaux ordinaires, il sera créé dans chaque commune une justice-de-paix composée d’un juge, d’un suppléant et d’un greffier. »
« La justice-de-paix comme les bureaux de police, seront placés dans des endroits facilement accessibles et autant que possible au centre du lieu le plus peuplé de la commune. »
« Les terrains nécessaires pour ces établissemens comme pour ceux des écoles, des prisons, des hôpitaux, seront achetés par le gouvernement, qui entrera en possession, s’il y avait refus de vente, selon les lois de l’expropriation forcée. »
[393]
« Pour éviter des frais, l’administration traitera de ces terrains, s’il y a lieu, par échange avec des terres appartenant à l’État. »
« Le tribunal de la justice-de-paix est en permanence depuis dix heures du matin jusqu’à cinq heures du soir. »
« Le juge-de-paix ne peut s’absenter de son tribunal que pour délit criminel à constater. Sauf ce cas, toute descente de lieu qu’il pourra avoir à faire est opérée par son greffier, qui lui rend compte. »
« Le juge-de-paix connaît de toute affaire d’intérêt au-dessous de 300 fr, à charge d’appel pour les causes au-dessus de 100 fr., de recouvremens de gages, recouvremens de petites dettes, débats entre propriétaires et laboureurs, relatifs à l’exécution, à l’interprétation des contrats faits entr’eux, difficultés sur conventions de gages, injures, rixes, coups et voies de fait. »
« Il a droit de casser les engagemens entre propriétaires et laboureurs. »
« Il peut lancer mandat d’amener pour délit criminel constaté par lui. »
« Il poursuit d’office dans tous les cas de préjudices causés au peuple, qui viennent à sa connaissance. »
« Il a droit, dans les limites du Code et en se faisant accompagner de deux hommes de police, de se présenter sur n’importe quelle habitation de sa commune, où il aura sujet de croire que la vindicte publique le requiert. »
« Il peut citer en témoignage devant son tribunal, et en cas de non comparution sans motif valable de la personne citée, condamner le délinquant à 50 fr. d’amende ou deux jours de sucrerie pénitentiaire. »
« Les témoins, s’ils perdent plus d’une demi journée ; ont droit à une indemnité de 1 fr. »
« Le jugement de nulle affaire portée devant le tribunal de paix ne peut être différé au delà de dix jours pour dernière limite, sauf le cas de force majeure. »
« Le juge qui ne pourrait suffire aux besoins de sa commune, s’adressera au procureur-général qui devra établir un tribunal supplémentaire. »
« Toute condamnation du juge-de-paix dépassant un mois de sucrerie pénitentiaire et 100 fr. d’amende est susceptible d’appel. Hors ces cas, il juge en dernier ressort, et ses arrêts (toujours sans procédures) sont immédiatement exécutoires, et la force publique est tenue de les mettre à exécution. »
« Toute personne qui s’opposerait l’exercice des droits conférés aux juges-de-paix, serait poursuivie dans les formes du droit public de France. »
[394]
Nous comptons beaucoup que la promptitude de la répression des délits aux audiences de chaque jour, amènera une grande diminution dans le nombre même des délits. Bien des animosités aussi qui prennent naissance dans les lenteurs des tribunaux, et les plaidoiries des avocats viendront expirer au pied de ce tribunal, dont les arrêts sont entièrement gratuits et dont le caractère est essentiellement conciliateur et paternel. C’est pour cela que nous donnons aux juges-de-paix le droit d’employer la force publique pour faire observer leurs sentences, Nous voulons éviter ainsi les procédures onéreuses auxquelles il faut souvent recourir pour obtenir exécution de leurs arrêts, Il n’y a aujourd’hui que les riches qui puissent avoir justice.
Jusqu’à nouvel ordre
« Les juges-de-paix et leurs greffiers devront être exclusivement métropolitains, et perdront leur place par le fait de leur mariage avec une femme de la colonie ou de toute acquisition d’immeubles dans le pays [247]. »
« Le juge-de-paix rendra mensuellement à l’autorité supérieure un compte des affaires portées à son tribunal et de l’état de sa commune. »
« Les juges-de-paix ne peuvent être révoqués que par ordre du ministre, ou en cas d’urgence par le gouverneur assisté en conseil du procureur-général, du président de la Cour royale et de deux juges-de-paix [248]. »
« Les juges-de-paix exerceront la juridiction qui leur est attribuée par la présente loi, nonobstant toute loi contraire antérieure. »
Les magistrats destinés à remplir ces hautes fonctions doivent être choisis avec un soin particulier. Ils sont appelés à devenir les arbitres et les conseils de la population. Ils forment la pierre angulaire de l’ordre nouveau. Il faudrait qu’ils fussent tous doués, s’il était possible, des deux qualités les plus rares à trouver réunies chez les hommes : la bonté et la fermeté.
[395]
Stations de police.
« À chaque tribunal de paix est attaché un poste que l’on pourrait appeler station de police, composé de quatre sergens ruraux à pied et deux à cheval. »
« Les sergens ruraux sont revêtus d’un uniforme, mais ne sont armés que de nuit. Ils représentent la force publique, et peuvent en cas de flagrant délit arrêter un homme qui leur est dénoncé, sous l’obligation de le conduire dans les douze heures au moins devant le juge-de-paix. »
Les stations de police pourront être multipliées autant que la tranquillité publique l’exigerait. Il sera sage d’y faire entrer beaucoup de noirs. Ne laissons échapper aucun moyen d’intéresser les nègres à l’établissement de l’ordre en les y faisant concourir.
Écoles.
L’espèce humaine ne peut s’améliorer que par l’instruction. En éclairant les masses, on leur donne la connaissance du bien, on leur révèle la conscience de leur grandeur, et par suite on épargne au monde les excès et les cruautés qui souillent les mouvemens populaires. Si l’on pouvait supprimer la portion abrutie des populations, on n’aurait que des révolutions héroïques ; supprimez-la donc en l’élevant à la dignité de peuple intelligent.
La populace est en bas ce que la noblesse est en haut ; il faut mettre autant de soins à purifier l’une que l’autre. Plus il y a d’hommes éclairés et bien éclairés dans une nation, plus il doit y avoir infailliblement de calme, de modération et de soumission à la loi, surtout lorsque la loi sera faite pour tous et par tous.
L’éducation des émancipés et de leurs enfans est donc une des parties constituantes de la réforme, elle exige toute la sollicitude du législateur. Il est important de les instruire avec soin, c’est le moyen le plus sûr de les mettre en état de se défendre contre tout retour de fortune, tout changement politique qui tendrait à les replonger dans la servitude.
« Outre les fermes agricoles qui recevront à demeure les orphelins et orphelines de la colonie, deux écoles de filles et deux écoles de garçons entièrement gratuites seront fondées dans chaque commune sur des points, choisis de manière à faciliter la réunion des enfans. »
[396]
« Si quatre écoles ne suffisent pas pour vaincre les obstacles qu’offre l’éparpillement de la population des colonies, on en établira davantage. »
« Il est interdit aux père et mère d’utiliser leurs enfans ou de louer leur travail avant l’âge de dix années révolues. »
« Nul enfant, fille ou garçon, au-dessus de six ans et au-dessous de dix ans ne peut être détourné, sous quelque prétexte que ce soit, des moyens d’acquérir l’éducation qui lui est due, »
La loi regarde comme aussi important d’assurer la subsistance de l’esprit que celle du corps. C’est pourquoi
« Nul ne peut se soustraire au devoir d’envoyer ses enfans aux écoles, à moins qu’il ne leur fasse donner une instruction particulière sous le toit paternel. »
« Tout père, mère ou tuteur qui, sauf le cas de maladie, n’envoie pas son enfant à l’école, est passible de deux jours de sucrerie pénitentiaire par chaque jour d’absence de l’enfant. »
« Ces absences sont constatées par l’instituteur sur des notes qu’il envoie chaque matin au juge-de-paix de la commune, le juge-de paix prononce. »
« Les enfans restent à l’école depuis dix heures jusqu’à quatre heures. »
« Il n’y a pas d’école sans un lieu ombragé pour les récréations. »
Dans un des établissemens que les frères Moraves ont formés à Antigues, on à joint à l’école quelques terres où chacun des élèves a un petit jardin qu’il peut cultiver durant les heures de récréation. C’est à notre avis un exemple à imiter. On peut ainsi associer, de bonne heure, dans l’esprit des enfans, des idées de plaisir aux travaux agricoles. En tous cas,
nbsp;Le gouvernement fera faire pour les écoles des colonies de petits livres élémentaires où l’on mettra en relief les avantages et la noblesse des travaux de la terre. »
« À toutes les écoles on adjoindra une salle d’asile pour les enfans en bas-âge que les parens voudraient y déposer pendant le jour. »
« Les citoyens en état de remplir une telle fonction seront invités à ouvrir dans le local public, des classes du soir et du dimanche pour les adultes qui désireraient y assister. »
[397]
Nous voudrions que le traitement des maîtres d’école fut assez élevé pour que l’on put attirer dans ce grave emploi des hommes d’une intelligence et d’une culture d’esprit supérieures. La préparation de la jeunesse pour la vie est une des œuvres les plus difficiles ; les plus délicates et les plus respectables que nous concevions. Il nous semble que les maîtres d’école, au sein d’une société qui comprendrait tous ses devoirs, seraient toujours mis au rang des premiers employés de la nation. Nous voudrions qu’ils fussent ! particulièrement honorés et qu’on leur réservât une place d’honneur dans toutes les cérémonies publiques où figurent les corps de l’État.
Cases à nègres.
Les colonies ainsi armées, ayant pourvu au sort de leurs invalides, de leurs malades et de leurs orphelins, certaines de n’avoir rien laissé derrière pourraient, sans embarras, s’occuper des mesures d’ordre.
« La loi déclarera d’abord que la case et le jardin dont jouissent aujourd’hui les esclaves ne leur appartiennent pas. »
Nous demandons que cette clause soit insérée dans la loi. On aura un peu de peine d’abord à faire comprendre aux nègres que ces biens qu’ils possèdent et qu’ils ont reçus de leurs pères, ne sont pas à eux.
Afin de prévenir les dangers d’un changement trop subit qui pourrait devenir funeste aux laboureurs et compromettre la tranquillité publique, en leur enlevant spontanément leur asile,
« Les anciens esclaves continueront à jouir de leurs cases et jardins pendant deux mois après la promulgation de l’acte libérateur. »
« Le laboureur paiera le loyer de sa case durant ces deux mois (à moins qu’il n’en veuille sortir immédiatement), par deux jours de travail chaque semaine. »
« Tout contrevenant à ces articles, laboureur ou propriétaire, sera passible, le propriétaire de 30 francs de dommages-intérêts, à verser dans les mains de l’expulsé ; le laboureur d’un mois de sucrerie pénitentiaire. »
« Les arbres fruitiers des habitations dont l’usage abandonnait la propriété aux esclaves, rentrent immédiatement et de plein droit dans la possession du propriétaire. »
[398]
« Toutefois, l’ancien esclave ne pourra être privé du jardin qu’il occupe aujourd’hui ; avant que la récolte de vivres plantés par lui et sur pied, n’ait été faite selon le cours naturel des saisons, à moins cependant qu’il ne convienne mieux au propriétaire de rembourser la valeur de la récolte, qui serait, faute par les partis de s’entendre, fixée à dire d’experts. »
« Le propriétaire qui aurait contrevenu à cette clause, sera condamné à une amende de 100 francs à verser dans la caisse coloniale, et à 150 francs de dommages-intérêts payable au laboureur spolié. »
« Toute voie de fait ou coup porté est puni conformément aux lois françaises, la peine de la prison étant convertie en celle de la sucrerie pénitentiaire ou criminelle, quelque soit le rang de la personne qui aura battu une autre personne. »
« La plainte est portée devant le juge-de-paix ou devant les tribunaux, selon qu’il y a crime ou délit. »
Terrains vagues, Vagabondage.
« La prise de possession dés terrains vagues est formellement interdite. »
« Toute personne qui s’établit sur une terre, sans droit ni titre, est coupable. Le propriétaire porte plainte pour sa chose, le procureur-général pour les propriétés de l’État. »
« Le juge-de-paix condamne l’envahisseur à une détention, de quinze jours à trois mois de sucrorie pénitentiaire ; et prononce en outre, adjudication au propriétaire de la récolte plantée et des bâtimens saisis sur le sol envahi, à moins qu’il ne reconnaisse que l’occupant a pu de bonne foi se croire autorisé à posséder. Dans ce dernier cas, le juge-de-paix se borne à le faire déguerpir, et ne le peut condamner à perdre que la moitié de la récolte ou de la valeur des constructions. »
« Cette disposition d’ordre ne privera aucune des parties des avantages de la loi commune ; c’est-à-dire qu’elles pourront toujours en appeler devant les tribunaux ordinaires des arrêts de la justice-de-paix. »
Une vieille loi d’Égypte, rendue par Amasis, punissait de mort les oisifs. Solon repoussa une aussi barbare pénalité, Mais à l’imitation d’Amasis, il obligeait les citoyens d’Athènes à venir rendre compte annuellement aux magistrats de leurs moyens d’existence. Celui qui manquait une fois était condamné à l’amende, celui qui manquait trois fois encourait la peine d’infamie ! La loi française, on le sait, s’est uniquement réservé le droit de demander ce compte aux citoyens quand elle [399] le juge nécessaire, et de punir de prison ceux qui ne lui répondent pas d’une manière satisfaisante. C’est justice. L’homme qui, sans fortune ne travaille pas, devient dangereux et doit être sauvé de lui-même.
« Le vagabondage, déjà prévu par nos lois, sera sévèrement poursuivi et réprimé comme en France. »
« Celui qui ne justifie pas de la possession d’un bien où d’un emploi quelconque propre à le faire vivre, est tenu pour vagabonds de même que celui qui ne justifie pas d’un gîte. »
« Le vagabond peut-être condamné par le juge-de-paix, de un mois à six mois de sucrerie pénitentiaire, en cas de récidive, de six mois à un an, et pour la troisième fois deux ans. »
« Dans aucun cas, néanmoins, il ne pourra être poursuivi de nouveau comme vagabond, que dix jours après sa dernière libération. »
Ainsi, tel qui n’aura pas assez de courage et de vertu pour secouer les vieux préjugés du pays et qui fuira les plantations, aimant mieux rester oisif que de se livrer à la culture de la canne, y retombera forcément s’il encourt les verdicts de la loi.
Tout citoyen doit travailler pour vivre, mais la liberté est le plus sacré des droits de l’homme : si un homme en ne travaillant qu’une heure dans un mois prouve que le gain de cette heure suffit à pourvoir à ses besoins, à ceux de sa femme, de ses enfans et à ses charges envers l’État, il n’est point répréhensible aux yeux de la loi. Nous voulons employer tous les moyens compatibles avec la justice pour conserver le travail, mais sans toucher à la pleine et entière liberté individuelle de l’affranchi, L’esclavage lui a malheureusement appris que l’on peut vivre avec un ou deux jours de travail par semaine, s’il lui convient de ne pas s’occuper davantage, nous ne reconnaissons pas à la société le droit de l’y forcer. Qu’elle l’y amène par une bonne direction politique.
Mendicités.
La mendicité est inexcusable aux colonies où l’ouvrage ne manque jamais aux bras de bonne volonté. La mendicité comme le vagabondage est un crime de lèse civilisation, car
« Le citoyen pauvre, mis par la maladie hors d’état de pouvoir travailler, sera reçu et soigné à l’hôpital jusqu’à parfaite guérison. »
[400]
« Le mendiant arrêté pour la première fois, passera trois mois à la sucrerie pénitentiaire ; pour la seconde fois, six mois ; pour la troisième, deux ans. »
Impôt.
« Tout citoyen vivant aux colonies, sans exception, à quelqu’une des anciennes dénominations de classe qu’il appartienne, est frappé d’un impôt personnel, payable par douzième. »
« Cet impôt sera fixé chaque année par la législature. »
« Le citoyen qui ne paie pas son impôt personnel, est condamné à la sucrerie pénitentiaire, où il reste jusqu’à ce qu’il ait acquitté sa dette envers l’État [249]. »
« Le produit de l’impôt personnel est versé dans les caisses de la colonie, et particulièrement affecté, si les circonstances le permettent, au remboursement des avances faites par là métropole [250]. »
Les esclaves appelés à l’indépendance, entrent immédiatement en jouissance des bienfaits de la société libre qui protège leur personne, leur liberté et la tranquillité publique. Il est juste qu’on les fasse immédiatement participer à ses charges. L’imposition personnelle saisissant les émancipés, au sortir même de la servitude, n’est pas seulement une chose équitable, elle a cet avantage de les accoutumer vite aux charges de leur nouvelle condition, de leur montrer qu’aux joies de l’indépendance, sont attachées des devoirs. Les gouverneurs auront à faire ressortir à leurs yeux cet enseignement austère de la vie pratique des hommes libres, par des proclamations très simples souvent répétées. L’impôt personnel a aussi l’avantage de forcer les nouveaux libres au travail pour satisfaire aux exigences du fisc, c’est un des premiers besoins artificiels que la liberté va créer pour eux.
Travail, Salaire.
En Europe, où il y a plus de bras que de travail, on voit l’employeur abuser de sa position et payer trop peu l’employé. Ce vice de notre so [401] ciété qui la fait souffrir en la déshonorant doit être présent aux yeux du législateur qui reconstitue les colonies sur des bases de justice pour tous. Dans ces pays où les bras manquent au travail, il faut craindre que l’employé ne veuille abuser à son tour de sa position, et être payé trop cher. En conséquence, jusqu’au moment où l’on organisera complètement le travail, nous regardons comme nécessaire
« De fixer un maximum et un minimum à la journée de salaire. »
Nous ne saurions donner les chiffres. Le législateur, pour atteindre les limites les plus équitables, aura à s’entourer de tous les documens qui peuvent éclairer un point aussi délicat. Dans un pareil examen il ne faudra point se demander à quel salaire on peut fixer le prix du travail de l’ouvrier, en raison du prix de la marchandise, mais bien en raison de ce qu’il faut à un homme pour satisfaire sans privation à ses besoins et à ceux de sa famille, pour le présent et pour l’avenir. Le prix de la marchandise sera ensuite fixé là-dessus. Nous croyons donc devoir dire que
« Le minimum ne peut, en aucun cas, être au-dessous de 1 fr. 75 c. par jour, non compris la jouissance du jardin pour l’ouvrier à demeure, 2 fr. pour l’ouvrier de passage. »
« La journée de travail restera fixée à neuf heures. »
« Les diverses conditions du labeur sont, dans les limites du maximum et du minimum données par la loi, entièrement laissées à la disposition des parties. »
Les planteurs anglais ont reconnu que la tâche était un des meilleurs modes à employer [251]. Chacun sait ce qu’il fait, il n’y a pas de fraude possible. On donne tant à un ou à plusieurs hommes pour un certain nombre de trous de cannes, une certaine étendue de terrain à fumer, épailler, récolter, etc. C’est l’intérêt du travailleur d’achever rapidement, l’ardeur au travail est en rapport direct avec ce que l’ouvrage donne de profit. Quelques habitans français ont déjà introduit la tâche sur leurs plantations et ceux qui possèdent de bons ateliers, c’est-à-dire ceux qui sont de bons maîtres, ont eu lieu de se féliciter de cet arrangement.
Le travail en participation mérite aussi d’être étudié sérieusement. [402] C’est celui que la république avait établi pour remplacer l’esclavage. Dans ce mode, le laboureur s’attache au sol. On n’a presque plus besoin de surveiller les ouvriers, ils se surveillent eux-mêmes, chacun est intéressé à ce que personne ne se livre à la paresse. Mais, outre que beaucoup de maîtres auront peu de goût à se donner des noirs pour associés, nous craignons que le nègre, dans son état actuel d’ignorance et conséquemment de défiance, ne puisse pas comprendre d’abord le mécanisme d’une telle association. Il refusera sans doute de s’y prêter dans la crainte d’être trompé sur les prélèvemens qui sont à faire pour l’entretien et le remplacement des outils et des animaux d’exploitation. Le travailleur nègre n’est pas non plus en état aujourd’hui de supporter les pertes que pourraient éprouver l’entreprise. En tous cas, ceci est laissé dans les limites de la loi à la discrétion des contractans, et il serait heureux pour tout le monde qu’un tel système put s’établir [252], [403] car le nègre s’attache infiniment plus au travail dont le fruit doit lui être attribué directement qu’à tout autre. Souvent, nous a dit M. Salvage Martin, un des principaux et des plus intelligens planteurs d’Antigues : « Souvent ils vous disent qu’ils ne peuvent travailler pour vous sous prétexte qu’ils sont malades, et vous les voyez travailler pour eux-mêmes avec bien plus d’ardeur qu’ils ne le font d’ordinaire pour votre compte. »
« Il est loisible aux employeurs et aux employés de former des engagemens de six mois à un an ; pas au-delà. »
[404]
« L’employeur s’engage à toujours entretenir de travail l’employé, celui-ci à ne point louer ses bras à d’autre que l’employeur. »
« Le loyer de la case que l’employé prendra dans ce cas sur l’habitation, y compris le jardin d’une étendue déterminée par la loi, ne pourra dépasser 1 fr. 50 par semaine ou 6 fr. par mois, soit 72 fr. par an. »
« Toute case d’habitation devra être composée de deux pièces, ayant chacune une fenêtre de trois pieds carrés, ouvrant et fermant. La porte d’entrée ne pourra avoir moins de six pieds de haut. Chaque case sera en outre pourvue d’un petit appendice couvert, propre à servir de cuisine. »
« Le juge-de-paix veillera à l’exécution de l’article précédent et pourra prononcer une amende de 50 fr. contre le propriétaire en contravention. »
[405]
« Le locataire est en droit d’exiger des dommages-intérêts si la case louée n’est pas entretenue selon les conditions fixées par la loi. »
Le législateur en dictant ainsi le moins qu’un propriétaire puisse donner à son locataire et en fixant le prix de la rente, préviendra beaucoup de démêlés fâcheux.
Les propriétaires feront un acte sage en ne marchandant pas sur le terrain qu’ils donneront à leurs engagés. Presque tous, grands terriers, la chose leur est facile. C’est un moyen efficace d’attacher les ouvriers au sol et de les localiser. Nous leur conseillerions aussi d’encourager les nègres à convertir leurs gains en achats de bestiaux, qu’ils laisseraient paître sur les savanes de la propriété. Il faut constituer les nouveaux libres, propriétaires malgré eux pour ainsi dire, et par tous les moyens possibles, afin qu’ils deviennent les premiers intéressés à poursuivre le vol et le désordre.
« Dans l’engagement, l’ouvrier pourra se réserver deux jours par semaine s’il ne veut point donner tout son temps, mais le fait même de son engagement l’oblige de fournir à l’époque de la roulaison son travail sans interruption (fêtes et dimanches exceptés), jusqu’à l’achèvement de la récolte. »
« En cas de discussion sur ce point, le jugement en sera ajourné jusqu’à la fin de roulaison, et l’ouvrier devra continuer à remplir sa tâche. »
« L’engagé convaincu d’avoir rompu violemment son contrat encourra une peine de trois à six mois de sucrerie pénitentiaire. »
« L’engagé qui déserterait l’atelier avant où pendant la roulaison, le laboureur embauché pour ce travail, qui refuserait de le continuer, quelque soit le prétexte qu’ils alléguassent pour excuse, pourront être ramenés par voie de contrainte et encourront une peine de six mois à deux ans de sucrerie pénitentiaire. »
Ces prescriptions, dont la sévérité peut paraître choquante, sont indispensables, car les ouvriers, par leur refus ou leur absence, peuvent compromettre toutes les opérations manufacturières.
« En cas de refus de paiement de gages, le juge-de-paix ordonne saisie et vente des biens meubles du propriétaire pour satisfaire au paiement du travailleur. »
« Le propriétaire qui violerait les clauses du contrat sera passible d’une amende de 100 fr. envers le fisc, et de 100 à 200 fr. de dommages-intérêts envers le plaignant, plus, si le cas y échéait, d’un mois à sis mois de sucrerie pénitentiaire. »
[406]
Les colons vont s’indigner de la pensée d’être confondus avec leurs esclaves de la veille et obligés de travailler à côté d’eux s’ils encourent quelque peine. Nous ne tenons aucun compte de ces vanités de coupables. La loi oblige l’ancien maître comme l’ancien esclave. C’en est fait des îles si l’on y laisse se perpétuer, sous une forme nouvelle, des distinctions désormais ridicules. Il est nécessaire que tout le monde, aux colonies, soit pénétré de cette vérité que tous les hommes sont égaux ; la rigide équité du législateur et de ses ministres doit ne le laisser oublier à personne.
La stricte observation des contrats devra fixer particulièrement l’attention des juges-de-paix. Il est d’une haute importance d’accoutumer, dès le commencement, les propriétaires à respecter leurs devoirs vis-à-vis des ouvriers, et ceux-ci à sentir la valeur de leur parole.
La sagesse du juge admettra toutefois des circonstances atténuantes. Il est aisé de concevoir qu’un ancien maître accoutumé à une puissance absolue comprenne avec peine, dans les premiers jours, la considération qu’il doit à d’anciens esclaves, devenus ses égaux et traitant avec lui sur le même pied. Il n’est pas moins facile d’imaginer que des hommes encore peu accoutumés à la liberté en usent mal par ignorance et sans mauvaise intention.
« Si l’engagement pris, soit pour location des cases ou pour travail, n’a pas de limites arrêtées, on sera tenu réciproquement de se prévenir un mois d’avance quand on voudra le rompre. »
« L’infraction à cette clause est punie d’une amende égale au dommage causé, ou de un mois de sucrerie pénitentiaire. »
« Hors le temps de récolte, l’engagé est libre de sortir de l’habitation, pourvu que ses absences ne deviennent pas assez fréquentes ni assez régulières pour porter atteinte à l’esprit du contrat. »
Notre contrat n’est pas un engagement au sol, c’est une garantie de travail. Plus les traités de cette nature seront utiles aux deux contractans, plus il faut mettre de soin à les faire bien larges pour les nègres. C’est pour cela que nous venons d’inscrire une clause qui peut entraîner quelques abus pareils à ceux qui troublent nos ateliers d’Europe. L’avantage nous a paru surpasser l’inconvénient. Il faut donner du jeu aux engagemens des nègres, autrement ils s’isoleront toujours par crainte de retomber de fait en esclavage, en aliénant la moindre parcelle de leur liberté. Selon nous la loi ne peut être admise dans [407] aucun cas à forcer un homme de demeurer à telle ou telle place. La faculté de locomotion est une de celles qu’il est le plus juste et le plus naturel de respecter. Au milieu des obligations que la vie en société nous impose, elle n’a toujours été touchée qu’avec la plus grande réserve par Les législateurs de tous les temps.
Vol de cannes et de vivres.
« Tout vol est poursuivi et puni conformément aux lois du royaume. »
« Le vol de la canne, du bois [253], des provisions de terre et des herbes propres à la nourriture des bestiaux, en un mot le vol que l’on pourrait appeler rural, sera poursuivi criminellement comme tout autre atteinte à la propriété. »
On peut objecter, nous ne l’ignorons pas, à cette sévérité particulière de notre loi que les terres des colonies n’ont ni haies, ni murailles, que chaque passant a les vivres, l’herbe, la canne, pour ainsi dire, sous la main, et que c’est punir avec trop de rigueur un larcin dont la tentation est si perpétuelle et l’exécution si facile. Mais les lois veulent être faites conformément aux nécessités des pays et des circonstances. Or, il faut le reconnaître, dans ces luxuriantes contrées des Antilles, où l’homme a besoin de si peu pour vivre, les produits de la terre doivent être étroitement défendus. La seule manière de ne pas décourager ceux qui cultivent, c’est de garantir inviolable leur propriété, et des moyens de tuer la paresse, c’est de l’empêcher de prendre pour se soutenir, un fruit qu’elle rencontre sur son chemin. À ce point de vue il est de la dernière urgence de ne pas tolérer la plus légère infraction au respect dû à la propriété. Quoi ! vous ne permettez pas à un pauvre de ramasser quelques petits morceaux de bois mort, un peu d’herbe ? Non, parce qu’il n’y a pas de pauvres dans un pays où le minimum de la journée de travail est fixé à trente-cinq sous, avec un jardin en outre à cultiver ; dans un pays où les bras faisant défaut, l’homme valide trouve immanquablement de l’emploi ; dans un pays où les hôpitaux et les hospices étant ouverts à tous, l’homme invalide et malade est toujours secouru et nourri par la société. Non, car un paquet d’herbe ou de bois que l’on fait en une heure, que l’on apporte à la ville en une demi-heure, se vend sept, huit, dix sous, et il y a plus que de quoi vivre pour celui qui peut se nourrir avec un sou de gros sirop et [408] deux sous de manioc ; qui peut s’habiller avec un pantalon de toile blanche et une chemise de toile bleue, qui n’a besoin pour dormir ni de draps, ni de lit, ni de matelas, ni de carreaux à sa fenêtre.
Indemnité.
Ces mesures, plus particulièrement spéciales au fait de l’émancipation, devront être accompagnées de leurs corollaires naturels. La loi sur l’indemnité d’abord.
« Le maître a fait inscrire chacun de ses esclaves sur le registre de l’état civil de sa commune. »
« Cette inscription a été faite dans le premier mois révolu, à partir du jour de l’affranchissement, sauf le cas de force majeure, sous peine de la perte de l’indemnité. »
« Celui qui a déclaré un plus grand nombre d’esclaves qu’il n’en possède, est poursuivi pour crime de faux en écriture publique, à quelqu’époque que la fraude soit découverte. »
« L’indemnité est payée en trois portions, un quart en numéraire au moment de l’inscription, un autre quart six mois après, aussi en numéraire, et la moitié restante en une inscription de rentes 5 pour cent, portant intérêt depuis le jour de la promulgation de la loi. »
« Le premier quart payé en numéraire, et la moitié de la rente sur le grand livre sont déclarés insaisissables pendant dix ans [254]. »
Viennent ensuite la loi sur l’expropriation forcée, la loi sur les tarifs protecteurs des sucres de nos îles à l’exclusion des sucres étrangers, et la loi sur les encouragemens à donner à l’émigration blanche, vers les colonies. Dans cette dernière on pourrait stipuler de petites concessions de terrain pour les pauvres, qui formeraient des mariages de fusion. On a vu dans le cours de l’ouvrage que nous regardons les unions de cette nature comme un des plus puissans réactifs à employer contre le préjugé de couleur.
Fête de l’agriculture.
Un autre préjugé à combattre est celui que l’esclavage a créé contre [409] le travail de la terre. Nous voudrions qu’il fut institué, dans ce but, une fête annuelle de l’agriculture.
« À l’époque jugée la plus favorable de l’année, on célèbrera cette fête avec tout l’appareil et toute la pompe dont il sera possible de l’entourer. »
« Elle sera présidée dans la ville, résidence du gouvernement, par le gouverneur, dans la seconde ville par le chef suprême de la justice, dans chaque commune par le juge-de-paix. »
« Il sera distribué publiquement à cette fête et dans chaque commune, un prix accordé au laboureur (homme ou femme) qui se sera le plus distingué par sa bonne conduite. »
« Le prix est une concession d’un carreau de terre. »
« Outre le prix il sera prononcé six mentions honorables pour les plus méritans. »
« À la ville officielle, le gouverneur remettra un prix d’excellence au laboureur (homme ou femme) qui aura mérité cette distinction. »
« Le prix d’excellence est de trois carreaux de terre, plus une bourse entière dans un collége de France, dont le laboureur, s’il n’a pas d’enfans, peut disposer en faveur d’un enfant de son choix. Si c’est une fille qui est désignée elle sera élevée à la maison de la Légion d’Honneur de Saint-Denis. »
« Au prix d’excellence est attaché en outre le droit de grâce pour deux condamnés à la sucrerie pénitentiaire. »
« Si les condamnés graciés ont des amendes à payer il leur en sera fait remise. »
« Deux accessit au prix d’excellence seront également proclamés par le gouverneur. »
« Chaque accessit au prix d’excellence, est d’un carreau de terre [255] et d’une bourse entière accordée dans les conditions de l’article ci-dessus. »
« Les juges-de-paix sont naturellement appelés à être les arbitres des prix décernés aux laboureurs. Ils s’entoureront des notes des propriétaires, qui seront sollicités de vouloir bien en fournir. »
« Le prix d’excellence et les deux accessits sont décernés par tous les juges-de-paix, réunis ensemble pour en délibérer. »
[410]
« Nul ne pourra obtenir un prix ou une mention, qui sera convaincu sur bonnes preuves d’avoir été vu en état d’ivresse une seule fois dans l’année. »
Tafia.
Cette dernière clause nous met sur la voie d’une réforme qui est le complément véritable de l’abolition.
L’un des plus grands ennemis que les colonies se soient créés à elles-mêmes est assurément le tafia [256]. La quantité que l’on en peut tirer des résidus de la fabrication du sucre, le bon marché auquel il est possible de le livrer, l’ont rendu d’un usage fort commun. Les nègres en boivent démesurément, mais leurs excès sont loin d’égaler ceux des blancs. Rien n’est moins rare aux Antilles que de rencontrer des soldats et des matelots roulant dans les ruisseaux et saisis de cette ivresse du rhum, plus hébétée, plus hideuse, s’il est possible, que celle du vin.
L’essence d’une bonne législation est d’encourager la vertu, de décourager et surtout de prévenir le vice. Pour obéir à ce principe,
« Le tafia sera frappé, à la consommation intérieure, d’un impôt de 6 fr. par demi-litre. »
Profondément convaincu que la débauche est la première cause de mort pour les ouvriers européens qui viennent aux îles, et de dérèglement pour les indigènes, nous sommes assez disposé à demander la suppression de la fabrication du tafia dans nos colonies, comme pouvant prévenir beaucoup de désordres et de malheurs. Nous recommandons ce sujet à la sollicitude du législateur. — Nos deux îles des Antilles ne fabriquent ensemble que trois millions et demi de litres de tafia. Les habitans sucriers tirent si peu de bénéfices de cette industrie, que plusieurs y ont déjà renoncé. On trouve, en parcourant les campagnes beaucoup de distilleries en ruine, et il n’y a guères que les habitans de l’intérieur où l’on éprouve de grandes difficultés à transporter les sirops, qui continuent à préparer ce poison. Il serait donc peu coûteux de faire renoncer nos îles au tafia en donnant une légère prime à l’exportation de tous les gros sirops, ou bien en les achetant au prix courant de la place. L’état qui revendrait ensuite ces liqueurs aux marchands de l’Amérique du nord, trouverait plutôt du bénéfice que [411] de la perte dans ce commerce auquel il se condamnerait momentanément, et dont, sans doute, quelque spéculateur ne tarderait pas à le débarrasser. — Puisque nous jugeons mauvaise et dangereuse la fabrication du tafia, nous ne tolérons, il est inutile de le dire, qu’avec une extrême répugnance ces livraisons de sirops, même à l’étranger. Bien mieux vaudrait forcer l’application des procédés nouveaux au moyen desquels la conversion des mélasses et des sirops en sucre est devenue une opération très facile. Des planteurs qui ont tenté cette expérience, reconnaissent qu’elle est aussi profitable pour leur bourse qu’elle le peut devenir pour la morale publique.
En chassant le tafia des îles il y a de grandes chances de mettre le peuple à même de faire des économies. Pour l’y encourager davantage
Caisses d’épargne.
« On ouvrira des caisses d’épargne à l’instar de celle la banque de France, sous la garantie de l’État et la surveillance immédiate de l’administration. »
Des instructions en créole sur le mécanisme des caisses d’épargne et leur utilité seront abondamment répandues. Les nègres, comme nos paysans, en sont encore à l’économie politique des Perses et des Mèdes, ils enfouissent dans la terre le peu de doublons qu’ils parviennent à ramasser. Ce sera un moyen de plus de les encourager au travail, que leur enseigner comment il n’y a pas de cachette plus sûre que la caisse d’épargne, où leurs petits trésors s’augmenteront journellement des intérêts des intérêts combinés. On verra dans notre prochain volume que les caisses d’épargne ont un succès extraordinaire aux colonies anglaises.
Anniversaire du jour de l’émancipation.
Nous touchons à la fin de notre projet.
« Indépendamment de la fête de l’agriculture, l’anniversaire du jour de l’émancipation est déclaré fête coloniale, et sera célébrée dans toutes les communes par des réjouissances auxquelles présideront, en personne, le gouverneur et les chefs de service. »
« Le laboureur qui aura gagné le prix d’excellence, obtiendra une place d’honneur dans la fête de l’anniversaire. »
[412]
Législation générale.
« Les colonies étant soumises à la loi commune, il s’en suit qu’elles doivent prendre part à la confection de la loi commune, et être représentées au corps législatif. »
Dans ce cas, la nature de la population des îles commande une modification à loi électorale, pour que la classe dénuée de tous biens puisse cependant être représentée. Il serait très regrettable que les chambres ne jugeassent pas nécessaire de baisser les cens d’électorat et d’éligibilité, au moins pour les conseils municipaux et le conseil général. Tant que l’on ne facilitera pas au peuple des colonies une voie vers ces fonctions, on n’aura toujours qu’une oligarchie que ses vieilles traditions de despotisme rendent difficile à manier ; et l’oligarchie est le pire des états, a dit Aristote, qui disait aussi que s’il suffit d’être riche pour offrir des garanties à la cité et prendre part à son gouvernement, ce qu’il y avait de plus simple à faire, était de chercher le plus riche, et de remettre en ses mains la toute puissance.
Il est important de faire observer que par suite de l’assimilation des colonies à des provinces françaises
« Les malheureux condamnés par les tribunaux d’outre-mer à des peines infamantes ou à la mort (puisque ce dernier supplice existe encore dans nos codes), jouissent de nouveau du pourvoi en cassation et du recours en grâce. »
Le cours de la justice en raison des distances sera interrompu, il est vrai, mais la vie et l’honneur d’un membre de la société sont au-dessus de toute considération.
« Un exemplaire de la constitution nouvelle des colonies, traduite en créole, sera distribué à chaque citoyen. »
« Tout fonctionnaire employé aux îles devra prêter serment devant la Cour royale assemblée, d’exécuter et faire exécuter avec intégrité l’acte colonial dans sa lettre et dans son esprit. »
« Sauf les cas spécifiés dans le dit acte, les colonies qui sont déclarés provinces d’outre-mer rentrent dans le droit public de la législation du royaume. »
« Leur organisation politique, judiciaire, civile, militaire et municipale, est assimilée à celle de la France. »
L’esclavage en disparaissant emporte tout l’arsenal de leurs lois exceptionnelles, elles sont affranchies du régime bâtard des ordonnances, [413] elles cessent d’appartenir exclusivement au ministère de la marine, elles rentrent en possession de la liberté de la presse ; les assesseurs font place au jury, les gouverneurs deviennent des préfets, les conseils coloniaux se transforment en conseils généraux de département, les conseils privés en conseils de préfecture.
Rien du passé des colonies ne subsiste. L’émancipation n’accepte rien de l’héritage de la servitude. Et les vieux codes de nos îles resteront dans les collections, comme ces instrumens de torture que l’on conserve pour apprendre aux générations présentes à travailler sans relâche au bonheur de leurs fils, en voyant de quelles souffrances elles ont été délivrés elles-mêmes par le courage de leurs pères.
Il ne nous reste rien de plus à ajouter, nous croyons superflu de dire que nous n’avons pas eu la prétention de construire ici le code des provinces d’outre-mer. Nos propositions ne sont que des essais soumis au public et au parlement, avec la plus excessive réserve ; mais ce serait cependant manquer de véracité que de dissimuler notre confiance dans les moyens que nous indiquons pour laver les terres coloniales de la tache qui les souille, sans mettre en péril leur société, pour substituer sans trouble ou du moins sans violence le brillant ordre libre à l’ignoble ordre esclave.
Conduits ainsi par le législateur d’une main ferme et douce, les nègres reconnaissans du grand acte de réparation fait à leur race, voudront se montrer dignes de la liberté, ils écouteront la voix des moralisateurs qu’on leur enverra pour leur apprendre que l’indépendance a ses charges. Ce sera un sujet d’émulation pour l’affranchi des diverses îles, de lutter à qui s’élèvera le premier à l’intelligence parfaite des devoirs de l’homme libre. Des administrateurs habiles auront à créer [414] cette généreuse rivalité, et pourront s’en servir comme d’un levier pour les pousser tous à plus grand pas vers la civilisation.
Invoquons une dernière fois, avant de finir, la grandeur d’âme des créoles. Qu’ils rompent courageusement avec le passé, qu’ils renoncent sans regret à leurs anciens droits, qu’ils embrassent l’avènement des noirs à l’humanité comme une cause digne de la noblesse que l’on trouve en leur cœur chaque fois qu’il n’est pas question d’esclavage. L’esclavage ! il ne devrait plus être, il n’est plus, tout est fini. Que l’affranchissement donc ne soit pas pour eux une lutte d’anciens maîtres contre d’anciens esclaves, qu’ils n’abordent pas le travail libre des nègres avec hostilité, mais avec des sentimens de bienveillance paternelle. Le xixe siècle qui veut délivrer les colonies françaises des horreurs de la servitude, fait appel à leur raison pour l’aider à sauver ces belles contrées des misères de la barbarie. Ils écouteront sa voix. Le plus prompt succès de l’affranchissement est dans leurs mains, dans leur franche adhésion à la transformation que la conscience publique réclame impérieusement. Ils peuvent beaucoup, ils peuvent presque tout pour cette grande œuvre. Eux qui ont su se faire une vertu de l’hospitalité, nous les en conjurons, qu’ils reçoivent affectueusement dans le temple de la liberté et de la civilisation dont ils deviennent les ministres, ces jeunes étrangers qui demandent à entrer sous les auspices des frères d’Europe.
Le rôle des colons est beau vraiment s’ils le veulent accepter : c’est celui d’éducateurs pour la race infortunée, que leurs pères leur ont laissée toute abrutie, que la morale délivre, et que la nation les supplie de régénérer.
fin.
NOTES
[417]
PROVERBES ET LOCUTIONS NÈGRES.↩
LETTRE (a), Page 161.
Les nègres tout stupides qu'on les dise font grand cas de l'esprit.
« L'esprit c'est manman bien. » — L'esprit, c'est la mère du bien.— Il engendre le bien pour celui qui en est doué.
« Ca qui sote chien mangé déjeuné li. » — Celui qui est sot, le chien mange son déjeuner.
« Gens sote rété la case papa yo. » —Que les knbécilles restent à la maison de leur père , — autrement leur sort sera assez misérable ;
« Cabrite qui pas malin mangé nen pié morne. » — Le cabri qui n'est pas adroit, mange au pied du morne. — Il ne sait pas grimper pour trouver les bons morceaux , il broute là où tous les voyageurs ont foulé l'herbe. Tant pis pour lui , qu'il ne s'en plaigne pas.
« Petite qui pas capable teter maman li , tété ma grande. —Le petitqui ne sait pas téter sa mère , est obligé de téter sa grand'mère [257]— Sachez donc vous tirer d'affaire, et surtout ne comptez que sur votre travail.
« Gambette ous trouvé nen gan chimin , nen ganchimin ous vas pede li. » — Le couteau que vous avez trouvé sur le grand chemin , vous allez le perdre sur le grand chemin. — Ce que vous n'avez pas gagné, [418] vous le dissiperez aisément ; bien mal acquis ne profile pas. Ne tous rebutes point, travaillez.
« Jadin pas jamais chiche pou maiteli. »— Le jardin n'est jamais avare pour son maître , — il donne toujours à celui qui le cultive. Au contraire.
« Chita, chiche. » — Asseyez-vous est chiche. — On dit en créole chita, pour asseyez-vous. De là, par une métaphore fréquente dans leurs formes de langage , les nègres disent que monsieur chita , monsieur asseyez-vous est chiche, c'est-à-dire celui qui reste assis, reste pauvre.
Au moyen des images prises toujours, comme on peut déjà s'en apercevoir dans les choses le plus communes de la vie , ils expriment souvent ainsi des idées très profondes.
« Maite cabrite mandéli , ous pas capable di li plainde. » — Le maître du cabri vient le redemander, vous ne devez pas dire qu'il a tort.— On trouve là une vive leçon aux ingrats. Ces idées nous paraissent s'élever quelquefois jusqu'au sublime.
« Acoma tombé toute moune dit : c'est bois pourri. » L'Acotna est le géant des gigantesques forêts des Antilles. Debout, on l'admire, on s'extasie ; renversé par l'ouragan , on marche dessus , et les passansdisent .- c'est du bois pourri. N'est-ce pas l'histoire entière de la fortune des grands qui tombent. Au faite de la puissance, on ne les approchait qu'en tremblant ; déchus, on les regarde à peine, on en vient vis-à-vis d'eux à la familiarité ;
«Feu mouri , petite chien badiné nen cende. » — Le feu mort , il n'est pas jusqu'aux petits chiens qui ne viennent jouer dans la cendre.
« Langue capaud, trahit capaud.»— La langue du crapaud le trahit. — En coassant , il indique où il est. Ainsi soyez prudent , ne dites quece que vous voulez dire.
« Toute mangé bon pou mangé, toute parole pas bon pou di. » — Toute chose à manger est bonne à manger, mais toute parole n'est pas bonne à dire , — car
« Miraies tini zoreilles. » — Les murailles ont des oreilles. — Ne vous exposez donc pas inconsidérément,
« Peu gade, vaut mieux m'en moque ben. » — Il vaut mieux dire: prends garde que je m'en moque bien. — La circonstance , d'ailleurs, est grave. Xe vous lancez que préparé et muni de bonnes armes.
[419]
« Nen chimin gêné quimbé chouval malin. » — Dans un chemin difficile ayez un bon cheval. — Et puis songez que votre adversaire est sur son propre terrain.
« Chien fo la case maite li. » — Le chien est fort dans la maison de son maître. — Encore une fois de la prudence.
« Couleve qui vlé vive li pas promené nen gand chimin.» — La couleuvre qui veut vivre , ne se promène pas dans le grand chemin. —Vous allez trop à découvert, on vous prendrait vraiment pour un enfant.
« Petite moune connait couri yo pas connaît caché. » — Le petit monde ( les enfans ) sait courir , mais il ne sait pas se cacher. — Veut ne voulez pas m'écouter, vous avez tort , songez à ce qui est arrivée votre voisin.
« Quand babe camarade eus prend di feu ; rusez celle à ous. » —Quand la barbe de votre voisin prend feu , arrosez la vôtre [258]— Votrevoisin était plus fort que vous, il a succombé, ayez peur qu'il ne vous entratne dans sa chute.
« Quand vent roulé pilon calebasse pend gade corps li. » — Quand le vent roule des pilons , la calebasse n'a rien de mieux à faire qu'à prendre garde à son corps. — À l'heure de la catastrophe, vous vous repentirez, vous direz : Ah ! si j'avais su. Mais il ne sera plus temps.
« Si moin te connait toujours deière. » — Si je l'avais m, vient toujours derrière ; — lorsque la sottise est faite et irréparable. Vous vou lez, dites- vous , vous adresser au sorcier; allons donc, je sais bien que
« Honte fait ous boit wanga. » — Que la honte vous fait boire le wanga [259]; — que l'on suit les préjugés vulgaires , même lorsqu'on n'ycroit pas soi-même , de crainte de passer pour esprit fort; mais ne vous abandonnez pas à de telles faiblesses, laissez-les aux imbécilles;
« Complot pis fo passé wanga. » — Un complot est plus fort qu'un wanga. —A la vérité tout ce que je vous dis ne sert à rien , mes con seils même peut-être vous deviendront funestes ,
« Quand moune tini malheu sepent mode li pa la queue. » — Lorsque quelqu'un a du malheur , un serpent le mordrait par la queue.
[42O]
«Quand milatestini iun vieux chouvalyo dit négresse pas maman yo.»— Quand les mulâtres ont un vieux cheval (dès qu'ils possèdent quelque chose ), ils disent que les négresses ne sont pas leurs mères.
Les noirs se vengent par bien des mots semblables de l'incompréhensible mépris que la classe de couleur a pour eux. C'est ainsi qu'ils disent encore , avec grande injustice du reste ,
« Milates qua battent cabrites qua morts. » — Les mulâtres se battent , ce sont les cabris qui meurent. — Un duel, plumez les canards. Et ce sera après quelque trait d'orgueil bien blessant d'un mulâtre en guenille, qu'ils auront trouvé
« Capaud vanté, bonda lt toute nu. » — Le crapaud se vante , et ila le bonda tout nu. — Les hommes de couleur intelligens ne se fâchentpas de ces leçons , ils blâment trop eux-mêmes Tes prétentions de beaucoup de leurs frères. Ils les voudraient dîme ambition plus raisonnable.
« Chouval rété nen zécurie , milete nen savane. » — Que le cheval reste à récurie et le mulet dans la savane. — Chacun sa condition. Ilssavent que dans leur état aetuel , ils n'ont rien â gagner à la sociétédes blancs.
« Zefe pas doite rentrer nen calenda roches. »— Les œufs ne doivent pas entrer dans la danse des pierres. — Ils savent surtout qu'il faut être modeste et ne pas vouloir paraître plus qu'on est.
« Croquez macoute [260] oué ti main ous ça rivé. » — Accrochez votre macoute où votre main peut arriver, peut atteindre.
« Rende sevice, baillé chagrin. » — Rendre service , donne du chagrin ; — soit par la jalousie que ce service excite parmi vos autres amis , soit par l'abus de la chose prêtée , soit par le châtiment que l'obligeant reçoit quelquefois à la place de l'obligé.
Cette triste idée est exprimée avec énergie dans
« C'est bon kior crabe qui la cause li pas tini tête. » — C'est le bon cœur de la crabe qui est la cause qu'elle n'a pas de tête [261] . — Enfin notre cruel axiome : charité bien ordonnée commence par soi-même , se retrouve tout entier ici.
« Chaque coucouille claire pour tête li. » — Chaque mouche à feu [421] éclaire ( fait de la lumière ) pour sa propre tête. — Ah dam ! c'est que uous vivons dans un temps mauvais, les protestations ne manquent pas.
« Parole pas chage. » — Les paroles ne chargent pas, — elles ne coûtent pas grand' chose , mais en réalité chacun n'est occupé que de soiet de ses intérêts;
« Piti mi tombé, ramassé li, chrétien tombé, pas ramassé li.»— On se donne la peine de ramasser le plus petit grain de maïs qui tombe , mais un chrétien torobe-t-il , on le laisse-là.
Au milieu de l'esclavage chacun pouvait s'attendre à rencontrer beauoup de ces formules d'égoïsme et d'amertume , le malheur rend insensible , quoique disent ceux qui n'ont pas connu les étreintes d'unegrande infortune , aussi le lecteur ne s'étonnera-t-il pas du sens de ce dicton,
« Moin pas qua prend di thé pou la fiève li. » — Je ne veux pas prendre du thé pour sa fièvre, — je ne veux pas m'occuper de son embarras ; mais il s'étonnera de retrouver dans le langage de ces nègresqu'on lui avait présentés comme des animaux domestiques , quelque chose de semblable au fameux : « J'ai mal à votre estomac. »
[422]
Allons, allons, dépêchez-vous.
« Pressé pas fait jou l'ouvri. » — Se presser, ne fais pas ouvrir le jour, — lever le soleil. Trop de presse n'avance à rien.
Que dites-vous , insolent ! répétez-moi un peu.
« Pai pas coutume prêché dé fois. » — Père ( le curé) n'a pas coutume de prêcher deux fois. Et d'ailleurs , je me garderais bien de répéter ce que j'ai dit. Vous me cherchez une querelle pour me trouverun tort.
« Ous vlé batte pai pou prend robe li. » — Vous voulez battre le curé pour prendre sa robe.
Allons , trêve de commentaires, remuez-vous un peu, avançons la besogne.
« Guidi, guidi, pas fait vite. » — Guidi [262]ne fait pas vite. — S'agiter n'est pas aller vite.
Eh bien ! et ce coin là , vous le laissez donc ?
« Chien gagné quate pattes, mais li pas capable prend quate chemins. — Le chien a quatre pattes, mais il ne peut prendre quatre chemins. — Je ne puis tout faire à la fois.
Ce sont là des mots de paresseux, vous feriez mieux de vous rappeler que
« Bœf qui douvant boit bon quiau. » — Le bœuf qui est devant (qui arrive le premier à la marre) boit la meilleure eau. — Encore une foisplus d'observations , à l'ouvrage.
« Sac qui vide pas save rété dbout. — Le sac vide ne peut resterdebout. — Celui qui a le ventre vide ne peut travailler.
« Chien maige rété en haut trois pieds. » — Le chien maigre reste sur trois pieds, — il traîne la patte.
Comment ! chien maigre et ventre vide! n'avez-vous pas eu hier double ration à propos de la fête ?
« Vente plein, pas graisse. » — Le ventre plein n'est pas de la graisse. — Un bon dtner par hasard n'est rien. Et puis la morue salée est une très bonne chose, sans doute, mais
« Zos bouqué chien. » — Les os même fatiguent un chien. — Toujours du pâté d'anguilles !
Vous n'êtes que des fainéans , au lieu de me débiter vos sornettes , [423] vous feriez mieux de suivre l'exemple de l'atelier voisin. -- Des fainéans !
« Bon savane , bon bœf . » — La bonne savane fait le bon bœuf. — Là où il y a bonne pourriture il y a des nègres vigoureux. Des fainéans , nous !
« Ça qui mange zœfs pas save si bonda poule fait li mal. » —Ceux qui mangent les œufs ne savent pas ce que la poule a de mal à les pondre. — Le maître qui prend les fruits ne s'inquiète guères des peines de l'esclave qui les cultive.
Encore des proverbes ; en vérité vous êtes d'insupportables bavards,
« Bouche a ous pas tini dimanche. » — Votre bouche n'a pas de dimanche , — votre langue ne se repose jamais ; cependant nous verrons bien , allez. Je vous ferai tous châtier. — C'est cela, tous ,
« Quand yo manque pice, yo pen pinaise. » — Quand ils manquent la puce , ils prennent la punaise. — Lorsqu'une faute est commise et que le maître en ignore Fauteur, sa rigueur atteint tout le monde.
« Mouton qua boit, cabrite qua saoul. — Le mouton boit, on dit que c'est le cabri qui est saoul ; — les innocens paient pour les coupables,
« Rates, mangé cannes zanolis [263]inouri innocens. » — Les rats ont mangé les cannes, les anolis meurent innocens [FN; Lorsque les rats ont dévasté un champ de cannes au point que la recolte en serait nulle, on y met le feu, et les anolis brûlent avec les cannes, tandis que les rats s'enfuient. [new para] Tous ces proverbes ont bien d'autres acceptions que nous ne pouvons indiquer. Daus celui-ci , les nègres voient encore la figure de cette terrible vérité qu'au milieu de la guerre entre les grands , c'est toujours le menu penple qui souffre davantage. Aussi pour le dire en passant , trouvons-nous d'une impertinence fort inhumaine le raisonnement des riches qui prétendent que le» pauvres n'ont rien à perdre dans les désordres inséparables des révolutions, auxquelles l'égoisme général entraîne souvent les sociétés.] . — Pauvres nègres que nous sommes ! quelle vie ! et même au tombeau nous emportons le chagrin de laisser un pareil sort à nos flls et à nos filles.
« Bœf mouri, quitté misai pour cui li. — Le bœuf en mourant lègue la misère à son cuir. — N'importe, soyons fermes , il a menacé de nous punir tous, ne dénonçons personne.
« Ça ous pedi nen feu ous va touvé nen cende. » — Ce que vous [424]avez perdu dans le feu, vous le retrouverez bientôt dans la cendre. — Un bienfait n'est jamais perdu ;
« Bon pas sote. » — Bonté n'est pas sottise.
C'est bien, voilà de généreuses pensées, j'oublie tout et sans peine,car je vous aime. — Oui.
« Lépe dit aimé ous pendant li ronge daite ous. » — La lèpre (qui s'attache à vous) dit qu'elle vous aime, pendant qu'elle vous range les doigts.
Ingrats ! est-ce que je ne vous nourris pas bien ?
« Dio passé farine. » — Il y a dans ce que vous nous donnez plus d'eau que de farine [FN; Pour bien comprendre ceci , il faut se rappeler que la farine de manioc(le pain des Antilles) se mange en l'humectant d'un peu d'eau. On applique souvent dans les colonies ce proverbe à un homme ivre , il a bu plus qu'il n'a mangé.].
Est-ce que je ne soigne pas vos enfans ? — Nous les soignerions bien nous mêmes.
« Cones pas lou pou bœf . » — Les cornes ne sont pas lourdes pour le bœuf. — Les enfans ne sont jamais un fardeau pour leurs pères.
Allons-donc, ne voyez-vous pas que l'esclavage estutile pour le nègre?
« Ça qui pas bon pou sac pas bon pou macoute. » Ce qui n'est pas bon pour le sac ne doit pas être bon pour la macoute. — Ce qui ne vaut rien pour vous, ne vaut rien pour nous.
Bah ! qu'est-ce que vous feriez de la liberté, vous autres ?
« Ça qui bon pou zoie bon pou canard. » — Il existe aussi peu de différence entre l'oie et le canard qu'entre le nègre et le blanc, ce qui convient à l'un convient à l'autre.
Quoi ! vous osez vous comparer aux blancs !
« Toute bois c'est bois, mes enfans, mais Mapou [264] pas cajou. » —Tout bois est du bois, mais le Mapou n'est pas de l'Acajou.
Vous dites cela parce que
« Nege esclave, c'est poule bequé. » — Parce que le nègre est lapoule du blanc, — sa vache à lait.
Non pas , consultez le curé, il rectifiera vos idées la-dessus. — Le[425] curé est un blanc comme vous, quand on est de la même caste , on se se soutient ,
« Main gauche lavé main drete. » — La main gauche lave la main droite,
« Panier couvri panier. » — Le panier couvre le panier [265] . — Les vicieux, ceux qui profitent ensemble d'un abus s'excusent les uns les autres.
Tenez, je vous laisse la place, car je me mettrais en colère.
Alors un vieux qui n'avait pas encore ouvert la bouche jusque-là se mit à dire : Enfans, je vous trouve bien hardis de parler ainsi au maître, n'y revenez pas.
« Quand ous mangé avec diabe quimpé cuiai ous longue. » — Quand vous manges avec le diable, tenez votre cuillère longue,— quand vous avez affaire à un grand, soyez circonspect. Restez à distance.
« Si ous pas vlé gagné pice pas badiné avec chien. » — Si vous ne voulez pas avoir des puces, ne badinez pas avec les chiens. — On ne gagne jamais rien de bon à jouer avec plus fort que soi.
Mais les autres ne l'écoutèrent pas et se mirent à danser.
« Chate pas là , rate fait calenda. » — Le chat n'est pas là , les rats font fête.
Croyez-moi ménagez-les, ils sont misérables, faibles, abattus, mais songez-y
« Fourni tué bœf . » — Les fourmis peuvent tuer un bœuf.
« Piti hache coupé gros bois. » — Une petite hache coupe un gros morceau de bois , — avec de fa patience , on vient à bout de tout. L'instinct de la liberté se réveille souvent en eux, vous le savez, et les pertes qu'ils font à le manifester, ne les lasseront pas. Vous pouvez saisir cette pensée dans cette inflexible parole
« Quand iun bâtiment cassé , ça pas empêché zautes naviguer. » — Lorsqu'un bâtiment se brise , ça n'empêche pas les autres de navi- guer.— Vous avez pendu ce révolté, cet empoisonneur, cela n'empê- chera pas les autres de se révolter ni d'empoisonner.
« Bité pas tombé. » — Buter n'est pas tomber, — ils ont échoué une fois ils peuvent réussir une autre.
[426]
« Gua pas rien qui chaud qui pas frète. » — U n'y a rien de chaud qui ne se refroidisse. — Leur tour viendra.
« Bâton qui batte chien noir batte chien blanc. — Le bâton qui bat le chien noir peut battre le chien blanc. — Ne vous laissez pas éblouir par votre prospérité.
« Gagné pas l'empêché manqué. » — Avoir (être riche) n'empêche pas de tomber dans le besoin. — La fortune est changeante.
« Joudui pou ous , demain pou moin. » — Aujourd'hui pour vous, demain pour moi.
« Soleil levé là li couché là. » — Le soleil se lève d'un coté et il se couche de l'autre. — J'en conviens, le sort ne leur a pas été favorable jusqu'ici, ils peuvent s'écrier que pour eux
« Soleil couché, malheu pas jamais couché. » — Je sais aussi qu'ils semblent prendre leur parti en disant après un gros soupir.
« Si pas té gagné soupir nen moune , moune ta touffe. » — Si l'on n'avait pas donné le soupir aux hommes , ils auraient étouffé. » — »• Ce- pendant, malgré ces accès de découragement, ces apparences de rési- gnation, veillez toujours, je vous le conseille.
« Quand ous mangé petite tige pas doumi dur. » — Quand tous avez mangé le petit d'un tigre ne dormez pas dur. — Ne vous laissez -pas prendre non plus à l'insouciance qui vous semble une garantie.
« Dents par kior. » — Les dents ne sont pas le cœur. — Le rire qui découvre les dents ne prouve pas toujours que le cœur soit satisfait
« C'est iunique couteau qui save ça qui dans kior à gname. » — Le couteau seul sait ce qu'il y a au cœur de l'igname [266]— quand on l'y plonge pour la partager, celui qui tient le couteau n'en sait rien. Nous ne voyons que l'extérieur, et leurs desseins nous sont cachés.
« Chacun save ça qu'a bouilli nen canari li. » — Chacun sait ce qui bout dans sa marmite.
Ma foi , mon cher , c'est votre faute si votre femme vous a trompé, voilà ce que c'est que de l'avoir trop négligée.
« Jadin loin, gombos gâtés. » — Lorsque le jardin est loin, les gombos [267]se gâtent, — parce que le maître ne les soigne pas assez. Je le disais bien aux autres , il a tort d'abandonner sa femme pour courir après Francillia,
[427]
« Li té nen bon case , mauvais case fait li signe. » — 11 est dans une bonne case, une mauvaise case lui fait signe, — il quitte une bonne position pour une mauvaise. En tous cas vous n'avez pas le droit de vous plaindre, il fallait faire attention.
« Cila qui gagné piti mi dehors vie la plie. » — Celui-là qui a du maïs dehors doit veiller à la pluie.
Mais c'est précisément celui que j'avais chargé de.... Ah! ma foi, si
« C'est chatte ous mettez pou gadé zavocats. » — Si c'est un chat .que vous mettez pour garder des avocats [268] , — je ne ne m'étonne plus.
Après tout, en étes-vous sûr ? Une calomnie est bientôt dite, et vous savez .-
« Coup de langue pis mauvais piqûre sepent. » — Un coup de lan- gue est pire qu'une piqûre de serpent.
Hélas ! je ne puis même avoir cette ressource
« Si zié pas vol kior pas fait mal. » — Si les yeux ne voient pas , le cœur ne souffre pas [269].
Son infidélité vous fait donc grande peine ?
«Ah! la fiève pas maladie , c'est jalousie qui maladie. » — La fièvre n'est pas une maladie , c'est la jalousie.
Mais puisque vous la regrettez si fort pourquoi n'avoir pas pardonné lorsqu'elle s'est montrée repentante.
« Padon , pas guérit malaingue. » — Demander pardon ne guérit pas le mal qu'on a fait.
Allons , prenez courage , c'est le destin commun ,
« Toute cabinete tini maragouin. » — Toute chambre a des marin- gouins. — Tout le monde a ses chagrins. Et puis, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un préjugé de s'affliger ainsi.
Vous en parlez bien à votre aise,
[428]
« Moin pas qu'à nourri chômai pou bah z'officiera pou monter. » — Je ne nourris pas de chevaux pour les donner à monter aux officiers.— Je ne prends pas soin de ma femme pour que les autres en jouissent. Je ne puis oublier non plus combien les premiers temps de notre mé- nage avaient été heureux.
Que voulez- vous , pauvre ami , vous savez la chanson :
« Entrée pas mal, c'est soti qui mal. » — Commencer est facile , c'est finir qui est difficile.
Ah ! si j'en avais cru mes pressentimens avant le mariage ! J'avais bien deviné quelque chose de mauvais en elle, mais il était trop tard, j'étais engagé.
Pitoyable raison , mon ami.
« Riviai peut empêcher ous passé, li pas empêche ous touné. » —La rivière peut vous empêcher de passer, elle ne vous empêche pas de re- tourner.— Votre femme vous a-t-elle au moins rendu ce que vous lui aviez donné. — Non, pourquoi?
« Dabo caïman pas bon , bouillon li pas bon. » — D'abord que le caïman est mauvais , son bouillon est mauvais. — Puisqu'elle vous juge indigne d'elle, vos cadeaux doivent lui paraître aussi indignes. — Vous avez, vous, d'indignes idées. — Que n'épousez-vous en manière de consoliation Hcrsilia? — Parbleu, vous me donnez là un beau conseil
« Lavé main suyé terre. » — Ce serait laver mes mains et les essuyer dans la crotte.
Pourquoi pas? Elle n'est plus jeune, mais elle a des qualités. — Xon.
« Si zanolis té bon viande, li pas té ça drivé. » — Si les anolis étaient une bonne viande , on n'en verrait pas tant courir de tous cotés. — Si elle valait quelque chose elle aurait été plus recherchée.
J'avais cependant toujours entendu dire
« Bisoin hider aimer. » — Le besoin aide à aimer.
Portez cette excuse aux jeunes gens qui épousent de vieilles femmes riches , aux malheureuses filles obligées de se donner pour de l'argent : quant à moi on ne me prendra plus au mariage ,
« Trapé montré connaît.» — Attrapé enseigne connaît, — être attrapé nous donne de l'expérience. Chat échaudé craint l'eau chaude, et vous m'avez tout l'air de me vouloir jeter dans un guêpier, heureusement,
« Malice ous nen caraffe. » — Votre malice est dans une caraffe ,—[429] elle est cousue de fil blanc. Au reste, il ne m'étonne pas que vous pre- niez peu de part à mon chagrin.
« Case camarade pas nen mâché. » —La maison d'un camarade n'est pas au marché, — les amis sont rares , on ne les trouve pas sur la place publique.
Que n'allez-vous revoir votre ancienne maltresse ?
« Vieux tison pend feu pis vite passé bois sec. » — Un vieux tison prend feu plus vite que du bois sec, — on revient plus facilement à une ancienne maltresse que Ton n'en prend une nouvelle.
Quelle idée ? — Mais , oui.
« Vieux canari [270] fait bon soupe. » — Un vieux canari fait de bonne soupe. — Les vieilles connaissances ne sont pas à dédaigner.
Laissez-moi, laissez-moi !
« Temps allé pas vini encore. » — Le temps passé ne revient plus.
Il faut convenir que son fils n'est pas beau. Il n'en conviendrait pas :
« Macaque pas jamais touvé iche li laide. » — Le singe ne trouve jamais ses petits laids. — Un père trouve toujours ses enfans gracieux.
Alors il devrait bien le traiter un peu plus doucement. — N'ayez pas peur,
« Chien pas janiais mode petite li jouque dans zios. » — Le chienne mord jamais ses petits jusqu'aux os.
A la vérité, ça me paratt être un assez mauvais garnement que son fils. — C'est possible.
« Ous fête petit ous pas fait kior li. » — Vous faites l'enfant , vous nçfaites pas son cœur.
En tous cas, ce qu'il a entrepris pour lui me paratt bien extravagant.
— Ne jugez pas si vite.
« Macaque connaît que bois li monté. >» — Le singe sait sur quelle branche il peut monter. — Chacun connaît son affaire. Mais je parle là de lui , est-il vrai qu'il vient de s'en aller marron ?
— C'est vrai ,
« Bons pied sauvé mauvais corps. » — De bonnes jambes sauvent un mauvais corps.— Comment? — Oui, lorsqu'un nègre doit être châtié, son [430] corps se trouve dam une mauvaise position , c'est alors un mauvais corps, et ses bonnes jambes en fuyant, le sauvent.
Oh! il n'est pas excusable, son maître passe pour si bon. — Hm!
« C'est soolié qui save si bas tini trou. » — C'est le soulier qui sait si le bas a des trous.
Pensez-vous donc que ce soit la faute du maître ? — rVut-4tre,ila blessé ce pauvre diable dans la seule chose qui lui tint à cœur; les hommes peuvent supporter beaucoup, il faut avoir assez d'adresse pour ne point attaquer tel ou tel point qu'ils réservent.
« Badinez bien avec macaque , mais n'a pas magné queue a Ti. » — Jouez avec le singe, mais ne touchez pas à sa queue.
Qu'est-ce que c'est que son maître? — Un de ces grands braillards qui sont quelquefois utiles dans les partis; ils ne tireraient pas un coup de fusil, mais ils savent enflammer les autres;
« Cabrite pas connaît goumé, mais cui li batte la chage. » — Le cabri ne sait pas aller au feu , mais son cuir sert à battre la charge.
Et vous croyez que les partis font bien d'user de pareilles gens ! — Pourquoi pas ? Le tout est de savoir employer les hommes , de se servir à propos de ce qu'ils ont de bon; pourvu qu'on ne les avilisse pas, la morale n'a rien à dire.
« Parroquet pas connaît goumé plumes li nallé nen la guai. » —Le perroquet ne sait pas se battre , mais ses plumes font très bien à h guerre.
Pour revenir au pauvre homme dont nous parlions : Ne craignez- vous pas qu'il ne tombe dans quelqu'embuscade ? Non , c'est un fin matois.
« Cochon marron save que bois li frotté. » — Le cochon marron sait contre quel arbre il se frotte.
« Toute moune connaît gens yo. » — Chacun connaît son monde, on sait à qui Ton s'adresse.
Mais que va-t-il faire, au milieu des bois? Ça ne m'embarrasse guères.
« Bon coq chanté dans toute poulailler. » — Les hommes vigoureux se montrent dans toutes les circonstances, et ils ont des ressources qiw nous ne connaissons pas.
« Chien connaît comment li fait pou mangé zos. » — Le chien «lit comment il s'y prend pour manger des os.
[431]
Ma toi, à le voir, je ne l'attirais pas cm capable de tant de résolu- tion.—Oui?
« C'est douvant tambour na connaît zamba. » — C'est devant le tam- bour qu'on connaît le devin. — A l'œuvre on connaît l'ouvrier.
Je suis fâché qu'il soit parti H c'était un joyeux conteur, il m'a quel- quefois bien amusé avec ses prouesses du temps de la guerre. — » Oh ! il n'en faut pas tout croire ,
« Nen temps la guai , nen temps menti. » — Temps de la guerre, temps de mensonge. — Celui qui a été à la guerre en raconte toujours plus qu'il n'a fait. Celui qui revient de loin à beau jeu pour mentir.
Mais~qu'avez-vous donc? Vous paraisses distrait, inquiet.
Non.- Si ! je vous dis , voilà plusieurs fois que vous vous êtes levé pour aller regarder sur la route, et moi aussi fais-je des proverbes.
« Quand moune couri si li pas deyai queque chose, queque chose deyai li. » — Quand un homme court, s'il n'est pas derrière quelque chose , il y a quelque chose derrière lui. — On ne fait rien sans motif.
Dois-je vous l'avouer ? J'ai envoyé mon garçon pour avoir des nou- velles du fugitif. — Eh bien ! attendez tranquillement.— Je ne puis.
« Quand ous voyé moune , pied ous posé, kior ous pas posé. » — Quand vous avez envoyé quelque part , vos pieds se reposent, mais votre cœur ne se repose pas.
Oh ! les maudits marrons , ce sont eux en définitive qui nous don- nent ces inquiétudes, qui excitent ainsi les meilleurs nègres à la désertion. Malheur à eux !
Vos imprécations ne sont pas bien redoutables.
« Zyié rouges pas boulé savannes. » — Les yeux rouges, les yeux en feu ne brûlent pas la savane. — La fausse où la vaine colère ne fait pas de mal , cependant ayez plus de réserve, les marrons sont à craindre
« Avant traversé riviai, pas juré maman caïman. » — Avant de traverser la rivière, n'injuriez pas la mère du caïman [271] — Ne mau-dissez pas l'homme dans les mains duquel vous pouvez tomber.
[432]
Eh ! tiens, le voilà ce pauvre garçon ! Par où diable as-tu passé ? — Au milieu même de ces imbécilles de gendarmes. ImbéctUes ! — Mais, oui, puisqu'ils m'ont laissé passer.
« Toti qui soti en di liau li dit ous caïman tini mal né, crois li. » — Croyez la tortue, qui vous dit en sortant de Teau que le caïman a mal aux yeux.
Vous avez-là un triste outil, mon cher ?— On se contente de ce qu'on peut avoir,
« Bout gambette mio passé zongues. » — Un morceau de lame de couteau vaut mieux que les ongles. — Les malheureux comme nous sont obligés de faire beaucoup avec peu.
« Peau gname fé gnames. » — La peau (les épluchures ) de l'i- gname produit d'autres ignames.
« Iun douaite pas jamais mangé calalou. » — Un seul doigt ne peut pas manger du calalou [272] .
C'est ici votre case ? Oui. On peut entrer n'est-ce pas ? Ah ! bon Dieu, quelle misère. Quoi ! vous n'avez que ce grand couï [273] ?
« Grand qua quhnbé ptit. » — Le grand contient le petit. — Un grand vase peut aussi bien contenir une faible qu'une grosse portion.
Mais vous ne pouvez inviter un ami avec un seul plat.
« Pauve raoune ba déjeuné dans kior. » — Les pauvres gens don- nent à déjeuner dans leur cœur.
Tiens vous n'avez qu'une natte pour dormir ? Pourquoi n'achetez- vous pas un lit ?
« Capaud pas gagné chimise ous vlé li poté caleçon. » — Le crapaud n'a pas de chemise et vous voulez qu'il porte des caleçons ?
Si moin te gagné moussa , moin te mangé gombo. » — Si j'avais de la moussa (pâte de maïs), je mangerais des gombos (fruits de dessert . Si j'avais le nécessaire, je me donnerais le superflu.
Mais on emprunte, mon cher. Merci du conseil.
« Ci la qui dit ous acheté chouval gros vente, li pas hidé ous pou[433] neurri li. » -- Celui qui vous conseille d'acheter on cheval qui a un gros ventre , ne vous aide pas à le nourrir.— Quand vous ra'aurei engagé dans une mauvaise affaire , ce n'est pas vous qui viendra pour uVen tirer. Au reste de quoi vous mélez-vous ?
« Ci la qui vlé couvé , couvé su zef yo. » —Que ceux [qui veulent cou- ver couvent leurs propres œufs. — Occupez-vous de vos affaires et pas des miennes ,
« Zaffai cabrite pas zaffai mouton. » — Les affaires du cabri ne sont pas celles du mouton. — Et de plus sachez une chose .- vous n'êtes pas très habile , mais le fussiez- vous davantage
« Mouché connaît tout, pas connaît tout. » — Monsieur je sais, ne sait pas tout. — Le plus savant ignore bien des choses.
Je vois que vous êtes un paresseux mon cher, — Paresseux ! Tenez
« Quate zié contrés, menti cabas. » — Quatre yeux se rencontrent, le mensonge est fini , — entre quatre yeux on se dit ses vérités. Je veux vous en dire quelques-unes.
« Paie français fait pas l'esprit. » — Parler français n'est pas avoir de l'esprit. — On peut être blanc et être un imbécille. Vous m'en don- nez la preuve , car si vous aviez. le sens commun vous sauriez que
« Qé bois pas ouvr seru fer. » — Qu'une clé de bois n'ouvre pas une serrure de fer, — que ce n'est pas d'aussi bas que nous sommes, que nous pouvons nous élever, vous sauriez que
« Giromon pas donné calebasse. » — Que le giromon ne donne pas de calebesse. —Que l'homme esclave ne peut faire œuvre d'homme libre. Vous vous montreriez moins rude à juger les abrutis de la servi- tude, vous sauriez que
« Misai gâté vaillant. » Que la misère 'gâte, abat les plus vaillans, les plus forts. — Vous avez toujours le mot justice à la bouche, vous autres blancs, mais tous n'êtes pas justes.
« Toute ça qui poté zéperons pas maquignons. » — Tous ceux qui portent des éperons ne sont pas maquignons. — Vous nous appelés paresseux, et vous ne dites rien de nos maîtres qui se balancent du matin au soir dans leurs hamacs, ou qui viennent à cheval voir si nous travaillons bien ;
« Toute poisson mangé moune requin seul poté mauvais nom. » — Tous les poissons mangent des hommes , le requin seul a une mau- vaise réputation. — Nous sommes le bouc émuniaire mît la tête duquel[434] vos pareils ont mis les péchés de la tribu entière. Il y a long-temps que cela est ainsi et long-temps encore on tous croira, car
« Rareté pas jamais tni raison doutant poule. » — Le raret [274] n'a jamais raison derant la poule. — La raison du plus fort et toujours la meilleure.
[435]
LETTRE (b), Page 305.
ÉTAT DE TOUTES LES LIBERTÉS ↩
DEPUIS FÉVRIER 1830 JUSQU’EN AVRIL 1840.
| Date des arrêtés. | Libres de fait. | Esclaves. | Total. | Date des arrêtés. | Libres de fait. | Esclaves. | Total. | ||||
| 14 | Février | 1830 | 3 | » | 3 | Report | 12740 | 1352 | 14092 | ||
| 1 | Avril | 1 | » | 1 | 7 | Mars | 1834 | 20 | » | 20 | |
| 3 | 1 | » | 1 | 31 | 60 | 58 | 118 | ||||
| 1 | Mars | 1 | » | 1 | 30 | Avril | 38 | 13 | 53 | ||
| 3 | Mai | 1 | » | 1 | 3 | Mai | 6 | 6 | 12 | ||
| 5 | Août | 1 | » | 1 | 9 | 42 | 24 | 66 | |||
| 6 | 1 | » | 1 | 17 | 2 | 18 | 20 | ||||
| 26 | Décembre | 128 | 22 | 150 | » | 16 | 14 | 30 | |||
| 19 | Février | 1831 | 12 | » | 12 | 20 | 14 | 6 | 20 | ||
| 28 | 61 | » | 61 | 22 | 9 | 14 | 23 | ||||
| 15 | Mars | 3 | » | 3 | 23 | 9 | 13 | 22 | |||
| 22 | Avril | 2 | » | 2 | 27 | 12 | 15 | 27 | |||
| 20 | Mai | 370 | 65 | 435 | 30 | 23 | 9 | 32 | |||
| 3 | Décembre | 1727 | 42 | 1769 | 3 | Juin | 18 | 6 | 24 | ||
| 3 | Février | 1832 | 406 | 17 | 423 | 17 | 12 | 7 | 19 | ||
| 1 | Mars | 401 | 9 | 410 | 18 | 45 | 24 | 69 | |||
| 9 | Avril | 476 | 4 | 480 | 21 | 24 | 7 | 31 | |||
| 1 | Mai | 820 | 6 | 826 | 5 | Juillet | 42 | 15 | 57 | ||
| 11 | Juin | 469 | 1 | 470 | 7 | 45 | 24 | 69 | |||
| » | 475 | 2 | 477 | 15 | 6 | 14 | 20 | ||||
| 7 | Août | 462 | 5 | 467 | 30 | 45 | 18 | 63 | |||
| 14 | 1345 | 103 | 1448 | 2 | Août | 36 | 7 | 43 | |||
| 27 | 552 | 60 | 612 | 6 | 37 | 11 | 48 | ||||
| 13 | Septembre | 620 | 150 | 770 | 19 | 33 | 23 | 56 | |||
| 21 | 660 | 119 | 779 | 28 | 24 | 33 | 57 | ||||
| 3 | Octobre | 682 | 118 | 800 | 6 | Septembre | 11 | 10 | 21 | ||
| 11 | 666 | 148 | 814 | 30 | 34 | 39 | 73 | ||||
| 21 | Octobre | 1833 | 723 | 54 | 777 | 3 | Octobre | 10 | 3 | 13 | |
| 16 | Novembre | 619 | 95 | 714 | 8 | 8 | 16 | 24 | |||
| 25 | 182 | 56 | 238 | 14 | 25 | 6 | 31 | ||||
| 2 | Décembre | 274 | 68 | 342 | 20 | 7 | 3 | 10 | |||
| 12 | 47 | 11 | 58 | 28 | 25 | 18 | 43 | ||||
| 4 | Janvier | 1834 | 196 | 52 | 248 | 4 | Novembre | 15 | 7 | 22 | |
| 13 | 139 | 17 | 156 | 1 | Décembre | 81 | 36 | 117 | |||
| 17 | 18 | 16 | 34 | 4 | 16 | 2 | 18 | ||||
| 31 | 89 | 34 | 123 | 20 | 24 | 23 | 47 | ||||
| 15 | Février | 31 | 26 | 57 | 29 | 22 | 8 | 30 | |||
| 1 | Mars | 57 | 44 | 101 | 7 | Janvier | 1835 | 40 | 30 | 70 | |
| 4 | 19 | 8 | 27 | 6 | Février | 18 | 27 | ||||
| 12740 | 1352 | 14092 | 13685 | 1952 | 15637 | ||||||
[416]
| Date des arrêtés. | Libres de fait. | Esclaves. | Total. | Date des arrêtés. | Libres de fait. | Esclaves. | Total. | ||||
| Report | 13685 | 1952 | 15637 | Report | 14415 | 3343 | 17840 | ||||
| 24 | Février | 1835 | 19 | 20 | 39 | 17 | Janvier | 1837 | » | 18 | 18 |
| 25 | Février | 12 | 14 | 26 | 1 | Février | 2 | 17 | 19 | ||
| 9 | Mars | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 | 47 | 57 | |||
| 19 | 16 | 21 | 37 | 15 | » | 2 | 2 | ||||
| 20 | 19 | 32 | 51 | 14 | Mars | 11 | 54 | 65 | |||
| 1 | Avril | 20 | 25 | 45 | 17 | 2 | 29 | 31 | |||
| 14 | 6 | 8 | 14 | 1 | Avril | 7 | 25 | 32 | |||
| 27 | 12 | 24 | 36 | 21 | 30 | 63 | 93 | ||||
| 7 | Mai | 15 | 11 | 26 | 20 | Mai | 19 | 23 | 42 | ||
| 18 | 9 | 18 | 27 | 27 | » | 2 | 2 | ||||
| 26 | 7 | 18 | 25 | 30 | 5 | 35 | 40 | ||||
| 30 | 3 | 13 | 16 | 6 | Juin | 4 | 18 | 22 | |||
| 16 | Juin | 3 | 10 | 13 | 14 | 3 | 23 | 26 | |||
| 25 | 54 | 82 | 136 | 8 | Juillet | 25 | 38 | 63 | |||
| 30 | 18 | 23 | 41 | » | 8 | 16 | 24 | ||||
| 1 | Août | 29 | 23 | 52 | 21 | Septembre | 17 | 18 | 35 | ||
| 13 | 1 | » | 1 | » | 4 | 23 | 27 | ||||
| 17 | 3 | 6 | 9 | » | 2 | 13 | 15 | ||||
| 24 | 2 | 10 | 12 | 7 | Octobre | 8 | 54 | 62 | |||
| 1 | Septembre | 12 | 10 | 22 | 19 | 14 | 12 | 26 | |||
| 13 | 25 | 21 | 46 | 25 | Novembre | 9 | 52 | 61 | |||
| 16 | 46 | 31 | 77 | 30 | Décembre | 19 | 57 | 76 | |||
| 5 | Octobre | 5 | 14 | 19 | 6 | Janvier | 1838 | 6 | 23 | 29 | |
| 14 | 15 | 14 | 29 | 12 | Février | 7 | 83 | 90 | |||
| 23 | 3 | 16 | 19 | 15 | Mars | 6 | 33 | 39 | |||
| 30 | 14 | 33 | 47 | 10 | Avril | 5 | 48 | 53 | |||
| 7 | Novembre | 10 | 21 | 31 | 27 | 5 | 50 | 55 | |||
| 12 | 10 | 15 | 25 | 9 | Juin | 8 | 62 | 70 | |||
| 14 | Décembre | 9 | 37 | 46 | 14 | 204 | » | 204 | |||
| 12 | Janvier | 1836 | 7 | 7 | 14 | 28 | 38 | » | 38 | ||
| 19 | 15 | 38 | 53 | 5 | Juillet | 4 | 17 | 21 | |||
| 1 | Février | 31 | 44 | 75 | 14 | Août | 6 | 75 | 81 | ||
| 3 | Mars | 28 | 39 | 67 | 22 | 1 | » | 1 | |||
| 14 | 10 | 37 | 47 | 29 | » | 16 | 16 | ||||
| 9 | Avril | 6 | 20 | 26 | 20 | Septembre | 2 | 29 | 31 | ||
| » | 8 | 20 | 28 | 11 | Octobre | 3 | 39 | 42 | |||
| 2 | Mai | 3 | 29 | 32 | 17 | Novembre | 17 | 70 | 87 | ||
| 13 | 6 | 4 | 10 | 23 | 3 | 41 | 44 | ||||
| 25 | 7 | 22 | 29 | 5 | Janvier | 1839 | 17 | 12 | 29 | ||
| 3 | Juin | 35 | 48 | 83 | 26 | 1 | 74 | 75 | |||
| 10 | 3 | 10 | 13 | 15 | Avril | 6 | 30 | 36 | |||
| 11 | Juillet | 25 | 52 | 77 | 25 | 3 | 19 | 22 | |||
| 20 | Août | 39 | 56 | 95 | 28 | Mai | 4 | 7 | 11 | ||
| 31 | 23 | 27 | 50 | 4 | Juillet | 8 | 6 | 14 | |||
| 6 | Septembre | 26 | 51 | 77 | 17 | Août | 10 | 11 | 21 | ||
| 12 | 19 | 36 | 55 | 30 | Septembre | 16 | 80 | 96 | |||
| 30 | 19 | 29 | 48 | 18 | Décembre | 12 | 77 | 89 | |||
| 21 | Octobre | 68 | 90 | 158 | 19 | 1 | 53 | 54 | |||
| 22 | Novembre | 20 | 32 | 52 | 28 | Janvier | 1840 | 13 | 117 | 130 | |
| 6 | Décembre | 14 | 61 | 75 | 6 | Avril | 27 | 154 | 181 | ||
| 20 | 5 | 19 | 24 | » | 12 | » | 12 | ||||
| 2 | Janvier | 1837 | 7 | 14 | 21 | » | 13 | 44 | 57 | ||
| 10 | 9 | 30 | 39 | » | |||||||
| 14415 | 3343 | 17840 | 15174 | 5252 | 20426 | ||||||
Endnotes↩
[1] Celle de consommer beaucoup de produits manufacturés de la métropole.
[2] Mémoires sur les Colonies.
[3] Les notices statistiques publiées par la marine, donnent sur ce point les chiffres suivans pour l’année 1833. La Guadeloupe a reçu 485 navires français [3a], jaugeant 68,315 tonneaux, et montés de 4,583 hommes d’équipage. La Martinique, 363 navires [3b], jaugeant 49,976 tonneaux et montés de 3,535 hommes d’équipage. En 1836, l’île Bourbon a reçu 143 navires français [3c], jaugeant 41,152 tonneaux et montés de 2,183 hommes d’équipage. Pendant la même année de 1836, la Guyane a reçu 36 navires [3d], jaugeant ensemble 5,514 tonneaux et montés de 355 hommes d’équipage. — Nous ne jugeons pas nécessaire de faire observer que la quantité d’hommes d’équipage appartient au mouvement de navigation tout entier, et que plusieurs navires européens dont deux voyages par an.
[3a] Sur ce nombre, 185 seulement venant d’Europe. Le reste appartient au commerce local des colonies entre elles, ou à la pêche de Terre-Neuve.
[3b] Sur ce nombre, 149 seulement viennent d’Europe.
[3c] 67 seulement venant d’Europe.
[3d] 22 venant d’Europe.
[4] Almanach du Commerce du Havre, chez le Male, au Havre, 1840.
[5] Statiques ministérielles, déjà citées, tome 4.
[6] Lettres des Commissaires des Ports de Mer, à la Chambre des Députés, 26 avril 1840.
[7] Nous sommes partisan de l’indemnité aux betteraviers, parce que la France les a particulièrement encouragés à fonder leur industrie ; qu’elle s’est imposée, pour la faire fructifier, de grands sacrifices, à la vue desquels les fabricans se sont livrés eux-mêmes à des dépenses qu’ils n’eussent pas faites sans cela. Au surplus, nous entendons très fermement que les ouvriers, frappés par la suppression du sucre indigène, aient leur part de l’indemnité accordée à leurs maîtres. C’est justice.
[8] C’est au traité de paix de 1814, que la France a perdu Sainte-Lucie, Tabago, l’île de France et les Seychelles.
[9] Voici la liste des possessions d’outre-mer qui nous restent.
En Amérique : la Martinique ; la Guadeloupe avec ses dépendances Marie Galante, la Désirade, les Saintes et une partie de l’île Saint-Martin ; la Guyane ; Saint-Pierre et Miquelon, rochers arides à peine peuplés.
En Afrique : le Sénégal, Gorée, Bourbon et Sainte-Marie, près de Madagascar.
En Asie : Pondichéry et Karikal côte de Coromandel, Mahé, côte de Malabar, Yanaon, côte d’Orixa, Chandernagor, Bengale.
De toutes ces possessions, il ne faut considérer que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Bourbon comme colonies, les autres ne sont que des établissemens ou des comptoirs.
[10] Article non signé du journal l’Office de Publicité, 10 mars 1841. Nous regrettons de ne pouvoir citer l’auteur de cet excellent morceau.
[11] M. Paul d’Aubrée vient de publier une brochure (Question coloniale sous le rapport industriel, chez Félix Malteste et Cie, 1841), dans laquelle il montre les avantages que l’application des grands procédés industriels procurerait aux colonies, et les bénéfices considérables que l’on trouverait, seulement à séparer l’agriculture de la fabrication, aujourd’hui réunies dans une même main. Le travail de M. Paul d’Aubrée, d’une grande portée de vue, d’une lucidité d’exposition remarquable, mérite toute l’attention des économistes.
[12] Revue des Deux-Mondes, numéro du 1er mai 1840.
[13] Voici ce que le président du conseil a déclaré dans la séance du 8 mai 1840 : « Notre personnel maritime se monte à 110,000 hommes, depuis les mousses pris à 10 ans jusqu’aux hommes âgés de 50 ans. 14,000 mousses, 17,000 novices, 10,000 ouvriers des ports, 10,000 capitaines et maîtres au cabotage. Il reste donc 55 à 56,000 hommes de 18 à 50 ans, bons à mettre sur les vaisseaux de l’état au jour du danger. La marine royale en absorbe 19,000, les diverses navigations marchandes, mer du nord, mer de l’Inde, côte d’Afrique, Méditerranée, 17,000, pêche de la morue, 12,000, pêche de la baleine, 2,000, et enfin, colonies, 6,000.
[14] Instrument aratoire pour la culture de la canne. C’est une bêche en forme de pioche.
[15] Espèce de sabre propre à couper la canne.
[16] Opinion de M. Saco. Voyez la brochure de M. Flinter, intitulée Examen del estado actual de los esclavos de la Isla de Puerto Rico, 1852.
[17] Platon, liv. II, des Lois.
[18] On sait que la Guyane est cependant considérée comme bien plus insalubre encore que les Antilles.
[19] The Dominica Colonist, numéro du 5 septembre 1840.
[20] Pétition à la Chambre sur la nécessité d’une prompte réforme dans notre système sanitaire, 1833.
[21] La hauteur commune du voyage que nous avons fait en parcourant la Jamaïque, était de 1,500 pieds au-dessus du niveau de la mer.
[22] L’engagement de trois ans que prenaient les premiers défricheurs de nos établissemens coloniaux, leur fit donner le sobriquet de trente-six mois.
[23] On appelle petits blancs les hommes pauvres de cette classe, ceux surtout qui vivent du revenu d’un morceau de terre qu’ils cultivent à l’aide d’un ou deux nègres.
[24] On ne saurait croire jusqu’à quel point il est possible d’adoucir le travail par les moyens les plus simples. M. Bouvier, jeune habitant créole de la Guadeloupe, plein d’idées généreuses, donna un jour des gants à ses nègres pour l’opération de l’épaillage [24a]. C’était pure humanité, il voulait seulement préserver ainsi leur mains des petits piquans attachés aux feuilles de cannes. Mais à sa grande surprise, la bonne action devint une excellente affaire. Il se trouva que son atelier fit avec des gants et sans fatigue le double de la besogne qu’il faisait sans gants.
[24a] L’épaillage consiste à enlever les feuilles jaunies ou trop abondantes de la canne, pour lui donner de l’air et ne lui pas laisser de parasites à nourrir.
[25] Qu’il nous soit permis d’indiquer sommairement quelles pourraient être ces mesures.
La loi assurerait d’une manière précise les bons traitemens des passagers en mer. Il est important que les émigrans n’arrivent point aux colonies, l’organisation déjà affectée par les privations de la traversée et les mauvais emménagemens des navires sur lesquels les armateurs aujourd’hui, comme autrefois, les entassent et les mettent à la gêne.
Il serait décrété que nul émigré pendant les cinq premières années de son séjour, ne pourrait être employé sur les habitations qui se trouvent dans un rayon d’une lieue tout à l’entour des bords de la mer. On obtiendrait par là deux avantages : le premier d’éloigner les nouveaux venus des plages fiévreuses, de les soustraire à l’excessive chaleur des plaines ; et le second de les tenir éloignés des villes qui leur offrent des tentations et des occasions de débauche, et dont les populations agglomérées donnent prise aux épidémies.
Il faudrait aussi que les émigrés avant de partir fussent toujours assurés d’un engagement auprès de l’agent accrédité des planteurs qui résiderait à Paris. Ils seraient reçus par l’habitant qui aurait fait préparer leur gîte sur l’habitation. C’est un moyen d’obvier d’abord aux embarras d’un débarquement isolé, aux exigences des seigneurs terriers, ensuite de soustraire les nouveaux venus à la fièvre jaune qui ne manquerait pas de les frapper au milieu des troubles d’esprit, où tombe l’homme inquiet de son sort.
Le traité que signerait l’émigrant avec le planteur ou l’agent des planteurs, devra être aussi l’objet de la surveillance administrative. Il ne pourra se faire que dans de certaines conditions, réglée par le législateur.
Les engagemens de cinq ans contractés par les émigrés auraient cet avantage, qu’une telle période permettrait de graduer la somme de labeur exigible. Ils travailleraient d’abord le matin de cinq à huit ou de six à neuf heures, et le soir de quatre à six ou de cinq à sept heures, selon la durée du jour, et l’on augmenterait chaque année d’une heure jusqu’à la quatrième, où ils seraient tenus de donner neuf heures.
Des gages de 500 francs par tête d’hommes ou de femmes, et de 200 francs par tête d’enfans, au-dessus de 12 ans et au-dessous de 17 ans, avec une case et un jardin seraient, nous croyons, des termes où l’employeur et l’employé trouveraient une égale convenance.
Leurs différens auraient les juges-de-paix pour arbitres. La loi serait pondérée de façon à garantir à l’engagiste le travail de l’engagé, et à l’engagé les bons traitemens de l’engagiste. L’engagé, qui après la première, seconde au troisième année, se soustrairait méchamment au contrat, outre la confiscation de la récolte de son jardin au profit du maître, serait enfermé jusqu’à ce qu’il ait remboursé la somme dont il aurait fait tort à l’engagiste [25a]. Cette clause est indispensable, car avec des engagemens comme ceux que nous désirons, le propriétaire aura pu avancer les frais de transport, dont la moitié resterait à son compte, et dont l’engagé lui rembourserait l’autre moitié par cinquième. Nous voyons dans ces avances faites par le planteur, et que le crédit lui rendra peu onéreuses, un actif élément de détermination pour nous pauvres prolétaires, qui ne se trouveraient plus alors arrêtés au premier pas par l’impossibilité de rassembler une somme de 4 ou 500 francs, qu’il leur est toujours si difficile de se procurer dans les conditions actuelles de leur existence.
[25a] Afin de répondre à ceux qui verraient là une sorte de détention perpétuelle, nous disons tout de suite que l’on travaillera sur les habitations pénitentiaires que nous proposerons en lieu et place d’instituer aux colonies.
[26] Le commandeur tient à peu près la place de nos contremaîtres. C’est lui qui dirige l’atelier [26a]. Il est toujours choisi parmi les esclaves.
[26a] On désigne collectivement, sous le nom d’atelier, l’ensemble des esclaves d’une habitation.
[27] Le canari est notre chaudron ; c’est la pièce capitale d’un ménage d’esclaves ; il n’est jamais soutenu que par trois pierres ramassées au hasard.
[28] Léonard, créole de la Guadeloupe.
[29] Quand on parle d’un libre, aux colonies, il est toujours sous-entendu qu’il est nègre ou sang mêlé, le blanc ne pouvant jamais être esclave.
[30] Des colonies, et particulièrement de celle de Saint-Domingue.
[31] Aux appétits déréglés se joint une prostration de forces, qui amène la mort à la suite d’un épuisement total.
[32] Nom de l’habillement fourni aux nègres.
[33] Un arrêté des administrateurs de la Guadeloupe du 2 floréal an xi, porte que ces jardins doivent être d’un douzième de carreau par individu. Le carreau de terre équivaut à un hectare 29 ares 26 centiares.
[34] Le planteur a toujours à nourrir les enfans, les vieillards, les infirmes, les femmes enceintes, tous les membres de l’atelier enfin qui ne peuvent gagner l’ordinaire en cultivant un jardin pour leur compte.
[35] Râpage de la racine pour la réduire en poudre.
[36] Fabrication du sucre.
[37] Jus de la canne qui n’a encore subi que deux cuissons, il lui en faut quatre pour devenir sucre ; le vezou est une liqueur excellente au goût et très nourrissante.
[38] Le pois d’Angole a des vertus médicinales que nous n’avons vu employer ni à la Martinique, ni à la Guadeloupe. En Haïti on applique les feuilles comme cataplasmes sur les plaies, et on fait du bois de l’arbuste, réduit en cendres, une lessive qui déterge les ulcères.
[39] La population totale de la Martinique était, au 84 décembre 1835, de 416,054 âmes ; 37,955 libres, dont 9,000 blancs et 78,078 esclaves. — Parmi les libres on ne compte que 2,508 individus au-dessus de soixante ans ; parmi les esclaves on en compte 6,041. La différence en faveur des esclaves, proportion gardée, est donc de presqu’un tiers. — Même différence se présente entre les deux populations de la Guadeloupe, dont le chiffre s’élève en total à 127,574 individus : 31,252 libres, dont 12,000 blancs et 96,322 esclaves.
La population de nos colonies à esclaves est répartie de la manière suivante :
| Martinique : | |
| Villes et bourgs, libres 12,655, esclaves 20,282, en tout | 32,937 |
| Habitations rurales, libres 25, 300, esclaves 57, 794 | 83,094 |
| 116,031 | |
| Guadeloupe | |
| Villes et bourgs, libres 15,477, esclaves 11,741, en tout | 27,218 |
| Habitations rurales libres, 15,575, esclaves 84,781 | 100,356 |
| Bourbon : | |
| Villes et bourgs, libres 15,601, esclaves 11,950 | 27,551 |
| Habitations rurales, libres 21,202, esclaves 57,346 | 78,548 |
| Guyane : | |
| Villes et bourgs, libres 2,841, esclaves 2,579 | 5,220 |
| Habitations rurales, libres 2,215, esclaves 14,213 | 16,428 |
| 21,648 | |
| Esclaves de villes et bourgs, c’est-à-dire non attachés à la terre : | |
| Martinique | 20,282 |
| Guadeloupe | 11,141 |
| Bourbon | 11,950 |
| Guyane | 2,379 |
| 46,352 |
Voici le mouvement général des populations de nos îles, depuis 1851 jusqu’à 1858 :
| 1831. | 1832. | 1833. | 1834. | 1835. | 1836. | 1837. | 1838. | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Martin. | 109,916 | 111,337 | 114,260 | 114,989 | 116,031 | 117,502 | 117,558 | 117,569 |
| Guad. | 119,663 | 122,819 | 124,849 | 125,427 | 127,574 | 127,835 | 127,835 | 128,284 |
| Guy. | 22,862 | 22,531 | 22,345 | 22,083 | 21,956 | 21,221 | 21,221 | 20,940 |
| Bourb. | 100,558 | 101,109 | 103,140 | 105,850 | 108,533 | 108,538 | 108,548 | 103,625 |
| 372,418 | ||||||||
Tous ces chiffres sont empruntés aux Notices Statistiques sur les colonies Françaises, publiées par le gouvernement, 4 vol. 1837 à 1840.
[40] Ceux qui conduisent les charrettes.
[41] Ceux qui font le sucre.
[42] Toutes les Antilles sont perpétuellement frappées d’une des plaies d’Égypte. Infestées d’une quantité innombrable de rats, elle ne peuvent s’en débarrasser, malgré la guerre acharnée qu’elles leur font. Il n’est pas d’habitation qui n’ait un homme ou deux, uniquement occupés, avec huit ou dix chiens, de la chasse aux rats, d’où ces hommes prennent le nom de ratiers. Pour stimuler davantage leur zèle on leur donne une petite prime par cent queues qu’ils apportent. On nous a cité à Puerto-Rico une sucrerie où il avait été tué, en six mois, dix mille de ces bêtes maudites. Les rats aiment la canne de passion, et comme ils savent toujours choisir la plus mûre, et qu’ils en gâtent une par repas, ils font un tort considérable aux récoltes. Les serpens venimeux de la Martinique aident un peu les ratiers, mais on ne leur en sait aucun gré, car ils font payer leurs services trop cher.
[43] Sur les chiffres que nous avons donnés page 20 et 21, Le total des sexes réunis en masse, présente pour la Martinique une différence de 6,025 [43a], et pour la Guadeloupe de 5,986 [43b], en faveur des femmes [43c].
| Masculin. | Féminin. | ||
| [43a] Population libre | 17,419 | 20,536. | |
| Population esclave | 37,584 | 40,496. | |
| 55,003. | 61,028. |
| Masculin. | Féminin. | ||
| [43b] Population libre | 14,626. | 16,626. | |
| Population esclave | 46,168. | 40,496. | |
| 60,794. | 66,780. |
[43c] Nous avons observé des différences analogues dans toutes les îles que nous avons visitées, elles corroborent les remarques déjà faites, tendant à établir qu’il naît dans les pays chauds plus de femmes que d’hommes.
[44] Tailler. Battre à coups de fouet.
[45] Le géreur remplace le maître, rarement un propriétaire qui habite sa plantation conserve un géreur ; il dirige lui-même. L’économe prend les ordres du maître ou du géreur, et les fait exécuter.
[46] Grosse cravache en nerf de bœuf.
[47] La vérité sur les événemens dont la Martinique a été le théâtre en février 1831.
[48] On dit avoir le poison chez soi, lorsque les nègres empoisonnent les bestiaux. Nous parlerons du poison.
[49] Nous sommes obligé de supprimer les noms des propriétaires accusés, car malheureusement nous n’avons pas de preuve et rien ne serait plus aisé que de dire : « Le correspondant a menti. » La nature de cette lettre nous justifiera suffisamment aussi auprès du public de ne point divulguer le nom du signataire. Notre livre n’est pas destiné à l’Europe seule ; notre désir, au contraire, est qu’il aille aux colonies, et notre espoir, qu’il y sera lu. Or, l’homme qui nous écrit est encore dans la dépendance de son maître, il pourrait être cruellement puni de ses révélations.
[50] Les mêmes motifs qui nous engagent à taire le nom de l’écrivain, nous forcent, on le conçoit, à cacher le nom de la personne indiquée ici, ce serait l’exposer à des persécutions ; car les colons ne manqueraient pas de voir en elle un faux-frère ou un ennemi. « Celui qui n’est pas avec moi, est contre moi, » a dit Jésus dans un moment d’intolérance.
[51] Il faut faire la part de l’humanité. Qui souffre devient injuste. Le blanc désigné pour conseiller le poison contre nous est un des plus nobles caractères que nous ayons rencontrés durant notre voyage.
[52] Nous déclarons n’avoir pu constater l’exactitude de ces faits, mais il y a ici cinq personnes de nommées, toutes cinq les démentiront-elles ? Il est juste de faire observer, d’ailleurs, que ces cadeaux de chair humaine, pour monstrueux qu’ils nous paraissent, n’ont pas aux colonies le même caractère. Les créoles sont gâtés par les habitudes et la législation de l’esclavage. Lorsque le Code les autorise à vendre les enfans de leurs nègres dès qu’ils ont atteint l’age de quatorze ans [52a], ils ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six où à huit ans. « Un maître vaut un autre maître ; » comme on me répliqua lorsque je parlai de ces tristes choses.
[52a] Voici les textes d’où dérivent ce droit cruel du maître, ils méritent bien d’être cités :
Les enfans qui naissent des esclaves appartiennent aux maîtres des esclaves (art. 12 du Code noir).
« Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme, et leurs enfans impubères, s’ils sont sous la puissance d’un même maître (art. 47).
La loi disant que les enfans impubères ne peuvent être séparés de la mère, il s’en suit que les enfans pubères le peuvent être. Tout ce que la loi ne défend pas est permis. Il est donc hors de doute que celui qui sépare l’enfant pubère de ses parens, est à l’abri de tout reproche légal. L’article 48 confirme d’une manière précise cette interprétation, lorsqu’il dit : « Ne pourront, les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu’à soixante, être saisi pour dettes, sinon pour ce qui sera dû sur le prix de leur achat. » Si un nègre de quatorze ans peut être saisi pour la valeur due sur son prix de vente, c’est donc qu’on a pu le vendre. Au reste, il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans. On remarque que notre correspondant ne se plaint du marché et des cadeaux qu’il signale que parce que « les trois petites filles n’ont pas encore quatorze ans. »
[53] Paroles textuelles d’un des premiers négocians de la Pointe-à-Pitre.
[54] Réponse au rapport Tocqueville, par une commission du conseil colonial de la Martinique, formée de MM. Huc, Bernard-Fessal et Lepelletier-Duclary.
[55] Mémoires de Xénophon, livre second.
[56] « Les esclaves des campagnes sont livrés à l’arbitraire de leurs maîtres, qui peuvent infliger les plus durs châtimens sans le contrôle d’aucune autorité administrative [56a]. »
M. Chazelles, dans le rapport de la commission du conseil colonial de la Guadeloupe, chargée de l’examen des communications du
[56a] « La vérité sur les événemens dont la Martinique a été le théâtre en 1841. » L’auteur de cette brochure est un créole auquel il est impossible de refuser une connaissance parfaite de toutes les choses coloniales.
[57] Un esclave à qui vous demandez son âge, répond : « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j’étais tout petit garçon quand telle chose arriva. »
[58] Le lecteur peut se reporter à la note de la page 32 pour s’assurer que ce que nous disons ici est malheureusement de la plus scrupuleuse exactitude.
[59] Arrêté local du 24 août 1828, portant défense aux esclaves de circuler sans permis, Guadeloupe. Code noir.
[60] Le maire de l’anse Bertrand, instruit de la séquestration prolongée de la fille Lucile dans le cachot Mahaudière, et supplié d’intercéder, pour la faire cesser, répondit : « Qu’il ne voulait pas se mêler de l’intérieur d’une habitation. » Cela fut établi aux débats de cette affaire, auxquels nous avons assisté.
[61] Les ordonnances de police prescrivent à tout individu esclave d’être rentré à huit heures du soir chez son maître. Le nègre de ville, même le domestique, a besoin pour passer l’heure légale, d’un billet qui l’y autorise ; mais, comme on donne une demi gourde à chaque agent qui arrête un nègre en délit, il arrive que l’homme de la police anéantit quelquefois violemment le billet, et pousse le pauvre nègre en prison. C’est une demi gourde [61a] de gagnée pour l’alguazil ; le noir en est quitte le lendemain pour six ou dix coups de fouet, en compensation des frais de geôle qu’il a coûtés pour avoir perdu son billet.
[61a] On donnait autrefois une gourde, mais on fut obligé de réduire la prime et de la verser dans une caisse commune, parce que les exempts de police trouvaient trop de nègres sans billets.
[62] « Le peu d’exactitude qui a été généralement apportée aux déclarations de naissances et décès des esclaves, fait reconnaître la nécessité de prendre sur la matière des dispositions spéciales. Les administrations coloniales ont été consultées à ce sujet. (Précis sur la législation des colonies françaises, publié par la direction des colonies, 31 décembre 1832.) »
Nulle mesure, à notre connaissance, n’a été prise depuis.
« Aucun registre n’est tenu des naissances et décès ; ce qui ouvre un vaste champ à l’injustice et à la barbarie de certains maîtres. » (La vérité sur les événemens dont la Martinique, etc.)
[63] Dans le procès Amé Noël, la justice constate que le cadavre de l’esclave Jean-Pierre a été jeté dans une falaise, portant encore aux bras les cordes qui les étreignaient. Dans un procès qui vient d’être jugé à la Martinique, contre un nommé Laffranque, il est avéré que l’esclave Delphont, tombé d’épuisement au travail où il avait été envoyé, malgré son état de maladie, et mort sur la place, fut enterré huit heures après son décès, sans aucune déclaration préalable. (Rapport de M. Goubert, juge d’instruction, 15 août 1841.)
[64] Le proverbe créole a raison : « Cochon dé maîtes mouri grand gout. » Le cochon qui a deux maîtres, meurt de faim.
[65] Considérations sur le système colonial ; par M. Sully Brunet, 1840.
[66] Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840.
[67] Journal officiel de la Martinique.
[68] Journal commercial de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
[69] « Je ne crois pas qu’aucun de ceux qui composent la nation, voulût tirer au sort pour savoir qui serait libre, qui serait esclave. Les hommes les plus misérables auraient horreur de la servitude. Le cri pour l’esclavage est donc le cri du luxe et de la volupté, et non pas celui de l’amour de la félicité publique. Dans ces choses, voulez-vous savoir si les désirs de chacun sont légitimes, examinez les désirs de tous. » (Esprit des Lois, liv. 15, chap. ix.)
[70] C’est M. Chazelles qui a osé dire cela. Voyez son mémoire comme rapporteur de la commission du conseil colonial de la Guadeloupe, 1840, page 13.
[71] Ces idées ne sont pas nouvelles chez nous. En 1833 nous écrivions : « Nos lois et nos gouvernans sont proportionnellement plus coupables envers le peuple, que les maîtres ne le sont envers leurs esclaves. Que l’amélioration morale et physique de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse devienne l’unique pensée des aristocraties d’argent et d’intelligence, ou elles auront un compte terrible à rendre des bénéfices sociaux qu’elles monopolisent. » (De l’Esclavage des noirs, 1833.)
[72] Notices statistiques sur les colonies françaises, publiées par le ministère de la marine et des colonies, 1837.
[73] L’Univers du 4 décembre 1841 contenait un fait qui prouve à la fois, et l’action que cette espèce de pouvoir surnaturel exerce sur l’esprit de certains esclaves, au milieu de la dépression continuelle où ils vivent, et l’odieux abus que les colons osent quelquefois en faire.
« Le noir Louis, Jean-Baptiste, fut amené en France, sous l’empire, par son maître. Il servit dans les armées françaises, de 1804 à 1817 ; en dernier lieu, il était cymbalier au 2e régiment de la garde royale. À cette époque, il eut le malheur de rencontrer son maître qui l’engagea à déserter pour aller à la Guadeloupe embrasser sa vieille mère. Le soldat séduit déserte et part du Havre sur le navire le Saint-Jacques, pendant la traversée, son brevet de chevalier du lys et tous ses papiers sont jetés à la mer. Dès son arrivée, il est remis en servitude, puis vendu. Menace de mort lui est faite, s’il révèle la trame infâme ourdie contre lui. Ce n’est qu’en 1839 que le malheureux a osé venir, pendant la nuit, consulter un avocat sur son affaire ; celui-ci fit venir de France un certificat constatant les services de Louis, qui fut à la fin rendu à la liberté en mars 1840 !
« Le dernier possesseur de Louis lui a crevé un œil d’un coup de rigoise, lui a cassé un doigt d’un coup de bâton, et lui a causé une tumeur au bas-ventre, à la suite d’un coup de pied. »
[74] Nous n’accordons pas plus d’importance qu’il ne convient à des faits individuels ; il n’y a que les faits généraux qui prouvent quelque chose dans une question de la nature de celle qui nous occupe. Nous voulons cependant donner encore au lecteur le plaisir de lire un trait noir d’une délicatesse exquise. Une négresse du jardin [74a] vint emprunter à madame Perrinelle, peu de temps avant le départ de cette dame pour l’Europe, 15 fr. destinés au baptême de son fils. Madame Perrinelle donna la somme, et n’y songeait plus lorsque, le lendemain de son retour, trois années après, on lui annonce la même négresse. Elle se rappelle alors l’argent prêté, et croit qu’il s’agit d’un nouvel emprunt. Point : la brave jeune femme s’avance, la remercie de nouveau, et lui présente les 15 fr. en petite monnaie. Inutile d’ajouter qu’elle les remporta. En vérité, si la race est mauvaise, il faut du moins convenir qu’elle a de nobles exceptions.
[74a] On appelle ainsi, par opposition aux domestiques, aux nègres de maisons, ceux qui travaillent à la terre.
[75] M. Fel. Patron, aujourd’hui membre du conseil colonial.
[76] Le rachat forcé est le droit par l’esclave de se racheter, lorsqu’il apporte sa valeur métallique.
[77] Abolition de l’esclavage, 1839
[78] « Deviennent-ils chefs de maison, père de famille ; leurs femmes délaissées, sont les tristes compagnes de la nouvelle Agar qu’ils leur associent. » (Voyage aux Antilles. Léonard, poète créole de la Guadeloupe.)
[79] Considérations sur le système colonial, etc.
[80] Il y courent le soir à la nuit tombante. L’amour du nègre ne redoute ni la fatigue, ni l’obscurité, et l’on en sait qui sans que cela dérange leur travail font, chaque nuit, trois, quatre, jusqu’à cinq et six lieues, pour aller voir leurs concubines. Il faut tout dire, il leur arrive quelquefois, afin de rendre la course plus facile, de prendre les chevaux de l’écurie du maître qui, le lendemain quand il sort, devine bien pourquoi sa monture est fatiguée.
[81] Règlement de don Miguel de la Torre, 12 août 1826. Puerto-Rico.
[82] Rapport d’une commission du conseil de li Martinique. Séance du 1er octobre 1838.
[83] Mémoire manuscrit sur l’abolition. L’auteur ne serait pas un homme fort spirituel, qu’un séjour de vingt années aux colonies suffirait à donner du poids à son opinion.
[84] C’est toujours le commandeur qui remplit les fonctions de bourreau. On a fait remarquer dans un Mémoire qui sera bientôt publié, et qu’il nous a été permis de lire, que c’était encore là un vice particulier à l’esclavage. Le commandeur est un nègre, un esclave, il est mêlé à la vie commune, et participe à toutes les passions qui agitent une réunion d’hommes. Que de mal ne peut-il pas faire ? Que de vengeances personnelles ou de famille ne peut-il pas couvrir du nom de juste punition ; et lorsqu’il est bourreau, combien de fois la haine de celui qui châtie n’a-t-elle pas augmenté le châtiment ?
[85] Léonard, déjà cité.
[86] On se rappelle ce que nous avons dit sur la disposition qu’ont les nègres à choisir leurs intimités hors de l’atelier auquel ils appartiennent.
[87] Ils volent dans les rues en passant près des boutiques, lorsqu’on les mène aux travaux publics.
[88] Chaque esclave est tenu de fournir matin et soir un paquet d’herbes pour les bestiaux.
[89] Faire travailler hors d’heure, est faire travailler l’esclave dans le temps qui lui appartient à lui-même.
[90] À moins de parti pris du maître on ne met guère les esclaves au cachot que la nuit, leurs bras sont de jour trop utiles pour les inutiliser.
[91] Les faits isolés n’ont point de valeur, c’est toujours d’ensemble que nous voulons juger. Si nous voulions opposer détail à détail, nous n’en manquerions pas. Ainsi nous pourrions mettre en regard de ces esclaves abrutis, celui de M. Pommez, négociant à la Pointe-à-Pitre, qui s’étant pris de querelle avec un homme de couleur, et sachant que son maître, sur la plainte de celui-ci, allait lui faire administrer un quatre piquets à geôle, se suicida pour échapper au déshonorant supplice. Cette triste aventure se passa en décembre 1839. — De tels événemens, hélas ! sont moins rares qu’on ne le pense. Nous venons de lire ceci dans une lettre adressée par un ecclésiastique à l’Univers, du 3 novembre 1841:
« Si les maîtres ne se jouent plus, comme autrefois, de la vie de leurs nègres, du moins ils continuent de la leur rendre si dure, que plusieurs se débarrassent de l’existence comme d’un fardeau intolérable, soit pour éviter les châtimens dont ils sont menacés, ou se dérober au supplice continuel de l’esclavage. Depuis le 4 octobre 1840 jusqu’au 5 juillet 1841, jour de mon départ pour la France, j’ai été témoin de trois suicides dans la classe des esclaves. Le premier a eu lieu à Saint-François, le second à Sainte-Anne, le troisième à la Basse-Terre. Dans la première localité, un nègre marron n’ayant pu obtenir son pardon par l’intercession de son curé, s’étrangla avec une de ses bretelles pour se soustraire à l’exécution des menaces que lui adressait son maître. Dans la seconde, un autre se noya à quelque distance du bourg ; à la Basse-Terre, un ouvrier esclave se fit sauter la cervelle, en mettant le feu à une cartouche placée dans sa bouche. Il a fallu que je me sois trouvé sur les lieux, que j’aie vu les cadavres pour apprendre ces faits, tant la mort du nègre est estimée peu de chose, ou tant les maîtres ont soin de la tenir secrète. Ce qui doit faire conclure que ce ne sont pas les seuls cas de suicide qui soient arrivés pendant ces neuf mois. »
L’écrivain ajoute en terminant :
« Après avoir été témoin de l’avilissement et des souffrances de nos frères noirs dans nos colonies, je me croirais coupable de sacrilège envers Dieu et d’inhumanité envers mes semblables, si je ne protestais pas, de toute l’énergie de mon indignation, comme chrétien, comme prêtre, comme homme, comme Français, contre le maintien d’un régime qui dégrade à la fois le maître et l’esclave. »
[92] « Nos agens ont été frappés des changemens que la mise en cellule a exercé sur le caractère des plus indomptables. Nos colons eux-mêmes se sont expliqués à ce sujet d’une manière formelle. Pour nous, disent-ils, nous préférerions les coups, mais la cellule nous vaut mieux. » (Rapport des directeurs de la colonie agricole de Mettray, 1841.)
[93] Pareille chose est tout à fait une exception à la Martinique, du moins à ma connaissance. C’est justice de le dire, je ne crois pas que l’on puisse trouver dans l’île entière un endroit pareil aux tumulus assez nombreux de la Guadeloupe.
[94] C’est le sepo des Espagnols, le stock des Anglais.
[95] On appelle rang une série de laboureurs travaillant ensemble. L’atelier au jardin est divisé en deux, trois ou quatre rangs de douze ou quinze individus.
[96] Annales de la Martinique.
[97] Ordonnance de Philippe II, 1571.
[98] Stedman.
[99] Marrons’s war.
[100] « Je commencera par citer Polydor, nègre intrépide et entreprenant qui, en 1703, se forma une bande de nègres marrons, avec laquelle il attaquait et massacrait impunément les blancs jusque dans leurs maisons, portant l’audace et le crime jusqu’à leur enlever leurs filles et leurs femmes. On marcha en vain contre lui, on ne put jamais le joindre. Ce ne fut qu’après sept ans des plus cruels excès qu’ayant commis un acte de violence envers un de sa bande, il en fut assassiné.
« Trois ans après un autre nègre ni moins barbare, ni moins courageux, nommé Chocolat, lui succéda. Il eut bientôt formé sa bande, et il se mit à commettre les mêmes atrocités ; plus adroit et plus fin que Polydor, il les eut poussées bien plus loin s’il ne se fut noyé en traversant la rivière à Limonade, après avoir inquiété et pillé les blancs pendant près de douze ans.
« Diverses circonstances ayant conduit plus de blancs dans la colonie, les campagnes s’étant établies, ce moyen ne parut plus praticable aux esclaves entreprenans pour exécuter leur projet. Un nègre nommé François Mancandal, homme profondément méchant et habile à capter les esprits de ses semblables, s’en empara au point qu’ils portèrent pour lui le respect, la confiance et la vénération jusqu’au plus grand fanatisme : ils croyaient fermement que Mancandal était envoyé tout exprès du ciel pour délivrer tous les esclaves du joug, et que dussent-ils même mourir pour lui, ils ne feraient que retourner dans leur patrie au sein de leur famille, recevoir la récompense due à leur courageux dévouement. Quand Mancandal crut être bien assuré de l’esprit de tous les esclaves, il recourut à un moyen d’autant plus perfide et plus sûr, qu’il était difficile de s’en garantir. Il employa au lieu de fer, le poison, qui ne laissait aucune trace de la main qui l’avait préparé. Dès 1748 il fit des ravages effroyables dans les villes et dans les campagnes : les blancs ne mangeaient plus qu’en tremblant.
« Heureusement pour la colonie, Mancandal fut trahi par une négresse créole qui aimait son maître, et qu’on avait chargée de l’empoisonner. Ce conspirateur infâme fut pris et brûlé en 1758 ; des milliers de nègres périrent dans les cachots et les bûchers, et la colonie fut préservée pour cette fois.
« L’espoir des esclaves ne se perdit point ; inspirés par un chef plus fin que tous les autres, puisqu’il n’a jamais été découvert et qu’il avait su donner le mot d’ordre à tous les esclaves, en moins d’un mois ils formèrent le dessein horrible de massacrer tous les blancs, à l’instant de l’élévation de la messe de minuit. Une jeune mulâtresse, qui aimait encore son maître, en eût connaissance et l’en prévint, ce qui sauva encore les blancs cette fois.
« Ces entreprises paraissant à la plus grande partie trop difficiles à exécuter comme il faut, les plus déterminés ne songèrent plus qu’au marronnage, pour lequel les montagnes inaccessibles de la colonie leur offraient des ressources assurées. Il en partit un grand nombre dans la partie de l’ouest et du sud, qui infestèrent bientôt les montagnes des grands bois et de Neyba, d’où ils ravageaient également les habitations françaises, et Les hattes espagnoles. Les deux gouvernemens se concertèrent et firent bientôt marcher des troupes de ligne et de milice contre ces brigands ; mais elles ne purent jamais les découvrir, incapables même de pénétrer sur ces montagnes trop escarpées et trop éloignées pour pouvoir y porter des munitions de bouche et de guerre, et où on marchait des jours entiers sans trouver une goutte d’eau pour se désaltérer. Les détachemens espagnols, à qui il faut moins de provisions, arrivèrent jusqu’au pied de Neyba ; mais des rochers préparés et suspendus furent lancés sur eux, et tuèrent on blessèrent un grand nombre d’hommes. On renonça des deux côtés à des poursuites démontrées inutiles et l’on traita avec ces nègres, qui, s’étant déclarés libres, sont tributaires de l’État, sons condition de ne plus souffrir de nouveaux marrons parmi eux. Cette clause du traité exactement observée, força les nouveaux marrons à se jeter dans les montagnes du Port de Paix, du Borgne, de Plaisance, du gros Morne, du Dondon, de la grande Rivière, de Vaslière, de Limonade et du Dauphin, d’où ils se réunissaient par détachemens avec d’autres retirés dans les montagnes espagnoles de Laxavon, pour aller chasser les bêtes dans les hattes, pour venir échanger la viande avec les nègres des habitations, contre des vivres du pays et contre du plomb et de la poudre.
« Les choses en étaient à ce point, lorsque sous le premier intérim de M. Raynaud, les bandes des nègres marrons, devenues considérables, osèrent enlever ouvertement des vivres dans les habitations des frontières. Les milices ne cessaient de faire des détachemens contre les marrons, mais toujours sans succès. Une des principales bandes, commandée par le nègre Toussaint, se trouvait cantonnée dans la montagne noire, dépendante de mon quartier. Plusieurs de mes nègres s’y étaient retirés. Quoique très-jeune, j’obtins, comme officier de M. de Raynaud, un ordre de chasse contre cette bande.
« Elle était composée de près de cent nègres. Je pris avec moi soixante mulâtres déterminés, et je me portai au lieu de leur retraite, que j’avais su découvrir. Ils firent une vigoureuse résistance ; mais leur chef ayant été tué, ainsi que ses principaux soutiens, une grande partie blessés, le reste voyant fondre sur eux les intrépides mulâtres le sabre à la main, prirent la fuite ; on en prit quatorze à la course, et neuf qui étaient restés sur le champ de bataille, avec le chef et six autres tués ; sept mulâtres furent blessés, mais aucun ne périt.
« Le bruit courut au cap que j’avais tué deux cents nègres et pris plus de cent.
« Ce succès dissipa entièrement cette bande, et fit rentrer tous les marrons chez leurs maîtres. Mais les autres bandes n’en continuèrent pas moins leurs ravages dans les autres quartiers, jusqu’en 1774.
« Il s’en forma trois bandes considérables dans les quartiers du Dauphin, des Écrevisses et de Vaslière, qui portèrent l’audace au point de faire justement craindre une révolte ouverte et générale. Le gouvernement recourut à son moyen banal de mettre la tête des chefs à prix : il réussit à l’égard de la bande commandée par Noël Barochen, qui avait osé camper au bord des habitations ; il fut trahi par un des siens, et tué par un ancien soldat aposté à cet effet.
« La bande se rejeta dans celles de Bœuf et surtout de Tang qui grossissaient chaque jour, et qui passaient déjà pour avoir plus de quinze cents nègres. Ces deux bandes devinrent plus acharnées depuis la mort de Noël, et exercèrent publiquement des actes de violence à main armée sur les habitations. M. d’Ennery, qui gouvernait alors la colonie, mit sur pied toutes les milices du lieu, fit faire continuellement des patrouilles et des chasses
« Mais tandis qu’on cherchait les nègres d’un côté, ils pillaient les habitations d’un autre. Plusieurs détachemens étaient tombés dans leurs pièges et s’étaient estropiés. La chose parut devenir plus sérieuse que jamais : c’était le sujet de toutes les conversations du pays, et tout le monde était dans la persuasion qu’il y avait plus de dix mille nègres dans ces deux bandes seules. Dieu sait comme les faits étaient exagérés sur les lieux mêmes !…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Après la mort de M. d’Ennery je partis pour la nouvelle Angleterre. Six mois après les nègres recommencèrent d’aller marronner par bande, et ces bandes se formaient déjà dans plusieurs quartiers. Le corps des chasseurs était rentré dans le néant, avec le souvenir de ses services. On en avait formé deux compagnies de la milice du quartier, on les fit marcher sous les ordres de leurs capitaines blancs, contre les marrons ; mais lorsqu’ils voulaient gravir les montagnes où ils pensaient rencontrer les nègres, les capitaines à demi-morts de fatigue s’y refusaient…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« La bande la plus considérable se forma sous la direction du nommé François, nègre très-intelligent, et capable également par son courage des plus grandes entreprises. Sa bande assassina, par ses ordres, plusieurs blancs français et espagnols, et pillaient les habitations et les hattes. »…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Observations sur la situation politique de Saint-Domingue, par M. de Pons ; habitant, 1790.)
[101] Arrêt du 1er décembre qui condamne Victor, esclave de Clémence ; Élie, esclave de Perpignan ; Charlery, esclave de Rachel, à assister à l’exécution de Manette et de Joseph, qui auront le jarret coupé par l’exécuteur de la haute justice, et seront ensuite remis à leurs maîtres ; Manette, pour vol avec effraction et évasion, Joseph pour vol et évasion, Charlery, Élie, Victor, pour s’être évadés et avoir volé à leur maître le prix de leur valeur.
Exécuté a été l’arrêt ci-dessus en présence des officiers de la sénéchaussée de Saint-Pierre, sur la place ordinaire des exécutions, le lundi 4 décembre 1815, à dix heures du matin.
Signé Borde.
(Gazette de la Martinique, 15 décembre 1815.)
On ne peut imaginer tout ce qu’il y a d’atrocité dans l’ancienne législation coloniale. Un arrêt du conseil de la Martinique, du 20 octobre 1670, condamne un esclave à avoir la jambe coupée et attachée à la potence afin de servir d’exemple, parceque cet esclave avait tué un ânon !
[102] Une ordonnance du 30 avril 1833 porte de nouveau abolition de ces peines.
[103] Il en existait quelques exemples autrefois, mais ils étaient fort rares et punis avec une rigueur inouïe, s’il faut en juger par un arrêt du Conseil supérieur, du 30 novembre 1815, confirmatif de la sentence des premiers juges, qui condamne le mulâtre Élisé, esclave de Farque, à être pendu pour s’être évadé de la colonie. Dans la Gazette de la Martinique qui enregistre le jugement le 15 décembre 1815, il est dit : Exécuté a été l’arrêt le 4 décembre.
[104] Discours d’ouverture du Conseil colonial de la Guadeloupe, 18 juin 1840.
[105] Même discours.
[106] Voici les renseignements que nous avons pu nous procurer sur le nombre des émigrés Français : à la Dominique de 7 à 800, à Sainte-Lucie 600, à Antigues 600.
[107] The West-Indies, in 1831, London.
[108] On interrogeait (à la Dominique, je crois,) un réfugié presqu’au moment de son débarquement. D’où venez-vous ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Par quels moyens ? etc., etc. Les réponses étaient évasives ; mal sûr encore du terrain, il avait peur de se compromettre et ne convenait pas surtout qu’il eut pris un canot. Et parbleu ! ne voyez-vous point, dit quelqu’un, qu’il a passé par terre… Le mot resta, et les nègres l’appliquent aux réfugiés dans une acception un peu injurieuse ; car on a donné à ces pauvres esclaves des notions si étranges du juste et de l’injuste, que plusieurs regardent comme un crime de se sauver. Ils estiment que l’esclave marron ou fugitif, est un homme qui vole son corps à son maître. — Les nègres ne sont pas si stupides qu’ils n’aient compris même les plus bizarres idées qu’on a voulu leur inculquer.
[109] Outre-Mer, par L. Maynard.
[110] Sous ce rapport, une des plus grandes curiosités de l’esclavage, c’est qu’un étranger auquel il faut dix ans de séjour en France pour obtenir d’être naturalisé, peut aux colonies faire en une heure autant de citoyens qu’il lui plaît. Un Allemand, un Turc, un Esquimaux s’en va dans une de nos possessions d’outre-mer, il achète cent, deux cents, trois cents esclaves, autant que sa bourse en comporte ; il les libère, et lui qui n’est rien comme membre de notre société, le voilà qui créé de sa seule munificence cent, deux cents, trois cents Français aptes à exercer tous les droits civils et politiques !
[111] Arrêté local de Saint-Domingue, 7 février 1738.
[112] Règlement du conseil souverain de la Martinique, 4 juillet 1799.
[113] Arrêté local de la Martinique, 27 octobre 1803.
[114] Nous avons cru nécessaire de conserver ce fait tel qu’il parut lorsque nous publiâmes le présent chapitre dans le National du 9 novembre 1841, mais c’est notre devoir de déclarer qu’il est inexact. Nous avions sans doute mal compris l’homme honorable dont nous tenions notre récit. La Revue des colonies, dirigée par M. Bissette, a montré qu’il y avait de notre part confusion de deux noms et de deux époques. C’est, dit-elle, (numéro d’octobre 1841), le prédécesseur de Davoust, un nommé Motet, qui fit plusieurs autodafés dans la colonie en 1805 et 1806, et notamment celui des seize noirs, sur la place du Lamentin.
Nous avons commis une erreur, mais il est aisé de voir, d’après les circonstances, que ce ne fut ni par mauvaise foi ni par légèreté.
Quant aux autres redressemens appliqués à notre narration, nous ne pouvons les accepter. Nous maintenons la vérité de tout ce que nous disons, et si nous n’en apportons point les irrécusables preuves, c’est qu’il est venu à notre connaissance qu’elles affligeraient des gens de bien dont la douleur est respectable à nos yeux.
Un colon nous a fait reproche d’avoir cité l’autodafé, ce ne serait pas de bonne guerre « parce qu’il est vieux de vingt ans ». Cela est-il bien raisonnable ? Le fait n’a-t-il pas été indiqué par nous avec sa date. Jetant un coup-d’œil historique sur le poison, fallait-il être animé de mauvaises passions pour en rapporter un épisode aussi capital ? Jusqu’à quel limite du passé nous serait-il permis de remonter ?
[115] Heidegger, histoire patriarchale, t. I, p. 409.
[116] Esprit des Lois, liv. 15, ch. 4.
[117] C’est comme on sait l’ouverture placée à la base du crâne, par laquelle passe la moëlle épinière, prolongement du cerveau.
[118] The progress of Society, 1796.
[119] De l’origine de la couleur des Nègres, 2e vol. des œuvres de Camper.
[120] Dictionnaire des sciences médicales, article Homme.
[121] Réflexions sur les Antilles françaises.
[122] Principes de la philosophie de l’histoire.
[123] Histoire du Paraguay, livre 5.
[124] Mœurs des Germains, liv. 10.
[125] Liv. 24.
[126] Liv. 16.
[127] Esprit des Lois, liv. 15.
[128] Blanc de l’œil.
[129] L’Éthiopien ou le noir, le Caucasique ou le blanc, le Mongolique ou le jaune. Dans cette nomenclature on ne voit pas figurer la race rouge qui peuple toutes les Amériques.
[130] Ce sont des métives, produit du blanc et de la mulâtresse laquelle est le produit du blanc et de la négresse.
[131] Ce sont des capresses, produit du nègre et de la mulâtresse.
[132] Abolition de l’Esclavage, 1839.
[133] Travels in Ethiopia, London, 1833.
[134] Principes de la philosophie de l’Histoire.
[135] Nous apprenons que M. Meat, se mettant au-dessus des préjugés du pays, vient de le nommer géreur de l’habitation.
[136] Le moulinier est chargé du moulin.
[137] La Guadeloupe est divisée par un petit bras de mer, en deux parties appelées Basse et Grande-Terre.
[138] Les obscures et impénétrables cavernes de l’Océan renferment bien des pierres précieuses de l’éclat le plus pur. Bien des fleurs sont nées pour se colorer sans être vues, et répandent leur doux parfum dans les espaces déserts.
[139] Un nègre, si jaloux du Monsieur, ne montre-t-il pas, pour le faire remarquer en passant, que le sentiment de la dignité vient vite à ces esclaves, la veille encore si abjects.
[140] Quite as much as the European child when he is favoured with the same advantages.
[141] The negro child shows as much intelligence as any other race under like circumstances. Ces textes se trouvent entre nos mains.
[142] Littéralement, établissement libre. C’est le nom donné à des villages fondés par les émancipés qui ne veulent point rester sur les habitations.
[143] Le gouverneur est le seul homme blanc de l’administration. Il est nommé par la Société d’abolition américaine.
[144] La vérité sur les Événemens etc. déjà cité.
[145] Les principes du législateur sont partout les mêmes.
[146] Un règlement des administrateurs, du 9 février 4779, montre d’une manière encore plus précise que tous ceux que nous avons cités, la différence des classes et l’abaissement de la population de couleur. Parmi les raisons qui déterminèrent les administrateurs à l’établir ; on trouve celle-ci : « L’assimilation des gens de couleur avec les personnes blanches dans la manière de se vêtir, et le rapprochement des distances d’une espèce à l’autre dans la forme des habillemens, sont des points contre lesquels il est très important d’exciter la vigilance de la police, etc. » En conséquence, art. 1er : « Il est enjoint aux gens de couleur ingénus ou affranchis de l’un ou de l’autre sexe, de porter le plus grand respect à leurs anciens maîtres, et à leurs patrons, de se montrer bienveillans non-seulement envers leurs veuves où orphelins, mais encore envers tous les blancs en général ; à peine d’être poursuivis extraordinairement si le cas y échet, et punis selon la rigueur des ordonnances même par la perte de la liberté si le manquement le mérite. »
Art. 2. « Leur défend très expressément d’affecter dans leurs vêtemens, coiffure, habillement ou parures, une assimilation répréhensible avec la manière de se mettre des hommes blancs ou femmes blanches. »
[147] Un arrêté du gouverneur de la Martinique, en date du 12 novembre 1830, relate quelques-unes des prohibitions vexatoires sous lesquelles le délire du despotisme avait courbé la malheureuse classe des libres. On ne peut lire cela sans un étonnement mêlé de stupeur.
« Art. 1er. Sont et demeurent abrogés :
« 1° L’article 3 du règlement local du 4 juin 1720, indiquant quel vêtement doivent porter les affranchis et libres de naissance ;
« 2° L’arrêt du règlement du 9 mai 1765, et l’art. 3 de l’ordonnance du gouverneur et intendant, du 25 décembre 1783, portant défense aux officiers publics de recevoir dans leurs bureaux, en qualité d’écrivains, des hommes de couleur ;
« 3° Les ordonnances des gouverneurs et intendans, des 6 janvier 1773 et 4 mai 1774, faisant défense aux gens de couleur, libres, de porter les noms des blancs ;
« 4° L’article du règlement du 6 novembre 1781; qui défend aux curés et officiers publics, de qualifier aucunes gens de couleur, libres, du titre de sieur et dame ;
« 5° L’article 1er de l’ordonnance du 25 décembre 1785, et l’article 3 du règlement du 1er novembre 1789, défendant aux hommes de couleur, libres, de porter des armes et de s’assembler sans une permission du procureur du roi et du commandant du quartier ;
« 6° L’article 2 de l’ordonnance du 25 décembre 1783, défendant aux hommes de couleur, libres, d’acheter de la poudre sans une permission du procureur du roi ;
« 7° L’article 6 de l’ordonnance du 25 décembre 1783, l’arrêt du règlement du 28 mai 1799, l’ordonnance du 27 septembre 1809, l’article 7 du règlement du 1er novembre 1809, l’article 17 du règlement de la pharmacie, du 25 octobre 1823, portant défense aux apothicaires d’employer les hommes de couleur, libres, à la préparation des drogues ;
« 8° L’article 11 de l’ordonnance du 3 janvier 1788, qui obligeait les hommes de couleur, libres, à prendre des permis pour travailler ailleurs qu’à la culture ;
« 9° L’article 3 de l’ordonnance du gouverneur-général du 16 octobre 1793, qui assignait dans les spectacles, le paradis pour les hommes de couleur, libres.
« 10° L’article 3 de l’ordonnance du 9 décembre 1809, fixant l’ordre à suivre dans les convois funéraires, par suite duquel les hommes de couleur, libres, ne pouvaient se placer parmi les blancs.
« Art. 2. Sont et demeurent également abrogés tous les usages qui empêchaient ou pouvaient empêcher anciennement les hommes de couleur, libres, de vendre en gros, d’exercer des professions mécaniques, et de se placer dans les églises ou dans les processions parmi les blancs. »
« Signé Dupotet. »
Il est presqu’impossible de croire jusqu’où fut portée la démence qu’indiquent de pareils actes. En 1762 les arrivages de farine ayant manqué, il y eut au Cap une espèce de disette à propos de laquelle le juge de police de la ville prit, le 17 avril, un arrêté « qui défendait aux boulangers de vendre du pain aux gens de couleur, même libres, à peine de 500 livres d’amende. »
[148] Il y avait la traite française et la traite étrangère. La traite française jouissait de certains privilèges à l’exclusion de l’autre, comme la pêche de la morue. Mais nos colonies avaient de si grands besoins que les étrangers y trouvaient encore leur compte. La situation de la Dominique entre nos deux îles en fit long-temps l’entrepôt de cet affreux métier. Les Anglais excellèrent dans le commerce des nègres comme dans tous les autres, et en vendirent beaucoup à la Martinique et à la Guadeloupe. Ils furent même soupçonnés d’avarier volontairement la marchandise ! « Les colons ont accusé les Anglais de faire boire de l’eau de mer pendant la traversée aux noirs qu’ils leur vendaient, soit pour multiplier leurs ventes, soit pour tenir les colonies de leurs rivaux dans la médiocrité [148a]. » Quand il est question de traite et d’esclaves, tout est croyable.
[148a] Voyage à la Martinique, par le général J.-B., 1804.
[149] Le rétablissement de l’ancien régime coûta beaucoup de sang à la Guadeloupe, et s’opéra en violant toutes les lois humaines et morales. Des nègres, entr’autres, pris sur les négriers anglais pendant les guerres de la république, et qui avaient été distribués sur les habitations par Victor Hughes, furent alors impitoyablement vendus au profit de l’État.
Nous tenons de l’obligeance de M. Lignières un vieux morceau de papier tout percé des vers et daté du 9 floréal an viii de la république, qui prête une force terrible aux plaintes des colons par un rapprochement singulier. Le voici dans son intégrité :
Habitation Ve Marsolle.
Les cafés revenant aux cultivateurs de cette habitation pour leur quart, ont été bonifiés, vendus, et ont produit la somme de 2, 295 livres 15 sous, pour être partagés en quinze lots. Il revient au lot la somme de 153 livres 1 sou. Le partage a eu lieu de la manière suivante :
| Noms des cultivateurs. | Lots. | Sommes devant revenir à chacun | Sommes déduites pour temps des maladies et absences. | Avances faites. | Espèces comptées ce jour. | Sommes touchées tant en avances qu’en espèces, pour l’appoint de chaque lot. | ||||||||||
| l. | s. | d. | l. | s. | d. | p. | l. | s. | l. | s. | d. | l. | s. | d. | ||
| Valère, chef | 2 | 306 | 2 | » | 306 | 2 | » | 306 | 2 | » | ||||||
| Joseph, cultivateur | 1 | 153 | 1 | » | 45 | » | 108 | 1 | » | 153 | 1 | » | ||||
| Jacques Ibo | 1 | 153 | 1 | » | 20 | 5 | 132 | 16 | » | 153 | 1 | » | ||||
| François | 1 | 153 | 1 | » | 18 | » | 135 | 1 | » | 153 | 1 | » | ||||
| Alexandre | 1 | 153 | 1 | » | 49 | 10 | 103 | 11 | » | 153 | 1 | » | ||||
| Alexis | 1 | 153 | 1 | » | 13 | 7 | 6 | 30 j. | 29 | 5 | 110 | 8 | 6 | 139 | 13 | 6 |
| Bibi | 1 | 153 | 1 | » | 13 | 7 | 6 | 30 j. | 38 | 5 | 101 | 8 | 6 | 139 | 13 | 6 |
| Marie-Jeanne | 1 | 153 | 1 | » | 11 | 2 | 11 | 25 j. | 20 | 5 | 121 | 13 | 1 | 141 | 18 | 1 |
| Jeanne | 1 | 153 | 1 | » | 16 | 1 | » | 36 j. | 20 | 5 | 116 | 15 | » | 137 | » | » |
| Vidal | 1 | 153 | 1 | » | 17 | 6 | » | 38 j. | 20 | 5 | 115 | 13 | 6 | 136 | » | 6 |
| Amaranthe | 1 | 153 | 1 | » | 11 | 11 | 10 | 26 j. | 20 | 5 | 121 | 4 | 2 | 141 | 9 | 2 |
| Virginie | 1 | 153 | 1 | » | 17 | 6 | » | 38 j. | 20 | 5 | 115 | 13 | 6 | 136 | » | 6 |
| Charles | ½ | 76 | 10 | 6 | 6 | 13 | 9 | 30 j. | 20 | 5 | 49 | 11 | 9 | 69 | 16 | 9 |
| Isidore | ½ | 76 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 20 j. | 20 | 5 | 51 | 17 | 2 | 72 | 2 | 2 |
| Pierre | ½ | 76 | 10 | 6 | 22 | 5 | 10 | 100 j. | » | » | 54 | 4 | 8 | 54 | 4 | 8 |
| Paul | ½ | 76 | 10 | 6 | 17 | 0 | 4 | 81 j. | » | » | 59 | 10 | 2 | 59 | 10 | 2 |
| 15 | 2295 | 15 | » | 150 | » | » | » | 342 | » | 1803 | 15 | » | 2145 | 15 | » | |
| Report | 2145 15 » | ||
| Les 450 livres déduites pour le temps des maladies et absences ont été réparties à égales portions entre Valère, Joseph, Jacques Ibo, François et Alexandre, comme ayant mieux rempli leur devoir ; | |||
| chacun a eu 40 francs, ci | 150 » » | ||
| Total | 2295 15 » | ||
À Bouillante, le 9 floréal an viii de la république française
une et indivisible.
Vu par le commissaire du gouvernement,
Signé Charvis.
Donc, personne n’en peut douter, la liberté régnait à la Guadeloupe, le travail libre s’y pratiquait. Les cultivateurs avaient le quart du produit net, et il se partageait entre eux au prorata de leur travail, avec cette précision d’ordre et de justice propre à la grande école républicaine. Le propriétaire leur faisait des avances qui se remboursaient sur ce que chacun avait à toucher. Le compte est net, clair et précis. Eh bien ! de quel nom est-il signé ? Quel est l’homme qui tout jeune encore servait si bien la cause de l’émancipation en dirigeant avec adresse le travail des nouveaux libres, en les rétribuant avec équité ?… quel nom ? Amé Noël !… celui-là même dont les traitemens cruels envers un nègre ont retenti par l’Europe entière, il y a quelques années ! Est-ce lui le vrai coupable, ou la société qui le corrompit, en lui rendant des esclaves ?
[150] Génériquement on exprime par homme de couleur le produit du blanc et du nègre, le sang mêlé proprement dit à quelque degré que ce soit ; mais lorsque l’on parle de la classe libre des hommes de couleur, il faut se souvenir que les nègres libres s’y trouvent englobés. C’est ainsi encore, nous le rappelons, que quand on parle d’un libre, il est toujours sous entendu qu’il est nègre ou sang mêlé ; les blancs ne pouvant jamais être esclaves.
[151] Les renseignemens qui suivent ne paraîtront peut être pas sans intérêt au lecteur, ils sont tirés des notices statistiques publiées par le gouvernement en 1837, et se rapportent à l’année 1833. « Les hommes de couleur libres, à la Martinique, ne possèdent guères jusqu’à présent au-delà du neuvième des propriétés immobilières de l’île. Il y a environ un sixième de ces personnes qui possèdent des propriétés. Sur les soixante-dix-huit mille soixante-seize esclaves de la colonie, treize mille cinq-cent quatre-vingt-cinq seulement sont à eux. On évalue à quatre mille quatre-cent-trente-six le nombre de carrés [151a] cultivés leur appartenant, tandis que le nombre de ceux que possède la fraction blanche s’élève à vingt-six mille. Sur les deux mille quatre-cent-soixante-six maisons existant à Fort-Royal et à Saint-Pierre, la classe blanche en a quinze-cent-seize rapportant annuellement 1,424,276 francs, et la classe de couleur neuf cent cinquante-un, d’un revenu de 505,954 francs. — Pour la Guadeloupe, les proportions sont à peu près les mêmes, treize quatorzièmes des terres possédées appartiennent aux blancs, un quatorzième seulement aux libres.
[151a] Nous avons dit, on se le rappelle, que le carreau équivalait à un hectare vingt-neuf ares vingt-six centiares.
[152] Le considérant de cet article et digne de la décision : « Considérant que de tout temps on a connu dans les colonies la distinction des couleurs, qu’elle est indispensable dans les pays d’esclaves, et qu’il est nécessaire d’y maintenir la ligne de démarcation qui a toujours existé entre la classe blanche et celle des affranchis ou de leurs descendans, etc. »
[153] Cette égalité qui existe parmi la classe blanche, existe également parmi la classe des sang mélés. Là non plus on ne fait aucune différence d’état ; et l’habit donne nettement des poignées de main à la veste. L’unité de caste fonde l’unité de condition. Aussi, faut-il le reconnaître, les ouvriers des Antilles n’ont point le cachet des ouvriers d’Europe : ils savent tous très bien porter du linge fin, et une fois habillés, ils passeraient facilement pour des gentilshommes !
[154] Une ouvrière à la journée ne reçoit pas plus de quatre à cinq gourdes par mois, 20 à 25 francs, sans la nourriture.
[155] Nous citons un peu plus souvent la Martinique que la Guadeloupe, il ne faut pas s’en étonner. Des deux possessions françaises aux Antilles, c’est la première que nous ayons visitée, et comme elles sont sœurs jumelles par le rapport exact des choses, des hommes et des mœurs, comme on peut juger de l’une par l’autre, comme enfin les observations comparées ne nous ont offert que des nuances, les études faites dans la première deviennent propres à la seconde.
[156] La dette totale de ces dix-sept débiteurs de l’état ne s’élevait pas ensemble à 4,500 francs ! Par ce chiffre on peut se former une idée de l’incroyable dénuement de la classe libre des colonies.
[157] On peut ajouter foi entière aux chiffres que nous présentons. Ils sont dus à l’obligeance de M. Lemaire, maire de Fort-Royal, homme charitable et intègre, qui joint à ses nombreux travaux, les fonctions gratuites d’inspecteur des prisons de l’île.
[158] Que l’on ne s’étonne pas de voir les esclaves ne figurer que dans une proportion minime au nombre des prisonniers. Leurs délits ressortent bien des tribunaux, mais ils sont soustraits à la loi et jugés sur les habitations. Les propriétaires ne s’exposent pas volontiers à faire condamner leurs nègres à deux, trois et cinq ans de prison ; c’est du temps perdu pour eux. On a ici une nouvelle preuve de la véracité de notre assertion précédente. « L’esclave n’est pas soumis à un pouvoir public. »
[159] Quand un mulâtre a un cheval (possède quelque chose), il dit que sa mère n’était pas une négresse. — Le reproche que nous faisons ici à la classe de couleur de nos Antilles ne leur est pas particulier ; toutes les îles à esclaves offrent le même triste exemple de démence. Dans les îles danoises où le préjugé blanc s’est un peu modifié, où les gouverneurs ont des hommes de couleur pour secrétaires, et reçoivent à table ces impurs, sans que cela paraisse gêner ni choquer les blancs de la compagnie ; ce pas que l’on a fait vers eux, les gens de couleur ne l’ont pas fait vers les nègres. Là aussi, comme chez nous, un esclave aime beaucoup mieux appartenir à un blanc qu’à un sang mêlé, ce qui veut dire que les sang mêlés traitent leurs inférieurs avec plus de dureté que les blancs ne le font. Le sentiment de la désaffection de l’esclave, et le manque d’éducation expliquent assez la chose pour qu’il soit inutile d’insister là-dessus. L’homme opprimé est plus oppresseur, il se venge sur les faibles du mépris des forts : c’est une loi du mauvais côté de notre nature.
[160] C’est par des actes aussi honorables que les mulâtres américains ont provoqué des lois qui leur font autant d’honneur que celles-ci ; dès 1807, un acte de la législature de la Nouvelle-Orléans prohiba l’entrée du territoire de la Louisiane à tout homme de couleur libre. Le 16 mars 1830, la même défense fut renouvelée, sous peine d’un an d’emprisonnement pour la première contravention, et des travaux à perpétuité pour la récidive. Toute personne qui émancipe un esclave à la Louisiane, doit fournir un cautionnement portant la condition expresse que l’esclave émancipé quittera l’état pour toujours.
[161] À la Dominique, ils sont même en majorité pour le moment dans l’assemblée.
[162] C’est l’opinion entre autres de M. Lignières de la Guadeloupe.
[163] Considérations sur Saint-Domingue.
[164] Idea del valor de la isla Hispanola, chap. 19.
[165] Il y en a toujours eu. « Le peu d’habitude de voir des nègres avait sans doute inspiré à M. Meckel une espèce de répugnance et d’horreur pour leur couleur. Il en aurait eu des idées moins révoltantes et plus raisonnables s’il eut été à même comme nous le sommes dans notre patrie, d’examiner journellement des noirs et de se convaincre par ses yeux que les blancs de l’un et de l’autre sexe, quelque supérieurs qu’ils se croient aux nègres, ne les regardent pas tout-à-fait indignes de leur amour et même de leur alliance. » Camper.
Après tout, pourquoi n’en serait-il pas ainsi ? Le visage des nègres certainement ne répond pas à ce qui constitue le beau, selon que nous autres blancs nous le concevons, mais il a son caractère, et il est impossible de ne pas convenir que le buste et les bras de l’homme noir sont des modèles de musculature qui ne laissent plus croire que les marbres antiques soient des créations idéales. Quant aux négresses, si elles étaient si affreuses qu’on le dit, elles ne feraient pas tant de tort à leurs maîtresses.
[166] L’Univers a raconté le fait suivant dans son numéro du 4 décembre 1841:
« En 1794, une demoiselle ***, créole de Saint-Pierre Martinique, se laissa séduire par un nègre libre, nommé Pierre Sauvignon. Elle accoucha dans une case au Morne d’Orange, et l’enfant placé dans un panier fut exposé à la porte d’un ami. Aux termes d’une coutume barbare, l’enfant porté à la maison des enfans trouvés, fut refusé parce qu’il avait la peau un peu foncée. Une commission s’assembla, il fut déclaré de couleur et vendu à l’encan au sieur Recoing de Lisle pour 32 francs 80 c. Cet habitant était l’ami de la mère du petit mulâtre auquel on donna le nom de Ferdinand, dit Moïse. M. Recoing avait reçu de l’argent de cette malheureuse, et s’était engagé à élever le pauvre enfant et à lui donner la liberté. M. Recoing de Lisle mourut, léguant Ferdinand à sa fille, le 16 mai 1814. Mademoiselle Sophie Recoing de Lisle avait été liée avec la mère du petit infortuné ; elle en eut tous les soins possibles. Devenue madame Pochard, et ayant perdu son mari, le 19 mars 1816, elle mourut en couches. Ferdinand passa au fils Recoing de Lisle qui le posséda jusqu’en 1833, année de son décès. Ce dernier propriétaire de Ferdinand racontait, à qui voulait l’entendre, l’intéressante histoire de son esclave, et il disait : « L’enfant, suivant la condition de la mère, devrait être blanc et libre. » Enfin, le sieur Parise succéda au sieur Recoing de Lisle fils ; des débats judiciaires s’engagèrent en 1834, et à force de soins et de persévérance, Ferdinand, dit Moïse, fut déclaré libre au mois de janvier 1840 ! »
Il est juste d’ajouter que c’est au zêle infatigable et courageux de M. Goubault, alors avocat à la Guadeloupe, qu’est due la réparation de la longue iniquité dont le malheureux Ferdinand était victime.
Il y a quelques mois, le 27 mai 1841, une mulâtresse vient encore de naître au petit Bourg (Guadeloupe), d’une demoiselle blanche de haute maison, âgée de 21 ans. Le substitut du procureur du roi, M. P. Mosse, a constaté le fait à la suite d’une accusation d’infanticide. On peut juger du reste dans ces occasions la bonté ferme qui est la qualité par excellence des femmes créoles. Ces pauvres jeunes filles, après avoir succombé, bravent l’affreuse honte dont les idées du pays environnent leurs fautes, elles avouent presque toutes le crime de maternité avec un héroïque courage, et jamais on ne les voit participer au forfait qui tue le fruit de leurs entrailles pour satisfaire l’orgueil de leurs parens.
[167] Le crime fut commis le 21 juillet 1839, signalé deux jours après, le 25, au procureur général de la Basse-Terre, M. Bernard, et le nègre, père des enfans, est resté l’esclave des frères de la pauvre fille compromise ! Si nous ne sommes point dans l’erreur, l’instruction préliminaire a été faite et le procès-verbal rédigé par M. Portalis, juge-de-paix au Moule. M. Portalis est un magistrat comme il en faudrait beaucoup aux colonies, homme courageux et intègre, il ne recule pas devant les inimitiés que le ferme accomplissement de ses devoirs pourrait lui attirer.
Que l’on ne s’étonne point, du reste, de nous voir instruit de ces choses. Les hommes de couleur naturellement peu amis des blancs, par suite de l’impolitique réprobation dont ils sont l’objet, ont su se procurer et gardent note de bien des offenses faites à la justice et à l’humanité par leurs ennemis. Souvent victimes de la partialité du parquet et des autorités, ils ont de quoi confondre plus d’un coupable si jamais cela pouvait devenir utile à leurs intérêts.
[168] C’est ce qui a fait dire à l’un des accusés dans le procès de 1831 : « Je sais en ma qualité de créole, à quels juges j’ai affaire, je me réjouis d’avoir réussi à mettre la mer entre eux et moi. » Puis autre part : « J’ai peur des juges, peur des témoins, peur des jurés, peur d’une forme oubliée. Je suis né à la Martinique, et je sais comment tout cela s’y arrange ; je me rappelle que dînant un jour sur une habitation, on annonça que trois malheureux, accusés d’avoir voulu assassiner un de ces nobles colons, avaient été arrêtés, et que l’information avait totalement prouvé leur innocence. C’est égal, dit un convive, on aurait dû pendre un innocent pour l’exemple. Cet homme avait une idée exacte de la manière dont la faction coloniale entend la justice. Je m’en suis souvenu, et je cours encore. » (La vérité sur les événemens, etc.)
[169] Dix lieues de trajet.
[170] L’ordonnance dit : « Les gouverneurs et intendans, en devenant propriétaires, seraient portés à favoriser les intérêts particuliers des colons, aux dépens de la métropole. »
[171] Séance du conseil colonial de la Martinique, du 1er novembre 1838.
[172] Deux hommes de couleur viennent cependant d’être nommés, le premier, greffier à Cayenne, le 49 septembre 1840 ; l’autre juge-auditeur à la Martinique, le 24 mars 1841. Ces deux nominations tardives et exceptionnelles sont peut-être un symptôme d’une ère meilleure pour la justice aux colonies ?
[173] C’est le terme des colonies qui exprime l’état de vagabondage.
[174] M. l’abbé Dugoujon dans sa lettre à l’Univers, insérée le 3 septembre 1841, révèle que des communes de plus de trois mille âmes n’ont pas d’église. Il cite entre autres à la Guadeloupe celles du Gosier et des Abymes.
[175] Une instruction ministérielle toute récente vient cependant d’enjoindre aux parquets, de rédiger pour le Journal officiel les comptes-rendus des affaires criminelles. C’était un sténographe juré qu’il fallait.
[176] M. Lignières est cet avocat défenseur d’Amé Noël, qu’un homme animé de bonnes intentions, dénonça à l’exécration du monde civilisé en dénaturant par erreur le caractère de sa plaidoirie. M. Lignières est de tous les blancs possesseurs d’esclaves, le seul qui ait osé s’avouer abolitioniste et prêcher ses doctrines à ciel ouvert. On ne peut imaginer en Europe ce qu’il faut de fermeté d’âme à un colon pour se poser ainsi aux colonies. Mais on saura en même temps l’estime que M. Lignières s’est acquise, et le progrès d’idées qui s’est opéré à la Basse-Terre, si l’on songe qu’il n’a manqué que d’une voix aux dernières élections pour être nommé membre du conseil colonial.
[177] Outre le fait très significatif du blanchissage des propriétés dont nous parlerons bientôt, d’autres symptômes indiquent que les colons croient plus à l’abolition qu’ils le disent. Les uns, qui la regardent comme juste et nécessaire, loin d’y mettre obstacle, s’y préparent ; il en est d’autres qui sans l’approuver se sont avoués à eux-mêmes qu’elle est inévitable, imminente, qu’elle marche en dépit des colonies, que le gouvernement malgré sa tiédeur ne la peut arrêter, et ils prennent leurs mesures en vue de cet événement. Je citerai entre autres M. Guignod, que l’on vient d’entendre tout à l’heure. Il est si bien persuadé que « les temps sont proches » qu’il parle de l’émancipation avec ses esclaves. Peu de jours avant que j’eusse l’honneur d’être présenté chez ni, un nègre libre était venu pour lui racheter son père. « Je ne refuse pas le marché, répondit M. Guignod, mais vous faites une folie, l’abolition générale sera bientôt prononcée, la France paiera votre père, et puisqu’il n’est pas malheureux ici, vous feriez mieux de garder l’argent pour le nourrir lorsque libre et cassé, il ne pourra plus gagner sa vie. » Le fils et le vieux bonhomme trouvèrent le raisonnement du maître fort juste. Ils gardèrent les piastres et attendent.
[178] À l’appui de ce que je viens de dire, je ne saurais mieux faire que de citer le passage d’une lettre de M. Auguste Prémoran de la Martinique, qui avait bien voulu m’admettre plusieurs jours chez lui. « J’ai reçu hier, m’écrivait M. A. P., une lettre de Saint-Pierre, dont tel est le contenu : « M. Schoelcher est depuis peu de jours de retour du Lamentin. S’il faut l’en croire, il aurait trouvé chez une partie des habitans de votre quartier une opinion bien différente de celles des autres propriétaires de la colonie. Suivant ces habitans, que d’ailleurs M. S. n’a pas nommés, ce qui est à regretter, car il est utile aujourd’hui de bien connaître son monde, on peut compter sur le travail libre, etc. » Et là-dessus l’écrivain me priait de déclarer, comme cela est vrai, que je l’avais trouvé entièrement contraire à cette opinion. « Le travail libre je le répète, ajoutait-il, est impossible pour le nègre. » On le voit, les passions anti-abolitionistes sont tellement exaspérées et tyranniques chez les créoles, qu’ils demandent à signaler ceux qui osent croire le travail libre possible. Il est bon de connaître son monde ! Cela n’équivaut-il pas à, il est bon de connaître ses ennemis ?
[179] Le caractère créole est réellement tel qu’on l’a peint, primesautier, ardent et surtout porté aux excès, à l’exagération. On ne saurait se figurer la violence que plusieurs mettent dans les idées contraires à l’abolition ; quiconque parmi eux prononce la moindre parole libérale n’est plus taxé que de quart ou de moitié de créole. Il a été dit du rapport Rémusat à la tribune du conseil colonial de la Martinique. « Lorsque Tartuffe l’ancien donnait une heure au ciel, une autre à l’adultère, il ne s’était certainement pas fait une si haute idée de l’hypocrisie. » À la même séance on a prononcé ces mots : « Si vous n’êtes traités comme des Français, vous pouvez sans crime, sans devoir être accusés de trahison, renoncer à la protection que la France vous accordait. Je dis que vous le pouvez avec d’autant plus de justice que votre dévouement pour elle ne s’est jamais démenti, tandis que depuis douze ans la protection promise par elle s’est transformée en déception et tyrannie. »
C’est la révolte à mots couverts.
Et celui qui a dit cela n’a fait qu’exprimer la pensée de plusieurs. Oui, les exaltés parlent aux colonies de cesser d’être Français, et de se donner à l’union américaine si la métropole ne veut pas leur laisser des esclaves. Pour d’autres, l’union américaine est encore trop libérale, parce que dans les états du nord il y a des sociétés d’Anti-Slavery, et nous avons entendu un habitant, homme de cœur du reste, dire en pleine table devant quinze personnes et sans trouver plus d’un seul contradicteur parmi ses frères. « C’est la Russie qu’il faudrait appeler, elle nous convient et nous lui convenons, elle n’a pas de colonies. » — On vient de voir ce que valent tous ces jets de colère sitôt qu’un danger de la patrie ramène la raison. On y donne tous les esclaves en masse.
[180] Esquisses de Mœurs coloniales. (Revue des Colonies.)
[181] M. Fereire est propriétaire à la Guadeloupe. — Élevé en Europe, il dit aujourd’hui comme disait un autre créole du dernier siècle, en revoyant sa patrie. « Non, je ne saurais me plaire dans un pays où mes regards ne peuvent tomber que sur le spectacle de la servitude, où le bruit du fouet et des chaînes étourdit mes oreilles et retentit dans mon cœur. » (Lettre de Parny à Bertin, île Bourbon, 19 janvier 1775.)
Pour ne point haïr l’esclavage, même lorsqu’on est créole, il faut ne pas quitter une seule minute le sol colonial, il faut respirer toujours son air malfaisant. Dès que vous vous en éloignez, vous prenez honte d’avoir pu vous y plaire. Ce n’est pas parce que M. Fereire est jeune qu’il est acquis aux idées qu’on vient de lui voir émettre ; des hommes politiques, spécialement chargés de venir défendre en Europe les intérêts coloniaux changent comme lui, et tous les délégués que nos îles ont envoyés de ce côté-ci des mers, s’y gâtent tous plus ou moins au foyer de la civilisation ; jusque-là qu’ils sont successivement rappelés et reviennent chez eux taxés avec amertume par les créoles pur sang de modérantisme, de faiblesse, et pis encore. Il y a des colons auxquels vous n’ôterez jamais de la tête que M. Jabrun, par exemple, qui perdrait (selon eux) 60, 000 francs de rente à l’abolition, n’a fait de concessions, que parce qu’il lui a été promis en France une place de 6, 000 francs ! Les électeurs, dit un journal, écho de l’opinion la plus rétrograde des colonies, en parlant de deux membres absens qui n’avaient point été réélus au conseil de la Guadeloupe : « Les électeurs avaient unanimement résolu de ne donner leurs suffrages à aucun planteur absent. Subsidiairement, le séjour en France, le contact des salons de Paris sont devenus une réprobation, depuis quelques expériences qui ont été faites, et sur lesquelles nous nous félicitons d’avoir appelé fructueusement l’attention de nos concitoyens. »
Est-il nécessaire d’expliquer notre pensée quand nous attaquons les créoles. Les créoles sont des hommes comme nous, bons ou méchans comme nous. Les révoltantes opinions qu’ils professent sur l’esclavage ne tiennent pas à leur qualité de créoles, mais de possesseurs d’hommes. Les européens qui achètent des esclaves ne sont pas les moins cruels envers ces malheureux, ni les moins ardens à vouloir perpétuer leur abjection. Ainsi qu’on vient de le voir, les créoles qui vivent en Europe deviennent presqu’abolitionistes. Il est même à noter que les propriétaires d’esclaves que nous avons pu citer honorablement sont presque tous exclusivement nés dans les îles. — Nous ne saurions oublier en faisant cette observation, que l’un des plus heureux apôtres de la liberté moderne, Barbez, est un fils de la Guadeloupe.
[182] Elles les mènent jusqu’à des calomnies qu’ils regretteraient s’ils étaient de sang-froid. Ainsi, M. Isambert pour s’être constitué le défenseur des sang mêlés est traité aux colonies d’une manière infâme. Je n’ai aucune intimité avec M. Isambert, et il n’a pas besoin d’être défendu, mais il s’est donné avec un si actif dévouement à la cause de l’abolition, que je me crois permis de rapporter une circonstance de mon voyage qui le regarde. Je serais heureux que ce récit éclairât les colons de bonne foi. Sans doute, après l’avoir lu, ils haïront toujours M. Isambert comme un ennemi, mais ils ne le mépriseront plus comme déloyal ; voilà tout ce qu’il faut pour des gens de cœur.
C’est une chose de la dernière authenticité pour tous les créoles, même les moins passionnés, que M. Isambert n’a embrassé et ne continue à défendre la cause de l’abolition que pour de l’argent ; on a tant répété cela, que tout le monde le croit, et croit aussi que les preuves en existent, écrites de la main du coupable, dans la correspondance d’un homme de couleur nommé Leriché, dont les papiers passèrent après décès au bureau des successions vacantes de Saint-Pierre, Martinique.
J’avais entendu plusieurs personnes graves se faire l’écho de ces terribles bruits, et les maintenir pour vrais, quoique je voulusse y opposer la réputation de probité dont jouit M. Isambert en France, Je dis à la fin : « La déconsidération publique du plus actif défenseur des noirs serait un coup très rude porté à la cause de l’affranchissement, car on juge avec quelque raison du procès par l’avocat. Cependant comme la vérité doit être honorée par-dessus toutes choses, je ferai, moi, ce que je suis étonné que pas un de vous n’ait encore fait. Puisque les preuves de la félonie subsistent, je m’engage à les publier si vous me les montrez. » Sur ce, un négociant de la Martinique, M. Auguste Bonnet, homme d’un noble caractère, et ami de la justice, me mit un jour en rapport avec M. Gravier Sainte-Luce, conseiller colonial, grâce au pouvoir duquel le conservateur des archives voulut bien nous ouvrir ses cartons. « Rappelez-vous que vous avez promis de publier, » me dit M. Bonnet, en commençant ; et lui, M. Sainte-Luce, ainsi que moi, nous nous mîmes à lire toute la correspondance de M. Isambert avec M. Leriché. Rien n’en sortit d’injurieux pour le caractère de l’abolitioniste ; loin de là ; il ne parlait de ses honoraires que comme mémoire, et mettait une délicatesse extrême à demander le remboursement de sommes déboursées par lui dans le célèbre procès des hommes de couleur, exprimant le regret que l’état de sa fortune ne lui permit pas de passer ces choses sous silence. Lorsque nous nous retirâmes, M. Bonnet, toujours intègre, dit à M. Gravier, en souriant : « Vous voyez qu’il faut voir. »
Ces deux messieurs attesteraient au besoin, je m’en assure, la scrupuleuse exactitude de ce que je viens de raconter. À l’occasion, je ne me fis pas faute d’en parler, mais il n’importe ; long-temps encore on répétera aux colonies que M. Isambert est un homme sans honneur, qu’il fait de son dévouement aux noirs métier et marchandise, qu’il a reçu des sommes considérables souscrites à son profit par la classe libre où quêtées jusqu’au fond des cases à nègres ; et, si vous paraissez en douter, on vous affirmera que la preuve en est dans les papiers de la succession Leriché, au bureau des successions vacantes de Saint-Pierre, Martinique.
[183] M. Jolivet, délégué des blancs de la Martinique. Nous disons délégué des blancs, quoique M. Jollivet, comme ses collègues ne fasse pas cette distinction. Nous nous refusons tout-à-fait à appeler délégués des colonies, les agens des propriétaires d’esclaves. Ce titre est une usurpation qui offense beaucoup la justice et le sens commun. Les délégués ne représentent que les blancs, c’est-à-dire une très minime fraction de la population française d’outre-mer, trente mille individus sur trois cent soixante-douze mille. — Les choses de ce monde vont d’une manière bizarre, et l’on conçoit qu’elles prêtent à rire au diable. Voilà dix ou douze mille maîtres auxquels il est permis d’avoir des mandataires accrédités auprès du gouvernement de la métropole, tandis que leurs deux cent soixante mille esclaves n’ont personne chargés de parler pour eux ! Où sont les représentans des nègres pour répondre aux avocats constitués des planteurs ? — Ce qui n’est pas moins singulier, c’est que les blancs payent leurs délégués sur les fonds des contribuables de toutes couleurs. Si bien que les libres, noirs et sang mêlés, salarient au moyen de cette fiction scandaleuse, des hommes apostés jusque dans les deux chambres pour les combattre et leur nuire ! En vérité cela est par trop extravagant. Et le conseil de Bourbon vient de voter 70,000 francs par année pour ses deux mandataires ! Mais qu’ont-ils donc à faire, que l’on doive leur donner tant d’argent ?
[184] Réflexions sur l’affranchissement des esclaves dans les colonies françaises, par M. Lacharrière, ancien délégué des blancs de la Guadeloupe.
[185] Au besoin nous pourrions citer comme partageant cette opinion, M. le docteur Rufz, de Saint-Pierre, et cependant le docteur Rufz est un vrai créole, ennemi de l’abolition, parce qu’il la croit funeste aux intérêts généraux de son pays.
[186] Nous avons de fortes raisons de croire que ce prix approcherait beaucoup de la valeur de la terre et des usines. La gazette officielle de la Guadeloupe du 15 novembre 1841, annonça la vente de l’habitation dite Getz, achetée le 26 janvier 1818, 79, 383 francs, dans les conditions suivantes. — Soixante-seize carrés de terre sur lesquels se trouvaient à peu près quatre cents pieds de café, du manioc et du coton, une maison principale construite en bois, une cuisine, un magasin, une sécherie, un glacis ; les restes d’une case à moulin, seize cases à nègres, une case couverte en paille, un moulin à vanner, un moulin à manioc, un moulin à passer le café, un moulin à moudre le maïs, une poële à farine, un mulet et cinquante esclaves !
[187] Notices statistiques, 4e volume.
Il est bien entendu que les marrons ne seront pas remboursés, ils ont conquis leur liberté, ce sont des libres de fait, ils ont usé du droit naturel, et l’on ne doit pas plus leur prix que celui des évadés aux îles anglaises. Ils ne peuvent être payés à leurs maîtres, puisqu’ils ne leur appartiennent plus. Qui pourrait dire d’ailleurs s’ils sont vivans.
[188] Arbre portant de petits fruits rouges appelés cadenettes.
[189] Tout calculé, la dépense de chaque nègre à la charge du propriétaire ne va pas à 400 livres par an. (Observations sur la situation politique de Saint-Domingue, par M. de Pons, habitant, 1790.)
[190] Commission du conseil colonial de la Guadeloupe, 4 décembre 1838.
[191] Tacite, Germanie, liv. xvii.
[192] Liv. xxii.
[193] Liv. xxiv.
[194] Josué, ch. 18, v. 3.
[195] Habitans qui ont des sucreries.
[196] Lettres de Parny à Bertin, 1775.
[197] Lettres sur Alger, par M. Ismaël Urbain, chez Paulin, 1839.
[198] Cette interdiction de toute œuvre manufacturière outre l’inconvénient moral déjà signalé dans le cours de notre ouvrage, est aussi matériellement très dommageable aux colonies, et y fait éprouver de grandes pertes à la richesse commune. Que d’élémens industriels s’en vont à la pourriture. En France, on ne sait qu’inventer pour trouver les matières premières propres à faire du papier, aux îles une masse énorme de chiffons, de coton, et surtout de toile est entièrement perdue. Les vieux outils, les vieilles ferrailles de toute espèce se rencontrent à chaque pas sur les routes et dans les rues ; abandonnés, ils se détruisent d’eux-mêmes sans profit pour la société. Bien d’autres choses de cette nature pourraient être citées. Deux commerçans de la Martinique qui s’avisèrent, il y a peu de temps, de s’en aller sur les habitations acheter toutes les chaudières de batteries [198a] hors de service, font une opération superbe en expédiant en France ces vieux fers. Ils en trouvent des amas qui datent du commencement de la colonie.
[198a] Une batterie est l’appareil des quatre chaudières qui servent à la fabrique du sucre.
[199] Le droit sur les sucres coloniaux est de 24 shillings, plus cinq pour cent de surtaxe (34 fr. 50 c.) par quintal anglais (cinquante-six kilogrammes) ; sur les sucres étrangers il est de 65 shillings, plus les cinq pour cent de surtaxe (82 fr. 70 c.)
[200] M. Laird.
[201] Essai sur des modifications à apporter au Code de procédure civile appliqué à la Martinique, par M. Bally. Le travail que nous citons ici est un traité ex-professo sur la question qui fait l’objet de ce chapitre. Le législateur en le consultant y trouvera de précieuses lumières pratiques.
[202] Voyage à la Martinique.
[203] Les dettes hypothécaires de la Guadeloupe et de la Martinique montent à 130 millions, celles de Bourbon et de la Guyane de 80 à 100 millions ; c’est un quart du capital représenté par les propriétés rurales des îles, du moins pour la Martinique, dont les documens publiés par le ministère de la marine, évaluent les terres à 33, 385, 450 francs, et pour la Guadeloupe, dont les mêmes documens évaluent les terres à 268, 371, 925. (Notices statistiques.)
Les ports de mer de France entrent en outre pour 60 millions parmi les créanciers des colonies. (Abolition de l’Esclavage, par M. Favard).
[204] Un seul trait du tableau : « On n’a pas d’exemple d’ouverture de portes effectuées à la campagne par un huissier chargé de faire saisie chez un propriétaire qui s’enferme. [204a] » Voici pourquoi ? les maires et leurs adjoints, habitans eux-mêmes ou occupés d’affaires qui les mettent dans la dépendance des habitans, liés tous d’intérêts communs ou d’affection avec leurs administrés, deviennent les agens de leurs amis au lieu d’en être les magistrats. L’huissier qui ne peut faire ouvrir une porte qu’en présence du maire ou de l’adjoint, lorsque le juge-de-paix de la ville ne l’a pas suivi, ne les trouve jamais chez eux quand il a besoin de leur assistance pour cet office ; ou bien les surprend-il, un mal subit les empêche toujours d’obtempérer à sa réquisition.
[204a] Travail de M. Bally, déjà cité.
[205] On dit aux colonies liberté dans le même sens qu’affranchissement.
[206]
| On a donné | à des libres de fait, | à des esclaves. | ||||
| En 1830 | 159 | titres de liberté, | 157 | 22 | ||
| 1831 | 2,282 | — | 2,175 | 107 | ||
| 1832 | 8,776 | — | 8,034 | 742 | ||
| 1833 | 2,129 | — | 1,845 | 282 | ||
| 1834 | 2,194 | — | 1,445 | 749 | ||
| 1835 | 1,072 | — | 448 | 624 | ||
| 1836 | 1,188 | — | 417 | 771 | ||
| 1837 | 998 | — | 215 | 683 | ||
| 1838 | 901 | — | 315 | 386 | ||
| 1839 | 447 | — | 78 | 369 | ||
| 1840 | 380 | — | 65 | 315 | ||
| 20,426 | 15,174 | 5,252 | ||||
Nous renvoyons à la fin du volume, le tableau détaillé avec les dates des arrêtés (b).
[207] Un arrêt du conseil du Cap, du 7 février 1770, condamna un mulâtre, malgré quarante ans de possession de liberté, à rentrer dans la servitude faute de justification de son titre d’affranchissement, et par suite cassa le mariage qu’il avait contracté, et déclara ses six enfans bâtards. Il fallut une ordonnance des administrateurs pour suspendre l’exécution d’un tel arrêt !
[208] Au commencement des colonies c’était un usage général parmi les blancs d’affranchir tous leurs enfans de couleur. Les mulâtres portaient même alors génériquement le nom d’affranchis.
[209] Notices statistiques.
[210]
| À la Guadeloupe le nombre des titres de liberté enregistrés depuis | |||
| 1830 jusqu’au 1er janvier 1837, a été de | 1,798 | de 1830 à 1833. | |
| Et | 6,839 | de 1833 à 1837. | |
| 8,637 | |||
| Sur le nombre de 6,859, on compte 4,053 libres de fait ; ce qui laisse seulement 2,804, d’où, en déduisant le dixième 280, on ne trouve somme totale que | 2,684 | ||
| Eh bien ! parmi ces 2, 684, il y a | 1,251 | enfans. | |
| Et | 1,041 | femmes. [210a] | |
| 2,292 | [210b] | ||
Ajoutez-y les vieillards que l’âge inutilisait, et jugez ce qu’il reste pour les affranchissemens des esclaves travailleurs, ceux auxquels la haute morale n’a rien à reprendre.
[210a] Il y a en Europe tant de blanches qui se vendent, qu’il n’est pas surprenant de voir aux colonies tant de négresses que l’on rachète.
[210b] Tous ces chiffres sont tirés des Notices statistiques.
[211] Considérations sur le système, etc. Rappelons encore que l’auteur, M. Sully Brunet, est un ancien délégué des blancs de Bourbon.
[212] Dans l’exposé des motifs de cette ordonnance on lit : « Voulant donner de nouvelles facilités aux concessions d’affranchissement. » Elle supprime toute taxe sur les affranchissemens.
[213] Un extrait de cet article a été traduit dans le numéro du Temps du 29 mars 1839.
[214] Dans un prochain volume, lorsque nous jetterons un coup-d’œil sur Cuba, il nous sera facile de démontrer que si la France voulait se réunir à l’Angleterre pour mettre un terme à la traite, la damnable prospérité de cette île s’affaisserait en quelques années sur elle-même, comme le géant à la tête d’or et aux pieds d’argile.
[215] Lisez les instructions données le 7 mars 1773 à MM. Bouillé et Tascher, allant occuper les deux premiers postes de la Martinique : « La plupart des maîtres sont des tyrans qui pèsent en quelque sorte la vie de leurs esclaves avec le produit d’un travail forcé. Cet excès trop commun ne peut cependant être corrigé par la loi, parce qu’il reste trop souvent inconnu, et qu’il est presque toujours impossible d’acquérir les preuves. Il serait d’ailleurs dangereux de donner aux nègres de spectacle d’un maître, puni pour des violences commises envers ses esclaves. L’empire de la persuasion, l’intérêt, la vanité, l’orgueil sont les freins uniques que l’on puisse opposer à un désordre aussi révoltant. L’intention de Sa Majesté est que les sieurs de Bouillé et Tascher, y veillent avec le plus grand soin, qu’ils distinguent par leurs égards, les maîtres cruels d’avec ceux qui traitent humainement leurs esclaves, et qu’ils excluent les premiers de toute distinction, de tout grade, de tout emploi, et qu’ils donnent enfin pour eux l’exemple du mépris et de l’indignation. »
[216] « Je dirai peu de choses au sujet de la moralisation religieuse. Les moyens ordonnés sont absurdes et impraticables. » (M. Guignod).
[217] Amulettes composés par les sorciers et les enchanteurs.
[218] Le lecteur nous saura gré de lui donner l’allocution de M. Goubert, c’est un morceau qui révèle un grand talent, et il est fâcheux pour l’église qu’elle perde encore dans M. Goubert un de ses membres les plus distingués.
« Avant de vous quitter mes enfans, j’ai un conseil à vous donner. Dans ce pays il y a encore l’esclavage, c’est-à-dire qu’il y a une résistance étrangement arriérée à l’esprit évangélique. Puisque vous venez de promettre que désormais vous serez des chrétiens, je dois vous avertir qu’encore, à cet égard, vous devez avoir une manière de penser et d’agir toute contraire à ce que vous verrez autour de vous. Si, à cause de la calamité des temps, vous êtes appelés à posséder des esclaves, n’oubliez pas qu’ils sont vos frères, et que vous devez les traiter avec les égards que l’homme doit à l’homme.
« Je sais que dans ce pays il se trouve des capacités scientifiques qui osent dire que l’esclave est d’une autre espèce que le maître. Eh bien ! enfans chrétiens, jamais on n’a rien dit de plus absurde. Tous les hommes n’ont qu’une seule et même souche : tout homme est fils d’Adam ; tout homme a été fait à l’image et ressemblance du créateur : tout homme a été racheté sur la croix par le sang du Rédempteur ; tout homme a droit au ciel, conséquemment à la vérité et à la liberté qui y conduisent. Notre Seigneur, dit l’Évangile, quand il naquit à Bethléem, voulut revêtir la forme de l’esclave. Eh pourquoi ? si non pour l’ennoblir dans les idées des hommes, faussées à cet égard par leur hideuse avarice ?
« Allez dans l’asile des morts, interrogez la poussière de ceux qui vécurent sous diverses couleurs cutanées, prenez à plusieurs sépultures la poussière funéraire, et cherchez à distinguer là le blanc du noir ! Laquelle de ces poussières sera la plus pesante ? Le vent, auquel vous l’abandonnerez, la trouvera, soyez-en certain, également légère : c’est que la mort sait rétablir l’ordre de la naissance. À leur berceau, les hommes sont égaux et frères, et la tombe les rapproche dans le même rapport.
« Si les lois civiles, lois que je ne prétends pas ici qualifier, refusent des droits à l’esclave, Dieu lui en donne, la religion lui en suppose, le sentiment naturel les proclame. Enfans, écoutez la religion, et ayez pour tous, mais pour le faible surtout, une charité sans bornes.
« Ne les battez pas ; l’homme n’est point sorti du sein d’Ève pour être fouetté ! Le moindre de vos coups ferait souffrir une âme immortelle ; et je vous le déclare, Dieu vous le rendrait.
« Ne les laissez pas nus. N’a-t-il jamais travaillé cet homme, pour que son aspect blesse partout la pudeur ?
« Ne le chargez pas de carcan ni de fers. Où l’on porte des chaînes, le riche s’asservit aussi bien que le pauvre ; car si l’inférieur porte au pied la chaîne, le supérieur est forcé de la porter au poing ; et de là gêne commune, de là violence : conséquemment malheur universel.
« Instruisez l’esclave ; laissez-le venir facilement à l’église pour y apprendre à vous aimer, à vous aider, à vous soutenir. De quel droit lui refuse-t-on l’instruction religieuse ? Est-ce Dieu qui l’a vendu ? Son service ne peut vous appartenir qu’après qu’il a servi le Seigneur. L’Écriture lance des malédictions sur le maître qui ne favorise pas le salut de ses inférieurs. Gardez-vous bien, mes enfans, de les assumer sur vos têtes, ces malédictions ! Les âmes sont trop précieuses aux yeux de Jésus-Christ pour qu’il puisse jamais vous permettre de lui en soustraire une seule.
« Ne les méprisez pas, non ne les méprisez pas ; car, dites, à quoi a-t-il tenu que vous ne soyez nés à leur place, et qu’ils ne soient nés à la vôtre ?
« Que votre cœur soit donc charité. Ce sont les impies qui, comme le dit l’Écriture, ont les entrailles dures et cruelles.
« Ainsi pour nous résumer, l’esprit de Dieu donne la douceur pour traiter avec amour le prochain, et surtout le malheureux, C’est à ce signe, mes enfans, que Dieu vous reconnaîtra un jour. »
[219] Plusieurs, hélas ! le pratiquent dans toute son horreur et les deux notes suivantes dont les originaux ont été mis sous nos yeux, donnent à juger si les esclaves de l’église sont toujours mieux traités que ceux des colons.
« Jacques, gardien du cimetière est autorisé à faire punir Joseph, esclave appartenant à la fabrique et attaché au cimetière, pour refus de faire son service pendant la semaine, notamment dans un enterrement où il a refusé de porter le brancard. »
Cayenne, le 12 septembre 1840.
Le président de la fabrique,
Signé Guillier,
Préfet apostolique.
Et en marge :
Bon pour vingt-neuf coups de fouet ;
Cayenne, le 13 septembre 1840,
Signé, le maire, F. Roubault.
« Joseph Appollon, gardien du cimetière par intérim, est autorisé à conduire à la geôle le noir Toussaint, de la fabrique attaché au cimetière, pour le faire punir de ce qu’il a manqué essentiellement à son devoir, en quittant le travail pendant toute une demi-journée qu’il a passée dans la débauche. »
Cayenne, 30 août 1840.
Le président de la fabrique,
Signé Guillier,
Préfet apostolique.
Vu pour vingt-neuf coups de fouet à donner au nègre Toussaint.
Cayenne, le 30 août 1840.
Signé, le maire,
F. Roubault
[220] Malgré ces progrès que nous ne sommes nullement tenté de cacher, le jour où l’on voudra réellement porter le pain de l’intelligence aux nègres de nos Antilles, nous aurons quelqu’objection à ce qu’on y emploie les frères de Ploërmel. Ils sont bons, obligeans et doux, mais ils montrent une dévotion exagérée, et ne paraissent pas tous assez cultivés peut-être pour cette œuvre si importante et si délicate de l’éducation de la première enfance.
[221] Par acte de la législation de la Louisiane du 16 mars 1830, il est décrété que toute personne dans l’état de la Louisiane qui enseignera, permettra qu’on enseigne ou fera enseigner à lire ou à écrire à un esclave quelconque sera sur conviction du fait, par devant toute Cour de juridiction compétente, condamné à un emprisonnement d’un mois à un an. — Dans l’état de Virginie il a été passé le 1er janvier 1819, une loi qui prohibe les écoles noires sous peine de vingt coups de fouet sur le dos nu.
[222] Les enfans qui naissent des esclaves appartiennent aux maîtres des femmes esclaves, art. 12 du Code noir.
[223] C’est la règle, c’est l’usage commun, mais ici comme toujours nous devons signaler des exceptions qui tiennent essentiellement à l’état d’esclavage où l’individu possédé est contraint, d’abord et avant tout de se conformer aux ordres de l’individu possesseur, sous peine du fouet, de la prison et des chaînes. Ainsi le rapport du juge d’instruction dans une plainte en sévices, portée contre un M. Vaultier Moyencourt (28 juillet 1841), établit que l’esclave Antoinette, enceinte et malade, ayant reçu l’ordre de se rendre au jardin malgré la demande qu’elle faisait d’aller à l’hôpital et n’ayant pas obéi, fut mise au cachot à neuf heures du matin ; que là elle se sentit prise de mal d’enfant et accoucha dans la journée de deux jumeaux. M. Vaultier disait pour sa justification, qu’ignorant l’état avancé de grossesse d’Antoinette (une femme qui accouche le jour même de deux jumeaux), il avait voulu la punir d’un acte de paresse compliqué de désobéissance.
M. Vaultier n’était pas compromis pour ce seul fait.
Le juge d’instruction avait en outre constaté par procès-verbal, qu’un petit nègre de douze à quatorze ans, était enchaîné depuis sept mois dans l’écurie de cet habitant. La chaîne pesant ensemble seize livres, était assez longue pour que l’enfant put donner aux chevaux l’herbe que l’on déposait à côté de lui. Il portait sur le corps des traces de coups de fouet et se trouvait dans un grand état de débilité.
C’est là un fait constant, positif, irrévocable, le colon ne le nie pas, il n’avait, disait-il, d’autre moyen de punir ce petit nègre marron et maraudeur incorrigible. — Il y a torture, elle est malheureusement trop évidente ; ce jeune nègre a été pendant sept mois un chien à l’attache ; la seule différence est qu’il avait la chaîne au pied au lieu de l’avoir an cou. Mais les mœurs coloniales sont telles, le délire que donne l’esprit maître va si loin, M. Vaultier avait si peu la conscience de son crime, que le lieu de séquestration était l’écurie ; or les écuries n’ont pas de portes aux colonies, tout le monde a la faculté de voir ce qui s’y passe, et le juge d’instruction, tant on avait peu l’envie de se cacher, ne fut instruit du mal que par un gendarme envoyé là pour y mettre les chevaux ! Le coupable n’est pas du tout un méchant homme, il a bonne réputation de maître, et il est certain que se privant une fois des services de son mauvais petit esclave, il aurait pu le plonger dans un cachot infect s’il l’avait voulu.
M. Vaultier a été poursuivi, et bien entendu acquitté. En revanche, M. Goubert, le juge d’instruction, reconnu à quelques enquêtes semblables pour magistrat abolitioniste, exposé aux coups de la coalition créole, fut révoqué assez brusquement de l’office qu’il remplissait par intérim. — Les colons voient un ennemi personnel dans tout magistrat qui se déclare ami des esclaves, et en le faisant chasser promptement, ils dégoûtent ceux qui pourraient être tentés de l’imiter. Peut-être est-il bien que ce soit ainsi ? Les obstacles que l’on oppose à l’action émancipatrice servent encore à accélérer son triomphe, en démontrant par leur nature même combien la cause est juste et bonne, Le désordre moral de la société des Antilles, l’odieux de certains actes des hauts fonctionnaires et le scandale des acquittemens judiciaires sont devenus, comme le disent les créoles sensés, d’énergiques dissolvans du pouvoir dominical, et les causes qui hâtent le plus la mesure de l’affranchissement.
[224] De l’esclavage des noirs, etc. Si l’on était tenté de lire notre projet, on y verrait que nous n’échappions à son vice principal qu’en arrachant les enfans aux père et mère pour les élever dans de grands établissemens publics, aux frais de la nation.
[225] L’expérience de l’apprentissage anglais a révélé mille autres difficultés inhérentes à ce système, et notamment celle-ci. Jusqu’à ce qu’il fut établi, les voleurs étaient jugés et punis sommairement par le maître sur l’habitation, mais sous l’empire de la nouvelle loi, il n’en pouvait plus être ainsi. Il fallait envoyer le délinquant à la geôle, où il restait quelquefois deux mois en attendant la session de justice ; de sorte que jusqu’à la fin de cette prévention d’abord et ensuite durant la détention s’il y avait lieu, le propriétaire restait privé par la loi, du travail de l’apprenti que la loi lui avait garanti. De plus, le jardin du coupable était nécessairement abandonné, et quand il sortait de prison, ne trouvant pas de vivres sur sa terre et ne pouvant rien gagner, puisque ses bras ne lui appartenaient point, il allait de nouveau piller les autres.
[226] The West-Indies, etc.
[227] Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises, publié par ordre du ministère de la marine ; deuxième publication.
[228] On voit, en entendant M. Bovis, comment les créoles intelligens et de bonne foi apprécient ce que la servitude a fait pour les nègres.
Moraliser, c’est faire prévaloir les bons penchans sur les mauvais ; or, les maîtres prétendent qu’il ne convient pas d’affranchir, parce que les esclaves n’ont que de mauvais penchans. Que penser ensuite de l’incroyable idée du conseil colonial de Bourbon, qui, répondant au rapport Tocqueville, ose avancer « qu’il faut voir dans l’esclavage de nos colonies la première visite de la Providence à la race noire. » L’aberration peut-elle aller plus loin ? Rapprochez cela de ce que vient de dire M. Bovis, ou de ce qu’à écrit M. Sully Brunet dans sa dernière brochure. « Si nos colonies offrent le spectacle d’une déplorable immoralité parmi les esclaves, c’est que nulle part ceux-ci n’ont été plus abandonnés à leurs grossiers instincts, par l’indifférence de la métropole et les mauvaises institutions qu’elle imposait aux colonies. » Qu’a dit encore un autre colon, M. Guignod, de la Martinique : « Nos hommes sont ignorans, demi-sauvages ; ils ont tous les vices inhérens à la servitude et à une demi-civilisation. » Quels effets de la visite divine ! C’est vraiment une grande impiété de faire intervenir la Providence dans toutes ces abominations. Ils fouettent des femmes nues, et ils nous soutiennent qu’ils les moralisent.
[229] À chaque instant, on le voit, les colons sincères nous fournissent eux-mêmes l’attestation de notre proposition : « L’esclave n’est pas soumis à un pouvoir public. »
[230] Dans notre ouvrage sur les colonies anglaises, on verra que les nègres anglais n’étaient pas plus instruits que les nôtres, et que les planteurs anglais disaient d’eux identiquement ce que les planteurs français disent encore des leurs.
[231] Rapport de M. Chazelles.
[232] M. Virey, Diction. des sciences médicales, article Homme.
[233] Voici comment l’un des accusés, raconte l’arrestation de ses nègres accusés avec lui : « Ils furent garottés avec une telle force, que les cordes leur coupèrent la peau. On les conduisit à la geôle où leur innocence ne fut pas si longue à établir que celle de leur maître. Après neuf jours employés à les interroger, on les rendit à la liberté ; mais dans quel état !… Presque tous malades, furent conduits à mon hôpital ; les soins les plus assidus bornèrent la mortalité à quatre. Ils succombèrent à la maladie qu’ils avaient gagnée dans le cloaque où on avait amassé cent créatures humaines. » (La vérité sur les événemens, etc.)
[234] Le blanc qui comparut dans cette affaire (l’autre s’était sauvé) fut acquitté. Encore de la justice coloniale ! On pend les soldats, on absout le chef ! Ou le chef était coupable, ou les soldats ne l’étaient pas.
[235] « Nous ne comprenons pas la peur que l’on veut bien éprouver pour nous. Que l’on nous donne deux mille hommes de troupes avec une bonne gendarmerie, que l’on n’attaque pas le respect de notre puissance morale, et je maintiens que nous n’avons rien à craindre. » (M. Guignod.)
[236] Dix nègres furent pendus à la Martinique le 4 décembre 1815, par suite d’un arrêt du conseil supérieur, en date du 30 novembre.
[237] Lettres sur l’esclavage.
[238] Considérations sur le système colonial.
[239] Ruche Populaire, journal des ouvriers.
[240] Séance du 6 février 1839.
[241] Séance du 21 novembre 1838.
[242] Rapport de M. Chazelles, 1841.
[243] Séance du 31 octobre 1838.
[244] Encyclopédie, article Traite des nègres.
[245] On a vu longuement exposés dans notre introduction les motifs qu’il y a de croire à la possibilité d’établir, sans aucun danger pour eux, des cultivateurs blancs sur les terres coloniales. En tout état de cause, nous sommes fermement persuadé qu’une émigration bien réglée d’Europe aux îles serait aussi utile pour l’Europe et les îles que pour les émigrans.
[246] C’est ici le lieu de remettre en lumière un très beau projet dû à M. Beauvallon, de la Guadeloupe, et communiqué il y a deux ans à la Sentinelle de l’Armée, par M. Éd. Bouvet. Nous approuvons d’autant plus le fonds des idées exposées dans la lettre ci-dessous que leur adoption permettrait d’envoyer aux îles tous les régimens de l’armée, à tour de rôle, et de supprimer les corps spéciaux chargés aujourd’hui du service colonial.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Il s’agirait d’établir la conscription dans nos colonies des Antilles, aux mêmes conditions que dans la métropole. Elle porterait sur toutes les classes libres, sans distinction de couleurs.
« La Guadeloupe, par exemple, à elle seule fournirait facilement un bataillon.
« Les pères de famille auraient un moyen de remplacement pour leurs fils, simple et facile, ce serait de fournir un de leurs noirs jugé acceptable par une commission, et rendu libre à l’instant.
« Ce bataillon colonial serait destiné à un service de protection et de sûreté dans l’intérieur de la colonie, pendant les huit à neuf mois où la fièvre jaune cesse ses ravages. Aussitôt l’invasion de la recrudescence, il descendrait dans les villes et postes du littoral, et nos soldats européens prendraient des cantonnemens dans diverses positions salubres. Alors les troupes européennes des Antilles ne seraient plus décimées, le fléau ne les atteindrait plus.
Une surabondance de population de couleur plus ou moins foncée serait retirée de l’oisiveté et du vagabondage. Ces hommes, ainsi que les nouveaux affranchis, soumis pendant sept années à un service actif, à une discipline régulière, instruits à des écoles régimentaires bien organisées, pourraient être rendus, en toute confiance à la société. Les vagabonds, libres déjà, seraient devenus des hommes honnêtes et laborieux, et pour les affranchir, l’éducation et la famille auraient commencé, La liberté serait devenue pour eux un breuvage salutaire.
« À la Guadeloupe, le littoral seul est cultivé : cette partie forme environ la moitié de la surface de l’île. Au centre, dans la partie élevée, il existe, parmi les montagnes, une quantité innombrable de plateaux et de vallées d’une riche fertilité. Là, le gouvernement pourrait donner une portion de terre déterminée à chaque soldat, à la fin de son temps de service. Une nouvelle population se formerait ; son principe serait honorable, son existence laborieuse.
« La population de couleur de la Guadeloupe est endurcie à gravir les montagnes, à vivre de racines, à marcher pieds-nus, à résister aux intempéries et au soleil le plus ardent. Cette population est brave jusqu’à la témérité. Elle ambitionne le métier de soldat ; son bonheur est de porter un uniforme.
« Il est probable qu’un bon nombre de volontaires s’adjoindraient à ce corps, que le tirage au sort aurait d’abord formé. Le voyage d’Alger sourirait à leur ambition. Les Antilles françaises viendraient ainsi, avec des soldats endurcis au soleil de l’équateur, porter un tribut précieux et un secours efficace dans une aussi intéressante possession de la France.
« Le corps, resté au service de la colonie, aurait pour cadre des colons. Le plus haut grade ne pourrait être que chef de bataillon. Ses officiers ne concourraient point, pour l’avancement, avec ceux de l’armée. Le service pour Alger, seul, jouirait des mêmes avantages que l’armée française.
« On s’occupe beaucoup, depuis quelques temps, de la question d’émancipation.
« Avec tous ses autres avantages, dont ici nous n’avons indiqué qu’une partie, la conscription, aux Antilles françaises, serait un commencement d’exécution de cette grande mesure. Ce moyen consacrerait le principe de l’égalité devant la loi, et ne coûterait rien à l’État, car il sera facile de prouver que la dépense, pour ce nouveau bataillon, se retrouverait amplement, et même avec bénéfice, dans la suppression de ces énormes frais de renouvellement continuel de troupes, de passages, de frais d’hôpitaux, etc., etc.
« En supposant même qu’il y eut à peine compensation, quelle différence pour la patrie, de payer pour la mort ou la vie de ses enfans !…
« Le fléau de la fièvre serait vaincu, plus de veuves, plus de mères en deuil !
« Le voyage aux colonies deviendrait une brillante et joyeuse campagne !
« La puissance de l’État, les colonies, l’humanité et la morale y gagneraient !
« Le projet est beau :
« Honneur à celui qui l’a conçu ! »
Édouard Bouvet.
[247] Nous étendons cette interdiction à tous les ordres judiciaires. La magistrature doit être entièrement métropolitaine, tout-à-fait indépendante dans le pays, sans intérêt local d’aucune nature ; cela est nécessaire jusqu’à ce que les passions de caste qui divisent les colonies soient éteintes.
[248] Nous laissons à la sagesse du législateur de décider si un magistrat, juge-de-paix ou autre, peut être poursuivi par une partie civile, à raison de l’exercice de ses fonctions, C’est une question de la plus haute gravité, touchant au droit politique, et sur laquelle nous n’avons pas assez réfléchi pour donner notre opinion.
[249] Si l’on suppose seulement quatre-vingt mille valides sur les mille esclaves que la loi délivre, l’impôt que nous établissons ici, en le fixant à 30 fr., par exemple, fait déjà rentrer chaque année plus de deux millions et demi au trésor ; et l’on ne peut douter que la France avec ses puissans moyens d’action et les sucreries pénitentiaires, ne puisse le percevoir, quelque force d’inertie que l’on veuille supposer à la classe ouvrière.
[250] On se rappelle que le travail est rétribué dans nos sucreries pénitentiaires.
[251] Nous donnerons en parlant des colonies émancipées les prix qui y sont à peu près généralement adoptés.
[252] M. Boyer a fait sur les engagemens en société, un projet législatif qui nous paraît laisser peu à désirer. Tout y est prévu. Nous croyons devoir le citer pour servir de guide au législateur. Il est important que toutes les formes de travail qui pourront être adoptées soient réglementées d’une manière précise.
engagements en société.
« Art. 1er. Lorsque le nombre des travailleurs effectifs habituellement employés à la culture sur une sucrerie, sera de (vingt) ou au-dessus, ils seront, si le juge de la commune l’ordonne ainsi [252a], associés au propriétaire, suivant les règles ci-après.
[252a] Nous dirions, nous, s’il convient aux travailleurs et au propriétaire.
« Art. 2. Une moitié de tout le revenu brut, sous la charge des grosses réparations et de la mise de premier établissement, reviendra au propriétaire.
« La seconde moitié, sous la charge de réparations et d’entretien, est attribuée au travail. Un (cinquième) en appartiendra au propriétaire pour la direction du travail, à la charge de payer les gérans et économes, s’il en emploie. Le surplus sera partagé entre les travailleurs, proportionnellement au nombre de journées dont chacun d’eux justifiera.
« Néanmoins les sommes nécessaires pour remplacer les instrumens de culture et les animaux d’exploitation seront prélevées sur le total du revenu.
« Art. 3. Chaque atelier en société aura un chef conducteur, (l’ancien commandeur), choisi par les travailleurs, et agréé par le propriétaire, en cas de non accord, nommé par le juge de la commune [252b]
[252b] Selon nous, tout travailleur qui n’agréerait pas le chef nommé, doit avoir le droit de se retirer.
« Ce chef-ouvrier conduira les travaux selon les prescriptions du propriétaire ou de son géreur. Tous les travailleurs lui devront à cet égard obéissance. Il aura la surveillance de leurs intérêts.
« Art. 4. Chaque jour, à la réunion du soir, le chef-ouvrier, distribuera aux travailleurs un bon de leur journée.
« Ceux qui n’auront été employés qu’à des travaux secondaires, ou qui n’auront pas mis dans leur travail l’activité convenable, ou qui auront commis quelque faute, ne recevront qu’un bon de demi-journée ou d’un quart. Ils pourront même en être entièrement privés [252c].
[252c] C’est le conducteur élu par tous et surveillant les travaux qui doit en juger.
« Les enfans, lorsqu’ils auront été employés, recevront de même un bon selon l’appréciation du dit chef-ouvrier.
« Ces bons seront représentés et remis lors des partages du revenu. Les journées du chef-ouvrier compteront pour le double.
« Art. 5. Dans le revenu commun entreront les sucres, sirops, tafia, bananes, manioc, cafés, et généralement tous les produits des champs cultivés par l’atelier, même des arbres qui s’y trouveront, ainsi que le lait des vaches et chèvres, et le croît des troupeaux.
« Les produits des jardins et vergers cultivés séparément par le propriétaire, lui appartiendront exclusivement.
« Le propriétaire abandonnera en jouissance, pour la durée de la société, à chacun des travailleurs, un terrain de deux cents mètres carrés, dans lequel à leurs heures et jours de repos ils pourront faire des plantations qui leur appartiendront aussi exclusivement.
« Art. 6. Chaque travailleur devra au travail commun tous ses jours, ceux de fêtes et les dimanches exceptés.
« Il pourra être fait par le propriétaire, sous l’approbation du juge de la commune, des réglemens où seront fixées les heures de repos et tous les détails relatifs à la vie des travailleurs [252d].
[252d] Ces conditions et réglemens devraient être stipulées au contrat d’engagement.
« Art, 7. Chaque travailleur se nourrira, et entretiendra lui et sa famille sur sa part dans le revenu.
« Néanmoins le propriétaire sera tenu de faire l’avance de la nourriture pendant la première année de la société, à ceux qui le demanderaient.
« Pour son remboursement il aura un privilége antérieur à tout autre, sur les parts de revenu de ceux à qui il aura fait cette avance.
« Art. 8. Il y aura pour les malades un hôpital commun, dont les dépenses y compris les remèdes et les honoraires de médecin, seront considérés comme frais d’entretien.
« Lorsqu’il n’y aura pas de fonds réservés pour cet objet, le propriétaire en fera l’avance, à raison de laquelle il aura le même privilége que ci-dessus.
« Art. 9. L’ordonnance de tous les travaux appartiendra au propriétaire ou à son représentant.
« Il ne pourra employer l’atelier à des travaux en dehors de l’intérêt de la société.
« Art. 10. Il sera loisible au propriétaire et aussi au chef-ouvrier d’employer au travail commun des ouvriers loués, desquels les salaires seront considérés comme frais d’entretien.
« Art. 11. Au cas d’inconduite grave de l’un des travailleurs, le propriétaire pourra le faire arrêter [252e] et le détenir jusqu’à décision du juge qu’il en informera immédiatement.
[252e] Dans nos données, une pareille faculté ne peut être accordée au propriétaire. Les sociétaires doivent être placés sous le droit commun.
« Art. 12. Le propriétaire ou son géreur tiendront un registre sur lequel seront inscrites jour par jour, toutes les affaires de la société, les plantations, les récoltes, les achats, les ventes, les travaux, les partages des fruits ou deniers, et généralement tous les faits et renseignemens utiles à consigner.
« Le chef-ouvrier en prendra communication toutes les semaines.
« Le juge de la commune le visera, quand il visitera l’habitation, et y inscrira telles observations qu’il croira convenable.
« Art. 13. Moyennant l’accomplissement de toutes leurs obligations envers la société, les travailleurs auront la libre jouissance de leur personne, de leur temps, de leurs maisons. Aux jours et heures de repos, ils pourront sortir de l’habitation sans permis. L’entrée en sera toujours ouverte aux instituteurs et aux ministres de la religion.
« Art. 14. Cette association durera cinq ans.
« En tout temps il sera loisible au propriétaire [252f] d’admettre de nouveaux travailleurs associés, lesquels seront aussi engagés pour cinq ans, à compter du jour de leur entrée. Leur part dans les produits pendans sera réglée à l’amiable ou par le juge.
[252f] Avec consentement des associés, dirions-nous.
« La continuation du travail pendant (un mois) après l’expiration de cinq ans, emportera renouvellement de l’engagement pour cinq années [252g].
[252g] Nous n’accepterions pas cette clause qui pourrait engager le travailleur malgré lui. Il est bien plus simple de contracter un nouvel engagement.
« Art. 15. Le commencement de la société pour chacun sera constaté sur le registre de l’habitation. Les associés signeront cette mention, s’ils savent signer.
« Art. 16. Tout travailleur qui se conduirait mal pourra, sur la demande du propriétaire, être déclaré par le juge, déchu de la société et expulsé de l’habitation, même sans indemnité [252h].
[252h] Selon nous, pareille exclusion ne peut être prononcée que par l’assemblée des sociétaires.
« Le juge pourra aussi, sur la plainte du propriétaire ou du chef-ouvrier, infliger au travailleur en faute telle correction qu’il croira juste[252i].
[252i] Dans aucun cas nous ne conseillerions à un travailleur d’accepter un engagement qui le lierait jusque-là. La loi commune suffit à tout.
« Art. 17. Toutes les difficultés auxquelles donnerait lieu l’exécution de cet engagement en société, soit entre les travailleurs entre eux, soit entre eux et le propriétaire, seront jugés par le juge de la commune, sans procédure, sans appel, ni pourvoi. Ses décisions seront mentionnées sur le registre de l’habitation et signées de lui. »
[253] Petits fagots que l’on porte à la ville pour les cuisines.
[254] Le lecteur aperçoit que par cette clause nous voulons mettre de l’argent aux mains du colon, nonobstant toutes dettes, afin qu’il ait de quoi payer ses ouvriers libres.
[255] Ces concessions ne seront jamais assez étendues pour qu’elles puissent nuire à la grande culture, et peuvent être un vif encouragement au travail pour les nègres qui ont assez généralement du goût pour la propriété.
[256] Le tafia est la liqueur que l’on obtient par distillation du gros sirop et des écumes résultant de la fabrication du sucre de cannes. Le rhum n’est autre chose que du tafia vieilli et coloré avec un peu de caramel.
[257] Ce proverbe pourrait aussi s'entendre : « Quand on ne peut faire ce qu'on veut , il faut faire ce qu'on peut. ».
[258] J'ai trouvé ce dicton à la Martinique , Ile que les Espagnols n'ont jamais possédée, il est dès lors assez singulier qu'on le retrouve pareil dans leur langue. « Cuaudo la barba de tu vecioo vieres pelar hecha la tuja à remojar, » Quand tu venu la barbe de ton voisin peler, mets tremper la tienne.
[259] Conjuration cabalistique.
[260] La macoute est ud grand sae de paille , quelque chose comme notre caba.
[261] Voici comment , du moins d'après la tradition que les nègres en recontent. Tous les animaux furent créés sans tête par les anges. La tête élant la partie la plus importante du corps , Dieu s'était réservé de la fabriquer lui-même. Quand vint le jour de la distribution tous les animaux accoururent , et Dieu donnait à chacun une tête qu'il prenait dans un grand panier , placé à côté de lui. 11 y avait presse , on craignait d'en manquer ; les anges n'avaient pas su faire de pieds aux serpens , Dieu pouvait bien ne pas savoir faire de têtes pour tout la monde ; eo un mot, on avait peur. La crabe très bonne personne de sa nature, se trouvait par hasard au premier rang, mais voyant l'inquiétude générale , elle céda son tour jusqu'à la fin parce que chacun l'en priait Cependant quand tout le monde eut passé , elle se présenta , le bon Dieu fouilla au panier, hélas ! plus de têtes, il s'était malheureusement trompé de compte en fabriquant , il ne lui en restait plus une seule : « Ma foi , dit-il à la crabe , ous qu'a vini tardtrope, moin té donné toutes têtes là à gens là, moin ben fâché chai pitite. » Ma foi , vous venez trop tard , j'ai donné toutes les têtes à ces gens-là , j'en suis bien fâché, chère petite. Dieu n'était pas trop rassuré, lui et les anges s'attendaient à ce que la crabe lui fil de grands reproches et poussât des cris terribles. Loin de là , la douce créature répondit doucement: « T'en prie, chai bon Dieu , fais pas to chagrin pou ça , ça pas valé la peine » , et elle s'en alla sans tête. Voilà pourquoi elle ne marche jamais droite devant elle , mais toujours de côté.
[262] Quidi est le scintillcuieui d'une étoile , le mouvement d'une flamme. Les nègres expriment merveilleusement par ce mot une agitation continue.
[263] Petit lézard très commun aux Antilles.
[264] Le Mapou est un arbre des bords de la mer, très tourmenté par les brises qui le rendent tortu.
[265] Les paniers dits caraïbes, sonl deux paniers semblables, donl l'un sert de couvercle à l'autre.
[266] Gros tubercule qui sert de pain.
[267] Fruit des colonies.
[268] L'avocat est un fruit des colonies dont les chats sont très friands.
[269] " Lafontaine n'a-t-il pas dit quelque chose de semblable! Nous n'avoua paa besoin de répéter que tous ces proverbes s'emploient dans millo autres accep- tions que celles où nous les avons placées afin d'en donner une idée générale. Celui-ci par exemple exprime encore pour les nègres que les malheurs arrivées au loin font peu d'impression sur ceux à qui on les raconte. Il est certain que nous sommes plus émus par la mort d'un malheureux couvreur que nous venons de voir tomber , que par le massacre de dix mille Chinois que le journal nous raconte. Sizvé pas vol, kior pas fait mal.
[270] C'est le chaudron de tous dos ménages de paysans.
[271] Les nègres , comme nous l'avons dit , ont une vénération profonde pour leurs parera ; la plus grande injure que l'on puisse faire à tin noir , c'est de mal parler de sa mère. Aussi voit-on qu'il leur parait bien plus dangereux d'insulter la mère du caïman > que le caïman lui-même.
[272] Le calalou est une soupe fort liquide et composée d'herbes, et très aimée de tout le monde aux Antilles.
[273] Plat en calebasse.
[274] Coleoptère , plut connu en Europe tout le non de cancrelat. lit échappent rarement aux poules.