
Louis Reybaud, “Socialistes, Socialisme,” DEP (1853)
 |
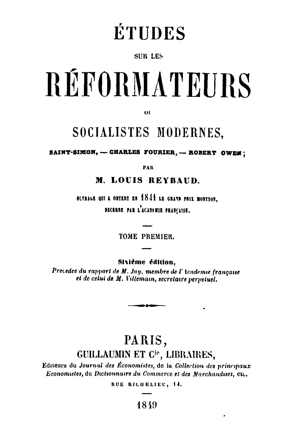 |
| Louis Reybaud (1798-1879) |
Source
Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. Troisième Édition (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1864), 2 vols. [1st ed. 1852-53.] vol. 1 facs. PDF; vol. 2 facs PDF
- Louis Reybaud, “Socialistes, Socialisme,” DEP, vol. 2, pp. 629-41. HTML and facs. PDF.
A shorter version of this article was translated and published in Cyclopaedia of Political Science, Political Economy, and of the Political History of the United States by the best American and European Authors, ed. John J. Lalor (New York: Maynard, Merrill, & Co., 1899). 3 vols.
Reybaud also wrote a two volume work on the history of socialism and socialist thought in 1840 which went through many editions:
- Louis Reybaud, Les Études sur les réformateurs contemporains. I. Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen ; II. La société et le socialisme, les communistes, les chartistes, les utilitaires, les humanitaires (Paris : Guillaumin, 1849). 6th edition. vol. 1 facs PDF; vol. 2 facs. PDF.
Text
SOCIALISTES, SOCIALISME. Avant d'examiner ce qu'est le socialisme, ce que sont les socialistes, il est essentiel de fixer le cadre dans lequel cet examen doit être renfermé et de définir d'une manière précise ce que signifient ces mots, quelles en sont l'origine et la portée, en se défendant avec soin des fausses applications qu'on a pu en faire.
L'auteur de cet article croit être certain qu'avant 1835, époque à laquelle il commença, un peu au hasard et poussé par un sentiment de curiosité, l'étude de quelques utopies alors toutes nouvelles, le mot de socialiste n'existait pas encore, et qu'il a eu le triste honneur de l'introduire dans notre langue. Il n'entendait l'appliquer alors et il ne se propose de l'appliquer ici qu'aux systèmes et aux inventeurs des systèmes dont il a été question récemment et qu'après tant de bruit et d'éclat attendent désormais le silence et l'oubli. C'est donc uniquement du socialisme et des socialistes spéculatifs qu'il va s'agir dans ce travail ; c'est de cette famille de visionnaires qui ont imaginé et portent dans leur cerveau un monde à leur usage, monde complet où ils assignent aux forces et aux facultés de la créature une destination bien supérieure à celle qu'elles ont aujourd'hui ; où la civilisation actuelle disparait comme un décor pour faire place à une civilisation autrement perfectionnée; où tout est renouvelé de fond en comble, les lois, les mœurs, la vie présente et la vie future. Dieu et l'homme, la terre et le ciel, les méthodes de culture aussi bien que celles de gouvernement. Voilà dans quel sens le socialisme sera envisagé. Cette donnée exclut tout ce que les événements politiques y ont introduit d'éléments hétérogènes ou violents; elle n'embrasse que les sectes, et laisse en dehors les partis qui en sont issus.
Le moment est d'ailleurs favorable pour dire un dernier mot sur des rêves, qui sont près de finir. L'effort est épuisé en effet; la veine tarie ! Si l'esprit de vertige reprend encore le dessus, ce sera sous une autre forme et avec d'autres illuminés ; le vide est déjà fait autour de ceux qui naguère occupaient la scène. On a vu les idées à l'essai et les hommes à l'œuvre; tout cela est jugé désormais. La même foule qui battait des mains à ces régénérateurs de l'humanité ne les accueillerait aujourd'hui qu'avec des sifflets et procéderait au besoin à leur exécution. Une seule chose à ses yeux justifie l'audace, c'est le succès; et non-seulement le succès leur a échappé, mais leur échec a été des plus ridicules et des plus tristes que l'on puisse voir. Le hasard, une surprise de l'opinion leur avaient livré la société comme un champ d'expériences ; ils pouvaient essayer sur elle toutes leurs formules de parfait bonheur, de satisfaction et de prospérité illimitées ; ils pouvaient en disposer à leur gré , y fonder leur âge d'or, lui prodiguer les délices de leur paradis imaginaire, l'affranchir des maux qui l'assiègent et des iniquités dont elle gémit ; rien ne gênait leur action, ne s'opposait à l'application de leurs programmes ; ils étaient les maîtres, ils commandaient, ils avaient l'influence et le pouvoir. Qu'en est-il résulté.? Un déplorable et universel avortement. Ce sont là des déceptions auxquelles on ne s'expose pas deux fois, et c'est en dernier ressort que de pareilles causes se perdent. Ainsi, en affirmant que le socialisme est éteint, du moins dans la forme où il s'est dernièrement produit, il n'y a pas à craindre de démenti ni du temps, ni des événements : parier de lui, c'est presque prononcer une oraison funèbre.
En commençant ce sujet, il est permis à l'auteur de cet article de rappeler que, l'un des premiers, le premier peut-être , il a rendu sensibles les analogies qui existent entre ces révoltes de l'esprit contemporain et d'autres révoltes qui se rencontrent dans le cours des âges, révoltes individuelles ou collectives, tranquilles ou violentes, suivant les temps et les lieux. Que ces analogies soient plus ou moins caractérisées, plus ou moins lointaines, qu'elles frappent mieux ici que là, peu importe; ce sont là des arguties d'école et il est sans intérêt de s'y appesantir. L'essentiel, c'est que la preuve du plagiat s'en dégage pleinement et avec une parfaite évidence, c'est qu'il demeure constant que ces prétendus inventeurs ne sont que de médiocres copistes et qu'il n'y a plus d'originalité ici-bas, même dans l'absurde. Voilà le véritable but, la sanction utile''de ce retour vers le passé. Or un simple coup d'œil y suffit.
En effet, rien n'est moins rare dans les annales du monde, que ces excursions du cerveau humain vers les régions de la fantaisie. Tantôt des philosophes y procèdent dans l'isolement de leur pensée, [630] tantôt des sectes s'en mêlent, d'autres fois ce sont des populations entières, jetées hors de leurs voies et passant d'un désordre moral au désordre matériel. Ici c'est le mobile mystique qui prévaut et comprime l'instinct au profit d'un système; là c'est l'instinct au contraire qui reprend le dessus et se donne carrière avec impunité. Le fond de tout cela, le point commun est une rupture ouverte avec les idées reçues et un penchant décidé pour les aventures.
Parmi les écrivains de l'antiquité, Platon est celui qui a laissé le plus ancien et le plus captieux modèle de ces créations imaginaires. En quête d'un gouvernement parfait, il proclame la communauté pure et s'applique à en rechercher les combinaisons.[FN1: De la république ; — Des lois.] Comme forme et comme détails, sa fiction défrayera toutes les antres ; on le variera en le copiant. C'est ce que fait Morus dans son Utopie. Le chancelier d'Angleterre se déclare également contre la propriété; il veut que les biens soient communs, que la terre et les fruits de la terre soient du domaine social. Quiconque aura besoin d'un instrument de travail, d'un vêtement, d'un meuble, d'une denrée, devra s'adresser aux magistrats chargés de la distribution générale. En revanche, ceux-ci disposeront des bras et de l'intelligence de chaque membre de la communauté, lui assigneront sa tâche et régleront l'emploi de son temps. La société devient ainsi une sorte de machine, montée et réglée méthodiquement. Après Morus arrive Campanella [FN2: Civitas solis.] qui renchérit sur cet excès et ajoute au code de la communauté celui de la promiscuité. Les croisements de la race humaine, l'union des couples sont, dans le livre de ce moine, l'objet de soins minutieux et de détails que le latin seul tolère. Il y joint quelques formules astrologiques et des recettes pour la culture des champs, mêlant ainsi les choses de la terre et du ciel. Dès ce moment, les mondes imaginaires se succèdent et ne laissent point de trêve au public. Harrington fournit le sien, l'abbé de Saint-Pierre aussi. Morelly vient ensuite avec une fiction plus complète encore et plus développée que celles de Campanella et de Morus .[FN3: La Code de la nature.] Avec lui, le principe de la communauté quitte les formes accommodantes qu'il a revêtues jusque-là ; il devient âpre , exigeant, soupçonneux; il use de contrainte et va au besoin jusqu'à la violence. Ainsi les travaux agricoles s'exécutent au moyen d'une sorte de conscription ; tout citoyen y est voué de l'âge de vingt à vingt-cinq ans ; ainsi tout individu convaincu d'avoir voulu introduire dans le pays
« la détestable propriété est enfermé pour toute sa vie comme fou furieux et ennemi de l'humanité, dans une caserne bâtie dans le lieu des sépultures publiques : son nom est effacé pour toujours du dénombrement de celui des autres citoyens; sa famille doit en prendre un autre. »
Ce moyen commode de se délivrer d'un contrôle fâcheux semble désormais du goût de tous les créateurs de mondes à l'envers. Babeuf s'en empare et qualifie les propriétaires de conspirateurs. A ses yeux l'établissement de la communauté n'a pas le caractère d'une réforme librement consentie ; il prétend le faire pénétrer de vive force dans la société française. La science du pouvoir consiste, d'après lui, à supprimer ce qui fait obstacle, et !e meilleur gouvernement est celui qui s'arrange de manière à n'avoir point de contradicteurs. Rien de plus héroïque d'ailleurs que son système : tous les traits épars dans Platon, dans Morus, dans Campanella et dans Morelly, il les réunit en un faisceau et en compose un amalgame étrange de despotisme et d'anarchie. Les grands centres de population l'embarrassent; d'un trait de plume, il les supprime : point ou peu de villes, beaucoup de bourgs et encore plus de villages. Le luxe prend naissance dans les villes et du luxe il n'en faut pas. Aussi les palais, les hôtels disparaissent-ils : à peine tolérera-t-on la magnificence dans les monuments publics. En revanche, les maisons seront construites sur un modèle uniforme et surtout installées de manière à n'exciter, par la comparaison des logements, aucune jalousie. Ce sera le souci et l'honneur des architectes que de trouver un terme moyen entre le premier et les mansardes. Quant aux vêtements, l'égalité et la simplicité en règlent la forme et la matrice ; la loi accorde tout à la salubrité, elle ne transige pas avec la vanité. Même soins pour l'éducation des citoyens; l'État s'en empare dès le berceau et ne les abandonne qu'à la mort. On en fait des cultivateurs et des ouvriers; on les élève plutôt en vue de services utiles que de services d'agrément. « Ce qui n'est pas communicable à tous, dit Babeuf, doit être sévèrement retranché. » Et en vertu de cet axiome, il n'envisage les lettres et les arts qu'avec une défiance voisine de l'hostilité.
Ainsi de Platon à Babeuf la filiation s'établit avec une entière évidence. C'est toujours la même fiction, obstinément reproduite et enrichie seulement de nouveaux détails. Chez les uns elle est plus naïve; plus raffinée chez les autres; ici elle n'a de sanction que dans le charme dont elle est environnée, là elle en cherche une plus positive dans l'emploi de la contrainte et de la force. C'est la même famille de rêveurs, tantôt sombres, tantôt riants: à peine les moyens diffèrent-ils ; le fond est identique. Près d'eux en outre et dans un cadre plus discret, ces idées trouvent des apologistes officieux ;c'est Mably, c'est J.-J. Rousseau, c'est Fénelon lui-même, qui répand sur ce sujet les tendresses de son imagination. Mercier et Rétif de La Bretonne s'y engagent aussi avec des formes plus rudes ; bien d'autres encore y trempent par la hardiesse de certaines thèses, semées dans leurs écrits, Hobbes, Bayle, Galiani, Gavoty, Helvétius, divers de mérite et de gloire, n'ayant que ce point de commun d'entrer, à leur insu ou de propos délibéré, dans le pays des rêves, ou bien de rompre des lances contre l'ordre établi au profil d'un ordre inconnu et chimérique.
D'ailleurs les choses ne se bornent pas à des protestations individuelles; il y a aussi des protestations collectives. Dans tout le cours des âges, il s'est rencontré des sectes et des associations qui ont essayé de former un État dans l'État, un monde dans notre monde. En premier lieu se présente l'organisation conventuelle et tout ce qui a eu son point de départ dans un mobile religieux. [631] Cependant il faut sur-le-champ faire une réserve. Sans doute le principe de la communauté prévalait dans ces institutions; mais il est essentiel de tenir compte des dispositions qu'y apportaient les membres dont elles étaient composées. Celait de la résignation, du renoncement, du détachement. Le calcul n'y entrait pour rien, ou s'il y jouait un rôle, il se portait au delà de cette vie et spéculait pour l'éternité. Ces âmes, cloîtrées dans une enceinte, vouées à la prière et au recueillement, en arrivaient, par l'effet de l'habitude ou de la vocation, à ne regarder ce monde que comme un lieu de passade, indigne d'attention et de regrets. C'était un avantage inappréciable. Avec de bons éléments, il n'est point de régime entièrement mauvais : ici les éléments valaient mieux que le régime et lui communiquaient quelque vertu. Tandis que la grande société humaine plaçait le bonheur dans la jouissance et dans la liberté, ces sociétés mystiques le faisaient consister dans la privation et dans l'obéissance. Une règle inflexible réprimait les écarts et contenait les révoltes du souvenir. Là où les vœux étaient éternels, l'engagement indissoluble, il fallait se plaire dans cette condition ou dévorer ses douleurs; là où le lien n'était que volontaire, la communauté rejetait dans le tourbillon du monde ceux que la vocation n'enchaînait pas suffisamment. Des deux côtés, il y avait pour l'institution une garantie suffisante, soit dans la compression , soit dans l'expulsion des individualités rebelles. L'ascendant des chefs, leur science, leur sagesse, leur fermeté faisaient le reste.
Mais là où ces révoltes de l'esprit humain conservent leur vrai caractère, c'est dans les hérésies, affranchies d'un joug supérieur et respecté, ou dans les sectes qui n'apportaient, au sein de la communauté, ni l'abdication de leurs intérêts, ni le sacrifice de leurs passions. Chez quelques-unes de ces sectes, le lien mystique subsiste encore dans une certaine mesure, comme chez les Esséniens, les Moraves et les Indiens des missions du Paraguay. Les Esséniens n'avaient rien qui leur appartint en propre, ni maisons, ni terres, ni denrées; ils vivaient sous un toit assigné, et leurs repas, pris en commun, ressemblaient à ces agapes célèbres dans les premiers âges de la chrétienté. Leur continence, leur désintéressement, leurs mœurs pures et leurs habitudes hospitalières, revivent dans Philon et dans Josèphe qui en parlent avec une sorte d'admiration. Chez les Moraves, plusieurs de ces circonstances se retrouvent; seulement ceux-ci admettent le mariage et le mélange des sexes, tandis que les Esséniens gardaient le plus strict célibat. La communauté des Moraves n'est d'ailleurs ni aussi rigoureuse, ni aussi exclusive que celle de la secte juive; on y maintient une propriété privée à côté du travail collectif. Dans les missions du Paraguay, la communauté ne se montre également qu'avec un caractère mixte pour ainsi dire. Chaque Indien y avait son champ, son troupeau ; mais, en dehors de ce lot personnel, il existait un vaste domaine que l'on nommait la possession de Dieu et à la culture duquel toute la colonie concourait. Les produits en étaient affectés à l'entretien des infirmes, à la guérison des malades, aux frais du culte et au payement du tribut envoyé chaque année au roi d’Espagne.
Si le régime de la communauté a eu , comme nous venons de le voir, des hommes d'action et des hommes d'imagination, il en est aussi qui ont poussé les choses plus loin et sont allés jusqu'à l'extase ou à la violence. Comme extase, il suffit de citer les millénaires, schisme qui éclata près du berceau même du christianisme et au sein de la seconde génération d'apôtres. Les millénaires croyaient à une seconde apparition de Jésus-Christ et à son empire temporel ; ce fut la doctrine de Papias, disciple de saint Jean, évêque d'Héralde, et après lui d'autres enthousiastes proclamèrent le règne des mille ans, dont les merveilles devaient effacer celles de l'âge d'or. Plus de séparation factice, plus de distinctions arbitraires; la fraternité évangélique gouverne le monde ; l'humanité ne forme plus qu'une famille. Le luxe des cours, l'insolence des grands, l'orgueil des riches font place au sentiment profond de l'égalité : on ne reconnaît plus qu'un titre , la vertu ; on n'a qu'un souci, le bonheur commun. Les efforts des générations s'unissent pour dompter la nature et la mettre au service de l'homme. Ce régime est inséparable d'une paix universelle; aussi les armées se dissolvent-elles, faute d'emploi ! On ne tue plus, on ne punit plus ; le crime ayant cessé, la loi n'a pas besoin de glaive. Tel est l'apocalypse de Towers, et Winchester ajoute qu'au moment où le millenium commencera, tout œil humain pourra distinguer, pendant vingt-quatre heures, le corps de Jésus-Christ suspendu sur l'équateur et visible d'un pôle à l'autre. Bellamy et Worthington, songeant aux intérêts positifs, font de cette métamorphose le point de départ d'un grand développement industriel, Sherlock celui d'une nouvelle fécondité agricole.
Jusqu'ici pourtant et, dans cette limite, les choses restent dans le domaine de la conscience et n'engendrent pas des faits dignes de répression. Mais tous les aïeux des socialistes actuels ne s'en sont pas tenus à cette attitude inoffensive. Il en est qui ont outragé publiquement les mœurs, comme les Carpocratiens chez qui la prosmiscuité et la communauté étaient également en honneur. Il en est d'autres qui ont placé leur pays sous le coup d'un bouleversement total, comme les lollards en Angleterre et les Jacques en France, en déguisant, quoi qu'on ait pu dire, sous la forme de droits politiques, des poursuites évidentes de partage et de spoliation. Il en est enfin qui sont allés plus loin encore et ont hautement avoué de pareils projets. Tels sont les anabaptistes qui ont rempli de leurs crimes et de leur nom deux siècles entiers de l'histoire de l'Allemagne. Ce furent d'abord Stork et Munzer, disciples de Luther, désavoués par lui. Stork fut l'homme de la doctrine, Munzer l'homme d'action; l'un la tète, l'autre le bras de cette levée de bouchers ; ils devinrent les chefs des premiers anabaptistes. Sous le couvert d'un schisme religieux, Munzer conduisit la populace à l'assaut des propriétés. Le sénat de Mulhausen se prêtait mal à ses plans de spoliation; Munzer le contraignit à se dissoudre. Ses moyens d'influence sur la multitude étaient infaillibles; il conviait les pauvres [632] au partage de la dépouille des riches et traînait à sa suite des bandes avides et indisciplinées. Quand le landgrave de Hesse, prenant la défense de la civilisation, attaqua et tailla en pièces les anabaptistes, ils étaient près de quarante mille; sept mille d'entre eux restèrent sur le champ de bataille, et l'imposteur fait prisonnier paya de sa tête une longue suite d'attentats. Sa mort pourtant ne termina rien et pendant longtemps encore les anabaptistes promenèrent en Allemagne le désordre et l'extermination. Vaincus et dispersés, ils se reformèrent opiniâtrement et firent de la cité de Munster le siège de leur odieux empire. La partie aisée des habitants avait abandonné cette enceinte maudite; les anabaptistes y régnèrent sans obstacle. Au boulanger Mathison ou Mathias qui ordonna le sac des maisons bourgeoises, on vit succéder le tailleur Bocold dit Jean de Leyde, qui proclama la polygamie comme loi de l'État et s'y conforma le premier en épousant dix-sept femmes. Le supplice de pareils bandits ne suffît pas pour extirper leur secte, et longtemps l'Allemagne se ressentit de l'ébranlement causé par leur passage. On put voir, aux ruines dont ils jonchèrent le sol, ce qu'engendre, dans une interprétation populaire, l'utopie de la communauté et quels vertiges elle laisse.
Ainsi toutes les formes du socialisme et du communisme ont été essayées dans le cours des temps. Quittée ou reprise à diverses fois, l'utopie parait et disparaît comme une épidémie, en léguant à l'avenir les germes qu'elle a empruntés au passé. Tout est désormais parcouru dans la sphère de ces idées et de ces faits ; le programme des spéculations imaginaires, des combinaisons pratiques, se trouve épuisé. Plus d'originalité sur ce terrain; les anciens ont tout dit; ils ont eu leur thème pacifique, leur thème violent, et l'impuissance et la monstruosité de ce principe sont manifestes dans cette suite d'efforts avortés. Et encore faut-il convenir qu'à l'aide d'un examen moins sommaire, il serait aisé de trouver dans le monde ancien, juif, grec et romain, dans les traditions de l'Egypte et de l'Inde, bien d'autres exemples tout aussi concluants, bien d'autres expériences non moins décisives. Mais ce coup d'oeil suffit ; il prouve surabondamment que l'originalité des sectes modernes se compose d'emprunts et que les chimères passées jettent toutes un reflet sur leur chimère.
Nous arrivons ainsi au dix-huitième siècle, et avant de dire quel est son lot, il n'est pas inutile de rechercher par quels motifs ce lot a été si considérable. Et d'abord, il faut savoir l'avouer, l'esprit public a été, plus qu'on ne le croit, le complice des idées et des folies socialistes. L'effet de ces doctrines n'a pas été renfermé seulement dans un petit cercle d'initiés qu'animait un enthousiasme irréfléchi ou que tourmentait une vanité voisine de la démence. La partie saine de la société ne s'est pas dérobée à ce contact; elle a subi, à son insu, cette influence délétère. On dirait qu'elle cède tout en se défendant et qu'elle ne résiste pas à ce qu'elle raille. Pour s'en convaincre, il suffît de voir quels thèmes de discussion l'utopie a introduits parmi nous, à quel langage elle a donné crédit et avec quel entrainement nous la suivons sur un terrain qui n’est pas le nôtre. Divers symptômes attestent cette influence , et c'est le moment de s'y arrêter. Nous irons ainsi des causes à l'effet, du principe à la conséquence.
Il est surtout un symptôme qu'il faut bien signaler quand on s'occupe d'Économie politique, c'est la tendance de l'opinion contemporaine à faire bon marché de la liberté sur tous les points et en toute chose; c'est une sorte d'entraînement irréfléchi vers une dictature économique et manufacturière. En vain les hommes sensés ont-ils essayé de lutter, le courant a été plus fort qu'eux ; les intérêts ont la voix si haute de nos jours, qu'ils dominent les conseils de la prudence. On s'est efforcé de nous rendre la liberté suspecte et de nous la présenter comme une source de misères et d'abus. De là ces rêves qui tendent à substituer un régime artificiel au cours naturel des choses ; de là les mots de droit au travail, d'organisation du travail, et les recettes empiriques à l'aide desquelles on espère guérir l'humanité de tous ses maux; de là ces sectes qui ont chacune un programme de parfait bonheur à l'usage des sociétés ; de là enfin toutes ces témérités récentes et ces malentendus qui détournent les esprits des véritables notions économiques, pour les rejeter vers des spéculations où l'absurde le dispute à l'odieux.
En vain protesterait-on, au nom d'Intelligences qui se croient parfaitement saines, contre ce reproche de complicité avec les divagations du socialisme. Cette complicité est formelle et elle a deux caractères, le sentiment et l'intérêt.
La complicité de sentiment découle de ces tableaux trop applaudis où l'on a exagéré, soit involontairement , soit à dessein , la somme des misères sociales ; de ces déclamations incessantes contre la civilisation , telle que les siècles nous l'ont léguée, c'est-à-dire mêlée de mauvais et de bon et n'épargnant pas à l'œil de l'observateur les tristes et douloureux contrastes. A aucune époque, le concert de doléances ne fut plus grand ; à aucune époque on ne fouilla avec plus d'opiniâtreté dans les sentines des grandes villes, foyers d'impureté et de dégradation, pour en faire sortir un acte d'accusation contre une société qui présente et tolère de pareils spectacles. Parler ainsi, forcer ainsi les choses, charger le tableau de couleurs sombres, renchérir sur la réalité des faits, n'était-ce pas préparer les voies et donner raison par avance à ces alchimistes qui affichaient la prétention de passer le monde au creuset de leur système et de l'en faire sortir affranchi de tout alliage impur? Voilà ce qu'a été la complicité du sentiment, voila où elle a dû nécessairement aboutir.
Quant à la complicité de l'intérêt, son influence a été bien plus grande et bien plus active. Il est, dans toute agglomération d'hommes, des parasites qui s'efforcent de vivre sur le commun, qui entendent se faire la meilleure position possible à l'aide des moindres efforts, et dont toute l'activité s'épuise ensuite à mettre cette position à l'abri des mauvaises chances. Ce sont ces parasites qui ont inventé et maintenu cette doctrine commode : que la liberté, abandonnée à [633] elle-même, n'engendre que des abus, et qu'il importe pour le bien de tous que le gouvernement demeure le tuteur vigilant des Intérêts, contienne et préserve ceux-là, imprime à l'industrie une direction savante, intervienne dans les contrats entre les maîtres et les ouvriers, protège le producteur contre la concurrence et le consommateur contre la fraude, se fasse l'arbitre des produits, le juge des qualités, le régulateur des prix de revient, agisse enfin comme un maître absolu de qui dépend l'activité nationale et qui, à son gré et sous son bon plaisir, peut accroître ou mutiler les fortunes des citoyens et frapper des impôts sur les uns afin d'en enrichir les autres. Or n'est-il pas évident qu'une pareille règle de conduite n'est autre chose que l'utopie socialiste, prise au berceau et dans ses premiers rudiments? N'est-il pas évident qu'une fois cette donnée admise, il en découle le plus naturellement du monde que l'État doit se mettre en quête de recettes de parfait bonheur, les trouver, les appliquer, les imposer au besoin , exercer enfin une sorte de justice distributive qui n'est autre chose que le commencement du communisme? Voilà quelle a été la complicité de l'intérêt dans les vertiges socialistes, et cette part de complicité, dénoncée par Bastiat avec tant d'esprit et de sens, est bien plus grande qu'on ne le présume.
Une autre cause encore, d'un ordre plus élevé, c'est rl’affaiblissement des mobiles moraux. Dans le cours du dernier siècle et les débuts de celui-ci, il s'est produit des systèmes qui ont eu pour objet le sort de l'homme sur cette terre, la satisfaction de ses désirs et l'amélioration de sa condition. Ces systèmes reposaient sur un sensualisme étroit : les besoins du corps y occupaient une telle place que l’âme en était presque exclue. C'était la réhabilitation de l'instinct, et il n'y a pas à s'étonner qu'en poussant cette doctrine à l'extrême, on en soit arrivé à faire bon marché de la liberté, de la volonté de l'individu, qu'on ait contesté son mérite dans le bien, sa responsabilité dans le mal. Dans les choses sensibles , l'être se trouve en effet assujetti à une impulsion qu'il ne peut pas toujours vaincre ni dominer; il obéit au ressort qui le fait mouvoir. Une détermination libre ne se concilie qu'avec un but hors de la vie et une force pour l'atteindre. Sans ce mobile, il n'y a plus que servitude aux exigences des sens, et, dans ce cas, il importe avant tout de régler le gouvernement de la matière. C'est ce qu'ont fait les apôtres du socialisme, et ils ne sont en cela que les élèves et les continuateurs des philosophes de la fatalité.
Plus qu'on ne croit aussi, ils sont les héritiers de ces esprits raisonneurs qui ont les premiers proclamé un nouveau culte, le culte de l'utile. A les entendre, le monde moral devrait, comme le monde de la matière, obéir au même mobile, le calcul. Que, dans la pensée de ses auteurs, cette doctrine ne contînt pas des résultats si tristes, c'est ce qui est hors de doute pour qui les a lus avec impartialité ; mais, quand on proclame un principe, il faut tout prévoir, même les déviations que ce principe peut subir ; même les interprétations abusives auxquelles il donnera lieu, La
morale de l'intérêt a imprimé à l'Individu cette fatale habitude de se considérer comme le point de départ et le but de toute chose. Elle l'a invité à juger ses propres actes au point de vue qu'il en doit retirer, direct ou indirect, médiat ou immédiat. Quoi d'étonnant que, dans une semblable direction, il ait été conduit à méconnaître ses devoirs sociaux dans l'interprétation libre de son intérêt particulier ! Il en sera ainsi de tout principe où l'égoïsme trouvera un prétexte ou un aliment. Il en sera ainsi tant qu'on n'en reviendra pas aux mobiles qui ont élevé l'homme et préservé la société, c'est-à-dire au dévouement, au détachement et à cet oubli de soi-même, qui est le signe le plus noble que Dieu ait imprimé sur le front humain.
Telles sont les diverses causes qui ont précédé et préparé ce déchaînement d'utopies auquel nous avons naguère assisté, et qui a rempli la première moitié du dix-huitième siècle. De ces sectaires contemporains, le premier pour la date, pour le bruit du nom et la persévérance dans ses efforts, est l'Anglais Robert Owen. Il y a deux hommes dans M. Owen : l'homme du fait, l'homme de l'idée; l'un supérieur, l'autre médiocre. Manufacturier à New-Lanark, il eut le bonheur d'y fonder, à l'aide d'une bienveillance sans bornes , et par le seul fait de la puissance de l'exemple, la colonie industrielle la plus heureuse et la mieux gouvernée qu'on eût jamais connue. Deux mille ouvriers y éprouvèrent les bienfaits d'un régime paternel, conçu dans leur intérêt et maintenu à l'aide d'une bonté inaltérable. La base de ce régime , son élément principal, était cette pensée, que la pratique de la vertu a en elle-même de quoi indemniser ceux qui s'y livrent, et que rien ne vaut les joies dont elle est accompagnée. Jusque-là , c'était bien, et aucun genre de succès ne manqua à l'expérience de New-Lanark : admiration des voyageurs, visites de souverains, témoignages publics dans la presse et au sein du parlement. Mais, dans l'ivresse du triomphe, M. Owen s'exagéra la portée de ce petit essai, et fut entraîné à en conclure qu'il pouvait appliquer à l'humanité un système qui lui avait réussi dans une manufacture. De là deux nouvelles tentatives, l'une à Orbiston, en Angleterre, l'autre à New-Harmony, aux États-Unis, qui furent toutes deux suivies d'un échec complet. C'est qu'il ne s'agissait plus d'une gestion industrielle, mais d'un nouveau plan de vie sociale. C'était le principe de la communauté appliqué dans toute son étendue, et avec l'athéisme pour complément. M.Owen supprimait d'un trait de plume toute l'existence future, et se contentait de pourvoir à l'existence terrestre, la seule, disait-il, qui fût accessible à nos moyens de connaître. Il ajoutait que l'homme, ne contribuant en aucune manière à sa venue en ce monde et aux circonstances qui forment son caractère, ne saurait justement être responsable de ses actes. Dans ce qui se fait ici-bas , il ne saurait y avoir ni mérite ni démérite : la fatalité seule détermine le bien et le mal ; l'individu n'est qu'un être passif. Dès lors pourquoi punir? pourquoi récompenser ? Il faut laisser l'homme, laisser les sociétés aller vers leur pente , en écartant toutes les circonstances qui peuvent amener le mal, en [634] multipliant toutes celles qui doivent amener le bien. C'est ainsi, et non par voie de compression ou d'excitation, que l'on parviendra à réaliser le progrès véritable. Voilà en quelques mots la donnée de M. Owen. Elle se réfute d'elle-même. Jamais doctrine n'aboutit d'une manière plus directe au vide et au néant ; jamais aucune ne se fonda plus visiblement sur des ruines.
Saint Simon y met plus de ménagements et moins de brutalité. Fils de grands seigneurs, grand seigneur lui-même, il se proposait de soumettre le monde à une sorte de théocratie. La division du pouvoir entre le temporel et le spirituel lui semblait être l'origine de la plus grande partie de nos désordres. Partagée entre les deux principes, religieux et civil, l'humanité s'épuisait dans ce combat, l'une de ses forces faisant équilibre à l'autre. D'après Saint-Simon, un pareil conflit devait cesser ; il fallait confondre dans les mêmes mains le temporel et le spirituel ; ne pas donner l'Aine à diriger aux uns, le corps aux autres. Ce partage des pouvoirs avait, d'après lui, amené ce résultat fâcheux, de vouer la chair à un perpétuel sacrifice. Or cette lutte était impie ; elle ne pouvait plus durer ; une fusion d'influence et d'autorité devait la terminer. Au lieu d'un pape et d'un empereur, il fallait proclamer un PÈRE , qui réunirait les deux titres et les deux pouvoir ; et, partageant ensuite la société en trois classes, les savants, les artistes, les industriels, en donner la direction aux plus grands savants, aux plus grands artistes, aux plus grands industriels. Ces détenteurs de l'autorité n'auraient pas besoins d'investiture ; ils devaient sentir eux-mêmes leur force et s'assigner leur propre rang. La famille humaine les reconnaîtrait à leurs œuvres. D'ailleurs le lien nouveau des sociétés devait être , sous ce régime, non la crainte, mais l'affection ; et les plus aimants, se plaçant au-dessus des autres, donneraient nécessairement le ton aux hommes de la hiérarchie inférieure. La chaîne des positions étant ainsi formée, tout en devait découler de la manière la plus naturelle ; chacun prenait son rang suivant sa capacité, et la capacité était servie en raison de ses œuvres. L'humanité ne formait plus dès lors qu'une famille, la terre un seul champ, cultivé en commun et à l'envi, mais dont les fruits se répartissaient entre les divers coopérateurs d'après une loi de justice distributive où tout était laissé à la discrétion des plus aimants et des plus capables. Ainsi parlait la loi saint-simonienne, dont quelques esprits abusés voulurent faire une révélation. L'expérience prouva ce qu'il y avait là-dedans de ridicule et de faux. Par une interprétation irrésistible du principe même qu'elle proclamait, cette secte fut conduite à la plus étrange et la moins édifiante morale, si bien que les tribunaux crurent devoir intervenir. Les saint-simoniens ne survécurent pas à ce scandale ; ils se dispersèrent au bruit des sillfets. A tout prendre, une papauté politique investie de pouvoirs diserétionnaires , disposant souverainement du sort, du rang des individus dans la société, prêchant le règne des sens sous le couvert menteur de l'égalité des sexes, n'était pas une doctrine qui lût à la hauteur du bruit qu’on en a fait, et qui put résister longtemps à l'arrêt de la conscience publique.
Celle de Charles Fourier n'a cédé que beaucoup plus tard et après une défense infiniment plus longue. Les formes scientifiques dont elle s'enveloppait ne laissaient pas le champ libre à la discussion , et entraînaient vers elle les esprits auxquels les abstractions sont familières. D'ailleurs, si Fourier allait, en fait de témérités, aussi loin, plus loin peut-être que les autres utopistes, il s'était formé autour de lui une école qui s'appliquait à écarter ce que ces idées avaient de trop exclusif et de trop extravagant. Avec une prudence judicieuse, cette école refusait le combat sur des folies impossibles à défendre, et s'en prenait, en manière de diversion, aux points sur lesquels notre état social se montre le plus vulnérable. Ainsi s'expliquent sa durée et les ravages qu'elle a faits. Au fond, la donnée de Fourier diffère peu de celle d'Owen et de Saint-Simon : c'est toujours la même prétention de substituer un monde de fantaisie au monde réel, et au cours des choses un ordre artificiel. Fourier part surtout de cette idée que les passions ne sont, depuis l'origine du monde, la cause de tant de maux que parce qu'elles ont été plutôt comprimées que réglées. Dieu, suivant lui, ne peut rien avoir fait d'essentiellement mauvais, d'essentiellement inutile. Si les passions, dans leur jeu actuel, sont la source de beaucoup de désordres, ce n'est pas aux passions mêmes qu'il faut s'en prendre, mais au milieu dans lequel elles se meuvent, milieu humain, et par conséquent susceptible de modifications. De là cette conclusion, que les attractions sont proportionnelles aux destinées, et la nécessité de donner aux passions une direction plus harmonieuse. Toutes doivent être utiles, aucune ne doit nuire. Il ne s'agit pour cela que de les associer, et c'est cette association qui est le travail capital de Charles Fourier. Elle se fait par groupes, qui contribuent à former des séries, puis des phalanges. Le groupe est l'alvéole de la ruche sociale ; il se compose de sept ou neuf personnes; il a un centre et des ailes; son harmonie résulte autant de son identité que de ses contrastes. Les séries comprennent de vingt-quatre à trente-deux groupes. La phalange est la commune de Fourier; la population s'y élève à dix-huit cents personnes environ ; elle habite un vaste palais que l'on nomme un phalanstère. Les distributions de cet édifice sont combinées de manière à assurer à ses habitants le plus de jouissances possible, en évitant toutes les pertes qui résultent de la division des ménages actuels. La propriété elle-même n'aura pas, dans une phalange, le caractère personnel qu'elle a dans nos sociétés : elle sera collective. La valeur d'une phalange et de son territoire sera représentée par des actions, et les porteurs de ces actions auront droit aux bénéfices dans la mesure de leur capital. Quant aux fruits , ils doivent se répartir entre les trois agents directs de la production ; le capital, le talent et le travail. Et ce travail n'aura aucun des inconvénients qui s'attachent au nôtre ; il sera aussi attrayant qu'il est répugnant aujourd'hui. Fourier veut que la passion, le goût s'en mêlent, et il a imaginé à cet effet une foule de combinaisons ingénieuses : les courtes séances, les rivalités d'atelier, l'engrènement [635] des passions d'après une loi de série fort difficile à comprendre et à expliquer. La réforme, d'ailleurs, ne s'arrête pas aux intérêts seuls; elle prévoit et ordonne tout. Ainsi les lois cosmogoniques, la transmigration des âmes et leur état futur, les phénomènes astronomiques de l'avenir, l'occupent successivement et amènent les révélations les plus singulières. Fourier y ajoute un gouvernement universel et un monde complet, garni d'une société complète. L'imagination ne saurait aller au delà de cet effort.
Après lui, arrive la foule des plagiaires de seconde main. C'est le rang de M. Cabet, qui, à l'instar de Morus et de Canipanella, nous a donné un nouvel échantillon d'une communauté imaginaire. M. Cabet a une singulière prétention : c'est de changer en communistes tous les écrivains d'un ordre supérieur. Pour cela, il glane et choisit dans leurs livres les passages qui, de près ou de loin, se rattachent à sa chimère, et, après avoir marqué les auteurs de cette étiquette, il les enrôle, bon gré, mal gré, dans son bataillon. Quant à sa fiction, elle n'est guère que la reproduction des fables connues, et ce qu'il y ajoute de son chef n'en rehausse ni le mérite ni le prix. Cependant M. Cabet a fait école, et de tous les chefs de secte, il est le seul qui se soit personnellement dévoué à l'application de ses doctrines, il a fondé aux États-Unis et y dirige encore une colonie où le principe de la communauté est en vigueur, tel qu'on le trouve et qu'il l'a développé dans ses livres. Dans aucun pays du monde un essai de ce genre ne pouvait se faire avec plus de chances de succès. L'espace et le sol ne manquent pas en Amérique, même aux auteurs de projets aventureux; les lois du pays s'y prêtent, et, pour peu qu'on s'enfonce dans les solitudes de l'ouest, on y est à l'abri de tout voisinage incommode. C'est ainsi que la colonie communiste de M. Cabet a pu s'établir et affronter les misères inévitables d'une installation ; c'est ainsi que la secte des mormons, à l'aide d'un ressort religieux, a couvert de bourgs florissants un des États nouvellement créés et où les terres appartenaient au premier occupant. Dans de telles conditions, la communauté peut devenir possible, à ses débuts surtout; mais il arrivera à ces établissements ce qui est arrivé à New-Harmony, fondée par M. Owen dans le district d'Indiana. Même parmi ces colons dont le capital ne consiste que dans leurs bras, il se révélera bientôt des inégalités d'aptitude, de forces, de bonne volonté, d'ardeur, d'émulation, qui feront d'un système de répartition égale une injustice permanente, et la réaction qui en sera la suite attaquera dans ses sources mêmes le mouvement de la production. Rassurés sur les premiers besoins de la vie, les ouvriers se reposeront les uns sur les autres du soin d'accomplir le travail, et un déficit dans les produits sera le premier symptôme de cette décadence. Tant il est vrai que le principe de la communauté est un Inévitable dissolvant, soit qu'il procède du stoïcisme et de la privation, soit qu'il invoque des satisfactions impossibles.
M. Louis Blanc arrive ici à son tour naturel dans cette revue des socialistes du second ordre. En dépouillant ses idées du vêtement pompeux dont il les couvre, il est aisé de voir tout ce qu'elles ont de grêle et d'emprunté. C'est du Babeuf et du Morelly relevé en couleur, et tout ce que l'auteur y a mis du sien est d'une puérilité que déguise mal l'emphase de la forme. A tout prendre, M. Louis Blanc n'a qu'un ennemi, ne volt qu'un ennemi : la concurrence. C'est l'infâme qu'il faut écraser. Sans la concurrence, il n'y aurait sur terre ni douleurs, ni souffrances, ni paupérisme, ni faillites. La concurrence est la cause de tous nos maux, et rien n'est pire, si ce n'est l'individualisme. Or quel est l'antipode de l'individualisme? Le communisme, rien de plus, rien de moins. M. Louis Blanc a l'air de rougir du mot, tant il évite de le prononcer; mais qu'il en rougisse ou non, c'est la seule sanction de son système. Toutes ses déclamations y tendent, toutes ses critiques y aboutissent. Il n'est pas jusqu'à l'organisation qu'il propose, avec une confiance voisine de la naïveté, qui ne soit du communisme et du communisme le plus formel. Qu'est-ce en effet que cet atelier social dont il veut doter l'industrie, si ce n'est une expérience poursuivie par le trésor public, aux frais et aux risques de la communauté ? Sur une échelle réduite, cette expérience ne serait qu'un non-sens et un sacrifice sans motif; sur une échelle considérable, elle conduirait à l'absorption de l'activité privée au profit d'une activité officielle. De quelque manière qu'on l'entende, c'est toujours du communisme; communisme sournois, en cas d'échec; communisme despotique, s'il était couronné de succès. Le régime de ces ateliers sociaux, tel que le conçoit M. Louis Blanc, est d'ailleurs marqué à ce signe et reproduit, à peu de variantes près, ce qu'on a lu dans Morus, dans Campanella, dans Morelly et dans Babeuf. Les ateliers sont associés entre eux de manière à ce que les bénéfices des uns servent à couvrir, s'il y a lieu, les pertes des autres. Dans chaque atelier, les chefs seront nommés à l'élection, et la rémunération du travail se fera sur le pied de l'égalité des salaires ; ainsi du reste. A ces seuls traits, un système est jugé ; il appartient aux réglons chimériques, et dérive de cette maladie du cerveau que l'on nomme l'utopie.
Après ce champion du socialisme, vient M. Proudhon. Mais faut-il ranger M. Proudhon parmi les socialistes? C'est l'opinion commune, et pourtant on éprouve quelque peine à y déférer. Si les socialistes ont été mis à nu et flagellés de main de maitre, si la pauvreté de leurs doctrines, le vide de leurs plans, l'évidence de leurs contradictions a été quelque part bien démontrée, c'est à coup sur dans les ouvrages de M. Proudhon. Personne n'a employé, pour les combattre, des armes plus redoutables et plus meurtrières: l'ironie, le sarcasme, la diatribe, même les gros mots, sans compter les syllogismes. Et pourtant on persiste à comprendre M. Proudhon parmi les socialistes. A la bonne heure I mais c'est alors un socialiste étrange que celui dont la tâche principale et la mieux remplie consiste à ne rien laisser debout ni de leurs systèmes, ni de leurs arguments, et a s’échauffer contre eux jusqu'à l'invective. Il est vrai que M. Proudhon se [636] montre pris de rage contre la propriété et l'a brutalement assimilée au vol; il est vrai qu'après cette prouesse, il s'est rengorgé en homme satisfait de sa découverte et très disposé à offrir une hécatombe aux divinités qui la lui avaient inspirée. Mais M. Proudhon, qui n'est commode pour personne, pas plus pour ses adversaires que pour ses amis, n'a été ni moins brutal, ni moins terrible envers la communauté, à laquelle il n'a épargné ni les qualifications blessantes, ni les adjectifs injurieux. Ainsi procède ce curieux jouteur : dans la mêlée des systèmes, il frappe sur tous indistinctement, afin qu'aucun d'eux ne profite des coups qu'il a portés aux autres. La même méthode le guide sur le terrain des idées économiques et philosophiques, et, remarquons-le en passant, c'est là une méthode d'emprunt, prise dans l'arsenal de la métaphysique allemande, la méthode de Kant et de Hegel, celle des antinomies. Elle consiste, à ce qu'il semble, à voir dans les choses d'abord un côté positif, puis un côté négatif, à prouver que l'antithèse est fausse aussi bien que la thèse, et que la vérité ne se trouve ni dans l'une ni dans l'autre notion, mais bien dans une troisième notion, la synthèse, qui les résume et les concilie. Voilà, dans un langage aussi intelligible que possible, quelles sont les formes générales du raisonnement de M. Proudhon; voilà dans quel jeu de dialectique se plaît et s'enveloppe cet esprit âpre et subtil, dont la rusticité s'élève souvent jusqu'à l'éloquence. C'est le pamphlet porté à sa plus haute expression. Mais il n'y faut rien voir au delà. En effet lorsqu'après avoir mis en pièces tous les systèmes qu'il trouve sur son chemin et multiplié les ruines autour de lui, M. Proudhon en est conduit, de guerre lasse et faute d'ennemis, à offrir une combinaison qui lui soit propre et comble les vides creusés par cette universelle démolition, alors son embarras commence: si fort vis-à-vis des autres, il se sent faible vis-à-vis de lui-même, il balbutie et se dérobe par une combinaison bien moins plausible et bien moins consistante que celles qu'il vient d'anéantir. C'est ainsi qu'entre la propriété et la communauté, l'une et l'autre frappées de ses anathèmes, il voit une place naturelle et légitime pour la possession. Il n'y aura plus de propriétaires; il y aura des possesseurs. Possesseurs? Mais comment? à quel titre? par quelle forme? dans quelle limite? pour quel temps de jouissance? sous quelles garanties et avec quels droits? Là-dessus M. Proudhon ne s'explique pas et il aurait quelque peine à le faire. Il sent qu'une possession précaire n'est autre chose que la communauté, et une possession bien assise autre chose que la propriété ; que tout ce qui est en deçà ou delà ne représente qu'un abus de mots et un sophisme. C'est ainsi encore qu'après avoir disserté à perte de vue sur la détermination de la valeur, il en arrive à imaginer un tarif général et uniforme, soit pour les travaux, soit pour les produits, en mesurant le prix de ces derniers sur le nombre d'heures employées à les créer. Puis, comme conséquence, il propose de remplacer les monnaies d'or et d'argent par des bons payables en nature, de manière à en revenir au troc et à l'échange, procédés rudimentaires de civilisation. Idée bien petite après de tels éclats de voix, et qui, souvent essayée et toujours abandonnée, n'avait pas besoin, pour fournir la mesure exacte de ce qu'elle vaut, d'un dernier et triste avortement sous la forme d'une banque du peuple.
Que dire de M. Pierre Leroux? Est-ce là encore ce que l'on nomme un socialiste, et ne vaudrait-il pas mieux lui restituer ses véritables noms de mystagogue et de thaumaturge? M. Pierre Leroux croit à la métempsycose, il croit à la cabale, à la puissance des nombres, à l'efficacité des formules géométriques, au cône, au cylindre et à la sphère; il veut couvrir la France de peupliers, symboles d'un gouvernement sans défaut. Si c'est In du socialisme, il faut convenir qu'il est d'une nature plus joviale que celui dont il a été question jusqu'ici. Cependant M. Pierre Leroux n'a pas toujours ces allures légères; il sacrifie aussi aux divinités de l'abstraction. Alors il devient moins amusant et plus difficile à comprendre ; ce qu'il perd en gaité, il le gagne en obscurité. C'est ce qui lui arrive quand il expose son système. Rien de plus mystérieux , comme on va voir. M. Pierre Leroux admet la famille, la patrie, la propriété ; seulement il se propose de les bouleverser de fond en comble. Il trouve que la patrie a cet inconvénient de reconnaître des chefs et de simples citoyens; la famille, des pères et des enfants; la propriété, des pauvres et des riches: trois vices radicaux d'où découle un triple despotisme. La patrie a le sien, la famille le sien, la propriété également. M. Pierre Leroux veut changer tout cela. Il imagine une combinaison où la famille, la patrie et la propriété seront telles que l'homme pourra se développer dans leur sein sans en être opprimé; il suffira pour cela que la famille ne crée pas l'héritier, la patrie le sujet et la propriété le propriétaire. Voilà en quoi consiste la métamorphose. Plus de castes ni dans la propriété, ni dans la patrie, ni dans la famille; plus d'héritiers, plus de sujets, plus de propriétaires, et les temps nouveaux auront commencé. Ainsi parle M. Pierre Leroux, et il appuie sa thèse d'autorités innombrables , celles de Brahma , de Bouddha, de Moïse, d'Apollonius de Thyane et de vingt autres personnages de l'antiquité. A côté de cette merveilleuse invention, il en place une autre qui ne l'est pas moins : c'est que l'homme, créé en vue de cette terre, n'est pas destiné à avoir un autre séjour, qu'il y a déjà vécu et qu'il y vivra, qu'il y recommencera dix, vingt, trente existences, sous des noms et en des pays divers, tantôt inerte comme la chrysalide, tantôt brillant comme le papillon, allant chercher l'oubli dans la mort, afin d'y puiser les conditions nécessaires pour une renaissance. Dès lors plus de vie future, mais des vies successives; plus de paradis ni d'enfer, mais simplement la terre en vue de laquelle l'homme a été créé. Tel est le socialisme de M. Pierre Leroux, et n'est-ce point assez pour faire apprécier le situation de son esprit? Est-il nécessaire d'y ajouter des traits nouveaux, par exemple la théorie des vertus du nombre trois, et cet étrange système où le bonheur terrestre se trouve impliqué et renfermé dans une loi de fécondation végétale?
Noui: voici au bout des folies du socialisme; les [637] coryphées les plus importants ont été passés en revue; le reste ne vaut pas l'honneur d'une mention. Il n'y a plus, au-dessous des noms cités, que des hommes pour qui le socialisme a été un instrument ou un piédestal, les esprits qu'égaraient les conseils d'une demi-science ou l'ambition d'un rôle excessif, enfin quelques cœurs sincères auxquels manquaient les leçons de l'expérience et le sentiment des réalités. Le socialisme a eu son jour de vogue; bien des gens sont allés vers lui comme on va vers la nouveauté; puis la foule s'en est mêlée, sans bien comprendre de quoi il s'agissait, mais avec le sentiment confus qu'elle y trouverait son intérêt et qu'à défaut de conviction elle devait y adhérer par calcul. Comment s'en serait-elle défendue? On lui promettait un âge d'or d'où toute souffrance serait bannie, un plus fort salaire en échange d'un moindre travail, des jouissances de toute nature, sans en excepter celles de la vanité, l'aisance, le luxe, les honneurs et jusqu'à l'empire. Aux uns on montrait la spoliation en perspective; aux autres, le relâchement du frein social; à ceux-ci, l'humiliation des classes élevées, à ceux-là, le nivellement des conditions. Tous les mauvais instincts étaient sollicités et conviés à un immense déchainement. Faut-il s'étonner qu'un semblable vertige ait été contagieux et qu'un instant il ait pu prendre un caractère aussi alarmant ?
Cependant le socialisme ne méritait pas un tel honneur. Il ne soutient pas l'examen comme doctrine; comme fait, il n'a pu réussir dans aucune circonstance, ni sur aucun point. Tous les essais qu'on en a faits en Amérique et en Europe ont tristement avorté. Robert Owen a éprouvé, dans sa longue et laborieuse carrière, deux échecs avérés, ceux de New-Harmony et d'Orbiston, sans compter une foule de mécomptes d'un ordre secondaire ; les saint-simoniens ont dû se retirer devant les huées du public, après avoir donné le spectacle d'un grand scandale et d'une triste bouffonnerie ; les disciples de Charles Fourier ont eu à Condé-sur-Vègres et à Citeaux deux expériences des plus malheureuses, et n'ont disparu qu'après avoir mis leur doctrine d'abord en commandite, puis en liquidation ; M. Cabet a promené ses infortunés adhérents de misères en misères, et semé de leurs ossements les solitudes de l'Amérique du Nord; M. Louis Blanc, quoiqu'il s'en défende, a donné dans son atelier social l'idée rudimentaire de l'atelier national, dont nous avons tous pu apprécier les mérites; M. Proudhon a eu sa banque d'échange, célèbre par le dénouement le plus malencontreux; M. Pierre Leroux est le seul qui n'ait pas poussé sa doctrine jusqu'aux honneurs d'une application; mais comment appliquer le cône, la sphère, le cylindre, la triade et les inventions coprologiques de M. Pierre Leroux?
Ainsi tous ces systèmes sont finis, toutes ces chimères ont fait leur temps. Ce qui a été l'anabaptisme au quinzième siècle est devenu le socialisme de nos jours, et, comme l'anabaptisme, le socialisme a été vaincu moins par l'emploi de la force que par le cri de la conscience publique. Plus tard peut-être ce vertige reparaîtra sous une autre forme et avec un autre nom; notre globe est le siège d'une éternelle révolte et d'une éternelle plainte. Mais alors comme aujourd'hui, et à moins que l'heure d'une déchéance définitive n'ait sonné pour l'humanité, l'issue de semblables égarements ne saurait être douteuse. Ce qui fait le fond de ces systèmes, ce qui est leur caractère commun, leur objet invariable, c'est le triomphe des sens sur l'intelligence, c'est une satisfaction plénière accordée aux passions, une vaste et universelle curée, le règne de saturnales sans frein et sans limites. Et qu'on ne se récrie pas, qu'on ne prononce pas le mot de calomnie. Il est vrai qu'il y a toujours eu un masque mis sur de pareils desseins; c'est l'amour du peuple, l'intérêt des classes souffrantes, le sentiment de la perfectibilité humaine, la marche des générations vers un état meilleur et moins rempli d'inégalités choquantes. Mais derrière ce masque se cache et se retrouve une physionomie plus réelle et plus vivante. C'est là qu'est le vrai des choses, qu'il soit ou non dans la pensée des inventeurs de systèmes ; c'est devant ce but que la conscience publique a toujours reculé et qu'elle reculera toujours, il faut l'espérer à son honneur. Rendre la bride aux penchants, les laisser aller où la nature les emporte, voilà en deux mots le programme sérieux et irrésistible de toutes ces belles inventions. L'homme a été créé pour obéir à ses instincts, non pour les combattre; quand il se maîtrise , quand il se dompte au prix de grands efforts, il ne remporte qu'une victoire stérile et presque sacrilège ; le véritable mérite serait de céder aux appels des sens, de jouir de tout sans mesure et sans réserve : voilà le code que l'on proclame, le code de la brute; voilà ce qu'on voudrait faire pénétrer de gré ou de force dans nos institutions, dans nos lois, dans nos mœurs. Et en même temps qu'on accorde cette liberté aux passions, on condamne l'activité de l'homme à porter un joug de fer. Désormais il ne sera plus libre de disposer du fruit de son travail, de régler l'emploi de son temps, de ses bras, de son intelligence. L'État s'emparera de sa personne, de ses biens, des produits qu'il crée, et mesurera ensuite la part qui lui en revient. Sous ce nouveau régime, l'individu disparaît, s'efface devant un être collectif qui l'absorbe; c'est un corps passif que l'on pousse dans un engrenage au sein duquel il doit se mouvoir. Triste abaissement, dégradation inouïe! Les autres systèmes fatalistes remontent au moins jusqu'au ciel : celui-ci s'arrête sur la terre, et sacrifie aux hommes le libre arbitre de l'homme. L'esclavage même n'anéantit pas plus complètement la personnalité.
En terminant, il est essentiel de dégager l'Économie politique de tout point de contact avec d'aussi odieuses imaginations, et quelques mois suffiront pour cela. L'Économie politique a surtout pour objet, en ce qui concerne l'homme, d'élever au plus haut point ses facultés physiques, morales et intellectuelles, par la libre disposition qu'il en doit avoir et l'emploi indépendant qu'il en doit faire. L'Économie politique condamne avec énergie tous les moyens artificiels de dispenser le bonheur aux hommes, et s'en remet à chacun d'eux pour chercher les moyens naturels qui peuvent le lui assurer : elle croit qu'en pareille [638] matière le meilleur juge et le meilleur instrument, c'est l'homme lui-même. Aussi l'Economie politique repousse-t-elie les combinaisons de tutelle et de dictature qui, sous une forme ou une autre, se proposent d'assurer la prospérité collective au moyen d'un amoindrissement des droits et d'un assujettissement des facultés de l'individu; elle trouve que le gouvernement est assez chargé de besogne quand il fait exécuter les lois, sans qu'on lui donne encore la tâche difficile de procurer le bonheur et de distribuer la richesse. Voilà ce qu'enseigne l'Économie politique, et cette donnée fondamentale suffit pour empêcher qu'elle puisse être jamais confondue avec le socialisme, même par le plus léger détail. En est-il ainsi de ce procédé qui consiste à intervenir dans le jeu des intérêts d'un pays; à nommer tel travail national, et à le favoriser au préjudice des autres travaux; à régler l'activité des regnicoles en l'excitant d'un côté et la contenant de l'autre ; à ménager à ceux-ci des moyens commodes de réussir, en imposant des entraves à ceux-là; enfin, à constituer l'État juge et arbitre souverain des conditions dans lesquelles doit se créer et se développer la richesse générale? Sur ce point et au milieu d'aussi évidentes affinités, le doute est au moins permis, et on est fondé à dire que ceux qui ont imaginé et maintenu de pareils errements administratifs sont plus voisins du socialisme qu'ils ne le pensent et qu'on ne le pense communément.
Louis Reybaud.