
Gustave de Molinari, "Les gouvernements de l'avenir" (1884)
 |
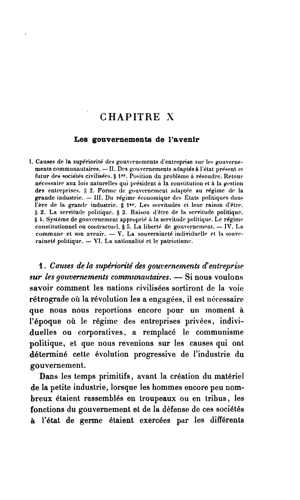 |
| Gustave de Molinari (1819-1912) |
This is part of a collection of works by Gustave de Molinari.
Source
Gustave de Molinari, L’évolution politique et la Révolution (Paris: C. Reinwald, 1884). Chap. X. Les gouvernements de l'avenir, pp. 351-423.
See my incomplete translation of this chapter (hand-written) in facs. PDF; also just this chapter in facs. PDF. See the entire book in HTML and facs. PDF.
Editor's Note: the numbers in [square brackets] refer to the original page numering of the published book; this is a first draft of the file so errors still remain. Molinari liked to have very long footnotes, sometimes with notes within the footnotes. We have tried our best to sort this out in an intelligent manner suitable for putting online.
[351]
CHAPITRE X. Les gouvernements de l'avenir
I. Causes de la supériorité des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires.— II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées. § 1er. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles qui président à la constitution et à la gestion des entreprises, g 2. Forme de gouvernement adaptée au régime de la grande industrie. — III. Du régime économique des Etats politiques dans l'ère de la grande industrie. § 1er. Les servitudes et leur raison d'être. § 2. La servitude politique. § 3. Raison d'être de la servitude politique. § ï. Système de gouvernement approprié à la servitude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel. § 5. La liberté de gouvernement. — IV. La commune et son avenir. — V. La souveraineté individuelle et la souveraineté politique. — VI. La nationalité et le patriotisme.
1. Causes de la supériorité des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires. — Si nous voulons savoir comment les nations civilisées sortiront de la voie rétrograde où la révolution les a engagées, il est nécessaire que nous nous reportions encore pour un moment à l'époque où le régime des entreprises privées, individuelles ou corporatives, a remplacé le communisme politique, et que nous revenions sur les causes qui ont déterminé cette évolution progressive de l'industrie du gouvernement.
Dans les temps primitifs, avant la création du matériel de la petite industrie, lorsque les hommes encore peu nombreux étaient rassemblés en troupeaux ou en tribus, les fonctions du gouvernement et de la défense de ces sociétés à l'état de germe étaient exercées par les différents [352] membres de la communauté, concurremment avec l'industrie rudimentairo qui leur fournissait leurs moyens de subsistance. Cette industrie, chasse, pêche, récolte des.fruits naturels du sol, ne leur procurant que le strict nécessaire, les fonctions gouvernantes ne pouvaient être rétribuées; elles constituaient autant de charges imposées dans l'intérêt commun et auxquelles on ne pouvait se soustraire sans aggraver celles d'autrui. comme il arriverait dans une association dont certains membres se refuseraient à payer leur cotisation, en prétendant cependant recueillir leur part des profits ou des avantages sociaux.
Mais, à la suite des temps, un progrès immense s'accomplit, le matériel de la petite industrie est créé. Aussitôt, par le fait de l'énorme accroissement de la productivité des industries alimentaires et autres, les fonctions gouvernantes deviennent productives d'onéreuses qu'elles étaient. On voit alors ces fonctions se spécialiser et devenir, comme les autres branches d'industrie, l'objet d'une exploitation par voie d'entreprise. Les hommes qui possèdent les aptitudes nécessaires à l'exercice de cette sorte d'entreprise constituent des « sociétés » ayant pour but d'exploiter l'industrie du gouvernement et d'en tirer le plus grand profit possible. Ces sociétés s'approprient un marché dont elles s'efforcent d'exclure les entreprises concurrentes et qu'elles s'appliquent à agrandir en vue d'augmenter leurs bénéfices. En cela, leurs pratiques ne diffèrent point de celles des corporations industrielles ou commerciales auxquelles donnent naissance, dans la même période, les progrès du matériel de la production.
Cependant on peut se demander si les nations vivant de la petite industrie n'auraient pas trouvé plus d'avantage à conserver le régime de la communauté politique, tel qu'il existait dans le troupeau ou la tribu, et de continuer, par conséquent, à répartir entre tous leurs membres les [353] fonctions gouvernantes, devenues productives. Chacun aurait eu sa part dans les profits de l'industrie du gouvernement, tandis que ces profits ont été monopolisés par la société politique qui a imposé ses services à la nation réduite à Fêlat de sujétion. L'humanité n'aurait pas subi l'oppression que les monarchies et les oligarchies politiques et religieuses ont fait peser sur elle pendant une longue suite de siècles; elle eût continué de jouir des bienfaits de la démocratie ou du gouvernement du peuple par lui-même. Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi?
Si les choses se sont passées autrement, si nulle part l'ancien régime de la communauté politique n'a pu subsister en concurrence avec le nouveau régime de la concentration du gouvernement dans une corporation particulière, c'est parce que celui-ci était plus efficace et plus économique; plus propre, par conséquent, à donner la victoire, dans la lutte pour l'existence, aux nations qui s'y trouvaient assujetties.
Quelles sont les causes de cette supériorité, démontrée par l'expérience, dos gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires? Ces causes résident, d'une part, dans le principe économique de la division du travail et de la spécialisation des fonctions, de l'autre dans les lois naturelles qui régissent la constitution et la mise en œuvre des entreprises.
En premier lieu, il en est des fonctions du gouvernement comme de toutes les autres. Elles exigent, aussi bien que les fonctions industrielles, artistiques, commerciales, des aptitudes et des connaissances spéciales avec une application continue et exclusive. C'est quand elles se trouvent séparées et spécialisées qu'elles sont le plus productives, qu'elles fournissent les produits et les services les plus abondants, les moins chers et les meilleurs. En supposant que les nations, vivant de la petite industrie, eussent [354] contiuué de se gouverner comme les tribus ou les troupeaux primitifs, que chacun de leurs membres eût coopéré au gouvernement et à la défense de l'Etat en même temps qu'il vaquait aux travaux nécessaires à sa subsistance et à son entretien, les nations eussent été plus mal défendues et gouvernées, défense et gouvernement leur eussent coûté plus cher. C'est exactement ce qui se serait passé si chacun avait continué à pourvoir à tous ses autres besoins, à cultiver son blé, à pétrir son pain, à fabriquer ses habits, à construire et à meubler son habitation, au lieu de s'adonner à une seule industrie et d'en échanger les produits ou les services contre les produits ou les services des autres industries.
En second lieu, un gouvernement est une entreprise comme une autre, et il se trouve à ce titre soumis aux lois naturelles qui régissent la généralité des entreprises. Que ses attributions soient étendues ou limitées, qu'il possède un marché plus ou moins vaste, un gouvernement a besoin d'un matériel et d'un personnel, il exige la concentration d'une quantité plus ou moins considérable de capital, de travail et de connaissances techniques, combinés et mis en œuvre en vue du but à atteindre qui est toujours de produire un maximum d'effet utile en échange d'un minimum de dépense. Or cette constitution et cette organisation économiques des entreprises ont leurs lois que l'expérience a fait découvrir comme elle a révélé celles de la construction des édifices ou de l'architecture, et dont la non-observation entraîne invariablement, au bout d'un temps plus ou moins long selon que les manquements sont plus ou moins graves, la chute des entreprises et l'effondrement des édifices. L'observation et l'expérience démontrent encore que ces lois sont les mêmes pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse d'agriculture, d'industrie, de commerce ou de gouvernement.
[355]
Voyons comment les choses se passent. Un produit ou un service vient à être assez demandé pour qu'on puisse trouver profit à en entreprendre la production. Qu'arrive-t-il alors? Si la demande est peu considérable, si le marché est peu étendu, un homme pourvu de la capacité, des connaissances et des ressources nécessaires entreprend cette production à ses frais et risques. Il fonde une entreprise individuelle. Si le marché est vaste et si le produit ou le service exige, en vertu de sa nature particulière, la mise en œuvre d'une grande agglomération de'forces et de ressources, une entreprise individuelle est ordinairement insuffisante, il faut une entreprise collective. Mais, individuelle ou collective, toute entreprise est soumise à des règles invariables. Ces règles, nous devons nous borner ici à les rappeler d'une façon sommaire. H faut : 1° qu'une entreprise ait la propriété ou la libre disponibilité de ses forces et de ses ressources, ainsi que des résultats de sa production; qu'elle puisse les augmenter ou les diminuer, conserver ses produits ou les mettre au marché aux conditions qu'il lui convient de stipuler; 2° il faut que les ressources et les forces dont elle dispose soient proportionnées aux exigences de la production, et, en même temps, qu'elle ne s'étende pas au delà de certaines limites, déterminées par le degré de puissance de son matériel, de capacité et de connaissances techniques de son personnel, de perfectionnement de ses procédés et de ses méthodes; il faut que sa direction soit une, et, à la fois, intéressée au succès de l'entreprise, libre d'agir et effectivement responsable de ses actes; 4° que tous les cointéressés dans l'entreprise possèdent un droit proportionné à leur intérêt de contrôler sa gestion avec la possibilité matérielle et la capacité d'exercer utilement ce droit de contrôle; 5° qu'elle n'ait autant que possible qu'un seul objet, qu'elle s'applique a une seule branche d'industrie, [356] qu'elle se conforme, en un mot, au principe de la division du travail et de la spécialisation des fonctions productives; 6° enfin et surtout qu'elle soit soumise, dans la mesure nécessaire, à la pression de la concurrence, sinon quelque solides et excellentes qu'aient été, à l'origine, sa constitution et:son organisation, elles finissent par se corrompre et devenir caduques.;
Telles sont, dans toutes les branches de l'activité humaine, les conditions principales et essentielles d'existence;et de succès des entreprises. Celles qui s'en écartent le'plus ne lardent pas à succomber, et, en général, elles ne durent et prospèrent que dans la mesure où elles les réalisent. Or, si l'on étudie la constitution et l'organisation des gouvernements institués sous forme d'entreprises individuelles ou collectives, dès l'époque où les fonctions gouvernantes sont devenues productives, on s'apercevra que ces conditions naturelles d'existence et de succès s'y trouvaient réunies beaucoup plus complètement qu'elles ne pouvaient l'être dans des communautés, composées désormais de millions d'individus, dont l'immense majorité n'avait ni la possibilité matérielle, ni la capacité d'intervenir utilement dans la gestion gouvernementale, sans .-parler des autres causes d'infériorité d'une entreprise communautaire. Qu'en faut-il conclure? C'est que les nations ont trouvé avantage à ce que le gouvernement devînt l'affaire d'une,entreprise particulière au lieu de continuer à être celle de la communauté elle-même. C'est qu'elles ont pu être gouvernées et défendues plus efficacement et à moins de frais.
Il serait impossible d'évaluer l'importance de l'avantage que les nations ont rencontré, au point de vue de l'efficacité des services, dans la substitution des gouvernements, constitués sous forme d'entreprises particulières, aux gouvernements communautaires des temps primitifs. On peut [357] soutenir cependant que cet avantage était illimité, en ce sens que les nations qui auraient conservé le régime de la communauté politique eussent été détruites par celles qui étaient assujetties à un gouvernement d'entreprise. Si lourd et si coûteux que pût être ce gouvernement, toujours valait-il mieux qu'un gouvernement communautaire, en ce qu'il procurait un sécurité extérieure et intérieure que celui-ci était incapable de produire dans la même mesure. Ce point paraîtra décisif si l'on songe que telle est la nature des services d'un gouvernement, que l'insuffisance et l'infériorité de ces services peuvent entraîner la destruction et la ruine de la nation qui les consomme.
Quoique la qualité des services doive passer ici avant le prix dont on les paye, cette dernière considération a cependant bien aussi son importance. Il est bien clair que les consommateurs des services politiques sont intéressés à se les procurer au meilleur marché possible, comme tous les autres. Or il peut arriver qu'une entreprise produisant un article de première nécessité, comme la sécurité ou le pain, en élève le prix non seulement à un taux bien supérieur à celui des frais de la production, mais encore à celui auquel il revenait aux consommateurs lorsqu'ils le produisaient eux-mêmes. Dans ce cas, qu'ont à faire les consommateurs? Avant d'entreprendre de le produire de nouveau eux-mêmes, — ce qui, à première vue, semble la solution naturelle du problème,—ils ont à considérer : 1° s'ils peuvent le produire en qualité aussi bonne et aussi régulière qu'un entrepreneur dont c'est la spécialité, 2° à un prix de revient aussi bas. Dans la négative, —et tel est le cas pour les services d'un gouvernement comme pour tous les autres, — c'est à l'analyse des causes qui permettent au producteur d'exploiter le consommateur et à l'examen des remèdes appropriés à cette nuisance qu'ils doivent s'appliquer d'une manière exclusive.
[358]
Quelles sont les causes qui agissent pour déterminer le prix des produits ou des services? L'observation la plus élémentaire nous apprend que le prix d'un produit ou d'un service quelconque dépend, d'une part, des frais de la production, d'une autre part, de la loi de l'offre et de la demande, et que celle-ci est influencée à son tour par la situation du producteur vis-à-vis du consommateur. Trois cas peuvent se présenter : une entreprise de production peut posséder 1° un monopole illimité, 2° un monopole limité, 3° être soumise à la libre concurrence. Dans le premier cas, les consommateurs sont entièrement à la discrétion du producteur. S'il s'agit d'un article nécessaire à la vie, il peut en élever le prix hors de toute proportion avec les frais de la production, jusqu'à la limite extrême des ressources des consommateurs. Dans le second cas, si le monopole est limité, soit par la coutume (appuyée sur une force suffisante), soit par une charte ou tout autre appareil protecteur, les consommateurs pourront être préservés, en partie du moins, de l'abus de la puissance que le monopole confère au producteur, à la condition cependant, — et cette condition a été rarement remplie, — que l'appareil préservatif possède et conserve une efficacité réelle. Dans le troisième cas, si l'entreprise est soumise à la concurrence, il n'y aura plus lieu de recourir à un appareil quelconque pour modérer le prix des produits ou des services et en maintenir la qualité, la concurrence suffira, pourvu qu'elle soit entièrement libre; le prix de vente ou prix courant couvrira simplement les frais de la production avec adjonction du profit nécessaire.
Les gouvernements de l'ère de la petite industrie appartenaient aux deux premières catégories. Les uns possédaient vis-à-vis des consommateurs politiques un monopole illimité, les autres un monopole limité. Les premiers pouvaient, en conséquence, augmenter selon leur bon plaisir [359] le prix de leurs services et en abaisser la qualité. Toutefois deux circonstances agissaient pour les empêcher d'abuser de ce pouvoir excessif. C'était, d'une part, la propriété perpétuelle ou tout au moins indéfinie de leur marché, qui les intéressait à ne point ruiner leur clientèle; c'était, d'une autre part, la pression continue de la concurrence politique et guerrière qui les obligeait de même à éviter de tarir la source où ils puisaient les moyens de la soutenir. Les seconds, ceux dont le monopole était plus ou moins efficacement limité, se trouvaient obligés de compter avec les consommateurs, mais nous avons vu qu'à mesure que les Etats politiques s'étaient agrandis et unifiés, leurs propriétaires s'étaient débarrassés d'une limitation et d'un contrôle qui leur paraissaient gênants et humiliants, et qu'ils avaient recouvré, pour la plupart, l'intégrité de leur monopole. Comme, dans l'intervalle, la pression de la concurrence politique et guerrière s'était ralentie et affaiblie, la gestion des gouvernements s'était relâchée, la qualité de leurs services avait baissé tandis que le prix s'en était élevé. De là, le mécontentement de plus en plus général et accentué des consommateurs politiques et la nécessité d'un changement de régime.
II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées.—§ 1er. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles qui président à la constitution et à la gestion des entreprises. — Qu'il existe des lois naturelles qui régissent les entreprises, que ces lois soient les mêmes pour toutes les entreprises, politiques, agricoles, industrielles ou commerciales; qu'elles continuent aujourd'hui de gouverner leur constitution et leurs opérations comme elles les gouvernaient il y a des milliers d'années, comme elles les gouverneront dans l'avenir le plus reculé; que la méconnaissance de ces lois naturelles et immuables de l'architecture et du gouvernement des entreprises ait [360] pour résultat inévitable de déterminer l'abaissement de la qualité et l'exhaussement du prix de leurs produits ou dé leurs services et finalement de précipiter leur chute, voilà ce que nous apprend l'étude économique de l'histoire du passé et mieux encore celle de l'histoire contemporaine.
Si nous considérons les gouvernements de l'ancien régime, nous constaterons, en effet, que les plus solides, ceux qui ont duré le plus longtemps et rendu les meilleurs services aux populations, étaient, invariablement, ceux-là dont la constitution et la gestion se conformaient de plus près aux lois que nous avons énumérées. Nous serons frappés aussi de la similitude qui existe entre leur constitution et leur gestion et celles des autres entreprises, industrielles ou commerciales. L'intérêt d'une famille ou d'une société limitée en nombre est le mobile qui préside à la fondation de l'établissement politique. Cet établissement est la propriété perpétuelle et héréditaire d'une « société » ou d'une «maison» qui l'exploite de père en fils, à ses frais et risques et qui subsiste des profits de son exploitation, après avoir pourvu à l'entretien et au renouvellement de son matériel et à la rétribution de son personnel. Le roi gouverne souverainement son Etat comme le chef d'industrie gouverne sa fabrique et le négociant son comptoir; il supporte toute la responsabilité de ses opérations et de ses obligations pécuniaires. L'établissement politique n'a que des attributions restreintes; il ne produit que des services essentiels mais peu variés, la sécurité intérieure et extérieure (encore les services de la justice proprement dite ont-ils fini par être confiés à une compagnie presque indépendante) et la monnaie. Toutes les autres productions sont abandonnées à la multitude des entreprises agricoles, industrielles, commerciales, constituées et gérées comme l'établissement politique qui les protège.
Si nous examinons maintenant la structure et le mode [361] de gestion des gouvernements issus de la révolution, nous reconnaîtrons qu'ils s'écartent par des points essentiels des lois qui président à la construction et à l'exploitation des entreprises industrielles ou commerciales. L'Etat a cessé d'être la chose d'une famille ou d'une association limitée, il appartient à une nation, c'est-à-dire à une communauté dont les membres se comptent par millions, dont l'intérêt dans cette entreprise est infinitésimal, et qui n'ont d'ailleurs pour la plupart ni la possibilité ni la capacité d'intervenir d'une manière active et utile dans sa gestion. Par suite de cet émiettement d'intérêts, de cet empêchement matériel et de cette incapacité de l'immense majorité de ses propriétaires, l'exploitation de l'État est livrée à des associations politiques qui tantôt s'en emparent en recourant à la force, tantôt en se la faisant adjuger pour un temps limité par l'assemblée des propriétaires, ou pour mieux dire par un corps électoral composé des propriétaires réputés politiquement capables. Sans parler des fraudes inévitables auxquelles donne lieu cette adjudication d'une entreprise dont les opérations se chiffrent par milliards, quel en est le résultat? C'est de remettre l'exploitation de l'État à une association qui, n'en ayant que la jouissance temporaire, est intéressée à en tirer la plus grande somme possible de bénéfices et d'avantages dans cet intervalle limité, dût-elle sacrifier au présent qui lui appartient l'avenir qui ne lui appartient pas. De là sa tendance irrésistible à augmenter les attributions de l'État, partant les bénéfices et avantages que son exploitation peut conférer, tendance encore développée par les nécessités de la compétition des associations organisées en vue de conquérir ou de se faire adjuger l'exploitation de l'État. Enfin, ces exploitants temporaires, quels que soient les erreurs, les fautes et même les crimes de leur gestion n'ont point à en supporter les conséquences : le seul risque qu'ils courent, c'est, à l'expiration [362] de leur jouissance, de voir l'État adjugé à d'autres; mais c'est la nation propriétaire qui supporte, avec la dépréciation de son domaine, la responsabilité des dettes dont ils l'ont grevé. Faut-il s'étonner si, en présence de ces dérogations aux lois essentielles de la construction et de la gestion des entreprises,les gouvernements n'ont plus qu'une durée éphémère, tout en imposant aux nations des sacrifices de plus en plus disproportionnés avec leurs ressources? On a remarqué avec raison qu'en admettant que les entreprises industrielles et commerciales fussent constituées et gouvernées comme les Etats politiques, elles seraient promptement vouées à la banqueroute. Si les États subsistent, c'est grâce à l'étendue des ressources des nations propriétaires et au développement progressif de leur industrie; mais si ce régime politique devait se perpétuer, il ruinerait à la longue les nations les plus riches et les plus industrieuses. Cela étant, quel est donc le problème à résoudre, problème qui s'imposera d'une manière plus pressante aux nations civilisées à mesure qu'elles subiront davantage les dommages de l'état présent des choses? Ce problème consiste à ramener les gouvernements modernes à l'observation des principes essentiels qui président à la construction et à la gestion des entreprises, en prenant pour modèles les entreprises industrielles et commerciales qui n'ont pas cessé d'être construites et gouvernées conformément à ces principes. Ainsi il faudra : 1° que l'État politique redevienne la chose d'une maison ou d'une association limitée en nombre, et dont tous les membres aient par conséquent un intérêt suffisant à ce qu'il soit bien constitué et géré; 2° que cette maison ou cette association en soit propriétaire à perpétuité, qu'elle le gère librement et souverainement sous sa responsabilité effective, sans pouvoir rejeter cette responsabilité sur les consommateurs politiques; en un mot, que la nation ne soit pas plus obligée de combler [363] les déficits et de payer les dettes de l'entrepreneur exploitant de l'État que ne l'est un consommateur de pain ou de viande de combler les déficits et de payer les dettes de son boulanger ou de son boucher; et telle était en droit, sinon toujours en fait, la situation sous l'ancien régime; enfin, que la maison ou l'association propriétaire exploitante de l'État limite, encore à l'exemple des gouvernements de l'ancien régime, et d'une manière plus rigoureuse, son industrie à la production de la sécurité, en abandonnant tous les autres produits et services, sans excepter la monnaie, aux autres entreprises. Alors, mais seulement alors, les gouvernements pourront de nouveau compter leur existence par siècles; ils cesseront d'être, suivant une expression pittoresque de J.-B. Say, les ulcères des nations.
§ 2. Forme de gouvernement adaptée au régime de la grande industrie. — Est-ce à dire que le progrès politique consiste à revenir purement et simplement aux gouvernements de l'ancien régime? Non, pas plus qu'il ne consisterait à revenir pour la construction de nos maisons et de nos édifices à l'architecture de l'ancienne Egypte, sous le prétexte que les lois de l'architecture n'ont pas changé depuis les Pharaons. La forme des édifices a changé et changera encore, si les lois qui président à leur construction sont demeurées immuables. Il en est de même de la forme des entreprises politiques et autres.
Sous l'ancien régime, la forme des gouvernements était monarchique ou oligarchique, sauf dans quelques petits cantons de la Suisse où elle était demeurée communautaire ou démocratique. Autrement dit, l'État était la propriété d'une maison ou d'une association, et cette propriété se léguait de père en fils, suivant les lois naturelles de l'hérédité, plus ou moins modifiées par des dispositions ou des conventions particulières. Tel était aussi le régime des [364] autres entreprises. Ce régime a continué de prévaloir dans celles-ci : les entreprises industrielles ou commerciales appartiennent soit à des maisons, soit à des associations. Seulement, ces dernières, qui avaient jadis une forme identique à celle des oligarchies politiques, ont été transformées par l'invention des titres transmissibles et nous avons montré les avantages de cette nouvelle forme des entreprises, malgré ce qu'elle a encore d'imparfait et de défectueux.[58] Elle est, avons-nous dit, la forme adaptée au régime de la grande industrie comme l'entreprise patrimoniale a été celle qui s'adaptait le mieux à la petite industrie. On peut donc prévoir que les « maisons politiques » disparaîtront peu à peu, comme disparaissent, dans les exploitations qui exigent de grandes accumulations de capitaux et de forces, telles que les chemins de fer, les mines, etc., les « maisons » pour faire place aux « sociétés ». Déjà il n'est point sans exemple que cette forme progressive des entreprises ait été appliquée à des établissements politiques. La Compagnie des Indes anglaises en a été le spécimen le plus célèbre, et si l'invasion des doctrines communistes en Angleterre n'avait déterminé sa suppression, elle continuerait d'être citée camme un modèle de bonne gestion politique et d'administration économique.[59]
[365]
III. Du régime économique des États politiques dans tare de la grande industrie. — § 1er. Les servitudes et leur raison [366]
d'etre. — Nous venons de voir quelle sera la forme probable des États politiques dans l'ère de la grande industrie; il [367] nous reste à rechercher maintenant quel sera leur régime économique. Sera-ce le monopole illimité ou limité vis-à-vis [368] des consommateurs, comme dans l'ère de la petite industrie, ou sera-ce la concurrence? Dans toutes les autres branches [369] d'industrie, ce dernier régime est celui qui a commencé généralement à prévaloir. Les entreprises peuvent se [370] constituer librement, en nombre illimité, tandis que les consommateurs, de leur côté, sont libres de s'adresser à celles qui leur offrent les produits ou les services qu'ils jugent les meilleurs et les moins cbers. Sous ce régime, le producteur est libre de constituer son entreprise, de confectionner ses produits ou ses services et d'en fixer le prix à son gré; mais le consommateur, à son tour, est libre d'accepter ou de refuser produits et services. La liberté, tel est donc le régime qui préside aux relations des producteurs et des consommateurs et qui est destiné à y présider de jour en jour davantage, dans les différentes branches de l'activité humaine.
Mais ce régime est-il actuellement applicable aux entreprises politiques? Le sera-t-il jamais?
Pour résoudre cette question, il est nécessaire que nous nous reportions encore au régime qui a prévalu jusqu'à une époque récente dans la production de la généralité des produits ou des services. Ce régime était celui de l'appropriation du marché, ou du monopole de son approvisionnement, monopole tantôt illimité, tantôt limité par la coutume ou un appareil réglementaire, et impliquant pour le consommateur une servitude restrictive de sa liberté naturelle. Les maisons ou les corporations industrielles et commerciales, aussi bien que les maisons ou les corporations politiques et religieuses, possédaient leur marché. Dans les limites de ce marché, elles ne souffraient point qu'aucun autre établissement se fondât pour leur faire concurrence ou que des établissements placés au dehors y importassent leurs produits ou leurs services. Cette propriété de leur [371] marché, elles la défendaient de tout leur pouvoir : en matière politique et religieuse, toute tentative d'empiéter sur ce marché ou de le morceler était recherchée avec un soin particulier et rigoureusement punie. L'inquisition, par exemple, avait été instituée dans le but de défendre les marchés approprié»au culte catholique, et par conséquent de sauvegarder les profits de leur exploitation, contre toute concurrence intérieure ou extérieure. De même les corporations industrielles et commerciales invoquaient le secours de la maison ou de la corporation politique pour empêcher l'importation des produits étrangers, et interdire aux autres corporations placées dans les limites de l'État d'empiéter sur leur domaine particulier. Sous le régime de l'état de guerre, ce régime, au moins dans ses applications aux articles nécessaires à la vie, ne garantissait pas seulement la sécurité des producteurs, mais encore celle des consommateurs. Dans un pays continuellement exposé à la guerre, — et n'oublions pas qu'aux époques où nous nous reportons la paix était l'exception et la guerre la règle, — si les entreprises agricoles et industrielles n'avaient point possédé leur marché, il leur eût été impossible de proportionner leur production aux besoins de la consommation. Dans les intervalles de paix, les produits importés du dehors auraient dérangé toutes lesprévisions des producteurs en leur causant des pertes ruineuses et déterminé, dans la production intérieure, une diminution qui, la guerre survenant de nouveau, et avec elle l'interruption des communications extérieures, eût exposé les consommateurs à la privation de produits nécessaires. Les servitudes agricoles et industrielles constituaient donc pour eux aussi bien que pour les producteurs une véritable assurance. Cependant, à mesure que les guerres sont devenues moins fréquentes et les communications internationales plus faciles, l'utilité de cette assurance a diminué, et les gouvernements se [372] sont moins appliqués à la garantir. Ils ont cessé de maintenir dans son intégrité la prohibition des produits étrangers, d'abord en autorisant, moyennant redevance, l'établissement des foires ou marchés temporaires libres; ensuite, en autorisant, en tous temps, l'importation de la plupart des denrées et marchandises, sous payement d'une taxe ou « droit d'entrée » ; ils ont laissé envahir le marché des corporations soit par de nouvelles maîtrises qu'ils autorisaient moyennant finance, soit par des entreprises libres qu'ils assujettissaient simplement au droit de patente; enfin, ils ont établi, comme un fait général, la liberté de l'industrie et du commerce à l'intérieur, substituant ainsi au dedans des frontières de l'État la concurrence au monopole.
La nécessité de cette assurance en cas de guerre était, comme on sait, le plus fort argument des protectionnistes anglais contre le rappel des lois-céréales. L'abrogation de ces lois tutélaires placerait, disaient-ils, l'Angleterre sous la dépendance de l'étranger pour sa subsistance, et ils faisaient ressortir, avec une inquiétude vraie ou simulée, les dangers d'un tel état de choses. L'événement leur a donné raison sur le premier point, car l'Angleterre achète aujourd'hui à l'étranger plus de la moitié de la masse des denrées alimentaires qui entrent dans sa consommation; en revanche, grâce au développement extraordinaire des moyens de communication le risque qu'une guerre peut lui faire courir de ce chef s'est singulièrement atténué. C'est pourquoi la nation anglaise a préféré s'y exposer plutôt que de continuer à payer, pour le couvrir, la prime de renchérissement des lois-céréales.[60]
Quant à la religion, aussi longtemps qu'elle est demeurée un instrument de gouvernement, son marché a été protégé à [373] l'égal de celui de l'Etat; mais à mesure que les liens qui attachaient l'Église à l'État se sont relâchés, la servitude religieuse a. été moins garantie et elle est en train de disparaître.
Au moment où nous sommes, le régime de la liberté de l'industrie, impliquant la concurrence intérieure, a généralement prévalu dans les États civilisés, tant pour les produits de l'agriculture, de Findustre et des arts que pour les services religieux, et les progrès de la liberté commerciale [374] y ajoutent, de plus en plus, la concurrence extérieure. L'ancien régime des marchés appropriés n'existe plus que pour un petit nombre d'industries, les unes réputées en possession d'un monopole naturel et soumises à une réglementation destinée à le limiter, les autres englobées, pour des raisons diverses, dans la régie de l'État.
§ 2. La servitude politique. — Cet ancien régime des marchés appropriés, tous les États se sont appliqués, en revanche, à le conserver pour leurs propres services. Les États issus de la révolution se sont même montrés plus encore que les autres jaloux de le maintenir, et de perpétuer, apparemment dans l'intérêt de la liberté, la servitude politique. En France, le gouvernement révolutionnaire a commencé par proclamer l'indivisibilité de la République, et le gouvernement de l'Union américaine a sacrifié à cette nécessité, réelle ou supposée, un million de vies humaines et quinze ou vingt milliards de francs, engloutis dans la guerre de sécession. Toute tentative de séparation est considérée comme un crime de haute trahison que les républiques démocratiques aussi bien que les monarchies absolues ou constitutionnelles réprouvent avec horreur et châtient avec sévérité.[61] On va même plus loin : en vue de prévenir [375] les tentatives de morcellement du marché politique, on oblige les populations suspectes de tendances sécessionnistes à renoncer à leurs institutions et à leur langue, et on leur impose les institutions et la langue dites « nationales».
Il s'agit de savoir si ces mesures répressives et préventives, sans parler de la réprobation morale, sont justifiées ou non; si, tandis que le progrès a consisté à supprimer les servitudes industrielles, commerciales et religieuses qui assuraient aux corporations de l'ancien régime la propriété de leur marché, à l'exclusion de toute concurrence intérieure ou extérieure, cette servitude doit être maintenue pour le marché politique; s'il est, et s'il sera toujours nécessaire que les consommateurs politiques demeurent assujettis à la maison, à la corporation ou à la nation propriétaire exploitante de l'Etat, et contraints de consommer ses services bons ou mauvais ; s'ils ne pourront jamais posséder la liberté de fonder des entreprises politiques en concurrence avec celle-là, d'accorder leur clientèle à des entreprises concurrentes ou même de ne l'accorder à aucune dans le cas où ils trouveraient plus d'avantage à demeurer les propres assureurs de leur vie et de leur propriété; s'il est, en un mot, dans la nature des choses que la servitude politique se perpétue et que les hommes ne puissent jamais posséder la liberté de gouvernement.
Il est clair que cette servitude, — la plus onéreuse de toutes, car elle s'applique à des services de première [376] nécessité, — ne peut être maintenue, sous un régime où la liberté est de droit commun, qu'à une condition, c'est d'être motivée par l'intérêt général. Si cet intérêt exige que les propriétaires exploitants des établissements politiques demeurent investis de lapropriété intégrale de leur marché, aussi longtemps du moins qu'ils ne sont pas obligés de céder une partie de ce marché, à la suite d'une guerre malheureuse, ou qu'ils ne jugent point avantageux de s'en dessaisir par une vente ou un troc, « la liberté de gouvernement » ne saurait être établie utilement comme l'ont été la liberté des cultes, de l'industrie et du commerce. Dans cette hypothèse le droit de sécession devrait être à jamais frappé d'interdit ou, pour mieux dire, il n'y aurait pas de droit de sécession. Il convient de remarquer toutefois que des brèches importantes ont déjà été faites à cette partie du vieux droit public, sous l'influence des changements que les progrès de la sécurité, de l'industrie et des moyens de communication ont introduits dans les relations des peuples civilisés. Si les gouvernements n'admettent aucune concurrence dans les limites de leur marché, ils ont généralement renoncé à empêcher leurs sujets de faire acte de sécession individuelle par voie d'émigration et de naturalisation à l'étranger. En revanche, ils n'admettent aucun acte de sécession collective, qui entame leur domaine territorial. Toutefois encore, si les sécessionnistes sont assez forts pour opérer cette séparation comme l'ont été les colons anglais et espagnols de l'Amérique du Nord et du Sud, les anciens propriétaires exploitants de ces marchés séparés se résignent à accepter le « fait accompli » et ils finissent même par reconnaître la légitimité des gouvernements sécessionnistes. Mais dans ce cas ils ne cèdent qu'à la force, et il est presque sans exemple qu'une sécession ait été accomplie à l'amiable.
Examinons donc quels motifs peuvent être invoqués en [377] faveur du maintien de la servitude politique, —en prenant ce mot dans son acception économique, — tandis que les autres servitudes ont cessé généralement d'être considérées comme nécessaires.
§ 3. Raison d'être de la servitude politique. — Sous l'ancien régime, cette servitude était, comme toutes les autres, motivée par les nécessités de l'état de guerre. En supposant qu'une partie de la nation eût possédé le droit de se séparer de l'État soit pour s'annexer à un État concurrent soit pour fonder un État indépendant, soit enfin pour vivre sans gouvernement, l'exercice de ce droit eût produit une nuisance générale, nuisance d'autant plus grande que la nation eût été exposée à être envahie, détruite ou assujettie par des peuples moins avancés, tels que les barbares qui menaçaient les frontières des Etats de l'antiquité et du moyen âge. La sécession d'une partie de la population, en diminuant ou simplement en divisant les forces de l'Etat eût aggravé le risque de destruction, d'asservissement et en tous cas de recul de civilisation qui pesait sur la nation à laquelle l'Etat servait de rempart. On peut comparer la situation des nations civilisées, dans cette période de l'histoire, à celle des populations des contrées menacées incessamment, comme la Hollande, par les flots de l'océan. Il est nécessaire que tous les habitants, sans exception, contribuent à l'entretien des digues; ceux qui s'y refuseraient profiteraient indûment d'un appareil de défense dont ils ne supporteraient point les frais; ils augmenteraient d'autant les charges des autres, et si les ressources de ceux-ci ne suffisaient point pour élever des digues assez solides et assez hautes, ils s'exposeraient eux-mêmes à être victimes de leur malhonnête égoïsme; ceux qui s'obstineraient à établir des digues particulières sans les rattacher au système commun compromettraient de même l'œuvre nécessaire de la défense contre l'élément destructeur. Aux époques où [378] la civilisation était menacée par la barbarie, la servitude politique s'imposait donc comme une absolue nécessité. En revanche, elle a perdu en grande partie sa raison d'être depuis que la supériorité des forces a passé du côté des peuples civilisés. Cependant elle peut encore être motivée, quoique à un degré moindre, par les inégalités de civilisation qui subsistent de pays à pays.
Dans l'état actuel du monde, bien que la supériorité des forces physiques et morales, des ressources et des connaissances techniques qui sont les matériaux de la puissance militaire, appartienne visiblement aux nations les plus civilisées, on ne saurait affirmer qu'elles soient entièrement à l'abri des invasions des peuples moins avancés. Sans doute, les populations de l'Empire russe, par exemple, n'ont aucun intérêt à envahir l'Europe centrale et occidentale, à la manière des hordes barbares et pillardes qui détruisirent jadis l'Empire romain ; mais dans l'état arriéré où se trouve encore la constitution politique de l'Europe, ce n'est pas l'intérêt général des populations qui décide de la paix et de la guerre. Tantôt, c'est l'intérêt bien ou mal entendu d'une maison souveraine et de l'armée de fonctionnaires militaires et civils sur laquelle elle s'appuie; tantôt c'est l'intérêt d'un parti, dont l'état-major se recrute dans une classe vivant du budget et de ses attenances et à laquelle la guerre fournit un accroissement de débouchés, partant de bénéfices, ou simplement dont elle peut, suivant les circonstances, consolider la domination. Dans cette situation et aussi longtemps qu'elle subsistera, les peuples les plus civilisés demeureront exposés au risque de l'invasion et de la conquête, et la « servitude politique » conservera jusqu'à un certain point sa raison d'être. Mais que cet état de choses vienne à cesser, que l'intérêt général des « consommateurs politiques » acquière assez de puissance pour maîtriser les appétits d'exploitation et de rapine des [379] producteurs, que le risque d'invasion et de conquête s'affaiblisse en même temps que s'effaceront, sous l'influence de la multiplicité des échanges, et du rayonnement des lumières, les inégalités de civilisation, la « servitude politique » perdra toute raison d'être, la « liberté de gouvernement » deviendra possible.
§ 4. Système de gouvernement approprié à la servitude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel. — En attendant, les « consommateurs politiques » devront se résigner à supporter les défectuosités naturelles du vieux régime de l'appropriation des marchés, sauf à recourir aux moyens, malheureusement toujours imparfaits et insuffisants, de limiter la puissance du monopole auquel ils se trouvent assujettis. Le système adapté actuellement à cet état de choses est celui du gouvernement constitutionnel ou pour mieux dire contractuel, monarchique ou républicain, se résolvant dans un contrat débattu et conclu librement entre la « maison » ou la « société » productrice des services politiques et la nation qui les consomme.
Seulement, ce système doit être établi de manière à respecter les lois naturelles qui régissent toutes les entreprises, politiques, industrielles ou commerciales, soit qu'elles possèdent un monopole, soit qu'elles se trouvent soumises à la concurrence. Il faut que la mai son ou la société politique possède un capital proportionnné à l'importance et aux exigences de son entreprise, capital immobilier et mobilier, investi sous forme de forteresses, de matériel et de provisions de guerre, de bureaux d'administration et de police, de prisons, de monnaie destinée au paiement de ses employés et de ses ouvriers civils et militaires, etc., etc. ; qu'elle soit maîtresse d'organiser son exploitation et de recruter son personnel, sans qu'aucune condition ou limite lui soit imposée. En revanche, il faut qu'elle subisse la responsabilité pécuniaire de ses actes et de ses entreprises; qu'elle [380] en supporte les pertes sans pouvoir les rejeter sur les consommateurs, sauf dans les cas de force majeure, — une invasion de barbares par exemple, —spécifiés dans le contrat; qu'elle en recueille les bénéfices, sauf encore à partager ceux-ci avec les consommateurs, au-dessus d'un certain taux fixé de même dans le contrat ; il faut enfin que ses pouvoirs et ses attributions soient strictement limités à ce qu'exige le bon accomplissement de ses services, qui consistent à préserver de toute atteinte intérieure et extérieure la vie et la propriété des consommateurs politiques, sans qu'il lui soit permis d'empiéter sur le domaine des autres industries. Telles doivent être, en substance, les conditions du contrat si l'on veut que les maisons ou les sociétés productrices de services politiques puissent, de nouveau, fonctionner d'une manière utile et durable. C'est pour les avoir méconnues, sous l'influence des doctrines et des faits révolutionnaires, c'est pour avoir cessé de tenir compte, dans la constitution et le fonctionnement des entreprises politiques, des lois naturelles qui régissent toutes les entreprises que l'on a essayé en vain de fonder des gouvernements économiques et stables, et que l'on n'a pas réussi davantage à adapter à l'état présent des sociétés ceux que nous a légués l'ancien régime.
Cependant, ces conditions du contrat politique, les nations peuvent-elles les débattre elles-mêmes et en surveiller l'exécution? N'est-il pas indispensable qu'elles choisissent des mandataires, d'abord pour rédiger le contrat après en avoir débattu les clauses avec les délégués de la maison ou de l'association politique, ensuite pour le modifier et le perfectionner s'il y a lieu, enfin pour surveiller et contrôler la fourniture des services politiques, sous le double rapport de la qualité et du prix, régler le compte de participation de la nation aux pertes et aux bénéfices de l'entreprise? Cette nécessité a été considérée jusqu'à [381] présent comme indiscutable. Toutefois, en présence de la corruption à peu près inévitable du régime représentatif, on peut se demander si les garanties qu'on croit y trouver ne sont pas, le plus souvent, illusoires, s'il ne serait pas préférable d'abandonner aux consommateurs eux-mêmes le soin de débattre les conditions du contrat, de le modifier et d'en surveiller l'exécution, sans leur imposer aucune formule de représentation. Sans doute, les consommateurs politiques sont individuellement incapables de se charger de cette tâche, mais des associations librement formées entre eux ne pourraient-elles pas s'en acquitter avec l'auxiliaire de la presse? Dans les pays où la masse de la population ne possède ni la capacité ni les loisirs nécessaires pour s'occuper des choses de la politique, cette représentation libre des consommateurs, recrutée parmi ceux qui possèdent cette capacité et ces loisirs, ne serait-elle pas un instrument de contrôle et de perfectionnement de la gestion do l'État plus efficace et moins sujet à se rouiller ou à se vicier que la représentation officielle d'une multitude ignorante ou d'une classe privilégiée?
§ 5. La liberté de gouvernement. —Un jour viendra toutefois, et ce jour n'est peut-être pas aussi éloigné qu'on serait tenté de le supposer en considérant la marche rétrograde que la révolution a imprimée aux sociétés civilisées; un jour viendra, disons-nous, où la servitude politique perdra toute raison d'être et où la liberté de gouvernement, autrement dit la liberté politique, s'ajoutera au faisceau des autres libertés. Alors, les gouvernements ne seront plus que des sociétés d'assurances libres sur la vie et la propriété, constituées et organisées comme toutes les sociétés d'assurances. De même que la communauté a été la forme de gouvernement adaptée aux troupeaux et aux tribus des temps primitifs, que l'entreprise patrimoniale ou corporative, avec monopole absolu ou limité par des [382] coutumes, des chartes, des constitutions ou des contrats, a été celle des nations de l'ère de la petite industrie; l'entreprise par actions avec marché libre sera, selon toute apparence, celle qui s'adaptera aux sociétés de l'ère de la grande industrie et de la concurrence.[62]
IV. La commune et son avenir. — Dans les temps primitifs, les sociétés embryonnaires, vivant de la chasse, de la pêche et de la récolte des fruits naturels du sol, formaient des communautés politiques, au gouvernement et à la défense desquelles tous leurs membres étaient obligés de contribuer. Dans la période suivante, lorsque la mise en culture régulière des plantes alimentaires et la création de la petite industrie eurent permis aux hommes de se multiplier en proportion de l'énorme accroissement de leurs moyens de subsistance, les fonctions politiques, devenues productives, se séparèrent et se spécialisèrent entre les mains d'une corporation ou d'une maison, fondatrice et exploitante de l'État. Soit qu'il fût partagé entre les membres de la corporation et formât un ensemble de seigneuries rattachées par les liens de la féodalité, soit qu'il se concentrât entre les mains d'un seul maître et propriétaire héréditaire, ce domaine politique dut être subdivisé en raison des nécessités de sa gestion. Cette subdivision s'opéra de deux manières : tantôt elle fut l'œuvre des propriétaires exploitants de l'État, tantôt celle des populations qui leur étaient assujetties.
Dans tous les pays où la population conquise a été réduite en esclavage, la commune, par exemple, ne se constitue ou pour mieux dire ne se reconstitue qu'à l'époque où les esclaves passent à l'état de serfs; dans ceux où les [383] conquérants se bornent à assujettir les habitants au servage, la commune est constituée par la tribu ou le troupeau primitif, fixé au sol, d'abord par les nécessités de l'exploitation de l'agriculture et des métiers, ensuite par l'intérêt du propriétaire du domaine politique qui vit de l'exploitation du cheptel humain de ce domaine, en l'obligeant à en cultiver une partie à son profit, et en lui laissant la jouissance du reste. Mais soit qu'il s'agisse d'une population passée de l'esclavage au servage ou immédiatement réduite à cette forme progressive de la servitude, le propriétaire politique, roi ou seigneur, ne s'impose la peine et les frais nécessaires pour la gouverner qu'autant qu'il y est intéressé et dans la mesure de son intérêt. Il laisse les groupes ou les communautés se former à leur convenance suivant la configuration du sol, la facilité des communications locales, la langue et les affinités de race ou de caractère, sauf à empêcher chaque commune d'empiéter sur les limites des autres ou de franchir celles de son domaine.[63] Il les laisse encore suivre leurs coutumes, parler leur langue ou leur patois, se servir de leurs poids et mesures, pourvoir, à leur guise, à leurs divers besoins individuels ou collectifs, en exceptant seulement les services susceptibles de lui valoir une rétribution ou un profit. Il les oblige par exemple à lui acheter du sel, à se servir de sa monnaie, de son four et de son pressoir; enfin, il les soumet à sa justice, [384] au moins quand il s'agit de crimes ou de délits qui troublent la paix du domaine et surtout d'atteintes à ses droits et de révoltes contre sa domination. Les communes forment d'autres groupements, des cantons, des bailliages pour l'établissement et l'entretien des moyens de communication, la perception des redevances, et plus tard, lorsque les seigneuries sont absorbées dans le domaine royal, elles forment des provinces administrées par un intendant. Certaines communes favorablement situées pour l'industrie et le commerce prennent un développement considérable; elles deviennent des villes; les industries et les métiers se constituent en corporations, dont les chefs ou les notables administrent la cité sous l'autorité du seigneur. Il arrive alors, surtout lorsque le seigneur exige des redevances trop lourdes; lorsque son joug est tyrannique ou bien encore lorsque les magistrats et les meneurs du peuple sont affamés de domination, que les communes veulent s'affranchir de l'autorité seigneuriale et se gouverner ellesmêmes. Quelquefois le seigneur consent à leur vendre la franchise, en capitalisant la somme des redevances ; d'autres fois, elles entreprennent de la conquérir par la force. En France, le roi favorise cette insurrection des communes, en vue d'abaisser la puissance des seigneurs. Mais il arrive rarement que les communes affranchies réussissent à se bien gouverner elles-mêmes. Tantôt la population est exploitée par l'oligarchie des métiers, tantôt la commune est le théâtre de la lutte des partis, recrutés les uns dans la bourgeoisie, les autres dans la populace, qui se disputent l'exploitation du petit État communal. C'est une lutte analogue à celle dont nous sommes aujourd'hui témoins, dans les pays où l'État est devenu la propriété de la nation. Cependant, lorsque les grandes seigneuries eurent absorbé les petites et, plus tard, lorsque la royauté eut absorbé les grandes, on vit disparaître ce que les communes et [385] les provinces avaient acquis ou conservé d'indépendance. Telle était la disproportion entre les forces dont disposait le maître d'un grand État et celles d'une commune ou même d'une province que toute lutte était désormais impossible entre eux. La conséquence fut que communes et provinces ne conservèrent que la portion du gouvernement d'ellesmêmes que le maître de l'État ne trouva aucun profit à leur enlever ou qui aurait été pour lui une charge sans compensation suffisante. Telle était la situation lorsque la Révolution éclata.
Tout en faisant passer entre les mains de leurs intendants et de leurs autres fonctionnaires civils et militaires les attributions et les pouvoirs exercés auparavant par les seigneurs et leurs officiers, en augmentant même ces attributions et ces pouvoirs, aux dépens de ceux des agents du self government communal ou provincial, les rois avaient cependant respecté, dans une certaine mesure, les coutumes locales, et ils ne s'étaient point avisés de toucher aux groupements qui s'étaient formés naturellement, dans le cours des siècles, sous l'influence des besoins et des affinités des populations. Mais cet état de choses ne pouvait trouver grâce devant les novateurs ignorants et furieux qui prétendaient refondre et régénérer d'emblée la société française. Ils découpèrent, suivant leur fantaisie, les circonscriptions provinciales, et remplacèrent les trente-deux provinces du royaume par quatre-vingt-trois départements, en triplant ainsi ou à peu près le haut personnel à appointements de l'administration. En même temps, ils portèrent à son maximum de développement la centralisation qui avait été, sous l'ancien régime, la conséquence naturelle de l'absorption successive des petites souverainetés seigneuriales dans le domaine politique du roi, et à laquelle avait contribué aussi une cause purement économique. En effet, à mesure que la productivité de l'industrie s'augmentait sous [386] l'influence des inventions mécaniques et autres, on voyait s'accroître la rétribuabilité des fonctions gouvernantes de tout ordre; il devenait par conséquent avantageux de faire passer, dès qu'elles devenaient rétribuables, les fonctions du self government local dans le domaine de l'administration centrale. C'étaient autant de situations qui élargissaient le débouché administratif et augmentaient l'importance et l'influence du haut personnel, distributeur des places. L'administration centrale alla ainsi grossissant aux dépens du self governmenl local qui ne conserva plus que des attributions subordonnées, faiblement rétribuées ou gratuites.
Cette centralisation des services avait des avantages et des inconvénients : des avantages, en ce que les fonctionnaires ouïes employés spécialisés et suffisamment rétribués de l'administration générale d'un pays peuvent posséder, à un plus haut degré, les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et s'en acquitter mieux que des fonctionnaires ou des employés à besognes multiples, à appointements insuffisants ou sans appointements d'une administration locale; à quoi il faut ajouter qu'ils sont moins accessibles aux influences et aux passions de clocher; des inconvénients, en ce que les moindres affaires passant par une longue filière administrative ne peuvent être résolues qu'après de nombreux délais, quelle que soit l'urgence d'une solution. Ces avantages et ces inconvénients sont devenus, comme on sait, une source inépuisable de débats entre les partisans de la centralisation et ceux de la décentralisation : les uns voulant augmenter les attributions du gouvernement central aux dépens des sousgouvernements départementaux et communaux; les autres prétendant, au contraire, réserver au département et à la commune l'examen et la solution définitive de toutes les affaires locales. Mais ni les uns ni les autres ne se sont avisés [387] de rechercher s'il n'y avait pas lieu de diminuer et de simplifier ces attributions, en abandonnant à l'industrie privée une partie des services accaparés par l'État, le département ou la commune. Quelle que fût l'issue de ces débats, elle ne pouvait donc avoir pour résultat de diminuer les charges des consommateurs de services publics.
La décadence de l'ancien régime et la rétrogression vers le communisme politique qui a caractérisé le régime nouveau, en déterminant l'éclosion des partis et leur compétition pour l'exploitation de l'État devaient, au contraire, avoir pour conséquence d'accroître le nombre et le poids des fonctions de tout ordre constituant le butin nécessaire de ces armées politiques.'Sans doute, la portion de ce butin que pouvaient fournir les administrations locales était de moindre valeur que celle qui formait le contingent de l'administration centrale. Un bon nombre de fonctions même, celles de conseillers communaux et départementaux, de maires et d'adjoints étaient demeurées gratuites ou ne procuraient que de faibles indemnités, et ceux qui les briguaient ne manquaient pas de faire sonner bien haut leur désintéressement et leur dévouement patriotique,mais elles étaient investies d'une influence qui se monnayait d'une manière ou d'une autre en avantages matériels; elles étaient d'ailleurs le chemin qui conduisait aux autres. C'est pourquoi nous avons vu, sous l'influence des mêmes causes qui ont agi pour augmenter les attributions et grossir le budget de l'État, croître les attributions et les budgets locaux, particulièrement dans les villes. La tendance des administrations urbaines a été de transformer la commune en un petit État, autant que possible indépendant du grand, ayant entre ses mains non seulement les services de l'édilité et de la voirie, mais encore la police, l'instruction publique, les théâtres, les beaux-arts, taxant à sa guise la population et s'entourant, à l'instar de l'État central, d'une muraille [388] douanière fiscale, et même protectrice de l'industrie municipale. Les dépenses communales, départementales ou provinciales ont crû, en conséquence, dans une progressioa qui dépasse même, dans certaines communes, celle des dépenses de l'État, et le résultat a été que la vie y est devenue de plus en plus chère. Il semblerait au premier abord que le gouvernement central dût s'opposer à ce débordement des dépenses locales, en vue de sauvegarder ses propres recettes. Il a interdit, en effet, aux communes d'empiéter sur ses attributions et il a veillé à ce qu'elles n'établissent point des impôts qui puissent faire aux siens une concurrence nuisible, mais il n'a rien fait pour les empêcher d'étendre leurs attributions aux dépens de l'industrie privée, et cela se conçoit aisément : les partis politiques en possession du gouvernement ou aspirant à le posséder ne sont-ils pas intéressés à l'accroissement du butin des places et des situations influentes, aussi bien dans la commune, le département ou la province que dans l'État, puisque ce butin constitue le fonds de rétribution de leur personnel?
Cependant un moment viendra où ce fardeau, aujourd'hui si rapidement croissant, ne pourra plus s'accroître, où une évolution analogue à celle dont nous avons montré l'inévitable nécessité dans l'État, devra s'opérer dans la commune, le département ou la province. Cette évolution sera déterminée : 1° par l'impossibilité où se trouveront les administrations locales de couvrir plus longtemps leurs dépenses au moyen de l'impôt ou de l'emprunt; 2° par la concurrence intercommunale et régionale, activée par le développement des moyens de communication et la facilité croissante des déplacements de l'industrie et de la.population. Les localités où les frais de production de l'industrie et le prix de la vie seront surélevés à l'excès par les taxes locales courront le risque d'être abandonnées pour celles [389] où cette cause de renchérissement sévira avec une moindre intensité; elles seront obligées alors, sous peine de ruine, de restreindre leurs attributions et leurs dépenses. En dehors de l'édilité et de la voirie, comprenant les services des égouts, des moyens de communication, du pavage, de l'éclairage et de la salubrité, il n'y a pas un seul service municipal qui ne puisse être abandonné à l'industrie privée. Enfin, si nous considérons ces services mêmes, nous nous apercevrons que la tendance déjà manifeste du progrès consiste à les annexer aux industries immobilières qui pourvoient à l'exploitation des immeubles et du sol, et par conséquent à en incorporer directement les frais dans les prix de revient de ces industries.
Essayons, en recourant à une simple hypothèse, de donner une idée du modus operandi de cette transformation progressive. Supposons qu'une société immobilière se constitue pour construire et exploiter une ville nouvelle (et ne voyons-nous point déjà des sociétés de ce genre construire des rues et même des quartiers?) sous la condition de demeurer pleinement libre de la bâtir, de l'entretenir et de l'exploiter à sa guise, sans qu'aucune administration centrale ou locale s'avise de se mêler de ses affaires ; comment procédera-t-elle? Elle commencera d'abord par acheter l'emplacement nécessaire dans la localité qu'elle jugera la mieux située, la plus aisément accessible et la plus salubre; elle convoquera ensuite des architectes et des ingénieurs pour tracer les plans et faire les devis de la future cité, et, parmi ces plans et devis, elle choisira ceux qui lui paraîtront les plus avantageux. Les entrepreneurs et les ouvriers de l'industrie du bâtiment et de la voirie se mettront aussitôt à l'œuvre. On percera les rues, on construira des maisons d'habitation appropriées aux différentes catégories de locataires, on n'oubliera pas les écoles, les églises, les théâtres, les salles de réunion. Cependant il ne suffit pas, pour [390] attirer les locataires, de mettre à leur disposition des logements, des écoles, des théâtres et même des églises ; il faut que les habitations accèdent à des rues bien pavées et éclairées, que les habitants puissent se procurer chez eux l'eau, le gaz et l'électricité; qu'ils aient à leur service des véhicules variés et à bon marché, enfin que leurs personnes et leurs propriétés soient préservées de toute nuisance dans l'enceinte de la cité. Mieux tous ces services seront remplis, moins cher ils coûteront et plus rapidement se peuplera la nouvelle cité. Que fera donc la compagnie propriétaire? Elle fera paver les rues, établir des trottoirs, creuser des égouts, construire et décorer des squares; elle traitera avec d'autres entreprises, maisons ou compagnies, pour la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la sécurité,des tramways,des chemins de fer aériens ou souterrains, c'est-a-dire pour les services qui ne peuvent, en vertu de leur nature particulière,être individualisés ou faire l'objet d'une concurrence illimitée dans l'enceinte limitée de la cité. Pour les omnibus et les voitures de place, elle se bornera, au contraire, à faire appel à la concurrence, sauf dans le cas où celle-ci ne pourrait se développer par suite de l'insuffisance de la demande; elle stipulera dans ce cas l'établissement d'un tarif maximum, tout en demandant aux entrepreneurs de locomotion aussi bien qu'aux propriétaires de voitures particulières un abonnement au pavage et à l'éclairage. Elle établira des règlements de voirie et de salubrité; interdira ou isolera les entreprises dangereuses, insalubres, incommodes ou immorales. En outre, comme il est possible que le plan de la cité doive être modifié plus tard, qu'il faille élargir certaines rues, en supprimer d'autres, la compagnie se réservera le droit de reprendre la disposition de ses immeubles, moyennant une indemnité proportionnée à la durée des baux restant à courir ; mais il est clair qu'elle n'usera de ce droit qu'en vue d'augmenter les produits de. [391] son exploitation. Cette exploitation, elle l'administrera soit elle-même, soit au moyen d'une agence urbaine, chargée d'une part du bon entretien de la cité et de la surveillance des différents services y attenant, d'une autre part de la perception des loyers, dans lesquels seront compris les services qui ne peuvent être séparés de la jouissance de l'habitation, tels que la police locale, les égouts, le pavage et l'éclairage des rues.
Une compagnie ainsi constituée pour exploiter sur une grande échelle l'industrie du logement sera intéressée à diminuer autant que possible les frais de construction, d'entretien et de gestion de ses immeubles et elle aura pour tendance naturelle d'élever autant que possible le taux de ses loyers. Si elle jouissait d'un monopole, cette tendance ne pourrait être combattue et neutralisée que par une coutume ou une réglementation analogue à celle qui limitait jadis le pouvoir de toutes les industries de monopole; mais, grâce à la multiplicité des moyens de communication et à la facilité des déplacements, ce monopole n'existe plus pour l'industrie du logement. Il n'est besoin d'aucun appareil artificiel pour protéger les consommateurs; la concurrence suffit pour obliger les producteurs de logements, si vastes que soient leurs entreprises, à améliorer leurs services et à abaisser leurs prix au taux nécessaire pour rétribuer leur industrie.
Poursuivons maintenant notre hypothèse. Supposons que la situation favorable de la nouvelle cité, la bonne gestion des services urbains et la modicité du taux des loyers agissent pour attirer la population et qu'il devienne avantageux de construire un supplément d'habitations. N'oublions pas que les entreprises de tous genres ont leurs limites nécessaires, déterminées par la nature et le degré d'avancement de leur industrie, et qu'en deçà comme au delà de ces limites, leurs frais de production vont croissant [392] et leurs bénéfices diminuant. Si la compagnie qui a construit et qui exploite la cité estime que ces limites se trouvent atteintes, elle laissera à d'autres le soin de l'agrandir. On verra donc se former d'autres compagnies immobilières qui construiront et exploiteront des quartiers nouveaux, lesquels feront concurrence aux anciens, mais augmenteront cependant la valeur de l'ensemble, en accroissant le pouvoir d'attraction de la cité agrandie. Entre ces compagnies exploitantes celle-là du noyau de la cité, celles-ci de nouvelles rues ou quartiers, il y aura des rapports nécessaires d'intérêt mutuel pour le raccordement des voies, des égouts, des tuyaux du gaz, l'établissement des tramways etc. ; elles seront, en conséquence, obligées de constituer une union ou un syndicat permanent pour régler ces différentes questions et les autres affaires résultant de la juxtaposition de leurs propriétés, et la même union devra s'étendre, sous l'influence des mêmes nécessités, aux communes rurales du voisinage. Enfin, si des différends surgissent entre elles, elles devront recourir à des arbitres ou aux tribunaux pour les vider.
Ainsi se transformeront, selon toute apparence, les communes en entreprises libres pour l'exploitation de l'industrie du logement et de ses attenances naturelles. En supposant que la propriété et l'exploitation immobilières individuelles continuent de subsister à côté de la propriété et de l'exploitation actionnaires, — malgré la supériorité économique de celles-ci, — les différents propriétaires exploitants de la cité, individus ou sociétés, formeront une union pour régler toutes les questions d'intérêt commun , union dans laquelle ils auront une participation proportionnée à la valeur de leurs propriétés. Cette union, composée des propriétaires, individus ou sociétés, ou de leurs mandataires, réglerait toutes les affaires de voirie, de pavage, d'éclairage, de salubrité, de sécurité par abonnement [393] ou autrement, et elle se mettrait en rapport avec les unions voisines pour le règlement commun de ces mêmes affaires, en tant toutefois que la nécessité de cette entente se ferait sentir. Ces unions seraient toujours libres de se dissoudre ou de s'annexer à d'autres, et elles seraient naturellement intéressées à former les groupements les plus économiques pour pourvoir aux nécessités inhérentes à leur industrie.
Tandis que les doctrines révolutionnaires et socialistes ont pour tendance d'augmenter incessamment les attributions de la commune ou de l'État, transformé en une vaste commune, en faisant entrer dans sa sphère d'activité toutes les industries et tous les services, ainsi rassemblés et confondus dans un monstrueux monopole, l'évolution, suscitée parles progrès de l'industrie et de la concurrence, agit au contraire pour spécialiser toutes les branches de la production, en y comprenant celles qui sont exercées par la commune et l'Etat, et les attribuer à des entreprises librement constituées et soumises à Faction à la fois propulsive et régulatrice de la concurrence. Ces entreprises libres n'en ont pas moins des rapports déterminés par les nécessités de leur industrie, De là une organisation naturelle mais libre qui va se développant et se modifiant avec ces nécessités mêmes.
C'est ainsi qu'au lieu d'absorber l'organisme de la société, suivant la conception révolutionnaire et communiste, la commune et l'Etat se fondent dans cet organisme. Leurs fonctions se divisent et la société est composée d'une multitude d'entreprises formant, sous l'empire de nécessités communes qui dérivent de leur nature particulière, des unions ou des États libres exerçant chacun un'e fonction spéciale. L'avenir n'appartient donc ni à l'absorption de la société par l'État, comme le prétendent les communistes et les collectivistes, ni à la suppression de l'État, comme le [394] rêvent les anarchistes et les nihilistes, mais à la diffusion de l'État dans la société. C'est, pour rappeler une formule célèbre, l'État libre dans la Société libre.
V. La souveraineté individuelle et la souveraineté politique. — L'homme s'approprie l'ensemble des éléments et des forces physiques et morales qui constituent son être. Cette appropriation est le résultat d'un travail de découverte ou de reconnaissance de ces éléments et de ces forces, et de leur application à la satisfaction de ses besoins, autrement dit de leur utilisation. C'est la propriété personnelle. L'homme s'approprie et se possède lui-même. Il s'approprie encore,— par un autre travail de découverte,d'occupation, de transformation et d'adaptation, — le sol, les matériaux et les forces du milieu où il vit, en tant qu'ils sont appropriables. C'est la propriété immobilière et mobilière. Ces éléments et ces agents qu'il s'est appropriés dans sa personne et dans le milieu ambiant, et qui constituent des valeurs, il agit continuellement, sous l'impulsion de son intérêt, pour les conserver et les accroître. Il les façonne, les transforme, les modifie ou les échange à son gré, suivant qu'il le juge utile. C'est la liberté. La propriété et la liberté sont les deux facteurs ou les deux composantes de la souveraineté.
Quel est l'intérêt de l'individu? C'est d'être absolument propriétaire de sa personne et des choses qu'il s'est appropriées en dehors d'elle, et d'en pouvoir disposer à son gré; c'est de pouvoir travailler soit isolément, soit en associant librement ses forces et ses autres propriétés, en tout ou en partie, à celles d'autrui; c'est de pouvoir échanger les produits qu'il tire de l'exploitation de sa propriété personnelle, immobilière ou mobilière, ou bien encore de les consommer ou de les conserver : c'est, en un mot, de posséder dans toute sa plénitude la « souveraineté individuelle ».
Cependant l'individu n'est pas isolé. Il est perpétuellement en contact et en rapport avec d'autres individus. [395] Sa propriété et sa liberté sont limitées par la propriété et la liberté d'autrui. Chaque souveraineté individuelle a ses frontières naturelles dans lesquelles elle s'exerce et qu'elle ne peut franchir sans empiéter sur d'autres souverainetés. Ces limites naturelles, il faut qu'elles soient reconnues et garanties, sinon les faibles se trouvent à la merci des forts et aucune société n'est possible. Tel est l'objet de l'indusIrie que nous avons nommée « la production de la sécurité » ou, pour nous servir de l'appellation habituelle, tel est l'objet du « gouvernement ».
Comme toutes les autres industries, celle-ci a commencé par être imparfaite et grossière; elle s'est successivement perfectionnée, mais non sans avoir des phases de rétrogression et de décadence. Dans le premier âge de la civilisation, elle est exercée par la communauté des membres du troupeau ou de la tribu. Ne possédant qu'un outillage et un armement rudimentaires, qui suffisent à peine à subvenir aux premières nécessités de la vie, et ne pouvant s'accroître au delà de quelques centaines ou de quelques milliers de têtes, le troupeau primitif ne fournirait point un débouché assez large pour rémunérer une entreprise spéciale de gouvernement. Ses membres sont obligés de produire euxmêmes la sécurité dont ils ont besoin. Ils en sont à la fois les producteurs et les consommateurs. Ils partagent leur temps et leurs efforts entre la production alimentaire et la production de la sécurité. Seulement, avec cette différence qui tient à la nature particulière de ces deux industries, que l'une peut être, dans la plupart des cas, exercée individuellement, tandis que l'autre ne peut l'être que collectivement. Les membres du troupeau ou de la tribu constituent donc une communauté ou une mutualité d'assurance, dans laquelle, à défaut d'autre capital, chacun apporte une partie de son temps et de ses forces. Des souverainetés individuelles ainsi associées, en vue de [396] pourvoir à une nécessité commune, naît la souveraineté politique. Cette souveraineté appartient collectivement, mais non également, à tous les membres de l'association. Chacun en possède une part proportionnée à son apport.
Telle est l'origine et tels sont les éléments de la souveraineté politique. Comme la souveraineté individuelle, elle a ses limites. Celles-ci sont déterminées par l'objet en vue duquel elle est instituée, et qui consiste à assurer contre toute agression intérieure ou extérieure la vie et la propriété des membres de la mutualité, considérés comme consommateurs de sécurité. Elle ne peut atteindre ce but sans leur imposer des charges, des obligations et des règles qui diminuent d'autant leur propriété et leur liberté. Aussi longtemps que ces charges, ces obligations et ces règles n'excèdent pas le nécessaire, le souverain ne dépasse pas les limites de son droit. Mais où est la garantie qu'il ne les dépassera point? Comment le consommateur individuel de sécurité se trouve-t-il préservé de l'abus du pouvoir du producteur collectif? Cette garantie essentielle réside d'abord dans son droit de renoncer à faire partie de la mutualité, soit pour produire lui-même, isolément, sa sécurité, soit pour s'annexer à une autre mutualité; toutefois, en fait, ce droit demeure à peu près inapplicable; elle réside ensuite, dans la participation de l'individu à l'exercice de la souveraineté politique, et, au sein d'une mutualité peu nombreuse, cette garantie pouvait avoir une efficacité suffisante.
Dans le second âge de la civilisation, le mode de production de la sécurité subit un changement radical. Grâce aux progrès de l'outillage, la productivité du travail s'accroît dans une proportion telle que l'individu peut non seulement pourvoir largement à ses besoins de première nécessité, mais encore à beaucoup d'autres. Alors apparaît le phénomène de la séparation des industries et de la division du travail. Les industries séparées sont exercées [397] par des entreprises spéciales, dont l'importance varie suivant l'étendue et la richesse de leur débouché. La production de la sécurité suit la loi commune. Aux mutualités primitives succèdent, nous avons vu en quelles circonstances et sous l'impulsion de quelles nécessités, des entreprises organisées sous forme de sociétés en participation ou autrement qui fondent un État et établissent un gouvernement. Qu'advient-il de la souveraineté sous ce nouveau régime?
Il y a alors deux sociétés: la société possédante et exploitante de l'État, et la société, ou plutôt la multitude assujettie à sa domination. Les membres de la première possèdent, à l'origine, comme ceux des communautés ou des mutualités primitives, la souveraineté individuelle et la souveraineté politique. Toutefois, les nécessités du maintien et de l'agrandissement de la domination qui leur fournit leurs moyens d'existence ont pour effet ordinaire et presque général de déterminer la concentration de l'exercice de la souveraineté politique entre les mains d'un petit nombre de familles, et finalement même d'une seule. Ceux qui en sont exclus se trouvent alors à la discrétion du souverain, sauf les garanties qu'ils ont pu stipuler pour l'empêcher d'entamer, au delà du nécessaire, leur souveraineté individuelle. Si ces garanties n'existent point, ils subissent le régime du despotime et du bon plaisir : le souverain peut disposer à sa guise des éléments de la souveraineté individuelle de chacun : la propriété et la liberté. Cependant ils peuvent avoir intérêt à courir ce risque inhérent à la concentration de la souveraineté politique, si cette concentration a pour effet de mieux garantir la domination dont ils sont les coparticipants et bénéficiaires.
La multitude assujettie à la domination de la société maîtresse de l'État ne possède, au début de ce régime, ni [398] la souveraineté individuelle ni la souveraineté politique. Elle est esclave. Les individus qui la composent sont appropriés soit à un membre, soit à la collectivité des membres de la société dominante. Ce n'est qu'à la longue, grâce à une série de progrès, déterminés surtout par la concurrence politique, qu'ils parviennent à s'affranchir, c'est-à-dire à entrer en possession de la souveraineté individuelle. Toutefois elle ne leur est point accordée entière; elle demeure grevée de la sujétion ou de la servitude politique. L'affranchi n'est plus esclave ou serf, mais il est encore « sujet ». Il est propriétaire de sa personne et de ses biens; il est libre d'agir à sa guise, il possède, en d'autres termes, d'une manière plus ou moins complète la souveraineté, sauf l'obligation strictement et universellement réservée de la faire garantir par la société politique de ses anciens maîtres, aux prix et conditions qu'il plaît à celle-ci d'établir, soit qu'elle exerce elle-même la souveraineté politique, soit que l'exercice en soit concentré dans une oligarchie ou dans une « maison ». Le consommateur de sécurité se trouve ainsi à l'entière discrétion du producteur, car il lui est interdit non seulement de la demander à d'autres, mais encore de la produire lui-même. Et sa situation va même s'aggravant de ce côté à mesure que sa souveraineté individuelle devient plus complète: quand il était sous la dépendance d'un maître, appartenant à la société dominante, celui-ci était intéressé à le protéger de son influence contre l'abus du pouvoir du souverain, et il l'était d'autant plus que cette dépendance était plus étroite. Cet intérêt a disparu du moment où l'esclave ou le serf est devenu entièrement propriétaire et maître de luimême. Il s'est trouvé alors entièrement à la merci de la corporation ou de la maison politique, en possession du monopole de la production de la sécurité. Ce monopole sans contrepoids n'a pas manqué de devenir de plus en [399] plus lourd et oppressif. On a entrepris d'abord de le limiter par l'établissement d'un système analogue à celui qui restreignait le pouvoir des autres corporations, également investies d'un monopole. Les consommateurs de sécurité ont obtenu le droit de débattre le prix et les conditions de ce service. Mais, comme nous l'avons constaté, les deux parties en présence réussissaient rarement à s'accorder et, en dernière analyse, elles avaient recours à la force pour vider leurs différends.
Ce recours n'avait pas été favorable aux consommateurs de sécurité. A la fin du xvm8 siècle, les corporations ou les maisons en possession de la souveraineté politique avaient réussi partout, sauf en Angleterre, à récupérer l'intégrité de leur monopole, et il en était résulté un abaissement général de la qualité et l'exhaussement du prix de la sécurité ou de la garantie de la souveraineté individuelle. La Révolution française survint et eut pour premier résultat de donner la victoire aux consommateurs. L'établissement politique qui produisait la sécurité tomba entre leurs mains et ils eurent à aviser aux moyens de pourvoir à ce service. Ce problème comportait trois solutions différentes : 1° on pouvait laisser subsister l'ancien établissement politique, en revenant au système des garanties et des contrepoids, usité au moyen âge, conservé et amélioré en Angleterre; 2° rétrograder jusqu'au système de la mutualité primitive, ou de la production de la sécurité par les consommateurs eux-mêmes; 3° supprimer purement et simplement la servitude politique, et laisser à la concurrence le soin de pourvoir à la garantie de la souveraineté individuelle.
C'est le second système qui a prévalu, et qui prévaut encore aujourd'hui avec des applications et des tempéraments divers, et l'on peut se rendre aisément compte des causes qui l'ont fait prévaloir. Les consommateurs avaient [400] souffert des abus du monopole; il était naturel qu'ils s'imaginassent que le moyen le plus simple et le plus efficace d'éviter le retour de ces abus consistait à produire eux-mêmes, — collectivement puisqu'il n'était pas possible de la produire autrement, — la sécurité dont ils avaient besoin. C est ainsi que nous voyons les consommateurs de pain, dans les localités où la taxe a été abolie et où la concurrence demeure insuffisante, fonder des boulangeries coopératives, autrement dit des mutualités de production du pain. Mais il est rare que ces mutualités, quoique instituées librement, sans que personne soit contraint à en faire partie, réussissent à atteindre le but en vue duquel elles ont été établies, savoir : de produire du pain, en meilleure qualité et à meilleur marché que les boulangeries de l'ancien système, et elles finissent communément par se liquider ou à revenir au régime économique des entreprises ordinaires, individuelles ou collectives. Encore moins est-on parvenu à fonder des mutualités de production de la sécurité, économiques et durables, et il suffit de jeter un coup d'œil sur leur constitution et leur fonctionnement pour se rendre compte de cet insuccès.
De quels éléments se composent les mutualités politiques, dites nationales? Elles se composent de populations d'origine diverse, meublant un territoire conquis parles sociétés gouvernantes de l'ancien régime, et réunies sans leur consentement ou même malgré elles. Ces populations, on les a déclarées propriétaires (apparemment en vertu du droit de conquête) de l'établissement politique auquel elles étaient naguère assujetties, après avoir confisqué cet établissement à ses légitimes propriétaires, et on leur a commis le soin de le gérer à leurs frais, risques et profits, en attribuant arbitrairement soit à une portion de leurs membres, soit à tous, le droit de participer à sa gestion. Mais d'abord cette souveraineté collective ainsi artificiellement [401] façonnée et rendue obligatoire ne constitue-t-elle pas, aussi bien que celle à laquelle elle succède, une atteinte ou une « servitude » imposée à la souveraineté individuelle? Si je suis souverain (et la révolution n'a-t-elle pas été faite pour m'affranchir de la servitude politique, c'est-à-dire pour me restituer ma souveraineté dans toute sa plénitude?), si je suis souverain, et, comme tel, propriétaire et libre de ma personne et de mes biens, en vertu de quel droit m'imposeriez-vous l'obligation de m'associer à tels individus plutôt qu'à tels autres pour garantir ma personne et mes biens? Serait-ce parce qu'à l'époque où nous subissions en commun la servitude politique, où nous étions obligés, les uns et les autres de demander notre sécurité à la corporation ou à la maison qui en avait le monopole, nous étions placés sous le même joug? A quoi nous servirait d'avoir secoué ce joug, si c'était pour le remplacer par un autre, fût-ce même par celui de la collectivité des serfs, dans laquelle nous avions été englobés sans notre consentement et presque toujours malgré nous? En dépossédant la corporation ou la maison dont nous étions les sujets, vous prétendez nous avoir restitué la part de souveraineté dont elle nous avait dépouillés? Soit! mais, il fallait alors nous permettre d'en user librement pour produire nous-mêmes notre sécurité, individuellement — ou en nous associant à d'autres à notre convenance, en admettant que la production individuelle fût impossible. Ou bien encore, il fallait nous permettre de nous adresser à une société ou à une maison de notre choix, pour obtenir ce service indispensable, et de contracter librement avec elle. Mais nous contraindre à faire partie d'une mutualité composée de tous les anciens sujets de l'Etat confisqué, n'était ce pas comme si, après avoir aboli la corporation investie du monopole de la production du pain, et nous avoir ainsi affranchis de l'obligation onéreuse de nous pourvoir exclusivement [402] à la boulangerie du quartier, on nous avait contraints à exploiter nous-mêmes cet établissement, transformé en une boulangerie coopérative obligatoire, à en supporter les frais, à en combler les déficits, et à nous approvisionner exclusivement chez elle? N'était-ce pas remplacer une servitude par une autre?
Ajoutons que cette servitude transférée à un corps politique nombreux et dont font partie ceux-là mêmes qui la subissent, peut devenir incomparablement plus lourde et plus oppressive que lorsqu'elle était établie au profit d'une corporation ou d'une maison. C'est, en effet, en s'appuyant sur l'intérêt de la généralité de la nation, et non plus seulement en se fondant sur l'intérêt particulier de la corporation ou de la maison souveraine, que l'on attente à la propriété et à la liberté de chacun, Et quelle limite les intérêts particuliers peuvent-ils opposer à une puissance qui agit au nom de l'intérêt général? On peut opposer un frein à la tyrannie d'un seul, ne fût-ce que par le fer ou le poison; on est impuissant contre la tyrannie d'une multitude. Dira-t-on que dans ce système renouvelé des temps primitifs l'individu participe à la souveraineté politique, et que cette participation suffit à le garantir contre l'oppression d'un pouvoir qu'il contribue à former. Elle suffisait peut-être dans les temps primitifs, lorsque les mutualités politiques ne comprenaient que quelques centaines ou quelques milliers de membres, ayant les mêmes moyens d'existence, partant les mêmes intérêts, et surtout n'ayant aucun intérêt à former des ligues ou des sociétés particulières pour exploiter l'industrie encore improductive du gouvernement; elle ne suffit plus, elle est devenue purement illusoire dans des mutualités politiques dont les membres se comptent par millions, exercent les industries les plus diverses, et à une époque où l'industrie du gouvernement possède une productivité croissante, limitée [403] seulement par les facultés contributives que les progrès de l'industrie augmentent sans cesse. Dans ce nouvel état des choses, quand chacun des membres de la mutualité politique ne possède plus qu'une fraction infinitésimale de souveraineté, comment cette part ainsi diluée pourraitelle être efficace? Comment cette poussière de souveraineté devenue presque impalpable pourrait-elle résister à l'effort des agglutinations compactes d'intérêts qui se forment pour exploiter l'industrie du gouvernement, devenue de plus en plus productive? Nous avons vu où conduit ce système, dont l'expérience se poursuit et dont les conséquences s'aggravent tous les jours sous nos yeux : il conduit à renchérissement et à l'abaissement progressifs des services des gouvernements, constitués et gérés, nominalement du moins, par des mutualités nationales.
Au point où cette expérience est parvenue, elle atteste déjà, avec une évidence suffisante, que le système révolutionnaire et communiste des mutualités nationales ne résout point le problème de la garantie utile de la souveraineté individuelle. Deux solutions restent donc en présence : celle de la limitation par voie de contrat librement débattu du monopole naturel ou artificiel des établissements politiques, et celle de la concurrence. Il y a apparence que l'on reviendra au premier, tout en introduisant dans le fonctionnement des établissements politiques les progrès déjà réalisés dans les autres entreprises collectives, et qu'il subsistera jusqu'à ce que le développement de la grande industrie rende le second possible et finisse par l'imposer comme nécessaire. Mais quels sont, dans l'état présent des choses, les droits des producteurs de sécurité et les droits des consommateurs? En quoi consistent-ils et quelles sont leurs limites? Nous allons voir que ces droits sont les mêmes que ceux des [404] producteurs et des consommateurs des autres industries. Tous dérivent également du principe de la souveraineté individuelle.
Reprenons l'exemple dont nous venons de nous servir. J'ai besoin de pain. Si la localité que j'habite n'est pas assez populeuse et riche pour fournir un débouché à un boulanger, je serai obligé de le fabriquer moi-même, — je serai à la fois producteur et consommateur de pain. Si la population s'enrichit et s'accroît, ce débouché s'ouvrira, une boulangerie pourra s'établir et je trouverai avantage à lui acheter mon pain plutôt qu'à continuer à le fabriquer. Mais qu'advient-il alors de mes droits de producteur et de consommateur? Je cesse d'exercer mon droit de producteur de pain, mais je continue à le posséder, et même il s'est étendu au lieu de décroître : à mon droit, dont je puis continuer à user, de fabriquer du pain pour ma consommation, s'est joint celui d'en produire pour autrui, en fondant une boulangerie ou en contribuant à la fonder et à la mettre en œuvre par mes capitaux et mon travail. Mon droit de consommateur s'est étendu de même; car je puis demander le pain dont j'ai besoin à deux producteurs au lieu d'un : au boulanger et à moi. Si je m'adresse de préférence au boulanger, c'est parce que son pain est meilleur et me revient moins cher que celui que je produisais moimême. Je bénéficie de la différence, et, en admettant que l'industrie soit libre et la concurrence possible, cette différence de prix représentera celle d'une production isolée et d'une production spécialisée.
Supposons cependant que l'industrie ne soit pas libre. Une boulangerie s'est établie, et celui qui l'exploite m'interdit à la fois de fabriquer mon pain moi-même et de m'adresser à d'autres qu'à lui pour me procurer cet article de première nécessité. Aussi longtemps qu'il me fournira du pain de bonne qualité et à un prix modéré, il y a [405] apparence que je ne réclamerai point; mais que la qualité vienne à baisser et le prix à s'élever, — et il p«ut, dans ces conditions, s'élever bien au-dessus des frais de la production, — je m'efforcerai soit de limiter cette servitude, soit de m'y dérober. Si le monopole auquel j'ai affaire est « naturel », s'il ne peut être supprimé sans compromettre l'alimentation et l'existence de la société dont je fais partie, je ne revendiquerai point, à titre de producteur, mon droit primordial de fabriquer mon pain moi-même ou de fonder quelque boulangerie concurrente, mais je réclamerai en échange le droit d'être admis à participer à l'exercice de l'industrie de la boulangerie, si je possède les aptitudes et les connaissances techniques nécessaires. Je ne revendiquerai pas davantage, à titre de consommateur, le droit de me pourvoir chez moi ou à une autre boulangerie: mais en compensation de ce droit, j'exigerai celui de contrôler la qualité du pain et d'en limiter le prix jusqu'au niveau moyen où l'abaisserait la concurrence, en supposant qu'elle fût possible. Si, des deux parts, nous entendons bien nos intérêts, et si nous sommes animés d'un esprit d'équité, l'accord pourra s'établir sur ces bases. Le boulanger continuera d'exercer son industrie et de gouverner son établissement à sa guise, mais sans exclure de son personnel les membres de sa clientèle, et il acceptetera de bonne grâce la création et la mise en vigueur d'un système plus ou moins exact de contrôle de la qualité et de limitation du prix, sans entreprendre d'intimider ou de corrompre les mandataires que les consommateurs auront chargés de ce contrôle et de cette limitation.
Si l'accord ne s'établit point ou s'il vient à se rompre, soit par la mauvaise foi du producteur ou son impatience à subir un contrôle, soit par les exigences excessives et déraisonnables des consommateurs ou de leurs mandataires, avides de popularité; et si l'on a recours à la force [406] pour vider ce procès, qu'arrivera-t-il? Si le propriétaire exploitant du monopole l'emporte, il ne manquera pas de supprimer le contrôle des consommateurs, et même de les exclure de son personnel. Si les consommateurs ont le dessus, ils confisqueront l'établissement investi d'un monopole pour l'exploiter eux-mêmes ou le faire exploiter à leur profit, en se réservant de plus le droit exclusif defaire partie du personnel exploitant. Mais, dans l'un et l'autre cas, les deux parties auront dépassé les limites de leur droit : le propriétaire exploitant d'un monopole excède le sien et empiète sur celui des consommateurs, en supprimant l'appareil qui tient lieu du régulateur naturel de la concurrence pour maintenir la qualité et modérer le prix de ses produits ou de ses services. Les consommateurs excèdent, de même, leur droit en confisquant la propriété et l'industrie du producteur, et en s'emparant de son établissement pour l'exploiter à leur profit. Les « nuisances » que produisent ces dérogations au droit, ne se font, au surplus, pas attendre. L'absence d'un contrôle efficace engendre l'abus inévitable du monopole, et expose le monopoleur à de nouvelles revendications plus violentes des consommateurs; la confiscation de la propriété de l'établissement politique crée un risque qui met en péril toutes les autres propriétés.[64]
[407]
Remplacez la fabrication du pain par la production de a sécurité et vous aurez l'explication de tous les conflits [408] et de toutes les luttes entre les gouvernants et les gouvernés, depuis l'époque où la concurrence politique et [409] guerrière a commencé à s'affaiblir entre les premiers et où les seconds ont commencé à entrer en possession de la [410] souveraineté individuelle. Vous connaîtrez aussi l'origine et les limites de la souveraineté politique.
Résumons maintenant cette théorie:
La souveraineté réside dans la propriété de l'individu sur sa personne et ses biens et dans la liberté d'en disposer, impliquant le droit de garantir lui-même sa propriété et sa liberté ou de les faire garantir par autrui. Lorsqu'il les garantit lui-même, la souveraineté politique demeure confondue avec la souveraineté individuelle. Lorsque cette garantie devient l'objet d'une industrie spéciale, la souveraineté politique se spécialise de même; mais dans ce nouvel état de choses, comme dans le précédent, elle a ses limites qui sont marquées par la nature et les nécessités de la production de la sécurité et qui ne [411] diffèrent point de celles dans lesquelles s'exercent les autres industries.
Si un individu ou une collection d'individus use de sa souveraineté pour fonder un établissement destiné à pourvoir à la satisfaction d'un besoin quelconque, il a le droit de l'exploiter et de le diriger suivant les impulsions de son intérêt, comme aussi de fixer à son gré le prix de ses produits ou de ses services. C'est le droit souverain du producteur. Mais ce droit est limité naturellement par celui des autres individus non moins souverains, considérés en leur double qualité de producteurs et de consommateurs. Cette délimitation s'opère naturellement sous un régime de concurrence, les autres individus demeurant libres de fonder des établissements analogues et de se [412] pourvoir ailleurs, ce qui oblige le producteur à réduire son prix et ses conditions au nécessaire. Il en est autrement sous un régime de monopole. Le droit du producteur est, en ce cas, plus difficile à mesurer et il ne peut être délimité que par un compromis. En échange de leur droit de fonder et d'exploiter d'autres établissements, le monopoleur doit concéder à ses clients assujettis, à titre de producteurs, un droit éventuel de coopération à son entreprise; en échange de leur droit de se pourvoir ailleurs, il doit leur consentir, à titre de consommateurs, un droit de contrôle de la qualité et de limitation du prix de ses produits ou de ses services. Le droit d'un producteur investi d'un monopole peut être ramené ainsi à ses limites naturelles et se concilier avec les droits des autres membres de la société, considérés comme producteurs et consommateurs. L'expérience atteste malheureusement que cette conciliation n'est pas facile à accomplir dans la pratique. Il en sera ainsi, selon toute apparence, aussi longtemps que la production de la sécurité s'opérera sous le régime du monopole et que subsistera la « servitude politique ». Seule, la concurrence peut établir une exacte délimitation de la souveraineté politique.
De cette analyse, il ressort que la souveraineté politique est une partie intégrante de la souveraineté individuelle. Il en ressort aussi qu'il n'est point nécessaire de faire partie du corps en possession de l'exercice de la souveraineté politique pour obtenir la garantie de sa souveraineté individuelle, pas plus qu'il n'est nécessaire d'être boulanger pour se procurer du pain en belle qualité et à bon marché. Il suffit, dans le cas du monopole, de posséder le droit éventuel de coopération qui appartient au producteur et d'exercer, d'une manière efficace, le droit de contrôle et de limitation qui appartient au consommateur; enfin, dans le cas où le monopôle [413] n'est point nécessaire, de recourir à la concurrence.[65]
VI. Nationalité et patriotisme. — La suppression de la servitude politique, en vertu de laquelle la maison ou l'association exploitante d'un Etat impose ses services à la population du territoire soumis à sa domination, n'entraînera-t-elle pas la destruction de la nationalité et du patriotisme? Voilà ce qu'il s'agit encore d'examiner. Pour résoudre cette question, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur les origines et le développement de ces deux phénomènes d'ordre politique et moral.
Dans les temps primitifs, le troupeau ou la tribu, réuni par des affinités de race et une nécessité commune, constituait la nationalité. La défaite et la dispersion de ce troupeau entraînait la destruction à peu près certaine de tous ceux qui en faisaient partie, hommes, femmes et enfants. De là, la formation d'une « opinion » qui exigeait de la part de chacun le sacrifice ou la subordination de [414] ses intérêts particuliers à l'intérêt général de l'association. De là aussi, et par contre-coup, le développement d'un instinct ou d'un sentiment analogue à celui de la famille, qui embrassait dans un même culte le troupeau, ses institutions, ses membres vivants ou morts. Cet instinct ou ce sentiment, c'était l'attachement à la nationalité et, lorsque le troupeau se fut établi en permanence dans les localités où il trouvait sa subsistance, ce même sentiment s'étendit au milieu ou à l'habitat, et il devint l'amour de la patrie ou le patriotisme.
Dans la période suivante, lorsque l'Etat politique se spécialise et appartient exclusivement à une corporation conquérante et gouvernante, la nationalité se spécialise de même. La nationalité dominante est celle des maîtres de l'État; au-dessous d'elle, les populations assujetties forment des nationalités diverses, selon leurs affinités de race, de mœurs et de langage. Le patriotisme subit une évolution analogue. L'existence de chacun des membres de la corporation dominante étant attachée à celle de cette corporation, au maintien de sa hiérarchie et des autres institutions qui sont les facteurs de sa puissance, l'opinion fait passer l'intérêt corporatif avant tout autre et le patriotisme se résout dans la fidélité au chef et la confraternité avec les membres du corps politique unis par la communauté des intérêts. Chez les populations assujetties, le patriotisme ne dépasse guère l'enceinte de la commune ou du canton, il ne réunit les maîtres et les sujets que lorsqu'un danger égal de dépossession et de destruction menace les uns et les autres. Mais cette communauté de patriotisme disparaît à mesure que le risque de dépossession et de destruction provenant de la guerre et de la conquête s'affaiblit et s'inégalise en s'affaiblissant. Lorsque les invasions barbares ont cessé d'être à craindre, la corporation propriétaire et gouvernante ou auxiliaire de la maison souveraine demeure [415] cependant exposée à perdre sa situation prépondérante, à la suite d'une conquête étrangère; tandis que les populations assujetties, protégées par les progrès des usages de la guerre, n'ont plus à redouter qu'un simple changement de domination, et qu'il arrive même parfois qu'elles gagnent à ce changement. On s'explique donc que leur patriotisme soit moins intense que celui de la classe gouvernante et qu'elles soient moins disposées à dépenser leur sang et leur argent pour défendre l'État : pourvu qu'elles ne soient point molestées dans leur existence, leur propriété, leur industrie ou leur commerce, qu'elles conservent leurs institutions locales, l'usage de leur langue et de leurs coutumes traditionnelles, et qu'elles n'aient point à supporter une augmentation de charges, peu leur importe le reste. Telle était la situation dans les derniers temps de l'ancien régime. Cependant la rétrogression déterminée par la Révolution française dans les usages de la guerre et de la conquête est venue modifier cet état des choses et des esprits. Les guerres et les conquêtes de la Révolution et du premier Empire n'ont pas intéressé seulement, comme les précédentes, les dominations politiques; elles ont atteint les propriétés et les institutions particulières des populations et même leur langue. Faute de ressources financières suffisantes, les énormes armées que le gouvernement révolutionnaire recrutait avec une facilité extraordinaire, grâce au rétablissement du servage d'État, vivaient sur les pays envahis; on ne se contentait pas même des réquisitions de subsistances, on dépouillait les églises et les musées, on confisquait sans scrupule les domaines des corporations; enfin, on obligeait, sous prétexte de progrès, les populations à renoncer à leurs vieilles institutions pour adopter celles des conquérants, au premier rang desquelles figurait la conscription. De là une recrudescence et on pourrait dire une unification du [416] patriotisme dans tous les pays envahis ou menacés par la révolution. De nos jours, cette unification tend de nouveau à s'effacer, bien que la pratique des usages de la guerre et de la conquête ne soit pas encore revenue au point d'avancement qu'elle avait atteint avant la révolution, et que les conquérants modernes, à l'imitation de leurs devanciers révolutionnaires continuent à vouloir imposer leurs institutions et leur langue aux populations qu'ils assujettissent. Mais la multitude des consommateurs politiques commence à comprendre, quoique d'une manière encore vague et confuse, que son intérêt à agrandir les frontières de l'État ou à les récupérer quand elles ont été entamées, ou même à conserver l'État, diffère sensiblement de celui des maisons et des associations politiques qui vivent de l'exploitation de l'Etat ou aspirent à en vivre. Cette différence apparaît clairement quand on analyse les effets de la guerre et de la conquête au point de vue des intérêts des producteurs de services politiques, d'une part, des consommateurs de ces services de l'autre. La guerre et la conquête, en cas de succès, augmentent à la fois la puissance, le prestige et les profits du personnel politique et militaire qui gouverne l'Etat; les officiers montent en grade à la suite d'une campagne victorieuse, et les fonctionnaires civils voient s'accroître le débouché administratif par l'annexion d'un nouveau territoire; les consommateurs politiques, en revanche, supportent les charges de la guerre, sans recueillir aucun bénéfice appréciable de la conquête. Ils alimentent la guerre au moyen de l'impôt du sang, qui n'est pas susceptible d'être remboursé, et au moyen d'emprunts dont les intérêts et l'amortissement exigent un accroissement d'impôts, que les plus fortes indemnités de guerre ne parviennent point à balancer, sans parler de la perturbation que toute guerre apporte dans l'industrie et les affaires. S'ils tirent quelque avantage [417] du reculement des lignes de douanes, ce profit est compensé le plus souvent par l'abaissement des services politiques et administratifs résultant de l'agrandissement de l'État au delà de ses limites utiles. Enfin, l'exhaussement du risque de guerre résultant de l'appréhension d'une revanche de l'Etat vaincu et diminué a pour conséquence inévitable d'augmenter, d'une manière permanente, leurs charges militaires. En cas de revers, au contraire, les effets de la guerre et de la conquête affectent dans une proportion plus forte les intérêts des maisons ou des associations exploitantes de l'État, et du personnel qui leur sert d'auxiliaires. La défaite leur enlève une portion notable de leur puissance et de leur prestige, elle diminue leur débouché si elles sont obligées de céder une partie du territoire national, elle le supprime si elles sont entièrement dépossédées, tandis que les consommateurs politiques ne subissent que le dommage résultant de la substitution d'une domination à une autre. De là, des différences notables entre l'opinion de la classe qui vit de l'exploitation de l'Etat et celle de la masse des consommateurs politiques en matière de guerre et de conquête. Autant la première est disposée à engager la nation dans une entreprise de ce genre, pour peu qu'elle ait confiance dans le succès, autant la seconde y répugne. Et, quand au lieu de succès viennent les revers, quand la maison ou l'association gouvernante se voit menacée d'une dépossession partielle ou totale, elle s'efforce de prolonger la lutte sans se faire scrupule d'imposer à la nation des sacrifices illimités; tandis, au contraire, que la multitude gouvernée réclame la paix avec une insistance plus marquée à mesure qu'elle estime que les sacrifices qu'on lui impose dépassent la mesure du dommage que lui infligerait une conquête partielle ou même une conquête entière. Sa voix ne tarde pas, à la vérité, à être étouffée par les clameurs des politiciens qui l'accusent [418] de manquer de patriotisme, et c'est seulement lorsque la nation est entièrement épuisée que la lutte cesse.
A. le bien considérer, le patriotisme, tel que l'entendent les politiciens modernes, et tel qu'ils sont parvenus à l'imposer à l'ignorance de la foule, en flattant ses passions grossières, n'est autre chose qu'une branche, on pourrait dire la branche maîtresse du protectionnisme. Sur quelle base se fonde la doctrine protectionniste? Sur l'appropriation du marché national aux producteurs indigènes; impliquant l'obligation pour les consommateurs de s'approvisionner exclusivement de produits nationaux, quand même ils pourraient se procurer ces articles en meilleure qualité et à meilleur marché à l'étranger. C'est une « servitude » économique qui avait sa raison d'être à l'époque où .les nations civilisées vivaient sous le régime de l'état de siège, mais qui l'a perdue depuis, nous avons vu sous l'influence de quels phénomènes d'évolution.
Dans l'opinion des protectionnistes, cette servitude n'a point cessé d'être nécessaire, et le devoir des consommateurs est de s'y soumettre quand même. Dans l'opinion du consommateur, au contraire, ce devoir n'existe pas, et c'est en vain qu'on a fondé des ligues ou des associations pour en raviver l'a notion, on n'a réussi nulle part à persuader aux consommateurs qu'ils devaient donner la préférence aux produits nationaux et à les détourner d'acheter des similaires étrangers quand ils croyaient y trouver avantage, ces produits similaires eussent-ils l'origine la plus détestée. Alors, qu'a-t-on fait? On a renforcé et étendu de plus en plus l'appareil de prohibitions et de pénalités qui avaient pour objet de contraindre les consommateurs à se soumettre à cette servitude, et quand les économistes ont entrepris de démolir cet appareil suranné, on les a accusés de vouloir ruiner l'industrie nationale au profit de l'industrie étrangère, en un mot, de manquer de patriotisme.
[419]
De même, la nation, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs politiques, dans les limites où s'étend la domination de l'État et de ses détenteurs, appartient ou est assujettie à l'État. Quelles que soient l'infériorité et la cherte des services qu'elle en reçoit, non seulement elle est obligée de s'en contenter, et ce serait un crime de les demander à un État étranger au moyen d'une annexion totale ou partielle; mais encore son devoir envers la patrie lui commande de mettre au besoin sans compter son sang et ses ressources à la discrétion des détenteurs de l'État pour empêcher la concurrence étrangère d'empiéter sur leur marché. Seulement, comme les consommateurs ne comprennent guère mieux ce qu'ils doivent à l'État que ce qu'ils doivent à l'industrie nationale, on les contraint à fournir par voie d'impôt, de réquisition ou de conscription, les capitaux et les hommes nécessaires à la défense des frontières de l'État et au besoin à leur agrandissement. Ceux qui refusent de se soumettre aux sacrifices qu'on leur impose dans l'intérêt de la patrie, ou même qui se contentent de protester contre leur exagération, sont accusés encore de manquer de patriotisme.
II y a toutefois une distinction à établir entre la protection de l'industrie et celle de l'État. En admettant que l'on cesse de protéger l'industrie, les consommateurs, libres de s'adresser aux industries concurrentes dans le pays et ù l'étranger, seront toujours assurés de pouvoir s'approvisionner des produits dont ils ont besoin aux conditions les plus avantageuses. Il en sera autrement pour les services politiques. Ces services, continuant partout d'être grevés d'une servitude au profit de l'État, la conquête expose les consommateurs à être assujettis à un Etat inférieur en civilisation, qui leur impose, à la mode révolutionnaire, ses institutions rétrogrades et son personnel de fonctionnaires aux allures despotiques et, de plus, leur [420] fasse payer à un plus haut prix des services de qualité moindre. Mais encore les sacrifices qu'on leur impose pour la protection de l'Etat devraient-ils être proportionnés à ce risque. Quand ils dépassent le montant de la prime nécessaire pour le couvrir, ils cessent d'être conformes à l'intérêt des consommateurs, c'est-à-dire à l'intérêt général, et la nation subirait un dommage moindre à être exposée à la conquête étrangère qu'à supporter des charges en disproportion avec le dommage auquel la conquête l'expose.
Malheureusement, ce n'est pas la masse des consommateurs politiques qui décide des questions de paix ou de guerre. Cette décision appartient encore, même dans les pays réputés les plus libres, au personnel gouvernant, qui, tirant ses moyens d'existence de l'industrie politique, a un intérêt illimité à imposer ses services aux consommateurs, tandis que ceux-ci n'ont qu'un intérêt limité à les recevoir de préférence à d'autres. On a pu constater fréquemment les différences d'opinion résultant de cette différence d'intérêt, dans les pays qui viennent à être assujettis à une domination étrangère, — ce qui, d'ailleurs, est parfois un avantage et un progrès, quand le gouvernement indigène était oppressif et vicieux. Si le gouvernement nouveau n'est pas plus lourd que l'ancien, s'il respecte les mœurs, les coutumes et la langue des populations, la masse des consommateurs politiques se résigne aisément k ce changement de domination. En revanche, la classe politique ne l'accepté que dans le cas où le conquérant lui conserve la situation prépondérante qu'elle possédait et qu'il est bien rarement en son pouvoir de lui conserver, car il est obligé de compter avec les appétits de son personnel. Cette classe politique dépouillée de son débouché demeure à l'état de conspiration et saisit toutes les occasions favorables de reconquérir l'État qu'elle a perdu. Il [421] arrive alors que les consommateurs politiques sont obligés de payer deux impôts : l'un à l'État étranger, sous la domination duquel la conquête les a fait tomber, l'autre à l'État national, représenté par les conspirateurs. Ils cherchent naturellement à sortir de cette situation critique et finissent d'ordinaire par faire cause commune avec les conspirateurs au milieu desquels ils vivent et qui se croient autorisés, d'ailleurs, à titre de représentants de la « nationalité », à soumettre ceux qui leur refusent obéissance et secours à des pénalités autrement terribles et sommaires que celles auxquelles peut avoir recours un gouvernement régulier. Ce qui ne les empêche pas de regretter plus tard, — quand la conspiration, devenue gouvernement, a augmenté leurs charges, — la domination étrangère.
Lorsque le gouvernement étranger a été expulsé, on ne manque pas de célébrer la délivrance de la patrie, mais ce n'est pas tout. Si quelque morceau du territoire réputé national reste soumis à ce gouvernement ou à un autre, on s'écrie douloureusement que la patrie n'est pas faite, et on soutient qu'aucun sacrifice ne doit lui coûter pour récupérer le morceau qui lui manque, — quand même la population de ce morceau manquant préférerait le statu quo. Au moins, lorsque la patrie est faite, renonce-t-on à l'agrandir? Nullement. Tantôt il lui faut des « frontières naturelles », tantôt elle a besoin de s'annexer des races approximativement de même famille pour faire contrepoids à des races naturellement ennemies, sauf à nationaliser de gré ou de force celles qui ne sont pas suffisamment nationales. Il est bien entendu encore que les hommes, qui s'opposent à cet agrandissement de la patrie ou, en d'autres termes, à l'extension du débouché des industriels politiques qui exploitent l'État, sont dépourvus de patriotisme.
Voilà comment le protectionnisme politique exploite et [422] fausse la notion de la nationalité et le sentiment de la patrie.
Maintenant, supposons que la nécessité, déjà contestable, de la servitude politique vienne à disparaître comme a disparu celle de la servitude économique : qu'adviendra-t-il de la nationalité et du patriotisme? Parce que les consommateurs politiques pourront, individuellement ou collectivement, demander la sécurité de leur vie, de leurs propriétés et de leurs transactions à l'établissement national ou étranger qui leur fournira ce service en meilleure qualité et au meilleur marché, s'ensuivra-t-il que la « nationalité » cessera d'exister? N'est-elle pas déjà mise en péril à un plus haut point par l'importation étrangère des produits agricoles qui s'incorporent au consommateur et font entrer dans sa chair et dans ses os des éléments étrangers? La nationalité dérive à la fois de phénomènes géographiques, physiologiques, économiques et moraux; elle dépend de la situation, des affinités de race, de l'ancienneté des relations, de la communauté du langage; aussi longtemps que ces facteurs de la nationalité subsistent, elle se maintient avec tous ses signes caractéristiques: c'est ainsi qu'il y a une nationalité anglaise, française, russe, allemande, espagnole. La servitude qui oblige une nation à demander les services politiques dont elle a besoin à un établissement indigène, à l'exclusion de tout autre, ne contribue pas plus à sauvegarder sa nationalité que ne le ferait l'obligation qui lui serait imposée de se pourvoir exclusivement de produits agricoles et industriels dans les fermes et les manufactures nationales. Au contraire! Si la servitude politique associe des races antipathiques ou simplement dissemblables, des Anglais et des Irlandais, des Russes et des Polonais, des Allemands et des Français, et si les plus fortes, suivant en cela la tradition révolutionnaire, prétendent imposer leurs institutions et leur [423] langue aux plus faibles, les caractères originaux et utiles de celles-ci finiront par s'effacer, tandis que l'amalgamation forcée d'un élément hétérogène altérera le type national de celles-là. Il en sera autrement si les peuples sont libres dans leurs relations politiques et autres : ces relations déterminées alors uniquement par l'intérêt et la sympathie seront les plus favorables à la conservation et au perfectionnement des types nationaux. Est-il nécessaire d'ajouter que l'amour de la patrie est indépendant de la provenance des services politiques comme de celle des produits agricoles ou industriels? Ce sentiment respectable se compose, comme nous l'avons remarqué, de deux sortes d'éléments: l'amour du sol et du milieu physique où la créature humaine a grandi, et l'attachement particulier à la tribu ou à la nation dont elle fait partie, impliquant le désir de la voir dépasser les autres en richesse, en puissance et en civilisation. Or, si la servitude politique, après avoir été une condition nécessaire de l'existence et de la prospérité des nations perd sa raison d'être et devient au contraire pour elles une cause d'affaiblissement et de retard, ne serace point faire acte de patriotisme que de les en affranchir?
Endnotes
[58] Voir L'Évolution économique.
[59] La conquête et l'occupation de l'Inde offrent cette particularité digne de remarque qu'elles ont été exécutées commercialement en vue des bénéfices qu'elles pouvaient procurer à une compagnie d'actionnaires. Fondée en l'an 1600, au capital assez modeste de 80,000 livres sterling, la « Compagnie des marchands de Londres faisant le trafic des Indes Orientales » obtint de la reine Elisabeth le monopole du commerce dans toutes les mers situées au delà du cap de Bonne-Espérance et du détroit de Magellan. Elle s'occupa d'abord uniquement d'opérations commerciales, et elle réalisa des bénéfices considérables : de 1603 à 1613, huit expéditions successives rapportèrent, en moyenne, aux actionnaires des dividendes de 171 p. 100. Ces bénéfices excitèrent naturellement la Compagnie à étendre la sphère de ses opérations et à multiplier ses comptoirs. Mais ceux-ci n'étaient pas toujours respectés par les princes indigènes. La Compagnie fut obligée d'enrôler des troupes pour les défendre. En 1686, Jacques II l'autorisa à attaquer les Mongols, dont elle avait à se plaindre, et peu de temps après elle fut investie des pouvoirs nécessaires pour faire la guerre et la paix « avec les princes et les peuples pourvu qu'ils ne fussent pas chrétiens ». La Compagnie des marchands de Londres cessa dès lors d'être purement commerciale ou pour mieux dire, elle fit entrer au nombre des opérations de son commerce le gouvernement des contrées où elle avait fondé ses établissements. « L'accroissement du revenu par l'impôt, écrivaient les directeurs à leurs agents, vers la fin du xvnc siècle, doit être désormais le but de nos efforts aussi bien que le développement de notre commerce. » Les agents de la Compagnie suivirent fidèlement ces nouvelles instructions et ils finirent, à force d'audace et de persévérance, par substituer dans l'Inde le pouvoir d'une simple compagnie dc marchands à celui du Grand Mogol. Les acquisitions territoriales, qui n'avaient d'abord été pour elle qu'un accessoire, devinrent peu à peu le principal. Elle conservait cependant encore le monopole du commerce avec l'Inde et la Chine ; mais sur les plaintes des négociants de la métropole, le Parlement lui enleva, en 1814,1e privilège exclusif du commerce de l'Inde et, en 1834, celui du commerce de la Chine. A dater de cette époque jusqu'en 1858, où le gouvernement l'a abolie pour se mettre à sa place, la Compagnie (les Indes a cessé entièrement d'être une compagnie de commerce pour n'être plus qu'une « compagnie de gouvernement ».
Au 30 avril 1856, la Compagnie des Indes exercait sa domination sur une superficie d'environ 3 millions de kilomètres carrés et sur .une population de 131,990,000 habitants. En outre, son influence ou son patronage s'exerçait sur une série d'États indigènes comprenant ensemble une population de 48.376,000 habitants. 180 millions d'hommes se trouvaient ainsi soumis à sa domination ou à son influence.
Malheureusement, si l'Inde était -soumise à la Compagnie, la Compagnie était soumise à son tour à la couronne, et depuis 1784, époque de la fondation du Board ofcontrol, cette sujétion était devenue de plus en plus étroite. La Compagnie avait joui jusqu'alors d'une certaine indépendance, quoiqu'elle fût obligée de faire renouveler son privilège tous les vingt ans. Elle se gouvernait elle-même, et la couronne n'exerçait sur elle qu'un faible controle. Mais, à la fin du xviiie siècle, les conquêtes de Clive ayant rendu la Compagnie maîtresse de la plus grande partie de l'Inde, sa puissance croissante ne manqua point d'exciter la jalousie du gouvernement. Les déprédations de Warren Hastings et le procès scandaleux auquel elles donnèrent lieu, fournirent bientôt au Parlement un motif plausible pour intervenir dans l'administration de la Compagnie. Le Bureau de contrôle fut institué avec des pouvoirs qui lui attribuaient la prépondérance réelle dans la direction des affaires de l'Inde. A partir de ce moment, la Compagnie fut obligée de subir la politique qu'il plut au gouvernement de lui imposer. Cette politique n'était, il faut bien le dire, ni intelligente ni élevée. Le gouvernement anglais ne se préoccupait ni des intérêts de la compagnie ni de ceux des populations qu'elle gouvernait : il ne songeait qu'à étendre la domination britannique et, avec elle, le patronage lucratif de l'aristocratie gouvernante.
En conséquence, il imposait à la Compagnie l'obligation de maintenir sur pied une armée formidable, et il la poussait incessamment à faire de nouvelles conquêtes. Si la Compagnie objectait l'insuffisance de ses ressourceg,<m l'autorisait à contracter des emprunts; si elle objectait encore la nécessité de distribuer des dividendes à ses actionnaires, on lui permettait de leur allouer, en tout temps, un dividende ou un intérêt de 10 1/2 p. 100.
L'organisation de la Compagnie des Indes ne différait pas essentiellement de celle d'une compagnie ordinaire. Son capital, qui était de 6 millions sterling à l'époque où elle a été abolie, se trouvait réparti entre environ 4,000 actionnaires ; mais ceux-ci n'étaient admis à participer à la gestion de la Compagnie qu'à la condition de posséder des actions jusqu'àconcurrencc de 1,000 livres sterling. Une part de 1,000 livres dans le capital donnait droit à une voix ; une part de 3,000 livres, à deux voix ; une part de 6,000 livres, à trois voix; enfin une part de 10,000 livres et plus, à quatre voix. Le nombre des actionnaires admis à voter était, en dernier lieu, de 1,780. Les actionnaires étaient admis à exercer leur droit sans distinction de nationalité ni de sexe et, parmi les 1,780 votants, on ne comptait pas moins de 400 femmes. Ces 1,780 actionnaires actifs, qui possédaient une part de capital de 1.000 livres et au-dessus se réunissaient quatre fois par an en assemblée générale (cour des propriétaires). Ils nommaient le conseil d'administration (cour des directeurs), qui a été composé tantôt de 24 et tantôt de 18 membres ; ils contrôlaient les dépenses, votaient les budgets, etc., etc. Le conseil d'administration, ou la cour des directeurs, était chargé de la gestion de l'entreprise. Il'se divisait pour l'expédition des affaires en trois comités: finances et intérieur, politique et guerre, revenus et justice. Tous les ans, les 6 directeurs le plus anciennement élus étaient remplacés. Un directeur ne pouvait être réélu qu'un an après sa sortie de fonctions. La cour des directeurs se choisissait un 'président, lequel était chargé de présider aussi les assemblées générales des actionnaires.
La cour des directeurs constituait donc le pouvoir exécutif de la Compagnie. Seulement, depuis 1784, époque à laquelle le gouvernement avait constitué le Board of control, la cour des directeurs était obligée de soumettre toutes ses décisions et toutes ses mesures de quelque importance à l'approbation de ce bureau de contrôle ou de surveillance, dont les membres étaient nommés par le souverain dans son conseil privé. Le Board of control avait fini même par empiéter sur les pouvoirs du conseil d'administration de la Compagnie, de facon à s'attribuer la direction réelle du gouvernement de l'Inde et à entraîner la Compagnie dans la voie coûteuse de la politique d'annexions. La Compagnie était constituée pour une période illimitée ; pliais sou privilège avait été limité à vingt années. Au bout de cette période, il était soumis au Parlement qui le renouvelait, en en modifiant plus ou moins les conditions. Il expirait en 1854, mais à cette époque l'opinion favorable au gouvernement direct de l'Inde ayant commencé à prévaloir, on ne l'a renouvelé que d'une manière provisoire jusqu'à la dissolution de la Compagnie en 1858.
De l'aveu de tous les voyageurs, les régions soumises à la Compagnie étaient incomparablement mieux administrées que celles qui étaient demeurées assujetties à la domination des princes indigènes. La police y était mieux faite, le pauvre y pouvait obtenir justice contrôle riche, et la presse jouissait dans l'Inde d'une liberté entière. Au bienfait d'une sécurité et d'une liberté inconnues dans le reste de l'Asie et même dans une bonne partie de l'Europe, il faut ajouter encore une énergique impulsion donnée aux travaux publics.
La Compagnie avait fait exécuter d'immenses travaux d'irrigation, construit les canaux de la Jumma et du Gange, le barrage du Godavery, etc. Enfin c'est à l'époque de sa domination qu'ont été commencés les travaux des chemins de fer et des télégraphes. En 1858, un réseau télégraphique de 5,000 kilomètres reliait les principaux foyers de population de l'Inde et près de 4,000 kilomètres de chemins de fer étaient en construction. [Note: La Domination anglaise dans l'Inde. Economiste belge. (Avril-juin 1858.)]
Dans une remarquable brochure intitulée :Suggestions fur a future government of India, miss Harriet Martincau faisait ressortir la supériorité du gouvernement de la Compagnie sur le gouvernement colonial de la métropole et elle signalait les causes de cette supériorité, qu'elle qualifiait de « manifeste et indiscutable ».
« Pendant des siècles de changements continuels et de fréquentes perturbations que les Anglais pouvaient contrôler chez eux, mais qui ne pouvaient manquer d'être terriblement nuisibles aux intérêts des colonies, le gouvernement de l'Inde a été stable, consistant et aussi immuable aux yeux de ses sujets indiens que celui d'un Dieu assis sur un trône inébranlable. Dans ce ras particulier, cette stabilité du gouvernement a été un inestimable bienfait. Sou caractère corporatif, la succession de ses chefs d'origine diverse, l'ont préservé des maux du despotisme, tandis que son indépendance de la politique du jour l'a protégé contre la multitude des inconvénients des changements de partis, — inconvénients que nous reconnaissons être des maux chez nous, quoique nous les préférions à ceux de tout autre système. Dans l'Indoustan, le caractère non politique de la Compagnie a été absolument une question vitale. Notre domination n'aurait pu y être maintenue si les autorités d'lndia House avaient été changées avec chaque ministère...D'un autre côté, le public n'ignore pas que partout où l'on a pu établir une comparaison entre les fonctionnaires du gouvernement et ceux de la Compagnie, la supériorité de ces derniers a été manifeste et indiscutable. Les chefs militaires de la Compagnie ou les officiers de la reine à la solde de la Compagnie et accoutumés de la guerre indienne, ont remporté des succès aussi brillants que les déconvenues des autres ont été lamentables. Le public a eu moins souvent l'occasion de constater à quel point le même contraste existe dans le service civil, mais il n'est pas moins sensible pour tous ceux qui sont au courant des affaires des deux gouvernements. »
Miss Harriet Martineau terminait par cette prédiction:
« Si nous nous hâtons de décider que l'Inde sera une colonie de la couronne, gouvernée directement et entièrement par l'Angleterre, d'après les notions et les habitudes existantes de notre régime colonial, nous perdrons l'Inde promptement, honteusement et d'une manière si désastreuse que ce sera uue des calamités les plus mémorables de l'histoire des nations. »
La prédiction de miss Martineau ne s'est pas encore réalisée, mais le rapide accroissement du budget et de la dette de l'Inde, sous le régime du gouvernement direct, confirme amplement ce qu'elle disait de la supériorité économique du gouvernement de la Compagnie.
Dans' l'exercice finissant le 30 avril 1856, les dépenses de la Compagnie étaient de liv. 29,154,490; elles se sont élevées à liv. 71,113,079 dans l'exercice 1881-1882. La dette a monté de liv. 34,684,997 en 1840 à liv. 157,388,879 en 1881.
Il est permis de croire, avec miss Martincau, que l'Angleterre aura quelque our à se repentir d'avoir assumé la lourde tâche du gouvernement direct de l'Inde. A l'époque où a eu lieu cette annexion rétrograde et anti-économique du domaine de la Compagnie à la régie de la couronne, voici comment nous proposions de résoudre la question indienne. Si nous reproduisons celte solution, c'est parce que le gouvernement de la Compagnie des Indes est, à nos yeux, le type des gouvernements de l'avenir.
Eu définitive, disions-nous (La Domination anglaise dans l'Inde), l'Angleterre, tout en s'attribuant la possession politique de l'Inde, ou si l'on veut, le droit de la gouverner, délègue ce droit à une compagnie organisée commercialement, mais en intervenant d'une manière plus ou moins active dans la gestion de celte compagnie concessionnaire du service gouvernemental de l'Inde et en se réservant la faculté de rompre le contrat au bout de vingt années ou d'en modifier les conditions. C'est pour tout dire le système de Va/fermage, transporté dans le domaine gouvernemental et substitué à celui du gouvernement direct ou de la régie.
Le système de l'affermage constitue évidemment un progrès économique sur celui de la régie, et ce serait faire un pas rétrograde que de l'abandonner pour revenir à ce dernier. Mais il ne s'ensuit pas qu'il soit nécessaire de conserver intact le mode actuel de concession ou d'affermage du gouvernement de l'Inde. Il ne s'ensuit pas non plus qu'il faille s'en tenir toujours aux conditions stipulées avec les premiers concessionnaires.
Ainsi l'expérience a démontré que l'Inde est maintenant trop vaste pour être bien gouvernée par une seule compagnie. Pourquoi ne diviserait-on pas la concession primitive? pourquoi ne fractionnerait-on pas l'Inde entre trois ou quatre compagnies, ayant chacune 40 à KO millions d'âmes à gouverner, au lieu de 130? N'est-il pas évident que le fractionnement d'un service trop vaste permettrait de le mieux remplir, et quo l'Inde serait beaucoup mieux gouvernée par trois ou quatre compagnies qu'elle ne peut l'être par une seule?
Dans l'état actuel des choses, avec l'intervention continue et tracassière du gouvcr.icmcnt dans les affaires de l'Inde, avec son système militaire et annexionniste qui a été si ruineux pour les finances de la Compagnie actuelle, ou trouverait sans doute assez difficilement des capitalistes disposés à aventurer leurs fonds dans de semblables entreprises. Mais on pourrait accorder aux compagnies concessionnaires plus de liberté dans leurs allures, ainsi que des concessions à plus longs termes. D'un autre côlé,lc gouvernement stipulerait différentes garanties en faveur des populations dont il affermerait ou concéderait ainsi l'administration ; il stipulerait, par exemple, que les impôts ne pourraient dépasser un certain chiffre, que les libertés les plus essentielles, la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté d'association, etc., devraient être respectées; enfin que la non-exécution de ces clauses rendrait le contrat nul de plein droit.
Ces compagnies ainsi maîtresses de leur gestion, à la seule condition d'exécuter les clauses de leur contrat, recruteraient leur personnel d'employés civils et militaires où ils seraient les meilleurs et au meilleur marché, sans faire aucune acception de nationalité. Le principe du fret trade serait appliqué à l'Inde pour les services aussi bien que pour les produits, et l'on verrait, en conséquence, s'y accroître rapidement l'élément européen qui s'y trouve aujourd'hui dans des proportions tout à fait insuffisantes.
Sans doute, l'Angleterre fournirait le plus grand nombre des actionnaires et du personnel des nouvelles compagnies, comme elle fournit encore les trois quarts des produits européens consommés dans l'Inde; mais enfin elle n'aurait plus, à aucun degré, le « monopole de l'Inde »; elle admettrait toutes les nations à concourir au gouvernement de ce vaste empire, au moyen de leurs capitaux ou de leurs services ; elle ne se réserverait qu'un simple patronage qui ne conférerait à ses nationaux aucun bénéfice, aucun avantage exclusif. Or, du moment où l'Inde ne procurerait plus aux Anglais aucun avantage particulier, du moment où tous les Européens seraient admis à y remplir toutes les fonctions publiques sur le même pied que les Anglais, nous ne voyons pas qui pourrait songer encore à déposséder l'Angleterre de ce patronage qu'elle exercerait pour l'avantage commun des peuples civilisés. Toutes les nations ne seraient-elles pas intéressées, au contraire, à le lui conserver, afin d'éviter le retour d'une domination exclusive qui substituerait, de nouveau, en matière de gouvernement, le principe du monopole à celui du Free trade?
Ce système ne serait, remarquons-le bien, qu'un perfectionnement du système actuel. Le principe demeurerait le même. Ce serait toujours la concession ou l'affermage substitué à la régie. Il n'y aurait de changé que le mode et les conditions de l'application. Au lieu d'une seule compagnie concessionnaire, devenue insuffisante pour gouverner un empire que des annexions successives ont rendu de plus en plus vaste, il y aurait autant de compagnies que cela serait nécessaire pour que l'Inde fût économiquement gouvernée. D'un autre côté, au lieu [de limiter la durée des concessions et d'assujettir les concessionnaires à l'intervention gênante et tracassière du Board of contrat, on leur assurerait une possession illimitée, à la seule condition d'exécuter fidèlement un cahier des charges dont les articles concerneraient surtout les garanties à accorder aux peuples gouvernés. Les compagnies réuniraient ainsi ces deux conditions essentielles à .toute bonne exploitation : la sécurité et la liberté. Elles seraient intéressées du reste à bien gouverner les peuples soumis à leur domination, afin de rendre plus productives les sources d'où elles tireraient leurs revenus; et l'Angleterre, de son côté, n'aurait pas moins d'intérêt à les empêcher de vexer et de pressurer leurs sujets. Car plus la situation des peuples de l'Inde deviendrait prospère, plus le commerce que font avec eux les nations européennes et l'Angleterre en particulier pourrait prendre d'extension, plus abondantes et plus fructueuses deviendraient les relations de l'Europe avec l'Inde. Les intérêts les plus élevés de la civilisation ne seraient pas moins bien servis par l'adoption de ce système qui détruirait les dernières barrières que l'esprit de monopole a élevées entre l'Inde ot le reste du monde; qui permettrait aux capitaux et aux intelligences, sans distinction d'origine, de contribuer à faire pénétrer dans ce foyer presque éteint de l'antique civilisation les idées, les inventions et les méthodes vivifiantes et progressives de la civilisation moderne.
[60] Voici, d'après le Financial reform Almanack pour 1884, le relevé des denrées alimentaires de toute espèce importées en Angleterre en 1840 sous le régime de la protection et en 1882, sous le régime du free trade:
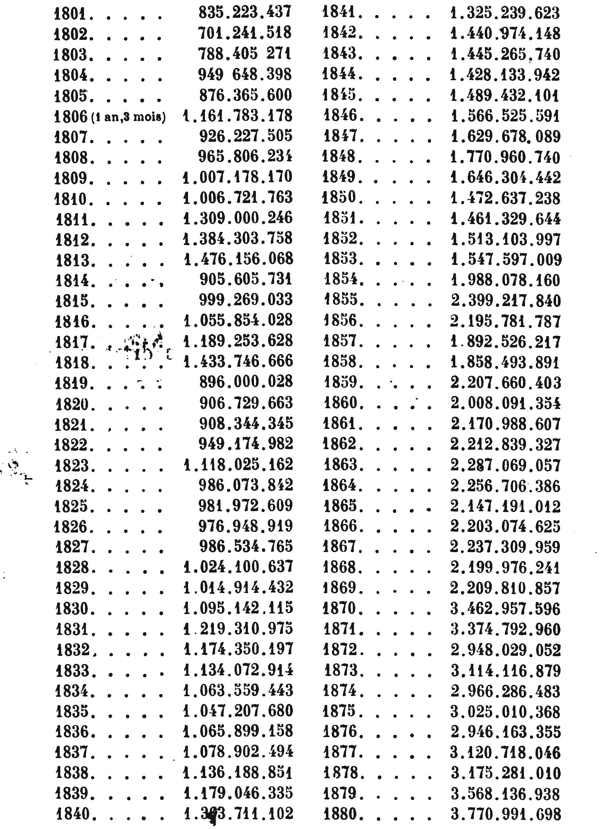
Tous ces articles entrent maintenant en franchise, à l'exception du cacao, du café, des groseilles, des raisins et du thé.
Ne suffit-il pas de jeter un simple coup d'œil sur ce relevé pour se convaincre que la paix s'impose aujourd'hui comme une nécessité aux peuples civilisés?
[61] Les pénalités contre les manœuvres séparatistes ont été renouvelées en France par la loi de 1871 contre l'Association internationale des travailleurs et le séparatisme.
« L'idée même de patrie, lisons-nous dans l'exposé des motifs du projet de loi, disparaîtrait s'il était loisible de proposer la rupture du lien national, sans que la loi pût réprimer de pareilles provocations.
« Les lois qui répriment les crimes et délits contre l'ordre public sont muettes cependant sur ce point et ne contiennent aucune peine contre ce genre de délit nouveau dans notre pays. L'article 77 du Code pénal punit de la peine capitale les intelligences entretenues et les manœuvres pratiquées avec les ennemis de l'Etat pour leur livrer une partie du territoire. La provocation par la voie de la presse à des crimes de cette nature est punie par les lois sur la presse, et notamment par les articles 1 et 2 de la loi du 17 mai 1819, qui punissent la provocation publique aux crimes et délits. Mais ces dispositions ne seraient pas facilement appliquées aux manœuvres ou aux manifestations publiques des séparatistes, ni à l'appel fait au suffrage universel pour le provoquer à se prononcer contre le maintien national.
« C'est cette lacune que le projet de loi soumis à l'Assemblée aurait pour objet de combler. Nous ne proposons que des peines modérées et prises dans la nature même du délit : le condamné sera privé de la qualité de citoyen français après en avoir méconnu et la dignité et les devoirs les plus essentiels. Soumis en France à la condition des étrangers, privé de cette nationalité qu'il aurait, en quelque sorte, abjurée par avance, il ne pourrait reconquérir la qualité de Français qu'en accomplissant les conditions prescrites à l'étranger qui aspire à devenir citoyen.
« La loi préserverait ainsi le principe de la souveraineté nationale d'attaques dont le danger n'est sans doute pas grand au milieu de populations françaises de cœur, mais qui ne sauraient rester impunies. »
[62] Voir les Soirées de la rue Saint-Lazare, 11° soirée, p. 303. — Les Questions d'économie politique et de droit public, la liberté de gouvernement, t. II, p. 24S. — Cours d'économie politique, les consommations publiques, 126 leçon, p. 480.
[63] La nécessité de ces groupements se fit sentir aussi pour l'administration des services religieux. C'est ainsi qu'on voit, à l'époque de l'établissement et de la propagation du christianisme, se former des communes religieuses ou paroisses, dans un rayon plus ou moins étendu selon la configuration du sol, la densité rtc la population, la facilité plus ou moins grande des communications. Lorsque la hiérarchie se constitue, ces paroisses se groupent ou sont groupées selon leur situation topographiquc et leurs affinités de race et de langue, et elles forment un évéché ; les évéchés à leur tour sont groupés en archevêchés toujours en tenant compte des circonstances naturelles parmi lesquelles il ne faut pas oublier l'appartenance politique; enfin, les archevêchés ressortent directement du pape, sous la réserve de leurs obligations envers le propriétaire politique de l'État.
[64] En confisquant l'État politique et en faisant suivre cette confiscation de celle des biens du clergé et d'une partie de la noblesse, la révolution a créé un « risque » qui menace tous les propriétaires et qu'une nouvelle révolution collectiviste ou anarchiste se chargera de faire échoir. Quel langage tiennent, en effet, aujourd'hui les collectivistes et les anarchistes? Ils disent: La révolution bourgeoise de 1789 a donné la puissance politique au tiers état, et elle a fait passer entre ses mains, par voie de confiscation, les biens de la noblesse et du clergé! Eh bien, ce qui a été fait alors au profit du tiers état, c'est-à-dire de la bourgeoisie, il s'agit de le refaire au profit du quatrième état, c'est-à-dire du peuple. Notre tâche à nous, c'est d'achever l'œuvre de la révolution en transformant en « biens nationaux » les exploitations agricoles, minières, industrielles et autres appartenant à la bourgeoisie capitaliste, comme nos pères ont transformé en « biens nationaux u les propriétés de la maison souveraine, de la noblesse et du clergé.
« La révolution qu'il s'agit de faire aujourd'hui contre la bourgeoisie, dit un écrivain notable du collectivisme, M. Jules Guesde (Collectivisme et Révolution), la bourgeoisie, lorsqu'elle n'était encore que le tiers état, l'a faite elle-même contre la noblesse et le clergé! Il n'est personne qui ne se souvienne comment elle s'est approprié en 89 les « biens » de ces deux ordres après les avoir déclarés « nationaux ». Et ce n'est pas parce qu'au lieu de s'emparer comme elle l'a fait à son profit exclusif de plus des deux tiers de la France, les prolétaires entendent approprier collectivement la France entière au bénéfice de tous, — les bourgeois y compris (?), —• que leur révolution pourrait être moins justifiée que l'autre. Bien au contraire.
« Car, — on ne saurait trop insister sur ce point, — ce qui caractérise la révolution poursuivie par la B'rance ouvrière ou le quatrième état, c'est qu'elle ne tend pas à substituer une classe à une autre classe dans la possession du sol et des autres capitaux, mais à fondre toutes les classes en une seule, celle des travailleurs, au service desquels devra être mis l'ensemble des capitaux de production. »
A ce langage, nous ne voyons pas ce que pourraient répondre les écrivains qui se plaisent à justifier la légitimité des confiscations révolutionnaires en France, la « reprise » des biens du clergé et des couvents dans les autres pays. Si le tiers état a eu le droit de confisquer les biens de la noblesse et du clergé avec l'État lui-même, le quatrième état n'a pas un droit moins évident de confisquer les biens de la bourgeoisie capitaliste pour les mettre au service de la « classe des travailleurs ».
Il n'y a, quoi qu'en disent les sophistes prétendus libéraux et conservateurs, aucune différence substantielle entre ces deux sortes de propriétés. Les unes et les autres ont été également'le fruit du travail et des services rendus. Si la noblesse n'a pas défriché, avec la houe et la charrue, le sol de ses domaines, elle l'a défendu pendant des siècles et il n'est pas xm sillon qui n'ait été arrosé de son sang; elle a produit la sécurité sans laquelle aucune terre n'eût été cultivée, et ce service, comme nous l'avons démontré ailleurs (Cours d'économie politique, 13e leçon, la Part de la terre), s'est incorporé dans le sol, il a été l'un des premiers éléments de la râleur de la terre. Les biens du clergé n'ont pas eu une origine moins légitime; ils ont été la récompense de services non moins nécessaires : ceux du gouvernement politique et moral de multitudes encore à l'état demi-sauvage, et c'est aux monastères que l'on doit le défrichement de la plus grande partie du sol et la renaissance de l'industrie et des lettres après les grandes invasions barbares. Dira-t-on que ces propriétés ont été accrues et viciées par les privilèges et les monopoles? Mais n'en peut-on pas dire autant de celles de la bourgeoisie? Qncl a été l'objet des monopoles conférés aux banques, aux Compagnies de chemins de fer et, finalement, à tous les entrepreneurs d'industrie que protègent les tarifs douaniers, sinon d'augmenter leurs revenus, partant leurs propriétés, aux dépens de la masse des consommateurs de leurs produits ou de leurs services? Dira-t-on encore que la noblesse s'était amollie, que les moines s'étaient corrompus et que les couvents étaient devenus des repaires du vice et de la fainéantise, que noblesse et clergé avaient fini par soulever contre eux la haine de toutes les autres classes de la nation? Mais si l'on compare les mœurs de la bourgeoisie gouvernée du xvnc et du xvin" siècle à celles de la bourgeoisie politicienne du xixe siècle, est-ce bien un progrès que l'on pourra constater? Si la corruption et la fainéantise étaient des motifs suffisants pour légitimer la confiscation, l'État ne serait-il pas autorisé à reprendre les biens de tous ces beaux fils d'industriels, de négociants, de financiers, [qui dissipent dans l'oisiveté et la débauche la fortune que des pères entreprenants, laborieux et économes leur ont léguée? Enfin, si l'impopularité d'une classe devait justifier sa dépossession, les entrepreneurs d'industrie, les propriétaires de mines et autres ne seraient-ils pas exposés aujourd'hui à être expropriés au même titre que l'ont été les nobles, les prêtres et les moines? Ne pourrait-on pas prétendre même, en lisant les journaux socialistes, en écoutant les discours des meetings populaires et les conversations d'atelier que la domination de la classe moyenne a soulevé plus de haines et de rancunes en cinquante ans que celle de la noblesse et du clergé n'en avait accumulé en dix siècles?
On insiste et on essaye tout au moins d'établir une distinction entre la propriété patrimoniale qui se lègue de père en fils, et la propriété des associations religieuses qui se perpétuent comme personnes civiles et constituent une « mainmorte. » C'est l'État qui crée, dit-on, les personnes civiles; il a, par conséquent, le droit de les supprimer, quand leur existence est devenue nuisible à la société. S'il ne possédait pas ce droit, s'il lui était interdit de toucher à la propriété d'institutions qui ont cessé, pour une cause ou pour une autre, de répondre à un besoin social, voyez à quelles conséquences absurdes et monstrueuses aboutirait le fétichisme de la propriété! Lorsque le christianisme a pris la place du paganisme, u'aurait-il pas fallu respecter la propriété des prêtres de Jupiter et de Vénus, et laisser subsister indéfiniment leurs temples? On les a confisqués avec justice dans l'intérêt général de la société. N'cst-il pas juste et raisonnable de confisquer de même la propriété des moines, devenus non moins inutiles sinon nuisibles que les prêtres de Jupiter et de Vénus? — A cet argument spécieux, la réponse est facile. L'État ne crée point les personnes civiles, — pas plus qu'il ne crée les personnes de chair et d'os. Elles se créent par l'accord des volontés et l'apport des capitaux de ceux qui fondent une association quelconque, civile ou commerciale; l'État se borne à garantir leur vie et leurs propriétés, absolument comme pour les personnes de chair et d'os. Il n'a pas plus le droit de tuer et de dépouiller les unes que les autres. Cependant, si des institutions se perpétuent quand elles ont perdu leur raison d'être, quand elles sont devenues une « nuisance », peut-on lui refuser le droit de les supprimer comme toute autre nuisance? Non! mais encore faudrait-il que cette nuisance fût manifeste et qu'elle se traduisît par dos actes criminels. Est-il nécessaire d'ajouter que les personnes civiles sont, comme les autres, sujettes à mourir de leur belle mort et qu'elles meurent dès qu'elles ont cessé d'être utiles quand on ne prolonge point artificiellement leur existence par des protections, des subventions et des privilèges. Prenons le cas d'une religion à son déclin. Comme toutes les autres entreprises, les établissements religieux en décadence sont abandonnés successivement par leur clientèle: d'où il suit que leurs profits vont diminuant et finissent par faire place à des pertes et à des déficits. On comble d'abord ces déficits par des emprunts. Mais si la clientèle continue à déserter, si les déficits subsistent et vont croissant, les emprunts finissent par absorber la valeur de la propriété et les propriétaires sont obligés de liquider l'établissement. Telle eût été la destinée finale et inévitable des établissements religieux du paganisme, et tel est, aux États-Unis, le sort des religions ou des sectes qui ne réussissent point à recruter une clientèle suffisante pour couvrir leurs frais. Il suffit que l'État s'abstienne de les subventionner pour qu'elles ne traînent point une existence inutile; la concurrence se charge d'en faire justice.
En revanche, aussi longtemps qu'un établissement religieux ou autre répond à un besoin, il résiste aux réglementations les plus étroites et même aux prohibitions les plus rigoureuses. Tel est actuellement le cas pour les ordres monastiques et les couvents. On a beau les dissoudre, disperser leurs membres et confisquer leurs biens au nom de la « liberté », on n'a point réussi et on ne réussira point à les extirper. Pourquoi? Parce qu'ils répondent encore à un besoin religieux et surtout, plus que jamais, à un besoin de tutelle dans nos sociétés de self govermnent obligatoire. C'est une forme arriérée et surannée, si l'on veut, de la tutelle, mais qui est encore préférée par beaucoup d'individualités des deux sexes à la responsabilité et l'isolement de leur existence. En vain on la prohibera, elle subsistera quand même. Il n'y a qu'un moyen efficace de la supprimer, c'est la concurrence. Le jour où des institutions de tutelle, mieux adaptées à l'état actuel des hommes et des choses, seront offertes aux individualités qui se sentent incapables de supporter la responsabilité du self government, les ordres monastiques auront vécu et les couvents entreront en liquidation; mais jusque-là iU résisteront victorieusement aux interdictions et aux confiscations du prohibitionnisme libéral et conservateur-révolutionnaire.
On voit par là comment devrait être résolue la question actuellement pendante de la séparation de l'Église et de l'État. En échange des biens que la révolution lui a enlevés, l'Église a accepté une subvention annuelle qui constitue la dotation du culte catholique. Le capital de cette subvention devrait lui être remis avec les édifices affectés au culte. L'atteinte portée par la révolution à la propriété religieuse serait ainsi réparée autant qu'elle peut l'être, et le risque auquel elle a exposé toutes les autres propriétés diminué. Ce qui n'empêcherait pas le catholicisme de disparaître et ses établissements de se liquider le jour où, comme autrefois le paganisme, il aurait cessé do répondre aux besoins religieux de la société et où quelque autre croyance mieux adaptée à ces besoins viendrait lui faire concurrence.
Une dernière question soulevée par les héritiers du dogme révolutionnaire de la souveraineté du peuple reste à résoudre. C'est la question de savoir si la confiscation de l'État et la dépossession de la noblesse et du clergé ont été avantageuses à la bourgeoisie; si, par conséquent, la dépossession de la bourgeoisie et la socialisation de l'État seraient avantageuses à la « classe des travailleurs ». Pour les collectivistes du quatrième état, l'affirmative n'est pas douteuse. Ils sont absolument convaincus que la bourgeoisie doit sa fortune à la dépossession de la noblesse et du clergé, à l'acquisition du monopole de l'exploitation de l'État, aux emplois, aux privilèges et aux faveurs que ce monopole lui a valus, et bon nombre de bourgeois, même éclairés, sont, au fond, du même avis. Cependant rien n'est plus contestable; disons mieux, rien n'est plus, contraire à la vérité.
Nous ferons remarquer d'abord que la classe moyenne de la GrandeBretagne s'est enrichie beaucoup plus encore que la nôtre, quoique la puissance politique soit restée jusqu'au Reform bill entre les mains de l'aristocratie. Nous ferons remarquer ensuite que la bourgeoisie française est, de toutes les classes de la nation, la noblesse et le clergé y compris, celle dont la fortune et l'influence se sont le plus augmentées dans les derniers siècles de l'ancien régime. En supposant que la révolution n'eût pas éclaté, et même que la bourgeoisie n'eût pas acquis jusqu'à présent la puissance politique, le développement prodigieux de l'industrie n'aurait pas manqué d'accroître sa fortune et son influence dans une mesure plus considérable encore qu'au siècle précédent. Elle n'aurait pas disposé peut-être d'une manière aussi complète du débouché des fonctions et des emplois politiques et administratifs, elle aurait moins émargé au budget, son industrie eût été moins protégée, le régime prohibitif n'eût point succédé au régime libéral inauguré par le traité de 1786, le monopole de la banque de France n'eût pas été institué, les ouvriers n'eussent pas été_mis à la discrétion des patrons par la suppression du droit d'association et les lois sur les coalitions; mais est-il bien avéré que l'émargement au budget, les monopoles et la protection ont contribué à augmenter la richesse, la vitalité et la puissance réelle de la bourgeoisie? Les emplois publics, en exigeant, avec un travail moins assidu, moins d'efforts d'intelligence et de volonté que les emplois de l'industrie privée, n'ont-ils pas pour effet d'affaiblir, à la longue, physiquement et intellectuellement ceux qui les exercent, et cet affaiblissement ne devient-il pas héréditaire? Si les monopoles et la protection enrichissent un petit nombre d'actionnaires d'établissements privilégiés, de propriétaires et d'entrepreneurs d'industrie, n'est-ce pas aux dépens du grand nombre des capitalistes et des hommes industrieux dont ils augmentent les charges et rétrécissent les débouchés? En laissant même de côté la démoralisation dont l'exploitation de l'État et les compétitions qu'elle provoque ont été la source pour la classe moyenne, on peut affirmer qu'elle serait aujourd'hui plus riche, plus influente, plus saine et aussi moins menacée si la révolution n'avait pas fait tomber entre ses mains la puissance politique. Maintenant supposons qu'une révolution complémentaire fasse descendre cette puissance dans le quatrième état, supposons même que ce quatrième état confisque les biens de la bourgeoisie capitaliste au profit de la « classe des travailleurs » et établisse en faveur de celle-ci un régime de monopole et de protection analogue à celui dont la première révolution a doté la classe moyenne, est-il bien certain que les travailleurs en deviendront plus riches? Il ne faut pas être bien fort en économie politique pour prévoir que la production de la richesse diminuera de la moitié ou des trois quarts sous ce nouveau régime ; que les biens et les capitaux confisqués aux bourgeois seront promptement gaspillés et détruits, et que le quatrième état ne régnera que sur des ruines et des cadavres. N'en déplaise aux collectivistes et aux anarchistes, ce n'est pas la possession de l'État qui a fait la fortune de la bourgeoisie; elle ferait encore moins celle du peuple.
Sans doute, la domination exclusive d'une classe est nuisible à toutes les autres. Mais s'ensuit-il que le monopole de la puissance politique soit avantageux, malgré ses bénéfices apparents, à la classe qui le possède? La noblesse et le clergé sont tombés en décadence pour l'avoir accaparé sous l'ancien régime. Il no se passera pas longtemps avant que les bourgeoisies politiciennes qui gouvernent actuellement la plupart des États modernes subissent le même sort. Tout ce que peuvent souhaiter les sincères amis du peuple; dans l'intérêt de son bien-être et de ses progrès matériels et moraux, c'est qu'une nouvelle révolution collectiviste ou anarchiste ne lui ïasse point ce présent décevant et funeste.
[65] La souveraineté individuelle contient la souveraineté politique, et celleci a ses limites déterminées par la nature même du besoin auquel pourvoit la production de la sécurité ou le gouvernement. Est-il nécessaire de remarquer que cotte théorie est en opposition absolue avec la théorie monarchique et la théorie révolutionnaire de la souveraineté? Celles-ci, à les bien considérer, sont identiques, ou du moins elles se ressemblent eu ce point capital qu'elles ne comportent pas de limites. Le roi ou l'empereur, dans la théorie monarchique, tient sa souveraineté de Dieu lui-même; il ne doit compte qu'à Dieu de l'usage qu'il en fait; clic est absolue et sans autres limites que celles qu'il plaît au souverain de lui imposer. Dans la théorie révolutionnaire, le peuple rentre en possession de la souveraineté qu'avait usurpée le roi ou l'empereur, et il n'en doit compte qu'à lui-même; elle est absolue et sans autres limites que celles qu'il plaît au peuple ou à ses mandataires de lui marquer; encore est-ce une question de savoir si les mandataires peuvent, sans se rendre coupables d'usurpation, limiter le droit du souverain. Avons-nous besoin de remarquer encore que ces deux théories ou plutôt cette théorie place la souveraineté individuelle, c'cst-ù-dirc la propriété et la liberté de l'individu, entièrement à la merci de l'homme ou du parti qui exerce la souveraineté politique? C'est en vertu de cette théorie que les despotes asiatiques confisquent les biens et font tomber les tètes de leurs sujets; c'est en vertu de la mémo théorie que le « peuple souverain i/ a confisqué, en France, les biens de la noblesse et du clergé, — non sans couper le cou aux nobles et aux prêtres récalcitrants, — et qu'il confisquera, quelque jour, ceux de la bourgeoisie propriétaire et capitaliste; c'est, pour tout dire, la théorie du despotisme.