
FrÉdÉric Bastiat, L'État (1848, 1849)
 |
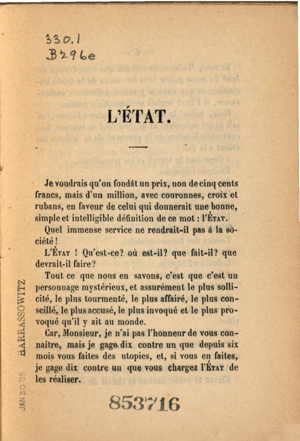 |
| Frédéric Bastiat (1801-1850) |
This is part of a collection of works by Frédéric Bastiat. See also the list of his works in chronological order.
There were three versions of this essay. Below is the third "pamphlet edition":
T.212 |
1848.06.11 |
"The State" (draft) (L’État) |
Jacques Bonhomme, no. 1, 11-15 June 1848, p. 2 |
JB article [PDF and HTML]; OC7.59, pp. 238-40 and HTML of collected articles |
T.222 |
1848.09.25 |
"The State" (L’État) |
Journal des Débats, 25 Sept. 1848, pp. 1-2. This is the second expanded edition of this essay. It was not used in the OC edition. |
JDD article [PDF]; and also the collected edition [HTML] |
CW4 (forth-coming) |
| T.320 | 1849.04.?? | "The State" (L'État) | A third, revised and enlarged edition of "The State" was published as an article in Annuaire de l'économie politique et de la statistique pour 1849, par MM. Joseph Garnier et Guillaumin et al. Sixième année (Paris: Guillaumin, 1849), pp. 356-68; and in a pamphlet L'État. Maudit Argent (Paris: Guillaumin, 1849), pp. 5-23. (exact date of publication not known.) This is the edition which appears in OC. | Annuaire version [PDF]; Pamphlet [PDF]; OC4, pp. 327-41 and [HTML]; and also the collected edition [HTML] |
[337]
L’ÉTAT[1].
Je voudrais qu’on fondât un prix, non de cinq cents francs, mais d’un million, avec couronnes, croix et rubans, en faveur de celui qui donnerait une bonne, simple et intelligible définition de ce mot : l’État.
Quel immense service ne rendrait-il pas à la société !
L’État ! Qu’est-ce ? où est-il ? que fait-il ? que devrait-il faire ?
Tout ce que nous en savons, c’est que c’est un personnage mystérieux, et assurément le plus sollicité, le plus tourmenté, le plus affairé, le plus conseillé, le plus accusé, le plus invoqué et le plus provoqué qu’il y ait au monde.
Car, Monsieur, je n’ai pas l’honneur de vous connaître, mais je gage dix contre un que depuis six mois vous faites des utopies ; et si vous en faites, je gage dix contre un que vous chargez l’État de les réaliser.
Et vous, Madame, je suis sûr que vous désirez du fond du cœur guérir tous les maux de la triste humanité, et que vous n’y seriez nullement embarrassée si l’État voulait seulement s’y prêter.
Mais, hélas ! le malheureux, comme Figaro, ne sait ni qui entendre, ni de quel côté se tourner. Les cent mille [338] bouches de la presse et de la tribune lui crient à la fois :
« Organisez le travail et les travailleurs.
Extirpez l’égoïsme.
Réprimez l’insolence et la tyrannie du capital.
Faites des expériences sur le fumier et sur les œufs.
Sillonnez le pays de chemins de fer.
Irriguez les plaines.
Boisez les montagnes.
Fondez des fermes-modèles
Fondez des ateliers harmoniques.
Colonisez l’Algérie.
Allaitez les enfants.
Instruisez la jeunesse.
Secourez la vieillesse.
Envoyez dans les campagnes les habitants des villes.
Pondérez les profits de toutes les industries.
Prêtez de l’argent, et sans intérêt, à ceux qui en désirent.
Affranchissez l’Italie, la Pologne et la Hongrie.
Élevez et perfectionnez le cheval de selle.
Encouragez l’art, formez-nous des musiciens et des danseuses.
Prohibez le commerce et, du même coup, créez une marine marchande.
Découvrez la vérité et jetez dans nos têtes un grain de raison. L’État a pour mission d’éclairer, de développer, d’agrandir, de fortifier, de spiritualiser et de sanctifier l’âme des peuples[2]. »
— « Eh ! Messieurs, un peu de patience, répond l’État, d’un air piteux. »
« J’essaierai de vous satisfaire, mais pour cela il me faut [339] quelques ressources. J’ai préparé des projets concernant cinq ou six impôts tout nouveaux et les plus bénins du monde. Vous verrez quel plaisir on a à les payer. »
Mais alors un grand cri s’élève : « Haro ! haro ! le beau mérite de faire quelque chose avec des ressources ! Il ne vaudrait pas la peine de s’appeler l’État. Loin de nous frapper de nouvelles taxes, nous vous sommons de retirer les anciennes. Supprimez :
L’impôt du sel ;
L’impôt des boissons ;
L’impôt des lettres ;
L’octroi ;
Les patentes ;
Les prestations. »
Au milieu de ce tumulte, et après que le pays a changé deux ou trois fois son État pour n’avoir pas satisfait à toutes ces demandes, j’ai voulu faire observer qu’elles étaient contradictoires. De quoi me suis-je avisé, bon Dieu ! ne pouvais-je garder pour moi cette malencontreuse remarque ?
Me voilà discrédité à tout jamais ; et il est maintenant reçu que je suis un hommesans cœur et sans entrailles, un philosophe sec, un individualiste, un bourgeois, et, pour tout dire en un mot, un économiste de l’école anglaise ou américaine.
Oh ! pardonnez-moi, écrivains sublimes, que rien n’arrête, pas même les contradictions. J’ai tort, sans doute, et je me rétracte de grand cœur. Je ne demande pas mieux, soyez-en sûrs, que vous ayez vraiment découvert, en dehors de nous, un être bienfaisant et inépuisable, s’appelant l’État, qui ait du pain pour toutes les bouches, du travail pour tous les bras, des capitaux pour toutes les entreprises, du crédit pour tous les projets, de l’huile pour toutes les plaies, du baume pour toutes les souffrances, des conseils pour toutes les perplexités, des solutions pour tous les doutes, [340] des vérités pour toutes les intelligences, des distractions pour tous les ennuis, du lait pour l’enfance, du vin pour la vieillesse, qui pourvoie à tous nos besoins, prévienne tous nos désirs, satisfasse toutes nos curiosités, redresse toutes nos erreurs, toutes nos fautes, et nous dispense tous désormais de prévoyance, de prudence, de jugement, de sagacité, d’expérience, d’ordre, d’économie, de tempérance et d’activité.
Et pourquoi ne le désirerais-je pas ? Dieu me pardonne, plus j’y réfléchis, plus je trouve que la chose est commode, et il me tarde d’avoir, moi aussi, à ma portée, cette source intarissable de richesses et de lumières, ce médecin universel, ce trésor sans fond, ce conseiller infaillible que vous nommez l’État.
Aussi je demande qu’on me le montre, qu’on me le définisse, et c’est pourquoi je propose la fondation d’un prix pour le premier qui découvrira ce phénix. Car enfin, on m’accordera bien que cette découverte précieuse n’a pas encore été faite, puisque, jusqu’ici, tout ce qui se présente sous le nom d’État, le peuple le renverse aussitôt, précisément parce qu’il ne remplit pas les conditions quelque peu contradictoires du programme.
Faut-il le dire ? Je crains que nous ne soyons, à cet égard, dupes d’une des plus bizarres illusions qui se soient jamais emparées de l’esprit humain.
L’homme répugne à la Peine, à la Souffrance. Et cependant il est condamné par la nature à la Souffrance de la Privation, s’il ne prend pas la Peine du Travail. Il n’a donc que le choix entre ces deux maux. Comment faire pour les éviter tous deux ? Il n’a jusqu’ici trouvé et ne trouvera jamais qu’un moyen : c’est dejouir du travail d’autrui ; c’est de faire en sorte que la Peine et la Satisfaction n’incombent pas à chacun selon la proportion naturelle, mais que toute la peine soit pour les uns et toutes les satisfactions pour les [341] autres. De là l’esclavage, de là encore la spoliation, quelque forme qu’elle prenne : guerres, impostures, violences, restrictions, fraudes, etc., abus monstrueux, mais conséquents avec la pensée qui leur a donné naissance. On doit haïr et combattre les oppresseurs, on ne peut pas dire qu’ils soient absurdes.
L’esclavage s’en va, grâce au Ciel, et, d’un autre côté, cette disposition où nous sommes à défendre notre bien, fait que la Spoliation directe et naïve n’est pas facile. Une chose cependant est restée. C’est ce malheureux penchant primitif que portent en eux tous les hommes à faire deux parts du lot complexe de la vie, rejetant la Peine sur autrui et gardant la Satisfaction pour eux-mêmes. Reste à voir sous quelle forme nouvelle se manifeste cette triste tendance.
L’oppresseur n’agit plus directement par ses propres forces sur l’opprimé. Non, notre conscience est devenue trop méticuleuse pour cela. Il y a bien encore le tyran et la victime, mais entre eux se place un intermédiaire qui est l’État, c’est-à-dire la loi elle-même. Quoi de plus propre à faire taire nos scrupules et, ce qui est peut-être plus apprécié, à vaincre les résistances ? Donc, tous, à un titre quelconque, sous un prétexte ou sous un autre, nous nous adressons à l’État. Nous lui disons : « Je ne trouve pas qu’il y ait, entre mes jouissances et mon travail, une proportion qui me satisfasse. Je voudrais bien, pour établir l’équilibre désiré, prendre quelque peu sur le bien d’autrui. Mais c’est dangereux. Ne pourriez-vous me faciliter la chose ? ne pourriez-vous me donner une bonne place ? ou bien gêner l’industrie de mes concurrents ? ou bien encore me prêter gratuitement des capitaux que vous aurez pris à leurs possesseurs ? ou élever mes enfants aux frais du public ? ou m’accorder des primes d’encouragement ? ou m’assurer le bien-être quand j’aurai cinquante ans ? Par ce moyen, j’arriverai à mon but en toute quiétude de conscience, car la loi elle-même aura [342] agi pour moi, et j’aurai tous les avantages de la spoliation sans en avoir ni les risques ni l’odieux ! »
Comme il est certain, d’un côté, que nous adressons tous à l’État quelque requête semblable, et que, d’une autre part, il est avéré que l’État ne peut procurer satisfaction aux uns sans ajouter au travail des autres, en attendant une autre définition de l’État, je me crois autorisé à donner ici la mienne. Qui sait si elle ne remportera pas le prix ? La voici :
L’État,c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde.
Car, aujourd’hui comme autrefois, chacun, un peu plus, un peu moins, voudrait bien profiter du travail d’autrui. Ce sentiment, on n’ose l’afficher, on se le dissimule à soi-même ; et alors que fait-on ? On imagine un intermédiaire, on s’adresse à l’État, et chaque classe tour à tour vient lui dire : « Vous qui pouvez prendre loyalement, honnêtement, prenez au public, et nous partagerons. » Hélas ! l’État n’a que trop de pente à suivre le diabolique conseil ; car il est composé de ministres, de fonctionnaires, d’hommes enfin, qui, comme tous les hommes, portent au cœur le désir et saisissent toujours avec empressement l’occasion de voir grandir leurs richesses et leur influence. L’État comprend donc bien vite le parti qu’il peut tirer du rôle que le public lui confie. Il sera l’arbitre, le maître de toutes les destinées : il prendra beaucoup, donc il lui restera beaucoup à lui-même ; il multipliera le nombre de ses agents, il élargira le cercle de ses attributions ; il finira par acquérir des proportions écrasantes.
Mais ce qu’il faut bien remarquer, c’est l’étonnant aveuglement du public en tout ceci. Quand des soldats heureux réduisaient les vaincus en esclavage, ils étaient barbares, mais ils n’étaient pas absurdes. Leur but, comme le nôtre, était de vivre aux dépens d’autrui ; mais, comme nous, ils [343] ne le manquaient pas. Que devons-nous penser d’un peuple où l’on ne paraît pas se douter que lepillage réciproque n’en est pas moins pillage parce qu’il est réciproque ; qu’il n’en est pas moins criminel parce qu’il s’exécute légalement et avec ordre ; qu’il n’ajoute rien au bien-être public ; qu’il le diminue au contraire de tout ce que coûte cet intermédiaire dispendieux que nous nommons l’État ?
Et cette grande chimère, nous l’avons placée, pour l’édification du peuple, au frontispice de la Constitution. Voici les premiers mots du préambule :
« La France s’est constituée en République pour… appeler tous les citoyens à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. »
Ainsi, c’est la France ou l’abstraction, qui appelle les Français ou lesréalités à la moralité, au bien-être, etc. N’est-ce pas abonder dans le sens de cette bizarre illusion qui nous porte à tout attendre d’une autre énergie que la nôtre ? N’est-ce pas donner à entendre qu’il y a, à côté et en dehors des Français, un être vertueux, éclairé, riche, qui peut et doit verser sur eux ses bienfaits ? N’est-ce pas supposer, et certes bien gratuitement, qu’il y a entre la France et les Français, entre la simple dénomination abrégée, abstraite, de toutes les individualités et ces individualités mêmes, des rapports de père à fils, de tuteur à pupille, de professeur à écolier ? Je sais bien qu’on dit quelquefois métaphoriquement : La patrie est une mère tendre. Mais pour prendre en flagrant délit d’inanité la proposition constitutionnelle, il suffit de montrer qu’elle peut être retournée, je ne dirai pas sans inconvénient, mais même avec avantage. L’exactitude souffrirait-elle si le préambule avait dit :
« Les Français se sont constitués en République pour appeler la France à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être ? »
Or, quelle est la valeur d’un axiome où le sujet et [344] l’attribut peuvent chasser-croiser sans inconvénient ? Tout le monde comprend qu’on dise : la mère allaitera l’enfant. Mais il serait ridicule de dire : l’enfant allaitera la mère.
Les Américains se faisaient une autre idée des relations des citoyens avec l’État, quand ils placèrent en tête de leur Constitution ces simples paroles :
« Nous, le peuple des États-Unis, pour former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, pourvoir à la défense commune, accroître le bien-être général et assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, décrétons, etc. »
Ici point de création chimérique, point d’abstraction à laquelle les citoyens demandent tout. Ils n’attendent rien que d’eux-mêmes et de leur propre énergie.
Si je me suis permis de critiquer les premières paroles de notre Constitution, c’est qu’il ne s’agit pas, comme on pourrait le croire, d’une pure subtilité métaphysique. Je prétends que cettepersonnification de l’État a été dans le passé et sera dans l’avenir une source féconde de calamités et de révolutions.
Voilà le Public d’un côté, l’État de l’autre, considérés comme deux être distincts, celui-ci tenu d’épandre sur celui-là, celui-là ayant droit de réclamer de celui-ci le torrent des félicités humaines. Que doit-il arriver ?
Au fait, l’État n’est pas manchot et ne peut l’être. Il a deux mains, l’une pour recevoir et l’autre pour donner, autrement dit, la main rude et la main douce. L’activité de la seconde est nécessairement subordonnée à l’activité de la première. À la rigueur, l’État peut prendre et ne pas rendre. Cela s’est vu et s’explique par la nature poreuse et absorbante de ses mains, qui retiennent toujours une partie et quelquefois la totalité de ce qu’elles touchent. Mais ce qui ne s’est jamais vu, ce qui ne se verra jamais et ne se peut même concevoir, c’est que l’État rende au public plus qu’il [345] ne lui a pris. C’est donc bien follement que nous prenons autour de lui l’humble attitude de mendiants. Il lui est radicalement impossible de conférer un avantage particulier à quelques-unes des individualités qui constituent la communauté, sans infliger un dommage supérieur à la communauté entière.
Il se trouve donc placé, par nos exigences, dans un cercle vicieux manifeste.
S’il refuse le bien qu’on exige de lui, il est accusé d’impuissance, de mauvais vouloir, d’incapacité. S’il essaie de le réaliser, il est réduit à frapper le peuple de taxes redoublées, à faire plus de mal que de bien, et à s’attirer, par un autre bout, la désaffection générale.
Ainsi, dans le public des espérances, dans le gouvernement deux promesses :beaucoup de bienfaits et pas d’impôts. Espérances et promesses qui, étant contradictoires, ne se réalisent jamais.
N’est-ce pas là la cause de toutes nos révolutions ? Car entre l’État, qui prodigue les promesses impossibles, et le public, qui a conçu des espérances irréalisables, viennent s’interposer deux classes d’hommes : les ambitieux et les utopistes. Leur rôle est tout tracé par la situation. Il suffit à ces courtisans de popularité de crier aux oreilles du peuple : « Le pouvoir te trompe ; si nous étions à sa place, nous te comblerions de bienfaits et t’affranchirions de taxes. »
Et le peuple croit, et le peuple espère, et le peuple fait une révolution.
Ses amis ne sont pas plus tôt aux affaires, qu’ils sont sommés de s’exécuter. « Donnez-moi donc du travail, du pain, des secours, du crédit, de l’instruction, des colonies, dit le peuple, et cependant, selon vos promesses, délivrez-moi des serres du fisc. »
L’État nouveau n’est pas moins embarrassé que l’État ancien, car, en fait d’impossible, on peut bien promettre, [346] mais non tenir. Il cherche à gagner du temps, il lui en faut pour mûrir ses vastes projets. D’abord, il fait quelques timides essais ; d’un côté, il étend quelque peu l’instruction primaire ; de l’autre, il modifie quelque peu l’impôt des boissons (1830). Mais la contradiction se dresse toujours devant lui : s’il veut être philanthrope, il est forcé de rester fiscal ; et s’il renonce à la fiscalité, il faut qu’il renonce aussi à la philanthropie.
Ces deux promesses s’empêchent toujours et nécessairement l’une l’autre. User du crédit, c’est-à-dire dévorer l’avenir, est bien un moyen actuel de les concilier ; on essaie de faire un peu de bien dans le présent aux dépens de beaucoup de mal dans l’avenir. Mais ce procédé évoque le spectre de la banqueroute qui chasse le crédit. Que faire donc ? Alors l’État nouveau prend son parti en brave ; il réunit des forces pour se maintenir, il étouffe l’opinion, il a recours à l’arbitraire, il ridiculise ses anciennes maximes, il déclare qu’on ne peut administrer qu’à la condition d’être impopulaire ; bref, il se proclamegouvernemental.
Et c’est là que d’autres courtisans de popularité l’attendent. Ils exploitent la même illusion, passent par la même voie, obtiennent le même succès, et vont bientôt s’engloutir dans le même gouffre.
C’est ainsi que nous sommes arrivés en Février. À cette époque, l’illusion qui fait le sujet de cet article avait pénétré plus avant que jamais dans les idées du peuple, avec les doctrines socialistes. Plus que jamais, il s’attendait à ce que l’État sous la forme républicaine, ouvrirait toute grande la source des bienfaits et fermerait celle de l’impôt. « On m’a souvent trompé, disait le peuple, mais je veillerai moi-même à ce qu’on ne me trompe pas encore une fois. »
Que pouvait faire le gouvernement provisoire ? Hélas ! ce qu’on fait toujours en pareille conjoncture : promettre, et gagner du temps. Il n’y manque pas, et pour donner à ses [347] promesses plus de solennité, il les fixa dans des décrets. « Augmentation de bien-être, diminution de travail, secours, crédit, instruction gratuite, colonies agricoles, défrichements, et en même temps réduction sur la taxe du sel, des boissons, des lettres, de la viande, tout sera accordé… vienne l’Assemblée nationale ».
L’Assemblée nationale est venue, et comme on ne peut réaliser deux contradictions, sa tâche, sa triste tâche, s’est bornée à retirer, le plus doucement possible, l’un après l’autre, tous les décrets du gouvernement provisoire.
Cependant, pour ne pas rendre la déception trop cruelle, il a bien fallu transiger quelque peu. Certains engagements ont été maintenus, d’autres ont reçu un tout petit commencement d’exécution. Aussi l’administration actuelle s’efforce-t-elle d’imaginer de nouvelles taxes.
Maintenant je me transporte par la pensée à quelques mois dans l’avenir, et je me demande, la tristesse dans l’âme, ce qu’il adviendra quand des agents de nouvelle création iront dans nos campagnes prélever les nouveaux impôts sur les successions, sur les revenus, sur les profits de l’exploitation agricole. Que le Ciel démente mes pressentiments, mais je vois encore là un rôle à jouer pour les courtisans de popularité.
Lisez le dernier Manifeste des Montagnards, celui qu’ils ont émis à propos de l’élection présidentielle. Il est un peu long, mais, après tout, il se résume en deux mots :L’État doit beaucoup donner aux citoyens et peu leur prendre. C’est toujours la même tactique, ou, si l’on veut, la même erreur.
« L’État doit gratuitement l’instruction et l’éducation à tous les citoyens. ».
Il doit :
« Un enseignement général et professionnel approprié autant que possible, aux besoins, aux vocations et aux capacités de chaque citoyen. » [348]
Il doit :
« Lui apprendre ses devoirs envers Dieu, envers les hommes et envers lui-même ; développer ses sentiments, ses aptitudes et ses facultés, lui donner enfin la science de son travail, l’intelligence de ses intérêts et la connaissance de ses droits. »
Il doit :
« Mettre à la portée de tous les lettres et les arts, le patrimoine de la pensée, les trésors de l’esprit, toutes les jouissances intellectuelles qui élèvent et fortifient l’âme. »
Il doit :
« Réparer tout sinistre, incendie, inondation, etc. (cetet caetera en dit plus qu’il n’est gros) éprouvé par un citoyen. »
Il doit :
« Intervenir dans les rapports du capital avec le travail et se faire le régulateur du crédit. »
Il doit :
« À l’agriculture des encouragements sérieux et une protection efficace. »
Il doit :
« Racheter les chemins de fer, les canaux, les mines, » et sans doute aussi les administrer avec cette capacité industrielle qui le caractérise.
Il doit :
« Provoquer les tentatives généreuses, les encourager et les aider par toutes les ressources capables de les faire triompher. Régulateur du crédit, il commanditera largement les associations industrielles et agricoles, afin d’en assurer le succès. »
L’État doit tout cela, sans préjudice des services auxquels il fait face aujourd’hui ; et, par exemple, il faudra qu’il soit [349] toujours à l’égard des étrangers dans une attitude menaçante ; car, disent les signataires du programme, « liés par cette solidarité sainte et par les précédents de la France républicaine, nous portons nos vœux et nos espérances au-delà des barrières que le despotisme élève entre les nations : le droit que nous voulons pour nous, nous le voulons pour tous ceux qu’opprime le joug des tyrannies ; nous voulons que notre glorieuse armée soit encore, s’il le faut, l’armée de la liberté. »
Vous voyez que la main douce de l’État, cette bonne main qui donne et qui répand, sera fort occupée sous le gouvernement des Montagnards. Vous croyez peut-être qu’il en sera de même de la main rude, de cette main qui pénètre et puise dans nos poches ?
Détrompez-vous. Les courtisans de popularité ne sauraient pas leur métier, s’ils n’avaient l’art, en montrant la main douce, de cacher la main rude.
Leur règne sera assurément le jubilé du contribuable.
« C’est le superflu, disent-ils, non le nécessaire que l’impôt doit atteindre. »
Ne sera-ce pas un bon temps que celui où, pour nous accabler de bienfaits, le fisc se contentera d’écorner notre superflu ?
Ce n’est pas tout. Les Montagnards aspirent à ce que « l’impôt perde son caractère oppressif et ne soit plus qu’un acte de fraternité. »
Bonté du ciel ! je savais bien qu’il est de mode de fourrer la fraternité partout, mais je ne me doutais pas qu’on la pût mettre dans le bulletin du percepteur.
Arrivant aux détails, les signataires du programme disent :
« Nous voulons l’abolition immédiate des impôts qui frappent les objets de première nécessité, comme le sel, les boissons,et caetera. » [350]
« La réforme de l’impôt foncier, des octrois, des patentes. »
« La justice gratuite, c’est-à-dire la simplification des formes et la réduction des frais. » (Ceci a sans doute trait au timbre.)
Ainsi, impôt foncier, octrois, patentes, timbre, sel, boissons, postes, tout y passe. Ces messieurs ont trouvé le secret de donner une activité brûlante à lamain douce de l’État tout en paralysant samain rude.
Eh bien, je le demande au lecteur impartial, n’est-ce pas là de l’enfantillage, et, de plus, de l’enfantillage dangereux ? Comment le peuple ne ferait-il pas révolution sur révolution, s’il est une fois décidé à ne s’arrêter que lorsqu’il aura réalisé cette contradiction : « Ne rien donner à l’État et en recevoir beaucoup ! »
Croit-on que si les Montagnards arrivaient au pouvoir, ils ne seraient pas les victimes des moyens qu’ils emploient pour le saisir ?
Citoyens, dans tous les temps deux systèmes politiques ont été en présence, et tous les deux peuvent se soutenir par de bonnes raisons. Selon l’un, l’État doit beaucoup faire, mais aussi il doit beaucoup prendre. D’après l’autre, sa double action doit se faire peu sentir. Entre ces deux systèmes il faut opter. Mais quant au troisième système, participant des deux autres, et qui consiste à tout exiger de l’État sans lui rien donner, il est chimérique, absurde, puéril, contradictoire, dangereux. Ceux qui le mettent en avant, pour se donner le plaisir d’accuser tous les gouvernements d’impuissance et les exposer ainsi à vos coups, ceux-là vous flattent et vous trompent, ou du moins ils se trompent eux-mêmes.
Quant à nous, nous pensons que l’État, ce n’est ou ce ne devrait être autre chose que laforce commune instituée, non pour être entre tous les citoyens un instrument [351] d’oppression et de spoliation réciproque, mais, au contraire, pour garantir à chacun le sien, et faire régner la justice et la sécurité[3].
Endnotes
- ↑ Pour expliquer la forme de cette composition, rappelons qu’elle fut insérée auJournal des Débats, n° du 25 septembre 1848. (Note de l’éditeur.)
- ↑ Cette dernière phrase est de M. de Lamartine. L’auteur la cite de nouveau dans le pamphlet qui va suivre. (Note de l’éditeur)
- ↑ Voy. au tome VI, le chap. XVII desHarmonies, et au tome 1er, l’opuscule de 1830, intitulé :Aux électeurs du département des Landes. (Note de l’éditeur)