
FRÉDÉRIC BASTIAT,
The Collected Works in French in Chronological Order
(2014, 2024)
 |
| (1801-1850) |
[Created: 28 January, 2014]
[Updated: 4 May, 2024] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, The Collected Works in French in Chronological Order (2014, 2024)http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Bastiat/OeuvresCompletes/OeuvresCompletes-master.html
Word length: 1,070,215 words; 3,334 pages.
This book is part of a collection of works by (1801-1850).
Editor's Note
I put together this compilation of the works of Bastiat in 2014 to assist me in my editing and translating efforts. I wanted to take a chronological approach and to include variorum of essays and chapters which first appeared as articles and then as chapters of books. For more details on the works and the source of their original publication see my list of "The Works of Frédéric Bastiat" made up of 216 letters, and 323 articles, pamphlets, and books, with user-sortable tables and links to those texts which I have online in French.
This compilation now includes the new HTML formatting and the citation tool. It also contains my highlights in bold of key terms and phrases which I used in my research.
The original compilation was based upon the edition of his Oeuvres complètes at Wikisource - Œuvres complètes de Frédéric Bastiat , to which I have now added the 1877 collection of his letters to Madame Cheuvreux. It does not include the original page numbers so it is less useful for citation purposes than my more recent editions of his key texts and most of the volumes of the Oeuvres complètes. These can be found here:
- a re-edit of as much of his Oeuvres complètes (1862-64) as I could get into the enhanced HTML format
- a combined tables of contents
- OC1 Correspondance, Mélanges (1862) [online] and [PDF]
- OC2 Le Libre-Échange (1862) [online] and [PDF]
- OC4 Sophismes Économiques, Petits Pamphlets I (1863) [online] and [PDF]
- OC5 Sophismes Économiques Petits Pamphlets II (1854) [online] and [PDF]
- OC7 Essais - Ébauches - Correspondance (1864) [online] and [PDF]
- note that two volumes have been excluded: OC3 (Cobden et la Ligue) and OC6 (Harmonies Économiques), because only the Introduction to CW3 is FB’s work, and I have HE elsewhere (the 2nd edition of 1851)
⠀See also his most Important Books and Pamphlets which are in enhanced HTML with the original page numbers:
- the “Introduction" to his first book Cobden et la ligue, ou l’Agitation anglaise pour la liberté du commerce (1845), pp. i-xcvi. [online] and [PDF]
- his first collection of Sophismes économiques (1846) [online] and [PDF]
- his second collection of Sophismes économiques. Deuxième Série (1848) [online] and [PDF]
- my combined version of SE as "2 vols in 1" [online]
- his pamphlet L’État. Maudit Argent (1849) [online] and [PDF]
- his pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, ou l’Économie politique en une leçon (1850) [online] and [PDF]
- his pamphlet La Loi (1850) [online] and [PDF]
- his posthumous unfinished magnum opus Harmonies économiques. 2me Édition (1851) [online] and [PDF]
- a posthumous collection of his lettres to Madame Cheuvreux Lettres d’un habitant des Landes (1877) [online] and [PDF]
Note (private joke): "BWV" = Bastiat Werke Verzeichnis. A more complete description with ID numbers can be found at my list of "The Works of Frédéric Bastiat".
TABLE OF CONTENTS
1819-1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | Undated Material | Posthumous Material
Writings Sept. 1819 - Nov. 1844
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 septembre 1819 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 5 mars 1820 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 18 mars 1820, Bayonne
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1820 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre d’octobre 1820 (Bayonne) [edit]
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 19 avril 1821 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1821 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 8 décembre 1821 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 20 octobre 1821 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre de décembre 1822 (Bayonne)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 15 décembre 1824 (Bayonne)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 8 janvier 1825, Bayonne
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 9 avril 1827 (Bordeaux)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 décembre 1827 (Mugron)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 mars 1829 (Mugron)
- à M. Victor Calmètes: Lettre de juillet 1829 (Mugron)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 4 août 1830 (Bayonne)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 5 août 1830 (Bayonne)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 22 avril 1821 (31???) (Bayonne)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 2 mars 1834 (Bordeaux)
- LETTRE A UN AMI NON IDENTIFIE POUR LA DEFENSE D'UN REFUGIE [Mugron le 1er Septembre 1835]
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juin 1840 (Bayonne)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 6 juillet 1840 (Madrid)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juillet 1840 (Madrid)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 17 août 1840 (Madrid)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 24 octobre 1840 (Lisbonne)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 7 novembre 1840 (Lisbonne)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 2 janvier 1841 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 janvier 1841 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 10 juillet 1844 (Bagnères)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 26 juillet 1844 (Eaux-Bonnes)
- Lettre à M. Laurence [9 Nov. 1844], Mugron
- à Richard Cobden: Lettre du 24 novembre 1844 (Mugron)
- à M. Horace Say; Lettre du 24 novembre 1844 (Mugron)
- Deux articles sur la langue basque (JCPD) [no date] [not available] [CW1.1.1]
- Proposition de création d'une école d'apprentis agricoles (JCPD) [no date] [not available] [CW1.1.6]
- Lettre à un candidat [1822???] [CW1.3.4]
- Aux électeurs du département des Landes (Nov. 1830) [CW1.2.4]
- D'un nouveau collège à fonder [c. 1834] [CW1.4.1]
- D'une pétition en faveur des réfugiés polonais [1834]
- Réflexions sur les pétitions de Bordeaux, Le Havre, et Lyon concernant les Douanes [Avril 1834] [CW2.1]
- Lettre à un ami non identifié pour la défense d’un refugié (sept. 1835)
- Canal latéral à l'Adour (18 juin - 20 août 1837)
- Compte rendu d'une brochure de F. Coudroy sur la question des duels [11 February 1838] [CW1.1.2]
- Réforme parlementaire [c. 1840] [CW1.2.3]
- Le fisc et la vigne [Jan. 1841] [CW2.2]
- Mémoire présenté à la société d’agriculture, commerce, arts, et sciences du département des Landes sur la question vinicole [22 janvier 1843] [CW3.3]
- « Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 1er article », Sentinelle des Pyrénées, 18 mai 1843, p. 3.
- « Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 2ème article », La Sentinelle des Pyrénées, 25 mai 1843, p. 2.
- « Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 3ème article », La Sentinelle des Pyrénées, 1er juin 1843, p. 2.
- La Reforme postale (3 and 6 August, 1844)
- Mémoire sur la répartition de l'impôt foncier dans les Landes [1844]
- Liberté du commerce [1844] [CW1.4.3]
- De l’influence des tarifs français et anglais sur l’avenir des deux peuples [JDE, octobre 1844]
1845
- [CW1.34] [OC7] 34. Mugron, 7 mars 1845. A M. Ch. Dunoyer, membre de l’Institut ???
- Lettre à M. de Lamartine [7 mars 1845], Mugron ????
- à Richard Cobden: Lettre du 8 avril 1845 (Mugron)
- à M. Félix Coudroy: Lettre de mai 1845 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 23 mai 1845 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 6 (5??) juin 1845 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juin 1845, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 18 [Juin 1845 ???], Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 juillet 1845 (11 heures du soir, Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre de juillet 1845 (Londres)
- à Richard Cobden: Lettre du 8 juillet 1845 (Londres)
- Lettre à M. Paulton [29 July 1845], Paris
- à Richard Cobden: Lettre du 2 octobre 1845 (Mugron)
- [CW1.47] [JCPD] 47. Mugron, 24 octobre 1845. A M. Potonié ???
- à Richard Cobden: Lettre du 13 décembre 1845 (Mugron)
- Lettre à M. Alcide Fonteyraud [20 Dec. 1845], Mugron
- Sur un livre de M. Dunoyer [1845]
- Un économiste à M. de Lamartine (Feb. 1845)
- Abondance, disette [April 1845] [CW3 ES1.1]
- Obstacle, cause [April 1845] [CW3 ES1.2]
- Effort, résultat [April 1845] [CW3 ES1.3]
- Introduction to Cobden et la Ligue. [June 1845] see below
- Égaliser les conditions de production [July 1845] [CW3 ES1.4]
- Nos produits sont grevés de taxes [July 1845] [CW3 ES1.5]
- De l’avenir du commerce des vins entre la France et la Grande-Bretagne [Aug. 1845]
- Balance du commerce [October 1845] [CW3 ES1.6]
- Pétition des fabricants de chandelles, etc. [October 1845] [CW3 ES1.7]
- Droits différentiels [October 1845] [CW3 ES1.8]
- Immense découverte!!! [October 1845] [CW3 ES1.9]
- Réciprocité [October 1845] [CW3 ES1.10]
- Prix absolus [October 1845] [CW3 ES1.11]
- Previously unpublished essays which appeared in ES1
- Sur les questions soumise aux conseils généraux [décembre 1845]
- D’autres questions soumises aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce, en 1845 [c. dec. 1845]
- La Ligue anglaise et la Ligue allemande. Réponse à la Presse[décembre 1845]
- Cobden et la Ligue [1st half 1845]: Introduction by FB
- Bastiat’s Introduction to Cobden et la Ligue.
- FB’s translations and Summaries of Meetings
- COBDEN ET LA LIGUE OU L’AGITATION ANGLAISE
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 16 mars 1843.
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 30 mars 1843.
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 5 avril 1843.
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 13 avril 1843.
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 26 avril 1843.
- SEPTIÈME MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 5 mai 1843.
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE À LA SALLE DE L’OPÉRA. 13 mai 1843.
- GRAND MEETING À COVENT-GARDEN. Octobre 1843.
- L’AGITATION EN ÉCOSSE
- GRAND MEETING DE COVENT-GARDEN. 25 janvier 1844.
- SECOND MEETING AU THÉÂTRE DE COVENT-GARDEN. 1er février 1844.
- WAKEFIELD. Extrait du Morning-Chronicle, 31 janvier 1844.
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 15 février 1844.
- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE AU THÉATRE DE COVENT-GARDEN 21 février 1844.
- Séance du 28 février 1844.
- Séance du 17 avril. — Présidence de M. Cobden.
- Séance du 1er mai 1844.
- Séance du 14 mai 1844.
- Séance du 22 mai 1844. — Présidence du général Briggs.
- Séance du 29 mai et Séance du 5 juin 1844
- Séance du 19 juin 1844.
- La motion annuelle de M. Ch. Pelham Villiers
- Séance du 7 août 1844.
- Les free-traders et les chartistes à northampton
- Démonstration en faveur de la liberté commerciale à walsall
- Grand meeting de la ligue au théatre de covent-garden. 11 décembre 1844.
- Meeting général de la ligue à manchester. 22 janvier 1845.
- INTERROGATOIRE DE JACQUES DEACON HUME, ESQ.,
- Appendice
- Fin de la première campagne de la Ligue anglaise 437
- Seconde campagne de la Ligue 449
- Deux Angleterre 459
- Meeting du 26 janvier 1848, à Manchester. — Discours de MM. Milner Gibson, Cobden et J. Bright 463
- Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849 492
- La réforme coloniale en Angleterre. — Discours de M. Cobden à Bradford 497
- Discours de John Russell au Parlement 508
1846
- à Richard Cobden: Lettre du 13 janvier 1846 (Mugron)
- à Richard Cobden: Lettre du 9 février 1846 (Mugron)
- à Richard Cobden: Lettre de février 1846 (Bordeaux)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 19 février 1846 (Bordeaux)
- à M. Victor Calmètes: Lettre du 4 mars 1846 (Bayonne)
- Lettre à M. Dunoyer [7 mars 1845/6???], Mugron
- à Richard Cobden: Lettre du 16 mars 1846 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 22 mars 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 25 mars 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 2 avril 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 11 avril 1846 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 18 avril 1846 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 mai 1846, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 4 mai, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 24 mai 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 25 mai 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 25 juin 1846 (Mugron)
- à Richard Cobden: Lettre du 21 juillet 1846 (Bordeaux)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 22 juillet 1846 (Bordeaux)
- à Richard Cobden: Lettre du 23 septembre 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 29 septembre 1846 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 1er octobre 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 22 octobre 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 22 novembre 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 25 novembre 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 20 décembre 1846 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 25 décembre 1846 (Paris)
- A M. de Larnac, député des Landes (1846) [CW1.2.3]
- Le vol à la prime [15 January 1846] [CW3 ES2.9]
- Projet de ligue anti-protectioniste [8 février 1846]
- Projet de ligue anti-protectionniste. 2e article [9 février 1846]
- Projet de ligue anti-protectionniste. 3e article [10 février 1846]
- Considérations sur le métayage [JDE, 15 Feb. 1846]
- Association pour la liberté des échanges à Bordeaux [18 février 1846]
- Au rédacteur du Journal de Lille [19 février 1846]
- Premier discours, à Bordeaux [23 Février 1846]
- Théorie du bénéfice [26 Feb. 1846]
- Au rédacteur de l’Époque [8 mars 1846]
- Le libre-échange en action [12 mars 1846]
- Qu’est-ce que le commerce ? [1 avril 1846]
- À M. le ministre de l’agriculture et du commerce [6 avril 1846]
- À monsieur le rédacteur du Courrier français [11 avril 1846]
- La Tribune et la Presse, à propos du traité belge [avril 1846]
- La réforme postale [23 avril 1846]
- Réforme postale. 2e article [30 avril 1846]
- La liberté commerciale [2 mai 1846]
- 1re lettre au Journal des Débats [2 mai 1846]
- Déclaration de principes (Association pour la liberté des échanges) [10 mai 1846]
- 2e Lettre au rédacteur du Journal des Débats [14 mai 1846]
- De la concurrence (On Competition), [JDE, Mai 1846] [??]
- Le sel, la poste et la douane [15 May 1846] [CW3 ES2.12]
- Du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne [19 mai 1846] [CW1.1.3]
- Sur un livre de Monsieur Vidal [June, 1846]
- Aux membres de l’Association [14 juin 1846]
- À M. Tanneguy-Duchâtel, ministre de l’intérieur [30 juin 1846]
- Aux électeurs de l'arrondissement de Saint-Sever (1 July 1846) [CW1.2.1]
- La logique du Moniteur industriel [1 juillet 1846]
- Lettre à M. Dampierre [3 Juillet 1846] [CW1.3.5]
- Toast porté au banquet offert à Cobden par les libre-échangistes de Paris [19 août 1846]
- Au rédacteur de la Presse [22 août 1846]
- La loi des céréales et le salaire des ouvriers [24 août 1846]
- Au Moniteur industriel [29 août 1846]
- À M. le rédacteur en chef de La Presse. Seconde lettre [2 septembre 1846] [1]
- Aux artisans et aux ouvriers [18 September 1846] [CW3 ES2.6]
- Second discours, à Paris [29 septembre 1846]
- De la population (On Population) (JDE, 15 Octobre 1846)
- Seconde lettre à Monsieur de Lamartine [15 Oct. 1846]
- Aux négociants du Havre (1) [22 octobre 1846]
- Aux négociants du Havre. Deuxième lettre [23 octobre 1846]
- Aux négociants du Havre. Troisième lettre [25 octobre 1846] [1]
- Au rédacteur du National [10 novembre 1846]
- À M. le rédacteur en chef du National. Seconde lettre [11 novembre 1846] [1]
- Post hoc, ergo propter hoc [6 December 1846] [CW3 ES2.8]
- La main droite et la main gauche [13 December 1846] [CW3 ES2.16]
- Les généralités [13 Décembre 1846]
- De l'influence du régime protecteur sur l'agriculture [Décembre 1846]
- Le libre-échange [19 Décembre 1846]
- Recettes protectionnistes [Recipes for Protectionism] [27 December 1846] [CW3 ES3.1]
- À quoi se réduit l'invasion [27 Décembre 1846] [CW3] [ES3.1]
- Sophismes économiques. Première série [January 1846]
- Introduction
- I. Abondance, disette
- II. Obstacle, cause
- III. Effort, résultat
- IV. Égaliser les conditions de production
- V. Nos produits sont grevés de taxes
- VI. Balance du commerce
- VII. Pétition des fabricants de chandelles, etc.
- VIII. Droits différentiels
- IX. Immense découverte !!!
- X. Réciprocité
- XI. Prix absolus
- XII. La protection élève-t-elle le taux des salaires
- XIII. Théorie, Pratique
- XIV. Conflit de principes
- XV. Encore la réciprocité
- XVI. Les fleuves obstrués plaidant pour les prohibitionistes
- XVII. Un chemin de fer négatif
- XVIII. Il n'y a pas de principes absolus
- XIX.
- XX. Travail humain, travail national
- XXI. Matières premières
- XXII. Métaphores
- Conclusion
1847
- à Richard Cobden: Lettre du 10 janvier 1847 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 mars 1847 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 20 mars 1847 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 20 avril 1847 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 5 juillet 1847 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre d’août 1847, Paris
- à M. Horace Say; Lettre d’un lundi d’octobre 1847 (Mugron)
- à Richard Cobden: Lettre du 15 octobre 1847 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 9 novembre 1847 (Paris)
- à Richard Cobden: Lettre du 15 novembre 1847 (Paris) ???
- Projet de discours libre-échangiste à prononcer à Bayonne [c. 1847]
- Le profit de l'un est le dommage de l'autre (c. 1847) [CW3 ES3.15]
- La peur d'un mot [The Fear of a Word] [June 20, 1847] [CW3 ES3.13]
- Midi à quatorze heures [Making a Mountain out of a Mole Hill] [c. 1847] [CW3 ES3.16]
- Le petit manuel du consommateur [A Little Manual for Consumers, in other words, for Everyone] [c. 1847] [CW3 ES3.17]
- Anglomanie, Anglophobie [c. 1847] [CW1.1.5] or [CW3 ES3.14]
- Bornes que s'impose l’Association [3 Janvier 1847]
- Organisation et liberté [Janvier 1847]
- L’utopiste [17 January 1847] [CW3 ES2.11]
- L'échelle mobile [24 Janvier 1847]
- M. de Noailles à la Chambre des pairs [24 January 1847]
- Réflexions sur l'année 1846 [30 Janvier 1847]
- Inanité de la protection de l'agriculture [31 Janvier 1847]
- L'Angleterre et le libre-échange [6 Février 1847]
- Deux principes [Two Principles] [7 February 1847] [CW3 ES3.2]
- Domination par le travail [14 February 1847] [CW3 ES2.17]
- Curieux phénomène économique. - La Réforme financière en Angleterre [21 Fév. 1847]
- Influence du libre-échange sur les relations des peuples [7 Mars 1847]
- Le parti démocratique et le libre-échange [14 Mars 1847]
- Sur la défense d'exporter les céréales [20 Mars 1847]
- Autre chose [21 March 1847] [CW3 ES2.14]
- Hausse des aliments, baisse des salaires [21 Mars 1847]
- Deux modes d'égalisation de taxes [4 April 1847]
- Le monde renversé [18 Avril 1847]
- Le National [18 Avril 1847]
- Programme of the French Free Trade Association (25 Apr. 1847, LE)
- Démocratie et libre-échange [25 Avril 1847]
- Le petit arsenal du libre-échangiste [26 April 1847] [CW3 ES2.15]
- L'échelle mobile et ses effets en Angleterre [1 Mai 1847]
- La logique de M. Cunin-Gridaine [Mr. Cunin-Gridaine’s Logic] [2 May 1847] [CW3 ES3.3]
- Subsistances [8 Mai 1847]
- L'empereur de Russie [8 Mai 1847]
- De la libre introduction du bétail étranger [14 Mars 1847]
- Un profit contre deux pertes [One profit versus Two Losses] [9 May 1847] [CW3 ES3.4]
- De la modération [On Moderation] [22 May 1847] [CW3 ES3.5]
- Peuple et Bourgeoisie [The People and the Bourgeoisie] [22 May 1847] [CW3 ES3.6]
- Deux pertes contre un profit [Two Losses versus One Profit] [30 May 1847] [CW3 ES3.7]
- Le Roi libre-échangiste [30 mai 1847]
- Guerre aux chaires d'économie politique [June 1847] [CW2.14]
- Discours à la salle Duphot [13 juin 1847]
- L'impôt du sel [20 Juin 1847]
- L’Économie politique des généraux [The Political Economy of the Generals] [20 June 1847] [CW3 ES3.8]
- Du Communisme [27 Juin 1847]
- La taxe unique en Angleterre, proposition de M. Ewart [27 Juin 1847]
- One of Bastiat’s Lectures at Taranne Hall( July 1847) (to translate - 4,753 words)
- REUNION DE LA RUE TARANNE
- Troisième discours, à Paris [3 juillet 1847]
- Autre réponse à la Presse sur la nature des échanges [10 Juillet 1847]
- Sur l'éloge de Ch. Comte [11 July, 1847]
- Cherté, bon marché [25 July, 1847] [CW3 ES2.5]
- Quatrième discours, à Lyon [août 1847]
- Cinquième discours, à Lyon [august 1847]
- Sixième discours, à Marseille [24 th ?? août 1847]
- Remontrance [A Protest] [30 August 1847] [CW3 ES3.9]
- Minutes of a Public Meeting in Marseilles by the Free Trade Association (5 Sept. 1847, LE)
- A Letter (to Hippolyte Castille on intellectual property [9 September 1847]
- Réponse au journal l’Atelier [12 Sept. 1847]
- Seconde campagne de la ligue [ 7 novembre 1847]
- Association espagnole pour la défense du travail national [The Spanish Association for the Defense of National Employment] [7 November 1847] [CW3 ES3.10]
- Aux membres du Conseil général de la Seine [14 novembre 1847]
- D'un plan de campagne proposé à l’Association du libre-échange [14 Novembre 1847]
- Bastiat's reply to a letter by Blanqui (14 Nov. 1847, LE)
- Aux membres du Conseil général de la Nièvre [21 novembre 1847]
- Les hommes spéciaux [The Specialists] [28 November 1847] [CW3 ES3.11]
- Projet de préface pour les Harmonies [c. late 1847] [CW1.1.4]
- Previously unpublished essays which were published in ES2
- Sur l'exportation du numéraire [11 Décembre 1847]
- Huitième discours, à Paris. Discours au cercle de la librairie [16 Dec. 1847]
- L'indiscret [The Man who asked Embarrassing Questions] [12 December 1847] [CW3 ES3.12]
- Lettre de M. Considérant et réponse [25 Décembre 1847]
Books and Printed Pamphlets - 1847
1848
- [CW1.85] [OC1] 85. Paris, 5 janvier 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.86] [OC7] 86. Paris, 17 janvier 1848. A Madame Schwabe
- [CW1.87] [OC1] 87. Paris, 24 janvier 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.88] [OC7] 88. Paris, 27 janvier 1848. A Madame Schwabe
- [CW1.89] [OC1] 89. Paris, 13 février 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.90] [OC7] 90. Paris, 16 février 1848. A Madame Schwabe
- [CW1.91] [OC1] 91. Paris, 25 février 1848. A Richard Cobden
- [CW1.92] [OC1] 92. Paris, 26 février 1848. A Richard Cobden
- [CW1.93] [JCPD] 93. Paris, 27 février 1848. A Madame Marsan [missing French]
- [CW1.94] [OC1] 94. Paris, 29 février 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.95] [OC7] 95. Paris, 4 mars 1848. A M. Domenger, à Mugron
- [CW1.96] [OC1] 96. Mugron, 5 avril 1848. A Richard Cobden
- [CW1.97] [OC7] 97. Mugron, 12 avril 1848. A Horace Say
- [CW1.98] [OC1] 98. Paris, 11 mai 1848. A Richard Cobden
- [CW1.99] [OC7] 99. Paris, 17 mai 1848. A Madame Schwabe
- [CW1.100] [OC1] 100. Paris, 27 mai 1848. A Richard Cobden
- [CW1.101] [OC1] 101. Paris, 9 juin 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.102] [OC1] 102. Paris, 24 juin 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.103] [OC1] 103. Paris, 27 juin 1848. A Richard Cobden
- [CW1.104] [JCPD] 104. Paris, 29 juin 1848. A Julie Marsan [missing French]
- [CW1.105] [OC1] 105. Paris, 7 août 1848. A Richard Cobden
- [CW1.106] [OC7] 106. Paris, 1er juillet 1848. A M. Schwabe
- [CW1.107] [OC1] 107. Paris, 18 août 1848. A Richard Cobden
- [CW1.108] [OC1] 108. Paris, 26 août 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.109] [OC7] 109. Paris, 3 septembre 1848. A M. Domenger
- [CW1.110] [OC1] 110. Paris, 7 septembre 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.111] [OC7] 111. Douvres, 7 octobre 1848. A M. Schwabe
- [CW1.112] [OC7] 112. Paris, 25 octobre 1848. A M. Schwabe
- [CW1.113] [CH] 113. Paris, novembre 1848. A Madame Cheuvreux
- [CW1.114] [OC7] 114. Paris, 14 novembre 1848. A Madame Schwabe
- [CW1.115] [OC1] 115. Paris, 26 novembre 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.116] [OC1] 116. Paris, 5 décembre 1848. A Félix Coudroy
- [CW1.117] [OC7] 117. Paris, 21 décembre 1848. A M. le Comte Arrivabene
- [CW1.118] [OC7] 118. Paris, 28 décembre 1848. A Madame Schwabe
- Barataria [c. 1848???]
- Réponse à divers [1 Jan. 1848]
- La liberté a donné du pain aux Anglais [1 Janvier 1848]
- Septième discours, à Paris [7 Jan 1848]
- Les armements en Angleterre [15 Janvier 1848]
- T.176 (1848.01.15) "Natural and Artificial Organisation" (JDE, Jan. 1848) (Fr, PDF)
- Minutes of the Seventh Meeting of the Free Trade Association (Jan. 1848, JDE)
- Paresse et restriction [16 Jan. 1848]
- Lettre À M. Jobard [22 Jan. 1848]
- Sur l'inscription maritime [23 Janvier 1848]
- Encore les armements en Angleterre [29 Janvier 1848]
- Le maire d'Énios [The Mayor of Enios] [6 February 1848] [CW3 ES3.18]
- Deux Angleterre [6 février 1848]
- Le sucre antédiluvien [Antediluvian Sugar] [13 February 1848] [CW3 ES3.19]
- Monita secreta [Monita Secreta: The Secret Book of Instructions] [20 February 1848] [CW3 ES3.20]
- La République française [26 Feb. - 28 Mar, 1848]
- ToC
- Statement of Principles: Quelques mots d'abord sur le titre de notre journal. [CW3.??]
- Sous la République [27 février 1848] [CW1.4.11]
- 43. Article 2 [26 February 1848] [CW1.4.14a]
- 44. Article 3 [27 February 1848] [CW1.4.14b]
- Sur le désarmement [27 février 1848] [CW1.4.12]
- 46. Article 5 [27 February 1848] [CW1.4.14c]
- 47. Article 6 [29 February 1848] [CW1.4.14d]
- Les rois doivent désarmer [29 février 1848] [CW1.4.13]
- “Les sous-préfectures” (The Sub-Prefects) [29 février 1848] [CW ??]
- Article dans La République Française [29 février 1848] [CW1.4.6]
- La Presse parisienne [1 mars 1848] [CW1.4.4]
- Pétition d'un Economiste [2 mars 1848] [CW1.4.5]
- Liberté de l'enseignement [4 mars 1848] [CW1.4.2]
- Curée des Places [5 mars 1848] [CW1.4.7]
- Entraves et Taxes [6 mars 1848] [CW1.4.8]
- Soulagement immédiat du peuple [The Immediate Relief of the People] [12 March 1848] [CW3 ES3.21]
- Funeste remède [A Disastrous Remedy] [12 March 1848] [CW3 ES3.22]
- Circulaires d'un ministère introuvable [Circulars from a Government that is Nowhere to be Found] [19 March 1848] [CW3 ES3.23]
- Funestes illusions [Disastrous Illusions] [March 1848] [CW3 ES3.24]
- Profession de foi électorale de 1848 [22 mars 1848] [CW1.2.2]
- Lettre à un ecclésiastique [28 mars 1848] [CW1.4.20]
- Propriété et loi [15 May 1848] [CW2.4]
- *Jacques Bonhomme* [11 June to 13 July, 1848]
- ToC
- La liberté [11-15 June 1848] [CW1.4.9]
- Laissez-Faire [11 au 15 juin 1848] [CW1.4.10]
- L'Assemblée Nationale [11-15 June 1848] [CW1.4.17]
- L'Etat (note) [11–15 June 1848] [CW2.4]
- Prendre cinq et rendre quatre, ce n'est pas donner. [15 to 18 June 1848]
- Une mystification [JB, 15 au 18 juin 1848]
- Funeste gradation [JB, 20 to 23 June 1848]
- Aux citoyens Lamartine et Ledru-Rollin [20 au 23 juin 1848] [CW1.4.10]
- Justice et fraternité [15 juin 1848] [CW2.5]
- Individualisme et fraternité [June 1848] [CW2.6]
- Propriété et spoliation [24 July 1848] [CW2.10]
- T.223 Economic Harmonies I, II, III in JDE (Sept. 1848) (Fr, PDF1, PDF2)
- L’État JDD version [25 September 1848]
- T.224 (1848.10.??) "Opinion of Bastiat on the right to work." (Garnier Book) (Fr, PDF)
- T.273 (1848.10.10) SEP: Séance de 10 oct. 1848 (on an income tax) (Fr, PDF1, PDF2)
- T.274 (1848.12.10) SEP: Séance de 10 dec. 1848 (on the emancipation of the colonies) (Fr, PDF1, PDF2)
- T.225 Economic Harmonies IV in JDE (15 Dec. 1848) (Fr, PDF1)
- Lettre sur le référendum pour le président de la république (JCPD) [late 1848 ???] [not available] [CW??]
- ToC
- Sophismes économiques. Deuxième série [January 1848] [CW3]
- I. Physiologie de la Spoliation
- II. Deux morales
- III. Les deux haches
- IV. Conseil inférieur du travail
- V. Cherté, bon marché
- VI. Aux artisans et ouvriers
- VII. Conte chinois
- VIII. Post hoc, ergo proper hoc
- IX. Le vol à la prime
- X. Le percepteur
- XI. L'utopiste
- XII. Le sel, la poste et la douane
- XIII. Les trois Échevins
- XIV. Autre chose
- XV. Le petit arsenal du libre-échangiste
- XVI. La main droite et la main gauche
- XVII. Domination par le travail
1849
- à M. et madame Cheuvreux: Lettre de 1849 (Bruxelles, hôtel de Bellevue) Paris???
- Letters to Cheuvreux Family: Janvier 1849, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 1er janvier 1849, Paris
- Lettre à M. George Wilson [15 Jan. 1849], Paris
- à M. Domenger: Lettre du 18 janvier 1849, Paris
- [CW1.123] [CH] 123. Paris, février 1849. A Madame Cheuvreux ???
- Letters to Cheuvreux Family: Mercredi, février 1849
- à M. Domenger: Lettre du 3 février 1849, Paris
- à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris
- à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris
- Letters to Cheuvreux Family: Lundi, mars 1849, Paris
- à M. et madame Schwabe: Lettre du 11 mars 1849, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 15 mars 1849, Paris
- à M. Domenger: Lettre du 25 mars 1849, Paris
- à M. Domenger: Lettre du 8 avril 1849, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 25 avril 1849, Paris
- à M. Domenger: Lettre du 29 avril 1849, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: 3 mai 1849, Paris
- à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris
- [CW1.137] [CH] 137. Bruxelles, hôtel de Bellevue, juin 1849. A Madame Cheuvreux ????
- Letters to Cheuvreux Family: Juin 1849, Bruxelles, hôtel de Bellevue
- Letters to Cheuvreux Family: Juin 1849, Notes prises d’Anvers
- à M. Domenger: Lettre d’un mardi 13 (été de 1849), Paris
- à M. Paillottet: Lettre du 14 juillet 1849 (Paris)
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 30 juillet 1849, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: 30 août 1849, Mont-de-Marsan
- Letters to Cheuvreux Family: 12 septembre 1849, Mugron
- Letters to Cheuvreux Family: 16 septembre 1849, Mugron
- à M. Horace Say; Lettre du 16 septembre 1849 (Mugron)
- Letters to Cheuvreux Family: 18 septembre 1849, Mugron
- Letters to Cheuvreux Family: 7 octobre 1849, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: 8 octobre 1849, Paris
- à M. et madame Schwabe: Lettre du 14 octobre 1849, Paris
- à Richard Cobden: Lettre du 17 octobre 1849, Paris
- à Richard Cobden: Lettre du 24 octobre 1849, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: Novembre 1849, Paris
- à M. Domenger: Lettre du 13 novembre 1849, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 13 décembre 1849 (Paris)
- à M. Domenger: Lettre du 25 décembre 1849, Paris
- à Richard Cobden: Lettre du 31 décembre 1849, Paris
- Le Capital [1849]
- De la séparation du temporel et du spirituel [1849] [CW1.4.22]
- Rapport du Conseil général des Landes sur les communaux [1849] [CW1.4.16]
- Protectionnisme et communisme [January 1849] [CW2.12]
- Conséquences de la réduction sur l’impôt du sel [1 Jan. 1849]
- Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849
- Capital et rente [February 1849]
- Paix et liberté du le budget républicain [février 1849] [CW2.15]
- T.275 (1849.02.10) SEP: Séance de 10 fev. 1849 (financial reform) (Fr, PDF1, PDF2)
- Incompatibilités parlementaires [March 1849] [CW2.19]
- Profession de foi électorale de 1849 [April 1849] [CW2.2.6]
- Maudit argent [avril 1849]
- L’État [April 1849 pamphlet version] [CW2.7]
- “Profession de foi électorale de 1849. À MM. Tonnelier, Oegos, Bergeron, Camors, Oubroca, Pomeoe, Fauret, etc.” [May, 1849] [CW2.2.5]
- T.276 (1849.05.10) SEP: Séance de 10 mai 1849 (on the Peace Congress and state support for socialist programs) (Fr)
- T.240 (1849.08.22) A speech on "Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement." (Longer English trans.)
- Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement
- T.277 (1849.10.10) SEP: Séance de 10 oct. 1849 (limits to the functions of the state and the individual - GdM's new book) (Fr, PDF1, PDF2)
- T.242 (1849.11.10) SEP: Séance de 10 nov. 1849 (on war, disarmament, and socialism) (Fr, PDF1, PDF2)
- Discours sur la répression des coalitions industrielles [17 Nov. 1849] [CW2.17]
- T.245 (1849.12.10) SEP: Séance de 10 dec. 1849 (state support for popularising political economy and FB’s new book EH) (Fr, PDF1, PDF2)
- Discours sur l'impôt des boissons [12 Dec. 1849] [CW2.16]
Books and Printed Pamphlets - 1849
1850
- à M. Félix Coudroy: Lettre du Commencement de 1850, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: 2 janvier 1850, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: Janvier 1850, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: Février 1850, Paris
- à M. Domenger: Lettre du 18 février 1850, Paris
- Letters to Cheuvreux Family: Mars 1850, Paris
- à M. Domenger: Lettre du 22 mars 1850 (Paris)
- Letters to Cheuvreux Family: Vendredi, avril 1850, Paris
- Cheuvreux ???
- Letters to Cheuvreux Family: Mai 1850, Bordeaux
- à M. Paillottet: Lettre du 19 mai 1850 (Mugron)
- Letters to Cheuvreux Family: 20 mai 1850, Mugron
- Letters to Cheuvreux Family: 23 mai 1850, Mugron
- Letters to Cheuvreux Family: 27 mai 1850, Mugron
- à M. Paillottet: Lettre du 2 juin 1850 (Mugron)
- à M. Horace Say; Lettre du 3 juin 1850 (Mugron)
- Letters to Cheuvreux Family: 11 juin 1850, Mugron
- à M. et madame Cheuvreux: Lettre de juin 1850 (Mugron) ???
- Letters to Cheuvreux Family: 15 juin 1850, Eaux-Bonnes
- à M. Paillottet: Lettre du 23 juin 1850 (Eaux-Bonnes)
- Letters to Cheuvreux Family: 23 juin 1850, Eaux-Bonnes
- [CW1.177] [CH] 177 Eaux-Bonnes, 24 juin 1850. A Madame Cheuvreux ????
- à M. Paillottet: Lettre du 28 juin 1850 (Eaux-Bonnes)
- à M. Paillottet: Lettre du 2 juillet 1850 (Eaux-Bonnes)
- Lettre à M. de Fontenay [3 july 1850] Eaux-Bonnes
- Letters to Cheuvreux Family: 4 juillet 1850, Eaux-Bonnes
- à M. et madame Cheuvreux: Lettre de juillet 1850 (Mugron) ???
- à M. Horace Say; Lettre du 4 juillet 1850 (Eaux-Bonnes)
- [CW1.183] [OC7] 183 Mugron, juillet 1850. A Madame Cheuvreux
- à M. et madame Cheuvreux: Lettre du 14 juillet 1850 (Mugron) ???
- [CW1.184] [CH] 184 Mugron, 14 juillet 1850. A M. Cheuvreux ???
- Letters to Cheuvreux Family: 14 juillet 1850, Mugron
- à Richard Cobden: Lettre du 3 août 1850, Paris
- à Richard Cobden: Lettre du 17 août 1850, Paris
- Lettre au président du Congrès de la paix, à Francfort [17 Aug. 1850], Paris
- à Richard Cobden: Lettre du 9 septembre 1850, Paris
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 9 septembre 1850 (Paris)
- Letters to Cheuvreux Family: 9 septembre 1850, Paris ????
- à M. Paillottet: Lettre du 14 septembre 1850 (Lyon)
- Letters to Cheuvreux Family: 14 septembre 1850, Lyon
- Letters to Cheuvreux Family: Le soir, 14 septembre 1850, Lyon
- Letters to Cheuvreux Family: 18 septembre 1850, Marseille
- Letters to Cheuvreux Family: 22 septembre 1850, Marseille (à bord du Castor)
- Letters to Cheuvreux Family: 2 octobre 1850, Pise
- à M. Domenger: Lettre du 8 octobre 1850 (Pise)
- à M. Paillottet: Lettre du 11 octobre 1850 (Pise)
- à M. Paillottet: Lettre du 11 octobre 1850 (Pise)
- Letters to Cheuvreux Family: 14 octobre 1850, Pise
- à Richard Cobden: Lettre du 18 octobre 1850 (Pise)
- à M. Horace Say; Lettre du 20 octobre 1850 (Pise)
- à M. le comte Arrivabene: Lettre du 28 octobre 1850 (Pise)
- Letters to Cheuvreux Family: 29 octobre 1850, Pise
- à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 novembre 1850 (Rome)
- à M. Paillottet: Lettre du 26 novembre 1850 (Rome)
- à M. Domenger: Lettre du 28 novembre 1850 (Rome)
- à M. Paillottet: Lettre du 8 décembre 1850 (Rome)
- Letters to Cheuvreux Family: Samedi 14 décembre 1850, Rome
- Lettre de M. Paillottet à Mme Cheuvreux, Rome, 22 décembre 1850 ???
- Lettre au Journal des Économistes [date?] ???
- Les trois conseils [c. 1850] [CW1.4.23]
- Baccalauréat et socialisme [early 1850] [CW2.11]
- T.250 (1850.01.10) SEP: Séance de 10 jan. 1850 (What is the Limit of the Functions of the State? Part II) (Fr, PDF1, PDF2)
- T.251 (1850.02.10) SEP: Séance de 10 fev. 1850 (the limits to state power - Part 3??)
- Balance du commerce [29 March 1850]
- T.255 (1850.04.15) "England’s New Colonial Policy. Lord John Russel’s Plan" (JDE, 15 Apr, 1850) (Fr, PDF)
- T.256 (1850.04.15) SEP: Séance du 10 Avril 1850 (Land Credit) (Fr, PDF1, PDF2)
- Spoliation et loi [15 mai 1850] [CW2.4]
- Réflexions sur l'amendement de M. Mortimer-Ternaux. [1 April 1850] [CW2.18]
- Nouvelle politique coloniale de l'Angleterre. Plan de Lord John Russel [15 avril 1850] [missing???] [CW ??]
- A MM. les protectionnistes du Conseil général des manufactures [15 mai 1850] [see Spoliation et loi [CW2.4]]
- La loi [June 1850]
- T.278 (1850.09.10) SEP: Séance de 10 sept. 1850 (SEP farewell to FB) (Fr, PDF1)
- Abondance [Sept. 1850]
- Table of Contents
- *Harmonies économiques* [1st ten chapters, Jan/Feb 1850]
- *Intérêt et principale* or *Gratuité du crédit* [Oct. 1849 - March 1850]
- Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas
- *Spoliation et loi*
- Gratuité du crédit [Oct. 1849 - March 1850]
- PREMIÈRE LETTRE. - F. C. Chevé, l'un des rédacteurs de la Voix du Peuple, à Frédéric Bastiat
- DEUXIÈME LETTRE. - F. Bastiat au rédacteur de la Voix du peuple
- TROISIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- QUATRIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- CINQUIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- SIXIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- SEPTIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- HUITIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- NEUVIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- DIXIÈME LETTRE - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- ONZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- DOUZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- TREIZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- QUATORZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- Harmonies économiques (1850, 1851)
- Foreword to the Second Enlarged Edition by Prosper Paillottet and Roger de Fontenay (La Société des amis de Bastiat) (1851) [to be trans.]
- À la jeunesse française
- I. Organisation naturelle, organisation artificielle
- II. Besoins, Efforts, Satisfactions
- III. Des Besoins de l’homme
- IV. Échange
- V. De la Valeur
- VI. Richesse
- VII. Capital
- VIII. Propriété, Communauté
- IX. Propriété foncière
- X. Concurrence
- Conclusion de la première édition
- Listes des chapitres destinées à completer les Harmonies économique [incomplete ???]
- XI. Producteur, Consommateur
- XII. Les deux Devises
- XIII. De la Rente
- De la Monnaie
- Du Crédit
- XIV. Des Salaires
- XV. De l’Épargne
- XVI. De la Population
- Long Note by “R.F.” [1851 ed.]
- XVII. Services privés, services publics
- XVIII. Causes perturbatrices
- XIX. Guerre
- XX. Responsabilité
- XXI. Solidarité
- XXII. Moteur social
- XXIII. Le Mal
- XXIV. Perfectibilité
- XXV. Rapports de l’économie politique avec la morale, avec la politique, avec la législation, …. avec la religion.
- Endnotes
- Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas [July 1850] [CW3]
Undated Material
- Sophismes électoraux [no date] [CW1.3.1]]
- Les élections. Dialogue entre un profond Publiciste et un Campagnard [no date] [CS1.3.2]
- Untitled Fragment on Canals [no date - 1837.06??] [CW1.3.3]
- Incompatibilités Parlementaires (Presse bayonnaise) (JCPD) [no date] [not available]
- Question religieuse [no date] [CW1.4.21]
- Deux articles sur la langue basque (JCPD) [no date] [not available]
Posthumous Material
- T.279 (1851.01.10) SEP: Séance de 10 jan. 1851 (announcement of FB's death) (Fr, PDF1)
- Lettre non datée [1851 ???] [missing]
- Lettre de M. Carey, réponse de MM. Frédéric Bastiat et A. Clément [15 Jan. 1851] [missing]
- Producteur — Consommateur (article inédit) de Frédéric Bastiat [15 June 1851] [missing]
- Lettre inédite de Frédéric Bastiat à Fonteyraud [Septembre et Octobre 1852]
- Lettres d’un habitant des Landes (1877)
Endnotes
Writings Sept. 1819 - Nov. 1844
Correspondence↩
à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 septembre 1819 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.1] [OC1] 1. Bayonne, 12 septembre 1819. A Victor Calmètes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous nous trouvons, mon ami, dans le même cas : tous les deux nous sommes portés par goût à une étude autre que celle que le devoir nous ordonne ; à la différence que la philosophie, vers laquelle notre penchant nous entraîne, tient de plus près à l’état d’avocat qu’à celui de négociant.
Tu sais que je me destine au commerce. En entrant dans un comptoir, je m’imaginais que l’art du négociant était tout mécanique et que six mois suffisaient pour faire de moi un négociant. Dans ces dispositions, je ne crus pas nécessaire de travailler beaucoup, et je me livrai particulièrement à l’étude de la philosophie et de la politique.
Depuis je me suis bien désabusé. J’ai reconnu que la science du commerce n’était pas renfermée dans les bornes de la routine. J’ai su que le bon négociant, outre la nature des marchandises sur lesquelles il trafique, le lieu d’où on les tire, les valeurs qu’il peut échanger, la tenue des livres, toutes choses que l’expérience et la routine peuvent en partie faire connaître, le bon négociant, dis-je, doit étudier les lois et approfondir l’économie politique, ce qui sort du domaine de la routine et exige une étude constante.
Ces réflexions me jetèrent dans une cruelle incertitude. Continuerais-je l’étude de la philosophie qui me plaît, ou m’enfoncerais-je dans les finances que je redoute ? Sacrifierais-je mon devoir à mon goût et, mon goût à mon devoir ?
Décidé à faire passer mon devoir avant tout, j’allais commencer mes études, quand je m’avisai de jeter un regard sur l’avenir. Je pesai la fortune que je pouvais espérer et, la mettant en balance avec mes besoins, je m’assurai que, pour peu que je fusse heureux au commerce, je pourrais, très-jeune encore, me décharger du joug d’un travail inutile à mon bonheur. Tu connais mes goûts ; tu sais si, pouvant vivre heureux et tranquille, pour peu que ma fortune excède mes besoins, tu sais si, pendant les trois quarts de ma vie, j’irai m’imposer le fardeau d’un ennuyeux travail, pour posséder, le reste de ma vie, un superflu inutile.
… Te voilà donc bien convaincu que, dès que je pourrai avoir une certaine aisance, ce qui, j’espère, sera bientôt, j’abandonne les affaires.
à M. Victor Calmètes: Lettre du 5 mars 1820 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.2] [OC1] 2. Bayonne, 5 mars 1820. A Victor Calmètes
J’avais lu le Traité d’économie politique de J. B. Say, excellent ouvrage très méthodique. Tout découle de ce principe que les richesses sont les valeurs et que les valeurs se mesurent sur l’utilité. De ce principe fécond, il vous mène naturellement aux conséquences les plus éloignées, en sorte qu’en lisant cet ouvrage on est surpris, comme en lisant Laromiguière, de la facilité avec laquelle on va d’une idée à une idée nouvelle. Tout le système passe sous vos yeux avec des formes variées et vous procure tout le plaisir qui naît du sentiment de l’évidence.
Un jour que je me trouvais dans une société assez nombreuse, on traita, en manière de conversation, une question d’économie politique ; tout le monde déraisonnait. Je n’osais pas trop émettre mes opinions, tant je les trouvais opposées aux idées reçues ; cependant me trouvant, par chaque objection, obligé de remonter d’un échelon pour en venir à mes preuves, on me poussa bientôt jusqu’au principe. Ce fut alors que M. Say me donna beau jeu. Nous partîmes du principe de l’économie politique, que mes adversaires reconnaissaient être juste ; il nous fut bien facile de descendre aux conséquences et d’arriver à celle qui était l’objet de la discussion. Ce fut à cette occasion que je sentis tout le mérite de la méthode, et je voudrais qu’on l’appliquât à tout. N’es-tu pas de mon avis là-dessus ?
à M. Victor Calmètes: Lettre du 18 mars 1820, Bayonne ↩
BWV
[CW1.3] [OC1] 3. Bayonne, 18 mars 1820. A Victor Calmètes
… Je suis entré pas à pas dans le monde, mais je ne m’y suis pas jeté ; et, au milieu de ses plaisirs et de ses peines, quand les autres, étourdis par tant de bruit, s’oublient, si je puis m’exprimer ainsi, dans le cercle étroit du présent, mon âme vigilante avait toujours un œil en arrière, et la réflexion l’a empêchée de se laisser dominer. D’ailleurs mon goût pour l’étude a pris beaucoup de mes instants. Je m’y suis tellement livré, l’année dernière, que cette année on me l’a défendue, à la suite d’une incommodité douloureuse qu’elle m’a occasionnée…
à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1820 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.4] [OC1] 4. Bayonne, 10 septembre 1820. A Victor Calmètes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une chose qui m’occupe plus sérieusement, c’est la philosophie et la religion. Mon âme est pleine d’incertitude et je ne puis plus supporter cet état. Mon esprit se refuse à la foi et mon cœur soupire après elle. En effet, comment mon esprit saurait-il allier les grandes idées de la Divinité avec la puérilité de certains dogmes, et, d’un autre côté, comment mon cœur pourrait-il ne pas désirer de trouver dans la sublime morale du christianisme des règles de conduite ? Oui, si le paganisme est la mythologie de l’imagination, le catholicisme est la mythologie du sentiment. — Quoi de plus propre à intéresser un cœur sensible que cette vie de Jésus, que cette morale évangélique, que cette médiation de Marie ! que tout cela est touchant…
à M. Victor Calmètes: Lettre d’octobre 1820 (Bayonne) [edit]↩
BWV
[CW1.5] [OC1] 5. Bayonne, octobre 1820. A Victor Calmètes
Je t’avoue, mon cher ami, que le chapitre de la religion me tient dans une hésitation, une incertitude qui commencent à me devenir à charge. Comment ne pas voir une mythologie dans les dogmes de notre catholicisme ? Et cependant cette mythologie est si belle, si consolante, si sublime, que l’erreur est presque préférable à la vérité. Je pressens que si j’avais dans mon cœur une étincelle de foi, il deviendrait bientôt un foyer. Ne sois pas surpris de ce que je te dis là. Je crois à la Divinité, à l’immortalité de l’âme, aux récompenses de la vertu et au châtiment du vice. Dès lors, quelle immense différence entre l’homme religieux et l’incrédule ! mon état est insupportable. Mon cœur brûle d’amour et de reconnaissance pour mon Dieu, et j’ignore le moyen de lui payer le tribut d’hommages que je lui dois. Il n’occupe que vaguement ma pensée, tandis que l’homme religieux a devant lui une carrière tracée à parcourir. Il prie. Toutes les cérémonies du culte le tiennent sans cesse occupé de son Créateur. Et puis ce sublime rapprochement de Dieu et de l’homme, cette rédemption, qu’il doit être doux d’y croire ! quelle invention, Calmètes, si c’en est une !
Outre ces avantages, il en est un autre qui n’est pas moindre : l’incrédule est dans la nécessité de se faire une morale, puis de la suivre. Quelle perfection dans l’entendement, quelle force dans la volonté lui sont indispensables ! et qui lui répond qu’il ne devra pas changer demain son système d’aujourd’hui ? L’homme religieux au contraire a sa route tracée. Il se nourrit d’une morale toujours divine.
à M. Victor Calmètes: Lettre du 19 avril 1821 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.6] [OC1] 6. Bayonne, 29 avril 1821. A Victor Calmètes
… Pour moi, je crois que je vais me fixer irrévocablement à la religion. Je suis las de recherches qui n’aboutissent et ne peuvent aboutira rien. Là, je suis sûr de la paix, et je ne serai pas tourmenté de craintes, même quand je me autre côtéais. D’ailleurs, c’est une religion si belle, que je conçois qu’on la puisse aimer au point d’en recevoir le bonheur dès cette vie.
Si je parviens à me déterminer, je reprendrai mes anciens goûts. La littérature, l’anglais, l’italien, m’occuperont comme autrefois ; mon esprit s’était engourdi sur les livres de controverse, de théologie et de philosophie. J’ai déjà relu quelques tragédies d’Alfieri…
à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1821 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.7] [OC1] 7. Bayonne, 10 septembre 1821. A Victor Calmètes
Je veux te dire un mot de ma santé. Je change de genre de vie, j’ai abandonné mes livres, ma philosophie, ma dévotion, ma mélancolie, mon spleen enfin, et je m’en trouve bien. Je vais dans le monde, cela me distrait singulièrement. Je sens le besoin d’argent, ce qui me donne envie d’en gagner, ce qui me donne du goût pour le travail, ce qui me fait passer la journée assez agréablement au comptoir, ce qui, en dernière analyse, est extrêmement favorable à mon humeur et à ma santé. Cependant je regrette parfois ces jouissances sentimentales auxquelles on ne peut rien comparer ; cet amour de la pauvreté, ce goût pour la vie retirée et paisible, et je crois qu’en me livrant un peu au plaisir, je n’ai voulu qu’attendre le moment de l’abandonner. Porter la solitude dans la société est un contre-sens, et je suis bien aise de m’en être aperçu à temps…
à M. Victor Calmètes: Lettre du 8 décembre 1821 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.8] [OC1] 8. Bayonne, 8 décembre 1821. A Victor Calmètes
J’étais absent, mon cher ami, quand ta lettre est parvenue à Bayonne, ce qui retarde un peu ma réponse. Que j’ai eu de plaisir à la recevoir cette chère lettre ! À mesure que l’époque de notre séparation s’éloigne de nous, je pense à toi avec plus d’attendrissement ; je sens mieux le prix d’un bon ami. Je n’ai pas trouvé ici qui pût te remplacer dans mon cœur. Comme nous nous aimions ! pendant quatre ans nous ne nous sommes pas quittés un instant. Souvent l’uniformité de notre manière de vivre, la parfaite conformité de nos sentiments et de nos pensées ne nous permettait pas de beaucoup causer. Avec tout autre, de silencieuses promenades aussi longues m’auraient été insupportables ; avec toi, je n’y trouvais rien de fatigant ; elles ne me laissaient rien à désirer. J’en vois qui ne s’aiment que pour faire parade de leur amitié, et nous, nous nous aimions obscurément, bonnement ; nous ne nous aperçûmes que notre attachement était remarquable que lorsqu’on nous l’eut fait remarquer. Ici, mon cher, tout le monde m’aime, mais je n’ai pas d’ami…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
… Te voilà donc, mon ami, en robe et en bonnet carré ! Je suis en peine de savoir si tu as des dispositions pour l’état que tu embrasses. Je te connais beaucoup de justesse et de rectitude dans le jugement ; mais c’est la moindre des choses. Tu dois avoir l’élocution facile, mais l’as-tu aussi pure ? ton accent n’a pas dû s’améliorer à Toulouse, ni se perfectionner à Perpignan. Le mien est toujours détestable et probablement ne changera jamais. Tu aimes l’étude, assez la discussion. Je crois donc que tu dois à présent t’attacher surtout à l’étude des lois, car ce sont des notions que l’on n’apprend que par le travail, comme l’histoire et la géographie, — et ensuite à la partie physique de ta profession. Les grâces, les manières nobles et aisées, ce vernis, ce coup d’œil, cet avant-main, ce je ne sais quoi qui plaît, qui prévient, qui entraîne. C’est là la moitié du succès. Lis à ce sujet les Lettres de lord Chesterfield à son fils. C’est un livre dont je suis loin d’approuver la morale, toute séduisante qu’elle est ; mais un esprit juste comme le tien saura facilement laisser le mauvais et faire son profit du bon.
Pour moi, ce n’est pas Thémis, c’est l’aveugle Fortune que j’ai choisie, ou qu’on m’a choisie pour amante. Cependant, je dois l’avouer, mes idées sur cette déesse ont beaucoup changé. Ce vil métal n’est plus aussi vil à mes yeux. Sans doute il était beau de voir les Fabricius et les Curius demeurer pauvres, lorsque les richesses n’étaient le fruit que du brigandage et de l’usure ; sans doute Cincinnatus faisait bien de manger des fèves et des raves, puisqu’il aurait dû vendre sa patrie et son honneur pour manger des mets plus délicats ; mais les temps sont changés. — À Rome la fortune était le fruit du hasard, de la naissance, de la conquête ; aujourd’hui elle n’est que le prix du travail, de l’industrie, de l’économie. Dans ce cas elle n’a rien que d’honorable. C’est un fort sot préjugé qu’on puise dans les colléges, que celui qui fait mépriser l’homme qui sait acquérir avec probité et user avec discernement. Je ne crois pas que le monde ait tort, dans ce sens, d’honorer le riche ; son tort est d’honorer indistinctement le riche honnête homme et le riche fripon…
à M. Victor Calmètes: Lettre du 20 octobre 1821 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.9] [OC1] 9. Bayonne, 20 octobre 1822. A Victor Calmètes
Tout le monde court après le bonheur, tout le monde le place dans une certaine situation de la vie et y aspire ; celui que tu attaches à la vie retirée n’a peut-être d’autre mérite que d’être aperçu de loin. J’ai plus aimé que toi la solitude, je l’ai cherchée avec passion, j’en ai joui ; et, quelques mois encore, elle me conduisait au tombeau. L’homme, le jeune homme surtout, ne peut vivre seul ; il saisit avec trop d’ardeur, et si sa pensée ne se partage pas sur mille objets divers, celui qui l’absorbe le tue.
J’aimerais bien la solitude ; mais j’y voudrais des livres, des amis, une famille, des intérêts ; des intérêts, oui, mon ami, ne ris pas de ce mot ; il attache, il occupe. Le philosophe même, ami de l’agriculture, s’ennuierait bientôt, n’en doute pas, s’il devait cultiver gratis la terre d’autrui. C’est l’intérêt qui embellit un domaine aux yeux du propriétaire, qui donne du prix aux détails, rend heureux Orgon et fait dire à l’Optimiste :
Le château de Plainville est le plus beau du monde.
Tu sens bien que, par intérêt, je ne veux point parler de ce sentiment qui approche de l’égoïsme.
Pour être heureux, je voudrais donc posséder un domaine dans un pays gai, surtout dans un pays où d’anciens souvenirs et une longue habitude m’auraient mis en rapport avec tous les objets. C’est alors qu’on jouit de tout, c’est là le vita vitalis. Je voudrais avoir pour voisins, ou même pour cohabitants, des amis tels que toi, Carrière et quelques autres. Je voudrais un bien qui ne fût ni assez grand pour que j’eusse la faculté de le négliger, ni assez petit pour m’occasionner des soucis et des privations. Je voudrais une femme… je n’en ferai pas le portrait, je le sens mieux que je ne saurais l’exprimer ; je serais moi-même (je ne suis pas modeste avec toi) l’instituteur de mes enfants. Ils ne seraient pas effrontés comme en ville, ni sauvages comme dans un désert. Il serait trop long d’entrer dans tous les détails, mais je t’assure que mon plan a le premier de tous les mérites, celui de n’être pas romanesque. . . . . . . . . . . . . .
à M. Victor Calmètes: Lettre de décembre 1822 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.10] [OC1] 10. Bayonne, décembre 1822. A Victor Calmètes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je lisais hier une tragédie de Casimir Delavigne intitulée le Paria. Je n’ai plus l’habitude des analyses critiques ; aussi je ne t’entretiendrai pas de ce poëme. D’ailleurs j’ai renoncé à cette disposition générale des lecteurs français, qui cherchent, dans leurs lectures, bien plus des fautes contre les règles que du plaisir. Si je jouis en lisant, je suis très-peu sévère sur l’ouvrage, car l’intérêt est la plus grande de toutes les beautés. J’ai remarqué que tous les modernes tragédiens échouent au dialogue. M. Casimir Delavigne, qui est en cela supérieur, selon moi, à Arnault et Jouy, est bien loin de la perfection. Son dialogue n’est pas assez coupé ni surtout assez suivi, ce sont des tirades et des discours, qui même ne s’enchaînent pas toujours ; et c’est un des défauts que le lecteur pardonne le moins, parce que l’ouvrage est sans vraisemblance ni vérité. Je crois plutôt assister à la conférence de deux prédicateurs, ou aux plaidoyers de deux avocats, qu’à la conversation sincère, animée et naturelle de deux personnes. — Alfieri excelle, je crois, dans le dialogue, celui de Racine est aussi très-simple et naturel. Du reste, entraîné par un vif intérêt (qui n’est peut-être pas assez souvent suspendu), j’ai plutôt parcouru que lu le Paria. La versification m’en a paru belle, trop métaphorique, si ce n’étaient des Orientaux. — Mais la catastrophe est trop facile à prévoir, et dès le début le lecteur est sans espérance.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 15 décembre 1824 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.11] [OC1] 11. Bayonne, 15 décembre 1824. A Félix Coudroy [3]
Je vois avec plaisir que tu étudies ardemment l’anglais, mon cher Félix. Dès que tu auras surmonté les premières difficultés, tu trouveras dans cette langue beaucoup de ressources, à cause de la quantité de bons ouvrages qu’elle possède. Applique-toi surtout à traduire et à remplir ton magasin de mots, le reste vient ensuite. Au collége, j’avais un cahier, j’en partageais les pages par un pli ; d’un côté j’écrivais tous les mots anglais que je ne savais pas, et de l’autre les mots français correspondants. Cette méthode me servit à graver beaucoup mieux les mots dans ma tête. Quand tu auras fini Paul et Virginie, je t’enverrai quelque autre chose ; en attendant je transcris ici quelques vers de Pope pour voir si tu sauras les traduire. Je t’avoue que j’en doute, parce qu’il m’a fallu longtemps avant d’en venir là.
Je ne suis pas surpris que l’étude ait pour toi tant de charmes. Je l’aimerais aussi beaucoup si d’autres incertitudes ne venaient me tourmenter. Je suis toujours comme l’oiseau sur la branche, parce que je ne veux rien faire qui puisse déplaire à mes parents ; mais pour peu que ceci continue, je jette de côté tout projet d’ambition et je me renferme dans l’étude solitaire.
Let us (since life can little more supply)
Than just to look about us to die)
Expatiate free over all this scene of man.
Je ne dois pas craindre que l’étude ne suffise pas à mon ardeur, puisque je ne tiendrais à rien moins qu’à savoir la politique, l’histoire, la géographie, les mathématiques, la mécanique, l’histoire naturelle, la botanique, quatre ou cinq langues, etc., etc.
Il faut te dire que, depuis que mon grand-père est sujet à ses fièvres, il a l’imagination frappée ; et par suite il ne voudrait voir aucun membre de sa famille s’éloigner. Je sais que je lui ferais beaucoup de peine en allant à Paris, et dès lors je prévois que j’y renoncerai, parce que je ne voudrais pas pour tout au monde lui causer du chagrin. Je sais bien que ce sacrifice n’est pas celui d’un plaisir passager, c’est celui de l’utilité de toute ma vie ; mais enfin je suis résolu à le faire pour éviter du chagrin à mon grand-père. D’un autre côté, je ne veux pas continuer, par quelques raisons qui tiennent aux affaires, le genre de vie que je mène ici ; et par conséquent je vais proposer à mon grand-père de m’aller définitivement fixer à Mugron. — Là je crains encore un écueil, c’est qu’on ne veuille me charger d’une partie de l’administration des biens, ce qui fait que je trouverais à Mugron tous les inconvénients de Bayonne. Je ne suis nullement propre à partager les affaires. Je veux tout supporter ou rien. Je suis trop doux pour dominer et trop vain pour être dominé. Mais enfin je ferai mes conditions. Si je vais à Mugron, ce sera pour ne me mêler que de mes études. Je traînerai après moi le plus de livres que je pourrai, et je ne doute pas qu’au bout de quelque temps ce genre de vie ne finisse par me plaire beaucoup.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 8 janvier 1825, Bayonne ↩
BWV
[CW1.12] [OC1] 12. Bayonne, 8 janvier 1825. A Félix Coudroy
Je t’envoie ce qui précède, mon cher Félix ; ça te sera toujours une preuve que je ne néglige pas de te répondre, mais seulement de plier ma lettre. J’ai ce malheureux défaut, qui tient à mes habitudes désordonnées, de me croire quitte envers mes amis quand j’ai écrit, sans songer qu’il faut encore que la lettre parte.
Tu me parles de l’économie politique, comme si j’en savais là-dessus plus que toi. Si tu as lu Say attentivement, comme il me paraît que tu l’as fait, je puis t’assurer que tu m’auras laissé derrière, car je n’ai jamais lu sur ces matières que ces quatre ouvrages, Smith, Say, Destutt, et le Censeur ; encore n’ai-je jamais approfondi M. Say, surtout le second volume, que je n’ai que lisotté. Tu désespères que jamais des idées saines sur ce sujet pénètrent dans l’opinion publique ; je ne partage pas ce désespoir. Je crois au contraire que la paix qui règne sur l’Europe, depuis dix ans, les a beaucoup répandues ; et c’est un bonheur peut-être que ces progrès soient lents et insensibles. Les Américains des États-Unis ont des idées très-saines sur ces matières, quoiqu’ils aient établi des douanes par représailles. L’Angleterre, qui marche toujours à la tête de la civilisation européenne, donne aujourd’hui un grand exemple en renonçant graduellement au système qui l’entrave. [4] En France, le commerce est éclairé, mais les propriétaires le sont peu, et les manufacturiers travaillent aussi vigoureusement pour retenir le monopole. Malheureusement nous n’avons pas de chambre qui puisse constater le véritable état des connaissances nationales. La septennalité nuit aussi beaucoup à ce mouvement lent et progressif d’instruction, qui, de l’opinion, passait à la législature avec le renouvellement partiel. Enfin quelques circonstances et surtout ce caractère français indécrottable, enthousiaste de nouveauté et toujours prêt à se payer de quelques mots heureux, empêchera quelque temps le triomphe de la vérité. Mais je n’en désespère pas ; la presse, le besoin et l’intérêt finiront par faire ce que la raison ne peut encore effectuer. Si tu lis le Journal du commerce, tu auras vu comment le gouvernement anglais cherche à s’éclairer en consultant officiellement les négociants et les fabricants les plus éclairés. Il est enfin convenu que la prospérité de la Grande-Bretagne n’est pas le produit du système qu’elle a suivi, mais de beaucoup d’autres causes. Il ne suffit pas que deux faits existent ensemble pour en conclure que l’un est cause et l’autre effet. En Angleterre, le système de prohibition et la prospérité ont bien des rapports de coexistence, de contiguïté, mais non de génération. L’Angleterre a prospéré non à cause, mais malgré un milliard d’impôts. C’est là la raison qui me fait trouver si ridicule le langage des ministres, qui viennent nous dire chaque année d’un air triomphant : Voyez comme l’Angleterre est riche, elle paye un milliard !
Je crois que si j’avais eu plus de papier, j’aurais continué cet obscur bavardage. Adieu, je t’aime bien tendrement.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 9 avril 1827 (Bordeaux) ↩
BWV
[CW1.13] [OC1] 13. Bordeaux, 9 avril 1827. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, n’étant pas encore fixé sur l’époque de mon retour à Mugron, je veux rompre la monotonie de mon éloignement par le plaisir de l’écrire, et je commence par te donner quelques nouvelles littéraires.
D’abord je t’annonce que MM. Lamennais et Dunoyer (noms qui ne sont pas ainsi accouplés) en sont toujours au même point, c’est-à-dire l’un à son quatrième et l’autre à son premier volume.
Dans un journal intitulé Revue encyclopédique, j’ai lu quelques articles qui m’ont intéressé, entre autres un examen très-court de l’ouvrage de Comte (examen qui se borne à un court éloge), des considérations sur les assurances et en général sur les applications du calcul des probabilités, un discours de M. Charles Dupin sur l’influence de l’éducation populaire, enfin, un article de Dunoyer, intitulé : Examen de l’opinion, à laquelle on a donné le nom d’industrialisme. Dans cet article, M. Dunoyer ne remonte pas plus haut qu’à MM. B. Constant et J. B. Say, qu’il cite comme les premiers publicistes qui aient observé que le but de l’activité de la société est l’industrie. À la vérité, ces auteurs n’ont pas vu le parti qu’on pouvait tirer de cette observation. Le dernier n’a considéré l’industrie que sous le rapport de la production, de la distribution et de la consommation des richesses ; et même, dans son introduction, il définit la politique la science de l’organisation de la société, ce qui semble prouver que, comme les auteurs du xviiie siècle, il ne voit dans la politique que les formes du gouvernement, et non le fond et le but de la société. Quant à M. B. Constant, après avoir le premier proclamé cette vérité, que le but de l’activité de la société est l’industrie, il est si loin d’en faire le fondement de sa doctrine, que son grand ouvrage ne traite que de formes de gouvernement, d’équilibre, de pondération de pouvoirs, etc., etc. Dunoyer passe ensuite à l’examen du Censeur Européen, dont les auteurs, après s’être emparés des observations isolées de leurs devanciers, en ont fait un corps entier de doctrine, qui, dans cet article, est discuté avec soin. Je ne puis t’analyser un article qui n’est lui-même qu’une analyse. Mais je te dirai que Dunoyer me paraît avoir réformé quelques-unes des opinions qui dominaient dans le Censeur. Par exemple, il me semble qu’il donne aujourd’hui au mot industrie une plus grande extension qu’autrefois, puisqu’il comprend, sous ce mot, tout travail qui tend à perfectionner nos facultés ; ainsi tout travail utile et juste est industrie, et tout homme qui s’y livre, depuis le chef du gouvernement jusqu’à l’artisan, est industrieux. Il suit de là que, quoique Dunoyer persiste à penser comme autrefois que, de même que les peuples chasseurs choisissent pour chef le chasseur le plus adroit, et les peuples guerriers, le guerrier le plus intrépide, les peuples industrieux doivent aussi appeler au timon des affaires publiques les hommes qui se sont le plus distingués dans l’industrie ; cependant il pense qu’il a eu tort de désigner nominativement les industries où devait se faire le choix des gouvernants, et particulièrement l’agriculture, le commerce, la fabrication et la banque ; car quoique ces quatre professions forment sans doute la plus grande partie du cercle immense de l’industrie, cependant ce ne sont pas les seules par lesquelles l’homme perfectionne ses facultés par le travail, et plusieurs autres semblent même plus propres à former des législateurs, comme sont celles de jurisconsulte, homme de lettres.
J’ai fait la trouvaille d’un vrai trésor, c’est un petit volume contenant des mélanges de morale et de politique par Franklin. J’en suis tellement enthousiaste que je me suis mis à prendre les mêmes moyens que lui pour devenir aussi bon et aussi heureux ; cependant il est des vertus que je ne chercherai pas même à acquérir, tant je les trouve inabordables pour moi. Je te porterai cet opuscule.
Le hasard m’a fait aussi trouver un article bien détaillé sur le sucre de betterave ; les auteurs calculent qu’il reviendrait au fabricant à 90 centimes la livre, celui de la canne se vend à 1 franc 10 centimes. Tu vois qu’à supposer qu’on réussît parfaitement dans une pareille entreprise, elle laisserait encore bien peu de marge. D’ailleurs, pour se livrer avec plaisir à un travail de ce genre et pour le perfectionner, il faudrait connaître la chimie, et malheureusement j’y suis tout à fait étranger ; quoi qu’il en soit, j’ai eu la hardiesse de pousser une lettre à M. Clément. Dieu sait s’il y répondra.
Pour la somme de 3 francs par mois, j’assiste à un cours de botanique qui se fait trois fois par semaine. On ne peut y apprendre grand’chose, comme tu vois ; mais outre que cela me fait passer le temps, cela m’est utile en me mettant en rapport avec les hommes qui s’occupent de science.
Voilà du babil ; s’il ne t’en coûtait pas autant d’écrire, je te prierais de me payer de retour.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 décembre 1827 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.14] [OC1] 14. Mugron, 3 décembre 1827. A Félix Coudroy
… Tu m’encourages à exécuter mon projet, je crois que je n’ai jamais pris de ma vie une résolution aussi ferme. Dès le commencement de 1828, je vais m’occuper de lever les obstacles ; les plus considérables seront pécuniaires. Aller en Angleterre, mettre mon habitation en état, acheter les bestiaux, les instruments, les livres qui me sont nécessaires, faire les avances des gages, des semences, tout cela pour une petite métairie (car je ne veux commencer que par une), je sens que ça me mènera un peu loin. Il est clair pour moi que, les deux ou trois premières années, mon agriculture sera peu productive, tant à cause de mon inexpérience que parce que ce n’est qu’à son tour que l’assolement que je me propose d’adopter fera tout son effet. Mais je me trouve fort heureux de ma situation, car si je n’avais pas de quoi vivre et au delà de mon petit bien, il me serait impossible défaire une pareille entreprise ; tandis que, pouvant au besoin sacrifier la rente de mon bien, rien ne m’empêche de me livrer à mes goûts. — Je lis des livres d’agriculture, rien n’égale la beauté de cette carrière, elle réunit tout ; mais elle exige des connaissances auxquelles je suis étranger : l’histoire naturelle, la chimie, la minéralogie, les mathématiques et bien d’autres.
Adieu, mon cher Félix, réussis et reviens.
à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 mars 1829 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.15] [OC1] 15. Mugron, 12 mars 1829. A Victor Calmètes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À propos, sais-tu que je suis dans l’intention de me faire imprimer tout vif ? — Quoi ! vas-tu dire, Bastiat auteur ? que va-t-il nous donner ? sera-ce un recueil de dix à douze tragédies ? ou bien une épopée ? ou bien des madrigaux ? Suit-il les traces de Walter Scott ou de lord Byron ? Rien de tout cela, mon ami ; je me suis borné à accumuler les plus lourds raisonnements sur la plus lourde des questions. En un mot, je traite du régime prohibitif. Vois si cela te tente, et je t’enverrai mes œuvres complètes, bien entendu lorsqu’elles auront reçu les honneurs de l’impression. — Je voulais t’en parler plus au long, mais j’ai trop d’autres choses à te dire…[5]
à M. Victor Calmètes: Lettre de juillet 1829 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.16] [OC1] 16. Mugron, juillet 1829. A Victor Calmètes
… Je vois avec plaisir que nous avons à peu près la même opinion. Oui, tant que nos députés voudront faire leurs affaires et non celles du public, le public ne sera que le grand côlon des gens du pouvoir. Mais, selon moi, le mal vient de plus loin. Nous nous figurons aisément (car notre amour-propre y trouve son compte) que tout le mal vient du pouvoir ; je suis au contraire convaincu qu’il a sa source dans l’ignorance et l’inertie des masses. Quel usage faisons-nous des attributions qui nous sont dévolues ? La constitution nous dit que nous payerons ce que nous jugerons à propos ; elle nous autorise à envoyer des fondés de pouvoirs à Paris, pour fixer la quotité que nous voulons accorder pour être gouvernés ; et nous donnons notre procuration à des gens qui sont parties prenantes dans l’impôt. Ceux qui se plaignent des préfets, se font représenter par des préfets ; ceux qui déplorent les guerres sentimentales que nous faisons en Orient et en Occident, tantôt pour la liberté d’un peuple, tantôt pour la servitude d’un autre, se font représenter par des généraux d’armée ; et l’on veut que les préfets votent la suppression des préfectures ; que les hommes de guerre soient imbus d’idées pacifiques! [6] C’est une contradiction choquante. — Mais, dira-t-on, on demande aux députés du dévouement, du renoncement à soi-même, vertus antiques que l’on voudrait voir renaître parmi nous. Puérile illusion ! qu’est-ce qu’une politique fondée sur un principe qui répugne à l’organisation humaine ? Dans aucun temps les hommes n’ont eu du renoncement à eux-mêmes ; et selon moi ce serait un grand malheur que cette vertu prît la place de l’intérêt personnel. Généralise par la pensée le renoncement à soi-même, et tu verras que c’est la destruction de la société. L’intérêt personnel, au contraire, tend à la perfectibilité des individus et par conséquent des masses, qui ne se composent que d’individus. Vainement dira-t on que l’intérêt d’un homme est en opposition avec celui d’un autre ; selon moi c’est une erreur grave et anti-sociale. [7] Et, pour descendre des généralités à l’application, que les contribuables se fissent représenter par des hommes qui eussent les mêmes intérêts qu’eux, et les réformes arriveraient d’elles-mêmes. Il en est qui craignent que le gouvernement ne fût détruit par esprit d’économie, comme si chacun ne sentait pas qu’il est de son intérêt de payer une force chargée de la répression des malfaiteurs.
Je t’embrasse tendrement.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 4 août 1830 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.17] [OC1] 17. Bayonne, 4 août 1830. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, l’ivresse de la joie m’empêche de tenir la plume. Ce n’est pas ici une révolution d’esclaves, se livrant à plus d’excès, s’il est possible, que leurs oppresseurs ; ce sont des hommes éclairés, riches, prudents, qui sacrifient leurs intérêts et leur vie pour acquérir l’ordre et sa compagne inséparable, la liberté. Qu’on vienne nous dire après cela que les richesses énervent le courage, que les lumières mènent à la désorganisation, etc., etc. Je voudrais que tu visses Bayonne. Des jeunes gens font tous les services dans l’ordre le plus parfait, ils reçoivent et expédient les courriers, montent la garde, sont à la fois autorités communales, administratives et militaires. Tous se mêlent, bourgeois, magistrats, avocats, militaires. C’est un spectacle admirable pour qui sait le voir ; et je n’eusse été qu’à demi de la secte écossaise, [8] j’en serais doublement aujourd’hui.
Un gouvernement provisoire est établi à Paris, ce sont MM. Laffilte, Audry-Puiraveau, Casimir Périer, Odier, Lobeau, Gérard, Schonen, Mauguin, Lafayette, commandant de la garde nationale, qui est de plus de quarante mille hommes. Ces gens-là pourraient se faire dictateurs ; tu verras qu’ils n’en feront rien pour faire enrager ceux qui ne croient ni au bon sens ni à la vertu.
Je ne m’étendrai pas sur les malheurs qu’ont déversés sur Paris ces horribles gardes prétoriennes, qu’on nomme gardes royales ; ces hommes avides de priviléges parcouraient les rues au nombre de seize régiments, égorgeant hommes, enfants et vieillards. On dit que deux mille étudiants y ont perdu la vie. Bayonne déplore la perte de plusieurs de ses enfants ; en revanche la gendarmerie, les Suisses et les gardes du corps ont été écrasés le lendemain. Cette fois l’infanterie de ligne, loin de rester neutre, s’est battue avec acharnement, et pour la nation. Mais nous n’avons pas moins à déplorer la perte de vingt mille frères, qui sont morts pour nous procurer la liberté et des bienfaits dont ils ne jouiront jamais. J’ai entendu à notre cercle [9] exprimer le vœu de ces affreux massacres ; celui qui les faisait doit être satisfait.
La nation était dirigée par une foule de députés et pairs de France, entre autres les généraux Sémélé, Gérard, Lafayette, Lobeau, etc., etc. Le despotisme avait confié sa cause à Marmont, qui, dit-on, a été tué.
L’École polytechnique a beaucoup souffert et bravement combattu.
Enfin, le calme est rétabli, il n’y a plus un seul soldat dans Paris ; et cette grande ville, après trois jours et trois nuits consécutives de massacres et d’horreurs, se gouverne elle-même et gouverne la France, comme si elle était aux mains d’hommes d’État…
Il est juste de proclamer que la troupe de ligne a partout secondé le vœu national. Ici, les officiers, au nombre de cent quarante-neuf, se sont réunis pour délibérer ; cent quarante-huit ont juré qu’ils briseraient leurs épées et leurs épaulettes, avant de massacrer un peuple uniquement parce qu’il ne veut pas qu’on l’opprime. À Bordeaux, à Rennes, leur conduite a été la même ; cela me réconcilie un peu avec la loi du recrutement.
On organise partout la garde nationale, on en attend trois grands avantages : le premier, de prévenir les désordres, le second, de maintenir ce que nous venons d’acquérir, le troisième, de faire voir aux nations que nous ne voulons pas conquérir, mais que nous sommes inexpugnables.
On croit que, pour satisfaire aux vœux de ceux qui pensent que la France ne peut exister que sous une monarchie, la couronne sera offerte au duc d’Orléans.
Pour ce qui me regarde personnellement, mon cher Félix, j’ai été bien agréablement désappointé, je venais chercher des dangers, je voulais vaincre avec mes frères ou mourir avec eux ; mais je n’ai trouvé que des figures riantes et, au lieu du fracas des canons, je n’entends que les éclats de la joie. La population de Bayonne est admirable par son calme, son énergie, son patriotisme et son unanimité ; mais je crois le l’avoir déjà dit.
Bordeaux n’a pas été si heureux. Il y a eu quelques excès. M. Curzay s’empara des lettres. Le 29 ou le 30 quatre jeunes gens ayant été envoyés pour les réclamer comme une propriété sacrée, il passa à l’un d’eux son épée au travers du corps et en blessa un autre ; les deux autres le jetèrent au peuple, qui l’aurait massacré, sans les supplications des constitutionnels.
Adieu, je suis fatigué d’écrire, je dois oublier bien des choses ; il est minuit, et depuis huit jours je n’ai pas fermé l’œil. Aujourd’hui au moins nous pouvons nous livrer au sommeil.
… On parle d’un mouvement fait par quatre régiments espagnols sur notre frontière. Ils seront bien reçus.
Adieu.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 5 août 1830 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.18] [OC1] 18. Bayonne, 5 août 1830. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je ne te parlerai plus de Paris, les journaux t’apprennent tout ce qui s’y passe. Notre cause triomphe, la nation est admirable, le peuple va être heureux.
Ici l’avenir paraît plus sombre, heureusement la question se décidera aujourd’hui même. Je te dirai le résultat par apostille.
Voici la situation des choses. — Le 3 au soir, des groupes nombreux couvraient la place publique et agitaient, avec une exaltation extraordinaire, la question de savoir si nous ne prendrions pas sur-le-champ l’initiative d’arborer le drapeau tricolore. Je circulais sans prendre part à la discussion, ce que j’aurais dit n’aurait eu aucun résultat. Comme il arrive toujours, quand tout le monde parle à la fois, personne n’agit ; et le drapeau ne fut pas arboré.
Le lendemain matin, la même question fut soulevée, les militaires étaient toujours bien disposés à nous laisser faire ; mais, pendant cette hésitation, des dépêches arrivaient aux colonels et refroidissaient évidemment leur zèle pour la cause. L’un d’eux s’écria même devant moi que nous avions un roi et une charte, et qu’il fallait lui être fidèles, que le roi ne pouvait mal faire, que ses ministres étaient seuls coupables, etc., etc. On lui répondit solidement… mais tous ces retours à l’inertie me firent concevoir une idée, qu’à force de remuer dans ma tête, j’y gravai si fixement, que depuis je n’ai pensé et ne pense encore qu’à cela.
Il me parut évident que nous étions trahis. Le roi, me disais-je, ne peut avoir qu’un espoir, celui de conserver Bayonne et Perpignan ; de ces deux points, soulever le Midi et l’Ouest et s’appuyer sur l’Espagne et les Pyrénées. Il pourrait allumer une guerre civile dans un triangle dont la base serait les Pyrénées et le sommet Toulouse ; les deux angles sont des places fortes. Le pays qu’il comprend est la patrie de l’ignorance et du fanatisme ; il touche par un des côtés à l’Espagne, par le second à la Vendée, par le troisième à la Provence. Plus j’y pensai, plus je vis clairement ce projet. J’en fis part aux amis les plus influents qui, par une faute inexcusable, ont été appelés par le vœu des citoyens à s’occuper des diverses organisations et n’ont plus le temps de penser aux choses graves.
D’autres que moi avaient eu la même idée, et à force de crier et de répéter, elle est devenue générale. Mais que faire, surtout quand on ne peut délibérer et s’entendre, ni se faire entendre ? Je me retirai pour réfléchir et je conçus plusieurs projets.
Le premier, qui était déjà celui de toute la population bayonnaise, était d’arborer le drapeau et de tâcher, par ce mouvement, d’entraîner la garnison du château et de la citadelle. Il fut exécuté hier, à deux heures de l’après-midi, mais par des vieux qui n’y attachaient pas la même idée que Soustra, moi et bien d’autres ; en sorte que ce coup a manqué.
Je pris alors mon passe-port pour aller en poste chercher le général Lamarque. Je comptais sur sa réputation, son grade, son caractère de député, son éloquence pour entraîner les deux colonels ; au besoin sur sa vigueur, pour les arrêter pendant deux heures et se présenter à la citadelle, en grand costume, suivi de la garde nationale avec le drapeau en tête. J’allais monter à cheval quand on vint m’assurer que le général est parti pour Paris, ce qui fit manquer ce projet, qui était assurément le plus sûr et le moins dangereux.
Aussitôt je délibérai avec Soustra, qui malheureusement est absorbé par d’autres soins, dépêches télégraphiques, poste, garde nationale, etc., etc. Nous fûmes trouver les officiers du 9me, qui sont d’un esprit excellent, nous leur proposâmes de faire un coup de main sur la citadelle, nous nous engageâmes à mener six cents jeunes gens bien résolus ; ils nous promirent le concours de tout leur régiment, après avoir cependant déposé leur colonel.
Ne dis pas, mon cher Félix, que notre conduite fut imprudente ou légère. Après ce qui s’est passé à Paris, ce qu’il y a de plus important c’est que le drapeau national flotte sur la citadelle de Bayonne. Sans cela, je vois d’ici dix ans de guerre civile ; et quoique je ne doute pas du succès de la cause, je sacrifierais volontiers jusqu’à la vie, et tous les amis sont dans les mêmes sentiments, pour épargner ce funeste fléau â nos misérables provinces.
Hier soir, je rédigeai la proclamation ci-jointe au 7me léger, qui garde la citadelle ; nous avions l’intention de l’y faire parvenir avant l’action.
Ce matin, en me levant, j’ai cru que tout était fini, tous les officiers du 9me avaient la cocarde tricolore, les soldats ne se contenaient pas de joie, on disait même qu’on avait vu des officiers du 7me parés de ces belles couleurs. Un adjudant m’a montré à moi-même l’ordre positif, donné à toute la 11me division, d’arborer notre drapeau. Cependant les heures s’écoulent et la bannière de la liberté ne s’aperçoit pas encore sur la citadelle. On dit que le traître J… s’avance de Bordeaux avec le 55me de ligne ; quatre régiments espagnols sont à la frontière, il n’y a pas un moment à perdre. Il faut que la citadelle soit à nous ce soir, ou la guerre civile s’allume. Nous agirons avec vigueur, s’il le faut ; mais moi que l’enthousiasme entraîne sans m’aveugler, je vois l’impossibilité de réussir, si la garnison, qu’on dit être animée d’un bon esprit, n’abandonne pas le gouvernement. Nous aurons peut-être des coups et point de succès. Mais il ne faudra pas pour cela se décourager, car il faut tout tenter pour écarter la guerre civile. Je suis résolu à partir de suite, après l’action, si elle échoue, pour essayer de soulever la Chalosse. Je proposerai à d’autres d’en faire autant dans la Lande, dans le Béarn, dans le pays Basque ; et par famine, par ruse, ou par force, nous aurons la garnison.
Je réserve le papier qui me reste pour t’apprendre la fin.
Le 5, à minuit.
Je m’attendais à du sang, c’est du vin seul qui a été répandu. La citadelle a arboré le drapeau tricolore. La bonne contenance du Midi et de Toulouse a décidé celle de Bayonne, les régiments y ont arboré le drapeau. Le traître J… a vu alors le plan manqué, d’autant mieux que partout les troupes faisaient défection ; il s’est alors décidé à remettre les ordres qu’il avait depuis trois jours dans sa poche. Ainsi tout est terminé. Je me propose de repartir sur-le-champ. Je t’embrasserai demain.
Ce soir nous avons fraternisé avec les officiers de la garnison. Punch, vins, liqueurs et surtout Béranger, ont fait les frais de la fête. La cordialité la plus parfaite régnait dans cette réunion vraiment patriotique. Les officiers étaient plus chauds que nous, comme des chevaux échappés sont plus gais que des chevaux libres.
Adieu, tout est fini. La proclamation est inutile, elle ne vaut pas les deux sous qu’elle te coûterait.
à M. Victor Calmètes: Lettre du 22 avril 1821 (31???) (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.19] [OC1] 19. Bayonne, 22 avril 1831. A Victor Calmètes
… Je suis fâché que le cens d’éligibilité soit un obstacle à ton élection ou du moins à la candidature. J’ai toujours pensé que c’était assez d’exiger des garanties des électeurs, et que celle qu’on demande aux éligibles est une funeste redondance. Il est vrai qu’il faudrait indemniser les députés ; mais cela est trop juste ; et il est ridicule que la France, qui paye tout le monde, n’indemnise pas ses hommes d’affaires.
Dans l’arrondissement que j’habite, le général Lamarque sera élu d’emblée toute sa vie. Il a du talent, de la probité et une immense fortune. C’est plus qu’il n’en faut. — Dans le troisième arrondissement des Landes, quelques jeunes gens qui partagent les opinions de la gauche m’ont offert la candidature. Privé de talents remarquables, de fortune, d’influence et de rapports, il est très-certain que je n’aurais aucune chance, d’autant que le mouvement n’est pas ici très-populaire. Cependant ayant adopté pour principe que la députation ne doit ni se solliciter ni se refuser, j’ai répondu que je ne m’en mêlerais pas et qu’à quelque poste que mes concitoyens m’appelassent, j’étais prêt à leur consacrer ma fortune et ma vie. Dans quelques jours, ils doivent avoir une réunion dans laquelle ils se fixeront sur le choix de leur candidat. Si le choix tombe sur moi, j’avoue que j’en éprouverai une vive joie, non pour moi, car outre que ma nomination définitive est impossible, si elle avait lieu, elle me ruinerait ; mais parce que je ne soupire aujourd’hui qu’après le triomphe des principes, qui font partie de mon être, et que si je ne suis pas sûr de mes moyens, je le suis de mon vote et de mon ardent patriotisme. Je te tiendrai au courant…
Ton bien dévoué.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 2 mars 1834 (Bordeaux) ↩
BWV
[CW1.20] [OC1] 20. Bordeaux, 2 mars 1834. A Félix Coudroy
… Je me suis un peu occupé de faire quelques connaissances, j’y réussirai, j’espère. Mais ici vous voyez écrit sur chaque visage auquel vous faites politesse : Qu’y a-t-il à gagner avec toi ? Cela décourage. — On fonde, il est vrai, un nouveau journal. Le prospectus n’apprend pas grand’chose, et le rédacteur encore moins ; car l’un est rédigé avec le pathos à la mode, et l’autre, me supposant un homme de parti, s’est borné à me faire sentir combien le Mémorial et l’Indicateur étaient insuffisants pour les patriotes. Tout ce que j’ai pu en obtenir, c’est beaucoup d’insistance pour que je prenne un abonnement.
Fonfrède est tout à fait dans les principes de Say. Il fait de longs articles qui seraient très-bons dans un ouvrage de longue haleine. À tout risque, je lui pousserai ma visite.
Je crois qu’un cours réussirait ici, et je me sens tenté. Il me semble que j’aurais la force de le faire, surtout si l’on pouvait commencer par la seconde séance ; car j’avoue que je ne répondrais pas, à la première, même de pouvoir lire couramment : mais je ne puis quitter ainsi toutes mes affaires. Nous verrons pourtant cet hiver.
Il s’est établi déjà un professeur de chimie. J’ai dîné avec lui sans savoir qu’il faisait un cours. Si je l’avais su, j’aurais pris des renseignements sur le nombre d’élèves, la cotisation, etc. J’aurais su si, avec un professeur d’histoire, un professeur de mécanique, un professeur d’économie politique, on pourrait former une sorte d’Athénée. Si j’habitais Bordeaux, il y aurait bien du malheur si je ne parvenais à l’instituer, dussé-je en faire tous les frais ; car j’ai la conviction qu’en y adjoignant une bibliothèque, cet établissement réussirait. Apprends donc l’histoire, et nous essayerons peut-être un jour.
Je te quitte ; trente tambours s’exercent sous mes fenêtres, je ne sais plus ce que je dis.
Adieu.
LETTRE A UN AMI NON IDENTIFIE POUR LA DEFENSE D'UN REFUGIE [Mugron le 1er Septembre 1835]↩
BWV
[Not included in CW1] [JdG note] [10]
Mon cher Charles,
Je ne cherche pas à t'exprimer ma reconnaissance pour l'empressement et le bonheur avec lequel tu prends sous ta protection les malheureux polonais que je te recommande. Ta dernière lettre a fait un heureux, d'autant plus qu'on ne s'attendait pas à un succès aussi prompt et aussi complet.
J'ai cru préférable de t'adresser la pétition de M. Michalewsky.J'y ai joint un certificat du maire de St-Sever et un autre de l'ingénieur de l'arrondissement. L'ingénieur en chef voulait m'en donner un aussi, mais c'est par un malentendu qu'il ne se trouve pas ci-inclus. Je te le procurerais si cela était nécessaire, mais je pense que ceux-ci suffiront. M. Michalewsky en a plusieurs entre les mains, des diverses villes qu'il a habitées et du professeur de mathématiques du collège de St-Sever. Je pense qu'il valait autant qu'il en fut porteur lui-même. La place qu'il occupait ici, il l'avait obtenue à la recommandation expressedu Directeur Général des Ponts et Chaussées. Quant aux démarches dont tu me parles dans le commencement de ta lettre, je t'en remercie comme si elles avaient été couronnées de succès. Je n'y ai personnellement aucun intérêt. Je désire que M. Durrieu n'ait pas été abusé.
Ici, on te fait tantôt conseiller à la cour royale de Paris, tantôt procureur général en Province. N'ayant rien vu de cela dans les journaux, je présume que ces bruits sont prématurés. Cependant, le procès étant terminé, j'espère que ta position ne tardera pas à être fixée.
Je reviens à mon Polonais. Il désirerait, comme tu le penses, rester le moins longtemps possible dans l'incertitude. En arrivant à Paris, il aura à se loger, à se préparer pour l'examen qui a lieu le 5 septembre. Le voyageest un peu long et toutes ces considérations te décideront, j'espère, à profiter immédiatement des dispositions bienveillantes de M. de Gasparini.
Tu ne me dis rien de nos réclamations portugaises. Ton père, qui a été à Paris, néglige aussi de me parler du procès Arias-Quivigne. La bonté de notre cause, me parait aussi claire que la lumière du jour, il me tarde d'en voir la fin.
Adieu, mon cher Charles. J'écris fort à la hâte parce que je ressens quelques atteintes de fièvre qui m'auront désolé ces trois dernières années. Mais je prendrai toujours le temps de t'assurer de ma sincère amitié et dans cette occasion, de ma vive reconnaissance.
Ton ami
Frédéric Bastiat.
Mugron le 1er Septembre 1835.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juin 1840 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.21] [OC1] 21. Bayonne, 16 juin 1840. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je suis toujours à la veille de mon départ, voilà trois fois que nous commandons nos places ; enfin elles sont prises et payées pour vendredi. Nous avons joué de malheur, car quand nous étions prêts, le général carliste Balmaceda a intercepté les routes ; il est à craindre que nous n’ayons de la peine à passer. Mais il ne faut rien dire de cela pour ne pas effrayer ma tante, qui est déjà trop disposée à redouter les Espagnols. Pour moi, je trouve que l’affaire qui nous pousse vers Madrid vaut la peine de courir quelques chances. Jusqu’à présent elle se présente sous un point de vue très-favorable. Nous trouverions ici les capitaux nécessaires, si nous ne tenions par-dessus tout à ne fonder qu’une compagnie espagnole[11]Serons-nous arrêtés par l’inertie de cette nation ? En ce cas j’en serai pour mes frais de route, et je trouverai une compensation dans le plaisir d’avoir vu de près un peuple qui a des qualités et des défauts qui le distinguent de tous les autres.
Si je fais quelques observations intéressantes, j’aurai soin de les consigner dans mon portefeuille pour te les communiquer.
Adieu, mon cher Félix.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 6 juillet 1840 (Madrid) ↩
BWV
[CW1.22] [OC1] 22. Madrid, 6 juillet 1840. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je reçois ta lettre du 6. D’après ce que tu me dis de ma chère tante, je vois que pour le moment sa santé est bonne, mais qu’elle avait été un peu souffrante ; c’est là pour moi le revers de la médaille. Madrid est aujourd’hui un théâtre peut-être unique au monde, que la paresse et le désintéressement espagnols livrent aux étrangers qui, comme moi, connaissent un peu les mœurs et la langue du pays. J’ai la certitude que je pourrais y faire d’excellentes affaires ; mais l’idée de l’isolement de ma tante, à un âge où la santé commence à devenir précaire, m’empêche de songer à proclamer mon exil.
Depuis que j’ai mis le pied dans ce singulier pays, j’ai formé cent fois le projet de t’écrire. Mais tu m’excuseras de n’avoir pas eu le courage de l’accomplir, quand tu sauras que nous consacrons le matin à nos affaires, le soir à une promenade indispensable, et le jour à dormir et haleter sous le poids d’une chaleur plus pénible par sa continuité que par son intensité. Je ne sais plus ce que c’est que les nuages, toujours un ciel pur et un soleil dévorant. Tu peux compter, mon cher Félix, que ce n’est pas par négligence que j’ai tant tardé à t’écrire ; mais réellement je ne suis pas fait à ce climat, et je commence à regretter que nous n’ayons pas retardé de deux mois notre départ…
Je suis surpris que le but de mon voyage soit encore un secret à Mugron. Ce n’en est plus un à Bayonne, et j’en ai écrit, avant mon départ, à Domenger pour l’engager à prendre un intérêt dans notre entreprise. Elle est réellement excellente, mais réussirons-nous à la fonder ? C’est ce que je ne puis dire encore ; les banquiers de Madrid sont à mille lieues de l’esprit d’association, toute idée importée de l’étranger est accueillie par eux avec méfiance, ils sont aussi très-difficiles sur les questions de personnes, chacun vous disant : Je n’entre pas dans l’affaire si telle maison y entre ; enfin ils gagnent tant d’argent avec les fournitures, emprunts, monopoles, etc., qu’ils ne se soucient guère d’autre chose. Voilà bien des obstacles à vaincre, et cela est d’autant plus difficile qu’ils ne vous donnent pas occasion de les voir un peu familièrement. Leurs maisons sont barricadées comme des châteaux forts. Nous avons trouvé ici deux classes de banquiers, les uns, Espagnols de vieille roche, sont les plus difficiles à amener, mais aussi ceux qui peuvent donner plus de consistance à l’entreprise ; les autres, plus hardis, plus européens, sont plus abordables mais moins accrédités : c’est la vieille et la jeune Espagne. Nous avions à opter, nous avons frappé à la porte de l’Espagne pure, et il est à craindre qu’elle ne refuse et que de plus nous ne nous soyons fermé, par ce seul fait, la porte de l’Espagne moderne. Nous ne quitterons la partie qu’après avoir épuisé tous les moyens de succès, nous avons quelque raison de penser que la solution ne se fera pas attendre.
Cette affaire et la chaleur m’absorbent tellement, que je n’ai vraiment pas le courage d’appliquer à autre chose mon esprit d’observation. Je ne prends aucune note, et cependant les sujets ne me manqueraient pas. Je me trouve placé de manière à voir bien des rouages, et si j’avais la force et le talent d’écrire, je crois que je serais en mesure de faire des lettres tout aussi intéressantes que celles de Custine, et peut-être plus vraies.
Pour te donner une idée de la facilité que je trouverais à vivre ici, indépendamment des affaires qui s’y traitent et auxquelles je pourrais prendre part, on m’a offert d’y suivre des procès de maisons italiennes contre des grands d’Espagne, ce qui me donnerait suffisamment de quoi vivre sans aucun travail suivi ; mais l’idée de ma tante m’a fait repousser cette proposition. Elle me souriait comme un moyen de prolonger mon séjour et d’étudier ce théâtre, mais mon devoir m’oblige à y renoncer.
Mon ami, je crains bien que le catholicisme ne subisse ici le même sort qu’en France. Rien de plus beau, de plus digne, de plus solennel et de plus imposant que les cérémonies religieuses en Espagne ; mais hors de là je ne puis voir en quoi ce peuple est plus spiritualiste que les autres. C’est, du reste, une matière que nous traiterons au long à mon retour et quand j’aurai pu mieux observer.
Adieu, mon cher Félix, fais une visite à ma tante, donne-lui de mes nouvelles, et reçois l’assurance de ma tendre amitié.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juillet 1840 (Madrid) ↩
BWV
[CW1.23] [OC1] 23. Madrid, 16 juillet 1840. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je te remercie de tes bonnes lettres des 1er et 6 juillet ; ma tante aussi a eu soin de m’écrire, en sorte que jusqu’à présent j’ai souvent des nouvelles, et elles me sont bien nécessaires. Je ne puis pas dire que je m’ennuie, mais j’ai si peu l’habitude de vivre loin de chez moi que je ne suis heureux que les jours où je reçois des lettres.
Tu es sans doute curieux de savoir où nous en sommes avec notre compagnie d’assurance. J’ai maintenant comme la certitude que nous réussirons. Il faut beaucoup de temps pour attirer à nous les Espagnols dont le nom nous est nécessaire ; il en faudra beaucoup ensuite pour faire fonctionner une aussi vaste machine avec des gens inexpérimentés. Mais je suis convaincu que nous y parviendrons. La part que Soustra et moi devons avoir dans les bénéfices, comme créateurs, n’est pas réglée ; c’est une matière délicate que nous n’abordons pas, n’ayant ni l’un ni l’autre beaucoup d’audace sur ce chapitre. Aussi, nous nous en remettons à la décision du conseil d’administration. Ce sera pour moi un sujet d’expérience et d’observations. Voyons si ces Espagnols si méfiants, si réservés, si inabordables, sont justes et grands quand ils connaissent les gens. À cet article près, nos affaires marchent lentement, mais bien. Nous avons aujourd’hui ce qui est la clef de tout, neuf noms pour former un conseil, et des noms tellement connus et honorables qu’il ne paraît pas possible que l’on puisse songer à nous faire concurrence. Ce soir, il y a une junte pour étudier les statuts et conditions ; j’espère qu’au premier jour l’acte de société sera signé. Cela fait, peut-être rentrerai-je en France pour voir ma tante et assister à la session du conseil général. Si je le puis en quelque manière, je n’y manquerai pas. Mais j’aurai à revenir ensuite en Espagne, parce que la compagnie me fournira une occasion de faire un voyage complet et gratis. Jusqu’à présent, je ne puis pas dire que j’aie voyagé. Toujours avec mes deux compagnons, je ne suis entré, sauf les comptoirs, dans aucune maison espagnole. La chaleur a suspendu toutes les réunions publiques, bals, théâtres, courses. — Notre chambre et quelques bureaux, le restaurant français et la promenade au Prado, voilà le cercle dont nous ne sortons pas. Je voudrais prendre ma revanche plus tôt. Soustra part le 26 ; sa présence est nécessaire à Bayonne. Lis tout ceci à ma tante que j’embrasse bien tendrement.
Le trait le plus saillant du caractère espagnol, c’est sa haine et sa méfiance envers les étrangers. Je pense que c’est un véritable vice, mais il faut avouer qu’il est alimenté par la fatuité et la rouerie de beaucoup d’étrangers. Ceux-ci blâment et tournent tout en ridicule ; ils critiquent la cuisine, les meubles, les chambres et tous les usages du pays, parce qu’en effet les Espagnols tiennent très-peu au confortable de la vie ; mais nous qui savons, mon cher Félix, combien les individus, les familles, les nations peuvent être heureuses sans connaître ces sortes de jouissances matérielles, nous ne nous presserions pas de condamner l’Espagne. Ceux-là arriveront avec leurs poches pleines de plans et de projets absurdes, et parce qu’on ne s’arrache pas leurs actions, ils se dépitent et crient à l’ignorance, à la stupidité. Cette affluence de floueurs nous a fait d’abord beaucoup de tort, et en fera à toute bonne entreprise. Pour moi, je pense avec plaisir que la méfiance espagnole l’empêchera de tomber dans l’abîme ; car les étrangers, après avoir apporté leurs plans, seront forcés, pour les faire réussir, de faire venir des capitaux et souvent des ouvriers français.
Donne-moi de temps en temps des nouvelles de Mugron, mon cher Félix, tu sais combien le patriotisme du clocher nous gagne quand nous en sommes éloignés.
Adieu, mon cher Félix, mes souvenirs à ta sœur.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 17 août 1840 (Madrid) ↩
BWV
[CW1.24] [OC1] 24. Madrid, 17 août 1840. A Félix Coudroy
… Tu me fais une question à laquelle je ne puis répondre : Comment le peuple espagnol a-t-il pu laisser chasser et tuer les moines ? Moi-même je me le demande souvent ; mais je ne connais pas assez le pays pour m’expliquer ce phénomène. Ce qu’il y a de probable, c’est que le temps des moines est fini partout. Leur inutilité, à tort ou à raison, est une croyance généralement établie. À supposer qu’il y eût en Espagne 40,000 moines, intéressant autant de familles composées de 5 personnes, cela ne ferait que 200,000 habitants contre 10 millions. Leurs immenses richesses ont pu tenter beaucoup de gens de la classe aisée ; l’affranchissement d’une foule de redevances a pu tenter beaucoup de gens de la classe du peuple. Le fait est qu’on en a fini avec cette puissance ; mais, à coup sûr, jamais mesure, à la supposer nécessaire, n’a été conduite avec au- tant de barbarie, d’imprévoyance et d’impolitique.
Le gouvernement était aux mains des modérés, qui désiraient l’abolition des couvents, mais n’osaient y procéder. Financièrement, on espérait avec le produit des biens nationaux payer les dettes de l’Espagne, éteindre la guerre civile et rétablir les finances. Politiquement, on voulait, par la division des terres, rattacher une partie considérable du peuple à la révolution. Je crois que ce but a été manqué.
N’osant agir légalement, on s’entendit avec les exaltés. Une nuit, ceux-ci firent irruption dans les couvents. À Barcelone, Malaga, Séville, Madrid, Valladolid, ils égorgèrent et chassèrent les moines. Le gouvernement et la force publique restèrent trois jours témoins impassibles de ces atrocités. Quand l’aliment manqua au désordre, le gouvernement intervint, et le ministère Mendizabal décréta la confiscation des couvents et des propriétés monacales. Maintenant on les vend ; mais tu vas juger de cette administration. Un individu quelconque déclare vouloir soumissionner un bien national, l’État le fait estimer, et cette estimation est toujours très-modique, parce que l’acquéreur s’entend avec l’expert. Cela fait, la vente se fait publiquement ; on s’est entendu aussi avec le notaire pour écarter la publicité, et le bien vous reste à bas prix. Il faut payer un cinquième comptant, et les quatre autres cinquièmes en huit ans, par huitièmes. L’État reçoit en payement des rentes de différentes origines, qui s’achètent à la Bourse depuis 75 jusqu’à 95 de perte ; c’est-à-dire qu’avec 25 fr. et même avec 5 on paye 100 fr.
Il résulte de là trois choses : 1° l’État ne reçoit presque rien, on peut même dire rien ; 2° ce n’est pas le peuple des provinces qui achète, puisqu’il n’est pas à la Bourse pour brocanter le papier ; 3° cette masse de terres vendues à la fois et à vil prix, a déprécié toutes les autres propriétés. Ainsi le gouvernement, qui s’est procuré à peine de quoi payer l’armée, ne remboursera pas la dette.
La propriété ne se divisera que lorsque les spéculateurs revendront en seconde main.
Les fermiers n’ont fait que changer de maîtres ; et au lieu de payer le fermage aux moines, qui, dit-on, étaient des propriétaires fort accommodants, peu rigoureux sur les termes, prêtant des semences, renonçant même au revenu dans les années malheureuses, ils payeront très-rigoureusement aux compagnies belges et anglaises qui, incertaines de l’avenir, aspirent à rembourser l’État avec le produit des terres.
Le simple paysan, dans les années calamiteuses, n’aura plus la soupe à la porte des couvents.
Enfin les simples propriétaires ne peuvent plus vendre leurs terres qu’à vil prix. — Voilà, ce me semble, les conséquences de cette désastreuse opération.
Des hommes plus capables avaient proposé de profiter d’un usage qui existe ici : ce sont des baux de 50 et même 100 ans. Ils voulaient qu’on affermât aux paysans, à des taux modérés, pour 50 ans. Avec le produit, on aurait payé l’intérêt annuel de la dette et relevé le crédit de l’Espagne ; et au bout de 50 ans, on aurait un capital déjà immense, plus que doublé probablement par la sécurité et le travail. Tu vois d’un coup d’œil la supériorité politique et financière de ce système.
Quoi qu’il en soit, il n’y a plus de moines. Que sont-ils devenus ? Probablement les uns sont morts dans les montagnes, au service de don Carlos ; les autres auront succombé d’inanition dans les rues et greniers des villes ; quelques-uns auront pu se réfugier dans leurs familles.
Quant aux couvents, ils sont convertis en cafés, en maisons publiques, en théâtres et surtout en casernes, pour une autre espèce de dévorants plus prosaïque que l’autre. Plusieurs ont été démolis pour élargir les rues, faire des places ; sur l’emplacement du plus beau de tous, et qui passait pour un chef-d’œuvre d’architecture, on a construit un passage et une halle qui se font tort mutuellement.
Les religieuses ne sont guère moins à plaindre. Après avoir donné la volée à toutes celles qui ont voulu rentrer dans le monde, on a enfermé les autres dans deux ou trois couvents, et comme on s’est emparé de leurs propriétés, qui représentaient les dots qu’elles apportaient à leur ordre, on est censé leur faire une pension ; mais, comme on ne la paye pas, on voit souvent sur la porte des couvents cette simple inscription : Pan para las pobres monjas.
Je commence à croire, mon cher Félix, que notre M. Custine avait bien mal vu l’Espagne. La haine d’une autre civilisation lui avait fait chercher ici des vertus qui n’y sont pas. Peut-être a-t-il, en sens inverse, commis la même faute que les Espagnols qui ne voient rien à blâmer dans la civilisation anglaise. Il est bien difficile que nos préjugés nous laissent, je ne dis pas bien juger, mais bien voir les faits.
Je rentre, mon cher Félix, et j’ai appris que demain on proclame la loi des ayuntamientos. Je ne sais pas si je t’ai parlé de cette affaire, en tout cas en voici le résumé.
Le ministère modéré, qui vient de tomber, avait senti que, pour administrer l’Espagne, il fallait donner au pouvoir central une certaine autorité sur les provinces ; ici, de temps immémorial, chaque province, chaque ville, chaque bourgade s’administre elle-même. Tant que le principe monarchique et l’influence du clergé ont compensé cette extrême diffusion de l’autorité, les choses ont marché tant bien que mal ; mais aujourd’hui cet état de choses ne peut durer. En Espagne, chaque localité nomme son ayuntamiento (conseil municipal), alcades, régidors, etc. Ces ayuntamientos, outre leurs fonctions municipales, sont chargés du recouvrement de l’impôt et de la levée des troupes. Il résulte de là que, lorsqu’une ville a quelque sujet de mécontentement, fondé ou non, elle se borne à ne pas recouvrer l’impôt ou à refuser le contingent. En outre, il paraît que ces ayuntamientos sont le foyer de grands abus, et qu’ils ne rendent pas à l’État la moitié des contributions qu’ils prélèvent. Le parti modéré a donc voulu saper celte puissance. Une loi a été présentée par le ministère, adoptée par les chambres, et sanctionnée par la reine, qui dispose que la reine choisira les alcades parmi trois candidats nommés par le peuple. Les exaltés ont jeté de hauts cris ; de là la révolution de Barcelone et l’intervention du sabre d’Espartero. Mais, chose qui ne se voit qu’ici, la reine, quoique contrainte à changer de ministère, en a nommé un autre qui maintient la loi déjà votée et sanctionnée. Sans doute que, parvenu au pouvoir par une violation de la constitution, il a cru devoir manifester qu’il la respectait en laissant promulguer une loi qui avait reçu la sanction des trois pouvoirs. C’est donc demain qu’on proclame cette loi : cela se passera-t-il sans trouble ? je ne l’espère guère. En outre, comme on attribue à la France et à notre nouvel ambassadeur une mystification aussi peu attendue, après les événements de Barcelone, il est à craindre que la rage des exaltés ne se dirige contre nos compatriotes ; aussi j’aurai soin d’écrire à ma tante après-demain, parce que les journaux ne manqueront pas de faire bruit de l’insurrection qui se prépare. Elle ne laisse pas que d’être effrayante, quand on songe qu’il n’y a ici, pour maintenir l’ordre, que quelques soldats dévoués à Espartero, qui doit être mortellement blessé de la manière dont son coup d’État a été déjoué.
Mais quel sujet de réflexions que cette Espagne qui, pour arrivera la liberté, perd la monarchie et la religion qui lui étaient si chères ; et, pour arriver à l’unité, est menacée dans ses franchises locales qui faisaient le fond même de son existence !
Adieu ! ton ami dévoué. Je n’ai pas le temps de relire ce fatras, tire-t’en comme tu pourras.
P.S. Mon cher Félix, la tranquillité de Madrid n’a pas été un moment troublée. Ce matin, les membres de l’ayuntamiento se sont réunis en séance publique pour promulguer la nouvelle loi qui ruine leur institution. Ils ont fait suivre cette cérémonie d’une énergique protestation, où ils disent qu’ils se feront tous tuer plutôt que d’obéir à la loi nouvelle. On dit aussi qu’ils ont payé quelques hommes pour crier les vivas et les mueras d’usage, mais le peuple ne s’est pas plus ému que ne s’en émouvraient les paysans de Mugron ; et l’ayuntamiento n’a réussi qu’à démontrer de plus en plus la nécessité de la loi. Car enfin, ne serait-ce point un bien triste spectacle que de voir une ville troublée et la sûreté des citoyens compromise par ceux-là mêmes qui sont chargés de maintenir l’ordre ?
On m’a assuré que les exaltés n’étaient pas d’accord entre eux ; les plus avancés (je ne sais pas pourquoi on a donné du crédit à cette expression en s’accordant à l’adopter) disaient :
« Il est absurde de faire un mouvement qui n’ait pas de résultat. Un mouvement ne peut être décisif qu’autant que le peuple s’en mêle ; or le peuple ne veut pas intervenir pour des idées ; il faut donc lui montrer le pillage en perspective. »
Et malgré cette terrible logique, l’ayuntamiento n’a pas reculé devant la première provocation ! Du reste, je te parle là de bruits publics, car, quant à moi, j’étais à la Bibliothèque royale, et je ne me suis aperçu de rien.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 24 octobre 1840 (Lisbonne) ↩
BWV
[CW1.25] [OC1] 25. Lisbonne, 24 octobre 1840. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, voilà bien longtemps que je ne t’ai écrit. C’est que nous sommes si éloignés et qu’il faut si longtemps pour avoir une réponse de Mugron, que je ne suis jamais sûr de la recevoir ici. Enfin me voilà à peu près décidé, et sauf circonstances imprévues, à dire adieu à la Péninsule de lundi en huit. Mon intention est d’aller à Londres ; je ne puis, selon le conseil que tu me transmets, de la part de ma tante, aller d’abord à Plymouth. Le steamboat va directement à Londres. J’avais d’abord pensé à m’embarquer pour Liverpool. Je satisferais ainsi à l’économie et à mon goût pour la marine, parce que la navigation à voiles est moins chère et plus fertile en émotions que la monotone vapeur. Mais la saison est si avancée que ce serait imprudence, et je courrais le risque de passer un mois en mer.
Je me suis un peu ennuyé à Lisbonne les premiers jours. Maintenant, à part le désir bien naturel de revenir chez moi, je me plais ici, quoique j’y mène une vie uniforme. Mais ce climat est si doux, si beau, cette nature si riche, et je me sens un bien-être, une plénitude de santé si inaccoutumée, que j’attribue à cela l’absence d’ennui.
Voici un pays qui, je crois, te conviendrait bien : ni chaud, ni froid, ni brouillards, ni humidité ; s’il pleut, ce sont des torrents pendant un jour ou deux, puis le ciel reprend sa sérénité, et l’atmosphère sa douce tiédeur. Partout on peut disposer d’un peu d’eau ; ce sont des bosquets de myrtes, d’orangers, des treilles touffues, des héliotropes qui rampent le long des murs, comme chez nous les convolvulus. Maintenant je comprends la vie des Maures. Malheureusement les hommes ici ne valent pas la nature, ils ne veulent pas se donner la peine par laquelle les Arabes se donnaient tant de jouissances. Peut-être penses-tu que ces fervents catholiques dédaignent la fraîcheur et les parfums de l’oranger, et qu’ils se renferment dans les sévères plaisirs de la pensée et de la contemplation. Hélas ! je reviendrai bien désabusé de la bonne opinion de Custine ; il a cru voir ce qu’il désirait voir.
Ce sera pour moi une étude fort curieuse que celle de l’Angleterre succédant à celle de la Péninsule. La comparaison serait plus intéressante encore, si le catholicisme était aussi vivace ici qu’on se le représente. Mais enfin je verrai un peuple dont la religion réside dans l’intelligence, après en avoir vu un pour qui elle est toute dans les sens. Ici les pompes du culte : des flambeaux, des parfums, des habits magnifiques, des statues ; mais la démoralisation la plus complète. Là, au contraire, des liens de famille, l’homme et la femme chacun aux devoirs de son sexe, le travail ennobli par un but patriotique, la fidélité aux traditions des ancêtres, l’étude constante de la morale biblique et évangélique ; mais un culte simple, grave, se rapprochant du pur déisme. Quel contraste ! que d’oppositions ! quelle source de réflexions !
Ce voyage aura aussi produit un effet auquel je ne me serais pas attendu. Il n’a pu effacer cette habitude que nous avons contractée de nous observer nous-mêmes, de nous écouter penser et sentir, de suivre toutes les modifications de nos opinions. Cette étude de soi a bien des charmes, et l’amour-propre lui communique un intérêt qui ne saurait s’affaiblir. Mais à Mugron, toujours dans un milieu uniforme, nous ne pouvions que tourner dans un même cercle ; en voyage, des situations excentriques donnent lieu à de nouvelles observations. Par exemple, il est probable que les événements actuels m’affectent bien différemment que si j’étais à Mugron ; un patriotisme plus ardent donne plus d’activité à ma pensée. En même temps, le champ où elle s’exerce est plus étendu, comme un homme placé sur une hauteur embrasse un plus vaste horizon. Mais la puissance du regard est pour chacun de nous une quantité donnée, et il n’en est pas de même de la faculté de penser et de sentir.
Ma tante, à l’occasion de la guerre, me recommande la prudence ; je n’ai absolument aucun danger à courir. Si je voyageais dans un bâtiment français et que la guerre fût déclarée, je pourrais craindre les corsaires ; mais dans un navire anglais je ne cours pas ce danger, à moins de tomber sous la serre d’un croiseur français, ce qui ne serait pas bien dangereux d’ailleurs. D’après les nouvelles reçues aujourd’hui, je vois que la France a pris le parti d’une résignation sentimentale, qui devient grotesque. D’ici elle me paraît toute décontenancée ; elle met son honneur à prouver sa modération, et, à chaque insulte, elle répond par des arguments en forme pour démontrer qu’elle a été insultée. Elle a l’air de croire que le remords va s’emparer des Anglais, et que, les larmes aux yeux, ils vont cesser de poursuivre leur but et nous demander pardon. Cela me rappelle ce mot : Il m’a souffleté, mais je lui ai bien dit son fait.
Adressez-moi vos lettres à Londres, sous couvert de MM. A. A. Gower neveux et compagnie.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 7 novembre 1840 (Lisbonne) ↩
BWV
[CW1.26] [OC1] 26. Lisbonne, 7 novembre 1840. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, malgré le vif désir de me rapprocher de la France, j’ai été forcé de prolonger mon séjour à Lisbonne. Un rhume m’a décidé à remettre mon départ de huit jours, et, dans cet intervalle, on a trouvé des papiers qu’il faut dépouiller, ce qui me force à rester encore ; mais il faudra de bien puissants motifs pour me retenir au delà du 17 de ce mois. Enfin ce retard a servi à me guérir, ce qui eût été plus difficile en mer ou à Londres.
J’ai joué de malheur de me trouver loin de la France dans un moment aussi intéressant ; tu ne peux te faire l’idée du patriotisme qui nous brûle quand nous sommes en pays étranger. À distance, ce n’est plus le bonheur, ni même la liberté de notre pays qui nous occupe le plus, c’est sa grandeur, sa gloire, son influence. Malheureusement, je crains bien que la France ne jouisse guère des premiers de ces biens ni des derniers.
Je me désole d’être sans nouvelles et de ne pouvoir préciser l’époque où j’en recevrai ; au moins, à Londres, j’espère trouver une rame de lettres.
Adieu, l’heure du courrier va sonner.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 2 janvier 1841 (Paris) ↩
BWV
[CW1.27] [OC1] 27. Paris, 2 janvier 1841. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je m’occupais d’un plan d’association pour la défense des intérêts vinicoles. Mais, selon mon habitude, j’hésitais à en faire part à quelques amis, parce que je ne voyais guère de milieu entre le succès et le ridicule, quand M. Humann est venu présenter aux chambres le budget des dépenses et recettes pour 1842. Ainsi que tu l’auras vu, le ministre ne trouve rien de mieux, pour combler le déficit qu’a occasionné notre politique, que de frapper les boissons de quatre nouvelles contributions. Cela m’a donné de l’audace, et j’ai couru chez plusieurs députés pour leur communiquer mon projet. Ils ne peuvent pas s’en mêler directement, parce que ce serait aliéner d’avance l’indépendance de leur vote. C’est une raison pour les uns, un prétexte pour les autres ; mais ce n’est pas un motif pour que les propriétaires de vignes se croisent les bras, en présence du danger qui les menace.
Il n’y a qu’un moyen non-seulement de résister à cette nouvelle levée de boucliers, mais encore d’obtenir justice des griefs antérieurs, c’est de s’organiser. L’organisation pour un but utile est un moyen assuré de succès. Il faut que chaque département vinicole ait un comité central, et chaque comité un délégué.
Je ne sais pas encore dans quelle mesure je vais prendre part à cette organisation. Cela dépendra de mes conférences avec mes amis. Peut-être faudra-t-il que je m’arrête en passant à Orléans, Angoulême, Bordeaux, pour travailler à y fonder l’association. Peut-être devrai-je me borner à notre département ; en tout cas, comme le temps presse, tu ferais bien de voir Domenger, Despouys, Labeyrie, Batistant, et de les engager à parcourir le canton, pour y préparer les esprits à la résistance légale, mais forte et organisée. (V. ci-après : Le fisc et la vigne. — Note de l’édit.)
Je n’ai pas besoin, mon cher Félix, de te dérouler la puissance de l’association ! Fais passer les convictions dans tous les esprits. J’espère être à Mugron dans une quinzaine, et nous agirons de concert.
Adieu, ton dévoué.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 janvier 1841 (Paris) ↩
BWV
[CW1.28] [OC1] 28. Paris, 11 janvier 1841. A Félix Coudroy
Que n’es-tu auprès de moi, mon cher Félix ! cela ferait cesser bien des incertitudes. Je t’ai entretenu du nouveau projet que j’ai conçu ; mais seul, abandonné à moi-même, les difficultés de l’exécution m’effrayent. Je sens que le succès est à peu près infaillible ; mais il exige une force morale que ta présence me donnerait, et des ressources matérielles que je ne sais pas prendre sur moi de demander. J’ai tâté le pouls à plusieurs députés, et je les ai trouvés froids. Ils ont presque tous des ménagements à garder ; tu sais que nos hommes du Midi sont presque tous quêteurs de places. — Quant à l’opposition, il serait dangereux de lui donner la haute main dans l’association, elle s’en ferait un instrument, ce qu’il faut éviter. Ainsi, tout bien pesé, il faut renoncer à fonder l’association par le haut, ce qui eût été plus prompt et plus facile. C’est la base qu’il faut fonder. — Si elle se constitue fortement, elle entraînera tout. Que les vignerons ne se fassent pas illusion, s’ils demeurent dans l’inertie, ils seront ici faiblement défendus. Je tâcherai de partir d’ici dimanche prochain ; j’aurai dans une poche le projet des statuts de l’association, dans l’autre le prospectus d’un petit journal destiné à être d’abord le propagateur et plus tard l’organe de l’association. Avec cela je m’assurerai si ce projet rencontre de la sympathie dans Orléans, la Charente et le bassin de la Garonne. La suite dépendra de mes observations. Une brusque initiative eût été plus de mon goût. Il y a quelques années que je l’aurais peut-être tentée ; maintenant une avance de six à huit mille francs me fait reculer, et j’en ai vraiment honte, car quelques centaines d’abonnés m’eussent relevé de tous risques. Le courage m’a manqué, n’en parlons plus.
Je suis obligé, mon cher Félix, d’invoquer sans cesse mon impartialité et ma philosophie pour ne pas tomber dans le découragement, à la vue de toutes les misères dont je suis témoin. Pauvre France ! — Je vois tous les jours des députés qui, dans le tête-à-tête, sont opposés aux fortifications de Paris [12] et qui cependant vont les appuyer à la chambre, l’un pour soutenir Guizot, l’autre pour ne pas abandonner Thiers, un troisième de peur qu’on ne le traite de Russe ou d’Autrichien ; l’opinion, la presse, la mode les entraîne, et beaucoup cèdent à des motifs plus honteux encore. Le maréchal Soult lui-même est personnellement opposé à cette mesure, et tout ce qu’il ose faire, c’est de proposer une exécution lente, dans l’espoir qu’un revirement d’opinion lui viendra en aide, quand il n’y aura encore qu’une centaine de millions engloutis. C’est bien pis dans les questions extérieures. Il semble qu’un bandeau couvre tous les yeux, et on court risque d’être maltraité si l’on énonce seulement un fait qui contrarie le préjugé dominant.
Adieu, mon cher Félix, il me tarde bien de causer avec toi ; les sujets ne nous manqueront pas.
Adieu, ton ami.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 10 juillet 1844 (Bagnères) ↩
BWV
[CW1.29] [OC1] 29. Bagnères, 10 juillet 1844. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, j’ai reçu, il y a quelques jours, une lettre de M. Laffitte, d’Aire, membre du conseil général, qui m’embarrasse beaucoup. Il m’annonce que le général Durrieu va être élevé à la pairie ; que le gouvernement veut le faire remplacer, à la chambre, par un secrétaire des commandements de M. le duc de Nemours. Il ajoute que les électeurs d’Aire ne sont pas disposés à subir cette candidature ; et enfin il me demande si je me présenterai, auquel cas il pense que j’aurai beaucoup de voix dans ce canton, où je n’eus que la sienne aux élections dernières.
Comme la législature n’a plus que trois sessions à faire, et qu’ainsi je serai libre de me retirer au bout de ce terme sans occasionner une réunion extraordinaire du collége de Saint-Sever, je serais assez disposé à entrer encore une fois en lice, si je pouvais compter sur quelques chances ; mais je ne dois pas m’aveugler sur le tort que me fera la scission qui s’est introduite dans le parti libéral. Si en outre je dois avoir encore contre moi l’aristocratie de l’argent et le barreau, j’aime mieux rester tranquille dans mon coin. Je le regretterais un peu, parce qu’il me semble que j’aurais pu me rendre utile à la cause de la liberté du commerce, qui intéresse à un si haut degré la France et surtout notre pays.
Mais cela n’est pas un motif pour que je me mette en avant en étourdi : je suis donc résolu à attendre qu’il me soit fait, par les électeurs influents, des ouvertures sérieuses ; il me semble que l’affaire les touche d’assez près pour qu’ils ne laissent pas aux candidats le soin de s’en occuper seuls.
Je voulais envoyer mon article au Journal des Économistes, mais je n’ai pas d’occasion ; je profiterai de la première qui se présentera. Il a le défaut, comme toute œuvre de commençant, de vouloir trop dire ; tel qu’il est, il me paraît offrir quelque intérêt. Je profiterai de l’occasion pour essayer d’engager une correspondance avec Dunoyer.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 26 juillet 1844 (Eaux-Bonnes) ↩
BWV
[CW1.30] [OC1] 30. Eaux-Bonnes, 26 juillet 1844. A Félix Coudroy
Ta lettre m’a fait une pénible impression, mon cher Félix, non point par les nouvelles que tu me donnes des perspectives électorales, mais à cause de ce que tu me dis de toi, de ta santé, et de la lutte terrible que se livrent ton âme et ton corps. J’espère pourtant que tu as voulu parler de l’état habituel de ta santé, et non pas d’une recrudescence qui se serait manifestée depuis mon départ. Je comprends bien tes peines, d’autant plus qu’à un moindre degré je les éprouve aussi. Ces misérables obstacles, que la santé, la fortune, la timidité élèvent comme un mur d’airain entre nos désirs et le théâtre où ils pourraient se satisfaire, est un tourment inexprimable. Quelquefois je regrette d’avoir bu à la coupe de la science, ou du moins de ne pas m’en être tenu à la philosophie synthétique et mieux encore à la philosophie religieuse. On y puise au moins des consolations pour toutes les situations de la vie, et nous pourrions encore arranger tolérablement ce qui nous reste de temps à passer ici-bas. Mais l’existence retirée, solitaire, est incompatible avec nos doctrines (qui pourtant agissent sur nous avec toute la force de vérités mathématiques) ; car nous savons que la vérité n’a de puissance que par sa diffusion. De là l’irrésistible besoin de la communiquer, de la répandre, de la proclamer. De plus, tout est tellement lié, dans notre système, que l’occasion et la facilité d’en montrer un chaînon ne peuvent nous contenter ; et pour en exposer l’ensemble il faut des conditions de talent, de santé et de position qui nous feront toujours défaut. Que faire, mon ami ? attendre que quelques années encore aient passé sur nos têtes. Je les compte souvent, et je prends une sorte de plaisir à remarquer que plus elles s’accumulent, plus leur marche paraît rapide :
… Vires acquirit eundo.
Quoique nous ayons la conscience de connaître la vérité, en ce qui concerne le mécanisme de la société et au point de vue purement humain, nous savons aussi qu’elle nous échappe quant aux rapports de cette vie avec la vie future ; et, ce qu’il y a de pire, nous croyons qu’à cet égard on ne peut rien savoir avec certitude.
Nous avons ici plusieurs prêtres très-distingués. Ils font, de deux jours l’un, des instructions de l’ordre le plus relevé ; je les suis régulièrement. C’est à peu près la répétition du fameux ouvrage de Dabadie. Hier le prédicateur disait qu’il y a dans l’homme deux ordres de penchants qui se rattachent, les uns à la chute, les autres à la réhabilitation. Selon les seconds, l’homme se fait à l’image de Dieu ; les premiers le conduisent à faire Dieu à son image. Il expliquait ainsi l’idolâtrie, le paganisme, il montrait leur effrayante convenance avec la nature corrompue. Ensuite il disait que la déchéance avait enfoncé si avant la corruption dans le cœur de l’homme, qu’il conservait toujours une pente vers l’idolâtrie, qui s’était ainsi insinuée jusque dans le catholicisme. Il me semble qu’il faisait allusion à une foule de pratiques et de dévotions qui sont un si grand obstacle à l’adhésion de l’intelligence. — Mais s’ils comprennent les choses ainsi, pourquoi n’attaquent-ils pas ouvertement ces doctrines idolâtres ? pourquoi ne les réforment-ils pas ? Pourquoi, au contraire, les voit-on s’empresser de les multiplier ? Je regrette de n’avoir pas de relations avec cet ecclésiastique qui, je crois, professe la théologie à la faculté de Cordeaux, pour m’en expliquer avec lui.
Nous voilà bien loin des élections. D’après ce que tu m’apprends, je ne doute pas de la nomination de l’homme du château. Je suis surpris que notre roi, qui a la vue longue, ne comprenne pas qu’en peuplant la chambre de créatures, il sacrifie à quelques avantages immédiats le principe même de la constitution. Il s’assure un vote, mais il place tout un arrondissement en dehors de nos institutions ; et cette manœuvre, s’étendant à toute la France, doit aboutir à corrompre nos mœurs politiques déjà si peu avancées. D’un autre côté, les abus se multiplieront, puisqu’ils ne rencontreront pas de résistance ; et quand la mesure sera pleine, quel est le remède que cherchera une nation qui n’a pas appris à faire de ses droits un usage éclairé ?
Pour moi, mon cher Félix, je ne me sens pas de force à disputer quelques suffrages. S’ils ne viennent pas d’eux-mêmes, laissons-les suivre leur cours. Il me faudrait aller de canton en canton organiser les moyens de soutenir la lutte. C’est plus que je ne puis faire. Après tout, M. Durrieu n’est pas encore pair.
J’ai profite d’une occasion pour envoyer au Journal des Économistes mon article sur les tarifs anglais et français. Il me paraît renfermer des points de vue d’autant plus importants qu’ils ne paraissent préoccuper personne. J’ai rencontré ici des hommes politiques qui ne savent pas le premier mot de ce qui se passe en Angleterre ; et, quand je leur parle de la réforme douanière qui s’accomplit dans ce pays, ils n’y veulent pas croire. — J’ai du temps devant moi pour faire la lettre à Dunoyer. Quant à mon travail sur la répartition de l’impôt, je n’ai pas les matériaux pour y mettre la dernière main. La session du conseil général sera une bonne occasion pour cette publication.
Adieu, mon cher Félix, si tu apprends quelque chose de nouveau, fais-m’en part ; mais de toutes les nouvelles la plus agréable que tu puisses me donner, c’est que le découragement dont ta lettre est empreinte n’était dû qu’à une souffrance passagère. Après tout, mon ami, et au milieu des épaisses ténèbres qui nous environnent, attachons-nous à cette idée qu’une cause première, intelligente et miséricordieuse, nous a soumis, par des raisons que nous ne pouvons comprendre, aux dures épreuves de la vie : que ce soit là notre foi. Attendons le jour où elle jugera à propos de nous en délivrer, et de nous admettre à une vie meilleure : que ce soit là notre espérance. Avec ces sentiments au cœur, nous supporterons nos afflictions et nos douleurs…
Lettre à M. Laurence [9 Nov. 1844], Mugron ↩
BWV
[CW1.31] [OC7] 31. Mugron, 9 novembre 1844. A M. Laurence
Lettre à M. Laurence
Mugron, le 9 novembre 1844
Monsieur et cher collègue,
Je vous remercie de ce que vous me dites de bienveillant dans la lettre que vous avez bien voulu m’écrire, au sujet de mon opuscule sur la répartition de l’impôt [1]. — Je regrette sincèrement qu’il n’ait pas agi avec plus d’efficacité sur votre conviction, car je reconnais que, dans les contestations auxquelles donnent lieu quelquefois les rivalités d’arrondissement, votre esprit élevé vous met au-dessus de cette partialité mesquine dont d’autres ne savent pas se dégager. Pour moi, je puis affirmer que si quelque erreur ou quelque exagération s’est glissée dans mon écrit, c’est tout à fait à mon insu. — Je suis loin de porter envie pour mon pays à la prospérité du vôtre ; bien au contraire ; et c’est ma ferme conviction que l’un des deux ne saurait prospérer sans que l’autre en profite. Je pense même que cette solidarité embrasse les peuples. C’est pourquoi je déplore amèrement ces jalousies nationales qui sont le thème favori du journalisme. Si j’avais, comme vous le pensez, raisonné sur cette fausse donnée que toute la surface des pignadas est également productive, je me rétracterais sur-le-champ. Mais il n’y a rien dans mon écrit qui puisse justifier cette allégation. Je n’ai pas parlé non plus des grêles, gelées, incendies. Ce sont là des circonstances dont on a dû tenir compte quand on a appliqué aux diverses cultures l’impôt actuel. — C’est cet impôt, tel qu’il est, qui est mon point de départ. Je ne crois pas non plus avoir attribué la détresse des pays de vignobles à la mauvaise répartition de l’impôt. Mais j’ai dit que la répartition de l’impôt devait se modifier en conséquence de cette détresse, puisqu’il est de principe que l’impôt se prélève sur les revenus. — Si le revenu d’un canton diminue d’une manière permanente, il faut que sa contribution diminue aussi, et que, par suite, celle des autres cantons augmente. C’est aussi une preuve de plus de la solidarité de toutes les portions du territoire ; et la Grande-Lande se blessait elle-même lorsque, par l’organe de notre collègue, M. Castagnède, elle s’opposait à ce que la société d’agriculture se fît, vis-à-vis du pouvoir, l’organe de nos doléances.
Vous dites qu’à Villeneuve l’agriculture a progressé sans que la population ait augmenté. Cela veut dire sans doute que chaque individu, chaque famille a vu s’accroître son aisance. Si cette aisance n’a pas favorisé les mariages, les naissances, et prolongé la durée moyenne de la vie, Villeneuve est, par une cause que je ne puis deviner, en dehors de toutes les lois naturelles qui gouvernent les phénomènes de la population.
Enfin, Monsieur et cher collègue, vous me renvoyez aux tables de recrutement. Elles attestent, dites-vous, que les races les plus belles, les hommes les plus forts, appartiennent à la région des labourables et des vignes. — Mais prenez garde qu’il n’entre pas dans mon sujet de comparer la population de la Lande à celle de la Chalosse, mais seulement chacune de ces populations à elle-même, à deux époques différentes. La question pour moi n’est pas de savoir si la population de la Lande égale en vigueur et en densité celle de la Chalosse, mais si, depuis quarante ans, l’une a progressé, l’autre a rétrogradé sous ces deux rapports. Cette vérification m’était facile quant au nombre. Pour ce qui est de la beauté des races, je serais bien aise de consulter les tables du recrutement, si elles existent à la préfecture.
Vous voyez que, comme tous les auteurs possibles, je ne conviens pas facilement d’avoir tort. Je dois pourtant dire que je n’ai pas suffisamment expliqué la portée du passage où j’ai résumé en chiffres (6,32) les considérations diverses disséminées dans mon écrit. Je sais bien que le mouvement de la population ne peut pas être une bonne base de répartition ; mon seul but a été de rendre mes conclusions sensibles par des chiffres, et je crois sincèrement que les recherches directes de l’administration donneront des résultats qui ne s’éloigneront pas de beaucoup de ceux auxquels je suis arrivé, parce qu’il y a selon moi un rapport sinon rigoureux, du moins très-approximatif entre le progrès de la population et celui du revenu.
FN: De la répartition de la contribution foncière dans le département des Landes, t. Ier, p. 283. (Note de l’éditeur.)
à Richard Cobden: Lettre du 24 novembre 1844 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.32] [OC1] 32. Mugron, 24 novembre 1844. A Richard Cobden
Monsieur,
Nourri à l’école de votre Adam Smith et de notre J. B. Say je commençais à croire que cette doctrine si simple et si claire n’avait aucune chance de se populariser, du moins de bien longtemps, car, chez nous, elle est complétement étouffée par les spécieuses fallacies que vous avez si bien réfutées, — par les sectes fouriéristes, communistes, etc., dont le pays s’est momentanément engoué, — et aussi par l’alliance funeste des journaux de parti avec les journaux payés par les comités manufacturiers.
C’est dans l’état de découragement complet où m’avaient jeté ces tristes circonstances, que m’étant par hasard abonné au Globe and Traveller, j’appris, et l’existence de la Ligue, et la lutte que se livrent en Angleterre la liberté commerciale et le monopole. Admirateur passionné de votre si puissante et si morale association, et particulièrement de l’homme qui paraît lui donner, au milieu de difficultés sans nombre, une impulsion à la fois si énergique et si sage, je n’ai pu contempler ce spectacle sans désirer faire aussi quelque chose pour la noble cause de l’affranchissement du travail et du commerce. Votre honorable secrétaire M. Hickin a eu la bonté de me faire parvenir la Ligue, à dater de janvier 1844, et beaucoup de documents relatifs à l’agitation.
Muni de ces pièces, j’ai essayé d’appeler l’attention du public sur vos proceedings, sur lesquels les journaux français gardaient un silence calculé et systématique. J’ai écrit dans les journaux de Bayonne et de Bordeaux, deux villes naturellement placées pour être le berceau du mouvement. Récemment encore, j’ai fait insérer dans le Journal des Économistes (n°35, Paris, octobre 1844) un article que je recommande à votre attention. Qu’est-il arrivé ? c’est que les journaux parisiens, à qui nos lois donnent le monopole de l’opinion, ont jugé la discussion plus dangereuse que le silence. Ils font donc les silence autour de moi, bien sûrs, par ce système, de me réduire à l’impuissance.
J’ai essayé d’organiser à Bordeaux une association pour l’affranchissement des échanges ; mais j’ai échoué parce que si l’on rencontre quelques esprits qui souhaitent instinctivement la liberté dans une certaine mesure, il ne s’en trouve pas qui la comprennent en principe.
D’ailleurs une association n’opère que par la publicité, et il lui faut de l’argent. Je ne suis pas assez riche pour la doter à moi seul ; et demander des fonds, c’eût été créer l’insurmontable obstacle de la méfiance.
J’ai songé à établir à Paris un journal quotidien fondé sur ces deux données : Liberté commerciale ; exclusion d’esprit de parti. — Là, encore, je suis venu me heurter contre des obstacles pécuniaires et autres, qu’il est inutile de vous exposer. Je le regretterai tous les jours de ma vie, car j’ai la conviction qu’un tel journal, répondant à un besoin de l’opinion, aurait eu des chances de succès. — (Je n’y renonce pas.)
Enfin, j’ai voulu savoir si je pouvais avoir quelques chances d’être nommé député, et j’ai acquis la certitude que mes concitoyens m’accorderaient leurs suffrages ; car j’atteignis presque la majorité aux dernières élections. Mais des considérations personnelles m’empêchent d’aspirer à cette position, que j’aurais pu faire tourner à l’avantage de notre cause.
Forcé de restreindre mon action, je me suis mis à traduire vos séances de Drury-Lane et de Covent-Garden. — Au mois de mai prochain, je livrerai cette traduction à la publicité. J’en attends de bons effets.
1° Il faudra bien que l’on reconnaisse, en France, l’existence de l’agitation anglaise contre les monopoles.
2° Il faudra bien qu’on cesse de croire que la liberté n’est qu’un piége que l’Angleterre tend aux autres nations.
3° Les arguments en faveur de la liberté du commerce auront peut-être plus d’effet, sous la forme vive, variée, populaire de vos speeches, que dans les ouvrages méthodiques des économistes.
4° Votre tactique si bien dirigée, en bas sur l’opinion, en haut sur le parlement, nous apprendra à agir de même et nous éclairera sur le parti qu’on peut tirer des institutions constitutionnelles.
5° Cette publication sera un coup vigoureux porté à ces deux grands fléaux de notre époque : L’esprit de parti et les haines nationales.
6° La France verra qu’il y a en Angleterre deux opinions entièrement opposées, et qu’il est par conséquent absurde et contradictoire d’embrasser toute l’Angleterre dans la même haine.
Pour que celle œuvre fût complète, j’aurais désiré avoir quelques documents sur l’origine et le commencement de la Ligue. Un court historique de cette association aurait convenablement précédé la traduction de vos discours. J’ai demandé ces pièces à M. Hickin ; mais ses occupations ne lui ont sans doute pas permis de me répondre. Mes documents ne remontent qu’à janvier 1843. — Il me faudrait au moins la discussion au parlement sur le tarif de 1842, et spécialement le discours où M. Peel proclama la vérité économique, sous cette forme devenue si populaire : We must be allowed to buy in the cheapest market, etc.
Je voudrais aussi que vous me disiez quels sont ceux de vos discours, soit aux meetings, soit au parlement, que vous jugez le plus à propos de faire traduire. — Enfin je désire que mon livre contienne une ou deux free-trade discussions de la chambre des communes, et que vous ayez la bonté de me les désigner.
Je m’estimerai heureux si j’obtiens une lettre de l’homme de notre époque à qui j’ai voué la plus vive et la plus sincère admiration.
à M. Horace Say; Lettre du 24 novembre 1844 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.33] [OC7] 33. Mugron, 24 novembre 1844. A Horace Say
Monsieur,
Permettez-moi de venir vous exprimer le sentiment de profonde satisfaction que m’a fait éprouver la lecture de votre bienveillante lettre du 19 de ce mois. Sans des témoignages tels que ceux que renferme cette lettre précieuse, comment pourrions-nous savoir, nous, hommes de solitude, privés des utiles avertissements qu’on reçoit au contact du monde, si nous ne sommes pas un de ces rêveurs trop communs en province qui se laissent dominer par une idée exclusive ? — Ne dites pas, Monsieur, que votre approbation ne peut avoir que peu de prix à mes yeux. Depuis que la France et l’humanité ont perdu votre illustre père, que je vénère aussi comme mon père intellectuel, quel témoignage peut m’être plus précieux que le vôtre, surtout quand vos propres écrits et les marques de confiance dont vous entoure la population parisienne, donnent tant d’autorité à vos jugements ?
Parmi les écrivains de l’école de votre père que la mort a respectés, il en est un surtout dont l’assentiment a pour moi une valeur inappréciable, quoique je n’eusse pas osé le provoquer. Je veux parler de M. Ch. Dunoyer. Ses deux premiers articles du Censeur européen (De l’équilibre des nations) ainsi que ceux de M. Comte qui les précèdent, décidèrent, il y a déjà bien longtemps, de la direction de mes idées et même de ma conduite politique. Depuis, l’école économiste paraît s’être effacée devant ces nombreuses sectes socialistes, qui cherchent la réalisation du bien universel, non dans les lois de la nature humaine, mais dans des organisations artificielles, produit de leur imagination : erreur funeste que M. Dunoyer a longtemps combattue avec une persévérance, pour ainsi dire, prophétique. Je n’ai donc pu m’empêcher de ressentir un mouvement, je dirai presque d’orgueil, quand j’ai appris, par votre lettre, que M. Dunoyer avait approuvé l’esprit de l’écrit que vous avez bien voulu admettre dans votre estimable recueil.
Vous avez l’obligeance, Monsieur, de m’encourager à vous adresser un autre travail. Je consacre maintenant le peu de temps dont je puis disposer à une œuvre de patience, dont l’utilité me semble incontestable quoiqu’il ne s’agisse que de simples traductions. Il y a, en Angleterre, un grand mouvement en faveur de la liberté commerciale : ce mouvement est tenu soigneusement caché par nos journaux ; et si, de loin en loin, ils sont forcés d’en dire un mot, c’est pour en dénaturer l’esprit et la portée. Je voudrais mettre les pièces sous les yeux du public français ; lui montrer qu’il y a de l’autre côté du détroit un parti nombreux, puissant, honnête, judicieux, prêt à devenir le parti national, prêt à diriger la politique de l’Angleterre, et que c’est à ce parti que nous devons donner la main. Le public serait ainsi à même de juger s’il est raisonnable d’embrasser toute l’Angleterre dans cette haine sauvage, que le journalisme s’efforce d’exciter avec tant d’opiniâtreté et de succès. J’attends d’autres avantages de cette publication. On y verra l’esprit de parti attaqué dans sa racine ; les haines nationales sapées dans leur base ; la théorie des débouchés exposée non point méthodiquement, mais sous des formes populaires et saisissantes : enfin, on y verra en action, cette énergie, cette tactique d’agitation, qui fait qu’aujourd’hui en Angleterre, lorsqu’on attaque un abus réel, on peut prédire le jour de sa chute, à peu près comme nos officiers du génie annoncent l’heure où les assiégeants s’empareront d’une citadelle.
Je compte me rendre à Paris au mois d’avril prochain pour surveiller l’impression de cette publication ; et si j’avais pu hésiter, vos offres bienveillantes, le désir de faire votre connaissance et celle des hommes distingués qui vous entourent suffiraient pour me déterminer.
Votre collègue, M. Dupérier, a bien voulu m’écrire aussi à l’occasion de mon article. C’est bon en théorie, dit-il ; j’ai envie de lui répondre par cette boutade de M. votre père : « Morbleu ! ce qui n’est pas bon pour la pratique n’est bon à rien. » — M. Dupérier et moi suivons en politique des routes bien différentes. Je n’en ai que plus d’estime pour son caractère et la franchise de sa lettre. Par le temps qui court les candidats sont rares qui disent à leurs adversaires ce qu’ils pensent.
J’oubliais de dire que si le temps et ma santé me le permettent, sur votre encourageante invitation, j’enverrai un autre article au Journal des économistes.
Veuillez, Monsieur, être mon interprète auprès de MM. Dussard, Fix, Blanqui, les remercier de leur bienveillance et les assurer que je m’associe de grand cœur à leurs nobles et utiles travaux.
P. S. Je prends la liberté de vous envoyer un écrit publié en 1842, à l’occasion des élections, par un de mes amis, M. Félix Coudroy. Vous y verrez que les doctrines de MM. Say, Comte, Dunoyer ont germé quelque part sur notre aride sol des Landes. J’ai pensé qu’il vous serait agréable d’apprendre que le feu sacré n’est pas tout à fait éteint. Tant qu’une étincelle brille encore, il ne faut pas désespérer.
Articles and Essays↩
Deux articles sur la langue basque (JCPD) [no date] [not available] [CW1.1.1]↩
Proposition de création d'une école d'apprentis agricoles (JCPD) [no date] [not available] [CW1.1.6]↩
Lettre à un candidat [1822???] [CW1.3.4]↩
BWV
1822.?? “Lettre à M. ***, en réponse à la sienne du 12 janvier” (A Letter to M. *** in reply to His Letter of 12 January, or “Letter to a Candidate”) [1822] [OC7.71, p. 293] [CW1, pp. 410-11]
[editor’s note] [13]
Monsieur,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, en date du 12 de ce mois, dans le but, selon vos expressions, de solliciter mon suffrage et celui de mes amis.
Je ne puis rien vous dire, monsieur, sur les intentions de mes amis ; je ne leur cache pas mon vote, mais je ne cherche pas à influencer le leur.
Quant au mien, il ne m’appartient pas au point de l’engager. L’intérêt public le détermine, et, jusqu’à l’instant où il tombe dans l’urne, je n’ai d’engagement qu’envers le public et ma conscience.
La notoriété publique attribue au général Durrieux, votre concurrent, des opinions favorables au ministère actuel, et, par conséquent défavorables, selon moi, aux intérêts de la France et spécialement de la France méridionale. Aucun acte de sa part n’est venu m’autoriser à regarder comme mal fondée l’opinion publique à cet égard ; bien, au contraire, sa position personnelle me le fait regarder comme un très mauvais représentant de nos intérêts, soit généraux, soit vinicoles. C’est vous dire que je ne lui donnerai pas mon suffrage.
Mais, par la même raison, je ne puis la donner à un candidat qui, il y a à peine un an, appelait de tous ses vœux la candidature du général Durrieux, et encore moins si ce même homme affiche maintenant des opinions différentes ; car, ou il n’était pas sincère alors, ou il ne l’est pas aujourd’hui.
Vous me dites, monsieur, que les voix du Gouvernement vous échapperont. Vous les avez sans doute laissé échapper ; vous les sollicitiez l’année dernière avec tant d’instance, que vous ne répugniez pas à faire agir sur les fonctionnaires ces deux grands ressorts, la crainte des destitutions et l’espérance de l’avancement. J’ai sous les yeux une lettre dans laquelle vous sollicitiez le suffrage d’un fonctionnaire, sous les auspices de son chef (ce qui équivaut à une menace) et où vous lui parliez de votre influence à Paris (ce qui équivaut à une promesse). Aujourd’hui, c’est aux hommes indépendants que vos promesses s’adressent ; ou celles d’aujourd’hui, ou celles d’alors ne sont pas sincères.
Et puis, que nous promettez-vous ? Des faveurs. Les faveurs ne s’accordent pas au public, mais aux dépens du public, sans quoi ce ne serait pas des faveurs.
Ensuite, pour obliger des favoris, il faut au moins le désirer, et vous dites que vous ne désirerez rien des ministres.
Enfin, monsieur, depuis quelques jours que les électeurs se communiquent réciproquement les lettres dont vous les favorisez, on en voit d’adressées aux ministériels et aux patriotes, aux nobles et aux roturiers, aux carlistes, aux philippistes, etc. Dans toutes, vous sollicitez l’obligeance des électeurs, vous demandez des votes comme on demande des services ; il est permis d’en conclure, qu’en vous nommant, on rendrait service au candidat plutôt qu’au public.
Aux électeurs du département des Landes (Nov. 1830) [CW1.2.4]↩
BWV
1830.11 “Aux électeurs du département des Landes (Nov. 1830)” (To the Electors of the Department of Les Landes (November, 1830)) [OC1.1, p. 217] [CW1]
Aux électeurs du département des Landes [14]
Novembre 1830
Un peuple n’est pas libre par cela seul qu’il possède des institutions libérales ; il faut encore qu’il sache les mettre en œuvre, et la même législation qui a fait sortir de l’urne électorale des noms tels que ceux de Lafayette et de Chantelauze, de Tracy et de Dudon, peut, selon les lumières des électeurs, devenir le palladium des libertés publiques ou l’instrument de la plus solide de toutes les oppressions, celle qui s’exerce sur une nation par la nation elle-même.
Pour qu’une loi d’élection soit pour le public une garantie véritable, une condition est essentielle : c’est que les électeurs connaissent leurs intérêts et veuillent les faire triompher ; c’est qu’ils ne laissent pas capter leurs suffrages par des motifs étrangers à l’élection ; c’est qu’ils ne regardent pas cet acte solennel comme une simple formalité, ou tout au plus comme une affaire entre l’électeur et l’éligible ; c’est qu’ils n’oublient pas complétement les conséquences d’un mauvais choix ; c’est enfin que le public lui-même sache se servir des seuls moyens répressifs qui soient à sa disposition, la haine et le mépris, pour ceux des électeurs qui le sacrifient par ignorance, ou l’immolent à leur cupidité.
Il est vraiment curieux d’entendre le langage que tiennent naïvement quelques électeurs.
L’un nommera un candidat par reconnaissance personnelle ou par amitié ; comme si ce n’était pas un véritable crime d’acquitter sa dette aux dépens du public, et de rendre tout un peuple victime d’affections individuelles.
L’autre cède à ce qu’il appelle la reconnaissance due aux grands services rendus à la Patrie ; comme si la députation était une récompense, et non un mandat ; comme si la chambre était un panthéon que nous devions peupler de figures froides et inanimées, et non l’enceinte où se décide le sort des peuples.
Celui-ci croirait déshonorer son pays s’il n’envoyait pas à la chambre un député né dans le département. De peur qu’on ne croie à la nullité des éligibles, il fait supposer l’absurdité des électeurs. Il pense qu’on montre plus d’esprit à choisir un sot dans son pays, qu’un homme éclairé dans le voisinage, et que c’est un meilleur calcul de se faire opprimer par l’intermédiaire d’un habitant des Landes, que de se délivrer de ses chaînes par celui d’un habitant des Basses-Pyrénées.
Celui-là veut un député rompu dans l’art des sollicitations ; il espère que nos intérêts locaux s’en trouveront bien, et il ne songe pas qu’un vote indépendant sur la loi municipale peut devenir plus avantageux à toutes les localités de la France, que les sollicitations et les obsessions de cent députés ne pourraient l’être à une seule.
Enfin un autre s’en tient obstinément à renommer à tout jamais les 221.
Vous avez beau lui faire les objections les mieux fondées, il répond à tout par ces mots : Mon candidat est des 221.
Mais ses antécédents? — Je les oublie : il est des 221.
Mais il est membre du gouvernement ; pensez-vous qu’il sera très-disposé à restreindre un pouvoir qu’il partage, à diminuer des impôts dont il vit ? — Je ne m’en mets pas en peine : il est des 221.
Mais songez qu’il va concourir à faire des lois. Voyez quelles conséquences peut avoir un choix fait par un motif étranger au but que vous devez vous proposer. — Tout cela m’est égal : il est des 221.
Mais c’est surtout la modération qui joue un grand rôle dans cette armée de sophismes que je passe rapidement en revue.
On veut à tout prix des modérés ; on craint les exagérés par-dessus tout ; et comment juge-t-on à laquelle de ces classes appartient le candidat ? On n’examine pas ses opinions, mais la place qu’il occupe ; et comme le centre est bien le milieu entre la droite et la gauche, on en conclut que c’est là qu’est la modération.
Étaient-ils donc modérés ceux qui votaient chaque année plus d’impôts que la nation n’en pouvait supporter ? ceux qui ne trouvaient jamais les contributions assez lourdes, les traitements assez énormes, les sinécures assez nombreuses ? ceux qui faisaient avec tous les ministères un trafic odieux de la confiance de leurs commettants, trafic par lequel, moyennant des dîners et des places, ils acceptaient au nom de la nation les institutions les plus tyranniques : des doubles votes, des lois d’amour, des lois sur le sacrilége ? ceux enfin qui ont réduit la France à briser, par un coup d’État, les chaînes qu’ils avaient passé quinze années à river ?
Et sont-ils exagérés ceux qui veulent éviter le retour de pareils excès ; ceux qui veulent mettre de la modération dans les dépenses ; ceux qui veulent modérer l’action du pouvoir ; qui ne sont pas immodérés, c’est-à-dire insatiables de gros salaires et de sinécures ; ceux qui veulent que notre révolution ne se borne pas à un changement de noms propres et de couleur ; qui ne veulent pas que la nation soit exploitée par un parti plutôt que par un autre, et qui veulent conjurer l’orage qui éclaterait infailliblement si les électeurs étaient assez imprudents pour donner la prépondérance au centre droit de la chambre ?
Je ne pousserai pas plus loin l’examen des motifs par lesquels on prétend appuyer une candidature, sur laquelle on avoue généralement ne pas fonder de grandes espérances. À quoi servirait d’ailleurs de s’étendre davantage à réfuter des sophismes que l’on n’emploie que pour s’aveugler soi-même ?
Il me semble que les électeurs n’ont qu’un moyen de faire un choix raisonnable : c’est de connaître d’abord l’objet général d’une représentation nationale, et ensuite de se faire une idée des travaux auxquels devra se livrer la prochaine législature. C’est en effet la nature du mandat qui doit nous fixer sur le choix du mandataire ; et, en cette matière comme en toutes, c’est s’exposer à de graves méprises que d’adopter le moyen, abstraction faite du but que l’on se propose d’atteindre.
L’objet général des représentations nationales est aisé à comprendre.
Les contribuables, pour se livrer avec sécurité à tous les modes d’activité qui sont du domaine de la vie privée, ont besoin d’être administrés, jugés, protégés, défendus. C’est l’objet du gouvernement. Il se compose du Roi, qui en est le chef suprême, des ministres et des nombreux agents, subordonnés les uns aux autres, qui enveloppent la nation comme d’un immense réseau.
Si cette vaste machine se renfermait toujours dans le cercle de ses attributions, une représentation élective serait superflue ; mais le gouvernement est, au milieu de la nation, un corps vivant, qui, comme tous les êtres organisés, tend avec force à conserver son existence, à accroître son bien-être et sa puissance, à étendre indéfiniment sa sphère d’action. Livré à lui-même, il franchit bientôt les limites qui circonscrivent sa mission ; il augmente outre mesure le nombre et la richesse de ses agents ; il n’administre plus, il exploite ; il ne juge plus, il persécute ou se venge ; il ne protége plus, il opprime.
Telle serait la marche de tous les gouvernements, résultat inévitable de cette loi de progression dont la nature a doué tous les êtres organisés, si les nations n’opposaient un obstacle aux envahissements du pouvoir.
La loi d’élection est ce frein aux empiétements de la force publique, frein que notre constitution remet aux mains des contribuables eux-mêmes ; elle leur dit : « Le gouvernement n’existera plus pour lui, mais pour vous ; il n’administrera qu’autant que vous sentirez le besoin d’être administrés ; il ne prendra que le développement que vous jugerez nécessaire de lui laisser prendre ; vous serez les maîtres d’étendre ou de resserrer ses ressources ; il n’adoptera aucune mesure sans votre participation ; il ne puisera dans vos bourses que de votre consentement ; en un mot, puisque c’est par vous et pour vous que le pouvoir existe, vous pourrez, à votre gré, le surveiller et le contenir au besoin, seconder ses vues utiles ou réprimer son action, si elle devenait nuisible à vos intérêts. »
Ces considérations générales nous imposent, comme électeurs, une première obligation : celle de ne pas aller chercher nos mandataires précisément dans les rangs du pouvoir ; de confier le soin de réprimer la puissance à ceux sur qui elle s’exerce, et non à ceux par qui elle est exercée.
Serions-nous en effet assez absurdes pour espérer que, lorsqu’il s’agit de supprimer des fonctions et des salaires, cette mission sera bien remplie par des fonctionnaires et des salariés ? Quand tous nos maux viennent de l’exubérance du pouvoir, confierions-nous à un agent du pouvoir le soin de le diminuer ? Non, non, il faut choisir : nommons un fonctionnaire, un préfet, un maître des requêtes, si nous ne trouvons pas le fardeau assez lourd ; si nous ne sommes pas fatigués du poids du milliard ; si nous sommes persuadés que le pouvoir ne s’ingère pas assez dans les choses qui devraient être hors de ses attributions ; si nous voulons qu’il continue à se mêler d’éducation, de religion, de commerce, d’industrie, à nous donner des médecins, des avocats, de la poudre, du tabac, des électeurs et des jurés.
Mais si nous voulons restreindre l’action du gouvernement, ne nommons pas des agents du gouvernement ; si nous voulons diminuer les impôts, ne nommons pas des gens qui vivent d’impôts ; si nous voulons une bonne loi communale, ne nommons pas un préfet ; si nous voulons la liberté de l’enseignement, ne nommons pas un recteur ; si nous voulons la suppression des droits réunis ou celle du conseil d’État, ne nommons ni un conseiller d’État ni un directeur des droits réunis. On ne peut être à la fois payé et représentant des payants, et il est absurde de faire exercer un contrôle par celui même qui y est soumis.
Si nous venons à examiner les travaux de la prochaine législature, nous voyons qu’ils sont d’une telle importance qu’elle peut être regardée plutôt comme constituante que comme purement législative.
Elle aura à nous donner une loi d’élection, c’est-à-dire à fixer les limites de la souveraineté.
Elle fera la loi municipale dont chaque mot doit influer sur le bien-être des localités.
C’est elle qui discutera l’organisation des gardes nationales, qui a un rapport direct avec l’intégrité de notre territoire et le maintien de la tranquillité publique.
L’éducation réclamera son attention ; et elle est sans doute appelée à livrer l’enseignement à la libre concurrence des professeurs, et le choix des études à la sollicitude des parents.
Les affaires ecclésiastiques exigeront de nos députés des connaissances étendues, une grande prudence, et une fermeté inébranlable ; peut-être, suivant le vœu des amis de la justice et des prêtres éclairés, agitera-t-on la question de savoir si les frais de chaque culte ne doivent pas retomber exclusivement sur ceux qui y participent.
Bien d’autres matières importantes seront agitées.
Mais c’est surtout pour la partie économique des travaux de la chambre que nous devons être scrupuleux dans le choix de nos députés. Les abus, les sinécures, les traitements excessifs, les fonctions inutiles, les emplois nuisibles, les régies substituées à la concurrence, devront être l’objet d’une investigation sévère ; je ne crains pas de le dire : c’est là qu’est le plus grand fléau de la France.
Je demande pardon au lecteur de la digression vers laquelle je me sens irrésistiblement entraîné ; mais je ne puis m’empêcher de chercher à faire comprendre, sur cette grave question, ma pensée tout entière.
Si je ne considérais les dépenses excessives comme un mal, qu’à cause de la portion des richesses qu’elles ravissent inutilement à la nation, si je n’y voyais d’autres résultats que le poids accablant de l’impôt, je n’en parlerais pas si souvent, je dirais, avec M. Guizot, qu’il ne faut pas marchander la liberté, qu’elle est un bien si précieux qu’on ne saurait le payer trop cher, et que nous ne devons pas regretter les millions qu’elle nous coûte.
Un tel langage suppose que la profusion et la liberté peuvent marcher ensemble ; mais si j’ai la conviction intime qu’elles sont incompatibles, que les gros traitements et la multiplication des places excluent non-seulement la liberté, mais encore l’ordre et la tranquillité publiques, qu’ils compromettent la stabilité des gouvernements, vicient les idées des peuples et corrompent leurs mœurs, on ne s’étonnera plus que j’attache tant d’importance au choix des députés qui nous permettent d’espérer la destruction d’un tel abus.
Or, que peut-il exister de liberté là où, pour soutenir d’énormes dépenses, le gouvernement, forcé de prélever d’énormes tributs, se voit réduit à recourir aux contributions les plus vexatoires, aux monopoles les plus injustes, aux exactions les plus odieuses, à envahir le domaine des industries privées, à rétrécir sans cesse le cercle de l’activité individuelle, à se faire marchand, fabricant, courrier, professeur, et non-seulement à mettre à très-haut prix ses services, mais encore à éloigner, par l’aspect des châtiments destinés au crime, toute concurrence qui menacerait de diminuer ses profits ? Sommes-nous libres si le gouvernement épie tous nos mouvements pour les taxer, soumet toutes les actions aux recherches des employés, entrave toutes les entreprises, enchaîne toutes les facultés, s’interpose entre tous les échanges pour gêner les uns, empêcher les autres et les rançonner presque tous ?
Peut-on attendre de l’ordre d’un régime qui, plaçant sur tous les points du territoire des millions d’appâts offerts à la cupidité, donne perpétuellement, à tout un vaste royaume, l’aspect que présente une grande ville au jour des distributions gratuites ?
Croit-on que la stabilité du pouvoir soit bien assurée lorsque, abandonné par les peuples, qu’il s’est aliénés par ses exactions, il reste livré sans défense aux attaques des ambitieux ; lorsque les portefeuilles sont assaillis et défendus avec acharnement, et que les assiégeants s’appuient sur la rébellion comme les assiégés sur le despotisme, les uns pour conquérir la puissance, les autres pour la conserver ?
Les gros traitements n’engendrent pas seulement les entraves, le désordre et l’instabilité du pouvoir, ils faussent encore les idées des peuples, en renforçant ce préjugé gothique qui faisait mépriser le travail et honorer exclusivement les fonctions publiques ; ils corrompent les mœurs en rendant les carrières industrielles onéreuses et celles des places florissantes ; en excitant la population entière à déserter l’industrie pour les emplois, le travail pour l’intrigue, la production pour la consommation stérile, l’ambition qui s’exerce sur les choses pour celle qui n’agit que sur les hommes ; enfin en répandant de plus en plus la manie de gouverner et la fureur de la domination.
Voulons-nous donc délivrer l’autorité des intrigants qui l’obsèdent pour la partager, des factieux qui la sapent pour la conquérir, des tyrans qui la renforcent pour la défendre ; voulons-nous arriver à l’ordre, à la liberté, à la paix publique ? appliquons-nous surtout à diminuer les grosses rétributions ; supprimons l’appât, si nous redoutons la convoitise ; faisons disparaître ces prix séduisants attachés au bout de la carrière, si nous ne voulons pas qu’elle se remplisse de jouteurs ; entrons franchement dans le système américain ; que les hauts fonctionnaires soient indemnisés et non richement dotés, que les places donnent beaucoup de travail et peu de profits, que les fonctions publiques soient une charge et non un moyen de fortune, qu’elles ne puissent pas faire briller ceux qui les ont ni exciter l’envie de ceux qui ne les ont pas.
Après avoir compris l’objet d’une représentation nationale, après avoir recherché quels seront les travaux qui occuperont la prochaine législature, il nous sera facile de savoir quelles sont les qualités et les garanties que nous devons exiger de notre député.
Il est clair que la première chose que nous devons chercher en lui, c’est la connaissance des objets sur lesquels il sera appelé à discuter, en d’autres termes, la capacité en économie politique et en législation.
On ne pourra pas contester que M. Faurie remplisse cette première condition. L’habileté avec laquelle il a géré ses affaires particulières est une garantie qu’il saura administrer les affaires publiques ; ses connaissances en finances pourront être à la chambre d’une grande utilité ; enfin, toute sa vie, il s’est livré avec ardeur à l’étude des sciences morales et politiques.
La capacité de bien l’aire ne suffit pas à notre mandataire, il faut encore qu’il en ait la volonté ; et cette volonté ne peut nous être garantie que par un passé invariable, une indépendance absolue dans le caractère, la fortune et la position sociale.
Sous tous ces rapports, M. Faurie doit satisfaire les exigences de l’électeur le plus sévère.
Aucune variation dans son passé ne peut nous en faire redouter pour l’avenir. Sa probité, dans la vie privée, est connue, et la vertu, chez M. Faurie, n’est pas un sentiment vague, mais un système arrêté et invariablement mis en pratique ; en sorte qu’il serait difficile de trouver un homme dont la conduite et les opinions fussent plus en harmonie. Sa probité politique est poussée jusqu’au scrupule ; sa fortune le met au-dessus de toutes les séductions, comme son courage au-dessus de toutes les craintes ; il ne veut pas de places et ne peut pas en vouloir ; il n’a ni fils ni frères, en faveur desquels il puisse, à nos dépens, compromettre son indépendance ; enfin l’énergie de son caractère en fera pour nous, non un solliciteur intrépide (il est bon de le dire), mais au besoin un défenseur opiniâtre.
Si, à la justesse des idées et à l’élévation des sentiments on désirait, comme condition, sinon indispensable, du moins avantageuse, le talent de la parole, je n’oserais affirmer que M. Faurie possédât cette éloquence passionnée destinée à remuer les masses populaires sur une place publique ; mais je le crois très en état d’énoncer devant la chambre les observations qui lui seraient suggérées par son esprit droit et ses intentions consciencieuses, et l’on conviendra que, lorsqu’il s’agit de discuter des lois, l’éloquence qui ne s’adresse qu’à la raison pour l’éclairer est moins dangereuse que celle qui agit sur les passions pour les égarer.
J’ai entendu faire contre ce candidat une objection qui me paraît bien peu fondée : « N’est-il pas à craindre, disait-on, qu’étant Bayonnais il ne travaille plus pour Bayonne que pour le département des Landes ? »
Je ne répondrai pas que personne ne songeait à faire cette objection contre M. d’Haussez ; que le lien qui s’établit entre l’élu et les électeurs est aussi puissant que celui qui attache l’homme au pays qui l’a vu naître ; enfin, que M. Faurie, possédant ses propriétés dans le département des Landes, peut être, en quelque sorte, regardé comme notre compatriote.
Il est une autre réponse qui, selon moi, ôte toute sa force à l’objection.
Ne semblerait-il pas, à entendre le langage de ces hommes prévoyants, que les intérêts de Bayonne et ceux du département des Landes sont tellement opposés, qu’on ne puisse rien faire pour les uns qui ne tourne nécessairement contre les autres ? Mais pour peu qu’on réfléchisse à la position respective de Bayonne et des Landes, on sentira qu’au contraire leurs intérêts sont inséparables, identiques.
En effet, une ville de commerce placée à l’embouchure d’un fleuve ne peut avoir, dans le cours ordinaire des choses, qu’une importance proportionnée à celle du pays que ce fleuve parcourt. Si Nantes et Bordeaux prospèrent plus que Bayonne, c’est que la Loire et la Garonne traversent des pays plus riches que l’Adour, des contrées capables de produire et de consommer davantage ; or, les échanges relatifs à cette production et à cette consommation se faisant dans la ville située à l’embouchure du fleuve, il s’ensuit que le commerce de cette ville se développe ou se restreint selon que les pays environnants prospèrent ou dépérissent. Que les bords de l’Adour et des rivières qui lui portent leurs eaux soient fertiles, que les landes soient défrichées, que la Chalosse ait des moyens de communication, que notre département soit traversé de canaux, habité par une population nombreuse et riche, alors Bayonne aura un commerce assuré, fondé sur la nature des choses. Notre député veut-il donc faire fleurir Bayonne, c’est sur le département des Landes qu’il doit d’abord appeler la prospérité.
Si une autre circonscription faisait entrer Bayonne dans notre département, n’est-il pas vrai qu’on ne ferait pas l’objection ? Eh quoi ! une ligne écrite sur un morceau de papier a donc changé la nature des choses ? parce que, sur la carte, une ville est séparée de la campagne qui l’environne, par une raie rouge ou bleue, cela peut-il rompre leurs intérêts réciproques ?
Il y en a qui craignent de compromettre le bon ordre en choisissant pour députés des hommes franchement libéraux. « Pour le moment, disent-ils, nous avons besoin de l’ordre avant tout. Il nous faut des députés qui ne veuillent aller ni trop loin ni trop vite ! »
Eh ! c’est précisément pour le maintien de l’ordre qu’il faut nommer de bons députés ! C’est par amour pour l’ordre que nous devons chercher à mettre les chambres en harmonie avec la France. Vous voulez de l’ordre, et vous renforcez le centre droit, au moment où la France s’irrite contre lui, au moment où, déçue dans ses plus chères espérances, elle attend avec anxiété le résultat des élections ? Et savez-vous ce qu’elle fera, si elle voit encore une fois son dernier espoir s’évanouir ? Quant à moi, je ne le sais pas.
Électeurs, rendons-nous à notre poste, songeons que la prochaine législature porte dans son sein toutes les destinées de la France ; songeons que ses décisions doivent étouffer à jamais, ou prolonger indéfiniment, cette lutte déjà si longue entre l’ancienne France et la France moderne ! Rappelons-nous que nos destinées sont dans nos mains, que c’est nous qui sommes les maîtres de raffermir ou de dissoudre cette monstrueuse centralisation, cet échafaudage construit par Bonaparte et restauré par les Bourbons, pour exploiter la nation après l’avoir garrottée ! N’oublions pas que c’est une chimère de compter, pour l’amélioration de notre sort, sur des couleurs et des noms propres ; ne comptons que sur notre indépendance et notre fermeté. Voudrions-nous que le pouvoir s’intéressât plus à nous que nous ne nous y intéressons nous-mêmes ? Attendons-nous qu’il se restreigne si nous le renforçons ; qu’il se montre moins entreprenant si nous lui envoyons des auxiliaires ; espérons-nous que nos dépouilles soient refusées si nous sommes les premiers à les offrir ? Quoi ! nous exigerions de ceux qui nous gouvernent une grandeur d’âme surnaturelle, un désintéressement chimérique, et nous, nous ne saurions pas défendre, par un simple vote, nos intérêts les plus chers !
Électeurs, prenons-y garde ! nous ne ressaisirons pas l’occasion, si nous la laissons échapper. Une grande révolution s’est faite ; jusqu’ici en quoi a-t-elle amélioré votre existence ? Je sais que les réformes ne se font pas en un jour, qu’il ne faut pas demander l’impossible, ni censurer à tort et à travers, par mauvaise humeur ou par habitude. Je sais que le nouveau gouvernement a besoin de force, je le crois animé des meilleures intentions ; mais enfin il ne faut pas fermer les yeux à l’évidence ; il ne faut pas que la crainte d’aller trop vite, non-seulement nous frappe d’immobilité, mais encore nous ôte l’espoir d’avancer ; et s’il n’a pas été fait d’améliorations matérielles, nous en fait-on du moins espérer ? Non, on déchire ces proclamations enivrantes qui, dans la grande semaine, nous auraient fait verser jusqu’à la dernière goutte de notre sang. Chaque jour nous rapproche du passé que les trois immortelles journées devaient rejeter à un siècle loin de nous. S’agit-il de la loi communale ? on exhume le projet Martignac, élaboré sous l’influence d’une cour méticuleuse et sans confiance dans la nation. S’agit-il d’une garde nationale mobile ? au lieu de ces choix populaires qui doivent en faire la force morale, on nous jette, pour nous consoler, l’élection des subalternes, et l’on se méfie assez de nous pour nous imposer tous nos chefs. Est-il question d’impôts ? on déclare nettement que le gouvernement n’en rabattra pas une obole ; que s’il fait un sacrifice sur une branche de revenu il veut se retrouver sur une autre ; que le milliard doit rester intact à tout jamais ; que si l’on parvient à quelque économie, on n’en soulagera pas les contribuables ; que supprimer un abus serait s’engager à les supprimer tous, et qu’on ne veut pas s’engager dans cette route ; que l’impôt sur les boissons est le plus juste, le plus équitable des impôts, celui dont la perception est la plus douce et la moins coûteuse ; que c’est le beau idéal des conceptions fiscales ; qu’il faudrait le maintenir, sans faire aucun cas des clameurs d’une population accablée ; que si on consent à le modifier, c’est bien à contre-cœur, et à condition qu’au lieu d’une iniquité, on nous en fera subir deux ; que tous les transports seront taxés sans qu’il en résulte aucune gène, aucun inconvénient pour personne ; que le luxe ne doit pas payer ; que ce sont les objets utiles qu’il faut frapper de contributions redoublées ; que la France est belle et riche, qu’on peut compter sur elle, qu’elle est facile à mettre à la raison, et cent autres choses qui font revivre le comte Villèle dans le baron Louis, et qui frappent d’un étourdissement au sortir duquel on ignore si l’on se réveille sous le règne de Philippe ou sous celui de Bonaparte.
Mais, dira-t-on, ce ne sont que des projets ; il faut encore que nos députés les discutent elles adoptent.
Sans doute ; et c’est pour cela qu’il importe d’être scrupuleux dans nos choix, de ne donner nos suffrages qu’à des hommes indépendants de tous les ministères présents et futurs.
Électeurs, Paris nous donne la liberté avec son sang, détruirons-nous son ouvrage avec nos votes ? Allons aux élections uniquement pour le bien général. Fermons l’oreille à toute promesse fallacieuse, fermons nos cœurs à toutes affections personnelles, même à la reconnaissance. Faisons sortir de l’urne le nom d’un homme sage, éclairé, indépendant. Si l’avenir nous apporte un meilleur sort, ayons la gloire d’y avoir contribué ; s’il recèle encore des tempêtes, n’ayons point à nous les reprocher.
D'un nouveau collège à fonder [c. 1834] [CW1.4.1]↩
BWV
1834.?? “D’un nouveau collège à fonder” (On Founding a New School) [a Bayonne newspaper in 1834] [OC7.2, p. 1] [CW1]
D’un nouveau collége à fonder à Bayonne [15]
Il a été question au conseil municipal de doter Bayonne d’un collége. Mais que voulez-vous ? on ne saurait tout faire à la fois ; il fallait courir au plus pressé, et la ville s’est ruinée pour se donner un théâtre : le plaisir d’abord ; l’instruction attendra. D’ailleurs, le théâtre, n’est-ce point aussi une école, et une école de mœurs encore ? Demandez au vaudeville et au mélodrame.
Cependant, en matière de fiscalité, Bayonne se tient à la hauteur de la civilisation, et l’on peut espérer que la question financière ne l’arrêtera pas. Dans cette confiance je demande la permission de lui soumettre quelques idées sur l’instruction publique.
À la première nouvelle du projet municipal, je me suis demandé si un collége qui donnerait l’instruction scientifique et industrielle n’aurait pas quelques chances de succès. Il ne manque pas d’établissements autour de Bayonne qui enseignent, ou pour parler plus exactement, qui font semblant d’enseigner le grec, le latin, la rhétorique, voire même la philosophie. Larresole, Orthez, Oléron, Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Aire, distribuent l’éducation classique. Là, la jeune génération qui doit nous succéder au comptoir et à l’atelier, au champ et à la vigne, au bivouac et au tillac, se prépare à remplir sa rude tâche en se morfondant sur la déclinaison et la conjugaison des langues qu’on parlait il y a quelque deux ou trois mille ans. Là, nos fils, en attendant qu’ils aient des machines à diriger, des ponts à construire, des landes à défricher, des vaisseaux à livrer aux quatre vents du ciel, une comptabilité sévère à tenir, apprennent à scander gentiment sur le bout de leurs doigts,… Tītўrĕ, tū pătŭlœ rĕcŭ, etc. — Soyons justes toutefois, avant de les lancer dans le monde, et vers les approches de leur majorité, on leur donnera une idée vague de la numération, peut-être même quelques aperçus d’histoire naturelle sous forme de commentaires de Phèdre et d’Ésope, le tout, bien entendu, pourvu qu’ils ne perdent pas un iota du Lexicon et du Gradus ad Parnassum.
Supposons que, par une singularité inouïe, Bayonne prît justement le contrepied de cette méthode, qu’il fît de la science, de la connaissance de ce qui est, de l’étude des causes et des effets, le principal, la base, et, de la lecture des poëtes anciens, l’accessoire, l’ornement de l’éducation, ne pensez-vous pas que cette idée, toute bouffonne qu’elle paraît au premier coup d’œil, pourrait sourire à beaucoup de pères de famille ?
Car enfin de quoi s’agit-il ? de composer ce bagage intellectuel qui nourrira ces enfants dans le rude voyage de la vie. Quelques-uns sont appelés à défendre, à éclairer, à moraliser, à représenter, à administrer le peuple, à développer, à perfectionner nos institutions et nos lois, le plus grand nombre, de beaucoup, devra chercher dans le travail et l’industrie les moyens de vivre et de faire vivre femme et enfants.
Et, dites-moi, est-ce dans Horace et dans Ovide qu’ils apprendront ces choses ? Pour être un bon agriculteur, faut-il passer dix ans à apprendre à lire les Georgiques ? Pour mériter les épaulettes, esl-il nécessaire d’user sa jeunesse à déchiffrer Xénophon ? Pour devenir homme d’État, pour s’imprégner des mœurs, des idées et des nécessités de notre époque, faut-il se plonger pendant vingt ans dansla vie romaine, se faire les contemporains des Lucullus et des Messaline, respirer le même air que les Brutus et les Gracques ?
Non seulement ce long séjour de l’enfance dans le passé ne l’initie pas au présent, mais il l’en dégoûte ; il fausse son jugement, il ne prépare qu’une génération de rhéteurs, de factieux et d’oisifs.
Car qu’y a-t-il de commun entre la Rome antique et la France moderne ? Les Romains vivaient de rapine, et nous vivons d’industrie ; ils méprisaient et nous honorons le travail ; ils laissaient aux esclaves la tâche de produire, et c’est justement la tâche dont nous sommes chargés ; ils étaient organisés pour la guerre et nous pour la paix, eux pour la spoliation et nous pour le commerce ; ils aspiraient à la domination, et nous tendons à la fusion des peuples.
Et comment voulez-vous que ces jeunes hommes échappés de Sparte et de Rome ne troublent pas notre siècle de leurs idées, que, comme Platon, ils ne rêvent pas de chimériques républiques ; que, comme les Gracques, ils n’aient pas le regard fixé sur le mont Aventin ? que comme Brutus, ils ne méditent pas la gloire sanglante d’un sublime dévouement.
Je concevrais l’éducation littéraire si nous étions, comme les Athéniens, un peuple d’oisifs. Disserter à perte de vue sur la métaphysique, l’éloquence, la mythologie, les beaux-arts, la poésie, c’est, je crois, le meilleur usage que puisse faire de ses loisirs un peuple de patriciens qui se meut au-dessus d’une multitude d’esclaves.
Mais, à qui doit créer lui-même le nutritum, le vestitum et le tectum, que servent les subtilités de l’école et les rêvasseries des sept sages de la Grèce ? Si Charles doit être laboureur, il faut qu’il apprenne ce que sont en réalité l’eau, la terre et les plantes, et non ce qu’en ont dit Thalès et Épicure. Il lui faut la physique des faits et non la physique des poëtes, la science et non l’érudition. Notre siècle est comme Chrysale :
Il vit de bonne soupe, et non de beau langage.
J’entends d’ici Belise se récrier : Se peut-il rencontrer un homme aussi prosaïque, aussi vulgaire,
Un esprit composé d’atomes si bourgeois ?
Et n’est-il pas triste de voir, pour parler le jargon du jour (qui ressemble assez à celui de Belise), le Fait étouffer l’Idée ?
Je répondrai que l’Idée de l’âge héroïque, idée de domination, de rapine et d’esclavage, n’est ni plus grande ni même plus poétique que l’Idée de l’âge industriel, idée de travail, d’égalité et d’unité, et j’ai pour moi l’autorité de deux grands poëtes, Byron et Lamartine.
Quoi qu’il en soit, si l’homme ne vit pas seulement de pain, il vit encore moins d’ambroisie, et j’oserais dire (en priant d’excuser le jeu de mots) que dans notre système d’éducation, c’est l’idée, l’idée fausse, qui étouffe le fait. C’est elle qui pervertit notre jeunesse, qui lui ferme les avenues de la fortune, qui la pousse vers la carrière des places, ou vers une désespérante oisiveté.
Et dis-moi, ma ville natale, toi que des lois vicieuses (filles aussi d’une instruction erronée) ont dépouillée de ton commerce, toi qui explores de nouvelles routes, qui files la laine et le lin, qui coules le fer, qui arraches le Kaolin à tes entrailles et ne sais pas t’en servir, toi qui crées des navires, qui as ta ferme-modèle, toi enfin qui cherches la force dans un peu d’eau chauffée et la lumière dans un filet d’air, — s’il te faut des bras pour accomplir tes entreprises et des intelligences pour les diriger, n’es-tu pas forcée d’appeler à ton aide des enfants du Nord, pendant que tes fils, si pleins de courage et de sagacité, battent le pavé de tes rues faute d’avoir appris ce qu’aujourd’hui il est indispensable de savoir ?
Mais admettons que l’instruction classique soit réellement la plus utile. On conviendra du moins que c’est à la condition de mettre l’acheteur en possession de la marchandise qu’elle débite. Or ces langues mortes si généralement enseignées sont-elles généralement sues ? Vous qui me lisez, et qui étiez peut-être le lauréat de votre classe, vous arrive-t-il souvent de vous promener, aux bords de la Nive et de l’Adour, un Perse ou un Sophocle à la main ? Hélas ! dans notre âge mur, à peine nous reste-t-il de tant d’études de quoi dénicher le sens d’une simple épigraphe. Je me souviens que, dans une société nombreuse, une dame s’avisa de demander ce que signifiait cette fameuse devise de Louis XIV : Nec pluribus impar. On fit la construction, puis le mot à mot, on disserta sur la force des deux négations, chacun fit sa version ;… il n’y en eut pas deux de semblables.
Voilà donc pour quel résultat vous fatiguez l’enfance, vous la saturez de syntaxe dix heures par jour et sept années durant ! — Vous l’étouffez sous la déclinaison et la conjugaison, vous l’affadissez, vous l’hébétez, vous lui donnez des nausées, et puis vous dites : Mon fils est charmant, il est plein d’intelligence, il comprend, il devine à demi-mot, mais il est léger, paresseux, il ne veut pas se captiver… Pauvre petit être ! que n’est-il assez sage pour répondre : Voyez, la nature m’a donné le goût et le besoin de la diversion ; elle m’a fait curieux et questionneur pour que j’apprenne toutes choses, et que deviennent en vos mains ces précieuses dispositions ? Vous enchaînez tous mes moments à une seule étude, à une étude ingrate et aride, qui ne m’explique rien, qui ne m’apprend rien, ni la cause de ce soleil qui tourne, de cette pluie qui tombe, de cette eau qui coule, de ce grain qui germe ; ni quelle force soutient le navire sur l’eau ou l’oiseau dans l’air; ni d’où vient le pain qui me nourrit et l’habit qui me couvre. Aucun fait n’entre dans ma tête ; des mots, toujours des mots, heure après heure, jour après jour, et toujours et sans fin, d’un bout de ma jeunesse à l’autre. Vouloir que ma noble volonté se concentre tout entière sur ces tristes formules, vouloir que je ne regarde ni le papillon qui voltige, ni l’herbe qui verdit, ni le vaisseau qui marche sans rame et sans voile, vouloir que mes jeunes instincts ne cherchent pas à pénétrer ces phénomènes, aliment de mes sensations, substance de ma pensée, c’est exiger plus que je ne puis. O mon père, si vous en faisiez vous-même l’expérience, si vous vous imposiez seulement pendant un mois cette chemise de force, vous jugeriez qu’elle ne peut convenir aux remuantes allures de l’enfance.
Donc si Bayonne instituait un collége où le latin occupât une heure par jour, ainsi que doit faire un utile accessoire, où le reste du temps fût consacré aux mathématiques, à la physique, à la chimie, à l’histoire, aux langues vivantes, etc., je crois que Bayonne répondrait à un besoin social bien senti et que l’administration actuelle mériterait les bénédictions de la génération qui nous presse.
D'une pétition en faveur des réfugiés polonais [1834] ↩
BWV
1834.?? “D’une pétition en faveur des réfugiés polonais” (On a Petition in favor of Polish Refugees) [1834, local Bayonne paper] [OC7.1, p. pp. 1-4]
N’oublions pas qu’à cette époque des voix retentissantes prodiguaient au capital les épithètes d’infâme et d’infernal.(Note de l’édit.)
D’une pétition en faveur des réfugiés polonais [1].
On signe en ce moment à Bayonne une pétition à la Chambre des députés pour demander que la loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés, ne soit pas renouvelée à l’époque de son expiration.
Nous apprenons avec plaisir que des hommes de toutes les opinions se proposent d’apposer leur signature à cette pétition. En effet, il ne s’agit point ici de demander à la Chambre un acte qui satisfasse telle ou telle coterie ; qui favorise la liberté aux dépens de l’ordre, ou l’ordre aux dépens de la liberté (si tant est que ces deux choses ne soient pas inséparables). Il s’agit de justice, d’humanité envers nos frères malheureux ; il s’agit de ne pas jeter de l’absinthe et du fiel dans la coupe de la proscription, déjà si amère.
Pendant la guerre de la Pologne, on pouvait remarquer en France divergence d’opinions, de projets, relativement à cette guerre : les uns auraient voulu que la France vînt au secours des Polonais par les armes, les autres par l’ argent, les autres par la diplomatie ; d’autres enfin croyaient tous secours inutiles. Mais, s’il y avait des avis divers, il n’y avait qu’un vœu, qu’une sympathie, et elle était toute pour la Pologne.
Quand les restes de cette nation infortunée vinrent en France pour se soustraire à la haine des rois absolus, cette sympathie fut fidèle au courage malheureux.
Cependant, depuis deux ans, quel est le sort des Polonais en France ? On en jugera par la lecture de la loi qui les a placés sous le pouvoir discrétionnaire du Ministère et dont voici le texte :
Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à réunir dans une ou plusieurs villes qu’il désignera les étrangers réfugiés qui résident en France.
Art. 2. — Le Gouvernement pourra les astreindre à se rendre dans celle de ces villes qu’il aura indiquée ; il pourra leur enjoindre de sortir du royaume, s’ils ne se rendent pas à cette destination ou s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique.
Art. 3. — La présente loi ne pourra être appliquée aux étrangers réfugiés qu’en vertu d’un ordre signé par un ministre.
Art. 4. — La présente loi ne sera en vigueur que pendant une année à compter du jour de sa promulgation.
Maintenant, nous demandons s’il ne serait pas indigne de la France de rendre une telle loi définitive ou, ce qui revient au même, de la proroger indéfiniment par des renouvellements successifs.
Le vœu le plus ardent que puisse former un proscrit, après celui de voir cesser son exil, est sans doute de se livrer à quelque travail, de se créer quelques ressources par l’industrie. Mais pour cela il faut pouvoir choisir le lieu de sa résidence ; il faut que ceux qui pourraient se rendre utiles dans des maisons de commerce résident dans des villes commerciales, que ceux qui ont une aptitude pour quelque industrie manufacturière puissent s’approcher des pays de fabrique, que ceux qui ont quelques talents habitent les villes où les beaux-arts sont encouragés. Il faut encore qu’ils ne puissent pas en être expulsés du soir au lendemain, et que le glaive de l’arbitraire ne soit pas constamment suspendu sur leur tête.
La loi du 21 avril est calculée de manière à ce que les Polonais qui ne peuvent recevoir de chez eux ni secours ni nouvelles, dont les familles sont opprimées, traînées en Sibérie, dont les compatriotes sont errants et dispersés sur le globe, ne puissent cependant rien faire pour adoucir leur sort. Ce ne sont plus des réfugiés, ce sont de véritables prisonniers de guerre, agglomérés par centaines dans des bourgades qui ne leur offrent aucune ressource, empêchés même par l’incertitude où on les laisse d’adopter plusieurs mesures qui pourraient diminuer leurs dépenses. Nous les avons vus recevoir à 9 heures l’ordre de quitter une ville à midi, etc.
Ce système de persécution se fonde sur la nécessité de conserver l’ordre et la tranquillité publique en France. Mais tous ceux qui ont eu occasion de connaître les Polonais savent qu’ils ne sont pas des fauteurs de troubles et de désordres ; qu’ils savent fort bien que les intérêts de la France doivent être débattus par des Français ; enfin s’il s’en trouvait quelqu’un qui n’eût pas l’intelligence de sa position et de ses devoirs, les tribunaux sont là, et il n’est nullement nécessaire qu’un ministre placé à deux cents lieues juge et condamne sans entendre et sans voir, sans même s’assurer, ou du moins sans être obligé de s’assurer qu’il ne commet pas une erreur de nom ou de personnes.
Il résulte de là qu’il suffit qu’un Polonais ait un ennemi personnel bien en cour pour qu’il soit jeté hors du territoire sans jugement, sans enquête et sans les garanties qu’obtiendrait en France le dernier des malfaiteurs.
Et d’ailleurs, est-ce de bonne foi qu’on craint que la présence des Polonais trouble la tranquillité publique ? Nous nions qu’ils veuillent troubler l’ordre ; et s’ils avaient une telle prétention, nous serions disposés à croire que ce sont les mesures acerbes employées contre eux qui ont irrité et égaré leurs esprits. Mais noire Gouvernement est-il si peu solide qu’il ait à redouter la présence de quelques centaines de proscrits ? Ne ferait-il pas sa propre satire en avançant qu’il ne peut répondre de l’ordre public si l’on ne l’arme pas envers eux de pouvoirs arbitraires ?
Il est donc bien évident que la pétition, qui se signe en ce moment, n’est pas et ne doit pas être l’œuvre d’un parti ; mais qu’elle doit être accueillie par tous les Bayonnais, sans distinction d’opinion politique, pourvu qu’ils aient dans l’âme quelque étincelle d’humanité et de justice.
FN:Il est probable, mais je n’en suis pas sûr, que cet article, extrait d’un cahier de Bastiat et écrit de sa main, a été inséré dans un journal de Bayonne, en 1834. (Note de l’éditeur.)
Réflexions sur les pétitions de Bordeaux, Le Havre, et Lyon concernant les Douanes [Avril 1834] [CW2.1]↩
BWV
1834.04 “Réflexions sur les pétitions de Bordeaux, Le Havre, et Lyon concernant les Douanes” (Reflections on the Petitions from Bordeaux, Le Havre, and Lyons Relating to the Customs Service) [April 1834] [OC1.2, p. 231] [CW2]
Source
<abc>
Réflexions sur les pétitions de Bordeaux, le Havre et Lyon, concernant les douanes [Avril 1834]
La liberté commerciale aura probablement le sort de toutes les libertés, elle ne s’introduira dans nos lois qu’après avoir pris possession de nos esprits. Aussi devons-nous applaudir aux efforts des négociants de Bordeaux, du Havre et de Lyon, dussent ces efforts n’avoir immédiatement d’autres résultats que d’éveiller l’attention publique.
Mais s’il est vrai qu’une réforme doive être généralement comprise pour être solidement établie, il s’ensuit que rien ne lui peut être plus funeste que ce qui égare l’opinion ; et rien n’est plus propre à l’égarer que les écrits qui réclament la liberté en s’appuyant sur les doctrines du monopole.
Il y a sans doute bien de la témérité à un simple agriculteur de troubler, par une critique audacieuse, l’unanime concert d’éloges qui a accueilli, au dedans et au dehors de notre patrie, les réclamations du commerce français. Il n’a fallu rien moins pour l’y décider que la ferme conviction, je dirai même la certitude, que ces pétitions seraient aussi funestes, par leurs résultats, aux intérêts généraux, et particulièrement aux intérêts agricoles de la France, qu’elles le sont par leurs doctrines au progrès des connaissances économiques.
En m’élevant, au nom de l’agriculture, contre les projets de douanes présentés par les pétitionnaires, j’éprouve le besoin de commencer par déclarer que ce qui, dans ces projets, excite mes réclamations, ce n’est point ce qu’ils renferment de libéral dans les prémisses, mais d’exclusif dans les conclusions.
On demande que toute protection soit retirée aux matières premières, c’est-à-dire à l’industrie agricole, mais qu’une protection soit continuée à l’industrie manufacturière.
Je ne viens point défendre la protection qu’on attaque, mais attaquer la protection qu’on défend.
On réclame le privilége pour quelques-uns ; je viens réclamer la liberté pour tous.
L’agriculture doit de bien vendre au monopole qu’elle exerce, et de mal acheter au monopole qu’elle subit. S’il est juste de lui retirer le premier, il ne l’est pas moins de l’affranchir du second. (Voyez tome II, pages 25 et suiv.)
Vouloir nous livrer à la concurrence universelle, sans y soumettre les fabricants, c’est nous léser dans nos ventes sans nous soulager dans nos achats, c’est faire justement le contraire pour les manufacturiers. Si c’est là la liberté, qu’on me définisse donc le privilége.
Il appartient à l’agriculture de repousser de telles tentatives.
J’ose en appeler ici aux pétitionnaires eux-mêmes, et particulièrement à M. Henri Fonfrède. Je l’adjure de réfuter mes réclamations ou de les appuyer.
Je prouverai :
1° Qu’il y a, entre le projet des pétitionnaires et le système du gouvernement, communauté de principe, d’erreur, de but et de moyens ;
2° Qu’ils ne diffèrent que par une erreur de plus à la charge des pétitionnaires ;
3° Que ce projet a pour but de constituer un privilége inique en faveur des négociants et des fabricants, et au détriment des agriculteurs et du public.
§ 1. Il y a, entre le système des pétitionnaires et le régime prohibitif, communauté de principe, d’erreur, de but et de moyens.
Qu’est-ce que le régime prohibitif ? Laissons parler M. de Saint-Cricq.
« Le travail constitue la richesse d’un peuple, parce que seul il a créé les choses matérielles que réclament nos besoins, et que l’aisance universelle consiste dans l’abondance de ces choses. » Voilà le principe.
« Mais il faut que cette abondance soit le produit du travail national ; si elle était le produit du travail étranger, le travail national s’arrêterait promptement. » Voilà l’erreur.
« Que doit donc faire un pays agricole et manufacturier ? Réserver son marché aux produits de son sol et de son industrie. » Voilà le but.
« Et pour cela, restreindre par des droits et prohiber au besoin les produits du sol et de l’industrie des autres peuples. » Voilà le moyen.
Rapprochons de ce système celui de la pétition de Bordeaux.
Elle divise toutes les marchandises en quatre classes. La première et la seconde renferment des objets d’alimentation et des matières premières, vierges encore de tout travail humain. En principe, une sage économie exigerait que ces deux classes ne fussent pas imposées.
La troisième classe est composée d’objets qui ont reçu une préparation. Cette préparation permet qu’on la charge de quelques droits. On le voit, la protection commence sitôt que, d’après la doctrine des pétitionnaires, commence le travail national.
La quatrième classe comprend des objets perfectionnés, qui ne peuvent nullement servir au travail national. Nous la considérons, dit la pétition, comme la plus imposable.
Ainsi les pétitionnaires professent que la concurrence étrangère nuit au travail national ; c’est l’erreur du régime prohibitif. Ils demandent protection pour le travail ; c’est le but du régime prohibitif. Ils font consister cette protection en des taxes sur le travail étranger ; c’est le moyen du régime prohibitif.
§ 2. Ces deux systèmes diffèrent par une erreur de plus à la charge des pétitionnaires.
Cependant il y a entre ces deux doctrines une différence essentielle. Elle réside tout entière dans le plus ou moins d’extension donnée à la signification du mot travail.
M. de Saint-Cricq l’étend à tout. Aussi veut-il tout protéger.
« Le travail constitue toute la richesse d’un peuple, dit-il ; protéger l’industrie agricole, toute l’industrie agricole, l’industrie manufacturière, toute l’industrie manufacturière, c’est le cri qui retentira toujours dans cette chambre. »
Les pétitionnaires ne voient de travail que celui des fabricants ; aussi n’admettent-ils que celui-là aux faveurs de la protection.
« Les matières premières sont vierges de travail humain ; en principe on ne devrait pas les imposer. Les objets fabriqués ne peuvent plus servir au travail national, nous les considérons comme les plus imposables.
Il se présente donc ici trois questions à examiner : 1° Les matières premières sont-elles le produit du travail ? 2° Si elles ne sont pas autre chose, ce travail est-il si différent du travail des fabriques qu’il soit raisonnable de les soumettre à des régimes opposés ? 3° Si le même régime convient à tous les travaux, est-ce celui de la liberté ou celui de la protection ?
1° Les matières premières sont-elles le produit du travail ?
Et que sont donc, je le demande, tous les articles que les pétitionnaires comprennent dans les deux premières classes de leur projet ? Qu’est-ce que les blés de toutes sortes, la farine, les bestiaux, les viandes sèches et salées, le porc, le lard, le sel, le fer, le cuivre, le plomb, la houille, la laine, les peaux, les semences, si ce n’est le produit du travail ?
Quoi ! dira-t-on, un lingot de fer, une balle de laine, un boisseau de blé sont des produits du travail ? N’est-ce point la nature qui les crée ?
Sans doute la nature crée les éléments de toutes ces choses, mais c’est le travail humain qui en produit la valeur. Il n’appartient pas à l’homme de créer, de faire quelque chose de rien, pas plus au manufacturier qu’au cultivateur ; et si par production on entendait création, tous nos travaux seraient improductifs, et ceux des négociants plus que tous autres.
L’agriculteur n’a donc pas la prétention d’avoir créé la laine, mais il a celle d’en avoir produit la valeur, je veux dire, d’avoir, par son travail et ses avances, transformé en laine des substances qui n’y ressemblaient nullement. Que fait de plus le manufacturier qui la convertit en drap ?
Pour que l’homme puisse se vêtir de drap, une foule d’opérations sont nécessaires. Avant l’intervention de tout travail humain, les véritables matières premières de ce produit sont l’air, l’eau, la chaleur, la lumière, le gaz, les sels qui doivent entrer dans sa composition. Un premier travail convertit ces substances en fourrages, un second en laine, un troisième en fil, un quatrième en vêtement. Qui osera dire que tout n’est pas travail dans cette œuvre, depuis le premier coup de charrue qui la commence, jusqu’au dernier coup d’aiguille qui la termine ?
Et parce que, pour plus de célérité, dans l’accomplissement de l’œuvre définitive, le vêtement, les travaux se sont répartis entre plusieurs classes d’industrieux, vous voulez, par une distinction arbitraire, que l’ordre de succession de ces travaux soit la raison de leur importance, en sorte que le premier ne mérite pas même le nom de travail, et que le dernier, travail par excellence, soit seul digne des faveurs du monopole ? Je ne crois pas qu’on puisse pousser plus loin l’esprit de système et de partialité.
L’agriculteur, dira-t-on, n’a pas comme le fabricant tout exécuté par lui-même ; la nature l’a aidé ; et s’il y a du travail, tout n’est pas travail dans le blé.
Mais tout est travail dans sa valeur, répéterai-je. Je veux que la nature ait concouru à la formation matérielle du grain ; je veux que cette formation soit exclusivement son ouvrage ; mais convenez que je l’y ai contrainte par mon travail, et quand je vous vends du blé, ce n’est point le travail de la nature que je me fais payer, mais le mien.
Et, à ce compte, les objets fabriqués ne seraient pas non plus des produits du travail. Le manufacturier ne se fait-il pas seconder aussi par la nature ? Ne s’empare-t-il pas, à l’aide de la machine à vapeur, du poids de l’atmosphère, comme à l’aide de la charrue je m’empare de son humidité ? A-t-il créé les lois de la gravitation, de la transmission des forces, de l’affinité ?
On conviendra peut-être que la laine et le blé sont le produit du travail. Mais la houille, dira-t-on, est certainement l’ouvrage, et l’ouvrage exclusif de la nature.
Oui, la nature a fait la houille (car elle a tout fait), mais le travail en a fait la valeur. La houille n’a aucune valeur quand elle est à cent pieds sous terre. Il l’y faut aller chercher, c’est un travail ; il la faut porter sur un marché, c’est un autre travail ; et remarquez-le bien, le prix de la houille sur le marché n’est autre que le salaire de ces travaux d’extraction et de transport.
La distinction qu’on a voulu faire, entre les matières premières et les matières fabriquées, est donc futile en théorie. Comme base d’une inégale répartition de faveurs, elle serait inique en pratique, à moins que l’on ne veuille prétendre que, bien qu’elles soient toutes deux des produits du travail, l’importation des unes est plus favorable que celle des autres au développement de la richesse publique. C’est la seconde question que j’ai à examiner.
2° Y a-t-il plus d’avantage pour une nation à importer des matières dites premières, que des objets fabriqués ?
J’ai ici à combattre une opinion fort accréditée.
« Plus les matières premières sont abondantes, dit la pétition de Bordeaux, plus les manufactures se multiplient et prennent d’essor. » — « Les matières premières, dit-elle ailleurs, laissent une étendue sans limites à l’œuvre des habitants du pays où elles sont importées. » — « Les matières premières, dit la pétition du Havre, étant les éléments du travail, il faut les soumettre à un régime différent et les admettre de suite au taux le plus faible [1]. » — « Entre autres articles dont le bas prix et l’abondance sont une nécessité, dit la pétition de Lyon, les fabricants citent toutes les matières premières. »
Sans doute, il est avantageux pour une nation que les matières dites premières soient abondantes et à bas prix ; et, je vous prie, serait-il avantageux pour elle que les objets fabriqués fussent chers et rares ? Pour les unes comme pour les autres, il faut que cette abondance, ce bon marché soient le fruit de la liberté, ou que cette rareté, cette cherté soient le fruit du monopole. Ce qui est souverainement absurde et inique, c’est de vouloir que l’abondance des unes soit due à la liberté et la rareté des autres au privilége.
L’on insistera encore, j’en suis sûr, et l’on dira que les droits protecteurs du travail des fabriques sont réclamés dans l’intérêt général ; qu’importer des articles auxquels le travail n’a plus rien à faire, c’est perdre tout le profit de la main-d’œuvre, etc., etc.
Remarquez sur quel terrain les pétitionnaires sont amenés. N’est-ce pas le terrain du régime prohibitif ? M. de Saint-Cricq ne peut-il pas opposer un argument semblable à l’introduction des blés, des laines, des houilles, de toutes les matières enfin qui sont, nous l’avons vu, le produit du travail ?
Réfuter ce dernier argument, prouver que l’importation du travail étranger ne nuit pas au travail national, c’est donc démontrer que le régime de la concurrence ne convient pas moins aux objets fabriqués qu’aux matières premières. C’est la troisième question que je m’étais proposée.
Qu’il me soit permis, pour abréger, de réduire cette démonstration à un exemple qui les comprend tous.
Un Anglais peut importer une livre de laine en France, sous plusieurs formes : en toison, en fil, en drap, en vêtement ; mais, dans tous ces cas, il n’importera pas une égale quantité de valeur, ou, si l’on veut, de travail. Supposons que cette livre de laine vaille 3 francs brute, 6 francs en fil, 12 francs en drap, 24 francs confectionnée en vêtement. Supposons encore que, sous quelque forme que l’introduction s’opère, le payement se fasse en vin ; car, après tout, il faut qu’il se fasse en quelque chose ; et rien n’empêche de supposer que ce sera en vin.
Si l’Anglais importe la laine brute, nous exporterons pour 3 francs de vin ; nous en exporterons pour 6 francs, si la laine arrive en fil ; pour 12 francs, si elle arrive en drap ; et enfin pour 24 francs, si elle arrive sous forme de vêtement. Dans ce dernier cas, le filateur, le fabricant, le tailleur auront été privés d’un travail et d’un bénéfice, je le sais ; une branche de travail national aura été découragée d’autant, je le sais encore ; mais une autre branche de travail également national, la viniculture, aura été encouragée précisément dans la même proportion. Et comme la laine anglaise ne peut arriver en France sous forme de vêtement qu’autant que tous les industrieux qui l’ont amenée à cet état seront supérieurs aux industrieux français, en définitive, le consommateur du vêtement aura réalisé un bénéfice qui pourra être considéré comme un profit net, tant pour lui que pour la nation.
Changez la nature des objets, leur appréciation, leur provenance, mais raisonnez juste, et le résultat sera toujours le même.
Je sais qu’on me dira que le payement a pu se faire non en vin, mais en numéraire. Je ferai observer que cette objection se tournerait aussi bien contre l’introduction d’une matière première que contre celle d’une matière fabriquée. J’ai d’ailleurs la certitude qu’elle ne me sera faite par aucun négociant digne de l’être. Quant aux autres, je me bornerai à leur faire observer que le numéraire est un produit indigène ou un produit exotique. Si c’est un produit indigène, nous n’en pouvons rien faire de mieux que de l’exporter. S’il est exotique, il a fallu le payer avec du travail national. Si nous l’avons acquis du Mexique, avec du vin par exemple, et que nous l’échangions ensuite contre un vêtement anglais, le résultat est toujours du vin changé contre un vêtement, et nous rentrons entièrement dans l’exemple précédent.
§ 3. Le projet des pétitionnaires est un système de priviléges réclamés par le commerce et l’industrie, contre l’agriculture et le public.
Que le projet des pétitionnaires crée d’injustes faveurs au profit des manufacturiers, c’est, je crois, un fait dont les preuves seraient maintenant surabondantes.
Mais on ne voit pas sans doute aussi bien comment il octroie aussi des priviléges au commerce. Examinons.
Toutes choses égales d’ailleurs, il est avantageux pour le public que les matières premières soient mises en œuvre sur le lieu même de leur production.
C’est pour cela que si l’on veut consommer à Paris de l’eau-de-vie d’Armagnac, c’est en Armagnac, non à Paris, que se brûle le vin.
Il ne serait pourtant pas impossible qu’il se rencontrât un commissionnaire de roulage qui aimât mieux transporter huit pièces de vin qu’une pièce d’eau-de-vie.
Il ne serait pas impossible non plus qu’il se rencontrât à Paris un bouilleur qui préférât l’importation de la matière première à celle de la matière fabriquée.
Il ne serait pas impossible, si cela était du domaine de la protection, que nos deux industrieux s’entendissent pour demander que le vin entrât librement dans la capitale, mais que l’eau-de-vie fût chargée de forts droits.
Il ne serait pas impossible qu’en s’adressant au protecteur, pour mieux cacher leurs vues égoïstes, le voiturier ne parlât que des intérêts du bouilleur, et le bouilleur que des intérêts du voiturier.
Il ne serait pas impossible que le protecteur vît dans ce plan l’occasion de conquérir une industrie pour Paris, et de se donner de l’importance.
Enfin, et malheureusement, il ne serait pas impossible que le bon public parisien ne vît dans tout cela que les vues larges des protégés et du protecteur, et qu’il oubliât qu’en définitive, c’est sur lui que retombent toujours les frais et les faux frais de la protection.
Qui voudra croire que c’est un résultat analogue, un système parfaitement identique, organisé sur une grande échelle, auquel, après un grand fracas de doctrines généreuses et libérales, concluent, d’un commun accord, les pétitionnaires de Bordeaux, de Lyon et du Havre ?
« C’est principalement dans cette seconde classe (celle qui comprend les matières vierges de tout travail humain), que se trouve, disent les pétitionnaires de Bordeaux, le principal aliment de notre marine marchande… En principe, une sage économie exigerait que cette classe, ainsi que la première, ne fût pas imposée… La troisième, on peut la charger ; la quatrième, nous la considérons comme la plus imposable. »
« Considérant, disent les pétitionnaires du Havre, qu’il est indispensable de réduire de suite, au taux le plus bas, les matières premières, afin que l’industrie puisse successivement mettre en œuvre les forces navales qui lui fourniront ses premiers et indispensables moyens de travail… »
Les manufacturiers ne pouvaient demeurer en reste de politesse envers les armateurs. Aussi la pétition de Lyon demande la libre introduction des matières premières, pour prouver, y est-il dit, « que les intérêts des villes manufacturières ne sont pas toujours opposés à ceux des villes maritimes. »
Ne semble-t-il pas entendre le voiturier parisien, dont je parlais tout à l’heure, formuler ainsi sa requête : « Considérant que le vin est le principal aliment de mes transports ; qu’en principe on ne devrait pas l’imposer ; que quant à l’eau-de-vie on peut la charger ; considérant qu’il est indispensable de réduire de suite le vin au taux le plus bas, afin que le bouilleur mette en œuvre mes voitures qui lui fourniront le premier et indispensable aliment de son travail… » et le bouilleur demander la libre importation du vin à Paris, et l’exclusion de l’eau-de-vie, pour prouver « que les intérêts des bouilleurs ne sont pas toujours opposés à ceux des voituriers. »
En me résumant, quels seront les résultats du système proposé ? Les voici :
C’est au prix de la concurrence que nous, agriculteurs, vendrons aux manufacturiers nos matières premières. C’est au prix du monopole que nous les leur rachèterons.
Que si nous travaillons dans des circonstances plus défavorables que les étrangers, tant pis pour nous ; au nom de la liberté, on nous condamne.
Mais si les fabricants sont plus malhabiles que les étrangers, tant pis pour nous ; au nom du privilége, on nous condamne encore.
Que si l’on apprend à raffiner le sucre dans l’Inde, ou à tisser le coton aux États-Unis, c’est le sucre brut et le coton en laine qu’on fera voyager pour mettre en œuvre nos forces navales ; et nous, consommateurs, payerons l’inutile transport des résidus.
Espérons que, par le même motif et pour fournir aux bûcherons le premier et l’indispensable aliment de leur travail, on fera venir les sapins de Russie avec leurs branches et leur écorce. Espérons qu’on fera voyager l’or du Mexique à l’état de minerai. Espérons que pour avoir les cuirs de Buénos-Ayres on fera naviguer des troupeaux de bœufs.
On n’en viendra pas là, dira-t-on. Ce serait pourtant rationnel ; mais l’inconséquence est la limite de l’absurdité.
Un grand nombre de personnes, j’en suis convaincu, ont
adopté de bonne foi les doctrines du régime prohibitif (et
certes ce qui se passe n’est guère propre à changer leur conviction). Je n’en suis point surpris ; mais ce qui me surprend, c’est que, quand on les a adoptées sur un point, on ne les adopte pas sur tous, car l’erreur a aussi sa logique ; et quant à moi, malgré tous mes efforts, je n’ai pu découvrir une objection quelconque que l’on puisse opposer au régime de l’exclusion absolue, qui ne s’oppose avec autant de justesse au système pratique des pétitionnaires.
FN:La même pétition veut que la protection des objets fabriqués soit réduite, non de suite, mais dans un temps indéterminé ; non au taux le plus faible, mais au taux de 20 pour 100.
Lettre à un ami non identifié pour la défense d’un refugié (sept. 1835)[16] ↩
BWV
1835.09 “Lettre à un ami non identifié pour la défense d’un refugié” (Letter to an unidentified Friend in Defence of a Refugee)[Sept. 1835] [JCPD]
Mon cher Charles,
Je ne cherche pas à t'exprimer ma reconnaissance pour l'empressement et le bonheur avec lequel tu prends sous ta protection les malheureux polonais que je te recommande. Ta dernière lettre a fait un heureux, d'autant plus qu'on ne s'attendait pas à un succès aussi prompt et aussi complet.
J'ai cru préférable de t'adresser la pétition de M. Michalewsky.J'y ai joint un certificat du maire de St-Sever et un autre de l'ingénieur de l'arrondissement. L'ingénieur en chef voulait m'en donner un aussi, mais c'est par un malentendu qu'il ne se trouve pas ci-inclus. Je te le procurerais si cela était nécessaire, mais je pense que ceux-ci suffiront. M. Michalewsky en a plusieurs entre les mains, des diverses villes qu'il a habitées et du professeur de mathématiques du collège de St-Sever. Je pense qu'il valait autant qu'il en fut porteur lui-même. La place qu'il occupait ici, il l'avait obtenue à la recommandation expressedu Directeur Général des Ponts et Chaussées. Quant aux démarches dont tu me parles dans le commencement de ta lettre, je t'en remercie comme si elles avaient été couronnées de succès. Je n'y ai personnellement aucun intérêt. Je désire que M. Durrieu n'ait pas été abusé.
Ici, on te fait tantôt conseiller à la cour royale de Paris, tantôt procureur général en Province. N'ayant rien vu de cela dans les journaux, je présume que ces bruits sont prématurés. Cependant, le procès étant terminé, j'espère que ta position ne tardera pas à être fixée.
Je reviens à mon Polonais. Il désirerait, comme tu le penses, rester le moins longtemps possible dans l'incertitude. En arrivant à Paris, il aura à se loger, à se préparer pour l'examen qui a lieu le 5 septembre. Le voyageest un peu long et toutes ces considérations te décideront, j'espère, à profiter immédiatement des dispositions bienveillantes de M. de Gasparini.
Tu ne me dis rien de nos réclamations portugaises. Ton père, qui a été à Paris, néglige aussi de me parler du procès Arias-Quivigne. La bonté de notre cause, me parait aussi claire que la lumière du jour, il me tarde d'en voir la fin.
Adieu, mon cher Charles. J'écris fort à la hâte parce que je ressens quelques atteintes de fièvre qui m'auront désolé ces trois dernières années. Mais je prendrai toujours le temps de t'assurer de ma sincère amitié et dans cette occasion, de ma vive reconnaissance.
Ton ami
Frédéric Bastiat.
Mugron le 1er Septembre 1835.
Canal latéral à l'Adour (18 juin - 20 août 1837) ↩
BWV
1837.06.18 “Canal latéral à l'Adour” (The Canal beside the Ardour) [5 articles] (18 juin 1837 - 20 août 1837, *La Chalosse*, no. 28-37) [JCPD]
LE CANAL LATERALAL'ADOUR.
PREMIER ARTICLE.
Nous nous proposons de soumettre aux lecteurs de la Chalosse quelques réflexions sur le Canal parallèle à l'Adour, dont le gouvernement vient d'ordonner les études. Mais il nous a paru utile de consacrer ce premier article à l'exposé des faits qui ont amené cette décision.
Il y a quelques années que MM. les Ingénieurs du département des Landes présentèrent un plan relatif à la navigation de l’Adour.
Ce plan consistait à améliorer ou à encaisser par des épis clayonnés : 1°. le lit du Bas-Adour jusqu'à l'embouchure de la Midouze ; 2°. celui de la Midouze jusqu'à Mont-de-Marsan; 3°. celui du Haut-Adour jusqu'à Mugron et éventuellement jusqu'à St. Sever.
Toutefois, quand à cette dernière partie du projet, MM. les Ingénieurs signalaient des difficultés sérieuses et n'annonçaient que des résultats incertains.
C'est cette considération, sans doute, qui décida le gouvernement et les chambres à ne s'occuper que du Bas-Adour et de la Midouze, à l'amélioration desquelles une somme de 900.000 fr. fut affectée.
Cette décision excita les réclamations des riverains du Haut-Adour. Ils se souvenaient que la navigabilité du fleuve avait fait autrefois la prospérité de leurs ancêtres, et il était naturel qu'ils ne la vissent pas sans douleur sur le point d'être abandonnée.
Cependant M. Durrieu, organe des doléances de ses commettants, parvint à les faire écouter. Le gouvernement accorda soixante mille fr. pour corriger les plus mauvaises passes du Haut-Adour entre le Hourquet et Mugron seulement, et encore avec cette réserve que dix mille fr. seraient préalablement consacrés à des essais. En même temps il chargea M. de Baudre, inspecteur divisionnaire au corps royal des ponts-et-chaussées, de visiter les lieux et de lui faire un rapport sur l'opinion controversée des ingénieurs et des réclamants.
Malheureusement les rapports de M. de Baudre abondèrent dans le sens de ceux de MM. les Ingénieurs. Ils nous furent même plus défavorables; car à l'aspect de la pente rapide du fleuve, des énormes bancs de gravier qu'il charrie, et de ses rives dépourvues de berges auxquelles on puisse rattacher les travaux, il se prononça non seulement contre les améliorations projetées, mais encore contre les essais qui étaient alors en cours d'exécution.
Et cependant, fallait-il abandonner définitivement le bassin du Haut-Adour, de ce pays qu'avait enrichi une navigation qui remontait autrefois jusqu'à Aire, plus tard jusqu'à Grenade, récemment jusqu'a St. Sever, et qu'on n'espérait plus aujourd’hui maintenir jusqu'à Mugron : MM. de Baudre et de Silguy ne pouvaient avoir une telle pensée.
Certes, il eut été moins malheureux pour le bassin du Haut-Adour, de n'avoir jamais eu de voie navigable que de la voir s'éteindre ainsi de siècle en siècle pour lui manquer complètement de nos jours.
Car il est pour les peuples un malheur plus grand que celui de manquer de débouchés : c'est celui de perdre ceux qu'ils possèdent de temps immémorial. Dans le premier cas, une population s'arrange; elle produit peu, mais cherche à pourvoir à tous ses besoins. Mais quand la facilité d'échanger l'a déterminée à étendre indéfiniment un nombre très restreint d'industries il est aisé de comprendre que si ses débouchés viennent à lui manquer, elle est soumise à d'horribles souffrances, privée qu'elle se trouve des objets les plus indispensables, en même temps que ses productions n'ont aucune valeur ni pour la consommation locale ni pour l'échange.
Telle est justement la situation de la Chalosse, qui, par ce motif, et par d'autres raisons étrangères au but de cet article, subit toutes les douleurs d'une décadence d'autant plus effrayante qu'aucune espérance ne lui en montre le terme.
Une pensée se présentait naturellement : si l'on ne peut améliorer le lit du Haut Adour, ou peut du moins se servir de ses eaux pour alimenter un Canal parallèle.
Cette pensée avait jailli pour la première fois de l'âme patriotique de l'illustre général Lamarque, qui l'avait développée dans un mémoire où l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer des vues de l'habile administrateur, des prévisions du grand capitaine ou des talents du brillant écrivain.
Bientôt elle prit dans les projets de M. Calabert ces proportions colossales qui ont éveillé tant d'espérances et trouvé si peu de concours.
Le célèbre ingénieur Brisson la réduisit à une échelle moins gigantesque,mais assez vaste encore pour mesurer plutôt des projets que des réalités.
Enfin. M. de Silguy, ingénieur en chef du département des Landes, l'a transformée en un plan qui a le mérite d'être facilement et immédiatement exécutable, sans exclure pour l'avenir la réalisation de plus vastes conceptions, puisqu'il est à la fois un système complet et le commencement du système gigantesque de ses prédécesseurs.
Le pian de cet ingénieur consiste à ouvrir un Canal de navigation et d'irrigation latéral à l'Adour depuis le point où ce fleuve, revoit l'Arros jusqu'à celui où sa navigation est assurée par l'allocation des 900.000 fr. dont il a été déjà parlé.
C'est ce projet, favorablement accueilli par le Conseil-Général des Landes dont l'étude vient d'être ordonnée.
DEUXIEME ARTICLE.
Tonte entreprise industrielle s'apprécie par la comparaison de la dépense qu'elle occasionne avec les avantages qu'elle produit. Nous pensons qu'il ne sera pas inutile, avant de rechercher quels sont les bienfaits que le pays doit attendre du Canal parallèle à l'Adour, d'appeler l'attention du lecteur sur les frais probables de cette opération.
Il est vrai qu'il est impossible de fixer en ce moment aucun chiffre de dépense. C'est là un inconnu qu'il est réservé à des études préalables de dégager, et le gouvernement ne les a ordonnées que très récemment.
Si nous abordons cependant cette question, c'estqu'elle en soulève une autre d'une haute importance, qui intéresse spécialement la Chalosse et dont la solution nous parait devoir servir de règle, même aux études qui se préparent en cemoment.
Nous avons dit dans l'article précédent qu'il s'agissait d'un Canal de navigation et d'irrigation. Certainement l'irrigation est à nos yeux une condition essentielle du projet ; c'est elle qui en rend l'exécution possible en assurant des revenus aux entrepreneurs, et nous essaierons prochainement de prouver qu'elle déterminera une révolution complète dans notre système agricole.
Mais plus les bienfaits de l'irrigation sont évidents, plus nous craignons que le génie des ponts-et-chaussées ne se laisse entrainer à les vouloir répandre avec trop de profusion.
A-t-on le projet de s'éloigner beaucoup de l'Adour? C’est là une question grave, qu'il appartient à l'opinion publique de mûrir.
S'éloigner beaucoup, c'est soumettre une plus vaste étendue de terre à l'irrigation, mais c'est aussi accroître indéfiniment la dépense, puisque, pour contenir unvolumed'eau plus considérable, le Canal devra s'exécuter sur de plus grandes dimensions.
S'éloigner peu, c'est restreindre le bienfait de l'irrigation mais c'est aussi restreindre la dépense.
Nous n'hésitons pas à donner la préférence à ce dernier système, parce que nous sommes bien convaincus que tout projet qui exigerait des capitaux considérables serait destiné à être enfoui pour toujours dans les cartons de 1' administration.
L'éloignement du Canal de l'Adour aurait encore l'inconvénient immense de brusquer toutes les habitudes du pays, et de déplacer violemment, si j'ose m'exprimer ainsi, tout le courant des transactions qui s'y exécutent. Il ne faut pas perdre de vue que le Canai est destiné à remplacer, en l'agrandissant, la navigation de l'Adour, dont les populations riveraines étaient en possession de temps immémorial. C'est l'impossibilité d'améliorer le lit du fleuve qui a fait naître l'idée de pratiquer une voie d'eau parallèle. Priver de cette navigation les entrepôts naturels de la Chalosse : Aire, Grenade, St. Sever, Mugron, ce serait s'écarter entièrement du but qu'on s'est proposé.
Nous reviendrons plus tard sur ce sujet; mais nous avons dû nous hâter de consigner ici ces réflexions, parce qu'on nous a fait craindre que les idées, autrefois fort modestes, de l'ingénieur qui a été chargé de la direction des études, aient pris un nouvel essor, depuis que le gouvernement a témoigné quelque intérêt à cette entreprise.
Jadis on parlait d'un Canal de petite navigation. Ses dimensions devaient être très restreintes ; il ne devait fournir l'irrigation qu'à une étendue de terre assez circonscrite, et par une conséquence forcée, il devait se maintenir à peu de distance de l'Adour. Nous croyons mêmesavoir qu'on évaluait approximativement la dépense à trais millions.
Nous engageons M. de Silguy à persister dans ce projet, et à se délier de ce désir secret qui porte tout homme distingué à attacher son nom à une œuvre monumentale. Nous le répétons, un Canal trop éloigné de l'Adour ne ferait beaucoup de bien qu'après avoir fait beaucoup de mal et, ce qui tranche la question, il serait inexécutable.
Quant au chiffre de trois millions dont nous avons parlé, on sent bien qu'en l'absence d'études préalables, il ne peut être qu'approximatif, toujours dans la supposition qu'on ne selaissera point entraîner à de vastes conceptions.
Mais sil'on ne peut fixer encore le chiffre précis de la dépense. onpeut du moins pressentir s'il dépassera la moyenne de ce qu'ont coûté en France les canaux de petite navigation, ou s'il restera au-dessous. Il suffit pour cela d'examiner si le pays qu'il s'agit de traverser doit être rangé parmi ceux qui offrent le plus de difficultés, ou ceux qui en présentent le moins.
Or, entre Plaisance et le Hourquet, il ne se rencontre aucun obstacle sérieux.
Il n'y a point d'eau à aller chercher au loin; point de réservoir à construire; point de montagnes à percer, de vallées à combler, de rivières à franchir; presque pas da routes à traverser,
Les matériaux abondent sur toute la ligne.
Les terrains, la main-d’œuvre et les transports s'obtiendront à un prix le plus modéré.
Enfin, le sol est de la nature la plus favorable à la conservation des eaux.
M. de Brisson établit que les canaux depetite navigation ont coûté, en moyenne, 57,000 fr. par kilomètre, et 15,000 fr. par mètre de hauteur de chute.
D'après ces bases, le Canal latéral à l'Adour reviendrait, à :
72 kilomètres à 57.000 fr
4,104,000 fr
7 m. haut. de chute, à 15,000 fr
105,000 fr
Total
4,209,000 fr
D'après ce que nous avons dit de l'absence de difficultés sur toute la ligne à traverser, nous sommes donc autorisés à espérer que le chiffre de trois millions se rapproche beaucoup de la vérité.
TROISIEME ARTICLE.
Il n'existe que trois sources directes de richesse : l'agriculture, la fabrication et le commerce. Créer des matières premières, leur faire subir des changements de forme et de lieu, tel est à peu près le cercle de toute activité industrielle.
D'un autre côté, il n'existe aucun agent plus propre que l'eau à exercer une favorable influence sur chacune de ces trois branches de prospérité nationale.
Car on ne saurait doter l'agriculture d'un amendement plus durable que l'irrigation, les fabriques de moteurs plus économiques que les chutes d'eau, le commerce de véhicule plus puissant que les voies navigables.
Produire n'est pas la seule fonction de la société; son intérêt et son devoir sont encore de conserver et de défendre ses produits.
On pourrait donc considérer le Canal latéral à l'Adour sous le point de vue agricole, industriel et militaire.
La plupart de ces questions ont été traitées par le général Lamarque avec une supériorité qui doit imposer silence à ses successeurs. Je ne m'en occuperai donc pas.
Je demande seulement qu'il me soit permis d'appeler l'attention des lecteurs de la Chalosse sur l'irrigation. C'est là, à mon sens, la conception capitale de M. de Silguy; et ce sujet, d'ailleurs, me fournira l'occasion de signaler quelques aperçus, sinon entièrement neufs, du moins assez généralement dédaignés ou négligés.
Pour avoir une idée de l'importance des eaux en agriculture, il suffit de comparer la valeur et la force productive de deux hectares de terre, placés d'ailleurs dans les mêmes circonstances, mais dont l'un seulement serait soumis à l'irrigation. Il est notoire en tous pays que la différence irait du simple au double.
Cependant on se tromperait beaucoup si l'on jugeait par l'irrigation ainsi circonscrite, de ce qu'elle peut lorsqu'elle est exécutée sur une grande échelle et fournie à tout unpays.
Dans le premier cas, on ne peut apprécier que l'influence directe des eaux; dans le second, outre ce résultat immédiat, il se produit une série d'effets qui s'engendrent les uns les autres, et dont quelques- uns ont peut-être plus d'importance intrinsèque que celui même qui leur a donné naissance. On va en juger.
Une contrée non arrosée (surtout si elle est exposée à l'influence d'un soleil ardent) renferme toujours peu de prairies, et est par conséquent pauvreen fourrages, en bestiaux et enfin en engrais. De là cette conséquence qu'elle doit présenter pour la dépaissance des bestiaux et pour la production des engrais végétaux, une proportion considérable de terres vagues, et avoir recours à la jachère. Voilàdéjà une perte immense de valeur territoriale. Il s'y ajoute nécessairement une déperdition non moins considérable de forces industrielles, pour la garde des troupeaux, l'entretien des clôtures, le transport d'énormes masses d'engrais végétaux, les sarclages réitérés, etc. que si cette contrée vient àrecevoir l'irrigation.
Les prairies se multiplient, et avec elles les bestiaux et les engrais ; les bonnes terres s’améliorent, les terres vagues se défrichent sous la triple influence des eaux, des engrais etdes assolements. Les frais de culture diminuent relativement aux produits; le sol gagne eu valeur et en fertilité; la population en nombre et en bien-être.
Tels sont les effets généraux de l'irrigation. Il en est d'autres qui se feraient sentir plus particulièrement sur les domaines des rives de l'Adour, à cause de leur situation exceptionnelle que je dois faire connaitre.
La rive droite de l'Adour offre d'abord une lisière de bonnes terres provenant des alluvions du fleuve. Derrière ces alluvions s'étendent de vastes landes. Le plus généralement ces deux natures de terrains sont séparées par des marais que forment les eaux de pluie, qui tombées sur les landes, sont empêchées par le bourrelet des alluvions de se dégorger dans le fleuve.
Le plus grand nombre des domaines se compose de ces trois natures de sol en diverses proportions.
Le mode de culture est indiqué aux habitants par cette composition des propriétés combinée avec la chaleur du climat et la nature siliceuse des terres.
On fait produire aux bonnes terres le plus qu'on peut de céréales. A ce régime elles seraient bientôt épuisées et envahies par les plantes parasites; mais on obvie au premier inconvénient par le transport d'énormes masses de terreaux enlevés à la superficie des landes, et au second par le sarclage ou la jachère.
Une culture aussi simple et fondée exclusivement sur un travail manuel, pouvait être et a été en effet abandonnée au métayage.
Décrire ici toutes les funestes conséquences du métayage, ce serait enter article sur article. Je me bornerai à les signaler sous une forme très générale, laissant au lecteur le soin de faire les applications.
Pour faire de la bonne agriculture, comme pour bien faire quoi que ce soit, il faut le concours de trois choses : le vouloir, le savoir et le pouvoir.
La volonté est nécessairement peu énergique chez les métayers, car toute dépense d'efforts au-delà de ceux qui sont rigoureusement indispensables est une mise dont la charge retomberait exclusivement sur eux, et dont le résultat profiterait pour moitié à un autre.
Pour la science il serait absurde de la chercher dans une classe d'hommes à qui tout manque, même la volonté.
La puissance fait également défaut à l'agriculture métayère. Le maitre seul pourrait confier quelques capitaux à la terre; mais il raisonne, pour les avances comme le métayer pour le travail, et il sent bien qu'il ne lui rentrerait que la moitié du profit des améliorations dont la dépense aurait été en entier par lui supportée.
Ainsi toute agriculture livrée au métayage est par ce seul fait apathique, routinière et misérable.
Si nous reportons nos regards de l'œuvre à l'ouvrier, nous ne serons pas frappés d'un spectacle moins déplorable.
Une culture uniforme explique une nourriture uniforme : du pain et de l'eau et quelques salaisons, tel est le régime alimentairedu paysan landais.
Le vêtement n'est pas plus confortable dans un pays où manquent les matières premières et les moyens de fabrication.
Il suffit, pour se faire une idée des habitations, de se rappeler qu'elles sont à la charge exclusive du propriétaire, qui ne s'en sert pas.
Enfin, cette population mal nourrie, mal vêtue, mal logée, est encore décimée par les fièvres endémiques que les marais engendrent et fixent dans le pays.
J'achèverais ce triste tableau, si j'y ajoutais la peinture de l'état intellectuel et moral de cette classe malheureuse ; mais cela m'éloignerait trop de mon sujet.
Je résume donc ainsi, dans l'ordre de leur génération, les obstacles qui, sur la rive droite de l'Adour, s'opposent au progrès de l'agriculture et au bien-être des habitants :
Soleil brillant, sol aride.
Manque nécessaire de prairies, de bestiaux et d'engrais
Proportion immense de terres incultes. Culture épuisante et dispendieuse des terres d'alluvion.
Métayage; absence d'énergie, d'intelligence et de capitaux.
Population mal nourrie, mal vêtue, mal logée, dévorée de maladies périodiques.
Un Canal d'irrigation changerait ce triste tableau.
QUATRIÈME ARTICLE.
Jusqu'ici je n'ai considéré le Canal latéral à l'Adour que dans ses rapports avec la rive droite de ce fleuve.
En essayant de prouver qu'il favoriserait à la fois l'industrie par les chutes d'eau, le commerce par la navigation, et l'agriculture par l'irrigation, j'ai voulu le montrer, si je puis m'exprimer ainsi, comme un moteur immense et multiple, occupant tout le diamètre de notre pays, pour donner une impulsion puissante à l'ensemble des travaux qui s'y exécutent.
I1 me reste à considérer ses effets sur la rive gauche de l'Adour ou sur la Chalosse. Et d'abord il serait difficile de comprendre comment tous les genres de travaux pourraient recevoir autour de nous un développement considérable sans que nous prissions une part quelconque dans cet accroissement de bien-être et de prospérité.
Cependant, sans précisément contester les avantages généraux du Canal, quelques bons esprits ont manifesté la crainte qu'il ne fût plus nuisible qu'utile aux intérêts spéciaux de la Chalosse. « Créer une voie de communication, ont-ils dit, qui mette nos vignobles en rapport avec le Madiran, c'est les soumettre à une concurrence ruineuse ».
La crainte de la concurrence est l'éternel obstacle où vient trébucher toute amélioration. Si elle dominait la question de la navigation de l'Adour, je le demande, où devrait-elle commencer? Grenade prouverait que la concurrence d'Aire est redoutable et que la navigabilité du fleuve est un fléau si les bateaux dépassent la porte de ses chais. St. Sever opposerait le même raisonnement à Grenade; Mugron à St. Sever; Laurède à Mugron ; et si une telle argumentation est absurde de commune à commune, je ne puis découvrir comment elle devient concluante de province à province.
Étrange contradiction! Nous voulons des routes et nous ne voulons pas des canaux qui ne sont que des routes perfectionnées. Cependant, la facilité des transactions est utile ou funeste. Dans le premier cas, il faut accueillir les canaux, dans le second il faut repousser les routes. Si la concurrence est une chose mauvaise en soi, isoler les empires, les provinces, les communes doit être le but et le résultat de toute civilisation.
Du reste, il ne faut point être surpris des craintes, même exagérées, de la Chalosse. Le mouvement de décadence qui l'entraîne est si rapide, qu'il faut respecter jusqu’à ses frayeurs, comme celles d'un malade que des dangers réels rendent timide aux dangers imaginaires.
Deux intérêts, ce me semble, doivent occuper la Chalosse : conquérir des débouchés à ses vins ; améliorer toutes ses autres sources de revenus.
Pour savoir si le Canal doit être utile ou funeste à l'écoulement- de ses vins, il faut rechercher les causes qui ont suspendu cet écoulement, et lorsqu'on s'occupe de cette recherche, on s'aperçoit qu'elles existent presque toutes dans une région où le Canal ne saurait les atteindre. Ce n'est pas en perfectionnant nos moyens de transport que nous parviendrons à modifier le régime prohibitif, les mille entraves de la contribution indirecte, les mille barrières de l'octroi, et le goût des consommateurs qui parait être fixé sur les vins rouges.
Mais parmi les causes de notre détresse, il en est une qui sera inévitablement affectée par la création d'un Canal parallèle à l'Adour, c'est la concurrence. Il nous importe donc d'examiner ce qui a pu amener cette concurrence, quel avenir elle nous prépare et comment elle pourra être modifiée par le Canal qui nous occupe.
Deux faits principaux me paraissent rendre la concurrence effrayante pour le présent, et surtout pour l'avenir de mon pays: la facilité des communications et la culture à bœufs.
Les personnes auxquelles je m'adresse n'ignorent pas que nous rencontrons sur les places de Dax et de Bayonne bien d'autres rivalités que celle du Madiran. Le Bordelais, la Saintonge, le Languedoc, la province de Salies, et jusqu'à l'Ile de Ré en ont récemment chassé nos produits. Comment des vins viennent-ils de si loin envahir nos entrepôts naturels? Parce que nous vivons dans un temps oùles transports s'opèrent à bon marché, et parce qu'aussi nous employons la culture à bras qui est très dispendieuse.
Et s'il en est ainsi, nos maux touchent-ils à leur terme ? Bien s'en faut. De toutes parts se préparent des moyens de transport bien autrement énergiques que ceux qui nous ont amené ces redoutables rivaux. Le moment approche où les distances vont disparaitre, et où le bénéfice de la proximité pourra être compté pour rien, où des canaux et des chemins de fer entraîneront les corps les plus lourds du nord au midi et du midi au nord, du centre à la circonférence et de la circonférence au centre, avec une économie prodigieuse. Que cela soit un bien ou un mal, peu importe; le monde marche, et nos plaintes ne l'arrêteront pas. Mais que ferons-nous alors devant cette effrayante concurrence, nous qui nous plaignons déjà qu'elle nous tue ? Comment nous défendrons-nous avec notre isolement et notre culture miteuse ? C'est là, ce me semble, ce qui devrait occuper les esprits sérieux, et non le calcul minutieux du tort que peut nous faire la concurrence du Madiran.
Après avoir mis sous les yeux des propriétaires de vignes l'avenir qui les attend, je dois dire comment il peut être modifié par le Canal latéral.
Ce qui a déterminé et fixé la culture à bras en Chalosse, c'est la cherté de la culture à bœufs, cherté qui s'explique par la stérilité des ressources de notre département pour l'élevage et pour l'entretien des bestiaux. Il nous faudrait donc renoncer à tout jamais à lutter, à armes égales, avec nos rivaux, si, nous attachant aveuglément au statu quò, nous repoussions les innovations qui peuvent mettre à notre portée cette culture économique qu'ils ont généralement adoptée. Or, quoi de plus propre à favoriser cette révolution, d'ailleurs imminente, qu'un Canal d'irrigation qui livrera quinze mille hectares de terres, au centre du département, à la culture à peu près exclusive des plantes fourragères.
Je n'ignore certes pas qu'une révolution dans la culture des vignes est hérissée de difficultés ; qu'un pays tout entier ne change point aisément toutes ses habitudes, et que nos prévisions à cet égard ont une physionomie fort utopique. Cependant, on ne peut contester que nous sommes entrainés vers cette révolution par des circonstances irrésistibles et qu'il n'est pas en notre pouvoir de maîtriser. Il faut nous préparer pour ces circonstances ou en être broyés ; il faut produire aux mêmes conditions que les autres ou succomber sous la concurrence. S'il nous faut nécessairement passer d'un régime à un autre ou périr, n'est-il pas sage d'accueillir avec faveur l'entreprise qui doit faciliter nette transition?
Il ne suffit pas que nous produisions au même prix que nos rivaux, il faut encore que nous ayonsles mêmes moyens de faire arriver nos produits aux foyers de la consommation. Sans doute ces routes, ces canaux qui sont des moyens de sortie pour nos vins sont des moyens d'entrée pour les vins étrangers. Les repousser par ce motif serait un acte de puérilité semblable à celle de ce gentillâtre du pays qui a fait condamner les portes de sa maison de crainte que les voleurs ne s'y introduisent.
On dit que le vin de Madiran viendra en Chalosse. Et pourquoi le vin de Chalosse n'irait-il pas en Madiran ? Les vins de Madiran ne descendent pas tous dans notre département ; la plus grande partie se répand dans le Béarn, la Bigorre, la plaine des Tarbes. On sait que ces vins supportent bien le coupage auxquels les nôtres sont éminemment propres. Il se peut donc que le Canal ouvre cette direction nouvelle à nos produits vinicoles.
Quoiqu'il en soit, il est certain du moins que ceux-ci ne peuvent que gagner à la facilité de nos transactions avec Dax et Bayonne, à l'accroissement de population et de richesses qu'il est destiné à provoquer sur tonte la ligne navigable, et qu'ainsi, considéré même sous le point de vue le plus étroit, le canal est loin de justifier les craintes qu'il a inspirées.
J’ai dit en commençant que la Chalosse avait un double intérêt, les débouchés de ses vins et l'amélioration de tous ses autres moyens d'existence. Quoique je n'aie fait qu'effleurer la question des vins, l'espace me manque pour exposer les effets du Canal sur tous nos autres ordres de travaux et d'intérêts. Ce sera peut-être l'objet d'un cinquième article.
CINQUIEME ET DERNIER ARTICLE.
Pour terminer ce que j'avais à dire du Canal latéral à l'Adour, après avoir recherché son influence sur l'industrie vinicole, il me reste à le considérer dans ses rapports avec nos autres industries. Un tel sujet, si j'en abordais les détails, ne m'offrirait qu'une série de lieux communs. Qu'il me soit permis de jeter un coup d'œil d'ensemble sur l'avenir probable de la Chalosse. Les résultats se présenteront d'eux-mêmes au lecteur.
La population de la Chalosse se divise en deux classes:
1). Celle qui vit de rentes;
2). Celle qui vit de travail.
La première a joui jusqu'à nos jours d’une importance presque exclusive. Mais il est évident que cette prépondérance tend incessamment à s'affaiblir. Un mouvement constant réduit les grandes fortunes immobilières et fait passer les petits propriétaires dans les rangs de la classe laborieuse; c'est un fait incontestable, et nos campagnes sont parsemées de maisons dégradées et désertes qui attestent la disparition d'autant de familles autrefois aisées.
La classe laborieuse, au contraire, a pris à peine possession de notre pays,et déjà on peut la voir s'agrandir de toutes parts. Je ne suis pas très vieux, et cependantj'ai vu bien des boutiques envahir bien des salons; j'ai vu s'augmenter le nombre des avocats, des médecins, des avoués, des notaires; j'ai vu grandir l'innombrable famille des artisans.
Il existe donc des lois qui, réduisant sans cesse l'importance des classes oisives et accroissant celle des classes laborieuses, tendent à modifier profondément la physionomie de nos cités.
Ces lois ne sont pas difficiles à trouver. J'en citerai deux principales: les progrès du luxe et la division des héritages.
Le classe oisive a mille moyens de se ruiner ; elle n'en a qu'un de s'enrichir, qui est l'épargne. Les fortunes immobilières que dissipent la prodigalité, l'incurie et les circonstances malheureuses sont nécessairement plus nombreuses que celles qu'accroissent l'ordre et l'économie. La division des héritages travaille avec plus d'activité encore à la destruction des fortunes immobilières. Un domaine, quelque étendu qu'il soit, qui va se divisant et se sous-divisant de génération en génération, se résout bientôt en une multitude de fractions impuissantes à maintenir autant de familles dans l'oisiveté.
Si ce sont là les causes qui entrainent la décadence de la classe oisive, il est clair que cette décadence ne s'arrêterait qu'autant que les causes elles-mêmes cesseraient d'exercer leur action.
Mais il s'en faut bien qu'il en soit ainsi. Loin de rien perdre de leur énergie, il semble que ces causes puisent une énergie nouvelle dans leurs propres effets, eu sorte qu'il est rigoureusement vrai de dire que la décadence des classes oisives est soumise à la même force accélératrice que la chute des corps.
En effet, la civilisation, les voyages, les fréquentes communications des hommes entre eux introduisent pour nous de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, de nouvelles tentations, de nouvelles habitudes, de nouvelles jouissances.
Si nos pères avaient mille moyens de se ruiner, nous en avons dix mille et nos neveux en auront cent mille. Ce qui était superflu il y a cent ans est nécessaire aujourd'hui et ce qui est luxe de nos jours sera indispensable dans un siècle. Il n’y a que la part propriétaire d'un territoire borné qui soit invariable, d'où il faut conclure que la bourgeoisie oisive est destinée à disparaitre.
D'un autre côté la division des héritages est loin de suspendre son cours. Elle a reçu au contraire un nouveau degré d'activité des changements récents qu'ont éprouvé nos lois et nos mœurs. On sait qu’il y a dans l'égalité des partages une puissance qui triompherait en peu de générations des plus fortes aristocraties. Combien de temps pense-t-on que notre petite bourgeoisie pourra lui résister ?
Ainsi nous sommes irrésistiblement entrainés vers le travail. Le travail est la loi des hommes; il est le seul refuge ouvert aux habitants de la Chalosse, et on voit bien qu'ils en ont tous le sentiment confus, car tous aspirent à laisser à leurs fils une profession à défaut de rentes.
Ce sont là, sans doute, d'incontestables vérités. Mais alors, par quel étrange renversement d'idées accueillons-nous avec tant d'indifférence et souvent avec tant de défaveur ces grandes améliorations qui doivent ouvrir une immense carrière de travail à la génération qui nous presse ? Que voulons-nous donc? Qu'elle soit réduite à l'alternative de chercher du travail loin du sol qui l'a vu naître ou de mener dans son pays une vie oisive et sans dignité? On ne peut contester que le Canal latéral à l'Adour n'offre de puissants aliments à tous les genres de travaux. Il ouvrira à l'ardeur de la jeunesse actuelle une multitude de carrières agricoles, industrielles et commerciales. Une production plus active, des transactions plus multipliées ne peuvent manquer d'agrandir le cercle d'affaires des avocats, des avoués, des notaires, et des toutes les professions libérales, d'accroître l'importance de nos marchés, et de donner au travail des artisans un encouragement considérable. La prospérité de chaque classe réagit sur toutes les autres, et c'est ainsi que se développe la prospérité générale.
Compte rendu d'une brochure de F. Coudroy sur la question des duels [11 February 1838] [CW1.1.2]↩
BWV
1838.02.11 “Compte rendu d'une brochure de F. Coudroy sur la question des duels” (Revue of a Pamphlet by F. Coudroy on Dueling) [La Chalosse, 11 February 1838] [OC7.3, p. 10] [CW1]
Réflexions sur la question des duels.
Compte rendu [1]
La centralisation littéraire est portée de nos jours à un tel point en France, et la province y est si bien façonnée, qu'elle dédaigne d'avance tout ce qui ne s'imprime pas à Paris. Il semble que le talent, l’esprit, le bon sens, l’érudition, le génie ne puissent exister hors de l’enceinte de notre capitale. Aurait-on donc découvert depuis peu que le calme silencieux de nos retraites soit essentiellement nuisible à la méditation et aux travaux de l’intelligence ?
L’écrit que nous annonçons est à nos yeux une protestation éloquente contre cet aveugle préjugé. À son début, l’auteur, jeune homme ignoré et qui peut-être s’ignore lui-même, s’attaque à une de nos plus brillantes illustrations littéraires et politiques ; et cependant quiconque comparera avec impartialité le réquisitoire fameux de M. Dupin sur le duel, et les réflexions de M. Coudroy, trouvera, nous osons le dire, que sous le rapport de la saine philosophie, de la haute raison et de la chaleureuse éloquence, ce n’est point M. le procureur général qui est sorti victorieux de la lutte.
M. Coudroy examine d’abord le duel dans ses rapports avec la législation existante, et il nous semble qu’à cet égard sa réfutation de la doctrine de M. Dupin ne laisse rien à désirer. En appliquant au suicide l’argumentation par laquelle M. le procureur général a fait rentrer le duel sous l’empire de notre loi pénale, il montre d’une manière sensible que c’est une interprétation forcée, aussi antipathique au bon sens qu’à la conscience publique, qui a entraîné la Cour à assimiler le duel au meurtre volontaire et prémédité.
M. Coudroy recherche ensuite si cet arrêt ne porte point atteinte à notre constitution. Il nous semble difficile de n’être point frappé de la justesse de cet aperçu. Notre constitution, en effet, reconnaît que c’est l’opinion, par l’organe du pouvoir législatif et spécialement de la chambre élective, qui classe les actions dans la catégorie des crimes, délits et contraventions. Nul ne peut être puni pour un fait que ce pouvoir n’a pas soumis à une peine. Mais, si au lieu d’attendre que la peine s’étende à l’action, le pouvoir judiciaire peut faire plier l’action à la peine, en déclarant que cette action, jusque-là réputée innocente, n’est qu’une espèce comprise dans un genre déterminé par la loi, je ne vois pas comment on pourrait empêcher le magistrat de se substituer au législateur, et le fonctionnaire choisi par le pouvoir au mandataire élu par le peuple.
Après ces considérations, l’auteur aborde la question morale et philosophique ; et ici, il faut le dire, il comble l’immense lacune qui se laisse apercevoir dans le réquisitoire de M. Dupin. Dans son culte superstitieux pour la loi, tous les efforts de ce magistrat se bornent à prouver qu’elle entend assimiler le duel à l’assassinat. Mais quels sont les effets du duel sur la société ; quels sont les maux qu’il prévient et qu’il réprime ; quel autre remède à ces maux pourrait-on lui substituer ; quels changements faudrait-il introduire dans notre législation pour créer à l’honneur la sauvegarde des lois, à défaut de celle du courage ; comment arriverait-on à donner aux décisions juridiques la sanction de l’opinion, et à empêcher que l’octroi de dommages-intérêts ne fût pour l’offensé une seconde flétrissure ; quels résultats produirait l’affaiblissement de la sensibilité de tous les citoyens à l’honneur et à l’opinion de leurs semblables ? Ce sont autant de graves questions dont M. Dupin ne paraît point s’être mis en peine, et qui ont été traitées par notre compatriote avec une remarquable supériorité.
Parmi les considérations qui nous ont le plus frappé dans cette substantielle discussion, nous citerons le passage dans lequel l’auteur expose la raison de l’inefficacité des peines pour réprimer les atteintes à l’honneur. Dans les crimes et délits ordinaires, les tribunaux ne font que constater et punir des actions basses dont l’opinion flétrit la source impure ; la sanction judiciaire et la sanction populaire sont d’accord. Mais, en matière d’honneur, ces deux sanctions marchent en sens opposé ; et si le tribunal prononce une peine afflictive contre l’offenseur, l’opinion inflige, avec plus de rigueur encore, une peine infamante à l’offensé qui a recours à la force publique pour se faire respecter. Ces jugements de l’opinion sont si unanimes, qu’ils sont dans le cœur du magistrat lui-même, alors que sa bouche est forcée d’en prononcer de tout contraires. On sait l’histoire de ce juge, devant qui un officier se plaignait d’un soufflet reçu : « Comment, Monsieur ! s’écriait-il avec indignation, vous avez reçu un soufflet, et vous venez… mais vous faites bien, vous obéissez aux lois. »
Nous signalerons encore cette belle réfutation d’un passage de Barbeyrac cité par M. Dupin, où l’auteur nous montre comment le cercle de la pénalité humaine s’étend en raison des progrès de la civilisation, sans qu’il puisse néanmoins franchir d’une manière permanente cette limite au delà de laquelle les inconvénients de la répression dépasseraient ceux du délit. La loi elle-même a reconnu cette limite, lorsque, par exemple, elle a défendu la recherche de la paternité. Elle n’a pas prétendu qu’en dehors de sa sphère d’activité il n’y eût des actions condamnées par la religion et la morale, dont cependant elle a cru devoir s’interdire la connaissance. C’est dans cette classe qu’il faut ranger les atteintes à l’honneur.
Mais il nous est impossible de suivre l’auteur dans la carrière qu’il a parcourue ; analyser une argumentation aussi nerveuse, ce serait en détruire la force et l’enchaînement. Nous renvoyons donc à la brochure elle-même, en prévenant toutefois qu’elle exige d’être lue, comme elle a été écrite, avec conscience et réflexion. C’est la matière d’un gros livre réduite à quelques pages. Elle diffère en cela de la plupart des écrits publiés de nos jours, que dans ceux-ci le nombre des feuilles semble s’accumuler en raison du vide des idées. M. Coudroy, au contraire, est prodigue de féconds aperçus et sobre de développements. Son écrit vaut mieux par les pensées qu’il suggère que par celles qu’il exprime. C’est le cachet du vrai mérite.
Peut-être même pourrait-on reprocher à l’auteur de s’être trop restreint. On sent en le lisant qu’il y a eu lutte constante entre ses idées, qui voulaient se faire jour, et sa volonté déterminée à ne les montrer qu’à demi. Mais tout le monde ne peut pas, comme Guvier, reconstruire l’animal tout entier à la vue d’un fragment. Nous vivons dans un siècle où l’auteur doit dire au lecteur tout ce qu’il pense. — Un homme d’esprit écrivait : « Excusez la longueur de ma lettre ; je n’ai pas le temps d’être plus court. » La plupart des lecteurs ne pourraient-ils pas dire aussi : « Votre livre est trop court ; je n’ai pas le temps de le lire ? »
PP FN: Letter
« Mon cher Félix,
« À cause de la difficulté de lire, je ne puis bien juger le style ; mais ma conviction sincère (tu sais que là-dessus je mets de côté toute modestie de convenance), c'est que nos styles ont des qualités et des défauts différents. Je crois que les qualités du tien sont celles qui, lorsqu'on s'exerce, amènent le vrai talent : je veux dire un style vif, animé, avec des idées générales et des aperçus lumineux. Copie toujours sur de petits feuillets ; s'il faut en modifier quelqu'un, ce sera peu de chose. En copiant, tu pourras peut-être polir ; mais, pour moi, je remarque que le premier jet est toujours plus rapide et plus à la portée des lecteurs de nos jours, qui n'approfondissent guère.
« N'as-tu pas le témoignage de M. Dunoyer ? »
Réforme parlementaire [c. 1840] [CW1.2.3]↩
BWV
1840.?? “Réforme parlementaire” (Parliamentary Reform) [post-1840] [OC7.70, p. 289] [CW1]
Réforme parlementaire [17]
La Révolution de Juillet a placé le sol de la patrie sous un drapeau où sont inscrits ces deux mots : Liberté, Ordre.
Si l’on met de côté quelques systèmes complétement excentriques, apocalypses de nos illuminés modernes, ce qui fait le fond des désirs communs, de l’opinion générale, c’est l’aspiration vers la réalisation simultanée de ces deux biens : Liberté, Ordre. Ils comprennent en effet tout ce que les hommes ont à demander aux Gouvernements. — Les écoles excentriques dont je parlais tout à l’heure vont, il est vrai, beaucoup plus loin. Elles demandent aux Gouvernements la richesse pour tous, la moralité, l’instruction, le bien-être, le bonheur, que sais-je ? — Comme si le gouvernement était lui-même autre chose qu’un produit de la société, et comme si, loin de pouvoir lui donner la sagesse et l’instruction, il n’était pas lui-même plus ou moins sage et éclairé selon que la société a plus ou moins de vertus et de lumières.
Quoi qu’il en soit, le point sur lequel la généralité des hommes se rallie est celui-ci : admettre toute réforme qui étende la Liberté en même temps qu’elle consolide l’Ordre, — repousser toute innovation qui compromet l’un et l’autre de ces bienfaits.
Mais ce qui établit la plus grande séparation parmi les esprits, c’est la préférence ou plutôt la prééminence qu’ils accordent à la liberté ou à l’ordre. Je n’ai pas besoin de dire que je ne parle point ici des hommes qui se mettent derrière des doctrines pour satisfaire leur ambition. Ceux-là se font les apôtres de l’ordre ou de la liberté, selon qu’ils ont à gagner ou à perdre à une innovation quelconque. — Je n’ai en vue que les esprits calmes, impartiaux, qui font, après tout, l’opinion publique. — Je dis que ces esprits ont cela de commun que tous ils veulent la liberté et l’ordre ; mais ils diffèrent en ceci, que les uns se préoccupent davantage de la liberté, les autres prennent surtout souci de l’ordre.
De là dans les chambres le centre et les extrémités, de là les libéraux et les conservateurs, les progressites et ce qu’on a nommé improprement les bornes.
Remarquons en passant qu’entre les hommes consciencieux qui fixent principalement leurs yeux sur un des mots de la devise de juillet, les accusations réciproques sont véritablement puériles. Parmis les amis de la liberté, il n’en est aucun qui admît un changement dans la loi, s’il lui était démontré que ce changement dût amener le désordre dans la société, surtout d’une manière permanente. D’une autre part, au sein du parti de l’ordre, il n’est pas un homme tellement borne qu’il n’accueillît une réforme favorable au développement de la liberté, s’il était complétement rassuré sur le maintien de l’ordre, et à plus forte raison s’il pensait qu’elle aurait encore pour effet de rendre le pouvoir plus fort, plus stable, plus capable de remplir sa mission et de garantir la sécurité des personnes et des propriétés.
Si donc, parmi les Réformes, dont l’esprit public se préoccupe depuis quelques années, il en était une qui dût satisfaire à la fois à cette double condition, dont le résultat évident fut, d’une part, de faire rentrer le pouvoir dans ses attributions réelles, en arrachant de ses mains tout ce qui s’y trouve par suite d’empiétements sur les libertés publiques, et, d’autre part, de rendre à ce pouvoir ainsi borné dans son œuvre, une stabilité, une permanence, une liberté d’action, une popularité, qu’il ne connaît pas aujourd’hui, cette réforme, j’ose le dire, pourrait bien être repoussée par ceux qui profitent de l’abus qu’il s’agit de ruiner, mais elle devrait être accueillie par les hommes consciencieux sur tous les bancs de la Chambre, et, dans le public, par toutes les opinions que ces hommes représentent.
Telle est, ce me semble, la réforme parlementaire.
Pour savoir ce que la liberté et l’ordre auraient à gagner ou à risquer de cette réforme, il faut rechercher comment ils sont affectés par l’état de choses actuel.
Sous l’empire de la loi électorale qui nous régit, environ cent cinquante à deux cents fonctionnaires publics ont pénétré dans l’enceinte législative, et ce nombre peut s’augmenter encore. Nous rechercherons quelle influence il doit en résulter sur la liberté.
En outre, toujours sous l’empire de cette loi, les députés qui ne sont pas fonctionnaires et qui, à raison de leurs précédents ou de leurs engagements envers les électeurs, ne peuvent pas le devenir en s’alliant un Ministère, peuvent faire irruption dans la région du Pouvoir par une autre voie, par celle de l’opposition. — Nous rechercherons les résultats de cet état de choses par rapport à la stabilité du pouvoir, et à l’ordre social.
Nous examinerons les objections que l’on a faites contre le principe de l’incomptabilité.
Nous tâcherons enfin de proposer les bases d’une bonne loi, en tenant compte de celles de ces objectoins qui ont quelque chose de réel……
§ 1er. — De l’influence de l’admissibilité des députés aux fonctions publiques sur la liberté.
Aux yeux de la classe d’hommes qui se disent libéraux, qui sont bien loin de croire que tous les progrès de la société dans le sens de la liberté se font aux dépens de l’ordre public, qui sont au contraire convaincus que rien n’est plus propre à affermir la tranquillité, la sécurité, le respect de la propriété et des droits, que les lois qui sont conformes à la justice absolue, pour cette classe d’hommes, dis-je, la proposition que j’ai à démontrer ici semble si évidente qu’il paraît peu nécessaire d’insister beaucoup sur sa démonstration.
Quel est en effet le principe du gouvernement représentatif ? C’est que les hommes qui composent un peuple ne sont la propriété ni d’un prince, ni d’une famille, ni d’une caste, c’est qu’ils s’appartiennent à eux-mêmes ; c’est que l’administration doit se faire non point dans l’intérêt de ceux qui administrent, mais dans l’intérêt de ceux qui sont administrés ; c’est que l’argent des contribuables doit être dépensé pour l’avantage des contribuables et non pour l’avantage des agents entre qui cet argent se distribue ; c’est que les lois doivent être faites par la masse qui y est soumise et non par ceux qui les décrètent ou les appliquent.
Il suit de là que cette immense portion de la nation qui est gouvernée a le droit de surveiller la petite portion à qui le gouvernement est confié ; qu’elle a le droit de décider en quel sens, dans quelles limites, à quel prix elle veut être administrée ; d’arrêter le Pouvoir quand il usurpe des attributions qui ne sont pas de sa compétence, et cela soit directement en rejetant les lois qui organisent ces attributions, soit indirectement en refusant tout salaire aux agents par qui ces attributions malfaisantes sont exercées.
La nation en masse ne pouvant exercer ces droits, elle le fait par représentants ; elle choisit dans son sein des députés auxquels elle confie celte mission de contrôle et de surveillance.
Ne tombe-t-il pas sous le sens que ce contrôle risque de devenir complétement inefficace, si les électeurs nomment pour leurs députés les hommes mêmes qui administrent, qui gèrent, qui gouvernent, c’est-à-dire si le pouvoir et le contrôle sont livrés aux mêmes mains ?
Nos charges de toute nature dépassent 1,500 millions, et nous sommes 34 millions ; nous payons donc en moyenne chacun 45, ou par famille de cinq personnes 225 fr. Cela est certes exhorbitant. Comment en sommes-nous venus là, en temps de paix, et sous un régime, où nous sommes censés tenir les cordons de la bourse. Eh mon Dieu ! la raison en est simple ; c’est que si nous, contribuables, sommes censés tenir les cordons de la bourse, nous ne les tenons pas réellement ; nous les avons un moment entre nos doigts pour les dénouer bien bénignement, et, cela fait, nous les remettons aux mains de ceux qui y puisent. Ce qu’il y a de plaisant, c’est que nous nous étonnons ensuite de la sentir s’alléger de jour en jour. Ne ressemblons-nous pas à cette cuisinière qui, en sortant, disait au chat : Gardez bien les ortolans, et, si le chien vient, montrez-lui les griffes.
Ce que je dis de l’argent on peut le dire de la liberté ! à vrai dire, et quoique cela paraisse un peu prosaïque, argent, liberté, cela ne fait qu’un. — Développement de cette pensée……
Je me suppose roi ; je suppose qu’amené par les événements à octroyer une constitution à mon peuple, je désire cependant retenir autant d’influence et de pouvoir que possible, comment m’y prendrais-je ?
Je commencerais par dire : « On n’accordera aux députés aucune indemnité. » Et pour faire passer cet article, je ne manquerais pas de faire du sentimentalisme, de vanter la beauté morale de l’abnégation, du dévouement, du sacrifice. — Mais en réalité, je comprendrais parfaitement que les électeurs ne pourraient envoyer à la chambre que deux classes d’hommes : ceux qui possèdent une grande existence, comme dit M. Guizot, et ceux-là sont toujours disposés à se rallier à cour ; — et puis une foule de prétendants à la fortune, incapables de résister aux entraînements de la vie parisienne, aux éblouissements de la richesse, placés entre leur ruine infaillible et celle de leur famille et un essor assuré vers les hautes régions de la fortune et de la prépondérance. Je saurais bien que quelques natures privilégiées sortiraient triomphantes de l’épreuve, mais enfin, une telle disposition me permettrait d’espérer au moins une grande influence sur la formation des majorités.
Mais comment séduire ces députés? Faudra-t-il leur offrir de l’argent ? Mais d’abord, il faut le reconnaître à l’honneur de notre pays, la corruption sous cette forme est impraticable au moins sur une échelle un peu vaste ; d’ailleurs, ma liste civile n’y suffirait pas ; il est bien plus habile et plus divertissant de faire payer la corruption par ceux-là mêmes qui en souffrent, et de prendre dans la poche du public de quoi solder l’apostasie de ses défenseurs. Il suffira donc qu’une constitution porte ces deux dispositions :
Le roi nomme à toutes les places ;
Les députés peuvent arriver à toutes les places.
Il faudrait que je fusse bien malhabile ou la nature humaine bien perfectionnée si, avec ces deux bouts de charte, je n’étais pas maître du parlement.
Remarquez, en effet, combien le pas est glissant pour le député. Il ne s’agit pas ici d’une corruption abjecte, de votes formellement achetés et vendus. — Vous êtes habile, M. le député, vos discours déploient de grandes connaissances en diplomatie ; la France sera trop heureuse que vous la représentiez à Rome ou à Vienne. — Sire, je n’ai pas d’ambition ; j’aime par-dessus tout la retraite, le repos, l’indépendance. — Monsieur, on se doit à son pays. — Sire, vous m’imposez le plus rude des sacrifices. — Tout le public vous en sera reconnaissant.
Un autre est simple juge de paix de son endroit et s’en contente.
— Vraiment, monsieur, votre position n’est guère en harmonie avec le mandat législatif. Le procureur du roi qui vous fait la cour aujourd’hui peut vous gronder demain. — Sire, je tiens à ma modeste place ; elle faisait toute l’ambition du grand Napoléon. — Il faut pourtant la quitter : vous devez être conseiller de cour royale. — Sire, mes intérêts en souffriront ; puis les déplacements, les dépenses… — Il faut savoir faire des sacrifices, etc.
On a beau vouloir faire du sentimentalisme ; il faut n’avoir aucune connaissannce du cœur humain, ne s’être jamais étudié sincèrement, n’avoir jamais suivi le conseil de l’oracle : Nosce te ipsum, et ignorer la subtilité des passions pour s’imaginer que les députés, qui sont appelés à faire une certaine figure dans le monde, sur qui l’on a les yeux ouverts, dont on exige une libéralité exceptionnelle, repousseront constamment les moyens de se donner de l’aisance, de la fortune, de l’influence, d’élever et de placer leurs fils, et cela par une voie qu’on a soin de leur présenter comme honorable, méritoire. Est-il besoin de reproduire ici la secrète argumentation qui, dans le fond du cœur, déterminera leur chute ?
On dit : il faut bien avoir confiance en ceux qui gouvernent. — L’objection est puérile. Si la défiance n’est pas admissible à quoi bon le gouvernement représentatif ? Des publicistes d’un grand talent, et entre autres M. de Lamartine, ont repoussé la réforme parlementaire et la loi des incompatibilités, sous le prétexte que la France est la patrie de l’honneur, de la générosité, du désintéressement; qu’on ne peut pas supposer qu’un député, en tant que tel, élargisse le pouvoir dont il est investi en tant que fonctionnaire, ou en grossisse les émoluments ; que ce là serait une nouvelle loi des suspects, etc.
Eh mon Dieu ! y a-t-il dans nos sept codes une seule loi qui ne soit une loi de méfiance ? Qu’est-ce que la Charte, si ce n’est tout un système de barrières et d’obstacles aux empiétements possibles du roi, de la pairie, des ministres ? La loi de l’inamovibilité a-t-elle été faite pour la commodité des juges ou en vue des conséquences funestes que pourrait avoir leur position dépendante ?
Je ne puis souffrir, je l’avoue, qu’au lieu d’examiner scrupuleusement une mesure, on la répousse avec de grands mots, des phrases sonores, qui sont du reste en contradiction flagrante avec toute la série des actes qui constituent notre vie privée. Je voudrais bien savoir ce que M. de Lamartine dirait à son régisseur, si celui-ci iui tenait ce langage : « Je vous apporte les comptes de ma gestion, mais la mauvaise foi ne se présume pas. En conséquence, j’espère que vous me laisserez le soin de les vérifier moi-même et de les faire vérifier par mon fils. »
Il faut véritablement fermer volontairement les yeux à la lumière, ne pas consentir à voir le cœur humain et les mobiles de nos actions, tels qu’ils sont, pour dire que l’honneur, la délicatesse, la vertu devant toujours se présumer, il est indifférent de remettre le contrôle du pouvoir au pouvoir lui-même. Il serait bien plus simple de supprimer le contrôle. Si vous êtes si confiants, poussez donc la confiance jusqu’au bout. Ce serait encore un bon calcul ; car, je le dis en toute sincérité, nous serons certainement moins trompés par des hommes qui auront la pleine responsabilité de leurs actes que s’ils peuvent nous dire : « Vous aviez le droit de m’arrêter et vous m’avez laissé aller ; je ne suis pas le vrai coupable. »…
Maintenant, je le demande, une fois que la majorité sera acquise au pouvoir, non point par le concours libre, par l’assentiment raisonné des députés, mais parce que ceux-ci seront successivement enrôlés dans les rangs des gouvernants, pourra-t-on dire que nous sommes encore dans les conditions sincères du gouvernement représentatif ?
Voilà une loi. Elle froisse les intérêts et les idées de ceux qu’elle est destinée à régir. — Ils sont appelés à déclarer par l’organe de leurs représentants s’ils l’admettent ou la repoussent. — Évidemment, ils la rejetteront si ces représentants représentent en effet ceux que la loi est destinée à régir. — Mais s’ils représentent ceux qui la proposent, la soutiennent et sont appelés à l’exécuter, elle sera admise sans difficulté. Est-ce là le gouvernement représentatif ?…
Le fisc et la vigne [Jan. 1841] [CW2.2]↩
BWV
1841.01 “Le Fisc et la vigne” (The Tax Authorities and Wine) [January 1841] [OC1.3, p. 243] [CW2]
Source
<abc>
Le fisc et la vigne [Janvier 1841]
La production et le commerce des boissons fermentées ou distillées doivent être nécessairement affectés par les traités et lois de finances actuellement soumis aux délibérations des Chambres.
Nous entreprenons d’exposer :
1° Les nouvelles entraves dont le projet de loi du 30 décembre 1840 menace l’industrie vinicole ;
2° Celles qui sont implicitement contenues dans la doctrine de l’Exposé des motifs qui accompagne ce projet ;
3° Les résultats qu’on doit attendre du traité conclu avec la Hollande ;
4° Les moyens par lesquels l’industrie vinicole peut arriver à son affranchissement.
§ Ier. — La législation sur les boissons est une dérogation évidente au principe de l’égalité des charges.
En même temps qu’elle place dans une exception onéreuse toutes les classes de citoyens dont elle régit l’industrie, elle crée, entre ces classes mêmes, des inégalités de second ordre : toutes sont mises hors le droit commun, et chacune en est tenue à divers degrés d’éloignement.
Il ne paraît pas que M. le ministre des finances se soit le moins du monde préoccupé de l’inégalité radicale que nous venons de signaler ; mais, en revanche, il se montre vivement choqué des inégalités secondaires créées par la loi : il tient pour privilégiées les classes qui ne subissent pas encore toutes les rigueurs qu’elle impose à d’autres classes ; il s’attache à effacer ces nuances, non par voie d’allégement, mais par voie d’aggravation.
Cependant, dans la poursuite de l’égalité ainsi entendue, M. le ministre demeure fidèle aux traditions du créateur de l’institution. On dit que Bonaparte avait d’abord établi des tarifs si modérés, que les recettes ne couvraient pas les frais de perception. Son ministre des finances lui fit observer que la loi mécontentait la nation, sans rien rapporter au trésor. « Vous êtes un niais, M. Maret, lui dit Napoléon : puisque la nation murmure de quelques entraves, que ferait-elle si j’y avais joint de lourds impôts ? Habituons-la d’abord à l’exercice ; plus tard, nous remanierons le tarif. » M. Maret s’aperçut que le grand capitaine n’était pas moins habile financier.
La leçon n’a pas été perdue, et nous aurons occasion de voir que les disciples préparent le règne de l’égalité avec une prudence digne du maître.
Les principes sur lesquels repose la législation des boissons sont clairement et énergiquement exprimés par les trois articles suivants de la loi du 28 avril 1810 :
« Art. 1. À chaque enlèvement ou déplacement de vins, cidres, etc., il sera perçu un droit de circulation. »
« Art. 20. Il sera perçu au profit du trésor, dans les villes et communes ayant une population agglomérée de 2,000 âmes et au-dessus… [1] un droit d’entrée…, etc. »
« Art. 47. Il sera perçu, lors de la vente en détail des vins, cidres, etc., un droit de 15 pour 100 du prix de ladite vente. »
Ainsi chaque mouvement de vins, chaque entrée, chaque vente au détail, entraîne le payement d’un droit.
À côté de ces rigoureux et on peut dire de ces étranges principes, la loi établit quelques exceptions.
Quant au droit de circulation.
« Art. 3. Ne seront point assujettis au droit imposé par l’art. 1er :
« 1° Les boissons qu’un propriétaire fera conduire de son pressoir, ou d’un pressoir public, dans ses caves ou celliers ; 2° celles qu’un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente, remettra au propriétaire ou recevra de lui, en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires ; 3° les vins, cidres ou poirés, qui seront expédiés par un propriétaire ou fermier des caves ou celliers où sa récolte aura été déposée, et pourvu qu’ils proviennent de ladite récolte, quels que soient le lieu de destination et la qualité du destinataire.
« Art. 4. La même exemption sera accordée aux négociants, marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs et débitants, pour les boissons qu’ils feront transporter de l’une de leurs caves dans une autre, située dans l’étendue du même département.
« Art. 5. Le transport des boissons qui seront enlevées pour l’étranger ou pour les colonies françaises sera également affranchi du droit de circulation. »
Le droit d’entrée ne souffrit pas d’exception.
Relativement au droit de détail :
« Art. 85. Les propriétaires qui voudront vendre les boissons de leur cru au détail jouiront d’une remise de 25 pour 100 sur les droits qu’ils auront, à payer…
« Art. 80.… Ils seront d’ailleurs assujettis à toutes les obligations imposées aux débitants de profession. Néanmoins, les visites et exercices des commis n’auront pas lieu dans l’intérieur de leur domicile, pourvu que le local où leurs boissons seront vendues au détail en soit séparé. »
Ainsi, pour résumer ces exceptions :
Franchise du droit de circulation pour les vins de leur récolte que les propriétaires envoyaient de chez eux chez eux, sur tout le territoire de la France ;
Franchise du même droit pour les vins que les négociants, marchands, débitants, etc., faisaient transporter d’une de leurs caves dans une autre située dans le même département ;
Franchise du même droit pour les vins exportés ;
Remise de 25 pour 100 du droit de détail, en faveur des propriétaires ;
Affranchissement des visites et exercices des commis dans l’intérieur de leur domicile, quand le local où s’opère cette vente en est séparé.
Voici maintenant le texte du projet de loi présenté par M. le ministre des finances :
« Art. 13. L’exemption du droit de circulation sur les boissons ne sera accordée que dans les cas ci-après : « 1° Pour les vins qu’un récoltant fera transporter de son pressoir à ses caves, celliers, ou de l’une à l’autre de ses caves dans l’étendue d’une même commune ou d’une commune limitrophe.
« 2° Pour les boissons qu’un fermier ou preneur à rente emphytéotique remettra à son propriétaire ou recevra de lui, dans les mêmes limites, en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires.
« Les art. 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la loi du 17 juillet 1819 sont abrogés.
« Art. 14. Seront affranchies du droit de circulation les boissons de leur récolte que les propriétaires feront transporter de chez eux chez eux, hors des limites posées par l’article précédent, pourvu qu’ils se munissent de l’acquit-à-caution, et qu’ils se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros, le payement de la licence excepté.
« Art. 25. La disposition de l’art. 83 de la loi du 28 avril 1816, qui accorde aux propriétaires, vendant au détail des boissons de leur cru, une remise exceptionnelle de 25 pour 100 sur les droits de détail qu’ils ont à payer, est abrogée. »
Nous dépasserions de beaucoup les bornes que nous nous sommes imposées, si nous nous livrions ici à toutes les réflexions que nous suggère le projet de loi, et nous devons nous borner à quelques courtes observations.
En premier lieu, l’art. 13 du projet abroge-t-il les art. 4 et 5 de la loi de 1816 ? L’affirmative semble résulter de ces expressions absolues : L’exemption ne sera accordée que…, qui impliquent l’exclusion de toutes catégories non désignées dans le reste de la disposition.
Mais la négative peut se conclure de la disposition qui termine cet art. 13 ; car, en n’abrogeant que l’art. 3 de la loi de 1810, elle maintient sans doute les art. 4 et 5.
Dans ce dernier cas, il y a, ce nous semble, une certaine anomalie à conserver aux négociants et débitants, dans l’étendue du département, une faculté qu’on restreint pour le propriétaire aux limites d’une commune.
Secondement, puisque les nouvelles mesures ont pour objet de faire fructifier l’impôt, nous devons sans doute nous attendre à ce qu’elles soient onéreuses pour les contribuables. Il est possible néanmoins qu’elles dépassent le but et qu’elles entraînent des inconvénients hors de proportion avec les avantages qu’on en espère.
Elles portent, en effet, un coup funeste à la grande propriété par l’art. 13, et à la petite propriété par l’art. 20.
Tant que la franchise du droit de circulation n’a été restreinte qu’aux limites d’un département, il n’a pu en rérésulter que des maux exceptionnels. Peu de propriétaires possèdent des vignes dans plusieurs départements ; et quand cela a lieu, ils ont des celliers dans chacun d’eux. Mais il est très-fréquent qu’un propriétaire ait des vignes dans plusieurs communes voisines sans être limitrophes ; et en général, dans ce cas, il a intérêt à réunir ses récoltes dans le même cellier. La nouvelle loi le contraint ou à multiplier les constructions, au détriment de la surveillance, ou à supporter le droit de circulation pour un produit déjà si grevé, et dont la vente n’aura peut-être lieu qu’après plusieurs années.
Et qu’y gagnera le trésor ? À moins que le propriétaire, selon le vœu de M. de Villèle, ne boive tout son vin, de recouvrer le droit un peu plus tôt.
On dira sans doute que l’art. 14 du projet remédie à cet inconvénient. Nous nous réservons d’en examiner ci-après l’esprit et la portée.
D’un autre côté, les petits propriétaires retirent de la vente au détail un avantage très-considérable, celui de conserver, d’année en année, leurs bois de barrique. Désormais ils seront forcés de faire tous les ans, pour les acheter, un déboursé trop souvent au-dessus de leurs facultés. Je ne crains pas d’avancer que cette disposition renferme pour beaucoup d’entre eux une cause de ruine complète. L’achat de bois de barrique n’est pas de ceux dont on puisse se dispenser, ou qu’il soit possible de retarder. Quand arrive la vendange, il faut de toute nécessité, et à quelque prix que ce soit, se pourvoir de bois pour la loger ; et, si l’on n’a pas d’argent, on subit la loi du vendeur. On a vu le vigneron offrir la moitié de sa récolte pour obtenir de quoi loger l’autre moitié. La vente en détail leur évite cette extrémité, qui se reproduira souvent, aujourd’hui que cette faculté va, de fait, leur être interdite.
Les deux modifications, ou, pour parler comme M. le ministre, les deux améliorations à la législation existante, que nous venons d’analyser, ne sont pas les seules que renferme le projet de loi du 30 décembre. Il y en a deux autres sur lesquelles nous devons faire quelques observations.
L’art. 35 de la loi du 21 avril 1832 avait converti les droits de circulation, d’entrée et de détail, en une taxe unique, perçue à l’entrée des villes, ce qui avait permis de rendre la circulation libre dans l’intérieur de ces villes et d’y supprimer les exercices.
D’après l’art. 16 du projet, cette taxe unique ne remplacerait plus que les droits d’entrée et de détail, les droits de circulation et de licence continuant à être perçus, comme ils l’étaient en 1829, en sorte qu’on pourra dire d’elle, avec le chansonnier :
Que cette taxe unique aura deux sœurs.
Ici se présente une autre difficulté.
Pour établir la taxe unique (loi de 1832, art. 36), « on divise la somme de tous les produits annuels, de tous les droits à remplacer, par la somme des quantités annuellement introduites. »
Les droits de circulation et de licence n’étant plus compris parmi ceux à remplacer, il ne faudra pas les faire entrer dans le dividende ; et alors, le quotient se trouvant proportionnellement affaibli, le public sera soumis aux anciennes entraves, sans profit pour le trésor.
Que si M. le ministre entend que le taux de la taxe actuelle soit maintenu, les droits de circulation et de licence seraient perçus deux fois : une fois directement en vertu de la nouvelle loi, une seconde fois par la taxe unique, puisqu’ils entrent comme éléments du taux de cette taxe.
Enfin, une quatrième modification introduit une nouvelle base de conversion de l’alcool en liqueurs.
Ce n’est pas tout. M. le ministre fait clairement pressentir qu’il ne tardera pas à relever le tarif des boissons aux taux de 1829. Beaucoup de bons esprits, dit-il, ont pensé que le moment était arrivé de revenir sur le dégrèvement de 1830.
Beaucoup d’autres bons esprits pensent que, si M. le ministre s’abstient de faire une proposition formelle à cet égard, c’est pour laisser à la Chambre l’honneur de l’initiative.
Nous laissons maintenant le lecteur mesurer l’espace qui nous sépare de la révolution de juillet. Dix années sont à peine écoulées, et voilà que notre législation sur les boissons ne se distinguera bientôt plus de celles de l’empire et de la restauration, que par un surcroît de charges et de rigueurs.
§ II. — Encore si ce développement de sévérité avait pour but le seul intérêt actuel du fisc, nous pourrions du moins espérer qu’il touche au terme de ses exigences. Mais il ne nous laisse pas même cette illusion ; et, en proclamant qu’il veut faire prévaloir un système, il nous avertit que nous devons nous attendre à des exigences nouvelles tant que ce système ne sera pas arrivé à sa complète réalisation.
« Il nous a paru juste (dit l’Exposé des motifs) de renfermer la franchise du droit de circulation, en faveur du propriétaire, dans les justes limites où elle peut être légitimement réclamée, c’est-à-dire de la restreindre aux produits de sa récolte qu’il destine à sa consommation et à celle de sa famille, dans les lieux mêmes de la production. Au delà c’était un privilége que rien ne justifie, et qui violait le principe de l’égalité des charges. Par la même raison, nous proposons de supprimer la remise d’un quart au récoltant qui vend en détail des vins de son cru. »
Or, dès l’instant que le gouvernement a pour but l’égalité des charges, entendant par ce mot l’assujettissement de toutes les classes qu’atteint la loi des boissons au maximum d’entraves qui pèse sur la classe la plus maltraitée, tant que ce but ne sera pas atteint, les mesures les plus rigoureuses ne peuvent être que le prélude de mesures plus rigoureuses encore.
Nous devons le craindre, surtout sachant que le maître a pratiqué et recommandé en cette matière une tactique impitoyable, mais prudente.
Nous avons vu que la loi de 1816 étendait l’exemption du droit de circulation pour le propriétaires à tout le territoire de la France.
Bientôt elle fut restreinte aux limites d’un département ou de départements limitrophes. (Loi du 25 mars 1817, art. 81.)
Plus tard, on la réduisit aux limites d’arrondissements limitrophes. (Loi du 17 juillet 1819, art. 3.)
Maintenant on propose de la circonscrire aux limites d’une commune ou de communes limitrophes. (Projet de loi, art. 13).
Encore un pas, et elle aura entièrement disparu.
Et ce pas, il ne faut pas douter qu’on ne le fasse ; car, si ces restrictions successives ont circonscrit le privilége, elles ne l’ont pas détruit. Il reste encore un cas où le récoltant consomme un vin qui a circulé sans payer de droit de circulation, et l’on ne tardera pas à venir dire que c’est un privilége que rien ne justifie, et qui viole le principe de l’égalité de l’impôt : ainsi, dans l’application, le fisc a transigé avec les principes ; mais, en théorie, il a fait ses réserves ; et n’est-ce point assez pour une fois qu’il soit descendu de l’arrondissement à la commune sans faire un temps d’arrêt au canton ?
Tenons-nous donc pour assurés que le règne de l’égalité arrive, et que sous peu il n’y aura plus aucune exception à ce principe : À chaque enlèvement ou déplacement de vin, cidre ou poiré, il sera perçu un droit.
Mais faut-il le dire ? Oui, nous exprimerons notre pensée tout entière, quoiqu’on puisse nous soupçonner de nous abandonnera une méfiance exagérée. Nous croyons que le fisc a entrevu que, lorsque le droit de circulation s’étendra à tous, sans exception, l’égalité n’aura achevé que la moitié de sa carrière ; il restera encore à faire passer les propriétaires sous le joug de l’exercice.
Il nous semble que le fisc a déposé dans l’art. 14 le germe de cette secrète intention.
Quel peut être, autrement, l’objet de cette disposition ?
L’art. 13 du projet restreint l’exemption du droit de circulation aux limites de la commune.
L’exposé des motifs prend soin de déclarer qu’au delà cette exemption est un privilége que rien ne justifie.
Et aussitôt l’art. 14 nous rend la faculté que l’art. 13 nous avait retirée ; il nous la rend sans limites, pourvu que le propriétaire se soumette aux obligations imposées aux marchands en gros.
Une telle concession est faite pour éveiller notre méfiance.
Ce sac enfariné ne me dit rien qui vaille.
Remarquez la physionomie de cet art. 14.
D’abord, il se présente comme un correctif. L’art. 13 pouvait paraître un peu brutal, l’art. 14 vient offrir des consolations.
Ensuite, il fait mieux que de dorer la pilule, il la cache, et nous insinue l’exercice sans le nommer.
Enfin, il pousse la prudence au point de se faire facultatif ; il fait plus, il rend facultatif l’art. 13. Le moyen de se plaindre ! Ne pourra-t-on pas fuir le droit de circulation en se réfugiant dans l’exercice, et trouver un abri contre l’exercice derrière le droit de circulation ?
Puissions-nous nous tromper ! mais nous avons vu grossir le tarif, nous avons vu grossir le droit de circulation ; craignons que l’exercice ne grandisse aussi. Le fabuliste nous l’a dit : « Ce qui est petit devient grand…, pourvu que Dieu lui prête vie. »
La marche progressive vers l’égalité se manifeste encore dans le développement du droit de détail.
Nous avons vu que la législation actuelle accorde au propriétaire, à cet égard, deux exemptions : l’une, par la remise de 25 pour 100 sur le droit ; l’autre, en affranchissant de visites domiciliaires l’intérieur de sa maison, quand le local où s’opère la vente en est séparé.
Pour le moment, on se borne à demander le retrait de la première de ces exemptions ; mais le principe de l’égalité n’est pas satisfait, puisque le propriétaire continuera à jouir d’un privilége dont est privé le cabaretier, à savoir : le privilége de n’ouvrir point sa maison, sa chambre et ses armoires à l’œil des commis, pourvu toutefois que, pour vendre son vin, il loue un local par bail authentique.
§ III. Si nous reportons nos regards vers les relations extérieures de la France, dans leurs rapports avec le commerce des vins, nous n’y trouverons guère aucun sujet de nous consoler du régime intérieur qui pèse sur notre industrie. Notre intention ne peut pas être de traiter ici toutes les questions qui se rattachent à ce vaste sujet. Nous devons nous borner à quelques réflexions sur une question actuellement pendante, le traité de commerce avec la Hollande.
Après avoir annoncé, dans la séance du 21 janvier, que, d’après ce traité, « nos vins et eaux-de-vie en cercles seront affranchis de tous droits de douane à l’entrée des états néerlandais ; qu’ils y seront admis, quand ils seront en bouteilles, avec remise des trois cinquièmes du droit, pour les vins, et de moitié, pour les spiritueux, » M. le ministre du commerce s’écrie :
« Vous ne l’ignorez pas, Messieurs, dans toutes les négociations commerciales entreprises par le gouvernement, une de ses préoccupations les plus sérieuses a toujours été d’élargir autant que possible le marché de nos productions vinicoles, en leur ménageant de nouvelles voies d’écoulement dans les pays étrangers. Ce n’est donc pas sans une satisfaction particulière que nous venons offrir à votre adoption les moyens de soulager les souffrances d’une branche de commerce si digne de notre sollicitude. »
À ce pompeux préambule, qui ne croirait que nos vins vont trouver dans la Hollande un large débouché ?
Pour mesurer l’importance des concessions que nos négociateurs ont obtenues du gouvernement néerlandais, il faut savoir que les boissons étrangères sont assujetties en Hollande à deux droits d’entrée : le droit de douane, et le droit d’accise.
Que l’on consulte le tableau placé à la fin de cet écrit, et l’on y verra que le gouvernement néerlandais a si bien combiné ses réductions, que notre commerce de luxe (vins en bouteilles) est dégrevé de 10 et demi pour 100 pour la Gironde et de 21 pour 100 pour la Meuse, et notre commerce essentiel (vins en cercles) de 12 pour 100 pour l’est et un et un tiers pour 100 pour l’ouest de la France. Ce beau résultat a causé une si vive satisfaction à nos négociateurs, qu’ils se sont empressés de réduire de 33 un tiers pour 100 les droits sur les fromages et céruses de fabrication néerlandaise.
§ IV. — Quand une portion considérable de la population se croit opprimée, elle n’a que deux moyens de reconquérir ses droits : les moyens révolutionnaires, et les moyens légaux.
Il semble que les gouvernements qui se sont succédé en France travaillent à l’envi à introduire parmi les classes vinicoles ce préjugé funeste qu’elles n’ont rien à attendre que des révolutions.
En effet, les révolutions de 1814 et de 1815 leur avaient valu au moins force promesses, et nous voyons, par le texte même des lois de l’époque, que la restauration ne prétendait maintenir les contributions indirectes que comme une ressource exceptionnelle et essentiellement transitoire. (Loi de 1816, art. 257, et de 1818, art. 84.)
Mais à peine ce pouvoir eut-il acquis de la consistance que ses promesses s’évanouirent avec ses craintes.
La révolution de 1830, il faut lui rendre ce témoignage, ne promit rien ; mais elle opéra de notables dégrèvements. (Lois des 17 octobre et 12 décembre 1830.)
Et déjà nous voyons qu’elle songe non-seulement à revenir à l’ancienne législation, mais encore à lui donner un caractère de rigueur inconnu aux beaux jours de l’empire et de la restauration.
Ainsi, aux époques de trouble, le fisc promet, transige, se relâche de sa sévérité.
Aux époques de calme, il reprend ses concessions et marche à de nouvelles conquêtes.
Nous sommes surpris, nous le répétons, que le pouvoir ne craigne pas que ce rapprochement frappe les esprits, et qu’ils en tirent cette déplorable conclusion : « La légalité nous tue. »
Certes, ce serait la plus triste des erreurs ; et l’expérience, qu’on invoquerait à l’appui, prouve au contraire qu’il n’y a aucun fond à faire sur des promesses et des adoucissements arrachés par la peur à un pouvoir chancelant.
Un pouvoir nouveau peut bien, sous l’empire des circonstances, renoncer pour un temps à une partie de ses recettes ; mais trop de charges pèsent sur lui pour qu’il abandonne jamais le dessein de les ressaisir. N’a-t-il pas plus que tout autre des ambitions à satisfaire, des existences à rassurer, des répugnances à vaincre ? Au dedans, il a fait naître des jalousies, des rancunes, des mécomptes : ne faut-il pas qu’il développe des moyens de police et de répression ? Au dehors, il excite la crainte et la méfiance : ne doit-il pas s’entourer de murailles, grossir ses flottes et ses armées ?
Il est donc illusoire de chercher du soulagement dans des révolutions.
Mais nous croyons, et nous croyons fermement, que la population vinicole peut, par un usage intelligent et persévérant des moyens légaux, parvenir à améliorer sa situation.
Nous appelons particulièrement son attention sur les ressources que lui offre le droit d’association.
Depuis plusieurs années, les manufacturiers ont reconnu l’avantage d’être représentés, auprès du gouvernement et des Chambres, par des délégations spéciales. Les fabricants de sucres, de draps, d’étoffes, de lin et de coton, ont à Paris leur comité de délégués.
Aussi aucune mesure fiscale ou douanière, de nature à affecter ces industries, ne peut être résolue sans avoir passé par le creuset d’une longue et sévère enquête ; et personne n’ignore combien, dans la lutte qu’ils viennent de soutenir, les producteurs de sucre indigène ont dû de force à l’association.
Si l’industrie manufacturière n’avait pas introduit le système des délégations, peut-être appartiendrait-il à l’industrie vinicole d’en donner le premier exemple. Mais, à coup sûr, elle ne peut pas refuser d’entrer dans la lice que d’autres ont ouverte. Il est trop évident que des enquêtes où sa voix ne se fait pas entendre sont incomplètes ; il est trop évident que ses intérêts ont tout à perdre à laisser le champ libre à des intérêts souvent rivaux.
Selon nous, chaque bassin vinicole devrait avoir un comité dans la ville qui centralise son mouvement commercial. Chacun de ces comités nommerait un délégué, et la réunion des délégués à Paris formerait le comité central.
Ainsi le bassin de l’Adour et ses affluents, de la Garonne, de la Charente, de la Loire, du Rhône, de la Meuse ; les départements que forment le Languedoc, la Champagne et la Bourgogne auraient chacun leur délégué.
Nous nous sommes entretenu, avec plusieurs personnes, de cette institution, sans en rencontrer une seule qui en ait contesté l’utilité ; mais nous devons répondre à quelques objections qui nous ont été faites.
On nous a dit :
« L’industrie vinicole a ses délégués naturels dans les députés.
« Il est difficile d’obtenir le concours d’un si grand nombre d’intéressés, la plupart disséminés dans les campagnes.
La situation financière de la France ne permet pas d’espérer l’abolition des contributions indirectes, qui d’ailleurs, à côté de beaucoup d’inconvénients, présentent d’incontestables avantages. »
1° Les députés sont-ils les délégués de l’industrie vinicole ?
Apparemment, lorsqu’un corps électoral investit un citoyen des fonctions législatives, il ne rapetisse pas cette mission aux proportions d’une question spéciale d’industrie. D’autres considérations déterminent son choix ; et il ne faudrait pas être surpris qu’un député, alors même qu’il représenterait un département vinicole, n’eût pas préalablement fait une étude approfondie de toutes les questions qui se rattachent au commerce et aux impôts des boissons. Encore moins, une fois nommé, peut-il concentrer exclusivement sur un seul intérêt une attention que réclament tant et de si graves matières. Il ne pourrait donc voir qu’un avantage à puiser, dans les comités spéciaux qui s’occupent des sucres, des fers, des vins, — des informations et des documents qu’il lui serait matériellement impossible de chercher et de coordonner. Les précédents établis par les manufacturiers ôtent d’ailleurs toute valeur à l’objection.
2° On dit encore qu’il est difficile d’obtenir le concours persévérant des habitants disséminés dans les provinces.
Nous croyons, nous, qu’on s’exagère cette difficulté. Sans doute elle serait invincible, s’il fallait attendre de chaque intéressé un concours actif et assidu. Mais, en pareille matière, les plus actifs font pour les autres, et les villes pour les campagnes. Cela est sans inconvénient quand les intérêts sont identiques ; et puisqu’il y a un comité vinicole à Bordeaux, on ne voit pas pourquoi il n’y en aurait pas à Bayonne, à Nantes, à Montpellier, à Dijon, à Marseille ; et de là à un comité central il n’y a qu’un pas. C’est en s’exagérant les difficultés qu’on n’arrive à rien. Il est certainement plus aisé à trois cents fabricants de sucre qu’à plusieurs milliers de propriétaires de se concerter, de s’organiser. Mais, de ce qu’une chose ne se fait pas toute seule, il ne faut pas conclure qu’elle est infaisable. Il faut même reconnaître que, si les masses ont plus de difficulté à s’organiser, elles acquièrent par l’organisation un ascendant irrésistible.
3° Enfin, on objecte que la situation financière de la France ne permet pas d’espérer qu’elle puisse renoncer aux ressources de l’impôt de consommation.
Mais c’est encore là circonscrire la question. L’organisation d’un comité central préjuge-t-elle qu’il aura pour mission exclusive de poursuivre l’abolition absolue de cet impôt ? N’y a-t-il pas autre chose à faire ? Ne se présente-t-il pas tous les jours des questions douanières qui intéressent la vigne ? Est-on assuré que l’intervention du comité, dans les conférences qui ont préparé le traité avec la Hollande, n’eût été d’aucune influence sur les stipulations de ce traité ? Et quant aux contributions indirectes, n’y a-t-il rien entre l’abolition complète et le maintien absolu du régime actuel ? Le mode de perception, le moyen de prévenir ou de réprimer la fraude, les attributions, les compétences, n’offrent-ils pas un vaste champ aux réformes ?
Il ne faut pas croire, du reste, que tout soit dit sur la question principale. Il ne nous appartient pas de formuler une opinion sur l’impôt de consommation, il a pour lui et contre lui de grandes autorités et de grands exemples ? il est la règle en Angleterre, en France il est l’exception. Eh bien ! il faut résoudre ce problème. Si le système est mauvais en principe, il faut le détruire ; si on le juge bon, il faut le perfectionner, lui ôter son caractère exceptionnel, et le rendre à la fois moins lourd et plus productif en le généralisant. Là peut-être est la solution du grand débat pendant entre le fisc et le contribuable. Et qui peut dire que le mouvement des esprits, qui naîtra de l’institution des comités industriels, les communications régulières qui s’établiront, soit entre eux, soit par leur intermédiaire, entre le public et le pouvoir, ne hâteront pas cette solution ?
FN:Ce chiffre a varié.
DROITS D’ENTRÉE EN HOLLANDE.
[missing table???]
Mémoire présenté à la société d’agriculture, commerce, arts, et sciences du département des Landes sur la question vinicole [22 janvier 1843] [CW3.3]↩
BWV
1843.01.22 “Mémoire présenté à la société d’agriculture, commerce, arts, et sciences du département des Landes sur la question vinicole” (Memoir Presented to the Société d’agriculture, commerce, arts, et sciences du département des Landes on the Wine-Growing Question) [22 January 1843] [OC1.4, p. 261] [CW2]
Source
<abc>
Mémoire présenté à la Société d’Agriculture, Commerce, Arts et Sciences, du département des Landes, sur la question Vinicole [22 janvier 1843]
Messieurs,
Dans une de vos précédentes séances, vous avez chargé une Commission de rechercher les causes de la détresse qui afflige la partie viticole du département des Landes, et les moyens par lesquels il serait possible de la combattre.
Les circonstances ne m’ont pas permis de communiquer à la Commission le travail dont elle m’a chargé. Je le regrette vivement, car la coopération des hommes éclairés qui la composent l’eût rendu plus digne de vous. Bien que j’ose croire que mes idées ne s’éloignent pas beaucoup de celles qu’ils m’eussent autorisé à vous soumettre, je ne dois pas moins en assumer sur moi toute la responsabilité…
Messieurs, prouver d’abord la réalité de la détresse de notre population viticole, en tracer à vos yeux une peinture animée, ce serait à la fois satisfaire à l’ordre logique de ce rapport et lui concilier votre intérêt et votre bienveillance. Je sacrifierai volontiers cette considération au désir de ménager vos moments ; puisque aussi bien je puis admettre, sans crainte de me tromper, que si nous ne sommes pas tous d’accord sur les causes de la décadence de l’industrie qui nous occupe, il n’y a du moins aucune dissidence parmi nous sur le fait même de cette décadence.
Une analyse complète de toutes les causes qui ont concouru à ce triste résultat entraînerait encore à des développements trop étendus.
Il faudrait d’abord examiner celles de ces causes qui sont au-dessus de nos moyens d’action. Telle est la concurrence du midi de la France, qui se développe de jour en jour, favorisée par le perfectionnement progressif de nos moyens de transport. Telle est encore l’infériorité relative qui semble devoir être le partage des contrées qui, comme la Chalosse, ne sont pas organisées de manière à substituer la culture à bœufs à la culture à bras.
Il faudrait ensuite distinguer les causes de souffrances dont la responsabilité pèse sur le producteur lui-même. A-t-il mis assez d’activité à améliorer ses procédés de culture et de vinification ? assez de prévoyance à limiter ses plantations ? assez d’habileté à faire suivre à ses produits les variations qui ont pu se manifester dans les besoins et les goûts des consommateurs ? A-t-on essayé, par le choix et la combinaison des cépages, ou par d’autres moyens, de remplacer la quantité du produit, à mesure que les débouchés se sont restreints, par la qualité, qui eût pu rétablir, dans une certaine mesure, l’équilibre des revenus ? Et la Société d’agriculture elle-même, si empressée à favoriser l’introduction de plantes exotiques d’un succès fort incertain, n’a-t-elle pas été trop sobre d’encouragements envers une culture qui fait vivre le tiers de notre population ?
Enfin, il faudrait exposer les causes de notre détresse qui doivent être attribuées aux mesures gouvernementales, qui ont eu pour effet d’entraver la production, la circulation et la consommation des vins, ce qui m’entraînerait à rechercher l’influence spéciale qu’exercent sur notre contrée l’impôt direct, l’impôt indirect, l’octroi et le régime des douanes.
C’est à l’examen de ces trois dernières causes de nos souffrances que je circonscrirai ce rapport, d’abord parce qu’elles sont de beaucoup celles qui ont le plus immédiatement déterminé notre décadence, ensuite, parce qu’elles me paraissent susceptibles de modifications actuelles ou prochaines, dont l’opinion publique peut, à son gré, selon ses manifestations favorables ou contraires, hâter ou retarder la réalisation.
Avant d’aborder ce sujet, je dois dire qu’il a été traité, ainsi que plusieurs autres questions économiques, avec un véritable talent, par un de nos collègues, M. Auguste Lacome, du Houga, dans un écrit dont il fut donné lecture dans une de vos précédentes séances. L’auteur apprécie, avec autant de sagacité que d’impartialité, la situation des propriétaires de vignobles. Par des concessions peut-être trop larges, il admet que les besoins sans cesse croissants de l’État, des communes et des manufactures, ne permettent pas d’espérer un dégrèvement dans l’ensemble de nos charges publiques ; il se demande si, dans cette hypothèse même, il est juste d’accorder satisfaction à tous les intérêts aux dépens des seuls intérêts viticoles, et, après avoir établi que cela est aussi contraire à l’équité naturelle qu’à notre droit écrit, il recherche par quels moyens on pourrait remplacer les ressources demandées jusqu’ici à notre industrie. Entrer dans cette voie, donner à ses méditations cette direction d’une utilité pratique, c’est faire preuve d’une capacité réelle, c’est s’élever au-dessus de la foule de ces esprits frondeurs, qui se bornent à la facile tâche de critiquer le mal sans indiquer le remède. Je ne me permettrai pas de décider si l’auteur a toujours réussi à indiquer les véritables sources auxquelles il faudrait demander une compensation à l’impôt des boissons, je me bornerai à proposer de mettre le public à même d’en juger par l’insertion de cet écrit dans nos Annales.
J’arrive, Messieurs, au sujet que je me propose de traiter. La triple ceinture des droits répulsifs que rencontrent nos vins dans l’octroi, l’impôt indirect, ou les tarifs douaniers, selon qu’ils cherchent des débouchés dans les villes, dans la circulation nationale, ou dans le commerce extérieur, a-t-elle réagi sur la production et causé l’encombrement qui excite nos plaintes ?
Il serait bien surprenant qu’il pût y avoir divergence d’opinions à cet égard.
Que sont devenues ces nombreuses maisons de commerce qui autrefois se livrèrent exclusivement, à Bayonne, à l’exportation de nos vins et eaux-de-vie vers la Belgique, la Hollande, la Prusse, le Danemark, la Suède et les villes Anséatiques ? Qu’est devenue cette navigation intérieure que nous avons vue si active, et qui, sans aucun doute, donna naissance à ces nombreuses agglomérations de population qui se formèrent sur la rive gauche de l’Adour ? Que sont devenus ces spéculations multipliées, ces placements sur une marchandise qui, par la propriété qu’elle possède de s’améliorer en vieillissant, doit, dans un état normal des choses, acquérir de la valeur par le temps, véritable caisse d’épargn e de nos pères, qui répandit l’aisance parmi les classes laborieuses de leur époque, et fut la source, bien connue par la tradition, de toutes les fortunes qui restent encore en Chalosse ? Tout cela a disparu avec la liberté de l’industrie et des échanges.
En présence de cette double atteinte portée à notre propriété par le régime prohibitif et l’exagération de l’impôt, en présence d’un encombrement qu’expliquent d’une manière si naturelle les obstacles qui obstruent nos débouchés intérieurs et extérieurs, rien ne surprend plus que l’empressement du fisc à chercher ailleurs la cause de nos souffrances, si ce n’est la crédulité du public à se payer de ses sophismes.
C’est pourtant là ce que nous voyons tous les jours. Le fisc proclame qu’on a planté trop de vignes, et chacun de répéter : « Si nous souffrons, ce n’est pas parce que les échanges nous font défaut, parce que le poids des taxes nous étouffe ; mais nous avons planté trop de vignes. »
J’ai, à une autre époque, combattu cette assertion ; mais elle exprime une opinion trop répandue, le fisc en fait contre nous une arme trop funeste, pour que je ne revienne pas succinctement sur cette démonstration.
D’abord, je voudrais bien que nos antagonistes fixassent les limites qu’ils entendent imposer à la culture de la vigne ! Je n’entends jamais reprocher au froment, au lin, aux vergers, d’envahir une trop forte portion de notre territoire. L’offre comparée à la demande, le prix de revient rapproché du prix de vente, voilà les bornes entre lesquelles s’opèrent les mouvements progressifs ou rétrogrades de toutes les industries. Pourquoi la culture de la vigne, échappant à cette loi générale, prendrait-elle de l’extension à mesure qu’elle devient plus ruineuse ?
Mais, dit-on, c’est là de la théorie. Eh bien, voyons ce que nous révèlent les faits.
Le fisc, par l’organe d’un ministre des finances [1], nous apprend que la superficie viticole de la France était de 1,555,475 hectares en 1788, et de 1,993,307 hectares en 1828. L’augmentation est donc dans le rapport de 100 à 128. Dans le même espace de temps, la population de la France qui, selon Necker, était de 24 millions, s’est élevée à 32 millions, ou, dans le rapport, de 100 à 133. La culture de la vigne, loin de s’étendre démesurément, n’a donc pas même suivi le progrès numérique de la population.
Nous pourrions contrôler ce résultat par des recherches sur la consommation, si nous avions, à cet égard, des données statistiques. Il n’en a été recueilli, à notre connaissance, que pour Paris ; elles donnent le résultat suivant :
| Population | Consommation | Consommation par habit. | |
| 1789. | — 599,566 [2] | — 687,500 hect. [3] | — 114 litres. |
| 1836. | — 909,125 [4] | — 922,364 [5] | — 101 |
Ainsi, Messieurs, il est incontestable que, dans ce dernier demi-siècle et pendant que toutes les branches de travail ont fait des progrès si remarquables, la plus naturelle de nos productions est demeurée au moins stationnaire.
Concluons que les prétendus envahissements de la vigne reposent sur des allégations aussi contraires à la logique qu’aux faits, et, après nous être ainsi assurés que nous ne faisions pas fausse route en attribuant nos souffrances aux mesures administratives qui ont restreint tous nos débouchés, examinons de plus près le principe et les effets de ces mesures.
Nous devons mettre en première ligne l’impôt indirect sur les boissons, droits de circulation, d’expédition, de consommation, de licence, de congé, d’entrée, de détail, triste et incomplet dénombrement des subtiles inventions par lesquelles le fisc paralyse notre industrie et lui arrache indirectement plus de cent millions tous les ans. Loin de laisser prévoir quelque adoucissement à ses rigueurs, il les redouble, d’année en année, et si, en 1830, il fut contraint, pour ainsi dire révolutionnairement, à consentir un dégrèvement de 40 millions, bien que ce dégrèvement ait cessé d’être sensible, il n’a jamais laissé passer une session sans faire éclater ses regrets et ses doléances.
Il faut le dire, les populations vinicoles ont rarement apporté l’esprit pratique des affaires dans les efforts qu’elles ont faits pour se soustraire à ce régime exceptionnel. Selon qu’elles ont été sous l’impression plus immédiate de leurs propres souffrances, ou des nécessités de l’époque, tantôt elles ont réclamé avec véhémence l’abolition complète de toute taxe de consommation, tantôt elles ont fléchi sans réserve sous un système qui leur a paru monstrueux, mais irrémédiable, passant ainsi tour à tour d’une confiance aveugle à un lâche découragement.
L’abolition pure et simple de la contribution indirecte est évidemment une chimère. Réclamée au nom du principe de l’égalité des charges, elle implique la chute de tous impôts de consommation, aussi bien ceux qui sont établis sur le sel, sur le tabac, que ceux qui pèsent sur les boissons ; et quel est le hardi réformateur qui parviendra à faire descendre immédiatement le budget des dépenses publiques aux proportions d’un budget de recettes réduit aux quatre contributions directes ? Sans doute un temps viendra, et nous devons le hâter de nos efforts autant que de nos vœux, où l’industrie privée, moralisée par l’expérience et élargie par l’esprit d’association, fera rentrer dans son domaine les usurpations des services publics ; où, le gouvernement circonscrit dans sa fonction essentielle, le maintien de la sécurité intérieure et extérieure, n’exigeant plus que des ressources proportionnées à cette sphère d’action, il sera permis de faire disparaître de notre système financier une foule de taxes qui blessent la liberté et l’égalité des citoyens. Mais combien s’éloignent d’une telle tendance les vues des gouvernants, aussi bien que les forces toutes-puissantes de l’opinion ! Nous sommes entraînés fatalement, peut-être providentiellement, dans des voies opposées. Nous demandons tout à l’État, routes, canaux, chemins de fer, encouragements, protection, monuments, instruction, conquêtes, colonies, prépondérance militaire, maritime, diplomatique ; nous voulons civiliser l’Afrique, l’Océanie, que sais-je ? Nous obéissons, comme l’Angleterre, à une force d’expansion qui contraint toutes nos ressources à se centraliser aux mains de l’État ; nous ne pouvons donc éviter de chercher, comme l’Angleterre, les éléments de la puissance dans l’impôt de consommation, le plus abondant, le plus progressif, le plus tolérable même de tous les impôts, — lorsqu’il est bien entendu, — puisqu’il se confond alors avec la consommation elle-même.
Mais faut-il conclure de là que tout est bien comme il est, ou du moins que nos maux sont irrémédiables ? Je ne le pense pas. Je crois au contraire que le temps est venu de faire subir à l’impôt indirect, encore dans l’enfance, une révolution analogue à celle que le cadastre et la péréquation ont amenée dans l’assiette de la contribution territoriale.
Je n’ai pas la prétention de formuler ici tout un système de contributions indirectes, ce qui exigerait des connaissances et une expérience que je suis loin de posséder. Mais j’espère que vous ne trouverez pas déplacé que j’établisse quelques principes, ne fût-ce que pour vous faire entrevoir le vaste champ qui s’offre à vos méditations.
J’ai dit que l’impôt indirect était encore dans l’enfance. On trouvera peut-être qu’il y a quelque présomption à porter un tel jugement sur une œuvre Napoléonienne. Mais il faut prendre garde qu’un système de contributions est toujours nécessairement vicieux à son origine, parce qu’il s’établit sous l’empire d’une nécessité pressante. Pense-t-on que si le besoin d’argent faisait recourir à l’impôt foncier, dans un pays où cette nature de revenu public serait inconnue, il fût possible d’arriver du premier jet à la perfection, que ce système n’a acquise en France qu’au prix de cinquante ans de travaux et cent millions de dépenses ? Comment donc l’impôt indirect, si compliqué de sa nature, aurait-il atteint, dès sa naissance, le dernier degré de perfection ?
La loi rationnelle d’un bon système d’impôts de consommation est celle-ci : Généralisation aussi complète que possible, quant au nombre des objets atteints ; modération poussée à son extrême limite possible, quant à la quotité de la taxe.
Plus l’impôt indirect se rapproche dans la pratique de cette double donnée théorique, plus il remplit toutes les conditions qu’on doit rechercher dans une telle institution, 1° de faire contribuer chacun selon sa fortune ; 2° de ne pas porter atteinte à la production ; 3° de gêner le moins possible les mouvements de l’industrie et du commerce ; 4° de restreindre les profits et par conséquent le domaine de la fraude ; 5° de n’imposer à aucune classe de citoyens des entraves exceptionnelles ; 6° de suivre servilement toutes les oscillations de la richesse publique ; 7° de se prêter avec une merveilleuse flexibilité à toutes les distinctions qu’il est d’une saine politique d’établir entre les produits, selon qu’ils sont de première nécessité, de convenance et de luxe ; 8° d’entrer facilement dans les mœurs, en imposant à l’opinion ce respect dont elle ne manque pas d’entourer tout ce qui porte un caractère incontestable d’utilité, de modération et de justice.
Il semble que c’est sur le principe diamétralement opposé, limitation quant au nombre des objets taxés, exagération quant à la quotité de la taxe, que l’on ait fondé notre système financier en cette matière.
On a fait choix, entre mille, de deux ou trois produits, le sel, les boissons, le tabac, — et on les a accablés.
Encore une fois, il ne pouvait guère en être autrement. Ce n’est pas de perfection, de justice que se préoccupait le chef de l’État, pressé d’argent. C’était d’en faire arriver au trésor abondamment et facilement, et, disposant d’une force capable de vaincre toutes les résistances, il ne lui restait qu’à discerner la matière éminemment imposable, et à la frapper à coups redoublés [6].
En ce qui nous concerne, les boissons ont dû se présenter d’abord à sa pensée. D’un usage universel, elles promettaient des ressources abondantes ; d’un transport difficile, elles ne pouvaient guère échapper à l’action du fisc ; produites par une population disséminée, apathique, inexpérimentée aux luttes publiques, elles ne le soumettaient pas aux chances d’une résistance insurmontable. Le décret du 5 ventôse an XII fut résolu.
Mais, de deux principes opposés, il ne peut sortir que des conséquences opposées ; aussi l’on ne saurait contester que l’impôt indirect, tel que l’a institué le décret de l’an XII, ne soit une violation perpétuelle des droits et des intérêts des citoyens.
Il est injuste, par cela seul qu’il est exceptionnel.
Il blesse l’équité, parce qu’il prélève autant sur le salaire de l’ouvrier que sur les revenus du millionnaire.
Il est d’une mauvaise économie, en ce que, par son exagération, il limite la consommation, réagit sur la production, et tend à restreindre la source même qui l’alimente.
Il est impolitique, parce qu’il provoque la fraude et ne saurait la prévenir et la réprimer, sans emprisonner les mouvements de l’industrie dans un cercle de formalités et d’entraves, consignées dans le code le plus barbare qui ait jamais déshonoré la législature d’un grand peuple.
Si donc les hommes de cœur et d’intelligence, les conseils de département et d’arrondissement, les chambres de commerce, les Sociétés d’Agriculture, les comités industriels et vinicoles, ces associations préparatoires où s’élabore l’opinion publique et qui préparent des matériaux à la législature, veulent donner à leurs travaux en cette matière une direction utile, pratique ; s’ils veulent arriver à des résultats qui concilient les nécessités collectives de notre civilisation et les intérêts de chaque industrie, de chaque classe de citoyens, ce n’est pas à la puérile manifestation d’exigences irréalisables qu’ils doivent recourir ; encore moins s’abandonner à un stérile découragement ; mais ils doivent travailler avec persévérance à faire triompher le principe fécond que nous venons de poser, dans tout ce qu’il renferme de conséquences à la fois justes et praticables.
La seconde cause de la décadence de la viticulture, c’est le régime de l’octroi. Comme l’impôt indirect gène la circulation générale des vins, l’octroi les repousse des populations agglomérées, c’est-à-dire des grands centres de consommation. C’est la seconde barrière que l’esprit de fiscalité interpose entre le vendeur et l’acheteur.
Sauf la destination spéciale de son produit, l’octroi est une branche de la contribution indirecte, et, par ce motif, son vrai principe de fécondité et de justice est celui que nous venons d’assigner à cette nature de taxe : généralisation quant à la sphère, limitation quant à l’intensité de son action ; en d’autres termes, il doit atteindre toutes choses, mais chacune d’un droit imperceptible. L’octroi est d’autant plus tenu de se soumettre à ce principe de bonne administration et d’équité que, pour s’y soustraire, il n’a pas même, comme la régie des droits réunis, la banale excuse de la difficulté d’exécution. Cependant nous voyons le principe d’exception prévaloir en cette matière, et des villes populeuses asseoir sur les seules boissons la moitié, les trois quarts et même la totalité de leurs revenus.
Si encore les tarifs de l’octroi étaient abandonnés à la décision souveraine des conseils municipaux, les départements vinicoles pourraient user de représailles envers les départements manufacturiers. On verrait alors toutes les fractions industrielles de la population se livrer à une lutte de douanes intérieures, désordre énorme, mais d’où le bon sens public ferait sans doute surgir tôt ou tard, par voie de transaction, le principe que nous avons invoqué. C’est sans contredit pour éviter ces perturbations intestines que l’on a remis au pouvoir central la faculté de régler les tarifs des octrois, faculté qui fait essentiellement partie des franchises municipales et dont elles n’ont été dépouillées, au profit de l’État, qu’à la charge par celui-ci de tenir la balance égale entre tous les intérêts.
Quel usage a-t-il fait de cette prérogative exorbitante ? S’il est un produit qu’il devait protéger et soustraire à la rapacité municipale, c’est certainement le vin qui porte déjà à la communauté tant et de si lourds tributs ; et c’est justement le vin qu’il laisse accabler. Bien plus, une loi posait des limite à ces extorsions ; vaine barrière.
Car le creuset des ordonnances
A fait évaporer la loi.
Nous montrerions-nous donc trop exigeants si nous demandions que les tarifs d’octroi soient progressivement ramenés à un maximum qui ne puisse dépasser 10 p. 100 de la valeur de la marchandise ?
Le régime protecteur est la troisième cause de notre détresse, et peut-être celle qui a le plus immédiatement déterminé notre décadence. Il mérite donc de vous une attention particulière, d’autant qu’il est en ce moment l’objet d’un débat animé entre tous les intérêts engagés, débat à l’issue duquel votre opinion et vos vœux ne peuvent rester étrangers.
Dans l’origine, la douane est un moyen de créer un revenu à l’État, c’est un impôt indirect, c’est un grand octroi national ; et tant qu’elle conserve ce caractère, c’est un acte d’injustice et de mauvaise gestion que de la soustraire à cette loi de tout impôt de consommation : universalité et modicité de la taxe.
Je dirai même plus : tant que la douane est une institution purement fiscale, il y a intérêt à taxer non-seulement les importations, mais encore les exportations, par cette double considération que l’État se crée ainsi un second revenu qui ne coûte aucuns frais de perception et qui est supporté par le consommateur étranger.
Mais, il faut le dire, ce n’est plus la fiscalité, c’est la protection qui est le but de nos mesures douanières ; et pour les juger à ce point de vue, il faudrait entrer dans des démonstrations et des développements qui ne peuvent trouver place dans ce rapport. Je me bornerai donc aux considérations qui se rattachent directement à notre sujet.
L’idée qui domine dans le système de la protection est celle-ci : que si l’on parvient à faire naître dans le pays une nouvelle industrie, ou à donner un plus grand développement à une industrie déjà existante, on accroît la masse du travail, et par conséquent de la richesse nationale. Or un moyen simple de faire naître un produit au dedans, c’est d’empêcher qu’il ne vienne du dehors. De là les droits prohibitifs ou protecteurs.
Ce système serait fondé en raison, s’il était au pouvoir d’un décret d’ajouter quelque chose aux éléments de la production. Mais il n’y a pas de décret au monde qui puisse augmenter le nombre des bras, ou la fertilité du sol d’une nation, ajouter une obole à ses capitaux ou un rayon à son soleil. Tout ce que peut faire une loi, c’est de changer les combinaisons de l’action que ces éléments exercent les uns sur les autres ; c’est de substituer une direction artificielle à la direction naturelle du travail ; c’est de le forcer à solliciter un agent avare de préférence à un agent libéral ; c’est, en un mot, de le diviser, de le disséminer, de le dévoyer, de le mettre aux prises avec des obstacles supérieurs, mais jamais de l’accroître.
Permettez-moi une comparaison. Si je disais à un homme : « Tu n’as qu’un champ et tu y cultives des céréales, dont tu vends ensuite une partie pour acheter du lin et de l’huile ; ne vois-tu pas que tu es tributaire de deux autres agriculteurs ? Divise ton champ en trois ; fais trois parts de ton temps, de tes avances et de tes forces, et cultive à la fois des oliviers, du lin et des céréales. » Cet homme aurait probablement de bonnes objections à m’opposer ; mais si j’avais autorité sur lui, j’ajouterais : « Tu ne connais pas tes intérêts ; je te défends, sous peine de me payer une taxe énorme, d’acheter à qui que ce soit de l’huile et du lin. » — Je forcerais bien cet homme à multiplier ses cultures ; mais aurais-je augmenté son bien-être ? Voilà le régime prohibitif. C’est une mauvaise taille appliquée à l’arbre industriel, laquelle, sans rien ajouter à sa sève, la détourne des boutons à fruit pour la porter aux branches gourmandes.
Ainsi la protection favorise, sous chaque zone, la production de la valeur consommable, mais elle décourage, dans la même mesure, celle de la valeur échangeable, d’où il faut rigoureusement conclure, et c’est ce qui me ramène à la détresse de la viticulture en France, que les tarifs protecteurs ne sauraient provoquer la production de certains objets que nous tirions du dehors, sans restreindre les industries qui nous fournissaient des moyens d’échange, c’est-à-dire, sans appeler la gêne et la souffrance sur le travail le plus en harmonie avec le climat, le sol et le génie des habitants.
Et, Messieurs, les faits ne viennent-ils pas encore ici attester énergiquement la rigueur de ces déductions ? Que se passe-t-il des deux côtés de la Manche ? Au delà, chez ce peuple que la nature a doté, avec tant de profusion, de tous les éléments et de toutes les facultés que réclame le développement de l’industrie manufacturière, c’est précisément la population des ateliers qui est dévorée par la misère, le dénûment et l’inanition. Le langage n’a pas d’expressions pour décrire une telle détresse ; la bienfaisance est impuissante à la soulager ; les lois sont sans force pour réprimer les désordres qu’elle enfante.
De ce côté du détroit, un beau ciel, un soleil bienfaisant devaient faire jaillir, sur tous les points du territoire, d’inépuisables sources de richesses ; eh bien ! c’est justement la population vinicole qui offre ce spectacle de misère, triste pendant de celle qui règne dans les ateliers de la Grande-Bretagne.
Sans doute la pauvreté des vignerons français a moins de retentissement que celle des ouvriers anglais ; elle ne sévit pas sur des masses agglomérées et remuantes ; elle n’est pas, matin et soir, proclamée par les mille voix de la presse ; mais elle n’en est pas moins réelle. Parcourez nos métairies, vous y verrez des familles strictement réduites, pour toute alimentation, au maïs et à l’eau, et dont toutes les consommations ne dépassent pas 10 centimes par jour et par individu. Encore la moitié peut-être leur est-elle fournie, en apparence, à titre de prêt, mais de fait gratuitement par le propriétaire. Aussi le sort de celui-ci n’est pas relativement plus heureux. Pénétrez au sein de sa demeure : une maison tombant en ruines, des meubles transmis de génération en génération attestent que là il y a lutte, lutte incessante et acharnée, contre les séductions du bien-être et de ce confort moderne, qui l’entoure de toute part et qu’il ne laisse pas pénétrer. D’abord vous serez tenté de voir un côté ridicule à ces persévérantes privations, à cette parcimonie ingénieuse ; mais regardez-y de plus près, et vous ne tarderez pas à en découvrir le côté triste, touchant et je dirai presque héroïque ; car la pensée qui le soutient dans ce pénible combat, c’est l’ardent désir de maintenir ses fils au rang de ses aïeux, de ne pas tomber de génération en génération jusqu’aux derniers degrés de l’échelle sociale, intolérable souffrance dont tous ses efforts ne le préserveront pas.
Pourquoi donc ce peuple si riche de fer et de feu, si riche de capitaux, si riche de facultés industrielles, dont les hommes sont actifs, persévérants, réguliers comme les rouages de leurs machines, périt-il de besoin sur des tas de houille, de fer, de tissus ? Pourquoi cet autre peuple, à la terre féconde, au soleil bienfaisant, succombe-t-il de détresse au milieu de ses vins, de ses soies, de ses céréales ? Uniquement parce qu’une erreur économique, incarnée dans le régime prohibitif, leur a défendu d’échanger entre eux leurs richesses diverses.
Ainsi, ce déplorable système, déjà théoriquement ruiné par la science, a encore contre lui la terrible argumentation des faits.
Il n’est donc pas surprenant que nous assistions à un commencement de réaction en faveur des idées libérales. Nées parmi les intelligences les plus élevées, elles ont, avant d’avoir rallié les forces de l’opinion publique, pénétré dans la sphère du pouvoir, en Angleterre avec Huskisson, en France avec M. Duchâtel [7].
Le pouvoir, sans doute, n’est pas, en général, très-empressé de hâter les développements des libertés publiques. Il y a pourtant une exception à faire en faveur de la liberté commerciale. Ce ne peut jamais être par mauvais vouloir, mais par erreur systématique, qu’il paralyse cette liberté. Il sent trop bien que si la douane était ramenée à sa primitive destination, la création d’un revenu public, le Trésor y gagnerait, la tâche du gouvernement serait rendue plus facile par sa neutralité au milieu des rivalités industrielles, la paix des nations trouverait dans les relations commerciales des peuples sa plus puissante garantie.
Il ne faut donc pas être surpris de la tendance qui se manifeste, parmi les sommités gouvernementales, vers l’affranchissement du commerce, en Prusse, en Autriche, eu Espagne, en Angleterre, en Belgique, en France, sous les noms d’unions douanières, traités de commerce, etc., etc., ce sont autant de pas vers la sainte alliance des peuples.
Une des plus significatives manifestations officielles de cette tendance, c’est, sans contredit, le traité qui se négocia il y a deux ans entre la France et l’Angleterre. Alors, si l’industrie vinicole avait eu l’œil ouvert sur ses véritables intérêts, elle aurait entrevu et hâté de sa part d’influence un avenir de prospérité dont elle ne se fait probablement aucune idée. À aucune époque, en effet, une perspective aussi brillante ne s’était montrée à la France méridionale. Non-seulement l’Angleterre abaissait les droits dont elle a frappé nos vins, mais encore, par une innovation d’une incalculable portée, elle substituait au droit uniforme, si défavorable aux vins communs, le droit graduel qui, en maintenant une taxe assez élevée sur le vin de luxe, réduisait dans une grande proportion celle qui pèse sur le vin de basse qualité. Dès lors ce n’étaient plus quelques caves aristocratiques, c’étaient les fermes, les ateliers, les chaumières de la Grande-Bretagne qui s’ouvraient à notre production. Ce n’était plus l’Aï, le Laffitte et le Sauterne qui avaient le privilége de traverser la Manche, c’était la France vinicole tout entière qui rencontrait tout d’un coup vingt millions de consommateurs. Je n’essaierai point de calculer la portée d’une telle révolution et son influence sur nos vignobles, notre marine marchande et nos villes commerciales ; mais je ne pense pas que personne puisse mettre en doute que, sous l’empire de ce traité, le travail, le revenu et le capital territorial de notre département n’eussent reçu un rapide et prodigieux accroissement.
À un autre point de vue, c’était une belle conquête que celle du principe du droit graduel, acheminement vers l’adoption générale de la taxe dite ad valorem, seule juste, seule équitable, seule conforme aux vrais principes de la science. Le droit uniforme est de nature aristocratique ; il ne laisse subsister quelques relations qu’entre les producteurs et les consommateurs de haut parage. Le droit proportionnel à la valeur fera entrer en communauté d’intérêts les masses populaires de toutes les nations.
Cependant la France ne pouvait prétendre à de tels avantages sans ouvrir son marché à quelques-uns des produits de l’industrie anglaise. Le traité devait donc trouver de la résistance parmi les fabricants. Elle ne tarda pas à se manifester habile, persévérante, désespérée ; les producteurs de houilles, de fers, de tissus firent entendre leurs doléances et ne se bornèrent pas à cette opposition passive. Des associations, des comités s’organisèrent au sein de chaque industrie ; des délégués permanents reçurent mission de faire prévaloir, auprès des ministères et des chambres, les intérêts privilégiés ; d’abondantes et régulières cotisations assurèrent à cette cause le concours des journaux les plus répandus, et par leur organe, la sympathie de l’opinion publique égarée. Il ne suffisait pas de faire échouer momentanément la conclusion du traité ; il fallait le rendre impossible, même au risque d’une conflagration générale, et pour cela s’attacher à irriter incessamment l’orgueil patriotique, cette fibre si sensible des cœurs français. Aussi les a-t-on vus, depuis cette époque, exploiter avec un infernal machiavélisme tous les germes longtemps inertes des jalousies nationales, et réussir enfin à faire échouer toutes les négociations ouvertes avec l’Angleterre.
Peu de temps après, les gouvernements de France et de Belgique conçurent la pensée d’une fusion entre les intérêts économiques des deux peuples. Ce fut encore un sujet d’espérances pour l’industrie méridionale, d’alarmes pour le monopole manufacturier. Cette fois les chances n’étaient pas favorables au monopole ; il avait contre lui l’intérêt des masses, celui des industries souffrantes, l’influence du pouvoir, et tous les instincts populaires, prompts à voir dans l’union douanière le prélude et le gage d’une alliance plus intime entre ces deux enfants de la même patrie. Le journalisme, qui l’avait si bien secondé dans la question anglaise, lui était de peu de ressources dans la question belge, sous peine de se décréditer dans l’opinion. Tout ce qu’il pouvait faire, c’était de contrarier l’union douanière par des insinuations entourées de force précautions oratoires, ou de se renfermer dans une honteuse neutralité.
Mais la neutralité des journaux, dans la plus grande question qui puisse s’élever au sein de la France de nos jours, n’était pas longtemps possible. Le monopole n’avait pas de temps à perdre ; il fallait une démonstration prompte et vigoureuse pour faire échouer l’union douanière et tenir toujours notre Midi écrasé. C’est la mission qu’accomplit avec succès une assemblée de délégués, devenue célèbre sous le nom du député qui la présidait (M. Fulchiron).
Que faisaient pendant ce temps-là les intérêts vinicoles ? Hélas ! à peine parvenaient-ils à présenter laborieusement quelques traces informes d’association. Quand il aurait fallu combattre, des comités se recrutaient péniblement au fond de quelque province. Sans organisation, sans ressources, sans ordre, sans organes, faut-il être surpris s’ils ont été pour la seconde fois vaincus ?
Mais il serait insensé de perdre courage. Il n’est pas au pouvoir de quelques intrigues éphémères d’enterrer ainsi les grandes questions sociales, de faire reculer pour toujours les tendances qui entraînent vers l’unité les destinées humaines. Un moment comprimées, ces questions renaissent, ces tendances reprennent leur force ; et au moment où je parle, nos assemblées nationales ont été déjà saisies de nouveau de ces questions par le discours de la couronne.
Espérons que cette fois les comités vinicoles ne seront pas absents du champ de bataille. Le privilége a d’immenses ressources ; il a des délégués, des finances, des auxiliaires plus ou moins déclarés dans la presse ; il est fort de l’unité et de la promptitude de ses mouvements. Que la cause de la liberté se défende par les mêmes moyens. Elle a pour elle la vérité et le grand nombre ; qu’elle se donne aussi l’organisation. Que des comités surgissent dans tous les départements ; qu’ils se rattachent au comité central de Paris ; qu’ils grossissent ses ressources financières et intellectuelles ; qu’ils l’aident enfin à remplir la difficile mission d’être pour le pouvoir un puissant auxiliaire, s’il tend à l’affranchissement du commerce, un obstacle, s’il cède aux exigences de l’industrie privilégiée.
Mais entre-t-il dans vos attributions de concourir à cette œuvre ?
Eh quoi, Messieurs, vous vous intitulez Société d’Agriculture et du Commerce, vous êtes convoqués de tous les points du territoire, comme les hommes les plus versés dans les connaissances qui se rattachent à ces deux branches de la richesse publique, vous reconnaissez qu’épuisées par des mesures désastreuses, elles ne fournissent plus à la population, je ne dis pas le bien-être, mais même la subsistance, et il ne vous serait pas permis de prendre des intérêts aussi chers sous votre patronage, de faire ce que font tous les jours les Chambres de commerce ? Ne seriez-vous donc pas une Société sérieuse ? Le cercle de vos attributions serait-il légalement limité à l’examen de quelque végétal étranger, de quelque engrais imaginaire ou de quelque lieu commun d’agronomie spéculative ? et suffira-t-il qu’une question soit grave pour qu’à l’instant vous décliniez votre compétence !
J’ai la conviction que la Société d’Agriculture ne voudra pas laisser amoindrir à ce point son influence. J’ai l’honneur de lui proposer d’adopter la délibération suivante :
Projet de délibération.
La Société d’Agriculture et de Commerce des Landes, prenant en considération la détresse qui afflige la population de la Chalosse et de l’Armagnac, spécialement vouée à la culture de la vigne ;
Reconnaissant que cette détresse a pour causes principales l’impôt indirect, l’octroi et le régime prohibitif ;
En ce qui concerne l’impôt indirect, la Société pense que les propriétaires de vignes, aussi longtemps que l’État, pour faire face à ses dépenses, ne pourra se passer de ses revenus actuels, ne peuvent pas espérer qu’une branche aussi importante de revenus soit retranchée sans être remplacée par une autre ; mais elle n’appuie pas moins leurs justes protestations contre le régime d’exception où ce système d’impôt les a placés. Il ne lui semble pas impossible qu’on trouve, dans l’extension combinée avec la modicité de cette nature de taxe, et dans un mode de recouvrement moins compliqué, un moyen de concilier les exigences du Trésor, l’intérêt des contribuables, et la vérité du principe de l’égalité des charges.
C’est par une déviation semblable aux lois de l’équité que l’octroi a été autorisé à s’attacher presque exclusivement aux boissons. Eu se réservant le droit de sanction sur les tarifs votés par les communes, il semble que l’État n’ait pu avoir pour but que d’empêcher l’octroi, envahi par l’esprit d’hostilité industrielle, de devenir entre les provinces, ce qu’est la douane entre les nations, un ferment perpétuel de discorde. Mais alors il est difficile d’expliquer comment il a pu tolérer et seconder la coalition de tous les intérêts municipaux contre une seule industrie. Tous les abus de l’octroi seraient prévenus si la loi, restituant leurs franchises aux communes, n’intervenait dans les règlements du tarif que pour les arrêter à une limite générale et uniforme, qui ne pourrait être dépassée au préjudice d’aucun produit, sans distinction.
La Société attribue encore la décadence de la viticulture dans le département des Landes, à la cessation absolue de l’exportation des vins et eaux-de-vie par le port de Bayonne, effet que ne pouvait manquer de produire le régime prohibitif. Aussi, elle a recueilli, dans les paroles récentes du Roi des Français, l’espoir d’une amélioration prochaine de nos débouchés extérieurs.
Elle ne se dissimule pas les obstacles que l’esprit de monopole opposera à la réalisation de ce bienfait. Elle fera observer qu’en faisant tourner momentanément l’action des tarifs au profit de quelques établissements industriels, jamais la France n’a entendu aliéner le droit de ramener la douane au but purement fiscal de son institution ; que, loin de là, elle a toujours proclamé que la protection était de sa nature temporaire. Il est temps enfin que l’intérêt privé s’efface devant l’intérêt des consommateurs, des industries souffrantes, du commerce maritime des villes commerciales, et devant le grand intérêt de la paix des nations dont le commerce est la plus sûre garantie.
La Société émet le vœu que les traités à intervenir soient, autant que possible, fondés sur le principe du droit proportionnel à la valeur de la marchandise, le seul vrai, le seul équitable, le seul qui puisse étendre à toutes les classes les bienfaits des échanges internationaux.
Dans la prévision des débats qui ne manqueront pas de s’élever entre les industries rivales, à l’occasion de la réforme douanière, la Société croirait déserter la cause qu’elle vient de prendre sous son patronage, si elle laissait le département des Landes sans moyens de prendre part à la lutte qui se prépare.
En conséquence, et en l’absence de comités spéciaux, dont elle regrette de ne pouvoir, en cette circonstance, emprunter le concours, elle décide que la Commission vinicole, déjà nommée dans la séance du 17 avril 1842, continuera ses fonctions, et se mettra en communication avec les Comités de la Gironde et de Paris.
Copies de la présente délibération seront transmises, par les soins de M. le Secrétaire de la Société, à M. le Ministre du commerce, aux Commissions des Chambres qu’elles concernent et au secrétariat des Comités vinicoles.
FN:M. de Chabrol, Rapport au Roi.
FN:Mémorial de chronologie.
FN:Lavoisier.
FN:Annuaire du bureau des longitudes.
FN:Annuaire du bureau des longitudes.
FN:« Il est reconnu que, de toutes les matières imposables, les boissons sont celles sur lesquelles l’impôt peut être le plus considérable et le plus facilement perçu. » M. de Villèle.
FN:Je parle ici moins du ministre, dont les actes me sont inconnus, que du publiciste qui appartient notoirement à l’école d’Adam Smith.
« Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 1er article », Sentinelle des Pyrénées, 18 mai 1843, p. 3.↩
Introduction de l’éditeur :
Tout le monde a remarqué en province le silence incompréhensible qu’une grande partie de la presse parisienne a gardé sur le scandale de la concession du chemin de fer de Paris à la frontière du Nord. C’est là un des plus fâcheux résultats de la législation actuelle sur les journaux, que l’énormité du cautionnement, des frais de timbres et de poste constituent, pour ainsi dire, en état de monopole, tant sont difficiles et chanceuses les tentatives de concurrence. Notre ami, M. F. B., a été frappé comme nous tantôt du silence, tantôt de la partialité de la grande presse parisienne (à l’exception néanmoins du National) sur diverses questions industrielles et commerciales.
Comme nous partageons les opinions de M. Fr. B. sur la liberté du commerce en général, nous accueillons avec plaisir son travail, en lui laissant toutefois la responsabilité de la vivacité des formes, dans ce qui a trait à la presse de la capitale.
LIBERTÉ COMMERCIALE.
État de la question en Angleterre.
1er article.
Un journal disait, il y a quelques jours :
« Les grands intérêts du Nord ont soudoyé, depuis quelques années, une grande partie de la presse parisienne. »
Il ajoutait :
« Nous ne faisons pas un crime aux journaux parisiens d'avoir accepté une subvention des fabricants ; les médecins, les avocats vivent de leur travail et il n'y a rien d'immoral à ce qu’un écrivain soit rémunéré pour publier dans un journal des articles en faveur d'un intérêt, quand tous les jours M. Berryer, M. Barrot sont rémunérés pour avoir rédigé des mémoires en faveur d’intérêts purement individuels. »
Le sophisme saute aux yeux. M. Berryer donne ses plaidoyers pour des plaidoyens. Mais si, moyennant un salaire secret, il professait à la tribune des opinions autres que les siennes, serait-il justifié en disant : chacun vit de son travail.
Quoi ! le gérant de la Presse, fondateur de Coëtbo, se rallie à un système qui ruine l'agriculture ; mentant à leurs abonnés, à leurs antécédents et à leur propre titre, le Siècle ressuscite des théories du temps de Colbert, le Constitutionnel se fait le champion du privilège ; le Commerce combat la liberté du commerce, et cela parce qu'ils sont soudoyés pour faire prévaloir des doctrines qu'ils savent être anti-sociales, et l'on dit cyniquement : chacun vit de son travail ! C'est de vénalité qu'il fallait dire.
Et voyez les conséquences de cette corruption dans laquelle le Globe ne voit rien d'immoral.
Il ne faut pas croire que la presse n’a aliéné aux monopoleurs que ses convictions économiques.
Le monopole ne se bornera jamais à se défendre sur le terrain de la science ; il aurait contre lui les Turgot, les Smith, les Say, les Riccardo [sic], les Sismondi, les Mill, les Malthus, les Senior. Son plus sûr moyen d'éloigner la concurrence étrangère, c'est de brouiller la France avec les autres nations, et s'il soudoie la presse il entend bien qu'elle excite les passions haineuses, les défiances politiques, les jalousies nationales. Il faut dire qu'à cet égard le journalisme parisien a consciencieusement travaillé à gagner sa subvention, et l’on a pu lire dans un des journaux que nous nommerons tout à l'heure cette étrange maxime :
« Nous concevons l’impartialité dans nos discussions intérieures ; mais à l'égard de l'étranger l’impartialité est une trahison. »
La presse parisienne nous donne en ce moment une preuve remarquable de l’esprit qui l’anime.
On sait qu’en Angleterre, il n’est pas de question si futile ou si grave qu’elle soit, depuis la plus simple réforme d'un hospice jusqu'aux plus profondes altérations de la grande charte, qui ne donne lieu à des assemblées (meetings) où elles sont librement discutées. Comme toute nation est composée d'hommes d'opinions et de vues fort diverses, il ne faut pas être surpris si parmi ces milliers de meetings il s’en rencontre qui aient pour objet des questions indifférentes ou même hostiles à des intérêts français. Ce qui se dit en ce cas nous est soigneusement rapporté par nos journaux. Ainsi que quelques missionnaires protestants se réunissent pour déclamer contre l’invasion du catholicisme à Otahiti, la presse voit là une manifestation de l'inextinguible jalousie de la perfidie Albion.
Mais des meetings pour l'affranchissement du commerce, elle n'en dit pas un mot. Le monopole manufacturier ne le permet pas.
Et cependant, il ne s’agit plus des vaines doléances de quelques méthodistes désappointés. Il s’agit d’un mouvement immense, profond, qui remue jusque dans ses fondements le sol de la vieille Angleterre. — Au point de vue britannique, c'est la lutte des masses contre l'oligarchie, sur un terrain où celle-ci est prête à succomber. — Au point de vue français, ce sont vingt millions de consommateurs qui réclament, qui exigent le droit d'acheter librement nos produits. — Au point de vue humanitaire, c'est un effort désespéré pour déraciner le monopole : dans les îles britanniques par la puissance de l'opinion, dans le monde entier par l'autorité de l'exemple. — Voilà ce qui agite l'Angleterre, ce qui l'ébranle d'un mouvement passionné, fébrile, irrésistible, tel qu’il n’est pas donné à une même génération d’assister deux fois à un semblable spectacle. — Voilà ce qui attire les regards du monde entier ....... et nos journaux n’en disent rien.
Je tâcherai de suppléer à leur silence. Dans un prochain article je ferai connaître l’association pour la liberté du commerce, ses travaux, l'esprit qui l'anime, son mode d'action, ses progrès et ses chances.
Fr. B.
« Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 2ème article », La Sentinelle des Pyrénées, 25 mai 1843, p. 2.↩
LIBERTÉ COMMERCIALE.
État de la question en Angleterre.
2ème article.
Dans toutes les grandes questions qui divisent les hommes, il y a toujours trois partis, deux extrêmes opposés, un intermédiaire : une gauche, une droite et un centre.
En Angleterre, et dans la question qui nous occupe, un parti réclame la liberté des échanges ; il a son centre d'action dans l’Anti-corn-law-league, l'association contre la loi qui restreint l'importation des céréales.
Un autre parti défend la protection. C'est le torysme représenté par l'administration de sir Robert Peel.
Enfin la politique de conciliation a été renversée du pouvoir avec lord John Russell.
Mais dans quelle mesure réclame-t-on la liberté d'une part, la protection de l'autre ? C'est là précisément ce qui nous fera connaître l’état de la question en Angleterre ; car ces mots : liberté, protection, n'ont selon les temps et les lieux qu’une valeur relative, et de même qu'un homme très brun en France serait trouvé d'une blancheur éclatante en Afrique, il peut se faire que le progrès des lumières eût mis entre deux nations une différence telle que la même mesure qu'on regarde comme conservatrice dans l'une, fût trouvée témérairement réformatrice dans l'autre.
Pour remplir notre tâche, nous avons donc à exposer les doctrines, les prétentions et l'action des trois grands partis que nous venons de signaler.
La première réunion des partisans de la libre importation des céréales eut lieu il y a deux ans, à Manchester. Sept cents ministres dissidents, dont un grand nombre venus, sur l’appel de leurs co-religionnaires, des extrémités du royaume, posèrent les bases d'une formidable association. Bientôt elle se popularisa dans cette ville, au point que, faute d'un local assez vaste pour tenir ses séances, elle construisit en peu de semaines une salle capable de contenir dix mille personnes.
De Manchester l'association se propagea dans les comtés comme un incendie ; elle s'installa enfin à Londres où elle se réunit, de fondation, tous les mercredis, et au besoin tous les jours et deux fois par jour, d'abord au théâtre de Drury-Lane, ensuite au théâtre de la Reine. À l'étroit dans ces immenses édifices, elle s'occupe, à l'exemple de Manchester, d'en construire un qui aura trois mille mètres carrés.
Au 12 avril, 76 associations provinciales s'étaient affiliées au comité métropolitain. Celui-ci avait distribué 300 000 traités populaires d'économie sociale et un nombre incalculable de discours et de journaux ; on avait envoyé au parlement 3 922 pétitions couvertes de 5 030 757 signatures ; enfin il ne se passait pas de jours que le comité ne députât dans les provinces et particulièrement dans les comtés agricoles, des économistes distingués chargés de répandre les doctrines de la liberté parmi les classes les plus attachées au régime de la protection.
Le titre que l'association a choisi, Anti-corn-law-league, ligue contre la loi des céréales, semble d'abord restreindre son objet. Mais il ne faut pas perdre de vue que si le monopole est manufacturier en France, il est territorial en Angleterre ; le frapper dans la loi des céréales, c'est le frapper dans sa raison d'être : tous les partis sont d'accord sur ce point. Pour juger la portée de ses vues, il ne faut d'ailleurs que lire la motion que le comité a fait solennellement adopter par l'association.
« L'association ...... répudie tous monopoles, privilèges exclusifs et droits protecteurs quelconques, désire et demande l'abolition totale et immédiate de toutes restrictions du commerce, de toutes protections en faveur de l'agriculture, des manufactures et de la navigation, et l'entière destruction de tous les obstacles à la libre communication des Anglais avec tous les peuples du globe. »
C'est sur ce texte que d'habiles orateurs, des économistes profonds, des religionnaires enthousiastes dissertent tous les jours, pendant des heures entières, devant des assemblées de quatre ou cinq mille personnes de tous sexes et de tous rangs.
Nos mœurs nationales ne nous permettent guère de comprendre quelle sorte d’intérêt attire en foule à ces réunions des pairs du royaume, des députés, des dames du monde le plus élégant.
Mais il faut dire, ce qui servira peut-être à expliquer cet étrange phénomène, que la question économique prend en Angleterre des proportions colossales et faites pour remuer toutes les fibres des cœurs anglais.
Nous avons vu, en France, les plus hautes questions de commerce, de marine et de colonies venir, une à une, s'engager dans un simple débat de rivalité entre deux sucres.
Et pourtant, grâces à la révolution de 89, notre France, et je l'en félicite, est une table rase comparée à l'Angleterre avec l’inextricable complication de ses intérêts.
Là, l'affranchissement du commerce attaque dans toutes ses positions l'aristocratie et sa prépondérance politique.
Il l'attaque dans le monopole territorial, qui, par la cherté des subsistances et l'élévation artificielle du taux des fermages, soutire au profit des maîtres du sol le fruit des sueurs des classes laborieuses.
Il l'attaque dans sa suprématie religieuse en diminuant la valeur de la dîme et les profits des nobles dignitaires de l'église établie. Cela est si vrai, que la ligue a été fondée par des ministres dissidents, et que les écrits qui en émanent ont été publiquement brûlés par des prêtres anglicans au sein d'associations rivales.
Il l'attaque dans le système colonial, car celui-ci n’est autre chose qu’un contrat de protection réciproque entre les colonies et la mère-patrie. Et que dit l’association au peuple ? « Vous-êtes fiers de vos immenses possessions, mais vous donnent-elles rien pour rien et ne vous faut-il pas payer le sucre aux planteurs des Antilles et le bois aux colons du Canada comme vous les paieriez aux habitants du Brésil et des bords de la Baltique ? Seulement vous les payez au prix du monopole et vous supportez en outre les frais de conquête et de conservation. On vous dit que vos colonies prennent vos produits en retour. C'est ce que ferait l'étranger, à moins que saisis d'un accès de philanthropie, il ne lui plaise de vous inonder jusqu'aux genoux de vin, de sucre et de froment sans rien exiger de vous. C'est là l'illusion qu'on cherche à vous faire, et c'est certes la plus étrange dont on ait jamais entendu parler. Elle surpasse les cures par l'eau froide et les machines volantes. It beats cold water cures or flying-machines. » Qui profite donc des colonies ? L'aristocratie, qui distribue à ses cadets de famille les gouvernements, les hauts emplois, les commandements sur terre et sur mer, que le système colonial met à sa disposition.
On voit l'immense portée des vues de l'association. Je ne les exagère point. Voici ce que répondait, il n'y a pas huit jours, sir Robert Peel à M. Villiers qui a proposé à la chambre l'abolition immédiate et totale des droits sur les céréales.
« Je remercie l'honorable membre de la franchise de sa proposition. Elle ne tend pas à une réforme mesurée et progressive ; elle réclame l'application d'un principe. Qui peut nier que l'adoption de ce principe n'entraîne l'abolition de toute protection et la rupture du contrat colonial ? L'histoire n'offre qu'un exemple d'une réforme aussi radicale et aussi précipitée ; celle qu'opéra l'assemblée constituante, dans la fameuse nuit du 4 août, lorsqu'elle abolit à la fois tous les privilèges. »
C'est ainsi qu'une réforme économique en apparence touche à l'existence d'un ordre social qui a si longtemps pesé sur l'Angleterre et sur le monde. On le voit, l'œuvre de l'association est immense. Que d'intérêts, que de préjugés à combattre ! Si l'aristocratie anglaise a infligé à la Grande-Bretagne des plaies profondes, elle les a cachées sous des trophées, et les peuples, nous le savons, se déshabituent difficilement de la gloire. Sans doute la science et la raison démontrent que la gloire acquise par la conquête et l'oppression porte en elle-même le germe de sa fin. Elle exige au dedans des efforts croissants qui à la longue ne peuvent égaler les résistances qu'elle crée au dehors. Paix et liberté, tels sont les solides fondements de la sécurité, du bien-être et de la moralité des nations. Mais ce n’est pas l'œuvre d'un jour que de faire pénétrer ces idées chez un peuple fier de ses conquêtes illimitées, fier de ces deux grands instrumens, army and navy, qui ont étendu sa domination jusqu'aux extrémités de la terre, fier de cette aristocratie même qui l'opprime, mais qui, par son habileté et ses travaux, a su enfoncer profondément ses racines dans le sol britannique. Un haut degré de lumières et d'expérience pourrait seul expliquer cet acte inouï d'un tel peuple répudiant son passé et brisant une organisation vicieuse, mais empreinte d'un caractère vénérable de grandeur.
Il est donc essentiel qu'après avoir étudié les forces, les opinions et les vues du parti de la liberté, nous soumettions au même examen celles des défenseurs du monopole. Dans un prochain et dernier article, j'exposerai les actes accomplis, les concessions faites par l’administration Tory. Le lecteur verra dans quelle mesure elle diffère en fait et en principe des vues de l'association, et connaissant les deux termes extrêmes de l'opinion en Angleterre sur cette grande question, il sera peut-être à même de juger s'il y a quelque chance que ce peuple qui a donné au monde le premier exemple du jugement par le jury, du vote de l'impôt, de la représentation nationale et de l'affranchissement des esclaves, soit aussi destiné à lui donner le signal de l’affranchissement du commerce.
FR. B.
« Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 3ème article », La Sentinelle des Pyrénées, 1er juin 1843, p. 2.↩
LIBERTÉ COMMERCIALE.
État de la question en Angleterre.
3ème article.
Je ne doute pas que le lecteur, si je suis assez heureux pour en rencontrer qui prenne intérêt au sujet que je traite, ne soit disposé à me dire : mais selon votre propre exposé, l'affranchissement du commerce a moins de chances en Angleterre qu'en France ; ici, il n'est repoussé que par une fausse doctrine et par les intérêts industriels qu'elle protège ; là, outre ces obstacles, il a à lutter contre la puissance des lords, l'influence du clergé, un immense développement colonial, et la plus forte des passions populaires, l’orgueil national jaloux d'une suprématie maritime incompatible avec la libre communication des peuples. Pour vaincre de telles forces, qu'est-ce que ces Meetings, cette propagande de quakers et de non-conformistes, ces parodies de l'agitation irlandaise, ces pétitions, ces motions radicales toujours brisées par une majorité compacte ?
Mais si je venais à démontrer que le parti tory, celui-là même que les classes privilégiées ont envoyé à la législature avec mission expresse de maintenir le régime protecteur, celui-là même qui a saisi le pouvoir dans le but avoué de défendre l'aristocratie et les colonies contre les réformes proposées par l'administration des whigs ; si je venais à démontrer, dis-je, que ce parti a fait de grandes concessions, en doctrine et en fait, au principe de la liberté du commerce, on ne pourrait échapper à l’une de ces deux conséquences : ou ces concessions ont été volontaires, ce qui implique que les connaissances économiques ont fait assez de progrès dans les classes même qui exploitent le monopole pour les déterminer à y renoncer ; ou elles ont été forcées, ce qui révèle la toute-puissance d’une opinion qui aurait exercé du dehors une telle pression sur la législature.
On sait quelle était la situation de l’Angleterre à l’époque où le pouvoir passa des whigs aux torys. Crise financière, stagnation des affaires, guerre de la Chine, désastres de l'Afghanistan, misère du peuple, décroissance des recettes, déficit. Certes, le moment semblait mal choisi pour opérer sur les droits de douane une réduction dont l’effet inévitable devait être de diminuer encore, du moins momentanément, les revenus du trésor.
C'est cependant au milieu de ces circonstances que l'administration des whigs propose un dégrèvement profond et général des tarifs. Cette mesure entraînait une altération non moins profonde du contrat colonial. En effet, dès que la mère-patrie affranchissait son marché du monopole colonial, la justice voulait que les colonies ne fussent plus assujetties, pour leurs approvisionnements, au monopole métropolitain. Aussi lord John Russell proposait-il l'admission aux colonies anglaise des objets de consommation venant de l'étranger. C'était préparer les colonies à vivre au grand air de la liberté ; c'était un pas décisif vers leur affranchissement.
Cette politique n'a pas prévalu. Il nous reste à examiner celle qu'a adoptée le cabinet tory.
Le plus pressé était de combler le déficit. Sir Robert Peel eut recours à l’income-tax. Il obtint pour trois ans une taxe de 3% sur tout revenu s'élevant au-dessus de 3 750 fr.
Mais ce n'était là qu'une ressource temporaire. Au bout de trois ans, on devait se trouver en face du déficit, si l'on ne mettait pas le temps à profit pour rétablir, par des moyens réguliers, l'équilibre dans les finances.
J’ai quelque idée qu'en présence d’une telle situation, nos ministres eussent tourné leurs regards vers les patentes, les boissons, les centimes additionnels, et qu'ils se fussent hâtés de dire : il faut exiger de l'impôt tout ce qu'il peut rendre.
Sir Robert eut recours à une autre maxime et à d'autres moyens. Il dit : « Pour que les finances prospère, il faut que la nation prospère, et pour cela, il faut que tout anglais puisse aller par tout le globe acheter au meilleur marché et vendre au plus haut prix qu’il le pourra » — Et pour justifier les résolutions qu'il allait proposer, sans attendre des concessions de la part des étrangers, il ajoutait : « S’il plait aux autres nations de payer cher ce qu'elles peuvent avoir bon marché, libre à elles. »
En conséquence, il proposa et obtint la révision du tarif anglais. Voici quelques exemples de ces modifications :
DÉNOMINATION
Ancien tarif.
NOUVEAU TARIF
Observations.
d'origine étrangère.
des colonies.
Bœufs
Vaches
Veaux
Porcs
Moutons
Viande de bœuf, 50 k.
Id. de porcs, les 50 k.
Lard …. id.
Bœuf salé …. id.
Farine, le bushal
Huile d’olive, le ton.
Bois de construction
Prohibé
Idem.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
35
15
3 75
105
75
fr.c.
25
1875
1250
625
375
10
10
1750
10
62½
50
31
fr.c.
1250
937½
625
312½
187½
250
250
437
250
31¼
35
2625
Le droit était de 12 f. 50 c.
Cuirs
Souliers, bottes gants
580
250
125
Réduction d’environ 50%
Goudron 6 barils
Terebenthine, 50 K.
Café, la livre
Riz, le quarter
Pomme de terre
18
540
156
25
250
750
125
80
375
30
375
62½
40
10
10
Ce tableau abonde en curieux enseignements.
On y voit l’Angleterre ouvrant son marché à une foule de nos produits agricoles et industriels le jour même (28 juin 1842) où nous fermions le nôtre à ses fils et tissus de lin, sous prétexte que les Anglais filent et tissent a meilleur marché que nous ; comme si ce n’était pas une règle à l’usage des nations comme des plus humbles ménages de ne pas s'obstiner à faire chez soi ce qu’on peut se procurer ailleurs avec plus d'avantage. (L’ordonnance est du 26 juin et parvint à Londres au moment de la troisième et définitive lecture du bill.)
On y voit les torys, les propriétaires du sol, substituant à une prohibition absolue un droit modéré de 25 fr. par tête de bœuf, dans un pays où la consommation moyenne par habitant est de 35 kilogrammes, tandis que nous maintenons un droit de 55 fr., nous qui ne pouvons atteindre qu’à une consommation de 6 kil. 74 par habitant. (Dans les 21 départements du Midi occidental, la consommation moyenne est de 3 k. 65 ; dans les Landes, 1 kil. 91 ; dans les Basses Pyrénées, 0,80. Statistique de la France, publiée par le ministre du commerce.)
Enfin, quoique cette réforme tory diffère des projets des whigs en ce qu'elle maintient en faveur des colonies des droits différentiels, il est juste de reconnaître qu'au rebours de ce qui vient de se faire en France, à l'occasion des sucres, elle procède par voie de dégrèvement et non par voie d'aggravation. On ne remarquera dans ce tableau qu'une seule déviation à ce principe (à l'article bois de construction), et cette déviation est certes l'atteinte la plus directe portée au lien colonial.
Voilà donc ce qu'a pu le torysme dans un jour de triomphe. En théorie, répudier le principe de la protection ; en fait, user sa force non à l'accroître, non pas même à le maintenir, mais à ralentir sa chute, agissant comme ces machines qui, dans une pente rapide, pressent les roues d'une voiture ; elles ne l'arrêtent pas ; encore moins la font-elles rétrograder, elles se bornent à en modérer la vitesse.
Et qu'on ne s'imagine pas que ces concessions ont satisfait l'opinion publique. Un cri universel s'est élevé sur toute la surface des trois royaumes contre cette tentative incomplète, contre ce simulacre de réforme ; jamais les Meetings n'ont été plus fréquents, les pétitions plus nombreuses, les motions plus multipliées pour arriver à l'affranchissement complet des échanges, et j'ose affirmer, dussé-je heurter des opinions formées à la source suspecte du journalisme parisien, que cette agitation commerciale a un bien autre retentissement au parlement britannique que l'agitation Irlandaise elle-même, quelle qu'en soit la gravité.
Forcé de me restreindre, je me bornerai à dire quelques mots de la motion de M. Riccardo, parce qu'elle intéresse notre pays.
On a pu remarquer dans le tableau précédent l'absence de deux articles aussi importants que le vin et le sucre, comme moyens d'échanges, comme objets de consommation. Sir Robert Peel avait déclaré qu’étant en négociations avec la France, l'Espagne, le Portugal et le Brésil, il avait cru devoir réserver ces deux articles comme moyen de déterminer la conclusion des traités.
M. Riccardo a vu dans cette réserve une déviation au principe de la liberté ; car, dit-il, nous ne devons nous occuper que d'amener parmi nous l'abondance de toutes choses, et ne pas négliger un bien actuellement réalisable dans l'espoir d'atteindre des avantages éventuels. En conséquence, il fit à la chambre des communes une motion ainsi conçue :
« La chambre est d'avis qu'il n'y a pas lieu à ajourner le dégrèvement pour en faire la base de négociations avec les nations étrangères. »
Cette motion a été repoussée sur des observations de sir Robert Peel, que la Presse qualifie de violentes. Elle ajoute : l'Angleterre fait prêcher la liberté du commerce par ses missionnaires ; mais elle se garde bien de l'adopter pour elle-même. Son but est de faire avec les autres peuples des traités léonins, etc., etc.
Or, ce discours violent de sir Robert peut se résumer ainsi : « Je regarde le système protecteur comme erroné et funeste. Je crois que nos tarifs sont un mal et que ceux des étrangers en sont un autre. M. Riccardo ne veut remédier qu’au premier ; j'aspire à remédier à tous les deux et j'y réussirai, si je stipule avec les étrangers des concessions réciproques. Mais comment offrirai-je des concessions, si vous m'obligez à dégrever immédiatement et sans conditions, le petit nombre d'articles que je me suis réservés comme moyens de négociation. »
Je prie le lecteur de remarquer sur quel terrain était établi le débat, et de se demander ce qu’il adviendrait à la chambre des députés d'une proposition qui aurait pour objet le renversement de tout notre système protecteur sans tenir aucun compte des dispositions des étrangers à notre égard. Il est douteux qu'elle ralliât deux suffrages.
Je terminerai cet article, déjà trop long, par une réflexion affligeante pour des Français, et surtout pour des Français du Midi.
Il est évident, d'après ce qui précède, qu'il y a eu un moment où il eût été facile de conclure avec l'Angleterre un traité dont les stipulations ne nous auraient pus été marchandées. L’abaissement que sir Robert Peel a fait subir aux tarifs anglais, sans rien exiger de nous en retour, implique qu'il eût tenu les portes grandes ouvertes à nos produits, si nous eussions consenti à ce que nous nommons si improprement des concessions. L’occasion n’a pas été saisie. Peut-être ne faut-il pas trop en accuser le ministère. Après tout, chez les peuples constitutionnels, c’est l’opinion qui fait la loi : et quel peut être l’état de l'opinion dans un pays où le journal qui s'adresse spécialement aux négociants, le journal qui s'intitule le Commerce, déshonore tous les jours ses colonnes par des articles tels que celui-ci :
« Les motions qui se succèdent dans le parlement anglais sur la nécessité d'apporter un remède aux souffrances des classes laborieuses renferment des renseignements trop graves pour qu'elles ne fixent pas l'attention de nos hommes d'état, surtout au moment où on parle d'un traité de commerce avec nos voisins d’outre mer .... Devons-nous songer à lier des relations commerciales avec un peuple placé dans une semblable situation … Combien ne devons-nous pas craindre, ne devons-nous pas surtout éviter soigneusement de nous exposer à gagner cette lèpre du paupérisme, cette contagion de misère, en multipliant les points de contact avec un peuple qui en est infecté à un si haut degré … Gardons-nous de nous laisser inoculer par notre propre faute ce mal du paupérisme, qu'on ne désignera bientôt plus que sous le nom de mal anglais. »
Fr. B.
La Reforme postale (3 and 6 August, 1844) ↩
BWV
1844.08.03 “La Reforme postale” (Postal Reform), the *Sentinelle des Pyrénées* (Bayonne), 3 and 6 August, 1844 [not in OC] [JCPD]
Editor’s Introduction↩
En Angleterre, en 1837, Rowland Hill fit un rapport pour démontrer l'avantage du tarif unique au moyen d'enveloppes spéciales coutant 1 penny. Peu de temps après, James Chandler reprit l'idée et inventa le timbre-poste, qui fut appliqué au courrier anglais en 1840.
En France, dès 1837, un haut fonctionnaire des postes, M. Piron, publia un ouvrage dans lequel il montrait l'intérêt d'une tarification unique du courrier. Cette idée mit du temps à émerger et en juillet 1844, une commission dont le rapporteur était M. Chegaray établit la supériorité de la taxe unique. En juillet 1844, la chambre des députés l'adopta dans un premier temps à une courte majorité (130 contre 129). Mais la proposition échoua le lendemain en deuxième lecture. Bastiat la défendit énergiquement dans deux articles parus dans la Sentinelle des Pyrénées de Bayonne les 3 et 6 août.1844.
Le débat reprit en 1846. Bastiat défendit de nouveau énergiquement la taxe unique au moyen de deux articles parus dans Le Mémorial Bordelais des 23 et 30 avril 1846 et qui suivent ces deux-ci.
La réforme ne fut finalement adoptée qu'en 1848!
Ces quatre textes, comme celui que l'on verra plus loin sur la répartition de l'impôt foncier dans les Landes, montre que Bastiat savait aussi se servir des chiffres et faire de l'arithmétique pour rendre ses démonstrations irréfutables.
J. de G.
ARTICLES PUBLIES DANS LA SENTINELLE DES PYRENEES
(AOUT 1844).
PREMIER ARTICLE
Les conseils généraux vont être appelés à donner leur avis sur la tarification uniforme de toutes les lettres à vingt centimes. Je crois devoir appeler l'attention de ces assemblées sur le rapport de M. Chegaray à ce sujet. L'objection la plus spécieuse que l'on ait faite contre la réforme postale, c'est qu'elle semble s'écarter de l'exacte justice. L'administration blesserait l'équité, a-t-on dit, si elle soumettait à la même taxe des lettres qu'elle porte à des distances qui varient de un à neuf cents kilomètres. Il est impossible après la lecture du rapport vraiment lumineux de M. Chegaray de se laisser arrêter un moment par une semblable objection.
1043. On sait que, chaque bureau de poste est le centre de onze cercles concentriques diversement espacés. Le port d'une lettre simple s'accroît de dix centimes à mesure qu'elle franchit un de ces cercles, en sorte que la moindre taxe étant de vingt centimes, la plus élevée est de 1 fr. 20 c. 1044. 1045.
Mais il entre trois éléments dans la taxe d'une lettre :
1° Les frais de locomotion;
2° Les frais généraux d'administration;
3° L'impôt.
De ces trois éléments, le premier est le seul qui par sa nature soit variable. L'administration dépense plus pour porter une lettre de Paris à Bayonne que pour la porter à Orléans.
Les frais généraux d'administration retombent d'une manière égale sur toutes les lettres. Celles qui s'arrêtent à Orléans n'occasionnent pas moins de dépenses de direction, inspection, tri, taxe, distribution, etc., que celles qui arrivent jusqu'à Bayonne.
Il en est de même de l'impôt. On ne dira pas sans doute que l'égalité des charges serait violée si toutes les lettres concouraient également au revenu public.
La loi de 1827 n'a tenu aucun compte de ces destinations. Il en est résulté que la taxe qu'elle a établie est certainement l'impôt le plus inégalement réparti de tous ceux qui entrent dans notre système financier.
M. Chegaray a recherché quel est, pour une lettre donnée, le chiffre qui correspond aux trois natures de charges que nous venons d'énumérer.
Il a trouvé que les frais de locomotion s’élèvent de 1 c. 3/.4 à 6 c. 3/4, selon la distance.
Les frais généraux coûtent à l'administration 8 c. par lettre.
La différence entre la somme de ces deux dépenses avancées par l'administration et la taxe qu'elle recouvre, fait connaître l'impôt payé par le destinataire.
Cela posé, voici un tableau qui reproduit et décompose exactement le système actuel :
SYSTEME ACTUEL
TAXE
FRAIS GENERAUX
FRAIS DE LOCOMOTION
IMPOTS
TOTAL
1066. f 1067. 1068. c 1069.
1071. f 1072. 1073. c 1074.
1076. f 1077. 1078. c 1079.
1081. f 1082. 1083. c 1084.
1086. 1ère zone au-dessous de 40k. 1087. 1088. 20 c 1089.
1091. 0 1092. 1093. 08 1094.
1096. 0 1097. 1098. 1 3/4 1099.
1101. 0 1102. 1103. 10 1/4 1104.
1106. 0 1107. 1108. 20 1109.
1111. 2ème id…….......de 40 à 80 1112. 1113. 30 1114.
1116. 1117. 8 1118.
1120. 1121. 2 1/4 1122.
1124. 1125. 19 3/4 1126.
1128. 1129. 30 1130.
1132. 3ème id…….....de 80 à 150 1133. 1134. 40 1135.
1137. 1138. 8 1139.
1141. 1142. 2 3/4 1143.
1145. 1146. 29 1/4 1147.
1149. 1150. 40 1151.
1153. 4ème id……...de 150 à 220 1154. 1155. 50 1156.
1158. 1159. 8 1160.
1162. 1163. 3 1/4 1164.
1166. 1167. 38 3/4 1168.
1170. 1171. 50 1172.
1174. 5ème id……...de 220 à 300 1175. 1176. 60 1177.
1179. 1180. 8 1181.
1183. 1184. 3 3/4 1185.
1187. 1188. 48 1/4 1189.
1191. 1192. 60 1193.
1195. 6ème id……...de 300 à 400 1196. 1197. 70 1198.
1200. 1201. 8 1202.
1204. 1205. 4 1/4 1206.
1208. 1209. 57 3/4 1210.
1212. 1213. 70 1214.
1216. 7ème id……...de 400 à 500 1217. 1218. 80 1219.
1221. 1222. 8 1223.
1225. 1226. 4 3/4 1227.
1229. 1230. 67 1/4 1231.
1233. 1234. 80 1235.
1237. 8ème id……...de 500 à 600 1238. 1239. 90 1240.
1242. 1243. 8 1244.
1246. 1247. 5 1/4 1248.
1250. 1251. 76 3/4 1252.
1254. 1255. 90 1256.
1258. 9ème id……...de 600 à 750 1259. 1260. 100 1261.
1263. 1264. 8 1265.
1267. 1268. 5 3/4 1269.
1271. 1272. 86 1/4 1273.
1275. 1 1276. 1277. 00 1278.
1280. 10ème id…….de 750 à 900 1281. 1282. 110 1283.
1285. 1286. 8 1287.
1289. 1290. 6 1/4 1291.
1293. 1294. 95 3/4 1295.
1297. 1 1298. 1299. 10 1300.
1302. 11ème id 1303. 1304. au-dessus de 900 1305. 1306. 120 1307.
1309. 1310. 8 1311.
1313. 1314. 6 3/4 1315.
1317. 1 1318. 1319. 05 1/4 1320.
1322. 1 1323. 1324. 20 1325.
Les personnes qui repoussent la réforme postale par esprit d'équité seront surprises sans doute à l'aspect de l'inégalité vraiment monstrueuse qui se révèle dans le tableau précédent.
Tandis que cette portion de la taxe qui est la juste rémunération des services rendus par la poste, qui se trouve comprise tout entière dans les colonnes 1 et 2 ne s'élève que de 9 3/4 à 14 3/4 c., c'est-à-dire dans la proportion de 1 à 1 1/2, cette autre part qui doit être considérée comme une pure contribution monte de 10 c à 1fr.05c ou dans le rapport de 1 à 11.
Recherchons maintenant quelle serait l'inégalité qui résulterait, au point de vue de l'impôt, de la tarification uniforme à 20 centimes.
Rémunération (1)
Contribution
Total
1333. 1re zone… 1334. 1335. fr 1336. 1337. » 09 3/4 c 1338.
fr » 10 1/4 c
1341. fr 1342. 1343. » 20 c 1344.
1346. 2ème zone… 1347. 1348. » 10 1/4 1349.
1351. 1352. » 1353. 1354. 9 3/4 1355.
1357. 1358. » 20 1359.
1361. 3ème zone… 1362. 1363. » 10 3/4 1364.
1366. 1367. » 1368. 1369. 9 1/4 1370.
1372. 1373. » 20 1374.
1376. 4ème zone… 1377. 1378. » 11 1/4 1379.
1381. 1382. » 1383. 1384. 8 1/4 1385.
1387. 1388. » 20 1389.
1391. 5ème zone… 1392. 1393. » 11 3/4 1394.
1396. 1397. » 1398. 1399. 8 3/4 1400.
1402. 1403. » 20 1404.
1406. 6ème zone… 1407. 1408. » 12 1/4 1409.
1411. 1412. » 1413. 1414. 7 3/4 1415.
1417. 1418. » 20 1419.
1421. 7ème zone… 1422. 1423. » 12 3/4 1424.
1426. 1427. » 1428. 1429. 7 1/4 1430.
1432. 1433. » 20 1434.
1436. 8ème zone… 1437. 1438. » 13 1/4 1439.
1441. 1442. » 1443. 1444. 6 1/4 1445.
1447. 1448. » 20 1449.
1451. 9ème zone… 1452. 1453. » 13 3/4 1454.
1456. 1457. » 1458. 1459. 6 3/4 1460.
1462. 1463. » 20 1464.
1466. 10ème zone… 1467. 1468. » 14 1/4 1469.
1471. 1472. » 1473. 1474. 5 1/4 1475.
1477. 1478. » 20 1479.
1481. 11ème zone… 1482. 1483. » 14 3/4 1484.
1486. 1487. » 1488. 1489. 5 3/4 1490.
1492. 1493. » 20 1494.
(1) On aadditionné les frais généraux et les frais de locomotion.
Ici l'inégalité procède en sens inverse. C'est la lettre qui parcourt la plus grande distance qui paie le moindre impôt. Mais cette inégalité n'est qu'idéale, tant elle est minime, puisqu'elle se meut dans les bornes étroites des divisions d'un sou.
Remarquez en effet que, pour arriver à une égalité parfaite, en partant de 20 c. pour la plus petite distance, il faudrait que les lettres fussent taxées ainsi :
1ère zone
1500. 1501. 20c 1502.
2ème ……………..
1505. 1506. 20 1/2 1507.
3ème ……………..
1510. 1511. 21 1512.
4ème ……………..
1515. 1516. 21 1/2 1517.
5ème ……………..
1520. 1521. 22 1522.
6ème ……………..
1525. 1526. 22 1/2 1527.
7ème ……………..
1530. 1531. 23 1532.
8ème ……………..
1535. 1536. 23 1/2 1537.
9ème ……………..
1540. 1541. 24 1542.
10 ème …………..
1545. 1546. 24 1/2 1547.
11ème…………….
1550. 1551. 25 1552.
N'avais-je pas raison de qualifier d'idéale une égalité qui ne saurait passer dans la pratique sans entraîner la création de demi-centimes?
La réforme postale peut soulever de graves questions. Je n'ai prétendu en traiter qu'une, celle de l'égalité des charges. J'ai voulu montrer aux personnes qui se font scrupule d'admettre la taxe uniforme, dans la persuasion qu'elle blesse l’équité, qu'elles sont complètement dans l'erreur. Toute taxe graduelle la blesse davantage par la raison très simple qu'il n'y a pour les frais de locomotion qu'un sou de différence entre la lettre qui parcourt la moindre distance et celle qui traverse tout le royaume. L'habitude seule a pu produire l'illusion que je cherche à détruire. Pourquoi, par amour de l'égalité, ne demande-t-on pas que les journaux soient soumis à la taxe progressive?Pourquoi n'exige-t-on pas que le tabac et les poudres se vendent d'autant plus chers que les dépôts sont plus éloignés des lieux de fabrication? Parce qu'on comprend que les frais de transport entrent pour si peu dans le prix de ces choses qu'il vaut mieux n'en pas tenir compte que d'embarrasser l'administration dans les minuties d'une comptabilité inextricable. — Le même motif milite, avec plus de force, en faveur du tarif uniforme des lettres.
. Frédéric Bastiat
DEUXIEME ARTICLE
J'ai démontré que la réforme postale est conforme à l'égalité des charges au lieu de s'en éloigner comme beaucoup de personnes paraissent le croire.
Débarrassé de cette fin de non recevoir, il me reste à examiner la question en elle-même, dans ses rapports avec les intérêts généraux et fiscaux.
Quant aux avantages pour le public, de la taxe uniforme et modérée, il ne peut y avoir de doute.
1561. « Il faut beaucoup de philosophie, dit Rousseau, pour apercevoir ce qu'il y a de merveilleux dans les phénomènes qui frappent incessamment nos regards.» Cette remarque s'applique avec justesse à la faculté de correspondre par lettres. Quel spectacle plus surprenant que celui-de deux êtres humains séparés par d'immenses distances, par des rivières, des montagnes, des mers, se communiquant néanmoins à jour et à heure fixes, leurs projets les plus secrets, leurs sentiments les plus intimes, sans que, dans le trajet, personne puisse surprendre les confidences de leur cœur! Lorsque l'onvient ensuite à songer qu'il n'est pas un membre de la grande famille humaine qui ne puisse ainsi correspondre avec un autre, que le nombre des combinaisons possibles s'élève par conséquent à l'infini, et que cependant il y a, pour chacune d'elles, des hommes, des chevaux, des voitures, des navires toujours prêts, afin que ces messages du cœur, n'importe le point de départ, quel que soit le lieu de destination, traversent l'espace par la ligne la plus directe et avec la plus grande rapidité. On demeurestupéfait devant cette puissance de la civilisation. — Mais le fisc ne tarde pas à intervenir. Il a calculé la force des affections, il a mesuré l'entrainement des sympathies, et il. ne craintpas de demander, pour .le service qu'il' rend un prix qui peut s'élever à dix fois ce qu'il lui coûte. 1562. 1563.
Dès lors la faculté de correspondre se restreint Oun'écrit plus pour les affaires douteuses ; on n'écrit plus pour faire part de son bonheur ou de sa joie ; on attend que 1’infortune et la tristesse aient fait naître cet irrésistible besoin d'épanchement que le calcul n'arrête pas. Malheur au pauvre; malheur au vieillard dont les bras énervés soutiennent à peine l'existence; il faudra qu'il se résigne à ne savoir que tous les mois, tous les ans peut-être, si le cœur de sa fille bat encore!
La philanthropie ne nous empêche pas de reconnaître que cette partie de la, taxe des lettres, qui est la juste rémunération du service rendu par l’administration, doit rester à la charge du destinataire. Mais il faut reconnaître aussi que cette autre portion de la taxe, qui est un pur impôt, doit être uniforme et surtout modérée; uniforme, car, je le demande, est-iljuste que plus on est séparé des êtres qu'on aime, moins on a l'occasion de les voir, de se réunir à eux, et plus l'on paie, je ne dis pas de frais, mais de contributions, à l'occasion des lettres qu'on en reçoit? Modérée, parce que cet impôt est le plus dur de tous qui tend à restreindre les joies morales et àinfliger à l'âmedes privations et des tourments.
Mais le fisc ne raisonne pas ainsi. S'il n'est pas méchant, il est égoïste. Il accueillera volontiers une réforme financière ; mais à la condition sine qua non qu'elle ne lui arrachera pas une obole. Examinons donc la mesure sous le rapport fiscal.
Nous croyons que M. Chegaray est dans l'erreur lorsqu'il dit dans son rapportque la réforme postale adoptée il y a quatre ans en Angleterre,n'a ni complètement justifié, ni complètementtrompé les calculs de ses auteurs.Si ces calculs ont ététrompés; c'est par un succèsinespéré. Ilest vrai que les intérêts généraux entraient pour beaucoup dans les motifs du cabinet qui réalisa cette grande mesure, que M. Chegaray n'examine qu'au point de vue financier. Mais, sous ce rapport encore, il n est pas exact de dire qu'elle n'a pas complètement justifié les prévisions, car elle lesa certainement dépassées. — La recette a fléchi, dit-on; mais est-ce que ce résultat n'était pas attendu ? En réduisant la taxe de 90 c. qui étaitle taux moyen, à 10c, prix qui, chez nous, serait à peine rémunérateur, jamais le cabinet whig n'a eu la pensée que le revenu des postes n'en serait pas altéré. Il a compté sur une correspondance plus active, sur un accroissement de transactions, de richesses, lequel améliorerait les autres sources du revenu public. Il a espéré subsidiairement que la réforme de la poste, permettant, de diminuer la dépense en même temps qu'elle favoriserait la circulation, la recette même de cette administration égalerait à la. longue celle qui était le produit du système des taxes graduelles et élevées.
A-t-il été trompé dans ces prévisions? Il avait calculé qu'il faudrait cinq ans pour que le nombre des lettres fût doublé, et il est triplé dans quatre ans. En 1839 le Post-Office avait distribué 65 millions de lettres, il en a distribué 209 millions en 1843. Sans la réforme, une telle circulation eût imposé au public le sacrifice de 185 millions de francs, tandis qu'il n'a eu à payer que 20 millions. Le Port-Office a cependant réalisé, pourtous les services dont il est chargé, un produit net de 15 millions, tandis que notre administration n'a laissé, en excédent des recettes sur les dépenses, que 18 millions. Ce que le fisc a perdu en Angleterre est donc peu de chose, ce que le .public a gagné estincalculable surtout s'il était possible de tenir compte de la masse d'affaires accomplies et d'affections satisfaites que cette énormecirculationsuppose. Certesjamais réforme n'a aussi complètement atteint son but.
Le plan auquel paraissent se rallier en France tous les esprits est la tarification uniforme à 20 centimes. Le taux moyen de la taxe actuelle étant de 42 c. 1/2, la remise faite au contribuable serait donc de moitié, tandis qu'elle a été en Angleterrede huit neuvièmes. Il ne faut donc s'attendre ni à un déficit aussi grave dans la recette fiscale, ni à un accroissement aussi rapide dans la circulation des lettres. Les avantages et les inconvénients de la réforme seront modérés comme laréforme elle-même. Tandis qu'en Angleterre il faut que le nombre des lettres portées par les malles soit neuf fois plus considérable, c’est-à-dire qu'il s'élève de 65 millions à 585 millions, pour que le déficit des recettes soit comblé, ilsuffira en France que le mouvement épistolaire soit doublé et porté de 8o à 171 millions de lettres. Quand ce fait sera accompli, le fisc des deux côtés du détroit, aura reconquis toute sa proie et le public aura gagné 17 millions de francs en France et 468 millions de francs en Angleterre ; par où l'on voit que si l'on a reproché à la réforme britannique d'être trop radicale, c'est parce qu'on a trop la malheureuse habitude de ne juger ces sortes de mesures qu'au point de vue fiscal et sans s'occuper des intérêts du public.
Mémoire sur la répartition de l'impôt foncier dans les Landes [1844]↩
BWV
1844.?? "De la répartition de la contribution foncière dans le Département des Landes" (On the Apportionment of the Land Tax in the Department of Les Landes) [OC1.5, pp. 283-333]
De la répartition de la contribution foncière dans le département des Landes
1844
Je me propose d’établir quelques faits qui me paraissent propres à jeter du jour sur ces deux questions :
1° Les forces contributives des trois grandes cultures du département des Landes, le pin, la vigne, les labourables, furent-elles équitablement appréciées lorsqu’on répartit l’impôt entre les trois arrondissements ?
2° Depuis la répartition, est-il survenu des circonstances qui ont changé le rapport de ces forces ?
S’il résultait de ces faits
Que, dès l’origine, la région des pins fut ménagée et celle des vignes surchargée ;
Que, depuis, l’une a constamment prospéré et l’autre constamment décliné ;
Il faudrait conclure qu’aujourd’hui celle-ci paye trop par deux motifs :
Parce qu’on aurait, en 1821, exagéré sa force contributive ;
Parce que, depuis 1821, cette force aurait diminué ;
Et que celle-là ne paye pas assez :
Parce qu’en 1821 ses revenus auraient été atténués ;
Parce que, depuis 1821, ses revenus se seraient accrus.
Je ferai mieux comprendre ma pensée par des chiffres.
Soient deux portions de territoire, P et V, donnant ensemble, et chacune par moitié, un revenu net de 10,000 fr.
Soient 1,000 fr. d’impôts ou 1/10 du revenu à répartir entre elles.
Cette répartition devra équitablement se faire ainsi :
P pour un revenu de 5,000 fr., 500 fr. d’impôts, ou 1 fr. sur 10.
V pour un revenu de 5,000 fr., 500 fr, d’impôts, ou 1 fr, sur 10.
| Mais si l’on atténue la force contributive de P d’un cinquième, la réduisant à . . . . . | 4,000 fr., |
| et si l’on exagère celle de V d’un cinquième, la portant à . . . . . | 6,000 fr., |
La répartition se fera ainsi :
P pour un revenu réel de 5,000 fr, supposé de 4,000 fr., 400 fr. d’impôts, 1 fr. sur 12 fr. 50 c. ;
V pour un revenu réel de 5,000 fr., supposé de 6,000 fr., 600 fr. d’impôts, 1 fr. sur 8 fr. 50 c.
Tant que les forces contributives de ces deux portions de territoire continueront à être égales, l’injustice se bornera à ôter un quart de la contribution à P pour la faire supporter par V.
Mais si, au bout d’un certain nombre d’années, le revenu réel de P s’élève de 5,000 fr. à 6,000 fr., tandis que celui de V tombe de 5,000 fr. à 4,000 fr.,
La répartition devient :
P pour un revenu supposé de 4,000 fr., mais en réalité de 6,000 fr., — 400 fr. ou 1 fr. sur 15 fr. ;
V pour un revenu supposé de 6,000 fr., mais en réalité de 4,000 fr., — 600 fr. ou 1 fr. sur 6 fr. 66 c.
Par où l’on voit qu’une contrée peut insensiblement rejeter sur une autre plus de la moitié de son fardeau.
PREMIÈRE QUESTION.
La répartition se fit-elle d’une manière équitable en 1821 ?
La règle générale est que l’impôt doit frapper le revenu.
Pour connaître le revenu des terres, on a appliqué à leurs productions le prix moyen des denrées déduit des quinze années antérieures à 1821.
Cependant, un seul mode d’opération peut conduire à des erreurs. On a cru les atténuer en cherchant le revenu par un autre procédé. Les actes de vente ont fait connaître la valeur capitale de certains domaines, et l’intérêt à 3 1/2 pour 100 du capital a été censé représenter le revenu.
On se trouvait donc, pour le même domaine, en présence de deux revenus révélés par deux procédés différents ; et l’on a établi l’impôt sur le revenu intermédiaire, d’après l’autorité de cet axiome : La réalité est dans les moyennes.
Malheureusement ce n’est pas le vrai, mais le faux, qui est dans les moyennes, quand les données d’où on les déduit concourent toutes vers la même erreur.
Examinons donc l’usage qui a été fait de ces deux bases de la répartition de l’impôt ; le prix moyen de denrées et les actes de vente.
§ I. — Les prix des denrées, dit M. le Directeur des Contributions directes, ont été fixés, dans les opérations cadastrales, année moyenne, savoir :
| Froment | 18 | fr. | 77 | c. | l’hect. — Vin rouge 28 à 60 fr. |
| Résine | 2 | fr. | 50 | c. | les 50 kilog. |
| Seigle | 12 | fr. | 76 | c. | l’hect. — Vin blanc 10 à 22. |
| Maïs | 11 | fr. | 33 | c. |
Je suis convaincu que cette première base d’évaluation présente plusieurs erreurs de fait et de doctrine, toutes au profit des pins et au préjudice des labourables et des vignes.
Les prix des céréales sont évidemment très-élevés. Je ne veux pas dire qu’on n’a pas suivi exactement les données fournies par les mercuriales ; mais la période de 1806 à 1821, soit parce qu’elle embrasse des temps de troubles et d’invasions, soit par toute autre cause, a donné des éléments d’évaluation peu favorables aux communes agricoles. La preuve en est que, dans les quinze années suivantes, de 1821 à 1836, et d’après M. le Directeur lui-même, ces prix moyens sont tombés à fr. 17,13 pour le froment, 11,27 pour le seigle, et 9,17 pour le maïs.
La première série avait donné, pour toutes sortes de céréales, une moyenne de 14 fr. 28 c. La seconde ne donne que 12 fr. 32 c. : différence 1 fr. 96 c. ou 14 pour 100.
Si donc la répartition se fût faite en 1836, le revenu des terres labourables eût été évalué à 14 pour 100 au-dessous de ce qu’on l’estima en 1821.
Quant aux prix assignés aux vins blancs, savoir 10 fr. et 22 fr., suivant les qualités, ils ne me semblent pas exagérés.
Il n’en est pas de même des vins rouges. S’il est quelques vignobles qui produisent du vin de qualité assez supérieure pour qu’il se vende, net et au pressoir, à 60 fr. (ce que j’ignore), je puis du moins affirmer que les qualités inférieures sont loin de trouver le prix de 28 fr. en moyenne, ce qui suppose 35 fr. trois mois après la vendange et avec la futaille.
Mais c’est surtout le prix de la résine qui me semble donner prise à la critique. En admettant ce chiffre évidemment atténué de 2 fr. 50 c. les 50 kilog., l’administration et la commission spéciale prévoyaient, sans doute, qu’elles s’exposaient à laisser planer sur toutes leurs opérations un soupçon de partialité. Ce soupçon n’a pas manqué. Les populations agricoles et vinicoles du département sont sous l’influence d’une méfiance qu’il serait difficile de détruire. On se plaint de cette méfiance, on dit qu’elle fait obstacle à la réforme dont on s’occupe ; mais la responsabilité n’en revient-elle pas exclusivement aux procédés qui l’ont fait naître ?
Je vais maintenant présenter quelques observations sur ce que j’ai nommé : Erreurs de doctrine, c’est-à-dire sur la manière erronée dont on forme les moyennes et sur les fausses conséquences que l’on en déduit.
D’abord, pour que le prix des qualités supérieures combiné avec celui des qualités inférieures donnât un prix moyen réel, en harmonie avec le revenu réel, il faudrait qu’il se récoltât autant des unes que des autres, ce qui, pour le vin, est contraire à la vérité. Le département des Landes en produit beaucoup plus de médiocre que de bon ; et en négligeant cette considération, on arrive à une moyenne exagérée. Exemple : soient 100 pièces de vin à 28 fr. et 10 pièces à 60 fr., la moyenne des prix considérés en eux-mêmes, est bien 44. fr. Mais la moyenne des prix réels accusant le revenu, c’est-à-dire des sommes recouvrées pour chaque barrique l’une dans l’autre, n’est que de 30 fr. 91 c.
Ensuite, lorsqu’on introduit un prix élevé dans la série de ceux qui doivent concourir à former une moyenne, celle-ci s’élève, d’où l’on conclut à une élévation correspondante de revenu. Or, cette conclusion n’est ni rigoureuse en théorie, ni vraie en pratique.
Je suppose que pendant quatre ans une denrée se vend à 10 fr., — la moyenne est 10 fr. Si la cinquième année cette même denrée se vend à 20 fr., on a pour les cinq années une moyenne de 12 fr. — L’opération arithmétique est irréprochable. Mais si l’on en conclut que, pour ces cinq années, le revenu est représenté par 12 au lieu de l’être par 10, la conclusion économique sera au moins fort hasardée. Pour qu’elle fût vraie, il faudrait que le produit, en quantité, eût été égal, pendant cette cinquième année, à celui des années précédentes, ce qui ne peut pas même se supposer, dans les circonstances ordinaires, puisque c’est précisément le déficit dans la récolte qui occasionne l’élévation du prix.
Pour obtenir des moyennes qui représentent la réalité des faits, et dont on puisse induire le revenu, il faut donc combiner les prix obtenus avec les quantités produites, et c’est ce qu’on a négligé de faire. — Si, dans la nouvelle répartition dont on s’occupe, on prenait pour base les prix moyens des vins des trois dernières années, voyez à quels résultats différents mèneraient le procédé administratif et celui que j’indique.
L’administration raisonnerait ainsi :
| 1840 | — | 10 | b/ques | à | 25 | fr. donnant un revenu de | 250 | fr. |
| 1841 | — | 10 | — | 25 | 250 | |||
| 1843 | — | 10 | — (Supposition gratuite). | 50 | 500 | |||
| 30 | b/ques, prix moyen | 33 | fr. 33 c. 1/3 revenu | 1,000 | fr. | |||
Tandis qu’elle devrait dire :
| 1840 | — | 10 | b/ques | à | 25 | fr. | 250 | fr. |
| 1841 | — | 10 | — | 25 | 250 | |||
| 1843 | — | 5 | — (réalité). | 50 | 250 | |||
| 25 | b/ques, prix moyen | 30 | 750 | fr. | ||||
C’est ainsi qu’on arrive à un revenu imaginaire, sur lequel néanmoins on ne laisse pas de prélever l’impôt.
On dira, sans doute, que la répartition est une opération déjà assez difficile sans la compliquer par des considérations aussi subtiles. On ajoutera que les mêmes procédés étant employés pour tous les produits, les erreurs se compensent et se neutralisent, puisque tous sont soumis aux mêmes lois économiques.
Mais c’est là ce dont je ne conviens pas ; et je maintiens que notre département se trouve dans des conditions telles, qu’il faut de toute nécessité tenir compte des causes d’erreur que je viens de signaler, si l’on aspire au moins à mettre quelque équité dans la répartition des charges publiques. Il me reste donc à prouver que l’application des prix moyens, prise abstractivement des proportions entre les qualités diverses et les quantités annuelles, a été défavorable aux pays de céréales et de vignes.
L’élévation du prix d’une chose peut être due à deux causes.
Ou la production de cette chose a manqué ; et alors le prix hausse, sans qu’on en puisse inférer, de beaucoup s’en faut, une augmentation de revenu.
Ou la production de cette chose est stationnaire, même progressive, mais la demande s’accroît dans une plus forte proportion ; et alors le prix de cette chose hausse et l’on doit conclure à une amélioration de revenu.
Or, prendre, dans un cas comme dans l’autre, le prix moyen de la chose comme indice du revenu, c’est là une souveraine injustice.
Si le haut prix de 50 fr., que la Chalosse retire cette année de ses vins, était intervenu sans diminution de quantité produite, comme, par exemple, si l’Angleterre, la Belgique et nos grandes villes, eussent renversé les barrières des douanes et de l’octroi, que par suite la consommation du vin se fût doublée et les prix avec elle, je dirais : Inscrivez 50 fr. dans votre liste de prix annuels, faites-les concourir à dégager une moyenne ; car ils correspondent à une amélioration réelle de revenu.
De même, si le prix élevé, auquel nous voyons que les matières résineuses sont parvenues, était dû à l’affaiblissement productif des pignadas ; si les propriétaires de pins perdaient plus sur la quantité de leurs produits qu’ils ne gagnent sur les prix, je serais assez juste pour dire : Ne concluez pas de ces hauts prix à des revenus proportionnels avec eux ; car ce serait un mensonge, ce serait une spoliation.
Eh bien ! le contraire est arrivé ; la Lande a été assez heureuse pour que l’amélioration des prix tourne à son profit ; la Chalosse a été assez malheureuse pour que l’augmentation des prix ne lui fasse pas atteindre même à ses revenus ordinaires. Ne suis-je pas fondé à réclamer que cette différence profonde de situation soit prise en considération ?
Concluons que la première base d’évaluation a été préjudiciable aux labourables et aux vignes.
§ II. — La seconde donnée, qui a servi à déterminer les revenus imposables, est prise des actes de vente.
La valeur vénale d’une terre en indique assez exactement le revenu. Deux domaines qui se sont vendus chacun 100,000 fr. sont présumés donner le même revenu, et ce revenu doit être égal à l’intérêt que rendent généralement les capitaux, dans un pays et à une époque donnés. Le débat qui s’établit entre le vendeur et l’acheteur, débat dans lequel l’un veille à ce que le revenu ne soit pas exagéré, l’autre, à ce qu’il ne soit pas déprécié, remplace avantageusement toute enquête administrative à ce sujet, et offre de plus la garantie de cette sagacité, de cette vigilance de l’intérêt personnel, que le zèle des contrôleurs, répartiteurs et experts ne saurait égaler. Aussi, si l’on pouvait connaître la valeur vénale de chaque parcelle, je ne voudrais pas, quant à moi, d’autres bases d’évaluation de revenus et de répartition d’impôts ; car cette valeur vénale résume toutes ces circonstances, si difficilement appréciables, ainsi que je l’ai dit dans le paragraphe précédent, qui influent sur le revenu moyen des terres.
Mais il ne faut pas perdre de vue la restriction que renferment ces mots : dans un pays et à une époque donnés.
L’intérêt des capitaux varie, en effet, selon les temps et les lieux.
Pour que des revenus identiques puissent s’induire de capitaux égaux, il faut que les mutations aient eu lieu à des époques et dans des localités où l’intérêt est uniforme. Cela est vrai pour les terres comme pour les fonds publics.
5,000 fr. de rentes inscrites ne représentaient, en 1814, que 60,000 fr. ; ils correspondent aujourd’hui à 120,000 fr. de capital.
De même, 100,000 placés en terres peuvent ne donner que 2,500 fr. de rentes, en Normandie, et constituer un revenu de 4,000 fr., en Gascogne.
Si la Chambre des députés, lorsqu’elle procédera à la péréquation générale, ne tenait aucun compte de ces différences, elle n’établirait pas l’égalité, mais l’inégalité de l’impôt.
C’est la faute qui a été commise dans notre département, lorsque l’on a voulu arriver à la connaissance des revenus par les actes de vente.
À l’époque où se fit cette opération, les terres ne se vendaient pas, sur tous les points du département, à un taux uniforme. Il était de notoriété publique qu’on plaçait l’argent à un revenu plus élevé dans la Lande que dans la Chalosse.
L’administration elle-même reconnaissait la vérité de ce fait, car elle proposa d’adopter trois chiffres pour le taux de l’intérêt, savoir : 3, 3 1/2 et 4 pour 100.
Selon cette donnée, un domaine de 100,000 fr. aurait été présumé donner 4,000 fr. de revenu, dans tel canton, tandis que, dans tel autre, on ne lui aurait attribué qu’un revenu de 3,000 fr. L’impôt se serait réparti selon cette proportion.
La commission spéciale, instituée par la loi du 31 juillet 1821, repoussa cette distinction et adopta le taux uniforme de 3 1/2 p. 100.
Or, en cela, elle commit une injustice, s’il n’est pas vrai qu’à cette époque l’intérêt fût uniforme dans toute l’étendue du territoire.
M. le Directeur le reconnaît lui-même.
« Cette application uniforme, dans le taux de l’intérêt, dit-il, a, sans nul doute, influé sur les résultats présentés par l’une des deux bases de la répartition, et il est inutile d’ajouter qu’elle est venue favoriser, à la vérité dans une assez faible proportion, la localité où le taux de l’intérêt est le plus élevé. »
La faible proportion signalée par M. le Directeur peut aisément se traduire en chiffres.
Supposons deux domaines vendus chacun 100,000 fr., l’un situé dans la localité où le taux de l’intérêt est à 4 p. 100, l’autre dans celle où il est à 3 p. 100.
Le premier donne 4,000 fr. de revenu, le second 3,000 fr. et l’impôt doit équitablement suivre cette proportion, puisqu’il se prélève sur le revenu.
Selon le système de l’administration, chaque cent francs d’impôts se seraient répartis entre ces deux domaines savoir :
| Quote-part afférente au domaine de la Lande. | 57 | fr. | 15 | c. | pour 4,000 de revenu. |
| Quote-part afférente au domaine de la Chalosse. | 42 | fr. | 85 | c. | pour 3,000 de revenu. |
| Total . . . | 100 | fr. | 00 | c. | |
Mais, selon le système de la commission, cent francs se sont répartis ainsi :
| Quote-part | afférente au domaine | de la Lande. | 50 | fr. | 00 | c. |
| — | — | de la Chalosse. | 50 | fr. | 00 | c. |
| Total . . . | 100 | fr. | 00 | c. | ||
C’est-à-dire que la Lande s’est dégrevée de 14 pour 100 qu’elle a appliqués à la Chalosse [1]. On dira, sans doute, que les actes de vente n’étant qu’un des deux éléments de la répartition, ce résultat a pu être atténué par l’influence de l’autre élément. Cela serait vrai si les cantons agricoles et vinicoles avaient été favorisés par l’application des prix moyens des denrées ; mais nous avons vu qu’ils n’ont pas été plus ménagés par la première que par la seconde base d’évaluation. Bien loin donc que les erreurs dont ces deux procédés sont entachés se compensent et se neutralisent, on peut dire qu’elles se multiplient les unes par les autres, et toujours au préjudice des mêmes localités.
Ainsi les deux bases de la répartition de l’impôt ont été viciées, dénaturées, et toujours au profit d’une nature de propriété, les pignadas, au détriment des deux autres, les labourables et les vignes.
Passons maintenant aux résultats.
Si l’on demandait à un homme désintéressé : Quels sont les cantons qui paient le plus de contributions relativement aux vignes ? il répondrait, sans doute. Ce sont ceux qui ont le plus de superficie consacrée à cette culture, les cantons de Montfort, Mugron, Saint-Sever, Villeneuve, Gabarret ; et cet homme ne se tromperait pas. À eux seuls, ces cinq cantons paient les trois quarts de l’impôt assigné aux vignobles. — Et si on lui demandait : Quels sont ceux qui paient le plus de contributions pour les landes ? il répondrait sans hésiter : Ceux qui en contiennent d’immenses étendues. Sabres, Arjuzanx, Labrit, etc. Mais ici notre interlocuteur se tromperait grossièrement, et il serait probablement bien surpris d’apprendre que ce sont la Chalosse et l’Armagnac, les pays des vignes, qui paient, non-seulement la plus grande partie, mais la presque totalité de l’impôt afférent aux landes.
Voici le tableau de nos vingt-huit cantons, rangés selon l’ordre décroissant de leur quote-part à la contribution afférente aux landes [2].
| fr. | fr. | |||
| Saint-Sever | 6,296 | Saint-Esprit | 1,593 | |
| Grenade | 5,599 | Sabres | 1,561 | |
| Mugron | 3,904 | Geaune | 1,287 | |
| Roquefort | 3,579 | Dax | 1,207 | |
| Hagetmau | 3,327 | Arjuzanx | 1,168 | |
| Amou | 3,000 | Labrit | 1,074 | |
| Montfort | 3,000 | Tartas (ouest) | 914 | |
| Pouillon | 2,883 | Castets | 600 | |
| Aire | 2,852 | Soustons | 522 | |
| Saint-Vincent | 2,663 | Tartas (est) | 495 | |
| Mont-de-Marsan | 2,465 | Pissos | 166 | |
| Gabarret | 2,272 | Parentis | 141 | |
| Peyrehorade | 2,061 | Sore | 107 | |
| Villeneuve | 1,817 | Mimizan | 94 |
N’est-il pas assez singulier de voir figurer dans la première moitié de cette liste tous les cantons vinicoles, Saint-Sever, Mugron, Amou, Montfort, Villeneuve, etc., ainsi que tous les cantons agricoles, Hagetmau, Aire, Peyrehorade, etc. ; et dans la seconde moitié, tous les cantons qui forment la Lande et le Alaransin ?
Voici un autre rapprochement non moins curieux.
Le canton de Saint-Sever, à lui tout seul, paie plus d’impôts pour ses 5,583 hectares de landes que ces neuf cantons réunis : Mimizan, Sore, Parentis, Castets, Soustons, Labrit, Arjuzanx et Sabres, qui en présentent ensemble une superficie de 203,760 hectares ; et quand on ajouterait, à ces neuf cantons, neuf autres cantons égaux à celui de Mimizan, on n’arriverait pas encore, par la répartition actuelle, à tirer de ces effrayantes étendues ce qui se prélève sur les landes du seul canton de Saint-Sever, ainsi qu’on peut s’en convaincre par le tableau suivant :
| LANDES | ||||||
| Impôt en principal. | Impôt en principal. | |||||
| fr. | fr. | |||||
| 1 | canton ; | Sabres | 1,561 | Saint-Sever | 6,296 | |
| 1 | — | Arjuzanx | 1,168 | |||
| 1 | — | Labrit | 1,074 | |||
| 1 | — | Castets | 600 | |||
| 1 | — | Soustons | 522 | |||
| 1 | — | Pissos | 166 | |||
| 1 | — | Parentis | 141 | |||
| 1 | — | Sore | 107 | |||
| 1 | — | Mimizan | 94 | |||
| 9 | cantons tels que celui de Mimizan, à 94 fr. chaque | 846 | ||||
| 18 | cantons | 6,279 | 6,296 | |||
Nous apprenons encore, par le rapport de M. le Directeur des contributions directes que le canton de Mimizan, dont le territoire nourrit près de 5,000 habitants, c’est-à-dire environ un tiers de la population du canton de Saint-Sever, paie de contributions :
| 1,223 | fr. | pour les | labourables. | |
| 8 | fr. | – | vignes. | |
| 4,212 | fr. | – | pins. | |
| 94 | fr. | – | landes. | |
| Total. | 5,537 | fr., somme inférieure à celle qu’ont à acquitter les seules landes de Saint-Sever | ||
Le contingent de Montfort est de 40,771 fr. — Il surpasse celui de Soustons et de Castets, qui sont :
| Soustons . . . . | 22,338 | fr. |
| Castets . . . . | 18,108 | |
| Total . . . . | 40,446 | fr. |
Cependant, selon le dernier dénombrement, la population de Montfort n’est que de 13,654 habitants. — Celle des deux cantons du Maransin est de 18,654 habitants.
| Castets . . . . | 9,906 | fr. |
| Soustons . . . . | 9,021 |
Le contingent du canton de Mugron est de 34,790 fr. — Il surpasse celui de ces trois cantons réunis :
| Sabres . . . . | 13,448 | fr. |
| Pissos . . . . | 11,694 | |
| Parentis . . . . | 9,103 | |
| Total . . . . | 34,245 | fr. |
et, à 355 fr. près, il égale celui de ces quatre cantons :
| Labrit . . . . | 10,286 | fr. |
| Parentis . . . . | 9,103 | |
| Sore . . . . | 7,937 | |
| Mimizan . . . . | 7,819 | |
| Total . . . . | 35,145 | fr. |
Et pourtant, à notre population de 10,038 habitants, ces quatre cantons opposent une population de 20,784 habitants (plus du double). — À nos 4,486 hectares de labourables, ils en opposent 9,584 hectares (plus du double). À nos 1,887 hectares de vigne, ils opposent 43,894 hectares de pignadas (23 pour 1). Enfin, à nos 3,250 hectares de landes, ils en opposent 88,719 hectares (27 pour 1).
Je ne veux pas dire que les labourables et les landes de ces cantons vaillent les nôtres, ni que leurs pins puissent égaler nos vignes, hectare par hectare. La question est de savoir s’il y a entre eux l’énorme disproportion que nous venons de constater. Si cela est, si les revenus de Mugron égalent ceux de Labrit, Parentis, Mimizan et Sore, il restera à expliquer comment il se fait qu’ils ne font vivre que 10,000 habitants en Chalosse, tandis qu’ils suffisent à 20,000 habitants dans la Lande. On ne pourrait expliquer ce phénomène qu’en disant que les premiers nagent dans l’abondance comparativement aux seconds. Mais alors je demanderai comment il se fait qu’ici la population diminue, tandis que là elle augmente sensiblement.
Loin de moi la pensée d’élever une lutte entre les arrondissements. Je crois que le débat ne peut exister qu’entre les diverses cultures, dont la force contributive a été mal appréciée. Aussi je n’ai pas hésité à comparer non-seulement des cantons situés dans divers arrondissements, mais encore des cantons faisant partie d’une même circonscription, mais soumis à des cultures différentes. C’est ainsi que j’ai opposé Montfort à Soustons et Castels. Je pourrais également comparer Villeneuve, canton vinicole du premier arrondissement, à Arjuzanx, ou même à Mont-de-Marsan, et nous retrouverions encore la même disproportion. Le premier de ces cantons, avec 8,887 habitants, paie beaucoup plus du double que le second qui en a 7,075, et autant que notre chef-lieu qui offre une population de 15,913 habitants.
Je pourrais signaler des anomalies encore plus frappantes si je voulais abandonner la comparaison des cantons pour aborder celle des communes : cela me mènerait trop loin ; je me bornerai à deux faits.
Il y a dans le deuxième arrondissement telle commune, comme Nerbis, qui paie 1 fr. 31 c. pour chaque hectare de lande. Il y a dans le premier arrondissement des communes, entre autres celles de Mimizan, Ponteux, Aureilhan, Bras, Argelouse, Luxey, qui ne paient que la moitié ou le tiers d’un centime. Calen, du canton de Sore, en est quitte pour 3/10 de centime ; d’où il suit qu’on a estimé un hectare de landes, à Nerbis, comme 300 hectares à Calen. On dit que dans le premier arrondissement chaque hectare de lande nourrit un mouton, et la statistique agricole, publiée par M. le ministre de l’agriculture, confirme cette assertion, puisque l’on y voit que cet arrondissement qui a 292,000 hectares de landes, entretient 338,800 animaux de l’espèce ovine. — MM. les administrateurs onl-ils pensé qu’à Nerbis un troupeau de 500 têtes peut vivre sur un hectare de landes ?
La quantité de vin que donne un hectare de vigne est, en réalité, le produit de
| 1 hect. de vigne qui paye, dans la commune de Monfort | 7 | fr. | 34 | c. |
| 1/2 hectare d’échalassière . . . . | 2 | 02 | ||
| 1/2 hectare de landes . . . . | “ | 30 | ||
| Total . . . . | 9 | fr. | 66 | c. |
Il y a vingt communes dans le premier arrondissement qui ne sont taxées qu’à 27, 26, 24, 20 centimes par hectare de pin ; et il y en a, telle que Laharie (canton d’Arjuzaux) qui ne paient que 17 c. Pour qu’une semblable répartition soit jugée équitable, il faut que le produit net d’un hectare de vigne, agencé à Montfort, soit égal au produit net de cinquante-sept hectares de pins à Laharie.
Je ne pousserai pas plus loin ces rapprochements. Je crois avoir démontré deux choses, savoir : 1° que les deux bases dont on s’est servi pour estimer le revenu de chacune des cultures de notre département étaient calculées, involontairement sans doute, de manière à préjudicier aux labourables et aux vignes au profit des pins ; 2° que des faits nombreux et irréfragables constatent que tel a été en effet le résultat de l’adoption de ces bases, d’où la conséquence que la répartition de l’impôt a été inégale dès l’origine. Il me reste à prouver que cette inégalité s’est accrue depuis et s’accroît tous les jours, par suite des changements qui sont intervenus dans les proportions des forces contributives de ces cultures.
DEUXIÈME QUESTION.
Les forces contributives des diverses cultures du département ont-elles conservé les proportions qu’elles avaient lorsqu’on fit la répartition de l’impôt ?
Pour constater les revenus des terres en 1821, on n’examina pas les faits relatifs à cette année. Les baux, les actes de vente que l’on consultait, avaient des dates plus ou moins anciennes, et les prix moyens dont on faisait l’application résultaient de mercuriales qui remontaient à quinze années. Ainsi ces divers éléments n’accusaient pas un état de choses actuel, mais la situation du pays pendant une période dont le point de départ peut être fixé au commencement du siècle.
C’est donc à cette période que je dois comparer l’époque présente, et j’ai à rechercher, pendant cette durée d’environ quarante ans, les phénomènes que la science enseigne à considérer comme les manifestations les plus certaines du progrès ou de la décadence des populations.
Le premier qui se présente, c’est le mouvement de la population elle-même. S’il est vrai, comme tous les publicistes s’accordent à le reconnaître, que le nombre des hommes croît ou décroît comme leurs revenus, il suffit d’observer le mouvement de la population dans les contrées où se cultivent le pin, les céréales et la vigne, pour connaître ce que chacune d’elles a gagné ou perdu en forces contributives. Livrons-nous donc à cet examen qui me paraît présenter un haut degré d’intérêt, même en dehors de la question de la répartition de l’impôt.
POPULATION DES TROIS ARRONDISSEMENTS DES LANDES
À DIVERSES ÉPOQUES.
| 1801 | 1804 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | Augmentation p. 100. | |||||||||||
| M. de Mar. | 71,707 | 75,115 | 77,225 | 82,364 | 86,859 | 91,595 | 93,292 | 94,145 | 31 | 80 | |||||||||
| S. Sever. | 77,467 | 80,384 | 80,602 | 83,585 | 84,486 | 90,446 | 90,500 | 88,587 | 14 | 20 | |||||||||
| Dax . . . . | 75,098 | 80,601 | 82,486 | 90,362 | 93,959 | 90,463 | 101,126 | 105,345 | 40 | “ | |||||||||
| 224,272 | 235,556 | 240,313 | 256,311 | 265,314 | 272,504 | 284,918 | 288,077 | 28 | 50 | ||||||||||
On voit par ce tableau que l’augmentation de la population a été pour le département de 28 1/2 p. 100. Cette moyenne a été dépassée de 11 1/2 p. 100 par le troisième arrondissement ; de 3 p. 100 par le premier : le second est resté de 44 p. 100 au-dessous.
L’arrondissement de Saint-Sever était le plus peuplé au commencement du siècle. Il passa au second rand en 1806 ; au troisième en 1831 ; enfin, dans la période de 1832 à 1841, sa population absolue a rétrogradé.
Il semble résulter de ce premier aperçu que l’arrondissement qui présente la plus forte production et le plus grand commerce de matières résineuses est celui qui a la plus rapidement prospéré. L’arrondissement qui vient en seconde ligne pour cette culture, est aussi en seconde ligne pour l’accroissement de la population. Enfin, l’arrondissement où la culture du pin n’occupe qu’une place insignifiante, et qui tire la principale source de ses revenus de la vigne, est demeuré à peu près stationnaire.
Mais cela ne nous apprend rien de très-précis sur l’influence des pins, des labourables et des vignes relativement à la population, puisque chacun de nos arrondissements admet ces trois cultures en proportions diverses. Dans l’hypothèse que la prospérité ait accompagné la culture du pin, la misère celle de la vigne, il est clair que le premier et le troisième arrondissement auraient présenté une augmentation de population plus considérable, sans les cantons vinicoles de Villeneuve et Gabarret, Montfort et Pouillon ; et le second un accroissement moindre, sans le canton de Tartas (ouest) qui contient beaucoup de pins.
Il est donc essentiel d’étudier les mouvements de la population dans la circonscription cantonale, qui nous offre une séparation beaucoup plus tranchée des trois cultures dont nous comparons l’influence.
Voici la liste de nos vingt-huit cantons, placés selon l’ordre décroissant de leur prospérité, révélée par l’augmentation de leur population.
MOUVEMENT DE LA POPULATION PAR CANTON.
| CANTONS. | 1804 | 1844 | AUGMENTATION p. 100. | DIMINUTION p. 100. | ||||||
| Castets | 5,760 | 9,006 | 56 | “ | ||||||
| Dax | 13,224 | 20,951 | 51 | “ | ||||||
| Mimizan | 2,700 | 4,870 | 43 | “ | ||||||
| Sabres | 4,994 | 7,144 | 43 | “ | ||||||
| Saint-Esprit | 10,907 | 15,612 | 43 | “ | ||||||
| Parentis | 4,287 | 5,870 | 37 | “ | ||||||
| Pissos | 4,693 | 6,342 | 37 | “ | ||||||
| Soustons | 6,625 | 9,021 | 36 | “ | ||||||
| Arjuzanx | 5,304 | 7,095 | 33 | “ | ||||||
| Saint-Vincent | 7,780 | 10,334 | 32 | “ | ||||||
| Sore | 3,251 | 4,268 | 31 | “ | ||||||
| Labrit | 4,541 | 5,776 | 27 | “ | ||||||
| Roquefort | 7,453 | 11,501 | 27 | “ | ||||||
| Tartas (ouest) | 8,391 | 10,571 | 25 | “ | ||||||
| Peyrehorade | 10,664 | 13,028 | 21 | “ | ||||||
| Hagetmau | 10,587 | 12,462 | 20 | “ | ||||||
| Mont-de-Marsan | 13,301 | 15,915 | 19 | “ | ||||||
| Tartas (est) | 4,595 | 5,335 | 16 | “ | ||||||
| Geaune | 8,183 | 9,197 | 13 | “ | ||||||
| Montfort | 12,209 | 13,654 | 11 | “ | ||||||
| Aire | 10,829 | 11,992 | 10 | “ | ||||||
| Amou | 12,438 | 13,579 | 10 | “ | ||||||
| Grenade | 7,173 | 7,872 | 9 | “ | ||||||
| Gabarret | 8,122 | 8,746 | 7 | “ | ||||||
| Villeneuve | 8,296 | 8,887 | 7 | “ | ||||||
| Pouillon | 13,332 | 14,294 | 7 | “ | ||||||
| Saint-Sever | 15,762 | 15,322 | „ | 2 1/2 | ||||||
| Mugron | 10,343 | 10,038 | „ | 3 | ||||||
Ce tableau me semble répandre un grand jour sur la question. On y voit d’une manière claire que la prospérité a coïncidé constamment avec la culture du pin, et qu’un état lentement progressif, stationnaire, ou même rétrograde, a été le partage de la région des labourables et de la vigne.
En effet, si l’on partage ce tableau en deux séries, la première comprend tous les cantons où la culture du pin est dominante, et finit aux cantons de Roquefort et de Tartas (ouest), comme pour constater que là où le pin s’arrête, là s’arrête aussi la prospérité du pays. — La seconde série des 14 cantons qui présentent le moindre accroissement, renferme précisément tous les cantons agricoles et vinicoles du département. La grande lande et le Maransin n’y sont pas plus représentés que la Chalosse et l’Armagnac dans la première.
Ces deux séries présentent les résultats suivants :
| CULTURES. | POPULATION. | |||||||||||
| vignes. | pins. | 1804 | 1841 | augmen- 1693.tation. | ||||||||
| hect. | hect. | hab. | hab. | hab. | ||||||||
| 1re série . . . | 2,160 | 150,022 | 89,910 | 127,463 | 37,553 | 42 p. 100. | ||||||
| 2e série . . . | 18,093 | 16,821 | 145,640 | 160,049 | 14,449 | 10 p.100 | ||||||
| Totaux. | 20,233 | 166,843 | 235,259 | 287,552[3] | 52,002 | 22 p. 100. | ||||||
Dans tableau de la population des cantons on remarquera quelques faits qui semblent ne pas s’accorder avec ces déductions : 1° Dax et Saint-Esprit, qui n’ont pas de pins, figurent en tête de l’échelle, comme présentant une augmentation de population de 56 et 43 p. 100. — Mont-de-Marsan, qu’on s’attendrait à trouver dans la première série ne vient qu’en troisième ligne dans la seconde, et n’offre qu’un accroissement de 19. p. 100. — Montfort, qui est un canton vinicole, et qui, par ce motif, devrait être l’un des derniers du tableau, a encore huit cantons au-dessous de lui, et présente une augmentation de 11 p. 100.
Mais, comme on va le voir, ces anomalies apparentes, bien loin d’infirmer, confirment le système que j’émets.
Remarquons d’abord qu’il s’agit des cantons où sont situées les villes de Dax, Saint-Esprit et Mont-de-Marsan, dont la population industrielle ne subit pas aussi directement que celle des campagnes l’influence de l’agriculture, qui fait principalement l’objet de ces recherches.
Saint-Esprit n’avait que 4,946 habitants en 1804 ; il en a 7,324 aujourd’hui. Sa situation à l’embouchure de l’Adour, son commerce, sa garnison, ses établissements militaires, sa proximité de Bayonne, expliquent ce développement.
Dax ne produit pas de matières résineuses, mais il est l’entrepôt où le Maransin vient faire ses ventes et ses achats. Dax a donc prospéré par les mêmes causes qui feraient prospérer Bordeaux, si le commerce de vins florissait et répandait la richesse dans la Gironde, quoique par elle-même la commune de Bordeaux ne puisse pas produire de vins.
Passons à Mont-de-Marsan. D’abord ce canton serait considéré à tort comme un de ceux où domine le pin. Il n’y en a que 9,828 hectares, contre 8,147 hectares de labourables et 428 hectares de vigne. L’impôt qu’il paie pour ses pins n’entre que pour 1/8 dans son contingent. Il faut donc le ranger parmi les cantons agricoles qui ressentent déjà l’influence de la culture du pin ; et, sous ce point de vue, la place qu’il occupe dans le tableau ne s’éloigne pas beaucoup de celle qu’on aurait pu lui assigner à priori.
Mais il est facile de se convaincre que ce n’est pas la faute des pins si ce canton ne figure pas à la première série. En effet, si l’on détache des dix-neuf communes qui le composent les six communes qui offrent le plus de superficie en pignadas, on trouve que dans ces six communes, quoiqu’elles aient une très-forte proportion de labourables, la population a augmenté de 33 p. 100, tandis que celle du canton entier ne s’est accrue que de 19 p. 100.
| CULTURES. | POPULATION | Augmentation, | ||||||||
| Labourables | Pins | 1804 | 1841 | |||||||
| Saint-Pardon | 659 | 906 | 596 | 788 | ||||||
| Saint-Martin | 591 | 985 | 578 | 699 | ||||||
| Geloux | 578 | 1,321 | 600 | 815 | ||||||
| Campagne | 744 | 743 | 881 | 1,052 | ||||||
| Saint-Avit | 418 | 787 | 435 | 501 | ||||||
| Saint-Pierre | 903 | 1,037 | 746 | 1,344 | ||||||
| Totaux . . . . | 3,893 | 5,779 | 3,896 | 5,199 | 33 p. 100. | |||||
D’où il résulte clairement que, dans le canton de Mont-de-Marsan, la culture du pin a eu les mêmes conséquences que dans le reste du département. Ce qui a réduit l’augmentation de la population de ce canton à 19 p. 100, c’est l’influence de la ville de Mont-de-Marsan qui n’a pas plus d’habitants en 1841 qu’en 1804. Si l’on faisait abstraction de la ville, le canton figurerait le dixième au tableau page 302, entre Arjuzanx et Saint-Vincent. Mais quelles sont les causes de l’état stationnaire de notre chef-lieu ? Il n’entre pas dans mon sujet de les rechercher. Peut-être la diminution du commerce des eaux-de-vie n’y est-elle pas étrangère ; peut-être aussi nous dissimule-t-il une partie de sa population.
Il nous reste à étudier le canton de Montfort. Ce canton présente, dans son ensemble, une augmentation de population de 11 p. 100. C’est bien peu relativement à la région des pins ; mais c’est encore plus qu’on ne devait attendre d’un canton vinicole, d’après ce qui se passe à Villeneuve, Gabarret, Saint-Sever et Mugron. Mais si le canton de Montfort renferme quelques communes vinicoles, il en contient aussi beaucoup d’agricoles.
Quelles sont celles qui ont fait atteindre à l’ensemble du canton le chiffre de 11 p. 100 ? C’est ce que nous allons reconnaître en observant séparément ces deux catégories.
| COMMUNES 1704. 1705.agricoles. | CULTURES. | POPULATION. | ||||||
| Labourables. | Vignes. | 1804. | 1841. | |||||
| hect. | hect. | hab. | hab. | |||||
| Clermont | 450 | 20 | 825 | 913 | ||||
| Garrey | 140 | 15 | 219 | 228 | ||||
| Gousse | 110 | 6 | 151 | 216 | ||||
| Hinx | 500 | 50 | 656 | 776 | ||||
| Louer | 120 | 4 | 112 | 149 | ||||
| Ouard | 330 | 1 | 321 | 370 | ||||
| Ozourt | 240 | 22 | 287 | 350 | ||||
| Lier | 420 | 1 | 371 | 509 | ||||
| Sort | 480 | 30 | 826 | 943 | ||||
| Vicq | 250 | “ | 290 | 344 | ||||
| Cassen | 170 | 43 | 348 | 466 | ||||
| Gibrel | 110 | 76 | 237 | 292 | ||||
| Goos | 310 | 60 | 487 | 566 | ||||
| Préchacq | 410 | 60 | 491 | 584 | ||||
| Totaux… | 4,040 | 388 | 5,621 | 6,706 | ||||
| Proportion des vignes aux labourables, 1/10. | ||||||||
| Augmentation de populationt, 19 p. 100. | ||||||||
| COMMUNES 1706. 1707.vinicoles. | CULTURES. | POPULATION. | ||||||
| Labourables. | Vignes. | 1804. | 1841. | |||||
| hect. | hect. | hab. | hab. | |||||
| Montfort | 190 | 350 | 1,574 | 1,644 | ||||
| Gamarde | 480 | 310 | 1,194 | 1,336 | ||||
| Laurède | 100 | 195 | 844 | 769 | ||||
| Lourqueu | 180 | 120 | 380 | 416 | ||||
| Nousse | 80 | 110 | 390 | 393 | ||||
| Poyanne | 100 | 140 | 563 | 558 | ||||
| Poyartin | 590 | 170 | 970 | 983 | ||||
| Saint-Geours | 240 | 310 | 773 | 849 | ||||
| Totaux… | 1,960 | 1,700 | ||||||
| Proportion des vignes aux labourables, 1/2. | ||||||||
| Augmentation de populationt, 4 p. 100. | ||||||||
Ainsi, comme, en décomposant le canton de Mont-de-Marsan, nous nous sommes assuré que s’il n’occupe pas un rang plus élevé dans l’échelle de la prospérité départementale, ce n’est pas la culture des pins qui l’a arrêté ; de même, en analysant le canton de Montfort, nous acquérons la certitude qu’il ne s’est maintenu au vingtième rang que grâce à ses nombreuses communes agricoles. Si l’on en détachait ces communes, il descendrait à un des rangs les plus inférieurs, et ne serait dépassé en misère et en dépopulation que par les cantons de Saint-Sever et de Mugron.
Ces deux exemples nous avertissent que la circonscription cantonale est encore trop étendue, qu’elle admet une trop grande variété de cultures pour nous révéler d’une manière satisfaisante l’influence de chacune d’elles sur la population, puisque ces influences ne nous apparaissent que confondues. Il faut les séparer autant que possible ; il faut poursuivre la vérité jusque dans la circonscription communale. C’est l’objet des cinq tableaux qui terminent cet écrit.
J’ai pris, dans le rapport de M. le Directeur des contributions directes, les vingt-deux communes qui offrent la plus forte proportion de pins, et les vingt-deux communes qui présentent la plus grande proportion de vignes, sans distinction de cantons et d’arrondissements. Ces deux classes de communes forment le premier et le dernier des cinq tableaux. Entre ces deux classes , il y en a une qui ne contient que des labourables. Enfin, deux autres classes marquent la transition, l’une entre le pin et les labourables, l’autre entre les labourables et la vigne. À côté de chaque commune, j’ai mis le chiffre de la population en 1804 et en 1841. Par là nous découvrirons comment la population a été affectée, non-seulement par chacune des trois grandes cultures du pays, mais encore par la combinaison de deux de ces cultures.
Comment n’être pas frappé des remarquables résultats que révèlent ces tableaux ?
Ils nous font voir que dans notre département le mouvement de la population s’est fait de la manière suivante :
| Augment. : | 60 | p.100, | dans la région des pins. |
| — | 34 | — | dans la région intermédiaire entre les pins et les labourables. |
| — | 16 | — | dans la région des labourabes. |
| — | 2 | — | dans la région intermédiaire entre les labourables et la vigne. |
| Diminut. : | 4 | — | dans la région de la vigne. |
Et il ne faut pas croire que ces deux chiffres : 60 pour 100 d’augmentation, 4 p. 100 de diminution expriment les effets extrêmes produits sur la population par les deux cultures que nous comparons. Pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que nous fussions parvenus à les étudier isolément. Mais il n’est pas de commune où il n’entre un élément, les labourables, qui par son action, lentement progressive, ne soit venu atténuer soit l’accroissement qui s’est manifesté dans la région des pins, soit la dépopulation qui a décimé la région de la vigne. Si l’on voulait dégager l’influence propre de ces deux cultures, exclusivement à celle des labourables, il faudrait avoir recours à une règle de proportion. Je crois qu’on arriverait à un résultat très-approximatif par un raisonnement, rigoureux en lui-même, et qu’on ne saurait ébranler qu’en révoquant en doute les données officielles sur lesquelles il repose.
Voici le problème à résoudre :
Les vingt-deux communes où domine le pin présentent une augmentation de 8,998 habitants sur 13,573, ou 60 p. 100.
Les vingt-deux communes où domine la vigne présentent une diminution de 890 habitants sur 20,224, ou 4 p. 100.
En admettant que, dans ces communes, comme dans le reste du département, les labourables aient favorisé, à raison de 10 p. 100, la portion de population qui leur correspond, quelle est la part d’augmentation et de diminution qu’il faut attribuer exclusivement aux pins et aux vignes ?
La population est en raison des moyens d’existence, les moyens d’existence ne sont autres que les revenus, et les revenus proportionnels de chaque culture nous sont connus par le contingent de leur contribution. De ces données, il est facile de déduire la population qui correspond à chaque culture.
Les contingents des vingt-deux communes de la première catégorie sont :
de 27,483 fr. pour les pins,
de 7,043 fr. pour les labourables.
Les revenus sont proportionnels à ces contingents.
La population est proportionnelle aux revenus.
Donc les 13,573 habitants, population de 1804, correspondaient, savoir :
| Aux pins . . . . | 10,815 | hab. |
| Aux labourables . . . . | 2,758 | |
| Faisant abstraction de l’augmentation cherchée, produite par les pins, il faut ajouter celle qui est due aux labourables, 16 p. 100 sur 2,758, soit . . . . | 441 | |
| En sorte que si les pins n’avaient exercé aucune influence, la population de ces vingt-deux communes serait aujourd’hui de . . . . | 14,014 | hab. |
| Mais elle est de . . . . | 21,771 | |
| Différence due exclusivement aux pins . . . . | 7,757 |
Or une augmentation de 7,757 sur 10,815 équivaut à 71 p. 100.
| Les contingent des vingt-deux communes vinicoles sont de 22,880 fr. afférents aux vignes, ce qui correspond à . . . . | 11,709 | hab. |
| 16,742 fr. afférents aux vignes, ce qui correspond à . . . . | 8,515 | |
| Population de 1804 . . . . | 20,224 | |
| Par l’action des labourables, qui implique un accroissement de 16 p. 100 sur 8,515 habitants, cette population se serait élevée de . . . . | 1,373 | |
| En sorte que, sans l’influence de la vigne, la population de 1841 serait de . . . . | 21,597 | hab. |
| Mais elle n’est que de . . . . | 19,325 | |
| Déficit dû exclusivement à la vigne . . . . | 2,272 | |
Un déficit de 2,272 sur 11,709 équivaut à 19 p. 100.
Ce qui ne veut pas dire autre chose, si ce n’est que, dans une commune où il n’y aurait que des pins, la population aurait augmente de 71 p. 100 ; qu’elle aurait diminué de 19 p. 100 dans une commune où il n’y aurait que des vignes, et qu’en réalité les mouvements progressifs et rétrogrades se sont accomplis, entre ces deux limites, dans chaque circonscription, selon les proportions de ces cultures combinées avec un troisième élément, les labourables.
Voici donc en définitive la loi qui a présidé au mouvement de la population dans le déparTement des Landes :
| Pin . . . . | augment. | 71 | p. 100 | |||
| 7/8 pin et 1/8 labourables. | (tableau | page | 329) | — | 60 | — |
| 4/5 pin et 1/5 labourables. | — | — | 330) | — | 34 | — |
| Labourables . . . . | — | — | 331) | — | 16 | — |
| 2/3 labourables et 1/3 vign. | — | — | 332) | — | 2 | — |
| 1/2 labourables et 1/2 vign. | — | — | 333) | diminut. | 4 | — |
| Vignes . . . . | — | 19 | — | |||
Il résulte de là que, si une étendue de pins et une étendue de vignes faisant vivre chacune cent personnes avaient été frappées à l’origine d’un contingent égal, aujourd’hui ce contingent subsisterait encore, quoique les mêmes pins offrent des moyens d’existence à 171 personnes, et que les mêmes vignes ne puissent plus faire vivre que 81 individus ou moins de moitié.
Cela est bien injuste. Mais combien l’injustice est plus criante, si dès l’origine le contingent fut mal réparti, comme je crois l’avoir démontré dans la première partie de ce travail !
Il m’en coûte beaucoup de fatiguer l’attention du lecteur sous le poids de chiffres arides. Je ne puis cependant pas quitter la question que je traite, sans le faire pénétrer dans les détails de ce phénomène de dépopulation qui a frappé non-seulement la région de la vigne, mais encore un rayon assez étendu autour de cette région, comme pour mettre le nombre des hommes en rapport avec les revenus réduits, tels que les a faits la législation des douanes et des contributions indirectes. Le cœur se serre à l’aspect de la détresse profonde que cette dépopulation implique.
Forcé de me restreindre, je me borne à donner le relevé des naissances et des décès, pendant une période de trente ans (de 1814 à 1843), dans les quinze communes vinicoles inscrites les premières au tableau page 333. Quant aux sept autres communes, j’ai demandé à MM. les Maires des états qui ne me sont pas parvenus. Le laps de trente années a été divisé en deux périodes de quinze années chacune, afin de faciliter la comparaison de l’état des choses actuel avec la situation du pays à des époques antérieures.
| DÉSIGNATION 1733.des 1734.communes. | PREMIÈRE PÉRIODE. | DEUXIÈME PÉRIODE. | |||||||||||||||
| Naissances | Décès | excédants | Naissances | Décès | excédants | ||||||||||||
| de naissances. | de décès. | de naissances. | de décès. | ||||||||||||||
| Mugron | 1,173 | 959 | 216 | “ | 949 | 1284 | “ | 335 | |||||||||
| Nerbis | 283 | 229 | 54 | “ | 179 | 267 | “ | 88 | |||||||||
| Laurède | 414 | 287 | 127 | “ | 304 | 333 | “ | 29 | |||||||||
| Gamarde | 611 | 433 | 178 | “ | 545 | 655 | “ | 110 | |||||||||
| Donzacq | 669 | 362 | 307 | “ | 541 | 531 | 10 | “ | |||||||||
| St-Geours | 492 | 401 | 85 | “ | 404 | 498 | “ | 94 | |||||||||
| Ranos | 202 | 175 | 27 | “ | 180 | 155 | 25 | “ | |||||||||
| Baigts | 469 | 303 | 166 | “ | 400 | 367 | 33 | “ | |||||||||
| Lourquen | 172 | 127 | 45 | “ | 176 | 162 | 14 | “ | |||||||||
| Montaut | 548 | 424 | 124 | “ | 464 | 490 | “ | 26 | |||||||||
| Poyanne | 250 | 225 | 25 | “ | 269 | 273 | “ | 4 | |||||||||
| Hauriet | 291 | 187 | 104 | “ | 224 | 234 | “ | 10 | |||||||||
| Montfort | 702 | 462 | 240 | “ | 137 | 138 | “ | 1 | |||||||||
| Nousse | 159 | 103 | 56 | “ | 404 | 470 | “ | 66 | |||||||||
| St-Aubin | 432 | 343 | 89 | “ | 404 | 470 | “ | 66 | |||||||||
| Totaux . . . | 6,869 | 5,026 | 1,843 | “ | 5,814 | 6,445 | 132 | 753 | |||||||||
Je supplie le lecteur de donner à ces chiffres l’attention la plus sérieuse. De 1814 à 1828, il y eut 6,869 naissances et 5,026 décès. La population était progressive, chaque 1,000 habitants donnant 33 naissances contre 24 décès.
Mais de 1829 à 1843, les naissances sont tombées à 5,814 ou 27 1/2 par 1,000 habitants, et les décès se sont élevés à 6,445 ou 30 1/2, par 1,000 habitants.
En sorte, et cela mérite attention, que cet état rétrograde de la population vinicole, que j’avais d’ailleurs constaté par les recensements, n’est pas l’œuvre de quarante ans, comme on aurait pu le croire, mais bien celle des quinze dernières années. Bien plus, pour que sa densité absolue ait diminué, il a fallu qu’elle perdît, par la mortalité ou l’émigration, non-seulement la différence accusée par les dénombrements de 1801 et 1843, mais encore tout ce qu’elle avait gagné pendant les vingt-cinq premières années de celle période. (Voir, au tome V, les pages 471 à 475.)
C’est ainsi que les faits les mieux constatés viennent donner aux lois de la population, révélées par la science, leur lugubre consécration.
« Les obstacles à la population qui maintiennent le nombre des habitants au niveau de leurs moyens de subsistance, dit Malthus, peuvent être rangés sous deux chefs : les uns agissent en prévenant l’accroissement de la population, et les autres en la détruisant à mesure qu’elle se forme. »
Sur quoi M. Senior fait cette réflexion :
« Malthus a divisé les obstacles à la population en préventifs et destructifs. Les premiers diminuent le nombre des naissances, les seconds augmentent celui des décès ; et comme son calcul ne se compose que de deux éléments, la fécondité et la longévité, il n’y a pas de doute que sa division ne soit complète. »
On s’est élevé dans ces derniers temps contre cette doctrine. On lui a reproché d’être triste, découragante. Il serait heureux, sans doute, que les moyens d’existence pussent diminuer, s’anéantir, sans que pour cela les hommes en fussent moins bien nourris, vêtus, logés, soignés dans l’enfance, la vieillesse et la maladie. Mais cela n’est ni vrai ni possible ; cela est même contradictoire. Je ne puis vraiment pas concevoir les clameurs dont Malthus a été l’objet. Qu’a donc révélé ce célèbre économiste ? Après tout, son système n’est que le méthodique commentaire de cette vérité bien ancienne et bien claire : quand les hommes ne peuvent plus se procurer, en suffisante quantité, les choses qui alimentent et soutiennent la vie, il faut nécessairement qu’ils diminuent en nombre ; et s’ils n’y pourvoient par la prudence, la souffrance s’en chargera.
Nous voyons clairement agir cette loi dans notre Chalosse. Les métairies ne donnent plus les mêmes revenus, ou, en d’autres termes, les mêmes moyens d’existence ; aussitôt une prévoyance instinctive diminue le nombre des naissances. On réfléchit avant de se marier. Le père de famille comprend que le domaine ne peut plus faire vivre qu’un moindre nombre de personnes, et il recule le moment d’établir ses enfants ; ou bien ses exigences s’accroissent et rendent les unions plus difficiles, c’est-à-dire plus rares, et le nombre des célibataires s’augmente. C’est ainsi qu’une contrée qui présentait 33 naissances par 1,000 habitants n’en donne plus que 27.
Cependant la prudence, ou ce que Malthus appelle l’obstacle préventif, ne suffit pas pour faire baisser la population aussi rapidement que les revenus ; il faut que l’obstacle répressif ou la mortalité vienne concourir à rétablir l’équilibre. Puisque l’abondance des choses a diminué, il faut qu’il y ait privation : la privation entraine la souffrance et la souffrance amène la mort. Les métairies sont moins productives ; par conséquent leur étendue, qui avait été calculée pour un autre ordre de choses, tend à augmenter ; de deux métairies on en fait une, ou de trois deux. Dans la seule commune de Mugron, vingt-neuf métairies ont été ainsi supprimées de nos jours ; ce sont autant de familles infailliblement vouées à une lente destruction. Enfin, ce qui reste a moins de moyens de se garantir contre la faim, le froid, l’humidité, la maladie ; la vie moyenne s’abrège, et en définitive, là où 1,000 habitants ne donnaient que 24 décès, ils en présentent 30 1/2.
Mais cette dépopulation, qui est bien l’effet et le signe de la misère, en est-elle aussi la mesure ? Écoutons là-dessus les judicieuses observations de M. de Chastellux. — « Les subsistances sont la mesure de la population, dit-on ; si les subsistances diminuent, le nombre des hommes doit diminuer en même proportion. Il doit diminuer sans doute ; en même proportion, c’est une autre affaire, ou du moins ce n’est qu’au bout d’un très-long temps que cette proportion se trouve juste. Avant que la vie des hommes s’abrège, que les sources de la vie s’altèrent, il faut que la misère ait abattu les forces et multiplié les maladies. Lorsqu’elle s’empare d’une contrée, lorsque les subsistances diminuent d’une certaine quantité, d’un sixième, par exemple, il n’arrive pas qu’un sixième des habitants meure de faim ou s’exile ; mais ces infortunés consomment en général un sixième de moins. Malheureusement pour eux, la destruction ne suit pas toujours la misère, et la nature, plus économe que les tyrans, sait encore mieux à combien peu de frais les hommes peuvent subsister. Ils pourront encore être nombreux, mais ils seront faibles et malheureux… C’est alors qu’en prenant peu on enlève beaucoup. »
Oui, l’idée qu’on se ferait de la détresse de la rive gauche de l’Adour serait bien incomplète, si on l’appréciait par les tables de la mortalité. La décroissance du revenu n’atteint pas seulement cette classe qui ne peut rien perdre sans être vouée à la mort. Combien de familles tombent, avant de succomber, de l’opulence dans la médiocrité, de la médiocrité dans la gêne, et de la gêne dans le dénûment ! Elles suppriment d’abord les dépenses de luxe, puis celles de commodité, ensuite celles de convenance ; elles descendent du rang qu’elles occupaient dans la société. Interrogez ces maisons en ruine, ces meubles délabrés, ces enfants dont l’éducation est interrompue ; ils vous diront que le niveau général s’abaisse au moral comme au physique ; que le monopole et le fisc, ces tyrans de notre industrie, savent à combien peu de frais les hommes peuvent subsister, et que malheureusement la destruction ne suit pas toujours la misère.
C’est alors, dit Chastellux, qu’en prenant peu on enlève beaucoup. C’est alors, dirai-je, qu’une répartition vicieuse et injuste, même pour des temps meilleurs, devient intolérable et monstrueuse.
Les faits que j’ai établis sont incontestables. Mais je ne doute pas qu’on n’essaie d’ébranler la conclusion en niant ce principe, que la population varie comme les moyens d’existence. « Nous n’acquiesçons pas, pourra-t-on dire, à cette doctrine de Malthus. Dans la région des pins, nous sommes plus nombreux qu’autrefois, sans doute ; mais il ne s’ensuit pas que le revenu de nos forêts ait augmenté. Seulement il se partage entre un plus grand nombre de personnes. »
Je me garderai bien de me livrer ici à de longues dissertations sur le principe de la population. Je sais qu’il soulève des questions qui sont encore controversées. Mais quant au principe lui-même, quant à cet axiome que l’augmentation de la population est l’effet, la preuve et le signe d’un accroissement correspondant de moyens d’existence ou de revenus, je n’ai pas connaissance qu’il ait jamais été mis en doute par aucun publiciste de quelque valeur ; et je crois ne pouvoir mieux faire que de placer ma démonstration sous l’autorité d’un grand nombre d’écrivains, qui s’accordent tous sur ce point, quelle que soit d’ailleurs la divergence de leurs opinions et de leurs systèmes.
« Quel est le signe le plus certain que les hommes se conservent et prospèrent ? C’est leur nombre et leur population. » (Rousseau, Contrat social, chap. ix.)
« Partout où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se fait un mariage. La nature y porte assez quand elle n’est pas arrêtée par la diffculté de la subsistance. » (Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXIII, chap. x.)
« À côté d’un pain il naît un homme. » (Buffon, Histoire naturelle.)
« Au bout d’un certain nombre d’années, la population d’un pays industrieux et commerçant se rapproche de la mesure des subsistances. » (Necker, de l’Administration des Finances, chap. ix.)
« Pour vivre il faut se nourrir, et comme tout accroissement a un terme, c’est là que la population s’arrête. » (Stewart, t. VI, p. 208.)
« La population est en raison des moyens de subsistance et des besoins. D’après ce principe, il y a un moyen d’augmenter la population, mais il n’y en a qu’un : c’est d’accroître la richesse nationale, ou, pour mieux dire, de la laisser s’accroître. » (J. Bentham, Théorie des peines et des récompenses, liv. IV, chap. ix.) [4]
« Le seul signe certain d’un accroissement réel et permanent de population est l’accroissement des moyens de subsistance. » (Malthus, liv. II, chap. xiii.)
« La détresse influe prodigieusement sur les tables de la mortalité. En thèse générale, on peut dire que, dans notre espèce, il existe toujours des hommes autant et en proportion qu’ils savent et qu’ils peuvent se procurer des moyens de subsistance. »
Il est certain que l’augmentation du nombre des individus est une conséquence de leur bien-être. » (Destutt de Tracy, Commentaire de l’Esprit des Lois, chap. xxii, liv. XXIII.)
« La population d’un pays n’est jamais bornée que par ses produits ; la production est la mesure de la population. » (J. B. Say, Cours d’économie politique, 6e partie, chap. II.)
« Le revenu est la mesure de la subsistance et de l’aisance. Le revenu est la mesure de l’accroissement de la population pour la société comme pour la famille. » (Simonde de Sismondi, Études sur l’économie politique, vol. II, p. 128.)
« La population croît naturellement à mesure que les ressources pour exister augmentent. » (Droz, Économie politique, liv. III, chap. vi.)
« Tant que les moyens de vivre s’accroissent, la population se multiplie ; quand ils restent stationnaires, la population reste stationnaire ; aussitôt qu’ils diminuent, la population diminue dans la même proportion. » (Ch. Comte, vol. VII, pag. 6.)
Qu’on me pardonne ce nombre inusité de citations ; j’ai cru ne pouvoir trop solidement établir un principe qui sert de base aux plaintes et aux réclamations de mon pays.
Mais après tout, et science à part, soutiendrait-on sérieusement qu’il n’y a pas eu amélioration dans les revenus de la Lande et du Maransin, détérioration dans ceux du Condomois et de la Chalosse ? Est-ce que le prix des matières résineuses et des vins est un mystère ? ou bien peut-il s’élever ou s’avilir d’une manière permanente, sans que la condition des propriétaires et des métayers s’en ressente ? Prétendra-t-on que 156 individus vivent aujourd’hui dans le canton de Gastets sur un revenu identique à celui qu’on proclamait autrefois insuffisant pour 100 personnes ? Ils sont donc bien misérables, forcés qu’ils sont de retrancher un tiers de leurs dépenses, de se réduire d’un tiers dans toutes leurs consommations ? Eh bien, examinons encore la question sous ce point de vue. Voyons si le nombre des hommes ne s’est accru, dans une portion du département, que par des retranchements que chacun se serait imposés sur ses consommations. Si nous venons à découvrir que les habitants de la Lande sont pourvus de toutes choses aussi bien et mieux que ceux de la Chalosse, il faudra bien reconnaître que cette population additionnelle n’est pas venue partager des revenus immuables, mais vivre sur des revenus nouveaux, qui se sont formés à mesure, lesquels, en toute justice, doivent leur part d’impôt.
M. le Ministre de l’agriculture et du commerce a fait publier une statistique de la France. J’y ai relevé avec soin l’état de la consommation, dans chacun de nos trois arrondissements. Il est à regretter, sans doute, que nous ne puissions pas faire de semblables relevés pour chaque canton, et même pour chaque commune ; car plus nous arriverions à une circonscription qui présentât d’une manière tranchée une culture dominante, plus l’effet se rapprocherait de la cause. Quoi qu’il en soit, le tableau suivant suffit pour éclairer la question qui nous occupe.
CONSOMMATION PAR HABITANT [5].
| Ier ARRONDISSEMENT. | IIe ARRONDISSEMENT. | |||||||||||
| Quantités. | Prix | Valeurs. | Quantités. | Prix. | Valeurs. | |||||||
| CÉRÉALES | hect. lit. | fr. c. | fr. c. | hect. lit. | fr. c. | fr. c. | ||||||
| Froment… | 0,55 | 15,20 | 8,36 | 0,97 | 14,90 | 14,15 | ||||||
| Méteil… | 0,09 | 11,20 | 0,90 | 0,10 | 10,40 | 1,04 | ||||||
| Seigle… | 2,25 | 7,93 | 17,92 | 6,37 | 9,21 | 3,42 | ||||||
| Maïs, millet… | 1,70 | 7,12 | 12,10 | 2,62 | 9,13 | 23,82 | ||||||
| Totaux… | 4,60 | 39,28 | 4,06 | 42,73 | ||||||||
| VIANDES. | kil. | kil. | ||||||||||
| Bœuf… | 1,66 | 0,70 | 1,16 | 1,52 | 0,65 | 0,99 | ||||||
| Veau… | 0,55 | 0,70 | 0,38 1/2 | 0,22 | 0,70 | 0,15 | ||||||
| Mouton… | 1,67 | 0,60 | 1,00 | 0,48 | 0,63 | 0,31 | ||||||
| Agneau… | 0,63 | 0,65 | 0,43 | 0,30 | 0,65 | 0,19 1/2 | ||||||
| Porc… | 10,64 | 0,65 | 6,92 | 10,31 | 0,65 | 6,70 | ||||||
| Chèvre… | 0,09 | 0,30 | 0,27 | ” | ” | ” | ||||||
| Totaux… | 15,24 | 16,16 1/2 | 12,84 | 8,37 1/2 | ||||||||
| BOISSONS. | hect. lit. | hect. lit. | ||||||||||
| Vin… | 2,19 | 7,83 | 17,29 | 0,67 | 8,86 | 6,90 | ||||||
| Eaux-de-vie… | 0,00,53 | 45,00 | 0,25 | 0,00,22 | 50,00 | 0,11 | ||||||
| Totaux… | 2,19,13 | 17,54 | 0,67,22 | 7,01 | ||||||||
| RÉCAPITULATION. | ||||||||||||
1767. 1768. fr. c. 1769. 1770. fr. c. 1771. 1773. Céréales… 1774. 1775. 39,28 1776. 1777. 42,73 1778. 1780. Viandes… 1781. 1782. 10,16 1783. 1784. 8,37 1785. 1787. Poissons… 1788. 1789. 17,54 1790. 1791. 7,01 1792. 1794. Totaux… 1795. 1796. 66,98 1797. 1798. 48,11 1799. |
||||||||||||
Ce qu’il faut surtout comparer, c’est les consommations du premier et du deuxième arrondissement, qui puisent leurs revenus, au moins dans une forte proportion, à des sources différentes, puisque l’un paie le double pour ses pins que pour ses vignes, et l’autre le triple pour ses vignes que pour ses pins.
Or, nous voyons que la consommation annuelle de chaque habitant du premier arrondissement dépasse celle de chaque habitant du second, de 54 litres pour les céréales, de 2 kil. 40 pour la viande, de 152 litres pour le vin, et de 21 centilitres pour l’eau-de-vie.
En argent la différence est moins forte, parce que, par des motifs dont je ne me rends pas compte, le document officiel porte le seigle, le maïs et le vin, à des prix beaucoup plus élevés à Saint-Sever qu’à Mont-de-Marsan. Mais cette différence est encore de 8 fr. 87 c, en faveur de l’habitant des Landes ; et cette somme, multipliée par le chiffre de la population du premier arrondissement, en 1836, établit une supériorité de consommation, et par conséquent de revenu, de plus de 800,000 fr. du côté de l’arrondissement qui paie 30,000 fr. de moins de contributions en principal.
Cette inégalité dans la répartition de l’impôt se déduit plus clairement encore de l’état ci-dessous, qui présente la valeur totale des consommations pour les trois arrondissements.
| MONT-DE-MAR. | SAINT-SEVER. | DAX. | ||||
| fr. | fr. | fr. | ||||
| Froment | 784,189 | 1,499,908 | 848,371 | |||
| Méteil | 93,251 | 97,573 | 60,375 | |||
| Seigle | 2,175,885 | 357,016 | 775,705 | |||
| Maïs et millet | 1,183,030 | 1,991,262 | 2,746,440 | |||
| Vins | 1,602,970 | 536,782 | 1,059,416 | |||
| Eau-de-vie | 22,000 | 10,000 | 84,000 | |||
| Pommes de terre | 34,164 | 35,405 | 35,627 | |||
| Légumes secs | 28,888 | 37,969 | 47,708 | |||
| Viandes | 906,764 | 749,828 | 1,159,689 | |||
| Totaux . . . . | 6,831,141 | 4,815,732 | 6,817,331 |
On voit combien était dans l’erreur M. le Ministre de l’intérieur lorsque, pour dissuader le Conseil général de réviser la sous-répartition actuelle, il écrivait, le 14 octobre 1836, qu’il n’était pas probable qu’il fût survenu de changements marqués dans le produit des vignes et des pins. Les faits révèlent une inégalité sérieuse et profonde. Ainsi, en céréales, viandes et boissons, il est consommé pour une valeur de
| 72 | fr. | 56 | c. | par chaque | habitant | du 1er | arrondissement. |
| 64 | 71 | — | — | du 3me | — | ||
| 54 | 60 | — | — | du 2me | — |
Et cependant, dans les cantons de Saint-Sever, Mugron, Aire, chaque habitant paie 3 fr. 24 c. de contribution en moyenne ; tandis que dans les cantons de Labrit, Parentis, Sore, Mimizan, Sabres, Pissos, il ne paie que 1 fr. 86 c, d’où il résulte que pour les premiers de ces cantons, le rapport de l’impôt à la consommation est de 5 fr. 93 c. à 100, tandis qu’il n’est que de 2 fr. 56 c. à 100 pour les seconds.
Et il ne faut pas perdre de vue que chacune des trois grandes circonscriptions du département admettant les trois cultures dont nous recherchons l’influence, ces influences ne nous apparaissent que confondues. Il est clair que dans le premier arrondissement, la moyenne de 72 fr. 56 c. a été nécessairement dépassée à Parentis, Sabres, Arjuzanx, Pissos, etc., si, comme il est permis de le croire, elle n’a pas été atteinte à Gabarret et Villeneuve. Ce que nous avons dit à cet égard, à propos de la population, s’applique, parles mêmes motifs, à la consommation.
Si l’on voulait se donner la peine de condenser en chiffres toutes les considérations qui précèdent, voici les résultats auxquels on arriverait :
Le contingent de chacune des trois grandes cultures du département est de
| 279,724 | fr. | pour les labourables, | |
| 66,396 | pour les vignes, | ||
| 75,888 | pour les pins. | ||
| Total … | 422,008 | fr. | |
Ce qui implique que chacune d’elles concourt à un revenu de 1,000 fr., selon le rapport des nombres :
663 — 157 — 180.
C’est là le rapport qu’il s’agit de rectifier conformément aux observations contenues dans les deux paragraphes de cet écrit.
Dans le premier, nous avons vu que les évaluations avaient été viciées par l’application de prix moyens inexacts, et d’un taux d’intérêt uniforme.
Pour les céréales, on avait adopté le prix commun de 14 fr. 28 c., tandis que les mercuriales, de 1828 à 1830, n’accusent que 12 fr. 52 c. — Préjudice fait aux labourables : 12 1/3 p. 100.
Pour les vins rouges, on a opéré sur un prix moyen supposé de 42 fr. Si l’on veut bien se reporter à ce que nous avons dit à ce sujet (p. 286), on reconnaîtra qu’il n’y a certes pas exagération à évaluer le préjudice fait aux vignes à 10 p. 100.
Pour les résines, on a établi le prix de 2 fr. 50 les 50 kil.
— En le portant à 3 fr. 50 c. on serait encore resté au-dessous de la vérité. Les pins ont donc été favorisés dans la proportion de 40 p. 100.
Rectifiant le revenu des trois cultures selon ces bases, ils sont entre eux comme :
582 — 141 — 252.
D’un autre côté, si l’intérêt à 3 p. 100 pour les labourables et les vignes, et 4 p. 100 pour les pins, eût prévalu sur le taux uniforme de 3 1/2 p. 100, le revenu des deux premières cultures eût été évalué à 16 2/3 p. 100 de moins, et celui de la troisième à 16 2/3 p. 100 de plus ; et leurs forces contributives se seraient trouvées proportionnelles aux nombres :
553 — 131 — 210.
La moyenne entre ces deux bases d’opération est de :
567 — 136 — 231.
Et par conséquent le contingent de 422,008 fr. se serait réparti comme suit :
| Pour les labourables | 256,189 | fr. | au lieu de | 279,734 | |
| Pour les vignes | 61,448 | — | 66,396 | ||
| Pour les pins | 104,371 | — | 75,888 | ||
| Totaux . . . . | 422,008 | fr. | 422,008 | fr. | |
Telle eût dû être la répartition originaire, en supposant qu’il n’a pas été commis, sur les quantités produites, des erreurs analogues à celles que nous avons relevées sur les prix moyens et le taux de l’intérêt.
Telle elle devrait être encore, s’il n’était survenu aucun changement dans la valeur productive des trois natures de cultures.
Mais dans le second paragraphe de ce travail, nous avons constaté que la population, et par induction le revenu, a varié comme suit :
| Les labourables ont gagné | 16 | p. 100. |
| Les vignes ont perdu . . . . | 19 | — |
| Les pins ont gagné . . . . . . | 71 | — |
Les trois rapports ci-dessus : 567 — 136 — 231 — doivent donc être modifiés selon ces nouvelles données, et remplacés par ceux-ci :
657 — 110 — 395.
D’où il suit, qu’en définitive le contingent de 422,008 fr. devrait se répartir ainsi ;
| Labourables. | 238,603 | fr. | au lieu de | 279,724 | fr. |
| Vignes . . . . | 39,964 | — | 66,396 | ||
| Pins . . . . . . | 143,441 | — | 75,888 |
En d’autres termes, l’impôt est trop élevé :
| Pour les labourables . . . . | d’un sixième. |
| Pour les vignes . . . . . . . | de plus d’un tiers. |
| Celui des pins est atténué . . | de près de moitié. |
Je ne puis m’empêcher de soumettre au lecteur, en terminant, quelques réflexions qui ne s’écartent pas trop du sujet que je traite.
Une détresse effrayante s’est étendue sur une portion considérable de notre département et y a si profondément affecté les moyens d’existence, que les sources mêmes de la vie en ont été altérées. Nous n’avons pas la statistique de toutes les consommations de notre arrondissement, mais nous savons que la population ne consacre à ses aliments, que 54 fr. au lieu de 72 fr. qu’on y affecte ailleurs. Cependant les aliments sont la dernière chose sur laquelle on s’avise d’opérer des retranchements. Et comme, d’ailleurs, il existe parmi nous une classe aisée qui n’en est pas encore réduite à se priver de pain et de vin, il faut en conclure qu’autant cette classe dépasse la moyenne de 54 fr., autant les classes laborieuses sont éloignées de l’atteindre.
C’est ainsi que s’explique la dépopulation que constatent les dénombrements et les actes de l’état civil.
Ce lamentable phénomène se lie à une révolution agricole qui s’opère sous nos yeux et qu’on n’a pas assez remarquée.
La superficie des métairies s’était naturellement proportionnée à ce qui était nécessaire, pour que la part colonne pût faire vivre une famille de cultivateurs.
Lorsque, par suite de la dépréciation des produits, cette part est devenue insuffisante, le métayer est tombé à la charge du propriétaire ; et celui-ci s’est vu dans l’alternative ou de laisser le domaine sans culture ou de prendre sur sa propre part, déjà réduite, de quoi suppléer à celle du colon.
Dès ce moment, l’aliment du métayer a été pesé, mesuré, restreint au strict nécessaire. De plus, une tendance prononcée s’est manifestée vers l’agrandissement des métairies, ici des réunions se sont opérées ; là on a arraché des vignes pour agrandir les labourables. Tous ces expédients ont un résultat et même un but commun : diminuer le nombre d’hommes, rétablir l’équilibre entre la population et les subsistances.
Si cette évolution, avec les conséquences qu’elle entraine, avait pour cause quelque cataclysme physique, il faudrait gémir et baisser la tête. Mais il n’en est pas ainsi ; la Providence ne nous a pas retiré ses dons, le ciel de la Chalosse n’est pas devenu d’airain, le soleil et la rosée n’ont pas cessé de la féconder. Pourquoi donc ne peut-elle plus nourrir ses habitants ?
Il ne faut pas aller bien loin pour en trouver la raison. C’est qu’ils ont été dépouillés de la liberté d’échanger, la plus immédiatement utile à l’homme après la liberté de travailler.
C’est donc la législation qui est la cause de nos maux. Les manufacturiers nous ont dit : « Vous n’achèterez qu’à nous et à notre prix. » Le fisc : « Vous ne vendrez qu’après que j’aurai pris la moitié de votre produit. »
La législation nous tue, dans le sens le plus absolu du mot ; et si nous voulons vivre, il faut réformer la législation. (V. le Discours sur l’impôt des boissons, t. V, p. 468.)
Or une réforme dans la législation ne peut émaner que du corps électoral.
Mais comment remplit-il sa mission ?
En présence des maux sans nombre qui dépeuplent nos champs et nos villes, que fait-il pour modérer l’action du fisc, pour restituer aux hommes la faculté d’échanger entre eux, selon leurs intérêts, le fruit de leurs sueurs ?
Ce qu’il fait ? Il remet le mandat législatif à nos adversaires ; il va chercher des représentants dans les forges, dans les fabriques et jusque dans les antichambres.
On entend de toute part proclamer cette doctrine : « Les faveurs sont au pillage ; bien fou celui qui ne fait pas comme les autres. »
Parmi les hommes qui tiennent ce langage, il en est qui ne songent qu’à eux, — je n’ai rien à leur dire. Mais d’autres ne peuvent être soupçonnés d’un tel égoïsme ; leur fortune les met au-dessus des combinaisons d’une ambition mesquine. Une raison sans réplique constate, d’ailleurs, leur désintéressement personnel : s’ils cherchaient leur propre avancement, ce n’est pas du droit électoral, mais de la députation qu’ils se feraient un marchepied ; et on les voit décliner la candidature.
Ce n’est donc pas à eux-mêmes, mais à l’esprit de localité qu’ils sacrifient l’intérêt général. L’intérêt général est une chose inaccessible, disent-ils. La machine est montée pour épuiser nos malheureux compatriotes ; il n’est pas en notre pouvoir de suspendre son action, faisons du moins retomber sur eux, sous forme de grâces, une partie de ce qu’elle leur arrache.
Mais, je le demande, ces grâces, ces faveurs, quelque multipliées qu’on les suppose, ont-elles aucune proportion avec les maux que je viens de décrire ? Qu’importe à ces paysans que l’inanition décime, à ces artisans sans ouvrage, à ces propriétaires dont la plus âpre parcimonie peut à peine retarder la ruine, qu’importe à ces victimes du fisc et du monopole qu’une sous-préfecture, un siège au Palais, aillent payer à l’Électeur en évidence le salaire de son apostasie ? — Rendez-leur le droit d’échanger, et vous aurez plus fait pour votre pays que si vous lui aviez concilié la faveur du duc de Nemours en personne, ou celle du Roi lui-même !
Vous vous proclamez conservateurs. Vous vous opposez à ce que le droit électoral pénètre jusqu’aux dernières couches sociales. Mais alors soyez donc les tuteurs intègres de ces hommes frappés d’interdiction. Vous ne voulez ni stipuler loyalement pour eux, ni qu’ils stipulent légalement pour eux-mêmes, ni qu’ils s’insurgent contre ce qui les blesse. Que voulez-vous donc ?… Il n’y a qu’un terme possible à leurs souffrances, — et ce terme, les tables de la mortalité le laissent assez entrevoir.
| RÉGION DES PINS. | ||||||||
| COMMUNES. | CULTURES. | POPULATION. | ||||||
| Labourables. | Pins. | 1804. | 1841. | |||||
| hect. | hect. | hab. | hab. | |||||
| Mimizan | 278 | 1,322 | 479 | 852 | ||||
| Onesse | 367 | 4,728 | 687 | 1,098 | ||||
| Lesperon | 670 | 5,490 | 683 | 1,060 | ||||
| Ponteux | 392 | 2,661 | 740 | 1,486 | ||||
| Mezos | 666 | 4,345 | 809 | 1,286 | ||||
| Saint-Paul en B. | 259 | 1,736 | 348 | 772 | ||||
| Comenzacq | 321 | 1,595 | 522 | 663 | ||||
| Escource | 468 | 4,396 | 673 | 1,180 | ||||
| Pissos | 600 | 3,500 | 1,477 | 2,056 | ||||
| Parentis | 550 | 4,500 | 1,181 | 1,788 | ||||
| Sainte-Eulalie | 180 | 2,000 | 271 | 475 | ||||
| Ichoux | 300 | 4,000 | 542 | 841 | ||||
| Gourbera | 194 | 979 | 206 | 303 | ||||
| Labenne | 291 | 1,215 | 392 | 526 | ||||
| Moliets | 154 | 1,643 | 293 | 404 | ||||
| Messange | 226 | 2,332 | 321 | 430 | ||||
| Magescq | 847 | 4,113 | 923 | 1,606 | ||||
| Seignosse | 210 | 2,089 | 334 | 458 | ||||
| Leon | 620 | 2,750 | 931 | 1,402 | ||||
| Linx | 750 | 4,050 | 650 | 1,074 | ||||
| Lit et Mix | 920 | 3,800 | 970 | 1,483 | ||||
| Vieille-Saint-Girons | 580 | 2,400 | 131 | 608 | ||||
| Totaux… | 9,849 | 65,344 | 13,573 | 21,771 | ||||
| Rapport des cultures : 7/8 pins, 1/8 labourables. | ||||||||
| Mouvement de la population : Augmentation, 60 p. 100. | ||||||||
| RÉGION DES PINS. | ||||||||
| COMMUNES. | CULTURES. | POPULATION. | ||||||
| Labourables. | Pins. | 1804. | 1841. | |||||
| hect. | hect. | hab. | hab. | |||||
| Geloux | 578 | 1,321 | 660 | 815 | ||||
| Aureilhan | 116 | 388 | 217 | 305 | ||||
| Bias | 74 | 281 | 107 | 169 | ||||
| Argelouse | 160 | 1,000 | 329 | 396 | ||||
| Calen | 320 | 2,000 | 533 | 660 | ||||
| Luxey | 1,000 | 3,500 | 1,244 | 1,532 | ||||
| Sore | 1,000 | 3,000 | 1,145 | 1,780 | ||||
| Sabres | 1,042 | 2,750 | 1,679 | 2,524 | ||||
| Lue | 314 | 2,103 | 503 | 790 | ||||
| Trenzacq | 335 | 1,203 | 610 | 727 | ||||
| Belhade | 200 | 1,200 | 384 | 518 | ||||
| Moussey | 350 | 2,000 | 659 | 945 | ||||
| Sagnac | 700 | 2,500 | 1,178 | 1,636 | ||||
| Bichet | 150 | 1,500 | 206 | 330 | ||||
| Biscarosse | 500 | 4,000 | 1,367 | 1,547 | ||||
| Gastes | 70 | 800 | 211 | 259 | ||||
| Sanguinet | 300 | 2,500 | 715 | 960 | ||||
| Saint-Yaguen | 671 | 1,311 | 479 | 892 | ||||
| Rion | 1,019 | 2,717 | 1,280 | 1,537 | ||||
| Laluque | 596 | 1,227 | 560 | 698 | ||||
| Saint-Vincent de Tyrosse | 385 | 466 | 558 | 754 | ||||
| Herm | 558 | 2,578 | 783 | 851 | ||||
| Cap-Breton | 182 | 793 | 586 | 968 | ||||
| Soustons | 1,358 | 2,513 | 2,516 | 2,783 | ||||
| Azur | 164 | 901 | 190 | 304 | ||||
| Saint-Geours | 717 | 1,321 | 899 | 1,420 | ||||
| Tosse | 316 | 752 | 493 | 698 | ||||
| Sorts | 139 | 599 | 217 | 266 | ||||
| Castets | 650 | 2,450 | 977 | 1,615 | ||||
| Levignac | 420 | 1,950 | 723 | 959 | ||||
| Saint-Julien | 760 | 3,000 | 884 | 1,123 | ||||
| Saint-Michel | 410 | 2,100 | 162 | 217 | ||||
| Taller | 480 | 1,500 | 332 | 527 | ||||
| Totaux… | 16,034 | 60,879 | 23,416 | 31,405 | ||||
| Rapport des cultures : 4/5 pins, 1/5 labourables. | ||||||||
| Mouvement de la population : Augmentation, 34 p. 100. | ||||||||
| RÉGION DES LABOURABLES. | ||||
| COMMUNES. | POPULATION. | |||
| 1804. | 1841. | |||
| hab. | hab. | |||
| Vielle-Soubiran | 273 | 471 | ||
| Grenade | 1,368 | 1,500 | ||
| Vignau | 605 | 601 | ||
| Gazères | 1,026 | 948 | ||
| Bordères | 159 | 524 | ||
| Losse | 711 | 1,027 | ||
| Estigarde | 267 | 307 | ||
| Lubbon | 361 | 420 | ||
| Cauna | 695 | 674 | ||
| Bas-Mauco | 223 | 202 | ||
| Benung | 1,110 | 945 | ||
| Duhort | 1,067 | 1,129 | ||
| Bahus | 549 | 533 | ||
| Latrille | 257 | 307 | ||
| Saint-Agnet | 352 | 385 | ||
| Lacajunte | 301 | 339 | ||
| Arboucave | 306 | 394 | ||
| Philondenx | 503 | 604 | ||
| Miramont | 832 | 827 | ||
| Samadet | 1,370 | 1,456 | ||
| Gouts | 538 | 475 | ||
| Pomarez | 1,765 | 2,115 | ||
| Saint-Martin-Juza | 1,974 | 2,515 | ||
| Saint-Larant | 664 | 855 | ||
| Biaudos | 694 | 834 | ||
| Orthevielle | 698 | 869 | ||
| Lannes | 921 | 1,131 | ||
| Saint-Martin | 1,101 | 1,340 | ||
| Onard | 321 | 370 | ||
| Lier | 371 | 509 | ||
| Vie | 290 | 244 | ||
| Saint-Cricq | 825 | 1,119 | ||
| Sainte-Colombe | 729 | 791 | ||
| Totaux… | 23,228 | 26,960 | ||
| Rapport des cultures : Tout labourables. | ||||
| Mouvement de la population : Augmentation, 16 p. 100. | ||||
| RÉGION DES VIGNES. | ||||||||
| COMMUNES. | CULTURES. | POPULATION. | ||||||
| Labourables. | Vignes. | 1804. | 1841. | |||||
| hect. | hect. | hab. | hab. | |||||
| Bascons | 409 | 290 | 1,067 | 1,033 | ||||
| Saint-Julien | 278 | 192 | 398 | 446 | ||||
| Arthez | 284 | 214 | 408 | 449 | ||||
| Fréche | 726 | 349 | 894 | 929 | ||||
| Perquie | 764 | 272 | 748 | 775 | ||||
| Audignon | 408 | 98 | 617 | 578 | ||||
| Montgaillard | 1,446 | 314 | 2,126 | 1,977 | ||||
| Larbey | 202 | 116 | 383 | 508 | ||||
| Lahosse | 276 | 107 | 583 | 613 | ||||
| Saint-Loubouer | 883 | 232 | 1,321 | 1,267 | ||||
| Vielle | 638 | 140 | 858 | 895 | ||||
| Urgons | 504 | 62 | 695 | 703 | ||||
| Castelnau-Turs | 472 | 99 | 505 | 590 | ||||
| Bastennes | 200 | 100 | 512 | 482 | ||||
| Pouillon | 1,520 | 506 | 3,060 | 3,163 | ||||
| Gibret | 110 | 76 | 237 | 292 | ||||
| Poyartin | 590 | 170 | 970 | 983 | ||||
| Totaux… | 9,710 | 3,337 | 15,382 | 15,683 | ||||
| Rapport des cultures : 2/3 labourables, 1/3 vignes. | ||||||||
| Augmentation de la population : 2 p. 100. | ||||||||
| RÉGION DES VIGNES. | ||||||||
| COMMUNES. | CULTURES. | POPULATION. | ||||||
| Labourables. | Vignes. | 1804. | 1841. | |||||
| hect. | hect. | hab. | hab. | |||||
| Banos | 185 | 130 | 595 | 383 | ||||
| Montaut | 470 | 274 | 1,060 | 1,180 | ||||
| Mugron | 348 | 446 | 2,388 | 2,190 | ||||
| Hauriet | 271 | 158 | 746 | 541 | ||||
| Nerbis | 79 | 125 | 402 | 545 | ||||
| Saint-Aubin | 317 | 240 | 930 | 809 | ||||
| Baigts | 350 | 235 | 1,034 | 987 | ||||
| Donzacq | 200 | 180 | 1,271 | 1,349 | ||||
| Montfort | 120 | 350 | 1,574 | 1,644 | ||||
| Gamarde | 480 | 310 | 1,194 | 1,336 | ||||
| Laurède | 100 | 195 | 844 | 769 | ||||
| Lourquen | 180 | 120 | 380 | 416 | ||||
| Nousse | 80 | 110 | 390 | 393 | ||||
| Poyanne | 100 | 140 | 563 | 558 | ||||
| Salnt-Geours d’Auribat | 240 | 310 | 773 | 849 | ||||
| Brassempouy | 600 | 150 | 1,023 | 1,016 | ||||
| Momûy | 528 | 103 | 700 | 792 | ||||
| Betbezer | 118 | 248 | 401 | 355 | ||||
| Parleboscq | 870 | 991 | 1,330 | 1,359 | ||||
| Lagrange | 389 | 340 | 612 | 604 | ||||
| Mauvezin | 148 | 132 | 287 | 290 | ||||
| Gaujacq | 400 | 130 | 927 | 960 | ||||
| Totaux… | 6,643 | 5,417 | 20,224 | 19,325 | ||||
| Rapport des cultures : 1/2 labourables, 1/2 vignes. | ||||||||
| Mouvement de la population : Diminution, 4 p. 100. | ||||||||
FN:En admettant que l’intérêt ne variât, d’un pays à l’autre, que dans la proportion de 3 à 4 p. 100.
FN:Ces rapprochements sont puisés dans le rapport de M. le Directeur des contributions directes publié en 1836. À cette époque, quatre cantons n’étaient pas encore cadastrés, en sorte que le document officiel ne pouvait donner sur la distribution du contingent de ces cantons, entre leurs diverses cultures, que des renseignements approximatifs. Depuis, M. le Directeur a eu la bonté de m’envoyer des étals de rectification, et je dois à la vérité de dire que les anomalies que je signale dans le texte sont moins choquantes dans ces états définitifs que dans les tableaux provisoires. Le temps me manque pour refaire le travail d’après les nouvelles bases. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce que les landes paient en plus dans ces quatre cantons, les pins et les labourables le paient en moins, car le contingent cantonal n’a pas varié.
FN:La différence, du reste insignifiante, qui se trouve entre ce chiffre et celui de 288,077, porté au dénombrement, provient d’erreurs d’additions qui se sont glissées dans l’annuaire.
FN:Il est peut-être bon de faire observer que tous les auteurs cités jusqu’ici, y compris Chastellux et Bentham, avaient écrit avant l’apparition du livre de Malthus.
FN:Il va sans dire que je n’assume pas sur moi la responsabilité des faits statistiques consignés dans le document officiel.
Liberté du commerce [1844] [CW1.4.3]↩
BWV
1844.?? “Liberté du commerce” (Freedom of Commerce) [1844] [OC7.4, p. 14] [CW1]
Liberté du commerce [18]
Dans la séance du 29 février dernier, M. Guizot a dit : « On parle sans cesse de la faiblesse du Gouvernement du Roi vis-à-vis de l’Angleterre. Je ne peux pas laisser passer cette calomnie.
« En Espagne, personne ne peut dire que nous ayons concouru à maintenir ce que l’Angleterre maintenait, à renverser ce qu’elle renversait.
« On a parlé d’un traité de commerce qui serait imposé par l’Angleterre ; a-t-il été conclu ?
« N’avons-nous pas rendu ces ordonnances qui ont changé les rapports commerciaux de l’Angleterre et de la France sur les questions des fils et tissus de lin ? « M. le Président du Conseil n’a-t-il pas fait rendre sur les tarifs d’Algérie une ordonnance qui a blessé, sur plus d’un point, des intérêts anglais respectables ? »
De tout quoi il résulte que si le pouvoir n’est pas sous le joug de l’Angleterre, à coup sûr il est sous le joug du Monopole.
Quoi ! le public n’ouvrira-t-il pas enfin les yeux sur cette honteuse mystification dont il est dupe ?
Il y a quelques années, on aurait pu croire que le Régime Prohibitif n’avait que quelques années d’existence.
Le système de la Protection, ruiné en théorie, ne se glissa dans la législation que comme mesure transitoire. Le ministre qui lui donna le plus d’extension, M. de Saint-Cricq, ne cessait d’avertir que ces taxes mutuelles, que les travailleurs se payent les uns aux autres, sont injustes au fond ; qu’elles ne sont justifiables que comme moyen momentané d’encourager certaines industries naissantes ; et il est certain que le Privilège lui-même ne réclamait pas alors la Protection comme un droit, mais comme une faveur de nature essentiellement temporaire.
Les faits qui s’accomplissaient en Europe étaient de nature à accroître les espérances des amis de la liberté.
La Suisse avait ouvert ses frontières aux produits de toutes provenances, et elle s’en trouvait bien.
La Sardaigne était entrée dans cette voie et n’avait pas à s’en repentir.
L’Allemagne avait substitué à une multitude de barrières intérieures une seule ceinture de douanes fondée sur un tarif modéré.
En Angleterre, le plus vigoureux effort qu’aient jamais tenté les classes moyennes était sur le point de renverser un système de restrictions qui, dans ce pays, n’est qu’une ransformation de la puissance féodale.
L’Espagne même semblait comprendre que ses quinze provinces agricoles étaient injustement sacrifiées à une province manufacturière.
Enfin la France se préparait à entrer dans le régime de la liberté par la transition des traités de commerce et de l’union douanière avec la Belgique.
Ainsi le travail humain allait être affranchi. Sur quelque point du globe que le sort les eût fait naître, les hommes allaient reconquérir le droit naturel d’échanger entre eux le fruit de leurs sueurs, et nous touchions au moment de voir se réaliser la sainte alliance des peuples.
Comment la France s’est-elle laissé détourner de cette voie ? comment est-il arrivé que ses enfants, qui s’enorgueillissaient d’être les premiers de la civilisation, saisis tout à coup d’idées Napoléoniennes, aient embrassé la cause de l’isolement, de l’antagonisme des nations, de la spoliation des citoyens les uns par les autres, de la restriction au droit de propriété, en un mot de tout ce qu’il y a de barbarie au fond du Régime prohibitif ?
Pour chercher l’explication de ce triste phénomène, il faut que nous nous écartions un moment en apparence de notre sujet.
Si, au sein d’un conseil général, un membre parvenait à créer une majorité contre l’administration, il ne s’ensuivrait pas nécessairement que le Préfet fût destitué, et moins encore que le chef de l’opposition fût nommé Préfet à sa place. Aussi, bien que les conseillers généraux soient pétris du même limon que les députés, leur ambition ne trouve pas à se satisfaire par les manœuvres d’une opposition systématique, ce qui explique pourquoi on ne les voit pas se produire dans ces assemblées.
Il n’en est pas ainsi à la Chambre. C’est une maxime de notre droit public que si un Député est assez habile pour opposer une majorité au Ministère, il devient lui-même Ministre ipso facto, et livre l’administration en proie à ceux de ses collègues qui se sont associés à son entreprise.
Les conséquences de cette organisation sautent aux yeux. La Chambre n’est plus une assemblée de Gouvernés, qui viennent prendre connaissance des mesures projetées par les Gouvernants, pour admettre, modifier, ou rejeter ces mesures, selon l’intérêt public qu’ils représentent ; c’est une arène où l’on se dispute le Pouvoir qui est mis au concours et dépend d’un scrutin.
Donc, pour renverser le Ministère, il suffit de lui enlever la majorité ; pour lui enlever la majorité, il faut le déconsidérer, le dépopulariser, l’avilir. La Loi elle-même, combinée avec l’irrémédiable faiblesse du cœur humain, a arrangé les choses ainsi. M. Guizot aura beau s’écrier : « N’apprendrons-nous jamais à nous attaquer, à nous combattre, à nous renverser, sans nous imputer des motifs honteux ! » j’avoue que ces plaintes me semblent puériles. — Vous admettez que vos adversaires aspirent à vous remplacer, et vous avez la bonhomie de leur conseiller de négliger les moyens de réussir ! — À cet égard, M. Guizot, chef d’opposition, fera contre M. Thiers, Ministre, ce que M. Guizot, Ministre, reproche à M. Thiers, chef d’opposition.
Nous devons donc admettre que notre mécanisme représentatif est organisé de telle sorte que, l’opposition et toutes les oppositions réunies n’ont et ne peuvent avoir qu’un seul but : Avilir le ministère, quel qu’il soit, pour le renverser le remplacer.
Or le plus sûr moyen, en France, d’avilir le Pouvoir, c’est de le représenter comme traître, comme lâche, comme dévoué à l’étranger, comme oublieux de l’honneur national. Ce fut, contre M. Molé, la tactique de M. Guizot coalisé avec les légitimistes et les Républicains ; c’est, contre M. Guizot, la tactique de M. Thiers, coalisé avec les Républicains et les légitimistes. L’un se servait d’Ancône comme l’autre se sert de Taïti.
Mais les oppositions ne se bornent pas à agir au sein des Chambres. Elles ont encore besoin d’entraîner à leurs vues l’opinion publique et le corps électoral. Les journaux de toutes les oppositions sont donc forcément amenés à travailler de concert, à exalter, à irriter, à égarer le sentiment national, à représenter la Patrie comme descendue, par l’œuvre du Ministère, au dernier degré d’avilissement et d’opprobre, et il faut avouer que notre susceptibilité nationale, les souvenirs de l’Empire, et l’Éducation toute Romaine qui a prévalu parmi nous, donnent à cette tactique parlementaire de grandes chances de succès.
Cet état de choses étant donné, il est aisé de prévoir tout le parti qu’ont dû en tirer les Industries Privilégiées.
Au moment où le Monopole allait être renversé et la libre communication des peuples graduellement fondée, que pouvait faire le Privilège ? Perdre son temps à ériger le système de la Protection en corps de doctrine et opposer la théorie de la Restriction à la théorie du libre échange ? C’eût été une vaine entreprise ; sur le terrain d’une libre et loyale discussion l’Erreur a peu de chances contre la Vérité.
Non, le Privilège a mieux vu ce qui pouvait prolonger son existence ; il a compris qu’il continuerait à puiser paisiblement dans les poches du public tant qu’une irritation factice préviendrait le rapprochement et la fusion des peuples. Dès lors, il a porté ses forces, son influence, ses richesses, son activité du côté des haines nationales ; il a, lui aussi, pris le masque du patriotisme ; il a soudoyé les journaux qui n’étaient pas encore enrôlés sous la bannière d’un faux honneur national ; et l’on peut dire que cette monstrueuse alliance a arrêté la marche de la civilisation.
Au milieu de ces étranges circonstances, la Presse Départementale, la Presse Méridionale surtout, eût pu rendre de grands services. Mais, soit qu’elle n’ait pas aperçu le mobile de ces machiavéliques intrigues, soit qu’elle ait cédé à la crainte de paraître faiblir devant l’étranger, toujours est-il qu’elle a niaisement uni sa voix à celle des journaux stipendiés par le Privilége, et aujourd’hui il peut se croiser les bras, en nous voyant, nous, hommes du Midi, nous hommes spoliés et exploités, faire son œuvre, comme il eût pu la faire lui-même et consacrer toutes les ressources de notre intelligence, toute l’énergie de nos sentiments à consolider les entraves, à perpétuer les extorsions qu’il nous inflige.
Cette faiblesse a porté ses fruits. Pour repousser les accusations dont on l’accable, le Gouvernement n’avait qu’une chose à faire, et il l’a faite : il nous a sacrifiés.
Les paroles de M. Guizot, que j’ai citées en commençant, n’équivalent-elles pas en effet à ceci :
« Vous dites que je soumets ma politique à la politique anglaise, mais voyez mes actes.
« Il était juste de rendre aux Français le droit d’échanger, confisqué par quelques privilégiés. Je voulais rentrer dans cette voie par des traités de commerce ; mais on a crié : à la trahison ! et j’ai rompu les négociations.
« Je pensais que s’il faut que les Français achètent au dehors des fils et tissus de lin, mieux vaut en obtenir plus que moins, pour un prix donné ; mais on a crié : à la trahison ! et j’ai créé les droits différentiels.
« Il était de l’intérêt de notre jeune colonie africaine d’être pourvue de toutes choses à bas prix, pour croître et prospérer. Mais on a crié : à la trahison ! et j’ai livré l’Algérie au Monopole.
« L’Espagne aspirait à secouer le joug d’une province. C’était son intérêt ; c’était le nôtre ; mais c’était aussi celui des Anglais ; on a crié : à la trahison ! et pour étouffer ce cri importun, j’ai maintenu ce que l’Angleterre voulait renverser : l’exploitation de l’Espagne par la Catalogne. »
Voilà donc où nous en sommes. La machine de guerre de tous les partis, c’est la haine de l’étranger. À gauche et à droite on s’en sert pour battre en brèche le Ministère ; au centre, on fait plus, on la traduit en actes pour faire preuve d’indépendance, et le Monopole s’empare de cette disposition des esprits pour se perpétuer en soufflant la discorde.
Où tout cela nous conduira-t-il ? Je l’ignore, mais je crois que ce jeu des partis recèle des dangers ; et je m’explique pourquoi, en pleine paix, la France entretient quatre cent mille hommes sous les armes, augmente sa marine militaire, fortifie sa capitale, [19] et paye un milliard et demi d’impôts.
De l’influence des tarifs français et anglais sur l’avenir des deux peuples [JDE, octobre 1844] ↩
BWV
1844.10.15 “De l'influence des tarifs français et anglais sur l'avenir des deux peuples” (On the Influence of French and English Tariffs on the Future of the Two People) [*Journal des Économistes*, T. 9, octobre 1844, pp. 244-71.] [OC1.6, p. 334-86]
De l’influence des tarifs français et anglais sur l’avenir des deux peuples [1]
« Que si, pour démentir mes assertions, on les appelait du nom d’utopies, nom merveilleusement propre à faire reculer les esprits timides et à les enfoncer dans l’ornière de la routine, j’inviterais ceux qui me répondraient ainsi à considérer attentivement tout ce qui s’est fait depuis quelques années et ce qui se fait encore aujourd’hui en Angleterre, et à dire ensuite si, de bonne foi, on ne peut aussi bien le réaliser en France. » (Prince de Joinville, Notes sur l’état des forces navales, etc.)
La France s’engage chaque année davantage dans le régime protecteur.
L’Angleterre s’avance, de session en session, vers le régime de la liberté du commerce.
Je me pose cette question :
Quelles seront pour ces deux nations les conséquences de deux politiques si opposées ?
Une explication préliminaire est nécessaire.
On verra, dans la suite de cet écrit, que je ne sépare pas le régime protecteur du système des colonies à monopole réciproque. Voici pourquoi :
La protection a pour objet d’assurer des consommateurs à l’industrie nationale. Or, « les gouvernements, disait M. de Saint-Cricq, alors ministre du commerce, ne pouvant disposer que des consommateurs soumis à leurs lois, ce sont ceux-là qu’ils s’efforcent de réserver au travail de leurs producteurs. » Si, par la protection, les gouvernements entendent disposer des consommateurs soumis à leurs lois, par les colonies ils s’efforcent de soumettre à leurs lois des consommateurs dont ils puissent disposer. Une de ces politiques conduit à l’autre ; toutes deux émanent de la même idée, procèdent de la même théorie, et ne sont, si je puis le dire, que les deux aspects, intérieur et extérieur, d’une combinaison identique.
Cela posé, j’ai à établir deux faits.
1° La France s’engage de plus en plus dans la vie artificielle de la protection.
2° L’Angleterre s’avance graduellement vers la vie naturelle de la liberté.
J’aurai ensuite à résoudre cette question :
3° Quelles seront, sur la prospérité, la sécurité et la moralité des deux peuples, les conséquences de la situation dans laquelle ils aspirent à se placer ?
§ I. — Que la France développe, à chaque session, le régime protecteur, c’est ce qui résulte surabondamment des dispositions qui viennent périodiquement prendre place dans le vaste Bulletin de ses lois.
Depuis deux ans, elle a exclu les tissus étrangers de l’Algérie, élevé les droits sur les fils anglais, renforcé le monopole du sucre au profit des Antilles, et la voilà sur le point de repousser, par aggravation de taxes, les machines et le sésame.
Un mot sur chacune de ces mesures.
On a repoussé de l’Algérie les produits étrangers. « C’est bien le moins, dit-on, que nous exploitions exclusivement une conquête qui nous coûte si cher. » Mais, en premier lieu, forcer la jeune colonie d’acheter cher ce qu’elle pourrait obtenir à bon marché, restreindre ses échanges et par suite ses exportations, est-ce bien là favoriser sa prospérité ? D’un autre côté, une telle mesure n’est-elle pas le germe du contrat colonial, de ce contrat que j’ai nommé à monopole réciproque, honte et fardeau des peuples modernes, si inférieurs à cet égard aux nations antiques ? Nous nous réservons le monopole en Algérie ; c’est fort bien. Mais qu’aurons-nous à répondre aux colons, quand ils demanderont, par réciprocité, à exercer un semblable monopole chez nous ? Manquaient-ils déjà de raisons spécieuses à faire valoir, et fallait-il leur en fournir d’irrécusables ? Le jour n’est pas éloigné où ils nous diront : Vous nous forcez à acheter vos tissus ; achetez donc nos laines, nos soies, nos cotons. Vous ne voulez pas que vos produits rencontrent chez nous de concurrence ; éloignez donc la concurrence qui attend les nôtres sur vos marchés. Ne sommes-nous pas Français ? N’avons-nous pas autant de droits que les planteurs des Antilles à une juste réciprocité ? Nous payons les capitaux à 10 pour 100 ; nous travaillons d’un bras et combattons de l’autre : comment pourrions-nous lutter contre des concurrences prospères et paisibles ? Prohibez donc les cotons des États-Unis, les soies d’Italie, les laines d’Espagne, si vous ne voulez étouffer dans son berceau une colonie arrosée de tant de sueurs, de tant de sang et de tant de larmes. — En vérité, j’ignore ce que la métropole aura à répondre. Sans cette malencontreuse ordonnance, nous aurions résisté à de telles exigences sans blesser la justice ni l’équité.
Vous êtes libres, dirions-nous aux colons, de porter ou de ne pas porter vos capitaux en Afrique ; c’est à vous de calculer les chances relatives de leur placement au delà ou en deçà de la Méditerranée. Libres d’acheter et de vendre selon vos convenances, vous êtes sans droit pour réclamer de notre part l’aliénation d’une semblable liberté.
Aujourd’hui de telles paroles ne seraient que mensonge et dérision.
Mais qu’ai-je besoin de prévoir l’avenir ? Il est si vrai que tout privilége métropolitain implique un privilége colonial correspondant, que l’ordonnance à laquelle je fais allusion nous a déjà engagés dans cette voie. Écoutons M. le ministre du commerce (Exposé des motifs de la loi des douanes, page 37 ; séance du 26 mars 1844).
« Pour nos produits, le régime de l’Algérie est la franchise entière de toute taxe d’importation. Pour les marchandises étrangères, le tarif était en général du quart du tarif métropolitain ; il a été élevé, au tiers… En outre, plusieurs produits fabriqués (étrangers)… ont reçu des taxes particulières propres à donner une impulsion nouvelle à nos exportations. »
Voilà pour le privilége de la métropole à l’égard de la colonie. Voici maintenant pour le privilége de la colonie vis-à-vis de la métropole :
« Pour imprimer à nos transactions commerciales, en Afrique, l’activité qu’elles peuvent avoir, il ne suffit pas d’y protéger nos produits, il faut encore que la consommation française s’ouvre aux principales denrées que peuvent nous fournir et la colonisation européenne qui se développe, et la population indigène rangée sous nos lois. Nous avons, dans ce but, par une autre ordonnance, dégrévé de moitié la généralité des produits dont la culture et le commerce de l’Algérie sont en mesure de pourvoir la métropole.»
Ainsi la première mesure que j’examine, quoiqu’en elle-même elle puisse paraître de peu d’importance, a cependant une immense gravité ; car elle est la première pierre d’un édifice monstrueux qui, je le crains, prépare à la France un long avenir de difficultés et d’injustices.
On a élevé les droits sur les fils et tissus de lin de provenance anglaise. Ici c’est plus que de la protection, c’est de l’hostilité. Quelle arme dangereuse que celle des droits différentiels ! quelle source de jalousies, de rancunes, de représailles ! quel arsenal de notes diplomatiques ! quel fardeau, quelle responsabilité pour les ministres ! Que dirions-nous si les Espagnols décrétaient que les draps du monde entier seront reçus chez eux au droit de 25 pour 100, excepté les draps français, qui payeront 50 pour 100 ?
Cette seconde mesure a donc, de même que la précédente, une haute portée comme doctrine, comme symptôme, à cause du nouveau droit public qu’elle introduit dans les relations internationales. Puisse-t-il n’être pas fécond en tempêtes !
Je ne reviendrai pas sur la lutte des deux sucres et sur la loi qui leur a imposé une trêve éphémère plutôt qu’une paix durable. Je dirai seulement que, puisqu’on trouvait que les prix du monopole étaient un trop puissant excitant pour le sucre indigène, une chaude atmosphère dans laquelle il se développait avec trop de rapidité, il y avait un moyen simple de faire rentrer la jeune industrie dans le droit commun et dans les conditions naturelles ; c’était d’abolir ou du moins d’amoindrir le monopole, c’est-à-dire de diminuer les droits sur les sucres coloniaux et étrangers. Par là, on aurait satisfait les colonies, étendu nos relations commerciales, favorisé la consommation et par suite le placement des sucres rivaux ; enfin, et par-dessus tout, on aurait fait justice au public, que malheureusement on oublie sans cesse dans ces sortes de questions, ou dont on ne se souvient que pour en disposer, selon l’heureuse expression de M. de Saint-Cricq, et le réserver, comme une proie, aux producteurs. Cette mesure n’aurait pas froissé les fabricants de sucre de betterave plus que celle qu’on a adoptée, et elle aurait eu l’avantage, comme tout ce qui porte un caractère évident de justice et d’utilité générale, d’arrêter la plainte sur les lèvres ce ceux-là mêmes qu’elle aurait atteints. La nouvelle industrie se serait tenue pour avertie que le public n’avait pas d’engagement envers elle ; et ayant en perspective le régime de la liberté, elle aurait su du moins dans quelles conditions elle devait vivre. C’eût été à elle à s’y renfermer, et il eût été bien entendu que s’il lui convenait de s’étendre au delà, c’était à ses périls et risques. L’État anéantissait ainsi toutes les difficultés ultérieures. Au lieu de cela, on a mieux aimé maintenir le monopole au sucre colonial et étouffer le sucre indigène sous le fardeau des taxes [2].
Bien plus, le gouvernement français n’a pas craint de proposer l’interdiction absolue de cette fabrication, principe monstrueux qui renferme virtuellement la mort légale de toute liberté industrielle et de tous les progrès de l’esprit humain. Je sais qu’on me dira que l’abaissement des droits sur les sucres étrangers et coloniaux eût laissé un vide au Trésor. J’en doute ; mais, après tout, c’est précisément ce que je veux prouver, savoir : qu’en France, on fait si bon marché de la liberté du travail et de l’échange, qu’on la sacrifie en toute rencontre et à la plus frivole considération.
Voici maintenant qu’on propose d’augmenter les droits sur les machines. Sans doute on trouve que notre industrie manufacturière n’a pas assez de difficultés à vaincre, puisqu’on veut lui imposer des machines coûteuses et imparfaites ? « Mais, dit-on, on fait en France des machines excellentes et à bon marché. » Alors, à quoi bon la protection ? Messieurs les industriels ont double face, comme Janus. S’agit-il d’obtenir des médailles, des primes d’encouragement ou simplement de recruter des actionnaires, oh ! alors ils sont magnifiques ; ils ont poussé leurs procédés à un point de perfection inespéré ; il n’y a pas de rivalité possible, et ils auront chaque année 100 pour 100 à donner à leurs bailleurs de fonds. Mais est-il question de monopole, de protection, ils se font petits, malhabiles, inintelligents, toute concurrence les importune ; et s’il fallait en croire leur modestie, il y aurait plus de science dans le petit doigt d’un ouvrier anglais que dans toutes les têtes du comité Mimerel.
Ce qui s’est passé à l’occasion des machines vaut la peine d’être raconté. Il y a trois ans, un membre du Parlement anglais vint à Paris pour négocier le traité de commerce. À cette époque, l’Angleterre prélevait des droits élevés sur l’exportation des machines. Le négociateur français vit là un obstacle au traité. On était d’accord sur le reste : l’Angleterre recevait nos vins ; nous admettions sa poterie et sa coutellerie. « Mais, disait-on au député de la Grande-Bretagne, la France manque de machines, surtout de métiers à filer et à tisser le lin. Pour le coton, nous pourrions à la rigueur nous suffire ; mais pour le lin, il est indispensable que vous nous laissiez arriver vos métiers francs de droits. » M. Bowring revint en Angleterre. On réunit les filateurs de lin, et on leur demande s’ils renonceraient au monopole des machines anglaises. Ils y consentirent, et la difficulté était levée, lorsque, comme on le sait, le traité échoua devant la résistance des fabricants du Nord et par des considérations politiques qu’il est inutile de rappeler.
Qu’est-il arrivé cependant ? La réforme commerciale de 1842 a balayé, en Angleterre, les droits d’exportation sur les machines. Nous voilà, sans condition, en possession de cet avantage que nous réclamions avec tant d’insistance. Nos filatures de lin et de coton vont avoir enfin des machines excellentes, franches de droit. Mais voici bien une autre affaire. M. Cunin-Gridaine réclame un droit prohibitif sur ces machines tant désirées, et, chose qui passe toute croyance, les métiers à filer le coton, dont on pouvait se passer, ne payeront que 30 francs par 100 kilogrammes, et les métiers à filer le lin, dont on était si envieux, auront à supporter un droit de 50 francs ! Mais telle est la nature de la protection : elle laisse entrer ce dont nous n’avons que faire et repousse ce dont nous avons le plus besoin.
Je ne rappellerai ici la proposition faite par le ministre des finances, d’élever les droits sur le sésame, que parce que le génie de la protection, ou plutôt du monopole, s’y montre dans toute sa nudité. C’est lui sans doute qui a inspiré les mesures que je viens d’examiner, mais secrètement pour ainsi dire, en s’environnant de prétextes, en mettant ses intérêts et ses vues derrière des questions fiscales et coloniales. Mais quant au sésame, il n’y a pas moyen d’invoquer le patriotisme, l’orgueil national, les besoins de la navigation, la haine de l’étranger, etc., etc. Il faut bien avouer franchement qu’on élève le droit uniquement parce que le sésame rend plus d’huile que le colza. On avait cru que cette graine rendait 20 pour 100 d’huile, et on l’avait soumise à un droit égal à 1. On s’aperçoit que ce rendement est de 40 pour 100, et l’on élève le droit à 2. Si plus tard une autre plante se présente qui donne 60 pour 100, on portera le droit à 3 ou 4, et ainsi de suite, repoussant les produits en proportion de ce qu’ils sont riches et précisément parce qu’ils sont riches. C’est bien là le caractère de la protection dans toute sa sincérité, débarrassée des prétextes, des sophismes, des faux exposés sous lesquels elle se déguise quand elle le peut. Ici elle se présente toute franche et toute nue. Ici le monopole ne prend pas des voies tortueuses ; il dit : L’étranger possède un végétal riche et productif ; c’est un bienfait de la nature qu’il veut partager avec mon pays. Mais moi j’ai une plante relativement pauvre, inféconde, et je veux forcer mon pays à s’en contenter. Le consommateur est une matière inerte dont le gouvernement dispose ; j’entends qu’il le réserve à mes produits. — Et le gouvernement d’accéder à l’injonction.
J’ai examiné la politique du gouvernement français, en matière de douanes et d’échanges internationaux, politique manifestée par une foule de mesures restrictives ; et comme, à ce que je crois on ne pourrait pas en citer une seule prise par lui dans un sens libéral, je suis fondé à dire que la France s’engage chaque année davantage dans le régime de la protection. C’est la première proposition que j’avais à établir.
Toutefois ce n’est point en vue de ces modifications rétrogrades que j’énonce cette proposition, sous une forme aussi générale. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’on peut conclure de quelques actes du gouvernement à la persistance d’un système. Les gouvernements ne sont pas toujours l’expression de l’opinion publique. Souvent même ces deux puissances agissent momentanément en sens contraire ; et comme nos constitutions modernes ont pour objet de faire tôt ou tard triompher l’opinion, je ne me hasarderais pas à dire, en vue de quelques ordonnances restrictives, que la France tend à s’isoler des autres nations, si je pouvais penser que l’opinion désapprouve ces mesures.
Mais il n’en est pas ainsi. Loin que les mesures dont je viens de parler aient été prises contrairement au vœu public, je suis porté à croire qu’en les adoptant, l’administration a obéi, et peut-être avec répugnance, à la toute-puissance de l’opinion ; et puisque c’est à elle surtout qu’appartient l’avenir, il doit m’être permis d’étudier le rôle qu’elle joue dans la question qui nous occupe.
Les économistes se plaisent à représenter le système prohibitif comme un édifice antique, vermoulu, qui croule de toutes parts : « Soutenu, disent-ils, par quelques intérêts privilégiés, il pèse sur les masses, et il porte en lui-même tous les éléments d’une prochaine destruction. » Ils ont raison sans doute d’attribuer de grandes et générales souffrances à ce système ; mais ils me semblent se faire complétement illusion quand ils s’imaginent que ces souffrances sont clairement aperçues par les masses et distinctement rattachées à la cause qui les produit. Il n’est plus vrai de dire que le monopole ne rallie à lui que quelques intérêts isolés ; il est devenu malheureusement le patrimoine de toutes les grandes industries, et particulièrement de celles qui confèrent l’influence politique. « Protéger, disait encore M. de Saint-Cricq, dans l’exposé des motifs de la loi qui organisa et consolida définitivement le régime prohibitif en France ; protéger l’industrie agricole, toute l’industrie agricole, l’industrie manufacturière, toute l’industrie manufacturière, c’est le cri qui retentira toujours dans cette Chambre. » On ne sait pourquoi le ministre oublie de parler de l’industrie commerciale, puisque la navigation a aussi sa large part de protection.
Ainsi les agriculteurs, les propriétaires, les manufacturiers, les capitalistes qui leur font des avances, les armateurs, les ouvriers des fabriques, les fermiers et métayers, les marins, les classes les plus influentes et les plus nombreuses ont été rattachées au régime restrictif. Sans doute la protection, dont l’injustice est évidente quand elle est le privilége de quelques-uns, devient illusoire quand elle s’exerce par tous sur tous. Mais il arrive alors que, chacun fermant les yeux sur les monopoles qu’il subit pour conserver celui qu’il exerce, le système entier jette dans tous les esprits des racines profondes.
Sur quel fondement alléguerait-on que l’opinion publique est favorable en France à la liberté du commerce, quand on ne pourrait pas citer une seule parole prononcée dans l’une ou l’autre chambre en faveur de cette liberté, si ce n’est peut-être l’exclamation d’un député ? De toutes les parties de l’enceinte législative, on réclamait des représailles contre le nouveau tarif des États-Unis : « Il n’est pas bien certain, dit un député, que les représailles ne soient aussi funestes à ceux qui s’en servent qu’à ceux contre qui on les dirige. » Ce député était sans doute de l’opposition dite avancée ? Point du tout : c’était M. Guizot.
L’amour du monopole, le penchant à exploiter le public paraît être enfoncé si avant dans nos mœurs, qu’il se montre là où on s’attendrait le moins à le trouver. Les négociants, ne faisant de profits que sur les échanges et les transports, devraient, ce semble, être ennemis de tout ce qui tend à les restreindre. Eh bien, dans des pétitions émanées de Bordeaux, du Havre, de Nantes, pétitions dirigées contre les restrictions commerciales, après avoir fait parade des doctrines les plus larges, ils ont trouvé le moyen de réclamer pour eux un privilége, et sous une forme assurément peu déguisée. Ils demandaient que, par une combinaison de tarifs, les produits lointains fussent astreints à voyager à l’état le plus grossier, afin de fournir plus d’aliment à la navigation. (V. pages 240 et suiv.)
Aux causes générales qui tendent à perpétuer chez nous l’esprit de monopole, il faut en ajouter une particulière, qui agit avec tant d’efficacité qu’elle mérite d’être dévoilée.
Chez les peuples constitutionnels, la vraie mission de l’opposition est de propager, de populariser les idées progressives, de les faire pénétrer d’abord dans les intelligences, ensuite dans les mœurs, et enfin dans les lois. Ce n’est point là proprement l’œuvre du pouvoir. Celui-ci résiste au contraire ; il ne concède que ce qu’on lui arrache, il ne trouve jamais assez longue la quarantaine qu’il fait subir aux innovations, afin d’être assuré qu’elles sont des améliorations. Or, il est malheureusement entré dans les combinaisons des chefs de l’opposition de déserter les idées libérales, en matière de relations internationales, en sorte qu’on ne voit plus par quel côté pourrait nous arriver la liberté du commerce.
Cet état de choses politiques étant donné, il est aisé d’imaginer tout le parti qu’ont dû en tirer les industries privilégiées. Elles n’ont plus perdu leur temps à systématiser le monopole, à opposer la théorie de la restriction à la théorie de l’échange. Non, le privilége a compris ce qui pouvait prolonger son existence ; il a compris que, pour prévenir tout traité de commerce, toute union douanière, pour continuer à puiser paisiblement dans les poches du public, il fallait irriter les peuples les uns contre les autres, empêcher toute fusion, tout rapprochement, les tenir séparés par des difficultés politiques, et rendre une conflagration générale toujours imminente. Dès lors, au moyen de ses comités, de ses cotisations, il a porté toutes ses forces, toute son activité, toute son influence du côté des haines nationales. Il a soudoyé le journalisme parisien, lui créant ainsi un intérêt pécuniaire, outre l’intérêt de parti, à envenimer les questions extérieures ; et l’on peut dire que cette monstrueuse alliance a détourné notre pays des voies de la civilisation.
Au milieu de ces circonstances la presse départementale, la presse méridionale surtout, eût pu rendre de grands services ; mais soit qu’elle n’ait pas aperçu le mobile de ces machiavéliques intrigues, soit que tout cède en France à la crainte de paraître faiblir devant l’étranger, toujours est-il qu’elle a niaisement uni sa voix à celle des journaux stipendiés ; et aujourd’hui le privilége peut se croiser les bras en voyant les hommes du Midi, hommes spoliés et exploités, faire son œuvre comme il eût pu la faire lui-même, et consacrer toutes les ressources de leur intelligence, toute l’énergie de leurs sentiments à consolider les entraves, à perpétuer les extorsions qu’il lui plaît de nous infliger.
Cette faiblesse a porté ses fruits. Pour repousser les accusations dont il est accablé, le gouvernement n’avait qu’une chose à faire, et il l’a faite. Il a sacrifié une portion du pays.
Qu’on se rappelle le fameux discours de M. Guizot (29 février 1844). M. le ministre lui-même oserait-il dire qu’il y a injustice à le paraphraser ainsi :
« Vous dites que je soumets ma politique à la politique anglaise ; mais voyez mes actes.
Il était juste de rendre aux Français le droit d’échanger confisqué par quelques privilégiés ; j’ai voulu entrer dans cette voie par des traités de commerce. Mais on a crié : À la trahison ! et j’ai rompu les négociations.
S’il faut que les Français achètent au dehors des fils et tissus de lin, je pensais qu’il valait mieux pour eux en obtenir plus que moins, pour un prix donné. Mais on a crié : À la trahison ! et j’ai établi des droits difféntiels.
Il était de l’intérêt de notre jeune colonie africaine d’être pourvue, à bas prix, de toutes choses, afin de croître et prospérer. Mais on a crié : À la trahison ! et j’ai livré l’Algérie au monopole. »
L’Espagne aspirait à secouer le joug d’une de ses provinces ; c’était son intérêt, c’était le nôtre, mais c’était aussi celui des Anglais. On a crié : À la trahison ! et pour étouffer ce cri importun, j’ai maintenu ce que l’Angleterre voulait renverser, à savoir l’exploitation de l’Espagne par la Catalogne. »
Voilà donc où nous en sommes. La machine de guerre de tous les partis, c’est la haine de l’étranger. À gauche, à droite, on s’en sert pour battre en brèche le ministère ; au centre, on fait pis, on la traduit en actes pour faire preuve d’indépendance, et le monopole arrive à toutes ses fins avec ce seul mot : À la trahison !
Où tout cela nous mènera-t-il ? je l’ignore. Mais je crois que ce jeu des partis recèle des dangers, et je m’explique pourquoi le général Cubière demandait que l’armée fût portée à 500,000 hommes ; pourquoi l’opinion alarmée réclame une puissante marine ; pourquoi la France fortifie la capitale et paye 1 milliard et demi d’impôts.
§ II. — Pendant que ces choses se passent en France, examinons les tendances de l’économie politique anglaise, manifestées d’abord par les actes législatifs, ensuite par les exigences de l’opinion.
On sait que, par son fameux acte de navigation, l’Angleterre entra dans les voies du monopole que lui avaient frayées les républiques italiennes et Charles-Quint. Mais tandis que cette politique égoïste et imprévoyante avait produit en Espagne et en Italie de si déplorables résultats, elle n’empêcha pas la Grande-Bretagne de s’élever à cette haute prospérité, qui a tant contribué à populariser en Europe le système auquel on s’est empressé de l’attribuer. Ce n’est que de nos jours, que l’Angleterre commence à comprendre qu’elle s’est enrichie non par les prohibitions, mais malgré les prohibitions. C’est de l’administration de M. Huskisson que date cette halte dans la politique de restriction.
Ce grand ministre, malgré le désavantage de lutter contre une opinion publique encore incertaine, voulut inaugurer la politique libérale par des résolutions décisives. Il s’attaqua aux monopoles des fabricants de soieries, des brasseurs, des producteurs de laines, et enfin au plus populaire, je dirai même au plus national de tous les monopoles, celui de la navigation. L’altération qu’il fait subir à l’acte de Cromwell fut si sérieuse et si profonde, qu’elle a amené ce fait que je trouve dans un journal anglais du 18 mai 1844 : « Du 10 avril au 9 mai, il est entré à Newcastle soixante-quatre bâtiments chargés de grains, dont soixante-un sont étrangers. »
On conçoit sans peine quelle lutte M. Huskisson eut à soutenir pour faire passer une réforme si dangereuse pour cette suprématie navale, si chère aux Anglais. L’empire des mers ! tel était le cri de ralliement de ses adversaires, auquel il répondit par ces nobles paroles, que je ne puis m’empêcher de rappeler ici, parce qu’elles signalent l’heureuse incompatibilité qui existe entre la liberté commerciale et ces jalousies nationales, triste cortége du régime protecteur : « J’espère bien que je ne ferai plus partie des conseils de l’Angleterre, quand il y sera établi en principe qu’il y a une règle d’indépendance et de souveraineté pour le fort et une autre pour le faible, et lorsque l’Angleterre, abusant de sa supériorité navale, exigera pour elle soit dans la paix, soit dans la guerre, des droits maritimes qu’elle méconnaîtra pour les autres, dans les mêmes circonstances. De pareilles prétentions amèneraient la coalition de tous les peuples du monde pour les renverser. »
On n’a pas oublié la crise industrielle, commerciale et financière qui désola l’Angleterre, vers la fin de l’administration de lord John Russell. Au milieu d’une détresse générale, en face des guerres de la Chine et de l’Afghanistan, en présence du déficit, il semble que le moment était mal choisi pour développer la grande réforme douanière et coloniale essayée par Huskisson. C’est pourtant dans ces circonstances que le cabinet whig présenta un projet qui n’allait à rien moins qu’à détruire presque entièrement le régime de la protection et à révoquer le contrat de monopole réciproque qui lie l’Angleterre à ses colonies. C’est une chose étrange, pour une oreille française, qu’un langage ministériel semblable à celui que tenaient alors les chefs de l’administration britannique. « Les taxes n’emplissent plus le trésor, disaient-ils ; il faut se hâter de les diminuer, afin que le peuple vive mieux, ait plus de travail, consomme davantage et prépare ainsi, pour l’avenir, un aliment au revenu public. Laissons entrer le froment, le sucre, le café, à des droits modérés. Débarrassons-nous du monopole qu’exercent sur nous nos colonies, à la charge par nous de renoncer à celui que nous exerçons sur elles. Par là nous les appellerons à l’indépendance, à la prospérité ; et délivrés des dépenses et des dangers qu’elles entraînent, nous n’aurons avec elles et avec le monde que des relations libres et volontaires. »
Il est vrai de dire que cette foi entière dans la solidité des doctrines sociales, cette adhésion dans réserve à ce grand principe : Il n’y a d’utile que ce qui est juste, en un mot, cette politique audacieuse des whigs, rencontra une opposition énergique dans l’aristocratie, les fermiers et les planteurs des Antilles ; et l’on doit même avouer que cette opposition eut l’assentiment de l’opinion publique, puisqu’un appel au corps électoral eut pour résultat la chute du ministère Melbourne. Mais n’est-ce rien, au moins comme fait symptomatique, que cette tentative d’un parti influent, d’un parti toujours prêt à s’emparer du timon de l’État, que cet effort pour faire entrer immédiatement dans la pratique des affaires ces grands principes sociaux que nous devions croire relégués, pour longtemps encore, dans les écrits des publicistes et dans la poudre des bibliothèques ? Et faut-il s’étonner si cette tentative radicale a échoué, sur la terre natale du monopole, dans ce pays où les priviléges aristocratiques, économiques, politiques, religieux, coloniaux sont si puissants et si étroitement unis ?
Mais enfin, voilà la liberté condamnée ; voilà le privilége au pouvoir, dans la personne de sir Robert Peel, porté et soutenu par une majorité compacte de vieux torys. Voyons, étudions les doctrines, les actes de ce nouveau cabinet, qui a reçu mission expresse de maintenir intact l’édifice du monopole.
Son premier empressement est de proclamer son adhésion aux doctrines de la liberté commerciale. « Il faut arriver, dit sir Robert, à ce que tout Anglais puisse librement acheter et vendre partout où il pourra le faire avec le plus d’avantage. » Son collègue, sir James Graham, en citant ces paroles, devenues proverbiales en Angleterre, les caractérise ainsi : « C’est la politique du sens commun. »
Il ne faut pas croire que sir Robert, en ajournant la réalisation de la doctrine libérale, s’abrite, comme on devrait s’y attendre, derrière ce prétexte si spécieux et si répandu : le défaut de réciprocité de la part des autres nations. Non, il a dit encore : « Réglons nos tarifs selon nos intérêts, qui consistent à mettre les produits du monde à la portée de nos consommateurs ; et si les autres peuples veulent payer cher ce que nous pourrions leur donner à bon marché, libre à eux ! »
Comparons maintenant les actes à ces déclarations de principes, et si nous trouvons que la pratique n’est pas à la hauteur de la théorie, nous reconnaîtrons du moins que ces actes ont une signification à laquelle on ne saurait se méprendre, si l’on ne perd pas de vue que le ministère anglais agit au milieu d’immenses difficultés financières et sous l’influence du parti qui l’a porté au pouvoir.
La première mesure que prit sir Robert Peel, ce fut de faire un appel aux riches pour combler le déficit. Il soumit à une taxe de 3 pour 100 tout revenu dépassant 150 liv. sterl. (fr. 3,250), quelle qu’en fût la source, terres, industries, rentes sur l’État, traitements, etc. Cette taxe doit durer trois ou cinq ans.
Au moyen de cette taxe sur le revenu (income-tax), sir Robert Peel espérait non-seulement combler le déficit annuel, mais encore avoir, après chaque exercice, un excédant disponible.
À quoi fallait-il consacrer cet excédant ? Évidemment à quelque mesure propre à relever les impôts ordinaires, de manière à pouvoir se passer, après trois ou cinq ans, de l’income-tax.
Je ne sais ce qu’on aurait imaginé, de ce côté-ci du détroit, en semblable conjoncture ; quoi qu’il en soit, le cabinet tory proposa d’abaisser le tarif des douanes de manière à produire, dans les revenus déjà en déficit, un nouveau vide égal à cet excédant attendu de l’income-tax. Il espérait qu’au bout des trois ou cinq années, cet allégement des droits favorisant la consommation, et par là le revenu public, l’équilibre des finances serait rétabli.
Faire monter les recettes par un dégrèvement de taxes, c’est, il faut l’avouer, un procédé hardi et encore inconnu chez un grand nombre de peuples.
Au reste, il est peut-être bon de remarquer ici que sir Robert Peel n’avait pas le mérite de l’invention. C’est une politique qui a été constamment suivie, depuis la paix, soit par les whigs, soit par les torys, que de chercher dans la diminution des taxes des ressources pour le trésor. Seulement, ce que les précédents cabinets avaient fait pour les taxes intérieures (et je citerai entre autres la réforme postale), sir Robert l’a appliqué aux droits de douane. Par là, il a introduit un germe de mort au cœur du régime prohibitif.
M. Dussard a déjà fait connaître dans ce journal les réductions opérées à cette époque sur les tarifs anglais. Je rappellerai ici les principales.
| DÉNOMINATIONS. | DROITS ANCIENS. | DROITS NOUVEAUX. | |||||||||||||||||||
| d’origine étrangère | des colonies | d’origine étrangère | des colonies | ||||||||||||||||||
| liv. | sch. | d. | liv. | sch. | d. | liv. | sch. | d. | |||||||||||||
| Boeufs | Prohibé | " | " | " | 1 | " | " | " | 10 | " | |||||||||||
| Veaux | – | " | " | " | " | 10 | " | " | 5 | " | |||||||||||
| Moutons | – | " | " | " | " | 3 | " | " | 1 | 6 | |||||||||||
| Cochons | – | " | " | " | " | 5 | " | " | 2 | 6 | |||||||||||
| Viande de boeuf | le quintal | – | " | " | " | " | 8 | " | " | 2 | " | ||||||||||
| Viande de porc | le quintal | – | " | " | " | " | 8 | " | " | 2 | " | ||||||||||
| Bière | 32 litres | 3 | liv. | 6 | sch. | d.. | " | " | " | 2 | " | " | 1 | " | " | ||||||
| Boeuf salé | " | 12 | " | " | " | " | " | 8 | " | " | 2 | " | |||||||||
| Farine | " | 3 | " | " | " | " | " | " | 6 | " | " | 3 | |||||||||
| Huile d’olives | 4 | 4 | " | " | " | " | 2 | " | " | 1 | " | " | |||||||||
| Huile de baleine | 26 | 12 | " | " | " | " | 6 | " | " | " | " | " | |||||||||
| Bois de construction | 3 | " | " | " | 10 | " | 1 | 5 | " | " | " | 1 | |||||||||
| Cuirs | le quintal | " | 4 | 8 | " | " | " | " | 2 | " | " | 1 | " | ||||||||
| Souliers de femmes | la douzaine | " | 18 | " | " | " | " | " | 8 | " | " | 4 | " | ||||||||
| Bottes | 2 | 14 | " | " | " | " | 1 | 5 | " | " | 12 | " | |||||||||
| Souliers d’hommes | 1 | 4 | " | " | " | " | " | 12 | " | " | 6 | " | |||||||||
| Gants, réduction 50 p. 100 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||
| Goudron | 12 barils | " | 15 | " | " | " | " | " | 6 | " | " | 3 | " | ||||||||
| Térébenthine | " | 4 | 4 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 6 | |||||||||
| Café | " | 1 | 3 | " | 6 | " | " | 8 | " | " | " | 4 | |||||||||
| Suif | le quintal | " | 3 | 2 | " | 1 | " | " | 3 | 2 | " | " | 3 | ||||||||
| Riz | 3 hectolitres | 1 | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | ||||||||
Voici comment fut modifiée l’échelle progressive (sliding scale) des droits sur les céréales :
| PRIX DU FROMENT. | NOUVELLE ÉCHELLE. | ANCIENNE ÉCHELLE. | |||
| sch. le quarter. | sch. | sch. | d. | ||
| 73 | 1 | 1 | " | ||
| 72 | 2 | 2 | 8 | ||
| 71 | 3 | 6 | 8 | ||
| 70 | 4 | 10 | 8 | ||
| 69 | 5 | 13 | 8 | ||
| 68 | 6 | 16 | 8 | ||
| 67 | 18 | 8 | |||
| 66 | 20 | 8 | |||
| 65 | 7 | 21 | 8 | ||
| 64 | 8 | 22 | 8 | ||
| 63 | 9 | 23 | 8 | ||
| 62 | 10 | 24 | 8 | ||
| 61 | 11 | 25 | 8 | ||
| 60 | 12 | 26 | 8 | ||
| 59 | 13 | 27 | 8 | ||
| 58 | 14 | 28 | 8 | ||
| 57 | 15 | 29 | 8 | ||
| 56 | 16 | 30 | 8 | ||
| 55 | 17 | 31 | 8 | ||
| 54 | 18 | 32 | 8 | ||
| 53 | 33 | 8 | |||
| 52 | 19 | 34 | 8 | ||
| 51 | 20 | 35 | 8 | ||
Le ministère Peel ne s’est pas arrêté dans cette voie.
Dans la séance du 1er mai 1844, le chancelier de l’Échiquier a annoncé que le but immédiat qu’on s’était proposé, celui de rétablir l’équilibre des finances, avait été atteint. Les recettes du dernier exercice ont dépassé les prévisions ; les dépenses, au contraire, sont demeurées au-dessous, en sorte que l’administration peut disposer d’un boni de 2,370,600 liv. sterl.
En conséquence il propose :
1° D’abolir intégralement les droits sur les laines étrangères ;
2° D’abolir intégralement les droits sur les vinaigres ;
3° De réduire les droits sur les cafés étrangers de 8 à 6 d., le droit sur le café colonial restant à 4 d. — La protection tombe ainsi de 2 d. ;
4° De réduire les droits sur les sucres étrangers provenant du travail libre (foreign free-grown sugar) de 63 à 34 sch. le quintal, le droit sur le sucre colonial restant à 24 sch. — La prime en faveur des colonies, ou la protection, tombe ainsi de 39 à 10 sch., ou des trois quarts ;
5° D’abaisser les droits sur plusieurs autres articles, verrerie, raisins de Corinthe, et les taxes sur les primes d’assurances maritimes. Ces diverses réductions doivent laisser un déficit au trésor de 400,000 liv. sterl., et réduire par conséquent le boni de 2,400,000 liv. sterl, à 2 millions.
Si l’on ajoute à cela la réforme de la Banque et la conversion des rentes, on reconnaîtra que la présente session du Parlement n’a pas été tout à fait perdue pour l’avenir économique de la Grande-Bretagne, même sous l’administration qui n’est arrivée au pouvoir que pour modérer l’esprit de réforme.
Et si l’on veut vient se rappeler que, contrairement à tous les précédents, les vainqueurs de la Chine et du Scind n’ont stipulé pour eux, dans ces pays, aucun avantage commercial qui ne s’étende à toutes les nations du monde, il faudra bien convenir que la doctrine de la liberté des échanges a dû faire des progrès en Angleterre pour amener de tels résultats.
On est surpris, il est vrai, que le gouvernement anglais pouvant disposer d’un excédant de recettes de 2,400,000 liv. sterl., il n’accorde des modérations de droits que jusqu’à concurrence de 400,000 liv. sterl. Voici comment M. Goulburn s’exprime à ce sujet :
« Je n’hésite pas à dire que, dans le moment actuel, je ne suis pas encore fixé sur les résultats de la réduction de droits opérée en 1842. Il est hors de doute que lorsque l’on considère la liste des articles et la consommation croissante, qui s’est manifestée sur presque tous, on est fondé à concevoir les plus grandes espérances. Sur les trente-trois principaux articles qui ont été réduits, il n’y en a que cinq dont la consommation a diminué. Sur tous les autres, il y a eu une augmentation plus ou moins prononcée. J’espère donc dans l’issue de cette expérience ; mais la Chambre ne doit pas perdre de vue que la nécessité de donner aux approvisionnements le temps de s’écouler n’a permis au nouveau tarif d’entrer en plein exercice que vers le milieu de l’année dernière. L’expérience n’est donc pas complète, et je ne saurais prendre sur moi, d’après un essai d’aussi courte durée, de préjuger les vues du Parlement dans le cours de la prochaine session, surtout alors que la taxe sur le revenu (income-tax) devra être prise en considération. Dans de telles circonstances, je pense qu’il sera évident pour tous que j’aurais agi d’une manière inconsidérée et même déloyale, si j’avais engagé la Chambre à voter, dès aujourd’hui, de plus fortes réductions, qui n’auraient eu d’autre résultat que de l’empêcher d’agir, l’année prochaine, en parfaite connaissance de cause. »
Ainsi le cabiner réserve 2 millions sterling, sur l’excédant de revenu déjà réalisé, pour les réunir à l’excédant prévu du présent exercice, afin de pouvoir, dès la prochaine session, soit supprimer l’income-tax, soit marcher résolûment dans la carrière de la réforme commerciale. Je dois ajouter que c’est l’opinion générale, en Angleterre, que le ministre usera de la faculté qui lui a été accordée de prélever l’income-tax pendant cinq ans au lieu de trois, et qu’il mettra ce délai à profit pour achever, autant du moins que cela entre dans ses vues, l’œuvre qu’il a entreprise.
De l’examen que je viens de faire de la politique suivie en Angleterre, depuis Huskisson jusqu’à ce moment, et de l’espèce d’engagement contracté le 1er mai dernier par le chancelier de l’Échiquier, je crois qu’on peut conclure que le Royaume-Uni s’avance d’année en année vers le régime de la liberté. C’est la seconde proposition que j’avais à établir ; mais afin qu’on ne soit pas porté à s’exagérer la libéralité de l’œuvre des torys, non plus qu’à en méconnaître l’importance, je crois devoir faire suivre cet exposé de quelques réflexions.
Quelle différence caractérise la politique de Peel et celle de Russel ? Comment le ministère whig est-il tombé pour avoir proposé une réforme qu’accomplissent ceux qui l’ont renversé ? C’est une question qui se présentera naturellement à l’esprit, dans l’état d’ignorance où la presse tient systématiquement le public français sur les affaires de l’Angleterre.
Le plan adopté par sir R. Peel répond à deux pensées : la première, c’est de relever le revenu public par l’accroissement de la consommation ; la seconde, de ménager, autant que possible, les intérêts aristocratiques et coloniaux. Soulager les masses, dans la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre des finances, n’abandonner du monopole que ce qui est indispensable pour atteindre ce but ; telle est la tâche que le ministère accomplit du consentement des torys. On conçoit que la situation de la Grande-Bretagne commandait si impérieusement de mettre un terme au déficit annuel du budget, que les torys eux-mêmes se soient vus forcés de laisser entamer le monopole.
Mais naturellement ils ont exigé du ministère qu’il en retînt tout ce qu’il est possible d’en retenir. Aussi sir R. Peel n’a pas songé à établir l’impôt foncier ; et il n’a touché que d’une manière illusoire à la protection dont jouissent les céréales, c’est-à-dire les seigneurs terriens.
Quant aux colonies, la protection leur est continuée et semble même leur promettre un nouvel avenir. Il est vrai que le nivellement tend à s’établir pour le sucre, le café et ce qu’on nomme les denrées tropicales ; il et vrai encore que les droits ont été abaissés sur une foule d’objets de provenance étrangère et dans une forte proportion ; ont été abaissés, pour les objets similaires provenant des colonies, dans une proportion encore plus forte, en sorte que la protection subsiste toujours en principe et en fait. Un exemple fera comprendre ce mécanisme.
| BOIS DE CONSTRUCTION | |||||
| Du canada. | De la Baltique. | Proportion | |||
| Tarif ancien. | 10 | sch. | 55 | sch. | 1 contre 5 1/2. |
| Tarif Russell. | 20 | 50 | 1 contre 2 1/2. | ||
| Tarif Peel. | 1 | 25 | 1 contre 25. | ||
Ainsi, quoique le bois de la Baltique ait subi une réduction plus forte même que celle que proposait lord John Russell, cependant la protection en faveur du Canada n’en est pas altérée ; bien au contraire, car sir Robert a en même temps dégrévé le bois colonial, tandis que lord Russell voulait l’élever. Cet exemple montre clairement par quel artifice le cabinet tory a su concilier l’intérêt du consommateur et celui des colons.
Il suit de là que sir Robert Peel est en mesure de refuser aux colonies la liberté du commerce. « Nous vous conservons la protection, leur dit-il, par d’autres chiffres, mais d’une manière tout aussi efficace. » Les whigs, au contraire, entraient dans la voie de l’affranchissement. Ils disaient aux colonies : « Le Royaume-Uni cesse d’être votre acheteur forcé, mais aussi il ne prétend plus être votre vendeur exclusif ; que chacun de nous se pourvoie selon ses intérêts et ses convenances. » Il est clair que c’était la rupture du contrat social. La métropole devenait libre de recevoir du bois, du sucre, du café d’ailleurs que des colonies ; les colonies devenaient libres de recevoir de la farine, des draps, des toiles, du papier, des soieries d’ailleurs que de l’Angleterre.
Le projet des whigs renfermait donc une pensée grande, féconde, humanitaire, qu’on regrette de ne pas retrouver, du moins au même degré, dans la réforme exécutée par les torys, d’autant que sir Robert Peel avait fait pressentir qu’il s’emparait de cette pensée, quand il avait placé son système sous le patronage de ces mémorables paroles : « Il faut arriver à ce que tout Anglais soit libre d’acheter et de vendre au marché le plus avantageux ! » « Every Englishman must be allowed to buy in the cheapest market, and to sell in the dearest. » (Speech on the tariff, 10 mai 1842.) Principe dont il s’écarte, puisqu’il oblige les Anglais et leurs colons d’acheter et de vendre dans des marchés forcés.
Telle est la différence qui signale les deux réformes que nous comparons ; mais quoique celle des torys soit moins radicale et sociale que celle des whigs, il est pourtant certain qu’elle procède constamment par voie de dégrèvement, et c’en est assez pour justifier la proposition que j’avais à établir.
Quand j’ai parlé de la France, j’ai dit que ce n’est pas par quelques actes du gouvernement, mais par les exigences de l’opinion publique qu’il fallait surtout apprécier les tendances des peuples et l’avenir qu’ils se préparent. Or, en matière de douanes, de l’autre côté comme de ce côté du détroit, il est facile de voir que l’initiative ministérielle est forcée par la puissance de l’opinion. Ici, elle réclame des protections, et le pouvoir rend des ordonnances restrictives. Là, elle demande la liberté, et le pouvoir opère les réformes du 26 juin 1842 et du 1er mai 1844 ; mais il s’en faut bien que ces mesures incomplètes satisfassent le vœu public, et comme il y a en France des comités manufacturiers qui tiennent les ministres sous leur joug, il y a en Angleterre des associations qui entraînent l’administration dans la voie de la liberté. Les manœuvres secrètes et corruptrices de comités, organisés pour le triomphe d’intérêts particuliers, ne peuvent nous donner aucune idée de l’action franche et loyale qu’exerce en Angleterre l’association pour la liberté du commerce [3], cette association puissante qui dispose d’un budget de 3 millions, qui, par la presse et la parole, fait pénétrer dans toutes les classes de la communauté les connaissances économiques, qui ne laisse ignorer à personne le mal ni le remède, et qui néanmoins paralyse entre les mains des opprimés toute arme que n’autorisent pas l’humanité et la religion. — Je n’entrerai pas ici dans des détails sur cette association dont la presse parisienne nous a à peine révélé l’existence. Je me contenterai de dire que son but est l’abolition complète, immédiate de tous les monopoles, « de toute protection en faveur de la propriété, de l’agriculture, des manufactures, du commerce et de la navigation, en un mot, la liberté illimitée des échanges, en tant que cela dépend de la législation anglaise et sans avoir égard à la législation des autres peuples ! » — Pour faire connaître l’esprit qui l’anime, je traduirai un passage d’un discours prononcé à la séance du 20 mai dernier par M. George Thompson.
« C’est un beau spectacle que de voir une grande nation presque unanime poursuivant un but tel que celui que nous avons en vue, par des moyens aussi parfaitement conformes à la justice universelle que ceux qu’emploie l’Association. En 1826, le secrétaire d’État, qui occupe aujourd’hui le ministère de l’intérieur, fit un livre pour persuader aux monopoleurs de renoncer à leurs priviléges, et il les avertissait que s’ils ne s’empressaient de céder et de sacrifier leurs intérêts privés à la cause des masses, le temps viendrait où, dans ce pays, comme dans un pays voisin, le peuple se lèverait dans sa force et dans sa majesté, et balayerait, de dessus le sol de la patrie, et leurs honneurs, et leurs titres et leurs distinctions, et leurs richesses mal acquises. Qu’est-ce qui a détourné, qu’est-ce qui détourne encore cette catastrophe dont l’idée seule fait reculer d’horreur ? qu’est-ce qui en préservera notre pays, quelque longue que soit la lutte actuelle ? C’est l’intervention de l’Association pour la liberté du commerce, avec son action purement morale, intellectuelle et pacifique, rassemblant autour d’elle et accueillant dans son sein les hommes de la moralité la plus pure, non moins attachés aux principes du christianisme qu’à ceux de la liberté, et décidés à ne poursuivre leur but, quelque glorieux qu’il soit, que par des moyens dont la droiture soit en harmonie avec la cause qu’ils ont embrassée. Si l’ignorance, l’avarice et l’orgueil se sont unis pour retarder le triomphe de cette cause sacrée, une chose du moins a lieu de nous consoler et de soutenir notre courage, c’est que chaque heure de retard est employée par dix mille de nos associés à répandre les connaissances les plus utiles dans toutes les classes de la communauté. Je ne sais vraiment pas, s’il était possible de supputer le bien qui résulte de l’agitation actuelle, je ne sais pas, dis-je, s’il ne présenterait pas une ample compensation au mal que peuvent produire, dans le même espace de temps, les lois qu’elle a pour objet de combattre. — Le peuple a été éclairé, la science et la moralité ont pénétré dans la multitude ; et si le monopole a empiré la condition physique des hommes, l’association a élevé leur esprit et donné de la vigueur à leur intelligence. Il semble qu’après tant d’années de discussion, les faits et les arguments doivent être épuisés. Cependant nos auditeurs sont toujours plus nombreux, nos orateurs plus féconds, et tous les jours ils exposent les principes les plus abstraits de la science sous les formes les plus variées et les plus attrayantes. Quel homme, attiré dans ces meetings par la curiosité, n’en sort pas meilleur et plus éclairé ? Quel immense bienfait pour la pays que cette association ! Pour moi, je suis le premier à reconnaître tout ce que je lui dois, et je suppose qu’il n’est personne qui ne se sente sous le poids des mêmes obligations. Avant l’existence de la Ligue, avais-je l’idée de l’importance du grand principe de la liberté des échanges ? l’avais-je considéré sous tous ses aspects ? avais-je reconnu aussi distinctement les causes qui ont fait peser la misère, répandu le crime, propagé l’immoralité parmi tant de millions de nos frères ? Savais-je apprécier, comme je le fais aujourd’hui, tout l’influence de la libre communication des peuples sur leur union et leur fraternité ? Avais-je reconnu le grand obstacle au progrès et à la diffusion par toute la terre de ces principes moraux et religieux, qui font tout à la fois la gloire, l’orgueil et la stabilité de ce pays ? Non, certainement non ! D’où est sorti ce torrent de lumière ? de l’association pour la liberté du commerce. Ah ! c’est avec raison que les amis de l’ignorance et de la compression des forces populaires s’efforcent de renverser la Ligue, car sa durée est le gage de son triomphe, et plus ce triomphe est retardé, plus la vérité descend dans tous les rangs et s’imprime dans tous les cœurs. Quand l’heure du succès sera arrivée, il sera démontré qu’il est dû tout entier à la puissance morale du peuple. Alors ces vivaces énergies, devenues inutiles à notre cause, ne seront point perdues, disséminées ou inertes ; mais, j’en ai la confiance, elles seront convoquées de nouveau, consolidées et dirigées vers l’accomplissement de quelque autre glorieuse entreprise. Il me tarde de voir ce jour, par cette raison entre autres que la lumière, qui a été si abondamment répandue dans le pays, a révélé d’autres maux et d’autres griefs que ceux qui nous occupent aujourd’hui… Hâtons donc le moment où, vainqueurs dans cette lutte, sans que notre victoire ait coûté une larme à la veuve et à l’orphelin, nous pourrons diriger vers un autre objet cette puissante armée qui s’est levée contre le monopole, et conduire à de nouveaux triomphes un peuple qui aura tout à la fois obtenu le juste salaire de son travail et fait l’épreuve de sa force morale. Nous faisons une expérience dont le monde entier profitera. Nous enseignons aux hommes civilisés de tous les pays comment on triomphe sans intrigue, sans transaction, sans crime et sans remords, sans verser le sang humain, sans enfreindre les lois de la société et encore moins les commandements de Dieu. »
Tel est le but, tel est l’esprit de l’association. On ne sera pas surpris des vives lumières qu’elle a répandues en Angleterre, si l’on veut bien se rappeler que la question de la liberté du commerce touche à tous les grands problèmes de la science économique : distribution des richesses, paupérisme, colonies, et à un grand nombre de difficultés politiques ; car c’est le monopole qui sert de base à l’influence aristocratique, à la prépondérance de l’Église établie, au système de conquêtes et d’envahissements qui a prévalu dans les conseils de la Grande-Bretagne, au développement exagéré de forces navales que cette politique exige, enfin à la haine et à la méfiance des peuples qu’elle ne peut manquer de susciter.
Je crois avoir établi que le France et l’Angleterre suivent, en matière de douanes, une politique opposée. C’est le moment d’examiner la question que je posais en commençant :
Quelles seront, sur la prospérité, la sécurité et la moralité des deux nations, les conséquences logiques de l’état de choses dans lequel chacune d’elles aspire à se placer ?
§ III. — Je n’examinerai pas longuement les effets comparés de la liberté et du monopole sur la prospérité des nations. Les écoles politiques modernes paraissent se préoccuper beaucoup moins de prospérité que de prépondérance, comme si la prépondérance pouvait être considérée comme autre chose qu’un moyen (et souvent un moyen trompeur) de prospérité, et comme si la prospérité d’un peuple n’était pas un des fondements de sa prépondérance. D’ailleurs, à quoi bon démontrer ce qui est évident de soi ? Que l’isolement commercial de la France doive la placer, sous le rapport des richesses, dans des conditions d’infériorité vis-à-vis de l’Angleterre, cela peut-il être l’objet d’un doute ?
L’Angleterre, on le sait, a des capitaux abondants que l’industrie emprunte à un taux très-modéré ; elle possède les deux principaux instruments du travail, la houille et le fer, des ports nombreux, des moyens de communication rapides, de puissantes institutions de crédit, une race d’entrepreneurs pleins d’audace, de prudence et de ténacité, un nombre immense d’ouvriers habiles dans tous les genres, un gouvernement qui procure au travail la plus complète sécurité, un climat tempéré, favorable au développement des forces humaines. La seule chose qui neutralise tant et de si puissants avantages, c’est, d’une part, la cherté des subsistances, et par suite l’élévation du prix de la main-d’œuvre, et d’autre part, l’irritation, la haine sourde qui existe entre les diverses classes, conséquence du monopole que les unes exercent sur les autres.
Mais quand l’Angleterre aura achevé sa réforme commerciale, quand ses douanes, au lieu d’être un instrument de protection, ne seront plus qu’un moyen de prélever l’impôt, quand elle aura renversé la barrière qui la sépare des nations, alors les moyens d’existence afflueront de tous les points du globe vers cette île privilégiée, pour s’y échanger contre du travail manufacturier. Les froments de la mer Noire, de la Baltique et des États-Unis s’y vendront à 12 ou 14 fr. l’hectolitre ; le sucre du Brésil et de Cuba à 15 ou 20 centimes la livre, et ainsi du reste. Alors l’ouvrier pourra bien vivre en Angleterre avec un salaire égal et même inférieur, dans un cas urgent, à celui que recevront les ouvriers du continent, et particulièrement les ouvriers français forcés, par notre législation, de distribuer en primes aux monopoleurs la moitié peut-être de leurs modiques profits. Quel moyen nous restera-t-il de soutenir la lutte, alors que capitaux, houille, fer, transports, impôts, main-d’œuvre, tout reviendra plus cher au fabricant français ; alors que les navires étrangers, soumis à des droits protecteurs de navigation, seront réduits à venir sur lest chercher nos produits dans nos ports, et que nos propres bâtiments, privés, par la prohibition, de tous moyens de faire des chargements de retour, seront forcés de faire supporter double fret à nos exportations ?
En même temps que, par le bon marché des subsistances, les classes ouvrières d’Angleterre seront mises à même d’étendre le cercle de leurs consommations, on verra s’apaiser le sentiment d’irritation qui les anime, d’abord parce qu’elles jouiront de plus de bien-être, ensuite parce qu’elles n’auront plus de griefs raisonnables contre les autres classes de la société.
Les choses suivront chez nous une marche diamétralement opposée.
Le but immédiat de la protection est de favoriser le producteur. — Ce que celui-ci demande, c’est le placement avantageux de son produit. — Le placement avantageux d’un produit dépend de sa cherté, — et la cherté provient de la rareté. — Donc la protection aspire à opérer la rareté. — C’est sur la disette des choses qu’elle prétend fonder le bien-être des hommes. — Abondance et richesse sont à ses yeux deux choses qui s’excluent, car l’abondance fait le bon marché, et le bon marché, s’il profite au consommateur, importune le producteur dont la protection se préoccupe exclusivement.
En persévérant dans ce système, nous arrivons donc à élever le prix de toutes choses. Dira-t-on que le bon marché peut revenir par la seule concurrence des producteurs nationaux ? Ce serait supposer qu’ils travaillent dans des conditions aussi favorables que les producteurs étrangers ; ce serait déclarer l’inutilité de la protection. Mais le régime restrictif, loin de présupposer cette égalité de conditions, aspire à la produire, et ici je dois faire remarquer un abus de mots qui conduit à de graves erreurs. — Ce ne sont pas les conditions de production, mais les conditions de placement que la protection égalise. Un droit élevé peut bien faire que les oranges mûries par la chaleur artificielle de nos serres se vendent au même prix que les oranges mûries par le soleil de Lisbonne. Mais il ne peut pas faire que les conditions de production soient égales en France et en Portugal. — Ainsi, cherté, rareté, sont les conséquences nécessaires de la protection, toutes les fois que la protection a des conséquences quelconques.
Partant de ces données, il est facile de voir ce qui arrivera si la France persévère dans le régime restrictif, pendant que l’Angleterre s’avance vers la liberté des échanges.
Déjà une foule de produits anglais sont à plus bas prix que les nôtres, puisque nous sommes réduits à les exclure. À mesure que la liberté produira en Angleterre ses effets naturels, le bon marché de tous les objets de consommation ; à mesure que la restriction produira en France ses conséquences nécessaires, la rareté, la cherté des moyens de subsistance, cette distance entre les prix des produits similaires ira toujours s’agrandissant, et il viendra un moment où les droits actuels seront insuffisants pour réserver à nos producteurs le marché national. Il faudra donc les élever, c’est-à-dire chercher le remède dans l’aggravation du mal. — Mais en admettant que la législation puisse toujours défendre notre marché, elle est au moins impuissante sur les marchés étrangers, et nous en serons infailliblement évincés, le jour, peu éloigné, je le crois, où les Îles Britanniques se seront déclarées port franc dans toute la force du mot. Alors, à beaucoup d’avantages naturels sous le rapport manufacturier, les Anglais joindront celui d’avoir la main-d’œuvre à bas prix, car le pain, la viande, le combustible, le sucre, les étoffes et tout ce que consomme la classe ouvrière, se vendra en Angleterre à peu près au même taux que dans les divers pays du globe où ces objets sont au moindre prix. Nos produits fabriqués, chassés de partout par cette concurrence invincible, seront donc refoulés dans nos ports et nos magasins ; il faudra las laisser pourrir ou les vendre à perte. Mais vendre à perte ne peut être l’état permanent de l’industrie. Il faudra donc opter : ou arrêter la fabrication, ou réduire le taux des salaires. L’un de ces partis facilitera l’autre. Plus il se fermera d’ateliers, plus la place regorgera d’ouvriers sans pain et sans emploi, qui se feront concurrence les uns aux autres, et loueront leurs bras au rabais, jusqu’à ce que soit atteinte cette dernière limite de privations et de souffrances au delà de laquelle il n’est plus possible à l’homme de subsister. — Je ne veux pas m’étendre ici sur les dangers d’un tel état de choses, au point de vue de l’ordre, de la sécurité intérieure, non plus que sous le rapport de la criminalité toujours si étroitement liée à la misère ; je me borne à la question économique. — La classe laborieuse sera donc réduite à retrancher sur toutes ses consommations déjà si restreintes ; dès lors, et je prie de remarquer ceci, ce ne sont plus les débouchés extérieurs que nous aurons perdus, mais encore ces débouchés réciproques que nos industries s’ouvrent les unes aux autres. Les classes manufacturières ne feront aucun retranchement sur le pain, la viande, le vêtement, qui ne nuise aux classes agricoles ; et celles-ci ne sauraient souffrir sans que la réaction soit sentie par les classes manufacturières. Le nord ruiné demandera moins de vins et de soieries au Midi, le Midi appauvri se passera dans une forte proportion des draps et des cotonnades du Nord. C’est ainsi que le dénûment, la privation, et sans doute aussi les passions mauvaises et dangereuses, s’étendront sur tous les points du territoire et sur toutes les classes de la société.
Je ne doute pas qu’on ne s’efforce de jeter du ridicule sur ces tristes prévisions. Mais peut-on raisonnablement accuser d’aspirer au rôle de prophète l’écrivain qui se borne à exposer les conséquences nécessaires du fait sur lequel il raisonne ? — Et après tout, quelle est ma conclusion ? que nous marchons vers le dénûment. Or, c’est la non-seulement l’effet, mais encore, nous l’avons vu, le but avoué de la protection, car elle ne prétend pas aspirer à autre chose qu’à favoriser le producteur, c’est-à-dire à produire législativement la cherté. Or, cherté, c’est rareté ; rareté, c’est l’opposé d’abondance ; et l’opposé d’abondance, c’est le dénûment.
Et puis, est-il vrai ou n’est-il pas vrai que, même en ce moment où une législation vicieuse tient en Angleterre les moyens de subsistance à haut prix, notre industrie lutte péniblement contre celle des anglais ? Si cela est vrai, que sera-ce donc quand cette législation réformée aura fait disparaître, de leur côté, cette cause d’infériorité relative ? Si cela n’est pas vrai, si nous sommes sans rivaux, si nous jouissons des conditions de production les plus favorables, sur quoi se fonde la protection ? qu’a-t-elle à dire pour sa justification ?
§ IV. — Sécurité. — On peut dire qu’un peuple dont l’existence repose sur le système colonial et sur des possessions lointaines n’a qu’une prospérité précaire et toujours menacée, comme tout ce qui est fondé sur l’injustice. Une conquête excite naturellement contre le vainqueur la haine du peuple conquis, l’alarme chez ceux qui sont exposés au même sort, et la jalousie parmi les nations indépendantes. Lors donc que, pour se créer des débouchés, une nation a recours à la violence, elle ne doit point s’aveugler : il faut qu’elle sache qu’elle soulève au dehors toutes les énergies sociales, et elle doit être préparée à être toujours et partout la plus forte, car le jour où cette supériorité serait seulement incertaine, ce jour-là serait celui de la réaction. — En relâchant le lien colonial, l’Angleterre ne travaille donc pas moins pour sa sécurité que pour sa prospérité, et (c’est là du moins ma ferme conviction) elle donne au monde un exemple de modération et de bon sens politique qui n’a guère de précédent dans l’histoire. Cette nation a longtemps cherché la grandeur dans des envahissements successifs, et elle a possédé jusqu’ici la condition essentielle de cette politique, la supériorité navale. Pour qu’elle pût être justifiée de persévérer dans ce système, il faudrait deux choses : la première, qu’il fût favorable à ses vrais intérêts ; la seconde, que la suprématie des mers ne pût jamais lui être arrachée. Mais, d’une part, les connaissances économiques ont fait assez de progrès en Angleterre pour que le système colonial y soit jugé, au point de vue de la prospérité de la métropole ; et il est peu d’Anglais qui ne sachent fort bien que le commerce avec le États libres est plus avantageux que les échanges avec les colonies. D’une autre part, être toujours le plus fort est une lourde obligation. À mesure que les autres peuples grandissent, il faut que l’Angleterre accroisse la masse de forces vives, de capitaux, de travail humain qu’elle soustrait à l’industrie pour les consacrer à la marine, et il doit arriver un moment où l’emploi improductif de tant de ressources dépasse de beaucoup les profits du commerce colonial, en les supposant même tels qu’on se plaît à les imaginer. — Il y a donc, de la part de l’Angleterre, une sagesse profonde, une prudence consommée à dissoudre graduellement le contrat colonial, à rendre et à recouvrer l’indépendance, à se retirer à temps d’un ordre de choses violent et par cela même dangereux, précaire, gros d’orages et de tempêtes, et qui, après tout, détruit et prévient plus de richesses qu’il n’en crée. Sans doute, il en coûtera à l’orgueil britannique de se dépouiller de cette ceinture de possessions échelonnées sur toutes les grandes routes du monde. Il en coûtera surtout à l’aristocratie, qui, par les places qu’elle occupe dans les colonies, dans les armées et dans la marine, recueille cette large moisson d’impôts, qu’un tel système oblige à faire peser sur les classes laborieuses. Mais derrière les torys, il y a les whigs ; derrière les whigs, il y a le peuple qui paye et qui souffre ; il y a la Ligue qui lui apprend pourquoi il souffre et pourquoi il paye ; il y a le cœur humain qui, pour faire triompher le juste, n’a besoin que d’apercevoir sa connexité avec l’utile ; et il est permis d’espérer qu’un faux orgueil national, une prospérité factice et inégale ne lutteront pas longtemps contre les forces combinées de l’intérêt, de la justice et de la vérité. La Ligue le proclame tous les jours et sous toutes les formes, ce qu’on nomme la puissance britannique, en tant qu’elle repose sur la violence, l’oppression et l’envahissement, outre les périls qu’elle tient suspendus sur l’empire, ne lui donne pas ces richesses qu’elle semble promettre et qu’il trouvera dans la liberté des relations internationales, si du moins on appelle richesses l’abondance des choses et leur équitable répartition.
Ainsi, en se délivrant du gigantesque fardeau de ses colonies, non point en ce qui touche des relations de libre échange, de fraternité, de communauté de race et de langage, mais en tant que possessions courbées avec la métropole sous le joug d’un monopole réciproque, l’Angleterre, je le répète, travaille autant pour sa sécurité que pour sa prospérité. Aux sentiments de haine, d’envie, de méfiance et d’hostilité que son ancienne politique avait semés parmi les nations, elle substitue l’amitié, la bienveillance et cet inextricable réseau des liens commerciaux qui rend les guerres à la fois inutiles et impossibles. Elle se replace dans une situation naturelle, stable, qui, en favorisant le développement de ses ressources industrielles, lui permettra d’alléger le faix des taxes publiques.
N’est-il pas à craindre que le régime protecteur n’engage la France dans cette voie dangereuse d’où l’Angleterre s’efforce de sortir ? — Je l’ai déjà dit en commençant, il y a connexité nécessaire entre la protection et les colonies. Établir cette connexité, exposer toutes les conséquences qui en dérivent, au point de vue de la sécurité, ce serait dépasser de beaucoup les limites dans lesquelles je suis forcé de me renfermer ; je me bornerai à quelques aperçus.
À mesure que nos débouchés se fermeront au dehors, par l’effet de notre législation restrictive, nous nous attacherons plus fortement aux débouchés coloniaux. Nous renforcerons autant que possible notre monopole à la Martinique, à la Guadeloupe, en Algérie ; nous suivrons la politique dont le germe est contenu dans l’ordonnance qui exclut les tissus anglais de l’Afrique française. Mais, sous peine de n’être que les oppresseurs de nos colons, de n’exciter en eux que le mécontentement et la haine, il faudra bien que les faveurs soient réciproques ; il faudra bien que nous repoussions aussi de nos marchés toute production du dehors qui pourra nous être fournie, à quelque prix que ce soit, par l’Algérie ; et nous serons ainsi amenés à rompre le peu de relations qui nous lient encore avec les nations étrangères.
Dans cette substitution de marchés réservés à des marchés libres, la perte sera évidente. Nos Antilles ne sauraient nous offrir un débouché égal à celui de tous les pays où croît la canne à sucre. Quand nous aurons exclu le coton, les soies, les laines étrangères, pour protéger l’Algérie, le débouché que nous nous serons réservé en Afrique sera loin, bien loin de compenser celui que nous aurons perdu aux États-Unis, en Italie, en Espagne ; et nous serons plus engorgés que jamais. Il faudra donc marcher à la conquête de débouchés nouveaux, de débouchés réservés, c’est-à-dire de nouvelles colonies. Nous convoitons Haïti, Madagascar, que sais-je ?
Ainsi, nous cimenterons, nous élargirons le système des colonies à monopoles réciproques, au moment même où il sera rejeté par le pays qui l’a le plus expérimenté. Mais on ne fait pas de conquêtes sans provoquer des haines. Après avoir prélevé sur nous-mêmes d’immenses capitaux, pour solder au loin des consommateurs, il nous faudra en prélever de plus immenses encore pour nous prémunir contre l’esprit d’hostilité que nous aurons fait naître. Jamais nous ne saurons augmenter assez nos forces de terre et de mer, et plus nous aurons anéanti, au sein de notre population, la faculté de produire, plus nous serons forcés de l’accabler de tributs et d’entraves. Se peut-il concevoir une politique plus insensée ? Quoi ! lorsque l’Angleterre s’effraye de sa puissance coloniale, elle qui a tant de vaisseaux pour la maintenir, lorsqu’elle reconnaît que cette puissance est artificielle, injuste, pleine de périls, quand elle comprend que ce système d’envahissement compromet la paix du monde, provoque des réactions, force tous les peuples à se tenir toujours prêts à prendre part à une conflagration générale, et tout cela, non-seulement dans profit pour elle, mais encore au détriment de son industrie et du bien-être de ses citoyens, quand enfin elle se dégage volontairement, librement, par prudence pure et après mûre réflexion, de ces liens dangereux, pour se replacer dans une situation naturelle, stable, sûre et équitable, c’est alors que nous voulons entrer dans cette voie funeste, nous qui proclamons tout haut notre pénurie de vaisseaux et de marins ; c’est alors que nous prétendons créer de toutes pièces et le système colonial et le développement des forces navales qu’il exige ! Et pourquoi ? pour substituer au marché universel, qui serait à nous par la liberté, le débouché de quelques îles lointaines, débouché forcé, illusoire, acheté deux fois par le double sacrifice que nous nous imposons comme consommateurs et comme contribuables !
Ainsi le régime prohibitif et le système colonial, qui en est le complément nécessaire, menacent notre indépendance nationale. — Un peuple sans possessions au delà de ses frontières a pour colonies le monde entier, et cette colonie, il en jouit sans frais, sans violence et sans danger. Mais lorsqu’il veut s’approprier des terres lointaines, en réduire les habitants sous son joug, il s’impose la nécessité d’être partout le plus fort. S’il réussit, il s’épuise en impôts, se charge de dettes, s’entoure d’ennemis, jusqu’à ce qu’il renonce à sa folie, pourvu qu’on lui en donne le temps ; c’est l’histoire de l’Angleterre. S’il ne réussit pas, il est battu, envahi, dépouillé de ses conquêtes, chargé de tributs ; heureux s’il n’est pas morcelé et rayé de la liste des nations !
On dira sans doute que j’ai fait intervenir les colonies pour détourner sur le régime prohibitif des dangers dont il n’est pas responsable. Mais ce régime, considéré en lui-même, en dehors de tout envahissement, ne suffit-il pas pour mettre les peuples en état d’hostilité permanente ? Quel est le principe sur lequel il repose ? le voici : Le proufict de l’un est le doumage de l’autre (Montaigne). Or, si la prospérité de chaque nation est fondée sur la décadence de toutes les autres, la guerre n’est-elle pas l’état naturel de l’homme ?
Si la Balance du commerce est vraie en théorie ; si, dans l’échange international, un peuple perd nécessairement ce que l’autre gagne ; s’ils s’enrichissent aux dépens les uns des autres, si le bénéfice de chacun est l’excédant de ses ventes sur ses achats, je comprends qu’ils s’efforcent tous à la fois de mettre de leur côté la bonne chance, l’exportation ; je conçois leur ardente rivalité, je m’explique les guerres de débouchés. Prohiber par la force le produit étranger, imposer à l’étranger par la force le produit national, c’est la politique qui découle logiquement du principe. Il y a plus, le bien-être des nations étant à ce prix, et l’homme étant invinciblement poussé à rechercher le bien-être, on peut gémir de ce qu’il a plu à la Providence de faire entrer dans le plan de la création deux lois discordantes qui se heurtent avec tant de violence ; mais on ne saurait raisonnablement reprocher au fort d’obéir à ces lois en opprimant le faible, puisque l’oppression, dans cette hypothèse, est de droit divin et qu’il est contre nature, impossible, contradictoire que ce soit le faible qui opprime le fort.
Aussi, s’il est quelque chose de vain et de ridicule dans le monde, ce sont les déclamations, si communes dans nos journaux, contre le despotisme commercial d’un pays voisin, lorsque nous agissons, autant qu’il est en nous, d’après les mêmes doctrines. Il n’y a que les peuples qui reconnaissent le principe de la liberté commerciale qui soient en droit de s’élever contre tout ce qui porte atteinte à cette liberté.
Ce n’est pas la seule contradiction où nous entraîne la doctrine restrictive. Voyez les journaux parisiens. Sur deux phrases consacrées à ces matières, il y en a une pour prouver à la France qu’elle a tout à gagner à repousser les produits étrangers, et une autre pour démontrer aux étrangers qu’ils ont tout à perdre à repousser nos produits, prêchant ainsi la prohibition à leurs concitoyens et la liberté à la Belgique, aux États-Unis, au Mexique. Comment des écrivains qui se respectent peuvent-ils se ravaler à de tels enfantillages ? et n’est-ce pas le cas de leur demander avec Basile : Qui donc est-ce que l’on trompe en tout ceci ?
J’ai nommé le Mexique. Cette république est un exemple du danger auquel la prohibition expose la sécurité et l’indépendance des peuples. Pour avoir voulu protéger le travail national, la voilà en ce moment en état d’hostilité ouverte avec la France, l’Angleterre et l’Union américaine. — Elle a exagéré le principe, dit on. — Que signifie cela ? Si le principe est bon, on n’en saurait faire une application trop absolue.
Si je voulais démontrer par les faits la connexité qui existe entre l’antagonisme commercial et l’antagonisme militaire, il me faudrait rappeler l’histoire moderne tout entière. Qu’il me soit permis d’en citer l’exemple contemporain le plus remarquable.
Écoutons Napoléon. Ses paroles, ses actes, le souvenir des résultats qu’ils ont amenés nous en apprendront plus que bien des volumes.
« On me proposa le blocus continental ; il me parut bon et je l’acceptai ; il devait ruiner le commerce anglais. En cela, il a mal fait son devoir, parce qu’il a produit, comme toutes les prohibitions, un renchérissement, ce qui est toujours à l’avantage du commerce. »
Voilà donc un système qui est bon parce qu’il doit ruiner nos rivaux ; qui fait mal son devoir précisément en cela ; qui est par sa nature tout à l’avantage du commerce qu’il a pour objet de ruiner ; qui agit donc contrairement à son but. Quelle logomachie !
« Les ports de mer (français) étaient ruinés. Aucune force humaine ne pouvait leur rendre ce que la Révolution avait anéanti. Il fallait donner une autre impulsion à l’esprit de trafic. Il n’y avait pas d’autre moyen que d’enlever aux Anglais le monopole de l’industrie manufacturière, pour faire de cette industrie la tendance générale de l’économie de l’État. Il fallait créer le système continental ; il fallait ce système et rien de moins, parce qu’il fallait donner une prime énorme aux fabriques. »
Voilà bien le régime prohibitif. Il aspire à donner à l’esprit de trafic (travail eût été une expression moins dédaigneuse et plus juste) une impulsion différente de celle qu’il reçoit de son propre intérêt ; et il ne veut pas voir que la prime énorme donnée au travail privilégié se prélève, non sur l’étranger, mais sur le consommateur national.
« Le fait a prouvé en ma faveur. — (C’est un peu fort !) J’ai déplacé le siége de l’industrie, etc. — J’ai été forcé de porter le blocus continental à l’extrême, parce qu’il avait pour but de faire non-seulement du bien à la France, mais encore du mal à l’Angleterre. »
On voit ici le principe : le bien de l’un, c’est le mal de l’autre. Mais on ne prétend pas sans doute l’appliquer sans résistance de la part de celui dont on veut faire le mal. Donc ce principe contient la guerre. Voyez en effet :
« Il faillait affermir le système. Cette nécessité a influé sur la politique de l’Europe, en ce qu’elle a fait à l’Angleterre une nécessité de poursuivre l’état de guerre. Dès ce moment aussi la guerre a pris en Angleterre un caractère plus sérieux. Il s’agissait pour elle de la fortune publique, c’est-à-dire de son existence ; la guerre se popularisa… La lutte n’est devenue périlleuse que depuis lors. J’en reçus l’impression en signant le décret. Je soupçonnai qu’il n’y aurait plus de repos pour moi et que ma vie se passerait à combattre des résistances !!… » Bonaparte aurait pu soupçonner aussi qu’il n’y aurait plus de repos pour la France.
Non-seulement ce principe conduit à la guerre avec la nation qu’on veut ruiner, mais avec toutes celles qu’on a besoin d’entraîner dans le système pour la faire réussir, bien qu’il soit dans sa nature, nous l’avons vu, de mal faire son devoir en cela, c’est-à-dire de ne pouvoir réussir. Écoutons encore Napoléon.
« Pour que le système continental fût bon à quelque chose, il fallait qu’il fût complet. Je l’avais établi, à peu de chose près, dans le Nord. Le Nord était soumis à mes garnisons ; il fallait le faire respecter dans le Midi. Je demandai à l’Espagne un passage pour un corps d’armée que je voulais envoyer en Portugal. Cette route nous mit en rapport avec l’Espagne. Jusqu’alors je n’avais jamais songé à ce pays-là, à cause de sa nullité. » Voilà l’origine de la guerre de la Péninsule.
« L’obligation de maintenir le système continental amenait seule des difficultés avec les gouvernements dont le littoral facilitait la contrebande. Entre ces États, la Russie se trouvait dans une situation embarrassante. Sa civilisation n’était pas assez avancée pour lui permettre de se passer des produits de l’Angleterre. J’avais exigé pourtant qu’ils fussent prohibés. C’était une absurdité ; mais elle était indispensable pour compléter le système prohibitif. La contrebande se faisait ; je m’en plaignis ; on se justifia ; on recommença ; nous nous irritions. Cette manière d’être ne pouvait durer. » Voilà l’origine de la guerre de Russie.
Et c’est là ce que l’école moderne nous donne pour de la politique profonde ! Certes, je n’ai pas la folle présomption de contester le génie de l’Empereur ; mais enfin, faut-il abjurer le sens commun et humilier sa raison devant ce tissu d’absurdités monstrueuses ? Bonaparte imagine que l’industrie manufacturière doit être la tendance générale de l’État ; qu’il doit, par ses décrets, détourner les capitaux et le travail de leur pente naturelle pour donner une autre impulsion à l’esprit de trafic. Pour cela, il organise un système de primes énormes en faveur des fabricants et fonde le régime prohibitif. Il reconnaît que ce régime fait mal son devoir ; qu’il produit un renchérissement qui tourne à l’avantage du commerce anglais, qu’il a pour but de ruiner. Alors il songe à le compléter. Il menace l’existence de l’Angleterre ; guerre à mort avec l’Angleterre. Il veut faire respecter son système dans le Midi ; guerre à mort avec l’Espagne. Il exige que la Russie se passe de ce dont elle ne peut se passer ; guerre à mort avec la Russie. Enfin la France est envahie deux fois, humiliée, chargée de tributs ; Bonaparte est attaché à un rocher, et il s’écrie : « Le fait a prouvé en ma faveur ! » Poursuivre un but qu’on déclare impossible par des moyens qu’on reconnaît absurdes, tomber dans l’abîme, y entraîner le pays et s’écrier : « Les faits m’ont donné raison, » c’est donner au monde le scandale d’un excès d’impéritie, en même temps que d’immoralité, dont l’histoire des plus affreux tyrans ne fournirait pas un autre exemple [4].
Donc le régime prohibitif est une cause permanente de guerre ; je dirai plus, de nos jours c’est à peu près la seule. Les guerres de spoliation directe, comme celles des Romains, celles qui ont pour objet de procurer des esclaves et d’imposer des croyances religieuses, d’augmenter le patrimoine d’une famille princière, ne sont plus de notre siècle. Aujourd’hui on se bat pour des débouchés, et si ce but n’est pas aussi naïvement odieux, il est certes plus puéril que les autres. On déteste, mais on comprend l’emploi de la force pour acquérir du butin, des esclaves, des vassaux, du territoire. Mais pour ouvrir des débouchés, ce n’est pas de la force, c’est de la liberté qu’il faut ; et cela est si vrai, que, de l’aveu même des partisans du système exclusif, le triomphe absolu d’une nation, s’il était possible, n’aurait pour résultat commercial que de lui assimiler toutes les autres et par conséquent de réaliser la liberté absolue du commerce.
Un nouveau Cinéas serait bien plus fondé à dire au peuple qui aspirerait, par la conquête, au monopole universel, ce que le Cinéas ancien disait à Pyrrhus : « Que ferez-vous quand vous aurez vaincu l’Italie ? — Je la forcerai à recevoir mes produits en échange des siens. — Et ensuite ? — La Sicile touche à l’Italie ; je la soumettrai. — Et après ? — Je rangerai sous mes lois l’Afrique, l’Inde, la Chine, les îles de la mer du Sud. — Mais enfin que ferez-vous quand le monde entier sera votre colonie ? — Oh ! alors j’échangerai librement, et jouirai du repos. — Et que n’échangez-vous d’ores et déjà, et ne jouissez du repos en proclamant la liberté ? »
Je reviens, un peu tard peut-être, à l’objet de ce paragraphe, qui n’est pas tant de montrer la liaison entre l’état de guerre et le système restrictif, que de faire voir combien, dans les luttes que l’avenir peut réserver aux nations, celles qui seront les dernières à s’affranchir de ce régime auront assumé de chances défavorable.
D’abord j’ai déjà prouvé que le peuple qui jouira de la liberté du commerce nous écrasera de sa concurrence, ce qui ne veut pas dire autre chose, sinon qu’il deviendra plus riche. À moins donc de soutenir que la richesse est indifférente au succès d’une guerre, il faut avouer que, sous ce rapport, la nation dont le travail languira dans les étreintes de la protection, sera, vis-à-vis de sa rivale, dans des conditions évidentes d’infériorité.
Ensuite, de nos jours, une guerre entre deux grands peuples entraîne bientôt tous les autres. Sous ce rapport encore, tout l’avantage sera du côté de la partie belligérante qui aura le plus d’alliances. Or, une nation qui s’isole n’a pas d’alliances nécessaires ; on peut rompre avec elle sans souffrances ni déchirements. Si l’Angleterre consomme les produits agricoles de la Baltique, de la mer Noire, de l’Amérique ; si la Russie, les États-Unis, la Prusse, consomment le travail manufacturier des Anglais ; si de part et d’autre la production s’est constituée de longue main selon cette donnée, il sera impossible à la France de désunir politiquement ce qui sera commercialement uni. « Le commerce, dit Montesquieu, tend à unir les nations. Si l’une a besoin de vendre, l’autre a besoin d’acheter, et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. » La France courra donc le risque d’avoir, à chaque guerre, toute l’Europe sur les bras, par ce double motif que l’Europe ne tiendra à nous par aucun lien fondé sur des besoins mutuels, et qu’elle tiendra à notre rivale par les liens les plus étroits.
Il est vrai, il faut le dire pour être impartial et pour qu’on ne m’accuse pas de ne considérer les questions que sous un aspect, que la France pourra tirer quelques avantages, en cas de guerre, de son isolement commercial, de l’extinction de ses rapports extérieurs, de la nullité de sa marine marchande, toutes conséquences du système économique qu’elle a adopté. Elle sera redoutable, comme l’est dans la société un ennemi qui, n’ayant rien à perdre, peut faire beaucoup plus de mal qu’il n’est possible de lui en rendre. L’absence de liens a été souvent prise, en politique comme en morale, pour de l’indépendance. Sous l’influence de cette idée, Rousseau, qui aimait à poursuivre un principe dans toutes ses conséquences, avait été amené à proscrire, comme autant de liens par lesquels on peut nous atteindre, d’abord la richesse, ensuite la science, puis la propriété, et enfin la société elle-même. Logicien inflexible, à ses yeux le négociant était le type de la dégradation humaine, « parce que, disait-il, on peut le faire crier à Paris en le touchant dans l’Inde ; » au contraire, le type de la perfection était le sauvage : il n’est assujetti qu’à la force brute, « et après tout, disait Rousseau, si on le chasse d’un arbre, il peut se réfugier sous un autre. » Le philosophe n’a pas vu que, à ce compte, la perfection est dans le néant.
Le système qui a pour objet de restreindre l’échange, et par conséquent le travail et le bien-être, procède de la même doctrine. Il invoque sans cesse l’indépendance nationale. Mais l’indépendance fondée sur ce qu’on n’a rien à perdre, sur ce qu’on a rompu tous les liens par lesquels on pourrait nous atteindre, c’est l’indépendance du sauvage, c’est l’invulnérabilité du néant. Si un peuple, adoptant la liberté du commerce, parsemait de ses vaisseaux toutes les mers, pendant qu’un autre, obéissant au régime restrictif, concentrerait toute sa vitalité dans les limites de ses frontières, il n’est pas douteux qu’en cas de guerre le premier ne fût plus vulnérable que le second. Et qui sait si le sentiment confus de cette différence de situation ne nous inspirera pas la funeste pensée de faire rétrograder vers la barbarie notre système d’agression et de défense ? S’il est une chose qui puisse consoler les âmes chrétiennes et généreuses des obstacles que rencontre l’établissement parmi les hommes de la paix universelle, c’est assurément la tendance, qu’on peut remarquer dans la guerre moderne, à restreindre ses fléaux sur les armées et tout au plus sur les nations prises en corps collectif. Sans doute le sang humain coule encore, des peuples ont été soumis à des tributs et quelquefois morcelés ; mais la propriété privée est en général respectée, on laisse aux hommes de travail le fruit de leurs sueurs et leurs moyens d’existence ; on a vu des armées passer et repasser, tantôt vaincues, tantôt victorieuses, sur le théâtre de ces luttes sanglantes, sans que le sort des habitants paisibles fût complétement bouleversé. Le même progrès tend à se réaliser sur mer : « La France légitime, dit M. de Chateaubriand, conservera éternellement la gloire d’avoir interdit l’armement en course, d’avoir la première rétabli, sur mer, ce droit de propriété respecté dans toutes les guerres sur terre par les nations civilisées, et dont la violation, dans le droit maritime, est un reste de la piraterie des temps barbares. » (Mélanges politiques, tome XXV, page 375.)
Mais n’est-il pas à craindre qu’une puissance belligérante qui n’aurait plus de commerce ne refusât d’accéder à une stipulation qui, sans pouvoir lui profiter, amoindrirait ses moyens d’agression ! La guerre à la propriété privée, aux matelots, aux passagers de tout âge et de tout sexe, semble donc être encore une des déplorables nécessités du régime prohibitif. N’avons-nous pas vu dernièrement, dans un brochure célèbre, recommander, systématiser cette guerre barbare ?
Mais ce n’est pas à l’auteur que le reproche doit s’adresser : il est marin, et il ne saurait conseiller à son pays une autre tactique navale que celle qui est indiquée par la nature des choses. C’est, nous le répétons, au régime prohibitif qu’il faut s’en prendre. C’est ce régime qui, nous plaçant dans cette situation de n’avoir bientôt plus rien à perdre sur mer, nous montre par où nous pouvons attaquer les peuples commerçants, sans avoir à craindre de représailles.
En 1823, la France avait interdit l’armement en course. À Dieu ne plaise que je veuille atténuer la gloire qui lui en revient ! Mais elle était alors en guerre avec une puissance plus dénuée que nous de propriété navale, et qui, par ce motif, n’accepta pas ce nouveau droit maritime. Au moment d’entrer en lutte, aucun peuple ne se soumet à une convention, quelque philanthrope qu’il soit, qui lui profite moins qu’à son ennemi. Raison de plus pour combattre ces lois restrictives, puisqu’elles sont inconciliables avec le progrès social dont la guerre même est susceptible.
Je laisse aux hommes spéciaux le soin d’examiner si la tactique proposée par le prince ne recèle pas de graves dangers : « Il faut agir sur le commerce anglais, » dit-il. Mais le commerce suppose deux intéressés. En agissant sur l’un, vous nuisez à l’autre, et vous vous faites autant d’ennemis qu’il y a de peuples dont vous interrompez les transactions.
Et puis, en admettant un plein succès, vous arriverez tout au plus à forcer les produits anglais à emprunter des navires neutres. Vous serez donc entraînés, comme Bonaparte, à imposer votre politique à toute l’Europe civilisée.
N’oublions pas ces paroles : « La Russie ne pouvait se passer des produits anglais. J’exigeai pourtant qu’elle les prohibât. C’était une absurdité ; mais elle était nécessaire pour compléter le système. La contrebande se faisait ; je m’en plaignis ; on se justifia ; on recommença ; nous nous irritions. Cette manière d’être ne pouvait durer. »
Ai-je besoin, après ce qui précède, de faire voir la liaison qui existe entre le régime protecteur et la démoralisation des peuples ? — Mais sous quelque aspect que l’on considère ce régime, il n’est tout entier qu’une immoralité. C’est l’injustice organisée ; c’est le vol généralisé, légalisé, mis à la portée de tout le monde, et surtout des plus influents et des plus habiles. Je hais autant que qui que ce soit l’exagération et l’abus des termes, mais je ne puis consciencieusement rétracter celui qui s’est présenté sous ma plume. Oui, protection, c’est spoliation, car c’est le privilége d’opérer législativement la rareté, la disette, pour être en mesure de surfaire à l’acheteur. Si, dans ce moment, moi, propriétaire, j’étais assez influent pour obtenir une loi qui forçât le public à me payer mon froment à 30 fr. l’hectolitre, n’est-ce pas comme si j’exerçais une déprédation égale à toute la différence de ce prix au prix naturel du froment ? Quand mon voisin me fait payer son drap, un autre son fer, un troisième son sucre, à un taux plus élevé que celui auquel j’achèterais ces choses si j’étais libre, ne suis-je pas du même coup dépouillé de mon argent et de ma liberté ? Et pense-t-on que les hommes puissent se familiariser ainsi avec des habitudes d’extorsion, sans fausser leur jugement et ternir leurs qualités morales ? Pour avoir une telle pensée, pour croire à la moralité des quêteurs de monopole, il faudrait n’avoir jamais lu un journal subventionné par les comités manufacturiers, il faudrait n’avoir jamais assisté à une séance de la Chambre ou du Parlement, quand il y est question de priviléges.
Je ne veux cependant pas dire que la spoliation, sous cette forme, ait un caractère aussi odieux que le vol proprement dit. Mais pourquoi ? uniquement parce que l’opinion porte encore un jugement différent sur ces deux manières de s’emparer du bien d’autrui.
Il a été un temps où une nation pouvait en dépouiller une autre, non-seulement sans tomber dans le mépris public, mais encore en se conciliant l’admiration du monde. L’opinion ne flétrissait pas alors le vol, pratiqué sur une grande échelle sous le nom de conquête ; et il est même remarquable que, bien loin de considérer l’abus de la force comme incompatible avec la vraie gloire, c’est précisément pour la force, en ce qu’elle a de plus abusif, qu’étaient réservés les lauriers, les chants des poëtes et les applaudissements de la foule.
Depuis que la conquête devient plus difficile et plus dangereuse, elle devient aussi moins populaire ; et l’on commence à la juger pour ce qu’elle est. Il en sera de même de la protection ; et si la déprédation, de peuple à peuple, est tombée en discrédit, malgré toutes les forces qui ont été de tout temps employées pour l’environner d’éclat et de lustre, il faut croire qu’il ne sera pas moins honteux, pour les habitants d’un même pays, de se dépouiller les uns les autres par la prosaïque opération des tarifs.
Si même l’on appréciait les actions humaines par leurs résultats, ce genre d’extorsion ne tarderait pas à être plus méprisé que le simple vol. Celui-ci déplace la richesse ; il la fait passer, des mains qui l’ont créée, à celles qui s’en emparent. L’autre la déplace aussi, et de plus il la détruit. La protection ne donne aux exploitants qu’une faible partie de ce qu’elle arrache aux exploités.
Si le régime restrictif place sous la sauvegarde des lois des actions criminelles, et présente comme légitime une manière de s’enrichir qui a, avec la spoliation, la plus parfaite analogie, par une suite nécessaire, il transforme en crimes fictifs les actions les plus innocentes, et attache des peines afflictives et infamantes aux efforts que font naturellement les hommes pour échapper aux extorsions, bouleversant ainsi toutes les notions du juste et de l’injuste. Un Français et un Espagnol se réunissent pour échanger une pièce d’étoffe contre une balle de laine. L’un et l’autre disposent d’une propriété acquise par le travail. Aux yeux de la conscience et du sens commun, cette transaction est innocente et même utile. Cependant, dans les deux pays, la loi la réprouve, et à tel point qu’elle aposte des agents de la force publique pour saisir les deux échangistes et pour les tuer sur place au besoin.
Qu’on ne dise pas que je cherche à innocenter la fraude et la contrebande. Si les droits d’entrée n’avaient qu’un but fiscal, s’ils avaient pour objet de faire rentrer dans les coffres de l’État les fonds nécessaires pour assurer tous les services, payer l’armée, la marine, la magistrature, et procurer enfin aux contribuables le bon ordre et la sûreté, oui, il serait criminel de se soustraire à un impôt dont on recueille les bénéfices ; mais les droits protecteurs ne sont pas établis pour le public, mais contre le public ; ils aspirent à constituer le privilége de quelques-uns aux dépens de tous. Obéissons à la loi tant qu’elle existe ; nommons même, si on le veut, contravention, délit, crime, la violation de la loi ; mais sachons bien que ce sont là des crimes, des délits, des contraventions fictives ; et faisons nos efforts pour faire rentrer, dans la classe des actions innocentes, des transactions de droit naturel, qui ne sont point criminelles en elles-mêmes, mais seulement parce que la loi l’a arbitrairement voulu ainsi.
Lorsque nous avons considéré les prohibitions dans leurs rapports avec la prospérité des peuples, nous avons vu qu’elles avaient pour résultat infaillible de fermer les débouchés extérieurs, de mettre les entrepreneurs hors d’état de soutenir la concurrence étrangère, de les forcer à renvoyer une partie de leurs ouvriers et à baisser le salaire de ceux qu’ils continuent à employer, enfin de réduire les profits de la classe laborieuse, en même temps que d’élever le prix des moyens de subsistance. Tous ces effets se résument en un seul mot : misère, et je n’ai pas besoin de dire la connexité qui existe entre la misère des hommes et leur dégradation morale. Le penchant au vol et à l’ivrognerie, la haine des institutions sociales, le recours aux moyens violents de se soustraire à la souffrance, la révolte des âmes fortes, l’abattement, l’abrutissement des âmes faibles, tels sont donc les effets d’une législation qui oblige les classes les plus nombreuses à demander à la violence, à la ruse, à la mendicité, ce que le travail honnête ne peut plus leur donner. Faire l’histoire de cette législation, ce serait faire l’histoire du chartisme, du rébeccaïsme, de l’agitation irlandaise et de tous ces symptômes anarchiques qui désolent l’Angleterre, parce que c’est le pays du monde qui a poussé le plus loin l’abus de la spoliation sous forme de protection.
L’esprit de monopole étant étroitement lié à l’esprit de conquête, cela suffit pour qu’on doive lui attribuer une influence pernicieuse sur les mœurs d’un peuple considéré dans ses rapports avec l’étranger. Une nation avide de conquêtes ne saurait inspirer d’autres sentiments que la défiance, la haine et l’effroi. Et ces sentiments qu’elle inspire, elle les éprouve, ou du moins, pour apaiser sa conscience, elle s’efforce de les éprouver, et souvent elle y parvient. Quoi de plus déplorable et de plus abject à la fois que cet effort dépravé, auquel on voit quelquefois un peuple se soumettre, pour s’inoculer à lui-même des instincts haineux, sous le voile d’un faux patriotisme, afin de justifier à ses propres yeux des entreprises et des agressions, dont au fond il ne peut méconnaître l’injustice ? On verra ces nations envahir des tribus paisibles, sous le prétexte le plus frivole, porter le fer et le feu dans les pays dont elles veulent s’emparer, brûler les maisons, couper les arbres, ravir les propriétés, violer les lois, les usages, les mœurs et la religion des habitants ; on les verra chercher à corrompre avec de l’or ceux que le fer n’aura pas abattus, décerner des récompenses et des honneurs à ceux de leurs ennemis qui auront trahi la patrie, et vouer une haine implacable à ceux qui, pour la défendre, se dévouent à toutes les horreurs d’une lutte sanglante et inégale. Quelle école ! quelle morale ! quelle appréciation des hommes et des choses ! et se peut-il qu’au XIXe siècle un tel exemple soit donné, dans l’Inde et en Afrique, par les deux peuples qui se prétendent les dépositaires de la loi évangélique et les gardiens du feu sacré de la civilisation !
J’appelle l’attention de mon pays sur une situation qui me paraît ne pas le préoccuper assez. Le système prohibitif est mauvais, c’est ma conviction. Cependant, tant qu’il a été général, il enfantait partout des maux absolus sans altérer profondément la grandeur et la puissance relatives des peuples. L’affranchissement commercial d’une des nations les plus avancées du globe nous place au commencement d’une ère toute nouvelle. Il ne se peut pas que ce grand fait ne bouleverse toutes les conditions du travail, au sein de notre patrie ; et si j’ai osé essayer de décrire les changements qu’il semble préparer, c’est que l’indifférence du public à cet égard me paraît aussi dangereuse qu’inexplicable.
FN:Extrait du Journal des Économistes, n° d’octobre 1844. (Note de l’éditeur.)
FN:V. Deux modes d’égalisation des taxes, t. II, p. 222. (Note de l’éditeur.)
FN:Cette association s’intitule Anti-corn law league, parce qu’elle s’attaque principalement à la loi des céréales, qui est la clef de voûte du système protecteur. Mais je ne crains pas qu’aucune personne connaissant le but de cette société m’accuse d’avoir mal traduit ce titre par ces mots : Association pour l’affranchissement du commerce.
FN:V. au t. IV, les pages 379 et 380. (Note de l’éditeur.)
Œuvres complètes de Frédéric Bastiat
Guillaumin, 1862 (tome 1, pp. 387-392).
1845
Correspondence↩
[CW1.34] [OC7] 34. Mugron, 7 mars 1845. A M. Ch. Dunoyer, membre de l’Institut ???↩
BWV
[CW1.34] [OC7] 34. Mugron, 7 mars 1845. A M. Ch. Dunoyer, membre de l’Institut
Monsieur,
De tous les témoignages que je pourrais ambitionner, celui que je viens de recevoir de vous m’est certainement le plus précieux. Même en faisant la part de la bienveillance dans les expressions si flatteuses pour moi que porte la première page de votre livre, je ne puis m’empêcher d’avoir la certitude que votre suffrage m’est acquis, sachant combien vous avez l’habitude de mettre d’accord votre langage avec votre pensée.
Dans mon extrême jeunesse, Monsieur, un heureux hasard mit dans mes mains le Censeur européen ; et je dois à cette circonstance la direction de mes études et de mon esprit. À la distance qui nous sépare de cette époque, je ne saurais plus distinguer ce qui est le fruit de mes propres méditations de ce que je dois à vos ouvrages, tant il me semble que l’assimilation a été complète. Mais n’eussiez-vous fait que me montrer dans la société et ses vertus, ses vues, ses idées, ses préjugés, ses circonstances extérieures, les vrais éléments des biens dont elle jouit et des maux qu’elle endure ; quand vous ne m’auriez appris qu’à ne voir dans les gouvernements et leurs formes que des résultats de l’état physique et moral de la société elle-même ; il n’en serait pas moins juste, quelques connaissances accessoires que j’aie pu acquérir depuis, d’en rapporter à vous et à vos collaborateurs la direction et le principe. C’est assez vous dire, Monsieur, que rien ne pouvait me faire éprouver une satisfaction plus vraie que l’accueil que vous avez fait à mes deux articles du Journal des économistes, et la manière délicate dont vous avez bien voulu me l’exprimer. Votre livre va devenir l’objet de mes études sérieuses, et c’est avec bonheur que j’y suivrai le développement de la distinction fondamentale à laquelle je faisais tout à l’heure allusion.
Lettre à M. de Lamartine [7 mars 1845], Mugron????↩
BWV
[CW1.35] [OC7] 35. Mugron, 7 mars 1845. A M. Al. de Lamartine.
[not same as CW1 version] this is by Alfred de Musset “Lettre à M. Lamartine” Rev. des Deux mondes, 1836, pp. 594-602
Lorsque le grand Byron allait quitter Ravenne, 2067.Et chercher sur les mers quelque plage lointaine 2068.Où finir en héros son immortel ennui, 2069.Comme il était assis aux pieds de sa maîtresse, 2070.Pâle, et déjà tourné du côté de la Grèce, 2071.Celle qu’il appelait alors sa Guiccioli 2072.Ouvrit un soir un livre où l’on parlait de lui. 2073. 2074.Avez-vous de ce temps conservé la mémoire, 2075.Lamartine, et ces vers au prince des proscrits, 2076.Vous souvient-il encor qui les avait écrits ? 2077.Vous étiez jeune alors, vous, notre chère gloire. 2078.Vous veniez d’essayer pour la première fois 2079.Ce beau luth éploré qui vibre sous vos doigts. 2080.La Muse que le ciel vous avait fiancée 2081.Sur votre front rêveur cherchait votre pensée, 2082.Vierge craintive encore, amante des lauriers. 2083.Vous ne connaissiez pas, noble fils de la France, 2084.Vous ne connaissiez pas, sinon par sa souffrance, 2085.Ce sublime orgueilleux à qui vous écriviez. 2086.De quel droit osiez-vous l’aborder et le plaindre ? 2087.Quel aigle, Ganymède, à ce Dieu vous portait ? 2088.Pressentiez-vous qu’un jour vous le pourriez atteindre, 2089.Celui qui de si haut alors vous écoutait ? 2090.Non, vous aviez vingt ans, et le coeur vous battait 2091.Vous aviez lu Lara, Manfred et le Corsaire, 2092.Et vous aviez écrit sans essuyer vos pleurs ; 2093.Le souffle de Byron vous soulevait de terre, 2094.Et vous alliez à lui, porté par ses douleurs. 2095.Vous appeliez de loin cette âme désolée ; 2096.Pour grand qu’il vous parût, vous le sentiez ami 2097.Et, comme le torrent dans la verte vallée, 2098.L’écho de son génie en vous avait gémi. 2099.Et lui, lui dont l’Europe, encore toute armée, 2100.Écoutait en tremblant les sauvages concerts ; 2101.Lui qui depuis dix ans fuyait sa renommée, 2102.Et de sa solitude emplissait l’univers ; 2103.Lui, le grand inspiré de la Mélancolie, 2104.Qui, las d’être envié, se changeait en martyr ; 2105.Lui, le dernier amant de la pauvre Italie, 2106.Pour son dernier exil s’apprêtant à partir ; 2107.Lui qui, rassasié de la grandeur humaine, 2108.Comme un cygne à son chant sentant sa mort prochaine, 2109.Sur terre autour de lui cherchait pour qui mourir... 2110.Il écouta ces vers que lisait sa maîtresse, 2111.Ce doux salut lointain d’un jeune homme inconnu. 2112.Je ne sais si du style il comprit la richesse ; 2113.Il laissa dans ses yeux sourire sa tristesse : 2114.Ce qui venait du coeur lui fut le bienvenu. 2115. 2116.Poète, maintenant que ta muse fidèle, 2117.Par ton pudique amour sûre d’être immortelle, 2118.De la verveine en fleur t’a couronné le front, 2119.A ton tour, reçois-moi comme le grand Byron. 2120.De t’égaler jamais je n’ai pas l’espérance ; 2121.Ce que tu tiens du ciel, nul ne me l’a promis, 2122.Mais de ton sort au mien plus grande est la distance, 2123.Meilleur en sera Dieu qui peut nous rendre amis. 2124.Je ne t’adresse pas d’inutiles louanges, 2125.Et je ne songe point que tu me répondras ; 2126.Pour être proposés, ces illustres échanges 2127.Veulent être signés d’un nom que je n’ai pas. 2128.J’ai cru pendant longtemps que j’étais las du monde ; 2129.J’ai dit que je niais, croyant avoir douté, 2130.Et j’ai pris, devant moi, pour une nuit profonde 2131.Mon ombre qui passait pleine de vanité. 2132.Poète, je t’écris pour te dire que j’aime, 2133.Qu’un rayon du soleil est tombé jusqu’à moi, 2134.Et qu’en un jour de deuil et de douleur suprême 2135.Les pleurs que je versais m’ont fait penser à toi. 2136. 2137.Qui de nous, Lamartine, et de notre jeunesse, 2138.Ne sait par coeur ce chant, des amants adoré, 2139.Qu’un soir, au bord d’un lac, tu nous as soupiré ? 2140.Qui n’a lu mille fois, qui ne relit sans cesse 2141.Ces vers mystérieux où parle ta maîtresse, 2142.Et qui n’a sangloté sur ces divins sanglots, 2143.Profonds comme le ciel et purs comme les flots ? 2144.Hélas ! ces longs regrets des amours mensongères, 2145.Ces ruines du temps qu’on trouve à chaque pas, 2146.Ces sillons infinis de lueurs éphémères, 2147.Qui peut se dire un homme et ne les connaît pas ? 2148.Quiconque aima jamais porte une cicatrice ; 2149.Chacun l’a dans le sein, toujours prête à s’ouvrir ; 2150.Chacun la garde en soi, cher et secret supplice, 2151.Et mieux il est frappé, moins il en veut guérir. 2152.Te le dirai-je, à toi, chantre de la souffrance, 2153.Que ton glorieux mal, je l’ai souffert aussi ? 2154.Qu’un instant, comme toi, devant ce ciel immense, 2155.J’ai serré dans mes bras la vie et l’espérance, 2156.Et qu’ainsi que le tien, mon rêve s’est enfui ? 2157.Te dirai-je qu’un soir, dans la brise embaumée, 2158.Endormi, comme toi, dans la paix du bonheur, 2159.Aux célestes accents d’une voix bien-aimée, 2160.J’ai cru sentir le temps s’arrêter dans mon coeur ? 2161.Te dirai-je qu’un soir, resté seul sur la terre, 2162.Dévoré, comme toi, d’un affreux souvenir, 2163.Je me suis étonné de ma propre misère, 2164.Et de ce qu’un enfant peut souffrir sans mourir ? 2165.Ah ! ce que j’ai senti dans cet instant terrible, 2166.Oserai-je m’en plaindre et te le raconter ? 2167.Comment exprimerai-je une peine indicible ? 2168.Après toi, devant toi, puis-je encor le tenter ? 2169.Oui, de ce jour fatal, plein d’horreur et de charmes, 2170.Je veux fidèlement te faire le récit ; 2171.Ce ne sont pas des chants, ce ne sont pas des larmes, 2172.Et je ne te dirai que ce que Dieu m’a dit. 2173. 2174.Lorsque le laboureur, regagnant sa chaumière, 2175.Trouve le soir son champ rasé par le tonnerre, 2176.Il croit d’abord qu’un rêve a fasciné ses yeux, 2177.Et, doutant de lui-même, interroge les cieux. 2178.Partout la nuit est sombre, et la terre enflammée. 2179.Il cherche autour de lui la place accoutumée 2180.Où sa femme l’attend sur le seuil entr’ouvert ; 2181.Il voit un peu de cendre au milieu d’un désert. 2182.Ses enfants demi-nus sortent de la bruyère, 2183.Et viennent lui conter comme leur pauvre mère 2184.Est morte sous le chaume avec des cris affreux ; 2185.Mais maintenant au loin tout est silencieux. 2186.Le misérable écoute et comprend sa ruine. 2187.Il serre, désolé, ses fils sur sa poitrine ; 2188.Il ne lui reste plus, s’il ne tend pas la main, 2189.Que la faim pour ce soir et la mort pour demain. 2190.Pas un sanglot ne sort de sa gorge oppressée ; 2191.Muet et chancelant, sans force et sans pensée, 2192.Il s’assoit à l’écart, les yeux sur l’horizon, 2193.Et regardant s’enfuir sa moisson consumée, 2194.Dans les noirs tourbillons de l’épaisse fumée 2195.L’ivresse du malheur emporte sa raison. 2196. 2197.Tel, lorsque abandonné d’une infidèle amante, 2198.Pour la première fois j’ai connu la douleur, 2199.Transpercé tout à coup d’une flèche sanglante, 2200.Seul je me suis assis dans la nuit de mon coeur. 2201.Ce n’était pas au bord d’un lac au flot limpide, 2202.Ni sur l’herbe fleurie au penchant des coteaux ; 2203.Mes yeux noyés de pleurs ne voyaient que le vide, 2204.Mes sanglots étouffés n’éveillaient point d’échos. 2205.C’était dans une rue obscure et tortueuse 2206.De cet immense égout qu’on appelle Paris : 2207.Autour de moi criait cette foule railleuse 2208.Qui des infortunés n’entend jamais les cris. 2209.Sur le pavé noirci les blafardes lanternes 2210.Versaient un jour douteux plus triste que la nuit, 2211.Et, suivant au hasard ces feux vagues et ternes, 2212.L’homme passait dans l’ombre, allant où va le bruit. 2213.Partout retentissait comme une joie étrange ; 2214.C’était en février, au temps du carnaval. 2215.Les masques avinés, se croisant dans la fange, 2216.S’accostaient d’une injure ou d’un refrain banal. 2217.Dans un carrosse ouvert une troupe entassée 2218.Paraissait par moments sous le ciel pluvieux, 2219.Puis se perdait au loin dans la ville insensée, 2220.Hurlant un hymne impur sous la résine en feux. 2221.Cependant des vieillards, des enfants et des femmes 2222.Se barbouillaient de lie au fond des cabarets, 2223.Tandis que de la nuit les prêtresses infâmes 2224.Promenaient çà et là leurs spectres inquiets. 2225.On eût dit un portrait de la débauche antique, 2226.Un de ces soirs fameux, chers au peuple romain, 2227.Où des temples secrets la Vénus impudique 2228.Sortait échevelée, une torche à la main. 2229.Dieu juste ! pleurer seul par une nuit pareille ! 2230.Ô mon unique amour ! que vous avais-je fait ? 2231.Vous m’aviez pu quitter, vous qui juriez la veille 2232.Que vous étiez ma vie et que Dieu le savait ? 2233.Ah ! toi, le savais-tu, froide et cruelle amie, 2234.Qu’à travers cette honte et cette obscurité 2235.J’étais là, regardant de ta lampe chérie, 2236.Comme une étoile au ciel, la tremblante clarté ? 2237.Non, tu n’en savais rien, je n’ai pas vu ton ombre, 2238.Ta main n’est pas venue entr’ouvrir ton rideau. 2239.Tu n’as pas regardé si le ciel était sombre ; 2240.Tu ne m’as pas cherché dans cet affreux tombeau ! 2241. 2242.Lamartine, c’est là, dans cette rue obscure, 2243.Assis sur une borne, au fond d’un carrefour, 2244.Les deux mains sur mon coeur, et serrant ma blessure, 2245.Et sentant y saigner un invincible amour ; 2246.C’est là, dans cette nuit d’horreur et de détresse, 2247.Au milieu des transports d’un peuple furieux 2248.Qui semblait en passant crier à ma jeunesse, 2249.`Toi qui pleures ce soir, n’as-tu pas ri comme eux ?’ 2250.C’est là, devant ce mur, où j’ai frappé ma tête, 2251.Où j’ai posé deux fois le fer sur mon sein nu ; 2252.C’est là, le croiras-tu ? chaste et noble poète, 2253.Que de tes chants divins je me suis souvenu. 2254.Ô toi qui sais aimer, réponds, amant d’Elvire, 2255.Comprends-tu que l’on parte et qu’on se dise adieu ? 2256.Comprends-tu que ce mot la main puisse l’écrire, 2257.Et le coeur le signer, et les lèvres le dire, 2258.Les lèvres, qu’un baiser vient d’unir devant Dieu ? 2259.Comprends-tu qu’un lien qui, dans l’âme immortelle, 2260.Chaque jour plus profond, se forme à notre insu ; 2261.Qui déracine en nous la volonté rebelle, 2262.Et nous attache au coeur son merveilleux tissu ; 2263.Un lien tout-puissant dont les noeuds et la trame 2264.Sont plus durs que la roche et que les diamants ; 2265.Qui ne craint ni le temps, ni le fer, ni la flamme, 2266.Ni la mort elle-même, et qui fait des amants 2267.Jusque dans le tombeau s’aimer les ossements ; 2268.Comprends-tu que dix ans ce lien nous enlace, 2269.Qu’il ne fasse dix ans qu’un seul être de deux, 2270.Puis tout à coup se brise, et, perdu dans l’espace, 2271.Nous laisse épouvantés d’avoir cru vivre heureux ? 2272.Ô poète ! il est dur que la nature humaine, 2273.Qui marche à pas comptés vers une fin certaine, 2274.Doive encor s’y traîner en portant une croix, 2275.Et qu’il faille ici-bas mourir plus d’une fois. 2276.Car de quel autre nom peut s’appeler sur terre 2277.Cette nécessité de changer de misère, 2278.Qui nous fait, jour et nuit, tout prendre et tout quitter. 2279.Si bien que notre temps se passe à convoiter ? 2280.Ne sont-ce pas des morts, et des morts effroyables, 2281.Que tant de changements d’êtres si variables, 2282.Qui se disent toujours fatigués d’espérer, 2283.Et qui sont toujours prêts à se transfigurer ? 2284.Quel tombeau que le coeur, et quelle solitude ! 2285.Comment la passion devient-elle habitude, 2286.Et comment se fait-il que, sans y trébucher, 2287.Sur ses propres débris l’homme puisse marcher ? 2288.Il y marche pourtant ; c’est Dieu qui l’y convie. 2289.Il va semant partout et prodiguant sa vie : 2290.Désir, crainte, colère, inquiétude, ennui, 2291.Tout passe et disparaît, tout est fantôme en lui. 2292.Son misérable coeur est fait de telle sorte 2293.Qu’il fuit incessamment qu’une ruine en sorte ; 2294.Que la mort soit son terme, il ne l’ignore pas, 2295.Et, marchant à la mort, il meurt à chaque pas. 2296.Il meurt dans ses amis, dans son fils, dans son père, 2297.Il meurt dans ce qu’il pleure et dans ce qu’il espère ; 2298.Et, sans parler des corps qu’il faut ensevelir, 2299.Qu’est-ce donc qu’oublier, si ce n’est pas mourir ? 2300.Ah ! c’est plus que mourir, c’est survivre à soi-même. 2301.L’âme remonte au ciel quand on perd ce qu’on aime. 2302.Il ne reste de nous qu’un cadavre vivant ; 2303.Le désespoir l’habite, et le néant l’attend. 2304. 2305.Eh bien ! bon ou mauvais, inflexible ou fragile, 2306.Humble ou fier, triste ou gai, mais toujours gémissant, 2307.Cet homme, tel qu’il est, cet être fait d’argile, 2308.Tu l’as vu, Lamartine, et son sang est ton sang. 2309.Son bonheur est le tien, sa douleur est la tienne ; 2310.Et des maux qu’ici-bas il lui faut endurer 2311.Pas un qui ne te touche et qui ne t’appartienne ; 2312.Puisque tu sais chanter, ami, tu sais pleurer. 2313.Dis-moi, qu’en penses-tu dans tes jours de tristesse ? 2314.Que t’a dit le malheur, quand tu l’as consulté ? 2315.Trompé par tes amis, trahi par ta maîtresse, 2316.Du ciel et de toi-même as-tu jamais douté ? 2317. 2318.Non, Alphonse, jamais. La triste expérience 2319.Nous apporte la cendre, et n’éteint pas le feu. 2320.Tu respectes le mal fait par la Providence, 2321.Tu le laisses passer, et tu crois à ton Dieu. 2322.Quel qu’il soit, c’est le mien ; il n’est pas deux croyances 2323.Je ne sais pas son nom, j’ai regardé les cieux ; 2324.Je sais qu’ils sont à Lui, je sais qu’ils sont immenses, 2325.Et que l’immensité ne peut pas être à deux. 2326.J’ai connu, jeune encore, de sévères souffrances, 2327.J’ai vu verdir les bois, et j’ai tenté d’aimer. 2328.Je sais ce que la terre engloutit d’espérances, 2329.Et, pour y recueillir, ce qu’il y faut semer. 2330.Mais ce que j’ai senti, ce que je veux t’écrire, 2331.C’est ce que m’ont appris les anges de douleur ; 2332.Je le sais mieux encore et puis mieux te le dire, 2333.Car leur glaive, en entrant, l’a gravé dans mon coeur : 2334. 2335.Créature d’un jour qui t’agites une heure, 2336.De quoi viens-tu te plaindre et qui te fait gémir ? 2337.Ton âme t’inquiète, et tu crois qu’elle pleure : 2338.Ton âme est immortelle, et tes pleurs vont tarir. 2339. 2340.Tu te sens le coeur pris d’un caprice de femme, 2341.Et tu dis qu’il se brise à force de souffrir. 2342.Tu demandes à Dieu de soulager ton âme : 2343.Ton âme est immortelle, et ton coeur va guérir. 2344. 2345.Le regret d’un instant te trouble et te dévore ; 2346.Tu dis que le passé te voile l’avenir. 2347.Ne te plains pas d’hier ; laisse venir l’aurore : 2348.Ton âme est immortelle, et le temps va s’enfuir 2349. 2350.Ton corps est abattu du mal de ta pensée ; 2351.Tu sens ton front peser et tes genoux fléchir. 2352.Tombe, agenouille-toi, créature insensée : 2353.Ton âme est immortelle, et la mort va venir. 2354. 2355.Tes os dans le cercueil vont tomber en poussière 2356.Ta mémoire, ton nom, ta gloire vont périr, 2357.Mais non pas ton amour, si ton amour t’est chère : 2358.Ton âme est immortelle, et va s’en souvenir.
à Richard Cobden: Lettre du 8 avril 1845 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.36] [OC1] 36. Mugron, 8 avril 1845. A Richard Cobden
Monsieur,
Puisque vous me permettez de vous écrire, je vais répondre à votre bienveillante lettre du 12 décembre dernier. J’ai traité avec M. Guillaumin, libraire à Paris, pour l’impression de la traduction dont je vous ai entretenu.
Le livre est intitulé : Cobden et la Ligue, ou l’Agitation anglaise pour la liberté des échanges. Je me suis permis de m’emparer de votre nom, et voici mes motifs : je ne pouvais intituler cet ouvrage Anti-corn-Law-league. Indépendamment de ce qu’il est un peu barbare pour les oreilles françaises, il n’aurait porté à l’esprit qu’une idée restreinte. Il aurait présenté la question comme purement anglaise, tandis qu’elle est humanitaire, et la plus humanitaire de toutes celles qui s’agitent dans notre siècle. Le titre plus simple : la Ligue, eût été trop vague et eût porté la pensée sur un épisode de notre histoire nationale. J’ai donc cru devoir le préciser, en le faisant précéder du nom de celui qui est reconnu pour être « l’âme de cette agitation. » Vous avez vous-même reconnu que les noms propres étaient quelquefois nécessaires « to give point, to direct attention. » — C’est là ma justification.
Les noms propres, les réputations faites, la mode, en un mot, a tant d’influence chez nous, que j’ai cru devoir faire un autre effort pour l’attirer de notre côté. J’ai écrit dans le Journal des Économistes (numéro de février 1845), une lettre à M. de Lamartine. Cet illustre écrivain, cédant à ce tyran Fashion, avait assailli les économistes de la manière la plus injuste et la plus irréfléchie, puisque, dans le même écrit, il adoptait leurs principes. J’ai lieu de croire, d’après la réponse qu’il a bien voulu m’adresser, qu’il n’est pas éloigné de se ranger parmi nous, et cela suffirait peut-être pour déterminer chez nous un revirement inattendu de l’opinion. Sans doute, un tel revirement serait bien précaire, mais enfin on aurait, au moins provisoirement, un public, et c’est ce qui nous manque. Pour moi, je ne demande qu’une chose, qu’on ne se bouche pas volontairement les oreilles.
Permettez-moi de vous recommander, si vous en avez l’occasion, the perusal de la lettre à laquelle je fais allusion.
Je suis, Monsieur, votre respectueux serviteur.
à M. Félix Coudroy: Lettre de mai 1845 (Paris) ↩
BWV
[CW1.37] [OC1] 37. Paris, mai 1845. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je suis persuadé qu’il te tarde de recevoir de mes nouvelles. J’aurais aussi bien des choses à te dire, mais je serai forcé d’être court. Quoique à la fin de chaque jour il se rencontre que je n’ai rien fait, je suis toujours affairé. Dans ce Paris, jusqu’à ce qu’on soit au courant, il faut perdre un demi-jour pour utiliser un quart d’heure.
J’ai été très-bien accueilli par M. Guillaumin, qui est le premier économiste que j’ai vu. Il m’annonça qu’il donnerait un dîner, suivi d’une soirée, pour me mettre en rapport avec les hommes de notre école ; en conséquence je ne suis allé voir aucun de ces messieurs. — Hier a eu lieu ce dîner. J’étais à la droite de l’amphitryon, ce qui prouve bien que le dîner était à mon occasion ; à la gauche était Dunoyer. À côté de madame Guillaumin, MM. Passy et Say. Il y avait en outre MM. Dussard et Reybaud. Béranger avait été invité, mais il avait d’autres engagements. Le soir, arrivèrent une foule d’autres économistes : MM. Renouard, Daire, Monjean, Garnier, etc., etc. Mon ami, entre toi et moi, je puis te dire que j’ai éprouvé une satisfaction bien vive. Il n’y a aucun de ces messieurs qui n’ait lu, relu et parfaitement compris mes trois articles. Je pourrais écrire mille ans dans la Chalosse, la Sentinelle, le Mémorial, sans trouver, toi excepté, un vrai lecteur. Ici on est lu, étudié, et compris. Je n’en puis pas douter, parce que tous ou presque tous sont entrés dans des détails minutieux, qui attestent que la politesse ne faisait pas seule les frais de cet accueil ; je n’ai trouvé un peu froid que M. X… Te dire les caresses dont j’ai été comblé, l’espoir qu’on a paru fonder sur ma coopération, c’est te faire comprendre que j’étais honteux de mon rôle. Mon ami, j’en suis aujourd’hui bien convaincu, si notre isolement nous a empêchés de meubler beaucoup notre esprit, il lui a donné, du moins sur une question spéciale, une force et une justesse, que des hommes plus instruits et mieux doués ne possèdent peut-être pas.
Ce qui m’a fait le plus de plaisir, parce que cela prouvé qu’on m’a réellement lu avec soin, c’est que le dernier article, intitulé Sophismes, a été mis au-dessus des autres. C’est en effet celui où les principes sont scrutés avec le plus de profondeur ; et je m’attendais à ce qu’il ne serait pas goûté. Dunoyer m’a prié de faire un article sur son ouvrage pour être inséré aux Débats. Il a bien voulu dire qu’il me croyait éminemment propre à faire apprécier son travail. Hélas ! je sens déjà que je ne me tiendrai pas à la hauteur exagérée où ces hommes bienveillants me placent.
Après dîner, on a parlé du duel. J’ai rendu un compte succinct de ta brochure. Demain nous avons encore un dîner de corps chez Véfour ; je l’y porterai, et comme elle n’est pas longue, j’espère qu’on la lira. Si tu pouvais la refondre ou du moins la retoucher, je crois qu’on la mettrait dans le journal ; mais le règlement s’oppose à ce qu’on la transcrive textuellement. — Du reste le Journal des Économistes n’est pas aussi délaissé que je le craignais. Il a cinq à six cents abonnés ; il gagne tous les jours en autorité.
Te rapporter la conversation m’entraînerait trop loin. Quel monde, mon ami, et qu’on peut bien dire : On ne vit qu’à Paris et l’on végète ailleurs !… Malgré cela je soupire déjà après nos promenades et nos entretiens intimes. Le papier me manque ; adieu, cher Félix, ton ami.
P. S. Je m’étais trompé ; un dîner, même d’économistes, n’est pas une occasion favorable pour la lecture d’une brochure. J’ai remis la tienne à M. Dunoyer, je ne connaîtrai son sentiment que dans quelques jours. Tu trouveras dans le Moniteur du 27 mars, qui doit être dans la bibliothèque de ma chambre, le réquisitoire de Dupin sur le duel. Peut-être cela te fournira-t-il l’occasion d’étendre la brochure. Ce soir je passe la soirée chez Y… Il m’a fait le plus cordial accueil, et nous avons parlé de tout, même de religion. Il m’a paru faible sur ce chapitre, parce qu’il la respecte sans y croire.
Ce n’est qu’aujourd’hui que je me suis présenté chez Lamartine. Je n’ai pas été admis, il partait pour Argenteuil ; mais avec sa grâce ordinaire, il m’a fait dire qu’il veut que nous causions à l’aise et m’a donné rendez-vous pour demain. Comment m’en tirerai-je ?
Dans notre dîner, ou pour mieux dire après, on a agité une grande question : de la propriété intellectuelle. Un Belge, M. Jobard, a émis des idées neuves et qui t’étonneront. Il me tarde que nous puissions causer de toutes ces choses ; car malgré ces succès éphémères je sens que je ne suis plus amusable de ce côté. À peine si cela touche l’épiderme ; et, tout bien balancé, la vie de province pourrait être rendue plus douce que celle-ci pour peu que l’on y eût le goût de l’étude et des arts.
Adieu, mon cher Félix, à une autre fois. Écris-moi de temps en temps et occupe-toi de ton écrit sur le duel. Puisque la cour est revenue à sa singulière jurisprudence, la chose en vaut la peine.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 23 mai 1845 (Paris) ↩
BWV
[CW1.38] [OC1] 38. Paris, 23 mai 1845. A Félix Coudroy
Tu t’attends à beaucoup de détails, mon cher Félix, mais tu vas être bien désappointé ; depuis ma dernière lettre que j’envoyai par Bordeaux et dont je n’ai pas encore l’accusé de réception, nous avons un temps qui me dégoûte des visites. Je passe les matinées à perdre mon temps à quelques bagatelles, commissions, affaires obligées, et le soir à le regretter. Ma lettre sera donc bien aride ; cependant j’espère qu’elle te sera agréable à cause de celle de Dunoyer que j’y joins. Tu verras qu’il a apprécié ton écrit sur le duel. Je le quitte à l’instant ; il m’a répété de vive voix ce qu’il a consigné dans sa lettre : il a vanté le fond et le style de la brochure, et a dit qu’elle supposait des études faites dans la bonne voie ; il m’a exprimé le regret de ne pouvoir en causer plus longtemps, et le désir de venir chez moi pour traiter plus à fond le sujet. Demain je la communiquerai à M. Say, qui est un homme vraiment séduisant par sa douceur, sa grâce, jointe à une grande fermeté de principes. C’est l’ancre du parti économiste. Sans lui, sans son esprit conciliant, le troupeau serait bientôt dispersé. Beaucoup de mes collaborateurs sont engagés dans des journaux qui les rétribuent beaucoup mieux que l’économiste. D’autres ont des ménagements politiques à garder ; en un mot, il y a une réunion accidentelle d’hommes bienveillants, qui s’aiment quoique différant d’opinions à beaucoup d’égards ; il n’y a pas de parti ferme, organisé et homogène. Pour moi, si j’avais le temps de rester ici et une fortune à recevoir chez moi, je tenterais de fonder une sorte de Ligue. Mais quand on ne fait que passer, il est inutile d’essayer une aussi grande entreprise.
D’ailleurs je suis arrivé trop tôt ; ma traduction ne s’imprime que lentement. Si j’avais pu disposer de quelques exemplaires, ils m’auraient peut-être ouvert des portes.
Je n’ai pas vu M. de Lamartine, il est absent de Paris ; j’ignore l’époque de son retour.
Un homme aimable aussi, c’est M. Reybaud ; ce qui prouve en lui une vigueur d’intelligence remarquable, c’est qu’il est devenu économiste en se livrant à l’étude des réformateurs du XIXe siècle. Il en tenait aussi quand il commença son ouvrage, mais son bon sens a triomphé.
Je suis en peine de savoir si M. Guizot t’a écrit. Il est à craindre que ses nombreuses préoccupations ne l’empêchent de lire ta brochure. S’il n’était qu’homme de lettres, certainement il te répondrait ; mais il est ministre et ministre dirigeant. En tout cas, s’il arrive quelque chose de ce côté, ne manque pas de m’en faire part.
Je me suis un peu occupé d’affaires publiques, je veux dire départementales. Ce serait trop long à raconter. Mais je crois que l’Adour, c’est-à-dire le bas Adour, de Hourquet au Gave, obtiendra 1,500,000 fr. Le hasard m’a placé de manière à y donner un petit coup d’épaule : ce sera toujours quelque chose si les bateaux à vapeur arrivent jusqu’à Pontons. Quant à la partie comprise entre Mugron et Hourquet, c’est pitoyable de savoir à quoi son exclusion a tenu ; mais que faire ? Il n’y a qu’une chose dont le public ne veut pas s’occuper, c’est des affaires publiques.
Je ne sais si j’écrirai aujourd’hui à ma tante, en tout cas fais-lui dire que nous nous portons tous bien ici. Adieu, mon cher Félix, mes souvenirs à ta sœur.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 6 (5??) juin 1845 (Paris) ↩
BWV
[CW1.39] [OC1] 39. Paris, 5 juin 1845. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, une occasion se présente pour Bordeaux, et je ne veux pas la laisser partir sans répondre quelques mots à ta lettre. Pardonne-moi si j’abrège beaucoup, j’ai honte de dire que je suis occupé, car les jours se passent sans que je les utilise. C’est une chose qu’on ne peut s’expliquer qu’ici. D’ailleurs nous causerons bientôt de tout ce qui nous intéresse tant, et qui n’intéresse guère que nous.
Tu ne m’accuses pas réception de là lettre de Dunoyer, je pense que tu ne l’as reçue qu’après le départ de Calon. Tu as vu son opinion sur ta brochure, il me tarde bien de savoir celle de M. Guizot, — s’il te la communique, — car on assure que les hommes du pouvoir ne s’occupent absolument que de le conserver. Je ne l’ai pas encore communiquée à M. Say, il est à la campagne, je ne le verrai que vendredi. C’est un homme charmant et celui que je préfère ; je dois dîner avec lui chez Dunoyer, et le 10 chez Véfour au banquet des Économistes. On doit y agiter la question d’inviter le gouvernement (toujours le gouvernement !) à instituer des chaires d’économie politique. J’ai été chargé de préparer là-dessus quelques idées, c’est un sujet qui me plairait ; mais je me bornerai à ruminer mon opinion, parce que, là comme ailleurs, il y a des amours-propres et des possesseurs qu’il faut ménager. Quant à une association qui me plairait bien mieux, j’attendrai pour en parler que ma traduction ait paru, parce qu’elle pourra y préparer les esprits. Mais, pour s’associer, il faut un principe reconnu ; et je crains bien qu’il ne nous fasse défaut. Je n’ai jamais vu tant de peur de l’absolu, comme si nous ne devions pas laisser à nos adversaires le soin de modérer au besoin notre marche.
À Mugron, je t’expliquerai les raisons qui ne permettent pas de modifier le journal. Au reste, la presse parisienne est maintenant fondée sur les annonces et constituée, sous le rapport financier, sur des bases telles que rien de nouveau n’est possible. Dès lors, il n’y a que l’association et les sacrifices qu’elle seule peut faire qui puissent nous tirer de cette impasse. — Je viens aux choses qui me sont personnelles et t’en parle ouvertement, comme à un ami de cœur, sans fausse modestie. Je crois que l’absence d’aveuglement est un trait qui nous est commun, et je ne crains pas que tu me trouves trop présomptueux.
Mon livre aura trente feuilles, il y en a vingt d’imprimées ; tout sera prêt, j’espère, à la fin du mois. Je n’ai rien changé ou peu de chose à l’introduction que je t’ai lue. La moitié environ paraîtra dans le prochain numéro du Journal des Économistes. L’ignorance des affaires d’Angleterre est telle, même ici, que cet écrit doit, ce me semble, faire quelque impression sur les hommes studieux. Je t’en dirai franchement l’effet.
J’acquiers chaque jour la preuve que les précédents articles ont fait quelque effet. L’éditeur a reçu plusieurs demandes d’abonnement motivées, entre autres une lettre de Nevers qui disait : « Il nous est parvenu deux articles du Moniteur Industriel, qui réfute un article du Journal des Économistes, intitulé : Sophismes. Nous ne connaissons cet écrit que par les citations du Moniteur, mais cela nous suffit pour en avoir une haute opinion ; veuillez nous l’envoyer et nous abonner. » Deux abonnements ont été demandés de Bordeaux. Mais ce qui me fait le plus de plaisir, c’est une conversation que j’ai eue avec M. Raoul Duval, conseiller à la cour de Reims, ville essentiellement prohibitionniste. Il m’a assuré qu’on avait lu à haute voix l’article des tarifs, et qu’à chaque instant les manufacturiers disaient : Mais c’est cela, c’est bien cela, voilà ce qui va nous arriver, il n’y a rien à répondre. Cette scène, mon cher Félix, me signale la route que je devrais suivre. Si je pouvais, je devrais maintenant étudier la situation réelle de nos industries protégées, au flambeau des principes, et pénétrer dans le domaine des faits. M. Guillaumin veut que je passe en revue une douzaine d’autres Sophismes pour les réunir et en faire, à ses frais, une brochure à bon marché qui pourra se répandre.
Il faut que ce soit toi, mon cher Félix, pour que je relate ces faits qui, du reste, me laissent aussi froid que si cela regardait un tiers. J’étais déjà fixé sur mes articles, et ton jugement me servait de garantie suffisante ; seulement je me réjouis qu’il y ait encore quelques autres lecteurs, ce dont je désespérais.
Je te dirai que je suis à peu près décidé à aller toucher la main à Cobden, Fox et Thompson ; la connaissance personnelle de ces hommes pourra nous être utile. J’ai quelque espoir qu’ils me donneront des documents ; en tout cas, je ferai provision de quelques bons ouvrages, et, entre autres, de discours de Fox et Thompson sur d’autres sujets que la liberté commerciale. Si je restais à Paris, je sentirais le besoin de m’adonner à cette spécialité : ce serait bien assez pour mes faibles épaules. Mais, dans notre douce retraite, cela ne nous suffirait pas. D’ailleurs, l’économie paraît bien plus belle quand on l’embrasse dans son ensemble. C’est cet ensemble harmonieux que je voudrais pouvoir un jour saisir. Tu devrais bien t’occuper d’en montrer quelques traits.
Si mon petit traité, Sophismes économiques, réussit, nous pourrions le faire suivre d’un autre intitulé : Harmonies sociales. Il aurait la plus grande utilité, parce qu’il satisferait le penchant de notre époque à rechercher des organisations, des harmonies artificielles, en lui montrant la beauté, l’ordre et le principe progressif dans les harmonies naturelles et providentielles.
J’emporterai quelques ouvrages d’ici. Mon voyage aura du moins servi à nous donner des aliments, et à nous faire connaître un peu l’esprit du siècle.
Adieu, mon cher Félix. Je n’ai pas écrit aujourd’hui à ma tante, dis-lui que j’ai reçu sa lettre qui m’a fait bien plaisir, en ayant été privé longtemps.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juin 1845, Paris ↩
BWV
[CW1.40] [OC1] 40. Paris, 16 juin 1845. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je t’annonce que ma Ligue est imprimée ; on est maintenant après l’introduction, et cela ne peut durer plus de huit jours. Il y a donc apparence qu’à la fin du mois, je serai libre de partir pour Londres, et que, le 15 juillet, j’aurai le plaisir de t’embrasser. Demain, je dîne chez Dunoyer avec toute notre secte, Dussard, Reybaud, Fix, Rossi, Say. Je ne fermerai ma lettre qu’après, au cas que j’aie quelque chose à te conter. Dimanche, on me fit une ouverture ; peut-être en sera-t-il question demain. Il y a tant de pour et de contre que je ne saurai jamais me décider sans toi. C’est d’être le directeur du Journal des Économistes. Au point de vue pécuniaire, c’est une misérable affaire ; il s’agit de cent louis par an, rédaction comprise. Mais tu comprendras facilement combien cette position doit aller à mes goûts. D’abord ce journal, bien dirigé, peut exercer sur la chambre, et par contre-coup sur la presse, une grande influence. Si l’économiste qui sera là établit sa réputation de supériorité dans sa spécialité, il est impossible qu’il ne se fasse pas quelque peu redouter des protectionnistes, des réformateurs, en un mot, des ignorants de toute espèce. Par la parole, je n’irai jamais bien loin, parce que je manque de confiance, de mémoire et de présence d’esprit ; mais ma plume a assez de dialectique pour faire honte à certains de nos hommes d’État.
Ensuite, si je dirige le journal, cette direction finira par être exclusive, parce que je serai entouré de paresseux ; et, autant que les actionnaires me le permettront, je parviendrai à lui donner une homogénéité qui lui manque.
Je serai en rapports naturels et nécessaires avec tous les hommes éminents, au moins dans la sphère de l’économie politique et des affaires financières et douanières ; et en définitive je serai à leur égard l’organe de l’opinion publique, de l’opinion consciencieuse et éclairée. Il me semble qu’un pareil rôle peut s’agrandir indéfiniment, suivant la portée de celui qui l’occupe.
Quant au travail, il n’est pas de nature, comme le journalisme quotidien, à me détourner de continuer mes études. Enfin (ceci n’est qu’une perspective éloignée),- le directeur du journal, s’il est à la hauteur de sa mission, peut avec avantage se mettre sur les rangs pour une chaire d’économie politique qui deviendrait vacante.
Voilà le pour. — Mais il faut quitter Mugron. Il faut me séparer de ceux que j’aime, il faut que je laisse ma pauvre tante s’acheminer vers la vieillesse dans la solitude, il faut que je mène ici une vie sévère, que je voie s’agiter les passions sans les partager ; que j’aie sans cesse sous les yeux le spectacle des ambitions satisfaites sans permettre à ce sentiment de s’approcher de mon cœur ; car toute notre force est dans nos principes, et dans la confiance que nous savons inspirer. Aussi ce n’est pas ce que je redoute. La simplicité des habitudes est loin de m’effrayer.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 18 [Juin 1845 ???], Paris ↩
BWV
[CW1.41] [OC1] 41. Paris, 18 juin 1845. A Félix Coudroy
le 18 [20]
Je me suis retiré ce matin à une heure de chez Dunoyer ; les convives étaient ceux que je t’ai nommés, plus M. de Tracy. À peine a-t-on effleuré l’économie politique ; ces messieurs en font en amateurs. Pendant le dîner cependant, on a parlé quelque peu liberté de commerce. M. X… a dit que les Anglais jouaient la comédie. Il ne me convenait pas de relever ce mot ; mais j’étais bien tenté de lui demander s’il croyait ou non au principe de la liberté. Car enfin, s’il y croit, pourquoi ne veut-il pas que les Anglais y croient ? Parce qu’ils y ont intérêt ? Je me rappelais ton argument : Si l’on formait une société de tempérance, faudrait-il la déprécier, parce que les hommes ont intérêt à être tempérants ? Si je fais un sophisme sur ce sujet, j’y glisserai cette réfutation. Après dîner on m’a cloué à un whist : soirée perdue. Toute la rédaction du journal y était : Wolowski, Villermé, Blaise, Monjean, etc., etc. — Z… — autre déception, je le crains. Il s’est engoué d’agriculture, et parlant d’idées prohibitives. Vraiment je vois les choses de près, et je sens que je pourrais faire du bien et payer ma dette à l’humanité.
Je reviens au journal. On ne m’a pas demandé de résolution actuelle, maintenant j’attendrai. J’en parle à ma tante, il faut voir ce qu’elle en pense. Elle me laisserait certainement suivre mon penchant, si elle voyait en même temps un avenir pécuniaire, et humainement parlant elle a raison, elle ne peut pas comprendre la portée de la position que je puis prendre. Si elle t’en parle, dis-moi l’effet que ma lettre aura produit. De mon côté je te dirai celui que va produire ma Ligue : la lira-t-on ? J’en doute. On est ici accablé de lecture. Si je te disais que, sauf Dunoyer et Say, aucun de mes collaborateurs n’a lu Comte ! Tu sais déjà que *** n’a pas lu Malthus. À dîner, Tracy a dit que la misère de l’Irlande infirmait la doctrine de Malthus !! J’ai entendu dire à quelqu’un qu’il y avait du bon (not all that bad) dans le Traité de législation, et surtout dans le Traité de la propriété. Pauvre Comte ! Say m’a conté sa triste histoire, la persécution et sa probité l’ont tué.
Il est bien entendu que tu ne souffleras pas un mot de ce que je te dis sur la direction du journal. Tu sens que cette nouvelle ferait un éclat inopportun.
Je crois t’avoir dit que l’éditeur de la Ligue va éditer aussi les Sophismes. Ce sera un petit livre à bon marché, mais le titre n’en est pas attrayant. J’en cherche un autre ; aide-moi. Le petit livre de Mathieu de Dombasle était intitulé : Un rayon de bon sens, etc.
Comme je ne pourrai pas épuiser tous les sophismes en un petit volume, s’il se vend, j’en ferai un autre. Il serait bon que, de ton côté, tu en traitasses quelques-uns ; je les intercalerais avec les miens, cela te ferait connaître au moins de mes confrères, et tu pourrais alors, si le cœur t’en disait, te faire éditer sans bourse délier, ce qui n’est pas une petite affaire.
Adieu, mon cher Félix, écris-moi.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 juillet 1845 (11 heures du soir, Paris) ↩
BWV
[CW1.42] [OC1] 42. Paris, 3 juillet 1845 (11 heures du soir). A Félix Coudroy
… Comme toi, mon cher Félix, j’envisage l’avenir avec effroi. Laisser ma tante, me séparer de ceux que j’aime, te laisser à Mugron seul, sans ami, sans livres, cela est affreux. Et, pour moi-même, je ne sais si des travaux solitaires, médités à loisir, discutés avec toi, ne vaudraient pas mieux. D’un autre côté, il est certain qu’il y a ici une place à conquérir, la seule que je pouvais ambitionner, la seule qui me convient et à qui je conviens. Il est maintenant certain que je puis avoir la direction du journal, et je ne doute pas qu’on ne m’accorde 6 fr. par abonnement. Il y a 500 abonnés, ce qui fait 3,000 fr. Ce n’est absolument rien, pécuniairement parlant ; mais il faut bien croire qu’une forte direction imprimée au journal augmenterait sa clientèle ; et si nous parvenions au chiffre 1.000, je serais satisfait. — Puis vient la perspective d’un cours ; je ne sais si je l’ai dit qu’à notre dernier dîner, nous avions décidé qu’une démarche serait faite auprès du ministère pour qu’il fondât des chaires d’économie politique à la Faculté. MM. Guizot, Salvandy, Duchâtel se sont montrés favorables à ce projet. M. Guizot a dit : « Je suis si bien disposé, que c’est moi qui ai fondé la chaire qu’occupe M. Chevalier. Évidemment, nous faisons fausse route, et il est indispensable de répandre les saines doctrines économiques. Mais la grande difficulté, c’est le choix des personnes. » Sur cette réponse, MM. Say, Dussard, Daire et quelques autres m’ont assuré que, si on les consultait, ils me désigneraient. M. Dunoyer sera certainement pour moi. J’ai su que le ministre des finances avait été frappé de mon introduction, et lui-même m’a fait demander l’ouvrage. J’aurais donc bien des chances, sinon d’être appelé à la Faculté, du moins, si l’on y nommait Blanqui, Rossi ou Chevalier, de remplacer un de ces messieurs au Collége de France ou au Conservatoire. D’une manière ou d’une autre, je serais lancé, avec une existence assurée, et c’est tout ce qu’il me faut.
Mais quitter Mugron ! mais quitter ma tante ! mais ma poitrine ! mais le cercle peu étendu de mes connaissances ! enfin le long chapitre des objections… Oh ! que n’ai-je dix ans de moins et une bonne santé ! Du reste, tu comprends que cette perspective est encore éloignée ; mais tu comprends aussi que la direction du journal mettrait bien des chances de mon côté. Donc, au lieu de donner deux sophismes, dans le prochain numéro, choisis parmi ceux d’un genre populaire et anecdotique, je sens l’opportunité de faire de la doctrine, et je vais consacrer la journée de demain à en refondre deux ou trois plus importants. Voilà pourquoi je ne puis t’écrire aussi longuement que je voudrais et me vois forcé de parler de moi au lieu de répondre à tes affectueuses lettres.
M. Say veut me confier tous les papiers de son père ; il y a des choses assez curieuses. C’est d’ailleurs un témoignage de confiance qui m’a touché. Hippolyte Comte, le fils de Charles, me laissera aussi fouiller dans les notes de notre auteur favori, lequel est entièrement inconnu ici même… Mais je ne veux pas manquer à ce que je dois aux hommes qui m’accablent de preuves d’amitié.
Tu vois, cher Félix, que de motifs pour et contre : il faudra pourtant que je me décide bientôt. Oh ! j’ai bien besoin de tes conseils, et surtout que tu me dises ce que pense ma pauvre tante.
Quoique je réponde à peine à les lettres, il faut pourtant que je te dise que l’ouvrage de Simon est très-rare et très-cher ; il n’y en a que quatre exemplaires, dont deux dans les bibliothèques publiques. Bossuet avait fait détruire toute l’édition.
Adieu, mon cher Félix, excuse la hâte avec laquelle j’écris.
à M. Félix Coudroy: Lettre de juillet 1845 (Londres) ↩
BWV
[CW1.43] [OC1] 43. Londres, juillet 1845. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, j’arrivai ici hier soir. Sachant combien tu t’intéresses à notre cause, et au rôle que le hasard m’y a donné, je te raconterai tout ce qui se passe, d’autant que je n’ai pas le temps de prendre des notes, et dès lors mes lettres me serviront plus tard à rappeler mes souvenirs, afin que de vive voix je puisse te donner plus de détails.
Après m’être installé à l’hôtel (à 10 sh. par jour), je me suis mis à écrire six lettres pour Cobden, Bright, Fox, Thompson, Wilson et le secrétaire qui m’envoie la Ligue. Puis j’ai écrit six dédicaces sur autant d’exemplaires de mon livre, et sur ce, je me suis mis au lit. Ce matin j’ai porté mes six exemplaires au bureau de la Ligue, avec prière de les remettre à qui de droit. L’on m’a dit que Cobden partait le jour même pour Manchester, et que probablement je le trouverais en train de faire ses préparatifs (les préparatifs d’un Anglais consistent à avaler un beefteak et à fourrer deux chemises dans un sac). J’ai couru chez Cobden ; je l’ai en effet rencontré, et nous avons causé pendant deux heures. Il comprend bien le français, le parle un peu, et d’ailleurs j’entends son anglais. Je lui ai exposé l’état des esprits en France, l’effet que j’attends de ce livre, etc., etc. Il m’a témoigné sa peine de quitter Londres, et je l’ai vu sur le point de renoncer à son voyage. Ensuite il m’a dit : La Ligue est une franc-maçonnerie, à cela près que tout est public. Voici une maison que nous avons louée pour recevoir nos amis pendant le Bazar, maintenant elle est vide, il faut vous y installer. — J’ai fait des façons, — Alors il a repris : Cela peut ne pas vous être agréable, mais c’est utile à la cause, parce que MM. Bright, Moore et autres ligueurs y passent leurs soirées, et il faut que vous soyez toujours au milieu d’eux. Cependant, comme dans la suite il a été décidé que j’irai le joindre à Manchester après-demain, je n’ai pas jugé à propos de déménager pour deux jours. Ensuite il m’a mené au Reform-Club, magnifique établissement, et m’a laissé à la bibliothèque pendant qu’il prenait le bain. Cela fait, il a écrit deux lettres, à Bright et à Moore, et je l’ai accompagné au rail-way. Le soir, je suis allé voir Bright, toujours au même hôtel, quoique ces messieurs ne l’habitent pas ; l’accueil de Bright n’a pas tout à fait été aussi cordial. Je me suis aperçu qu’il n’approuvait pas que j’eusse mis le nom de Cobden sur le titre de mon livre ; de plus, il parut surpris que je n’eusse rien traduit de M. Villiers ; et quant à lui, sa part est petite, quoique assurément il en méritât une plus grande, car il est doué d’une éloquence entraînante. Cependant la conversation a arrangé tout cela. Obligé de parler lentement pour me faire comprendre, et traitant toujours des sujets qui me sont familiers, avec des hommes qui ont toutes nos idées, je me trouvais certainement dans les circonstances les plus favorables. Il m’a mené au parlement, où je suis resté jusqu’à présent, parce qu’on traitait une question qui embrasse l’éducation et la religion. Sorti à onze heures, je me suis mis à l’écrire. Demain, j’ai rendez-vous avec lui, et après-demain je vais voir Manchester et retrouver mon Cobden. Il doit faire mon logement et me laisser entre les mains de M. Ashworth, ce riche manufacturier qui a fait un si bon argument pour démontrer aux fermiers que l’exportation des objets manufacturés impliquait l’exportation des choses qui s’y sont incorporées, et que, par conséquent, la restriction du commerce leur retombait sur le nez. Ce brusque départ, je le crains, m’empêchera de voir Fox et Thompson jusqu’à mon retour, ainsi que Mill et Senior, pour qui j’ai des lettres.
Voilà ma première journée, fort en abrégé. Je vais donc pénétrer dans Manchester et Liverpool, dans des circonstances que peu de Français peuvent espérer. J’y serai un dimanche. Cobden me mènera chez les quakers, les wesleyens. Nous saurons enfin quelque chose ; et quant aux fabriques, rien ne me sera caché. De plus, toutes les opérations delà Ligue me seront dévoilées. Il a été vaguement question d’une seconde édition de mon ouvrage sur une plus grande échelle. Nous verrons.
N’oublions pas Paris. Avant de le quitter, j’ai passé une heure avec Hippolyte, le fils de Charles Comte ; il m’a montré tous les manuscrits de son père. Il y a deux ou trois cours faits à Genève, à Londres, à Paris ; tout cela, sans doute, a servi au Traité de législation ; mais quelle mine à mettre au jour !
Adieu, je te quitte. J’ai encore trois lettres à écrire à Paris, et nous sommes déjà à demain, car il est plus de minuit.
à Richard Cobden: Lettre du 8 juillet 1845 (Londres) ↩
BWV
[CW1.44] [OC1] 44. Londres, 8 juillet 1845. A Richard Cobden
Monsieur,
J’ai enfin le plaisir de vous présenter un exemplaire de la traduction dont je vous ai plusieurs fois entretenu. En me livrant à ce travail, j’avais la conviction que je rendais à mon pays un véritable service, tant en popularisant les saines doctrines économiques, qu’en démasquant les hommes coupables qui s’appliquent à entretenir de funestes préventions nationales. Mon espérance n’a pas été trompée. J’en ai distribué à Paris une centaine d’exemplaires, et ils ont produit la meilleure impression. Des hommes qui, par leur position et l’objet de leurs études, devraient savoir ce qui se passe chez vous, ont été surpris à cette lecture. Ils ne pouvaient en croire leurs yeux. La vérité est que tout le monde en France ignore l’importance de votre agitation, et l’on en est encore à soupçonner que quelques manufacturiers cherchent à propager au dehors des idées de liberté par pur machiavélisme britannique. — Si j’avais combattu directement le préjugé, je ne l’aurais pas vaincu. En laissant agir les free-traders, en les laissant parler, en un mot, en vous traduisant, j’espère lui avoir porté un coup auquel il ne résistera pas, pourvu que le livre soit lu : That is the question.
J’espère, Monsieur, que vous voudrez bien m’admettre à l’honneur de m’entretenir un moment avec vous et de vous témoigner personnellement ma reconnaissance, ma sympathie et ma profonde admiration.
Votre très-humble serviteur.
Lettre à M. Paulton [29 July 1845], Paris ↩
BWV
[CW1.45] [OC7] 45. Paris, 29 juillet 1845. A M. Paulton.
Lettre à M. Paulton [1]
Paris, 29 juillet 1845
Mon cher Monsieur, ainsi que je vous l’ai annoncé, je vous envoie quatre exemplaires de ma traduction, que je vous prie de remettre aux éditeurs du Times, du ' Morning-Chronicle etc., etc. Je m’estimerais heureux que la presse anglaise accueillît avec faveur un travail que je crois utile. Cela me dédommagerait de l’indifférence avec laquelle il a été reçu en France. Tous ceux à qui je l’ai donné ne cessent de manifester leur surprise à l’égard des faits graves qui y sont révélés ; mais personne ne l’achète, et cela n’est pas surprenant, puisqu’on ne sait pas de quoi il traite. Nos journaux d’ailleurs paraissent décidés à ensevelir la question dans le silence. Il m’en coûtera cher pour avoir tenté d’ouvrir les yeux à mon pays ; mais le pis est de n’avoir pas réussi [2].
En arrivant ici, j’ai trouvé une lettre de sir Robert Peel. Comme il l’a écrite avant d’avoir lu le livre, il n’a pas eu à donner son opinion. Il a aussi évité de citer le litre (Cobden et la Ligue). — Si c’est de la diplomatie, il faut qu’elle soit bien dans les habitudes de votre premier ministre pour qu’il en fasse usage dans une aussi mince occasion. Au reste, voici le texte de ce billet.
Wite-Hall, 24 July.
Sir Robert Peel presents his compliments to M. Bastiat, and is most obliged to M. Bastiat’s attention in transmitting for the acceptance of sir Robert Peel a copy of his recent publication. Sir Robert hopes to be enabled to proifit by it when he shall have leisure from the present severe pressure of parliamentary business.
Cette lettre n’est pas signée. J’aurais été curieux de savoir si elle est écrite de la main même de sir Robert.
J’ai trouvé encore d’autres lettres, dont deux ne manquent pas d’importance. Une de M. Passy, pair de France, ex-ministre du commerce. Il donne son approbation sans restriction aux principes contenus soit dans l’introduction, soit dans vos travaux.
L’autre lettre est de M. de Langsdorf, notre chargé d’affaires dans le Grand-Duché de Bade. Il m’annonce qu’il a lu le livre avec ardeur, et appris, pour la première fois, ce qui se passe en Angleterre. Il y a en ce moment, à Carlsruhe, une réunion de commissaires de tout le Zollverein décidés à boucher les plus petites voies par lesquelles le commerce étranger viendrait à s’infiltrer sur le grand marché national.
Ce qu’il me dit à cet égard vient à l’appui de l’idée qu’avait M. Cobden de faire traduire en allemand un historique de la Ligue et un choix de vos discours. L’Angleterre, qui a fait traduire la Bible en trois ou quatre cents langues, ne pourrait-elle pas faire traduire aussi cet excellent cours d’économie politique pratique, au moins en allemand et en espagnol ? Je sais les raisons qui vous empêchent de chercher, dès à présent, à agir au dehors. Mais de simples traductions prépareraient les esprits, sans qu’on pût vous accuser de faire de la propagande.
Si, plus tard, la Ligue peut sans inconvénient faire l’acquisition de quelques exemplaires de ma traduction, voici l’usage qui m’en paraît le plus utile. C’est de prendre autant de villes, dans l’ordre de leur importance commerciale, et d’envoyer un exemplaire dans chacune, adressé au cercle littéraire ou à la chambre de commerce.
Je n’essayerai pas, Monsieur, de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l’accueil fraternel que j’ai reçu parmi vous. Je désire seulement que l’occasion se présente de vous la témoigner en fait, et mon bonheur serait de rencontrer des Ligueurs en France. J’ai déjà été deux fois chez M. Taylor sans le trouver.
J’oubliais de vous dire que, la lettre de M. de Langsdorf étant confidentielle et émanée d’un homme public, il est bien entendu que son nom ne peut figurer dans aucun journal [3].
Agréez, mon cher Monsieur, l’assurance de ma sincère amitié, et veuillez me rappeler au souvenir de tous nos frères en travaux et en espérances.
FN:L’un des lecturers de l’Anti-corn-laws League. (Note de l’édit.)
FN:Voyez ci-dessus, p. 325, la fin de l’ébauche intitulée : Anglomanie, Anglophobie. (Note de l’éditeur.)
FN:Il me semble que je ne dois me faire aucun scrupule de livrer aujourd’hui à la publicité le nom de M. de Langsdorf. Quel blâme pourrait-il encourir, à raison des secrètes sympathies témoignées à la cause de la liberté commerciale, il y a dix-neuf ans ? (Note de l’édit.)
à Richard Cobden: Lettre du 2 octobre 1845 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.46] [OC1] 46. Mugron, 2 octobre 1845. A Richard Cobden
Quel que soit le charme, mon cher Monsieur, que vos lettres viennent répandre sur ma solitude, je ne me permettrais pas de les provoquer par des importunités si fréquentes ; mais une circonstance imprévue me fait un devoir de vous écrire.
J’ai rencontré dans les cercles de Paris un jeune homme qui m’a paru plein de cœur et de talent, nommé Fonteyraud, rédacteur de la Revue britannique. Il m’écrit qu’il se propose de continuer mon œuvre, en insérant dans le recueil qu’il rédige la suite des opérations de la Ligue ; à cet effet, il veut aller en Angleterre pour voir par lui-même votre belle organisation, et il me demande des lettres pour vous, pour MM. Bright et Wilson. L’objet qu’il a en vue est trop utile pour que je ne m’empresse pas d’y consentir, et j’espère que, de votre côté, vous voudrez bien satisfaire la noble curiosité de M. Fonteyraud.
Mais, par une seconde lettre, il m’apprend qu’il a encore un autre but qui, selon lui, exigerait de la part de la Ligue un appui effectif, et, pour tout dire, pécuniaire. Je me suis empressé de répondre à M. Fonteyraud que je ne pouvais pas vous entretenir d’un projet que je ne connais que très-imparfaitement. Je ne lui ai pas laissé ignorer d’ailleurs que, selon moi, toute action exercée sur l’opinion publique, en France, et qui paraîtrait dirigée par le doigt et l’or de l’Angleterre, irait contre son but, en renforçant des préventions enracinées et que beaucoup d’habiles gens ont intérêt à exploiter. Si donc M. Fonteyraud exécute son voyage, veuillez, ainsi que MM. Bright et Wilson, juger par vous-même de ses projets et me considérer comme totalement étranger aux entreprises qu’il médite. Je me hâte de quitter ce sujet, pour répondre à votre si affectueuse lettre du 23 septembre.
J’apprends avec peine que votre santé se ressent de vos immenses travaux tant privés que publics. On ne saurait, certes, la compromettre dans une plus belle cause ; chacune de vos souffrances vous rappellera de nobles actions ; mais c’est là une triste consolation, et je n’oserais pas la présenter à tout autre qu’à vous ; car, pour la comprendre, il faut avoir votre abnégation, votre dévouement au bien public. Mais enfin votre œuvre touche à son terme, les ouvriers ne manquent plus autour de vous, et j’espère que vous allez enfin chercher des forces au sein du repos.
Depuis ma dernière lettre, un mouvement que je n’espérais pas s’est manifesté dans la presse française. Tous les journaux de Paris et un grand nombre des journaux de province ont rendu compte, à l’occasion de mon livre, de l’agitation contre les lois-céréales. Ils n’en ont pas, il est vrai, saisi toute la portée ; mais enfin l’opinion publique est éveillée. C’était le point essentiel, celui auquel j’aspirais de toute mon âme ; il s’agit maintenant de ne pas la laisser retomber dans son indifférence, et si j’y puis quelque chose, cela n’arrivera pas.
Votre lettre m’est parvenue le lendemain du jour où nous avons eu une élection. C’est un homme de la cour qui a été nommé. Je n’étais pas même candidat. Les électeurs sont imbus de l’idée que leurs suffrages sont un don précieux, un service important et personnel. Dès lors ils exigent qu’on le leur demande. Ils ne veulent pas comprendre que le mandat parlementaire est leur propre affaire ; que c’est sur eux que retombent les conséquences d’une confiance bien ou mal placée, et que c’est par conséquent à eux à l’accorder avec discernement sans attendre qu’on la sollicite, qu’on la leur arrache. — Pour moi, j’avais pris mon parti de rester dans mon coin, et, comme je m’y attendais, on m’y a laissé. Il est probable que, dans un an, nous aurons en France les élections générales. Je doute que d’ici là les électeurs soient revenus à des idées plus justes. Cependant un grand nombre d’entre eux paraissent décidés à me porter. Mes efforts en faveur de notre industrie vinicole seront pour moi un titre efficace et que je puis avouer. Aussi, j’ai vu avec plaisir que vous étiez disposé à seconder les vues que j’ai exposées dans la lettre que la League a reproduite. [21] Si vous pouvez obtenir que ce journal appuie le principe du droit ad valorem appliqué aux vins, cela donnerait à ma candidature une base solide et honorable. Au fait, dans ma position, la députation est une lourde charge ; mais l’espoir de contribuer à former, au sein de notre parlement, un noyau de free-traders me fait passer par-dessus toutes les considérations personnelles. Quand je viens à penser qu’il n’y a pas, dans nos deux chambres, un homme qui ose avouer le principe de la liberté des échanges, qui en comprenne toute la portée, ou qui sache le soutenir contre les sophismes du monopole, j’avoue que je désire au fond du cœur m’emparer de cette place vide, que j’aperçois dans notre enceinte législative, quoique je ne veuille rien faire pour cela qui tende à fausser de plus en plus les idées dominantes en fait d’élections. Essayons de mériter la confiance, et non de la surprendre.
Je vous remercie des conseils judicieux que vous me donnez, en m’indiquant la marche qui vous semble le mieux adaptée aux circonstances de notre pays, pour la propagation des doctrines économiques. Oui, vous avez raison, je conçois que chez nous la diffusion des lumières doit procéder de haut en bas. Instruire les masses est une tâche impossible, puisqu’elles n’ont ni le droit, ni l’habitude, ni le goût des grandes assemblées et de la discussion publique. C’est un motif de plus pour que j’aspire à me mettre en contact avec les classes les plus éclairées et les plus influentes, through la députation.
Vous me faites bien plaisir en m’annonçant que vous avez de bonnes nouvelles des États-Unis. Je ne m’y attendais pas. L’Amérique est heureuse de parler la même langue que la Ligue. Il ne sera pas possible à ses monopoleurs de soustraire à la connaissance du public vos arguments et vos travaux. Je désirerais que vous me dissiez, quand vous aurez l’occasion de m’écrire, quel est le journal américain qui représente le plus fidèlement l’école économiste. Les circonstances de ce pays ont de l’analogie avec les nôtres, et le mouvement free-trader des États-Unis ne pourrait manquer de produire en France une forte et bonne impression, s’il était connu. — Pour épargner du temps, vous pourriez faire prendre pour moi un abonnement d’un an, et prier à Fonteyraud de vous rembourser. Il me sera plus facile de lui faire remettre le prix que de vous l’envoyer.
J’accepte avec grand plaisir votre offre d’échanger une de vos lettres contre deux des miennes. Je trouve que vous sacrifiez encore ici la fallacy de la réciprocité : car assurément c’est moi qui gagnerai le plus, et vous ne recevrez pas valeur contre valeur. Vu vos importantes occupations, j’aurais bien souscrit à vous écrire trois fois. Si jamais je suis député, nous renouvellerons les bases du contrat.
[CW1.47] [JCPD] 47. Mugron, 24 octobre 1845. A M. Potonié ???↩
BWV
[CW1.47] [JCPD] 47. Mugron, 24 octobre 1845. A M. Potonié
à Richard Cobden: Lettre du 13 décembre 1845 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.48] [OC1] 48. Mugron, 13 décembre 1845. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, me voilà bien redevable envers vous, car vous avez bien voulu, au milieu de vos nobles et rudes travaux, vous relâcher de cette convention que j’avais acceptée avec reconnaissance, « une lettre pour deux ; » mais je n’ai malheureusement que trop d’excuses à invoquer, et pendant que tous vos moments sont si utilement consacrés au bien public, les miens ont été absorbés par la plus grande et la plus intime douleur qui pût me frapper ici-bas. [22]
J’attendais pour vous écrire d’avoir des nouvelles de M. Fonteyraud. Il fallait bien que je susse en quels termes vous remercier de l’accueil que vous lui avez fait, à ma recommandation. J’étais bien tranquille à cet égard ; car j’avais appris indirectement qu’il était enchanté de son voyage et enthousiasmé des ligueurs. J’apprends avec plaisir que les ligueurs n’ont pas été moins satisfaits de lui. Quoique je l’aie peu connu, j’avais jugé qu’il avait en lui de quoi se recommander lui-même. Il n’a pas eu, sans doute, le loisir de m’écrire encore.
À ce sujet, vous revenez sur mon séjour auprès de vous, et les excuses que vous m’adressez me rendent tout confus. À l’exception des deux premiers jours, où, par des circonstances fortuites, je me trouvai isolé à Manchester, et où mon moral subit sans doute la triste influence de votre étrange climat (influence que je laissai trop percer dans ce billet inconvenant auquel vous faites allusion), à l’exception de ces deux jours, dis-je, j’ai été accablé de soins et de bontés par vous et vos amis, MM. John et Thomas Bright, Paulton, Wilson, Smith, Ashworth, Evans et bien d’autres ; et je serais bien ingrat si, parce qu’il y avait élection à Cambridge pendant ces deux jours,je ne me souvenais que de ce moment de spleen pour oublier ceux que vous avez entourés de bienveillance et de charme. Croyez, mon cher Monsieur, que notre dîner de Chorley, votre entretien si instructif avec M. Dyer, chez M. Thomas Bright, ont laissé dans ma mémoire et dans mon cœur des souvenirs ineffaçables. — Vous voulez m’inviter à renouveler ma visite. Cela n’est pas tout à fait irréalisable ; voici comment les choses pourraient s’arranger. Il est probable que cet été la grande question sera décidée ; et, comme un vaillant combattant, vous aurez besoin de prendre quelque repos et de panser vos blessures. Comme la parole a été votre arme principale, c’est son organe qui aura le plus souffert en vous ; et vous avez fait quelque allusion à l’état de votre santé dans votre lettre précédente. Or, nous avons dans nos Pyrénées des sources merveilleuses pour guérir les poitrines et les larynx fatigués. Venez donc passer en famille une saison aux Pyrénées. Je vous promets, soit d’aller vous chercher, soit de vous reconduire, à votre choix. — Ce voyage ne sera pas perdu pour la cause. Vous verrez notre population vinicole ; vous vous ferez une idée de l’esprit qui l’anime, ou plutôt ne l’anime pas. En passant à Paris, je vous mettrai en relations avec tous nos frères en économie politique et en philanthropie rationnelle. Je me plais à croire que ce voyage laisserait d’heureuses traces dans votre santé, dans vos souvenirs, et aussi dans le mouvement des esprits en France, relativement à l’affranchissement du commerce. Bordeaux est aussi une ville que vous verrez avec intérêt. Les esprits y sont prompts et ardents ; il suffit d’une étincelle pour les enflammer, et elle pourrait bien partir de votre bouche.
Je vous remercie, mon cher Monsieur, de l’offre que vous me faites relativement à ma traduction. Permettez-moi cependant de ne pas l’accepter. C’est un sacrifice personnel que vous voulez ajouter à tant d’autres, et je ne dois pas m’y prêter.
Je sens que le titre de mon livre ne vous permet pas de réclamer l’intervention de la Ligue. Dès lors, laissons mon pauvre volume vivre ou mourir tout seul. — Mais je ne puis me repentir d’avoir attaché votre nom, en France, à l’histoire de ce grand mouvement. En cela j’ai peut-être froissé un peu vos dignes collaborateurs, et cette injustice involontaire me laisse quelques remords. Mais véritablement, pour exciter et fixer l’attention, il faut chez nous qu’une doctrine s’incarne dans une individualité, et qu’un grand mouvement soit représenté et résumé dans un nom propre. Sans la grande figure d’O’Connell, l’agitation irlandaise passerait inaperçue de nos journaux. — Et voyez ce qui est arrivé. La presse française se sert aujourd’hui de votre nom pour désigner, en économie politique, le principe orthodoxe. C’est une ellipse, une manière abrégée de parler. Il est vrai que ce principe est encore l’objet de beaucoup de contestations et même de sarcasmes. Mais il grandira, et à mesure votre nom grandira avec lui. L’esprit humain est ainsi fait. Il a besoin de drapeaux, de bannières, d’incarnations, de noms propres ; et en France plus qu’ailleurs. Qui sait si votre destinée n’excitera pas chez nous l’émulation de quelque homme de génie ?
Je n’ai pas besoin de vous dire avec quel intérêt, quelle anxiété, je suis le progrès de votre agitation. Je regrette que M. Peel se soit laissé devancer. Sa supériorité personnelle et sa position le mettent à même de rendre à la cause des services plus immédiatement réalisables, peut-être, que ceux qu’elle peut attendre de Russell ; et je crains que l’avénement d’un ministère whig n’ait pour résultat de recomposer une opposition aristocratique formidable, qui vous prépare de nouveaux combats.
Vous voulez bien me demander ce que je fais dans ma solitude. Hélas, cher Monsieur, je suis fâché d’avoir à vous répondre par ce honteux monosyllabe : Rien. — La plume me fatigue, la parole davantage, en sorte que si quelques pensées utiles fermentent dans ma tête, je n’ai plus aucun moyen de les manifester au dehors. Je pense quelquefois à notre infortuné André Chénier. Quand il fut sur l’échafaud, il se tourna vers le peuple et dit en se frappant le front : « C’est dommage, j’avais quelque chose là. » Et moi aussi, il me semble que « j’ai quelque chose là. » — Mais qui me souffle cette pensée ? Est-ce la conscience d’une valeur réelle ? est-ce la fatuité de l’orgueil ?… Car quel est le sot barbouilleur qui de nos jours ne croie avoir aussi « quelque chose là ? »
Adieu, mon cher Monsieur, permettez-moi, à travers la distance qui nous sépare, de vous serrer la main bien affectueusement.
P. S. J’ai des relations fréquentes avec Madrid, et il me sera facile d’y envoyer un exemplaire de ma traduction.
Lettre à M. Alcide Fonteyraud [20 Dec. 1845], Mugron ↩
BWV
[CW1.49] [OC1] 49. Mugron, 20 décembre 1845. A Alcide Fonteyraud. Also in "Lettre inédite de Frédéric Bastiat à Fonteyraud" (Mugron, 20 dec. 1845), JDE, T. XXXIII, N(os) 137 et 138, Septembre et Octobre 1852, pp. 192-94.
“Lettre inédite de Frédéric Bastiat à Fonteyraud” [An unpublished Letter from Frédéric Bastiat to Fonteyraud)
Mugron, le 20 décembre 1845
Mon cher monsieur Fonteyraud, je ne répondrai pas aujourd’hui à votre lettre si aimable, si bonne, si intéressante par les sujets dont elle m’entretient et par la manière dont elle en parle. Ceci n’est qu’un simple accusé de réception dont je charge une personne qui part dans quelques heures pour Paris.
J’avais de vos nouvelles par le journal de la Ligue, par M. Guillaumin et par M. Cobden, qui me parle de vous en termes que je ne veux pas vous répéter pour ne pas blesser votre modestie… Cependant je me ravise. M. Cobden sera assez justement célèbre un jour, pour que vous soyez bien aise de savoir le jugement qu’il a porté de vous. D’ailleurs ce jugement renferme un conseil, et je n’ai pas le droit de l’arrêter au passage, d’autant que vous persistez à me donner le titre de maître. J’en remplirai les fonctions une fois, sinon en vous donnant des avis, du moins en vous transmettant ceux qui émanent d’une autorité bien imposante pour les disciples du free-trade.
Voici donc comment s’exprime M. Cobden :
« Let me thank you for introducing to us Mr. Fonteyraud, who excited our admiration not only by his superior talents, but by the warmth of his zeal in the cause of free-trade. I have rarely met with a young man of his age possessing so much knowledge and so mature a judgement both as respects men and things. If he be preserved from the temptations which beset the path of youg men of litterary pursuits in Paris, » (M. Cobden veut-il parler des écoles sentimentalistes ou des piéges de l’esprit de parti, c’est ce que j’ignore) « he possesses the ability to render himself very useful in the cause of humanity. »
Le reste ne pouvant s’adresser qu’à votre amour-propre, permettez-moi de le supprimer.
Il est doux, il est consolant de marcher dans la vie appuyé par un tel témoignage. Il y a bien quelque chose au fond du cœur qui nous parle de notre propre mérite ; mais quand nous voyons l’aveuglement de tous les hommes à ce sujet, comment pouvons-nous avoir jamais la certitude que le sentiment de nos forces en est la mesure ? Pour vous, vous voilà jugé et consacré ; vous êtes voué à la cause de l’humanité. Apprendre et répandre, telle doit être votre devise, telle est votre destinée.
Oh ! comme mon cœur battait quand je lisais votre description du grand meeting de Manchester ! Comme vous, je sentais l’enthousiasme me pénétrer par tous les pores. Jamais rien de semblable, quoi qu’en dise Salomon, s’était-il vu sous le soleil ? On a vu de grandes réunions d’hommes se passionner pour une conquête, pour une victoire, pour un intérêt, pour le triomphe de la force brutale ; mais avait-on jamais vu dix mille hommes s’unir pour faire prévaloir par des moyens pacifiques, par la parole, par le sacrifice, un grand principe de justice universelle ? Quand la liberté du commerce serait une erreur, une chimère, la Ligue n’en serait pas moins glorieuse, car elle a donné au monde le plus puissant et le plus moral de tous les instruments de civilisation. Comment ne voit-on pas que ce n’est pas seulement l’affranchissement des échanges, mais successivement toutes les réformes, tous les actes de justice et de réparation, que l’humanité pourra réaliser à l’aide de ces gigantesques et vivantes organisations !
Aussi, avec quel bonheur, je dirai presque avec quel délire de joie, j’ai accueilli la nouvelle que vous me donniez à la fin de votre lettre ! La France aurait aussi sa ligue ! la France verrait cesser son éternelle adolescence ; elle rougirait du puérilisme honteux dans lequel elle végète, elle se ferait homme ! Oh ! vienne ce jour, et je le saluerai comme le plus beau de ma vie. Ne cesserons-nous jamais d’attacher la gloire au développement de la force matérielle, de vouloir trancher toutes les questions par l’épée, de ne glorifier que le courage du champ de bataille, quels que soient son mobile et ses œuvres ? Comprendrons-nous enfin que, puisque l’opinion est la reine du monde, c’est l’opinion qu’il faut travailler, c’est à l’opinion qu’il faut communiquer des lumières qui lui montrent la bonne voie et de l’énergie pour y marcher ?
Mais après l’enthousiasme est venue la réflexion. Je tremble que quelque germe funeste ne se glisse dans les commencements de notre ligue, par exemple l’esprit de transaction, de transition, d’attermoiements, de ménagements. Tout est perdu si elle ne se rallie, si elle n’adhère étroitement à un principe absolu. Comment les ligueurs eux-mêmes pourraient-ils s’entendre, si la ligue admettait divers principes, à diverses doses ? Et s’ils ne s’entendaient pas entre eux, quelle influence pourraient-ils exercer au dehors ? — Ne soyons que vingt, ou dix, ou cinq ; mais que ces vingt, ou dix, ou cinq aient le même but, la même volonté, la même foi. Vous avez assisté à l’agitation anglaise ; je l’ai moi-même beaucoup étudiée, et je sais (ce que je vous prie de bien dire à nos amis) que si la Ligue eût fait la moindre concession, à aucune époque de son existence, il y a longtemps que l’aristocratie en serait débarrassée.
Donc, qu’une association se forme en France ; qu’elle entreprenne d’affranchir le commerce et l’industrie de tout monopole ; qu’elle se dévoue au triomphe du principe, et vous pouvez compter sur moi. De la parole, de la plume, de la bourse, Je suis à elle. S’il faut subir des poursuites judiciaires, essuyer des persécutions, braver le ridicule, je suis à elle. Quelque rôle qu’on m’y donne, quelque rang qu’on m’y assigne, sur les hustings ou dans le cabinet, je suis à elle. Dans des entreprises de ce genre, en France plus qu’ailleurs, ce qu’il faut redouter, ce sont les rivalités d’amour-propre ; et l’amour-propre est le premier sacrifice que nous devons faire sur l’autel du bien public. Je me trompe, l’indifférence et l’apathie sont peut-être de plus grands dangers. Puisque ce projet a été formé, ne le laissez pas tomber. Oh ! que ne suis-je auprès de vous !
J’allais finir ma lettre sans vous remercier d’avance de ce que vous direz dans la Revue britannique de ma publication. Une simple traduction ne peut mériter de grands éloges. Quoi qu’il en soit, éloges et critiques sont bien venus quand ils sont sincères.
Adieu ; votre affectionné.
Articles and Essays↩
Sur un livre de M. Dunoyer [1845]↩
BWV
1845.?? "Sur l'ouvrage de M. Dunoyer. De la Liberté du travail. Ébauche inédite (1845)" (On the Book by M. Dunoyer. On The Liberty of Working. Unpublished draft. (1845)) [OC1.10, pp. 428-33.]
Sur l’ouvrage de M. Dunoyer, De la liberté du travail [Ébauche inédite. (1845.)]
« Il y a vingt ans, dit M. Dunoyer, que j’ai conçu la pensée de ce livre. » Certes, pendant ces vingt années, il n’en est pas une où cet important ouvrage eût pu avec plus d’à-propos être livré au public, et j’ose croire qu’il est dans sa destinée de faire rentrer la science dans sa voie. Un système funeste semble prendre sur les esprits un dangereux ascendant. Émané de l’imagination, accueilli par la paresse, propagé par la mode, flattant chez les uns des instincts louables mais irréfléchis de philanthropie, séduisant les autres par l’appât trompeur de jouissances prochaines et faciles, ce système est devenu épidémique ; on le respire avec l’air, on le gagne au contact du monde ; la science même n’a plus le courage de lui résister ; elle se range devant lui ; elle le salue, elle lui sourit, elle le flatte, et pourtant elle sait bien qu’il ne peut soutenir un moment le sévère et impartial examen de la raison. On le nomme socialisme. Il consiste à rejeter du gouvernement du monde moral tout dessein providentiel ; à supposer que du jeu des organes sociaux, de l’action et de la réaction libre des intérêts humains, ne résulte pas une organisation merveilleuse, harmonique, et progressive, et à imaginer des combinaisons artificielles qui n’attendent pour se réaliser que le consentement du genre humain. Nous ferons-nous tous Moldaves ? nous enfermerons-nous dans un phalanstère ? N’abolirons-nous que l’hérédité, ou bien nous débarrasserons-nous aussi de la propriété et de la famille ? On n’est pas encore fixé à cet égard ; et, pour le moment, il n’est qu’une chose dont l’exclusion soit unanimement résolue, la liberté.
Fi de la liberté !
À bas la liberté !
On est d’accord sur ce point. Il ne reste plus au milliard d’hommes qui peuplent notre globe qu’à faire choix, parmi les mille plans qui ont vu le jour, de celui auquel ils préfèrent se soumettre, à moins cependant qu’il n’y en ait un meilleur parmi ceux que chaque matin voit éclore. Ce choix, il est vrai, offrira quelques difficultés, car messieurs les socialistes, quoiqu’ils prennent le même nom, sont loin d’avoir les mêmes projets sociaux. Voici M. Jobard qui pense que la propriété a encore la moitié de son domaine à acquérir, et qui veut y soumettre jusqu’à la plus fugitive pensée littéraire ou artistique ; mais voilà Saint-Simon qui n’admet pas même la propriété matérielle ; et entre eux se pose M. Blanc, qui reconnaît bien la propriété des produits du travail (sauf un partage de son invention), mais qui flétrit comme impie et sacrilège quiconque tire quelque avantage de son livre, de son tableau ou de sa partition, heureux pourtant M. Blanc de savoir se soumettre à la vulgaire pratique, en attendant le triomphe de sa théorie !
Au milieu de ces innombrables enfantements de Plans sociaux, nés de l’imagination échauffée de nos modernes Instituteurs de nations, la raison éprouve un charme indicible à se sentir ramenée, par le livre de M. Dunoyer, à l’étude d’un plan social aussi, mais d’un plan créé par la Providence elle-même ; à voir se développer ces belles harmonies qu’elle a gravées dans le cœur de l’homme, dans son organisation, dans les lois de sa nature intellectuelle et morale. On a beau dire qu’il n’y a pas de poésie dans les sciences expérimentales, cela n’est pas vrai ; car cela reviendrait à dire qu’il n’y a pas de poésie dans l’œuvre de Dieu.
Pense-t-on que les découvertes géologiques de Cuvier, parce qu’elles étaient dues à une laborieuse et patiente observation, parce qu’elles étaient conformes à la réalité des faits, ne nous font pas admirer ce qu’elles nous laissent entrevoir des desseins de la création, autant que les inventions les plus ingénieuses ?
Le point de départ obligé des réformateurs modernes (qu’ils en conviennent ou non) est que la société se détériore sous l’empire des lois naturelles, et qu’elles tendent à introduire de plus en plus la misère et l’inégalité parmi les hommes ; aussi par quels tristes tableaux n’assombrissent-ils pas les premières pages de leurs livres ! Avouer le principe de la perfectibilité, ce serait créer d’avance une fin de non-recevoir contre leur prétention à refaire le monde. S’ils reconnaissaient qu’il y a, dans les lois de la Responsabilité et de la Solidarité, une force qui tend invinciblement à améliorer et à égaliser les hommes, pourquoi s’élèveraient-ils contre ces lois, eux qui font profession d’aspirer à ce résultat ? Leur tâche se bornerait à les étudier, à en découvrir les harmonies, à les divulguer, à signaler et à combattre les obstacles qu’elles rencontrent encore dans les erreurs de l’esprit, les vices du cœur, les préjugés populaires, les abus de la force et de l’autorité.
Ce qu’il y a de mieux à opposer aux socialistes, c’est donc la simple description de ces lois. C’est ce que fait M. Dunoyer. Mais comme après tout on ne diffère souvent sur les choses que parce qu’on n’est pas d’accord sur le sens des mots, M. Dunoyer commence par définir ce qu’il entend par liberté.
Liberté, c’est puissance d’action. Donc chaque obstacle qui s’abaisse, chaque restriction qui tombe, chaque expérience qui s’acquiert, toute lumière qui éclaire l’intelligence, toute vertu qui accroît la confiance, la sympathie et resserre les liens sociaux, c’est une liberté conquise au monde ; car il n’y a rien en toutes ces choses qui ne soit une puissance d’action, une puissance pacifique, bienfaisante et civilisatrice.
Le premier volume de M. Dunoyer est consacré à la solution de cette question de fait : Le monde a-t-il ou n’a-t-il pas progressé sous l’empire de la loi de liberté ? Il étudie successivement les divers états sociaux par lesquels il a été dans la destinée de l’homme de passer, l’état des peuples chasseurs, pasteurs, agricoles, industriels, auxquels correspondent l’anthropophagie, l’esclavage, le servage, le monopole. Il montre l’espèce humaine s’élevant vers le bien-être et la moralité, à mesure qu’elle devient libre ; il prouve qu’à chaque phase de son existence les maux qu’elle a endurés ont eu pour cause les obstacles qu’elle a rencontrés dans son ignorance, ses erreurs et ses vices ; il signale le principe qui les lui fait surmonter, et, tournant enfin vers l’avenir le flambeau qui vient de lui montrer le passé, il voit la société progresser et progresser indéfiniment, sans qu’elle ait à se soumettre à des organisations récemment inventées, — à la seule condition de combattre sans cesse et les liens qui gênent encore le travail des hommes, et l’ignorance qui obstrue leur esprit, et ce qu’il reste d’imprévoyance, d’injustice et de passions mauvaises dans leurs habitudes.
C’est ainsi que l’auteur fait justice de ce vieux sophisme, indigne de la science et récemment renouvelé des âges les plus barbares, qui consiste à s’étayer de faits isolés, malheureusement trop nombreux encore, pour en induire la détérioration de l’espèce humaine. Fidèle à sa méthode, il suppute les progrès acquis, les rattache à leurs véritables causes, et démontre que c’est en développant ces causes, en détruisant et non en ressuscitant des obstacles, en étendant et non en restreignant le principe de la responsabilité, en renforçant et non en affaiblissant le ressort de la solidarité, en nous éclairant, en nous amendant, en devenant libres, que nous marcherons vers des progrès nouveaux.
Après avoir étudié l’humanité dans ses divers âges, M. Dunoyer la considère dans ses diverses fonctions.
Mais ici il avait à faire la nomenclature de ces fonctions. Nous n’hésitons pas à dire que celle de l’auteur est plus rationnelle, plus méthodique et surtout plus complète que celle qu’avait traditionnellement adoptée la science économique.
Soit que l’on divise l’industrie en agricole, manufacturière et commerciale, soit que, comme M. de Tracy, on la réduise à deux branches, le travail qui transforme et celui qui transporte, il est évident qu’on laisse, en dehors de la science, une multitude de fonctions sociales et notamment toutes celles qui s’exercent sur les hommes. La société, au point de vue économique, est un échange de services rémunérés ; et sous ce rapport l’avocat, le médecin, le militaire, le magistrat, le professeur, le prêtre, le fonctionnaire public appartiennent à la science économique aussi bien que le négociant et le cultivateur.
Nous travaillons tous les uns pour les autres, nous faisons tous entre nous échange de services, et la science est incomplète si elle n’embrasse pas tous les services et tous les travaux.
Nous croyons donc que l’économie politique est redevable à M. Dunoyer d’une classification, qui, sans la faire sortir de ses limites naturelles, a le mérite de lui ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux champs de recherches, surtout dans l’ordre intellectuel et moral, et de l’arracher à ce cercle matériel où les esprits supérieurs n’aiment pas à se laisser longtemps renfermer.
Aussi, lorsque M. Dunoyer, après avoir recherché quels sont les états sociaux qui ont été les plus favorables à l’humanité, examine les conditions dans lesquelles chaque fonction se développe avec le plus de puissance et de liberté, on sent qu’un principe moral est venu prendre place dans la science. Il prouve que les forces intellectuelles et les vertus privées ou de relation ne sont pas moins nécessaires aux succès de nos travaux que les forces industrielles. Le choix des lieux et des temps, la connaissance du marché, l’ordre, la prévoyance, l’esprit de suite, la probité, l’épargne concourent tout aussi réellement à la prompte formation, à l’équitable distribution, à la judicieuse consommation des richesses que le capital, l’habileté et l’activité.
Nous n’oserions pas dire que, dans le cadre immense qu’embrasse l’auteur, il ne s’est pas glissé quelques observations de détail qu’on pourrait contester ; encore moins qu’il a épuisé son inépuisable sujet. Mais sa méthode est bonne, les limites de la science bien posées, le principe qui la domine clairement défini. Dans ce vaste champ, il y a place pour bien des ouvriers ; et, s’il faut dire toute notre pensée, nous croyons que là est le terrain où pourront désormais se rencontrer et ces esprits exacts que leur irrésistible soumission aux exigences de la logique retenait dans cette partie de l’économie politique qui est susceptible de démonstrations rigoureuses, et ces esprits ardents que l’idolâtrie du beau et du bien entraînait dans la région des utopies et des chimères.
Un économiste à M. de Lamartine (Feb. 1845)↩
BWV
1845.02.15 "Un économiste à M. de Lamartine. A l'occasion de son écrit intitulé: *Du Droit au travail*” (Letter from an Economist to M. de Lamartine. On the occasion of his article entitled: *The Right to Work*) [*Journal des Économistes*, February 1845, T. 10, no. 39, pp. 209-223] [OC1.9, pp. 406-28]
Journal des économistes, février 1845
Un économiste à M. de Lamartine 2504.À l'occasion de son écrit intitulé : Du droit au travail
Monsieur [1],
Le talent prodigieux dont vous a doué la nature, talent que rehausse une réputation sans tache, après avoir fait de vous le point de mire des partis, vous a signalé comme l’attente des doctrines. Vos opinions, à demi voilées, laissaient à chaque école l’espoir de vous rallier. Le catholicisme, le néo-christianisme, la liberté, et même ces modernes excentricités qu’on nomme saint-simonisme, fouriérisme, communisme, comptaient sur vous, espéraient en vous. Le système qui se résume par le mot concentration forcée, celui qui se formule par le mot libre concurrence, la théorie qui veut imposer au travail, aux facultés, aux capitaux une organisation artificielle, celle qui ne voit pas de meilleure organisation des forces sociales que leur naturelle gravitation, toutes les écoles, en un mot, vous désiraient pour auxiliaire et vous eussent accepté pour chef.
Car il n’en est pas dont vous n’eussiez été le plus puissant interprète. Que faut-il à une idée qui porte en elle-même l’élément du triomphe, la vérité ? Être connue, être comprise, être vulgarisée ; et, pour cela, il lui faut des expressions saisissantes, des formules lumineuses qui, par leur clarté soudaine, aillent réveiller dans tous les cœurs cette sympathie innée pour le vrai et le juste que la libéralité de la Providence y a déposée. Voilà pourquoi les hommes de labeur, de veille et d’étude auraient confié à votre parole le travail des années et des siècles, les investigations de la science, les rectifications de l’expérience, en un mot, tout le mouvement intellectuel de leur école, afin que vous le manifestassiez au monde. Par cette heureuse combinaison de fortes pensées et de vives images, dont vous seul possédez le secret, par le privilége inouï, qui n’a été dévolu qu’à vous, de faire pénétrer la logique dans la poésie et la poésie dans la logique, vous eussiez fait briller la vérité dans le cabinet du savant, dans l’atelier de l’artiste, dans le salon et le boudoir, dans le palais et la chaumière ; vous lui eussiez frayé une voie vers la chaire et vers la tribune.
Et moi aussi, monsieur, parce que j’ai dans l’esprit une conviction entière, parce que je porte au cœur une foi inébranlable, combien de fois n’ai-je pas tourné mes regards vers vous ! combien de fois n’ai-je pas demandé aux paroles tombées de vos lèvres, aux écrits échappés à votre plume, s’ils ne m’apportaient pas enfin le secret de vos opinions, s’ils ne recélaient point votre vague et mystérieux symbole ! Car comprenant ou du moins croyant sincèrement comprendre le mécanisme des forces sociales, je me disais: « Cette lumière n’est rien tant qu’elle est sous le boisseau ; et elle n’en sortira qu’à la voix puissante de l’homme capable de fondre dans sa parole la dialectique du métaphysicien, l’expérience de l’homme d’État, l’éloquence du tribun, l’ardente charité du chrétien et l’accent délicieux du poëte. »
Vous vous êtes prononcé enfin. Mais, hélas ! l’attente des écoles économiques a été trompée. Vous n’en reconnaissez que deux, et vous déclarez n’appartenir ni à l’une ni à l’autre. Tel est l’écueil du génie. Il dédaigne les voies explorées et le trésor des connaissances accumulé par les siècles. Il cherche son trésor en lui-même ; il veut se frayer sa propre voie. Comme vous le dites, il y a deux écoles en économie politique. Permettez-moi de les caractériser, afin d’apprécier ensuite l’amère critique que, par une inexplicable contradiction, vous faites de celle dont en définitive vous adoptez le principe, et les emphatiques éloges que vous décernez, par une autre contradiction non moins inexplicable, à celle dont vous repoussez les vaines et subversives théories.
La première procède d’une manière scientifique. Elle constate, étudie, groupe et classe les faits et les phénomènes, elle cherche leurs rapports de cause à effet ; et de l’ensemble de ses observations, elle déduit les lois générales et providentielles selon lesquelles les hommes prospèrent ou dépérissent. Elle pense que l’action de la science, en tant que science, sur l’espèce humaine, se borne à exposer et divulguer ces lois, afin que chacun sache la récompense qui est attachée à leur observation et la peine dont leur violation est suivie, elle s’en rapporte au cœur humain pour le reste, sachant bien qu’il aspire invinciblement à l’une et a pour l’autre un éloignement inévitable ; et parce que ce double mobile, le désir du bien, l’horreur du mal, est la plus puissante des forces qui ramènent l’homme sous l’empire des lois sociales, elle repousse comme un fléau l’intervention de forces arbitraires qui tendent à altérer la juste distribution naturelle des plaisirs et des peines. De là ce fameux axiome : « Laissez faire, laissez passer, » contre lequel vous manifestez tant d’indignation, — qui n’est cependant que la périphrase servile du mot liberté, que vous inscrivez sur votre bannière comme le principe de votre doctrine.
L’autre école, ou plutôt l’autre méthode, qui a enfanté et devait enfanter des sectes innombrables, procède par l’imagination. La société n’est pas pour elle un sujet d’observations, mais une matière à expériences ; elle n’est pas un corps vivant dont il s’agit d’édudier les organes, mais une matière inerte que le législateur soumet à un arrangement artificiel. Cette école ne suppose pas que le corps social soit assujetti à des lois providentielles ; elle prétend lui imposer des lois de son invention. La République de Platon, l’Utopie de Thomas Morus, l’Oceana de Harrington, le Salente de Fénelon, le régime protecteur, le saint-simonisme, le fouriérisme, l’owenisme et mille autres combinaisons bizarres, quelquefois appliquées, pour le malheur de l’espèce humaine, presque toujours à l’état de rêve pour servir de pâture aux enfants à cheveux blancs, telles sont quelques-unes des manifestations infinies de cette école.
La méthode analytique devait nécessairement conduire à l’unité de doctrine, car il n’y a pas de raison pour que les même faits ne présentent les mêmes aspects à tous les observateurs. Voilà pourquoi, sauf quelques légères nuances que des observations rectifiées tendent incessamment à faire disparaître, elle a rallié autour de la même foi, Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Jefferson, Bentham, Senior, Cobden, Thompson, Huskisson, Peel, Destutt de Tracy, Say, Comte, Dunoyer, Droz et bien d’autres hommes illustres, dont la vie s’est passée non point à arranger dans leur tête une société de leur invention avec des hommes de leur invention, mais à étudier les hommes et les choses et leur action réciproque, afin de reconnaître et de formuler les lois auxquelles il a plu à Dieu de soumettre la société.
La méthode inventive devait de toute nécessité amener l’anarchie des intelligences, parce qu’il y a l’infini à parier contre un qu’une infinité de rêveurs ne feront pas le même rêve. Aussi voyons-nous que, pour se mettre à l’aise dans leur monde imaginaire, l’un en a banni la propriété, l’autre l’hérédité, celui-ci la famille, celui-là la liberté ; en voici qui ne tiennent aucun compte de la loi de la population, en voilà qui font abstraction du principe de la solidarité humaine, car il fallait mettre en œuvre des êtres chimériques pour faire une société chimérique.
Ainsi la première observe l’arrangement naturel des choses, et sa conclusion est liberté [2]. La seconde arrange une société artificielle, et son point de départ est contrainte. C’est pourquoi, et pour abréger, j’appellerai l’une école économiste ou libérale, et l’autre école arbitraire.
Voyons maintenant le jugement que vous portez sur ces deux doctrines :
« Il y a en économie politique deux écoles : une école anglaise et matérialiste (c’est l’école libérale que vous voulez décrire dans ces lignes) qui traite les hommes comme des quantités inertes ; qui parle en chiffres de peur qu’il ne se glisse un sentiment ou une idée dans ses systèmes ; qui fait de la société industrielle une espèce d’arithmétique impassible et de mécanisme sans cœur, où l’humanité n’est qu’une société en commandite, où les travailleurs ne sont que des rouages à user et à dépenser au plus bas prix possible, où tout se résout par perte ou gain au bas d’une colonne de chiffres, sans considérer que ces quantités sont des hommes, que ces rouages sont des intelligences, que ces chiffres sont la vie, la moralité, la sueur, le corps, l’âme de millions d’êtres semblables à nous et créés par Dieu pour les mêmes destinées. C’est cette école qui règne en France, depuis l’importation de la science économique née en Angleterre. C’est celle qui a écrit, professé et gouverné jusqu’ici, sauf quelques grandes exceptions ; c’est celle qui a proscrit l’aumône, incriminé la mendicité sans pourvoir aux mendiants, blâmé les hôpitaux, condamné les hospices, raillé la charité, mis la misère hors la loi, maudit l’excès de la population, interdit les mariages, conseillé la stérilité, fermé les tours des enfants trouvés, et qui, livrant tout sans miséricorde et sans entrailles à la concurrence, cette providence de l’égoïsme, a dit aux prolétaires : « Travaillez. — Mais nous ne trouvons pas de travail. — Eh bien ! mourez. Si vous ne rapportez rien, vous n’avez pas le droit de vivre ; la société est un compte bien fait. »
« Il y a une autre école qui est née en France, dans ces dernières années, des souffrances du prolétaire, des égoïsmes du manufacturier, de la dureté du capitaliste, de l’agitation des temps, des souvenirs de la Convention, des entrailles de la philanthropie et des rêves anticipés d’une époque entièrement idéale. C’est celle qui, prophétisant aux masses l’avènement du Christ industriel (Fourier), les appelle à la religion de l’association, substitue ce principe de l’association par le travail à tous les autres principes, à tous les autres instincts, à tous les autres sentiments dont Dieu a pétri la nature humaine, croit avoir trouvé le moyen d’organiser le travail sans intervertir les rapports libres du producteur et du consommateur, de violenter le capital sans l’anéantir, de régler les salaires et de les distribuer arbitrairement avec l’infaillibilité et la toute-justice de Dieu. Cette école, qui compte parmi ses maîtres et ses adeptes tant d’hommes de lumière et de foi, porte en soi deux grands trésors : un principe, l’association ; une vertu, la charité des masses. Mais elle nous semble pousser son principe jusqu’à l’excès et la vertu jusqu’à la chimère. Le fouriérisme est jusqu’ici une sublime exagération de l’espérance. — Nous n’appartenons ni à l’une ni à l’autre de ces écoles. Nous les croyons toutes deux dans le faux. Mais l’une manque d’âme, et l’autre manque seulement de mesure dans la passion du bien. Nous faisons entre elles la différence qu’il y a entre une cruauté et une illusion, et nous empruntons, pour la solution de la question des salaires, à l’une la lumière des calculs, à l’autre la chaleur de la charité. »
Je ne m’arrêterai pas à relever les expressions vagues et fausses, les assertions hasardées qui fourmillent dans ce passage, où il semble que votre plume vous a maîtrisé plus que vous n’avez maîtrisé votre plume. Où avez-vous vu que les économistes traitent les hommes comme des quantités inertes, eux qui voient précisément l’harmonie du monde social dans la liberté de leur action ? Où avez-vous vu que cette école gouverne en France, quand elle ne compte pas un seul organe, du moins avoué, au ministère ou au Parlement ? Qu’est-ce que ce dédain pour les chiffres, les calculs, l’arithmétique, comme si les chiffres servaient à autre chose qu’à constater des résultats, et comme si le bien et le mal pouvaient s’apprécier autrement que par des résultats constatés ? Quelle valeur scientifique est-il possible de reconnaître dans votre indignation contre la dureté du capitaliste, l’égoïsme du manufacturier, en tant que tels, comme si les services industriels et les capitaux pouvaient échapper, plus que les salaires, aux lois de l’offre et de la demande qui les gouvernent, pour se soumettre aux lois du sentiment et de la philanthropie ?
Mais je sens le besoin de protester de toutes mes forces contre les imputations odieuses que vous faites peser sur la tête de tous ces savants illustres, dont je rappelais tout à l’heure les noms vénérés. Non, la postérité ne ratifiera pas votre arrêt. Elle ne mettra pas, comme vous le faites, entre Smith et Fourier, entre Say et Enfantin l’abîme qui sépare la cruauté de la simple illusion. Elle ne conviendra pas que le seul tort de Fourier ait été de pousser « un grand principe jusqu’à l’excès et une grande vertu jusqu’à la chimère. » Elle ne verra pas dans la promiscuité des sexes une sublime exagération de l’espérance. Elle ne croira pas la science sociale redevable au fouriérisme de ces trois grandes innovations : « la foi à l’amélioration indéfinie de l’espèce humaine, le principe de l’association et la charité des masses ; » — parce que la perfectibilité de l’homme, conséquence de son principe intelligent, a été reconnue longtemps avant Fourier ; — parce que l’association est aussi ancienne que la famille ; — parce que la charité des masses, de quelque manière qu’on veuille la considérer, au point de vue théorique ou au point de vue pratique, dans l’individu ou dans la société, a été formellement promulguée par le christianisme et partout mise en œuvre, du moins à quelque degré. Mais la postérité s’étonnera que vous assigniez une place si élevée, que vous prodiguiez tant d’encens à une école que vous flétrissez en même temps par ces paroles éloquentes : C’est un monastère où « la mère n’est qu’une femme enceinte, le père un homme qui engendre, et l’enfant un produit des deux sexes. »
Mais que blâmez-vous dans les économistes ? Seraient-ce les formes parfois arides dont ils ont revêtu leurs idées ? C’est là de la critique littéraire. En ce cas il fallait reconnaître les services qu’ils ont rendus à la science, et vous borner à les accuser d’être de froids écrivains. Sur ce terrain encore, on pourrait répondre que si le langage sévère et précis de la science a l’inconvénient de n’en pas hâter assez la propagation, le style chaleureux et imagé du poëte, transporté dans le domaine didactique, a l’inconvénient bien plus grave d’égarer souvent le lecteur après avoir égaré l’écrivain. Mais ce n’est pas la forme que vous attaquez, c’est la pensée et même l’intention.
La pensée ! mais comment l’accuser ? Elle peut bien être fausse ; elle ne saurait être blâmable, car elle se résume ainsi : « Il y a plus d’harmonie dans les lois divines que dans les combinaisons humaines. » Permis à vous de dire comme Alphonse : « Ces lois seraient meilleures si j’eusse été appelé dans les conseils de Dieu. » Mais non, vous ne tenez point ce langage impie. Vous laissez de tels blasphèmes aux utopistes. Pour vous, vous vous emparez de la doctrine même dont vous essayez de flétrir les révélateurs, et dans tout votre écrit, sauf quelques vues exceptionnelles que je discuterai tout à l’heure, domine le grand principe de la liberté, qui suppose de votre part la reconnaissance de l’harmonie des lois divines, puisqu’il serait puéril d’adhérer à la liberté, non parce qu’elle est la vraie condition de l’ordre et du bonheur social, mais par un platonique amour pour la liberté elle-même, abstraction faite des résultats qu’il est dans sa nature de produire.
L’intention ! mais quelle perversité peut-on apercevoir dans l’intention de ceux qui se bornent à dire à l’arbitraire : « L’équilibre des forces sociales s’établit de lui-même ; n’y touchez pas ? »
Pour arriver jusqu’aux intentions des économistes, il faudrait prouver trois choses :
1° Que le libre jeu des forces sociales providentielles est funeste à l’humanité ;
2° Qu’il est possible d’en paralyser l’action par la substitution de forces arbitraires ;
3° Que les économistes repoussent celles-ci en parfaite connaissance de leur prétendue supériorité sur celles-là.
En dehors de ces trois démonstrations, vos attaques, si vous pensiez à les faire remonter jusqu’à l’intention des écrivains dont je parle, ne seraient ni justifiées ni justifiables.
Mais je ne croirai jamais que vous, dont personne ne soupçonne l’honneur et la loyauté, vous ayez voulu incriminer jusqu’à la moralité des savants illustres qui vous ont précédé dans la carrière, qui vous ont légué leurs doctrines et que l’humanité a absous d’avance par la vénération et le respect dont elle environne leur mémoire. Y a-t-il d’ailleurs, dans ce qu’il vous plaît d’appeler l’école anglaise, comme si une science qui se borne à décrire les faits et leur enchaînement pouvait être d’un pays plutôt que d’un autre, comme s’il pouvait y avoir une géométrie russe, une mécanique hollandaise, une anatomie espagnole et une économie française ou anglaise ; y a-t-il, dis-je, dans cette école, des hommes qui, comme les prohibitionnistes, aient proclamé leurs doctrines pour abuser les esprits et bénéficier par l’erreur commune sciemment et volontairement répandue ? Non, vous n’en citeriez pas un seul. Aucune secte philosophique peut-être n’a offert le spectacle d’autant de dignité, de modération, de dévouement au bien public ; et si vous voulez y réfléchir, vous comprendrez qu’il devait en être ainsi.
Dans le XVIIIe siècle siècle, quand l’astronomie n’était pas parvenue au point où elle est arrivée de nos jours, on avait remarqué une sorte d’aberration dans la marche des planètes. On avait constaté que les unes se rapprochaient, que les autres s’éloignaient du centre du mouvement ; et l’on se hâta de conclure que les premières s’enfonçaient de plus en plus dans les profondeurs glacées de l’espace, que les secondes allaient s’engloutir dans la matière incandescente du soleil. Laplace vint, il soumit ces prétendues aberrations au calcul, il démontra que si les planètes s’écartaient de leur orbite, la force qui les y rappelait s’augmentait en raison de cet éloignement même : « Par la toute-puissance d’une formule mathématique, dit M. Arago, le monde matériel se trouva raffermi sur ses fondements. » Pense-t-on que celui qui découvrit et mesura cette belle harmonie eût volontiers consenti, dans un intérêt personnel, à troubler ces admirables lois de la gravitation ?
L’économie des sociétés a eu aussi ses Laplace. S’il y a des perturbations sociales, ils ont aussi constaté l’existence de forces providentielles qui ramènent tout à l’équilibre, et ils ont trouvé que ces forces réparatrices se proportionnent aux forces perturbatrices, parce qu’elles en proviennent. Ravis d’admiration devant cette harmonie du monde moral, ils ont dû se passionner pour l’œuvre divine et répugner plus que les autres hommes à tout ce qui peut la troubler. Aussi n’a-t-on jamais vu, que je sache, les séductions de l’intérêt privé balancer dans leur cœur cet éternel objet de leur admiration et de leur amour. Bonaparte s’en étonna. Peu habitué à de telles résistances, il les honora du titre de niais, parce qu’ils refusaient leur concours à sa mission d’arbitraire, la regardant comme incompatible avec les grandes lois sociales qu’ils avaient découvertes et proclamées. Et ce titre glorieux, ils le portent encore, — et on n’en voit aucun aux affaires, car ils n’y veulent entrer qu’avec leur principe.
Je le dis avec regret mais avec franchise, monsieur, je crois que vous avez fait une chose funeste et de nature à égarer les premiers pas d’une jeunesse pleine de confiance dans l’autorité de vos paroles, lorsque, distribuant sans mesure le blâme et l’éloge, vous avez violemment assailli l’école la plus consciencieuse, la plus pratiquement chrétienne qui se soit jamais élevée à l’horizon des sciences morales, réservant votre enthousiasme, votre sympathie et, pardonnez-moi le mot, vos coquettes câlineries pour ces autres écoles qui ne sont, selon vous-même, que la négation de la liberté, de l’ordre, de la propriété, de la famille, de l’amour, des affections domestiques et de tous les sentiments dont Dieu a pétri la nature humaine.
Et ce qui achève de rendre cette injuste appréciation des hommes tout à fait inexplicable, c’est que vous adoptez, ainsi que je l’ai dit, le principe des économistes, la liberté des transactions, la libre concurrence, cette providence de l’égoïsme.
« Il n’y a d’autre organisation du travail, dites-vous, que sa liberté ; il n’y a d’autre distribution des salaires que le travail lui-même se rétribuant par ses œuvres et se faisant à lui-même une justice que vos systèmes arbitraires ne lui feraient pas. Le libre arbitre du travail dans le producteur, dans le consommateur, dans le salaire, dans l’ouvrier, est aussi sacré que le libre arbitre de la conscience dans l’homme. En touchant à l’un, on tue le mouvement ; en touchant à l’autre, on tue la moralité. Les meilleurs gouvernements sont ceux qui n’y touchent pas. »
Et ailleurs : « Nous ne connaissons d’autre organisation possible du travail dans un pays libre que la liberté se rétribuant elle-même par la concurrence, par la capacité, par la moralité. »
Ce n’est pas assez de dire que ces paroles coïncident avec les idées des économistes ; elles embrassent et résument leur doctrine tout entière. Elles supposent en vous la pleine connaissance, la claire vue de cette grande loi de la concurrence qui porte en elle-même le remède général aux maux inévitables qu’elle peut produire dans des cas particuliers.
Et cependant, comment croire que votre vue embrasse l’ensemble des faits et des forces sociales qui découlent du principe de la liberté, quand on vous voit décliner le dogme de la responsabilité des agents intelligents et libres !
Car en parlant des deux grandes écoles, celle de la liberté et celle de la contrainte, vous dites : « J’emprunte à l’une la lumière de ses calculs, à l’autre la chaleur de sa charité. » Pour parler avec précision, vous deviez dire : « J’emprunte à l’une le principe de la liberté, à l’autre celui de l’irresponsabilité. »
En effet, il résulte des citations que je viens de produire que ce que vous avez pris aux économistes, ce n’est point des calculs seulement, c’est un principe, à savoir : « La liberté est la meilleure des organisations sociales. »
Mais ce n’est qu’à une condition : c’est que la loi de la responsabilité sortisse son plein, entier et naturel effet. Que si la loi humaine intervient et fait dévier les conséquences des actions, de telle sorte qu’elles ne retombent pas sur ceux à qui elles étaient destinées, non-seulement la liberté n’est plus une bonne organisation, mais elle n’existe pas.
C’est donc une grave contradiction de dire qu’on emprunte là la liberté et ici la contrainte, pour en faire un monstrueux ou plutôt un impossible mélange.
Je me ferai mieux comprendre en abordant quelques détails.
Vous reprochez à l’école libérale d’être cruelle, et dès lors vous empruntez à l’école arbitraire la « chaleur de sa charité ». — Voilà la généralité, voici l’application.
Vous accusez les économistes d’interdire le mariage, de conseiller la stérilité, — et par opposition, vous voulez que l’État adopte les enfants orphelins ou trop nombreux.
Vous accusez les économistes de proscrire et de railler l’aumône, — et par opposition, vous voulez que l’État s’interpose entre les masses et leurs misères.
Vous accusez les économistes de dire aux prolétaires : « Travaillez ou mourez, » — et par opposition, vous voulez que la société proclame le droit au travail, le droit de vivre.
Examinons ces trois antithèses, que j’aurais pu multiplier ; cela suffira pour reconnaître s’il est possible de ramasser ainsi des dogmes dans des écoles opposées et d’accomplir entre eux une solide alliance.
Je ne veux point encombrer par des discussions de détail le terrain des principes sur lequel j’entends me maintenir. Je ferai cependant une remarque préliminaire. Il y a longtemps qu’on a dit que le moyen le plus sûr, mais certainement le moins loyal, de combattre son adversaire, c’était de lui prêter des sentiments outrés, des idées fausses et des paroles qu’il n’a jamais prononcées. Je vous crois incapable de recourir sciemment à un tel artifice ; mais, soit entraînement de la phrase à effet, soit exigences de concision, il est certain que vous attribuez aux économistes un langage qui ne fut jamais le leur.
Jamais ils n’ont conseillé la stérilité, interdit le mariage. — Ce reproche pourrait être adressé avec plus de raison et vous l’adressez en effet au fouriérisme. — S’ils ont, non pas maudit, mais déploré l’excès de la population, ce mot même « excès » que vous employez les justifie.
Ce qu’ils ont dit sur ce grave sujet, le voici : « L’homme est un être libre, responsable et intelligent. Parce qu’il est libre, il dirige ses actions par sa volonté ; — parce qu’il est responsable, il recueille la récompense ou le châtiment de ses actions, selon qu’elles sont ou ne sont pas conformes aux lois de son être ; — parce qu’il est intelligent, sa volonté et par suite ses actes se perfectionnent sans cesse, ou par la lumière de la prévoyance ou par les leçons fatales de l’expérience. — C’est un fait que les hommes, comme tous les êtres qui ont vie, peuvent se multiplier au-delà de leurs moyens actuels de subsistance. C’est un autre fait que lorsque l’équilibre est rompu entre le nombre des hommes et les ressources qui font vivre, il y a malaise et souffrance dans la société. — Donc, il n’y a pas d’autre alternative : il faut prévoir pour que l’équilibre se maintienne ; ou souffrir pour qu’il se rétablisse. Nous concluons qu’il est à désirer que la population, prise en masse, ne suive pas une progression trop rapide, et pour cela, que les individus qui la composent n’entrent dans l’état du mariage qu’autant qu’ils ont la chance probable de pouvoir entretenir une famille. — Et comme les hommes sont libres, comme nous n’admettons pas de législation coercitive ou restrictive en cette matière, nous nous adressons à leur raison, à leurs sentiments, à leur bon sens. Le langage que nous leur faisons entendre n’a rien d’utopique ou d’ abstrait. Nous leur disons avec la sagesse des siècles et ce sens si commun qu’il est presque de l’instinct : — « C’est donner la vie à des malheureux, c’est se rendre malheureux soi-même que de se charger imprudemment ou prématurément d’une famille qu’on n’a pas encore les moyens d’élever. » Nous ajoutons : « Si ces actes individuels d’imprévoyance sont trop multipliés, la société a plus d’enfants qu’elle n’en peut nourrir : elle souffre car l’homme n’est pas seulement soumis à la loi de la responsabilité, mais encore à celle de la solidarité ; et c’est pour cela que les économistes s’attachent à exposer toutes les conséquences fatales de la multiplication désordonnée des êtres humains, afin que l’opinion intervienne avec son action toute-puissante, car ils croient sincèrement que, contre ce terrible phénomène, la société n’a que cette alternative, la prévoyance ou la souffrance.
Mais vous, monsieur, vous lui apportez un expédient. Vous ne pensez pas qu’elle doit prévoir pour ne pas souffrir, et vous ne voulez pas qu’elle souffre pour n’avoir pas prévu. Vous dites : « Que l’État adopte les enfants trop nombreux. »
Voilà certes qui est bientôt décrété. Mais avec quoi, s’il vous plaît, les entretiendra-t-il ? Sans doute avec des aliments, des vêtements, des produits prélevés sur la masse sous forme d’impôts, car l’État, que je sache, n’a pas de ressources à lui, indépendantes du travail national. — Ainsi la grande loi de la responsabilité sera éludée. Ceux qui, dans des vues personnelles peut-être, mais parfaitement conformes à l’intérêt public, se seront conduits d’après les règles de la prudence, de l’honnêteté et de la raison, se seront abstenus ou auront retardé le moment de s’entourer d’une famille, se verront contraints de nourrir les enfants de ceux qui se seront abandonnés à la brutalité de leurs instincts. — Mais le mal sera-t-il guéri au moins ? Bien au contraire, il s’aggravera sans cesse, car en même temps qu’on ne pourra plus compter sur la prévoyance qui n’aura plus rien de rationnel, la souffrance elle-même, sans cesser d’agir, n’agira plus comme châtiment, comme frein, comme leçon, comme force équilibrante ; elle perdra sa moralité, il n’y aura plus rien en elle qui l’explique et la justifie, et c’est alors que l’homme pourra sans blasphémer dire à l’auteur des choses : « À quoi sert le mal sur la terre, puisqu’il n’a pas de cause finale ? »
On peut faire sur la charité les mêmes remarques. D’abord, jamais la science économique n’a proscrit ni raillé l’aumône. La science ne raille pas et ne proscrit rien ; elle observe, déduit et expose.
Ensuite, l’économie politique distingue la charité volontaire de la charité légale ou forcée. L’une, par cela même qu’elle est volontaire, se rattache au principe de la liberté et entre comme élément harmonique dans le jeu des lois sociales ; l’autre, parce qu’elle est forcée, appartient aux écoles qui ont adopté la doctrine de la contrainte, et inflige au corps social des maux inévitables. La misère est méritée ou imméritée, et il n’y a que la charité libre et spontanée qui puisse faire cette distinction essentielle. Si elle a des secours même pour l’être dégradé qui a encouru son malheur par sa faute, elle les distribue d’une main parcimonieuse, justement dans la mesure nécessaire pour que la punition ne soit pas trop sévère ; et elle n’encourage pas, par d’inopportunes délicatesses, des sentiments abjects et méprisables, qui, dans l’intérêt général, ne doivent pas être encouragés. Elle réserve, pour les infortunes imméritées et cachées, la libéralité de ses dons et ce secret, cette ombre, ces ménagements auxquels a droit le malheur, au nom de la dignité humaine.
Mais la charité légale, contrainte, organisée, décrétée comme une dette du côté du donateur et une créance positive du côté du donataire, ne fait ni ne peut faire une telle distinction. Permettez-moi d’invoquer ici l’autorité d’un auteur trop peu connu et trop peu consulté en ces matières :
« Il est plusieurs genres de vices, dit M. Charles Comte, dont le principal effet est de produire la misère pour celui qui les a contractés. Une institution qui a pour objet de mettre à l’abri de la misère toute sorte de personnes, sans distinction des causes qui l’ont produite, a donc pour résultat d’encourager tous les vices qui conduisent à la pauvreté. Les tribunaux ne peuvent condamner à l’amende les individus qui sont coupables de paresse, d’intempérance, d’imprévoyance et d’autres vices de ce genre ; mais la nature, qui a fait à l’homme une loi du travail, de la tempérance, de la modération, de la prévoyance, a pris sur elle d’infliger aux coupables les châtiments qu’ils encourent. Rendre ces châtiments vains en donnant droit à des secours à ceux qui les ont encourus, c’est laisser au vice tous les attraits qu’il a ; c’est laisser agir, de plus, les maux qu’il produit pour les individus auxquels il est étranger, et affaiblir ou détruire les seules peines qui peuvent le réprimer. »
Ainsi la charité gouvernementale, indépendamment de ce qu’elle viole les principes de la liberté et de la propriété, intervertit encore les lois de la responsabilité ; et en établissant une sorte de communauté de droit entre les classes aisées et les classes pauvres, elle ôte à l’aisance le caractère de récompense, à la misère le caractère de châtiment que la nature des choses leur avait imprimé.
Vous voulez que l’État s’interpose entre les masses et leur misère. — Mais avec quoi ? — Avec des capitaux. — Et d’où les tirera-t-il ? — De l’impôt ; il aura un budget des pauvres. — Il faudra donc que, soutirant ces capitaux à la circulation générale, il fasse retomber sur les masses, sous forme d’aumônes, ce qui leur arrivait sous forme de salaires !
Enfin vous proclamez le droit du prolétaire au travail, au salaire, à la subsistance. Et qui jamais a contesté à qui que ce soit le droit de travailler, et par conséquent le droit à une juste rémunération ? Est-ce sous le régime de la liberté qu’un tel droit peut être dénié ? Mais, dites-vous, en nous plaçant dans une terrible hypothèse, « si la société n’a pas du travail pour tous ses membres, si son capital ne suffit pas pour donner à tous de l’occupation ? » Eh bien ! cette supposition extrême implique que la population a dépassé ses moyens de subsistance. Je vois bien alors par quels procédés la liberté tend à rétablir l’équilibre ; je vois les salaires et les profits baisser, c’est-à-dire je vois diminuer la part de chacun à la masse commune ; je vois les encouragements au mariage s’affaiblir, les naissances diminuer, peut-être la mortalité augmenter jusqu’à ce que le niveau soit rétabli. Je vois que ce sont là des maux, des souffrances ; je le vois et je le déplore. Mais ce que je ne vois pas, c’est que la société puisse éviter ces maux en proclamant le droit au travail, en décrétant que l’État prendra sur les capitaux insuffisants de quoi fournir du travail à ceux qui en manquent ; car il me semble que c’est faire le plein d’une part en faisant le vide de l’autre. C’est agir comme cet homme simple qui, voulant remplir un tonneau, puisait par-dessous de quoi verser par-dessus ; ou comme un médecin qui, pour donner des forces au malade, introduirait dans le bras droit le sang qu’il aurait tiré au bras gauche.
À nos yeux, dans l’hypothèse extrême où l’on nous force de raisonner, de tels expédients ne sont pas seulement inefficaces, ils sont essentiellement nuisibles. L’État ne déplace pas seulement les capitaux, il retient une partie de ceux auxquels il touche, et trouble l’action de ceux qu’il ne touche pas. De plus, la nouvelle distribution des salaires est moins équitable que celle à laquelle présidait la liberté, et ne se proportionne pas, comme celle-ci, aux justes droits de la capacité et de la moralité. Enfin, loin de diminuer les souffrances sociales, elle les aggrave au contraire. Ces expédients ne font rien pour rétablir l’équilibre rompu entre le nombre des hommes et leurs moyens d’exister ; bien loin de là, ils tendent à déranger de plus en plus cet équilibre.
Mais si nous pensons que la société peut être placée dans une situation telle qu’elle n’a que le choix des maux, si nous pensons qu’en ce cas la liberté lui apporte les remèdes les plus efficaces et les moins douloureux, prenez garde que nous croyons aussi qu’elle agit surtout comme moyen préventif. Avant de rétablir l’équilibre entre les hommes et les subsistances, elle agit pour empêcher que cet équilibre ne soit rompu, parce qu’elle laisse toute leur influence aux motifs qu’ont les hommes d’être moraux, actifs, tempérants et prévoyants. Nous ne nions pas que ce qui suit l’oubli de ces vertus, c’est la souffrance ; mais vouloir qu’il n’en soit pas ainsi, c’est vouloir qu’un peuple ignorant et vicieux jouisse du même degré de bien-être et de bonheur qu’un peuple moral et éclairé.
Il est si vrai que la liberté prévient les maux dont vous cherchez le remède dans le droit au travail, que vous reconnaissez vous-même que ce droit est sans application aux industries qui jouissent d’une entière liberté : « Laissons de côté, dites-vous, le cordonnier, le tailleur, le maréchal, le charron, le tonnelier, le serrurier, le maçon, le charpentier, le menuisier… Le sort de tous ceux-là est hors de cause. » Mais le sort des ouvriers des fabriques serait aussi hors de cause si l’industrie manufacturière vivait d’une vie naturelle, ne posait le pied que sur un terrain solide, ne progressait qu’à mesure des besoins, ne comptait pas sur les prix factices et variables de la protection, une des formes émanées de la théorie de l’arbitraire.
Vous proclamez le droit au travail, vous l’érigez en principe ; mais, en même temps, vous montrez peu de foi dans ce principe. Voyez en effet dans quelles étroites limites vous circonscrivez son action. Ce droit au travail ne pourra être invoqué que dans des cas rares, dans des cas extrêmes, pour cause de vie seulement (propter vitam), et à la condition que son application ne créera jamais, contre le travail des industries libres et le tarif des salaires volontaires, la concurrence meurtrière de l’État.
Réduites à ces termes, les mesures que vous annoncez sont du domaine de la police plutôt que de l’économie sociale. Je crois pouvoir affirmer, au nom des économistes, qu’ils n’ont pas d’objections sérieuses à faire contre l’intervention de l’État dans des cas rares, extrêmes, où, sans nuire aux industries libres, sans altérer le tarif des salaires volontaires, il serait possible de venir, propter vitam, au secours d’ouvriers momentanément, brusquement déplacés, sous le coup de crises industrielles imprévues. — Mais, je vous le demande, pour aboutir à ces mesures d’exception, fallait-il remuer toutes les théories des écoles les plus opposées ? fallait-il élever drapeau contre drapeau, principe contre principe, et faire retentir aux oreilles des masses ces mots trompeurs : droit au travail, droit de vivre ! Je vous dirai, en empruntant vos propres expressions : « Ces idées ne sont si sonores que parce qu’il n’y a rien dedans que du vent et des tempêtes. »
Monsieur, je ne pense pas que le Ciel ait jamais accordé à un homme des dons plus précieux que ceux qu’il vous a prodigués. Il y a assez de chaleur dans votre âme, assez de puissance dans votre génie pour que le siècle subisse votre influence et fasse, à votre voix, un pas de plus dans la carrière de la civilisation. Mais pour cela, il ne faut pas que vous alliez butiner d’ici, de là, dans les écoles les plus opposées, des principes qui s’excluent. Votre prodigieux talent est un puissant levier ; mais ce levier est sans force s’il n’a pour point d’appui un principe. — Naguère vous vous présentâtes devant l’opposition, la bonne foi au cœur et l’éloquence sur les lèvres. Quel résultat avez-vous obtenu ? Aucun, parce que vous ne lui portiez pas un principe. Oh ! si vous adhériez fortement à la liberté ! Si vous la montriez faisant progresser le monde social par l’action de ces deux grandes lois corollaires : responsabilité, solidarité ! Si vous ralliiez les esprits autour de cette vérité : « En économie politique, il y a beaucoup à apprendre et peu à faire ! » On comprendrait alors que la liberté porte en elle-même la solution de tous les grands problèmes sociaux que notre époque agite, et « qu’elle fait aux hommes une justice que les systèmes arbitraires ne leur feraient pas. » Comment avez-vous rencontré des vérités si fécondes pour les abandonner l’instant d’après ? — Ne voyez-vous pas que la conséquence rationnelle et pratique de cette doctrine c’est la simplification du gouvernement ? Courage donc, suivez cette voie lumineuse ! Dédaignez la vaine popularité qu’on vous promet ailleurs. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez travailler à la simplification du pouvoir, demander qu’il ne touche « ni au travail ni à la conscience, » et exiger en même temps « qu’il prodigue l’instruction, qu’il colonise, qu’il adopte les enfants trop nombreux, qu’il s’interpose entre les masses et leurs misères. » Si vous lui confiez ces tâches multipliées et délicates, vous l’agrandissez outre mesure ; vous lui conférez une mission qui n’est pas la sienne ; vous substituez ses combinaisons à l’économie des lois sociales ; vous le transformez en « Providence qui ne voit pas seulement, mais qui prévoit ; » vous le mettez à même de prélever et de distribuer d’énormes impôts ; vous le rendez l’objet de toutes les ambitions, de toutes les espérances, de toutes les déceptions, de toutes les intrigues ; vous agrandissez démesurément ses cadres, vous transformez la nation en employés ; en un mot vous êtes sur la voie d’un fouriérisme bâtard, incomplet et illogique.
Ce ne sont pas là les doctrines que vous devez promulguer en France. Repoussez leurs trompeuses séductions. Rattachez-vous au principe sévère, mais vrai, mais le seul vrai, de la Liberté. Embrassez dans votre vaste intelligence et ses lois, et son action, et ses phénomènes, et les causes qui la troublent, et les forces réparatrices qui sont en elle. Inscrivez sur votre bannière : « Société libre, gouvernement simple, » — idées corrélatives et pour ainsi dire consubstantielles. Cette bannière, les partis la repousseront peut-être ; mais la nation l’embrassera avec transport. Mais effacez-y jusqu’à la dernière trace de cette devise : « Société contrainte, gouvernement compliqué ». — Des mesures exceptionnelles, applicables dans des circonstances rares, dans des cas extrêmes et d’une utilité après tout fort contestable, ne sauraient longtemps contre-balancer dans votre esprit la valeur et l’autorité d’un principe. Un principe est de tous les temps, de tous les lieux, de tous les climats et de toutes les circonstances. Proclamez donc la liberté : liberté de travail, liberté d’échanges, liberté de transactions pour ce pays et pour tous les pays, pour cette époque et pour toutes les époques. À ce prix, j’ose vous promettre sinon la popularité du jour, du moins la popularité et les bénédictions des siècles. — Un grand homme s’est emparé de ce rôle en Angleterre. Il n’y a pas de jour dans l’année, il n’y a pas d’heure dans le jour où on ne le voie exposer aux yeux des masses les grandes lois de la mécanique sociale. Il a réuni autour de lui une université mouvante, un apostolat du XIXe siècle siècle ; et la parole de vie pénétrant dans toutes les couches de la société en a fait surgir une opinion publique puissante, éclairée, pacifique, mais indomptable, qui sous peu présidera aux destinées de la Grande-Bretagne. Car savez-vous ce qui arrive ? Plus de cinquante mille Anglais se seront mis, d’ici à la fin du mois, en possession du droit électoral pour balancer l’influence des écoles arbitraires et neutraliser les efforts des prohibitionnistes, des faux philanthropes et de l’aristocratie. — la liberté ! — voilà le principe qui va régner à nos portes ; et un homme, M. Cobden, aura été l’instrument de cette grande et paisible révolution. Oh ! puisse vous être réservée une semblable destinée, dont vous êtes si digne !
Mugron (Landes)… janvier 1845.
FN:Extrait du Journal des Économistes, n° de février 1845.
FN: En disant que les hommes doivent jouir du libre exercice de leurs facultés, il demeure bien entendu que je n’entends point dénier au gouvernement le droit et le devoir de réprimer l’abus qu’ils en peuvent faire. Bien au contraire, les économistes pensent que c’est là sa principale et presque sa seule mission.
Abondance, disette [April 1845] [CW3 ES1.1]↩
BWV
1845.04.15 “Abondance, disette” (Abundance and Scarcity) [*Journal des Économistes*, April 1845, T. 11, p. 1-8] [ES1.1] [OC4.1.1, pp. 5-14] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Obstacle, cause [April 1845] [CW3 ES1.2]↩
BWV
1845.04.15 “Obstacle, cause” (Obstacle and Cause] [*Journal des Économistes*, April 1845, T. 11, p. 8-10] [ES1.2] [OC4.1.2, pp. 15-18] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Effort, résultat [April 1845] [CW3 ES1.3]↩
BWV
1845.04.15 “Effort, résultat” (Effort and Result) [*Journal des Économistes*, April 1845, T. 11, p. 10-16] [ES1.3] [OC4.1.3, pp. 19-27] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Introduction to Cobden et la Ligue. [June 1845] see below↩
BWV
1845.06?? “Introduction” [Bastiat’s Introduction to *Cobden et la Ligue, ou l’agitation anglaise pour la liberté du commerce* (Paris: Guillaumin, 1845), pp. i-xcvi.] [OC3.1, pp. 1-80][published before July 1845 when reviewed in JDE, July, p. 446]
*Cobden et la Ligue, ou l’agitation anglaise pour la liberté du commerce* (Paris: Guillaumin, 1845). [OC3] [Reviewed in July 1845 edition of JDE, p. 446.]
Also: 1845-06.15 “Situation économique de la Grande-Bretagne. Réformes financières. Agitation pour la liberté commerciale," JDE, Juin 1845, T. XI, 233-265. [Extract from intro to Cobden and the League, pp. vii-lxx (out of 96)] - states book sous presse
Égaliser les conditions de production [July 1845] [CW3 ES1.4]↩
BWV
1845.07.15 “Égaliser les conditions de production” (Equalizing the Conditions of Production) [*Journal des Économistes*, July 1845, T. 11, p. 345-56] [ES1.4] [OC4.1.4, pp. 27-45] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Nos produits sont grevés de taxes [July 1845] [CW3 ES1.5]↩
BWV
1845.07.15 “Nos produits sont grevés de taxes” (Our Products are weighed down with Taxes) [*Journal des Économistes*, July 1845, T. 11, p. 356-60] [ES1.5] [OC4.1.5, pp. 46-52] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
De l’avenir du commerce des vins entre la France et la Grande-Bretagne [Aug. 1845] ↩
BWV
1845.08.15 “De l'avenir du commerce des vins entre la France et la Grande-Bretagne” (On the Future of the Wine Trade between France and England) [*Journal des Économistes*, n° d’août 1845] [OC1.7, p. 387]
DE L’AVENIR DU COMMERCE DES VINS ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE [1].
Aux membres de la Ligue, aux officiers du Board of trade, aux ministres du gouvernement anglais.
La Ligue provoque les réformes commerciales, le Board of trade les élabore, le ministre les convertit en lois : c’est donc à ces trois degrés de juridiction que j’adresse les réflexions qui suivent.
L’Angleterre ne produisant pas de vins, les droits de douane qui frappent ce liquide ne peuvent être considérés comme protecteurs. Par ce motif, ils ne suscitent pas les réclamations de la Ligue. Aussi voit-on les vins figurer parmi les huit articles auxquels paraît devoir se restreindre l’action du tarif anglais.
Cependant un droit, même fiscal, est contraire à la liberté du commerce, si, par son exagération, il prévient des échanges internationaux, s’il interdit au peuple des satisfactions qui n’ont en elles-mêmes rien d’immoral, s’il va jusqu’à lui ravir le choix de ses habitudes [2], si même, sacrifiant ce revenu public, qui lui sert de prétexte, on s’en sert comme d’un acte de représailles contre des tarifs étrangers, ou qu’on le réserve comme moyen d’agir sur ces tarifs [3]. C’est parce que l’administration anglaise est décidée à mettre enfin la justice au-dessus de ces vaines considérations d’une fausse et étroite politique, qu’elle se propose, si je suis bien informé, de substituer au droit fixe actuel de 5 sch. 6 d. par gallon une taxe fixe d’un schilling, plus un droit de 20 pour 100.
Cependant, en laissant subsister ce droit fixe d’un schilling, faites-vous réellement justice au peuple anglais, d’une part, de l’autre, entrez-vous franchement dans la voie d’une saine politique à l’égard des autres peuples ? — Ce sont deux points sur lesquels je vous prie de me permettre d’appeler votre attention.
Mais quel droit a un étranger de s’immiscer dans une telle question ? Le droit que je tiens de votre principe : liberté de commerce n’implique-t-elle pas entre les nations communauté d’intérêts ? En m’occupant de votre pays, je travaille pour le mien, ou, si vous l’aimez mieux, en m’occupant du mien, je travaille pour le vôtre.
Qu’un droit uniforme appliqué à des valeurs différentes soit injuste, c’est ce qui n’a pas besoin de démonstration. Je me bornerai donc, sur ce point, à montrer en chiffres les résultats des trois systèmes, en supposant que les prix maximum et minimum des vins pouvant donner lieu à un commerce important soient de 28 sch. et 3 sch. le gallon.
| VIN DU RICHE. | ||||||||
| Système actuel, 2591.droit fixe de 5 sch. 6 d. | Prix d’achat | 28 | sch. | |||||
| Droit | 5 | 6 | d. | ou 20 p. 100. | ||||
| 33 | 6 | |||||||
| Système projeté, 2592.droit mixte. | Prix d’achat | 28 | sch. | |||||
| Droit fixe | 1 | ou 23 p. 100 | ||||||
Droit graduel à 20 p. 100. |
5 | 6 | d. | |||||
| Système du droit 2594.ad valorem. | Prix d’achat | 28 | sch. | |||||
| Droit à 20 p. 100. | 5 | 6 | d. | ou 20 p. 100. | ||||
| 33 | 6 | |||||||
| VIN DU PAUVRE. | ||||||||
| Prix d’achat | 3 | sch. | ||||||
| Droit | 5 | 6 | d. | ou 183 p. 100 | ||||
| 8 | 6 | |||||||
| Prix d’achat | 3 | sch. | ||||||
| Droit fixe | 1 | 50 p. 100. | ||||||
| Droit graduel à 20 p. 100. | 0 | 6 | d. | |||||
| 4 | 6 | |||||||
| Prix d’achat | 3 | sch. | ||||||
| Droit à 20 p. 100. | 0 | 6 | d. | ou 20 p. 100. | ||||
| 3 | 6 | |||||||
Ces chiffres approximatifs n’ont pas besoin de commentaires.
Aujourd’hui, pour une dépense égale, le pauvre paye huit fois la taxe du riche.
Dans le système projeté, il payerait encore une taxe double.
Le droit ad valorem est seul équitable.
J’ai eu l’honneur de soumettre verbalement cette observation à quelques-uns de vos plus célèbres économistes, à des membres du Parlement, à des hommes d’État : ils sont loin d’en contester la justesse ; mais, disent-ils, le droit ad valorem est d’une perception coûteuse et difficile. Mais une difficulté d’exécution suffit-elle pour justifier la perpétration d’une injustice ? En France, l’administration aurait trouvé commode de frapper chaque hectare de terre d’un impôt uniforme, sans égard à sa force contributive ; elle n’y a pas songé, cependant, et n’a pas reculé devant les complications du cadastre. La raison en est simple : quand la nation en masse rencontre un obstacle, c’est à la nation en masse à le vaincre ; et elle ne peut sans iniquité s’en débarrasser aux dépens d’une classe, et précisément de la classe la plus malheureuse.
L’objection, d’ailleurs, perd toute sa force en présence du système mixte. Il implique la possibilité de prélever le droit graduel.
On ajoute, il est vrai, que sans le droit fixe il faudrait, sous peine de compromettre le revenu de l’État, porter plus haut le droit ad valorem, qui, dans ce cas, offrirait un trop fort appât à la fraude.
Mais sont-ce les réformateurs auxquels je m’adresse qui plaideront la cause des droits exagérés, au point de vue fiscal ? Quand vous voulez grossir votre revenu, quel est depuis longtemps tout votre secret ? C’est justement de modérer les taxes. Cette politique ne vous a jamais failli ; et, en ce moment même, les résultats de l’abaissement des droits sur le sucre lui donnent une éclatante consécration.
On peut, je crois, tenir pour certain qu’avec un droit modéré de 20 pour 100, l’Angleterre fera sur les vins un commerce immense et constamment progressif. La France consomme 40 millions d’hectolitres de vins, malgré les taxes et les entraves par lesquelles il semble qu’elle cherche à détruire cette branche d’industrie ; y a-t-il exagération à établir que la Grande-Bretagne, avec ses puissantes ressources de consommation, achètera le dixième de ce qu’achète la France, ou 4 millions d’hectolitres, dont 7/8 de vins ordinaires à 3 sch. et 1/8 de vins fins à 28 sch. en moyenne ? Or, dans cette hypothèse, le Trésor recouvrerait de 3 à 4 millions sterling. Il ne perçoit aujourd’hui que 2 millions.
J’ai dit, en second lieu, que le droit uniforme me semble impolitique.
L’Angleterre s’étant assurée que la prospérité d’un peuple se mesure mieux par ses importations que par ses exportations, a pris le parti d’ouvrir ses ports aux produits des autres nations, sans attendre d’elles réciprocité, et sans même la leur demander. Son but principal est de mettre sa législation commerciale en harmonie avec la saine économie politique ; mais, accessoirement, elle espère agir au dehors par son exemple, car, jusqu’à ce que la liberté soit universelle, elle ne lui cédera que la moitié de ses fruits.
Or, au point de vue de l’influence que peut exercer sur les nations cette initiative de la grande réforme commerciale, quelle différence immense sépare le droit fixe du droit ad valorem !
Avec le droit uniforme, vous continuerez, comme aujourd’hui, à recevoir quelques vins de Xérès et des bons crus de la Champagne et du Bordelais. L’Angleterre et la France se toucheront encore par leurs sommités aristocratiques, et vos riches seigneurs donneront la main, par-dessus la Manche et à travers les tarifs, à nos grands propriétaires. Mais voulez-vous que votre population et la nôtre soient mises en contact sur tous les points ; qu’un commerce actif et régulier entre les deux peuples pénètre dans tous les districts, dans toutes les communes, dans toutes les familles ? Tenez-vous à voir l’Angleterre passer le détroit et enfoncer dans notre sol de profondes racines ? Renoncez à ce droit fixe, et laissez l’infinie variété de nos produits aller satisfaire l’infinie variété de vos goûts et de vos fortunes. Alors les avocats du free-trade, en France, auront une large base d’opérations ; car la connaissance, l’amour, le besoin du libre-échange descendront jusque dans nos chaumières, et il n’y aura pas un de nos foyers qui ne suscite quelque défenseur à ce principe d’éternelle justice. Et ai-je besoin de vous dire les conséquences ?… La puissance de consommation s’élargira tellement, en France comme en Angleterre, qu’il y aura des débouchés pour vos manufactures comme pour nos fabriques, pour nos champs comme pour les vôtres ; et le temps arrivera, je l’espère, où vous pourrez transformer en navires marchands vos vaisseaux de guerre, comme nous pourrons rendre nos jeunes soldats à l’industrie.
Paix au dehors, justice au dedans, prospérité partout, — de tels résultats pourraient-ils être balancés dans votre esprit par une simple difficulté d’exécution, qui ne vous a pas arrêtés pour le thé, et que d’ailleurs vous n’évitez pas par le système mixte ?
FN:Extrait du Journal des Économistes, n° d’août 1845.
(Note de l’éditeur.)
FN:J’ai souvent entendu dire, en Angleterre, que l’élévation des droits sur les vins de basse qualité était sans importance, parce qu’en aucun cas le peuple ne buvait de vin, dont il n’a pas l’habitude. Mais ne sont-ce pas ces droits qui ont créé ces habitudes ?
FN:Sir Robert Peel, en présentant son plan financier, a dit qu’il « réservait les droits sur les vins comme moyen d’amener la France à un traité de commerce. » Mais il a dit aussi que « si cette politique ne réussissait pas, y persévérer serait léser les intérêts du peuple anglais. »
Balance du commerce [October 1845] [CW3 ES1.6]↩
BWV
1845.10.15 “Balance du commerce” (The Balance of Trade) [*Journal des Économistes*, October 1845, T. 12, p. 201-04] [ES1.6] [OC4.1.6, pp. 52-57] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Pétition des fabricants de chandelles, etc. [October 1845] [CW3 ES1.7]↩
BWV
1845.10.15 “Pétition des fabricants de chandelles, etc.” (Petition by the Manufacturers of Candles, etc.) [*Journal des Économistes*, October 1845, T. 12, p. 204-07] [ES1.7] [OC4.1.7, pp. 57-62] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Droits différentiels [October 1845] [CW3 ES1.8]↩
BWV
1845.10.15 “Droits différentiels” (Differential Duties) [*Journal des Économistes*, October 1845, T. 12, p. 207-08] [ES1.8] [OC4.1.8, pp. 62-63] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Immense découverte!!! [October 1845] [CW3 ES1.9]↩
BWV
1845.10.15 “Immense découverte!!!” (An immense Discovery!!!) [*Journal des Économistes*, October 1845, T. 12, p. 208-11] [ES1.9] [OC4.1.9, pp. 63-67] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Réciprocité [October 1845] [CW3 ES1.10]↩
BWV
1845.10.15 “Réciprocité” (Reciprocity) [*Journal des Économistes*, October 1845, T. 12, p. 211] [ES1.10] [OC4.1.10, pp. 67-70] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Prix absolus [October 1845] [CW3 ES1.11]↩
BWV
1845.10.15 “Prix absolus” (Nominal Prices) [*Journal des Économistes*, October 1845, T. 12, p. 213-15 (this chapter was originally numbered XII in the JDE but became chapter XI in the book version of Economic Sophisms and incorporated chapter XI. “Stulta et Puera”, from the JDE version p. 211-12)] [ES1.11] [OC4.1.11, pp. 70-74] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Previously unpublished essays which appeared in ES1↩
The above essays were written but not published before the appearance of ES1 in Jan. 1846; thus, before Dec. 1845.
BWV
1845.11 [Author’s Introduction][ES1.0] [OC4.1.0, pp. 1-5] [CW3]
1845.11 “La protection élève-t-elle le taux des salaires?” (Does Protection increase the Rate of Pay?) [n.d.][ES1.12] [OC4.1.12, pp. 74-79] [CW3]
1845.11 “Théorie, Pratique” (Theory and Practice) [n.d.][ES1.13] [OC4.1.13, pp. 79-86] [CW3]
1845.11 “Conflit de principes” (A Conflict of Principles) [n.d.] [ES1.14] [OC4.1.14, pp. 86-90] [CW3]
1845.11 “Encore la réciprocité” (More Reciprocity) [n.d.][ES1.15] [OC4.1.15, pp. 90-92] [CW3]
1845.11 “Les fleuves obstrués plaidant pour les prohibitionistes” (Blocked Rivers pleading in favor of the Prohibitionists) [n.d.][ES1.16] [OC4.1.16, pp. 92-93] [CW3]
1845.11 “Un chemin de fer négatif” (A Negative Railway] [n.d.][ES1.17] [OC4.1.17, pp. 93-94] [CW3]
1845.11 “Il n'y a pas de principes absolus” (There are no Absolute Principles) [n.d.][ES1.18] [OC4.1.18, pp. 94-97] [CW3]
1845.11 “Indépendance nationale” (National Independence) [n.d.][ES1.19] [OC4.1.19, pp. 97-99] [CW3]
1845.11 “Travail humain, travail national” (Human Labor and Domestic Labor) [n.d.][ES1.20] [OC4.1.20, pp. 100-05] [CW3]
1845.11 “Matières premières” (Raw Materials) [n.d.][ES1.21] [OC4.1.21, pp. 105-15] [CW3]
1845.11 “Métaphores” (Metaphors) [n.d.][ES1.22] [OC4.1.22, pp. 115-19] [CW3]
1845.11 “Conclusion” (Conclusion) [signed “Mugron, 2 November, 1845”][ES1.23] [OC4.1.23, pp. 119-26] [CW3]
[See Economic Sophisms ES1 for details]
Sur les questions soumise aux conseils généraux [décembre 1845] ↩
BWV
1845.12.15 “Sur les questions soumise aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce” (On Questions submitted to the General Councils of Agriculture, Manufactures, and Commerce) [*Journal des Économistes*, décembre 1845] [OC1.8, p. 392]
Journal des économistes, décembre 1845
Une question soumise aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce [1]'
Faut-il, dans l’intérêt de notre marine, admettre en franchise de droits les fers destinés à la construction des navires engagés dans la navigation internationale ?
Cette question n’aurait-elle pas été convenablement suivie de cette autre :
Faut-il, dans l’intérêt de nos voies de communication, admettre en franchise de droits les fers destinés à la construction des railways ?
Et de cette autre encore :
Faut-il, dans l’intérêt de nos estomacs, admettre en franchise de droits les fers destinés au labourage des terres, et par là à la production des subsistances ?
Quoi qu’il en soit, restreignons-nous à la proposition du ministre.
Remarquons d’abord comment elle est posée.
Il ne s’agit pas de recevoir du fer étranger pour construire toute sorte de navires, mais seulement les navires destinés à la navigation internationale. Pourquoi cela ? La raison en est simple. Il y a deux sortes de navigation, celle qui se fait de France à France, ou de métropole à colonie et réciproquement. Cela s’appelle la navigation réservée. Ici on tient le consommateur à la gorge, et il faut qu’il paye. Que le navire soit lourd, mauvais marcheur, qu’il revienne à un prix exorbitant, et grève inutilement les objets transportés d’un fret onéreux, c’est ce dont notre législation ne se met pas en peine, ou plutôt c’est ce qu’elle cherche. Le consommateur est là, tout disposé à se laisser exploiter, et l’on n’y fait pas faute.
Mais la navigation internationale est soumise, dans une certaine mesure, à la concurrence extérieure. Il arrive généralement que les armateurs et marins étrangers se contentent d’un moindre fret que les nôtres, et ils ont l’audace de rendre les marchandises dans nos magasins avec une grande économie, à notre profit.
Comme il est de principe, chez nous, que le public, en tant que consommateur, ne doit jamais être compté pour rien, si ce n’est pour être rançonné, et que ce n’est qu’en qualité de producteur que chaque travailleur doit être protégé, c’est-à-dire mis à même de tirer sa part delà curée, on conçoit aisément que le législateur a dû se préoccuper des moyens de soutenir notre marine nationale, en faisant retomber sur les masses les pertes que lui occasionne son impuissance ou son incapacité.
C’est ce qui a été fait. On s’est dit : L’étranger porte en France telle marchandise pour 20 francs ; nos armateurs ne peuvent la porter que pour 25 francs. Mettons une taxe de 5 francs sur cette marchandise, quand c’est l’étranger qui la porte, et il sera exclu de nos ports. Dès lors, nos armateurs feront la loi et hausseront leur fret à 25 francs. — C’est là l’origine de la surtaxe consignée dans nos tarifs à la colonne qui a pour titre : Par navires étrangers.
En thèse générale, le calcul était mauvais. En effet, il est incontestable qu’à ce système l’acheteur perd cinq francs, tandis que l’armateur ne les gagne pas, puisque, d’après l’hypothèse, il ne peut opérer le transport même à 24 francs. Mais enfin on était autorisé à penser qu’au moyen de cette surtaxe, au préjudice du public, le but immédiat de la mesure serait atteint, et que notre marine serait en mesure de lutter contre la concurrence étrangère.
Il n’en a pas été ainsi. Malgré le doux oreiller de la surtaxe, on a pu voir, dans un article de la Presse, et d’après des chiffres soigneusement relevés de documents officiels, qu’il n’est pas une peuplade sur la surface du globe qui n’envahisse et ne restreigne, d’année en année, notre modeste part de l’intercourse.
J’ai dit ailleurs : Protection, c’est spoliation. C’est là son côté odieux.
J’aurais pu dire aussi : Protection, c’est déception. C’est son côté ridicule.
Car si la protection pèse sur le public, au moins devrait-elle soutenir l’industrie qu’elle prétend favoriser. Comment donc se fait-il que notre marine ne puisse opérer les transports quand la France lui paye pour cela, outre le prix naturel du fret, une prime énorme, cachée sous la surtaxe ?
On ne prend pas garde à une chose, c’est que la protection a deux tranchants. Chacun de nous regarde avec cupidité la part qu’elle lui permet de puiser dans le fonds commun de la spoliation ; mais nous fermons les yeux sur la part qu’elle nous force d’y verser. Le marin français a pour lui les droits différentiels, sa liste civile, cela est vrai. Mais il n’y a pas une planche, un clou, un bout de corde, un lambeau de toile, une tache de goudron qu’il n’ait surpayés en vertu du régime protecteur. Le biscuit qui le nourrit, le paletot qui le couvre, le soulier qui le chausse ont payé la taxe au monopole ; en sorte que ce que la protection lui a injustement conféré en gros, elle le reprend injustement et amplement en détail. Voilà pourquoi notre marine est aux abois.
Maintenant il se présente plusieurs moyens de la relever.
Le plus efficace, le seul efficace selon nos principes, serait de détruire ce régime sous lequel elle succombe. Nous savons qu’il n’y faut pas songer de longtemps. Aussi nous nous proposons de n’examiner que les moyens qui sont en harmonie avec les principes qui dominent notre législation commerciale, principes d’après lesquels le sacrifice des intérêts généraux est toujours de droit.
Dans le sens de cette théorie, le moyen le plus sur, le plus décisif, le plus logique, serait de faire entrer tous les transports par mer dans la navigation réservée ; de remplacer la surtaxe par la prohibition, et de déclarer qu’à l’avenir la France ne recevra plus rien dans ses ports qui n’y arrive par navires français. Je m’étonne que M. le ministre n’y ait pas songé ; et j’espère qu’il me saura gré de lui avoir suggéré cette idée, quoique, à vrai dire, je n’aie pas le mérite de l’invention. Les journaux ne se font pas faute de le pousser dans cette voie. Avons-nous besoin de charbons anglais ? Accordez, disent-ils, le privilége du transport aux navires nationaux. — Mais ce sera plus cher ! — Qu’importe ? c’est l’affaire du public, qui ne s’en soucie guère.
Après ce moyen héroïque, celui qui se présente le plus naturellement, c’est, sinon de convertir la surtaxe en prohibition, du moins de la renforcer. Si la surtaxe est bonne en principe, elle n’a pu faillir que parce qu’elle est trop modérée. Ne pas la relever, c’est en nier implicitement la justice ou l’efficacité ; c’est rejeter le principe même de la protection. Pourquoi donc M. le ministre n’a-t-il pas recours à ce moyen, qui n’est pas nouveau, qui n’est que le développement et le complément d’une mesure universellement adoptée ? Pourquoi ? parce que, sans doute, il entrevoit plus ou moins confusément la déception qui est au bout de ces expédients, comme je le disais tout à l’heure. Voyez en effet dans quel cercle vicieux on s’engagerait ! — Élever la surtaxe, c’est renchérir le fret ; renchérir le fret, c’est grever la marchandise ; grever la marchandise, c’est rompre l’équilibre que la protection a voulu fonder entre notre industrie et l’industrie étrangère. Rompre cet équilibre, c’est se condamnera le rétablir par l’exhaussement du tarif général ; exhausser le tarif, c’est renchérir les armements ; c’est provoquer de nouvelles surtaxes, lesquelles auront les mêmes effets, deviendront causes à leur tour, et ainsi de suite à l’infini.
Ce second moyen ayant été jugé inexécutable, il paraît que M. le ministre s’est enfin avisé que l’on devrait demander à la liberté ce qu’on n’a pu obtenir de l’arbitraire. Il s’est dit : La France, sans doute, naviguerait au même prix que les autres nations, si les matériaux qui entrent dans la construction de ses vaisseaux n’étaient pas grevés de droits qui en élèvent démesurément le prix.
En conséquence, il consulte les Conseils pour savoir s’il ne conviendrait pas d’admettre en franchise les fers qui entrent dans la construction de nos navires.
Évidemment, cette mesure serait par elle-même inefficace, et il faut la considérer comme un premier et timide essai dans la voie de la liberté commerciale. Le raisonnement de M. le ministre doit le conduire à adopter la même politique pour le bois, le cuivre, le chanvre, la toile, etc. , etc.
Le fer, en effet, est de si peu d’importance dans un bâtiment en bois doublé, cloué et chevillé en cuivre, que la mesure que médite M. le ministre ne peut pas affecter sensiblement le cours du fret. Cela est si évident qu’on est porté à croire, quoique M. le ministre ne le dise pas, qu’il a eu en vue les navires et surtout les bateaux à vapeur entièrement construits en fer.
Mais alors pourquoi ne pas admettre, en franchise de droits, les navires en fer eux-mêmes de construction étrangère ?
Oh ! dit-on, c’est que nos constructeurs veulent être protégés. — Mais si vous voulez écouter tous les quêteurs de monopole, vous ne pourrez pas admettre le fer ; car nos propriétaires de forêts, nos maîtres de forges, nos actionnaires de mines ne sont pas très-disposés à abandonner leur part de protection. — Vous ne pouvez servir deux maîtres, il faut opter. Est-ce pour le public ou pour les constructeurs que vous êtes ministre ?
Examinons donc la question en elle-même. Elle est bien restreinte, comme on le voit. Les navires en bois, c’est-à-dire la marine actuelle tout entière est hors de cause. Il s’agit de navires en fer, d’une marine future et éventuelle. La question que nous avons à résoudre est celle-ci :
« Vaut-il mieux admettre, en franchise de droits, le fer étranger destiné à la construction des navires, ou les navires en fer eux-mêmes de construction étrangère ? »
Il serait assez curieux de voir d’abord comment elle a été traitée, au point de vue du principe prohibitif, par un journal spécial fort accrédité en ces matières, le Moniteur industriel. La libre admission du fer, pour la destination dont il s’agit, a été insinuée pour la première fois, à ma connaissance, dans un article récent de ce journal.
Il n’est pas possible de faire du régime prohibitif une satire plus naïve à la fois et plus sanglante ; et il semble que le but secret de l’auteur de cet article est de confondre et de ridiculiser ce système, en le montrant sous un aspect vraiment burlesque. Quoi ! vous convenez que notre marine marchande est chassée de tous les ports de l’Océan par la marine étrangère ! Vous en cherchez la cause ; vous trouvez que les matériaux qui entrent dans la construction de nos navires nous coûtent, dans la proportion de 300 pour 100, plus cher qu’aux Anglais ; vous établissez vous-même qu’à cette cause d’infériorité viennent s’ajouter le haut prix du combustible, l’insuffisance de l’outillage, l’inexpérience des constructeurs et des ouvriers ; vous ne disconvenez pas que c’est le régime de la prohibition qui a placé notre marine dans cette situation humiliante et ridicule, et, après tout cela, vous concluez… au maintien de ce régime !
Et remarquez comme la rapacité du monopole est habile à faire argument de tout, même des données les plus contradictoires ! Lorsque, délivré de toute concurrence, il est parvenu à créer dans le pays une industrie factice, à détourner vers un emploi onéreux les capitaux elles bras, et à couvrir ses pertes par des taxes déguisées mais réelles, quelle est la raison sur laquelle il s’appuie pour prolonger et perpétuer son existence ? Il montre ces capitaux que la liberté va détruire, ces bras qu’elle va paralyser ; et cet argument a tant de puissance qu’il n’est pas encore de ministère ou de législature qui ait osé l’affronter. « C’est un malheur, disent humblement les intérêts privilégiés, que la protection nous ait jamais été accordée. Nous comprenons qu’elle pèse lourdement sur le public. Nous avons cru, que, grâce à cette protection dont la loi a entouré notre enfance, nous parviendrions bientôt à voler de nos propres ailes, à marcher dans notre force et notre liberté. Nous nous sommes trompés. La société a partagé notre erreur. C’est elle, pour ainsi dire, qui nous a appelés à l’existence. Elle ne peut plus maintenant nous laisser mourir. Nous avons des droits acquis.
Aujourd’hui ce terrible argument est pris à rebours.
« Nous n’avons pas encore employé le fer à la construction des navires. Il n’y a ni bras ni capitaux engagés dans cette voie. D’ailleurs, les matériaux, le combustible, les outils, les entrepreneurs, les ouvriers nous manquent. En outre, cette branche d’industrie exige des connaissances spéciales dans les procédés de fabrication que nul ne possède, et bien peu de personnes sont en état de la naturaliser chez nous. Donc, pour l’implanter dans le pays, pour lui donner l’être, la protection est loin de suffire, c’est la prohibition absolue qu’il nous faut. »
Dites donc que ce n’est pas notre marine qui vous préoccupe, mais vos priviléges. Si sérieusement vous vouliez une marine marchande, vous laisseriez la France échanger avec l’Angleterre des vins contre des navires en fer. Ils ne reviendraient pas plus cher aux armateurs de Bordeaux qu’à ceux de Liverpool, et la concurrence serait possible. Il est vrai que l’auteur de l’article insinue ici le moyen proposé par M. le ministre, la libre introduction du fer destiné à la construction.
Mais n’a-t-il pas lui-même prouvé d’avance l’inefficacité de ce moyen quand il a dit, avec raison, que ce n’est pas seulement le prix de la matière qui renchérit nos navires, mais encore et surtout l’infériorité de notre mise en œuvre ; quand il a fait observer que notre pays n’était pas disposé pour ce genre d’industrie, qu’il ne le serait pas de longtemps, que les établissements, les machines, le charbon, tout lui manque à la fois ?
Au mois de juillet dernier, j’étais à Liverpool. Un honnête quaker. M. Baines, de la maison Hodgson et compagnie, me fit visiter ses ateliers de construction. Je vis sur le chantier un immense navire tout en fer, quille, membrures, bordages, etc. Après avoir examiné d’innombrables machines que je ne décrirai pas (et pour cause, car je n’en sais guère plus là-dessus que ce pauvre Tristram qui ne put jamais comprendre le mécanisme d’un tourne-broche) ; après avoir vu d’énormes poinçons, de gigantesques ciseaux trouer, tailler, festonner des planches de fer de 2 centimètres d’épaisseur, comme si c’eût été de la pâte de jujube, j’eus avec M. Baines la conversation suivante :
« Ces navires en fer reviennent-ils plus cher que les navires en bois ? — À peu près. La matière est, il est vrai, plus chère, mais on la travaille avec une telle facilité, une telle précision, le système de l’étalonnage présente tant d’avantages, que cela compense bien et au delà le prix du fer. — En quoi donc consiste la supériorité de ce nouveau mode de construction ? — Le navire dure plus, les pièces qui le composent se changent plus facilement, il a moins de tirant d’eau, il est plus léger ; et comme le tonnage se calcule par les trois dimensions, il porte plus, à tonnage égal, et économise les taxes à la marchandise. — En sorte, lui dis-je, que, la concurrence s’en mêlant, c’est le consommateur qui profitera de ces avantages ; vos armateurs baisseront le prix du fret, et nous, Français, qui avons déjà tant de mal à lutter contre vos navires en bois, nous serons tout à fait évincés par vos navires en fer. — Cela est probable, me dit-il, à moins que vous ne fassiez comme nous, ou, si vous ne pouvez, que vous n’achetiez nos bâtiments. — Pourriez-vous me démontrer par des chiffres ces deux points décisifs : 1° les navires en fer ne reviennent pas plus cher que les navires en bois ; 2° ils portent plus, à tonnage égal ? — Venez chez moi ; tous mes livres sont à votre disposition. — Est-ce que vous ne craignez pas de divulguer des secrets qui font votre fortune ? — Ce n’est pas le secret, mais la publicité qui fera ma fortune. Plus on sera convaincu de la supériorité des navires en fer, plus je recevrai des ordres de construction. D’ailleurs, si mes procédés sont bons, comme je le crois, je ne demande pas mieux que l’humanité en profite ; et, quant à moi, quel que soit le sort de cette industrie, j’ai la confiance d’utiliser toujours l’amour du travail et le peu de connaissances qu’il a plu à la Providence de me donner. »
Je regrettai, on le croira sans peine, que le temps ne me permît pas de compulser les livres que l’honnête quaker mettait si loyalement à ma disposition. Si j’avais pu prolonger mon séjour à Liverpool, je serais sans doute en mesure de soumettre aujourd’hui aux Conseils des documents précieux sur la question dont ils sont saisis.
Quoi qu’il en soit, le premier moyen de relever notre marine, l’admission des bâtiments en fer de construction étrangère, est d’une efficacité incontestable, puisqu’il donnerait aux armateurs de Bordeaux, de Nantes et du Havre des navires qui leur reviendraient au même prix qu’aux armateurs de Liverpool, de Londres et de Bristol.
Il est d’une exécution facile. Il ne complique en rien les opérations de la douane ; il ne blesse pas ce qu’on nomme les droits acquis, ni ceux des constructeurs, puisque ce genre d’industrie n’a pour ainsi dire pas encore chez nous d’existence sérieuse ; ni ceux des maîtres de forges, puisque le fer ainsi introduit ne ferme aucun débouché à notre production métallurgique, n’en diminue pas l’emploi actuel et ne peut par conséquent en affecter le prix.
Le second moyen, l’admission en franchise de droits du fer destiné à la construction, a-t-il les mêmes avantages ? ne présente-t-il pas de graves inconvénients ?
On a déjà vu que, tout en le proposant, le Moniteur s’était chargé de démontrer sa disproportion avec le but qu’on a en vue.
Non-seulement il est illusoire, mais il ouvre à l’industrie un avenir si effrayant, que je me vois forcé, afin que le public ne soit pas pris au dépourvu, d’invoquer encore un moment son attention.
Je suis surpris qu’on ne soit pas frappé, comme je le suis moi-même, des tendances vraiment exorbitantes et dangereuses dans lesquelles la France laisse s’engager l’administration des douanes.
Certes, c’était bien assez que cette institution, d’abord purement fiscale, se fût convertie en un instrument soi-disant de protection, en réalité de priviléges et de monopoles. Dès lors les travailleurs se sont aussi transformés en solliciteurs ; ils ont assailli le gouvernement pour lui arracher la faculté de rançonner la nation, comme les quêteurs de places l’assiègent pour acquérir le droit d’exploiter le budget. Et le pouvoir, détourné de sa véritable et simple mision, qui est de garantir à chacun sa liberté, sa sûreté et sa propriété, s’est vu chargé encore de l’effroyable tâche de satisfaire à toutes les prétentions des classes laborieuses, d’assurer à chaque industrie les moyens de se soutenir et de se développer, et cela par le jeu des tarifs, par des combinaisons de taxes, par l’octroi à quelques-uns de ce qu’il parvient à arracher à tous.
Cependant la douane, obéissant à de fausses notions dont elle n’est pas responsable, puisqu’elle les reçoit du public, procédait au moins à son œuvre nouvelle par mesures générales et uniformes, lorsqu’il y a trois ans, elle déposa dans le traité belge le funeste germe des droits différentiels. À partir de cette époque, il fut établi en principe que les taxes d’importation pourraient varier selon les pays de provenance, selon le cours des denrées dans chacun de ces pays, selon leur distance, ou même, qu’on me passe l’expression, selon la température des passions, des animosités et des jalousies nationales. Ainsi la douane n’a plus borné ses prétentions à être un instrument de protection, elle est devenue une arme offensive, un moyen politique d’agression. Elle a dit à un peuple : « Tu es ami, nous admettrons tes produits à des conditions modérées, » à un autre : « Nous te haïssons, notre marché te sera fermé. » Qui ne voit combien ce caractère hostile imprimé à la douane augmente les chances de guerre, déjà si nombreuses, que les tarifs recèlent dans leur sein ? Qui ne comprend que ce sont les factions désormais qui se combattront sur le terrain des questions douanières ? Qui ne s’aperçoit avec effroi qu’un nouvel horizon a été ouvert à de diaboliques alliances entre les cupidités industrielles et les intrigues politiques ?
Voici maintenant que les droits de douane varieront, non plus seulement selon les pays de provenance, mais encore suivant la destination de la marchandise.
Voyez comme s’élargit insensiblement le rôle du douanier !
D’abord, il n’avait qu’une question à adressera la marchandise : « Qu’es-tu ? » Sur la réponse il prélevait la taxe, et tout était dit.
Plus tard, le dialogue s’est étendu à deux questions : « Qu’es-tu? — Du fil. — D’où viens-tu ? — Que t’importe ? — Il m’importe que si tu viens de Bruxelles, tu payeras dix ; et si tu arrives de Manchester, tu payeras trente. » C’était bien le moins qu’on pût accorder à la ligue du monopole avec l’anglophobie.
Maintenant voici que le douanier aura droit à trois interrogations : « Qu’es-tu? — Du fer. — D’où viens-tu ? car le droit varie selon que la nature t’avait déposé dans les mines du Westergothland ou dans celles du Cornouailles. — Je viens du Cornouailles. — À quoi es-tu destiné ? car le droit varie encore suivant que tu vas devenir navire ou charrue. »
Ainsi la douane gagne tous les jours du terrain. De fiscale qu’elle était, elle s’est faite protectrice, puis diplomate, ensuite industrielle. La voilà qui va s’immiscer dans tous nos travaux, se faire juge de leur importance relative ; non plus par des mesures générales, mais par une inquisition de détails qui ira jusqu’à nous demander compte de l’emploi de tous les matériaux que nous aurons à mettre en œuvre.
Mais laissons de côté ce principe exorbitant et nouveau qu’on veut introduire dans nos tarifs ; fermons les yeux au vaste horizon qu’il ouvre à la douane. A-t-on du moins songé aux difficultés de l’exécution ? Si les droits d’entrée varient pour chaque marchandise, en raison de l’infinie variété de ses usages, il faudra donc que la douane ait l’œil sur elle dans toutes ses transformations. Il faudra donc qu’elle pénètre dans le chantier du constructeur, qu’elle s’y installe jour et nuit, qu’elle y dresse sa tente, qu’elle constate les déchets et les manquants, en un mot, il faudra qu’elle soit armée de l’exercice avec son cortège d’entraves, de mesures préventives, d’acquits-à-caution, de laissez-passer, de passavants, de passe-debout, que sais-je ? Pour peu que le principe s’étende à d’autres matériaux, nos ateliers, nos magasins, nos bureaux, nos livres même ne devront plus avoir de secrets pour MM. les employés ; nos maisons, nos armoires, nos chambres n’auront plus pour eux de verrous ni de serrures ; une autre institution méritant bien le titre énergique de droits-réunis pèsera sur la France ; la législation qui régit les débitants de boissons, de spéciale qu’elle est, deviendra générale, et nous serons tous ainsi ramenés à cette égalité devant la loi si chère au prédécesseur du ministre actuel des finances, laquelle aura pour niveau commun la condition du cabaretier [2]. (V. p. 243.)
Qu’on ne dise pas que ces craintes sont exagérées. Je défie qu’on me prouve que l’on peut faire pénétrer dans les tarifs le principe des droits variables selon la destination de la marchandise, sans investir aussitôt la douane de l’exercice, ou de quelque chose de semblable sous un autre nom.
Messieurs les conseillers généraux des manufactures et du commerce, messieurs les simples conseillers de l’agriculture, vous êtes presque tous des hommes du Nord ; vous n’avez guère à vous débattre sous l’inquisition des droits réunis ; vous savez à peine ce que c’est. Prenez garde que la douane ne se charge un jour de vous l’apprendre, et ne méprisez pas ce cri d’alarme qui s’élève dans un pays parfaitement instruit par l’expérience.
Je conclus, 1° que ce qu’il y aurait de mieux à faire, sans se préoccuper des intérêts de la marine plus que de ceux de l’agriculture et des fabriques, ce serait d’abaisser les droits sur le fer étranger quelle que fût sa destination. Ce n’est pas à la douane, c’est à l’industrie de demander, comme le statuaire de la fable :
Sera-t-il dieu, table ou cuvette ?
2° Que si l’on veut favoriser notre marine marchande, le moyen le plus simple est de permettre à nos armateurs d’acheter des navires en fer et même en bois, au meilleur marché possible, dans tous les chantiers du monde.
3° Que la libre admission du fer destiné à la construction est une mesure qui n’a qu’un bon côté, qui est d’être la plus sanglante satire que l’on puisse faire du régime prohibitif ; car elle implique l’aveu que ce régime a paralysé notre marine, et il n’y a aucune raison pour ne pas reconnaître qu’il a exercé la même influence sur l’ensemble de toutes nos industries. Mais, relativement au but cherché, cette mesure est complétement inefficace ; elle a en outre l’immense inconvénient de compliquer nos tarifs, et de déposer dans le terrain de la douane le germe dangereux de l’exercice, germe que l’atmosphère bureaucratique ne manquera pas de développer rapidement.
FN:Par une circulaire de 1845, M. Cunin-Gridaine, ministre du commerce, interrogeait les Conseils généraux sur diverses modifications à introduire dans nos lois. L’une des questions posées était relative à l’importation du fer. C’est à l’occasion de celle-ci que F. Bastiat publia les réflexions suivantes dans le n° de décembre 1845 du Journal des Économistes. (Note de l’éditeur.)
FN:Lorsque M. Humann empirait d’année en année le sort des propriétaires de vignes, il disait : « De quoi se plaignent ces messieurs ? relativement à celle des cabaretiers, leur condition est privilégiée, et la Charte me fait un devoir de faire triompher le principe de l’égalité. »
D’autres questions soumises aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce, en 1845 [c. dec. 1845] ↩
BWV
1845.?? “D’autres questions soumises aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce, en 1845” (Other Questions submitted to the General Councils of Agriculture, Manufactures, and Commerce, in 1845) [OC7.5, p. 20]
D’autres questions soumises aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce [1]
Je me suis laissé entraîner par le premier sujet qui est tombé sous ma plume, et il me reste peu d’espace à donner aux autres questions posées par M. le Ministre. Je ne terminerai pas cependant sans en dire quelques mots.
Certes, je m’attends à ce que le développement illimité qu’on paraît vouloir donner à la Douane soit rétorqué contre l’École Économiste. « Vous repoussez la mesure, dira-t-on, parce qu’elle accroît d’une manière exorbitante l’intervention du Pouvoir dans l’Industrie, et c’est précisément pour cela que nous l’appuyons. Ne fût-elle pas très bonne en elle-même, elle a au moins cette heureuse tendance d’agrandir le rôle de l’État, et vous savez bien que le Progrès, suivant la mode du jour, n’est autre chose que l’absorption successive de toutes les activités individuelles dans la grande activité collective ou gouvernementale. »
Je sais en effet que telle est la tendance irréfléchie de l’époque. Je sais qu’il faut observer pour comprendre l’organisation naturelle de la société et qu’il est plus court d’imaginer des organisations artificielles. Je sais qu’il n’est plus un jeune Rhétoricien, échappé aux étreintes de Salluste et de Tite-Live, qui n’ait inventé son ordre social, qui ne se croie de la force de Minos et de Lycurgue, et je comprends que, pour obliger les hommes à porter docilement le joug de la félicité publique, il faut bien qu’ils commencent par les dépouiller de toute liberté et de toute volonté. Une fois l’État maître de tout, il ne s’agira plus que de se rendre maître de l’État. Ce sera l’objet d’une lutte entre MM. les fourriéristes, communistes, saint-simoniens, humanitaires et fraternitaires. Quelle secte demeurera maîtresse du terrain ? Je l’ignore ; mais, n’importe laquelle, ce qu’il y a de sûr, c’est que nous lui devrons une organisation d’où la liberté sera soigneusement exclue, car toutes, malgré les abîmes qui les séparent, ont au moins en commun cette devise empruntée à notre grand chansonnier : [23]
Mon cœur en belle haine
A pris la liberté.
Fi de la liberté !
À bas la liberté !
À force de bruit, ces écoles sont enfin parvenues à pousser leurs idées jusque dans les hautes régions administratives, comme le prouvent quelques-unes des questions adressées aux conseils par M. le Ministre du commerce.
« L’insuffisance du crédit agricole, dit la circulaire, et l’' absence d’institutions propres à en favoriser le développement méritent également toute l’attention des conseils comme elles excitent la sollicitude du Gouvernement. »
Proclamer l’insuffisance du crédit agricole, c’est avouer que les capitalistes ne recherchent pas cet emploi de leurs fonds ; et comme, en matière de placements, leur sagacité n’est pas douteuse, c’est de plus avouer que le prêt ne rencontre pas dans l’agriculture les avantages qu’il trouve ailleurs. Donc, de l’insuffisance du crédit agricole, ce à quoi il faut conclure ce n’est pas l’absence d’institutions propres à le favoriser, mais bien la présence d’institutions propres à le contrarier. Cela séduit moins les imaginations vives. Il est si doux d’inventer ! Le rôle d’Organisateur, de Père des nations a tant de charmes ! surtout quand il vous ouvre la chance de disposer un jour des capitaux et des capitalistes ! Mais que l’on y regarde de près ; on trouvera peut-être qu’il y a, en fait de crédit agricole, plus d’obstacles artificiels à détruire que d’institutions gouvernementales à fonder.
Car que le développement en ait été, sous beaucoup de rapports, législativement arrêté, c’est ce qu’on ne peut pas mettre en doute. — C’est d’abord l’impôt qui, par son exagération, empêche les capitaux de se former dans nos campagnes. — C’est ensuite le crédit public qui, après avoir attiré à lui les capitaux par l’appât de nombreux et injustes priviléges, les dissipe bien souvent aux antipodes ou par de là l’Atlas, sans qu’il en revienne autre chose au public qu’une rente perpétuelle à payer. — Il y a de plus les lois sur l’usure qui, agissant contre leur but intentionnel, font obstacle à l’égale diffusion et au nivellement de l’intérêt. — Il y a encore le régime hypothécaire imparfait, procédurier et dispendieux. — Il y a enfin le Système protecteur qui, on peut le dire sans exagération, a jeté la France hors de ses voies et substitué à sa vie naturelle une vie factice, précaire, qui ne se soutient que par le galvanisme des tarifs.
Ce dernier sujet est très vaste. Je ne puis le traiter ici ; mais on me pardonnera quelques courtes observations.
Les classes agricoles ne sont certainement pas les moins âpres elles moins exigeantes en fait de protection. Comment ne s’aperçoivent-elles pas que c’est la Protection qui les ruine ?
Si les capitaux, en France, eussent été abandonnés à leur tendance propre, les verrait-on se livrer, comme ils font, à l’imitation britannique ? Suffit-il que les capitaux anglais trouvent un emploi naturel dans des mines inépuisables, pour que les nôtres aillent s’engouffrer dans des mines dérisoires ? Parce que les Anglais exploitent avantageusement le fer et le feu dont les éléments abondent dans leur île, est-ce une raison pour que nous persistions à avoir chez nous, bon gré malgré, du fer et du feu, en négligeant la terre, l’eau et le soleil, qui sont les dons que la nature avait mis à notre portée ? Ce n’est pas leur gravitation qui pousse ainsi nos capitaux hors de leur voie, c’est l’action des tarifs ; car l’anglomanie peut bien envahir les esprits, mais non les capitaux. Pour les engager et les retenir dans cette carrière de stériles et ineptes singeries, où une perte évidente les attendait, il a fallu que la Loi, sous le nom de Tarifs, imposât au public des taxes suffisantes pour transformer ces pertes en bénéfices. — Sans cette funeste intervention de la Loi, il ne faudrait pas aujourd’hui demander à des institutions artificielles un crédit agricole qu’ont détruit d’autres institutions artificielles. La France serait la première nation agricole du monde. Pendant que les capitaux anglais auraient été chercher pour nous de la houille et du fer dans les entrailles de la terre, pendant que pour nous, ils auraient fait tourner des rouages et fumeries obélisques du Lancastre, les nôtres auraient distribué sur notre sol privilégié les eaux de nos magnifiques rivières. L’Océan n’engloutirait pas les richesses incalculables qui s’écoulent dans le lit de nos fleuves sans laisser à nos champs desséchés la moindre trace de leur passage. Le vigneron ne maudirait pas le soleil qui prépare sur nos coteaux une ruineuse abondance. Nous aurions moins de broches et de navettes en mouvement, mais plus de gras troupeaux sur de plus riches pâturages ; moins de prolétaires dans les faubourgs de nos villes, mais plus de robustes laboureurs dans nos campagnes. L’agriculture n’aurait pas à déplorer non seulement que les capitaux lui soient soustraits pour recevoir, de par les tarifs, une autre destination, mais encore qu’ils ne puissent couvrir les pertes qu’ils subissent dans ces carrières privilégiées qu’au moyen d’une cherté factice qui lui est, toujours de par les tarifs, imposée à elle-même. Encore une fois, nous aurions laissé à nos frères d’outre-Manche le fer et le feu, puisque la nature l’a voulu ainsi, et gardé pour nous la terre, l’eau et le soleil, puisque la Providence nous en a gratifiés. Au lieu de nous exténuer dans une lutte insensée, ridicule même, dont l’issue doit nécessairement tourner à notre confusion, puisque l’invincible nature des choses est contre nous, nous adhérerions à l’heure qu’il est à l’Angleterre par la plus puissante des cohésions, la fusion des intérêts ; nous l’inonderions, pour son bien, de nos produits agricoles ; elle nous envahirait, pour notre avantage, par ces mêmes produits auxquels elle aurait donné, plus économiquement que nous, la façon manufacturière ; l’entente cordiale, non celle des ministres mais celle des peuples, serait fondée et scellée à jamais. Et pour cela que fallait-il ? Prévoir ? non, les capitaux ont leur prévoyance plus sûre que celle des hommes d’État ; régenter ? gouverner ? encore moins, mais laisser faire. Le mot n’est pas à la mode. Il est un peu collet monté. Mais les modes ont leur retour, et quoiqu’il soit téméraire de prophétiser, j’ose prédire qu’avant dix ans, il sera la devise et le cri de ralliement de tous les hommes intelligents de mon pays.
Donc, qu’on cherche à faire revivre le crédit agricole en corrigeant les institutions qui l’ont détruit, rien de mieux. Mais qu’on le veuille fonder directement, par des institutions spéciales, c’est ce qui me paraît au moins chimérique.
Ces capitaux dont vous voulez gratifier l’agriculture, d’où les tirerez-vous ? Votre astrologie financière les fera-t-elle descendre de la lune ? ou les extrairez-vous par une moderne alchimie des votes du Parlement ? La Législation vous offre-t-elle aucun moyen d’ajouter une seule obole au capital que le travail actuel absorbe ? Non ; les cent volumes du Bulletin des lois suivis de mille autres encore ne peuvent vous investir tout au plus que du pouvoir de le détourner d’une voie pour le pousser dans une autre. Mais si celle où il est aujourd’hui engagé est la plus profitable, quel secret avez-vous de déterminer ses préférences pour la perte et ses répugnances pour le bénéfice ? Et si c’est la carrière où vous voulez l’attirer qui est la plus lucrative, qu’a-t-il besoin de votre intervention ?
Vraiment, il me tarde de voir ces institutions à l’œuvre. Après avoir forcé le capital, par l’artifice des tarifs, à déserter l’agriculture pour affluer vers les fabriques, avertis par l’état stationnaire ou rétrograde de nos champs, vous reconnaissez votre faute, et que proposez-vous ? De modifier les tarifs ? Pas le moins du monde. Mais de faire refluer le capital des fabriques vers l’agriculture par l’artifice des banques ; en sorte que ce génie organisateur qui se donne tant de mal aujourd’hui pour faire marcher cette pauvre société qui marcherait bien toute seule, se borne à la surcharger de deux institutions inutiles, d’un tarif agissant en sens inverse de la banque, et d’une banque neutralisant les effets du tarif !…
Mais allons plus loin. Supposons le problème résolu comme on dit à l’École. Voilà vos agents tout prêts, votre bureaucratie toute montée, votre caisse établie ; et le public bénévole y verse le capital à flots, heureux (il est bien de cette force) de vous livrer son argent sous forme d’impôts, dans l’espoir que vous le lui rendrez à titre de prêt. Voilà qui va bien ; fonctionnaires et public, tout le monde est content, l’opération va commencer. — Oui, mais voici une difficulté imprévue. Vous entendez veiller sans doute à ce que les fonds prêtés à l’agriculture reçoivent une destination raisonnable, qu’ils soient consacrés à des améliorations agricoles qui les reproduisent ; car si vous alliez les livrer à de petits propriétaires affamés qui en acquitteraient leurs douzièmes ou à des fermiers besoigneux pour payer leur fermage, ils seraient bientôt consommés sans retour. Si votre caisse avance des capitaux indistinctement et sans s’occuper de l’emploi qui en sera fait, votre belle institution de crédit courra grand risque de devenir une détestable institution d’aumône. Si au contraire L’État veut suivre dans toutes ses phases le capital distribué à des millions de paysans, afin de s’assurer qu’il est consacré à une consommation reproductive, il faudra un garnisaire comptable par chaque ferme, et voici reparaître, aux mains de je ne sais quelle administration nouvelle, cette puissance inquisitoriale qui est l’apanage des Droits réunis et menace de devenir bientôt celui de la Douane.
Ainsi, de tous côtés nous arrivons à ce triste résultat : ce qu’on nomme Organisation du travail ne cache trop souvent que l’Organisation de la Bureaucratie, végétation parasite, incommode, tenace, vivace, que l’industrie doit bien prendre garde de ne pas laisser attacher à ses flancs.
Après avoir manifesté sa sollicitude pour les agriculteurs, M. le Ministre se montre, avec grande raison, fort soucieux du sort des ouvriers. Qui ne rendrait justice au sentiment qui le guide ? Ah ! si les bonnes intentions y pouvaient quelque chose, certes, les classes laborieuses n’auraient plus rien à désirer. À Dieu ne plaise que nous songions à nous élever contre ces généreuses sympathies, contre cette ardente passion d’égalité qui est le trait caractéristique de la littérature moderne ! Et nous aussi, qu’on veuille le croire, nous appelons de tous nos vœux l’élévation de toutes les classes à un commun niveau de bien-être et de dignité. Ce ne sont pas les bonnes intentions qui nous manquent, c’est l’exécution qui nous préoccupe. Nous souhaitons, comme nos frères dissidents, que notre marine et notre commerce prospèrent, que nos laboureurs ne soient jamais arrêtés faute de capital, que nos ouvriers soient abondamment pourvus de toutes choses, du nécessaire, du confortable et même du superflu. Malheureusement, n’ayant en notre pouvoir ni une baguette magique ni une conception organisatrice qui nous permette de verser sur le monde un torrent de capitaux et de produits, nous sommes réduit à attendre toute amélioration dans la condition des hommes, non de nos bonnes intentions et de nos sentiments philanthropiques, mais de leurs propres efforts. Or nous ne pouvons concevoir aucun effort sans vue d’avenir, ni aucune vue d’avenir sans prévoyance. Toute institution qui tend à diminuer la prévoyance humaine ne nous semble conférer quelque bien au présent que pour accumuler des maux sans nombre dans l’avenir ; nous la jugeons antagonique au principe même de la civilisation; et, pour trancher le mot, nous la croyons barbare. C’est donc avec une extrême surprise que nous avons vu dans la circulaire ministérielle la question relative au sort des ouvriers formulée de la manière suivante :
« Ainsi que l’agriculture, l’industrie a de graves intérêts en souffrance ; la situation des ouvriers hors d’état de travailler est souvent malheureuse : elle est toujours précaire. L’opinion publique s’en est préoccupée à juste titre, et le Gouvernement a cherché dans les plans proposés les moyens d’y porter remède. Malheureusement rien jusqu’à ce jour n’a paru pouvoir suppléer la prévoyance privée. Aucune question n’est plus digne de la sollicitude des conseils. Ils rechercheront quelles caisses de secours ou de retraite ou quelles institutions peuvent être fondées pour le soulagement des travailleurs invalides. »
Si l’on ne devait pas admettre que tout est sérieux dans un document de cette nature, on serait tenté de croire que M. le Ministre a voulu tout à la fois embarrasser les conseils, en les mettant en présence d’une impasse, et décocher une épigramme contre tous ces plans d’organisation sociale que chaque matin voit éclore.
Est-ce bien sérieusement que vous demandez l’amélioration des classes laborieuses à des institutions qui les dispensent de Prévoyance ? Est-ce bien sincèrement que vous déplorez le malheur de n’avoir pas encore imaginé de telles institutions ?
Suppléer la Prévoyance ! mais c’est suppléer l’épargne, l’aliment nécessaire du travail ; en même temps que renverser la seule barrière qui s’oppose à la multiplication indéfinie des travailleurs. C’est augmenter l’offre et diminuer la demande des bras, en d’autres termes combiner ensemble l’action des deux plus puissantes causes qu’on puisse assigner à la dépression des salaires !
Suppléer la Prévoyance ! mais c’est suppléer la modération, le discernement, l’empire sur les passions, la dignité, la moralité, la raison, la civilisation, l’homme même, car peut-elle porter le nom d’homme, la créature qui n’a plus rien à démêler avec son avenir ?
Sans la Prévoyance, peut-on concevoir la moralité qui n’est autre chose que le sacrifice du présent à l’avenir ?
Sans la Prévoyance, peut-on concevoir la civilisation ? Anéantissez par la pensée tout ce que la Prévoyance a préparé et accumulé sur le sol de la France, et dites-moi en quoi elle différera des forêts américaines, empire du buffle et du sauvage ?
Mais, dira-t-on, il n’est pas question de supprimer la Prévoyance, mais de la transporter de l’homme à l’institution. Je voudrais bien savoir comment les institutions peuvent être prévoyantes quand les hommes qui les conçoivent, les soutiennent, les appliquent et les subissent ne le sont pas.
Les institutions n’agissent pas toutes seules. Vous admettez du moins que cette noble faculté de prévoir devra se réfugier dans les hautes régions administratives. — Eh bien ! qu’aurez-vous ajouté à la dignité de la race humaine, en quoi aurez-vous augmenté ses chances de bonheur, qu’aurez-vous fait pour le rapprochement des conditions, pour l’avancement du principe de l’Égalité et de la Fraternité parmi les hommes, quand la Pensée sera dans le Gouvernement et l’abrutissement dans la multitude ?
Qu’on ne se méprenne pas à nos paroles. Nous ne blâmons pas M. le Ministre d’avoir saisi les conseils d’une question grave qui, comme il le dit, préoccupe avec raison l’opinion publique.
Seulement, nous croyons que c’est dans des institutions propres à développer la prévoyance privée, et non à la suppléer, que se trouve la solution rationnelle du problème.
Nous n’attachons pas plus d’importance qu’il ne faut à quelques expressions hétérodoxes, échappées sans doute à l’auteur de la circulaire, et qui très probablement ne répondent pas à sa pensée. Si cependant nous avons cru devoir les relever, c’est que, comme on a pu en juger par l’accueil qu’elles ont reçu de certains journaux, elles ont paru donner une sorte de consécration à cette voie déplorable où l’opinion n’a que trop de pente à s’engager.
FN:Lorsque Bastiat écrivait un article, une fois sa tâche faite et le manuscrit livré à l’éditeur, il n’y pensait guère et n’en parlait plus. Les lignes que nous allons reproduire devaient faire suite, dans le Journal des Économistes, à l’article intitulé : Une question soumise aux Conseils généraux, etc. (Voir Œuvres complètes, t. Ier, p. 392 et suiv.) Mais, restées inédites par suite d’une omission contre laquelle l’auteur n’a pas réclamé, elles n’ont été remises dans mes mains que postérieurement à 1855. (Note de l’édit.)
La Ligue anglaise et la Ligue allemande. Réponse à la Presse[décembre 1845]↩
BWV
1845.12.15 “La Ligue anglaise et la Ligue allemande. Réponse à la Presse” (The English Free Trade League and the German League) [*Journal des Économistes*, décembre 1845] [OC2.26, 141]
La Ligue Anglaise et la Ligue Allemande
Réponse à la Presse, publiée dans le Journal des Économistes de décembre 1845.
La Ligue anglaise représente la liberté, la Ligue allemande la restriction. Nous ne devons pas être surpris que toutes les sympathies de la Presse soient acquises à la Ligue allemande.
« Les États, dit-elle, qui composent aujourd’hui l’association allemande, ont-ils à se féliciter du système qu’ils ont adopté en commun ?… Si les résultats sont d’une nature telle que l’Allemagne, encouragée par les succès déjà obtenus, ne puisse que persévérer dans la voie où elle est entrée, alors nécessairement le système de la Ligue anglaise repose sur de grandes illusions…
Or, voyez les résultats financiers… D’année en année le progrès est sensible et doublement satisfaisant : les frais diminuent, les recettes augmentent ;… la masse de la population est soulagée,… etc.
Les résultats économiques ne sont pas moins significatifs. De grandes industries ont été fondées ; de nombreux emplois ont été créés pour les facultés physiques et pour l’intelligence des classes pauvres ; d’abondantes sources de salaires se sont ouvertes ; la population s’est accrue ; la valeur de la propriété foncière s’est élevée ; etc.
Enfin, les résultats politiques se manifestent à tous les yeux,… etc. »
Après ce dithyrambe, la conclusion ne pouvait être douteuse.
« L’ensemble des faits acquis prouve que la pensée du Zollverein a été une pensée éminemment féconde ;… que la combinaison des tarifs adoptés parle Zollverein a été favorable au développement de la prospérité intérieure. Nous en concluons que les principes qui ont présidé à l’organisation du Zollverein ne sont pas près d’être répudiés ; qu’ils ne peuvent au contraire qu’exercer une influence contagieuse sur les autres parties du continent européen, et que, par conséquent, les doctrines de la Ligue anglaise risquent de rencontrer, dans le mouvement des esprits au dehors, des obstacles de plus en plus insurmontables… »
Nous ferons observer que la Presse a tort de parler de la pensée du Zollverein, car le Zollverein n’a pas eu qu’une pensée, il en a eu deux, et, qui plus est, deux pensées contradictoires : une pensée de liberté et une pensée de restriction. Il a entravé les relations des Allemands avec le reste des hommes, mais il a affranchi les relations des Allemands entre eux. Il a exhaussé la grande barrière qui ceint l’Association, mais il a détruit les innombrables barrières qui circonscrivaient chacun des associés. Tel État, par exemple, a vu s’accroître les difficultés de ses relations par sa frontière méridionale, mais s’aplanir les obstacles qu’elles rencontraient jusqu’alors sur ses trois autres frontières. Pour les États enclavés, le cercle dans lequel ils peuvent se mouvoir librement a été considérablement élargi.
Le Zollverein a donc mis en action deux principes diamétralement opposés. Or, il est clair que l’Allemagne ne peut attribuer la prospérité qui s’en est suivie à l’œuvre simultanée de deux principes qui se contredisent. Elle a progressé, d’accord ; mais est-ce grâce aux barrières renforcées ou aux barrières renversées ? car, quelque fond que fasse le journalisme sur la crédulité de l’abonné, je ne pense pas qu’il le croie encore descendu à ce degré de niaiserie qu’il faut lui supposer pour oser lui dire en face que oui et non sont vrais en même temps,
L’Allemagne ayant été tirée vers le bien et vers le mal, si le bien l’a emporté, comme on l’établit, il reste encore à se demander s’il faut en remercier l’abolition des tarifs particuliers ou l’aggravation du tarif général. La Presse en attribue toute la gloire au principe de restriction générale : en ce cas, pour être conséquente, elle devait ajouter que le bien a été atténué par le principe de liberté locale. Nous croyons, nous, que l’Allemagne doit ses progrès aux entraves dont elle a été dégagée, et c’est pourquoi nous concluons qu’ils eussent été plus rapides encore si, à l’œuvre de l’affranchissement, ne s’était pas mêlée une pensée restrictive.
L’argumentation de la Pressekk n’est donc qu’un sophisme de confusion. L’Allemagne avait ses deux bras garrottés ; le Zollverein est survenu qui a dégagé le bras droit (commerce intérieur) et gêné un peu plus le bras gauche (commerce extérieur) ; dans ce nouvel état elle a fait quelque progrès. « Voyez, dit la Presse, ce que c’est pourtant que de gêner le bras gauche ! » Et que ne nous montre-t-elle le bras droit ?
Faut-il être surpris de voir la Presse, en cette occasion, confondre les effets de la liberté et du monopole ? L’absence de principes, ou, ce qui revient au même, l’adhésion à plusieurs principes qui s’excluent, semble être le caractère distinctif de cette feuille, et il n’est pas invraisemblable qu’elle lui doit une partie de sa vogue. Dans ce siècle de scepticisme, en effet, rien n’est plus propre à donner un vernis de modération et de sagesse. « Voyez la Presse, dit-on, elle ne s’enchaîne pas à un principe absolu, comme ces hommes qu’elle appelle des songe-creux ; elle plaide le pour et le contre, la liberté et la restriction, selon les temps et l’occurrence. »
Pendant longtemps encore cette tactique aura des chances de succès ; car, au milieu du choc des doctrines, le grand nombre est disposé à croire que la vérité n’existe pas. — Et pourtant elle existe. Il est bien certain qu’en matière de relations internationales, elle se trouve dans cette proposition : Il vaut mieux acheter à autrui ce qu’il en coûte plus cher de faire soi-même. — Ou bien dans celle-ci : Il vaut mieux faire les choses soi-même, encore bien qu’il en coûte moins cher de les acheter à autrui.
Or, la Presse raisonne sans cesse comme si chacune de ces propositions était tour à tour vraie et fausse. L’article auquel je réponds ici offre un exemple remarquable de cette cacophonie.
Après avoir félicité le Zollverein des grands résultats qu’il a obtenus par la restriction, elle le blâme de restreindre l’importation du sucre, et ses paroles méritent d’être citées :
« Ç’a été, de la part de l’Association, une grande faute de laisser prendre un développement si marqué, chez elle, au sucre de betterave… Si elle n’avait pas cédé à la tentation de fabriquer elle-même son sucre, elle aurait pu établir, avec le continent américain et avec une portion de l’Asie, de relations très-profitables… Pour s’assurer ces relations fécondes, l’Allemagne était placée dans une position unique ; elle avait le bonheur de ne posséder aucune colonie ; par conséquent, elle échappait à la nécessité de créer des monopoles. Elle était libre d’ouvrir son marché à tous les pays de vaste production sucrière, au Brésil, aux colonies espagnoles, aux Indes, à la Chine ; et Dieu sait la masse énorme de produits qu’elle aurait exportés comme contre-valeur de ces sucres exotiques, que ces populations auraient pu consommer à des prix fabuleusement bas. Cette magnifique chance, elle l’a perdue le jour où elle s’est mis en tête de faire sur son propre sol du sucre de betterave. »
Y a-t-il dans ce passage un argument, un mot qui ne se retourne contre toutes les restrictions imaginables qui ont pour but de protéger le travail, de provoquer la création de nouvelles industries ; restrictions dont le but général de l’article est de favoriser sur le continent l’influence contagieuse ?
Je suppose qu’il s’agisse de l’industrie métallurgique en France.
Vous dites : « L’Allemagne a commis une grande faute de laisser prendre un développement si marqué, chez elle, au sucre de betterave. »
Et moi, je dis : « La France a commis une grande faute de laisser prendre un développement si marqué, chez elle, à la production du fer. »
Vous dites : « Si l’Allemagne n’avait pas cédé à la tentation de fabriquer elle-même son sucre, elle aurait pu établir, avec le continent américain et une partie de l’Asie, des relations très-profitables. »
Et moi, je dis : « Si la France n’avait pas cédé à la tentation de fabriquer elle-même son fer, elle aurait pu établir, avec l’Espagne, l’Angleterre, la Belgique, la Suède, des relations très-profitables. »
Vous dites : « L’Allemagne était libre d’ouvrir son marché à tous les pays de vaste production sucrière, et Dieu sait la masse énorme de produits qu’elle aurait exportés comme contre-valeur de ces sucres exotiques, que sa population aurait consommés à des prix fabuleusement bas. »
Et moi, je dis: « La France était libre d’ouvrir son marché à tous les pays de vaste production métallurgique, et Dieu sait la masse énorme de produits qu’elle aurait exportés comme contre-valeur de ces fers exotiques, que sa population aurait consommés à des prix fabuleusement bas. »
Vous dites : « Cette magnifique chance, l’Allemagne l’a perdue le jour où elle s’est mis en tête défaire sur son propre sol du sucre de betterave. »
Et moi, je dis : « Cette magnifique chance, la France l’a perdue le jour où elle s’est mis en tête de faire chez elle tout le fer dont elle a besoin. »
Ou si, revenant à vos doctrines de prédilection, vous voulez justifier la protection que la France accorde à l’industrie métallurgique, je vous répondrai par les arguments que vous dirigez contre la protection que l’Allemagne accorde à l’industrie sucrière.
Direz-vous que la production du fer est une source de travail pour les ouvriers français ?
J’en dirai autant de la production du sucre pour les ouvriers allemands.
Direz-vous que le travail allemand ne perdrait rien à l’importation du sucre exotique, parce qu’il serait employé à créer la contre-valeur ?
J’en dirai autant du travail français k l’égard de l’importation du fer.
Direz-vous que si les Anglais nous vendent du fer, il n’est pas sûr qu’ils prennent en retour nos articles Paris et nos vins ?
Je vous répondrai que si les Brésiliens vendent du sucre aux Allemands, il n’est pas certain qu’ils reçoivent en échange des produits allemands.
Vous voyez donc bien qu’il y a une vérité, une vérité absolue, et que, comme dirait Pascal, ce qui est vrai au delà ne saurait être faux en deçà du Rhin.
Books and Printed Pamphlets↩
Cobden et la Ligue [1st half 1845]: Introduction by FB ↩
BWV
*Cobden et la Ligue, ou l’agitation anglaise pour la liberté du commerce* (Paris: Guillaumin, 1845). [OC3] [Reviewed in July 1845 edition of JDE, p. 446.]
Also: ”Situation économique de la Grande-Bretagne. Réformes financières. Agitation pour la liberté commerciale," JDE, Juin 1845, T. XI, 233-265. [Extract from intro to Cobden and the League, pp. vii ff.]
Source
<http://fr.wikisource.org/wiki/Cobden_et_la_ligue/Introduction>
[We have translated only those parts of the book (the long introduction and some other shorter pieces) which were written by Bastiat. We have not translated his translations or paraphrasing of speeches and articles of the Anti-Corn League.]
Source
OC vol. 3 Cobden et la ligue (1864 ed.) <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_3.djvu>.
TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME.
Introduction 1
Meeting à Manchester, en octobre 1842. — Discours de M. Cobden 81
Meeting à Londres, 16 mars 1843, théâtre de Drury-Lane. — Discours de M. Cobden 91
Meeting à Londres, 30 mars 1843. — Discours de MM. James Wilson, J. W. Fox et Cobden 96
Meeting à Londres, 5 avril 1843. — Exposé du président ; discours de MM. Hume, Brotherton, Milner Gibson 118
Meeting à Londres, 13 avril 1843. — Discours du D. Bowring 144
Meeting à Londres, 26 avril 1843. — Discours du R. Th. Spencer. 153
Meeting à Londres, 5 mai 1843. — Discours du R. Cox et de M. Cobden 160
Meeting à Londres, 13 mai 1843, salle de l'Opéra. — Discours de M. Cobden 179
Meeting à Londres, octobre 1843, théâtre de Covent-Garden. — Discours de MM. Cobden et J. W. Fox 190
Meetings en Écosse, du 8 au 18 janvier 1844. — Allocutions diverses ; extraits des discours de M. Cobden, à Perth, et du colonel Thompson, à Greenock, etc. 207
Meeting à Londres, 25 janvier 1844, théâtre de Covent-Garden. — Discours de MM. George Wilson et J. W. Fox 223
Meeting à Londres, 1er février 1844. — Compte rendu 236
Banquet à Wakefield (Yorkshire), le 31 janvier 1844. — Allocution du président, M. Marshall, et discours de lord Morpeth et de M, Cobden 238
Meeting à Londres, 15 février 1844. — Discours de MM. Villiers et J. W. Fox 246
Meeting à Londres, 21 février 1844. — Compte rendu ; discours de MM. O’Connell et George Thompson 259
Meeting à Londres, 28 février 1844. — Discours de M. Ashworth 275
Meeting à Londres, 17 avril 1844. — Compte rendu ; discours de M. George Thompson 281
Meeting à Londres, 1er mai 1844. — Discours de MM. Ricardo et Cobden 298
Meeting à Londres, 14 mai 1844. — Discours de MM. Bright et James Wilson 309
Meeting à Londres, 22 mai 1844. — Discours de M. George Thompson 327
Meeting à Londres, 5 juin 1844. — Résumé d'un discours de M. Bouverie, et discours de M. Milner Gibson 343
Exposé du dissentiment sur le tarif des sucres 351
Meeting à Londres, le 19 juin 1844. — Discours du R. Th. Spencer et de MM. Cobden et Fox. Réflexions du traducteur 355
Débat à la Chambre des communes sur la proposition de M. Villiers. — Argument de M. Milner Gibson. — Résumé historique. 384
Meeting à Londres, le 7 août 1844. — Considérations sur l'esprit de paix. — Discours de M. Milner Gibson et de M. Fox 391
Les free-traders et les chartistes à Northampton 403
Démonstrations en faveur de la liberté commerciale à Walsall. — Présentation d’une coupe à M. John B. Smith 404
Grand meeting de la Ligue au théâtre de Covent-Garden, 17 décembre 1844. — Discours de M. Cobden 409
Meeting général de la Ligue à Manchester, 22 janvier 1845. Discours de M. J. Bright 420
Interrogatoire de Jacques Deacon Hume, esq., ancien secrétaire du Board of trade, sur la loi des céréales, devant le comité de la Chambre des communes chargé de préparer le projet de loi relatif aux droits d'importation pour 1839 430
Appendice
Fin de la première campagne de la Ligue anglaise 437
Seconde campagne de la Ligue 449
Deux Angleterre 459
Meeting du 26 janvier 1848, à Manchester. — Discours de MM. Milner Gibson, Cobden et J. Bright 463
Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849 492
La réforme coloniale en Angleterre. — Discours de M. Cobden à Bradford 497
Discours de John Russell au Parlement 508
Bastiat’s Introduction to Cobden et la Ligue. ↩
Source
<http://fr.wikisource.org/wiki/Cobden_et_la_ligue/Introduction>
La personne la plus exposée à se faire illusion sur le mérite et la portée d’un livre, après l’auteur, c’est certainement le traducteur. Peut-être n’échappé-je pas à cette loi, car je n’hésite pas à dire que celui que je publie, s’il obtenait d’être lu, serait pour mon pays une sorte de révélation. La liberté, en matière d’échanges, est considérée chez nous comme une utopie ou quelque chose de pis. On accorde bien, abstraitement, la vérité du principe ; on veut bien reconnaître qu’il figure convenablement dans un ouvrage de théorie. Mais on s’arrête là. On ne lui fait même l’honneur de le tenir pour vrai qu’à une condition : c’est de rester à jamais relégué, avec le livre qui le contient, dans la poudre des bibliothèques, de n’exercer sur la pratique aucune influence, et de céder le sceptre des affaires au principe antagonique, et par cela même abstraitement faux, de la prohibition, de la restriction, de la protection. S’il est encore quelques économistes qui, au milieu du vide qui s’est fait autour d’eux, n’aient pas tout à fait laissé échapper de leur cœur la sainte foi dans le dogme de la liberté, à peine osent-ils, d’un regard incertain, en chercher le douteux triomphe dans les profondeurs de l’avenir. Comme ces semences recouvertes d’épaisses couches de terre inerte et qui n’écloront que lorsque quelque cataclysme, les ramenant à la surface, les aura exposées aux rayons vivifiants du soleil, ils voient le germe sacré de la liberté enfoui sous la dure enveloppe des passions et des préjugés, et ils n’osent compter le nombre des révolutions sociales qui devront s’accomplir, avant qu’il soit mis en contact avec le soleil de la vérité. Ils ne se doutent pas, ils ne paraissent pas du moins se douter que le pain des forts, converti en lait pour les faibles, a été distribué sans mesure à toute une génération contemporaine ; que le grand principe, le droit d’échanger, a brisé son enveloppe, qu’il s’est répandu comme un torrent sur les intelligences, qu’il anime toute une grande nation, qu’il y a fondé une opinion publique indomptable, qu’il va prendre possession des affaires humaines, qu’il s’apprête à absorber la législation économique d’un grand peuple ! C’est là la bonne nouvelle que renferme ce livre. Parviendra-t-elle à vos oreilles, amis de la liberté, partisans de l’union des peuples, apôtres de l’universelle fraternité des hommes, défenseurs des classes laborieuses, sans qu’elle réveille dans vos cœurs la confiance, le zèle et le courage ? Oui, si ce livre pouvait pénétrer sous la froide pierre qui couvre les Tracy, les Say, les Comte, je crois que les ossements de ces illustres philanthropes tressailliraient de joie dans la tombe.
Mais, hélas ! je n’oublie pas la restriction que j’ai posée moi-même : Si ce livre obtient d’être lu. — Cobden ! Ligue ! Affranchissement des échanges ! — Qu’est-ce que Cobden ? Qui a entendu parler, en France, de Cobden ? Il est vrai que la postérité attachera son nom à une de ces grandes réformes sociales qui marquent, de loin en loin, les pas de l’humanité dans la carrière de la civilisation ; la restauration, non du droit au travail, selon la logomachie du jour, mais du droit sacré du travail à sa juste et naturelle rémunération. Il est vrai que Cobden est à Smith ce que la propagation est à l’invention ; qu’aidé de ses nombreux compagnons de travaux, il a vulgarisé la science sociale ; qu’en dissipant dans l’esprit de ses compatriotes les préjugés qui servent de base au monopole, cette spoliation au dedans, et à la conquête, cette spoliation au dehors ; en ruinant ainsi cet aveugle antagonisme qui pousse les classes contre les classes et les peuples contre les peuples, il a préparé aux hommes un avenir de paix et de fraternité fondé, non sur un chimérique renoncement à soi-même, mais sur l’indestructible amour de la conservation et du progrès individuels, sentiment qu’on a essayé de flétrir sous le nom d’intérêt bien entendu, mais auquel, il est impossible de ne pas le reconnaître, il a plu à Dieu de confier la conservation et le progrès de l’espèce ; il est vrai que cet apostolat s’est exercé de notre temps, sous notre ciel, à nos portes, et qu’il agite encore, jusqu’en ses fondements, une nation dont les moindres mouvements ont coutume de nous préoccuper à l’excès. Et cependant, qui a entendu parler de Cobden ? Eh, bon Dieu ! nous avons bien autre chose à faire qu’à nous occuper de ce qui, après tout, ne tend qu’à changer la face du monde. Ne faut-il pas aider M. Thiers à remplacer M. Guizot, ou M. Guizot à remplacer M. Thiers ? Ne sommes-nous pas menacés d’une nouvelle irruption de barbares, sous forme d’huile égyptienne ou de viande sarde ? et ne serait-il pas bien fâcheux que nous reportassions, un moment, sur la libre communication des peuples une attention si utilement absorbée par Noukahiva, Papeïti et Mascate ?
La Ligue ! De quelle Ligue s’agit-il ? L’Angleterre a-t-elle enfanté quelque Guise ou quelque Mayenne ? Les catholiques et les anglicans vont-ils avoir leur bataille d’Ivry ?
L’agitation que vous annoncez se rattache-t-elle à l’agitation irlandaise ? Va-t-il y avoir des guerres, des batailles, du sang répandu ? Peut-être alors notre curiosité serait-elle éveillée, car nous aimons prodigieusement les jeux de la force brutale, et puis nous prenons tant d’intérêt aux questions religieuses ! nous sommes devenus si bons catholiques, si bons papistes, depuis quelque temps.
Affranchissement des échanges ! Quelle déception ! quelle chute ! Est-ce que le droit d’échanger, si c’est un droit, vaut la peine que nous nous en occupions ? Liberté de parler, d’écrire, d’enseigner, à la bonne heure ; on peut y réfléchir de temps en temps, à moments perdus, quand la question suprême, la question ministérielle, laisse à nos facultés quelques instants de répit, car enfin ces libertés intéressent les hommes qui ont des loisirs. Mais la liberté d’acheter et de vendre ! la liberté de disposer du fruit de son travail, d’en retirer par l’échange tout ce qu’il est susceptible de donner, cela intéresse aussi le peuple, l’homme de labeur, cela touche à la vie de l’ouvrier. D’ailleurs, échanger, trafiquer, cela est si prosaïque ! et puis c’est tout au plus une question de bien-être et de justice. Le bien-être ! oh ! c’est trop matériel, trop matérialiste pour un siècle d’abnégation comme le nôtre ! La justice ! oh ! cela est trop froid. Si au moins il s’agissait d’aumônes, il y aurait de belles phrases à faire. Et n’est-il pas bien doux de persévérer dans l’injustice, quand en même temps on est aussi prompt que nous le sommes à faire montre de charité et de philanthropie ?
« Le sort en est jeté, s’écriait Kepler, j’écris mon livre ; on le lira dans l’âge présent ou dans la postérité ; que m’importe ? il pourra attendre son lecteur. » — Je ne suis pas Kepler, je n’ai arraché à la nature aucun de ses secrets ; et je ne suis qu’un simple et très-médiocre traducteur. Et cependant j’ose dire comme le grand homme : Ce livre peut attendre ; le lecteur lui arrivera tôt ou tard. Car enfin, pour peu que mon pays s’endorme quelque temps encore dans l’ignorance volontaire où il semble se complaire, à l’égard de la révolution immense qui fait bouillonner tout le sol britannique, un jour il sera frappé de stupeur à l’aspect de ce feu volcanique… non, de cette lumière bienfaisante qu’il verra luire au septentrion. Un jour, et ce jour n’est pas éloigné, il apprendra, sans transition, sans que rien la lui ait fait présager, cette grande nouvelle : l’Angleterre ouvre tous ses ports ; elle a renversé toutes les barrières qui la séparaient des nations ; elle avait cinquante colonies, elle n’en a plus qu’une et c’est l’univers ; elle échange avec quiconque veut échanger ; elle achète sans demander à vendre ; elle accepte toutes les relations sans en exiger aucune ; elle appelle sur elle l’invasion de vos produits ; l’Angleterre a affranchi le travail et l’échange. — Alors, peut-être, on voudra savoir comment, par qui, depuis combien de temps cette révolution a été préparée ; dans quel souterrain impénétrable, dans quelles catacombes ignorées elle a été ourdie, quelle franc-maçonnerie mystérieuse en a noué les fils ; et ce livre sera là pour répondre : Eh, mon Dieu ! cela s’est fait en plein soleil, ou du moins en plein air (car on dit qu’il n’y a pas de soleil en Angleterre). Cela s’est accompli en public, par une discussion qui a duré dix ans, soutenue simultanément sur tous les points du territoire. Cette discussion a augmenté le nombre des journaux anglais, en a allongé le format ; elle a enfanté des milliers de tonnes de brochures et de pamphlets ; on en suivait le cours avec anxiété aux États-Unis, en Chine, et jusque chez les hordes sauvages des noirs Africains. Vous seuls, Français, ne vous en doutiez pas. Et pourquoi ? Je pourrais le dire, mais est-ce bien prudent ? N’importe ! la vérité me presse et je la dirai. C’est qu’il y a parmi nous deux grands corrupteurs qui soudoient la publicité. L’un s’appelle Monopole, et l’autre Esprit de parti. Le premier a dit : J’ai besoin que la haine s’interpose entre la France et l’étranger, car si les nations ne se haïssaient pas, elles finiraient par s’entendre, par s’unir, par s’aimer, et peut-être, chose horrible à penser ! par échanger entre elles les fruits de leur industrie. Le second a dit : J’ai besoin des inimitiés nationales, parce que j’aspire au pouvoir ; et j’y arriverai, si je parviens à m’entourer d’autant de popularité que j’en arracherai à mes adversaires, si je les montre vendus à un étranger prêt à nous envahir, et si je me présente comme le sauveur de la patrie. — Alors l’alliance a été conclue entre le monopole et l’esprit de parti, et il a été arrêté que toute publicité, à l’égard de ce qui se passe au dehors, consisterait en ces deux choses : Dissimuler, dénaturer. C’est ainsi que la France a été tenue systématiquement dans l’ignorance du fait que ce livre a pour objet de révéler. Mais comment les journaux ont-ils pu réussir ? Cela vous étonne ? — et moi aussi. Mais leur succès est irrécusable.
Cependant, et précisément parce que je vais introduire le lecteur (si j’ai un lecteur) dans un monde qui lui est complétement étranger, il doit m’être permis de faire précéder cette traduction de quelques considérations générales sur le régime économique de la Grande-Bretagne, sur les causes qui ont donné naissance à la Ligue, sur l’esprit et la portée de cette association, au point de vue social, moral et politique.
[section below to p. lxx extract published in JDE juin 1845]
On a dit et on répète souvent que l’école économiste, qui confie à leur naturelle gravitation les intérêts des diverses classes de la société. était née en Angleterre ; et on s’est hâté d’en conclure, avec une surprenante légèreté, que cet effrayant contraste d’opulence et de misère, qui caractérise la Grande-Bretagne, était le résultat de la doctrine proclamée avec tant d’autorité par Ad. Smith, exposée avec tant de méthode par J. B. Say. On semble croire que la liberté règne souverainement de l’autre côté de la Manche et qu’elle préside à la manière inégale dont s’y distribue la richesse.
« Il avait assisté, » disait, ces jours derniers, M. Mignet, en parlant de M. Sismondi, « il avait assisté à la grande révolution économique opérée de nos jours. Il avait suivi et admiré les brillants effets des doctrines qui avaient affranchi le travail, renversé les barrières que les jurandes, les maîtrises, les douanes intérieures et les monopoles multipliés opposaient à ses produits et à ses échanges ; qui avaient provoqué l’abondante production et la libre circulation des valeurs, etc.
Mais bientôt il avait pénétré plus avant, et des spectacles moins propres à l’enorgueillir des progrès de l’homme et à le rassurer sur son bonheur s’étaient montrés à lui, dans le pays même où les théories nouvelles s’étaient le plus vite et le plus complétement développées, en Angleterre où elles régnaient avec empire. Qu’y a avait-il vu ? Toute la grandeur, mais aussi tous les excès de la production illimitée,… chaque marché fermé réduisant des populations entières à mourir de faim, les déréglements de la concurrence, cet état de nature des intérêts, souvent plus meurtrier que les ravages de la guerre ; il y avait vu l’homme réduit à être un ressort d’une machine plus intelligente que lui, entassé dans des lieux malsains où la vie n’atteignait pas la moitié de sa durée, où les liens de famille se brisaient et les idées de morale se perdaient… En un mot, il y avait vu l’extrême misère et une effrayante dégradation racheter tristement et menacer sourdement la prospérité et les splendeurs d’un grand peuple.
Surpris et troublé, il se demanda si une science qui sacrifiait le bonheur de l’homme à la production de la richesse… était la vraie science… Depuis ce moment, il prétendit que l’économie politique devait avoir beaucoup moins pour objet la production abstraite de la richesse que son équitable distribution. »
Disons en passant que l’économie politique n’a pas plus pour objet la production (encore moins la production abstraite), que la distribution de la richesse. C’est le travail, c’est l’échange qui ont ces choses-là pour objet. L’économie politique n’est pas un art, mais une science. Elle n’impose rien, elle ne conseille même rien, et par conséquent elle ne sacrifie rien ; elle décrit comment la richesse se produit et se distribue, de même que la physiologie décrit le jeu de nos organes ; et il est aussi injuste d’imputer à l’une les maux de la société qu’il le serait d’attribuer à l’autre les maladies qui affligent le corps humain.
Quoi qu’il en soit, les idées très-répandues, dont M. Miguet s’est rendu le trop éloquent interprète, conduisent naturellement à l’arbitraire. À l’aspect de cette révoltante inégalité que la théorie économique, tranchons le mot, que la liberté est censée avoir engendrée, là où elle règne avec le plus d’empire, il est tout naturel qu’on l’accuse, qu’on la repousse, qu’on la flétrisse et qu’on se réfugie dans des arrangements sociaux artificiels, dans des organisations de travail, dans des associations forcées de capital et de main-d’œuvre, dans des utopies, en un mot, où la liberté est préalablement sacrifiée comme incompatible avec le règne de l’égalité et de la fraternité parmi les hommes.
Il n’entre pas dans notre sujet d’exposer la doctrine du libre-échange ni de combattre les nombreuses manifestations de ces écoles qui, de nos jours, ont usurpé le nom de socialisme et qui n’ont entre elles de commun que cette usurpation.
Mais il importe d’établir ici que, bien loin que le régime économique de la Grande-Bretagne soit fondé sur le principe de la liberté, bien loin que la richesse s’y distribue d’une manière naturelle, bien loin enfin que, selon l’heureuse expression de M. de Lamartine, chaque industrie s’y fasse par la liberté une justice qu’aucun système arbitraire ne saurait lui faire, il n’y a pas de pays au monde, sauf ceux qu’afflige encore l’esclavage, où la théorie de Smith, — la doctrine du laissez-faire, laissez-passer, — soit moins pratiquée qu’en Angleterre, et où l’homme soit devenu pour l’homme un objet d’exploitation plus systématique.
Et il ne faut pas croire, comme on pourrait nous l’objecter, que c’est précisément la libre concurrence qui a amené, à la longue, l’asservissement de la main-d’œuvre aux capitaux, de la classe laborieuse à la classe oisive. Non, cette injuste domination ne saurait être considérée comme le résultat, ni même l’abus d’un principe qui ne dirigea jamais l’industrie britannique ; et, pour en fixer l’origine, il faudrait remonter à une époque qui n’est certes pas un temps de liberté, à la conquête de l’Angleterre par les Normands.
Mais sans retracer ici l’histoire des deux races qui foulent le sol britannique et s’y sont livré, sur la forme civile, politique, religieuse, tant de luttes sanglantes, il est à propos de rappeler leur situation respective au point de vue économique.
L’aristocratie anglaise, on le sait, est propriétaire de toute la surface du pays. De plus elle tient en ses mains la puissance législative. Il ne s’agit que de savoir si elle a usé de cette puissance dans l’intérêt de la communauté ou dans son propre intérêt.
« Si notre Code financier, » disait M. Cobden, en s’adressant à l’aristocratie elle-même, dans le Parlement, « si le statute-book pouvait parvenir dans la lune, seul et sans aucun commentaire historique, il n’en faudrait pas davantage pour apprendre à ses habitants qu’il est l’œuvre d’une assemblée de seigneurs maîtres du sol (Landlords). »
Quand une race aristocratique a tout à la fois le droit de faire la loi et la force de l’imposer, il est malheureusement trop vrai qu’elle la fait à son profit. C’est là une pénible vérité. Elle contristera, je le sais, les âmes bienveillantes qui comptent, pour la réforme des abus, non sur la réaction de ceux qui les subissent, mais sur la libre et fraternelle initiative de ceux qui les exploitent. Nous voudrions bien qu’on pût nous signaler dans l’histoire un tel exemple d’abnégation. Mais il ne nous a jamais été donné ni par les castes dominantes de l’Inde, ni par ces Spartiates, ces Athéniens et ces Romains qu’on offre sans cesse à notre admiration, ni par les seigneurs féodaux du moyen âge, ni par les planteurs des Antilles, et il est même fort douteux que ces oppresseurs de l’humanité aient jamais considéré leur puissance comme injuste et illégitime [1].
Si l’on pénètre quelque peu dans les nécessités, on peut dire fatales, des races aristocratiques, on s’aperçoit bientôt qu’elles sont considérablement modifiées et aggravées par ce qu’on a nommé le principe de la population.
Si les classes aristocratiques étaient stationnaires de leur nature ; si elles n’étaient pas, comme toutes les autres, douées de la faculté de multiplier, un certain degré de bonheur et même d’égalité serait peut-être compatible avec le régime de la conquête. Une fois les terres partagées entre les familles nobles, chacune transmettrait ses domaines, de génération en génération, à son unique représentant, et l’on conçoit que, dans cet ordre de choses, il ne serait pas impossible à une classe industrieuse de s’élever et de prospérer paisiblement à côté de la race conquérante.
Mais les conquérants pullulent tout comme de simples prolétaires. Tandis que les frontières du pays sont immuables, tandis que le nombre des domaines seigneuriaux reste le même, parce que, pour ne pas affaiblir sa puissance, l’aristocratie prend soin de ne les pas diviser et de les transmettre intégralement, de mâle en mâle, dans l’ordre de primogéniture ; de nombreuses familles de cadets se forment et multiplient à leur tour. Elles ne peuvent se soutenir par le travail, puisque, dans les idées nobiliaires, le travail est réputé infâme. Il n’y a donc qu’un moyen de les pourvoir ; ce moyen, c’est l’exploitation des classes laborieuses. La spoliation au dehors s’appelle guerre, conquêtes, colonies. La spoliation au dedans se nomme impôts, places, monopoles. Les aristocraties civilisées se livrent généralement à ces deux genres de spoliation ; les aristocraties barbares sont obligées de s’interdire le second par une raison bien simple, c’est qu’il n’y a pas autour d’elles une classe industrieuse à dépouiller. Mais quand les ressources de la spoliation extérieure viennent aussi à leur manquer, que deviennent donc, chez les barbares, les générations aristocratiques des branches cadettes ? Ce qu’elles deviennent ? On les étouffe ; car il est dans la nature des aristocraties de préférer au travail la mort même.
« Dans les archipels du grand Océan, les cadets de famille n’ont aucune part dans la succession de leurs pères. Ils ne peuvent donc vivre que des aliments que leur donnent leurs aînés, s’ils restent en famille ; ou de ce que peut leur donner la population asservie, s’ils entrent dans l’association militaire des arreoys. Mais, quel que soit celui des deux partis qu’ils prennent, ils ne peuvent espérer de perpétuer leur race. L’impuissance de transmettre à leurs enfants aucune propriété et de les maintenir dans le rang où ils naissent, est sans doute ce qui leur a fait une loi de les étouffer [2]. »
L’aristocratie anglaise, quoique sous l’influence des mêmes instincts qui inspirent l’aristocratie malaie (car les circonstances varient, mais la nature humaine est partout la même), s’est trouvée, si je puis m’exprimer ainsi, dans un milieu plus favorable. Elle a eu, en face d’elle et au-dessous d’elle, la population la plus laborieuse, la plus active, la plus persévérante, la plus énergique et en même temps la plus docile du globe ; elle l’a méthodiquement exploitée.
Rien de plus fortement conçu, de plus énergiquement exécuté que cette exploitation. La possession du sol met aux mains de l’oligarchie anglaise la puissance législative ; par la législation, elle ravit systématiquement la richesse à l’industrie. Cette richesse, elle l’emploie à poursuivre au dehors ce système d’empiétements qui a soumis quarante-cinq colonies à la Grande-Bretagne ; et les colonies lui servent à leur tour de prétexte pour lever, aux frais de l’industrie et au profit des branches cadettes, de lourds impôts, de grandes armées, une puissante marine militaire.
Il faut rendre justice à l’oligarchie anglaise. Elle a déployé, dans sa double politique de spoliation intérieure et extérieure, une habileté merveilleuse. Deux mots, qui impliquent deux préjugés, lui ont suffi pour y associer les classes mêmes qui en supportent tout le fardeau : elle a donné au monopole le nom de Protection, et aux colonies celui de Débouchés.
Ainsi l’existence de l’oligarchie britannique, ou du moins sa prépondérance législative, n’est pas seulement une plaie pour l’Angleterre, c’est encore un danger permanent pour l’Europe.
Et s’il en est ainsi, comment est-il possible que la France ne prête aucune attention à cette lutte gigantesque que se livrent sous ses yeux l’esprit de la civilisation et l’esprit de la féodalité ? Comment est-il possible qu’elle ne sache pas même les noms de ces hommes dignes de toutes les bénédictions de l’humanité, les Cobden, les Bright, les Moore, les Villiers, les Thompson, les Fox, les Wilson et mille autres qui ont osé engager le combat, qui le soutiennent avec un talent. un courage, un dévouement, une énergie admirables ? C’est une pure question de liberté commerciale, dit-on. Et ne voit-on pas que la liberté du commerce doit ravir à l’oligarchie et les ressources de la spoliation intérieure, — les monopoles, — et les ressources de la spoliation extérieure, — les colonies, — puisque monopoles et colonies sont tellement incompatibles avec la liberté des échanges, qu’ils ne sont autre chose que la limite arbitraire de cette liberté !
Mais que dis-je ? Si la France a quelque vague connaissance de ce combat à mort qui va décider pour longtemps du sort de la liberté humaine, ce n’est pas à son triomphe qu’elle semble accorder sa sympathie. Depuis quelques années, on lui a fait tant de peur des mots liberté, concurrence, sur-production ; on lui a tant dit que ces mots impliquent misère, paupérisme, dégradation des classes ouvrières ; on lui a tant répété qu’il y avait une économie politique anglaise, qui se faisait de la liberté un instrument de machiavélisme et d’oppression, et une économie politique française qui, sous les noms de philanthropie, socialisme, organisation du travail, allait ramener l’égalité des conditions sur la terre, — qu’elle a pris en horreur la doctrine qui ne se fonde après tout que sur la justice et le sens commun, et qui se résume dans cet axiome : « Que les hommes soient libres d’échanger entre eux, quand cela leur convient, les fruits de leurs travaux. — » Si cette croisade contre la liberté n’était soutenue que par les hommes d’imagination, qui veulent formuler la science sans s’être préparés par l’étude, le mal ne serait pas grand. Mais n’est-il pas douloureux de voir de vrais économistes, poussés sans doute par la passion d’une popularité éphémère, céder à ces déclamations affectées et se donner l’air de croire ce qu’assurément ils ne croient pas, à savoir : que le paupérisme, le prolétariat, les souffrances des dernières classes sociales doivent être attribués à ce qu’on nomme concurrence exagérée, sur-production ?
Ne serait-ce pas, au premier coup d’œil, une chose bien surprenante que la misère, le dénûment, la privation des produits eussent pour cause… quoi ? précisément la surabondance des produits ? N’est-il pas singulier qu’on vienne nous dire que si les hommes n’ont pas suffisamment de quoi se nourrir, c’est qu’il y a trop d’aliments dans le monde ? que s’ils n’ont pas de quoi se vêtir, c’est que les machines jettent trop de vêtements sur le marché ? Assurément le paupérisme en Angleterre est un fait incontestable ; l’inégalité des richesses y est frappante. Mais pourquoi aller chercher à ces phénomènes une cause si bizarre, quand ils s’expliquent par une cause si naturelle : la spoliation systématique des travailleurs par les oisifs ?
C’est ici le lieu de décrire le régime économique de la Grande-Bretagne, tel qu’il était dans les dernières années qui ont précédé les réformes partielles, et à certains égards trompeuses, dont, depuis 1842, le Parlement est saisi par le cabinet actuel.
La première chose qui frappe dans la législation financière de nos voisins, et qui est faite pour étonner les propriétaires du continent, c’est l’absence presque totale d’impôt foncier, dans un pays grevé d’une si lourde dette et d’une si vaste administration.
| En 1706 (époque de l’Union, sous la reine Anne), l’impôt foncier entrait dans le revenu public pour | 1,997,379 | liv. st. |
| L’accise, pour | 1,792,763 | |
| La douane, pour | 1,549,351 |
En 1841, sous la reine Victoria :
| Part contributive de l’impôt foncier (land tax) | 2,037,627 |
| Part contributive de l’accise | 12,858,014 |
| Part contributive de la douane | 19,485,217 |
Ainsi l’impôt direct est resté le même pendant que les impôts de consommation ont décuplé.
Et il faut considérer que, dans ce laps de temps, la rente des terres ou le revenu du propriétaire a augmenté dans la proportion de 1 à 7, en sorte que le même domaine qui, sous la reine Anne, acquittait 20 pour 100 de contributions sur le revenu, ne paie pas aujourd’hui 3 pour 100.
On remarquera aussi que l’impôt foncier n’entre que pour un vingt-cinquième dans le revenu public (2 millions sur 50 dont se composent les recettes générales). En France, et dans toute l’Europe continentale, il en constitue la portion la plus considérable, si l’on ajoute à la taxe annuelle les droits perçus à l’occasion des mutations et transmissions, droits dont, de l’autre côté de la Manche, la propriété immobilière est affranchie, quoique la propriété personnelle et industrielle y soit rigoureusement assujettie.
La même partialité se montre dans les taxes indirectes. Comme elles sont uniformes au lieu d’être graduées selon les qualités des objets qu’elles frappent, il s’ensuit qu’elles pèsent incomparablement plus sur les classes pauvres que sur les classes opulentes.
Ainsi le thé Pekoe vaut 4 shellings et le Bohea 9 deniers ; le droit étant de 2 shellings, le premier est taxé à raison de 50, et le second à raison de 300 pour 100.
Ainsi le sucre raffiné valant 71 shellings, et le sucre brut 25 shillings, le droit fixe de 24 shillings est de 34 pour 100 pour l’un, et de 90 pour 100 pour l’autre.
De même le tabac de Virginie commun, le tabac du pauvre, paie 1200 pour 100, et le Havane 105 pour 100.
Le vin du riche en est quitte pour 28 pour 100. Le vin du pauvre acquitte 254 pour 100.
Et ainsi du reste.
Vient ensuite la loi sur les céréales et les comestibles (corn and provisions law), dont il est nécessaire de se rendre compte.
La loi-céréale, en excluant le blé étranger ou en le frappant d’énormes droits d’entrée, a pour but d’élever le prix du blé indigène, pour prétexte de protéger l’agriculture, et pour effet de grossir les rentes des propriétaires du sol.
Que la loi-céréale ait pour but d’élever le prix du blé indigène, c’est ce qui est avoué par tous les partis. Par la loi de 1815, le Parlement prétendait très-ostensiblement maintenir le froment à 80 shillings le quarter ; par celle de 1828, il voulait assurer au producteur 70 shillings. La loi de 1842 (postérieure aux réformes de M. Peel, et dont par conséquent nous n’avons pas à nous occuper ici) a été calculée pour empêcher que le prix ne descendît au-dessous de 56 shillings qui est, dit-on, strictement rémunérateur. Il est vrai que ces lois ont souvent failli dans l’objet qu’elles avaient en vue ; et, en ce moment même, les fermiers, qui avaient compté sur ce prix législatif de 56 shillings et fait leurs baux en conséquence, sont forcés de vendre à 45 shillings. C’est qu’il y a, dans les lois naturelles qui tendent à ramener tous les profits à un commun niveau, une force que le despotisme ne parvient pas facilement à vaincre.
D’un autre côté, que la prétendue protection à l’agriculture soit un prétexte, c’est ce qui n’est pas moins évident. Le nombre des fermes à louer est limité ; le nombre des fermiers ou des personnes qui peuvent le devenir ne l’est pas. La concurrence qu’ils se font entre eux les force donc à se contenter des profits les plus bornés auxquels ils peuvent se réduire. Si, par suite de la cherté des grains et des bestiaux, le métier de fermier devenait très-lucratif, le seigneur ne manquerait pas de hausser le prix du bail, et il le ferait d’autant mieux que, dans cette hypothèse, les entrepreneurs viendraient s’offrir en nombre considérable.
Enfin, que le maître du sol, le landlord, réalise en définitive tout le profit de ce monopole, cela ne peut être douteux pour personne. L’excédant du prix extorqué au consommateur doit bien aller à quelqu’un ; et puisqu’il ne peut s’arrêter au fermier, il faut bien qu’il arrive au propriétaire.
Mais quelle est au juste la charge que le monopole des blés impose au peuple anglais ?
Pour le savoir, il suffit de comparer le prix du blé étranger, à l’entrepôt, avec le prix du blé indigène. La différence, multipliée par le nombre de quarters consommés annuellement en Angleterre, donnera la mesure exacte de la spoliation légalement exercée, sous cette forme, par l’oligarchie britannique.
Les statisticiens ne sont pas d’accord. Il est probable qu’ils se laissent aller à quelque exagération en plus ou en moins, selon qu’ils appartiennent au parti des spoliateurs ou des spoliés. L’autorité qui doit inspirer le plus de confiance est sans doute celle des officiers du bureau du commerce (Board of trade), appelés à donner solennellement leur avis devant la Chambre des communes réunie en comité d’enquête.
Sir Robert Peel, en présentant, en 1842, la première partie de son plan financier, disait : « Je crois que toute confiance est due au gouvernement de S. M. et aux propositions qu’il vous soumet, d’autant que l’attention du Parlement a été sérieusement appelée sur ces matières dans l’enquête solennelle de 1839. »
Dans le même discours, le premier ministre disait encore : « M. Deacon Hume, cet homme dont je suis sûr qu’il n’est aucun de nous qui ne déplore la perte, établit que la consommation du pays est d’un quarter de blé par habitant. »
Rien ne manque donc à l’autorité sur laquelle je vais m’appuyer, ni la compétence de celui qui donnait son avis, ni la solennité des circonstances dans lesquelles il a été appelé à l’exprimer, ni même la sanction du premier ministre d’Angleterre.
Voici, sur la question qui nous occupe, l’extrait de cet interrogatoire remarquable [3].
Le Président : Pendant combien d’années avez-vous occupé des fonctions à la douane et au bureau du commerce ?
M. Deacon Hume : J’ai servi trente-huit ans dans la douane et ensuite onze ans au bureau du commerce.
D. Vous pensez que les droits protecteurs agissent comme une taxe directe sur la communauté, en élevant le prix des objets de consommation ?
R. Très-décidément. Je ne puis décomposer le prix que me coûte un objet que de la manière suivante : une portion est le prix naturel ; l’autre portion est le droit ou la taxe, encore que ce droit passe de ma poche dans celle d’un particulier au lieu d’entrer dans le trésor public…
D. Avez-vous jamais calculé quel est le montant de la taxe que paie la communauté par suite de l’élévation de prix que le monopole fait éprouver au froment et à la viande de boucherie ?
R. Je crois qu’on peut connaître très-approximativement le montant de cette charge additionnelle. On estime que chaque personne consomme annuellement un quarter de blé. On peut porter à 10 shillings ce que la protection ajoute au prix naturel. Vous ne pouvez porter à moins du double ce qu’elle ajoute, en masse, au prix de la viande, orge, avoine, foin, beurre et fromage. Cela monte à 36 millions sterling par an (900 millions de francs) ; et, au fait, le peuple paie cette somme de sa poche tout aussi infailliblement que si elle allait au trésor, sous la forme de taxes.
D. Par conséquent, il a plus de peine à payer les contributions qu’exige le revenu public ?
R. Sans doute ; ayant payé les taxes personnelles, il est moins en état de payer des taxes nationales.
D. N’en résulte-t-il pas aussi la souffrance, la restriction de l’industrie de notre pays ?
R. Je crois même que vous signalez là l’effet le plus pernicieux. Il est moins accessible au calcul, mais si la nation jouissait du commerce que lui procurerait, selon moi, l’abolition de toutes ces protections, je crois qu’elle pourrait supporter aisément un accroissement d’impôts de 30 shellings par habitant.
D. Ainsi, d’après vous, le poids du système protecteur excède celui des contributions ?
R. Je le crois, en tenant compte de ses effets directs et de ses conséquences indirectes plus difficiles à apprécier.
Un autre officier du Board of trade, M. Mac-Grégor, répondait :
« Je considère que les taxes prélevées, dans ce pays, sur la production de la richesse due au travail et au génie des habitants, par les droits restrictifs et prohibitifs, dépassent de beaucoup, et probablement de plus du double, le montant des taxes payées au trésor. »
M. Porter, autre membre distingué du Board of trade, et bien connu en France par ses travaux statistiques, déposa dans le même sens [4].
Nous pouvons donc tenir pour certain que l’aristocratie anglaise ravit au peuple, par l’opération de cette seule loi (corn and provisions law), une part du produit de son travail, ou, ce qui revient au même, des satisfactions légitimement acquises qu’il pourrait s’accorder, part qui s’élève à 1 milliard par an, et peut-être 2 milliards, si l’on tient compte des effets indirects de cette loi. C’est là, à proprement parler, le lot que les aristocrates-législateurs, les aînés de famille se sont fait à eux-mêmes.
Restait à pourvoir les cadets ; car, ainsi que nous l’avons vu, les races aristocratiques ne sont pas plus que les autres privées de la faculté de multiplier, et, sous peine d’effroyables dissensions intestines, il faut bien qu’elles assurent aux branches cadettes un sort convenable, — c’est-à-dire, en dehors du travail, en d’autres termes, par la spoliation, — puisqu’il n’y a et ne peut y avoir que deux manières d’acquérir : Produire ou ravir.
Deux sources fécondes de revenus ont été ouvertes aux cadets : le trésor public et le système colonial. À vrai dire, ces deux conceptions n’en font qu’une. On lève des armées, une marine, en un mot des taxes pour conquérir des colonies, et l’on conserve les colonies pour rendre permanentes la marine, les armées ou les taxes.
Tant qu’on a pu croire que les échanges, qui s’opèrent, en vertu d’un contrat de monopole réciproque, entre la métropole et ses colonies, étaient d’une nature différente et plus avantageuse que ceux qui s’accomplissent entre pays libres, le système colonial a pu être soutenu par le préjugé national. Mais lorsque la science et l’expérience (et la science n’est que l’expérience méthodique) ont révélé et mis hors de doute cette simple vérité : les produits s’échangent contre des produits, il est devenu évident que le sucre, le café, le coton, qu’on tire de l’étranger, n’offrent pas moins de débouchés à l’industrie des regnicoles que ces mêmes objets venus des colonies. Dès lors ce régime, accompagné d’ailleurs de tant de violences et de dangers, n’a plus pour point d’appui aucun motif raisonnable ou même spécieux. Il n’est que le prétexte et l’occasion d’une immense injustice. Essayons d’en calculer la portée.
Quant au peuple anglais, je veux dire la classe productive, il ne gagne rien à la vaste extension de ses possessions coloniales. En effet, si ce peuple est assez riche pour acheter du sucre, du coton, du bois de construction, que lui importe de demander ces choses à la Jamaïque, à l’Inde et au Canada, ou bien au Brésil, aux États-Unis, à la Baltique ? Il faut bien que le travail manufacturier anglais paie le travail agricole des Antilles, comme il paierait le travail agricole des nations du Nord. C’est donc une folie que de faire entrer dans le calcul les prétendus débouchés ouverts à l’Angleterre par ses colonies. Ces débouchés, elle les aurait alors même que les colonies seraient affranchies, et par cela seul qu’elle y exécuterait des achats. Elle aurait de plus les débouchés étrangers, dont elle se prive en restreignant ses approvisionnements à ses possessions, en leur en conférant le monopole.
Lorsque les États-Unis proclamèrent leur indépendance, les préjugés coloniaux étaient dans toute leur force, et tout le monde sait que l’Angleterre crut son commerce ruiné. Elle le crut si bien, qu’elle se ruinait d’avance en frais de guerre pour retenir ce vaste continent sous sa domination. Mais qu’est-il arrivé ? En 1776, au commencement de la guerre de l’Indépendance, les exportations anglaises à l’Amérique du Nord étaient de 1,300,000 liv. sterl., elles s’élevèrent à 3,600,000 liv. sterl. en 1784, après que l’indépendance eût été reconnue ; et elles montent aujourd’hui à 12,400,000 liv. sterl., somme qui égale presque celle de toutes les exportations que fait l’Angleterre à ses quarante-cinq colonies, puisque celles-ci n’ont pas dépassé, en 1842, 13,200,000 liv. sterl. — Et, en effet, on ne voit pas pourquoi des échanges de fer contre du coton, ou d’étoffes contre des farines, ne s’accompliraient plus entre les deux peuples. Serait-ce parce que les citoyens des États-Unis sont gouvernés par un président de leur choix au lieu de l’être par un lord-lieutenant payé au frais de l’Échiquier ? Mais quel rapport y a-t-il entre cette circonstance et le commerce ? Et si jamais nous nommions nos maires et nos préfets, cela empêcherait-il les vins de Bordeaux d’aller à Elbeuf, et les draps d’Elbeuf de venir à Bordeaux ?
On dira peut-être que, depuis l’acte d’indépendance, l’Angleterre et les États-Unis repoussent réciproquement leurs produits, ce qui ne serait pas arrivé si le lien colonial n’eût pas été rompu. Mais ceux qui font l’objection entendent sans doute présenter un argument en faveur de ma thèse ; ils entendent insinuer que les deux pays auraient gagné à échanger librement entre eux les produits de leur sol et de leur industrie. Je demande comment un troc de blé contre du fer, ou de tabac contre de la toile, peut être nuisible selon que les deux nations qui l’accomplissent sont ou ne sont pas politiquement indépendantes l’une de l’autre ? — Si les deux grandes familles anglo-saxonnes agissent sagement, conformément à leurs vrais intérêts, en restreignant leurs échanges réciproques, c’est sans doute parce que ces échanges sont funestes ; et, en ce cas, elles auraient également bien fait de les restreindre alors même qu’un gouverneur anglais résiderait encore au Capitole. — Si au contraire elles ont mal fait, c’est qu’elles se sont trompées, c’est qu’elles ont mal compris leurs intérêts, et l’on ne voit pas comment le lien colonial les eût rendues plus clairvoyantes.
Remarquez en outre que les exportations de 1776 s’élevant à 1,300,000 liv. sterl., ne peuvent pas être supposées avoir donné à l’Angleterre plus de vingt pour 100, ou 260,000 liv. sterl. de bénéfice ; et pense-t-on que l’administration d’un aussi vaste continent n’absorbait pas dix fois cette somme ?
On s’exagère d’ailleurs le commerce que l’Angleterre fait avec ses colonies et surtout les progrès de ce commerce. Malgré que le gouvernement anglais contraigne les citoyens à se pourvoir aux colonies et les colons à la métropole ; malgré que les barrières de douane qui séparent l’Angleterre des autres nations se soient, dans ces dernières années, prodigieusement multipliées et renforcées, on voit le commerce étranger de l’Angleterre se développer plus rapidement que son commerce colonial, comme le constate le tableau suivant :
| exportations. | ||||||
| aux colonies. | à l’étranger. | total. | ||||
| 1831 | 10,254,940 | l. st. | 26,900,432 | l. st. | 37,164,372 | l. st. |
| 1842 | 13,261,436 | 34,119,587 | 47,381,023 | |||
Aux deux époques, le commerce colonial n’entre que pour un peu plus du quart dans le commerce général. — L’accroissement, dans onze ans, est de trois millions environ. Et il faut remarquer que les Indes orientales, auxquelles ont été appliqués, dans l’intervalle, les principes de la liberté, entrent pour 1,300,000 liv. dans cet accroissement, et Gibraltar, — qui ne donne pas lieu à un commerce colonial, mais à un commerce étranger, avec l’Espagne, — pour 600,000 liv. sterl. ; en sorte qu’il ne reste pour l’augmentation réelle du commerce colonial, dans un intervalle de onze ans, que 1,100,000 liv. sterl. — Pendant ce même temps, et en dépit de nos tarifs, les exportations de l’Angleterre en France se sont élevées de liv. sterl. 602,688 à 3,193,939.
Ainsi le commerce protégé a progressé dans la proportion de 8 pour 100 ; et le commerce contrarié de 450 pour 100 !
Mais si le peuple anglais n’a pas gagné, s’il a même énormément perdu au système colonial, il n’en est pas de même des branches cadettes de l’aristocratie britannique.
D’abord ce système exige une armée, une marine, une diplomatie, des lords-lieutenants, des gouverneurs, des résidents, des agents de toutes sortes et de toutes dénominations. — Quoiqu’il soit présenté comme ayant pour but de favoriser l’agriculture, le commerce et l’industrie, ce n’est pas, que je sache, à des fermiers, à des négociants, à des manufacturiers que ces hautes fonctions sont confiées. On peut affirmer qu’une grande partie de ces lourdes taxes, que nous avons vu peser principalement sur le peuple, sont destinées à salarier tous ces instruments de conquête, qui ne sont autres que les puînés de l’aristocratie anglaise.
C’est un fait connu d’ailleurs que ces nobles aventuriers ont acquis de vastes domaines dans les colonies. La protection leur a été accordée ; il est bon de calculer ce qu’elle coûte aux classes laborieuses.
Antérieurement à 1825, la législation anglaise sur les sucres était très-compliquée.
Le sucre des Antilles payait le moindre droit ; celui de Maurice et des Indes était soumis à une taxe plus élevée. Le sucre étranger était repoussé par un droit prohibitif.
Le 5 juillet 1825, l’île Maurice, et le 13 août 1836, l’Inde anglaise furent placées avec les Antilles sur le pied de l’égalité.
La législation simplifiée ne reconnut plus que deux sucres : le sucre colonial et le sucre étranger. Le premier avait à acquitter un droit de 24 sh., le second de 63 sh. par quintal.
Si l’on admet, pour un instant, que le prix de revient soit le même aux colonies et à l’étranger, par exemple, 20 sh., on comprendra aisément les résultats d’une telle législation, soit pour les producteurs, soit à l’égard des consommateurs.
L’étranger ne pourra livrer ses produits sur le marché anglais au-dessous de 83 sh., savoir : 20 sh. pour couvrir les frais de production, et 63 sh., pour acquitter la taxe. — Pour peu que la production coloniale soit insuffisante à alimenter ce marché ; pour peu que le sucre étranger s’y présente, le prix vénal (car il ne peut y avoir qu’un prix vénal) sera donc de 83 shell., et ce prix, pour le sucre colonial, se décomposera ainsi :
| 20 | sh. | Remboursement des frais de production. |
| 24 | Part du trésor public ou taxe. | |
| 39 | Montant de la spoliation ou monopole. | |
| 83 | Prix payé par le consommateur. | |
On voit que la loi anglaise avait pour but de faire payer au peuple 83 sh. ce qui n’en vaut que 20, et de partager l’excédant, ou 63 sh., de manière à ce que la part du trésor fût de 24, et celle du monopole de 39 sh.
Si les choses se fussent passées ainsi, si le but de la loi avait été atteint, pour connaître le montant de la spoliation exercée par les monopoleurs au préjudice du peuple, il suffirait de multiplier par 39 sh. le nombre de quintaux du sucre consommé en Angleterre.
Mais, pour le sucre comme pour les céréales, la loi a failli dans une certaine mesure. La consommation limitée par la cherté n’a pas eu recours au sucre étranger, et le prix de 83 sh. n’a pas été atteint.
Sortons du cercle des hypothèses et consultons les faits. Les voici soigneusement relevés sur les documents officiels.
| ANNÉES | CONSOMMATION 2920.totale. | CONSOMMATION 2921.par habitant. | PRIX 2922.du 2923.sucre colonial 2924.à l’entrepôt. | PRIX 2925.du 2926.sucre étranger 2927.à l’entrepôt. | |||||||
| sh. | d. | sh. | d. | ||||||||
| 1837 | 3,954,810 | 16 | 12/13 | 34 | 7 | 21 | 3 | ||||
| 1838 | 3,909,365 | 16 | 8/13 | 33 | 8 | 21 | 3 | ||||
| 1839 | 3,825,599 | 15 | 12/13 | 39 | 2 | 22 | 2 | ||||
| 1840 | 3,594,834 | 14 | 7/9 | 49 | 1 | 21 | 6 | ||||
| 1841 | 4,058,435 | 16 | 1/2 | 39 | 8 | 20 | 6 | ||||
| moyennes. | 3,868,668 | 16 | 1/6 | 39 | 5 | 21 | 5 | ||||
De ce tableau, il est fort aisé de déduire les pertes énormes que le monopole a infligées, soit à l’Échiquier, soit au consommateur anglais.
Calculons en monnaies françaises et en nombres ronds pour la plus facile intelligence du lecteur.
À raison de 49 fr. 20 c. (39 sh. 5 d.), plus 30 fr. de droits (24 sh.), il en a coûté au peuple anglais, pour consommer annuellement 3,868,000 quintaux de sucre, la somme de 306 millions et demi, qui se décompose ainsi :
| 103 | 1/2 | millions qu’aurait coûtés une égale quantité de sucre étranger au prix de 29 fr. 75 (21 sh. 5 d.). |
| 116 | millions impôt pour le revenu à 30 fr. (24 ch.). | |
| 86 | 1/2 | millions part du monopole résultant de la différence du prix colonial au prix étranger. |
| 306 | millions. | |
Il est clair que, sous le régime de l’égalité et avec un impôt uniforme de 30 fr. par quintal, si le peuple anglais eût voulu dépenser 306 millions de francs en ce genre de consommation, il en aurait eu, au prix de 26 fr. 75, plus 30 francs de taxe, 5,400,000 quintaux ou 22 kil. par habitant au lieu de 16. — Le trésor, dans cette hypothèse, aurait recouvré 162 millions au lieu de 116.
Si le peuple se fût contenté de la consommation actuelle, il aurait épargné annuellement 86 millions, qui lui auraient procuré d’autres satisfactions et ouvert de nouveaux débouchés à son industrie.
Des calculs semblables, que nous épargnons au lecteur, prouvent que le monopole accordé aux propriétaires de bois du Canada coûte aux classes laborieuses de la Grande-Bretagne, indépendamment de la taxe fiscale, un excédant de 30 millions.
Le monopole du café leur impose une surcharge de 6,500,000 fr.
Voilà donc, sur trois articles coloniaux seulement, une somme de 123 millions enlevée purement et simplement de la bourse des consommateurs en excédant du prix naturel des denrées ainsi que des taxes fiscales, pour être versée, sans aucune compensation, dans la poche des colons.
Je terminerai cette dissertation, déjà trop longue, par une citation que j’emprunte à M. Porter, membre du Board of trade.
« Nous avons payé en 1840, et sans parler des droits d’entrée, 5 millions de livres de plus que n’aurait fait pour une égale quantité de sucre toute autre nation. Dans la même année, nous avons exporté pour 4,000,000 l. st. aux colonies à sucre ; en sorte que nous aurions gagné un million à suivre le vrai principe, qui est d’acheter au marché le plus avantageux, alors même que nous aurions fait cadeau aux planteurs de toutes les marchandises qu’ils nous ont prises. »
M. Ch. Comte avait entrevu, dès 1827, ce que M. Porter établit en chiffres. « Si les Anglais, disait-il, calculaient quelle est la quantité de marchandises qu’ils doivent vendre aux possesseurs d’hommes, pour recouvrer les dépenses qu’ils font dans la vue de s’assurer leur pratique, ils se convaincraient que ce qu’ils ont de mieux à faire, c’est de leur livrer leurs marchandises pour rien et d’acheter, à ce prix, la liberté du commerce. »
Nous sommes maintenant en mesure, ce me semble, d’apprécier le degré de liberté dont jouissent en Angleterre le travail et l’échange, et de juger si c’est bien dans ce pays qu’il faut aller observer les désastreux effets de la libre concurrence sur l’équitable distribution de la richesse et l’égalité des conditions.
Récapitulons, concentrons dans un court espace les faits que nous venons d’établir.
1° Les branches aînées de l’aristocratie anglaise possèdent toute la surface du territoire.
2° L’impôt foncier est demeuré invariable depuis cent cinquante ans, quoique la rente des terres ait septuplé. Il n’entre que pour un vingt-cinquième dans les recettes publiques.
3° La propriété immobilière est affranchie de droits de succession, quoique la propriété personnelle y soit assujettie.
4° Les taxes indirectes pèsent beaucoup moins sur les objets de qualités supérieures, à l’usage des riches, que sur les mêmes objets de basses qualités, à l’usage du peuple.
5° Au moyen de la loi-céréale, les mêmes branches aînées prélèvent, sur la nourriture du peuple, un impôt que les meilleures autorités fixent à un milliard de francs.
6° Le système colonial, poursuivi sur une très-grande échelle, nécessite de lourds impôts ; et ces impôts, payés presque en totalité par les classes laborieuses, sont, presque en totalité aussi, le patrimoine des branches cadettes des classes oisives.
7° Les taxes locales, comme les dîmes (tithes), arrivent aussi à ces branches cadettes par l’intermédiaire de l’Église établie.
8° Si le système colonial exige un grand développement de forces, le maintien de ces forces a besoin, à son tour, du régime colonial, et ce régime entraîne celui des monopoles. On a vu que, sur trois articles seulement, ils occasionnent au peuple anglais une perte sèche de 124 millions.
J’ai cru devoir donner quelque étendue à l’exposé de ces faits parce qu’ils me paraissent de nature à dissiper bien des erreurs, bien des préjugés, bien des préventions aveugles. Combien de solutions aussi évidentes qu’inattendues n’offrent-ils pas aux économistes ainsi qu’aux hommes politiques ?
Et d’abord, comment ces écoles modernes, qui semblent avoir pris à tâche d’entraîner la France dans ce système de spoliations réciproques, en lui faisant peur de la concurrence, comment, dis-je, ces écoles pourraient-elles persister à soutenir que c’est la liberté qui a suscité le paupérisme en Angleterre ? Dites donc qu’il est né de la spoliation, de la spoliation organisée, systématique, persévérante, impitoyable. Cette explication n’est-elle pas plus simple, plus vraie et plus satisfaisante à la fois ? Quoi ! La liberté entraînerait le paupérisme ! La concurrence, les transactions libres, le droit d’échanger une propriété qu’on a le droit de détruire, impliqueraient une injuste distribution de la richesse ! La loi providentielle serait donc bien inique ! Il faudrait donc se hâter d’y substituer une loi humaine, et quelle loi ! Une loi de restriction et d’empêchement. Au lieu de laisser faire, il faudrait empêcher de faire ; au lieu de laisser passer, il faudrait empêcher de passer ; au lieu de laisser échanger, il faudrait empêcher d’échanger ; au lieu de laisser la rémunération du travail à celui qui l’a accompli, il faudrait en investir celui qui ne l’a pas accompli ! Ce n’est qu’à cette condition qu’on éviterait l’inégalité des fortunes parmi les hommes ! « Oui, disiez-vous, l’expérience est faite ; la liberté et le paupérisme coexistent en Angleterre. » Mais vous ne pourrez plus le dire. Bien loin que la liberté et la misère y soient dans le rapport de cause à effet, l’une d’elles du moins, la liberté, n’y existe même pas. On y est bien libre de travailler, mais non de jouir du fruit de son travail. Ce qui coexiste en Angleterre, c’est un petit nombre de spoliateurs et un grand nombre de spoliés ; et il ne faut pas être un grand économiste pour en conclure l’opulence des uns et la misère des autres.
Ensuite, pour peu qu’on ait embrassé dans son ensemble la situation de la Grande-Bretagne, telle que nous venons de la montrer, et l’esprit féodal qui domine ses institutions économiques, on sera convaincu que la réforme financière et douanière qui s’accomplit dans ce pays est une question européenne, humanitaire, aussi bien qu’une question anglaise. Il ne s’agit pas seulement d’un changement dans la distribution de la richesse au sein du Royaume-Uni, mais encore d’une transformation profonde de l’action qu’il exerce au dehors. Avec les injustes priviléges de l’aristocratie britannique, tombent évidemment et la politique qu’on a tant reprochée à l’Angleterre, et son système colonial, et ses usurpations, et ses armées, et sa marine, et sa diplomatie, en ce qu’elles ont d’oppressif et de dangereux pour l’humanité.
Tel est le glorieux triomphe auquel aspire la ligue lorsqu’elle réclame « l’abolition totale, immédiate et sans condition de tous les monopoles, de tous les droits protecteurs quelconques en faveur de l’agriculture, des manufactures, du commerce et de la navigation, en un mot la liberté absolue des échanges [5]. »
Je ne dirai que peu de choses ici de cette puissante association. L’esprit qui l’anime, ses commencements, ses progrès, ses travaux, ses luttes, ses revers, ses succès, ses vues, ses moyens d’action, tout cela se manifestera plein d’action et de vie dans la suite de cet ouvrage. Je n’ai pas besoin de décrire minutieusement ce grand corps, puisque je l’expose respirant et agissant devant le public français, aux yeux de qui, par un miracle incompréhensible d’habileté, la presse subventionnée du monopole l’a si longtemps tenu caché [6].
Au milieu de la détresse que ne pouvait manquer d’appesantir sur les classes laborieuses le régime que nous venons de décrire, sept hommes se réunirent à Manchester au mois d’octobre 1838, et, avec cette virile détermination qui caractérise la race anglo-saxonne, ils résolurent de renverser tous les monopoles par les voies légales, et d’accomplir, sans troubles, sans effusion de sang, par la seule puissance de l’opinion, une révolution aussi profonde, plus profonde peut-être que celle qu’ont opérée nos pères en 1789 [7].
Certes, il fallait un courage peu ordinaire pour affronter une telle entreprise. Les adversaires qu’il s’agissait de combattre avaient pour eux la richesse, l’influence, la législature, l’Église, l’État, le trésor public, les terres, les places, les monopoles, et ils étaient en outre entourés d’un respect et d’une vénération traditionnels.
Et où trouver un point d’appui contre un ensemble de forces si imposant ? Dans les classes industrieuses ? Hélas ! en Angleterre comme en France, chaque industrie croit son existence attachée à quelque lambeau de monopole. La protection s’est insensiblement étendue à tout. Comment faire préférer des intérêts éloignés et, en apparence, incertains à des intérêts immédiats et positifs ? Comment dissiper tant de préjugés, tant de sophismes que le temps et l’égoïsme ont si profondément incrustés dans les esprits ? Et à supposer qu’on parvienne à éclairer l’opinion dans tous les rangs et dans toutes les classes, tâche déjà bien lourde, comment lui donner assez d’énergie, de persévérance et d’action combinée pour la rendre, par les élections, maîtresse de la législature ?
L’aspect de ces difficultés n’effraya pas les fondateurs de la Ligue. Après les avoir regardées en face et mesurées, ils se crurent de force à les vaincre. L’agitation fut décidée.
Manchester fut le berceau de ce grand mouvement. Il était naturel qu’il naquît dans le nord de l’Angleterre, parmi les populations manufacturières, comme il est naturel qu’il naisse un jour au sein des populations agricoles du midi de la France. En effet, les industries qui, dans les deux pays, offrent des moyens d’échange sont celles qui souffrent le plus immédiatement de leur interdiction, et il est évident que s’ils étaient libres, les Anglais nous enverraient du fer, de la houille, des machines, des étoffes, en un mot, des produits de leurs mines et de leurs fabriques, que nous leur paierions en grains, soies, vins, huiles, fruits, c’est-à-dire en produits de notre agriculture.
Cela explique jusqu’à un certain point le titre bizarre en apparence que prit l’association : Anti-corn-law-league [8]. Cette dénomination restreinte n’ayant pas peu contribué sans doute à détourner l’attention de l’Europe sur la portée de l’agitation, nous croyons indispensable de rapporter ici les motifs qui l’ont fait adopter.
Rarement la presse française a parlé de la Ligue (nous dirons ailleurs pourquoi), et lorsqu’elle n’a pu s’empêcher de le faire, elle a eu soin du moins de s’autoriser de ce titre : Anti-corn-law, pour insinuer qu’il s’agissait d’une question toute spéciale, d’une simple réforme dans la loi qui règle en Angleterre les conditions de l’importation des grains.
Mais tel n’est pas seulement l’objet de la Ligue. Elle aspire à l’entière et radicale destruction de tous les priviléges et de tous les monopoles, à la liberté absolue du commerce, à la concurrence illimitée, ce qui implique la chute de la prépondérance aristocratique en ce qu’elle a d’injuste, la dissolution des liens coloniaux en ce qu’ils ont d’exclusif, c’est-à-dire une révolution complète dans la politique intérieure et extérieure de la Grande-Bretagne.
Et, pour n’en citer qu’un exemple, nous voyons aujourd’hui les free-traders prendre parti pour les États-Unis dans la question de l’Orégon et du Texas. Que leur importe, en effet, que ces contrées s’administrent elles-mêmes sous la tutelle de l’Union, au lieu d’être gouvernées par un président mexicain ou un lord-commissaire anglais, pourvu que chacun y puisse vendre, acheter, acquérir, travailler ; pourvu que toute transaction honnête y soit libre ? À ces conditions, ils abandonneraient encore volontiers aux États-Unis et les deux Canada et la Nouvelle-Écosse, et les Antilles par-dessus le marché ; ils les donneraient même sans cette condition, bien assurés que la liberté des échanges sera tôt ou tard la loi des transactions internationales [9].
Mais il est facile de comprendre pourquoi les free-traders ont commencé par réunir toutes leurs forces contre un seul monopole, celui des céréales : c’est qu’il est la clef de voûte du système tout entier. C’est la part de l’aristocratie, c’est le lot spécial que se sont adjugé les législateurs. Qu’on leur arrache ce monopole, et ils feront bon marché de tous les autres.
C’est d’ailleurs celui dont le poids est le plus lourd au peuple, celui dont l’iniquité est la plus facile à démontrer. L’impôt sur le pain ! sur la nourriture ! sur la vie ! Voilà, certes, un mot de ralliement merveilleusement propre à réveiller la sympathie des masses.
C’est certainement un grand et beau spectacle que de voir un petit nombre d’hommes essayant, à force de travaux, de persévérance et d’énergie, de détruire le régime le plus oppressif et le plus fortement organisé, après l’esclavage, qui ait pesé jamais sur un grand peuple et sur l’humanité, et cela sans en appeler à la force brutale, sans même essayer de déchaîner l’animadversion publique, mais en éclairant d’une vive lumière tous les replis de ce système, en réfutant tous les sophismes sur lesquels il s’appuie, en inculquant aux masses les connaissances et les vertus qui seules peuvent les affranchir du joug qui les écrase.
Mais ce spectacle devient bien plus imposant encore, quand on voit l’immensité du champ de bataille s’agrandir chaque jour par le nombre des questions et des intérêts qui viennent, les uns après les autres, s’engager dans la lutte.
D’abord l’aristocratie dédaigne de descendre dans la lice. Quand elle se voit maîtresse de la puissance politique par la possession du sol, de la puissance matérielle par l’armée et la marine, de la puissance morale par l’Église, de la puissance législative par le Parlement, et enfin de celle qui vaut toutes les autres, de la puissance de l’opinion publique par cette fausse grandeur nationale qui flatte le peuple et qui semble liée aux institutions qu’on ose attaquer ; quand elle contemple la hauteur, l’épaisseur et la cohésion des fortifications [24] dans lesquelles elle s’est retranchée ; quand elle compare ses forces avec celles que quelques hommes isolés dirigent contre elle, — elle croit pouvoir se renfermer dans le silence et le dédain.
Cependant la Ligue fait des progrès. Si l’aristocratie a pour elle l’Église établie, la Ligue appelle à son aide toutes les Églises dissidentes. Celles-ci ne se rattachent pas au monopole par la dîme ; elles se soutiennent par des dons volontaires, c’est-à-dire par la confiance publique. Elles ont bientôt compris que l’exploitation de l’homme par l’homme, qu’on la nomme esclavage ou protection, est contraire à la charte chrétienne. Seize cents ministres dissidents répondent à l’appel de la Ligue. Sept cents d’entre eux, accourus de tous les points du royaume, se réunissent à Manchester. Ils délibèrent ; et le résultat de leur délibération est qu’ils iront prêcher, dans toute l’Angleterre, la cause de la liberté des échanges comme conforme aux lois providentielles qu’ils ont mission de promulguer.
Si l’aristocratie a pour elle la propriété foncière et les classes agricoles, la Ligue s’appuie sur la propriété des bras, des facultés et de l’intelligence. Rien n’égale le zèle avec lequel les classes manufacturières s’empressent de concourir à la grande œuvre. Les souscriptions spontanées versent au fonds de la Ligue 200,000 fr. en 1841, 600,000 en 1842, un million en 1843, 2 millions en 1844 ; et en 1845 une somme double, peut-être triple, sera consacrée à l’un des objets que l’association a en vue, l’inscription d’un grand nombre de free-traders sur les listes électorales. Parmi les faits relatifs à cette souscription, il en est un qui produisit sur les esprits une profonde sensation. La liste, ouverte à Manchester le 14 novembre 1844, présenta, à la fin de cette même journée, une recette de 16,000 livres sterling (400,000 francs). Grâce à ces abondantes ressources, la Ligue, revêtant ses doctrines des formes les plus variées et les plus lucides, les distribue parmi le peuple dans des brochures, des pamphlets, des placards, des journaux innombrables ; elle divise l’Angleterre en douze districts, dans chacun desquels elle entretient un professeur d’économie politique. Elle-même, comme une université mouvante, tient ses séances en public dans toutes les villes et tous les comtés de la Grande-Bretagne. Il semble d’ailleurs que celui qui dirige les événements humains a ménagé à la Ligue des moyens inattendus de succès. La réforme postale lui permet d’entretenir, avec les comités électoraux qu’elle a fondés dans tout le pays, une correspondance qui comprend annuellement plus de 300,000 dépêches ; les chemins de fer impriment à ses mouvements un caractère d’ubiquité, et l’on voit les mêmes hommes qui ont agité le matin à Liverpool agiter le soir à Edimbourg ou à Glasgow ; enfin la réforme électorale a ouvert à la classe moyenne les portes du Parlement, et les fondateurs de la Ligue, les Cobden, les Bright, les Gibson, les Villiers, sont admis à combattre le monopole, en face des monopoleurs et dans l’enceinte même où il fut décrété. Ils entrent dans la Chambre des communes, et ils y forment, en dehors des Whigs et des Torys, un parti, si l’on peut lui donner ce nom, qui n’a pas de précédents dans les annales des peuples constitutionnels, un parti décidé à ne sacrifier jamais la vérité absolue, la justice absolue, les principes absolus aux questions de personnes, aux combinaisons, à la stratégie des ministères et des oppositions.
Mais il ne suffisait pas de rallier les classes sociales sur qui pèse directement le monopole ; il fallait encore dessiller les yeux de celles qui croient sincèrement leur bien-être et même leur existence attachés au système de la protection. M. Cobden entreprend cette rude et périlleuse tâche. Dans l’espace de deux mois, il provoque quarante meetings au sein même des populations agricoles. Là, entouré souvent de milliers de laboureurs et de fermiers, parmi lesquels on pense bien que se sont glissés, à l’instigation des intérêts menacés, bien des agents de désordre, il déploie un courage, un sang-froid, une habileté, une éloquence, qui excitent l’étonnement, si ce n’est la sympathie de ses plus ardents adversaires. Placé dans une position analogue à celle d’un Français qui irait prêcher la doctrine de la liberté commerciale dans les forges de Decazeville ou parmi les mineurs d’Anzin, on ne sait ce qu’il faut le plus admirer, dans cet homme éminent, à la fois économiste, tribun, homme d’État, tacticien, théoricien, et auquel je crois qu’on peut faire une juste application de ce qu’on a dit de Destutt de Tracy : « À force de bon sens, il atteint au génie. » Ses efforts obtiennent la récompense qu’ils méritent, et l’aristocratie a la douleur de voir le principe de la liberté gagner rapidement au sein de la population vouée à l’agriculture.
Aussi le temps n’est plus où elle s’enveloppait dans sa morgue méprisante ; elle est enfin sortie de son inertie. Elle essaie de reprendre l’offensive, et sa première opération est de calomnier la Ligue et ses fondateurs. Elle scrute leur vie publique et privée, mais forcée bientôt d’abandonner le champ de bataille des personnalités, où elle pourrait bien laisser plus de morts et de blessés que la Ligue, elle appelle à son secours l’armée de sophismes qui, dans tous les temps et dans tous les pays, ont servi d’étai au monopole. Protection à l’agriculture, invasion des produits étrangers, baisse des salaires résultant de l’abondance des subsistances, indépendance nationale, épuisement du numéraire, débouchés coloniaux assurés, prépondérance politique, empire des mers ; voilà les questions qui s’agitent, non plus entre savants, non plus d’école à école, mais devant le peuple, mais de démocratie à aristocratie.
Cependant il se rencontre que les Ligueurs ne sont pas seulement des agitateurs courageux ; ils sont aussi de profonds économistes. Pas un de ces nombreux sophismes ne résiste au choc de la discussion ; et, au besoin, des enquêtes parlementaires, provoquées par la Ligue, viennent en démontrer l’inanité.
L’aristocratie adopte alors une autre marche. La misère est immense, profonde, horrible, et la cause en est patente ; c’est qu’une odieuse inégalité préside à la distribution de la richesse sociale. Mais au drapeau de la Ligue qui porte inscrit le mot justice, l’aristocratie oppose une bannière où on lit le mot charité. Elle ne conteste plus les souffrances populaires ; mais elle compte sur un puissant moyen de diversion, l’aumône. « Tu souffres, dit-elle au peuple ; c’est que tu as trop multiplié, et je vais te préparer un vaste système d’émigration. (Motion de M. Butler.) — Tu meurs d’inanition ; je donnerai à chaque famille un jardin et une vache. (Allotments.) — Tu es exténué de fatigue ; c’est que l’on exige de toi trop de travail, et j’en limiterai la durée. (Bill de dix heures.) » Ensuite viennent les souscriptions pour procurer gratuitement aux classes pauvres des établissements de bains, des lieux de récréations, les bienfaits d’une éducation nationale, etc. Toujours des aumônes, toujours des palliatifs ; mais quant à la cause qui les nécessite, quant au monopole, quant à la distribution factice et partiale de la richesse, on ne parle pas d’y toucher.
La Ligue a ici à se défendre contre un système d’agression d’autant plus perfide, qu’il semble attribuer à ses adversaires, entre autres monopoles, le monopole de la philanthropie, et la placer elle-même dans ce cercle de justice exacte et froide qui est bien moins propre que la charité, même impuissante, même hypocrite, à exciter la reconnaissance irréfléchie de ceux qui souffrent.
Je ne reproduirai pas les objections que la Ligue oppose à tous ces projets d’institutions prétendues charitables, on en verra quelques-unes dans le cours de l’ouvrage. Il me suffira de dire qu’elle s’est associée à celles de ces œuvres qui ont un caractère incontestable d’utilité. C’est ainsi que, parmi les free-traders de Manchester, il a été recueilli près d’un million pour donner de l’espace, de l’air et du jour aux quartiers habités par les classes ouvrières. Une somme égale, provenant aussi de souscriptions volontaires, a été consacrée dans cette ville à l’établissement de maisons d’école. Mais en même temps la Ligue ne s’est pas lassée de montrer le piège caché sous ce fastueux étalage de philanthropie : « Quand les Anglais meurent de faim, disait-elle, il ne suffit pas de leur dire : Nous vous transporterons en Amérique où les aliments abondent ; il faut laisser ces aliments entrer en Angleterre. Il ne suffit pas de donner aux familles ouvrières un jardin pour y faire croître des pommes de terre ; il faut surtout ne pas leur ravir une partie des profits qui leur procureraient une nourriture plus substantielle. — Il ne suffit pas de limiter le travail excessif auquel les condamne la spoliation ; il faut faire cesser la spoliation même, afin que dix heures de travail en valent douze. — Il ne suffit pas de leur donner de l’air et de l’eau, il faut leur donner du pain ou du moins le droit d’acheter du pain. Ce n’est pas la philanthropie mais la liberté qu’on doit opposer à l’oppression ; ce n’est pas la charité mais la justice qui peut guérir les maux de l’injustice. L’aumône n’a et ne peut avoir qu’une action insuffisante, fugitive, incertaine et souvent dégradante. »
À bout de ses sophismes, de ses faux-fuyants, de ses prétextes dilatoires, il restait une ressource à l’aristocratie : la majorité parlementaire, la majorité qui dispense d’avoir raison. Le dernier acte de l’agitation devait donc se passer au sein des colléges électoraux. Après avoir popularisé les saines doctrines économiques, la Ligue avait à donner une direction pratique aux efforts individuels de ses innombrables prosélytes. Modifier profondément les constituants (constituencies), le corps électoral du royaume, saper l’influence aristocratique, attirer sur la corruption les châtiments de la loi et de l’opinion ; telle est la nouvelle phase dans laquelle est entrée l’agitation, avec une énergie que les progrès semblent accroître. Vires acquirit eundo. À la voix de Cobden, de Bright et de leurs amis, des milliers de free-traders se font inscrire sur les listes électorales, des milliers de monopoleurs en sont rayés, et, d’après la rapidité de ce mouvement, on peut prévoir le jour où le sénat ne représentera plus une classe, mais la communauté.
On demandera peut-être si tant de travaux, tant de zèle, tant de dévouement, sont demeurés jusqu’ici sans influence sur la marche des affaires publiques, et si le progrès des doctrines libérales dans le pays ne s’est pas réfléchi à quelque degré dans la législation.
J’ai exposé, en commençant, le régime économique de l’Angleterre antérieurement à la crise commerciale qui a donné naissance à la Ligue ; j’ai même essayé de soumettre au calcul quelques-unes des extorsions que les classes dominatrices exercent sur les classes asservies par le double mécanisme des impôts et des monopoles.
Depuis cette époque, les uns et les autres ont été modifiés. Qui n’a pas entendu parler du plan financier que sir Robert Peel vient de soumettre à la Chambre des communes, plan qui n’est que le développement de réformes commencées en 1842 et 1844, et dont la complète réalisation est réservée à des sessions ultérieures du Parlement ? Je crois sincèrement qu’on a méconnu en France l’esprit de ces réformes, qu’on en a tour à tour exagéré ou atténué la portée. On m’excusera donc si j’entre ici dans quelques détails, que je m’efforcerai du reste d’abréger le plus qu’il me sera possible.
La spoliation (qu’on me pardonne le retour fréquent de ce terme ; mais il est nécessaire pour détruire l’erreur grossière qui est impliquée dans son synonyme protection), la spoliation, réduite en système de gouvernement, avait produit toutes ses naturelles conséquences : une extrême inégalité des fortunes, la misère, le crime et le désordre au sein des dernières couches sociales, une diminution énorme dans toutes les consommations, par suite, l’affaiblissement des recettes publiques et le déficit, qui, croissant d’année en année, menaçait d’ébranler le crédit de la Grande-Bretagne. Évidemment il n’était pas possible de rester dans une situation qui menaçait d’engloutir le vaisseau de l’État. L’Agitation irlandaise, l’Agitation commerciale, l’Incendiarisme dans les districts agricoles, le Rébeccaïsme dans le pays de Galles, le Chartisme dans les villes manufacturières, ce n’étaient là que les symptômes divers d’un phénomène unique, la souffrance du peuple. Mais la souffrance du peuple, c’est-à-dire des masses, c’est-à-dire encore de la presque universalité des hommes, doit à la longue gagner toutes les classes de la société. Quand le peuple n’a rien, il n’achète rien ; quand il n’achète rien, les fabriques s’arrêtent, et les fermiers ne vendent pas leur récolte ; et s’ils ne vendent pas, ils ne peuvent payer leurs fermages. Ainsi les grands seigneurs législateurs eux-mêmes se trouvaient placés, par l’effet même de leur loi, entre la banqueroute des fermiers et la banqueroute de l’État, et menacés à la fois dans leur fortune immobilière et mobilière. Ainsi l’aristocratie sentait le terrain trembler sous ses pas. Un de ses membres les plus distingués, sir James Graham, aujourd’hui ministre de l’intérieur, avait fait un livre pour l’avertir des dangers qui l’entouraient : « Si vous ne cédez une partie, vous perdrez tout, disait-il, et une tempête révolutionnaire balayera de dessus la surface du pays non-seulement vos monopoles, mais vos honneurs, vos priviléges, votre influence et vos richesses mal acquises. »
Le premier expédient qui se présenta pour parer au danger le plus immédiat, le déficit, fut, selon l’expression consacrée aussi par nos hommes d’État, d’exiger de l’impôt tout ce qu’il peut rendre. Mais il arriva que les taxes mêmes qu’on essaya de renforcer furent celles qui laissèrent le plus de vide au Trésor. Il fallut renoncer pour longtemps à cette ressource, et le premier soin du cabinet actuel, quand il arriva aux affaires, fut de proclamer que l’impôt était arrivé à sa dernière limite : « I am bound to say that the people of this country has been brought to the utmost limit of taxation. » (Peel, discours du 10 mai 1842.)
Pour peu que l’on ait pénétré dans la situation respective des deux grandes classes, dont j’ai décrit les intérêts et les luttes, on comprendra aisément quel était, pour chacune d’elles, le problème à résoudre :
Pour les free-traders, la solution était très-simple : abroger tous les monopoles. Affranchir les importations, c’était nécessairement accroître les échanges et par conséquent les exportations ; c’était donc donner au peuple tout à la fois du pain et du travail ; c’était encore favoriser toutes les consommations, par conséquent les taxes indirectes, et en définitive rétablir l’équilibre des finances.
Pour les monopoleurs, le problème était pour ainsi dire insoluble. Il s’agissait de soulager le peuple sans le soustraire aux monopoles, de relever le revenu public sans augmenter les taxes, et de conserver le système colonial sans diminuer les dépenses nationales.
Le ministère Whig (Russell, Morpeth, Melbourne, Baring, etc.) présenta un plan qui se tenait entre ces deux solutions. Il affaiblissait, sans les détruire, les monopoles et le système colonial. Il ne fut accepté ni par les monopoleurs ni par les free-traders. Ceux-là voulaient le monopole absolu, ceux-ci la liberté illimitée. Les uns s’écriaient : « Pas de concessions ! » les autres : « Pas de transactions ! »
Battus au Parlement, les Whigs en appelèrent au corps électoral. Il donna amplement gain de cause aux Torys, c’est-à-dire à la protection et aux colonies. Le ministère Peel fut constitué (1841) avec mission expresse de trouver l’introuvable solution, dont je parlais tout à l’heure, au grand et terrible problème posé par le déficit et la misère publique ; et il faut avouer qu’il a surmonté la difficulté avec une sagacité de conception et une énergie d’exécution remarquables.
J’essaierai d’expliquer le plan financier de M. Peel, tel du moins que je le comprends.
Il ne faut pas perdre de vue que les divers objets qu’a dû se proposer cet homme d’État, eu égard au parti qui l’appuie, sont les suivants :
1° Rétablir l’équilibre des finances ;
2° Soulager les consommateurs ;
3° Raviver le commerce et l’industrie ;
4° Conserver autant que possible le monopole essentiellement aristocratique, la loi céréale ;
5° Conserver le système colonial et avec lui l’armée, la marine, les hautes positions des branches cadettes ;
6° On peut croire aussi que cet homme éminent, qui plus que tout autre sait lire dans les signes du temps, et qui voit le principe de la Ligue envahir l’Angleterre à pas de géant, nourrit encore au fond de son âme une pensée d’avenir personnelle mais glorieuse, celle de se ménager l’appui des free-traders pour l’époque où ils auront conquis la majorité, afin d’imprimer de sa main le sceau de la consommation à l’œuvre de la liberté commerciale, sans souffrir qu’un autre nom officiel que le sien s’attache à la plus grande révolution des temps modernes ;
Il n’est pas une des mesures, une des paroles de Sir Robert Peel qui ne satisfasse aux conditions prochaines ou éloignées de ce programme. On va en juger.
Le pivot autour duquel s’accomplissent toutes les évolutions financières et économiques dont il nous reste à parler, c’est l’income-tax.
L’income-tax, on le sait, est un subside prélevé sur les revenus de toutes natures. Cet impôt est essentiellement temporaire et patriotique. On n’y a recours que dans les circonstances les plus graves, et jusqu’ici, en cas de guerre. Sir Robert Peel l’obtint du Parlement en 1842, et pour trois ans ; il vient d’être prorogé jusqu’en 1849. C’est la première fois qu’au lieu de servir à des fins de destruction et à infliger à l’humanité les maux de la guerre, il sera devenu l’instrument de ces utiles réformes que cherchent à réaliser les nations qui veulent mettre à profit les bienfaits de la paix.
Il est bon de faire observer ici que tous les revenus au-dessous de 150 liv. sterl. (3,700 fr.) sont affranchis de la taxe, en sorte qu’elle frappe exclusivement la classe riche. On a beaucoup répété, de ce côté comme de l’autre côté du détroit, que l’income-tax était définitivement inscrit dans le Code financier de l’Angleterre. Mais quiconque connaît la nature de cet impôt et le mode d’après lequel il est perçu, sait bien qu’il ne saurait être établi d’une manière permanente, du moins dans sa constitution actuelle ; et, si le cabinet entretient à cet égard quelque arrière-pensée, il est permis de croire qu’en habituant les classes aisées à contribuer dans une plus forte proportion aux charges publiques, il songe à mettre l’impôt foncier (land-tax), dans la Grande-Bretagne, plus en harmonie avec les besoins de l’État et les exigences d’une équitable justice distributive.
Quoi qu’il en soit, le premier objet que le ministère Tory avait en vue, le rétablissement de l’équilibre dans les finances, fut atteint, grâce aux ressources de l’income-tax ; et le déficit qui menaçait le crédit de l’Angleterre a, du moins provisoirement, disparu.
Un excédant de recettes était même prévu dès 1842. Il s’agissait de l’appliquer à la seconde et à la troisième condition du programme : Soulager les consommateurs ; raviver le commerce et l’industrie.
Ici nous entrons dans la longue série des réformes douanières exécutées en 1842, 1843, 1844 et 1845. Notre intention ne peut être de les exposer en détail ; nous devons nous borner à faire connaître l’esprit dans lequel elles ont été conçues.
Toutes les prohibitions ont été abolies. Les bœufs, les veaux, les moutons, la viande fraîche et salée, qui étaient repoussés d’une manière absolue, furent admis à des droits modérés : les bœufs, par exemple, à 25 fr. par tête (le droit est presque double en France), ce qui n’a pas empêché M. Gauthier de Rumilly de dire en pleine Chambre, en 1845, sans être contredit par personne, tant les journaux ont eu soin de nous tenir dans l’ignorance sur ce qui se passe de l’autre côté de la Manche, que les bestiaux sont encore prohibés en Angleterre.
Les droits furent abaissés dans une très-forte proportion, et quelquefois de moitié, des deux tiers et des trois quarts sur 650 articles de consommation : entre autres les farines, l’huile, le cuir, le riz, le café, le suif, la bière, etc., etc.
Ces droits, d’abord abaissés, ont été complétement abolis en 1845 sur 430 articles, parmi lesquels figurent toutes les matières premières de quelque importance, la laine, le coton, le lin, le vinaigre, etc., etc.
Les droits d’exportation furent aussi radicalement abrogés. Les machines et la houille, ces deux puissances dont, dans des idées étroites de rivalité commerciale, il serait peut-être assez naturel que l’Angleterre se montrât jalouse, sont en ce moment à la disposition de l’Europe. Nous en pourrions jouir aux mêmes prix que les Anglais, si, par une bizarrerie étrange, mais parfaitement conséquente au principe du système protecteur, nous ne nous étions placés nous-mêmes, par nos tarifs, dans des conditions d’infériorité à l’égard de ces instruments essentiels de travail, au moment même où l’égalité nous était offerte ou pour mieux dire conférée sans condition.
On conçoit que l’abrogation totale d’un droit d’entrée doit laisser un vide définitif ; et l’abaissement, un vide au moins momentané dans le Trésor. C’est ce vide que les excédants de recette dus à l’income-tax sont destinés à couvrir.
Cependant l’income-tax n’a qu’une durée limitée. Le cabinet Tory a espéré que l’accroissement de la consommation, l’essor du commerce et de l’industrie réagirait sur toutes les branches de revenus de manière à ce que l’équilibre des finances fût rétabli en 1849, sans que la ressource de l’income-tax fût plus longtemps nécessaire. Autant qu’on en peut juger par les résultats de la réforme partielle de 1842, ces espérances ne seront pas trompées. Déjà les recettes générales de 1844 ont dépassé celles de 1843 de liv. sterl. 1,410,726 (35 millions de francs).
D’un autre côté, tous les faits concordent à témoigner que l’activité a repris dans toutes les branches du travail, et que le bien-être s’est répandu dans toutes les classes de la société. Les prisons et les work-houses se sont dépeuplées ; la taxe des pauvres a baissé ; l’accise a fructifié ; le Rébeccaïsme et l’Incendiarisme se sont apaisés ; en un mot, le retour de la prospérité se montre par tous les signes qui servent à la révéler, et entre autres par les recettes des douanes.
| Recettes de l’année | 1841 (sous le système ancien) | 19,900,000 | l. st. |
| — | 1842 | 18,700,000 | |
| — | 1843 première année de la réforme | 21,400,000 | |
| — | 1844 | 23,500,000 |
Maintenant si l’on considère que, pendant cette dernière année, les marchandises qui ont passé par la douane n’ont rien payé à la sortie (abrogation des droits d’exportation), et n’ont acquitté à l’entrée que des taxes réduites, au moins pour 650 articles (abaissement des droits d’importation), on en conclura rigoureusement que la masse des produits importés a dû augmenter dans une proportion énorme pour que la recette totale, non-seulement n’ait pas diminué, mais encore se soit élevée de cent millions de francs.
Il est vrai que, d’après les économistes de la presse et de la tribune françaises, cet accroissement d’importations ne prouve autre chose que la décadence de l’industrie de la Grande-Bretagne, l’invasion, l’inondation de ses marchés par les produits étrangers, et la stagnation de son travail national ! Nous laisserons ces messieurs concilier, s’ils le peuvent, cette conclusion avec tous les autres signes par lesquels se manifeste la renaissante prospérité de l’Angleterre ; et, pour nous, qui croyons que les produits s’échangent contre des produits, satisfaits de trouver, dans l’accord des faits qui précèdent, une preuve nouvelle et éclatante de la vérité de cette doctrine, nous dirons que sir Robert Peel a rempli la seconde et la troisième condition de son programme : Soulager le consommateur ; raviver le commerce et l’industrie.
Mais ce n’était pas pour cela que les Torys l’avaient porté, le soutenaient au pouvoir. Encore tout émus de la frayeur que leur avait causée le plan bien autrement radical de John Russell, et de l’orgueil de leur récent triomphe sur les Whigs, ils n’étaient pas disposés à perdre le fruit de leur victoire, et ils entendaient bien ne laisser agir l’homme de leur choix, dans l’accomplissement de son œuvre, qu’autant qu’il ne toucherait pas, ou qu’il ne toucherait que d’une manière illusoire aux deux grands instruments de rapine que s’est législativement attribués l’aristocratie anglaise : La loi-céréale et le système colonial.
C’est surtout dans cette difficile partie de sa tâche que le premier ministre a déployé toutes les ressources de son esprit fertile en expédients.
Lorsqu’un droit d’entrée a fait arriver le prix d’un produit à ce taux que la concurrence intérieure ne permet, en aucun cas, de dépasser, tout son effet protecteur est obtenu. Ce qu’on ajouterait à ce droit serait purement nominal, et ce qu’on en retrancherait, dans les limites de cet excédant, serait évidemment inefficace. Supposez qu’un produit français, soumis à la rivalité étrangère, se vende à 15 fr., et qu’affranchi de cette rivalité, il ne puisse, à cause de la concurrence intérieure, s’élever au-dessus de 20 fr. En ce cas, un droit de 5 ou 6 fr. sur le produit étranger donnera au similaire national toute la protection qu’il soit au pouvoir du tarif de conférer. Le droit, fût-il porté à 100 fr., n’élèverait pas d’un centime le prix du produit, d’après l’hypothèse même, et par conséquent toute réduction, qui ne descendrait pas au-dessous de 5 ou 6 fr., serait de nul effet pour le producteur et pour le consommateur.
Il semble que l’observation de ce phénomène a dirigé la conduite de sir Robert Peel, en ce qui concerne le grand monopole aristocratique, le blé, et le grand monopole colonial, le sucre.
Nous avons vu que la loi-céréale, qui avait pour but avoué d’assurer au producteur national 64 sh. par quarter de froment avait failli dans son objet. L’échelle mobile (sliding scale) était bien calculée pour atteindre ce but, car elle ajoutait au prix du blé étranger à l’entrepôt un droit graduel qui devait faire ressortir le prix vénal à 70 sh. et plus. Mais la concurrence des producteurs nationaux, d’une part, et, de l’autre, la diminution de consommation qui suit la cherté, ont concouru à retenir le blé à un taux moyen moins élevé et qui n’a pas dépassé 56 sh. Qu’a fait alors sir Robert Peel ? Il a tranché dans cette portion de droit qui était radicalement inefficace, et il a baissé l’échelle mobile de manière, à ce qu’il pensait, à fixer le froment à 56 sh., c’est-à-dire au prix le plus élevé que la concurrence intérieure lui permette d’atteindre, dans les temps ordinaires ; en sorte qu’en réalité il n’a rien arraché à l’aristocratie ni rien conféré au peuple.
À cet égard, sir Robert n’a pas caché cette politique de prestidigitateur, car à toute demande de droits plus élevés, il répondait : « Je crois que vous avez eu des preuves concluantes que vous êtes arrivés à l’extrême limite de la taxe utile (profitable taxation), sur les articles de subsistances. Je vous conseille de ne pas l’accroître, car si vous le faites, vous serez certainement déjoués dans votre but. » « Most assuredly you will be defeated in your object. »
Je n’ai parlé que du froment, mais il est bon d’observer que la même loi embrasse les céréales de toutes sortes. De plus, le beurre et le fromage, qui entrent pour beaucoup dans les revenus des domaines seigneuriaux, n’ont point été dégrevés. Il est donc bien vrai que le monopole aristocratique n’a été que très-inefficacement entamé.
La même pensée a présidé aux diverses modifications introduites dans la loi des sucres. Nous avons vu que la prime accordée aux planteurs, ou le droit différentiel entre le sucre colonial et le sucre étranger, était de 39 sh. par quintal. C’est là la marge que la spoliation avait devant elle ; mais à cause de la concurrence que se font entre elles les colonies, elles n’ont pu extorquer au consommateur, en excédant du prix naturel et du droit fiscal, que 18 sh. (Voir ci-dessus, pages 24 et suiv.) Sir Robert pouvait donc abaisser le droit différentiel de 39 sh. à 18 sans rien changer, si ce n’est une lettre morte, dans le statute-book.
Or, qu’a-t-il fait ? Il a établi le tarif suivant :
| Sucre colonial, | brut | 14 | sh. |
| — | terré | 16 | |
| Sucre étranger (libre), | brut | 23 | |
| — | terré | 28 | |
| Sucre étranger | (esclave) | 63 |
Il estime qu’il entrera en Angleterre, sous l’empire de ce nouveau tarif, 230,000 tonnes de sucre colonial ; et la protection étant de 10 sh. par quintal ou 10 liv. st. par tonne, la somme extorquée au consommateur, pour être livrée sans compensation aux planteurs, sera de 2,300,000 liv. st., ou fr. 57,000,000, au lieu de 86 millions. (Voir page 25).
Mais d’un autre côté, il dit : « La conséquence sera que le Trésor recevra du droit sur le sucre, par suite de la réduction, liv. st. 3,960,000. Le revenu obtenu de cette denrée, l’année dernière, a été de 5,216,000 liv., il y, aura donc pour l’année prochaine une perte de revenu de 1,300,000 liv. sterl., » soit fr. 32,500,000, et c’est l’income-tax, c’est-à-dire un nouvel impôt, qui est chargé de remplir le vide laissé à l’Échiquier ; en sorte que si le peuple est soulagé, en ce qui concerne la consommation du sucre, ce n’est pas au préjudice du monopole, mais aux dépens du Trésor, et comme on rend à celui-ci par l’income-tax ce qu’il perd sur la douane, il en résulte que les spoliations et les charges restent les mêmes, et c’est tout au plus si l’on peut dire qu’elles subissent un léger déplacement.
Dans tout l’ensemble des réformes réelles ou apparentes accomplies par sir Robert Peel, sa prédilection en faveur du système colonial ne cesse de se manifester, et c’est là surtout ce qui le sépare profondément des free-traders. Chaque fois que le ministre a dégrevé une denrée étrangère, il a eu soin de dégrever, dans une proportion au moins aussi forte, la denrée similaire venue des colonies anglaises ; en sorte que la protection reste la même. Ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, le bois de construction étranger a été réduit des cinq sixièmes ; mais le bois des colonies l’a été des neuf dixièmes. Le patrimoine des branches cadettes de l’aristocratie n’a donc pas été sérieusement entamé, pas plus que celui des branches aînées, et, à ce point de vue, l’on peut dire que le plan financier (financial statement), l’audacieuse expérience (bold experiment), du ministre dirigeant, demeurent renfermés dans les bornes d’une question anglaise, et ne s’élèvent pas à la hauteur d’une question humanitaire ; car l’humanité n’est que fort indirectement intéressée au régime intérieur de l’échiquier anglais, mais elle eût été profondément et favorablement affectée d’une réforme, même financière, impliquant la chute de ce système colonial qui a tant troublé et menace encore si gravement la paix et la liberté du monde.
Loin que sir Robert Peel suive la Ligue sur ce terrain, il ne perd pas une occasion de se prononcer en faveur des colonies, et, dans l’exposé des motifs de son plan financier, après avoir rappelé à la Chambre que l’Angleterre possède quarante-cinq colonies, après avoir même demandé à ce sujet un accroissement d’allocations, il ajoute : « On pourra dire qu’il est contraire à la sagesse d’étendre autant que nous l’avons fait notre système colonial. Mais je m’en tiens au fait que vous avez des colonies, et que, les ayant, il faut les pourvoir de forces suffisantes. Je répugnerais d’ailleurs, quoique je sache combien ce système entraîne de dépenses et de dangers, je répugnerais à condamner cette politique qui nous a conduits à jeter sur divers points du globe les bases de ces possessions animées de l’esprit anglais, parlant la langue anglaise et destinées peut-être à s’élever dans l’avenir au rang de grandes puissances commerciales ! »
Je crois avoir démontré que sir Robert Peel a rempli avec habileté les plus funestes parties de son programme. Il me resterait à justifier les motifs des prévisions qui m’ont fait dire : « On peut croire encore que cet homme éminent qui, plus que tout autre, sait lire dans les signes du temps, et qui voit le principe de la Ligue envahir l’Angleterre à pas de géant, nourrit au fond de son âme une pensée personnelle, mais glorieuse, celle de se ménager l’appui des free-traders pour l’époque où ils auront conquis la majorité, afin d’imprimer de ses mains le sceau de la consommation à l’œuvre de la liberté commerciale, sans souffrir qu’un autre nom officiel que le sien s’attache à la plus grande révolution des temps modernes. »
Comme il ne s’agit ici que d’une simple conjecture qui, vu l’humble source d’où elle émane, ne peut avoir pour le lecteur qu’une faible importance, je ne vois aucune utilité à la justifier à ses yeux [10]. Je ne crois pas qu’elle ait rien de chimérique pour quiconque a étudié la situation économique du Royaume-Uni, le dénoûment probable des réformes qu’il subit, le caractère de celui qui les dirige, le mouvement et le déplacement, même actuels, des majorités, et surtout les rapides progrès de l’opinion dans les masses et au sein du corps électoral. Jusqu’ici sir Robert Peel s’est montré grand financier, grand ministre, grand homme d’État peut-être ; pourquoi n’aspirerait-il pas au titre de grand homme, que la postérité ne décernera plus sans doute qu’aux bienfaiteurs de l’humanité ?
Il ne sera peut-être pas sans intérêt pour le lecteur d’entrevoir l’issue probable des réformes dont nous ne connaissons encore que les premiers linéaments. Une brochure récente vient de révéler un plan financier qui doit rallier les membres influents de la Ligue. Nous le mentionnerons ici, tant à cause de son admirable simplicité et de sa parfaite conformité aux principes les plus purs de la liberté commerciale, que parce qu’il est loin d’être dépourvu de tout caractère officiel. Il émane, en effet, d’un officier du Board of trade, M. Mac-Grégor, comme la réforme postale eut pour promoteur un employé du post-office, M. Rowland-Hill. On peut ajouter qu’il a assez d’analogie avec les changements opérés par sir Robert Peel pour laisser supposer qu’il n’a pas été jeté dans le public à l’insu, et moins encore contre la volonté du premier ministre.
Voici le plan du secrétaire du Board of trade.
Il suppose que les dépenses s’élèveront comme aujourd’hui, à 50 millions st. Elles devront subir sans doute une grande diminution, car ce plan entraîne une forte réduction dans l’armée, la marine, l’administration des colonies et la perception de l’impôt ; en ce cas, les excédants de recettes pourront être affectés, soit au remboursement de la dette, soit au dégrèvement de la contribution directe dont il va être parlé.
Les recettes se puiseraient aux sources suivantes :
Douane. — Les droits seraient uniformes, que les produits viennent des colonies ou de l’étranger.
Il n’y aurait que huit articles soumis aux droits d’entrée, savoir :
1° Thé ; 2° sucre ; 3° café et cacao ; 4° tabac ; 5° esprits distillés ; 6° vins ; 7° fruits secs ; 8° épiceries.
| Produit | 21,500,000 | l. st. | 31,500,000 | l. st. | |
| Esprits distillés à l’intérieur | 5,000,000 | ||||
| Drèche tant indigène qu’importée. | 5,000,000 | ||||
| Ces deux derniers impôts réunis à l’administration des douanes. | |||||
| Timbre. — On en éliminerait les droits sur les assurances contre les risques de mer et d’incendie, et l’on y réunirait les licences, ci | 7,500,000 | ||||
| Taxe foncière, non rachetée | 1,200,000 | ||||
| Déficit à couvrir, la première année, par un impôt direct qui est une combinaison de l’income-tax et du land-tax | 9,800,000 | ||||
| Total égal de la dépense… | 50,000,000 | l. st. | |||
Quant à la poste, M. Mac-Grégor pense qu’elle ne doit pas être une source de revenus. On ne peut pas abaisser le tarif actuel, puisqu’il est réduit à la plus minime monnaie usitée en Angleterre ; mais les excédants de recettes seraient appliqués à l’amélioration du service et au développement des paquebots à vapeur.
Il faut observer que dans ce système :
1° La protection est complétement abolie, puisque la douane ne frappe que des objets que l’Angleterre ne produit pas, excepté les esprits et la drêche. Mais ceux-ci sont soumis à un droit égal à leurs similaires étrangers.
2° Le système colonial est radicalement renversé. Au point de vue commercial, les colonies sont indépendantes de la métropole et la métropole des colonies, car les droits sont uniformes ; il n’y a plus de priviléges, et chacun reste libre de se pourvoir au marché le plus avantageux. Il suit de là qu’une colonie qui se séparerait politiquement de la mère patrie n’apporterait aucun changement dans son commerce et son industrie. Elle ne ferait que soulager ses finances.
3° Toute l’administration financière de la Grande-Bretagne se réduit à la perception de l’impôt direct, à la douane, considérablement simplifiée, et au timbre. Les assessed taxes et l’accise sont supprimées, et les transactions intérieures et extérieures laissées à une liberté et une rapidité dont les effets sont incalculables.
Tel est, très en abrégé, le plan financier qui semble être comme le type, l’idéal vers lequel on ne peut s’empêcher de reconnaître que tendent de fort loin, il est vrai, les réformes qui s’accomplissent sous les yeux de la France inattentive. Cette digression servira peut-être de justification à la conjecture que j’ai osé hasarder sur l’avenir et les vues ultérieures de sir Robert Peel.
Je me suis efforcé de poser nettement la question qui s’agite en Angleterre. J’ai décrit et le champ de bataille, et la grandeur des intérêts qui s’y discutent, et les forces qui s’y rencontrent, et les conséquences de la victoire. J’ai démontré, je crois, que bien que toute la chaleur de l’action semble se concentrer sur des questions d’impôt, de douanes, de céréales, de sucre, — au fait il s’agit de monopole et de liberté, d’aristocratie et de démocratie, d’égalité ou d’inégalité dans la distribution du bien-être. Il s’agit de savoir si la puissance législative et l’influence politique demeureront aux hommes de rapine ou aux hommes de travail, c’est-à-dire si elles continueront à jeter dans le monde des ferments de troubles et de violences, ou des semences de concorde, d’union, de justice et de paix.
Que penserait-on de l’historien qui s’imaginerait que l’Europe en armes, au commencement de ce siècle, ne faisait exécuter, sous la conduite des plus habiles généraux, tant de savantes manœuvres à ses innombrables armées que pour savoir à qui resteraient les champs étroits où se livrèrent les batailles d’Austerlitz ou de Wagram ? Les dynasties et les empires dépendaient de ces luttes. Mais les triomphes de la force peuvent être éphémères ; il n’en est pas de même de ceux de l’opinion. Et quand nous voyons tout un grand peuple, dont l’action sur le monde n’est pas contestée, s’imprégner des doctrines de la justice et de la vérité, quand nous le voyons renier les fausses idées de suprématie qui l’ont si longtemps rendu dangereux aux nations, quand nous le voyons prêt à arracher l’ascendant politique à une oligarchie cupide et turbulente, gardons-nous de croire, alors même que l’effort des premiers combats se porterait sur des questions économiques, que de plus grands et de plus nobles intérêts ne sont pas engagés dans la lutte. Car, si à travers bien des leçons d’iniquité, bien des exemples de perversité internationale, l’Angleterre, ce point imperceptible du globe, a vu germer sur son sol tant d’idées grandes et utiles ; si elle fut le berceau de la presse, du jury, du système représentatif, de l’abolition de l’esclavage, malgré les résistances d’une oligarchie puissante et impitoyable ; que ne doit pas attendre l’univers de cette même Angleterre, alors que toute sa puissance morale, sociale et politique aura passé aux mains de la démocratie, par une révolution lente et pénible, paisiblement accomplie dans les esprits, sous la conduite d’une association qui renferme dans son sein tant d’hommes, dont l’intelligence supérieure et la moralité éprouvées jettent un si grand éclat sur leur pays et sur leur siècle ? Une telle révolution n’est pas un événement, un accident, une catastrophe due à un enthousiasme irrésistible, mais éphémère. C’est, si je puis le dire, un lent cataclysme social qui change toutes les conditions d’existence de la société, le milieu où elle vit et respire. C’est la justice s’emparant de la puissance et le bon sens entrant en possession de l’autorité. C’est le bien général, le bien du peuple, des masses, des petits et des grands, des forts et des faibles devenant la règle de la politique ; c’est le privilége, l’abus, la caste disparaissant de dessus la scène, non par une révolution de palais ou une émeute de la rue, mais par la progressive et générale appréciation des droits et des devoirs de l’homme. En un mot, c’est le triomphe de la liberté humaine, c’est la mort du monopole, ce Protée aux mille formes, tour à tour conquérant, possesseur d’esclaves, théocrate, féodal, industriel, commercial, financier et même philanthrope. Quelque déguisement qu’il emprunte, il ne saurait plus soutenir le regard de l’opinion publique ; car elle a appris à le reconnaître sous l’uniforme rouge, comme sous la robe noire, sous la veste du planteur, comme sous l’habit brodé du noble pair. Liberté à tous ! à chacun juste et naturelle rémunération de ses œuvres ! à chacun juste et naturelle accession à l’égalité, en proportion de ses efforts, de son intelligence, de sa prévoyance et de sa moralité. Libre échange avec l’univers ! Paix avec l’univers ! Plus d’asservissement colonial, plus d’armée, plus de marine que ce qui est nécessaire pour le maintien de l’indépendance nationale ! Distinction radicale de ce qui est et de ce qui n’est pas la mission du gouvernement et de la loi ! L’association politique réduite à garantir à chacun sa liberté et sa sûreté contre toute agression inique, soit au dehors, soit au dedans ; impôt équitable pour défrayer convenablement les hommes chargés de cette mission, et non pour servir de masque, sous le nom de débouchés, à l’usurpation extérieure, et, sous le nom de protection, à la spoliation des citoyens les uns par les autres : voilà ce qui s’agite en Angleterre, sur le champ de bataille, en apparence si restreint, d’une question douanière. Mais cette question implique l’esclavage dans sa forme moderne, car, comme le disait au Parlement un membre de la Ligue, M. Gibson : « S’emparer des hommes pour les faire travailler à son profit, ou s’emparer des fruits de leur travail, c’est toujours de l’esclavage ; il n’y a de différence que dans le degré. »
[here ends extract in JDE juin 1845]
À l’aspect de cette révolution qui, je ne dirai pas se prépare, mais s’accomplit dans un pays voisin, dont les destinées, on n’en disconvient pas, intéressent le monde entier ; à l’aspect des symptômes évidents de ce travail humanitaire, symptômes qui se révèlent jusques dans les régions diplomatiques et parlementaires, par les réformes successives arrachées à l’aristocratie depuis quatre ans ; à l’aspect de cette agitation puissante, bien autrement puissante que l’agitation irlandaise, et bien autrement importante par ses résultats, puisqu’elle tend, entre autres choses, à modifier les relations des peuples entre eux, à changer les conditions de leur existence industrielle, et à substituer dans leurs rapports le principe de la fraternité à celui de l’antagonisme, — on ne peut s’étonner assez du silence profond, universel et systématique que la presse française semble s’être imposé. De tous les phénomènes sociaux qu’il m’a été donné d’observer, ce silence, et surtout son succès, est certainement celui qui me jette dans le plus profond étonnement. Qu’un petit prince d’Allemagne, à force de vigilance, fût parvenu, pendant quelques mois, à empêcher le bruit de la révolution française de retentir dans ses domaines, on pourrait, à la rigueur, le comprendre. Mais qu’au sein d’une grande nation, qui se vante de posséder la liberté de la presse et de la tribune, les journaux aient réussi à soustraire à la connaissance du public, pendant sept années consécutives, le plus grand mouvement social des temps modernes, et des faits qui, indépendamment de leur portée humanitaire, doivent exercer et exercent déjà sur notre propre régime industriel une influence irrésistible, c’est là un miracle de stratégie auquel la postérité ne pourra pas croire et dont il importe de pénétrer le mystère.
Je sais que c’est manquer de prudence, par le temps qui court, que de heurter la presse périodique. Elle dispose arbitrairement de nous tous. Malheur à qui fuit son despotisme qui veut être absolu ! Malheur à qui excite son courroux qui est mortel ! Le braver ce n’est pas courage, c’est folie, car le courage affronte les chances d’un combat, mais la folie seule provoque un combat sans chances ; et quelle chance peut vous accompagner devant le tribunal de l’opinion publique, alors que, même pour vous défendre, il vous faut emprunter la voix de votre adversaire, alors qu’il peut vous écraser à son choix par sa parole ou son silence ? — N’importe ! Les choses en sont venues au point qu’un acte d’indépendance peut déterminer, dans le journalisme même, une réaction favorable. Dans l’ordre physique, l’excès du mal entraîne la destruction, mais dans le domaine impérissable de la pensée, il ne peut amener qu’un retour au bien. Qu’importe le sort du téméraire qui aura attaché le grelot ? Je crois sincèrement que le journalisme trompe le public ; je crois sincèrement en savoir la cause, et, advienne que pourra, ma conscience me dit que je ne dois pas me taire.
Dans un pays où ne règne pas l’esprit d’association, où les hommes n’ont ni la faculté, ni l’habitude, ni peut-être le désir de s’assembler pour discuter au grand jour leurs communs intérêts, les journaux, quoi qu’on en puisse dire, ne sont pas les organes mais les promoteurs de l’opinion publique. Il n’y a que deux choses en France, des individualités isolées, sans relations, sans connexion entre elles, et une grande voix, la presse, qui retentit incessamment à leurs oreilles. Elle est la personnification de la critique, mais ne peut être critiquée. Comment l’opinion lui servirait-elle de frein, puisqu’elle fait règle, et régente elle-même l’opinion ? En Angleterre, les journaux sont les commentateurs, les rapporteurs, les véhicules d’idées, de sentiments, de passions qui s’élaborent dans les meetings de Conciliation-Hall, de Covent-Garden et d’Exeter-Hall. Mais ici, où ils dirigent l’esprit public, la seule chance qui nous reste de voir à la longue l’erreur succomber et la vérité triompher, c’est la contradiction qui existe entre les journaux eux-mêmes et le contrôle réciproque qu’ils exercent les uns sur les autres.
On conçoit donc que, s’il était une question entre toutes que les journaux de tous les partis eussent intérêt à représenter sous un faux jour, ou même à couvrir de silence ; on conçoit, dis-je, que, dans l’état actuel de nos mœurs et de nos moyens d’investigation, ils pourraient, sans trop de témérité, entreprendre d’égarer complétement l’opinion publique sur cette question spéciale. — Qu’aurez-vous à opposer à cette ligue nouvelle ? — Arrivez-vous de Londres ? Voulez-vous raconter ce que vous avez vu et entendu ? Les journaux vous fermeront leurs colonnes. Prendrez-vous le parti de faire un livre ? Ils le décrieront, ou, qui pis est, ils le laisseront mourir de sa belle mort, et vous aurez la consolation de le voir un beau jour
Chez l’épicier, 3047.Roulé dans la boutique en cornet de papier.
Parlerez-vous à la tribune ? Votre discours sera tronqué, défiguré où passé sous silence.
Voilà précisément ce qui est arrivé dans la question qui nous occupe.
Que quelques journaux eussent pris en main la cause du monopole et des haines nationales, cela ne devrait surprendre personne. Le monopole rallie beaucoup d’intérêts ; le faux patriotisme est l’âme de beaucoup d’intrigues, et il suffit que ces intrigues et ces intérêts existent pour que nous ne soyons pas étonné qu’ils aient leurs organes. Mais que toute la presse périodique, parisienne ou provinciale, celle du Nord comme celle du Midi, celle de gauche comme celle de droite, soit unanime pour fouler aux pieds les principes les mieux établis de l’économie politique ; pour dépouiller l’homme du droit d’échanger librement selon ses intérêts ; pour attiser les inimitiés internationales, dans le but patent et presque avoué d’empêcher les peuples de se rapprocher et de s’unir par les liens du commerce, et pour cacher au public les faits extérieurs qui se lient à cette question, c’est un phénomène étrange qui doit avoir sa raison. Je vais essayer de l’exposer telle que je la vois dans la sincérité de mon âme. Je n’attaque point les opinions sincères, je les respecte toutes ; je cherche seulement l’explication d’un fait aussi extraordinaire qu’incontestable, et la réponse à cette question : Comment est-il arrivé que, parmi ce nombre incalculable de journaux qui représentent tous les systèmes, même les plus excentriques que l’imagination puisse enfanter, alors que le socialisme, le communisme, l’abolition de l’hérédité, de la propriété, de la famille, trouvent des organes, le droit d’échanger, le droit des hommes à troquer entre eux le fruit de leurs travaux n’ait pas rencontré dans la presse un seul défenseur ? Quel étrange concours de circonstances a amené les journaux de toutes couleurs, si divers et si opposés sur toute autre question, à se constituer, avec une touchante unanimité, les défenseurs du monopole, et les instigateurs infatigables des jalousies nationales, à l’aide desquelles il se maintient, se renforce et gagne tous les jours du terrain ?
D’abord, une première classe de journaux a un intérêt direct à faire triompher en France le système de la protection. Je veux parler de ceux qui sont notoirement subventionnés par les comités monopoleurs, agricoles, manufacturiers ou coloniaux. Étouffer les doctrines des économistes, populariser les sophismes qui soutiennent le régime de la spoliation, exalter les intérêts individuels qui sont en opposition avec l’intérêt général, ensevelir dans le plus profond silence les faits qui pourraient réveiller et éclairer l’esprit public : telle est la mission qu’ils se sont chargés d’accomplir, et il faut bien qu’ils gagnent en conscience la subvention que le monopole leur paie.
Mais cette tâche immorale en entraîne une autre plus immorale encore. Il ne suffit pas de systématiser l’erreur, car l’erreur est éphémère par nature. Il faut encore prévoir l’époque où la doctrine de la liberté des échanges, prévalant dans les esprits, voudra se faire jour dans les lois ; et ce serait certes un coup de maître que d’en avoir d’avance rendu la réalisation impossible. Les journaux auxquels je fais allusion ne se sont donc pas bornés à prêcher théoriquement l’isolement des peuples. Ils ont encore cherché à susciter entre eux une irritation telle qu’ils fussent beaucoup plus disposés à échanger des boulets que des produits. Il n’est pas de difficultés diplomatiques qu’ils n’aient exploitées dans cette vue : évacuation d’Ancône, affaires d’Orient, droit de visite, Taïti, Maroc, tout leur a été bon. « Que les peuples se haïssent, a dit le monopole, qu’ils s’ignorent, qu’ils se repoussent, qu’ils s’irritent, qu’ils s’entr’égorgent, et, quel que soit le sort des doctrines, mon règne est pour longtemps assuré ! »
Il n’est pas difficile de pénétrer les secrets motifs qui rangent les journaux dits de l’opposition parlementaire parmi les adversaires de l’union et de la libre communication des peuples.
D’après notre constitution, les contrôleurs des ministres deviennent ministres eux-mêmes, s’ils donnent à ce contrôle assez de violence et de popularité pour avilir et renverser ceux qu’ils aspirent à remplacer. Quoi qu’on puisse penser, à d’autres égards, d’une telle organisation, on conviendra du moins qu’elle est merveilleusement propre à envenimer la lutte des partis pour la possession du pouvoir. Les députés candidats au ministère ne peuvent guère avoir qu’une pensée, et cette pensée le bon sens public l’exprime d’une manière triviale mais énergique : « Ôte-toi de là, que je m’y mette. » On conçoit que cette opposition personnelle établit naturellement le centre de ses opérations sur le terrain des questions extérieures. On ne peut pas tromper longtemps le public sur ce qu’il voit, ce qu’il touche, ce qui l’affecte directement ; mais sur ce qui se passe au dehors, sur ce qui ne nous parvient qu’à travers des traductions infidèles et tronquées, il n’est pas indispensable d’avoir raison, il suffit, ce qui est facile, de produire une illusion quelque peu durable. D’ailleurs, en appelant à soi cet esprit de nationalité si puissant en France, en se proclamant seul défenseur de notre gloire, de notre drapeau, de notre indépendance ; en montrant sans cesse l’existence du ministère liée à un intérêt étranger, on est sûr de le battre en brèche avec une force populaire irrésistible : car quel ministre peut espérer de rester au pouvoir si l’opinion le tient pour lâche, traître et vendu à un peuple rival [11] ?
Les chefs de parti et les journaux qui s’attellent à leur char sont donc forcément amenés à fomenter les haines nationales ; car comment soutenir que le ministère est lâche, sans établir que l’étranger est insolent ; et que nous sommes gouvernés par des traîtres, sans avoir préalablement prouvé que nous sommes entourés d’ennemis qui veulent nous dicter des lois ?
C’est ainsi que les journaux dévoués à l’élévation d’un nom propre concourent, avec ceux que les monopoleurs soudoient, à rendre toujours imminente une conflagration générale, et par suite à éloigner tout rapprochement international, toute réforme commerciale.
En s’exprimant ainsi, l’auteur de cet ouvrage n’entend pas faire de la politique, et encore moins de l’esprit de parti. Il n’est attaché à aucune des grandes individualités dont les luttes ont envahi la presse et la tribune, mais il adhère de toute son âme aux intérêts généraux et permanents de son pays, à la cause de la vérité et de l’éternelle justice. Il croit que ces intérêts et ceux de l’humanité se confondent loin de se contredire, et dès lors il considère comme le comble de la perversité de transformer les haines nationales en machine de guerre parlementaire. Du reste, il a si peu en vue de justifier la politique extérieure du cabinet actuel, qu’il n’oublie pas que celui qui la dirige employa contre ses rivaux les mêmes armes que ses rivaux tournent aujourd’hui contre lui.
Chercherons-nous l’impartialité internationale et par suite la vérité économique dans les journaux légitimistes et républicains ? Ces deux opinions se meuvent en dehors des questions personnelles, puisque l’accès du pouvoir leur est interdit. Il semble dès lors que rien ne les empêche de plaider avec indépendance la cause de la liberté commerciale. Cependant, nous les voyons s’attacher à faire obstacle à la libre communication des peuples. Pourquoi ? Je n’attaque ni les intentions ni les personnes. Je reconnais qu’il y a, au fond de ces deux grands partis, des vues dont on peut contester la justesse, mais non la sincérité. Malheureusement, cette sincérité ne se manifeste pas toujours dans les journaux qui les représentent. Quand on s’est donné la mission de saper journellement un ordre de choses qu’on croit mauvais, on finit par n’être pas très-scrupuleux dans le choix des moyens. Embarrasser le pouvoir, entraver sa marche, le déconsidérer : telles sont les tristes nécessités d’une polémique qui ne songe qu’à déblayer le sol des institutions et des hommes qui le régissent, pour y substituer d’autres hommes et d’autres institutions. Là, encore, le recours aux passions patriotiques, l’appel aux sentiments d’orgueil national, de gloire, de suprématie, se présentent comme les armes les plus efficaces. L’abus suit de près l’usage ; et c’est ainsi que le bien-être et la liberté des citoyens, la grande cause de la fraternité des nations, sont sacrifiés sans scrupule à cette œuvre de destruction préalable, que ces partis considèrent comme leur première mission et leur premier devoir.
Si les exigences de la polémique ont fait un besoin à la presse opposante de sacrifier la liberté du commerce, parce que, impliquant l’harmonie des rapports internationaux, elle leur ravirait un merveilleux instrument d’attaque, il semble que, par cela même, la presse ministérielle soit intéressée à la soutenir. Il n’en est pas ainsi. Le gouvernement accablé sous le poids d’accusations unanimes, en face d’une impopularité qui fait trembler le sol sous ses pieds, sent bien que la voix peu retentissante de ses journaux n’étouffera pas la clameur de toutes les oppositions réunies. Il a recours à une autre tactique. — On l’accuse d’être voué aux intérêts étrangers… Eh bien ! il prouvera, par des faits, son indépendance et sa fierté. Il se mettra en mesure de pouvoir venir dire au pays : — Voyez, j’aggrave partout les tarifs ; je ne recule pas devant l’hostilité des droits différentiels ; et, parmi les îles innombrables du Grand Océan, je choisis, pour m’en emparer, celle dont la conquête doit susciter le plus de collisions et froisser le plus de susceptibilités étrangères !
La presse départementale aurait pu déjouer toutes ces intrigues, en les dévoilant.
Une pauvre servante au moins m’était restée,
Qui de ce mauvais air n’était pas infectée.
Mais au lieu de réagir sur la presse parisienne, elle attend humblement, niaisement son mot d’ordre. Elle ne veut pas avoir de vie propre. Elle est habituée à recevoir par la poste l’idée qu’il faut délayer, la manœuvre à laquelle il faut concourir, au profit de M. Thiers, de M. Molé ou de M. Guizot. Sa plume est à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, mais sa tête est à Paris.
Il est donc vrai que la stratégie des journaux, qu’ils émanent de Paris ou de la province, qu’ils représentent la gauche, la droite ou le centre, les a entraînés à s’unir à ceux que soudoient les comités monopoleurs, pour tromper l’opinion publique sur le grand mouvement social qui s’accomplit en Angleterre ; pour n’en parler jamais, ou, si l’on ne peut éviter d’en dire quelques mots, pour le représenter, ainsi que l’abolition de l’esclavage, comme l’œuvre d’un machiavélisme profond, qui a pour objet définitif l’exploitation du monde, au profit de la Grande-Bretagne, par l’opération de la liberté même.
Il me semble que cette puérile prévention ne résisterait pas à la lecture de ce livre. En voyant agir les free-traders, en les entendant parler, en suivant pas à pas les dramatiques péripéties de cette agitation puissante, qui remue tout un peuple, et dont le dénoûment certain est la chute de cette prépondérance oligarchique qui est précisément, selon nous-mêmes, ce qui rend l’Angleterre dangereuse ; il me semble impossible que l’on persiste à s’imaginer que tant d’efforts persévérants, tant de chaleur sincère, tant de vie, tant d’action, n’ont absolument qu’un but : tromper un peuple voisin en le déterminant à fonder lui-même sa législation industrielle sur les bases de la justice et de la liberté.
Car enfin, il faudra bien reconnaître, à cette lecture, qu’il y a en Angleterre deux classes, deux peuples, deux intérêts, deux principes, en un mot : aristocratie et démocratie.
Si l’une veut l’inégalité, l’autre tend à l’égalité ; si l’une défend la restriction, l’autre réclame la liberté ; si l’une aspire à la conquête, au régime colonial, à la suprématie politique, à l’empire exclusif des mers, l’autre travaille à l’universel affranchissement ; c’est-à-dire à répudier la conquête, à briser les liens coloniaux, à substituer, dans les relations internationales, aux artificieuses combinaisons de la diplomatie, les libres et volontaires relations du commerce. Et n’est-il pas absurde d’envelopper dans la même haine ces deux classes, ces deux peuples, ces deux principes, dont l’un est, de toute nécessité, favorable à l’humanité si l’autre lui est contraire ? Sous peine de l’inconséquence la plus aveugle et la plus grossière, nous devons donner la main au peuple anglais ou à l’aristocratie anglaise. Si la liberté, la paix, l’égalité des conditions légales, le droit au salaire naturel du travail sont nos principes, nous devons sympathiser avec la Ligue ; si au contraire, nous pensons que la spoliation, la conquête, le monopole, l’envahissement successif de toutes les régions du globe sont, pour un peuple, des éléments de grandeur qui ne contrarient pas le développement régulier des autres peuples, c’est à l’aristocratie anglaise qu’il faut nous unir. Mais, encore une fois, le comble de l’absurde, ce qui serait éminemment propre à nous rendre la risée des nations, et à nous faire rougir plus tard de notre propre folie, ce serait d’assister à cette lutte de deux principes opposés, en vouant aux soldats des deux camps la même haine et la même exécration. Ce sentiment, digne de l’enfance des sociétés et qu’on prend si bizarrement pour de la fierté nationale, a pu s’expliquer jusqu’ici par l’ignorance complète où nous avons été tenus sur le fait même de cette lutte ; mais y persévérer alors qu’elle nous est révélée, ce serait avouer que nous n’avons ni principes, ni vues, ni idées arrêtées : ce serait abdiquer toute dignité ; ce serait proclamer à la face du monde étonné que nous ne sommes plus des hommes, que ce n’est plus la raison, mais l’aveugle instinct qui dirige nos actions et nos sympathies.
Si je ne me fais pas illusion, cet ouvrage doit offrir aussi quelque intérêt au point de vue littéraire. Les orateurs de la Ligue se sont souvent élevés au plus haut degré de l’éloquence politique, et il devait en être ainsi. Quelles sont les circonstances extérieures et les situations de l’âme les plus propres à développer la puissance oratoire ? N’est-ce point une grande lutte où l’intérêt individuel de l’orateur s’efface devant l’immensité de l’intérêt public ? Et quelle lutte présentera ce caractère, si ce n’est celle où la plus vivace aristocratie et la plus énergique démocratie du monde combattent avec les armes de la légalité, de la parole et de la raison, l’une pour ses injustes et séculaires priviléges, l’autre pour les droits sacrés du travail, la paix, la liberté et la fraternité dans la grande famille humaine ?
Nos pères aussi ont soutenu ce combat, et l’on vit alors les passions révolutionnaires transformer en puissants tribuns des hommes qui, sans ces orages, fussent restés enfouis dans la médiocrité, ignorés du monde et s’ignorant eux-mêmes. C’est la révolution qui, comme le charbon d’Isaïe, toucha leurs lèvres et embrasa leurs cœurs ; mais à cette époque, la science sociale, la connaissance des lois auxquelles obéit l’humanité, ne pouvait nourrir et régler leur fougueuse éloquence. Les systématiques doctrines de Raynal et de Rousseau, les sentiments surannés empruntés aux Grecs et aux Romains, les erreurs du xviiie siècle, et la phraséologie déclamatoire, dont, selon l’usage, on se croyait obligé de revêtir ces erreurs, si elles n’ôtèrent rien, si elles ajoutèrent même au caractère chaleureux de cette éloquence, la rendent stérile pour un siècle plus éclairé : car ce n’est pas tout que de parler aux passions, il faut aussi parler à l’esprit, et, en touchant le cœur, satisfaire l’intelligence.
C’est là ce qu’on trouvera, je crois, dans les discours des Cobden, des Thompson, des Fox, des Gibson et des Bright. Ce ne sont plus les mots magiques mais indéfinis, liberté, égalité, fraternité, allant réveiller des instincts plutôt que des idées ; c’est la science, la science exacte, la science des Smith et des Say, empruntant à l’agitation des temps le feu de la passion, sans que sa pure lumière en soit jamais obscurcie.
Loin de moi de contester les talents des orateurs de mon pays. Mais ne faut-il pas un public, un théâtre, une cause surtout pour que la puissance de la parole s’élève à toute la hauteur qu’il lui est donné d’atteindre ? Est-ce dans la guerre des portefeuilles, dans les rivalités personnelles, dans l’antagonisme des coteries ; est-ce quand le peuple, la nation et l’humanité sont hors de cause, quand les combattants ont répudié tout principe, toute homogénéité dans la pensée politique ; quand on les voit, à la suite d’une crise ministérielle, faire entre eux échange de doctrines en même temps que de siéges, en sorte que le fougueux patriote devient diplomate prudent, pendant que l’apôtre de la paix se transforme en Tyrtée de la guerre ? est-ce dans ces données étroites et mesquines que l’esprit peut s’agrandir et l’âme s’élever ? Non, non, il faut un autre atmosphère à l’éloquence politique. Il lui faut la lutte, non point la lutte des individualités, mais la lutte de l’éternelle justice contre l’opiniâtre iniquité. Il faut que l’œil se fixe sur de grands résultats, que l’âme les contemple, les désire, les espère, les chérisse, et que le langage humain ne serve qu’à verser dans d’autres âmes sympathiques ces puissants désirs, ces nobles desseins, ce pur amour et ces chères espérances.
Un des traits les plus saillants et les plus instructifs, entre tous ceux qui caractérisent l’agitation que j’essaie de révéler à mon pays, c’est la complète répudiation parmi les free-traders de tout esprit de parti et leur séparation des Whigs et des Torys.
Sans doute l’esprit de parti a toujours soin de se décorer lui-même du nom d’esprit public. Mais il est un signe infaillible auquel on peut les distinguer. Quand une mesure est présentée au Parlement, l’esprit public lui demande : Qu’es-tu ? et l’esprit de parti : D’où viens-tu ? Le ministre fait cette proposition, — donc elle est mauvaise ou doit l’être ; et la raison, c’est qu’elle émane du ministre qu’il s’agit de renverser.
L’esprit de parti est le plus grand fléau des peuples constitutionnels. Par les obstacles incessants qu’il oppose à l’administration, il empêche le bien de se réaliser à l’intérieur ; et comme il cherche son principal point d’appui dans les questions extérieures, que sa tactique est de les envenimer pour montrer que le cabinet est incapable de les conduire, il s’ensuit que l’esprit de parti, dans l’opposition, place la nation dans un antagonisme perpétuel avec les autres peuples et dans lui danger de guerre toujours imminent.
D’un autre côté, l’esprit de parti, aux bancs ministériels, n’est ni moins aveugle, ni moins compromettant. Puisque les existences ministérielles ne se décident plus par l’habileté ou l’impéritie de leur administration, mais à coup de boules, résolues à être noires ou blanches quand même, la grande affaire, pour le cabinet, c’est d’en recruter le plus possible par la corruption parlementaire et électorale.
La nation anglaise a souffert plus que toute autre de la longue domination de l’esprit de parti, et ce n’est pas pour nous une leçon à dédaigner que celle que donnent en ce moment les free-traders qui, au nombre de plus de cent à la Chambre des communes, sont résolus à examiner chaque mesure en elle-même, en la rapportant aux principes de la justice universelle et de l’utilité générale, sans s’inquiéter s’il convient à Peel ou à Russell, aux Torys ou au Whigs qu’elle soit admise ou repoussée.
Des enseignements utiles et pratiques me semblent devoir encore résulter de la lecture de ce livre. Je ne veux point parler des connaissances économiques qu’il est si propre à répandre. J’ai maintenant en vue la tactique constitutionnelle pour arriver à la solution d’une grande question nationale, en d’autres terme l’art de l’agitation. Nous sommes encore novices en ce genre de stratégie. Je ne crains pas de froisser l’amour-propre national en disant qu’une longue expérience a donné aux Anglais la connaissance, qui nous manque, des moyens par lesquels on arrive à faire triompher un principe, non par une échauffourée d’un jour, mais par une lutte lente, patiente, obstinée ; par la discussion approfondie, par l’éducation de l’opinion publique. Il est des pays où celui qui conçoit l’idée d’une réforme commence par sommer le gouvernement de la réaliser, sans s’inquiéter si les esprits sont prêts à la recevoir. Le gouvernement dédaigne et tout est dit. En Angleterre, l’homme qui a une pensée qu’il croit utile s’adresse à ceux de ses concitoyens qui sympathisent avec la même idée. On se réunit, on s’organise, on cherche à faire des prosélytes ; et c’est déjà une première élaboration dans laquelle s’évaporent bien des rêves et des utopies. Si cependant l’idée a en elle-même quelque valeur, elle gagne du terrain, elle pénètre dans toutes les couches sociales, elle s’étend de proche en proche. L’idée opposée provoque de son côté des associations, des résistances. C’est la période de la discussion publique, universelle, des pétitions, des motions sans cesse renouvelées ; on compte les voix du Parlement, on mesure le progrès, on le seconde en épurant les listes électorales, et, quand enfin le jour du triomphe est arrivé, le verdict parlementaire n’est pas une révolution, il n’est qu’une constatation de l’état des esprits ; la réforme de la loi suit la réforme des idées, et l’on peut être assuré que la conquête populaire est assurée à jamais.
Sous ce point de vue, l’exemple de la Ligue m’a paru mériter d’être proposé à notre imitation. Qu’on me permette de citer ce que dit à ce sujet un voyageur allemand.
« C’est à Manchester, dit M. J. G. Kohl, que se tiennent les séances permanentes du comité de la Ligue. Je dus à la bienveillance d’un ami de pénétrer dans la vaste enceinte où j’eus l’occasion de voir et d’entendre des choses qui me surprirent au dernier point. George Wilson et d’autres chefs renommés de la Ligue, assemblés dans la salle du Conseil, me reçurent avec autant de franchise que d’affabilité, répondant sur-le-champ à toutes mes questions et me mettant au fait de tous les détails de leurs opérations. Je ne pouvais m’empêcher de me demander ce qui adviendrait, en Allemagne, d’hommes occupés à attaquer avec tant de talent et de hardiesse les lois fondamentales de l’État. Il y a longtemps sans doute qu’ils gémiraient dans de sombres cachots, au lieu de travailler librement et audacieusement à leur grande œuvre, à la clarté du jour. Je me demandais encore si, en Allemagne, de tels hommes admettraient un étranger dans tous leurs secrets avec cette franchise et cette cordialité.
J’étais surpris de voir les Ligueurs, tous hommes privés, marchands, fabricants, littérateurs, conduire une grande entreprise politique, comme des ministres et des hommes d’État. L’aptitude aux affaires publiques semble être la faculté innée des Anglais. Pendant que j’étais dans la salle du conseil, un nombre prodigieux de lettres étaient apportées, ouvertes, lues et répondues sans interruption ni retard. Ces lettres, affluant de tous les points du Royaume-Uni, traitaient les matières les plus variées, toutes se rapportant à l’objet de l’association. Quelques-unes portaient les nouvelles du mouvement des Ligueurs ou de leurs adversaires ; car l’œil de la Ligue est toujours ouvert sur les amis comme sur les ennemis…
Par l’intermédiaire d’associations locales, formées sur tous les points de l’Angleterre, la Ligue a étendu maintenant son influence sur tout le pays, et est arrivée à un degré d’importance vraiment extraordinaire. Ses festivals, ses expositions, ses banquets, ses meetings apparaissent comme de grandes solennités publiques… Tout membre qui contribue pour 50 l. (1,250 fr.) a un siège et une voix au conseil… Elle a des comités d’ouvriers, pour favoriser la propagation de ses doctrines parmi les classes laborieuses ; et des comités de dames, pour s’assurer la sympathie et la coopération du beau sexe. Elle a des professeurs, des orateurs qui parcourent incessamment le pays, pour souffler le feu de l’agitation dans l’esprit du peuple. Ces orateurs ont fréquemment des conférences et des discussions publiques avec les orateurs du parti opposé, et il arrive presque toujours que ceux-ci sortent vaincus du champ de bataille… Les Ligueurs écrivent directement à la reine, au duc de Wellington, à sir Robert Peel et autres hommes distingués, et ne manquent pas de leur envoyer leurs journaux et des rapports circonstanciés et toujours fidèles de leurs opérations. Quelquefois ils délèguent auprès des hommes les plus éminents de l’aristocratie anglaise une députation chargée de leur jeter à la face les vérités les plus dures.
On pense bien que la Ligue ne néglige pas la puissance de ce Briarée aux cent bras, la Presse. Non-seulement elle répand ses opinions par l’organe des journaux qui lui sont favorables ; mais encore elle émet elle-même un grand nombre de publications périodiques exclusivement consacrées à sa cause. Celles-ci contiennent naturellement les comptes rendus des opérations, des souscriptions, des meetings, des discours contre le régime prohibitif, répétant pour la millième fois que le monopole est contraire à l’ordre de la nature et que la Ligue a pour but de faire prévaloir l’ordre équitable de la Providence. — … L’association pour la liberté du commerce a surtout recours à ces pamphlets courts et peu coûteux, appelés tracts, arme favorite de la polémique anglaise : c’est avec ces courtes et populaires dissertations, à deux sous, dues à la plume d’écrivains éminents tels que Cobden et Bright, que la Ligue attaque perpétuellement le public, et entretient comme une continuelle fusillade à petit plomb. Elle ne dédaigne pas des armes plus légères encore ; des affiches, des placards qui contiennent des devises, des pensées, des sentences, des aphorismes, des couplets, graves ou gais, philosophiques ou satiriques, mais tous ayant trait à ces deux objets précis : le Monopole et le Libre-Échange… La Ligue et l’anti-Ligue ont porté leur champ de bataille jusque dans les Abécédaires, semant ainsi les éléments de la discussion dans l’esprit des générations futures.
Toutes les publications de la Ligue sont non-seulement écrites, mais imprimées, mises sous enveloppe et publiées dans les salles du comité de Manchester. Je traversai une foule de pièces où s’accomplissent ces diverses opérations jusqu’à ce que j’arrivai à la grande salle de dépôt, où livres, journaux, rapports, tableaux, pamphlets, placards, étaient empilés, comme des ballots de mousseline ou de calicot. Nous parvînmes enfin à la salle des rafraîchissements, où le thé nous fut offert par des dames élégantes. La conversation s’engagea, etc… »
Puisque M. Kohl a parlé de la participation des dames anglaises à l’œuvre de la Ligue, j’espère qu’on ne trouvera pas déplacées quelques réflexions à ce sujet. Je ne doute pas que le lecteur ne soit surpris, et peut-être scandalisé, de voir la femme intervenir dans ces orageux débats. Il semble que la femme perde de sa grâce en se risquant dans cette mêlée scientifique toute hérissée des mots barbares Tarifs, Salaires, Profits, Monopoles. Qu’y a-t-il de commun entre des dissertations arides et cet être éthéré, cet ange des affections douces, cette nature poétique et dévouée dont la seule destinée est d’aimer et de plaire, de compatir et de consoler ?
Mais si la femme s’effraie à l’aspect du lourd syllogisme et de la froide statistique, elle est douée d’une sagacité merveilleuse, d’une promptitude, d’une sûreté d’appréciation qui lui font saisir le côté par où une entreprise sérieuse sympathise avec le penchant de son cœur. Elle a compris que l’effort de la Ligue est une cause de justice et de réparation envers les classes souffrantes ; elle a compris que l’aumône n’est pas la seule forme de la charité. Nous sommes toujours prêtes à secourir l’infortune, disent-elles, mais ce n’est pas une raison pour que la loi fasse des infortunés. Nous voulons nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui ont froid ; mais nous applaudissons à des efforts qui ont pour objet de renverser les barrières qui s’interposent entre le vêtement et la nudité, entre la subsistance et l’inanition.
Et d’ailleurs, le rôle que les dames anglaises ont su prendre dans l’œuvre de la Ligue n’est-il pas en parfaite harmonie avec la mission de la femme dans la société ? — Ce sont des fêtes, des soirées données aux free-traders ; — de l’éclat, de la chaleur, de la vie, communiqués par leur présence à ces grandes joutes oratoires où se dispute le sort des masses ; — une coupe magnifique offerte au plus éloquent orateur ou au plus infatigable défenseur de la liberté.
Un philosophe a dit : « Un peuple n’a qu’une chose à faire pour développer dans son sein toutes les vertus, toutes les énergies utiles. C’est tout simplement d’honorer ce qui est honorable et de mépriser ce qui est méprisable. » Et quel est le dispensateur naturel de la honte et de la gloire ? C’est la femme ; la femme, douée d’un tact si sûr pour discerner la moralité du but, la pureté des motifs, la convenance des formes ; la femme, qui, simple spectateur de nos luttes sociales, est toujours dans des conditions d’impartialité trop souvent étrangères à notre sexe ; la femme, dont un sordide intérêt, un froid calcul ne glace jamais la sympathie pour ce qui est noble et beau ; la femme, enfin, qui défend par une larme et qui commande par un sourire.
Jadis, les dames couronnaient le vainqueur du tournoi. La bravoure, l’adresse, la clémence se popularisaient au bruit enivrant de leurs applaudissements. Dans ces temps de troubles et de violences, où la force brutale s’appesantissait sur les faibles et les petits, ce qu’il était bon d’encourager, c’était la générosité dans le courage et la loyauté du chevalier unie aux rudes habitudes du soldat.
Eh quoi ! parce que les temps sont changés ; parce que les siècles ont marché ; parce que la force musculaire a fait place à l’énergie morale ; parce que l’injustice et l’oppression empruntent d’autres formes, et que la lutte s’est transportée du champ de bataille sur le terrain des idées, la mission de la femme sera terminée ? Elle sera pour toujours reléguée en dehors du mouvement social ? Il lui sera interdit d’exercer sur des mœurs nouvelles sa bienfaisante influence, et de faire éclore, sous son regard, les vertus d’un ordre plus relevé que réclame la civilisation moderne ?
Non, il ne peut en être ainsi. Il n’est pas de degré dans le mouvement ascensionnel de l’humanité, où l’empire de la femme s’arrête à jamais. La civilisation se transforme et s’élève ; cet empire doit se transformer et s’élever avec elle, et non s’anéantir ; ce serait un vide inexplicable dans l’harmonie sociale et dans l’ordre providentiel des choses. De nos jours, il appartient aux femmes de décerner aux vertus morales, à la puissance intellectuelle, au courage civil, à la probité politique, à la philanthropie éclairée ces prix inestimables, ces irrésistibles encouragements qu’elles réservaient autrefois à la seule bravoure de l’homme d’armes. Qu’un autre cherche un côté ridicule à cette intervention de la femme dans la nouvelle vie du siècle ; je n’en puis voir que le côté sérieux et touchant. Oh ! si la femme laissait tomber sur l’abjection politique ce mépris poignant dont elle flétrissait autrefois la lâcheté militaire ! si elle avait pour qui trafique d’un vote, pour qui trahit un mandat, pour qui déserte la cause de la vérité et de la justice, quelques-unes de ces mortelles ironies dont elle eût accablé, dans d’autres temps, le chevalier félon qui aurait abandonné la lice ou acheté la vie au prix de l’honneur !… Oh ! nos luttes n’offriraient pas sans doute ce spectacle de démoralisation et de turpitude qui contriste les cœurs élevés, jaloux de la gloire et de la dignité de leur pays… Et cependant il existe des hommes au cœur dévoué, à l’intelligence puissante ; mais, à l’aspect de l’intrigue partout triomphante, ils s’environnent d’un voile de réserve et de fierté. On les voit, succombant sous la répulsion de la médiocrité envieuse, s’éteindre dans une douloureuse agonie, découragés et méconnus. Oh ! c’est au cœur de la femme à comprendre ces natures d’élite. — Si l’abjection la plus dégoûtante a faussé tous les ressorts de nos institutions ; si une basse cupidité, non contente de régner sans partage, s’érige encore effrontément en système ; si une atmosphère de plomb pèse sur notre vie sociale, peut-être faut-il en chercher la raison dans ce que la femme n’a pas encore pris possession de la mission que lui a assignée la Providence.
En essayant d’indiquer quelques-uns des enseignements que l’on peut retirer de la lecture de ce livre, je n’ai pas besoin de dire que j’en attribue exclusivement le mérite aux orateurs dont je traduis les discours, car, quant à la traduction, je suis le premier à en reconnaître l’extrême faiblesse ; j’ai affaibli l’éloquence des Cobden, des Fox, des George Thompson ; j’ai négligé de faire connaître au public français d’autres puissants orateurs de la Ligue, MM. Moore, Villiers et le colonel Thompson ; j’ai commis la faute de ne pas puiser aux sources si abondantes et si dramatiques des débats parlementaires ; enfin, parmi les immenses matériaux qui étaient à ma disposition, j’aurais pu faire un choix plus propre à marquer le progrès de l’agitation. Pour tous ces défauts, je n’ai qu’une excuse à présenter au lecteur. Le temps et l’espace m’ont manqué, l’espace surtout ; car, comment aurais-je osé risquer plusieurs volumes, quand je suis si peu rassuré sur le sort de celui que je soumets au jugement du public ?
J’espère au moins qu’il réveillera quelques espérances au sein de l’école des économistes. Il fut un temps où elle était raisonnablement fondée à regarder comme prochain le triomphe de son principe. Si bien des préjugés existaient encore dans le vulgaire, la classe intelligente, celle qui se livre à l’étude des sciences morales et politiques, en était à peu près affranchie. On se séparait encore sur des questions d’opportunité, mais, en fait de doctrines, l’autorité des Smith et des Say n’était pas contestée.
Cependant vingt années se sont écoulées, et bien loin que l’économie politique ait gagné du terrain, ce n’est pas assez de dire qu’elle en a perdu, on pourrait presque affirmer qu’il ne lui en reste plus, si ce n’est l’étroit espace où s’élève l’Académie des sciences morales. En théorie, les billevesées les plus étranges, les visions les plus apocalyptiques, les utopies les plus bizarres ont envahi toute la génération qui nous suit. Dans l’application, le monopole n’a fait que marcher de conquête en conquête. Le système colonial a élargi ses bases ; le système protecteur a créé pour le travail des récompenses factices, et l’intérêt général a été livré au pillage ; enfin, l’école économiste n’existe plus qu’à l’état, pour ainsi dire, historique, et ses livres ne sont plus consultés que comme les monuments qui racontent à notre âge les pensées d’un temps qui n’est plus.
Cependant un petit nombre d’hommes sont restés fidèles au principe de la liberté. Ils y seraient fidèles encore alors qu’ils se verraient dans l’isolement le plus complet, car la vérité économique s’empare de l’âme avec une autorité qui ne le cède pas à l’évidence mathématique.
Mais, sans abandonner leur foi dans le triomphe définitif de la vérité, il n’est pas possible qu’ils ne ressentent un découragement profond à l’aspect de l’état des esprits et de la marche rétrograde des doctrines. Ce sentiment se manifeste dans un livre récemment publié, et qui est certainement l’œuvre capitale qu’a produite depuis 1830 l’école économiste. Sans sacrifier aucun principe, on voit, à chaque ligne, que M. Dunoyer (Lib Travail??) en confie la réalisation à un avenir éloigné ; alors qu’une dure expérience, à défaut de la raison, aura dissipé ces préjugés funestes que les intérêts privés entretiennent et exploitent avec tant d’habileté.
Dans ces tristes circonstances, je ne puis m’empêcher d’espérer que ce livre, malgré ses défauts, offrira bien des consolations, réveillera bien des espérances, ranimera le zèle et le dévouement au cœur de mes amis politiques, en leur montrant que si le flambeau de la vérité a pâli sur un point, il jette sur un autre un éclat irrésistible ; que l’humanité ne rétrograde pas, mais qu’elle progresse à pas de géant, et que le temps n’est pas éloigné où l’union et le bien-être des peuples seront fondés sur une base immuable : La libre et fraternelle communication des hommes de toutes les régions, de tous les climats et de toutes les races.
FN:Deux pensées, que l’auteur devait développer plus lard, en écrivant la seconde série des Sophismes, apparaissent dans ce paragraphe et ceux qui suivent. De l’une procède le chapitre les Deux morales ; de l’autre, le chapitre Physiologie de la spoliation. V. tome IV, pages 127 et 148. (Note de l’éditeur.)
FN:Anderson, 3e Voyage de Cook.
FN:V. la traduction de ce document, avant l’appendice.
FN:M. G. R. Porter, qui n’a pas survécu longtemps à Bastiat, a publié une traduction anglaise de la première série des Sophismes. V., au tome Ier, la notice biographique. (Note de l’éditeur.)
FN:Résolution du conseil de la Ligue, mai 1845.
FN:Bon nombre des publicistes enrôlés dans la presse quotidienne eussent pu, mais seulement en s’avouant coupables de légèreté et d’ignorance, se laver de l’accusation de vénalité que l’auteur portait contre eux, en 1845. (Note de l’éditeur.)
FN:Voici les noms de ces hommes bien dignes de notre sympathique estime : Edward Baxter, W. A. Cunningham, Andrew Dalziel, James Howie, James Leslie, Archibald Prentice, Philip Thomson. Il nous paraît juste d’ajouter à ces sept noms celui de M. W. Rawson, arrivé un peu trop tard au rendez-vous où la ligue fut résolue, mais qui s’associa de tout cœur à la résolution que ses amis venaient de prendre en son absence. (Note de l’éditeur.)
FN:Association contre la loi-céréale.
FN:On se rappelle les discours de lord Aberdeen et de sir Robert Peel à l’occasion du message du nouveau président des États-Unis. Voici comment s’exprimait à ce sujet M. Fox, dans un meeting de la Ligue et aux applaudissements de six mille auditeurs :
« Quel est donc ce territoire qu’on se dispute ? 300,000 milles carrés dont nous revendiquons le tiers ; désert aride, lave desséchée, le Sahara de l’Amérique, le Botany-Bay des Peaux-Rouges, empire des buffles, et tout au plus de quelques Indiens fiers de s’appeler Têtes-Plates, Nez-Fendus, etc. Voilà l’objet de la querelle ! Autant vaudrait que Peel et Polk nous poussassent à nous disputer les montagnes de la Lune ! Mais que la race humaine s’établisse sur ce territoire, que les hommes qui n’ont pas de patrie plus hospitalière en soumettent à la culture les parties les moins infertiles ; et lorsque l’industrie aura promené autour de ses frontières le char de son paisible triomphe, lorsque de jeunes cités verront fourmiller dans leurs murs d’innombrables multitudes, quand les montagnes Rocheuses seront sillonnées de chemins de fer, que des canaux uniront l’Atlantique et la mer Pacifique, et que le Colombia verra flotter sur ses eaux la voile et la vapeur, alors il sera temps de parler de l’Orégon. Mais alors aussi, sans bataillons, sans vaisseaux de ligne, sans bombarder des villes ni verser le sang des hommes, le libre commerce fera pour nous la conquête de l’Orégon et même des États-Unis, si l’on peut appeler conquête ce qui constitue le bien de tous. Ils nous enverront leurs produits ; nous les paierons avec les nôtres. Il n’y aura pas un pionnier qui ne porte dans ses vêtements la livrée de Manchester ; la marque de Sheffield sera imprimée sur l’arme qui atteindra le gibier ; et le lin de Spitalfield sera la bannière que nous ferons flotter sur les rives du Missouri. L’Orégon sera conquis, en effet, car il travaillera volontairement pour nous ; et que peut-on demander de plus à un peuple conquis ? C’est pour nous qu’il fera croître le blé, et il nous le livrera sans nous demander en retour que nous nous imposions des taxes afin qu’un gouverneur anglais contrarie sa législature ou qu’une soldatesque anglaise sabre sa population. Le libre commerce ! voilà la vraie conquête ; elle est plus sûre que celle des armes. Voilà l’empire, en ce qu’il a de noble, voilà la domination fondée sur des avantages réciproques, moins dégradante que celle qui s’acquiert par l’épée et se conserve sous un sceptre impopulaire. » (Acclamations prolongées.)
FN:Cette conjecture n’a pas tardé à se vérifier complétement ; mais l’auteur, tout en applaudissant aux mesures libérales prises enfin par le grand ministre, ne l’a pas absous d’en être venu là si tard. (V. tome V, pag. 544 et suiv.). (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome V, les Incompatibilités parlementaires, page 516. (Note de l’éditeur.)
FB’s translations and Summaries of Meetings↩
Meeting à Manchester, en octobre 1842. — Discours de M. Cobden 81
Meeting à Londres, 16 mars 1843, théâtre de Drury-Lane. — Discours de M. Cobden 91
Meeting à Londres, 30 mars 1843. — Discours de MM. James Wilson, J. W. Fox et Cobden 96
Meeting à Londres, 5 avril 1843. — Exposé du président ; discours de MM. Hume, Brotherton, Milner Gibson 118
Meeting à Londres, 13 avril 1843. — Discours du D. Bowring 144
Meeting à Londres, 26 avril 1843. — Discours du R. Th. Spencer. 153
Meeting à Londres, 5 mai 1843. — Discours du R. Cox et de M. Cobden 160
Meeting à Londres, 13 mai 1843, salle de l'Opéra. — Discours de M. Cobden 179
Meeting à Londres, octobre 1843, théâtre de Covent-Garden. — Discours de MM. Cobden et J. W. Fox 190
Meetings en Écosse, du 8 au 18 janvier 1844. — Allocutions diverses ; extraits des discours de M. Cobden, à Perth, et du colonel Thompson, à Greenock, etc. 207
Meeting à Londres, 25 janvier 1844, théâtre de Covent-Garden. — Discours de MM. George Wilson et J. W. Fox 223
Meeting à Londres, 1er février 1844. — Compte rendu 236
Banquet à Wakefield (Yorkshire), le 31 janvier 1844. — Allocution du président, M. Marshall, et discours de lord Morpeth et de M, Cobden 238
Meeting à Londres, 15 février 1844. — Discours de MM. Villiers et J. W. Fox 246
Meeting à Londres, 21 février 1844. — Compte rendu ; discours de MM. O’Connell et George Thompson 259
Meeting à Londres, 28 février 1844. — Discours de M. Ashworth 275
Meeting à Londres, 17 avril 1844. — Compte rendu ; discours de M. George Thompson 281
Meeting à Londres, 1er mai 1844. — Discours de MM. Ricardo et Cobden 298
Meeting à Londres, 14 mai 1844. — Discours de MM. Bright et James Wilson 309
Meeting à Londres, 22 mai 1844. — Discours de M. George Thompson 327
Meeting à Londres, 5 juin 1844. — Résumé d'un discours de M. Bouverie, et discours de M. Milner Gibson 343
Exposé du dissentiment sur le tarif des sucres 351
Meeting à Londres, le 19 juin 1844. — Discours du R. Th. Spencer et de MM. Cobden et Fox. Réflexions du traducteur 355
Débat à la Chambre des communes sur la proposition de M. Villiers. — Argument de M. Milner Gibson. — Résumé historique. 384
Meeting à Londres, le 7 août 1844. — Considérations sur l'esprit de paix. — Discours de M. Milner Gibson et de M. Fox 391
Les free-traders et les chartistes à Northampton 403
Démonstrations en faveur de la liberté commerciale à Walsall. — Présentation d’une coupe à M. John B. Smith 404
Grand meeting de la Ligue au théâtre de Covent-Garden, 17 décembre 1844. — Discours de M. Cobden 409
Meeting général de la Ligue à Manchester, 22 janvier 1845. Discours de M. J. Bright 420
Interrogatoire de Jacques Deacon Hume, esq., ancien secrétaire du Board of trade, sur la loi des céréales, devant le comité de la Chambre des communes chargé de préparer le projet de loi relatif aux droits d'importation pour 1839 430
COBDEN ET LA LIGUE OU L’AGITATION ANGLAISE↩
La Ligue fut fondée à Manchester en 1838. Ce ne fut qu’en 1843 qu’elle commença ses opérations dans la métropole, et nous n’avons pas cru devoir remonter plus haut dans le compte rendu de ses travaux. C’eût été, sans doute, réclamer du lecteur plus d’attention qu’il n’est disposé à nous en accorder. — Cependant, avant de suivre la Ligne à Londres, nous avons jugé utile de traduire le discours prononcé à Manchester, par M. Codben, en octobre 1842, parce qu’il résume les progrès accomplis jusque-là et les plans ultérieurs de cette puissante association.
M. Cobden. — Monsieur le président, ladies et gentlemen : C’est pour l’avenir de notre cause une circonstance d’un augure favorable que de voir tant de personnes distinguées, et particulièrement un si grand nombre de dames réunies dans cette enceinte. Je me réjouis surtout d’y apercevoir de nombreux représentants de la classe ouvrière. (Applaudissements.) J’ai entendu avec satisfaction les rapports qui nous ont été lus et qui ne laissent aucun doute sur les progrès que nous avons faits, non-seulement dans cette cité, mais dans toutes les parties du royaume. Parmi ces rapports, il en est un qui exige que je m’y arrête un instant. M. Murray a fait allusion au mécontentement qu’a excité parmi les fermiers la baisse des produits agricoles. De graves erreurs ont prévalu à ce sujet. Les fermiers se plaignent amèrement de ce qu’ils n’obtiennent plus, pour leurs bestiaux, le prix accoutumé, et ils s’en prennent à ce que les changements introduits récemment dans les tarifs par sir Robert Peel auraient amené du dehors une invasion de quadrupèdes. — Je maintiens que c’est là une illusion. Tous les bestiaux que les étrangers nous ont envoyés ne suffiraient pas à alimenter la consommation de Manchester pendant une semaine. La baisse des prix provient d’une tout autre circonstance, qu’il est utile de signaler parce qu’elle a un rapport direct avec notre cause. La véritable raison de cette baisse, ce n’est pas l’importance des arrivages du dehors, mais la ruine complète à l’intérieur de la clientèle des fermiers. (Écoutez ! écoutez !) J’ai fait des recherches à ce sujet, et je me suis assuré qu’à Dundee, Leeds, Kendal, Carlisle, Birmingham, Manchester, la consommation de la viande, comparée à ce qu’elle était il y a cinq ans, a diminué d’un tiers ; et comment serait-il possible qu’une telle dépression dans le pouvoir de consommer n’amenât une dépression relative dans les prix ? Pour nous, manufacturiers, qui sommes accoutumés à nous enquérir du sort de nos acheteurs, à désirer leur prospérité, à en calculer les effets sur notre propre bien-être, nous n’aurions point conclu comme les fermiers. Quand notre clientèle décline, quand nous la voyons privée des moyens de se pourvoir, nous savons que nous ne pouvons qu’en souffrir comme vendeurs. Les fermiers n’ont point encore appris cette leçon. Ils s’imaginent que la campagne peut prospérer quand la ville décline. (Écoutez ! écoutez !) À la foire de Chester, le fromage est tombé de 20 sh. le quintal, et les fermiers de dire : « Il y a du Peel là-dessous. » Mais l’absurdité de cette interprétation résulte évidemment de ce que rien n’a été changé au tarif sur ce comestible. Le prix du fromage, du lait, du beurre a baissé, et pourquoi ? parce que les grandes villes manufacturières sont ruinées et que Stockport, par exemple, paie en salaires 7,000 l. s. (175,000 fr.) de moins, par semaine, qu’il ne faisait il y a quelques années. Et-en présence de tels faits qui leur crèvent les yeux, comment les fermiers peuvent-ils aller quereller sir Robert Peel, et chercher dans son tarif la cause de leur adversité ? Au dernier meeting de Waltham, le duc de Rutland a essayé de nier cette dépréciation. Il a eu tort ; elle est réelle, et nous ne devons pas méconnaître les souffrances des fermiers, mais leur en montrer les vraies causes. — Il peut paraître étrange que ce soit moi qui vienne ici exonérer sir Robert des reproches que lui adressent ses propres amis. Nous ne sommes pas plus opposés à sir Robert Peel qu’à tout autre ministre. Nous ne sommes pas des hommes de parti, et s’il se rencontre des partis politiques, qu’ils s’intitulent whigs ou torys, qui s’efforcent d’attribuer à sir Robert des maux résultant de la mauvaise politique commerciale adoptée par toutes les administrations successives qui ont dirigé les affaires de ce pays, il est de notre devoir de rendre justice à sir Robert Peel lui-même, et de remettre les fermiers sur la bonne voie. (Applaudissements.)
L’orateur décrit ici la détresse des villes manufacturières et continue ainsi :
On s’en prend encore, de nos souffrances, au tarif récemment adopté par les États-Unis, et les journaux du monopole ne se font faute de railler, à ce sujet, la législation américaine. Mais s’ils étaient sincères lorsqu’ils professent que nous devons nous suffire à nous-mêmes, et pourvoir directement à tous nos besoins par le travail national, assurément ils devraient reconnaître que cette politique, qui est bonne pour nous, est bonne pour les autres, et en saluer avec joie l’avènement parmi toutes les nations du globe. Mais les voilà qui invectivent les Américains parce qu’ils agissent d’après nos propres principes. (Applaudissements.) Eh bien ! qu’ils plaident notre cause au point de vue américain s’ils le trouvent bon. Nous les laisserons dans le bourbier de leur inconséquence. (Applaudissements.) Mais quelle a été l’occasion de ce tarif ? Nous ne devons pas perdre de vue que ce sont nos fautes qui nous ont fermé les marchés d’Amérique. Remontons jusqu’à 1833. À cette époque, une grande excitation existait aux États-Unis au sujet des droits élevés imposés aux produits de nos manufactures ; le mécontentement était extrême, et dans un des États, la Caroline du Sud, il fut jusqu’à se manifester par la rébellion. Il s’ensuivit qu’en 1833, la législature adopta une loi selon laquelle les droits d’entrée devaient être abaissés d’année en année, de manière à ce qu’au bout de dix ans il n’y en eût aucun qui dépassât le maximum fixé à 20 pour cent. Ce terme est expiré cet été. Eh bien ! qu’a fait notre gouvernement ? qu’a fait notre pays pour répondre à cette politique libérale et bienveillante ? Hélas ! un fait si important n’a pas plus excité l’attention de nos gouvernements successifs, et je suis fâché de le dire, du peuple lui-même, que s’il se fût passé dans une autre planète. Nous n’avons eu aucun égard aux tentatives qu’ont faites les Américains pour raviver nos échanges réciproques. Maintenant ils se mettent à considérer les effets de leur politique, et qu’aperçoivent-ils ? c’est qu’au bout des dix ans, leur commerce avec ce pays est moindre qu’il n’était avant la réduction. Leur coton, leur riz, leur tabac a baissé de prix, et ce sont les seules choses que nous consentons à recevoir d’eux. Nous avons repoussé leurs céréales. Les Américains ont donc pensé qu’ils n’avaient aucun motif de persévérer dans leur politique, et il a été facile à un petit nombre de leurs monopoleurs manufacturiers d’obtenir de nouvelles mesures dont l’effet sera d’exclure du continent américain les produits de nos fabriques. Cela ne fût point arrivé, si nous avions tendu, à nos frères d’au delà de l’Atlantique, la main de réciprocité, sous forme d’une loi libérale qui, admettant leurs céréales, aurait intéressé les États agricoles de l’Union à voter pour nous, au lieu de voter contre nous. Nous eussions ouvert à leurs céréales un débouché décuple de celui que leur offrent leurs manufacturiers monopoleurs. Les Américains sont gens avisés et clairvoyants ; et quiconque les connaît sait bien que jamais ils n’eussent supporté le tarif actuel, si nous avions répondu à leurs avances, et reçu leurs produits agricoles en échange de nos produits manufacturés. (Applaudissements.) Je ne veux point dire que les Américains ont agi sagement en adoptant ce tarif ; il n’a pour résultat, à leur égard, que de détruire leur propre revenu. Mais enfin les voilà, d’un côté, se tordant les mains à l’aspect de leurs greniers pliant sous le poids des récoltes précédentes, tandis que le vent agite dans leurs vastes plaines des récoltes nouvelles ; et voici, d’un autre côté, les Anglais contemplant, les bras croisés, leurs magasins encombrés et leurs usines silencieuses. Là, on manque de vêtements, ici on meurt de faim, et des lois aussi absurdes que barbares s’interposent entre les deux pays pour les empêcher d’échanger et de devenir l’un pour l’autre, un débouché réciproque. (Écoutez ! écoutez !) Oh! cela ne peut pas continuer. Un tel système ne peut durer. (Applaudissements.) Il répugne trop à l’instinct naturel, au sens commun, à la science, à l’humanité, au christianisme. (Applaudissements.) Un tel système ne peut durer. (Nouveaux applaudissements.) Croyez que, lorsque deux nations telles que l’Amérique et l’Angleterre sont intéressées à des échanges mutuels, il n’est au pouvoir d’aucun gouvernement de les isoler à toujours. (Applaudissements.) Et je crois sincèrement que dans dix ans tout ce mécanisme de restriction, ici comme au delà des mers, ne vivra plus que dans l’histoire. Je ne demande que dix ans pour qu’il devienne aussi impossible aux gouvernements d’intervenir dans le travail des hommes, de le restreindre, de le limiter, de le pousser vers telle ou telle direction, qu’il le serait pour eux de s’immiscer dans les affaires privées, d’ordonner les heures des repas, et d’imposer à chaque ménage un plan d’économie domestique. (Écoutez ! écoutez !) Il y a précisément le même degré d’absurdité dans ce système, que dans celui qui prévalait, il y a deux siècles, alors que la loi réglait la grandeur, la forme, la qualité du linge de table, prescrivait la substitution d’une agrafe à un bouton, et indiquait le lieu où devait se tisser la serge, et celui où devait se fabriquer le drap (Rires et applaudissements.) C’est là le principe sur lequel on agit encore. Alors on intervenait dans l’industrie des comtés ; aujourd’hui on intervient dans l’industrie des nations. Dans l’un et l’autre cas, on viole ce que je soutiens être le droit naturel de chacun : — échanger là où il lui convient. (Applaudissements.) — Messieurs, ce système, cet abominable système ne peut pas durer. (Acclamations.) C’est pourquoi je me réjouis que nous ayons entrepris de venger les lois et les droits de la nature, en employant tous nos efforts pour le renverser. (Applaudissements.) Mais, pour arriver au triomphe de notre principe, il faut d’abord que nous détruisions, en nous-mêmes et dans le pays, les préjugés qui lui font obstacle, car, quoique la doctrine que nous combattons nous apparaisse, à nous, comme évidemment funeste et odieuse, nous ne devons pas oublier qu’elle prévaut, dans ce monde, à peu près depuis qu’il est sorti des mains du Créateur. Notre rôle est véritablement celui de réformateurs ; car nous sommes aux prises avec le monopole, système qui, sous une forme ou sous une autre, remonte, je crois, à la période adamique, ou du moins aux temps diluviens. (Rires.) Ce ne sera pas la moindre gloire de l’Angleterre, qui a donné au monde des institutions libres, la presse, le jury, les formes du gouvernement représentatif, si elle est encore la première à lui donner l’exemple de la liberté commerciale. (Bruyantes acclamations.) Car, ne perdez pas de vue que ce grand mouvement se distingue, parmi tous ceux qui ont agité le pays, en ce qu’il n’a pas exclusivement en vue, comme les autres, des intérêts locaux, ou l’amélioration intérieure de notre patrie. Vous ne pouvez triompher dans cette lutte, sans que les résultats de ce triomphe se fassent ressentir jusqu’aux extrémités du monde ; et la réalisation de vos doctrines n’affectera pas seulement les classes manufacturières et commerciales de ce pays, mais les intérêts matériels et moraux de l’humanité sur toute la surface du globe. (Applaudissements.) Les conséquences morales du principe de la liberté commerciale, pour lequel nous combattons, m’ont toujours paru, parmi toutes celles qu’implique ce grand mouvement, comme les plus imposantes, les plus dignes d’exciter notre émulation et notre zèle. Fonder la liberté commerciale, c’est fonder en même temps la paix universelle, c’est relier entre eux, par le ciment des échanges réciproques, tous les peuples de la terre. (Écoutez ! écoutez !) C’est rendre la guerre aussi impossible entre deux nations, qu’elle l’est entre deux comtés de la Grande-Bretagne. On ne verra plus alors toutes ces vexations diplomatiques, et deux hommes, à force de protocoliser, par un combat de dextérité entre un ministre de Londres et un ministre de Paris, finir par envelopper deux grandes nations dans les horreurs d’une lutte sanglante. On ne verra plus ces monstrueuses absurdités, alors que dans ces deux grandes nations, unies comme elles le seront par leurs mutuels intérêts, chaque comptoir, chaque magasin, chaque usine, deviendra le centre d’un système de diplomatie qui tendra à la paix, en dépit de tout l’art des hommes d’État pour faire éclater la guerre. (Tonnerre d’applaudissements.) Je dis que ce sont là de nobles et glorieux objets qui, s’ils réclament toute l’énergie du sexe à qui reviennent le poids et la fatigue de la lutte, méritent aussi le sourire et les encouragements des dames que je suis heureux de voir autour de moi. (Applaudissements prolongés.) C’est une œuvre qui devait nous assurer, et qui nous a valu, en effet, l’active coopération de tout ce qu’il y a dans le pays de ministres chrétiens. (Acclamations.) Tel est l’objet que nous avons en vue, et gardons-nous de le considérer jamais, ainsi qu’on le fait trop souvent, comme une question purement pécuniaire, et affectant exclusivement les intérêts d’une classe de manufacturiers et de marchands.
Dans le cours des opérations qui ont eu lieu au commencement de la séance, j’ai appris, avec une vive satisfaction, que, sous les auspices de notre infatigable, de notre indomptable président (acclamations), la Ligue se prépare à une campagne d’hiver plus audacieuse, et j’espère plus décisive qu’aucune de celles qu’ait jamais entreprises cette grande et influente association. En entrant dans les bureaux, j’ai été frappé à l’aspect de quatre énormes colis emballés et cordés comme les lourdes marchandises de nos magasins. J’ai pris des informations, et l’on m’a dit que c’étaient des brochures, — environ cinq quintaux de brochures — adressées à quatre de nos professeurs, pour être immédiatement et gratuitement distribués. (On applaudit.) J’ai été curieux de vérifier dans nos livres où en sont les affaires, en fait d’impressions. — L’impression sur coton, vous le savez, va mal, et menace d’aller plus mal encore ; mais l’impression sur papier est conduite avec vigueur, sous ce toit, depuis quelque temps. Depuis trois semaines la Ligue a reçu des mains des imprimeurs trois cent quatre-vingt mille brochures. C’est bien quelque chose pour l’œuvre de trois semaines, mais ce n’est rien relativement aux besoins du pays. Le peuple a soif d’information ; de toutes parts on demande des brochures, des discours, des publications ; on veut s’éclairer sur ce grand débat. Dans ces circonstances, je crois qu’il nous suffit de faire connaître au public les moyens d’exécution dont nous pouvons disposer, — que la moisson est prête, qu’il ne manque que des bras pour l’engranger, — et le public mettra en nos mains toutes les ressources nécessaires pour conduire notre campagne d’hiver, avec dix fois plus d’énergie que nous n’en avons mis jusqu’ici. Nous dépensons 100 l. s. par semaine, à ce que je comprends, pour agiter la question, il faut en dépenser 1,000 par semaine d’ici à février prochain. Je crains que Manchester ne se soit un peu trop attribué le monopole de cette lutte. Quel que soit l’honneur qui lui en revienne, il ne faut pas que Manchester monopolise toutes les invectives de la Presse privilégiée. Ouvrons donc cordialement nos rangs à ceux de nos nombreux concitoyens des autres comtés, qui désirent, j’en suis sûr, devenir nos collaborateurs dans cette grande œuvre. Leeds, Birmingham, Glasgow, Sheffield ne demandent pas mieux que de suivre Manchester dans la lice. Cela est dans le caractère anglais. Ils ne souffriront pas que nous soyons les seuls à les délivrer des étreintes du monopole ; ce serait s’engager d’avance à se reconnaître redevables envers nous de tout ce qui peut leur échoir de liberté et de prospérité, et il n’est pas dans le caractère des Anglais de rechercher le fardeau de telles obligations. Que font nos compatriotes dans les luttes moins glorieuses de terre et de mer ? Avez-vous entendu dire, avez-vous lu dans l’histoire de votre pays, qu’ils laissent à un vaisseau ou à un régiment tout l’honneur de la victoire ? Non, ils se présentent devant l’ennemi, et demandent qu’on les place à l’avant-garde. — Il en sera ainsi de Leeds, de Glasgow, de Birmingham ; offrons-leur une place honorable dans nos rangs. — Messieurs, la première considération, c’est le nerf de la guerre. Il faut de l’argent pour conduire convenablement une telle entreprise. Je sais que notre honorable ami, qui occupe le fauteuil, a dans les mains un plan qui ne va à rien moins, vous allez être surpris, qu’à demander au pays un subside de 50,000 l. s. (Écoutez ! écoutez !) C’est juste un million de shillings ; et, si deux millions de signatures ont réclamé l’abrogation de la loi-céréale, quelle difficulté peut présenter le recouvrement d’un million de shillings ?… — Ladies et gentlemen, ce à quoi nous devons aspirer, c’est de disséminer à profusion tous ces trésors d’informations enfouis dans les enquêtes parlementaires et dans les œuvres des économistes. Nous n’avons besoin ni de force, ni de violence, ni d’exhibition de puissance matérielle (applaudissements) ; tout ce que nous voulons, pour assurer le succès de notre cause, c’est de mettre en œuvre ces armes bien plus efficaces, qui s’attaquent à l’esprit. Puisque j’en suis sur ce sujet, je ne puis me dispenser de vous recommander la récente publication des œuvres du colonel Thompson (applaudissements) ; c’est un arsenal qui contient plus d’armes qu’il n’en faut pour atteindre notre but, si elles étaient distribuées dans tout le pays. Il n’est si chétif berger qui, pour abattre le Goliath du monopole, n’y trouve un caillou qui aille à son bras. Je ne saurais élever trop haut ceux de ces ouvrages qui se rapportent à notre question. Le colonel Thompson a été pour nous un trésor caché. Nous n’avons ni apprécié ni connu sa valeur. Ses écrits, publiés d’abord dans la Revue de Westminster, ont passé inaperçus pour un grand nombre d’entre nous. Il vient de les réunir en corps d’ouvrage, en six volumes complets, au prix de sacrifices pécuniaires très-considérables, dont je sais qu’il n’a guère de souci, pourvu qu’ils fassent progresser la bonne cause. Je n’hésite pas à reconnaître que tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons aujourd’hui, a été mieux dit et mieux écrit, il y a dix ans, par le colonel Thompson. Il n’est que lieutenant-colonel dans l’armée, à ce que je crois, mais c’est un vrai Bonaparte dans la grande cause de la liberté. Cette cause, nous la ferons triompher en propageant les connaissances qui sont exposées dans ses ouvrages, en les publiant par la voie des journaux et des revues, en les placardant aux murs de tous les ateliers, afin que le peuple soit forcé de lire et de comprendre. Qu’on ne dise pas que de tels moyens manquent d’efficacité. Je sais qu’ils sont tout-puissants. (Applaudissements.) Je ne suis certainement pas entré à la chambre des communes sous l’influence de préventions favorables à cette assemblée, mais je puis dire qu’elle n’est pas une représentation infidèle de l’opinion publique. Cette assertion vous étonne ; mais songez donc que, sur cent personnes, il y en a quatre-vingt-dix-neuf qui ne concourent en rien à la formation de l’opinion publique ; elles ne veulent pas penser par elles-mêmes. (Applaudissements.) À ce point de vue, je dis que la chambre des communes représente assez fidèlement l’esprit du pays. Ne répond-elle pas d’ailleurs aux moindres changements de l’opinion, avec autant de sensibilité et de promptitude qu’en met le vaisseau à obéir au gouvernail ? Voulez-vous donc emporter, dans la chambre des communes, quelque question que ce soit ? Instruisez le peuple, élevez son intelligence au-dessus des sophismes qui sont en usage au Parlement sur cette question ; que les orateurs n’osent plus avoir recours à de tels sophismes, dans la crainte d’une juste impopularité au dehors, et la réforme se fera d’elle-même. (Applaudissements.) C’est ce qui a été fait déjà à l’occasion de grandes mesures, et c’est ce que nous ferons encore. (Applaudissements.) Ne craignez pas que, pour obéir à la voix du peuple, le Parlement attende jusqu’à ce que la force matérielle aille frapper à sa porte. Les membres de la Chambre ont coutume d’interroger de jour en jour l’opinion de leurs constituants, et d’y conformer leur conduite. Ils peuvent bien traiter, avec un mépris affecté, les efforts de cette association, ou de toute autre, mais soyez sûrs qu’en face de leurs commettants ils seront rampants comme des épagneuls. (Rires et bruyants applaudissements.)
Tout nous encourage donc à faire, pendant cette session, un effort herculéen. — Je m’entretenais aujourd’hui avec un gentleman de cette ville qui arrive de Paris. Il a traversé la Manche avec un honorable membre, créature du duc de Buckingham. « Dans mon opinion, disait l’honorable député, le droit actuel sur les céréales sera converti en un droit fixe, dans une très-prochaine session, et j’espère que ce droit sera assez modéré pour être permanent. » — Mais quant à nous, veillons à ce qu’il n’y ait pas de droit du tout. (Applaudissements.) Si nous avons pu amener une créature du duc de Buckingham à désirer une taxe assez modérée pour que ces messieurs soient sûrs de la conserver, quelques efforts de plus suffiront pour convaincre les fermiers qu’ils n’ont à attendre ni stabilité, ni loyale stipulation de rentes, ni apaisement de l’agitation actuelle, jusqu’à ce que tous droits protecteurs soient entièrement abrogés. C’est pourquoi je vous dis : Attachez-vous à ce principe : abrogation totale et immédiate. (Applaudissements.) N’abandonnez jamais ce cri de ralliement : abrogation totale et immédiate ! Il y en a qui pensent qu’il vaudrait mieux transiger ; c’est une grande erreur. Rappelez-vous ce que nous disait sir Robert Peel, à M. Villiers et à moi : « Je conviens, disait-il, que, comme avocats du rappel [25] [1] total et immédiat, vous avez sur moi un grand avantage dans la discussion. » Nous séparer de ce principe absolu, ce serait donc renoncer à toute la puissance qu’il nous donne, — etc.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 16 mars 1843.↩
Une brillante démonstration a eu lieu hier soir au théâtre de Drury-Lane. À peine le bruit s’est-il répandu que la Ligue devait tenir dans cette vaste enceinte sa première séance hebdomadaire, que les cartes d’entrées ont été enlevées. La foule encombrait les avenues et les couloirs de l’édifice longtemps après que la salle, les galeries et le parterre étaient occupés par la réunion la plus distinguée et la mieux choisie dont il nous ait jamais été donné d’être les témoins. — Les dames assistaient en grand nombre à la séance et paraissaient en suivre les travaux avec le plus vif intérêt.
Nous avons remarqué sur l’estrade MM. Cobden, m. P. [26][1], Williams, m. P., Ewart, m. P., Thomely. m. P., Bowring, m. P., Gibson, m. P., Leader, m. P., Ricardo. m. P., Scholefield, m. P., Wallace, m. P., Chrestie, m. P., Bright, m. P., etc.
M. George Wilson occupe le fauteuil.
Le président annonce qu’il est prévenu que quelques perturbateurs se sont introduits dans l’assemblée avec le projet d’occasionner du désordre, soit en éteignant le gaz ou en criant au feu; si de pareilles manifestations ont lieu, que chacun se tienne sur ses gardes et reste calme à sa place.
M. Ewart parle le premier.
M. Cobden lui succède (bruyants applaudissements). Il s’exprime ainsi :
Monsieur le président, ladies et gentlemen : J’ai assisté à un grand nombre de meetings contre les lois-céréales[2]. [27]J’en ai vu d’aussi imposants par le nombre, le bon ordre et l’enthousiasme ; mais je crois qu’il y a dans cette enceinte la plus grande somme de puissance intellectuelle et d’influence morale qui se soit jamais trouvée réunie dans un édifice quelconque, pour le progrès de la grande cause que nous avons embrassée. Plus cette influence est étendue, plus est grande notre responsabilité à l’égard de l’usage que nous en saurons faire. Je me sens particulièrement responsable des quelques minutes pendant lesquelles j’occuperai votre attention, et je désire les faire servir au progrès de la cause commune. Je n’ai jamais aimé, dans aucune circonstance, à faire intervenir des personnalités dans la défense d’un grand principe. On m’assure cependant qu’à Londres on est assez enclin à ranger les opinions politiques sous la bannière des noms propres. Peut-être, au milieu du perpétuel mouvement d’idées qui s’agitent dans cette vaste métropole, cet usage a-t-il prévalu, afin de fixer l’attention, par un intérêt plus incisif, sur les questions particulières. Mais, ce dont je suis sûr, c’est que ce qui a fait notre succès à Manchester, le fera partout où la nature humaine a acquis ces nobles qualités, qui la distinguent au sein de la capitale industrielle du Royaume-Uni, je veux dire, la ferme conviction que, si l’on se renferme dans la défense des principes, on acquerra, à la longue, d’autant plus d’influence, qu’on se sera, avec plus de soin, interdit le dangereux terrain des personnalités. (Écoutez ! écoutez !) Je suis pourtant forcé de revenir, contre ma volonté, sur ce qui vient de se passer à la chambre haute. Nous avons été assaillis — violemment, amèrement, malicieusement assaillis, — par un personnage (lord Brougham) qui fait profession de partager nos doctrines, d’aimer, d’estimer les membres les plus éminents de la Ligue. Je vois, dans les journaux de ce matin, un long discours dont les deux tiers sont une continuelle invective contre la Ligue, dont l’autre tiers est consacré à défendre ses principes. (Écoutez !) Je pense que le plus juste châtiment que l’on pourrait infliger à l’homme éminent qui s’est rendu coupable de la conduite à laquelle je fais allusion, ce serait de l’abandonner à ses propres réflexions ; car, ce qu’on peut découvrir de plus clair dans la longue diatribe du noble lord, c’est que, quelque mécontent qu’il soit de la Ligue, il est encore plus mécontent de lui-même. Il est vrai que le noble et docte lord n’a pas été très-explicite quant aux personnes contre lesquelles il a entendu diriger ses attaques réitérées. Eh bien, je lui épargnerai l’embarras de désignations plus spéciales, en prenant pour moi le poids de ses invectives et de ses sarcasmes. (Applaudissements.) Bien plus, il a attaqué la conduite des membres de notre députation ; il a blâmé les actes des ministres de la religion qui coopèrent à notre œuvre. Eh bien, je me porte fort pour cette conduite et pour ces actes. Il ne s’est pas prononcé une parole, — et je désire qu’on comprenne bien toute la portée de celte déclaration, — il n’a pas été prononcé une seule parole par un ministre de la religion dans nos assemblées et nos conférences, dont je ne sois prêt à accepter toute la responsabilité, pourvu qu’on ne lui prête qu’une interprétation honnête et loyale… J’ai été blâmé de n’avoir pas récusé le langage du Rév. M. Bailey de Sheffield. J’ai été accusé d’être son complice, parce que je ne m’étais pas levé pour répudier l’imputation dirigée contre lui d’avoir excité le peuple de ce pays à commettre un meurtre. — Eh, mon Dieu ! cela ne m’est pas plus venu dans la pensée que d’aller trouver le lord-maire, pour cautionner M. Bailey contre une accusation de cannibalisme. M. Bailey, objet de ces imputations, à travers lesquelles perce le désir d’atteindre et de détruire la Ligue, est environné de respect et de confiance par une nombreuse congrégation de chrétiens qui le soutiennent par des cotisations volontaires. (Bruyants applaudissements.) C’est un homme de zèle ardent, de sentiments élevés, un cœur chaud et ami du bien public, il y a longtemps qu’il s’est dévoué à une œuvre qui n’a pas d’exemple dans ce pays, la fondation d’un collége pour les classes laborieuses. C’est un homme d’un talent remarquable, supérieur. — Mais à travers ces belles qualités, il peut manquer de ce tact, de cette discrétion qui nous est si nécessaire, à nous qui savons à quelle sorte d’ennemis et de faux amis nous avons affaire. Il n’eut pas plutôt prononcé le discours, qui a été si insidieusement commenté, que je l’avertis de ce qui l’attendait. Mais ne souffrons pas que ses paroles soient défigurées. M. Bailey venait d’avancer que la dépression morale du peuple de Sheffield était la conséquence de sa détérioration physique. Pour établir son argumentation, pour montrer la profonde désaffection des basses classes, il a dit qu’un homme s’était vanté d’appartenir à une société de cent personnes, qui devaient tirer au sort pour savoir qui serait chargé d’assassiner le premier ministre. M. Bailey a exprimé son indignation à cet égard, en termes énergiques, et cela était à peine nécessaire. Et voilà ce dont on s’empare pour insinuer, par une basse calomnie, que M. Bailey est engagé dans une société d’assassins ? Il est temps de rejeter, à la face des calomniateurs de haut et de bas étage, ces fausses imputations ; et j’ai honte de ne l’avoir pas fait plus tôt. (Approbation.) — La Ligue, le pays, l’univers entier, doivent une reconnaissance profonde aux ministres dissidents pour leur coopération à notre grande cause. (Bruyantes acclamations.) Il y a deux ans, sur l’invitation de leurs frères, sept cents ministres de ce corps respectable se réunirent à Manchester pour protester contre les lois-céréales, contre ce Code de la famine ; et il est à ma connaissance, que quelques-uns d’entre eux se sont éloignés de plus de deux cents milles de leurs résidences pour concourir à cette protestation. Quand des hommes ont montré un tel dévouement, je rougirais de moi-même si, par la considération d’obligations passées, j’hésitais à me lever pour les défendre. (Acclamations.) Mais nous avons perdu assez de temps au sujet du noble lord. Je pourrais gémir sur sa destinée, quand je compare ce qu’il est à ce qu’il a été. (Écoutez ! écoutez !) Je n’ai pas oublié ce temps où, encore enfant, je me plaisais à fréquenter les cours de judicature, pour contempler, pour entendre celui que je regardais comme un fils prédestiné de la vieille Angleterre. Avec quel enthousiasme ne me suis-je pas abreuvé de son éloquence ! avec quel orgueil patriotique n’ai-je pas suivi, mesuré tous ses pas vers les hautes régions où il est parvenu ! Et qu’est-il maintenant ? hélas ! un nouvel exemple, un triste, mais éclatant exemple du naufrage qui attend toute intelligence que ne préserve pas la rectitude morale. (Applaudissements.) Oui, nous pourrions le comparer à ces ruines majestueuses, qui, désormais, loin d’offrir un sûr abri au voyageur, menacent de destruction quiconque ose se reposer sous leur ombre. J’en finis avec ce sujet, sur lequel je n’aurais pas détourné votre attention, si je n’y avais été provoqué, et j’arrive à l’objet principal de cette réunion.
Qu’est-ce que les lois-céréales ? Vous pûtes le comprendre à Londres, le jour où elles furent votées. Il n’y eut pas alors (1815) un ouvrier qui ne pressentît les maux horribles qui en sont sortis. Il en est beaucoup parmi vous à qui je n’ai pas besoin de rappeler cette funèbre histoire ; la chambre des communes, sous la garde de soldats armés, la foule se pressant aux avenues du Parlement, les députés ne pouvant pénétrer dans l’enceinte législative qu’au péril de leur vie…
Mais sous quel prétexte maintient-on ces lois ? On nous dit : Pour que le sol soit cultivé, et que le peuple trouve ainsi de l’emploi. Mais, si c’est là le but, il y a un autre moyen de l’atteindre. — Abrogez les lois-céréales, et s’il vous plaît ensuite de faire vivre le peuple par le moyen des taxes, ayez recours à l’impôt, et non à la disette des choses mêmes qui alimentent la vie. (Applaudissements.) — À supposer que la mission du législateur soit d’assurer du travail au peuple, et, à défaut de travail, du pain, je dis : Pourquoi commencer par imposer ce pain lui-même ? Imposez plutôt les revenus, et même, si vous le voulez, les machines à vapeur (rires), mais ne gênez pas les échanges, n’enchaînez pas l’industrie, ne nous plongez pas dans la détresse où nous succombons, sous prétexte d’occuper dans le Dorsetshire quelques manouvriers à 7 sh. par semaine. (Rires et applaudissements.) Le fermier de ce pays est à son seigneur ce qu’est le fellah d’Égypte à Méhémet-Ali. Traversant les champs de l’Égypte, armé d’un fusil et accompagné d’un interprète, je lui demandais commuent il réglait ses comptes avec le pacha. « Avez-vous pris des arrangements ? » lui demandai-je. — Oh ! me répondit il, nos arrangements ont à peu près la portée de votre fusil (rires) ; et quant aux comptes, il n’y a pas d’autre manière de les régler, sinon que le pacha prend tout, et nous laisse de quoi ne pas mourir de faim. (Rires et bruyantes acclamations.)
L’orateur continue pendant longtemps. — M. Bright lui succède. — À 10 heures le président ferme la séance.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 30 mars 1843.↩
Le troisième meeting de la Ligue contre les lois-céréales s’est tenu hier au théâtre de Drury-Lane. La vaste enceinte avait été envahie de bonne heure par une société des plus distinguées.
Nous avons remarqué sur l’estrade les personnages dont les noms suivent : MM. Villiers, Cobden, Napier, Scholefield, James Wilson, Gisborne, Elphinstone, Ricardo, etc.
La séance est ouverte à 7 heures, sous la présidence de M. George Wilson.
Le président justifie le comité de s’être vu forcé de refuser un grand nombre de billets. La salle eût-elle été deux fois plus vaste, elle n’aurait pas pu contenir tous ceux qui désiraient assister à la séance. Des arrangements sont pris pour que ceux qui n’ont pu être admis aujourd’hui aient leur tour la semaine prochaine. — L’intention de votre président était de vous présenter ce soir un rapport sur les progrès de notre cause. Mais la liste des orateurs qui doivent prendre la parole contient des noms trop connus de vous pour que je veuille retarder le plaisir que vous vous promettez à les entendre. La tribune sera occupée d’abord par M. James Wilson de Londres (applaudissements), ensuite par M. W. J. Fox, de Finsburg (applaudissements). Th. Gisborne (applaudissements), et enfin, en l’absence de M. Milner Gibson (représentant de Manchester), que de douloureuses circonstances empêchent d’assister à la réunion, j’aurai le plaisir de vous présenter l’honorable M. Richard Cobden. (Applaudissements bruyants et prolongés.)
M. James Wilson se lève. — Après l’annonce que vous venez d’entendre, je me sens obligé d’être aussi concis que possible dans les remarques que j’ai à vous présenter, et je me renfermerai strictement dans mon sujet, ayant une trop haute opinion de ceux qui m’écoutent, pour croire qu’un autre but que celui que la Ligue a en vue, les a déterminés à se réunir dans cette enceinte. Je ne m’écarterai donc pas des principes et des faits qu’implique cette grande cause nationale. (Approbation.) La question est celle-ci : Les lois qui affectent l’importation des céréales et le prix des aliments du peuple, doivent-elles, ou non, être maintenues ? Je ne fais aucun doute que l’opinion publique, quelle que soit celle de la législature, ne les regarde comme incompatibles avec l’état de choses actuel. Qu’un changement dans cette législation soit devenu indispensable, c’est ce qui est admis par toute la communauté, sinon par le Parlement. Il est vrai que l’opinion se divise sur la nature de ce changement. Le commerce des céréales sera-t-il entièrement affranchi, ou soumis à un droit fixe ? Dans ces derniers temps, le système du droit fixe a rencontré beaucoup de défenseurs[1]. [28]La protection a été par eux abandonnée, et le principe auquel ils adhèrent est celui du droit fixe, non point en tant que droit protecteur, mais en tant que droit fiscal. Mais la Ligue élève contre ce droit, renfermé dans ces limites, une objection péremptoire, savoir qu’il viole les principes d’après lesquels doit se prélever le revenu public. Le premier de ces principes, c’est que l’impôt doit donner la plus grande somme possible de revenus à l’État, avec la moindre charge possible sur la communauté. Mais, sous l’un et l’autre rapport, le but est manqué par le droit fixe, car il ne peut produire un revenu sans agir comme protection, en élevant le prix des céréales de tout le montant du droit lui-même. Aux époques où il serait efficace, il produirait du revenu, mais il élèverait le prix des grains. Aux époques où il ne serait pas efficace, il n’influerait pas sur le prix, mais il ne remplirait pas non plus le but du chancelier de l’Échiquier. On a dit que le droit serait supporté par l’étranger et non par les habitants de ce pays ; alors, je demande pourquoi fixer le droit à 8 sh. ? Pourquoi pas 10, 15, 20 sh. ? C’est une grande inconséquence que de répondre : Au delà de 8 sh., le droit restreindrait l’importation ; à 20 sh., il équivaudrait à une prohibition. Car, n’en résulte-t-il pas ceci : que 8 sh. laisse plus de place à l’importation que 10 sh. ? et dès lors ne suis-je pas fondé à dire que l’importation serait plus grande avec le droit de 5 sh. ; plus grande encore avec celui de 2 sh., et la plus grande possible avec la liberté absolue ? (Approbation.) Il n’y a pas en économie politique de proposition mieux établie que celle-ci : Le prix varie suivant la proportion de l’offre à la demande. — Si la liberté amène de plus grands approvisionnements que le droit fixe, il est clair que celui-ci restreint l’offre, élève le prix et agit dans le sens de la protection. C’est pourquoi je comprendrais qu’on défendît le droit fixe en tant que protecteur, mais je ne puis comprendre qu’on le soutienne au point de vue du revenu public, et comme indifférent à toute action protectrice. — Un droit fixe serait certainement quelquefois une source de revenus; autant on en peut dire du droit graduel (sliding scale). Mais la question, pour le public, est précisément de savoir si c’est là un mode juste et économique de prélever l’impôt. (Approbation.) Les partisans eux-mêmes du droit fixe conviennent que lorsque le froment serait arrivé à 70 sh. le quarter, il faudrait renoncer à la taxe et affranchir l’importation. C’est avouer qu’il implique tous les inconvénients de l’échelle mobile, qu’il nous rejette dans les embarras des prix-moyens, et dans tous les désavantages du système actuel[2]. — Je crois être l’interprète fidèle des membres de la Ligue, en disant que le blé n’est pas une matière qui se puisse convenablement imposer ; mais s’il doit être imposé, la taxe doit retomber aussi bien sur le blé indigène, que sur le blé étranger. (Applaudissements). Les Hollandais mettent une taxe de 9 deniers sur le blé, à la mouture. Une taxe semblable donnerait autant de revenu à l’Échiquier que le droit de 8 sh. sur le blé étranger, et elle n’élèverait le prix du blé pour le consommateur, que de 9 deniers au lieu de 8 sh. — Mais le blé, — ce premier aliment de la vie, — est la dernière chose qu’un gouvernement doive imposer. (Approbation.) — C’est un des premiers principes du commerce, que les matières premières ne doivent pas être taxées. C’est sur ce principe que notre législature a réduit les droits sur toutes les matières premières. L’honorable représentant de Dumfries (M. Ewart) a établi, dans une des précédentes séances, que le blé est matière première, et cela est vrai. Mais il y a plus, c’est la principale matière première de toute industrie. — Prenez, au hasard, un des articles qui s’exportent le plus de ce pays, l’acier poli, par exemple, et considérez l’extrême disproportion qu’il y a entre la valeur de la matière première et le prix de l’ouvrage achevé. — Depuis le moment où le minerai a été arraché de la terre, jusqu’à celui où il s’est transformé en brillant acier, la quantité de travail humain qui s’est combinée avec le produit est vraiment immense. Or, ce travail représente des aliments. Les aliments sont donc de la matière première. (Approbation.) La classe agricole est aveugle à cet égard, comme aussi sur l’intérêt dont sont pour elle le commerce et l’industrie de ce pays. C’est pourtant ce que lui montrent clairement les faits qui se sont passés l’année dernière. En 1842, nos exportations sont tombées de 4,500,000 l. s. C’est là la vraie cause de la détresse qui règne dans nos districts agricoles ; car, pour combien les produits de l’agriculture entrent ils dans ce chiffre ? Le fer, la soie, la laine, le coton, dont ces objets auraient été faits, ne peuvent être estimés à plus de 1,500,000 l. Le reste, ou trois millions de livres auraient été dépensées en travail humain ; et le travail, je le répète, représente des aliments ou des produits agricoles ; en sorte que, sur un déficit de 4,500,000 l. dans nos exportations, la part de perte supportée par l’agriculture est de trois millions. (Assentiment.)
On a beaucoup parlé de la dépendance où les importations nous placeraient à l’égard des nations étrangères. Mais l’Angleterre devrait être la dernière des nations à recourir à un tel argument ; car, même aujourd’hui, il est bien peu de choses que nous ne tirions pas du dehors, et le commerce extérieur est certainement la base de notre prospérité et de notre grandeur. Je suis heureux de voir que le président du conseil, lord Wharncliffe, abandonnant enfin cet insoutenable terrain, reconnaisse que la protection ne peut plus être soutenue par des motifs tirés d’une fausse vue sur ce qui constitue l’indépendance nationale. Cependant le noble lord, arguant de ce que l’agriculture s’est améliorée depuis vingt-cinq ans, sous l’empire des lois-céréales, a conclu en général que la protection était nécessaire au perfectionnement de l’industrie nationale. Mais, en fait, depuis vingt-cinq ans, il n’est aucune branche d’industrie qui soit demeurée aussi stationnaire que l’agriculture. Et qui a jamais entendu parler d’améliorations agricoles, si ce n’est depuis l’époque récente où la protection est menacée ? On peut voir maintenant que la libre concurrence a effectué ce que la protection n’avait pu faire, et que la Ligue a été plus utile à l’agriculture que la prohibition. Je crois sincèrement que lorsque l’agitation actuelle sera arrivée au jour de son triomphe, les intérêts territoriaux s’apercevront qu’il n’est rien à quoi ils soient plus redevables qu’aux efforts de la Ligue. (Approbation.) L’argument fondé sur la nécessité de protéger l’industrie nationale me paraît reposer sur une illusion. Je ne puis faire aucune distinction entre du blé d’Amérique ou du comté de Kent, pour s’échanger contre des objets manufacturés en Angleterre. Il est un autre argument dont s’est servi lord Wharncliffe et que je dois relever. C’est celui tiré de la sur-production. Nos adversaires attribuent toutes nos souffrances à la sur-production. Je pense que c’est là une maladie dont nous sommes en bon train de guérir radicalement. — Reportons-nous en 1838, alors que survint la première mauvaise récolte, et que, par suite, la loi-céréale fut de fait ressuscitée, puisqu’une longue succession de bonnes années l’avait pour ainsi dire enterrée. Le pays a mis en œuvre :
3162. En 1838, 3163. 3164. 4,800,000 l. de soie brute. 3165. 3166. En 1842, 3167. 3168. 4,300,000 l. 3169.
3171. En 1838, 3172. 3173. 1,600,000 quintaux de lin. 3174. 3175. En 1842, 3176. 3177. 1,100,000 q. 3178.
3180. En 1830, 3181. 3182. 56 millions de l. de laines étr. 3183. 3184. En 1842, 3185. 3186. 44 millions. 3187.
C’est là, je pense, une grave atteinte à celte surabondance de production qui est l’objet de tant de plaintes ; et si elle était la vraie cause de nos maux, certes, ils commenceraient à disparaître. Malheureusement, il se trouve qu’à mesure que la production diminue, la misère et l’inanition s’étendent sur le pays.
Il est ensuite devenu de mode de parler de réciprocité, et un sentiment hostile a été excité contre les peuples étrangers comme s’ils étaient des rivaux dangereux et non d’utiles amis. De là est née cette politique de notre gouvernement, qui consiste à ne conférer des avantages au pays, qu’à la condition de décider les autres nations à en faire autant. Mais l’Angleterre ne devrait pas oublier la grande influence que ses lois et son exemple exercent sur le reste du monde. Il n’est pas possible à ce pays d’accroître ses importations sans accroître dans le même rapport ses exportations sous une forme ou sous une autre. Que ce soit en produits manufacturés, en denrées coloniales ou étrangères, ou en numéraire, il ne se peut pas que ces échanges n’augmentent l’emploi de la main-d’œuvre, et même, lorsque nous payons les marchandises étrangères en argent, cet argent représente le produit d’un travail national. Il est tellement impossible de prévenir les transactions internationales, lorsqu’elles sont avantageuses que, pendant la dernière guerre, lorsque les armées de Napoléon et les flottes de l’Angleterre étaient levées pour s’opposer à toutes communications entre les deux peuples, cependant, dans cette même année 1810, le Royaume-Uni importa plus de blé de France qu’il n’avait fait à aucune autre époque. D’un autre côté, c’est un fait historique que le prince de Talleyrand, chef du cabinet, non-seulement toléra la fraude des marchandises anglaises, mais encore la conseilla, l’encouragea, et même en tira un grand profit personnel ; en sorte que les Français étaient vêtus de draps anglais, comme les Anglais étaient nourris de blés français, témoignage remarquable de la faiblesse et de l’impuissance des gouvernements quand ils prétendent contrarier les grands intérêts des nations. (Applaudissements.)
On a récemment fait une proposition qui, je le crois, ne rencontrera pas beaucoup de sympathie dans celte enceinte. On a parlé d’organiser une émigration systématique (murmures), afin de se délivrer des embarras d’une excessive multiplication de nos frères. (Honte ! honte !) Je n’incrimine pas les intentions. Au bas du mémoire adressé à ce sujet à sir Robert Peel, j’ai vu figurer le nom de personnes que je sais être incapables de rien faire sciemment qui soit de nature à infliger un dommage, soit au pays, soit à une classe de nos concitoyens. Mais il s’agit ici d’une question qui veut être abordée avec prudence, d’une question d’où peuvent sortir des dangers et des maux sans nombre. Avant de vous faire une opinion à cet égard, laissez-moi mettre sous vos yeux quelques documents statistiques. Depuis dix ans, six cent mille Anglais ont émigré, moitié vers les États-Unis, moitié vers nos autres possessions répandues sur la surface du globe. C’est une chose surprenante qu’après deux siècles d’émigration, on songe aujourd’hui pour la première fois à transformer les émigrants en acheteurs, pour leur avantage comme pour celui de la mère-patrie. Il y a, dans les établissements de l’Union américaine, une population composée d’hommes qui étaient naguère nos compatriotes ; une population qui, tout entière, se rattache à nous par les liens d’une langue et d’une origine communes ; elle est active, industrieuse, capable de beaucoup produire et de beaucoup consommer ; n’est-ce pas une chose étonnante qu’avant de penser à la renforcer, on n’ait pas d’abord songé à établir entre elle et nous un système d’échanges libres ? J’en dirai autant de Java avec ses sept millions, du Brésil avec ses huit millions d’habitants. Ce sont là des pays riches et fertiles, et tout ce qu’il y a à faire, c’est de leur offrir des transactions fondées sur la base d’une juste réciprocité. Il n’en faudrait pas davantage pour absorber rapidement tout le travail national qui se trouve maintenant sans emploi. (Applaudissements.)
Il règne de grandes préventions en faveur des colonies. Pendant la guerre, on les regarde comme les soutiens de nos forces navales. En temps de paix, on les considère commue offrant au commerce les débouchés les plus étendus et les mieux assurés. Mais qu’y a-t-il de vrai en cela ? Le quart seulement de nos exportations va aux colonies, les trois quarts sont destinés à l’étranger. Je ne suis point anthipathique aux colonies, mais je proteste contre un système qui courbe la métropole sous le joug d’une évidente oppression. (Applaudissements.) La production des Antilles est tombée de trois à deux millions de quintaux de sucre. Ce n’est pas, comme on l’a dit, une conséquence de l’émancipation des noirs ; car quoique nos exportations dans ces îles aient d’abord descendu à 2 millions de livres sterling, elles se sont depuis relevées à 3 millions et demi. Mais il est absurde que ces îles prétendent au privilége exclusif d’approvisionner de sucre notre population toujours croissante. Aussi qu’est-il arrivé ? Cet approvisionnement s’est considérablement réduit, et tandis qu’il y a vingt ans, la consommation moyenne était de vingt-quatre livres par habitant, elle n’est plus que de quinze livres, ce qui est inférieur à ce qu’on accorde aux matelots et même aux indigents dans les maisons de travail. Veut-on savoir ce que coûte à ce pays le privilége de faire le commerce de l’île Maurice ? Nous payons le sucre de Maurice 15 shil. plus cher que le sucre étranger que nous pourrions acheter dans les docks de Londres et de Liverpool, ce qui constitue pour nous un excédant de déboursés de 450,000 liv. sterl. par an. En retour, nous avons le privilége de vendre à cette colonie pour 350,000 liv. sterl. d’objets manufacturés. — J’arrive à nos possessions des Indes occidentales. En 1840, nous y avons exporté pour 3,500,000 liv. sterl., et nos importations ont été de deux millions de quintaux de sucre et treize millions de livres de café. Le coût différentiel de ces articles, si nous les eussions achetés ailleurs, nous aurait épargné 2,000.000 liv. sterl. Sur ces bases, il est clair que nous payons aux planteurs des Antilles 2 millions et demi par an le privilége de leur livrer pour 3 millions et demi des produits de notre travail. — Voilà pour quels avantages illusoires nous négligeons nos meilleurs débouchés, nous sacrifions les contrées où ils existent, et nous nous efforçons ensuite de les remplacer, en poussant, par des lois restrictives et la famine artificielle, le peuple de ce pays à une émigration générale. (Approbation.) Je crains de fatiguer l’attention de l’assemblée. (Non, non, continuez.) Si elle me le permet, je terminerai par la réfutation d’un reproche qu’on a adressé à la Ligue. Quelle que soit l’opinion du moment, la postérité reconnaîtra, j’en suis convaincu, que l’agitation actuelle, qui est irréprochable en principe, aura tourné principalement à l’avantage des classes agricoles. Quelle a été la conduite de la Ligue ? En a-t-elle appelé aux passions de la multitude ? (Non, non.) Tous ses efforts n’ont-ils pas tendu à améliorer l’esprit public, à répandre la lumière parmi les classes laborieuses ? N’a-t-elle pas cherché par là à redresser, relever et éclairer l’opinion ? Ne s’est-elle pas appliquée à encourager les sentiments les plus moraux ? Et n’a-t-elle pas cherché son point d’appui dans la classe moyenne, dans cette classe qui est le plus ferme soutien du gouvernement, qui seule a su jusqu’ici faire triompher les grandes réformes constitutionnelles ? (Applaudissements.) Quiconque a visité les nations étrangères et a pu les comparer à cette grande communauté, a sans doute remarqué que ce qui caractérise les habitants de ce pays, c’est le respect, je dirai presque le culte des lois et des institutions, sentiment si profondément enraciné dans le cœur de nos concitoyens. Il a été choqué, sans doute, à l’étranger, de l’absence des sentiments de cette nature. Il ne faut pas douter que ce respect dont les Anglais entourent la constitution ne soit né parmi nous de ce que le peuple possède des pouvoirs et des priviléges, ce qui l’accoutume à respecter les pouvoirs et les priviléges des autres classes. Je crois que le respect que montre le peuple d’Angleterre, pour la propriété des classes aristocratiques, est fondé sur cette profonde conviction, que ceux à qui elle est échue en partage ont des devoirs à remplir aussi bien que des droits à exercer. (M. Wilson reprend sa place au bruit d’applaudissements réitérés. Ces applaudissements se renouvellent lorsque le président annonce que la parole est à M. Fox.)
M. J. W. Fox. — L’orateur qui vient de s’asseoir a relevé plusieurs reproches qui ont été adressés à la Ligue et à nos meetings, mais il en a oublié un, savoir, que les arguments que nous apportons à cette tribune n’ont rien de nouveau. J’admets, en ce qui me concerne, la vérité de cette accusation. Je crois que les arguments contre la loi-céréale sont entièrement épuisés, et tout ce que nous devons attendre, c’est que ces vieux arguments se renouvellent aussi longtemps que se renouvellera dans le pays le progrès de la misère et du mécontentement, l’accroissement du nombre des banqueroutes, et l’extension de la souffrance et de la famine. (Bruyantes acclamations). Il n’est, en tout cela, aucun argument nouveau contre le monopole, parce qu’on ne saurait rien dire de neuf contre l’oppression et le vol, contre l’injustice infligée à la classe pauvre et dénuée, contre cette législation, plus meurtrière que la guerre et la peste, qui restreint l’alimentation du peuple et couvre le pays de longs désordres et de tombeaux prématurés. Il n’y a pas de nouveaux arguments, parce que le moment est venu où il faut agir plus que parler, et c’est le sentiment profond de cette vérité qui attire vers ces meetings d’innombrables multitudes. C’est là ce qui soumet à l’aristocratie un problème à résoudre, — problème qui implique tout ce que la question renferme de nouveauté, — et ce problème est celui-ci : Jusqu’où peut aller la force de l’opinion publique et la résistance du gouvernement ? (Acclamations.) Ce n’est pas la discussion qui résoudra ce problème ; si cela était en son pouvoir, il y a longtemps qu’il serait résolu. La discussion a commencé dans les revues et les journaux ; elle s’est continuée dans des joutes orales ; elle a été éclairée par les recherches des statisticiens et les méditations des économistes ; elle a fait pénétrer des convictions profondes dans les esprits aussi bien que des sentiments énergiques dans les cœurs, à regard de ces sinistres intérêts dont la détresse publique ne révèle que trop la présence. (Applaudissements.) Je reviendrai pourtant encore sur quelques-uns de ces vieux arguments, bien qu’ils se présentent naturellement à quiconque a un peu de logique dans la cervelle. J’aurais voulu épargner à nos seigneurs terriens et à leurs organes des objections qui les fatiguent. S’il leur plaisait de ménager nos poches, nous ménagerions leur attention. (Rires.) Mais aussi longtemps qu’ils lèveront une taxe sur le pain du peuple, le peuple en lèvera une sur leur patience. (Nouveaux rires et applaudissements.) — Les arguments sont épuisés, dit-on, mais le sujet ne l’est pas ; sans cela, que ferions-nous ici ? — Les arguments sont épuisés ! et pourquoi ? parce que le principe de la liberté du commerce a surgi, a surmonté tous les témoignages qu’on a produits contre lui. De toutes parts, au dedans comme au dehors, ce grand et irrésistible principe a été opposé à des intérêts de caste. Si vous considérez nos relations extérieures, qu’a fait la loi-céréale, si ce n’est provoquer l’inimitié et la guerre ? Comme question extérieure, elle a mis en mouvement contre nous, sinon des armées, du moins des tarifs hostiles ; elle a détruit les relations amicales des gouvernements et ces sentiments de bienveillance et de fraternité qui devaient cimenter l’union des peuples. (Acclamations.) Comme question intérieure, les lois-céréales font que l’Angleterre n’est plus la patrie des Anglais (applaudissements prolongés ; les cris de « bravo » retentissent dans toute l’assemblée) : car, forcer les hommes à s’expatrier, plutôt que de laisser importer des aliments, n’est-ce pas systématiser la déportation des êtres humains ? (Acclamations.) L’esprit de cette loi ne diffère pas de ce qui se pratiquait en Angleterre, il y a plusieurs siècles, alors que les seigneurs saxons élevaient de jeunes hommes pour les vendre comme esclaves. Ils les exportaient vers des terres lointaines, mais ils les nourrissaient du moins pour accomplir leurs desseins. Ils leur donnaient des aliments afin d’en élever le prix, tandis que les lois-céréales affament le peuple pour élever le prix dos aliments. (Bruyantes acclamations ; on agite les chapeaux et les mouchoirs dans toutes les parties de la salle.) — Au point de vue financier, la question est aussi épuisée. Et que faut-il penser d’un chancelier de l’Échiquier qui ne s’aperçoit pas qu’arracher 40 millions de livres sterling au peuple, pour l’avantage d’une classe, c’est diminuer la puissance de ce peuple à contribuer aux dépenses nationales ? (Approbation.) En outre, des états statistiques montrent distinctement qu’à mesure que le prix du blé s’élève, le revenu public diminue. Dans cet état de choses, je plains les personnes qui voient sans s’émouvoir les souffrances du pays, l’augmentation rapide du nombre des faillites, la diminution des mariages, l’accroissement des décès parmi les classes pauvres, l’extension du crime et de la débauche ; oui, ce sont là de vieux arguments contre les lois-céréales. Si l’aristocratie en veut d’autres, elle les trouvera sous l’herbe épaisse qui couvre les tombeaux de ceux dont un honnête travail eût dû soutenir l’existence. — Eh quoi ! la charité elle-même est engagée dans la question ; car nous ne saurions soulager le pauvre sans payer tribut aux seigneurs, et il n’est pas jusqu’au pain de l’aumône dont ils ne s’adjugent une fraction. Notre gracieuse souveraine a beau ouvrir une souscription en faveur des pauvres de Paisley et d’ailleurs, lorsque les 100,000 liv. sterl. seront recueillies, la rapacité de la classe dominante viendra en prélever le tiers ou la moitié ; la charité en sera restreinte et bien des infortunes resteront sans soulagement. C’est ainsi que la commisération elle-même est soumise à la taxe, et que des limites sont posées aux meilleurs sentiments du cœur humain. Ce n’est pas là la leçon que nous donne ce livre sacré que les monopoleurs eux-mêmes font profession de révérer. Il nous enseigne à demander « le pain de chaque jour. » Mais les seigneurs taxent au contraire le pain de chaque jour. Le même livre nous montre un jeune homme qui demande ce qu’il doit faire. Et il lui est répondu ; « Vendez votre bien et distribuez-le aux pauvres. » Mais notre législation prend ce précepte au rebours, car elle procède de ce principe : « Oter au pauvre pour donner au riche. » (Applaudissements.) Si je viens à considérer la question du côté politique, je dirai que l’oppression ne cesse pas d’être oppression pour se cacher sous des formes légales. Un peuple dont le pain est taxé est un peuple esclave, de quelque manière que vous le preniez. La prépondérance aristocratique a passé sur les esprits comme la herse sur le champ vide, et la corruption y a fait germer une ample moisson de votes antipathiques, mais inféodés. C’est donc une question de classes, comme toutes celles qui s’agitent dans ce pays. Mais quelle est la classe d’habitants intéressés au maintien de ces lois ? Ce ne sont pas les fermiers, car la rente leur arrache jusqu’au dernier shilling qu’elles ajoutent au prix du blé ! Ce n’est pas la classe ouvrière, puisque les salaires sont arrivés à leur dernière expression. Ce n’est pas la classe marchande, car nos ports sont déserts et nos usines silencieuses. Ce n’est pas la classe littéraire, car les hommes ont peu de goût à la nourriture de l’esprit quand le corps est épuisé d’inanition. Eh quoi ! ce ne sont pas même les seigneurs terriens, si ce n’est un petit nombre d’entre eux qui possèdent encore la propriété nominale de domaines chargés d’hypothèques. Et c’est dans le seul intérêt de ce petit nombre de privilégiés, pour satisfaire à leurs exigences, pour alimenter leur prodigalité, que tant de maux seront accumulés sur les masses, et que la valeur même du sol sera ravie à leurs descendants ! Et que gagnent-ils à ce système ? Ne faut-il pas qu’ils en rachètent les avantages passagers en s’endurcissant le cœur ? Car ils sentent bien qu’il ne sera pas en leur pouvoir de détourner les conséquences terribles qui menacent eux-mêmes et le pays ; et déjà ils voient les classes industrieuses, dont les travaux infatigables et la longue résignation méritaient plus de sympathies, se lever, non pour les bénir, mais pour les maudire. Ils n’échapperont pas toujours aux lois de cette justice distributive qui entre dans les desseins de l’éternelle Providence… (Applaudissements.)
On dit que la loi-céréale doit être continuée pour maintenir le salaire de l’ouvrier. Mais, comme ce philosophe d’autrefois, qui démontra le mouvement en se prenant à marcher, l’ouvrier répond en montrant son métier abandonné et sa table vide. (Applaudissements.) — On dit encore que nous devons nous rendre indépendants de l’étranger ; mais la dépendance et l’indépendance sont toujours réciproques, et rendre la Grande-Bretagne indépendante du monde, c’est rendre le monde indépendant de la Grande-Bretagne. (Bruyantes acclamations.) Le monopole isole le pays de la grande famille humaine ; il détruit ces liens et ces avantages mutuels que la Providence avait en vue le jour où il lui plut de répandre tant de diversité parmi toutes les régions du globe. La loi-céréale est une expérience faite sur le peuple ; c’est un défi jeté par l’aristocratie à l’éternelle justice ; c’est un effort pour élever artificiellement la valeur de la propriété d’un homme aux dépens de celle de son frère. Ceux qui taxent le pain du peuple taxeraient l’air et la lumière s’ils le pouvaient ; ils taxeraient les regards que nous jetons sur la voûte étoilée ; ils soumettraient les cieux avec toutes les constellations, et la chevelure de Cassiope, et le baudrier d’Orion, et les brillantes Pléiades, et la grande et la petite Ourse au jeu de l’échelle mobile. (Rires et applaudissements prolongés.) — On a fait valoir en faveur de la nouvelle loi un autre argument. « Elle est jeune, a-t-on dit, expérimentez-la encore quelque temps. » Oh ! l’expérience a déjà dépassé tout ce que le peuple peut endurer ; et il est temps que ceux qui la font sachent bien qu’ils assument sur eux, non plus seulement une responsabilité ministérielle, mais ce qui est plus solennel et plus sérieux, une responsabilité toute personnelle. (Applaudissements prolongés.) La Ligue fait aussi son expérience. Elle est venue de Manchester pour expérimenter l’agitation. Il fallait bien que l’expérience des landlords eût sa contre-épreuve ; il fallait bien savoir s’ils seront à tout jamais les oppresseurs des pauvres. (Applaudissements.) La Ligue et sir Robert Peel ont, après tout, une cause commune. L’une et l’autre sont les sujets ou plutôt les esclaves de l’aristocratie. L’aristocratie, en vertu de la possession du sol, règne sur la multitude comme sur les majorités parlementaires. Elle commande au peuple et à la législature. Elle possède l’armée, donne la marine à ses enfants, s’empare de l’Église et domine la souveraine. Notre Angleterre, « grande, libre et glorieuse, » est attelée à son char. Nous ne pouvons nous enorgueillir du passé et du présent, nous ne saurions rien augurer de l’avenir ; nous ne pouvons nous rallier à ce drapeau qui, pendant tant de siècles, « a bravé le feu et l’ouragan ; » nous ne pouvons exalter cet audacieux esprit d’entreprise qui a promené nos voiles sur toutes les mers ; nous ne pouvons faire progresser notre littérature, ni réclamer pour notre patrie ce que Milton appelait le plus élevé de ses priviléges : « enseigner la vie aux nations. » Non, toutes ces gloires n’appartiennent pas au peuple d’Angleterre ; elles sont l’apanage et comme les dépendances domaniales d’une classe cupide… La dégradation, l’insupportable dégradation, sans parler de la détresse matérielle, qu’il faut attribuer à la loi-céréale, est devenue horrible, intolérable. C’est pourquoi, nous, ceux d’entre nous qui appartiennent à la métropole, nous accueillons avec transport la Ligue au milieu de nous ; nous devenons les enfants, les membres de la Ligue ; nous vouons nos cœurs et nos bras à la grande œuvre ; nous nous consacrons à elle, non point pour obéir à l’aiguillon d’un meeting hebdomadaire, mais pour faire de sa noble cause le sujet de nos méditations journalières et l’objet de nos infatigables efforts. (Bruyantes acclamations.) Nous adoptons solennellement la Ligue ; nous nous engageons à elle comme à un covenant religieux (applaudissements enthousiastes) ; et nous jurons, par celui qui vit dans tous les siècles des siècles, que la loi-céréale, cette insigne folie, cette basse injustice, cette atroce iniquité, sera radicalement abolie. (Tonnerre d’applaudissements. L’assemblée se lève d’un mouvement spontané. Les mouchoirs et les chapeaux s’agitent pendant longtemps.)
M. Gisborne succède à M. Fox.
Le Président : Avant de donner la parole à M. Cobden, je dois informer l’assemblée qu’à l’occasion du dernier débat du parlement, des pétitions nombreuses sont parvenues à l’honorable gentleman, celle de Bristol étant revêtue de quatorze mille signatures.
M. Cobden : Après les remarquables discours que vous venez d’entendre, et quoique je sois un vieux praticien de semblables meetings, je dois dire que je n’en ai jamais entendu qui les aient surpassés; après le discours si philosophique de M. Wilson, l’éloquence émouvante de M. Fox, l’ingénieuse et satirique allocution de mon ami, M. Gisborne, il eût mieux valu, sans doute, et j’aurais désiré que vous eussiez été laissés à vos méditations ; mais l’autorité de votre président est absolue, et, si je lui cède, c’est qu’elle constitue la meilleure forme de gouvernement, le despotisme infaillible. (Rires…)
Il est difficile, après ce que vous venez d’entendre, de dire quelque chose de neuf sur le sujet qui nous occupe ; mais M. Wilson a parlé d’émigration. C’est une question qui se lie aux lois-céréales, et cette connexité n’est pas nouvelle, car chaque fois que le régime restrictif a jeté le pays dans la détresse, on n’a jamais manqué de dire : « Transportez les hommes au loin. » Cela fut ainsi dans les années 1819, 1829 et 1839. C’est encore ainsi en 1843. A toutes ces époques, on entendit la même clameur : « Défaisons-nous d’une population surabondante. » — Les bœufs et les chevaux maintiennent leur prix sur le marché ; mais quant à l’homme, cet animal surnuméraire, la seule préoccupation de la législation paraît être de savoir comment on s’en débarrassera, même à perte. (Approbation.) Je vois maintenant que les banquiers et les marchands de Londres commencent aussi à se montrer. Ils ne sont plus les froids et apathiques témoins de la misère du pays, elles voilà qui se présentent avec un plan pour la soulager. Ils proposent une émigration systématique opérée par les soins du gouvernement. Mais qui veulent-ils expatrier ? Si l’on demandait quelle est la classe de la communauté qui contient le plus grand nombre d’êtres inutiles, il ne faudrait certes pas aller les chercher dans les rangs inférieurs. (Écoutez ! écoutez !) — Je demandais à un gentleman, signataire de la pétition, si, par hasard, les marchands avaient dessein d’émigrer. — Oh ! non ; aucun de nous, me répondit-il. — Qui donc voulez-vous renvoyer ? lui demandai-je. — Les pauvres, ceux qui ne trouvent pas d’emploi ici. — Mais ne vous semble-t-il pas que ces pauvres devraient au moins avoir une voix dans la question ? (Écoutez !) Ont-ils jamais pétitionné le parlement pour qu’il les fît transporter ? (Écoutez !) À ma connaissance, depuis cinq ans, cinq millions d’ouvriers ont présenté des pétitions, pour qu’on laissât les aliments venir à eux, mais je ne me souviens pas qu’ils aient demandé une seule fois à être envoyés vers les aliments. (Écoutez !) Les promoteurs de ce projet s’imaginent-ils que leurs compatriotes n’ont aucune valeur ? Je leur dirai ce qu’on en pense aux États-Unis. J’ai lu dernièrement, dans les journaux de New-York, un document qui établit que tout Anglais qui débarque sur le sol de l’Union y porte une valeur intrinsèque de 2,000 dollars. Un nègre s’y vend 1,000 dollars. Ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux garder notre population, qui a une valeur double de toute autre, à nombre égal ? Ne vaut-il pas mieux que l’Angleterre conserve ses enfants pour l’enrichir et la défendre, plutôt que de les expatrier ? Mais on dit : « Ces pauvres tisserands ! (tant on a de sympathie pour les pauvres tisserands) certainement il faut les renvoyer. » — Mais qu’en disent les tisserands eux-mêmes ? — Voici M. Symons, commissaire intelligent, qui a été chargé de faire une enquête sur la condition des ouvriers. Il rapporte leur avoir fréquemment demandé s’ils étaient favorables au système de l’émigration, et qu’ils ont constamment répondu : « Il serait bien plus simple et bien plus raisonnable de porter les aliments vers nous, que de nous porter vers les aliments. » (Applaudissements.) Car pourquoi expatrier le peuple ? quel est le but de cette mesure ? C’est littéralement pour le nourrir ; il n’y a pas d’autre raison de le jeter sur des plages étrangères. — Mais recherchons un moment la possibilité pratique de ce système d’émigration. Nous sommes dans une période de détresse accablante ; dans quelle mesure l’émigration pourrait-elle y remédier ? Et d’abord, comment transporter un million et demi de pauvres à travers les mers ? Consultez l’histoire ; fait-elle mention qu’aucun gouvernement, quelque puissant qu’il fût, ait jamais fait traverser l’Océan à une armée de cinquante mille hommes ? Et puis, que ferez-vous d’un million et demi de pauvres, dans le Canada, par exemple ? Même en Angleterre, malgré l’accumulation des capitaux et des ressources de dix siècles, vous trouvez que les maintenir est déjà une charge assez lourde. Qui donc les maintiendra au Canada ? Ceux qui s’adressent à sir Robert Peel imaginent-ils qu’il soit possible de jeter sur une terre déserte une population succombant sous le poids d’une détresse invétérée, sans apporter sur cette terre le capital par lequel cette population sera employée ? Si vous transportez dans de vastes solitudes une population nombreuse, elle doit comprendre tous les éléments de société et de vie qui la composent dans la mère patrie. Vous voyez bien qu’il vous faudra transporter en même temps des fermiers, des armateurs, des fabricants et même des banquiers… (Applaudissements prolongés qui ne nous permettent pas de saisir la fin de la phrase.) N’est-il pas déplorable de voir, dans cette métropole, proposer de tels remèdes à de telles souffrances ? Je crois apercevoir devant moi quelques-uns des signataires de la pétition, et je m’en réjouis ; ce sera peut-être l’occasion d’imprimer une autre direction à l’esprit de la cité de Londres. (Écoutez !) Ces messieurs ont été circonvenus. Ainsi que je l’ai dit souvent, tout se fait moutonnièrement dans cette cité. Il semble que ses habitants ont renoncé à penser par eux-mêmes. Si j’avais à faire prévaloir quelque résolution, comment pensez-vous que je m’y prendrais ? Je m’adresserais à M. tel, puis à M. tel, et, quand j’aurais une demi-douzaine de signatures, les autres viendraient à la file. Personne ne lirait le mémoire, mais chacun le signerait. (Rires et cris : Oui, cela se ferait ainsi.) — Je dois quelques mots d’avis à ceux de mes amis, parmi les membres de la Ligue, qui ont attaché leur nom à cette pétition. Qu’ils se donnent la peine de remonter à sa source, qu’ils recherchent quels en sont les principaux colporteurs. Ne sont-ce point des armateurs habitués à passer avec le gouvernement des contrats de transport ? des propriétaires de terres dans le Canada, ou des actionnaires dans les spéculations onéreuses de la Nouvelle-Zélande ou de la Nouvelle-Galles du Sud ? Oh ! laissons-les suivre leurs plans tant qu’ils ne font des dupes que parmi les monopoleurs. Mais je tiens à voir les membres de la Ligue passer pour des hommes trop avisés pour tomber dans ces pièges grossiers. Oh ! comme le gouvernement et les monopoleurs se riraient de nous, si nous leur apportions ce moyen de diversion, ce prétexte pour ajourner l’affranchissement du commerce ! Sans doute, sir Robert Peel, qui, vous le savez, est un admirable tacticien, ne se ferait pas personnellement le patron de la pétition, mais avec quel empressement ne saisirait-il pas cette excellente occasion de venir dire : « Je suis forcé de reconnaître que la question est grave, entourée de grandes difficultés, et qu’elle exige, de la part du gouvernement de Sa Majesté, une prudente réserve (rire général) ; quelles que soient mes vues personnelles sur ce sujet, on ne peut s’empêcher d’admettre qu’une proposition de cette nature, émanée du corps respectable des banquiers et négociants de cette vaste métropole, mérite une considération lentement mûrie, laquelle ne lui manquera pas. » (L’orateur excite les applaudissements et les rires de toute l’assemblée par la manière heureuse dont il contrefait la pose, les gestes et jusqu’à l’organe du très-honorable baronnet à la tête du gouvernement.) Qui sait alors si la Chambre ne se formera pas en comité, et ne nommera pas un commissaire pour rechercher lentement jusqu’à quel point l’exportation des hommes est praticable et peut suppléer à l’importation du blé ? Quelle joie pour les monopoleurs ! Je suis bien sûr que la moitié des pétitionnaires ont donné leurs signatures sans en connaître la portée.
Il y a d’ailleurs à ce système d’émigration systématique par les soins du gouvernement un obstacle auquel ses promoteurs n’ont probablement pas songé ; c’est que le peuple ne consentira pas à se laisser transporter. Je puis dire du moins que les habitants de Stockport[3], quoique arrivés au dernier degré de misère, seraient unanimes pour répondre : « Nous savons trop bien ce qu’est la tendre clémence du gouvernement chez nous pour nous mettre à sa merci de l’autre côté de l’Atlantique. » (Applaudissements.) Je n’ai aucune objection à faire contre l’émigration volontaire. Dans un pays comme celui-ci, il y a toujours des hommes que leur goût ou les circonstances poussent vers d’autres régions. Mais l’émigration, lorsqu’elle provient de la nécessité de fuir la famine légale, c’est de la déportation et pas autre chose. (Bruyantes acclamations.) Si l’on venait vous raconter qu’il existe une île dans l’océan Pacifique, à quelques milles du continent, dont les habitants sont devenus les esclaves d’une caste qui s’empara du sol il y a quelque sept siècles ; si l’on vous disait que cette caste fait des lois pour empêcher le peuple de manger autre chose que ce qu’il plaît au conquérant de lui vendre ; si l’on ajoutait que ce peuple est devenu si nombreux, que le territoire ne suffit plus à sa subsistance, et qu’il est réduit à se nourrir de racines ; enfin, si l’on vous apprenait que ce peuple est doué d’une grande habileté, qu’il a inventé les machines les plus ingénieuses, et que néanmoins ses maîtres l’ont dépouillé du droit d’échanger les produits de son travail contre des aliments ; si ces détails vous étaient rapportés par quelque voyageur philanthrope, par quelque missionnaire récemment arrivé des mers du Sud, et s’il concluait enfin en vous annonçant que la caste dominante de cette île s’apprête à en transporter l’habile et industrieuse population vers de lointaines et stériles solitudes, que diriez-vous, habitants de Londres ? que dirait-on à Exeter-Hall[4], dans cette enceinte dont l’usage a été refusé à la ligue ? (Honte ! honte !) Oh ! Exeter-Hall retentirait des cris d’indignation de ces philanthropes dont la charité ne s’exerce qu’aux antipodes ! On verrait la foule des dames élégantes tremper leurs mouchoirs brodés de larmes de pitié, et le clergé appellerait le peuple à souscrire pour que des flottes anglaises aillent arracher ces malheureux aux mains de leurs oppresseurs ! (Applaudissements.) Mais cette hypothèse, c’est la réalité pour nos compatriotes ! (Nouveaux applaudissements.) Rendez au peuple de ce pays le droit d’échanger le fruit de ses labeurs contre du blé étranger, et il n’y a pas en Angleterre un homme, une femme ou un enfant qui ne puisse pourvoir à sa subsistance et jouir d’autant de bonheur, sur sa terre natale, qu’il en pourrait trouver dans tout autre pays sur toute la surface de la terre.
Mais puisqu’il s’agit de plans, j’en ai aussi un à proposer aux monopoleurs-gouvernants. — Qu’ils laissent les manufacturiers travailler en entrepôt, qu’ils mettent la population du Lancastre en entrepôt ; — non pour qu’elle échappe aux contributions dues à la reine, — non, nous ne voulons pas soustraire un farthing au revenu public, — mais qu’ils tirent un cordon autour du Lancastre, afin que le duc de Buckingham soit bien assuré qu’aucun grain de cet infâme blé étranger ne pénètre dans le Cheshire et le Buckinghamshire. Là, les fabricants travailleront à l’entrepôt, payant exactement leur subside à la reine, mais affranchis des exactions des monopoleurs oligarques. Si l’on nous permet de suivre ce plan, nous ne serons pas embarrassés pour obtenir des subsistances abondantes pour la population du Lancastre, quelque dense qu’elle soit ; et bien loin de redouter de la voir s’augmenter, nous la verrons avec joie croître de génération en génération. Le plan que je propose, au lieu de dissoudre le lien social, donnera de l’emploi et du bien-être à tous ; il montrera combien réagirait sur le commerce intérieur un peu d’encouragement donné au commerce extérieur par l’admission du blé étranger. Cela ne vaut-il pas mieux que d’expatrier les hommes ?
Mais la question a encore des aspects moraux qu’il est de notre devoir d’examiner. L’homme, a-t-on dit, est de tous les êtres créés le plus difficile à déplacer du lieu de sa naissance. L’arracher à son pays est une tâche plus lourde que celle de déraciner un chêne. (Applaudissements.) Oh ! les signataires de la pétition se sont-ils jamais trouvés au dock de Sainte-Catherine moment où un des navires de l’émigration s’apprêtait à entreprendre son funèbre voyage ? (Écoutez !) Ont-ils vu les pauvres émigrants s’asseoir pour la dernière fois sur les dalles du quai, comme pour s’attacher jusqu’au moment suprême à cette terre où ils ont reçu le jour ? (Écoutez ! écoutez !) Avez-vous considéré leurs traits ? Oh ! vous n’avez pas eu à vous informer de leurs émotions, car leur cœur se peignait sur leur visage ! Les avez-vous vus prendre congé de leurs amis ? Si vous l’aviez vu, vous ne parleriez pas légèrement d’un système d’émigration forcée. Pour moi, j’ai été bien des fois témoin de ces scènes déchirantes. J’ai vu des femmes vénérables disant à leurs enfants un éternel adieu ! J’ai vu la mère et l’aïeule se disputer la dernière étreinte de leurs fils. (Acclamations.) J’ai vu ces navires de l’émigration abandonner la Mersey pour les États-Unis ; les yeux de tous les proscrits se tourner du tillac vers le rivage aimé et perdu pour toujours, et le dernier objet qui frappait leurs avides regards, alors que leur terre natale s’enfonçait à jamais dans les ténèbres, c’étaient ces vastes greniers, ces orgueilleux entrepôts (véhémentes acclamations), où, sous la garde, j’allais dire de notre reine, — mais non, — sous la garde de l’aristocratie, étaient entassées comme des montagnes, des substances alimentaires venues d’Amérique, seuls objets que ces tristes exilés allaient chercher au delà des mers. (Applaudissements enthousiastes.) Je ne suis pas accoutumé à faire du sentiment ; on me dépeint comme un homme positif, comme un homme d’action et de fait, étranger aux impulsions de l’imagination. Je raconte ce que j’ai vu. J’ai vu ces souffrances, oui, et je les ai partagées ! et c’est nous, membres de la Ligue, nous qui voulons aider ces malheureux à demeurer en paix auprès de leurs foyers, c’est nous qu’on dénonce comme des gens cupides, comme de froids économistes ! Quelles seraient vos impressions, si un vote du Parlement vous condamnait à l’émigration, non point à une excursion temporaire, mais à une éternelle séparation de votre terre natale ! Rappelez-vous que c’est là, après la mort, la plus cruelle pénalité que la loi inflige aux criminels ! Rappelez-vous aussi que les classes populaires ont des liens et des affections comme les vôtres, et peut-être plus intimes ; et si vous ressentez au cœur ces vives impressions, que le cri qui a provoqué le gouvernement à organiser l’émigration soit comme un tocsin qui rallie tous vos efforts contre cette cruelle calamité. (Applaudissements.) Je terminerai en répétant que vous ne devez pas venir ici comme à un lieu de diversion. L’objet que nous avons en vue réclame des efforts personnels, énergiques et persévérants. Parler sert de peu, et j’aurais honte de paraître devant vous, si la parole n’était pas le moindre des instruments que j’ai mis au service de notre cause. (Applaudissements.) On a dit que c’était ici l’agitation de la classe moyenne. Je n’aime pas cette définition, car je n’ai pas en vue l’avantage d’une classe, mais celui de tout le peuple. Que si, cependant, c’est ici l’agitation de la classe moyenne, je vous adjure de ne pas oublier ce qu’est cette classe. C’est elle qui nomme les législateurs ; c’est elle qui soutient la presse. Il est en son pouvoir de signifier sa volonté au Parlement ; il est en son pouvoir, et je l’engage à en user, de soutenir cette portion de la presse par qui elle est soutenue. (Acclamations véhémentes.) Faites cela, et vous détournerez la nécessité de transporter sur des terres lointaines la plus précieuse production des domaines de Sa Majesté, le peuple ; faites cela, « et le peuple vivra en paix et en joie, à l’ombre de sa vigne et de son figuier, sans qu’aucun homme ose l’affliger. » (Véhémentes acclamations.)
Le président, en proposant un vote de remercîment envers les orateurs, saisit cette occasion pour engager les assistants à propager dans tout le pays les journaux qui contiendront le compte rendu le plus fidèle du présent meeting.
FN: Le cabinet whig avait proposé un droit de 8 sh. par quarter. Le droit actuel est progressif ; de 1 sh., quand le blé est à 73 sh., il s’élève à 20 sh., quand le blé est à 50 sh. ou au-dessous.
FN: On comprend que le droit se proportionnant au prix, il faut connaître à chaque instant ce prix, ce qui exige un appareil administratif considérable.
FN: M. Cobden représente au parlement la ville de Stockport.
FN: C’est la salle où se tiennent les assemblées de l’association pour la propagation des missions étrangères.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 5 avril 1843.↩
L’assemblée est aussi nombreuse qu’aux séances précédentes, et nous n’y avons jamais remarqué autant de dames. L’attention soutenue prêtée aux orateurs, l’ordre et la décence qui règnent dans toutes les parties de la salle, témoignent que la Ligue agit avec calme, mais avec efficacité sur l’esprit de cette métropole.
Nous avons remarqué sur l’estrade MM. Villiers, Gibson Hume, Cobden, Ricardo, le cap. Plumridge, Malculf, Scholefield, Holland, Bowring, tous membres du Parlement ; Moore, Heyworth, l’amiral Dundas, Pallison, etc., etc.
« Le président, M. Georges Wilson, en ouvrant la séance, annonce que plusieurs meetings ont été tenus sur divers points du territoire : un à Salford, présidé par le premier officier de la municipalité ; un autre à Doncastre, où plusieurs propriétaires du voisinage se sont fait entendre. Dans tous les deux, des résolutions ont été prises contre le monopole. Vendredi dernier, un meeting a eu lieu à Norwich, auquel assistait une députation de la Ligue, composée du col. Thompson, de M. Moore et de M. Cobden. Plus de 4,000 personnes assistaient à celte réunion, et les applaudissements dont elles ont salué la députation témoignent assez de leur sympathie pour notre cause. Samedi, un autre meeting, spécialement destiné à la classe des agriculteurs, a été tenu dans la même ville avec l’assistance de la même députation. Aucun murmure de désapprobation, aucune parole hostile, ne se sont fait entendre[1]. À la fin de la séance, le célèbre philanthrope M. John-Joseph Gurney de Norwich a invité le peuple à mettre de côté tout esprit de parti, toutes préventions politiques, et à ne voir dans cette cause qu’une question de justice et d’humanité. (Applaudissements.) Le président se félicite de voir aussi l’Irlande entrer dans le mouvement. La semaine dernière un grand meeting a eu lieu à Newtownards, sur la propriété de lord Londonderry. (Bruyante hilarilé.) Faute d’un local assez vaste, la réunion a eu lieu en plein air, malgré la rigueur du temps. — Quelque importantes que soient ces grandes assemblées, la Ligue n’a pas négligé ses autres devoirs. Les professeurs d’économie politique ont continué leurs cours. Dès l’origine, la Ligue a senti combien il était désirable qu’elle concourût de ses efforts à l’avancement d’un bon système d’éducation libérale. Elle aspire à se préparer, pour l’époque où elle devra se dissoudre, d’honorables souvenirs, en guidant le peuple dans ces voies d’utilité publique qu’elle a eu le mérite d’ouvrir. On l’a accusée d’être révolutionnaire ; mais les trois quarts de ses dépenses ont pour but la diffusion des saines doctrines économiques. Si la Ligue est révolutionnaire, Adam Smith et Ricardo étaient des révolutionnaires, et le bureau du commerce (board of tirade) est lui-même rempli de révolutionnaires[2]. (Approbation.) Ce n’est pas ses propres opinions, mais les opinions de ces grands hommes, que la Ligue s’efforce de propager ; elles commencent à dominer dans les esprits et sont destinées à dominer aussi dans les conseils publics, dans quelques mains que tombent le pouvoir et les portefeuilles. — Il faut excuser les personnes que leur intérêt aveugle sur la question du monopole ; mais il est pénible d’avoir à dire que, dans quelques localités, le clergé de l’Église établie n’a pas craint de dégrader son caractère en maudissant les écrits de la Ligue, auxquels il n’a ni le talent ni le courage de répondre[3]. (Bruyantes acclamations.) Le doyen de Hereford a abandonné la présidence de la Société des ouvriers, parce que l’excellent secrétaire de cette institution avait déposé dans les bureaux quelques exemplaires de notre circulaire contre la taxe du pain (bread-tax). M. le doyen commença bien par offrir la faculté de retirer le malencontreux pamphlet ; mais le secrétaire ayant préféré son devoir à un acte de courtoisie envers le haut dignitaire de l’Église, il en est résulté que la circulaire est restée et que c’est le doyen qui est sorti. (Rires.) J’ai devant moi une lettre authentique qui établit un cas plus grave. Dans un bourg de Norfolk, un gentleman avait été chargé de faire parvenir, par l’intermédiaire du sacristain, quelques brochures de la Ligue au curé et à la noblesse du voisinage. Le sacristain déposa ces brochures sur la table du vestiaire ; mais lorsque le ministre entra pour revêtir sa robe, il s’en empara, les porta à l’église et en fit le texte d’un discours violent, où il traita les membres de la Ligue d’assassins (éclats de rires), ajoutant qu’un certain Cobden (on rit plus fort) avait menacé sir Robert Peel d’être assassiné s’il ne satisfaisait aux vœux de la Ligue ; après quoi il fit brûler les brochures dans le poêle, disant qu’elles exhalaient une odeur de sang. (Nouveaux rires.) Je conviens qu’une telle conduite mérite plus de compassion que de colère, compassion pour le troupeau confié à la garde d’un tel ministre ; compassion surtout pour le ministre lui-même, qui demande à son Créateur « le pain de chaque jour » avec un cœur fermé aux souffrances de ses frères ; pour un ministre qui oublie à ce point la sainteté du sabbat et la majesté du temple, que de convertir le service divin en diffamation et le sanctuaire en une scène de scandale[4]. — La parole sera d’abord à M. Joseph Hume, cet ami éprouvé du peuple. Vous entendrez ensuite MM. Brotherton et Gibson. Nous comptions aussi sur la coopération de M. Bright, mais il est allé samedi à Nottingham et à Durham pour prendre part, dans l’intérêt de la liberté du commerce, aux luttes électorales de ces bourgs. »
M. Hume se lève au bruit d’acclamations prolongées. Lorsque le silence est rétabli, il s’exprime en ces termes :
Je suis venu à ce meeting pour écouter et non pour parler ; mais le comité a fait un appel à mon zèle, et ne pouvant comme d’autres alléguer le prétexte de l’inhabitude[5] (rires), j’ai dû m’exécuter malgré mon insuffisance. C’est avec plaisir que j’obéis, car je me rappelle un temps, qui n’est pas très-éloigné, où les opinions aujourd’hui généralement adoptées, non-seulement au sein de la communauté, mais encore parmi les ministres de la couronne, étaient par eux vivement controversées. Mais ces hommes, autrefois si opposés à la liberté du commerce, reconnaissent enfin la vérité des doctrines de la Ligue, et c’est avec une vive satisfaction que j’ai récemment entendu tomber de la bouche même de ceux qui furent nos plus chauds adversaires, cette déclaration : « Le principe du libre-échange est le principe du sens commun[6]. » (Acclamations.) Je me présente à ce meeting sous des auspices bien différents de ceux qui auraient pu m’y accompagner à l’époque à laquelle je fais allusion. Il y a quelque quatorze ans que je fis une motion devant une assemblée composée de six cent cinquante-huit gentlemen. (Rires. Écoutez, écoutez !) qui n’étaient pas des hommes ignorants et illettrés, mais connaissant, ou du moins censés connaître leurs devoirs envers eux-mêmes et envers le pays. Je proposai à ces six cent cinquante-huit gentlemen de retoucher la loi-céréale, de telle sorte que l’échelle mobile fût graduellement transformée en droit fixe, et que le droit fixe fît place en définitive à la liberté absolue. (Applaudissements.) Mais sur ces six cent cinquante-huit gentlemen, quatorze seulement me soutinrent. (Écoutez, écoutez.) Chaque année, depuis lors, des efforts sont tentés par quelques-uns de mes collègues, et il est consolant d’observer que chaque année aussi notre grande cause gagne du terrain. Je suis fâché de voir que les landlords, et ceux qui vivent sous leur dépendance, persistent à ne considérer la question que par le côté qui les touche. Plusieurs d’entre eux font partie de la législature, et, se plaçant à leur point de vue personnel, ils ont fait des lois dont le but avoué est de favoriser leurs intérêts privés sans égard à l’intérêt public. C’est là une violation des grands principes de notre constitution, qui veut que les lois embrassent les intérêts de toutes les classes. (Approbation.) Malheureusement la chambre des communes ne représente pas les opinions de toutes les classes. (Approbation.) Elle ne représente que les opinions d’une certaine classe, celle des législateurs eux-mêmes, qui ont fait tourner la puissance législative à leur propre avantage, au détriment du reste de la communauté. (Applaudissements.) Je voudrais demander à ces hommes, qui sont riches et possèdent plus que tous autres les moyens de se protéger eux-mêmes, comment ils peuvent, sans que leur conscience soit troublée, trouver sur leur chevet un paisible sommeil après avoir fait des lois, tellement injustes et oppressives, qu’elles vont jusqu’à priver de moyens d’existence plusieurs millions de leurs frères. (Applaudissements.) C’est sur ce principe que j’ai toujours plaidé la question, et voici la seule réponse que j’aie pu obtenir : « Si nous croyions mal agir, nous n’agirions pas ainsi.» (Rires.) Vous riez, Messieurs, et cependant je puis vous assurer qu’il y a beaucoup de personnes, et même de personnages, qui sont si ignorants des plus simples principes de l’économie politique, qu’ils n’hésiteraient pas à venir répéter cette assertion devant la portion la plus éclairée du peuple de ce pays. Mais une lumière nouvelle s’est levée à l’horizon des intelligences, et il y a dans les temps des signes capables de réveiller ceux-là mêmes qui sont les plus attachés à leurs sordides intérêts. (Applaudissements.) Il est temps qu’ils regardent autour d’eux et qu’ils s’aperçoivent que le moment est venu, où, en toute justice, la balance doit enfin pencher du côté de ceux qui sont pauvres et dénués. — L’état de détresse qui pèse sur le pays est la conséquence d’une injuste législation ; c’est pour la renverser que nous sommes unis, et j’espère qu’en dépit de la calomnie, la Ligue ne tardera pas à être considérée comme l’amie la plus éclairée de l’humanité. Cette grande association, j’en ai la confiance, se montrera supérieure aux traits qu’il plaira à la malignité de lui infliger ; elle apprendra, comme une longue expérience me l’a appris à moi-même, que plus elle se tiendra dans le sentier de la justice, plus elle sera en butte à la persécution. (Applaudissements.) Lorsqu’il m’est arrivé que quelque portion de la communauté m’a assailli par des paroles violentes, ma règle invariable a été de considérer attentivement les imputations dirigées contre moi. Si je leur avais trouvé quelque fondement, je me serais empressé de changer de conduite. Dans le cas contraire, j’y ai vu une forte présomption que j’étais dans le droit sentier et que mon devoir était d’y rester. Je ne puis que conseiller à la Ligue de faire de même. Vous êtes noblement entrés dans cette grande entreprise ; vous n’avez épargné ni votre argent ni votre temps ; vous avez fait pour le triomphe d’une noble cause tout ce qu’il est humainement possible de faire, et le temps approche où le succès va couronner vos généreux efforts. (Applaudissements.) C’est une idée très-répandue que les intérêts territoriaux font la force de ce pays ; mais les intérêts territoriaux puisent eux-mêmes leur force dans la prospérité du commerce et des manufactures, et ils commencent enfin à comprendre ce qu’ils ont gagné à priver le travail et l’industrie de leur juste rémunération. L’ouvrier ne trouve plus de salaire, les moyens d’acheter les produits du sol lui échappent : de là, ces plaintes sur l’impossibilité de vendre le bétail et le blé. La souffrance pèse en ce moment sur les dernières classes, mais elle gagne les classes moyennes, elle atteindra les classes élevées, et le jour, peu éloigné, où celles-ci se sentiront froissées, ce jour-là elles reconnaîtront qu’un changement radical au présent système est devenu indispensable. (Approbation.) En me rappelant ce qui s’est passé aux dernières élections générales, je ne puis m’empêcher de remarquer combien le peuple s’est égaré, lorsqu’il a cru, en appuyant les monopoleurs, soutenir les vrais intérêts du pays. Les défenseurs de la liberté du commerce voient aujourd’hui avec orgueil que ceux-là mêmes qui les accusaient d’être des novateurs et qui combattaient la doctrine du libre-échange, ne sont pas plutôt arrivés au pouvoir, qu’ils se sont retournés contre leurs amis pour devenir les champions de nos principes. (Applaudissements.) Tout ce que je leur demande, c’est de suivre ces principes dans leurs conséquences. Il n’y a pas un homme, dans la chambre des communes ni dans toute l’Angleterre, plus capable que sir Robert Peel d’exposer clairement et distinctement les doctrines qui devraient régir notre commerce, et qui sont les mieux calculées pour promouvoir les intérêts et la prospérité de ce pays. (Marques d’approbation.) Le très-honorable baronnet a fait un pas dans cette voie, mais ce n’est qu’un pas. Il s’attarde et s’alanguit sur la route, sans doute parce que son parti ne lui permet pas d’avancer. Il a proclamé le principe, il ne lui reste qu’à l’appliquer pour assurer au pays une paix solide et une prospérité durable. (Applaudissements.) — Il y a un grand nombre de personnes bien intentionnées qui ne peuvent comprendre pourquoi une réforme commerciale est plus urgente aujourd’hui qu’à des époques antérieures. Les fermiers s’imaginent que, parce que au temps de la guerre, ils ont obtenu des prix élevés en même temps que les fabriques réalisaient de grands profits, il ne s’agit que d’avoir encore la guerre pour ramener et ces prix et ces bénéfices. Cette illusion existe même parmi quelques manufacturiers ; dans les classes agricoles elle est presque universelle ; mais il est aisé d’en montrer l’inanité. Si les circonstances étaient les mêmes qu’aux époques qui ont précédé 1815, elles amèneraient sans doute les mêmes résultats. Bien heureusement, sous ce rapport du moins, la situation de l’Angleterre a tellement changé, qu’il est impossible que des conséquences semblables découlent d’une législation identique. Pendant la guerre, qui a rempli ce quart de siècle qui s’est terminé en 1815, il n’y avait pas de manufactures sur le continent, et à la paix, l’Angleterre, qui était en possession de pourvoir tous les marchés du monde, put maintenir pour un temps les hauts prix occasionnés par la guerre. C’est ce qu’elle fît, bien que le prix des aliments fût alors plus élevé de 50 p. 100, dans ce pays que partout ailleurs. Mais quel est l’état actuel des choses ? La paix règne en Europe et en Amérique, et la population s’y partage entre l’industrie et l’agriculture. Elle rivalise, sur les marchés neutres, avec le fabricant anglais, et à moins que celui-ci ne puisse établir les mêmes prix, il lui est impossible de soutenir la concurrence. Que veut-il donc quand il demande l’abrogation des lois restrictives ? Il veut que les ports de l’Angleterre soient ouverts aux denrées du monde entier, afin qu’elles s’y vendent à leur prix naturel, et que les Anglais soient placés sur le même pied que toutes les autres nations. Craignez-vous qu’à ces conditions le génie industriel, le capital et l’activité de la Grande-Bretagne aient rien à redouter ? (Acclamation.) Vos acclamations répondent. Non. Ne nous lassons donc pas de réclamer la liberté du commerce. — J’adresserai maintenant quelques paroles à ceux qui jouissent du privilége d’envoyer des représentants au Parlement. Une grande responsabilité pèse sur eux ; car ils ne doivent pas oublier que le mandat qu’ils confèrent dure sept ans, et pendant ce temps, quelles que soient leurs souffrances, fût-ce une ruine totale, ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. C’est là un grave sujet de réflexions pour tous les électeurs. Tous sont intéressés à voir le pays florissant, et ce n’est certes pas son état actuel. Le seul moyen d’y arriver, c’est d’ouvrir nos ports à toutes les marchandises du monde. Je pourrais nommer plusieurs nations dont les produits nous conviennent : je n’en citerai qu’une. À un meeting tenu en septembre dernier, sous la présidence du duc de Rutland, M. Everett, ministre plénipotentiaire de l’Union américaine, fut appelé à prendre la parole, et dit en substance : « Mon pays désire échanger ses produits contre les vôtres. Vous avez beaucoup d’objets qui lui manquent, et il a pour vous payer des marchandises qui encombrent ses quais, jusqu’à ce point qu’on a été a obligé de se servir de salaisons comme de combustibles. » (Et en effet un citoyen des États-Unis m’a confirmé qu’il y avait sur les quais de la Nouvelle-Orléans des amas de salaisons qu’on pourrait vendre à 6 deniers la livre, et qu’on employait en guise de charbon, à bord des bateaux à vapeur.) « Nous avons, ajoutait M. Everett, du blé qui pourrit dans nos magasins, et nous manquons de vêtements et d’instruments de travail. » Qui s’oppose à l’échange de ces choses ? Le gouvernement britannique : ce que nous réclamons, c’est cette liberté d’échanges avec le monde entier. Chaque climat, chaque peuple a ses productions spéciales. Que toutes puissent librement arriver dans ce pays, pour s’y échanger contre ce qu’il produit en surabondance, et tout le monde y gagnera. Le manufacturier étendra ses entreprises ; les salaires hausseront ; la consommation des produits agricoles s’accroîtra ; la propriété foncière et le revenu public sentiront le contre-coup de la prospérité générale. Mais avec notre législation restrictive, les usines sont de moins en moins occupées, les salaires de plus en plus déprimés, les productions du sol de plus en plus délaissées, et le mal s’étend à toutes les classes. Que ceux donc qui ont à cœur le bien-être de la patrie consacrent à ces graves sujets leurs plus sérieuses méditations. N’est-il pas vrai que le pays décline visiblement, et ne donneriez-vous pas à cette assertion votre témoignage unanime ?…
On a dit que la loi-céréale était nécessaire pour soutenir les fermiers ; mais voilà la quatrième fois que les fermiers sont dupes de cette assertion. Le prix de leurs produits s’avilit et ne se relèvera pas tant que le travail manquera au peuple. Les propriétaires leur disent : « Si vous ne pouvez payer la rente, prenez patience, la dépréciation ne sera pas permanente ; le cours de vos denrées se relèvera, comme il fit après les crises de 1836 et 1837. » Mais comment pourrait-on assimiler la détresse actuelle à celle d’aucune autre époque antérieure ? J’ai reçu aujourd’hui même d’un fermier de Middlesex, nommé M. Fox, un document qui établit que le capital des tenanciers était tombé de 25 p. 100 dans ces cinq dernières années. Il a calculé que 32 millions de bêtes à laine, sept millions de bêtes à cornes et 60 millions de quarters de blé, formant ensemble une valeur de 468 millions de livres sterling, ont perdu 25 p. 100, ce qui constitue pour les fermiers une perte de 117 millions de livres. Ce n’est pas là un tableau imaginaire, et, si les capitaux décroissent dans une aussi effrayante proportion, comment le pays pourra-t-il supporter 55 à 36 millions de subsides ?
Les lois-céréales ont pour objet l’avantage des landlords ; mais, dans mon opinion, elles ne leur ont pas plus profité qu’aux autres classes de la communauté. Tout ce qu’on peut dire d’eux, c’est qu’après tout ils n’ont que ce qu’ils méritent, puisque ces lois sont leur œuvre. (Rires.) Soyez certains que les rentes tomberont aussitôt qu’interviendront entre les fermiers et les seigneurs de nouveaux arrangements ; car, si le prix des denrées décline, il faut bien que les fermages diminuent. Quelle sera alors la situation du propriétaire ? Le sol est grevé d’une première charge, qui est le pauvre ; avant que le seigneur touche sa rente, il faut que le pauvre soit nourri. Or, il est de fait que, dans ces derniers temps, la taxe des pauvres a doublé et même triplé ! Dans ma paroisse, Mary-le-Bone, qu’on pourrait croire une des plus étrangères à la crise actuelle, elle s’est élevée de 8,500 à 17,000 l. s. Ainsi une portion considérable de la rente réduite passera aux pauvres. Vient ensuite le clergé ; et l’on sait que depuis la dernière commutation de la loi des dîmes, le seigneur ne saurait toucher un farthing de sa rente, que les ministres ne soient payés. Voilà une seconde charge. — Et puis, voici venir Sir Robert Peel, avec son income-tax, qui dit : « Vous ne palperez pas un shilling sur vos baux que l’Échiquier ne soit satisfait. » Cette taxe a produit un million huit cent mille livres sterling pendant ce quartier ; mais selon toute apparence, une faible partie de cette somme aura été acquittée par les seigneurs, car ils sont toujours les derniers à payer. (Rires.) C’est une troisième charge de la propriété. — Enfin, s’il est vrai. comme je l’ai ouï dire, qu’une grande portion du sol est hypothéquée, c’est une quatrième charge. — Que reste-t-il donc aux propriétaires campagnards ? Je leur conseille d’y regarder de près. La difficulté est le fruit de leur impéritie, et elle ne fera que s’accroître jusqu’à ce qu’ils viennent eux-mêmes offrir leur assistance à la Ligue. (Écoutez ! écoutez !) Gentlemen, les circonstances travaillent pour vous ; l’income-tax plaide pour vous ; l’abaissement des revenus témoigne pour vous, et il le fallait peut-être, car il y en a beaucoup qui ne s’émeuvent que lorsque leur bourse est compromise. — D’un autre côté, les prisons regorgent ; cent cinquante mille personnes y passent tous les ans, chacune desquelles suffit ensuite pour en corrompre cinquante autres. C’est pourquoi je dis que c’est ici une question qui touche à vos devoirs de chrétiens. Nous demandons justice ! Nous demandons que le gouvernement ne persévère pas dans une voie qui conduit le pays dans un état de ruine et de mendicité capable de faire frissonner le cœur de tout homme honnête ! (Applaudissements.)
M. Brotherton : Ce n’est pas ici la cause d’un parti, mais celle de tout un peuple, ce n’est pas la cause de l’Angleterre, mais celle du monde entier ; car c’est la cause de la justice et de la fraternité. Mon honorable ami a dit que la Ligue soutenait le principe du sens commun, et il a été reconnu au Parlement, par le premier ministre de la couronne, que vendre et acheter aux prix les plus avantageux, étaient le droit de tous les Anglais et de tout homme. Lui aussi a proclamé que le principe de la liberté des échanges était le principe du sens commun, mais ce qu’il faut faire sortir de ce principe, c’est un peu de commune honnêteté. (Acclamation.) Les législateurs savent bien ce qui est juste ; tout ce que le peuple demande, c’est qu’ils le mettent en pratique. J’aurai bientôt l’honneur de présenter à la Chambre des communes une pétition de mes commettants pour le retrait de la loi-céréale (rires), et je crains bien qu’elle n’y reçoive qu’un froid accueil. Mes commettants néanmoins veulent que j’en appelle non-seulement à la Chambre, mais à ce meeting. C’est au peuple de cette métropole que la nation doit en appeler. Le peuple de la métropole tient dans ses mains les destinées de l’empire. Il y a longtemps que les provinces agitent cette grande question ; elles en comprennent toute l’importance. C’est la condition la plus favorable à une prochaine solution ; car dans mon expérience, j’ai toujours reconnu que comme toute corruption descend de haut en bas, toute réforme procède de bas en haut. (Applaudissements.) L’agitation actuelle a commencé parmi de pauvres tisserands. Leurs sentiments furent d’abord méconnus, même par les manufacturiers, mais ils reconnaissent aujourd’hui que les pauvres tisserands avaient raison…
J’ai toujours combattu les lois-céréales au point de vue de la justice ; car je les considère comme injustes, inhumaines et impolitiques. Je dis qu’une loi qui protège une classe de la communauté aux dépens des autres classes est une loi injuste. Je ne conteste pas aux landlords le droit de disposer de leurs propriétés à leur plus grand avantage, et même d’exporter le blé s’ils le peuvent produire à meilleur marché qu’au dehors ; mais les landlords ont fait une loi qui dépouille l’ouvrier du droit de disposer du produit de son travail selon sa convenance ; et c’est pourquoi je dis qu’une telle loi ne saurait se maintenir, voyant qu’elle est si manifestement injuste. — La loi-céréale a encore le tort d’affecter les diverses classes de la société d’une manière fort inégale ; si elle ôte cinq pour cent au riche, elle arrache cinquante pour cent aux pauvres, et moi qui ne suis taxé qu’à cinq pour cent, je finis par oublier jusqu’au sens du mot justice. Ce qui fait que beaucoup d’hommes ne comprennent pas toute la signification de ce mot, c’est que l’intérêt personnel les aveugle. Je me rappelle qu’un gentleman, discutant au milieu d’un grand nombre de gens d’église, ne pouvait leur faire comprendre le sens d’un terme que je supposerai être ce mot justice. Il écrivit ce mot et demanda : Qu’est-ce que cela signifie ? Un des ministres s’écria : Justice. Le gentleman posa une guinée sur le mot et dit : Que voyez-vous maintenant ? et le ministre répondit : Rien, — car l’or lui interceptait la vue. (Rires.) — On dit que ces lois ont été faites, non pour l’avantage des landlords, mais pour celui des fermiers et des ouvriers des campagnes. Mais il n’est personne qui, après avoir observé les effets de ces lois, ne soit arrivé à cette conclusion, qu’elles ont profité aux manouvriers des districts agricoles ; et quant aux fermiers, s’ils étaient appelés en témoignage, ils déclareraient qu’ils n’en ont tiré certainement aucun bénéfice. Les seigneurs sont donc les seuls auxquels on pourrait supposer qu’elles ont profité ; mais on reconnaîtra à la fin qu’il n’en a pas été ainsi. Je suis assez vieux pour me rappeler les démonstrations d’enthousiasme avec lesquelles les seigneurs terriens accueillirent la guerre de France, déclarant que, pour la soutenir, ils dépenseraient leur dernière guinée et leur dernière acre de terre ; et chacun se hâta de faire honneur de leur désintéressement à leur patriotisme. Tant que dura la guerre, ils empruntèrent comme ils purent. Enfin, la paix revint, et avec elle l’abondance et le bon marché ; mais les landlords qui avaient emprunté de l’argent commencèrent à rechercher comment ils pourraient en éviter le payement. Quoiqu’ils eussent engagé leur dernière acre et leur dernier écu à cette cause glorieuse, payer n’était jamais entré dans leurs intentions. (Écoutez ! écoutez !) Leur premier soin fut de débarrasser leurs épaules de 14 millions d’impôts fonciers, et puis ils firent la loi-céréale, afin de maintenir le taux élevé des rentes. Ils savaient bien que les rentes fléchiraient naturellement comme le prix des blés, et ils inventèrent les lois-céréales. Lorsqu’elles furent portées pour la première fois devant la législature, lord Liverpool admit avec franchise et loyauté qu’elles auraient pour effet, et par voie d’induction, qu’elles avaient pour but, d’empêcher la dépression des rentes. Ainsi, l’aristocratie qui avait hypothéqué ses domaines, dans des vues soi-disant patriotiques, au lieu de payer elle-même ses dettes, saisit la première occasion d’en reporter le fardeau sur les classes laborieuses ; et après avoir emprunté jusqu’à concurrence de la valeur des terres, elle en a législativement doublé la rente, en élevant le prix du pain, c’est-à-dire que c’est le peuple et non elle qui paye les arrérages. Voilà comment on en a agi envers le peuple de ce pays ; c’est à lui de dire si cela doit continuer. Le duc de Newcastle a demandé s’il n’avait pas le droit d’user comme il l’entendrait de sa propriété. (Rires.) Je n’ai pas d’objection à faire contre cette doctrine convenablement définie ; mais puisque nous nous donnons pour un peuple loyal et religieux, nous devons bien reconnaître que nul n’a le droit de faire de sa propriété ce qu’il veut, à moins que ce qu’il veut ne soit juste. Il me semble qu’il nous est commandé de faire aux autres ce que nous voudrions qui nous fût fait. Les landlords cependant ont fait des lois pour obtenir un prix artificiel des fruits de leurs terres, et en même temps pour empêcher le peuple de recevoir le prix naturel de son travail. C’est là une grande injustice, et il n’est personne dont ce ne soit le devoir d’en poursuivre le redressement. La détresse publique est profonde, quoique plusieurs puissent ne pas l’éprouver. Elle ne s’est pas encore appesantie sur Londres dans toute son intensité, ou plutôt elle y est moins aperçue qu’ailleurs, parce que les hautes classes s’y préoccupent peu du sort du peuple. Je suis disposé à croire, comme M. Hume, qu’il règne ici une grande apathie ; mais il n’en est pas moins vrai que la population souffre, et nous venons demander aide et assistance aux habitants de cette métropole. Il est de leur devoir de répondre à cet appel, et de faire tous leurs efforts pour ramener la prospérité dans le pays. La détresse a gagné les classes agricoles, et elles s’aperçoivent enfin que les meilleurs débouchés consistent en une clientèle prospère, ou dans le bien-être général. Il est des personnes qui s’imaginent qu’en poursuivant le retrait des lois-céréales, les manufacturiers travaillent pour leur avantage au détriment des autres classes. C’est là une illusion ; la chose est impossible. Il n’est pas possible que l’activité et l’extension des affaires profitent aux uns au préjudice des autres. (Cris : Non, non !) Notre population s’accroît de trois cent mille habitants chaque année. Il faut que cet excédant soit occupé et nourri. S’il n’est pas nourri au dehors des workhouses, il faudra qu’il soit nourri au dedans. Mais s’il trouve de l’emploi, des moyens de subsistance, par cela même il ouvrira aux produits du sol de nouveaux débouchés. Aujourd’hui la législation prive les ouvriers de travail, en s’interposant dans leurs échanges ; elle en fait un fardeau pour la propriété. Ainsi que l’a dit M. Hume, il faut bien que ces ouvriers soient secourus, et à mesure que leur masse toujours croissante pèsera de plus en plus sur la propriété, l’aristocratie reconnaîtra que l’honnêteté eût été une meilleure politique. (Écoutez ! écoutez !) Voulez-vous le maintien des lois-céréales ? (Non, non !) Eh bien ! j’en appelle à tout homme qui s’intéresse à l’amélioration du sort du peuple, au progrès de son éducation intellectuelle et morale, à la prospérité de l’industrie et du commerce, rallions-nous à la Ligue ! unissons nos efforts pour effacer de nos codes ces lois iniques et détestables. (Applaudissements prolongés.)
M. Milner Gibson se lève, et après quelques considérations il continue en ces termes :
Je ne puis jeter les yeux sur cette nombreuse et brillante assemblée, sans me sentir assuré que nous agitons ici une question nationale. On a parlé de meetings réunis par surprise ; mais tant d’hommes distingués ne sauraient se réunir que pour une cause qui préoccupe à un haut degré l’esprit public. (Assentiment.) Certes, s’il s’agissait de discourir sur le fléau de l’abondance, sur les charmes de la disette, sur les bienfaits des restrictions industrielles et commerciales, une plus étroite enceinte suffirait[7]. (Rires.) Un autre trait caractéristique de ces assemblées, et dont je dois vous féliciter, c’est d’être sanctionnées et embellies par la plus gracieuse portion de la communauté. Comment expliquer la présence du beau sexe dans cette enceinte ? Il n’est pas disposé d’ordinaire à s’intéresser à de pures questions d’argent, et à d’arides problèmes d’économie politique. Pour avoir mérité son attention, il faut bien que notre cause renferme une question de philanthropie, une question qui touche aux intérêts de l’humanité, à la condition morale et physique du plus grand nombre de nos frères ! et si les dames viennent applaudir aux efforts de la Ligue, c’est qu’elles entendent soutenir ce grand principe évangélique, ce dogme de la fraternité humaine que peuvent seuls réaliser l’affranchissement du commerce et la libre communication des peuples. (Applaudissements prolongés.) Une autre leçon qui dérive de cette grande démonstration, c’est que la philanthropie n’a pas besoin de s’égarer dans les régions lointaines pour trouver un but à ses efforts. La détresse règne autour de nous ; c’est notre propre patrie maintenant qui réclame ces nobles travaux humanitaires par lesquels elle se distingue avec autant d’honneur. (Applaudissements.) J’apprécie les motifs et la générosité de ceux qui s’efforcent de répandre jusqu’aux extrémités du globe les bienfaits de la foi et de la civilisation ; mais je dois dire qu’il y a tant de souffrances autour de nos foyers, qu’il n’est plus nécessaire d’aller chercher aux antipodes ou en Chine un aliment à notre bienveillance. (Applaudissements.) Je regrette l’absence d’un gentleman qui devait prendre ce soir la parole. (De toutes parts : il est arrivé. En effet, M. Bright vient de monter sur l’estrade.) Je veux parler du colonel Thompson, et je suis fâché de n’avoir pas plus tôt prononcé son nom. Je regrette l’absence de ce gentleman, qui, par ses écrits et ses discours, a plus que tout autre fourni des arguments contre le monopole. C’est de ses nombreuses publications, et particulièrement de son Catéchisme contre les lois-céréales que j’ai tiré les matériaux dont je me suis servi pour combattre ces lois. On raconte que Georges III rencontra par hasard un mot heureux. Une personne lui disait que les avocats étaient des gens habiles, possédant dans leur tête une immense provision de science légale pour tous les cas. Non, dit Georges III, les avocats ne sont pas plus habiles que d’autres et ils n’ont pas plus de lois dans la tête ; mais ils savent où en trouver quand ils en ont besoin. (Rires.) Dans les ouvrages du colonel Thompson, vous trouverez la solution de toutes les questions qui se rattachent à notre cause, et vous vous rendrez maîtres des arguments qu’il faut opposer aux lois-céréales. Que sont ces lois, après tout ? On a dit qu’elles étaient nécessaires, — pour protéger l’industrie nationale, — pour assurer de l’emploi aux ouvriers des campagnes, — pour placer le pays dans un état d’indépendance à l’égard de l’étranger. — D’abord, en ce qui touche le travail national, la protection n’est qu’un mot spécieux. Il implique une faveur conférée par la législature aux personnes protégées. Quand on y regarde de près, en effet, on s’aperçoit que tout se réduit à décourager quelques branches d’industrie pour en encourager d’autres, c’est-à-dire à gratifier de certaines faveurs des classes déterminées. (Ici l’orateur examine l’influence des lois restrictives sur la propriété, le fermage et la main-d’œuvre.) Si l’on considère les conséquences des lois-céréales relativement à l’industrie, on ne peut nier qu’elles n’aient pour objet direct de la contenir dans de certaines limites. Le but qu’on se propose, avec une intention bien arrêtée, c’est de prévenir l’émancipation et l’accroissement des classes industrieuses, d’abord pour conserver aux landlords des rentes exagérées, ensuite pour les maintenir dans leur position au plus haut degré de l’échelle sociale. (Applaudissements.) Je répète que les landlords ont pour but de conserver cet ascendant qu’ils exercent sur le pays, ascendant qu’ils ne doivent certes pas à leurs talents ou à leur supériorité ; ils le veulent conserver néanmoins pour demeurer à toujours les dominateurs des classes moyennes et laborieuses. (Applaudissements.) Ils voient d’un œil d’envie les progrès de la richesse et de l’intelligence parmi les classes rivales, et, dans leur fol amour des distinctions féodales, ils ont fait des lois pour assurer leur domination. (Bravos prolongés.) On a dit encore que nous proposions une mesure violente, et que, en égard aux tenanciers et aux capitaux engagés dans l’agriculture, il ne fallait pas, par trop de précipitation, ajouter aux embarras de la situation actuelle. Je réponds, dans l’intérêt des tenanciers eux-mêmes, que rien ne saurait leur être plus profitable que l’abrogation absolue et immédiate de la loi. (Assentiment.) C’est dans leur intérêt surtout qu’il faut renouveler entièrement les bases de notre police commerciale. Des changements périodiques et successifs ne feraient, pour ainsi dire, qu’organiser le désordre. Il vaut mieux pour eux que la révolution s’opère complètement et d’un seul coup. Puisqu’on reconnaît la justice du principe de la liberté commerciale, je le demande, pourquoi refuse-t-on de le mettre en pratique ? C’est en réclamant, d’une manière absolue, l’abrogation immédiate et totale de toutes les lois restrictives ; c’est en suivant cette ligne de conduite, la seule qui ait pour elle l’autorité des principes, que la Ligue a rallié autour d’elle tout ce qu’il y a dans le pays d’intelligence, d’enthousiasme et de dévouement. Ce n’est pas que je veuille nier qu’une mesure de transaction, telle que le droit fixe de 8 shillings, si le dernier cabinet l’eût fait prévaloir, n’eût conféré au pays de grands avantages et résolu pour un temps de graves questions, etc…
Puisque j’ai parlé du droit fixe, je dois répondre à cette étrange assertion, que le droit sur le blé est payé par l’étranger. S’il en est ainsi, il ne s’agirait que d’augmenter ce droit pour rejeter sur l’étranger tout le fardeau de nos taxes. (Rires et applaudissements.) Si toutes nos importations provenaient d’une petite île comme Guernesey, je pourrais comprendre qu’elles seraient trop disproportionnées avec la consommation du pays, pour qu’un droit prélevé sur ce faible supplément pût affecter le prix du blé indigène. Dans cette hypothèse, abolir le droit, ce serait en faire profiter le propriétaire de Guernesey. Mais avec la liberté du commerce, les arrivages nous viendraient de tous les points du globe, et feraient au blé indigène une concurrence suffisante pour le maintenir à bas prix. Dans de telles circonstances, une taxe sur le blé étranger ne peut qu’élever le prix du blé national, et soumettre par conséquent le peuple à un impôt beaucoup plus lourd que celui qui rentre à l’Échiquier…
On dit encore que, si nous supprimons la taxe sur le blé exotique, l’étranger pourra le soumettre à un droit d’exportation, et attirer vers son trésor public une source de revenu, qui maintenant va à notre trésor. Si les étrangers interrompaient ainsi le commerce du blé, nos agriculteurs du moins ne devraient pas s’en plaindre, puisque c’est ce qu’ils font eux-mêmes. — Mais commençons par mettre de notre côté la chance que l’étranger s’abstiendra d’établir de tels droits. (Approbation.) Ouvrons nos ports, et s’il se rencontre un gouvernement qui taxe le blé destiné à l’Angleterre, il sera victime de son impéritie, car nous irons chercher nos approvisionnements ailleurs.
Il est un autre sophisme qui a fait son entrée dans le monde sous le nom de traités de commerce[8]. On nous dit : « N’abrogez pas les lois-céréales jusqu’à ce que l’étranger réduise les droits sur nos produits manufacturés. » Ce sophisme repose sur l’opinion que le gouvernement d’un pays est disposé à modifier son tarif à la requête des étrangers ; il tend à subordonner toute réforme chez un peuple à des réformes chez tous les autres. Mais quelle est, au sein d’un peuple, la force capable de détruire la protection ? Ce n’est pas les prétentions de l’étranger, mais l’union et l’énergie du peuple, fatigué d’être victime d’intérêts privilégiés. Voyez ce qui se passe ici. Qu’est-ce qui maintient les lois restrictives ? C’est l’égoïsme et la résolution de nos monopoleurs, les Knatchbull, les Buckingham, les Richmond. Si l’étranger venait leur demander l’abandon de ces lois, adhéreraient-ils à une telle requête ? Certainement non. Les exigences de l’étranger ne rendraient nos seigneurs ni plus généreux, ni plus indifférents à leurs rentes, ni moins soucieux de leur prépondérance politique. (Applaudissements.) Eh bien, en cela les autres pays ne diffèrent pas de celui-ci ; et si nous allions réclamer d’eux des réductions de droits, ils ont aussi des Knatchbull et des Buckingham engagés dans des priviléges manufacturiers, et on les verrait accourir à leur poste pour y défendre vigoureusement leurs monopoles. Ailleurs, comme ici, ce n’est que la force de l’opinion qui affranchira le commerce. (Écoutez ! écoutez !) Je vous conseille de ne pas vous laisser prendre à ce vieux conte de réciprocité ; de ne point vous laisser détourner de votre but par ces histoires d’ambassadeur allant de nation en nation pour négocier des traités de commerce et des réductions réciproques de tarifs. Le peuple de ce pays ne doit compter que sur ses propres efforts pour forcer l’aristocratie à lâcher prise. (Acclamations.) — La question maintenant est de savoir sous quelle forme nous nous adresserons à la législature. Demanderons-nous aux landlords l’abrogation des lois restrictives comme un acte de charité et de condescendance ? solliciterons-nous à titre de faveur, ou exigerons-nous comme un droit la libre et entière disposition des fruits de notre travail, soit que nous les devions à nos bras ou à notre intelligence ? (Bravos prolongés.) On a dit, je le sais, que le joug de l’oppression avait pesé si longtemps sur la classe moyenne, qu’elle avait perdu jusqu’au courage de protester, et que son cœur et son esprit avaient été domptés par la servilité. Je ne le crois pas. (Applaudissements.) Je ne puis pas croire que les classes moyennes et laborieuses, du moment qu’elles ont la pleine connaissance des maux que leur infligent les nombreuses restrictions imposées à leur industrie par la législature, reculent devant une démonstration chaleureuse et unanime (bruyantes acclamations), pour demander d’être placées, avec les classes les plus favorisées, sur le pied d’une parfaite égalité. — Les propriétaires terriens me demanderont si, lorsque je réclame l’abolition de leurs monopoles, je suis autorisé par les manufacturiers à abandonner toutes les protections dont ils jouissent. Je réponds qu’ils sont prêts à faire cet abandon (applaudissements), et je rougirais de paraître devant cette assemblée pour y plaider la cause de l’abrogation des lois-céréales, si je ne réclamais en même temps l’abolition radicale de tous les droits protecteurs, en quoi qu’ils puissent consister. (Applaudissements.) C’est sur ce terrain que nous avons pris position et que nous entendons nous maintenir. Les lois-céréales, aussi bien que les autres droits protecteurs, ont passé au Parlement alors que les classes manufacturières et commerciales n’y étaient pas représentées, à une époque où ce corps nombreux et intelligent, qui forme la grande masse de la communauté, ne pouvait s’y faire entendre par l’organe de ses députés. Vainement reproche-t-on aux manufacturiers de jouir des bienfaits de la protection, comme par exemple de droits à l’entrée des étoffes de coton à Manchester, ou de la houille à Newcastle. (Rires.) N’est-il pas clair que les landlords ont admis ces priviléges illusoires pour faire passer les leurs ? (Approbation.) Ce ne sont pas les manufacturiers qui ont établi ces droits, c’est l’aristocratie, qui, pénétrant dans leurs comptoirs, a la prétention de leur dicter quand, où et comment ils doivent accomplir des importations et des échanges. Il est puéril de reprocher à l’industrie ces droits protecteurs, car les lois existantes n’émanent pas d’elle ; et la responsabilité en appartient tout entière, ainsi que celle de la détresse nationale, au Parlement britannique. (Acclamations prolongées.) On a dit que, si la cité de Londres était lente à entrer dans ce mouvement, c’est qu’elle ne voulait pas recevoir de lois. Je n’ai jamais compris que la Ligue ait cherché à s’imposer à qui que ce soit. Nous sommes ici pour un objet commun, le bien-être de la communauté, et, par-dessus tout, celui du commerce de Londres. Est-il possible, par une interprétation absurde, de nous accuser d’outrecuidance, lorsque nous nous bornons à venir dire aux classes laborieuses : « Votre industrie sera mieux placée sous votre direction que sous celle des chasseurs de renards de la Chambre des communes (rires et applaudissements) ; elle prospérera mieux sous le régime de la liberté que sous le contrôle oppresseur de ces gentilshommes que des votes corrompus ont transformés en législateurs. » (Tonnerre d’applaudissements.) — J’arrive maintenant à cette question : L’abrogation de la loi-céréale est-elle une mesure praticable ? Si nous pouvons convaincre le premier ministre et l’administration que l’opinion publique est favorable à cette mesure, je suis convaincu qu’elle sera proposée au Parlement ; elle n’est pas hors de notre portée, nous ne courons pas après un objet impraticable. Des réformes plus profondes ont été préparées et amenées par la discussion, par l’appel à la raison publique et au moyen de ce qu’on nomme aujourd’hui agitation. Je crois que l’aristocratie elle-même, si elle voit que le pays est décidé, acquiescera par pudeur, et, sinon par pudeur, du moins par crainte. (Bruyantes acclamations.) Vous redoutez la Chambre des lords. Mais, quoi ! il n’y a pas dans tout le pays un corps plus complaisant ! (Rires.) Il n’y a pas dans toute la métropole quatre murs qui renferment une collection d’hommes si timides ! Que le pays manifeste donc sa résolution, et l’administration proposera la mesure, les communes la renverront aux lords qui la voteront à leur tour. Peut-être n’obtiendra-t-elle pas les suffrages du banc des évêques, mais Leurs Révérences en seront quittes pour aller se promener un moment en dehors de la salle. (Rires.) Les grands propriétaires ont déjà montré d’autres sympathies de docilité, par exemple en votant l’admission des bestiaux étrangers, ce qu’ils se sont hâtés de faire lorsqu’ils ont vu qu’abandonner le ministère, c’était renoncer à la portion d’influence que, par certains arrangements, le cabinet actuel leur a assurée. Les promesses solennelles faites aux fermiers ne les ont pas arrêtés. En parcourant ces jours derniers un livre d’histoire naturelle, je suis tombé sur la description d’un oiseau, et j’en ai été frappé, tant elle s’applique aussi à ces gentilshommes campagnards envoyés au Parlement comme monopoleurs, et qui néanmoins admettent enfin les principes de la liberté commerciale. Le naturaliste dit, en parlant du rouge-queue (bruyants éclats de rires) : « Son chant sauvage n’a rien d’harmonieux ; mais lorsqu’il est apprivoisé, il devient d’une docilité remarquable. Il apprend des airs à la serinette ; il va même jusqu’à parler. » (Rires prolongés.) Que l’administration présente donc une mesure décisive, et les grands seigneurs s’y soumettront, car tout le monde peut avoir remarqué que, dans la dernière session, leurs discours ont eu une teinte apologétique, et semblent avoir été calculés plutôt pour excuser que pour soutenir les lois-céréales. Quelques personnes pourront penser que je vais trop loin en demandant l’abrogation totale (non, non) ; mais je les prie d’observer qu’une protection modérée empêcherait l’entrée d’une certaine quantité de blé, et que, relativement à cette quantité, elle agirait comme une prohibition absolue. C’est donc un sophisme de dire que la protection diffère en principe de la prohibition. La différence n’est pas dans le principe, mais dans le degré. La Ligue a répudié le principe même de la protection. Elle proclame que toutes les classes ont un droit égal à la liberté des échanges et à la rémunération du travail. (Approbation.) Je sais qu’on me dira que l’Angleterre est un pays favorisé, et qu’elle devrait se contenter de ses avantages ; mais je ne puis voir aucun avantage à ce que les ouvriers de l’Angleterre ne soient pas pourvus des choses nécessaires à la vie aussi bien que ceux des États-Unis ou d’ailleurs. On peut se laisser éblouir et séduire par les parties ornementales de notre constitution et l’antiquité vénérable de nos institutions ; mais la vraie pierre de touche du mérite et de l’utilité des institutions, c’est, à mon sens, que le grand corps de la communauté atteigne à une juste part des nécessités et du confort de la vie. Je dis que, dans un pays comme celui-ci, qui possède tant de facilités industrielles et commerciales, tout homme sain de corps et de bonne volonté, doit pouvoir atteindre non-seulement à ce qui soutient, mais encore à ce qui améliore, je dis plus, à ce qui embellit l’existence. (Applaudissements.) C’est ce qu’admet la cité de Londres, dans le mémoire qu’elle a récemment soumis au premier ministre, au sujet de la colonisation. N’ayant pas lu ce mémoire, je ne m’en fais pas le juge, mais je sais qu’il a été signé par des adversaires comme par des partisans de la liberté commerciale. Quant aux premiers, je leur demanderai, avec tout le respect que je leur dois, comment ils peuvent, sans tomber en contradiction avec eux-mêmes, nous engager à créer au loin et à gros frais de nouveaux marchés pour l’avenir, quand ils nous refusent l’usage des marchés déjà existants. Je ne puis concilier le refus qu’on nous fait du libre-échange avec les États-Unis, où il existe une population nombreuse, qui a les mêmes besoins et les mêmes goûts que celle de ce pays, avec l’ardeur qu’on montre à créer de nouveaux marchés, c’est-à-dire à provoquer l’existence d’une population semblable à celle des États-Unis, et cela pour ouvrir dans l’avenir des débouchés à notre industrie. C’est là une inconséquence manifeste. Quant à ceux qui soutiennent à la fois et les principes de la Ligue et le projet de colonisation, n’ont-ils pas à craindre de s’être laissé entraîner à appuyer une mesure que le monopole considère certainement comme une porte de secours, comme une diversion de ce grand mouvement que la Ligue a excité dans le pays ? (Écoutez !) Je ne veux pas contester les avantages de la colonisation ; mais il me semble qu’il faut savoir, avant tout, si l’ouvrier veut ou ne veut pas vivre sur sa terre natale. (Approbation.) Je sais bien que les personnes auxquelles je m’adresse n’entendent pas appuyer l’émigration forcée ; je suis loin de leur imputer une telle pensée. Mais il y a deux manières de forcer les hommes à l’exil. (Écoutez ! écoutez !) La première, c’est de les prendre pour ainsi dire corps à corps, de les jeter sur un navire, et de là sur une plage lointaine ; la seconde, c’est de leur rendre la patrie si inhospitalière qu’ils ne puissent pas y vivre (acclamation), et je crains bien que l’effet des lois restrictives ne soit de pousser à l’expatriation des hommes qui eussent préféré le foyer domestique. (Applaudissements.) Messieurs, j’ai abusé de votre patience. (Non, non, parlez, parlez.) On vous dira que les autres nations sont, comme celle-ci, chargées d’entraves et de droits protecteurs ; cela n’affaiblit en rien mon argumentation. Nous devons un exemple au monde. C’est à nous, par notre foi en nos principes, à déterminer les autres peuples à se débarrasser des liens dont les gouvernements les ont chargés. Notre exemple sera-t-il suivi ? C’est ce que nous ne saurions prédire. Notre but est le bien général, notre moyen un grand acte de justice. C’est ainsi que déjà nous avons émancipé les esclaves ; et puisque les lois-céréales sont aussi l’esclavage sous une autre forme, je ne puis mieux terminer que par ces paroles de Sterne, car il n’y en a pas de plus vraies : « Déguise-toi comme il te plaira, esclavage, ta coupe est toujours amère, et elle n’a pas cessé de l’être parce que des milliers d’êtres humains y ont trempé leurs lèvres. » (L’orateur s’assoit au bruit d’applaudissements prolongés.)
Le président, en introduisant M. Bright, dit que quoiqu’il ne puisse pas le présenter à l’assemblée comme représentant de Durham, il n’est personne qui mérite plus de sa part un chaleureux et gracieux accueil.
M. Bright raconte qu’étant à Nottingham pour y poser en face des électeurs la question commerciale, qui, selon toute apparence, triomphera dans la personne d’un membre de la Ligue, M. Gisborne (applaudissements), il apprit qu’une réélection allait avoir lieu à Durham, où un grand nombre d’électeurs étaient disposés en faveur d’un candidat free-trader[9]. Je m’empressai de m’y rendre, continue M. Bright, sans la moindre intention de me présenter moi-même aux suffrages des électeurs, mais pour appuyer tout candidat qui professerait nos principes. Par suite de quelques malentendus, aucun candidat libéral ne se présentant, des hommes graves et réfléchis me pressèrent de me porter moi-même. Le temps me manquait pour prendre conseil de mes amis politiques ; je me déterminai à publier une adresse qui parut à huit heures ; à onze l’élection commença. — Lorsqu’on considère que Durham est une ville épiscopale (rires) ; que le marquis de Londonderry exerce sur ce bourg une influence énorme quoique très-inconstitutionnelle, disposant de cent électeurs qui votent comme un seul homme sous ses inspirations ; que mon adversaire est un homme d’un rang élevé ; qu’il a déjà représenté Durham, et qu’il a eu tout le temps qu’il a voulu pour préparer l’élection, je crois qu’on peut voir dans ce qui vient de se passer le présage certain d’un prochain triomphe, puisque j’ai obtenu 406 suffrages contre 507, ce qui constitue la plus forte minorité que le parti libéral ait jamais obtenue à Durham depuis le bill de réforme, etc.
L’orateur continue son discours au milieu d’applaudissement réitérés.
Le président, en fermant la séance, renouvelle à tous les assistants la recommandation de propager autant que possible les journaux qui inséreront le procès-verbal dans leurs colonnes.
FN: On conçoit qu’en Angleterre c’est la classe agricole qui s’oppose à la liberté des échanges, comme en France la classe manufacturière.
FN: Le Board of trade est une sorte de ministère du commerce. Son président est membre du cabinet. — C’est dans ce bureau, c’est grâce aux lumières de ses membres, MM. Porter, Deacon Hume, M’Grégor, que s’est préparée la révolution douanière qui s’accomplit en Angleterre. Nous traduisons à la fin de ce volume le remarquable interrogatoire de M. Deacon Hume, sur lequel nous appelons l’attention du lecteur.
FN: Le clergé d’Angleterre se rattache au monopole par la dîme. Il est évident que plus le prix du blé est élevé, plus la dîme est lucrative. Il s’y rattache encore par les liens de famille qui l’unissent à l’aristocratie.
FN: J’ai conservé ces détails comme peinture de mœurs et aussi pour faire connaître la chaleur de la lutte et l’esprit des diverses classes qui y prennent part.
FN: On sait qu’au Parlement M. Hume est toujours sur la brèche. Il laisse rarement passer un article du budget des dépenses sans demander une économie.
FN: Ce mot est de sir James Graham, ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur.
FN: Allusion aux meetings des prohibitionnistes qui se tiennent dans le salon d’une maison particulière de Bond-Street.
FN: En 1842, sir Robert Peel, en présentant au Parlement la première partie de cette réforme commerciale que nous voyons se développer en 1845, disait qu’il n’avait pas touché à plusieurs articles importants, tels que le sucre, le vin, etc., pour se ménager les moyens d’obtenir des traités de commerce avec le Brésil, la France, l’Espagne, le Portugal, etc. ; mais il reconnaissait en principe, que si les autres nations refusaient de recevoir les produits britanniques, ce n’était pas une raison pour priver les Anglais de la faculté d’aller acheter là où ils trouveraient à le faire avec le plus d’avantage. Ses paroles méritent d’être citées :
« We have reserved many articles from immediate reduction in the hope that ere long we may attain what is just and right, namely increased facilities for our exports in return ; at the same time, I am bound to say, that it is for the interest of this country to buy cheap, whether other countries will buy cheap from us or no. We have right to exhaust all means to induce them to do justice, but if they persevere in refusing, the penalty is on us if we do not buy in the cheapest market. » (Speach of Sir Robert Peel, 10th May 1842.)
Toute la science économique, en matière de douanes, est dans ces dernières lignes.
FN: Free-trader, partisan de la liberté commerciale.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 13 avril 1843.↩
Il devient maintenant inutile de parler de l’immense concours qu’attirent ces réunions. Quelque vaste que soit le théâtre de Drury-Lane, il est à notre connaissance qu’un grand nombre de personnes n’ont pu être admises. Le bruit s’étant répandu qu’il n’y aurait pas d’autres meetings jusqu’après les fêtes de Pâques, une foule considérable affluait dans les rues adjacentes. Il nous a semblé que les dames étaient plus nombreuses que dans les occasions précédentes, et l’assemblée présentait un air de distinction bien propre à soutenir le caractère de ces meetings, qui est de représenter la classe moyenne. Nous avons remarqué sur la plate-forme un grand nombre de membres du Parlement.
Le président annonce qu’il n’y aura pas de réunion la semaine prochaine. Dans l’intervalle, les membres de la Ligue se disperseront dans le pays pour exciter cette agitation dont les résultats sont sensibles à Londres. Il rend compte de plusieurs meetings tenus dans les comtés par les adversaires et par les partisans de la liberté commerciale, et particulièrement de celui de Sommerset, dans lequel se sont fait entendre MM. Cobden, Bright et Moore. De semblables réunions auront lieu successivement dans chaque comté du royaume tous les samedis. M. Cobden s’est engagé à y assister. (Bruyantes acclamations.) Ce système d’agitation ne sera plus abandonné tant qu’il restera à visiter un coin du territoire. Nous commençons à éprouver les bons effets de la distribution des brochures dans les districts agricoles. La faiblesse de nos adversaires y devient visible. Nous sommes déterminés à porter la guerre jusque dans leurs propres citadelles, et à arracher de leurs mains cette influence politique dont ils ont tant abusé. (Acclamations.) Vous aurez le plaisir d’entendre ce soir mon excellent ami, le docteur Bowring, m. P. (applaudissements), ensuite M. Elphinstone, m. P. (applaudissements), et enfin votre estimable concitoyen, le révérend John Burnet. (Bruyantes acclamations.) Avant la clôture de la séance, M. Heyworth, de Liverpool, vous soumettra une proclamation qui a été approuvée par le conseil de la Ligue, et que nous nous proposons d’adresser au peuple d’Angleterre.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le docteur Bowring se lève au bruit des applaudissements enthousiastes. L’honorable gentleman s’exprime en ces termes :
Ladies et gentlemen : Il est permis d’éprouver quelque embarras et quelque anxiété en présence d’un auditoire aussi imposant. Quant à moi, qui ai vu les commencements de la Ligue et ses premiers combats, quand je compare cette multitude assemblée avec le petit nombre d’hommes qui résolurent d’éveiller l’attention publique sur cette grave question, et de renoncer à tout repos jusqu’à ce qu’ils eussent vaincu le grand abus dont ils voyaient souffrir leurs concitoyens, je vous assure, mes amis, que je me sens encouragé, car j’éprouve que d’honorables et vertueux efforts trouvent toujours une digne récompense. (Applaudissements.) Nous avons tous une mission qui nous a été confiée par la Providence. Comme hommes, comme chrétiens, comme citoyens, nous avons des devoirs à remplir. La femme aussi a sa mission, sa haute et sainte mission ! Sa présence dans cette enceinte nous prouve qu’elle en comprend toute l’étendue et qu’elle se sent appelée à porter l’efficace tribut de son concours dans la grande lutte où nous sommes engagés. (Bruyantes acclamations.) Les peuples ont aussi leur mission ; et l’Angleterre, la plus grande des nations, — l’Angleterre, qui possède plus de pouvoir et d’influence qu’il n’en avait jamais été confié à aucune association d’êtres humains, — l’Angleterre, plus grande que la Phénicie, alors que Tyr et Sidon remplissaient le monde du bruit de leur renommée, — cette noble Angleterre, qui étend ses bras jusqu’aux extrémités du globe, qui a fait pénétrer son influence parmi les hommes de tous les climats, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les religions, — l’Angleterre a aussi la plus haute et la plus noble des missions, celle d’enseigner au monde que le commerce doit être libre (acclamations), — que tous les hommes sont faits pour s’aimer et s’entr’aider les uns les autres, — pour se communiquer réciproquement les avantages et les bienfaits divers qui leur ont été départis par la nature, — pour vivre en bon voisinage comme des frères, sans égard aux fleuves ou aux montagnes qui les séparent. Oui, c’est la mission de l’Angleterre de montrer aux hommes qu’ils remplissent un devoir commun, qu’ils font un moral usage des prérogatives qui leur ont été conférées par la Providence, qu’ils témoignent de leur fraternité comme enfants d’un même père, lorsqu’ils consacrent leurs efforts à émanciper le travail, lorsqu’ils ouvrent toute la terre aux libres et amicales communications des peuples, lorsqu’ils renversent ces barrières élevées, non dans l’intérêt de tous, mais dans l’intérêt du petit nombre, dans le sinistre intérêt d’une aristocratie qui, pour le malheur de l’humanité, ayant usurpé le pouvoir législatif, n’en usa jamais que dans des vues égoïstes et personnelles. (Applaudissements.) Que si les peuples ont leur mission, les cités ont aussi la leur. Birmingham a agité pour le bill de réforme électorale, pour l’émancipation politique de l’Angleterre. (Acclamations.) Manchester s’est levée à son tour pour l’accomplissement d’un devoir plus élevé, d’une œuvre plus grande et plus sainte ; Manchester s’est levée pour émanciper le monde industriel ; et Manchester, — honneur à cette cité ! — a produit des hommes dignes que cette sublime mission leur fût confiée ! (Acclamations prolongées.) Mes amis, je l’ai déjà dit, nous ne représentons point ici un égoïste et sinistre intérêt. Les doctrines que nous enseignons ici n’intéressent pas nous seuls, elles intéressent toute la grande confraternité humaine ; car la voix de l’Angleterre, cette voix majestueuse, quand elle s’élève, retentit jusqu’aux confins de la terre, et les vérités que nous proclamons, revêtues de notre belle langue, sont portées sur les ailes de tous les vents du ciel. (Applaudissements.) J’ai devant moi un document venu de la Chine, cette terre fleurie du Céleste Empire ; il est rempli des opérations de la Ligue. (Acclamations.) Là, vous avez fondé un nouveau pouvoir ; vous avez porté la terreur de votre nom au milieu d’un peuple innombrable, et que vous dit l’écho qui revient de ce lointain pays ? Il vous dit : Si vous voulez tirer parti de votre influence, affranchissez votre commerce, mettez-nous à même d’échanger avec vous, réalisez les opinions que votre premier ministre a proclamées devant votre Chambre des communes ; prouvez-nous que lorsque sir Robert Peel a déclaré que « acheter à bon marché et vendre cher, était la politique du sens commun, » il croyait à ses propres paroles ; faites pénétrer dans vos lois cette théorie qu’il a exaltée comme celle de tout homme consciencieux et de toute nation intelligente et honnête. (Applaudissements.) J’ai encore devant moi une longue lettre d’Ava, le royaume du seigneur au pied d’or et de l’éléphant blanc, et cette lettre m’annonce que ce qui se passe en Angleterre produit une telle excitation dans ces lointaines contrées, que l’on s’y est soulevé contre les monopoles. Le peuple s’est aperçu que son souverain le pille sous prétexte de le protéger, et il est en train de lui donner une leçon qui promet des modifications dans les conseils de l’empire. (Rires et applaudissements.) Voyez l’Égypte ! Il y a dans cette assemblée des hommes distingués venus des bords du Nil. Ils désirent savoir si on laissera enfin les surabondantes productions de cette terre privilégiée venir rassasier le peuple affamé de l’Angleterre. Les patriarches des anciens temps descendirent en Égypte pour y trouver du soulagement contre les maux de la famine, à une époque que nous qualifions de barbare, et cependant aucune loi n’empêcha les fils de Jacob d’aller sur les rives du Nil, et de rapporter en Palestine la nourriture dont ils avaient besoin. Au temps de la révélation mosaïque, et même dans les temps antérieurs, aucun obstacle ne s’opposait à ces communications. Sera-t-il dit que le christianisme a laissé dégénérer les hommes au-dessous du niveau moral auquel ils étaient parvenus dès ces temps reculés ! Est-ce ainsi que nous devons appliquer le commandement de faire aux autres ce que nous voudrions qui nous fût fait ? Est-ce là l’interprétation que nous donnons à la plus sublime de toutes les leçons : « Aimez-vous les uns les autres comme des frères ? » Ah ! l’enseignement du monopole est : « Haïssez-vous, dépouillez-vous les uns les autres. » (Bruyantes acclamations.) — Mais la liberté du commerce enseigne une tout autre doctrine. Elle introduit parmi les hommes et dans leurs transactions journalières la religion de l’amour. La liberté du commerce, j’ose le dire, c’est le christianisme en action. (Applaudissements.) C’est la manifestation de cet esprit de bénignité, de bienveillance et d’amour qui cherche partout à éloigner le mal, qui s’efforce en tous lieux d’augmenter le bien. (Immenses acclamations.) — On parle de l’Orient. Il a été dans ma destinée d’errer parmi les ruines de ces anciennes cités auxquelles je faisais tout à l’heure allusion. J’ai vu les colonnes de Tyr dans la poussière. J’ai vu ce port vers lequel affluaient jadis les vaisseaux de ses marchands fastueux, princes et dominateurs de la terre, vêtus de pourpre et de lin, et maintenant, il n’y a pas une colonne qui soit restée debout ; elles sont cachées sous le flot et sous le sable ; la gloire s’est exilée de ces lieux ! — Et qui en a recueilli l’héritage ? qui, si ce n’est les enfants de l’Angleterre ? Quand je compare ces vicissitudes et ces destinées, quand je me rappelle qu’au temps de la prospérité de Tyr et de Sidon, au temps où la Phénicie représentait tout ce qu’il y avait de grand et de glorieux sur la terre, notre île n’était qu’un désert habité par une poignée de sauvages, je puis bien me demander à quelle cause l’une doit son déclin, et l’autre sa prodigieuse élévation. C’est le commerce qui nous a faits grands ; c’est le travail de nos mains industrieuses qui a élevé notre puissance. L’industrie a créé nos richesses, et nos richesses ont créé cette influence politique qui attire sur nous les regards de l’humanité. Et maintenant le monde se demande quel enseignement nous allons lui donner. Ah ! nous n’avons que trop disséminé sur le globe des leçons de folie et d’injustice ! Le temps n’est-il pas venu où il est de notre devoir de donner des leçons de vertu et de sagesse ? — Et cette cité, — cette cité qui dans ces temps reculés échappait aux regards de la renommée ; cette cité qui surpasse par le nombre des habitants plusieurs des nations et royaumes qui se sont fait un nom dans l’histoire, — ne voudra-t-elle pas aussi se montrer digne de sa destinée? (Applaudissements.) Non, elle ne restera pas en arrière. (Nouveaux applaudissements.) Des réunions comme celle-ci ne laissent aucune incertitude, et répondent éloquemment à ceux qui disent que la Ligue travaille en vain, qu’elle se lassera de son œuvre, et que le monopole peut dormir en paix à l’ombre du mancenillier qu’il a planté sur le sol de la patrie. Oh ! qu’il ne compte pas sur un tel avenir ! Si l’effort que nous faisons maintenant, pour affranchir le commerce, le travail et l’échange, ne suffit pas, nous en ferons un plus grand (acclamations), et puis un plus grand encore. (Tonnerre d’applaudissements.) Nous creuserons de plus en plus la mine sous le temple du monopole ; nous y amoncellerons de plus en plus les matières explosibles, jusqu’à ce que le Parlement en approche l’étincelle fatale, et que l’orgueilleux édifice vole en éclats dans les airs. Alors de libres relations existeront entre toutes les nations de la terre, et ce sera la gloire de l’Angleterre d’avoir ouvert la noble voie. S’il fallait des exemples pour prouver les fatales conséquences du monopole, l’histoire nous en fournirait de toutes parts. Considérez les plus belles portions du globe. Voyez l’Espagne. Vous avez entendu parler de ses fleuves, qui, selon les poètes, roulent des sables d’or ; vous avez entendu parler de ses riches vallées, de ses huiles, de ses vins et de ses troupeaux ; vous avez entendu raconter ses gloires navales et militaires, alors que ses grands hommes, marchant de conquêtes en conquêtes, ajoutaient des mondes entiers aux domaines de ses souverains. L’Espagne ne manifesta pas moins sa supériorité intellectuelle par la voix de ses poètes, de ses fabulistes et de ses romanciers. Et maintenant qu’est-elle devenue ? Vainement elle a subjugué un monde, planté ses bannières au nord et au sud des continents américains, acquis des îles innombrables, rapporté de l’hémisphère occidental des trésors qu’elle ne comptait pas, exercé en Europe une prépondérance à laquelle aucune nation n’était parvenue, — l’Espagne a adopté le système prohibitif et protecteur, et la voilà plongée dans l’ignorance et la désolation. (Applaudissements.) Ses marchands sont des fraudeurs, ses négociants des contrebandiers ; et ces grandes cités, d’où s’élancèrent les Pizarre et les Cortez, voient l’herbe croître dans leurs rues et le lézard familier se réchauffer sur leurs murs. — Reportez maintenant vos regards vers une autre contrée à qui la nature avait refusé tant d’avantages. Regardez la Hollande, votre voisine. Son sol est placé au-dessous du niveau de la mer ; il n’a pu être arraché aux flots de l’Atlantique que par la plus haute intelligence et la plus active industrie, unies au plus ardent patriotisme. Mais la Hollande a découvert le secret de la grandeur des nations : la liberté. Par la liberté du commerce, bientôt elle soumit, dompta, enchaîna l’Espagne ; et tant qu’elle fut fidèle à ses principes, tant qu’elle professa et mit en pratique les doctrines de ses grands hommes, elle fut, malgré ses étroites limites, assez influente pour être comptée parmi les plus puissantes associations humaines. Et voyez combien, dans des régions éloignées, la tradition porte haut le nom de la Hollande ! Parmi les importations récemment arrivées de la Chine, se trouve un exemplaire de la géographie enseignée dans les écoles du Céleste Empire. Comment croyez-vous qu’on y décrit l’Angleterre ? le voici : « L’Angleterre est une petite île de l’Occident, subjuguée et gouvernée par les Hollandais. » (Hilarité prolongée.) D’après cette exhibition de l’état de l’instruction en Chine, vous ne serez point surpris que l’Empereur ait été saisi d’une inconcevable stupéfaction, lorsque son commissaire Ke-Shen lui apprit qu’une poignée de ces barbares avait mis en déroute la plus forte armée qu’il lui eût été possible de rassembler. Vous vous rappelez qu’il ordonna que Ke-Shen fût scié en deux quand celui-ci arriva avec la malencontreuse nouvelle. Mais je ne doute pas qu’avant que la présente année ait fini son cours, une nouvelle géographie, ou du moins une édition revue et corrigée ne soit introduite dans les écoles du Royaume du Milieu. (Rires et applaudissements.) — Portez maintenant vos yeux vers l’Italie ; il n’est pas de pays plus fertile en utiles enseignements. Ses pieds sont baignés par la Méditerranée, tous ses habitants ont une commune origine ; mais les uns sont livrés aux bienfaisantes influences de la liberté commerciale, tandis que les autres reçoivent les secours et la protection du monopole. Comparez la situation de la Toscane à celle des États Pontificaux. En Toscane, tout présente l’aspect d’une riante félicité. — Le cœur s’y réjouit à la vue d’une population satisfaite, d’une moralité élevée, d’un commerce florissant et d’une production toujours croissante ; car depuis le temps de Léopold, elle a été fidèle aux principes posés par cet admirable souverain. — Passez la frontière. — Entrez dans les États Romains. C’est le même sol, le même climat, le même soleil radieux et vivifiant ; ce sont les mêmes puissances de production ; les hommes s’y vantent d’une plus haute origine, et s’y proclament avec orgueil les fils des plus illustres héros qui aient jamais foulé la surface de ce globe. Je me rappelle avoir été introduit auprès du Pape par son secrétaire qui se nommait Publio-Mario. Il affirmait descendre de Publius-Ma- rius, et il vivait, disait-il, sur les mêmes terres que ses ancêtres occupaient avant la venue de Jésus-Christ. (Rires.) Eh bien ! dans quel état est l’industrie de Rome ? Pourriez-vous croire qu’à l’heure qu’il est, sous le régime protecteur, les Romains foulent la laine de leurs pieds nus, et que les moulins à farine sont d’un usage peu répandu dans les États du Pape infaillible ? En fait, que faut-il entendre par l’émancipation du commerce ? Pourquoi combattons-nous ? pourquoi sommes-nous réunis ? Nous voulons donner à tout homme, à tout ouvrier, à toute entreprise, les plus grandes raisons possibles de marcher de perfectionnement en perfectionnement. Nous désirons que les Anglais disent au monde : « Nous n’appréhendons rien dans la carrière où nous entrons. Nous ne demandons qu’à être délivrés des liens qui pèsent sur nos membres. Brisez ces chaînes ; et nous, race de Saxons, nous qui avons porté notre langue, la langue de Shakespeare et de Milton aux quatre coins de la terre ; nous qui avons enseigné le grand droit de représentation au monde altéré de liberté ; nous qui avons semé des nations destinées à nous surpasser nous-mêmes en nombre, en puissance, en gloire et en durée, nous ne craignons aucune rivalité (bruyants applaudissements), pourvu, car il faut toujours en venir à cette simple proposition, que nous soyons libres de vendre aussi cher et d’acheter à aussi bon marché que nous pourrons le faire. (Applaudissements.) Et quelle est, mes amis, la signification de ces magnifiques meetings, tels que celui auquel je m’adresse ? Ils signifient que vous avez compris ce langage du premier ministre de la Grande-Bretagne ; que vous ne souffrirez pas que ce langage se dissipe aux vents comme une oiseuse théorie qui ne doit être l’héritage de personne ; que vous l’avez relevé ; que vous avez conquis sir Robert Peel ; que vous lui ferez de sa déclaration un cercle de fer (applaudissements) ; que vous réclamerez du Parlement d’Angleterre, au dedans de l’enceinte législative, la même vigueur, la même énergie que le peuple déploie au dehors. (Applaudissements.) Mes amis, on dit que, dans cette Chambre des communes, nous ne sommes qu’une minorité désespérante. Mais, là aussi, il y en a plusieurs qui ont rendu d’admirables services à la cause populaire, dont l’énergie n’a jamais fait défaut, dont les voix n’ont jamais été étouffées, dont les votes ne se sont jamais égarés, et qui en appellent toujours à vous pour marcher, sans cesse et sans relâche, vers le noble but placé au bout de la carrière. (Applaudissements.) Mais après tout, mes amis, nous ne sommes, nous, que le petit nombre, et vous, vous êtes le grand nombre, et c’est à vous de décider s’il appartient aux intérêts, à la voix, à la volonté du grand nombre, de prédominer, ou si la Chambre continuera à rester aveugle, sourde, insoucieuse et indifférente à la détresse qui l’entoure de toutes parts. En ce qui me concerne, je nourris dans mon cœur des espérances plus hautes et plus consolantes, car je crois fermement que l’énergique volonté de l’Angleterre n’a qu’à se déclarer, comme elle le fait en ce moment, pour que toute résistance s’évanouisse. (L’orateur reprend son siège au bruit des applaudissements enthousiastes.)
MM. Elphinstone, Burnet et Heyworth se font entendre ; une proclamation au peuple est votée à l’unanimité, et la séance est levée à 10 heures.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 26 avril 1843.↩
L’affluence est aussi considérable que dans les précédentes occasions. On remarque dans l’assemblée plusieurs des membres les plus respectables de la société des wesleyens.
À 7 heures, le président, M. Georges Wilson, ouvre la séance. Il expose les travaux et les progrès de la Ligue depuis la dernière réunion. — « Nous avons distribué, dit-il, des plis contenant douze brochures (tracts), à chacun des électeurs de 160 bourgs et de 24 comtés. — Pendant la lecture de la liste de ces bourgs et comtés, l’assemblée applaudit avec véhémence, principalement quand il s’agit de circonscriptions électorales placées sous l’influence de l’aristocratie. — Le président annonce que ce système de distribution sera étendu à tout le pays, jusqu’à ce qu’il n’y ait pas un seul électeur dans tout le royaume qui ne soit sans excuse, s’il émet un vote contraire aux intérêts de ses concitoyens. — Depuis notre dernière réunion, de nombreux meetings ont eu lieu, auxquels assistait la députation de la Ligue, lundi à Plymouth, mardi à Devonport, mercredi à Tavistock, jeudi à Devonport, samedi à Liskeard, dans le comté de Cornouailles. En outre, mardi, les ouvriers de Manchester ont donné une soirée à laquelle assistaient quatre mille personnes, et qui a eu lieu dans les salons de la Ligue (free-trade hall). Elle avait pour objet la présentation d’une adresse à M. Cobden. Jeudi il y a eu meeting à Sheffield, vendredi à Wakefield, lundi à Macclesfield. Il y a eu aussi des réunions dans le Cheshire et dans le Sunderland, présidées par les premiers officiers municipaux, et j’ai la satisfaction d’annoncer qu’elles seront suivies de beaucoup d’autres. — C’est le 9 mai prochain que M. Pelham Villiers portera à la Chambre des communes sa motion annuelle pour le retrait des lois-céréales. (Bruyantes acclamations.) Des délégués de toutes les associations du royaume affiliées à la Ligue seront à Londres pour surveiller les progrès de notre cause pendant la discussion[1]. La parole est au Révérend Thomas Spencer. » (Applaudissements.)
M. Spencer : Je n’ai jamais porté la parole devant une aussi imposante assemblée, quoique je sois habitué aux grandes réunions, ce dont je me félicite en ce moment; car si je n’étais enhardi par l’expérience, le courage me manquerait en présence d’un tel auditoire. Je me présente ici comme un témoin indépendant dans la lutte entre la classe manufacturière et la classe agricole. Je n’appartiens ni à l’une ni à l’autre. J’ai observé la marche de toutes les deux, sans intérêt personnel dans leur conflit ; je n’ai de préférence pour aucune, et je respecte dans tous les partis les hommes bien intentionnés. C’est pourquoi j’espère que ce meeting me permettra d’exposer ce qui est ma conviction sincère dans cette grande lutte nationale. (Approbation.) — J’ai observé depuis son origine les procédés de la Ligue ; j’ai entendu beaucoup de discours, j’ai lu beaucoup d’écrits émanés de cette puissante association, et, du commencement à la fin, je n’y ai rien vu qui ne fût juste, loyal et honorable ; rien qui tendît le moins du monde à sanctionner la violence, et quoiqu’on ait accusé les membres de la Ligue de vouloir ravir la protection aux fermiers, tout en la conservant pour eux-mêmes, je dois dire que je les ai toujours entendus repousser cette imputation, et proclamer qu’ils n’entendaient ni laisser profiter personne ni profiter eux-mêmes de ce système de priviléges. (Applaudissements.) Spectateur désintéressé de ce grand mouvement, je me suis efforcé de le juger avec impartialité d’esprit, et de rechercher s’il portait en lui-même les éléments du succès. — J’ai vu naître des entreprises qui ne pouvaient réussir, et des projets placés sous le patronage de préjugés que le temps devait dissiper. — Mais, quant à cette grande agitation, j’aperçois clairement qu’il est dans sa nature de triompher, et je vous en dirai la raison. Je vois des changements dans mon pays, et l’histoire m’enseigne qu’il ne recule pas, mais qu’il avance ; qu’il ne se modifie pas dans un sens rétrograde, mais dans un sens progressif. Sans remonter bien loin, dans mon enfance on ne connaissait ni l’éclairage au gaz, ni les bateaux à vapeur, ni les chemins de fer, et maintenant le gaz illumine toutes nos rues, la vapeur parcourt toutes nos rivières, les rails sillonnent toutes les provinces de l’empire. (Applaudissements.) Dans mon enfance, un catholique romain, quelles que fussent sa bonne foi et ses lumières, ne pouvait entrer au Parlement, il n’en est pas de même aujourd’hui ; dans mon enfance, nul ne pouvait être chargé d’une fonction publique, s’il n’avait reçu les sacrements de l’Église établie, il n’en est pas de même aujourd’hui ; dans mon enfance, aucun Anglais, n’importent ses scrupules, ne pouvait être marié que par un ministre de cette église, il n’en est pas de même aujourd’hui. (Applaudissements.) De cette progression, qui n’est pas, si l’on veut, arithmétique ou géométrique, mais qui certes est une progression intellectuelle, politique et nationale, je tire cette conclusion, que non-seulement d’autres progrès nous attendent, mais qu’on en pourrait presque calculer la rapidité. Le temps passé étant donné, on pourrait presque dire ce que sera le temps qui le suit. En astronomie, des savants avaient remarqué dans le système solaire un mystère qui leur semblait inexplicable : ils avaient vu que les distances du soleil aux planètes étaient entre elles comme des nombres harmoniques, sauf qu’il y avait dans la série une lacune qui les confondait. À tel point du ciel, disaient-ils, il devrait y avoir une planète. — Et en effet, les astronomes modernes, armés de plus puissants télescopes, ont découvert à la place indiquée quatre petites planètes qui complètent la série des nombres harmoniques et prouvent la justesse du raisonnement qui avait soupçonné leur existence. Et moi, je dis qu’en considérant la série des progrès dans les affaires humaines, j’y vois aussi une place vide, quelque chose qui manque, et jugeant par le passé, je dis que si le principe de la liberté des transactions est vrai, il doit triompher. (Applaudissements.) J’ai un autre motif pour espérer ce triomphe : quiconque est engagé dans une grande entreprise doit avoir foi dans le succès, sous peine de sentir ses mains faiblir et ses genoux plier. C’est là d’ailleurs un résultat qu’il est dans les lois de la civilisation d’amener. Plusieurs personnes agitaient, il y a quelque temps, la question de savoir si la civilisation était favorable au bonheur de l’homme ; quelques-unes se prononçaient pour la négative. Je leur demandai ce qu’elles entendaient par civilisation, et je découvris, bien plus, elles avouèrent qu’elles avaient donné à ce mot une interprétation erronée. Il y a plusieurs degrés de civilisation : si vous enseignez à un sauvage quelque chose des mœurs de la vieille Europe, il mettra probablement son honneur dans ses vêtements ; il s’adonnera à la mollesse, aux liqueurs spiritueuses, et votre civilisation lui donnera la mort. Il en sera de même si vous prodiguez l’or à un indigent. Mais regardez dans les rangs élevés de la société ; considérez un membre de vos nobles familles, qui toute sa vie a été accoutumé à ces jouissances et à ce luxe, et remarquez cet autre niveau de civilisation qui prévaut dans les classes supérieures ; et, à cet égard, je puis dire avec sincérité que l’aristocratie anglaise donne un grand et utile exemple à toutes les aristocraties du monde ; elle les a devancées de bien loin dans la saine entente de la vie civilisée. Les lords d’Angleterre ont abandonné l’orgueil des vêtements, et ils ont jeté leurs livrées à leurs domestiques ; fuyant la mollesse et les excès, ils couchent sur la dure et ont introduit la simplicité sur leurs tables ; ils ont renoncé aux excès de la boisson. Plus vous vous élevez dans l’échelle sociale, plus vous trouverez que les hommes agissent sur ce principe, de conserver un esprit sain dans un corps vigoureux. Le bonheur de l’homme ne consiste pas dans les jouissances des sens, mais dans le développement des facultés physiques, intellectuelles et morales, qui le rendent capable de faire du bien pendant une longue vie. (Applaudissements.) S’il est dans la nature de la civilisation de tendre à tout simplifier, qu’y a-t-il de plus simple, en matière d’échanges, que la liberté ; et si l’Angleterre est le pays du monde le plus civilisé, ne dois-je pas m’attendre à voir, dans un temps prochain, ce grand résultat du progrès, la simplification, s’introduire dans nos lois commerciales ? Il est une autre chose qui doit résulter aussi du progrès de la civilisation, c’est que le Parlement se rende un compte plus éclairé de sa propre mission. Les membres du Parlement, dans les deux Chambres, ont blâmé, et quelquefois dans un langage brutal, les ministres de la religion, pour avoir pris part à cette agitation au sujet d’une chose aussi temporelle, disent-ils, que les lois-céréales. Ils demandent ce qu’il y a de commun entre ces lois et le saint ministère ; mais ils savent bien que tout être humain qui paye une taxe, et qui travaille pour subsister, est profondément affecté par ces lois ; ils savent bien que tout homme qui aime son frère, et qui voit ce qui se passe dans le pays, est tenu en conscience de prendre part à cette grande agitation. (Approbation.) Eh quoi ! les ministres de la religion n’ont-ils pas été spécialement appelés à considérer cette question ? et la lettre de la reine, qui leur a été envoyée pour être lue dans toutes les paroisses, ne leur en fait-elle pas, pour ainsi dire, un devoir ? (Approbation.) Cette lettre, que je dois moi-même lire dans l’église de ma paroisse, établit qu’une profonde détresse règne sur les districts manufacturiers, que cette détresse a pour cause la stagnation du commerce, et elle provoque des souscriptions pour subvenir aux besoins des indigents. Certes il n’appartient pas à un être intelligent, après avoir appris que la détresse pèse sur son pays, de rentrer dans l’inaction sans s’inquiéter des causes qui l’ont amenée. L’Écriture nous dit : « Occupez votre esprit de tout ce qui est juste, vrai, honnête et aimable. » Mais pourquoi en occuper votre esprit ? Qui voudrait penser, sans jamais réaliser sa pensée dans quelque effet pratique ? S’il est bon de penser, il est bon d’agir, et s’il est bien d’agir, il est bien de se lever pour prendre part à ce grand mouvement. (Bruyantes acclamations.) Je suis enclin à croire que les personnes, dans l’une et l’autre Chambre, qui accusent les ministres de la religion de sortir de leur sphère pour s’immiscer dans cette agitation, sont à moitié envahies par les erreurs du Puséisme. (Applaudissements.) Le Puséisme établit une profonde démarcation entre l’ordre du clergé et les autres ordres, distinction injuste et indigne de tout esprit libéral et éclairé. Ne voyez-vous pas d’ailleurs que le même argument par lequel on voudrait m’empêcher d’intervenir, servirait également à prévenir l’intervention de toute autre personne, à moins qu’elle n’intervînt du côté du monopole, auquel cas on est toujours bien reçu. (Applaudissements prolongés.) N’ont-ils pas dit, dans leurs assemblées, que M. Bright n’avait que faire de parcourir et d’enseigner le pays, et qu’il ferait mieux de rester dans son usine ? N’en ont-ils pas dit autant des dames qui assistent à ces réunions ? Avec cet argument, il n’est personne qu’ils ne puissent exclure de toute participation à la vie publique. Nous avons tous un emploi, une profession spéciale ; mais notre devoir n’en est pas moins de nous occuper en commun de ce qui intéresse la communauté. Je crains bien que le Parlement ne cherche à endormir le peuple par cette argumentation. Et lui aussi a sa mission spéciale qui est de faire des lois pour le bien de tous ; et lorsqu’il fait des lois au détriment du grand nombre, ne peut-on pas lui reprocher de se mêler de ce qui ne le regarde pas ? Ce n’est pas le clergé dissident qui sort de sa sphère, c’est le Parlement. Nous supportons le poids des taxes, en temps de paix comme en temps de guerre ; nous partageons les souffrances et le bien-être du peuple. Nous sommes donc justifiés dans notre résistance ; mais le Parlement n’est pas justifié lorsqu’il entrave le commerce et envahit le domaine de l’activité privée. (Applaudissements.) Lorsqu’il intervient et dit : « Je connais les intérêts de cet homme mieux qu’il ne les connaît lui-même; je lui prescrirai sa nourriture et ses vêtements, je m’enquerrai du nombre de ses enfants et de la manière dont il les élève (applaudissements prolongés), les citoyens seraient fondés à répondre : Laissez-nous diriger nos propres affaires et élever nos enfants, ces choses-là ne sont point dans vos attributions ; autant vaudrait que nous nommions aussi des commissions d’enquête pour savoir si les membres de l’aristocratie gouvernent convenablement leurs domaines et leurs familles. » Mais c’est là un jeu dans lequel le droit n’est pas plus d’un côté que de l’autre. Que l’aristocratie sache donc qu’il ne lui appartient pas de restreindre les échanges et le commerce de la nation.
J’ai dit que je me présentais comme un témoin indépendant et impartial dans cette lutte entre les intérêts manufacturiers et les intérêts agricoles ; mais je déclare que, dans ma conviction, les intérêts, bien compris, ne font qu’un. Ce qui affecte l’un affecte l’autre.
Supposez qu’il n’y eût au monde qu’une seule famille. Un des membres laboure la terre, un autre garde et soigne les troupeaux, un troisième confectionne les vêtements, etc. — Si, pendant que le laboureur porte la nourriture au berger, il rencontre des entraves et des taxes, ne regarderiez-vous pas ces taxes et ces entraves comme un dommage pour toute la famille ? Tout ce qui empêche, tout ce qui retarde, tout ce qui entraîne des dépenses, est une perte pour la communauté. Le même raisonnement s’applique aux nations, quelles que soient la multiplicité des professions et la complication des intérêts.
En ce qui concerne l’état actuel de ce pays, vous avez été informés par une haute autorité, par un ministre d’État, que la misère, le paupérisme et le crime régnaient sur cette terre désolée. C’est à celui qui admet l’existence de ces maux à prouver que la Ligue en méconnaît la cause lorsqu’elle les attribue à cette législation qui s’interpose entre l’homme et l’homme ; lorsqu’elle affirme que la liberté du commerce entraînerait l’augmentation des salaires, que l’augmentation des salaires amènerait la satisfaction des besoins et la diffusion des connaissances, et enfin que l’extinction du paupérisme serait suivie de l’extinction de la criminalité. (Applaudissements.) Si la Ligue a raison, que la législation soit changée ; si elle a tort, que ses adversaires le prouvent.
Je sais qu’il est de mode de railler les manufacturiers et leur prétendu égoïsme ; de dire qu’ils exploitent à leur profit des milliers d’ouvriers. J’ai visité les districts manufacturiers aussi bien que les districts agricoles, et je demande quels sont ceux qui fournissent les cotisations les plus abondantes quand il s’agit d’une souscription nationale ? Où recueille-t-on 1,000 l. s. dans une seule séance ? À Manchester. J’ai dans les mains la liste de plusieurs individus qui donnent 63 liv. par an aux missions étrangères, c’est-à-dire de quoi entretenir un missionnaire. Je ne vois rien de semblable dans les districts agricoles, je ne connais aucun gentilhomme campagnard qui maintienne à ses frais un de ces hommes utiles qui s’expatrient pour faire le bien. La semaine dernière, j’ai visité une des grandes manufactures de Bolton, et je n’ai jamais rencontré nulle part une sollicitude plus éclairée pour le bien-être, l’instruction et le bonheur des ouvriers.
L’orateur continue à examiner le système restrictif dans ses rapports avec l’union des peuples, et termine au milieu des applaudissements.
M Ewart et M. Bright prennent successivement la parole. Ce dernier rend compte des nombreux meetings auxquels il a assisté dans les districts agricoles.
FN: On comprendra aisément et j’ai senti moi-même que ces brèves analyses ôtent au compte rendu des séances ce que les détails leur donnent toujours de piquant et quelquefois de dramatique. Obligé de me borner, j’ai préféré sacrifier ce qui pouvait plaire à ce qui doit instruire.
SEPTIÈME MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 5 mai 1843.↩
Longtemps avant l’ouverture de la séance, toutes les places sont envahies et l’entrée a dû être refusée à plus de trois mille personnes.
Le président annonce que, par suite d’une nouvelle résolution prise par le directeur du théâtre de Drury-Lane, cet édifice ne sera plus à la disposition de la Ligue ! Mais les intrigues du monopole seront encore déjouées. À Manchester nous avons construit en six semaines une salle capable de contenir dix mille personnes. Nous ferons de même à Londres, s’il le faut. — Il rend compte des meetings tenus dans les provinces pendant cette semaine.
Le Rév. docteur Cox : Si l’on me demandait pourquoi je me présente devant vous, moi, ministre protestant, étranger aux pompes du théâtre (rires), quoique familier avec la chaire, je répondrais : Homo sum, nil humani alienum puto ; je suis homme, et, comme tel, je ne suis étranger à rien de ce qui intéresse mon pays et l’humanité. (Approbation.) J’ai eu ma part de blâme pour m’être réuni avec mes confrères à Manchester, il y a deux ans. — J’entendis alors, je ne dirai pas les murmures, mais les clameurs d’une partie de la presse (honte!), qui nous reprochait de nous être rassemblés à l’occasion d’une loi étrangère à notre position et à nos études. Maintenant l’on dit qu’en se réunissant à Manchester, les ministres protestants avaient fait tout ce qu’ils avaient à faire. Monsieur, je ne puis adhérer à ces sentiments. Je dis que notre cause réclame toujours nos efforts, et j’adopte sans hésiter la maxime de César : « Rien n’est fait tant qu’il reste quelque chose à faire ! » (Applaudissements.) Il ne m’appartient pas de décider si une nouvelle Convention des Ministres dissidents serait convenable ; mais engagés, comme nous le sommes, au nombre de sept cents, dans notre caractère collectif, je ne vois pas pourquoi nous ne nous efforcerions pas individuellement de faire triompher cette cause que nous avons embrassée avec vous, Monsieur, avec M. Cobden, avec les membres de la Ligue, cause que nous regardons comme intéressant au plus haut degré le bien-être de nos frères. (Approbation.) Et quel est mon frère ? Ce n’est pas celui qui vit dans mon voisinage, dans la rue ou la ville prochaine, — mais c’est l’homme. (Applaudissements.) L’homme, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Le christianisme m’enseigne la sympathie pour toute la race humaine, et d’atteindre, si je le puis, par mon influence morale, jusqu’aux extrémités du monde. On nous dit que comme Ministres nous devons nous en tenir à nos fonctions spirituelles; — que nous ne sommes point présumés comprendre des questions d’économie politique. Ma réponse est celle-ci : Je ne me reconnais pas plus incompétent pour comprendre une question, si je veux l’étudier, que tout autre individu doué d’honnêteté et de quelque sens commun. J’ai d’ailleurs présent à l’esprit que le Sauveur du monde, Notre-Seigneur, ne montra pas moins de sollicitude pour les intérêts temporels que pour les intérêts spirituels des hommes. (Écoutez, écoutez.) Il ne se borna pas à enseigner son éternel Évangile, mais il eut aussi compassion de la multitude et lui donna une nourriture miraculeuse ; ce qui doit me déterminer à faire tous mes efforts pour lui donner une nourriture naturelle ; et si ceux qui font profession d’être les disciples de Jésus-Christ, je veux dire les évêques de ce pays (grands cris de honte ! honte !), qui occupent une si haute position et qui s’assoient sur les sièges de velours du Parlement, si les évêques, dis-je, combattaient au lieu de les soutenir ces lois-céréales qui ont infligé tant de maux à la communauté, je leur pardonnerais d’occuper une situation que je regarde comme incompatible avec leur caractère sacré (applaudissements), et j’oublierais, pour un moment, que j’ai vu la pompe de l’hermine et l’éclat de la mitre, là où je me serais attendu à rencontrer le manteau de bure et la couronne d’épines ! (Écoutez, écoutez.) J’ai fait allusion au Parlement, c’est pour moi un sujet délicat à traiter ; je crois que nous sentons tous que c’est là que nos intérêts ont été sacrifiés à l’esprit de parti. (Bruyantes acclamations.) C’est là, je crois, que les luttes et les rivalités pour le pouvoir et l’influence, pour les places et les honneurs, ont fait obstacle à plusieurs des grands principes que nous voulons faire prévaloir ; et cependant nous pouvons tourner nos regards vers cette enceinte élevée avec quelque espérance, dans la conviction que le sentiment populaire, qui ne peut y être toujours méconnu, y fera tôt ou tard assez d’impression pour déterminer le triomphe des principes que nous avons à cœur.
Monsieur, je défendrai la cause de la Ligue au point de vue de l’humanité, du patriotisme et de la religion. (Applaudissements.) Je dis d’abord, quant à la question d’humanité, que la population de ce pays s’est accrue et s’accroît tous les jours, et que la première loi de la société est que l’homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Mais ici, pendant que la population s’accroît d’année en année, pendant que le travail de l’homme s’accroît de jour en jour, l’ouvrier ne peut gagner son pain à la sueur de son front, parce qu’il y a des obstacles sur son chemin, et ce sont ces obstacles que la Ligue a pour but de renverser. (Applaudissements.) Je plaide cette cause sur le terrain de l’humanité, parce que si les intérêts manufacturiers souffrent, tous les autres ne peuvent manquer de souffrir aussi, et la détresse s’étend sur tout le pays. Je me souviens qu’il y a bien des années, M. Fox, combattant dans la Chambre des communes les mesures de son antagoniste, M. Pitt, disait ces paroles prophétiques : « Si vous persistez dans ce que vous appelez des guerres justes et nécessaires, vous finirez par être chargé d’une dette nationale de huit cents millions et d’un fardeau de taxes qui écrasera et ruinera le pays. » Les législateurs de l’époque se moquèrent de M. Fox; ils riaient de ses prévisions et de ce qu’ils appelaient ses folles prophéties ; qu’est-il arrivé cependant ? N’avons-nous pas cette dette nationale qui avait été prédite ? N’avons-nous pas cette taxe que les citoyens ne peuvent supporter, à moins d’avoir quelques moyens extraordinaires, quelques propriétés héréditaires — ou, ce qui est la propriété du peuple, le droit de chercher et d’obtenir du travail ? — Je plaide cette cause sur le terrain de l’humanité, car sans m’appesantir sur la condition profondément misérable des habitants des comtés septentrionaux, je pourrais signaler dans cette métropole, — à nos portes, — des circonstances de la nature la plus affligeante. J’ai en main un rapport qui me vient de la source la plus authentique, qui constate que dans le mois de mars dernier et dans une seule semaine, il y a eu quatre cas de mort provenant d’inanition. (Écoutez, écoutez.) Il est établi par les verdicts que deux de ces malheureux sont morts d’épuisement ; un à la suite d’un complet dénûment, et le quatrième d’inanition absolue. (Écoutez, écoutez.) Mais au fait, tous ces mots sont synonymes, et ils signifient que, dans Londres, au sein du luxe et de l’abondance, quatre personnes dans une semaine sont mortes littéralement de faim. (Honte ! honte !) Vous faites allusion à l’enceinte où se tiennent nos séances ; vous parlez de tragédies ! Voilà certainement de la tragédie, non point de celle qui a pour but de distraire le peuple, mais de la tragédie, faite pour arracher des larmes et éveiller la sympathie la plus profonde. Me plaçant donc sur le terrain de l’humanité, lorsqu’il a été prouvé surabondamment que, par l’effet des lois-céréales, des milliers et des millions d’hommes sont dénués, non-seulement des moyens de vivre dans l’aisance, mais encore, à strictement parler, des moyens de vivre, quand le peuple souffre depuis le centre de cette métropole jusques aux districts les plus reculés du royaume, — lorsque le dénûment, la stagnation du travail, la famine, avec tous les maux qu’elles engendrent, pèsent de tout leur poids sur le pays, — lorsque l’humanité saigne par tous les pores, alors, Monsieur, je ne regarde pas si je suis un ministre de la religion, mais je me lève en dépit du blâme et de la calomnie pour défendre la cause de l’homme, qui est essentiellement la cause de Dieu. (Tonnerre d’applaudissements.)
J’ai dit, en second lieu, que je soutiendrais la cause delà Ligue sur le terrain du patriotisme, et ici je devrais me répéter, car les souffrances des manufactures ne sont-elles pas les souffrances de la masse ? La détresse du centre ne s’étend-elle pas aux extrémités ? Je maintiens qu’en principe il est faux qu’une partie de la communauté prospérera par la détresse d’un autre partie de cette même communauté ; que l’aristocratie, par exemple, s’élèvera par l’abaissement des classes ouvrières. Que j’entende ou non l’économie politique, j’en sais assez sur cette matière, j’en sais assez surtout sur la morale du christianisme, pour dire que la vraie prospérité d’un peuple consiste en ce que chacun trouve le contentement de son cœur dans la prospérité de tous ; en ce que les volontés soient unanimes pour porter le pays au plus haut degré de gloire et de félicité temporelle. Ce n’est qu’alors que l’Angleterre s’élèvera comme un monument digne d’attirer les regards de l’univers ; ce n’est qu’alors qu’elle apparaîtra brillante à la clarté du jour, et répandra sa gloire sur toutes les nations; ce n’est qu’alors, quand tout privilége aura disparu, quand chaque classe, chaque parti se réjouira du bonheur des autres, quand ils travailleront tous à leur mutuelle satisfaction, que l’Angleterre sera pour l’étranger un objet d’étonnement et d’envie, et pour ses enfants un objet d’orgueil et de délices !
Après quelques autres considérations, l’orateur continue ainsi :
Enfin, je défends la cause de la liberté commerciale au point de vue religieux ; je dis que la misère engendre l’égoïsme, les mauvais penchants, les dissensions domestiques. — Elle engendre l’abattement d’esprit ; elle aboutit au suicide et trop souvent au meurtre. Les liens les plus tendres, les sympathies les plus douces de la vie domestique ont été brisées par la pression de la détresse, par l’impuissance de se procurer des moyens de subsistance au sein du pays ruiné. L’insanité s’en est suivie, et le tombeau prématuré s’est fermé sur ses victimes infortunées[1]. Dans ces circonstances je dis, Monsieur, que les dominateurs de ce monde se sont placés sous une effrayante responsabilité. (Écoutez, écoutez.) C’est pour nous un devoir de chrétiens de secourir le pauvre dans sa souffrance et dans sa détresse ; mais prier pour son soulagement et son bien-être, n’est que la moitié de notre devoir. Nous devons encore plaider sa cause et faire tous nos efforts pour relever sa condition. À cet égard, permettez-moi une citation que je recommande à vos méditations. « Les affections qui cimentent la société ne sont guère moins importantes que les affections domestiques. Le sentiment de l’indépendance et de la dignité personnelle, l’amour de la justice, le respect des droits de la propriété, la satisfaction de notre position sociale, l’attachement éclairé aux institutions qui nous régissent, — ce sont là des éléments essentiels au corps politique, et dont la destruction ne peut être considérée que comme une calamité nationale. Cependant nous les voyons périr autour de nous. Quelque noble répugnance que les classes ouvrières aient montrée à accepter le secours de la paroisse, il n’est que trop vrai que le cœur de plusieurs a été courbé par un long désespoir devant cette humiliation ; le sentiment du droit s’est évanoui aux approches de la famine, et les hommes ont appris à se demander s’il n’existait pas un droit primordial, antérieur au droit de propriété, qui les justifie de prendre là où ils le rencontrent, ce qui est indispensable au soutien de la vie ; et finalement, nos institutions nationales si longtemps et si cordialement vénérées, ont été accusées, sinon d’être la source incurable du mal, du moins de constituer toute la force agressive et défensive de ceux qui perpétuent cet abus intolérable. » (Écoutez, écoutez.) Nous sommes dans un temps d’agitation, de grande et juste agitation parmi le peuple, le tonnerre commence à gronder ; des bruits prophétiques se font entendre sur tous les points de l’horizon, cris pleins d’agonie, de désespoir et de détermination ; l’électricité s’accumule et la tempête commence à éclater. Le peuple est résolu, — non comme tant d’autres fois l’épée à la main et en esprit de rébellion, mais en esprit de paix et de légalité, — à revendiquer les droits qu’il tient de l’auteur des choses, et dont il a été si injustement dépouillé. Le peuple veut vaincre et il vaincra. Le flot s’avance, les vagues grossissent, et rien ne pourra les arrêter. — Les effets de ces lois ont été à un haut degré préjudiciables aux intérêts de la religion. En beaucoup d’endroits, les hommes du peuple, faute de vêtements convenables, se sont éloignés du service divin. (Écoutez.) Les lois-céréales tendent en outre directement à restreindre les effets de ces institutions charitables, dont l’étendue et la bienveillance ont jeté tant de gloire sur le nom britannique, car à mesure que la détresse gagne du terrain, toutes les classes sont successivement envahies, toutes, excepté celles que défendent la naissance aristocratique et les possessions héréditaires. Ces lois ont encore un plus funeste résultat en prévenant l’extension de l’éducation, ce grand objet que le gouvernement pourrait abandonner à lui-même si la misère ne forçait à avoir recours à lui. (Écoutez, écoutez.) Je n’ajouterai qu’un mot, comme ami de la liberté en toutes choses. Liberté d’action, liberté de pensée, liberté d’échange, — car tout ce qu’il y a de bon sur cette terre est né de la liberté, — je défendrai cette grande cause tant que j’aurai un cœur pour sentir, une voix pour parler et un bras pour agir. (Bruyantes acclamations.)
M. Cobden s’avance au bruit des applaudissements et s’exprime en ces termes :
Le Révérend Ministre qui vient de s’asseoir s’est rendu coupable au moins d’une œuvre de surérogation (rires) lorsqu’il a jugé nécessaire de défendre les Ministres du culte pour la noble part qu’ils ont prise à cette agitation. (Bruyantes acclamations.) Si je regrette quelque chose dans le cours de nos opérations relatives aux lois-céréales, c’est de ne les avoir peut-être pas suffisamment considérées comme affectant les mœurs, la religion et l’éducation. On parle d’éducation ; l’on demande si le peuple désire l’éducation. Je puis affirmer qu’il n’est aucune classe, même la plus humble, où les hommes, s’ils en avaient les moyens, ne se montrassent aussi empressés de procurer à leurs enfants le bienfait de l’éducation qu’on peut l’être dans les classes supérieures. Dans les années 1835 et 1836, lorsque le nord de l’Angleterre florissait, lorsque l’énergie du peuple n’était pas assoupie, lorsque nous n’étions pas engagés comme aujourd’hui dans un humiliant combat pour du pain. — Je me rappelle qu’il y eut plusieurs magnifiques meetings à Manchester pour l’avancement de l’éducation, et dans l’espace de quelques mois on recueillit 12,000 livres parmi les classes manufacturières, dans le but de construire des maisons d’école convenables. (Applaudissements.) Mais la loi-céréale s’élève comme un obstacle sur le seuil de toute amélioration morale. Qu’elle soit abrogée, et les classes industrieuses auront le moyen, comme elles ont la volonté, d’élever leurs enfants. Je regarde encore la question de la liberté commerciale comme impliquant la question de la paix universelle. Si, comme on peut me l’objecter, de grandes puissances, de grandes cités commerciales ont été renommées pour leurs guerres et leurs conquêtes, c’est parce qu’elles ne pouvaient accroître leur commerce que par l’agrandissement du territoire. Il est certain cependant que toutes les fois que les villes commerciales se sont confédérées, elles ont eu pour but de conserver la paix et non de faire la guerre. ( Approbation.) Telle fut la confédération des villes Anséatiques. Nous nous efforçons maintenant de réaliser une ère nouvelle ; nous cherchons, par la liberté du commerce, à accroître nos richesses et notre prospérité, tout en accroissant les richesses et la prospérité de toutes les nations du monde. (Bruyantes acclamations.) Introduisez le principe de la liberté commerciale parmi les peuples, et la guerre sera aussi impossible entre eux qu’elle l’est entre Middlesex et Surrey. Nos adversaires ont cessé de nous opposer des arguments, du moins des arguments dignes d’une discussion sérieuse. Mais, quoiqu’ils en soient venus à admettre à peu près nos principes, ils refusent de les mettre en pratique, sous prétexte que ces principes, quelque justes et incontestables qu’ils soient, ne sont pas encore adoptés par les autres nations. Ces Messieurs se lèvent à la Chambre des communes et nous disent que nous ne devons pas recevoir le sucre du Brésil et le blé des États-Unis jusqu’à ce que ces peuples admettent, sur le pied de l’égalité, nos fers et nos tissus. Mais ce que nous combattons, ce n’est point les marchands brésiliens ou américains, c’est la peste des monopoles intérieurs. (Acclamations prolongées.) La question n’est pas brésilienne ni américaine, elle est purement anglaise, et nous ne la laisserons pas compliquer par des considérations extérieures. Telle qu’elle est, notre tâche a assez de difficultés. — Que demandons-nous ? Nous demandons la chute de tous les monopoles, et d’abord, et surtout, la destruction de la loi-céréale, parce que nous la regardons comme la clef de voûte de l’arche du monopole. Qu’elle tombe, et le lourd édifice s’écroulera tout entier. (Écoutez, écoutez.) Et qu’est-ce que le monopole ? C’est le droit ou plutôt le tort qu’ont quelques personnes de bénéficier par la vente exclusive de certaines marchandises. (Écoutez, écoutez.) Voilà ce que c’est que le monopole. Il n’est pas nouveau, dans ce pays. Il florissait en Angleterre il y a deux cent cinquante ans, et la loi-céréale n’en est qu’une plus subtile variété. Le système du monopole avait grandi au temps des Tudors et des Stuarts, et il fut renversé, il y a deux siècles et demi, au moins dans ses aspects les plus odieux, sous les efforts de nos courageux ancêtres. Il est vrai qu’il revêtait, dans ces temps reculés, des formes naïvement grossières ; on n’avait pas encore, à cette époque, inventé les ruses de l’échelle mobile (écoutez, écoutez) ; mais ce n’en étaient pas moins des monopoles, et des monopoles très-lourds. Voici en quoi ils consistaient : les ducs de ces temps-là, un Butkingham, un Richmond, sollicitaient de la reine Elisabeth ou du roi Jacques des lettres-patentes en vertu desquelles ils s’assuraient le monopole du sel, du cuir, du poisson, n’importe. Ce système fut poussé à une exagération si désordonnée que le peuple refusa de le supporter, comme il le fait aujourd’hui. Il s’adressa à ses représentants au Parlement pour appuyer ses doléances. Nous avons les procès-verbaux des discussions auxquelles ces réclamations donnèrent lieu, et quoique les discours n’y soient point rapportés assez au long pour nous faire connaître les arguments qu’on fît valoir de part et d’autre, il nous en reste quelques lambeaux qui ne manquent pas d’intérêt. Voici ce que disait un M. Martin, membre de la Ligue, assurément (rires), et peut-être représentant de Stockport (nouveaux rires,) car il s’exprimait comme j’ai coutume de le faire. « Je parle pour une ville qui souffre, languit et succombe sous le poids de monstrueux et intolérables monopoles. Toutes les denrées y sont accaparées par les sangsues de la république. Tel est l’état de ma localité, que le commerce y est anéanti ; et si on laisse encore ces hommes s’emparer des fruits que la terre nous donne, qu’allons-nous devenir, nous qu’ils dépouillent des produits de nos travaux et de nos sueurs, forts qu’ils sont des actes de l’autorité suprême auxquels de pauvres sujets n’osent pas s’opposer ? » (Acclamations.) Voilà ce que disait M. Martin, il y a deux cent cinquante ans, et je pourrais aujourd’hui tenir pour Stockport le même langage. — On nous fait ensuite connaître la liste des monopoles dont le peuple se plaignait. Nous y voyons figurer drap, fer, étain, houille, verre, cuir, sel, huile, vinaigre, fruit, vin, poisson. Ainsi ce que lord Stanhope et le Morning-Post appellent protection de l’industrie nationale, s’étendait à toutes ses branches. (Rires et acclamations prolongés.) Le malin journaliste ajoute : « Lorsque la liste des monopoles a été lue, une voix s’est écriée : et le monopole des cartes à jouer ! ce qui a fait rougir sir Walter-Raleigh, car les cartes sont un de ses monopoles. » Les hommes de cette époque étaient délicats sans doute ; car, quoique nous ayons un lustre puissant à la Chambre des communes, jamais, depuis que j’en fais partie, je n’ai vu le rouge monter au front de nos monopoleurs. (Éclats de rire.) Le journal continue : « Après la seconde lecture de la liste des monopoles, M. Hackewell (autre ligueur sans doute) (rires) se lève et dit : Le pain ne figure-t-il point dans cette liste ? — Le pain ! dit l’un ; — Le pain ! s’écrie un second. — Cela est étrange, murmure un troisième. — Eh bien, reprend M. Hackewell, retenez mes paroles, si l’on ne met ordre à tout ceci, le pain y passera. » (Bruyantes acclamations.) — Et le pain y a passé, et c’est pour cela, Messieurs, que nous sommes réunis dans cette enceinte. (Applaudissements prolongés.) Le journaliste continue : « Quand la reine Élisabeth eut connaissance des plaintes du peuple, elle se rendit au Parlement et le remercia d’avoir attiré son attention sur un si grand fléau. » S’indignant ensuite d’avoir si longtemps été trompée par ses varlets (c’est le terme dont elle jugea à propos de se servir à l’égard de ses ministres monopoleurs), « pensent-ils, s’écria-t-elle, demeurer impunis, ceux qui vous ont opprimés, qui ont méconnu leurs devoirs et l’honneur de la reine ? Non, assurément. Je n’entends pas que leurs actes oppressifs échappent au châtiment qu’ils méritent. Je vois maintenant qu’ils en ont agi envers moi comme ces médecins (rires, écoutez, écoutez) qui ont soin de relever par une saveur aromatique le breuvage amer qu’ils veulent faire accepter, ou qui, voulant administrer une pilule (cris répétés : Écoutez, écoutez, c’est le docteur Tamworth), ne manquent pas de la dorer. » (Rires universels et applaudissements.) Vraiment, on pourrait presque soupçonner dans ces paroles quelques rapports prophétiques avec un certain docteur homme d’État de notre époque. (Nouveaux éclats de rire.) Telle fut, Messieurs, la conduite de la reine Élisabeth. Nous vivons maintenant sous une reine qui occupe dignement le trône de cette souveraine. (Acclamations.) J’ai la conviction que Sa Majesté ne voudrait pas sanctionner personnellement un tort fait au plus pauvre ou au plus humble de ses sujets, et quoiqu’elle ne soit pas disposée, sans doute, à venir à la Chambre des lords pour y dénoncer ses ministres comme des varlets (rires), je crois qu’elle donnerait sans difficulté son assentiment à l’abolition absolue des lois-céréales. (Applaudissements et cris répétés : Dieu sauve la reine !) Tels étaient les priviléges autrefois ; aujourd’hui les monopoleurs, agissant suivant des principes identiques, si ce n’est pires, ont introduit de grands raffinements dans les dénominations des choses ; ils ont inventé l’échelle mobile et le mot protection. En reconstruisant ces monopoles, l’aristocratie de ce pays s’est formée en une grande société par actions pour l’exploitation des abus de toute espèce ; les uns ont le blé, les autres le sucre, ceux-ci le bois, ceux-là le café, ainsi de suite. Chacune de ces classes de monopoleurs dit aux autres : « Aidez-moi à arracher le plus d’argent possible au peuple, et je vous rendrai le même service. » (Écoutez.) Il n’y a pas, en principe, un atome de différence entre le monopole de nos jours et celui d’autrefois. Et si nous n’avons pas réussi à nous débarrasser des abus qui pèsent sur nous, il faut nous en prendre à notre ignorance, à notre apathie, à ce que nous n’avons pas déployé ce mâle courage que montrèrent nos ancêtres dans des circonstances bien moins avantageuses, à une époque où il n’y avait pas de liberté dans les communes, et où la Tour de Londres menaçait quiconque osait faire entendre la vérité. (Écoutez.) Quelle différence pourrait-on trouver dans les deux cas ? Voici des hommes qui se sont rendus possesseurs de tout le blé du pays, qui ne suffit pas, selon eux-mêmes, à la consommation. Cependant ils n’admettent de blé étranger que ce qu’il leur plaît, et jamais assez pour ne pas retirer le plus haut prix possible de celui qu’ils ont à vendre. (Écoutez, écoutez.) Que faisaient de plus les monopoleurs du temps d’Élisabeth ? Les monopoleurs de sucre ne fournissent pas au peuple d’Angleterre la moitié de celui qu’il pourrait consommer, s’il était libre de s’en procurer au Brésil, à prix débattu, et en échange de son travail. Il en est de même pour le café et autres articles de consommation journalière. Combien de temps faudra-t-il donc au peuple d’Angleterre pour comprendre ces choses et pour faire ce que firent ses ancêtres il y a plus de deux siècles ? Ils renversèrent l’oppression : pourquoi ne le ferions-nous pas ? (Applaudissements.)
Vraiment, je sens qu’il y a quelque chose de vrai dans ce que disait hier soir mon ami John Bright : « Nous ne sommes, à la Chambre des communes, que de beaux diseurs à la langue mielleuse et dorée. » Nous ne savons pas parler comme les Martin et les Hackewell d’autrefois. (Écoutez ! écoutez !) Bien que, après tout, ce n’est point dans de rudes paroles mais dans de fortes actions qu’il faut placer noire confiance. (Applaudissements.) Ainsi que je vous le disais tout à l’heure, lorsque nous demandons au gouvernement de mettre un terme à ce système, il nous envoie au dehors, au Brésil par exemple, et nous dit de décider ce peuple à recevoir nos marchandises contre son sucre ; mais quelle est donc cette déception dont on nous berce depuis si longtemps ? Quel est l’objet pratique de ces traités de commerce si attendus ? Y a-t-il quelque pays, à un degré de latitude donné, qui produise des choses que ne puissent produire d’autres pays dans la même latitude ? Pourquoi, je le demande, devons-nous nous adresser au Portugal, et lui donner le privilége exclusif de nous vendre ses vins, lui conférant ainsi un monopole contre nous-mêmes ? Pourquoi nous priver de l’avantage de la concurrence de notre voisine, la France, dont le Champagne est décidément supérieur, dans mon opinion, au vin épais de Porto ? (Applaudissements.) On nous dit qu’en donnant la préférence au Portugal, nous forcerons la France à réduire ses droits sur nos fils et tissus de lin. Mais cela ne pourrait-il pas avoir l’effet contraire ? l’expérience en est faite. Voilà plus de cent ans que nous avons conclu le fameux traité de Methuen, et au lieu de concilier les peuples il les a divisés, et a, plus que toute autre chose, provoqué ces guerres désastreuses qui ont désolé l’Europe. Au lieu de forcer cette brave nation de l’autre côté du canal à venir acheter nos produits, il n’a eu d’autre effet que de la décider à doubler les droits sur nos marchandises. (Approbation.) Non, non, agissons à la façon des ligueurs du temps d’Élisabeth. Renversons nos propres monopoles ; montrons aux nations que nous avons foi dans nos principes ; que nous mettons ces principes en pratique, en admettant, sans condition, le blé, le sucre et tous les produits étrangers. S’il y a quelque chose de vrai dans nos principes, une prospérité générale suivra cette grande mesure, et lorsque les nations étrangères verront, par notre exemple, ce que produit le renversement des barrières restrictives, elles seront infailliblement disposées à le suivre. (Applaudissements.) Ce sophisme, qu’un peuple perd l’excédant de ses importations sur ses exportations, ou qu’un pays peut toujours nous donner sans jamais recevoir de nous, est de toutes les déceptions la plus grande dont j’aie jamais entendu parler. Elle dépasse les cures par l’eau froide et les machines volantes. (Éclats de rires.) Cela revient tout simplement à dire qu’en refusant les produits des autres pays, de peur qu’ils n’acceptent pas nos retours, nous obéissons à la crainte que l’étranger, saisi d’un soudain accès de philanthropie, ne nous inonde jusqu’aux genoux de blé, de sucre, de vins, etc. (Applaudissements.) Au lieu de mesurer l’étendue de notre prospérité commerciale par nos exportations, j’espère que nous adopterons la doctrine si admirablement exposée hier à la Chambre des communes par M. Villiers, et que c’est par nos importations que nous apprécierons les progrès de notre industrie. (Approbation.) Quels sont les pays qui aient adopté le système des libres importations, et qui ne témoignent pas, par leur prospérité, de la bonté de ce système ! Parcourez la Méditerranée. Visitez Trieste et Marseille, et comparez leurs progrès. Le commerce de Marseille est protégé et encouragé, comme on dit, depuis des siècles par la plus grande puissance du continent. Mais il n’a fallu que quelques années à Trieste pour dépasser Marseille. — Et pourquoi ? parce que Trieste jouit de la liberté d’importation en toutes choses. (Bruyants applaudissements.) Voyez Hambourg ; c’est le port le plus important de toute la partie occidentale de l’Europe. — Et pourquoi ? parce que l’importation y est libre. La Suisse vous offre un autre exemple de ce que peut la liberté. J’ai pénétré dans ce pays par tous les côtés : par la France, par l’Autriche et par l’Italie, et il faut vouloir tenir ses yeux fermés pour ne pas apercevoir les remarquables améliorations que la liberté du commerce a répandues sur la république ; le voyageur n’a pas plutôt traversé la frontière, qu’elles se manifestent à lui par la supériorité des routes, par l’activité et la prospérité croissante des habitants. D’où cela provient-il ? de ce que, en Suisse, aucune loi ne décourage l’importation. Les habitants des pays voisins, les Italiens, les Français, les Allemands y apportent leurs produits sans qu’il leur soit fait la moindre question, sans éprouver ni empêchement ni retard. Et pense-t-on que pour cela le sol ait moins de valeur en Suisse que dans les pays limitrophes ? J’ai constaté qu’il valait trois fois plus qu’au delà de la frontière, et je suis prêt à démontrer qu’il y vaut autant qu’en Angleterre, acre par acre, et à égalité de situation et de nature, quoiqu’en Suisse la terre seule paye la moitié de toutes les taxes publiques. (Écoutez ! écoutez !) Et d’où vient cette grande prospérité ? de ce que tout citoyen qui a besoin de quelques marchandises, de quelque instrument, ou de quelque matière première, est libre de choisir le point du globe sur lequel il lui convient de s’en approvisionner. Je me souviens d’avoir visité, avec un ami, le marché de Lausanne, un samedi. La ville était remplie de paysans vendant du fruit, de la volaille, des œufs, du beurre et toute espèce de provisions. Je m’informai d’où ils venaient ? — De la Savoie, pour la plupart, me dit mon ami, en me montrant du doigt l’autre rive du lac de Genève. — Et entrent-ils sans payer de droit ? demandai-je. — Ils n’en payent d’aucune espèce, me fut-il répondu, ils entrent librement et vendent tant que cela leur convient. Je ne pus m’empêcher de m’écrier : « Oh ! si le duc de Buckingham voyait ceci, il en mourrait assurément. » (Rires et acclamations.) Mais comment ces gens-là reçoivent-ils leur payement ? demandai-je, car je savais que le monopole fermait hermétiquement la frontière de Savoie, et que les marchandises suisses ne peuvent y pénétrer. Pour toute réponse, mon ami me mena en ville dans l’après-dînée, et là, je vis les paysans italiens fourmillant dans les boutiques et magasins, où ils achetaient du tabac, des tissus, etc., qu’on arrangeait en paquets du poids de 6 livres environ, pour en faciliter l’entrée en fraude en Italie. (Rires.) Eh bien, si vous ouvrez les ports d’Angleterre, et si les autres nations ne veulent pas retirer les droits qui pèsent sur nos produits, j’ose prédire que les étrangers qui nous porteront du blé ou du sucre rapporteront de nos marchandises en ballots de 6 livres, pour éviter la surveillance de leur douane. Mais, après tout, ce ne sont là que des excuses et de vains prétextes ; nous y sommes accoutumes, nous y sommes préparés, on ne peut plus nous y prendre ; et le mieux est de ne pas les écouter. Sommes-nous d’accord sur ce point, qu’il est juste de renverser le monopole ? Qu’on ne nous parle pas de la Russie, du Portugal ou de l’Espagne ; nous nous en occuperons plus tard (bien, bien) ; nous ne manquons pas chez nous d’ennemis d’une pire espèce (bravos) ; ne perdons pas de vue l’objet de notre association, qui est d’emporter le retrait des lois-céréales, absolument, immédiatement et sans condition[2]. Si nous renoncions au mot sans condition, nous aurions un nouveau débordement de prétextes à chaque semaine.
Ici l’orateur rend compte de la tournée qu’il a faite dans les districts agricoles et de l’état de l’opinion parmi les fermiers.
J’ai assisté dans le comté de Hartford, à un meeting où étaient réunis plus de deux mille fermiers ; il avait été annoncé longtemps à l’avance. Je m’y suis présenté seul (applaudissements) sans être accompagné d’un ami, sans avoir une seule connaissance dans tout le comté. (Bravos.) Nous nous réunîmes d’abord dans le Shire Hall (salle du comté) ; mais n’étant pas assez spacieuse, nous tînmes le meeting à ciel ouvert, à Plough-Meal où se font ordinairement les élections. Je pris ma place sur un wagon ; je débitai mon thème pendant près de deux heures (rires et applaudissements) ; et sur le champ même où, il y a près de deux ans, la fine fleur de la chevalerie du comté, sous la bannière du conservatisme, fit élire par les fermiers trois partisans du monopole et de la protection, sur ce même champ, je plaidai, il y a une semaine, la cause de l’abrogation totale et immédiate des lois-céréales. (Applaudissements.)… Les fermiers se divisèrent ; les uns parlèrent pour, les autres contre ; je ne pris plus aucune part aux débats et abandonnai entièrement la discussion à elle-même. Vous avez su qu’au moment du vote, la motion en faveur du maintien de la protection n’avait pas réuni plus de douze suffrages.
Ici M. Cobden annonce qu’un des fermiers de Hertford, M. Latimore, est auprès de lui et se fera entendre pendant la séance. L’assemblée applaudit avec enthousiasme. M. Cobden continue :
Saisissons cette occasion, puisque nous avons parmi nous un représentant de cette digne et excellente classe d’hommes, de lui exprimer les sentiments dont nous sommes animés pour l’ordre dont il est un membre si distingué. Disons à la landocratie du pays, qui prétend maintenir son injuste suprématie, — je dis injuste, parce qu’elle se fonde sur le monopole, — disons-lui qu’il n’est plus en son pouvoir de séparer, d’exciter l’une contre l’autre ces deux grandes classes industrieuses, les manufacturiers et les fermiers (applaudissements), identifiés désormais dans les mêmes intérêts publics, économiques et sociaux. Présentons la main de l’amitié à M. Latimore et à l’ordre auquel il appartient, et qu’il soit bien convaincu que toute la puissance qu’exerce la Ligue sur l’opinion publique, sera employée à obtenir pour les fermiers la même justice que nous réclamons pour nous-mêmes. Le temps approche où, industriels et fermiers, serrant leurs rangs, marcheront côte à côte à l’attaque des monopoles. (Applaudissements.) Souvenez-vous de mes paroles ! le temps approche où la foule des fermiers, mêlée à la foule des Ligueurs, tous animés de la même ardeur, tous sous le poids de la même anxiété, attendront dans les couloirs de la Chambre des communes le dénoûment de cette grande question ; et j’avertis la landocratie qu’elle se trompe complétement si elle compte sur le concours de ses tenanciers pour combattre la population urbaine, quand elle se lève pour la cause de la justice. J’en ai vu assez pour être assuré que c’est autour des châteaux de l’aristocratie que se trouvent les penchants les moins aristocratiques. Que les lois-céréales opèrent quelque temps encore leur œuvre destructive parmi les fermiers, et je ne voudrais pas être chargé de braver l’indignation morale qui s’élèvera des districts agricoles… Je voudrais bien savoir où les landlords iront désormais chercher leur appui. Je les ai combattus jusque dans leurs places fortes. (Applaudissements.) Je les ai rencontrés dans les comtés de Norfolk, de Hertford et de Somerset. (Applaudissements.) La semaine prochaine je serai dans le Buckinghamshire, la semaine d’après à Dorchester, et le samedi suivant dans le Lincoln. (Applaudissements.) Je l’annonce ici publiquement. Je sais que les landlords n’ont pas vu jusqu’ici mes pérégrinations avec indifférence, et quand ils n’ont pas détourné nos fermiers d’assister à nos meetings, ils les ont engagés à y occasionner du désordre. Je leur dis publiquement où je vais, et ils n’osent pas venir m’y regarder en face. S’ils n’osent pas justifier leur loi en présence de leurs propres tenanciers, où donc pouvons-nous espérer de les rencontrer, si ce n’est à la chambre des communes et à la chambre des lords ?…
J’ai eu un attachement si passionné pour la liberté du commerce, que je n’ai jamais regardé au delà ; mais il y a des hommes qui regardent au delà et qui comptent sur la Ligue pour une œuvre bien autrement radicale que celle qu’elle a en vue. Je n’ai pas d’avis à donner à l’aristocratie de ce pays ; mon affection pour elle ne va pas jusque-là ; mais si elle ferme les yeux, dans son orgueil, sur le travail qui s’opère au-dessous d’elle, elle verra peut-être la question se porter fort au delà d’une simple lutte de liberté commerciale, par des hommes qui, après avoir accompli une utile réforme, en poursuivront une autre bien autrement profonde. (Acclamations.) Si l’on persévère dans ce système, alors que le pays rend contre lui un témoignage unanime, je répète ici ce que j’ai dit dans une autre enceinte (bruyantes acclamations), la responsabilité tout entière en retombera sur le pouvoir exécutif (applaudissements), et cette responsabilité deviendra tous les jours plus terrible. (Nouveaux applaudissements.) Sir Robert Peel dirige le gouvernement en sens contraire de ses propres opinions. (Assentiment.) Je n’incrimine les intentions de personne ; j’observe la conduite des hommes publics, et c’est sur elle que je les juge. Mais quand je trouve qu’un ministre suit une marche diamétralement opposée à ses opinions avouées, j’ai le droit de m’enquérir de ses intentions, parce qu’alors sa conduite n’est pas dirigée par les règles ordinaires. Et de qui se sert-il pour faire triompher ses résolutions ? il les obtient d’une majorité brutale. Je dis brutale, parce qu’elle est irrationnelle ; et je ne l’appelle pas irrationnelle parce qu’elle ne s’accorde pas avec moi, mais parce qu’elle suit un chef qui s’accorde avec moi en principe, et adopte une autre marche en pratique. Le ministre qui dirige l’administration avec un tel instrument, sachant qu’il est le produit de l’intrigue, de l’erreur et de la corruption, lorsqu’il voit les mêmes hommes, autrefois trompés par ses créatures, s’assembler aujourd’hui à la clarté du jour, et, au milieu de l’aristocratie à cheval, voter comme un seul homme contre cet odieux système, ce ministre, dis-je, encourt une immense responsabilité.
L’orateur annonce que le théâtre de Drury-Lane n’est plus à la disposition de la Ligue ; et répondant aux personnes qui voudraient que les meetings se tinssent en plein air, il dit :
Les personnes se méprennent sur ce qui constitue l’opinion publique, qui disent que des meetings à Islington-Green auraient plus d’influence que ceux-ci. Ce ne sont pas les tacticiens de l’école moderne qui pensent qu’une grande question d’intérêt public peut être résolue devant une armée de trente à quarante mille hommes rassemblés à Islington ou ailleurs. Mon opinion est que depuis la réforme électorale, qui a mis la puissance politique aux mains de plus d’un million de personnes appartenant à la classe éclairée de ce pays, si cette classe veut agir, sa puissance ne sera pas ébranlée, ni par les efforts de l'aristocratie d’un côté, ni par les démonstrations populaires de l’autre. — Sans vouloir négliger la coopération d’aucune classe, je pense que ceux qui veulent emporter une grande question, doivent le faire précisément par cette classe dont je suis en ce moment entouré. Les applaudissements de la foule, l’enthousiasme manifesté par un grand chœur de voix humaines, à Islington, pourraient bien nous amuser ou flatter notre amour-propre, mais si nous sommes animés d’une passion sincère, si nous voulons faire triompher la liberté, ainsi que nous y avons engagé nos fortunes, et s’il le faut, nos vies, alors nous prendrons conseil de quelque chose de mieux que de la vanité, et nous choisirons parmi nos moyens ceux qui sont les plus propres à amener le succès. Rien n’est plus propre à le garantir que de semblables réunions. C’est un axiome parmi les auteurs dramatiques, que le jugement du public est sans appel. Au foyer, les critiques peuvent différer et se combattre. Mais si la pièce a réussi à Drury-Lane, elle réussira dans tout le royaume. Vous devez bien penser que ce n’est pas sans quelque anxiété que nous avons porté notre œuvre devant vous. Mais forts de nos précédents, nous rappelant que le succès n’avait jamais manqué à nos démarches les plus hardies, nous résolûmes d’affronter votre jugement à Drury-Lane. Vous l’avez prononcé, ce jugement, après plusieurs épreuves réitérées. De semaine en semaine votre enthousiasme a grandi ; de séance en séance, les dames, cette meilleure partie de la création, sont venues en plus grand nombre sourire à nos efforts. (Acclamations.) Maintenant, qu’ils nous retirent l’usage de cette enceinte privilégiée ! — Nous les remercions de ce qu’ils ont fait. — Vous avez condamné le monopole ; votre verdict est prononcé… Il n’en sera pas fait appel. (L’honorable gentleman s’assoit au milieu des acclamations enthousiastes. L’assemblée se lève dans un état d’excitation tumultueux qui se prolonge plusieurs minutes.)
MM. Latimore et Moore prennent successivement la parole.
FN: On sait que le suicide est presque toujours attribué dans les verdicts à la démence, insanity.
FN: Le mot : unconditional (sans condition), adopté par la Ligue, se rapporte à l’étranger et signifie : sans demander des concessions réciproques.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE À LA SALLE DE L’OPÉRA. 13 mai 1843.↩
À l’occasion de la discussion sur les lois-céréales, discussion qui a occupé cinq séances entières de la Chambre des communes et qui n’est pas encore terminée, la Ligue s’est réunie, samedi 13 mai, à la salle de l’Opéra. Après un discours éloquent de M. Fox, la parole est à M. Cobden.
M. Cobden : C’est avec surprise que j’ai vu figurer mon nom sur l’affiche de la distribution des rôles. (Rires.) Notre président est d’un despotisme achevé, et ne laisse ni voix délibérative ni voix consultative à ce sujet. Si j’étais libre, j’aimerais mieux, pardonnez-le-moi, aller me reposer, car il était cinq heures ce matin quand je suis sorti du Parlement, après avoir assisté à une scène… comment la qualifierai-je ?… Une scène digne des bêtes sauvages d’Éphèse. (Rires et applaudissements.) Ce n’est pas d’ailleurs une tâche aisée que de succéder à M. Fox. Je regrette qu’il ne puisse pas répéter, lundi prochain, l’éloquent discours que vous venez d’entendre, à la Chambre des communes, où son grand talent, vous en conviendrez avec moi, devrait lui assurer une place. Mais quoique l’occasion lui en soit refusée, je pense qu’il en sera dit quelque chose lundi soir, car autant les membres du Parlement sont impatients de la critique qui s’attache à leurs représentations de Saint-Stephen, autant ils aiment à critiquer nos représentations de Drury-Lane et de l’Opera-House. Il n’a guère été question d’autre chose dans les derniers débats, et nos opérations sont devenues le thème favori du Parlement. Un autre sujet inépuisable pour ces Messieurs, c’est le blâme et les plaintes dirigés contre le représentant de Stockport. (Rires.) Je ne suis pas surpris que les membres des communes supportent impatiemment la critique du public, et puisque leurs belles manières devaient se manifester par une violence si inusitée, ils ont agi prudemment d’exclure de l’enceinte législative les étrangers et les journalistes. — Je voudrais que mes compatriotes de la classe ouvrière eussent été derrière les coulisses pour voir comment se comportent, en quelques occasions, ceux qui se disent leurs supérieurs. (Rires et applaudissements.)
Je ne sais vraiment que vous dire sur le fond de la question ; je me sens tout à fait dans la thèse de sir Robert Peel. Je n’ai pas de nouveaux arguments à faire valoir, et je ne puis que vous chanter toujours le même refrain. (Rires.) Mais, croyez-moi bien, les plus vieux arguments sont les meilleurs. (Écoutez ! écoutez !) Le tout est de les bien comprendre. Je ne suis pas bien sûr que vous ayez aucune raison, ni même aucun droit à obtenir la liberté des échanges, si vous ne la comprenez parfaitement, si vous ne la désirez avec ardeur. Mais, une chose dont je suis sûr, c’est qu’en l’absence de cette intelligence et de cette volonté, vous l’auriez aujourd’hui, que vous la perdriez demain. — Je vais donc continuer mon cours ; ce sera sans doute toujours le vieux refrain. Mais je vois parmi vous des jeunes gens ; pourquoi ne les instruirions-nous pas ? pourquoi ne les mettrions-nous pas à même de convertir les vieux monopoleurs, en retournant à leurs foyers ? (Approbation.) Qu’est-ce que le monopole du pain ? c’est la disette du pain. Vous êtes surpris d’apprendre que la législation de ce pays, à ce sujet, n’a pas d’autre objet que de produire la plus grande disette de pain qui se puisse supporter ? et cependant ce n’est pas autre chose. (Écoutez ! écoutez !) La législation ne peut atteindre le but qu’elle poursuit que par la disette. Ne vous semble-t-il pas que c’est assez clair ? — Quelle chose dégoûtante de voir la Chambre des communes…, je dis dégoûtante ici, ailleurs le mot ne serait pas parlementaire. Mon ami, le capitaine Bernai, leur a dit le mot en face ; mais rappelé à l’ordre par le président, il a dû s’excuser et retirer l’expression. Mais allez, comme je l’ai fait, d’abord à la barre de la Chambre des lords, et puis à la Chambre des communes, et vous verrez que le fond de leurs discours c’est : rentes ! rentes ! rentes ! cherté ! cherté ! cherté ! rentes ! rentes ! rentes ! (Rires et applaudissements.) Qu’est-ce que cela signifie ? Voilà une collection de grands seigneurs, de dignes gentilshommes assurément, et faisant figure sur les coussins de soie de la Chambre des lords, mais, du reste, ne dépassant guère le niveau de l’intelligence ordinaire, et fort peu au-dessus de la médiocrité, selon ce que j’en puis savoir, en vertus et en connaissance ; — mais enfin les voilà. Et que sont-ils? — des marchands de blé et de viande. (Bruyants applaudissements.) C’est là ce qui les fait vivre, et ils vont à la législature, pour assurer, par acte du parlement, un prix élevé, un prix de monopole, à la chose qu’ils mettent en vente. C’est là leur grande affaire. Ce que je dis peut n’être pas parlementaire, mais c’est la vérité. (Applaudissements.) Voilà encore de grands seigneurs à la Chambre des communes, très-dignes gens sans doute, et qui représentent fidèlement les lumières et les vertus de leurs commettants. Cependant je suis fâché de le dire, la plupart d’entre eux tirent leurs revenus de la vente des blés et des bestiaux ; et quelle a été leur occupation pendant toute cette semaine ? de combattre vigoureusement pour maintenir, par acte du Parlement, le prix de leurs marchandises. (Applaudissements.) S’il y avait un Pasquin sur les murs de Saint-Stephen, j’écrirais en vers, au-dessus de son effigie : Ici résident les marchands de grains. — Vous ne voyez pas les hommes qui ont des cotons, des draps, des soieries, ou des fers à vendre, quelle que soit la détresse de leur commerce, entrer d’un pas délibéré à la Chambre des communes, et y faire des lois pour s’assurer des prix élevés ; pourquoi les maîtres de forges, les imprimeurs sur étoffes, n’auraient-ils pas aussi leur échelle mobile ? Ils pourraient s’adjuger 1 sh. 2 d. de protection. Et pourquoi pas 1 sh. 6 d.? on peut bien être généreux quand on l’est envers soi-même. Mais il n’y a pas jusqu’aux grooms qui gardent leurs chevaux à la porte de la Chambre qui ne riraient après eux. Pourquoi donc tolérez-vous que les grands seigneurs aillent à la Chambre des communes, et convertissent en une halle ce qui devrait être le temple de la justice ? (Approbation.) Pourquoi le peuple tolère-t-il cela ? parce que, fasciné par le vieux système féodal, il voit avec indulgence, que dis-je ? avec vénération, de la part des possesseurs du sol, des actions pour lesquelles il honnirait les hommes qui dirigent, dans la boutique ou l’atelier, une honnête industrie. (Applaudissements.) Mais mon devoir est d’instruire les enfants mêmes, afin que, rentrés chez eux, ils catéchisent jusqu’à leurs grand’mères. (Éclats de rire.) Ces enfants entendront dire sans doute que la protection n’a pas pour but d’élever le prix du blé, mais d’en augmenter la production intérieure. Et comment veut-on arriver à ce résultat ? d’abord le moyen est bizarre, et le sens commun peut trouver étrange qu’on essaye de procurer l’abondance en excluant l’abondance. (Écoutez !) Mais voyons les effets. Le peuple est-il nourri de pain blanc ? Selon le docteur Marsham, cinq millions d’habitants vivent de pain d’avoine, et cinq autres millions de pommes de terre. Que l’enfant revienne donc vers sa grand’mère, et qu’il lui dise : Le plan a failli, car le peuple n’est pas nourri. Quelle objection peut-on faire alors à l’essai de notre plan, en laissant entrer le blé étranger? Qui le mangera ? Ce ne sont pas sans doute ceux qui assistent à ce meeting ; ils en ont plus qu’il ne leur en faut. Si donc il en entre davantage, il sera consommé par ceux qui n’en mangent pas assez ou ceux qui n’en mangent pas du tout. (Applaudissements.) Donc, laissez arriver le blé. Mais ici vous êtes assaillis d’un débordement d’arguments tirés des charges qui pèsent sur le sol, du danger de dépendre de l’étranger, du développement exagéré des machines, etc. La réponse à laquelle l’enfant doit se tenir attaché, est celle-ci : Toutes ces choses peuvent être très-fâcheuses, mais rien n’est plus fâcheux que la rareté des aliments ; il pourrait être bon de ne pas dépendre de l’étranger, si nous ne dépendions pas de gens qui nous traitent plus mal chez nous. Mes malheureux commettants de Stockport dépendent de la production intérieure, et ils se trouvent si mal nourris, depuis tantôt cinq ans, qu’ils aimeraient mieux dépendre des Russes, des Polonais, des Allemands ou des Américains, ou de quelque nation que ce soit sur la surface de la terre, plutôt que de se fier aux nobles marchands qui ont érigé le système exclusif. Mais les landlords objectent qu’ils payent de plus lourdes taxes que les autres classes de la société. En admettant que, possédant le pouvoir de manipuler les taxes, ces anges de désintéressement les aient toutes placées sur leurs propres épaules, comme Sancho Pança ; eh bien ! dans ce cas même, qu’ils les rectifient, qu’ils les fassent passer sur d’autres ; mais cela ne justifie point la rareté des aliments. Il y a une autre grande duperie mise en avant par l’ennemi, et qui a trompé beaucoup d’enfants de tous âges. C’est la question des machines. Mais une aiguille est une machine, un dé à coudre est une machine, c’est un grand progrès sur l’ongle du pouce. (Rires.) J’ai toujours trouvé que les plus grandes clameurs contre les machines partent de gens qui, d’une façon ou d’une autre, se servent de machines pour leurs propres affaires. Mais ils ont entendu parler de quelque merveilleuse invention dans le nord de l’Angleterre, et les monopoleurs se sont empressés de les mettre sur une fausse quête, en leur persuadant que c’est là ce qui nuit au peuple, et non la taxe du pain. J’ai rencontré à Yarmouth un de ces hommes qui vont vociférant contre les machines. Je lui demandai de quelle espèce de machine il se plaignait ; il me répondit : Du power-loom. Vous en servez-vous à Yarmouth ? lui dis-je. — À Yarmouth, nous ne tissons ni ne filons, mais nous prenons du poisson. — Et quel poisson ? — Du hareng. — De quoi vous servez-vous pour le prendre ? — De filets, et de très-grands filets encore. — Pourquoi ne vous servez-vous pas de lignes et d’hameçons ? (Acclamations.) — La réponse me prouva qu’il est dangereux de s’immiscer dans les affaires des autres, car un vieux pêcheur prit ma question en très-mauvaise part, et me dit : Nous n’avons que faire d’hameçons. — Mais pourquoi ? insistai-je. — Parce que ce serait trop de peine, répondit le vieux pêcheur. — Voilà tout le secret ; voilà aussi la raison pour laquelle on ne file plus avec la quenouille et le fuseau. — Ce serait trop de peine.
En ce qui concerne le manque d’emploi occasionné par les machines, il n’y a jamais eu de plus grande méprise depuis le commencement du monde. Il y a dans le comté de Lancastre un million cinq cent mille habitants, dont cinq cent mille n’y sont pas nés, mais sont venus des comtés où les machines sont inconnues, vers celui où les inventions les plus merveilleuses épargnent de plus en plus le travail de l’homme. C’est là que la population s’est le plus rapidement accrue depuis vingt ans. Que pensez-vous que soient devenus les enfants dans les villages où la population se montre stationnaire ? Il y a, dans les districts ruraux du Lancastre, des villages qui ne sont pas maintenant plus populeux qu’à l’époque où Guillaume le Conquérant fit dresser le doomsday-book. Cela peut paraître étonnant, mais cela est vrai. Un de mes amis, qui est à côté de moi, s’est beaucoup occupé de réfuter cette erreur. Il a pris la peine de parcourir une grande partie du Lancastre, principalement là où les machines n’ont pas été introduites ; il a compulsé les registres des baptêmes et des funérailles, et il a trouvé, en général, trois naissances contre deux décès ; qu’est donc devenue cette population excédante ? Elle a afflué vers Blackburn, vers Bolton, vers les villes où elle a été employée par ces mêmes machines qu’on accuse de détruire l’emploi des bras. Je vous dirai quelle est l’utilité des machines : c’est d’accroître la puissance de la production ; mais à mesure qu’elles se multiplient, il faut que le marché du monde s’ouvre devant nous. Si nous avions la liberté du commerce, chaque perfectionnement mécanique serait suivi d’une diminution dans le prix de revient du produit, diminution qui mettrait le marchand à même de lui trouver de nouveaux débouchés. Le bon marché toujours croissant pousserait toujours nos produits plus loin vers les extrémités du globe. — À 1 shilling, tel article peut être envoyé en Allemagne; — réduisez-le à 8 d., et il ira en Italie ; diminuez-le jusqu’à 6 d., et il pénétrera en Turquie ; — à 4, il se montrera en Perse ; à 2, il pénétrera jusque dans les régions les plus éloignées de l’Asie centrale. (Bruyants applaudissements.) Mais comment le marchand pourrait-il étendre ses opérations, s’il ne lui était pas permis de rapporter chez nous, en échange de nos produits, les produits que les autres peuples ont à nous donner ? Le statute-book laisse nos négociants exploiter le monde entier, y chercher des objets de convenance et de luxe pour la classe riche ; mais il ne permet pas qu’ils rapportent cette denrée, qui, parmi toutes les autres, pourrait contribuer au bien-être et au bonheur des ouvriers et de leurs familles, et cependant c’est le rude travail de leurs mains calleuses qui paye ces superfluités qu’on tolère, comme il payerait les denrées utiles qu’on exclut. Les législateurs donnent un libre accès aux objets de luxe qui peuvent décorer leurs personnes et embellir leurs fastueux palais : mais pourquoi défendent-ils l’entrée du blé ? Pourquoi empêchent-ils la Russie, la Pologne, l’Amérique de nous fournir du blé ? Pourquoi ? Parce qu’ils sont marchands de blé ! Ils devraient inscrire sur la porte de leurs demeures ces mots : « Marchands de blé ; aucune concurrence n’est permise. » (Bruyantes acclamations.) — Je vous ai dit que les étourdis qui se laissent prendre à de pareilles jongleries, ne sont que des enfants, quel que soit leur âge, et en effet, ne faut-il pas être bien novice, que ce soit faute d’années ou faute d’intelligence, pour tomber dans des pièges aussi grossiers ? Les lois-céréales affectent également toute la communauté, et la taxe du pain coûte plus aux habitants de Londres qu’à tous ceux du Lancastre ; et n’est-ce point une véritable puérilité que de se laisser mettre sur une fausse quête, et d’aller chercher la cause du mal dans le Lancastre, sans regarder autour de nous et chez nous ? Mais enfin, admettons que les machines aient l’effet qu’on leur attribue ; — condamnons ces puissantes inventions, ces merveilleuses applications de la science, qui ont arraché l’espèce humaine à l’état sauvage, et qui ont fait, pour ainsi dire, le fer lui-même participant de la vie ; ne voyons dans ces merveilles que malédictions pour le pays ; élevons-nous contre la Divinité elle-même : reprochons-lui d’avoir soufflé dans l’esprit humain le désir et la faculté de s’élever dans le champ indéfini des découvertes ; accordons tout cela. Qu’en résultera-t-il ? Est-ce que les choses en iront mieux, parce qu’une taxe sur le pain viendra ajouter ses nuisibles effets aux nuisibles effets de ces machines maudites ? (Véhémentes acclamations.) Je le répète, il n’y a que l’enfance, l’enfance morale, qui puisse être dupe de ces clameurs contre les machines, puisque nos maux sont les mêmes, que les machines soient une malédiction, ou qu’elles soient un bienfait ; puisqu’ils pèsent également sur nous tous, soit que nous travaillions avec nos dents et nos ongles, soit que nous appelions à notre aide les forces des vents et de la vapeur, — et ce que je dis des machines, je le dis aussi de toutes autres clameurs élevées pour faire perdre de vue le grand fléau, la grande iniquité : — la rareté des aliments.
Quelques personnes parlent d’un changement dans la valeur des espèces métalliques. Nous ne nous y opposons pas ; mais ce dont souffre le pays, ce n’est pas la rareté du numéraire, c’est la rareté des aliments, et jamais nos efforts ne se ralentiront, jusqu’à ce que nous ayons renversé toutes les barrières qui nous en séparent. (Bruyantes acclamations.) J’appelle une lourde responsabilité, comme chrétien et comme citoyen, sur quiconque néglige de plaider l’abrogation de la loi-céréale. Je ne veux pas qu’on infère de mes paroles qu’il n’y a pas, selon moi, des hommes consciencieux parmi nos adversaires ; mais, dans l’état présent du pays, la neutralité n’a pas d’excuse. Une loi, parmi les Spartiates, condamnait à mort les citoyens qui ne prenaient pas parti dans les grandes questions d’intérêt public. Quoique la Ligue n’entende pas infliger à ceux qui restent neutres d’exclusion physique, il est une exclusion civile dont elle frappera les citoyens qui n’entrent pas dans ses rangs. Si les banquiers, les armateurs et les marchands de la cité de Londres ne trouvent pas de loisirs pour étudier cette grande question, qu’ils soient moralement déposés du rang qu’ils occupent dans l’opinion publique, qu’ils descendent dans l’estime de leurs concitoyens au niveau de leurs commis et de leurs portiers ; ils ne méritent pas d’être élevés sur un piédestal d’or pour être vénérés comme des idoles. Qu’ils soient jugés selon leur mérite. (Applaudissements.) Tout homme qui comprend la question doit sortir de l’inaction et s’efforcer de rallier ses semblables à la vérité, car ce n’est que par la force de l’opinion que cette grande réforme peut être résolue. Il n’est personne qui ne puisse beaucoup pour l’avancement de notre cause. Des hommes, dont les noms étaient jusqu’ici inconnus, ont rendu de grands services en propageant autour d’eux les doctrines de la liberté commerciale. Je citerai un membre de la Société des Amis, qui, depuis deux années, a mis à distribuer les pamphlets de la Ligue une prodigieuse activité. Il a parcouru à pied tout le pays, depuis le comté de Warwick jusqu’au Hampshire, et a disséminé partout les vérités et les lumières. Avec le secours de tels auxiliaires, il nous est bien permis d’entretenir l’espoir d’un triomphe prochain et définitif. Cet humble serviteur de notre œuvre n’a été dirigé que par la conscience d’accomplir envers ses frères un grand devoir de charité. (Bruyantes acclamations.) Voilà un homme qui ne verserait pas une goutte de sang, même pour défendre sa propre vie, qui a visité plus de vingt mille maisons, y a déposé le germe de la vérité et de la justice, et qui, pour cette grande cause, a supporté plus de fatigues et de travaux que ne fit jamais le duc de Wellington lui-même. (Nouvelles acclamations.) Et quand le monde saura apprécier la vraie moralité des actions, c’est à la mémoire de ce quaker obscur et modeste, plutôt qu’à celle de Wellington, qu’il dressera des statues. (Bravos.) Cet homme excellent, de même que beaucoup d’autres de ses frères en religion, s’est efforcé de propager les principes de la Ligue, non-seulement parce qu’il croit que la liberté commerciale fera descendre l’aisance et le bien-être dans la masse du peuple, mais encore parce qu’il la considère comme le seul moyen humain d’unir toutes les nations par les liens d’une paix durable, de faire cesser à jamais le fléau de la guerre et d’extirper du sein des nations cette force brutale qui, maintenue sous prétexte de les défendre, retombe sur elles d’un poids accablant, sous la forme de marine militaire et d’armée permanente, funestes et prodigieuses créations qui n’ont servi jusqu’ici qu’à élever par une route sanglante les Clives et les Wellington. (Acclamations prolongées.) Vous avez entendu dire, dans le dernier débat du Parlement, que le principe de la liberté des échanges, quoique vrai, ne s’adaptait pas aux circonstances actuelles. Un honorable membre a dit que c’était la vérité abstraite et sans application aux temps modernes. (Écoutez ! écoutez !) Quoi donc! Faut-il conclure de là que nos chambres législatives n’ont rien de commun avec la justice et la vérité ? La mission du Parlement est de faire justice ; et depuis quand la justice n’est-elle point applicable à la population de ce pays ? Voulez-vous savoir pourquoi la justice n’est pas applicable ? C’est que la plupart des membres de cette assemblée sont intéressés au maintien de l’injustice. Le chef des monopoleurs s’est levé dans la chambre et il a dit en propres termes au ministre de sa création : « Tu iras jusque-là, tu n’iras pas plus loin. » Que penser d’un premier ministre qui se soumettrait à une telle domination ? (Tonnerre d’applaudissements.) Pour moi, si je me complais dans la défense du grand principe de la liberté, c’est que, dans ma profonde conviction, il implique les plus chers intérêts de l’humanité ; il tend à unir de plus en plus les nations de la terre, à faire prévaloir la paix, la moralité, la sage administration ; à saper la domination des classes privilégiées. J’en appelle à mon pays, j’adjure tous nos concitoyens de se rallier à ce grand mouvement contre le monopole, s’ils veulent partager la douce satisfaction qui naît de l’accomplissement d’un devoir et de la conscience qu’on n’a point refusé aide et assistance à la cause de l’humanité. (Applaudissements.)
Au mois d’octobre 1843, la ville de Londres dut procéder à l’élection d’un membre de la Chambre des communes. Le candidat était M. Baring, chef de la première maison de banque d’Angleterre, frère de lord Ashburton, appuyé tout à la fois par l’aristocratie, la banque, le haut commerce, le monopole et le gouvernement. C’est dans ces circonstances que la Ligue voulut essayer ses forces et son influence. Elle suscita pour concurrent à M. Baring un de ses membres, M. Pattison. Un grand meeting tenu à Liverpool, le 4 octobre, prit à l’unanimité la résolution suivante : « Qu’une vacance ayant lieu dans la représentation de la cité de Londres, ce meeting remontrera sérieusement aux électeurs de la métropole qu’ils sont appelés à exercer leurs droits dans un moment décisif ; qu’il importe que la première cité commerciale du monde dise si elle entend soutenir un ami ou un ennemi de ce commerce qui est la base de sa grandeur ; que ce meeting fera un appel aux citoyens de Londres pour qu’ils accordent leurs suffrages à un avocat de l’abolition totale, immédiate et sans condition des lois-céréales, et de tous les monopoles, et pour qu’ils aident ainsi les amis de la liberté commerciale à faire consacrer le droit, pour tout Anglais, de disposer du fruit de son travail sur le marché du monde. »
Dès que cette résolution fut prise, la Ligue commença à agiter, comme elle a coutume de le faire dans toutes les circonstances importantes. Il n’entre pas dans notre sujet de consigner ici tous les épisodes de cette lutte. Les principaux traits s’en sont reproduits dans la séance tenue à Covent-Garden le 10 octobre, séance dont nous donnons un extrait. On sait d’ailleurs que la Ligue remporta un signalé triomphe par la nomination de M. Pattison.
GRAND MEETING À COVENT-GARDEN. Octobre 1843.↩
L’objet spécial de ce meeting explique l’affluence extraordinaire qu’il attire. Malgré qu’il ait été construit des galeries supplémentaires, la salle ne peut contenir la moitié des personnes qui se présentent.
À sept heures, M. Villiers, m. P., monte au fauteuil et prononce un discours fréquemment interrompu par les applaudissements.
M. Cobden … Le président vous a clairement expliqué l’objet de ce meeting. Nous ne cherchons pas à cacher que notre but est d’en appeler à vos suffrages, de réclamer votre concours électoral. À vrai dire, tous nos meetings ont un caractère électoral. Mais, dans cette circonstance, tous les électeurs de Londres ont été invités à assister à la séance… Nous sommes venus vous demander si vous voulez donner vos voix au monopole ou à la liberté. Par liberté, nous n’entendons pas l’abolition de tous droits de douane, ainsi que l’un de vos candidats, M. Baring, nous l’impute, sans doute par ignorance. Nous avons répété mille fois que nous n’aspirons point à arracher de la douane les agents de Sa Majesté, mais les agents que des classes particulières y ont introduits dans leur intérêt privé, et pour y percevoir des droits qui ne vont pas au trésor public. (Applaudissements.) Il y a quelque chose de si évidemment juste et honnête dans notre cause, que tout écrivain qui se recueille dans le silence du cabinet, et qui aspire à voir son œuvre survivre au terme d’une année, est d’accord avec nous en doctrine. Bien plus, nous avons assez vécu pour voir les hommes d’État
les plus pratiques, pendant qu’ils sont aux affaires, amenés par
la force de la logique et les lumières de leur siècle, à admettre la justesse de notre principe, quoiqu’ils condescendent bassement à gouverner par le principe opposé. Il y a plus encore ; vos candidats, aussi bien M. Baring que M. Pattison, se placent en théorie sur le même terrain. Il n’y a entre eux que cette différence : l’un promet d’être conséquent avec lui-même, et l’autre s’y refuse. (Bruyants applaudissements.) Eh bien ! nous venons demander si vous voulez choisir pour votre représentant un homme qui, reconnaissant la justice de la liberté en matière d’échanges, nous la refuse néanmoins. Le préférez-vous à un homme qui s’engage à mettre d’accord sa conduite et ses opinions ? — M. Baring admet que nos principes sont vrais, in abstracto ; cela veut dire que sa pratique sera fausse in abstracto. (Applaudissements.) Quoi ! avez-vous jamais ouï parler d’un père qui enseigne à ses enfants l’obéissance aux commandements de Dieu, in abstracto ? Avez-vous jamais entendu un accusé, après le verdict de condamnation, s’écrier : « J’ai volé ce mouchoir, mais c’est une abstraction. »
— Et le monopole est-il une abstraction ? S’il en est ainsi, je cède volontiers la place à M. Baring et à son élection. Mais c’est là une abstraction qui se montre sous la forme très-corporelle de certains monopoleurs, qui se permettent d’abstraire ou de soustraire la moitié de votre sucre et de votre pain. (Rires et applaudissements.) — Mais plaçons-nous un moment sur le terrain de nos adversaires et examinons leur raisonnement, quoiqu’à vrai dire ils se sont eux-mêmes interdit la faculté de raisonner en admettant que ce qui est vrai en principe est faux en conséquence. Sur quel fondement refusent-ils de mettre leur théorie en pratique ? « Si vous abandonnez le monopole, disent- ils d’abord, il vous sera impossible de prélever des taxes suffisantes. » Mais, si je comprends bien l’objection, elle signifie que nous serons hors d’état de payer à la reine des impôts pour la marine, l’armée, la magistrature, à moins que nous ne nous mettions sur le dos des taxes à peu près égales en faveur du duc de Buckingham, du duc de Richmond et compagnie. (Rires. — Écoutez ! écoutez !) L’objection signifie cela, ou elle ne signifie rien . C’est un pauvre compliment à faire à notre siècle que de lui attribuer la découverte de cet argument, car il n’était certes venu à l’esprit de personne quand on établit les monopoles. Mais voyons comment les monopoles favorisent les recettes publiques. En 1834, 35, 36 et 37, le prix du blé fut en moyenne à 45 sh. Il arriva que le chancelier de l’Echiquier eut des excédants de recettes, et put diminuer les impôts. En 1838, 39, 40 et 41, lorsque le monopole, s’il froissait le peuple, devait au moins, selon nos adversaires, favoriser le trésor, qu’est-il arrivé ? les recettes ont baissé ; et pendant que le blé était à 65 sh., nous avons entendu le premier ministre déclarer que la puissance contributive du peuple était épuisée, et qu’il ne lui restait d’autre ressource que de mettre un income-tax sur les classes moyennes. J’avoue que les faits et l’expérience me paraissent des guides plus sûrs, pour se faire une opinion, que l’autorité, et notamment l’autorité de M. Baring. — Venons au sucre. Que fait le sucre pour le trésor ? — quel est le prix du sucre à l’entrepôt? 21 sh. Que le payez-vous ? 41 sh.[1]. Vous payez donc un excédant de 20 sh. par quintal, sur 4 millions de quintaux. Il vaut la peine de lutter, n’est-ce pas ? (Applaudissements.) Et vous, boutiquiers, artisans, ouvriers, boulangers de Londres, que vous revient-il de ce monopole ? Le monopole ! oh ! c’est un personnage mystérieux qui s’assoit avec votre famille autour de la table à thé, et quand vous mettez un morceau de sucre dans votre coupe, il en prend vilement un autre dans le sucrier (rires et applaudissements) ; et lorsque votre femme et vos enfants réclament ce morceau de sucre qu’ils ont bien gagné et qu’ils croient leur appartenir, le mystérieux filou, le monopole, leur dit : je le prends pour votre protection. (Éclats de rire.) Et combien prend le trésor sur le sucre ? M. Mac-Grégor, secrétaire du Board of trade, dans l’enquête de 1840, affirme que si le droit protecteur était aboli, la consommation serait double, et le trésor gagnerait trois millions sterling. M. Mac-Grégor est encore secrétaire du Board of trade, position qu’il est certes bien digne d’occuper, et son témoignage est là qui nous condamne aux yeux du monde. Quel est donc le prétexte du monopole du sucre ? On ne peut pas dire qu’il est établi dans l’intérêt du trésor, ni dans celui des fermiers anglais, ni dans celui des nègres des Antilles ? Quel est donc le prétexte qu’on met en avant ? que nous ne devons pas acheter du sucre-esclave[2].
Je crois que l’ambassadeur du Brésil est ici présent, et sans le blesser, je puis lui faire jouer un rôle dans une petite scène avec le ministre du commerce. Son Excellence est admise à une audience avec toute la courtoisie due à son rang. Il présente ses lettres de créance, et annonce qu’il vient pour arranger un traité de commerce. Il me semble voir le ministre prendre une altitude recueillie, solennelle et religieuse[3] (rires) et dire : « Vous êtes du Brésil. Nous serions heureux de faire des échanges avec votre pays, mais nous ne pouvons, en conscience, recevoir des produits-esclaves. » Son Excellence entend bien les affaires (cela est assez ordinaire aux gens qui viennent du dehors pour traiter avec nous). (Écoutez ! écoutez !) « Eh bien, dit-elle, nous verrons à vous payer de quelque autre manière. Qu’avez-vous à nous vendre ? — Des étoffes de coton, dit le ministre, nous sommes en ce genre les plus grands pourvoyeurs du monde. — Du coton, s’écrie l’ambassadeur, et d’où le tirez-vous ? — Des États-Unis. — Et est-il produit par des esclaves ou par des hommes libres ? » Je vous laisse à penser la réponse et la contenance de notre président du Board of trade. (Applaudissements.) (Ici quelque confusion se manifeste dans la salle par suite de la chute d’un banc.) Ne vous effrayez pas, dit M. Cobden, c’est le présage et le symbole de la chute des monopoleurs. (Éclats de rire.) — Y en a-t-il quelques-uns parmi vous dont l’humanité et les sympathies se soient laissé prendre à ces clameurs contre le sucre-esclave ! Connaissez-vous la loi à cet égard ? Nous envoyons nos produits manufacturés au Brésil, par exemple ; nous les échangeons contre du sucre-esclave. Ce sucre, nous le raffinons dans des entrepôts, c’est-à-dire dans des magasins où les Anglais seuls ne peuvent pas acheter. De là, il est envoyé par nos marchands, par ces mêmes marchands qui déclament aujourd’hui contre le sucre-esclave, et envoyé en Russie, en Chine, en Turquie, en Égypte, en un mot, aux quatre coins de la terre. Il se distribue parmi cinq cents millions d’hommes, et vous seuls ne pouvez y toucher ; et pourquoi ? parce que vous êtes ce que ne sont pas les autres hommes, les esclaves de votre oligarchie. Oh ! hypocrites ! hypocrites !…
M. Baring a dit, à ce que m’apprennent les journaux du jour, que nous, hommes du Lancastre, nous n’avons rien à voir dans l’élection de Londres. Je voudrais bien savoir s’il se fait une loi qui n’oblige pas dans le Lancastre aussi bien que dans le Middlesex ? L’oligarchie du sucre se borne-t-elle à piller ses commettants ? — Au reste, celte prétention va bien aux monopoleurs. Il est assez naturel que les hommes qui prétendent isoler les nations, veuillent aussi isoler les provinces. Ils sont conséquents, et nous montrent jusqu’où ils portent leurs vues. (Applaudissements.)
Ici, M. Cobden dit qu’en parlant de l’opposition que certains négociants font à l’élection de M. Pattison, il n’entend pas prétendre que toute la classe des négociants est contraire à la liberté illimitée du commerce. Il cite l’opinion de MM. Rothschild, Samuel-Jones Lloyd et autres riches banquiers. Il continue ainsi :
De toutes parts on alarme, on stimule les propriétaires ; on les appelle à venir défendre les droits de la propriété qu’on accuse la Ligue de vouloir renverser, et je suis personnellement l’objet de ces vaines clameurs. J’ose dire que s’il est un homme en Angleterre qui plaide la cause de la propriété, cet homme, c’est moi. Et que fais-je autre chose depuis cinq ans ? à quoi sont consacrés tous les travaux de ma vie publique, si ce n’est à rendre leurs droits de propriété à ceux qui en ont été injustement dépouillés? (Véhémentes acclamations.) Comme il y a une espèce particulière de propriété, que M. Baring semble perdre entièrement de vue, je ne crois pas pouvoir mieux faire que de le renvoyer à Ad. Smith. Cet écrivain s’exprime ainsi : « La propriété du travail, étant le fondement de toutes les autres, est la plus sacrée et la plus inviolable. Le patrimoine du pauvre consiste dans la vigueur et la dextérité de ses bras. L’empêcher d’employer cette vigueur et cette dextérité, comme il l’entend, sans nuire à autrui, c’est une violation de la plus sacrée de toutes les propriétés ; c’est une usurpation manifeste des droits de l’ouvrier et de ceux qui pourraient l’occuper. » Fort de l’autorité d’Adam Smith, je dis que M. Baring et ceux qui l’appuient, en tant qu’ils soutiennent les monopoles, violent le droit de propriété dans la personne des ouvriers, et en agissant ainsi, je répète ici ce que je leur ai dit au dernier meeting, je les avertis qu’ils sapent les fondements mêmes de la propriété de quelque espèce qu’elle soit. (Applaudissements.)
Ici, l’orateur démontre par des faits nombreux que la prospérité de chaque industrie dépend de la prospérité de toutes les autres.
Il vient à parler ensuite de la corruption électorale. Nous traduirons un extrait de cette partie du discours de M. Cobden, pour montrer l’importance et la hardiesse des résolutions de la Ligue.
Notre adversaire, si l’on en croit le bruit public, a eu recours ailleurs à des pratiques que nous ne devons pas tolérer à Londres. Il faut que l’on sache ce qui se passa à Yarmouth en 1835. On me dira que tout se fit à l’insu du candidat. Mais alors cette question se présente naturellement : Qui dirigeait ces manœuvres ? (Écoutez ! écoutez !) C’est ma ferme conviction qu’aucun acte corrupteur n’a lieu sans que le candidat l’autorise et le paye… Je dis cela après avoir été candidat moi-même. Je n’ai jamais dépensé 10 l. s. sans savoir pourquoi, et je ne présume pas que d’autres avancent des 12,000 l. sans en recevoir la contre-valeur en suffrages. (Rires et approbation.) Je vois dans les journaux que vraisemblablement on aura recours aux mêmes manœuvres dans un quartier de Londres. Le corps électoral (constituency) de Londres est le plus honnête parce qu’il est le plus nombreux. Mais il y a un cancer rongeur à l’une des extrémités de la métropole. Je crois utile de prévenir les personnes qui pourraient se laisser envelopper dans ces intrigues, qu’elles courent aujourd’hui un danger plus grand que par le passé, en acceptant des présents, ou d’être défrayées de leurs dépenses. Que si l’on dit à un pauvre électeur : « Allez en avant ; tout s’arrangera quand le terme prescrit par la loi sera passé, » je le préviens qu’il n’y a pas de prescription pour la fraude. La Ligue, parmi les objets qu’elle a en vue, considère, comme un des plus importants, de vaincre la corruption électorale ; et elle est bien décidée à mettre en œuvre, dans la présente élection, le plan qu’elle a conçu pour atteindre ce but. C’est notre intention de poursuivre criminellement quiconque pourra être convaincu d’avoir offert, reçu, donné ou demandé un présent. De plus, l’intention de la Ligue est d’accorder une récompense de 100 l. s. à celui dont le témoignage aura amené la condamnation du coupable. Que l’électeur pauvre sache que s’il offre son suffrage pour une somme d’argent, ou si quelqu’un lui offre de l’argent pour sa voix, ce sont là deux actes criminels passibles d’une peine. Je conseille donc au pauvre électeur, si on lui offre de l’argent, de saisir le corrupteur au collet, de le livrer à l’officier de police et de le suivre devant le premier magistrat, veillant bien à ce que, dans le trajet, l’accusé ne se défasse d’aucun objet, ou ne détruise aucun papier. (Rires et applaudissements.) Je crois que nous parviendrons ainsi à prévenir la corruption dans la Cité. Je ne dis rien des pétitions contre l’élection frauduleuse, parce que nous entendons bien que M. Baring ne sera pas élu ; mais, élu ou non, tout homme que l’on pourra espérer de convaincre d’un acte corrupteur, sera poursuivi criminellement devant la Cour de justice. (Applaudissements.) Dans les cas ordinaires, la pénalité est d’un an de prison. — Nous préférerions de beaucoup poursuivre celui qui offre que celui qui reçoit un don corrupteur ; c’est pourquoi nous disons au pauvre électeur d’y aviser et de voir s’il ne vaut pas mieux, pour lui, gagner 100 l. s. honnêtement, que 30 sh. en vendant son suffrage. Il est surprenant que l’on ait fait lois sur lois contre la corruption, qu’on les ait entassées jusqu’à en faire la risée du peuple, sans qu’on se soit jamais avisé d’un moyen aussi simple de la déjouer. On raconte que le chancelier Thurlow, s’embarrassant au milieu des définitions techniques qu’il voulait donner de la corruption, comme les gens de sa profession ont coutume de le faire, un plaisant de la Chambre s’écria : « Ne prenez pas tant de peine ; il n’est aucun de nous qui ne sache fort bien ce que c’est. » (Éclats de rire.) — Voilà, Messieurs, ce que nous ferons pour en finir avec la corruption électorale. Nous ne nous adresserons pas au Parlement, nous ne lui demanderons pas de casser l’élection ; nous en appellerons directement à un jury de nos concitoyens. Y a-t-il quelqu’un qui puisse dire qu’il n’y a pas autant de pureté dans notre but que dans nos moyens ? Qu’on parle tant qu’on voudra de notre violence, du caractère révolutionnaire de nos procédés, nous ne nous sommes jamais écartés des voies légales et paisibles, etc.
L’orateur, après quelques autres considérations, termine au milieu des applaudissements.
M. Bright lui succède. Le caractère chaleureux de son éloquence a, comme toujours, le privilége d’exciter au plus haut degré l’enthousiasme de l’assemblée.
M. W. J. Fox : Dans le choix important que les électeurs de la cité de Londres vont être appelés à faire sous peu de jours, il est remarquable que le plus solide argument, en faveur d’un des candidats, a été fourni par l’autre. « Si l’on me demandait, a dit M. Baring, vendredi dernier, dans son exposition de principes aux électeurs : Reconnaissez-vous abstractivement la justice de la doctrine de la liberté en matière d’échanges ? je répondrais : Oui. Si l’on me demandait : Désirez-vous voir le commerce dégagé de toutes les entraves qui le restreignent ? je répondrais : Oui. » Voilà les principes proclamés par M. Baring, voilà ses vœux avoués. Ce sont précisément les principes que M. Pattison s’engage à faire pénétrer dans la pratique ; ce sont précisément les vœux que sa carrière parlementaire aurait pour objet de transformer en réalités. (Applaudissements.) Pourquoi donc M. Baring ne se trouve-t-il pas parmi les partisans de M. Pattison ? (Rires et applaudissements.) Pourquoi n’agit-il pas dans le sens de ses propres désirs ? Pourquoi repousse-t-il l’aplication de ses propres principes ? Est-ce lâcheté ? est-ce hypocrisie ? Est-il de ceux qui mettent toujours un « je n’ose » après un « je voudrais ; » ou bien qui jettent en avant des phrases sonores pour leurrer les simples et les débonnaires ? Étale-t-il le principe pour capter vos votes, et l’exception pour réserver le sien ? (Applaudissements.)
C’est la vulgaire stratégie des sophistes, quand ils s’élèvent directement contre un grand principe, de lui rendre en paroles un hommage révérencieux, et d’envelopper le principe antagonique sous la forme d’une exception, et c’est là la stratégie qui est l’âme de tout le discours de M. Baring. Il adhère d’abord largement et clairement au principe de la liberté des échanges ; mais ensuite tout le discours est calculé de manière à montrer comment et pourquoi ce principe ne doit pas être appliqué, comment et pourquoi il faut transiger dans l’intérêt d’une classe, d’un parti, du trésor, de la défense nationale, ou sous prétexte d’humanité envers les noirs. Mais la chose qu’il plaide, et qu’il nomme protection, tandis que le vrai nom est monopole, n’est pas une exception au principe de la liberté, c’est un autre principe antagonique à celui-là. Ce qu’il nomme protection, c’est ce qui élève le prix des subsistances. Protection signifie ce qui diminue la capacité d’acheter. Protection signifie ce qui arrache à l’honnête ouvrier une part de son juste salaire. Protection désigne toutes les formes variées du monopole, et, entre autres choses en ce moment, le fardeau de l’income-tax. (Applaudissements.) Et à qui entend-il accorder protection ? Voyez ses votes, il protége les établissements ecclésiastiques dans leur orgueil et leur splendeur, mais il ne protège pas le pauvre dissident contre la saisie de son lit et de sa Bible, pour parfaire la taxe de l’Église. Il protége le riche électeur qui peut se présenter au Poll, sûr de ne souffrir ni dans ses moyens pécuniaires, ni dans sa position sociale, mais il ne protége pas celui que la dureté des temps a arriéré d’un terme dans le paiement des taxes, et qui aurait besoin de la protection du scrutin contre les menaces et les persécutions des puissants du jour. (Applaudissements.) En un mot, sa protection est acquise aux riches, mais non aux pauvres ; au petit nombre des oppresseurs, mais non aux multitudes opprimées et mises au pillage. (Applaudissements.) J’essaierai, si vous le permettez, de poursuivre, dans cette argumentation, la série des exceptions qu’il oppose à son propre principe. Il dit : « Les principes de la liberté du commerce doivent être modifiés par les besoins de la défense nationale, par les nécessités du trésor, par l’intérêt de quelques classes et par les exigences de l’humanité et de la philanthropie. » D’où il suit que ces principes de liberté auxquels il fait profession d’adhérer, il les croit en même temps en collision avec la sûreté du pays, avec ses ressources, avec quelques-unes de ses classes les plus importantes, et enfin avec les devoirs de la charité, — étrange manière de recommander un principe… Je crains bien que son but, sous prétexte de la défense nationale, ne soit de favoriser quelques intérêts monopoleurs. Il cite Adam Smith, pour prouver que l’acte de navigation fut un des meilleurs règlements commerciaux de l’Angleterre. Mais il ne cite qu’une partie de l’opinion de ce grand homme, et ce n’est certainement pas celle qui a le mieux résisté à l’épreuve de l’examen et de l’expérience, car la loi dont parle Adam Smith n’est pas celle qui nous régit. L’intervention et les représailles de l’Amérique et de la Prusse nous forcèrent à la modifier profondément ; les hommes d’État que M. Baring fait profession de révérer l’ont jugée inexécutable, l’ont effacée du statute-book, et M. Peel lui-même, à ce que je crois, a contribué à la réduire à ses minimes dimensions actuelles. Si M. Baring eût cité le passage entier, la portée de l’argument eût été toute différente, et il me semble que c’est manquer de probité logique que d’omettre ce membre de phrase. « L’acte de navigation n’est pas favorable au commerce extérieur, ni au développement de la richesse qui en provient. L’intérêt d’une nation, dans ses relations commerciales, comme l’intérêt du marchand dans ses transactions, est d’acheter au prix le plus bas et de vendre au prix le plus haut possible. En diminuant le nombre de nos vendeurs, nous diminuons nécessairement le nombre de nos acheteurs, et nous nous plaçons dans cette position, non-seulement d’acheter les produits étrangers plus cher, mais encore de vendre les nôtres à meilleur marché que si l’échange eût été libre. » — Après tout, que gagne la défense nationale à cette première exception au principe, en faveur de la navigation ? La marine marchande d’Angleterre doit-elle sa supériorité au monopole ? La cherté artificielle du bois de construction nous donne-t-elle de plus grands et de plus solides vaisseaux ? La cherté artificielle des subsistances nous met-elle à même de les mieux approvisionner, et la liberté empêcherait-elle qu’il n’y eût des marins sur nos rivages ? Qu’a donc fait l’acte de navigation pour notre puissance maritime, si ce n’est d’engendrer cette loi violente, opprobre de notre civilisation, la presse des matelots ? La défense nationale en est réduite à ce qu’on peut arracher dans les rangs de l’industrie, par la pratique de la presse des matelots» (Applaudissements.) Nous n’avions pas besoin de l’intervention de cet usage odieux pour repousser les agressions du dehors, et un moyen beaucoup plus sûr de pourvoir, en tout temps et en toutes circonstances, à notre sûreté, c’eût été de laisser au peuple quelque chose à défendre de plus qu’il ne possède en ce moment. (Bruyantes acclamations.) Il ne se battra pas pour défendre la taxe du pain ; il ne se battra pas pour servir l’oligarchie qui le foule aux pieds; il ne se battra pas pour maintenir des institutions qui favorisent le riche, mais qui écrasent le pauvre. Dans l’extension, la vaste et rapide extension d’affaires qui naîtrait de l’abolition de toutes les entraves commerciales, nous trouverions une défense plus sûre que celle des armes : la dépendance réciproque des peuples, et par là leur mutuelle bienveillance. Cela est plus sûr que l’acte de navigation et la loi sur la presse des matelots. La réponse d’un vieux maître de boxe trouve ici son application. Quelle est, lui demandait un jeune homme querelleur, quelle est la meilleure pose défensive ? — La meilleure pose de défense, répondit le vétéran, c’est de n’avoir jamais dans votre bouche qu’une langue prudente et honnête. (Rires.) Le commerce travaillant sans cesse à entrelacer et égaliser les intérêts, les besoins et les jouissances des peuples, le progrès vers cette unité de sentiment et d’esprit, qui naît d’une communication universelle, d’un perpétuel échange de produits, de capitaux, d’énergies et d’idées, voilà pour la sûreté des nations des garanties plus solides que les armées, les marines, l’esprit de lutte et de jalousie. Et si Burke a pu dire que l’honneur était pour les nations le plus économique des moyens de défense, nous pouvons le dire à plus forte raison du commerce. Ce n’est pas seulement une défense économique, c’est une défense qui tend à abolir la pauvreté, à distribuer dans les masses des satisfactions et du bien-être. La seconde exception que fait M. Baring au principe de la liberté est fondée sur les intérêts du revenu public. Elle dénote une ignorance grossière qui a été souvent exposée dans cette enceinte. On vous a dit et répété bien souvent que cette agitation n’a rien à démêler avec les taxes qui ont pour but, qui ont honnêtement et prudemment pour but le revenu public, mais bien avec les taxes qui sont imposées au peuple pour satisfaire la rapacité de quelques classes particulières. Ses exemples me semblent d’ailleurs mal choisis. Il a dit qu’avec la liberté du commerce il serait impossible de taxer le tabac à 1.000 pour cent, et le thé à 300 pour cent. Une telle impossibilité le fait frissonner, et il y trouve une raison suffisante de modifier son principe (écoutez ! écoutez !) ; car ne s’ensuivrait-il pas cet horrible événement, que vous ne payeriez plus quatre guinées pour un sou valant de tabac, et que vous auriez pour six sous le thé qui vous coûte aujourd’hui 2 sh. ? Voilà un dénouement, un état de choses qui ne saurait être enduré, et il vient vous demander de l’envoyer au Parlement, pour s’opposer à ce que ses propres principes ne réalisent de si terribles résultats. (Rires.) — Arrivant ensuite à la troisième exception à son principe tirée des intérêts particuliers, M. Baring, candidat de la grande cité commerciale de Londres, — désigne cette classe qu’il s’agit de favoriser. Et quelle classe pensez-vous qu’il en a vue ? les négociants de cette métropole ? ses marchands, ses ouvriers ? C’est la classe agricole dont il signale les intérêts particuliers, comme étant de ceux devant qui les principes de la liberté doivent courber la tête et passer outre, reconnaissant qu’ils sont sans aucune application en cette matière. Mais ce n’est là qu’un des traits de cette disposition que montre en toutes circonstances le candidat dont je commente les prétentions parlementaires. L’esprit des Ashburton vit en lui. Si vous l’envoyez au Parlement, il aura le pied sur le premier degré de cette échelle de Jacob, qui s’élève au-dessus des barons et des chevaliers, et le portera un jour au troisième ciel parmi les pairs du royaume. (Rires.) Dans sa première adresse, il exalte des services qu’il rendrait, comme membre de la Chambre des communes, aux intérêts commerciaux, « qui ont dans ce pays, dit-il, une importance nationale. » Il en parle comme d’une chose qui a assez grandi pour mériter son patronage, une chose à laquelle on peut tendre une main condescendante, tandis que, citoyen de Londres, il n’en devrait parler qu’avec fierté. Il ne comprend pas cette virile indépendance, cette noble franchise que l’industrie a soufflée dans l’esprit de l’homme, et qui valut naguère à un monarque de ce royaume cette fière réponse. Dans un moment d’humeur, il menaçait de s’éloigner avec sa cour, comme si la destruction de la cité avait dû s’ensuivre. « J’espère, lui dit respectueusement un citoyen, qu’il plaira à Sa Majesté de laisser la Tamise derrière elle. » (Rires.) Mais cette cité a nourri des hommes qui connaissent leurs droits et qui les maintiendront…
L’orateur, avec une force de logique et une vigueur d’éloquence qui nous fait regretter d’être forcé d’abréger ce discours, discute ici les opinions de M. Baring, et le poursuit à travers ses nombreuses contradictions. Nous nous bornerons à citer quelques extraits, où il combat des sophismes qui ont aussi bien cours de ce côté que de l’autre côté de la Manche.
… « Nous produisons » (dit M. Baring, et c’est un de ses arguments pour maintenir le monopole des aliments) ; « j’ose dire que, grâce à nos machines, les manufacturiers de ce pays disposent d’une puissance de production capable de répondre à tous les besoins des contrées qui pourraient nous fournir du blé. » S’il en est ainsi, ce doit être en effet une puissance merveilleuse que celle qui peut accroître indéfiniment la production, sans exiger plus de travail humain. Je n’ai jamais ouï parler de machines, quelque ingénieuses qu’elles soient, qui se passent de la direction de l’homme, et qui, ayant produit jusqu’ici des résultats déterminés avec un travail humain déterminé, soient en état de doubler ces résultats sans réclamer l’intervention d’un travail additionnel. Mais admettons ce phénomène. Quel en est le remède ? Tant qu’il y aura des besoins à satisfaire, et que cette puissance de production sera le moyen d’atteindre ce but, on serait tenté de la considérer comme le don le plus précieux du ciel. — Mais admettant qu’elle soit funeste, quel en est le remède ? L’arrêter, l’anéantir. Nous avons un excédant de pouvoir producteur qu’il ne faut pas mettre en exercice. N’est-ce point un singulier état de choses qu’une immense puissance de production, que la création de choses utiles doivent être réprimées et forcées à l’inertie ? Eh quoi ! si nous voulions suivre les conséquences logiques de cette doctrine, à quelles absurdités ne nous conduirait-elle pas ? Elle nous induirait à remplacer une machine puissante par une machine moins puissante, et pourquoi pas diminuer aussi la puissance de la machine humaine qui met en œuvre toutes les autres ? Si les hommes travaillent trop, s’ils ont le pouvoir d’acheter du pain au dehors et l’audace de réclamer ce droit, eh bien, diminuez cette puissance, coupez-leur les bras et qu’ils ne travaillent désormais que dans des limites raisonnables qui satisfassent le système protecteur. Je m’imagine que nous serions quelque peu surpris si un voyageur nous racontait que, dans ses pérégrinations, il a vu un pays où tous les ouvriers avaient subi l’amputation de deux doigts, et notre étonnement ne diminuerait pas sans doute si un homme politique, — un représentant de cette métropole, ou qui aspire à l’être, disait : Je devine que ces hommes s’étaient rendus coupables de surproduction. (Rires.) Ils travaillaient tant avec leurs cinq doigts infatigables que cela ne pouvait plus se tolérer. Le pays ne produisait pas assez de blé pour les satisfaire, et la production du blé devant être protégée, les propriétaires ont jugé à propos de couper les doigts aux ouvriers, en sorte que ce peuple tridigite nous offre le plus bel exemple de la sagesse du régime protecteur, et combien il est beau d’exclure les principes abstraits de la législation commerciale. (Applaudissements.)
L’orateur dit que M. Baring se contredit encore en manifestant sa préférence pour le droit fixe tout en s’engageant à soutenir l’échelle mobile.
… Ainsi, dit-il, son opinion est pour le droit fixe, et sa volonté pour l’échelle mobile. Son opinion contredit sa volonté, et toutes deux violent le principe de la liberté, auquel M. Baring fait profession d’adhérer aussi. — Et voilà l’homme que soutiennent ceux qui mettaient naguère toute leur énergie à renverser l’administration whig parce qu’elle avait osé proposer un droit fixe !
Je passe à sa quatrième exception, fondée sur les exigences de ses sentiments philanthropiques. Je comprends qu’un homme hésite quand il sent qu’il y a contradiction entre les principes et les sentiments d’humanité, bien qu’une telle contradiction soit certainement une chose étrange. Mais ici quel est le prétexte de cet étalage de charité ? On veut que le sucre consommé dans ce pays soit pur de la tache de l’esclavage. M. Baring a tant de sympathie pour les noirs qu’il exclut de l’Angleterre le sucre-esclave, tandis qu’il souffre très-bien que ces mêmes noirs adoucissent leur grog avec du sucre-esclave, venu du Brésil en Angleterre pour y être raffiné et en être réexporté. (Écoutez écoutez !) Singulière philanthropie, vraiment ! Oh ! ce ne sont pas les noirs, ce sont les planteurs qui vous préoccupent. Vous ne trouvez pas leurs profits satisfaisants. Le noir n’a que faire d’une sympathie de cette nature. Il ne regrette pas le fouet et la canne à sucre. Sa condition actuelle lui convient. Eh quoi ! ne se plaint-on pas déjà de ce qu’il devient trop riche ? de ce que sa femme porte des robes de soie, de ce que lui-même figure dans son cabriolet comme un homme « respectable, » et de ce qu’il marchande aujourd’hui la propriété qu’il bêchait autrefois ?… Et voilà sous quel vain prétexte on maintient un système qui restreint la consommation du sucre dans ce pays, à tel point que, malgré la population toujours croissante, elle est aujourd’hui ce qu’elle était il y a vingt ans, au détriment des jouissances et du bien-être des classes pauvres ! Non, non, à travers toutes ces exceptions, règne un même esprit, un même principe. Déchirez le masque, et vous trouverez derrière la hideuse et dégoûtante figure du monopole. — Monopole de la navigation, monopole du blé, monopole du sucre, les voilà, se couvrant du manteau de la défense nationale, du revenu public, de l’humanité, mais au fond ne signifiant qu’une seule et même chose, la spoliation de la multitude laborieuse par le petit nombre. Et c’est pour maintenir un tel système qu’on nous invite à sacrifier nos principes, comme M. Baring méprise les siens. C’est pour maintenir ces anomalies, ces absurdités, cette oppression et ces abus que nous abandonnerions l’homme qui veut mettre de l’accord entre ses opinions et ses actes, pour nommer celui qui déclare publiquement que sa conduite politique ne sera qu’une perpétuelle exception, bien plus, une flagrante violation des principes que lui-même reconnaît fondés sur la justice et la vérité ? Gentlemen, je ne suis pas un de ces hommes qui ont leurs foyers dans le Lancastre, ce qui, dans certains lieux, semble être une fâcheuse recommandation. Mais j’aimerais mieux être du Lancastre et avoir fait à mes compatriotes de Londres ce noble appel que leur adressent les citoyens de Liverpool, que d’être de Londres, et d’émettre, au mépris de cet appel, un vote favorable au monopole et funeste à mes frères. Eh ! qu’importe d’où viennent ceux qui vous adjurent de nommer M. Pattison ? J’augurerais mal de Londres, si je pouvais croire qu’on y sera arrêté par cette frivole objection. Londres s’est-il tellement rétréci et rapetissé qu’il n’y ait pas place, qu’il n’y ait pas droit de bourgeoisie pour quiconque porte un cœur dévoué et travaille avec ardeur au triomphe de la justice ? La patrie de ces hommes du Lancastre est partout où prévaut l’amour du bien et du vrai. En quelque lieu que la science pénètre, en quelque lieu que parviennent leurs innombrables écrits, partout où leurs discours ont éclairé les intelligences et passionné les cœurs, c’est là qu’est la Ligue. Partout où un infatigable travail est privé de sa juste rémunération, partout où dans nos populeuses cités l’ouvrier n’a qu’une insuffisante nourriture à distribuer à sa famille, partout où, dans nos campagnes, le laboureur ne peut donner à sa femme et à ses enfants des habits décents qui leur permettent la fréquentation de l’église, c’est là qu’est la Ligue, pour relever l’abattement par l’espérance et inspirer à l’affliction la confiance en des jouis meilleurs. Partout où, dans des contrées lointaines, la fertilité du sol est frappée d’inertie, partout où la terre est condamnée à une stérilité artificielle, parce que le monopole s’interpose entre les libres et volontaires échanges des hommes, c’est là qu’est la Ligue, promettant au moissonneur de plus abondantes récoltes et au vigneron de plus riches vendanges. Et partout aussi où se livrera cette grande lutte sur le terrain électoral, partout où le génie du monopole opposera ses derniers et convulsifs efforts au génie de la liberté, c’est là que la Ligue plantera sa tente pour stimuler les forts et encourager les faibles, saluer le candidat dévoué aux intérêts sociaux, et montrer que ce pays a encore une longue carrière de gloire à parcourir. (Applaudissements.) Et j’espère bien que le résultat de cette élection sera de montrer au monde que partout où il y a une représentation qui tient en mains les destinées d’un grand empire, c’est là que sera aussi l’esprit de la Ligue pour témoigner que la justice, — non point la justice abstraite, mais la justice réelle envers toutes les classes, depuis la plus élevée jusqu’à la plus infime, — que la justice, dis-je, est le guide le plus sûr de la législation, comme elle est la source la plus abondante de la prospérité nationale. (Applaudissements prolongés.)
FN: Non compris le droit fiscal de 24 sh.
FN: Slave-grown sugar, free-grown sugar. Il faudrait traduire sucre produit par les esclaves, ou par les hommes libres. Pour abréger, je me suis permis ces néologismes : Sucre-esclave, sucre-libre.
FN: Ce ministre était M. Gladstone, que l’on sait être sorti depuis des affaires pour des scrupules religieux.
L’AGITATION EN ÉCOSSE↩
[Note by FB]
Nous croyons devoir donner ici un compte rendu succinct des travaux de la Ligue en Écosse, du 8 au 18 janvier 1844.
Rien ne nous semble plus propre à donner une idée de la puissance de l’association, de la vie politique qu’elle fait circuler dans le corps social, et de son influence sur la diffusion des lumières. Comment ne pas admirer l’activité prodigieuse, le dévouement infatigable des Cobden, des Bright, des Thompson ? Et quel est le but de tant d’efforts ? propager, vulgariser un grand principe.
Nous aurions pu choisir toute autre semaine de l’année : elle nous aurait montré la même énergie. On devinera aisément pourquoi nous avons préféré suivre la Ligue en Écosse. — Il existe en France un préjugé contre les économistes anglais. On y est imbu de l’idée que s’ils proclament le principe de la liberté commerciale, s’ils paraissent même travailler à la réaliser dans la pratique, tout cela n’est que ruse, hypocrisie, machiavélisme. On répète contre l’agitation commerciale ce qu’on a dit contre l’agitation abolitionniste. Ce sont des démonstrations, dit-on, qui cachent un but secret et funeste aux intérêts des nations. Le caractère écossais est beaucoup moins impopulaire, et c’est le motif pour lequel j’ai, de préférence, rendu compte de l’agitation en Écosse. On sera peut-être bien aise de voir comment sont accueillis les principes de la liberté du commerce, sur cette terre loyale, parmi ce peuple éclairé, qui a le premier entendu la grande voix d’Adam Smith.
CARLISLE. Extrait du Carlisle Journal, 8 janvier 1844.
Lundi soir, 8 janvier, il y a eu un thé à la salle de l’Athénée. L’objet de cette réunion était de recevoir une députation du conseil de la Ligue, et d’activer la souscription nationale (the League fund of l. s. 100,000).
Le meeting a commencé à 6 heures, sous la présidence de M. Joseph Fergusson. Vers 8 heures, M. John Bright, m. P., est entré dans la salle et a été reçu par des applaudissements enthousiastes. On remarquait dans cette réunion les principaux négociants et manufacturiers de la cité, et un grand nombre de dames.
Le président, après avoir exposé l’objet de la réunion, donne la parole à M. Bright.
M. Bright s’exprime avec sa vigueur et son éloquence accoutumée. Le cadre que nous nous sommes imposé ne nous permet pas de donner ici ce remarquable discours.
M. Pierre Dixon soumet au meeting la résolution suivante :
« Le meeting exprime son inaltérable confiance en la Ligue, et s’engage à l’aider de tous ses efforts dans sa grande lutte pour la liberté commerciale. »
Nous remarquons dans le discours de M. Dixon le passage suivant :
« J’ai été grandement désappointé par le bill de réforme électorale qui a tant agité ce pays. Nous avons eu un Parlement réformé, et qu’a-t-il fait ? Au lieu de veiller aux intérêts des masses, les représentants n’ont paru s’occuper que de leurs propres intérêts. Qu’a fait lord Grey, si ce n’est procurer des places à ses cousins ? (Rires ; écoutez !) Nous lui devons sans doute le bill de réforme, mais en en a fait un mauvais usage, et cette mesure m’a, je le répète, extrêmement désappointé. Mais pendant que le Parlement oublie les souffrances du peuple, la Ligue s’est levée pure de tout esprit de parti. C’est l’esprit de parti qui ruine le pays, et nous venons d’entendre les membres de la Ligue déclarer leur ferme détermination d’en finir avec toutes ces questions de factions et de personnes. Le bon sens et la vérité prévaudront. À eux appartient l’empire du monde. Je sens une profonde reconnaissance envers ces hommes qui sacrifient généreusement leur temps et leur tranquillité à l’avancement de notre cause. À peine M. Bright a-t-il vu ses foyers depuis un an. Nous ne saurions trop honorer de tels services, puisqu’ils sont au-dessus de nos forces. »
Plusieurs autres orateurs se font entendre. — À la fin de la séance, on procède à la souscription. Elle s’élève à 403 l. s. — Nous remarquons sur la liste M. Marshal, m. P., pour 40 l. s.
GLASGOW. banquet pour le soutien des principes de la liberté commerciale. Extrait du Glasgow-Argus, 10 janvier 1844.
Cette grande et imposante démonstration, en faveur de la liberté commerciale, et spécialement du rappel des lois-céréales, a eu lieu mercredi soir, 10 de ce mois, dans la salle de la Cité (City hall). Ainsi que nous l’avions prévu, jamais l’ouest de l’Écosse n’avait vu une semblable manifestation de l’opinion publique ; jamais, à Glasgow, réunion n’avait présenté de tels caractères de distinction, d’ordre, de lumières et d’énergie. La vaste salle contenait plus de deux mille personnes, cent cinquante dames occupaient la galerie de l’ouest.
Le fauteuil était tenu par l’honorable lord prévôt.
Nous avons remarqué sur l’estrade MM. Fox Maule, m. P., James Oswald, m. P., le col. Thompson, le Rév. M. Moore, John Bright, m. P., Arch. Hastie, m. P., le prévôt Bain, et une foule d’autres personnages.
Lecture est faite des lettres d’excuses adressées par MM. Dunfermline, m. P., lord Kinnaird, m. P., Villiers, m. P., Stewart, m. P., Georges Duncan, m. P.
Ces honorables représentants ont été empêchés, malgré leur désir, d’assister au banquet de Glasgow, soit parce qu’ils sont appelés à d’autres meetings, qui ont pour objet la même cause, soit pour d’autres motifs.
Sur la demande du lord prévôt, le doct. Wardlaw, dans une belle et touchante prière, appelle sur l’assemblée la bénédiction divine.
Le lord prévôt est accueilli par des applaudissements enthousiastes, lorsqu’il se lève pour proposer le premier toast.
« Messieurs, dit-il, c’est avec une profonde satisfaction que j’occupe le fauteuil dans cette circonstance. Il y a longtemps que les principes de la liberté commerciale ont prévalu parmi les citoyens de Glasgow et beaucoup d’entre eux, vers la fin du dernier siècle, soutinrent avec zèle les saines doctrines si admirablement exposées et développées par l’immortel Adam Smith, lorsqu’il occupait une des chaires de notre Université. (Applaudissements.) Je suis heureux de voir qu’aujourd’hui les négociants et les manufacturiers si éclairés de cette cité prennent un intérêt toujours croissant à cette grande cause qui embrasse toutes les autres, savoir : l’abolition de tous les monopoles, — et rien ne peut m’être plus agréable que de remplir mon devoir de premier magistrat de la cité, en prêtant aide et assistance, quand l’occasion s’en présente, à ces réformes qui ont pour objet le bien-être des classes ouvrières et la prospérité de cette métropole commerciale de l’Écosse. »
Après quelques observations, le lord prévôt conclut en ces termes :
« Je vous invite à vous joindre à moi pour rendre hommage à notre gracieuse souveraine. La vie de son père, ses propres sentiments ne nous laissent aucun doute que nous avons en elle une amie éclairée de toute mesure qui tend au bien-être, à la prospérité et au bonheur du peuple. À la reine ! » (Applaudissements prolongés. Toute l’assemblée se lève et reste debout pendant que l’orchestre exécute l’hymne national.)
M. Fox Maule, représentant de Perth, — après quelques réflexions, porte le second toast :
« À la liberté des échanges ! Messieurs, je ne m’étendrai pas sur ces grands principes qui, s’ils vivent quelque part, doivent vivre surtout dans cette cité qui, la première, entendit les leçons d’Adam Smith. Ils pénètrent de jour en jour, et avec tant de force dans les esprits, qu’il serait inutile et pour ainsi dire déplacé, de les développer devant vous. Je considère que le but de cette réunion est d’examiner en commun les idées pratiques qui pourront nous être soumises sur le mode à la fois le plus prompt, le plus efficace et le plus sûr de faire enfin pénétrer ces principes dans notre gouvernement et notre législature. Vous admettez, je crois, que le vieux système des protections spéciales, alors même qu’on pourrait lui attribuer quelques effets momentanément favorables, n’est pas la base sur laquelle doivent reposer les grands intérêts permanents de ce pays. Le monopole est une plante qu’on peut à la rigueur élever en serre chaude, mais qui ne saurait enfoncer profondément ses racines dans notre sol, et exposer ses branches à tous les vents de notre climat. Nous sommes des hommes libres. Pourquoi n’aurions-nous pas un commerce libre ? (Bruyants applaudissements.) La raison dit que ce système est le meilleur, le plus propre à répandre le bien-être parmi les hommes, qui met toutes les denrées du monde à notre portée et laisse refluer les produits de notre travail sur tous les points de la terre. »
L’orateur traite la question dans ses rapports avec l’agriculture ; il témoigne toute son admiration pour les utiles efforts de la Ligue, et termine en portant ce toast :
« À la liberté du commerce ; à la chute du monopole qui est le fléau du pays et du peuple. » (Applaudissements enthousiastes.)
Le lord prévôt porte la santé de la députation do la Ligue. M. Cobden remercie et prononce un discours qui fait sur l’assemblée une profonde impression.
M. Alexandre Graham : « Aux ministres àe la religion qui se sont réunis à la cause de la liberté du commerce. Dans le cours de ces dernières années, deux appels ont été faits au clergé. La première fois, sept cents ministres dissidents de toutes les dénominations se sont réunis à Manchester, et plus de neuf cents, dans leurs lettres d’excuse, ont donné leur approbation à l’objet de la Ligue. La seconde réunion de plus de deux cents ministres, eut lieu à Edimbourg. »
L’orateur, dans un discours que nous supprimons à regret, examine les causes qui tiennent le clergé de l’Église établie éloigné de ce grand mouvement. — Il traite ensuite la question de la liberté commerciale, au point de vue religieux.
Le Rév. doct. Heugh : « Au progrès des connaissances, nécessaire et seule garantie de l’extension et de la permanence des institutions libres. » (Immenses applaudissements. Ce magnifique texte fait le sujet d’un discours du rév. ministre, qui est écouté avec recueillement.)
D’autres discours sont prononcés par MM. Bright, Thompson, Oswald, Hastie. La souscription de Glasgow, au fonds de la Ligue, paraît devoir s’élever à plus de 3,000 l. s. (125,000 fr.)
L’assemblée se sépare à 8 heures du soir.
GRAND MEETING D’ÉDIMBOURG POUR LE SOUTIEN DE LA LIGUE. Extrait du Scotchman, 11 janvier 1844.
Mardi, 11 de ce mois, un grand meeting a eu lieu dans cette cité, pour recevoir la députation de la Ligue, composée de MM. Cobden, Bright, le col. Thompson et Moore. — L’objet spécial de la réunion était de concourir à la souscription au fonds de la Ligue (the 100,000 l. League fund). La salle de la Société philharmonique, la plus vaste d’Édimbourg, était entièrement occupée, et, faute de places, plus de mille billets d’entrée ont dû être refusés.
On remarquait dans l’assemblée les citoyens les plus éclairés et les plus influents, un grand nombre de dames et trente-quatre ministres du culte. Le très-honorable lord prévôt occupait le fauteuil. Les villes de Leith, Dalkeith, Musselburgh avaient envoyé des députations.
Nous ne fatiguerons pas le lecteur par la traduction des discours prononcés dans cette mémorable séance. Nous nous bornerons à reproduire un passage du discours de M. Cobden, parce qu’il répond à un argument que l’on oppose souvent à l’affranchissement du commerce, aussi bien de ce côté que de l’autre côté de la Manche.
« Tout le monde, ou du moins toutes les personnes dont l’opinion a quelque poids, s’accordent sur ce point, que le principe de la liberté des échanges est le principe du sens commun, et que, considéré d’une manière abstraite, il est aussi juste qu’incontestable. (Assentiment.) Mais lorsque vous sommez ces personnes de réaliser dans la pratique des principes dont, en théorie, elles reconnaissent si volontiers la justice et la vérité, on vous objecte que les circonstances du pays s’y opposent. Quelles sont ces circonstances ? D’abord, nous dit-on, par l’ancienneté de la protection, le pays se trouve dans une situation économique tout artificielle. À cela je réponds que si nous sommes dans une situation artificielle, c’est que nous y avons été amenés par des lois arbitraires contraires aux lois de la nature. Nous ne pouvons remédier à ce mal qu’en revenant aux lois naturelles et en mettant notre législation en harmonie avec les desseins visibles de la divine Providence. — Ensuite, on allègue que la dette publique et l’Echiquier imposent à l’Angleterre de lourdes charges, » etc.
PERTH. Extrait du Perthshire-Advertiser, 12 janvier 1844.
Selon l’avis qui en avait été donné, un grand meeting public a eu lieu mercredi, 12 de ce mois, dans une des églises de cette ville (North-United secession church), pour entendre MM. Cobden, Thompson et Moore, députés de la Ligue nationale. Plus de deux mille personnes étaient présentes, presque toutes appartenant aux classes moyennes, et l’on a remarqué l’attention soutenue que les fermiers et les agriculteurs, venus de tous les points du comté, ont prêtée aux discours qui ont occupé une séance de plus de quatre heures.
M. Maule, m. P., occupait le fauteuil.
Nous ne pouvons rapporter ici les discours prononcés par MM. Maule, Cobden, lord Kinnaird, M’Kinloch, Moore, etc. — Cependant, comme les arguments qu’on fait valoir en faveur du monopole, sous le nom de protection, sont les mêmes en France qu’en Angleterre, nous croyons devoir citer de courts extraits du discours de M. Cobden, où quelques-uns de ces arguments sont heureusement réfutés.
« Les fermiers et les ouvriers de campagne ont plus souffert que tous autres des lois-céréales, et, à cet égard, j’invoque le témoignage de ceux d’entre eux qui m’écoutent. Depuis 1815, époque où passa cette loi, la Chambre des communes ne s’est pas réunie moins de six fois en comité pour s’enquérir de la détresse agricole, et, depuis 1837, elle a été solennellement proclamée cinq fois dans le discours de la reine à l’ouverture du Parlement. J’ai parcouru le pays dans tous les sens ; j’ai assisté à une multitude de meetings ; partout j’ai posé aux fermiers cette question : « Avez-vous, dans un certain nombre d’années, et avec un capital donné, réalisé autant de profits que les personnes engagées dans des industries qui ne reçoivent pas de protection, tels que les drapiers, carrossiers, épiciers, » etc. — Partout, invariablement, on m’a fait la même réponse: « Non, l’industrie agricole est la moins rémunérée. » Si le fait est incontestable, il doit avoir une cause, et comme ce ne peut être l’absence de la protection, c’est sans doute la protection elle-même. Pour moi, je crois qu’il est mauvais de taxer l’industrie ; il n’y a qu’une chose qui soit pire, c’est de la protéger. (Applaudissements.) Montrez-moi une industrie protégée, et je vous montrerai une industrie qui languit. Si l’on accordait, par exemple, des priviléges aux épiciers qui habitent tel quartier, pensez-vous que les propriétaires des maisons n’en exigeraient pas de plus forts loyers ? Ils le feraient indubitablement ; et c’est ce qu’ont fait les landlords, à l’égard des fermiers, sous le manteau de la loi-céréale. Un pauvre fermier gallois, nommé John Jonnes, a parfaitement expliqué le jeu de cette loi. Il disait: « La loi a promis aux fermiers des prix parlementaires. Sur cette promesse, les fermiers ont promis aux seigneurs des rentes parlementaires. Mais à la halle, le prix parlementaire ne s’est presque jamais réalisé, et il n’en a pas moins fallu acquitter la rente parlementaire. » Toute la question-céréale est là.
« Pour persuader aux fermiers qu’ils ne peuvent soutenir la concurrence étrangère, on leur dit qu’ils ont de lourdes taxes à payer, et cela est vrai. Ils payent la taxe des routes, mais ils ont les routes, et je puis vous assurer que les fermiers russes et polonais voudraient bien en avoir au même prix. Essayez de porter vos denrées au marché, par monts et par vaux et à dos de mulet, et vous vous convaincrez que l’argent mis sur les chemins n’est pas perdu, mais placé, et placé à bon intérêt. — Ils payent encore la taxe des pauvres et les taxes ecclésiastiques ; mais il y a aussi des prêtres et des pauvres sur le continent. »
M. Cobden cite plusieurs exemples pour démontrer que les industries libres prospèrent mieux que les industries protégées.
« Voyez la laine ; c’est un fait notoire que c’est, depuis qu’elle n’est plus favorisée, une branche beaucoup plus lucrative que la culture du froment. — Voyez le lin. Pendant que M. Warnes se donnait beaucoup de mouvement, dépensait beaucoup d’encre et de paroles pour prouver que le fermier anglais ne pouvait soutenir la concurrence du dehors, lui-même substituait, et avec succès, la culture du lin, qui n’est pas protégée, à celle du froment, qui est l’objet de tant de prédilections législatives…
« Quant aux avantages que la loi-céréale est censée conférer aux simples ouvriers des campagnes, j’avance ce fait, et je défie qui que ce soit de le contredire : c’est que les salaires vont toujours diminuant à mesure qu’on s’éloigne des districts manufacturiers et qu’on s’enfonce au cœur des districts agricoles. En arrivant dans le Dorsetshire, le plus agricole et par conséquent le plus protégé de tous les comtés, on trouve le taux des salaires fixé à 6 sh. par semaine. Pour moi, je donne 12 sh. au moindre de mes ouvriers. J’en ai qui gagnent 20, 30 et même 35 sh. Mais quant à ceux qui ne donnent que le travail le plus brut, qui ne font que ce que tout homme peut faire, ils reçoivent au moins 12 sh. — Je n’en tire pas vanité. Ce n’est ni par plaisir ni par philanthropie que j’accorde ce taux ; je le fais parce que c’est le taux établi par la libre concurrence. Voilà un fait général qui ne permet plus de dire que la loi-céréale favorise l’ouvrier des campagnes. (Écoutez ! écoutez !) — Mais j’aperçois ici bon nombre d’ouvriers des fabriques. Quant à eux, il est certain que la loi-céréale les dépouille, sans aucune compensation, et j’expliquerai comment cela se fait, il y aune certaine doctrine à l’usage des ignorants imberbes, selon laquelle les salaires peuvent être fixés par acte du Parlement. Je mettrai en lumière et cette doctrine et le caractère de la loi-céréale, par une anecdote qui se rapporte à un fait parlementaire qui m’est personnel. Lorsque sir Robert Peel présenta la dernière loi-céréale à la Chambre des communes, loi qui avait pour but avoué de maintenir le prix du blé à 56 sh., ainsi que l’auteur le déclare expressément, je fis, par voie d’amendement, cette motion : Qu’il est expédient, avant de fixer le prix du pain par acte du Parlement, de rechercher les moyens de fixer aussi un taux relatif des salaires qui soit en harmonie avec ce prix artificiel des aliments. » Proposition bien raisonnable, à ce qu’il me paraît, mais qui fut combattue par MM. Peel, Gladstone et leurs collègues, au dedans et au dehors des Chambres, par cette réponse : « Oh ! nous ne pouvons régler ou fixer le prix du travail, cela est au-dessus de notre puissance. Le taux des salaires s’établit par la concurrence sur le marché du monde. » — Néanmoins, quoique je reconnusse la validité de ce raisonnement, comme je le crois aussi bien applicable au blé qu’au travail, et que je n’aime pas à voir des règles différentes appliquées à des cas intrinsèquement identiques, j’insistai pour que ma motion fût mise aux voix ; et elle fut soutenue par vingt ou trente membres qui pensaient, comme moi, que le taux des salaires devait être positivement fixé, si l’on était décidé à dépouiller l’ouvrier, par un prix des aliments artificiellement élevé. Mais, ainsi que je m’y attendais, les monopoleurs de la Chambre refusèrent de faire une franche et loyale application de leur propre principe, et tous, jusqu’au dernier, votèrent contre ma motion. — Sans doute, il est incontestable que le régulateur naturel des salaires, c’est le marché, la concurrence, le rapport de l’offre à la demande. Mais n’est-il pas évident que le blé doit être soumis à la même règle, et valoir plus ou moins, selon les besoins d’une part et la faculté de payer de l’autre ? Qu’on laisse donc le prix du blé s’établir dans le même marché où le travail est contraint de chercher sa rémunération. Oh ! qui pourrait sonder la profonde immoralité de ces hommes qui s’adjugent à eux-mêmes un certain prix pour leur blé, et qui néanmoins refusent de fixer un prix proportionnel pour les salaires qui doivent acheter ce blé ? » (Applaudissements prolongés.)
GREENOCK. Extrait du Greenock-Advertiser, 15 janvier 1844.
Lundi, 15 de ce mois, une députation de la Ligue, composée de M. Bright, m. P., et du col. Thompson, a assisté à un grand meeting tenu à la chapelle de…
Le prévôt occupait le fauteuil.
Des discours ont été prononcés par MM. Steete, Stewart, m. P., col. Thompson, Bright, Robert Wallace, m. P.
Nous avons remarqué, dans le discours du colonel Thompson, la démonstration suivante, qui présente, sous une forme sensible, les inconvénients des lois restrictives.
« Suivons vos marchandises sur les marchés étrangers, et observons ce qui arrive. Je suppose que vous les envoyez à Hambourg. Le capitaine débarque, et, s’adressant à un négociant de cette ville, il lui dit : « J’amène de Greenock tant de balles de marchandises que je désire vendre. — Bien, dit le marchand, je vous en donnerai dix thalers. — J’accepte, répond le capitaine ; et maintenant que pourrais-je acheter avec dix thalers, car je désire revenir à Greenock avec un chargement de retour ? — Je trouve, dit le Hambourgeois, que le blé est à meilleur marché ici qu’en Angleterre ; achetez du blé. — Oh ! répond le capitaine, je ne puis pas rapporter du blé, car nous avons dans notre pays une loi qui le défend. — Eh bien ! prenez du bois de construction. — Nous avons encore une loi qui l’empêche. — Dieu me pardonne ! s’écrie le Hambourgeois, je crois que, vous autres Anglais, vous repoussez les choses qui vous sont les plus nécessaires, et n’admettez que ce qui ne vous est bon à rien, des sifflets et des cure-dents, peut-être. (Éclats de rire.) — Je crains bien qu’il n’en soit ainsi, reprend l’Anglais, et je vois que ce que j’ai de mieux à faire, c’est de m’en retourner sur lest et de ne plus remettre les pieds à Hambourg. » — C’est ainsi que prennent fin nos relations avec Hambourg, et successivement avec les autres ports étrangers. — Et ne voyez-vous pas que le chargeur de Greenock sera forcé de limiter sa fabrication plus qu’il n’aurait fait, si son capitaine lui eût porté de meilleures nouvelles ? Que si la fabrication se ralentit, le travail est moins demandé, les salaires sont plus dépréciés, en même temps que les subsistances renchérissent ? » etc…
ABERDEEN. Extrait de l’Aberdeen-Herald, 15 janvier 1844.
La démonstration en faveur de la Ligue a dépassé tout ce que l’on pouvait attendre. Lundi, 15 de ce mois, deux meetings ont été tenus, l’un le matin, l’autre le soir, et, dans l’un et l’autre, l’accueil le plus enthousiaste a été fait à MM. Cobden et Moore. Le meeting du matin a eu lieu dans la vaste salle du théâtre, qui s’est trouvée cependant trop étroite pour le grand nombre de citoyens distingués qui désiraient assister à la séance. Rien n’égale l’intérêt qu’a excité le discours clair et nerveux de M. Cobden, et nous avons pu remarquer que des hommes, qui prennent rarement part à des démonstrations publiques, joignaient chaleureusement leurs applaudissements à ceux de la foule.
Le soir, les classes ouvrières et laborieuses affluaient à la salle de la Société de Tempérance, et nous avons entendu dire à M. Cobden qu’il n’avait jamais parlé devant un auditoire plus attentif et plus intelligent.
Nous avons assisté à bien des meetings publics, nous avons entendu tous les grands orateurs de l’époque, mais nous devons dire que jamais nous n’avons assisté à un spectacle plus imposant et plus instructif que celui qui a été offert aujourd’hui à la population d’Aberdeen. (Suit le compte rendu de la séance.)
DUNDEE. 16 janvier 1844.
Mardi soir, 16 du courant, une soirée a été donnée, dans le cirque royal, à MM. Cobden et Moore, députés de la Ligue nationale. M. Edouard Baxter, esquire, occupait le fauteuil.
Les orateurs qui se sont fait entendre, outre MM. Cobden et Moore, sont MM. Baxter, James Brow, lord Kinnaird, Georges Duncan, m. P., etc.
PAISLEY. Extrait du Glasgow-Argus, 16 janvier 1844.
Mardi soir, 16 de ce mois, une soirée a eu lieu, dans une des églises dissidentes de Paisley (secession church), à l’effet d’accueillir MM. Thompson et Bright, membres de la Ligue, et sous la présidence du prévôt Henderson. Nous avons remarqué sur l’estrade MM. Stewart, Wallace et Hastie, membres du Parlement, et un grand nombre de ministres du culte.
Nous croyons devoir nous dispenser de donner en détail le compte rendu de ce meeting, ainsi que de ceux qui suivent, pour éviter de dépasser les bornes que nous nous sommes prescrites.
AYR. Extrait de l’Ayr-Advertiser.
Mardi matin, 16 de ce mois, un grand meeting public a été tenu au théâtre de cette ville, sous la présidence du prévôt Miller pour entendre MM. Bright et Thompson, membres de la Ligue.
MONTROSE. Extrait du Montrose-Review, 16 janvier 1844.
MM. Cobden et Moore, de passage dans cette ville, pour se rendre d’Aberdeen à Dundee, ont été sollicités de s’arrêter quelques heures dans l’objet de tenir un meeting public. Malgré la brièveté du temps qu’avaient devant eux les amis de la liberté commerciale, une telle affluence s’est portée à Guild-Hall, à l’heure désignée, que le meeting a dû immédiatement se transporter à George Free Church. Le prévôt Paton a été unanimement appelé au fauteuil.
Après un discours de M. Cobden, qui a fait sur l’assemblée une profonde impression, M. Alexandre Watson fait cette motion :
« Que le meeting approuve hautement les infatigables travaux de la Ligue, et en particulier les virils et nobles efforts de MM. Cobden et Moore, pour propager les principes de la liberté commerciale ; et que, pour offrir aux citoyens de Montrose l’occasion de contribuer au fonds de la Ligue, il nomme, à l’effet de recueillir les souscriptions, une commission composée de MM. etc. »
La motion est votée à l’unanimité.
FORFAR.
Le même journal rend compte du meeting tenu à Forfar, le samedi 10 janvier, à l’occasion de la présence en cette ville, de MM. Cobden et Moore. Les honorables députés de la Ligue n’ont pas eu plutôt accédé aux vives instances qui leur étaient adressées pour qu’ils s’arrêtassent un moment à Forfar, que toute la population a été convoquée à l’église de la paroisse au son du tambour. Les fonctions de président étaient remplies par le Rév. ministre, M. Lowe, etc.
KILMARNOCK.
Ln grand meeting a été tenu dans celte ville, le mardi 16 janvier 1844, à l’effet d’entendre M. Bright et le colonel Thompson, membres de la Ligue.
CUPAR. Extrait du Fife-Sentinel, 18 janvier 1844.
L’annonce de la visite d’une députation de la Ligue avait excité au plus haut degré l’intérêt du comté. Des délégations de toutes les villes environnantes s’étaient rendues à Cupar. — MM. Cobden et Moore sont arrivés le 18, à 2 heures. Le meeting avait été convoqué à l’église de Westport ; mais cet édifice étant insuffisant à contenir la foule qui se pressait, il a été décidé qu’on se transporterait dans Old-Church.
Le prévôt Nicol occupait le fauteuil.
LEITH. Extrait du Caledonian-Mercury, 19 janvier 1844.
Un meeting nombreux a été tenu, vendredi soir 19 du courant, dans Relief-Church. MM. Cobden, Thompson, Moore, ont été écoutés avec l’intérêt le plus manifeste et la plus vive sympathie, etc.
DUMFRIES. Extrait du Dumfries-Courrier, 17 janvier 1844.
Ce journal rend compte du meeting tenu le mercredi 17 janvier, à l’occasion de la visite de MM. Bright et Thompson ; il présente le même caractère que les précédents.
Si nous avons donné au lecteur cette nomenclature aride des nombreux meetings que la députation de la Ligue a provoqués en Écosse, pendant un séjour de si courte durée, c’est que nous sommes nous-même convaincu qu’en France, comme en Angleterre, comme dans tous les pays constitutionnels, le seul moyen d’emporter une grande question, c’est d’éclairer et de passionner le public. Notre but a été d’appeler l’attention sur l’activité et l’énergie que déploie la Ligue, et dont les premiers résultats se montrent aujourd’hui aux yeux de l’Europe étonnée dans le plan financier de sir Robert Peel.
GRAND MEETING DE COVENT-GARDEN. 25 janvier 1844.↩
Après une interruption de deux mois, la Ligue a repris ses meetings au théâtre de Covent-Garden. Jeudi soir, la foule avait envahi le vaste édifice. Dans aucune des précédentes occasions elle n’avait montré plus de sympathie et d’enthousiasme.
À 7 heures, le président, M. George Wilson, monte au fauteuil. Il ouvre la séance par le rapport des travaux de la Ligue, dont nous extrayons quelques passages.
« Ladies et gentlemen : Je ne doute pas que la première question que vous m’adresserez au moment de la reprise de nos séances, ne soit : « Qu’a fait la Ligue depuis la dernière session ? » D’abord, je n’ai pas besoin de vous dire qu’elle n est pas morte, ainsi que ses ennemis l’ont tant de fois répété. Il est vrai que le duc de Buckingham ne s’y est pas encore rallié ; le duc de Richmond ne nous a pas signifié son approbation ; sir Edward Knatchbull compte toujours sur le monopole pour payer des dots et des hypothèques, et le colonel Sibthorp a gratifié de 50 l. s, l’association protectionniste. (Rires.) Mais d’un autre côté, le marquis de Westminster a donné 500 l. s. à la Ligue. (Applaudissements.) Que nous ayons fait quelques progrès, c’est ce que nos adversaires pourront nier, et ce dont vous jugerez vous-mêmes d’après les meetings qui ont eu lieu et dont je vais vous faire l’énumération. »
Ici le président nomme les villes où ont été tenus les meetings et les sommes qui y ont été souscrites.
3392. Liverpool, 3393. 3394. 6,000 l. s. 3395.
3397. Ashton, 3398. 3399. 4,300 3400.
3402. Leeds, 3403. 3404. 2,700 ; la maison Marshall a souscrit pour 800 l. s. 3405.
3407. Halifax, 3408. 3409. 2,000 3410.
3412. Huddersfield, 3413. 3414. 2,000 3415.
3417. Bradford, 3418. 3419. 2,000 3420.
3422. Bacup, 3423. 3424. 1,345 3425.
3427. Bolton, 3428. 3429. 1,205 3430.
3432. Leicester, 3433. 3434. 800 3435.
3437. Derby, 3438. 3439. 1,200 ; la maison Strutt adonné 500 l. s. 3440.
3442. Notthingham, 3443. 3444. 520 3445.
3447. Burnley, 3448. 3449. 1,000 3450.
3452. Oldham, 3453. 3454. 1,000 3455.
3457. Todmorden, 3458. 3459. 611 3460.
3462. Strond, 3463. 3464. 558 3465.
(M. Wilson cite encore une douzaine de meetings où des sommes moindres ont été recueillies.)
« En outre, une députation de la Ligue, composée de MM. Cobden, Bright, Thompson, Moore, Ashworth a parcouru l’Écosse. Nous avons reçu :
3469. Glasgow, 3470. 3471. 3,000 l. s. 3472.
3474. Edimbourg, 3475. 3476. 1,500 3477.
3479. Dundee, 3480. 3481. 500 3482.
3484. Leith, 3485. 3486. 350 3487.
3489. Paisley, 3490. 3491. 230 3492.
3494. Hawick, 3495. 3496. 70 3497.
(De bruyants applaudissements accompagnent cette lecture.) Tel est le témoignage que nous avons à rendre des progrès que fait notre cause dans l’esprit public. C’est un nouveau gage d’union, un nouveau pacte, un nouveau covenant auquel les amis de la Ligue en Écosse et dans le nord de l’Angleterre ont attaché leur nom, s’engageant tous envers eux-mêmes, envers vous et envers le pays, à persévérer dans la voie qu’ils se sont tracée, et à ne prendre aucun repos tant qu’ils se sentiront un reste de force et que la Ligue n’aura pas atteint le but qu’elle a en vue… »
M. Bouverie prononce un discours instructif sur la situation financière de l’Angleterre et sur la répartition des taxes entre les diverses classes de la société.
M. W. J. Fox s’avance au bruit des applaudissements ; quand le silence est rétabli, il s’exprime en ces termes :
« Je suis appelé à prendre la parole à l’entrée de cette nouvelle année d’agitation, dans un moment où la confusion, l’anxiété et l’incertitude règnent dans le pays. La législature est convoquée ; le peuple attend plutôt qu’il n’espère ; la Ligue a recruté des adhérents, augmenté ses moyens et discipliné ses forces ; les partis politiques épient les chances de se maintenir dans leur position ou de conquérir celle de leurs adversaires ; des anti-Ligues se forment dans plusieurs comtés. Dans ces circonstances, il est à propos d’établir le principe autour duquel se rallie notre association, ce principe que nous avons tant de fois, mais pas encore assez proclamé ; ce principe qui est l’objet et le but d’efforts et de travaux qui ne cesseront qu’au jour de son triomphe : — la liberté absolue des échanges, — et, en ce qui concerne sa réalisation pratique et actuelle, — l’abrogation immédiate, totale et sans condition[1] de la loi-céréale ! (Bruyants applaudissements.) Voilà notre étoile polaire ; voilà le point unique vers lequel nous naviguons, sans nous préoccuper d’aucune autre considération. Nous n’avons rien de commun avec les factions politiques ; nous n’avons aucun égard aux démarcations qui séparent les partis de vieille ou de fraîche date ; peu nous importent les inconséquences de tel ou tel meneur d’une portion de la Chambre des communes. — L’abrogation totale, immédiate, sans condition des lois-céréales, voilà ce que nous demandons, tout ce que nous demandons. — Nous n’exigeons pas plus, nous n’accepterons pas moins — de Robert Peel ou de John Russell, — de lord Melbourne d’un côté, ou de lord Wellington de l’autre, ou de lord Brougham de tous les côtés. (Rires et approbation.) Nous sommes en paix avec tous ceux qui reconnaissent ce principe. Mais nous ferons une guerre éternelle à ceux qui ne l’accordent pas. — Et précisément parce que c’est un principe, il n’admet, dans nos esprits, aucune transaction quelconque. (Applaudissements.) C’est là notre mot d’ordre. Il y a une classe dans le pays qui ne cesse de crier : « Pas de concessions. » Et nous, nous lui répondons: « Pas de transaction. » Si ce mouvement, ainsi qu’on l’a quelquefois faussement représenté, n’était qu’une pure combinaison industrielle ; s’il avait pour objet de relever telle ou telle branche de fabrication ou de commerce ; — ou bien s’il était l’effort d’un parti et s’il aspirait à déplacer le pouvoir au détriment d’une classe et au profit d’une autre classe d’hommes politiques ; ou encore si notre cri : Liberté d’échanges, n’était qu’un de ces cris populaires, mis en avant dans des vues personnelles ou politiques, comme le cri ; À bas le papisme ! et autres semblables, qui ont si souvent égaré la multitude et jeté la confusion dans le pays, oh ! alors, nous pourrions transiger. Mais nous soutenons un principe à l’égard duquel notre conviction est faite, et qui est comme la substance de notre conscience ; nous revendiquons pour l’homme un droit antérieur même à toute civilisation, car s’il est un droit qu’on puisse appeler naturel, c’est certainement celui qui appartient à tout homme d’échanger le produit de son honnête travail, contre ce qu’il juge le plus utile à sa subsistance ou à son bien-être. (Approbation.) Ce n’est pas là une question qui admette des degrés, ni qui se puisse arranger par des fractions. Nous respectons tous les droits ; mais nous ne respectons aucun abus. (Applaudissements.) Nous ne comprenons pas cette doctrine qui consiste à tolérer un certain degré de vol, d’iniquité ou d’oppression, au préjudice d’un individu ou de la communauté. Nous considérons au point de vue du juste et de l’injuste propriété, quelle qu’elle soit, réalisée par le travail et sanctionnée par les lois et les institutions humaines. Nous proclamons notre profond respect pour la propriété de cette classe qui est la plus ardente à s’opposer à nos réclamations. Les domaines du seigneur lui appartiennent, nous ne prétendons pas y toucher, mettre des limites à leur agglomération et à leur division. Nous n’intervenons pas dans l’administration de ce qui lui est acquis par achat ou par héritage. Qu’il en fasse ce qu’il jugera à propos : il est justiciable de l’opinion s’il viole les lois des convenances ou de la moralité. Tant qu’il se renferme dans les limites que lui prescrivent les nécessités des sociétés humaines, nous respectons tous ses droits. Qu’il proscrive ou tolère la chasse ; qu’il abatte ou conserve ses forêts ; qu’il accorde ou refuse des baux, nous ne nous en mêlons pas. Les produits de ses domaines sont à lui ou à ceux à qui il les loue. Mais il y a une chose qui n’est pas à lui, et c’est le travail d’autrui, c’est l’industrie de ses frères, et leur habileté, et leur persévérance, et leurs os et leurs muscles, et nous ne lui reconnaissons pas le droit de diminuer, par des taxes à son profit, le pain qui est le fruit de leurs travaux et de leurs sueurs. (Bruyantes acclamations.) Ils sont ses frères, et non pas ses esclaves. Les bras de l’ouvrier sont sa propriété, et non pas celle du landlord. Nous réclamons pour nous ce que nous accordons aux seigneurs, et notre principe exige le même respect, la même vénération pour la propriété de celui qui n’a au monde que sa force physique pour se procurer le pain du soif par le travail du jour, que pour celle de l’héritier du plus vaste domaine dont on puisse s’enorgueillir dans la Grande-Bretagne. (Applaudissements.) Dans notre attachement à ce principe, nous nous opposons à tout empiétement sur la propriété de la classe industrieuse, de quelque forme qu’on le revête, quel que soit le but auquel on veuille le faire servir. Notre principe exclut le droit fixe aussi bien que le droit graduel. (Approbation.) L’un est aussi bien que l’autre une invasion sur les droits du peuple, car quelle est leur commune tendance ? Évidemment d’élever le prix des aliments, et tout ce qui élève le prix des aliments, diminue le légitime bien-être des classes laborieuses. Lorsque nous nous rappelons la condition de ces classes ; quand nous venons à songer que l’ouvrier se lève avant le jour, et qu’il est déjà bien tard quand il peut goûter quelque repos et manger le pain de l’anxiété ; quand nous nous rappelons par quels fatigants efforts il obtient dans ce monde sa chétive pitance, et combien il y a de malheureuses créatures autour de nous dont toute l’histoire est résumée dans ces tristes vers si populaires :
Travaillons, travaillons, travaillons
Jusqu’à ce que nos yeux soient rouges et obscurcis ;
Travaillons, travaillons, travaillons
Jusqu’à ce que le vertige nous monte au cerveau.
« Quand nous sommes témoins d’une telle destinée, nous disons que le droit fixe ne doit pas prendre même un farthing sur la part exiguë du pauvre pour augmenter les trésors d’un duc de Buckingham ou de Richmond. (Applaudissements prolongés.) Bien plus, il est des cas où le droit fixe aurait plus d’inconvénients que l’échelle mobile elle-même. On a déjà fait cette objection contre le droit fixe, et je crois qu’elle a déjà frappé ses partisans. « Que ferez-vous de votre droit de 10, de 8, de 5 sh. lorsque le blé s’élèvera, comme cela peut et doit quelquefois arriver, à un prix de famine, a famine price ? (Écoutez ! écoutez !) Et l’on a répondu : « Alors, on le suspendra. » — Mais quel est le pouvoir qui décidera cette suspension, et sur quelle épreuve ? Réalisez dans votre imagination la situation d’un premier ministre obligé d’observer le pays pour décider si le temps approche, si le temps est arrivé où le droit fixe sur le blé sera remis, parce que les aliments ont atteint le prix de famine ! Il faudra qu’il compte dans les journaux combien d’êtres humains ont été relevés dans nos rues, tombés par défaut de nourriture. Combien faudra-t-il de cas de morts par inanition ? quelle somme de maladies, de typhus, de mortalité sera-t-il nécessaire de constater pour justifier la remise du droit ? Voilà donc les occupations d’un premier ministre ! Il faudra donc qu’il veille auprès du pays, qu’il compte ses pulsations, comme fait le médecin d’un régiment quand on flagelle un soldat. — la main sur son poignet, l’œil sur la blessure saignante, l’oreille attentive au bruit du fouet tombant sur les épaules nues, prêt à s’écrier : Arrêtez ; il se meurt ! (Acclamations.) Est-ce là le rôle du premier ministre du gouvernement d’un peuple libre ? (Non, non.) — La pente est glissante quand on quitte le sentier de la justice. Oubliez la justice, et vous oublierez bientôt la charité, et l’humanité vous trouvera sourde à ses cris. — Un droit fixe ! Mais c’est toujours la protection sous un autre nom, et la protection, c’est cela même que la Ligue est résolue de combattre et d’anéantir à jamais. — Et qu’entend-on protéger ? L’agriculture, dit-on ; mais quelle branche d’agriculture ? quelle classe de personnes ? Non, non, dépouillée de sophismes, d’énigmes, de circonlocutions, cette protection, c’est la protection des rentes, et rien de plus. (Approbation.) Protection aux fermiers ! — Et quel fermier s’est jamais enrichi par elle ? — Protection à l’ouvrier des campagnes ! Oh ! oui ! vous l’avez protégé jusqu’à ce qu’il ait descendu tous les degrés de l’échelle sociale ; jusqu’à ce que ses vêtements aient été convertis en haillons ; sa chaumière en une hutte ; jusqu’à ce que sa femme et ses enfants, faute de vêtements, aient été forcés de fuir le service divin. Votre protection l’a poursuivi du champ à la maison de travail, et de la maison de travail à la cour de justice, et de la cour de justice au cachot, et du cachot à la tombe. C’est sous la froide pierre qu’il trouvera enfin plus de protection réelle qu’il n’en obtint jamais de vos lois. (Acclamations prolongées)
« Et pourquoi privilégier une classe ? Qu’y a-t-il dans la condition d’un rentier qui lui donne droit à être protégé aux dépens de la communauté ? Pourquoi pas protéger aussi le philosophe, l’artiste, le poëte ? À pareil jour naquit un poëte, et les Écossais qui m’entendent savent à qui je fais allusion, car beaucoup de leurs compatriotes sont réunis aujourd’hui pour célébrer l’anniversaire de Robert Burns. La nature en avait fait un poëte ; la protection aristocratique en fit un employé. Mais la seule protection qui lui convint, c’est celle qu’il devait à ses bras vigoureux et à son âme élevée. Le servilisme lui faisait dire :
Je n’ai pas besoin de me courber si bas,
Car, grâce à Dieu, j’ai la force de labourer ;
Et quand cette force viendra à me faire défaut,
Alors, grâce à Dieu, je pourrai mendier.
« Et il se sentait l’indépendance du mendiant, et, en réalité, elle est plus digne et plus respectable que l’indépendance pécuniaire de ceux qui l’ont acquise par la rapine et l’oppression.
… « Et pourquoi la Ligue transigerait-elle aujourd’hui ? Si elle n’y a pas songé quand elle était faible, comment y songerait-elle quand elle est forte ? Si nous avons repoussé toute transaction quand nous n’étions qu’un petit nombre, pourquoi l’accepterions-nous quand nous sommes innombrables ? Habitants de Londres, permettez-moi de vous le dire, vous n’avez pas l’idée de la puissance de la Ligue, et il serait à désirer que vous envoyassiez dans les comtés du Nord une députation chargée d’observer la nature de cette puissance, sa progression, son intensité. (Écoutez ! écoutez !) Là, vous verriez les multitudes, hommes, femmes, enfants, accourir, s’assembler et mettre la main à cette œuvre si bien faite pour éveiller les plus intimes sympathies du cœur humain ; les maîtres et les ouvriers porter leur cordiale contribution ; les femmes payer leur tribut, car elles ont compris qu’il leur appartient de soulager ceux qui souffrent, et de sympathiser avec les opprimés, et l’enfant même, respirer comme une atmosphère d’agitation patriotique, pressentant qu’un jour viendra, — alors que tant de glorieux dévouements auront assuré le triomphe de la liberté commerciale, — où il pourra dire avec orgueil : — « Et moi aussi j’étais, encore enfant, un soldat de la Ligue ! » Oh ! si vous pouviez voir l’ardeur qui les anime, vous comprendriez que l’arrêt de mort du monopole est prononcé ; oui, le jour où Londres prendra le rôle qui lui revient, le jour où la voix des provinces réveillera l’écho de la métropole, le jour où votre libéralité, votre enthousiasme, votre ferme résolution, votre foi dans la vérité égalera la libéralité, l’enthousiasme, la détermination et la foi de vos frères du Nord, ce jour-là, l’œuvre sera consommée et le monopole anéanti. (Acclamations prolongées.) L’idée de transiger n’entrerait pas dans la tête des chefs de la Ligue, alors même qu’ils seraient seuls dans la lutte. Rappelez-vous qu’ils n’étaient que sept quand ils proclamèrent pour la première fois le principe de l’abrogation immédiate et totale. Ils persévéreraient encore, quand bien même l’opinion publique n’aurait pas été éveillée, quand bien même ces vastes meetings n’auraient pas encouragé leurs efforts, car, lorsqu’une fois un principe s’empare de l’âme, il est indomptable. C’est ce qui fait le martyre ou la victoire ! Il peut y avoir des victimes, mais il n’y a pas de défaite. — C’est à cette foi individuelle, à cette résolution de ne jamais transiger sur un principe, que nous devons tout ce qu’il y a de grand et de beau sur cette terre. Sans cette foi, nous n’aurions pas eu la liberté politique, la réformation, la religion chrétienne. Si la Ligue pouvait fléchir dans sa marche ; si ceux qui la dirigent pouvaient la trahir, eh bien ! qu’importe ? ils ne sont que l’avant-garde, la grande armée leur passerait sur le corps et marcherait toujours jusqu’à la grande consommation. (Acclamations.)
« Je le répète donc, pas de transactions. On nous défie, on nous appelle au combat ; les seigneurs nous jettent le gant et ils veulent, disent-ils, abattre la Ligue. (Rires ironiques.) Eh bien, nous en ferons l’épreuve. — Ce ne sont plus les fiers barons de Runnêymède. Le temps de la chevalerie est passé ; il est passé pour eux surtout, car il n’y a rien de chevaleresque à se faire marchand de blé et à fouler le pays pour grossir son lucre. — Mais où veulent-ils en venir en s’isolant ainsi au milieu de la communauté ? Ils créent la méfiance parmi les fermiers, la haine et l’insubordination parmi les ouvriers ; ils se déclarent en guerre avec tous les intérêts nationaux ; ils rejettent les Spencer, les Westminster, les Ducie, les Radnor ; ils se dépouillent de ce qui constitue leur force et leur dignité ; où veulent-ils en venir, en se séparant du mouvement social, en rêvant qu’ils seront toujours assez forts pour écraser leurs concitoyens ? Ils n’ont rien à attendre de cette politique, si ce n’est ruine et confusion ! S’ils y persistent, ils ne tarderont pas à s’apercevoir qu’ils n’ont d’autre perspective qu’une vie de dangers et d’appréhensions ; ils sentiront la terre trembler sous leurs pas, comme on dit qu’elle tremblait partout où se posait le pied du fratricide Caïn. Qu’ils parcourent l’univers ; nulle part ils ne rencontreront la sympathie de l’affection et le sourire de la bienveillance. Ah ! qu’ils se joignent à nous ; qu’ils s’unissent à la nation ; c’est là que les attendent le respect, la richesse, le bonheur ; mais s’ils lui déclarent la guerre, la destruction menace celle caste orgueilleuse. »
L’orateur discute quelques-uns des sophismes sur lesquels s’appuie le régime restrictif, et en particulier le prétexte tiré de l’indépendance nationale. Il poursuit en ces termes : [29]
« Être indépendants de l’étranger, c’est le thème favori de l’aristocratie. Elle oublie qu’elle emploie le guano à fertiliser les champs, couvrant ainsi le sol britannique d’une surface de sol étranger qui pénétrera chaque atome de blé, et lui imprimera la tache de cette dépendance dont elle se montre si impatiente. Mais qu’est-il donc ce grand seigneur, cet avocat de l’indépendance nationale, cet ennemi de toute dépendance étrangère ? Examinons sa vie. Voilà un cuisinier français qui prépare le dîner pour le maître, et un valet suisse qui apprête le maître pour le dîner. (Éclats de rire.) Milady, qui accepte sa main, est toute resplendissante de perles qu’on ne trouve jamais dans les huîtres britanniques, et la plume qui flotte sur sa tête ne fut jamais la queue d’un dindon anglais. Les viandes de sa table viennent de la Belgique ; ses vins, du Rhin et du Rhône. Il repose sa vue sur des fleurs venues de l’Amérique du Sud, et il gratifie son odorat de la fumée d’une feuille apportée de l’Amérique du Nord. Son cheval favori est d’origine arabe, son petit chien de la race du Saint-Bernard. Sa galerie est riche de tableaux flamands et de statues grecques. Veut-il se distraire, il va entendre des chanteurs italiens vociférant de la musique allemande, le tout suivi d’un ballet français. S’élève-t-il aux honneurs judiciaires, l’hermine qui décore ses épaules n’avait jamais figuré jusque-là, sur le dos d’une bête britannique. (Éclats de rire.) Son esprit même est une bigarrure de contributions exotiques. Sa philosophie et sa poésie viennent de la Grèce et de Rome ; sa géométrie, d’Alexandrie ; son arithmétique d’Arabie, et sa religion de Palestine. Dès son berceau, il presse ses dents naissantes sur le corail de l’océan Indien, et lorsqu’il mourra, le marbre de Carrare surmontera sa tombe. (Bruyants applaudissements.) Et voilà l’homme qui dit : Soyons indépendants de l’étranger ! Soumettons le peuple à la taxe ; admettons la privation, le besoin, les angoisses et les étreintes de l’inanition même ; mais soyons indépendants de l’étranger ! (Écoutez !) Je ne lui dispute pas son luxe ; ce que je lui reproche c’est le sophisme, l’hypocrisie, l’iniquité de parler d’indépendance, quant aux aliments, alors qu’il se soumet à dépendre de l’étranger pour tous ces objets de jouissance et de faste. Ce que les étrangers désirent surtout nous vendre, ce que nos compatriotes désirent surtout acheter, c’est le blé ; et il ne lui appartient pas, à lui, qui n’est de la tête aux pieds que l’œuvre de l’industrie étrangère, de s’interposer et de dire : « Vous serez indépendants, moi seul je me dévoue à porter le poids de la dépendance. » Nous ne transigeons pas avec de tels adversaires, non, ni même avec la législature. Nous ne recourrons pas à la législature dans cette session. (Écoutez ! écoutez !) Plus de pétitions. (Approbation. ) Membres de la Chambre des communes, membres de la Chambre des lords, faites ce qu’il vous plaira et comme il vous plaira, — nous en appelons à vos maîtres. (Tonnerre d’applaudissements qui se renouvellent à plusieurs reprises.) La Ligue en appelle à vos commettants, aux créateurs des législateurs ; elle leur dit qu’ils ont mal rempli leur tâche, elle leur enseigne à la mieux remplir, à la première occasion. (Nouveaux applaudissements.) C’est sur ce terrain que nous transportons la lutte ; et nos moyens sont, non point, comme on l’a dit faussement, la calomnie. Terreur, la corruption, mais de persévérants efforts pour faire pénétrer dans ceux qui possèdent le pouvoir politique, l’intelligence et l’indépendance qui ennoblissent l’humanité. Remarquons qu’un notable changement s’est déjà manifesté dans les élections, depuis que la Ligue a adopté cette nouvelle ligne de conduite. Tandis que ses adversaires recherchent tous les sales recoins, toutes les taches de boue qui peuvent se trouver dans le caractère de l’homme, pour bâtir là-dessus ; tandis que les gens qui exploitent en grand le monopole du sol britannique, vont chassant au tailleur et au cordonnier et lui disent : « N’avez-vous pas aussi quelque petit monopole ? Soutenez-nous, nous vous soutiendrons. » Tandis qu’ils gouvernent avec les mauvaises passions, avec ce qu’il y a de folie et de bassesse dans la nature humaine, la Ligue s’efforce de mettre en œuvre les principes, la vérité ; et réveillant, non la partie brutale, mais la partie divine de l’âme, de réaliser cet esprit d’indépendance sans lequel ni les institutions, ni les garanties politiques, ni les droits de suffrage, ne firent et ne feront jamais un peuple grand et libre. C’est pour cela qu’ils nous appellent des étrangers et des intrus… »
L’orateur établit ici des documents statistiques qui prouvent que la mortalité et la criminalité ont toujours été en raison directe de l’élévation du prix des aliments. Il continue ainsi :
« Voilà l’expérience d’un grand nombre d’années résumée en chiffres. Elle fait connaître les résultats de ce système, horrible calcul, qui montre l’âme succombant aussi bien que les corps, les tendances les plus généreuses et les plus naturelles conduisant au crime, l’amour de la famille transformé en un irrésistible aiguillon au mal, et la perversité décrétée pour ainsi dire par acte de la législature. (Écoutez ! écoutez !) Oh ! je le déclare à la face du ciel et de la terre, j’aimerais mieux comparaître à la barre d’Old-Bailey comme prévenu d’un de ces crimes auxquels poussent fatalement ces lois iniques, que d’être du nombre de ceux qui profitent de ces lois pour extraire de l’or des entrailles, du cœur et de la conscience de leurs frères. (Immenses acclamations, l’auditoire se lève en masse, agitant les chapeaux et les mouchoirs.)
« Nous dira-t-on qu’il faut attendre une plus longue expérience ? Qu’il faut éprouver encore le tarif de R. Peel ou de nouvelles formes du monopole ? Mais, c’est expérimenter la privation, l’incertitude, la souffrance, la faim, le crime et la mort. C’est un vieil axiome médical que les expériences doivent se faire sur la vile matière. Mais voici des lois qui expérimentent cruellement sur le corps même d’une grande et malheureuse nation. (Applaudissements.) Oh ! c’en est assez pour réveiller tous les sentiments de l’âme ; hommes, femmes, enfants, levons-nous, prêchons la croisade contre cette horrible iniquité, et fermons l’oreille à toute proposition jusqu’à ce qu’elle soit anéantie à jamais. Habitants de cette métropole, prenez dans nos rangs la place qui vous convient. Combinons nos efforts, et ne nous accordons aucun repos jusqu’à ce que nos yeux soient témoins de ce spectacle si désiré : le géant du travail libre assis sur les ruines de tous les monopoles. (Applaudissements.) C’est pour cela que nous agitons d’année en année, et tant qu’il restera un atome de restriction sur le statute-book, tant qu’il restera une taxe sur la nourriture du peuple, tant qu’il restera une loi contraire aux droits de l’industrie et du travail ; nous ne nous désisterons jamais de l’agitation, jamais ! jamais ! jamais ! (Applaudissements enthousiastes.) Nous marchons vers la consommation de cette œuvre, convaincus que nous réalisons le bien, non de quelques-uns, mais de tous, même de ceux qui s’aveuglent sur leurs vrais intérêts, car l’universelle liberté garantit aussi bien le plus vaste domaine que l’humble travail de celui qui n’a que ses bras. Nous croyons que la liberté commerciale développera la liberté morale et intellectuelle, enseignera à toutes les classes leur mutuelle dépendance, unira tous les peuples par les liens de fraternité, et réalisera enfin les espérances du grand poëte qui fut donné, à pareil jour, à l’Écosse et au monde :
Prions, prions pour qu’arrive bientôt
Comme il doit arriver, ce jour
Où, sur toute la surface du monde,
L’homme sera un frère pour l’homme ! »
(Longtemps après que l’honorable orateur a repris son siège, les acclamations enthousiastes retentissent dans la salle.)
MM. Milner Gibson et le Rév. J. Burnett parlent après M. Fox. La séance est levée à 11 heures.
FN: Unconditional ; la Ligue entend par là que l’abolition des droits d’entrée, sur les grains étrangers, ne doit pas être subordonnée à des dégrèvements accordés par les autres nations aux produits anglais.
SECOND MEETING AU THÉÂTRE DE COVENT-GARDEN. 1er février 1844.↩
Le second meeting hebdomadaire de la Ligue avait attiré, mardi soir, au théâtre de Covent-Garden, une foule nombreuse et enthousiaste. Le nom de lord Morpeth circule dans toute la salle. On parle d’une entrevue qui eut lieu à Wakefield, hier, entre le noble lord, membre de la dernière administration, et M. Cobden. Cette nouvelle provoque une vive satisfaction, à laquelle succède le désappointement lorsqu’on apprend que Sa Seigneurie n’a pas complètement répondu aux espérances que la Ligue avait fondées sur son noble caractère, son humanité et son patriotisme.
Le président rend compte des nombreux meetings qui ont été tenus dans les provinces depuis la dernière séance, ainsi que des sommes qui ont été recueillies.
[Note by FB]
Au moment où nous sommes parvenus, un grand changement s’est opéré dans l’attitude de l’aristocratie. Jusqu’ici nous l’avons vue dédaigner le réveil de l’opinion publique, et chercher à l’égarer en lui présentant, comme remède aux souffrances du peuple, des plans plus ou moins charitables, plus ou moins réalisables, tantôt le travail limité par la loi (le bill des dix heures), tantôt l’émigration forcée.
Aujourd’hui que l’action intellectuelle et morale de la Ligue menace de devenir irrésistible, l’aristocratie sort enfin de sa dédaigneuse apathie. L’apaisement de l’agitation irlandaise et la dissolution du meeting de Clontarf lui donnent l’espérance d’étouffer l’agitation commerciale par l’intervention de la loi. Et en même temps qu’elle dénonce, comme dangereux et illégaux, les meetings de la Ligue, par une contradiction manifeste, elle organise un vaste système d’associations affiliées entre elles, ayant pour but, sous le nom d’anti-Ligue, le maintien des monopoles et delà protection. — La lutte devient donc plus serrée, plus personnelle, plus animée. Chacune de son côté, la Ligue et l’anti-Ligue avaient espéré que leurs efforts, influant sur la marche des affaires, trouveraient quelque écho dans le discours de la reine. Les free-traders espéraient que Sir Robert Peel donnerait, dans la présente session, quelque développement à son plan de réforme financière et commerciale. Les prohibitionnistes ne doutaient pas, au contraire, que le premier ministre, cédant à la pression de cette majorité qui l’a porté au pouvoir, ne revînt sur quelques-unes des mesures libérales adoptées en 1842. Mais le discours du trône, prononcé dans la journée même, a trompé l’attente des deux partis. Le ministère y garde le silence le plus absolu à l’égard de la détresse publique et des moyens d’y remédier.
Tels sont les objets qui servent de texte aux discours prononcés, dans le meeting du 1er février, par le docteur Bowring, le col. Thompson et M. Bright. Bien qu’ils doivent avoir pour le public anglais un intérêt plus actuel, plus incisif, que des dissertations purement économiques, fidèles à la loi que nous nous sommes imposée de sacrifier ce qui peut plaire à ce qui doit instruire, nous nous abstenons d’appeler l’attention du public français sur cette nouvelle phase de l’agitation.
Nous croyons utile, cependant, de donner une relation succincte de l’entrevue de lord Morpeth avec M. Cobden. Lord Morpeth, ayant été un des chefs influents de l’administration whig, renversée en 1841 par les torys, on comprend que son adhésion aux principes absolus de la Ligue devait être considérée comme un fait grave, et de nature à exercer une grande influence sur le mouvement des majorités et des partis. L’attitude de ces deux hommes d’ailleurs, la franchise de leurs explications, leur fidélité aux principes, nous ont semblé une peinture de mœurs constitutionnelles, dignes d’être proposées pour exemple à nos hommes politiques.
WAKEFIELD. Extrait du Morning-Chronicle, 31 janvier 1844.↩
La démonstration des free-traders du West-Riding du Yorkshire a eu lieu ce soir dans la vaste salle de la Halle aux blés, qui était magnifiquement décorée de draperies et ornée de fleurs. Six cent trente-trois sièges avaient été préparés autour de la table du banquet.
Vingt-cinq villes du Yorkshire avaient envoyé des délégués à la séance. — Le fauteuil est occupé par M. Marshall, qui a, à sa droite, lord Morpeth, et à sa gauche M. Cobden.
Après les toasts d’usage, le président se lève et dit :
« Nous sommes réunis aujourd’hui, en dehors de toute distinction de partis et d’opinions politiques, pour discuter les avantages de la liberté absolue de l’industrie, du travail et du commerce. Nous reconnaissons ce grand principe comme l’unique objet du meeting. Il y a dans cette enceinte des hommes qui représentent toutes les nuances des opinions politiques, et ils entendent bien se réserver, à cet égard, toute leur indépendance. Quand nous jetons nos regards autour de nous, quand nous voyons ce qu’est l’Angleterre, ce que l’industrie l’a faite, et que nous venons à penser que le peuple, qui a élevé la nation à ce degré de grandeur, travaille sous le poids des chaînes, sous la pression des monopoles, au milieu des entraves de la restriction, ne sentons-nous pas la honte nous brûler le front ? Pouvons-nous être témoins d’un phénomène aussi étrange, sans sentir profondément gravé dans nos cœurs le désir de vouer toute notre énergie à combattre une telle servitude, jusqu’à ce qu’elle soit radicalement détruite, jusqu’à ce que notre industrie soit aussi libre que nos personnes et nos pensées ? Je ne m’étendrai pourtant pas sur ce sujet qu’il appartient à d’autres que moi de traiter. Je me bornerai à rapporter une preuve, et de la bonté de notre cause, et de l’efficacité avec laquelle elle a été soutenue ; et cette preuve, c’est le nombre toujours croissant de nouveaux adhérents à nos principes qui, de toutes les classes de la société, et de tous les points du royaume, accourent en foule dans notre camp. Ces conquêtes n’ont été acquises à la ligue par aucune concession, par aucune transaction sur son principe. C’est au principe qu’il faut nous attacher ; il est le gage de notre union et de notre force. Ce n’est pas un de nos moindres encouragements que de voir maintenant nos plus fermes soutiens sortir des rangs les plus nobles et des plus opulents propriétaires terriens (applaudissements), des plus habiles et des plus riches agriculteurs, aussi bien que des classes manufacturières. Mais si nous offrons notre accueil hospitalier à tant de nouveaux adhérents, il en est un surtout dont nous devons saluer la bienvenue, lord Morpeth. (Ici l’assemblée se lève comme un seul homme, et des salves d’applaudissements se succèdent pendant plusieurs minutes. Parfois, il semble que le silence va se rétablir, mais les acclamations se renouvellent à plusieurs reprises avec une énergie croissante.) Lord Morpeth n’est pas un nouveau converti aux principes de la liberté du commerce ; ce n’est pas la première fois qu’il assiste aux meetings du West-Riding. C’est parce que nous le connaissons bien, parce que nous apprécions en lui l’homme privé aussi bien que l’homme d’État, parce que nous admirons la puissance de son intelligence comme les qualités de son cœur, c’est pour ce motif que le retour de lord Morpeth parmi nous est accueilli avec ce respect, cette cordialité que devait exciter la coopération à notre œuvre d’un nom aussi distingué. Gentlemen, je propose la santé du très-honorable vicomte Morpeth. »
Lord Morpeth se lève (applaudissements), et après avoir remercié, il s’exprime ainsi :
« Si je ne me trompe, le principal objet de cette réunion est, de la part du West-Riding du Yorkshire, d’honorer et d’encourager la Ligue, ainsi que sa députation ici présente, et de déterminer, autant que cela dépend d’elle, l’abrogation totale et immédiate des lois-céréales. (Bruyants applaudissements.) Vous m’informez que c’est bien là le but de cette assemblée. (Oui, certainement.) Eh bien, je sais qu’il me sera demandé par les amis comme par les ennemis : « Êtes-vous préparé à aller aussi loin ? » La dernière fois, ainsi que vous vous le rappelez sans doute, que je me suis occupé des lois-céréales, c’était en 1841, alors que, comme membre du cabinet de cette époque, j’étais un des promoteurs du droit fixe de 8 shillings. (Écoutez ! écoutez !) Cette proposition entraîna notre chute, parce que les défenseurs du système actuel, qui étaient nos adversaires alors, comme ils sont les vôtres aujourd’hui, pensèrent que nous accordions trop, et que notre mesure était surabondamment libérale envers le consommateur. Mais bien loin que l’insuccès m’ait changé et que notre chute m’ait ébranlé, je crois qu’il est maintenant trop tard pour transiger sur ces termes (ici l’assemblée se lève en masse et applaudit avec enthousiasme), et que ce qui était alors considéré comme trop par les constituants de l’empire, serait trop peu aujourd’hui. En outre, le fait même de ma présence dans cette enceinte, libre de toute influence, sans avoir pris conseil de personne, sans m’être entendu avec qui que ce soit, agissant entièrement et exclusivement pour moi-même, tout cela, gentlemen, vous donne la preuve que je ne refuse pas de reconnaître le zèle et l’énergie déployés par la Ligue (sans accepter naturellement la responsabilité de tout ce qu’elle a pu dire ou pu faire) ; que je ne refuse pas ma sympathie à cette lutte que vous, mes commettants du Yorkshire, vous soutenez avec tant de courage, et comme vous l’avez prouvé récemment, avec tant de libéralité, dans une cause où vous pensez, et vous pensez avec raison (applaudissements), que vos plus chers intérêts sont profondément engagés. Mais, gentlemen, quoiqu’il me fût facile de m’envelopper dans de vagues généralités, et de m’abstenir de toute expression contraire même à ceux d’entre vous dont les idées sont les plus absolues, cependant en votre présence, en présence de vos hôtes distingués, dussé-je réprimer ces applaudissements que vous avez fait retentir autour de moi, et refroidir l’ardeur qui se montre dans votre accueil, je me fais un devoir de déclarer que je ne suis pas préparé à m’interdire pour l’avenir, — soit que je vienne à penser que l’intérêt bien entendu du trésor le réclame, ou que je ne voie pas d’autre solution plus efficace à la question qui nous agite, soit encore que je le considère comme un grand pas dans la bonne voie, — dans ces hypothèses et au très semblables, je ne m’interdis pas la faculté d’acquiescer à un droit fixe et modéré. (Grands cris : « Non, non, cela ne nous convient pas. » Marques de désapprobation.) Je m’attendais à ce que la liberté que je dois néanmoins me réserver provoquerait ces signes de dissentiment. Mais après m’être prononcé comme je crois qu’il appartient à un honnête homme, qui ne saurait prévoir dans quel concours de circonstances il peut se trouver engagé, je déclare, avec la même franchise, que je ne suis nullement infatué du droit fixe. À vrai dire, réduit au taux modéré que j’ai indiqué, je ne lui vois plus cette importance qu’y attachent ses défenseurs et ses adversaires ; et je suis sûr au moins de ceci : que je préférerais l’abrogation, même l’abrogation totale et immédiate, à la permanence de la loi actuelle pendant une année. (Tonnerre d’applaudissements.) Et même, si dans le cours de la présente année l’abrogation totale et immédiate pouvait être emportée, — comme je me doute que cela arriverait, gentlemen, si la décision dépendait de vous, — je ne serais certainement pas inconsolable, ni bien longtemps à en prendre mon parti. (Applaudissements.) — Sa Seigneurie déclare qu’elle a partagé la satisfaction de l’assemblée lorsque M. Plint a rendu compte des progrès de la cause de la liberté. Elle annonce qu’elle va porter ce toast : « À la prospérité du West-Riding ; puissent les classes agricoles, manufacturières et commerciales, reconnaître que leurs vrais et permanents intérêts sont indissolublement unis et ont leur base la plus solide dans la liberté du travail et des échanges. » Après avoir peint en termes chaleureux les heureux résultats du commerce libre, le noble lord ajoute : « Je ne veux pas, gentlemen, développer ici une argumentation sérieuse et solennelle, peu en harmonie avec le caractère de cette fête, quoique je ne doute pas que votre détermination ne soit calme, mais sérieuse. (Oui ! oui ! nous sommes déterminés.) Mais ce que je voudrais faire pénétrer dans l’esprit de nos adversaires, des adversaires de la liberté de l’industrie, c’est que leur système lutte contre la nature elle-même et contre les lois qui régissent l’univers. (Applaudissements.) Car, gentlemen, quelle est l’évidente signification de cette diversité répandue sur la surface du globe, ici tant de besoins, là tant de superflu ; tant de dénûment sur un point, et, sur un autre, une profusion si libérale ? Les poëtes se sont plu quelquefois à peupler de voix les brises du rivage, et à prêter un sens aux échos des montagnes ; mais les mots réels que la nature fait entendre, dans l’infinie variété de ses phénomènes, c’est : Travaillez, échangez, » etc.
Le maire de Leeds porte la santé de MM. Cobden, Bright et des autres membres de la députation de la Ligue.
M. Cobden. (Pendant plusieurs minutes les acclamations qui retentissent dans la salle empêchent l’orateur de se faire entendre. Quand le silence est rétabli, il déclare qu’il n’accepte pour lui et pour M. Bright qu’une partie des éloges qui ont été exprimés par le maire de Leeds. Il y a dans la Ligue d’énergiques ouvriers dont le nom n’est guère entendu au delà de la salle du conseil, et qui cependant ne travaillent pas avec moins de dévouement et d’efficacité que ceux qui, par la nature de leurs fonctions, sont plus en contact avec le public. Après quelques autres considérations, l’orateur continue ainsi) : On nous a objecté dans une autre enceinte que le blé était une matière imposable. Gentlemen, comme free-traders, nous n’entendons pas nous immiscer dans le système des taxes levées sur le pays, et si l’on proposait de lever loyalement et équitablement un impôt sur le blé, sans que cet impôt, par une voie insidieuse, impliquât un odieux monopole, je ne pense pas qu’en tant que membres de la Ligue nous soyons appelés à intervenir, quoique une taxe sur le pain soit une mesure dont je ne connais aucun exemple dans l’histoire des pays même les plus barbares. Mais que nous propose-t-on ? De taxer le blé étranger sans taxer le blé indigène ; et l’objet notoire de ce procédé, c’est de conférer une protection au producteur national. Eh bien ! nous nous opposons à cela, parce que c’est du monopole ; nous nous opposons à cela en nous fondant sur un principe, et notre opposition est d’autant plus énergique, qu’il s’agit d’une taxe qui n’offre aucune compensation à la très-grande majorité de ceux qu’elle frappe. Il n’est pas au pouvoir du gouvernement, en effet, de donner protection aux manufacturiers et aux ouvriers ; et, quant à eux, le monopole du pain est une pure injustice. S’il y a quelques personnes qui désirent, en toute honnêteté, asseoir une taxe sur le blé, qu’elles proposent, afin de montrer la loyauté de leur dessein, de prélever cette taxe, par l’accise, et sur le blé, à la mouture. Personnellement, je résisterai à cet impôt. Mais parlant comme free-trader, je dis que si l’on veut une loi céréale qui n’inflige pas un monopole au pays, il faut taxer les céréales de toutes provenances à la mouture, et laisser entrer librement les grains étrangers. Alors quiconque mangera du pain paiera la taxe ; et quiconque produira du blé ne bénéficiera pas par la taxe. Je crois que lorsque la proposition se présentera sous cette forme, elle ne rencontrera pas l’agitation dans le pays, pas plus que la taxe du sel qui ne confère à personne d’injustes avantages (Applaudissements.) S’il faut que le trésor public prélève un revenu sur le blé, il en tirera dix fois plus d’une taxe à la mouture que d’un droit de douane, sans que le premier mode élève plus que le second le prix du pain[1].
[Note by FB]
M. Cobden répond à l’accusation qu’on a dirigée contre la Ligue, d’être trop absolue. Il adjure le meeting de ne se séparer jamais de la justice abstraite et des principes absolus. Nos progrès, dit-il, démontrent assez ce qu’il y a de force dans la ferme adhésion à un principe. Nous avions à instruire la nation, et qu’est-ce qui nous a soutenus ? la vérité, la justice, le soin de ne nous laisser pas détourner par la séduction d’un avantage momentané, par aucune considération de parti, ou de statégie parlementaire.
M. Cobden continue ainsi : Nous ne sommes point des hommes politiques ; nous ne sommes point des hommes d’État, et n’avons jamais aspiré à l’être. Nous avons été arrachés à nos occupations presque sans nous y attendre. Je le déclare solennellement, si j’avais pu prévoir il y a cinq ans que je serais graduellement et insensiblement porté à la position que j’occupe, et dont je ne saurais revenir par aucune voie qui se puisse concilier avec l’honneur (bruyantes acclamations), si j’avais prévu, dis-je, tout ce que j’ai eu à sacrifier de temps, d’argent et de repos domestique à cette grande cause, quel que soit le dévouement qu’elle m’inspire, je crois que je n’aurais pas osé, considérant ce que je me dois à moi-même, ce que je dois à ceux qui tiennent de la nature des droits sacrés sur mon existence, accepter le rôle qui m’a été fait. (Acclamations.) Mais notre cause s’est peu à peu élevée à la hauteur d’une grande question politique et nationale ; et maintenant que nous l’avons portée au premier rang entre toutes celles qui préoccupent le sénat, il nous manque des hommes dans ce sénat ; — des hommes dont le caractère comme hommes d’État soit établi dans l’opinion, — des hommes qui, par leur position sociale, leurs priviléges et leurs précédents, soient en possession d’être considérés par le peuple comme des chefs politiques. Il nous manque de tels hommes dans la Chambre à qui nous puissions confier le dénoûment de cette lutte. (Applaudissements.) Et s’il est un sentiment qui, dans mon esprit, ait prévalu sur tous les autres, quand je suis entré dans cette enceinte, sachant que j’allais y rencontrer cet homme d’État distingué que ses commettants considèrent autant et plus que tout autre, comme le chef prédestiné à la conduite des affaires publiques de ce pays, si, dis-je, un sentiment a prévalu dans mon esprit, c’était l’espoir de saluer le nouveau Moïse qui doit, à travers le désert, nous faire arriver à la terre de promission. (Acclamations longtemps prolongées.) Je le déclare de la manière la plus solennelle, en mon nom, comme au nom de mes collègues, c’est avec bonheur que nous remettrions notre cause entre les mains d’un tel homme, s’il se faisait à la Chambre des communes le défenseur de notre principe ; c’est avec bonheur que nous travaillerions encore aux derniers rangs, là où nos services seraient le plus efficaces, afin d’aider loyalement un tel homme d’État à attacher son nom à la plus grande réforme, que dis-je ? à la plus grande révolution dont le monde ait jamais été témoin. (Applaudissements.) — Gentlemen, je ne désespère pas (les acclamations redoublent) ; nous travaillerons une autre année. (Applaudissements.) Je crois que le noble lord a parlé d’une année, il a demandé une année. Eh bien, nous travaillerons volontiers pour lui encore une année. (Applaudissements.) Et alors, quand il aura réfléchi sur nos principes ; quand il se sera assuré de la justice de notre cause ; quand ses calmes méditations, guidées par la délicatesse de sa conscience, l’auront amené à cette conviction que le droit et la justice sont de notre côté, j’espère qu’au terme de l’année qu’il se réserve, il se lèvera courageusement, pour imprimer à notre cause, au sein des communes, le sceau du triomphe. (Bruyantes acclamations.) Mais, après avoir exprimé cette sincère espérance, je dois vous rappeler que nous sommes ici comme membres de la Ligue. Nous sommes engagés à un principe, et je dois vous dire, habitants du West-Riding, qu’il est de votre devoir de montrer une entière loyauté dans votre attachement à ce principe. Vous pouvez être appelés à faire le sacrifice d’une affection personnelle aussi bien placée que bien méritée, à consommer, comme électeurs de ce pays, le plus douloureux sacrifice qui puisse vous être commandé. Je ne cherche ni à séduire ni à menacer le noble lord. Je sais qu’il est compétent, par l’étendue de son esprit et l’intégrité de son caractère, à juger par lui-même. Mais quant à nous, nos engagements ne sont pas envers les whigs ou envers les torys, mais envers le peuple. Je n’ajouterai qu’un mot. Le noble lord nous a dit : « Dieu vous protége ; vous êtes dans la bonne voie, et j’espère que vous y avancerez sous votre bannière triomphante. » Et moi je lui dis : « Vous êtes dans le droit sentier, et Dieu vous protége tant que vous n’en dévierez pas !… »
Quelle que soit l’éloquence déployée par les orateurs qui se sont succédé, l’assemblée demeure longtemps encore sous l’impression de cette conférence qui laisse indécis un événement d’une haute importance. — Elle se sépare à minuit, des trains spéciaux ayant été retenus sur tous les chemins de fer, pour ramener chacun des assistants à son domicile.
FN: Cela se comprend aisément. Supposons que la consommation du blé en Angleterre soit de 60 millions d’hectolitres, dont 54 millions de blé indigène et 6 millions de blé étranger.
Supposons encore que ce dernier vaut à l’entrepôt 20 fr. l’hectolitre. Un droit de 2 fr. à la mouture frapperait les 60 millions d’hectolitres et donnerait au trésor un produit de 120 millions. De plus, il établirait le cours du grain sur le marché à 22 francs.
Un droit de douane de 2 fr. fixerait aussi le cours du blé à 22 fr., puisque, d’après l’hypothèse, l’étranger ne saurait vendre au-dessous. Mais le droit, ne se prélevant que sur 6 millions d’hectolitres, ne produirait à l’Échiquier que 12 millions.
Ce sont les monopoleurs qui gagnent la différence.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 15 février 1844.↩
Le meeting hebdomadaire de la Ligue a eu lieu jeudi soir au théâtre de Covent-Garden. — En l’absence du président, M. George Wilson, M. Villiers, membre du Parlement, occupe le fauteuil. Nous avons extrait de son discours les passages suivants :
« Messieurs, notre estimable ami, M. Wilson, forcément retenu à la campagne, m’a requis d’occuper le fauteuil. Malgré mon inexpérience, j’ai accepté cette mission, parce que je crois que le temps est venu où il n’est permis à personne de rejeter le fardeau sur autrui, et de refuser sa cordiale assistance à l’œuvre de cette grande et utile association. L’objet de la Ligue est identifié avec le bien-être de la nation, mais le sinistre intérêt que nous combattons est malheureusement identifié avec le pouvoir et les majorités parlementaires. La Ligue a donc à surmonter de graves difficultés, et il lui faut redoubler d’énergie. (Applaudissements.) Nous vivons dans un temps où l’on ne manque pas de tirer avantage de ce qu’il reste au peuple d’ignorance et d’apathie à l’égard de ses vrais intérêts, et il ne faut pas espérer d’arriver à un gouvernement juste et sage, autrement que par la vigoureuse expression d’une opinion publique éclairée. C’est à ce résultat, c’est à réprimer le sordide abus de la puissance législative que la Ligue a consacré ses efforts incessants et dévoués. Le soin que mettent ses adversaires à calomnier ses desseins, montre assez combien ils redoutent ses progrès, et combien sa marche ferme et loyale trompe leur attente. L’objet que la Ligue a en vue a toujours été clair et bien défini ; je ne sache pas qu’il ait changé. Elle aspire à populariser, à rendre manifestes, aux yeux de tous, ces doctrines industrielles et commerciales, qui ont été proclamées par les plus hautes intelligences. (Écoutez ! écoutez !) Doctrines dont la vérité est accessible aux intelligences les plus ordinaires, dont l’application, commandée d’ailleurs par les circonstances de ce pays, a été conseillée par tout ce qu’il renferme d’hommes pratiques, prudents et expérimentés. Ce but, de quelque manière qu’il plaise aux monopoleurs et aux ministres qui leur obéissent de le présenter, mérite bien l’appui et la sympathie de quiconque porte un cœur ami du bien et de la justice. Depuis notre dernière réunion, je comprends que ce mot que l’autorité a mis à la mode, et sur lequel elle compte pour étouffer les plaintes de nos frères d’Irlande (immenses acclamations), je veux dire le mot conspiration, a été appliqué à ces meetings. (Rires ironiques.) Jusqu’à quel point ce mot s’applique-t-il avec quelque justesse à nos réunions ? Je l’ignore. Ce que je sais, c’est que considérant le but pour lequel on allègue que nous sommes associés, il n’y a pas lieu de s’étonner si nos travaux ont répandu la colère et l’alarme dans le camp ennemi, et si nous sommes désignés comme des conspirateurs, sur l’autorité de celui à qui l’on attribue d’avoir proclamé que les doctrines que nous cherchons à faire prévaloir sont les doctrines du sens commun[1]. (Rires.) Car, certes, on ne saurait rien concevoir de plus funeste que le sens commun, à ceux qui ont fondé leur puissance sur les préjugés, l’ignorance et les divisions du peuple, à ceux qui ont tout à redouter de sa sagesse, et rien à gagner à son perfectionnement. (Applaudissements.) S’ils déploient maintenant contre la Ligue une nouvelle (énergie, peut-être faut-il les excuser, car elle naît de cette conviction qui a envahi leur esprit, que nos doctrines font d’irrésistibles progrès, et que le temps approche où ce sentiment profond qu’on appelle sens commun prévaudra enfin dans le pays. En cela, du moins, je crois qu’ils ont raison, et tout — jusqu’aux procédés de l’anti-Ligue, qui a sans doute en vue autre chose que le sens commun, — concourt à ce résultat. Lorsqu’il s’agit de disculper une loi qui a provoqué contre elle cette puissante agitation, il faut autre chose, le sens commun réclame autre chose que l’invective, qui fait le fond de leur éloquence. Il faut autre chose pour disculper une loi accusée de n’avoir été faite à une autre fin que d’infliger la famine à une terre chrétienne (écoutez ! écoutez !), alors surtout que cette loi, condamnée par les hommes de l’autorité la plus compétente, par les Russell et les Fitzwilliams, condamnée par le spectacle des maux qu’elle répand au sein d’une population toujours croissante, est maintenue par des législateurs qui ont à la maintenir un intérêt direct et pécuniaire. Je le répète, si l’invective grossière est la seule réponse que l’on sait faire à des imputations si graves et si sérieuses, c’est qu’il n’y en a pas d’autre ; et alors le peuple est bien près de comprendre que demander pour le travail honnête sa légitime rémunération, pour les capitaux leurs profits naturels, sans la funeste intervention de la loi, que vouloir réduire la classe oisive et improductive à sa propriété, c’est proclamer non-seulement la doctrine du sens commun, mais la doctrine de l’éternelle justice. Les conspirateurs qui se sont unis pour répandre cette doctrine parmi le peuple, recueilleront, en dépit de l’injuste censure de l’autorité, l’honnête et cordial assentiment d’une nation reconnaissante. » (Applaudissements prolongés.)
Le meeting entend MM. Hume et Christie, membres du Parlement. La parole est ensuite à M. J. W. Fox.
M. Fox : Si les honorables membres du Parlement que vous venez d’entendre (étaient condamnés à subir cet arrêt qui, grâces au ciel, se présente plus rarement qu’autrefois sur les lèvres du juge : « Qu’on les ramène d’où ils sont venus, » ils pourraient, je crois, annoncer à la Chambre des communes que la Ligue vit encore ; car, pas plus tard qu’hier, on y affirmait que, depuis la déclaration de sir Robert Peel, au premier jour de la session, notre agitation était tombée dans l’insignifiance[2]. (Rires.) Oui, elle est tombée de chute en chute, d’un revenu de 50,000 liv. sterl. à un revenu de 100.000 liv. ; — de petits meetings provinciaux à de splendides réunions comme celle qui m’entoure, et de l’humiliation de pétitionner la Chambre à l’honneur de guider dans la lutte les maîtres de cette assemblée. (Acclamations.) Quelle idée confuse, imparfaite, étrange, ne faut-il pas se faire de la Ligue, pour imaginer qu’elle va s’anéantir au souffle des membres du Parlement ou des ministres de la couronne ! Eh quoi ! les législateurs du monopole ne verraient-ils dans la Ligue qu’une mesquine coterie, qu’une pitoyable manœuvre de parti, choses qui leur sont beaucoup plus familières que les grands principes de la vérité et de la justice, que les puissants mouvements de l’opinion nationale ? Et celui, entre tous, devant la volonté de qui la Ligue est le moins disposée à se courber, c’est ce ministre dont la bouche a si souvent soufflé le chaud et le froid, et qui dénonçait jadis, comme destructives de la constitution politique et de l’établissement religieux du royaume, ces mêmes mesures dont il se soumet maintenant à se faire l’introducteur. L’existence de la Ligue, le triomphe prochain qui l’attend, ne dépendent ni de Sir Robert Peel, ni d’aucun autre chef de parti. Nous abjurons toute alliance avec les partis. L’anti-Ligue s’enorgueillissait récemment d’avoir rallié à elle un grand nombre de whigs. Tant pis pour les whigs, mais non pas pour la Ligue. (Écoutez !) Notre force est dans notre principe ; dans la certitude que la liberté du commerce est fatalement arrêtée dans les conseils de Dieu comme un des grands pas de l’homme dans la carrière de la civilisation. Les droits de l’industrie à la liberté des échanges peuvent être momentanément violés, confisqués par la ruse ou la violence ; mais ils ne peuvent être refusés d’une manière permanente aux exigences de l’humanité. (Applaudissements.)… Mais ce que le monopole n’a pu faire avec toutes les ressources d’une constitution partiale, il espère le réaliser par le concours d’associations volontaires et d’efforts combinés. Non content de cette grande anti-Ligue, la Chambre des lords, et de cette anti-Ligue supplémentaire, la Chambre des communes, il couvre le pays de petites associations qui vont s’écriant :
Oh ! laissez mon petit navire tendre aussi sa voile,
Partager la même brisé et courir au même triomphe.
Et voyez jusqu’où les conduit l’esprit d’imitation ! Elles se prennent à nous copier nous-mêmes. Elles commencent à pétitionner le Parlement, justement quand nous en avons fini avec les pétitions. — Elles dénoncent l’agitation. « L’agitation est immorale, » s’écrie le duc de Richmond, et disant cela, il se met à la tête d’une agitation nouvelle… Les monopoleurs déclarent que nous sommes passibles des peines de la loi. Mais s’il y a quelque impartialité dans la distribution de la justice, que font-ils autre chose, en nous imitant, que nous garantir contre ces peines ? Non que je prenne grand souci du mot conspiration[3] ; et en débutant tout à l’heure, j’aurais pu aussi bien choisir ce terme que tout autre et vous apostropher ainsi : « Mes chers conspirateurs. » Je ne tiens pas à déshonneur qu’on m’applique cette expression ou toute autre, quand j’ai la conscience que je poursuis un but légitime par des moyens légitimes. (Applaudissements.) Quel que soit l’objet spécial de notre réunion, je rougirais de moi-même et de vous, si nous usions du privilége de la libre parole et du libre meeting, sans exprimer notre sympathie envers ceux de nos frères d’Irlande que menacent des châtiments pour avoir usé des mêmes droits. (Acclamations enthousiastes et prolongées.) Je dis que c’est de la sympathie pour nous-mêmes et non pour eux. Car, entre tous les hommes, celui-là, sans doute, a moins besoin de sympathie que nul autre, qui, du fond de son cachot, si on l’y plonge, régnera encore sur la pensée, sur le cœur, sur le dévouement de la nation à laquelle il a consacré ses services. (Les acclamations se renouvellent.) C’est à nous-mêmes qu’elle est due, c’est au plus sacré, au plus cher des droits que possède le peuple de ce pays, — le droit de s’assembler librement, — en nombre proportionné à la grandeur de ses souffrances, — pour exposer ses griefs et en demander le redressement. Ce droit ne doit être menacé, où que ce soit, à l’égard de qui que ce soit, sans qu’aussitôt une protestation énergique et passionnée émane de quiconque apprécie la liberté publique et les intérêts d’une nation qui n’a d’autres garanties que la hardiesse de sa parole et son esprit d’indépendance. (Acclamations.) — Mais je reviens aux associations des prohibitionnistes. Incriminer la Ligue, semble être leur premier besoin et leur première pensée. Mais de quoi nous accusent-ils ? Parmi leurs plates et mesquines imputations, les plus pitoyables figurent toujours au premier rang. La première résolution prise par une de ces associations agricoles consiste à déclarer que la Ligue fait une chose intolérable en envoyant dans le pays des professeurs salariés. Mais au moins elles ne peuvent pas nous accuser de salarier des rustres pour porter le désordre dans leurs meetings. Elles oublient aussi que la Ligue dispose d’une puissance d’enseignement qu’aucune richesse humaine ne saurait payer ; puissance invisible, mais formidable, descendue du ciel pour pénétrer au cœur de l’humanité ; puissance qui ouvre l’oreille de celui qui écoute et enflamme la lèvre de celui qui parle; puissance immortelle, partout engagée à faire triompher la liberté, à renverser l’oppression ; et le nom de cette puissance, c’est l’amour de la justice. (Applaudissements.) Elles se plaignent aussi de nos pétitions, maintenant que nous y avons renoncé. Une foule d’anecdotes nous sont attribuées, parmi lesquelles celle d’un homme qui aurait inscrit de faux noms au bas d’une pétition contre la loi-céréale, ils racontent, avec assez peu de discernement dans le choix de leur exemple, qu’un homme a été vu dans les cimetières inscrivant sur la pétition des noms relevés sur la pierre des tombeaux. (Rires.) Il ne manquait pas de subtilité, le malheureux, s’il en a agi ainsi, et il faut que le sens moral de nos adversaires soit bien émoussé pour qu’ils osent citer un tel fait à l’appui de leur accusation ; car combien d’êtres inanimés peuplent les cimetières de nos villes et de nos campagnes, qui y ont été poussés par l’effet de cette loi maudite. Ah ! si les morts pouvaient se mêler à notre œuvre, des myriades d’entre eux auraient le droit de signer des pétitions sur cette matière. Ils ont été victimes de ce système qui pèse encore sur les vivants, et s’il existait une puissance qui pût souffler sur cette poussière aride pour la réveiller, si ces pensées et ces sentiments d’autrefois pouvaient reprendre possession de la vie, si la tombe pouvait nous rendre ceux qu’elle a reçus sans cortège et sans prières :
« Car elle est petite la cloche qui annonce à la hâte le convoi du pauvre ; »
s’ils accouraient du champ de repos vers ce palais où l’on codifie sur la mort et sur la vie, oh ! la foule serait si pressée que les avenues du Parlement seraient inaccessibles ; il faudrait une armée, Wellington en tête, pour frayer aux sénateurs un passage à travers cette multitude, et peut-être ils ne parviendraient à l’orgueilleuse enceinte que pour entendre le chapelain de Westminster prêcher sur ce texte : « Le sang de ton frère crie vers moi de la terre. » (Vive sensation.)
Après cette folle disposition à calomnier la Ligue, ce qui caractérise le plus les sociétés monopolistes, c’est une avalanche de professions d’attachement à l’ouvrier. Cette tendresse défraye leurs résolutions et leurs discours ; il semble que le bien-être de l’ouvrier soit la cause finale de leur existence. (Rires.) Il semble, à les entendre, que les landlords n’ont été créés et mis au monde que pour aimer les ouvriers. (Nouveaux rires). Ils aiment l’ouvrier avec tant de tendresse, qu’ils prennent soin que des vêtements trop amples et une nourriture trop abondante ne déguisent pas sa grâce et n’altèrent pas ses belles proportions. Ils aiment sans doute, sur le principe invoqué par certain pasteur à qui l’on reprochait une douteuse orthodoxie. Que voulez-vous ? disait-il, je ne puis croire qu’à raison de 80 liv. sterl. par an, tandis que mon évêque croit sur le taux de 15,000 livres. (Éclats de rires.) C’est ainsi que, dans leurs meetings, les landlords font montre envers les ouvriers d’un amour de 50 et 80,000 livres par an, mais ceux-ci ne peuvent les payer de retour que sur le pied de 7 à 8 shillings par semaine. (Rires prolongés…) Mais quand donc a commencé cet amour ? Quelle est l’histoire de cette tendresse ardente et passionnée de l’aristocratie pour l’habitant des campagnes ? Dans quel siècle est-elle née ? Est-ce dans les temps reculés où le vieux cultivateur était tenu de dénoncer sur son bail le nombre d’attelages de bœufs et le nombre d’attelages d’hommes ? Lorsque l’on engraissait les esclaves dans ce pays pour les vendre en Irlande, jusqu’à ce qu’il y eût sur le marché engorgement de ce genre de produits ? Est-ce dans le quatorzième siècle, lorsque la peste ayant dépeuplé les campagnes, et que le manque de bras eût pu élever le taux de la main-d’œuvre, l’aristocratie décréta le Code des ouvriers, — loi dont on a fait l’éloge de nos jours, — qui ordonnait que les ouvriers seraient forcés de travailler sous le fouet et sans augmentation de salaires ? Est-ce dans le quinzième siècle, quand la loi voulait que celui qui avait été cultivateur douze ans, fût pour le reste de sa vie attaché aux manches de sa charrue, sans qu’il pût même faire apprendre un métier à son fils, de peur que le maître du sol ne perdît les services d’un de ses serfs ? Est-ce dans le seizième siècle, quand un landlord pouvait s’emparer des vagabonds, les forcer au travail, les réduire en esclavage et même les marquer, afin qu’ils fussent reconnus partout comme sa propriété ? Est-ce à l’époque plus récente qui a précédé immédiatement la naissance de l’industrie manufacturière, période pendant laquelle les salaires, mesurés en froment, baissèrent de moitié, tandis que le prix de ce même froment haussa du double et plus encore ? Est-ce dans les temps postérieurs, sous l’ancienne ou la nouvelle loi des pauvres, qui, tantôt assujettissait l’ouvrier à la dégradation de recevoir de la paroisse, à titre d’aumône, un salaire honnêtement gagné, tantôt lui disait : Tu arrives trop tard au banquet de la nature, il n’y a pas de couvert pour toi ; sois indépendant ? Est-ce maintenant enfin, où l’ouvrier est gratifié de 2 shillings par jour quand il fait beau, qu’il perd s’il vient à pleuvoir, et où sa vie se consume en un travail incessant, jour après jour, et de semaine en semaine ? À quelle époque donc trouvons-nous l’origine, où lisons-nous l’histoire, où voyons-nous les marques de cette paternelle sollicitude, qui, à en croire l’aristocratie, a placé la classe ouvrière sous sa tendre et spéciale protection ? (Acclamations bruyantes et prolongées.) Si tels sont les sentiments de l’aristocratie envers les ouvriers, pourquoi ne donne-t-elle pas une attention plus exclusive à leurs intérêts ? Les législateurs de cette classe ne s’abstiennent pas, d’habitude, de se mêler des affaires d’autrui. Ils se préoccupent des manufactures, où les salaires sont pourtant plus élevés que sur leurs domaines ; ils réglementent les heures de travail et les écoles ; ils sont toujours prêts à s’ingérer dans les fabriques de soie, de laine, de coton, en toutes choses au monde ; et, sur ces entrefaites, voilà ces ouvriers qu’ils aiment tant, les voilà les plus misérables et les plus abandonnés de toutes les créatures ! Quelquefois peut-être on distribuera à ceux d’entre eux qui auront servi vingt ans le même maître un prix de 10 shillings, toujours accompagné de la part du révérend président du meeting de cette allocution : « Méfiez-vous des novateurs, car la Bible enseigne qu’il y aura toujours des pauvres parmi vous. » (Honte ! honte !)
Et que dirons-nous de la prétention des propriétaires au titre d’agriculteurs ? On n’est pas savant parce qu’on possède une bibliothèque ; et comme l’a dit énergiquement M. Cobden : « on n’est pas marin parce qu’on est armateur. » Les propriétaires de grands domaines n’ont pas davantage droit au titre honorable « d’agriculteurs. » Ils ne cultivent pas le sol ; ils se bornent à en recueillir les fruits, ayant soin de s’adjuger la part du lion. Si un tel langage prévalait en d’autres matières, s’il fallait juger des qualités personnelles et des occupations d’un homme, par l’usage auquel ses propriétés sont destinées, il s’ensuivrait qu’un noble membre de la Ligue, le marquis de Westminster[4] serait le plus grand tuilier de Londres (rires), que le duc de Bedfort[5] en serait le musicien et le dramatiste le plus distingué, et que les membres du clergé de l’abbaye de Westminster, dont les propriétés sont affectées à un usage fort équivoque, seraient d’éminents professeurs de prostitution. (Rires et applaudissements.) Entre la Ligue et ses adversaires toute la question, dégagée de ces vains sophismes, se réduit à savoir si les seigneurs terriens, au lieu de n’être dans la nation qu’une classe respectable et influente, absorberont tous les pouvoirs et seront la nation, toute la nation, car c’est à quoi ils aspirent. Ils reconnaissent la reine, mais ils lui imposent des ministres ; ils reconnaissent la législature, mais ils constituent une Chambre et tiennent l’autre sous leur influence ; ils reconnaissent la classe moyenne, mais ils commandent ses suffrages et s’efforcent de nourrir dans son sein les habitudes d’une dégradante servilité ; ils reconnaissent la classe industrielle, mais ils restreignent ses transactions et paralysent ses entreprises ; ils reconnaissent la classe ouvrière, mais ils taxent son travail, et ses os, et ses muscles, et jusqu’au pain qui la nourrit. (Applaudissements.) J’accorde qu’ils furent autrefois « la nation ». Il fut un temps où les possesseurs du sol en Angleterre formaient la nation, et où il n’y avait pas d’autre pouvoir reconnu. Mais qu’était-ce que ce temps-là ? Un temps où le peuple était serf, était « chose », pouvait être fouetté, marqué et vendu. Ils étaient la nation ! Mais où étaient alors tous les faits de la vie ? où étaient alors la littérature et la science ? Le philosophe ne sortait de sa retraite que pour être, au milieu de la foule ignorante, un objet de défiance et peut-être de persécution ; bon tout au plus à vendre au riche un secret magique pour gagner le cœur d’une dame ou paralyser le bras d’un rival. Ils étaient la nation ! et on les voyait s’élancer dans leur armure de fer, conduisant leurs vassaux au carnage, tandis que les malheureux qu’ils foulaient aux pieds n’avaient d’autres chances pour s’en défaire que de les écraser, comme des crustacés dans leur écaille. Ils étaient la nation ! et quel était alors le sort des cités ? Tout citoyen qui avait quelque chose à perdre était obligé de chercher auprès du trône un abri contre leur tyrannie, et de renforcer le despotisme pour ne pas demeurer sans ressources devant ces oligarques ; en ce temps-là, s’il y avait eu un Rothschild, ils auraient eu sa dernière dent pour arriver à son dernier écu. Quand ils étaient la nation, aucune invention n’enrichissait le pays, ne faisait exécuter au bois et au fer l’œuvre de millions de bras ; la presse n’avait pas disséminé les connaissances sur toute la surface du pays et fait pénétrer la lumière jusque dans la mansarde et la cabane ; la marine marchande ne couvrait pas la mer et ne présentait pas ses voiles à tous les vents du ciel, pour atteindre quelque lointain rivage et en rapporter le nécessaire pour le pauvre et le superflu pour le riche. Non, non, la domination du sol n’est pas la nationalité ; la pairie n’est pas la nation. Les cœurs et les cerveaux entrent pour quelque chose dans la constitution d’un peuple. Le philosophe qui pense, l’homme d’État qui agit, le poëte qui chante, la multitude qui travaille ; voilà la nation. (Applaudissements.) L’aristocratie y prend noblement sa place, lorsque, ainsi que plusieurs de ses membres qui appartiennent à notre association, elle coopère du cœur et du bras à la cause de la patrie et au perfectionnement de l’humanité. De tels hommes rachètent l’ordre auquel ils appartiennent et le couvrent d’un lustre inhérent à leur propre individualité. Nous regardons comme membre de la communauté quiconque travaille, soit par l’intelligence, soit d’une main calleuse, à rendre la nation grande, libre et prospère ! Certes, si nous considérons la situation des seigneurs terriens dans ce pays, nous les voyons dotés de tant d’avantages, dont ils ne sauraient être dépouillés par aucune circonstance, aucun événement, à moins d’une convulsion sociale, terrible et universelle, qu’en vérité ils devraient bien s’en contenter, « trop heureux s’ils connaissaient leur bonheur. » Car il est vrai, comme on l’a dit souvent, que l’Angleterre est le paradis des propriétaires, grâce à l’indomptable énergie, à l’audacieux esprit d’entreprise de ses enfants. Que veulent-ils de plus ? Le sol n’est-il pas à eux d’un rivage à l’autre ? N’est-il pas à eux, l’air que sillonnent les oiseaux du ciel ? Il n’est pas un coin de la terre où nous puissions enfoncer la charrue sans leur permission, bâtir une chaumière sans leur consentement ; ils foulent le sol anglais comme s’ils étaient les dieux qui l’ont tiré du néant, et ils veulent encore élever artificiellement le prix de leurs produits ! Maîtres du sol, ils veulent encore être les maîtres de l’industrie et s’adjuger une part jusque sur le pain du peuple ! Que leur faut-il donc pour les contenter ? Ils ont affranchi de toutes charges ces domaines acquis non par une honnête industrie, mais par l’épée, la rapine et la violence. Jadis ils avaient à soutenir l’Église et l’État, à lever les corps de troupes, quand il plaisait au roi de les requérir, pour la conquête, ou pour la défense nationale. Maintenant l’aristocratie a su convertir en sources d’émoluments les charges mêmes qui pesaient sur ses terres, et elle tire de l’armée, de l’église et de toutes nos institutions, des ressources pour ses enfants et ses créatures ; et cependant elle veut encore écraser l’industrie sous le poids d’un fardeau plus lourd qu’aucun de ceux qui pesèrent jamais sur ses domaines ! — Libre échange ! ce fut, il y a des siècles, le cri de Jean Tyler et de ses compagnons, que le fléau des monopoles avait poussés à l’insurrection. L’épée qui le frappa brille encore dans l’écusson de la corporation de Londres, comme pour nous avertir de fuir toute violence, nous qui avons embrassé la même cause et élevé le même cri : Libre échange ! (Applaudissements enthousiastes.) Libre échange, non pour l’Angleterre seulement, mais pour tout l’univers. (Acclamations.) Quoi ! ils trafiquent librement de la plume, de la parole et des suffrages électoraux, et nous ne pouvons pas échanger entre nous le fruit de nos sueurs ? Nous demandons que l’échange soit libre comme l’air, libre comme les vagues de l’Océan, libre comme les pensées qui naissent au cœur de l’homme ! (Applaudissements.) Ne prennent-ils pas aussi leur part, et la part du lion, dans la prospérité commerciale ? Qu’ont fait les machines, les bateaux à vapeur, les chemins de fer, pour le bien-être du peuple, qui n’ait servi aussi à élever la valeur du sol elle taux de la rente ? Leurs journaux font grand bruit depuis quelques jours de ce qu’ils appellent un « grand fait ». « Le froment, disent-ils, n’est pas plus cher aujourd’hui qu’en 1791, et comment le cultivateur pourrait-il soutenir la concurrence étrangère, lorsque, pendant cette période, ses taxes se sont accrues dans une si énorme proportion ? » Mais ils omettent de dire que, quoique le prix du blé n’ait pas varié depuis 1791, la rente a doublé et plus que doublé. (Écoutez !) Et voilà le vrai fardeau qui pèse sur le fermier, qui l’écrase, comme il écrase tout notre système industriel. — Oh ! que l’aristocratie jouisse de sa prospérité, mais qu’elle cesse de contrarier, d’enchaîner l’infatigable travail auquel elle la doit. Nous ne la craignons pas, avec ses forfanteries et ses menaces. Nous sommes ici librement, et ils siègent à Westminster par mandat royal ; nos assemblées sont accessibles à tous les hommes de cœur, et leurs salles sénatoriales ne sont que des enceintes d’exclusion. Ici, nous nous appuyons sur le droit ; là, ils s’appuient sur la force ; ils nous jettent le gant, nous le relevons et nous leur jetons le défi à la face. (Acclamations, l’assemblée se lève saisie d’enthousiasme ; on agite pendant plusieurs minutes les chapeaux et les mouchoirs.) Nous marcherons vers la lutte, — opinion contre force, — respectant la loi, leur loi, en esprit d’ordre, de paix et de moralité ; nous ferons triompher cette grande cause, et ainsi nous affranchirons, — eux, de la malédiction qui pèse toujours sur la tête de l’oppresseur, — nous, de la spoliation et de l’esclavage, — le pays, de la confusion, de l’abattement, de l’anarchie et de la désolation. (Applaudissements.) Le siècle de la féodalité est passé ; l’esprit de la féodalité ne peut plus gouverner ce pays. Il peut être fort encore du prestige du passé ; il peut briller dans la splendeur dont les efforts de l’industrie l’ont environné ; il peut se retrancher derrière les remparts de nos institutions ; il peut s’entourer d’une multitude servile ; mais l’esprit féodal n’en doit pas moins succomber devant le génie de l’humanité. L’esprit, le génie, le pouvoir de la féodalité, ont fait leur temps. Qu’ils fassent place aux droits du travail, aux progrès des nations vers leur affranchissement commercial, intellectuel et politique ! (L’orateur reprend sa place au milieu d’applaudissements enthousiastes qui se renouvellent longtemps avec une énergie dont il est impossible de donner une idée.)
Le président : Ladies et gentlemen, les travaux du meeting sont terminés. Après l’admirable discours que vous venez d’entendre, je suis fâché de vous retenir un moment ; mais un fait vient de parvenir à ma connaissance et je crois devoir le communiquer au meeting avant qu’il se disperse. — L’homme éminent auquel M. Fox a fait allusion dans son éloquent discours, ce grand homme qui, par la cause qu’il représente et le traitement qu’il a reçu, excite, j’ose le dire, plus d’intérêt et de sympathie que tout autre sujet de la reine, M. O’Connell (tonnerre d’applaudissements), a été prié d’assister au prochain meeting, et toujours fidèle à notre cause, il a déclaré qu’il saisirait la première occasion de manifester son attachement inébranlable aux principes de la Ligue. (Acclamations.)
Le meeting se sépare après avoir poussé trois hurrahs en faveur de M. O’Connell.
FN: « Prétendre enrichir un peuple par la disette artificielle, c’est une politique en contradiction avec le sens commun. » (Sir James Graham, ministre de l’intérieur.)
FN: Sir Robert Peel avait annoncé que son intention n’était pas de réviser la loi céréale.
FN: Il faut se rappeler que ce discours fut prononcé à l’époque du procès d’O’Connell.
FN: Propriétaire d’une partie de Londres.
FN: Propriétaire du théâtre de Covent-Garden.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE AU THÉATRE DE COVENT-GARDEN 21 février 1844.↩
Le meeting métropolitain de la Ligue, tenu mercredi dernier au théâtre de Covent-Garden, formera certainement un des traits les plus remarquables dans l’histoire de l’agitation commerciale.
Le nombre des billets demandés pendant la semaine a dépassé trente mille. Il n’y a aucune exagération à dire que si la salle eût pu contenir ce nombre d’assistants, elle aurait été encore bien étroite relativement aux besoins de la circonstance. Longtemps avant cinq heures, la foule encombrait toutes les avenues du théâtre ; elle est devenue telle, en peu de temps, qu’on a jugé à propos d’ouvrir toutes les portes. Aussitôt toutes les parties de la salle ont été envahies, une foule épaisse a stationné pendant toute la soirée dans les rues adjacentes, répondant par des applaudissements enthousiastes aux acclamations qui s’élevaient dans l’enceinte du meeting. À sept heures, le président, accompagné des membres du conseil et d’un grand nombre de personnages de distinction, s’est présenté sur l’estrade, mais M. O’Connell n’est arrivé qu’à près de 8 heures. Lorsque l’honorable membre a fait son entrée, l’enthousiasme de l’assemblée n’a plus connu de bornes. Les acclamations de l’auditoire, répétées au dehors, ont duré un quart d’heure, et il n’a fallu rien moins pour les apaiser que l’épuisement des forces physiques. Une autre circonstance, qui a excité au plus haut degré l’intérêt du meeting, c’est la présence de M. Georges Thompson, récemment arrivé de l’Inde. Nous avons remarqué, sur la plate-forme, des Aldermen, plusieurs généraux et une trentaine de membres du Parlement.
M. James Wilson a la parole. Malgré l’excitation de l’assemblée, ce profond économiste traite avec sa vigueur accoutumée quelques points relatifs à la liberté du commerce. Il est plusieurs fois interrompu par la fausse annonce de M. O’Connell. Enfin on apprend que le grand patriote irlandais va paraître. Toute l’assemblée se lève spontanément et ébranle les voûtes de Covent-Garden par des salves réitérées d’applaudissements. Les acclamations durent sans interruption pendant dix minutes consécutives. Toutes les voix s’unissent, tous les bras sont tendus, on agite les chapeaux, les mouchoirs, les shalls. M. O’Connell s’avance et salue l’assemblée à plusieurs reprises, mais chacun de ses saints ne fait que provoquer de nouvelles manifestations d’enthousiasme. Enfin l’honorable gentleman prend sa place, et M. Wilson continue son discours. Mais c’est surtout quand M. O’Connell se présente devant la table des orateurs que l’enthousiasme atteint son paroxysme. Covent-Garden en est ébranlé jusques aux fondements. Il est impossible d’exprimer ce qu’il y a d’imposant dans les acclamations de six mille voix auxquelles répondent du dehors les applaudissements d’une multitude innombrable. M. O’Connell paraît très-ému. Il essaye en vain de se faire entendre. Enfin le silence s’étant fait, il s’exprime en ces termes :
En me présentant au milieu de vous, mon intention était de faire ce soir un discours éloquent ; mais j’en cède la partie la plus sonore à un autre, et je commence par vous présenter 100 l. s. de la part d’un de mes amis qui est aussi un ami de la justice. (Applaudissements.) De telles souscriptions ont aussi leur éloquence, et si vous en obtenez 999 semblables, vous aurez vos 100,000 l. s. (Rires d’approbation.) Mais hélas ! là s’arrête mon éloquence, car où trouverais-je des expressions, de quel langage humain pourrais-je revêtir les sentiments de gratitude et de reconnaissance dont mon cœur est en ce moment pénétré ? On dit que ma chère langue irlandaise excelle à exprimer les affections tendres, mais il n’est pas au pouvoir d’une langue humaine, il n’est pas au pouvoir de l’éloquence, fût-elle imprégnée de la plus séraphique douceur, de rendre ces élans de gratitude, d’orgueil, d’excitation d’âme que votre accueil me fait éprouver. (Nouvelles acclamations.) Oh ! cela est bien à vous ! et c’est pour cela que vous l’avez fait. Cela est généreux de votre part, et vous avez voulu me donner cette consolation ! À toute autre époque de ma vie j’aurais été justement fier de votre réception ; mais je puis dire que je me trouve dans des circonstances, auxquelles je ne ferai pas autrement allusion[1], — qui décuplent et centuplent ma reconnaissance. — Je suis venu ici ce soir résolu à garder cette neutralité politique qui est le caractère distinctif de votre grande lutte. Il doit m’être permis de dire cependant, puisqu’aussi bien cela ne s’écarte pas de la question des lois-céréales, que je me réjouis de voir les ducs de Buckingham et de Richmond commencer à soupçonner qu’ils pourraient bien, eux aussi, être des « conspirateurs[2]. » (Approbation et rires.) C’est pourquoi ils sont partis — couple de vaillants chevaliers, — et de peur de se laisser entraîner par trop de vaillance, ils s’adressent à un magicien, dans le temple — un certain M. Platt — bonne créature — et lui demandent humblement : Dites, sommes-nous des conspirateurs ? — « Non, dit M. Platt, vous ne l’êtes pas. » — Il les regarde et voit qu’ils n’appartiennent pas à cette classe qui produit les conspirateurs, car le conspirateur penche toujours quelque peu du côté populaire. (Nouveaux rires.) — « Non, répète M. Platt, vous n’êtes pas des conspirateurs. » Mais malgré cette décision, je ne conseille pas aux nobles ducs de tenter l’épreuve de l’autre côté du canal. (Rires prolongés et acclamations.) Oui, votre réception m’est délicieuse, et je sens mon cœur prêt à éclater sous le sentiment de la joie, à l’aspect de cette sympathie entre les enfants de l’Angleterre et de l’Irlande. (Bruyantes acclamations.) Je vous ai dit que votre générosité me touche. Ah ! croyez bien que s’il existe sous le ciel une vertu qui surpasse la virile générosité des Anglais, on ne pourrait la trouver que dans la reconnaissance des Irlandais. — Oui, je le répète, votre conduite est noble, mais elle ne s’adresse pas à un ingrat.
Votre vénéré président a daigné m’introduire auprès de vous par quelques paroles bienveillantes. Il m’a rendu justice en disant que je suis, que j’ai toujours été un constant, ami de la Ligue. Je le suis non par choix ou par prédilection, mais par la profonde conviction que ses principes sont ceux du bien général. (Écoutez ! écoutez !) J’ai été élu au présent Parlement par deux comtés d’Irlande qui présentent ensemble une population agricole de plus de 1,100,000 habitants : les comtés de Meath et de Cork. Je représente le comté de Cork qui contient 750,000 habitants voués à l’agriculture. Je n’avais aucun moyen d’acheter ou d’intimider leurs suffrages, aucun ascendant seigneurial pour influencer leurs convictions consciencieuses ; mon élection ne m’a pas coûté un shilling, et une majorité de 1,100 votants, dans un district agricole, m’a envoyé au Parlement, sachant fort bien mes sentiments à l’égard des lois-céréales, et que j’étais l’ennemi très-décidé de toute taxe sur le pain du peuple. (Acclamations.) Bien plus, non-seulement mon opinion était connue, mais je l’avais si souvent émise et développée, que la même conviction s’était étendue dans tout le pays, à tel point que les monopoleurs n’ont pas essayé d’un seul meeting dans toute l’Irlande. — Je me trompe, ils en ont eu un où ils furent battus (rires) ; milord Mountcashel y assistait. (Murmures et sifflets.) Le pauvre homme ! il y était, et en vérité il y faisait une triste figure ; car il disait : « Nous autres, de la noblesse, nous avons des dettes, nos domaines sont hypothéqués, et nous avons des charges domestiques. » Un pauvre diable s’écria dans la foule : « Que ne les payez-vous ? » (Rires.) Quelle fut la réponse, ou du moins le sens de la réponse ? « Grand merci, dit milord, je ne paierai pas mes dettes, mais les classes laborieuses les paieront. J’obtiens un prix élevé de mes blés sous le régime actuel. Je serais disposé à être un bon maître et à réduire les fermages, si je le pouvais. Mais j’ai des dettes, je dois maintenir mes rentes, pour cela assurer à mes blés un prix élevé, et, au moyen de cette extorsion, je paierai mes créanciers… quand il me plaira. » (Rires.) — Il n’y a en tout cela qu’une proposition qui soit parfaitement assurée, c’est que milord Mountcashel obtiendra un grand prix de son blé ; quant à l’acquittement des dettes, il reste dans ce qu’on appelle à l’école le paulò post futurum, c’est-à-dire cela arrivera une fois ou autre. (Rires.)
Et, pas plus tard qu’hier, voici que le duc de Northumberland s’écrie, dans une proclamation à ses tenanciers : « Vous devez former des associations pour le maintien des lois-céréales ; car ces misérables et importuns conspirateurs de la Ligue vous disent que si ces lois sont abrogées, vous aurez le pain à bon marché. N’en croyez pas un mot, » ajoute-t-il. — Je pense pouvoir vous prouver qu’il ne s’en croit pas lui-même. Ne serait-ce pas une chose curieuse de voir un noble duc forcé de reconnaître qu’il ne croit pas à ses propres paroles? (Rires.) Cependant en voici la preuve. Il a conclu par ces mots : « La protection nous est nécessaire. » Mais quel est le sens de ce mot : protection ? Protection veut dire 6 deniers de plus pour chaque pain. C’est là la vraie traduction irlandaise. (Rires et applaudissements.) Protection, c’est le mot anglais qui signifie 6 deniers additionnels, et, qui plus est, 6 deniers extorqués. — Vous voyez bien que protection, c’est spoliation (applaudissements) et spoliation du pauvre par le riche ; car si le pauvre et le riche paient également ce prix additionnel de 6 deniers par chaque pain, le pain n’entre pas pour la millième partie dans la dépense d’un Northumberland, tandis qu’il constitue les neuf dixièmes de celle de la pauvre veuve et de l’ouvrier ; mais c’est un de vos puissants aristocrates, un de vos excessivement grands hommes, et son ombre ose à peine le suivre. (Rires bruyants et prolongés.) En voici un autre qui est un Ligueur, mais de cette Ligue qui a pour objet la cherté du pain ; c’est un autre protectionniste, c’est un autre homme de rapine. (Rires.) Il dit : « Oh ! ne laissez pas baisser le prix du pain, cela serait horrible ! » (Ici quelque confusion se manifeste au fond du parterre.) — Je crois qu’il y a là-bas quelques mangeurs de gens qui viennent troubler nos opérations. — Ce grand homme dit donc : « Cela serait horrible de vendre le pain à bon marché, car alors les bras seraient moins employés, et le taux des salaires baisserait. » Voyons comment cela peut être. Si le pain était à bon marché, ce serait parce que le blé viendrait des pays où on l’obtient à bas prix. Pour chaque livre sterling de blé que vous achèteriez dans ces pays,vous y enverriez pour une livre sterling d’objets manufacturés, de manière qu’au lieu de voir les salaires diminués, vous verriez certainement les bras plus recherchés. Cela est clair comme 2 et 2 font 4, et l’objection tombe complètement. Je parle ici comme un représentant de l’Irlande, et fort de la connaissance que j’ai de ce pays essentiellement agricole. Si votre législation devait avoir pour effet d’élever le taux des salaires, cet effet se serait fait sentir surtout en Irlande. Oserait-on dire qu’il en a été ainsi ? Oh ! non, car vous pouvez y faire travailler un homme tout un jour pour 4 deniers. (Honte ! honte !) L’ouvrier regarde comme son bienfaiteur le maître qui lui paie 6 deniers, et il croit atteindre la félicité suprême quand il obtient 8 deniers, — Tel est l’effet de la loi-céréale, elle agit en Irlande dans toute sa force, elle fait pour ce pays tout ce qu’elle peut faire, et cependant voilà le taux des salaires, et ce qu’il y a de pis, c’est que l’on n’y trouve pas d’emploi, même à ce taux. — Voilà pourquoi le peuple d’Irlande, et ceux même de la noblesse qui étudient en conscience les affaires publiques, voient cette question au même point de vue que je la vois moi-même ; en sorte que bien loin que l’Irlande soit un obstacle sur votre route, bien loin qu’elle soit une de vos difficultés (rires), elle est à vous tout entière, et de cœur et d’âme. (Applaudissements enthousiastes.) N’en avons-nous pas une preuve dans la présence au milieu de nous du représentant de Rochdale (acclamations), qui est un des plus grands propriétaires de l’Irlande, et un ami, vous le savez, de la liberté partout et pour tous. Je fais allusion à M. Crawford, qui représentait un comté d’Irlande avant de représenter un bourg d’Angleterre, et qui était Ligueur dans l’âme avant d’être membre du Parlement. (Bruyantes acclamations.) Il est donc clair que vous avez pour vous l’assentiment et les vœux de l’Irlande, et vous n’aurez pas peu de part dans sa reconnaissance, quand elle apprendra l’accueil que je reçois devons. Non, Anglais, le bruit des acclamations dont vous avez salué ma présence n’expirera pas dans les murs de celle enceinte. Il retentira dans votre métropole ; les vents d’orient le porteront en Irlande ; il remontera les rives du Shannon, de la Nore, de la Suir et du Barrow ; il réveillera tous les échos de nos vallées ; l’Irlande y répondra par des accents d’affection et de fraternité ; elle dira que les enfants de l’Angleterre ne doivent pas être affamés par la loi. (Acclamations qui durent plusieurs minutes.) — Je vous déclare que l’injustice et l’iniquité de l’aristocratie m’accablent d’une horreur et d’un dégoût que je suis incapable d’exprimer. Eh quoi ! si la loi-céréale actuelle n’existait pas ; si le ministère osait présenter un bill de taxes sur le pain ; s’il plaçait un agent à la porte du boulanger, chargé d’exiger le tiers du prix de chaque pain, taxe que le boulanger se ferait naturellement rembourser par le consommateur, y a-t-il un homme dans tout le pays qui supporterait une telle oppression ? (Grands cris : Écoutez ! écoutez !) Il ne servirait de rien au ministre de dire : « Cet argent est nécessaire à mes plans financiers; j’en ai besoin pour l’équilibre des recettes et des dépenses. » John Bull vociférerait : « Taxez ce qu’il vous plaira, mais ne taxez pas le pain. » Mais ne voit-on pas que, par le chemin détourné de la protection, ils font absolument la même chose ? Ils taxent le pain, non pour le bien de l’État, — du moins chacun y participerait, — non pour repousser l’invasion étrangère et pour maintenir la paix intérieure, mais pour le profit d’une classe, pour mettre l’argent dans la poche de certains individus. (Écoutez ! écoutez !) Véritablement, c’est trop mauvais pour que vous le supportiez et prétendiez passer pour un peuple jaloux de ses droits. (Rires.)
Je ne voudrais pas sans doute en ce moment vous manquer de respect ; mais tout ceci dénote quelque chose de dur et d’épais dans les intelligences que je ne m’explique pas. (Murmures d’approbation.) Duc de Northumberland ! vous n’êtes pas mon roi ! je ne suis pas votre homme-lige, je ne vous paierai pas de taxes. (Bruyantes acclamations.) Duc de Richmond ! il y a eu des Richmond avant vous, vous pouvez avoir du sang royal dans vos veines ; vous n’êtes pas mon roi cependant, je ne suis pas votre homme-lige, et je ne vous paierai pas de taxes ! (Applaudissements.) Qu’ils s’unissent tous ; c’est à nous de nous unir aussi, — paisibles, mais résolus, — tranquilles, mais fermes, décidés à en finir avec ces sophismes, ces tromperies et ces extorsions. — J’aimerais à voir un de ces nobles ducs prélever sa taxe en nature. — J’aimerais à le voir, pénétrant dans une des étroites rues de nos villes manufacturières, et s’avançant vers le pauvre père de famille qui, après le poids du jour, affecte d’être rassasié pour que ses enfants affamés se partagent une bouchée de plus, — ou vers cette malheureuse mère qui s’efforce en vain de donner un peu de lait à son nourrisson, pendant que son autre fils verse des larmes parce qu’il a faim. — J’aimerais, dis-je, à voir le noble duc survenir au milieu de ces scènes de désolation, s’emparer de la plus grosse portion de pain, disant : « Voilà ma part, la part de ma taxe, mangez le reste si vous voulez. » Si la taxe se prélevait ainsi, vous ne la toléreriez pas, et cependant, voilà ce que fait le lord, sous une autre forme. Il ne vous laisse pas entrevoir le fragment de pain, avant de l’emporter, seulement il prend soin qu’il ne vous arrive pas, et il vous fait payer de ce pain un prix pour lequel vous pourriez avoir et ce pain et le fragment en sus, si ce n’était la loi. (Écoutez ! écoutez !) Oh ! j’aurais mieux auguré de l’ancienne noblesse d’Angleterre ; je me serais attendu à quelque chose de moins vil de la part de ces hommes qui, je ne dirai pas « conspirent », car ils ne sont pas conspirateurs, — je ne dirai pas « se concertent, » quoique ce soit un crime qu’on ne punit guère que chez les pauvres, — mais qui se réunissent pour décider que le peuple paiera le pain plus cher qu’il ne vaut. Je répéterai ma proposition encore et encore, parce que je désire la fixer dans l’esprit de ceux qui m’écoutent ; c’est du vol, c’est du pillage. Ne nous laissons pas prendre à l’appât de l’augmentation des salaires. Augmentation des salaires ! mais ouvrez le premier livre venu d’économie politique, vous y verrez que chaque fois que le pain a été à bas prix, les salaires ont été élevés ; ils ont été doublement élevés puisque l’ouvrier avait plus d’argent et achetait plus de choses avec le même argent. Tout cela est aussi clair que le soleil — et nous nous laissons embarrasser par ces sophismes ! Il semble que nous soyons des bipèdes sans tête et qui pis est sans cœur. Oh ! finissons-en avec ce système ! (Applaudissements.)
Le Parlement n’est-il pas composé de monopoleurs ? n’y sont-ils pas venus en grande majorité, non-seulement des comtés, grâce à la clause Chandos, moins encore en achetant des bourgs[3] !
Il y a deux ans, on admettait ouvertement, aux deux côtés de la Chambre, que jamais la corruption n’avait autant influencé l’élection d’un Parlement. M. Rëbuck le proclamait d’un côté ; sir R. Peel l’admettait de l’autre sans difficulté. Quoique opposés en toute autre chose, ils étaient au moins parfaitement d’accord sur ce point. (Rires.) — Et voilà vos modèles de vertu et de piété ; voilà les soutiens de l’Église ; voilà les hommes qui puniraient volontiers un malheureux s’il venait à se tromper le dimanche sur le chemin qui conduit au temple ; oui, ces grands modèles de moralité lèvent vers le ciel le blanc des yeux, contristés qu’ils sont par l’iniquité d’autrui, lorsqu’eux-mêmes mettent les mains dans les poches du malheureux qui a besoin de nourrir sa famille ! (Immenses acclamations.) Oh ! cela est trop mauvais. Voilà ce qu’il faudrait « proclamer » dans tout le pays. Voilà ce qui doit inspirer aux hommes justes et sages de la défiance, de la désaffection et du dégoût. Si les nobles seigneurs épousent la cause du pauvre et du petit, oh ! que toutes les bénédictions du ciel se répandent sur eux ; mais s’ils persistent à appauvrir le pauvre, à augmenter la souffrance de celui qui souffre, à accroître la misère et le dénûment, — afin que le riche devienne plus riche et fasse servir la taxe du pain à libérer ses domaines, alors je dis : Honte à eux, qui pratiquent l’iniquité ; et honte à ceux qui ne font pas entendre leurs doléances, jusqu’à ce que la grande voix de l’humanité, comme un tonnerre, effraye le coupable, et donne au pays et au peuple la liberté. (Bruyantes acclamations.) Oui, mes seigneurs, vous entrez dans la bonne voie et je suis convaincu que vos efforts pour contre-balancer ceux de la Ligue auront un effet contraire. Nous voici donc à même d’argumenter avec eux. Amenez-les à raisonner, et ils sont perdus. Qu’ils viennent à l’école primaire (et beaucoup d’entre eux n’ont guère jamais été au delà), nous leur disputerons le terrain pied à pied ; nous les combattrons de point en point. Plus ils entraîneront de monde à leurs meetings, plus nous aurons de chances de voir la vérité se répandre, et les fermiers surmonter l’illusion dont on les aveugle, — Pourquoi les seigneurs n’accordent-ils pas de baux aux fermiers ? Ceux-ci ne seraient-ils pas mis à même par là de nourrir leurs ouvriers et de prendre part dans leur voisinage aux associations de bienfaisance ? Mais non ; le seigneur veut tout avoir. Son nom est Behemoth, et il est insatiable. (Rires et applaudissements.) Vous êtes engagés dans une lutte glorieuse, et je suis fier qu’il me soit donné d’y prendre part avec vous. C’est avec une joie profonde que j’y apporte la coopération de mes talents, quelque faibles qu’ils soient, et le secours d’une voix fatiguée par de longues épreuves. Tels qu’ils sont, je les consacre de grand cœur à votre cause sacrée. (Applaudissements.) Je me hasarderai à dire de moi-même qu’on m’a trouvé du côté de la liberté dans toutes les questions qui ont été agitées, depuis que je fais partie du Parlement. Je ne demande pas à quelle race, à quelle caste, à quelle couleur appartient une créature humaine, je réclame pour elle les priviléges et les droits de l’homme, et la protection, non du volet du pillage, mais la protection contre l’iniquité quelle qu’elle soit. (Bruyantes acclamations.) Je ne puis donc que m’unir à vous ; et, quel que soit le sort qui m’attend, — que ce soit la prison ou même l’échafaud (grands cris : Non, non, jamais ! jamais !) — je suis convaincu que si cela dépendait de vos votes, il n’en serait pas ainsi. (Une voix : Nous ne sommes pas contre vous.) Je crois à voire sincérité (rires), — je me félicite d’être engagé avec vous dans cette lutte. J’en comprends toute la portée. Je sais combien la liberté des échanges favoriserait votre commerce en vous ouvrant des débouchés ; je sais combien elle contribuerait à renverser l’ascendant politique d’une classe, ascendant qui me semble avoir sa racine dans la loi-céréale. C’est là un stimulant à tous les genres d’iniquité. L’aristocratie comprend l’injustice de sa position, et elle appelle à sa défense toute la force, toutes les formalités de la législation. Mais elle ne réussira pas, — les yeux du peuple sont ouverts ; l’esprit public est éveillé. Jamais l’Angleterre n’a voulu et voulu en vain. — Jadis elle poussa sa volonté jusqu’à l’extravagance, et fit tomber sur l’échafaud la tête d’un monarque insensé. Ce fut une folie, car elle amena le despotisme militaire qui suit toujours la violence. Plus tard, le fils de ce roi viola les lois du pays, et le peuple, instruit par l’expérience, n’abattit pas sa tête, mais se contenta de l’exiler pour avoir foulé aux pieds les droits de la nation. — Ces violentes mesures ne sont plus nécessaires ; elles ne sont plus en harmonie avec notre époque. Ce qui est nécessaire, c’est un effort concerté et public ; cet effort commun qui naît de la sympathie, de l’électricité de l’opinion publique. Oh oui ! cette puissante électricité de l’opinion s’étendra sur tout l’empire. L’Écosse partagera notre enthousiasme ; les classes manufacturières sont déjà debout, les classes agricoles commencent à comprendre qu’elles ont les mêmes intérêts. Le temps approche… il est irrésistible. Ils peuvent tromper çà et là quelques électeurs ; d’autres peuvent être intimidés ; mais l’intelligence publique marche, comme les puissantes vagues de l’Océan. Le tyran des temps anciens ordonna aux flots de s’arrêter, mais les flots s’avancèrent malgré ses ordres et engloutirent l’insensé qui voulait arrêter leurs progrès. — Pour nous, nous n’avons pas besoin d’engloutir les grands seigneurs, nous nous contenterons de leur mouiller la plante des pieds. (Rires.) Mais, vraiment, cette lutte offre un spectacle magnifique ; quel pays sur la surface de la terre aurait pu faire ce que vous avez fait ? L’année dernière, vous avez souscrit 50,000 liv. sterl., c’est le revenu de deux ou trois petits souverains d’Allemagne. Cette année vous aurez 100,000 liv. sterl., et, s’il le faut, vous en aurez le double l’année prochaine. (Applaudissements.) Oui, ce mouvement présente le spectacle d’un majestueux progrès. Chaque jour de nouvelles recrues grossissent nos rangs ; et nous, vétérans de cette grande cause, nous contemplons avec délices et la force toujours croissante de notre armée et l’esprit de paix qui l’anime. — La puissance de l’opinion se manifeste en tous lieux. Les plus violents despotes, à l’exception du monstre Nicolas, s’interdisent ces actes cruels qui leur étaient autrefois familiers. L’esprit de l’Angleterre veille, il ne s’endormira plus jusqu’à ce que le pauvre ait reconquis ses droits et que le riche soit forcé d’être honnête. (L’honorable et docte gentleman s’assoit au bruit d’acclamations véhémentes et prolongées.)
M. George Thompson s’avance au bruit des applaudissements et s’exprime en ces termes : M. le président, quand je suis venu ce soir dans cette enceinte pour assister à la réception de M. O’Connell, je ne pensais pas à être appelé à prendre la parole, et je sens bien que je ne puis guère être que cette ombre dont parlait M. O’Connell, qui ne suivait de loin son maître qu’avec crainte.
Messieurs, le spectacle dont je suis témoin est bien fait pour enivrer mon cœur. Depuis deux ans, j’ai été absent de mon pays, et j’ai parcouru des régions lointaines qui n’ont jamais vu des scènes, qui n’ont jamais entendu des accents tels que ceux qui viennent de réjouir ma vue et mes oreilles. Mais quoique je me sois éloigné de plus de 15,000 milles de l’endroit où nous sommes réunis, jamais je ne suis parvenu en un lieu où ne soit pas arrivé le bruit de vos glorieux travaux ; partout j’ai entendu parler de cette association gigantesque, qui a entrepris de purifier, de diriger et de préparer pour un grand et définitif triomphe les sentiments et l’opinion publique de la Grande-Bretagne. Il a été dans ma destinée, sinon de m’associer intimement aux efforts de la Ligue, du moins de suivre ses progrès depuis son origine, et de compter mes meilleurs et mes plus vieux amis parmi ceux qui ont accepté avec tant de dévouement le poids du travail et la chaleur du jour. De retour sur ma terre natale, je me plais à comparer la situation de cette cause à ce qu’elle était quand je pris congé à Manchester d’un meeting rassemblé pour le même objet qui vous réunit dans cette enceinte. Je me séparai de la Ligue au milieu d’une assemblée provinciale de douze cents personnes, et je la retrouve représentée par six fois ce nombre dans le plus vaste édifice de la métropole. Alors, vous luttiez contre des adversaires silencieux, — pleins de confiance en leur rang, en leurs richesses, en leurs grandeurs, — spectateurs muets de vos progrès parmi les classes laborieuses. — Maintenant je vous retrouve combattant ouvertement et à armes courtoises ces mêmes adversaires ; mais ils ont rompu le silence ; leurs plans sont déconcertés, leurs espérances évanouies, leurs forces diminuées, et les voilà forcés, dans l’intérêt de leur défense, de recourir à ces mêmes mesures qu’ils ont tant de fois blâmées. (Acclamations.) Faut-il mal augurer de votre cause parce qu’ils imitent vos procédés ? Non, certainement. Je crois au contraire que rien ne peut vous être plus favorable que d’être mis à même de connaître tous les arguments, — si on peut leur donner ce nom, — par lesquels ils s’efforcent de soutenir, au dedans comme au dehors des Chambres, les monopoles dont ils profitent. Gentlemen, je vous félicite de vos progrès ; je vous félicite de la fermeté avec laquelle vous avez toujours adhéré aux vrais principes, et de l’assentiment que vous avez obtenu des intelligences les plus éclairées. Je vous félicite d’avoir maintenant réuni autour de votre bannière à peu près tout ce qu’il y a d’estimable et d’excellent dans notre chère patrie. — Partout où j’ai porté mes pas, en Égypte comme dans l’Inde, j’ai vu le plus vif intérêt se manifester pour les travaux de cette association ; partout j’ai entendu exprimer le plus profond étonnement de la folie et de l’infatuation de ceux qui prétendent fonder leur prospérité sur les désastres et la pauvreté, et la faim, et la nudité et le crime du peuple, prospérité bien odieuse et bien coupable achetée à ce prix ! Il n’y a qu’une opinion à cet égard parmi les hommes que n’aveuglent pas l’esprit de parti ou l’intérêt personnel. Ils ne peuvent traverser des plaines incommensurables, en calculer les ressources, estimer la facilité avec laquelle on pourrait transporter sur le rivage, et de là à travers l’Océan, vers notre pays, des objets propres à soutenir la vie de tant de nos frères qui périssent jusque sous nos yeux ; ils ne peuvent savoir que la valeur de ces aliments reviendrait vers les lieux de leur origine sous une autre forme également avantageuse ; ils ne peuvent, dis-je, voir et comprendre ces choses sans être frappés d’étonnement à l’aspect de la monstrueuse et révoltante spoliation qui se pratique dans ce pays. (Acclamations.) Gentlemen, je n’ai jamais eu qu’une vue sur le régime restrictif, et c’est une vue qui les embrasse toutes ; qui satisfait pleinement mon esprit et qui a fait de moi ce que je suis : un ennemi déclaré absolu, universel, éternel des lois qui circonscrivent les bienfaits de la divine Providence, et disent aux dons que Dieu a répandus avec tant de libéralité sur la surface de la terre : « Vous irez jusque-là, vous n’irez pas plus loin. » (Tonnerre d’applaudissements.) Tout point de vue étroit, — je dirai même national, — de la question, — perd à mes yeux de son importance, quand je viens à penser qu’il n’a pu entrer dans les desseins de Dieu, qu’un peuple toujours croissant, dans l’enceinte de frontières immuables, dépendît de son sol pour sa subsistance ; tandis que les routes de l’Océan, le génie des hommes de science, la bravoure de nos marins, l’audace de nos armateurs, la fécondité des régions lointaines, la prospérité du monde, et la variété qui se montre dans la dispensation et dans la paternelle sollicitude de notre Créateur, révèlent assez qu’il a voulu que les hommes échangeassent entre eux les dons divers qu’ils tiennent de sa munificence, et que l’abondance d’une région contribuât au bien-être et au bonheur de toutes. (Acclamations.) À mes yeux, l’offense commise par les promoteurs de ces lois, est une de celles qui atteint le trône de Dieu même. Le monopole, c’est la négation pratique des dons que le Tout-Puissant destinait à ses créatures. Il arrête ces dons au moment où ils s’échappaient des mains de la Providence pour aller réjouir le cœur et ranimer les forces défaillantes de ceux à qui elle les avait destinés. Sur une rive, les aliments surabondent ; sur l’autre, voilà des hommes affamés qui commettraient un crime s’ils touchaient un grain de ces moissons jaunissantes qui ont été prodiguées à la terre pour le bien de tous. Que me parle-t-on d’intérêts engagés, de droits acquis, du droit exclusif de l’aristocratie à ces moissons ? Je connais ces droits. Je respecte le rang de l’aristocratie, alors surtout qu’elle y joint ce qui est plus respectable que le rang, cette sympathie pour ses frères qui doit s’accroître en proportion de ce que Dieu a été bon pour elle, et qu’il a jugé à propos de leur retirer ses bienfaits temporels. (Acclamations.) Que le seigneur garde ce qui lui appartient loyalement ; qu’il possède ses enclos, ses parcs et ses chasses ; qu’il les entoure de murs, s’il le veut, et qu’il fasse inscrire sur les poteaux : « Ici on a tendu des piéges aux hommes. » Je n’entreprendrai pas sur ses domaines, je ne regarderai pas par-dessus ses murs, je me contenterai de suivre la route poudreuse, pourvu qu’arrivé au terme de mon voyage, je puisse acheter pour ma famille le pain que la bonté de Dieu lui a destiné. (Applaudissements.) L’opulent seigneur demande protection ! Mais il la possède. Il la possède dans la supériorité de ses domaines, dans leur proximité des centres de population ; il la possède dans l’éloignement des plaines rivales, dans les tempêtes et les naufrages auxquels sont exposés sur l’Océan les vaisseaux qui apportent dans ce pays les productions étrangères ; dans les frais de toutes sortes, assurances, magasinages, commissions dont ces produits sont grevés. Voilà ce qui constitue en sa faveur une protection naturelle aussi durable que l’Océan et dont personne ne peut le priver. Mais il veut plus ; il veut que la loi élève encore artificiellement le prix de son blé, et que le pauvre lui-même soit forcé de le lui acheter, ne lui rendant le droit de se pourvoir dans le marché du monde que lorsque la possibilité lui échappe de bénéficier par la confiscation de ce droit.
… Gentlemen, la législation de ce pays a beaucoup pris sur elle. On parle de désaffection, d’insubordination, de conspiration ! Je demande où sont les causes de ces maux. Je cherche le coupable ; je m’adresse à celui qui tient en ses mains le châtiment, et je lui dis : c’est toi ! (Écoutez !) Une loi injuste, c’est un germe révolutionnaire. Suivez-la dans son action jusqu’à ce qu’elle commence à flétrir, appauvrir, fouler et provoquer l’humanité. Puis vient le temps de l’appel des patriotes ; puis celui de l’écho populaire ; puis l’attitude de la détermination et du défi, et puis enfin les persécutions, la prison, l’échafaud, les martyres. (Acclamations.) Mais je remonte aux criminels originaires, aux hommes qui ont conçu la funeste loi, et je leur dis : Vous avez fomenté la désaffection, vous avez popularisé la résistance patriotique ; vous avez provoqué les plaintes du peuple ; vous avez organisé la persécution; c’est vous qui commettez le crime, c’est vous qui devez subir le châtiment. Gentlemen, telle est mon opinion ; si les gouvernements étaient justes, l’esprit de sédition mourrait faute d’aliment (écoutez), et si les lois étaient équitables, les chaînes seraient livrées à la rouille. C’est pourquoi je m’en prends aux mauvaises lois, et j’en vois beaucoup dans cette île et plus encore dans une île voisine. Elles nous avertissent que si nous voulons rétablir la paix et l’amitié, maintenir l’union et la loyauté, si nous voulons que la Grande-Bretagne soit ce qu’elle a toujours été, « maîtresse des mers, invincible dans les combats, » nous devons faire justice au peuple, et non-seulement rendre la liberté aux noirs des Antilles, mais encore affranchir le pain de l’ouvrier anglais. (Applaudissements.)
FN: M. O’Connell parut au meeting de l’Anti-corn-law-league, dans l’intervalle qui sépara sa condamnation de son emprisonnement (21 février 1844).
FN: À cette époque, l’aristocratie anglaise organisait une agitation en faveur des monopoles ; la loi lui était aussi bien applicable qu’à l’agitation irlandaise.
FN: Il y a à la Chambre des communes deux classes de représentants, ceux des comtés et ceux des bourgs. — Pour être électeur de comté, il suffit d’avoir une propriété (freehold) de 40 sh. de rente. C’est ce qu’on nomme la clause Chandos. Il est aisé de comprendre que les possesseurs du sol ont pu faire autant d’électeurs qu’ils ont voulu. C’est en mettant en œuvre cette clause sur une grande échelle qu’ils acquirent, en 1841, cette majorité qui renversa le cabinet whig. Jusqu’ici la Ligue n’avait pu porter la bataille électorale que dans les villes et bourgs. On verra plus loin que M. Cobden a proposé et fait accepter un plan qui semble donner des chances aux free-traders même dans les comtés. Ce plan consiste à décider tous les amis de la liberté du commerce, et particulièrement les ouvrier, à consacrer en acquisitions de freeholds toutes leurs économies.
Séance du 28 février 1844.↩
M. Ashworth : Ce n’est pas une chose ordinaire que de voir un manufacturier du Nord abandonner ses foyers et ses occupations pour se montrer devant une telle assemblée. Un manufacturier a autre chose à faire, et il est peu enclin à recourir à ses concitoyens alors même qu’il se sent lésé. Il répugne naturellement à l’agitation ; et absorbé par l’étude pratique des sciences et des arts qui se lient à l’accomplissement de son œuvre, il aimerait à ne pas s’éloigner de ses intérêts domestiques, s’il n’y était forcé par des lois pernicieuses. Messieurs, c’est avec une pleine confiance que j’en appelle à vous, comme manufacturier, parce que j’ai la conviction que j’appartiens à une classe d’hommes qui ne réclame que ses droits. (Applaudissements.) On les a accusés d’être difficiles dans leurs marchés ; ils ont cela de commun avec tous les hommes prudents, et vous comme les autres, sans doute. (Rires.) Mais on ne peut au moins leur imputer d’avoir une grande maison commerciale, sous le nom de Parlement, de s’en servir pour circonvenir les intérêts de la communauté, et fixer eux-mêmes le prix de leur marchandise. Messieurs, les manufacturiers ne jouissent d’aucune protection ; ils n’en demandent pas ; ils repoussent le système protecteur tout entier, et tout ce qu’ils réclament, c’est que tous les sujets de S. M. soient placés à cet égard, ainsi qu’eux-mêmes, sur le pied de l’égalité. (Écoutez ! écoutez !) Est-ce là une exigence déraisonnable ? (Bien.) Les landlords vous disent qu’ils ont besoin de protection ; qu’ils ont droit à être protégés par certaines considérations. Je ne vous dirai pas quelles sont ces considérations. Je laisse ce soin à lord Mountcashel et
sir Edward Knatchbull. Ils ne vous l’ont pas laissé ignoré[1].
(Rires et applaudissements.) Ils disent encore qu’ils ont besoin de protection pour lutter contre l’étranger. Pour ce qui me regarde, je ne sais pas sous quels rapports le peuple anglais est inférieur aux autres peuples. Je suis convaincu que les fermiers anglais, et notamment les ouvriers des campagnes, sont capables d’autant de travail que toute autre classe de la communauté ; et il n’en est pas qui soient plus en mesure de soutenir la concurrence étrangère, pourvu que les landlords leur permettent de se procurer les aliments à un prix naturel. (Applaudissements.) Les manufacturiers sont bien exposés à cette concurrence. Pourquoi les landlords en seraient-ils affranchis ? (Très-bien.) Je le répète, les manufacturiers ne jouissent d’aucuns privilèges ; ils n’en veulent pas. Ils n’ont, sous le rapport des machines, aucun avantage qui ne soit commun au monde entier. (Écoutez ! écoutez !) Nous empruntons aux autres peuples leurs inventions et leurs perfectionnements ; nous les appliquons à nos machines et en augmentons ainsi la puissance ; et si l’exportation de ces machines perfectionnées fut autrefois prohibée, elle est libre aujourd’hui, et il n’est aucun peuple qui ne puisse se les procurer à aussi bon marché que nous-mêmes. La loi prohibitive de l’exportation des machines a été abrogée, il y a un an ou deux ; et quoique à cette époque notre industrie fût dans une situation déplorable, — quoiqu’il ne manquât pas de bons esprits qui regardaient la libre exportation de nos belles machines, comme une mesure hasardeuse pour le maintien de notre supériorité manufacturière, — cependant, nous ne fîmes aucune opposition à cette mesure, et nous la laissâmes s’accomplir sans hésiter, sans incidenter, en esprit de justice et de loyauté. (Acclamations.) Ainsi, après avoir conféré à l’étranger tous les avantages que nous pouvions retirer de la supériorité de nos machines, nous demandons à être affranchis de toutes restrictions, et nous posons en principe que, puisque les manufacturiers sont abandonnés à l’universelle concurrence, ils ont le droit de dire qu’il leur est fait injustice si une autre classe — et notamment l’opulente classe des landlords — jouit d’avantages exclusifs, d’avantages qui ne soient pas communs à toutes les autres.
On a dit que le marché intérieur était le plus important pour l’industrie manufacturière. — Je suis en mesure d’évaluer l’importance du marché intérieur en ce qui concerne ma propre industrie, l’industrie cotonnière. Elle s’alimente principalement par l’exportation. On voit dans l’ouvrage de Brom, qu’une balle seulement de coton sur sept est mise en œuvre pour la consommation du pays, et, par conséquent, cette consommation ne paie qu’un septième de la main-d’œuvre britannique qui est consacrée à cette branche, ou environ un jour par semaine. (Écoutez ! écoutez !) Ne perdez pas de vue que c’est là la totalité de la consommation du pays. Ainsi, cette clientèle de l’aristocratie terrienne, qu’on nous dépeint en termes si pompeux, se réduit, quand nous venons à l’examiner de près, à payer une fraction d’un jour pour une semaine de travail ; et quant aux débouchés que nous offrent les autres classes, — car les landlords ne sont pas nos seuls acheteurs, — je me bornerai à dire que cette métropole seule consomme plus que toute l’Irlande ; et la ville de Manchester, plus que le comté de Buckingham. (Écoutez ! écoutez !) — Venons aux exportations. — Je viens de vous dire qu’elles s’élèvent aux six septièmes de ce que nous fabriquons. Il en résulte que nous dépendons de l’étranger pour les six septièmes de notre travail, et comme nous n’avons aucun empire sur la législation étrangère, nous sommes incapables de recevoir aucune protection, dans cette mesure, alors qu’elle nous serait offerte. — Considérons maintenant l’intérêt agricole. La fabrication des aliments n’est pas, dans ce pays, une industrie d’exportation. Elle possède, dans le pays même, le meilleur marché du monde, et jouit encore de la protection. Il fut un temps où les produits agricoles de l’Angleterre étaient exportés, où les landlords vendaient leurs céréales au dehors. Ce temps n’est plus. Aujourd’hui notre population consomme tous les grains que le pays peut produire, et ses besoins en réclameraient bien davantage, s’il lui était permis d’en recevoir. (Écoutez ! écoutez !) Ainsi, les propriétaires, voyant que notre population manufacturière consomme tous leurs produits, ont cessé de les exporter, car ils ont l’avantage de vendre cet insuffisant produit sur un marché où l’offre est constamment inférieure à la demande. Ce n’est point là, comme je viens de le démontrer, la situation de l’industrie manufacturière. Les six septièmes de ses produits sont exportés. Arrêtez un moment votre attention aux conséquences de cet état de choses, les aliments sont la matière première du travail, précisément comme le coton est la matière première de l’étoffe. Il s’ensuit que les balles de produits fabriqués que nous exportons contiennent virtuellement du froment et autres produits agricoles aussi bien que du coton. (Écoutez ! écoutez !) C’est ainsi que les propriétaires du sol, tout en cessant de vendre directement au dehors, se sont déchargés de ce soin sur les manufacturiers, et se sont mis en possession d’un moyen indirect d’exportation beaucoup plus commode et surtout plus profitable. Ils se sont épargné les embarras de convertir leurs denrées en argent sur les marchés étrangers, et les manufacturiers, par la circulation que je viens de décrire, ont pris cette peine à leur charge. (Écoutez ! écoutez !) Ainsi le manufacturier anglais, qui accomplit ses opérations sous l’influence des lois-céréales, est d’abord contraint de payer un prix législativement artificiel pour ses aliments et ceux de ses ouvriers ; ensuite, puisque ses produits sont destinés à l’exportation, et puisqu’ils sont une sorte d’incarnation de denrées agricoles anglaises, combinées, sous forme de travail, avec le coton et autres matières premières, il devient l’intermédiaire malheureux de la revente de ces mêmes aliments, livré à la concurrence du monde entier, sur des marchés lointains, où les produits similaires se vendent peut-être pour la moitié du prix qu’ils lui ont coûté dans la Grande-Bretagne. (Applaudissements.) Ainsi, nous sommes devenus les instruments du propriétaire pour la défaite de ses denrées, et, ce qu’il y a de pire, l’opération nous constitue en perte pour la moitié de leur valeur. (Écoutez ! écoutez !) Comme manufacturier travaillant pour l’exportation, je m’arrêterai encore un moment sur cette partie de mon sujet. Vous n’aurez pas de. peine à comprendre cet axiome général : Les importateurs sont des acheteurs. Donc, le critérium de la prospérité d’un pays ce n’est pas ses exportations, mais ses importations. Je le répète, les importateurs sont des acheteurs. Permettez-moi d’éclairer ceci par un exemple. Le navire qui aborde nos rivages chargé de marchandises, n’importe la provenance, est la personnification d’un marchand étranger à la bourse bien garnie ; car le chargement est bientôt converti en argent, et cet argent est à la disposition du consignataire pour être de nouveau converti en marchandises d’exportation. Plus donc il nous arrive de ces navires, plus il nous arrive d’acheteurs. — Au sujet de nos impôts, je vous ferai observer que les marchandises qui nous viennent du dehors ne passent pas directement du rivage au magasin du négociant. Elles s’arrêtent d’abord à la douane, et là, elles payent un droit fiscal. Comme free-traders nous n’avons pas d’objection contre un tel droit. Il est juste et convenable d’asseoir une partie des recettes publiques sur les marchandises étrangères. Mais ici nous distinguons et nous disons : S’il est juste que nous payions un droit pour le revenu public, il ne l’est pas que nous en payions un autre pour des avantages personnels, et notamment pour grossir les rentes des propriétaires du sol. Messieurs, nos importations devraient être libres. Dans un pays éclairé, elles seraient libres comme les vents qui les poussent vers nos rivages. (Applaudissements.) Supposez-vous transportés par la pensée dans un autre pays, — car je ne veux pas vous offenser inutilement en citant votre propre patrie, — supposez que vous voyez sur les côtes des hommes en uniforme, allant et venant, un mousquet d’une main et une lunette de l’autre. Si l’on vous disait qu’il s’agit d’un service préventif, d’un service destiné par le gouvernement à empêcher l’arrivage des navires, et, par suite, l’introduction des produits étrangers, ne déclareriez-vous pas que c’est là pour ce pays, l’indice d’une ignorance qui va jusqu’au suicide ? et ne jugeriez- vous pas que ses lois commerciales remontent aux siècles les plus barbares ? C’est pourtant l’esprit, je regrette de le dire, qui caractérise notre législation. Nos lois admettent les objets de luxe, les vins, les soieries, les rubans à l’usage des grands et des riches ; elles laissent librement entrer ces choses moyennant un droit fiscal, et elles prohibent l’importation des aliments, c’est-à-dire de ce qui affecte le plus les classes pauvres et laborieuses. De telles lois sont le fruit de l’injustice, et nous nous élevons contre leur partialité. Les seigneurs disent que c’est là une question manufacturière. S’ils l’ont ainsi stigmatisée, c’est qu’ils ont surtout trouvé les manufacturiers prompts et persévérants à combattre leurs priviléges. Mais nous repoussons leur imputation. Non, ce n’est pas la cause des manufacturiers ; c’est votre cause; c’est la mienne, c’est la cause de tous. Ce n’est pas une question individuelle, c’est une question générale, qui intéresse toute la communauté ! Le manufacturier voit son industrie lésée, ses ouvriers affamés, et dès lors il lui appartient, il appartient à tout homme dans cette situation, de se plaindre. — Cette vaine clameur des landlords est suivie d’une autre. C’est la sur-production[2], disent-ils, qui fait tout le mal. On les entend crier : « Ces manufacturiers prétendent vêtir l’univers entier. » Peut-être feraient-ils mieux de nous laisser d’abord vêtir l’univers, et si, par là, nous portions le trouble et la misère dans le pays, ils seraient à temps de gémir. (Rires et approbations.) Cependant examinons la question de plus près. Supposez que nous parvinssions à habiller l’univers entiers, nous n’avons pas encore trouvé le secret de faire des calicots éternels (rires), ils s’usent, et dès lors ceux que nous avons accoutumés à en porter en réclameront d’autres. Voilà donc une source permanente de travail. (Écoutez !) ne serait-ce point une chose plaisante de voir venir à cette tribune un manufacturier du Lancastre, pleurant comme Alexandre, de ce qu’il ne lui reste point un autre monde, non à conquérir, mais à habiller ? (Éclats de rire.) En tout cas, au milieu de son chagrin, il aurait au moins cette consolation, fondement d’une espérance légitime, que s’il parvient à vêtir l’univers, c’est bien le moins qu’il ait le droit d’être nourri. (Acclamations.) Je n’ai encore entendu personne se plaindre qu’il avait trop de vêtements. (Une voix dans les galeries : Je suis sans. Rire universel.) Quel que soit leur bas prix, nul ne se fâche de les avoir à trop bon marché. Les landlords se réunissent de temps à autre, et on les entend se flatter d’être de bons patriotes, parce qu’ils font deux coupes de foin là où ils n’en faisaient qu’une autrefois. Gentlemen, à ce compte, je puis aussi, comme manufacturier, réclamer le titre de patriote, car je fais maintenant deux chemises pour moins qu’une seule ne me coûtait il y a quelques années. (Rires). Mais je n’accepte ni pour les landlords ni pour moi-même la qualification de patriote ou de philanthrope à ce titre. La même cause, la même impulsion nous fait agir, et c’est notre intérêt éclairé. (Écoutez ! écoutez !) Mais voici une autre clameur de l’aristocratie. Elle s’en prend aux machines.
Ici l’orateur combat l’erreur qui fait considérer les machines comme nuisibles à l’emploi du travail humain. Il établit, par des faits nombreux, qu’il y a dans tous les comtés où les machines ne sont pas employées, une tendance à émigrer vers ceux où elles sont le plus multipliées. Ce sujet ayant déjà été traité par d’autres orateurs, et notamment par M. Cobden, nous supprimons, quoiqu’à regret, cette partie du remarquable discours de M. Ashworth.
FN: Allusion à l’aveu fait par ces deux personnages que la protection leur était nécessaire pour payer leurs dettes, dégager leurs domaines et doter leurs filles.
FN: Sur-production, autre néologisme pour traduire le mot over-production, excès de production. Ici au moins je puis m’étayer de l’autorité de M. de Sismondi.
Séance du 17 avril. — Présidence de M. Cobden.↩
Le président rend compte des nombreux meetings auxquels les députations de la Ligue ont assisté, depuis la dernière réunion de Covent-Garden, à Bristol, Wolwerhampton, Liverpool, etc. — Il parle aussi des mesures prises par l’association pour porter principalement la discussion partout où se font des élections, afin de répandre la lumière précisément au moment où l’excitation, qui accompagne toujours les luttes électorales, dispose le public à la recevoir. C’est pourquoi dorénavant la Ligue portera toutes ses forces dans tout bourg où un certain nombre d’électeurs, quelque petit qu’il soit, sera disposé à appuyer la candidature d’un free-trader.
M. Ward, membre du Parlement, prononce un discours plein de faits curieux, de données statistiques et de solides arguments.
Le colonel Thompson succède à M. Ward. Ce vétéran de la cause de la liberté commerciale s’est acquis en Angleterre une immense réputation par ses discours et ses nombreux écrits. Nous aurions beaucoup désiré le faire connaître au public français. Malheureusement pour nous, le brave officier est dans l’usage de revêtir des pensées profondes de formes originales, et d’un langage incisif et populaire entièrement intraduisible. — Nous essayerons peut-être, à la fin de cet ouvrage, de faire passer dans notre langue au risque de les affaiblir, quelques-unes de ses pensées.
Le président. J’ai l’honneur de vous présenter un des orateurs les plus accomplis de l’époque, un homme qui a déjà déployé des talents de l’ordre le plus élevé dans une grande cause humanitaire, égale en importance à celle qui nous réunit aujourd’hui. Il a puissamment contribué à l’émancipation des esclaves de nos colonies des Indes occidentales et, quant à moi, je n’ai jamais pu apercevoir la moindre différence entre spolier l’homme tout entier en le forçant au travail et le dépouiller du fruit de son travail. J’introduis auprès de vous M. George Thompson. (Tonnerre d’applaudissements.)
[Note by FB]
Les événements qui se passent dans la Grande-Bretagne ont naturellement leur retentissement dans les meetings de la Ligue, surtout quand ils ont quelque connexité avec la cause qu’elle défend. On a pu voir déjà l’opinion qui s’était manifestée au sein de cette puissante association au sujet de l’émigration forcée (compulsory emigration), quand cette question était traitée au Parlement, On a vu aussi l’effet qu’avait produit sur la Ligue l’accusation de conspiration dirigée contre O’Connell et l’agitation irlandaise. — À l’époque où nous sommes parvenus, une seconde modification dans les tarifs était soumise aux Chambres par le cabinet Peel, et comme elle servira dorénavant de texte à plusieurs orateurs, il n’est pas sans utilité de dire ici en quoi ces modifications consistent.
Le droit sur le sucre colonial était de 24 sh., et sur le sucre étranger de 63. La différence ou 39 sh. était ce qui constituait proprement la protection. — Le gouvernement proposait, tout en maintenant le droit sur le sucre des colonies à 24, de réduire le droit sur le sucre étranger à 34, c’est-à-dire de limiter la protection à 10 sh. — C’eût été un grand pas dans la voie de la liberté commerciale, si le cabinet anglais n’eût en même temps restreint le dégrèvement au sucre produit par le travail libre (free-grown sugar). Mais en laissant peser le droit de 63 sh. sur le sucre produit dans les pays à esclaves (slave-grown sugar), on excluait les sucres du Brésil, de Cuba, etc. Cette distinction étant évidemment un moyen indirect de maintenir le monopole, autant que la diffusion des lumières et les circonstances le permettaient, elle avait la chance de rallier beaucoup d’hommes honnêtes, en leur présentant la mesure proposée comme dirigée contre l’esclavage ; et la preuve que les monopoleurs avaient bien calculé, c’est qu’ils sont parvenus à rallier à leurs vues un grand nombre d’abolitionnistes, et de se créer ainsi en Angleterre un appui sur lequel ils ne pouvaient compter que grâce à cette distinction hypocrite. — On verra dans la suite l’opinion des free-traders et les péripéties de ce débat.
M. George Thompson, après avoir réclamé, vu l’état de sa santé, l’indulgence de l’assemblée, s’exprime ainsi : Comme l’honorable et brave officier qui vient de s’asseoir, je pense que la question de la liberté commerciale, et notamment de l’abrogation des lois-céréales, en tant qu’elle touche au bien-être et au bonheur delà race humaine, à la stabilité et à l’honneur de l’empire britannique, ne le cède point en grandeur et en solennité à cette autre question à laquelle, dans d’autres temps, je consacrai mes efforts. Si je réclamais alors la liberté de l’homme, je réclame aujourd’hui la franchise de ses aliments. (Acclamations.) Dieu a voulu que l’homme fût libre ; et je crois qu’il a voulu aussi que l’homme vécût. C’est un crime de lui ravir la liberté, mais c’est aussi un crime d’élever le prix, d’altérer la qualité ou de diminuer la quantité de ses aliments ; et quand je viens à considérer que la loi-céréale affecte les salaires, rompt l’équilibre entre l’offre et la demande des bras, jette hors d’emploi des millions d’ouvriers, ne laisse à ceux qui sont assez heureux pour s’en procurer que la moitié d’une juste rémunération, et les force en outre de payer le pain à un prix double de celui qu’il aurait sans son intervention, alors je dis qu’une telle loi m’ apparaît comme une monstrueuse spoliation (applaudissements), et comme la violation de cette charte descendue du ciel sur la terre : « Homme, tu mangeras les fruits de la terre ; la saison de semer et la saison de moissonner, l’hiver et l’été se succéderont à perpétuité, afin que les créatures de Dieu ne soient pas privées de nourriture. » Quel est le grand principe d’économie sociale dont nous confions la propagation à nos concitoyens, pour leur bonheur, celui de la patrie et du monde ? Quelle est cette doctrine que la Ligue, comme une mouvante université, prêche et enseigne en tous lieux ? C’est que toutes les classes de la communauté doivent être abandonnées à leur libre action, dans la conduite de leurs transactions commerciales, tout autant que ces transactions soient en elles-mêmes honnêtes et honorables ; — c’est qu’on ne doit souffrir aucune intervention, aucun contrôle, et moins encore aucune contrainte législative en matière de travail, d’industrie et d’échanges. (Écoutez ! écoutez !) Nous avons foi dans la vérité de cette doctrine ; mais nous ne nous bornons pas à l’ériger en un système abstrait, qu’on prend et qu’on laisse à volonté. Nous la regardons comme d’une importance pratique et capitale pour ce pays et pour tous les pays, pour ce temps et pouf tous les temps. Dans son application honnête et impartiale, elle implique la chute de toutes les restrictions qui ont été si souvent dénoncées dans cette enceinte ; elle ouvre le monde au travail de l’homme ; elle soustrait au domaine de la loi anglaise l’échange des fruits de notre travail et de notre habileté avec les nations du globe ; elle appelle sur nos rivages les innombrables tribus répandues sous tous les climats. Comme la piété, elle est deux fois bénie ; bénie dans celui qui donne, bénie dans celui qui reçoit. (Écoutez !) Ce n’est pas sans un sentiment profond de douleur que nous pouvons, comme Anglais, contempler les scènes de désolation qui se sont passées sous nos yeux depuis deux ans ; et si la situation de ce pays est pour nous un juste sujet d’orgueil, d’un autre côté elle est bien propre à exciter notre compassion. Notre grandeur comme nation est incontestable. Des rivages de cette île, nous nous sommes élancés sur le vaste Océan ; nous y avons promené nos voiles aventureuses ; nous avons visité et exploré les régions les plus reculées de la terre ; nous avons fait plus, nous avons cultivé et colonisé les plus belles et les plus riches contrées du globe ; aux hommes qui reconnaissent l’empire de notre gracieuse et bien-aimée souveraine, nous avons ajouté des hommes de tous les climats et de toutes les races ; par la valeur de nos soldats et de nos marins, l’habileté de nos officiers de terre et de mer, l’esprit d’entreprise de nos armateurs et de nos matelots, les talents de nos hommes d’État au dedans et de nos diplomates au dehors, nous avons soumis bien des nations, formé des alliances avec toutes, fait reconnaître en tous lieux notre prééminence industrielle, et c’est ainsi que la puissance combinée de notre influence morale, physique et politique a rendu l’univers notre tributaire, le forçant de jeter à nos pieds ses innombrables trésors. (Acclamations prolongées.) En ce moment, nos capitaux surabondent, nos vaisseaux flottent sur toutes les eaux et n’attendent que le signal de cette nation, — que de voir se dérouler au vent le drapeau de la liberté illimitée du commerce pour amener et verser sur nos rivages les produits de notre mère commune. Des millions d’être humains ne demandent qu’à échanger les fruits de leur jeune civilisation contre les produits plus coûteux, plus élaborés de notre civilisation avancée. (Nouvelles acclamations.) Ici la puissance de la production est incommensurable ; sous nos pieds gisent d’insondables couches de minéraux divers, dans un si étroit voisinage, que des métaux plus précieux que l’or peuvent être extraits, fondus et façonnés sur place pour l’usage des hommes de tous les pays. Dans nos vertes vallées, se précipitent des rivières capables de mouvoir dix mille fois dix mille machines, et l’homme règne sur cette île, qui est « comme un diadème de gloire sur la création. » Le premier, quoique entré le dernier dans la carrière de la civilisation, montrant au monde combien est vaste sa capacité et combien il doit à la libéralité de la nature ; appréciant la valeur et la destination de toutes les puissances qui l’entourent, il a un œil pour la beauté, une intelligence pour la science, un bras pour le travail, un cœur pour la patrie, une âme pour la religion. (Applaudissements.) L’air, la terre, l’océan lui sont familiers dans tous leurs aspects, leurs changements, leurs usages et leurs applications. Chacun d’eux paye à ses investigations le tribut qu’il refuse à une apathique ignorance ; chacun d’eux lui révèle ses secrets avec certitude, quoique avec une lente réserve. Le voilà debout, éternel objet d’étonnement et de terreur pour les peuples lâches, objet d’une noble émulation pour les nations dignes de la liberté. À la hauteur où il est parvenu, s’élever encore ou tomber, voilà sa seule alternative. Il ne peut s’arrêter, et il dédaigne de tomber, car la trempe de son esprit le soutient et la vigueur de son génie le pousse en avant. Telles sont quelques-unes des circonstances que j’avais à l’esprit quand je vous disais que, comme Anglais, nous sommes justifiés de nous complaire dans des sentiments d’orgueil national. Mais, hélas ! combien de causes ne viennent-elles pas froisser ces sentiments et les convertir en une profonde humiliation ! Car pourrait-on jamais croire que cette Angleterre, si illimitée dans son empire, si riche de ressources, si supérieure par ses armées et sa marine, si fière de ses alliances, si incomparable dans son génie productif, quelles que soient l’abondance de ses capitaux, la surabondance de ses bras et de son habileté, orgueilleuse de sa littérature puisée aux sources les plus pures, de sa moralité qui respire la bienveillance universelle, et de sa religion qui est divine, — que l’Angleterre ne peut pas, ne veut pas nourrir ses propres enfants ; mais qu’elle les voit errer dans l’oisiveté, s’accroupir dans l’abattement, et languir et mourir d’inanition sous les murs de ses monuments, sur les marches de ses palais, sous les portiques et jusque dans le sanctuaire de ses temples ! Quel est l’étranger connaissant notre position géographique, l’étendue et les ressources de notre empire, le génie, l’habileté et l’énergie de nos concitoyens, qui pourrait jamais croire qu’ici où siège le gouvernement, dans ce pays, la grande usine du monde, le centre du commerce ; dans ce pays où s’entreposent tant de richesses, où s’élaborent tant d’idées et d’intelligence, il y a plus d’oisiveté, de misère, de privation, de souffrances physiques et morales, qu’on n’en pourrait trouver, à population égale, dans aucune autre contrée du monde ? Et pourtant voilà où en est la puissante Angleterre. Peut-être les choses se sont-elles un peu améliorées dans quelques comtés de la Grande-Bretagne, et, s’il en est ainsi, nous en remercions le Dieu tout-puissant, au nom des malheureux et des indigents. Mais même en ce moment, vous pouvez rencontrer des multitudes d’hommes oisifs tout le jour, tandis que ceux qui sont occupés ne reçoivent que d’insuffisants salaires et n’obtiennent, après une longue semaine de travail incessant, qu’une chétive pitance à peine suffisante au soutien de la vie… Oh ! si vous cherchez, vous trouverez bien des intérieurs désolés, — où le feu s’est éteint au foyer, — où la coupe est vide, — où les couches ont été dépouillées et les couvertures vendues pour du pain, — où la mère a laissé sur la paille l’enfant s’endormir au bruit de ses propres vagissements, — où le père de famille qui, s’il eût été libre, aurait pu et voulu être un artisan honnête, actif et satisfait, n’est qu’un vagabond affamé, sans ressources, sans courage et sans espoir ; — triste famille, ou plutôt, quand elle est réunie dans sa sale nudité, triste juxtaposition de créatures dégradées, dont l’irrésistible action de la misère a détruit les mutuelles sympathies. Là, vous ne rencontrerez plus le sentiment de la dignité personnelle. Là, le murmure s’élève contre Dieu, comme la malédiction contre les gouvernants et les législateurs. Là, s’est éteinte toute vénération pour les lois sociales ou pour les divins commandements. Là, des projets de rapine se complotent sans remords. Là, enfin, des créatures proscrites, se croyant abandonnées de Dieu et de l’homme, se regardent comme les victimes de la législation, ou sentant du moins qu’elle n’est pour elles ni une protection ni un refuge, s’insurgent contre la société, puisque aussi bien le sort qui les attend ne saurait être pire que celui qu’elles endurent. (Bruyantes acclamations.) Voilà ce qui se passe en Angleterre. — Je veux que vous compreniez bien que l’existence d’un tel état de choses révèle l’existence de quelque mauvaise loi, qui étouffe le commerce de ce pays, qui nous ferme les marchés du monde, en empêchant les produits des autres contrées de venir ici pour satisfaire à nos besoins. Une misère aussi profonde, une indigence aussi abjecte, une souffrance aussi incurable n’existe ailleurs nulle part. Quoi qu’aient pu faire dans d’autres pays le despotisme et la superstition, ils ne sont point parvenus, comme nos lois, à affamer une population active et laborieuse, à qui il reste au moins la faculté d’échanger ce qu’elle produit contre ce dont elle a besoin. (Acclamations bruyantes et prolongées.) — J’ai beaucoup voyagé ; j’ai vu l’ignorance la plus profonde ; la superstition la plus sombre et la plus terrible ; le despotisme le plus illimité et le plus rigoureux ; la théocratie la plus orgueilleuse et la plus tyrannique; mais une misère semblable à celle que je vois ici et qui nous entoure, je ne l’ai vue nulle part. (Applaudissements.)
Ici l’orateur discute le principe et les effets des lois-céréales, et arrivant à la question des sucres, il continue en ces termes :
Je viens de vous parler des lois-céréales ; permettez-moi de vous entretenir de la loi des sucres. — Personne ne me soupçonnera, je pense, de désirer le maintien de l’esclavage. S’il se trouvait dans cette enceinte quelque personne disposée à diriger contre moi une telle accusation, il me suffirait de lui dire, en signalant l’histoire de mes actes et de ma vie passée : — Voilà ma réponse. (Acclamation.) — J’ai le regret de différer d’opinion avec d’anciens amis, qui, dirigés par les plus pures intentions, croient maintenant devoir s’opposer au triomphe de la liberté commerciale dans la question des sucres. J’ai examiné la question maturément, pendant de longues années; je me suis efforcé d’arriver à une saine et juste conclusion, et je combattrai énergiquement, sans m’écarter du respect et de l’affection que je leur ai voués, cette doctrine qu’il appartient au gouvernement de fermer au sucre produit par les esclaves l’accès de notre marché national. Nous sommes d’accord sur l’esclavage ; nous l’avons également en horreur ; nous croyons que réduire ou retenir les hommes dans l’esclavage, les forcer au travail, tout en retenant le juste salaire qui leur est dû, ce sont des crimes aux yeux de Dieu, et d’horribles empiétements sur les droits et l’égalité des hommes. Nous croyons aussi que c’est le devoir de tout homme éclairé et de tout chrétien d’élever la voix contre l’esclavage sous toutes ses formes, et d’employer tous les moyens moraux et légitimes pour avancer le jour où cessera la servitude et avec elle le trafic sur l’espèce humaine. (Écoutez ! écoutez !) Il faut donc se demander, d’abord, quels sont les droits du peuple de ce pays ; ensuite, quels sont les moyens de saper l’esclavage qu’on peut considérer comme honnêtes et légitimes, c’est-à-dire qui, tout en ayant pour fin la justice due aux hommes des autres contrées, n’interviennent pas cependant dans l’action de la liberté civile et dans les justes prérogatives de nos concitoyens. — J’admets la vérité de cette proposition : que les hommes ont droit à la liberté personnelle ; qu’ils doivent demeurer en plein exercice de leur liberté, dans le choix de leurs chefs[1], de la nature et du lieu de leurs occupations, et du marché sur lequel ils jugent à propos d’apporter ou leur travail, ou les résultats de leur travail. — Mais il est également clair à mon esprit que les hommes de ce pays et de tous les pays doivent être libres aussi (je veux dire libres par rapport à l’intervention de la loi civile) de choisir, comme consommateurs, parmi tous les produits portés des diverses régions du globe sur le marché commun. (Bruyantes acclamations.) Je ne vois pas qu’ils puissent avec justice être empêchés d’acheter les produits du Brésil et de Cuba sur le fondement que ces produits sont le fruit de l’esclavage. Je ne vois pas qu’ils puissent, avec justice, être placés dans l’alternative ou d’acheter les produits des Antilles britanniques, ou de se passer d’une chose qui leur est nécessaire.
J’admets que c’est un droit et un devoir de dénoncer l’esclavage, et de propager les saines idées parmi toutes les classes, relativement à la criminalité de ce système. C’est un droit et un devoir de mettre en lumière l’obligation, pour chacun, de retirer tout encouragement à ceux qui commettent le crime de retenir les hommes en servitude. Chaque fois que, par le raisonnement, la persuasion et la prière, nous amènerons un homme à agir comme nous, en cette matière, on pourra dire, dans le langage de l’Écriture : « Tu as gagné ton frère ! » C’est là un moyen légitime de détourner les hommes d’une pratique mauvaise et un pas fait dans la bonne voie, vers l’extinction d’un système que nous avons en égale exécration. Mais la prohibition législative, c’est de la violence et non du raisonnement ; c’est de la force et non de la raison ; de la tyrannie et non de la persuasion. De tels actes sont la perversion et l’abus de la puissance législative. Il n’y a pas de garantie contre un tel exercice de l’autorité. C’est, de la part du Parlement, une usurpation sur la conscience des hommes, dans un sujet où ils ont le droit de juger par eux-mêmes et de se conduire comme des êtres moraux et responsables. Une loi telle que celle à laquelle je fais allusion, et qui est en ce moment en pleine vigueur dans ce pays, ne peut être considérée comme émanée du peuple ou comme un acte conforme à sa volonté ; car, s’il en était ainsi, la loi elle-même serait superflue, et le produit qu’elle prohibe, débarqué sur nos rivages et exposé en vente, ne trouverait pas d’acheteurs et serait délaissé comme flétri de la pollution morale qui y est attachée. — Même, en tant qu’imposée par des hommes parlementaires, cette loi prohibitive manque manifestement de sincérité ; car ces mêmes hommes permettent que le sucre-esclave soit débarqué et raffiné dans ce pays, — ils en encouragent l’exportation sur des bâtiments anglais ; ils sanctionnent le commerce qu’en font nos négociants avec les nations. Ils savent bien qu’il est consommé au dehors, à l’état raffiné, et malgré cette coûteuse préparation, à un prix moins élevé que le sucre brut dans notre île. Ils encouragent ce commerce, jusqu’à ce qu’il approche de cette limite où il affecterait leur propre monopole, et alors seulement ils le prohibent sous le prétexte qu’il porte la tache de la servitude… Malheureusement pour la sincérité de ces hommes, ils sont les mêmes qui, dans les temps passés, mirent tant d’éloquence au service de la cause de l’esclavage. (Écoutez ! écoutez !) J’ouvre le livre bleu ; il mentionne les noms de ceux qui ont reçu indemnité sur le fonds de vingt millions voté pour opérer l’émancipation, et je trouve qu’ils étaient les principaux copartageants de ce qu’ils appellent maintenant le prix de l’injustice. Je scrute leurs votes au Parlement, et je les vois résistant opiniâtrement, d’année en année, à toute tentative pour adoucir les horreurs de l’esclavage des nègres, jusque-là qu’ils repoussaient l’abolition de cette coutume barbare, la flagellation des femmes. (Écoutez !) Je rencontre les mêmes hommes imposant des droits monstrueux sur le sucre de l’Inde, quoique produit par un travail libre ; je les rencontre encore prodiguant annuellement des millions sous la forme de drawbacks, de primes, de protection, aux planteurs des Antilles, possesseurs d’esclaves. — Eh quoi ! ils étaient alors producteurs de sucre comme ils le sont aujourd’hui ; ils étaient, comme ils le sont encore, producteurs de céréales. Montrez-leur un article qu’ils ne produisent pas, et ils en permettront volontiers l’importation et la consommation, fût-il saturé des larmes et du sang des malheureux esclaves (acclamations) : mais montrez-leur un article qu’ils produisent, et ils prohibent les articles similaires, que ce soit du blé de l’Ohio ou des Indes, ou du sucre du Brésil ou de Cuba. (Écoutez ! écoutez !) — Est-ce là de la philanthropie sincère ? (Écoutez ! écoutez !) Tout homme doué de sentiments droits ne peut qu’éprouver les nausées d’un indicible dégoût, en voyant ces hommes se poser au Parlement comme les Élisées de l’abolition, et verser des larmes de feinte compassion sur les souffrances des travailleurs du Brésil. Voilà pourtant les hommes qui vous contestaient le droit d’intervenir dans leurs propriétés quand ils étaient possesseurs d’esclaves. Ils nous arrêtaient à chaque pas, quand nous nous efforcions de détruire par la loi ce qui avait été créé par la loi. (Écoutez !) Ils défendirent jusqu’au dernier moment les prétendus droits des planteurs, et refusèrent d’accorder la liberté aux nègres jusqu’à ce qu’on leur eût jeté et qu’ils se fussent partagé la plus grande somme d’argent qui ait jamais été votée dans des vues d’humanité ! Alors comme aujourd’hui, ils étaient les organes du monopole ; ils parlaient et agissaient comme des hommes profondément intéressés au maintien des restrictions. Le sentiment public était contre eux alors ; le sentiment national est encore contre eux maintenant. — Ils n’étaient pas sincères alors, ou ils pratiquent la déception aujourd’hui. Ils parlent et votent contre leur conscience maintenant, ou ils doivent être préparés à dire qu’ils parlaient et votaient contre leur conscience autrefois. (Écoutez !) Pour nous, nous sommes sur le terrain où nous étions il y a quatorze ans. Nous disons que l’esclavage est un crime ; que travailler par des moyens honnêtes à son abolition, c’est le devoir des individus et des nations. C’était notre droit de pétitionner contre l’esclavage ; c’était le droit de la législature de l’abolir par acte du Parlement passé en conformité de la volonté nationale. — Mais forcer trente millions de citoyens de payer des sommes énormes sous forme de prix additionnel pour une denrée de première nécessité ; — diminuer de moitié, par l’emploi de la force brutale, l’approvisionnement de cette denrée ; — dépouiller les hommes du droit d’acheter ce qui est porté sur le marché, parce que dans les opérations de la production une injustice a été commise en pays étrangers, — ce n’est pas du droit, c’est de la rapine (bruyants applaudissements) ; et agir ainsi sous le prétexte de prendre en main la cause de la liberté et de l’humanité, quand nous savons (autant qu’il est possible d’avoir cette certitude) que ce prétexte est faux, vide et hypocrite, c’est ajouter la fraude mentale à la tyrannie législative, et pratiquer la dissimulation aux yeux de Dieu en même temps que l’injustice à l’égard des hommes. Ce serait au moins faire montre de quelque honnêteté que d’appliquer le principe avec impartialité ; mais c’est ce qu’on ne fait pas. Le droit sur le sucre du Brésil est prohibitif. Pourquoi n’augmentent-ils pas aussi le droit sur le tabac jusqu’à ce qu’il produise le même effet que pour le sucre, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il en prévienne la consommation ? — Parce que ces hommes ne produisent pas le tabac, et qu’ils sont à cet égard sans intérêt personnel. — Pourquoi n’appliquent-ils pas leur principe au coton, produit par des esclaves, et ne se contentent-ils pas du coton excru sur ces vastes plaines que je viens de parcourir ? Nous admettons le coton des États-Unis, et nous repoussons leur blé ! triste inconséquence ! S’ils permettent à nos armateurs de porter du coton, produit de l’esclavage, à nos courtiers de le vendre, à nos capitalistes de le filer et de le tisser dans de vastes usines, aux femmes et aux enfants de ce pays de le façonner pour l’usage des citoyens, depuis la reine sur le trône jusqu’au mendiant de la rue ; pourquoi, lorsque nos industrieux compatriotes ont gagné par le travail de la semaine un chétif salaire, leur défendent-ils d’en employer une partie, le samedi soir, à l’achat d’un peu de sucre à bon marché ? Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas producteurs de coton, tandis qu’ils sont producteurs de sucre ; il n’y a pas d’autre raison. Voici trente années que nous affirmons, que nous essayons de prouver que le travail libre revient moins cher que le travail des esclaves ; que les mettre loyalement aux prises, c’est le moyen le plus pacifique et le plus efficace de détruire l’esclavage. C’est pour propager cette vérité que nous avons distribué à profusion les écrits de Fearon, de Hodgson, de Cropper, de Jérémie, de Conder, de Dickson et de bien d’autres. Donnerons-nous maintenant un démenti pratique à nos affirmations antérieures en invoquant la prohibition, funeste même au travail libre, et l’intervention arbitraire de la loi dans le domaine de la raison individuelle et de la libre action de l’homme ? — J’ai lu avec plaisir une déclaration solennelle et officielle émanée des chefs des abolitionnistes, par laquelle ils expriment que, dans leur conviction, il est funeste et dispendieux, dangereux et criminel, de faire intervenir les armes dans la cause de l’abolition. Je partage cette conviction[2]. L’arithmétique et l’histoire prouveront la première partie de cette proposition ; le sens commun et le christianisme se chargent de la seconde. Mais l’analogie n’est-elle pas parfaite entre l’intervention armée et des actes du Parlement, qui seraient vains et de nul effet, s’ils ne puisaient leur force dans les peines, les châtiments, le blocus de nos côtes et les armées permanentes ? Qu’est-ce qui communique quelque puissance à cette loi, naturellement opposée aux droits et aux sentiments du peuple ? N’est-ce point l’irrésistible force physique du gouvernement ? Quelles seraient les suites de la désobéissance ? Nous savons tous que peu de personnes respectent une loi qui force le peuple à assister au réembarquement du sucre du Brésil, raffiné ici pour être vendu ailleurs à 4 d., tandis que lui-même ne peut obtenir le sucre brut qu’à 8 d. ; mais chacun craint d’enfreindre la loi à cause des conséquences terribles attachées à cette infraction. Aussi, ce n’est point aux vues et aux idées des monopoleurs que l’on croit ; mais c’est le douanier, la cour de l’Échiquier, l’amende et le cachot que l’on craint. (Approbation.) Est-ce ainsi qu’il convient de rendre les hommes abolitionnistes ? Est-ce ainsi qu’il faut rendre l’esclave à la liberté ? Toutes nos anciennes maximes d’économie politique sont-elles changées ? N’est-il pas possible d’atteindre l’objet que nous avons en vue par l’action combinée du travail libre au dehors, et d’un loyal appel à la conscience des hommes au dedans ?
Je comprends, qu’autant pour se montrer conséquents avec leurs principes que pour décourager l’esclavage, les hommes s’abstiennent de l’usage des produits du travail des noirs ; mais je dénie formellement à la législature (alors surtout qu’elle ne s’appuie pas sur la voix du peuple) le droit de forcer qui que ce soit à une semblable privation. C’est à nos yeux, je l’avoue, une choquante inconséquence de prétendre maintenir un principe par la violation d’un autre principe ; — de défendre dans un sens les droits des hommes et de les usurper et de les détruira dans un autre sens. (Écoutez !) Combien il serait plus noble de dire : « Nos ports sont ouverts ; — ouverts aux produits de tous les climats, afin que notre peuple se procure toutes choses au meilleur marché possible. Nous n’intervenons dans la conscience de personne. Nous ne forçons qui que ce soit à acheter ceci, à s’abstenir de cela. Aux nations qui conservent des esclaves nous disons : Nous ne nous battrons pas avec vous, car ce serait faire le mal pour que le bien se fasse ; nous n’imposerons pas des droits prohibitifs, car ce serait violer le principe de la liberté des échanges, et employer à l’égard de nos citoyens des mesures coercitives. Mais nous ne cesserons jamais de vouer votre système d’esclavage à la censure et à l’exécration universelles ; de faire retentir nos protestations comme individus, comme associations, comme peuple. (Applaudissements.) Nous encouragerons dans tous les recoins du globe le travail libre, votre rival. Nous rendrons enfin, comme gouvernement, justice et liberté à nos magnifiques possessions. Au lieu d’arrêter le développement de l’industrie indigène dans l’Inde, nous l’encouragerons par de nobles récompenses. Nous accueillerons le sucre, le riz, le coton, le tabac des contrées où les soupirs de l’esclave ne se mêlent pas au murmure des vents, mais où la joyeuse voix du travailleur volontaire retentit sur des champs aimés, autour de foyers indépendants et heureux. — Vendez comme vous pourrez vos sucres et vos cafés. En attendant, nous travaillerons la conscience des hommes jusqu’à ce qu’ils rejettent volontairement tout ce qui porte la tache de l’esclavage. (Applaudissements.) Oui, et nous attaquerons aussi vos consciences. Nos canons sont encloués et livrés à la rouille ; mais nous aurons recours aux armes morales, et nous porterons des coups qui, s’ils ne brisent pas les membres et ne répandent pas le sang, pénètrent néanmoins jusqu’au cœur des hommes, les forcent à céder à la voix de la justice, et leur enseignent que l’honnêteté est la meilleure politique. (Écoutez ! écoutez ! et applaudissements.) Nous ne tomberons pas dans cette contradiction de blâmer chez vous la spoliation des facultés humaines, pendant que nous tolérons chez nous la spoliation du produit de ces facultés; nous n’aurons donc point de lois restrictives. Nous avons foi dans les principes universels d’une saine et honnête économie sociale. Nous avons foi dans la puissance de l’exemple, que n’affaiblissent pas la restriction et la contrainte. Nous avons foi dans la fécondité de ces régions où l’esclavage n’a pas porté sa rouille et ses malédictions. Nous avons foi dans cette doctrine qu’un but honnête n’a pas besoin de la coopération de moyens déshonnêtes. Nous nourrissons d’autres espérances ; et, tant que nous pourvoirons aux besoins et veillerons sur les droits de nos laborieux enfants ; tant que nous donnerons un grand exemple au monde en renversant les barrières qui environnent cette maison de servitude, en ouvrant nos ports aux produits de tous les climats, afin que ceux qui ont faim soient rassasiés, et que ceux qui sont oisifs soient occupés ; tant que nous préférerons le fruit du travail libre au produit du travail servile, nous espérons que Dieu répandra sur nous ses bénédictions, et nous choisira entre tous les peuples pour arracher les nations aux voies tortueuses et mauvaises, et les replacer dans le droit sentier de la justice et de la liberté. » (Applaudissements.) Que si nos adversaires nous menacent des conséquences de la liberté commerciale, nous acceptons ces conséquences, car nous avons foi en nos principes ; nous avons foi dans la parole de Dieu ; nous avons foi dans la réciprocité des intérêts humains ; nous croyons que le système le plus simple, le plus équitable, le plus juste, est aussi celui qui répandra le plus de bienfaits sur les habitants de ce pays. (Acclamations.) Éloignons donc de nous toute impression de doute ou de découragement à l’égard de l’issue de notre entreprise. Un progrès rapide et sans précédent a été fait. Des difficultés énormes ont été vaincues et tout nous présage un prochain triomphe. Des siècles d’obscurité et d’ignorance, d’erreurs et de méprises, quant aux effets des lois protectrices, se sont écoulés. Notre pernicieux exemple, il est vrai, a entraîné les autres peuples, par de fausses inductions, à adopter nos suicides[3] théories. Tout le mécanisme des luttes de parti, tout le poids de l’influence gouvernementale, ont été engagés en faveur de la cause du monopole. — Mais enfin le jour se fait. Des vérités cachées pendant des siècles ont été mises en lumière. Le monde, dans ses belles et infinies variétés de sols, de climats, de productions et d’intérêts, a été observé à la lumière du sens commun, et sous l’impression du désir sincère et respectueux de discerner la volonté de Dieu, révélée par les œuvres de ses mains et par les dispensations de sa providence. On a constaté une consolante harmonie entre les maximes les plus profondes de l’économie sociale et les plus nobles desseins de la philanthropie et d’une religion d’amour et de paix. Ce n’est pas tout. Des hommes ont apparu, qu’on peut avec justice signaler comme les apôtres de la liberté commerciale. (Écoutez ! écoutez !) Ils ont révélé des vérités découvertes dans le silence du cabinet par le philosophe, ou déduites par l’homme du monde de l’observation éclairée de la situation, des circonstances spéciales et de la dépendance mutuelle des hommes et des nations, et ils ont parcouru le pays dans tous les sens proclamant et vulgarisant ces grandes vérités. Leur voix vibrante a frappé l’oreille de millions de nos concitoyens. La chaire, la bourse, la place publique, le salon du riche, le parloir du fermier, le boudoir, et jusqu’aux chemins et aux sentiers de l’Empire, tout est devenu le théâtre de cette discussion animée et instructive. Aucune portion de la population n’a été oubliée, ou méprisée, ou négligée. L’almanach du free-trader est suspendu au mur de la chaumière ; le pamphlet du free-trader se trouve sur la table du plus humble citoyen, et celui même qui ne sait pas lire a été instruit par des peintures éloquentes. Chacun a pu étudier et comprendre la philosophie du travail, de l’échange, des salaires, de l’offre et de la demande. La lumière a pénétré là où elle était le plus nécessaire, — dans le Sénat. Un économiste s’est rencontré qui a revêtu la vérité du langage le plus convaincant, qui a su disposer son argumentation dans un degré de simplicité et de clarté qui n’avait jamais été égalé, qui a fait dominer les principes sur le tumulte des luttes parlementaires. Son éloquence et sa modération ont arraché l’admiration de ses adversaires, et on les aurait vus accourir sous son drapeau s’ils n’eussent été retenus par les liens des hypothèques et par la soif indomptable des rentes élevées. Cet homme a demandé audience aux monopoleurs, et il les a forcés d’entendre sa voix retentir sous les voûtes de leurs orgueilleux palais ; ils ont été muets pendant qu’il parlait, et ils sont restés muets quand il cessait de parler ; car, triste alternative ! ils ne savaient point répondre et ils ne voulaient pas céder. (Bruyantes acclamations.) Ayez donc bon courage. Fuyez les piéges, les manœuvres et les expédients de l’esprit de parti. Laissez aux principes leur propre poids et leur légitime influence. Quand le jour de l’épreuve sera venu, soyez justes et ne craignez rien. — Le devoir est à nous ; les conséquences appartiennent à Dieu. Celui qui suit les inspirations de sa conscience, les lois de la nature et les commandements du ciel, peut en toute sécurité abandonner le reste. Au lit de mort, son esprit revenant sur ses actions passées, prononcera ce verdict consolant : Tu as vu ton devoir et tu l’as rempli. — (Applaudissements prolongés.)
FN: Employers
FN: Ceci prouve, pour le dire en passant, que le droit de visite n’était pas, de l’autre côté du détroit, aussi populaire qu’on le suppose en France, puisqu’il était repoussé par deux puissantes associations : les abolitionnistes et les free-traders.
FN: On a fait des adjectifs des mots homicides, régicides, liberticides. On peut dire une théorie homicide. Pourquoi ne ferait-on pas aussi un adjectif du mot suicide. — Qu’on me permette donc encore ce néologisme, sans lequel il n’est pas possible de traduire ces mots : suicidal, self-destructing.
Séance du 1er mai 1844.↩
Le fauteuil est occupé par un membre de l’aristocratie, lord Kinnaird, un des plus grands propriétaires et des plus savants agronomes de la Grande-Bretagne. Cette circonstance répand un nouvel intérêt sur cette séance. Je n’ai pourtant pas cru devoir traduire le discours du noble lord, tant parce que l’espace et le temps me font défaut, qu’à cause du caractère agricole et pratique de ce discours, qui, quoique très-adapté au but de la Ligue, n’offrirait que peu d’intérêt au public français.
M. Ricardo. (L’orateur se livre à quelques réflexions générales et continue ainsi :) Je viens ici sous l’impression du dégoût et n’espérant plus rien de cette autre enceinte où je me suis efforcé de soutenir votre cause. Je viens ici pour en appeler de l’oppresseur à l’opprimé, — de ceux qui font la loi à ceux qui sont victimes de la loi. (Bruyante approbation). Ce n’est pas qu’en quelques occasions, je n’aie entendu développer au Parlement d’excellentes doctrines économiques. J’y ai entendu professer les plus saines doctrines à propos de liéges (rires), et je me suis d’abord étonné de l’unanime accueil qu’elles y ont reçu. (Écoutez ! écoutez !) Mais en regardant autour de moi, j’ai vu qu’il n’y avait pas de fabricants de bouchons dans la Chambre. (Nouveaux rires.) J’ai vu encore étaler d’excellents principes au sujet de paille tressée ; mais il n’y a pas d’ouvriers empailleurs derrière les bancs de la trésorerie (on rit plus fort), et cette nuit même, j’ai été surpris de voir comme a été bien reçu le dogme de la liberté à propos de raisins de Corinthe. Seulement, je me suis pris à penser que, dans tous mes voyages en chemin de fer dans le pays, je n’ai jamais traversé une plantation de cette espèce. De tout cela je conclus que vous pouvez en user sans façon avec les pauvres bouchonniers, empailleurs, et renverser toute la nichée des petits monopoles ; mais ôtez un brin de paille à la ruche des grands monopoles, et vous serez assailli par une nuée de frelons (bruyants applaudissements), qui vous feraient un mauvais parti si leur aiguillon répondait à leur bourdonnement. (Rires et acclamations.) Il n’est pas hors de propos de dire comment nous avons été traités dans cette Chambre. Je me souviens que les seuls arguments qu’on opposa à M. Villiers, la première fois qu’il porta la question au Parlement, ce furent des murmures et des ricanements. Mais quand l’opinion publique a été éveillée dans le pays, ils ont jugé prudent de rompre le silence, et, descendant de leur dédaigneuse position, ils se sont mis à parler de droits acquis. Plus tard, et à mesure que le public a pris la question avec plus de chaleur, ils ont commencé à argumenter. Battus sur tous les points, chassés de position en position, incapables de rester debout, les voilà maintenant qui reviennent sur leurs pas et ne savent plus qu’invoquer les droits acquis. Notre noble Président a déjà fort bien dévoilé la nature de ces droits acquis. Excusez-moi si je m’arrête un moment à expliquer en quoi ils consistent. À ma manière de voir, posséder un droit acquis, c’est avoir dérobé quelque chose à quelqu’un. (Rires.) C’est avoir volé la propriété d’autrui et prétendre qu’on y a droit parce qu’on l’a volée depuis longtemps. (Acclamations.) — Il en est beaucoup d’entre vous qui ont été en France, et ils savent qu’on n’y connaît pas cette classe d’hommes que nous appelons boueurs (Rires.) On est dans l’usage de déposer les cendres et les balayures devant les maisons. Certains industriels, qu’on nomme chiffonniers viennent remuer cette ordure pour y ramasser les chiffons et autres objets de quelque valeur, et se procurent ainsi une chétive subsistance. À l’époque du choléra, le gouvernement français pensa que ces tas d’immondices contribuaient à étendre le fléau et ordonnateur enlèvement ; mais en cela il touchait aux droits acquis des chiffonniers. Ceux-ci se soulevèrent ; ils avaient des droits acquis sur les immondices, si bien que l’administration, craignant une émeute, ne put prendre des mesures de salubrité et ne les a pas prises encore. (Rires.) La même chose est arrivée à Madrid. Il est d’usage dans cette capitale d’approvisionner les maisons d’eau apportée d’une distance considérable. Il fut question de construire un aqueduc ; mais les porteurs d’eau trouvèrent que c’était toucher à leurs droits acquis. Ils avaient un droit acquis sur l’eau et nul ne pouvait s’en procurer qu’en la leur achetant à haut prix. Eh bien ! quelque absurdes et ridicules que paraissent ces exemples de droits acquis, je dis qu’il s’en faut de beaucoup qu’ils soient aussi absurdes, aussi déshonnêtes, aussi funestes que les droits acquis qu’invoque l’aristocratie de ce pays. (Approbation.) Quelle fut l’origine de ces prétendus droits ? Une guerre longue et terrible, et le prix élevé auquel elle porta les aliments ne fut pas le moins désastreux de ses effets. Elle fut un fléau pour le pays, mais un bienfait pour les propriétaires terriens. Aussi, quand elle fut terminée, au prix des plus grands sacrifices, ils vinrent à la Chambre des communes, et, s’appuyant sur ces mêmes baïonnettes qui avaient combattu l’ennemi, ils firent passer une loi qui avait pour but de maintenir la disette artificielle des aliments et de dépouiller le pays du plus grand bienfait que la paix puisse conférer. (Approbation.) Us ont, eux aussi, des droits acquis à la disette. Mais le pays a des droits acquis à l’abondance, droits fondés sur une loi antérieure à celles qui émanent du Parlement, car les produits sont répandus dans le monde, non pour l’avantage exclusif des lieux où ils naissent, mais afin que tous les hommes, par des échanges réciproques, puisent à la masse commune une juste part des bienfaits qu’il a plu à la Providence de répandre sur l’humanité. (Acclamations.) Quand nous voyons ces choses, quand nous ne pouvons nous empêcher de les voir, quand il n’est pas un négociant, un manufacturier, un fermier, un propriétaire, un ouvrier à qui elles ne sautent aux yeux, ne faut-il pas s’étonner, je le demande, de voir tout un peuple demeurer dans l’apathie à l’aspect de ses droits foulés aux pieds, à l’aspect de milliers de créatures humaines poussées par la faim dans les maisons de travail ? Ne devons-nous pas être frappés de surprise, quand nous entendons un membre du parti protectionniste dire (et pour tout l’univers je ne voudrais pas qu’on eût à me reprocher ces insolentes paroles) que, pour ceux qui n’ont pas de pain, il y a de l’avoine et des pommes de terre ? et lorsque, pour toute réponse, un ministre d’État vient nous affirmer que plusieurs millions de quarters de blé pourrissent, en ce moment, dans les greniers de l’Amérique, et qu’il considérerait leur introduction dans ce pays comme une calamité publique ? (Applaudissements.) Quoi ! les citoyens des États-Unis, les habitants de l’Ukraine et de Pultawa voient leur blé se pourrir ; et on vient nous dire que l’échange de ce blé, dont nous manquons, contre des marchandises, dont ils ont besoin, serait une calamité universelle ! mais quand ils proclament ouvertement de telles doctrines, en ont-ils bien pesé toutes les conséquences ? Ne s’aperçoivent-ils pas que pendant qu’ils croient, par des lois de fer, environner leurs propriétés d’un mur impénétrable, il est fort possible qu’ils ne fassent que susciter des ennemis à la propriété elle-même ? Qu’ils se rappellent les paroles qui ont été prononcées, non par un ligueur, non dans cette enceinte, mais par un serviteur du pouvoir : « Le peuple de ce pays reconnaît le droit de propriété. Mais si quelqu’un vient nous dire qu’il y a dans sa propriété quelque attribut particulier qui l’autorise à envahir la nôtre, que nous avons acquise par le travail de nos mains, il est possible que nous nous prenions à penser qu’il y a, dans cette nature de propriété, quelque anomalie, quelque injustice que nous devons loyalement nous efforcer de détruire. » (Approbation.) Ce sont là des sujets sur lesquels je n’aime pas à m’appesantir. Il n’a fallu rien moins pour m’y décider que le souvenir du traitement qu’on nous fait éprouver. (Écoutez !) Je ne vous retiendrai pas plus longtemps ; mais avant de m’asseoir, je réclamerai votre assistance, car vous pouvez et vous pouvez seuls nous assister. Nous présentons le clou, mais vous êtes le marteau qui l’enfonce. (Bruyants applaudissements.) Vos ancêtres vous ont légué la liberté civile et religieuse. Ils la conquirent à la pointe de l’épée, au péril de leur vie et de leur fortune. Je ne vous demande pas de tels sacrifices ; mais n’oubliez pas que vous devez aussi un héritage à vos enfants, et c’est la liberté commerciale. (Tonnerre d’applaudissements.) Si vous l’obtenez, vous ne regretterez pas vos efforts et vos sacrifices. Rappelez-vous que vos noms seront inscrits dans les annales de la patrie, et, en les voyant, vos enfants et les enfants de vos enfants diront avec orgueil : Voilà ceux qui ont affranchi le commerce de l’Angleterre. (L’honorable membre reprend sa place au bruit d’applaudissements prolongés.)
M. Sommers, fermier du comté de Somerset, succède à M. Ricardo, et traite la question au point de vue de l’intérêt agricole.
La parole est ensuite à M. Cobden. À peine le président a prononcé ce nom, que les applaudissements éclatent dans toute la salle et empêchent pendant longtemps l’honorable orateur de se faire entendre. Le calme étant enfin rétabli, M. Cobden s’exprime en ces termes :
… Que vous dirai-je sur la question générale de la liberté du commerce. Messieurs, puisque vous êtes tous d’accord à ce sujet ? Je ne puis que me borner à vous féliciter de ce que, pendant cette semaine, notre cause n’a pas laissé que de faire quelque progrès en haut lieu. Nous avons eu la présentation du budget, — je ne puis pas dire que ce soit un budget free-trader, car lorsque nous autres, ligueurs, arriverons au pouvoir, nous en présenterons un beaucoup meilleur (Rires ; écoutez ! écoutez !) ; mais enfin, il a été fait quelques petites choses lundi soir à la Chambre des communes, et tout ce qui a été fait, a été dans le sens de la liberté du commerce. Que faisaient pendant ce temps-là le duc de Richmond et les protectionnistes ? Réunis dans le parloir de Sa Grâce, ils ont, à ce que je crois, déclaré que le premier ministre était allé si loin, qu’il ne lui sera pas permis de passer outre. Mais il est évident pour moi que le premier ministre ne s’inquiète guère de leur ardeur chevaleresque, et qu’il compte plus sur nous qu’il ne les redoute. (Écoutez !) — Il y a une mesure prise par le gouvernement, et qui est excellente en ce qu’elle est totale et immédiate[1]. Je veux parler de l’abolition du droit protecteur sur la laine. — Il y a vingt-cinq ans qu’il y eut une levée en masse de tous les Knatchbulls, Buckinghams et Richmonds de l’époque, qui dirent : « Nous exigeons un droit de 6 d. par livre sur la laine étrangère, afin de protéger nos produits. » Leur volonté fut faite. À cinq ans de là, M. Huskisson déclara que, selon les avis qu’il recevait des manufactures de Leeds, si ce droit n’était pas profondément altéré et presque aboli, toutes les fabriques de drap étaient perdues, et que, dès lors, les fermiers anglais verraient se fermer pour leurs laines le marché intérieur. À force d’habileté et d’éloquence, M. Huskisson réduisit alors ce droit de 6 à 1 denier, et c’est ce dernier denier dont nous nous sommes débarrassés la semaine dernière. — Lorsqu’il fut proposé de toucher à ce droit, les agriculteurs (j’entends. les Knatchbulls et les Buckinghams d’alors) exposèrent que, sil était aboli, il n’y aurait plus de bergers ni de moutons dans le pays. À les entendre, les bergers seraient contraints de se réfugier dans les workhouses, et quant aux pauvres moutons, on aurait dit qu’ils portaient sur leurs dos toute la richesse et la prospérité du pays. Enfin il ne resterait plus qu’à pendre le chiens. — Les voilà forcés maintenant d’exercer l’industrie pastorale sans protection. Pourquoi ne pratiqueraient-ils pas la culture et la vente du blé sur le même principe ? Si l’abolition totale et immédiate des droits sur le blé est déraisonnable, pourquoi le gouvernement opère-t-il l’abolition totale et immédiate du droit sur la laine ? Ainsi, chaque pas que font nos adversaires, nous fournit un sujet d’espérance et de solides arguments. Voyez pour le café ! nous n’en avons pas entièrement fini, mais à moitié fini avec cette denrée. Le droit était primitivement et est encore de 4 d. sur le café colonial et de 8 d. sur le café étranger. Cela conférait justement une prime de 4 d. par livre aux monopoleurs, puisqu’ils pouvaient vendre à 4 d. plus cher qu’ils n’auraient fait sans ce droit. Sir Robert Peel a réduit la taxe sur le café étranger, sans toucher à celle du café colonial, ne laissant plus à celui-ci qu’une prime de 2 deniers par livre. Je ne puis donc pas dire : C’en est fait, mais c’est à moitié fait. Nous obtiendrons l’autre moitié en temps et lieu. (Très-bien.) Vient ensuite le sucre. Mesdames, vous ne pouvez faire le café sans sucre, et toute la douceur de vos sourires ne parviendrait pas à le sucrer. (Rires.) Mais nous nous trouvons dans quelque embarras à ce sujet, car il est survenu au gouvernement de ce pays des scrupules de conscience. Il ne peut admettre le sucre étranger, parce qu’il porte la tache de l’esclavage. Gentlemen, je vais divulguer un secret d’État. Il existe sur ce sujet une correspondance secrète entre les gouvernements anglais et brésilien. Vous savez que les hommes d’État écrivent quelquefois à leurs agents au dehors des lettres et des instructions confidentielles, qui ne sont publiées qu’au bout de cent ans, quand elles n’ont plus qu’un intérêt de curiosité. Je vais vous en communiquer une de notre gouvernement à son ambassadeur au Brésil, qui ne devait être publiée que dans cent ans. Vous n’ignorez pas que c’est sur la question des sucres que le cabinet actuel évinça l’administration antérieure. Lord Sandon, lorsqu’il s’opposa, par un amendement, à l’introduction du sucre étranger proposée par le ministère whig, se fonda sur ce qu’il serait impie de consommer du sucre-esclave. Mais il ne dit pas un mot du café. La lettre dont je vais vous donner connaissance vous expliquera le reste : « Informez le gouvernement brésilien que nous avons des engagements relativement au sucre, et qu’en présentant le budget, nous nous verrons forcés de dire au peuple d’Angleterre, très-crédule de sa nature et disposé à accueillir tout ce qu’il nous plaira, de lui dire de dessus nos sièges de la Chambre des communes, qu’il serait criminel d’encourager l’esclavage et la traite par l’admission du sucre du Brésil. — Mais afin de prouver au gouvernement brésilien que nous n’avons aucune intention de lui nuire, nous aurons soin de faire précéder nos réserves, à l’égard du sucre, de la déclaration que nous admettons le café brésilien sous la réduction de 2 d. par livre du droit actuel. — Et comme quatre esclaves sur cinq sont employés au Brésil sur les plantations de café, et que cet article forme les trois cinquièmes de toutes les exportations de ce pays (toutes choses que le peuple d’Angleterre ignore profondément), le gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité demeurera convaincu que nous ne voulons aucun mal à ses plantations, que l’esclavage et la traite ne nous préoccupent guère, mais que nous sommes contraints d’exclure leur sucre par les exigences de notre parti et de notre position particulière. Mais faites-lui bien comprendre en même temps avec quelle adresse nous avons désarçonné les whigs par cette manœuvre. » (Rires et applaudissements.) Telle est la teneur de la dépêche du cabinet actuel à son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au Brésil, dépêche qui sera publiée dans cent ans d’ici. Il n’est pas douteux que beaucoup de gens se sont laissé prendre à cet étalage d’intérêt affecté au sujet de l’esclavage ; bons et honnêtes philanthropes, si tant est que ce ne soit pas trop s’avancer que de décerner ce titre à des hommes qui se complaisent dans la pure satisfaction d’une conscience aveugle, car la bienveillance du vrai philanthrope doit bien être guidée par quelque chose qui ressemble à la raison. Il y a une classe d’individus qui se sont acquis de nos jours une certaine renommée, qui veulent absolument nous assujettir, non aux inspirations d’une charité éclairée, mais au contrôle d’un pur fanatisme. Ces hommes, sous le prétexte d’être les avocats de l’abolition, pétitionnent le gouvernement pour qu’il interdise au peuple de ce pays l’usage du sucre, à moins qu’il ne soit prouvé que ce sucre est pur de la tache de l’esclavage, comme ils l’appellent. Y a-t-il quelque chose dans l’ordre moral, analogue à ce qui se passe dans l’ordre physique, d’où l’on puisse inférer que certains objets sont conducteurs, d’autres non conducteurs d’immoralité ? (Rires.) Que le café, par exemple, n’est pas conducteur de l’immoralité de l’esclavage ; mais que le sucre est très-conducteur, et qu’en conséquence il n’en faut pas manger ? J’ai rencontré de ces philanthropes sans logique, et ils m’ont personnellement appelé à répondre à leurs objections contre le sucre-esclave. Je me rappelle, entre autres circonstances, avoir discuté la question avec un très-bienveillant gentleman, enveloppé d’une belle cravate de mousseline blanche. (Rires.) « N’ajoutez pas un mot, lui dis-je, avant d’avoir arraché cette cravate de votre cou. » (Éclats de rire.) Il me répondit que cela n’était pas praticable. (Oh ! oh !) « J’insiste, lui répondis-je, cela est praticable, car je connais un gentleman qui se refuse des bas de coton, même en été (rires), et qui ne porterait pas des habits cousus avec du fil de coton s’il le savait. » (Nouveaux rires.) Je puis vous assurer que je connais un philanthrope qui s’est imposé ce sacrifice. — « Mais, ajoutai-je, s’il n’est pas praticable pour vous, qui êtes là devant moi avec du produit esclave autour de votre cou, de vous passer de tels produits, cela est-il praticable pour tout le peuple d’Angleterre ? Cela est-il praticable pour nous comme nation ? (Applaudissements.) Vous pouvez bien, si cela vous plaît, défendre par une loi l’introduction du sucre-esclave en Angleterre. Mais atteindrez-vous par là votre but ? Vous recevez dans ce pays du sucre-libre ; cela fait un vide en Hollande ou ailleurs qui sera comblé avec du sucre-esclave. » (Applaudissements.) Avant que des hommes aient le droit de prêcher de telles doctrines et d’appeler à leur aide la force du gouvernement, qu’ils donnent, par leur propre abnégation, la preuve de leur sincérité. (Écoutez ! écoutez !) Quel droit ont les Anglais, qui sont les plus grands consommateurs de coton du monde, d’aller au Brésil sur des navires chargés de cette marchandise, et là, levant les yeux au ciel, versant sur le sort des esclaves des larmes de crocodile, de dire : Nous voici avec nos chargements de cotons ; mais nous éprouvons des scrupules de conscience, des spasmes religieux, et nous ne pouvons recevoir votre sucre-esclave en retour de notre coton-esclave ? (Bruyants applaudissements.) Il y a là à la fois inconséquence et hypocrisie. Croyez-moi, d’habiles fripons se servent du fanatisme pour imposer au peuple d’Angleterre un lourd fardeau. (Écoutez ! écoutez !) Ce n’est pas autre chose. Des hommes rusés et égoïstes exploitent sa crédulité et abusent de ce que sa bienveillance n’est pas raisonnée. Nous devons en finir avec cette dictature que la raison ne guide pas. (Applaudissements.) Oseront-ils dire que je suis l’avocat de l’esclavage, parce que je soutiens la liberté du commerce ? Non, je proclame ici, comme je le ferai partout, que deux principes également bons, justes et vrais, ne peuvent jamais se contrarier l’un l’autre. Si vous me démontrez que la liberté du commerce est calculée pour favoriser, propager et perpétuer l’esclavage, alors je m’arrêterai dans le doute et l’hésitation, j’examinerai laquelle des deux, de la liberté personnelle ou de la liberté des échanges, est la plus conforme aux principes de la justice et de la vérité ; et comme il ne peut y avoir de doute que la possession d’êtres humains, comme choses ou marchandises, ne soit contraire aux premiers principes du christianisme, j’en conclurai que l’esclavage est le pire fléau, et je serai préparé à abandonner la cause de la liberté commerciale elle-même. (Applaudissements enthousiastes.) Mais j’ai toujours été d’opinion avec les grands écrivains qui ont traité ce sujet, avec les Smith, les Burke, les Franklin, les Hume, — les plus grands penseurs du siècle, — que le travail esclave est plus coûteux que le travail libre, et que s’ils étaient livrés à la libre concurrence, celui-ci surmonterait celui-là.
L’orateur développe cette proposition. Il démontre par plusieurs citations d’enquêtes et de délibérations émanées de la société contre l’esclavage (anti-slavery society), que cette grande association a toujours considéré la libre concurrence comme le moyen le plus efficace de détruire l’esclavage, en abaissant assez le prix des produits pour le rendre onéreux.
Et maintenant, continue-t-il, j’adjure les abolitionnistes de faire ce que font les free-traders, d’avoir foi dans leurs propres principes (applaudissements), de se confier, à travers les difficultés de la route, à la puissance de la vérité. Comme free-traders, nous ne demandons pas l’admission du sucre-esclave, parce que nous préférons le travail de l’esclave à celui de l’homme libre, mais parce que nous nous opposons à ce qu’un injuste monopole soit infligé au peuple d’Angleterre, sous le prétexte d’abolir l’esclavage. Nous nions que ce soit là un moyen loyal et efficace d’atteindre ce but. Bien au contraire, c’est assujettir le peuple de la Grande-Bretagne à un genre d’oppression et d’extorsion qui n’est dépassé en iniquité que par l’esclavage lui-même. Nous soutenons, avec la Convention des abolitionnistes (anti-slavery convention), que le libre travail, mis en concurrence avec le travail esclave, ressortira moins cher, sera plus productif, qu’il l’étouffera à la fin, à force de rendre onéreux au planteur l’affreux système de retenir ses frères en servitude. (Applaudissements.) Eh quoi ! ne serait-ce point une chose monstrueuse que, dans la disposition du gouvernement moral de ce monde, les choses fussent arrangées de telle sorte que l’homme fût rémunéré pour avoir exercé l’injustice envers son semblable! L’abondance et le bon marché : voilà les récompenses promises dès le commencement à ceux qui suivent le droit sentier. Mais si un meilleur marché, une plus grande abondance, sont le partage de celui qui s’empare de son frère et le force au travail sous le fouet, plutôt que de celui qui offre une loyale récompense à l’ouvrier volontaire ; s’il en est ainsi, je dis que cela bouleverse toutes les notions que nous nous faisions du juste, et que c’est en contradiction avec ce que nous croyons du gouvernement moral de l’univers. (Bruyants applaudissements.) Si donc il est dans la destinée de la libre concurrence de renverser l’esclavage, je demande aux abolitionnistes qui ont proclamé cette vérité, comment ils peuvent aujourd’hui, en restant conséquents avec eux-mêmes, venir pétitionner la Chambre des communes, lui demander d’interdire cette libre concurrence, c’est-à-dire d’empêcher que les moyens mêmes qu’ils ont proclamés les plus efficaces contre l’esclavage ne soient mis en œuvre dans ce pays. Je veux bien croire que beaucoup de ces individus sont honnêtes. Ils ont prouvé leur désintéressement par les travaux auxquels ils se sont livrés ; mais qu’ils prennent bien garde de n’être pas les instruments aveugles d’hommes subtils et égoïstes ; d’hommes qui ont intérêt à maintenir le monopole du sucre, qui est aussi pour ce pays l’esclavage sous une autre forme, d’hommes qui, pour arriver à leur fin personnelle et inique, s’empareront effrontément des sentiments de ce peuple, et exploiteront sans scrupule cette vieille horreur britannique contre l’esclavage.
Le reste de ce discours a trait aux mesures prises par l’association pour élargir et purifier les cadres du corps électoral. La Ligue s’étant plus tard exclusivement occupée de cette œuvre, nous aurons occasion de faire connaître ses plans et ses moyens d’exécution.
On remarquera les efforts auxquels sont obligés de se livrer les free-traders pour prémunir le peuple contre l’exploitation par les monopoleurs du sentiment public à l’égard de l’esclavage ; ce qui prouve au moins l’existence, la sincérité et même la force aveugle de ce sentiment.
FN: On a vu ailleurs que c’est la formule employée par la Ligue dans ses réclamations.
Séance du 14 mai 1844.↩
Le fauteuil est occupé par M. John Bright, m. P., qui ouvre la séance par l’allocution suivante, dont nous donnons ici des extraits, quoiqu’elle n’ait qu’un rapport indirect avec la question de la liberté commerciale, mais parce qu’elle nous paraît propre à initier le lecteur français dans les mœurs anglaises, sous le rapport électoral.
Ladies et gentlemen, le président du conseil de la Ligue devait aujourd’hui occuper le fauteuil ; mais quand je vous aurai expliqué la cause de son absence, vous serez, comme moi, convaincus qu’il ne pouvait pas être plus utilement occupé dans l’intérêt de notre cause. Il est en ce moment engagé dans les dispositions qu’exige la grande lutte électorale qui se prépare dans le Sud-Lancastre ; et connaissant, comme je le fais, l’habileté extraordinaire de M. G. Wilson en cette matière, je suis certain qu’il n’est aucun homme dont on eût plus mal à propos négligé les services. (Bruyantes acclamations.) Lorsque je promène mes regards sur la foule qui se presse dans ce vaste édifice, quand je considère combien de fois elle y a déployé son enthousiasme, combien de fois elle y est accourue, non pour s’abreuver des charmes de l’éloquence, mais pour montrer au monde qu’elle adhère pleinement aux principes que la Ligue veut faire prévaloir, je suis certain aussi qu’en ce moment des milliers de cœurs battent dans cette enceinte, animés du vif désir de voir la lutte qui vient de s’ouvrir dans le Lancastre se terminer par le triomphe de la cause de la liberté commerciale. (Acclamations prolongées.) Il y a des bourgs de peu d’importance où nous ne pouvons compter sur aucune ou presque aucune voix indépendante, et, sous ce rapport, les résolutions du Lancastre ont plus de poids que celles d’une douzaine de bourgs tels que Woodstock ou Abingdon. C’est pourquoi les vives sympathies de ce meeting se manifestent au sujet de la lutte actuelle, et il désire que les électeurs du Lancastre sachent bien toute l’importance qu’il y attache. Et quelle que soit notre anxiété, je crains encore que nous ne voyons pas ce grand débat avec tout l’intérêt qu’il mérite (Écoutez !) J’ai souvent rencontré des personnes dans le sud de l’Angleterre qui parlent du Lancastre comme d’un comté d’une importance ordinaire ; comme n’en sachant pas autre chose, si ce n’est — qu’il renferme un grand nombre de manufacturiers avares et cupides, dont quelques-uns très-riches, et une population compacte d’ouvriers brutalisés, mal payés et dégradés ; — qu’il contient un grand nombre de villes considérables, de morne apparence, reliées entre elles par des chemins de fer (rires) ; que chaque trait de ce pays est plus fait pour inspirer la tristesse que le contentement ; qu’il n’a de valeur que par ce qu’on en retire ; que c’est une terre, en un mot, dont le touriste et l’amateur du pittoresque doivent soigneusement s’éloigner. (Rires et applaudissements.) — Je suis né dans ce comté, j’y ai vécu trente ans ; j’en connais la population, l’industrie et les ressources, et j’ai la conviction, j’ai la certitude qu’il n’y a pas en Angleterre un autre comté qui puisse lui être comparé, et dont l’importance influe au même degré sur le bien-être et la grandeur de l’empire. (Bruyantes acclamations.) C’est certainement le plus populeux, le plus industrieux, le plus riche comté de l’Angleterre. Comment cela est-il arrivé ? Il fut un temps où il présentait un aspect bien différent. On le considérait comme un désert, il y a deux cent quarante ans. Cambden, dans son voyage, traversa le pays de York à Durham, et sur le point de pénétrer dans le Lancastre, son esprit se remplit d’appréhension. « J’approche du Lancastre, écrivait-il, avec une sorte de terreur. » (De notre temps il ne manque pas de gens qui ne pensent aussi au Lancastre qu’avec terreur.) (Rires et applaudissements.) « Puisse-t-elle n’être pas un triste présage ! cependant pour n’avoir pas l’air d’éviter ce pays, je suis décidé à tenter les hasards de l’entreprise, et j’espère que l’assistance de Dieu, qui m’a accompagné jusqu’ici, ne m’abandonnera pas en cette circonstance. » (Écoutez ! écoutez !) Il parle de Rochdale, Bury, Blackburn, Preston, Manchester, comme de villes de quelque industrie ; il mentionne Liverpool — Litherpool, et par abréviation Lerpooly, comme une petite place sur le rivage, bien située pour faire voile vers l’Irlande. Mais il ne dit pas un mot de Ashton, Bolton, Oldham, Salford et autres villes, et il n’y a aucune raison de croire qu’elles étaient connues à cette époque. (Écoutez ! écoutez !) Il n’est pas inutile de consacrer quelques instants à examiner le prodigieux accroissement de valeur qu’a acquis la propriété dans ce comté. En 1692, il y a un siècle et demi, la valeur annuelle était de 7,000 liv. sterl. En 1841, elle était de 6,192,000 liv. sterl. (Bruyantes acclamations.) Ainsi l’accroissement moyen dans ce comté, pendant cent cinquante ans, a été de 6,300 pour cent. Par là les landlords peuvent apprécier combien l’industrie réagit favorablement sur la propriété.
L’orateur entre ici dans quelques détails statistiques sur les étonnants progrès du Lancastre, et poursuit ainsi :
À qui sont dus ces grands changements ? (Acclamations.) Est-ce aux seigneurs terriens? (Non, non.) Il y a quarante-quatre ans que l’antiquaire Whittaker, dans son histoire de Whalley, dépeignait l’état des propriétaires terriens du Lancastre, comme n’ayant subi aucun changement depuis deux siècles. « Ils aiment, disait-il, la vie de famille ; sont sans curiosité et sans ambition. Ils demeurent beaucoup chez eux, et s’occupent d’amusements domestiques peu délicats, mais aussi peu coûteux. » Il ajoute qu’il ne rencontra parmi eux qu’un homme ayant de la littérature. (Rires.) Si tels étaient les propriétaires du Lancashire, ce ne sont donc pas eux qui l’ont fait ce qu’il est. Il existe dans ce comté beaucoup de vieilles demeures, résidences d’anciennes, familles, maintenant éteintes pour la plupart ; elles se sont vu dépasser dans la carrière par une autre classe d’hommes. Leurs habitations sont transformées en manufactures, et elles-mêmes ont été balayées de toute la partie méridionale du comté ; non qu’elles aient souffert la persécution ou la guerre, car elles ont eu les mêmes chances ouvertes à tous les citoyens ; mais, fruges consumere nati, elles n’ont pas jugé nécessaire de cultiver leur intelligence, elles n’ont cru devoir se livrer à aucun travail. D’autres hommes se sont élevés, qui, s’emparant des inventions de Watt et d’Arkwright, dédaignées par les classes nobles, ont effacé les anciens magnats du pays et se sont mis à la tête de cette grande population. (Acclamations.) C’est l’industrie, l’intelligence et la persévérance de ces générations nouvelles qui, en se combinant, ont fait du Lancastre ce que nous le voyons aujourd’hui. Ses minéraux sont inappréciables ; mais gisant depuis des siècles sous la surface de son territoire, il a fallu que des races nouvelles, pleines de sève et de jeunesse, les ramenassent à la lumière, pour les transformer en ces machines puissantes si méprisées par d’autres classes ; machines qui sont comme les bras de l’Angleterre, dont elle se sert pour disséminer dans le monde les richesses de son industrie, rapporter et répandre avec profusion, au sein de l’empire, les trésors accumulés dans tout l’univers. (Tonnerre d’applaudissements.) Ce souple et léger duvet arraché à la fleur du cotonnier, telle est la substance à laquelle cette grande nation doit sa puissance et sa splendeur. (Applaudissements.) Ainsi, le Lancastre est l’enfant du travail et de l’industrie sous leurs formes les plus magnifiques. Naguère il essayait encore ses premiers pas dans la vie ; il est maintenant plein de force et de puissance, et dans le court espace de temps qui suffit à l’enfant pour devenir homme, il est devenu un géant aux proportions colossales. Et pourtant, malgré sa vigueur, ce géant languit comme abattu sous les liens et les chaînes qu’une politique imprévoyante, ignorante et arriérée a imposés à ses membres musculeux. (Applaudissements prolongés. ) La question, pour les électeurs du Lancastre, est donc de savoir si ces entraves doivent durera toujours. (Écoutez ! écoutez !) Riveront-ils eux-mêmes ces fers par leurs suffrages, ou sauront-ils s’en dégager comme des hommes ? Si les électeurs savaient tout ce qui dépend de leurs votes, quel est l’homme, dans ce comté, ou ailleurs, qui oserait aller leur demander leurs voix en faveur de ce fléau pestilentiel — la loi-céréale, et tous les monopoles qui l’accompagnent ? (Bruyantes acclamations.) S’ils étaient pénétrés de cette conviction (et je crois qu’elle a gagné beaucoup d’entre eux) que la détresse des cinq dernières années doit son origine à cette loi ; s’ils savaient qu’elle a précipité bien des négociants de la prospérité à la ruine, et bien des artisans de l’aisance à la misère ; qu’elle a poussé le peuple à l’expatriation, porté la désolation dans des milliers de chaumières, la douleur et le découragement dans le cœur de millions de nos frères ; s’ils savaient cela, croyez-vous qu’ils iraient appuyer de leurs suffrages la plus aveugle, la plus hypocrite folie qui soit jamais entrée dans l’esprit de la législation d’aucun peuple de la terre ? (Acclamations prolongées.) Oh ! si les électeurs pouvaient voir ce meeting ; si chacun d’eux, debout sur cette estrade, pouvait sentir les regards de six mille de ses compatriotes se fixer sur son cœùr et sur sa conscience et y chercher si l’on y découvre quelque souci du bien public, quelque trace de l’amour du pays, je vous le demande, en est-il un seul assez dur et assez stupide pour se présenter ensuite aux hustings et y lever la main en faveur de cet effroyable fléau ? — Mais je conçois d’autres et de meilleures espérances. J’espère que le résultat de cette lutte tournera à la gloire de notre grande cause. Le principe de la liberté gagne du terrain de toutes parts. — Il peut arriver encore, pendant quelque temps, que vous ne réussirez pas dans les élections; il se peut que votre minorité actuelle dans le Parlement ne soit pas près de se transformer en majorité ; il peut se rencontrer encore des organes de la presse qui nient nos progrès, raillent nos efforts et cherchent à les paralyser. — Tout cela peut être ; mais le flot est en mouvement; il s’enfle, il s’avance et ne reculera pas. Dans les assemblées publiques, comme au sein des foyers domestiques, partout où nous allons, partout où nous nous mêlons, nous voyons le préjugé de la « protection » mis à nu, et le principe de la liberté dominer les intelligences. (Applaudissements bruyants et prolongés.)
La lutte actuelle du Lancashire nous offre encore un sujet de satisfaction. Le candidat des free-traders est le chef d’une des maisons de commerce les plus puissantes de ce royaume, et peut-être du monde. C’est un homme de haute position, de longue expérience, de vastes richesses, et de grand caractère. Il a d’énormes capitaux engagés, soit dans des entreprises commerciales, soit dans des propriétés territoriales. Ses principales relations sont aux États-Unis, et c’est ce qui me plaît dans sa candidature. Il a vécu longtemps en Amérique ; il y a un établissement considérable ; il sent avec quelle profusion la Providence a accordé à ce pays les moyens de satisfaire les besoins de celui-ci, et combien, d’un autre côté, le génie, l’industrie et le capital de l’Angleterre sont merveilleusement calculés pour répandre sur nos frères d’outre-mer les bienfaits de l’aisance et du bien-être. (Acclamations.) Il est un de ces hommes qui sont debout, pour ainsi dire, sur les rivages de celte île, comme représentant les classes laborieuses, et qui échangent, par-dessus l’Atlantique, les vêtements que nous produisons contre les aliments qui nous manquent. Si ce n’était cette loi, que sa mission au Parlement sera de déraciner à jamais ; si ce n’était cette loi, il ne rapporterait pas seulement d’Amérique du coton, du riz, du tabac, et d’autres produits de cette provenance, mais encore et surtout ce qui les vaut tous, l’aliment, l’aliment substantiel pour les millions de nos concitoyens réduits à la plus cruelle des privations. (Les acclamations se renouvellent avec un enthousiasme toujours croissant.) L’accueil que vous faites aux sentiments que j’exprime prouve qu’il y a dans cette assemblée une anxiété profonde quant au résultat de cette grande lutte électorale, et que nous, qu’elle concerne plus spécialement, dans les meetings que nous tiendrons dans le Lancastre, dans les discours que nous y prononcerons, dans les écrits que nous y ferons circuler, nous sommes autorisés à dire aux 18,000 électeurs de ce comté que les habitants de cette métropole, représentés par la foule qui m’entoure, les prient, les exhortent, les adjurent, par tout ce qu’il y a de plus sacré au monde, de rejeter au loin toute manœuvre, tout préjugé, tout esprit de parti ; de mépriser les vieux cris de guerre des factions; de marcher noblement et virilement sous la bannière qui fait flotter dans les airs cette devise : Liberté du commerce pour le monde entier ; pleine justice aux classes laborieuses de l’Angleterre.
À la fin de ce brillant discours, l’assemblée se lève en masse et fait retentir pendant plusieurs minutes des applaudissements enthousiastes, au milieu desquels M. Bright reprend le fauteuil. Au bout d’un moment, il s’avance encore et dit : Le meeting entendra maintenant M. James Wilson que j’ai le plaisir d’introduire auprès de vous comme un des plus savants économistes de l’époque.
M. James Wilson s’avance et est accueilli par des marques de satisfaction. Il s’exprime en ces termes :
Monsieur le président, ladies et gentlemen, pour ceux qui, depuis plusieurs années, ont suivi avec un profond intérêt les progrès de cette question, il n’est peut-être pas de spectacle plus consolant à la fois et plus encourageant que celui que nous offrent ces vastes réunions. Nous ne devons pas perdre de vue cependant que la forte conviction qui nous anime n’a pas encore gagné l’ensemble du pays, la grande masse des électeurs du royaume, et malheureusement la plus grande portion de la législature ; et nous devons nous rappeler que, sur le sujet qui nous occupe, les esprits flottent encore au gré d’un grand nombre de préjugés spécieux, qu’il est de notre devoir de combattre et de dissiper par tous les moyens raisonnables. Un de ces sophismes, qui peut-être en ce moment nuit plus que tout autre au progrès de la cause de la liberté commerciale, c’est l’accusation d’inconséquence qui nous est adressée, relativement à une double assertion que nous avons souvent à reproduire. Cette imputation est souvent répétée au dedans et au dehors des Chambres ; elle est dans la bouche de toutes les personnes qui soutiennent des doctrines opposées aux nôtres, et je crois que, présentée sans explication, elle ne manque pas d’un certain degré de raison apparente. Par ce motif, nous devons nous attacher à détruire ce préjugé. J’ai l’habitude de considérer ces meetings comme des occasions d’instruction plutôt que d’amusement. Lors donc que je me propose d’élucider une ou deux difficultés qui me paraissent, dans le moment actuel, agir contre le progrès de notre cause, j’ai la confiance que vous m’excuserez si je renferme mes remarques dans ce qui est capable de procurer une instruction solide, plutôt que dans ce qui serait de nature à divertir les esprits ou exciter les passions. Cette inconséquence, à laquelle je faisais allusion, et qu’on nous attribue trop souvent, consisterait en ceci : que, lorsque nous nous adressons aux classes manufacturières et commerciales, nous représentons les effets des lois-céréales comme désastreux, en conséquence de la cherté des aliments qu’elles infligent au consommateur ; tandis que d’un autre côté, quand nous nous adressons à la population agricole, nous lui disons que la liberté commerciale ne nuira pas à ses intérêts quant aux prix actuels, et moins encore peut-être, quant aux prix relatifs. — Ces assertions, j’en conviens, paraissent se contredire, et cependant je crois pouvoir prouver qu’elles sont toutes deux exactes. — Il faut toujours avoir présent à l’esprit que la « cherté » et le « bon marché » peuvent être l’effet de deux causes distinctes. — La cherté peut provenir ou de la rareté, ou d’une grande puissance de consommation dans la communauté. Si la cherté provient de la rareté, alors les prix s’élèvent pour les consommateurs au-dessus de leurs moyens relatifs d’acquisition. Si la cherté est l’effet d’un accroissement dans la demande, cela implique une plus grande puissance de consommation, ou, en d’autres termes, le progrès de la richesse publique. D’un autre côté, le bon marché dérive aussi de deux causes. Il peut être le résultat de l’abondance, et alors c’est un bien pour tous ; mais il peut être produit aussi, ainsi que nous en avons eu la preuve dans ces deux dernières années, par l’impuissance du consommateur à acheter les objets de première nécessité. — Maintenant, ce que je soutiens, c’est que les restrictions et les monopoles tendent à créer cette sorte de cherté qui est préjudiciable, parce qu’elle naît de la rareté ; tandis que la liberté du commerce pourrait bien aussi amener la cherté, mais seulement cette sorte de cherté qui suit le progrès de la richesse et accompagne le développement de la puissance de consommation. — De même, il peut arriver que les mesures restrictives soient suivies du bon marché, non de ce bon marché qui est l’effet de l’abondance, mais de ce bon marché qui prouve l’absence de facultés parmi les consommateurs. C’est pourquoi je dis que la première tendance des lois-céréales, l’objet et le but même de notre législation restrictive, c’est de limiter la quantité. Si elles limitent la quantité, leur premier effet, j’en conviens, est d’élever le prix. — Mais l’effet d’approvisionnements restreints, c’est diminution d’industrie, suivie de diminution dans l’emploi, suivie elle-même de diminution dans les moyens de consommer, d’où résulte, pour effet dernier et définitif, diminution de prix. (Bruyants applaudissements.) Sur ce fondement, je soutiens que les lois-céréales, ou toutes autres mesures restrictives, manquent leur propre but, et cessent, à la longue, de profiter à ceux-là mêmes dont elles avaient l’avantage en vue. En effet, ce système produit d’abord des prix élevés, mais trompeurs, parce qu’il ne peut les maintenir. Il entraîne dans des marchés qu’on ne peut tenir, dans des contrats qui se terminent par le désappointement ; il sape dans leur base même les ressources de la communauté, parce qu’il lèse les intérêts et détruit les facultés de la consommation. Combien est clair et palpable cet enchaînement d’effets, en ce qui concerne la restriction, qui nous occupe principalement, la loi-céréale ! Sa tendance est d’abord de limiter la quantité des aliments, et par conséquent d’en élever le prix ; mais sa seconde tendance est de détruire l’industrie. — Cependant, le fermier a stipulé sur son bail une rente calculée sur le haut prix promis par la législature ; mais, dans la suite des événements, l’industrie est paralysée, le travail délaissé, les moyens de consommer diminuent, et en définitive, le prix des aliments baisse, au désappointement du fermier et pour la ruine de tout ce qui l’entoure. (Approbation.) — Raisonnons maintenant dans l’hypothèse d’une parfaite liberté dans le commerce des céréales. L’argument serait le même pour toute autre denrée, mais bornons-nous aux céréales. — Si l’importation était libre, la tendance immédiate serait d’augmenter la quantité, et il s’ensuivrait peut-être une diminution de prix. Mais avec des quantités croissantes vous auriez un travail croissant, et avec un travail croissant, puis d’emploi pour vos navires et vos usines, vos marins et vos ouvriers, plus de communications intérieures, une meilleure distribution des aliments parmi les classes de la communauté, finalement plus de travail, afin de créer précisément les choses que vous auriez à donner en payement du blé ou du sucre. Je dis donc que, quoique la première tendance de la liberté commerciale soit de réduire les prix, son effet ultérieur est de les relever, de les maintenir à un niveau plus égal et plus régulier que ne peut le faire le système restrictif. Il n’y a peut-être pas d’erreur plus grossière que celle qui consiste à attribuer trop d’importance aux prix absolus. Quand nous parlons de diminuer les droits, on nous dit sans cesse : « Cela fera tout au plus une différence d’un farthing ou d’un penny par livre, et qu’est-ce que cela dans la consommation d’un individu ? » Mais quand la différence serait nulle, quand le sucre conserverait son prix actuel, s’il est vrai que la diminution du droit doit amener dans le pays une quantité additionnelle de sucre, cela même est un grand bien pour la communauté. En un mot si la nation peut importer plus de sucre, et payer, la plus grande quantité au même prix qu’elle payait la plus petite, c’est là précisément ce qui témoigne de son progrès, parce que cela prouve que son travail s’est assez accru pour la mettre en mesure de consommer, au même taux, des quantités additionnelles.
Nous avons eu, l’année dernière, des preuves remarquables de la vérité de ces principes. Au commencement de l’an, les prix en toutes choses étaient extraordinairement réduits. Les produits agricoles de toute nature, les objets manufacturés de toute espèce étaient à très-bon marché, et les matières premières de toute sorte, à des prix plus bas qu’on ne les avait jamais vues. La conséquence de ce bon marché (et ces faits se suivent toujours aussi régulièrement que les variations du mercure suivent, dans le baromètre, les variations de la pesanteur de l’air), la conséquence de ce bon marché, dis-je, fut de donner à l’industrie une impulsion qui réagit sur les prix. Pendant l’année, vous avez vu s’accroître l’importation de presque toutes les matières premières, et spécialement de cet article (la laine) dont s’occupe maintenant la législature et qui témoigne si hautement de la vérité de nos principes. Le duc de Richmond se plaint amèrement de ce que sir Robert Peel se propose d’abolir le droit sur la laine. Il est persuadé que la libre introduction de la laine étrangère diminuera la valeur des toisons que lui fournissent ses nombreux troupeaux du nord de l’Écosse. Mais si le noble duc s’était donné la peine d’examiner la statistique commerciale du pays (et il n’a certes pas cette prétention), il aurait trouvé que nos plus fortes importations ont toujours coïncidé avec l’élévation du prix des laines indigènes, et que c’est quand nous cessons d’importer que ces prix s’avilissent. En 1819, la laine étrangère était assujettie à un droit de 6 d. par livre, et nos importations étaient de 19,000,000 livres. M. Huskisson décida le gouvernement et la législature à réduire le droit à 1 d., et depuis ce moment, l’importation s’accrut jusqu’à ce qu’elle a atteint, en 1836, le chiffre de 64,000,000 liv. ; durant cette période, le prix de la laine indigène, au lieu de baisser par l’effet d’importations croissantes, s’éleva de 12 à 19 d. par livre. Depuis 1836 (et ceci est à remarquer), pendant les années des crises commerciales, l’importation de la laine est tombée de 64 millions à 40 millions de livres (1842), et pendant ce temps, bien que la laine indigène n’ait eu à lutter que contre une concurrence étrangère réduite de 20 millions de livres, elle a baissé de 19 d. à 10 d. — Enfin, l’année dernière, l’état des affaires s’est amélioré. J’ai dans les mains un document qui constate l’importation des trois premiers mois de l’année dernière, comparée à celle de la période correspondante de cette année. Je trouve qu’elle fut alors de 4,500,000 livres, et qu’elle a été maintenant de 9,500,000 livres ; et dans le moment actuel, le producteur anglais, malgré une importation plus que double, reçoit un prix plus élevé de 25 pour 100. Ces principes sont si vrais, que les faits viennent, pour ainsi dire, les consacrer de mois en mois. J’en rappellerai encore un bien propre à résoudre la question, et je le soumets au noble duc et à tous ceux qui s’opposent à la mesure proposée par le ministère. Je viens dédire qu’en 1842 l’importation fut de 4,500,000 livres, et le prix de 10 d., — en 1843, l’importation a été de 9,500,000 livres et le prix de 13 d. Mais il faut examiner l’autre face de la question ; il faut s’enquérir de nos exportations d’étoffes de laine, car c’est là qu’est la solution du problème. Nous ne pouvons en effet acheter au dehors sans y vendre ; y augmenter nos achats, c’est y augmenter vos ventes. Il est évident que l’étranger ne vous donne rien pour rien, et si vous pouvez importer, cela preuve que vous devez exporter. (Bruyantes acclamations.) Je trouve que, dans les trois premiers mois de 1842, quand vous importiez peu de laines et que les prix étaient avilis, vos exportations ne s’élevèrent qu’à 1,300,000 l. st. Mais cette année, avec une importation de 9,500,000 l. st., avec des prix beaucoup plus élevés, vous avez exporté pour 1,700,000 l. st. C’est là qu’est l’explication. Vos croissantes importations ont amené de croissantes exportations et une amélioration dans les prix. (Écoutez ! écoutez !) Je voudrais bien demander au duc de Richmond et à ceux qui pensent comme lui en cette matière, à quelle condition ils amèneraient l’industrie de ce pays, s’ils donnaient pleine carrière à leurs principes restrictifs ? S’ils disent : « Nous circonscrirons l’industrie de la nation à ses propres produits, » il s’ensuit que nous aurons de moins en moins de produits à échanger, de moins en moins d’affaires, de moins en moins de travail, et finalement de plus en plus de paupérisme. — Au contraire, si vous agissez selon les principes de la liberté, plus vous leur laisserez d’influence, plus leurs effets se feront sentir. Tout accroissement d’importation amènera un accroissement correspondant d’exportation et réciproquement, et ainsi de suite sans limite et sans terme. Plus vous ajouterez à la richesse et au bien-être de la race humaine, dans le monde entier, plus elle aura la puissance et la volonté d’ajouter à votre propre richesse, à votre propre bien-être. (Applaudissements.) À chaque pas, le principe de la restriction s’aheurte à une nouvelle difficulté ; tandis qu’à chaque pas le principe de la liberté acquiert plus d’influence sur le bonheur de la grande famille humaine. (Les applaudissements se renouvellent.) Il y a, dans les doctrines que les gouvernements ont de tous temps appliquées et appliquent encore au commerce, une inconséquence dont il est difficile de se rendre compte. Ce n’est pas que le principe pour lequel nous combattons soit nouveau, car il n’est pas d’hommes d’État, de philosophes, d’hommes d’affaires et même de grands seigneurs, doués d’une vaste intelligence, qui ne répètent depuis des siècles, dans leurs écrits et leurs discours, les mêmes paroles qu’à chaque meeting nous faisons retentir à cette tribune. Nous en trouvons partout la preuve ; hier encore, il me tomba par hasard sous les yeux un discours prononcé il y a quatre-vingts ans à la Chambre des communes, par lord Chatam, et le langage qu’il tenait alors ne serait certes pas déplacé aujourd’hui dans cette enceinte. En parlant de l’extension du commerce, il disait : « Je ne désespère pas de mon pays, et je n’éprouve aucune difficulté à dire ce qui, dans mon opinion, pourrait lui rendre son ancienne splendeur. Donnez de la liberté au commerce, allégez le fardeau des taxes, et vous n’entendrez point de plaintes sur vos places publiques. Le commerce étant un échange de valeurs égales, une nation qui ne veut pas acheter ne peut pas vendre, et toute restriction à l’importation fait obstacle à l’exportation. Au contraire, plus nous admettrons les produits de l’étranger, plus il demandera de nos produits. Que notre absurde système de lois-céréales soit graduellement, prudemment aboli ; que les productions agricoles de l’Europe septentrionale, de l’Amérique et de l’Afrique entrent librement dans nos ports, et nous obtiendrons, pour nos produits manufacturés, un débouché illimité. Une économie sévère, efficace, systématique des deniers publics, en nous permettant de supprimer les taxes sur le sel, le savon, le cuir, le fer et sur les principaux articles de subsistance, laissera toute leur influence à nos avantages naturels ; et par notre position insulaire, par l’abondance de nos mines, de nos combustibles, par l’habileté et l’énergie de notre population, ces avantages sont tels, que, si ce n’étaient ces restrictions absurdes et ces taxes accablantes, la Grande-Bretagne serait encore pendant des siècles le grand atelier de l’univers. » (Pendant la lecture de cette citation, les applaudissements éclatent à plusieurs reprises.)
Ainsi, ces principes ont été proclamés par tous les hommes qui se sont fait un nom dans l’histoire comme hommes d’État et comme philosophes. Cependant, nous trouvons que jusqu’à ce jour, ces mêmes principes sont répudiés par tous les gouvernements sur la surface de la terre. Quel témoignage plus éclatant de l’inconséquence de leur politique que ce principe qui la dirige, savoir : La chose dont le pays manque le plus sera le plus rigidement exclue ; la chose que le pays possède en plus grande abondance sera le plus librement admise. (Écoutez ! écoutez !) La France nous donne un remarquable exemple de cette inconséquence, et il vaut la peine de le rapporter, car nous jugeons toujours avec plus de sang-froid, de calme et d’impartialité la folie d’autrui que la nôtre. Il y a environ trois ans, un de mes amis fut envoyé sur le continent par le dernier cabinet pour conclure un traité avec la France. Elle consentait à admettre nos fers ouvrés, notre coutellerie et nos tissus de lin, à des droits plus modérés. Mais la principale chose que les Français stipulèrent en retour, c’est qu’ils pourraient recevoir nos machines à filer et tisser le lin. Cela était regardé par la France comme une grande concession. Elle se souciait peu des machines à filer le coton, ayant appris depuis longtemps à les faire aussi bien que nous. Mais elle désirait ardemment recevoir nos machines linières, branche d’industrie dans laquelle nous faisions de rapides progrès. — La stipulation fut arrêtée, nos manufacturiers consultés acquiescèrent libéralement à l’exportation des machines linières. — Sur ces entrefaites, l’ancien cabinet fut renversé et le traité de commerce n’eut pas de suite. — Cependant, l’année dernière, notre gouvernement, sans avoir en vue aucun traité, affranchit le commerce des machines, comme il devrait faire de tous les autres. Il purgea notre Code commercial, notre tarif, de ce fléau, la prohibition de l’exportation des machines. — Eh bien, quoique la libre exportation des machines linières de ce pays pour la France fût précisément la stipulation qui lui tenait tant au cœur, il y a trois ans, quelle a été sa première démarche alors que nous avons affranchi ces machines de tous droits ? Dans cette session, dans ce moment même, elle fait des lois pour exclure nos machines ; et ce qui est le comble de l’inconséquence, elle va mettre un droit de 30 fr. par cent kilog. sur les machines cotonnières dont elle ne s’inquiétait pas, et un droit de 50 fr. sur les machines linières dont elle désirait avec tant d’ardeur la libre introduction. (Écoutez ! écoutez !) Et comment justifie-l-on une conduite si déraisonnable ? Si vous parlez de cela à un Français, il vous dira : « L’Angleterre est devenue puissante par ses machines ; donc il importe à un pays d’avoir des machines, et par ce motif nous exclurons les vôtres afin d’encourager nos propres mécaniciens. » Voilà une manière d’agir qui nous semble bien inconséquente, bien extravagante dans les Français ; mais il n’est pas une des restrictions que nous imposons à notre commerce qui ne soit entachée de la même inconséquence, d’une semblable absurdité. (Écoutez ! écoutez !) Passez en revue tous les articles de notre tarif ; choisissez les articles dont nous avons le plus grand besoin, et vous les verrez assujettis aux plus sévères restrictions. Prenez ensuite les objets qui ne nous sont pas nécessaires, et vous les trouverez affranchis de toute entrave. (Écoutez ! écoutez !) Il est notoire que ce pays-ci manque de produits agricoles et que nous sommes obligés d’en importer périodiquement des quantités énormes. Eh bien, ce sont ces produits qui sont exclus avec le plus de rigueur. À peine laisse-t-on à cette branche de commerce comme une soupape de sûreté, sous la forme de l’échelle mobile (sliding scale), de peur que la chaudière ne s’échauffe trop et ne vole en éclats. (Approbation.) L’importation est donc tolérée dans les années de cruelles détresses. — Mais les choses que vous avez en abondance ne sont assujetties à aucune restriction. Ainsi, cette même inconséquence que nos ministres reprochent aux gouvernements étrangers, et au sujet de laquelle ils écrivent tant de notes diplomatiques, ils la pratiquent sur nous-mêmes. (Acclamations.) Ils la pratiquent non-seulement à l’égard des choses que nous ne produisons pas au dedans en assez grande abondance, mais aussi à l’égard des produits insuffisants de nos colonies. S’il est une denrée dont les colonies nous laissent manquer, c’est celle-là même que l’on repousse par de fortes taxes. Voyez le sucre, objet de première nécessité, dont la production coloniale ne répond pas à notre consommation ; c’est précisément l’article que notre gouvernement exclut avec le plus de rigueur et soumet à la plus forte taxe. Mais enfin, la liberté commerciale obtient en ce moment ce que je considère comme un triomphe signalé. Le ministère actuel, après avoir renversé le cabinet whig à propos de la question des sucres, entraîné maintenant par les nécessités du pays et par le progrès de l’opinion publique, présente une mesure dans le sens de la liberté. (Écoutez ! écoutez !) Je suis loin de vouloir déprécier le changement proposé[1], et je serais plutôt disposé à lui attribuer plus d’importance que ne semblent l’admettre les ministres et les planteurs des Antilles. Je regarde cette mesure comme aussi libérale, plus libérale même (en tant qu’un droit de 34 sh. est moindre qu’un droit de 36 sh.) que celle à l’occasion de laquelle lord Sandon et sir Robert Peel renversèrent lors John Russell et ses collègues. Il est bien vrai qu’il y a entre les deux mesures une prétendue différence. La dernière aspire à établir une distinction entre le sucre-libre et le sucre-esclave. (Écoutez ! écoutez !) Mais la moindre investigation suffit pour démontrer que cette distinction n’a rien de réel. Si le ministère eût présenté le plan que M. Hawes soumit l’année dernière à la Chambre des communes, et qui ne parlait ni de sucre-libre ni de sucre-esclave, le résultat eût été absolument le même ; et en ce qui me concerne, je me réjouis que cela n’ait pas été aperçu ; car, si cela eût été aperçu, il n’est pas douteux qu’on n’eût fait une plus large part à la protection. Examinons, en effet, la portée de cette prétendue différence. On nous dit que nous ne pouvons, sans nous mettre en contradiction avec les principes de moralité que nous professons et avec ce que nous avons fait pour abolir l’esclavage, recevoir du sucre produit à l’étranger par le travail des esclaves. Je crois que ceux qui soutiennent aujourd’hui la liberté commerciale, furent aussi les plus ardents défenseurs de la liberté personnelle. (Acclamations.) C’est pourquoi, dans les observations que j’ai à présenter, veuillez ne pas supposer un seul instant que je sois favorable au maintien de l’esclavage dans aucune partie du monde. Seulement, je pense que la mesure proposée ne tend point directement ni efficacement à l’abolition ; je crois que, comme peuple, nous nous livrons au mépris du monde, lorsque, sous prétexte de poursuivre un but louable, que nous savons bien ne pouvoir atteindre par ce moyen, nous en avons en vue un autre moins honnête, auquel nous tendons par voie détournée, n’osant le faire ouvertement. (Applaudissements.) On nous dit que nous pourrons porter sur le marché autant de sucre-libre que nous voudrons. En examinant de près quelle est la quantité de sucre-libre dont nous pouvons disposer, je trouve que Java, Sumatra et Manille en produisent environ 93,000 tonnes annuellement. En même temps, j’ai la conviction que, sous l’empire du droit proposé, nous ne pouvons, sur ces 93,000 tonnes, en consommer plus de 40,000. Il en restera donc plus de 50,000 tonnes qui devront se vendre sur le continent ou ailleurs et au cours. Vous voyez donc que celui qui arrivera ici sera précisément au même prix que le sucre-esclave sur le continent. Chaque quintal de ce sucre que nous importons, lequel aurait été en Hollande, en Allemagne ou dans la Méditerranée, y sera remplacé par un quintal de sucre-esclave que nous aurons refusé de l’Amérique. Ainsi, bornons-nous à dire que nous recevons le sucre destiné à la Hollande et à l’Allemagne, où cela occasionne un vide qui sera comblé par du sucre-esclave. Transporté sur nos navires, acheté de notre argent, échangé contre nos produits, ce sucre-esclave sera nôtre, entièrement nôtre, sauf qu’il ne nous sera pas permis de le consommer. Nous l’enverrons remplacer ailleurs le sucre-libre que nous aurons porté ici. Ne serons-nous donc pas les agents de toutes ces transactions, tout comme si nous introduisions ce sucre-esclave dans nos magasins ? (Écoutez ! écoutez !) Eh quoi! nous le portons dans nos magasins, nous l’y entreposons pour le raffiner ! Nous nous rendrons la risée de l’Europe continentale, etc.
L’orateur continue à discuter la question des sucres. Il traite ensuite avec une grande supériorité la question du numéraire et des instruments d’échange, à propos du bill de renouvellement de la Banque d’Angleterre, présenté par sir Robert Peel. Cette question n’ayant pas un intérêt actuel pour le public français, nous supprimons, mais non sans regret, cette partie du discours de M. Wilson.
La parole est prise successivement par M. Turner, fermier dans le Somersetshire, et le Rév. John Burnet.
La séance est levée.
FN: Les droits sur les sucres étaient :
3630. 3631. 3632. Sucre étranger. 3633. 3634. Sucre colonial. 3635.
3637. En 1840… 3638. 3639. 69 sh. 3640. 3641. 24 sh. 3642.
3644. Proposition Russel. 3645. 3646. 36 3647. 3648. 24 3649.
3651. Proposition Peel… 3652. 3653. 34 3654. 3655. 24 3656.
Mais selon le projet de M. Peel, converti en loi, on n’admet au droit de 34 sh. que le sucre produit du travail libre.
Séance du 22 mai 1844. — Présidence du général Briggs.↩
Le meeting entend d’abord le Rév. Sam. Greene ; ensuite M. Richard Taylor, common-councilman de Faringdon. Le président donne la parole à M. George Thompson.
M. Thompson est accueilli par des salves réitérées d’applaudissements. Quand le silence est rétabli, il s’exprime en ces termes :
Monsieur le président, ladies et gentlemen, en me levant devant ce splendide meeting, j’éprouve un embarras qui prend sa source dans le sentiment de mon insuffisance ; mais je me console en pensant que vous entendrez après moi un orateur qui vous dédommagera amplement du temps que vous m’accorderez. J’espère donc que vous m’excuserez si je me décharge, sinon entièrement, du moins en grande partie, du devoir qui vient de m’être inopinément imposé par le conseil de la Ligue. (Cris : non ! non !) Monsieur le président, je regrette infiniment que cette assemblée n’ait pas eu ce soir l’occasion d’entendre votre opinion sur la grande question qui nous rassemble. Je sais pertinemment qu’il est en votre pouvoir d’établir devant ce meeting des faits et des arguments d’une grande valeur pour notre cause, des faits et des arguments qui ne sont pas à la disposition de la plupart de nos orateurs, parce qu’il en est bien peu qui aient eu, comme vous, l’occasion d’étudier les hommes et les choses dans les contrées lointaines ; il en est peu qui aient passé, comme vous, une grande partie de la vie là où le fléau du monopole et les effets des lois restrictives se montrent d’une manière plus manifeste que dans ce pays ; dans ce pays qui, quels que soient les liens qui arrêtent son essor, est, grâce au ciel, notre terre natale. Car, après tout, nous avons une patrie que, malgré ses erreurs et ses fautes, nous pouvons aimer, non-seulement parce que nous y avons reçu le jour, mais encore parce qu’elle est riche de bénédictions obtenues par le courage, l’intégrité et la persévérance de nos ancêtres. (Acclamations.) J’ai la confiance que vous n’avez qu’ajourné l’accomplissement d’un devoir dont j’espérais vous voir vous acquitter aujourd’hui, et que vous vous empresserez de remplir, j’en ai la certitude, dans une prochaine occasion. Je pensais ce soir combien c’est un glorieux : spectacle que de voir une grande nation presque unanime, poursuivant un but tel que celui que nous avons en vue, par des moyens aussi conformes à la justice universelle que ceux qu’emploie l’Association. En 1826, le secrétaire d’État, qui occupe aujourd’hui le ministère de l’intérieur, fit un livre pour persuader aux monopoleurs de renoncer à leurs priviléges, et il les avertissait que, s’ils ne s’empressaient pas de céder et de subordonner les intérêts privés aux grands et légitimes intérêts des masses, le temps viendrait où, dans ce pays, comme dans un pays voisin, le peuple se lèverait dans sa force et dans sa majesté, et balaierait de dessus le sol de la patrie et leurs honneurs, et leurs titres, et leurs distinctions, et leurs richesses mal acquises. Qu’est-ce qui a détourné, qu’est-ce qui détourne encore cette catastrophe dont l’idée seule fait reculer d’horreur ? C’est l’intervention de la Ligue avec son action purement morale, intellectuelle et pacifique, rassemblant autour d’elle et accueillant dans son sein les hommes de la moralité la plus pure, non moins attachés aux principes du christianisme qu’à ceux de la liberté, et décidés à ne poursuivre leur but, quelque glorieux qu’il soit, que par des moyens dont la droiture soit en harmonie avec la légitimité de la cause qu’ils ont embrassée. Si l’ignorance, l’avarice et l’orgueil se sont unis pour retarder le triomphe de cette cause sacrée, une chose du moins est propre à nous consoler et à soutenir notre courage, c’est que chaque heure de retard est employée par dix mille de nos associés à propager les connaissances les plus utiles parmi toutes les classes de la communauté. Je ne sais vraiment pas, s’il était possible de supputer le bien qui résulte de l’agitation actuelle, je ne sais pas^ dis-je, s’il ne présenterait pas une ample compensation au mal que peuvent produire, dans le même espace de temps, les lois qu’elle a pour objet de combattre. Le peuple a été éclairé, la science et la moralité ont pénétré dans la multitude, et si le monopole a empiré la condition physique des hommes, l’association a élevé leur esprit et donné de la vigueur à leur intelligence. Il semble qu’après tant d’années de discussions les faits et les arguments doivent être épuisés. Cependant nos auditeurs sont toujours plus nombreux, nos orateurs plus féconds, et tous les jours ils exposent les principes les plus abstraits de la science sous les formes les plus variées et les plus attrayantes. Quel homme, attiré dans ces meetings par la curiosité, n’en sort pas meilleur et plus éclairé ! Quel immense bienfait pour ce pays que la Ligue ! Pour moi, je suis le premier à reconnaître tout ce que je lui dois, et je suppose qu’il n’est personne qui ne se sente sous le poids des mêmes obligations. Avant l’existence de la Ligue, avais-je l’idée de l’importance du grand principe de la liberté des échanges ? l’avais-je considéré sous tous ses aspects ? avais-je reconnu aussi distinctement les causes qui ont fait peser la misère, répandu le crime, propagé l’immoralité parmi tant de millions de nos frères ? savais-je apprécier, comme je le fais aujourd’hui, toute l’influence de la libre communication des peuples sur leur union et leur fraternité ? avais-je reconnu le grand obstacle au progrès et à la diffusion par toute la terre de ces principes moraux et religieux qui font tout à la fois la gloire, l’orgueil et la stabilité de ce pays ? Non, certainement non. D’où est sorti ce torrent de lumière ? De l’association pour la liberté du commerce. Ah ! c’est avec raison que les amis de l’ignorance et de la compression des forces populaires s’efforcent de renverser la Ligue, car sa durée est le gage de son triomphe, et plus ce triomphe est retardé, plus la vérité descend dans tous les rangs et s’imprime dans tous les cœurs. Quand l’heure du succès sera arrivée, il sera démontré qu’il est dû tout entier à la puissance morale du peuple. Alors ces vivaces énergies, devenues inutiles à notre cause, ne seront point perdues, disséminées ou inertes ; mais, j’en ai la confiance, elles seront convoquées de nouveau, consolidées et dirigées vers l’accomplissement de quelque autre glorieuse entreprise. Il me tarde de voir ce jour, par cette raison entre autres, que la lumière, qui a été si abondamment répandue, a révélé d’autres maux et d’autres griefs que ceux qui nous occupent aujourd’hui. La règle et le cordeau qui nous ont servi à mesurer ce qu’il y a de malfaisant dans le monopole des aliments du pauvre, ont montré aussi combien d’autres institutions, combien de mesures, combien de coutumes s’éloignent des prescriptions de la justice et violent les droits nationaux, et j’ajouterai les droits naturels du peuple.
Hâtons donc le moment où, vainqueurs dans cette lutte, sans que notre drapeau ait été terni, sans que nos armes soient teintes de sang, sans que les soupirs de la veuve, de l’orphelin ou de l’affligé se mêlent à nos chants de triomphe, nous pourrons diriger sur quelque autre objet cette puissante armée qui s’est levée contre le monopole, et conduire à de nouveaux succès un peuple qui aura tout à la fois obtenu le juste salaire de son travail et fait l’épreuve de sa force morale. Nous faisons une expérience dont le monde entier profitera. Nous enseignons aux hommes de tous les pays comment on triomphe sans intrigue, sans transaction, sans crime et sans remords, sans verser le sang humain, sans enfreindre les lois de la société et encore moins les commandements de Dieu. J’ai la confiance que le jour approche où nous serons délivrés des entraves qui nous gênent, et où les autres nations, encouragées par les résultats que nous aurons obtenus, entreront dans la même voie et imiteront notre exemple. Quelle est en effet, monsieur, l’opinion qu’on a de nous en pays étranger, grâce à ces funestes lois-céréales ? Un excellent philanthrope, dont le cœur embrasse le monde, fut, aux États-Unis, chargé d’une mission de bienfaisance en faveur des malheureux nègres de ce pays, je veux parler de M. Joseph Sturge. (Bruyantes acclamations.) Il n’y avait pas trente-six heures qu’il était débarqué, qu’un heureux hasard le conduisit à l’hôtel où j’étais avec ma femme et mes enfants. Mais quelles furent les paroles dont on le salua à son arrivée à New-Nork ? « Ami, lui dit-on, retournez en Angleterre. Vous avez des lois-céréales qui affament vos compatriotes. Regardez leurs pâles figures et leurs formes exténuées, et lorsque vous aurez aboli ces lois, lorsque vous aurez affranchi l’industrie britannique, revenez et laissez éclater votre mépris pour notre système d’esclavage. » (Applaudissements.) Quel était, il y a quelques jours, le langage d’un des grands journaux de Paris[1] ? «Angleterre, orgueilleuse Angleterre, efface de ton écusson le fier lion britannique et mets à la place un ouvrier mourant en implorant vainement du pain. » (Acclamations prolongées.) Que répondit Méhémet-Ali à un Anglais qui lui reprochait son système de monopole, car il est le grand et universel monopoleur de l’Égypte ? « Allez, dit le pacha, allez abolir chez vous le monopole des céréales, et vous me trouverez prêt ensuite à vous accorder toutes les facilités commerciales que vous pouvez désirer. » Ainsi, soit le grave pacha d’Alexandrie, soit l’Américain susceptible ou le Français aux formes polies, chacun nous jette à la face notre propre inconséquence ; et on ne peut pas comprendre comment le peuple d’Angleterre, qui prétend se gouverner par un Parlement de son choix, tolère ce fléau destructeur qu’on appelle lois-céréales. (Acclamations.) Mais il est consolant de penser que nous sommes enfin aux prises avec la dernière difficulté. La Chambre des communes n’était pas notre plus grand obstacle. Je crois qu’on peut dire avec vérité de la plupart des grandes questions, qu’elles seront emportées, quelle que soit la composition de la Chambre des communes, aussitôt que le peuple appréciera pleinement, généralement et universellement la nature et la portée de ce qu’il demande. Je ne puis voir avec découragement la Chambre des communes, toute mauvaise qu’elle est. Considérée en elle-même, et dans les éléments de réforme qu’elle recèle, elle est incurable, dépourvue qu’elle est de tout germe de restauration ou de rénovation. Mais je sais aussi, par l’histoire des trente dernières années, que le peuple n’a qu’à être unanime pour réussir. (Bruyants applaudissements.) Si nous avons obtenu le rappel de l’acte de coopération, d’un Parlement anglican, — l’émancipation catholique, d’une législature Orangiste, — la réforme électorale d’une Chambre nommée par les bourgs-pourris, — l’abolition de la traite et de l’esclavage, d’une assemblée de possesseurs d’hommes, eh bien ! nous arracherons la liberté commerciale à un Parlement de monopoleurs. (Applaudissements.)
Permettez-moi de vous dire quelques mots sur la question des sucres. Je le fais avec quelque répugnance, car dans une occasion récente, où ma santé m’a empêché d’assister à votre réunion, vous avez entendu sur ce sujet un orateur dont je reconnais l’extrême supériorité ; je veux parler de ce profond économiste, qui, malgré sa modestie, quelque soin qu’il prenne de se cacher, n’en est pas moins un des plus utiles ouvriers de notre cause, M. James Wilson. (Applaudissements.) Mais j’ai plusieurs motifs pour dire ce soir quelques mots sur la question des sucres. D’abord, parce qu’il existe sur ce sujet une honnête différence d’opinion parmi nous ; je dis une honnête différence, car je reconnais la sincérité de nos adversaires, comme je me plais à croire que la nôtre n’est pas contestée. — Ensuite, parce que cette branche si importante de la question commerciale sera bientôt discutée au Parlement, et que les opérations de la législature, du moins quant aux résultats, subissent toujours l’influence de l’opinion publique du dehors. J’ai peut-être été plus à même qu’un autre d’apprécier les scrupules de ceux de nos amis qui ont embrassé l’autre côté delà question, ayant toujours été uni à eux, comme je le suis encore, en ce qui concerne l’objet général qu’ils ont en vue, quoique, à mon grand regret, je ne partage pas leur opinion sur l’objet spécial dont il s’agit maintenant. Je respecte leur manière de voir ; je sais qu’ils n’en changeront pas si nous ne parvenons aies vaincre par de fortes et suffisantes raisons, — je retire le mot vaincre, — si nous ne parvenons à leur démontrer que les sentiments d’humanité, auxquels ils croient devoir céder, trouveront une plus ample et prompte satisfaction dans le triomphe de nos desseins que dans l’accomplissement de leurs vues. Et enfin, parce que j’aime à rencontrer des occasions qui mettent nos principes à l’épreuve. Voici une de ces occasions. Un abolitionniste me demande : « Êtes-vous pour la liberté commerciale, alors même qu’elle donnerait accès dans ce pays aux produits du travail esclave ? » Je réponds formellement : Je suis pour la liberté commerciale ; si elle ne peut s’établir universellement, ou si elle conduit à l’esclavage, le principe est faux ; mais je l’adopte parce que je le crois juste ; comme je m’unis aux abolitionnistes, parce que leur principe est juste.
Deux principes justes ne peuvent s’entre-croiser et se combattre ; ils doivent suivre des parallèles pendant toute l’éternité. Si notre principe est bon pour ce pays, il est bon pour les hommes de toutes les races, de toutes les conditions, il engendre le bien dans tous les temps et dans tous les lieux. (Applaudissements.) Plusieurs de nos amis de l’association contre l’esclavage disent qu’ils ne peuvent s’accorder avec nous sur ce sujet. Je me suis fait un devoir d’assister au meeting d’Exeter-Hall, vendredi soir. (Applaudissements.) Je n’y aurais pas paru si je n’avais consulté que mes sentiments personnels, l’amitié ou la popularité. J’ai gardé le silence sur cette partie de la question. J’ai cru que mes amis étaient dans l’erreur, et que, contre leur intention, ils faisaient tort à une noble cause en mettant des arguments dans la bouche de nos adversaires. Dans mon opinion, ils favorisaient, et en tant qu’ils agissent selon leur principe, ils favoriseront la perpétration d’une fraude déplorable au sein du Parlement. J’aurais voulu voir le monopole s’y montrer dans sa nudité, dans sa laideur et dans son égoïsme. J’aurais voulu le voir réduit à ces arguments qui se réfutent d’eux mêmes, tant ils sont empreints d’avarice et de personnalité. Je regrette qu’il soit aujourd’hui placé dans des circonstances qui lui permettent de jeter derrière lui ces arguments et de leur en préférer d’autres, qui lui sont fournis du dehors par une association estimable, et qui sont sanctionnés par le principe de l’humanité. (Applaudissements.) Les feuilles publiques vous ont appris les résultats de celte mémorable séance. (Écoutez ! écoutez !) Si j’éprouve un sentiment de satisfaction du succès qu’a obtenu dans cette assemblée un amendement dans le sens de la liberté commerciale, je regrette encore plus peut-être qu’une telle démarche ait été nécessaire et qu’elle ait rencontré l’opposition d’une aussi forte minorité. Cependant, les membres de cette minorité ont émis un vote sincère. Dès qu’ils seront convaincus, ils seront avec nous ; leur intégrité et leur inflexibilité seront de notre côté, dès qu’ils comprendront, ce qui, je l’espère, ne peut tarder, que le grand principe auquel ils veulent faire des exceptions dans des cas particuliers, doit régner universellement pour le bien de l’humanité.
J’ai reçu bien des lettres de mes amis qui m’accusent d’inconséquence, parce qu’ayant été jusqu’ici l’avocat de l’abolition, je me présente aujourd’hui, disent-ils, comme un promoteur de l’esclavage. Monsieur, en mon nom, au nom de tous ceux qui partagent mes vues, je proteste contre cette imputation. Je ne suis pas plus le promoteur de l’esclavage, parce que je défends la liberté commerciale, que je ne suis un ami de l’erreur parce que je m’oppose à ce que la peine de mort soit infligée à quiconque émet ou propage de fausses opinions. (Applaudissements.) Je crois que l’esclavage est efficacement combattu par la liberté des échanges, comme je crois que la vérité n’a pas besoin pour se défendre de gibets, de chaînes, de tortures et de cachots. (Bruyantes acclamations.) Eh quoi ! appeler le monopole en aide à l’abolition de l’esclavage ! mais l’esclavage a sa racine dans le monopole. Le monopole l’a engendré ; il l’a nourri, il l’a élevé, il l’a maintenu et le maintient encore. La mort du monopole, il y a cinquante ans, c’eût été probablement, certainement, la mort de l’esclavage (écoutez ! écoutez !) et cela sans croisières, sans protocoles, sans traités, sans l’intervention de l’agitation abolitionniste, sans la dépense de 20 millions sterl. (Écoutez ! écoutez !) Je demande qu’il me soit permis de dire que je n’ai pas changé d’opinion à cet égard. Pour vous en convaincre, je vous lirai quelques lignes d’un discours que je prononçai, en 1839, longtemps avant que j’eusse jamais pris la parole dans un meeting de la Ligue, parce qu’alors j’étais absorbé par d’autres occupations et n’avais encore pris aucune part au mouvement actuel. Le discours auquel je fais allusion fut prononcé à Manchester, au sujet de l’abolition de l’esclavage, et de l’amélioration de la condition des Indiens, dans le but de faire progresser simultanément leur bien-être et celui de la population de ce pays. Veuillez me pardonner ce qu’il y a de personnel dans cette remarque, si j’ajoute que, dans le même espace de temps, je ne sache pas qu’aucun homme ait travaillé, avec plus d’ardeur et d’énergie que je ne l’ai fait, à éveiller l’attention du peuple d’Angleterre sur la nécessité d’encourager le travail libre dans toutes les parties de l’univers. (Écoutez ! écoutez !) En plaidant la cause du travail libre, je disais : « Quoique le désir de mon cœur, et ma prière de tous les jours, soit que le jour arrive bientôt où il n’y ait plus une fibre du coton travaillé ou consommé dans ce pays, qui ne soit le produit du travail libre, cependant je ne demande ni restrictions, ni règlements, ni droits prohibitifs, ni rien qui ferme nos ports aux produits de quelque provenance et de quelque nature que ce puisse être, que ce soit du coton pour vêtir ceux qui sont nus, ou du blé pour nourrir ceux qui ont faim. Grâce aux imprescriptibles lois qui gouvernent le monde social, de tels remèdes ne sont pas nécessaires. Je ne demande que liberté, justice, impartialité, convaincu que, si elles nous sont accordées, tout système fondé sur le monopole, ou mis en œuvre par l’esclavage, s’écroulera pour toujours. » Je tenais ce langage dans un meeting mémorable de la Société des Amis à Manchester, devant un auditoire composé en grande partie de membres de ce corps respectable de chrétiens. Le lendemain, dans la même enceinte, je disais : « Si nous laissons une libre carrière à la concurrence du travail libre de l’Orient et du travail esclave de l’Occident, nous pouvons ouvrir tous nos ports, laisser à toutes les nations du globe la chance de vendre leurs produits sur notre marché, bien assurés que le génie de la liberté l’emportera sur la torpeur de la servitude. » J’adhère encore à ce sentiment, je crois fermement que tout autre moyen est comparativement impuissant. Je ne veux pas dire que tous les autres doivent être exclus. Je ne présente pas la liberté commerciale comme le seul agent de l’abolition. J’admets qu’il peut se combiner avec d’autres moyens, pourvu qu’ils soient justes, tels que la chaire, la tribune et la presse. Que le Parlement fasse son devoir, non en imposant, mais en détruisant les restrictions, en affranchissant l’industrie, en lui laissant sa rémunération légitime. Si je suis dans l’erreur sur ce sujet, c’est avec les hommes les plus remarquables de la Société contre l’esclavage. (Écoutez ! écoutez !) Il fut un temps, et principalement vers l’époque de son triomphe, où j’étais intimement identifié à cette association estimable, qui avait avec la Ligue bien des traits de ressemblance. Je me souviens qu’à cette époque elle me fournissait des ouvrages où je pus puiser des exemples et des arguments propres à dévoiler l’iniquité et le faux calcul de l’esclavage. Je conserve ces ouvrages et je les trouve encore éminemment instructifs. J’y cherche quel était alors notre symbole abolitionniste. Voici une lettre d’un grand mérite adressée en 1823 à M. J. B. Say, par M. Adam Hodgson, chef d’une grande maison de Liverpool, sur la dépense du travail esclave comparée à celle du travail libre. Cette lettre fut répandue à profusion dans tout le royaume. Que disait M. Hodgson ? « La nation ne consentira pas longtemps à soutenir un ruineux système de culture, au prix de ses plus chers intérêts, sacrifiant pour cela ses transactions avec 100 millions de sujets de la Grande-Bretagne. Le travail esclave de l’ouest doit succomber devant le travail libre de l’est.» (Approbation.) Voici encore un livre dont je désire vous citer quelques extraits. J’espère que vous m’excuserez. Nous ne devons pas perdre de vue que les discours prononcés dans cette enceinte s’adressent aussi au dehors. Grâce à ces messieurs, devant moi, dont les plumes rapides fixent en caractères indélébiles des pensées qui, sans cela, s’évanouiraient dans l’espace, les sentiments que nous exprimons ici arrivent aux extrémités de la terre. Qu’il me soit donc permis de parler, de cette tribune, à des amis absents, à des hommes que j’honore et que j’aime, et puissé-je les convaincre qu’ils ne sauraient mieux faire que de venir grossir nos rangs ; que nous marchons sur une ligne droite qui ne heurte aucun principe de rectitude et qui s’associe spécialement avec la grande cause qu’ils ont pris à tâche de faire prévaloir. — Ce livre me fut donné, il y a bien des années, par l’Anti-slavery Society. Il est écrit avec soin, et a pour but de montrer que si le travail libre et le travail esclave étaient laissés à une loyale concurrence, le dernier, à cause de sa cherté, devrait succomber devant la perfection plus économique du premier. L’auteur est M. Sturge, non point Joseph Sturge, mais son frère à jamais regretté, qui, s’il m’est permis de prononcer un jugement, est mort trop tôt pour la cause de l’humanité et de la bienfaisance. Quel était le principe fondamental sur lequel il s’appuyait ? « Aucun système qui contredit les lois de Dieu, et qui blesse sa créature raisonnable, ne peut être définitivement avantageux. » Comme free-traders, ces paroles couvrent entièrement notre position. (Écoutez ! écoutez !) Nous soutenons que les restrictions et les taxes, qui ferment nos ports aux productions des autres régions, qui interdisent l’échange entre un homme industrieux qui produit une chose et un autre homme industrieux qui en produit une autre, — sont « contraires aux lois de Dieu et funestes à sa créature raisonnable, » et que ce système ne peut être définitivement avantageux ni aux individus ni aux masses. Voyons ce qu’ajoute M. Sturge : « Nous croyons que les faits que nous allons établir convaincront tout observateur sincère et dégagé de passion de la vérité de cet axiome : Le travail de l’homme libre est plus économique que celui de l’esclave. En poursuivant les conséquences de ce principe général, nous aurons fréquemment l’occasion d’admirer la sagesse consommée qui a préparé par un moyen si simple un remède au plus détestable abus qu’ait jamais inventé la perversité humaine. Nous sentirons la consolation pénétrer dans nos cœurs, lorsque, détournant nos regards des crimes et des malheurs de l’homme, et de l’inefficacité de sa puissance, nous viendrons à contempler l’action silencieuse mais irrésistible de ces lois qui ont été assignées, dans les conseils de la Providence, pour mettre un terme à l’oppression de la race africaine. » (Écoutez ! écoutez !) Monsieur le président, ce n’est pas la première fois que je cite ces extraits. Ce livre est couvert de notes que j’y écrivis il y a douze ans, quand il me fut remis alors que, pour la première fois, ces nobles sentiments réveillant toutes les sympathies de mon cœur, je me levai pour proclamer ces glorieux principes et cette doctrine fatale au maintien de la servitude. Je pourrais multiplier les citations. Je me bornerai à une dernière. Veuillez remarquer le fait qu’établit M. Sturge comme preuve de la vérité de son axiome : « Il y a quarante ans, il ne s’exportait pas d’indigo des Indes orientales. Tout ce qui s’en consommait en Europe était le produit du travail esclave. Quelques personnes employèrent leur capital et leur intelligence à diriger l’industrie des habitants du Bengale vers cette culture, à leur enseigner à préparer l’indigo pour les marchés de l’Europe, et quoique de graves obstacles leur aient été opposés dans le commencement, cependant, les droits ayant été nivelés, leurs efforts furent couronnés d’un plein succès. Telle a été la puissance du capital et de l’habileté britannique, que, quoique les premières importations eussent à supporter un fret quintuple du taux actuel, l’indigo de l’Inde a graduellement remplacé sur le marché l’indigo produit par les esclaves, jusqu’à ce qu’enfin, grâce à la liberté du commerce, il ne se vend plus en Europe une once d’indigo qui soit le fruit de la servitude. » (Acclamations.) Vous savez très-bien, monsieur, ce que M. Sturge appelle liberté du commerce ; le principe même n’en était pas reconnu à cette époque, etc.
L’orateur cite encore un passage dans lequel M. Sturge établit que ce qui est arrivé pour l’indigo arriverait pour le sucre. Il se termine ainsi :
« Ces faits sont de la plus haute importance, non-seulement parce qu’ils confirment le principe général que nous proclamons, mais encore parce qu’ils nous conduisent au but de nos recherches, et nous signalent le moyen spécifique d’abolir l’esclavage et la traite. Laissez sa libre action à ce principe, et il étendra sa bénigne influence sur toute créature humaine actuellement retenue en servitude. » (Écoutez ! écoutez !) Et qui donc a abandonné ce principe ? Très-certainement ce n’est pas nous. — J’arrive maintenant à la Convention de 1840, à laquelle, dans une occasion récente, faisait allusion ce grand homme qui dirige la Ligue, notre maître à tous, qui s’est créé lui-même ou qui a été créé à cette fin, je veux parler de M. Cobden. (Des applaudissements enthousiastes éclatent dans toute la salle.)
L’orateur cite ici des délibérations, des rapports, des enquêtes émanés de la Convention, et qui démontrent que cette association s’était rattachée au principe exposé plus haut par M, Sturge. Il continue ainsi :
Je le demande encore : Qui rend maintenant hommage à ce principe ? N’est-ce pas ceux qui disent : Nous ne reculons pas devant les résultats ; nous n’avons pas posé un principe comme étant la loi de la nature et de Dieu ; nous n’avons pas prouvé par les annales de l’humanité que le malheur et la ruine ont toujours suivi sa violation, pour venir, maintenant que le temps de l’application est arrivé, dans les circonstances les plus favorables, reculer et dire : Nous n’en parlions que comme d’une abstraction ; nous n’osons pas le mettre en œuvre ; nous contemplons avec horreur le moment où il va lutter loyalement contre le principe opposé ! — Que l’on ne dise pas que nous voulons favoriser l’esclavage et la traite ; car bien loin de là, quand nous plaidons la cause de la liberté illimitée du commerce, nous sommes influencés par cette ferme croyance qu’elle est le moyen le plus doux, le plus pacifique de réaliser l’abolition de la traite et de l’esclavage. Nous marchons dans vos sentiers ; nous adoptons vos doctrines ; nous applaudissons à l’habileté avec laquelle vous avez révélé la beauté de cette loi divine qui a ordonné que, dans tous les cas où une franche rivalité est admise, les systèmes fondés sur l’oppression doivent être détruits par ceux qui ont pour base l’honnêteté et la justice. Nous vous imitons en tout, excepté dans votre pusillanimité et dans ce que nous ne pouvons nous empêcher de regarder comme votre inconséquence. Ne nous blâmez pas de ce que notre foi est plus forte que la vôtre. Nous honorons vos sentiments d’humanité. Votre erreur consiste, selon nous, en ce que vous vous laissez entraîner par ces sentiments à quelque chose qui ressemble à la négation de vos propres doctrines. Tout ce que nous vous demandons, c’est de rester attachés à vos principes ; de les appliquer courageusement ; et si vous ne l’osez, permettez-nous du moins de ne pas suivre les conseils d’hommes qui manquent de courage, quand le moment est venu de prouver qu’ils ont foi dans l’infaillibilité des principes qu’ils ont proclamés eux-mêmes. — Aujourd’hui nos amis fondent leur opposition à leur grand principe, sur ce qu’il ne saurait être appliqué d’une manière absolue sans entraîner des conséquences désastreuses. Mais je leur rappellerai que ce n’est point ainsi qu’ils raisonnaient autrefois. Ils en demandaient l’application immédiate sans égard aux conséquences fatales que prédisaient leurs adversaires. Ils croyaient sincèrement ces craintes chimériques, et fussent-elles fondées, ce n’était pas une raison, disaient-ils, pour ajourner un grand acte de justice. On nous disait : Vous faites tort à ceux à qui vous voulez faire du bien, aux nègres. On nous opposait sans cesse le danger pour les noirs de leur affranchissement immédiat. Un membre du Parlement m’affirmait un jour, devant des milliers de nos concitoyens réunis pour nous entendre discuter cette question, que si nous émancipions les nègres, ils rétrograderaient dans leur condition ; qu’au lieu de se tenir debout comme des hommes, ils prendraient bientôt l’humble attitude des quadrupèdes. (Rires.) Il faisait un tableau effrayant de la misère qui les attendait, et y opposait la poétique description de leur bonheur, de leur innocence et même de leur luxe actuels. (Rires.) Si vous doutez de ce que je dis, informez-vous auprès du membre du Parlement qui parla le dernier, hier soir, à la Chambre. (Rires.) Oui, on nous disait gravement que l’émancipation empirerait le sort des noirs, et paralyserait les philanthropiques projets des planteurs. Les Antilles, d’ailleurs, allaient être inondées de sang, les habitations incendiées, et nos navires devaient pourrir dans nos ports. Vous pouvez, monsieur le président, attester la vérité de mes paroles. On calculait le nombre de vaisseaux devenus inutiles et les millions anéantis. Au milieu de tous ces pronostics funèbres, quelle était notre devise ? Fiat justitia, ruat cœlum. Quelle était notre constante maxime ? « Le devoir est à nous ; les événements sont à Dieu. » Non, le triomphe d’un grand principe ne peut avoir une issue funeste. Lancez-le au milieu du peuple, et il en est comme lorsqu’une montagne est précipitée dans l’Océan : l’onde s’agite, tourbillonne, écume, mais bientôt elle s’apaise et son niveau poli reflète la splendeur du soleil. (Applaudissements prolongés.) Avons-nous, ou n’avons-nous pas un principe dans ce grand mouvement ? Si nous l’avons, poussons-le jusqu’au bout. Il a été éloquemment démontré dans une précédente séance, par l’orateur qui doit me succéder à cette tribune, que ce que nous défendons, c’est la cause de la moralité ; par des centaines de ministres accourus de toutes les parties du royaume, que c’est la cause de la religion ; que c’est le droit de l’homme, le devoir de la législature, que l’honneur et la prospérité de ce pays, que les intérêts des régions lointaines sont attachés au triomphe de ce principe ; eh bien, poussons-le jusqu’au bout. (Applaudissements.)
Mais, disent quelques-uns de nos amis, « nous exceptons Cuba et le Brésil. » Je ne répéterai pas, avec M. Wilson, qu’il est indifférent pour les nègres que vous consommiez du sucre-esclave ou du sucre-libre, car si c’est de ce dernier, il ne peut arriver sur notre marché qu’en faisant quelque part un vide qui sera comblé par du sucre-esclave ; mais je demanderai à nos adversaires quel droit ils ont de réclamer l’intervention de la législature dans une matière aussi exclusivement religieuse que celle-ci, où il s’agit d’incriminer ou d’innocenter telle ou telle consommation ? Ils n’en ont aucun. Je veux qu’on réunisse des hommes appartenant à toutes les sectes religieuses, les hommes de la plus haute intelligence ; je veux qu’ils aient le respect le plus profond pour la volonté du Créateur et toute la délicatesse imaginable en matière de moralité et de scrupules ; et j’ose affirmer qu’ils ne s’accorderont pas sur la question de savoir s’il est criminel de se servir d’une chose, parce que sa production, dans des contrées lointaines, adonné lieu à quelques abus, et je crois que la grande majorité d’entre eux décidera qu’une telle question est entre la conscience individuelle et Dieu. Je suis certain du moins qu’elle n’est point du domaine de la Chambre des communes. (Écoutez ! écoutez !)
Un mot encore, et je finis. Je voudrais conseiller à nos amis de bien réfléchir avant de fournir de tels arguments au cabinet actuel ou à tout autre. Si sir Robert Peel n’avait pas été mis à même de dérouler sur le bureau de la Chambre le mémoire abolitionniste qui porte la vénérable signature de M. Thomas Clarkson, il eût été privé du plus fort argument dont il s’est servi pour résister au principe que nous soutenons, la liberté d’échanges avec le Brésil comme avec l’univers. Mais il a imposé silence à ses adhérents. Il a dit aux planteurs des Antilles : Tenez-vous tranquilles. J’ai par devers moi quelque chose qui vaut mieux que tout ce que vous pourriez dire comme propriétaires dans les Indes occidentales. Et s’adressant à la Chambre des communes, il a dit : « Les abolitionnistes sont contre vous. Ils nous adjurent au nom de l’humanité d’exclure les produits du Brésil. Si nous le faisons, ce n’est pas parce que nous possédons de grandes plantations dans l’Inde et à Demerara ; parce que les Chandos et les Buckingham ont de vastes propriétés à la Jamaïque. Non, nous ne cédons pas à de telles considérations. Ce n’est pas non plus parce que nous sommes obligés de ménager les colons, d’autant plus que si nous les blessions, ils renverseraient dès demain la loi-céréale. Nous ne sommes déterminés par aucune de ces raisons ; nous sommes parfaitement désintéressés, et nous ferions bon accueil au sucre du Brésil, s’il n’était teint du sang des esclaves. Il est vrai que nous fûmes toujours les adversaires de l’émancipation, et que lorsqu’il ne nous a plus été possible de reculer, nous avons imposé à la nation une charge de vingt millions sterling que nous avons distribués non aux esclaves, mais à leurs oppresseurs. (Bruyantes acclamations.) Le sens du juste est si délicat chez nous que nous avons indemnisé le tyran et non la victime. (Nouvelles acclamations.) Nous avons payé les planteurs pour qu’ils s’abstinssent du crime ; nous avons sauvé leur réputation et peut-être leur âme. Nous avons fait tout cela, c’est vrai, mais nous sommes bien changés aujourd’hui. N’ai-je pas assisté aux meetings d’Exeler-Hall ? N’y ai-je point péroré ? N’y ai-je point entendu l’orgue saluer la présence et la parole de Daniel O’Connell ? Nous sommes bien changés. Nous sommes maintenant les disciples, les représentants des Grenville, des Sharpe, des Wilberforce, qui se reposent de leurs travaux. Nous nous couvrons de leur manteau, et nous vous adjurons, au nom de deux millions et demi d’esclaves, de ne pas manger de sucre du Brésil. » (Applaudissements prolongés.) Après ce discours, il regardera sans doute les monopoleurs par-dessus les épaules, et dira : « Vous ne vous souciez guère du café, n’est-ce pas ? — Non, disent-ils. — Très-bien, reprend sir Robert, nous réduirons le droit du café de 25 p. 0/0, et nous prohiberons le sucre. — Et c’est ainsi que toute cette belle philanthropie passe de la cafetière dans le sucrier. (Rires.)
Après quelques autres considérations, M. Thompson, revenant à cette idée, que l’abstention de la consommation du sucre-esclave est une affaire de conscience, termine ainsi :
Ma force est dans mes arguments, et je n’en appelle qu’à la raison. Si je puis éveiller votre conscience et convaincre votre jugement, vous m’appartenez. Si je ne le puis, que Dieu vous juge, quant à moi, je ne vous jugerai pas. Je m’efforcerai de vous persuader de bien faire, et vous plaindrai si vous faites mal. Je poursuivrai le bien moi-même, et n’emploierai d’autres efforts pour conquérir mes frères que la raison, la tolérance et l’amour. (À la fin de ce discours, l’assemblée se lève en masse, les chapeaux et les mouchoirs s’agitent, et les applaudissements retentissent pendant plusieurs minutes.)
FN: Le National.
Séance du 29 mai et Séance du 5 juin 1844↩
La séance du 29 mai fut présidée par le comte Ducie, qui a traité longuement la question de la liberté commerciale au point de vue de l’agriculture pratique. Le meeting a entendu MM. Cobden, Perronet Thompson, Holland, propriétaire dans le Worcestershire, et M. Bright, m. P.
Séance du 5 juin 1844.
Le fauteuil est occupé par M. George Wilson.
Le premier orateur entendu est M. Edward Bouverie, membre du Parlement pour Kilmarnock.
L’honorable membre examine l’esprit de la législature actuelle manifesté par ses actes. La majorité ayant toujours maintenu les lois-céréales, sous le prétexte de faire fleurir l’agriculture, et avec elle toutes les classes qui se livrent aux travaux des champs, M. Cobden a demandé qu’il fût fait une enquête dans les comtés agricoles, afin de savoir si la loi avait atteint son but, et si, sous l’empire de cette loi, les fermiers et les ouvriers des campagnes jouissaient de quelque aisance et de quelque sécurité. Il semble que les amis du monopole, qui s’intitulent exclusivement aussi « les amis des fermiers », auraient dû saisir avidement cette occasion de montrer qu’en appuyant la protection, ils suivaient une saine politique. Mais, continue M. Bouverie, ils ont dit : « Nous ne voulons pas d’enquête. » Et pourquoi ? Parce qu’ils savent bien qu’elle démontrerait l’absurdité et la futilité de leurs doctrines ; que la protection n’est que déception ; que ce n’est autre chose que le public mis au pillage, lis préfèrent les ténèbres à la lumière. Ils craignent la lumière, parce que leurs actions ne sont pas pures.
Est venu ensuite le bill sur les travaux des manufactures, connu sous le nom de « bill des dix heures ». Et qu’avons-nous vu ? Une majorité étalant sa fastueuse sympathie pour les classes ouvrières, déclarant que le peuple de ce pays est soumis à un trop rude travail, et que l’intensité de ce travail, pour les femmes et les enfants, est incompatible avec la santé de leur corps et même de leur âme. Mais quoi ! c’est cette même majorité qui, en maintenant la loi-céréale, force le peuple à demander sa subsistance à un travail excessif. La loi-céréale dit au peuple : « Tu n’auras pas à ta disposition les mêmes moyens d’existence que si le commerce des blés était libre. Tu n’auras pas les mêmes moyens de travail que si de grandes importations provoquaient des exportations correspondantes et augmentaient ainsi l’emploi des bras. » C’est donc cette loi qui broie le peuple et le force à chercher une maigre pitance dans des sueurs excessives, dans un travail incessant, incompatible avec le maintien de sa santé, de ses forces et de son bien-être. Mais nous avons vu autre chose. Nous avons vu tomber cette philanthropie affectée ; et dès l’instant que le ministère eut déclaré qu’il s’opposait à cette proposition et en faisait une question de cabinet, nous avons vu la majorité défaire ce qu’elle avait fait, moins soucieuse de sa prétendue sympathie pour le peuple que de maintenir le pouvoir aux mains des ministres de son choix.
Ce n’est pas qu’il n’ait été fait quelques timides pas dans la voie de la liberté commerciale. On a diminué les droits sur les raisins de Corinthe (currants). (Rires.) J’en félicite sincèrement les amateurs de puddings. (Éclats de rire.) Mais il faut autre chose que du raisin pour faire du pudding. Il y entre aussi de la farine ; et en abrogeant la taxe sur le blé, on eût mieux servi les intérêts de ceux qui mangent du pudding, et de l’immense multitude de nos frères qui n’en ont jamais vu, même en rêve. C’est au peuple de leur dire : « Vous deviez faire ces choses, sans négliger le reste. »
L’orateur aborde la question des sucres et la distinction proposée entre le produit du travail libre et celui du travail esclave. — Si nous adoptons cette distinction en principe, dit-il, où nous arrêterons-nous ? Si nous devons nous enquérir de la tradition sociale, morale et politique de tous les peuples avec lesquels il nous sera permis d’entretenir des relations, où poserons-nous la limite ? Une grande partie du blé qui arrive dans ce pays, même sous la loi actuelle (et il en viendrait davantage si elle ne s’y opposait), provient d’un pays où l’esclavage est dans toute sa force, je veux parler de la Russie. (Grognements.) Vraiment, je suis surpris que les sociétés en faveur de la protection, qui battent les buissons pour chasser aux arguments, et ne sont pas difficiles, ne se soient pas encore emparées de celui-ci : « Maintenons la loi-céréale pour exclure le blé russe. »
M. Milner Gibson, m. P. pour Manchester. (Nous sommes forcé par le défaut d’espace à nous renfermer dans l’analyse et quelques extraits du remarquable discours de l’honorable représentant de Manchester.)
Monsieur le président, c’est avec bonheur que je vous ai entendu déclarer, à l’ouverture de la séance, que vous étiez résolu à ne jamais ralentir vos efforts jusqu’au triomphe de la liberté commerciale. Je me réjouis de vous entendre exprimer que vous sentez profondément la justice de cette cause, car je sais que cette association et ces meetings ne surgissent pas d’une impulsion nouvelle et soudaine, mais qu’ils sont fondés sur la large et éternelle base de la justice immuable. (Acclamations.) La liberté commerciale n’est pas une question de sous, de shillings et de guinées. C’est une question qui implique les droits de l’homme, le droit, pour chacun, d’acheter et de vendre, le droit d’obtenir une juste rémunération du travail ; et je dis qu’il n’est aucun des droits, pour la protection desquels les gouvernements sont établis, qui soit plus précieux que celui de vivre d’un travail libre de toute entrave et de toute restriction. (Acclamations.)
L’honorable orateur traite longuement la question à ce point de vue.
Je me rappelle que le duc de Richmond disait dans une occasion : « Si l’on abroge les lois-céréales, je quitte le pays, » (Éclats de rire.) On lui répondit : « Au moins vous n’emporterez pas vos terres. » (Nouveaux rires.) Mais considérons la position où se place un homme qui fait une telle déclaration. Qu’est-ce que la loi-céréale ? Quelle est sa nature ? Cela se réduit à ceci : Des gens qui tiennent boutique d’objets de consommation ne veulent pas que d’autres vendent des objets similaires. Le noble duc est grandement engagé dans ce genre d’affaires, et il voudrait bien être une sorte de marchand breveté. (Rires.) Mais je dis que tout Anglais a le même droit que lui d’approvisionner le marché de blé, pourvu qu’il l’ait acquis honnêtement. Comme Anglais, j’ai le droit de vendre du blé que je me suis procuré par l’échange, justement comme le duc de Richmond aie droit de vendre du blé qu’il s’est procuré par la culture. Mais, me dit-on, vous ne devez pas le faire, parce que cela empêcherait le noble duc de tirer un parti aussi avantageux de sa propriété. Et quel droit ce grand seigneur a-t-il sur moi ? Je ne sache pas lui devoir quelque chose, qu’il existe des comptes entre lui et moi, et qu’il doive avoir un contrôle sur mon industrie. — À ce point de vue, oh ! combien est monstrueuse l’intervention de la loi-céréale sur la liberté civile des sujets de S. M. la reine ! (Acclamations.) Quel est le but du gouvernement ? quel est le but de la société ? L’objet unique du gouvernement est d’empêcher les citoyens de se faire déloyalement du tort les uns aux autres, d’empêcher une classe d’envahir les droits d’une autre classe. Or, je dis que le droit de suivre une branche d’affaires, le commerce, est à ma portée, que c’est une propriété que le gouvernement doit me garantir. Mais qu’a fait le gouvernement ? Il a aidé une classe de la communauté à me dépouiller de ce droit, de cette propriété, à m’interdire l’échange du produit de mon travail ; il s’est départi de sa vraie et seule légitime mission. (Acclamations.) J’espère, monsieur, que l’on me pardonnera d’insister autant sur ce sujet (Continuez, continuez !) ; mais je considère ce point de vue comme le plus important dans la question. Je crois qu’on n’a pas assez considéré le système protecteur au point de vue de la liberté civile. Je soutiens que, comme vous avez aboli l’esclavage dans vos colonies, comme vous avez aboli, dans toute l’étendue des possessions britanniques, la faculté pour l’homme de faire de son frère sa propriété, vous devez, pour être conséquent à ce principe, abolir aussi le monopole. (Acclamations.) Qu’est-ce que l’esclavage ? La prétention, de la part d’une classe d’hommes, au contrôle du travail d’une autre classe et à l’usurpation des produits de ce travail : — mais n’est-ce pas là le monopole ? (Applaudissements prolongés.) En détruisant l’un, vous vous êtes engagé à détruire l’autre. La servitude reconnaît, dans un homme, un droit personnel à s’emparer de l’esprit, du corps et des muscles de son semblable. Le monopole reconnaît aussi le droit inhérent à l’aristocratie de s’emparer de la rémunération industrielle qui appartient et doit être laissée aux classes laborieuses. (Applaudissements longtemps prolongés.) Entre l’esclavage et le monopole, je ne vois de différence que le degré. En principe, c’est une seule et même chose. Car pourquoi le planteur avait-il des esclaves ? Ce n’est pas pour en faire parade ou pour les garder comme des canaris en cage, mais pour consommer le fruit de leur travail. Or, c’est précisément là le principe qui dirige les défenseurs de la loi-céréale. Ils veulent s’attribuer, sur le produit des classes manufacturières et commerciales, une plus grande part que celle à laquelle ils ont un juste droit…
La question, dans ses rapports avec la liberté civile, me paraît donc aussi simple qu’importante. Cependant j’ai entendu de profonds théologiens, versés dans la philosophie ancienne, dans les mathématiques, capables d’écrire et de composer en hébreu et en sanscrit, déclarer que cette loi-céréale était si compliquée, si difficile, si inextricable, qu’ils n’osaient s’en occuper. Je crains bien que ces excellents théologiens de l’Église d’Angleterre n’aperçoivent ces difficultés que parce qu’ils oublient cette maxime, que pourtant ils citent souvent : « Mon royaume n’est pas de ce monde. » Je crains que l’acte de commutation des dîmes ecclésiastiques n’ait introduit dans leur esprit des idées préconçues, et que ce qu’ils redoutent surtout, c’est que l’abrogation des lois-céréales, en diminuant le prix du pain, ne diminue aussi la valeur de leur dîme. Si ce n’était cette appréhension, j’ose croire que le clergé anglican serait pour nous, car le principe de la liberté est en parfaite harmonie avec la morale chrétienne, et les meilleurs arguments qu’on puisse invoquer en sa faveur se trouvent encore dans la Bible. (Applaudissements.)
… La liberté commerciale tend à réaliser par elle-même tout ce qui fait l’objet des vœux du philanthrope. Elle offre les moyens de répandre la civilisation et la liberté religieuse, non-seulement dans les possessions britanniques, mais dans toutes les parties du globe. Si nous voulons voir le Brésil et Cuba affranchir leurs esclaves, il ne faut pas isoler ces contrées des nations plus civilisées où l’esclavage est en horreur. Quelle était noire conduite, alors que nous étions nous-mêmes possesseurs d’esclaves, alors que nous tous, hélas ! et jusqu’aux évêques de la Chambre des lords, soutenions la traite des nègres ? Comment agissions-nous ? Le gouvernement de ce pays connaissait bien l’influence des communications commerciales sur la propagation des idées, et il ne manqua pas d’interdire toutes relations entre nos colonies occidentales et Saint-Dominque de peur de leur inoculer le venin de la liberté. Les transactions commerciales sont, croyez-le bien, les moyens auxquels la Providence a confié la civilisation du genre humain, ou du moins la diffusion des vérités civilisatrices. En ce moment, l’empereur de Russie est à Londres. (Grognements et sifflets.) Quand j’ai nommé ce souverain, je n’ai pas voulu provoquer des marques de désapprobation. Je pense que nous ne devons voir en celle circonstance que la simple visite d’un homme privé, sans reporter notre pensée sur l’état de la Russie. Quoi qu’il en soit, ce monarque est parmi nous, ainsi que le roi de Saxe, et l’on attend le roi des Français. On nous assure que les visites réciproques de ces augustes personnages tendent à affermir la paix du monde. Je me réjouis d’être témoin de ces communications amicales ; mais pour établir la paix sur des bases solides, il faut autre chose, il faut faire triompher les principes de la Ligue, il faut attacher les nations les unes aux autres par les liens d’un commun intérêt, et étouffer l’esprit d’antagonisme dans son germe, la jalousie nationale. (Acclamations.) Les empereurs et les ambassadeurs y peuvent quelque chose sans doute, mais leur influence est bien inefficace auprès de cet intérêt commun qui naîtra parmi les peuples de la liberté de leurs transactions. Que les hommes soient tous entre eux des clients réciproques, qu’ils dépendent les uns des autres pour leur bien-être, pour la rémunération de leur travail ; et vous verrez s’élever une opinion publique parmi les nations qui ne permettra pas aux souverains et à leurs ambassadeurs de les entraîner dans la guerre, comme cela est trop souvent arrivé autrefois
Nous citerons un dernier extrait de ce discours pour montrer que la question est plus près de sa solution qu’on ne s’en doute en France,
« Le ministère demande à être forcé ; il vous invite à le forcer. Plus vous le presserez, plus il vous accordera. Je suis persuadé qu’à aucune époque de notre histoire, on n’a vu les ministres de la couronne en appeler aussi directement à l’agitation et insinuer à l’opposition qu’ils ne demandent qu’à avoir la main forcée. Vous les voyez fréquemment emporter les questions, non par le secours de leurs amis qui ne sont que des dupes, mais par l’influence de leurs adversaires. « Voyez, disent-ils, le bruit que font tous ces messieurs engagés dans la Ligue ; nous ne pouvons plus maintenir ces lois de protection. Vous devez y renoncer. Le pays est en danger ; si vous n’abandonnez pas la protection, vous serez réduits à abandonner bien davantage. Soyez donc prudents à propos, car la pression est devenue trop forte pour pouvoir y résister. Vous ne pouvez chercher les éléments d’une administration dans la Société centrale pour la protection de l’agriculture, ni dans l’association des Antilles. Elles ne présentent pas des hommes assez forts. Pour avoir un cabinet conservateur, il vous faut avoir recours à nous, et (ajoute sir Robert Peel), je vous le déclare, gentlemen, la pression du parti free-trader est devenue irrésistible, et je ne veux pas que de vaines considérations, une exagération de persistance, viennent me faire obstacle quand j’ai un grand devoir à remplir. Ainsi, acceptez la liberté commerciale, ou renoncez à mon concours. » (Rires prolongés.) C’est là un bon et prudent avis. Nous suivons, je le crois, une marche convenable et patriotique à tous égards, soit au point de vue des considérations morales, soit sous le rapport de l’accumulation des richesses. Je dis que nous suivons une marche convenable, quand nous nous efforçons de former, autant qu’il est en nous, une opinion publique qui est l’instrument dont le ministère se servira pour abroger ces lois funestes. Quand il dit à l’aristocratie qu’elle doit renoncer à la protection, ou à bien d’autres priviléges plus importants, il lui donne un sage conseil, car je me rappelle, et beaucoup d’entre vous se rappellent aussi, sans doute, l’éloquente expression du révérend Robert Stall, qui disait : « Il y a une tache de putridité à la racine de l’arbre social qui gagnera les branches extrêmes et les flétrira, quelque élevées qu’elles puissent être. » (M. Gibson reprend sa place au bruit d’applaudissements enthousiastes.)
M. Robert Moore lui succède.
[note by FB]
Les deux grandes questions sur lesquelles se portent les efforts opposés des free-traders et des prohibitionnistes, savoir : la loi-céréale et la loi des sucres, approchent enfin, sinon de leur dénoûment définitif, du moins de la solution provisoire qu’elles doivent recevoir cette année par un vote du Parlement. Nous terminerons donc, du moins pour cette campagne, l’œuvre que nous avons entreprise, par l’analyse succincte des débats et des péripéties parlementaires auxquels auront donné lieu ces votes mémorables. Commençons par la loi des sucres.
Il semble que cette question n’a qu’un médiocre intérêt pour le public français ; cependant elle a fait ressortir d’une manière si remarquable les aberrations de l’esprit de parti, et le soin minutieux qu’ont pris les membres de la Ligue de se défaire de cette rouille, qui semblait inhérente aux gouvernements constitutionnels, que l’on ne lira pas sans intérêt, nous le croyons, les phases de celle grande lutte, qui, on se le rappelle, compromit un instant l’existence du ministère.
Établissons d’abord l’état de la question.
La législation ancienne, et encore en vigueur au moment du vote, frappait le sucre colonial d’un droit de 24 sh., et le sucre étranger d’une taxe de 63 sh. — La différence, ou 39 sh., était donc la part faite à la protection.
Sous le ministère de lord John Russell, le gouvernement proposa de modifier ainsi ces taxes :
Sucre colonial, 24 sh. — Sucre étranger, 36 sh. Ainsi, la protection était réduite à 12 sh. au lieu de 39, et l’abandon de ce système colonial, auquel on croit l’Angleterre si attachée, consommé dans cette mesure. C’est à l’occasion de cette proposition que, par l’influence combinée des monopoleurs, le cabinet whig fut renversé.
Les torys arrivés au pouvoir avec la mission expresse de maintenir la protection, forcés eux-mêmes de céder aux exigences de l’opinion publique éclairée par les travaux de la Ligue, proposèrent, en 1844, par l’organe de M. Peel, la modification suivante :
Sucre colonial, 24 sh. — Sucre étranger, 34 sh.
La protection est ainsi réduite à 10 sh.
Il semble d’abord que cette mesure, présentée par les torys, soit plus libérale que celle qui les mit à même de renverser les whigs.
Mais il faut prendre garde que la réduction de 63 à 34 sh. n’est accordée par sir R. Peel qu’au sucre étranger produit par le travail libre (free-grown sugar). Ainsi, le monopole se trouve affranchi de la concurrence de Cuba et du Brésil, qui était pour lui la plus redoutable.
Les monopoleurs, qui, à leur grand regret, ne peuvent marcher qu’avec l’opinion publique, se sont emparés ici, avec une habileté incontestable, du sentiment d’horreur que l’esclavage inspire à toutes les classes du peuple anglais. Ce sentiment fomenté, exalté pendant les quarante années de l’agitation abolitionniste, a servi, dans son aveuglement, à la perpétration d’une fraude grossière dans le Parlement.
On a vu dans le compte rendu des meetings de la Ligue, l’opinion de cette association relativement à cette distinction entre le sucre-libre et le sucre-esclave.
Il est bon de dire ici, qu’en présentant cette loi, sir Robert Peel a déclaré que, si l’état du revenu public le permettait, il se proposait de pousser beaucoup plus loin la réforme en 1845, mais qu’il tenait à faire prévaloir en principe, et dès cette année, la distinction entre les deux sucres, afin de la faire reparaître lorsqu’il s’agirait d’un nouvel abaissement des droits. Il est permis de croire que son arrière-pensée était de se ménager un moyen de conclure un traité de commerce avec le Brésil, et nous savons en effet que des commissaires anglais sont en ce moment chargés de cette mission.
Ainsi, la mesure soumise au Parlement était celle-ci : Sucre colonial, 24 sh. — Sucre-libre étranger, 34 sh. — Sucre-esclave étranger, 63 sh.
Le premier amendement fut proposé par lord John Russell. Il tendait à faire disparaître la distinction entre le sucre-libre et le sucre-esclave ; en d’autres termes, il proposait 24 sh. pour le sucre colonial, et 34 pour le sucre étranger, de toutes provenances.
Cet amendement fut repoussé par 197 voix contre 128. Un second amendement fut présenté par M. Ewart, membre de la Ligue. En harmonie avec les doctrines de cette puissante association, il n’allait à rien moins qu’à la suppression de tous droits différentiels, non point entre le sucre-libre et le sucre-esclave, mais entre le sucre colonial et le sucre étranger. En un mot, M. Ewart proposait le droit de 24 sh. pour tous les sucres, sans distinction d’aucune espèce.
Les Ligueurs ne pouvaient espérer de faire triompher leurs vues, mais ils voulaient une discussion de principes ; et en effet, dans cette séance mémorable, les principes de la liberté absolue, les vices du système colonial furent exposés avec une grande force par MM. Ewart, Bright, Cobden, Roebuck et Warburton.
Cependant l’amendement fut repoussé par 259 voix contre 36.
Enfin est venu le captieux amendement de M. Philips Miles, député de Bristol, qui a un moment ébranlé le cabinet tory. Voici cet amendement ;
Sucre colonial, 20 sh. — Sucre-libre étranger, d’une certaine qualité, 30 sh. (brown, muscovado or clayed). — Sucre-libre étranger, d’une autre qualité, 34 sh. (white clayed or equivalent).
Cet amendement était parfaitement calculé pour jeter le trouble dans toutes les dispositions de la Chambre des communes. Il laissait à la protection une marge de 10 sh. dans un cas, et de 14 dans l’autre. Il pouvait plaire aux free-traders, car il paraissait abaisser le niveau général des droits de tous les sucres, même coloniaux. Il devait convenir aux monopoleurs qui le mettaient en avant, sachant bien que, dans la pratique il leur donnerait une prime de 14 sh., presque tout le sucre qui s’importe en Angleterre étant de cette qualité spéciale soumise au droit de 34 sh.
Aussi cet amendement passa-t-il à la première épreuve.
Mais la confusion fut bien plus grande encore lorsque le ministère vint déclarer qu’il se retirerait si la Chambre persistait dans sa résolution.
On comprend facilement que l’esprit de parti vint s’attacher beaucoup plus à la question de cabinet qu’à la question des sucres.
Par le fait, l’une et l’autre étaient à la disposition de la Ligue. Disposant de plus de cent voix, elle pouvait à son gré faire pencher la balance en faveur des whigs ou des torys. Chacun avait les yeux fixés sur les Ligueurs.
Quelle fut pourtant leur conduite ? Quoique naturellement plus portés pour Russell que pour Peel, ils se mirent à étudier la question, abstraction faite de tout esprit de parti, de toute combinaison parlementaire et ministérielle, et au seul point de vue de la liberté commerciale. Ils crurent que la proposition du gouvernement était plus libérale que celle de M. Miles. Ils repoussèrent l’amendement, et le ministère Peel fut maintenu.
On a beaucoup reproché aux ligueurs cette conduite. On a dit qu’ils avaient sacrifié à une simple question d’argent une grande révolution ministérielle, qui aurait plus tard profité au principe de la liberté commerciale.
Le remarquable discours prononcé par M. Cobden au meeting de la Ligue du 19 juin, fera connaître les motifs de l’Association, et initiera le lecteur à cet esprit nouveau qui surgit en Angleterre, et qui étouffera jusqu’aux derniers restes du fléau destructeur qu’on nomme : Esprit de parti.
Séance du 19 juin 1844.↩
M. Cobden est reçu avec enthousiasme par une assemblée des plus nombreuses et des plus distinguées qui ait jamais assisté aux meetings de Covent-Garden. Quand le silence est rétabli, il s’exprime en ces termes :
Monsieur le président, ladies et gentlemen, je viens d’apprendre que le docteur Bowring, que vous espériez entendre ce soir, avait été inévitablement forcé de s’absenter. Je me présente donc pour remplir la place qu’il a malheureusement laissée vide. Des sujets nouveaux sur notre grande cause me feraient défaut peut-être, si, devenue prédominante dans tout le pays, elle ne présentait chaque semaine quelque phase nouvelle pour servir de texte à nos entretiens. Gentlemen, la semaine dernière, nous avons eu deux discussions à la Chambre des communes, et si l’esprit de parti n’avait pas mis de côté la pauvre économie politique, cette assemblée serait devenue une grande école bien propre à instruire le public sur une matière qui, je crois, n’est pas suffisamment comprise. Je veux parler de ce qu’on nomme Droits différentiels. (Écoutez ! écoutez !) Malheureusement aux deux côtés de la Chambre, plusieurs personnages, au lieu de ne voir dans le débat que 4 sh. de plus ou de moins à accorder à la protection du sucre, se sont persuadé qu’il s’agissait de places, de pouvoir, d’influence à conquérir pour eux-mêmes. (Écoutez ! écoutez !) La vraie question a été ainsi absorbée dans des récriminations, des invectives, des reproches rétrospectifs, à l’occasion d’actes qui remontent à 1835. En un mot, ceux qui sont en dehors comme ceux qui sont au dedans du pouvoir, paraissaient sous l’influence d’une seule cause d’anxiété, savoir, si les uns chasseraient les autres et se mettraient à leur place. (Applaudissements.) Ladies et gentlemen, cette enceinte est aussi une école d’économie politique, et si vous le permettez, je vous donnerai une leçon sur le sujet qui était le vrai texte du débat à la Chambre des communes, et qui a été étouffé, au grand détriment de l’intérêt public, par d’autres matières, selon moi, beaucoup moins importantes. Je voudrais que le pays comprît bien la signification de ces expressions : Droits différentiels ; et je crois pouvoir en donner une explication si simple, qu’après l’avoir entendue, un enfant sera en mesure de faire à son tour la leçon à son vieux grand-père auprès du foyer. — Vous savez que le marché de Covent-Garden, où se vendent les légumes pour la consommation de la métropole, appartient au duc de Bedfort. — Je supposerai qu’un certain nombre de jardiniers, propriétaires d’une étendue limitée de terrain dans le voisinage, par exemple, la paroisse de Hammersmith, décident le duc de Bedfort à établir un droit de 10 sh. par charge sur tous les choux qui viendront des environs, comme Battersea et autres paroisses, en exceptant celle de Hammersmith. Quelle serait la conséquence ? Comme la paroisse à laquelle serait conféré le privilége ne produit pas assez de choux pour la consommation de la métropole, les jardiniers de Hammersmith s’abstiendraient de vendre jusqu’à ce qu’ils pussent obtenir le même prix que ceux de Battersea, lesquels, ayant à payer 10 sh. au duc de Bedfort, ajouteraient naturellement le montant de ce droit au prix naturel de leurs légumes. Que résulterait-il donc de là ? Le voici : le noble duc de Bedfort recevrait 10 sh. par charge pour tous les choux venus de Battersea ou d’ailleurs. — Les jardiniers de Hammersmith vendraient aussi à 10 sh. plus cher qu’autrefois, et n’ayant pas à payer le droit, ils l’empocheraient ; quant au public, il paierait 10 sh. d’extra, sur les choux de toutes les provenances.
Supposons maintenant que le noble duc a besoin de tirer de ces choux un peu plus de revenu, et que voulant néanmoins continuer à favoriser les jardiniers de Hammersmith, il propose de prélever sur leurs choux une taxe de 10 sh., mais en même temps de porter à 20 sh., le droit sur les choux de Battersea et d’ailleurs. Voyons l’effet de cette mesure. Comme dans le cas précédent, les hommes de Hammersmith tiendront la main haute, jusqu’à ce que le prix des choux soit fixé par les jardiniers de Battersea qui ont à payer un droit de 20 sh., tandis que leurs concurrents ne paient que 10 sh. De quelle manière ces combinaisons affecteront-elles le public ? — Il paiera 20 sh. au delà de la valeur naturelle sur tous les choux qu’il achètera. Le duc de Bedfort recouvrera la totalité du droit de 20 sh. sur les choux de Battersea, il recouvrera aussi 10 sh. sur ceux de Hammersmith, et les jardiniers de Hammersmith empocheront les 10 autres shillings. Mais quant au public il paiera dans tous les cas une taxe de 20 sh.
Quelque temps après, les jardiniers de Hammersmith désirent avoir un peu plus de monopole. En ayant goûté les douceurs, ils veulent y revenir, cela est bien naturel (rires) ; et, en conséquence, ils s’assemblent et mettent toutes leurs ruses en commun. Ils ne jugent pas à propos de réclamer du duc de Bedfort un enouvelle aggravation de droits sur les choux de Battersea, parce que la mesure serait extrêmement impopulaire. Ils imaginent d’élever ce cri : Les choux à bon marché ! et disent au noble propriétaire de Covent-Garden : « Réduisez le droit sur les choux de Hammersmith de 10 à 6 sh., laissant la taxe sur ceux de Battersea telle qu’elle est maintenant à 20 sh. »
Revêtus du manteau du patriotisme, ils s’adressent à lord John Russell et le prient d’intervenir auprès de son frère, le duc de Bedfort, afin qu’il adopte cette admirable combinaison. Le noble duc, que je suppose un homme avisé, réplique : Votre devise : les choux à bon marché ! n’est qu’un prétexte pour cacher votre égoïsme. — Si je réduis votre taxe de 4 sh., laissant celle de Battersea à 20 sh. comme à présent, vous continuerez à vendre vos choux au même prix que vos concurrents, et le seul résultat, c’est que je perdrai 4 sh. que vous empocherez, et le public paiera précisément le même prix qu’auparavant. (Applaudissements.) Mettez le mot « sucre » à la place du mot « chou », et vous aurez une complète intelligence de la motion récemment proposée par nos anciens adversaires, les planteurs des Indes occidentales. (Écoutez ! écoutez !) Le gouvernement avait proposé de fixer le droit sur le sucre étranger à 34 sh. et le sucre colonial à 24 sh., c’était donner au producteur de ce dernier un extra-prix de 10 sh., parce que, comme dans l’hypothèse des choux de Hammersmith, les fournitures des colons sont insuffisantes pour notre marché, et ils ne vendront pas une once de leur sucre jusqu’à ce qu’ils retirent le même prix que les planteurs de Java, lesquels, sur ce prix, ont à payer un droit de 10 sh. plus élevé que nos colons. Voyons à combien monte ce droit protecteur ? Nos colonies fournissent, en nombre rond, à ce pays, environ 4,000,000 quintaux de sucre ; 10 sh. par quintal, sur cette quantité, cela fait bien, si je sais compter, 2 millions sterling. Cette somme immense, c’est la prime, ou, comme on l’appelle, la protection que le gouvernement propose d’accorder aux planteurs des Indes occidentales. Gentlemen, quelle a été la conduite des free-traders par rapport à ce monopole ? Nous avons mis en avant une motion pour l’égalisation des droits sur tous les sucres, afin que tous les producteurs de sucre payassent une taxe égale, sous forme de droit, à la reine Victoria, et qu’il ne fût permis à aucun de mettre une portion de cette taxe dans sa poche. (Bruyants applaudissements.) Nous avons soutenu cette proposition à la Chambre des communes, et bien que, à ce que je crois, nous les ayons indubitablement battus par les arguments, ils nous ont battus par les votes. Est venu alors l’amendement de M. Miles, qui proposait un droit de 20 sh. sur le sucre colonial, et 30 sh. sur le sucre étranger. Mais en même temps, introduisant dans sa mesure une distinction omise dans le projet du gouvernement, il voulait que tout sucre étranger, d’une espèce particulière appelée white-clayed, payât 34 sh. — Je suis informé qu’un grand nombre de personnes, même dans celle capitale éclairée, pensent que les free-traders ont eu tort de résister à l’amendement de M. Miles. (Écoutez !) D’abord, un fort soupçon, pour ne rien dire de plus, s’attachait à l’origine de cette proposition ; cependant, je ne la juge pas d’après cette circonstance. Les planteurs des Antilles se plaignaient de ce que la motion de sir Robert Peel causait leur ruine, et c’est pourquoi ils lui opposaient l’amendement de M. Miles. Il y a pourtant des gens assez bénévoles pour croire que cette dernière mesure est moins protectrice que la première. Mais ne jugeons pas sur l’apparence ; n’apprécions pas la mesure par le caractère de ceux qui la proposent, mais examinons-en la portée et la tendance réelle. La réduction de 4 sh. sur le sucre colonial embrasse tout le sucre colonial, quelle qu’en soit la qualité. La réduction de 4 sh. sur le sucre étranger, c’est seulement la réduction sur une certaine qualité de sucre étranger. Recherchons donc quelle est la nature du sucre étranger que l’on excepte de cette réduction et sur lequel le droit de 34 sh. continuera à être prélevé, car c’est là qu’est toute la question. Les hommes qui ne sont pas versés dans le commerce du sucre, ne sont que des juges fort incompétents du mérite et des effets de l’exception proposée. Quelques-uns d’entre nous, free-traders, nous avons pensé qu’il valait la peine d’aller aux informations dans la Cité, pour savoir enfin ce que c’était que ce clayed-sugar, qui nous vient de pays étrangers. Nous avons cru que nous n’avions rien de mieux à faire, et, en conséquence, nous avons consulté une vingtaine de raffineurs et de marchands parmi lesquels, etc…
M. Cobden cite ici l’opinion d’un grand nombre d’hommes spéciaux qui s’accordent à dire que cette qualité de sucre étranger (white clayed) qui est exceptée par l’amendement de M. Miles du bénéfice de la réduction de 4 sh., forme en ce moment et formera en toutes circonstances les trois quarts de l’importation étrangère.
D’après cela, messieurs, je n’hésite pas à déclarer que l’amendement de M. Miles n’était autre chose qu’un piége tendu aux free-traders inattentifs. (Écoutez ! écoutez !) Je n’accuse pas M. Miles d’être l’inventeur ou le complice de cette déception calculée. Mais je crois que ce plan artificieux a été combiné à Minenglane par des hommes qui savaient très-bien ce qu’ils faisaient, et qui espéraient enlacer les free-traders de la Chambre des communes dans leurs spécieux artifices. Quel eût été l’effet de l’amendement s’il eût été adopté ? Le droit sur le sucre colonial eût été abaissé de 24 à 20 sh. La grande masse de sucre étranger eût payé 34 sh. Ainsi, la prime de protection en faveur des intérêts coloniaux eût été de 14 sh. au lieu de 10 que leur accorde la proposition ministérielle. (Écoutez ! écoutez !) Cependant il y a des hommes simples qui nous disent : « Pourvu que l’amendement Miles nous fasse obtenir le sucre à meilleur marché, quel mal y a-t-il à ce que les planteurs y trouvent aussi quelque avantage ? » Mais le fait est qu’il ne nous fera pas avoir le sucre à meilleur marché. Une réduction de 4 sh. sur le sucre colonial se bornerait à faire passer une certaine somme du revenu public dans la poche des monopoleurs. 4 sh. sur 4,000,000 quintaux qui viennent annuellement de nos colonies, équivalent à 800,000 l. st. qui seraient enlevées à l’Échiquier national et que vous vous verriez contraints d’y restituer par quelque autre impôt. Prenez bien garde à ceci : le revenu public et le revenu national naviguent dans la même barque ; les monopoleurs sont dans une autre, et si vous ôtez au revenu public pour donner au monopole, il faut vous soumettre à des taxes nouvelles. Qu’est-ce que le plan de M. Miles ? Rien autre chose que l’absorption par les monopoleurs d’un revenu destiné à la reine Victoria, c’est le renouvellement de mesures qui nous ont déjà conduits l’income-tax. (Approbation.) Il y en a qui disent que la somme ainsi distraite de l’Échiquier est insignifiante. Mais il faut se rappeler qu’il s’agit de 800 000 liv. st. par an, et que cette somme à 4 pour % répond à un capital de 20 millions de liv. st. Ainsi la proposition de M. Miles revient à ceci, ni plus ni moins : Prendre, pour la seconde fois, 20 millions dans les poches du public pour les livrer aux intérêts coloniaux. J’ai dit à mes amis et je répète ici, — car je reconnais à certains signes qu’il y en a parmi vous qui ont été dupes de cette proposition insidieuse, — je répète qu’une réduction de droit sur le sucre colonial ne fera pas baisser le sucre d’un farthing tant que le droit sur le sucre étranger restera le même. — Et puisqu’on nous a annoncé qu’à une époque très-prochaine, probablement dans un an, il y aurait un changement profond dans les droits sur le sucre, profitons du temps pour bien apprendre d’ici là notre leçon et savoir ce que c’est que les droits différentiels ; et si nous parvenons à en bien faire comprendre au public la vraie nature, soyez certains qu’en février prochain, il n’est pas de ministère qui ose les proposer. (Applaudissements.) Je vous répète encore que, si le gouvernement venait à effacer radicalement le droit sur le sucre colonial, laissant subsister le droit actuel sur le sucre étranger, vous n’en payeriez pas votre sucre un farthing de moins. Vous ne pouvez obtenir cet article à meilleur marché qu’en augmentant la quantité importée. Il n’y a pas d’autre moyen d’abaisser le prix des choses que d’en accroître l’offre, la demande restant la même. Ainsi, le seul résultat de l’abolition totale du droit sur le sucre colonial serait de transférer quatre ou cinq millions par an du trésor public aux monopoleurs, somme que vous auriez à restituer à l’Échiquier par un autre income-tax. Que ces questions soient enfin bien comprises, que le public y voie ce qu’elles renferment ; et nous en aurons bientôt fini avec toutes ces impositions infligées au peuple dans des intérêts privés, sous forme de droits différentiels. Quand les colons viennent au Parlement et proposent « la protection » comme le remède à tous leurs maux, enquérons-nous du moins si ce système de protection profite même à ceux qui le réclament. Eh quoi ! j’ai vu les honorables gentlemen, propriétaires aux Indes occidentales, se lever à la Chambre des communes, pleurer sur leur détresse et celle de leurs familles. « Nous sommes ruinés, disaient-ils ; notre propriété est sans valeur ; au lieu de tirer du revenu de nos domaines, nous sommes forcés d’envoyer d’ici de l’argent pour leur entretien. » Et dans quelles circonstances les frappe cette détresse ? Dans un moment où ils jouissent d’une protection illimitée ; où ils sont affranchis de toute concurrence étrangère : car vous ne pouvez acheter du sucre à nul autre qu’à eux qu’en vous soumettant au droit de 64 sh. qui équivaut à une prohibition. Si ce système de monopole ne les a pas mis en état de soutenir avantageusement leur industrie ; s’ils déclinent, et tombent sous une telle protection, cela ne prouve-t-il pas qu’ils sont dans une mauvaise voie, et que ce système, si onéreux pour les consommateurs, n’a pas eu les résultats qu’en attendaient ceux-là mêmes en faveur de qui il nous fut imposé ? Il faut voir les choses sous leur vrai jour. Mon honorable ami, M. Milner Gibson, dans sa manière ingénieuse, disait une chose bien juste. Au lieu d’envelopper subrepticement des primes aux monopoleurs, dans un acte du Parlement qui a pour but ostensible d’allouer des subsides à la couronne, votons séparément ces subsides, et si les colons ont de justes droits sur nous à faire valoir, qu’ils les établissent clairement, et accordons-leur aussi séparément ce qui leur est légitimement dû. Mais dès qu’ils se présenteront devant nous dans cette nouvelle attitude, nous aurons à pousser notre enquête au delà du fait matériel de leur détresse. Il faudra savoir s’ils ont convenablement géré leurs propriétés. Quand un homme réunit ses créanciers, et leur déclare qu’il ne peut faire honneur à ses engagements, ils s’enquièrent naturellement des habitudes de cet homme, et ils examinent s’il a conduit ses affaires avec prudence et habileté. Nous poserons quelques questions semblables aux planteurs des Antilles, si vous le voulez bien. Je dis qu’ils sont au-dessous de leurs affaires parce qu’ils les ont dirigées sans habileté et sans économie. Je me rappelle avoir traversé l’Atlantique, il y a sept ans, avec un voyageur très-éclairé et qui avait parcouru toutes les régions du globe où croît la canne à sucre ; il me disait : « Il y a entre la culture et la fabrication du sucre, dans nos colonies occidentales, et celles des pays qui ne jouissent pas du même monopole, autant de différence qu’il peut y en avoir entre vos filatures actuelles et celles dont vous faisiez usage en 1815. » Donc, s’il en est ainsi, je dis : Arrière cette tutelle de la protection qui rend paresseux et impotents ceux qui s’endorment sous son influence. Mettez ces colons sur le pied d’une loyale et parfaite égalité avec leurs concurrents, et qu’ils luttent pour eux-mêmes, sans faveurs et à armes égales, comme nous sommes obligés de le faire nous-mêmes. Gentlemen, j’ai exposé devant vous les motifs qui m’ont déterminé à voter contre l’amendement de M. Miles. Je vous avouerai franchement que je ne me suis pas douté du piége qu’on nous tendait jusqu’à vendredi matin, c’est-à-dire jusqu’au jour même du vote. Le jeudi encore, j’étais décidé à l’adopter, m’imaginant, simple que j’étais, que quelque chose de bon pouvait venir de l’honorable représentant de Bristol. (Rires.) Je veux croire, je ne doute même pas que plusieurs free-traders, et des plus ardents, ont voté pour l’amendement, sous l’influence du même malentendu qui me l’aurait fait accueillir moi-même, si le débat eût eu lieu la veille du jour où les informations me sont parvenues. Mais, messieurs, si les free-traders ont été égarés de bonne foi, nous ne devons pas nous dissimuler que d’autres personnages, dans la Chambre des communes, n’ont vu en tout ceci qu’une question de parti. (Écoutez ! écoutez !) Je vois bien que les journaux, organes de ces partis, sont très-mécontents de ce que nous, qui avons en vue des principes et non des combinaisons de partis et des desseins factieux, nous avons refusé d’accueillir un amendement pire que la mesure, déjà assez mauvaise, de sir Robert Peel, alors que, par ce moyen, nous pouvions contribuer à arrêter le char politique. (Approbation.) Je ne vois pas, dans les opérations du Parlement, une occasion de lutte pour les partis. Je n’ai jamais émis au Parlement un vote factieux, et j’espère que je ne le ferai jamais. (Acclamations.) Je cherche à obtenir le mieux possible. Je ne proposerai jamais une mesure mauvaise, je n’appuierai jamais le pire quand le mieux se présentera. Mais alors même que je serais un homme de parti ; quand je serais disposé à ne voir cette question que dans ses rapports avec la tactique des partis, et à travers le prisme de l’opposition, que devrais-je encore penser de la sagesse de cette tactique en cette occasion ? Voici une coalition. — Et quelle coalition ? — J’ai entendu dire à des hommes raisonnables que nous verrions bientôt une coalition dans la Chambre des communes ; qu’il y a 250 membres des plus modérés sur les bancs des Torys, et 100 membres des plus conservateurs du côté des Whigs, dont les vues politiques sont maintenant si près d’être homogènes, qu’ils pourraient siéger côte à côte sous la conduite du même chef, si ce n’était la difficulté de concilier les prétentions personnelles. Il est des gens qui pensent qu’il y a du bon sens et de la politique dans une coalition de cette nature. Mais quelle sorte de coalition était celle de lundi dernier, entre les libéraux d’un côté et les ultra-monopoleurs de l’autre, entre lord John Russell avec ses Whigs et lord John Manners avec sa « jeune Angleterre » ? Si l’esprit de faction n’aveuglait pas les hommes ; s’il ne les empêchait pas de voir plus loin que leur nez, ne se demanderaient-ils pas à quoi cela peut mener ? En admettant que cette combinaison réussît à renverser leur rival, où les conduirait-elle eux-mêmes ? Au premier vote, on verrait une majorité, composée de tels ingrédients, se dissoudre et se transformer en une impuissante minorité. Et qu’en résulterait-il pour sir Robert Peel ? Supposez que la reine envoie chercher lord John Russell et lui demande de former un cabinet, quel conseil donnerait lord John à Sa Majesté ? Probablement d’envoyer quérir sir Robert de nouveau.
Pense-t-on qu’avec une majorité de 90 voix, dans toutes les questions politiques, sir Robert peut être dépossédé par d’aussi misérables manœuvres ? Si les partis se balançaient à peu près, s’ils présentaient les mêmes forces à 10 ou 20 voix près, il y aurait peut-être ouverture à cette tactique des partis. Mais, avec une majorité de 90 à 100 voix du côté de sir Robert Peel, comment de telles intrigues porteraient-elles ses adversaires au pouvoir ? Non, non, le moyen d’arriver au pouvoir, si lord John Russell elles Whigs le désirent tant, ce n’est pas de s’associer, au mépris des principes, avec les ultra-monopoleurs ; cette tactique ne réussirait pas, même en France, où les hommes politiques sont moins scrupuleux qu’en Angleterre, et moins retenus par le contrôle éclairé de l’opinion publique ; mais si ce noble lord veut arriver au pouvoir, qu’il déploie sa force au dehors, afin d’accroître son influence dans la Chambre des communes » (Acclamations.) Et quel est pour lui, comme pour tout homme politique, le moyen d’acquérir du crédit au dehors ? Ce n’est point de faire obstacle à cette liberté commerciale qu’il fait profession d’admettre en principe, mais, au contraire, d’adhérer étroitement à ce principe, prêt à s’élever ou à tomber avec lui. Je suis fâché dédire que telles sont les idées des deux grands partis parlementaires — je veux parler des Whigs et des Torys, — que le peuple ne se soucie guère de l’un plus que de l’autre, (écoutez ! écoutez !) et je crois vraiment qu’il les vendrait tous les deux pour une légère réduction de taxes et de prohibitions. (Rires.) Gentlemen, la Ligue, au moins en ce qui me concerne, n’appartient à aucune de ces deux factions. Ni les Whigs ni les Torys ne sont des free-traders pratiques. Nous ne tenons encore aucun gage du chef des Whigs non plus que du chef des Torys, duquel nous puissions inférer qu’il est prêt à pousser à bout le principe de la liberté des échanges. Nous avons bien entendu de vagues déclarations, mais cela ne peut nous suffire, et il nous faut des votes à l’appui. On trouve toujours quelque prétexte pour continuer la protection du sucre et quelque justification en faveur de la protection du blé. Tant que nous n’aurons pas amené l’un ou l’autre parti politique à embrasser, sans arrière-pensée, la cause de la liberté contre celle de la protection, qui n’est que le pillage organisé, je ne crois pas que la Ligue, comme Ligue, agirait avec sagesse et politique, si elle s’identifiait avec l’un des deux. Gentlemen, mon opinion est, qu’encore que nous soyons isolés comme corps, pourvu que nous soyons un corps, nous aurons plus de force à la Chambre et dans le pays, quoique privés de la force numérique, que si nous nous laissions absorber par les Whigs ou les Torys. (Acclamations.) Je vois la confusion des partis et le chaos dans lequel tombent les factions politiques ; je ne m’en afflige pas. Mais je dis : Formons un corps compacte de free-traders, et plus sera grande la confusion et la complication entre les Whigs et les Torys, plus tôt nous réussirons à faire triompher notre principe. (Applaudissements enthousiastes.)
Le révérend T. Spencer : Monsieur le président, ladies et gentlemen, comme vous tous, j’ai écouté avec le plus grand intérêt le discours de M. Cobden, et je me réjouis de voir l’esprit de parti tomber enfin dans le discrédit ; je me réjouis de penser que bientôt disparaîtront les vaines dénominations de Whigs et de Torys. J’espère, — et il y a longtemps que je nourris cette espérance, — que sur les ruines de ces partis, il s’en élèvera un troisième que le peuple appellera le parti de la justice (bruyants applaudissements), parce qu’il n’aura d’autre règle que la justice, non justice pour quelques-uns, mais justice pour tous (acclamations) ; parce qu’il ne favorisera pas la classe riche, ou la classe pauvre, ou la classe moyenne, mais qu’il tiendra la balance égale, faisant ce qui est bien et ce qui est droit, en tout temps et en toutes circonstances. (Acclamations.) J’espère voir en même temps changer l’esprit des journaux. Au lieu d’être calculés et écrits pour égarer le public, ou pour acquérir de la popularité ; au lieu d’en appeler constamment aux passions ; au lieu de ces vieux journaux Whigs et Torys, j’espère voir les journaux de la Vérité, constater les événements sans chercher à les colorer, enregistrer les faits tels qu’ils sont (applaudissements), de manière à ce que le peuple puisse croire ce qu’il lit, ce qu’il ne peut faire maintenant, obligé qu’il est, pour arriver à la vérité, de lire les journaux de tous les partis et de juger entre eux. (Acclamations.) Comme prêtre de l’Église d’Angleterre, je dois me défier de ma propre opinion quand je vois la grande majorité du clergé penser autrement que moi en matière politique. Cependant, il n’est pas impossible que la minorité ait raison. On a vu la vérité soutenue par le petit nombre, et même un homme rester seul debout ; et en tout cas penser pour soi-même est le droit de chacun. Il s’agit de savoir de quel côté est la vérité et non de quel côté est le nombre. (Approbation.) Je suis fâché d’être, à cet égard, de l’avis de l’évêque Butler, qui disait : « La plupart des hommes pensent par les autres ; » je ne veux rien dire qui s’écarte du respect que je dois à mes semblables, mais je crois que le prélat avait raison, et que beaucoup d’hommes sont moralement, sinon physiquement, indolents. Ils n’aiment pas à étudier, à travailler, à penser, et même quand ils lisent, ils font souvent, comme il disait encore : « acte de paresse. » Nous les voyons dévorer un roman, — cela n’est pas une étude ; — ou parcourir un journal ; — il n’y a pas là travail intellectuel, investigation, recherche de la vérité. C’est ainsi qu’on se charge la mémoire, qu’on se bourre l’esprit, jusqu’à ce qu’un accès d’indigestion vide l’un et l’autre ; car, permettez-moi de vous le dire, rien n’affaiblit plus la mémoire que ces immenses lectures que la méditation ne transforme pas, par le travail intime de l’assimilation, en la substance même de notre esprit. J’attribue le premier obstacle que rencontre la Ligue à ce défaut de pensée de la part du peuple. La Ligue est obligée de penser pour lui. Il est comme ces hommes qui abandonnent leur santé au médecin, leurs domaines à l’intendant, leurs discussions à l’avocat et leur âme au prêtre. (Rires et applaudissements.) Ils ne suivent pas l’Écriture, car elle dit : Examinez, et eux disent : « Qu’un autre examine pour moi. » (Rires.) C’est ainsi qu’ils se déchargent de toute responsabilité et ne font rien que par procuration. (Nouveaux rires.) Mais aussitôt que le peuple de ce pays voudra penser par lui-même, — surtout quand il examinera par lui-même ce que c’est que la vraie religion, quand il comprendra qu’elle ne consiste pas en de vaines simagrées, à montrer des figures allongées, à réciter des prières et à chanter des psaumes, mais à mettre la rectitude et la justice dans nos paroles et nos actions, alors la Ligue parcourra le pays, recrutant tant de prosélytes, que ses triomphes de quelques semaines effaceront ceux qu’elle doit à plusieurs années de labeurs. (Applaudissements.) La seconde raison qui empêche la Ligue de faire des progrès plus rapides, c’est que parmi ceux-là mêmes qui pensent un peu (et penser mène nécessairement au principe de la liberté commerciale), il en est beaucoup qui laissent à d’autres le soin d’agir. Ils disent : « Il n’est pas nécessaire que je me donne tant de peine ; voilà M. Cobden (tonnerre d’applaudissements), voilà M. Cobden, il pourvoira à tout. Voilà notre représentant à la Chambre des communes ; c’est un brave homme, il parlera pour moi. Voici des hommes qui tiennent des meetings et signent des pétitions. Voici des agents salariés et d’autres qui ne le sont pas, et voici la Ligue, et ses journaux, et ses pamphlets ; tout cela fait merveille. À quoi bon dépenser mon temps, mes peines, mon argent, me faire des ennemis, négliger mes affaires ? Je m’en rapporte aux autres. » (Applaudissements.) Voilà ce qui a perdu plus d’une noble cause. (Cris : Écoutez !) L’homme véritablement grand se dit : « J’agirai, fussé-je seul. Si les autres négligent leur devoir, je ferai le mien, et quoique j’aie foi dans la suprême intervention de la Providence, je travaillerai comme si elle n’aidait que ceux qui s’aident eux-mêmes. »
L’orateur traite ici la question de la liberté commerciale au point de vue religieux. Il cherche des autorités dans la Bible, dans le livre de prières, dans les opinions des sectaires les plus célèbres. Nous regrettons que le défaut de temps et d’espace ne nous permette pas de reproduire celte argumentation si étrange pour des oreilles françaises, et si propre à initier le lecteur dans le génie de la nation britannique. De la prière pour obtenir la pluie, l’orateur conclut que l’Église demande l’abondance, ce qui est le but de la liberté commerciale. La prière en faveur du Parlement lui fournit l’occasion d’interpeller sir Robert Peel. « O Dieu, dit cette prière, faites que tout s’ordonne et s’arrange par les efforts du Parlement sur la base la plus solide, afin que la paix et le bonheur, la vérité et la justice, la religion et la piété règnent parmi nous jusqu’à la dernière génération. » — Or, sir Robert a reconnu que la plus solide base du commerce était de laisser « chacun acheter et vendre au marché le plus avantageux ; » d’où l’orateur tire cette conséquence que, puisque sir Robert Peel ne donne pas la liberté au commerce, il ne peut honnêtement faire la prière du dimanche.
Il aborde ensuite la question à l’ordre du jour, la distinction entre les deux sucres. Comme on devait s’y attendre, il déploie un grand luxe d’érudition biblique pour démontrer que le gouvernement n’a pas le droit d’imposer au consommateur une telle distinction ; et malgré que tout semble avoir été dit par les précédents orateurs, M. Spencer ne laisse pas que d’opposer au projet du gouvernement une solide argumentation.
« Je suis convaincu, dit-il, que le maître que nous servons, notre Créateur, n’a pas entendu nous assujetir à examiner l’origine de toutes les choses dont nous nous servons. Ce livre (montrant le livre de prières) est fait avec du coton produit par le travail esclave. Dieu n’attend pas de nous que nous tremblions à chaque pas, et ne nous imputera pas à péché l’usage de tels objets. C’est pourquoi je pense que le gouvernement a tort de s’emparer de telles idées, momentanément dominantes dans le public, pour s’en faire des arguments de circonstance. Je ne doute pas que chacun des membres qui composent le cabinet a des idées plus justes ; mais ils ne veulent pas froisser les sentiments de ceux qui pensent différemment. Il est à regretter que ce sentiment ait prévalu ; il est à regretter qu’il existe dans l’esprit d’un grand nombre d’hommes honnêtes. Quand la pitié et la charité prennent dans l’esprit la place de la justice, il en résulte toutes sortes de méprises. Tout ce que je puis dire, c’est que la Bible ne sanctionne pas cette substitution de la charité à la justice. Elle dit : « Soyez justes, » et ensuite : « Aimez la pitié, » fondez toutes choses sur la vérité, sur l’honnêteté, sur la loyauté, sur l’équité ; payez ce que vous devez ; faites ce qui est bien, et ensuite, si vous en avez les moyens, montrez-vous généreux[1]. Et même encore la charité de la Bible n’est pas la charité moderne, — cette charité qui s’exerce aux dépens du public, — qui dit aux hommes : « Soyez bien vêtus, bien chauffés, » en ajoutant : « Adressez-vous à la paroisse ; » non, la charité de la Bible est volontaire, et chacun la puise dans son cœur et dans sa bourse. (Applaudissements.) Je vous raconterai un acte de vraie charité dont j’ai eu hier connaissance. Un de mes amis me racontait qu’il voyageait dans une voiture publique, de compagnie avec un lord anglais, par une terrible nuit d’hiver. Il y avait sur la voiture la femme d’un soldat et son enfant exposés à une pluie battante et à un vent glacial. Le noble lord, dès qu’il apprit cette circonstance, et quoique le voyage fût long, établit la femme du soldat et son enfant dans sa bonne place de l’intérieur, et supporta pendant de longues heures les assauts d’une violente tempête. (Applaudissements.) Ce gentleman est un noble free-trader dont le nom est Radnor. (L’assemblée se lève en masse et applaudit à outrance.) — Le principe que je voulais établir devant vous est celui-ci : Quand la détresse règne dans le pays, il ne faut pas se contenter, selon le système moderne, de replâtrer, de corriger, de rapiécer, il faut aller à la source du mal et en détruire la cause.
Et ailleurs :
Je n’admets pas qu’on puisse revenir sans cesse sur une règle solidement établie. Si un homme, par exemple, après avoir examiné la Bible, s’est une fois assuré, par l’évidence intérieure et extérieure, que ses pages sont pures et authentiques, il ne peut être reçu à pointiller sur chaque expression particulière, et il doit adhérer à sa conclusion générale et primitive. (Écoutez ! écoutez !) Chaque science prend pour reçus un certain nombre d’axiomes et de définitions. Euclide commence par les établir. Si vous les admettez à l’origine, vous devez les regarder comme établis pendant tout le cours de la démonstration. De même, sir Isaac Newton pose des axiomes et des propositions simples à l’entrée de son livre des Principes. Si nous les lui accordons une fois, il ne faut pas, plus tard, faire porter la discussion sur ce point. Il en est de même pour la liberté commerciale. Reconnaissons-nous que la liberté d’échanger est un des droits de l’homme ; que chacun est admis à tirer pour lui-même le meilleur parti de ses forces dans le marché du monde ; vous ne devez point ensuite dévier de ce principe à chaque occasion particulière. Vous ne pouvez plus dire au peuple : « Tu n’échangeras pas avec la Russie, parce que la conduite de son empereur envers les Polonais n’a pas notre approbation ; tu n’échangeras pas avec tel peuple, parce qu’il est mahométan ; avec tel autre, parce qu’il est idolâtre, et ne rend pas à Dieu le culte qui lui est dû. » Le peuple anglais n’est pas responsable de ces choses. Ma question est celle-ci : Sommes-nous tombés d’accord que la liberté des échanges est fondée sur la justice ? Si cela est, adhérez virilement à ce que vous avez une fois approuvé, soyez conséquents et ne revenons pas sans cesse sur les fondements de cette croyance. (Applaudissements.)
[Note by FB]
Qu’il me soit permis de faire ici une réflexion. La question des sucres, telle qu’elle est posée en Angleterre, n’a pas pour le lecteur français un intérêt actuel. Nous n’en sommes pas à savoir si nous repousserons le sucre des Antilles comme portant la tache de l’esclavage. J’ai cru pourtant devoir citer quelques-uns des arguments qui se sont produits dans les meetings de la Ligue à ce sujet, et mon but a été principalement de faire connaître l’état de l’opinion publique en Angleterre. Nous autres Français, grâce à l’influence d’une presse périodique sans conscience, nous sommes imbus de l’idée que l’horreur de l’esclavage n’est point, chez les Anglais, un sentiment réel, mais un sentiment hypocrite, un sentiment de pure parade, mis en avant pour tromper les autres peuples et masquer les calculs profonds d’une politique machiavélique. Nous oublions que le peuple anglais est, plus que tout autre peuple, peut-être, sous l’influence des idées religieuses. Nous oublions que, pendant quarante ans, l’agitation abolitionniste a travaillé à susciter ce sentiment dans toutes les classes de la société. Mais comment croire que ce sentiment n’existe pas, quand nous le voyons mettre obstacle à la réalisation de la liberté commerciale, admise en principe par tous les hommes d’État éclairés du Royaume-Uni, quand nous voyons les chefs de la Ligue occupés, meeting après meeting, à en combattre l’exagération ? À qui s’adressent tous ces discours, tous ces arguments, toutes ces démonstrations ? Est-ce à nos journaux français qui ne s’occupent jamais de la Ligue et en ont à peine révélé l’existence ? À qui fera-t-on croire que les monopoleurs, dans cette circonstance, se sont emparés, à leur profit, avec tant d’habileté, d’un sentiment public qui n’existe pas ?
On peut faire la même réflexion sur l’agitation commerciale. Nos journaux n’en parlent jamais, ou, s’ils sont forcés par quelque circonstance impérieuse d’en dire un mot, c’est pour y chercher ce qu’ils appellent le machiavélisme britannique. À les entendre , on dirait que ces efforts presque surhumains, tous ces discours, tous ces meetings, toutes ces luttes parlementaires et électorales, n’ont absolument qu’un but : tromper la France, en imposer à la France, l’entraîner dans la voie de la liberté pour l’y laisser plus tard marcher toute seule. Mais, chose extraordinaire, la France ne s’occupe jamais de la Ligue, pas plus que la Ligue ne paraît s’occuper d’elle, et il faut avouer que, si l’agitation n’a que ce but hypocrite, elle s’enferre niaisement, car elle aboutit à faire opérer en Angleterre même ces réformes qu’on l’accuse de redouter, sans faire faire un pas à notre législation douanière.
Quand donc en finirons-nous avec ces puérilités ? Quand le public français se fatiguera-t-il d’être traité par la Presse, par le Commerce, par le comité Mimerel, comme une dupe, comme un enfant crédule, toujours prêt à se blesser, à s’avilir lui-même, pourvu qu’on fasse retentir à ses oreilles ces grands mots : la France, la généreuse France ; l’Angleterre, la perfide Angleterre ? Non, ils ne sont pas Français ceux qui, par leurs sophismes, retiennent les Français dans une enfance perpétuelle ; ils n’aiment pas véritablement la France, ceux qui l’exposent sciemment à la risée des nations et travaillent de tout leur pouvoir à abaisser notre niveau moral au plus bas degré de l’échelle sociale.
Que penserions-nous, si nous venions à apprendre que, pendant dix années, la presse et l’opposition espagnoles, profitant de ce que la langue française est peu répandue au delà des Pyrénées, ont travaillé et sont parvenues à persuader au peuple que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit en France, a pour but de tromper, d’opprimer et d’exploiter l’Espagne ? que nos débats sur l’adresse, sur les sucres, sur les fonds secrets, sur les réformes parlementaire et électorale, ne sont que des masques que nous empruntons pour cacher, à l’égard de l’Espagne, les plus perfides desseins ? si, après avoir excité le sentiment national contre la France, les partis politiques s’en emparaient, comme d’une machine de guerre, pour battre en brèche tous les ministères ? Nous dirions : Bons Espagnols, vous êtes des dupes. Nous ne nous occupons point de vous. Nous avons bien assez d’affaires. Tâchez d’arranger les vôtres, et croyez que tout un grand peuple n’agit pas, ne pense pas, ne vit pas, ne respire pas uniquement pour en tromper un autre. Faites rentrer vos journaux et vos hommes politiques dans une autre voie, si vous ne voulez être un objet de mépris et de pitié aux yeux de tous les peuples.
La question est toujours de savoir ce qui vaut le mieux, de la liberté ou de l’absence de liberté. Au moins ceux qui admettent que la liberté a des avantages doivent-ils admettre aussi que les Anglais la réclament de bonne foi ; et n’est-ce point une chose monstrueuse et décourageante d’entendre nos libéraux mettre à la suite l’une de l’autre ces deux phrases contradictoires : La liberté est le fondement de la prospérité des peuples. — Les Anglais travaillent depuis vingt ans à conquérir la liberté, mais avec la perfide arrière-pensée de nous la faire adopter pour la répudier eux-mêmes l’instant d’après ? — Se peut-il concevoir une absurdité plus exorbitante ?
Nous terminerons le compte rendu de cette séance par le discours de M. Fox, dont nous ne traduisons que l’exorde et la péroraison.
M. W. J. Fox : La motion que l’honorable M. Ch. Pelham Villiers doit proposer mardi prochain, pour l’abrogation des lois-céréales, marque le terme d’une autre année de l’agitation de la Ligue. C’est le moment de constater les progrès de notre cause ; et le résultat de cette motion fera connaître l’état de l’opinion du Parlement relativement à la liberté commerciale, comparée à ce qu’elle était l’année dernière. J’avoue que de ce côté je n’ai pas de grandes espérances. Le révérend ministre, qui m’a précédé à cette tribune, vous a fort à propos rappelé la prière qui se répète dans toute l’Angleterre pour la Chambre des communes. Mais avec quelque sincérité qu’elle soit offerte, je crains qu’elle ne soit à peu près aussi inefficace qu’une proposition qu’on faisait il y a quelques jours, dans un village agricole où les fermiers souffrent de cette sécheresse dont parlait M. Spencer. On invitait le curé à dire une prière pour demander la pluie. Il consulta un vieux fermier des environs et voulut savoir s’il acquiesçait à la requête de ses autres paroissiens : « Oh ! monsieur le curé, dit le fermier, dans mon opinion, il est inutile de prier pour la pluie tant que le vent soufflera du nord-est. » (Rires.) Et pour moi, je crains que les prières de l’Église ne soient aussi inefficaces à amener l’établissement de la liberté commerciale sur les bases de la justice et de la vérité, par l’intervention de la Chambre des communes, tant que les vents régnants y souffleront des froides et dures régions du monopole. (Applaudissements.) J’attends peu de chose, dans une question qui s’agite entre une classe et le public, d’une assemblée fondée et élue par cette classe. Le mal est dans les organes vitaux, et il ne faut rien moins qu’une régénération du corps législatif pour que des millions de nos frères puissent espérer justice, sinon charité, de ceux qui se sont constitués les arbitres de nos destinées. Il y a d’ailleurs des symptômes propres à modérer notre attente sur le vote prochain du Parlement. Je ne serais pas surpris que nos forces parussent être diminuées depuis le dernier débat, et je ne me laisserai pas décourager par un tel phénomène ; car il est à remarquer que toutes les fois que le parti whig a entrevu le pouvoir en perspective, des phrases et des expressions, que le progrès de cette controverse semblait avoir vieillies, ne manquent pas de se reproduire ; et dans les récents événements parlementaires, il n’a pas plutôt aperçu la chance de supplanter le parti rival qu’on a vu la doctrine du droit fixe reparaître dans ses journaux. (Une voix : Ils ont le droit d’agir ainsi.) Sans doute, ils ont le droit d’agir ainsi ; ils ont le droit de faire revivre le droit fixe comme vous avez le droit d’arracher un cadavre à la terre, si cette terre vous appartient. Mais vous n’avez pas le droit de jeter cette masse de corruption au milieu des vivants et de dire : Ceci est l’un de vous ; il vient partager vos travaux et vos priviléges. (Applaudissements.) Il n’y a pas encore bien longtemps, qu’au grand jour de la discussion publique le droit fixe est mort, enseveli, corrompu et oublié pour toujours ; et il ne reparaît sur la scène que parce qu’un certain parti parlementaire croit avoir amélioré sa position et s’être ouvert une brèche vers le pouvoir. Mais au droit fixe comme à l’échelle mobile, la Ligue déclare une guerre éternelle. (Écoutez !) L’intégrité de notre principe répugne à l’un comme à l’autre. Nous ne transigerons jamais avec une taxe sur le pain, quel qu’en soit le mode, et nous les repousserons tous les deux, comme des obstacles divers qui viennent s’interposer entre les dons de la Providence et le bien-être de l’humanité…
À propos des crises ministérielles que venaient d’occasionner coup sur coup la loi sur les sucres et le bill des dix heures, l’orateur s’écrie :
Des symptômes de nos progrès se révèlent dans la condition actuelle des partis qui nous sont hostiles. Où est cette phalange serrée qui se leva contre nous il y a deux ans ? Où est cette puissance qui, aux élections de 1841, balayait tout devant elle comme un tourbillon ? Divisée sur toutes les questions qui surgissent, tourmentée par une guerre intestine à propos d’un évêché dans le pays de Galles, à propos des chapelles des dissidents, à propos de la loi des pauvres, de celle du travail dans les manufactures, la voilà encore livrée à l’anarchie au sujet de la loi des sucres. (Applaudissements.) Les voilà ! Église orthodoxe contre Église modérée ; vieux Torys contre conservateurs modernes ; vieille Angleterre contre jeune Angleterre. — Voilà la grande majorité dont sir Robert Peel a mis dix ans à amalgamer les ingrédients. (Rires et applaudissements.) L’état présent de la Chambre des communes est une haute leçon de moralité pour les hommes d’État à venir. Elle les avertit de la vanité des efforts qu’ils pourraient tenter pour former un parti sans un principe, ou, ce qui ne vaut guère mieux, avec une douzaine de principes antipathiques. Quand il était dans l’opposition, sir Robert Peel courtisait tous les partis, évitant, avec une dextérité merveilleuse, de se commettre avec aucun. Il leur donnait à entendre — confidentiellement sans doute — que la coalition tournerait à leur avantage. Il ne s’agissait que de déplacer les Whigs. Tout le reste devait s’ensuivre. Enfin la coalition a réussi ; et voilà qu’elle montre le très-honorable baronnet dans la plus piteuse situation où se soit jamais trouvé, à ma connaissance, un premier ministre d’Angleterre. Accepté seulement à cause de sa dextérité, nécessaire à tous, méprisé de tous, contrarié par tous, il est l’objet de récriminations unanimes, et les reproches dont il est assailli de toutes parts se résument cependant avec une écrasante uniformité par le mot : « Trahison… »
C’était hier l’anniversaire de la bataille de Waterloo. Les guerriers qui triomphèrent dans cette terrible journée se reposent à l’ombre de leurs lauriers. Plusieurs d’entre eux occupent des positions élevées, et je désirerais que cette occasion leur suggérât l’idée de rechercher quelles furent les causes qui avaient affaibli la puissance sociale de Napoléon, longtemps avant que sa force militaire reçût un dernier coup sur le champ de Waterloo. Pour les trouver, je crois que, remontant le cours des événements, nous devrions revenir jusqu’au décret de Berlin qui déclara le blocus des îles Britanniques[2]. Les lois naturelles du commerce, on l’a dit avec raison, le brisèrent comme un roseau. L’opinion s’était retirée de lui, sa politique avait perdu en Europe tout respect et toute confiance avant le prodigieux revers que ses armes subirent le 18 juin. Lui-même s’était porté le premier coup par les proclamations antisociales auxquelles je fais allusion. Eh bien ! que ces guerriers, qui renversèrent alors le blocus de la Grande-Bretagne, y songent bien avant de s’unir à une classe qui s’efforce de la soumettre à un autre blocus. (Écoutez !) La loi-céréale, c’est un blocus. Elle éloigne de nos rivages les navires étrangers ; elle nous sépare de nos aliments ; elle nous traite en peuple assiégé ; elle nous enveloppe comme pour nous chasser du pays par la famine. Le blocus que rompit le duc de Wellington ne portait pas les caractères essentiels d’un blocus plus que celui que nous impose le monopole ; seulement le premier prétendait se justifier par une grande politique nationale, et le second ne s’appuie que sur les misérables intérêts d’une classe. Il ne s’agit plus de l’empire du monde, mais d’une question de revenus privés. (Applaudissements.) Ce n’est plus la lutte des rois contre les nations ; il n’y a d’engagés que les intérêts des oisifs propriétaires du sol, et c’est pour cela qu’ils font la guerre, et c’est pour cela qu’ils renferment dans leur blocus les multitudes industrieuses et laborieuses delà Grande-Bretagne. (Applaudissements.) Le système du monopole est aussi antinational que la politique commerciale de Napoléon était hostile aux vrais intérêts de l’Europe, et il doit s’écrouler comme elle. Il n’est pas de puissance, quels que soient ses succès passagers, qui puisse maintenir le monopole. Ce blocus nouveau aura aussi sa défaite de Waterloo, et la législation monopoliste son rocher de Sainte-Hélène, par delà les limites du monde civilisé. (Acclamations prolongées.) J’ai la confiance que les guerriers qui s’assemblèrent hier, contents de leurs triomphes passés, se réjouissent dans leur cœur de ce que l’occasion ne s’est plus offerte à eux de conquérir de nouveaux lauriers, et de ce que la paix n’a pas été rompue. Oh ! puisse-t-elle durer toujours ! (Écoutez ! écoutez !) Mais, soit qu’il faille assigner la cessation de l’état de guerre à l’épuisement des ressources des nations, ce qui y est sans doute pour beaucoup, — ou au progrès de l’opinion, — et j’espère qu’elle n’y a pas été sans influence — (j’entends cette opinion qui repousse le recours aux armes dans les ques- tions internationales, qui, aec de la bonne foi et de la tolé- rance, peuvent être amiablement arrangées) ; — quelles que soient ces causes, ou dans quelques proportions qu’elles se combinent, les principes qui sont antipathiques à la guerre sont également antipathiques au monopole. Si les nations ne peuvent plus combattre parce qu’elles sont épuisées, certainement, par le même motif, elles ne peuvent plus supporter le poids du monopole. — Si l’opinion s’est élevée contre les luttes de nation à nation, l’opinion se prononce aussi contre les luttes de classe à classe, et spécialement s’il s’agit pour les riches et les puissants de s’attribuer une part dans la rémunération des classes pauvres et laborieuses. (Applaudissements.) L’action de ces causes détruira, j’espère, l’un de ces fléaux comme elle a détruit l’autre. Leurs caractères sont les mêmes. Si la guerre appauvrit la société, si elle renverse le négociant des hauteurs de la fortune, si elle dissipe les ressources des nations, et si elle enfonce le pauvre dans une pauvreté de plus en plus profonde, le monopole reproduit les mêmes scènes et exerce la même influence. Si la guerre dévaste la face de la nature, change les cités en ruines, et transforme en déserts les champs que couvraient les moissons mouvantes, quelle est aussi la tendance du monopole, si ce n’est de faire pousser l’herbe dans les rues des cités autrefois populeuses, et de rendre solitaires et vides des provinces entières, qui, par la liberté des échanges, eussent préparé une abondante nourriture pour des milliers d’hommes laborieux, vivant sous d’autres cieux et dans des conditions différentes ? Si la guerre tue, si elle imbibe de sang humain le champ du carnage, le monopole aussi détruit des milliers d’existences, et cela après une lente agonie plus douloureuse cent fois que le boulet et la pointe de l’épée. Si la guerre démoralise et prépare pour les temps de paix les recrues du cachot, le monopole ouvre aussi toutes les sources du crime, le propage dans tous les rangs delà société, et dirige sur le crime et la violence la vengeance et le glaive de la loi. (Applaudissements.) Semblables par les maux qu’ils engendrent, minés par l’action dès mêmes causes, condamnés pour la criminalité qui est en eux, par la même loi morale, je m’en remets au même plan providentiel de leur complète destruction. (Applaudissements enthousiastes.)
[Note by FB]
Nous ne pouvons pas nous dissimuler que l’esprit de parti, cette rouille des États constitutionnels, fait en France, comme en Angleterre, comme en Espagne, d’épouvantables ravages. Grâce à lui, les questions les plus vitales, les questions dont dépendent le bien-être national, la paix des nations et le repos du monde, ne sont pas envisagées dans leurs conséquences et considérées en elles-mêmes, mais seulement dans leur rapport avec le triomphe d’un nom propre. La presse, la tribune, et enfin l’opinion publique, y cherchent des moyens de déplacer le pouvoir, de le faire passer d’une main dans une autre. Sous ce rapport, l’apparition au Parlement britannique d’un petit nombre d’hommes résolus à n’avoir en vue, dans chaque question, que l’intérêt public qui y est impliqué, est un fait d’une grande importance et d’une haute moralité. Le jour où un député français prendra cette position à la Chambre, s’il sait la maintenir avec courage et talent, ce jour-là sera l’aurore d’une révolution profonde dans nos mœurs et dans nos idées ; car, il n’est pas possible que cet homme ne rallie à lui l’assentiment et la sympathie de tous les amis de la justice, de la patrie et de l’humanité. Pleins de cette idée, nous espérons ne pas fatiguer inutilement le public en traduisant ici l’opinion d’un des organes de la presse anglaise, sur le rôle qu’ont joué les free-traders dans la question des sucres.
« Ce qu’il s’agissait de démêler, c’était de savoir laquelle des deux propositions, celle de R. Peel et celle de M. Miles, s’approchait pratiquement le plus des principes de la liberté commerciale. Et cette question, M. Miles la résolvait lui-même en fondant son amendement sur ce que le plan ministériel n’accordait pas une suffisante protection monopole des planteurs des Antilles. Dépouillée de ses artifices technologiques, elle était calculée pour accroître la protection en faveur du sucre colonial, ’et nous ne pouvons pas comprendre comment une pareille mesure aurait pu, sans inconséquence, recevoir l’appui de gens qui font profession de dénoncer toute protection comme injuste, et tout monopole comme funeste. »
« On dit que, selon les règles de moralité à l’usage des partis, le principe abstrait aurait dû céder devant les nécessités d’une manœuvre, et que la proposition de M. Miles aurait dû être soutenue, afin que sir R. Peel, perdant la majorité, fût forcé de résigner le pouvoir ; on fait entendre que, dans la crise ministérielle, les free-traders auraient sans doute obtenu des avantages qu’on ne spécifie pas. Eh bien, même sur ce terrain abject des expédients, et mettant de côté toute considération de principe, nous sommes convaincus qu’en votant avec sir R. Peel, les free-traders ont adopté la ligne de conduite non-seulement la plus juste, mais encore la plus prudente qu’ils pussent choisir dans la circonstance. Il est bien clair qu’une majorité contre sir Robert Peel ne pouvait être obtenue que par la coalition des partis. Mais voyons avec qui les free-traders se seraient coalisés. Il suffit de jeter les yeux sur la liste des membres qui ont voté avec M. Miles, pour s’assurer qu’elle présente les noms des plus fanatiques monopoleurs de l’empire, des plus désespérés adhérents au vieux système de priviléges en faveur du sucre et des céréales, tels qu’ils existaient dans les plus beaux jours des bourgs-pourris ; gens qui n’ont rien oublié ni rien appris, pour qui le flot du temps coule en vain, et dont les vœux non dissimulés sont le retour des vieux abus et la restauration de la corruption électorale. — Quel principe commun unit ces hommes aux free-traders ? Absolument aucun. Leur concours fortuit n’eût donc été qu’une coalition en dehors des principes, et l’histoire d’Angleterre a été écrite en vain, si elle ne nous apprend pas que de telles coalitions ont toujours été funestes au pays. C’est là qu’a toujours été la pierre d’achoppement des Whigs, et la raison qui explique pourquoi les hommes d’État de ce parti n’ont jamais inspiré à l’opinion publique une pleine confiance dans l’honnêteté et la droiture deleur politique. La fameuse coalition de M. Fox avec lord North, qu’il avait si souvent dépeint comme quelque chose de pis qu’un démon incarné, fit reculer de plus d’un demi-siècle la cause de la réforme en Angleterre, et permit à notre oligarchie de nous plonger dans une guerre contre la France, dont les conséquences pèseront encore sur bien des générations futures. Dans le débat auquel donna lieu le traité de commerce avec la France, en février 1787, on vit M. Fox plaider formellement l’exclusion des produits français de nos marchés, se fondant sur ce que les Français étaient « nos ennemis naturels, » et qu’il fallait par conséquent éviter tout rapprochement commercial ou politique entre les deux nations. En se faisant, dans des vues spéciales et temporaires, le héraut de ce vieux préjugé, M. Fox rendit d’avance complétement inefficaces tous les efforts qu’il devait faire plus tard pour empêcher la guerre contre la France. De même, l’adoption temporaire de la bannière de la protection par les chefs des Whigs dans la question des sucres, les eût forcés, le jour où ils seraient arrivés aux affaires, à se mettre en état d’hostilité contre la liberté du commerce. — La récente coalition de lord John Russell avec lord Ashley, dont, pendant qu’il était au pouvoir, il avait traité les propositions de toute la hauteur de son mépris[3], est un autre exemple du danger de subordonner les principes au triomphe réel ou imaginaire d’une manœuvre de parti ; et s’il rentre au pouvoir, il s’apercevra qu’il s’est préparé une série d’embarras auxquels il ne pourra échapper qu’aux dépens de sa dignité. — Pour ne parler que du cabinet actuel, chacun sait que les plus grandes difficultés que rencontre l’administration de sir R. Peel proviennent des encouragements pleins de partialité qu’il donna aux démonstrations de lord Sandon, des calomnies prodiguées au clergé d’Irlande, des appels faits aux préjugés nationaux contre le peuple irlandais, et de l’acquiescement plus qu’implicite par lequel il seconda les clameurs des classes privilégiées contre les réformes commerciales, proposées par les Whigs en 1841. On dit proverbialement : « C’est l’opposition Peel qui tue le ministère Peel. » Avec de tels exemples sous les yeux, les free traders se seraient montrés incapables de profiter des leçons de l’histoire et de l’expérience, s’ils fussent entrés dans une coalition immorale avec les fanatiques du monopole, dans le seul but de fomenter le désordre d’une crise ministérielle. »
« Les chefs des Whigs viennent de se coaliser, dans deux occasions récentes, avec les exaltés du parti opposé, pour renverser le ministère. Mais leur influence morale dans le pays y a-t-elle gagné ? Bien au contraire, et ils se sont placés eux-mêmes dans cette situation que la victoire eût amené leur ruine, et qu’ils ont trouvé leur salut dans la défaite. S’ils avaient renversé le gouvernement à l’occasion du bill de lord Ashley, ils étaient réduits à se présenter devant le pays sous l’engagement d’imposer des restrictions à la liberté du travail. Vainqueurs avec M. Miles, ils étaient également engagés à imposer des restrictions à la liberté du commerce. On a dit que la Ligue avait sauvé sir R. Peel ; mais on peut affirmer avec plus de raison qu’elle a affranchi le parti libéral de la honte de paraître en face de la nation, portant empreints sur son front les mots « restriction et monopole ». Mais, après tout, ce sont là des conséquences de votes whigs ou torys, avec lesquelles les free-traders n’ont rien à démêler. Ils ont exposé et soutenu leurs principes, sans égard à aucune considération prise de l’esprit de parti ; ils n’ont reculé devant aucun engagement ; ils n’ont parlementé avec aucun monopole ; ils n’ont abandonné aucun principe ; ils ont adhéré simplement et pleinement à la vérité, refusant de transiger avec l’erreur. Quand viendra le jour de la justice, comme il viendra certainement, ils n’auront pas à payer la dette du déshonneur, et ne seront pas réduits à sacrifier, en tout ou en partie, l’intérêt national, pour racheter des antécédents factieux. »
[Note by FB]
On pourra soupçonner ce jugement de partialité, comme émané de la Ligue elle-même. Mais nous pourrions prouver ici, en invoquant le témoignage de la presse provinciale d’Angleterre, que l’opinion publique, un moment incertaine, a fini par sanctionner la conduite des free-traders. On comprend qu’au delà, comme en deçà du détroit, les journaux de la capitale doivent être beaucoup plus engagés dans les manœuvres des partis. Aussi vit-on le Morning-Chronicle, qui d’ordinaire soutient la Ligue, s’élever avec indignation contre M. Cobden et ses adhérents. D’après ce journal, les free-traders auraient dû considérer « qu’il ne s’agissait plus d’un droit sur le sucre un peu plus ou un peu moins élevé, mais de choisir entre sir Robert Peel et son échelle mobile d’un côté et lord John Russell et le droit fixe de l’autre, — et qui sait ? peut-être entre sir Robert Peel et lord Spencer avec l’abolition totale. »
Il est consolant, pour les personnes qui se préoccupent de l’avenir constitutionnel des nations, de voir avec quel ensemble la presse impartiale, la presse de province, a repoussé cette manière de poser la question. Sur cent journaux, quatre-vingt-dix ont approuvé la Ligue, parmi lesquels ceux-ci : Liverpool-Mercury, Leeds-Mercury, Northern-Whig, Oxford-Chronicle, Manchester-Times, Sunderland-Herald, Kent-Herald , Edimburg-Weckly-Chronicle, Carliste-Journal, Bristol-Mercury, Sussex-Advertiser, etc. D’autres blâmèrent, dans le premier moment, et ne tardèrent pas à se rétracter. « Après mûr examen, dit le Stirling-Observer, nous nous voyons obligé de modifier profondément, sinon de retirer complètement nos premières remarques ; et nous avouons avec franchise que les chefs de la Ligue ont voté d’après une connaissance des faits et des circonstances, que nous ne possédons nous-mêmes que depuis peu de jours. »
Combien il serait à désirer que la presse départementale sût se soustraire, en France, au despotisme de la presse parisienne ; et quel immense service rendraient les journaux de province, s’ils se consacraient à étudier les questions en elles-mêmes, s’ils démasquaient leurs confrères de Paris, toujours disposés et même intéressés à transformer les plus graves questions en machines de guerre parlementaire ! Les feuilles qui se publient à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, ne sont pas soudoyées par l’ambassade russe, ou par les comités agricoles et manufacturiers, ou par les délégués des colonies. Leurs rédacteurs n’entrent pas, par l’élévation de tel ou tel chef de parti, dans la région universitaire ou diplomatique. Rien donc n’explique l’abjection servile avec laquelle ils reçoivent les inspirations de la presse parisienne, si ce n’est qu’ils sont dupes eux-mêmes de cette stratégie cupide dont ils se font aveuglément les instruments ridicules. Servum pecus ! Pour moi, je l’avoue, quand au fond d’une province je découvre un homme qui ne manque pas de talent et même de sincérité, qui sait manier une plume, et que le public qui l’entoure est habitué à considérer comme une lumière ; quand je vois cet homme se passionner sur le mot d’ordre de ses collègues de Paris ; pour une question de cabinet, négliger, froisser les intérêts de l’humanité, de la France, et même de son public spécial ; soutenir, par exemple, ou les fortifications de Paris, [30] ou le régime protecteur, ou le mépris des traités, et cela uniquement pour faire pièce à un ministre, au profit d’intérêts qui lui sont étrangers comme ils le sont au pays, je crois avoir sous les yeux la personnification de la plus profonde dégradation où il soit donné à l’espèce humaine de descendre.
FN: À l’époque où ce discours fut prononcé, le parti qui soutenait le monopole des céréales et la cherté du pain proposait une foule de plans philanthropiques pour le soulagement du peuple.
FN: M. Fox aurait pu s’étayer ici de l’opinion de Napoléon lui-même. En parlant du décret de Berlin, il dit : « La lutte n’est devenue périlleuse que depuis lors. J’en reçus l’impression en signant le décret. Je soupçonnai qu’il n’y aurait plus de repos pour moi et que ma vie se passerait à combattre des résistances. » (Note du traducteur.)
FN: On sait que la motion de lord Ashley consiste à limiter à dix heures le travail des manufactures, et que sir Robert Peel, qui s’y oppose, en fait une question de cabinet.
La motion annuelle de M. Ch. Pelham Villiers↩
[Note by FB]
Le 25 juin 1844, l’ordre du jour de la Chambre des communes amena enfin la discussion sur la motion annuelle de M. Ch. Pelham Villiers, pour l’abrogation de la loi-céréale.
La composition actuelle de la Chambre ne permet pas de penser que les free-traders se bercent de l’espoir de faire triompher cette mesure radicale. Ils la présentent néanmoins, d’abord, pour faire naître l’occasion d’une discussion solennelle sur le terrain des principes, sachant fort bien que la raison, sinon le nombre, sera de leur côté, et qu’à la longue le nombre se rallie à la raison ; ensuite, afin de constater l’état de l’opinion publique, là où elle leur est certainement le plus défavorable, c’est-à-dire au Parlement.
L’annonce de cette grande discussion avait agité toute l’Angleterre. De toutes parts il se formait des meetings, où les électeurs (constituencies) formulaient des requêtes à leurs mandataires pour les sommer de respecter les droits du travail, de l’industrie et du commerce.
Ainsi qu’on l’a vu, dans le discours de M. Fox, les circonstances n’étaient pas favorables à la motion de M. Villiers. D’abord les Whigs, toujours prêts à mettre l’intérêt général au second rang et l’intérêt de parti au premier, se montraient peu disposés à seconder les free-traders. Ils ne pouvaient oublier que, quelques jours avant, et dans deux occasions successives, les free-traders leur avaient fait manquer l’occasion de ressaisir le pouvoir. « Ils nous ont abandonnés, disaient-ils, et nous les abandonnons à notre tour. »
Mais il y a cette différence que les Cobden, les Gibson, les Villiers avaient sacrifié les partis aux principes, tandis que les Whigs sacrifiaient les principes aux partis.
Les Whigs avaient d’ailleurs un autre motif de se montrer moins radicaux que l’année précédente. Les événements récents, en ébranlant le ministère Tory, leur avaient laissé entrevoir une chance d’arriver aux portefeuilles. Dès lors, ils avaient fait revivre le droit fixe, cet ancien projet de lord John Russell, et ils ne voulaient pas s’engager en votant pour l’abolition immédiate et totale de tous droits protecteurs.
La forme que M. Villiers avait donnée à sa proposition était aussi combinée de manière à faire reconnaître les forces des purs free-traders. C’était, selon l’expression anglaise, « a rigid test, » une pierre de touche sévère. En 1843, la motion de M. Villiers était ainsi formulée : « Que la Chambre se forme en comité pour examiner la convenance d’abroger les lois-céréales. » On conçoit que les partisans du droit fixe, et les hommes sincères dont l’opinion n’est pas bien arrêtée, pouvaient se rallier à une telle proposition, qui avait moins pour objet de résoudre la question que de la mettre officiellement à l’étude.
Mais, en 1844, la motion de M. Villiers était conçue ainsi :
« Que la Chambre se forme en comité pour examiner les résolutions suivantes :
« Il résulte du dernier recensement que la population du royaume s’accroît rapidement ;
« La Chambre reconnaît qu’un très-grand nombre de sujets de Sa Majesté est insuffisamment pourvu des objets de première nécessité ;
« Que cependant une loi est en vigueur qui restreint les approvisionnements, et, par conséquent, diminue l’abondance des aliments ;
« Que toute restriction ayant pour objet d’empêcher l’a- chat des choses nécessaires à la subsistance du peuple est insoutenable en principe, funeste en fait, et doit être abolie ;
« Que, par ces motifs, il est expédient d’abroger immédiatement les actes 5 et 6, Victoria, c. 14. »
Il est bien évident qu’une telle proposition ne pouvait être accueillie que par les membres préparés à reconnaître la vérité théorique et les avantages pratiques du principe de la liberté illimitée du commerce.
Après un débat qui se prolongea jusqu’au vendredi 28 juin, la division donna les résultats suivants.
3776. Pour la motion de M. Villiers 3777. 3778. 124 3779. 3780. voix. 3781.
3783. Contre 3784. 3785. 330 3786. 3787.
3789. Majorité 3790. 3791. 206. 3792. 3793.
À ces 124 voix, il faut en ajouter 11, dites paired, selon les usages parlementaires de la Chambre[1], et 30 de membres absents, ce qui forme une masse compacte de pure free-traders de 165 membres.
En résumé, la majorité contre l’abrogation avait été, en 1842, de 303, — en 1843, de 256, — en 1844, de 206.
Nous ne traduisons pas ici les discours prononcés dans cette mémorable circonstance de crainte de fatiguer le lecteur. Nous nous bornerons à dire que, dans le cours de la discussion, on a accusé les free-traders de ne demander que la liberté du commerce des céréales, et on a, par conséquent, présenté la motion comme faite dans un intérêt purement manufacturier. M. Cobden a répondu que le système protecteur avait principalement en vue les intérêts du sol ; que les propriétaires du sol étant en même temps les maîtres du Parlement, la Ligue avait considéré le système tout entier comme n’ayant d’autre point d’appui que cette branche particulière de protection. Dans la nécessité de concentrer ses forces, pour leur donner plus d’efficacité, elle a résolu d’attaquer surtout la loi-céréale, sachant fort bien que, si elle en obtenait l’abrogation, les propriétaires eux-mêmes seraient les premiers à détruire toutes autres mesures protectrices. « Je déclare ici, dit-il, très-sincèrement et très-formellement, que je me présente comme l’avocat de la liberté des échanges en toutes choses, et, dans le cas où vous vous formeriez en comité au sujet des lois-céréales, si les règles de la Chambre me le permettent, je suis prêt à } ajouter} à la motion l’abrogation de tous les droits protecteurs sur quelque chose que ce soit. »
Nous avons remarqué encore un argument, émané de M. Milner Gibson, et qui nous paraît mériter l’attention des personnes qui aiment à considérer les questions d’un point de vue philosophique.
Après avoir exposé les conséquences funestes du régime restrictif, M. Gibson ajoute :
J’adjure le très-honorable baronnet (sir Robert Peel), j’adjure le payeur général de l’armée (sir E. Knatchbull), dont l’expérience est si ancienne, et qui ont entendu dans cette session comme dans les précédentes tant d’arguments pour et contre la question, je les adjure de se lever dans cette enceinte, et de déclarer, une fois pour toutes, sur quel fondement ils pensent que l’aristocratie de ce pays peut réclamer pour elle-même, avec justice, le droit de s’interposer dans la liberté de l’industrie. (Écoutez ! écoutez !) C’est là une interpellation loyale. Je me souviens d’avoir lu, à l’Université de Cambridge, dans les œuvres du docteur Paley, que toute restriction était per se un mal ; qu’il incombe à ceux qui la proposent ou la maintiennent de prouver qu’elle apportait à la communauté de grands et incontestables avantages, de le prouver distinctement, jusqu’à l’évidence et par delà l’ombre du doute. Il ajoutait qu’il n’incombe pas à ceux qui en souffrent de faire aucunes preuves. C’est pourquoi je vous interpelle en stricte conformité des principes que j’ai appris dans vos universités. Au nom de la philosophie du docteur Paley, puisqu’il existe une restriction dont j’ai à me plaindre, je vous somme, vous le législateur du pays, vous le gouvernement du pays, je vous somme, et j’ai le droit de le faire, de venir justifier votre restriction, et jusqu’à ce que vous l’ayez fait clairement et explicitement, il m’appartient, sans autre explication, d’en demander l’abrogation complète et immédiate.
Sir Robert Peel, sûr de la majorité, ne paraissait guère disposé à s’expliquer. Cependant, il est des convenances et une opinion publique qu’il faut bien respecter. Vaincu par ces interpellations directes, vers la fin du débat, il prit la parole, et, selon sa coutume, il fit de larges concessions aux principes sans s’engager à rien pour la pratique :
« Dans l’état artificiel de la société actuelle, dit-il, nous ne pouvons agir sur de pures abstractions, et nous déterminer par des maximes philosophiques dont, en principe, je ne conteste pas la vérité. Nous devons prendre en considération les circonstances dans lesquelles nous avons progressé et les intérêts engagés. »
Après cette épreuve, une séance générale de l’association pour la liberté commerciale eut lieu au théâtre de Covent-Garden, le 3 juillet 1844. Nous regrettons que le temps nous manque pour rapporter ici les discours remarquables de MM. Villiers, Cobden, Bright, etc.
[Note by FB]
À partir de cette époque, la Ligue s’est consacrée surtout à donner de nouveaux développements à son action. On peut partager sa carrière en trois grandes époques. Dans la première, elle s’était occupée de s’organiser, de fixer son but, de tracer sa marche, de réunir dans son sein un grand nombre d’économistes éclairés. Dans la seconde, elle s’adressa à l’opinion publique. Nous venons de la voir, multipliant les meetings dans toutes les provinces, envoyant de toutes parts des brochures, des journaux, des professeurs, essayant enfin de vaincre la résistance du Parlement par la pression d’une opinion nationale forte et éclairée. À l’époque où nous sommes parvenus, nous allons la voir donner à ses travaux une direction plus pratique, et aspirer à modifier profondément, dans son personnel, la constitution de la Chambre des communes. Pour cela, il s’agissait de mettre en œuvre la loi électorale et de tirer tout le parti possible des réformes introduites par les Whigs dans la législation.
Ce n’est pas que la Ligue fût restée étrangère jusque-là aux luttes électorales. Déjà elle avait essayé ses forces sur ce terrain. Rarement elle avait manqué l’occasion de mettre, dans chaque bourg, un candidat free-trader aux prises avec un candidat monopoleur. Partout on l’avait vue élever drapeau contre drapeau et principe contre principe. Elle consacrait une partie de son royal budget à poursuivre devant les tribunaux la corruption électorale, et l’on se rappelle qu’elle fit passer, à Londres même, un free-trader, M. Pattison, quoiqu’il eût pour concurrent un des hommes les plus riches et les plus haut placés de cette métropole, le banquier Baring, soutenu d’ailleurs par toutes les influences réunies des aristocraties terrienne, commerciale, ecclésiastique et gouvernementale.
Mais la Ligue n’apportait guère alors aux élections que son influence morale et n’opérait qu’avec les éléments existants. Nous allons la voir essayer de changer ces éléments eux-mêmes, et de remettre la puissance élective aux mains des classes aisées et laborieuses.
Des comités s’organisent sur toute la surface du Royaume-Uni. Ils ont pour mission de faire porter sur les listes électorales tout free-trader qui remplit les conditions exigées par la loi, et d’en faire rayer tout monopoleur qui n’a pas le droit d’y figurer. Des milliers de procès sont soutenus à la fois devant l’autorité compétente, et avec tant de succès, qu’on peut déjà prévoie qu’au sein de beaucoup de collèges la majorité sera déplacée.
Mais M. Cobden, cet homme éminent qui est l’âme de la Ligue, et qui la dirige, à travers mille obstacles, d’une manière si habile et si ferme, conçoit un plan bien autrement gigantesque.
En France, pour être électeur, il faut payer 200 fr. d’impôts directs. La loi anglaise ne procède point avec cette uniformité. Une multitude de positions diverses peuvent donner le droit de voter. Parmi les dispositions de la loi, il en est une, appelée la clause Chandos, selon laquelle est électeur quiconque a une propriété libre (freehold), donnant 40 sh. de revenu net, c’est-à-dire pouvant s’acquérir moyennant un capital de 50 à 60 l. s.
Le plan de M. Cobden consiste à faire arriver au droit électoral, par le moyen de cette clause, un nombre suffisant d’hommes indépendants pour contre-balancer la masse d’électeurs dont l’aristocratie anglaise dispose, comme d’une dépendance et appartenance de ses vastes domaines.
Dans l’espace de quarante jours, M. Cobden s’est présenté devant trente-cinq meetings, principalement dans les comtés de Lancastre, d’York, de Chester, afin de divulguer et de populariser son projet. La variété qu’il a su répandre sur tant de discours, fondés sur le même thème et tendant au même but, révèle une puissance de facultés et une étendue de connaissances qu’on est heureux de voir associées à la vertu la plus pure et au caractère le plus élevé. Son collègue, M. Bright, n’a pas déployé moins de zèle, de talent et d’énergie.
On n’attend pas de nous que nous suivions pas à pas la Ligue dans cette nouvelle phase de l’agitation. Nous nous bornerons dorénavant à recueillir, dans les innombrables documents que nous avons sous les yeux, les arguments qui pourront nous paraître nouveaux et les circonstances propres à jeter quelque jour sur l’esprit de la Ligue et les mœurs anglaises.
FN: Lorsque deux membres d’opinion différente ont besoin de s’absenter, ils s’entendent et sortent ensemble sans altérer le résultat du vote.
Séance du 7 août 1844.↩
[Note by FB]
Nous voici arrivés à l’époque où les relations entre la France et l’Angleterre, et par suite la paix du monde, paraissaient gravement compromises. La presse, des deux côtés du détroit, et malheureusement dans des vues peu honorables, s’efforçait de réveiller tous les vieux instincts de haine nationale. On dit que, dans la salle d’Exeter-Hall, des missionnaires fanatiques faisaient entendre des paroles irritantes peu en harmonie avec le caractère dont ils sont revêtus. Sir Robert Peel enfin, peut-être dominé par le déchaînement des passions ardentes du dehors, venait de prononcer devant le Parlement les paroles impolitiques et imprudentes qui rendaient si difficile l’arrangement des affaires de Taïti.
Jusqu’à ce moment, pas une allusion n’avait été faite au sein des meetings de la Ligue sur les rapports de la France avec l’Angleterre. Cette circonstance nous semble mériter toute l’attention du lecteur impartial ; car enfin, les occasions n’avaient pas manqué ; l’affaire d’Alger, celle du Maroc, celle du droit de visite, l’hostilité de nos tarifs, manifestée par des droits différentiels mis à la charge des produits anglais, et bien d’autres circonstances offraient aux orateurs de la Ligue un texte facile à exploiter, dans l’intérêt de leur popularité, un instrument fécond pour arracher des applaudissements à la multitude. Comment se fait-il que ces hommes, parlant tous les jours en présence de cinq à six mille personnes réunies, et dans les circonstances où il leur était si facile de ménager à leur amour-propre d’orateur toutes les ovations de l’enthousiasme politique, se soient constamment abstenus de céder à cette si séduisante tentation ? Comment des manufacturiers, des négociants, des fermiers se sont-ils montrés à cet égard si supérieurs à des missionnaires, à des journalistes, et même aux hommes d’État les plus haut placés ?
Il n’y a qu’une circonstance qui puisse expliquer raisonnablement ce phénomène, et cette circonstance est si importante, qu’il doit m’être permis de la révéler au public français. — C’est que la Ligue s’adresse à la classe industrieuse et laborieuse, et que cette classe, en Angleterre, n’est point animée des sentiments haineux contre la France que nos journaux, par des motifs expliqués ailleurs, lui attribuent avec tant d’obstination. — J’ai lu plus de trois cents discours prononcés par les orateurs de la Ligue dans toutes les villes importantes de la Grande-Bretagne. J’ai lu un nombre immense de brochures, de pamphlets populaires, de journaux émanés de cette puissante association, et j’affirme sur l’honneur que je n’y ai jamais vu un mot blessant pour notre dignité nationale, ni une allusion directe ou indirecte à l’état de nos relations politiques avec l’Angleterre.
C’est que, dans ce pays, les classes industrieuses ont vraiment l’esprit d’industrie qui est opposé à l’esprit militaire. C’est que les haines nationales, grâce aux progrès de l’opinion, leur sont devenues aussi étrangères que le sont maintenant parmi nous les haines de ville à ville et de province à province.
Cependant, au moment où la paix du monde était sérieusement menacée, il était difficile que l’émotion générale ne se fît pas aussi sentir parmi ces multitudes assemblées à Covent-Garden, ou dans le free-trade-hall de Manchester. On verra, dans les discours qui suivent, à quel point de vue les graves événements du mois d’août 1844 étaient envisagés par les membres de la Ligue.
7 août 1844.
Le dernier meeting de la Ligue, pour cette saison, a eu lieu mercredi soir au théâtre de Covent-Garden. Une affluence extraordinaire de free-traders remplissait toutes les parties du vaste édifice. Pendant toute la séance, les dames, par leurs physionomies animées et leurs applaudissements réitérés, ont montré qu’elles prennent un vif intérêt au sort des classes souffrantes et opprimées. — M. G. Wilson occupait le fauteuil. Un grand nombre de membres du Parlement et d’hommes distingués avaient pris place autour de lui sur l’estrade.
Le président, en ouvrant la séance, annonce que la parole sera prise successivement par M. Milner Gibson, m. P., par M. Richard Cobden, m. P., en remplacement de M. George Thompson, absent, et par M. Fox.
M. Gibson : Monsieur, j’ai eu le bonheur d’assister à un grand nombre de meetings de la Ligue, mais jamais une aussi magnifique assemblée que celle qui est en ce moment réunie dans ces murs n’avait encore frappé mes regards, et j’ajoute, monsieur, que cette marque signalée de l’approbation publique, à ce dernier meeting d’adieu, est pour nous un juste sujet d’espérance et de félicitation. À l’aspect d’une assemblée aussi imposante, il est impossible de croire qu’une cause rétrograde, d’imaginer qu’une question a perdu du terrain dans l’esprit et l’estime du peuple. (Applaudissements.)
… Je crois sincèrement que tout homme impartial qui jettera les yeux autour de lui, et qui se demandera quels sont les premiers besoins sociaux, quelles sont les nécessités qui se manifestent en première ligne non-seulement dans les possessions britanniques, mais dans la plus grande partie de l’Europe, reconnaîtra que ces besoins et ces nécessités se lient intimement à la souffrance physique. Il reconnaîtra que toute grande amélioration sociale ne peut venir qu’après l’amélioration matérielle de la condition du peuple. On montre un grand désir d’instruire le peuple ; on se plaint de son ignorance ; on se plaint de ce qu’il manque d’éducation morale. Mais que sert de vouloir faire germer la vertu parmi des hommes courbés sous la misère, flétris par une pénurie désespérante et qui ne sont point en état de recevoir les leçons du prêtre ou du moraliste ? Croyez-le bien, si nous voulons que la vertu, la science, la religion, prennent racine dans le cœur de l’homme laborieux, commençons par améliorer sa condition physique. Nous devons arracher l’ouvrier des campagnes à l’état d’abaissement où il est maintenant placé. En vain nous cherchons à restreindre l’immoralité, à diminuer le crime dans le pays, tant que la classe laborieuse, en levant les yeux sur ceux qui occupent des positions plus élevées dans l’échelle sociale, se sentira d’une autre caste, pour ainsi dire, et se croira rejetée comme une superfétation inutile, aussi peu digne, moins digne d’égards peut-être que la nature animale engraissée sur les domaines de l’aristocratie.
L’orateur rappelle ici qu’ayant voulu parler à la Chambre des communes de la situation de l’ouvrier des campagnes, et s’étant étayé de l’autorité d’un ministre du culte dont le nom est vénéré dans tout le royaume, M. Godolphin Osborn, le ministre secrétaire d’État pour le département de l’intérieur, avait parlé de prélats courant après la popularité.
Je voudrais de tout mon cœur, continue M. Gibson, voir beaucoup de nos prêtres et même de nos évoques condescendre à une telle conduite. Je me rappelle un célèbre écrivain qui disait qu’une très-utile association pourrait être fondée, et dans le fait cette institution manque à l’Angleterre, dans le but de convertir l’épiscopat au christianisme. (Applaudissements prolongés.) J’ai la certitude absolue que la liberté du commerce est en parfaite harmonie avec l’esprit de l’Évangile, et que la libre communication des peuples est le moyen le plus efficace de répandre la foi et la civilisation sur toute la surface de la terre. Je ne pense pas que les efforts des missionnaires, quels que soient leurs bonnes intentions et leur mérite, puissent obtenir un succès complet tant que les gouvernements sépareront les nations par des barrières artificielles, sous forme de tarifs hostiles, et leur inculqueront, au lieu de sentiments fraternels fondés sur des intérêts réciproques, des sentiments de jalousie si prompts à éclater en vaste incendie. (Bruyantes acclamations.) C’est une chose surprenante que l’excessive délicatesse, en matière d’honneur national, qui s’est tout à coup révélée parmi nos grands seigneurs trafiquants de céréales. On croirait voir des coursiers entraînés pour le turf. (Rires.) Mais qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, pour ces messieurs, guerre est synonyme de rentes. (Approbation et rires.) J’ignore s’ils aperçoivent aussi clairement que je le fais la liaison de ces deux idées. La première conséquence de la guerre, c’est la cherté du blé ; la seconde, c’est un accroissement d’influence ministérielle, dont une bonne part revient toujours à nos seigneurs terriens. Quelque lourdes que soient les charges, quelque lamentables que soient les maux que la guerre infligerait à la communauté, tenez pour certain que, s’il est possible qu’elle profite à une classe, ce sera à la classe aristocratique. Je crois très-consciencieusement qu’il y a dans ce pays un grand parti lié avec l’intérêt territorial, parti représenté par le Morning-Post (rires), qui s’efforce de susciter un sentiment antifrançais (an anti-french-feeling), dans l’unique but de maintenir le monopole des grains. (Rires.) Qu’est-ce que la guerre pour ces messieurs ? Ils s’en tiennent bien loin. (Rires.) Ils envoient leurs compatriotes au champ du carnage, et, quant à eux, ils profitent de l’interruption du commerce pour tenir à haut prix la subsistance du peuple ; et quand revient la paix, ils se font un titre de cette cherté même, pour continuer et renforcer la protection. Nous avons vu tout cela dans la dernière guerre. (Applaudissements.)
Une autre de leurs raisons pour pousser à la guerre, c’est qu’ils y voient un moyen de détourner l’attention publique de ces grands mouvements sociaux qui les mettent maintenant si mal à l’aise. « Une bonne guerre, disent-ils, c’est une excellente diversion. » Il y a très-peu de jours, un homme distingué, dont je ne me crois pas autorisé à proclamer le nom dans cette enceinte, me disait : Quoi qu’on en ait dit sur les maux de la guerre, quoi qu’en aient écrit les moralistes et les philosophes, je crois que ce pays a besoin d’une bonne guerre, et qu’elle nous délivrerait de bien des difficultés. (Rires bruyants.) — C’est la vieille doctrine. Bien heureusement, il ne sera pas en leur pouvoir de pousser le peuple de ce pays vers ces folles exhibitions d’un faux patriotisme. Il y a dans la nation britannique un bon sens, un esprit de justice, qui, depuis les terribles luttes du commencement de ce siècle, ont jeté de profondes racines ; et il sera difficile de lui persuader de se lancer dans toutes les horreurs de la guerre pour le seul avantage de gorger notre riche aristocratie aux dépens de la communauté. (Applaudissements prolongés.)
[Note by FB]
Qu’il nous soit permis de faire une remarque sur ce passage du discours de M. Gibson. Ne pourrait-il pas être très-à propos prononcé devant une assemblée française ?
C’est une chose surprenante (dirait-on) que l’excessive délicatesse, en matière d’honneur national, qui s’est tout à coup révélée parmi nos trafiquants de fer et de houille. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que pour ces messieurs guerre est synonyme de cherté ; entente cordiale est synonyme de commerce, d’échanges, de concurrence à redouter. Je crois très-consciencieusement qu’il y a, dans ce pays, un grand parti lié avec l’intérêt manufacturier, parti représenté par la Presse et le journal du Commerce, qui s’efforce de susciter un sentiment anti-anglais, dans l’unique but de maintenir le haut prix des draps, des toiles, de la houille et du fer, etc., etc.
Après cette courte observation, nous reprenons le compte rendu de la séance du 7 août, et nous consignons ici notre regret de ne pouvoir traduire le remarquable discours de M. Cobden. Nous nous bornerons, forcé que nous sommes de nous restreindre, à citer quelques passages de l’allocution de M. Fox, et particulièrement la péroraison qui se lie au sujet traité par le représentant de Manchester.
M. Fox. L’orateur, prenant texte d’un article du Morning-Post qui annonce pour la vingtième fois que la Ligue est morte après avoir totalement échoué dans sa mission, passe en revue le passé de cette institution, et montre l’influence qu’elle a exercée sur l’administration des Whigs et ensuite sur celle des Torys, influence à laquelle il faut attribuer les modifications récemment introduites dans la législation commerciale de la Grande-Bretagne. Il parle ensuite du progrès qu’elle a fait faire à l’opinion publique.
On peut dire de l’économie politique ce qu’on disait de la philosophie, elle est descendue des nuages et a pénétré dans la demeure des mortels ; elle se mêle à toutes leurs pensées et fait le sujet de tous leurs entretiens. C’est ainsi que la Ligue a propagé dans le pays une sagacité politique qui finira par bannir de ce monde les préjugés, les sophismes et les faussetés par lesquels le genre humain s’est laissé si longtemps égarer. Nous touchons presque au temps où deux grands hommes d’État, Pitt et Fox, remplissaient l’univers de leurs luttes ; et l’on ne saurait encore décider lequel des deux était le plus profondément ignorant des doctrines économiques. Et maintenant, il n’y a pas un dandy, un incroyable, qui se présente devant les électeurs d’un bourg-pourri, pour y recueillir un mandat de famille, qui ne se soit gorgé d’Adam Smith, au moins dans l’édition de M. Cayley[1]. (Rires.) Quand un peuple a acquis de telles lumières, on ne se joue plus de lui. C’est pour la Ligue un sujet de juste orgueil d’avoir disséminé dans le pays, non-seulement des connaissances positives et de bonnes habitudes intellectuelles, mais encore un véritable esprit d’indépendance morale. Partout où je trouve une disposition à secouer cette servilité abjecte qui a si longtemps pesé sur une portion du peuple de ce pays ; partout où je le vois donner aux choses leurs vrais noms, quels que soient les fallacieux synonymes dont on les décore ; quand je vois le faible et le fort, le pauvre et le riche, le paysan et le pair d’Angleterre, tous également jugés selon les règles du juste et de l’injuste ; quand je rencontre une ferme volonté de rendre témoignage aux principes de l’équité et de la justice, en même temps qu’une profonde sympathie pour les souffrances des classes malheureuses et opprimées, alors je reconnais l’influence de la Ligue ; je la vois se répandre dans toutes les classes de la société, j’adhère à cette ferme détermination de faire régner le bien, de détruire le mal par des moyens paisibles, légaux, mais honorables et sûrs, dont les fondateurs de cette grande institution ont eu la gloire de faire adopter l’usage par leurs concitoyens. (Applaudissements.) Je sais que ces grands et nobles résultats n’ont pas atteint les limites auxquelles aspirent les hommes de cœur qui dirigent la Ligue. Nous en avons le témoignage par des faits irrécusables, que nous ne nions pas et qu’au contraire nous regardons loyalement en face. Ils nous sont d’ailleurs rappelés surabondamment par certains journaux. « Voyez, disent-ils, dans combien d’élections la Ligue a échoué, dans combien elle n’a pas osé accepter le combat ! Elle a été battue dans le Sud-Lancastre et à Birmingham. » — Il est vrai que nous n’avons pu soutenir la lutte à Hortham, Cirencester et ailleurs. Qu’est-ce à dire ? Je ne m’en afflige pas. Il est bien que dans une cause comme celle-ci — qui intéresse une multitude de personnes étrangères aux agitations politiques et aux rudes travaux qui peuvent seuls assurer le succès d’une grande réforme sociale — il est bien qu’on ne se laisse point dominer par cette idée, qu’il suffit d’instruire le peuple de ce qui est juste et vrai, pour que le vrai et le juste triomphent d’eux-mêmes. Car, si ces élections eussent amené d’autres résultats, quel enseignement en aurions-nous obtenu ? Quel effet auraient-elles produit sur le grand nombre de ceux qui, pour la première fois, s’unissant à la Ligue, se sont précipités dans le tumulte de l’agitation ? Ils n’auraient pas manqué de penser que les électeurs sont libres dans leur opinion et dans leur action, que l’intimidation, la corruption et les menées de sinistres intérêts n’interviennent pas pour pervertir la conscience des votants, et les vaincre en dépit de leurs idées et de leurs sentiments ; et cet enseignement eût été un mensonge. Ils en auraient conclu encore que le monopole, loin de songer à faire des efforts vigoureux et désespérés, loin d’avoir recours aux armes les plus déloyales, n’attend pour abandonner la lutte que de voir la vanité et l’injustice de ses prétentions bien comprises par le public ; — et cet enseignement aussi eût été un mensonge. — Ces faciles triomphes eussent fait croire que l’esprit de parti est vaincu ; qu’il a appris la sagesse et la droiture ; et que, dans le vain but de soutenir quelque point de sectairianisme politique, l’opposition ne se laisserait pas vaincre en se divisant alors qu’elle peut être victorieuse par l’unité ; — et cet enseignement aussi eût été un mensonge. — Ils eussent encore suggéré cette idée que les combinaisons législatives actuelles sont plus que suffisantes pour protéger aux élections les droits et les intérêts du peuple ; que nos institutions et notre mécanisme politique ont toute la perfection qu’on peut imaginer et désirer ; — et cet enseignement aussi eût été un mensonge, — un grossier mensonge. — Dans mon opinion, subir quelques défaites partielles, quelques désastres momentanés, quelques retards dans le dénoûment de cette grande lutte, ce n’est pas acheter trop cher les bonnes habitudes, l’expérience et la discipline que ces revers mêmes font pénétrer dans l’esprit de la multitude, la préparant à travailler avec constance et avec succès à la défense des intérêts de la communauté. À ceux qui font de ces défaites électorales un sujet de mépris envers nous, et d’orgueil pour eux-mêmes, je dirai : Vous vous jouez avec ce qui vous suscitera une puissance antagonique, une force à laquelle rien ne pourra résister. Ces mêmes défaites nous apprennent l’art d’agiter. Elles nous ont instruits, elles nous instruiront bien plus encore jusqu’au jour où la communauté s’apercevra qu’en croyant ne diriger son énergie que sur un seul point et ne poursuivre que le triomphe d’un seul principe, la Ligue a jeté les fondements de tout ce qui constitue la dignité, la grandeur et la prospérité nationales. (Applaudissements.)
Il est une autre chose que la Ligue a accomplie, et c’était un objet bien digne de ses efforts. Elle a démasqué les classes privilégiées ! (Écoutez ! écoutez !) Leurs traits sont maintenant connus de tous, et il n’est plus en leur pouvoir de se déguiser. Le temps n’est pas éloigné où régnait une sorte de mystification à l’égard des pairs et des hommes de haut parage, comme si le sang qui coule dans leurs veines était d’une autre nature que celui qui fait battre le cœur du peuple. Il a fallu que les principes de la liberté commerciale fussent soumis à cette discussion serrée, continuelle et animée qu’ils sont condamnés à subir, pour qu’on reconnût la vraie portée de ces associations féodales ; pour qu’on s’assurât que ces grands hommes sont aussi bien des marchands que s’ils ouvraient boutique à Cheapside ; et que ces écussons, regardés jusqu’ici comme les emblèmes d’une dignité quasi royale, ne sont autre chose que des enseignes où l’on peut lire : Acres à louer, blés à vendre. (Applaudissements.) Oui, ce sont des marchands ; ce sont tous des marchands. Ils trafiquent de terres aussi bien que de blés. Ils trafiquent des aliments, depuis le pain de l’homme jusqu’à la graine légère qui nourrit l’oiseau prisonnier dans sa cage. (Rires.) Ils trafiquent de poissons, de faisans, de gibier ; ils trafiquent de terrains pour les courses de chevaux ; ils y perdent même l’argent qu’ils y parient et font ensuite des lois au Parlement pour être dispensés de payer leurs dettes. (Applaudissements.) Ils trafiquent d’étoiles, de jarretières, de rubans — spécialement de rubans bleus — et, ce qui est le pis de tout, ils trafiquent des lois par lesquelles ils rendent leur négoce plus lucratif. Ils poussent des clameurs contre le petit boutiquier qui instruit son apprenti dans l’art de « tondre la pratique », tandis qu’ils font bien pis, eux nobles législateurs, car ils tondent la nation, et surtout, ils tondent court et ras l’indigent affamé La Ligue a montré les classes privilégiées sous un autre jour, en stimulant leurs vertus, en provoquant leur philanthropie. Oh ! combien elles étalent de charité, pourvu que la loi-céréale s’en échappe saine et sauve ! Des plans pour l’amélioration de la condition du peuple sont en grande faveur, et chaque section politique présente le sien.
L’orateur énumère ici et critique un grand nombre de projets tous aspirant à réparer par la charité les maux faits par l’injustice, tels que le système des allotments (V. p. 39), le bill des dix heures, les sociétés pour l’encouragement de toiles ou telles industries, etc. — Il continue et termine ainsi :
Si notre cause s’élève contre le monopole, elle est encore plus opposée à une guerre qui prendrait pour prétexte l’intérêt national. J’espère que les sages avertissements qui sont sortis de la bouche de l’honorable représentant de Manchester (M. Gibson) pénétreront dans vos esprits et dans vos cœurs ; car, quand nous voyons à quels moyens le monopole a recours, il n’y a rien de chimérique à redouter que, par un machiavélisme monstrueux, il ne s’efforce, dans un sordide intérêt, de plonger la nation dans toutes les calamités de la guerre. Si nous étions menacés d’une telle éventualité, j’ai la confiance que le peuple de ce pays se lèverait comme un seul homme pour protester contre tout appel à ces moyens sanguinaires qui devront être relégués à jamais dans les annales des temps barbares. Cette agitation doit se maintenir et progresser, parce qu’elle se fonde sur une vue complète des vrais intérêts nationaux et sur les principes de la morale. Oui, nous soulevons une question morale. Laissons à nos adversaires les avantages dont ils s’enorgueillissent. Ils possèdent de vastes domaines, une influence incontestable ; ils sont maîtres de la Chambre des lords, de la Chambre des communes, d’une grande partie de la presse périodique et du secret des lettres (applaudissements) ; à eux encore le patronage de l’armée et de la marine, et la prépondérance de l’Église. Voilà leurs priviléges, et la longue énumération ne nous en effraye pas, car nous avons contre eux ce qui est plus fort que toutes ces choses réunies : le sentiment du juste gravé au cœur de l’homme. (Acclamations.) C’est une puissance dont ils ne savent pas se servir, mais qui nous fera triompher d’eux ; c’est une puissance plus ancienne que leurs races les plus antiques, que leurs châteaux et leurs cathédrales, que l’Église et que l’État ; aussi ancienne, que dis-je ? plus ancienne que la création même, car elle existait avant que les montagnes fussent nées, avant que la terre reposât sur ses fondements ; elle habitait avec la sagesse dans l’esprit de l’Éternel. Elle fut soufflée sur la face de l’homme avec le premier souffle de vie, et elle ne périra pas en lui tant que sa race n’aura pas compté tous ses jours sur cette terre. Il est aussi vain de lutter contre elle que contre les étoiles du firmament. Elle verra, bien plus, elle opérera la destruction de tout ce qu’il y a d’injustice au fond de foutes les institutions politiques et sociales. Oh ! puisse la Providence consommer bientôt sur le genre humain cette sainte bénédiction ! (Applaudissements prolongés.)
Après une courte allocution dans laquelle le président, au nom de la Ligue, adresse aux habitants de la métropole des remercîments et des adieux, la session de 1844 est close et l’assemblée se sépare.
FN: M. Cayley avait cité des extraits d’Adam Smith qu’il avait rendus, en les falsifiant, favorables au système protecteur.
Les free-traders et les chartistes à northampton↩
Dans un des passages du discours précédent, M. Fox avait fait allusion à un meeting tenu, deux jours avant, à Northampton. Le but de cette publication étant de jeter quelque jour sur les mœurs politiques de nos voisins, et de montrer, en action, l’immense liberté d’association dont ils ont le bonheur de jouir, nous croyons devoir dire un mot de ce meeting.
les free-traders et les chartistes à northampton.
Lundi 5 juin 1844, un important meeting a eu lieu dans le comté et dans la ville de Northampton.
Quelques jours d’avance, un grand nombre de manufacturiers, de fermiers, de négociants et d’ouvriers avaient présenté une requête à MM. Cobden et Bright, pour les prier d’assister au meeting et d’y discuter la question de la liberté commerciale. Ces messieurs acceptèrent l’invitation.
Une autre requête avait été présentée, par les partisans du régime protecteur, à M. O’Brien, représentant du comté, et membre de la Société centrale pour la protection agricole. M. O’Brien déclina l’invitation, se fondant sur ce que les requérants étaient bien en état de se former une opinion par eux-mêmes, sans appeler des étrangers à leur aide.
Enfin, les chartistes de Northampton avaient, de leur côté, réclamé l’assistance de M. Fergus O’Connor qui, dans leur pensée, devait s’unir à M. O’Brien pour combattre M. Cobden. M. Fergus O’Connor avait promis son concours.
Le square dans lequel se tenait le meeting contenait plus de 6,000 personnes. Les free-traders proposèrent pour président lord Fitz Williams, maire, mais les chartistes exigèrent que le fauteuil fût occupé par M. Grandy, ce qui fut accepté.
M. Cobden soumet à l’assemblée la résolution suivante :
« Que les lois-céréales et toutes les lois qui restreignent le commerce dans le but de protéger certaines classes sont injustes et doivent être abrogées. »
M. Fergus O’Gonnor propose un amendement fort étendu qu’on peut résumer ainsi :
« Les habitants de Northampton sont d’avis que toutes modifications aux lois-céréales, toutes réformes commerciales, doivent être ajournées jusqu’à ce que la charte du peuple soit devenue la base de la constitution britannique. »
De nombreux orateurs se sont fait entendre. Le président ayant consulté l’assemblée, la résolution de M. Cobden a été adoptée à une grande majorité.
Démonstration en faveur de la liberté commerciale à walsall↩
[Note by FB]
Un autre trait caractéristique des mœurs politiques que la liberté paraît avoir pour tendance de développer, c’est l’affranchissement de la femme, et son intervention, du moins comme juge, dans les grandes questions sociales. Nous croyons que la femme a su prendre le rôle le mieux approprié à la nature de ses facultés, dans une réunion dont, par ce motif, nous croyons devoir analyser succinctement le procès-verbal.
démonstration en faveur de la liberté commerciale à walsall. Présentation d’une coupe à M. John B. Smith.
En 1841, la lutte s’établit entre le monopole et la liberté aux élections de Walsall. M. Smith était le candidat des free-traders, et l’influence de la corruption, portée à ses dernières limites, assura aux monopoleurs un triomphe momentané. L’énergie et la loyauté, qui présidèrent à la conduite de M. Smith dans cette circonstance, lui concilièrent l’estime et l’affection de toutes les classes de la société, et les dames de Walsall résolurent de lui en donner un témoignage public. Elles formèrent entre elles une souscription dont le produit a été consacré à faire ciseler une magnifique coupe d’argent. Mercredi soir (11 septembre 1844), une soirée a eu lieu dans de vastes salons, décorés avec goût, et où était réunie la plus brillante assemblée. M. Robert Scott occupait le fauteuil.
Après le thé, M. le président se lève pour proposer la santé de la reine. « Dans une assemblée, dit-il, embellie par la présence d’un si grand nombre de dames, il serait inconvenant de ne pas commencer par payer un juste tribut de respect à notre gracieuse et bien-aimée souveraine. C’est une des gloires de l’Angleterre de s’être soumise à la domination de la femme, et ce n’est pas un des traits les moins surprenants de son histoire, que la nation ait joui de plus de bonheur et de prospérité, sous l’empire de ses souveraines, que n’ont pu lui en procurer les règnes des plus grands hommes, etc. »
Après un discours de M. Walker, en réponse à ce toast, le président arrive à l’objet de la réunion. Il rappelle qu’en 1841, un appel fut fait aux habitants de Walsall pour poser aux électeurs la question de la liberté commerciale. C’était la première fois que cette grande cause subissait l’épreuve électorale. Nous avions alors un candidat whig qui n’allait pas, sur cette matière, jusqu’à l’affranchissement absolu des échanges. Il sentit la nécessité de se retirer, et le champ restait libre aux manœuvres du candidat conservateur. Un grand nombre d’électeurs lui promirent imprudemment leurs votes, sans considérer que la loi leur a confié un dépôt sacré dont ils ne sont pas libres de disposer à leur avantage, mais dont ils doivent compte à ceux qui ne jouissent pas du même privilége. Vous vous rappelez l’anxiété qui régna alors parmi les free-traders, et les difficultés qu’ils rencontrèrent à trouver un candidat à qui l’on pût confier la défense du grand principe que nous posions devant le corps électoral. C’est dans ce moment qu’un homme d’une position élevée, d’un noble caractère et d’un grand talent, M. Smith (applaudissements), accepta sans hésiter la candidature et entreprit de relever ce bourg de la longue servitude à laquelle il était accoutumé. M. Smith était alors président de la chambre de commerce de Manchester, président de la Ligue. Sur notre demande, il vint à Walsall et dirigea la lutte avec une vigueur et une loyauté qui lui valurent, non-seulement l’estime de ses amis, mais encore l’approbation de ses adversaires. L’Angleterre et l’Irlande s’intéressaient au succès de ce grand débat, où les plus chers intérêts du pays étaient engagés. Grâce à des influences que vous n’avez pas oubliées, nous fûmes vaincus cependant, mais non sans avoir réduit la majorité de nos adversaires dans une telle proportion qu’il ne leur reste plus aucune chance pour l’avenir. Les dames de Walsall, profondément reconnaissantes des services éminents rendus par M. Smith à la cause de la pureté électorale non moins qu’à celle de la liberté, résolurent de lui donner un témoignage public de leur estime. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, et ne veux point retarder les opérations qui sont l’objet principal de cette réunion.
Mme Cox se lève, et s’adressant à M. Smith, elle dit : « J’ai l’honneur de vous présenter cette coupe, au nom des dames de Walsall. »
M. Smith reçoit ce magnifique ouvrage d’orfèvrerie, d’un travail exquis, qui porte l’inscription suivante :
« Présenté à M, J. B. Smith, esq.
« Par les dames de Walsall, comme un témoignage de leur estime et de leur gratitude, pour le courage et le patriotisme avec lesquels il a soutenu la lutte électorale de 1841, dans ce bourg, contre un candidat monopoleur, — pour l’indépendance de sa conduite et l’urbanité de ses manières, — pour ses infatigables efforts dans la défense des droits du travail contre les intérêts égoïstes et la domination usurpée d’une classe.
Puisse-t-il vivre assez pour jouir de la récompense de ses travaux et voir la vérité triompher et la patrie heureuse ! »
M. Smith remercie et prononce un discours que le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas de rapporter.
[Note by FB]
Le but que nous nous sommes proposé était de faire connaître la Ligue, ses principaux chefs, les doctrines qu’elle soutient, les arguments par lesquels elle combat le monopole ; nous ne pouvions songer à initier le lecteur dans tous les détails des opérations de cette grande association. Il est pourtant certain que les efforts persévérants, mais silencieux, par lesquels elle essaye de rénover, non-seulement l’esprit, mais encore le personnel du corps électoral, ont peut-être une importance plus pratique que la partie apparente et populaire de ses travaux.
Sans vouloir changer notre plan et attirer l’attention du lecteur sur les travaux électoraux de la Ligue, ce qui exigerait de sa part l’étude approfondie d’un système électif beaucoup plus compliqué que le nôtre, nous croyons cependant ne pouvoir terminer sans dire quelques mots et rapporter quelques discours relatifs à cette phase de l’agitation.
Nous avons vu précédemment qu’il y a en Angleterre deux classes de députés, et, par conséquent, d’électeurs. — 158 membres du Parlement sont nommés par les comtés, et tous sont dévoués au monopole. — Jusqu’à la fin de 1844, les free-traders n’avaient en vue que d’obtenir, sur les députés des bourgs, une majorité suffisante pour contre-balancer l’influence de ce corps compacte de 158 protectionnistes. — Pour cela, il s’agissait de faire inscrire sur les listes électorales autant de free-traders, et d’en éliminer autant de créatures de l’aristocratie que possible. Un comité de la Ligue a été chargé et s’est acquitté pendant plusieurs années de ce pénible et difficile travail, qui a exigé une multitude innombrable de procès devant les cours compétentes (courts of registration), et le résultat a été d’assurer aux principes de la Ligue une majorité certaine dans un grand nombre de villes et de bourgs.
Mais, à la fin de 1844, M. Cobden conçut l’idée de porter la lutte jusque dans les comtés. Son plan consistait à mettre à profit ce qu’on nomme la clause Chandos, qui confère le droit d’élire, au comté, à quiconque possède une propriété immobilière donnant un revenu net de 40 schellings. De même que l’aristocratie avait, en 1841, mis un grand nombre de ses créatures en possession du droit électoral par l’action de cette clause, il s’agissait de déterminer les classes manufacturières et commerciales à en faire autant, en investissant les ouvriers des mêmes franchises, et en les transformant en propriétaires, en landlords au petit pied. — Le temps pressait, car on était au mois de décembre 1844, quand M. Cobden soumit son plan au conseil de la Ligue, et on n’avait que jusqu’au 31 janvier 1845, pour se faire inscrire sur les listes électorales qui doivent servir en cas de dissolution jusqu’en 1847.
Aussitôt le plan arrêté, la Ligue le mit à exécution avec celte activité prodigieuse qui ne lui a jamais fait défaut, et que nous avons peine à croire, tant elle est loin de nos idées et de nos mœurs politiques. Dans l’espace de dix semaines, M. Cobden a assisté à trente-cinq grands meetings publics, tenus dans les divers comtés du nord de l’Angleterre dans le seul but de propager cette nouvelle croisade électorale. — Nous nous bornerons à donner ici la relation d’un de ces meetings, celui de Londres, qui ouvre d’ailleurs la troisième année de l’agitation dans la métropole.
Grand meeting de la ligue au théatre de covent-garden. 11 décembre 1844.↩
Six mille personnes assistent à la réunion. Le président de la Ligue, M. George Wilson, occupe le fauteuil.
En ouvrant la séance, après quelques observations générales, le président ajoute :
Vous avez peut-être entendu dire que depuis notre dernier meeting la Ligue avait « pris sa retraite ». Mais soyez assurés qu’elle n’a pas perdu son temps dans les cours d’enregistrement (registration courts). Nous avons envoyé des hommes expérimentés dans 140 bourgs, dans le but d’organiser des comités électoraux là où il n’en existe pas, et de donner une bonne direction aux efforts des free-traders là où il existe de semblables institutions. Depuis, les cours de révision ont été ouvertes. C’est là que la lutte a été sérieuse. Je n’ai pas encore les rapports relatifs à la totalité de ces 140 bourgs, mais seulement à 108 d’entre eux. Dans 98 bourgs nous avons introduit sur les listes électorales plus de free-traders que nos adversaires n’y ont fait admettre de monopoleurs ; et d’un autre côté nous avons fait rayer de ces listes un grand nombre de nos ennemis. Dans 8 bourgs seulement la balance nous a été défavorable, sans mettre cependant notre majorité en péril. (Applaudissements.)
Le président entre ici dans des détails de chiffres inutiles à reproduire ; il expose ensuite les moyens de conquérir une majorité dans les comtés.
M. Villiers, m. P., prononce un discours. La parole est ensuite à M. Cobden. Nous extrayons du discours de l’honorable membre les passages qui nous ont paru d’un intérêt général.
M. Cobden… Les monopoleurs ont fait circuler à profusion une brochure adressée aux ouvriers, qui porte pour épigraphe une sentence qui a pour elle l’autorité républicaine, celle de M. Henry Clay. Je suis bien aise qu’ils aient inscrit son nom et cité ses paroles sur le frontispice de cette œuvre, car les ouvriers n’oublieront pas que, depuis sa publication, M. Henry Clay a été repoussé de la présidence des États-Unis. Il demandait cet honneur à trois millions de citoyens libres, et il fondait ses droits sur ce qu’il est l’auteur et le père du système protecteur en Amérique. J’ai suivi avec une vive anxiété les progrès de cette lutte, et reçu des dépêches par tous les paquebots. J’ai lu le compte rendu de leurs discours et de leurs processions. Vraiment les harangues de Clay et de Webster auraient fait honneur aux ducs de Richmond et de Buckingham eux-mêmes. (Rires.) Leurs bannières portaient toutes des devises, telles que celles-ci : « Protection au travail national. » « Protection contre le travail non rémunéré d’Europe. » « Défense de l’industrie du pays. » « Défense du système américain. » « Henry Clay et protection. » (Rires.) Voilà ce qu’on disait à la démocratie américaine, comme vous le dit votre aristocratie dans ce même pamphlet. Et qu’a répondu le peuple américain ? Il a rejeté Henry Clay ; il l’a rendu à la vie privée. (Applaudissements.) Je crois que nos sociétés prohibitionnistes, s’il leur reste encore un grand dépôt de cette brochure, pourront l’offrir à bon marché. (Rires.) Elles seront toujours bonnes à allumer des cigares. (Nouveaux rires.)…
Eh bien ! habitants de Londres ! Qu’y a-t-il de nouveau parmi vous ? Vous avez su quelque chose de ce que nous avons fait dans le Nord ; que se passe-t-il par ici ? Je crois que j’ai aperçu quelques signes, sinon d’opposition, du moins de ce que j’appelle des tentatives de diversion. Vous avez eu de grands meetings, remplis de beaux projets pour le soulagement du peuple. Mon ami M. Villiers vous a parlé du grand développement de l’esprit, charitable parmi les monopoleurs et de leur manie de tout arranger par l’aumône. En admettant que cette charité soit bien sincère et qu’elle dépasse celle des autres classes, j’ai de graves objections à opposer à un système qui fait dépendre une portion de la communauté des aumônes de l’autre portion. (Écoutez ! écoutez !) Mais je nie cette philanthropie elle-même, et, relevant l’accusation qu’ils dirigent contre nous, — froids économistes, — je dis que c’est parmi les free-traders que se trouve la vraie philanthropie. Ils ont tenu un grand meeting, il y a deux mois, dans le Suffolk. Beaucoup de seigneurs, de nobles, de squires, de prêtres se sont réunis, et pourquoi ? Pour remédier, par un projet philanthropique, à la détresse générale. Ils ont ouvert une souscription. Ils se sont inscrits séance tenante ; et qu’est-il arrivé depuis ? Où sont les effets de cette œuvre qui devait fermer toutes les plaies ? J’oserais affirmer qu’il est tel ligueur de Manchester qui a plus donné pour établir dans celle ville des lieux de récréation pour les ouvriers, qu’il n’a été recueilli parmi toute la noblesse de Suffolk pour le soulagement des ouvriers des campagnes. Ne vous méprenez pas, messieurs, nous ne venons pas ici faire parade de générosité, mais décrier ces accusations sans cesse dirigées contre le corps le plus intelligent de la classe moyenne de ce pays, et cela parce qu’il veut se faire une idée scientifique et éclairée de la vraie mission d’un bon gouvernement. Ils nous appellent « économistes politiques ; durs et secs utilitaires ». Je réponds que les « économistes » ont la vraie charité et sont les plus sincères amis du peuple. Ces messieurs veulent absolument que le peuple vive d’aumônes ; je les somme de nous donner au moins une garantie qu’en ce cas le peuple ne sera pas affamé. Oh ! il est fort commode à eux de flétrir, par une dénomination odieuse, une politique qui scrute leurs procédés. (Rires.) Nous nous reconnaissons « économistes », et nous le sommes, parce que nous ne voulons pas voir le peuple se fier, pour sa subsistance, aux aumônes de l’aristocratie, sachant fort bien que, s’il le fait, sa condition sera vraiment désespérée. (Applaudissements.) Nous voulons que le gouvernement agisse sur des principes qui permettent à chacun de pourvoir à son existence par un travail honnête et indépendant. Ces grands messieurs ont tenu un autre meeting aujourd’hui. On y a traité de toutes sortes de sujets, excepté du sujet essentiel. (Écoutez !) Une réunion a eu lieu ce matin à Exeter-Hall, où il y avait des gens de toute espèce, et dans quel but ? Afin d’imaginer des moyens et de fonder une société pour « l’assainissement des villes. » (Rires.) Ils vous donneront de la ventilation, de l’air, de l’eau, des dessèchements, des promenades, de tout, excepté du pain. (Applaudissements.) Cependant, du moins en ce qui concerne le Lancashire, nous avons les registres généraux de la mortalité qui montrent distinctement le nombre des décès s’élevant et s’abaissant d’année en année, avec le prix du blé, et vous pouvez suivre cette connexité a vec autant de certitude que si elle résultait d’une enquête du coroner. Il y a eu trois mille morts de plus dans les années de cherté que depuis que le blé est descendu à un prix naturel, et cela dans un très-petit district du Lancastre. Et ces messieurs, dans leurs sociétés de bienveillance, parlent d’eau, d’air, de tout, excepté du pain qui est le soutien et comme l’étoffe de la vie ! Je ne m’oppose pas à des œuvres de charité ; je les appuie de toute mon âme ; mais je dis : Soyons justes d’abord, ensuite nous serons charitables. (Applaudissements.) Je ne doute nullement de la pureté des motifs qui dirigent ces messieurs ; je ne les accuserai point ici d’hypocrisie, mais je leur dirai : « Répondez à la question, ne l’escamotez pas. »
Je me plains particulièrement d’une partie de l’aristocratie[1], qui affiche sans cesse des prétentions à une charité sans égale, dont, sans doute par ce motif, les lois-céréales froissent la conscience, et qui les maintient cependant, sans les discuter et même sans vouloir formuler son opinion. Je fais surtout allusion à un noble seigneur qui en a agi ainsi l’année dernière, à l’occasion de la motion de M. Villiers, quoique, en toutes circonstances, il fasse profession d’une grande sympathie pour les souffrances du peuple. Il ne prit pas part à la discussion, n’assista pas même aux débats, et ne vint pas moins au dernier moment voter contre la motion. (Grands cris : Honte ! honte ! le nom ! le nom !) Je vous dirai le nom ; c’est lord Ashley. (Murmures et sifflets.) Eh bien, je dis : Admettons la pureté de leurs motifs, mais stipulons au moins qu’ils discuteront la question et qu’ils l’examineront avec le même soin qu’ils donnent « aux approvisionnements d’eau et aux renouvellements de l’air. » Ne permettons pas qu’ils ferment les yeux sur ce sujet. Comment se conduisent-ils en ce qui concerne la ventilation ? Ils appellent à leur aide les hommes de science. Ils s’adressent au docteur Southwood-Smith, et lui disent : Comment faut-il s’y prendre pour que le peuple respire un bon air ? Eh bien ! quand il s’agit de donner au peuple du travail et des aliments, nous les sommons d’interroger aussi les hommes de science, les hommes qui ont passé leur vie à étudier ce sujet, et qui ont consigné dans leurs écrits des opinions reconnues pour vraies dans tout le monde éclairé. Comme ils appellent dans leurs conseils Soutwood-Smith, nous leur demandons d’y appeler aussi Adam Smith, et nous les sommons ou de réfuter ses principes ou d’y conformer leurs votes. (Applaudissements.) Il ne suffit pas de se tordre les bras, de s’essuyer les yeux et de s’imaginer que dans ce siècle intelligent et éclairé le sentimentalisme peut être de mise au sénat. Que dirions-nous de ces messieurs qui gémissent sur les souffrances du peuple, si, pour des fléaux d’une autre nature, ils refusaient de prendre conseil de la science, de l’observation, de l’expérience ? S’ils entraient dans un hôpital, par exemple, et si, à l’aspect des douleurs et des gémissements dont leurs sens seraient frappés, ces grands philanthropes mettaient à la porte les médecins et les pharmaciens, et tournant au ciel leurs yeux attendris, ils se mettaient à traiter et médicamenter à leur façon ? (Rires et applaudissements.) J’aime ces meetings de Covent-Garden, et je vous dirai pourquoi. Nous exerçons ici une sorte de police intellectuelle. Byron a dit que nous étions dans un siècle d’affectation ; il n’y a rien de plus difficile à saisir que l’affectation. Mais je crois que si quelque chose a contribué à élever le niveau moral de cette métropole, ce sont ces grandes réunions et les discussions qui ont lieu dans cette enceinte. (Acclamations.) Il va y avoir un autre meeting ce soir dans le but d’offrir à sir Henry Pottinger un don patriotique. Je veux vous en dire quelques mots. Et d’abord, qu’a fait sir Henry Pottinger pour ces monopoleurs? — Je parle de ces marchands et millionnaires monopoleurs, y compris la maison Baring et Cie, qui a souscrit pour 50 liv. st. à Liverpool, et souscrira sans doute à Londres. Je le demande, qu’a fait M. Pottinger pour provoquer cette détermination des princes-marchands de la Cité ? Je vous le dirai. Il est allé en Chine, et il a arraché au gouvernement de ce pays, pour son bien sans doute, un tarif. Mais de quelle espèce est ce tarif ? Il est fondé sur trois principes. Le premier, c’est qu’il n’y aura aucun droit d’aucune espèce sur les céréales et toutes sortes d’aliments importés dans le Céleste Empire. (Écoutez ! Écoutez !) Bien plus, si un bâtiment arrive chargé d’aliments, non-seulement la marchandise ne paye aucun droit, mais le navire lui-même est exempt de tous droits d’ancrage, de port, etc., et c’est la seule exception de cette nature qui existe au monde. Le second principe, c’est qu’il n’y aura aucun droit pour la protection. (Écoutez !) Le troisième, c’est qu’il y aura des droits modérés pour le revenu. (Écoutez ! écoutez !) Eh quoi ! c’est pour obtenir un semblable tarif, que nous, membres de la Ligue, combattons depuis cinq ans ! La différence qu’il y a entre sir Henry Pottinger et nous, la voici : c’est que pendant qu’il a réussi à conférer, par la force, un tarif aussi avantageux au peuple chinois, nous avons échoué jusqu’ici dans nos efforts pour obtenir de l’aristocratie, par la raison, un bien- fait semblable en faveur du peuple anglais. (Applaudissements.) Il y a encore cette différence : c’est que, en même temps que ces marchands monopoleurs préparent une splendide réception à sir Henry Pottinger pour ses succès en Chine, ils déversent sur nous l’invective, l’insulte et la calomnie, parce que nous poursuivons ici, et inutilement jusqu’à ce jour, un succès de même nature. Et pourquoi n’avons-nous pas réussi ? Parce que nous avons rencontré sur notre chemin la résistance et l’opposition de ces mêmes hommes inconséquents, qui vont maintenant saluant de leurs toasts et de leurs hurrahs la liberté du commerce… en Chine. (Applaudissements.) Je leur adresserai à ce sujet une ou deux questions. Ces messieurs pensent-ils que le tarif que M. Pottinger a obtenu des Chinois sera avantageux pour ce peuple ? À en juger parce qu’on leur entend répéter en toute occasion, ils ne peuvent réellement pas le croire. Ils disent que les aliments à bon marché et la libre importation du blé seraient préjudiciables à la classe ouvrière et abaisseraient le taux des salaires. Qu’ils répondent catégoriquement. Pensent-ils que le tarif sera avantageux aux Chinois ? S’ils le pensent, quelle inconséquence n’est-ce pas de refuser le même bienfait à leurs concitoyens et à leurs frères ! S’ils ne le pensent pas, s’ils supposent que le tarif aura pour les Chinois tous ces effets funestes qu’un semblable tarif aurait, à ce qu’ils disent, pour l’Angleterre, alors ils ne sont pas chrétiens, car ils font aux Chinois ce qu’ils ne voudraient pas qu’on fît à eux-mêmes. (Bruyantes acclamations.) Je les laisse entre les cornes de ce dilemme et entièrement maîtres de choisir.
Il y a quelque chose de sophistique et d’erroné à représenter, comme on le fait, le tarif chinois comme un traité de commerce. Ce n’est point un traité de commerce. Sir Henry Pottinger a imposé ce tarif au gouvernement chinois, non en notre faveur, mais en faveur du monde entier. (Écoutez ! écoutez !) Et que nous disent les monopoleurs ? « Nous n’avons pas d’objection contre la liberté commerciale, si vous obtenez la réciprocité des autres pays. » Et les voilà, à cette heure même, nous pourrions presque entendre d’ici leur « hip, hip, hip, hurrah ! hurrah ! » les voilà saluant et glorifiant sir Henry Pottinger pour avoir donné aux Chinois un tarif sans réciprocité avec aucune nation sur la surface de la terre ! (Écoutez !) Après cela pensez-vous que sir Thomas Baring osera se présenter encore devant Londres ? (Rires et cris : Non ! non !) Lorsqu’il manqua son élection l’année dernière, il disait que vous étiez une race ignorante. Je vous donnerai un mot d’avis au cas qu’il se représente. Demandez-lui s’il est préparé adonner à l’Angleterre un tarif aussi libéral que celui que sir Henry Pottinger a donné à la Chine, et sinon, qu’il vous explique les motifs qui l’ont déterminé à souscrire pour cette pièce d’orfèvrerie qu’on présente à M. Pottinger. Nous ne manquons pas, à Manchester même, de monopoleurs de cette force qui ont souscrit aussi à ce don patriotique. On fait toujours les choses en grand dans cette ville, et pendant que vous avez recueilli ici mille livres sterling dans cet objet, ils ont levé là-bas trois mille livres, presque tout parmi les monopoleurs qui ne sont ni les plus éclairés, ni les plus riches, ni les plus généreux de notre classe, quoiqu’ils aient cette prétention. Ils se sont joints à cette démonstration en faveur de sir Henry Pottinger. J’ai été invité aussi à souscrire. Voici ma réponse : Je tiens sir Henry Pottinger pour un très-digne homme, supérieur à tous égards à beaucoup de ceux qui lui préparent ce splendide accueil. Je ne doute nullement qu’il n’ait rendu d’excellents services au peuple chinois ; et si ce peuple peut envoyer un sir Henry Pottinger en Angleterre, si ce Pottinger chinois réussit par la force de la raison (car nous n’admettons pas ici l’intervention des armes), si, dis-je, par la puissance de la logique, à supposer que la logique chinoise ait une telle puissance (rires), il arrache au cœur de fer de notre aristocratie monopoliste le même tarif pour l’Angleterre que notre général a donné à la Chine, j’entrerai de tout mon cœur dans une souscription pour offrir à ce diplomate chinois une pièce d’orfèvrerie. (Rires et acclamations prolongés.) Mais, gentlemen, il faut en venir à parler d’affaires. Notre digne président vous a dit quelque chose de nos derniers travaux. Quelques-uns de nos pointilleux amis, et il n’en manque pas de cette espèce, — gens d’un tempérament bilieux et enclins à la critique, qui, ne voulant ni agir par eux-mêmes, ni aider les autres dans l’action, de peur d’être rangés dans le servum pecus, n’ont autre chose à faire qu’à s’asseoir et à blâmer, — ces hommes vont répétant : « Voici un nouveau mouvement de la Ligue ; elle attaque les landlords jusque dans les comtés; elle a changé sa tactique. » Mais non, nous n’avons rien changé, rien modifié ; nous avons développé. Je suis convaincu que chaque pas que nous avons fait était nécessaire pour élever l’agitation là où nous la voyons aujourd’hui. (Écoutez !) Nous avons commencé par enseigner, par distribuer des pamphlets, afin de créer une opinion publique éclairée. Cela nous a tenu nécessairement deux ou trois ans. Nous avons ensuite porté nos opérations dans les collèges électoraux des bourgs ; et jamais, à aucune époque, autant d’attention systématique, autant d’argent, autant de travaux n’avaient été consacrés à dépouiller, surveiller, rectifier les listes électorales des bourgs d’Angleterre. Quant à l’enseignement par la parole, nous le continuons encore ; seulement, au lieu de nous faire entendre dans quelque étroit salon d’un troisième étage, comme il le fallait bien à l’origine, nous nous adressons à de magnifiques assemblées telles que celle qui est devant moi. Nous distribuons encore nos pamphlets, mais sous une autre forme : nous avons notre organe, le journal la Ligue, dont vingt mille exemplaires se distribuent dans le pays, chaque semaine. Je ne doute pas que ce journal ne pénètre dans toutes les paroisses du royaume, et ne circule dans toute l’étendue de chaque district. Maintenant, nous allons plus loin, et nous avons la confiance d’aller troubler les monopoleurs jusque dans leurs comtés. (Applaudissements.) La première objection qu’on fait à ce plan, c’est que c’est un jeu à la portée des deux partis, et que les monopoleurs peuvent adopter la même marche que nous. J’ai déjà répondu à cela en disant que nous sommes dans cette heureuse situation de nous asseoir devant un tapis vert où tout l’enjeu appartient à nos adversaires et où nous n’avons rien à perdre. (Écoutez !) Il y a longtemps qu’ils jouent et ils ont gagné tous les comtés. Mon ami M. Villiers n’a eu l’appui d’aucun comté la dernière fois qu’il a porté sa motion à la Chambre. Il y a là 152 députés des comtés, et je crois que si M. Villiers voulait prouver clairement qu’il peut obtenir la majorité, sans en détacher quelques-uns, il y perdrait son arithmétique. Nous allons donc essayer de lui en donner un certain nombre.
Ici l’orateur passe en revue les diverses clauses de la loi électorale et indique, pour chaque position, les moyens d’acquérir le droit de suffrage soit dans les bourgs, soit dans les comtés. Nous n’avons pas cru devoir reproduire ces détails qui ne pourraient intéresser qu’un bien petit nombre de lecteurs.
… Les monopoleurs ont des yeux de lynx pour découvrir les moyens d’atteindre leur but. Ils dénichèrent dans le bill de réforme la clause Chandos, et la mirent immédiatement en œuvre. Sous prétexte de faire inscrire leurs fermiers sur les listes électorales, ils y ont fait porter les fils, les neveux, les oncles, les frères de leurs fermiers, jusqu’à la troisième génération, jurant au besoin qu’ils étaient associés à la ferme, quoiqu’ils n’y fussent pas plus associés que vous. C’est ainsi qu’ils ont gagné les comtés. Mais il y a une autre clause dans le bill de réforme, que nous, hommes de travail et d’industrie, n’avions pas su découvrir ; celle qui confère le droit électoral au propriétaire d’un freehold de 40 shillings de revenu. J’élèverai cette clause contre la clause Chandos et nous les battrons dans les comtés mêmes. (Bruyantes acclamations.)…
… Il y a un très-grand nombre d’ouvriers qui parviennent à économiser 50 à 60 liv. sterl., et ils sont peut-être accoutumés à les déposer à la caisse d’épargne. Je suis bien éloigné de vouloir dire un seul mot qui tende à déprécier cette institution ; mais la propriété d’un cottage et de son enclos donne un intérêt double de celui qu’accorde la caisse d’épargne. Et puis, quelle satisfaction pour un ouvrier de croiser ses bras et de faire le tour de son petit domaine, disant : « Ceci est à moi, je l’ai acquis par mon travail ! » Parmi les pères dont les fils arrivent à l’âge de maturité, il y en a beaucoup qui sont enclins à les tenir en dehors des affaires et étrangers au gouvernement de la propriété. Mon opinion est que vous ne sauriez trop tôt montrer de la confiance en vos enfants et les familiariser avec la direction des affaires. Avez-vous un fils qui arrive à ses vingt et un ans ? Ce que vous avez de mieux à faire, si vous le pouvez, c’est de lui conférer un vote de comté. Cela l’accoutume à gérer une propriété et à exercer ses droits de citoyen, pendant que vous vivez encore, et que vous pouvez au besoin exercer votre paternel et judicieux contrôle. Je connais quelques pères qui disent : « Je mettrais mon fils en possession du droit électoral, mais je redoute les frais. » Je donnerai un avis au fils. Allez trouver votre père et offrez-lui de faire vous-même cette dépense. Si vous ne le voulez pas, et que votre père s’adresse à moi, je la ferai. (Applaudissements.) C’est ainsi que nous gagnerons Middlesex. Mais ce n’est pas tout que de vous faire inscrire. Il faut encore faire rayer ceux qui sont sans droit. On a dit que c’était une mauvaise tactique et qu’elle tendait à diminuer les franchises du peuple. Si nos adversaires consentaient à ce que les listes s’allongeassent de faux électeurs des deux côtés, nous pourrions ne pas faire d’objections. Mais s’ils scrutent nos droits sans que nous scrutions les leurs, il est certain que nous serons toujours battus…
… L’Écosse a les yeux sur vous. On dit dans ce pays-là : Oh ! si nous n’étions soumis qu’à ce cens de 40 shillings, nous serions bientôt maîtres de nos 12 comtés. L’Irlande aussi a les yeux sur vous. Son cens, comme en Écosse, est fixé à l0 liv. sterlings. — Quoi! l’Angleterre, l’opulente Angleterre, n’aurait qu’un cens nominal de 40 shillings, elle aurait une telle arme dans les mains, et elle ne battrait pas cette oligarchie inintelligente et incapable qui l’opprime ! Je ne le croirai jamais ! Nous élèverons nos voix dans tout le pays ; il n’est pas de si légère éminence dont nous ne nous ferons un piédestal pour crier : Aux listes ! aux listes! aux listes ! Inscrivez-vous, non-seulement dans l’intérêt de millions de travailleurs, mais encore dans celui de l’aristocratie elle-même ; car, si elle est abandonnée à son impéritie et à son ignorance, elle fera bientôt descendre l’Angleterre au niveau de l’Espagne et de la Sicile, et subira le sort de la grandesse castillane. Pour détourner de telles calamités, je répète donc : Aux listes ! aux listes ! aux listes ! (Tonnerre d’applaudissements.)
[Note by FB]
Nous terminerons ce choix ou plutôt ce recueil de discours (car nous pouvons dire avec vérité que le hasard nous a plus souvent guidé que le choix),[31]par le compte rendu du meeting tenu à Manchester le 22 janvier 1845, meeting où ont été rendus les comptes de l’exercice 1844, et qui clôt, par conséquent, la cinquième année de l’agitation. Encore, dans cette séance, nous nous bornerons à traduire le discours de M. Bright qui résume les travaux et la situation de la Ligue. M. Bright est certainement un des membres de la Ligue les plus zélés, les plus infatigables et en même temps les plus éloquents. La verve et la chaleur de Fox, le profond bon sens et le génie pratique de Cobden semblent tour à tour tributaires du genre d’éloquence de M. Bright. Ainsi que nous venons de le dire, au milieu des richesses oratoires qui étaient à notre disposition, nous avons dû nous fier au hasard et nous nous apercevons un peu tard qu’il nous a mal servi en ceci que notre recueil ne renferme presque aucun discours de M. Bright. Nous saisissons donc cette occasion de réparer envers nos lecteurs un oubli involontaire.
FN: L’orateur désigne ici le parti qui s’intitule « la jeune Angleterre, » et qui a pour chefs lord Ashley, Manners, d’Israeli, etc. Lord Ashley, cherchant à rejeter sur les manufacturiers les imputations que la Ligue dirige contre les maîtres du sol, attribue les souffrances du peuple à l’excès du travail. En conséquence, de même que M. Villiers propose chaque année la libre introduction du blé étranger, lord Ashley propose la limitation des heures de travail. L’un cherche le remède à la détresse générale dans la liberté, l’autre dans de nouvelles restrictions. — Ainsi, ces deux écoles économiques sont toujours et partout en présence.
Meeting général de la ligue à manchester. 22 janvier 1845.↩
Une première séance a lieu le matin. Elle a pour objet la reddition des comptes, au nom du conseil de la Ligue, aux membres de l’association. Les opérations de cette séance ne pourraient avoir qu’un faible intérêt pour le public français.
Le soir, une immense assemblée est réunie dans la grande salle de l’édifice élevé à Manchester par la Ligue. Plus de six cents des principaux membres de l’association sont sur la plate-forme. À 7 heures, M. Georges Wilson occupe le fauteuil. On ne peut pas estimer à moins de 10,000 le nombre des spectateurs présents à la réunion.
M. Hickin, secrétaire de la Ligue, présente le compte rendu des opérations pendant l’exercice de 1844. Nous nous bornerons à extraire de ce rapport les faits suivants.
En conformité du plan de la Ligue, l’Angleterre a été divisée en treize districts électoraux. Des agents éclairés, rompus dans la connaissance et la pratique des lois, ont été assignés à chaque district pour surveiller la formation des listes électorales, et en poursuivre la rectification devant les tribunaux.
L’opération a été exécutée dans 160 bourgs. La masse des informations ainsi obtenues permettra de donner à l’avenir aux efforts de la Ligue plus d’ensemble et d’efficacité. Jusqu’ici, on peut considérer que les free-traders ont eu l’avantage sur les monopoleurs dans 112 de ces bourgs, et, dans le plus grand nombre, cet avantage suffit pour assurer la nomination de candidats engagés dans la cause du libre-commerce.
Plus de 200 meetings ont été tenus en Angleterre et en Écosse, à ne parler que de ceux où ont assisté les députations de la Ligue.
Les professeurs de la Ligue ont ouvert des cours dans trente-six comtés sur quarante. Partout, et principalement dans les districts agricoles, on demande plus de professeurs que la Ligue n’en peut fournir.
Il a été distribué 2 millions de brochures, et 1,340,000 exemplaires du journal la Ligue. Les bureaux de l’association ont reçu un nombre immense de lettres et en ont expédié environ 300,000.
Ce n’est que dans ces derniers temps que la Ligue a dirigé son attention sur les listes électorales des comtés. En peu de jours, la balance en faveur des free-traders s’est accrue de 1,750 pour le Lancastre du nord, de 500 pour le Lancastre du sud et de 500 pour le Middlesex. Le mouvement se propage dans les comtés de Chester, d’York, etc.
3895. Les recettes de la Ligue se sont élevées à. 3896. 3897. 86,009 3898. 3899. liv. sterl. 3900.
3902. Les dépenses à… 3903. 3904. 59,333 3905. 3906.
3908. Balance en caisse… 3909. 3910. 26,676 3911.
L’annonce de ces faits (que, pressé par l’espace, nous nous bornons à extraire du rapport de M. Hickin), est accueillie par des applaudissements enthousiastes.
M. Bright. (Mouvement de satisfaction.) C’est, ce me semble, une chose convenable que le conseil de la Ligue vienne faire son rapport annuel à cette assemblée, dans cette salle et sur le lieu qu’elle occupe ; car cette assemblée est la représentation fidèle des multitudes qui, dans tout le pays, ont engagé leur influence dans la cause du libre-commerce. Cette salle est un temple élevé à l’indépendance, à la justice, en un mot aux principes du libre-commerce, et ce lieu est à jamais mémorable dans les fastes de la lutte du monopole et du libre-commerce ; car, à l’endroit même où je parle, il y a un quart de siècle, vos concitoyens furent attaqués par une soldatesque lâche et brutale, et l’on vit couler le sang d’hommes inoffensifs et de faibles femmes qui s’étaient réunis pour protester contre l’iniquité des lois-céréales. (Écoutez ! écoutez !) Deux choses qui se lient à ce sujet frappent mon esprit en ce moment. La première c’est que l’objet et la tendance de toutes les lois-céréales qui se sont succédé ont été les mêmes, à savoir : spolier les classes industrieuses par la famine artificielle ; enrichir les grands propriétaires du sol, ceux qui se disent la noblesse de la terre. (Bruyants applaudissements.) Lorsque la loi fut adoptée en 1815, elle avait pour objet de fixer le prix du froment à 80 sh. le quarter. Ce prix est maintenant à 40 sh. ou un peu plus de moitié. Or, nous sommes convaincus que 80 sh. c’est un prix de famine. C’était donc un prix de famine que la loi entendait rendre permanent. Il est vrai que, depuis cette époque, deux années seulement ont vu le blé à 80 sh. En 1817 et 1818, le prix de famine légale fut atteint, et ce furent deux années d’effroyable détresse, de mécontentement, où l’insurrection faillit éclater dans tous les districts populeux du royaume. Mais la loi entendait bien que le prix de famine fût maintenu, non point pendant deux ans, mais à toujours, aussi longtemps qu’elle existerait elle-même. Les vues de ses promoteurs leur objet avoué, n’avaient d’autre limite que celle-ci : approcher toujours du prix autant que cela sera compatible avec notre sécurité. (Buyantes acclamations.) Arracher à l’industrie tout ce qu’elle voudra se laisser arracher tranquillement. (Écoutez !) Ne craignez pas d’affamer quelques pauvres ; ils descendront prématurément dans la tombe, et leur voix ne se fera plus entendre au milieu des dissensions des partis et des luttes que suscite la soif de la puissance politique. (Nouvelles acclamations.) Oh ! cette loi est sans pitié ! et ses promoteurs furent sans pitié. — Nous avons eu des périodes où le pays était comparativement affranchi de sa détresse habituelle ; nous traversons maintenant un de ces courts intervalles ; mais si nous ne sommes point plongés dans la désolation, nous n’en devons aucune reconnaissance à la loi. Vous avez entendu dire et je le répète ici, qu’il y a une puissance, une puissance miséricordieuse qui, dans ses voies cachées, ne consulte pas les vues ignorantes et sordides des propriétaires du sol britannique ; c’est cette puissance infinie, qui voit au-dessous d’elle ces potentats qui siègent dans l’enceinte où s’élaborent les lois humaines, c’est cette puissance qui, déconcertant les projets des promoteurs de la loi-céréale, répand en ce moment sur le peuple d’Angleterre le bien-être et l’abondance. Nous apprenons quelquefois que l’esclave a fui loin du fouet et de la chaîne et qu’il a échappé à la sagacité de la meute lancée sur sa trace. Mais est-il jamais venu dans la pensée de personne de faire honneur de sa fuite et de sa sûreté à la clémence des maîtres ou à celle des dogues altérés de sang ? Est-il un homme qui osât dire que ce pays est redevable à la protection, à une clémence cachée au fond du système protecteur, s’il n’est point, à cette heure, accablé sous le poids du paupérisme, et si ses nobles et chères institutions ne sont pas menacées par la révolte de multitudes affamées ? La seconde chose que je veux rappeler, et qu’il ne faut pas perdre de vue un seul instant, c’est que cette loi a été imposée par la force militaire et par cette force seule (écoutez ! écoutez !), que, le jour où elle fut votée, on vit, dans cette terre de liberté, une garnison occuper l’enceinte législative ; que cette même police, cette même force armée, que nourrissent les contributions du peuple, fut employée à imposer, à river sur le front du peuple ce joug odieux, qui devait être à la fois et le signe de sa servitude et le tribut que lui coûte son propre asservissement. Dans nos villes, c’est encore la force, dans nos campagnes, c’est la fraude qui maintient cette loi. Le peuple ne l’a jamais demandée. On n’a jamais vu de pétitions au Parlement pour demander la disette. Jamais même le peuple n’a tacitement accepté une telle législation et, depuis l’heure fatale où elle fut promulguée, il n’a pas cessé un seul jour de protester contre son iniquité. Ce meeting ensanglanté, dont je parlais tout à l’heure, n’était qu’une protestation ; et depuis ce moment terrible jusqu’à celui où je parle, il s’est toujours rencontré des hommes, parmi les plus éclairés de cet empire et du monde, pour dénoncer l’infamie de ces lois. (Applaudissements.) La Ligue elle-même, qu’est-ce autre chose, sinon l’incarnation, pour ainsi dire, d’une opinion ancienne, d’un sentiment vivace dans le pays ? Nous n’avons fait que relever la question qui préoccupait profondément nos pères. Nous sommes mieux organisés, plus résolus peut-être, et c’est en cela seulement que cette agitation diffère de celle qui s’émut, il y a un quart de siècle, sur le lieu même où s’élève cette enceinte. — Nos adversaires nous demandent souvent ce qu’a fait la Ligue. Quand il s’agit d’une œuvre matérielle, de l’érection d’un vaste édifice, le progrès se montre de jour en jour, la pierre vient se placer sur la pierre jusqu’à ce que le noble monument soit achevé. Nous ne pouvons pas nous attendre à suivre de même, dans ses progrès, la destruction du système protecteur. Notre œuvre, les résultats de nos travaux, ne sont pas aussi visibles à l’œil extérieur. Nous aspirons à créer le sentiment public, à tourner le sentiment public contre ce système, et cela avec une puissance telle que la loi maudite en soit virtuellement abrogée, notre triomphe consommé, et que l’acte du Parlement, la sanction législative, ne soit que la reconnaissance, la formelle ratification de ce que l’opinion publique aura déjà décrété. (Applaudissements.)
Je repassais nos progrès dans mon esprit, et je me rappelais qu’en 1839 la Ligue leva une souscription de 5,000 liv. sterl. (125,000 fr.), ce fut alors regardé comme une chose sérieuse ; en 1840, une autre souscription eut lieu. En 1841, intervint ce meeting mémorable qui réunit dans cette ville sept cents ministres de la religion, délégués par autant de congrégations chrétiennes. Ces hommes, avec toute l’autorité que leur donnaient leur caractère et leur mission, dénoncèrent la loi-céréale comme une violation des droits de l’homme et de la volonté de Dieu. Oh ! ce fut un noble spectacle (applaudissements) ! et il n’a pas été assez apprécié ! Mais dans nos nombreuses pérégrinations à travers toutes les parties du royaume, nous avons retrouvé ces mêmes hommes ; nous avons vu qu’en se séparant à Manchester, ils sont allés répandre jusqu’aux extrémités de cette île les principes que ce grand meeting avait ravivés dans leur âme, organisant ainsi en faveur du libre-commerce de nombreux centres d’agitation, dont les résultats nous ont puissamment secondés.
En 1842, nous eûmes un bazar à Manchester qui réalisa 10,000 l. s., somme qui dépasse de plusieurs milliers de livres celles qui ont été jamais recueillies dans ce pays par des établissements analogues, quelque nobles que fussent leurs patrons et leurs dames patronesses. En 1843, nous levâmes une souscription de 50,000 l. s. (1,250,000 fr.) (Bruyantes acclamations.) En 1844, nous avons demandé 100,000 l. s. (2,500,000 f.) et vous venez d’entendre que 83,000 l. s. avaient déjà été reçues, quoique un des moyens les plus puissants qui devait concourir à cette œuvre ait été ajourné[1]. Mais que dirai-je de l’année 1845, dont le premier mois n’est pas encore écoulé ? Sachez donc que depuis trois mois, sur l’appel du conseil de la Ligue, aidé de nombreux meetings, auxquels la députation a assisté, les free-traders des comtés de Lancastre, d’York et de Chester ont certainement dépensé un quart de million sterling pour acquérir des votes dans les comtés que je viens de nommer. (Bruyantes acclamations.) Vous vous rappelez ce que disait le Times il y a moins d’un an, alors qu’un petit nombre de manufacturiers, objets de vains mépris, souscrivaient à Manchester et dans une seule séance 12,000 liv. sterl. (300,000 fr.) en faveur de la Ligue. On ne peut nier, disait-il, que ce ne soit « un grand fait. » Maintenant, je serais curieux de savoir ce qu’il dira de celui que je signale, savoir que, dans l’espace de trois mois, et à notre recommandation, plus de 200,000 liv. sterl., j’oserais dire 250,000 liv. sterl. (6,250,000 fr.) ont été consacrés à l’acquisition de propriétés dans le seul but d’augmenter l’influence électorale des free-traders dans trois comtés. (Applaudissements.) Je le demande à ce meeting, après cette succincte description de nos progrès, ce mouvement peut-il s’arrêter ? (Cris : Non, non, jamais !) Je le demande à ceux des monopoleurs qui ont quelque étincelle d’intelligence, et qui savent comment se résolvent dans ce pays les grandes questions publiques ; je demande aux ministres mêmes du gouvernement de la reine, s’ils pensent qu’il peut y avoir quelque repos pour ce cabinet ou tout autre qui serait appelé à lui succéder, tant que cette infâme loi-céréale déshonorera notre Code commercial. (Applaudissements et cris : Jamais !) Cette agitation naquit quand le commerce commença à décliner ; elle se renforça quand ses souffrances furent extrêmes ; elle traversa cette douloureuse époque, et elle marche encore, d’un pas plus ferme et plus audacieux, aujourd’hui que les jours de prospérité se sont de nouveau levés sur l’Angleterre. Quelle illusion, quelle misérable illusion n’est-ce pas que de voir dans ce retour de prospérité industrielle la chute de notre agitation ! Oh ! les hommes que nous combattons ne nous ont jamais compris. Ils ont cru que nous étions comme l’un d’eux, que nous étions mus par l’intérêt, la soif du pouvoir ou l’amour de la popularité. Mais quelle que soit la diversité de nos motifs, quelle que soit notre fragilité à tous, j’ose dire qu’il n’est pas un membre de la Ligue qui obéisse à d’aussi indignes inspirations. (Tonnerre d’applaudissements.) Ce mouvement est né d’une conviction profonde — conviction qui est devenue une foi — foi entière dès l’origine, et qu’a renforcée encore l’expérience des dernières années. Nous avons devant nous des preuves si extraordinaires, que si on me demandait des faits pour établir notre cause, je n’en voudrais pas d’autres que ceux que chaque année qui passe apporte à notre connaissance. (Écoutez ! écoutez !) Pendant cinq ans, de 1838 à 1842, le prix moyen du blé a été de 65 sh., — il est maintenant de 45 sh. — c’est 20 sh. de différence. Qu’en résulte-t-il ? (Écoutez !) Si nous consommons 20 millions de quarters de blé, nous épargnons 20 millions de livres dans l’achat de notre subsistance, comparativement aux années de cherté auxquelles je faisais allusion. — Alors les seigneurs dominaient, et abaissant leur grande éponge féodale (rires), ils puisaient 20 millions de livres dans l’industrie des classes laborieuses, sans leur en rendre un atome sous quelque forme que ce soit. (Applaudissements.) Maintenant, ces 20 millions circulent par des milliers de canaux, ils vont encourager toutes les industries, fertiliser toutes les provinces, et répandre en tous lieux le contentement et le bien-être. (Immenses acclamations.) On parlait dernièrement du bien que fait l’ouverture du marché chinois. Cela est vrai, mais combien est plus favorable l’ouverture de ce nouveau marché anglais. (Applaudissements.) Si vous considérez la totalité de nos exportations vers nos colonies, vous trouverez qu’elles se sont élevées, en 1842, à 13 millions. Les marchés réunis de l’Allemagne, la Hollande, la France, l’Italie, la Russie, la Belgique et le Brésil nous ont acheté pour 20,206,446 livres sterling. — Vous voyez bien que cette simple réduction de 20 sh. dans le prix du blé, nous a ouvert un débouché intérieur égal à celui que nous offrent toutes ces nations ensemble, et supérieur de moitié à celui que nous ont ouvert nos innombrables colonies répandues sur tous les points du globe. (Bruyantes acclamations.) Il est donc vrai que notre prospérité même nous fait une loi de continuer cette agitation. (Nouvelles acclamations.) Et en tout cas la détresse agricole nous en imposerait le devoir… La lutte dans laquelle nous sommes engagés est la lutte de l’industrie contre la spoliation seigneuriale. (Applaudissements.) Vous savez comment ils parlent de l’industrie. Vous savez ou vous devez savoir ce que le Standard a dit de cette province. « L’Angleterre serait aussi grande et chaque utile enfant de l’Angleterre aussi riche et heureux qu’ils le sont maintenant, alors même que toutes les villes et toutes les provinces manufacturières du royaume seraient englouties dans une ruine commune. » Oh ! ce fut là une malheureuse inspiration ! c’est là un horrible et diabolique sentiment ! mais il ne dépare pas la feuille où il a trouvé accès. On a bien des fois essayé depuis de lui donner une interprétation moins odieuse, et on avait raison ; car si ce sentiment doit être considéré comme l’expression réelle des idées de nos adversaires, il ne sera pas difficile de susciter dans toutes les classes industrieuses du pays un cri d’exécration contre une telle tyrannie, et de la balayer pour toujours de dessus la surface de l’empire. (Applaudissements.) C’est ici la lutte de l’honnête industrie contre l’oisiveté déshonnête. On a dit que quelques-uns des promoteurs de ce mouvement étaient filateurs ou imprimeurs sur étoffes. Nous l’avouons. Nous confessons que nous sommes coupables et que nos pères ont été coupables de vivre de travail. Nous n’avons pas de prétention à une haute naissance, ni même à de nobles manières. Si nos pères se sont courbés sur le métier, — et je ne nierai jamais que ce fut la destinée du mien (applaudissements), — nous n’en sommes pas moins nés sur le sol de l’Angleterre, et quel que soit le gouvernement qui dirige ses destinées, nous sommes pénétrés de cette forte conviction qu’il nous doit, comme aux plus riches et aux plus nobles de nos concitoyens, impartialité et justice. (Bruyantes acclamations.) Mais enfin l’industrie se relève, elle regarde autour d’elle, et ne perd pas de vue ceux qui l’ont jusqu’ici tenue courbée dans la poussière. L’industrie conquiert, sur les listes électorales, ses droits de franchise. Ce grand mouvement, cette dernière arme aux mains de la Ligue, fait et fera encore des miracles en faveur du travail et du commerce de ce pays. Lorsque je considère les effets qu’elle a déjà produits, l’enthousiasme qu’elle a excité, il me semble voir un champ de bataille : le monopole est d’un côté, et le libre-commerce de, l’autre ; la lutte a été longue et sanglante, les forces se balancent, la victoire est incertaine, lorsque une intelligence supérieure jette aux guerriers de la liberté une armure invulnérable et des traits d’une trempe si exquise que la résistance de leurs ennemis est devenue impossible. (Tonnerre d’applaudissements.) C’est une lutte solennelle, une lutte à mort, une lutte d’homme à homme, de principe à principe. Mais ne sentons-nous pas grandir notre courage quand nous venons à considérer le terrain déjà conquis et les dangers déjà surmontés ? (Acclamations.) Je vous le demande, hommes de Manchester, vous dont la postérité dira, à votre gloire éternelle, que dans vos murs fut fondé le berceau de la Ligue, je vous le demande, ne voulez-vous point vous montrer encore valeureux ? (Cris : Oui ! oui !) Je sens qu’à chaque pas le terrain se raffermit sous nos pieds ; que l’ennemi bat en retraite de toutes parts, et par tout ce que je vois, par tout ce que j’entends, par la présence de tant de nos concitoyens qui sont venus de tous les points de l’empire pour nous prêter assistance, je sens que nous approchons du terme de ce conflit ; et après les travaux, les périls et les sacrifices de la guerre, viendront enfin, comme une digne récompense, les douceurs d’une paix éternelle et dignement acquise. (À la fin du discours de M. Bright l’assemblée se lève en masse et les applaudissements retentissent longtemps dans la salle.)
[Note by FB]
Ainsi s’est close la sixième année de l’agitation. Nous devons ajouter que la motion annuelle de M. Villiers présentée cette année au Parlement dans la forme la plus absolue, puisqu’elle avait pour objet l’abrogation totale et immédiate de la loi-céréale, n’a été repoussée que par une majorité de 132 voix, majorité qui, on le voit, va s’affaiblissant d’année en année. Ainsi le moment approche où va s’accomplir, en Angleterre, la réforme radicale que la Ligue a en vue. Je laisse aux hommes d’État de mon pays le soin d’en calculer l’influence sur nos destinées industrielles, et particulièrement sur ces branches du travail national qui ne portent pas en elles-mêmes des éléments de vitalité. Si, d’un autre côté, le public apprend par ce livre quelle est la puissance de l’association, lorsqu’elle se renferme dans la défense d’un principe, et qu’elle commence par faire pénétrer, dans les esprits et dans les mœurs, la pensée qu’elle veut introduire dans les lois ; s’il reste convaincu que, dans les États représentatifs, l’association est à la fois l’utile complément et le frein nécessaire de la presse périodique, je croirai pouvoir répéter, après un orateur de la Ligue [32] : j’ai fait mon devoir, les événements appartiennent à Dieu !
Je termine en appelant l’attention du lecteur sur l’extrait suivant de l’interrogatoire de M. Deacon Hume, secrétaire du Board of trade.
FN: Le bazar de Londres qui a été tenu en mai 1815 et a produit plus de 25,000 liv, st. (625,000 fr.).
INTERROGATOIRE DE JACQUES DEACON HUME, ESQ.,↩
Ancien secrétaire du Board of trade
SUR LA LOI DES CÉRÉALES,
DEVANT LE COMITÉ DE LA CHAMBRE DES COMMUNES CHARGÉ DE PRÉPARER LE PROJET RELATIF AUX DROITS D’IMPORTATION POUR 1839.
« Je trouve que M. Deacon Hume, cet homme éminent dont nous déplorons tous la perte, établit que la consommation de ce pays est d’un quarter de froment par personne. »
Sir Robert Peel (séance du 9 février 1842).
Le Président : Pendant combien d’années avez-vous occupé des fonctions à la douane et au bureau du commerce ? — J’ai demeuré trente-huit ans dans la douane et ensuite onze ans au bureau du commerce.
Vous vous êtes retiré l’année dernière ? — Il n’y a que quelques mois.
M. Villiers : Qu’entendez-vous par le principe de la protection ? est-ce de soutenir un intérêt existant qui ne saurait se soutenir de lui-même ? — Oui ; elle ne peut servir de rien qu’à des industries qui sont naturellement en perte.
Et ces industries peuvent-elles se soutenir si la communauté peut se pourvoir ailleurs à meilleur marché ? — Non, certainement, si la protection leur était nécessaire.
La protection est donc toujours à la charge du consommateur ? — Cela est manifeste.
Avez-vous toujours pensé ainsi ? — J’ai toujours cru que l’augmentation du prix, conséquence de la protection, équivalait à une taxe. Si la loi me force à payer 1 sh. 6 d. une chose que sans elle j’aurais eue pour 1 sh., je regarde ces 6 d. comme une taxe, et je la paie à regret, parce qu’elle n’entre pas au trésor public, et que dès lors je n’ai pas ma part dans l’emploi que le Trésor en aurait fait. Il me faudra lui payer une seconde taxe.
Le Président : Ainsi, vous pensez que tout droit protecteur opère comme une taxe sur la communauté ? — Oui, très-décidément.
M. Villiers : Pensez-vous qu’il imprime aussi une fausse direction au travail et aux capitaux ? — Oui, il les attire dans une industrie par un appui factice, qui à la fin peut être trompeur. Je me suis souvent étonné que des hommes d’État aient osé assumer sur eux la responsabilité d’une telle politique.
Le Président : Les droits protecteurs et les monopoles soumettent-ils les industries privilégiées à des fluctuations ? — Je pense qu’une industrie qui est arrachée par la protection à son cours naturel est plus exposée qu’une autre à de grandes fluctuations.
M. Tufnell : Ainsi, vous croyez que, dans aucune circonstance, il n’est au pouvoir des droits protecteurs de conférer à la communauté un avantage général et permanent ? — Je ne le crois pas ; s’ils opèrent en faveur de l’industrie qu’on veut favoriser, ils pèsent toujours sur la communauté ; cette industrie reste en face du danger de ne pouvoir se soutenir par sa propre force, et la protection peut un jour être impuissante à la maintenir. La question est de savoir si l’on veut servir la nation ou un intérêt individuel.
M. Villiers : Avez-vous reconnu par expérience qu’une protection sert de prétexte pour en établir d’autres ? — Je crois que cela a toujours été l’argument des propriétaires fonciers. Ils ont, dans un grand nombre d’occasions, considéré la protection accordée aux manufactures comme une raison d’en accorder aux produits du sol
Plusieurs intérêts ne se font-ils pas un argument, pour réclamer la protection, de ce que la pesanteur des taxes et la cherté des moyens d’existence les empêchent de soutenir la concurrence étrangère ? — J’ai entendu faire ce raisonnement ; et non-seulement je le regarde comme mal fondé, mais je crois, de plus, que la vérité est dans la proposition contraire. Un peuple chargé d’impôts ne peut suffire à donner des protections ; un individu obligé à de grandes dépenses ne saurait faire des largesses.
Ne devons-nous pas conclure de là qu’il faut maintenir la protection à chaque industrie ou la retirer à toutes ? — Oui, je pense que la considération des taxes entraîne une protection universelle, jusqu’à ce qu’en voulant affranchir tout le monde de la taxe, on finit par n’en affranchir personne.
Le Président : Avez-vous connaissance que les pays étrangers, en s’imposant des droits d’entrée, ont été entraînés par l’exemple de l’Angleterre ? — Je crois que notre système a fortement impressionné tous les étrangers ; ils s’imaginent que nous nous sommes élevés à notre état présent de prospérité par le régime de la protection, et qu’il leur suffit d’adopter ce régime pour progresser comme nous.
Lorsque vous parlez de donner l’exemple à l’Europe, pensez-vous que, si l’Angleterre retirait toute protection aux étoffes de coton et autres objets manufacturés, cela pourrait conduire les autres peuples à adopter un système plus libéral, et, par conséquent, à recevoir une plus grande proportion de produits fabriqués anglais ? — Je crois que très-probablement cet effet serait obtenu, même par cet abandon partiel, de notre part, du régime protecteur ; mais j’ai la conviction la plus forte que si nous l’abandonnions en entier, il serait impossible aux autres nations de le maintenir chez elles.
Voulez-vous dire que nous devions abandonner la protection sans que l’étranger en fasse autant ? — Très-certainement, et sans même le lui demander. J’ai la plus entière confiance que, si nous renversions le régime protecteur, chacun des autres pays voudrait être le premier, ou du moins ne pas être le dernier, à venir profiter des avantages du commerce que nous leur aurions ouvert.
M. Villiers : Regardez-vous les représailles comme un dommage ajouté à celui que nous font les restrictions adoptées par les étrangers ? — Je les ai toujours considérées ainsi. Je répugne à tous traités en cette matière ; je voudrais acheter ce dont j’ai besoin, et laisser aux autres le soin d’apprécier la valeur de notre clientèle.
Le Président : Ainsi, vous voudriez appliquer ce principe à l’ensemble des relations commerciales de ce pays ? — Oui, d’une manière absolue ; je voudrais que nos lois fussent faites en considération de nos intérêts, qui sont certainement de laisser la plus grande liberté à l’introduction des marchandises étrangères, abandonnant aux autres le soin de profiter ou de ne pas profiter de cet avantage, selon qu’ils le jugeraient convenable. Il ne peut pas y avoir de doute que si nous retirions une quantité notable de marchandises d’un pays qui protégerait ses fabriques, les producteurs de ces marchandises éprouveraient bientôt la difficulté d’en opérer les retours ; et, au lieu de solliciter nous-mêmes ces gouvernements d’admettre nos produits, nos avocats, pour cette admission, seraient dans leur propre pays. Il surgirait là des industries qui donneraient lieu, chez nous, à des exportations.
M. Chapman : Êtes-vous d’opinion que l’Angleterre prospérerait davantage en l’absence de traités de commerce avec les autres nations ? — Je crois que nous établirions mieux notre commerce par nous-mêmes, sans nous efforcer de faire avec d’autres pays des arrangements particuliers. Nous leur faisons des propositions qu’ils n’acceptent pas ; après cela, nous éprouvons de la répugnance à faire ce par quoi nous aurions dû commencer. Je me fonde sur ce principe qu’il est impossible que nous importions trop ; que nous devons nous tenir pour assurés que l’exportation s’ensuivra d’une manière ou de l’autre ; et que la production des articles ainsi exportés ouvrira un emploi infiniment plus avantageux au travail national que celle qui aura succombé à la concurrence.
Le Président : Pensez-vous que les principes que vous venez d’exposer sont également applicables aux articles de subsistances dont la plupart sont exclus de notre marché ? — Si j’étais forcé de choisir, la nourriture est la dernière chose sur laquelle je voudrais mettre des droits protecteurs.
C’est donc la première chose que vous voudriez soustraire à la protection ? — Oui, il est évident que ce pays a besoin d’un grand supplément de produits agricoles qu’il ne faut pas mesurer par la quantité des céréales importées, puisque nous importons, en outre, et sur une grande échelle, d’autres produits agricoles qui peuvent croître sur notre sol ; cela prouve que notre puissance d’approvisionner le pays est restreinte, que nos besoins dépassent notre production ; et, dans ces circonstances, exclure les approvisionnements, c’est infliger à la nation des privations cruelles.
Vous pensez que les droits protecteurs agissent comme une taxe directe sur la communauté en élevant le prix des objets de consommation ? — Très-décidément. Je ne puis décomposer le prix que me coûte un objet que de la manière suivante : Une portion est le prix naturel ; l’autre portion est le droit ou la taxe, encore que ce droit passe de ma poche dans celle d’un particulier au lieu d’entrer dans le revenu public…
Vous avez souvent entendu établir que le peuple d’Angleterre, plus surchargé d’impôts que tout autre, ne pourrait soutenir la concurrence, en ce qui concerne le prix de la nourriture, si les droits protecteurs étaient abolis ? — J’ai entendu faire cet argument ; et il m’a toujours étonné, car il me semble que c’est précisément parce que le revenu public nous impose de lourdes taxes que nous ne devrions pas nous taxer encore les uns les autres.
Vous pensez que c’est là une déception? — La plus grande déception qu’on puisse concevoir, c’est l’antipode même d’une proposition vraie.
(Le reste de cette enquête roule sur des effets particuliers de la loi des céréales et a moins d’intérêt pour un lecteur français. Je me bornerai à en extraire encore quelques passages d’une portée plus générale.)
Vous considérez qu’il importe peu au consommateur de surpayer sa nourriture sous forme d’une taxe pour le Trésor ou sous forme d’une taxe de protection ? — La cause de l’élévation de prix ne change rien à l’effet. Je suppose qu’au lieu de protéger la terre par un droit sur les grains étrangers, le pays fût libre de se pourvoir au meilleur marché et qu’une contribution fût imposée dans le but spécial de favoriser la terre. L’injustice serait trop palpable ; on ne s’y soumettrait pas. Je conçois pourtant que l’effet du régime actuel est absolument le même pour le consommateur ; et s’il y a quelque chose à dire, la prime vaudrait mieux, serait plus économique que la protection actuelle, parce qu’elle laisserait au commerce sa liberté.
En supposant qu’une taxe fût imposée sur le grain au moment de la mouture, elle pèserait sur tout le monde ; ne pensez-vous pas qu’elle donnerait un revenu considérable ? — Elle donnerait selon le taux. Le peuple en souffrirait-il moins que des droits protecteurs actuels ? — Elle serait moins nuisible. Un grand revenu pourrait-il être levé par ce moyen ? — Oui, sans que le peuple payât le pain plus cher qu’aujourd’hui.
Quoi ! le Trésor pourrait gagner un revenu, et le peuple avoir du pain à meilleur marché ? — Oui, parce que ce serait une taxe et non un obstacle au commerce.
J’entends dans mes questions une parfaite liberté de commerce et une taxe à la mouture ? — Oui, un droit intérieur et l’importation libre.
La communauté ne serait pas aussi foulée qu’à présent, et l’État prélèverait un grand revenu ? — Je suis convaincu que si le droit imposé à la mouture équivalait à ce que le public paye pour la protection, non-seulement le revenu public gagnerait un large subside, mais encore cela serait moins dommageable à la nation.
Vous voulez dire moins dommageable au commerce ? — Certainement, et même alors que la taxe serait calculée de manière à maintenir le pain au prix actuel, malgré la libre importation du froment.
Le Président : Avez-vous jamais calculé ce que coûte au pays le monopole des céréales et de la viande ? — Je crois qu’on peut connaître très-approximativement le taux de cette charge. On estime que chaque personne consomme, en moyenne, un quarter de blé. On peut porter à 10 sh. ce que la protection ajoute au prix naturel. Vous ne pouvez pas porter à moins du double, ou 20 sh., l’augmentation que la protection ajoute au prix de la viande, orge pour faire la bière, avoine pour les chevaux, foin, beurre et fromage. Cela monte à 36 millions de livres sterling par an ; et, en fait, le peuple paye cette somme de sa poche tout aussi infailliblement que si elle allait au Trésor sous forme de taxes.
Par conséquent, il a plus de peine à payer les contributions qu’exige le revenu public ? — Sans doute ; ayant payé des taxes personnelles, il est moins en état de payer des taxes nationales.
N’en résulte-t-il pas encore la souffrance, la restriction de l’industrie de notre pays ? — Je crois même que vous touchez là à l’effet le plus pernicieux. Il est moins accessible au calcul, mais si la nation jouissait du commerce que lui procurerait, selon moi, l’abolition de toutes ces protections, je crois qu’elle pourrait supporter aisément un accroissement d’impôts de 30 sh. par habitant.
Ainsi, d’après vous, le poids du système protecteur excède celui des contributions ? — Je le crois, en tenant compte de ses effets directs et de ses conséquences indirectes, plus difficiles, à apprécier.
Fin de la première campagne de la Ligue anglaise]]" />
Appendice↩
Fin de la première campagne de la Ligue anglaise 437 ↩
Le triomphe que Bastiat prédisait aux ligueurs, dans les pages qui précèdent, ne se fit pas longtemps attendre ; mais tout ne fut pas consommé, pour lui, le jour où il vit les lois céréales abolies et la Ligue dissoute. Du principe qui venait enfin de prévaloir dans la législation anglaise devaient découler bien d’autres légitimes conséquences. Et si dorénavant les souscriptions, les prédications, les immenses meetings devenaient des armes inutiles, s’il n’était plus besoin de la force du nombre, c’est que la puissance morale du principe allait agir d’elle- même, c’est que les chefs de la Ligue siégeant au Parlement ne manqueraient pas d’y réclamer le complément naturel de leur victoire. Ces chefs avaient donc encore une tâche, une grande tache, à remplir. Bastiat les suivait de l’œil et du cœur au milieu de leurs efforts, et, pour lui, là où se signalaient Cobden et Bright, là était la Ligue. En se plaçant à ce point de vue, il avait projeté, sous le titre de Seconde Campagne' de la Ligue anglaise, un écrit qu’il n’eut pas le temps de composer. Divers matériaux destinés à cette œuvre sont dans nos mains et méritent de passer sous les yeux du public. Qu’il nous soit cependant permis, avant de donner ces fragments sur une seconde Campagne de la Ligue, d’exposer en peu de mots comment se termina la première [1].
En 1845, l’opinion publique se prononçait de plus en plus contre les lois-céréales. Elle se manifestait sur tous les points du Royaume-Uni par la fréquentation plus empressée des meetings de la Ligue et le progrès des souscriptions pécuniaires. Pendant que la confiance et le zèle des ligueurs recevaient cet encouragement, l’esprit de conduite et la résolution abandonnaient leurs adversaires. Quant aux hommes politiques, ceux qui possédaient le pouvoir comme ceux qui aspiraient à le posséder, ceux qu’auraient dû retenir des engagements électoraux comme ceux qui n’étaient retenus que par leur penchant pour les moyens termes, sir Robert Peel comme lord John Russell se rapprochaient peu à peu des conclusions de la Ligue. Tout cela devenait manifeste pour les protectionnistes intelligents. Ils voyaient leur cause abandonnée par l’homme même sur l’habileté duquel ils avaient placé leur dernière espérance. De là leur colère et l’amertume de leur langage. — Ce fut dans la séance du 17 mars, à la Chambre des communes, que M. d’Israëli termina un discours plein de sarcasmes contre le premier ministre par cette véhémente apostrophe : « Pour mon compte, si nous devons subir le libre-échange, je préférerais, parce que j’honore le talent, qu’une telle mesure fut proposée par le représentant de Stockport (M. Cobden), au lieu de l’être par une habileté parlementaire qui s’est fait un jeu de la confiance généreuse d’un grand parti et d’un grand peuple. Oui, advienne que pourra ! Dissolvez, si cela vous plaît, le Parlement que vous avez trahi, appelez-en au peuple, qui, je l’espère, ne croit plus en vous ; il me reste au moins cette satisfaction de déclarer publiquement ici, qu’à mes yeux le cabinet conservateur n’est que l’hypocrisie organisée. » — Deux jours après s’engagea une mesquine discussion sur la graisse et le lard, articles dont le gouvernement proposait d’affranchir l’importation de toute taxe. Il se trouva des orateurs qui combattirent la mesure, au nom de l’intérêt agricole, que menacerait, disaient-ils, l’invasion du beurre étranger ; et pour les rassurer, un membre de l’administration exposa que le beurre étranger ne serait admis en franchise que mélangé avec une certaine quantité de goudron, c’est-à-dire rendu impropre à la nourriture de l’homme. — Le spirituel colonel Thompson, qui parcourait alors l’Écosse, dit à ce sujet dans une réunion de libres-échangistes é cossais : « Vous avez fondé de nombreuses écoles pour l’enfance, dans le voisinage de vos manufactures ; mais dans les livres élémentaires, que vous mettez aux mains des élèves, j’aperçois une omission et vous engage à la réparer. Il faut qu’à la question, — À quoi sert le gouvernement ? — ces enfants sachent répondre : — À mettre du goudron dans notre beurre. »
Le 10 juin, l’honorable M. Villiers renouvela sa proposition annuelle [2], proposition toujours rejetée par la Chambre et toujours reproduite, dans les délais du règlement, par son habile et courageux auteur. Elle eut le même sort que par le passé. Combattue par le ministère, elle fut repoussée. Mais dans cet insuccès même on pouvait trouver un point de vue rassurant. Les adversaires faiblissaient ; et comme le dit avec beaucoup de justesse lord Howich, dans le cours du débat, s’il se fût agi d’une abolition graduelle, la proposition de M. Villiers n’eût pas pu être mieux appuyée que par le discours prononcé par sir Robert Peel à l’effet d’écarter l’abolition immédiate.
Aussitôt les journaux protectionnistes jetèrent ce cri d’alarme : Voilà le gouvernement qui admet explicitement les principes du libre-échange et n’oppose plus à leur application que l’inopportunité !
Cette question devait encore appeler l’attention de la Chambre, dans la séance finale du 5 août, qui fut, comme de coutume, consacrée à la revue rétrospective des actes du Parlement pendant la session. Pour lord John Russell ce fut une occasion nouvelle de démontrer que les ministres actuels étaient arrivés au pouvoir en déguisant leurs véritables opinions, notamment à l’égard des lois-céréales. Et comme, à cette époque, la saison devenue pluvieuse faisait naître des inquiétudes sur la récolte, l’orateur en prit texte pour accuser le ministère d’ajouter, en matière de subsistances, à une incertitude naturelle une incertitude artificielle, qui doublait l’ardeur des spéculations hasardeuses, au grand détriment du pays. Il rappela qu’un membre connu par son dévouement ministériel avait déclaré publiquement, depuis peu de jours, que la loi-céréale n’aurait probablement plus que deux ans de durée. S’il en est ainsi, ajouta-t-il, si cette loi doit être abolie, pourquoi nous laisse-t-on dans une incertitude pleine de périls et de malheurs ? — À cela sir James Graham répliqua seulement par un argument ad hominem. « Est-ce que le noble lord, qui était au pouvoir en 1839, dans des circonstances bien autrement alarmantes pour le bien-être du pays, se crut obligé de proposer comme un remède à cette triste situation l’abolition des lois-céréales ? Non, il ne fit rien de semblable ni en 1839, ni en 1840, ni en 1841. » — L’argument était sans force contre les libres-échangistes. Ceux-ci, par l’organe de MM. Villiers et Gibson, renouvelèrent les protestations les plus chaleureuses contre l’inique monopole des landlords. — Bientôt il fut reconnu que ce monopole avait rencontré un ennemi des plus redoutables dans le caprice des saisons. À la suite d’un été pluvieux, il fut constaté de la manière la plus certaine, vers le milieu d’octobre, que la récolte en blé était insuffisante en quantité comme en qualité, et que la récolte en pommes de terre était presque entièrement perdue. Alors un cri en faveur de la libre entrée des grains étrangers s’éleva dans toute l’Angleterre, cri devant lequel les protectionnistes les moins endurcis commencèrent à lâcher pied, tandis qu’il doubla l’énergie des ligueurs. Dans un meeting tenu le 28 octobre à Manchester, l’un des orateurs, M. Henry Ashworth, de Turton, prononça ces paroles : « Je vois autour de moi nos dignes chefs, sur le front desquels la lutte des sept dernières années a imprimé des rides ; mais je suis sûr qu’ils sont prêts tous à mettre au service de notre cause, s’il en est besoin, sept autres années de labeur et à dépenser en outre un quart de million [3]. »
De tout côté, cependant, on signalait au ministère la nécessité de prendre des mesures décisives contre la disette. Il y avait émulation entre les conseils municipaux, les corporations et les chambres de commerce pour l’assaillir, à cet effet, de pétitions, de mémoires, de remontrances. Au milieu de cette excitation, une lettre adressée d’Edimbourg, le 22 novembre, par lord John Russell, aux électeurs de Londres, fut publiée. « J’avoue, disait le noble lord, que, dans l’espace de vingt ans, mes opinions sur la loi-céréale se sont grandement modifiées… le moment de s’occuper d’un droit fixe est passé. Proposer maintenant, comme solution, une taxe sur le blé, si faible qu’elle fût, sans une clause d’abolition complète et prochaine, ne ferait que prolonger un débat qui a produit déjà trop d’animosité et de mécontentement… » Le 24 septembre, lord Morpeth, autre membre de l’ancien cabinet Whig, exprima aussi par écrit sa conviction que l’heure du rappel définitif de la loi-céréale avait sonné. — Voilà les Whigs ralliés au programme de la Ligue : Que va faire Peel ? ira-t-il jusqu’à y donner de même son adhésion ? Celte question faisait le fond de toutes les conversations politiques, lorsque le Times, journal ordinairement bien informé, annonça, dans son numéro du 4 décembre, que l’intention du gouvernement était d’abolir la loi-céréale et, à cet effet, de convoquer en janvier les deux Chambres. Mais un autre journal, en relations connues avec certains membres du cabinet, le Standard, démentit aussitôt la nouvelle donnée par le Times, en la qualifiant d’atroce invention. La vérité fut bientôt révélée par la démission collective des ministres, dont les uns accédaient à la grande mesure du rappel, tandis que les autres ne s’y résignaient pas ou du moins ne voulaient pas en être les instruments [4]. Lord John Russell, qui se trouvait alors à Edimbourg, mandé en toute hâte par la reine, échoua dans la tentative de créer un nouveau cabinet ; en sorte que le jour même où sir Robert Peel se présentait devant la reine, pour prendre congé d’elle et remettre son portefeuille aux mains d’un successeur, il reçut au contraire la mission de reconstituer un ministère, mission qu’il put remplir sans difficulté. Excepté lord Stanley, qui se retira, et lord Wharncliffe qui mourut subitement, le cabinet nouveau conservait tous les membres de l’ancien.
La situation ne porta nullement les libres-échangistes à se relâcher de leur vigilance et de leur activité. Un grand meeting eut lieu le 23 décembre à Manchester, auquel se rendirent toutes les notabilités manufacturières des environs. Il y fut résolu à l’unanimité de réunir une somme de 200,000 livres sterling pour subvenir aux dépenses futures de la Ligue. Immédiatement ouverte, la souscription atteignit en peu d’instants le chiffre de 60 mille livres (1 million 500 mille francs). Cette manifestation frappante du zèle des ligueurs leur gagna de nouveaux adhérents et consterna leurs adversaires. Au bout d’un mois, la souscription s’élevait déjà à 150 mille livres.
Ce fut le 19 janvier 1846 que s’ouvrit le Parlement. Dans le débat sur l’adresse, sir Robert Peel fit une déclaration de principes, qu’un libre-échangiste n’eût pas désavouée, et termina son discours par une allusion à sa position personnelle vis-à-vis des torys. Je n’entends pas, dit-il, que dans mes mains le pouvoir soit réduit en servage. Huit jours après, il exposa son plan qui, à l’égard de l’importation des grains, se résumait ainsi :
Échelle mobile très-réduite pendant trois années encore ;
Suppression de tout droit, à partir du 1er février 1849.
Le délai de trois ans était un mécompte pour la Ligue. Aussi dès le surlendemain, c’est-à-dire le 29 janvier, son conseil d’administration se réunit à Manchester et prit la résolution de provoquer, par toutes les voies constitutionnelles, la suppression immédiate de toute taxe sur les aliments provenant de l’étranger. Aucune crainte d’embarrasser sir Robert Peel ne pouvait arrêter les ligueurs ; et d’ailleurs, en présence de l’opposition furieuse des conservateurs-bornes, il était vraisemblable qu’une opposition en sens contraire lui servirait plutôt de point d’appui. La discussion sur l’ensemble des mesures qu’il proposait s’ouvrit le lundi 9 février. Sauf de courtes interruptions, elle occupa, sans arriver à son terme, toutes les séances de la chambre pendant cette semaine. Le lundi suivant, à 10 heures du soir, le premier ministre prit la parole. Tour à tour logicien serré, orateur entraînant, administrateur habile, on eût dit qu’affranchi d’un joug longtemps détesté, son talent se manifestait pour la première fois dans toute sa plénitude. Il termina son discours, qui dura près de trois heures, par cet appel aux sentiments de justice et d’humanité de la Chambre :
« Les hivers de 1841 et 42 ne s’effaceront jamais de ma mémoire, et la tâche qu’ils nous donnèrent doit être présente à vos souvenirs. Alors, dans toutes les occasions où la reine assemblait le Parlement, on y entendait l’expression d’une sympathie profonde pour les privations et les souffrances de nos concitoyens, d’une vive admiration pour leur patience et leur courage. Ces temps malheureux peuvent revenir. Aux années d’abondance peuvent succéder les années de disette… J’adjure tous ceux qui m’écoutent d’interroger leur cœur, d’y chercher une réponse à la question que je vais leur poser. Si ces calamités nous assaillent encore, si nous avons à exprimer de nouveau notre sollicitude pour le malheur, à répéter nos exhortations à la patience et à la fermeté, ne puiserons-nous pas une grande force dans la conviction que nous avons repoussé, dès aujourd’hui, la responsabilité si lourde de réglementer l’alimentation de nos semblables ? Est-ce que nos paroles de sympathie ne paraîtront pas plus sincères ? est-ce que nos encouragements à la résignation ne seront pas plus efficaces, si nous pouvons ajouter, avec orgueil, qu’en un temps d’abondance relative, sans y être contraints par la nécessité, sans attendre les clameurs de la foule, nous avons su prévoir les époques difficiles et écarter tout obstacle à la libre circulation des dons du Créateur ? Ne sera-ce pas pour nous une précieuse et durable consolation que de pouvoir dire au peuple : Les maux que vous endurez sont les châtiments d’une Providence bienfaisante et sage qui nous les inflige à bon escient, peut-être pour nous rappeler au sentiment de notre dépendance, abattre notre orgueil, nous convaincre de notre néant ; il faut les subir sans murmure contre la main qui les dispense, car ils ne sont aggravés par aucun pouvoir terrestre, par aucune loi de restriction sur la nourriture de l’homme ! »
Dans la séance du lendemain, on lui prodiguait l’accusation de trahison, de manque de foi, de fourberie et de lâcheté. Alors M. Bright se lève mû par un sentiment généreux et prend la défense de son ancien adversaire. « J’ai suivi du regard le très-honorable baronnet, dit-il, lorsque la nuit dernière il regagnait sa, demeure, et j’avoue que je lui enviais la noble satisfaction qui devait remplir son cœur, après le discours qu’il venait de prononcer, discours, j’ose le dire, le plus éloquent, le plus admirable qui, de mémoire d’homme, ait retenti dans cette enceinte. » En poursuivant, il apostropha en ces termes ceux qui déversaient le blâme et l’injure sur le ministre, après avoir été ses partisans déclarés. « Quand le très-honorable baronnet se démit récemment de ses fonctions, il cessa d’être votre ministre, sachez-le bien ; et quand il reprit le portefeuille, ce fut en qualité de ministre du souverain, de ministre du peuple, — non de ministre d’une coterie, pour servir d’instrument docile à son égoïsme. » À ce témoignage inattendu de bienveillance pour lui, les membres qui siégeaient près de sir Robert Peel, virent des larmes mouiller sa paupière.
La discussion générale durait encore le vendredi suivant. Dans cette nuit du vendredi au samedi, M. Cobden battit en brèche avec grande vigueur un argument spécial, au moyen duquel les protectionnistes s’efforçaient de renvoyer la décision à une autre législature. À trois heures et demie du matin, on mit aux voix la question de savoir si la proposition ministérielle serait examinée et discutée dans ses détails. 337 membres votèrent pour l’affirmative et 240 contre. Si favorable que fût ce vote, il n’assurait pas l’adoption complète du plan soumis au débat. Une scission pouvait se produire dans une majorité improvisée, dont les éléments étaient fort hétérogènes ; et la minorité ne manquait pas de chances pour obtenir que la taxe proposée, tout en conservant le caractère mobile et temporaire, fût plus élevée et plus durable que ne le voulaient les ministres. L’événement ne confirma pas ces conjectures. En vain les protectionnistes disputèrent le terrain et employèrent tous les moyens de prolonger la lutte ; le 27 mars, la seconde lecture du bill fut adoptée par une majorité de 88 membres, et la troisième lecture, le 16 mai, par une majorité de 98 (327 contre 229). Dans la Chambre des lords, le bill rencontra moins d’obstacles et de lenteurs qu’on ne s’y attendait. Le 26 mai, il devint définitivement loi de l’État.
Peu après sir Robert Peel rentrait dans la vie privée. Au moment de quitter le pouvoir, dans un dernier discours parlementaire, il dit, au sujet des grandes mesures qu’il avait inaugurées :
« Le mérite de ces mesures, je le déclare à l’égard des honorables membres de l’opposition comme à l’égard de nous-mêmes, ce mérite n’appartient exclusivement à aucun parti. Il s’est produit entre les partis une fusion qui, aidée de l’influence du gouvernement, a déterminé le succès définitif. Mais le nom qui doit être et sera certainement associé à ces mesures, c’est celui d’un homme, mû par le motif le plus désintéressé et le plus pur, qui, dans son infatigable énergie, en faisant appel à la raison publique, a démontré leur nécessité avec une éloquence d’autant plus admirable qu’elle était simple et sans apprêt ; c’est le nom de Richard Cobden. Maintenanl, monsieur le Président, je termine ce discours, qu’il était de mon devoir d’adresser à la Chambre, en la remerciant de la faveur qu’elle me témoigne pendant que j’accomplis le dernier acte de ma carrière politique. Dans quelques instants cette faveur que j’ai conservée cinq années se reportera sur un autre ; j’énonce le fait sans m’en affliger ni m’en plaindre, plus vivement ému au souvenir de l’appui et de la confiance qui m’ont été prodigués qu’à celui des difficultés récemment semées sur ma voie. Je quitte le pouvoir, après avoir attiré sur moi, je le crains, l’improbation d’un assez grand nombre d’hommes qui, au point de vue de la chose publique, regrettent profondément la rupture des liens de parti, regrettent profondément cette rupture non par des motifs personnels, mais dans la ferme conviction que la fidélité aux engagements de parti, que l’existence d’un grand parti politique est un des plus puissants rouages du gouvernement. Je me retire, en butte aux censures sévères d’autres hommes qui, sans obéir à une inspiration égoïste, adhèrent au principe de la protection et en considèrent le maintien comme essentiel au bien-être et aux intérêts du pays. Quant à ceux qui défendent la protection par des motifs moins respectables et uniquement parce qu’elle sert leur intérêt privé, quant à ces partisans du monopole, leur exécration est à jamais acquise à mon nom ; mais il se peut que ce nom soit plus d’une fois prononcé avec bienveillance sous l’humble toit des ouvriers, de ceux qui gagnent chaque jour leur vie à la sueur de leur front, eux qui auront désormais, pour réparer leurs forces épuisées, le pain en abondance et sans payer de taxe, — pains d’autant meilleurs qu’il ne s’y mêlera plus, comme un levain amer, le ressentiment contre une injustice. »
Ces dernières paroles, expression d’un sentiment touchant, ont été gravées, après la mort de sir R. Peel, sur le piédestal d’une des statues élevées à sa mémoire. Si le passant qui les lit donne à l’homme d’État un souvenir reconnaissant, sans doute il sentira dans son cœur une sympathie encore plus vive pour les généreux citoyens dont le dévouement et la persévérance ont doté leur pays de la liberté commerciale.
Le 22 juillet, au sein du Conseil exécutif de la Ligue, réuni à Manchester, les résolutions suivantes furent adoptées : 1° Suspension des opérations de la Ligue ; 2° exemption pour les souscripteurs au fonds de 250,000 livres de tout versement au delà d’un à-compte de 20 pour 100 ; 3° attribution aux membres du Conseil exécutif, si le protectionnisme renouvelait quelques tentatives hostiles, de pleins pouvoirs pour réorganiser l’agitation qu’ils avaient conduite avec tant de zèle et d’habileté. — Le cas prévu par cette dernière résolution parut se réaliser six ans plus tard, à l’avènement du ministère Derby-d’Israëli ; et l’on vit aussitôt la Ligue sur pied, jusqu’à ce qu’il fût constaté qu’il y avait eu fausse alerte.
Dans cette même séance du 22 juillet 1846, d’autres motions furent faites qui obtinrent l’assentiment unanime. M. Wilson, président, et les autres principaux membres du Conseil exécutif, MM. Archibald Prentice, S. Lees, W. Rawson, T. Woolley, W. Bickham, W. Evans et Henry Rawson, furent priés d’accepter un témoignage de gratitude pour les travaux incessants et gratuits dont ils s’étaient acquittés. On offrit à M. Wilson une somme de 10,000 livres st. (250,000 fr. environ), et à chacun de ses collègues précités un service à thé, en argent, du poids de 240 onces.
Un autre témoignage de gratitude suivit de près la clôture des opérations de la Ligue. Par un mouvement spontané, les libres-échangistes anglais se réunirent pour faire présent à leur chef reconnu, M. Cobden, d’une somme de 75.000 livres, et à son ami, son digne auxiliaire, M. Bright, d’une magnifique bibliothèque. Mais pour de tels hommes la plus précieuse des récompenses est la conviction d’avoir servi la cause de l’humanité.
Quand on connaît le but des ligueurs elles moyens employés pour l’atteindre, on ne saurait hésitera voir, dans l’œuvre qu’ils ont accomplie, une des plus belles manifestations du progrès social dont puisse s’honorer notre siècle. Puisse cette œuvre, appréciée à sa juste valeur, leur assurer la reconnaissance de toutes les nations et particulièrement celle de la France, où leur exemple a suscité Bastiat !
(Note de l’éditeur.)
FN:Nous empruntons les détails qui suivent à l’excellent ouvrage de M. Archibald Prentice : History of the Anti-corn-law League.
FN:Voir p. 384 à 387.
FN:Un quart de million sterling, plus de six millions de francs.
FN:En se reportant à cette phase des progrès de la Ligue, à l’ascendant qu’elle parvint à exercer sur les hommes politiques de tous les partis, il est impossible de ne pas reconnaître combien Bastiat, qui la voyait personnifiée dans son principal chef, était fondé à porter, quatre ans plus tard, le jugement suivant :
« Que dirai-je du libre-échange, dont le triomphe est dû à Cobden, non à Robert Peel ; car l’apôtre aurait toujours fait surgir un homme d’État, tandis que l’homme d’État ne pouvait se passer de l’apôtre ? » (Tom. VI, chap. xiv.)
Seconde campagne de la Ligue 449 ↩
Seconde campagne de la Ligue
Le Parlement anglais est convoqué pour le 18 de ce mois.
C’est la situation critique des affaires qui a déterminé le cabinet à hâter cette année la réunion des Communes.
Tout en déplorant la crise qui pèse sur le commerce et l’industrie britanniques, nous ne pouvons nous empêcher d’espérer qu’il en sortira de grandes réformes pour l’Angleterre et pour le monde. Ce ne sera pas la première fois, ni la dernière sans doute, que le progrès aura été enfanté dans la douleur. Le libre arbitre, noble apanage de l’homme, ou la liberté de choisir, implique la possibilité de faire un mauvais choix. L’erreur entraîne des conséquences funestes, et celles-ci sont le plus dur mais le plus efficace des enseignements. Ainsi nous arrivons toujours, à la longue, dans la bonne voie. Si la Prévoyance ne nous y a mis, l’Expérience est là pour nous y ramener.
Nous ne doutons pas que des voix se feront entendre dans le Parlement pour signaler à l’Angleterre la fausse direction de sa politique trop vantée.
« Rendre à toutes les colonies, l’Inde comprise, la liberté d’échanger avec le monde entier, sans privilége pour la métropole.
« Proclamer le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres nations ; mettre fin à toutes les intrigues diplomatiques ; renoncer aux vaines illusions de ce qu’on nomme influence, prépondérance, prépotence, suprématie.
« Abolir les lois de navigation.
« Réduire les forces de terre et de mer à ce qui est indispensable pour la sécurité du pays. »
Tel devra être certainement le programme recommandé et énergiquement soutenu par le parti libéral, par tous les membres de la Ligue, parce qu’il se déduit rigoureusement du libre-échange, parce qu’il est le libre-échange même.
En effet, quand on pénètre les causes qui soumettent à tant de fluctuations et de crises le commerce de la Grande-Bretagne, à tant de souffrances sa laborieuse population, on reste convaincu qu’elles se rattachent à une Erreur d’économie sociale, laquelle, par un enchaînement fatal, entraîne à une fausse politique, à une fausse diplomatie ; en sorte que cette imposante mais vaine apparence qu’on nomme la puissance anglaise repose sur une base fragile comme tout ce qui est artificiel et contre nature.
L’Angleterre a partagé cette erreur commune, que l’habileté commerciale consiste à peu acheter et beaucoup vendre, afin de recevoir la différence en or.
Cette idée implique nécessairement celle de suprématie, et par suite celle de violence.
Pour acheter peu, la violence est nécessaire à l’égard des citoyens. Il faut les soumettre à des restrictions législatives.
Pour vendre beaucoup (alors surtout que les autres nations, sous l’influence de la même idée, voulant acheter peu, se ferment chez elles et défendent leur or), la violence est nécessaire à l’égard des étrangers. Il faut étendre ses conquêtes, assujettir des consommateurs, accaparer des colonies, en chasser les marchands du dehors, et accroître sans cesse le cercle des envahissements.
Dès lors on est entraîné à s’environner de forces considérables, c’est-à-dire à détourner une portion notable du travail national de sa destination naturelle, qui est de satisfaire les besoins des travailleurs.
Ce n’est pas seulement pour étendre indéfiniment ses conquêtes qu’une telle nation a besoin de grandes forces militaires et navales. Le but qu’elle poursuit lui crée partout des jalousies, des inimitiés, des haines contre lesquelles elle a à se prémunir ou à se défendre.
Et comme les inimitiés communes tendent toujours à se coaliser, il ne lui suffit pas d’avoir des forces supérieures à celles de chacun des autres peuples, pris isolément, mais de tous les peuples réunis. Quand un peuple entre dans cette voie, il est condamné à être, coûte que coûte, le plus fort partout et toujours.
La difficulté de soutenir le poids d’un tel établissement militaire le poussera à chercher un auxiliaire dans la ruse. Il entretiendra des agents auprès de toutes les cours ; il fomentera et réchauffera partout les germes de dissensions ; il affaiblira ses rivaux les uns par les autres ; il leur créera des embarras et des obstacles ; il suscitera les rois contre les peuples, et les peuples contre les rois ; il opposera le Nord au Midi ; il se servira des peuples au sein desquels l’esprit de liberté a réveillé quelque énergie pour tenir en échec la puissance des despotes, et en même temps il fera alliance avec les despotes pour comprimer la force que donne ailleurs l’esprit de liberté. Sa diplomatie sera toute ruse et duplicité ; elle invoquera selon les temps et les lieux les principes les plus opposés ; elle sera démocrate ici, aristocrate là ; autocrate plus loin, constitutionnelle, révolutionnaire, philanthrope, déloyale, loyale même au besoin ; elle aura tous les caractères, excepté celui de la sincérité. Enfin, on verra ce peuple, dans la terrible nécessité où il s’est placé, aller jusqu’à contracter des dettes accablantes pour soudoyer les rois, les peuples, les nations qu’il aura mis aux prises.
Mais l’intelligence humaine ne perd jamais ses droits. Bientôt les nations comprendront le but de ces menées. La défiance, l’irritation et la haine ne feront que s’amasser dans leur cœur ; et le peuple dont nous retraçons la triste histoire sera condamné à ne voir dans ses gigantesques efforts que les pierres d’attente, pour ainsi parler, d’efforts plus gigantesques encore.
Or, ces efforts coûtent du travail à ce peuple. — Cela peut paraître extraordinaire, mais il est cependant certain, quoique les hommes n’en soient pas encore bien convaincus, que ce qui est produit une fois ne peut pas être dépensé deux, et que cette portion de travail qui est destinée à atteindre un but ne peut être en même temps consacrée à en obtenir un autre. Si la moitié de l’activité nationale est détournée vers des conquêtes ou la défense d’une sécurité qu’on a systématiquement compromise, il ne peut rester que l’autre moitié de l’activité des travailleurs pour satisfaire les besoins réels (physiques, intellectuels ou moraux) des travailleurs eux-mêmes. On a beau subtiliser et théoriser, les arsenaux ne se font pas d’eux-mêmes, ni les vaisseaux de guerre non plus ; ils ne sont pas pourvus d’armes, de munitions, de canons et de vivres par une opération cabalistique. Les soldats mangent et se vêtissent comme les autres hommes, et les diplomates plus encore. Il faut pourtant bien que quelqu’un produise ce que ces classes consomment ; et si ce dernier genre de consommation va sans cesse croissant comme le système l’exige, un moment arrive de toute nécessité où les vrais travailleurs n’y peuvent suffire.
Remarquez que toutes ces conséquences sont contenues très-logiquement dans cette idée : Pour progresser, un peuple doit vendre plus qu’il n’achète. — Et si cette idée est fausse, même au point de vue économique, à quelle immense déception ne conduit-elle pas un peuple, puisqu’elle exige de lui tant d’efforts, tant de sacrifices et tant d’iniquités pour ne lui offrir en toute compensation qu’une chimère, une ombre ?
Admettons la vérité de cette autre doctrine : les exportations d’un peuple ne sont que le paiement de ses importations.
Puisque le principe est diamétralement opposé, toutes les conséquences économiques, politiques, diplomatiques, doivent être aussi diamétralement opposées.
Si, dans ses relations commerciales, un peuple n’a à se préoccuper que d’acheter au meilleur marché, laissant, comme disent les free-traders, les exportations prendre soin d’elles-mêmes, — comme acheter à bon marché est la tendance universelle des hommes, ils n’ont besoin à cet égard que de liberté. Il n’y a donc pas ici de violence à exercer au dedans. — Il n’y a pas non plus de violences à exercer au dehors ; car il n’est pas besoin de contrainte pour déterminer les autres peuples à vendre.
Dès lors, les colonies, les possessions lointaines sont considérées non-seulement comme des inutilités, mais comme des fardeaux ; dès lors leur acquisition et leur conservation ne peuvent plus servir de prétexte à un grand développement de forces navales ; dès lors on n’excite plus la jalousie et la haine des autres peuples; dès lors la sécurité ne s’achète pas au prix d’immenses sacrifices ; dès lors enfin, le travail national n’est pas détourné de sa vraie destination, qui est de satisfaire les besoins des travailleurs. — Et quant aux étrangers, le seul vœu qu’on forme à leur égard, c’est de les voir prospérer, progresser par une production de plus en plus abondante, de moins en moins dispendieuse, partant toujours de ce point, que tout progrès qui se traduit en abondance et en bon marché profite à tous et surtout au peuple acheteur.
L’importance des effets opposés, qui découlent des deux axiomes économiques que nous avons mis en regard l’un de l’autre, serait notre justification si nous recherchions ici théoriquement de quel côté est la vérité. Nous nous en abstiendrons, puisque cette recherche est après tout l’objet de notre publication tout entière.
Mais on nous accordera bien que les free-traders d’Angleterre professent à cet égard les mêmes opinions que nous-mêmes.
Donc, leur rôle, au prochain Parlement, sera de demander l’entière réalisation du programme que nous avons placé au commencement de cet article.
Les événements de 1846 et de 1847 leur faciliteront cette noble tâche.
En 1846, ils ont détrôné cette vieille maxime, que l’avantage d’un peuple était d’acheter peu et de vendre beaucoup pour recevoir la différence en or. Ils ont fait reconnaître officiellement cette autre doctrine, que les exportations d’un peuple ne sont que le paiement de ses importations. Ayant fait triompher le principe, ils seront bien plus forts pour en réclamer les conséquences. Il serait par trop absurde que l’Angleterre, renonçant à un faux système commercial, retînt le dispendieux et dangereux appareil militaire et diplomatique que ce système seul avait exigé.
Les événements de cette année donneront de la puissance et de l’autorité aux réclamations des free-traders. On aura beau vouloir attribuer la crise actuelle à des causes mystérieuses, il n’y a pas de mystère là-dessous. Le travail énergique, persévérant, intelligent d’un peuple actif et laborieux ne suffit pas à son bien-être ; pourquoi ? parce qu’une portion immense de ce travail est consacrée à autre chose qu’à son bien-être, à payer des marins, des soldats, des diplomates, des gouverneurs de colonies, des vaisseaux de guerre, des subsides, — le désordre, le trouble et l’oppression.
Certainement, la lutte sera ardente au Parlement, et nous n’avons pas l’espoir que les free-traders emportent la place au premier assaut. Les abus, les préjugés, les droits acquis sont les maîtres dans cette citadelle. C’est même là que leurs forces sont concentrées. L’aristocratie anglaise y défendra énergiquement ses positions. Les gouvernements à l’extérieur, les hauts emplois, les grades dans l’armée et la marine, la diplomatie et l’Église, sont à ses yeux son légitime patrimoine ; elle ne le cédera pas sans combat ; et nous qui savons quelle est, dans son aveuglement, la puissance de l’orgueil national, nous ne pouvons nous empêcher de craindre que l’oligarchie britannique ne trouve de trop puissants auxiliaires dans les préjugés populaires, qu’une politique dominatrice a su faire pénétrer au cœur des travailleurs anglais eux-mêmes. Là, comme ailleurs, on leur dira que la destinée des peuples n’est pas le bien-être, qu’ils ont une mission plus noble, et qu’ils doivent repousser toute politique égoïste et matérialiste. — Et tout cela, pour les faire persévérer dans le matérialisme le plus brutal, dans l’égoïsme sous sa forme la plus abjecte : l’appel à la violence pour nuire à autrui en se nuisant à soi-même.
Mais rien ne résiste à la vérité, quand son temps est venu et que les faits, dans leur impérieux langage, la font éclater de toutes parts.
Si le peuple anglais, dans son intérêt, abolit les lois de navigation, s’il rend à ses colonies la liberté commerciale, si tout homme, à quelque nation qu’il appartienne, peut aller échanger dans l’Inde, à la Jamaïque, au Canada, au même titre qu’un Anglais, quel prétexte restera-t-il à l’aristocratie britannique pour retenir les forces qui en ce moment écrasent l’Angleterre ?
Dira-t-elle qu’elle veut conserver les possessions acquises ?
On lui répondra que nul désormais n’est intéressé à les enlever à l’Angleterre, puisque chacun peut en user comme elle, et de plus que l’Angleterre, par le même motif, n’est plus intéressée à les conserver.
Dira-t-elle qu’elle aspire à de nouvelles conquêtes ?
On lui objectera que le moment est singulièrement choisi de courir à de nouvelles conquêtes quand, sous l’inspiration de l’intérêt, d’accord cette fois avec la justice, on renonce à des conquêtes déjà réalisées.
Dira-t-elle qu’il faut s’emparer au moins de positions militaires telles que Gibraltar, Malte, Héligoland ?
On lui répondra que c’est un cercle vicieux ; que ces positions étaient sans doute une partie obligée du système de domination universelle ; mais qu’on ne détruit pas l’ensemble pour en conserver précisément la partie onéreuse.
Fera-telle valoir la nécessité de protéger le commerce, dans les régions lointaines, par la présence de forces imposantes ?
On lui dira que le commerce avec des barbares est une déception, s’il coûte plus indirectement qu’il ne vaut directement.
Exposera-t-elle qu’il faut au moins que l’Angleterre se prémunisse contre tout danger d’invasion ?
On lui accordera que cela est juste et utile. Mais on lui fera observer qu’il est de la nature d’un tel danger de s’affaiblir, à mesure que les étrangers auront moins sujet de haïr la politique britannique et que les Anglais auront plus raison de l’aimer.
On dira sans doute que nous nous faisons une trop haute idée de la philanthropie anglaise.
Nous ne croyons pas que la philanthropie détermine aucun peuple, pas plus le peuple anglais que les autres, à agir sciemment contre ses intérêts permanents.
Mais nous croyons que les intérêts permanents d’un peuple sont d’accord avec la justice, et nous ne voyons pas pourquoi il n’arriverait pas, par la diffusion des lumières, et au besoin par l’expérience, à la connaissance de cette vérité.
En un mot, nous avons foi, une foi entière, dans le principe du libre-échange.
Nous croyons que, selon qu’un peuple prend ou ne prend pas pour règle de son économie industrielle la théorie de la balance du commerce, il doit adopter une politique toute différente.
Dans le premier cas, il veut vendre à toute force ; et ce besoin le conduit à aspirer à la domination universelle.
Dans le second, il ne demande qu’à acheter, sachant que le vendeur prendra soin du paiement ; et, pour acheter, il ne faut faire violence à personne.
Or, si la violence est inutile, ce n’est pas se faire une trop haute idée d’un peuple que de supposer qu’il repoussera les charges et les risques de la violence.
Et si nous sommes pleins de confiance, c’est parce que, sur ce point, le vrai intérêt de l’Angleterre et de ses classes laborieuses nous paraît d’accord avec la cause de la justice et de l’humanité.
Car si nous avions le malheur de croire à l’efficacité du régime restrictif, sachant quelles idées et quels sentiments il développe, nous désespérerions de tout ordre, de toute paix, de toute harmonie. Toutes les déclamations à la mode contre le vil intérêt ne nous feraient pas admettre que l’Angleterre renoncera à sa politique envahissante et turbulente, laquelle, dans cette hypothèse, serait conforme à ses intérêts. Tout au plus, nous pourrions penser qu’arrivée à l’apogée de la grandeur, elle succomberait sous la réaction universelle ; mais seulement pour céder son rôle à un autre peuple, qui, après avoir parcouru le même cercle, le céderait à un troisième, et cela sans fin et sans cesse jusqu’à ce que la dernière des hordes régnât enfin sur des débris. Telle est la triste destinée que la Presse annonçait ces jours derniers aux nations ; et comme elle croit au régime prohibitif, sa prédiction était logique.
Au moment où le Parlement va s’ouvrir, nous avons cru devoir signaler la ligne que suivra, selon nous, le parti libéral. Si le monde est sur le point d’assister à une grande révolution pacifique, à la solution d’un problème terrible : — l’écroulement de la puissance anglaise en ce qu’elle a de pernicieux, et cela non par la force des armes, mais par l’influence d’un principe, — c’est un spectacle assurément bien digne d’attirer les regards impartiaux de la presse française. Est-ce trop exiger d’elle que de l’inviter à ne pas envelopper de silence cette dernière évolution de la Ligue comme elle a fait de la première ? Le drame n’intéresse-t-il pas assez le monde et la France ? Sans doute nous avons été profondément étonnés et affligés de voir la presse française, et principalement la presse démocratique, tout en fulminant tous les jours contre le machiavélisme britannique, faire une monstrueuse alliance avec les hommes et les idées qui sont en Angleterre la vie de ce machiavélisme. C’est le résultat de quelque étrange combinaison d’idées qu’il ne nous est pas donné de pénétrer. Mais, à moins qu’il n’y ait parti pris, ce que nous ne pouvons croire, de tromper le pays jusqu’au bout, nous ne pensons pas que cette combinaison d’idées, quelle qu’elle soit, puisse tenir devant la lutte qui va s’engager dans quelques jours au Parlement.
FN: Libre-Échange, n° du 7 novembre 1847.
Deux Angleterre 459 ↩
| Deux Angleterre[1] | Grand meeting à Manchester |
Quand nous avons entrepris d’appeler l’attention de nos concitoyens sur la question de la liberté commerciale, nous n’avons pas pensé ni pu penser que nous nous faisions les organes d’une opinion en majorité dans le pays, et qu’il ne s’agit pour nous que d’enfoncer une porte ouverte.
D’après les délibérations bien connues de nombreuses chambres de commerce, nous pouvions espérer, il est vrai, d’être soutenus par une forte minorité, qui, ayant pour elle le bon sens et le bien général, n’aurait que quelques efforts à faire pour devenir majorité.
Mais cela ne nous empêchait pas de prévoir que notre association provoquerait la résistance désespérée de quelques privilégiés, appuyée sur les alarmes sincères du grand nombre.
Nous ne mettions pas en doute qu’on saisirait toutes les occasions de grossir ces alarmes. L’expérience du passé nous disait que les protectionnistes exploiteraient surtout le sentiment national, si facile à égarer dans tous les pays. Nous prévoyions que la politique fournirait de nombreux aliments à cette tactique ; que, sur ce terrain, il serait facile aux monopoleurs de faire alliance avec les partis mécontents ; qu’ils nous créeraient tous les obstacles d’une impopularité factice et qu’ils iraient au besoin jusqu’à élever contre nous ce cri : Vous êtes les agents de Pitt et de Cobourg. Il faudrait que nous n’eussions jamais ouvert un livre d’histoire, si nous ne savions que le privilége ne succombe jamais sans avoir épuisé tous les moyens de vivre.
Mais nous avions foi dans la vérité. Nous étions convaincus, comme nous le sommes encore, qu’il n’y a pas une Angleterre, mais deux Angleterre. Il y a l’Angleterre oligarchique et monopoliste, celle qui a infligé tant de maux au monde, exercé et étendu partout une injuste domination, celle qui a fait l’acte de navigation, celle qui a fait la loi-céréale, celle qui a fait de l’Église établie une institution politique, celle qui a fait la guerre à l’indépendance des États-Unis, celle qui a d’abord exaspéré et ensuite combattu à outrance la révolution française, et accumulé, en définitive, des maux sans nombre, non-seulement sur tous les peuples, mais sur le peuple anglais lui-même. — Et nous disons que, s’il y a des Français qui manquent de patriotisme, ce sont ceux qui sympathisent avec cette Angleterre.
Il y a ensuite l’Angleterre démocratique et laborieuse, celle qui a besoin d’ordre, de paix et de liberté, celle qui a besoin pour prospérer que tous les peuples prospèrent, celle qui a renversé la loi-céréale, celle qui s’apprête à renverser la loi de navigation, celle qui sape le système colonial, cause de tant de guerres, celle qui a obtenu le bill de la réforme, celle qui a obtenu l’émancipation catholique, celle qui demande l’abolition des substitutions, cette clef de voûte de l’édifice oligarchique, celle qui applaudit, en 1787, à l’acte par lequel l’Amérique proclama son indépendance, celle qu’il fallut sabrer dans les rues de Londres avant de faire la guerre de 1792, celle qui, en 1830, renversa les torys prêts à former contre la Franco une nouvelle coalition. — Et nous disons que c’est abuser étrangement de la crédulité publique que de représenter comme manquant de patriotisme ceux qui sympathisent avec cette Angleterre.
Après tout, le meilleur moyen de les juger, c’est de les voir agir ; et certes ce serait le devoir de la presse de faire assister le public à cette grande lutte, à laquelle se rattachent l’indépendance du monde et la sécurité de l’avenir.
Absorbée par d’autres soins, influencée par des motifs qu’il ne nous est pas donné de comprendre, elle répudie cette mission. On sait que la plus puissante manifestation de l’esprit du siècle, agissant par la Ligue contre la loi-céréale, a agité pendant sept ans les trois royaumes, sans que nos journaux aient daigné s’en occuper.
Après les réformes de 1846, après l’abrogation du privilége foncier, au moment où la lutte va s’engager en Angleterre sur un terrain plus brûlant encore, l’acte de navigation, qui a été le principe, le symbole, l’instrument et l’incarnation du régime restrictif, on aurait pu croire que la presse française, renonçant enfin à son silence systématique, ne pourrait s’empêcher de donner quelque attention à une expérience qui nous touche de si près, à une révolution économique qui, de quelque manière qu’on la juge, est destinée à exercer une si grande influence sur le monde commercial et politique.
Mais puisqu’elle continue à la tenir dans l’ombre, c’est à nous de la mettre en lumière. C’est pourquoi nous publions le compte rendu de la séance par laquelle les chefs de la Ligue viennent pour ainsi dire de réorganiser à Manchester cette puissante association.
Nous appelons l’attention de nos lecteurs sur les discours qui ont été prononcés dans celte assemblée, et nous leur demanderons de dire, la main sur la conscience, de quel côté est le vrai patriotisme ; s’il est en nous, qui sympathisons de tout notre cœur avec l’infaillible et prochain triomphe de la Ligne, ou s’il est dans nos adversaires, qui réservent toute leur admiration pour la cause du privilége, du monopole, du régime colonial, des grands armements, des haines nationales et de l’oligarchie britannique.
Après avoir lu le discours, si nourri de faits, de M. Gibson, vice-président du Board of trade, l’éloquente et chaleureuse allocution de M. Bright, et ces nobles paroles par lesquelles M. Cobden a prouvé qu’il était prêt à tout sacrifier, même l’avenir qui s’ouvre devant lui, même sa popularité, pour accomplir sa belle mais rude mission, nous demandons à nos lecteurs de dire, la main sur la conscience, si ces orateurs ne défendent pas ces vrais intérêts britanniques qui coïncident et se confondent avec les vrais intérêts de l’humanité ?
Le Moniteur industriel et le Journal d’Elbeuf ne manqueront pas de dire : « Tout cela est du machiavélisme ; depuis dix ans M. Gobden, M. Bright, sir R. Peel, jouent la comédie. Les discours qu’ils prononcent, comédie ; l’enthousiasme des auditeurs, comédie ; les faits accomplis, comédie ; le rappel de la loi-céréale, comédie ; l’abolition des droits sur tous les aliments et sur toutes les matières premières, comédie ; le renversement de l’acte de navigation, comédie ; l’affranchissement commercial des colonies, comédie ; et, comme disait il y a quelques jours un journal protectionniste, l’Angleterre se coupe la gorge devant l’Europe sur le simple espoir que l’Europe l’imitera.
Et nous, nous disons que s’il y a une ridicule comédie au monde, c’est ce langage des protectionnistes. Certes, il faut prendre en considération les longues, et nous ajouterons les justes préventions de notre pays ; mais ne faudrait-il pas rougir enfin de sa crédulité, si cette comédie pouvait être plus longtemps représentée devant lui au bruit de ses applaudissements ?
FN: Libre-Échange du 6 février 1848.
Meeting du 26 janvier 1848, à Manchester. — Discours de MM. Milner Gibson, Cobden et J. Bright 463 ↩
Jeudi soir, 25 janvier 1848, un grand meeting de ligueurs a été tenu à Manchester pour célébrer l’entrée au Parlement des principaux apôtres de la liberté commerciale.
Trois mille personnes s’étaient rendues à la réunion. Au nombre des assistants on comptait une trentaine de membres du Parlement, et parmi eux MM. Cobden, Milner Gibson, Bright, Bowring, le colonel Thompson, G. Thompson, Ewart, M. Brown, Ricardo, le maire de Manchester et celui d’Ashton.
Le meeting était présidé par M. George Wilson, président de la Ligue.
M. George Wilson, dans une brève allocution, signale d’abord le progrès qui s’est accompli dans les élections depuis le Reform-bill ; les électeurs, dit-il, s’occupent aujourd’hui beaucoup moins de la naissance que du mérite réel des candidats. On nous reproche, je le sais, ajoute-t-il, de nommer des gens dont les ancêtres n’ont jamais fait parler d’eux, mais qu’importe, s’ils ont la confiance du peuple ? Nous les avons choisis à cause de leur mérite et non pas à cause de leurs titres. (Applaudissements.) L’orateur expose ensuite les progrès de la liberté commerciale. Le succès du tarif libre-échangiste de sir Robert Peel, dit-il, est maintenant reconnu par tout le monde, excepté par les protectionnistes exagérés, qui envoient encore de loin en loin de petites notes aux journaux. Le succès du tarif libre-échangiste des États-Unis n’a pas été moindre que celui du nôtre. On peut se faire une idée aussi de l’influence rapide que l’opinion publique de l’Angleterre exerce sur les classes intelligentes et éclairées du continent, par la réception qui a été faite à M. Cobden dans tous les pays qu’il a visités. (Applaudissements.) Il nous paraît certain aujourd’hui que nos vieux amis les protectionnistes ont quitté le champ de bataille, et que la salle du n° 17, Old-Bond-street, sera mise incessamment à louer. Depuis les dernières élections aucun d’eux n’a proposé, devant la plus petite assemblée de fermiers, le rétablissement des lois-céréales qui doivent mourir en 1849. (Mouvement d’attention.) Je ne pense pas non plus qu’ils blâmeraient beaucoup lord John Russell s’il faisait ce que je pense qu’il devrait faire, s’il suspendait les lois-céréales jusqu’à ce qu’elles soient définitivement abolies en 1849. (Vifs applaudissements.) Mais ils veulent combattre en faveur des lois de navigation. Eh bien ! nous les suivrons sur ce terrain-là, et avec un vigoureux effort nous leur enlèverons les lois de navigation comme nous leur avons enlevé les lois-céréales. Ils nous attaqueront ensuite sur les intérêts des Indes occidentales ; nous ne demandons pas mieux, et de nouveau nous les battrons sur cette question comme sur toutes les autres. (Applaudissements.)
M. Wilson porte un toast à la reine ; après lui, M. Armitage, maire de Manchester, propose le toast suivant :
Aux membres libres-échangistes des deux Chambres du Parlement ; au succès de leurs efforts pour compléter la chute de tous les monopoles !
M. F. M. Gibson, membre du Parlement de Manchester, et vice-président du Board of trade, répond à ce toast. L’orateur remercie d’abord l’auteur du toast au nom de ses collègues absents ; puis il s’excuse sur son émotion : Je devrais être, direz-vous peut-être, rassuré comme le chasseur qui entend le son du cor ; car ce n’est pas la première fois que je prends la parole dans cette enceinte ; mais je vous affirme que lorsque je pense à quel public éclairé et au courant de la question j’ai affaire, il m’est impossible de maîtriser mon embarras. J’ai cru toutefois, qu’il était de mon devoir de me trouver au milieu de mes commettants dans cette occasion importante. (Applaudissements.) J’ai cru que toute autre considération devait céder à ce devoir ; car, ancien membre de la Ligue, je m’honore, par-dessus tout, d’avoir fait partie de cette association qui, en éclairant l’opinion publique, a permis au gouvernement d’abolir l’odieux monopole du blé. (Applaudissements.) Je regrette toutefois de paraître devant vous dans un moment de dépression commerciale, dans un moment de grande anxiété pour tous ceux qui se trouvent engagés dans les affaires, dans un moment où s’est manifestée une crise grave, à laquelle nous n’avons pas encore entièrement échappé. Mais je pense, messieurs, que la politique de la liberté commerciale n’est pour rien dans les causes qui ont amené cette dépression (vifs applaudissements) ; je pense, au contraire, que la crise aurait été bien plus intense si les réformes commerciales n’avaient pas eu lieu. (Nouveaux applaudissements.)
Quoique, actuellement, la confiance soit bien altérée dans le monde commercial, il y a certains éléments sur lesquels il est permis de compter pour le rétablissement de la prospérité future. L’approvisionnement des articles manufacturés est modéré ; les prix des matières premières sont bas, et nous avons en perspective un prix modéré des subsistances. (Une voix : Non pas si les lois-céréales sont remises en vigueur.) Nous avons devant nous toutes ces choses (mouvement d’attention), et je crois que l’on peut, sans se faire illusion, croire que le retour de la confiance amènera le retour de la prospérité. (Applaudissements.) Mais permettez-moi, messieurs, de demander à ceux qui accusent par leurs vagues déclamations la liberté commerciale d’avoir causé la détresse actuelle, permettez-moi de leur demander d’être intelligibles une fois et de désigner les droits qui auraient prévenu cette détresse, s’ils n’avaient point été abolis. Était-ce le droit sur le coton ? Était-ce le droit sur la laine ou le droit sur le verre ? (Applaudissements et rires.) Est-ce que, pendant une période de famine, il aurait été sage de maintenir les droits sur les articles de subsistance ? Quels sont donc les droits qui auraient empêché la crise de se produire ? (Applaudissements.)
On nous accuse encore, nous autres libres-échangistes, d’avoir préconisé une politique qui a diminué le revenu. Diminué le revenu ! Est-ce que ceux qui émettent de semblables assertions ont bien comparé le revenu tel qu’il était, avant les réformes commencées en 1842, et tel qu’il a été depuis ? Quels sont les faits ? Le revenu, au 5 janvier 1842, s’élevait à environ 47,500,000 liv. st. ; au 5 janvier 1848, il n’était plus que de 44,300,000 liv. st. Mais quelles ont été, dans l’intervalle, les réductions opérées dans les taxes ? Il est vrai qu’on a établi, en 1842, un income-tax s’élevant à environ 5,500,000 liv. st. par an. Mais, d’un autre côté, on a retranché à la fois de la douane et de l’excise des droits qui rapportaient environ 8,000,000 liv, st., ce qui donne en faveur des réductions une balance de 3,000,000 liv. st. Il ne saurait y avoir rien de bien mauvais dans une politique qui a augmenté le revenu par une réduction des droits sur les articles de consommation. Souvenez-vous aussi que cette politique a été adoptée en 1842, après que l’on eut essayé de la politique opposée, après que l’on eut essayé d’augmenter le revenu en élevant les droits de la douane et de l’excise. On ajouta 5 % aux droits de douane ; mais les douanes ne donnèrent pas, avec cette augmentation, la moitié de ce qu’on avait estimé qu’elles rendraient. L’augmentation échoua complètement, et ce fut après la chute de cette expérience que l’on avait faite d’accroître le revenu du pays en augmentant les droits de l’excise et de la douane, que l’on adopta heureusement l’impôt direct, et qu’on affranchit de leurs entraves l’industrie et le commerce de ce pays, en réduisant les taxes indirectes. Si nous considérons isolément les chiffres du revenu des douanes et de l’excise, nous verrons qu’ils présentent une justification remarquable de la politique adoptée par sir Robert Peel. Après la réduction de 8,000,000 liv. st., dont 7,000,000 liv. st. environ pour la douane, la totalité de celte somme, à l’exception de 7 à 8,000 liv. st., a été remplacée par le pays ; c’est à peine s’il y a eu une baisse dans le revenu de la douane. On élève une autre accusation contre la liberté du commerce, à propos des exportations et des importations. On nous dit que nous avons importé plus que nous n’avons exporté, et que nos importations ont plus de valeur que nos exportations. Je réponds : S’il en est ainsi, tant mieux ! (Applaudissements.)
Ce serait une chose singulière que des marchands exportassent leurs marchandises pour recevoir en retour des produits qui auraient précisément la même valeur ; espérons qu’il y a quelque gain dans l’échange des denrées ; et, si nos importations ont excédé nos exportations^ c’est nous qui avons gagné. Mais, ajoute-t-on, une quantité d’or est sortie du pays, notre numéraire a été exporté et nos intérêts commerciaux en ont souffert. À cela je puis répondre que si la balance, comme on la nomme, a été soldée en numéraire, c’est parce que le numéraire était à cette époque la marchandise la plus convenable et la moins chère que l’on pût exporter, et qu’il y avait plus de bénéfice à l’exporter qu’à exporter les autres marchandises. Voilà tout ! À la vérité, on fait revivre aujourd’hui la vieille doctrine de la balance du commerce. Avant d’avoir lu les articles du Blackwood’s Magazine et de la Quarterly Review, j’espérais qu’elle était morte et enterrée, et qu’elle ne ressusciterait plus ; mais nos adversaires y tiennent ! Je ne vous ferais pas l’injure de défendre davantage devant vous la politique de la liberté commerciale, — laquelle certes n’a pas besoin d’être défendue, — si depuis quelque temps les organes du parti protectionniste ne s’étaient plus que jamais efforcés de donner le change au pays, s’ils n’avaient prétendu que nous nous étions montrés de mauvais prophètes et qu’un grand nombre de nos prévisions n’avaient abouti qu’à des déceptions ; mais il m’est impossible de laisser passer de semblables accusations sans y répondre. Voyons d’abord les prophéties. Avons-nous oublié celles des protectionnistes? Avons-nous oublié qu’ils prédisaient que les bonnes terres de l’Angleterre seraient laissées sans culture si les lois-céréales étaient révoquées (rires) ? que les meilleurs terrains deviendraient des garennes de lapins et des repaires de bêtes fauves ? (Rires.) Avez vous oublié cela ? Avez-vous oublié les menaces alarmantes que proférait un noble duc (le duc de Richmond) en 1839, lorsque j’eus l’honneur de paraître pour la première fois devant vous ? Souvenez-vous de la menace qu’il nous faisait de quitter le pays si les corn-law étaient révoquées. Souvenez-nous qu’il affirmait qu’alors l’Angleterre ne serait plus digne d’être habitée par des gentlemen, (Rires.) Mais félicitons-nous de posséder encore parmi nous le noble duc, félicitons-nous de ce qu’il n’a point abandonné sa patrie (rires) ; et espérons qu’il demeurera longtemps parmi nous, afin de rendre à ses concitoyens de meilleurs services que ceux qu’il leur a rendus jusqu’ici. (Tonnerre d applaudissements.) Je me souviens de beaucoup d’autres prédictions qui ont été faites à la Chambre des communes, au sujet du rappel des lois-céréales. Je me rappelle que M. Hudson, l’honorable représentant de Sunderland, disait, en février 1839, que si les lois-céréales étaient abolies, les fermiers anglais ne pourraient plus cultiver le sol, même si la rente se trouvait entièrement supprimée, et que la terre devrait être laissée en friche, parce qu’on ne pourrait plus trouver un prix rémunérateur pour ses produits. Je suis charmé que M. Hudson ait montré un plus mauvais jugement en cette matière qu’il ne l’a fait dans la direction des entreprises de chemins de fer. Dans le monde des chemins de fer, il s’est montré un homme habile et entreprenant ; mais, en fait de prophéties, nous opposerions volontiers le plus mauvais prophète que la Ligue ait jamais produit, à l’honorable représentant de Sunderland. (Applaudissements et rires.)
L’orateur, après avoir réfuté d’autres critiques qui se rattachent à la situation des colonies anglaises, dans les Indes occidentales, poursuit en ces termes :
Nous avons eu, dans ces derniers temps, des preuves si nombreuses des bons résultats de la réduction des droits et des avantages de la suppression des entraves apportées au commerce, non-seulement dans ce pays, mais encore à l’étranger, que je crois inutile de m’étendre plus longuement sur cet objet. Il y a cependant, dans nos relations extérieures, un fait sur lequel je veux appeler un instant votre attention : il s’agit de notre commerce avec la France. (Mouvement d’attention.) Considéré d’une manière absolue, ce commerce peut être regardé comme faible encore, mais il n’y en a pas qui se soit développé plus rapidement. La valeur déclarée de nos exportations pour la France s’est élevée, il y a peu de temps, à 3,000,000 de liv. st., et maintenant elle est de 2,700,000 liv. st. Or, en 1815, elle était à peine de 300,000 liv. st. La plus grande partie de cet accroissement a eu lieu, il faut bien le remarquer, à une époque récente, et le progrès s’est accompli à la suite des réductions opérées dans notre tarif, sans qu’il y ait eu la moindre réciprocité de la part de la France. Je mentionne ce fait, parce qu’il renferme un très-fort argument contre ce que l’on a nommé le système de réciprocité. Vous avez augmenté matériellement votre commerce avec la France, en réduisant vos droits sur les importations de ce pays, quoiqu’il n’ait point, de son côté, réduit ses droits sur les importations anglaises. (Applaudissements.) Je cite aussi le commerce avec la France, pour vous prouver que nous faisons autant d’affaires avec ce pays qu’avec les Indes occidentales. Ainsi donc, ces terribles Français, que l’on nous apprend à considérer comme nos ennemis naturels, sont pour nous d’aussi bonnes pratiques que nos propriétaires aimés et privilégiés des Indes occidentales. (Applaudissements.) Les Français nous prennent pour 2,700,000 liv. st. de marchandises, et les propriétaires des Indes occidentales pour 2 millions 300,000 liv. st. seulement. Et, de plus, les colons demandent pour leurs sucres une protection égale en valeur au montant de toutes nos exportations pour les Indes occidentales. Je n’exagère rien (applaudissements) ; je mentionne simplement les faits, avec les documents parlementaires sous les yeux.
Maintenant, je vous le demande, quand on jette un coup d’œil sur l’augmentation de notre commerce avec la France, ne s’aperçoit-on pas en même temps que ce commerce a établi entre les deux pays des liens d’amitié et d’intérêt, des liens qu’il serait plus difficile de briser que si leurs transactions en étaient encore au chiffre de 300,000 liv. st. comme en 1813 ? (Applaudissements.) Pour moi, messieurs, j’ai la conviction entière, et je l’exprime sans hésiter devant cette assemblée publique, que, nonobstant les services que les diplomates peuvent avoir rendus au monde, rien n’a autant de pouvoir pour prévenir la guerre et pour maintenir la paix que le développement du commerce international. (Applaudissements prolongés.) On nous avertit cependant dans le sud, — et de plus on nous rappelle qu’une lettre émanée d’un homme célèbre dans ce district (rires) nous a donné le même avis, — on nous avertit, dis-je, que, malgré cet accroissement de notre commerce avec la France, nous devons nous attendre à une invasion de la part des Français (explosion de rires), et que nous nous endormirions dans une sécurité trompeuse si nous ne préparions des forces considérables pour repousser cette invasion longuement méditée. (Rires.) Eh bien ! je ne saurais dire que je pense que vous puissiez vous dispenser de toute espèce de force militaire. Je ne saurais dire et je ne crois pas que mon excellent ami M. Cobden ait jamais dit qu’il faille détruire toutes nos défenses militaires, de terre et de mer. Il y a, je le sais, des personnes qui seraient charmées que M. Cobden eût proposé cela, mais je ne crois pas qu’il l’ait fait. Mais voici ce que nous avons à dire sur cette question. Nous sommes d’accord à penser, la grande majorité des hommes s’accorde à penser comme nous, que si les armées pouvaient être supprimées par le fait du développement des communications internationales, ce serait un immense progrès, le plus grand progrès qui eût jamais été accompli dans le monde, et le meilleur auxiliaire qui ait été donné à la civilisation, à la moralité et au bon vouloir mutuel des peuples. (Applaudissements.) Nous sommes tous d’accord là-dessus. Aucun homme, aucun homme doué de sentiments d’humanité, pourvu qu’il n’ait pas intérêt au maintien des choses (rires), ne saurait penser autrement. Néanmoins, je crois, — et je donne ici mon opinion personnelle, — que nous ne sommes pas dans une situation qui nous permette de nous dispenser de moyens de défense. Nous avons dépensé chaque année, depuis 1815, 16,000,000 de liv. st. pour la défense de notre pays, et je crois que nous avons toujours eu des moyens de défense suffisants. Je nie qu’aucun fait se soit produit qui puisse nous faire redouter aujourd’hui cette soudaine invasion des Français dont on nous menace. C’est, au reste, une vieille histoire que cette invasion. Je me souviens que M. Thomas Atwood, l’un des représentants de Birmingham, se leva, un jour, à la Chambre des communes, et dans un discours de quatre heures, que beaucoup de gens considérèrent comme un excellent discours d’invasion, prouva que l’on devait s’attendre à ce que les Russes feraient un beau matin leur apparition au pont de Londres, sans en donner le moindre avis et sans que personne se fût douté le moins du monde de leur intention de nous envahir. (Rires.) Mais aujourd’hui nous laissons la Russie de côté ; c’est de la France que nous avons peur. (Rires et mouvements.)
Le budget français nous annonce une réduction dans l’effectif militaire pour l’année prochaine. Je ne vois donc dans ce budget aucune raison de craindre ; je n’y vois rien qui me porte à craindre que la France se prépare à envahir l’Angleterre. Pourquoi réduit-on le budget de la marine, de telle sorte que l’on demandera en France, l’année prochaine, 13 navires et 2,000 hommes de moins que les années précédentes ? (Mouvement.) Mais les gentlemen de l’invasion nous disent : « Il ne faut pas vous fier au budget ; on ne le réduit que pour vous aveugler et vous plonger dans une fausse sécurité. » (Rires.) D’après cet argument, plus les Français réduiront leurs armements, plus nous devrons augmenter les nôtres. Probablement, la France a des méthodes de recueillir de l’argent que nous ne connaissons point ; elle a des moyens de lever des hommes, d’armer des vaisseaux, dont personne ne sait rien ; si bien qu’elle réduit son budget uniquement pour jeter de la poudre dans les yeux du pauvre John Bull ! (Mouvements et rires.) Je sais peu de chose sur ces matières ; mais je crois, en vérité, que tous ces rapports alarmistes ne méritent guère de crédit. Chaque fois que l’on construit en France un bassin pour l’amélioration d’un port, chaque fois que l’on y creuse un fossé, c’est, aux yeux des trembleurs de l’invasion, pour y lancer des steamers de guerre. Selon ces gens-là, ces travaux ne sont nullement entrepris dans l’intention d’accroître et de perfectionner l’industrie et le commerce de la France. Toutes les mesures adoptées pour améliorer la situation du peuple français ou pour augmenter son commerce, telles, par exemple, que l’agrandissement des ports, le creusement de nouveaux bassins au Havre et à Cherbourg, sont regardées par eux comme des moyens de préparer et de faciliter l’envahissement de la Grande-Bretagne. Ils disent que le peuple français ne se soucie pas du commerce, et que les bassins creusés par les Français ne sont pas destinés aux vaisseaux marchands, mais bien aux steamers de guerre. Eh bien! je ne suis pas de cet avis, et je crois que nous tous, en Angleterre, nous avons intérêt à l’amélioration des ports de France. (Écoutez ! écoutez !) Comme Anglais, je n’éprouve aucun sentiment de jalousie à l’aspect de semblables travaux (applaudissements) ; au contraire, je ressens de la satisfaction et de la joie lorsque j’apprends que des améliorations ont lieu dans n’importe quelle partie du globe, dans n’importe quel pays ! (Applaudissements prolongés.) Et si l’on me dit que nous devons voir avec jalousie les travaux qui s’opèrent en France pour l’amélioration des ports et pour la construction de la digue de Cherbourg, laquelle est une œuvre dont tout le monde profitera (applaudissements) ; si l’on me dit que nous devons regarder ces travaux avec des pensées d’animosité et de haine, je répondrai que je ne saurais partager de semblables pensées (applaudissements), et qu’elles ne m’inspirent aucune sympathie. (Nouveaux applaudissements.) Je suis charmé de tous ces progrès, et je crois en outre que vous n’avez pas le droit d’imputer à une grande nation la pensée d’une invasion digne tout au plus d’une horde de sauvages. (Vifs applaudissements.) Descendre en Angleterre sans aucun autre dessein que celui d’humilier le peuple de ce pays, de le priver du produit de son travail et d’insulter toutes les classes de la population, en vérité cela ne serait pas digne d’une grande nation. Vous n’avez pas le droit de jeter à la face d’un peuple de semblables imputations. (Applaudissements.) Il y a une chose que nous pouvons dire, c’est que nous voulons conserver l’appareil militaire qui sera jugé le plus convenable, parce que le monde ne nous paraît pas encore en état de se passer de moyens de défense, et que nous voulons avoir les moyens de protéger le pays ; mais autre chose est d’imputer à une nation voisine et amie des desseins qui ne peuvent manquer de soulever l’indignation de tout honnête homme en France ! Quoi ! après une si longue paix, après tant de relations amicales nouées entre les deux pays, la France serait jugée capable de si détestables desseins ! En vérité, messieurs, je ne saurais m’arrêter patiemment à cette idée que des hostilités soient encore nécessaires entre la France et l’Angleterre ! (Applaudissements prolongés.) Je ne pense pas qu’il soit possible, dans l’état actuel du monde, que ces nations voisines et maintenant en paix, l’une et l’autre avancées en civilisation, soient maintenues par n’importe quelle ruse dans un état de mutuelle haine ! (Adhésions.)
J’espère, messieurs, dans tout ce que j’ai dit, n’avoir pas employé un mot qui puisse faire mal interpréter ma pensée. Je sais que les hommes de Manchester n’aiment pas les titres ; je sais qu’ils sont naturellement portés à suspecter les membres du gouvernement (rires), et aujourd’hui même j’ai entendu dire à un honorable gentleman qu’il s’attendait à ce que je serais atteint soudainement d’un accès de grippe (rires) et hors d’état de me trouver au milieu de vous. Je sais que l’on croit généralement que les hommes n’aiment pas à dire leur pensée lorsqu’ils sont aux affaires (rires) ; mais je n’ai jamais trouvé que la franchise fût une mauvaise politique. (Applaudissements.)
Je vous ai dit sincèrement que je n’ai aucune sympathie pour ce que l’on appelle l’esprit militaire (applaudissements) ; je vous l’ai dit, mais je ne veux pas m’engager devant cette assemblée à agir de telle ou telle façon particulière dans cette question ; j’ignore encore ce que veut faire le gouvernement ; peut-être a-t-il la même opinion que moi sur l’invasion et sur la folie de la panique ; mais tout ce que je puis dire, c’est ceci : attendez, attendez, et avant de prononcer sur ses actes sachez ce qu’il proposera. Donnez votre opinion sur la lettre du comté de Lancastre ; donnez votre opinion sur M. Pigon [1] et sur la lettre du duc de Wellington ; mais ne vous prononcez pas sur les intentions du gouvernement avant de les connaître. (Applaudissements.) Laissez-moi aussi toute ma liberté d’opinion ; et si mon vote ou ma conduite clans cette question ou dans toute autre vous déplaît, vous aurez certainement l’occasion de régler mon compte d’une manière que je ne veux point nommer devant cette assemblée.
L’orateur s’occupe ensuite de l’acte qui a récemment affranchi les juifs de leurs incapacités légales, et il prononce quelques paroles, chaudement applaudies, en faveur de la liberté de conscience. J’espère, dit-il en terminant, aider dans le Parlement à l’abolition de tous les monopoles qui subsistent encore aujourd’hui, et j’ai la confiance que, sur n’importe quel point où se porte la lutte des grands principes de la liberté civile, commerciale ou religieuse, vous ne me trouverez pas en défaut, non plus qu’aucun de mes amis les partisans de la liberté des échanges. (Tonnerre d’applaudissements.)
M. Kershaw, m. P., propose le toast suivant : Aux électeurs du sud et du nord Lancastre ; aux électeurs du West-Riding de l’Yorkshire, et à tous ceux qui ont envoyé des free-traders au Parlement.
M. Cobden se lève et est accueilli par de nombreuses salves d’applaudissements. Après avoir remercié l’auteur du toast, il continue ainsi : On m’a demandé, messieurs, au moins une douzaine de fois, quel est l’objet de ce meeting. J’avoue que je ne désire pas qu’il soit regardé comme un meeting destiné à célébrer des triomphes passés, et encore moins à nous glorifier nous-mêmes ou les uns les autres. Je désire plutôt qu’on le considère comme ayant eu lieu pour témoigner que nous sommes encore en vie pour l’avenir (applaudissements) ; qu’ayant obtenu une garantie sur le statute-book pour la liberté du commerce des grains, nous entendons en obtenir une autre pour la liberté de la navigation ; que nous entendons bien empêcher les propriétaires des Indes occidentales de taxer à leur profit les membres de la communauté ; et, en résumé, que nous entendons appliquer à tous les articles du commerce les principes que nous avons appliqués au blé. (Applaudissements.) Messieurs, notre honorable représentant a traité d’une manière si habile et si complète quelques points dont j’avais l’intention de m’occuper, relativement à la question des sucres et à la justification de nos principes de liberté commerciale, que je me trouve dégagé de la nécessité d’y revenir, et je le remercie de tout mon cœur de son discours, l’un des meilleurs que j’aie entendus dans cette enceinte. (Applaudissements.) Je crois que la question de la liberté du commerce, — la question de la liberté du commerce dans tous ses détails, — est connue de cette assemblée ; je crois que toutes les réformes dont je vous ai fait l’énumération comme devant être poursuivies par nous ont l’assentiment de cette assemblée, et que tous les honorables nombres qui m’écoutent sur cette plate-forme se joindront à nous pour obtenir la complète application de nos principes dans le Parlement. (Écoutez ! écoutez !) Maintenant, messieurs, je vais m’occuper d’un autre sujet, et quoique ce sujet soit intimement lié à la question de la liberté commerciale, je désire cependant qu’on ne pense pas que je veuille exprimer les sentiments d’aucun de mes collègues dans le Parlement ; je parle seulement en mon nom, et je ne veux compromettre personne. Je touche, comme vous l’avez probablement deviné, à l’intention que l’on a manifestée d’augmenter nos armements. (Applaudissements.) Personne ne me démentira si je dis que les hommes qui, pendant la longue agitation du free-trade, ont coopéré le plus énergiquement à cette œuvre sont ceux qui prêchaient la liberté des échanges, non pas seulement pour les avantages matériels qu’elle devait amener, mais aussi pour le motif beaucoup plus élevé d’assurer la paix entre les nations. (Applaudissements.)
Je crois que c’est ce motif qui a amené dans nos rangs la grande armée des ministres de la religion, laquelle a donné une impulsion si puissante à nos progrès dans les commencements de la Ligue. J’ai connu un grand nombre des chefs de notre armée, j’ai eu l’occasion de savoir à quels mobiles ils obéissaient, et je crois que les plus ardents, les plus persévérants et les plus dévoués d’entre nos collègues, ont été des hommes qui se trouvaient stimulés par le motif purement moral et religieux dont j’ai parlé, par le désir de la paix. (Applaudissements.) Et je suis certain que chacun de ces hommes a partagé l’étonnement que j’ai éprouvé, lorsqu’à peine douze mois après que notre nation s’est proclamée libre-échangiste à la face du monde, on est venu nous annoncer qu’il fallait augmenter nos armements. (Applaudissements.) Quelle est, je le demande, la cause de cette panique ? Probablement nous pourrons la trouver dans la lettre du duc de Wellington, dans les démarches particulières qu’il annonce avoir faites auprès du gouvernement, et dans sa correspondance avec lord John Russell. Nous pouvons l’attribuer au duc de Wellington, à sa lettre et à ses démarches particulières. Je ne professe pas, je l’avoue, l’admiration que quelques hommes éprouvent pour les guerriers heureux ; mais y a-t-il, je le demande, parmi les plus fervents admirateurs du duc, un homme doué des sentiments ordinaires d’humanité qui ne souhaitât que cette lettre n’eût jamais été écrite ni publiée ? (Mouvements d’attention et applaudissements.) Le duc a passé déjà presque les limites de l’existence humaine, et nous pouvons dire sans figure oratoire qu’il est penché sur le bord de la tombe. N’est-il pas lamentable (applaudissements), n’est-ce pas un spectacle lamentable que cette main, qui n’est plus capable de soutenir le poids d’une épée, emploie le peu qui lui reste de forces à écrire une lettre, — probablement la dernière que ce vieillard adressera à ses concitoyens, — une lettre destinée à susciter de mauvaises passions et des animosités dans les cœurs des deux grandes nations voisines ? (Applaudissements.) N’aurait-il pas mieux fait de prêcher le pardon et l’oubli du passé, que de raviver les souvenirs de Toulon, de Paris et de Waterloo, et de faire tout ce qu’il faut pour engager une nation courageuse à user enfin de représailles, et à se venger de ses désastres passés ? (Écoutez ! écoutez !) N’aurait-il pas accompli une œuvre plus glorieuse en mettant de l’huile sur ces blessures, maintenant à peu près guéries, au lieu de les rouvrir, en laissant à une autre génération le soin de réparer les maux accomplis par lui ? En lisant la lettre du duc, je laisse de côté l’objet de cette lettre, et j’arrive à la fin, lorsqu’il dit : « Je suis dans ma 77e année. » Et moi j’ajoute : Cela explique et cela excuse tout ! (Applaudissements.) Nous n’avons pas, au reste, à nous occuper du duc de Wellington ; nous avons à nous occuper de ces hommes plus jeunes qui se servent de son autorité pour faire réussir leurs desseins particuliers. (Écoutez ! écoutez !) Ce dont j’ai besoin d’abord de vous faire convenir, vous et le peuple anglais, c’est que la question qui nous occupe n’est ni une question militaire ni une question navale, mais que c’est une question qu’il appartient aux citoyens de décider. (Mouvements d’attention et applaudissements.) Lorsque nous sommes en guerre, les hommes qui portent l’habit rouge et l’épée au côté peuvent prendre le pas sur nous pour aller à leur besogne, — une besogne peu enviable et qu’un excellent militaire, sir Harry Smith, a très-heureusement caractérisée en disant « que c’était un damnable commerce. » Mais nous sommes maintenant dans une situation différente, et nous voulons recueillir les fruits du passé. Il faut donc que nous calculions nous-mêmes les probabilités d’une guerre. Je disais tout à l’heure que c’était une question du ressort des citoyens. C’est une question du ressort des contribuables, qui ont à soutenir de leurs deniers l’armée et la flotte. (Applaudissements.) C’est une question du ressort des marchands, des manufacturiers, des boutiquiers, des ouvriers et des fermiers de ce pays. Et j’en demande pardon à lord Ellesmere, mais c’est une question du ressort des imprimeurs de calicots aussi. (Applaudissements prolongés.) Quelles sont les chances de guerre ? D’où la guerre doit-elle venir ? Vous êtes, je l’affirme, plus compétents pour en juger que les hommes de guerre, vous êtes plus impartiaux, car, à tout événement, votre intérêt n’est pas du côté de la guerre. Et tout homme qui est en état de lire un livre renfermant une description de la France actuelle, tout homme qui est en état de lire une traduction d’un journal français, tout homme qui veut prendre la peine de consulter le tableau des progrès du commerce, des manufactures et de la richesse des Français, tout homme, dis-je, qui est en état d’étudier ces choses, est aussi compétent qu’un soldat pour juger des probabilités de la guerre. (Applaudissements.) J’ajoute qu’il n’y a aucune époque dans l’histoire de France où ce pays ait été plus qu’en ce moment disposé à embrasser une politique pacifique, particulièrement à l’égard de l’Angleterre. Le peuple français se trouve maintenant dans une situation qui doit l’éloigner de la guerre. Il a traversé une révolution sociale qui a tellement égalisé le partage du sol, que la masse contribue à peu près d’une manière égale à l’entretien du gouvernement. L’impôt est en grande partie direct, ce qui rend le peuple très-sensible à l’endroit des dépenses publiques, et ce qui doit nécessairement le détourner de la guerre. La propriété n’est pas en France ce qu’elle est dans ce pays. Il y a en France cinq à six millions de propriétaires de terres, tandis que nous n’avons pas ici la dixième partie de ce nombre. Tous sont des hommes laborieux, économes de leurs pièces de cinq francs, et très-désireux de laisser quelque chose à leurs enfants. Je puis dire, sans crainte d’être démenti, qu’il n’y a pas au monde un peuple plus affectueux et mieux doué des sentiments de famille que le peuple français. Aussi, ai-je vu avec horreur, honte et indignation, la manière dont quelques-uns de nos journaux en ont parlé. Ils l’ont représenté comme étant dans une situation misérable et dégradée, en proie à une basse ignorance. Je suis bien charmé que l’occasion se présente à moi de démentir de pareilles fables, et de montrer sous leur vrai jour la situation et les sentiments véritables du peuple français. Il y a dans cette ville un journal qui se servait, la semaine passée, de l’argument suivant ; que nous étions obligés d’avoir une police à Manchester pour nous protéger contre les voleurs, les filous et les assassins, et, pour la même raison, qu’il nous fallait une armée pour nous protéger contre les Français. (Rires.) — Comme si les Français étaient des voleurs, des filous ou des meurtriers ! La nation française est maintenant aussi bien organisée, elle jouit d’autant d’ordre que la nôtre ; il n’y a pas eu, depuis cinq ou six ans, plus de désordres en France qu’en Angleterre. Il y a un autre journal à Londres, un journal hebdomadaire [2], qui a coutume d’écrire avec beaucoup de gravité, mais à qui la panique a probablement enlevé son sang-froid (rires) ; ce journal nous affirme que le premier engagement avec la France aura lieu sans déclaration de guerre, et que nous serons obligés de protéger Sa Majesté, dans Osbornehouse, contre ces Français peu scrupuleux qui voudraient nous l’enlever. (Rires.) Quelle leçon notre courageuse reine a donnée récemment à ces gens-là ! Elle est allée en France sans la moindre protection, et elle a abordé au rivage du château d’Eu littéralement dans une baignoire. (Rires.) Il faut donc, messieurs, qu’il y ait un bien grand courage d’un côté, ou une insigne couardise de l’autre ! (Rires et applaudissements.) Mais, à vrai dire, cette panique est une sorte de maladie périodique. Je la compare quelquefois au choléra, car je crois qu’elle nous a visités, la dernière fois, en même temps que le choléra. On nous disait alors que nous aurions une invasion des Russes, et je m’occupai de l’invasion des Russes. Je crois que si je n’avais pas été choqué de la folie de quelques journaux (et il y en a aujourd’hui qui sont presque aussi fous que ceux-là), — lesquels prétendaient que les Russes allaient aborder d’un moment à l’autre à Portsmouth, — je crois, dis-je, que je ne serais jamais devenu ni auteur ni homme public, que je n’aurais jamais écrit de pamphlets ni prononcé de discours, et que je serais demeuré jusqu’aujourd’hui un laborieux imprimeur sur calicots. (Applaudissements prolongés.) Maintenant, messieurs, il importe que nous connaissions un peu mieux les étrangers. Vous vous souvenez qu’il y a trois semaines ou un mois, j’eus l’occasion de prononcer quelques mots au sujet de l’élection de mon ami, M. Henri, à Newton, et que je m’occupai de la réduction de nos armements ; je démontrai combien il était nécessaire de réduire nos dépenses, si nous voulions poursuivre nos réformes fiscales. Dans le moment même où je parlais, un grand meeting avait lieu à Rouen, le Manchester de la France ; 1800 électeurs s’y trouvaient rassemblés pour faire une manifestation en faveur de la réforme électorale. Dans cette assemblée, un orateur, M. Visinet, a prononcé un discours dirigé absolument dans le même sens que le mien. Je vais vous en lire un morceau, en signalant les marques d’approbation données dans l’auditoire.
Après cette lecture, M. Cobden ajoute :
Ces extraits sont un peu longs ; mais j’ai pensé qu’ils vous intéresseraient (applaudissements) ; j’ai pensé que vous seriez charmés d’apprendre ce qui s’est passé au sein d’une assemblée représentant l’opinion d’une immense ville manufacturière de France : et quand vous voyez que de pareils sentiments sont applaudis comme ils l’ont été dans une assemblée française, comment voulez-vous croire, hommes de Manchester, que la France soit la nation de bandits que certains journaux vous dépeignent ? (Applaudissements.) Je ne veux pas dire qu’il n’y ait des préjugés à déraciner en France comme il y en a en Angleterre ; mais je dis qu’il ne faut pas chercher querelle à un petit nombre d’hommes à Paris, — d’hommes sans considération et sans influence en France ; — mais que nous devons tendre la main aux hommes dont je vous parlais tout à l’heure. (Applaudissements.)
Maintenant, je tâcherai de traiter avec vous d’une manière pratique et détaillée cette question des armements ; car c’est probablement la dernière fois que j’aurai à vous en parler, avant qu’elle ne soit portée devant la Chambre. C’est, je le répète, une question sur laquelle la masse des citoyens doit prononcer ; les hommes spéciaux n’ont rien à y voir. Je n’ai pas le dessein d’entrer dans les détails du métier ; je ne crois pas qu’il soit utile pour vous d’avoir la moindre connaissance pratique de l’horrible métier de la guerre. (Applaudissements.) Je veux seulement vous demander si, dans un état de paix profonde, vous autres contribuables, vous voulez vous décider à courir les risques de la guerre en gardant votre argent dans vos poches, ou bien si vous voulez permettre à un plus grand nombre d’hommes de vivre dans la paresse, en se couvrant d’une casaque rouge ou d’une jaquette bleue, sous le prétexte de vous protéger ? (Mouvement.) Pour moi, je crois que nous devons agir en toutes choses selon la justice et l’honnêteté, et partager la branche de l’olivier avec le monde entier ; et aussi longtemps que nous agirons ainsi, je veux bien courir les risques de tout ce qui pourra arriver, sans payer un soldat ou un marin de plus ! (Vifs applaudissements.) Mais ce n’est pas seulement la question de savoir si nous devons augmenter nos armements qu’il s’agit de décider. Vous avez déjà dépensé, cette année, 17,000,000 liv. st. en armements, et vous êtes très-aptes à décider si vous n’auriez pas pu faire un meilleur emploi de votre argent. (Applaudissements.) Vous êtes-vous informés si la marine que vous payez si largement est employée de la meilleure manière possible ? (Écoutez ! écoutez ! et applaudissements.) Où sont ces grands vaisseaux qui vous coûtent si cher ? Ordinairement ils voyagent en faisant un grand étalage de puissance ; mais ils ne vont ni à Hambourg ni dans la Baltique, où il y a un si grand commerce. Non ! ils ne vont pas là ; la température est rude, et il y a peu d’agrément à se trouver sur ces rivages. (Rires et applaudissements.) Vont-ils davantage dans l’Amérique du Nord, aux États-Unis, avec lesquels nous faisons la cinquième ou la sixième partie de notre commerce étranger ? Non pas ! L’arrivée d’un vaisseau de guerre anglais dans ces parages est signalée par les journaux comme un événement extraordinaire. Les matelots des navires de guerre sont fainéants, et c’est pourquoi ils font bien de n’aller pas souvent dans ce pays-là. En résumé, on n’a besoin d’eux dans aucune région commerçante. (Applaudissements.) À la fin de notre petite session, j’ai demandé un rapport sur les stations occupées par nos navires, et je vous prierai de jeter les yeux sur ce rapport. J’ai demandé un rapport sur les forces navales qui se trouvaient dans le Tage et dans les eaux du Portugal, au commencement de chaque mois, pendant l’année dernière, avec les noms des navires, le nombre des hommes et des canons. Lorsqu’il sera sous vos yeux, je ne serai aucunement surpris si vous lisez que les forces navales que nous avons dans le Tage et le Douro, et sur les côtes du Portugal, dépassent l’ensemble des forces navales américaines. Il est vrai que Lisbonne est une ville agréable, je puis en témoigner, car je l’ai visitée ; — le climat en est délicieux ; on voit là des géraniums en plein air au mois de janvier. (Rires et applaudissements.) Je ne veux pas disputer sur les goûts des capitaines et des amiraux qui ne demandent pas mieux que de passer l’année dans le Tage, si vous voulez bien le leur permettre. (Applaudissements.) On vous affirme qu’ils y sont pour servir vos intérêts ; mais je puis vous assurer qu’il n’en est rien ; votre flotte a été mise dans le Tage à l’entière disposition de la reine de Portugal et de ses ministres ; et elle est tenue de leur porter secours dans le cas où ils encourraient l’indignation du peuple par leur mauvaise administration. Voilà tout! Sans manquer aux convenances, je puis dire qu’aujourd’hui le Portugal est le plus petit et le plus misérable des États de l’Europe ; et je me demande ce que l’Angleterre peut gagner à prendre de semblables pays sous sa protection ? Le Portugal compte environ 3 millions d’habitants ; nous sommes sûrs de son commerce, par la raison fort simple que nous prenons les quatre cinquièmes du vin de Porto qu’il produit ; — et si nous ne le prenions pas, personne n’en voudrait. (Rires et applaudissements.) J’espère qu’on ne m’imputera point un sentiment odieux, j’espère que l’on prendra uniquement au point de vue économique l’argument que je vais employer ; mais je dis que si le tremblement de terre qui a ruiné Lisbonne se faisait sentir de nouveau et engloutissait le Portugal sous les eaux de l’Océan, une grande source de dilapidation serait fermée pour le peuple anglais.
Je n’accuse point les Portugais ; ils font ce qu’ils peuvent pour s’assister eux-mêmes. Dernièrement encore, un de leurs députés a été renvoyé aux cortez par le cri unanime du peuple, lequel, au dire de lord Palmerston et Cie n’exerce aucune influence en Portugal (applaudissements) ; mais chaque fois que la nation essaie de se révolter, les Anglais font usage de leur puissance pour comprimer ses efforts ! Que la reine et ses ministres administrent convenablement leur pays et le peuple sera leur meilleur soutien ! Je vous engage à suivre cette question du Portugal ; étudiez-la et examinez bien ses rapports avec la question des armements. Je sais qu’il y a en Angleterre une grande aversion pour la politique extérieure, et cela vient sans doute de ce que cette politique ne nous a jamais fait aucun bien. (Mouvement.) Mais je puis vous garantir que si vous voulez secouer votre apathie et exercer une surveillance active sur les faits et gestes du département des affaires étrangères, vous épargnerez de bonnes sommes d’argent, — ce qui, à tout prendre, serait un bon résultat par le temps qui court. (Applaudissements.) — Maintenant, messieurs, je poserai cette question : si les gens de Brighton, — si les vieilles femmes des deux sexes de Brigthon, — craignent qu’on ne vienne les arracher de leurs lits (rires), pourquoi ne rappelle-t-on pas la flotte qui est dans le Tage pour la faire croiser dans la Manche ? (Applaudissements.) Je ne suis pas marin ; mais je crois qu’aucun marin ne me démentira, si je dis qu’il vaudrait mieux pour nos équipages qu’ils naviguassent dans la Manche, que de croupir à Lisbonne dans la paresse et la démoralisation.
Nous avons des navires de guerre qui vont de Portsmouth directement à Malte, car Malte est le grand hôpital de notre marine. (Applaudissements prolongés.) Je me trouvais à Malte au commencement de l’hiver, au mois de novembre. Pendant mon séjour, un de nos vaisseaux de ligne arriva de Portsmouth ; il entra dans le port de Valette et il y demeura pendant que j’allai de Malte à Naples, et de là en Grèce et en Égypte ; il y était encore quand je retournai à Malte. Les principaux officiers étaient sur la côte, où ils vivaient dans les clubs, et le reste de l’équipage avait toutes les peines du monde à se créer l’apparence d’une occupation utile, en hissant et en abaissant alternativement les voiles et en nettoyant le pont. (Éclats de rire.) Je fus introduit chez le consul américain, qui m’entretint beaucoup de notre marine. Il me dit : « Nous autres Américains, nous regardons votre marine comme très-molle. — Qu’entendez-vous par molle ? — Oh! répliqua-t-il, les équipages de vos navires sont trop paresseux ; ils n’ont rien à faire. Vous ne pouvez espérer d’avoir de bons équipages si vos navires séjournent pendant de longs mois dans le port. Nous autres Américains, nous n’avons jamais plus de trois navires dans la Méditerranée, et un seul de ces trois navires est plus considérable qu’une frégate ; mais les instructions de notre gouvernement sont que les navires américains ne doivent jamais séjourner dans un port, qu’ils doivent traverser constamment la Méditerranée dans l’un ou l’autre sens ; visiter tantôt un port, tantôt un autre, et donner la chasse aux pirates quand il s’en montre. Nos navires sont toujours en mouvement, et il en résulte que leur discipline est meilleure que celle des navires anglais, dont les équipages demeurent dans un état de perpétuelle oisiveté. » (Mouvement.)
L’orateur revient ensuite sur la mauvaise interprétation que l’on avait donnée de son opinion, relativement à la question du désarmement. J’ai déclaré franchement à Stockport ce que je déclare encore aujourd’hui, ce que j’ai déclaré depuis douze ans dans mes écrits, — à savoir, que nous ne pourrons pas réduire matériellement nos armements aussi longtemps qu’il ne sera opéré aucun changement dans les esprits, relativement à la politique extérieure. Il faut que le peuple anglais se défasse de cette idée, qu’il lui appartient de régler les affaires du monde entier. Je ne blâme pas le ministère de maintenir nos armements ; je veux seulement appeler l’attention publique sur la folie que l’on commet en dirigeant aujourd’hui notre politique extérieure comme on le faisait autrefois. (Applaudissements.) Lorsque l’opinion publique, — lorsque la majorité de l’opinion publique, — se trouvera de mon côté, je serai charmé de voir appliquer mes vues ; mais jusque-là je veux bien être en minorité, et en minorité je resterai jusqu’à ce que je réussisse à transformer la minorité en majorité. (Applaudissements.) Mais la question qui s’agite devant vous n’est pas de savoir si nous devons démanteler notre flotte ; la question est de savoir si vous voulez ou non augmenter votre armée et votre marine. Tout en admettant que l’opinion publique n’adopte pas mes vues, à ce point de consentir à une réduction dans nos armements, je prétends, néanmoins, au nom du West-Riding de l’Yorkshire (applaudissements) ; au nom du comté de Lancastre, au nom de Londres, d’Edimbourg et de Glasgow, que l’opinion publique est avec moi. (Tonnerre d’applaudissements. — L’assemblée se lève comme un seul homme en faisant entendre des hourras prolongés.) Et si l’opinion publique s’exprime partout comme elle vient de le faire ici, nos armements ne seront pas augmentés. (Applaudissements.) Mais que cette manifestation ait lieu ou non, — je parle pour moi-même comme membre indépendant du Parlement, — on n’ajoutera pas un shilling au budget de notre armée et de notre flotte, sans qu’auparavant j’aie forcé la Chambre à une division sur cet objet. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, en commençant, je vous ai montré le lien qui unit la question des armements à celle de la liberté du commerce ; en terminant, je vous dirai que la question de la liberté du commerce est grandement compromise en Europe par les mesures proposées au sujet de nos défenses nationales. Je reçois des journaux de Paris, et je vous dirai qu’à Paris il y a des libres-échangistes qui se sont associés et qui publient un journal hebdomadaire pour éclairer les esprits, comme notre Ligue a publié le sien. Ce journal est dirigé par mon habile et excellent ami M. Bastiat, et la semaine dernière il s’affligeait des remarques d’un autre journal, le Moniteur industriel, qui prétendait que l’Angleterre n’était pas sincère dans sa politique de liberté commerciale, et que, s’apercevant que les principes proclamés par elle n’étaient pas adoptés en Europe, elle préparait ses armements pour enlever par la force ce qu’elle avait cru pouvoir enlever par la ruse. J’exhorte mes concitoyens à résister à cette tentative, qui est faite pour répandre de l’odieux sur nos principes. Nous avons commencé à prêcher la liberté commerciale, avec la conviction qu’elle amènerait la paix et l’harmonie parmi les nations ; mais les free-traders les plus enthousiastes n’ont jamais dit, comme le prétendent certains journaux, qu’ils s’attendaient à ce que la liberté commerciale amènerait l’ère rêvée par les millénaires. Nous ne nous sommes jamais attendus à rien de semblable. Nous nous sommes attendus à ce que les autres nations demanderaient du temps, comme la nôtre l’a fait, pour adopter nos vues ; mais ce que nous avons toujours espéré, le voici : c’est que les peuples de l’Europe ne nous verraient point douter nous-mêmes les premiers de la tendance de nos propres principes, et nous armer contre les peuples avec lesquels nous voulions entretenir seulement des relations d’amitié. Nous avons entrepris de faire du libre-échange l’avant-coureur de la paix ; voilà tout ! Lorsque nous avons planté l’olivier, nous n’avons jamais pensé que ses fruits mûriraient en un jour, mais nous avons eu l’espoir de les recueillir dans leur saison ; et avec l’aide du Ciel et la vôtre, il en sera ainsi ! (Applaudissements prolongés.)
Le colonel Thompson propose un toast à la Ligue et à ses travaux, dont l’utilité a été si grande pour le pays et pour le monde.
M. Bright répond à ce toast : Si quelqu’un dans cette assemblée avait, en venant ici, quelques doutes sur le véritable objet de notre réunion, ses doutes doivent être maintenant dissipés. On m’a demandé pourquoi nous nous réunissions, maintenant que le monde politique est si calme, et que les réformes que nous avons poursuivies dans cette enceinte sont pour la plupart accomplies ; j’ai répondu que nous nous réunissions pour faire honneur au grand principe qui a triomphé, et à un autre principe qui marche vers un plus grand triomphe encore, — à ce principe que, dans l’avenir, l’opinion du peuple sera le seul guide, et l’intérêt du peuple le seul objet du gouvernement de ce pays. Je n’aurai pas besoin de faire longuement l’apologie de la liberté commerciale. Si jamais principe a été triomphant, si jamais but poursuivi par une grande association a été justifié par les résultats, c’est bien le principe de la liberté du commerce et le but qui a été poursuivi par les agitateurs de notre association. (Applaudissements.) N’avons-nous pas entendu dire, pendant de longues années, qu’il fallait que ce pays fût entièrement indépendant de l’étranger ? Et maintenant ne devons-nous pas avouer que c’est grâce aux importations de subsistances de l’étranger que plusieurs millions de nos concitoyens ont conservé la vie, pendant ces dix-huit mois ? Ne nous disait-on pas que le meilleur moyen d’avoir un approvisionnement sûr et abondant de subsistance, c’était de protéger nos cultivateurs ? Et n’est-il pas prouvé à présent qu’après trente années d’une protection rigoureuse, des millions de nos concitoyens seraient morts de faim, si nous n’avions pas reçu du blé du dehors ? Ne nous disait-on pas encore que si nous achetions du blé à l’étranger, nous serions obligés d’exporter des masses considérables d’or, et que cet or servirait à édifier des manufactures rivales des nôtres ? Eh bien ! il y a eu des importations et des exportations considérables de numéraire destinées au paiement du blé, mais où le numéraire a-t-il été retenu ? Ne nous revient-il pas, en ce moment, aussi vite qu’il s’en était allé ? Et, de plus, la nation qui a pris la plus grande partie de cet or, les États-Unis n’ont-ils pas doublé ou triplé leurs achats de nos marchandises depuis un an ? (Applaudissements.) Si quelqu’un vient se plaindre à moi de la liberté commerciale, — quoique je doive dire que peu d’hommes s’en plaignent, si ce n’est quelques esprits obtus que nous ne parviendrons jamais à convaincre, — si quelqu’un me demande si la liberté commerciale a triomphé, si notre politique a réussi, je lui cite les seize millions de quarters de blé qui ont été importés dans les seize derniers mois et je lui demande : qu’auriez-vous fait sans cette importation ? Vous auriez eu une anarchie, une ruine, une mortalité sans exemple dans aucun temps et dans aucun pays ; vous auriez souffert toutes ces épouvantables calamités si votre politique de restriction et d’exclusion était demeurée plus longtemps en vigueur. (Applaudissements.) Jamais l’efficacité d’un principe n’a été aussi admirablement prouvée que l’a été celle du nôtre, pendant les douze derniers mois. Si un homme avait pu s’élever assez haut pour embrasser le monde de son regard, qu’aurait-il vu ? Que faisait alors pour notre pays le génie du commerce ? Nous étions abattus par la peur, nous étions en proie à la famine, nous implorions du monde entier notre salut ; et le commerce nous a répondu de toutes les régions du globe. Sur les bords de la mer Noire et de la Baltique, auprès du Nil classique et du Gange sacré, sur les rives du Saint-Laurent et du Mississipi, dans les îles éloignées de l’Inde, dans le naissant empire de l’Australie, des créatures humaines s’occupaient de recueillir et d’expédier les fruits de leurs moissons pour nourrir le peuple affamé de ce royaume. (Applaudissements.) L’orateur s’occupe ensuite des résultats politiques de la liberté des échanges. Le rappel des lois-céréales, dit-il, peut être comparé, dans le monde politique, à la débâcle qui suit une longue gelée. Lorsque le dégel arrive, vous voyez sur les fleuves des masses de glaçons se disloquer et se disjoindre; ils se mettent séparément en marche ; tantôt ils se touchent, tantôt ils se séparent, mais tous tendent au même but, tous sont entraînés vers l’Océan. C’est ainsi que nous voyons dans notre Parlement les vieux partis se dissoudre pour toujours. Et dans notre Parlement comme au dehors, nous voyons la masse aspirer et marcher vers une liberté plus grande que celle dont nous avons joui jusqu’à ce jour. (Applaudissements.) Où donc allons-nous ? (L’orateur énumère les réformes gui restent à accomplir ; en première ligne il place la réforme de l’Église établie, puis celle de la transmission des propriétés.) Cette question de la tenure du sol et du mode selon lequel il doit être transmis de main en main et de père en fils, intéresse l’Angleterre et l’Écosse aussi bien que l’Irlande. Les abus qui subsistent depuis si longtemps ont pris naissance à une époque où la population était clair-semée et où le peuple n’avait aucun pouvoir. Il s’agit maintenant de les détruire ; et de même que le Parlement a admis la libre introduction des blés étrangers, de même — quoi que puissent faire les influences aristocratiques — il admettra avant peu l’affranchissement du sol, — la liberté sera donnée à la terre comme elle a été donnée à ses produits. (Applaudissements.)
Il est singulier que, dans ce meeting, toutes les pensées se soient tournées vers une question à laquelle personne ne songeait il y a quelques semaines ; je veux parler du cri de guerre qui a été jeté dans le pays. J’entends dire de tout côté qu’il y a eu une panique. Eh bien ! moi, je suis persuadé du contraire : il n’y a pas eu de panique. Voici ce qui est arrivé. Mon honorable ami le représentant du West-Riding de l’Yorkshire (M.Cobden) est allé au fond du Cornouailles ; il y a lu les journaux de Londres et il s’est imaginé que nous ajoutions foi à ce qu’ils disaient. (Rires.) Il faut que je vous donne une autre preuve de sa crédulité. Lorsqu’il se trouvait en Espagne, il m’écrivit une lettre à peu près au moment où une querelle paraissait s’être élevée entre lord Palmerston et quelqu’un à Paris, à propos du mariage de la reine d’Espagne, et savez-vous ce qu’il disait ? Il nous suppliait de ne pas entreprendre une guerre à ce sujet, il nous suppliait de ne pas nous livrer à la manie de la guerre. Étant en Espagne, il avait évidemment tout à fait oublié le caractère du peuple au milieu duquel il avait vécu ! (Rires.) Il a lu les journaux de Londres, et il s’est imaginé que nous tous y écrivions des premiers Londres. Le fait est que la panique est demeurée tout entière parmi les chefs du parti militaire de ce pays et les rédacteurs en chef des journaux. (Rires.) Pour moi, je suis persuadé que toute cette panique n’est qu’une feinte. Je crois que je puis vous en donner le secret. C’est la coutume dans ce pays que plus un homme est riche, moins il laisse au plus grand nombre de ses enfants. (Écoutez — et applaudissements.) Si un honnête fabricant de coton, ou un marchand, ou un imprimeur sur calicots, vient à amasser 20,000 ou 30,000 liv. st., il s’arrange ordinairement de manière à partager également cette somme entre ses enfants lorsqu’il quitte la terre. (Applaudissements.) Je ne sais vraiment comment un homme qui possède des sentiments naturels et une dose ordinaire d’honnêteté pourrait faire autrement. Mais plus un homme titré possède de propriétés, surtout si ces propriétés consistent en champs, plus il juge nécessaire que son fils aîné les possède toutes après lui. Le colonel Thompson, en donnant l’explication du fait, dit que l’intention de cet homme est de rendre une main assez forte pour contraindre le public à entretenir le reste de la famille. (Rires.) Or, vous savez que les familles aristocratiques se multiplient tout comme les familles des autres classes. (Rires.) Il y a d’abord un ou deux enfants autour de la table ; puis, — petit à petit, — il en vient six ou huit, ou dix ou douze, comme le bon Dieu les envoie. Tous ces enfants sont entretenus dans l’idée qu’ils souffriraient dans leur dignité, si on les voyait offrir quelque chose à vendre. Ils n’embrassent pas la carrière commerciale, ils suivent celle des emplois publics. (Rires.) Ils sont tellement pleins de patriotisme qu’ils ne veulent rien faire, si ce n’est consacrer leurs services à leurs concitoyens. Mais la pitance devient de jour en jour plus maigre. (Rires.) Les classes moyennes ont, de jour en jour, fourni un plus grand nombre d’hommes actifs, habiles et intelligents, qui sont venus faire concurrence aux membres de l’aristocratie, dans les services publics. La conséquence de ce fait était facile à prévoir. Comme dirait le colonel Thompson, il est arrivé que cette population a pressé sur les moyens de subsistance. (Rires.) Elle a besoin aujourd’hui d’une carrière plus large pour déployer son énergie, — qu’elle applique principalement à ne rien faire et à manger des taxes. (Rires et applaudissements.)
Songez qu’il s’est passé, depuis une trentaine d’années, des choses qui ont dû plonger dans le désespoir une portion considérable de la classe aristocratique. Prenez les vingt-cinq dernières années et comparez-les à n’importe quelle période de vingt-cinq ans de notre histoire, et vous verrez que nous avons accompli une véritable révolution, une révolution glorieuse et pacifique, et d’autant plus glorieuse qu’elle a été plus pacifique. Nous avons eu, dans nos lois et dans nos institutions, dans la politique de notre gouvernement, dans la constitution même du pouvoir, des changements plus considérables que d’autres n’en ont obtenu par des révolutions sanglantes. Et qui sait ce qui pourra survenir encore ? « Si nous avons trente autres années de paix et si des clubs pour la liberté du commerce s’ouvrent, dans toutes les grandes villes du royaume, disent les membres de l’aristocratie, nous voudrions bien savoir ce qui adviendra. » Sans aucun doute, quelque chose de très-sérieux pour quelques-uns d’entre eux. Ils en sont, du reste, bien persuadés. Il y a un duel à mort entre l’esprit de guerre et le progrès politique, social et industriel. Nous servirions les desseins de cette classe antinationale, si nous permettions à l’esprit de guerre de se répandre dans la Grande-Bretagne. Laissez-le prévaloir, laissez la guerre désoler de nouveau le monde, et vous aurez beau faire des meetings, aucune nouvelle réforme sociale et industrielle ne s’accomplira dans le gouvernement du Royaume-Uni. (Applaudissements.) Je sais bien que si vous jetez un regard sur les pages de notre histoire dans ces trente dernières années, elles ne vous paraîtront pas aussi brillantes que celles des trente années précédentes. Il n’y a pas eu autant d’hommes nés pour être de grands généraux ou des amiraux ; il n’y a pas eu autant de grandes victoires par mer et par terre ; vos églises et vos cathédrales n’ont pas été, dirai-je ornées ? ne devrais-je pas plutôt dire souillées ? par les trophées de la guerre. Un illustre Français, Lamartine, a dit : « Le sang est ce qui brille le plus dans l’histoire, cela est vrai, mais il tache. » « Le sang et la liberté s’excluent, » dit-il encore. Je vous en supplie, messieurs, par toutes les victoires que vous avez déjà remportées, par toutes celles que vous pouvez remporter encore, résistez, résistez énergiquement à tout ce que l’on pourrait vous dire pour entretenir en vous des pensées hostiles aux étrangers, à tout ce que l’on pourrait vous dire pour vous engager à augmenter la somme que vous dépensez en armements. (Applaudissements.)
Messieurs, le pouvoir du peuple s’étend chaque jour ; efforçons-nous bien de prouver que ce pouvoir est un bienfait pour ceux qui le possèdent. J’imagine quelles seront les exclamations de l’United Service et du club de l’armée et de la marine, lorsque les journaux arriveront à Londres avec un compte rendu de ce meeting. Oh ! c’est une époque glorieuse que celle où des milliers de citoyens peuvent se réunir librement ! car il n’est pas de liberté plus grande, plus féconde, que celle dont nous jouissons aujourd’hui, — de discuter librement et ouvertement, d’approuver librement ou de condamner librement la politique de ceux qui gouvernent ce grand empire. (Applaudissements.) Je suis resté souvent debout sur le rivage, lorsqu’il n’y avait pas un souffle d’air qui ridât la surface de l’Océan. J’ai vu la marée s’élever, comme si elle était mue par quelque impulsion mystérieuse et irrésistible qui lançait successivement les vagues sur le rivage. Nous qui sommes une grande et magnanime nation, ayons dans nos âmes ce souffle mystérieux et irrésistible, cet amour pour la liberté, cet amour pour la justice ! Il nous poussera en avant, en avant toujours, et nous fera obtenir triomphe sur triomphe, jusqu’à ce que cette nation soit — comme toutes les nations peuvent l’être un jour — une communauté heureuse et fortunée, que le monde se proposera pour modèle. (Applaudissements prolongés.)
M. Brotherton propose un autre toast à la liberté du commerce et à la paix.
M. George Thompson répond au toast porté par M. Brotherton. Ne laissons pas revivre, dit-il, les animosités nationales, lorsque les Français eux-mêmes nous donnent un exemple que nous pourrions suivre avec profit. Dans chacun des soixante banquets qui ont eu lieu récemment pour la réforme électorale, un toast a été porté « à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. » M. le colonel Thompson se demandait alors ce que penserait un naturel d’un pays éloigné, converti au christianisme par un de nos missionnaires, si, venant dans ce pays, il nous trouvait
occupés à nous préparer à la guerre contre une nation qui ne
nous a pas témoigné le moindre sentiment d’hostilité. Si les classes ouvrières sont appelées à faire partie de la milice, qu’elles demandent au moins au gouvernement de connaître la cause pour laquelle elles sont destinées à combattre ; qu’elles prennent avantage de l’obligation qu’on leur imposera de verser leur sang, s’il en est besoin, pour revendiquer les droits du citoyen et quelques biens qui valent la peine d’être défendus. (Applaudissements.)
Des remercîments sont ensuite votés aux membres du Parlement qui ont honoré le banquet de leur présence ; puis l’assemblée se sépare.
FN:M. Pigon, grand fabricant de poudre et l’un des principaux instigateurs de la panique.
FN:Le Spectator.
Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849 492 ↩
| Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849 | La réforme coloniale |
À partir de la révolution de Février, des devoirs nouveaux et impérieux réclament tous les instants de Bastiat. Il s’y dévoue avec une ardeur funeste à sa santé et interrompt la tâche qu’il s’était donnée de signaler à la France les bienfaits de la liberté commerciale en Angleterre.
Une invitation lui parvint, le 11 janvier 1849, de la part des free-traders, qui avaient résolu de célébrer à Manchester le 1er février, ce jour où, conformément aux prescriptions législatives, toute restriction sur le commerce des grains devait cesser. Nous reproduisons la réponse qu’il fit alors à M. George Wilson, l’ancien président de la Ligue et l’organe du comité chargé des préparatifs de cette fête.
Monsieur,
« Veuillez exprimer à votre comité toute ma reconnaissance pour l’invitation flatteuse que vous m’adressez en son nom. Il m’eût été bien doux de m’y rendre, car, Monsieur, je le dis hautement, il ne s’est rien accompli de plus grand dans ce monde, à mon avis, que cette réforme que vous vous apprêtez à célébrer. J’éprouve l’admiration la plus profonde pour les hommes que j’eusse rencontrés à ce banquet, pour les George Wilson, les Villiers, les Bright, les Cobden, les Thompson et tant d’autres qui ont réalisé le triomphe de la liberté commerciale, ou plutôt, donné à cette grande cause une première et décisive impulsion. Je ne sais ce que j’admire le plus de la grandeur du but que vous avez poursuivi ou de la moralité des moyens que vous avez mis en œuvre. Mon esprit hésite quand il compare le bien direct que vous avez fait au bien indirect que vous avez préparé ; quand il cherche à apprécier, d’un côté, la réforme même que vous avez opérée, et de l’autre, l’art de poursuivre légalement et pacifiquement toutes les réformes, art précieux dont vous avez donné la théorie et le modèle.
Autant que qui que ce soit au monde, j’apprécie les bienfaits de la liberté commerciale, et cependant je ne puis borner à ce point de vue les espérances que l’humanité doit fonder sur le triomphe de votre agitation.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger, sans discuter et consolider, chemin faisant, le droit de propriété. Et peut-être l’Angleterre doit-elle à votre propagande de n’être pas, à l’heure qu’il est infestée, comme le continent, de ces fausses doctrines communistes qui ne sont, ainsi que le protectionnisme, que des négations, sous formes diverses, du droit de propriété.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger, sans éclairer d’une vive lumière les légitimes attributions du gouvernement et les limites naturelles de la loi. Or, une fois ces attributions comprises, ces limites fixées, les gouvernés n’attendront plus des gouvernements prospérité, bien-être, bonheur absolu ; mais justice égale pour tous. Dès lors les gouvernements, circonscrits dans leur action simple, ne comprimant plus les énergies individuelles, ne dissipant plus la richesse publique à mesure qu’elle se forme, seront eux-mêmes dégagés de l’immense responsabilité que les espérances chimériques des peuples font peser sur eux. On ne les culbutera pas à chaque déception inévitable, et la principale cause des révolutions violentes sera détruite.
Vous n’avez pu démontrer, au point de vue économique, la doctrine du libre-échange sans ruiner à jamais dans les esprits ce triste et funeste aphorisme : Le bien de l’un, c’est le dommage de l’autre. Tant que cette odieuse maxime a été la foi du monde, il y avait incompatibilité radicale entre la prospérité simultanée et la paix des nations. Prouver l’harmonie des intérêts, c’était donc préparer la voie à l’universelle fraternité.
Dans ses aspects plus immédiatement pratiques, je suis convaincu que votre réforme commerciale n’est que le premier chaînon d’une longue série de réformes plus précieuses encore. Peut-elle manquer, par exemple, de faire sortir la Grande-Bretagne de cette situation violente, anormale, antipathique aux autres peuples, et par conséquent pleine de dangers, où le régime protecteur l’avait entraînée ? L’idée d’accaparer les consommateurs vous avait conduits à poursuivre la domination sur tout le globe. Eh bien ! je ne puis plus douter que votre système colonial ne soit sur le point de subir la plus heureuse transformation. Je n’oserais prédire, bien que ce soit ma pensée, que vous serez amenés, par la loi de votre intérêt, à vous séparer volontairement de vos colonies ; mais alors même que vous les retiendrez, elles s’ouvriront au commerce du monde, et ne pourront plus être raisonnablement un objet de jalousie et de convoitise pour personne.
Dès lors que deviendra ce célèbre argument en cercle vicieux : « Il faut une marine pour avoir des colonies, il faut des colonies pour avoir une marine ? » Le peuple anglais se fatiguera de payer seul les frais de ses nombreuses possessions, dans lesquelles il n’aura pas plus de priviléges qu’il n’en a aux États-Unis. Vous diminuerez vos armées et vos flottes ; car il serait absurde, après avoir anéanti le danger, de retenir les précautions onéreuses que ce danger seul pouvait justifier. Il y a encore là un double et solide gage pour la paix du monde.
Je m’arrête, ma lettre prendrait des proportions inconvenantes, si je voulais y signaler tous les fruits dont le libre échange est le germe.
Convaincu de la fécondité de cette grande cause, j’aurais voulu y travailler activement dans mon pays. Nulle part les intelligences ne sont plus vives ; nulle part les cœurs ne sont plus embrasés de l’amour de la justice universelle, du bien absolu, de la perfection idéale. La France se fût passionnée pour la grandeur, la moralité, la simplicité, la vérité du libre-échange. Il ne s’agissait que de vaincre un préjugé purement économique, d’établir pour ainsi dire un compte commercial, et de prouver que l’échange, loin de nuire au travail national, s’étend toujours tant qu’il fait du bien, et s’arrête, par sa nature, en vertu de sa propre loi, quand il commencerait à faire du mal ; d’où il suit qu’il n’a pas besoin d’obstacles artificiels et législatifs. L’occasion était belle, — au milieu du choc des doctrines qui se sont heurtées dans ce pays, — pour y élever le drapeau de la liberté. Il eût certainement rallié à lui toutes les espérances et toutes les convictions. C’est dans ce moment qu’il a plu à la Providence, dont je ne bénis pas moins les décrets, de me retirer ce qu’elle m’avait accordé de force et de santé ; ce sera donc à un autre d’accomplir l’œuvre que j’avais rêvée, et puisse-t-il se lever bientôt !
C’est ce motif de santé, ainsi que mes devoirs parlementaires, qui me forcent à m’abstenir de paraître à la démocratique solennité à laquelle vous me conviez. Je le regrette profondément, c’eût été un bel épisode de ma vie et un précieux souvenir pour le reste de mes jours. Veuillez faire agréer mes excuses au comité et permettez-moi, en terminant, de m’associer de cœur à votre fête par ce toast :
À la liberté commerciale des peuples ! à la libre circulation des hommes, des choses et des idées ! au libre-échange universel et à toutes ses conséquences économiques, politiques et morales !
Je suis, Monsieur, votre très-dévoué,
Frédéric Bastiat.
15 janvier 1849.
À M. George Wilson.
La réforme coloniale en Angleterre. — Discours de M. Cobden à Bradford 497 ↩
discours prononcé au meeting de bradford, par M. Cobden.
Les free-traders anglais poursuivent, avec une ardeur que nous sommes, hélas ! impuissants à imiter, la réforme de la vieille législation économique de la Grande-Bretagne. Aux protectionnistes qui demandent la restauration des vieux abus, ils ne répondent qu’en exigeant incessamment des réformes nouvelles. Non contents d’avoir obtenu la suppression complète et définitive des lois-céréales, la modification presque radicale des lois de navigation, l’égalisation des droits sur les sucres, ils demandent aujourd’hui, entre autres réformes, la suppression entière du vieux régime colonial, l’émancipation politique des colonies. Comme toujours, M. Cobden a pris les devants dans cette question. C’est dans la tournée qu’il vient de faire pour combattre dans ses foyers mêmes l’agitation protectionniste, qu’il a fait lever ce nouveau lièvre, pour ainsi dire entre les jambes de ses adversaires. Les applaudissements qui ont accueilli ses paroles nous prouvent, du reste, que la cause de l’émancipation coloniale est déjà plus qu’à moitié gagnée dans l’opinion, tant les saines doctrines de la science économique sont devenues populaires dans la Grande-Bretagne !
C’est dans un meeting convoqué à la Société de tempérance de Bradford, et où affluait la population intelligente de cette ville, que M. Cobden, assisté du colonel Thompson, a exposé, avec le plus de développements, ses idées sur la réforme coloniale. Nous reproduisons les principaux passages de son discours, qui est destiné à servir de point de départ à une réforme nouvelle.
M. Cobden. Je compte vous entretenir aujourd’hui principalement de nos relations avec nos colonies. Vous avez eu connaissance, sans doute, des mauvaises nouvelles qui sont venues du Canada, du cap de Bonne-Espérance et de l’Australie. Vous avez pu voir un manifeste, émanant du Canada, dans lequel on attribue la détresse présente aux réformes commerciales. Les protectionnistes n’ont pas manqué d’en tirer parti. Voyez, se sont-ils écriés, comme ces free-traders de malheur ont ruiné nos colonies ! (Rires.) Examinons donc ce que disent nos concitoyens du Canada. Ils se plaignent de leur situation rétrograde, en comparaison de celle des États-Unis. Ils nous disent que, tandis que les États-Unis sont couverts de chemins de fer et de télégraphes électriques, ils possèdent à peine cinquante milles de chemins de fer. Encore ces tronçons de chemins perdent-ils 50 ou 80 pour 100. Mais, je le demande, aucun homme sensé pourra-t-il prétendre que la liberté du commerce des grains, qui existe seulement depuis cette année, a empêché le Canada de construire des chemins de fer, tandis que les États-Unis en construisent depuis plus de quinze ans ? — On ne saurait nier que le Canada ne soit au moins de cinquante années en arrière des États-Unis. Il y a quelques années, lorsque je voyageais dans le Canada, je demeurai frappé de cette infériorité. Cependant, alors, la protection était pleinement en vigueur ; le Canada jouissait de tous les bienfaits de cette protection prétendue. Pourquoi donc le Canada florissait-il moins alors que les États-Unis ? Tout simplement parce qu’il était sous notre protection ; parce que les États-Unis dépendaient d’eux-mêmes (applaudissements), se soutenaient et se gouvernaient eux-mêmes (applaudissements), tandis que le Canada était obligé non-seulement de recourir à l’Angleterre pour son commerce et son bien être matériel, mais encore de s’adressera l’hôtel de Downing-street pour tout ce qui concernait son gouvernement. (Applaudissements.)
Je poserai d’abord cette question préliminaire au sujet de notre régime colonial. Le Canada, avec une surface cinq ou six fois plus considérable que celle de la Grande-Bretagne, peut-il dépendre toujours du gouvernement de l’Angleterre ? N’est-ce pas une absurdité monstrueuse, une chose contraire à la nature, de supposer que le Canada, ou l’Australie, qui est presque aussi grande que toute la partie habitable de l’Europe, ou le cap de Bonne-Espérance, dont le territoire est double du nôtre ; n’est-il pas, dis-je, absurde de supposer que ces pays, qui finiront probablement par contenir des centaines de millions d’habitants, demeureront d’une manière permanente la propriété politique de ce pays ? (Applaudissements.) Eh bien ! je le demande, est-il possible que les Anglais de la mère patrie et les Anglais des colonies engagent une guerre fratricide, à l’occasion d’une suprématie temporaire, que nous voudrions prolonger sur ces contrées ? (Applaudissements.) En ce qui concerne nos colonies, ma doctrine est celle-ci : Je voudrais accorder à nos concitoyens du Canada ou d’ailleurs une aussi grande part de self-government qu’ils pourraient en demander. Je dis que des Anglais, soit, qu’ils vivent à Bradford, ou à Montréal, ou à Sidney, ou à Cape-Town, ont naturellement droit à tous les avantages du self-government. (Applaudissements.) Notre Constitution tout entière leur donne le droit de se taxer eux-mêmes par leurs représentants, et d’élire leurs propres fonctionnaires. Ce droit, qui appartient aux Anglais au dehors, est le même que celui dont nous jouissons ici. — Si nous accordions à nos colonies le droit de se gouverner elles-mêmes, cela impliquerait, sans doute, la suppression de la plus grande partie du patronage de notre aristocratie. Cela impliquerait le remplacement des Anglais de Downing-street, dans les fonctions coloniales, par les Anglais de là-bas. Il en résulterait que nous lirions plus rarement dans la Gazette des avis de cette espèce : John Thompson, esquire, a été appelé aux fonctions de solliciteur général, dans telle île, aux antipodes (rires) ; ou David Smith, esquire, a été appelé aux fonctions de contrôleur des douanes, dans tel autre endroit, à peu près inconnu (rires), et toute une série de nominations de cette espèce. Vous n’entendriez plus parler de ces sortes d’affaires, parce que les colons nommeraient eux-mêmes leurs fonctionnaires et les salarieraient eux-mêmes. (Applaudissements.) Que si vous persistez à faire ces nominations et à maintenir votre patronage sur les colonies, dans l’intérêt de vos protégés de ce pays, il arrivera de deux choses l’une : ou que vous devrez continuer à soutenir à vos frais les fonctionnaires que vous aurez nommés, ou que les colons seront obligés de les payer eux-mêmes ; et, dans ce cas, ils se croiront naturellement en droit de vous demander quelques compensations en échange. Jusqu’à présent, vous leur avez accordé une protection illusoire, une protection qui, aux colonies comme dans la métropole, a conduit aux plus funestes extravagances ; mais le temps de cette protection est fini. (Applaudissements prolongés.)
C’est au point de vue de la réforme financière que je veux surtout envisager la question. Vous ne pouvez plus faire aucune réforme importante ; vous ne pouvez plus réduire les droits sur le thé, sur le café, sur le sucre ; vous ne pouvez supprimer le droit sur le savon, la taxe odieuse qui, en grevant la fabrication du papier, atteint la diffusion des connaissances humaines (applaudissements) ; et cette autre taxe, la plus odieuse de toutes, qui pèse sur les journaux (tonnerre d’applaudissements) ; vous ne pouvez modifier ou supprimer ces taxes et beaucoup d’autres encore, si vous ne commencez par remanier complétement votre système colonial. (Applaudissements.) C’est le premier argument qu’on nous oppose à la Chambre des communes, lorsque mon ami M. Hume ou moi nous demandons une réduction de notre effectif militaire. Nous proposons, par exemple, de renvoyer dix mille hommes dans leurs foyers. Aussitôt M. Fox Maule, le secrétaire de la guerre, ou lord John Russell, ou tous les deux, se récrient : « Nous avons, disent-ils, au delà de quarante colonies, et nous entretenons des garnisons dans toutes ces colonies ; or, comme on ne peut se passer d’avoir dans la métropole un nombre suffisant de dépôts pour alimenter les garnisons de dehors, comme nous avons toujours plusieurs milliers d’hommes en mer, soit qu’ils se rendent dans nos colonies, soit qu’ils en reviennent, il nous sera impossible de réduire notre armée, aussi longtemps que nous aurons cet immense empire colonial à soutenir. »
Pour moi, je voudrais dire aux colons : « Je vous accorde dans toute son étendue le bienfait du self-government ; et j’ajouterais : Vous serez tenus aussi de payer le prix du self-government. (Applaudissements.) Vous devrez en supporter tous les frais, comme font les États-Unis, par exemple, à qui cela réussit si admirablement. Vous payerez pour votre marine, vous payerez pour vos établissements civils et ecclésiastiques. (Applaudissements.) Que pourraient-ils objecter à cela ? Je suis convaincu qu’aucune assemblée de colons, aucune assemblée composée, comme celle-ci, d’Anglais éclairés et intelligents, soit au Canada, au cap de Bonne Espérance ou en Australie, n’infirmerait la justesse et l’opportunité de mes propositions. Je suis convaincu qu’aucune ne réclamerait le maintien des dépenses que nos colonies occasionnent aujourd’hui à la métropole.
Nos colonies de l’Amérique du Nord, qui sont en contact immédiat avec les États-Unis par une frontière de 2,000 milles de longueur, contiennent environ 2 millions d’habitants. Quelle force militaire croyez-vous que nous entretenions dans ces colonies ? Nous y avons, dans ce moment, 8 à 9,000 hommes, sans compter les artilleurs, les sapeurs et les mineurs. Quelle est l’armée permanente des États Unis ? 8,700 hommes ! Voilà quelle est l’armée permanente d’un pays qui compte environ 20 millions d’habitants. (Applaudissements.) En sorte que nous entretenons, pour 2 millions d’habitants, dans nos colonies de l’Amérique du Nord, la même force qui suffit à nos voisins pour 20 millions. Si l’armée des États-Unis était proportionnée à notre armée du Canada, elle serait de 80,000 hom- mes au lieu de 8,000.
Je me demande où la nécessité pour nous d’entretenir une armée dans le Canada. Souvenez-vous bien que nos colonies ne nous payent pas un shilling pour l’entretien de nos forces militaires. Rien de pareil s’est-il jamais vu sur la surface de la terre ? Et je ne croirai jamais que si le gouvernement de ce pays eût été entre les mains de la grande masse de nos classes moyennes, au lieu d’être exclusivement entre les mains de l’aristocratie, je ne croirai jamais, dis-je, que ce ruineux système colonial se fût maintenu. (Applaudissements.) D’autres nations, l’Espagne et la Hollande, réussissent encore à tirer quelque profit de leurs colonies. Mais, en Angleterre, lorsque je consulte notre budget annuel, je vois bien une multitude d’item pour les gouverneurs, députés, secrétaires, munitionnaires, évêques, diacres et tout le reste ; mais je ne vois jamais le moindre item fourni par nos colonies pour le remboursement de ces dépenses. Je vous ai dit quel était le montant de notre armée dans le Canada ; mais nous y entretenons, en outre, tout un matériel de guerre, des équipements, de l’artillerie, etc. Rien qu’en matériel, nous y avons pour 650,000 liv. st. (Honte !) Ils ne contribuent pas même à entretenir les amorces de leurs fusils ! Mais ce n’est pas tout encore : nous entretenons aussi leurs établissements ecclésiastiques ; j’en ai justement le détail sous la main. L’évêque de Montréal nous coûte 1,000 liv. st. ; l’archevêque de Québec, 500 liv. st. ; le recteur de Québec, pour son loyer, 90 liv. st. (honte !) ; pour le cimetière des presbytériens, 21 liv. 18 sch. 6 pence. L’évêque de la Nouvelle-Écosse, 2,000 liv., etc., etc. Voilà ce que nous coûtent, chaque année, les établissements ecclésiastiques de l’Amérique du Nord. C’est nous qui faisons les frais de la nourriture spirituelle des catholiques, des épiscopaux et des presbytériens de nos colonies. Ils ne peuvent ni être baptisés, ni se marier, ni se faire enterrer à leurs frais. (Applaudissements.)
Je ne demande pas, certes, que nous établissions des contributions sur nos colonies ; car, comme Anglais, les colons pourraient nous répondre, en se fondant sur notre Constitution, qu’une contribution sans représentation n’est autre chose qu’un vol. (Applaudissements.) Du reste, depuis notre essai malheureux de taxer nos colonies d’Amérique et la rupture qui en a été la suite, nous avons renonce à ce système. Mais comment donc se fait-il que nous n’en ayons pas moins continué à étendre les limites de notre empire colonial ? Comment se fait-il que nous ayons consenti à augmenter par là même, d’année en année, la somme de nos dépenses ? Peut-on pousser plus loin la folie ! — Les colonies n’ont pas gagné plus que nous à ce système. Comparez le Canada aux États-Unis, et vous aurez la preuve que les dépenses énormes que nous avons supportées pour entretenir les forces militaires de cette colonie, construire ses fortifications et ses places, soutenir ses établissements ecclésiastiques, n’ont contribué en rien à sa prospérité. J’ajoute que la situation présente du Canada nous prouve aussi que, quels que soient les bénéfices qu’une classe de sycophantes puisse réaliser en trafiquant des places de nos établissements militaires, quels que soient les avantages que les classes qui nous gouvernent retirent de ce système, en y trouvant des moyens de patronage, et trop souvent aussi, — dans les temps passés, — des moyens de corruption, néanmoins, il n’est ni de l’intérêt des colons, ni de l’intérêt du peuple de le maintenir. Je dis que ce système n’aurait jamais dû être maintenu, et qu’il ne doit pas l’être davantage. (Applaudissements prolongés.)
M. Cobden s’occupe ensuite de la colonie du Cap, qui a refusé de recevoir les convicts de la métropole. — Les colons nous menacent d’une résistance armée, — et ils ont raison ; — mais est-on bien fondé à prétendre que ces colons belliqueux ont besoin de 2,000 à 3,500 de nos meilleurs soldats pour se protéger contre les sauvages ? Ne sont-ils pas fort capables de se protéger eux-mêmes ? L’Australie aussi ne veut plus de nos convicts. En effet, de quel droit répandrions-nous notre virus moral parmi les populations des autres contrées ? Nos colonies ne sont-elles pas bien fondées à refuser de nous servir de bagnes ? Mais si elles ne peuvent même nous tenir lieu de prisons, pourquoi en ferions-nous les frais ? — M. Cobden s’élève encore contre la prise de possession d’un rocher sur la côte de Bornéo. Nous avons voté, dit-il, 2,000 liv. st. pour le gouverneur de ce rocher, qui ne possédait pas un seul habitant ; c’est plus que ne coûte le gouverneur de la Californie. Ce n’est pas tout. Notre rajah Brooke a fait une battue sur les côtes de Bornéo, et il a massacré environ 1,500 indigènes sans défense (honte !), et c’est nous qui avons supporté la honte et payé les frais de cette indigne guerre. Notre gouverneur des îles Ioniennes nous a déconsidérés de même, auprès de tous les peuples de l’Europe. Comme si nous n’avions pas assez de nos colonies, nous nous sommes avisés encore de protéger un roi des Mosquitos. Il paraît que le principal talent de ce monarque, qui a été couronné à la Jamaïque, — toujours à nos frais, — consiste à extraire une sorte d’insectes qui s’introduisent sous la plante des pieds. C’est, en un mot, un excellent pédicure. Cependant, c’est à l’occasion d’un monarque de cette espèce, que nous sommes en train de nous quereller avec les États-Unis ; quoi de plus pitoyable ?
Le système colonial a toujours été funeste au peuple anglais. Nous nous sommes emparés de certains pays éloignés, dans l’idée que nous trouverions profit à en accaparer le commerce, à l’exclusion de tous les autres peuples. C’était absolument comme si un individu de cette ville disait : « Je ne veux plus aller au marché pour acheter mes légumes, mais je veux avoir un jardin à moi pour cultiver moi-même des légumes. » Notre langage est le même en ce qui concerne les colonies. Nous disons : Nous voulons prendre exclusivement possession de cette île-ci ou de celte île-là, et nous voulons accaparer son commerce, en restreignant ses productions à notre propre usage. Comme s’il n’était pas infiniment plus profitable pour un peuple d’avoir un marché ouvert où tout le monde puisse venir ! Les colonies se trouvent, à cet égard, dans la même situation que nous. Comme nous, elles auraient plus d’intérêt à jouir d’une entière liberté commerciale qu’à vivre sous le régime des restrictions. J’espère donc que vous pousserez unanimement le cri de self-government pour les colonies ; j’espère que vous demanderez qu’il ne soit plus voté un shilling dans ce pays pour les dépenses civiles et militaires des colonies.
Si je vous ai longuement entretenus de cette question, c’est qu’elle sera un des principaux thèmes des débats du Parlement dans la prochaine session ; c’est aussi que les destinées futures de notre pays dépendent beaucoup de la manière dont elle sera comprise par vous. Nous devons reconnaître le droit de nos colonies à se gouverner elles-mêmes ; et, en même temps, comme elles sont en âge de réclamer les droits des adultes et de se tirer d’affaire elles-mêmes, nous pouvons exiger qu’elles ne recourent plus à leur vieux père, déjà suffisamment obéré, pour couvrir les dépenses de leur ménage ; cela ne saurait évidemment devenir le sujet d’une querelle entre nous et nos colonies. — Si quelques-uns, exploitant un vieux préjugé de notre nation, m’accusent de vouloir démembrer cet empire par l’abandon de nos colonies, je leur répondrai que je veux que les colonies appartiennent aux Anglais qui les habitent. Est-ce là les abandonner ? Pourquoi en avons-nous pris possession, si ce n’est pour que des Anglais pussent s’y établir ? Et maintenant qu’ils s’y trouvent établis, n’est-il pas essentiel à leur prospérité qu’ils y jouissent des priviléges du self-government ? On m’objecte aussi que l’application de ma doctrine aurait pour résultat d’affaiblir de plus en plus les liens qui unissent la métropole et les colonies. Les liens politiques, oui, sans doute ! Mais si nous accordons de plein gré, cordialement, à nos colonies le droit de se gouverner elles-mêmes, croyez-vous qu’elles ne se rattacheront pas à nous par des liens moraux et commerciaux beaucoup plus solides qu’aucun lien politique ? Je veux donc que la mère patrie renonce à toute suprématie politique sur ses colonies, et qu’elle s’en tienne uniquement aux liens naturels qu’une origine commune, des lois communes, une religion et une littérature communes ont donnés à tous les membres de la race anglo-saxonne disséminés sur la surface du globe. (Applaudissements.)
N’oublions pas, non plus, que nous sommes des free-traders. Nous avons adopté le principe de la liberté du commerce ; et en agissant ainsi, nous avons déclaré que nous aurions le monde entier pour consommateur. Or, s’il y a quelque vérité dans les principes de la liberté du commerce, que nous avons adoptés comme vrais, il doit en résulter qu’au lieu de nous laisser confinés dans le commerce, comparativement insignifiant, d’îles ou de continents presque déserts, la liberté du commerce nous donnera accès sur le marché du monde entier. En abandonnant le monopole du commerce de nos colonies, nous ne ferons qu’échanger un privilége misérable, contre le privilége du commerce avec le monde entier. Que personne ne vienne donc dire qu’en abandonnant ce monopole, l’Angleterre nuira à sa puissance ou à sa prospérité futures ! On m’objecte enfin que nos colonies servent d’exutoires à notre population surabondante, et, qu’en les laissant, nous fermerons ces exutoires utiles. À quoi je réponds que si nous permettons à nos colonies de se gouverner elles-mêmes, elles offriront plus de ressources à nos émigrants que si elles continuent à être mal gouvernées par la métropole. D’ailleurs, que se passe-t-il aujourd’hui ? Beaucoup plus d’Anglais émigrent chaque année aux États-Unis que dans toutes nos colonies réunies. (Applaudissements.) Pourquoi ? parce que, grâce à la liberté dont jouissent les États-Unis, l’accroissement du capital y est tel, qu’un plus grand nombre de travailleurs peuvent y trouver de bons salaires que dans les pays que nous gouvernons. Accordez à nos colonies une liberté et une indépendance semblables à celles dont jouissent les États-Unis, accordez-leur l’élection de leurs fonctionnaires et la faculté de pourvoir elles-mêmes à leurs propres dépenses, accordez-leur ce stimulant ; et elles progresseront bientôt assez pour donner à votre émigration une issue plus large et meilleure. Un autre avantage que je trouve dans l’application du self-government à nos colonies, c’est qu’elles ouvriront une carrière plus large à l’ambition des classes supérieures. Les membres de ces classes se rendront aux colonies lorsque le self-government fournira une carrière à leur capacité de juges, d’administrateurs, etc., tandis que la centralisation du bureau de Downing-street les décourage aujourd’hui d’y aller. Ce n’est pas que je veuille jeter un blâme spécial sur le colonial-office. Je crois que les colonies seraient gouvernées plus mal encore par la Chambre des communes ; c’est le système que je blâme. Je conclus donc en vous suppliant de demander pour nos colonies les bienfaits de l’émancipation politique, et de refuser désormais de subvenir à leurs frais de gouvernement. Qu’elles nomment elles-mêmes leurs gouverneurs, leurs contrôleurs, leurs douaniers, leurs évêques et leurs diacres, et qu’elles payent elles-mêmes les rentes de leurs cimetières ! (Applaudissements.) Cessons à tout jamais de nous mêler de leurs affaires. Ne nous occupons plus de cette question coloniale que pour la régler à la pleine et entière satisfaction de nos concitoyens des colonies, en leur accordant tous les droits politiques qu’ils pourront nous demander. (Applaudissements prolongés.)
FN: Journal des Économistes, n° du 15 février 1850.
Discours de John Russell au Parlement 508 ↩
Plan de Lord John Russel [1]
Si l’on demandait quel est le phénomène économique qui, dans les temps modernes, a exercé le plus d’influence sur les destinées de l’Europe, peut-être pourrait-on répondre : C’est l’aspiration de certains peuples, et particulièrement du peuple anglais, vers les colonies.
Existe-t-il au monde une source qui ait vomi sur l’humanité autant de guerres, de luttes, d’oppression, de coalitions, d’intrigues diplomatiques, de haines, de jalousies internationales, de sang versé, de travail déplacé, de crises industrielles, de préjugés sociaux, de déceptions, de monopoles, de misères de toutes sortes ?
Le premier coup porté volontairement, scientifiquement au système colonial, dans le pays même où il a été pratiqué avec le plus de succès, est donc un des plus grands faits que puissent présenter les annales de la civilisation. Il faudrait être dépourvu de la faculté de rattacher les effets aux causes pour n’y point voir l’aurore d’une ère nouvelle dans l’industrie, le commerce et la politique des peuples.
Avoir de nombreuses colonies et constituer ces colonies, à l’égard de la mère patrie, sur les bases du monopole réciproque, telle est la pensée qui domine depuis des siècles la politique de la Grande-Bretagne. Or, ai-je besoin de dire quelle est cette politique ? S’emparer d’un territoire, briser pour toujours ses communications avec le reste du monde, c’est là un acte de violence qui ne peut être accompli que par la force. Il provoque la réaction du pays conquis, celle des pays exclus, et la résistance de la nature même des choses. Un peuple qui entre dans cette voie se met dans la nécessité d’être partout et toujours le plus fort, de travailler sans cesse à affaiblir les autres peuples.
Supposez qu’au bout de ce système, l’Angleterre ait rencontré une déception. Supposez qu’elle ait constaté, pour ainsi dire arithmétiquement, que ses colonies, organisées sur ce principe, ont été pour elle un fardeau ; qu’en conséquence, son intérêt est de les laisser se gouverner elles-mêmes, autrement dit, de les affranchir ; — il est aisé de voir que, dans cette hypothèse, l’action funeste, que la puissance britannique a exercée sur la marche des événements humains, se transformerait en une action bienfaisante.
Or, il est certain qu’il y a en Angleterre des hommes qui, acceptant dans tout leur ensemble les enseignements de la science économique, réclament non par philanthropie, mais par intérêt, en vue de ce qu’ils considèrent comme le bien général de l’Angleterre elle-même, la rupture du lien qui enchaîne la métropole à ses cinquante colonies.
Mais ils ont à lutter contre deux grandes puissances : l’orgueil national et l’intérêt aristocratique.
La lutte est commencée. Il appartenait à M. Cobden de frapper le premier coup. Nous avons porté à la connaissance de nos lecteurs le discours prononcé au meeting de Bradford, par l’illustre réformateur (v. pages 497 et suiv.) ; aujourd’hui nous avons à leur faire connaître le plan adopté par le gouvernement anglais, tel qu’il a été exposé par le chef du cabinet, lord John Russell, à la Chambre des communes, dans la séance du 8 février dernier.
Le premier ministre commence par faire l’énumération des colonies anglaises.
Ensuite il signale les principes sur lesquels elles ont été organisées :
En premier lieu, dit-il, l’objet de l’Angleterre semble avoir été d’envoyer de ce pays des émigrants pour coloniser ces contrées lointaines. Mais, en second lieu, ce fut évidemment le système de ce pays, — comme celui de toutes les nations européennes à cette époque, — de maintenir strictement le monopole commercial entre la mère patrie et ses possessions. Par une multitude de statuts, nous avons eu soin de centraliser en Angleterre tout le commerce des colonies, de faire arriver ici toutes leurs productions, et de ne pas souffrir qu’aucune autre nation pût aller les acheter pour les porter ici ou ailleurs. C’était l’opinion universelle que nous tirions de grands avantages de ce monopole, et cette opinion persistait encore en 1796, comme on le voit par un discours de M. Dundas, qui disait : « Si nous ne nous assurons pas, par le monopole, le commerce des colonies, leurs denrées trouveront d’autres débouchés, au grand détriment de la nation. »
Un autre trait fort remarquable caractérisait nos rapports avec nos colonies, et c’est celui-ci : il était de principe que partout où des citoyens anglais jugeaient à propos de s’établir, ils portaient en eux-mêmes la liberté des institutions de la mère patrie.
À ce propos, lord John Russell cite des lettres patentes émanées de Charles Ier, desquelles il résulte que les premiers fondateurs des colonies avaient le droit de faire des lois, avec le consentement, l’assentiment et l’approbation des habitants libres desdites provinces ; que leurs successeurs auraient les mêmes droits, comme s’ils étaient nés en Angleterre, possédant toutes les libertés, franchises et priviléges attachés à la qualité de citoyens anglais.
Il est aisé de comprendre que ces deux principes, savoir : 1° le monopole réciproque commercial ; 2° le droit pour les colonies de se gouverner elles-mêmes, ne pouvaient pas marcher ensemble. Le premier a anéanti le second, ou du moins il n’en est resté que la faculté assez illusoire de décider ces petites affaires municipales, qui ne pouvaient froisser les préjugés restrictifs dominants à cette époque.
Mais ces préjugés ont succombé dans l’opinion publique. Ils ont aussi succombé dans la législation par la réforme commerciale accomplie dans ces dernières années.
En vertu de cette réforme, les Anglais de la mère patrie et les Anglais des colonies sont rentrés dans la liberté d’acheter et de vendre selon leurs convenances respectives et leurs intérêts. Le lien du monopole est donc brisé, et la franchise commerciale étant réalisée, rien ne s’oppose plus à proclamer aussi la franchise politique.
Je pense qu’il est absolument nécessaire que le gouvernement et la Chambre proclament les principes qui doivent désormais les diriger ; s’il est de notre devoir, comme je le crois fermement, de conserver notre grand et précieux empire colonial, veillons à ce qu’il ne repose que sur des principes justes, propres à faire honneur à ce pays et à contribuer au bonheur, à la prospérité de nos possessions.
En ce qui concerne notre politique commerciale, j’ai déjà dit que le système entier du monopole n’est plus. La seule précaution que nous ayons désormais à prendre, c’est que nos colonies n’accordent aucun privilége à une nation au détriment d’une autre, et qu’elles n’imposent pas des droits assez élevés sur nos produits pour équivaloir à une prohibition. Je crois que nous sommes fondés à leur faire cette demande en retour de la sécurité que nous leur procurons.
J’arrive maintenant au mode de gouvernement de nos colonies. Je crois que, comme règle générale, nous ne pouvons mieux faire que de nous référer à ces maximes de politique qui guidaient nos ancêtres en cette matière. Il me semble qu’ils agissaient avec justice et sagesse, quand ils prenaient soin que partout où les Anglais s’établissaient, ils jouissent de la liberté anglaise et qu’ils eussent des institutions anglaises. Une telle politique était certainement calculée pour faire naître des sentiments de bienveillance entre la mère patrie et les colonies ; et elle mettait ceux de nos concitoyens, qui se transportaient dans des contrées lointaines, à même de jeter les semences de vastes communautés, dont l’Angleterre peut être fière.
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Canada. — Jusqu’en 1828, il y a eu de graves dissensions entre les ministres de la couronne et le peuple canadien. Le gouvernement de ce pays crut pouvoir régler les impôts du Canada, sans l’autorité et le consentement des habitants de la colonie. M. Huskisson proposa une enquête à ce sujet. Le Parlement s’en occupa longuement : des comités furent réunis, des commissions furent envoyées sur les lieux ; mais à la fin une insurrection éclata. Le gouvernement, dont je faisais partie, jugea à propos de suspendre, pour un temps, la constitution de la colonie. Plus tard, il proposa de réunir les deux provinces et de leur donner d’amples pouvoirs législatifs. En établissant ce mode de gouvernement, dans une colonie si importante, nous rencontrâmes une question, qui, je l’espère, a été résolue à la satisfaction du peuple canadien, quoiqu’elle ne pût pas être tranchée de la même manière dans une province moins vaste et moins peuplée. Le parti populaire du Canada réclamait ce qu’il appelait un gouvernement responsable, c’est-à-dire qu’il ne se contentait pas d’une législature librement élue, mais il voulait encore que le gouverneur général, au lieu de nommer son ministère, abstraction faite de l’opinion de la législature, ainsi que cela était devenu l’usage, fût obligé de le choisir dans la majorité de l’Assemblée. Ce plan fut adopté.
… Dans ces dernières années, le gouvernement a été dirigé, en conformité de ce que les ministres de Sa Majesté croient être l’opinion du peuple canadien. Quant lord Elgin vit que son ministère n’avait qu’une majorité insignifiante, il proposa, soit de le maintenir jusqu’à ce qu’il rencontrât des votes décidément adverses, soit de dissoudre l’Assemblée. L’Assemblée fut dissoute. Les élections donnèrent la majorité à l’opposition, et lord Elgin céda les portefeuilles à ses adversaires. Je ne crois pas qu’il fût possible de respecter plus complètement et plus loyalement le principe de laisser la colonie s’administrer elle-même.
New-Brunswick et Nouvelle-Écosse. — Le ministre rappelle que, dans ces provinces, le conseil exécutif est récemment devenu électif, de telle sorte que les affaires du pays se traitent par les habitants eux-mêmes, ce qui a fait cesser les malheureuses dissensions qui agitaient ces provinces.
Cap de Bonne-Espérance. — Le ministre annonce qu’après de longues discussions et malgré de sérieuses difficultés, il a été décidé que le gouvernement représentatif serait introduit au cap de Bonne-Espérance. L’Assemblée représentative sera élue par les habitants qui présenteront certaines garanties. On demandera des garanties plus étendues pour élire les membres du Conseil. Les membres de l’Assemblée seront élus pour cinq ans, ceux du Conseil pour dix ans, renouvelables, par moitié, tous les cinq ans.
Australie. — Je ne propose pas, pour l’Australie, une Assemblée et un Conseil, en imitation de nos institutions métropolitaines, mais un seul Conseil élu, pour les deux tiers, par le peuple, et pour un tiers, par le gouverneur. Ce qui m’a fait arriver à cette résolution, c’est que cette forme a prévalu avec succès dans la Nouvelle-Galles du Sud, et, autant que nous pouvons en juger, elle y est préférée par l’opinion populaire à des institutions plus analogues à celles de la mère patrie. (Écoutez ! écoutez ! et cris : Non ! non !) Tout ce que je puis dire, c’est que nous avons cru adopter la forme la plus agréable à la colonie, et s’il eût existé, dans la Nouvelle-Galles du Sud, une opinion bien arrêtée sur la convenance de substituer un Conseil et une Assemblée à la constitution actuelle, nous nous serions hâtés d’accéder à ce vœu.… J’ajoute que, tout en proposant pour la colonie cette forme de gouvernement, notre intention est de lui laisser la faculté d’en changer. Si c’est l’opinion des habitants, qu’ils se trouveraient mieux d’un Conseil et d’une Assemblée, ils ne rencontreront pas d’opposition de la part de la couronne.
L’année dernière, nous avions proposé que les droits de douane actuellement existants à la Nouvelle-Galles du Sud fussent étendus, par acte du Parlement, à toutes les colonies australiennes. Quelque désirable que soit cette uniformité, nous ne croyons pas qu’il soit convenable de l’imposer par l’autorité du Parlement, et nous préférons laisser chacune de ces colonies voter ion propre tarif, et décider pour elle-même.
Nous proposons qu’un Conseil électif, semblable à celui de la Nouvelle-Galles du Sud, soit accordé au district de Port-Philippe, un autre à la terre de Van-Diémen, un autre à l’Australie méridionale.
Nous proposons, en outre, que, sur la demande de deux de ces colonies, il y ait une réunion générale de tous ces Conseils australiens, afin de régler, en commun, des affaires communes, comme l’uniformité du tarif, l’uniformité de la mise à prix des terres à vendre.
Je n’entrerai pas dans plus de détails sur la portée de ce bill, puisqu’il est sous vos yeux. J’en ai dit assez pour montrer notre disposition à introduire, soit dans nos colonies américaines, soit dans nos colonies australienne, des institutions représentatives, de donner pleine carrière à la volonté de leurs habitants, afin qu’ils apprennent à se frayer eux-mêmes la voie vers leur propre prospérité, d’une manière beaucoup plus sûre que si leurs affaires étaient réglementées et contrôlées par des décrets émanés de la mère patrie.
Nouvelle-Zélande. — En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, nous montrâmes dès 1846, et peut-être d’une manière un peu précipitée, notre disposition à introduire dans ce pays des institutions représentatives. L’homme supérieur qui gouverne en ce moment la colonie nous a signalé la différence qui existe entre les naturels de la Nouvelle-Zélande et ceux de nos autres possessions, soit en Amérique, soit en Afrique, dans la Nouvelle-Hollande, ou la terre de Van-Diémen. 11 nous a fait remarquer leur aptitude à la civilisation et avec quelle répugnance ils supporteraient la suprématie d’un petit nombre de personnes de race anglaise, seules chargées de l’autorité législative. Ces objections ont frappé le gouvernement par leur justesse, et, en conséquence, nous proposâmes de suspendre la constitution. Maintenant le gouverneur écrit qu’il a institué un Conseil législatif dans la partie méridionale de la Nouvelle-Zélande. Il nous informe en outre que, dans son opinion, les institutions représentatives peuvent être introduites sans danger et avec utilité dans toute la colonie. En conséquence, et croyant son opinion fondée, nous n’attendons plus, pour agir, que quelques nouvelles informations de détail et le terme fixé par l’acte du Parlement.
Le ministre expose ensuite le plan qu’il se propose de suivre à l’égard de la Jamaïque, des Barbades, de la Guyane anglaise, de la Trinité, de Maurice et de Malte. Il parle de la répugnance que manifestent toutes les colonies à recevoir les condamnés à la transportation, et en conclut à la nécessité de restreindre ce mode de châtiment.
Quant à l’émigration qui, dans ces dernières années surtout, a acquis des proportions énormes, il se félicite de ce que le gouvernement s’est abstenu de toute intervention au-delà de quelques primes et secours temporaires. « L’émigration, dit-il, s’est élevée, depuis trois ans, à deux cent soixante-cinq mille personnes annuellement. » Il n’estime pas à moins de 1,500,000 livres sterling la dépense qu’elle a entraînée.
Les classes laborieuses ont trouvé pour elles-mêmes les combinaisons les plus ingénieuses. Par les relations qui existent entre les anciens émigrants et ceux qui désirent émigrer, des fonds se trouvent préparés, des moyens de travail et d’existence assurés à ces derniers, au moment même où ils mettent le pied sur ces terres lointaines. Si nous avions mis à la charge du trésor cette somme de 1,500,000 liv. st., indépendamment du fardeau qui en serait résulté pour le peuple de ce pays, nous aurions provoqué toutes sortes d’abus. Noua aurions facilité l’émigration de personnes impropres ou dangereuses, qui auraient été accueillies avec malédiction aux États-Unis et dans nos propres colonies. Ces contrées n’auraient pas manqué de nous dire : « Ne nous envoyez pas vos paresseux, vos impotents, vos estropiés, la lie de votre population. Si tel est le caractère de votre émigration, nous aurons certainement le droit d’intervenir pour la repousser. » Telle eût été, je n’en doute pas, la conséquence de l’intervention gouvernementale exercée sur une grande échelle.
Après quelques autres considérations, lord John Russell termine ainsi :
Voici ce qui résulte de tout ce que je viens de dire. En premier lieu, quel que soit le mécontentement, souvent bien fondé, qu’a fait naître la transition pénible pour nos colonies du système du monopole au système du libre-échange, nous ne reviendrons pas sur cette résolution que désormais votre commerce avec les colonies est fondé sur ce principe : vous êtes libres de recevoir les produits de tous les pays, qui peuvent vous les fournir à meilleur marché et de meilleure qualité que les colonies ; et d’un autre côté les colonies sont libres de commercer avec toutes les parties du globe, de la manière qu’elles jugeront la plus avantageuse à leurs intérêts. C’est là, dis-je, qu’est pour l’avenir le point cardinal de notre politique.
En second lieu, conformément à la politique que vous avez suivie à l’égard des colonies de l’Amérique du Nord, vous agirez sur ce principe d’introduire et maintenir, autant que possible, la liberté politique dans toutes vos colonies. Je crois que toutes les fois que vous affirmerez que la liberté politique ne peut pas être introduite, c’est à vous de donner des raisons pour l’exception ; et il vous incombe de démontrer qu’il s’agit d’une race qui ne peut encore admettre les institutions libres ; que la colonie n’est pas composée de citoyens anglais, ou qu’ils n’y sont qu’en trop faible proportion pour pouvoir soutenir de telles institutions avec quelque sécurité. À moins que vous ne fassiez cette preuve, et chaque fois qu’il s’agira d’une population britannique capable de se gouverner elle-même, si vous continuez à être leurs représentants en ce qui concerne la politique extérieure, vous n’avez plus à intervenir dans leurs affaires domestiques, au delà de ce qui est clairement et décidément indispensable pour prévenir un conflit dans la colonie elle-même.
Je crois que ce sont là les deux principes sur lesquels vous devez agir. Je suis sûr au moins que ce sont ceux que le gouvernement actuel a adoptés, et je ne doute pas qu’ils n’obtiennent l’assentiment de la Chambre…
Non-seulement je crois que ces principes sont ceux qui doivent vous diriger, sans aucun danger pour le présent, mais je pense encore qu’ils serviront à résoudre, dans l’avenir, de graves questions, sans nous exposer à une collision aussi malheureuse que celle qui marqua la fin du dernier siècle. En revenant sur l’origine de cette guerre fatale avec les contrées qui sont devenues les États-Unis de l’Amérique, je ne puis m’empêcher de croire qu’elle fut le résultat non d’une simple erreur, d’une simple faute, mais d’une série répétée de fautes et d’erreurs, d’une politique malheureuse de concessions tardives et d’exigences inopportunes. J’ai la confiance que nous n’aurons plus à déplorer de tels conflits. Sans doute, je prévois, avec tous les bons esprits, que quelques-unes de nos colonies grandiront tellement en population et en richesse qu’elles viendront nous dire un jour : « Nous avons assez de force pour être indépendantes de l’Angleterre. Le lien qui nous attache à elle nous est devenu onéreux et le moment est arrivé où, en toute amitié et en bonne alliance avec la mère patrie, nous voulons maintenir notre indépendance. » Je ne crois pas que ce temps soit très-rapproché, mais faisons tout ce qui est en nous pour les rendre aptes à se gouverner elles-mêmes. Donnons-leur autant que possible la faculté de diriger leurs propres affaires. Qu’elles croissent en nombre et en bien-être, et, quelque chose qui arrive, nous, citoyens de ce grand empire, nous aurons la consolation de dire que nous avons contribué au bonheur du monde.
Il n’est pas possible d’annoncer de plus grandes choses avec plus de simplicité, et c’est ainsi que, sans la chercher, on rencontre la véritable éloquence.
La reproduction que nous venons de faire a dû suffire pour démontrer que si la Ligue n’agit plus en corps, son esprit est une des forces vives de la démocratie anglaise, et qu’il anime des hommes dont la foi ardente, les lumières et les talents peuvent surmonter bien des obstacles. Bastiat, qui attendait beaucoup de ces hommes, vécut assez pour assister à la réalisation d’une partie de ses espérances. Il vit l’Angleterre abolir ses droits de navigation et réformer profondément son régime colonial. Depuis sa mort, de tristes événements, en modifiant la situation de l’Europe, ont rendu bien difficile la seconde partie de la tâche qu’il assignait aux ligueurs ; nous voulons dire l’application du principe de non-intervention et la réduction des forces militaires. Mais quelque éloigné que puisse être le jour où s’accompliront de tels vœux, — où la civilisation obtiendra des succès décisifs dans sa lutte contre le fléau de la guerre, — on peut affirmer dès aujourd’hui que les apôtres du libre-échange auront leur part dans les actions de grâces et les bénédictions qui accueilleront cette incomparable victoire.
(Note de l’Éditeur.)
FN: Journal des Économistes, n° du 16 avril 1850.
1846
Correspondence↩
à Richard Cobden: Lettre du 13 janvier 1846 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.50] [OC1] 50. Mugron, 13 janvier 1846. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, quelle reconnaissance ne vous dois-je pas pour vouloir bien songer à moi, au milieu d’occupations si pressantes et si propres à exciter au plus haut point votre intérêt ! C’est le 23 que vous m’avez écrit, le jour même de cet étonnant meeting de Manchester, qui n’a certes pas de précédent dans l’histoire. Honneur aux hommes du Lancastre ! Ce n’est pas seulement la liberté du commerce que le monde leur devra, mais encore l’art éclairé, moral et dévoué de l’agitation. L’humanité connaît enfin l’instrument de toutes les réformes. — En même temps que votre lettre, m’est parvenu le numéro du Manchester Guardian où se trouve la relation de cette séance. Comme j’avais vu, quelques jours avant, le compte rendu de votre première réunion à Manchester, dans le Courrier français, j’ai pensé que l’opinion publique était maintenant éveillée en France, et je n’ai pas cru nécessaire de traduire the report of your proceeding. J’en suis fâché maintenant, car je vois que ce grand fait n’a pas produit ici une impression proportionnée à son importance.
Que je vous félicite mille fois, mon cher Monsieur, d’avoir refusé une position officielle dans le cabinet whig. — Ce n’est pas que vous ne soyez bien capable et bien digne du pouvoir. Ce n’est pas même que vous n’y puissiez rendre de grands services. Mais, au siècle où nous sommes, on est si imbu de l’idée que quiconque paraît se consacrer au bien public, travaille en effet pour soi ; on comprend si peu le dévouement à un principe, que l’on ne peut croire au désintéressement ; et certes, vous aurez fait plus de bien par cet exemple d’abnégation et par l’effet moral qu’il produira sur les esprits, que vous n’en eussiez pu faire au banc ministériel. J’aurais voulu vous embrasser, mon cher Monsieur, quand vous m’avez appris, par cette conduite, que votre cœur est à la hauteur de votre intelligence. — Vos procédés ne resteront pas sans récompense ; vous êtes dans un pays où l’on ne décourage pas la probité politique par le ridicule.
Puisqu’il s’agit de dévouement, cela me servira de transition pour passer à l’autre partie de votre bonne lettre. Vous me conseillez d’aller à Paris. Je sens moi-même que, dans ce moment décisif, je devrais être à mon poste. Mon propre intérêt l’ordonne autant que le bien de la cause. — Depuis deux mois, nos journaux débitent sur la Ligue un tas d’absurdités, ce qu’ils ne pourraient faire si j’étais à Paris, parce que je n’en laisserais pas échapper une sans la combattre. — D’un autre côté, mieux instruit que bien d’autres sur la portée de votre mouvement, j’acquerrais dans le public une certaine autorité. — Je vois tout cela, et cependant je languis dans une bourgade du département des Landes. — Pourquoi ? Je crois vous en avoir dit quelques mots dans une de mes lettres. — Je suis ici dans une position honorable et tranquille, quoique modeste. À Paris, je ne pourrais me suffire qu’en tirant parti de ma plume, chose que je ne blâme pas chez les autres, mais pour laquelle j’éprouve une répugnance invincible. — Il faut donc vivre et mourir dans mon coin, comme Prométhée sur son rocher.
Vous aurez peut-être une idée de la souffrance morale que j’éprouve, quand je vous dirai qu’on a essayé d’organiser une Ligue à Paris. Cette tentative a échoué et devait échouer. La proposition en a été faite dans un dîner de vingt personnes où assistaient deux ex-ministres. Jugez comme cela pouvait réussir ! Parmi les convives, l’un veut 1/2 liberté, l’autre 1/4 liberté, l’autre 1/8 liberté, trois ou quatre peut-être sont prêts à demander la liberté en principe. Allez-moi faire avec cela une association unie, ardente, dévouée. Si j’eusse été à Paris, une telle faute n’eût pas été commise. J’ai trop étudié ce qui fait la force et le succès de votre organisation. — Ce n’est pas du milieu d’hommes fortuitement assemblés que peut surgir une ligue vivace. Ainsi que je l’écrivais à M. Fonteyraud, ne soyons que dix, que cinq, que deux s’il le faut, mais élevons le drapeau de la liberté absolue, du principe absolu ; et attendons que ceux qui ont la même foi se joignent à nous. Si le hasard m’avait fait naître avec une fortune plus assurée, avec dix à douze mille francs de rente, il y aurait en ce moment une ligue en France, bien faible sans doute, mais portant dans son sein les deux principes de toute force, la vérité et le dévouement.
Sur votre recommandation, j’ai offert mes services à M. Buloz. S’il m’avait chargé de l’article à insérer dans la Revue des deux Mondes, j’aurais continué l’histoire si intéressante de la Ligue jusqu’à la fin de la crise ministérielle. Mais il ne m’a pas même répondu. — Je crains bien que ces directeurs de journaux ne voient, dans les événements les plus importants, qu’une occasion de satisfaire la curiosité de l’abonné, prêts à crier, selon l’occurrence : Vive le roi, vive la Ligue !
La chambre de commerce de Bordeaux vient d’élever la bannière de la liberté commerciale. Malheureusement elle prend selon moi un texte trop restreint : l’Union douanière entre la France et la Belgique. Je vais lui adresser une lettre où je m’efforcerai de lui faire voir qu’elle aurait bien plus de puissance si elle se vouait à la cause du principe, et non à celle d’une application spéciale à tel ou tel traité. — C’est la fallacy de la réciprocité qui paralyse les efforts de cette chambre. — Les traités lui sourient parce qu’elle y voit la stipulation possible d’avantages réciproques, de concessions réciproques, et même de sacrifices réciproques. Sous ces apparences libérales, se cache toujours la pensée funeste que l’importation en elle-même est un mal, et qu’on ne le doit tolérer qu’après avoir amené l’étranger à tolérer de son côté notre exportation. Comme modèle à suivre, j’accompagnerai ma lettre d’une copie de la fameuse délibération de la chambre de commerce de Manchester des 13 et 20 décembre 1838. — Pourquoi la chambre de commerce de Bordeaux ne prendrait-elle pas en France la généreuse initiative qu’a prise en Angleterre la chambre de commerce de Manchester ?
Connaissant vos engagements si étendus, j’ose à peine vous demander de m’écrire. Cependant, veuillez vous rappeler, de temps en temps, que vos lettres sont le baume le plus efficace pour calmer les ennuis de ma solitude et les tourments qui naissent du sentiment de mon inutilité.
à Richard Cobden: Lettre du 9 février 1846 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.51] [OC1] 51. Mugron, 9 février 1846. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, au moment où vous recevrez cette lettre vous serez dans le coup de feu de la discussion. J’espère pourtant que vous trouverez un moment pour notre France ; car, malgré ce que vous me dites d’intéressant sur l’état des choses chez vous, je ne vous en parlerai pas. Je n’aurais rien à vous dire, et il me faudrait perdre un temps précieux à exprimer des sentiments d’admiration et de bonheur dont vous ne doutez pas. Parlons donc de la France. Mais avant je veux en finir avec la question anglaise. Je n’ai rien vu, dans votre Peel’s measure, concernant les vins. C’est certainement une grande faute contre l’économie politique et contre la politique. — Un dernier vestige of the Policy of reciprocal treaties se montre dans cette omission, ainsi que dans celle du timber. C’est une tache dans le projet de M. Peel ; et elle détruira, dans une proportion énorme, l’effet moral de l’ensemble, précisément sur les classes, en France et dans le Nord, qui étaient les mieux disposées à recevoir ce haut enseignement. Cette lacune et cette phrase : We shall beat all other nations, ce sont deux grands aliments jetés à nos préjugés ; ils vivront longtemps là-dessus. Ils verront là la pensée secrète, la pensée machiavélique de la perfide Albion. De grâce, proposez un amendement. Quel que soit l’absolutisme de M. Peel, il ne résistera pas à vos arguments.
Je reviens en France (d’où je ne suis guère sorti). Plus je vais, plus j’ai lieu de me féliciter d’une chose qui m’avait donné d’abord quelques soucis. C’est d’avoir mis votre nom sur le titre de mon livre. Votre nom est maintenant devenu populaire dans mon pays, et avec votre nom, votre cause. On m’accable de lettres ; on me demande des détails ; les journaux s’offrent à moi, et l’institut de France m’a élu membre correspondant, M. Guizot et M. Duchâtel ayant voté pour moi. Je ne suis pas assez aveugle pour m’attribuer ces succès ; je les dois à l’à-propos, je les dois à ce que les temps sont venus, et je les apprécie, non pour moi, mais comme moyens d’être utile. Vous serez surpris que tout cela ne m’ait pas déterminé à m’installer à Paris. En voici le motif : Bordeaux prépare une grande démonstration, trop grande selon moi, car elle embrassera force gens qui se croient free-traders et ne le sont pas plus que M. Knatchbull. Je crois que mon rôle en ce moment est de mettre à profit la connaissance des procédés de la Ligue, pour veiller à ce que notre association se forme sur des bases solides. Peut-être vous enverra-t-on le Mémorial bordelais où j’insère une série d’articles sur ce sujet. J’insiste et j’insisterai jusqu’au bout, pour que notre Ligue, comme la vôtre, s’attache à un principe absolu ; et si je ne réussis pas en cela, je l’abandonnerai.
Voilà ma crainte. — En demandant une sage liberté, une protection modérée, on est sûr d’avoir à Bordeaux beaucoup de sympathies, et cela séduira les fondateurs. Mais où cela les mènera-t-il ? à la tour de Babel. — C’est le principe même de la protection que je veux battre en brèche. Jusqu’à ce que cette affaire soit décidée, je n’irai pas à Paris. — On m’annonce qu’une réunion de quarante à cinquante négociants va avoir lieu à Bordeaux. C’est là qu’on doit jeter les bases d’une ligue, sur laquelle je suis invité à donner mon avis. Vous rappelez-vous que nous avons vainement cherché ensemble votre règlement dans l’Anti-Bread-tax circular ? Combien je regrette aujourd’hui que nous n’ayons pu réussir à le trouver ! Si M. Paulton voulait dépenser une heure à le chercher, elle ne serait pas perdue ; car je tremble que notre Ligue n’adopte des bases vacillantes. Après cette réunion, il y aura un grand meeting à la bourse pour lever un League-fund. C’est le maire de Bordeaux qui se place à la tête du mouvement.
J’avais connaissance de l’adresse que vous avez reçue de la société des économistes, mais je ne l’ai pas lue ; puisse-t-elle être digne de vous et de notre cause !
Pardon de vous entretenir si longtemps de notre France. Mais vous comprendrez que les faibles vagissements qu’elle fait entendre m’intéressent presque autant que les virils accents de sir Robert.
Une fois que l’affaire bordelaise sera réglée, je me rendrai à Paris. L’espoir de votre visite me décide.
Je vais dresser un plan pour la distribution de 50 exemplaires de ma traduction.
à Richard Cobden: Lettre de février 1846 (Bordeaux) ↩
BWV
[CW1.52] [OC1] 52. Bordeaux, février 1846. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, vous apprendrez sans doute avec intérêt qu’une démonstration se fait à Bordeaux dans le sens du free-trade. Aujourd’hui l’association s’est constituée. Le maire de Bordeaux a été nommé président. Avant peu la souscription va s’ouvrir et on espère qu’elle produira une centaine de mille francs. Voilà un beau résultat. Je n’ose concevoir de grandes espérances, et je crains que nos commencements un peu timides ne nous suscitent plus tard des obstacles. On n’a pas osé poser hardiment le principe. On se borne à dire que l’association réclame l’abolition, le plus promptement possible, des droits protecteurs. Ainsi la question de gradation est réservée, et votre total, immédiate n’a pu passer. Vu l’état peu avancé des esprits en cette matière, il eût été inutile d’insister, et il faut espérer que l’association, qui a pour but d’éclairer les autres, aura pour effet de s’éclairer elle-même.
Quand cette affaire sera organisée, je suis décidé à aller à Paris. Plusieurs lettres me sont parvenues, d’après lesquelles je dois croire que cette immense branche d’industrie qu’on nomme articles Paris est disposée à faire un mouvement. J’ai cru que mon devoir était de mettre de côté les raisons personnelles que je puis avoir de rester dans mon coin. Soyez sûr que je fais à la cause un sacrifice qui a quelque mérite, en ce qu’il n’a rien d’apparent.
Depuis un mois, mon volume a un succès extraordinaire à Bordeaux. Le ton prophétique avec lequel j’annonçais la réforme m’a fait une réputation que je ne mérite guère, car je n’ai eu qu’à être l’écho de la Ligue. Mais enfin, j’en profite pour faire de la propagande. Quand je serai à Paris, je me consulterai pour savoir s’il ne serait pas à propos de faire une seconde édition dans un format à bon marché. Je ne doute pas que l’association bordelaise ne vienne en aide au besoin. Vous m’éviteriez un travail immense si vous me désigniez deux discours de MM. Bright, Villiers et autres, après avoir pris leur avis. Cela m’éviterait de relire les trois volumes de la Ligue. Il faudrait que ces messieurs indiquassent les discours où ils ont traité la question au point de vue le plus élevé et le plus général ; où ils ont combattu les fallacies les plus universellement répandues, surtout la réciprocité. J’y joindrai des observations, des renseignements statistiques et des portraits. Enfin il faudra aussi m’indiquer quelques séances du parlement, et principalement les plus orageuses, celles où les free-traders ont été attaqués avec le plus d’acharnement. Un pareil ouvrage, vendu à 3 francs, fera plus que dix traités d’économie politique. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que fait à Bordeaux la première édition.
Je ne puis m’empêcher de déplorer que votre Premier ait manqué l’occasion de frapper l’Europe d’étonnement. Si, au lieu de dire : « J’ai besoin de nouveaux subsides pour augmenter nos forces de terre et de mer, » il avait dit : « Puisque nous adoptons le principe delà liberté commerciale, il ne peut plus être question de débouchés et de colonies. Nous renonçons à l’Orégon, peut-être même au Canada. Nos différends avec les États-Unis disparaissent, et je propose une réduction de nos forces de terre et de mer. » — S’il eût tenu ce langage, il y aurait eu, pour l’effet, autant de différence entre ce discours et les traités d’économie politique que nous sommes encore réduits à faire, qu’il y en a entre le soleil et des traités sur la lumière. L’Europe aurait été convertie en un an, et l’Angleterre y aurait gagné de trois côtés. Je me dispense de les énumérer, car je suis accablé de fatigue.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 19 février 1846 (Bordeaux) ↩
BWV
[CW1.53] [OC1] 53. Bordeaux, 19 février 1846. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je t’avais promis de t’écrire les événements de Bordeaux. Je suis si interrompu par les visites, les assemblées et autres incidents fâcheux, que l’heure du courrier arrive toujours avant que j’aie pu réaliser ma promesse ; d’ailleurs je n’ai pas grand’chose à te dire. Les choses se passent fort doucement. On a beaucoup pataugé dans les préliminaires d’une constitution. Enfin elle est sortie telle quelle de la discussion, et aujourd’hui elle est offerte à la sanction de soixante-dix à quatre-vingts membres fondateurs ; le bureau définitif va être installé, avec le maire en tête pour président, et, dans deux ou trois jours, aura lieu une grande réunion pour ouvrir la souscription. On croit que Bordeaux ira à 100,000 fr. Il me tarde de le voir. Tu comprends que ce n’est qu’à partir d’aujourd’hui, de l’installation du bureau, qu’on peut s’occuper d’un plan, puisque c’est lui qui doit avoir l’initiative. Quel sera ce plan ? Je l’ignore.
Quant à mon concours personnel, il se borne à assister aux séances, à faire quelques articles de journaux, à faire et recevoir des visites et à essuyer des objections économiques de toutes sortes. Il m’est bien démontré que l’état de l’instruction en ce genre ne suffit pas pour faire marcher l’institution, et je me retirerais sans espoir si je ne comptais un peu sur l’institution même pour éclairer ses propres membres.
J’ai trouvé ici mon pauvre Cobden tout à fait en vogue. Il y a un mois, il n’y en avait que deux exemplaires, celui que j’ai donné à Eugène et l’échantillon du libraire ; aujourd’hui on le trouve partout. J’aurais honte, mon cher Félix, de te dire l’opinion qu’on s’est formée de l’auteur. Les uns supposent que je suis un savant du premier ordre ; les autres, que j’ai passé ma vie en Angleterre à étudier les institutions et l’histoire de ce pays. Bref, je suis tout honteux de ma position, sachant fort bien distinguer ce qu’il y a de vrai et ce qu’il y a d’exagéré dans cette opinion du moment. Je ne sais si tu verras le Mémorial d’aujourd’hui (18) ; tu comprendras que je n’aurais pas pris ce ton, si je n’avais bien vu ce que je puis faire.
Il est à peu près résolu que, lorsque cette organisation sera en train, je me rendrai à Paris pour essayer de mettre en mouvement l’industrie parisienne, que je sais être bien disposée. Si cela réussit, je prévois une difficulté, c’est celle de décider les Bordelais à envoyer leur argent à Paris. Il est certain, cependant, que c’est le centre d’où tout doit partir ; car, à dépense égale, la presse parisienne a dix fois plus d’influence que la presse départementale.
Quand tu m’écriras (que ce soit le plus tôt possible), dis-moi quelque chose de tes affaires.
à M. Victor Calmètes: Lettre du 4 mars 1846 (Bayonne) ↩
BWV
[CW1.54] [OC1] 54.Bayonne, 4 mars 1846. A Victor Calmètes
Mon bon et vieil ami, ta lettre m’a réjoui le cœur, et il me semblait en la lisant que vingt-cinq ans de moins pesaient sur ma tête. Je me reportais à ces jours heureux où nos bras toujours entrelacés étaient l’image de notre cordiale union. Vingt-cinq ans ! hélas ! ils sont bien vite revenus faire sentir leur poids. 4201.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je crois qu’en elle-même la nomination de membre correspondant de l’Institut a peu d’importance, et je crains bien que beaucoup de médiocrités n’aient pu se parer de ce titre ; mais les circonstances particulières qui ont précédé ma nomination ne me permettent pas de repousser les amicales félicitations. — Je n’avais publié qu’un livre et, dans ce livre, la préface seule était mon œuvre. Rentré dans ma solitude, cette préface a travaillé pour moi, et à mon insu ; car la même lettre qui m’a appris mon élection m’a annoncé ma candidature. — Jamais de la vie je n’avais pensé à cet honneur.
Ce livre est intitulé : Cobden et la Ligue. Je te l’envoie par ce courrier, ce qui me dispense de t’en parler. — En 1842 et 1843, je m’efforçai d’attirer l’attention sur le sujet qui y est traité. J’adressai des articles à la Presse, au Mémorial Bordelais et à d’autres journaux. Ils furent refusés. Je vis que ma cause venait se briser contre la conspiration du silence ; et je n’avais d’autre ressource que de faire un livre. — Voilà comment je me suis trouvé auteur sans le savoir. Maintenant je me trouve engagé dans la carrière, et je le regrette sincèrement ; bien que j’aie toujours aimé l’économie politique, il m’en coûte d’y donner exclusivement mon attention, que j’aimais à laisser errer librement sur tous les objets des connaissances humaines. Encore, dans cette science, une seule question m’entraîne et va m’absorber : La liberté des relations internationales ; car peut-être auras-tu vu qu’on m’a assigné un rôle dans l’association qui vient de se former à Bordeaux. Tel est le siècle ; on ne peut s’y mêler sans être garrotté dans les liens d’une spécialité. 4204.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’oubliais de te parler d’élections. Les électeurs de mon pays songent à moi, mais nous nous boudons. Je prétends que leur choix est leur affaire et non la mienne, et que par conséquent je n’ai rien à leur demander. Ils veulent absolument que j’aille solliciter leurs suffrages, sans doute pour acquérir des droits sur mon temps et mes services, dans des vues personnelles. Tu vois que nous ne nous entendons pas ; aussi ne serai-je pas nommé !…
Adieu, cher Calmètes : ton ami dévoué.
Lettre à M. Dunoyer [7 mars 1845/6???], Mugron ↩
BWV
[CW1.34] [OC7] 34. Mugron, 7 mars 1845 (6???). A M. Ch. Dunoyer, membre de l’Institut
CD’s book appeared in 1845; is FB writing to him soon after??
À M. Ch. Dunoyer, membre de l’Institut
Mugron, le 7 mars 1846/45
Monsieur,
De tous les témoignages que je pourrais ambitionner, celui que je viens de recevoir de vous m’est certainement le plus précieux. Même en faisant la part de la bienveillance dans les expressions si flatteuses pour moi que porte la première page de votre livre, je ne puis m’empêcher d’avoir la certitude que votre suffrage m’est acquis, sachant combien vous avez l’habitude de mettre d’accord votre langage avec votre pensée.
Dans mon extrême jeunesse, Monsieur, un heureux hasard mit dans mes mains le Censeur européen ; et je dois à cette circonstance la direction de mes études et de mon esprit. À la distance qui nous sépare de cette époque, je ne saurais plus distinguer ce qui est le fruit de mes propres méditations de ce que je dois à vos ouvrages, tant il me semble que l’assimilation a été complète. Mais n’eussiez-vous fait que me montrer dans la société et ses vertus, ses vues, ses idées, ses préjugés, ses circonstances extérieures, les vrais éléments des biens dont elle jouit et des maux qu’elle endure ; quand vous ne m’auriez appris qu’à ne voir dans les gouvernements et leurs formes que des résultats de l’état physique et moral de la société elle-même ; il n’en serait pas moins juste, quelques connaissances accessoires que j’aie pu acquérir depuis, d’en rapporter à vous et à vos collaborateurs la direction et le principe. C’est assez vous dire, Monsieur, que rien ne pouvait me faire éprouver une satisfaction plus vraie que l’accueil que vous avez fait à mes deux articles du Journal des économistes, et la manière délicate dont vous avez bien voulu me l’exprimer. Votre livre va devenir l’objet de mes études sérieuses, et c’est avec bonheur que j’y suivrai le développement de la distinction fondamentale à laquelle je faisais tout à l’heure allusion.
à Richard Cobden: Lettre du 16 mars 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.55] [OC1] 55. Paris, 16 mars 1846. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, j’ai tardé quelques jours à répondre à votre bonne et instructive lettre. Ce n’est pas que je n’eusse bien des choses à vous dire, mais le temps me manquait ; aujourd’hui même, je ne vous écris que pour vous annoncer mon arrivée à Paris. Si j’avais pu hésiter à y venir, l’espoir que vous me donnez de vous y voir bientôt aurait suffi pour m’y décider.
Bordeaux est vraiment en agitation. Il a été de mode de s’associer à cette œuvre, il m’a été impossible de suivre mon plan, qui était de borner l’association aux personnes convaincues. La furia francese m’a débordé. Je prévois que ce sera un grand obstacle pour l’avenir ; car déjà, quand on a voulu faire une pétition aux chambres pour fixer nos prétentions, des dissidences profondes se sont révélées. — Quoi qu’il en soit, on lit, on étudie, et c’est beaucoup. Je compte sur l’agitation elle-même pour éclairer ceux qui la font. Ils ont pour but d’instruire les autres et ils s’instruiront eux-mêmes.
Arrivé hier soir, je ne puis vous rien dire par ce courrier. J’aimerais mieux mille fois réussir à former un noyau d’hommes bien convaincus que de provoquer une manifestation bruyante comme celle de Bordeaux. — Je sais que l’on parle déjà de modération, de réformes progressives, d’experiments. Si je le puis, je conseillerai à ces gens-là de former entre eux une association sur ces bases et de nous laisser en former une autre sur le terrain du principe abstrait et absolu : no protection, bien convaincu que la nôtre absorbera la leur.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 22 mars 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.56] [OC1] 56. Paris, 22 mars 1846. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, j’espère que tu ne tarderas pas à me donner de tes nouvelles. Dieu veuille qu’un arrangement soit intervenu : je ne l’espère guère et le désire beaucoup. — Une fois délivré de cette pénible préoccupation, tu pourrais consacrer ton temps à des choses utiles, comme par exemple ton article du Mémorial, que je n’ai eu le temps que de lire très-rapidement, mais que je relirai demain chez mon oncle, il est plein de vivacité et offre, sous des formes saisissantes, d’excellentes démonstrations. Lundi je le lirai à l’assemblée, qui sera assez nombreuse. Quand je me serai un peu mieux posé, je t’indiquerai le journal de Paris auquel il faudra t’adresser ; mais alors il faudra, autant que possible, t’abstenir de parler de vins. Je viens de dire que nous avions une assemblée lundi. Le but est de constituer le bureau de l’association. Nous avons pour président le duc d’Harcourt qui a accepté avec une résolution qui m’a plu. Les autres membres seront MM. Say, Blanqui et Dunoyer. Mais ce dernier n’aimerait guère à se mettre en évidence, et je proposerai à sa place M. Anisson-Duperron, pair de France, qui m’a charmé en ce qu’il est ferme sur le principe. Pour trésorier, nous aurons le baron d’Eichthal, riche banquier. Enfin l’état-major se complétera d’un secrétaire, qui évidemment est appelé à supporter le poids de la besogne. Tu pressens peut-être que ces fonctions me sont destinées. Comme toujours j’hésite. Il m’en coûte de m’enchaîner ainsi à un travail ingrat et assidu. D’un autre côté, je sens bien que je puis être utile en m’occupant exclusivement de cette affaire. D’ici à lundi il faudra bien que ma détermination soit irrévocablement prise. Au reste, j’espère que les adhésions ne nous manqueront pas. Pairs, députés, banquiers, hommes de lettres viendront à nous en bon nombre, et même quelques fabricants considérables. Il me parait évident qu’il s’est opéré un grand changement dans l’opinion, et le triomphe n’est peut-être pas aussi éloigné que nous le supposions d’abord.
Ici on voudrait beaucoup que je fusse nommé député ; tu ne peux te figurer combien l’espèce de prophétie que contient mon introduction m’a donné de crédit. J’en suis confus et embarrassé, sentant fort bien que je suis au-dessous de ma réputation ; mais il ne m’est permis de conserver aucun espoir, relativement à la députation, car ce qui se passe à Bordeaux et à Paris n’a que peu de retentissement à Saint-Sever. Et d’ailleurs, ce serait peut-être un motif de plus pour qu’on me tînt à l’écart. Cette chère Chalosse ne semble pas comprendre la portée de l’entreprise à laquelle j’ai consacré mes efforts ; sans cela il est probable qu’elle voudrait s’y associer, en accroissant mon influence dans son intérêt. Je ne lui en veux pas ; je l’aime et la servirai jusqu’au bout, quelle que soit son indifférence.
Aujourd’hui j’ai fait mon entrée à l’Institut, on y a discuté la question de l’enseignement. Des universitaires, Cousin en tête, ont accaparé la discussion. Je regrette bien d’avoir laissé à Mugron mon travail sur ce sujet, car je ne vois pas que personne l’envisage à notre point de vue.
Tàche de faire de temps en temps des articles pour entretenir à Bordeaux le feu sacré ; plus tard on en fera sans doute une collection qui sera distribuée à grand nombre d’exemplaires. Dans la prochaine lettre que j’écrirai à ma tante, je mettrai un mot pour te dire ce qu’on a pensé de ton dernier article, à l’assemblée.
J’attends notre ami Daguerre pour être présenté à M. de Lamennais ; j’espère le convertir au free-trade. M. de Lamartine a annoncé son adhésion, ainsi que le bon Béranger ; on fera arriver aussi M. Berryer dès que l’association sera assez fortement constituée pour ne pouvoir pas être détournée par les passions politiques. De même pour Arago ; tu vois que toutes les fortes intelligences de l’époque seront pour nous. On m’a assuré que M. de Broglie accepterait la présidence. J’avoue que je redoute un peu les allures diplomatiques qui doivent être dans ses habitudes. Sa présence ferait sans doute, dès l’abord, un effet prodigieux ; mais il faut voir l’avenir et ne pas se laisser séduire par un éclat momentané.
à Richard Cobden: Lettre du 25 mars 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.57] [OC1] 57. Paris, 25 mars 1846. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, dès la réception de votre lettre, j’ai remis à M. Dunoyer votre réponse à l’adresse de notre société d’économistes. Je viens de la traduire et elle n’a paru rien contenir qui puisse avoir des inconvénients à la publicité. Seulement, nous ne savons trop où faire paraître ce précieux document. Le Journal des Économistes ne paraîtra que vers le 20 avril. C’est bien tard. Beaucoup de journaux sont engagés avec le monopole, beaucoup d’autres avec l’anglophobie, et beaucoup d’autres sont sans valeur. Une démarche va être faite auprès du Journal des Débats. Je vous en dirai l’effet par post-scriptum. — Assurément, il n’y a rien dans votre lettre que de pur, noble, vrai et cosmopolite, comme dans votre cœur. Mais notre nation est si susceptible, elle est d’ailleurs si imbue de l’idée que la liberté commerciale est bonne pour vous et mauvaise pour nous, — que vous ne l’avez adoptée, en partie, que par machiavélisme et pour nous entraîner dans cette voie, — ces idées, dis-je, sont si répandues, si populaires, que je ne sais si la publication de votre adresse ne sera pas inopportune au moment où nous formons une association. On ne manquera pas de dire que nous sommes dupes de la perfide Albion. Des hommes qui savent que si deux et deux font quatre en Angleterre, ils ne font pas trois en France, rient de ces préjugés. Cependant, il me paraît prudent de les dissiper plutôt que de les heurter. C’est pourquoi je soumettrai encore la question de la publicité à quelques hommes éclairés avec lesquels je me réunis ce soir, et je vous ferai connaître demain le résultat de cette conférence.
J’ai souligné le mot en partie, voici pourquoi : notre principal point d’appui pour l’agitation est la classe commerciale, les négociants. Ils vivent sur les échanges et en désirent le plus possible. Ils ont d’ailleurs l’habitude de conduire les affaires. Sous ce double rapport, ils sont nos meilleurs auxiliaires. Cependant ils tiennent au monopole par un côté, le côté maritime, la protection à la navigation nationale, en un mot ce qu’on nomme la surtaxe.
Or, il arrive que tous nos armateurs sont frappés de cette idée que, dans son plan financier, sir Robert Peel n’a pas modifié votre acte de navigation, qu’il a laissé en cette matière la protection dans toute sa force ; et je vous laisse à penser les conséquences qu’ils en tirent. Je crois me rappeler que votre acte de navigation fut modifié par Huskisson. J’ai votre tarif et je n’y aperçois nulle part que les denrées apportées par navires étrangers y soient soumises à une taxe différentielle. Je voudrais bien être fixé sur cette question, et si vous n’avez pas le temps de m’en instruire, ne pourriez-vous pas prier M. Paulton ou M. James Wilson de m’écrire à ce sujet une lettre assez étendue ?
Maintenant je vous dirai un mot de notre association. Je commence à être un peu découragé par la difficulté, même matérielle, de faire quelque chose à Paris. Les distances sont énormes, on perd tout son temps dans les rues, et, depuis dix jours que je suis ici, je n’ai pas employé utilement deux heures. Je me déciderais à abandonner l’entreprise, si je ne voyais les éléments de quelque chose d’utile. Des pairs, des députés, des banquiers, des hommes de lettres, tous ayant un nom connu en France, consentent à entrer dans notre société ; mais ils ne veulent pas faire les premiers pas. À supposer qu’on finisse par les réunir, je ne pense pas qu’on puisse compter sur un concours bien actif de la part de gens si occupés, si emportés par le tourbillon des affaires et des plaisirs. Mais leur nom seul aurait un grand effet en France et faciliterait des associations semblables et plus pratiques à Marseille, Lyon, le Havre et Nantes. Voilà pourquoi je suis résolu à perdre deux mois ici. En outre, la société de Paris aura l’avantage de donner un peu de courage aux députés free-traders, qui, jusqu’ici abandonnés par l’opinion, n’osaient avouer leurs principes.
Je n’ai pas d’ailleurs perdu de vue ce que vous me disiez un jour, que le mouvement, qui s’était fait de bas en haut en Angleterre, doit se faire de haut en bas en France ; et par ce motif je me réjouirais de voir se réunir à nous des hommes marquants, tels que les d’Harcourt, Anisson-Dupéron, Pavée de Vendeuvre, peut-être de Broglie, parmi les Pairs ; d’Eichthal, Vernes, Ganneron et peut-être Rothschild parmi les banquiers ; Lamartine, Lamennais, Béranger, parmi les hommes de lettres. Assurément je suis loin de croire que tous ces illustres personnages aient des opinions arrêtées. C’est l’instinct plutôt que la claire-vue du vrai qui les guide ; mais le seul fait de leur adhésion les engagera dans notre cause et les forcera de l’étudier. Voilà pourquoi j’y tiens, car sans cela j’aimerais mieux une association bien homogène, entre une douzaine d’adeptes libres d’engagements et dégagés des considérations qu’impose un nom politique.
À quoi tiennent quelquefois les grands événements ! Certainement, si un opulent financier se vouait à cette cause, ou ce qui revient au même, si un homme profondément convaincu et dévoué avait une grande fortune, le mouvement s’opérerait avec rapidité. Aujourd’hui par exemple, je connais vingt notabilités qui s’observent, hésitent et ne sont retenues que par la crainte de ternir l’éclat de leur nom. Si au lieu de courir de l’un à l’autre, à pied, crotté jusqu’au dos, pour n’en rencontrer qu’un ou deux par jour et n’obtenir que des réponses évasives ou dilatoires, je pouvais les réunir à ma table, dans un riche salon, que de difficultés seraient surmontées ! Ah ! croyez-le bien, ce n’est ni la tête, ni le cœur qui me manquent. Mais je sens que cette superbe Babylone n’est pas ma place, et il faut que je me hâte de rentrer dans ma solitude et de borner mon concours à quelques articles de journaux, à quelques écrits. N’est-il pas singulier que je sois arrivé à l’âge où les cheveux blanchissent, témoin des progrès du luxe et répétant comme ce philosophe grec : Que de choses dont je n’ai pas besoin ! et que je me sente à mon âge envahi par l’ambition. L’ambition ! oh ! j’ose dire que celle-là est pure, et si je souffre de ma pauvreté, c’est qu’elle oppose un obstacle invincible à l’avancement de la cause.
Pardonnez-moi, mon cher Monsieur, ces épanchements de mon cœur. Je vous parle de moi quand je ne devrais vous entretenir que d’affaires publiques.
Adieu, croyez-moi toujours votre bien affectionné et dévoué.
à Richard Cobden: Lettre du 2 avril 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.58] [OC1] 58. Paris, 2 avril 1846. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, ainsi que je vous l’ai annoncé, votre réponse à l’adresse de la société des économistes paraîtra dans le prochain numéro du Journal des Économistes. Elle fera, j’espère, un bon effet. Mais vu l’extrême susceptibilité de nos concitoyens, on a jugé à propos de ne pas l’insérer dans les journaux quotidiens et d’attendre que notre association parisienne fût un peu plus avancée.
Ce qui nous manque surtout, c’est un organe, un journal spécial, comme la Ligue. Vous me direz qu’il doit être l’effet de l’association. Mais je crois bien que, dans une certaine mesure, c’est l’association qui sera l’effet du journal ; nous n’avons pas de moyens de communication et aucun journal accrédité ne peut nous en servir.
Donc j’ai pensé à créer ici un journal hebdomadaire intitulé le Libre Échange. Hier soir on m’en a remis le devis. Il se monte pour la dépense à 40,000 francs, pour la première année ; et la recette, en supposant 1000 abonnés à 10 francs, n’est que de 10,000 francs : perte, 30,000 francs.
Bordeaux, je l’espère, consentira à en supporter une partie. Mais je dois aviser à couvrir la totalité. J’ai pensé à vous. Je ne puis demander à l’Angleterre une subvention avouée ou secrète, elle aurait plus d’inconvénients que d’avantages. Mais ne pourriez-vous pas nous avoir 1,000 abonnements à une demi-guinée ? ce serait pour nous une recette de 500 livres sterling ou 12,500 francs, dont 10,000 francs nets, frais de poste déduits. Il me semble que Londres, Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham, Glasgow et Edimbourg suffiraient pour absorber ces 1,000 exemplaires, en abonnements réels que vos agents faciliteront. Il n’y aurait pas alors subvention, mais encouragement loyal, qui pourrait être hautement avoué.
Quand je vois la timidité de nos soi-disant free-traders, et combien peu ils comprennent la nécessité de s’attacher à un principe absolu, je ne vous cacherai pas que je regarde comme essentiel de prendre l’initiative de ce journal, d’en avoir la direction ; car si, au lieu de précéder l’association, il la suit, et est obligé d’en prendre l’esprit au lieu de le créer, je crains que l’entreprise n’avorte.
Veuillez me répondre le plus tôt que vous pourrez et me donner franchement vos conseils.
à Richard Cobden: Lettre du 11 avril 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.59] [OC1] 59. Paris, 11 avril 1846. A Richard Cobden
Mon cher Monsieur, je m’empresse de vous annoncer que votre réponse à l’adresse des économistes paraîtra dans le journal de ce mois qui se publie du 15 au 20. — La traduction en est un peu faible, celui à qui elle est principalement adressée ayant cru convenable d’adoucir quelques expressions, afin de ménager la susceptibilité de notre public. Cette susceptibilité est réelle, et de plus elle est habilement exploitée. — Ces jours-ci, lisant quelques épreuves dans une imprimerie, il me tomba sous la main un livre où on nous accusait positivement d’être soudoyés par l’Angleterre ou plutôt par la Ligue. Connaissant l’auteur, je l’ai décidé à retirer cette absurde assertion, mais elle m’a fait sentir de plus en plus le danger d’avoir aucune relation financière avec votre société. Il m’est impossible de voir dans quelques abonnements que vous prendriez à nos écrits, pour les répandre en Europe, rien de répréhensible, et cependant je m’abstiendrai dorénavant d’en appeler à votre sympathie ; et indépendamment des raisons que vous me donnez, celle-là suffit pour me décider à me conformer sur cette matière au préjugé national.
Le mouvement Bordelais, quoiqu’il ait été assez imposant et précisément à cause de cela, nous créera, je le crains, bien des obstacles. À Paris on n’ose rien faire, de peur de ne pas faire autant qu’à Bordeaux. — Dès l’origine, j’avais prévu qu’une association, inaperçue d’abord, mais composée d’hommes parfaitement unis et convaincus, aurait de meilleures chances qu’une grande démonstration. Enfin, il faut bien agir avec les éléments qu’on a sous la main, et l’un des bienfaits de l’association, si elle se propage, sera to train les associés eux-mêmes. — Ils en ont grand besoin. La distinction entre droit fiscal et droit protecteur ne leur entre pas dans la tête. C’est vous dire qu’on ne comprend pas même le principe de l’association, la seule chose qui puisse lui donner de la force, de la cohésion et de la durée. J’ai dévelopé cette thèse dans le Courrier français d’aujourd’hui et je continuerai encore.
Quoi qu’il en soit, un progrès dans ce pays est incontestable. Il y a six mois, nous n’avions pas un journal pour nous. Aujourd’hui, nous en avons cinq à Paris, trois à Bordeaux, deux à Marseille, un au Havre et deux à Bayonne. J’espère qu’une douzaine de pairs et autant de députés entreront dans notre ligue et y puiseront, sinon des lumières, au moins du courage.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 18 avril 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.60] [OC1] 60. Paris, 18 avril 1846. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je suis entièrement privé de tes lettres, il est vrai que je suis moi-même bien négligent. Tu ne pourras pas croire que le temps me manque, et c’est pourtant la vérité ; quand on est comme campé à Paris, la distribution des heures est si mauvaise qu’on n’arrive à rien.
Je ne te dirai pas grand’chose de moi, j’ai tant de personnes à voir que je ne vois personne ; cela semble un paradoxe, et c’est la vérité. Je n’ai été qu’une fois chez Dunoyer, une fois chez Comte, une fois chez Mignet, et ainsi du reste. Je puis avoir des relations avec les journaux ; la Patrie, le Courrier français, le Siècle et le National m’ont ouvert leurs colonnes. Je n’ai pas encore d’aboutissant aux Débats. M. Michel Chevalier m’a bien offert d’y faire admettre mes articles ; mais je voudrais avoir entrée dans les bureaux pour éviter les coupures et les altérations.
L’association marche à pas de tortue, ce n’est que de dimanche en huit que je serai fixé, ce jour-là il y aura une réunion. Voici les noms de quelques-uns des membres : d’Harcourt, Pavée de Vendeuvre, amiral Grivel, Anisson-Duperron, Vincens Saint-Laurent, pairs.
Lamartine, Lafarelle, Bussières, Lherbette, de Corcelles et quelques autres députés. [33]
Michel Chevalier, Blanqui, Wolowski, Léon Faucher et autres économistes ; d’Eichthal, Cheuvreux, Say et autres banquiers négociants.
La difficulté est de réunir ces personnages emportés par le tourbillon politique. Derrière, il y a des jeunes gens plus ardents, et qu’il faut contenir, au moins provisoirement, pour ne pas perdre l’avantage de nous appuyer sur ces noms connus et populaires.
En attendant, nous avons eu un meeting composé de négociants et fabricants de Paris. Notre but était de les préparer, j’étais très-peu préparé moi-même et je n’avais pas consacré plus d’une heure à méditer ce que j’aurais à dire. Je me suis fait un plan très-simple dans lequel je ne pouvais m’égarer ; j’ai été heureux de m’assurer que cette méthode n’était pas au-dessus de mes facultés. En débutant très-simplement et sur le ton de la conversation, sans rechercher l’esprit ni l’éloquence, mais seulement la clarté et le ton de la conviction, j’ai pu parler une demi-heure, sans fatigue ni timidité. D’autres ont été plus brillants. Nous aurons un autre meeting plus nombreux dans huit jours, puis j’essayerai d’aller agiter le quartier latin.
J’ai vu ces jours-ci le ministre des finances ; il a approuvé tout ce que je fais, et ne demande pas mieux que de voir se former une opinion publique.
Adieu, l’heure me presse, je crains même d’être en retard.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 mai 1846, Paris ↩
BWV
[CW1.61] [OC1] 61. Paris, 3 mai 1846. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, j’apprends qu’une occasion se présente pour cette lettre, et quoique je sois abîmé (car il y a sept heures que j’ai la plume à la main), je ne veux pas la laisser partir sans te donner de mes nouvelles.
Je t’ai parlé d’une réunion pour demain, en voici l’objet. L’adjonction des personnages a enterré notre modeste association. Ces messieurs ont voulu tout reprendre ab ovo, nous en sommes donc à faire un programme, un manifeste, c’est à cela que j’ai travaillé tout aujourd’hui. Mais il y en a quatre autres qui font la même besogne. Qu’on veuille choisir ou fondre, je m’attends à une longue discussion sans dénoûment, parce qu’il y a beaucoup d’hommes de lettres, beaucoup de théoriciens, puis le chapitre des amours-propres ! Je ne serais donc pas surpris qu’on renvoyât à une autre commission où les mêmes difficultés se présenteront, car chacun, excepté moi, défendra son œuvre, et l’on viendra se faire juger par l’assemblée. C’est dommage ; après le manifeste viendront les statuts, l’organisation conforme, les souscriptions, et ce n’est qu’après tout cela que je serai fixé. Quelquefois il me prend envie de déserter, mais quand je songe au bon effet que produira le simple manifeste avec ses quarante signatures, je n’en ai pas le courage. Peut-être, une fois le manifeste lancé, irai-je à Mugron attendre qu’on me rappelle, car je suis effrayé de passer les mois entiers à travers de simples formalités, et sans rien faire d’utile. D’ailleurs la lutte électorale pourra réclamer ma présence. M. Dupérier m’a fait dire qu’il s’était formellement désisté, il a même ajouté qu’il avait brûlé ses vaisseaux et écrit à tous ses amis qu’il renonçait à la candidature. Puisqu’il en est ainsi, si d’autres candidats ne se présentent pas, je pourrai me trouver en présence de M. de Larnac tout seul ; et cette lutte ne m’effraye pas, parce que c’est une lutte de doctrines et d’opinions. Ce qui m’étonne, c’est de ne recevoir aucune lettre de Saint-Sever. Il semble que la communication de Dupérier aurait dû m’attirer quelques ouvertures. Si tu apprends quelque chose, fais-le-moi savoir.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 4 mai, Paris ↩
BWV
[CW1.62] [OC1] 62. Paris, 4 mai 1846. A Félix Coudroy
Hier soir on a discuté et adopté un manifeste, la discussion a été sérieuse, intéressante, approfondie, et cela seul est un grand bien, car beaucoup de gens qui entreprennent d’éclairer les autres s’éclairent eux-mêmes. On a remis tous les pouvoirs exécutifs à une commission composée de MM. d’Harcourt, Say, Dunoyer, Renouard, Blanqui, Léon Faucher, Anisson-Duperron et moi. D’un autre côté, cette commission me transmettra, au moins de fait, l’autorité qu’elle a reçue et se bornera à un contrôle ; dans ces circonstances, puis-je abandonner un rôle qui peut tomber en d’autres mains, et compromettre la cause tout entière ? Je souffre de quitter Mugron et mes habitudes, et mon travail capricieux et nos causeries. C’est un déchirement affreux ; mais m’est-il permis de reculer ?
Adieu, mon cher Félix, ton ami.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 24 mai 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.63] [OC1] 63. Paris, 24 mai 1846. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, j’ai tant couru ce matin que je ne puis tenir la plume, et mon écriture est toute tremblante. Ce que tu me dis de l’utilité de ma présence à Mugron me préoccupe tous les jours. Mais, mon ami, j’ai presque la certitude que, si je quitte Paris, notre association tombera dans l’eau et tout sera à recommencer. Tu en jugeras ; voici où nous en sommes : je crois t’avoir dit qu’une commission avait été nommée, réunissant pleins pouvoirs ; au moment de lancer notre manifeste, plusieurs des commissaires ont voulu que nous fussions pourvus de l’autorisation préalable. Elle a été demandée, le ministre l’a promise ; mais les jours se passent et je ne vois rien arriver. En attendant, le manifeste est dans nos cartons. C’est certainement une faute d’exiger l’autorisation, nous devions nous borner à une simple déclaration. Les peureux ont cru être agréables au ministre, et je crois qu’ils l’embarrassent, parce que, surtout à l’approche des élections, il craindra de se mettre à dos les manufacturiers.
Cependant M. Guizot a déclaré qu’il donnerait l’autorisation, M. de Broglie a laissé entendre qu’il viendrait à nous aussitôt après, c’est pourquoi je patiente encore ; mais pour peu qu’on retarde, je casserai les vitres, au risque de tout dissoudre, sauf à recommencer sur un autre plan, et avec d’autres personnes.
Tu vois combien il est difficile de déserter le terrain en ce moment ; ce n’est pas l’envie qui me manque, car, mon cher Félix, Paris et moi nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre. Il y aurait trop à dire là-dessus, ce sera pour une autre fois.
Ton article du Mémorial était excellent, peu de personnes l’ont lu, car il n’est arrivé précisément que quand nos réunions ont cessé, par la cause que je t’ai dite ; mais je l’ai communiqué à Dunoyer et à Say, ainsi qu’à quelques autres, et tous y ont trouvé une vivacité et une clarté qui entraînent le lecteur et forcent la conviction. Le je ne m’en mêle plus ne pouvait que plaire beaucoup à Dunoyer ; malheureusement les idées du jour sont portées à un point effrayant vers l’autre sens : Mêler à tout l’État. Bientôt on fera une seconde édition de mes Sophismes. Nous pourrons y joindre cet article et quelques autres, si tu en fais. Je puis bien te dire à toi que ce petit livre est destiné à une grande circulation. En Amérique, on se propose de le propager à profusion ; les journaux anglais et italiens l’ont traduit presque en entier. Mais ce qui me vexe un peu, c’est de voir que les trois à quatre plaisanteries que j’ai glissées dans ce volume ont fait fortune, tandis que la partie sérieuse est fort négligée. Tâche donc de faire aussi du Buffa.
Je te quitte ; je viens d’apprendre qu’une occasion se présente pour Bordeaux, et je veux en profiter.
à Richard Cobden: Lettre du 25 mai 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.64] [OC1] 64. Paris, 25 mai 1846. A Richard Cobden
Voilà bien des jours que je ne vous ai pas écrit, mon cher monsieur Cobden, mais enfin je ne pouvais trouver une occasion plus favorable pour réparer ma négligence, puisque j’ai le plaisir d’introduire auprès de vous le Maire de Bordeaux, le digne, le chaleureux président de notre association, M. Duffour Dubergié. Je ne pense pas avoir rien à ajouter pour lui assurer de votre part le plus cordial accueil. Connaissant l’étroite union qui lie tous les ligueurs, je me dispense même d’écrire à messieurs Bright, Paulton, etc., bien convaincu qu’à votre recommandation, M. Duffour sera admis au milieu de vous comme un membre de cette grande confraternité qui s’est levée pour l’affranchissement et l’union des peuples. Et qui mérite plus que lui votre sympathie ? C’est lui qui, par l’autorité de sa position, de sa fortune et de son caractère, a entraîné Bordeaux et décidé le peu qui se fait à Paris. Il n’a pas tergiversé et hésité comme font nos diplomates de la capitale. Sa résolution a été assez prompte et assez énergique pour que notre gouvernement lui-même n’ait pas eu le temps d’entraver le mouvement, à supposer qu’il en eût eu l’intention.
Recevez donc M. Duffour comme le vrai fondateur de l’association en France. D’autres rechercheront et recueilleront peut-être un jour cette gloire. C’est assez ordinaire ; mais, quant à moi, je la ferai toujours remonter à notre président de Bordeaux.
Au milieu de l’agitation que doit exciter l’état de vos affaires, peut-être vous demandez-vous quelquefois où en est notre petite ligue de Paris. Hélas ! elle est dans une période d’inertie fort ennuyeuse pour moi. La loi française exigeant que les associations soient autorisées, plusieurs membres, et des plus éminents, ont exigé que cette formalité précédât toute manifestation au dehors. Nous avons donc fait notre demande et, depuis ce jour, nous voilà à la discrétion des ministres. Ils promettent bien d’autoriser, mais ils ne s’exécutent pas. Notre ami, M. Anisson-Dupéron, déploie dans cette circonstance un zèle qui l’honore. Il a toute la vigueur d’un jeune homme et toute la maturité d’un pair de France. Grâce à lui, j’espère que nous réussirons. Si le ministre s’obstine à nous enrayer, notre association se dissoudra. Tous les peureux s’en iront ; mais il restera toujours un certain nombre d’associés plus résolus, et nous nous constituerons sur d’autres bases. Qui sait si à la longue ce triage ne nous profitera pas ?
J’avoue que je renoncerai à regret à de beaux noms propres. C’est nécessaire en France, puisque les lois et les habitudes nous empêchent de rien faire avec et par le peuple. Nous ne pouvons guère agir que dans la classe éclairée ; et dès lors les hommes qui ont une réputation faite sont d’excellents auxiliaires. Mais enfin, mieux vaut se passer d’eux que de ne pas agir du tout.
Il paraît que les protectionnistes préparent en Angleterre une défense désespérée. Si vous aviez un moment, je vous serais bien obligé de me faire part de votre avis sur l’issue de la lutte. M. Duffour assistera à ce grand combat. J’envie cette bonne fortune.
à Richard Cobden: Lettre du 25 juin 1846 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.65] [OC1] 65. Mugron, 25 juin 1846. A Richard Cobden
Ce n’est point à vous de vous excuser, mon cher Monsieur, mais à moi ; car vous faites un grand et noble usage de votre temps, et moi, qui gaspille le mien, je n’aurais pas dû rester si longtemps sans vous écrire. Vous voilà au terme de vos travaux. L’heure du triomphe a sonné pour vous. Voue pouvez vous rendre le témoignage que vous aurez laissé sur cette terre une profonde empreinte de votre passage ; et l’humanité bénira votre nom. Vous avez conduit votre immense agitation avec une vigueur, un ensemble, une prudence, une modération qui seront un éternel exemple pour tous les réformateurs futurs ; et, je le dis sincèrement, le perfectionnement que vous avez apporté à l’art d’agiter sera pour le genre humain un plus grand bien que l’objet spécial de vos efforts, quelle qu’en soit la grandeur. Vous avez appris au monde que la vraie force est dans l’opinion, et vous lui avez enseigné comment on met cette force en œuvre. De ma propre autorité, mon cher Cobden, je vous décerne la palme de l’immortalité et je vous marque au front du signe des grands hommes.
Et moi, vous le voyez à la date de ma lettre, j’ai déserté le champ de bataille, non point découragé, mais momentanément dégoûté. Il faut bien le dire, l’œuvre en France est plus scientifique, moins susceptible de pénétrer dans les sympathies populaires. Les obstacles matériels et moraux sont aussi énormes. Nous n’avons ni railways ni penny-postage. On n’est pas accoutumé aux souscriptions ; les esprits français sont impatients de toute hiérarchie. On est capable de discuter un an les statuts d’un règlement ou les formes d’un meeting. Enfin, le plus grand de tous les malheurs, c’est que nous n’avons pas de vrais Économistes. Je n’en ai pas rencontré deux capables de soutenir la cause et la doctrine dans toute son orthodoxie, et l’on voit les erreurs et les concessions les plus grossières se mêler aux discours et aux écrits de ceux qui s’appellent free-traders. Le communisme et le fouriérisme absorbent toutes les jeunes intelligences, et nous aurons une foule d’ouvrages extérieurs à détruire avant de pouvoir attaquer le corps de la place.
Que si je jette un regard sur moi-même, je sens des larmes de sang me venir aux yeux. Ma santé ne me permet pas un travail assidu et… mais que servent les plaintes et les regrets !
Ces lois de septembre qu’on nous oppose ne sont pas bien redoutables. Au contraire, le ministère nous fait beau jeu en nous plaçant sur ce terrain. Il nous offre le moyen de remuer un peu la fibre populaire, et de fondre la glace de l’indifférence publique. S’il a voulu contrarier l’essor de notre principe, il ne pouvait pas s’y prendre plus mal.
Vous ne me parlez pas de votre santé. J’espère qu’elle s’est un peu rétablie. Je serais désolé que vous passiez à Paris sans que j’aie le plaisir de vous en faire les honneurs. C’est sans doute l’instinct des contrastes qui vous pousse au Caire, contraria contrariis curantur. Et vous voulez trouver, sous le soleil, sous le despotisme et sous l’immobilité de l’Égypte, un refuge contre le brouillard, la liberté et l’agitation britanniques. Puissé-je, dans sept ans, aller chercher dans les mêmes lieux un repos aux mêmes fatigues !
Vous allez donc dissoudre la Ligue ! Quel instructif et imposant spectacle ! Qu’est-ce auprès d’un tel acte d’abnégation que l’abdication de Sylla ? — Voici pour moi le moment de refaire et de compléter mon Histoire de la Ligue. Mais en aurai-je le temps ? Le courant des affaires absorbe toutes mes heures. Il faut aussi que je fasse une seconde édition de mes Sophismes, et je voudrais beaucoup faire encore un petit livre intitulé : Harmonies économiques. Il ferait le pendant de l’autre ; le premier démolit, le second édifierait.
à Richard Cobden: Lettre du 21 juillet 1846 (Bordeaux) ↩
BWV
[CW1.66] [OC1] 66. Bordeaux, 21 juillet 1846. A Richard Cobden
Mon cher et excellent ami, votre lettre est venue me trouver à Bordeaux, où je me suis rendu pour assister à un meeting occasionné par le retour de notre président M. Duffour-Dubergié. Ce meeting aura lieu dans quelques heures ; je dois y parler, et cette circonstance me préoccupe à tel point que vous excuserez le désordre et le décousu de ma lettre. Je ne veux cependant pas remettre de vous écrire à un autre moment, puisque vous me demandez de vous répondre par retour du courrier.
Je n’ai pas besoin de vous dire combien j’ai accueilli avec joie l’achèvement de votre grande et glorieuse entreprise. La clef de voûte est tombée ; tout l’édifice du monopole va s’écrouler, y compris le Système colonial, en tant que lié au régime protecteur. C’est là surtout ce qui agira fortement sur l’opinion publique, en Europe, et dissipera chez nous de bien funestes et profondes préventions.
Lorsque j’intitulai mon livre Cobden et la Ligue, personne ne m’avait dit que vous étiez l’âme de cette puissante organisation et que vous lui aviez communiqué toutes les qualités de votre intelligence et de votre cœur. Je suis fier de vous avoir deviné et d’avoir pressenti sinon devancé l’opinion de l’Angleterre toute entière. Pour l’amour des hommes, ne rejetez pas le témoignage qu’elle vous confère. Laissez les peuples exprimer librement et noblement leur reconnaissance. L’Angleterre vous honore, mais elle s’honore encore plus par ce grand acte d’équité. Croyez qu’elle place à gros intérêts ces 100,000 livres sterling ; car tant qu’elle saura ainsi récompenser ses fidèles serviteurs, elle sera bien servie. Les grands hommes ne lui feront jamais défaut. Ici, dans notre France, nous avons aussi de belles intelligences et de nobles cœurs, mais ils sont à l’état virtuel, parce que le pays n’a point encore appris cette leçon si importante quoique si simple : honorer ce qui est honorable et mépriser ce qui est méprisable. Le don qu’on vous prépare est une glorieuse consommation de la plus glorieuse entreprise que le monde ait jamais vue. Laissez ces grands exemples arriver entiers aux générations futures.
J’irai à Paris au commencement d’août. Il n’est pas probable que j’y arrive comme député. Toujours la même cause me force à attendre que ce mandat me soit imposé, et, en France, on peut attendre longtemps. Mais comme vous, je pense que l’œuvre que j’ai à faire est en dehors de l’enceinte législative.
Je sors du meeting où je n’ai pas parlé. [34] Mais il m’est arrivé, à propos de députation, une chose bien extraordinaire. Je vous la conterai à Paris. Oh ! mon ami, il est des pays où il faut avoir vraiment l’âme grande pour s’occuper du bien public, tant on s’y applique à vous décourager.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 22 juillet 1846 (Bordeaux) ↩
BWV
[CW1.67] [OC1] 67. Bordeaux, 22 juillet 1846. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je t’écrivais avant-hier, et je ne serais pas surpris que ma lettre se fût égarée ; car depuis un mois je marche de malentendu en malentendu. Il faudrait une rame de papier pour te raconter tout ce qui m’arrive ; ce ne sont pas choses aimables, mais elles ont ce bon côté, qu’elles me font faire de grands progrès dans la connaissance du cœur humain. Hélas ! il vaudrait mieux peut-être conserver le peu d’illusions qu’on peut avoir à notre âge.
D’abord je me suis assuré que le retard qu’on a mis à expédier ma brochure tient à une intrigue. Ma lettre à M. Duchâtel l’a outré ; mais elle lui a arraché l’autorisation que tant de hauts personnages poursuivaient, depuis trois mois. Et tu penses que l’association bordelaise m’en a su gré ? point du tout. Il y a ici un revirement complet d’opinion contre moi, et je suis flétri du titre de radical ; ma brochure m’a achevé. M. Duchâtel a écrit au préfet, le préfet a fait venir le directeur du Mémorial, et lui a lavé la tête ; le directeur a racheté sa faute en retardant ma brochure. Cependant en ce moment les quatre cents exemplaires doivent t’être parvenus. [35]
Quant à ce qui se passe en fait d’élections, ce serait trop long, je te le dirai verbalement. En résultat, je ne serai porté nulle part, excepté peut-être à Nérac. Mais je ne puis voir là qu’une démonstration de l’opposition et non une candidature sérieuse, sauf l’imprévu d’une journée électorale.
Hier il y a eu séance de l’association bordelaise. La manière dont on m’a engagé à prendre la parole m’a engagé à refuser.
Je présume qu’à l’heure qu’il est, tous les électeurs de Saint-Sever ont ma brochure. C’est tout ce que j’ai à leur offrir avec mon dévouement. Cette distribution doit te donner bien de la peine. Entre quatre pourtant, la besogne n’est pas lourde. J’espère être rentré à Mugron vers le 28 ou 29, tout juste pour aller voter.
Adieu, mon cher Félix, je ne fermerai ma lettre que ce soir, en cas que j’aie quelque chose à ajouter.
P. S. Je viens d’avoir une entrevue importante, je te conterai cela. Mais le résultat est que Bordeaux ne me portera pas, on veut un Économiste qui soit du juste milieu. Le ministère a recommandé Blanqui.
à Richard Cobden: Lettre du 23 septembre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.68] [OC1] 68. Paris, 23 septembre 1846. A Richard Cobden
Bien que je n’aie pas grand’chose à vous apprendre, mon cher ami, je ne veux pas laisser plus de temps sans vous écrire.
Nous sommes toujours dans la même situation, ayant beaucoup de peine à enfanter une organisation. J’espère pourtant que le mois prochain sera plus fertile. D’abord nous aurons un local. C’est beaucoup ; c’est l’embodyment de la Ligue. Ensuite plusieurs leading-men reviendront de la campagne, et entre autres l’excellent M. Anisson, qui me fait bien défaut.
En attendant, nous préparons un second meeting pour le 29. C’est peut-être un peu dangereux, car un fiasco en France est mortel. Je me propose d’y parler et je relirai, d’ici là, plusieurs fois votre leçon d’éloquence. Pouvait-elle me venir de meilleure source ? Je vous assure que j’aurai au moins, faute d’autres, deux qualités précieuses quoique négatives : la simplicité et la brièveté. Je ne chercherai ni à faire rire, ni à faire pleurer, mais à élucider quelque point ardu de la science.
Il y a un point sur lequel je ne partage pas votre opinion. C’est sur le public speaking. Il me semble que c’est le plus puissant instrument de propagation. — N’est-ce rien déjà que plusieurs milliers d’auditeurs qui vous comprennent bien mieux qu’à la lecture ? puis le lendemain chacun veut savoir ce que vous avez dit et la vérité fait son chemin.
Vous avez su que Marseille a fait son pronunciamento, ils sont déjà plus riches que nous. J’espère bien qu’ils nous aideront au moins pour la fondation du journal.
Bruxelles vient de former son association. Et, chose étonnante, ils ont déjà émis le premier numéro de leur journal. Hélas ! ils n’ont sans doute pas une loi sur le timbre et une autre sur le cautionnement.
Je suis impatient d’apprendre si vous avez visité nos délicieuses Pyrénées. Le maire de Bordeaux m’écrivait que mes tristes Landes vous étaient apparues comme la patrie des lézards et des salamandres. Et pourtant, une profonde affection peut transformer cet affreux désert en paradis terrestre ! Mais j’espère que nos Pyrénées vous auront réconcilié avec le midi de la France. Quel dommage que toutes ces provinces qui avoisinent Pau, le Juranson, le Béarn, le Tursan, l’Armagnac, la Chalosse, ne puissent pas faire avec l’Angleterre un commerce qui serait si naturel !
Je reviens aux associations. Il s’en forme une de protectionnistes. C’est ce qui pouvait nous arriver de plus heureux, car nous avons bien besoin de stimulant. — On dit qu’il s’en forme une autre pour le Libre-Échange en matières premières et la protection des manufactures. Celle-là du moins n’a pas la prétention de s’établir sur un principe et de compter la justice pour quelque chose. Aussi elle s’imagine être éminemment pratique. Il est clair qu’elle ne pourra pas tenir sur pied, et qu’elle sera absorbée par nous.
à Richard Cobden: Lettre du 29 septembre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.69] [OC1] 69. Paris, 29 septembre 1846. A Richard Cobden
Mon cher ami, je suis allé chez M. de Loménie, il est venu chez moi, et nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Mais je le verrai demain et je mettrai à sa disposition tous mes documents et ceux de Fonteyraud. En outre, je lui offrirai ma coopération, soit pour traduire, soit pour donner à son article, au besoin, la couleur d’orthodoxie économique. J’ai très-présent à la mémoire le passage de votre discours de clôture, où vous faites une excursion dans l’avenir, et, de là, montrez à vos auditeurs un horizon plus vaste et plus beau que celui que le Pic du midi a étalé à vos yeux. — Ce discours sera traduit et communiqué à M. de Loménie. Il pourrait bien se servir aussi de votre morceau sur l’émigration, qui est vraiment éloquent. Bref, rapportez-vous-en à moi. — Seulement, je dois vous dire que l’on ne parle guère ici de cette galerie des hommes illustres. On assure que ce genre d’ouvrage est une spéculation sur l’amour-propre des prétendants à l’illustration. Mais peut-être cette insinuation a-t-elle sa source dans des jalousies d’auteurs et d’éditeurs, irritabile genus, la plus vaine espèce d’hommes que je connaisse, après les maîtres d’escrime.
Je reçois à l’instant votre bonne lettre. M’arrivera-t-elle à temps ? J’ai cousu assez naturellement le texte que vous me signalez à mon discours. Comment n’ai-je pas pensé à vous demander vos conseils ? Cela provient sans doute de ce que j’ai la tête pleine d’arguments et me sentais riche. Mais je ne pensais qu’au sujet, et vous me faites penser à l’auditoire. Je comprends maintenant qu’un bon discours doit nous être fourni par l’auditoire plus encore que par le sujet. En repassant le mien dans ma tête, il me semble qu’il n’est pas trop philosophique ; que la science, l’à-propos et la parabole s’y mêlent en assez juste proportion. [36] Je vous l’enverrai, et vous m’en direz votre façon de penser, pour mon instruction. Vous comprenez que tout ménagement serait un mauvais service que vous me rendriez, mon cher Cobden. J’ai de l’amour-propre comme les autres, et personne ne craint plus que moi le ridicule ; mais c’est précisément ce qui me fait désirer les bons conseils et les bonnes critiques. Une de vos remarques peut m’en épargner mille dans l’avenir qui s’ouvre devant moi et qui m’entraîne. Ce soir va décider beaucoup de choses.
On m’attend au Havre. Oh ! quel fardeau qu’une réputation exagérée ! Là, il faudra traiter le shipping interest. Je me rappelle que vous avez dit de bonnes choses à ce sujet, à Liverpool ou à Hall. Je chercherai, mais si vous avez quelque bonne idée relativement au Havre, faites-m’en la charité, ou plutôt faites-la, through me, à ces peureux armateurs qui comptent sur la rareté des échanges pour multiplier les transports. Quel aveuglement ! quelle perversion de l’intelligence humaine !
Et je suis étonne, quand je pense à cela,
Comment l’esprit humain peut baisser jusque-là.
Je ne mettrai ma lettre à la poste que demain, afin de vous rendre compte d’un événement qui vous intéresse, je suis sûr, comme s’il vous était personnel.
J’oubliais de vous dire que votre lettre antérieure m’est arrivée trop tard. J’avais arrêté déjà deux appartements séparés, l’un pour l’association, l’autre pour moi, mais dans la même maison. Il faut en prendre son parti avec ce mot qui console l’Espagnol de tout : no hay remedio ! Quant à ma santé, ne vous alarmez pas ; elle va mieux. Je crois que la Providence m’en donnera jusqu’au bout. Je deviens superstitieux, n’est-il pas bon de l’être un peu ?
Mais voici que ma lettre arrive au square yard. Elle payera de forts droits. Il n’en serait pas ainsi probablement, si la poste adoptait the ad valorem duty. Je réserve la place pour demain.
Minuit.
La séance vient de finir. Anisson nous présidait. L’auditoire était plus nombreux que l’autre fois. Nous avons eu cinq Speeches, dont deux de professeurs qui croyaient faire leur cours. Bien plus que moi, ils ont songé à leur sujet plus qu’à leur public. M. Say a eu beaucoup de succès. Il a parlé avec chaleur et a été fort applaudi. Cela me fait bien plaisir, car comment ne pas aimer cet excellent homme ? M*** a fait trois excellents discours en un. Il n’avait d’autre défaut que la longueur. J’ai parlé le cinquième, et avec le désavantage de n’avoir plus qu’un auditoire harassé. Cependant, j’ai réussi tout autant que je le désirais. Chose drôle, je n’éprouvais d’émotion qu’au mollet. Je comprends maintenant le vers de Racine :
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi.
30.
Je n’ai vu qu’un journal, le Commerce. Voici comment il s’exprime : « M. Bastiat a fait accepter des paraboles économiques, grâce à un débit sans prétention et à une verve toute méridionale. » Ce maigre éloge me suffit, et je n’en voudrais pas davantage ; car Dieu me préserve d’exciter jamais l’envie parmi mes collaborateurs !
à M. Félix Coudroy: Lettre du 1er octobre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.70] [OC1] 70. Paris, 1er octobre 1846. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je n’ai pas de tes nouvelles et ne sais par conséquent où tu en es de ton procès. Puisses-tu être près de l’issue et du succès ! Donne-moi des nouvelles de ta bonne sœur ; les bains de Biarritz lui ont-ils été favorables ? Je regrette que tu n’aies pas été l’accompagner ; il me semble que Mugron doit devenir tous les jours plus triste et plus monotone pour toi.
On m’écrit de Bordeaux qu’on fait réimprimer en brochure plusieurs de nos articles. C’est ce qui fait que je ne me presse pas de faire un second volume des Sophismes ; cela ferait un double emploi. La correspondance seule me prend autant de temps que j’en puis consacrer à écrire, Mon ami, je ne suis pas seulement de l’association, je suis l’association tout entière ; non que je n’aie de zélés et dévoués collaborateurs, mais seulement pour parler et écrire. Quant à organiser et à administrer cette vaste machine, je suis seul, et combien cela durera-t-il ? Le 15 de ce mois, je prends possession de mes appartements. J’aurai alors un personnel ; jusque-là, il n’y a pas pour moi de travail intellectuel possible.
Je t’envoie un numéro du journal qui relate notre séance publique d’hier soir. J’ai débuté sur la scène parisienne et dans des circonstances vraiment défavorables. Le public était nombreux et les dames avaient pour la première fois fait apparition aux tribunes. Il avait été arrêté qu’on entendrait cinq orateurs, et que chacun ne parlerait qu’une demi-heure. — C’était déjà une séance de deux heures et demie. — Je devais parler le dernier ; sur mes quatre prédécesseurs, deux ont été fidèles aux engagements pris, et deux autres ont parlé une grande heure, c’étaient deux professeurs. Je me suis donc présenté devant un auditoire harassé par trois heures d’économie politique et fort pressé de décamper. Moi-même j’avais été très-fatigué par une attente si prolongée. Je me suis levé avec un pressentiment terrible que ma tête ne me fournirait rien. J’avais bien préparé mon discours, mais sans l’écrire. Juge de mon effroi. — Comment se fait-il que je n’aie pas eu un moment d’hésitation ; que je n’aie éprouvé aucun trouble, aucune émotion, si ce n’est aux jarrets ? C’est inexplicable. Je dois tout au ton modeste que j’ai pris en commençant. Après avoir averti le public qu’il ne devait pas attendre une pièce d’éloquence, je me suis trouvé parfaitement à l’aise, et je dois avoir réussi, puisque les journaux ne donnent que ce discours. Voilà une grande épreuve surmontée. Je te dis tout cela bien franchement, comme tu vois, convaincu que tu en seras charmé pour mon compte et pour la cause. Mon cher Félix, nous vaincrons, j’en suis sûr. Dans quelque temps, mes compatriotes pourront échanger leurs vins contre ce qu’ils désireront. La Chalosse renaîtra à la vie. Cette pensée me soutient. Je n’aurai pas été tout à fait inutile à mon pays.
Je présume que j’irai au Havre dans deux ou trois mois pour organiser un comité. Le préfet de Rouen avertit M. Anisson « qu’il ait soin de passer de nuit, s’il ne veut pas être lapidé. »
On assure qu’hier soir, il y eut un grand meeting protectionniste à Rouen. Si je l’avais su, j’y serais allé incognito. Je me féliciterais que ces Messieurs fissent comme nous ; cela nous aiguillonnerait. Et d’ailleurs, c’est une soupape de sûreté ; tant qu’ils se défendront par les voies légales, il n’y aura pas à craindre de collision.
Adieu, mon cher Félix, écris-moi de temps en temps, mets ta solitude à profit, et fais quelque chose de sérieux. Je regrette bien de ne pouvoir plus rien entreprendre pour la vraie gloire. S’il te vient en tête quelque bonne démonstration, fournis-la-moi. Je me suis assuré que la parabole et la plaisanterie ont plus de succès et opèrent plus que les meilleurs traités.
à Richard Cobden: Lettre du 22 octobre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.71] [OC1] 71. Paris, 22 octobre 1846. A Richard Cobden
Mon cher ami, je commençais à m’inquiéter de votre silence. Enfin je reçois votre lettre du et me réjouis d’apprendre que vous et madame Cobden vous trouvez au mieux de l’Espagne. Que sera-ce quand vous verrez l’Andalousie ! Autant que j’ai pu le remarquer, il y a dans les manières, à Séville et à Cadix, un air d’égalité entre les classes, qui réjouit l’âme. Je suis enchanté d’apprendre qu’il y a de bons free-traders au delà des Pyrénées. Ils nous feront peut-être honte. Cher ami, je crois que nous avons cela de commun, que nous sommes exempts de jalousie personnelle. Mais avez-vous de la jalousie nationale ? Pour moi, je ne m’en sens guère. Je voudrais bien que mon pays donnât de bons exemples, mais à défaut, j’aime encore mieux qu’il en reçoive que s’il fallait attendre un siècle pour qu’il prît la tête. — Et puis je ne puis retenir ici une réflexion philosophique. — Les nations s’enorgueillissent beaucoup d’avoir produit un grand musicien, un bon peintre, un habile capitaine, comme si cela ajoutait quelque chose à notre propre mérite. L’on dit : « Le Français invente, l’Anglais encourage. » Morbleu ! ne voyez-vous pas que l’invention est un fait personnel et l’encouragement un fait national ? Bentham disait des sciences : « Ce qui les propage vaut mieux que ce qui les avance. » J’en dis autant des vertus.
Mais où vais-je m’égarer ? Donc que le progrès nous vienne du couchant ou de l’aurore, pourvu qu’il vienne.
Votre discours paraîtra demain dans deux journaux de Paris. Ce n’est pas moi qui l’ai traduit. J’ai remarqué que vous avez pu vous permettre le conseil plus qu’à Paris. Au reste, vous l’avez fait avec une parfaite convenance, et je vous approuve fort d’avoir dit aux Castillans qu’il n’est pas nécessaire de tuer les gens pour leur apprendre à vivre.
Ici nous allons lentement, mais nous allons. Notre dernière séance a été bonne et le public en réclame une autre. Je suis allé au Havre. Une association s’y est formée ; mais elle n’a pas cru devoir prendre notre titre. Je crains que ces messieurs n’aient pas compris l’importance de se rallier à un principe simple. Ils demandent la Réforme commerciale et l’abaissement des impôts sur la consommation. Que de choses il y aurait à dire ! — Réforme commerciale ! — Ils n’ont pas osé prononcer le mot Liberté, à cause de la navigation. — Abaissement des taxes ! — Dans quel monde de discussions cela va-t-il les jeter !
À propos de la navigation, j’ai mis un article dans le journal du Havre qui a fait un bon effet local. — M. Anisson croit que c’est aux dépens du principe. Je ne le pense pas, mais il m’en coûte d’être en désaccord avec le plus zélé et le plus éclairé de mes collègues. — Je voudrais bien que vous fussiez à portée de nous, pour décider sur ce dissentiment. — Mais vraiment le débat par correspondance serait trop long.
Je ne sais si c’est à ma honte ou à ma gloire, mais je n’ai rien lu about the mariage. Notre journal le Courrier ne parle que de cela depuis deux mois. Je l’ai prévenu qu’autant vaudrait mettre sous son titre : Journal d’une coterie espagnole. Il a perdu ses abonnés ; il s’en prend au Libre-Échange. Quelle pitié ! vraiment je regrette mes Landes. Là j’imaginais la turpitude humaine ; mais il est plus pénible de la voir.
Adieu, mon frère d’armes, soignez bien votre santé et celle de madame Cobden, à qui je présente mes civilités. Méfiez-vous de l’air de l’Espagne qui est fort traître et détruit les poumons sans avoir l’air d’y toucher.
à Richard Cobden: Lettre du 22 novembre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.72] [OC1] 72. Paris, 22 novembre 1846. A Richard Cobden
Mon cher ami, je vous remercie de m’avoir mis à même de vous suivre dans votre voyage, par les journaux de Madrid, de Séville et de Cadix. Les témoignages de sympathie que vous recevez partout arrivent, through you, à notre belle cause. Cela me réjouit l’âme de voir que les hommages des peuples vont enfin à la bonne adresse, au lieu de s’égarer, selon l’usage, vers les actions, quels qu’en soient les motifs, qui infligent les maux les plus évidents à la pauvre humanité. En même temps, il m’est bien agréable d’apprendre que vous jouissez d’une bonne santé et que celle de madame Cobden n’a pas eu à souffrir d’un si long voyage.
Je partage votre opinion sur l’Espagne et les Espagnols. Cependant, ne vous faites-vous pas un peu illusion sur le degré de prospérité auquel ce pays est appelé ? Je sais qu’on parle toujours de sa fertilité ; mais l’absence de rivières, de canaux, de routes, d’arbres sont des obstacles dont vous devez apprécier la force. En isolant les hommes, ils s’opposent autant au développement moral et social qu’à l’accroissement des richesses. L’Espagne a besoin qu’on invente le moyen de faire franchir les montagnes aux locomotives. Pressé par le temps, qui ne me permet plus guère de faire face à une correspondance de famille, je vais droit à la question du free-trade en France. En ce moment, nous sommes accablés. Les prohibitionnistes font de l’agitation à fond et à l’anglaise. Journaux, contributions, appels aux ouvriers, menaces au gouvernement, rien n’y manque. Quand je dis à l’anglaise, j’entends qu’ils déploient beaucoup d’énergie et une véritable entente de l’agitation.
Sous ce rapport, nos provinces du Nord sont beaucoup plus avancées que nos départements méridionaux. — Et puis un intérêt plus actuel les aiguillonne. — Dans vingt-quatre heures ils ont fondé un journal, et nous… croiriez-vous que nous ne savons pas encore si Bordeaux veut ou ne veut pas nous aider ? Marseille et le Havre s’isolent, et leur seul motif est qu’ils ne nous trouvent pas assez pratiques, comme si nous avions autre chose à faire qu’à détruire une erreur publique. Mais je m’attendais à tout cela et à pis encore.
Je n’ai pas pu échapper à la nécessité de prendre sur moi le travail matériel. Le défaut d’argent, d’un côté, et les occupations de mes collègues, de l’autre, ne me laissaient que l’alternative de tout abandonner ou de boire ce calice. — Je vois passer dans le journal protectionniste et dans les feuilles démocratiques les fallacies les plus étranges sans avoir le temps d’y répondre ; et il m’est même impossible de réunir les matériaux d’un second volume des Sophismes, quoique je les aie en suffisante quantité. Seulement, ils sont tous dans le genre Buffa, et je voudrais en entremêler quelques-uns de Scria. — Quant à une autre édition plus complète de « Cobden et la Ligue, » je n’y pense même plus.
Quelle différence, mon cher ami, si je pouvais aller de ville en ville parlant et écrivant !
Quoi qu’il en soit, l’opinion publique est éveillée et j’espère.
Il est à peu près décidé que nous émettrons notre premier numéro dans les premiers jours de décembre, sans savoir comment nous pourrons nous soutenir. Mais les bonnes causes ne doivent-elles pas compter sur la Providence ? — Je vous en enverrai un exemplaire toutes les fois que je pourrai vous rejoindre dans vos pérégrinations. J’espère aussi que vous nous ferez avoir des abonnés au dehors. Nous calculons qu’à 12 fr., il nous faudrait 5,000 abonnés pour faire nos frais. Nous pourrions alors nous passer de Marseille et du Havre. Malgré que nous devions être très-circonspects à l’égard des étrangers et surtout des Anglais, je ne pense pas qu’il y ait des inconvénients à ce que vos compatriotes nous aident à accroître la circulation de notre journal dans les contrées où la langue française est répandue.
Je reçois à l’instant une lettre de Bordeaux. Elle me donne l’espérance que nous serons aidés. Le maire y travaille cordialement.
Une autre bonne fortune m’arrive en ce moment. Les ouvriers m’engagent à aller les trouver et à m’entendre avec eux. Si je les avais, ils entraîneraient le parti démocratique. J’y ferai tous mes efforts.
à Richard Cobden: Lettre du 25 novembre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.73] [OC1] 73. Paris, 25 novembre 1846. A Richard Cobden
Mon cher ami, hier soir, nous avons tenu notre troisième séance publique. La salle Montesquieu était pleine et beaucoup de personnes n’ont pas pu entrer, ce qui est, à Paris, la circonstance la plus favorable pour attirer du monde. De nouvelles classes ont paru dans l’assemblée. J’avais envoyé des billets aux ouvriers et aux élèves des écoles de droit. Le public a été admirable ; et quoique les orateurs oublient quelquefois ce conseil de la sagesse, de la prudence et même de leur intérêt bien entendu, arrêtez-vous donc ! l’auditoire a écouté avec une attention religieuse, quand il n’était pas entraîné par l’enthousiasme. Nos orateurs ont été MM. Faucher, qui a commenté avec beaucoup de force et d’à-propos une lettre officielle des protectionnistes au conseil des ministres ; Peupin, ouvrier, qui aurait été parfait de verve et de simplicité, s’il avait su se renfermer dans son rôle, d’où il a un peu trop voulu sortir ; Ortolan, qui a fait un discours éloquent, et a considéré la question à un point de vue tout à fait neuf. Ce discours a enflammé l’auditoire et remué la fibre française. Enfin, Blanqui, qui a été aussi énergique que spirituel. — Notre digne président avait ouvert la séance par quelques paroles pleines de grâce et empreintes du bon ton que conserve encore notre aristocratie nominale. Je vous enverrai tout cela.
Parler en public a un attrait irrésistible pour le Français. Il est donc probable que nous serons accablés de demandes, et quant à moi je suis décidé à attendre que la parole me soit offerte. C’est m’exposer à attendre longtemps ; quoi qu’il en soit, je ne serais pas fâché de me tenir prêt au besoin. — Si donc il vous venait quelque idée neuve, quelqu’une de ces pensées qui, développées, puissent servir de texte à un bon discours, ne manquez pas de me l’indiquer. — Si ma santé ne peut se concilier avec la part de travail intérieur qui m’est échue, je demanderai un congé et j’en profiterai pour aller à Lyon, Marseille, Nîmes, etc. Envoyez-moi donc tout ce qui pourra se présenter à votre esprit approprié à ces diverses villes. — Vous pourriez écrire ces pensées, à mesure qu’elles s’offrent à votre esprit, sur de petits morceaux de papier et les enfermer dans vos lettres. — Je me charge du verre d’eau dans lequel devront être délayées ces gouttes d’essence.
Particulièrement, je tiens à approfondir la question des salaires, c’est-à-dire l’influence de la liberté et de la protection sur le salaire. Je ne serais pas embarrassé de traiter cette grande question d’une manière scientifique ; et si j’avais un livre à faire là-dessus, j’arriverais peut-être à une démonstration satisfaisante. — Mais ce qui me manque, c’est une de ces raisons claires, saisissantes, propres à être présentées aux ouvriers eux-mêmes, et qui, pour être comprises, n’ont pas besoin de toutes les notions antérieures de valeur, numéraire, capital, concurrence, etc.
Adieu, mon cher ami, écrivez-moi de Barcelone. Je crois avoir un peu de fièvre et je me suis imposé la loi de ne rien faire aujourd’hui. C’est pourquoi je m’arrête, en vous renouvelant l’expression de mon amitié.
à Richard Cobden: Lettre du 20 décembre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.74] [OC1] 74. Paris, 20 décembre 1846. A Richard Cobden
Mon cher ami, j’avais perdu votre trace depuis quelque temps et je suis bien aise de vous savoir en France, dans ce pays le plus délicieux qu’il y ait au monde, s’il avait le sens commun. Ah ! mon ami, je m’attendais que nos adversaires exploiteraient contre nous les aveugles passions populaires, et entre autres la haine de l’étranger. Mais je ne croyais pas qu’ils réussiraient aussi bien. Ils ont soudoyé de nouveau la presse, et le mot d’ordre est de nous représenter comme des traîtres, des agents de Pitt et Cobourg. Croiriez-vous que, dans mon pays même, cette calomnie a fait son chemin ! On m’écrit de Mugron, qu’on n’ose plus y parler de moi qu’en famille, tant l’esprit public y est monté contre noire entreprise. Je sais bien que cela passera, mais la question pour nous est de savoir combien de temps il faut à la raison pour avoir raison. Le 29 de ce mois, je dois parler à la salle Montesquieu, et mon projet est de toucher ce sujet délicat et de développer cette idée: « L’oligarchie anglaise a pesé sur le monde, et c’est ce qui explique l’universelle défiance avec laquelle on accueille ce qui se fait de l’autre côté du détroit. Mais il y a un pays sur lequel elle a pesé plus que sur tout autre, et c’est l’Angleterre elle-même. Voilà pourquoi il y a en Angleterre, une classe qui résiste à l’oligarchie et la dépouille peu à peu de ses dangereux priviléges. C’est cette classe qui a conquis successivement l’émancipation catholique, la réforme électorale, l’abolition de l’esclavage et la liberté commerciale, et qui est sur le point de conquérir l’affranchissement des colonies. Elle travaille donc dans notre sens, et il est absurde de l’envelopper dans la même haine que nous devons réserver aux classes dominatrices de tous les pays. »
Voilà le texte. Je crois pouvoir l’habiller de manière à le faire passer. [37]
Que de choses j’aurais à vous dire, mon cher ami ! mais le temps me manque. — Je vous envoie les quatre premiers numéros de notre journal. J’y ai marqué ce qui est de moi. Je me suis vu contraint, sous peine de faire manquer l’entreprise, d’y mettre mon nom, et maintenant je ne puis supporter plus longtemps d’accepter la responsabilité de tout ce qui s’y dit. Cela va amener une crise, car il faut qu’on me laisse faire le journal comme je le veux ou qu’un autre le signe.
De tous les sacrifices que j’ai faits à la cause, celui-là est le plus grand. — Combattre à mon gré allait mieux à mon caractère ; tantôt faisant des articles sérieux et de longue haleine, tantôt allant à Lyon ou à Marseille, enfin, obéissant à ma nature sensitive. Me voilà au contraire attaché à la polémique quotidienne. Mais dans notre pays, c’est le champ de l’utilité.
Vous n’avez pas besoin d’introduction auprès de M. Rossi ; votre renommée vous donne accès partout. Cependant, puisque vous le désirez, je vais vous envoyer une lettre de M. Chevalier ou de quelque autre.
Maintenant, je crois que nos efforts doivent tendre à la diffusion de notre journal le Libre-Échange. Soyez convaincu que, dès que nous serons sortis des tiraillements inséparables d’un commencement, ce journal sera fait dans un bon esprit et pourra rendre de grands services, pourvu qu’il soit lu. Attachez-vous donc, dans vos voyages, à lui trouver des abonnés ; faites en sorte que les frontières de l’Italie ne lui soient pas fermées. Faites observer qu’il n’attaque aucune institution politique, aucune croyance religieuse. — L’Italie est le pays qui donne le plus d’abonnés au Journal des Économistes. Il doit en donner bien davantage au Libre-Échange, qui paraît toutes les semaines et ne coûte que 12 fr. — Ce n’est pas tout. Je pense que vous devriez écrire à Londres et à Manchester, car enfin the cry contre l’Angleterre n’empêche pas que nous ne puissions y trouver des abonnés. Des abonnements, c’est pour nous une question de vie et de mort. Mon cher Cobden, après avoir dirigé de si haut le mouvement en Angleterre, ne dédaignez pas l’humble mission de courtier d’abonnements.
J’ai vraiment honte de vous envoyer cette lettre faite à bâtons rompus et sans trop savoir ce que je dis. Je me réserve de vous écrire plus à l’aise, cette nuit et la suivante.
à Richard Cobden: Lettre du 25 décembre 1846 (Paris) ↩
BWV
[CW1.75] [OC1] 74. Paris, 25 décembre 1846. A Richard Cobden
Mon cher ami, j’ai communiqué votre lettre à Léon Faucher. Il dit que « vous ne connaissez pas la France. » Pour moi, je suis convaincu que nous ne pouvons réussir qu’en éveillant le sentiment de la justice, et que nous ne pourrions pas même prononcer le mot justice si nous admettions l’ombre de la protection. Nous en avons fait l’expérience ; et la seule fois que nous avons voulu faire des avances à une ville, elle nous a ri au nez. — C’est cette conviction et la certitude où je suis qu’elle n’est pas assez partagée qui m’a principalement engagé à accepter la direction du journal. — Non que ce soit une direction bien réelle : il y a un comité de rédaction qui a la haute main ; mais je puis espérer néanmoins de donner à l’esprit de cette feuille une couleur un peu tranchée. Quel sacrifice, mon ami, que d’accepter le métier de journaliste et de mettre mon nom au bas d’une bigarrure ! mais je ne vous écris pas pour vous faire mes doléances.
Marseille ne paraît, pas plus que Bordeaux, comprendre la nécessité de concentrer l’action à Paris. Cela nous affaiblit. Nos adversaires n’ont pas fait cette faute ; et quoique leur association recèle des germes innombrables de division, ils compriment ces germes par leur habileté et leur abnégation. Si vous avez occasion de voir les meneurs de Marseille, expliquez-leur bien la situation.
The cry contre l’Angleterre nous étouffe. On a soulevé contre nous de formidables préventions. Si cette haine contre la perfide Albion n’était qu’une mode, j’attendrais patiemment qu’elle passât. Mais elle a de profondes racines dans les cœurs. Elle est universelle, et je vous ai dit, je crois, que dans mon village on n’ose plus parler de moi qu’en famille. De plus, cette aveugle passion est si bien à la convenance des intérêts protégés et des partis politiques, qu’ils l’exploitent de la manière la plus éhontée. Écrivain isolé, je pourrais les combattre avec énergie ; mais, membre d’une association, je suis tenu à plus de prudence.
D’ailleurs, il faut avouer que les événements ne nous favorisent pas. Le jour même où sir Robert Peel a consommé le free-trade, il a demandé un crédit de 25 millions pour l’armée, comme pour proclamer qu’il n’avait pas foi dans son œuvre, et comme pour refouler dans notre bouche nos meilleurs arguments. Depuis, la politique de votre gouvernement est toujours empreinte d’un esprit de taquinerie qui irrite le peuple français et lui fait oublier ce qui pouvait lui rester d’impartialité. Ah ! si j’avais été ministre d’Agleterre ! à l’occasion de Cracovie, j’aurais dit: « Les traités de 1815 sont rompus. La France est libre ! l’Angleterre combattit le principe de la révolution française jusqu’à Waterloo. Aujourd’hui, elle a une autre politique, celle de la non-intervention dans toute son étendue. Que la France rentre dans ses droits, comme l’Angleterre dans une éternelle neutralité. » — Et joignant l’acte aux paroles, j’aurais licencié la moitié de l’armée et les trois quarts des marins. Mais je ne suis pas ministre.
Articles and Essays↩
A M. de Larnac, député des Landes (1846) [CW1.2.3]↩
BWV
1846.?? “A M. de Larnac, député des Landes: De la réforme parlementaire” (To M. de Larnac, Deputy of Les Landes, on Parliamentary Reform) [OC1.15, p. 480] [CW1]
De la réforme parlementaire
À M. de Larnac, député des Landes
Monsieur,
Vous avez jugé à propos de mettre en circulation une lettre que j’ai eu l’honneur de vous adresser et la réponse que vous avez bien voulu y faire. Je ne vous en fais pas de reproche. Vous prévoyiez sans doute que nous nous trouverions aux élections dans des camps opposés ; et si ma
correspondance vous révélait en moi un homme professant des opinions fausses et dangereuses, vous étiez en droit d’avertir le public. J’admets que vous vous êtes décidé sous l’influence de cette seule préoccupation d’intérêt général. Peut-être eût-il été plus convenable d’opter entre une réserve absolue et une publicité entière. Vous avez préféré quelque chose qui n’est ni l’un ni l’autre : le colportage officieux, insaisissable d’une lettre dont je n’ai pas gardé la minute et dont je ne puis par conséquent expliquer et défendre les expressions. Soit. Je n’ai pas le plus léger doute sur la fidélité du copiste qui a été chargé de la reproduire, et cela me suffit.
Mais, monsieur, cela suffit-il pour remplir votre but, qui est sans doute d’éclairer la religion de MM. les électeurs ? Ma lettre a rapport à un fait particulier, ensuite à une doctrine politique. Le fait, je l’ai à peine indiqué, et cela est tout simple, puisque je m’adressais à quelqu’un qui en connaissait toutes les circonstances. La doctrine, je l’ai ébauchée comme on peut le faire en style épistolaire. Cela ne suffit pas pour le public ; et puisque vous l’avez saisi, permettez-moi de le saisir à mon tour.
Je répugne trop à introduire des noms propres dans ce débat pour insister sur le fait particulier. Le besoin de ma défense personnelle pourrait seul m’y décider, et je me hâte d’en venir à la grande question politique qui fait le sujet de votre lettre : l’incompatibilité du mandat législatif avec les fonctions publiques.
Je le déclare d’avance : je ne demande pas précisément que les fonctionnaires soient exclus de la Chambre ; ils sont citoyens et doivent jouir des droits de la cité ; mais qu’ils n’y soient admis qu’à titre de citoyens et non à titre de fonctionnaires. Que s’ils veulent représenter la nation sur qui s’exécute la loi, ils ne peuvent pas être les exécuteurs de la loi. Que s’ils veulent représenter le public qui paye son gouvernement, ils ne peuvent pas être les agents salariés du gouvernement. Leur présence à la Chambre me semble devoir être subordonnée à une mesure indispensable, que j’indiquerai plus tard, et j’ajoute sans hésiter qu’il y a, à mes yeux du moins, cent fois plus d’inconvénients à les y admettre sans condition qu’à les en exclure sans rémission.
« Votre thèse est fort vaste (dites-vous) ; si je traitais à priori la question des incompatibilités, je commencerais à blâmer cette tendance au soupçon qui me semble peu libérale. »
Mais, monsieur, qu’est-ce que l’ensemble de nos lois, sinon une série de précautions contre les dangereuses tendances du cœur humain ? Qu’est-ce que la constitution ? que sont toutes ces balances, équilibres, pondérations de pouvoirs, sinon un système de barrières opposées à leurs usurpations possibles et même fatales, en l’absence de tout frein? Qu’est-ce que la religion elle-même, au moins dans une de ses parties essentielles, sinon une source de grâces destinées par la Providence à porter remède à la faiblesse native et, par conséquent, prévue de notre nature ? Si vous vouliez effacer de nos symboles, de nos chartes et de nos codes tout ce qu’y a déposé ce que vous appelez le soupçon, et que j’appelle la prudence, vous rendriez la tâche des légistes bien facile, mais le sort des hommes bien précaire. Si vous croyez l’homme infaillible, brûlez les lois et les chartes. Si vous le croyez faillible, alors, quand il s’agit d’une incompatibilité ou même d’une loi quelconque, la question n’est pas de savoir si elle est fondée sur le soupçon, mais sur un soupçon impartial, raisonnable, éclairé, ou plutôt sur une prévision malheureusement justifiée par l’indélébile infirmité du cœur de l’homme.
Ce reproche de tendances soupçonneuses a été si souvent dirigé contre quiconque réclame une réforme parlementaire, que je crois devoir mettre quelque insistance à le repousser. Dans l’extrême jeunesse, quand nous venons d’échapper à l’atmosphère de la Grèce et de Rome, où l’université nous force de recevoir nos premières impressions, il est vrai que l’amour de la liberté se confond trop souvent en nous avec l’impatience de toute règle, de tout gouvernement, et, par suite, avec une puérile aversion pour les fonctions et les fonctionnaires. Pour ce qui me regarde, l’âge et la méditation m’ont parfaitement guéri de ce travers. Je reconnais que, sauf le cas d’abus, dans la vie publique ou dans la vie privée, chacun rend à la société des services analogues. Dans celle-ci, on satisfait le besoin qu’elle a de nourriture et de vêtement ; dans l’autre, le besoin qu’elle a d’ordre et de sécurité. Je ne m’élève donc pas en principe contre les fonctions publiques ; je ne soupçonne individuellement aucun fonctionnaire ; j’en estime un grand nombre, et je suis fonctionnaire moi-même quoiqu’à un rang fort modeste. Si d’autres ont plaidé la cause des incompatibilités, sous l’influence d’une étroite et chagrine jalousie ou des alarmes d’une démocratie ombrageuse, je puis poursuivre le même but sans m’associer à ces sentiments. Certes, sans franchir les limites d’une défiance raisonnable, il est permis de tenir compte des passions des hommes ou plutôt de la nature des choses.
Or, monsieur, quoique les fonctions publiques et les industries privées aient ceci de commun, que les unes et les autres rendent à la société des services analogues, on ne peut nier qu’elles diffèrent par une circonstance qu’il est essentiel de remarquer. Chacun est libre d’accepter ou de refuser les services de l’industrie privée, de les recevoir dans la mesure qui lui convient et d’en débattre le prix. Tout ce qui concerne les services publics, au contraire, est réglé d’avance par la loi ; elle soustrait à notre libre arbitre, elle nous prescrit la quantité et la qualité que nous en devrons consommer (passez-moi ce langage un peu trop technique), ainsi que la rémunération qui y sera attachée. C’est pourquoi, à ce qu’il me semble, il appartient à ceux en faveur de qui et aux dépens de qui ce genre de services est établi, d’agréer au moins la loi qui en détermine l’objet, l’étendue et le salaire. Si le domaine de la coiffure était régi par la loi, et si nous laissions aux perruquiers le soin de la faire, il est à croire (sans vouloir froisser ici la susceptibilité de MM. les perruquiers, sans montrer une tendance au soupçon peu libérale, et raisonnant d’après la connaissance que l’on peut avoir du cœur humain), il est à croire, dis-je, que nous serions bientôt coiffés outre mesure, jusqu’à en être tyrannisés, jusqu’à épuisement de nos bourses. De même, lorsque MM. les électeurs font faire les lois qui règlent la production et la rémunération de la sécurité ou de tout autre produit gouvernemental, par les fonctionnaires qui vivent de ce travail, il me paraît incontestable qu’ils s’exposent à être administrés et imposés au delà de toute mesure raisonnable.
Poursuivi par l’idée que nous obéissons à une tendance au soupçon peu libérale, vous ajoutez :
« Dans des époques d’intolérance, on aurait dit aux candidats : Ne sois ni protestant ni juif ; aujourd’hui on dit : Ne sois pas fonctionnaire. »
Alors on aurait été absurde, aujourd’hui on est conséquent. Juifs, protestants et catholiques, régis par les mêmes lois, payant les mêmes impôts, nous les votons au même titre. Comment le symbole religieux serait-il un motif soutenable d’exclusion pour l’un d’entre nous ? Mais quant à ceux qui appliquent la loi et vivent de l’impôt, l’interdiction de les voter n’a rien d’arbitraire. L’administration elle-même agit selon ce principe et témoigne ainsi qu’il est conforme au bon sens. M. Lacave-Laplagne ne fait pas inspecter la comptabilité par les comptables. Ce n’est pas lui, c’est la nature même de ces deux ordres de fonctions qui en fait l’incompatibilité. Ne trouveriez-vous pas plaisant que M. le Ministre la fondât sur le symbole religieux, la longueur du nez ou la couleur des cheveux ? L’analogie que vous me proposez est de cette force.
« Je trouve qu’il faut des motifs bien graves, bien patents, bien avérés pour demander une exception contre quelqu’un. En général, cette pensée est mauvaise et rétrograde. »
Entendez-vous faire la satire de la Charte ? Elle prononce l’exclusion de quiconque ne paye pas 500 fr. d’impôts sur le simple soupçon que, qui n’a pas de fortune, n’a pas d’indépendance. Ne me conformé-je pas à son esprit, lorsque, n’ayant qu’un suffrage à donner et forcé d’excepter tous les candidats, hors un, je laisse dans l’exception celui qui, ayant de la fortune, peut-être, mais la tenant du ministre, me semble plus dépendant que s’il n’en avait pas ?
« Je suis pour l’axiome progressif: Sunt favores ampliandi, sunt odia restringenda. »
Sunt favores ampîiandi ! Ah ! monsieur, je crains bien qu’il n’y ait que trop de gens de ce système. Quoi qu’il en soit, je demande si la députation est faite pour les députés ou pour le public. Si c’est pour le public, montrez-moi donc ce qu’il gagne à y envoyer des fonctionnaires. Je vois bien que cela tend à élargir le budget, mais non sans restreindre les ressources des contribuables.
Sunt odia restringenda ! Les fonctions et les dépenses inutiles, voilà les odia qu’il s’agit de restreindre. Dites-moi donc comment on peut l’attendre de ceux qui remplissent les unes et engloutissent les autres ?
Toutefois, il est un point sur lequel nous serons d’accord. C’est l’extension des droits électoraux. À moins que vous ne les rangiez parmi les odia restringenda, il faut bien que vous les mettiez au nombre des favores ampliandi, et votre généreux aphorisme nous répond que la réforme électorale peut compter sur vous.
« J’ai confiance dans le jeu de nos institutions (spécialement sans doute de celle qui fait l’objet de cette correspondance). Je le crois propre à produire la moralité. Cette condition des sociétés réside nécessairement dans les électeurs ; elle se résume dans l’élu, elle passe dans le vote des majorités, etc. »
Voilà, certes, un tableau fort touchant, et j’aime cette moralité qui s’élève de la base au sommet de l’édifice. J’en pourrais tracer un moins optimiste et montrer l’immoralité politique descendant du sommet à la base. Lequel des deux serait le plus vrai ? Quoi ! la confusion dans les mêmes mains du vote et de l’exécution des lois, du vote et du contrôle du budget produire la moralité ! Si je consulte la logique, j’ai peine à le comprendre. Si je regarde les faits, j’ai encore plus de peine à le voir.
Vous invoquez la maxime : Quid leges sine moribus ? Je ne fais pas autre chose. Je n’ai pas fait le procès à la loi, mais aux électeurs. J’ai émis le vœu qu’ils se fissent représenter par des députés dont les intérêts fussent en harmonie et non en opposition avec les leurs propres. C’est bien là une affaire de mœurs. La loi ne nous interdit pas de nommer des fonctionnaires, mais elle ne nous y oblige pas non plus. Je ne dissimule pas qu’il me semblerait raisonnable qu’elle contînt à cet égard quelques précautions. En attendant, prenons-les nous-mêmes : Quid leges sine moribus ?
J’avais dit: « À tort ou à raison, c’est une idée très-arrêtée en moi que les députés sont les contrôleurs du pouvoir. »
Vous raillez sur les mots à tort ou à raison. Soit ; je vous les abandonne. Substituez-y ceux-ci : Je puis me tromper, mais c’est en moi une idée arrêtée que les députés sont les contrôleurs du pouvoir.
De quel pouvoir ? Demandez-vous. — Évidemment du pouvoir exécutif. Vous dites : « Je ne reconnais que trois pouvoirs : le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés. » — Si nous remontons aux principes abstraits, je me verrai forcé de différer d’opinion avec vous, car je ne reconnais originairement qu’un pouvoir : le pouvoir national. Tous les autres sont délégués ; et c’est parce que le pouvoir exécutif est délégué que la nation a le droit de le contrôler. Et c’est pour que ce contrôle ne soit pas dérisoire que la nation, selon mon humble avis, ferait sagement de ne pas remettre aux mêmes mains et le pouvoir et le contrôle. Assurément, elle est maîtresse de le faire. Elle est maîtresse de s’attirer, comme elle le fait, des entraves et des taxes. En cela, elle me paraît inconséquente, et plus inconséquente encore de se plaindre du résultat. Vous croyez que j’en veux beaucoup à l’administration ; point du tout, je l’admire, je la trouve bien généreuse, quand le public lui fait la partie si belle, de se contenter d’un budget de 14 à 1,500 millions. Depuis trente ans, c’est à peine si les impôts ont doublé. Il y a là de quoi être surpris, et il faut bien reconnaître que l’avidité du fisc est restée fort au-dessous de l’imprudence des contribuables.
Vous trouvez vague cette pensée : « La mission des députés est de tracer le cercle où le pouvoir doit s’exercer. » — « Ce cercle, dites-vous, est tout tracé, c’est la Charte. »
J’avoue que je ne sais pas, dans la Charte, une seule disposition qui ait rapport à la question. Il faut bien que nous ne nous entendions pas ; je vais tâcher d’expliquer ma pensée.
Une nation peut être plus ou moins administrée. En France et sous l’empire de la Charte, il est une foule de services qui peuvent sortir du domaine de l’industrie privée pour être confiés à la puissance publique et réciproquement. Naguère, on a disputé très-chaudement pour savoir auquel de ces deux modes d’activité resteraient les chemins de fer. On dispute plus chaudement encore la question de savoir auquel des deux doit appartenir l’éducation. Un jour, peut-être, le même doute s’élèvera au sujet des cultes. Il est tel pays, comme les États-Unis, où l’État ne s’en mêle pas et s’en trouve bien. Ailleurs, en Russie et en Turquie, par exemple, le système contraire a prévalu. Dans les Iles Britanniques, aussitôt que l’agitation pour l’affranchissement des échanges sera apaisée par son triomphe, une autre agitation se prépare pour faire prédominer, en matière de religion, le voluntary system, ou le renversement de l’Église établie. J’ai parlé de la liberté des échanges ; chez nous, le gouvernement s’est fait, par le jeu des tarifs, le régulateur de l’industrie. Tantôt il favorise l’agriculture aux dépens des fabriques, tantôt les fabriques aux dépens de l’agriculture ; et il a même la singulière prétention de faire prospérer toutes les branches de travail aux dépens les unes des autres. — C’est lui qui opère exclusivement le transport des lettres, la manutention des poudres et des tabacs, etc., etc.
Il y a donc un partage à faire entre l’activité privée et l’activité collective ou gouvernementale. D’un côté, beaucoup de gens sont enclins à accroître indéfiniment les attributions de l’État. Les visionnaires les plus excentriques, comme Fourier, se rencontrent sur ce point avec les hommes d’État les plus pratiques, comme M. Thiers. Suivant ces puissants génies, l’État doit être, bien entendu sous leur suprême direction, le grand justicier, le grand pontife, le grand instituteur, le grand ingénieur, le grand industriel, le grand bienfaiteur du peuple. D’un autre côté, beaucoup de bons esprits soutiennent la thèse contraire ; et il y en a qui vont même jusqu’à désirer que le gouvernement soit contenu dans ses attributions essentielles, qui sont de garantir la sécurité des personnes et des propriétés, de prévenir et réprimer la violence et le désordre, d’assurer à chacun le libre exercice de ses facultés et la naturelle récompense de ses efforts. Ce n’est déjà pas sans quelque danger, disent-ils, que la nation confie à un corps hiérarchiquement organisé le redoutable dépôt de la force publique. Il le faut bien ; mais du moins qu’elle se garde de lui donner encore autorité sur les consciences, sur les intelligences, sur l’industrie, si elle ne veut être réduite à l’état de propriété, à l’état de chose.
Et c’est pour cela qu’il y a une Charte. Et c’est pour cela que dans cette Charte il y a un article 15 : « Toute loi d’impôt doit être d’abord votée par la Chambre des députés. » Car, remarquez-le bien, chaque invasion de la puissance publique, dans le domaine de l’activité privée, implique une taxe. Si le gouvernement prétend s’emparer de l’éducation, il lui faut des professeurs à gages et partant une taxe. S’il aspire à soumettre nos consciences à un symbole, il lui faut un clergé et partant une taxe. S’il doit exécuter les chemins de fer et les canaux, il lui faut un capital et partant une taxe. S’il doit faire des conquêtes en Afrique et dans l’Océanie, il lui faut des armées, une marine, et partant une taxe. S’il doit pondérer les profits des diverses industries par l’action des tarifs, il lui faut une douane et partant une taxe. S’il est chargé de fournir à tous du travail et du pain, il lui faut des taxes et toujours des taxes.
Or, par cela même que, selon notre droit public, la nation n’est pas la propriété de son gouvernement, que c’est pour elle et non pour lui qu’existent la religion, l’éducation, l’industrie, les chemins de fer, etc., c’est à elle et non à lui qu’il appartient de décider quels services lui seront confiés, quels lui seront retirés. Elle en a le moyen dans l’article 15 de la Charte. Il lui suffit de refuser une taxe pour acquérir par cela même une liberté.
Mais si elle abandonne à l’État et à ses agents, au pouvoir exécutif et à ses instruments, le soin de fixer ce grand départ entre le domaine de l’activité collective et celui de l’activité privée ; si, de plus, elle leur livre l’article 15 de la Charte, n’est-il pas à croire qu’elle sera bientôt administrée à merci et à miséricorde ? qu’on créera indéfiniment des fonctions pour substituer dans chaque branche le service forcé au service volontaire, et aussi des impôts pour alimenter ces fonctions ? et est-il possible d’apercevoir un terme quelconque à cet enchaînement d’usurpations et de taxes qui se nécessitent les unes les autres ? car, sans songer à attaquer les individus, ni à exagérer les penchants dangereux de l’homme, ne pouvons-nous pas affirmer qu’il est dans la nature de tout corps constitué et organisé de tendre à s’agrandir, à absorber toutes les influences, tous les pouvoirs, toutes les richesses ?
Eh bien, monsieur, le sens de la phrase que vous avez trouvé vague est celui-ci : Lorsque la nation nomme des députés, elle leur donne pour mission, entre autres choses, de circonscrire la sphère d’action du gouvernement, de fixer les limites que cette action ne doit point dépasser ; de lui ôter, par un judicieux usage de l’article 15 de la Charte, tout moyen de s’emparer de celles de ses libertés qu’elle entend conserver. Objet dans lequel elle échouera infailliblement, si elle abandonne cette force restrictive à ceux-là mêmes en qui réside la force expansive qu’il s’agit de contenir et de restreindre. Puissiez-vous, monsieur, ne pas trouver le commentaire plus vague encore que le texte.
Enfin, il y a dans ma lettre une autre phrase qui doit m’entraîner à de longues explications, car elle semble vous avoir particulièrement choqué, et c’est celle-ci :
« Dès l’instant que les députés peuvent devenir ministres, il est tout simple que les ambitieux cherchent à se frayer une route vers le ministère par l’opposition systématique. »
Ici, monsieur, je ne m’en prends plus aux personnes qui occupent les places, mais au contraire à celle qui les convoitent non plus aux fonctionnaires, mais bien à ceux qui veulent les supplanter. Ce sera à vos yeux, je l’espère, une preuve irrécusable que je ne suis animé d’aucune jalousie chagrine contre tel individu ou telle classe.
Jusqu’à présent j’ai traité la question de l’admissibilité des fonctionnaires à la députation, et me plaçant au point de vue des contribuables, j’ai essayé de prouver qu’ils ne pouvaient guère (pour revenir aux expressions que vous relevez avec tant d’insistance) remettre le contrôle aux mains des contrôlés, sans risquer à la fois leur fortune et leur liberté.
Le passage que je viens de rapporter me conduit à traiter de l’admissibilité des députés aux fonctions publiques, à envisager cette grande question dans ses rapports avec le pouvoir lui-même. Ainsi se trouvera parcouru le cercle des incompatibilités.
Oui, monsieur, je regarde l’admissibilité des députés aux fonctions publiques, et spécialement au ministère, comme essentiellement destructive de toute force, de toute stabilité, de toute suite dans l’action du gouvernement. Je ne pense pas qu’il fût possible d’imaginer une combinaison plus contraire aux intérêts du monarque et de ceux qui le représentent, un oreiller plus anguleux pour la tête du roi et des ministres. Rien au monde ne me semble plus propre à éveiller l’esprit de parti, à alimenter les factions, à corrompre toutes les sources d’information et de publicité, à dénaturer l’action de la tribune et de la presse, à égarer l’opinion après l’avoir passionnée, à entraver l’administration, à fomenter les haines nationales, à provoquer la guerre extérieure, à user et déconsidérer les gouvernants, à décourager et pervertir les gouvernés, à fausser, en un mot, tous les ressorts du régime représentatif. Pour ce qui me regarde, je ne connais aucune plaie sociale qui se puisse comparer à celle-là. Comme ce côté de la question n’a jamais été traité ni même aperçu, que je sache, par les partisans de la reforme parlementaire, puisque dans tous leurs projets de loi, si l’article 1er pose le principe des incompatibilités, l’article 2 se hâte de créer des exceptions en faveur des ministères, des ambassades, et de tout ce qu’on nomme hautes situations politiques, je me vois forcé de développer ma pensée avec quelque étendue.
Avant tout, je dois repousser une fin de non-recevoir. Vous dites que je suis en opposition avec la Charte. — Point du tout. — La Charte ne défend pas au député consciencieux de refuser un portefeuille, ni aux électeurs prudents de choisir parmi les candidats qui renoncent à cet illogique cumul. Si elle n’est pas prévoyante, elle ne nous interdit pas la prévoyance. Cela dit, je poursuis :
Un des prédécesseurs de M. le Préfet actuel des Landes me fit un jour l’honneur de me visiter. Les élections approchaient, et la conversation tomba naturellement sur les incompatibilités et spécialement sur l’admissibilité des députés au ministère. M. le Préfet s’étonnait, comme vous, que j’osasse professer une doctrine qui lui paraissait, comme à vous, exorbitamment rigide, impraticable, etc. Je lui dis :
Je pense, monsieur le Préfet, que vous rendrez cette justice au Conseil général des Landes, que vous y avez rencontré un grand esprit d’indépendance, mais jamais une opposition personnelle et systématique. Les mesures que vous proposez y sont examinées en elles-mêmes. Chaque membre vote pour ou contre, selon qu’il les juge bonnes ou mauvaises. Chacun consulte l’intérêt général tel qu’il le comprend, peut-être l’intérêt local, peut-être même l’intérêt personnel, mais il n’en est aucun que l’on puisse soupçonner de repousser une proposition utile émanée de vous, uniquement parce qu’elle émane de vous. — Jamais, dit M. le Préfet, la pensée ne m’est venue qu’il eu pût être ainsi. — Eh bien, je suppose que l’on introduise dans la loi qui organise ces conseils une disposition conçue en ces termes :
« Si une mesure proposée par le préfet est repoussée, il sera destitué. Celui des membres du conseil qui aura soulevé l’opposition, sera nommé préfet à sa place, et il pourra distribuer à ses compagnons de fortune toutes les grandes places du département : recette générale, direction des contributions directes et indirectes, etc. »
Je vous le demande, n’est-il pas probable, n’est-il pas même certain que cet article changerait complétement l’esprit du conseil ? N’est-il pas certain que cette salle, où règnent aujourd’hui l’indépendance et l’impartialité, serait convertie en une arène de brigues et de factions ? N’est-il pas à croire que l’ambition y serait fomentée en proportion de l’aliment qui lui serait offert ? Et quelque bonne opinion que vous ayez de la vertu des conseillers, pensez-vous qu’elle ne succomberait pas à cette épreuve ? Ne serait-il pas en tous cas bien imprudent de tenter cette dangereuse expérience ? Peut-on douter que chacune de vos propositions ne devînt le champ de bataille d’une lutte de personnes ? qu’on ne les étudierait plus dans leur rapport avec le bien public, mais au seul point de vue des chances qu’elles pourraient ouvrir aux partis ? Et maintenant, admettez qu’il y a dans le département des journaux. Certes, les armées belligérantes ne manqueront pas de les attacher à leur sort, et toute leur polémique s’empreindra des passions qui agiteront le conseil. Et quand viendra le jour de l’élection, la corruption et l’intrigue, surexcitées par l’ardeur de l’attaque et de la défense, ne connaîtraient plus de bornes.
— « J’avoue, me dit M. le Préfet, que sous un tel état de choses, je ne voudrais pas garder mes fonctions, même vingt-quatre heures. »
Eh bien, monsieur, cette constitution fictive des conseils généraux qui effrayait un préfet, n’est-ce point la constitution réelle de la Chambre ? Quelle différence y a-t-il ? Une seule. L’arène est plus vaste, le théâtre plus élevé, le champ de bataille plus étendu, l’aliment des passions plus excitant, le prix de la lutte plus convoité, les questions qui servent de texte ou de prétexte au combat plus brûlantes, plus difficiles et partant plus propres à égarer le sentiment et le jugement de la multitude. C’est le désordre organisé sur le même modèle, mais sur une plus grande échelle.
Des hommes ont occupé leur esprit de politique, c’est-à-dire qu’ils ont rêvé de grandeur, d’influence, de fortune et de gloire. Tout à coup le vent de l’élection les jette dans l’enceinte législative ; et que leur dit la constitution du pays ? Elle dit à l’un : « Tu n’es pas riche ; le ministre a besoin de grossir ses phalanges, il dispose de toutes les places, et la loi ne t’en interdit aucune. Conclus. » Elle dit à un autre : « Tu te sens du talent et de l’audace ; voilà le banc des ministres ; si tu les en chasses, ta place y est marquée. Conclus. » À un troisième : « Ton âme n’est pas à la hauteur d’une telle ambition, et pourtant tu as promis à tes électeurs de combattre le ministère ; mais une voie vers la région du pouvoir te reste : voilà un chef de parti, attache-toi à sa fortune. »
Alors, et cela est infaillible, alors commence ce pêle-mêle d’accusations réciproques, ces efforts inouïs pour mettre de son côté la force d’une popularité éphémère, cet étalage fastueux de principes irréalisables, quand on attaque, et de concessions abjectes, quand on se défend. Ce n’est que piéges et contre-piéges, mines et contre-mines. On voit se liguer les éléments les plus hétérogènes et se dissoudre les plus naturelles alliances. On marchande, on stipule, on vend, on achète. Ici, l’esprit de parti forme une coalition ; là, la souterraine habileté ministérielle en fait échouer une autre. Tout événement que le temps amène, portât-il dans ses flancs une conflagration générale, est toujours bien venu des assiégeants s’il présente un terrain où se puissent appuyer les éehelles d’abordage. Le bien public, l’intérêt général, ce ne sont plus que mots, prétextes, moyens. L’essentiel est de faire sortir d’une question la force qui aidera un parti à renverser le ministère et à lui passer sur le ventre. Ancône, Taïti, Syrie, Maroc, fortifications, droit de visite, tout est bon. Il ne s’agit que d’arranger convenablement la mise en œuvre. Alors nous sommes saturés de ces éternelles lamentations dont la forme est stéréotypée : Au dedans, la France est soutirante, inquiète, etc., etc.; au dehors, la France est humiliée, méprisée, etc., etc. Cela est-il vrai, cela n’est-il pas vrai ? on ne s’en met pas en peine. Cette mesure nous brouillera-t-elle avec l’Europe ? Nous forcera-t-elle à maintenir éternellement 300 mille hommes sur pied ? Arrêtera-t-elle la marche de la civilisation ? Créera-t-elle des obstacles à toute administration future ? Ce n’est pas ce dont il s’agit ; une seule chose intéresse : la chute et le triomphe de deux noms propres.
Et ne croyez pas que cette sorte de perversité politique n’envahisse au sein de la Chambre que les âmes vulgaires, les cœurs dévorés d’une ambition de bas étage, les prosaïques amants des places bien rémunérées. Non ; elle s’attaque encore, et surtout, aux âmes d’élite, aux nobles cœurs, aux intelligences puissantes. Pour les dompter, pour les soumettre, il lui suffit d’éveiller dans les secrètes profondeurs de leur conscience, au lieu de cette pensée triviale : Tu réaliseras tes rêves de fortune, cette autre pensée bien autrement séductrice : Tu réaliseras tes rêves de bien public.
Nous en avons un exemple remarquable. Il n’est pas en France une tête d’homme sur laquelle se soient accumulés autant d’accusations, d’invectives, d’outrages que sur celle de M. Guizot. Si le vocabulaire des partis contenait des épithètes plus sanglantes que celles de transfuge, traître, apostat, elles ne lui eussent pas été épargnées. Cependant il est un reproche que je n’ai jamais entendu formuler ni même insinuer contre lui : c’est celui d’avoir fait servir ses succès parlementaires à sa fortune personnelle. J’admets qu’il pousse la probité jusqu’à l’abnégation. J’accorde qu’il ne cherchera jamais le triomphe de sa personne que pour mieux assurer le triomphe de ses principes. C’est, d’ailleurs, un genre d’ambition qu’il a formellement avouée.
Eh bien, ce philosophe austère, cet homme à principes, nous l’avons vu dans l’opposition. Et qu’y faisait-il ? Tout ce que peut suggérer la soif du pouvoir. Afficher des vues démocratiques qui ne sont pas les siennes, s’envelopper d’un patriotisme farouche qu’il n’approuve pas, susciter des embarras au gouvernement de son pays, entraver les négociations les plus importantes, fomenter la coalition, se liguer avec qui que ce soit, fût-ce l’ennemi du trône, pourvu qu’il le soit du ministre, combattre hors des affaires ce qu’aux affaires il eût soutenu, diriger contre M. Molé les batteries d’Ancône comme M. Thiers dirige contre lui les batteries du Maroc, enfin appeler de tous ses vœux et de tous ses efforts uns crise ministérielle, et créer sciemment à son propre ministère futur les difficultés de tels précédents ; voilà ce qu’il faisait, et pourquoi ? Parce qu’il y a dans la Charte un article 46, un serpent tentateur qui lui disait :
« Vous serez égal aux Dieux ; arrivez au pouvoir, n’importe la route, et vous serez la Providence du pays ! » Et le député, séduit, prononce des discours, expose des doctrines, se livre à des actes que sa conscience réprouve, mais il se dit : Il le faut bien pour arriver au ministère ; que j’y parvienne enfin, et je saurai bien reprendre ma pensée réelle et mes vrais principes.
Est-il besoin de rappeler d’autres faits ? Eh ! mon Dieu, l’histoire de la guerre aux portefeuilles, c’est l’histoire tout entière du parlement.
Je ne m’en prends pas à tel ou tel homme ; je m’en prends à l’institution. Que le pouvoir soit offert en perspective aux députés, et il est impossible que la Chambre soit autre chose qu’un champ de bataille.
Voyez ce qui se passe en Angleterre. En 1840, le ministère était sur le point de réaliser l’affranchissement du commerce. Mais il y avait un homme, dans l’opposition, imbu des doctrines de Smith, que la gloire des Canning et des Huskisson empêchait de dormir, et qui voulait à tout prix être l’instrument de cette immense révolution. Elle va s’accomplir sans lui. Que fait-il ? Il se déclare le protecteur de la protection, Il remue tout ce qu’il y a d’ignorance, de préjugés et d’égoïsme dans le pays, il rallie l’aristocratie effrayée, il soulève les classes populaires faciles à égarer, il combat son propre principe au parlement et sur les hustings, il renverse le ministère réformateur, il arrive aux affaires avec mission expresse de fermer aux produits du dehors les ports de la Grande-Bretagne. Alors fond sur l’Angleterre ce déluge de maux inouïs dans les fastes de l’histoire, que les whigs avaient voulu conjurer. Le travail s’arrête, l’inanition désole les villes et les campagnes, escortée de ses deux satellites fidèles : le crime et la maladie. Toutes les intelligences, tous les cœurs se soulèvent contre cette affreuse oppression ; et M. Peel, trahissant son parti et la majorité, vient dire un jour au parlement : Je me trompais, j’étais dans l’erreur, j’abjure la protection ; je donne à mon pays la liberté des échanges. Non, il ne se trompait pas. Il était économiste en 1840 comme en 1846. Mais il voulait de la gloire, et c’est pour cela qu’il a retardé de six ans, à travers des calamités sans nombre, le triomphe de la vérité.
Il est donc bien peu de députés que la perspective des places et des portereuilles ne fasse dévier de cette ligne de rectitude dans laquelle leurs commettants espéraient les voir marcher. Encore si le mal ne s’étendait pas au delà de l’enceinte du Palais-Bourbon ! Mais vous le savez, monsieur, les deux armées qui se disputent le pouvoir transportent leur champ de bataille au dehors. Les masses belligérantes sont partout, les chefs seuls sont dans la Chambre, et c’est de là qu’ils donnent le mot d’ordre. Ils savent bien que, pour arriver au corps de la place, il faut emporter les ouvrages extérieurs, les journaux, la popularité, l’opinion, les majorités électorales. Il est donc fatal que toutes ces forces, à mesure qu’elles viennent s’enrôler sous l’un des chefs de file, s’imprègnent et s’imbibent de la même insincérité. Le journalisme, d’un bout de la France à l’autre, ne discute plus les mesures, il les plaide, et il les plaide, non au point de vue de ce qu’elles ont en elles-mêmes de bon ou de mauvais, mais au seul point de vue de l’assistance qu’elles peuvent prêter momentanément à tel ou tel meneur. On sait bien qu’il n’y a guère de journaliste éminent dont l’avenir ne doive être affecté par l’issue de cette guerre de portefeuilles. Quelle politique le ministre suit-il au Texas, au Liban, à Taïti, au Maroc, à Madagascar ? N’importe. La presse ministérielle n’a qu’une devise : Ê sempre bene ; et celle de l’opposition, comme la vieille femme de la satire, laisse lire sur son jupon Argumentabor.
Il faudrait une plume plus exercée que la mienne pour retracer tout le mal que fait en France le journalisme propageant l’esprit de parti, et (notez bien ceci, c’est le cœur de ma thèse) le propageant uniquement pour servir tel député qui veut être ministre. Vous approchez de la personne du roi, monsieur, je n’aime guère à la faire intervenir dans ces discussions. Cependant je puis dire, puisque c’est l’opinion de l’Europe, qu’il a contribué à maintenir la paix du monde. Mais peut-être avez-vous été témoin des sueurs morales que lui a arrachées ce succès digne de la bénédiction des peuples. Et pourquoi ces sueurs, ces difficultés, ces résistances dans une si noble tâche ? Parce qu’à un moment donné la paix n’avait pas pour elle l’opinion publique. Et pourquoi n’avait-elle pas l’opinion ? Parce qu’elle ne convenait pas à certains journaux. Et pourquoi ne convenait-elle pas à certains journaux ? Parce qu’elle était importune à tel député. Et pourquoi enfin était-elle importune à ce député ? Parce que la paix était la politique des ministres, et qu’alors la guerre est nécessairement celle des députés qui aspirent à le devenir. Là est certainement la racine du mal.
Parlerai-je d’Ancône, des fortifications de Paris, [38] d’Alger, des événements de 1840, du droit de visite, des tarifs, de l’anglophobie et de tant d’autres questions, où le journalisme égarait l’opinion, non qu’il s’égarât lui-même, mais parce que cela entrait dans ses plans froidement prémédités, dont le succès importait à quelque combinaison ministérielle.
J’aime mieux consigner ici les aveux du journalisme lui-même proclamés par le plus répandu de ses organes, la Presse (17 novembre 1845).
« M. Petetin décrit la presse comme il la comprend, comme il se plaît à la rêver. De bonne foi, croit-il que lorsque le Constitutionnel, le Siècle, etc., s’attaquent à M. Guizot, que lorsqu’à son tour le Journal des Débats s’en prend à M. Thiers, ces feuilles combattent uniquement pour l’idée pure, pour la vérité, provoquées par le besoin intérieur de la conscience ? Définir ainsi la presse, c’est la peindre telle qu’on l’imagine, ce n’est pas la peindre telle qu’elle est. Il ne nous en coûte aucunement de le déclarer, car si nous sommes journalistes, nous le sommes moins par vocation que par circonstance. Nous voyons tous les jours la presse au service des passions humaines, des ambitions rivales, des combinaisons ministérielles, des intrigues parlementaires, des calculs politiques les plus divers, les plus opposés, les moins nobles ; nous la voyons s’y associer étroitement. Mais nous la voyons rarement au service des idées ; et quand par hasard il arrive à un journal de s’emparer d’une idée, ce n’est jamais pour elle-même, c’est toujours comme instrument de défense ou d’attaque ministérielle. Celui qui écrit ces lignes parle ici avec expérience. Toutes les fois qu’il a essayé de faire sortir le journalisme de l’ornière des partis pour le faire entrer dans le champ des idées et des réformes, dans la voie des saines applications de la science économique à l’administration publique, il s’est trouvé tout seul, et il a dû reconnaître qu’en dehors du cercle étroit tracé par les lettres assemblées de quatre ou cinq noms propres, il n’y avait pas de discussion possible, il n’y avait pas de politique. À quoi sert de nier le mal ? Cela l’empêche-t-il d’exister ? Quand les journaux ne s’associent pas à des intérêts, ils s’associent à des passions ; et à les examiner elles-mêmes de près, ces passions ne sont le plus souvent que des intérêts égoïstes. Voilà la vérité. »
Quoi ! monsieur, vous n’êtes pas scandalisé, vous n’êtes pas épouvanté de cet effroyable aveu ? Ou peut-il vous rester aucun doute sur la cause d’une situation aussi pleine d’humiliations et de périls ? Ce n’est pas moi qui parle. Ce n’est pas un misanthrope, un républicain ou un factieux. C’est la presse elle-même qui dévoile son secret et qui vous dit où l’a réduite cette institution dont la moralité vous inspire tant de confiance. Depuis que l’enceinte, où l’on est censé discuter les lois, a été transformée en champ de bataille, les destins du pays, la paix et la guerre, la justice et l’iniquité, l’ordre et l’anarchie sont comptés pour rien, absolument pour rien en eux-mêmes ; ce sont les instruments du combat, qu’on prend et qu’on quitte selon ses exigences. Qu’importe qu’à chaque péripétie de cette lutte impie, la commotion se fasse sentir sur toute la surface du pays ? Elle est à peine apaisée que les armées changent de position, et que le combat recommence avec plus d’acharnement.
Enfin, l’esprit de parti, ce ver rongeur, ce cancer dévorant qui puise sa vie et sa force dans l’admissibilité des députés au pouvoir exécutif, faut-il que je le montre au sein des colléges électoraux ? Je ne parle pas ici des opinions, des passions, des erreurs politiques. Je ne parle pas même de la pusillanimité, de la vénalité de certaines consciences ; il n’est pas au pouvoir de la loi de rendre les hommes parfaits. Je n’ai en vue que les passions et les vices qui découlent directement de la cause dont je parle, qui se rattachent à la guerre des portefeuilles, engagée au sein des Chambres et propagée sur toute la ligne des journaux. Est-il donc si difficile d’en calculer les effets sur le corps électoral ? Et quand, jour après jour, la tribune et la presse s’appliquent à ne laisser arriver au public que de fausses lueurs, de faux jugements, de fausses citations et de fausses assertions, est-il possible d’avoir quelque confiance dans le verdict prononcé parle grand jury national, ainsi égaré, circonvenu, passionné ? Qu’est-il appelé à juger ? Ses intérêts. Jamais on ne lui en parle ; car la bataille ministérielle se livre à Ancône, à Taïti, en Syrie, partout où le public n’est pas. Et sur ce qui se passe dans ces régions lointaines, que sait-il ? Rien que ce que lui disent des orateurs et des écrivains, dont, de leur propre aveu, il n’est pas une parole articulée ou écrite qui ne leur soit inspirée par le désir furieux d’un succès personnel.
Et puis, si je voulais soulever le voile qui couvre non plus les erreurs, mais les turpitudes de l’urne électorale ! Pourquoi l’électeur fait-il tant valoir son suffrage, exige-t-il qu’on le mendie, et le considère-t-il comme un précieux objet de commerce ? Parce qu’il sait que ce suffrage contient la fortune de l’heureux candidat qui le sollicite. Pourquoi, de son côté, le candidat est-il si souple, si rampant, si prodigue de promesses, si peu soucieux de toute dignité ? Parce qu’il a des vues ultérieures ; parce que la députation est pour lui un moyen ; parce que la constitution du pays lui permet de voir dans le lointain, en cas de succès, des perspectives enivrantes, des places, des honneurs, des richesses, du pouvoir et ce manteau doré qui cache toutes les hontes et absout toutes les bassesses.
Aussi, où en sommes-nous ? Où en sont les électeurs ? Combien en est-il parmi eux qui osent rester et se montrer honnêtes ? qui déposent loyalement dans l’urne un bulletin, expression fidèle de leur foi politique ? Oh ! ils craindraient de passer pour des niais, pour des dupes. Ils ont soin de publier bien haut le trafic qu’ils ont fait de leur vote, et on les verrait placarder leur propre ignominie à la porte des églises plutôt que de laisser mettre en doute leur déplorable habileté. S’il est encore quelques vertus qui survivent à ce grand naufrage, ce sont des vertus négatives. On ne croit à rien, on n’espère en rien, on se préserve de la contagion, on dit avec je ne sais quel poëte :
Une paisible indifférence
Est la plus sûre des vertus.
On laisse faire et voilà tout. En attendant, ministres, députés, candidats succombent sous le faix des promesses et des engagements. Et quel en est le résultat ? Le voici. Le gouvernement et la Chambre changent de rôles. « Voulez-vous me laisser disposer de tous les emplois ? » disent les députés. « Voulez-vous me laisser décider des lois et du budget ? » répondent les ministres. Et chacun abandonne l’office dont il est responsable pour celui qui ne le regarde pas. Je le demande : Est-ce là le gouvernement représentatif ?
Mais tout ne s’arrête pas là. Il y a autre chose en France que des ministres, des députés, des candidats, des journalistes et des électeurs. Il y a un public, il y a trente millions d’hommes qu’on s’accoutume à ne compter pour rien. Ils ne voient pas, direz-vous, et leur indifférence en est la preuve. Ah ! ne prenez pas confiance dans ce prétendu aveuglement. S’ils ne voient pas la cause du mal, ils en voient les effets, le budget grossir sans cesse, leurs droits et leurs titres foules aux pieds, et toutes les faveurs devenir le prix de marchés électoraux dont ils sont exclus. Plût à Dieu qu’ils apprissent à rattacher leurs souffrances à la vraie cause, car l’irritation s’amasse dans leur cœur ; ils cherchent ce qui pourra les affranchir, et malheur au pays s’ils se trompent. Ils cherchent, et le suffrage universel s’empare de tous les esprits ; ils cherchent, et le communisme se propage comme un incendie ; ils cherchent, et, pendant que vous jetez un voile sur la plaie hideuse, qui peut compter les erreurs, les systèmes, les illusions dans lesquels ils croiront trouver un remède à leurs maux et un frein à vos injustices ?
Ainsi, tout le monde souffre d’un état de choses si profondément illogique et vicieux. Mais si toute l’étendue du mal est appréciée quelque part, ce doit être au sommet de l’échelle sociale. Je ne puis pas croire que des hommes d’État comme M. Guizot, M. Thiers, M. Molé, soient depuis si longtemps en contact avec toutes ces turpitudes, sans avoir appris à les connaître et à en calculer les effrayantes conséquences. Il n’est pas possible qu’ils se soient trouvés tantôt dans les rangs, tantôt en face d’une opposition systématique, qu’ils aient été assaillis par des rivalités personnelles, qu’ils aient eu à lutter contre les obstacles factices que la fureur de les déplacer suscita sous leurs pas, sans qu’ils se soient dit quelquefois : Les choses iraient autrement, l’administration serait bien plus régulière et la tâche du gouvernement bien moins lourde, si les députés ne pouvaient devenir ministres.
Oh ! si les ministres étaient en face des députés ce que sont les préfets en présence des conseillers généraux ; si la loi supprimait dans la Chambre ces perspectives qui fomentent l’ambition, il me semble qu’une paisible et fructueuse destinée serait ouverte à tous les organes du corps social. Les dépositaires du pouvoir pourraient bien rencontrer encore des erreurs et des passions ; mais jamais de ces coalitions subversives à qui tous les moyens sont bons, et qui n’aspirent qu’à renverser cabinets sur cabinets, sous les coups d’une impopularité momentanément et intentionnellement égarée. Les députés ne pourraient avoir d’autres intérêts que ceux de leurs commettants ; les électeurs ne seraient pas mis à même de prostituer leurs votes à des vues égoïstes ; la presse, dégagée de tous liens avec des chefs de parti qui n’existeraient plus, remplirait son vrai rôle qui est d’éclairer l’opinion et de lui servir d’organe ; le peuple, administré avec sagesse, avec suite, avec économie, heureux, ou ne pouvant s’en prendre au pouvoir de ses souffrances, ne se laisserait point séduire par les utopies les plus dangereuses, et le roi enfin, dont la pensée ne saurait plus être méconnue, entendrait prononcer de son vivant le jugement que lui réserve l’histoire.
Je n’ignore pas, monsieur, les objections que l’on peut opposer à la réforme parlementaire. On y trouve des inconvénients. Eh, mon Dieu ! il y en a dans tout. La presse, la liberté civile, le jury, la monarchie ont les leurs. La question n’est jamais de savoir si une institution réformée aura des inconvénients, mais si l’institution non réformée n’en a pas de plus grands encore. Et quelles calamités pourront jamais découler d’une Chambre de contribuables, égales à celles que verse sur le pays une Chambre d’ambitieux qui se battent pour la possession du pouvoir ?
On dit qu’une telle Chambre serait trop démocratique, animée de passions trop populaires. — Elle représenterait la nation. Est-ce que la nation a intérêt à être mal administrée, à être envahie par l’étranger, à ce que la justice ne soit pas rendue ?
La plus forte objection, celle qu’on renouvelle sans cesse, c’est que la Chambre manquerait de lumières et d’expérience.
Il y aurait fort à dire là-dessus. Mais enfin, si l’exclusion des fonctionnaires offre des dangers, si elle semble violer les droits d’hommes honorables qui sont citoyens aussi, si elle circonscrit la liberté des électeurs, ne serait-il pas possible, en ouvrant aux agents du pouvoir les portes du Palais-Bourbon, d’y environner leur présence de précautions dictées par la plus simple prudence ?
Vous ne vous attendez pas à ce que je formule ici un projet de loi. Mais il me semble que le bon sens public sanctionnerait une mesure conçue à peu près en ces termes :
« Tous les Français, sans distinction de profession, sont éligibles (sauf les cas exceptionnels où une position officielle élevée fait supposer une influence directe sur les suffrages : préfets, etc.).
Tous les députés reçoivent une indemnité convenable et uniforme.
Les fonctionnaires nommés députés résigneront leurs fonctions, pour tout le temps que durera leur mandat. Ils ne recevront pas de traitement ; ils ne pourront être ni destitués ni avancés. En un mot, leur vie administrative sera entièrement suspendue pour ne recommencer qu’après l’expiration de leur mission législative.
Aucun député ne pourra être appelé à une fonction publique. »
Et enfin, bien loin d’admettre, comme MM. Gauguier, Rumilly, Thiers et autres, qu’une exception sera faite au principe de l’incompatibilité, en faveur des ministères, des ambassades et de tout ce que l’on nomme situations politiques, ce sont celles-là surtout que je voudrais exclure, sans pitié et en première ligne ; car il est évident pour moi que ce sont les aspirants ambassadeurs et les aspirants ministres qui troublent le monde. Sans vouloir le moins du monde offenser les coryphées de la réforme parlementaire, qui ont proposé une telle exception, j’ose dire qu’ils n’aperçoivent pas ou ne veulent pas apercevoir la millionième partie des maux qui résultent de l’admissibilité des députés aux fonctions publiques ; que leur prétendue réforme ne réforme rien, et qu’elle n’est qu’une mesure mesquine,
étriquée, sans portée sociale, dictée par un sentiment
étroit de basse et injuste jalousie.
Mais l’article 46 de la Charte, dites-vous. – À cela je n’ai rien à répondre. La Charte est-elle faite pour nous, ou sommes-nous faits pour la Charte ? La Charte est-elle la dernière expression de l’humaine sagesse ? Est-ce un Alcoran sacré descendu du ciel, dont il ne soit pas permis d’examiner les effets, quelque désastreux qu’ils puissent être ? Faut-il dire : Périsse le pays plutôt qu’une virgule de la Charte ? S’il en est ainsi, je n’ai rien à dire, si ce n’est : Électeurs ! la Charte ne vous défend pas de faire de vos suffrages un usage déplorable, mais elle ne vous l’ordonne pas non plus. Quid leges sine moribus ?
En terminant cette trop longue lettre, je devrais répondre à ce que vous me dites de votre position personnelle. Je m’en abstiendrai. Vous pensez que la réforme, si elle a lieu, ne pourra vous atteindre, parce que vous ne dépendez pas du pouvoir responsable, mais bien du pouvoir irresponsable. À la bonne heure. La législature a décidé que cette position n’entraîne pas une incapacité légale. Il appartient aux électeurs de décider si elle ne constitue pas l’incapacité morale la plus évidente que se puisse imaginer.
Je suis, monsieur, votre serviteur.
Le vol à la prime [15 January 1846] [CW3 ES2.9]↩
BWV
1846.01.15 “Le vol à la prime” (Theft by Subsidy) [*Journal des Économistes*, January 1846, T. XIII, pp. 115-120] [ES2.9] [OC4.2.9, pp. 189-98] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Projet de ligue anti-protectioniste [8 février 1846] ↩
BWV
1846.02.08 “Projet de ligue anti-protectionniste” (Plan for an Anti-Protectionist League) [*Mémorial bordelais*, 8 février 1846] [OC7.6, p. 30]
Source
[Mémorial bordelais du 8 février 1846. (Note de l’édit.)]
Projet de ligue anti-protectioniste [1]
On assure que Bordeaux est en travail d’une association pour la liberté commerciale. Sera-t-il permis à l’auteur de cet article, quelque besoin qu’il ait d’avis en toute autre matière, d’exprimer le sien en celle-ci ? Il a étudié les travaux, l’esprit et les procédés de la Ligue anglaise ; il en connait les chefs ; il sait quels obstacles ils ont eu à vaincre, quels pièges à déjouer, quels écueils à éviter, quelles objections à résoudre ; à quelles qualités de l’esprit et du cœur ils doivent leurs glorieux succès ; il a vu, entendu, observé, approfondi. Il ne fallait pas moins pour qu’il eût la présomption d’élever la voix dans une ville où il y a tant de citoyens capables de mener à bien une grande entreprise, pour qu’il osât tracer une sorte de programme de la ligue française anti-protectioniste.
Si je m’adresse à Bordeaux, ce n’est pas que je désire voir cette ville s’emparer du rôle principal, et encore moins d’un rôle exclusif, dans le grand mouvement qui se prépare. Non ; l’abnégation individuelle est une des conditions du succès, et l’on doit en dire autant de l’abnégation locale ou départementale. Arrière toute pensée de prééminence et de fausse gloire ! Que chaque ville de France forme son comité ; que tous les comités se fondent dans la grande association dont le centre naturel est Paris ; et Bordeaux, renonçant à la gloire de Manchester, saura bien remettre les rênes là où elles peuvent être placées avec le plus d’avantage. Voulons-nous réussir ? ne voyons que le but de la lutte, sans nous laisser séduire par ce que la lutte elle-même peut donner de satisfactions à l’esprit d’égoïsme et de localité.
Mais Bordeaux est déjà descendu bien des fois dans la lice ; les idées libérales, en matière de commerce, y sont très répandues ; il n’est pas de ville dont la protection ait plus froissé les intérêts ; elle est le centre de vastes et populeuses provinces qui étouffent sous la pression du régime restrictif ; elle est féconde en hommes ardents, dévoués, prêts à faire à une grande cause nationale de généreux sacrifices ; elle est le berceau de celte Union vinicole, qui a accompli tant de travaux si méritoires quoique si infructueux, et qui forme comme la pierre d’attente d’une organisation plus vaste. Il n’est donc pas surprenant que Bordeaux donne le signal de l’agitation, tout préparé qu’il est, j’en suis convaincu, à céder à Paris les rênes de la direction aussitôt que le bien de la cause exigera de lui ce sacrifice.
Voilà pourquoi j’adresse à Bordeaux cette première vue générale des conditions auxquelles il faut acheter la victoire ; elles sont dures, mais inflexibles.
1° D’abord la Ligue doit proclamer un principe et y adhérer indissolublement, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, dans ses revers et dans ses triomphes, soit qu’il éveille ou non les échos de la presse et de la tribune, soit qu’il excite ou non les sympathies du Pouvoir et des Chambres. La Ligue ne doit point se faire le champion d’un intérêt spécial, d’un traité de commerce, d’une modification douanière ; sa mission est de proclamer et de faire triompher un principe absolu, un droit naturel, la liberté des échanges, l’abrogation de toute loi ayant pour objet d’influer sur le prix des produits, afin de régler les profits des producteurs. La Ligue doit réclamer pour tout Français le droit (qu’on peut s’étonner de ne pas voir écrit dans la Charte), le droit d’échanger ce qu’il a le droit de consommer. La loi nous laisse à tous la pleine liberté de vendre ; il faut qu’elle nous laisse aussi la pleine liberté d’acheter. Vendre et acheter, ce sont deux actes qui s’impliquent réciproquement, ou plutôt ce sont les deux termes d’un seul et même contrat. Là où l’un des termes manque, l’autre fait défaut par cela même ; et il est mathématiquement impossible que les ventes ne soient pas contrariées sur tous les points du globe, si sur tous les points du globe la loi contrarie les achats.
Au reste, il n’est pas question ici de prouver la doctrine. Il faut admettre qu’elle est la foi inébranlable des premiers ligueurs, et c’est pour la propager qu’ils se liguent. Eh bien ! je leur dis : En vous ralliant à un principe absolu, vous vous priverez, je le sais, du concours d’une multitude de personnes, car rien n’est plus commun que l’horreur d’un principe, l’amour de ce qu’on nomme une sage liberté, une protection modérée. Ce perfide concours, sachez vous en passer, il entraverait bientôt toutes vos opérations. Ne soyez que cent, ne soyez que cinquante, ne soyez que dix et moins encore, s’il le faut, mais soyez unis par une entière conformité de vues, par une parfaite identité de doctrine. Or un tel lien ne saurait être ailleurs que dans un principe. Réclamez, poursuivez, exigez jusqu’au bout la complète réalisation de la liberté des échanges ; n’admettez ni transactions, ni conditions, ni transitions, car où vous arrêteriez-vous ? Comment conserverez-vous l’unité de vos démarches si vous laissez pénétrer parmi vous l’idée d’une seule exception ? Chacun ne voudra-t-il pas placer son industrie dans cette exception ? L’un, à grand renfort de belliqueux patriotisme, voudra qu’un petit bout de protection reste à la marine marchande, et sa grande raison est qu’il est armateur. L’autre, la larme à l’œil, vous fera un tableau touchant de l’agriculture. Il la faut protéger, dira-t-il, c’est notre nourrice à tous ; et il ne manquera pas de vous rappeler que l’empereur de la Chine trace tous les ans un sillon. Un troisième, au contraire, vous demandera grâce pour les produits perfectionnés, vous abandonnant généreusement les matières premières, vierges de tout travail humain, à quoi il sera facile de reconnaître un fabricant. — Alors vous ne serez plus que la doublure du comité Mimerel, et ce que vous aurez de mieux à faire, ne pouvant vous entendre sur l’égalité dans la liberté, ce sera de tâcher au moins, comme lui, de vous entendre sur l’égalité dans le privilége.
2° La Ligue doit se hâter de proclamer encore qu’en demandant la liberté absolue des échanges, elle n’entend pas intervenir dans les droits du fisc. Elle ne réclame pas la destruction de la douane, mais l’abrogation d’une des fins à laquelle la douane a été injustement et impolitiquement détournée. Les ligueurs, en tant que tels, n’ont rien à démêler avec les dépenses publiques. Ils n’ont pas la prétention de s’accorder sur tous les points ; la quotité et le mode de perception des impôts est pour chacun d’eux une question réservée. Que la douane subsiste donc, s’il le faut, comme machine fiscale, comme octroi national, mais non comme moyen de protection. Ce qu’elle procure au trésor public n’est pas de notre compétence ; ce qu’elle confère au monopole, c’est là ce qui nous regarde et à quoi nous devons nous opposer. Si l’État a tellement besoin d’argent, qu’il faille taxer les marchandises qui passent à la frontière, à la bonne heure ; les sommes ainsi prélevées proviennent de tous et sont dépensées au profit de tous. Mais que les tarifs soient appliqués à enrichir une classe aux dépens de toutes les autres, à organiser au sein de la communauté un système de spoliation réciproque, c’est là un abus auquel il est grand temps que l’opinion publique mette un terme.
3° Une troisième condition de succès, non moins essentielle que les deux autres, c’est l’abjuration de tout esprit de parti…… Mais voilà assez de sujets de méditation pour un jour.
FN: Mémorial bordelais du 8 février 1846. (Note de l’édit.)
Projet de ligue anti-protectionniste. 2e article [9 février 1846] ↩
BWV
1846.02.09 “Projet de ligue anti-protectionniste. 2e article” (Plan for an Anti-Protectionist League. Second Article) [*Mémorial bordelais*, 9 février 1846.] [OC7.7, p. 34]
Source
Mémorial bordelais du 9 février 1846. (Note de l’édit.)
Projet de ligue anti-protectioniste
2e article [1]
J’en suis resté à l’esprit de parti. Il semble assez inutile de s’en occuper déjà. Hélas ! notre Ligue est à naître ; à quoi sert de prévoir le temps où l’on recherchera son alliance ? Mais c’est avant d’élever l’édifice qu’il faut s’assurer de la qualité des matériaux. Les destinées de la Ligue se ressentiront toujours de l’esprit de ses fondateurs. Faible et chancelante, s’ils flottent au gré de toutes les doctrines économiques ; factieuse, isolée, n’ayant de puissance que pour le mal, s’ils rêvent d’avance autre chose que son principe avoué. — Ligue, triomphe, principe, liberté, vous n’êtes peut-être que les fantômes adorés d’une imagination trop facile à se laisser séduire à tout ce qui offre l’image du bien public ! Mais il n’est pas impossible, puisque cela s’est vu ailleurs, que ces fantômes se revêtent de réalité. Ce qui est impossible, tout à fait impossible, c’est que la Ligue puisse avoir force, vie, influence utile, si elle se laisse entamer par l’esprit de parti.
La Ligue ne doit être ni monarchique, ni républicaine, ni orthodoxe, ni dissidente ; elle n’intervient ni dans les hautes questions métaphysiques de légitimité, de souveraineté du peuple, ni dans la polémique dont le Texas, le Liban et le Maroc font les frais. Son royaume n’est pas de ce monde qu’on nomme politique ; c’est un terrain neutre où M. Guizot peut donner la main à M. Garnier Pages, M. Berryer à M. Duchâtel, et l’Évêque de Chartres à M. Cousin. Elle ne provoque ni n’empêche les crises ministérielles, elle ne s’en mêle pas et ne s’y intéresse même pas. Elle n’a qu’un objet en vue : la liberté des échanges. Cette liberté, elle la demande à la droite, à la gauche et aux centres, mais sans rien promettre en retour, car elle n’a rien à donner ; et son influence, si jamais elle a une influence, appartient exclusivement à son principe. La force éphémère d’un parti, c’est un auxiliaire qu’elle dédaigne ; et, quant à elle, elle ne veut être l’instrument d’aucun parti. Elle n’est pas née, nul ne saurait dire ce qu’elle sera, mais j’ose prédire ce qu’elle ne sera jamais ; elle ne sera pas le piédestal d’un ministre en titre, ni le marchepied d’un ministre en expectative, car le jour où elle se laisserait absorber par un parti, ce jour-là on la chercherait en vain, elle se serait dissipée comme une fumée.
4° La plus grande difficulté, en apparence, que puisse rencontrer la formation d’une Ligue, c’est la question de personnes. Il n’est pas possible qu’un corps gigantesque, travaillant à une œuvre immense, à travers une multitude d’oppositions extérieures et peut-être de rivalités intestines, puisse se dispenser d’obéir à une impulsion unique et pour ainsi dire à une omnipotence volontairement déléguée. Mais qui sera le dépositaire de cette puissance morale ? On est justement effrayé quand on songe aux qualités éminentes et presque inconciliables que suppose un tel rôle. Tête froide, cœur de feu, main ferme, formes attachantes, connaissances étendues, coup d’œil sûr, talent oratoire, dévouement sans bornes, abnégation entière ; voilà ce qu’il faudrait trouver dans un seul homme, et de plus ce charme magnétique qui pétrifie l’envie et désarme les amours-propres.
Eh bien ! cette difficulté n’en est pas une. Si les temps sont mûrs en France pour l’agitation commerciale, l’homme de la Ligue surgira. Jamais grande cause n’a failli faute d’un homme. Pour qu’il se trouve, il suffit qu’on ne se préoccupe pas trop de le chercher. Y a-t-il quelqu’un que sa position seule place naturellement à notre tête et consent-il à être notre chef ? acceptons-le par acclamation et acceptons aussi avec joie le rôle, quelque humble qu’il soit, qu’il jugera utile de nous assigner. Amis de la liberté, unissons-nous d’abord, mettons avec confiance la main à l’œuvre, pensons toujours au succès de notre principe, jamais à nos propres succès, et laissons à la cause, dans sa marche progressive, le soin de nous porter en avant. Quand la lutte sera engagée, assez de résistances nous mettront à l’épreuve, pour que chacun déploie ses ressources ; et qui sait alors combien se révéleront de talents ignorés et de vertus assoupies ? L’agitation est un grand crible qui classe les individualités selon leur pesanteur spécifique. Elle manifestera un homme et plusieurs hommes ; et nous nous trouverons, sans nous en apercevoir, coordonnés dans une naturelle et volontaire hiérarchie.
Faut-il le dire ? Ce que je crains, ce n’est pas que l’homme de génie fasse défaut à la Ligue ; mais plutôt que la Ligue fasse défaut à l’homme de génie. Les vertus individuelles jaillissent de la vertu collective comme l’étincelle électrique de nuages saturés d’électricité. Si chacun de nous apporte à la Ligue un ample tribut de zèle, de conviction, d’efforts et d’enthousiasme, ah ! ne craignons pas que ces forces demeurent inertes, faute d’une main qui les dirige ! Mais si le corps entier est apathique, indifférent, dégoûté, inconstant et railleur, alors sans doute les hommes nous manqueront, — et qu’en ferions-nous ?
Ce qui a fait le succès de la Ligue, en Angleterre, c’est une chose, une seule chose, la foi dans une idée. Ils n’étaient que sept, mais ils ont cru ; et, parce qu’ils ont cru, ils ont voulu ; et, parce qu’ils ont voulu, ils ont soulevé des montagnes. La question pour moi n’est pas de savoir s’il y a des hommes à Bordeaux, mais s’il y a de la foi dans Israël.
5° Je voulais parler aujourd’hui de la question financière, mais le sujet est trop vaste pour l’espace qui me reste. Je le remplirai par quelques considérations générales. — D’après ce qui a pu me revenir, on se promet beaucoup d’une grande démonstration publique, d’un appel solennel fait au Gouvernement. Oh ! combien se trompent ceux qui pensent qu’à cela se réduisent les travaux d’une ligue ! Une ligue a pour mission de détruire successivement tous les obstacles qui s’opposent à la liberté commerciale. Et quels sont ces obstacles ? Nos erreurs, nos préjugés, l’égoïsme de quelques-uns, l’ignorance de presque tous. L’ignorance, c’est là le monstre qu’il faut étouffer ; et ce n’est pas l’affaire d’un jour ! Non, non, l’obstacle n’est pas au ministère, c’est tout au plus là qu’il se résume. Pour modifier la pensée ministérielle, il faut modifier la pensée parlementaire ; et pour changer la pensée parlementaire, il faut changer la pensée électorale ; et pour réformer la pensée électorale, il faut réformer l’opinion publique.
Croyez-vous que ce soit une petite entreprise que de renouveler les convictions de tout un peuple ? J’ignore quelles sont les doctrines économiques de M. Guizot ; mais fût-il M. Say, il ne pourrait rien pour nous, ou bien peu de chose. Son traité avec l’Angleterre n’a-t-il pas échoué ? Son union douanière avec la Belgique n’a-t-elle pas échoué ? La volonté du ministre a été surmontée par une volonté plus forte que la sienne, celle du parlement. Faut-il en être surpris ? Je ne sache pas que la liberté des échanges, comme principe, ait à la Chambre, je ne dis pas la majorité, mais même une minorité quelconque, et je ne lui connais pas un seul défenseur, je dis un seul, dans l’enceinte où se font les lois. Peut-être le principe y vit-il endormi au fond de quelque conscience. Mais que nous importe si, l’on n’ose l’avouer ? — Il est un député sur lequel on avait fondé quelques espérances. Entré à la Chambre jeune, sincère, plein de cœur, avec des facultés développées par l’étude et la pratique des affaires commerciales, les amis de la liberté avaient les yeux fixés sur lui. Mais un jour, jour funeste ! je ne sais quel mauvais génie fit briller à ses yeux la lointaine perspective d’un portefeuille ; et depuis ce jour il semble que la crainte de se rendre impossible fausse toutes ses déterminations et paralyse son énergie. Le moyen d’être ministre, si l’on affiche avant le temps cette dangereuse chose, un principe ! — Ami, cette page arrêtera peut-être un moment tes regards. Qu’elle soit pour toi le bouclier d’Ubalde ; qu’elle te reproche, mais ne dise qu’à toi ta molle oisiveté ; qu’elle t’arrache à de trompeuses illusions !
Natura
Del coraggio in tuo cuor la flamma accese…
Il tuo dover compisce e nostra speme [2].
FN: Mémorial bordelais du 9 février 1846. (Note de l’édit.)
FN:Ce reproche discret et poétique, que Bastiat adressait à l’un de ses anciens condisciples de Sorrèze, resta sans effet.(Note de l’édit.)
Projet de ligue anti-protectionniste. 3e article [10 février 1846] ↩
BWV
1846.02.10 “Projet de ligue anti-protectionniste. 3e article” (Plan for an Anti-Protectionist League. Third Article) [*Mémorial bordelais*, 10 février 1846] [OC7.8, p. 38]
Source
Mémorial bordelais du 10 février 1846.(N. E.)
Projet de ligue anti-protectioniste
3e article [1]
Il suffit de dire le but de la Ligue, ou plutôt le moyen d’atteindre ce but, pour établir qu’il lui faut, — lâchons le grand mot, — de l’argent, et beaucoup d’argent. Répandre la vérité économique, et la répandre avec assez de profusion pour changer le cours de la volonté nationale, voilà sa mission. Or les communications intellectuelles ont besoin de véhicules matériels. Les livres, les brochures, les journaux, ne naîtront pas au souffle de la Ligue, comme les fleurs au souffle du zéphir. M. Conte (directeur des postes) ne lui a pas encore donné la franchise, ni même la taxe modérée ; et si l’usage des Quinconces est gratuit, elle ne saurait y établir sa comptabilité, ses bureaux, ses archives et ses séances. L’argent, ce n’est pas pour les ligueurs des dîners, des orgies, des habits somptueux, de brillants équipages : c’est du travail, de la locomotion, des lumières, de l’organisation, de l’ordre, de la persévérance, de l’énergie.
Personne ne nie cela. Tout le monde en convient et nul n’y contredit. Cependant, qui sait si la Ligue trouvera à Bordeaux cette assistance métallique que chacun reconnaît nécessaire ? Si Bordeaux était une ville besogneuse et lésineuse, cela s’expliquerait ; mais sa générosité, je dirai même sa prodigalité, est proverbiale. Si Bordeaux n’avait pas de convictions, cela s’expliquerait encore. On pourrait le plaindre de n’avoir pas de convictions, non le blâmer, n’en ayant pas, d’agir en conséquence. Mais Bordeaux est, de toutes les villes de France, celle qui a le sentiment le plus vif de ce qu’il y a d’injuste et d’impolitique dans le régime protecteur. Comment donc expliquer cette réserve pécuniaire, que beaucoup de gens semblent craindre ?
Il ne faut pas se le dissimuler, la question financière est en France l’écueil de toute association. Souscrire, contribuer pécuniairement à une œuvre, quelque grande qu’elle soit, cela semble nous imposer le rôle de dupes, et heurte cette prétention que nous avons tous de paraître clairvoyants et avisés. Il est difficile de concilier une telle défiance avec la loyauté, que nous nous plaisons à regarder comme le trait caractéristique de notre nation ; car justifier cette défiance en alléguant qu’elle est le triste fruit de trop fréquentes épreuves, ce serait reconnaître que la loyauté française a été trop souvent en défaut. Puisse la Ligue effacer les dernières traces de la triste disposition que je signale !
Il semble à beaucoup de gens que lorsqu’ils versent quelques fonds à une société qui a en vue un objet d’utilité publique, ils font un cadeau, un acte de pure libéralité ; j’ose dire qu’ils s’aveuglent, qu’ils font tout simplement un marché, et un excellent marché.
Si nous avions pour voisin un peuple riche et industrieux, capable de beaucoup échanger avec nous, et si nous étions séparés de ce peuple par de grandes difficultés de terrain, assurément nous souscririons volontiers pour qu’un chemin de fer vînt unir son territoire au nôtre, et nous croirions faire, non de la générosité, mais de la spéculation. Eh bien ! nous sommes séparés de l’Espagne, de l’Italie, de l’Angleterre, de la Russie, des Amériques, du monde entier, par des obstacles, — artificiels, il est vrai, — mais qui, sous le rapport des communications, ont absolument les mêmes effets que les difficultés matérielles. Et c’est pour cela que Bordeaux, souffre, languit et décline ; et ces obstacles s’appuient sur des préjugés ; et ces préjugés ne peuvent être détruits que par un vaste et laborieux enseignement ; et cet enseignement ne peut être distribué que par une puissante association. Vous pouvez opter entre les inconvénients de la restriction et ceux de la souscription ; mais vous ne pouvez pas considérer la souscription comme un don gratuit, puisqu’elle aura pour résultat de briser les liens qui vous gênent.
Je dis encore que c’est une bonne spéculation, un marché beaucoup plus avantageux que ceux que vous avez coutume de faire. S’il s’agissait de détruire les obstacles naturels qui vous séparent des autres nations, il n’y a pas une parcelle de l’œuvre qu’il ne faudrait payer à beaux deniers, l’exécution comme la conception ; mais les triomphes de la Ligue seront dus en partie, en très grande partie, à de nobles efforts qui ne cherchent pas de récompense pécuniaire. Vous aurez des agents zélés, des orateurs, des écrivains qui ne s’enrichiront pas d’une obole, et qui, épris d’amour pour les biens qu’ils attendent de la libre communication des peuples, donneront à cette grande cause, sans compte et sans mesure, leur intelligence, leurs travaux, leurs sueurs et leurs veilles.
Soyons justes toutefois, et reconnaissons que, dans la souscription volontaire, il y a un côté noble et généreux. Chacun pourrait se dire : « On fera bien sans moi ; et, quand la cause sera gagnée, elle le sera à mon profit, bien que je n’y aie pas concouru. » Voilà le calcul qu’on pourrait faire. Les Bordelais le repousseront avec dédain. Ce sera leur gloire, et ce n’est pas moi qui voudrai la méconnaître.
La souscription ne doit pas être envisagée exclusivement au point de vue matériel. Elle procure des jouissances morales dont je suis surpris qu’on ne tienne pas compte. N’est-ce rien que de s’affilier à un corps nombreux qui poursuit un grand résultat par d’honorables moyens? Je me suis dit quelquefois que la civilisation et la diffusion des richesses amèneraient infailliblement le goût des associations philanthropiques. Lorsque le riche oisif a sitôt épuisé des jouissances matérielles, fort peu appréciables en elles-mêmes, et qui n’ont d’attrait que parce qu’elles le distinguent de la masse, quel plus satisfaisant usage pourrait-il faire de sa fortune que de s’associer à une utile entreprise ? C’est là qu’il trouvera un aliment à ses facultés, des relations agréables, du mouvement, de la vie, quelque chose qui fait circuler le sang et dilate la poitrine.
Il y avait, près de Manchester, un riche manufacturier retiré, qui vivait seul, ennuyé, et n’avait jamais voulu prendre part à aucune des nombreuses entreprises qui se font, dans cette ville, par souscription. La Ligue tenait à voir figurer son nom dans ses rôles ; car c’était le témoignage le plus frappant qu’elle pût donner de la sympathie qu’elle excitait dans le pays. Elle lui décocha M. Bright, le meilleur négociateur en ce genre qu’elle pût choisir ; car, selon lui, demander pour la Ligue, ce n’était pas demander. Après beaucoup d’objections, il obtint de l’avare quatre cents guinées [2]. Quand il annonça cette nouvelle à ses amis : « Vous avez dû lui faire faire une laide grimace ? » lui dirent-ils. — « Point du tout, répondit M. Bright ; — je crois sincèrement que cet homme me devra le bonheur du reste de sa vie. » Et en effet, depuis ce jour les ennuis de l’avare se sont dissipés, ses dégoûts se sont fondus ; il s’intéresse à la Ligue, il en suit les progrès avec anxiété, il la regarde comme son œuvre ; et ces sentiments nouveaux ont pour lui tant de charmes, qu’il n’est plus une institution charitable à laquelle il ne s’empresse de concourir.
Mais, pour que l’esprit d’association prévale, une condition est essentielle ; c’est que toute garantie soit donnée aux souscripteurs. Je le répète, ce n’est pas la perte de quelque argent qu’ils redoutent, c’est le ridicule qui, en ce genre, suit toujours la déception. Personne n’aime à montrer en public la face d’une dupe. On a donné 100 francs ; on en donnerait 1,000 pour les retirer.
Donc, si la Ligue française veut voir affluer dans ses caisses d’abondantes recettes, son premier soin doit être de forcer dans toutes les convictions une confiance absolue. Elle y parviendra par deux moyens : le choix le plus scrupuleux des membres du comité, et la publicité la plus explicite de ses comptes. Je voudrais que, de son premier argent, elle s’assurât du plus méticuleux teneur de livres de Bordeaux, et que le bureau de la comptabilité fût placé, si c’était possible, dans un édifice de verre. Je voudrais que les livres de la Ligue fussent constamment ouverts à l’œil des amis, et surtout des ennemis.
FN:
FN:10,000 francs.
Considérations sur le métayage [JDE, 15 Feb. 1846] ↩
BWV
1846.02.15 “Considérations sur le métayage” (Thoughts on Share Cropping), [Journal des Économistes, T. XIII, N° 51, Février 1846, p. 225-39.] [JCPD not in OC]
Source
Source:
En soumettant au public le plan d'un établissement agricole susceptible de devenir une pépinière de bons métayers, je dois avouer que, comme tous les faiseurs de projets, j'éprouve pour le mien une sorte de faiblesse paternelle. Il me semble que peu d'institutions analogues se combinent aussi bien avec les circonstances de notre département, et recèlent, à peu de frais, des germes aussi féconds de bien-être, d'instruction et de moralité.
J'ai autrefois critiqué le métayage, je suis aujourd'hui persuadé que si mes observations étaient justes, elles étaient incomplètes. J'avais vu le bien qu'il empêche, je n'avais pas vu le bien qu'il fait ou peut faire. Mon but étant de le perfectionner, d'en bannir les inconvénients qu'il présente, il doit m'être permis de me livrer à quelques considérations générales sur ce mode d'association du travail et du capital, ce qui me forcera de toucher à quelques-uns des problèmes les plus élevés de l'économie sociale.
Cet ensemble de travaux par lesquels la race humaine pourvoit à sa subsistance, a subi de grandes révolutions. D'abord, l'homme s'est borné à poursuivre les animaux sauvages. - Ensuite, en réduisant à la domesticité certaines espèces, il a pu utiliser et tourner indirectement à son profit les graminées qui naissent spontanément sur le sol. Plus tard, il a soumis la terre à la charrue, et parait s'être fixé, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, à ce système agricole qu'on nomme triennal. — Enfin l'agriculture entre aujourd'hui dans sa quatrième phase : la culture alterne.
On conçoit aisément les immenses progrès que chacun de ces pas a fait faire à l'humanité. Il fallait des étendues immenses pour procurer aux peuples chasseurs une chétive subsistance. – Les peuples pasteurs ont pu comparativement croître en nombre et en richesse. — Un progrès analogue a dû suivre la conversion des pâturages en labourages. — Enfin, il n'est pas douteux que la culture alterne ne prépare à l'humanité un nouveau progrès qui la mettra autant au-dessus de sa condition actuelle que le système triennal l'a élevée au-dessus de la vie pastorale, ou celle-ci au-dessus de la vie sauvage.
Lorsque l'on considère combien chacun de ces systèmes contient naturellement en germe le système suivant, on est surpris du temps qu'il a fallu à l'humanité pour les parcourir. Entre poursuivre le gibier pour le dévorer à mesure qu'on s'en empare, et élever autour de soi les espèces les moins sauvages pour obtenir, à mesure des besoins, leur lait, leur viande, leur laine, leur cuir, il semble qu'il n'y ait qu'un pas, et ce pas paraît encore infranchissable aux tribus américaines. Entre élever des animaux autour d'une tente, au moyen de certaines graminées venues spontanément sur le sol, et favoriser par la culture la végétation de ces graminées, on croirait la transition facile, et elle n'a jamais été essayée par les peuples nomades de la Tartarie et de l'Arabie. Enfin, le système triennal coïncida sans doute avec les premiers essais de culture. En effet, les hommes durent d'abord ensemencer sur la terre défrichée du blé pour eux et de l'avoine pour le bétail ; mais ne tardant pas à s'apercevoir que la succession de ces récoltes favorisait l'envahissement des plantes parasites, la jachère ne dut pas tarder à s'introduire et à compléter la rotation. De là, à atteindre le même but par la culture successive de plantes de diverses familles, on pourrait croire qu'il n'y a, du moins sous le rapport de la difficulté, qu'un insensible progrès à accomplir, et nous voyons ce progrès paraître au-dessus de la puissance des peuples les plus éclairés, les plus avancés en civilisation, malgré les efforts des savants et les encouragements du pouvoir.
Quoi qu'il en soit, cette dernière révolution s'accomplit, bien qu'avec lenteur, sous nos yeux. Pour savoir la part que le métayage peut y prendre, il importe de comparer la culture triennale à la culture alterne.
Dans la culture triennale, chaque domaine est divisé en deux parties, l'une consacrée aux prairies permanentes et à la dépaissance des bestiaux, l'autre soumise à la charrue. C'est à cette division fondamentale que fait allusion le mot de Sully : «Patur et labur sont les deux mamelles nourricières de l'Etat», mot dans lequel on a si mal à propos voulu reconnaître un vague pressentiment de la culture alterne.
La terre cultivée présente elle-même trois divisions ou trois soles livrées alternativement à la production de deux céréales, et à une année de repos, ou plus exactement de travaux de nettoyage et de préparation.
Il est aujourd'hui de mode de honnir ce vieux système, comme le triste produit de l'ignorance. De bons esprits en ont porté un jugement bien différent : «On ne me soupçonnera pas, je pense, dit M. de Dombasle, d'être un trop zélé partisan de ce système de culture. Cependant il m'est impossible de dissimuler qu'il me semble parfaitement approprié aux circonstances de l'époque pour laquelle il a été conçu, époque à laquelle l'agriculture ne pouvait s'exercer que sur un petit nombre de plantes, prises dans la famille des céréales. Si l'on considère l'extrême simplicité de ce système, l'harmonie avec laquelle toutes les parties qui le composent se lient entre elles, l'égale répartition qu'il offre, sur toutes les parties de l'année, des travaux qu'il exige ; la facilité avec laquelle il s'applique aux sols de toutes natures, placés sous des climats très-variés, on jugera peut-être qu'il eût été impossible alors d'imaginer une solution plus complète du problème suivant : Trouver le système de culture le plus convenable pour fournir les objets indispensables de consommation à une nation pauvre, peu avancée dans la civilisation et peu peuplée, quoique déjà trop nombreuse pour que le système pastoral puisse suffire à sa subsistance ; le système qui exige le moins de main-d’œuvre possible, qui puisse le plus facilement être mis en pratique par des hommes manquant d'instruction et d'avances pécuniaires.
«C'était bien là, sans doute, les données du problème dans les circonstances dans lesquelles se trouvaient les nations de l'Europe à l'époque du moyen âge et encore longtemps après. Considéré sous ce point de vue, on trouvera que l'assolement triennal avec jachère et vaine pâture, malgré des défauts graves, mais inévitables, était vraiment une admirable conception.»
Le caractère le plus saillant du système triennal, c'est l'immobilité. Il est aujourd'hui ce qu'il a été de tous temps ; par là, il se prête merveilleusement au métayage, parce qu'il se maintient sur un trésor d'observations et d'expériences qui remontent à la nuit des temps, et que les générations se transmettent sous le nom de routine. (Routine, de rota, roue, laquelle une fois montée, tourne toute seule.)
Mais quelque vénérable que soit cette antique culture que nos pères nous ont transmise, il ne faut pas se dissimuler qu'elle a fait son temps et touche à son terme. Dans ses bornes étroites, dans son homogénéité, elle est impuissante à alimenter l'industrie moderne de cette abondance et de cette variété de matières premières dont le besoin s'accroît sans cesse. Elle est même incapable d'assurer la subsistance d'une population nombreuse, parce qu'elle exclut un grand nombre de produits animaux et végétaux, et que la variété des produits est le seul obstacle que nous puissions opposer à l'inconstance des saisons.
Aussi, je le répète, une révolution agricole se prépare de nos jours, c'est-à-dire qu'elle s'élabore dans le corps social, comme toutes les révolutions, au moment où elle devient nécessaire. Cette révolution, c'est l'avènement de la culture alterne.
De même que l'immobilité, l'homogénéité sont les caractères du système triennal, la mobilité, la variété sont les traits distinctifs de la culture alterne.
Dans ce système, le pâturage, le parcours, et même les prairies permanentes disparaissent. La superficie entière des héritages, chacun divisé en un nombre très-varié de soles, est assujettie à l'action de la charrue. L'infinie diversité des besoins sociaux, manifestés par le cours des denrées, détermine la production de chacune des soles qui entrent dans la rotation ; et le chef de l'exploitation a le soin de maintenir au sein de cette confusion apparente l'ordre indiqué par les lois de l'assolement, faisant succéder sans interruption et sans intervalle les plantes qui fertilisent le sol à celles qui l'épuisent, les végétaux propres à la nourriture des animaux à ceux qui alimentent l'homme, intercalant à propos entre eux des plantes qui permettent de nettoyer et préparer le sol, sans avoir recours à la jachère, enfin ne perdant jamais de vue que toutes ces cultures doivent être combinées de manière à ce qu'au terme de la rotation, le sol se trouve dans un état au moins stationnaire, et plutôt progressif de prospérité et de fertilité.
Tel est le système alterne. Je n'ai pas besoin de faire remarquer ici combien, par l'abondance et la variété de ses produits, il favorise le développement et le bien-être de l'homme.
Une chose me frappe, c'est l'état d'infériorité qui menace les contrées qui s'élèveront les dernières à la culture alterne. Il est dans la nature de ce système, non-seulement de livrer à la consommation des substances alimentaires très-variées, de la viande, des légumes, des racines, des laitages, mais encore d'obtenir les céréales elles-mêmes à un prix de revient inférieur à celui auquel la culture triennale peut les donner. Cela semble un paradoxe, puisque le système ancien consacre à cette nature de production les deux tiers, et le nouveau la moitié au plus de la superficie du terrain cultivable.
Mais il faut remarquer que le domaine de la charrue s'augmente, dans la culture alterne, de tout ce que la culture triennale abandonne aux prairies permanentes et à la dépaissance des bestiaux, de manière qu'au total les céréales ne perdent pas en espace.
D'un autre côté, dans le système triennal, la rente afférente au tiers du domaine en friche et les frais considérables de la jachère viennent grever le débit des comptes des deux récoltes qui la suivent, ce qui ne lui permet de soutenir la concurrence avec le système alterne que parce que celui-ci est encore limité, en France, à un très-petit nombre de cantons.
Enfin, il est douteux que le premier maintienne la fertilité du sol que le second augmente indéfiniment.
La statistique agricole publiée récemment par ordre de l'administration met ces vérités en lumière avec l'irrésistible éloquence des chiffres. Comparons ici trois départements, l'un pris dans la Flandre française, berceau de la culture alterne ; le second dans la Touraine, où la culture triennale est arrivée à son plus haut degré de perfection, enfin le dernier dans notre propre région.
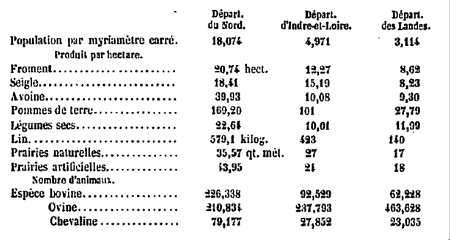
Quoi de plus significatif que de pareils chiffres?
Présentons-les sous une autre forme pour en rendre les résultats plus sensibles. Nous poserons l'état réel des choses, dans le département des Landes, comme l'unité.
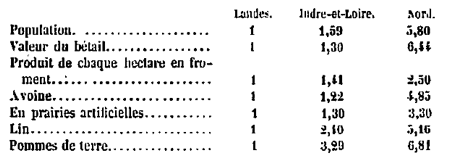
Aussi, dans le département du Nord, la production est triple, quand il s'agit des deux végétaux qui se combinent également avec la culture alterne et la culture triennale, comme le froment et l'avoine. Elle est quintuple, quant aux plantes, telles que le trèfle, le lin, la pomme de terre, qui ne peuvent trouver une place convenable dans l'assolement triennal. Le résultat les deux systèmes se manifeste par une population plus que quintuple, consommant pour une valeur plus que sextuple en viande de boucherie.
Il est vrai que la classe des agriculteurs ne profite pas seule de cet excédant de production dû à ses travaux intelligents. A mesure que les frais de production diminuent relativement aux produits, on voit s'élever le taux du fermage, par conséquent le prix de la terre, en sorte que, en définitive, c'est le propriétaire qui recueille le fruit de cette supériorité des fermiers allemands. C'est là ce qui rétablit l'équilibre entre les deux cultures. Sans cette sorte de modérateur, il serait impossible à la culture triennale de lutter contre sa rivale. Mais on comprend aisément quelle puissance il y a dans cet accroissement successif de la valeur des terres pour attirer vers le Nord les capitaux qui cherchent à se placer.
La culture alterne n'a pas moins de puissance pour appeler à elle ces capitaux qui cherchent, non la collocation, mais la spéculation. Par l'abondance et la variété des matières premières qu'elle fournit à l'industrie, aussi bien que par la consommation active qui se manifeste au sein de populations denses et riches, elle offre aux manufactures des chances infiniment supérieures à celles qu'elles pourraient rencontrer dans les régions où une population rare et dénuée se borne à la production des céréales.
Ainsi, population, consommation, capitaux, instruction, industrie, la culture alterne attire tout à elle.
Cependant, le métayage n'est-il pas un obstacle invincible à ce que les pays où ce mode d'exploitation est adopté entrent dans les voies de l'agriculture moderne ?
Nous l'avons déjà dit, le métayage se combine parfaitement avec la culture triennale, parce que l'un et l'autre portent en eux-mêmes le principe de l'immobilité. Une action toujours identique n'exige pas un agent progressif. Sans doute, l'agriculture triennale suppose une multitude de connaissances; mais ses procédés étant uniformes, de telles connaissances ont pu se fixer, se condenser, pour ainsi dire, dans une série de règles devenues proverbiales, et se transmettre ainsi, et surtout par l'exemple, depuis l'époque la plus reculée jusqu'à nos jours. Le métayer sans instruction, sans idées générales, en sait toujours assez pour faire comme faisaient ses pères ; et la masse des observations, qui va sans cesse grossissant de siècle en siècle, permet même quelques perfectionnements d'exécution dans la pratique d'un système dont l'ensemble est immuable.
Mais le caractère essentiel de l'agriculture alterne, c'est la mobilité ou du moins la diversité. Ici l'assolement peut varier d'époque à époque, selon les besoins de la consommation, et doit varier de canton à canton, suivant les exigences du sol. C'est donc à sa propre expérience, et non à celle de ses ancêtres, que l'agriculteur doit demander la règle de ses résolutions.
Quand on supposerait que le système alterne, se formulant en un assolement simple, put aussi, comme l'exploitation pastorale ou triennale, devenir l'objet d'une routine nouvelle, et se transmettre de père en fils aux générations futures par le seul véhicule de l'expérience et de l'usage, toujours est-il que le premier exemple ne peut être donné par la classe des métayers. Ce n'est pas l'esclave qui conduit au pâturage les troupeaux du Tartare nomade qui lui révélera la culture triennale ; ce n'est pas davantage le métayer, dans lequel s'est incarnée l'expérience antique, qui pourra initier l'agriculture dans sa nouvelle phase.
Trois choses manquent au métayer pour qu'il puisse devenir l'instrument d'une telle révolution : le savoir, le pouvoir et le vouloir.
La culture alterne exige plus de connaissances que la culture triennale ; elle s'exerce sur un plus grand nombre de végétaux, pour chacun desquels il faut connaître la préparation des terres, le mode d'ensemencement, de culture, de récolte, de conservation. Elle procède indifféremment quant à la confection des engrais. L'éducation des bestiaux y occupe aussi plus de place, et doit s'y appliquer à des races plus perfectionnées. Enfin, l'art de tirer parti des produits animaux s'y étend sur une plus grande échelle. Où veut-on que le métayer puise de telles connaissances ? Dans les livres ? Il ne sait pas lire et ne parle même pas leur langue. Dans l'exemple? Il n'en a pas d'autre sous les yeux que celui de la culture triennale. Dans ses relations avec les propriétaires ? Mais son seul instinct l'avertit que s'ils lui sont supérieurs sous le rapport de l'instruction scientifique, ils sont cependant moins avancés que lui dans la connaissance de l'art, du métier. Sans savoir faire cette distinction, il comprend, il devine que cette instruction est insuffisante dans la pratique.
Alors même que le métayer saurait changer son agriculture, il ne le pourrait pas. L'exploitation d'un domaine selon les procédés nouveaux demande un accroissement considérable de capital : l'acquisition d'instruments aratoires plus perfectionnés, un plus grand approvisionnement de semences, une augmentation d'animaux de trait, l'agrandissement et une meilleure distribution des granges et des étables. Qui fournira ce supplément de capital ? Que ce soit le maître ou le métayer, cette modification dans la proportion de leur apport à l'œuvre commune doit amener une modification correspondante rigoureuse pourrait seule servir de base à une distribution nouvelle et équitable. Cette comptabilité est d'autant plus indispensable, qu'il est impossible d'apprécier sans elle le prix de revient d'une foule de produits, particulièrement de produits animaux, tels que viande, lait, beurre, fromage, laine, etc., qui sont cependant, dans la culture alterne une branche nécessaire et importante de revenus. Or, la tenue des livres est hors de portée de tous les métayers et de la plupart des propriétaires.
Enfin, que le métayer n'ait pas davantage la volonté d'innover, c'est ce qui n'a pas besoin de démonstration. Nous entendons assez souvent les agronomes, et surtout les agronomanes, se lamenter sur la répugnance, la force d'inertie que rencontrent parmi les métayers leurs projets d'améliorations. Ce qu'on ne remarque pas assez, c'est l'utilité, je dirai même la nécessité d'une telle résistance. L'attachement aux anciens usages que la nature a enfoncé si avant dans le cœur de cette classe est la seule garantie que nous ayons contre les innovations inconsidérées. Sans lui, des changements aussitôt acceptés que conçus ne pourraient manquer de compromettre la source même des subsistances. Et n'est-il pas heureux que le vouloir fasse défaut, là où font défaut, ainsi que nous venons de le démontrer, le savoir et le pouvoir ?
Tels sont les motifs qui, à une autre époque, m'avaient fait m'élever contre le métayage, et l'on voit par ce qui précède que je continue à le considérer, du moins dans son organisation actuelle, comme incompatible avec l'introduction dans le pays de l'agriculture perfectionnée.
Faut-il en conclure qu'il y a urgence à lui substituer le fermage ? Ce serait là, il faut le dire, une déduction précipitée. D'abord, un pays ne change pas son organisation, sa coutume, avec la même facilité que nous avons de remplacer un vêtement usé par un vêtement nouveau. Rien n'est prêt dans la plupart des départements pour recevoir le fermage en ce qu'il a surtout d'avantageux. La classe d'hommes entreprenants et éclairés qui devaient, à titre de fermiers, diriger les exploitations, n'existe pas sur notre sol, et la distribution des terres en domaines d'une étendue fort restreinte n'est pas propre à les y attirer. Les agents immédiats du travail agricole, ou la race des journaliers, n'existe pas davantage et il est au moins douteux que son avènement dans le pays soit désirable. Enfin, l'usage où sont les propriétaires de recevoir la rente de leurs terres en nature a fait prendre des dispositions qui ne sauraient changer, sans bouleverser toutes les relations qui constituent, à proprement parler, la vie sociale d'une contrée.
Alors donc qu'il serait démontré qu'au point de vue agricole le fermage est supérieur au métayage, ce serait une véritable utopie que de le présenter au pays comme l'échelon indispensable pour s'élever à la culture alterne.
Mais si le métayage, plus stationnaire par sa nature que le fermage, lui est inférieur au point de vue de l'art ; si cette infériorité devient plus sensible encore à ces époques critiques où une modification profonde, et l'on peut dire une grande révolution dans les procédés agricoles, réclame l'intervention de l'intelligence et des capitaux, il faut se demander aussi si cette infériorité existe sous d'autres rapports, et principalement sous le rapport social, qui est de beaucoup le plus important. Le métayage et le fermage se combinent très diversement avec les lois de la population et avec celles qui président à la distribution des richesses. En admettant que le fermage crée plus de produits, il reste à savoir s'il les distribue d'une manière aussi équitable entre tous ceux qui y ont concouru, et s'il oppose un frein aussi puissant à l'accroissement désordonné de la population, ce qui est considéré par tous les économistes et les hommes d'État comme le plus grand fléau qui puisse affliger l'humanité, puisqu'il implique à lui seul tous les autres.
C'est avec répugnance que j'aborde ces graves questions. Cependant elles on un intérêt si puissant, particulièrement pour notre midi, que je me vois forcé de réclamer un moment d'attention. Comment pourrais-je, d'ailleurs, proposer la fondation d'une école de métayage, après avoir montré cette organisation sous son aspect le plus défavorable, si je ne l'envisageais pas aussi en ce qu'elle a de bon, d'utile et d'avantageux au bien-être des populations au sein desquelles elle a prévalu ?
Les produits agricoles se partagent entre trois classes de personnes dans les pays de ferme : le propriétaire, le fermier et les manouvriers.
Les proportions de ce partage sont loin de présenter un caractère de perpétuité. A mesure qu'une exploitation intelligente parvient à améliorer le sol et à augmenter les produits, le propriétaire, profitant de la concurrence des fermiers, élève, à chaque renouvellement de bail, la rente de la terre, en sorte que l'accroissement de la richesse ne profite au fermier que temporairement, et dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre ; en définitive, c'est dans la caisse du propriétaire oisif, de celui qui n'a contribué en rien au progrès, que les résultats du progrès viennent se réaliser. La condition du fermier demeure stationnaire, si même elle n'empire pas par l'effet d'une concurrence exagérée. On dira, sans doute, qu'il y a également concurrence de terres à affermer. Mais il est sensible que le nombre des domaines est limité, tandis que le nombre des hommes qui peuvent se placer à la tête d'une exploitation doit s'accroître sans cesse à mesure que les lumières se répandent et que les capitaux se multiplient.
Cette inégalité dans la répartition de tous les produits qui sont le fruit de l'amélioration successive du sol et des progrès des procédés de l'art, est plus désavantageuse encore à la classe des manouvriers.
La concurrence réduit naturellement le salaire à ce qui est nécessaire pour entretenir la vie de l'ouvrier. Cela est vrai en agriculture, comme dans les manufactures. Qu'une filature bien dirigée parvienne à donner de meilleurs résultats, il ne s'ensuit nullement accroissement dans le salaire de l'ouvrier. Si l'amélioration est un fait isolé, elle profite à l'entrepreneur ; si elle est commune à toutes les filatures, elle tourne au profit du consommateur. Quant au salaire, il n'en est pas altéré. L'entrepreneur, en effet, ne le règle pas selon ses profits, mais suivant le taux auquel la concurrence lui livre les bras ; et si le pays les lui offre à un franc par jour, ses profits auront beau s'accroître, ils ne le détermineront pas à donner bénévolement deux francs.
Les choses se passent de même dans les pays de ferme. Il y a même une raison de plus pour que la condition des manouvriers ne s'y améliore pas avec le progrès de la culture. Cette raison, c'est que tout l'excédant de richesse produite passant au propriétaire, le fermier n'est pas placé dans une condition meilleure, quoique la ferme soit bien plus productive. Economiser sur les frais de production est pour lui une obligation qui ne se ralentit jamais, et la première, la principale, comme la plus notable des économies, c'est de diminuer, autant que possible, la main-d'œuvre, et de ne payer celle qu'il ne peut épargner qu'au taux le plus bas auquel la concurrence des, journaliers lui permet de descendre.
Pour que le salaire s'améliorât, il faudrait donc de deux choses l'une, ou que la quantité de main-d’œuvre demandée s'accrut progressivement avec les progrès de la culture, ou que la population ouvrière se restreignît de manière à limiter l'offre de la main- d'œuvre, et en élever ainsi le taux.
Mais, sous l'un ou l'autre rapport, on trouve que cette classe est placée dans les conditions les plus défavorables. — Quant à la demande de main-d’œuvre, elle tend plutôt à diminuer qu'à augmenter avec les progrès de la culture, car ces progrès consistent précisément à faire accomplir les travaux par des agents mécaniques. Et quant à l'offre des bras, on ne peut douter qu'elle ne tende sans cesse à s'accroître, car il est dans la nature du salariat de créer l'imprévoyance et de favoriser l'accroissement désordonné de la population. C'est ce que la science moderne a parfaitement compris et démontré, et ce qui a été confusément senti de tout temps, ainsi que le témoigne cette énergique expression, prolétariat, appliquée à la classe qui vit de salaires, longtemps avant que les lois de la population fussent soumises aux investigations de la science.
Ainsi, en admettant que le fermage fût une organisation agricole plus favorable que le métayage au perfectionnement de l'agriculture et à l'accroissement de la richesse, on ne peut nier qu'il ne recèle, quant à la distribution des produits, le plus grand de tous les inconvénients. Loin d'appeler toutes les classes de travailleurs au partage équitable des produits ; loin de les faire participer toutes aux avantages des progrès agricoles, de manière à ce que l'accroissement des richesses ne fût autre chose qu'une augmentation de bien-être justement réparti, il n'aboutit, au contraire, qu'à enrichir le riche et à appauvrir le pauvre, éloignant sans cesse l'une de l'autre ces deux extrémités de la chaîne sociale, et créant ainsi cette incommensurable distance qui sépare l'extrême opulence de l'extrême misère.
Ce n'est pas seulement le bien-être qui se répartit d'une manière aussi inégale sous la loi du fermage, mais encore l'instruction et l'influence, même en ce qu'elles ne sont pas le fruit de la richesse.
Le propriétaire oisif, complètement étranger aux procédés de l'art, s'éloigne de la terre qui le fait vivre, et souvent même il ne l'a jamais visitée. Il habite les grandes villes, au centre de la civilisation, des affaires politiques.
Le fermier, à la vérité, est obligé de cultiver son intelligence, et de se tenir au courant des progrès de l'art. En lui se concentrent toutes les lumières. Mais remarquez que les résultats positifs de son instruction, périodiquement confisqués par le propriétaire, laissent, à chaque renouvellement, le fermier dans la même position. Il est donc enfermé dans un cercle qu'il ne peut franchir, et se idées, comme son influence, ne peuvent s'étendre au delà du métier.
Quant au journalier, toujours réduit au salaire qui le fait vivre, peu lui importent les procédés de l'art dont il est un rouage inintelligent. Il est même douteux qu'on puisse regarder comme avantageuse pour lui cette sorte d'instruction subreptice qui lui vient du dehors, qui ne naît pas de sa position, qui ne doit pas l'améliorer, et qui ne servira peut-être qu'à lui en faire apprécier l'horreur.
Enfin l'industrie elle-même doit se ressentir, dans le pays de ferme, de l'absence permanente des propriétaires et de leurs familles. Libres de toute participation personnelle à l'œuvre agricole, ils ont affaibli autant que possible les liens qui les attachaient au sol, et ils s'en éloignent sans peine pour aller consommer au loin leurs revenus. Le quart, le tiers peut-être des produits sont ainsi perdus pour le pays qui les a fait naître, et le vide causé par cet absentéisme régulier est d'autant plus irréparable qu'il ne saurait être comblé à la longue par les efforts des fermiers et des journaliers, puisque ces efforts n'aboutissent, ainsi que nous l'avons vu, qu'à grossir la part de l'absentéisme.
Aussi le voyageur qui parcourt les riches ou plutôt les fertiles contrées soumises au contrat de ferme , a-t-il peine à concilier la beauté des cultures, la richesse des produits avec la misère du pays ; des châteaux déserts, des fermes dont une loi inexorable arrête le progrès, et des amas de masures où pullule la race des journaliers ; un antagonisme incurable entre les trois classes que nourrit le sol, des propriétaires qui souvent n'ont jamais vu la terre qui fournit à leur luxe de cour, des fermiers déplorant l'aspect de leurs riches moissons, signe certain de surcroît de charges qui les menace, des journaliers sans instruction, sans intérêt au succès de leur œuvre, sans prévoyance et sans espoir en un avenir qui pour eux ne recèle aucun germe d'amélioration, telle est la condition réelle à laquelle ont été réduites ces contrées par le fermage, combinaison trop vantée, parce qu'elle a été trop souvent considérée au seul point de vue de la production et dans le seul intérêt du propriétaire.
Il semble au premier coup d'œil qu'une bien légère différence sépare le fermage du métayage. Pour le loyer de la terre, l'un paye en argent une redevance fixe, l'autre livre en nature une redevance proportionnelle aux produits. Il est pourtant certain que de ces légères nuances naissent deux ordres sociaux complètement distincts.
Le bail à ferme est essentiellement temporaire ; il se renouvelle tous les vingt et un, tous les dix-huit, quelquefois tous les neuf ans, et même, comme en Irlande, tous les ans. Pour peu que le fermier se soit enrichi, ait fait ses affaires, le bail à ferme intervient périodiquement et le fait descendre à sa condition première.
Le bail à colonie a un caractère essentiel de perpétuité, ou du moins sa durée dépend entièrement de l'activité, de l'esprit d'ordre et de la probité de colon partiaire. Pourvu qu'il travaille bien la terre et exécute loyalement les conditions de son contrat, il n'y a aucune raison pour qu'il soit expulsé, et en aucun cas ses charges ne sont aggravées. Il y a donc une place pour l'espérance dans le cœur du métayer. Il profitera de chacun de ses efforts, chaque goutte de sueur qui tombe de son front aura sa récompense, il peut montrer les champs avec orgueil et confiance au propriétaire, il n'a pas à craindre que le bon état des cultures enflamme sa cupidité.
Le métayage a divisé le sol cultivable en portions égales à ce qu'une famille peut exploiter. Dans les pays de métairies, il n'y a donc pas de journaliers, de prolétaires. Quiconque met la main à l'œuvre est intéressé au résultat. Les qualités morales, le perfectionnementintellectuel ne sont pour personne un bagage inutile et peut-être funeste. Exécuter les travaux avec plus de sagacité, avec plus de persévérance, ce n'est pas améliorer momentanément le sort d'un fermier, et en définitive grossir la fortune du maître, c'est améliorer sa propre condition et celle de sa famille.
Dans le métayage, la distribution de la richesse s'opère évidemment d'une manière plus équitable. La famille qui fournit le capital et celle qui fournit la main-d’œuvre partagent selon des proportions une fois arrêtées, mais immuables. Selon les difficultés de la main-d’œuvre, sa part est de moitié, des deux tiers, des trois cinquièmes et souvent des trois quarts. C'est la véritable association du capital et du travail tant cherchée par les utopistes de notre siècle. Une fois la part du travail convenue, il ne reste à celui-ci qu'à agir, à se multiplier, à se perfectionner, sa récompense lui est toujours assurée.
Sous le rapport de la population, les pays de métairies paraissent être dans des conditions très-favorables.
On s'est beaucoup récrié dans ces derniers temps contre les doctrines de Malthus. On dirait que ce célèbre économiste a imposé à l'humanité les lois qu'il n'a fait que constater. Autant vaudrait s'en prendre à Newton d'avoir exposé des lois de la gravitation parce que c'est en vertu de ces lois que nous sommes blessés par la chute des corps, ou par notre propre chute.
Le fait est que l'exubérance de la population a toujours été et sera toujours le plus grand fléau de l'humanité, parce qu'il implique tous les autres.
Un fait également bien constaté, c'est que la tendance à une multiplication désordonnée se manifeste principalement au sein de cette classe d'hommes qui vit de salaires. Cette prévoyance qui retarde les mariages a sur elle peu d'empire, parce que les maux qui résultent de l'excès de concurrence ne lui apparaissent pas très-confusément et dans un lointain en apparence peu redoutable.
C'est donc la circonstance la plus favorable pour un pays d'être organisé de manière à exclure le salariat. Dans les pays de métairies, les mariages sont déterminés principalement par les besoins de la culture ; ils se multiplient quand, par quelque circonstance, les métairies offrent des vides nuisibles aux travaux ; ils se ralentissent quand les places sont remplies. Ici, un état de choses facile à constater, savoir, le rapport entre l'étendue du domaine et le nombre des bras, opère comme la prévoyance et plus sûrement qu'elle. Aussi voyons-nous que si aucune circonstance n'intervient pour ouvrir des débouchés à une population surnuméraire, elle demeure stationnaire. Nos départements méridionaux en sont la preuve.
En est-il de même dans les pays de ferme ? L'Angleterre et l'Irlande sont là pour nous répondre. On ne sait ce qui croit avec le plus de rapidité de l'autre côté de la Manche, la production, la population ou le paupérisme. Or, la simultanéité de ce triple développement semble au premier coup d'œil inconciliable. Une population croissante s'explique bien par une production progressive et réciproquement ; mais ce surcroît de misère est un phénomène qui semble contradictoire aux deux autres, car, d'autre part, comment la surabondance des produits n'amène-t- elle pas le bien-être des producteurs, et de l'autre, comment le paupérisme ne restreint-il pas la population? Ces apparentes anomalies s'expliquent par le salariat, que les manufactures et l'agriculture développent à l'envi dans les Iles-Britanniques. Le salariat détermine une inégale répartition des produits, ainsi s'explique l'accroissement simultané de la richesse et de la misère. Il neutralise la prévoyance à l'égard du mariage, ainsi s'explique le développement simultané de la population et du paupérisme.
Est-ce là un résultat que la philanthropie puisse désirer? Une exubérance désordonnée de cette partie de la population qui vit sur la précaire ressource des salaires, ressource que tant de causes viennent sans cesse altérer et déranger ; une concurrence de plus en plus active dans l'offre des bras ; une baisse relative et constante dans la valeur des salaires, jusqu'à ce que l'ouvrier se réduise, comme en Irlande, à vivre de quelques pommes de terre dérobées à l'auge des pourceaux, est-ce là le but définitif de l'humanité?
Heureuses donc les contrées au sein desquelles la plus importante, la plus générale de toutes les industries, celle qui occupe l'immense majorité des travailleurs, est fondée par une organisation qui exclut le salariat. Gardons-nous de toucher au métayage, à cette association du travail et du capital, qui ferme la porte aux deux plus terribles fléaux de l'humanité : l'exubérance de la population et le paupérisme.
Sous le rapport moral, le métayage offre encore d'incontestables avantages. La communauté d'intérêts qu'il établit entre les propriétaires et les métayers, la force avec laquelle il les pousse vers un même but par des routes parallèles, ne laissent point se produire ces sentiments de défiance et d'envie, cette sourde irritation qui travaille la classe ouvrière salariée, et qui se manifeste de temps en temps par les terribles explosions de l'émeute, du rébeccaïsme, de l'incendiarisme, symptômes divers d'une même souffrance. Dans les contrées où le métayage domine, il y a, sans doute, différence de degrés entre les fortunes, mais communauté de chances et de perspectives. Le métayer gagne ou perd par les mêmes causes qui enrichissent le maître ou l'appauvrissent. Tous deux sont intéressés à s'entendre, à se concerter pour traverser, en s'entraidant, les jours mauvais, et pour consacrer en améliorations le superflu des années favorables. Il s'établit des relations de tous les jours, presque des liens de parenté entre la famille du propriétaire et celle du métayer. Le maître aime à s'instruire de la position de ses colons ; il intervient, par ses conseils, dans les projets de mariage ; il les accélère ou les retarde selon les nécessités du travail, ou, ce qui revient au même, selon l'intérêt social. Il tient compte de la bonne renommée quand il s'agit d'introduire dans son domaine un nouveau travailleur destiné à devenir chef de colonie, ouvrant ainsi aux familles les mieux famées des chances supérieures d'accroissement et de propagation. Quand le métayer vient porter à son propriétaire la poule de vendange ou les œufs de Pâques, leur entretien est cordial et affectueux. Ils n'ont point à se soupçonner réciproquement de sinistres arrière-pensées, et le colon peut se complaire à vanter la beauté des récoltes, la fertilité du sol, sans craindre d'enflammer la cupidité du maître et de lui suggérer la funeste pensée d'un changement dans les clauses de leur contrat. J'ai vu un propriétaire inviter ses métayers au premier de l'an, suivant un usage antique, et voir sa table couronnée de cent vingt chefs de colonie. [39]
Je n'ai pas voyagé ; je n'ai pas été à même de comparer les pays de fermes à ceux de métairie ; mais il me semble que le raisonnement suffit pour montrer qu'ils doivent présenter un aspect bien différent. Dans les uns, quelques châteaux délabrés que l'absentéisme laisse silencieux et vides, des fermes placées à de grandes distances et où l'instruction et l'aisance ne peuvent franchir la barrière de fer imposée par le contrat de fermage ; des bourgades exclusivement habitées par les manouvriers, et où s'étalent, sans doute, la misère, la malpropreté, l'imprévoyance, le défaut de culture qui sont le triste cortège du prolétariat. Ce n'est pas là la froide physionomie que le métayage imprime à nos campagnes. La division du territoire en petits domaines y multiplie les maisons, les jardins, les bouquets d'arbres, les près, les champs, les vignes, les taillis, et répand sur tout le paysage l'attrait de la variété.
La conclusion qui ressort de tout ce qui précède, c'est que le fermage est plus favorable à la production, et le métayage à la distribution de la richesse. L'un paraît supérieur sous le rapport purement agricole. L'autre paraît avoir des avantages incontestables au point de vue social. Si donc il était possible de répandre une instruction vraieet solide dans la classe métayère; si l'on pouvait faire franchir au métayage la barrière qui sépare le système triennal et le système alterne, il ne me paraît pas douteux qu'on ne vît bientôt les contrées où cette organisation a prévalu égaler, sous le rapport de l'art, les pays de fermes, sans présenter comme ceux-ci le triple fléau de l'absentéisme quant au propriétaire, d'un état fatalement stationnaire en ce qui concerne le fermier, et du prolétariat pour le lot de l'ouvrier des campagnes.
Association pour la liberté des échanges à Bordeaux [18 février 1846] ↩
BWV
1846.02.18 “Association pour la liberté des échanges à Bordeaux” (The Free Trade Association in Bordeaux) [*Mémorial bordelais*, 18 février 1846] [OC7.9, p. 43]
Source
Mémorial bordelais du 18 février 1846.(N. E.)
Association pour la liberté des échanges [1]
Au moment d’engager contre le monopole une lutte qui pourra être longue et acharnée, il peut se trouver, parmi vos lecteurs, des hommes qui, absorbés par la gestion de leurs affaires, n’ont pas le loisir de mesurer dans toute son étendue la grande question de la liberté commerciale. Ils me pardonneront, j’espère, d’attirer leur attention sur ce vaste sujet.
L’affranchissement du commerce est une question de prospérité, de justice, d’ordre et de paix.
C’est une question de prospérité. — J’entends de prospérité générale ; mais, puisque nous sommes à Bordeaux, parlons de Bordeaux. — Que veut dire restriction ? Cela veut dire certains échanges empêchés. Donc que signifie absence de restriction ou affranchissement du commerce ? Cela signifie plus d’échanges. Mais plus d’échanges, c’est plus de produits importés et exportés, plus de voitures mises en mouvement, plus de navires allant et venant, moins de temps à composer une cargaison, plus de courtages, d’emballages, de pilotages, de roulages, plus de commissions, de consignations, de constructions, de réparations ; en un mot, plus de travail pour tout le monde.
Échanger, c’est donner une chose que l’on fait facilement contre une autre chose que l’on ferait plus difficilement. — Donc échanger implique moins d’efforts pour une satisfaction égale, ou plus de satisfactions pour des efforts déterminés. Échange, c’est division mieux entendue du travail, c’est application plus lucrative des capitaux, c’est coopération plus efficace des forces de la nature ; et, en définitive, plus d’ échanges, c’est non seulement plus de travail, mais encore un meilleur résultat de chaque portion donnée de travail, — c’est plus de richesses, de bien-être, de prospérité matérielle, d’instruction, de moralité, de grandeur et de dignité.
C’est une question de justice. — Il y a injustice évidente à dépouiller qui que ce soit de la faculté d’accomplir un échange qui ne blesse ni l’ordre public ni les bonnes mœurs. Le droit de propriété implique le droit d’échanger aussi bien que de consommer. Vainement dirait-on que, lorsque la législation douanière exproprie un citoyen ou une classe de ce droit sacré de propriété, elle guérit la blessure qu’elle fait au corps social par l’avantage qu’elle procure à un autre citoyen ou à une autre classe ; car c’est en cela même que consiste l’injustice.
Encore si la protection pouvait s’étendre à tous, elle serait une erreur, elle ne serait pas une iniquité. Mais l’activité nationale s’exerce dans une foule de carrières qui ne sont point susceptibles de protection douanière ; le commerce, dans ses innombrables ramifications, les fonctions publiques, le clergé, la magistrature, le barreau, la médecine, le professorat, les sciences, la littérature, les beaux-arts, la plupart des métiers ; voilà une masse immense du travail national qui subit les inconvénients du système protecteur, sans en pouvoir jamais partager les illusoires avantages.
C’est une question d’ordre. — Les hommes qui dirigent les affaires publiques savent dans quelle énorme proportion ils seraient soulagés du fardeau de leur responsabilité, si le préjugé national n’avait remis en leurs mains la laborieuse tâche de régler, équilibrer et pondérer les profits relatifs des diverses industries. Depuis cet instant funeste, il n’est pas de gênes, de souffrances, de misères et de calamités qui ne soient attribuées à l’État. Les citoyens ont appris à ne plus compter sur leur prudence, sur leur habileté, sur leur énergie, mais sur la protection. Chacun fait effort pour arracher à la législature un lambeau de monopole ; et, comme si ce n’était pas assez de la foule des solliciteurs que la soif des emplois pousse dans les avenues des ministères, le peuple en masse, le peuple des champs et des ateliers, s’est transformé tout entier en solliciteur. Il s’agite, il se soulève, il se plaint, il encombre les rouages administratifs ; et il serait difficile de citer un acte du Gouvernement, un traité, une négociation, que l’esprit du monopole ne soit parvenu à fausser, à entraver ou à empêcher d’aboutir.
C’est une question de paix. — Avec la liberté du commerce, les rivalités nationales ne peuvent être autre chose que de l’émulation industrielle ; et, par une admirable dispensation de la divine Providence, il arrive que, dans cette lutte pacifique, c’est le vaincu qui recueille les fruits de la victoire par l’abondance et le bon marché des produits auxquels il a eu la sagesse d’ouvrir ses ports et ses frontières. Cette vérité, universellement comprise, est destinée à briser le contrat colonial en ce qu’il a d’exclusif, à décréditer le prestige des conquêtes et l’erreur des guerres de débouchés, à étouffer l’antagonisme international, à délivrer les peuples du fardeau et du danger des grandes armées permanentes et des puissantes marines militaires, et à unir les hommes de tous les pays, de toutes les langues, de tous les climats et de toutes les races par les liens d’une bienveillance réciproque et d’une universelle fraternité.
C’est pour coopérer à cet avenir de bien-être, de justice et de paix que l’Association bordelaise a élevé le drapeau de la liberté des échanges.
Enfants de Bordeaux, puisqu’il vous a été donné de prendre l’initiative de ce grand mouvement, n’oubliez pas à quel prix la victoire s’achète : assez d’obstacles vous attendent au dehors, préservez-vous de tout obstacle intérieur, et que le moindre symptôme de division soit étouffé dans son germe par votre abnégation et votre zèle ; que le dissolvant de la critique ne s’attache pas à quelques négligences, à quelques tâtonnements inséparables d’une première et prompte organisation ; ne laissez pas dire que Bordeaux, qui a toujours les mains ouvertes à tous les actes de philanthropie isolée, a laissé mourir, faute d’aliments, une grande réforme sociale ; ne laissez pas dire que Bordeaux, cette ville si féconde en hommes éminents, et qui a jeté tant de lustre sur les cours de judicature, les assemblées législatives et les conseils de la Couronne, a néanmoins manqué de cette intelligence collective, de cet esprit de hiérarchie volontaire qui est le sceau de toute civilisation avancée et l’âme de toute grande entreprise ! Levez-vous comme un seul homme et prodiguez sans mesure le tribut de toutes vos facultés à votre sainte cause. Et, au jour du triomphe, lorsque Bordeaux se revêtira d’une splendeur nouvelle, lorsqu’une activité trop longtemps assoupie animera ses quais, ses chantiers, ses entrepôts et ses magasins ; lorsque le chant laborieux du matelot retentira sur toute la ligne de cette rade splendide, magnifique présent du ciel, si le monopole n’était parvenu à le couvrir de silence et de vide ; — alors, certains que votre prospérité n’est point achetée par les souffrances de vos frères et alimentée par d’injustes priviléges, mais qu’elle est, pour ainsi dire, une des ondulations de la prospérité générale, se communiquant du centre aux extrémités, et des extrémités au centre de l’empire ; — alors, dis-je, vous pourrez vous rendre le témoignage que vous ne vous êtes pas levés pour une cause solitaire et égoïste ; et, rompant vos rangs, comme une milice fidèle au retour de la paix, vous dissoudrez cette Association, avec la consolation de penser qu’elle aura ajouté une noble et glorieuse page aux annales de votre belle cité.
Au rédacteur du Journal de Lille [19 février 1846] ↩
BWV
1846.02.19 “À M. le rédacteur du Journal de Lille, organe des intérêts du nord” (Letter to the Editor of the Journal de Lille, mouth-piece of the northern interests) [*Mémorial bordelais*, 19 février 1846] [OC7.10, 47]
À M. le rédacteur du Journal de Lille, organe des intérêts du nord [1]
Monsieur,
Vous vous occupez de l’Association pour la liberté des échanges, et cela, il faut le dire, en très bons termes. Cette modération est d’un trop bon augure pour que nous ne nous empressions pas de la reconnaître et de l’imiter.
Vous prenez acte d’abord de ce que l’association se donne pour mission de propager la vérité économique avec assez de profusion pour changer le cours de la volonté nationale. — Puis, vous vous demandez si une telle mission est opportune ; et, bien entendu, vous résolvez la question négativement. — Et pourquoi n’est-il pas opportun de répandre la vérité? — C’est, dites-vous, parce que l’opinion n’est pas encore fixée. « N’avons-nous pas, en France, des intérêts d’agriculture qui demandent la protection, et d’autres intérêts d’agriculture qui demandent la liberté des échanges ; des industries qui veulent être protégées, et des industries qui se plaignent du régime restrictif ? Dans nos ports de mer, telle branche de commerce vit de la protection, et telle autre proteste contre elle. Tout cela ne forme-t-il pas une mêlée confuse ? »
Eh ! sans doute, les uns sont pour et les autres contre. Mais, par le grand Dieu du ciel ! ils n’ont pas tous raison en même temps. On se trompe de part ou d’autre ; et, puisque les partisans du monopole, par leurs journaux, leurs comités, leurs souscriptions, répandent assez leurs idées pour qu’elles se traduisent en lois, pourquoi les amis de la liberté ne feraient-ils pas de même ? Y a-t-il quelque moyen, de faire cesser cette confusion dont vous parlez que de débattre à fond la question devant le public ? Ou bien les armes dont l’erreur fait usage sont-elles interdites à la vérité, et faut-il que les monopoleurs aient encore le monopole de la parole ?
« Quand les conflits auront peu à peu disparu par la force des choses, — dites-vous, — alors surgira pour nous, comme pour l’Angleterre, cette grande question de réforme, que l’Association bordelaise cherche en vain aujourd’hui à précipiter à contre-temps. »
Fort bien : quand tout le monde sera d’accord, vous nous permettrez de parler ; et quand la lumière se sera faite par la force des choses, vous ne verrez plus d’inconvénient à ce que nous en appelions à la force des raisons. — Trouvez bon que nous ne nous laissions pas renfermer dans ce cercle vicieux. Vraiment, vous vous faites la part trop belle, car votre proposition revient à ceci : Maintenant, il y a conflit d’opinions ; que les moyens d’information soient tous de notre côté, et si, malgré cela, la doctrine de la liberté triomphe par la seule force des choses, alors la réforme commerciale pourra surgir, non en fait, mais à l’état de question.
Ensuite, toujours pour prouver que notre principe est faux et qu’en tout cas il est inutile de chercher à le répandre, vous dites : « Il y a vingt-six ans et plus que cette doctrine de la liberté s’agite en Angleterre. MM. Huskisson, Bowring et d’autres hommes éminents avaient formé école et poursuivaient avec un zèle infatigable la réalisation de leurs plans. Il a fallu cependant près d’un quart de siècle, dans un pays où les principes économiques sont admirablement étudiés et compris, il a fallu qu’à des doctrines nouvelles des faits vinssent, un à un, graduellement et par une sorte d’attraction, prêter toute l’autorité d’un problème résolu, avant qu’un homme d’Etat, abdiquant ses convictions passées, ses antécédents politiques, osât proclamer à la face de son pays qu’il était prêt à entreprendre une œuvre que jadis il eût combattue. Il s’est fait chez sir Robert Peel une révolution dans ses idées et dans son esprit. Pour qu’un tel homme fasse consciencieusement et sans sourciller un pareil aveu, ne faut-il pas que l’évidence l’ait étreint de toute part ? etc. »
Certes, si l’on voulait démontrer tout à la fois la vérité de la doctrine libérale et la nécessité de constants efforts pour la propager, on ne pourrait mieux dire.
Quoi ! malgré ce qu’a de spécieux la doctrine de la restriction, les faits sont venus un à un, comme par une sorte d’attraction, prêter à la doctrine opposée l’autorité d’un problème résolu ! Quoi ! malgré ses convictions et ses engagements protectionistes, sir Robert Peel a été étreint de toute part d’une évidence telle qu’elle l’a amené à confesser publiquement qu’une révolution s’était opérée dans ses idées et dans son esprit ! — Et vous ne voulez pas que nous tenions cette doctrine pour vraie !
D’un autre côté, il a fallu vingt-six ans à un peuple qui étudie et qui comprend ; il a fallu d’infatigables efforts à Huskisson, à Bowring et à leur école, avant que l’Angleterre ait pu mettre sa législation en harmonie avec cette vérité ; — et vous en concluez que les amis de la liberté, en France, n’ont qu’à garder le silence et laisser agir la force des choses ! — En vérité, je ne puis comprendre par quelle étrange liaison d’idées de telles prémisses vous ont conduit à de telles conclusions.
« C’est, — dites-vous, — la fameuse Ligue Cobden, moins Cobden, que Bordeaux vise à copier. »
Avez-vous voulu faire la satire de la France ? Certes, il n’est personne qui puisse refuser son admiration à l’homme éminent qui a conduit la nation anglaise à triompher des whigs, des tories, de l’aristocratie, du monopole, et, ce qui était plus difficile, de sa propre apathie et de ses préjugés. — Est-ce à dire qu’il n’y a dans notre pays ni intelligence ni dévouement ? Et la France est-elle tellement épuisée d’hommes de mérite, qu’il n’en puisse plus surgir pour répondre aux nécessités du temps et à ses espérances ?
Mais le système protecteur, ajoutez-vous, n’a pas le même caractère en France qu’en Angleterre, et l’Association de Bordeaux a tort de copier la Ligue de Manchester.
Eh ! qui vous dit qu’on veut copier la Ligue ? La Ligue a adopté la tactique qui lui était imposée par le caractère de la lutte qu’elle avait à souvenir ; l’Association fera de même.
FN: Mémorial bordelais du 19 février 1846. (N. E.)
Premier discours, à Bordeaux [23 Février 1846] ↩
BWV
1846.02.23 “Premier discours, à Bordeaux” (First Speech given in Bordeaux) [23 Février 1846] [OC2.42, p. 229]
Discours à Bordeaux
23 Février 1846
Messieurs,
En présence d’une assemblée si imposante, qui réunit dans cette enceinte tant de lumières, d’esprit d’entreprise, de richesses et d’influence, vous ne serez pas surpris que j’éprouve une émotion insurmontable, et que je commence par réclamer votre indulgence. Je parais devant vous, Messieurs, pour me conformer aux dispositions prises par notre honorable président. Eussions-nous à notre tête un chef moins expérimenté, il faudrait encore nous soumettre à sa direction ; car mieux vaut un plan même médiocre que l’absence, ou, ce qui revient au même, la multiplicité des plans. Mais puisque l’Association a eu le bonheur de remettre la conduite de ses opérations à un de ces hommes rares, à la tête froide et au cœur chaud, qui tire plus d’autorité encore de son caractère personnel que de sa position élevée, il ne nous reste plus qu’à marcher au pas, sous sa conduite, et dans un esprit de discipline volontaire, à la conquête du grand principe que nous avons inscrit sur notre bannière : La Liberté des Échanges !
Messieurs, la première épreuve par laquelle est condamnée à passer notre grande entreprise, c’est le dénigrement, qui s’attache toujours à la pensée généreuse qui cherche à se traduire en fait. Grâce au ciel, la valeur individuelle et l’ensemble imposant des noms, qui figureront ce soir au bas de notre acte de société, imposeront silence à bien des insinuations malveillantes. On dira bien, on a déjà dit que notre association est une copie, une pâle copie de la Ligue anglaise ; mais est-ce que les hommes de tous les pays, qui tendent au même but, ne sont pas amenés à prendre des moyens analogues ? Non, nous ne copions pas la Ligue, nous obéissons aux nécessités de notre situation. D’ailleurs, est-ce la première fois que Bordeaux élève la voix pour la liberté des échanges ? La Chambre de commerce de cette ville ne combat-elle pas depuis longues années pour cette cause ? Cette cause n’est-elle pas un des objets de l’Union vinicole qui s’est fondée dans la Gironde ? Si tant de nobles efforts ont échoué jusqu’ici, c’est qu’ils s’adressaient à la législation qui ne peut que suivre l’opinion publique. C’est donc pour poser la question là où elle doit être préalablement vidée, — devant le public, — que nous nous levons aujourd’hui ; et en cela, si nous imitons quelqu’un, c’est notre adversaire, le monopole. Il y a longtemps qu’il fait ce que nous faisons ; il y a longtemps qu’il a ses comités, ses finances, ses moyens de propagande, qu’il s’empare de l’opinion, et par elle de la loi. Nous l’imiterons en cela. Mais il y a une chose que nous ne lui emprunterons pas, c’est le mystère de son action. Il lui faut le secret, il lui faut des journaux achetés par-dessous main. À nous, il faut l’air, le grand jour, la sincérité.
Et puis, quand nous imiterions la Ligue en quelque chose ? Sommes-nous dispensés de bon sens et de dévouement parce qu’il s’est rencontré du bon sens en Angleterre ? Oh ! plaise à Dieu que nous empruntions à la Ligue ce qui fera sa gloire éternelle ! Plaise à Dieu que nous apportions à notre œuvre la même ardeur, la même persévérance et la même abnégation ; que nous sachions comme elle nous préserver de tout contact avec les partis politiques ; grandir, acquérir de l’influence, sans être tentés de la détourner à d’autres desseins, sans la mettre au service d’aucun nom propre ! Et si jamais notre apostolat s’incarne dans un homme, puisse-t-il, à l’heure du triomphe, finir comme finit Cobden ! Il y a deux mois, l’aristocratie anglaise, selon un usage invariable, voulut absorber cet homme. On lui offrit un portefeuille ; M. Peel est lui-même le fils d’un manufacturier, et Cobden pouvait voir, en espérance, son fils premier lord de la trésorerie. Il répondit simplement : « Je me crois plus utile à la cause en restant son défenseur officieux. » — Mais ce n’est pas tout. Aujourd’hui que la Ligue l’a placé sur un piédestal qui l’élève plus haut que l’aristocratie elle-même, aujourd’hui qu’elle a remis en ses mains des forces populaires capables de tenir en échec les whigs et les tories, aujourd’hui que de toute part ses amis le pressent de faire tourner cette immense puissance à l’achèvement de quelque autre grande entreprise, aucune passion, aucune séduction ne peut l’émouvoir ; il s’apprête à briser de ses mains l’instrument de son élévation, et il dit à l’aristocratie :
« Vous redoutez notre agitation, vous craignez qu’elle ne se porte sur un autre terrain. La Ligue s’est fondée pour l’abolition des monopoles : abolissez-les ce matin, et, dès ce soir, la Ligue sera dissoute. » Non, jamais, depuis dix-huit siècles, le monde n’a vu s’accomplir de plus grandes choses avec une si adorable simplicité.
Mais si la Ligue nous offre de beaux modèles, ce n’est point à dire que nous ayons à copier servilement sa stratégie. À qui fera-t-on croire que ces hommes graves dont je suis entouré, que des négociants rompus aux affaires et versés dans la connaissance des mœurs et des institutions des peuples, n’aient pas compris tout d’abord en quoi notre Association diffère de la Ligue anglaise ?
En Angleterre, le système protecteur avait deux points d’appui : l’erreur économique et la puissance féodale. On conçoit sans peine que l’aristocratie, tenant en main le privilége de faire la loi, et avec lui, pour ainsi parler, le monopole des monopoles, les avait établis principalement en sa faveur.
Lors donc que des réformateurs véritables, non plus des Huskisson et des Baring, mais des réformateurs sortis du peuple, se sont levés contre le régime restrictif, ils se sont trouvés en face d’une difficulté dont heureusement notre voie est débarrassée depuis un demi-siècle.
Il s’agissait bien, comme chez nous, de réformer la loi, de détruire le monopole ; mais leurs adversaires avaient seuls le droit, non point seulement le droit actuel, mais le droit exclusif, héréditaire, féodal, de faire la loi, de décréter la chute ou le maintien de leur propre monopole.
Il fallait ou arracher à l’aristocratie la puissance législative, c’est-à-dire faire une révolution, ou la déterminer par la peur à abandonner la part du lion qu’elle s’était faite à elle-même, par l’exploitation légale des tarifs.
La Ligue résolut, dès le premier jour, de rejeter les moyens révolutionnaires. Il ne lui restait donc qu’à instruire le peuple de la vérité économique, à lui faire comprendre l’injustice dont il était victime et à lui en donner un sentiment assez vif et assez pressant pour le porter jusqu’à l’extrême limite de la légalité, et pour ainsi dire jusqu’à ce degré d’irritation au delà duquel il n’y a que convulsions sociales.
Mais, si le poids que les ligueurs avaient à soulever était énorme, si énorme qu’on comprend à peine qu’ils n’en aient pas été effrayés, il faut dire que cette difficulté même mettait en leurs mains un puissant levier. Les mots magiques : liberté, droits de l’homme, oppression féodale, venaient naturellement se placer dans la question économique, lui enlever son aridité et lui faire trouver le chemin de la fibre la plus vibrante du cœur humain. On parlait aux cœurs, on parlait même aux estomacs, car, par une coïncidence qui s’explique naturellement, il arrivait que la part de l’aristocratie terrienne dans la protection pesait sur les aliments et principalement sur le pain.
Cette situation étant donnée, on comprend les procédés de la Ligue, meetings monstres, souscriptions monstres, appels au peuple, éloquence passionnée, inscription incessante des ouvriers sur les listes électorales, enfin toute l’agitation nécessaire pour mettre aux mains d’un seul homme, Cobden, des forces populaires capables de faire capituler la puissance des whigs et des tories. Hé bien ! qu’a de commun cette situation avec la nôtre ? Si, comme les Anglais, nous avons un préjugé économique à détruire, avons-nous comme eux une puissance féodale à combattre ? Avons-nous un 89 à montrer toujours au bout de nos efforts, comme notre ultima ratio ? Non ; 89 a passé sur la France. Nous avons des pouvoirs publics qui empruntent à l’opinion la pensée de la loi ; c’est donc sur l’opinion que nous devons agir, notre mission est purement enseignante ; ce que nous demandons est ceci : Le droit de propriété est-il reconnu en France ? Avons-nous ou n’avons-nous pas la propriété de nos facultés ? Avons-nous ou n’avons-nous pas la propriété de notre travail ? Si nous l’avons, comment se fait-il que cette chose qui est le fruit de mes sueurs, cette chose que je puis consommer directement et détruire pour mon usage, je ne la puisse pas porter sur quelque marché que ce soit dans le monde, pour l’y troquer contre une autre chose qui est plus à ma convenance ; ou du moins comment se fait-il que je ne puisse pas rapporter en France cette autre chose qu’on a consenti à me donner en échange ? — Parce que, dit-on, cela nuirait au travail national. — Mais en quoi cent mille trocs de ce genre peuvent-ils jamais porter atteinte au travail national, puisque tout travail étranger que je fais entrer dans le pays implique un travail national que j’en ai fait sortir ? Je sais bien que le commerce ne se compose pas ainsi de trocs directs entre le producteur immédiat et le consommateur immédiat. Mais tout ce vaste mécanisme qu’on appelle commerce, ces navires, ces banquiers, négociants, marchands, ce numéraire, peuvent-ils altérer la nature intime de l’échange, qui est toujours troc de travail contre travail ? Qu’on y regarde de près, et l’on se convaincra qu’ils n’ont d’autre destination et d’autre résultat que de faciliter et multipliera l’infini les échanges.
Ainsi, si nous n’avons pas le levier populaire que la Ligue anglaise a mis en œuvre, il ne nous est pas nécessaire. Nous n’avons point à exalter les passions démocratiques jusqu’à les rendre menaçantes. Nous n’attaquons pas les intérêts d’un corps de législateurs héréditaires ; la seule chose que nous ayons à combattre, c’est une erreur, une fausse notion, un préjugé profondément enraciné dans les esprits, et qui développe sur sa tige ce fruit empoisonné, le monopole. Nous n’attaquons pas même spécialement telle ou telle restriction en particulier. Comme le laboureur n’arrache pas un à un tous les joncs qui infestent sa prairie, mais la saigne, et en détourne l’humidité malfaisante qui leur sert d’aliment, nous attaquons dans les intelligences le principe même de la protection qui nourrit tous les monopoles. La tâche est immense sans doute ; mais ne trouvons-nous pas de puissants auxiliaires dans les faits qui s’accomplissent autour de nous ? Les États-Unis sont sur le point d’affranchir les importations. Qui n’a lu le message du président Polk et l’admirable rapport du secrétaire Walker ? Le Zollverein suspend les réunions où devait se décider l’élévation de ses tarifs ; et que dirai-je de la grande mesure de sir Robert Peel, précédée d’expériences si réitérées et si décisives ? À ce propos, qu’il me soit permis d’exprimer ici le profond regret qu’ont éprouvé les amis de la liberté commerciale, quand ils ont vu, dans cette magnifique conception, des lacunes et des taches contraires à l’esprit de son imposant ensemble. Comment le grand homme qui a aspiré à la gloire de cette réforme n’a-t-il pas voulu que le monde, et l’Angleterre surtout, en recueillissent tout le fruit ? Pourquoi a-t-il placé dans l’exception les vins, comme pour attester qu’au moment même où il rejetait la déception de la réciprocité, il en voulait retenir quelques lambeaux ? comment surtout a-t-il enveloppé, dans les replis de ce grand document, une demande de subsides ? Oh ! si, au lieu de parler d’accroître l’armée et la marine, sir Robert Peel avait dit : « Puisque nous affranchissons les échanges, puisque nous ouvrons au monde le marché de l’Angleterre, il n’y a plus pour nous de guerre à craindre. Le jour où le bill que je vous présente recevra la sanction de notre gracieuse souveraine, j’enverrai des instructions à M. Packenham pour qu’il abandonne aux États-Unis l’Orégon contesté, l’Orégon incontesté ; et au consul d’Angleterre à Alger, pour qu’il cesse toute opposition directe ou indirecte aux vues de la France ; la suite nécessaire de cette politique nouvelle est une diminution considérable des forces de terre et de mer, et une réduction correspondante de subsides. » Si M. Peel eût tenu ce langage, qui peut calculer l’effet moral qu’il eût produit sur l’Europe ? Nous n’aurions pas besoin aujourd’hui de prouver péniblement la lumière, elle jaillirait radieuse de la réforme anglaise.
On dira, j’en suis sûr : Mais ce sont là des chimères, des rêves généreux peut-être, mais plus vains encore que généreux. — Non, ce ne sont pas des chimères. Ces conséquences sont contenues dans le principe que l’Angleterre a proclamé, et j’ose affirmer qu’il n’y a pas un ligueur qui les désavoue. Il y a un an, si quelqu’un avait prédit la réforme commerciale, on l’aurait traité de visionnaire. Et moi, je dis : L’Angleterre en a fini avec les guerres de débouchés, non par vertu, mais par intérêt ; et rappelez-vous ces paroles : Pourvu que son honneur soit ménagé, elle renoncera à l’Orégon, dont elle n’aura que faire, qui lui appartiendra toujours par droit de commerce autant et mieux que par droit de conquête. Pour moi, Messieurs, je tiens autant qu’un autre au développement du bien-être matériel de mon pays ; mais si je ne voyais clairement l’intime connexité qui existe entre ces trois choses : liberté commerciale, prospérité, paix universelle, je ne serais pas sorti de ma solitude pour venir prendre à ce grand mouvement la part que votre bienveillance m’a assignée. (V. tome VI, page 507.)
Donc l’Angleterre, les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie même, s’avancent vers l’ère nouvelle qui s’ouvre à l’humanité. La France voudra-t-elle se laisser retenir, par quelques intérêts égoïstes, à la queue des nations ? Après s’être laissé ravir le noble privilége de donner l’exemple, dédaignera-t-elle encore de le suivre ? Non, non ; le moment est venu, élevons intrépidement principe contre principe. Il faut savoir, enfin, de quel côté est la vérité. Si nous nous trompons, si l’on nous démontre qu’on enrichit les peuples en les isolant, alors, poussons la protection jusqu’au bout. Renforçons nos barrières internationales, ne laissons rien entrer du dehors, comblons nos ports et nos rivières, et demandons à nos navires, pour dernier service, d’alimenter pendant quelques jours nos foyers ! Que dis-je, et pourquoi n’élèverions-nous pas des barrières entre tous les départements ? Pourquoi ne les affranchirions-nous pas tous des tributs qu’ils se payent les uns aux autres, et pourquoi reculerions-nous devant la protection du travail local sur tous les points du territoire, afin que les hommes, forcés de se suffire à eux-mêmes, soient partout indépendants, et qu’on cultive le sucre et le coton jusqu’au sommet glacé des Pyrénées ? — Mais, si nous sommes dans le vrai, enseignons, réclamons, agitons, tant que nos intérêts seront sacrifiés et nos droits méconnus.
Proclamons le principe de la liberté, et laissons au temps d’en tirer les conséquences. Demandons la réforme, et laissons aux monopoleurs le soin de la modérer. Il est des personnes qui reculent devant l’Association parce qu’elles redoutent la liberté immédiate. Ah ! qu’elles se tranquillisent ! Nous ne sommes point des législateurs ; la réforme ne dépend pas de nos votes ; la lumière ne se fera pas instantanément, et le privilége a tout le temps de prendre ses mesures. Ce mouvement sera même un avertissement pour lui, et l’on doit le considérer comme un des moyens tant cherchés de transition. Levons-nous calmes, mais résolus. Appelons à nous Nantes, Marseille, Lyon, le Havre, Metz, Bayonne, tous les centres de lumière et d’influence, et Paris surtout, Paris qui ne voudra pas perdre le noble privilége de donner le signal de tous les grands progrès sociaux. Voulez-vous que je vous dise ma pensée ? Dans deux heures nous saurons si le mouvement ascensionnel de la protection est arrêté ; si l’arbre du monopole a fini sa croissance. Oui ! que Bordeaux fasse aujourd’hui son devoir, et il le fera, — et j’ose dire ici à haute voix : Je défie tous les prohibitionnistes et tous leurs comités, et tous leurs journaux de faire désormais hausser le chiffre des tarifs d’une obole, c’est quelque chose.
Mais pour cela, soyons forts ; et, pour être forts, soyons unis et dévoués. Ce conseil, dit-on, est tombé d’une bouche officielle : « Soyez forts, disait-elle, et nous vous soutiendrons. » Je m’en empare et je répète : « Soyons forts, et nous serons soutenus ; ne le fussions-nous pas par le pouvoir, nous le serons par la vérité. » Mais ne croyons pas que le pouvoir nous soit hostile. Pourquoi le serait-il ? Il sait bien que nous plaidons sa cause aussi bien que la nôtre. Vienne la liberté du commerce, et c’en est fait de ces obsessions protectionnistes qui pèsent si lourdement sur l’administration du pays. Vienne la liberté du commerce, et c’en est fait de ces questions irritantes, de ces nuages toujours gros de la guerre, qui ont rendu si laborieux le règne de la dynastie de Juillet.
Je ne puis me défendre d’une profonde anxiété quand je pense à ce qui va se décider bientôt dans cette enceinte. Ce n’est pas seulement l’affranchissement du commerce qui est en question. Il s’agit de savoir si nous entrerons, enfin, dans les mœurs constitutionnelles. Il s’agit de savoir si nous savons mettre en œuvre des institutions acquises au prix de tant d’efforts et de tant de sacrifices. Il s’agit de savoir si les Français, comme on les en accuse, trouvant trop longue la route de la légalité et de la propagande, ne savent poursuivre que par des moyens violents des réformes éphémères. Il s’agit de savoir s’il y a encore parmi nous du dévouement, de l’esprit public, de la vie, — ou si nous sommes une société assoupie, indifférente, léthargique, incapable d’une action suivie, et tout au plus animée encore par quelques rares et vaines convulsions. La France a les yeux sur vous, elle vous interroge ; et bientôt notre honorable Président proclamera votre réponse.
Théorie du bénéfice [26 Feb. 1846] ↩
BWV
1846.02.26 "Théorie du bénéfice" (The Theory of Profit) [*Mémorial bordelais*, 26 February 1846] [OC7.11, p. 50-53]
Théorie du bénéfice [1]
Lundi, en sortant de l’assemblée, un monsieur m’accoste et me dit : Je vous ai écouté avec attention, vous avez articulé ces paroles : « Il faut savoir enfin de quel côté est la vérité. Si nous nous trompons, qu’on pousse la protection jusqu’au bout. Si nous sommes dans le vrai, réclamons la liberté, etc., etc. » — Or, Monsieur, cela suppose que liberté et restriction sont incompatibles.
— Il me semble que cela résulte des termes eux-mêmes.
— Vous n’avez donc pas lu le Moniteur industriel ? Il prouve clairement que liberté, protection, prohibition, tout cela s’accommode fort bien ensemble, en vertu de la théorie du bénéfice.
— Quelle est donc cette théorie ?
— La voici en peu de mots. L’homme aspire à consommer. Pour consommer, il faut produire ; pour produire, il faut travailler ; et pour travailler il faut avoir en perspective un bénéfice probable, ou, mieux encore, assuré.
— Fort bien, et la conclusion ?
— La conclusion, elle est bien simple : écoutez le Moniteur ! « À quelles mesures doit avoir recours un peuple qui veut tel produit, qui cherche à arriver à la plus grande production possible, afin d’arriver ainsi, par le plus court chemin possible, à une plus grande consommation, à un plus grand bien-être ? Évidemment il doit assurer des bénéfices à quiconque entreprend telle industrie. Il doit assurer des bénéfices aux producteurs. »
— Et le moyen ?
— Écoutez encore le Moniteur : « Pour développer le plus possible le travail, tantôt la prohibition est bonne, tantôt c’est la protection, et tantôt c’est la liberté. » Vous voyez que le Moniteur industriel n’est pas plus pour la prohibition, que pour la protection, que pour la liberté.
— En d’autres termes : il faut que toute industrie gagne, de manière ou d’autre. À celle qui donne un bénéfice naturel, liberté, concurrence ; à celle qui donne naturellement de la perte, le droit de convertir cette perte en profit par le pillage organisé. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Mais vous me rappelez une scène dont j’ai été témoin ces jours-ci. Voulez-vous me permettre de la raconter ?
— J’écoute.
— J’étais chez M. le maire, lorsqu’est survenu un solliciteur industriel, et voici le dialogue que j’ai entendu.
L’Industriel. — monsieur le Maire, j’ai découvert dans mon jardin une terre rougeâtre qui m’a paru contenir du fer, et j’ai l’intention d’établir chez moi, au milieu de la ville, un haut fourneau.
Le Maire. — Vous vous ruinerez.
L’Industriel. — Pas du tout, je suis sûr de gagner.
Le Maire. — Comment cela ?
L’Industriel. — Tout simplement par le bénéfice.
Le Maire. — Où sera le bénéfice, si vous êtes forcé de vendre au cours, c’est-à-dire à 12 ou 15 francs, du fer qui vous reviendra peut-être à 100 francs, peut-être à 1,000 francs. ?
L’Industriel. — C’est pour cela que je viens vous trouver. Mettez-moi à même de rançonner vos administrés non seulement jusqu’à concurrence de mes pertes, mais encore au delà, et vous aurez assuré à mon industrie des bénéfices.
Le Maire. — Mon autorité ne va pas jusque-là.
L’Industriel. — Pardon, monsieur le Maire, n’avez-vous pas un octroi ?
Le Maire. — Oui ; et, par parenthèse, je voudrais bien qu’il fût possible d’asseoir les revenus de la ville sur un autre moyen.
L’Industriel. — Eh bien ! mettez l’octroi à mon service ; qu’il ne laisse pas une parcelle de fer passer la barrière. Les Bordelais seront bien forcés de venir acheter mon fer, et à mon prix.
Le Maire. — Tous les autres travailleurs jetteront de hauts cris.
L’Industriel. — Vous leur accorderez à tous les mêmes faveurs.
Le Maire. — Fort bien. En sorte que, comme vous aurez bien peu de fer à fournir, nous aurons aussi peu de pain, peu de vêtements, peu de toutes choses. Ce sera le régime de la moindre quantité.
L’Industriel. — Qu’importe, si nous réalisons tous des bénéfices, en nous pillant les uns les autres légalement et avec ordre ?
Le Maire. — Monsieur, voire plan est fort beau ; mais les Bordelais ne s’y soumettront pas.
L’Industriel. — Pourquoi pas ? Les Français s’y soumettent bien. Je ne demande à l’octroi que ce que d’autres demandent à la Douane.
Le Maire. — Eh bien ! puisqu’elle est si bénévole, adressez-vous à elle et ne me rompez plus la tête. L’octroi est chargé de prélever un impôt, et non de procurer des bénéfices aux industriels.
L’Industriel. — Monsieur le Maire, encore un mot. Supposez que ma requête ait prévalu il y a vingt ans ; vous auriez aujourd’hui un haut fourneau au milieu de la ville, qui ferait vivre au moins trente ouvriers.
Le Maire. — Oui, et Bordeaux serait réduit peut-être à deux mille âmes de population.
L’Industriel. — Vous comprenez que si, dans mon hypothèse, on voulait renverser l’octroi, mes trente ouvriers seraient sans ouvrage.
Le Maire. — Et Bordeaux tendrait à redevenir ce qu’il est, une splendide cité de cent mille habitants.
L’Industriel, en s’en allant. — Ce que c’est que d’avoir affaire à un théoricien ! Ne pas comprendre la théorie du bénéfice ! — Mais j’irai trouver le directeur des Douanes, et ma cause n’est pas perdue.
FN: Mémorial bordelais, du 26 février 1846. (N. E.)
Au rédacteur de l’Époque [8 mars 1846] ↩
BWV
1846.03.08 “Au rédacteur de l’Époque” (To the Editor of the Époque) [*Mémorial bordelais*, 8 mars 1846] [OC7.12, 53]
À M. le rédacteur de L’Époque [1]
Monsieur,
Permettez-moi de féliciter l’Association pour la liberté des échanges de l’attention qu’elle obtient de ses adversaires. C’est un premier succès, qui, j’espère, sera suivi de bien d’autres. Le temps n’est plus où le monopole accablait de ses mépris ou étouffait sous la conspiration du silence tout effort dans le sens de la liberté. Tout en nous prêchant la modération, vous nous en donnez l’exemple ; ce n’est pas nous qui refuserons de le suivre.
Mais, Monsieur, il s’agit ici de modération dans la forme, car, quant au fond, en conscience, nous ne pouvons pas être modérés. Nous sommes convaincus que deux et deux font quatre, et nous le soutiendrons opiniâtrement, sauf à le faire avec toute la courtoisie que vous pouvez désirer.
Il y en a qui professent que deux et deux font tantôt trois, tantôt cinq, et là-dessus ils se vantent de n’avoir pas de principes absolus ; ils se donnent pour des hommes sérieux, modérés, prudents, pratiques ; ils nous accusent d’intolérance.
« Il y a de par le monde, dites-vous, des hommes qui s’arrogent le monopole de la science économique. » Qu’est-ce à dire ? Nous avons foi en la liberté comme vous en la protection. N’avons-nous pas le même droit que vous de faire des prosélytes ? Si nous employions la violence, votre reproche serait fondé. Singuliers monopoleurs, qui se bornent à réclamer la liberté pour les autres comme pour euxmêmes ! Vous mettons-nous le pistolet sur la gorge pour vous forcer à échanger, quand cela ne vous convient pas ? Mais c’est bien par la force que les protectionistes nous empêchent d’échanger lorsque cela nous convient. Pourquoi ne font-ils pas comme nous ? pourquoi, si l’échange est aussi funeste qu’ils le disent, n’en détournent-ils pas leurs concitoyens par la persuasion ? Nous demandons la liberté, ils imposent la restriction ; et ils nous appellent monopoleurs !
Vous nous reprochez d’être des théoriciens, puis vous dites : « Les restrictions de la douane, qui sont un obstacle au développement des nations peu avancées ou de celles qui sont à la tête de la civilisation, ont été reconnues un puissant moyen d’émulation pour celles qui ont encore quelques degrés à franchir. »
En économie sociale, je ne connais rien de plus systématique, si ce n’est les quatre âges de la vie des nations imaginés par M. de Girardin ; vous vous rappelez cette bouffonnerie.
C’est dire, en d’autres termes :
L’échange a deux natures opposées. Au haut et au bas de l’échelle sociale, il est bon, il faut le laisser libre ; dans les degrés intermédiaires, il est mauvais, il faut le restreindre.
En d’autres termes encore :
Deux et deux font quelquefois trois, quelquefois cinq, quelque fois quatre. Eh bien ! Monsieur, que vous le vouliez ou non, c’est là une théorie, et, qui plus est, une théorie fort étrange ; si étrange, que vous devriez bien vous donner la peine de la démontrer. Car comment l’échange, utile à un peuple pauvre, devient-il nuisible à un peuple aisé, pour redevenir utile à un peuple riche ? Tracez-nous donc les limites exactes où s’opèrent, dans la nature intime du troc, ces étonnantes métamorphoses.
Voici le système de M. de Girardin :
Premier âge. — Importation. — (C’est le temps heureux où les peuples reçoivent sans donner.)
Second âge. — Protection. — (Alors on ne reçoit ni ne donne.)
Troisième âge. — Exportation. — (Devenu plus avisé, le peuple, pour s’enrichir, donne toujours, sans recevoir jamais.)
Quatrième âge. — Liberté. — (Chacun fait librement ses ventes et ses achats, détestable régime, dont M. de Girardin nous dégoûte, en ayant soin de nous prévenir qu’il ne convient qu’aux nations en décadence et en décrépitude, comme l’Angleterre.)
Votre système est plus simple, mais il repose sur la même idée, qui est celle-ci :
« Sous le régime de la liberté, les nations les plus avancées écraseraient les autres de leur supériorité. »
Mais cette supériorité, à quoi-se réduit-elle ?
Les Anglais ont de la houille et du fer en abondance, des capitaux inépuisables, auxquels ils ne demandent que 2 1/2 pour 100, des ouvriers habiles, disposés à travailler seize heures par jour. — Fort bien ! à quoi cela aboutit-il ? À fournir à l’ouvrier, pour 50 centimes, le couteau ou le calicot qui, sans cela, lui coûteraient 3 francs. Quel est le vrai gagnant?
— Les Polonais ont un sol fertile, qui ne coûte rien d’achat et presque rien de culture. Eux-mêmes se contentent d’une chétive rémunération, en sorte qu’ils peuvent inonder la France de blé à 8 francs l’hectolitre. — Je ne crois pas le fait, mais supposons-le vrai ; que faut-il en conclure ? Que le pain en France sera à bon marché. Or à qui profite le bon marché ? Est-ce au vendeur ou à l’acheteur ? Si c’est à l’acheteur, quelle n’est pas l’inconséquence de la loi française d’interdire à la population française l’achat du blé polonais, sur le fondement qu’il ne coûte presque rien !
On dit que le travail s’arrêterait, en France, faute d’aliment, si l’étranger était admis à pourvoir à tous nos besoins. — Oui, si les besoins et les désirs de l’homme n’étaient pas illimités. L’éternel cercle vicieux de nos adversaires est celui-ci : ils supposent que la production générale est une quantité invariable, et apercevant que, grâce à l’échange, elle sera obtenue avec une réduction de travail, ils se demandent ce que deviendra cette portion de travail surabondant.
Ce qu’il deviendra ? — Ce qu’est devenu le travail que la bonne nature a mis en disponibilité quand elle nous a donné gratuitement de l’air, de l’eau, de la lumière.
Ce qu’est devenu le travail que l’imprimerie a rendu inutile pour un nombre donné d’exemplaires d’un même livre, lorsqu’elle s’est substituée au procédé des copistes.
Ce que devient mon travail, quand le boulanger avec une heure de peine m’en épargne six ; ce que devient le vôtre, quand le tailleur vous fait, en un jour, l’habit qui vous prendrait un mois, si vous le faisiez vous-même.
La somme des satisfactions [2] restant la même, tout travail rendu superflu par l’invention ou par l’échange est une conquête pour le genre humain, un moyen d’étendre le cercle de ses jouissances.
Vous ne sauriez croire, Monsieur, combien je suis douloureusement affecté quand je viens à songer qu’une nuance presque imperceptible sépare, au moins en doctrine, les amis de la liberté de ceux de la protection. Il suffirait, pour que nous nous accordions, que ces derniers, par une petite évolution, après avoir vu, comme aux Gobelins, le revers de la tapisserie, consentissent à aller contempler sur l’autre face l’effet définitif. — Essayez : placez-vous un moment au point de vue, non du producteur, mais du consommateur ; non du vendeur, que toute concurrence importune, mais de l’acheteur, à qui elle profite. Demandez-vous si les besoins des uns sont faits pour être exploités par les autres ; si les estomacs ont été créés et mis au monde pour l’avantage des propriétaires fonciers ; si nos membres nous ont été donnés pour que monsieur tel ou tel ait le privilége de les vêtir. Mettez-vous du côté de ceux qui ont faim et froid, qui sont dénués et ignorants, et vous serez bientôt rangé sous la bannière de l’abondance, d’où qu’elle vienne.
« Quelle que soit la magie du mot liberté, dites-vous, il y a une autre idée qui exerce plus d’empire sur les populations, c’est celle des droits du travail. »
Les droits du travail ! Vous voulez dire les droits des travailleurs ? Eh bien ! parmi ces droits, ainsi que l’a dit le digne président de l’Association bordelaise, en est-il un plus naturel, plus respectable, plus sacré, que celui de troquer ce que l’on a produit à la sueur de son front ? Voyez où vous vous jetez : le droit mis en opposition avec la liberté ! le droit placé dans la restriction !
Enfin, vous nous menacez d’une coalition de producteurs.
Nous ne la craignons pas. Elle n’est pas à naître ; elle agit, elle fonctionne, elle exploite la protection. Cette entente cordiale d’intérêts divergents est un vrai miracle au sein du pays. Après tout, le pis qui puisse nous arriver, c’est qu’elle persévère, et nous avons mille chances pour qu’elle s’évanouisse.
FN: Mémorial bordelais du 8 mars 1846. (N. E.)
FN:Ici le mot satisfactions, préféré par l’auteur à consommations, montre que, longtemps avant d’écrire les Harmonies, il jugeait nécessaire d’introduire quelques modifications dans la langue de l’économie politique.(Note de l’éditeur)
Le libre-échange en action [12 mars 1846] ↩
BWV
1846.03.12 “Le libre-échange en action” (Free Trade in Action) [*Mémorial bordelais*, du 12 mars 1846] [OC7.13, p. 58]
Le libre-échange en action [1]
Monsieur le Rédacteur,
Nous avons déjà fait bien de la théorie sur la liberté commerciale. Nous en ferons encore, je l’espère ; mais voici de la liberté pratique, vivante, en chair et en os. Il ne s’agit plus de livres, d’articles de journaux, de raisonnements ; il s’agit de deux millions d’hommes placés au centre de l’Europe, pratiquant le libre échange, dans le sens le plus rigoureux du mot, c’est-à-dire se soumettant volontairement à toutes les concurrences, sans se défendre législativement contre aucune. Je crois donc utile que vous admettiez dans vos colonnes des extraits un peu étendus d’un rapport fait à la Chambre des Communes, par l’honorable représentant de Kilmarnock, sur l’état du commerce et de l’industrie en Suisse.
… « C’est une chose bien faite pour exciter l’attention de toute personne réfléchie que les manufactures suisses, presque inaperçues et entièrement privées de protection, soient graduellement parvenues à écouler leurs produits sur tous les marchés du monde, quelque éloignés et inaccessibles qu’ils parussent. Certes on ne peut attribuer un résultat aussi remarquable à la position géographique de la Suisse ; car, d’une part, elle ne produit pas les matières premières nécessaires à ses fabriques, de l’autre, elle n’a d’autres points d’expédition que ceux que les puissances voisines consentent à lui prêter, aux conditions qu’il leur plaît. Aucune de ses fabriques ne doit sa prospérité à la protection ou à l’intervention de la loi. Cependant il n’est pas moins vrai que, sans le concours des douanes pour amortir l’action de la rivalité extérieure, ses progrès sont sans exemple dans l’histoire des pays manufacturiers. Je m’attendais bien à trouver en Suisse un vivant et instructif exemple de la vérité des principes économiques réduits en pratique ; mais je ne pouvais soupçonner qu’ils avaient produit une si grande somme de contentement et de bonheur, et qu’ils eussent élevé une si grande proportion de la classe ouvrière à la dignité et au bien-être.
« S’il y a des défauts et des lacunes dans les détails que j’ai à soumettre à vos Seigneuries, j’espère qu’elles n’oublieront pas qu’il est fort difficile de recueillir les faits, dans un pays où la puissance publique n’intervient nullement dans l’industrie, où il n’existe ni douane, ni aucun système de taxes qui nécessitent des rapports officiels.»
« Dans de tels pays, les questions de consommation, d’entrée et de sortie échappent nécessairement à toute appréciation rigoureuse, quant à leur fluctuation et à leur progrès. Quoique j’aie rencontré tous les gouvernements suisses sans aucune exception, très disposés à me communiquer toutes les informations qui étaient en leur pouvoir, cependant il est toujours arrivé que les connaissances statistiques ne m’ont pas été accessibles. Mais il est impossible de se méprendre sur le mérite d’une politique dont le résultat éclate dans la satisfaction et la prospérité générales. Dans la plupart des cantons manufacturiers de la Suisse, le pouvoir législatif est, non pas indirectement, mais très directement aux mains des classes populaires. Si leur système commercial était opposé à l’intérêt commun, il ne pourrait pas subsister un seul jour ; mais il est sanctionné par l’universelle expérience et l’universelle approbation. Deux millions d’hommes, placés dans les conditions les plus désavantageuses, ont fait systématiquement l’épreuve de la liberté absolue du commerce. Les résultats incontestables sont de nature à détruire tous les doutes de l’observateur honnête et désintéressé. »
« La Suisse est très éloignée de tout grand centre commercial ; le coton qu’elle fabrique doit y être transporté, pendant des centaines de milles, de la Méditerranée ou des rivages encore plus éloignés de l’Atlantique. Elle importe la soie de la France et de l’Italie, et la laine de l’Allemagne. »
« Lorsque ses produits cherchent un marché extérieur, ils rencontrent les mêmes droits, les mêmes risques et les mêmes frais d’un transit lent, difficile et dispendieux ; il faut qu’ils traversent les montagnes du Jura ou des Alpes. Cependant, malgré ces obstacles, on les trouve sur tous les grands marchés de l’univers, et la raison en est simple : en Suisse, l’industrie est abandonnée à elle-même ; la richesse n’a point été détournée par les lois de sa tendance naturelle ; on n’y a pas vu cette lutte stupide encouragée par le gouvernement entre les monopoles du petit nombre et les intérêts des masses. Le consommateur est resté libre d’acheter au meilleur marché, comme le producteur de vendre au marché le plus élevé, et la situation actuelle de l’industrie suisse, ainsi que son avenir, examiné dans ses détails, auront quelque influence sur les personnes auxquelles les principes de la liberté commerciale sont antipathiques.
« On aurait pu s’attendre à ce que le régime prohibitif, par lequel les États circonvoisins ont défendu leurs frontières, eût jeté l’alarme parmi les manufacturiers suisses et les eût entraînés à chercher des alliés commerciaux, en adoptant une législation semblable, faussement appelée protectrice ; mais telle n’a pas été la tendance de l’opinion, ni les enseignements de l’expérience en Suisse. Plusieurs des manufacturiers les plus éclairés m’ont assuré que quoiqu’ils aient été fort alarmés en 1814 par les grands changements politiques de cette époque, et fort désireux de contracter des arrangements avec d’autres puissances, basés sur la réciprocité, ils étaient maintenant convaincus que la politique du libre échange et du libre transit était la plus sage et la meilleure. Malgré les désavantages naturels des cantons suisses, à raison de leur position géographique, je suis persuadé qu’il n’existe pas dans le monde une industrie manufacturière plus saine, plus vigoureuse et plus élastique que celle de ce pays. Quoique, d’un côté, elle soit un objet de terreur pour les intérêts protégés des manufacturiers français, quoique les marchés d’Allemagne et d’Italie se resserrent de plus en plus pour elle, continuellement elle gagne du terrain et fait des progrès vers de nouvelles régions. La consommation qu’elle trouvait autrefois en Europe est maintenant dépassée de beaucoup par celle des États transatlantiques, et la Suisse, en persévérant courageusement dans sa politique intelligente, a établi ses manufactures sur la large et inébranlable base de la production à bon marché. En traversant les différents districts, j’ai constamment rencontré des marchands et des manufacturiers qui avaient noué des relations avec les contrées les plus éloignées du globe. Ils m’ont assuré qu’ils étaient maintenant dégagés des anxiétés que leur avaient fait éprouver les lignes de douane dont la France, l’Allemagne et l’Italie avaient entouré leurs frontières ; qu’en fait ils étaient indépendants de la politique étroite et égoïste qui avait créé les tarifs de tant de nations européennes ; que ces tarifs mêmes les avaient forcés d’explorer des champs plus vastes, et où leurs capitaux ainsi que tous leurs moyens de production trouvaient un emploi illimité. »
« En 1820, la Diète suisse, au sein de laquelle des réclamations énergiques s’étaient produites contre les mesures prohibitives du Gouvernement français, essaya, par voie de représailles, d’introduire le régime protecteur dans la législation du pays. En réalité, il n’eut que quelques mois d’existence, et les obstacles à la liberté des communications succombèrent graduellement sous la pression de l’opinion publique et l’instinct des intérêts bien entendus. Il n’est aucun sujet sur lequel j’aie trouvé une telle communauté de sentiments que celle qui existe à l’égard des bienfaits que la liberté commerciale a répandus sur le pays. Même parmi les industriels qui, en apparence, auraient été les plus intéressés à la protection et à la prohibition, plusieurs avouaient que leurs opinions étaient changées. Un certain nombre de fabricants, qui d’abord avaient été les ardents promoteurs des droits de douane sur les produits étrangers, et se considéraient comme ayant un droit exclusif à la consommation nationale, notamment quand les États voisins repoussaient leurs propres produits, étaient maintenant convaincus par l’expérience que leurs vues avaient été erronées, et que leurs établissements avaient acquis une force et une solidité qu’une législation prohibitive n’aurait jamais pu leur donner. L’un des principaux filateurs disait : Dans tous les magasins, dans toutes les boutiques du pays, les produits anglais et français sont étalés côte à côte avec les nôtres ; ils n’ont payé aucun droit ; les nôtres n’ont reçu aucune protection ; et quelque insignifiants qu’aient été nos premiers essais, quelque restreints qu’aient été nos débouchés, le Gouvernement crut devoir nous refuser une main secourable et nous forcer à aviser pour nous-mêmes. Cependant, en dépit de la terrible concurrence du capital britannique et du goût français, nous avons réussi. L’histoire du dernier siècle n’est pour nous que l’histoire de nos progrès. Malgré tous les obstacles, faibles comme nous sommes, sans aucun port d’expédition que ceux que nous tenons du bon plaisir de nos voisins, nos articles se sont fait jour et se débitent dans les quatre coins du monde. »
Les réflexions se présentent en foule à la lecture de ce rapport. On pourrait demander aux protectionistes : Où sont donc les invasions, les inondations de produits étrangers qui eussent dû tuer le travail national en Suisse ? On pourrait faire bien d’autres questions encore. J’aime mieux laisser à ce précieux document toute la force qu’il porte en lui-même.
FN: Mémorial bordelais, du 12 mars 1846. (N. E.)
Qu’est-ce que le commerce ? [1 avril 1846] ↩
BWV
1846.04.01 “Qu'est-ce que le commerce?” (What is Commerce?) [*Courrier français*, 1er avril 1846] [OC7.14, p. 63]
Qu’est-ce que le commerce ? [1]
L’argument qu’il est de mode aujourd’hui d’opposer à la liberté des échanges a été porté à la tribune nationale par M. Corne. C’est celui-ci :
« Attendons, afin de pouvoir lutter avec l’étranger à armes égales, que nous ayons autant que lui de capitaux, de fer, de houille, de routes, et alors nous affronterons les périls de la concurrence. »
Ceci implique que le bon marché auquel l’étranger peut nous livrer certains produits est justement le motif pour lequel on nous défend de les acheter.
Là-dessus je me demande : Qu’est-ce que le commerce ? Une chose est à meilleur marché dans tel pays étranger qu’en France ; est-ce une raison pour nous abstenir de commercer avec ce pays ? ou bien est-ce un motif de commercer avec lui le plus tôt possible ?
Si les monopoleurs ne s’en mêlaient pas, la question serait bientôt résolue. Non-seulement les négociants décideraient que c’est là un motif suffisant pour déterminer le commerce, mais encore que c’est le motif unique, qu’il n’y en a pas d’autre possible, ni même imaginable.
Mais ces messieurs raisonnent autrement, en fait de commerce, que les commerçants. Ils disent : Ce qui est plus cher au dehors qu’au dedans, laissons-le entrer librement ; et ce qui est à meilleur marché, repoussons-le de par la loi.
Il est possible que le principe absolu de la prohibition ne soit pas dans les actes de ces législateurs, mais il est très certainement dans leur exposé des motifs.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ.
M. Corne a mis l’égalité en opposition avec la liberté.
Cela seul devrait l’avertir qu’il y a un vice radical dans sa doctrine. En tout cas, une chose m’étonne : comment ose-t-on prendre sur soi d’opter, quand on a le malheur de croire que la liberté et l’égalité sont incompatibles ?
M. Corne a opté, néanmoins ; et, réduit à sacrifier l’une ou l’autre, c’est la liberté qu’il immole.
La liberté ! mais c’est la justice !
Pierre rencontre Paul, et lui dit : « Mon ami, je fais de la toile, et je vous en vendrai, pourvu que vous me permettiez de mettre la main dans votre poche et d’en retirer un prix qui me satisfasse. » — Paul répond : « Ne prenez pas cette peine, je sais quelqu’un qui me donnera de la toile à moitié prix. » — De quel côté est le bon droit ? — La loi tranche la question en mettant au service de Pierre la baïonnette du douanier.
Qu’y faire ? dites-vous : la justice et la liberté sont d’un côté ; l’égalité et la prospérité, de l’autre ; il faut choisir.
Triste alternative, ou plutôt dérisoire blasphème. Non, il n’est pas vrai qu’il y ait entre le juste et l’utile un irrémédiable conflit. Cette doctrine contredit les faits autant qu’elle choque la raison.
Car enfin qui protégez-vous ? Celui qui élève des bestiaux, aux dépens de ceux qui mangent de la viande ; celui qui a obtenu des concessions houillères ou qui possède des forêts, au détriment de ceux qui ont besoin de faire cuire leurs aliments ou de réchauffer leurs membres engourdis ; le petit nombre, au préjudice du grand nombre.
Vous parlez de la classe ouvrière. Et quel est le langage que tient le monopoleur au charpentier, au maçon, au cordonnier, à cette innombrable famille d’artisans auxquels la douane n’a aucune compensation à donner ? Le voici :
« Il vous faut du pain, du vin, des vêtements, du feu, du fer. Prenez une bêche, et si vous trouvez un coin de terre inoccupé, labourez-le ; semez-y du blé, du lin et du gland ; plantez-y de la vigne, cherchez-y du minerai, faites-y paître vos troupeaux, et rien ne vous manquera. »
« Hélas ! dit chaque ouvrier, votre conseil est excellent, mais je ne puis le suivre. Heureusement que j’ai des bras. Je puis tailler la pierre, ou manier la hache et pousser le rabot. On me payera, et avec mon salaire j’achèterai les objets nécessaires au maintien de mon existence. »
Mais alors, dit à chacun le monopoleur : « Pain, bois, viande, laine, je te forcerai de l’acheter à ma boutique, ainsi que ta truelle, ta hache et ton rabot. J’ai même fait une loi pour que tu n’en obtiennes que le moins possible en échange de ton labeur. »
Et puis il ajoute : « Tu n’es pas libre, — mais que l’égalité te console ! »
FN: Courrier français du 1er avril 1846. (N. E.)
À M. le ministre de l’agriculture et du commerce [6 avril 1846] ↩
BWV
1846.04.06 “À M. le ministre de l’agriculture et du commerce” (To the Minister of Agriculture and Commerce) [*Mémorial bordelais*, du 6 avril 1846] [OC7.15, p. 66]
À M. le ministre de l’agriculture et du commerce [1]
Monsieur le Ministre,
Lorsque vous êtes monté à la tribune pour proclamer la politique commerciale du cabinet, nous nous attendions à ce que vous vous prononceriez sur cette question : En matière d’échanges, la restriction vaut-elle mieux que la liberté ?
Si, après avoir reconnu que la restriction est un mal, qu’elle implique nécessairement fausse application de travail humain et déperdition de services naturels, qu’elle équivaut, par conséquent, à une limitation de force, de richesse, de bien-être et de puissance, vous eussiez ajouté : « Néanmoins, nous ne proposons pas l’abolition du régime restrictif, parce que l’opinion publique le soutient, et que, sous un gouvernement représentatif, la conviction ministérielle doit céder devant la volonté nationale, » — nous comprendrions ce langage. Il nous ferait entrevoir que le ministère sympathise avec les associations qui se forment pour propager les saines doctrines économiques et pour contre-balancer l’influence, jusqu’ici prépondérante, des coalitions protectionistes.
Si vous aviez dit encore :
« Alors même que la majorité apercevrait la funeste déception qui est au fond du régime protecteur, de ce régime qui voit un profit national dans tout ce que les industries s’arrachent les unes aux autres, il n’en est pas moins vrai qu’il a créé un état de choses artificiel, que le Gouvernement ne peut détruire sans ménager la transition, sans préparer surtout des ressources aux ouvriers déclassés ou hors d’état d’entreprendre de nouvelles carrières, » — nous vous comprendrions assurément, et nous nous féliciterions d’apprendre que le cabinet a un but vers lequel il est prêt à marcher.
Mais tel n’a point été votre langage, et nous vous avons entendu, avec regret, attaquer l’échange dans son principe.
Car vous avez dit formellement que la protection ne doit se relâcher qu’à mesure que l’indusirie nationale peut lutter à armes égales contre l’industrie étrangère.
Ce qui équivaut à ceci : tant qu’une différence dans le prix de revient déterminerait l’échange international, il sera interdit. Nous le permettrons sitôt qu’il cessera d’être utile.
Or c’est bien là le condamner dans sa seule raison d’être.
« En Angleterre, dites-vous, le fer et la houille se trouvent en abondance, presque partout ; dans les mêmes localités, les moyens de transport vers l’intérieur et vers la mer, par les rivières, les canaux et les chemins de fer, sont multipliés et faciles, les ports et les rades sont en grand nombre, sûrs et dans le meilleur état… Les capitaux et les moyens de crédit surabondent, d’immenses établissements industriels ont presque tous racheté leur mise de fondation, etc. »
Voilà certes bien des avantages naturels et acquis. Ne serions-nous pas heureux que les Anglais nous les cédassent gratuitement ?
Et c’est ce qui arriverait par la liberté des échanges. Car en quoi se résument ces avantages ? — En bon marché. — Et à qui profite le bon marché ? — À l’acheteur. — Donc laissez-nous acheter.
Si l’on cherche la cause de la modicité du prix auquel les Anglais livrent leur fer et leur houille, on trouve qu’elle provient de ce que les avantages que vous énumérez concourent gratuitement à la création de ces produits. Les Anglais, comme dit M. Lestiboudois, se contentent de retirer un intérêt fort abaissé de leurs capitaux ; leurs ouvriers livrent beaucoup de travail contre peu de salaire ; et quant à la sûreté des rades, la facilité des routes, l’abondance et la proximité du combustible et du minerai, tout cela ils le donnent par-dessus le marché. C’est une coopération très effective, qui pourtant n’entre pour rien dans le prix ; c’est un don gratuit fait au consommateur, si celui-ci n’avait pas la folie de le repousser.
Tel est le bénéfice de l’échange, non seulement dans ce cas particulier, mais dans tous les cas imaginables. Il rend l’acheteur participant des avantages naturels dont le vendeur n’est qu’en possession apparente. Je dis plus, celui-ci n’en est que le dépositaire, le dispensateur ; et c’est celui-là qui en recueille tout le fruit. Par le bon marché du sucre, l’avantage de la haute température des tropiques est véritablement conféré aux Européens ; par le bon marché du pain, l’avantage d’une chute d’eau est réellement conféré à ceux qui le consomment.
Lors donc qu’avec MM. Corne et Lestiboudois vous avez dit : « Attendons, pour proclamer la liberté, de pouvoir lutter avec les Anglais, à armes égales, » — vous avez condamné radicalement les échanges, puisque votre proposition implique qu’ils doivent être interdits précisément par le motif même qui les détermine.
Vous dites que « la marche suivie par l’Angleterre n’est pas un hommage rendu à la théorie absolue de la liberté commerciale ; que l’Angleterre retire la protection à celles de ses industries qui peuvent s’en passer ; qu’elle se fait enfin libérale là seulement où elle n’a rien à craindre du régime libéral. »
De telles assertions, répétées par un grand nombre d’orateurs et de journaux, ont lieu de nous surprendre. Elles seraient incontestables, si M. Peel se fût borné à réduire les droits sur la houille, le fer, les tissus de lin et de coton. Mais à quoi l’Angleterre a-t-elle ouvert ses ports ? Aux céréales, aux bestiaux, au beurre, aux fromages, aux laines. Or, dans des idées restrictives, n’avait-elle pas autant de motifs pour repousser ces choses que nous pouvons en avoir pour repousser la houille et le fer ?
Qu’invoquaient les propriétaires et les fermiers anglais pour demander le maintien de la protection ? L’élévation du prix des terres et de la main-d’œuvre, l’infertilité du sol, la pesanteur des taxes, l’impossibilité, par ces motifs, de soutenir la concurrence étrangère. — Et que leur a répondu le cabinet ? — Toutes ces circonstances se traduisent en cherté des aliments, et la cherté, qui arrange le producteur, mais qui nuit au consommateur, nous n’en voulons plus. — Et ce n’est point là un hommage rendu à la théorie du libre échange !
Qu’invoquent nos actionnaires de mines et de forges pour perpétuer la protection ? La difficulté des transports, la distance qui sépare le combustible du minerai, l’impossibilité par ces motifs de soutenir la concurrence étrangère.
Et que leur répondez-vous ? — Toutes ces circonstances se traduisent en cherté de la houille et du fer, et la cherté, qui nuit au consommateur, mais qui arrange le producteur, nous la maintiendrons.
Vous pouvez bien croire que l’Angleterre se trompe, mais vous ne pouvez pas dire qu’elle agit selon votre principe.
Vous ajoutez, il est vrai, qu’elle a tiré du régime prohibitif tout le parti qu’on en peut tirer. — Ceci suppose que c’est un bon instrument de richesses, et même c’est sur lui que vous comptez pour porter notre marine, notre industrie et nos capitaux au niveau de ceux de nos voisins.
Mais c’est là la question. Il s’agit de savoir si capitaux, marine, industrie, ne grandiraient pas plus vite par le travail et l’échange libres que par le travail et l’échange contrariés.
Vous affirmez que la protection, qui, selon vous, a porté si haut la puissance anglaise, produit chez nous des effets aussi grands que rapides.
En ce cas, il n’y a rien à faire, si ce n’est de la renforcer ; et nous pourrions être surpris que vous annonciez un projet de loi qui adoucira nos tarifs.
Nous aimons mieux nous en féliciter et vous venir en aide dans la sphère où il nous est donné d’agir.
Vous méditez une réforme. Mais personne, assurément, n’est plus en mesure que vous de savoir combien vous rencontrerez de résistances, non seulement dans les intérêts alarmés, mais encore dans une opinion publique sincère, mais égarée. Voulez-vous un point d’appui ? Nous vous l’offrons. — Depuis longtemps, grâce à la puissance de l’association, l’école protectioniste se fait seule entendre en France. C’est aussi au moyen de l’association que nous voulons donner une voix à l’école libérale. Soyez neutre. Nous propagerons le principe de la liberté pendant que d’autres prêcheront le principe de la protection. La vérité jaillira du débat. Et si nous parvenons à faire prévaloir notre doctrine dans l’esprit public, quelle vaste perspective s’ouvre devant nous ! La douane, rendue à sa destination essentielle, versera certainement cent millions de plus au trésor ; la paix, solidement établie, vous permettra certainement aussi de retrancher cent millions au budget de la guerre. Avec un excédant de deux cents millions, que de grandes choses ne pouvez-vous pas entreprendre ! Que d’impôts onéreux ou impopulaires ne pouvez-vous pas dégréver ! Oui, si la liberté commerciale est en elle-même une grande et magnifique réforme, elle est le point de départ de réformes plus grandes et plus magnifiques encore, bien dignes d’éveiller une noble ambition dans le sein d’un cabinet auquel on reproche, avec quelque raison, une immobilité dont le pays s’étonne, et dont il commencera bientôt peut-être à se lasser.
FN: Mémorial bordelais, du 6 avril 1846. (N. E.)
À monsieur le rédacteur duCourrier français [11 avril 1846] ↩
BWV
1846.04.11 “À monsieur le rédacteur du *Courrier Français*” (To the Editor of the *Courrier français*) [*Courrier français*, 11 avril 1846] [OC7.16, p. 71]
À monsieur le rédacteur du Courrier Français [1]
J’aie toujours trouvé fort hardi, presque impertinent, l’usage d’attribuer le langage d’un journal au personnage qu’on suppose en être le patron, et de se servir de ces locutions : M. Guizot dit ; — M. Thiers affirme ; — M. de Metternich nous répond, — et cela à propos d’un premier Paris dont il est plus que probable que ces illustres patrons n’ont eu aucune connaissance. Ce n’est pas que j’aie la simplicité d’ignorer, tout villageois que je suis, les liens qui attachent certaines feuilles à certains hommes politiques ; mais, je le répète, la formule banale dont je parle me semble renfermer une double insulte ; elle dit au patron qu’on interpelle : Tu n’as pas le courage d’avouer tes paroles ! — et au client supposé : Tu n’es qu’un commis à gages !
Aussi je me garderai de faire remonter à M. Thiers la responsabilité de l’article qui a paru hier dans le Constitutionnel, sur ou contre la liberté des échanges. Et pourtant, quand on voit ce manifeste suivre de si près celui du Journal des Débats, et ces deux feuilles élever bannière contre bannière, ne peut-on pas supposer, sans sortir du domaine des conjectures permises, que M. Thiers et M. Guizot ont transporté leur lutte sur le terrain de la réforme commerciale ?
S’il en est ainsi, on ne peut pas féliciter M. Thiers du rôle qu’il a pris. — Se placer dans les idées rétrogrades, planter sa tente au milieu du camp des monopoles, chercher la force dans la sympathie des intérêts égoïstes, c’est assurément manquer de tact ; c’est engager la partie avec des chances, peut-être actuellement favorables, mais qui, de leur nature, doivent aller toujours s’amoindrissant ; c’est abandonner à son adversaire des auxiliaires puissants : la liberté, la vérité, la justice, l’intérêt général et le développement naturel de la raison publique.
Mais laissons là le champ des conjectures, et, sans nous occuper des ressorts plus ou moins problématiques qui agissent sur le journalisme, examinons en lui-même l’article du Constitutionnel.
La première erreur où tombe cette feuille, c’est de supposer que les associations qui se forment pour la défense de la liberté, en matière d’échanges, aspirent à supprimer la douane, et qu’elles attribuent cette portée à la réforme de sir Robert Peel.
« À lire la plupart des appréciations de la mesure de sir Robert Peel, et quand on ignore les conditions d’existence mercantile de la Grande-Bretagne, on est tenté de croire que, sous peu, il n’y aura plus chez nos voisins, ni taxes à l’entrée, ni douanes. C’est, il faut le dire, une illusion bien naïve ; car, malgré les réformes, le gouvernement anglais s’arrange de manière à retirer encore des douanes un revenu de 450 à 500 millions de francs. Malgré les réformes, il n’y aura pas un douanier de moins sur cette vaste étendue de côtes ; malgré les réformes, le métier de smuggler sera encore très lucratif ; malgré les réformes, enfin, le tabac, le thé, les eaux-de-vie, les vins continueront à être frappés de taxes tellement exorbitantes, qu’on chercherait en vain dans les tarifs des autres peuples des droits aussi élevés sur les mêmes articles. Si vous appelez cela de la liberté commerciale, il faut avouer que vous êtes faciles à contenter et que vous êtes d’excellente composition pour l’application des principes. »
Oui, nous sommes d’excellente composition avec le fisc, dont, en tant qu’association, nous ne nous occupons pas. Mais nous sommes moins faciles à l’égard de la protection, avec laquelle, je l’espère, nous ne transigerons jamais.
Au moment où beaucoup de bons esprits sentent la nécessité de s’unir pour la propagation des saines doctrines économiques, nous croyons utile d’insister sur cette distinction fondamentale et de fixer, de manière à ce qu’on ne puisse plus s’y méprendre, le vrai caractère des associations qui se forment. — Nous n’avons pas besoin de dire que nous n’exprimons ici que notre opinion personnelle.
Napoléon a dit : « La douane n’est pas seulement un instrument fiscal, elle doit être encore et surtout un moyen de protéger l’industrie. » Prenant le contre-pied de cette sentence, nous disons : « La douane ne doit pas être un moyen de protéger l’industrie et de restreindre les échanges ; mais elle peut être un moyen comme un autre de prélever l’impôt. » Là est toute la pensée de l’Association. Elle ne doit pas, elle ne peut pas être ailleurs.
Nous ferons encore connaître son esprit et sa portée par une autre opposition.
Sous le titre de Comité central pour la défense du travail national, une société s’est formée en France, et son objet avoué est d’exploiter l’institution des douanes, non seulement au détriment du public consommateur, mais au détri- ment du fisc lui-même.
L’Association pour la liberté des échanges a pour mission de propager le principe directement opposé à celui du Comité central.
Elle réclame pour tout Français, en ce qui ne blesse ni d’ordre public ni les bonnes mœurs, la plénitude du droit de propriété, lequel implique la faculté d’opter entre la consommation et l’échange.
Elle demande que la liberté d’acheter au dehors soit reconnue et garantie aussi bien que la liberté de vendre au dehors, d’autant plus que ce qui restreint l’une limite nécessairement l’autre.
De ce que l’association réclame pour tous les produits le libre passage de la frontière, il ne s’ensuit pas qu’elle s’oppose à ce qu’une taxe fiscale les atteigne soit à l’entrée soit à la sortie. Sans renoncer à discuter accessoirement l’opportunité et la quotité de ces taxes, il suffit quelles soient calculées exclusivement dans un but de fiscalité, pour qu’elles sortent de la compétence de l’Association. Elle ne s’attaque pas au fisc, mais à la protection. Elle s’élève contre le système qui consiste à exagérer le droit, même au préjudice du trésor, dans le but avoué d’élever le prix d’une denrée, afin d’accroître, aux dépens du consommateur, la rémunération naturelle du producteur. Elle soutient que c’est là une violation de la propriété et une usurpation commise par la loi.
Ici se présente une difficulté que je crois devoir aborder ouvertement, car, d’un côté, sous peine d’introduire la dissension dans son sein, l’Association ne doit pas se laisser entraîner à poursuivre des réformes, quelque séduisantes qu’elles paraissent, qui ne sont pas dans son principe ; et d’une autre part, il importe qu’on sache bien au dehors où elle commence, où elle s’arrête, quelle est la sphère de son activité et le terme précis de ses prétentions.
Nous l’avons déjà dit, un droit de douane peut être soit fiscal, soit protecteur. Malheureusement il peut être aussi, et il est presque toujours à la fois l’un et l’autre. Il est fiscal quand la charge qu’il impose au public profite tout entière au trésor, c’est-à-dire au public lui-même. Tels sont les droits sur le thé et les autres denrées qui n’ont pas de similaires dans le pays. En ce cas, pas de difficulté, l’Association ne s’en mêle pas. De tels droits peuvent être fort différemment appréciés, et, à cet égard, l’opinion de chaque sociétaire est réservée. Mais enfin c’est une question d’impôt ; la protection n’y est pour rien, et l’Association non plus. Pour le dire en passant, on voit combien le Constitutionnel s’est mépris quand, pour prouver que la réforme anglaise est tout ce qu’il y a de plus vulgaire, il cite précisément les taxes qu’elle a laissées subsister sur les denrées de cette catégorie. Il ne voit pas que c’est en cela que consiste tout le libéralisme de la mesure.
Le droit est exclusivement protecteur quand il empêche l’importation de la marchandise étrangère, comme dans les cas de prohibition ou de droits prohibitifs. — Dans ce cas encore, pas de difficulté. C’est là l’abus contre lequel l’Association s’est formée ; sa tâche est de démontrer que d’une telle mesure, généralisée et réduite en système, résulte pour tout Français interdiction de tirer tout l’avantage possible de son travail, contrainte de s’adresser à un vendeur plus malhabile ou moins bien situé. Ici, l’acheteur n’acquitte pas une taxe au trésor, dont il profite comme citoyen ; il paye un excédant de prix qui ne lui reviendra sous aucune forme ; il subventionne une industrie privilégiée ; il est soumis à une extorsion ; il est dépouillé sans compensation d’une partie de sa propriété ; il travaille pour autrui et, dans une certaine mesure, sans rémunération ; il est esclave dans toute la rigueur du mot, car l’esclavage consiste non dans la forme, mais dans le fait d’une spoliation permanente et légale. — C’est ce régime que l’Association veut détruire.
Mais on nous dit : Vous admettez un droit fiscal. Or, chaque fois qu’un produit étranger a un similaire au dedans, est-il possible de le frapper d’un droit, même fiscal, qui n’élève le prix vénal de ce produit et n’agisse, par conséquent, comme droit protecteur ?
Voici, dans ce cas, comment il me semble que l’Association doit comprendre l’application de son principe.
Chaque fois qu’un droit est arrivé à cette limite inférieure, au-dessous de laquelle il ne pourrait descendre, sans compromettre d’une manière permanente le revenu qu’en tire le trésor, on peut dire qu’il est essentiellement fiscal et involontairement protecteur. C’est à cette limite que l’action de l’Association doit s’arrêter, parce que tout ce que l’on pourrait discuter au delà serait une question d’impôt.
Ainsi, par exemple, si l’on abaissait successivement le droit sur les fers à 20, 15 et 10 pour 100, cherchant, sans se préoccuper aucunement de nos forges, le point où il donne le plus gros revenu possible, c’est-à-dire où il entre le plus de fer possible sans nuire au trésor, — je dis qu’à cette limite le droit devrait être considéré comme fiscal et soustrait aux discussions de nos assemblées. Ce n’est pas à dire que cet impôt, comme impôt, fût à l’abri de toute objection. Il resterait à savoir s’il est d’une bonne administration de renchérir le prix du fer. Mais cette considération rentre dans les questions générales relatives à toute contribution publique. Elle se présente aussi bien à propos du sel et du port des lettres qu’au sujet des douanes. Elle sort de la compétence de l’Association, parce que l’Association ne discute pas les impôts, même mauvais ; elle n’a qu’un but : le renversement du système protecteur.
Il ne faut pas se le dissimuler, cette déclaration ouvre une brèche au monopole. À chaque abaissement du tarif, il s’écriera : « Arrêtez ! non dans mon intérêt, mais dans celui du trésor. »
C’est un inconvénient ; mais ce serait bien pis si l’Association ignorait ce qu’elle veut et à quoi elle tend. Quand une difficulté résulte de la nature des choses, il n’y a nul avantage à fermer les yeux pour se la dissimuler à soi-même.
Je sais que beaucoup de personnes ont de la peine à admettre cette distinction. Elles voient, dans toute restriction douanière, alors même qu’elle a un but fiscal, une atteinte à la liberté des échanges, et elles en concluent que l’Association désavouerait son propre titre, si elle se bornait à combattre le système protecteur.
Mais une taxe n’infirme pas plus le principe de la liberté commerciale, qu’un impôt n’infirme le principe de la propriété. Si l’Association voulait intervenir dans les questions que peuvent soulever, à propos de tous les cas particuliers, l’opportunité, la quotité, la forme, l’assiette ou la perception des contributions publiques, elle n’aurait aucune chance de durée, car les avis y seraient bientôt partagés ; — et à une institution de cette nature, ce n’est pas la majorité qu’il faut, c’est l’unanimité.
Entre associés, il n’y a qu’un lien possible : la communauté du principe. — Pas de protection ! Voilà notre mot de ralliement. — Que le législateur ramène le tarif à sa destination originaire, qui est de prélever sur tous une taxe qui profite à tous. Mais nous ne voulons pas de taxes qui, sans rentrer au trésor, pèsent sur le grand nombre pour profiter au petit nombre. Attachons-nous à ce principe, ne nous en laissons jamais séparer. C’est un rocher inébranlable qui repose sur deux bases éternelles : la justice et la vérité.
FN: Courrier français du 11 avril 1846. (N. E.)
La Tribune et la Presse, à propos du traité belge [avril 1846] ↩
BWV
1846.04.15 “*La Tribune* et *la Presse*; à propos du traité belge” (To *La Tribune* and *La Presse* on the Question of the Treaty with Belgium) [*Journal des Économistes*, avril 1846] [OC2.16, p. 81]
La Tribune et la Presse, à propos du traité belge
Journal des Économistes, avril 1846.
Voici quelque chose de nouveau, — ce que les Anglais appellent a free-trade debate, — une joute entre deux principes, la liberté et la protection. — Pendant bien des années, les chefs de la Ligue ont provoqué, au sein des Communes, de semblables discussions. Sûrs d’être défaits, ils ne regardaient pas comme inutiles ces longues et laborieuses veilles où s’élaborait cette reine du monde, l’opinion ; — l’opinion qui assure enfin leur victoire. Pendant ce temps-là, il ne se fût pas trouvé chez nous un député assez audacieux pour articuler cette impopulaire expression : un principe. L’inattention, le dédain, la raillerie, peut-être quelque chose de pis, eussent prouvé au téméraire qu’il est des époques où, si l’on n’est pas sceptique, il faut du moins le paraître, et où quiconque croit à quelque chose n’est propre à rien.
Enfin, voici venir l’ère des discussions théoriques, les seules, il faut le reconnaître, qui grandissent les questions, éclairent l’esprit public. La protection et la liberté se sont prises corps à corps, à propos du traité belge. — Je dis à propos, car il était le prétexte plutôt que le sujet du débat. Chacun savait d’avance que le projet ministériel ne rencontrerait pas d’opposition sérieuse au scrutin.
Nous n’avons donc pas à l’examiner, et nous nous bornerons à une remarque. En toutes choses, il est un signe auquel le progrès se fait reconnaître : c’est la simplification. S’il en est ainsi, rien de plus rétrograde que le traité belge, car il complique d’une manière exorbitante l’action de la douane. La voilà donc chargée, non-seulement de constater la valeur des objets importés pour prélever une taxe proportionnelle, mais, si c’est du fil, de s’assurer de son origine ; de lui ouvrir ou de lui fermer certains bureaux ; de lui appliquer, selon l’occurrence, ou le droit de 25 pour 100, ou celui de 11 pour 100, ou ce dernier augmenté de la moitié de la différence, ou bien encore des trois quarts de la différence. — Et si c’est de la toile ? Oh ! alors viennent de nouvelles complications : on comptera le nombre des fils contenus dans l’espace de cinq millimètres, sur quatre points différents du tissu, et la fraction de fil ne sera prise pour fil entier qu’autant qu’elle se trouvera trois fois sur quatre.
Et tout cela, pourquoi ? De peur que le bon peuple de France ne soit inondé de mouchoirs et de chemises, malheur qui arriverait assurément, si la douane se bornait à recouvrer le revenu de l’État.
Non, la vérité ne saurait être dans ce dédale de subtilités. On a beau dire que nous sommes absolus. Oui, nous le sommes, et nous disons : Si le public est fait pour quelques producteurs, nos adversaires ont raison et il faut repousser les produits belges ; s’il s’appartient à lui-même, laissez-le se pourvoir comme il l’entend.
J’ajouterai une observation plus grave. Les traités de commerce sont toujours et nécessairement contraires aux saines doctrines, parce qu’ils reposent tous sur cette idée que l’importation est funeste en soi. Si on la croyait utile, évidemment on ouvrirait ses portes, et tout serait dit.
Ils ont de plus l’inconvénient d’éveiller l’hostilité de tous les peuples, hors un. — Je veux bien acheter des vins, pourvu qu’ils ne soient pas français. — Voilà le traité de Méthuen. — Je veux bien acheter des toiles, pourvu quelles ne soient pas à bon marché, c’est-à-dire anglaises. — Voilà le traité belge. — Quand notre siècle sera vieux, je crains bien qu’il ne dise : À quarante-six ans, dans mon âge mûr, j’étais encore bien novice.
Mais laissons la douane, et ses fils, et ses fractions de fils, et ses moitiés et ses quarts de différence ; et passons à la lutte des doctrines, seule chose qui, dans cette discussion, ait une importance réelle.
M. Lestiboudois a ouvert la brèche avec sa théorie de l’an passé. Vous la rappelez-vous ? — « Le commerce extérieur ruine une nation qui achète avec ses capitaux des objets de consommation fugitive. »
Avec ou sans commerce, on se ruine quand on dépense plus qu’on ne gagne, ce que font les gens paresseux, désordonnés et prodigues. En quoi la douane y peut-elle quelque chose ? Si, cet été, il plaisait à Paris de se croiser les bras, de ne rien faire, si ce n’est boire, manger et s’ébattre ; si, après avoir dévoré ses provisions, il s’en procurait d’autres en vendant, dans les provinces, ses meubles, ses bijoux, ses instruments, ses outils, et jusqu’à son sol et ses palais, il se ruinerait à coup sûr. Mais remarquez ceci : ses vices étant donnés, loin qu’il pût imputer sa ruine à ses relations avec les provinces, ce sont ces relations qui retarderaient le jour de la souffrance et du dénûment. — Tant que la France sera laborieuse et prévoyante, ne craignons pas que le commerce extérieur lui enlève ses capitaux. — Que si jamais elle devient fainéante et fastueuse, le commerce extérieur la fera vivre plus longtemps sur ses capitaux acquis.
M. Ducos est venu ensuite. Il a déployé du talent. Mais ce n’est pas ce dont il faut le plus le louer. Sachons apprécier surtout son courage et son désintéressement. Il faut du courage pour faire retentir le mot liberté au sein d’une Chambre et en face d’un pays presque exclusivement hostiles. Il faut du désintéressement pour rompre en visière avec le parti qui seul peut vous ouvrir l’accès du pouvoir, et dans une cause qui seule peut vous le fermer.
Que dirons-nous de M. Corne ? Il a défendu le régime protecteur avec un accent de conviction qui atteste sa sincérité. Mais plus M. Corne est sincère, plus il est à plaindre, puisque sa logique l’a conduit à ces affligeantes conclusions : La liberté est antipathique à l’égalité, et la justice au bien-être.
M. Wustemberg a paru vouloir se poser, dès le début, en homme pratique, c’est-à-dire dégagé de tout principe absolu, partisan tour à tour, selon l’occurrence, de la liberté et de la protection. — Nous avons d’abord été surpris de cette profession d’absence de foi. Ce n’est pas que nous ignorions le vernis de sagesse et de modération qu’elle donne. Comment révoquer en doute la supériorité de l’homme qui juge tous les partis, se préserve de toute exagération, discerne le fort et le faible de toute théorie ? — Mais ces praticiens ont beau dire, si la restriction est mauvaise en soi, tout ce qu’on peut concéder à la restriction modérée, c’est d’être modérément mauvaise. Aussi nous avons été heureux d’apprendre, quand M. Wustemberg a développé sa pensée, qu’il condamne le principe de la protection, qu’il avoue le principe de la liberté et que sa modération doit s’entendre du passage d’un système à l’autre. (V. ci-après le n° 49.)
Il y aurait peu d’utilité à passer en revue tous les discours qui ont occupé trois séances. Je me hâte d’arriver à celui qui a fait, sur l’assemblée et le public, l’impression la plus profonde. Ce ne sera pas cependant sans rendre hommage à une courte, mais substantielle allocution de M. Kœchlin, qui a relevé avec netteté les faits et les calculs erronés que le monopole invoquait à son aide. On y voit combien il faut se tenir en garde contre la statistique.
Ce n’est pas chose aisée que d’apprécier les paroles d’un premier ministre. Faut-il les juger en elles-mêmes, en se bornant à rechercher leur conformité avec la vérité abstraite ? Faut-il les apprécier au point de vue des opinions de l’orateur, manifestées par ses actes et ses discours antérieurs ? Ne peut-on point douter qu’elles soient l’expression, du moins complète, de sa pensée intime ? Est-il permis d’espérer qu’un chef de cabinet viendra exposer sa doctrine, comme un professeur, sans se soucier ni des exigences de l’opinion, ni des passions de la majorité, ni du retentissement de ses paroles, ni des craintes et des espérances qu’elles peuvent éveiller ?
Si encore M. Guizot était un de ces hommes, comme on peint le duc de Wellington, qui ne savent parler que tout juste assez pour dire ce qu’ils ont sur le cœur ? Mais on reconnaît qu’il possède au plus haut degré toutes les ressources oratoires, et qu’il excelle particulièrement dans l’art de mettre, non point les maximes en pratique, mais les pratiques en maximes, selon le mot qu’on attribue à M. Dupin.
Ce n’est donc qu’avec beaucoup de circonspection qu’on peut apprécier la portée et la pensée d’un tel discours ; et, le meilleur moyen, c’est de se mettre à la place de l’orateur et de peser les circonstances dans lesquelles il a parlé. Quelles sont ces circonstances ?
D’un côté, une grande nation qui passe pour habile en matière commerciale, au sein de laquelle les connaissances sont très-répandues, exige l’application du principe proclamé vrai d’ailleurs par tous les hommes, sans excepttion, qui ont fait de la science économique l’étude de toute leur vie.
En outre, un ministre auquel l’Europe décerne le titre de grand homme d’État, un cabinet composé d’hommes supérieurs, les chefs de toutes les oppositions s’accordent un moment pour rendre à ce principe le plus sincère des hommages, la réalisation.
Eh bien ! pense-t-on que, lorsque le monde entier assiste à ce grand spectacle, M. Guizot pourra, sans compromettre sa renommée, venir élever à la tribune française le drapeau de la protection ?
D’un autre côté, il s’adresse à des hommes qui, presque tous, croient, je ne dirai pas leur fortune, mais celle de leurs commettants, liée au régime protecteur. Bien plus, ils ont la conviction que la fortune de la France est attachée au maintien de ce régime. Enfin, au dehors des Chambres, l’opinion, la presse sont pour le monopole ; et s’il y a une association un peu forte en France, c’est celle qui s’est vouée à le défendre. Pense-t-on que le premier ministre arborera le drapeau de la liberté ?
Que fera-t-il donc ?
Il débutera par un pompeux éloge de la réforme anglaise, mais ensuite, en entassant distinctions sur distinctions, il prouvera qu’elle n’est pas applicable à la France.
Il dira, par exemple, que la population de la Grande-Bretagne étant en très-grande majorité composée d’ouvriers des manufactures, il y avait intérêt à lui donner à bon marché le pain, la viande et tous les aliments ; — ce qui est sans application à notre pays agricole.
Comme si, précisément parce que notre population est, en très-grande majorité, vouée aux travaux de l’agriculture, il n’y avait pas également intérêt à lui donner la houille, le fer et le vêtement à bon marché.
Mais enfin, il faudra bien que le ministre se prononce. Qu’est-ce donc qui est applicable à la France ? Est-ce la restriction ? est-ce la liberté ?
Ni l’une ni l’autre. Il faut voir, examiner, résoudre les questions une à une, à mesure qu’elles se présentent, et sans les rattacher à aucun système ; en un mot, poursuivre la marche que le cabinet s’est tracée dans la voie du progrès. — (Car, quel ministre peut avouer qu’il n’est pas dans le progrès ?)
En sorte que, lorsque le chef du cabinet descend de la tribune, les libéraux se disent : Il y a une pensée de liberté dans ce discours-là.
Et les monopoleurs : Si le progrès futur va du même train que le progrès passé, nous pouvons dormir tranquilles.
Ceci n’est pas une critique.
Peut-être aurons-nous un jour le spectacle d’un premier ministre venant dire aux Chambres : « Voilà mon principe : — vous le repoussez, je me retire. Ma place est à la chaire, au journal ; elle ne saurait être au banc ministériel. »
En attendant, il faut bien se résigner à ce que, sans sacrifier explicitement ses convictions sur une question spéciale, il consulte l’opinion publique, cherche même à la modifier, mais qu’en définitive il préfère gouverner avec elle que de ne pas gouverner du tout.
M. Peel, cet homme d’État qu’il est aujourd’hui de mode d’exalter démesurément comme l’instrument, presque l’inventeur de la réforme commerciale, n’a pas fait autre chose [1].
Il y a longtemps que M. Peel est économiste, malgré la comédie de sa confession. Mais il ne s’est pas avisé de devancer l’opinion, il l’a laissée se former ; et pendant que d’autres ouvriers, dont la postérité vénérera la mémoire, se chargeaient de cette tâche laborieuse, lui se contentait, selon l’expression anglaise, de lui tâter le pouls. Il l’a aidée même, par des expériences partielles, qu’il savait bien devoir réussir ; et, quand le moment est venu, quand il a vu derrière lui une opinion publique capable de contre-balancer l’influence qui l’avait élevé, il s’est placé du côté de la force, et il a dit aux monopoleurs : Je pensais comme vous ; mais l’étude et l’expérience m’ont détrompé. — Et il a accompli la réforme.
Le discours même, par lequel il a introduit aux Communes cette grande mesure, se ressent des ménagements que doivent s’imposer les ministres qui redoutent plus l’éloignement des affaires que l’inconséquence théorique. Pense-t-on que M. Peel ne soit pas plus libéral au fond que sa réforme et surtout que son discours ? Combien d’hérésies n’a-t-il pas articulées, contre sa conviction intime, uniquement pour ne pas trop heurter une partie de son auditoire !
Et par exemple, quand il a dit : « Qu’avons-nous à craindre ? Nous avons de la houille, du fer et des capitaux. Nous battrons tous les manufacturiers du monde. »
Vous nous battrez ! — Peut-être : et en tout cas, très-honorable baronnet, vous savez bien qu’en ce genre de lutte, c’est le vaincu qui recueille le butin. Vous nous battrez, en nous admettant, par droit d’échange, en communauté de vos avantages. Vous nous battrez comme la Beauce bat Paris en lui vendant du blé, comme Newcastle bat Londres en lui vendant du combustible.
Mais il fallait flatter John Bull et ce qui lui reste encore de préjugés. De là ce mélange de doctrines antagonistes. Qu’en est-il résulté ? ce qui résultera toujours de cette stratégie. L’Europe n’a retenu que cette rodomontade de M. Peel. On l’a citée à notre tribune. L’influence morale de la réforme en a été neutralisée ; et malgré les précédents, malgré les faits, malgré la renonciation à toute réciprocité, la prévention traditionnelle contre le machiavélisme de la perfide Albion est demeurée, ou peu s’en faut, dans toute sa force.
Mais enfin, ne reste-t-il rien du discours de M. Guizot ? N’y a-t-il rien à conclure de ces paroles qui ont eu en France tant de retentissement ?
S’il faut dire ce que j’en pense, je crois qu’à travers beaucoup de distinctions et de précautions, une pensée de liberté s’y laisse apercevoir.
Il est vrai que M. Guizot a dit et répété : Nous sommes conservateurs, nous sommes protecteurs. — Mais il a dit aussi : M. Peel est conservateur et protecteur.
Donc, dans sa pensée, l’esprit de conservation et de protection n’est pas incompatible avec une réforme plus ou moins radicale.
Il a été plus loin lorsqu’il a dit : « Nous avons intérêt à réformer progressivement nos tarifs, à étendre nos relations au dehors, à nous donner à nous-mêmes de nouveaux gages de bons rapports et de paix, à améliorer ainsi la condition du public consommateur. »
Et encore :
« Il faut avancer toutes les fois que cela se peut sans danger pour nos grandes industries, avec profit pour notre influence politique dans le monde, avec profit pour le public consommateur. »
Le voilà donc prononcé le grand mot, le mot consommateur, le mot qui résout tous les problèmes ; car, enfin, la consommation est le but définitif de tout effort, de tout travail, de toute production. Le consommateur est mis en scène ; il n’en sortira pas, et bientôt il l’occupera tout entière. (V. tome IV, page 72.)
Il est permis de croire que M. Guizot n’a pas fait de la science de Smith et de Say une étude spéciale. Nul homme ne peut tout savoir. Mais j’ose prendre sur moi d’affirmer qu’il tient dans sa main le fil qui le conduira sûrement à travers tous les détours de ce labyrinthe. Qu’il attache sa pensée à ce phénomène de la consommation, et il sera bientôt plus économiste que beaucoup d’économistes de profession. Il arrivera à cette simple conclusion : Le tarif doit être une source de revenu public, et non une source de faveurs partielles. (V. le chap. XI du tome VI.)
Rapprochons les paroles de M. Guizot de celles de M. Cunin-Gridaine.
« Dès aujourd’hui nous pouvons annoncer que des études poursuivies de concert, par les départements du commerce et des finances, auront pour résultat la présentation, à la session prochaine, d’un projet de loi de douanes qui comprendra de nombreuses modifications. »
Et, pour qu’on ne s’y méprenne pas, le ministre s’est servi, un moment avant, du mot adoucissements.
Ainsi, il n’en faut pas douter, l’heure de la réparation approche.
Et pourquoi ne concevrions-nous pas cet espoir ? Les monopoleurs ne s’y sont pas trompés. Ils ne s’en sont point laissé imposer par les grands mots : conservation, protection. M. Grandin s’est écrié : « On vous fera bientôt des propositions ; prenez garde ! ne vous y laissez pas prendre. M. le ministre des affaires étrangères, il est vrai, ne vous parle pas encore d’admettre les produits anglais. Il sait bien qu’aujourd’hui il rencontrerait encore dans cette Chambre une forte opposition. Mais ces idées, je le crains bien, germent dans son esprit, et peut-être ne fait-il que les ajourner. M. le ministre a bien dit qu’il était partisan du régime protecteur. Mais en même temps il a déclaré qu’il fallait élargir ce système, et successivement le modifier, à l’égard surtout des industries privilégiées ; ce qui veut dire sans doute que ces industries doivent s’attendre, un jour ou l’autre, à entrer en concurrence avec l’étranger. »
Oui, cela veut dire qu’un jour ou l’autre le droit de propriété sera reconnu en France, et que quiconque travaille, maître du fruit de ses sueurs, sera libre de le consommer, ou de l’échanger, si tel est son intérêt, même ailleurs que chez M. Grandin.
Ainsi, je le répète, l’heure approche. Nous ne sommes pas arrivés sans doute au temps de la réforme, de l’application des grands principes d’économie politique et d’éternelle justice. Mais nous entrons dans l’ère des essais. Nous nous rapprochons de l’Angleterre à six ans de distance. Les experiments que sir Robert Peel commença en 1841, M. Guizot les commencera en 1847, et leur succès en provoquera d’autres jusqu’à ce que la justice règne dans le pays.
L’heure approche. Mais le temps qui nous en sépare doit être consacré à la discussion et à la lutte.
Amis de la liberté, je vous dirai comme M. Grandin à sa phalange : Prenez garde ! ne vous laissez pas surprendre !
Prenez garde ! ce n’est pas le ministre qui décidera la réforme. Ce n’est pas la Chambre, ce ne sont pas même les trois pouvoirs ; c’est l’opinion. Et êtes-vous prêts pour le combat ? avez-vous tout préparé ? avez-vous un organe avoué et dévoué ? vous êtes-vous occupés des moyens d’agir sur l’esprit public ? de faire comprendre aux masses comment on les exploite ? disposez-vous d’une force morale que vous puissiez apporter à ce ministère, ou à tout autre, qui osera toucher à l’arche du privilége ?
Prenez garde ! le monopole ne s’endort pas. Il a son organisation, ses coalitions, ses finances, sa publicité. Il a réuni en un faisceau tous les intérêts égoïstes. Il a agi sur la presse, sur la Chambre, sur les élections. Il met en œuvre, et c’est son droit, tout le mécanisme constitutionnel. Il vous battra certainement, si vous restez dans l’indifférence.
Vous comptez sur le pouvoir. Sa déclaration vous suffit. Ah ! ne vous y laissez pas prendre. Le pouvoir ne fait que ce que l’opinion veut qu’il fasse. Il ne peut, il ne doit pas faire autre chose. Ne voyez-vous pas qu’il cherche, qu’il sollicite, qu’il implore un point d’appui ? et vous hésitez à le lui donner !
Plusieurs d’entre vous sont découragés. Ils disent : « L’intérêt général, parce qu’il est général, touche tout le monde, mais touche peu. Jamais il ne pourra se mesurer à l’intérêt privé. » — C’est une erreur. La vérité, la justice ont une force irrésistible. C’est l’esprit de doute qui la paralyse. — Pour l’honneur du pays, croyons que le bien public a encore la puissance de faire battre les cœurs.
Unissez-vous donc : agissez. À quoi servent les garanties conquises par tant de sacrifices ? À quoi servent les droits de parler, d’écrire, d’imprimer, de nous associer, de pétitionner, d’élire, si tous ces droits nous les laissons dans l’inertie ?
Je ne sais si je m’abuse, mais il me semble que quelque chose circule dans l’air qui annonce l’affranchissement commercial des peuples.
Ce n’est pas la tribune seulement qui a eu son débat théorique, il a envahi la presse quotidienne.
Quelle eût été, il y a quelques mois, l’attitude des journaux ? — Et voilà que le Courrier français, le Siècle, la Patrie, l’Époque, la Réforme, la Démocratie pacifique ont passé dans notre camp [2] ; et tout le monde a été frappé de l’orthodoxie et du ton de résolution qui règne dans le manifeste an Journal des Débats, habituellement si prudent et si mesuré.
Il est vrai que nous avons contre nous la Presse, l’Esprit public, le Commerce et le Constitutionnel. — Mais la Presse ne combat plus, depuis sa correspondance avec M. Blanqui, sur le terrain des principes. Elle veut la liberté, la justice ; seulement elle y veut arriver avec une lenteur désespérante. Quant au Constitutionnel, on ne peut pas dire qu’il se prononce ; il s’efforce dé nous décourager. Mais ses arguments sont si faibles qu’ils manquent leur but, et il semble qu’une secrète répugnance dominait la plume qui les a formulés. Ils reposent tous sur une perpétuelle confusion entre les tarifs protecteurs, que nous attaquons, et les tarifs fiscaux que nous laissons en paix. Ainsi, le Constitutionnel nous apprend que la réforme de sir Robert Peel est tout ce qu’il y a de plus vulgaire. Et quelle preuve en donne-t-il ? C’est qu’elle laisse subsister de forts droits sur le thé, le tabac, les eaux-de-vie, les vins, droits qui n’ont et ne peuvent avoir rien de protecteur, puisque ces produits n’ont pas de similaires en Angleterre. Il ne voit pas que c’est en cela que consiste la libéralité de la mesure. — Il nous assure qu’il y a, en Suisse, beaucoup d’obstacles à la circulation des marchandises ; mais il ne disconvient pas que ces obstacles sont communs aux marchandises indigènes et aux marchandises exotiques ; que les unes et les autres y sont traitées sur le pied de la plus parfaite égalité, d’où il résulte seulement une chose, c’est que la Suisse prospère sans protection, malgré la mauvaise assiette de l’impôt.
Encore quelques efforts. Que Paris se réveille ; qu’il fasse une démonstration digne de lui ; que les six mois qui sont devant nous soient aussi féconds que ceux qui viennent de s’écouler, et la question de principe sera emportée.
FN:V. tome III, pages 438 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:L’auteur reconnut bientôt que quelques-unes des adhésions qu’il enregistre ici n’étaient ni solides ni complètes. (Note de l’éditeur.)
La réforme postale [23 avril 1846] ↩
BWV
1846.04.23 “Réforme postale" (Postal Reform) [*Mémorial bordelais*, 23 avril 1846] [OC7.17, p.78-83]
Réforme postale [1]
Que sont devenues cette énergie française, cette audace, cette initiative qui frappaient le monde d’admiration ? Nous sommes-nous rapetissés à la taille des Lilliputiens ? L’intrépide géant s’est-il fait nain timide et trembleur ? Notre orgueil national se contente-t-il qu’on dise encore de nous : « Ce sont les premiers hommes du monde pour donner et recevoir des coups de sabre, » — et sommes-nous décidés à dédaigner la solide gloire de marcher résolument dans la voie des réformes fondées sur la justice et la vérité ?
On serait tenté de le croire, quand on lit ce rachitique projet émané de la commission de la Chambre, intitulé emphatiquement : Réforme postale.
L’État s’est emparé du transport et de la distribution des lettres. Je ne songe pas à lui disputer, au nom des droits de l’activité individuelle, ce délicat service, puisqu’il l’accomplit du consentement de tous.
Mais de ce que, par des motifs d’ordre et de sûreté, il s’est déterminé à dépouiller les citoyens de la faculté de se transmettre réciproquement leurs dépêches comme ils l’entendent, ne s’ensuit-il pas qu’il ne doit rien leur demander au delà du service rendu ?
Voyez les routes. Elles servent à la circulation des hommes et des choses, à quoi l’on a attaché tant de prix, que l’État, après avoir consacré des sommes énormes à leur confection, les livre, sans aucune rémunération, à l’usage des citoyens.
Eh quoi ! la circulation de la pensée, l’échange des sentiments, la transmission des nouvelles, les relations de père à fils, de frère à sœur, de mère à fille, seraient-elles à nos yeux moins précieuses ?
Cependant, non seulement l’État se fait rembourser, pour le transport des lettres, le prix du service rendu, mais il le surcharge d’un impôt inégal et exorbitant.
Il faut des revenus au trésor, j’en conviens. Mais on conviendra aussi que les rapports des parents, les épanchements de l’amitié, l’anxiété des familles, devraient être la dernière des matières imposables.
Chose singulière ! Par une double inconséquence, on imprime à la poste un caractère fiscal qu’on refuse à la douane, les détournant ainsi l’une et l’autre de leur destination rationnelle.
Un citoyen a certainement le droit de dire à l’État : Vous ne pouvez, sans porter atteinte à mes plus chers priviléges, me dépouiller de la faculté de faire parvenir comme je l’entends une dépêche dont dépendent peut-être ma fortune, ma vie, mon honneur et le repos de mon existence. Tout ce que vous pouvez avec justice, c’est de me déterminer à avoir volontairement recours à vous, en m’offrant les moyens de correspondance les plus prompts, les plus sûrs et les plus économiques.
Que si on posait en principe (je demande grâce pour cette expression peu parlementaire) que l’État ne doit point bénéficier sur le transport des lettres, on arriverait avec une facilité merveilleuse à la solution de tous les problèmes que soulève la réforme postale, car je n’ai jamais entendu faire contre la taxe inférieure et uniforme qu’une seule objection : Le trésor perdrait tant de millions (perdre, en style administratif, c’est ne pas gagner).
Remboursement réel, remboursement uniforme, voilà les deux sujets sur lesquels j’essaierai d’appeler l’attention du lecteur.
Mais, avant tout, je crois devoir rendre un hommage éclatant à l’administration des postes. On dit qu’en Angleterre, c’est dans le post-office que s’organise la résistance à la réforme. En France, au contraire, elle est née dans les bureaux, s’il est vrai que la première publication qui ait traité ce sujet doive être attribuée à un haut fonctionnaire de la rue Jean-Jacques-Rousseau. Jamais je n’ai lu un ouvrage plus dégagé d’esprit bureaucratique et fiscal, plus empreint d’idées élevées, généreuses, philanthropiques, et qui respire plus, à chaque page, l’amour du progrès et du bien public.
Remboursement réel des frais. — Fidèle au principe que je posais tout à l’heure, je dois d’abord chercher quelle devrait être la taxe ou plutôt le prix de chaque lettre.
La circulation fut, en 1844, de 108 millions de lettres, et il est impossible qu’elle ne dépassât pas, avec la taxe réduite, 200 millions.
| Les dépenses se sont élevées à | fr. 30,000,000 | |
| À déduire : | ||
| Paquebots du Levant | fr. 5,200,000 | » 11,000,000 |
| Produit réalisé des places dans la malle-poste | » 2,300,000 | |
| Envois d’argent | » 1,100,000 | |
| Remboursement par les offices continentaux | » 400,000 | |
| Produit réalisé des journaux | » 2,000,000 | |
| Reste à la charge des lettres | fr. 19,000,000 | |
Encore les frais administratifs devraient-ils être imputés rigoureusement, dans la proportion d’un tiers, aux services accessoires.
Reste toujours que 200 millions de lettres à 10 centimes, produisant 20 millions, couvriraient et au delà leurs frais.
Remarquons qu’à ce prix les lettres payeraient encore un impôt de 5 centimes ou 100 p. 100, puisqu’elles défrayeraient le transport gratuit des dépêches administratives égales à leur propre poids.
Par cette dernière considération, je le dis ouvertement, si nous ne vivions dans un temps où il semble qu’on a horreur du bien quand il se présente sous une forme un peu absolue et dégagé d’une dose de mal qui le fasse accepter, je dirais que la lettre simple ne doit payer que 5 centimes ; et certes les avantages de la réforme seraient alors si complets, que peut-être ne devrait-on pas hésiter. — Mais admettons 10 centimes, moitié rémunération, moitié impôt.
Le premier avantage de cette modicité, je n’ai pas besoin de le dire, ce serait la juste satisfaction donnée au plus délicat, au plus respectable des besoins de l’homme, dans l’ordre moral.
Le second, d’accroître l’ensemble des transactions et des affaires, fort au delà probablement de ce qui serait nécessaire pour restituer par d’autres canaux, au trésor public, la perte du produit net actuel des postes.
Le troisième, de mettre la correspondance à la portée de tous.
La commission fixe à 10 centimes le prix des lettres adressées aux soldats. Elle oublie une chose, c’est que, sur 34 millions d’habitants, il y en a 8 millions qui sont des soldats aussi, les soldats de l’industrie, et qui, après avoir pourvu aux premières nécessités de la vie, n’ont pas toujours le sou de poche.
Enfin, un quatrième et précieux avantage, ce serait de restituer à tout Français la faculté de transporter des lettres et de ne pas faire arbitrairement une catégorie de délits artificiels.
Je suis surpris qu’on ne soit pas frappé du grave inconvénient qu’il y a toujours à classer législativement, parmi les délits et les crimes, des actions innocentes en elles-mêmes, et souvent louables. Et ici, voyez dans quelle série d’absurdités et d’immoralités on s’engage nécessairement quand on fonde la poste sur le principe de la fiscalité.
La taxe est fiscale ; donc elle doit dépasser de beaucoup le prix du service rendu ; donc les particuliers seront excités à faire la concurrence à l’État ; donc il faut leur ôter une liberté innocente, quelquefois précieuse ; donc il faut une sanction pénale.
Et quelle sanction ! Peut-on lire sans une insurmontable répugnance l’article 7 du projet de la Commission ? Un acte de simple obligeance puni comme un forfait ! Le port d’une lettre entraîner une amende qui peut aller à 6,000 francs ! Combien de crimes contre les propriétés, même contre les personnes, n’exposent point à une telle pénalité !
Avec la taxe à 10 centimes, — ou mieux à 5 centimes, — vous n’avez pas besoin de créer de délits. La nomenclature en est déjà assez longue. Vous pouvez rendre à chacun la liberté. On ne s’amusera pas à chercher des occasions incertaines, quand on aura sous la main la plus économique, la plus commode, la plus directe, la plus sûre et la plus prompte des occasions.
Puisque j’ai parlé de châtiments, je dois faire ressortir dans le projet de la Commission, un contraste dont je suis sûr que le sentiment public sera révolté.
Un homme se charge d’une lettre. En lui-même, l’acte n’est pas coupable. Ce n’est pas la nature des choses, c’est la loi, la loi seule, qui l’a fait tel. Cet homme peut être puni de 6,000 francs d’amende, et, qui plus est, par une autre fiction légale, le châtiment peut tomber sur un tiers qui n’a pas même eu connaissance du fait (art. 8).
Un fonctionnaire abuse du contre-seing. Il y a fraude aussi, et qui pis est fraude du plus mauvais caractère, fraude préméditée, calculée, intentionnelle. De plus, il y a faux, et faux commis par un homme public en écritures publiques ; il y a abus de confiance ; il y a violation de serments. — L’amende est de 25 francs ! Que dirai-je de l’article 10 : L’administration pourra transiger avant comme après jugement, etc. ? De telles dispositions portent avec elles-mêmes leur commentaire.
Ainsi, transactions gênées, sentiments froissés, liens de famille relâchés, affaires gênées, liberté restreinte, taxes inégales, crimes fictifs, châtiments arbitraires ; telles sont les conséquences nécessaires du principe de la fiscalité introduit dans la loi des postes.
Donc il faut recourir à cet autre principe, que la poste doit rendre le service auquel elle est destinée, au prix le plus bas possible, c’est-à-dire à un prix qui couvre ses frais.
Il me reste à parler de l’uniformité de la taxe, et aussi des moyens de combler le déficit du trésor. Ce sera l’objet d’un second article.
FN: Mémorial bordelais du 23 avril 1846.(Note de l’édit.)
Réforme postale. 2e article [30 avril 1846] ↩
BWV
1846.04.30 “Réforme postale. 2e article” (Postal Reform. 2nd article)[*Mémorial bordelais*, 30 avril 1846] [OC7.18, pp. 83-91]
Réforme postale [1]
Deuxième article
L’uniformité de la taxe a des avantages si nombreux, si incontestables, si éclatants, que, pour ne pas les voir, il faut fermer volontairement les yeux.
On fait cette objection : « L’uniformité résiste au principe même que vous avez posé, celui du simple remboursement du service reçu, car il est juste de le payer d’autant plus qu’il est plus dispendieux.
« L’égalité apparente ne serait qu’une réelle inégalité. »
Mais tous, tant que nous sommes, n’écrivons-nous pas tantôt à de grandes, tantôt à de petites distances ? L’égalité se rétablit donc par là, et rien n’empêche de faire de toutes les distances une moyenne que chaque lettre est censée avoir parcourue [2].
Partout où, dans des cas analogues, l’uniformité est établie pour le port des journaux, pour les envois d’argent, il faut qu’on s’en trouve bien, car personne n’y contredit.
D’ailleurs, il est un point où, dans la pratique, tout est forcé de s’arrêter, même la justice rigoureuse ; c’est quand on arrive à des différences microscopiques, à des infiniment petits, à un fractionnement si minutieux, que l’exécution en devient onéreuse à tout le monde. Est-ce que le système de la Commission a la prétention de réaliser l’égalité mathématique ? Fait-il payer plus la lettre remise à huit heures que la lettre délivrée à neuf ? Observe-t-il la proportionnalité entre le destinataire placé à 39 ou à 40 kilomètres ?
Lors donc qu’on parle d’égalité, il faut entendre une égalité possible, praticable, qui n’exige pas, par exemple, qu’on prenne de la monnaie d’un centime.
Et c’est précisément ce qui arriverait dans le système de la taxe graduelle, s’il tenait compte de cette équité infinitésimale dont il se masque.
Car il est prouvé que les frais de locomotion, les frais qui affectent diversement les lettres, ne font varier la dépense, d’une zone à l’autre, que de 1/2 centime [3].
Mais puisque c’est au nom de l’égalité et de l’équité que la Commission s’est décidée pour la taxe graduelle, examinons son système à ce point de vue.
D’abord elle est partie de ce principe, que la poste devait être un instrument fiscal, et que, tandis que l’État épuise ses revenus pour faciliter la circulation des marchandises, il devait se faire une source de revenus de la circulation des sentiments, des affections et des pensées.
Il suit de là qu’il y a trois choses dans un port de lettre :
1° Un impôt ;
2° Le remboursement de frais communs à toutes les lettres ;
3° Le remboursement de frais variables selon les distances.
Il est clair que l’uniformité de la taxe devrait exister pour toutes les lettres, en ce qui concerne les deux premiers éléments, et que la gradualité ne peut résulter, avec justice, que du troisième.
Il est donc nécessaire d’en déterminer l’importance.
Les frais généraux communs à toutes les lettres, administration, inspection, surveillance, etc., s’élèvent à 12 millions que nous pouvons réduire à 10, parce qu’une partie de ces frais est absorbée par des services étrangers au sujet qui nous occupe, tels que le transport de cinquante mille voyageurs, les envois d’argent, les paquebots, etc.
Les frais de locomotion sont de 17,800,000 fr. qui se réduisent aussi à 10 millions, ainsi que nous l’avons vu dans l’article précédent, si l’on en déduit, comme on le doit, ceux qui ne concernent pas les dépêches.
Ces frais doivent se répartir sur :
| 875,000 | kilog. | de lettres représentant | 116 | millions de lettres simp. |
| 1,000,000 | — | journaux et imprimés | 133 | — |
| 1,000,000 | — | dépêches administratives | 133 | — |
| Total…… | 382 millions. | |||
Soit, en nombre rond, 400 millions de lettres simples.
| Ainsi , 10 millions de frais fixes répartis sur 400 millions de lettres donnent pour chacune . . . | 2 c. 1/2 |
| 10 millions de frais graduels ajoutent en moyenne au prix de revient . . . | 2 c. 1/2 |
| Total . . . | 5 cent. |
Enfin, le coût moyen d'une lettre étant aujourd'hui de 42 c. 1/2, il s'ensuit que chacun des trois éléments y entre dans les proportions suivantes :
| cent. | |
| Frais fixes . . . | 2 1/2 |
| Frais graduels . . . | 2 1/2 |
| Impôt . . . | 37 1/2 |
| Total . . . | 42 c. 1/2 |
Si, comme le demandent les partisans de la réforme radicale, la partie purement fiscale était supprimée, le port serait fixé à 5 centimes, prix de revient. — En ce cas, l'État aurait à subventionner le port des dépêches administratives.
Ou, si l'on adoptait 10 centimes, les lettres des particuliers paieraient encore un impôt suffisant pour défrayer le service public.
Dans l’un et l'autre cas, l'uniformité est forcée, car les frais de locomotion, les seuls qui pussent justifier la gradualité, n'étant en moyenne que de 1/2 centime, il en résulte que la plus petite distance coûte 1 c. 1/2 et la plus grande 5 centimes.
Voici donc quel devrait être le tarif fondé sur ce principe.
| Frais fixes. | Frais graduels. | Total ou tarif. | ||
| 1ere | zone | 2 1/2 | 1 1/4 | 3 3/4 |
| 2e | — | 2 1/2 | 1 6/8 | 4 3/8 |
| 3e | — | 2 1/2 | 2 1/2 | 5 |
| 4e | — | 2 1/2 | 3 3/4 | 6 1/4 |
| 5e | — | 2 1/2 | 5 | 7 1/2 |
Tarif évidemment inexécutable. Il ne le serait pas moins, si l’on y ajoute une taxe fiscale, puisqu’elle devrait être immuable, par exemple 20 centimes. — Et l’on aurait alors ce monstrueux tarif :
1re zone, 23 c. 1/2 ; — 2e, 24 c. 3/8 ; — 3e, 25 c., etc.
Or, qu’a fait la Commission sous le manteau de l’égalité ? Elle a inégalisé l’impôt, et son tarif décomposé donne les résultats suivants :
| Frais généraux. | Frais graduels. | Impôt. | Total de la taxe proposée. | ||
| 1re | zone | 2 1/2 | 1 1/4 | 6 1/4 | 10 |
| 2e | — | 2 1/2 | 1 6/8 | 15 5/8 | 20 |
| 3e | — | 2 1/2 | 2 1/2 | 25 | 30 |
| 4e | — | 2 1/2 | 5 1/4 | 33 3/4 | 40 |
| 5e | — | 2 1/2 | 5 | 42 1/2 | 50 |
N’avais-je pas raison de dire que le système de la Commission établissait un impôt aussi inégal qu’exorbitant, puisqu’il s’élève pour quelques-uns à deux fois, pour d’autres à dix fois le prix du service rendu.
Il n’y a donc de sérieuse égalité que dans l’uniformité. Mais une taxe uniforme implique une taxe modique, et, pour ainsi dire, réduite au minimum praticable.
On a beaucoup parlé de 20 centimes. — Mais à ce taux, il vous faut une catégorie de lettres à 10 centimes (celles qui circulent dans le rayon d’un bureau) ; de là la nécessité du tri, de la taxation ; de là, l’impossibilité d’arriver jamais à l’affranchissement obligatoire.
Je viens de prononcer le mot affranchissement obligatoire. Il n’est possible qu’avec une taxe de 10 ou mieux de 5 centimes, et les avantages en sont si évidents, qu’il y a lieu d’être surpris qu’on recule devant cette objection : la perte du trésor, — comme si le trésor n’était pas le public.
Qu’on se figure quel est le travail actuel de la poste, ce qu’il sera encore après la réforme telle que la Commission nous l’a faite. Cent lettres sont jetées à la poste. Chacune d’elles peut appartenir, pour la distance, à onze zones et pour le poids à neuf classes, ce qui élève le nombre des combinaisons à quatre-vingt-dix-neuf pour chaque lettre, et voilà M. le directeur, consultant tour à tour son tableau et sa balance, réduit à faire 9,900 recherches en quelques minutes. Après cela il constatera le poids sur un coin et la taxe au beau milieu des adresses.
Faut-il affranchir ? Il recevra l’argent, donnera la monnaie, inscrira l’adresse sur je ne sais combien de registres, enveloppera la lettre dans un bulletin qui relate, pour la troisième ou la quatrième fois, le nom du destinataire, le lieu du départ, le lieu de l’arrivée, le poids, la taxe, le numéro.
Puis vient la distribution ; autres comptes interminables entre le directeur et le facteur, le facteur et le destinataire, et toujours contrôle sur contrôle, paperasse sur paperasse.
Que dirai-je du travail qu’occasionnent les rebuts ; et les trop taxés, et les moins taxés, et cette comptabilité générale, chef-d’œuvre de complication, destinée, et il le faut bien, à s’assurer la fidélité des agents de tous grades ?
N’est-il pas singulier qu’on prodigue des millions pour faire gagner aux malles une heure de vitesse, et qu’on prodigue d’autres millions pour faire perdre cette heure aux distributeurs ?
Avec l’affranchissement obligatoire, toutes ces lenteurs, toutes ces complications, toutes ces paperasses, tous ces rebuts, les plus trouvés, les moins trouvés, les tris, les taxes, cette comptabilité prodigieuse en matière et en finances, tout cela disparaît tout à coup. La poste et l’enregistrement vendent des enveloppes et des timbres à 5 ou 10 centimes, et tout est dit.
On objectera qu’il y aurait de l’arbitraire à priver l’envoyeur de la faculté de faire partir une lettre non affranchie.
On ne l’en prive pas. Rappelons-nous que, dans ce système, il est maître de faire parvenir ses lettres comme il le juge à propos, il n’a donc pas à se plaindre, si la poste, pour rendre le service aussi prompt et aussi économique que possible, veut rester maîtresse de ses moyens.
Disons les choses comme elles sont. Sous le rapport moral, au point de vue de la civilisation, des affaires, des affections, quant à la commodité, la simplicité et la célérité du service, enfin dans l’intérêt de la justice et de la vraie égalité, il n’y a pas d’objection possible contre la taxe uniforme et modérée.
La perte du revenu ! — Voilà le seul et unique obstacle.
La perte du revenu ! — Voilà pourquoi on frappe d’un impôt énorme et inégal les communications de la pensée, la transmission des nouvelles, les anxiétés du cœur et les tourments de l’absence ! Voilà pourquoi on grossit nos Codes de crimes fictifs et de châtiments réels. Voilà pourquoi on perd à la distribution des lettres le temps qu’on gagne sur la vitesse des malles. Voilà pourquoi on surcharge le service de complications inextricables ! Voilà pourquoi on l’assujettit à une comptabilité qui porte sur 40 millions divisés en somme de 40 centimes, dont chacune donne lieu au moins à une douzaine d’écritures !
Mais, en définitive, à combien se monte cette perte ?
Admettons qu’elle soit de 20 millions.
On accordera sans doute que cette somme, laissée à la disposition des contribuables, achètera du sucre, du tabac, du sel, par quoi la perte du trésor sera atténuée.
On accordera aussi que la fréquence et la facilité des relations, multipliant les affaires, réagiront favorablement sur tous les canaux des revenus publics.
Le nombre des lettres ne peut pas manquer non plus de s’accroître d’année en année.
Enfin le service, simplifié dans une proportion incalculable, permettra certainement de notables économies.
Toutes ces compensations faites, supposons encore la perte du revenu de 10 millions.
La question est de savoir si vous pouvez employer 10 millions d’une manière plus utile, et j’ose vous défier de me montrer dans le budget, tout gros qu’il est, une dépense mieux entendue.
Eh quoi ! c’est au moment où vous prodiguez 1 milliard pour faciliter la circulation des hommes et des choses, que vous hésitez à sacrifier 10 millions pour faciliter la circulation des idées !
Vous vous demandez s’il est sage de négliger une rentrée de 1 millions, quand il s’agit de conférer au public des avantages inappréciables ?
Car si le nombre des lettres vient seulement à doubler, qui osera assigner une valeur aux affaires engagées, aux affections satisfaites, aux anxiétés dissipées par ce surcroît de correspondance ?
Et n’est-ce rien que d’effacer de vos Codes des crimes chimériques, des châtiments arbitraires, et ces transactions immorales entre le caprice administratif et les arrêts de la justice ?
N’est-ce rien que de remettre à un pauvre manœuvre la lettre de son fils, si longtemps attendue, sans lui arracher, et presque tout pour l’impôt, le fruit de quinze heures de sueur ?
N’est-ce rien que de ne pas réduire une misérable veuve, afin d’amasser les 24 sous qu’on exige (dont 22 sont une pure contribution) à laisser séjourner quinze jours à la poste la lettre qui doit lui apprendre si sa fille vit encore ?
Aujourd’hui même je lisais dans le Moniteur que le chiffre des recettes publiques s’accroît de trimestre en trimestre.
Comment donc le moment n’arrive-t-il jamais où les réformes les plus urgentes ne sont pas ajournées ou gâtées par cette éternelle considération : la perte du revenu ?
Mais enfin, vous faut-il absolument 10 millions ? Vous avez un moyen simple de vous les procurer. Rentrez, sous un double rapport, dans la vérité des choses. — En même temps que vous ôterez à la poste, rendez à la douane le caractère fiscal.
Diminuez seulement d’un quart les droits sur le fer, la houille, les bestiaux et le lin.
Le trésor et le public s’en trouveront bien. Chacune de ces réformes facilitera l’autre, vous aurez rendu hommage à deux principes d’éternelle justice, et vos prochaines professions de foi se baseront au moins sur quelque chose de plus substantiel que l’ordre avec la liberté et la paix avec l’honneur, lieux communs qui, s’ils n’engagent à rien, ne trompent non plus personne.
FN: Mémorial bordelais, 30 avril 1846.(Note de l’édit.)
FN:Recevez dans l’année 4 lettres à 3 décimes, 4 lettres à 2 décimes et 2 lettres à 1 franc ; n’est-ce point comme si vous aviez payé pour chaque lettre le taux fixe de 40 centimes qui est la moyenne du système actuel ?
FN:Nous renvoyons pour la démonstration à l’excellent rapport de M Chégaray (Séance du 5 juillet 1844, p. 10 et suiv.).
La liberté commerciale [2 mai 1846] ↩
BWV
1846.05.02 “La liberté commerciale” (Commercial Liberty) [*Mémorial bordelais*, 2 mai 1846] [OC7.19, 91]
Liberté commerciale [1]
Comment trouvez-vous Philis ? — Belle, admirable, adorable. — N’est-ce pas qu’elle a de beaux yeux ? — Oui, mais ils louchent. — Et son teint ? — Il est un peu couperosé. — Et que dites-vous de son nez ? — Il fait honte à celui de la Sulamite que l’époux compare à la tour du mont Liban. — Oui dà ! mais en quoi donc trouvez-vous que Philis soit si belle ? — Elle est incomparable dans l’ensemble, mais elle ne supporte pas le détail.
C’est de cette façon qu’on traite aussi la liberté commerciale. Tant qu’elle reste théorie, on la salue, on la respecte, on la flatte ; il n’y a rien de plus beau sous le soleil. S’avise-t-elle de vouloir être réalisée ? montre-t-elle le pied, la main ou le visage ? c’est une horreur depuis les pieds jusqu’à la tête.
Le Constitutionnel, par exemple, se garderait bien de rien objecter, en principe, contre la liberté des échanges. Mais il soulève contre toutes ses applications l’armée entière des sophismes protectionistes.
Nous n’avons pas la prétention de les combattre tous. Bornons-nous à ceux qui sont le plus à la mode.
D’abord le Constitutionnel affirme que le monde entier se méprend sur les réformes de sir Robert Peel.
« Nous avons établi, dit-il, que les réformes anglaises laissent subsister, pour ainsi dire en entier, le régime commercial et douanier de la Grande-Bretagne et que la liberté des transactions, qu’on a cru découvrir dans les mesures de sir Robert Peel n’était qu’une pure illusion. Ainsi l’Association bordelaise, qui s’appuie sur l’exemple de l’Angleterre pour réclamer la liberté commerciale, commet tout simplement une grosse inconséquence. »
Plus bas il ajoute : « L’Angleterre, tout en demandant aux autres nations la liberté commerciale, s’est bien gardée de leur donner un pareil exemple. »
C’est là une assertion qu’on a beaucoup répétée à la Chambre. Nous n’y répondrons pas. Nous prions seulement le Constitutionnel de vouloir bien dresser un petit tableau en deux colonnes, dont l’une aura pour titre : Tarif de 1840 ; — l’autre, tarif de 1846. Au-dessous figureront les droits, pour les deux époques, des articles suivants :
Froment, seigle, orge, avoine, maïs, bœufs, veaux, vaches, moutons, brebis, agneaux, viandes fraîches et salées, beurre, fromage, cuir, laine, coton, lin, soie, huile, bois, gants, bottes, souliers, tissus de laine, de coton, de lin, de soie.
Alors il nous sera possible de décider la question par le fait ; nous verrons bien si l’Angleterre s’est bien gardée d’entrer dans la voie de la liberté ; puis il restera au ' Constitutionnel à nous dire à quelle nation elle a demandé cette liberté comme condition des mesures qu’elle a cru devoir prendre.
Ensuite le Constitutionnel, exploitant habilement cette ancienne tactique qui consiste à mettre les intérêts aux prises et à les irriter en les touchant par le côté sensible, demande aux Bordelais s’ils sont préparés à une réforme du tarif en ce qui concerne les droits de navigation.
Je n’ai à me porter fort pour personne. Je sais que si l’on demande tour à tour à tous les privilégiés : Voulez-vous voir cesser votre privilége ? — on court grand risque qu’ils ne répondent : non ou au moins pas encore.
« Nous sommes tous de Lille en ce point… »
Et voilà pourquoi je comprends très bien cette stratégie de la part d’un protectioniste, car elle seconde merveilleusement ses desseins ; mais je ne la comprends pas de la part d’un homme qui cherche sincèrement le triomphe de la liberté et de la justice pour tous.
Mais entrons dans le fond de la question. Le Constitutionnel affirme « que les ports de mer se sont toujours élevés contre la réciprocité, en matière de navigation. »
C’est possible, mais en même temps les ports se plaignent que la marine marchande décline sans cesse.
Et à quoi conduit, en fait de navigation, la non-réciprocité ? Le voici :
Un armateur du Havre avait fait construire trois magnifiques bateaux à vapeur pour faire un service régulier entre cette ville et Saint-Pétersbourg. Il acquitta 300,000 francs de droits pour les machines qui étaient anglaises. Elles étaient servies par des mécaniciens français, comme les bateaux étaient montés par des marins français.
Ainsi l’honorable armateur, en organisant cette belle entreprise, avait servi les intérêts de notre marine aussi bien que ceux du commerce.
Les choses en étaient là, quand la France augmenta les droits sur les graines oléagineuses et la ’’surtaxe’’ de celles qui arrivent par navires étrangers.
Voilà donc les navires russes exclus de nos ports.
La Russie a senti le coup, et par un ukase elle a élevé de 50 pour 100 les droits sur les produits arrivant en Russie sous pavillon français.
Et voilà nos navires exclus des ports russes.
Or, qu’arrive-t-il de là ?
C’est que dorénavant tout bâtiment, à laquelle des deux nations qu’il appartienne, doit faire deux voyages pour un fret.
Car, s’il est russe, il faut qu’il vienne à vide, chez nous, chercher des marchandises ; et s’il est français, force est qu’il aille à vide chercher des produits russes.
Ainsi la réciprocité s’est établie, mais c’est une réciprocité de gênes, d’entraves et de travail perdu.
Voilà-t-il pas un beau résultat ?
Mais écoutons la fin de l’histoire.
L’entreprise de l’armateur du Havre ne pouvant plus continuer, il est sur le point de vendre ses trois steamers à des Anglais. Et remarquez ceci : les Anglais ne lui rembourseront certainement pas les 300,000 francs de droits qu’ont acquittés les machines. Ils ne payeront pas non plus toute la valeur des steamers, dont le propriétaire n’a que faire. Ils pourront donc, au besoin, établir le fret au-dessous du taux normal, et se servir de nos capitaux pour nous battre chez nous.
Et tout cela parce qu’ils ont un traité de réciprocité avec la Russie et que nous n’en avons ni n’en voulons.
Un mot encore sur l’intérêt maritime.
Un constructeur de Marseille médisait : Le navire que je livre aux Italiens pour 70,000 francs, coûte aux Français 100,000 francs, à cause des droits.
Mettons d’abord le trésor hors de cause. Le 'Constitutionnel nous apprend que la douane lui vaut 160 millions, « et il est plus que douteux, ajoute-t-il, qu’un accroissement dans les transactions et une augmentation d’impôts indirects, qui en seraient la conséquence, au dire des libres-échangistes, remplirait le vide causé par la suppression des douanes. »
Où le Constitutionnel a-t-il pris que les partisans du libre-échange invoquent une augmentation d’impôts indirects ? C’est là une insinuation dont la portée est facile à comprendre. Elle a sans doute pour but de jeter l’alarme dans le pays, de soulever contre nous l’opinion publique. Toujours de la stratégie ! mais encore faudrait-il qu’elle fût fondée sur quelque chose de spécieux. En quoi l’abrogation de la protection compromettrait-elle le trésor ? J’ai toujours compris qu’une marchandise qui n’entre pas ne paye pas de droits… au trésor s’entend, car elle fait peser sur le consommateur une taxe odieuse.
Je prie le Constitutionnel de nous dire combien le trésor retire des droits sur le fer. Pour lui éviter des recherches, je le lui dirai : c’est trois millions. — Au reste, si l’État veut affermer la douane à 160 millions, à la condition de n’élever aucuns droits et de les abaisser tous, j’ose dire qu’une compagnie sera prête avant la fin de l’année. Que le monopole ne parle donc plus du trésor qu’il opprime, comme il opprime le consommateur.
Mais voici la grande difficulté : « Il est difficile d’arriver à une pondération exacte et rigoureuse de tous les intérêts. Un changement brusque de régime douanier, favorisant les uns, ruinerait évidemment les autres. »
Brusquerie à part, qui donc demande que le gouvernement pondère tous les intérêts ? Ce qu’on lui demande, c’est qu’il les laisse se pondérer entre eux par l’échange. — Et puis, n’y a-t-il aucune distinction à faire entre deux intérêts dont l’un demande à n’être pas opprimé par l’autre ?
« Nous n’examinerons pas, dit le Constitutionnel, si le régime protecteur prend sa source dans une erreur des gouvernements ou dans la nécessité des industries qui se sont établies dans le pays. Il suffit qu’il existe et qu’il ait créé de nombreux intérêts pour qu’on n’y touche qu’avec prudence. »
Vous n’examinez pas !… Mais précisément c’est ce qu’il faut examiner. Il n’est pas indifférent que la protection douanière soit ou non une erreur, soit ou non une injustice. Cela change complétement la position des parties belligérantes. Les droits acquis, dont le monopole se fait un titre, perdent bien de leur force, s’ils sont mal acquis, s’ils sont acquis aux dépens d’autrui.
Quand le choléra régnait à Paris, il y favorisait certaines industries ; les médecins, les pharmaciens, les droguistes, les entrepreneurs de pompes funèbres, tendaient à se multiplier sous son influence. Si l’État eût trouvé un moyen de chasser ce fléau, qu’aurait-on pensé d’un publiciste qui serait venu dire : Je n’examine pas si le choléra est un bien ou un mal ; il suffit qu’il existe et qu’il ait créé de nombreux intérêts pour qu’on n’y touche qu’avec prudence ? —
FN: Mémorial bordelais du 2 mai 1846.(Note de l’édit.)
1re lettre au Journal des Débats [2 mai 1846] ↩
BWV
1846.05.02 “Lettre au rédacteur du *Journal des Débats*. Première lettre” (First Letter to the Editor of the *Journal des débats*) [*Journal des Débats*, 2 mai 1846] [OC7.20, p. 96]
Lettre au rédacteur du Journal des débats [1]
Première lettre
Monsieur,
Me permettrez-vous d’ajouter quelque chose aux judicieuses observations que vous faites, dans votre feuille du 28 avril, au sujet des modifications que l’Angleterre fait subir à ses tarifs ?
Vous envisagez cette réforme au point de vue spécial de l’influence qu’elle pourra exercer sur notre commerce. Vous faites remarquer que nos ventes dans le Royaume-Uni devront nécessairement s’accroître, puisque les droits d’entrée y seront considérablement réduits, quelquefois abolis sur une foule d’articles, tels que céréales, bestiaux, beurre, fromage, eau-de-vie, vinaigre, soieries, tissus de laine et de lin, peaux ouvrées, savons, chapeaux, bottes, horlogerie, carrosserie, ouvrages en métaux, cuivre, bronze, plomb ou étain, papiers de tenture, etc., etc.
Vous pensez, avec raison, que cette grande mesure aura pour effet de développer considérablement les échanges de la Grande-Bretagne avec les États continentaux.
Assurément, il n’est pas possible de douter que la réforme anglaise n’ouvre de nouveaux débouchés aux produits des autres peuples.
Mais qui s’emparera de ces débouchés nouveaux ? Il me semble évident que ce sont les nations qui les premières réformeront leurs propres tarifs.
Tout négociant sait que ce qui favorise ou entrave les exportations, c’est le plus ou moins de facilité à opérer les retours. Vendre pour de l’argent, c’est une demi-opération qui supporte les frais d’une opération entière, et qui, par ce motif, sourit beaucoup moins aux négociants qu’aux théoriciens de cabinet.
Je me ferai comprendre par un exemple.
Vous avez cité le beurre parmi les articles dont notre exportation pourra s’accroître.
Je suppose que deux navires entrent dans la Tamise, l’un venant de France, l’autre de Hollande, tous les deux chargés de beurre. Je suppose encore que le prix de revient soit identique.
Ici on pourra m’arrêter et me dire que de telles suppositions ne se réalisent jamais ; mais comme je cherche l’ influence de deux systèmes de douane différents sur deux opérations analogues, je dois bien raisonner comme les géomètres, sur cette formule : toutes choses égales d’ailleurs.
Ainsi admettons qu’en entrant en rivière le beurre normand et le beurre hollandais reviennent à 100 fr. les 100 kilogr. ; admettons encore que le fret ajoutera 5 fr. à ce prix, et que les spéculateurs veulent faire un bénéfice de 10 p. 100.
Voici le compte du négociant français :
| Prix de revient du beurre . . . | 100 | fr. |
| Fret . . . | 5 | |
| Retour à vide du navire . . . | 5 | |
| Bénéfice . . . | 10 | |
| Total . . . | 120 | fr. |
Au-dessous de ce cours, il y aurait perte, tout au moins absence de bénéfice, et ce genre de commerce ne pourrait continuer.
Voici maintenant le compte du négociant hollandais :
| Prix de revient du beurre . . . | 100 | fr. |
| Fret | 5 | |
| Retour du navire : néant, puisque les frais en seront supportés par la cargaison de retour. | 0 | |
| Bénéfice, comme ci-dessus . . . | 10 | |
| Total . . . | 115 | fr. |
Par où l’on voit que le Hollandais pourra établir le cours à 115 fr., gagner encore et chasser le Français du marché.
Et il le fera même nécessairement sous l’aiguillon de la concurrence que lui feront ses compatriotes.
Je pourrais, monsieur le Rédacteur, tirer de là bien des conséquences ; faire voir que le beurre français n’attendra pas d’être chassé des marchés anglais ; que par cela seul qu’il ne pourra s’y vendre, il ne sera pas produit en Bretagne et en Normandie ; qu’il y aura donc dans ces provinces moins de prairies artificielles et naturelles, moins de bestiaux, moins d’engrais, moins de capitaux engagés dans l’agriculture, etc., etc.
On me dira sans doute que, d’un autre côté, par cela seul que le navire français n’a pu rapporter de la toile et des rails, ces mêmes capitaux payeront des fileurs et des mineurs.
Reste à savoir si cet emploi forcé est plus avantageux que l’autre. Je me garderai bien d’entrer ici dans cette discussion, et je terminerai en faisant observer que le beurre n’a été pris que comme exemple ; ce que j’en ai dit s’applique à l’ensemble de nos transactions.
Après avoir montré l’influence de la réforme anglaise sur celles de nos industries nationales qu’elle semble d’abord devoir développer, il serait utile de rechercher la condition qu’elle prépare à nos productions les plus protégées. Ce sera peut-être l’objet d’un second article.
Agréez, etc.
FN: Journal des Débats du 2 mai 1846.(Note de l’édit.)
Déclaration de principes(Association pour la liberté des échanges) [10 mai 1846] ↩
BWV
1846.05.10 “Déclaration de principes (Association pour la liberté des échanges)” (Declaration of Principles of the Free Trade Association) [*Libre-Échange*, 10 mai, 1846] [OC2.1, p. 1]
Déclaration [1]
10 mai 1846
Au moment de s’unir pour la défense d’une grande cause, les soussignés sentent le besoin d’exposer leur croyance ; de proclamer le but, la limite, les moyens et l’esprit de leur association.
L’échange est un droit naturel comme la propriété. Tout citoyen, qui a créé ou acquis un produit, doit avoir l’option ou de l’appliquer immédiatement à son usage, ou de le céder à quiconque, sur la surface du globe, consent à lui donner en échange l’objet de ses désirs. Le priver de cette faculté, quand il n’en fait aucun usage contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et uniquement pour satisfaire la convenance d’un autre citoyen, c’est légitimer une spoliation, c’est blesser la loi de la justice.
C’est encore violer les conditions de l’ordre ; car quel ordre peut exister au sein d’une société où chaque industrie, aidée en cela par la loi et la force publique, cherche ses succès dans l’oppression de toutes les autres !
C’est méconnaître la pensée providentielle qui préside aux destinées humaines, manifestée par l’infinie variété des climats, des saisons, des forces naturelles et des aptitudes, biens que Dieu n’a si inégalement répartis entre les hommes que pour les unir, par l’échange, dans les liens d’une universelle fraternité.
C’est contrarier le développement de la prospérité publique ; puisque celui qui n’est pas libre d’échanger ne l’est pas de choisir son travail, et se voit contraint de donner une fausse direction à ses efforts, à ses facultés, à ses capitaux, et aux agents que la nature avait mis à sa disposition.
Enfin c’est compromettre la paix entre les peuples, car c’est briser les relations qui les unissent et qui rendront les guerres impossibles, à force de les rendre onéreuses.
L’Association a donc pour but la liberté des Échanges.
Les soussignés ne contestent pas à la société le droit d’établir, sur les marchandises qui passent la frontière, des taxes destinées aux dépenses communes, pourvu qu’elles soient déterminées par la seule considération des besoins du Trésor.
Mais sitôt que la taxe, perdant son caractère fiscal, a pour but de repousser le produit étranger, au détriment du fisc lui-même, afin d’exhausser artificiellement le prix du produit national similaire et de rançonner ainsi la communauté au profit d’une classe, dès cet instant la Protection ou plutôt la Spoliation se manifeste ; et c’est là le principe que l’Association aspire à ruiner dans les esprits et à effacer complétement de nos lois, indépendamment de toute réciprocité et des systèmes qui prévalent ailleurs.
De ce que l’Association poursuit la destruction complète du régime protecteur, il ne s’ensuit pas qu’elle demande qu’une telle réforme s’accomplisse en un jour et sorte d’un seul scrutin. Même pour revenir du mal au bien et d’un état de choses artificiel à une situation naturelle, des précautions peuvent être commandées par la prudence. Ces détails d’exécution appartiennent aux pouvoirs de l’État ; la mission de l’Association est de propager, de populariser le principe.
Quant aux moyens qu’elle entend mettre en œuvre, jamais elle ne les cherchera ailleurs que dans des voies constitutionnelles et légales.
Enfin l’Association se place en dehors de tous les partis politiques [2]. Elle ne se met au service d’aucune industrie, d’aucune classe, d’aucune portion du territoire. Elle embrasse la cause de l’éternelle justice, de la paix, de l’union, de la libre communication, de la fraternité entre tous les hommes ; la cause de l’intérêt général, qui se confond, partout et sous tous les aspects, avec celle du Public consommateur.
FN:En composant ce volume presque exclusivement d’articles extraits d’une feuille hebdomadaire, lesquels, dans la pensée de l’auteur, n’étaient pas destinés à être ainsi réunis, nous essayons de les classer dans l’ordre suivant : 1° Exposition du but de l’association libre-échangiste, de ses principes et de son plan d’opérations ; — 2° articles relatifs à la question des subsistances ; — 3° polémique contre les journaux, appréciation de divers faits ; — 4° discours publics ; — 5° variétés et nouvelle série de sophismes économiques. (Note de l’éditeur.)
FN:L’année suivante, l’auteur commentait ainsi cette phrase :
« Est-il possible de penser de même sur la liberté commerciale et de différer en politique ? »
Il nous suffirait de citer des noms d’hommes et de peuples pour prouver que cela est très-possible et très-fréquent.
Le problème politique, ce nous semble, est celui-ci :
« Quelles sont les formes de gouvernement qui garantissent le mieux et au moindre sacrifice possible à chaque citoyen sa sûreté, sa liberté et sa propriété ? »
Certes, on peut ne pas être d’accord sur les formes gouvernementales qui constituent le mieux cette garantie, et être d’accord sur les choses mêmes qu’il s’agit de garantir.
Voilà pourquoi il y a des conservateurs et des hommes d’opposition parmi les libre-échangistes. Mais, par cela seul qu’ils sont libre-échangistes, ils s’accordent en ceci : que la liberté d’échanger est une des choses qu’il s’agit de garantir.
Ils ne pensent pas que les gouvernements, n’importe leurs formes, aient mission d’arracher ce droit aux uns pour satisfaire la cupidité des autres, mais de le maintenir à tous.
Ils sont encore d’accord sur cet autre point qu’en ce moment l’obstacle à la liberté commerciale n’est pas dans les formes du gouvernement, mais dans l’opinion.
Voilà pourquoi l’Association du libre-échange n’agite pas les questions purement politiques, quoique aucun de ses membres n’entende aliéner à cet égard l’indépendance de ses opinions, de ses votes et de ses actes.
Extrait du Libre-Échange, du 14 novembre 1847. (Note de l’éditeur.)
2e Lettre au rédacteur du Journal des Débats [14 mai 1846] ↩
BWV
1846.05.14 “Lettre au rédacteur du *Journal des Débats*. Seconde lettre” (Second Letter to the Editor of the *Journal des débats*) [*Mémorial bordelais*, 14 mai 1846] [OC7.21, p. 99]
Lettre au rédacteur du Journal des débats [1]
Seconde lettre
Monsieur le Rédacteur,
J’ai essayé de montrer par un exemple, et en évitant la dissertation, comment l’immense débouché qui va s’ouvrir dans la Grande-Bretagne aux produits européens ne profiterait guère qu’aux nations qui, les premières, modifieront leurs tarifs. Il est aisé de comprendre que les autres, réduites par la difficulté des retours à mettre au compte d’une demi-opération les frais d’une opération, seront hors d’état de soutenir la lutte.
Il suit de là que nos industries nationales, celles dont notre climat et notre génie favorisent le développement, gagneront moins qu’on ne devait s’y attendre à la réforme anglaise.
Comment s’en trouveront nos industries protégées ?
Si quelque chose m’étonne, c’est qu’elles n’aient pas déjà jeté leur cri d’alarme, car je les crois de beaucoup les plus menacées. D’où leur vient cette sécurité ? Est-ce confiance en elles-mêmes, est-ce découragement ?
Notre tarif actuel est calculé pour un ordre de choses qui évidemment va cesser. La protection qu’il a en vue est corrélative au prix qu’ont les choses au dehors ; or, ce prix venant à baisser, la protection deviendra naturellement inefficace.
Quand un homme rencontre une barrière, il a deux moyens de la surmonter : le premier, c’est de l’abaisser ; le second, c’est d’exhausser le sol autour d’elle. Les Anglais ont devant eux la barrière de nos tarifs ; ils ne peuvent rien sur notre législation, et par conséquent il ne dépend pas d’eux de diminuer la hauteur absolue de l’obstacle. Que font-ils ? Ils en diminuent la hauteur relative, en accumulant à ses pieds des produits et en les allégeant pour ainsi dire d’une partie de leur prix.
Voyons comment les choses vont se passer.
Nous fabriquons un produit X pour 150 fr.
Les Anglais peuvent vendre, à l’entrepôt, X à 100 fr.
L’État qui, selon l’expression de M. de Saint-Cricq, dispose des consommateurs et les réserve aux producteurs, frappe le produit anglais d’un droit de 50 fr, et rétablit ainsi, aux dépens du public français, ce qu’on appelle l’égalité des conditions.
Mais, sous le régime actuel des tarifs anglais, plusieurs éléments entrent dans ce prix de 100 fr. du produit X, lesquels vont disparaître par la réforme.
1° La matière première ne payera plus de taxe, ce qui permettra une réduction de 10 fr. peut-être à la vente.
2° La vie à bon marché, donnée au peuple, entraînera une baisse égale.
3° La facilité des retours, qui n’existe pas maintenant et que la réforme va conférer aux Anglais, peut équivaloir à une diminution de 5 fr.
C’est donc à 75 fr. au lieu de 100 fr. que le produit X pourra être livré dans notre entrepôt. Ajoutez-y les 50 fr. de droits, et vous n’arrivez qu’à 125 fr., le produit français restant toujours à 150 fr.
S’il veut être fidèle au principe de la protection, l’État devra donc élever le droit de 50 à 75 fr. Or, le droit de 50 fr. sur une marchandise de 100 fr. équivalait à 50 pour 100 ; celui de 75 fr. sur un produit de 75 fr. sera de 100 pour 100.
Par où l’on voit que si le prix baisse d’un quart, il faut que le tarif s’élève du double.
Les industries privilégiées peuvent donc préparer leurs armes, leurs manœuvres secrètes, leurs requêtes et leurs doléances.
Et le ministère aussi peut s’attendre à une laborieuse campagne. Déjà il a bien du mal à maintenir la trêve entre ceux qui profitent et ceux qui souffrent du régime protecteur ; que sera-ce, quand il sera tiraillé dans les deux sens opposés avec une double intensité ? quand les monopoleurs apporteront d’excellentes raisons pour motiver l’exhaussement du tarif, précisément à l’instant où, pour le faire abaisser, les consommateurs donneront de meilleures raisons encore ?
Mais, puisque j’ai nommé le consommateur, permettez-moi une réflexion.
Au point de vue des hommes qui se disent socialistes, j’ encourrai, je le sens, un grave reproche pour avoir dit que la vie à bon marché, fruit de la réforme anglaise, se traduira en baisse du produit fabriqué.
« Vous voyez bien, diront-ils, que c’est toujours la guerre du riche contre le pauvre, du capital contre le travail. Voilà la secrète pensée des manufacturiers, le machiavélisme britannique qui se dévoile. Ce qu’on veut, c’est abaisser le taux des salaires, c’est se mettre en mesure de sous-vendre (undersell) tous les rivaux. L’ouvrier, c’est une machine dont on cherche un emploi plus économique, etc., etc. »
J’ignore si les Anglais ont fait ce calcul ; mais s’ils l’ont fait, j’admire leur philanthropie ; car, quoi de plus généreux que d’appeler le monde entier au bénéfice de leur réforme ? Si, à mesure qu’ils abrogent les taxes sur les matières premières, ou qu’ils réduisent le taux de la main-d’œuvre, ou qu’ils se mettent à même de naviguer à meilleur compte, ils abaissent proportionnellement le prix du produit ; s’ils font à l’acheteur une remise de 10 francs à raison de la première circonstance, de 10 francs pour la seconde, de 5 francs pour la troisième, — je le demande, qui donc, en définitive, recueillera le fruit de la réforme, le plus clair et le plus net de ses avantages ? n’est-ce pas l’acheteur, le consommateur, le Français, le Russe, l’Italien, l’homme rouge, noir ou jaune, quiconque, en un mot, n’est pas assez fou pour s’interdire, par d’absurdes tarifs, toute participation aux bienfaits de cette grande mesure ?
Et voilà, messieurs les Socialistes, la vraie fraternité, non point la fraternité fouriériste, mais la fraternité providentielle : que les nations ne puissent rien accomplir de grand et de beau, même dans des vues égoïstes, qui ne profite aussitôt à l’humanité tout entière.
J’aimerais à aborder ce vaste sujet, mais je ne dois pas abuser de votre complaisance et de la patience du lecteur.
Sans vouloir faire ici du prospectus, me sera-t-il permis de dire qu’il est traité d’une manière générale dans un article du Journal des Économistes emprunté à l’Encyclopédie du dix-neuvième siècle, intitulé : De la concurrence.
FN:Reproduite par le Mémorial bordelais du 14 mai 1846.
De la concurrence (On Competition), [JDE, Mai 1846] [??] ↩
BWV
?? 1846.05.15 "De la concurrence,” (On Competition), JDE, Mai 1846, T. XIV, pp. 106-122. [??] [rewritten for Ec. Harmonies. Chap. X “Concurrence”]
Originally published as an article article “Concurrence" in Encyclopédie du dix-neuvième siècle: répertoire universel des sciences, des lettres et des arts avec la biographie de tous les hommes célèbres, ed. Ange de Saint-Priest (Paris: Au bureau de l'Encyclopédie du dix-neuvième siècle, Impr. Beaulé, Lacour, Renoud et Maulde, 1846). Tome huitième, pp. 389-400. Encyclopedia article and JDE articles are identical. Substantially revised for Economic Harmonies (1851 ed.) with new introduction and new examples (e.g. Enfantin dropped).
Text: Encyclopédie 19ieme Siècle version↩
[389]
CONCURRENCE. — J'ai à exposer les effets d'une des lois auxquelles la Providence a confié le progrès de la société humaine; de cette loi qui a pour mission d'égaliser le bien-être et les conditions parmi les membres de la grande famille, de faire tomber dans le domaine de la communauté la jouissance des biens que la nature semblait avoir réservés à certaines contrées, et les conquêtes dont le génie de chaque siècle accroît le trésor des générations qui le suivent; loi féconde en harmonies sociales, immense dans ses résultats généraux, mais souvent brutale dans ses procédés, loi méconnue do notre époque, et qui, plus que toute autre, atteste l'incommensurable supériorité des desseins de Dieu sur les vaines et impuissantes combinaisons des hommes.
Quelle est cette puissance fatale sous [390] laquelle nous nous débattons en vain depuis que se sont écoulés les jours insoucieux de l'enfance; qui ne nous laisse pas le temps d'apprendre ce qu'il nous est indispensable de savoir; qui nous jette dans les tumultueuses avenues du monde et, tout en contrariant notre élan vers les objets de nos espérances, ne cesse de nous crier : Marche t marche! qui n'écrase pas est écrasé?
Oh! la réponse s'élève immense, unanime de tous les points du globe, du palais et de la chaumière , de la ferme et de la métairie, du chantier et de l'atelier, du magasin et de l'échoppe, du cabinet et de l'étude, du comptoir et du bureau, du péristyle de la bourse et des antichambres du pouvoir : la concurrence! la concurrence!
Mais quelle est la puissance bienfaisante qui accomplit le miracle étonnant dont mes yeux sont témoins? Je suis admis au foyer d'un de ces hommes de la classe industrieuse que la concurrence importune, et que vois-je ? Je vois qu'il consomme en un jour ce qu'il ne parviendrait pas à produire pendant toute la durée de son existence, quand dix mille vies viendraient s'ajouter bout à bout à la sienne. Et quand j'essaye de supputer combien il a fallu de temps, d'efforts, de capitaux , d'instruments, de véhicules pour que ce cabinet reçût le simple ameublement que j'y trouve, pour que ces tapis, ces fauteuils, ces draperies, ces porcelaines, ces bronzes et ces cristaux vinssent s'accumuler dans cet étroit espace; quand je considère que ce n'est là, peut-être, que la millième partie de ce que mon hôte a puisé dans le marché général du monde; que néanmoins il n'a rien dérobé à personne, ni privé qui que ce soit de quoi que ce soit; qu'il a réellement produit la valeur de ces innombrables objets, sans occuper ses mains à autre chose qu'à manier une plume, une aiguille , une navette ou un rabot; quand je viens à songer que cette immense disproportion apparente que je remarque entre les productions et les consommations d'un individu, que ce prodige étonnant se réalise, à un degré quelconque, en faveur de tous les hommes répandus sur la surface du globe, quelque extraordinaire, quelque contradictoire même que cela puisse paraître; alors je reste confondu d'admiration devant la beauté, la majesté, la puissance de ce mécanisme social qui a pour moteur la concurrence, et laissant à d'autres la prétention d'inventer une organisation plus ingénieuse, je borne la mienne à étudier, à comprendre, à aimer et, si je puis, à décrire celle qui est sortie toute faite des mains de la sagesse éternelle.
Ainsi, parce que l'homme a , avec le travail , deux rapports très-distincts, parce qu'il est tour à tour producteur d'utilités qu'il ne consomme pas et consommateur d'utilités qu'il ne produit pas, la concurrence doit être envisagée, relativement à lui, sous deux aspects très-différents.
Au premier point de vue, au point de vue individualiste, la pensée intime , incurable, éternelle de tout travailleur est la solution de ce problème : « Faire que les utilités que j'apporte dans le milieu social y soient aussi recherchées et aussi rares que possible.» Et voilà pourquoi le producteur, en tant que tel, réagit contre ses concurrents, les réprouve, les détruit autant qu'il est en lui, et appelle à son aide la force, la ruse, la loi, le sophisme, le tarif, le monopole, la protection et la restriction.
Mais le problème social est celui-ci : Faire que, pour un travail déterminé qu'il livre au marché général, chaque homme en retire une somme d'utilités qui tende sans cesse à s'accroître et à s’égaliser. Nous allons voir que c'est là l'œuvre de la concurrence.
Il faut d'abord établir que l’utilité que renferme tout objet y a été mise par la coopération de deux puissances, la nature et le travail.
Le blé est dû en partie à la libéralité de la nature, à l'air, à la lumière, à la chaleur, aux sels qu'elle a mis sans mesure à notre disposition. D'un autre côté, il a fallu labourer, semer, herser, moissonner. S'agit-il de convertir ce blé en farine, la nature fournit la force de la gravitation mise en œuvre par une chute d'eau, la dureté de la pierre meulière, et l'homme concourt au résultat en surveillant et réglant l'action de ces forces, en la dirigeant vers une fin déterminée. — Il en est ainsi dans toutes les industries.
De ces deux forces qui coopèrent à la production de l'utilité, l'une, celle de la nature, est gratuite; l'autre, celle du travail, est seule la matière de l'échange, de la rémunération, de la valeur.
Quelque précieux que soit un service naturel, si la main ou le génie de l'homme n'y est pour rien, il est gratuit, il est dépourvu de valeur dans le sens économique du mot. Jamais l'industrie humaine n'a produit ni-[391] ne produira rien qui nous soit plus utile, nécessaire, indispensable que l'eau, l'air, la chaleur, la lumière, et cependant nous en jouissons à titre gratuit quand nos organes les recueillent immédiatement de la nature , sans l'intervention d'aucun effort. Mais, pour avoir de l'eau , faut-il l'aller chercher à une grande distance, c'est une peine à prendre ou à rémunérer. Voulons-nous séparer de l'air respirable un des éléments qui le composent, par exemple le gaz hydrogène, pour alimenter un aérostat, c'est un travail à accomplir; et voilà pourquoi le gaz hydrogène, qui n'est que la partie, a une valeur, tandis que l'air respirable, qui est le tout, n'en a pas.
Nous passerions ainsi en revue tous les objets de nos transactions, et nous trouverions toujours qu'ils sont pourvus d'une utilité composée : une portion y a été mise par la nature, et celle-là est gratuite; l'autre par le travail, et celle-là est l'objet de l'échange, par la très-simple raison que, pour jouir d'une utilité qui a coûté une peine, il faut la prendre, ou la restituer, sous une autre forme, à ceux qui la prennent pour nous.
Le désir qu'éprouve l'homme d'améliorer sa condition le porte à accroître le plus qu'il peut la coopération de la nature à la production de l'utilité. C'est là le champ ouvert au génie humain. L'eau, le vent, la chaleur, la lumière, la gravitation, l'électricité, toutes les lois du monde physique sont mises de plus en plus à contribution , d'où il suit que de génération en génération une quantité de travail humain peut, pour parler ainsi, servir de véhicule à une plus forte somme de services naturels, et ceci nous montre qu'il n'y a rien d'insoluble, rien de contradictoire dans le problème social que je posais tout à l'heure en ces termes :Faire que la consommation de l'homme s'accroisse plus rapidement que son travail.
Non-seulement le progrès ainsi expliqué est possible, mais il est nécessaire, il est fatal, il est une conséquence providentielle de la perfectibilité de nos facultés; et nous verrions le bien-être se répandre rapidement sur l'espèce humaine, si, par une autre loi dont nous n'avons pas à nous occuper ici, elle ne croissait pas en nombre en même temps qu'en capacité de production.
J'avais besoin d'exposer succinctement ces notions générales pour montrer dans toute sa puissance, dans toutes ses harmonies l'action sociale de la concurrence.
Ce qui s'échange , ce qui fait la base de nos transactions, ai-je dit, c'est le travail, c'est la peine, c'est l'effort, en sorte qu'on pourrait, en langage un peu vulgaire, définir ainsi l'économie politique : c'est la théorie des services que les hommes se rendent les uns aux autres à charge de revanche.
Mais le travail n'est pas une qualité homogène, une quantité absolue qui se pèse ou se nombre, qui se mesure au chronomètre ou au dynamomètre. Il y a du travail plus ou moins favorisé par le milieu où il s'exerce, plus ou moins intelligent, pénible, dangereux , précaire, heureux même. Il ne faut pas perdre de vue, d'ailleurs, qu'il ne s'aliène que volontairement, que chacun reste juge de la peine qu'il exige en retour de la peine qu'il cède , ainsi que des circonstances qui peuvent le déterminer à être exigeant ou facile. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris qu'il y ait une grande inégalité dans les rémunérations, et, en définitive, dans le bien-être des hommes.
Examinons les principales circonstances qui influent sur cette inégalité et comment elle tend à s'effacer sous l'action de la concurrence.
Une des plus évidentes, c'est la possibilité de s'emparer d'un des agents naturels dont je parlais tout à l'heure. Ces agents ne sont pas répartis d'une manière égale sur la surface du globe. Ici la terre est plus féconde , là la chaleur plus intense; sur tel point il y a des dépôts de houille considérables, sur tel autre des rivières poissonneuses, etc., etc.
Sans la concurrence, ceux qui sont à portée de ces avantages naturels ne permettraient aux autres hommes d'y participer que moyennant une rétribution excessive et inaltérable; en sorte que nous payerions au producteur non-seulement sa peine, mais les dons de la nature. Un homme qui vit sous les tropiques pourrait dire à un Européen : « Grâce à mon soleil, je puis obtenir une balle de coton avec une peine égale à dix, tandis que vous ne le pouvez qu'avec une peine égale à cent. Or, pour vous céder ce coton, ce n'est pas ma peine qui est la mesure de mes exigences, mais la vôtre. Ce n'est pas à vous, mais à moi, que Dieu a donné une température élevée. Ainsi, voilà mon coton; donnez-moi en échange un objet dans lequel « vous ayez mis une peine égale à cent ou à peu près. Sinon, faites le coton [392] vous-même. » — Mais la concurrence ne permet pas ces marchés léonins, elle ne permet pas à un homme de se faire rétribuer pour une peine qu'il n'a pas prise, pour un travail qu'il n'a pas accompli, et elle tend à rendre communs et gratuits pour tous les hommes ces biens naturels qui semblaient être l'apanage exclusif de quelques-uns.
L'homme des tropiques n'a pu faire prévaloir sa prétention de mesurer son salaire à ma peine et non à la sienne. Elle était trop rémunérée pour ne pas exciter la rivalité. La concurrence s'en est mêlée; le coton a été offert au rabais jusqu'à ce que l'Européen paye, avec une peine égale à dix, ce que l'Indien produit avec une peine égale à dix. Or, quand les choses en sont là, quand je ne donne d'une balle de coton qu'une peine égale au dixième de celle que j'aurais dû prendre pour le produire en France, je le demande, n'y a-t-il pas échange de travail contre travail, et moi, consommateur européen, n'obtiens-je pas, par-dessus le marché, la coopération du climat des tropiques? Donc, grâce à la concurrence, je suis devenu, tous les hommes sont devenus, au même titre que les Indiens et les Américains, c’est-à-dire à titre gratuit, participants de la libéralité de la nature en tant qu'elle intéresse la production du coton. Il en est de même de tous les produits imaginables.
Il y a un pays, l'Angleterre, qui a d'abondantes mines de houille. C'est là, sans doute, un grand avantage local, surtout si l'on suppose, comme je le ferai pour plus de simplicité dans la démonstration, qu'il n'y a pas de houilles sur le continent. — Tant que l'échange n'intervient pas, l'avantage qu'ont les Anglais, c'est d'avoir du feu en plus grande abondance que les autres peuples, de s'en procurer avec moins de peine, sans entreprendre autant sur leur temps utile. Sitôt que l'échange apparaît, abstraction faite de la concurrence, la possession exclusive des mines les met à même de demander une rémunération considérable et de mettre leur peine à haut prix. Ne pouvant ni prendre cette peine nous-mêmes, ni nous adresser ailleurs, il faudra bien subir la loi. Le travail anglais, appliqué à ce genre d'exploitation , sera très-rétribué ; en d'autres termes la houille sera chère, et le bienfait de la nature pourra être considéré comme conféré à un peuple et non à l'humanité.
Mais cet état de choses ne peut durer; il y a une grande loi naturelle et sociale qui s'y oppose, la concurrence. Par cela même que ce genre de travail sera très-rémunéré en Angleterre, il y sera très-recherché, car les hommes recherchent toujours les grosses rémunérations. Le nombre des mineurs s'accroîtra à la fois par adjonction et par génération; ils s'offriront au rabais; ils se contenteront d'une rémunération toujours décroissante jusqu'à ce qu'elle descende a l’état normal, au niveau de celle qu'on accorde généralement, dans le pays, à tous travaux analogues. Cela veut dire que le prix de la houille anglaise baissera en France; cela veut dire qu'une quantité donnée de travail français obtiendra une quantité de plus en plus grande de houille anglaise, ou plutôt de travail anglais incorporé dans de la houille; cela veut dire enfin, et c'est là ce que je prie d'observer, que le don que la nature semblait avoir fait à l'Angleterre, elle l'a conféré, en réalité, à l'humanité tout entière. La houille de Newcastle est prodiguée gratuitement à tous les hommes; ce' n'est là ni un paradoxe ni une exagération : elle leur est prodiguée à titre gratuit, comme l'eau du torrent, à la seule condition de prendre la peine de l'aller chercher ou de restituer cette peine à ceux qui la prennent pour nous. Quand nous achetons la houille, ce n'est pas la houille que nous payons, mais le travail qu'il a fallu exécuter pour l'extraire et la transporter. Nous nous bornons à donner un travail égal que nous avons fixé dans du vin ou de la soie. Il est si vrai que la libéralité de la nature s'est étendue à la France, que le travail que nous restituons n'est pas supérieur à celui qu'il eût fallu accomplir si le dépôt houiller eût été en France. La concurrence a amené l'égalité entre les deux peuples par rapport à la houille, sauf l'inévitable et légère différence qui résulte de la distance et du transport.
J'ai cité deux exemples. Mon but était d'élucider ma pensée. Mais ne perdons pas de vue que la loi de la concurrence s'appliquant à tous les dons que la nature a inégalement distribués sur le globe, il faut la considérer comme le principe d'une juste et naturelle égalisation; il faut l'admirer, la bénir, comme la plus évidente manifestation de l'impartiale sollicitude de Dieu envers toutes ses créatures.
Je regrette que l'espace ne me permette pas de tirer les conséquences de la doctrine [393] que je viens d'établir; je me bornerai à en indiquer une. S'il est vrai, comme cela me paraît incontestable, que les divers peuples du globe soient amenés, par la concurrence, à n'échanger entre eux que du travail, de la peine de plus en plus nivelée, et à se donner réciproquement, par-dessus le marché, les services naturels que chacun d'eux a à sa portée, combien ne sont-ils pas aveugles et absurdes quand ils repoussent législativement des produits qui renferment une énorme proportion d'utilité gratuite?
Une autre circonstance qui place certains hommes dans une situation favorable et exceptionnelle quant à la rémunération, c'est la connaissance exclusive des procédés par lesquels il est possible de s'emparer des agents naturels. Ce qu'on nomme une invention est une conquête du génie humain. Il faut voir comment ces belles et pacifiques conquêtes, qui sont, à l'origine, une source de richesses pour ceux qui les font, deviennent bientôt, sous l'action de la concurrence, le patrimoine commun et gratuit de tous les hommes.
Les forces de la nature appartiennent bien à tout le monde. La gravitation, par exemple, est une propriété commune; elle nous entoure, elle nous pénètre, elle nous domine : cependant, s'il n'y a qu'un moyen de la faire concourir à un résultat utile déterminé et qu'un homme qui connaisse ce moyen, cet homme pourra mettre sa peine à haut prix ou refuser de la prendre, si ce n'est en échange d'une rémunération considérable. Sa prétention, à cet égard, n'aura d'autres limites que le point où il exigerait des consommateurs un sacrifice supérieur à celui que leur impose le vieux procédé. Il sera parvenu, par exemple, à anéantir les neuf dixièmes du travail nécessaire pour produire l'objet X.— Mais X a actuellement un prix courant déterminé par la peine que sa production exige selon la méthode ordinaire. L'inventeur vend X au cours; en d'autres termes, sa peine lui est payée dix fois plus que celle de ses rivaux. C'est là la première phase de l'invention.
Remarquons d'abord qu'elle ne blesse en rien la justice. Il est juste que celui qui révèle au monde un procédé utile reçoive sa récompense : A chacun selon sa capacité.
Remarquons encore que jusqu'ici l'humanité, moins l'inventeur, n'a rien gagné que virtuellement, en perspective pour ainsi dire, puisque pour acquérir le produit X elle est tenue aux mêmes sacrifices qu'il lui coûtait autrefois.
Cependant l'invention entre dans sa seconde phase, celle de l’imitation. Il est dans la nature des rémunérations excessives d'éveiller la convoitise. Le procédé nouveau se répand, le prix de X va toujours baissant, et la rémunération décroît aussi, d'autan plus que l'imitation s'éloigne de l'époque de l'invention, c'est-à-dire d'autant plus qu'elle devient plus facile, moins chanceuse et, partant, moins méritoire. Il n'y a certes rien là qui ne pût être avoué par la législation la plus ingénieuse et la plus impartiale.
Enfin l'invention parvient à sa troisième phase, à sa période définitive, celle de la diffusion universelle, de la communauté, de la gratuité; son cycle est parcouru, lorsque la concurrence a ramené la rémunération des producteurs de X au taux général et normal de tous les travaux analogues. Alors les neuf dixièmes de la peine épargnée par l'invention, dans l'hypothèse, sont une conquête au profit de l'humanité entière. L'utilité de X est la même; mais les neuf dixièmes y ont été mis par la gravitation, qui était autrefois commune à tous en principe et qui est devenue commune à tous dans cette application spéciale. Cela est si vrai, que tous les consommateurs du globe sont admis à acheter X par le sacrifice du dixième de la peine qu'il coûtait autrefois. Le surplus a été entièrement anéanti par le procédé nouveau.
Si l'on veut bien considérer qu'il n'est pas une invention humaine qui n'ait parcouru ce cercle, que X est ici un signe algébrique qui représente le blé, le vêtement, les livres, les vaisseaux, pour la production desquels une masse incalculable de peine a été anéantie par la charrue, la machine à filer, l'imprimerie et la voile; que cette observation s'applique au plus humble des outils, comme au mécanisme le plus compliqué, au clou, au coin, au levier, comme à la machine à vapeur et au télégraphe électrique, on comprendra, j'espère, comment se résout dans l'humanité ce grand problème : Qu'une masse, toujours plus considérable et toujours plus également répartie, d'utilités ou de jouissances vienne rémunérer chaque quantité fixe de travail humain.
J'ai fait voir que la concurrence fait tomber dans le domaine de la communauté et de la gratuité et les forces naturelles et les [394] procédés par lesquels on s'en empare; il me reste à faire voir qu'elle remplit la même fonction quant aux instruments au moyen desquels on met ces forces en œuvre.
Il ne suffit pas qu'il existe dans la nature une force, chaleur, lumière, gravitation, électricité; il rte suffit pas que l'intelligence conçoive le moyen de l'utiliser; il faut encore des instruments pour réaliser cette conception de l'esprit, et des approvisionnements pour entretenir pendant l'opération l'existence de ceux qui s'y livrent.
C'est une troisième circonstance favorable à un homme ou à une classe d'hommes , relativement à la rémunération, que de posséder des capitaux. Celui qui a en ses mains l'outil nécessaire au travailleur, les matériaux sur lesquels le travail va s'exercer et les moyens d'existence qui doivent se consommer pendant le travail, celui-là a une rémunération, à statuer; le principe en est certainement équitable, car le capital n'est qu'une peine antérieure, laquelle n'a pas encore été rétribuée. Le capitaliste est dans une bonne position pour imposer la loi, sans doute; mais remarquons que, même affranchi de toute concurrence, il est une limite que ses prétentions ne peuvent jamais dépasser; cette limite est le point où sa rémunération absorberait tous les avantages du service qu'il rend. Cela étant, il n'est pas permis de parler, comme on le fait si souvent, de la tyrannie du capital, puisque jamais sa présence ne peut nuire plus que son absence à la condition du travailleur. Tout ce que peut faire le capitaliste, comme l'homme des tropiques qui dispose d'une intensité de chaleur que la nature a refusée à d'autres, comme l'inventeur qui a le secret d'un procédé inconnu à ses semblables, c'est de leur dire : « Voulez-vous disposer de ma peine, j'y mets tel prix; le trouvez-vous trop élevé, faites comme vous avez fait jusqu'ici, passez-vous-en. »
Mais la concurrence intervient parmi les capitalistes. Des instruments, des matériaux, des approvisionnements n'aboutissent à réaliser des utilités qu'à la condition d'être mis en œuvre : il y a donc lutte parmi les capitalistes pour trou ver de l'emploi aux capitaux. Tout ce que cette lutte les force de rabattre sur les prétentions extrêmes dont je viens d'assigner les limites, se résolvant en une diminution dans le prix du produit, est donc un profit net, an gain gratuit pour le consommateur, c'est à-dire pour l'humanité!
Ici, il est clair que la gratuité ne peut jamais être absolue : puisque tout capital représente une peine, il y a toujours en lui le principe de la rémunération.
Nous avons vu qu'il y a une limite supérieure au delà de laquelle on n'emprunterait plus; cette limite, c'est zéro-service par l'emprunteur. De même, il y a une limite en deçà de laquelle on ne prêterait pas, et cette limite est zéro-rétribution par le prêteur. La concurrence entre les emprunteurs pousse la rémunération du capital vers la limite supérieure; la concurrence des prêteurs la rappelle vers la limite inférieure:c'est entre ces deux points qu'elle oscille, s'élevant, comme cela est juste et nécessaire, quand le capital est rare, s'abaissant quand il abonde.
Ce sujet est immense, je ne puis le traiter ici, et je me bornerai à constater un fait qui met au néant beaucoup de déclamations fort à la mode : ce fait, c'est que la civilisation tend à faire baisser le loyer des capitaux, qui se paye 20 pour 100 au Brésil, 10 pour 100 à Alger, 8 pour 100 en Espagne, 6pour 100 en Italie, 5 pour 100 en Allemagne, 4 pour 100 en France, 3 pour 100 en Angleterre, et moins encore en Hollande. Or tout ce que le progrès des temps anéantit sur le loyer des capitaux, perdu pour les capitalistes, n'est pas perdu pour l'humanité;c'est une force qui, comme les agents naturels, comme les procédés expéditifs, se résout en abondance, en égalisation, et hausse, par conséquent, le niveau général de l'espèce humaine.
Il me reste à étudier la concurrence que le travail fait au travail lui-même, sujet plus vaste encore que celui que je viens d'ébaucher. S'il fallait un volume pour suivre, à travers tontes ses métamorphoses, la destinée du capital, il en faudrait dix peut-être pour rectifier toutes les erreurs que les écoles sentimentalistes ont répandues de nos jours relativement au sort des travailleurs. Les exigences du cadre où je jette cette esquisse me forcent à me borner à quelques simples linéaments.
Une foule de circonstances contribuent à rendre inégale la rémunération du travail (je ne parle ici que du travail libre, soumis à la concurrence) : si l'on y regarde de près, on s'aperçoit que, presque toujours juste et nécessaire, cette inégalité prétendue n'est que de l'égalité réelle.
[395]
Toutes choses égales d'ailleurs, il y a plus de profits aux travaux dangereux qu'à ceux qui ne le sont pas; aux états qui exigent un long apprentissage et des déboursés longtemps improductifs, ce qui suppose, dans la famille, le long exercice de certaines vertus, qu'à ceux où suffit la force musculaire; aux professions qui réclament la culture de l'esprit et font naître des goûts délicats, qu'aux métiers où il ne faut que des bras. Tout cela n'est-il pas juste? Or la concurrence établit nécessairement ces distinctions : la société n'a pas besoin qu'un Fourier ou un père Enfantin en décident.
Parmi ces circonstances, celle qui agit de la manière la plus générale, c'est l'inégalité de l'instruction : or, ici comme partout, nous voyons la concurrence exercer sa double action, niveler les classes et élever la société.
Si l'on se représente la société comme composée de deux couches superposées, dans l'une desquelles domine le principe intelligent et dans l'autre le principe de la force brute, et si l'on étudie les rapports naturels de ces deux couches, on distingue aisément une force d'attraction dans la première, une force d'aspiration dans la seconde, qui concourent à leur fusion. L'inégalité même des profits souffle dans la couche inférieure une ardeur inextinguible vers la région du bienêtre et des loisirs, et cette ardeur est secondée par le rayonnement des clartés qui illuminent les classes élevées. Les méthodes d'enseignement se perfectionnent; les livres baissent de prix; l'instruction s'acquiert en moins de temps et à moins de frais; la science, monopolisée par une classe ou même une caste, voilée par une langue morte ou scellée dans une écriture hiéroglyphique, s'écrit et s'imprime en langue vulgaire, pénètre, pour ainsi dire, l'atmosphère et se respire comme l'air.
Mais ce n'est pas tout; en même temps qu'une instruction plus universelle et plus égale rapproche les deux couches sociales, des phénomènes économiques très-importants et qui se rattachent à la grande loi de la concurrence viennent accélérer la fusion. Le progrès de la mécanique diminue sans cesse la proportion du travail brut. La division du travail, en simplifiant et isolant chacune des opérations qui concourent à un résultat productif, met à la portée de tous des industries qui no pouvaient d'abord être exercées que par quelques-uns. Il y a plus, un ensemble de travaux qui suppose, à l'origine, des connaissances très-variées, par le seul bénéfice des siècles, tombe, sous le nom de routine, dans la sphère d'action des classes les moins instruites; c'est ce qui est arrivé pour l'agriculture. Des procédés agricoles qui, dans l'antiquité, méritèrent à ceux qui les ont révélés au monde les honneurs de l'apothéose, sont aujourd'hui l'héritage et presque le monopole des hommes les plus grossiers, et à tel point que cette branche si importante de l'industrie humaine est, pour ainsi dire, entièrement soustraite aux .classes bien élevées.
De tout ce qui précède on peut tirer une fausse conclusion et dire : « Nous voyons bien la concurrence rabaisser les rémunérations dans tous les pays, dans toutes les carrières, dans tous les rangs, et les niveler par voie de réduction; mais alors c'est le salaire du travail brut, de la peine physique, qui deviendra le type, l'étalon de fonte rémunération. »
Je n'aurais pas été compris si l'on ne voyait que la concurrence, qui travaille à ramener toutes les rémunérations excessives vers une moyenne de plus en plus uniforme, élève nécessairement cette moyenne : elle froisse, j'en conviens, lés hommes en tant que producteurs; mais c'est pour améliorer la condition générale de l'espèce humaine au seul point de vue qui puisse raisonnablement la révéler, celui du bien-être, de l'aisance, des loisirs, du perfectionnement intellectuel et moral, et, pour tout dire en un mot, au point de vue de la consommation.
Dira-t-on qu'en fait l'humanité n'a pas fait les progrès que cette théorie semble impliquer?
Je répondrai d'abord que, dans les sociétés modernes, la concurrence est loin de remplir la sphère naturelle de son action; nos lois la contrarient au moins autant qu'elles la favorisent; et, quand on se demande si l'inégalité des conditions est due à sa présence ou à son absence, il suffit de voir quels sont les hommes qui tiennent le haut du pavé et nous éblouissent par l'éclat de leur fortune scandaleuse, pour s'assurer que l'inégalité, en ce qu'elle a d'artificiel et d'injuste, a pour base la conquête, les monopoles , les restrictions, les offices privilégiés , les hautes fonctions , les grandes places, les marchés administratifs, les [396] emprunts publics, toutes choses auxquelles la concurrence n'a rien à voir.
Ensuite, je crois que l'on méconnaît le progrès réel qu'a fait l'humanité depuis l'époque très-récente à laquelle on doit assigner l'affranchissement partiel du travail. On a dit, avec raison, qu'il fallait beaucoup de philosophie pour discerner les faits dont on est sans cesse témoin. Ce que consomme une famille honnête et laborieuse de la classe ouvrière ne nous étonne pas, parce que l'habitude nous a familiarisés avec cet étrange phénomène. Si, cependant, nous comparions le bien-être auquel elle est parvenue avec la condition qui serait son partage dans l'hypothèse d'un ordre social d'où la concurrence serait exclue: si les statisticiens, armés d'un instrument de précision,pouvaient mesurer, comme avec un dynamomètre, le rapport de son travail avec ses satisfactions à deux époques différentes , nous reconnaîtrions que la liberté, toute restreinte qu'elle est encore, a accompli en sa faveur un prodige que sa perpétuité même nous empêche de remarquer. Le contingent d'efforts humains, qui pour un résultat donné a été anéanti, est vraiment incalculable. Qu'un sauvage du Canada ait besoin d'un objet pesant un quintal , placé à 300 lieues de lui , il lui faudra l'aller chercher au prix peut-être de six mois de fatigues. Aujourd'hui un artisan bayonnais fait venir de Paris un poids égal moyennant k francs , ou l'équivalent de son salaire d'un jour; c'est donc 179 parties sur 180 de la peine primitive qui ont été anéanties. Cette portion de la peine n'est plus prise par personne, il n'y a point à la rétribuer; c'est le contingent qu'ont pris à leur charge des agents naturels, des forces animales, des procédés, des instruments dont l'usage est devenu commun et gratuit. Par l'action de la concurrence, une seule journée de travail fait face à la rémunération afférente à ce transport, tant pour la peine actuelle qu'il exige que pour les peines antérieures fixées dans les instruments mécaniques ou animaux, qui, sous le nom de capital, concourent au résultat. Il n'est pas une de nos consommations qui ne donne lieu à la même remarque.
Enfin ce flux toujours grossissant d'utilités, que le travail verse et que la concurrence distribue dans toutes les veines du corps social, ne se résume pas tout en bien-être ; il s'absorbe, en grande partie, dans le flot de générations de plus en plus nombreuses; il se résout en accroissement de population selon des lois qui ont une connexité intime avec le sujet qui nous occupe et qui seront exposées dans une autre partie de cet ouvrage.
Arrêtons-nous un moment et jetons un coup d'œil rapide sur l'espace que nous venons de parcourir.
L'homme a des besoins qui n'ont pas de limites ; il forme des désirs qui sont insatiables : pour y pourvoir, il a des matériaux et des agents qui lui sont fournis par la nature, des facultés, des instruments, toutes choses que le travail met en œuvre. Le travail est la ressource qui a été le plus également départie à tous; chacun cherche instinctivement, fatalement, à lui associer le plus de forces naturelles, le plus de capacité innée ou acquise, le plus de capitaux qu'il lui est possible, afin que le résultat de cette coopération soit plus d'utilités produites ou, ce qui revient au même, plus de satisfactions acquises. Ainsi le concours toujours plus actif des agents naturels, le développement indéfini de l'intelligence, l'accroissement progressif des capitaux amènent ce phénomène, étrange au premier coup d'œil, qu'une quantité de travail donnée fournisse une somme d'utilités toujours croissante, et que chacun puisse, sans dépouiller personne, atteindre à une masse de consommations hors de proportion avec ce que ses propres efforts pourraient réaliser.
Mais ce phénomène, résultat de l'harmonie divine que la Providence a répandue dans le mécanisme de la société, aurait tourné contre la société elle-même, en y introduisant le germe d'une inégalité indéfinie, s'il ne se combinait avec une autre harmonie non moins admirable, la concurrence, qui est une des branches de la grande loi de la solidarité humaine.
En effet, s'il était possible que l'individu, la famille, la classe, la nation, qui se trouvent à portée de certains avantages naturels, ou qui ont fait dans l'industrie une découverte importante, ou qui ont acquis par l'épargne les instruments de la production, s'il était possible, dis-je, qu'ils fussent soustraits d'une manière permanente à la loi de la concurrence, il est clair que cet individu, cette famille, cette nation auraient à tout jamais le monopole d'une rémunération exceptionnelle aux dépens de l'humanité. Où en [397] serions-nous si les habitants des régions équinoxiales, affranchis entre eux de toute rivalité, pouvaient, en échange de leur sucre, de leur café, de leur coton, de leur vanille, exiger de nous, non point la restitution d'un travail égal au leur, mais une peine égale à celle qu'il nous faudrait prendre nous-mêmes pour produire ces choses, sous notre rude climat? Quelle incalculable distance séparerait les diverses conditions des hommes, si la race de Cadmus était la seule qui sût lire, si nul n'était admis à manier une charrue à moins de prouver qu'il descend en droite ligne de Triptolème; si, seuls, les descendants de Guttemberg pouvaient imprimer, le fils d'Arkwright mettre en mouvement une filature, les neveux de Watt faire fumer la cheminée d'une locomotive?
Mais la Providence n'a pas voulu qu'il en fût ainsi; elle a placé dans la machine sociale un ressort qui n'a rien de plus surprenant que sa puissance, si ce n'est sa simplicité, ressort par l'opération duquel toute force productive, toute supériorité de procédé, tout avantage, en un mot, qui n'est pas du travail propre, s'écoule entre les mains du producteur, ne s'y arrête, sous forme de rémunération exceptionnelle, que le temps nécessaire pour exciter son zèle, et vient, en définitive, grossir le patrimoine commun et gratuit de l'humanité et s'y résoudre en satisfactions individuelles toujours progressives, toujours plus également réparties : ce ressort, c'est la concurrence. Nous avons vu ses effets économiques, il nous resterait à jeter un rapide regard sur quelques-unes de ses conséquences politiques et morales; je me bornerai à indiquer les plus importantes.
Des esprits superficiels ont accusé la concurrence d'introduire l'antagonisme parmi les hommes. Cela est vrai .et inévitable tant qu'on ne les considère que dans leur qualité de producteurs; mais placez-vous au point de vue de la consommation, et vous verrez la concurrence elle-même rattacher les individus , les familles , les classes, les nations et les races, par les liens de l'universelle fraternité.
Puisque les biens qui semblent être d'abord l'apanage de quelques-uns deviennent, par un admirable décret de la munificence divine, le patrimoine commun de tous, puisque les avantages naturels de situation, de fertilité, de température, de richesses minéralogiques et même d'aptitude industrielle ne font que glisser sur les producteurs, à cause de la concurrence qu'ils se font entre eux, et tournent exclusivement au profit des consommateurs, il s'ensuit qu'il n'est aucun pays qui ne soit intéressé à l'avancement de tous les autres. Chaque progrès qui se fait à l'Orient est une richesse en perspective pour l'Occident. Du combustible découvert dans le Midi, c'est du froid épargné aux hommes du Nord. La Grande-Bretagne a beau faire faire des progrès à ses filatures, ce ne sont pas ses capitalistes qui en recueillent le bienfait, car l'intérêt de l'argent ne hausse pas; ce ne sont pas ses ouvriers, car-le salaire reste le même; mais, à la longue, c'est le Russe, c'est le Français, c'est l'Espagnol, c'est l'humanité, en un mot, qui obtient des satisfactions égales avec moins de peine, ou, ce qui revient au même, des satisfactions supérieures à peine égale.
Je n'ai parlé que des biens, j'aurais pu en dire autant des maux qui frappent certains peuples ou certaines régions. L'action propre de la concurrence est de rendre général ce qui était particulier. Elle agit exactement sur le principe des assurances. Un fléau ravage-t-il les terres des agriculteurs, ce sont les mangeurs de pain qui en souffrent; un impôt injuste atteint-il la vigne en France, il se traduit en cherté de vin pour tous les buveurs de la terre. Ainsi les biens et les maux, qui ont quelque permanence, ne font que glisser sur les individualités, les classes, les peuples; leur destinée providentielle est d'aller, à la longue, affecter l'humanité tout entière et élever ou abaisser le niveau de sa condition. Dès lors, envier à quelque peuple que ce soit la fertilité de son sol ou la beauté de ses ports et de ses fleuves, ou la chaleur de son soleil, c'est méconnaître des biens auxquels nous sommes appelés à participer; c'est dédaigner l’abondance qui nous est offerte ; c'est regretter la fatigue qui nous est épargnée. Dès lors les jalousies nationales ne sont pas seulement des sentiments pervers, ce sont encore des sentiments absurdes. Nuire à autrui, c'est se nuire à soi-même; semer des obstacles dans la voie des autres, tarifs, coalitions ou guerres, c'est embarrasser sa propre voie. Dès lors les passions mauvaises ont leur châtiment comme les sentiments généreux ont leur récompense. L'inévitable sanction d'une exacte justice distributive parle à l'intérêt, éclaire l'opinion, proclame et doit faire [398] prévaloir enfin, parmi les hommes, cette maxime d'éternelle vérité : L'utile, c'est un des aspects du juste; la liberté, c'est la plus belle des harmonies sociales; l'équité* c'est la meilleure politique.
Le christianisme a introduit dans le monde le grand principe de la fraternité humaine; il s'adresse au cœur, au sentiment, aux nobles instincts. L'économie politique vient faire accepter le même principe à la froide raison et, montrant l'enchaînement des effets aux causes, réconcilier* dans, un consolant accord, les calculs de l'intérêt le plus vigilant aux inspirations de la morale la plus sublime.
Une seconde conséquence qui découle de cette doctrine, c'est que la société est une véritable communauté. MM. Owen et Pierre Leroux peuvent s'épargner le soin de chercher la solution du grand problème communiste; elle est toute trouvée : elle résulte, non de leurs vaines et despotiques combinaisons, mais de l'organisation que Dieu a donnée à l'homme et à la société. Forces naturelles, procédés expéditifs, instruments de production, tout est commun entre les nommes ou tend à le devenir, tout, hors la peine, le travail, l'effort individuel. Il n'y a, il ne peut y avoir entre eux qu'une inégalité, que les communistes les plus absolus admettent, celle qui résulte de l'inégalité des efforts. Ce sont ces efforts qui s'échangent les uns les autres à prix débattu. Tout ce que la nature, le génie des siècles et la prévoyance humaine ont mis d'utilité dans les produits échangés, est donné par-dessus le marché. Les rémunérations réciproques ne s'adressent qu'aux efforts respectifs, soit actuels, sous le nom de travail, soit préparatoires, sous le nom de capital; c'est donc la communauté dans le sens le plus rigoureux du mot, à moins qu'on ne veuille prétendre que le contingent personnel de la satisfaction doit être égal, encore que le contingent de la peine ne le soit pas, ce qui serait, certes, la plus inique et la plus monstrueuse des inégalités, l'ajoute et la plus funeste, car elle ne tuerait pas la concurrence; seulement elle lui donnerait une action inverse; on lutterait encore, mais on lutterait de paresse, d'inintelligence et d'imprévoyance.
Enfin la doctrine si simple et, selon notre conviction, si vraie que nous venons de développer fait sortir du domaine de la déclamation, pour le faire entrer dans celui de la démonstration rigoureuse, le grand principe de la perfectibilité humaine — De ce mobile interne qui ne se repose jamais dans le sein de l'individualité, et qui la porte à améliorer sa condition , nait le progrès des arts, qui n'est autre chose que le concours progressif de forces étrangères, parleur nature, à la rémunération.— De la concurrence naît l'attribution à la communauté des avantages d'abord individuellement obtenus. — L'intensité de la peine requise pour chaque résultat donné va se restreignant sans cesse au profit du genre humain, qui voit ainsi s'élargir, de génération en génération, le cercle de ses satisfactions, de ses loisirs, et s'élever le niveau de son perfectionnement physique, intellectuel et moral ; et, par cet arrangement si digne de notre étude et de notre éternelle admiration, on voit clairement l'humanité se relever de sa déchéance.
Qu'un ne se méprenne pas à mes paroles. Je ne dis point que toute fraternité, toute communauté, toute perfectibilité sont renfermées dans la concurrence; je dis qu'elle s'allie, qu'elle se combine à ces trois grands dogmes sociaux, qu'elle en fait partie, qu'elle les explique, qu'elle les manifeste, qu'elle est un des plus puissants agents de leur sublime réalisation.
Je me suis attaché à décrire les effets généraux et, par conséquent, bienfaisants de la concurrence, car il serait impie de supposer qu'aucune grande loi de la nature pût en produire qui fussent à la fois nuisibles et permanents ; mais je suis loin de nier que son action ne soit accompagnée de beaucoup de froissements et de souffrances. Il me semble même que la théorie qui vient d'être exposée explique et ces souffrances et les plaintes inévitables qu'elles excitent. Puisque l'œuvre de la concurrence consiste à niveler, nécessairement elle doit contrarier quiconque élève au-dessus du niveau sa tête orgueilleuse. On comprend que chaque producteur, afin de mettre son travail à plus haut prix, s'efforce de retenir le plus longtemps possible l'usage exclusif d'un agent, d'un procédé ou d'un instrument de production. Or, la concurrence ayant justement pour mission et pour résultat d'enlever cet usage exclusif à l'individualité pour en faire une propriété commune, il est fatal que tous les hommes, en tant que producteurs, s'unissent dans un concert de malédictions contre la concurrence . ils ne se peuvent réconcilier [399] avec elle qu'en appréciant leurs rapports avec la consommation; en se considérant non point en tant que membres d'une coterie, d'une corporation, mais en tant qu'hommes.
L'économie politique, il faut le dire, n'a pas encore assez fait pour dissiper cette funeste illusion, source de tant de haines, de calamités, d'irritations et de guerres; elle s'est épuisée, par une préference peu scientifique, à analyser les phénomènes de la production ; sa nomenclature même, toute commode qu'elle est, n'est pas en harmonie avec son objet. Agriculture, manufacture, commerce, c'est là une classification excellente peut-être, quand il s'agit de décrire les procédés des arts; mais cette description, capitale en technologie, est à peine accessoire en économie sociale : j'ajoute qu'elle y est essentiellement dangereuse. Quand on a classé les hommes en agriculteurs, fabricants et négociants, de quoi peut-on leur parler, si ce n'est de leurs intérêts de classe, de ces intérêts spéciaux que heurte la concurrence et qui sont en opposition avec le bien général? Ce n'est pas pour les agriculteurs qu'il y a une agriculture, pour les manufacturiers qu'il y a des manufactures , pour les négociants qu'il se fait des échanges, mais afin que les hommes aient à leur disposition le plus possible de produits de toute espèce. Les lois de la consommation, ce qui la favorise, l'égalise et la moralise, voilà l'intérêt vraiment social, vraiment humanitaire; voilà l'objet réel de la science ; voilà sur quoi elle doit concentrer ses vives clartés; car c'est là qu’est le lien des classes, des nations, des races, le principe et l'explication de la fraternité humaine. C'est donc avec regret que nous voyons les économistes vouer des facultés puissantes, dépenser une somme prodigieuse de sagacité à l'anatomie de la production, rejetant au fond de leurs livres, dans des chapitres complémentaires, quelques brefs lieux communs sur les phénomènes de la consommation. Que dis-je? On a vu naguère un professeur, célèbre à juste titre, supprimer entièrement cette partie de la science, s'occuper des moyens sans jamais parler du résultat, et bannir de son cours tout ce qui concerne la consommation des richesses, comme appartenant, disait-il, à la morale et non à l'économie politique. Faut-il être surpris que le public soit plus frappé des inconvénients de la concurrence que de ses avantages, puisque les premiers l'affectent au point de vue spécial de la production dont on l'entretient sans cesse, et les seconds au point de vue général de la consommation dont on ne lui dit jamais rien?
Au surplus, je le répète, je ne nie point, je ne méconnais pas et je déplore comme d'autres, les douleurs que la concurrence inflige aux hommes ; mais est-ce une raison pour fermer les yeux sur le bien qu'elle réalise? Ce bien, il est d'autant plus consolant de l'apercevoir, que la concurrence, je le crois bien, est, comme toutes les grandes lois de la nature, indestructible; si elle pouvait mourir, elle aurait succombé sans doute sous la résistance universelle de tous les hommes qui ont jamais concouru à la création d'un produit depuis le commencement du monde, et spécialement sous la levée en masse de tous les réformateurs modernes; mais, s'ils ont été assez fous, ils n'ont pas été assez forts.
Et quel est, dans le monde, le principe progressif dont l'action bienfaisante ne soit pas mêlée, surtout à l'origine, de beaucoup de douleurs et de misères? — Les grandes agglomérations d'êtres humains favorisent l'essor de la pensée, mais souvent elles dérobent la vie privée au frein de l'opinion, et servent d'abri à la débauche et au crime. — La richesse, unie au loisir, enfante la culture de l'intelligence, mais elle enfante aussi le luxe et la morgue chez les grands, l'irritation et la convoitise chez les petits. — L'imprimerie fait pénétrer la lumière et la vérité dans toutes les couches sociales, mais elle y porte aussi le doute douloureux et l'erreur subversive. — La liberté politique a déchaîné assez de tempêtes et de révolutions sur le globe; elle a assez profondément modifié les simples et naïves habitudes des peuples primitifs pour que de graves esprits se soient demandé s'ils ne préféraient pas la tranquillité à l'ombre du despotisme. — Et le christianisme lui-même a jeté la grande semence de l'amour et de la charité sur une terre abreuvée du sang des martyrs.
Comment est-il entré dans les desseins de la bonté et de la justice infinies que le bonheur d'une région ou d'un siècle soit acheté par les souffrances d'un autre siècle ou d'une autre région? quelle est la pensée divine qui se cache sous cette grande et irrécusable loi de la solidarité, dont la concurrence n'est qu'un des mystérieux aspects? la science humaine l'ignore. Ce qu'elle sait, [400] c’est que le bien s'étend toujours et le mal se restreint sans cesse. A partir de l'état social, tel que la conquête l'avait fait, où il n'y avait que des maîtres ou des esclaves, et où l'inégalité des conditions était extrême, la concurrence n'a pu travailler à rapprocher les rangs, les fortunes, les intelligences sans infliger des maux individuels dont, à mesure que l'œuvre s'accomplit, l'intensité va toujours s'affaiblissant comme les vibrations du son, comme les oscillations du pendule; aux douleurs qu'elle lui réserve encore, l'humanité apprend, chaque jour, à opposer deux puissants remèdes, la prévoyance, fruit de l'expérience et des lumières, et l'association, qui est la prévoyance organisée.
Frédéric Bastiat.
Text: DE LA CONCURRENCE (JDE version).↩
[Note] [40]
J'ai à exposer les effets d'une des lois auxquelles la Providence a confié le progrès de la société humaine ; de cette loi qui a pour mission d'égaliser le bien-être et les conditions parmi les membres de la grande famille, de faire tomber dans le domaine de la communauté la jouissance des biens que la nature semblait avoir réservés à certaines contrées, et les conquêtes dont le génie de chaque siècle accroît le trésor des générations qui le suivent; loi féconde en harmonies sociales, immense dans ses résultats généraux, mais souvent brutale dans ses procédés; loi méconnue de notre époque, et qui, plus que toute autre, atteste l'incommensurable supériorité des desseins de Dieu sur les vaines et impuissantes combinaisons des hommes.
Quelle est cette puissance fatale sous laquelle nous nous débattons eh Vain depuis que se sont écoulés les jours insoucieux de l'enfance; qui ne nous laisse pas le temps d'apprendre ce qu'il nous est indispensable de savoir ;qui nous jette dans les tumultueuses avenues du monde, et, tout en contrariant notre élan vers les objets de nos espérances, ne cesse de nous crier : Marche! marche! qui n'écrase pas est écrasé?
Oh! la réponse s'élève immense, unanime de tous les points du globe, du palais et de la chaumière, de la ferme et de la métairie, du chantier et de l'atelier, du magasin et de l'échoppe, du cabinet et de l'étude, du comptoir et du bureau, du péristyle de la bourse et des antichambres du pouvoir: la Concurrence! la Concurrence!
Mais quelle est la puissance bienfaisante qui accomplit le miracle étonnant dont mes yeux sont témoins? Je suis admis au foyer d'un de ces hommes de la classe industrieuse que la concurrence importune, et que vois-je? Je vois qu'il consomme en un jour ce qu'il ne parviendrait pas à produire pendant toute la durée de son existence, quand dix mille vies viendraient s'ajouter bout à bouta la sienne! Et quand j'essaye de supputer combien il a fallu de temps, d'efforts, de capitaux, d'instruments, de véhicules pour que ce cabinet reçût le simple ameublement que j'y trouve, pour que ces tapis, ces fauteuils, ces draperies, ces porcelaines, ces bronzes et ces cristaux vinssent s'accumuler dans cet étroit espace; quand je considère que ce n'est là, peut-être, que la millième partie de ce que mon hôte a puisé dans le marché général du monde; que néanmoins il n'a rien dérobé à personne, ni privé qui que ce soit de quoi que ce soit; qu'il a réellement produit la valeur de ces innombrables objets, sans occuper ses mains à autre chose qu'à manier une plume, une aiguille, une navette ou un rabot; quand je viens à songer que cette immense disproportion apparente que je remarque entre les productions et les consommations d'un individu, que ce prodige étonnant se réalise, à un degré quelconque, en faveur de tous les hommes répandus sur la surface du globe, quelque extraordinaire, quelque contradictoire même que cela puisse paraître; alors je reste confondu d'admiration devant la beauté, la majesté, la puissance de ce mécanisme social qui a pour moteur la concurrence, et laissant à d'autres la prétention d'inventer une organisation plus ingénieuse, je borne la mienne à étudier, à comprendre, à aimer et, si je puis, à décrire celle qui est sortie toute faite des mains de la sagesse éternelle.
Ainsi, parce que l'homme a, avec le travail, deux rapports très-distincts, parce qu'il est tour à tour producteur d'utilités qu'il ne consomme pas et consommateur d'utilités qu'il ne produit pas, la concurrence doit être envisagée, relativement à lui, sous deux aspects très-différents.
Au premier point de vue, au point de vue individualiste, la pensée intime, incurable, éternelle de tout travailleur est la solution de ce problème: « Faire que les utilités que j'apporte dans le milieu social y soient aussi recherchées et aussi rares que possible. » Et voilà pourquoi le producteur, en tant et tel, réagit contre ses concurrents, les réprouve, les détruit autant qu'il est en lui, et appelle à son aide la force, la ruse, la loi, le sophisme, le tarif, le monopole, la protection et la restriction.
Mais le problème social est celui-ci : Faire que, pour un travail déterminé qu'il livre au marché général, chaque homme en retire une somme d'utilités qui tende sans cesse à S'accroître et à S'égaliser. Nous allons voir que c'est là l'œuvre de la concurrence.
Il faut d'abord établir que l'utilité que renferme tout objet y a été mise par la coopération de deux puissances, la nature et le travail.
Le blé est dû en partie à la libéralité de la nature, à l'air, à la lumière, à la chaleur, aux sels qu'elle a mis sans mesure à notre disposition. D'un autre côté, il a fallu labourer, semer, herser, moissonner. S'agit-il de convertir ce blé en farine, la nature fournit la force de la gravitation mise en œuvre par une chute d'eau, la dureté de la pierre meulière, et l'homme concourt au résultat en surveillant et réglant l'action de ces forces, en la dirigeant vers une fin déterminée. — II en est ainsi dans toutes les industries.
De ces deux forces qui coopèrent à la production de l'utilité, l'une, celle de la nature, est gratuite. L'autre, celle du travail, est seule la la matière de l'échange, de la rémunération, de la valeur.
Quelque précieux que soit un service naturel, si la main ou le génie de l'homme n'y est pour rien, il est gratuit, il est dépourvu de valeur dans le sens économique du mot. Jamais l'industrie humaine n'a produit ni ne produira rien qui nous soit plus utile, nécessaire, indispensable que l'eau, l'air, la chaleur, la lumière, et cependant nous en jouissons à titre gratuit quand nos organes les recueillent immédiatement de la nature, sans l'intervention d'aucun effort. Mais, pour avoir de l'eau, faut-il l'aller chercher à une grande distance, c'est une peine à prendre ou à rémunérer. Voulons-nous séparer de l'air respirable un des éléments qui le composent, par exemple le gaz hydrogène, pour alimenter un aérostat, c'est un travail à accomplir; et voilà pourquoi le gaz hydrogène, qui n'est que la partie, a une valeur, tandis que l'air respirable, qui est le tout, n'en a pas.
Nous passerions ainsi en revue tous les objets de nos transactions, et nous trouverions toujours qu'ils sont pourvus d'une utilité composée : une portion y a été mise par la nature, et celle-là est gratuite; l'autre par le travail, et celle-là est l'objet de l'échange, par la très-simple raison que pour jouir d'une utilité qui a coûté une peine, il faut la prendre, ou la restituer, sous une autre forme, à ceux qui la prennent pour nous.
Le désir qu'éprouve l'homme d'améliorer sa condition le porte à accroître le plus qu'il peut la coopération de la nature à la production de l'utilité. C'est là le champ ouvert à l'esprit humain. L'eau, lèvent, la chaleur, la lumière, la gravitation, l'électricité, toutes les lois du monde physique sont mises de plus en plus à contribution; d'où il suit que de génération en génération une quantité de travail humain peut, pour parler ainsi, servir de véhicule à une plus forte somme de services naturels, et ceci nous montre qu'il n'y a rien d'insoluble, rien de contradictoire dans le problème social que je posais tout à l'heure en ces termes : Faire que la consommation de l'homme s'accroisse plus rapidement que son travail.
Non-seulement le progrès ainsi expliqué est possible , mais il est nécessaire, il est fatal, il est une conséquence providentielle de la perfectibilité de nos facultés; et nous verrions le bien-être se répandre rapidement sur l'espèce humaine, si par une autre loi dont nous n'avons pas à nous occuper ici, elle ne croissait pas en nombre en même temps qu'en capacité de production.
J'avais besoin d'exposer succinctement ces notions générales, pour montrer dans toute sa puissance, dans toutes ses harmonies, l'action de la concurrence.
Ce qui s'échange, ce qui fait la base de nos transactions, ai-je dit, c'est le travail, c'est la peine, c'est l'effort, en sorte qu'on pourrait, en langage un peu vulgaire, définir ainsi l'économie politique : c'est la théorie des services que les hommes se rendent les uns aux autres à charge de revanche.
Mais le travail n'est pas une qualité homogène, une quantité absolue qui se pèse ou se nombre, qui se mesure au chronomètre ou au dynamomètre. Il y a du travail plus ou moins favorisé par le milieu où il s'exerce, plus ou moins intelligent, pénible, dangereux, précaire, heureux même. Il ne faut pas perdre de vue, d'ailleurs, qu'il ne s'aliène que volontairement, que chacun reste juge de la peine qu'il exige en retour de la peine qu'il cède, ainsi que des circonstances qui peuvent le déterminer à être exigeant ou facile. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris qu'il y ait une grande inégalité dans les rémunérations, et, en définitive, dans le bien-être des hommes.
Examinons les principales circonstances qui influent sur cette inégalité, et comment elle tend à s'effacer sous l'action de la concurrence.
Une des plus évidentes, c'est la possibilité de s'emparer d'un des agents naturels dont je parlais tout à l'heure. Ces agents ne sont pas répartis d'une manière égale sur la surface du globe. Ici la terre est plus féconde, là la chaleur plus intense; sur tel point il y a des dépôts de houille considérables, sur tel autre des rivières poissonnenses, etc., etc.
Sans la concurrence, ceux qui sont à portée de ces avantages naturels ne permettraient aux autres hommes d'y participer que moyennant une rétribution excessive et inaltérable; en sorte que nous payerions au producteur non-seulement sa peine, mais les dons de la nature. Un homme qui vit sous les tropiques pourrait dire à un Européen : « Grâce à mon soleil, je puis obtenir une balle de coton avec une peine égale à dix, tandis que vous ne le pouvez qu'avec une peine égale à cent. Or, pour vous céder ce coton, ce n'est pas ma peine qui est la mesure de mes exigences, mais la vôtre. Ce n'est pas à vous, mais à moi, que Dieu a donné une température élevée. Ainsi, voilà mon coton; donnez-moi en échange un objet dans le quel vous ayez mis une peine égale à cent ou à peu près. Sinon, faites le coton vous-même. » — Mais la concurrence ne permet pas ces marchés léonins, elle ne permet pas à un homme de se faire rétribuer pour une peine qu'il n'a pas prise, pour un travail qu'il n'a pas accompli, et elle tend à rendre communs et gratuits pour tous les hommes ces biens naturels qui semblaient être l’apanage exclusif de quelques-uns.
L'homme des tropiques n'a pu faire prévaloir sa prétention de mesurer son salaire à ma peine et non à la sienne. Elle était trop rémunérée, pour ne pas exciter la rivalité. La concurrence s'en est mêlée; le coton a été offert au rabais jusqu'à ce que l'Européen paye, avec une peine égale à dix, ce que l'Indien produit avec une peine égale à dix. Or, quand les choses en sont là, quand je ne donne d'une balle de coton qu'une peine égale au dixième de celle que j'aurais dû prendre pour le produire en France, je le demande, n'y a-t-il pas échange de travail contre travail, et moi, consommateur européen, n'obtiens-je pas, par-dessus le marché, la coopération du climat des tropiques? Donc, grâce à la concurrence, je suis devenu, tous les hommes sont devenus, au même titre que les Indiens et les Américains, c'est-à-dire à titre gratuit, participants de la libéralité de la nature en tant qu'elle intéresse la production du coton. Il en est de même de tous les produits imaginables.
[below is same as Chap. X Ec. Harm.]
Il y a un pays, l'Angleterre, qui a d'abondantes mines de houille. C'est là, sans doute, un grand avantage local, surtout si l'on suppose, comme je le ferai pour plus de simplicité dans la démonstration, qu'il n'y a pas de houilles sur le continent. — Tant que l'échange n'intervient pas, l'avantage qu'ont les Anglais, c'est d'avoir du feu en plus grande abondance que les autres peuples, de s'en procurer avec moins de peine, sans entreprendre autant sur leur temps utile. Sitôt que l'échange apparaît, abstraction faite de la concurrence, la possession exclusive des mines les met à même de demander une rémunération considérable et de mettre leur peine à haut prix. Ne pouvant ni prendre cette peine nous-mêmes, ni nous adresser ailleurs, il faudra bien subir la loi. Le travail anglais, appliqué à ce genre d'exploitation, sera très-rétribué; en d'autres termes, la houille sera chère, et le bienfait de la nature pourra être considéré comme conféré à un peuple et non à l'humanité.
Mais cet état de choses ne peut durer; il y a une grande loi naturelle et sociale qui s'y oppose, la concurrence. Par cela même que ce genre de travail sera très-rémunéré en Angleterre, il y sera très-recherché, car les hommes recherchent toujours les grosses rémunérations. Le nombre des mineurs s'accroîtra à la fois par adjonction et par génération; ils s'offriront au rabais; ils se contenteront d'une rémunération toujours décroissante jusqu'à ce qu'elle descende à l'état normal, au niveau de celle qu'on accorde généralement, dans le pays, à tous les travaux analogues. Cela veut dire que le prix de la houille anglaise baissera en France; cela veut dire qu'une quantité donnée de travail français obtiendra une quantité de plus en plus grande de houille anglaise, ou plutôt de travail anglais incorporé dans de la houille; cela veut dire enfin, et c'est là ce que je prie d'observer, que le don que la nature semblait avoir fait à l'Angleterre, elle l'a conféré, en réalité, à l'humanité tout entière. La houille deNewcastle est prodiguée gratuitement à tous les hommes. Ce n'est là ni un paradoxe ni une exagération : elle leur est prodiguée à titre gratuit, comme l'eau du torrent, à la seule condition de prendre la peine de l'aller chercher ou de restituer cette peine à ceux qui la prennent pour nous. Quand nous achetons la houille, ce n'est pas la houille que nous payons, mais le travail qu'il a fallu exécuter pour l'extraire et la transporter. Nous nous bornons à donner un travail égal que nous avons fixé dans du vin ou de la soie. Il est si vrai que la libéralité de la nature s'est étendue à la France, que le travail que nous restituons n'est pas supérieur à celui qu'il eût fallu accomplir si le dépôt houiller eût été en France. La concurrence a amené l'égalité entre les deux peuples par rapport à la houille, sauf l'inévitable et légère différence qui résulte de la distance et du transport.
J'ai cité deux exemples. [text is changed in Ec Harm from here] Mon but était d'élucider ma pensée. Mais ne perdons pas de vue que la loi de la concurrence s'appliquant à tous les dons que la nature a inégalement distribués sur le globe , il faut la considérer comme le principe d'une juste et naturelle égalisation; il faut l'admirer, la bénir, comme la plus évidente manifestation de l'impartiale sollicitude de Dieu envers toutes ses créatures.
Je regrette que l'espace ne me permette pas de tirer les conséquences de la doctrine que je viens d'établir ; je me bornerai à en indiquer une. S'il est vrai, comme cela me paraît incontestable, que les divers peuples du globe soient amenés, par la concurrence, à n'échanger entre eux que du travail, de la peine de plus en plus nivelée, et à se donner réciproquement, par-dessus le marché, les services naturels que chacun d'eux a à sa portée, combien ne sont-ils pas aveugles et absurdes quand ils repoussent législativement des produits qui renferment une énorme proportion d'utilité gratuite!
Une autre circonstance qui place certains hommes dans une situation favorable et exceptionnelle quant à la rémunération, c'est la connaissance exclusive des procédés par lesquels il est possible de s'emparer des agents naturels. Ce qu'on nomme une invention est une conquête du génie humain. Il faut voir comment ces belles et pacifiques conquêtes, qui sont, à l'origine, une source de richesses pour ceux qui les font, deviennent bientôt, sous l'action de la concurrence, le patrimoine commun et gratuit de tous les hommes.
Les forces de la nature appartiennent bien à tout le monde. La gravitation, par exemple, est une propriété commune; elle nous entoure, elle nous pénètre, elle nous domine : cependant, s'il n'y a qu'un moyen de la faire concourir à un résultat utile déterminé, et qu'un homme qui connaisse ce moyen, cet homme pourra mettre sa peine à haut prix ou refuser de la prendre, si ce n'est en échange d'une rémunération considérable. Sa prétention, à cet égard, n'aura d'autres limites que le point où il exigerait des consommateurs un sacrifice supérieur à celui que leur impose le vieux procédé. Il sera parvenu, par exemple, à anéantir les neuf dixièmes du travail nécessaire pour produire l'objet x;. —Mais x a actuellement un prix courant déterminé par la peine que sa production exige selon la méthode ordinaire. L'inventeur vend x au cours; en d'autres termes, sa peine lui est payée dix fois plus que celle de ses rivaux. C'est là la première phase de l'invention.
Remarquons d'abord qu'elle ne blesse en rien la justice. Il est juste que celui qui révèle au monde un procédé utile reçoive sa récompense : A chacun selon sa capacité.
Remarquons encore que jusqu'ici l'humanité, moins l'inventeur, n'a rien gagné que virtuellement, en perspective pour ainsi dire, puisque pour acquérir le produit x elle est tenue aux mêmes sacrifices qu'il lui coûtait autrefois.
Cependant l'invention entre dans sa seconde phase, celle de l'imitation. Il est dans la nature des rémunérations excessives d'éveiller la convoitise. Le procédé nouveau se répand, le prix de x va toujours baissant, et la rémunération décroît aussi, d'autant plus que l'imitation s'éloigne de l'époque de l'invention, c'est-à-dire d'autant plus qu'elle devient plus facile, moins chanceuse et, partant, moins méritoire. Il n'y a certes rien là qui ne pût être avoué par la législation la plus ingénieuse et la plus impartiale.
Enfin l'invention parvient à sa troisième phase, à sa période définitive, celle de la diffusion universelle, de la communauté, de la gratuité; son cycle est parcouru, lorsque la concurrence a ramené la rémunération des producteurs de x au taux général et normal de tous les travaux analogues. Alors les neuf dixièmes de la peine épargnée par l'invention, dans l'hypothèse, sont une conquête au profit de l'humanité entière. L'utilité de x est la même; mais les neuf dixièmes y ont été mis par la gravitation, qui était autrefois commune à tous en principe et qui est devenue commune à tous dans cette application spéciale. Cela est si vrai, que tous les consommateurs du globe sont admis à acheter x par le sacrifice du dixième de la peine qu'il coûtait autrefois. Le surplus a été entièrement anéanti par le procédé nouveau.
Si l'on veut bien considérer qu'il n'est pas une invention humaine qui n'ait parcouru ce cercle, que x est ici un signe algébrique qui représente le blé, le vêtement, les livres, les vaisseaux, pour la production desquels une masse incalculable de peine a été anéantie par la charrue, la machine à filer, l'imprimerie et la voile; que cette observation s'applique au plus humble des outils comme au mécanisme le plus compliqué; au clou, au coin, au levier, comme à la machine à vapeur et au télégraphe électrique, on comprendra, j'espère, comment se résout dans l'humanité ce grand problème : Qu'une masse, toujours plus considérable et toujours plus également répartie, d'utilités ou de jouissances vienne rémunérer chaque quantité fixe de travail humain.
J'ai fait voir que la concurrence fait tomber dans le domaine de la communauté et de la gratuité et les forces naturelles et les procédés par lesquels on s'en empare; il me reste à faire voir qu'elle remplit la même fonction quant aux instruments au moyen desquels on met ces forces en œuvre.
Il ne suffit pas qu'il existe dans la nature une force, chaleur, lumière, gravitation, électricité; il ne suffit pas que l'intelligence conçoive le moyen de l'utiliser ; il faut encore des instruments pour réaliser cette conception de l'esprit, et des approvisionnements pour entretenir pendant l'opération l'existence de ceux qui s'y livrent.
C'est une troisième circonstance favorable à un homme ou à une classe d'hommes, relativement à la rémunération, que de posséder des capitaux. Celui qui a en ses mains l'outil nécessaire au travailleur, les matériaux sur lesquels le travail va s'exercer et les moyens d'existence qui doivent se consommer pendant le travail, celui-là a une rémunération à statuer; le principe en est certainement équitable, car le capital n'est qu'une peine antérieure, laquelle n'a pas encore été rétribuée. Le capitaliste est dans une bonne position pour imposer la loi, sans doute; mais remarquons que, même affranchi de toute concurrence, il est une limite que ses prétentions ne peuvent jamais dépasser; cette limite est le point où sa rémunération absorberait tous les avantages du service qu'il rend. Cela étant, il n'est pas permis de parler, comme on le fait si souvent, de la tyrannie du capital, puisque jamais sa présence ne peut nuire plus que son absence à la condition du travailleur. Tout ce que peut faire le capitaliste, comme l'homme des tropiques qui dispose d'une intensité de chaleur que la nature a refusée à d'autres, comme l'inventeur qui a le secret d'un procédé inconnu à ses semblables, c'est de leur dire: « Voulez-vous disposer de ma peine, j'y mets tel prix; le trouvez-vous trop élevé, faites comme vous avez fait jusqu'ici, passez-vous -en. »
Mais la concurrence intervient parmi les capitalistes. Des instruments, des matériaux, des approvisionnements n'aboutissent à réaliser des utilités qu'à la condition d'être mis en œuvre: il y a donc lutte parmi les capitalistes pour trouver de l'emploi aux capitaux. Tout ce que cette lutte les force de rabattre sur les prétentions extrêmes dont je viens d'assigner les limites, se résolvant en une diminution dans le prix du produit, est donc un profit net, un gain gratuit pour le consommateur, c'est-à-dire pour l'humanité!
Ici, il est clair que la gratuité ne peut jamais être absolue : puisque tout capital représente une peine, il y a toujours en lui le principe de la rémunération.
Nous avons vu qu'il y a une limite supérieure au delà de laquelle on n'emprunterait plus ; cette limite, c'est zéro-service pour l'emprunteur. De même, il y a une limite en deçà de laquelle on ne prêterait pas, et cette limite est zéro-rétribution pour le prêteur. La concurrence entre les emprunteurs pousse la rémunération du capital vers la limite supérieure; la concurrence des prêteurs la rappelle vers la limite inférieure : c'est entre ces deux points qu'elle oscille, s'élevant, comme cela est juste et nécessaire, quand le capital est rare, «'abaissant quand il abonde.
Ce sujet est immense, je ne puis le traiter ici, et je me bornerai à constater un fait qui met au néant beaucoup de déclamations fort à la mode : ce fait, c'est que la civilisation tend à faire baisser le loyer des capitaux, qui se paye 20 pour 100 au Brésil, 10 pour 100 à Alger, 8 pour 100 en Espagne, 6 pour 100 en Italie, 5 pour 100 en Allemagne, 4 pour 100 en France, 3 pour 100 en Angleterre, et moins encore en Hollande. Or, tout ce que le progrès des temps anéantit sur le loyer des capitaux, perdu pour les capitalistes, n'est pas perdu pour l'humanité; c'est une force qui, comme les agents naturels, comme les procédés expéditifs, se résout en abondance, en égalisation, et hausse, par conséquent, le niveau général de l'espèce humaine.
Il me reste à étudier la concurrence que le travail fait au travail lui-même, sujet plus vaste encore que celui que je viens d'ébaucher. S'il faudrait un volume pour suivre, à travers toutes ses métamorphoses, la destinée du capital, dix ne suffiraient pas peut-être pour rectifier toutes les erreurs que les écoles sentimentalistes ont répandues de nos jours relativement au sort des travailleurs. Les exigences du cadre où je jette cette esquisse me forcent à me borner à quelques simples linéaments.
Une foule de circonstances contribuent à rendre inégale la rémunération du travail (je ne parle ici que du travail libre, soumis à la concurrence) : si l'on y regarde de près, on s'aperçoit que, presque toujours juste et nécessaire, cette inégalité prétendue n'est que de l'égalité réelle.
Toutes choses égales d'ailleurs, il y a plus de profits aux travaux dangereux qu'à ceux qui ne le sont pas; aux états qui exigent un long apprentissage et des déboursés longtemps improductifs, ce qui suppose, dans la famille, le long exercice de certaines vertus, qu'à ceux où suffit la force musculaire; aux professions qui réclament la culture de l'esprit et font naître des goûts délicats, qu'aux métiers où il ne faut que des bras. Tout cela n'est-il pas juste? Or, la concurrence établit nécessairement ces distinctions : la société n'a pas besoin qu'un Fourier ou un père Enfantin en décident.
Parmi ces circonstances, celle qui agit de la manière la plus générale, c'est l'inégalité de l'instruction :or, ici comme partout, nous voyons la concurrence exercer sa double action, niveler les classes et élever la société.
Si l'on se représente la société comme composée de deux couches superposées, dans l'une desquelles domine le principe intelligent, et dans l'autre le principe de la force brute, et si l'on étudie les rapports naturels de ces deux couches, on distingue aisément une force d'attraction dans la première, une force d'aspiration dans la seconde, qui concourent à leur fusion. L'inégalité même des profits souffle dans la couche inférieure une ardeur inextinguible vers la région du bienêtre et des loisirs, et cette ardeur est secondée par le rayonnement des clartés qui illuminent les classes élevées. Les méthodes d'enseignement se perfectionnent; les livres baissent de prix; l'instruction s'acquiert en moins de temps et à moins de frais; la science, monopolisée par une classe ou même une caste, voilée par une langue morte ou scellée dans une écriture hiéroglyphique, s'écrit et s'imprime en langue vulgaire, pénètre, pour ainsi dire, l'atmosphère et se respire comme l'air.
Mais ce n'est pas tout; en même temps qu'une instruction plus universelle et plus égale rapproche les deux couches sociales, des phénomènes économiques très-importants et qui se rattachent à la grande loi de la concurrence viennent accélérer la fusion. Le progrès de la mécanique diminue sans cesse la proportion du travail brut. La division du travail, en simplifiant et isolant chacune des opérations qui concourent à un résultat productif, met à la portée de tous des industries qui ne pouvaient d'abord être exercées que par quelques-uns. Ilya plus, un ensemble de travaux qui suppose, à l'origine, des connaissances très-variées, par le seul bénéfice des siècles, tombe, sous le nom de routine, dans la sphère d'action des classes les moins instruites; c'est ce qui est arrivé pour l'agriculture. Des procédés agricoles qui, dans l'antiquité, méritèrent, à ceux qui les ont révélés au monde, les honneurs de l'apothéose, sont aujourd'hui l'héritage et presque le monopole des hommes les plus grossiers, et à tel point que cette branche si importante de l'industrie humaine est, pour ainsi dire, entièrement soustraite aux classes bien élevées.
De tout ce qui précède on peut tirer une fausse conclusion et dire: « Nous voyons bien la concurrence rabaisser les rémunérations dans tous les pays, dans toutes les carrières, dans tous les rangs, et les niveler par la voie de réduction; mais alors c'est le salaire du travail brut, de la peine physique, qui deviendra le type, l'étalon de toute rémunération. »
Je n'aurais pas été compris si l'on ne voyait que la concurrence, qui travaille à ramener toutes les rémunérations excessives vers une moyenne de plus en plus uniforme, élève nécessairement cette moyenne : elle froisse, j'en conviens, les hommes en tant que producteurs; mais c'est pour améliorer la condition générale de l'espèce humaine au seul point de vue qui puisse raisonnablement la relever, celui du bienêtre, de l'aisance , des loisirs, du perfectionnement intellectuel et moral, et, pour tout dire en un mot, au point de vue de la consommation.
Dira-t-on qu'en fait l'humanité n'a pas fait les progrès que cette théorie semble impliquer?
Je répondrai d'abord que, dans les sociétés modernes, la concurrence est loin de remplir la sphère naturelle de son action; nos lois la contrarient au moins autant qu'elles la favorisent; et quand on se demande si l'inégalité des conditions est due à sa présence ou à son absence, il suffit de voir quels sont les hommes qui tiennent le haut du pavé et nous éblouissent par l'éclat de leur fortune scandaleuse, pour s'assurer que l'inégalité, en ce qu'elle a d'artificiel et d'injuste, a pour base la conquête, les monopoles, les restrictions, les offices privilégiés, les hautes fonctions, les grandes places, les marchés administratifs, les emprunts publics, toutes choses auxquelles la concurrence n'a rien à voir.
Ensuite, je crois que l'on méconnaît le progrès réel qu'a fait l'humanité depuis l'époque très-récente à laquelle on doit assigner l'affranchissement partiel du travail. On a dit, avec raison, qu'il fallait beaucoup de philosophie pour discerner les faits dont on est sans cesse témoin. Ce que consomme une famille honnête et laborieuse de la classe ouvrière ne nous étonne pas, parce que l'habitude nous a familiarisés avec cet étrange phénomène. Si, cependant, nous comparions le bien-être auquel elle est parvenue avec la condition qui serait son partage dans l'hypothèse d'un ordre social d'où la concurrence serait exclue; si les statisticiens, armés d'un instrument de précision, pouvaient mesurer, comme avec un dynanomètre, le rapport de son travail avec ses satisfactions à deux époques différentes, nous reconnaîtrions que la liberté, toute restreinte qu'elle est encore, a accompli en sa faveur un prodige que sa perpétuité même nous empêche de remarquer. Le contingent d'efforts humains qui, pour un résultat donné, a été anéanti, est vraiment incalculable. Qu'un sauvage du Canada ait besoin d'un objet pesant un quintal, placé à 300 lieues de lui, il lui faudra l'aller chercher au prix peut-être de six mois de fatigues. Aujourd'hui, un artisan bayonnais fait venir de Paris un poids égal, moyennant 4 fr., ou l'équivalent de son salaire d'un jour; c'est donc 179 parties sur 180 de la peine primitive qui ont été anéanties. Cette portion de la peine n'est plus prise par personne, il n'y a point à la rétribuer; c'est le contingent qu'ont pris à leur charge des agents naturels, des forces animales, des procédés, des instruments dont l'usage est devenu commun et gratuit par l'action de la concurrence. Une seule journée de travail fait face à la rémunération afférente à ce transport, tant pour la peine actuelle qu'il exige que pour les peines antérieures fixées dans les instruments mécaniques ou animaux, qui, sous le nom de capital, concourent au résultat. Il n'est pas une de nos consommations qui ne donne lieu à la même remarque.
Enfin, ce flux toujours grossissant d'utilités, que le travail verse et que la concurrence distribue dans toutes les veines du corps social ne se résume pas tout en bien-être ; il s'absorbe, en grande partie, dans le flot de générations de plus en plus nombreuses ; il se résout en accroissement de population selon les lois qui ont une connexité intime avec le sujet qui nous occupe et qui seront exposées dans un autre article. [41]
Arrêtons-nous un moment et jetons un coup d'ceil rapide sur l'espace que nous venons de parcourir.
L'homme a des besoins qui n'ont pas de limites; il forme des désirs qui sont insatiables. Pour y pourvoir, il a des matériaux et des agents qui lui sont fournis par la nature, des facultés, des instruments, toutes choses que le travail met en œuvre. Le travail est la ressource qui a été le plus également départie à tous ; chacun cherche instinctivement, fatalement, à lui associer le plus de forces naturelles, le plus de capacité innée ou acquise, le plus de capitaux qu'il lui est possible, afin que le résultat de cette coopération soit plus d'utilités produites, ou, ce qui revient au même, plus de satisfactions acquises. Ainsi le concours toujours plus actif des agents naturels, le développement indéfini de l'intelligence, l'accroissement progressif des capitaux amènent ce phénomène, étrange au premier coup d’œil, qu'une quantité de travail donnée fournisse une somme d'utilités toujours croissante, et que chacun puisse, sans dépouiller personne, atteindre à une masse de consommations hors de proportion avec ce que ses propres efforts pourraient réaliser.
Mais ce phénomène, résultat de l'harmonie divine que la Providence a répandue dans le mécanisme de la société, aurait tourné contre la société elle-même, en y introduisant le germe d'une inégalité indéfinie, s'il ne se combinait avec une autre harmonie non moins admirable, la concurrence, qui est une des branches de la grande loi de la solidarité humaine.
En effet, s'il était possible que l'individu, la famille, la classe, la nation, qui se trouvent à portée de certains avantages naturels, ou qui ont fait dans l'industrie une découverte importante, ou qui ont acquis par l'épargne les instruments de la production, s'il était possible, dis— je, qu'ils fussent soustraits d'une manière permanente à la loi de la concurrence, il est clair que cet individu, cette famille, cette nation auraient à tout jamais le monopole d'une rémunération exceptionnelle aux dépens de l'humanité. Où en serions-nous si les habitants des régions équinoxiales, affranchis entre eux de toute rivalité, pouvaient, en échange de leur sucre, de leur café, de leur coton, de leur vanille, exiger de nous, non point la restitution d'un travail égal au leur, mais une peine égale à celle qu'il nous faudrait prendre nous-mêmes pour produire ces choses sous notre rude climat! Quelle incalculable distance séparerait les diverses conditions des hommes, si la race de Cad mus était la seule qui sût lire, si nul n'était admis à manier une charrue à moins de prouver qu'il descend en droite ligne de Triptolème; si, seuls, les descendants de Gutenberg pouvaient imprimer, le fils d'Arkwright mettre en mouvement une filature, les neveux de Watt faire fumer la cheminée d'une locomotive?
Mais la Providence n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Elle a placé dans la machine sociale un ressort qui n'a rien de plus surprenant que sa puissance, si ce n'est sa simplicité; ressort par l'opération duquel toute force productive, toute supériorité de procédé, tout avantage, en un mot, qui n'est pas du travail propre, s'écoule entre les mains du producteur, ne s'y arrête, sous forme de rémunération exceptionnelle, que le temps nécessaire pour exciter son zèle, et vient, en définitive, grossir le patrimoine commun et gratuit de l'humanité, et s'y résoudre en satisfactions individuelles toujours progressives, toujours plus également réparties: ce ressort, c'est la concurrence. Nous avons vu ses effets économiques, il nous resterait à jeter un rapide regard sur quelques-unes de ses conséquences politiques et morales. Je me bornerai à indiquer les plus importantes.
Des esprits superficiels ont accusé la concurrence d'introduire l'antagonisme parmi les hommes. Cela est vrai et inévitable tant qu'on ne les considère que dans leur qualité de producteurs; mais placez-vous au point de vue de la consommation, et vous verrez la concurrence elle-même rattacher les individus, les familles, les classes, les nations et les races, par les liens de l'universelle fraternité.
Puisque les biens qui semblent être d'abord l'apanage de quelques-uns deviennent, par un admirable décret de la munificence divine, le patrimoine commun de tous, puisque les avantages naturels de situation, de fertilité, de température, de richesses minéralogiques et même d'aptitude industrielle, ne font que glisser sur les producteurs, à cause de la concurrence qu'ils se font entre eux, et tournent exclusivement au profit des consommateurs, il s'ensuit qu'il n'est aucun pays qui ne soit intéressé à l'avancement de tous les autres. Chaque progrès qui se fait à l'orient est une richesse en perspective pour l'occident. Du combustible découvert dans le Midi, c'est du froid épargné aux hommes du Nord. La Grande-Bretagne a beau faire faire des progrès à ses filatures, ce ne sont pas ses capitalistes qui en recueillent le bienfait, car l'intérêt de l'argent ne hausse pas; ce ne sont pas ses ouvriers, car le salaire reste le même; mais, à la longue, c'est le Russe, c'est le Français, c'est l'Espagnol, c'est l'humanité, en un mot, qui obtient des satisfactions égales avec moins de peine, ou, ce qui revient au même, des satisfactions supérieures, à peine égale.
Je n'ai parlé que des biens, j'aurais pu en dire autant des maux qui frappent certains peuples ou certaines régions. L'action propre de la concurrence est de rendre général ce qui était particulier. Elle agit exactement sur le principe des assurances. Un fléau ravage-t-il les terres des agriculteurs , ce sont les mangeurs de pain qui en souffrent. Un impôt injuste atteint-il la vigne en France, il se traduit en cherté de vin pour tous les buveurs de la terre: ainsi les biens et les maux qui ont quelque permanence ne font que glisser sur les individualités, les classes, les peuples; leur destinée providentielle est d'aller, à la longue, affecter l'humanité tout entière, et élever ou abaisser le niveau de sa condition. Dès lors, envier à quelque peuple que ce soit la fertilité de son sol ou la beauté de ses ports et de ses fleuves, ou la chaleur de son soleil, c'est méconnaître des biens auxquels nous sommes appelés à participer; c'est dédaigner l'abondance qui nous est offerte; c'est regretter la fatigue qui nous est épargnée. Dès lors, les jalousies nationales ne sont pas seulement des sentiments pervers, ce sont encore des sentiments absurdes. Nuire à autrui, c'est se nuire à soi-même; semer des obstacles dans la voie des autres, tarifs, coalitions ou guerres, c'est embarrasser sa propre voie. Dès lors les passions mauvaises ont leur châtiment comme les sentiments généreux ont leur récompense. L'inévitable sanction d'une exacte justice distributive parle à l'intérêt, éclaire l'opinion, proclame et doit faire prévaloir enfin, parmi les hommes, cette maxime d'éternelle vérité : L'utile, c'est un des aspects du juste; la liberté, c'est la plus belle des harmonies sociales; l'équité, c'est la meilleure politique.
Le christianisme a introduit dans le monde le grand principe de la fraternité humaine. Il s'adresse au cœur, au sentiment, aux nobles instincts. L'économie politique vient faire accepter le même principe à la froide raison, et, montrant l'enchaînement des effets aux causes, réconcilier, dans un consolant accord, les calculs de l'intérêt le plus vigilant avec les inspirations de la morale la plus sublime.
Une seconde conséquence qui découle de cette doctrine, c'est que la société est une véritable communauté. MM. Owen et Pierre Leroux peuvent s'épargner le soin de chercher la solution du grand problème communiste; elle est toute trouvée: elle résulte, non de leurs vaines et despotiques combinaisons, mais de l'organisation que Dieu a donnée à l'homme et à la société. Forces naturelles, procédés expéditifs, instruments de production, tout est commun entre les hommes, ou tend à le devenir, tout, hors la peine, le travail, l'effort individuel. Il n'y a, il ne peut y avoir entre eux qu'une inégalité, que les communistes les plus absolus admettent, celle qui résulte de l'inégalité des efforts. Ce sont ces efforts qui s'échangent les uns les autres à prix débattu. Tout ce que la nature, le génie des siècles et la prévoyance humaine ont mis d'utilité dans les produits échangés, est donné par-dessus le marché. Les rémunérations réciproques ne s'adressent qu'aux efforts respectifs, soit actuels, sous le nom de travail, soit préparatoires, sous le nom de capital; c'est donc la communauté dans le sens le plus rigoureux du mot, à moins qu'on ne veuille prétendre que le contingent personnel de la satisfaction doit être égal, encore que le contingent de la peine ne le soit pas, ce qui serait, certes, la plus inique et la plus monstrueuse des inégalités. J'ajoute et la plus funeste, car elle ne tuerait pas la concurrence, seulement elle lui donnerait une action inverse; on lutterait encore, maison lutterait de paresse, d'inintelligence et d'imprévoyance.
Enfin la doctrine si simple, et, selon notre conviction, si vraie que nous venons de développer, fait sortir du domaine de la déclamation pour le faire entrer dans celui de la démonstration rigoureuse, le grand principe de la perfectibilité humaine. —De ce mobile interne qui ne se repose jamais dans le sein de l'individualité, et qui la porte à améliorer sa condition, naît le progrès des arts, qui n'est autre chose que le concours progressif de forces, étrangères par leur nature, à la rémunération.—De la concurrence naît l'attribution à la communauté des avantages d'abord individuellement obtenus.—L'intensité de la peine requise pour chaque résultat donné va se restreignant sans cesse, au profit du genre humain, qui voit ainsi s'élargir, de génération en génération, le cercle de ses satisfactions, de ses loisirs, et s'élever le niveau de son perfectionnement physique, intellectuel et moral; et par cet arrangement, si digne de notre étude et de notre éternelle admiration, on voit clairement l'humanité se relever de sa déchéance.
Qu'on ne se méprenne pas à mes paroles. Je ne dis point que toute fraternité, toute communauté, toute perfectibilité sont renfermées dans la concurrence ; je dis qu'elle s'allie, qu'elle se combine à ces trois grands dogmes sociaux, qu'elle en fait partie, qu'elle les manifeste, qu'elle est un des plus puissants agents de leur sublime réalisation.
Je me suis attaché à décrire les effets généraux et, par conséquent, bienfaisants de la concurrence ; car il serait impie de supposer qu'aucune grande loi de la nature pût en produire qui fussent à la fois nuisibles et permanents; mais je suis loin de nier que son action ne soit accompagnée de beaucoup de froissements et de souffrances. Il me semble même que la théorie qui vient d'être exposée explique et ces souffrances et les plaintes inévitables qu'elles excitent. Puisque l'œuvre de la concurrence consiste à niveler, nécessairement elle doit contrarier quiconque élève au-dessus du niveau sa tête orgueilleuse. On comprend que chaque producteur, afin de mettre son travail à plus haut prix, s'efforce de retenir le plus longtemps possible l'usage exclusif d'un agent, d'un procédé,ou d'un instrument de production. Or, la concurrence ayant justement pour mission et pour résultat d'enlever cet usage exclusif à l'individualité, pour en faire une propriété commune , il est fatal que tous les hommes , en tant que producteurs, s'unissent dans un concert de malédictions contre la concurrence. Ils ne se peuvent réconcilier avec elle qu'en appréciant leurs rapports avec la consommation ; en se considérant non point en tant que membres d'une coterie, d'une corporation, mais en tant qu'hommes.
L'économie politique, il faut le dire, n'a pas encore assez fait pour dissiper cette funeste illusion, source de tant de haines, de calamités, d'irritations et de guerres : elle s'est épuisée, par une préférence peu scientifique, à analyser les phénomènes de la production ; sa nomenclature même, toute commode qu'elle est, n'est pas en harmonie avec son objet. Agriculture, manufacture, commerce, c'est là une classification excellente peut-être, quand il s'agit de décrire les procédés des arts; mais cette description, capitale en technologie, est à peine accessoire en économie sociale :j'ajoute qu'elle y est essentiellement dangereuse. Quand on a classé les hommes en agriculteurs, fabricants et négociants, de quoi peut-on leur parler, si ce n'est de leurs intérêts de classe, de ces intérêts spéciaux que heurte la concurrence et qui sont mis en opposition avec le bien général? Ce n'est pas pour les agriculteurs qu'il y a une agriculture, pour les manufacturiers qu'il y a des manufactures, pour les négociants qu'il se fait des échanges, mais afin que les hommes aient à leur disposition le plus possible de produits de toute espèce. Les lois de la consommation, ce qui la favorise, l'égalise et la moralise, voilà l'intérêt vraiment social, vraiment humanitaire ; voilà l'objet réel de la science; voilà sur quoi elle doit concentrer ses vives clartés; car c'est là qu'est le lien des classes, des nations, des races, le principe et l'explication de la fraternité humaine. C'est donc avec regret que nous voyons les économistes vouer des facultés puissantes, dépenser une somme prodigieuse de sagacité à l’anatomie de la production, rejetant au fond de leurs livres, dans des chapitres complémentaires, quelques brefs lieux communs sur les phénomènes de la consommation. Que dis-je? On a vu naguère un professeur, célèbre à juste titre, supprimer entièrement cette partie de la science, s'occuper des moyens sans jamais parler du résultat, et bannir de son cours tout ce qui concerne la consommation des richesses, comme appartenant, disait-il, à la morale et non à l'économie politique. Faut-il être surpris que le public soit plus frappé des inconvénients de la concurrence que de ses avantages, puisque les premiers l'affectent au point de vue spécial de la production dont on l'entretient sans cesse, et les seconds, au point de vue général de la consommation dont on ne lui dit jamais rien?
Au surplus, je le répète, je ne nie point, je ne méconnais pas et je déplore comme d'autres les douleurs que la concurrence inflige aux hommes; mais, est-ce une raison pour fermer les yeux sur le bien qu'elle réalise? Ce bien, il est d'autant plus consolant de l'apercevoir, que la concurrence, je le crois bien, est, comme toutes les grandes lois de la nature, indestructible ; si elle pouvait mourir, elle aurait succombé sans doute sous la résistance universelle de tous les hommes qui ont jamais concouru à la création d'un produit depuis le commencement du monde, et spécialement sous la levée en masse de tous les réformateurs modernes. Mais s'ils ont été assez fous, ils n'ont pas été assez forts.
Et quel est, dans le monde, le principe progressif dont l'action bienfaisante ne soit pas mêlée, surtout à l'origine, de beaucoup de douleurs et de misères? — Les grandes agglomérations d'êtres humains favorisent l'essor de la pensée, mais souvent elles dérobent la vie privée au frein de l'opinion, et servent d'abri à la débauche et au crime. —La richesse, unie au loisir, enfante la culture de l'intelligence, mais elle enfante aussi le luxe et la morgue chez les grands, l'irritation et la convoitise chez les petits. — L'imprimerie fait pénétrer la lumière et la vérité dans toutes les couches sociales, mais elle y porte aussi le doute douloureux et l'erreur subversive.— La liberté politique a déchaîné assez de tempêtes et de révolutions sur le globe ; elle a assez profondément modifié les simples et naïves habitudes des peuples primitifs pour que de graves esprits se soient demandé s'ils ne préféraient pas la tranquillité à l'ombre du despotisme. — Et le christianisme lui-même a jeté la grande semence de l'amour et de la charité sur une terre abreuvée du sang des martyrs.
Comment est-il entré dans les desseins de la bonté et de la justice infinies que le bonheur d'une région ou d'un siècle soit acheté par les souffrances d'un autre siècle ou d'une autre région? Quelle est la pensée divine qui se cache sous cette grande et irrécusable loi de la solidarité, dont la concurrence n'est qu'un des mystérieux aspects? La science humaine l'ignore. Ce qu'elle sait, c'est que le bien s'étend toujours et le mal se restreint sans cesse. A partir de l'état social, tel que la conquête l'avait fait, où il n'y avait que des maîtres et des esclaves, et où l'inégalité des conditions était extrême, la concurrence n'a pu travailler à rapprocher les rangs, les fortunes, les intelligences sans infliger des maux individuels dont, à mesure que l'œuvre s'accomplit, l'intensité va toujours s'affaiblissant comme les vibrations du son, comme les oscillations du pendule. Aux douleurs qu'elle lui réserve encore, l'humanité apprend chaque jour à opposer deux puissants remèdes, la prévoyance, fruit de l'expérience et des lumières, et l'association, qui est la prévoyance organisée.
Le sel, la poste et la douane [15 May 1846] [CW3 ES2.12]↩
BWV
1846.05.15 “Le sel, la poste et la douane” (Salt, the Mail, and the Customs Service) [*Journal des Économistes*, May 1846, T. XIV, pp. 142-152] [ES2.12] [OC4.2.12, pp. 213-29] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne [19 mai 1846] [CW1.1.3]↩
BWV
1846.05.19 “Du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne. Lettre adressée à une commission de la Chambre des députés” (On the Railway between Bordeaux and Bayonne. A Letter addressed to a Commission of the Chamber of Deputies) [Le Mémorial bordelais, 19 May 1846] [OC7.22, p. 103] [CW1]
Lettre adressée à une commission de la Chambre des députés. [42]
Messieurs,
Les partisans du tracé direct et ceux du tracé courbe ont beau s’évertuer, il n’y a de part et d’autre qu’un argument sérieux.
Les premiers disent : Notre ligne est plus courte de 29 kilomètres.
Les seconds répondent : La nôtre dessert une population quatre fois plus dense.
Ou, sous la forme agressive, les uns :
Votre tracé courbe renchérit les transports pour les points extrêmes ;
Les autres : Votre tracé direct passe dans le désert et sacrifie tous les intérêts du pays.
La question ainsi posée, on comprend quelle importance les partisans de la ligne directe devaient attacher à prouver, d’une part, que le désert n’est pas aussi désert qu’on le suppose ; de l’autre, que les vallées ne sont ni aussi riches ni aussi peuplées qu’on le dit.
C’est l’argumentation à laquelle a eu recours la commission d’enquête des Basses-Pyrénées, et, dans l’ impartial exposé des motifs de M. le Ministre des travaux publics, on la voit reproduite en ces termes :
« Il convient de remarquer que, dans les cantons des grandes Landes, la population s’est constamment accrue, depuis quarante ans, dans une proportion moyenne de 50 pour 100 ; tandis que dans les vallées elle est demeurée stationnaire et même a décru sur quelques points. »
J’ai lieu de croire que le fait qu’on invoque a été puisé dans un mémoire que j’ai publié sur la répartition de l’impôt dans le département des Landes, mémoire qu’on ne manquera pas sans doute de faire passer sous vos yeux. Il doit donc m’être permis de protester contre l’usage étrange qu’on en prétend faire. Je n’ai pas la prétention de plaider pour ou contre une des deux lignes rivales, mais j’ai celle de m’opposer à ce que, pour éloigner le chemin de nos vallées, on fasse argument de tout, même de leurs souffrances.
Tout homme qui s’est occupé du vaste sujet de la population sait qu’elle croît plus rapidement, d’ordinaire, dans les pays où elle est rare que dans ceux où elle a atteint une grande densité. Dire que c’est là un motif pour accorder la préférence aux premiers, en fait de chemin de fer, c’est dire qu’ils sont plus utiles en Russie qu’en Angleterre, et dans les Landes que dans la Normandie.
Ensuite on a généralisé un fait local. Il n’est pas vrai que la population diminue dans la vallée de la Garonne, de la Midouze et de l’Adour. Elle y croît lentement, il est vrai, précisément parce qu’elle y est très pressée.
Ce qui est vrai, ce que je ne rétracte pas, c’est que, dans un petit pays, qu’on nomme la Chalosse, situé sur la rive gauche de l’Adour, et spécialement dans quatre à cinq cantons vinicoles de cette province, le nombre des décès surpasse régulièrement, depuis vingt ans, le nombre des naissances.
C’est là une perturbation déplorable, un phénomène unique dans le siècle, et il ne se montre nulle part, pas même en Turquie. Pour savoir ce qu’on en doit conclure, relativement à la question qui nous occupe, il ne suffit pas de constater le fait, il faut encore le rattacher à sa cause.
La population a décru, disent les commissaires enquêteurs. Ce mot est bientôt prononcé. Ah ! ils ne savent pas tout ce qu’il implique ! Ils n’ont pas assisté à ce douloureux travail par lequel s’accomplit une telle révolution ! Ils ne savent pas ce qu’elle suppose de souffrances morales et physiques. Je vais le leur dire. C’est une funèbre histoire, mais elle est pleine d’enseignement.
La Chalosse est un des pays les plus fertiles de la France.
Autrefois, on y récoltait des vins qui descendaient l’Adour. Une partie se consommait aux environs de Bayonne ; l’autre s’exportait au nord de l’Europe. Ce commerce extérieur occupait à Bayonne l’activité et les capitaux de dix ou douze maisons honorables, dont un de vos collègues, M. Chégaray, pourrait au besoin citer les noms.
À cette époque les vins avaient une valeur soutenue. L’aisance s’était répandue dans le pays, et avec elle la population. L’étendue des métairies s’était naturellement restreinte ; elles ne comportaient pas plus de deux à trois hectares. Chacune de ces petites exploitations, travaillée comme un jardin, fournissait à une famille des moyens assurés d’existence. Les revenus des propriétaires et des métayers faisaient vivre une classe nombreuse d’artisans, et l’on conçoit à quel degré de densité la population avait dû parvenir sous ce régime.
Mais les choses ont bien changé !
La politique commerciale qui a prévalu parmi les peuples a fermé à la Chalosse ses débouchés extérieurs. L’exportation a été, je ne dirai pas réduite, mais détruite, complétement anéantie.
D’un autre côté, le système des contributions indirectes a beaucoup restreint ses débouchés intérieurs. En affranchissant de l’impôt de consommation, en faveur du propriétaire, le vin récolté sur son fonds, il a altéré, en matière de viniculture, la division du travail. Il a agi comme ferait une loi qui porterait : « Le pain sera soumis à un impôt, excepté celui que chacun fera dans son ménage. » Évidemment une telle disposition tendrait à détruire la boulangerie.
Enfin, l’Adour cesse graduellement d’être navigable. Des documents authentiques constatent que les bateaux remontaient jusqu’à Aire. — Les vieillards du pays les ont vus aller à Grenade ; je les ai, moi-même, vus charger à Saint-Sever. Maintenant ils s’arrêtent à Mugron, et d’après les difficultés qu’on éprouve à les y conduire, il est aisé de prévoir que dans peu ils ne dépasseront pas le confluent de la Midouze.
Je n’ai point à raisonner sur les causes. Elles existent, c’est positif. Quels ont été les effets ?
D’abord de diminuer le revenu des propriétaires ; ensuite de rendre la part du métayer insuffisante pour son existence et celle de sa famille. Il a donc fallu que, sur ce qui lui restait de revenu, le propriétaire fît un fort prélèvement pour parfaire au métayer ce qui est rigoureusement nécessaire au maintien de la vie. L’un a été ruiné. Vainement il a lutté contre les séductions du luxe dont le siècle l’entoure de toute part ; vainement il s’est imposé les plus durs sacrifices, la parcimonie la plus minutieuse, il n’a pu échapper aux cuisantes douleurs qui accompagnent une dégradation inévitable.
Le métayer n’a plus été un métayer ; sa part colonne ne servant qu’à diminuer sa dette, il est devenu un journalier auquel on donne pour tout salaire une ration quotidienne de maïs.
En d’autres termes, on a reconnu que l’étendue des exploitations, bonne pour d’autres circonstances, était maintenant trop bornée ; et en ce moment il s’opère, dans la constitution agricole du pays, une révolution remarquable.
Les vins n’ayant plus de débouchés, deux hectares de vigne ne peuvent plus constituer un corps d’exploitation. Il y a tendance manifeste à organiser la propriété sur d’autres bases. De deux métairies de vigne, on en fait une qui renferme une juste proportion de labourables. On comprend que, sous l’empire des causes énumérées, ce n’est plus deux ou trois hectares qu’il faut, mais cinq ou six pour faire vivre une famille de métayers. Là aussi on fait des fusions, mais des fusions qui altèrent les sources de la vie.
Dans la commune que j’habite, trente maisons de métayers ont été démolies depuis le cadastre, et plus de cent cinquante dans le canton dont les intérêts judiciaires me sont confiés ; et remarquez ceci, ce sont autant de familles vouées à une complète destruction. Leur sort est de souffrir, décliner et disparaître.
Oui, la population a diminué dans une partie de la Chalosse, et j’ajouterai, dût-on retourner contre elle cet aveu, que cette dépopulation, si elle accuse notre détresse, est bien loin d’en donner la mesure. Si vous parcouriez mon malheureux pays, vous apprendriez combien les hommes peuvent souffrir sans mourir, et qu’une vie de moins sur vos froides statistiques est le symptôme d’incalculables tortures.
Et maintenant ce sont nos souffrances qu’on invoque contre nous ! Et pour nous refuser des débouchés, on nous parle des douleurs que le défaut des débouchés nous inflige ! — Encore une fois, je ne me prononce pas sur le tracé du chemin de fer. Je sais que les intérêts de la Chalosse pèseront bien peu dans la balance. Mais, si je ne m’attends pas à ce qu’ils soient un argument pour le tracé des vallées, je ne veux pas qu’on en fasse un argument contre, parce qu’un tel argument est aussi faux que cruel. N’est-ce point, en effet, une impitoyable cruauté que de venir nous dire : « Vous avez un beau ciel, un sol fécond, de fraîches vallées, des coteaux sur lesquels le travail de vos pères avait répandu l’aisance et le bonheur. Grâce à ces dons de la nature et de l’art, votre population était aussi pressée que dans nos plus riches provinces. Les débouchés vous ont fait défaut tout à coup, et la détresse a succédé à l’aisance, les larmes aux chants de joie. Or, pouvant disposer d’un immense débouché, nous ne savions encore si nous en doterions le désert ou si nous le mettrions à votre portée. Vos souffrances nous décident. Elles sont bien avérées ; le pouvoir lui-même les a constatées, par ces expressions laconiques : ce n’est rien, c’est la population qui diminue. Il n’y a rien à répliquer à cela ; et nous voilà bien décidés à rejeter le chemin dans la grande Lande. Cette détermination, en ruinant toutes vos villes, accélérera la dépopulation qui vous attriste ; mais la chance de peupler le désert ne vaut-elle pas bien la certitude de dépeupler les vallées ? »
Ah ! Messieurs, donnez au chemin la direction que, dans votre sagesse, vous jugerez la plus utile à l’intérêt général ; mais si vous en frustrez notre vallée, ne dites pas dans vos considérants, comme on vous y engage, que ce sont ses malheurs, et ses malheurs seuls, qui vous déterminent.
Sur un livre de Monsieur Vidal [June, 1846]↩
BWV
1846.06.15 "De la répartition des richesses. Par M. Vidal" (On the Redistribution of Wealth by M. Vidal) [*Journal des économistes*, June 1846, T. 14, No. 55, pp. 243-49][OC1.12, pp. 440-51]
De la répartition des richesses, Par M. Vidal [1]
Ce livre se présente sous de tristes auspices. Son apparition dans le monde a réveillé, au fond de ces cavernes littéraires,
Que la haine se creuse au bas des grands journaux, un écho d’injures plus fait pour attrister que pour irriter ceux à qui elles s’adressent, et qui placent sous des préventions défavorables non-seulement le feuilletoniste, mais encore l’auteur qui a inspiré le feuilleton.
Par une coïncidence singulière, le jour même où je lisais dans la Démocratie pacifique ces épithètes accumulées sur la tête de nos plus illustres économistes : ignorants, orgueilleux, hérétiques maudits, sots, impies, fatalistes, plagiaires, marionnettes, traîtres, etc., etc., ce jour même, le hasard mettait sous mes yeux une galerie de lettres autographes, où l’on voit les plus grands hommes du siècle, les plus ardents amis de l’humanité, Jefferson, Maddison, Bentham, Bernadotte, Chateaubriand, B. Constant, et même Saint-Simon, venir rendre l’hommage le plus sincère et le plus spontané à la science et à la philanthropie de J. B. Say.
Mais ne cherchons pas une pénible solidarité entre M. Vidal et son compromettant commentateur, qui, je l’espère, rougira un jour de son injustice et de ses emportements.
Il me semble que c’est faire preuve d’un orgueil bien indomptable, quand on aborde une science, que de débuter ainsi : « Mes devanciers n’ont rien su ni rien vu. Vainement des hommes tels que Smith, Malthus, Say, ont consacré toute leur vie et de puissantes facultés à l’étude d’un sujet ; ils ne l’ont pas même entrevu. Moi, j’arrive, j’ai vingt ans, et j’ai fait la science. »
N’inspirerait-on pas plus de confiance au public, si l’on disait : La science est de sa nature progressive. Mes prédécesseurs l’ont avancée ; mais, aidé de leurs travaux, j’aspire à l’avancer encore. Forcés de creuser les idées élémentaires, d’analyser les notions de travail, utilité, valeur, capital, production, etc., ils me semblent n’avoir pas assez approfondi le phénomène de la répartition des richesses ; je viens après eux, et mettant à profit les connaissances qu’ils nous ont transmises, prenant la science où ils l’ont laissée, j’essaye de lui faire faire un pas de plus.
Mais, pour que M. Vidal pût tenir un tel langage, il aurait fallu qu’il s’astreignît à la méthode de ses devanciers, à l’observation de la manière dont les faits se passent et s’enchaînent. Cette méthode, il la repousse. Selon lui, la science, ainsi limitée, n’est qu’un objet de pure curiosité. Il pense que sa mission est de donner des conseils, d’enseigner, peut-être même d’imposer des règles de conduite. — « La belle science, s’écrie-t-il, qui se résume en une négation : ne rien faire ! »
M. Vidal se méprend. La science ne fait à personne un devoir de l’inertie, ou, comme on dirait aujourd’hui, de l’immobilisme. Elle éclaire toutes les routes, celle qui conduit au bien, comme celle qui mène au mal, et croit que c’est à cela que se borne sa tâche, parce que le principe d’action n’est pas en elle, mais dans les hommes. Si le penchant naturel de l’homme le pousse vers ce qui nuit, il est certain que jeter la lumière sur les conséquences des habitudes, c’est seconder cette triste direction. Mais si l’homme est porté au bien, il suffit que la science le montre, et il n’est pas nécessaire, pour l’y déterminer, qu’elle invoque la contrainte ni même le devoir.
Ce qui nous sépare complétement des écoles dites socialistes, fouriéristes, communistes, saint-simoniennes, etc., c’est précisément cela. Elles placent le principe d’action dans l’observateur, et nous le laissons là où il est, dans le sujet observé, l’homme.
Ce qu’il y a de singulier, c’est qu’ils nous accusent de ne voir dans les hommes que des chiffres, des quantités abstraites. « Qu’ils cessent, dit M. Vidal, de faire abstraction de l’homme, dans une science qui a pour but le bonheur de l’homme. »
Mais c’est vous qui faites abstraction de l’homme, de ce qu’il y a en lui d’intelligence, de moralité, de vie, d’initiative, de perfectibilité ; car, pour vous, qu’est-ce que l’humanité, si ce n’est une matière inerte, une argile, que le savant, sous le nom de réformateur, organisateur, peut et doit pétrir à son gré ?
L’économie politique, ainsi que son nom même le témoigne, admet que l’homme est un être sentant et pensant ; que les facultés de comparer, de juger, de décider sont en lui ; que la prévoyance l’avertit, que l’expérience le rectifie, qu’il porte avec lui le principe progressif.
Voilà pourquoi elle se borne à décrire les phénomènes, leurs causes et leurs effets, — sûre que les hommes sauront choisir.
Voilà pourquoi, comme celui qui place des écriteaux à l’entrée de chaque route, elle se contente de dire : Voici où conduit l’une : voilà où mène l’autre.
Mais vous, vous ne voyez dans les hommes que de la matière expérimentale, des machines qui produisent et consomment ; et désirant, il faut vous rendre cette justice, que la richesse soit équitablement répartie entre eux, vous vous attribuez cette fonction, persuadé que vous êtes que la Providence n’y a pas pourvu.
« Suffira-t-il au mécanicien, dit M. Vidal, pour inventer la machine, d’observer, de recueillir des faits, puis de laisser faire les forces naturelles ? Eh ! non, sans doute, il faut encore qu’il trouve le moyen d’utiliser ces forces, qu’il invente sa machine… »
« De même, en économie…, on peut inventer un mode particulier de production et de consommation, un système économique. »
Ailleurs, il compare la société à un régiment :
« Faudra-t-il donc laisser chacun manœuvrer à sa guise, permettre à chaque officier, à chaque soldat de faire et de suivre son petit plan de campagne ? etc. »
Ailleurs, à un orchestre :
« Comme les musiciens d’un orchestre discipliné, chacun de nous a un rôle utile, indispensable… ; mais pour qu’il y ait accord, unité, il faut que tous les exécutants obéissent à la pensée du compositeur et à la direction du chef d’orchestre. »
Mais quand un mécanicien a sous la main des rouages, des ressorts, il dispose d’une matière inerte, et son intervention est indispensable. Les hommes ne sont-ils donc que des rouages et des ressorts aux mains d’un socialiste ?
Mais ces soldats, que vous nous proposez pour exemple, quoiqu’ils soient des hommes, en tant que soldats, ne sont plus hommes, ils ne sont que des machines. Le principe d’action n’est plus en eux. Soumis, selon cette énergique expression, à l’obéissance passive, ils ne s’appartiennent plus, ils tournent à droite et à gauche au moindre signe. Aussi faut-il tirer au sort à qui ne sera pas soldat. Croyez-moi, l’humanité ne se laissera pas aisément réduire à ce rôle passif que vous lui réservez.
Enfin, vos musiciens, nous en convenons volontiers, arriveront à l’accord, à l’harmonie, si la direction du chef d’orchestre est imposée.
Eh ! mon Dieu, ce n’est pas en économie seulement ; et qui ne sait qu’en toutes choses le despotisme infaillible serait la meilleure solution ?
Mais où est-il ce chef d’orchestre social en mesure de faire reconnaître son titre d’infaillibilité et son droit à la domination ?
En son absence, j’aime mieux laisser les musiciens eux-mêmes s’organiser entre eux, car, comme vous le dites, ils sont trop intelligents pour ne pas comprendre que sans cela l’harmonie serait impossible !
Vous voyez donc bien que nous commençons à nous entendre, et que vous êtes amené, comme nous, à laisser, bon gré mal gré, le principe d’action là où Dieu l’a placé, dans l’humanité et non dans celui qui l’étudie.
Quand nous exposons les phénomènes, leurs causes et leurs conséquences ; quand nous nous contentons de montrer comment telle action vicieuse conduit inévitablement à telle conséquence funeste ; quand, par exemple, nous disons : La paresse conduit à la misère, l’excès de population à une diminution et à une mauvaise répartition du bien être, vous vous écriez que nous sommes fatalistes.
Entendons-nous. Oui, nous sommes fatalistes à la manière des physiciens, quand ils disent : « Si une pierre n’est pas soutenue, il est fatal qu’elle tombe. »
Nous sommes fatalistes à la manière des médecins, quand ils disent : « Si vous mangez outre mesure, il est fatal que vous ayez une indigestion. »
Mais reconnaître l’existence d’une loi fatale, est-ce bien du fatalisme ? Après tout, avons-nous fait ces lois, comme vous nous en accusez, quand vous reprochez aux économistes tous les maux de la société, faisant abstraction des mauvaises habitudes, des préjugés, des erreurs et des vices par lesquels elle a pu se les attirer ?
Le vrai fatalisme, ce me semble, est au fond de tous vos systèmes, qui, quelque opposés qu’ils soient entre eux, s’accordent seulement en ceci : le bonheur ou le malheur des hommes, indépendant de leurs vices et de leurs vertus, et sur lequel, par conséquent, ils ne peuvent rien, dépend exclusivement d’une invention contingente, d’une organisation imaginée, en l’an de grâce 1846, par M. Vidal.
Il est bien vrai qu’en l’an 1845 M. Blanc en avait imaginé une autre. Mais, heureusement, les trois milliards d’hommes qui couvrent la terre ne l’ont pas acceptée ; sans cela ils ne seraient plus à temps d’essayer celle de M. Vidal.
Que serait-ce si l’humanité s’était pliée à l’organisation inventée par Fourier, qui offrait au capital 24 pour 100 de dividende au lieu des 5 pour 100 qu’assure la nouvelle invention ?
Pour se faire une idée de l’esprit de despotisme qui fait la base de toutes ces rêveries, il suffit de voir combien on y est prodigue de formules comme celles-ci :
« Il faudra proportionner la production aux moyens de consommation.
Il faudra organiser puissamment le travail.
Il faudra appeler toutes les activités et toutes les intelligences, etc.
Il faudra distribuer les produits d’après la justice.
Il faudra élever chaque travailleur au rang de sociétaire.
Il faudra lui fournir les moyens de satisfaire ses besoins, etc.
Il faudra établir l’équilibre entre la production, la consommation et la population.
On peut combiner un bon mécanisme industriel.
On peut inventer un mode particulier de production et de consommation.
Il faut constituer avant tout la solidarité effective. »
Tout cela est bientôt dit. Mais quand on demande aux socialistes : Qui donc fera toutes ces choses ? qui donc, si l’humanité est passive, l’animera du souffle de vie ? chacun d’eux se pose et répond : Moi.
Il faut être juste envers M. Vidal. Il ne dit pas moi ; il dit : le pouvoir, l’autorité.
Mais ce n’est là que reculer la difficulté ; car si tous les hommes sont des ressorts, des soldats, de la matière inerte ; si toute pensée d’ordre et d’organisation émane d’une autorité, à quel signe pouvons-nous la reconnaître ?
La difficulté est grande, et il fallait bien que M. Vidal se donnât la peine de la résoudre.
Voici comment il s’exprime :
« Nous supposons à priori un pouvoir normal régulièrement constitué. Nous laissons à chacun la faculté de comprendre sous ce nom le système qu’il préfère, qu’il désire, qu’il conçoit ou qu’il rêve. Le gouvernement, quel qu’il soit, c’est pour nous la protection, la prévoyance sociale, le représentant de l’ordre pour tous et dans l’intérêt de tous, etc. »
Si vous supposez à priori un pouvoir normal et infaillible, nous sommes d’accord. Seulement montrez-moi son certificat d’infaillibilité, et je suis prêt à me laisser organiser.
Mais si, dans l’embarras de trouver ce phénix, vous admettez une autorité quelconque, telle que chacun la préfère, la désire, la conçoit ou la rêve, je crains bien que nous n’ayons autant d’autorités qu’il y a d’hommes, ce qui nous replace justement au point de départ.
Ici, M. Vidal a recours à la grande ressource des socialistes, l’organisation. Une s’agit que d’organiser le pouvoir.
« Un mauvais gouvernement, dit-il, peut abuser de la force ; cela est vrai. Mais un bon gouvernement, loin de gêner en rien la liberté véritable, peut en favoriser le développement… ; il ne s’agit donc pas d’amoindrir ou de supprimer le pouvoir, mais de lui donner une bonne organisation. »
C’est fort bien. Mais qui est-ce qui organisera le pouvoir ? La société sans doute. — Point du tout, puisque c’est le pouvoir qui doit organiser la société. — J’entends ; M. Vidal, ou tout autre socialiste qui préfère, désire, conçoit ou rêve, organisera le pouvoir, lequel organisera la société. Reste toujours à savoir comment est organisé le premier organisateur.
Il y a, dans le livre de M. Vidal, un chapitre vers lequel on se sent attiré parla séduction du titre : Conclusion pratique. Il y a si longtemps que nous désirons voir les socialistes formuler une conclusion ! Enfin, me disais-je, la nouvelle invention sociale va nous être déroulée dans tous ses détails, avec les moyens d’exécution propres à faire fonctionner l’appareil.
Malheureusement M. Vidal, se fondant sur ce que nous ne sommes pas en état de le comprendre, ne nous dit rien.
La société actuelle est une masure que nous refusons obstinément d’abandonner. Il a bien dans sa poche le plan de constructions nouvelles ; mais à quoi bon nous les montrer, puisque nous ne voulons pas en entendre parler, et que nous nous obstinons à maintenir la maison délabrée, l’édifice vermoulu ? Il n’y a donc pas pour aujourd’hui de restauration possible. Reste tout au plus à placer des arcs-boutants au dehors et à gâcher du plâtre dans les crevasses.
Notre obstination nous prive donc de l’avantage de connaître le nouvel appareil social imaginé par M. Vidal. Tout ce qu’il nous laissera voir, ce sont quelques élançons et un peu de plâtre, qu’il veut bien appliquer à retarder la chute du vieil édifice.
Le problème ainsi circonscrit, M. Vidal en revient à ses formules favorites :
« Il faut organiser, sur tous les points du royaume, dans chaque département, des ateliers où tout homme de bonne volonté puisse toujours trouver à gagner sa vie en travaillant ; où tout ouvrier inoccupé, déplacé par la mécanique, puisse utiliser ses bras ; des ateliers qui ne fassent point concurrence aux ateliers existants, car autrement on créerait autant de pauvres d’un côté qu’on en soulagerait de l’autre.
Des ateliers permanents, qui soient à l’abri du chômage et des mortes-saisons, à l’abri des crises commerciales, industrielles et politiques.
Des ateliers où l’introduction d’une machine perfectionnée profite aux travailleurs, sans pouvoir leur porter préjudice…
Des ateliers où l’on puisse établir un équilibre constant entre la production et les besoins de la consommation ; des ateliers où la population surabondante des villes puisse se déverser.
Des ateliers où le travailleur trouve le bien-être, l’indépendance et la sécurité ; une occupation permanente, une rétribution convenable et toujours assurée. »
Certes, nous rendons justice aux bonnes intentions de M. Vidal, et nous désirons que ses vues philanthropiques se réalisent. Comme lui, nous voudrions qu’il n’y eût pas un homme sur la terre qui ne trouvât toujours du travail assuré, du bien-être, de la sécurité, de l’indépendance ; qui ne fût à l’abri de toute crise commerciale, industrielle, politique et même atmosphérique ; qu’il y eût parfait équilibre entre la production, la consommation et la population.
Mais au lieu de penser, comme M. Vidal, qu’il y a un être abstrait qu’on appelle l’État, qui a les moyens de réaliser ces beaux rêves ; au lieu de faire dériver exclusivement le bonheur individuel d’une organisation inventée par un journaliste et imposée du dehors aux travailleurs, nous croyons qu’il dépend surtout des habitudes et des vertus des travailleurs eux-mêmes. Si les uns sont actifs et les autres paresseux ; s’il y a parmi eux des prodigues, des économes, des avares, des gens ordonnés et des gens débauchés ; si les uns se marient à seize ans, et sont chargés de famille à l’âge où les autres s’établissent, — nous ne voyons pas d’organisation qui puisse empêcher l’inégalité de s’introduire dans votre colonie.
S’il y a des hommes qui se livrent à des entreprises hasardeuses, des gens qui empruntent sans savoir comment ils pourront rendre, et d’autres qui prêtent sans savoir comment ils seront payés ; si la colonie est saisie, par exemple, de passions guerrières qui la mettent en hostilité avec le genre humain, — nous ne croyons pas que votre organisation la mette à l’abri de toute crise commerciale et politique.
Vous aurez beau nous dire que nous sommes fatalistes parce que nous croyons que le mal lui-même a sa mission, celle de réprimer le vice dont il est le produit ; oui, nous devons l’avouer, nous croyons à l’existence du mal. Nous n’y croyons pas seulement, nous le voyons ; et, au physique comme au moral, nous n’avons pas d’autre alternative à proposer à l’humanité que de l’éviter par la prévoyance ou de le subir par la douleur.
À moins donc que vous ne chargiez votre organisateur d’avoir de la prudence pour tout le monde, de l’ordre, de l’économie, de l’activité, des lumières et des vertus pour tout le monde, vous nous permettrez de continuer à croire que l’humanité ne peut être heureuse qu’autant que ces causes de bonheur soient en elle-même.
Et certes, si vous me permettez de supposer seulement l’existence d’un vice dans la colonie dont vous tracez le plan ; si vous raisonnez dans l’hypothèse qu’elle est affectée de paresse, ou de débauche, ou de faste, ou d’ambition, ou d’humeur conquérante, vous arriverez à voir qu’elle suivra bientôt la destinée commune et qu’il n’est pas au pouvoir de l’organisation la plus ingénieuse d’empêcher l’effet de sortir de la cause.
Ainsi les ordres sociaux, que chacun de vous invente chaque jour, supposent la perfection dans l’inventeur d’abord, et ensuite dans l’humanité, cette même matière inerte dont s’amuse votre féconde imagination.
Eh ! monsieur, accordez-nous seulement la perfection de l’humanité, et croyez que les économistes feront des plans sociaux tout aussi séduisants que les vôtres.
Les socialistes nous reprochent de repousser l’association. Et nous, nous leur demandons : De quelle association voulez-vous parler ? est-ce de l’association volontaire ou de l’association forcée ?
Si c’est de l’association volontaire, comment peut-on nous reprocher de la repousser, nous qui croyons que la société est une grande association, et que c’est pour cela qu’elle s’appelle société ?
Veut-on parler seulement de quelques arrangements particuliers, que peuvent faire entre eux les ouvriers d’une même industrie ? Eh ! mon Dieu, nous ne nous opposons à aucune de ces combinaisons : société simple, en commandite, anonyme, par actions et même en phalanstère. Associez-vous comme vous l’entendrez, qui vous en empêche ? Nous savons fort bien qu’il y a des conventions plus ou moins favorables au progrès de l’humanité et à la bonne répartition des richesses. Pour l’exploitation des terres, par exemple, avons-nous jamais dit que le fermage et le métayage, par cela seul qu’ils existent, exercent pour toutes les classes agricoles des effets identiques ? Mais nous pensons que la science a rempli sa tâche quand elle a exposé ces effets ; parce que, encore une fois, nous pensons que le principe d’action, l’aspiration vers le mieux n’est pas dans la science, mais dans l’humanité.
Mais vous, vous qui ne voyez dans l’espèce humaine qu’une cire molle aux mains d’un organisateur, c’est l’association forcée que vous proposez ; l’association qui ôte à tous les individus, hors un, toute moralité et toute initiative ; c’est-à-dire le despotisme le plus absolu qui ait jamais existé, je ne dis pas dans les annales, mais même dans l’imagination des hommes.
Je ne terminerai pas sans rendre à M. Vidal la justice qui lui est due. S’il a épousé les théories des socialistes, il n’a pas emprunté leur style. Son livre est écrit en français, et même en bon français. Le néologisme s’y montre, mais il n’y déborde pas. M. Vidal nous fait grâce du vocabulaire fouriériste, et des gammes et des pivots, et des amitiés en quinte superflue, et des amours en tierce diminuée. S’il voit la science sous un autre aspect que ses devanciers, il la prend du moins au sérieux, il ne méprise pas son public au point de vouloir lui en imposer par des phrases d’Apocalypse. C’est d’un bon augure, et si jamais il fait une seconde édition de son livre, je ne doute pas qu’il n’en retranche, sinon ce qu’il va d’erroné dans la partie systématique, du moins ce que la partie critique offre d’exagéré et même d’injuste.
FN:Extrait du Journal des Économistes, n° de juin 1846. (Note de l’éditeur.)
Aux membres de l’Association [14 juin 1846] ↩
BWV
1846.6.14 “Aux membres de l’Association pour la liberté des échanges” (To the members of the Free Trade Association) [*Mémorial bordelais*, 14 juin 1846] [OC7.23, p. 108]
Aux membres de l’Association pour la liberté des échanges [1]
Mes chers Collègues,
Quelques esprits ardents s’affligent de ce que l’Association parisienne a fait si peu de progrès. Je voudrais les convaincre qu’ils se pressent trop de désespérer. Paris offre tous les éléments de succès. Sans doute le travail de cohésion et d’organisation est lent ; il peut être souvent interrompu par les circonstances, comme il l’est maintenant par les élections générales, qui absorbent à bon droit l’attention publique ; mais l’œuvre sera reprise en temps opportun, et le triomphe en est assuré.
Eh quoi ! Une noble et belle cause peut-elle faillir quand elle rallie toutes les fortes intelligences d’une époque, toutes les illustrations, toutes les renommées, tous les titres que le génie élève au-dessus du siècle !
J’exposerai devant vous le dénombrement de nos forces, et vous verrez s’il y a lieu de désespérer.
Si l’on vous demandait quel est l’homme qui léguera à nos annales la renommée parlementaire la plus solide et la plus pure ; qui, par la hauteur de ses vues, la constance de ses convictions, plus encore que par l’éclat de son nom, s’est élevé au plus haut degré d’influence qu’on puisse acquérir en dehors du pouvoir, vous nommeriez l’illustre pair qui a consacré sa vie à l’abolition de l’esclavage ; mais vous ne seriez pas étonné d’apprendre qu’il n’est pas moins favorable à l’abolition du monopole ; car l’esclavage et le monopole reposent sur le même principe.
Si l’on vous demandait :
Quel est le poëte du sentiment, qui a fait vibrer dans nos cœurs les cordes les plus intimes et les plus mystérieuses ?
Quel est le poëte du peuple, dont les chants, aux jours de notre jeunesse, pénétraient comme un fluide puissant et rapide dans toutes les couches de la société ?
Quel est le prosateur inimitable, ou plutôt le poëte des idées, qui a su jeter sur le monde des abstractions le manteau d’un style à la fois simple, gracieux, touchant, énergique, expression d’une belle âme tourmentée par l’inquiétude du génie ?
Quel est le savant qui, soumettant les élans de l’imagination aux lois du calcul, a sondé le plus avant la mystérieuse profondeur des harmonies célestes, pour venir ensuite distribuer la science aux profanes, sous les formes les plus accessibles ?
Quel est l’orateur, quelle que soit sa bannière, qui a fait revivre à notre tribune nationale les traditions des Foy et des Mirabeau ?
Quel est l’homme d’État, quelque opinion qu’on se fasse de sa pensée politique, qui, par l’éloquence et le caractère, a su la faire dominer sur un peuple encore tout frémissant des agitations et des espérances de Juillet ?
Quel est l’heureux du siècle à qui une habileté d’un autre ordre, qui a aussi son génie, a fait donner le nom de roi de la finance ?
Vous répondriez : C’est le duc de Broglie, c’est Lamartine, Béranger, Lamennais, Arago, Berryer, Guizot, Rothschild, qui tous, avec des vues diverses, souvent opposées, ont marché, chacun dans sa voie, jusqu’aux bornes qui semblent assignées au domaine intellectuel de notre époque.
Eh bien ! Messieurs, une cause est-elle perdue, quand elle a pour elle des autorités si imposantes, et auxquelles leur diversité même communique une force irrésistible ?
Je ne veux pas dire que tous ces personnages illustres prendront une part directe à notre association, mais je sais que tous adhèrent à son principe et nous entourent de leur sympathique assentiment [2].
Que les monopoleurs, armés du télescope, cherchent donc dans tout l’horizon intellectuel une petite étoile pour faire équilibre à cette écrasante constellation.
On dit qu’ils ont pour eux M. Thiers. C’est beaucoup ; mais, en vérité, cela ne suffit pas.
À cette nomenclature assez rassurante, et que j’aurais pu allonger beaucoup, se joint un autre symptôme encore plus propre peut-être à vous inspirer de la confiance. Je veux parler du mouvement qui s’est opéré dans la presse française.
L’opinion des journaux fait-elle celle des abonnés, ou celle des abonnés fait-elle celle des journaux ? ou bien, ce qui est plus probable, exercent-elles l’une sur l’autre une action réciproque ? Quoi qu’il en soit, et dans toutes les hypothèses, un principe est bien près de son triomphe quand on voit tous les journaux venir l’un après l’autre se ranger sous son drapeau.
Vous avez vu l’attitude ferme et décidée qu’a prise le Journal des Débats, cette feuille qui, par ses relations, le public auquel elle s’adresse, le mérite de sa rédaction, est une des grandes forces du pays, presque un des pouvoirs de l’État, sinon défini par la Charte, du moins écrit dans les faits. — Le Journal des Débats est pour vous.
Le Courrier français, qui n’a d’engagements avec aucun parti, est pour vous. C’est une sentinelle avancée, courageuse et même un peu aventureuse, telle qu’il en faut à une doctrine qui sort de l’abstraction pour entrer dans la carrière militante.
La Patrie est pour vous. Les journaux qui se forment ou se reforment, comme le Commerce et l’Océan, cherchent un abri sous votre bannière.
La Réforme ne ment pas à son titre : elle est pour vous.
La Démocratie pacifique est pour vous. Sans doute la liberté d’échanger n’a qu’une importance secondaire à ses yeux auprès de la merveilleuse organisation qu’elle rêve et qui doit effacer tous les péchés du monde ainsi que toutes ses misères ; mais elle convient que, pour être maîtres de s’associer, les hommes doivent au moins s’appartenir à eux-mêmes ; d’où il suit que la lutte contre le monopole doit précéder le travail de l’organisation.
Il est un journal que je regrette de ne pas voir dans nos rangs et au premier rang, c’est le National. Quoique cette feuille soit l’organe d’un parti, elle est considérée dans tous, à cause du mérite transcendant de ses écrivains et de sa réputation bien établie d’indépendance et d’austérité politique. Je sais que le National est favorable à la liberté commerciale comme à toutes les libertés. S’il ne descend pas dans la lice, cela tient à ses vues sur la politique générale de l’Europe, qui lui font penser que le moment n’est pas venu où la France pourrait, sans péril, s’engager par les liens du commerce avec des puissances oligarchiques ou absolues, hostiles aux principes de notre révolution. Mais, quoi ! les nations les plus avancées en industrie ne sont-elles pas les plus éclairées en politique ? — Et le commerce libre, ce grand distributeur des produits, n est-il pas aussi le grand propagateur des idées ?
Enfin, si je jette un coup d’œil sur la presse départementale, je n’y vois aucun motif de découragement. Les trois grands journaux de Bordeaux défendent énergiquement notre principe. Le Courrier de Marseille consacre à cette cause un talent de premier ordre. Le Sémaphore suit la même voie ; je ne connais qu’un journal à Lyon, et il est pour nous, ainsi que le Journal du Havre, qui a acquis en ces matières une grande autorité.
Tel est, dans la presse française, le dénombrement de nos forces. Quels sont nos adversaires ? La Presse et le Constitutionnel. Encore ces deux journaux s’accordent-ils à reconnaître la vérité et la justice de notre doctrine. Ils se bornent à en ajourner indéfiniment l’application. En principe, disent-ils, vous avez raison. Ah ! ils ne comprennent pas sans doute toute la portée d’une telle concession ! Nous avons raison en principe ! Et qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la restriction est un système faux et oppressif ; — donc il faut le renverser. Cela veut dire que le monopole est une injustice, une spoliation, un déplacement forcé et violent de la richesse, transportée des uns aux autres sans compensation ; — donc il faut rétablir le règne de la justice et de l’intégrité du droit de propriété. Cela veut dire que la protection est une illusion, une déception, qu’elle opprime le travail en prétendant le favoriser ; que ses effets sont directement contraires à ses promesses ; qu’elle retranche au bien-être des masses et porte ainsi atteinte à leur dignité et à leur moralité.
Voilà ce qui est impliqué dans cet aveu : La liberté des échanges est vraie en principe ; car elle serait fausse en théorie comme en pratique, s’il était au pouvoir de la restriction de faire plus de bien que la liberté. Aussi les journaux auxquels je fais allusion ne pourront pas tenir longtemps la position qu’ils ont prise. Les principes ont d’autres exigences, et les abonnés aussi. Ce n’est pas impunément qu’on peut dire longtemps à un principe (c’est-à-dire à la vérité) : « Je te respecte et te salue, mais je te tourne le dos. » Il vient un moment où le lecteur voit une insulte dans ce langage [3].
FN: Mémorial bordelais du 14 juin 1846.
FN:Aucun de ces personnages ne fit partie de l’association pour laquelle, dans des conversations particulières, ils n’avaient pas hésité à témoigner de la bienveillance. La plupart n’avaient pas assez étudié la question, et les plus compétents n’étaient pas assez convaincus pour embrasser ouvertement la cause du libre-échange, sans s’inquiéter des obstacles qui pouvaient en retarder le triomphe.(Note de l’édit.)
FN:On vient de voir l’auteur, s’adressant à ses collègues, manifester une ferme espérance. Dans la pièce suivante, n° 24, il emprunte, pour s’adresser à un ministre, le fier langage d’Achille. Sa lettre à M. Duchâtel eut des résultats bien divers, sur lesquels les pages 73 et 74 du tome Ier fournissent des renseignements.(Note de l’édit.)
À M. Tanneguy-Duchâtel, ministre de l’intérieur [30 juin 1846] ↩
BWV
1846.06.30 “À M. Tanneguy-Duchâtel, ministre de l’intérieur” (To M. Tanneguy-Duchâtel, , Minister for the Interior) [*Mémorial bordelais*, 30 juin 1846] [OC7.24, 114]
Source
Mémorial bordelais du 30 juin 1846. (Note de l’édit.)
À M. Tanneguy-Duchâtel, ministre de l’intérieur [1]
Un bruit assez étrange est venu jusqu’à moi,
Seigneur ; je l’ai jugé trop peu digne de foi.
On dit, et sans horreur je ne puis le redire,
Que la Ligue aujourd’hui par vos ordres expire.
Serait-il vrai que vous vous efforciez d’anéantir l’Association pour la liberté des échanges, vous qui avez écrit ces lignes :
« Nous défendons, avec nos propres intérêts, ceux des consommateurs en général, et ceux de toutes les branches d’industrie auxquelles les prohibitions enlèvent de vastes débouchés. Entre tous ces intérêts doit se former une ligue puissante, dont les vœux n’appellent ni priviléges ni monopoles, mais se bornent à réclamer les bienfaits de la libre concurrence, le naturel développement de la prospérité générale. »
Mais non ; j’aime mieux croire qu’en entourant le berceau de la Ligue, — de votre ligue, — d’une feinte persécution, vous avez voulu lui donner un ingénieux témoignage de votre sympathie.
Que deviendrait-elle, en effet, sans cet adroit stimulant ? l’économie politique est une belle science, mais elle n’a rien de gai et de bien saisissant. Livrée à elle-même, notre agitation commerciale aurait conservé son caractère scientifique et se serait vue reléguée dans la région glacée de la dissertation. Chez nous, elle ne se mêle pas, comme en Angleterre, à l’éternelle lutte du peuple contre l’aristocratie. Là, le monopole est une des formes de l’oppression féodale, et la résistance qu’on lui oppose a quelque chose de cette ardeur fiévreuse qui, en 89, faisait battre le cœur de nos pères. Ici, il n’est qu’un faux système ; et qu’opposer à un faux système, si ce n’est la froide argumentation ? De l’autre côté du détroit, le privilége retranche directement sur la subsistance du peuple pour ajouter au faste des grands, semant dans les masses la misère, l’inanition, la mort et le crime. C’est donc une de ces questions de charité immédiate si propres à éveiller la sympathie du beau sexe, et les agitateurs anglais trouvaient, jusque dans le cœur des femmes, le plus puissant des encouragements et la plus douce des récompenses. Mais, chez nous, comment intéresser le peuple au syllogisme et les dames à la balance du commerce ?
Il est vrai qu’elles font, dans leur ménage, de l’économie politique, et de la plus orthodoxe encore. On leur entend dire souvent : Je renonce au tricot, parce que c’est une manière dispendieuse d’acheter des bas ; si je fais de la tapisserie, c’est que cela m’amuse, et je sais que j’y perds. — Hélas ! il est triste de penser qu’il nous faut, vous et moi et bien d’autres, accumuler des volumes pour démontrer aux savants ce que comprennent de simples femmes, et pour prouver que l’économie des nations est fondée sur le même principe que l’économie des ménages !
Il n’en reste pas moins que notre théorique association devait résolument renoncer à ces ovations qui, d’ordinaire, accompagnent les réformateurs et soutiennent leur courage. Une seule porte pouvait laisser arriver jusqu’à nous la sympathie populaire, vous l’avez compris sans doute, et c’est pour cela que vous avez voulu l’ouvrir, — c’est la porte de la persécution. La persécution ! Ah ! l’apôtre qui se dévoue à un principe ne la recherche pas ; mais il ne la craint pas non plus. Peut-être la désire-t-il, dans le secret de son cœur, car il sait bien qu’elle est le précurseur et le gage du succès.
Si c’est de la stratégie, de la diplomatie de vieil économiste, elle est fort adroite, sans doute ; mais n’offre-t-elle pas quelques dangers ?
Il y avait au fond de nos codes une loi si odieuse, si exorbitante, que vous n’osiez pas vous en servir. Vous craigniez qu’à sa première apparition, la réprobation publique n’en demandât le retrait ; et vous préfériez la laisser sommeiller, inerte, inefficace, la réservant pour ces cas rares où l’horreur du crime fait oublier le danger de la précaution. Cette loi, en voici le texte :
« Nulle association, etc., ne pourra se former qu’avec l’agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. »
Ce qui veut bien dire : En fait d’association, il n’y a pas de loi, il n’y a que le bon plaisir du ministre.
Voilà où en est la grande nation de 89 et de 1830 ! Voilà le respect qu’obtient chez nous la dignité de l’homme !
Cependant l’Association parisienne pour la liberté des échanges avait déclaré qu’elle n’agirait jamais que par les voies légales. En conséquence, elle vous demanda l’autorisation et les conditions qu’il vous plairait de lui imposer. Beaucoup l’ont blâmée ; pour moi, je l’approuve, et cette ligne de conduite me semble toujours avantageuse ; car de deux choses l’une : ou l’on rencontre une loi juste et prudente, et alors quel motif de ne pas s’y soumettre ? ou l’on se heurte contre une mesure arbitraire, inique, dégradante, et, en ce cas encore, en exiger la stricte application, c’est le meilleur moyen d’en exposer au grand jour les inconvénients et de la frapper de l’animadversion publique.
Voyez en effet ce qui est arrivé. Je vous laisse à juger, monsieur le Ministre, si, après cette expérience, l’article 291 peut longtemps défigurer nos codes.
Il y a deux classes d’industriels en France : les uns prétendent que leur travail laisse naturellement de la perte, et ils veulent être autorisés à la combler par une taxe sur les consommateurs. (C’est vous qui l’avez dit : mémoire sur le système des douanes, page 6.) — Les autres demandent que chacun soit propriétaire de ses propres facultés et de leur produit. Ils soutiennent que la nation ne doit payer de taxes que pour faire face aux services publics.
La question ne pouvait être loyalement portée qu’au tribunal de l’opinion ; et vous, Monsieur, qui avez jadis provoqué l’existence de la Ligue, vous deviez au moins rester neutre.
Eh bien ! les monopoleurs s’associent en toute liberté. Ils s’organisent comme ils l’entendent ; ils se coalisent ; ils ont des réunions, des comités, des journaux, un système de contributions qui fonctionne aussi régulièrement que celui de votre collègue des finances. Grâce à ces ressources, au jour marqué, et quand ils le jugent utile à leurs intérêts, la foule de leurs délégués accourt de tous les points du territoire vers le centre du Gouvernement ; elle le circonvient, elle obsède l’administration, elle pèse d’un poids immense sur les résolutions des pouvoirs publics, et il n’y a pas de législature qui ne se voie contrainte de lui prodiguer les deniers des contribuables.
D’un autre côté, les amis de la liberté et de la justice demandent bénévolement à s’associer aussi. Ils n’aspirent qu’à discuter leurs droits, à répandre l’information, à éclairer les esprits. Que les deux systèmes soient admis à se faire écouter, disent-ils : si le nôtre est faux, il succombera ; s’il est vrai, n’est-il pas juste qu’il triomphe ?
Et vous nous refusez l’autorisation !… Ah ! monsieur le Ministre, prenez garde et voyez sur quel terrain vous transportez le débat. Entre vous et nous, il n’est pas question de liberté commerciale ; c’est une lutte que nous soutiendrons contre les monopoleurs et dont l’opinion sera juge. Ce que nous vous demandons, c’est de tenir la balance égale, de ne pas nous fermer la bouche, de ne pas nous accabler seuls sous les pouvoirs exorbitants que la législation ne vous a pas confiés à celte fin. Si, pour arriver à faire prévaloir nos droits de contribuables, nous sommes réduits à défendre d’abord nos droits de citoyens ; s’il nous faut préalablement discuter et renverser l’article 291 et sa lignée de septembre, nous sommes prêts. Odieuses en elles-mêmes, l’usage que vous faites de ces armes achèvera de les discréditer, et nous les briserons dans vos mains.
Mais, en même temps, nous ne méconnaîtrons pas le service que vous rendez à notre cause. Combien d’auxiliaires inattendus ne poussez-vous pas sous notre drapeau ! La presse opposante y accourra toute entière. Elle hésitait ; ses convictions économiques, à ce qu’il semble, sont encore douteuses. Ce combat d’avant-garde la fera arriver dans nos rangs, et elle y restera ; car elle apprendra qu’on y respire l’air de la justice et de la liberté.
Je suis, monsieur le Ministre, votre serviteur.
Aux électeurs de l'arrondissement de Saint-Sever (1 July 1846) [CW1.2.1]↩
BWV
1846.07.01 “Aux électeurs de l'arrondissement de Saint-Sever (Mugron, 1 July, 1846)” (To the Electors of the Arrondissement of Saint-Séver (Mugron, July 1, 1846)) [OC1.14, p. 461] [CW1]
À MM. les électeurs de l’arrondissement de Saint-Séver
Mugron, le 1er juillet 1846
Mes chers Compatriotes,
Encouragé par quelques-uns d’entre vous à me présenter aux prochaines élections, et voulant pressentir le concours sur lequel je pouvais compter, je me suis adressé à quelques électeurs. Hélas ! l’un me trouve trop avancé, l’autre pas assez ; celui-ci rejette mes opinions anti-universitaires, celui-là mes répugnances algériennes, qui mes convictions économiques, qui mes vues de réforme parlementaire, etc.
Ceci prouve que la meilleure tactique, pour un candidat, c’est de cacher ses opinions, ou, pour plus de sûreté, de n’en point avoir, et de s’en tenir prudemment au banal programme : « Je veux la liberté sans licence, l’ordre sans tyrannie, la paix sans honte et l’économie sans compromettre aucun service. »
Comme je n’aspire nullement à surprendre votre mandat, je continuerai à vous exposer sincèrement mes pensées, dussé-je par là m’aliéner encore bien des suffrages. Veuillez m’excuser si le besoin d’épancher des convictions qui me pressent me fait dépasser les limites que l’usage assigne aux professions de foi.
J’ai vu beaucoup de conservateurs, je me suis entretenu avec beaucoup d’hommes de l’opposition, et je crois pouvoir affirmer que ni l’un ni l’autre de ces deux grands partis qui divisent le parlement n’est satisfait de lui-même.
On combat à la chambre avec des boules molles.
Les conservateurs ont la majorité officielle ; ils règnent, ils gouvernent. Mais ils sentent confusément qu’ils perdent le pays et qu’ils se perdent eux-mêmes. Ils ont la majorité, mais le mensonge notoire des scrutins élève au fond de leur conscience une protestation qui les importune. Ils règnent, mais ils voient que, sous leur règne, le budget s’accroît d’année en année, que le présent est obéré, l’avenir engagé, que la première éventualité nous trouvera sans ressources, et ils n’ignorent pas que l’embarras des finances fut toujours l’occasion des explosions révolutionnaires. Ils gouvernent, mais ils ne peuvent pas nier qu’ils gouvernent les hommes par leurs mauvaises passions, et que la corruption politique pénètre dans toutes les veines du pays légal. Ils se demandent quelles seront les conséquences d’un fait aussi grave, et ce qui doit advenir d’une nation où l’immoralité est en honneur et où la foi politique est un objet de dérision et de mépris. Ils s’inquiètent de voir le régime constitutionnel faussé dans son essence, jusque-là que le pouvoir exécutif et l’assemblée nationale ont publiquement échangé leurs attributions, les ministres cédant aux députés la nomination à tous les emplois, les députés abandonnant aux ministres leur part du pouvoir législatif. Ils voient, par cet ordre, un profond découragement s’emparer des serviteurs de l’État, alors que la faveur et la docilité électorale sont les seuls titres à l’avancement, et que les plus longs et les plus dévoués services sont comptés absolument pour rien. Oui, l’avenir de la France trouble les conservateurs ; et combien n’y en a-t-il pas parmi eux qui passeraient à l’opposition, s’ils y trouvaient quelques garanties pour cette paix intérieure et extérieure qui est l’objet de leur prédilection !
D’un autre côté, l’opposition, comme parti, a-t-elle confiance dans la solidité du terrain où elle s’est placée ? Que demande t-elle ? que veut-elle ? quel est son principe ? son programme ? Nul ne le sait. Son rôle naturel serait de veiller au dépôt sacré de ces trois grandes conquêtes de la civilisation : paix, liberté, justice. Et elle ne respire que guerres, prépondérance, idées napoléoniennes. Et elle déserte la liberté du travail et des échanges comme la liberté de l’intelligence et de l’enseignement. Et, dans son ardeur conquérante, à l’occasion de l’Afrique et de l’Océanie, il est sans exemple que le mot justice se soit jamais présenté sur ses lèvres. Elle sent qu’elle travaille pour des ambitieux et non pour le public ; que la multitude ne gagnera rien au succès de ses manœuvres. Nous avons vu une opposition de quinze membres soutenue autrefois par l’enthousiaste assentiment d’un grand peuple. Mais l’opposition de nos jours n’a point enfoncé ses racines dans les sympathies populaires ; elle se sent séparée de ce principe de force et de vie, et, sauf l’ardeur que des vues personnelles inspirent à ses chefs, elle est pâle, confuse découragée, et la plupart de ses membres sincères passeraient au parti conservateur, s’ils ne répugnaient à s’associer à la direction perverse qu’il a imprimée aux affaires.
Étrange spectacle ! D’où vient qu’au centre comme aux extrémités de la chambre, les cœurs honnêtes se sentent mal à l’aise ? Ne serait-ce pas que la conquête des portefeuilles, but plus ou moins avoué de la lutte où ils sont engagés, n’intéresse que quelques individualités et reste complétement étranger aux masses ? Ne serait-ce point qu’un principe de ralliement leur manque ? Peut-être suffirait-il de jeter au sein de cette assemblée une idée simple, vraie, claire, féconde, pratique, pour y voir surgir ce qu’on y cherche en vain, un parti représentant exclusivement, dans toute leur étendue et dans tout leur ensemble, les intérêts des administrés, des contribuables.
Cette féconde idée, je la vois dans le symbole politique d’illustres publicistes dont la voix n’a malheureusement pas été écoutée. J’essayerai de le résumer devant vous.
Il est des choses qui ne peuvent être faites que par la force collective ou le pouvoir, et d’autres qui doivent être abandonnée à l’activité privée.
Le problème fondamental de la science politique est de faire la part de ces deux modes d’action.
La fonction publique, la fonction privée ont toutes deux en vue notre avantage. Mais leurs services diffèrent en ceci, que nous subissons forcément les uns et agréons volontairement les autres ; d’où il suit qu’il n’est raisonnable de ne confier à la première que ce que la seconde ne peut absolument pas accomplir.
Pour moi, je pense que lorsque le pouvoir a garanti à chacun le libre exercice et le produit de ses facultés, réprimé l’abus qu’on en peut faire, maintenu l’ordre, assuré l’indépendance nationale et exécuté certains travaux d’utilité publique au-dessus des forces individuelles, il a rempli à peu près toute sa tâche.
En dehors de cercle, religion, éducation, association, travail, échanges, tout appartient au domaine de l’activité privée, sous l’œil de l’autorité publique, qui ne doit avoir qu’une mission de surveillance et de répression.
Si cette grande et fondamentale ligne de démarcation était ainsi établie, le pouvoir serai fort, il serait aimé, puisqu’il ne ferai jamais sentir qu’une action tutélaire.
Il serait peu coûteux, puisqu’il serait renfermé dans les plus étroites limites.
Il serait libéral, car, sous la seule condition de ne point froisser la liberté d’autrui, chaque citoyen jouirait, dans toute sa plénitude, du franc exercice de ses facultés industrielles, intellectuelles et morales.
J’ajoute que la puissance de perfectibilité qui est en elle étant dégagée de toute compression réglementaire, la société serait dans les meilleures conditions pour le développement de sa richesse, de son instruction et de sa moralité. Mais, fût-on d’accord sur les limites de la puissance publique, ce n’est pas une chose aisée que de l’y faire rentrer et de l’y maintenir.
Le pouvoir, vaste corps organisé et vivant, tend naturellement à s’agrandir. Il se trouve à l’étroit dans sa mission de surveillance. Or, il n’y a pas pour lui d’agrandissements possibles en dehors d’empiétements successifs sur le domaine des facultés individuelles. Extension du pouvoir, cela signifie usurpation de quelque mode d’activité privée, transgression de la limite que je posais tout à l’heure entre ce qui est et ce qui n’est pas son attribution essentielle. Le pouvoir sort de sa mission quand, par exemple, il impose une forme de culte à nos consciences, une méthode d’enseignement à notre esprit, une direction à notre travail ou à nos capitaux, une impulsion envahissante à nos relations internationales, etc.
Et veuillez remarquer, messieurs, que le pouvoir devient coûteux à mesure qu’il devient oppressif. Car il n’y a pas d’usurpations qu’il puisse réaliser autrement que par des agents salariés. Chacun de ses envahissements implique donc la création d’une administration nouvelle, l’établissement d’un nouvel impôt ; en sorte qu’il y a entre nos libertés et nos bourses une inévitable communauté de destinées.
Donc si le public comprend et veut défendre ses vrais intérêts, il arrêtera la puissance publique dès qu’elle essayera de sortir de sa sphère ; et il a pour cela un moyen infaillible, c’est de lui refuser les fonds à l’aide desquels elle pourrait réaliser ses usurpations.
Ces principes posés, le rôle de l’opposition, et j’ose dire de la chambre tout entière, est simple et bien défini.
Il ne consiste pas à embarrasser le pouvoir dans son action essentielle, à lui refuser les moyens de rendre la justice, de réprimer les crimes, de paver les routes, de repousser l’agression étrangère.
Il ne consiste pas à le décréditer, à l’avilir dans l’opinion, à le priver des forces dont il a besoin.
Il ne consiste pas à le faire passer de main en main, par des changements de ministères, et, encore moins, de dynasties.
Il ne consiste même pas à déclamer puérilement contre sa tendance envahissante ; car cette tendance est fatale, irrémédiable, et se manifesterait sous un président comme sous un roi, dans une république comme dans une monarchie.
Il consiste uniquement à le contenir dans ses limites ; à maintenir, dans toute son intégrité et aussi vaste que possible, le domaine de la liberté et de l’activité privée.
Si donc vous me demandiez : Que feriez-vous comme député ? je répondrais : Eh ! mon Dieu, ce que vous feriez vous-même en tant que contribuables et administrés.
Je dirais au pouvoir : Manquez-vous de force pour maintenir l’ordre au dedans et l’indépendance au dehors ? Voilà de l’argent et des hommes, car c’est au public et non au pouvoir que l’ordre et l’indépendance profitent.
Mais prétendez-vous nous imposer un symbole religieux, une théorie philosophique, un système d’enseignement, une méthode agricole, un courant commercial, une conquête militaire ? Point d’argent ni d’agents ; car ici, il nous faudrait payer non pour être servis mais asservis, non pour conserver notre liberté mais pour la perdre.
Cette doctrine se résume en ces simples mots : Tout pour la masse des citoyens grands et petits. Dans leur intérêt, bonne administration publique en ce qui, par malheur, ne se peut exécuter autrement. Dans leur intérêt encore, liberté pleine et entière pour tout le reste, sous la surveillance de l’autorité sociale.
Une chose vous frappera, messieurs, comme elle me frappe, et c’est celle-ci ; pour qu’un député puisse tenir ce langage, il faut qu’il fasse partie de ce public pour qui l’administration est faite et qui le paye.
Il faut bien admettre qu’il appartient exclusivement au public de décider comment, dans quelle mesure, à quel prix il entend être administré, sans quoi le gouvernement représentatif ne serait qu’une déception, et la souveraineté nationale un non-sens. Or, la tendance du gouvernement à un accroissement indéfini étant admise, si, quand il vous interroge par l’élection, sur ses propres limites, vous lui laissez le soin de se faire lui-même la réponse, en chargeant ses propres agents de la formuler, autant vaudrait mettre vos fortunes et vos libertés à sa discrétion. Attendre qu’il puise en lui-même la résistance à sa naturelle expansion, c’est attendre de la pierre qui tombe une énergie qui suspende sa chute.
Si la loi d’élection portait : « Les contribuables se feront représenter par les fonctionnaires, » vous trouveriez cela absurde et comprendriez qu’il n’y aurait plus aucune borne à l’extension du pouvoir, si ce n’est l’émeute, et à l’accroissement du budget, si ce n’est la banqueroute ; mais les résultats changent-ils parce que les électeurs suppléent bénévolement à une telle prescription ?
Ici, messieurs, je dois aborder la grande question des incompatibilités parlementaires. J’en dirai peu de chose, me réservant d’adresser des observations plus étendues à M. Larnac. Mais je ne puis la passer entièrement sous silence, puisqu’il a jugé à propos de faire circuler parmi vous une lettre, dont je n’ai pas gardé la copie, et qui, n’étant pas destinée à la publicité, ne faisait qu’effleurer ce vaste sujet.
Selon l’interprétation qu’on a donnée à cette lettre, je demanderais que tous les fonctionnaires fussent exclus de la Chambre.
J’ignore si ma lettre laisse apercevoir un sens aussi absolu. En ce cas, l’expression aurait été au delà de ma pensée. Je n’ai jamais cru que l’assemblée où s’élaborent les lois pût se passer de magistrats ; qu’on y pût traiter avec avantage des questions maritimes en l’absence de marins ; des questions militaires en l’absence de militaires ; des questions de finances, en l’absence de financiers.
J’ai dit ceci et je le maintiens. Tant que la loi n’aura pas réglé la position des fonctionnaires à la Chambre, tant que leurs intérêts de fonctionnaires ne seront pas, pour ainsi dire, effacés par leurs intérêts de contribuables, ce que nous avons de mieux à faire, nous électeurs, c’est de n’en pas nommer ; et j’aimerais mieux, je l’avoue, qu’il n’y en eût pas un seul au Palais-Bourbon que de les y voir en majorité, sans que des mesures de prudence, réclamées par le bon sens public, les aient mis et nous aient mis à l’abri de l’influence que l’espoir et la crainte doivent exercer sur leurs votes.
On a voulu voir là une jalousie mesquine, une défiance presque haineuse contre les fonctionnaires.
Il n’en est rien. Je connais beaucoup de fonctionnaires, presque tous mes amis le sont (car qui ne l’est aujourd’hui ?), je le suis moi-même ; et, dans mes essais d’économie politique, j’ai soutenu, contre l’opinion de mon maître, M. Say, que leurs services étaient productifs au même titre que les services privés. Mais il n’en est pas moins vrai qu’ils en diffèrent en ce que nous prenons de ceux-ci que ce que nous voulons, et à prix débattu, tandis que ceux-là nous sont imposés ainsi que la rémunération qui y est afférente. Ou, si l’on prétend que les services publics et leur rémunération sont volontairement agréés par nous, parce que nos députés les stipulent, on conviendra que notre acquiescement ne résulte que de cette stipulation même. Ce n’est donc pas aux fonctionnaires de la faire. Il ne leur appartient pas plus de régler l’étendue du service et sa rémunération, qu’il n’appartient à mon fournisseur de vin de régler la quantité que j’en dois prendre et le prix que je dois y mettre. Ce n’est pas des fonctionnaires que je me défie, c’est du cœur humain ; et je puis estimer les hommes qui vivent sur les impôts tout en les croyant peu propres à les voter, tout comme M. Larnac estime probablement les juges, tout en regardant leurs fonctions comme incompatibles avec le service de la garde nationale.
On a aussi présenté ces vues de réforme parlementaire comme entachées d’un radicalisme outré.
J’avais cependant eu soin de préciser que, dans ma pensée, elle est plus nécessaire encore à la stabilité du pouvoir qu’à la sauvegarde de nos libertés. Les hommes les plus dangereux à la Chambre, disais-je, ne sont pas les fonctionnaires, mais ceux qui aspirent à le devenir. Ceux-là sont entraînés à faire au cabinet, quel qu’il soit, une guerre incessante, tracassière, factieuse, sans aucune utilité pour le pays ; ceux là exploitent les événements, faussent les questions, égarent l’esprit public, entravent les affaires, troublent le monde, car ils n’ont qu’un pensée : renverser les ministres pour se mettre à leur place. Pour nier cette vérité, il faudrait n’avoir jamais ouvert les yeux sur les annales de la Grande-Bretagne, il faudrait repousser volontairement les enseignements de notre histoire constitutionnelle tout entière.
Ceci me ramène à la pensée fondamentale de cette adresse, car vous voyez que l’opposition peut-être conçue sous deux aspects très-différents.
L’opposition, telle qu’elle est, résultat infaillible de l’admissibilité des députés au pouvoir, c’est l’effort désordonné des ambitions. Elle attaque violemment les hommes et mollement les abus ; c’est tout simple, puisque les abus composent la plus grande part de l’héritage qu’elle s’efforce de recueillir. Elle ne songe pas à circonscrire le domaine administratif. Elle se donnerait bien garde de supprimer quelques rouages à la vaste machine dont elle convoite la direction. Au reste, nous l’avons vue à l’œuvre. Son chef a été premier ministre ; le premier ministre a été son chef. Elle a gouverné sous l’une et l’autre bannière. Qu’y avons-nous gagné ? À travers ces évolutions, jamais le mouvement ascensionnel du budget a-t-il été suspendu une minute ?
L’opposition, telle que je la conçois, c’est la vigilance organisée du public. Elle est calme, impartiale, mais permanente comme la réaction du ressort sous la main qui le presse. Pour que l’équilibre ne soit pas rompu, ne faut-il pas que la force résistante des administrés soit égale à la force expansive des administrateurs ? Elle n’en veut point aux hommes, elle n’a que faire de les déplacer, elle les aide même dans le cercle de leurs légitimes fonctions ; mais elle les y enferme sans pitié.
Vous croyez peut-être que cette opposition naturelle, qui n’a rien de dangereux ni de subversif, qui n’attaque le pouvoir ni dans ses dépositaires, ni dans dans son principe, ni dans son action utile, mais seulement dans son exagération, est moins antipathique aux ministres que l’opposition factieuse. Détrompez-vous. C’est celle là surtout qu’on craint, qu’on hait, qu’on fait avorter par la dérision, qu’on empêche de se produire au sein des colléges électoraux, parce qu’on voit bien qu’elle va au fond des choses et poursuit le mal dans sa racine. L’autre opposition, l’opposition personnelle, n’est pas aussi redoutable. Entre les hommes qui se disputent les portefeuilles, quelque acharnée que soit la lutte, il y a toujours un pacte tacite, en vertu duquel le vaste appareil gouvernemental doit être laissé intact. « Renversez-moi si vous le pouvez, dit le ministre, je vous renverserai à votre tour ; seulement, ayons soin que l’enjeu reste sur le bureau, sous forme d’un budget de quinze cents millions. » Mais le jour où un député, parlant au nom des contribuables et comme contribuable, ayant donné des garanties qu’il ne veut et ne peut pas être autre chose, se lèvera à la Chambre pour dire soit aux ministres en titre, soit aux ministres en expectative : Messieurs, disputez-vous le pouvoir, je ne cherche qu’à le contenir ; disputez-vous la manipulation du budget, je n’aspire qu’à le diminuer ; ah ! soyez sûr que ces furieux athlètes, si acharnés en apparence, sauront fort bien s’entendre pour étouffer la voix du mandataire fidèle. Ils le traiteront d’utopiste, de théoricien, de réformateur dangereux, d’homme à idée fixe, sans valeur pratique ; ils l’accableront de leur mépris ; ils tourneront contre lui la presse vénale. Mais si les contribuables l’abandonnent, tôt ou tard ils apprendront qu’ils se sont abandonnés eux-mêmes.
Voilà ma pensée toute entière, messieurs ; je l’ai exposé sans déguisement, sans détour, tout en regrettant de ne pouvoir la corroborer de tous les développements qui auraient pu entraîner vos convictions. J’espère en avoir assez dit, cependant, pour que vous puissiez apprécier la ligne de conduite que je suivrais si j’étais votre mandataire, et il est à peine nécessaire d’ajouter que mon premier soin serait de me placer, à l’égard du pouvoir et de l’opposition ambitieuse, dans cette position d’indépendance qui seule peut donner des garanties, et qu’il faut bien s’imposer, puisque la loi n’y a pas pourvu.
Après avoir établi le principe qui doit, selon moi, dominer toute la carrière parlementaire de vos représentants, permettez-moi de dire quelque chose des objets principaux auxquels ce principe me semble devoir être appliqué.
Vous avez peut-être entendu dire que j’avais consacré quelques efforts à la cause de la liberté commerciale, et il est aisé de voir que ces efforts sont conséquents à la pensée fondamentale que je viens d’exposer sur les limites naturelles de la puissance publique. Selon moi, celui qui a créé un produit doit avoir la faculté de l’échanger comme de s’en servir. L’échange est donc partie intégrante du droit de propriété. Or, nous n’avons pas institué et nous ne payons pas une force publique pour nous priver de ce droit, mais au contraire pour nous le garantir dans toute son intégrité. Aucune usurpation du gouvernement, sur l’exercice de nos facultés et sur la libre disposition de leurs produits, n’a eu des conséquences plus fatales.
D’abord ce régime prétendu protecteur, examiné de près, est fondé sur la spoliation la plus flagrante. Lorsque, il y a deux ans, on a pris des mesures pour restreindre l’entrée des graines oléagineuses, on a bien pu augmenter les profits de certaines cultures, puisque immédiatement l’huile haussa de quelques sous par livre. Mais il est de toute évidence que ces excédants de profit n’ont pas été un gain pour la nation en masse, puisqu’ils ont été pris gratuitement et artificieusement dans la poche d’autres citoyens, de tous ceux qui ne cultivent ni le colza ni l’olivier. Il n’y a donc pas eu de création, mais translation injuste de richesses. Dire que par là on a soutenu une branche d’agriculture, ce n’est rien dire, relativement au bien général, puisqu’on ne lui a donné qu’une sève qu’on enlevait aux autres branches. Et quelle est la folle industrie qu’on ne pourrait rendre lucrative à ce prix ? Un cordonnier s’avisât-il de tailler de souliers dans des bottes, quelque mauvaise que fût l’opération, donnez-lui un privilége, et elle deviendra excellente. Si la culture du colza est bonne en elle-même, il n’est pas nécessaire que nous fassions un supplément de gain à ceux qui s’y livrent. Si elle est mauvaise, ce supplément ne la rend pas bonne. Seulement il rejette la perte sur le public.
La spoliation, en général, déplace la richesse, mais ne l’anéantit pas. La protection la déplace et en outre l’anéantit, et voici comment : les graines oléagineuses du Nord n’entrant plus en France, il n’y a plus moyen de produire chez nous les choses au moyen desquelles on les payait, par exemple, une certaine quantité de vins. Or, si, relativement à l’huile, les profits des producteurs et les pertes des consommateurs se balancent, les souffrances des vignerons sont un mal gratuit et sans compensations.
Il y a sans doute, parmi vous, beaucoup de personnes qui ne sont pas fixées sur les effets du régime protecteur. Qu’elles me permettent une observation.
Je suppose que ce régime ne nous soit pas imposé par la loi, mais par la volonté directe des monopoleurs. Je suppose que la loi nous laisse entièrement libres d’acheter du fer aux Belges ou aux Suédois, mais que les maîtres de forges aient assez de domestiques pour repousser le fer de nos frontières et nous forcer ainsi à nous pourvoir chez eux et à leur prix. Ne crierions-nous pas à l’oppression, à l’iniquité ? L’iniquité, en effet, serait plus apparente ; mais quand aux effets économiques, on ne peut pas dire qu’ils seraient changés. Eh quoi ! en sommes-nous beaucoup plus gras, parce que ces messieurs ont été assez habiles pour faire faire, par des douaniers, et à nos frais, cette police des frontières que nous ne tolérerions pas si elle se faisait à leurs propres dépens ?
Le régime protecteur atteste cette vérité, qu’un gouvernement qui sort de ses attributions ne puise dans ses usurpations qu’une force dangereuse, même pour lui. Quand l’État se fait le distributeur et le régulateur des profits, toutes les industries le tiraillent en tout sens pour lui arracher un lambeau de monopole. A-t-on jamais vu le commerce intérieur et libre placer un cabinet dans la situation que le commerce extérieur et réglementé a faite à sir Robert Peel ? Et si nous regardons chez nous, n’est ce pas un gouvernement bien fort que celui que nous voyons trembler devant M. Darblay ? Vous voyez donc bien que contenir le pouvoir, c’est le consolider et non le compromettre.
La liberté des échanges, la libre communication des peuples, les produits variés du globe mis à la portée de tous, les idées pénétrant avec les produits dans les régions qu’assombrit l’ignorance, l’État affranchi des prétentions opposées des travailleurs, la paix des nations fondée sur l’entrelacement de leurs intérêts, c’est sans doute une grande et noble cause. Je suis heureux de penser que cette cause, éminemment chrétienne et sociale, est en même temps celle de notre malheureuse contrée, qui languit et périt sous les étreintes des restrictions commerciales.
L’enseignement se rattache aussi à cette question fondamentale qui, en politique, précède toute les autres. Est-il dans les attributions de l’État ? est-il du domaine de l’activité privée ? Vous devinez ma réponse. Le gouvernement n’est pas institué pour asservir nos intelligences, pour absorber les droits de la famille. Assurément, messieurs, s’il vous plaît de résigner en ses mains vos plus nobles prérogatives, si vous voulez vous faire imposer par lui des théories, des systèmes, des méthodes, des principes, des livres et des professeurs, vous en êtes les maîtres ; mais ce n’est pas moi qui signerai en votre nom cette honteuse abdication de vous-mêmes. Ne vous en dissimulez pas d’ailleurs les conséquences. Leibnitz disait : « J’ai toujours pensé que si l’on était maître de l’éducation, on le serait de l’humanité. » C’est peut-être pour cela que le chef de l’enseignement par l’État, s’appelle Grand Maître. Le monopole de l’instruction ne saurait être raisonnablement confié qu’à une autorité reconnue infaillible. Hors de là, il y a des chances infinies pour l’erreur soit uniformément enseignée à tout un peuple. « Nous avons fait la république, disait Robespierre, il nous reste à faire des républicains. » Bonaparte ne voulait faire que des soldats, Frayssinous que des dévots ; M. Cousin ferait des philosophes, Fourier des harmoniens, et moi sans doute des économistes. L’unité est une belle chose, mais à la condition d’être dans le vrai. Ce qui revient toujours à dire que le monopole universitaire n’est compatible qu’avec l’infaillibilité. Laissons donc l’enseignement libre. Il se perfectionnera par les essais, les tâtonnements, les exemples, la rivalité, l’imitation, l’émulation. L’unité n’est pas au point de départ des efforts de l’esprit humain ; elle est le résultat de la naturelle gravitation des intelligences libres vers le centre de toute attraction : la vérité.
Ce n’est pas à dire que l’autorité publique doit se renfermer dans une complète indifférence. Je l’ai déjà dit : sa mission est de surveiller l’usage et de réprimer l’abus de toutes nos facultés. J’admets qu’elle l’accomplisse dans toute son étendue, et avec plus de vigilance en matière d’enseignement qu’en toute autre ; qu’elle exige des conditions de capacité, de moralité ; qu’elle réprime l’enseignement immoral ; qu’elle veille à la santé des élèves. J’admets tout cela, quoiqu’en restant convaincu que sa sollicitude la plus minutieuse n’est qu’une garantie imperceptible auprès de celle que la nature a mise dans le cœur des pères et dans l’intérêt des professeurs.
Je dois m’expliquer sur une question immense, d’autant que mes vues diffèrent probablement de celles de beaucoup d’entre vous : je veux parler de l’Algérie. Je n’hésite pas à dire que, sauf pour acquérir des frontières indépendantes, on ne me trouvera jamais, dans cette circonstance ni dans aucune autre, du côté des conquêtes.
Il m’est démontré, et j’ose dire scientifiquement démontré, que le système colonial est la plus funeste des illusions qui ait jamais égaré les peuples. Je n’en excepte pas le peuple anglais, malgré ce qu’il y a de spécieux dans le fameux argument : post hoc, ergo propter hoc.
Savez-vous ce que vous coûte l’Algérie ? Du tiers aux deux cinquièmes de vos quatre contributions directes, centimes additionnels compris. Celui d’entre vous qui paye trois cents francs d’impôts, envoie chaque année cent francs se dissiper dans les nuages de l’Atlas et s’engloutir dans les sables du Sahara.
On nous dit que c’est là un avance que nous recouvrerons, dans quelques siècles au centuple. Mais qui dit cela ? Les riz-pain-sel qui exploitent notre argent. Tenez messieurs, en fait d’espèces, il n’y a qu’une chose qui serve : c’est que chacun veille sur sa bourse… et sur ceux à qui il en remet les cordons.
On nous dit encore : « Ces dépenses font vivre du monde. » Oui, des espions kabyles, des usuriers maures, des colons maltais et des cheicks arabes. Si on en creusait le canal des Grandes-Landes, le lit de l’Adour et le port de Bayonne, elles feraient vivre du monde aussi autour de nous, et de plus elles doteraient le pays d’immenses forces de production.
J’ai parlé d’argent ; j’aurais dû d’abord parler des hommes. Tous les ans, dix mille de nos jeunes concitoyens, la fleur de notre population, vont chercher la mort sur cette plage dévorante, sans autre utilité jusqu’ici que d’élargir, à nos dépens, le cadre de l’administration qui ne demande pas mieux. À cela, on oppose le prétendu avantage de débarrasser le pays de son trop-plein. Horrible prétexte, qui révolte tous les sentiments humains et n’a pas même le mérite de l’exactitude matérielle ; car, à supposer que la population soit surabondante, lui enlever, avec chaque homme, deux ou trois fois le capital qui l’aurait fait vivre ici, ce n’est pas, il s’en faut, soulager ceux qui restent.
Il faut être juste. Malgré sa sympathie pour tout ce qui accroît ses dimensions, il paraît qu’à l’origine le pouvoir reculait devant ce gouffre de sang, d’iniquité et de misère. La France l’a voulu ; elle en portera longtemps la peine.
Ce qui l’entraîna, outre le mirage d’un grand empire, d’une nouvelle civilisation, etc., ce fut une énergique réaction du sentiment national contre les blessantes prétentions de l’oligarchie britannique. Il suffisait que l’Angleterre fît une sourde opposition à nos desseins pour nous décider à y persévérer. J’aime ce sentiment, et je préfère le voir s’égarer que s’éteindre. Mais ne risquons-nous pas qu’il nous place, par une autre extrémité, sous cette dépendance que nous détestons ? Donnez-moi un homme docile et un homme contrariant, je les mènerai tous deux à la lisière. Si je les veux faire marcher, je dirai à l’un : Marche ! à l’autre : Ne marche pas ! et tous deux obéiront à ma volonté. Si le sentiment de notre dignité prenait cette forme, il suffirait à la perfide Albion, pour nous faire faire les plus grandes sottises, de paraître s’y opposer. Supposez, ce qui est certainement peu admissible, qu’elle voie dans l’Algérie le boulet qui nous enchaîne, l’abîme de notre puissance ; elle n’aura donc qu’à froncer le sourcil, à se donner des airs hautains et courroucés pour nous retenir dans une politique dangereuse et insensée ? Évitons cet écueil ; jugeons par nous-mêmes et pour nous-mêmes ; ne nous laissons faire la loi ni directement ni par voie détournée. La question d’Alger n’est malheureusement pas entière. Les précédents nous lient ; le passé a engagé l’avenir, et il y a des précédents dont il est impossible de ne pas tenir compte. Restons cependant maîtres de nos résolutions ultérieures ; pesons les avantages et les inconvénients ; ne dédaignons pas de mettre aussi quelque peu la justice, même envers les Kabyles, dans la balance. Si nous ne regrettons pas l’argent, si nous ne marchandons pas la gloire, comptons pour quelque chose la douleur des familles, les souffrances de nos frères, le sort de ceux qui succombent et les funestes habitudes de ceux qui survivent.
Il est un autre sujet qui mérite toute l’attention de votre mandataire. Je veux parler des contributions indirectes. Ici la distinction entre ce qui est ou n’est pas du ressort de l’État est sans application. Il appartient évidemment à l’État de recouvrer l’impôt. On peut dire cependant que c’est l’extension démesurée du pouvoir qui le fait avoir recours aux inventions fiscales les plus odieuses. Quand une nation, victime d’une timidité exagérée, n’ose rien faire par elle-même, et qu’elle sollicite à tout propos l’intervention de l’État, il faut bien qu’elle se résigne à être impitoyablement rançonnée ; car l’État ne peut rien faire sans finances, et quand il a épuisé les sources ordinaires de l’impôt, force lui est d’en venir aux exactions les plus bizarres et les plus vexatoires. De là, les contributions indirectes sur les boissons. La suppression de ces taxes est donc subordonnée à la solution de cette éternelle question que je ne me lasse point de poser : Le peuple français veut-il être perpétuellement en tutelle et faire intervenir son gouvernement en toutes choses ? alors qu’il ne se plaigne plus du fardeau qui l’accable, et qu’il s’attende même à le voir s’aggraver.
Mais en supposant même que l’impôt sur les boissons ne pût pas être supprimé (ce que je suis loin d’accorder), il me paraît certain qu’il peut être profondément modifié, et qu’il est facile d’en élaguer les accessoires les plus odieux. Il ne faudrait pour cela qu’obtenir des propriétaires de vignes la renonciation à certaines idées exagérées sur l’étendue du droit de propriété et l’inviolabilité du domicile.
Permettez-moi, messieurs, de terminer par quelques considérations personnelles. Il faut bien me les passer. Je n’ai pas, moi, un agent actif et dévoué à 3,000 fr. d’appointements et 4,000 fr. de frais de bureau, pour s’occuper de faire valoir ma candidature d’une frontière à l’autre de l’arrondissement, d’un bout à l’autre de l’année.
Les uns disent : « M. Bastiat est un révolutionnaire. » Les autres : « M. Bastiat s’est rallié au pouvoir. »
Ce qui précède répond à cette double assertion.
Il y en a qui disent : « M. Bastiat peut être fort honnête, mais ses opinions ont changé. »
Et moi, quand je considère ma persistance dans un principe qui ne fait en France aucun progrès, je me demande quelquefois si je ne suis pas un maniaque en proie à une idée fixe.
Pour vous mettre à même de juger si j’ai changé, laissez-moi placer sous vos yeux un extrait de la profession de foi que je publiai, en 1832, alors qu’un mot bienveillant du général Lamarque attira sur moi l’attention de quelques électeurs.
« Dans ma pensée, les institutions que nous possédons et celles que nous pouvons obtenir par les voies légales suffisent, si nous en faisons un usage éclairé, pour porter notre patrie à un haut degré de liberté, de grandeur et de prospérité.
Le droit de voter l’impôt, en donnant aux citoyens la faculté d’étendre ou de restreindre à leur gré l’action du pouvoir, n’est-il pas l’administration par le public de la chose publique ? Où ne pouvons-nous pas arriver par l’usage judicieux de ce droit ?
Pensons-nous que l’ambition des places est la source de beaucoup de luttes, de brigues et de factions ? Il ne dépend que de nous de priver de son aliment cette passion funeste, en diminuant les profits et le nombre des fonctions salariées.
. . . . .
L’industrie est-elle à nos yeux entravée, l’administration trop centralisée, l’enseignement gêné par le monopole universitaire ? Rien ne s’oppose à ce que nous refusions l’argent qui alimente ces entraves, cette centralisation, ces monopoles.
Vous le voyez, messieurs, ce ne sera jamais d’un changement violent dans les formes ou les dépositaires du pouvoir que j’attendrai le bonheur de ma patrie ; mais de notre bonne foi à le seconder dans l’exercice utile de ses attributions essentielles et de notre fermeté à l’y restreindre. Il faut que le gouvernement soit fort contre les ennemis du dedans et du dehors, car sa mission est de maintenir la paix intérieure et extérieure. Mais il faut qu’il abandonne à l’activité privée tout ce qui est de son domaine. L’ordre et la liberté sont à ce prix. »
Ne sont-ce pas les mêmes principes, les mêmes sentiments, la même pensée fondamentale, les mêmes solutions des questions particulières, les mêmes moyens de réforme ? On peut ne pas partager mes opinions ; on ne peut pas dire qu’elles ont varié, et j’ose ajouter ceci : Elles sont invariables. C’est un système trop homogène pour admettre des modifications. Il s’écroulera ou il triomphera tout entier.
Mes chers compatriotes, pardonnez-moi la longueur et la forme inusitée de cette lettre. Si vous m’accordez vos suffrages, j’en serai profondément honoré. Si vous les reportez sur un autre, je servirai mon pays dans une sphère moins élevée et plus proportionnée à mes forces.
La logique du Moniteur industriel [1 juillet 1846] ↩
BWV
1846.07.01 “La logique du *Moniteur industriel*” (The Logic of the *Moniteur industriel*)[*Mémorial bordelais*, 1er juillet 1846] [OC7.25, p. 119]
La logique du Moniteur Industriel [1]
Le Moniteur industriel, toujours fidèle au monopole, commente aujourd’hui la déclaration de l’Association du libre-échange. Après avoir dit qu’elle tient compte de quelques idées générales dont il ne conteste pas la justesse, il ajoute qu’elle ne tient pas compte de la vie réelle ; d’où il suit, selon lui, qu’il y a incompatibilité entre la vie et les idées. Sous l’influence de cette pensée, le Moniteur affirme que la déclaration est bonne pour l’Académie des sciences morales, mais détestable pour le régime d’un peuple raisonnable ; d’où il suit encore qu’il y a incompatibilité entre l’Académie et la raison.
Le Moniteur résume ainsi sa théorie :
« Ce qui doit nous préoccuper, c’est de développer, c’est « de doubler, c’est de quadrupler, si nous le pouvons, toutes nos industries. Est-ce que, si nous parvenions à quadrupler toutes nos industries, nous ne serions pas dix fois plus riches ? »
Voilà donc le Moniteur fouriériste et entiché du quadruple produit, avec cette variante que, d’après lui, quatre fois plus de produits donnent dix fois plus de richesses ! — Et ces messieurs nous appellent utopistes ! Et ils nous reprochent de n’avoir pas mis de chiffres dans notre manifeste !
J’en pourrais, par malheur, faire d’aussi méchants,
Mais je me garderais de les montrer aux gens.
Cependant accordons au Moniteur qu’il serait bon de quadrupler toutes nos industries. Et qui en doute, alors même que nos richesses n’en seraient pas décuplées ? — Reste à savoir si le moyen proposé par le Moniteur est bon, et si les industries se peuvent quadrupler toutes à la fois, par la vertu du pillage qu’elles exercent les unes sur les autres.
Supposons vingt-quatre industries, autant que de lettres dans l’alphabet. Leurs profits sont divers : A gagne énormément, B beaucoup, C joliment, D moins, et ainsi de suite jusqu’à Y, qui joint à peine les deux bouts, et Z qui est en perte.
Dans cette situation, Z demande à prélever une petite somme sur les profits de chacune de ses sœurs, par une taxe directe, sous le nom de prime, ou par un impôt déguisé sous le nom de protection, de manière, non seulement à ne plus perdre, mais à quadrupler son importance.
La plus grande des niaiseries imaginables serait de voir là un profit général, car l’importance de Z ne s’accroît qu’en diminuant celle de toutes les autres industries. Y, en particulier, qui était sur la limite de la perte, y entre de plein saut.
Y a la ressource de demander l’autorisation de piller ses vingt-trois sœurs, y compris Z.l’œil nu
C’est le tour de X de tomber dans le domaine de la perte. Nouveau recours au pillage, qui entraîne V, puis U, puis T, jusqu’à ce que toutes les sœurs se ruinent les unes par les autres.
Alors le système est complet, et on se flatte d’avoir quadruplé toutes les industries.
Messieurs du Moniteur, de grâce, prouvez-nous une fois pour toutes que par la restriction nous pillons l’étranger. Nous examinerons alors la question de justice nationale, mais nous nous avouerons battus sur celle du profit national.
Que si cette portion de bénéfice procuré par la protection à un Français est payée exclusivement par d’autres Français, cessez de nous le présenter comme un bénéfice net, clair, liquide, national. C’est là qu’est la déception, c’est là que nous vous ramènerons sans cesse.
Il y a, dans l’article du Moniteur, un autre sophisme qui est du reste fort répandu et que, par ce motif, nous relèverons ici. Il consiste à assimiler le commerce à la guerre et les échanges de produits aux échanges de coups de poing.
Après avoir rabaissé humblement la France et exalté la supériorité infinie de l’Angleterre, le Moniteur s’écrie :
« Voilà Goliath et David en présence. Eh bien ! pour égaliser leurs forces, on propose à David de laisser là sa fronde et d’aller se colleter avec Goliath. Quelle économie politique ! »
C’est le Moniteur qui fait cette exclamation à notre endroit, et non nous au sien.
On pourrait aisément s’y tromper.
Eh ! qui parle à David de s’aller colleter avec Goliath ? Ce que nous disons à David, c’est ceci :
« Mets tes forces et ton temps à faire une chose, à moins que Goliath ne te la cède en échange d’une autre chose qui te coûtera moins de temps et de forces. »
Il s’agit de commerce, et non de pugilat.
« Est-ce que dans l’industrie, dit le Moniteur, les plus forts n’ont pas toujours tué les plus faibles ? »
Non pas que nous sachions. En guerre, les plus forts tuent les plus faibles. En industrie, ils les servent en leur épargnant une inutile déperdition de travail. — Je voudrais bien savoir si l’auteur de l’article auquel je réponds l’a lui-même imprimé. Non sans doute, et il n’en est pas mort. Pourquoi ? C’est qu’en fait d’imprimerie, auprès de lui, M. Lange est un Goliath ; et ce Goliath n’a pas tué David, il lui a au contraire rendu service. Messieurs, je vous en prie, ne commençons pas par confondre les échanges avec les coups, si nous ne sommes pas décidés à déraisonner tout du long.
Le Moniteur termine par un argument qui aspire à soulever contre nous les ouvriers ; et cet argument, chose singulière, il le ruine lui-même. Voici comment il s’exprime :
« L’autre jour, à Elbeuf, une machine qui pouvait faire le travail de vingt ouvriers, mais qui ne remplaçait pas vingt ouvriers, et qui devait au contraire augmenter le nombre des ouvriers dans l’atelier de M. Aroux, a provoqué une émeute ; et vous osez proposer des doctrines qui, réduites en lois, jetteraient sur le pavé et condamneraient à la faim et à la mort plus tard des milliers d’ouvriers ! »
À présent je reconnais que la lutte est sérieusement engagée entre le monopole et la liberté, puisque le monopole, faisant appel aux préventions de l’ignorance, nous place et se place lui-même sur le cratère enflammé de l’émeute. J’avais toujours pensé qu’il en viendrait là, que ce serait son suprême argument, et qu’après avoir abusé de la loi, il abuserait de la force brutale. Il le fait, il faut le dire, avec maladresse. Il parle d’une machine qui, faisant l’ouvrage de vingt ouvriers, doit néanmoins en augmenter le nombre, et cela dans l’atelier même où elle est employée. Nous n’allons pas aussi loin. Nous ne nions pas que les machines, comme la liberté, ne déplacent du travail. Nous disons seulement qu’en tenant compte des épargnes qu’elles procurent aux consommateurs, épargnes qui payent d’autre main-d’œuvre, dans l’ensemble, elles favorisent le travail plus qu’elles ne lui nuisent. — Autant en fait la liberté. — La thèse du Moniteur donne de l’à-propos à un article de M. Goudroy, inséré dans le Mémorial du 12 juin. Nous le recommandons à MM. les manufacturiers. Qu’ils sachent bien une chose : l’échange et les machines, pour le bien et pour le mal, opèrent exactement de même. Relativement aux ouvriers, l’étranger est une machine économique, comme la machine est un concurrent étranger. En soulevant contre nous la classe ouvrière, les fabricants la soulèvent donc, et plus immédiatement, contre eux-mêmes ; car elle est plus près des ateliers où fonctionnent les machines que du cabinet où s’élabore la pensée de l’économiste.
FN: Mémorial bordelais du 1er juillet 1846. (Note de l’édit.)
Lettre à M. Dampierre [3 Juillet 1846] [CW1.3.5]↩
BWV
1846.07.03 “Lettre à M. Dampierre” (A Letter to M. Dampierre) [3 July 1846] [OC7.72, p. 300] [CW1]
3 Juillet 1846.
Monsieur Dampierre,
Comme vous, je regrette de ne m’être pas trouvé chez moi quand vous m’avez fait l’honneur de venir me voir, et je le regrette encore plus, depuis que j’ai reçu votre bienveillante lettre du 30 juin. Je ne m’arrêterai pas à vous remercier de tout ce qu’elle contient d’obligeant ; je crains bien qu’on ne vous ait fort exagéré les efforts que j’ai pu consacrer quelquefois à ce qui m’a paru le bien du pays. Je me bornerai à répondre à ce que vous me dites, touchant les prochaines élections, et je le ferai avec toute la franchise que je dois au ton de sincérité qui respire dans toute votre lettre.
Je suis décidé à émettre ma déclaration de principes ; dès que la chambre sera dissoute, et abandonner le reste aux électeurs que cela regarde. C’est vous dire que, ne sollicitant pas leurs suffrages pour moi-même, je ne puis les engager dans la combinaison dont vous m’entretenez. Quant à ma conduite personnelle, j’espère que vous en trouverez la raison dans la brochure que je vous envoie par ce courrier. [43] Permettez-moi d’ajouter ici quelques explications : Une alliance entre votre opinion et la mienne est une chose grave, que je ne puis admettre ou rejeter, sans vous exposer, un peu longuement peut-être, les motifs qui me déterminent.
Vous êtes légitimiste, monsieur, vous le dites franchement dans votre profession de foi, et, par conséquent, je suis plus loin de vous que des vrais conservateurs.
Ainsi, si nous avions aux prochaines élections un candidat conservateur, par opinion, mais indépendant par position, tels que MM. Basquiat, Poydenot, etc., etc., je ne pourrais pas songer un moment, en cas d’échec de mon parti, à me rallier au vôtre. La perspective de déterminer une crise ministérielle ne me déciderait pas ; et j’aimerais mieux voir triompher l’opinion, dont je ne diffère que par des nuances, que celle dont je suis séparé par les principes.
Je dois vous avouer, d’ailleurs, que ces coalitions des partis extrêmes me paraissent des duperies artificieusement arrangées par des ambitieux et à leur profit. Je me place exclusivement au point de vue du contribuable, de l’administré, du public, et je me demande ce qu’il peut gagner à des combinaisons qui n’ont pour but que de faire passer le pouvoir d’une main dans une autre. En admettant le succès d’une alliance entre les deux opinions, à quoi cela peut-il mener ? Évidemment, elles ne s’entendent un moment qu’en laissant sommeiller les points par lesquels elles diffèrent, et s’abandonnant au seul désir qui leur soit commun : Renverser le cabinet. — Mais après ? — Lorsque M. Thiers, ou tout autre, sera aux affaires, que fera-t il avec une minorité de gauche, qui n’aura été majorité un instant que par l’appoint des légitimistes ; appoint qui lui sera désormais refusé ? Je vois d’ici une coalition nouvelle se former entre la droite et M. Guizot. Au bout de tout cela, j’aperçois bien confusion, crises ministérielles, embarras administratifs, ambitions satisfaites, mais je ne vois rien pour le public.
Ainsi, monsieur, je n’hésite pas à vous dire : je ne pourrais, dans aucun cas, aller à vous, si c’était réellement l’opinion conservatrice qui se présentât aux prochaines élections.
Mais il n’en est pas ainsi, je vois dans un secrétaire des commandements, le représentant, non d’une opinion politique, mais d’une pensée individuelle, et de cette pensée même à laquelle le droit électoral doit servir de barrière. Une telle candidature nous jette hors du régime représentatif, elle en est plus que la déviation, elle en est la dérision ; et il semble qu’en la proposant, le pouvoir ait résolu d’expérimenter jusqu’où peut aller la simplicité du corps électoral. [44] Sans avoir d’objection personnelle contre M. Larnac, j’en ai une si grave contre sa position, que je ne le nommerai pas, quoi qu’il arrive; et, de plus, si besoin est, je nommerai son adversaire, fût-ce un légitimiste. — Quelle que puisse être la pensée secrète des partisans de la branche ainée, je la redoute moins que les desseins du pouvoir actuel, manifestés par l’appui qu’il prête à une telle candidature. Je hais les révolutions ; mais elles prennent des formes diverses, et je considère, comme une révolution de la pire espèce, ce systématique envahissement de la représentation nationale par les agents du pouvoir, et, qui pis est, du pouvoir irresponsable. Si donc je me trouve dans la cruelle alternative d’opter entre un secrétaire des commandements et un légitimiste, mon parti est pris, je nommerai le légitimiste. Si l’arrière-pensée qu’on prête à ce parti, a quelque réalité, je la déplore ; mais je ne la redoute pas, convaincu que le principe de la souveraineté nationale a assez de vie, en France, pour triompher encore une fois de ses adversaires. Mais, avec une Chambre peuplée de créatures du pouvoir, le pays, sa fortune et sa liberté, sont sans défense ; et c’est là qu’est le germe d’une révolution plus dangereuse que celle que votre parti peut méditer.
En résumé, monsieur, comme candidat, je me bornerai à publier une profession de foi, et à assister aux réunions publiques, si j’y suis appelé ; comme électeur, je voterai d’abord pour un homme de la gauche, à défaut, pour un conservateur indépendant, et, à défaut encore, pour un légitimiste franc et loyal, tel que vous, plutôt que pour un secrétaire des commandements de M. le duc de Nemours.
Veuillez, etc…
Toast porté au banquet offert à Cobden par les libre-échangistes de Paris [19 août 1846] ↩
BWV
1846.08.19 “Toast porté au banquet offert à Cobden par les libre-échangistes de Paris” (A Toast offered at the banquet in Honor of Richard Cobden by the Free Traders of Paris)[*Courrier français*, 19 août 1846] [OC7.26, p. 122]
Source
[Courrier français du 19 août 1846. (Note de l’édit.)]
Toast porté au banquet offert à Cobden par les libre-échangistes de Paris.
Frédéric Bastiat : Aux défenseurs de la liberté commerciale dans les deux Chambres !
Messieurs, le grand principe de vérité et de justice, auquel cette réunion a pour but de rendre hommage, vient d’acquérir, par les dernières élections, de nouveaux et zélés défenseurs. Félicitons-les des circonstances favorables qui accompagnent leur entrée au parlement. Jamais, peut-être, un pareil avenir ne s’ouvrit à des cœurs animés d une plus généreuse ambition. Ils arrivent avec des noms que je ne reproduirai point dans cette enceinte, parce qu’ils sont précédés d’une renommée européenne. Au dedans des Chambres, ils ne seront point accueillis avec cette froideur calculée et cet esprit de raillerie intéressé que rencontraient jusqu’ici les promoteurs de la moindre réforme économique. Au dehors, une association naissante s’apprête à créer autour d’eux l’appui d’une formidable opinion publique. L’Europe, l’Amérique, l’Asie même, travaillent à l’envi à accomplir cette grande révolution sociale qu’ils ont si souvent appelée de leurs vœux. Voilà les circonstances dans lesquelles la confiance du pays leur offre l’occasion d’aborder la tribune française, cette chaire du monde intellectuel, où il leur sera peut-être donné de consommer la grande oeuvre dont ils jetèrent les bases dans leurs écrits. Mais, si la gloire les attend, une grande responsabilité leur incombe. La France et le monde exigent d’eux d’être, par leur zèle, leur courage, et, s’il le faut, par leur abnégation, au niveau de la mission qui leur est confiée. J’ai la confiance qu’ils ne tromperont aucune des espérances qui reposent sur leur tête.
Mais, en félicitant les nouveaux députés sur le bonheur des circonstances qui les entourent, n’oublions pas de payer un juste tribut d’admiration et de sympathie à ces vétérans du libre-échange, dont quelques-uns sont présents à cette assemblée, et qui, depuis bien des années, soutiennent dans les deux Chambres le poids d’une lutte inégale ; à ces hommes dont on peut dire, sans rien exagérer, qu’ils se sont faits volontairement les martyrs de leurs profondes et honnêtes convictions. Leur tâche, Messieurs, a été bien rude ! Réduits par l’indifférence ou l’hostilité de leur auditoire à faire entendre, par intervalles, quelques protestations impuissantes, abandonnés même par les intérêts dont ils étaient les défenseurs éclairés, mais soutenus par le témoignage de leur conscience, ils n’ont pas désespéré de la cause pour laquelle leurs efforts semblaient inutiles. Non, ils n’étaient pas inutiles, puisqu’ils nous ont légué un noble exemple. Mais enfin le jour de la rétribution est venu ; et, quoique bien des hivers et bien des travaux aient blanchi leur tête, j’espère qu’ils vivront assez pour voir la chute des barrières qui séparent les cœurs aussi bien que les intérêts des peuples.
Messieurs, je désire que ce toast soit aussi un témoignage de sympathie pour les députés sortants qui ont noblement succombé sur le champ de bataille électoral, en tenant haut et ferme le drapeau de la liberté des échanges. Par là, ils ont rendu un précieux service et maintenu, dans toute leur intégrité, ces règles de droiture et de dignité morale, dont il n’est pas permis de s’écarter, même sous le spécieux prétexte de l’utilité. Peut-être auraient-ils pu assurer leur élection en laissant leurs principes dans l’ombre ; ils ne l’ont pas voulu, et l’opinion publique doit leur en savoir gré. Il n’y a pas deux bases d’appréciation pour les actions humaines. Nous honorons le soldat qui meurt en s’enveloppant de son drapeau, et nous livrons au mépris public celui qui n’est toujours victorieux que parce qu’il se met toujours du côté du nombre. Transportons ce jugement dans la politique, en accordant notre cordiale sympathie à ceux qui, ne pouvant s’élever avec leur principe, ont voulu tomber avec lui.
Aux anciens et aux nouveaux défenseurs du libre-échange, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés !
Au rédacteur de la Presse [22 août 1846] ↩
BWV
1846.08.22 “Aux rédacteurs de *la Presse* (1)” (To the Editors of *La Press* (1)) [*Courrier français*, 22 août 1846] [OC7.32, p. 143]
À M. le rédacteur en chef de La Presse [1]
Monsieur,
Que faut-il penser du nouveau tarif américain ? Les Journaux anglais le vantent comme très libéral, se fondant sur ce qu’il a en vue le revenu public et non la protection. — C’est justement ce dont vous le blâmez, quand vous dites :
« Il faut qu’il soit bien entendu que les États-Unis, se plaçant sur le terrain étroit et égoïste de la fiscalité, n’ont pas eu la prétention de se poser en champions ou en adversaires de la liberté commerciale, » — « Difficile problème, ajoutez-vous ailleurs, que l’on cherche à agiter en France. »
Vous êtes donc d’accord avec les journaux anglais sur ce fait que le tarif américain a été combiné en vue du revenu public. C’est pour cela qu’ils le disent libéral, et c’est précisément pour cela que vous le proclamez étroit et égoïste.
Mais un droit de douane ne peut avoir qu’un de ces deux objets : le revenu ou la protection. Dire que la fiscalité, en matière de tarifs, est un terrain étroit et égoïste, c’est dire que la protection est un terrain large et philanthropique. Alors, Monsieur, faites-moi la grâce de m’expliquer sur quel fondement vous donnez si facilement raison, en principe, aux partisans de la liberté des échanges, lesquels ont déclaré hautement que ce qu’ils combattent dans nos tarifs, ce n’est pas le but fiscal, mais le but protecteur [2].
Le tarif américain nous semble libéral par deux motifs. Le premier, c’est qu’il est fondé tout entier sur le système des droits ad valorem, le seul qui fasse justice au consommateur. Il se peut que l’application en soit difficile ; mais, le droit à la pièce, au poids ou à la mesure est inique ; car quoi de plus inique que de frapper de la même taxe la veste de l’ouvrier et l’habit du dandy ? — Placés entre une difficulté et une iniquité, les Américains ont bravement accepté la difficulté ; et il est impossible de ne pas reconnaître que, sous ce rapport du moins, ils se sont montrés vraiment libéraux.
Ils n’ont pas moins agi selon les règles du vrai libéralisme, lorsqu’ils ont refusé de faire de la douane un privilége pour certaines classes de citoyens. Il ne peut pas, ce me semble, tomber dans l’esprit d’un homme impartial qu’en soumettant les produits étrangers à une taxe, on puisse avoir une autre intention, dans un pays où tous les citoyens sont égaux devant la loi, que de créer des ressources au Trésor, ressources qui sont ou sont censées être dépensées au profit de tous. En ce cas, il est vrai que la taxe retombe sur les consommateurs. Mais sur qui donc voulez-vous qu’elle retombe ? N’est-ce point eux qui profitent des dépenses publiques ?
Vous dites :
« Croit-on, par exemple, qu’on ait eu le moindre souci des intérêts des consommateurs, lorsqu’on a frappé d’une taxe de 100 pour 100 les eaux-de-vie et les liqueurs, pour lesquelles on aurait pu aller jusqu’à la franchise, sans provoquer les plaintes d’une double industrie agricole et manufacturière qui n’existe pas aux États-Unis ? »
Eh ! ne voyez-vous pas que c’est là ce qui constitue le libéralisme du tarif américain ? Il frappe de forts droits les produits qui n’ont pas de similaires au dedans. — Nous faisons le contraire. Pourquoi ? parce qu’ils ont en vue le revenu public, et nous le monopole.
Le droit, il est vrai, est très élevé, même dans l’intérêt du trésor, et comme aucun autre intérêt n’a pu déterminer l’adoption d’un chiffre aussi exagéré, il faut qu’on ait eu un autre motif. Nous le trouverons dans l’exposé de M. J. R. Walker, secrétaire du Trésor, à qui l’Amérique doit la réforme.
« Les améliorations dans nos lois de finances sont fondées sur les principes suivants : »
« 1° Qu’il ne soit rien prélevé au delà de ce qui est nécessaire pour les besoins du gouvernement économiquement administré ;
« 2° Qu’aucun droit ne soit imposé, sur aucun article, au-dessus du taux le plus bas où il donne le plus grand revenu ;
« 3° Que, selon l’utilité des produits, ce droit puisse être abaissé et même aboli ;
« 4° Que le maximum du droit soit prélevé sur les objets de luxe ;
« 5° Que tous minimums et droits spécifiques soient abolis pour être remplacés par des droits ad valorem. »
Voilà, Monsieur, ce qui explique la taxe énorme que l’Union a imposée à l’eau-de-vie. Elle l’a considérée comme un objet de luxe et peut-être comme un objet pernicieux.
Vous pouvez alléguer que c’est une faute, financièrement. Je serai de votre avis, car rien ne me semble plus monstrueux qu’une taxe qui égale la valeur de l’objet imposé. Vous pouvez dire que la douane est un mauvais moyen de moralisation. J’en tomberai d’accord, car je suis d’avis que ce n’est point à elle qu’il faut confier la réforme des mœurs [3]. Mais vous ne pouvez pas conclure de cette disposition exceptionnelle que le tarif américain ne soit pas combiné, dans son ensemble, selon les vrais principes de la liberté commerciale.
Au reste, avons-nous le droit de nous plaindre de la rigueur d’autrui, à l’égard des boissons, nous qui mettons sur nos alcools une taxe de 82 fr. 50 par hectolitre ?
Ce qui est certain, c’est que le tarif américain répudie le principe de la protection (nous n’en demandons pas davantage au nôtre), et je n’en veux pour preuve que ce que je trouve dans le Boston Atlas, organe des intérêts privilégiés. Voici ce curieux morceau d’éloquence que j’offre à l’imitation de nos monopoleurs :
« Le peuple, dont les vœux ont été méconnus, dont les pétitions ont été rejetées avec mépris, dont les droits ont été foulés aux pieds, n’a plus qu’une espérance. Renverser les auteurs de ces calamités est pour lui le seul moyen d’effectuer la restauration du tarif. Poussons ce cri de ralliement. Qu’il retentisse, sur les ailes du vent, dans les profondeurs de l’Est à l’Ouest. À bas les gouvernants qui nous ont ruinés au dedans et humiliés au dehors ! restauration du tarif de 1842 ! Que toute la Nouvelle-Angleterre au moins se lève comme un seul homme ! Tous, tant que nous sommes, quels que soient nos drapeaux, whigs, libéraux ou radicaux, nous tous qui voulons la protection en faveur du travail américain, nous tous qui voulons nous opposer à l’abaissement du salaire des ouvriers, quand le prix des aliments s’accroît ; nous enfin qui voulons rétablir le tarif de 1842, tel qu’il était avant qu’on nous eût frustrés de ses avantages ; — serrons nos rangs, marchons comme un seul homme pour le grand œuvre de la restauration. Un grand et glorieux objet nous unit. La patrie souffrante nous appelle ; un peuple outragé implore notre secours, etc. »
Ainsi, Monsieur, ce qui a suivi, comme ce qui a précédé l’adoption du tarif de 1846, montre que le principe de la protection y est entièrement abandonné. C’est tout ce que je voulais prouver.
Agréez, etc.
FN: Courrier français du 22 août 1846. (Note de l’édit.)
FN:Voir la déclaration de l’Association pour la liberté des échanges, t. II, p. 1 et 2.(Note de l’édit.)
FN:Voir t. VI, p. 415 et suiv.(Note de l’édit.)
La loi des céréales et le salaire des ouvriers [24 août 1846] ↩
BWV
1846.08.24 “La loi des céréales et le salaire des ouvriers” (The Corn Laws and Workers’ Wages) [*Courrier français*, 24 août 1846] [OC7.27, p. 125]
La loi des céréales et le salaire des ouvriers [1]
En Angleterre, les deux journaux protectionistes le Morning Herald et le Standard ont fait grand bruit d’une réduction de salaires qui a eu lieu dans quatre ou cinq fabriques. — Voyez-vous, ont-ils dit, les effets de la liberté des transactions ? Vive la restriction pour mettre les gens à l’aise ! — Et les journaux protectionistes de Paris de s’écrier : Voilà les effets de cette maudite liberté ! Il n’y a que le monopole pour enrichir le peuple.
D’abord ces bons amis du peuple se sont un peu trop hâtés, car enfin, si la loi anglaise a décrété la liberté, on sait qu’elle a donné, sous les rapports les plus importants, trois ans de répit au monopole. Comment donc pourrait-on imputer à ce bon marché du pain, qui n’existe pas encore, les calamités qu’on allègue ? La prétendue retenue de 5 pour 100 opérée sur les salaires par des manufacturiers, en vue du bon marché des aliments, serait donc par eux anticipée, ou, comme nous disons en Gascogne, antichipée ! Ensuite les partisans du libre-échange prédisent-ils que, sous le règne de leurs principes, il n’y aura plus aucune fluctuation dans les salaires ? Ce serait assurément se bercer d’espérances chimériques. Dites-moi, Messieurs, n’y a-t-il pas eu du haut et du bas, du bas surtout pour les ouvriers tant qu’a régné la protection ? Vraiment on croirait qu’en 1842 et en 1843, quand vous étiez les maîtres, quand vous mettiez en œuvre, selon votre bon plaisir, le mécanisme des restrictions, le pauvre peuple était sur des roses !
Mais le fait, direz-vous, le fait ! Rien n’est plus entêté qu’un fait ! Les salaires ont baissé de 5 pour 100 dans toute l’Angleterre, c’est le Morning Herald qui l’a dit, et lord Bentinck, le Darblay britannique, l’a répété. Récuserez-vous cette autorité ?
En fait de faits, je tiens surtout à l’exactitude, quoi qu’ils prouvent ou semblent prouver. Ne pouvant cependant vérifier par moi-même celui qu’on allègue, j’ai cru devoir au moins consulter les journaux du lieu où l’on dit qu’il se passe. Voici comment s’exprime le Manchester Times :
« Nos lecteurs connaissent sans doute la fable des Trois Corneilles, inventée pour montrer ce qu’on peut échafauder d’impostures sur un petit brin de vérité. Depuis quelques jours, certains journaux et certaines harangues nous donnent une version de la fable presque aussi instructive que la fable elle-même. Vendredi dernier, nous annoncions que quelques fabricants de rouleaux, dans les environs de Manchester, avaient manifesté l’intention de réduire de 5 pour 100 le salaire de leurs ouvriers, mais notre correspondant ne nous avait pas donné les détails de cette affaire. Il paraît qu’il y a quelques mois les ouvriers employés à la fabrication des rouleaux, quoiqu’ils gagnassent plus qu’ils n’avaient jamais fait, demandèrent une réduction d’une heure dans la journée de travail, sans une réduction correspondante de salaire. Après quelque hésitation, les fabricants accédèrent à la demande. Ils consentirent à payer aux ouvriers les mêmes salaires pour dix heures que pour onze heures de travail, et même ils élevèrent de 5 pour 100 le prix de l’ouvrage à la tâche, en les avertissant néanmoins que ce changement devait être considéré comme une expérience et que l’augmentation du salaire serait subordonnée à celle du prix des rouleaux. La dépression récente de l’industrie cotonnière ayant nui à la demande des machines, le prix des rouleaux s’en est ressenti, et les fabricants, en vertu de la réserve convenue, ont annoncé une réduction de 5 pour 100 sur les salaires de certaines classes d’ouvriers. Ces fabricants sont au nombre de cinq.
« Quel parti a-t-on tiré de ce fait dans les journaux de Londres et à la Chambre des communes ? La première amplification est due au ’’Morning Herald’’ qui s’exprime en ces termes :
« Les fabricants de rouleaux de Stockport, Park, Bridge, Oldham, Ashton-under-Lyne, Dunkenfield et autres lieux, ont annoncé à leurs ouvriers qu’ils allaient abaisser leurs salaires de 5 pour 100. Cet avis a naturellement créé une grande excitation parmi les ouvriers, qui attribuent avec amertume cette réduction au rappel des lois céréales. Ils demandent à leurs patrons pourquoi ils réduisent les salaires sitôt après la chute des monopoles, et les maîtres leur répondent : — Le pain est à présent à bon marché, vous n’avez plus besoin de gagner autant. »
« Voilà certes un récit bien enflé. Cependant le Standard a renchéri sur son confrère. Mais il appartenait à lord Georges Bentinck de porter l’hyperbole jusqu’à son paroxysme, en s’exprimant ainsi :
« La nouvelle loi céréale et le vote de la loi des sucres n’ont pas suffi pour assurer la prospérité des manufacturiers. A Oldham, Ashton, Stockport et autres villes du Yorkshire, les fabricants ont annoncé à leurs ouvriers une réduction de salaire de 5 pour 100, en leur disant que, puisque les aliments étaient à bas prix, ils pouvaient bien travailler à bon marché. »
« Comme les manufacturiers, particulièrement dans les endroits nommés par lord Georges Bentinck, n’ont opéré aucune réduction de salaire, il est clair que toutes ces déclamation reposent sur le simple fait que nous avons nous-mêmes rapporté, etc., etc. »
Telle est la version du Manchester Times. Je n’ai point à me prononcer entre ce journal et le Morning Herald. Je ferai seulement observer que la feuille de Manchester se rédige et s’imprime sur les lieux, qu’elle se distribue aux ouvriers, qu’elle ne peut pas songer à leur en imposer sur un fait qui les touche de si près. Enfin il est notoire que les ouvriers anglais font des meetings publics quands ils le veulent et pour des circonstances moins graves. Jusqu’à ce qu’ils se plaignent eux-mêmes, il nous est donc permis de mettre les exagérations de lord Bentinck et du Morning Herald sur le compte d’un dépit mal déguisé. Il est à regretter que les journaux français s’y soient laissé prendre.
FN: Courrier français du 24 août 1846.
Au Moniteur industriel [29 août 1846] ↩
BWV
1846.08.29 “Lettre au *Moniteur Industriel*” (Letter to the *Moniteur industriel*) [*Courrier français*, 29 août 1846] [OC7.28, p. 128]
Lettre au Moniteur Industriel [1]
Monsieur,
Nous avons toujours dit ceci : « La protection fait supporter au consommateur national des pertes hors de toute proportion avec les profits qu’elle procure au producteur national.
Dans votre numéro d’hier, vous nous en fournissiez une preuve aussi claire, ce me semble, que la lumière du jour.
Voici ce que vous dites :
« Le capital primitif de Decazeville était de 7,200,000 fr. — Or, depuis 1826 jusqu’en 1840, pendant quatorze années, il ne produisit aux actionnaires ni un décime de dividende ni un centime d’intérêt ! En tenant compte des intérêts, le capital s’élevait, en 1842, à 12,621,807 francs, soit 5,260 fr. par action. Alors il fut fait un emprunt d’un million, ce qui porta le capital engagé à 13,621,807 fr. Ce capital a été encore augmenté depuis par de nouveaux emprunts.
« Quoi qu’il en soit, voilà les chiffres du capital. Voici maintenant les immenses dividendes distribués aux actionnaires depuis les premiers jours de l’entreprise.
« De 1826 à 1840, pendant quatorze années, ni dividendes ni intérêts.
« Pour l’exercice de 1840-41, il a été distribué 90 francs par action au capital de 5,260 francs, soit 1 et 7/10 pour 100 d’intérêt, et pas un centime de dividende.
« Pour l’exercice de 1841-42, il a été distribué 270 francs par action, soit 5 pour 100 d’intérêt et 10 centimes de dividende pour 100 francs de capital. »
« Pour l’exercice de 1842-43, il a été distribué 300 francs par action, soit 5 pour 100 d’intérêt et 70 centimes de dividende pour 100 francs de capital.
« Idem pour les exercices de 1843-44 et 1844-45.
« Pour l’exercice de 1845-46, il a été distribué 360 francs par action, soit 5 pour 100 d’intérêt et 1 fr. 84 de dividende pour 100 francs de capital. »
Il résulte de là que les producteurs privilégiés de Decazeville ont placé leurs capitaux, pendant vingt ans, à 1/2 pour 100 en moyenne.
Tout autre placement leur eût donné 4 1/2 pour 100 ; ils ont donc perdu 3 pour 100 chaque année, ou en tout seize millions.
Recherchons maintenant combien le pays a perdu pour aider M. Decaze et ses associés à perdre 16 millions.
Voici ce que je lis dans un rapport de M. le ministre du commerce (1841) :
« Le prix moyen de la fonte française était de 18 fr. 64, et celui de la fonte anglaise de même nature ne revenait, dans nos entrepôts, qu’à 13 fr. 75. Il en résultait une surcharge de 4 fr. 89.
« De même le prix du fer était en France de 48 fr. 15, et le fer anglais, rendu dans nos ports, ne revenait qu’à 22 fr. 88. Il en résultait une surcharge de 25 fr. 30. »
Dans un tableau n° 4 A, annexé à ce rapport, nous voyons que la consommation de la fonte en France, pendant vingt ans, a été de 42 millions de quintaux métriques. La surcharge de 4 fr. 89 équivaut donc à 205 millions de francs.
Dans le tableau n° 4 B, on voit que la consommation du fer, durant le même espace de temps, a été de 34 millions de quintaux. La surcharge de 25 fr. 30 a donc infligé au consommateur une perte de 860 millions.
Ces deux pertes réunies s’élèvent à plus d’un milliard !
Et cela pour décider les pauvres maîtres de forges, — que le bon Dieu les assiste ! — à placer à perte des capitaux que, sans la protection, ils eussent placés à profit.
Vous me direz sans doute, — je m’y attends, — que l’argent de M. Decaze, en allant s’engouffrer dans les mines, a fait vivre des ouvriers.
J’en conviens ; mais convenez aussi que s’il en eût fait un emploi un peu moins malencontreux, s’il en eût retiré, par exemple, 4 1/2 pour 100, comme font les simples paysans, ses treize millions, qui s’élèveraient aujourd’hui à trente, auraient fait vivre plus d’ouvriers encore.
Enfin, et c’est ceci qui importe, si le public n’eût pas perdu un milliard dans l’affaire, il se serait donné du bien-être et des satisfactions jusqu’à concurrence de cette somme, et toutes les industries en eussent été encouragées d’autant.
Croyez, Monsieur, que deux pertes ne font pas un profit, et agréez mes civilités.
FN: Courrier français du 29 août 1846. (Note de l’édit.)
À M. le rédacteur en chef de La Presse. Seconde lettre [2 septembre 1846] [1]↩
BWV
1846.09.02 “Aux rédacteurs de *la Presse*” (To the Editors of *La Presse* (2)) [*Courrier français*, 2 septembre 1846] [OC7.33, p. 148]
Monsieur,
Dans votre réponse à ma lettre sur le tarif américain, de graves erreurs se mêlent à des observations dont je ne contesterai pas la justesse ; car je ne cherche pas d’autre triomphe que celui de la vérité.
Ainsi, je reconnais que le nouveau tarif est encore fort élevé ; qu’il laisse subsister de grands obstacles aux relations de l’Europe, et, en particulier, de la France avec les États-Unis ; et que le commerce, qui se préoccupe plus de pratique que de théorie, et du présent que de l’avenir, ne sera guère porté à voir une compensation dans la pensée libérale et féconde qui a présidé à cette œuvre.
Cependant, monsieur, même sous le rapport des droits, le tableau que vous avez donné, dans votre numéro du 20 août, est de nature à induire le public en erreur.
Vous portez les vins à 12 et 9 pour 100 dans l’ancien tarif, tandis que c’est 12 et 9 cents le gallon. De même, vous n’attribuez à la soie qu’un droit de 15 et 16 pour 100, quand c’est 15 ou 16 cents par livre qu’il faudrait dire. En faisant les rectifications sur ces bases, vous verrez que les vins et les soies, surtout dans les qualités ordinaires, ont été plutôt dégrevés que surchargés. Il est fâcheux que ces erreurs concernent précisément nos deux principaux articles d’exportation.
Vous ne parlez pas non plus du mécanisme d’après lequel on prélevait jusqu’ici le prétendu droit ad valorem sur tous les tissus de coton. Le tarif faisait figurer, il est vrai, le modeste chiffre de 20 pour 100. Mais, par une ruse digne du génie du monopole, il avait supposé que tous les tissus de colon valaient au moins 30 cents le yard carré (shall be deemed to have cost 30 cents the square yard), en sorte que sur une étoffe de la valeur réelle de 6 cents, on prélevait cinq fois le droit, soit 100 pour 100. — Il en était de même de tous les articles à l’occasion desquels le monopole avait cru devoir se déguiser et faire, comme on dit, patte de velours.
Maintenant le droit est fixé à 25 pour 100 de la valeur réelle. Le privilége a donc perdu du terrain dans la proportion de 75 pour 100, au moins, à l’égard des étoffes les plus communes, c’est-à-dire les plus consommées.
Vous êtes surpris que nous nous félicitions de ces résultats, et vous nous demandez pourquoi nous en voulons tant aux droits protecteurs, puisque les droits fiscaux n’opposent pas de moindres obstacles à notre commerce. Je vais vous le dire.
Nous nous attaquons aux droits protecteurs, parce qu’une fois que le monopole, détournant les tarifs de leur destination, les a accordés à ses vues cupides, aucune réforme n’est plus possible qu’après une lutte acharnée entre le droit et le privilége. Et maintenant qu’aux États-Unis la protection a été vaincue, vous-même vous montrez avec quelle facilité on pourra désormais faire disparaître du tarif ce qu’il a de défectueux et d’exorbitant. Qu’on veuille diminuer le droit sur le vin, qu’est-ce qui s’y opposera ? Ce ne sera point le fisc, puisqu’il recouvrera plus avec un droit moindre. Ce ne sera pas l’industrie indigène, puisqu’elle ne fait pas de vin.
Qu’on dégrève le thé en France, nul ne contredira ; mais qu’on touche au fer, et vous verrez un beau tapage.
Nous nous attaquons aux droits protecteurs, parce qu’ils décuplent et centuplent le sacrifice du consommateur. Si la douane perçoit un million sur le thé, sans doute c’est un million mis à la charge du consommateur ; mais ce million lui est rendu sous forme de route et de sécurité, puisqu’il rentre tout entier au trésor. Mais quand la douane prélève un million sur le fer étranger, elle fait hausser de 5 ou 10 fr. par 100 kilos, non seulement le fer importé, mais encore tout celui qui se produit dans le pays, imposant ainsi au public une taxe incalculable qui n’entre pas au Trésor, et par conséquent n’en sort pas.
Nous nous attaquons aux droits protecteurs, parce qu’ils sont injustes, parce qu’ils violent la propriété ; et, pour mon compte, je suis surpris que l’évidence de cette vérité ne vous ait pas déjà rallié tout à fait à notre cause. Il n’y a pas bien longtemps que les monopoleurs anglais demandaient une transaction à sir Robert Peel. Il leur répondit : « Je vous ai accordé un délai de trois ans, et je ne me rétracterai pas. Mais peut-être ai-je été trop loin. Je croyais alors que c’était une question de finances et d’économie politique, et sur de telles questions on peut transiger. Aujourd’hui je suis convaincu que c’est une question de justice ; il n’y a pas de transaction possible. »
Enfin nous attaquons le régime protecteur, parce que c’est la racine qui alimente chez les peuples l’esprit de domination et de conquête. Et voyez ce qui se passe. Tant qu’elle a obéi à ce système, l’Angleterre a été un fardeau pour le monde, qu’elle aspirait à envahir. Aujourd’hui elle affranchit commercialement ses colonies, qui lui ont coûté tant de sang et de trésors. Dans cinq ans, un Anglais n’y aura pas plus de priviléges qu’un Russe ou un Français ; et je demande quelle raison elle aura alors de retenir ou d’acquérir des colonies.
Voilà pourquoi, Monsieur, nous nous réjouissons de voir le système protecteur succomber sur quelque point du globe que ce soit. Voilà pourquoi nous avons accueilli avec joie le nouveau tarif américain, quoique nous le considérions comme très défectueux au point de vue fiscal.
À ce sujet, je ne crois pas, comme vous, que les Américains, en maintenant des droits monstrueux de 40 et de 100 pour 100, aient songé à réduire le chiffre total de leurs importations, de crainte qu’il ne surpassât celui des exportations. Ce serait les supposer encore encroûtés dans la balance du commerce, et ils ne méritent pas cette épigramme. Mais, direz-vous, si ce n’est ni l’intérêt de la protection ni celui du fisc qui les a décidés, comment expliquer ces droits absurdes sur le vin et l’eau-de-vie ? — Je les explique par le sentimentalisme. En Amérique, comme ailleurs, il est fort à la mode. On veut faire de la moralisation à coups d’impôts et de tarifs. Les sociétés de tempérance, les teetotallers ont voulu imposer leur doctrine au lieu de la prêcher, voilà tout. C’est un chapitre de plus à ajouter à l’histoire de l’intolérance à bonne intention ; mais, quel que soit l’intérêt du sujet, ce n’est pas ici le lieu de le traiter.
Me permettrez-vous, Monsieur, de vous faire remarquer que la dernière phrase de votre article cache le sophisme qui sert de prétexte à tous les priviléges ?
Vous dites : « Si les manufactures américaines ne peuvent pas demeurer victorieuses sur leur propre marché, c’est qu’il y a en elles un germe incurable d’impuissance… »
Ce germe, c’est la cherté des capitaux et de la main-d’œuvre.
En d’autres termes, les Américains ne sont impuissants à filer le coton que parce qu’ils gagnent plus à faire autre chose. Les plaindre à ce sujet, c’est comme si l’on disait à M. de Rothschild : « Il est vraiment fâcheux pour vous que votre état de banquier vous donne un million de rente ; cela vous met dans l’impuissance incurable de soutenir la concurrence avec les cordonniers, s’il vous prenait fantaisie de faire des souliers. »
Si pourtant la loi s’en mêlait, je ne réponds pas qu’au moyen de certains priviléges, elle ne pût rendre le métier de cordonnier fort lucratif.
Agréez, etc. [2].
FN: Courrier français du 2 septembre 1846.
FN: La protection s’est relevée, en Amérique, du coup que lui avait porté le tarif de 1846. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Ce n’est pas d’une mesure gouvernementale, c’est de l’opinion publique que dépend le sort définitif d’un système. Or l’opinion publique, aux États-Unis, n’en est pas encore arrivée à reconnaître ce qu’a d’inique et de malfaisant le système protecteur. Bastiat l’avait crue plus avancée.(Note de l’éd.)
Aux artisans et aux ouvriers [18 September 1846] [CW3 ES2.6]↩
BWV
1846.09.18 “Aux artisans et aux ouvriers” (To Artisans and Workers) [Le Courrier français, 18 September 1846] [ES2.6] [OC4.2.6, pp. 173-82] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Second discours, à Paris [29 septembre 1846] ↩
BWV
1846.09.26 “Deuxième discours, à Paris” (Second Speech given in the Montesquieu Hall in Paris) [salle Montesquieu, 29 septembre 1846] [*Journal des Économistes*, octobre 1846] [OC2.43, p. 238]
Prononcé à Paris, salle Montesquieu, 29 septembre 1846
La première partie de ce discours est à l’adresse de ceux qui accusent les libre-échangistes de ne pas ménager les transitions.
Dans mon village, il y avait un pauvre menuisier ; il ne travaillait que six heures par jour. Hélas ! mon village et bien d’autres ont été ruinés par le régime protecteur ; on n’y a pas toujours le nécessaire, à plus forte raison on s’y passe de superflu. Bref, notre menuisier ne travaillait que six heures. — Il devint aveugle ; mais comme il ne manquait pas d’énergie, il parvint à expédier le même ouvrage, en y consacrant douze heures de pénible labeur.
Un de ses voisins, menuisier comme lui, venait le voir souvent et lui disait : « Vous êtes bien heureux d’avoir la cataracte ; avant, vous n’aviez pas de quoi vous occuper, maintenant vous êtes occupé toute la journée ; et, vous le savez, M. de Saint-Cricq l’a dit : le travail, c’est la richesse. » (Hilarité.)
Le pauvre aveugle le crut. Il se voyait déjà millionnaire, et il s’encroûta si bien de cette doctrine qu’il refusait opiniâtrement de se laisser opérer.
Alors ses parents et ses amis se concertèrent pour le tirer d’erreur. Ils cherchèrent à lui démontrer que le travail n’est de la richesse qu’autant qu’il est suivi de quelques résultats. Je crois même que mon ami, M. Wolowski, leur a dérobé l’argument du tread-mill, qu’il vous soumettait tout à l’heure avec tant d’à-propos. — Le malade était sur le point d’être persuadé.
Que fît son perfide concurrent ? Il vint trouver l’aveugle et lui dit : Vos parents sont de beaux théoriciens, et peut-être ont-ils raison en principe. Mais vous ont-ils parlé du danger de la transition ? — Ils ne m’en ont pas dit un mot, dit l’aveugle. — Ah ! je les y surprends ; ils veulent exposer vos yeux subitement à la clarté du soleil et vous faire perdre à jamais la vue. (L’hilarité redouble.)
Le malade, toujours crédule, s’en fut à ses parents et leur dit : Vous ne m’aviez pas parlé de la transition. Vous voulez donc me rendre aveugle ?
— Vous ne seriez pas pis que vous n’êtes, répondirent les parents. (Rires.) Cependant, soyez tranquille. Nous ne voulons pas vous faire perdre la vue, mais vous la rendre. Nous n’avons pas parlé de transition, parce que cela ne nous regarde pas, c’est l’affaire de l’oculiste. Il fallait bien vous décider à l’appeler. Nous n’étions préoccupés que de combattre votre égarement. Une fois cela obtenu, nous laisserons faire l’opérateur, pourvu toutefois qu’il ne s’entende pas avec votre perfide conseiller, et ne vous laisse pas un bandeau sur les yeux toute votre vie, sous prétexte de ménager la transition. (Éclats de rires.)
L’aveugle fut convaincu, se laissa opérer, et la transition ne fit aucune difficulté ; car malgré tous les raisonnements du concurrent, qui ne cessait de crier : « N’ôtez pas le bandeau ou tout est perdu, » le malade était le premier à demander la lumière. (Très-bien ! très-bien !)
Ce petit conte, messieurs, me semble assigner assez fidèlement le rôle de chacun dans le grand débat qui nous occupe. Le pauvre aveugle, c’est le peuple, qui a perdu une faculté précieuse, ce qui l’oblige à plus de travail. Le faux ami, ce sont les théoriciens de la protection, qui, après avoir cherché à persuader au peuple qu’il était trop heureux d’être privé d’une faculté, et ne pouvant plus tenir ce terrain, lui font peur maintenant de la transition. Les vrais amis du peuple, c’est l’Association, qui croit n’avoir autre chose à faire qu’à le tirer de son erreur, bien convaincue qu’il exigera ensuite de lui-même la liberté des échanges. L’opérateur, c’est le gouvernement, et l’Association n’a rien à démêler avec lui, si ce n’est de veiller à ce qu’il ne se coalise pas avec le conseiller perfide, auquel cas elle dirait au malade : Adressons-nous à un autre ; il n’en manque pas. (Rires et bravos.)
L’hilarité générale interrompt un moment la séance.
La seconde parabole de M. Bastiat avait pour but une démonstration économique assez difficile, l’orateur a triomphé de son sujet avec un grand bonheur. Voici comment il a démontré, à son tour, qu’il y a au fond du système protecteur une grande déception, même pour les industries qui croient le plus en profiter.
Il y avait une fois… encore un conte. Mais rassurez-vous, celui-ci est très-court. — Vraiment, Messieurs, je me demande si ce style familier est bien de mise devant un auditoire si éclairé. Je m’empresse de me placer sous l’autorité du bon La Fontaine, qui était bien Français, et qui disait :
« Si Peau d’âne m’était conté,
« J’y prendrais un plaisir extrême. »
D’ailleurs, je vous ai prévenus, je ne suis pas orateur ; je n’ai pas fait mon cours de rhétorique, et je ne puis pas même dire comme Lindor :
« Je ne suis qu’un simple bachelier, »
Et je dois avouer, ainsi que la servante de Chrysale :
« Que je parle tout dret comme on parle cheux nous. »
Donc un homme descendait une montagne, le baromètre à la main. Quand il fut au fond de la vallée : Oh ! oh ! dit-il, qu’est-ce ceci ? Le mercure a monté ! Il faut de toute nécessité qu’il ait perdu de son poids.
Cet homme se trompait. Ce n’était pas le mercure, c’était l’atmosphère qui avait changé. Il ne prenait pas garde que la hauteur d’un fluide dans un tube dépend de deux circonstances : de sa pesanteur spécifique sans doute, et aussi du poids de la colonne d’air qui le presse.
Voilà, Messieurs, la source de toutes les erreurs économiques. On cherche la valeur d’un objet en lui-même, dans son utilité intrinsèque, dans le travail qu’il a occasionné ; et l’on oublie que cette valeur dépend aussi du milieu dans lequel l’objet est placé. Par exemple, si le sol sur lequel je suis était à vendre, il trouverait probablement des acquéreurs à des centaines, à des milliers de francs la toise carrée. Dans mon pays des Landes, une égale superficie de terrain se donnerait pour cinq centimes. D’où vient la différence ? Est-elle dans les qualités intrinsèques de la terre ? Non, messieurs, on peut faire des fossés aussi profonds et élever des murs aussi hauts chez nous qu’à Paris. Mais ici le terrain à bâtir est dans un autre milieu : il est environné d’une population nombreuse, riche, qui veut être logée.
Ce que je dis des choses est vrai des hommes. L’Auvergnat qui descend de sa montagne, où il ne gagnait peut-être pas dix sous par jour, ne subit pas, en arrivant à Paris, une transformation instantanée. Ses muscles ne prennent pas tout à coup de la force et son esprit du développement. Cependant il gagne 2 et 3 francs. Pourquoi ? Parce qu’il est dans un autre milieu [2].
Mais je crains que ces détails techniques ne vous fatiguent. (Non ! non ! — Parlez ! parlez !)
Le monde, au point de vue économique, peut être considéré comme un vaste bazar où chacun de nous apporte ses services et reçoit en retour… quoi ? des écus, c’est-à-dire des bons qui lui donnent droit à retirer de la masse des services équivalents à ceux qu’il y a versés.
Chacun de nous comprend instinctivement que nos services seront d’autant plus recherchés, d’autant plus demandés, auront d’autant plus de valeur, d’autant plus de prix, qu’ils seront plus rares, toutes choses égales d’ailleurs, c’est-à-dire le grand réservoir commun, le milieu demeurant également pourvu. Et voilà pourquoi nous avons tous l’instinct du monopole. Tous nous voudrions opérer la rareté du service qui fait l’objet de notre industrie, en éloignant nos concurrents.
Mais il est bien clair que, si nous réussissions tous dans ce vœu, la rareté se manifesterait, non-seulement dans l’objet spécial que nous présentons au grand réservoir commun, mais encore à l’égard de tous les produits qui le composent et qui forment, relativement à chaque service déterminé, cette atmosphère, ce milieu dont je parlais tout à l’heure. En sorte que, de même, qu’il n’y aurait aucune variation dans la hauteur du mercure alors qu’il perdrait de son poids, s’il était promené dans une atmosphère constamment allégée en même proportion, de même il n’y a aucune variation dans la valeur nominale, dans le prix des choses lorsque la rareté s’opère également sur toutes à la fois.
Et c’est là ce que fait précisément le régime protecteur. Il dit au maître de forges : « Tu n’es pas content de ta position, tu ne trouves pas que tu t’enrichisses assez vite ; mais j’ai la force en main, et je vais élever la valeur du fer en le rendant plus rare. Pour cela, j’écarterai le fer étranger. »
S’il s’arrêtait là, il commettrait une injustice envers tous ceux qui échangent leurs services contre du fer. Mais il va plus loin. Après avoir opéré la rareté du fer, poussé par le même motif, il opère la rareté des bestiaux, du drap, du blé, des combustibles, de l’huile, en un mot, de l’atmosphère dans laquelle le fer est plongé. Il en détruit les ressources, les moyens d’échange, les débouchés, la force d’absorption : en un mot, il rétablit au taux primitif toutes les valeurs nominales.
Mais n’y a-t-il rien de changé cependant ? n’y a-t-il que des compensations ? Oh ! si fait, il y a l’abondance changée en rareté. Les produits ont conservé leur valeur relative, mais il y en a moins, et par conséquent les hommes sont moins bien pourvus de toutes choses.
De cette démonstration, on peut tirer plusieurs conséquences.
La première, c’est que le système protecteur est une déception, et qu’il trompe même ceux qu’il prétend favoriser. Il aspire à leur conférer le triste privilége de la rareté, dont le propre, il est vrai, est d’élever le prix d’un objet, quand elle est relative ; mais opérant de même sur tout, ce n’est pas la rareté relative, mais bien la rareté absolue qu’il procure, manquant même son but immédiat [3].
Une autre conséquence plus importante encore qui vous aura frappés, c’est celle-ci : pour chaque individu, pour chaque industrie, pour chaque nation, le moyen le plus sûr de s’enrichir, c’est d’enrichir les autres, puisque la richesse générale est ce milieu qui donne de l’emploi, des débouchés et des rémunérations aux services de chacun ; et nous sommes ainsi conduits à reconnaître que la fraternité humaine n’est pas un vain sujet de déclamation, mais un phénomène susceptible de démonstration rigoureuse [4].
Enfin, il s’ensuit encore que le régime protecteur est essentiellement injuste. — Il est injuste même à l’égard des industries privilégiés, car il ne lui est pas possible d’accorder à toutes, — il n’en a pas la prétention, — la faveur d’une rareté exactement proportionnelle.
Mais que dirai-je, Messieurs, des nombreux services humains qui payent tribut au monopole et ne reçoivent, ne sont pas même susceptibles de recevoir aucune compensation par l’action des tarifs ?
Ces services sont si nombreux qu’ils occupent le fond même de la population. Je crois qu’on ne l’a point assez remarqué, et je vous prie de me permettre d’en faire passer sous vos yeux la nomenclature.
Pour qu’un service puisse recevoir la protection douanière il faut que le travail auquel il donne lieu s’incorpore dans un objet matériel susceptible de passer la frontière ; car ce n’est que sous cette forme que le produit similaire étranger peut être repoussé ou grevé d’une taxe.
Or, il est un produit extrêmement précieux qui n’est pas dans ce cas, je veux parler de la sécurité. Ce service absorbe, ou est censé absorber les facultés d’une multitude de personnes, depuis les ministres du roi jusqu’aux gardes champêtres, magistrats, militaires, marins, collecteurs de taxes, etc., etc.
Une autre classe qui ne peut pas être protégée, c’est celle qui rend des services immatériels : avocats, avoués, médecins, notaires, greffiers, huissiers, auteurs, artistes, professeurs, prêtres, etc., etc.
Une troisième classe est celle qui s’occupe exclusivement de distribuer les produits : banquiers, négociants, marchands en gros et en détail, agents de change, assureurs, courtiers, voituriers, etc., etc.
Une quatrième se compose de tous ceux qui font un travail qui se consomme sur place et à mesure qu’il se produit : tailleurs, cordonniers, menuisiers, maçons, charpentiers, forgerons, jardiniers, etc., etc.
Enfin, il faut aussi compter comme radicalement exclus des faveurs de la protection tous ceux qui cultivent ou fabriquent des choses qui ne craignent pas la concurrence étrangère : les vins, les soies, les articles de Paris, etc.
Toutes ces classes, Messieurs, payent tribut au monopole, et n’en peuvent jamais recevoir aucune compensation. À leur égard, l’injustice de ce système est évidente.
Messieurs, j’ai insisté principalement sur la question de justice, parce qu’elle me semble de beaucoup la plus importante. Le monopole a deux faces comme Janus. Le côté économique a des traits incertains ; il faut être du métier pour en discerner la laideur. Mais du côté moral on ne peut pas s’y tromper, et il suffit d’y jeter les yeux pour le prendre en horreur. Il y en a qui me disent : Voulez-vous faire de la propagande ? Parlez aux hommes de leurs intérêts, montrez-leur comment le monopole les ruine. — Et moi je dis que c’est surtout la question de justice qui passionne les masses. J’ai du moins cette foi dans mon siècle et dans mon pays. — Et voilà pourquoi, tant que ma main pourra tenir une plume ou mes lèvres proférer un son, je ne cesserai de crier : Justice pour tous ! liberté pour tous ! égalité devant la loi pour tous ! [5] »
FN:N’ayant pas le texte entier de ce discours, nous en reproduisons tout ce qu’en a conservé le Journal des Économistes, dans son numéro d’octobre 1846. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome VI, le chap. ix (Note de l’éditeu
FN:V. au tome V, les pages 398 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome VI le chap. iv. (Note de l’éditeur.)
FN:V. tome IV, pages 538 et suiv.(Note de l’éditeur.)
De la population (On Population) (JDE, 15 Octobre 1846) [45]↩
BWV
1846.10.15 "De la population,” (On Population), JDE, 15 Octobre 1846, T. XV, pp. 217-234.
Originally published as the article “Population” in Encyclopédie du dix-neuvième siècle: répertoire universel des sciences, des lettres et des arts avec la biographie de tous les hommes célèbres, ed. Ange de Saint-Priest (Paris: Au bureau de l'Encyclopédie du dix-neuvième siècle, Impr. Beaulé, Lacour, Renoud et Maulde, 1855). Tome XX, pp. 110-20.
Partly rewritten and “completed” by Fonteyraud in the 1851 edition of Economic Harmonies. Chap. XVI “De la population”, FB’s section pp. 422-53; Fonteyraud explication pp. 454-64.
Text: Population (Encyclopedie du 19e siecle↩
POPULATION. — La loi qui gouverne les hommes relativement à leur nombre a été formulée en ces termes:
La population tend à se mettre au niveau des moyens de subsistance.
Il est difficile d'expliquer pourquoi on a attribué à Malthus l'honneur ou la responsabilité de cette formule ; je ne crois pas qu'un seul auteur, antérieurement à l'économiste anglais, se soit occupé de celte matière sans exprimer la même pensée en d'autres termes et souvent en termes identiques. — M. Say, se fondant sur ce que l'aliment ne suffit pas pour qu'une famille puisse exister; sur ce que l'homme, suivant le pays qu'il habile, le rang qu'il occupe, les habitudes qu'il a contractées, a des besoins variés dont la satisfaction importe au maintien de la vie, a substitué les mots moyens d'existence aux mots moyens de subsistance. —La plupart des économistes ont adopté l'expression de M. Say. — Mais ces formules, il faut le dire,et M. Say en convient, ont besoin de tant d'explications et de commentaires, prises dans un sens rigoureux et absolu, elles sont si contraires aux faits, que leur utilité scientifique est au moins fort contestable.— La production des subsistances, selon Malthus, la production en général, suivant M. Say, le revenu, d'après Sismondi, telle est la mesure de la population. Mais, s'il en est ainsi, on ne voit pas que les hommes puissent jamais faire de progrès, si ce n'est quant à leur nombre. A mesure que s'accroît la production ou le revenu au sein d'un peuple ou d'une classe, si le nombre des hommes qui composent cette classe ou ce peuple s'accroît exactement dans la même proportion, alors la condition des êtres humains est immuable. Dix fois plus de production au xixe qu'au ve siècle, dix fois plus de revenus dans une nation industrieuse que chez un peuple sauvage, cela implique une population décuple en faveur du siècle et du pays civilisé, mais cela exclut toute idée de progrès, d'amélioration individuelle. —Ce n'est pas là très-certainement ce qu'ont prétendu dire les économistes, et cependant c'est la conséquence rigoureuse de leurs formules: elles sont donc tout au moins incomplètes. — Ce qui importe, c'est d'exposer les lois de la population; si, ensuite, il est possible de les résumer en un court aphorisme, ce sera certes une circonstance heureuse pour l'avancement et la diffusion de la science. Mais, si, à raison du nombre et de la mobilité des données du problème, nous trouvons que ces lois répugnent à se laisser renfermer dans une formule pourvue de cette rigueur exacte que la science a droit d'exiger, nous saurons y renoncer et accepter les inconvénients d'une prolixité inévitable, de préférence à ceux d'une trompeuse concision. — La première donnée à déterminer, c'est la puissance physiologique de multiplication dans la race humaine : il est clair que c'est là la limite supérieure que, dans aucun cas, le progrès réel de la population ne peut dépasser.— Ici nous voudrions bien être compris et ne pas encourir les accusations qui ont été si mal à propos, selon nous, dirigées contre Malthus. — On lui a attribué ce raisonnement: « La population s'accroît en progression géométrique; la subsistance, en progression arithmétique ; donc la misère, la maladie et la mort doivent intervenir pour rétablir l'équilibre. » — Malthus n'a jamais posé cette inepte prémisse : les hommes multiplient en progression géométrique. — Il a recherché quelle est, physiologiquement, dans la race humaine, la puissance organique de multiplication ; en combien de temps une population donnée pourrait doubler, dans la supposition que la satisfaction de tous les besoins ne rencontrât jamais aucun obstacle; et il a fixé cette période à vingt-cinq ans : il l'a fixée ainsi parce que l'observation directe la lui a révélée chez le peuple qui se rapproche le plus (quoique infiniment loin) de son hypothèse, chez le peuple américain. — Une fois celte période trouvée, et comme il s'agit toujours de la puissance virtuelle de propagation, il a dit que la population tendait à augmenter dans une progression géométrique. Assurément c'est là un véritable truisme, car, dans la supposition de l'auteur, celle où la satisfaction des besoins serait complètement assurée d'avance, il n'y a aucune raison de dire que 2 mille, 100 mille, 1 million découplés ne multiplieront pas proportionnellement autant que mille. — En fait, cela n'arrive pas : pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas dans l'hypothèse de Malthus; parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits aussitôt qu'ils se manifestent ; parce qu'il faut créer des subsistances pour que des générations virtuelles subsistent : or les subsistances ne peuvent pas doubler partout tous les vingt-cinq ans. Voilà pourquoi, en fait, la population ne double pas tous les vingt-cinq ans. — Mais qu'est-ce qui fait obstacle à cette puissance organique, à cette force virtuelle, à ce principe abstrait de multiplication? qu'est-ce qui fait que la population , en tous pays, au lieu de suivre la progression possible de celte puissance, ne suit que la progression des produits? Evidemment c'est que, dans la réalité , il naît moins d'hommes et il en meurt plus que dans l'hypothèse ; c'est que les hommes, prévoyant que leurs besoins ne seront pas indéfiniment et immédiatement satisfaits, s'abstiennent, ou, ne le prévoyant pas, succombent. Or, les naissances et les décès étant les seuls éléments qui puissent altérer le nombre des hommes, il n'est pas douteux que la division de Malthus en obstacles préventifs et obstacles répressifs ne soit complète.
Telle est la doctrine de Malthus. Je ferai observer ici que cet économiste a eu tort d'adopter comme limite de la fécondité humaine cette période de vingt-cinq ans, constatée aux Etats-Unis ; il a cru par là éviter tout reproche d'exagération et d'abstraction. Comment osera-t-on prétendre, s'est-il dit, que je donne trop de latitude au possible si je me fonde sur le réel? Il n'a pas pris garde qu'en mêlant ainsi le virtuel et le réel, en donnant pour mesure à la loi de multiplication, abstraction faite de la loi de limitation, une période relevée des faits où ces deux lois coagissent.il s'exposait à n'être pas compris, et c'est ce qui est arrivé : on s'est moqué de ses progressions géométriques et arithmétiques ; on lui a reproché de prendre les EtatsUnis pour type du reste du monde ; en un mot, on s'est servi de la confusion qu'il a faite de deux lois distinctes pour lui contester l'une par l'autre. — Qu'il soit donc bien entendu que, lorsque nous cherchons quelle est, pour l'espèce humaine, la puissance de propagation, nous mettons pour un moment en oubli tout obstacle, physique ou moral, provenant du défaut d'espace et d'aliments; il faut bien commencer par reconnaître quelle est la limite supérieure que l'organisation humaine rend abstraitement possible. La première question-que nous posons est donc celle-ci : l'âge de la puberté et la durée de la fécondité étant donnés, dans quelle progression la vie pourrait-elle se propager, s'il n'était pas nécessaire de l'entretenir?—Dans l'espèce humaine, comme dans tous les êtres organisés , cette puissance est telle, qu'il est véritablement superflu de la déterminer avec exactitude; il suffit de constater qu'elle surpasse dans une proportion énorme tous les phénomènes de rapide multiplication que l'on a observés dans le passé ou qui pourront se montrer dans l'avenir. — Pour le froment , en admettant cinq tiges par semence et vingt grains par tige, un grain a la puissance virtuelle d'en produire 10 milliards en cinq années.— Pour l'espèce canine, en raisonnant sur ces deux bases, quatre produits par portée et six ans de fécondité, on trouvera qu'un couple peut donner naissance, en douze ans, à 8 millions d'individus. — Dans l'espèce humaine, en fixant la puberté à 16 ans et la durée de la fécondité à trente ans, chaque couple pourrait donner naissance à huit : c'est beaucoup que de réduire ce nombre de moitié à cause de la mortalité prématurée, puisque nous raisonnons dans l'hypothèse que les besoins de ton le nature sont satisfaits à mesure qu'ils se manifestent, ce qui restreint beaucoup l'empire de la mort. Toutefois ces prémisses nous donnent, par période de dix-sept ans, la progression:
2 — 4 — 16 — 64 —256 —1,024— 4,096 — 16,384, etc.
Enfin plus de 50 millions en deux siècles.
Veut-on fixer la puberté à 20 ans et réduire à six le nombre d'enfants que chaque couple peut élever?On aura, par période de vingt et un ans, la progression:
1 — 3 _—6 — 18 — 54 — 162 — 486- 1,358, etc.
Si l'on calcule selon les bases adoptées par Euler, la période de doublement sera de douze ans et demi : huit périodes feront justement un siècle, et l'accroissement dans cet espace de temps sera comme 512:2.
II est inutile de pousser plus loin ces recherches ; il suffit de reconnaître que dans notre espèce, comme dans toutes, la puissance organique de multiplication est supérieure à la multiplication réelle;d'ailleurs il implique contradiction que le réel dépasse le virtuel ; c'est tout ce que nous voulions établir.
A aucune époque, dans aucun pays, on n'a vu le nombre des hommes s'accroître avec cette effrayante rapidité. Selon la Genèse, les Hébreux entrèrent en Egypte au nombre de soixante-dix couples; on voit dans le livre des Nombres que le dénombrement fait par Moïse, deux siècles après, constata la présence de 600,000 hommes au-dessus de 21 ans, ce qui suppose une population de 2 millions au moins : on en peut déduire le doublement par période de quatorze ans.
Après cet exemple, qui est vraisemblablement celui où la fécondité de fait s'est le plus rapprochée de la fécondité virtuelle, nous avons celui des Etats-Unis. On sait que, dans ce pays, le doublement de la population s'accomplit, depuis trois siècles , en vingt-cinq ans. D'après les recherches de M. Moreau de Jonnès, le même phénomène, en prenant pour base le mouvement de la population tel qu'il s'effectue de nos jours, exigerait 43 ans en Russie et en Angleterre, 76 en Allemagne, 100 en Hollande, 106 en Espagne, 135 en Italie, 138 en France, 227 en Suisse, 238 en Portugal, et 555 en Turquie. — Il y a donc une force qui limite, comprime, suspend dans une certaine mesure l'action de la puissance physiologique que nous avons constatée , et cette force est sans doute complexe, puisqu'elle oppose des bornes si différentes, selon les temps et les lieux, à une puissance qu'on peut considérer comme uniforme. Les éléments de cette force, les faits généraux qui empêchent toutes les espèces organisées d'atteindre, dans leur propagation, la loi de doublement qui est virtuellement en elles, s'il est possible de les connaître et de les formuler, sont aussi une loi. Je l'appelle loi de limitation, et il est clair que le mouvement de la population dans chaque pays, dans chaque classe, est le résultat de l'action combinée de ces deux lois. — Mais en quoi consiste la loi de limitation ? Je crois que l'on peut dire d'une manière très-générale que la propagation de la vie est contenue ou prévenue par la difficulté d'entretenir la vie. Il importe d'approfondir cette pensée; à vrai dire, elle constitue la partie essentielle de notre sujet. — Les êtres organisés qui ont vie et qui n'ont pas de sentiment sont rigoureusement passifs dans cette lutte entre les deux principes. Pour les végétaux, il est exactement vrai que leur nombre, dans chaque espèce, est limité par les moyens d'existence. La profusion des germes est infinie, mais les ressources d'espace et de fertilité territoriale ne le sont pas. Les germes se nuisent, se détruisent entre eux; ils avortent, et, en définitive, il n'en réussit qu'autant que le sol en peut nourrir. — Les animaux sont doués de sentiment, mais ils paraissent privés de prévoyance; ils propagent, ils pullulent, ils foisonnent, sans se préoccuper du sort de leur postérité. La mort, une mort prématurée, peut seule borner leur multiplication et maintenir l'équilibre entre leur nombre et leurs moyens d'existence. — Lorsque M. de Lamennais, s'adressant au peuple, dans son inimitable langage, dit:
« Il y a place pour tous sur la terre, et Dieu l'a rendue assez féconde pour fournir abondamment aux besoins de tous. » — Et plus loin: — « L'auteur de l'univers n'a pas fait l'homme de pire condition que les animaux; tous ne sont-ils pas conviés au riche banquet de la nature ? Un seul d'entre eux en est-il exclu ?» — Et encore: — « Les plantes des champs étendent l'une prés de l'autre leurs racines dans le sol qui les nourrit toutes, et toutes y croissent en paix; aucune d'elles n'absorbe la séve d'une autre. »
Il est permis de ne voir là que des déclamations fallacieuses, servant de prémisses à de dangereuses conclusions, et de regretter qu'une éloquence si admirable soit consacrée à populariser la plus funeste des erreurs. — Certes, il n'est pas vrai qu'aucune plante ne dérobe la séve d'une autre et que toutes étendent leurs racines, sans se nuire, dans le sol. Des milliards de germes végétaux tombent chaque année sur la terre, y puisent un commencement de vie et succombent étouffés par des plantes plus fortes et plus vivaces. — Il n'est pas vrai que tous les animaux qui naissent soient conviés au banquet de la nature et qu'aucun d'eux n'en soit exclu. Parmi les espèces sauvages, ils se détruisent les uns les autres, et dans les espèces domestiques l'homme en retranche un nombre incalculable. — Rien même n'est plus propre à montrer l'existence et les relations de ces deux principes : celui de la multiplication et celui de L limitation. Pourquoi y a-t-il en France tant de bœufs et de moutons malgré le carnage qui s'en fait? Pourquoi y a-t-il si peu d'ours et de loups, quoiqu'on en tue bien moins et qu'ils soient organisés pour multiplier bien davantage? C’est que l'homme prépare aux uns et soustrait aux autres la subsistance; il dispose à leur égard de la loi de limitation de manière à laisser plus ou moins de latitude à la loi de fécondité. — Ainsi, pour les végétaux comme pour les animaux, la force limitative ne parait se montrer que sous une forme, la destruction. — Mais l'homme est doué de raison, de prévoyance , et ce nouvel élément modifie, change même à son égard le mode d'action de cette force.
Sans doute, en tant qu'être pourvu d'organes matériels, et, pour trancher le mot, en tant qu'animal, la loi de limitation par voie de destruction lui est applicable. Il n'est pas possible que le nombre des hommes dépasse les moyens d'existence : cela voudrait dire qu'il existe plus d'hommes qu'il n'en peut exister, ce qui implique contradiction. Si donc la raison, la prévoyance sont assoupies en lui, il se fait végétal, il se fait brute ; alors il est fatal qu'il multiplie, en vertu de la grande loi physiologique qui domine toutes les espèces; et il est fatal aussi qu'il soit détruit, en vertu de la loi limitative à l'action de laquelle il demeure étranger. —Mais, s'il est prévoyant, celte loi entre dans la sphère de sa volonté : il la modifie, il la dirige; elle n'est vraiment plus la même; ce n'est plus une force aveugle, c'est une force intelligente; ce n'est plus seulement une loi naturelle, c'est de plus une loi sociale.— L'homme est le point où se rencontrent, se combinent et se confondent ces deux principes, la matière et l'intelligence ; il n'appartient exclusivement ni à l'une ni à l'autre. Donc la loi de limitation se manifeste, pour l'espèce humaine, sous deux influences, et maintient la population à un niveau nécessaire, par la double action de la prévoyance et de la destruction. — Ces deux actions n'ont pas une intensité uniforme : au contraire, l'une s'étend à mesure que l'autre se restreint. Il y a un résultat qui doit être atteint, la limitation: il l'est plus ou moins par répression ou par prévention, selon que l'homme s'abrutit ou se spiritualise, selon qu'il est plus matière ou plus intelligence, selon qu'il participe davantage de la vie végétative ou de la vie morale ; la loi est plus ou moins hors de lui ou en lui, mais il faut toujours qu'elle soit quelque part.
On ne se fait pas une idée exacte du vaste domaine de la prévoyance, que le traducteur de Malthus a beaucoup circonscrit en mettant en circulation cette vague et insuffisante expression contrainte morale, dont il a encore amoindri la portée par la définition qu'il en donne : « C'est la vertu, dit-il, qui consiste à ne point se marier quand on n'a pas de quoi faire subsister une famille et toutefois à vivre dans la chasteté. » Les obstacles que l'intelligente société humaine oppose à la multiplication possible des hommes prennent bien d'autres formes que celle de la contrainte morale ainsi définie. Qu'est-ce que cette sainte ignorance du premier âge, la seule ignorance sans doute qu'il soit criminel de dissiper, que chacun respecte et sur laquelle la mère craintive veille comme sur un trésor? Qu'est-ce que la pudeur qui succède à l'ignorance, arme mystérieuse de la jeune fille, qui enchante et intimide l'amant, et prolonge en l'embellissant la saison des innocentes amours? N'est-ce point une chose merveilleuse, et qui serait absurde en toute autre matière, que ce voile ainsi jeté d'abord entre l'ignorance et la vérité, et ces magiques obstacles placés ensuite entre la vérité et le bonheur? Qu'est-ce que cette puissance de l'opinion qui impose des lois si sévères aux relations des personnes de sexe différent, flétrit la plus légère transgression de ces lois, et poursuit la faiblesse et sur celle qui succombe, et, de génération en génération, sur ceux qui en sont les tristes fruits? Qu'est-ce que cet honneur si délicat, cette rigide réserve, si généralement admirée, même de ceux qui s'en affranchissent, ces institutions, ces difficultés de convenances, ces précautions de toutes sortes, si ce n'est l'action de la loi de limitation manifestée dans l'ordre intelligent, moral, préventif et, par conséquent, exclusivement humain.—Que ces barrières soient renversées, que l'espèce humaine, en ce qui concerne l'union des sexes, ne se préoccupe ni de convenances, ni de fortune, ni d'avenir, ni d'opinion, ni de mœurs, qu'elle se ravale à la condition des espèces végétales et animales, peut-on douter que, pour celle-là comme pour celles-ci, la puissance de multiplication n'agisse avec assez de force pour nécessiter bientôt l'intervention de la loi de limitation, manifestée cette fois dans l'ordre physique, brutal, répressif, c'est-à-dire par le ministère de l'indigence, de la maladie et de la mort? — Est-il possible de nier que, abstraction faite de toute prévoyance et de toute moralité, il n'y ait assez d'attrait dans le rapprochement des sexes pour le déterminer, dans notre espèce comme dans toutes, dès la première apparition delà puberté ? Si on la fixe à 16 ans et si les actes de l'état civil prouvent qu'on ne se marie pas, dans un pays donné, avant 24 ans, ce sont donc huit années soustraites, par la partie morale et préventive de la loi de limitation, à l'action de la loi de multiplication ; et, si l'on ajoute à ce chiffre, ce qu'il faut attribuer au célibat absolu, on restera convaincu que l'humanité intelligente n'a pas été traitée par le Créateur comme l'animalité brutale, et qu'il est en sa puissance de transformer la limitation répressive en limitation préventive.
Qu'un père de famille consulte le prêtre le plus orthodoxe; assurément, il en recevra , pour le cas particulier, des conseils entièrement conformes aux idées que la science érige en principes. «Cachez votre fille, dira le vieux prêtre ; dérobez-la le plus que vous pourrez aux séductions du monde; cultivez, comme une fleur précieuse, la sainte ignorance, la céleste pudeur qui font à la fois son charme et sa défense. Attendez qu'un parti honnête et sortable se présente; travaillez cependant, mettez-vous à même de lui assurer un sort convenable. Songez que le mariage, dans la pauvreté , entraîne beaucoup de souffrances et encore plus de dangers. Rappelez-vous ces vieux proverbes qui sont la sagesse des nations et qui nous avertissent que l'aisance est la plus sûre garantie de l'union et de la paix. Pourquoi vous presseriez-vous? Voulez-vous qu'à 25 ans votre fille soit chargée d'une nombreuse famille, qu'elle ne puisse l'élever et l'instruire selon votre rang et votre condition? Voulez-vous que le mari, incapable de surmonter l'insuffisance de son salaire, tombe d'abord dans l'affliction, puis dans le désespoir et peut-être après dans le désordre? Le projet qui vous occupe est le plus grave de tous ceux auxquels vous puissiez donner votre attention. Pesez-le, mûrissez-le; gardez-vous de toute précipitation, etc. » — Supposez que le père de famille, empruntant le langage de M. de Lamennais, répondit : « Dieu adressa dans l'origine ce commandement à tous les hommes : Croissez et multipliez, et remplissez la terre et subjuguez la; et vous, vous dites à ma fille : Renonce à la famille, aux chastes douceurs du mariage,aux saintes joies de la maternité; abstiens-toi, vis seule ; que pourrais-tu multiplier que les misères?» — Croit-on que le vieux prêtre n'aurait rien à opposer à ce raisonnement?
Dieu, dirait-il, n'a pas ordonné aux hommes de croître sans discernement et sans mesure, de s'unir comme les bêtes, sans nulle prévoyance de l'avenir; il n'a pas donné la raison à sa créature de prédilection pour lui en interdire l'usage dans les circonstances les plus solennelles : il a bien ordonné à l'homme de croître, mais pour croître il faut vivre et pour vivre il faut en avoir les moyens; donc dans l'ordre de croître est impliqué celui de préparer aux jeunes générations des moyens d'existence. La religion n'a pas mis la virginité au rang des crimes; bien loin de là, elle en a fait une vertu, elle l'a honorée, sanctifiée et glorifiée; il ne faut donc point croire qu'on viole le commandement de Dieu parce qu'on se prépare à le remplir avec prudence, en vue du bien, du bonheur et de la dignité de la famille. — Eh bien, ce raisonnement et d'autres semblables, dictés par l'expérience, que l'on entend répéter journellement dans le monde, et qui règlent la conduite de toute famille morale et éclairée, que sont-ils autre chose que l'application, dans des cas particuliers, d'une doctrine générale? ou plutôt, qu'est-ce que cette doctrine, si ce n'est la généralisation d'un raisonnement qui revient dans tous les cas particuliers?
Nous venons de voir que par cela seul que l'homme est une créature raisonnable et morale, douée de la faculté déjuger de l'avenir par le passé et de modifier son propre sort, la loi de limitation, qui n'a qu'un élément pour les autres êtres organisés, l'obstacle répressif, en a un second pour lui, l'obstacle préventif, celui-ci destiné à réduire, à neutraliser, à absorber le premier. — Jusqu'ici nous ne nous sommes pas éloigné de la théorie malthusienne; mais il est un attribut de l'humanité dont il me semble que cet économiste n'a pas tenu un compte proportionné à son importance , qui joue un rôle immense dans les phénomènes relatifs à la population, qui résout plusieurs des problèmes que cette grande question a soulevés, et fait renaître dans l'âme du philanthrope une sérénité et une confiance que la science incomplète semblait en avoir bannies; cet attribut, compris, du reste, sous les notions de raison et prévoyance, c'est la perfectibilité.— L'homme est perfectible; il est susceptible d'amélioration et de détérioration : si, à la rigueur, il peut demeurer stationnaire, il peut aussi monter et descendre les degrés infinis de la civilisation ; cela est vrai des individus, des familles, des nations et des races.
La population, dit-on, tend à se mettre au niveau des moyens d'existence; mais ces moyens sont-ils une chose fixe, absolue, uniforme? Non certainement. A mesure que l'homme se civilise, le cercle de ses besoins s'étend ; on peut le dire même de la simple subsistance. Mais, considérés au point de vue de l'être perfectible, les moyens d'existence, en quoi il faut comprendre la satisfaction des besoins physiques, intellectuels et moraux, admettent autant de degrés qu'il y en a dans la civilisation elle-même, c'est-à-dire dans l'infini. Sans doute, il y a une limite inférieure : apaiser sa faim, se garantir d'un certain degré de froid , c'est une condition de la vie ; et cette limite, nous pouvons l'apercevoir dans l'état des sauvages d'Amérique et des pauvres d'Europe; mais une limite supérieure, je n'en connais pas, il n'y eu a pas. Les besoins naturels satisfaits, il en naît d'autres, qui sont factices d'abord, si l'on veut, mais que l'habitude rend naturels à leur tour, et, après ceux-ci, d'autres encore, et encore, sans terme assignable. — Donc, à chaque pas de l'homme dans la vole de la civilisation, ses besoins embrassent un cercle plus étendu, et les moyens d'existence, ce point où se rencontrent les deux grandes lois de multiplication et de limitation, se déplacent pour s'exhausser. — Car, quoique l'homme soit susceptible de détérioration aussi bien que de perfectionnement, il répugne à l'une et aspire à l'autre : ses efforts tendent à le maintenir au rang qu'il a conquis , à l'élever encore; et l'habitude , qu'on a si bien nommée une seconde nature, fait obstacle à tout pas rétrograde. Il est donc tout simple que l'action intelligente et morale qu'il exerce sur sa propre multiplication se ressente, s'imprègne, s'inspire de ces efforts et se combine avec ces habitudes progressives.— Les conséquences qui résultent de cette organisation de l'homme se présentent en foule: nous nous bornerons à en indiquer quelques-unes. — D'abord nous admettrons bien avec les économistes que la population et les moyens d'existence se font équilibre ; mais le dernier de ces termes étant d'une mobilité infinie, et variant avec la civilisation et les habitudes, nous ne pourrions pas admettre que, en comparant les peuples et les classes, la population soit proportionnelle à la production, comme dit M. Say , ou aux revenus, comme l'affirme M. de Sismondi. — Ensuite chaque degré supérieur de culture impliquant plus de prévoyance, l'obstacle moral et préventif doit neutraliser de plus en plus l'action de l'obstacle brutal et répressif, à chaque phase de perfectionnement réalisé dans la société ou dans quelques-unes de ses fractions. — Il suit de là que tout progrès social contient le germe d'un progrès nouveau , vires acquirit eundo, puisque le mieux-être et la prévoyance s'engendrent l'un l'autre dans une succession indéfinie.—De même, quand, par quelque cause, l'humanité suit un mouvement rétrograde, le malaise et l'imprévoyance sont entre eux cause et effet réciproques, et la déchéance n'aurait pas de terme si la société n'était pas pourvue de cette force curative, vis medicatrix, que la Providence a placée dans tous les corps organisés. Remarquons, en effet, que, à chaque période dans la déchéance, l'action de la limitation dans son mode destructif devient à la fois plus douloureuse et plus facile à discerner. D'abord il ne s'agit que de détérioration, d'abaissement; ensuite c'est la misère, la famine, le désordre, la guerre, la mort.
Nous voudrions pouvoir nous arrêter à montrer combien ici la théorie explique les faits, combien, à leur tour, les faits justifient la théorie. Lorsque, pour un peuple ou une classe, les moyens d'existence sont descendus à cette limite inférieure où ils se confondent avec les moyens de pure subsistance, comme en Chine, en Irlande et dans les dernières classes de tous pays, les moindres oscillations de population ou de ressources alimentaires se traduisent en mortalité : les faits confirment à cet égard l'induction scientifique.
Depuis longtemps la famine ne visite plus l'Europe, et l'on attribue la destruction de ce fléau à une multitude de causes : il y en a plusieurs sans doute, mais la plus générale c'est que les moyens d'existence se sont, par suite du progrès social, exhaussés fort au-dessus des moyens de subsistance. Quand viennent des années disetteuses, on peut sacrifier beaucoup de satisfactions avant d'entreprendre sur les aliments eux-mêmes. —Il n'en est pas ainsi en Chine et en Irlande: quand des hommes n'ont rien au monde qu'un peu de riz ou de pommes de terre, avec quoi achèteront-ils d'autres aliments si ce riz et ces pommes de terre viennent à manquer?— Enfin il est une troisième conséquence de la perfectibilité humaine, que nous devons signaler ici, parce qu'elle contredit, en ce qu'elle a de désolant, la doctrine de Malthus. — Nous avons attribué à cet économiste cette formule: —«La population tend à se mettre au niveau des moyens de subsistance. » — Nous aurions dû dire qu'il était allé fort au delà, et que sa véritable formule, celle dont il a tiré des conclusions si affligeantes, est celle-ci : — La population tend à dépasser les moyens de subsistance.
Si Malthus avait simplement voulu exprimer par là que dans la race humaine la puissance de propager la vie est supérieure à la puissance de l'entretenir, il n'y aurait pas de contestation possible. Mais ce n'est pas là sa pensée; il affirme que, prenant en considération la fécondité absolue d'une part, de l'autre la limitation manifestée par ses deux modes répressif et préventif, le résultat n'en est pas moins la tendance de la population à dépasser les moyens de vivre. — Cela est vrai de toutes les espèces animées, excepté de l'espèce humaine. L'homme est intelligent et peut faire de la limitation préventive un usage illimité. Il est perfectible, il aspire au perfectionnement, il répugne à la détérioration; le progrès est son état normal; le progrès implique un usage de plus en plus éclairé de la limitation préventive : donc les moyens d'existence s'accroissent plus vite que la population. Non-seulement ce résultat dérive du principe de la perfectibilité, mais encore il est confirmé par le fait, puisque partout le cercle des satisfactions s'est étendu. — S'il était vrai, comme le dit Malthus, qu'à chaque excédant de moyens d'existence réponde un excédant supérieur de population, la misère de notre race serait fatalement progressive, la civilisation serait à l'origine et la barbarie à la fin des temps. Le contraire a eu lieu; donc la loi de limitation a eu assez de puissance pour contenir le flot de la multiplication des hommes au-dessous de la multiplication des produits.
On voit, par ce qui précède, combien est vaste et difficile la question de la population. Il est à regretter sans doute que l'on n'en ait pas donné la formule exacte, et naturellement je regrette encore plus de ne pouvoir la donner moi-même. Mais ne voiton pas combien le sujet répugne aux étroites limites d'un axiome dogmatique, et n'est-ce point une vaine tentative que de vouloir exprimer par une équation inflexible les rapports de données essentiellement variables? — Rappelons ces données.
1° Loi de multiplication. Puissance absolue, virtuelle, physiologique, qui est en la race humaine de propager la vie, abstraction faite de la difficulté de l'entretenir. —Cette première donnée, la seule susceptible de quelque précision, est la seule où la précision soit superflue; car qu'importe où est cette limite supérieure démultiplication, dans l'hypothèse, si elle ne peut jamais être atteinte dans la condition réelle de l'homme, qui est d'entretenir la vie à la sueur de son front?
2° Il y a donc une limite à la loi de multiplication. Quelle est cette limite? Les moyens d'existence, dit-on. Mais qu'est-ce que les moyens d'existence? C'est un ensemble de satisfactions insaisissables. Ils varient, et par conséquent déplacent la limite cherchée, selon les lieux, les temps, les races, les rangs, les mœurs, l'opinion et les habitudes.
3° Enfin, en quoi consiste la force qui restreint la population à cette borne mobile? Elle se décompose en deux pour l'homme: celle qui réprime et celle qui prévient. Or l'action de la première, inaccessible par elle-même à toute appréciation rigoureuse, est, de plus, entièrement subordonnée à l'action de la seconde, qui dépend du degré de civilisation, de la puissance des habitudes, de la tendance des institutions religieuses et politiques, de l'organisation de la propriété, du travail et de la famille, etc., etc. — Il n'est donc pas possible d'établir entre la loi de multiplication et la loi de limitation une équation dont on puisse déduire la population réelle. En algèbre, a et b représentent des quantités déterminées qui se nombrent, se mesurent, et dont on peut fixer les proportions; mais moyens d'existence , empire moral de la volonté, action fatale de la mortalité, ce sont là trois données du problème de la population, données flexibles en elles-mêmes, et qui, en outre, empruntent quelque chose à l'étonnante flexibilité du sujet qu'elles régissent, l'homme, cet être, selon Montaigne, si merveilleusement ondoyant et divers. Il n'est donc pas surprenant que, en voulant donner à cette équation une précision qu'elle ne comporte pas, les économistes aient plus divisé que rapproché les esprits , parce qu'il n'est aucun des termes de leurs formules qui ne prête le flanc à une multitude d'objections de raisonnement et de fait.
Entrons maintenant dans le domaine de l'application : l'application, outre qu'elle sert à élucider la doctrine, est le vrai fruit de l'arbre de la science. — Ici nous sommes obligé d'esquisser à grands traits la théorie que nous avons exposée au mot CONCURRENCE, sujet qui a, avec celui qui nous occupe, une étroite connexité.
Le travail, avons-nous dit, est l'objet unique de l'échange. Pour acquérir une utilité (à moins que la nature ne nous la donne gratuitement), il faut prendre la peine de la produire, ou restituer cette peine à celui qui l'a prise pour nous. L'homme ne crée absolument rien ; il arrange, dispose, transporte pour une fin utile ; il ne fait rien de tout cela sans peine, et le résultat de cette peine est sa propriété ; s'il la cède, il a droit à restitution, sous forme d'un service jugé égal après libre débat. C'est là le principe de la valeur, de la rémunération, de l'échange, principe qui n'en est pas moins vrai pour être simple. — Dans ce qu'on appelle produits, il entre divers degrés d'utilité naturelle et divers degrés d'utilité artificielle; celle-ci, qui, seule, implique du travail, est seule la matière des transactions humaines, et sans contester en aucune façon la célèbre et si féconde formule de M. Say : Les produits s'échangent contre des produits, je tiens pour plus rigoureusement scientifique celle-ci : Le travail s'échange contre du travail, ou, mieux encore , les services s'échangent contre des services.
Il ne faut pas entendre par là que les travaux s'échangent entre eux en raison de leur durée ou de leur intensité ; que toujours celui qui cède une heure de peine a droit à une heure de peine, ou bien, que celui dont l'effort aurait poussé l'aiguille du dynamomètre à 100 degrés peut exiger qu'on fasse en sa faveur un effort semblable. La durée, l’intensité sont deux éléments qui influent sur l'appréciation du travail, mais ils ne sont pas les seuls ; il y a encore du travail plus ou moins répugnant, dangereux, difficile, intelligent, prévoyant, heureux même. Sous l'empire des transactions libres,, là où la propriété est complètement assurée, chacun est maître de sa propre peine, et maître, par conséquent, de ne la céder qu'à son prix : il y a une limite à sa condescendance, c'est le point où il a plus d'avantage à réserver son travail qu'à l'échanger ; il y a aussi limite à ses prétentions, c'est le point où l'autre partie contractante a intérêt à refuser le troc. Les travailleurs, et c'est leur droit, cherchent à tirer parti des circonstances qui peuvent augmenter la valeur de leur peine; l'un appelle à son aide un agent naturel, l'autre un procédé ingénieux, ou un instrument dont il a eu la prévoyance de se pourvoir. L'œuvre vraiment harmonique de la concurrence, force égalitaire contre laquelle on s'élève, de nos jours, avec tant de légèreté, c'est d'empêcher que nul n'ait le monopole de ces circonstances et de ramener dans les limites de la justice toutes les prétentions exagérées.
Il y a dans la société autant de couches, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il y a de degrés dans le taux de la rémunération.— Le moins rémunéré de tous les travaux est celui qui se rapproche le plus de l'action brute, automatique; c'est là une disposition providentielle, à la fois juste, utile et fatale. Le simple manouvrier a bientôt atteint cette limite des prétentions dont je parlais tout à l'heure, car il n'est personne qui ne puisse exécuter le travail mécanique qu'il offre; et il est lui-même acculé à la limite de sa condescendance, parce qu'il est incapable de prendre la peine intelligente qu'il demande. La durée, l’intensité, attributs de la matière, sont bien les seuls éléments de rémunération pour cette espèce de travail matériel; et voilà pourquoi il se paye généralement à la journée. — Tous les progrès de l'industrie se résument en ceci: remplacer dans chaque produit une certaine somme d'utilité artificielle et, par conséquent, onéreuse, par une même somme d'utilité naturelle et, partant, gratuite. Il suit de là que, s'il y a une classe de la société intéressée plus que toute autre à la libre concurrence, c'est surtout la classe ouvrière. Quel serait son sort si les agents naturels, les procédés et les instruments de la production n'étaient pas constamment amenés, par la compétition, à conférer gratuitement, à tous, les résultats de leur coopération? Ce n'est pas le simple journalier qui sait tirer parti de la chaleur, de la gravitation, de l'élasticité, qui invente les procédés et possède les instruments par lesquels ses forces sont utilisées : à l'origine de ces découvertes, le travail des inventeurs, intelligent au plus haut degré, est très-rémunéré; en d'autres termes, il fait équilibre à une masse énorme de travail brut; en d'autres termes encore, son produit est cher. Mais la concurrence intervient, le produit baisse, le concours des services naturels ne profite plus au producteur, mais au consommateur, et le travail qui les utilisa se rapproche, quant à la rémunération, de celui où elle se calcule par la durée. — Ainsi le fond commun des richesses gratuites s'accroît sans cesse ; les produits de toute sorte tendent à revêtir et revêtent positivement , de jour en jour, cette condition de gratuité sous laquelle nous sont offerts l'eau, l'air et la lumière : donc le niveau de l'humanité aspire à s'élever et à s'égaliser; donc, abstraction faite de la loi de la population, la dernière classe de la société est celle dont l'amélioration est virtuellement la plus rapide. —Mais nous avons dit, abstraction faite des lois de la population ; ceci nous ramène à notre sujet.
Représentons-nous un bassin dans lequel un orifice, qui s'agrandit sans cesse, amène des eaux toujours plus abondantes. Ane tenir compte que de cette circonstance, le niveau devra constamment s'élever ; mais, si les parois du bassin sont mobiles, susceptibles de s'éloigner et de se rapprocher, il est clair que la hauteur de l'eau dépendra de la manière dont cette nouvelle circonstance se combinera avec la première. Le niveau baissera, quelque rapide que soit l'accroissement du volume d'eau qui alimente le bassin, si sa capacité s'agrandit plus rapidement encore; il haussera si le cercle du réservoir ne s'élargit qu'avec une grande lenteur, plus encore s'il demeure fixe, et plus surtout s'il se rétrécit.
C'est là l'image de la couche sociale dont nous cherchons les destinées et qui forme, il faut le dire, la grande masse de l'humanité. La rémunération, les objets propres à satisfaire les besoins, à entretenir la vie, c'est l'eau qui lui arrive par l'orifice élastique. La mobilité des bords du bassin, c'est le mouvement de la population. — Il est certain, nous l'avons démontré au mot CONCURRENCE, que les moyens d'existence lui parviennent dans une progression toujours croissante : mais il est certain aussi que son cadre peut s'élargir suivant une progression supérieure. Donc, dans cette classe, la vie sera plus ou moins heureuse, plus ou moins digne, selon que la loi de limitation, dans sa partie morale, intelligente et préventive, y circonscrira plus ou moins le principe absolu de la multiplication. —Il y a un terme à l'accroissement du nombre des hommes de la classe laborieuse , c'est celui où le fonds progressif de la rémunération est insuffisant pour les faire vivre. Il n'y en a pas à leur amélioration possible, parce que, des deux éléments qui la constituent, l'un, la richesse, grossit sans cesse, l'autre, la population , tombe dans la sphère de leur volonté.
Tout ce que nous venons de dire de la dernière couche sociale, celle où s'exécute le travail le plus brut, s'applique aussi à chacune des autres couches superposées et et classées entre elles en raison inverse, pour ainsi dire, de leur grossièreté, de leur matérialité spécifique. A ne considérer chaque classe qu'en elle-même, toutes sont soumises aux mêmes lois générales. Dans toutes, il y a lutte entre la puissance physiologique de multiplication et la puissance morale de limitation. La seule chose qui diffère d'une classe à l'autre, c'est le point de rencontre de ces deux forces, la hauteur où la rémunération porte et où les habitudes fixent cette limite entre les deux lois, qu'on nomme moyens d'existence.
Mais, si nous considérons les diverses couches, non plus en elles-mêmes, mais dans leurs rapports réciproques, je crois que l’on peut discerner l'influence de deux principes agissant en sens inverse, et c'est là qu'est certainement l'explication de la condition réelle de l'humanité. — Nous avons établi comment tous les phénomènes économiques, et spécialement la loi de la concurrence, tendaient à l'égalité des conditions; cela ne nous parait pas théoriquement contestable. Puisque aucun avantage naturel, aucun procédé ingénieux, aucun des instruments par lesquels ces procédés sont mis eu œuvre, ne peuvent s'arrêter définitivement aux producteurs en tant que tels: puisque les résultats , par une dispensation irrésistible de la Providence, tendent à devenir le patrimoine commun, gratuit et, par conséquent, égal de tous les hommes, il est clair que la classe la plus pauvre est celle qui tire le plus de profit relatif de cette admirable disposition des lois de l'économie sociale. Comme le pauvre est aussi libéralement traité que le riche à l'égard de l'air respirable, de même il devient l'égal du riche pour toute cette partie du prix des choses que le progrès anéantit sans cesse. Il y a donc au fond de la race humaine une tendance prodigieuse vers l’égalité. Je ne parle pas ici d'une tendance d'aspiration, mais de réalisation.— Cependant l'égalité ne se réalise pas, ou elle se réalise si lentement, qu'à peine, en comparant deux siècles éloignés, s'aperçoit-on de ses progrès; ils sont même si peu sensibles, que beaucoup de bons esprits les nient, quoique certainement à tort.
Quelle est la cause qui retarde celte fusion des classes dans un niveau commun et toujours progressif?
Je ne pense pas qu'il faille la chercher ailleurs que dans les divers degrés de cette prévoyance qui anime chaque couche sociale à l'égard de là population.—La loi de la limitation, avons-nous dit, est à la disposition des hommes en ce qu'elle a de moral et de préventif. L'homme, avons-nous dit encore, est perfectible, et, à mesure qu'il se perfectionne, il fait un usage plus intelligent de cette loi. Il est donc naturel que les classes, à mesure qu'elles sont plus éclairées, sachent se livrer à des efforts plus efficaces, s'imposer des sacrifices mieux entendus pour maintenir leur population respective au niveau des moyens d'existence qui lui sont propres.
Si la statistique était assez avancée, elle convertirait probablement en certitude cette induction théorique en montrant que les mariages sont moins précoces dans les hautes que dans les basses régions de la société. — Or, s'il en est ainsi, il est aisé de comprendre que, dans le grand marché où toutes les classes portent leurs services respectifs, où s'échangent les travaux de diverses natures , le travail brut s'offre en plus grande abondance relative que le travail intelligent, ce qui explique la persistance de cette inégalité des conditions que tant et de si puissantes causes d'un autre ordre tendent incessamment à effacer.
Fr. Bastiat.
Text: JDE version↩
La loi qui gouverne les hommes relativement à leur nombre a été formulée en ces termes :
La population tend à se mettre au niveau des moyens de subsistance.
Il est difficile d'expliquer pourquoi on a attribué à Malthus l'honneur ou la responsabilité de cette formule; je ne crois pas qu'un seul auteur, antérieurement à l'économiste anglais, se soit occupé de cette matière sans exprimer la même pensée en d'autres termes et souvent en termes identiques. -—- .l.-B. Say, se fondant, avec raison, sur ce que l'aliment ne suffit pas pour qu'une famille puisse exister,- sur ce que l'homme, suivant le pays qu'il habite, le rang qu’il occupe, les habitudes qu’il a contractées, a des besoins variés dont la satisfaction importe au maintien de la vie, a substitué les mots moyens d’existence aux mots moyens de subsistance. —La plupart des économistes ont adopté l'expression de J.—B. Say. ——Mais ces formules, il faut le dire, et J.—B. Say en convient, ont besoin de tant d'explications et de commentaires; prises dans un sens rigoureux et absolu, elles sont si contraires aux faits, que leur utilité scientifique est au moins fort contestable. —— La production des Subsistances, selon Malthus, la production en général, suivantJ.—B. Say, le revenu, d'après Sismondi, telle est la mesure de la population. Mais, s'il en est ainsi, on ne voit pas que les hommes puissent jamais faire de progrès, si ce n'est quant à leur nombre. A mesure que s'accroît la production ou le revenu au sein d'un peuple ou d'une classe, si le nombre des hommes qui composent cette classe ou ce peuple s'accroît exactement dans la même proportion , alors la condition des êtres humains est immuable. Dix fois plus de productions au dix-neuvième qu’on cinquième siècle, dix fois plus de revenus dans une nation industrieuse que chez un peuple sauvage, cela implique une population décuple en faveur du siècle et du pays civilisé, mais cela exclut tonte idée de progrès, d'amélioration individuelle. — Ce [n'est pas là très-certainement ce qu'ont entendu dire lcs économistes, et cependant c'est la conséquence rigoureuse de leurs formules : elles sont donc tout au moins incomplètes. — Ce qui importe, c'est d'exposer les lois de la population; si, ensuite, il est possible de les résumer en un court aphorisme, ce sera, certes, une circonstance heureuse pour l'avancement et la diffusion de la science. Mais si, a raison du nombre et de la mobilité des données du problème, nous trouvons que ces lois répugnent à se laisser renfermer dans une formule pourvue de cette rigueur exacte que la science a droit d'exiger, nous saurons y renoncer et accepter les inconvénients d'une prolixité inévitable , de préférence à ceux d'une trompeuse concision.
La première donnée à déterminer, c'est la puissance physiologique de multiplication dans la race humaine : il est clair que c'est là la limite supérieure que, dans aucun cas, le progrès réel de la population ne peut dépasser. — Ici nous voudrions bien être compris et ne pas encourir les accusations qui ont été. si mal à propos, selon nous, dirigées contre Malthus. — On lui a attribué ce raisonnement : «La population s'accroît en progression géométrique; la subsistance, en progression arithmétique; donc la misère, la maladie et la mort doivent intervenir pour rétablir l'équilibre.» — Malthus n'a jamais posé cette inepte prémisse: «les hommes multiplient en progression géométrique. » Il a recherché quelle est, physiologiquement, dans la race humaine, la puissance organique de multiplication; en combien de temps une population donnée pourrait doubler, dans la supposition que a satisfaction de tous les besoins ne rencontrait jamais aucun obstacle; et il a fixé cette période à vingt-cinq ans : il l'a fixée ainsi, parce que l'observation directe la lui a révélée chez le peuple qui se rapproche le plus (quoique infiniment loin) de ‘son hypothèse, chez le peuple américain. — Une fois cette période trouvée, et, comme il s'agit toujours de la puissance virtuelle de propagation, il a dit que la population tendait à augmenter dans une progression géométrique. Assurément c'est là un véritable truisme, car, dans la supposition de l'auteur, celle où la satisfaction des besoins serait complètement assurée d'avance, il n'y aurait aucune raison de dire que 2 mille, 100 mille, 1 million de couples ne multiplieront pas proportionnellement autant que mille. — En fait, cela n'arrive pas : pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas dans l'hypothèse e Malthus; parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits aussitôt qu'ils se manifestent; parce qu'il faut créer des subsistances pour que des générations virtuelles subsistent, ou, si l'on veut, des moyens d'existence pour qu'elles puissent exister; or, les subsistances ne peuvent pas doubler partout tous les vingt-cinq ans. Voilà pourquoi, en fait, la population ne double pas tous les vingt-cinq ans. — Mais qu'est-ce qui fait obstacle à cette puissance organique, à cette force virtuelle, à ce principe abstrait de multiplication?Qu'est-ce qui fait que la population, en tous pays, au lieu de suivre la progression possible de cette puissance, ne suit tout au plus que la progression des produits? Evidemment c'est que, dans la réalité, il naît moins d'hommes et il en meurt plus que dans l'hypothèse; c'est que les hommes, prévoyant que leurs besoins ne seront pas immédiatement et indéfiniment satisfaits, s'abstiennent, ou, ne le prévoyant pas, succombent. Or, les naissances et les ‘décès étant les seuls éléments qui puissent altérer le nombre des hommes, il n'est pas douteux que la division de Malthus en obstacles préventifs et obstacles répressifs ne soit complète.
Telle est la doctrine de Malthus. Je ferai observer ici que cet économiste a eu tort d'adopter comme limite de la fécondité humaine cette période de vingt-cinq ans, constatée aux Etats-Unis; il a cru par lä éviter tout reproche d'exagération et d'abstraction. Comment osera-t-on prétendre, s'est-il dit, que je donne trop de latitude au possible si je me fonde sur le réel? ll n'a pas pris garde qu'en mêlant ainsi le virtuel et le réel, en donnant pour mesure à la loi de multiplication, abstraction faite de la loi de limitation, une période relevée des faits où ces deux lois coagissent, il s'exposait à n'être pas compris, et c'est ce qui est arrivé : on s'est moqué de ses progressions géométriques et arithmétiques ; on lui a reproché de prendre les Etats-Unis pour type du reste du monde; en un mot, on s'est servi de la confusion qu'il a faite de d'eux lois distinctes pour lui contester l'une par l'autre. — Qu'il soit donc bien entendu que, lorsque nous cherchons quelle est, pour l'espèce humaine, la puissance de propagation, nous mettons pour un moment en oubli tout obstacle, physique ou moral, provenant du défaut d'espace et d'aliments; il faut bien commencer par reconnaître où est cette limite supérieure de la propagation que l'organisation humaine rend abstraitement possible. La première question que nous posons est donc celle-ci : l'âge de la puberté et la durée de la fécondité étant donnés, dans quelle progression la vie pourrait-elle se propager, s'il n’était pas nécessaire de l’entretenir? Dans l'espèce humaine, comme dans tous les êtres organisés, cette puissance est telle, qu'il est véritablement superflu de la déterminer avec exactitude; il suffit de constater qu'elle surpasse dans une proportion énorme tous les phénomènes de rapide multiplication que l'on a observés dans le passé ou qui pourront se montrer dans l'avenir. — Pour le froment, en admettant cinq tiges par semence, et vingt grains par tige, un grain a la puissance virtuelle d'en produire dix milliards en cinq années. — Pour l'espèce canine, en raisonnant sur ces deux bases : quatre produits par portée, et six ans de fécondité, on trouvera qu'un couple peut donner naissance, en douze ans, à huit millions d'individus. — Dans l'espèce humaine, en fixant la puberté à seize ans, et la durée de la fécondité à trente ans, chaque couple pourrait donner naissance à huit : c'est beaucoup que de réduire ce nombre de moitié à raison de la mortalité prématurée, puisque nous raisonnons dans l'hypothèse que les besoins de toute nature sont satisfaits à mesure qu’ils se manifestent, ce qui restreint beaucoup l'empire de la mort. Toutefois ces prémisses nous donnent, par période de dix-sept ans, la progression :
2—4—8——16—32—64—128—256—512, etc.
Enfin plus de cinquante millions en deux siècles.
Veut-on fixer la puberté à vingt ans, et réduire à six le nombre d'enfants que chaque couple peut élever? On aura, par période de vingt et un ans, la progression :
2—6—18—54—162—486-1,558, etc.
Si l'on calcule selon les bases adoptées par Euler, la période de doublement sera de douze ans et demi : huit périodes feront justement un siècle, et l’accroissement dans cet espace de temps sera comme 512 :2.
Il est inutile de pousser plus loin ces recherches; il suffit de reconnaître que dans notre espèce, comme dans toutes, la puissance organique de multiplication est supérieure à la multiplication réelle; d'ailleurs il implique contradiction que le réel dépasse le virtuel; c'est tout ce que nous voulions établir.
A aucune époque, dans aucun pays, on n'a vu le nombre des hommes s'accroître avec cette effrayante rapidité. Selon la Genèse, les Hébreux entrèrent en Egypte au nombre de soixante-dix couples; on voit dans le livre des Nombres que le dénombrement l'ait par Moïse, deux siècles après, constate la présence de six cent mille hommes au-dessus de vingt-un ans, ce qui suppose une population de deux millions au moins; on en peut déduire le doublement par période de quatorze ans. — Les tables du Bureau des longitudes ne sont guère recevables à contrôler des faits bibliques. Dira-t-on que six cent mille combattants supposent une population supérieure à deux millions, et en conclura-t-on une période de doublement moindre que celle calculée par Euler? — On sera le maître soit de révoquer en doute le dénombrement de Moïse, ou les calculs d'Euler, mais on ne prétendra pas sans doute que les Hébreux ont multiplié plus qu’il n'est possible dc multiplier; c'est tout ce que je demande. [46]
Après cet exemple, qui est vraisemblablement. celui où la fécondité de fait s'est le plus rapprochée de la fécondité virtuelle. nous avons celui des Etats-Unis. On sait que dans ce pays le doublement de la population s'accomplit, depuis trois siècles, en vingt-cinq ans. D'après les recherches de M. Moreau de Jonnès, le même phénomène, en prenant pour base le mouvement de la population, tel qu'il s'effectue de nos jours. exigerait 1L3 ans en Russie et en Angleterre, 76 en Allemagne, 100 en Hollande, 106 en Espagne, 135 en Italie, 138 en France, 227 en Suisse, 238 en Portugal, et 555 en Turquie. —Il y a donc une force qui limite, comprime, suspend dans une certaine mesure l'action de la puissance physiologique que nous avons constatée, et cette force est sans doute complexe, puisqu'elle oppose des bornes si différentes, selon les temps et les lieux , à une puissance qu'on peut considérer comme uniforme. Les éléments de cette force, les faits généraux qui empêchent toutes les espèces organisées d'atteindre, dans leur propagation, la loi de doublement qui est virtuellement en elles, s'il est possible de les connaître et de les formuler, sont aussi une loi. Je l'appelle loi de limitation, et il est clair que le mouvement de la population dans chaque pays, dans chaque classe, est le résultat de l'action combinée dc ces deux lois. — Mais en quoi consiste la loi de limitation? Je crois que l'on peut dire d'un manière très-générale que la propagation de la vie est contenue ou prévenue par la difficulté d'entretenir la vie. ll importe d'approfondir cette pensée; à vrai dire, elle constitue la partie essentielle de notre sujet.
Les êtres organisés qui ont vie et qui n'ont pas de sentiment sont rigoureusement passifs dans cette lutte entre les deux principes. Pour les végétaux, il est exactement vrai que leur nombre, dans chaque espèce. est limité par les moyens de subsistance. La profusion des germes est infinie, mais les ressources d'espace et de fertilité territoriale ne le sont pas. Les germes se nuisent, se détruisent entre eux; ils avortent, et, en définitive, il n'en réussit qu'autant que le sol en peut nourrir. — Les animaux sont doués de sentiment, mais ils paraissent privés de prévoyance; ils propagent, ils pullulent, ils foisonnent, sans se préoccuper du sort de leur postérité. La mort, une mort prématurée, peut seule borner leur multiplication et maintenir l'équilibre entre leur nombre et leurs moyens d'existence. —Lorsque M. de Lamennais, s'adressant au peuple, dans son inimitable langage. dit :
« lI y a place pour tous sur la terre, et Dieu l'a rendue assez féconde pour fournir abondamment aux besoins de tous. » — Et plus loin : — « L'auteur de l'univers n'a pas fait l'homme de pire condition que les animaux; tous ne sont-ils pas conviés au riche banquet de la nature ? un seul d'entre eux en est-il exclu?» —Et encore : — «Les plantes des champs étendent l'une près de l'autre leurs racines dans le sol qui les nourrit toutes, et toutes y croissent en paix; aucune d'elles n'absorbe la sève d'une autre.»
Il est permis de ne voir là que des déclamations fallacieuses, servant de prémisses à de dangereuses conclusions, et de regretter qu'une éloquence si admirable soit consacrée à populariser la plus funeste des erreurs. — Certes, il n'est pas vrai qu'aucune plante ne dérobe la sève d'une autre, et que toutes étendent leurs racines, sans se nuire, dans le sol. Des milliards de germes végétaux tombent chaque année sur la terre, y puisent un commencement de vie et succombent étouffés par des plantes plus fortes et plus vivaces. — ll n'est pas vrai que tous les animaux qui naissent soient conviés au banquet de la nature et qu'aucun d'eux n'en soit exclu. Parmi les espèces sauvages, ils se détruisent les uns les autres, et dans les espèces domestiques l'homme en retranche un nombre incalculable. — Rien même n'est plus propre à montrer l'existence et les relations de ces deux principes : celui de la multiplication et celui de la limitation. Pourquoi y a-t-il en France tant de bœufs et de moutons malgré le carnage qu'il s'en fait? Pourquoi y a-t-il si peu d'ours et de loups quoiqu'on en tue bien moins et qu'ils soient organisés pour multiplier bien davantage? C'est que l'homme prépare aux uns et soustrait aux autres la subsistance; il dispose à leur égard de la loi de limitation de manière à laisser plus ou moins de latitude à la ‘loi de fécondité. —- Ainsi, pour les végétaux comme pour les animaux, la force limitative ne paraît se montrer que sous une forme, la destruction. —Mais l'homme est doué "de raison, de prévoyance, et ce nouvel «Élément modifie. change même à son égard e mode d'action de cette force. i
Sans doute, en tant qu'être pourvu d'organes matériels, et, pour trancher le mot, en tant qu'animal, la loi de limitation par voie de destruction lui est applicable. Il n'est pas possible que le nombre des hommes dépasse les moyens d'existence : cela voudrait dire qu’il existe plus d'hommes qu'il n'en peut exister, ce qui implique contradiction. Si donc la raison, la prévoyance sont assoupies en lui, il se fait végétal, il se fait brute; alors il est fatal qu'il multiplie, en vertu de la grande loi physiologique qui domine toutes les espèces; et il est fatal aussi qu'il soit détruit. en vertu de la loi limitative à l'action de laquelle il demeure, en ce cas, étranger. —-Mais, s'il est prévoyant, cette seconde loi entre dans la sphère de sa volonté : il la modifie, il la dirige; elle n'est vraiment plus la même; ce n'est plus une force aveugle, c'est une force intelligente ; ce n'est plus seulement une loi naturelle, c'est de plus une loi sociale. — L'homme est le point où se rencontrent, se combinent et se confondent ces deux principes, la matière et l'intelligence; il n'appartient exclusivement ni à l'un ni à l'autre. Donc la loi de limitation se manifeste, pour l'espèce humaine, sous deux influences, et maintient l'a population à un niveau nécessaire, par la double action de la prévoyance et de la destruction. — Ces deux actions n'ont pas une intensité "uniforme ; au contraire, l'une s'étend à mesure que l’autre se restreint. Il y a un résultat qui doit être atteint, la limitation : il l'est plus ou moins par répression ou par prévention. selon que l'homme s'abrutit ou se spiritualise, selon qu'il est "plus matière ou plus intelligence, selon qu'il participe davantage de la vie végétative ou de la vie morale; la loi est plus ou moins hors de lui ou en lui, mais il faut toujours qu'elle soit quelque part.
On ne se fait pas une idée exacte du vaste domaine de la prévoyance, que le traducteur de Malthus a beaucoup circonscrit e_n mettant en circulation cette vague et insuffisante expression contrainte morale, dont il a encore amoindri la portée par la définition qu'il en donne : «C'est la vertu, dit-il, qui consiste à ne point se marier quand on n'a pas de quoi faire subsister une famille, et toutefois à vivre dans la chasteté.» Les obstacles que l’intelligente société humaine oppose à la multiplication possible des hommes prennent bien d'autres formes que celle de la contrainte morale ainsi définie. Qu'est-ce que cette sainte ignorance du premier âge, la seule ignorance sans doute qu'il soit criminel de dissiper, que chacun respecte et sur laquelle la mère craintive veille comme sur un trésor? Qu’est-ce que la pudeur qui succède à l'ignorance, arme mystérieuse de la jeune fille, qui enchante et intimide l'amant, et prolonge en l'embellissant la saison des innocentes amours? N 'est-ce point une chose merveilleuse, et qui serait absurde en toute autre matière, que ce voile ainsi jeté d'abord entre l'ignorance et la vérité, et ces magiques obstacles placés ensuite entre la vérité et le bonheur? Qu'est-ce que cette puissance de l'opinion qui impose des lois si sévères aux relations des personnes de sexe différent, flétrit la plus légère transgression de ces lois, et poursuit la faiblesse, et sur celle qui succombe, et, de génération en génération, sur ceux qui en sont les tristes fruits? Qu'est-ce que cet honneur si délicat, cette rigide réserve, si généralement admirée, même de ceux qui s'en affranchissent, ces institutions, ces difficultés de convenances, ces précautions de toutes sortes, si ce n'est l'action de la loi de limitation manifestée dans l'ordre intelligent, moral, préventif, et par conséquent, exclusivement humain?— Que ces barrières soient renversées, que l'espèce humaine, en ce qui concerne l'union des sexes, ne se préoccupe ni de convenances, ni de fortune, ni d'avenir, ni d'opinion, ni de mœurs. qu'elle se ravale à la condition des espèces végétales et animales, (peut-on douter que, pour celles-là comme pour celles-ci, la puissance e multiplication n'agisse avec assez de force pour nécessiter bientôt l'intervention de‘ la loi de limitation, manifestée cette fois dans l'ordre physique, brutal, répressif, dest-à-dire par le ministère de l’indigence, de la maladie et de la mort? — Est-il possible de nier que, abstraction faite de toute prévoyance et de toute moralité, il n'y ait assez d'attrait dans le rapprochement des sexes pour le déterminer, dans notre espèce comme dans tentes, dès la première apparition de la puberté? on la fixe à seize ans, et si les actes de l'état civil prouvent qu'on ne se marie pas, dans un pays donné, avant vingt-quatre ans, ce sont donc huit années sang‘. traites par in partie morale et préventive de la loi de limitation, à l'action de la loi de multiplication; et, si l'on ajoute à ce chiffre ce qu'il faut attribuer au célibat absolu, (in restera convaincu que l'humanité intelligente n'a pas été traitée par le Créateur comme l’animalité brutale, et qu'il est en sa puissance de transformer la limitation répressive en limitation préventive. — ll est assez singulier que l'école spiritualiste et l'école matérialiste aient, pour ainsi dire, changé de rôle dans cette grande question : la première, tonnant contre la prévoyance, s'efforce de faire prédominer le principe brutal; la seconde, exaltant la partie morale de l'homme, recommande l'empire de la raison sur les passions et les appétits. [47]
C'est qu'il y a en tout ceci un véritable malentendu. Qu'un père de famille consulte, pour la direction de sa maison, le prêtre le plus orthodoxe; assurément il en recevra, pour le cas particulier, des conseils entièrement conformes aux idées que la science érige en principes, et que ce même prêtre repousse comme tels. «Cachez votre fille, dira le vieux prêtre; dérobez-la le plus que vous pourrez aux séductions du monde; cultivez, comme une fleur précieuse, la sainte ignorance, la céleste pudeur qui font à la fois son charme et sa défense. Attendez qu'un parti honnête et sortable se présente; travaillez cependant, mettez-vous à même de lui assurer un sort convenable. Songez que le mariage, dans la pauvreté, entraîne beaucoup de souffrances et encore plus de dangers. Rappelez-vous ces vieux proverbes qui sont la sagesse des nations et qui nous avertissent que l'aisance est la plus sûre garantie de l'union et de la paix. Pourquoi vous presseriez-vous‘? Voulez-vous qu'à vingt-cinq ans votre fille soit chargée d'une nombreuse famille, qu'elle ne puisse l'élever et l'instruire selon votre rang et votre condition? Voulez—vous que le mari, incapable de surmonter l’insuffisance de son salaire. tombe d'abord dans l'affliction, puis dans le désespoir, et peut-être enfin dans le désordre? Le projet qui vous occupe est le plus grave de tous ceux auxquels vous puissiez donner votre attention. Pesez-le, mûrissez-le; gardez-vous de toute précipitation, etc. » —-« Supposez que le père, empruntant le langage de M. de Lamennais, répondît : «Dieu adressa dans l'origine ce commandement à tous les hommes: Croissez et multipliez , et remplissez la terre et subjuguez-la. Et vous, vous dites à une fille : Renonce à la famille, aux chastes douceurs du mariage, aux saintes joies de la maternité; abstiens-toi, vis seule; que pourrais-tu multiplier‘? que tes misères. » — Croit-on que le vieux prêtre n'aurait rien à opposer à ce raisonnement?
Dieu, dirait-il, n'a pas ordonné aux hommes de croître sans discernement et sans mesure, de s'unir comme les bêtes, sans nulle prévoyance de l'avenir; il n'a pas donné la raison à sa créature de prédilection pour lui en interdire l'usage dans les circonstance les plus solennelles : il a bien ordonné à l'homme de croître, mais pour croître il faut vivre, et pour vivre il faut en avoir les moyens; donc dans l'ordre de croître est impliqué celui de préparer aux jeunes générations des moyens d'existence. —— La religion n'a pas mis la virginité au rang des crimes; bien loin de là, elle en a fait une vertu, elle l'a honorée, sanctifiée et glorifiée; il ne faut donc point croire qu'on viole le commandement de Dieu parce qu'on se prépare à le remplir avec prudence, en vue du bien, du bonheur et de la dignité de la famille. -— Eh bien, ce raisonnement, et d'autres semblables, dictés par l'expérience, que l'on entend répéter journellement dans le monde, et qui règlent la conduite de toute famille morale et éclairée, que sont-ils autre chose que l'application, dans des cas particuliers, d'une doctrine générale? ou plutôt, qu'est-ce que cette doctrine, si ce n'est la généralisation d'un raisonnement qui revient dans tous les cas particuliers? Le spiritualiste qui repousse, en principe, l'intervention de la limitation préventive ressemble au physicien qui dirait aux hommes : a Agissez en toute rencontre comme si la pesanteur existait, mais n'admettez pas la pesanteur en théorie. » [48]
Nous venons de voir que par cela seul que l'homme est une créature raisonnable et morale, douée de la faculté de juger de l'avenir par le passé, et de modifier son propre sort, la loi de limitation, qui n'a qu'un élément pour les autres êtres organisés, l'obstacle répressif, en a un second pour lui , l'obstacle préventif, celui-ci destiné à réduire, à neutraliser, à absorber le premier.—. Jusqu'ici nous ne nous sommes pas éloignés de la théorie malthusienne; mais il est un attribut de l'humanité dont il me semble que la plupart des auteurs n'ont pas tenu un compte proportionné à son importance, qui joue un rôle immense dans les phénomènes relatifs à la population, qui résoud plusieurs des problèmes que cette grande question a soulevés. et fait renaître dans l'âme du philanthrope une sérénité et une confiance que la science incomplète semblaient en avoir bannies; cet attribut, compris, du reste. sous les notions de raison et prévoyance, c'est la perfectibilité. —L'homme est perfectible ; il est susceptible d'amélioration et de détérioration : si, à la rigueur, il peut demeurer stationnaire, il peut aussi monter et descendre les degrés infinis de la civilisation. Cela est vrai des individus, des familles, des nations et des races.
La population, dit-on, tend à se mettre au niveau des moyens d'existence; mais ces moyens sont-ils une chose fixe, absolue, uniforme? Non certainement : à mesure que l'homme se civilise, le cercle de ses besoins s'étend : on peut le dire même de la simple subsistance. Mais, considérés au point de vue de l'être perfectible, les moyens d'existence, en quoi il faut comprendre la satisfaction des besoins physiques, intellectuels et moraux, admettent autant de degrés qu'il y en a dans la civilisation elle-même, c'est-à-dire dans l'infini. Sans doute, il y a une limite inférieure : apaiser sa faim, se garantir d'un certain degré de froid, c'est une condition de la vie; et cette limite, nous pouvons l'apercevoir dans l'état des sauvages d'Amérique et des pauvres d'Europe; mais une limite supérieure. je n'en connais pas, il n'y en a pas. Les besoins naturels satisfaits, il en naît d'autres, qui sont factices d'abord, si l'on veut, mais que l'habitude rend naturels à leur tour, et, après ceux-ci, d'autres encore, et encore sans terme assignable. — Donc, à chaque pas de l'homme dans la voie de la civilisation, ses besoins embrassent un cercle plus étendu, et les moyens d'existence, ce point où se rencontrent les deux grandes lois de multiplication et de limitation, se déplace pour s’exhausser. — Car, quoique l'homme soit susceptible de détérioration aussi bien que de perfectionnement, il répugne à l'une et aspire à l'autre : ses efforts tendent à le maintenir au rang qu'il a conquis. à l'élever encore; et l'habitude, qu'on a si bien nommée une seconde nature, faisant les fonctions des valvules de notre système artériel, fait obstacle à tout pas rétrograde. Il est donc tout simple que l'action intelligente et morale qu'il exerce sur sa propre multiplication se ressente, s'impreigne, s'inspire de ces efforts et se combine avec ces habitudes progressives.
Les conséquences qui résultent de cette organisation de l'homme se présentent en foule : nous nous bornerons à en indiquer quelques-unes. —D'abord nous admettrons bien avec les économistes que la population et les moyens d'existence se font équilibre; mais le dernier de ces termes étant d'une mobilité infinie, et variant avec la civilisation et les habitudes, nous ne pourrions pas admettre qu’en comparant les peuples et les classes, la population soit proportionnelle à la production, comme dit .l.-B. Say [49], ou aux revenus, comme l'affirme de Sismondi. — Ensuite, chaque degré supérieur de culture impliquant plus de prévoyance, l'obstacle moral et préventif doit neutraliser de plus en plus l'action de l'obstacle brutal et répressif, à chaque phase de perfectionnement réalisé dans la société ou dans quelques—unes de ses fractions. —ll suit de là que tout progrès social contient le germe d'un progrès nouveau, vires acquirit eundo, puisque le mieux-être et la prévoyance s’engendrent l'un l'autre dans une succession indéfinie. — De même, quand, par quelque cause, l'humanité suit un mouvement rétrograde, le malaise e, l'imprévoyance sont entre eux cause et effet réciproques, et la déchéance n'aurait pas de terme si la société n'était pas pourvue de cette force curative, vis medicatrix, que la Providence a placée dans tous les corps organisés. Remarquons, en effet, qu'à chaque période dans la déchéance, l'action de la limitation dans son mode destructif devient à la fois plus douloureuse et plus facile à discerner. D'abord; il ne s'agit que de détérioration, d'abaissement; ensuite c'est la misère, la famine, le désordre, la guerre, la mort, tristes mais infaillibles moyens d'enseignement. [50]
Nous voudrions pouvoir nous arrêter à montrer combien ici la théorie explique les faits, combien, à leur tour, les faits justifient la théorie. Lorsque, pour un peuple ou une classe, les moyens d'existence sont descendus à cette limite inférieure où ils se confondent avec les moyens de pure subsistance, comme en Chine, en Irlande et dans les dernières classes de tous pays, les moindres oscillations de population on de ressources alimentaires se traduisent en mortalité : les faits confirment à cet égard l'induction scientifique. — Depuis longtemps la famine ne visite plus l'Europe, et l'on attribue la destruction de ce fléau à une multitude de causes : il y en a plusieurs sans doute, mais la plus générale c’est que les moyens d'existence se sont, par suite du progrès social, exhaussés fort au-dessus des moyens de subsistance. Quand viennent des années disetteuses, on peut sacrifier beaucoup de satisfactions avant d'entreprendre sur les aliments eux-mêmes. — Il n'en est pas ainsi en Chine et en Irlande : quand les hommes n’ont rien au monde qu'un peu de riz ou de pommes de terre, avec quoi achèteront-ils d'autres aliments si ce riz et ces pommes de terre viennent manquer? —- Enfin il est une troisième conséquence de la perfectibilité humaine, que nous devons signaler ici, parce qu'elle contredit, en ce qu'elle a de désolant, la doctrine de Malthus. — Nous avons attribué à cet économiste cette formule : — a La population tend à se mettre au niveau des moyens de subsistance. » — Nous aurions dû dire ‘qu'il était allé fort au delà, et que sa véritable formule, celle dont il a tiré des conclusions si affligeantes, est celle-ci : — La population tend à dépasser les moyens de subsistance. —Si Malthus avait simplement voulu exprimer par là que, dans la race humaine, la puissance de propager la vie est supérieure à la puissance de l'entretenir, il n'y aurait pas de contestation possible. Mais ce n'est pas là sa pensée; il affirme que, prenant en considération la fécondité absolue d'une part, de l'autre la limitation manifestée par ses deux modes répressif et préventif, le résultat n'en est pas moins la tendance de la population à dépasser les moyens de vivre. —- Cela est vrai de toutes les espèces animées, excepté de l'espèce humaine. L'homme est intelligent et peut faire de la limitation préventive un usage illimité. _ll est perfectible, il aspire au perfectionnement. il répugne à la détérioration; le progrès est son état normal; le progrès implique un usage de plus en plus éclairé de la limitation préventive : donc les moyens d’existence s'accroissent plus vite que la population. Non-seulement ce résultat dérive du principe de la perfectibilité, mais encore il est confirmé par le fait, puisque partout le cercle des satisfactions s'est étendu. — S'il était vrai, comme le dit Malthus, qu'à chaque excédant de moyens d'existence corresponde un excédant supérieur de population, la misère de notre race serait fatalement progressive, la civilisation serait à l'origine, et la barbarie à la des temps. Le contraire a lieu; donc la loi de limitation a eu assez de puissance pour contenir le flot de la multiplication des hommes au-dessous de la multiplication des produits.
On voit parce qui précède combien est vaste et difficile la question de la population. Il est à regretter sans doute que l'on n'en ait pas donné la formule exacte , et naturellement je regrette encore plus de ne pouvoir la donner moi-même. Mais ne voit-on pas combien le sujet répugne aux étroites limites d'un axiome dogmatique? Et n'est-ce point une vaine tentative que de vouloir exprimer par une équation inflexible les rapports de données essentiellement variables?— Rappelons ces données.
1° Loi de multiplication. Puissance absolue, virtuelle, physiologique, qui est en la race humaine de propager la vie, abstraction faite de la difficulté de l'entretenir. —Cette première donnée, la seule susceptible de quelque précision, est la seule où la précision soit superflue ; car, qu'importe où est cette limite supérieure de multiplication, dans l'hypothèse, si elle ne peut jamais être atteinte dans la condition réelle de l'homme, qui est d'entretenir la vie à la sueur de son front?
2° Il y a donc une limite à la loi de multiplication. Quelle est cette limite? Les moyens d'existence , dit-on. Mais qu'est-ce que les moyens d'existence? C'est un ensemble de satisfactions insaisissable. Elles varient, et, par conséquent, déplacent la limite cherchée, selon les lieux, les temps, les races, les rangs, les mœurs, l'opinion et les habitudes.
3° Enfin, en quoi consiste la force qui restreint la population à cette borne mobile? Elle se décompose en deux pour l'homme : celle qui réprime , et celle qui prévient. Or. l'action de la première , inaccessible par elle-même à toute appréciation rigoureuse , est, de plus, entièrement subordonnée à l'action de la seconde, qui dépend du degré de civilisation, de la puissance des habitudes , de la tendance des institutions religieuses et politiques . de l'organisation de la propriété, du travail et de la famille, etc., etc. — Il n'est donc pas possible d'établir entre la loi de multiplication et la loi de limitation une équation dont on puisse déduire la population réelle. En algèbre , a et b représentent des quantités déterminées qui se nombrent, se mesurent, et dont on peut fixer les proportions; mais moyens d'existence, empire moral de la volonté, action fatale de la mortalité, ce sont là trois données du problème de la population, données flexibles en elles-mêmes, et qui, en outre, empruntent quelque chose à l'étonnante flexibilité du sujet qu'elles régissent, l'homme , cet être, selon Montaigne , si merveilleusement ondoyant et divers. Il n'est donc pas surprenant qu'en voulant donner à cette équation une précision qu'elle ne comporte pas, les économistes aient plus divisé que rapproché les esprits , parce qu'il n'est aucun des termes de leurs formules qui ne prête le flanc à une multitude d'objections de raisonnement et de fait.
Entrons maintenant dans le domaine de l'application : l'application , outre qu'elle sert à élucider la doctrine, est le vrai fruit de l'arbre de la science. —Ici , nous sommes obligé d'esquisser à grands traits la théorie que nous avons exposée au mot CONCURRENCE, sujet qui a , avec celui qui nous occupe , une étroite connexité.
Le travail, avons-nous dit , est l'objet unique de l'échange. Pour acquérir une utilité (à moins que la nature ne nous la donne gratuitement), il faut prendre la peine de la produire , ou restituer cette peine à celui qui l'a prise pour nous. L'homme ne crée absolument rien; il arrange , dispose , transporte pour une lin utile; il ne fait rien de tout cela sans peine, et le résultat de cette peine est sa propriété; s'il la cède , il a droit à restitution , sous forme d'un service jugé égal après libre débat. C'est là le principe de la valeur, de la rémunération, de l'échange, principe qui n'en est pas moins vrai pour être simple. — Dans ce qu'on appelle produits, il entre divers degrés d'utilité naturelle, et divers degrés d'utilité artificielle,- celle-ci , qui seule implique du travail. est seule la matière des transactions humaines, et. sans contester en aucune façon la célèbre et si féconde formule de .l.-B. Say: «Les produits s’échangent contre des produits» , je tiens pour plus rigoureusement scientifique celle-ci : Le travail s'échange contre du travail, ou, mieux encore, les services s'échangent contre des services.
Il ne faut pas entendre par là que les travaux s'échangent entre eux en raison de leur durée ou de leur intensité; que toujours celui qui cède une heure de peine a droit à une heure de peine, ou bien , que celui dont l'effort aurait poussé l'aiguille du dynamomètre à 100 degrés peut exiger qu'on fasse en sa faveur un effort semblable. La durée, l'intensité, sont deux éléments qui influent sur l'appréciation du travail, mais ils ne sont pas les seuls; il y a encore du travail plus ou moins répugnant, dangereux , difficile , intelligent, prévoyant, heureux même. Sous l'empire des transactions libres , là où la propriété est complètement assurée. chacun est maître de sa propre peine , et maître. par conséquent, de ne la céder qu'à son prix. ll y a une limite à sa condescendance, c'est le point où il a plus d'avantage à réserver son travail qu'à l'échanger; il y a aussi une limite à ses prétentions, c'est le point où l'autre partie contractante a intérêt à refuser le troc. Les travailleurs, et c'est leur droit, cherchent à tirer parti des circonstances qui peuvent augmenter la valeur de leur peine; l'un appelle à son aide un agent naturel, l'autre un procédé ingénieux , ou un instrument dont il a eu la prévoyance de se pourvoir. L'œuvre vraiment harmonique de la concurrence, force égalitaire contre laquelle on s'élève, de nos jours, avec tant de légèreté, c'est d'empêcher que nul n'ait le monopole de ces circonstances, et de ramener dans les limites de la justice toutes les prétentions exagérées.
Il y a dans la société autant de couches, si je puis m'exprimer ainsi. qu'il y a de degrés dans le taux de la rémunération.— Le moins rémunéré de tous les travaux est celui qui se rapproche le plus de l'action brute, automatique; c'est là une disposition providentielle , à la fois juste, utile et fatale. Le simple manœuvrier a bientôt atteint cette limite des prétentions dont je parlais tout à l'heure, car il n'est personne qui ne puisse exécuter le travail mécanique qu'il offre ; et il est lui-même acculé à la limite de sa condescendance, parce qu’il est incapable de prendre la peine intelligente qu'il demande. La durée, l'intensité, attributs de la matière , sont bien les seuls éléments de rémunération pour cette espèce de travail matériel; et voilà pourquoi il se paye généralement à la journée. — Tous les progrès de l'industrie se résument en ceci : remplacer dans chaque produit une certaine somme d'utilité artificielle et, par conséquent, onéreuse, par une même somme d'utilité naturelle et partant gratuite. Il suit de là que s'il y a une classe de la société intéressée plus que toute antre à la libre concurrence , c'est surtout la classe ouvrière. Quel serait son sort si les agents naturels, les procédés et les instruments de la production n'étaient pas constamment amenés , par la compétition , à conférer gratuitement, à tous, les résultats de leur coopération? Ce n'est pas le simple journalier qui sait tirer parti de la chaleur, de la gravitation , de l'élasticité, qui invente les procédés et possède les instruments par lesquels ces forces sont utilisées. A l'origine de ces découvertes, le travail des inventeurs, intelligent au plus haut degré , est très-rémunéré, en d'autres termes, il fait équilibre à une masse énorme de travail brut; en d'autres termes encore, son produit est cher. Mais la concurrence intervient, le produit baisse, le concours des services naturels ne profite plus au producteur, mais au consommateur, et le travail qui les utilisa se rapproche, quant à la rémunération , de celui ou elle se calcule par la durée. — Ainsi, le fonds commun des richesses gratuites s'accroît sans cesse; les produits de toute sorte tendent à revêtir et revêtent positivement, de jour eu jour, cette condition de gratuité sous laquelle nous sont offerts l'eau , l'air et la lumière : donc le niveau de l'humanité aspire à s'élever et à s'égaliser; donc, abstraction faite de la loi de la population, la dernière classe de la société est celle dont l'amélioration est virtuellement la plus rapide. —Mais nous avons dit, abstraction faite des lois de la population; ceci nous ramène à notre sujet.
Représentons-nous un bassin dans lequel un orifice , qui s'agrandit sans cesse, amène des eaux toujours plus abondantes. A ne tenir compte que de cette circonstance, le niveau devra constamment s'élever; mais, si les parois du bassin sont mobiles , susceptibles de s'éloigner et de se rapprocher, il est clair que la hauteur de l'eau dépendra de la manière dont cette nouvelle circonstance se combinera avec la première. Le niveau baissera , quelque rapide que soit l'accroissement du volume d'eau qui alimente le bassin , si sa capacité s'agrandit plus rapidement encore; il haussera si le cercle du réservoir ne s'élargit proportionnellement qu'avec une grande lenteur, plus encore s'il demeure fixe, et plus surtout s'il se rétrécit.
C'est là l'image de la couche sociale dont nous cherchons les destinées et qui forme , il faut le dire, la grande masse de l'humanité. La rémunération, les objets propres à satisfaire les besoins, ä entretenir la vie, c'est l'eau qui lui arrive par l'orifice élastique. La mobilité des bords du bassin, c'est le mouvement de la population. —Il est certain, nous l'avons démontré à l'article CONCURRENCE, [51] que les moyens d'existence lui parviennent dans une progression toujours croissante : mais il est certain aussi que son cadre peut s'élargir suivant une progression supérieure. Donc, dans cette classe, la vie sera: pas; ou moins heureuse, plus ou moins digne, selon que la loi de limitation, dans sa partie morale, intelligente et préventive, y circonscrira plus ou moins le principe absolu de la multiplication.—Il y a un terme à l'accroissement du nombre des hommes de la classe laborieuse : c'est celui où le fonds progressif de la rémunération est insuffisant pour les faire vivre. Il n'y en a pas à leur amélioration possible . parce que des deux éléments qui la constituent, l'un , la richesse, grossit sans cesse; l'autre, la population, tombe dans la sphère de leur volonté.
Tout ce que nous venons de dire de la dernière couche sociale, celle où s'exécute le travail le plus brut, s'applique aussi à chacune des autres couches superposées et classées entre elles en raison inverse, pour ainsi dire, de leur grossièreté, de leur matérialité spécifique. A ne considérer chaque classe qu'en elle-mémé , toutes sont soumises aux mêmes lois générales. Dans toutes, il y a lutte entre la puissance physiologique de multiplication et la puissance morale de limitation. La seule chose qui diffère d'une classe à l'autre , c'est le point de rencontre de ces deux forces , la hauteur où la rémunération porte, ou les habitudes fixent cette limite entre les deux lois qu'on nomme moyens d’ existence.
Mais, si nous considérons les diverses couches, non plus en elles-mêmes, mais dans leurs rapports réciproques, je crois que l'on peut discerner l'influence de deux principes, agissant en sens inverse, et c'est là qu'est ‘certainement l'explication de la condition réelle de l'humanité.—Nous avons établi comment tous les phénomènes économiques, et spécialement la loi de la concurrence , tendaient à l'égalité des conditions; cela ne nous paraît pas théoriquement contestable. Puisque aucun avantage naturel, aucun procédé ingénieux, aucun des instruments par lesquels ces procédés sont mis en œuvre , ne peuvent s'arrêter définitivement aux producteurs en tant que tels; puisque l'es résultats, par une dispensation irrésistible de la Providence, tendent à devenir le patrimoine commun, gratuit. et, par conséquent. égal de tous les hommes, il est clair que la classe la plus pauvre est celle qui tire le plus de profit relatif de cette admirable disposition des lois de l'économie sociale. Comme le pauvre est aussi libéralement traité que le "riche, à l'égard de l'air respirable , de même il devient l'égal du riche pour toute cette partie du prix des choses que le progrès anéantit sans cesse. Il y a donc au fond de la race humaine une tendance prodigieuse vers l'égalité. Je ne parle pas ici d'une tendance d'aspiration, mais de réalisation. —Cependant l'égalité ne se réalise pas, ou elle se réalise si lentement qu'à peine, en comparant deux siècles éloignés , s'aperçoit-on de ses progrès. Ils sont même si peu sensibles , que beaucoup de bons esprits les nient, quoique certainement à tort. —Quelle est la cause qui retarde cette fusion des classes dans un niveau commun et toujours progressif?
Je ne pense pas qu'il faille la chercher ailleurs que dans les divers degrés de cette prévoyance qui anime chaque couche sociale à l'égard de la population. —La loi de la limitation , avons-nous dit , est à la disposition des hommes en ce qu'elle a de moral et de préventif. L'homme, avons-nous dit encore, est perfectible, et à mesure qu'il se perfectionne, il fait un usage plus intelligent de cette loi. Il est donc naturel que les classes , à mesure qu'elles sont plus éclairées , sachent se soumettre à des efforts plus efficaces, s'imposer des sacrifices mieux entendus pour maintenir leur population respective au niveau des moyens d'existence qui lui sont propres.
Si la statistique était assez avancée, elle convertirait probablement en certitude cette induction théorique en montrant que les mariages sont moins précoces dans les hautes que dans les basses régions de la société. — Or, s'il en est ainsi, il est aisé de comprendre que dans le grand marché où toutes les classes portent leurs services respectifs , où s'échangent les travaux de diverses natures, le travail brut s'offre en plus grande abondance relative que le travail intelligent, ce qui explique la persistance de cette inégalité des conditions que tant et de si puissantes causes d'un autre ordre tendent incessamment à effacer. [52]
La théorie que nous venons d'exposer succinctement conduit à ce résultat pratique, que les meilleures formes de la philanthropie, les meilleures institutions sociales sont celles qui, agissant dans le sens du plan providentiel, tel que les harmonies sociales nous le révèlent, à savoir, l'égalité dans le progrès, font descendre dans toutes les couches de l'humanité, et spécialement dans la dernière , la connaissance , la raison, la moralité, la prévoyance.
Nous disons les institutions, parce qu'en effet, la prévoyance résulte autant des nécessités de position que de délibérations purement intellectuelles. ll est telle organisation de la propriété, ou, pour mieux dire, de l'exploitation, qui favorise plus qu'une autre ce que les économistes nomment la connaissance du marché et, par conséquent, la prévoyance. Il paraît certain, par exemple, que le métayage est beaucoup plus efficace que le fermage pour opposer l'obstacle préventif à l'exubérance de la population dans la classe inférieure. Une famille de métayers est beaucoup mieux en mesure qu'une famille de journaliers de sentir les inconvénients des mariages précoces et d'une multiplication désordonnée. — Nous disons encore les formes de la philanthropie. En effet, l'aumône peut faire un bien actuel et local, mais elle ne peut avoir qu'une influence bien restreinte, si même elle n'est funeste, sur le bien-être de la classe laborieuse; car elle ne développe pas, peut-être même paralyse-t-elle la vertu la plus propre à élever cette classe, la prévoyance. Propager des idées saines, et surtout les habitudes empreintes d'une certaine dignité, c'est là le plus grand bien, le bien permanent que l'on peut conférer aux classes inférieures. Les moyens d'existence, nous ne saurions trop le répéter, ne sont pas une quantité fixe; ils dépendent des mœurs, de l'opinion, des habitudes. A tous les degrés de l'échelle sociale, on éprouve la même répugnance à descendre du milieu dont on a l'habitude, qu'on en peut ressentir au degré le plus inférieur. Peut-être même la souffrance est-elle plus grande chez l'aristocrate dont les nobles rejetons se perdent dans la bourgeoisie, que chez le bourgeois dont les fils se font manœuvres, ou chez les manœuvres dont les enfants sont réduits à la mendicité. L'habitude d'un certain bien-être. d'une certaine dignité dans la vie, est donc le plus fort des stimulants pour mettre en œuvre la prévoyance, et si la classe ouvrière s'élève une fois à certaines jouissances, elle n'en voudra pas descendre. A l'action des classes supérieures pour l'y forcer, elle opposera plutôt un remède infaillible, la loi de limitation préventive. Il faudra bien lui donner le salaire en harmonie avec ses nouvelles habitudes, sans quoi elle cessera de multiplier. C'est pourquoi je considère comme une des plus belles manifestations de la philanthropie la résolution qui paraît avoir été prise en Angleterre par beaucoup de propriétaires et de manufacturiers, celle d'abattre les cottages de boue et de chaume, pour y substituer des maisons ile brique, propres, spacieuses, bien éclairées, bien aérées et convenablement meublées. Si cette mesure était générale, elle élèverait le ton de la classe ouvrière, convertirait en besoins réels ce qui aujourd'hui est un luxe relatif, exhausserait cette limite qu'on nomme moyens d'existence, et, par suite, l'étalon de la rémunération à son degré inférieur. — Pourquoi pas? La dernière classe dans les pays civilisés est bien au-dessus de la dernière classe des peuples sauvages. Elle s'est élevée ; pourquoi ne s'élèverait—elle pas encore?
Cependant il ne faut pas se faire illusion; le progrès ne peut être que très-lent, parce qu'il faut qu'il soit général à quelque degré. On concevrait qu'il pût se réaliser rapidement sur un point du globe, si les peuples n'exerçaient aucune influence les uns sur les autres; mais il n'en est pas ainsi : il y a une grande loi de solidarité pour la race humaine dans le progrès comme dans la détérioration. Si en Angleterre, par exemple, la condition des ouvriers s'améliorait sensiblement, par suite d'une hausse générale des salaires, l'industrie française aurait plus de chances de surmonter sa rivale, et, par son essor, modérerait le mouvement progressif qui se serait manifesté de l'autre côté du détroit. Il semble que la Providence n'a pas voulu qu'un peuple pût s'élever au-dessus d'un autre au delà de certaines limites; ainsi, dans le vaste ensemble, comme dans les moindres détails de la société humaine, nous trouvons toujours que des forces admirables et inflexibles tendent à conférer, en définitive, à la masse des avantages individuels ou collectifs, et à ramener toutes les supériorités sous le joug d'un niveau commun, qui, comme celui de I'Océan dans les heures du flux, s'égalise sans cesse et s'élève toujours.
En résumé, la perfectibilité, qui est le caractère distinctif de l'homme, étant donnée, l'action de la concurrence et la loi de la limitation étant connues, le sort de la race humaine, au seul point de vue de ses destinées terrestres, nous semble pouvoir se résumer ainsi : 1° élévation de toutes les couches sociales à la lois, ou du niveau général de l’humanité; 2° rapprochement indéfini de tous les degrés et annihilation successive des distances qui séparent les classes, jusqu'à une limite posée par la justice absolue; 3° diminution relative, quant au nombre, de la dernière et de la première couche sociale, et extension des couches intermédiaires. —— On dira que ces lois doivent amener l'égalité absolue. — Pas plus que le rapprochement éternel de la droite et de [asymptote ne doivent amener la fusion.
Seconde lettre à Monsieur de Lamartine [15 Oct. 1846]↩
BWV
1846.10.15 "Seconde lettre à Monsieur de Lamartine" (Second Letter to M. de Lamartine) [*Journal des Économistes*, October 1846, T. 15, No. 49, pp. 265-70] [OC1.13, pp. 452-60]
Journal des économistes, octobre 1846
Seconde lettre à M. de Lamartine
Monsieur,
Je viens de lire l’article qui, du Bien public de Mâcon, a passé dans tous les journaux de Paris ; vous dire combien cette lecture m’a surpris et affligé, cela me serait impossible.
Il n’est donc que trop vrai ! aucun homme sur la terre n’a le privilége de l’universalité intellectuelle. Il est même des facultés qui s’excluent, et il semble que l’aride domaine de l’économie politique vous soit d’autant plus interdit que vous possédez à un plus haut degré l’art enchanteur, l’art suprême
De penser par image ainsi que la nature.
Cet art, ou plutôt ce don divin, pourquoi l’avez-vous dédaigné ? Ah ! vous avez beau dire, vous aviez reçu la plus noble, la plus sainte mission du génie dans ce monde. Qu’est devenu le temps où, esprits froids et méthodiques, natures encore alourdies par le poids de la matérialité, nous nous arrachions avec délices à ce monde positif pour suivre votre vol dans la vague et poétique région de l’idéal ? où vous nous révéliez des pensées, des doutes, des désirs et des espérances qui sommeillaient au fond de nos cœurs, comme ces échos qui dorment dans les grottes de nos Pyrénées tant que la voix du pâtre ne les réveille pas ? Qui nous ouvrira désormais d’autres horizons et d’autres cieux, séjours adorés qu’habitent l’Amour, la Prière et l’Harmonie ? Combien de fois, quand vous me faisiez entrevoir ces vaporeuses demeures, je me suis écrié : « Non, ce monde n’embrasse pas tout ; la science ne révèle pas tout ; il y a l’infini au delà, et l’imagination a aussi son flambeau ! »
Oh ! qu’elle est grande la puissance du poëte ! — Je ne dis pas du versificateur ; de quelle licence, de quelle tyrannie n’est-il pas le complaisant ? — Mais cette perception du Beau et du Sublime dans la nature, cette forte émotion éveillée dans l’âme à leur aspect, ce don de les revêtir d’un mélodieux langage pour y faire participer le vulgaire, voilà la Poésie. — Et à mesure qu’elle s’élève, elle se détache de tout élément égoïste ou pervers ; car elle ne saurait partager les tristes infirmités d’ici-bas sans perdre le sentiment de ce qui est vrai, aimable et grand, c’est-à-dire sans cesser d’être Poésie. Tant que le rayon divin luit sur son front, ses tendances sont de purifier, spiritualiser, illuminer, élever. Aussi le vrai poëte, qu’il en ait ou non la conscience, est par excellence l’ami de l’humanité, le défenseur de ses droits, de ses priviléges et de ses progrès. Que dis-je ? nul plus que lui ne l’entraîne dans la voie du progrès. N’est-ce pas lui en effet qui, en offrant sans cesse à notre contemplation la perfection idéale, nous la fait aimer, verse dans nos cœurs l’aspiration vers le Beau, et élève ainsi le diapason de notre âme jusqu’à ce qu’elle se sente en consonnance avec les types éternels dont il compose sa céleste harmonie ?
Cette mission sublime, vous la remplissiez dans toute son étendue, et voilà pourquoi, Lamartine, vous étiez notre poëte de prédilection. Et maintenant, serons-nous condamnés à être les témoins de votre déchéance, à vous voir descendre vivant du haut de votre gloire, et à douter si ces émotions délicieuses, dont vous berciez notre jeunesse, étaient autre chose que de trompeuses illusions ?
Car voilà qu’ambitionnant la royauté de la science, vous avez abdiqué votre royauté à vous, celle de la poésie. Vous avez voulu faire de la méthode avec l’imagination et de l’analyse avec des figures. Où cela vous a-t-il mené ? à ressusciter l’empirisme économique de la Rome impériale ; à exhumer des théories cent fois condamnées par l’expérience et qu’on croyait ensevelies pour toujours dans les profondeurs de l’oubli. — Au moment de succomber, quand il est naturel, pour me servir d’une expression vulgaire, de se prendre à toutes les branches, le monopole terrien, par l’organe des Bentinck et des Buckingham, n’a pas essayé de demander son salut ou un répit momentané à ces théories vermoulues ; et le monde s’étonnera que ce soit vous, le grand poëte du siècle, qui soyez allé les déterrer on ne sait où, pour les exposer encore une fois, revêtues d’un magnifique langage, à la risée publique.
Décidément, votre muse s’est faite économiste ; elle ne s’est pas effarouchée de cette bizarre transformation. Un moment j’ai cru que ce caprice allait lui réussir ; c’est quand vous avez dit : « Laissons les capitaux, les industries et les salaires se faire, par la liberté, une justice que nos lois arbitraires ne leur feraient pas. »
Il me semblait qu’on ne pouvait émettre une pensée si vraie, sous une forme si précise, sans avoir suivi des deux côtés, dans leur long enchaînement, les effets de l’arbitraire et de la liberté. Et je disais à mes graves collègues : Miracle ! triomphe ! le grand poëte est à nous !
Hélas ! je vois bien que vous deviez à vos puissants et généreux instincts cet éclair de vérité, et je serais tenté de vous demander :
Si quand vous avez fait ce charmant quoi qu’on die,
Vous avez bien senti toute son énergie ;
car voilà que, d’un trait de plume, vous renversez aujourd’hui vos doctrines économiques de l’an dernier.
Voyons, avec quelque détail, ce que vous y substituez cette année.
| « La question des blés est une des plus délicates, nous dirons même des plus insolubles qui puissent se présenter aux économistes. | La question des blés insoluble ! En ce cas, il ne faut pas plus s’en occuper que de la quadruture du cercle. Ce mot ne doit donc pas être pris à la rigueur, et vous avez voulu parler D’un problème insolu, mais non pas insoluble. Remarquez que, dès le début, vous vous ôtez à vous-même le droit de raisonner. |
| « Elle échappe par sa masse et sa pesanteur aux mains de la science. | Oui, si 200 et 200 ne font pas 400, aussi bien que 2 et 2 font 4 ; oui, si par sa masse et sa pesanteur, un quintal échappe aux lois de la gravitation plus qu’une livre. |
| « La théorie n’y peut évidemment rien. C’est une question expérimentale. | Il y a donc incompatibilité entre la théorie et l’expérience ? Je croyais que la théorie n’était que l’expérience méthodiquement exposée. Remarquez que c’est déjà la seconde fois que vous vous ôtez le droit de raisonner. |
| « La liberté complète du commerce est la vérité générale en matière de produit, de commerce et d’échange. | Voilà une belle maxime. La tenez-vous de la théorie ou de l’expérience ? |
| « Laissez faire, laissez passer, est devenu proverbe chez les écrivains. | D’après la phrase qui précède, il semble que vous teniez ce proverbe pour vrai. D’après la phrase qui suit, il semble que vous le teniez pour faux. |
| « Mais quand il s’agit d’appliquer cette prétendue vérité à l’importation, à l’exportation et au commerce des grains, on s’aperçoit à l’instant que, si elle n’est pas un mensonge, elle est du moins un danger suprême, et la théorie recule devant l’application, car le blé c’est la vie du peuple ; or, on ne joue pas avec la vie. Vivre d’abord, voilà la vérité sans réplique. Les théories après le nécessaire, voilà le bon sens. | Voici, en effet, la vérité générale qui n’est plus qu’une prétendue vérité. Bientôt elle sera un mensonge. Si la gravitation est la vérité générale, il importe de s’y conformer toujours, mais surtout quand il s’agit de la vie. Je n’aurais pas été surpris que vous n’eussiez pas reconnu la liberté comme la vérité générale du commerce ; mais, cela une fois admis, votre déduction eût dû être, ce me semble, ainsi formulée : « Quand il s’agit de l’importation ou de l’exportation de quelque superfluité, on peut reculer devant l’application de la vérité générale. Mais en fait de blé, il ne faut pas hésiter , car le blé, c’est la vie du peuple. Or, on ne joue pas avec la vie ; vivre d’abord, voilà la vérité sans réplique. Les expériences gouvernementales après le nécessaire, voilà le bon sens. » |
| Or, pourquoi la vérité du libre commerce, de la libre exportation et de la libre importation fait-elle trembler et reculer l’économiste ? Le voici, quant à la France, par exemple : | Ou la liberté est le meilleur moyen d’assurer l’abondance et la bonne distribution des pro- duits (ce n’est qu’à cette condition qu’elle est la vérité générale), et dans ce cas, il faut l’appliquer à tout et au blé à fortiori ; ou il y a des moyens plus sûrs d’accomplir cette œuvre, et alors elle n’est pas la vérité générale, pas plus pour les joujoux que pour le blé. |
| « Premièrement, c’est que le blé étant la vie de tout un peuple, et la passion de vivre étant la plus légitime, et la plus terrible passion des hommes, la moindre faute de commerce, la moindre erreur de calcul dans les importations et les exportations de blé, la moindre inquiétude sérieuse de la population sur la vie, produirait des commotions et des pénuries telles qu’aucun législateur humain et sage ne pourrait y exposer son pays. | Puisque le blé c’est la vie ; puisque la moindre erreur de calcul dans l’importation ou l’exporta- tion du blé peut produire la pénurie ; puisque aucun législateur sage et humain ne peut prendre sur lui d’y exposer son pays, il faut donc laisser le commerce libre, la liberté étant d’ailleurs la verité générale, c’est-à-dire le moyen le moins chanceux d’assurer l’abondance et la bonne distribution. N’est-il pas évident qu’une erreur de calcul, dont les conséquences peuvent être si terribles, est infiniment plus probable de la part d’un ministre, qui n’y a pas un intérêt direct, et qui a bien d’autres choses en tête, que de la part de cent mille négociants qui passent leur vie à faire ces calculs, de l’exactitude desquels dépend leur propre existence ? |
| « Secondement, c’est que le blé étant le produit agricole le plus immense, et se comptant par deux ou trois milliards de revenu dans les produits du pays, si l’importation libre des blés étrangers pouvait venir faire en tous temps aux blés français une concurrence sans limites qui serait, quant aux prix, comme dix est à trente, la France cesserait à l’instant de produire des blés que nul ne voudrait acheter à leur prix, et trois milliards de revenu national et dix millions de cultivateurs français seraient anéantis du même coup. Que deviendrait le revenu ? que deviendrait l’impôt? que deviendrait le propriétaire? que deviendrait le laboureur ? On frémit d’y penser. Ce serait le suicide de la terre française et de la population. Ce remède qu’on nous présente, n’est donc pas un remède, c’est un meurtre. | Si ce que vous dites de la libre importation est vrai pour le blé, ce doit être vrai, dans une mesure quelconque, pour toute autre chose ; car, monsieur, les négociants font bien venir le blé, quand on le leur permet, de là où il est à meilleur marché qu’en France, mais ils n’ont pas coutume d’agir sur un principe opposé à l’égard des autres produits, et d’aller les acheter cher pour venir les vendre à bas prix. — Donc, la libre importation du fer serait le suicide de nos forges et des ouvriers qu’elles occupent ; la libre importation des tissus serait le suicide de nos fabriques et de la population qu’elles emploient. En un mot, la liberté serait le carnage universel ou, comme vous dites, le meurtre de tous les Français. En ce cas, je ne vois pas bien à quel titre vous l’appelez la vérité générale. Pour mettre quelque harmonie entre vos prémisses et vos conclusions, il aurait fallu commencer par établir que la liberté est le mensonge général du commerce. Mais alors vous n’auriez pas eu un pied dans chaque camp, précaution que beaucoup de gens prennent par le temps qui court, mais qui est indigne de vous. J’ose vous le dire, cette tactique pusillanime a fini son temps. Que celui qui ne connaît pas les lois de l’échange les étudie ou se taise, mais qu’il ne croie pas obtenir le double avantage de passer pour un grand esprit et de satisfaire tout le monde, en disant à l’un : « Vous êtes pour, c’est d’un bon logicien, » et à l’autre : « Vous êtes contre, c’est d’un bon praticien. » Trop de gens aujourd’hui voient l’inconséquence et la dénoncent. |
| Quant à réfuter votre triste tableau de l’agriculture libre, vous vous en êtes chargé vous-même dans le paragraphe suivant. | |
| « Troisièmement, c’est que le blé étant une des matières les plus encombrantes, il serait physiquement impossible au commerce d’importer et de distribuer dans tout l’empire les blés nécessaires à la consommation de la France. Des calculs faits en 1810, année de disette bien plus alarmante que celle-ci, révèlent en chiffres cette triste vérité : que tous les navires marchands de l’Europe, si, par impossible, ils étaient tous consacrés à importer des blés pour la France, ne pourraient en importer que pour une consommation de quinze ou dix-sept jours. Parlez donc de la liberté illimitée du commerce après cela ! » | Craignez donc la liberté illimitée après cela ! dirai-je à mon tour. Venez donc nous dire que l’étranger vendra son blé sur nos marchés pour une bagatelle, pour presque rien, pour rien peut-être ! Venez donc nous peindre tous les Français mourant de faim, les bras croisés, laissant leurs bœufs ruminer, leurs charrues se rouiller, leurs capitaux oisifs et leur terre en friche, comptant sur des blés étrangers qu’il est physiquement impossible d’importer ! Oh ! bénissons le ciel de ce que parmi nos 34 millions de compatriotes, il s’en soit trouvé un qui ait prévu tout cela, que ce soit précisément un homme d’État, et qu’il ait su prévenir notre mort à tous, en fixant ce bienheureux maximum qu’on n’a jamais connu en Suisse et qu’on vient d’abolir en Angleterre. |
Mais il serait peut-être inconvenant de prolonger cette discussion pied à pied. Je me demande quelquefois comment il est possible que deux esprits arrivent, sur la même question, à des solutions si opposées. Est-ce l’intérêt personnel qui m’aveugle ? non, assurément. Je n’ai d’autres moyens d’existence qu’une terre, et cette terre ne produit que des céréales. Qu’on laisse entrer les céréales étrangères, et je ne crains pas que ma terre perde de sa valeur, je ne crains pas que mes bras restent oisifs. Non, je ne le crains pas, alors même que le blé étranger se vendrait, ainsi que vous le dites, relativement au nôtre, comme dix est à trente, alors même qu’il se donnerait pour rien ; car dans cette supposition extrême, ce que le peuple dépense aujourd’hui en pain, il le dépenserait en viande, en beurre, en légumes, en fil, en laine et autres produits agricoles. Ma terre ne serait pas plus sans valeur, parce que chacun aurait gratuitement du pain pour son estomac, qu’elle n’est sans valeur aujourd’hui, parce que chacun a gratuitement de l’air pour ses poumons.
Et, après tout, quel droit avons-nous, nous propriétaires, sur les estomacs de ceux qui ne le sont pas ? Leur faim est-elle faite pour notre blé, ou notre blé pour leur faim ? Ne renversons pas le monde. Vivre, c’est le but, cultiver la terre, ce n’est que le moyen ; c’est à nous de subordonner les convenances de notre production à la vie de nos frères, et il ne nous est pas permis de subordonner au contraire leur vie à nos convenances bien ou mal entendues. C’est pour moi une bien douce consolation que la doctrine de la liberté ne me montre qu’harmonie entre ces divers intérêts ; et, avec votre âme, vous devez être bien malheureux, puisque vous ne voyez entre eux qu’une irrémédiable dissonance. Propriétaire, vous invoquez aujourd’hui la générosité des possesseurs du sol. Ah ! c’est à leur justice qu’il fallait en appeler ! Vous avez écrit sur la charité une page que j’admire comme tout le monde. Mais je l’admirerais bien davantage si je ne la voyais se terminer par cette amère conclusion : Le blé, c’est la vie ; que la loi le maintienne à un maximum qui donne de la valeur à nos terres ! — Et quelle est la main qui écrit ces lignes ? C’est la même qui se lèvera à la Chambre pour le maximum, et qui s’ouvrira ensuite pour recevoir du pauvre l’injuste denier qui en est la conséquence. — Ah ! croyez-moi, ainsi comprise, la charité perd bien de son prestige. Quand on demande l’exclusion du blé étranger pour mieux vendre le sien, on a beau parler de charité, on a beau porter ce mot devant soi comme une bannière, on n’a pas droit à la popularité, au moins à une popularité de bon aloi. Non, on n’y a pas droit, alors même qu’on ferait retentir, devant une population alarmée, de banales déclamations contre les doctrines meurtrières des amis de la liberté, contre les fautes et les crimes du gouvernement et des Chambres, contre la cupidité des spéculateurs et l’égoïsme du commerce. Avant de semer ainsi de dangereuses, et j’ose dire, injustes préventions populaires, il faudrait au moins ne pas venir dire : Que la loi irrite de quelques degrés la faim du peuple par l’exclusion du blé étranger, afin que nous, législateurs-propriétaires, tirions un meilleur parti de notre blé.
À Dieu ne plaise, monsieur, que je révoque en doute la pureté de vos intentions. Elle éclate dans tous vos écrits. En vous lisant, on sent que vous aimez le peuple. C’est vous, je crois, qui avez le premier employé cette expression : « la vie à bon marché, » qui pourrait être le titre de notre association du Libre-Échange ; car la vie à bon marché, c’est la vie plus facile, plus douce, moins traversée de fatigues et d’angoisses, plus digne, plus intellectuelle et plus morale. La vie à bon marché, c’est le résultat que l’échange, et surtout l’échange libre, tend à produire. Assez de monopoleurs cherchent, sur cette question, à égarer le peuple ; chose facile, car tout obstacle attirant à lui une portion de travail national, il est aisé de tourner contre le progrès, sous quelque forme qu’il se présente, — Liberté, Inventions, ou Épargnes, — le sentiment des masses. Vous, monsieur, qui savez leur parler, qu’elles écoutent et qu’elles aiment, aidez-nous à les dissuader. Mais ne soyez pas surpris que le zèle contre le monopole nous emporte, quand nous avons à craindre qu’il n’ait trouvé un champion tel que vous.
Je suis, monsieur, votre dévoué serviteur.
Aux négociants du Havre (1) [22 octobre 1846] ↩
BWV
1846.10.22 “Aux négociants du Havre (1)” (To the Merchants of Le Havre (1)) [*Mémorial bordelais*, 22 octobre 1846] [OC7.29, p. 131]
Aux négociants du Havre
Trois lettres en faveur du libre-échange, écrites et publiées au Havre, pendant le séjour de l’auteur — Première lettre [1]
À l’aspect de cette ville où se concentre une grande partie du commerce français, où tant de puissantes facultés combinent des opérations lointaines et des entreprises dont la hardiesse nous étonne, je me disais : — Tout ce travail, toute cette activité, tout ce génie n’ont qu’un objet : accomplir les échanges de la nation française avec les autres nations, et je me demandais : — Ces échanges ne seraient-ils pas plus nombreux, s’ils étaient libres ? En d’autres termes, ces quais, ces magasins, ce port, ces bassins, ne seraient-ils pas bientôt trop étroits pour l’activité havraise s’exerçant en liberté ?
J’avoue que l’affirmative est si évidente à mes yeux, qu’elle ne me paraît pas susceptible de démonstration. Vous savez que les géomètres n’ont jamais pu prouver cet axiome sur lequel repose toute leur science : Le plus court chemin d’un point à un autre, c’est la ligne droite. De même, dire que les échanges seraient plus nombreux s’ils étaient libres, c’est énoncer une proposition plus claire que toutes celles qu’on pourrait faire servir à la démontrer.
Et, de plus, je croirais manquer à toutes les convenances, si je m’avisais de venir exposer devant les négociants du Havre les inconvénients du régime protecteur. Ils me diraient sans doute : « Votre intervention est superflue ; l’expérience nous en apprend là-dessus plus que toutes les théories. Lisez les écrits émanés de notre Chambre de commerce ou de nos Commissions spéciales ; voyez l’esprit de nos journaux ; faites-vous raconter les efforts, les démarches de nos délégués auprès du Gouvernement et des Chambres, et vous resterez convaincu qu’ils ont toujours eu pour objet la liberté commerciale. »
Il ne s’agit donc point ici de dissertations économiques. Nous avons le même but ; tâchons de nous entendre sur les moyens de l’atteindre.
La première pensée qui se présente, c’est de laisser cette œuvre aux Chambres de commerce. Le législateur ne saurait, en effet, puiser à de meilleures sources les lumières dont il a besoin pour accomplir la réforme.
Cependant l’expérience a prouvé que l’action de ces corps est insuffisante. Il y a longtemps qu’ils réclament la modification du régime restrictif par les raisons les plus concluantes. Qu’ont-ils obtenu ? Rien. — Pourquoi ? Parce que des demandes en sens contraire émanent des classes agricole et manufacturière, qui , plus nombreuses, entraînent par leur poids les résolutions législatives.
L’obstacle, le véritable obstacle, est donc une opinion publique égarée, prévenue, voyant la liberté avec des terreurs chimériques, et fondant sur la restriction des espérances plus chimériques encore.
Il faut donc redresser l’opinion. C’est notre unique ressource. Le chemin est long, mais il n’y en a pas d’autre. Telle est la mission, pour ainsi dire préparatoire, de l’Association pour la liberté des échanges.
Habitants du Havre, nous venons vous demander de donner à cette entreprise, en vous y associant, l’autorité de votre influence morale, l’assistance de vos cotisations, le tribut de vos efforts, de votre expérience et de vos lumières.
Maintenant, qu’il me soit permis de répondre à quelques objections qu’on a élevées contre la portée, les vues et les procédés de cette Association.
On a dit : « que nous nous tenions trop dans le domaine des généralités ;
« Que nous aurions dû concentrer nos efforts sur un seul monopole, et qu’en les attaquant tous nous effrayions trop d’intérêts ;
« Que, dans notre programme, nous avions gardé le silence sur l’intérêt maritime. »
Si l’on veut bien s’assurer où est l’obstacle à la liberté commerciale, la première objection disparaît.
Il est tout entier, en effet, dans la puissance d’une généralité très populaire, et c’est celle-ci : « Il ne faut rien tirer du dehors de ce qu’on peut faire au dedans ; un peuple ne doit pas se procurer par l’échange ce qu’il peut se procurer par la production. »
Ce principe (car c’en est un, seulement il est faux) tend à anéantir le commerce extérieur. Il a la prétention de favoriser le travail national et repose sur cette présomption que, lorsque nous consommons un produit étranger, ce produit n’est pas dû à notre travail. Je n’ai pas besoin de dire ici que c’est là une erreur. Sans doute le produit est étranger ; mais sa valeur est nationale, puisqu’on l’a acquise avec du travail national donné en échange. Elle est un peu comme ces sermons de l’abbé Roquette, dont on disait :
Moi qui sais qu’il les achète,
Je soutiens qu’ils sont à lui.
Ceci me rappelle que, visitant le palais de la reine d’Espagne, je m’extasiais sur la beauté des meubles, des tapis, des rideaux, et demandais à un grave concierge castillan si c’étaient des produits de l’industrie espagnole. Il me répondit fièrement : « Hombre, aqui todo es español… pues lo hemos pagado. »
Ainsi l’obstacle qui est devant nous, c’est une théorie, une généralité. Que pouvons-nous faire que de lui opposer une autre généralité ? C’est le moyen d’extirper une erreur que de fonder la vérité contraire.
Dieu me préserve de repousser pour cela le concours des praticiens, des hommes instruits par l’expérience et le maniement des affaires. C’est leur collaboration surtout que nous recherchons, que nous sollicitons comme la plus précieuse et la plus efficace. Ce sont les négociants qui, ayant non seulement compris mais senti les inconvénients des restrictions douanières, avec lesquelles ils sont perpétuellement en lutte, peuvent les exposer dans ce langage simple, clair et précis, qui force la conviction. Enfin, quand l’opinion sera préparée et qu’il sera temps d’en venir à l’exécution, ce sont encore eux qui fourniront aux hommes d’État les indications les plus sûres.
Puisqu’on a pu dire de la vertu même : Pas trop n’en faut, permettez-moi de ne pas faire trop d’économie politique en un jour et de renvoyer à demain l’examen des deux autres objections.
FN: Mémorial bordelais au 22 octobre 1846. (Note de l’édit.)
Aux négociants du Havre. Deuxième lettre [23 octobre 1846] ↩
BWV
1846.10.23 “Aux négociants du Havre (2)” (To the Merchants of Le Havre (2)) [*Mémorial bordelais*, 23 octobre 1846] [OC7.30, p. p. 134]
Deuxième lettre [1]
On nous reproche de n’avoir pas concentré tous nos efforts contre le monopole du fer. On a la bonté de supposer que, par cette adroite tactique, nous n’aurions pas alarmé l’ensemble des intérêts privilégiés ; et enfin on nous cite l’exemple de l’Angleterre.
D’abord nous avons attaqué le monopole du fer et nous l’attaquons tous les jours. Si même la réforme devait frapper isolément un produit (ce qui n’est pas mon avis), une foule de raisons nous justifieraient de réclamer, pour commencer, la libre entrée du fer et, par suite, l’abaissement du prix du combustible.
Mais croire que le camp de la protection en serait moins alarmé, c’est se faire illusion.
En effet, après avoir traité la question sociale et pratique, après avoir dit que la cherté du fer, et même le manque absolu du fer, paralyse toutes nos entreprises, suspend les travaux des chemins de fer, retarde notre navigation transatlantique, impose une taxe à toutes nos manufactures, à notre industrie agricole, à notre marine marchande, porte atteinte aux moyens déjà si bornés, qu’a le peuple français de se garantir du froid et de s’assurer des aliments ; après avoir dit tout cela et bien d’autres choses encore, que du reste on crie depuis vingt ans, pouvons-nous nous flatter que les maîtres de forges resteront la bouche close ? Non, ils se défendront, et eux aussi répéteront ce qu’ils disent depuis vingt ans. Ils diront qu’il vaut mieux produire chèrement au dedans que d’acheter à bon marché au dehors, qu’il faut protéger le travail national ; que plus il en coûte pour mettre un quintal de fer à la portée du consommateur, plus cela prouve que cette industrie distribue du travail et des salaires. En un mot, ils diront tout ce que pourraient dire les autres industries protégées. — Et ce sera à nous d’aborder aussi ces généralités. Vous voyez bien qu’il y faudra venir sous peine d’être battus. Il faudra soutenir la lutte sur le terrain des théories, et dès lors nous n’aurons pas réussi à mettre les protectionistes sur une fausse quête.
Il est donc plus simple et plus loyal de poser d’abord le principe de la liberté commerciale. Ce principe est vrai ou il est faux. S’il est faux, la discussion le montrera. S’il est vrai, il triomphera, j’en ai la certitude. Le nombre des adversaires n’y fait rien, au contraire ; plus ils seront, plus ils se contrediront entre eux. Notre principe triomphera, pourvu que nous y soyons fidèles, que nous le défendions avec une virile énergie, que nous n’abandonnions jamais notre position sur ce roc inébranlable : la vérité et la justice.
La justice !… À ce mot, je me demande si, alors que la protection est devenue un système, qu’elle s’est étendue à un grand nombre d’industries, alors que les charges qu’elle impose à chacune d’elles absorbent les profits qu’elle lui promettait (et c’est en cela qu’elle est une déception), je me demande s’il est juste de procéder ainsi isolément, et s’il ne serait pas plus juste et plus prudent d’adopter une mesure d’ensemble et une réduction uniforme.
Si par exemple on disait : En vue du revenu, il n’est pas possible de demander, sur un produit, plus du dixième de sa valeur ; si, partant de cette donnée, on ramenait tout le tarif à ce taux au maximum, et cela en cinq ans, par réduction annuelle d’un cinquième, il me semble que nul n’aurait à se plaindre. Ce qu’on perdrait d’un côté, on le gagnerait de l’autre, et même avec avantage, et la perturbation serait insensible, beaucoup plus insensible qu’on ne se le figure. — Je n’entends pas proposer un plan, nous n’en sommes pas là, je cherche à faire comprendre ma pensée.
Mais dire aux maîtres de forges : Nous allons réduire le prix du fer, sans réduire pour vos ouvriers le prix des aliments, des vêtements et du combustible, — cela ne me semble pas s’accorder avec notre principe, et j’avoue que j’aurais quelque peine à adopter cette marche, même comme procédé stratégique.
On nous cite l’exemple de la Ligue anglaise. J’admire autant qu’un autre, et plus qu’un autre, l’habileté des chefs de la Ligue. Mais il ne s’ensuit pas que je croie devoir imiter servilement cette partie de leur tactique, déterminée par des circonstances qui ne nous sont pas applicables.
En Angleterre, il y avait deux classes : l’une se livrait au travail, l’autre possédait la terre ; celle-ci faisait aussi la loi. Tout en laissant pénétrer dans la loi quelques priviléges industriels, elle s’était servie du pouvoir législatif pour exclure les produits agricoles étrangers et constituer à son profit le plus incommensurable des monopoles, le monopole de l’alimentation du peuple.
Qu’ont fait les manufacturiers? Ils ont dit : « Nous commençons par déclarer que nous ne voulons pas de protection, et nous attaquons celle que les législateurs se sont attribuée à eux-mêmes ; bien convaincus que si nous les forçons à lâcher prise, ils n’iront pas, eux qui font la loi, maintenir des priviléges industriels dont ils ne profitent pas, dont ils souffrent eux-mêmes, et qu’ils n’ont accordés que pour faire passer les leurs. » Aussi, quand on demandait à M. Cobden pourquoi il dissolvait la Ligue avant que toute protection fût retirée aux manufacturiers, il a pu répondre, et tout le monde a senti la force de cette réponse : The landlords will do that.
Je le demande, quelle analogie trouve-t-on entre cette position et la nôtre ? Les maîtres de forges ont-ils le privilége de faire la loi en France, par cela même qu’ils sont maîtres de forges, comme les landlords font la loi en Angleterre parce qu’ils sont landlords ? Toutes nos industries se réunissent-elles pour dire aux maîtres de forges législateurs : « Nous abandonnons notre monopole, abandonnez le vôtre ? » Rien de semblable. Ce qui, en Angleterre, soutenait le système, c’était la loi des céréales. Ce qui le soutient, en France, c’est l’erreur, l’erreur renfermée dans ce simple mot : travail national. Attaquons donc cette erreur. Réunissons contre elle toutes nos forces. C’est elle qui est notre législateur puisqu’elle a fait notre législation.
Combattons-la dans toutes ses formes, démasquons-la sous tous ses déguisements ; poursuivons-la au sein des Chambres, dans le corps électoral, dans le peuple, au ministère, dans la presse, dans les coteries, et ne nous préoccupons pas tant de pratique et d’exécution ; car, lorsqu’enfin nous l’aurons exposée toute nue aux yeux de l’intelligence nationale, nous serons tout étonnés de voir la grande réforme accomplir d’elle-même, aux applaudissements du Moniteur industriel.
Mais je m’aperçois que le fer a envahi ces colonnes et votre attention. Que voulez-vous ? Il est un peu enfant gâté, habitué aux préséances et même aux envahissements. Il faut donc que la navigation attende à demain. Elle reste dans son rôle.
FN: Mémorial bordelais du 23 octobre 1846.
Aux négociants du Havre. Troisième lettre [25 octobre 1846] [1]↩
[
BWV
1846.10.25 “Aux négociants du Havre (3)” (To the Merchants of Le Havre (3))[*Mémorial bordelais*, 25 octobre 1846] [OC7.31, p. 138]
Me voici arrivé à une question difficile et brûlante, dit-on, celle de la situation qui serait faite, sous l’empire de la liberté du commerce, à notre marine marchande.
J’ose prédire, disent les uns, que les armateurs n’entreront dans le mouvement antiprotectioniste que sous la réserve des priviléges accordés au pavillon national.
J’oserais parier, disent les autres, que l’Association ne saura pas sortir de cette difficulté, forcée qu’elle est de renoncer à son principe, si elle cède aux armateurs ; ou de perdre leur puissant concours, bien plus, de les avoir pour adversaires, si elle leur résiste.
Et moi, je dis : Messieurs de la galerie, faites vos paris, engagez vos enjeux, vous ne perdrez ni les uns ni les autres ; car les armateurs maintiendront leurs prétentions, l’Association maintiendra son principe, et cependant ils seront d’accord et marcheront ensemble vers le grand dénouement qui s’approche, quoi qu’on en dise : la liberté du travail et de l’échange.
Je n’ai ni l’intention ni la prétention d’approfondir ici toutes les questions qui se rattachent à la marine marchande. Je n’aspire qu’à établir quelques principes qui, malgré la défaveur du mot, concilieront, je crois, toutes les convictions.
Sous le régime de liberté qui se prépare, l’industrie maritime, en tant qu’industrie, n’a droit à aucune faveur. Elle n’a droit qu’à la liberté, mais elle a droit à la liberté. Le service qu’elle rend est d’opérer les transports ; et si, par l’incapacité de ses agents, ou par quelque cause naturelle d’infériorité, elle ne peut le faire qu’avec perte, elle n’a pas droit de se couvrir de cette perte au moyen d’une taxe sur le public, de quelque façon que cette taxe soit déguisée. Si les armateurs élevaient une telle prétention, de quel front demanderaient-ils que la protection fût retirée au fer, au drap, au blé, etc. ? Que pourraient-ils dire ? Que leur industrie fait vivre des marins ? Mais les maîtres de forges disent aussi que la leur fait vivre des ouvriers.
En quoi les transports sont-ils par eux-mêmes plus intéressants que les produits ? Comment, si la nation est ridiculement dupe, quand elle comble par une taxe le déficit d’un producteur de blé, ne sera-t-elle pas dupe, si elle comble le déficit d’un voiturier de blé par terre ou par mer ? Tout ce qu’on peut dire pour ou contre le travail national subventionné, on peut le dire pour ou contre les transports nationaux subventionnés. La liberté n’admet pas ces distinctions qui ne reposent sur rien. Si l’on veut être juste, il faut laisser tous les services humains s’échanger entre eux sur le pied de la plus parfaite égalité et les protéger tous, aux dépens les uns des autres, — ce qui est absurde, — ou n’en protéger aucun.
Ainsi le principe de l’Association est absolu.
Mais ce principe est-il en collision avec cet autre principe : Celui qui cause un dommage doit le réparer ; celui qui reçoit un service doit le rendre ; celui qui exige un sacrifice doit un sacrifice ? Nullement ; quant à moi, je ne puis séparer dans ma pensée l’idée de liberté de celle de justice.
C’est la même idée sous deux aspects.
Ainsi, s’il arrivait que les industries nationales, toutes parfaitement libres, exigeassent d’une d’entre elles, et dans leur intérêt, des sacrifices particuliers, ne seraient-elles pas tenues à offrir une compensation, et pourrait-on voir dans cette compensation une dérogation au principe de la liberté ? Je ne pense pas qu’il y ait un seul homme raisonnable qui ose soutenir l’affirmative. On peut différer d’avis sur la valeur du sacrifice, sur la valeur ou la forme de la compensation, mais non sur le principe que l’une est la juste conséquence de l’autre ; et j’irai même plus loin : Si l’on soutenait qu’il y a dans un tel arrangement violation de la liberté absolue, je dirais qu’elle n’est pas imputable à celui qui fait le sacrifice. Mais nous tomberions ici dans une dispute de mots.
Appliquons ces prémisses à l’industrie maritime.
Voilà toutes les industries, toutes les transactions libres. Nulle n’est protégée, mais nulle n’est entravée. Vendez, achetez au dedans, au dehors, l’État ne s’en mêle pas.
Mais l’État, c’est-à-dire la nation, c’est-à-dire encore l’ensemble des industries, veut se mettre à l’abri des agressions extérieures. Pour cela, il lui faut une marine ; pour créer cette marine de toutes pièces, il lui faut cent millions par an, charge à répartir entre tous les travailleurs. Cependant il aperçoit un moyen d’arriver au même résultat avec cinquante millions. Ce moyen, c’est d’imposer des charges et des entraves particulières à la marine marchande.
L’État lui dira par exemple :
« Je te défends d’acheter au dehors ton outil principal, le navire, parce que je veux former des constructeurs !
« Je te défends d’emporter au dehors le capital, parce que je veux que le navire soit exclusivement français.
« Je te défends de louer des matelots au dehors, parce que j’entends avoir des marins qui tiennent au pays.
« Je te défends de faire toucher à ton navire par des charpentiers ou calfats autres que ceux que j’ai placés sous un régime exceptionnel, et qui, par conséquent, demandent des salaires exceptionnels.
« Je t’ordonne d’avoir à bord plus de matelots et d’officiers qu’il ne t’en faudrait, parce que j’en veux avoir une pépinière bien fournie.
« Je t’ordonne de les nourrir de telle façon, de les ramener de tout port où tu les auras congédiés.
« Et, pour l’exécution de ces conditions et de bien d’autres, je me fais l’intermédiaire entre toi et ton équipage. »
Je le demande, à la suite de ce discours, n’attend-on pas naturellement cette conclusion : « Et en compensation, etc. »
Je n’entre pas ici dans un calcul ; encore une fois, je discute le principe.
Et remarquez une chose : toutes ces mesures sont prises, non pas dans l’intérêt de l’armateur ni de la marine marchande, mais dans l’intérêt de la défense nationale, dans l’intérêt de toutes les industries.
Mais ce n’est pas tout : outre que la compensation est exigée par un motif de justice, elle est déterminée encore par une considération non moins grave, le succès. Car ne serait-il pas bien singulier que tant de mesures fussent prises pour aboutir à un désappointement complet, à l’absence totale des moyens de défense ?
Or, en dehors de la compensation, c’est ce qui arriverait infailliblement.
Les dispositions analogues à celles que je viens de supposer ont toutes ce commun résultat d’exhausser, pour l’armateur, le prix de revient de ses moyens de transport. Si aucune indemnité ne lui est accordée, il cessera de naviguer en concurrence avec l’étranger, car toute la puissance du Gouvernement ne saurait le forcer à naviguer à perte. Nous voilà donc sans marins et sans défense. Certes mieux eût valu ne pas intervenir dans cette industrie, même avec la chance de la voir succomber. Le pire de tout, c’est de faire comme je ne sais quel philosophe : acheter fort cher un regret.
On m’a demandé ce que je déciderais dans ce cas.
Supposez la marine marchande entièrement libre, et que cependant elle ne puisse pas se soutenir.
Je n’aime guère à m’évertuer sur des problèmes imaginaires ; mais enfin je crois qu’on peut déduire de ce qui précède les solutions suivantes, dont aucune, ce me semble, n’est incompatible avec la justice ni avec la liberté.
La nation aurait à décider : d’abord si elle veut s’assurer des moyens de défense ; ensuite s’il n’y a aucun moyen plus économique et plus sûr que d’assister, de soudoyer la marine marchande ; enfin, s’il n’y en a pas de meilleur, qu’il faut s’y résoudre.
Mais ce que je voudrais qui fût bien entendu, pour l’honneur des théories (car j’avoue mon respect des théories), c’est ceci : que lorsque des considérations supérieures vous réduisent à soudoyer une industrie qui tomberait sans cela, il ne faut pas s’imaginer que cette industrie soit lucrative, que le travail et les capitaux qu’elle occupe reçoivent industriellement un bon emploi ; il faut savoir qu’on perd, il faut savoir qu’on fait un sacrifice à la sûreté nationale ; il ne faut pas surtout s’étayer de cet exemple pour appliquer à d’autres industries le même procédé, sans avoir le même motif.
J’aurais bien d’autres considérations à présenter, mais l’espace et le temps m’obligent à me résumer. Armateurs du Havre, de Bordeaux, de Marseille et de Nantes, si vous êtes partisans de la liberté du commerce, votre position particulière ne doit pas vous empêcher d’apporter à notre Association le tribut de vos lumières et de votre influence. Votre rôle vis-à-vis de la nation est tout tracé.
Demandez, pour vous comme pour tout le monde, le droit commun, c’est-à-dire la liberté. Qu’au grand air de la liberté vous puissiez ou non vous soutenir, demandez toujours la liberté, car vous n’avez pas le droit d’exiger que la nation y renonce pour votre avantage, et vous vous placeriez dans une position fausse et indigne de vous, si vous le demandiez. — Que si la nation, pour sa défense et dans l’intérêt commun, a besoin de votre concours, de vos sacrifices, stipulez des conditions dans lesquelles votre patriotisme ait une généreuse part ; mais surtout gardez-vous de laisser donner à l’indemnité qui vous sera offerte le nom de protection ou privilége, car les fausses dénominations font les fausses idées ; que votre cri soit : Liberté !… et compensation pour ceux qu’on en prive. — Nos adversaires ne viendront point alors vous jeter de prétendues contradictions à la face.
FN: Mémorial bordelais du 25 octobre 1846.(Note de l’édit.)
Au rédacteur du National [10 novembre 1846] ↩
BWV
1846.11.10 “Aux rédacteurs du *National* (1)” (To the Editors of *Le National* (1)) [*Courrier français*, 10 novembre 1846] [OC7.34, p. 152]
À M. le rédacteur en chef du National [1]
Monsieur,
Si j’ai bien compris la portée des nouvelles attaques que vous dirigez contre le libre-échange (National des 6 et 7 novembre), elles peuvent se résumer ainsi :
D’abord il va sans dire que le Principe du libre-échange est le vôtre. La liberté commerciale est fille de vos idées ; l’avenir que vous espérez, c’est l’alliance des peuples, et il serait absurde d’aspirer à cette alliance, à cette fraternité des nations, sans vouloir l’échange libre de leurs produits, qu’ils émanent de l’intelligence ou qu’ils soient les fruits de l’industrie et du travail.
Fort bien. Mais il se présente une petite difficulté. Cette liberté qu’il est absurde de ne pas vouloir quand on aspire à l’alliance des peuples, il se rencontre qu’elle doit être le résultat de cette alliance, ce qui fait que vous n’avez plus à vous occuper du principe fils de vos idées (si ce n’est pour le combattre), lequel se manifestera de lui-même, comme sanction de votre idéal politique, quand la carte de l’Europe sera refaite, etc.
La seconde objection est tirée de ce que nous payons de lourdes taxes mal réparties. Nous manquons d’institutions de crédit, la propriété est immobilisée, le capital monopolisé ; d’où il suit clairement que le droit d’échange n’a qu’à attendre que votre idéal financier, comme votre idéal politique, soit réalisé sur tout le globe. — C’est tout comme la Démocratie pacifique qui salue respectueusement le principe du libre-échange, mais qui demande qu’il soit ajourné seulement jusqu’à ce que l’univers se soit soumis à l’idéal fouriériste.
Enfin, quand il y aurait avantage matériel à ce que les échanges fussent libres, l’avantage matériel est chose vile et abjecte aux yeux des classes laborieuses ; l’aisance, l’indépendance, la sécurité, la dignité qui en sont la suite, doivent être sacrifiées, si elles nous ôtent la chance de nous brouiller avec l’Autriche et l’Angleterre.
Ces étranges opinions, que votre plume a su rendre spécieuses, je les discuterai dans cet ordre.
Le principe du libre-échange est le vôtre. — Monsieur, je crois pouvoir vous assurer que vous vous faites illusion. Tout votre article est là pour prouver que vous n’êtes pas fixé sur la question économique. Cela n’est pas surprenant, puisque vous n’y attachez qu’une importance très secondaire. — Vous avez écrit ceci : « Quand ces mêmes résultats (de la liberté commerciale) seraient aussi certains qu’ils sont hypothétiques et faux, » et encore : « Au point de vue économique, la liberté des échanges est incontestablement utile aux peuples arrivés à l’apogée de l’industrie… Elle est utile encore aux peuples qui n’ont pas d’industrie… En est-il de même pour une nation comme la nôtre ? etc. »
Eh bien ! Monsieur, puisque vous croyez que la liberté d’ opérer des échanges est funeste à tous les hommes, excepté à ceux qui sont les premiers et les derniers en industrie, j’ose dire que la nature de l’échange, du moins telle que nous la comprenons, vous est complétement étrangère, et je ne puis voir sur quel fondement vous vous en déclarez le partisan en principe. Vous êtes protectioniste, plus protectioniste que ne le furent jamais les Darblay, les Saint-Cricq, les Polignac ou les aristocrates britanniques.
Vous soulevez, Monsieur, une question pleine d’intérêt. « L’alliance des peuples doit-elle être le résultat de la liberté commerciale, ou bien la liberté commerciale de l’alliance des peuples ? »
Pour traiter cette question sans trop de répugnance, il faudrait bien être fixé sur la valeur économique de l’échange ; car s’il est dans sa nature de ruiner ceux qui le font, il y a incompatibilité radicale entre l’union des peuples et leur bien-être. Que ce soit l’échange qui amène l’alliance ou l’alliance qui amène l’échange, le résultat sera toujours l’universelle misère. La seule différence qu’on puisse apercevoir entre les deux cas, c’est que, dans le premier, on se soumet à une chose mauvaise, à savoir l’échange, pour arriver à une bonne, à savoir l’alliance, tandis que dans le second on commence par la chose bonne, l’alliance, pour aboutir à la mauvaise, l’échange. Dans tous les cas, l’humanité est placée dans cette alternative d’être unie et ruinée, ou riche et désunie. J’avoue, Monsieur, que je ne me sens pas la force de choisir.
Si, au contraire, l’échange est d’une bonne nature économique, s’il ne s’exécute jamais qu’au profit des deux hommes ou des deux pays contractants, alors il peut être intéressant de s’assurer s’il est cause ou effet de l’alliance des peuples pour savoir à quoi il faut d’abord travailler ; mais quelque parti que nous prenions, nous aurons toujours la consolation de penser que nous travaillons à des résultats harmoniques ; et en vérité je ne comprendrais pas que vous poursuiviez de vos sarcasmes ceux qui veulent arriver à l’union politique par l’union commerciale, uniquement parce que vous préférez la marche inverse, alors que cette double union est le but de nos communs efforts.
Il serait donc aussi essentiel que logique de vider cette question préalable : Quelle est la vraie nature de l’échange ?
Pour cela il faudrait refaire un cours d’économie politique ; j’aime mieux m’en référer à ceux qui sont déjà faits, et je raisonnerai dans la supposition que cette nature est bonne de soi.
C’est d’ailleurs ce que vous avez fait vous-même, car vos objections viennent après cette hypothèse : « Supposez que la liberté des échanges procure aux consommateurs français trente, quarante, cinquante millions par an. »
Je ferai remarquer ici que vous affaiblissez considérablement, dans l’expression, les effets de l’échange supposé bon. Il ne s’agit pas de trente, de cinquante millions ; il s’agit de plus de pain pour ceux qui ont faim, de plus de vêtements pour ceux qui ont froid, de plus de loisirs pour ceux que la fatigue accable, de plus de ces joies domestiques que l’aisance introduit dans les familles, de plus d’instruction et de dignité personnelle, d’un avenir mieux assuré, etc. Voilà ce qu’il faut entendre par les biens matériels qui vous paraissent si secondaires.
Le libre-échange devant accroître ces biens, selon notre hypothèse, la question est de savoir s’il est nécessaire de les sacrifier à la communion des peuples dans les mêmes idées et les mêmes principes. — « S’ils doivent porter atteinte, dites-vous, à l’expansion de nos idées, à la mission de la France au sein de l’Europe, les hommes qui ont le moindre instinct soit du pouvoir, soit de la démocratie, n’y consentiront jamais. »
C’est une chose précieuse que l’expansion des idées, surtout quand elles sont bonnes. Cependant aux fouriéristes, communistes, démocrates, conservateurs et autres, je demanderai d’abord quel droit ils ont d’épancher au dehors leurs idées, en empêchant l’expansion de mes produits ; et, en second lieu, en quoi l’expansion de mes produits nuit à l’expansion de leurs idées ?
Est-ce sérieusement, monsieur, que vous représentez le commerce libre comme faisant obstacle à la grande mission que vous attribuez à la France ? La propagande ne se fait-elle qu’à la bayonnette ? Les principes qu’elle doit promulguer sont-ils d’une nature telle qu’on ne puisse les faire accepter que le sabre au poing ? Et la démocratie ne grandit-elle parmi nous que pour remettre en honneur le culte de la force brutale ? Vous craignez que si la France s’unit étroitement par le commerce à l’Autriche et à l’Angleterre, elle ne puisse plus se brouiller avec elles, et vous allez jusqu’à dire : « La liberté commerciale serait grosse de tous les bienfaits qu’on lui attribue (ce que vous mettez toujours en doute) qu’il faudrait la sacrifier à ces intérêts suprêmes. » (Celui, entre autres, de la brouillerie.)
Vous avez emprunté l’idée et presque l’expression de l’Atelier. « Croyez-vous, m’écrivait-il, que la France veuille sacrifier au soin du râtelier ses causes d’animosité nationale ? »
L’Atelier et le National tiennent donc bien à guerroyer ! Ils y tiennent tellement qu’ils n’hésitent pas à sacrifier ce qu’ils appellent l’intérêt matériel à ce qu’ils nomment l’intérêt politique, c’est-à-dire, en bon français, l’aisance du peuple au maintien des brouilleries et des animosités nationales. Oublient-ils que c’est toujours le peuple qui paie de son sang et de sa bourse les frais de la guerre ? Et quel motif d’ailleurs ont les classes laborieuses françaises et russes de s’entr’égorger ? Est-ce parce que les malheureux russes sont encore soumis au régime du knout ? Faut-il les tuer pour leur apprendre à vivre ?
Ce n’est pas aux travailleurs que nous en voulons, direz-vous. Ce n’est pas aux opprimés, mais aux oppresseurs, à l’autocrate russe, à l’oligarchie anglaise.
Et moi, je vous demanderai si vous avez foi dans vos idées démocratiques. Si vous y avez foi, ne parquez donc pas les peuples, laissez-les se voir, se connaître, se mêler, échanger leurs produits, qu’ils émanent de l’intelligence ou qu’ils soient les fruits de l’industrie et du travail. Laissez leurs intérêts s’entrelacer au point qu’il devienne impossible aux oligarques et aux diplomates d’embraser l’Europe, tantôt pour un lopin de désert en Syrie, tantôt pour un rocher dans le grand Océan, tantôt pour les épousailles d’un jeune prince avec une gracieuse infante. Laissez pénétrer dans les pays encore soumis au joug du despotisme nos idées, nos principes avec notre langue, notre littérature, nos arts, nos sciences, notre commerce et notre industrie. C’est là la vraie, l’efficace propagande, et non celle qui se fait à coups de canon.
Est-ce que d’ailleurs toutes les libertés ne se tiennent pas ? Ouvrez donc les yeux, et voyez ce qui se passe. Il y a six mois à peine, le monopole des céréales a été frappé en Angleterre, et déjà tous les monopoles sont ébranlés à Paris, Rome, Naples, Saint-Pétersbourg et Madrid ; déjà le système colonial s’écroule de toute part. L’Angleterre, cette orgueilleuse métropole de tant de possessions lointaines, leur rend le droit de régler leur commerce et la faculté de s’approvisionner où elles l’entendront, par quelque pavillon qu’il leur plaira de choisir. N’est-ce pas un fait immense ? Est-ce qu’il ne nous annonce pas que l’ère de la domination et de la conquête est finie pour toujours ? Je dis plus, il est aisé de voir que c’en est fait du règne funeste de l’aristocratie anglaise et de son action sur l’indépendance et les libertés du genre humain.
Car lorsque les colonies anglaises n’offriront plus à la métropole aucun privilége maritime, industriel et commercial, lorsque ces priviléges auront succombé non point devant un acte de philanthropie, on pourrait s’en méfier, mais devant un calcul, devant la démonstration évidente qu’ils coûtent plus qu’ils ne rapportent ; quand les ports de toutes ces dépendances seront ouverts aux échanges du monde entier ; croyez-vous que le peuple d’Angleterre ne se fatiguera pas bientôt d’entretenir seul, dans ces régions émancipées, des soldats, des flottes, des gouverneurs et des lords-commissaires ? Ainsi l’affranchissement du travail porte un double coup à l’aristocratie britannique ; car voilà qu’une seule campagne lui arrache ses injustes monopoles au dedans, et menace, au dehors, ses fiers cantonnements et ses grandes existences.
Au milieu de ces grands événements, les plus imposants, après la Révolution française, que l’Europe ait vus depuis des siècles, quelle attitude prend notre démocratie ? Il semble qu’elle veuille rester étrangère à tout ce qui se passe, et que cette chute de la plus forte aristocratie qui ait jamais pesé sur le monde, du système d’envahissement qu’elle a organisé, n’ouvre aucune chance devant nous. Que dis-je ? si sortant un moment de sa sceptique indifférence, notre démocratie daigne jeter les yeux sur ce grand mouvement social, c’est pour le nier ou en contester la portée. Par le plus étrange renversement d’idées, toutes ses sympathies sont pour les tyrans britanniques, tous ses sarcasmes, toutes ses défiances pour ces multitudes si longtemps opprimées, qui brisent le joug odieux qui pèse à la fois sur elles et sur le monde. Tantôt elle va fouiller dans les journaux torys pour y trouver un fait isolé, qu’elle exploite, pendant des mois entiers ; et ayant appris que, dans je ne sais quelle fabrique, il y avait eu une discussion entre le maitre et les ouvriers, elle se hâte de flétrir la réforme, de lui assigner pour but l’oppression des ouvriers, comme si les dominateurs du sol n’y avaient introduit le monopole que pour élever le taux des salaires. Tantôt, prenant un chiffre pour un autre, elle croit découvrir que l’abaissement des droits a restreint les importations, et, forte de cet argument contre la liberté, elle entonne un chant de triomphe et semble dire : Non, non, le temps des lourdes taxes, des fortifications, [53] des arsenaux et de la conscription n’est pas près de finir !
Pour moi, j’appartiens de toutes les manières à la démocratie ; mais je ne la comprends qu’autant qu’elle inscrit sincèrement sur sa bannière : Paix et liberté. Si je voyais les hommes qui se posent comme les meneurs du parti populaire, comme les défenseurs exclusifs des classes laborieuses, si je les voyais, dis-je, repousser systématiquement tout ce qui tend à développer nos libertés et à faire régner la paix parmi les hommes, je ne me croirais pas tenu de les suivre ; mais au contraire de les avertir qu’ils s’égarent et qu’ils ont choisi un terrain qui manquera sous leurs pieds.
Il me reste à prouver que la pesanteur et la mauvaise répartition des taxes antérieures ne justifie pas le régime protecteur.
FN: Courrier français du 10 novembre 1846.
À M. le rédacteur en chef du National. Seconde lettre [11 novembre 1846] [1]↩
BWV
1846.11.11 “Aux rédacteurs du *National* (2) (To the Editors of *Le National* (2)) [*Courrier français*, 11 novembre 1846] [OC7.35, p. 159]
Monsieur,
J’ai essayé de combattre les raisons politiques que vous alléguez à l’appui du régime restrictif. Il me semble que ces raisons sont sans valeur, surtout au point de vue démocratique. Rejeter le bien-être des travailleurs de peur qu’il n’éloigne les chances de la guerre, repousser la liberté parce qu’elle est favorable à la paix, c’est un double machiavélisme dont la démocratie française devrait laisser l’odieux à l’aristocratie britannique. Il est étrange de voir deux éléments sociaux si divers fraterniser aujourd’hui au nom d’une si déplorable doctrine. Pour moi, quand je suis les événements du jour, quand je vois deux grandes nations prêtes à se précipiter, ou plutôt à être précipitées l’une sur l’autre par des intrigues de cour, quand je comprends que, dans ce moment même, notre sang et nos trésors dépendent d’une visite de lord Normanby, bien loin de dire : « Arrière la liberté du commerce qui pourrait prévenir la guerre ! » je m’écrie de toutes mes forces : « Hommes de la classe laborieuse, travaillons plus que jamais à réaliser la liberté du commerce, la plus précieuse des libertés, puisqu’il est en sa puissance d’arracher le gouvernement du monde aux dangereuses mains de la diplomatie ! »
Mais pour être dévoué de cœur à la liberté des transactions internationales, il faut croire à son utilité économique, et ceci me conduit à examiner votre seconde objection, beaucoup plus spécieuse que la première. Je la reproduis textuellement :
« Prenez garde, partisans de la liberté au dehors, que vous n’ayez pas une ombre de liberté commerciale à l’intérieur. Voyez votre état social, l’assiette de vos impôts, la répartition inique des charges publiques, l’établissement de votre crédit, le mouvement de vos capitaux : tout pressure votre industrie, le travail est accablé de taxes énormes, toute denrée arrive avec des surcharges écrasantes au milieu de vos propres consommateurs… Quoi ! vous avez une organisation intérieure aussi fatale à l’industrie, des capitaux sans circulation, une propriété frappée d’immobilité, des impôts écrasant le travail et épargnant la rente, des octrois ajoutant au prix des subsistances et par conséquent à la main-d’œuvre ; et c’est le malheureux producteur, placé dans ces conditions détestables, que vous allez menacer de la concurrence étrangère ! »
Cette objection contre la liberté commerciale est assez spécieuse pour être présentée et accueillie de bonne foi, pour jeter du doute dans les esprits les plus sincères. J’ai le droit de réclamer pour la réponse que j’ai à y faire une sérieuse attention.
J’admets que, dans un pays donné, les impôts soient lourds et vexatoires. La question que je pose est celle-ci : Un tel état de choses justifie-t-il la protection ? Le poids des charges en est-il allégé ? Est-il sage de repousser la concurrence extérieure parce qu’elle arrive sur le marché affranchie de charges semblables ?
On voit que je n’élude ni n’affaiblis la difficulté. J’ajoute qu’elle ne se présente pas ici dans toute son étendue, et je veux mettre les choses au pire.
Il y a en effet deux sortes d’impôts, les bons et les mauvais.
J’appelle bon impôt celui en retour duquel le contribuable reçoit un service supérieur ou du moins équivalent à son sacrifice. Si l’État, par exemple, prend, en moyenne, 1 franc à chaque citoyen, et si, avec les 36 millions qui en proviennent, il fait un canal qui économise tous les ans à l’industrie 5 ou 6 millions de frais de transport, on ne peut pas dire que l’opération nous place dans une condition inférieure au peuple voisin, qui, cæteris paribus, ne paye pas les 36 millions, mais n’a pas non plus le canal. S’agit-il du fer ? Il est bien vrai qu’en raison de la taxe son prix de revient sera augmenté dans une proportion quelconque ; mais, en raison du canal, il sera diminué dans une proportion plus forte encore, en sorte que, si le maître de forges fait son compte, il trouvera que son fer lui coûte moins qu’avant la taxe. Or, il est évident qu’un impôt de cette nature (et tous devraient l’être) ne justifie pas une protection spéciale en faveur du fer. Il s’en passait avant la taxe, à fortiori, il peut s’en passer après.
J’appelle mauvais impôt celui qui ne confère pas au contribuable un avantage égal à son sacrifice. La taxe est détestable si le contribuable ne reçoit rien, et odieuse s’il reçoit en retour, comme cela s’est vu, une vexation. Il n’est pas sans exemple qu’un peuple ait payé pour être opprimé, et qu’on lui ait arraché son argent pour lui ravir sa liberté. Quelquefois la taxe est pour lui le châtiment d’anciennes folies. En ce moment, chaque Anglais paye 25 francs par an et chaque Français 6 francs, pour les frais d’une guerre acharnée, qui, à ce qu’il me semble, n’a pas fait grand’chose pour l’expansion des idées et la communion des principes. Il est permis de croire que vingt ans de paix y eussent servi davantage.
Eh bien ! j’admets que cette dernière nature d’impôts pèse sur le pays F, tandis que le pays A en est exempt. Je raisonne dans cette hypothèse par déférence pour la logique, car, en fait, on aurait de la peine à citer un pays où les classes laborieuses ne payent pas d’impôts ou n’en payent que de bons.
Voilà donc tous les citoyens de F, et particulièrement les travailleurs, chargés de lourdes contributions. Dans ce pays, que nous supposons commercialement libre, on m’accordera, j’espère, qu’il se produit quelque chose. Mettons que ce soit du fer et du blé, que chaque quintal de fer, comme chaque hectolitre de blé, revienne à 15 francs sans la taxe, et à 20 francs avec la taxe.
Dans ces circonstances, les maîtres de forges adressent cette pétition aux Députés :
« Messieurs, nous, nos fournisseurs et nos ouvriers, nous succombons sous le poids des impôts. Notre industrie en souffre, tandis qu’elle prospérerait à ravir si vous daigniez nous dégrever. Néanmoins, sachant que votre intention n’est pas de lâcher prise d’un centime, tout ce que nous vous demandons, c’est de décharger notre cote contributive et de charger d’autant celle de nos compatriotes qui ne font pas de fer, par exemple, les laboureurs. »
Ceux-ci ne seront-ils pas fondés à contre-pétitionner en ces termes :
« Honorables députés, les maîtres de forges se plaignent de payer beaucoup de taxes ; ils ont raison. Ils disent que cela nuit à leur industrie ; ils ont encore raison. Mais ils vous demandent que leur part du fardeau soit ajoutée à celle que nous portons comme eux ; en cela, ils ont tort. »
Les maîtres de forges ne se tiennent pas pour battus. Ne pouvant pas faire passer, sous une forme par trop naïve, une injustice aussi criante, ils imaginent une combinaison plus rusée et font aux députés cette nouvelle adresse :
« Messieurs, — nous reconnaissons que le moyen que nous avons indiqué pour nous dégrever de notre part d’impôt était inadmissible. Il avait le tort, non point d’être injuste, mais de laisser trop clairement apercevoir l’injustice. Les laboureurs l’ont aperçue et notre plan a échoué. Mieux avisés, nous venons vous en proposer un autre, tendant aux mêmes fins, et auquel, à ce que nous espérons, nos revêches co-contribuables ne verront que du feu. Ainsi que nous avons eu l’honneur de vous l’exposer, nous sommes, comme eux, accablés de taxes. Nous avons calculé que cela monte à 5 francs, par chaque quintal de fer, que la concurrence étrangère nous force à vendre à 20 francs, d’où il suit qu’il ne nous reste que 15 fr. — Chassez le fer étranger ; nous vendrons le nôtre 25 francs, peut-être 30. Ce sera comme si nous ne payions plus la taxe ; mais vous n’y perdrez rien, puisqu’elle se trouvera naturellement repassée sur le dos des acheteurs de fer, de ces bons laboureurs qui, sans s’en douter, payeront leur part et la nôtre. Nous aurons même la chance de réaliser, en fin de compte, si nous vendons au-dessus de 25 francs, un boni à leurs dépens. »
J’ai quelques raisons de penser que cette ruse pourrait avoir du succès à la Chambre. Qui sait si elle n’y exciterait pas une noble émulation et si le laboureur ne se coaliserait pas avec le maître de forges, pour s’emparer, lui aussi, de cet ingénieux moyen de se débarrasser de sa taxe en la rejetant sur d’autres, tels que armateurs, artisans, etc.
Mais, en supposant qu’ils veuillent rester sur la défensive, si ces braves laboureurs y voyaient plus loin que leur nez, ils devraient, ce me semble, s’empresser de répondre :
« Messieurs les Députés, — la nouvelle combinaison présentée par les maîtres de forges ne diffère en rien de la première. Que nous acquittions, à leur décharge, 5 francs au fisc, ou que nous leur payions le fer 5 francs de plus, cela revient absolument au même pour eux et pour nous. Si nous n’avions pas nous-mêmes à payer 5 francs de taxe par hectolitre de blé, la chose serait proposable ; mais ce que l’on veut, c’est ceci : que les laboureurs payent 10 francs, et les maîtres de forges rien du tout, — à quoi, si nous avons le moindre instinct de la justice et de notre dignité, nous ne consentirons jamais. »
Supposons maintenant que la Chambre passe outre et décrète la protection. Les impôts dont vous vous plaignez avec raison n’en seraient pas moins lourds ; seulement ils seraient autrement répartis ; une iniquité évidente serait consommée dans le pays, et le mal ne s’arrêterait pas là.
Ce vote désastreux changerait les conditions des deux industries métallurgique et agricole. L’une deviendrait lucrative relativement à l’autre. Le travail et les capitaux auraient une forte tendance à déserter celle-ci pour se porter vers celle-là. On ferait plus de fer et moins de blé ; et, veuillez remarquer ceci, les nouvelles usines s’établiraient dans des situations défavorables jusqu’à ce que le moment arrivât où, vendant le fer à 25 francs, elles ne gagneraient pas plus que les anciennes ne faisaient avec le prix de 20 francs. — C’est un très vaste point de vue, il va au cœur de la question et je le livre à votre sagacité.
Ne nous méprenons donc pas sur la nature et les effets de la protection. Les impôts directs et indirects étant répartis tant bien que mal, à quelque nombre de millions ou de milliards qu’ils s’élèvent, quel que soit l’emploi bon ou mauvais qu’on en fasse, la population n’est pas soulagée d’une obole par cela seul que les diverses industries se les repassent les unes aux autres. N’oublions pas d’ailleurs qu’il y a un nombre considérable de professions, et les plus démocratiques, qui sont par leur nature dans l’impossibilité radicale de prendre part à ce jeu, si ce n’est pour y perdre. Tel est, en première ligne, le travail manuel dont la rémunération est le salaire.
Si les taxes sont mal réparties, qu’on change la répartition ; rien de mieux. Si elles sont mal employées, qu’on les supprime ; d’accord. Mais tant qu’elles existent, tant qu’elles versent au trésor quinze cents millions, n’allons pas nous imaginer que c’est un prétexte raisonnable, encore moins une raison légitime, de diminuer la part de Jean en augmentant celle de Pierre ; et c’est là tout ce que fait et peut faire la protection. Que si Pierre obtient le même privilége, la taxe va toujours s’accumulant sur d’autres professions et particulièrement sur celles qui ne peuvent recevoir la protection douanière.
Un peuple surchargé d’impôt perd, j’en conviens, une partie de ses forces. Mais, sous l’empire du libre-échange, il a du moins la ressource de tirer le meilleur parti possible de celles qui lui restent. Ses taxes agissent comme tout autre obstacle naturel. Le pays F est faible relativement au pays A, comme si sa terre était moins féconde ou sa population moins vigoureuse. C’est un malheur, je le sais, mais un malheur sur lequel le régime restrictif agit comme aggravation, non comme compensation.
L’illusion à cet égard provient de ce que, comparant sans cesse le peuple taxé au peuple non taxé, on reconnaît à celui-ci des éléments de supériorité ; — et qui en doute ? Ce qu’il faut comparer, c’est le peuple taxé à lui-même sous les deux régimes, celui de la restriction et celui de la liberté.
Il y avait, aux environs de Paris, un hospice pour les aveugles. Ils travaillaient les uns pour les autres et ne faisaient des échanges qu’entre eux. Leur pitance était chétive, car ils étaient condamnés à exécuter des travaux bien difficiles et bien longs pour des aveugles. Le directeur de l’établissement leur donna enfin la liberté d’acheter et de vendre au dehors. Leur bien-être s’en augmenta progressivement, non pas jusqu’à égaler celui d’hommes clairvoyants, mais du moins jusqu’à dépasser de beaucoup ce qu’il était du temps de la restriction.
P. S. Le National dit aujourd’hui qu’il n’a pas trop su démêler à qui et à quoi je réponds. Me serais-je mépris sur le sens et la portée de son opposition au libre-échange ? Veut-il, comme nous, que l’entrelacement des intérêts unisse les classes laborieuses de tous les pays de manière à déjouer les calculs pervers ou imprudents de l’aristocratie ? Oh ! Dieu le veuille ! Je serais heureux de reconnaître mon erreur, et de voir avec nous, au moins sous ce rapport, un journal qui s’adresse à des hommes sincères et convaincus.
FN: Courrier français du 11 novembre 1846.
Post hoc, ergo propter hoc [6 December 1846] [CW3 ES2.8]↩
BWV
1846.12.06 “Post hoc, ergo propter hoc” (Post Hoc, Ergo Propter Hoc) [*Libre-Échange*, 6 December 1846] [ES2.8] [OC4.2.8, pp. 187-89] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
La main droite et la main gauche [13 December 1846] [CW3 ES2.16]↩
BWV
1846.12.13 “La main droite et la main gauche” (The Right Hand and the Left Hand) [*Libre-Échange*, 13 December 1846] [ES2.16] [OC4.2.16, pp. 258-65] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Les généralités [13 Décembre 1846] ↩
BWV
1846.12.13 “Sur les généralités” (On General Principles) [*Libre-Échange*, 13 Décembre 1846] [OC2.4, p. 12]
Sur les généralités
13 Décembre 1846
Le grand reproche qui nous arrive de divers quartiers, amis et ennemis, c’est de rester dans les généralités. « Abordez donc la pratique, nous dit-on, entrez dans les détails, descendez des nuages et laissez-y en paix les principes. Qui les conteste ? qui nie que l’échange ne soit une bonne, une excellente chose, in abstracto ? »
Il faut pourtant bien que nous ne nous soyons pas tout à fait fourvoyés et que nos coups n’aient pas toujours porté à faux. Car, s’il en était ainsi, comment expliquerait-on la fureur des protectionnistes ? Qu’on lise le placard qu’ils ont fait afficher dans les fabriques, pour l’édification des ouvriers, et la lettre qu’ils ont adressée aux ministres [1]. Croit-on que ce soit la pure abstraction qui les jette ainsi hors de toute mesure ?
Nous sommes dans les généralités ! — Mais cela est forcé, car nous défendons l’intérêt général. — N’avons-nous pas d’ailleurs à combattre une généralité ? Le système protecteur est-il autre chose ? Sur quoi s’appuie-t-il ? sur des raisonnements subtils : l’épuisement du numéraire, l’intérêt du producteur, le travail national, l’inondation, l’invasion, l’inégalité des conditions de production, etc., etc. — Charitables donneurs d’avis, faites-nous la grâce de nous dire ce qu’on peut opposer à de faux arguments, si ce n’est de bons arguments ?
« Opposez-leur des faits, nous dit-on, citez des faits, de petits faits bien simples, bien isolés, bien actuels, entremêlés de quelques chiffres bien frappants. »
C’est à merveille ; mais le fait et le chiffre n’apprennent rien par eux-mêmes. Ils ont leurs causes et leurs conséquences, et comment les démêler sans raisonner ?
Le pain est cher, voilà un fait. Qui le vend s’en réjouit ; qui le mange s’en afflige. Mais comment ce fait affecte-t-il en définitive l’intérêt général ? Tâchez de me l’apprendre sans raisonner.
Le peuple souffre ; voilà un autre fait. Souffrirait-il moins si un plus vaste marché s’ouvrait à ses ventes et à ses achats ? Essayez de résoudre le problème sans raisonner.
La restriction élève le prix du fer ; voilà un troisième fait. Et remarquez qu’il n’y a pas contestation sur le fait lui-même. M. Decaze ne le nie pas, ni sa clientèle non plus. Seulement l’un dit : tant, mieux ; et l’autre : tant pis. Des deux côtés on raisonne pour prouver qu’on a raison. Entreprenez donc de juger sans raisonner.
Nous dirons à nos amis : Vos intentions sont excellentes sans doute ; mais en nous interdisant les généralités, vous ne savez pas toute la force que vous portez à nos communs adversaires ; vous abondez dans leur sens, allez au-devant de leurs désirs. Ils ne demandent pas mieux que de voir bannir de la discussion les idées générales de vérité, liberté, égalité, justice ; car ils savent bien que c’est avec ces idées que nous les battrons.
Ils ne peuvent souffrir qu’on sorte du fait actuel et tout au pins de son effet immédiat. Pourquoi ? Parce que toute injustice a pour effet immédiat un bien et un mal. Un bien, puisqu’elle profite à quelqu’un ; un mal, puisqu’elle nuit à quelque autre. Dans ce cercle étroit, le problème serait insoluble et le statu quo éternel. C’est ce qu’ils veulent. Laissez-nous donc suivre les conséquences de la protection jusqu’à l’effet définitif, qui est un mal général.
Et puis, ne faites- vous pas trop bon marché de l’intelligence du pays ? À vous entendre, on croirait nos concitoyens incapables de lier deux idées. Nous avons d’eux une autre opinion, et c’est pourquoi nous continuerons à nous adresser à leur raison.
Les prohibitionnistes aussi en veulent beaucoup aux généralités. Que trouve-t-on dans leurs journaux, au rang desquels le Constitutionnel vient de s’enrôler ? d’interminables déclamations contre le raisonnement. Il faut que ces messieurs en aient bien peur.
Vous voulez des faits, messieurs les prohibitionnistes, rien que des faits ; eh bien ! en voici :
Le fait est que nous sommes trente-cinq millions de Français à qui vous défendez d’acheter du drap en Belgique, parce que vous êtes fabricants de drap.
Le fait est que nous sommes trente-cinq millions de Français à qui vous défendez de faire les choses contre lesquelles nous pourrions acheter du drap en Belgique. — Il est vrai que ceci sent un peu la généralité, car il faut raisonner pour comprendre que cette seconde prohibition est impliquée dans la première. — Revenons donc aux faits.
Le fait est que vous avez introduit dans la loi dix-huit prohibitions de ce genre.
Le fait est que ces prohibitions sont bien votre œuvre, car vous les défendez avec acharnement.
Le fait est que vous avez fait charger le fer et la houille, d’un droit énorme, afin d’en élever le prix, parce que vous êtes marchands de fer et de houille.
Le fait est que, par suite de cette manœuvre, les actions, de vos mines ont acquis une valeur fabuleuse, à tel point qu’il est tel d’entre vous qui ne les céderait pas pour dix fois le capital primitif.
Le fait est que le salaire de vos ouvriers n’a pas haussé d’une obole ; d’où il est permis d’inférer, si vous voulez bien nous permettre cette licence, que, sous prétexte de défendre le salaire des ouvriers, vous défendez vos profits.
Or, ces faits, d’ailleurs incontestables, sont-ils conformes à la justice ? Vous aurez bien de la peine à le prouver sans raisonner… et même en déraisonnant.
FN:La lettre adressée au conseil des ministres, et signée de MM. A. Odier, A. Mimerel, J. Perier et L. Lebeuf, finissait par cette menace : « Ne faites jamais que vos ennemis soient armés par ceux qui veulent toujours contribuer avec vous à la prospérité du pays. »
Quant au placard, en voici quelques phrases :
« Ils (les libre-échangistes) semblent ne pas s’apercevoir que, par là, ils travaillent à ruiner leur pays et qu’ils appellent l’Anglais à régner en France…
Celui qui veut une semblable chose n’aime pas son pays, n’aime pas l’ouvrier. »(Note de l’éditeur.)
De l'influence du régime protecteur sur l'agriculture [Décembre 1846] ↩
BWV
1846.12.15 “De l'influence du régime protecteur sur l'agriculture” (On the Impact of the Protectionist Regime on Agriculture) [*Journal des Économistes*, Décembre 1846] [OC2.7, p. 25]
De l'influence du régime protecteur sur l'agriculture en France
Journal des Économistes, Décembre 1846
Il n’est certainement aucun peuple qui se brûle à lui-même autant d’encens que le peuple français, quand il se considère en masse, et, pour ainsi dire, en nation abstraite. « Notre terre est la terre des braves ; notre pays, le pays de l’honneur et de la loyauté par excellence ; nous sommes généreux et magnifiques ; nous marchons à la tête de la civilisation, et ce qu’ont de mieux à faire tous les habitants de cette planète, c’est de recevoir nos idées, d’imiter nos mœurs et de copier notre organisation sociale. »
Que si nous venons, hélas ! à nous considérer classe par classe, fraction par fraction, non-seulement ces puissantes vibrations du dithyrambe n’arrivent plus à notre oreille, mais elles font place à une clameur d’accusations, à un feu croisé de reproches, qui, s’ils étaient vrais, nous réduiraient à accepter humblement la terrible condamnation de Rousseau. « Peuple français, tu n’es peut-être pas le plus esclave, mais tu es bien le plus valet de tous les peuples. »
Écoutez, en effet, ce que disent les Députés des Ministres, les Électeurs des Députés, les Prolétaires des Électeurs ! Selon le Commerce, le temple de Thémis est une forêt noire ; suivant la Magistrature, le Commerce n’est plus que l’art de la fraude. Si l’esprit d’association ne se développe que lentement, le faiseur d’entreprises s’en prend à la défiance qu’éprouve l’actionnaire, et l’actionnaire à la défiance qu’inspire le faiseur d’entreprises. Le paysan est un routinier ; le soldat, un instrument passif prêt à faire feu sur ses frères ; l’artisan, un être anormal qui n’est plus retenu par le frein des croyances sans l’être encore par celui de l’honneur. Enfin, si la moitié ou le quart seulement de ces récriminations étaient fondées, il faudrait en conclure que le misanthrope de Genève nous a traités avec ménagement.
Ce qu’il y a de singulier, c’est que nous en usons d’une façon tout opposée envers nos voisins d’outre-Manche. En masse, nous les accablons de nos mépris. « Méfiez-vous de l’Angleterre, elle ne cherche que des dupes, elle n’a ni foi ni loi ; son Dieu est l’intérêt, son but l’oppression universelle, ses moyens l’astuce, l’hypocrisie et l’abus de la force. » — Mais, en détail, nous lui élevons un piédestal afin de la mieux admirer. « Quelle profondeur de vues dans ses hommes d’État ! quel patriotisme dans ses représentants ! quelle habileté dans ses manufacturiers ! quelle audace dans ses négociants ! Comment l’association mettrait-elle en œuvre dans ce pays trente milliards de capitaux, si elle ne marchait pas dans la voie de la loyauté ? Voyez ses fermiers, ses ouvriers, ses mécaniciens, ses marins, ses cochers, ses palefreniers, ses grooms, etc., etc. »
Mais cette admiration outrée se manifeste surtout par le plus sincère de tous les hommages : l’imitation.
Les Anglais font-ils des conquêtes ? Nous voulons faire des conquêtes, sans examiner si nous avons, comme eux, des milliers de cadets de famille à pourvoir. Ont-ils des colonies ? nous voulons avoir des colonies, sans nous demander si, pour eux comme pour nous, elles ne coûtent pas plus qu’elles ne valent. Ont-ils des chevaux de course ? nous voulons des chevaux de course, sans prendre garde que ce qui peut être recherché par une aristocratie amante de la chasse et du jeu est fort inutile à une démocratie dont le sol fractionné n’admet guère la chasse, même à pied. Voyons-nous enfin leur population déserter les campagnes pour aller s’engloutir dans les mines, s’agglomérer dans les villes manufacturières, se matérialiser dans de vastes usines ? aussitôt notre législation, sans égard à la situation, à l’aptitude, au génie de nos concitoyens, se met en devoir de les attirer, par l’appât de faveurs dont ils supportent, en définitive, tous les frais, vers les mines, les grandes usines, et les villes manufacturières. — Qu’il me soit permis d’insister sur cette observation, qui me conduit d’ailleurs au sujet que j’ai à traiter.
Il est constaté que les deux tiers de la population habitent, en Angleterre, les villes, et en France, la campagne.
Deux circonstances expliquent ce phénomène.
La première, c’est la présence d’une aristocratie territoriale. Au delà du détroit, d’immenses domaines permettent d’appliquer à la culture du sol des moyens mécaniques et paraissent même rendre plus profitable l’extension du pâturage.
D’un autre côté, la situation géographique de l’Angleterre, placée entre le Midi et le Nord de l’Europe, et sur la route des deux hémisphères, la multitude et la profondeur de ses rades, le peu de pente de ses rivières qui donne tant de puissance aux marées, l’abondance de ses mines de fer et de houille, le génie patient, ordonné, mécanicien de ses ouvriers, les habitudes maritimes qui naissent d’une position insulaire, tout cela la rend éminemment propre à remplir, pour son compte et souvent pour le compte des autres peuples, à l’avantage de tous, deux grandes fonctions de l’industrie : la fabrication et le voiturage des produits.
Lors donc que la Grande-Bretagne aurait été abandonnée par le génie de ses hommes d’État au cours naturel des choses, lorsqu’elle n’aurait pas cherché à étendre au loin sa domination, lorsqu’elle n’aurait employé sa puissance qu’à faire régner la liberté du commerce et des mers, il n’est pas douteux qu’elle ne fût parvenue à une grande prospérité, et j’ajouterai, selon mes convictions profondes, à un degré de bonheur et de solide gloire qu’on peut certainement lui contester.
Mais, parce qu’ailleurs cette émigration de la campagne à la ville s’est opérée naturellement, était-ce une raison pour que la France dût chercher à la déterminer par des moyens artificiels ?
À Dieu ne plaise que je veuille m’élever ici d’une manière générale contre l’esprit d’imitation. C’est le plus puissant véhicule du progrès. L’invention est au génie, l’imitation est à tous. C’est elle qui multiplie à l’infini les bienfaits de l’invention. En matière d’industrie surtout, l’imitation, quand elle est libre, a peu de dangers. Si elle n’est pas toujours rationnelle, si elle se fourvoie quelquefois, au bout de chaque expérience il y a une pierre de touche, le compte des profits et pertes, qui est bien le plus franc, le plus logique, le plus péremptoire des redresseurs de torts. Il ne se contente pas de dire : « l’expérience est contre vous. » Il empêche de la poursuivre, et cela forcément, sans appel, avec autorité ; car la raison ne fût-elle pas convertie, la bourse est à sec.
Mais quand l’imitation est imposée à tout un peuple par mesure administrative, quand la loi détermine la direction, la marche et le but du travail, il ne reste plus qu’un souhait à faire : c’est que cette loi soit infaillible ; car si elle se trompe, au moment où elle donne une impulsion déterminée à l’industrie, celle-ci doit suivre toujours une voie funeste.
Or, je le demande, le sol, le soleil de la France, sa position géographique, la constitution de son régime foncier, le génie de ses habitants justifient-ils des mesures coercitives, par lesquelles on pousserait la population des travaux agricoles aux travaux manufacturiers et du champ à l’usine ?
Si la fabrication était plus profitable, on n’avait pas besoin de ces mesures coercitives. Le profit a assez d’attrait par lui-même. Si elle l’est moins, — en déplaçant les capitaux et le travail, en faisant violence à la nature physique et intellectuelle des hommes, on n’a fait qu’appauvrir la nation.
Je ne m’attacherai pas à démontrer que la France est essentiellement un pays agricole ; aussi bien, je ne me rappelle pas avoir jamais entendu mettre cette proposition en doute. Je n’entends pas dire que toutes les fabriques, tous les arts doivent en être bannis. Qui pourrait avoir une telle pensée ? Je dis qu’abandonnée à ses instincts, à sa pente, à son impulsion naturelle, — les capitaux, les bras, les facultés se distribueraient entre tous les modes d’activité humaine, agriculture, fabrication, arts libéraux, commerce, navigation, exertions intellectuelles et morales, dans des proportions toujours harmoniques, toujours calculées pour faire sortir de chaque effort le plus grand bien du plus grand nombre. J’ajoute, sans crainte d’être contredit, que, dans cet ordre naturel de choses, l’agriculture et la fabrication seraient entre elles dans le rapport du principal à l’accessoire, quoiqu’il en puisse être tout différemment en Angleterre.
On nous accuse, nous partisans du libre-échange, de copier servilement un exemple venu d’Angleterre. Mais si jamais imitation a été servile, maladroite, inintelligente, c’est assurément le régime que nous combattons, le régime protecteur.
Examinons-en les effets sur l’agriculture française.
Tous les agronomes (je ne dis pas les agronomanes, ceux-ci décuplent le revenu des terres avec une facilité sans égale), tous les agronomes, dis-je, sont d’accord sur ce point, que ce qui manque à notre agriculture, ce sont les capitaux. Sans doute, il lui manque aussi des lumières ; mais l’art arrive avec les moyens d’améliorer, et il n’est paysan si routinier qui ne sût fort bien placer sur sa métairie ses épargnes à bon intérêt, s’il en pouvait faire.
La plus petite amélioration de détail exige des avances ; à plus forte raison une amélioration d’ensemble. Voulez-vous perfectionner vos voitures de transport ? Vous êtes entraîné à élargir, niveler, et graveler les chemins de la ferme. Voulez-vous défricher ? Outre qu’il y faut beaucoup de main-d’œuvre, il faut songer à augmenter les frais de semonces, labours, cultures, moissons, transports, etc. Mais vous vient-il dans l’idée de faire faire à votre exploitation ce pas plus décisif, qui en change toutes les conditions, je veux dire de substituer à la culture de deux céréales avec jachère, un assolement où céréales, plantes sarclées, végétaux textiles et fourrages divers viennent occuper tour à tour chaque division du sol, dans un ordre régulier ? Malheur à vous, si vous n’avez pas prévu la très-notable augmentation de capital qui vous est nécessaire ? Dès qu’un tel changement s’introduit dans le domaine, une activité inaccoutumée se manifeste. La terre ne se repose plus, et ne laisse pas reposer les têtes et les bras. La jachère, les prairies permanentes, les pâturages sont soumis à l’action de la charrue. Les labours, les hersages, les semailles, les sarclages, les moissons, les transports se multiplient ; et le temps est passé où l’on pouvait se contenter d’instruments grossiers fabriqués en famille. Les semences de trèfle, de lin, de colza, de betterave, de luzerne, etc., ne laissent pas que d’exiger de gros débours. Mais c’est surtout le département des étables, soit qu’on y entretienne des vaches laitières, des bœufs à l’engrais, ou des moutons de races perfectionnées, qui devient un véritable atelier industriel, fort lucratif quand il est bien conduit, mais plein de déception si on le fonde avec un capital insuffisant. Dans ce système, pour doubler le produit net, il faut, non pas doubler, mais sextupler peut-être le produit brut, en sorte qu’une exploitation qui présentait 5,000 fr. de produit net, avec un compte de 15,000 fr. en entrée et sortie, — pour être amenée à donner 10,000 fr. de profit, devra présenter un compte de dépenses et de recettes de 60 à 80,000 francs.
Les avantages de la culture perfectionnée sont tellement clairs, tellement palpables, ils ont été démontrés dans tant de livres répandus à profusion, proclamés par tant d’agronomes dont l’expérience est incontestable, confirmés par tant d’exemples, que, s’il n’a pas été fait plus de progrès, il faut bien en chercher la cause ailleurs que dans l’attachement aux vieilles coutumes et dans cette routine, que, fort routinièrement, on accuse toujours de tout. Les agriculteurs, croyez-le bien, sont un peu faits comme tout le monde ; et le bien-être ne leur répugne en aucune façon. D’ailleurs, il y a partout des hommes disposés à combattre cette nature de résistance. Ce qui a manqué, ce qui manque encore, c’est le capital. C’est là ce qui a réduit les tentatives à un bien petit nombre, et, dans ce petit nombre, c’est là ce qui a entraîné tant de revers.
Les agronomes les plus renommés, les Young, les Sinclair, les Dombasle, les Pictet, les Thaër, ont recherché quel était le capital qui serait nécessaire pour amener les pratiques au niveau des connaissances agricoles. Leurs livres sont pleins de ces calculs. Je ne les produirai pas ici. Je me bornerai à dire que ces avances doivent être d’autant plus grandes que l’exploitation est plus petite, et que, pour la France, ce ne serait peut-être pas trop d’un capital égal en valeur à la valeur du sol lui-même.
Mais si un énorme supplément de capital est indispensable au perfectionnement de l’agriculture, est-il permis d’espérer qu’elle le tire de son propre sein ?
Il faut bien que les publicistes ne le pensent pas, car on les voit tous à la recherche de ce problème : Faire refluer les capitaux vers l’agriculture. Tantôt on a songé à réformer notre régime hypothécaire. On devrait supposer à priori, a-t-on dit avec raison, que le prêteur sur hypothèque ne recherche pas un taux d’intérêt supérieur à la rente de la terre, puisque celle-ci sert de gage au prêt et qu’elle est même assujettie à des chances (ravages pour cause d’inondation, insolvabilité des fermiers, etc.) dont le prêt est exempt. Cependant un emprunt sur hypothèque revient à 6, 7 et 8 pour 100, tandis que la rente du sol ne dépasse pas 3 ou 4 pour 100 ; d’où l’on a conclu que notre système hypothécaire doit être entaché de nombreuses imperfections.
D’autres ont imaginé des banques agricoles, des institutions financières qui auraient pour résultat de mobiliser le sol et de le faire entrer, pour ainsi dire comme un billet au porteur, dans la circulation. — Il y en a qui veulent que le prêt soit fait par l’État, c’est-à-dire par l’impôt, cet éternel et commode point d’appui de toutes les utopies. Des combinaisons plus excentriques sont aussi fort en vogue sous les noms beaucoup moins clairs qu’imposants, d’organisation ou réorganisation du travail, association du travail et du capital, phalanstères, etc., etc.
Ces moyens peuvent être fort bons, on peut en attendre d’excellents effets ; mais il en est un qu’ils ne parviendront jamais à produire, c’est de créer de nouveaux moyens de production. Déplacer les capitaux, les détourner d’une voie pour les attirer dans une autre, les pousser alternativement du champ à l’usine et de l’usine au champ, voilà ce que la loi peut faire ; mais il n’est pas en sa puissance d’en augmenter la masse, à un moment donné ; vérité bien simple et constamment négligée.
Ainsi, si la réforme du régime hypothécaire parvenait à attirer une plus grande portion du capital national vers l’agriculture, ce ne pourrait être qu’en le détournant de l’industrie proprement dite, des prêts à l’État, des chemins de fer, des canaux, de la colonisation d’Alger, des hauts-fourneaux, des mines de houille, des grandes filatures, en un mot des diverses issues ouvertes à son activité.
Avant donc d’imaginer des moyens artificiels pour lui faire faire cette évolution, ne serait-il pas bien naturel de rechercher si une cause, également artificielle, n’a pas déterminé en lui l’évolution contraire ?
Eh bien ! oui, il y a une cause qui explique comment certaines entreprises ont aspiré le capital agricole.
Cette cause, je l’ai déjà dit, c’est l’imitation mal entendue du régime économique de l’Angleterre, c’est l’ambition, favorisée par la loi, de devenir, avant le temps, un peuple éminemment manufacturier, en un mot, c’est le système protecteur.
Si le travail, les capitaux, les facultés eussent été abandonnés à leur pente naturelle, ils n’auraient pas déserté prématurément l’agriculture, alors même que chaque Français eût été saisi de l’anglomanie la plus outrée. Il n’y a pas d’anglomanie qui détermine, d’une manière permanente, un homme à ne gagner qu’un franc au lieu de deux, un capital à se placer à 10 pour 400 de perte, au lieu de 10 pour 100 de profit. Sous le régime de la liberté, le résultat est là qui avertit à chaque instant si l’on fait ou non fausse route [1].
Mais quand l’État s’en mêle, c’est tout différent ; car quoiqu’il ne puisse pas changer le résultat général et faire que la perte soit bénéfice, il peut fort bien altérer les résultats partiels et faire que les pertes de l’un retombent sur l’autre. Il peut, par des taxes plus ou moins déguisées, rendre une industrie lucrative aux dépens de la communauté, attirer vers elle l’activité des citoyens, par un déplorable déplacement du capital, et, les forçant à l’imitation, réduire l’anglomanie en système.
L’État donc, voulant implanter en France, selon l’expression consacrée, certaines industries manufacturières, a été conduit à prendre les mesures suivantes :
1° Prohiber ou charger de forts droits les produits fabriqués au dehors ;
2° Donner de fortes subventions ou primes aux produits fabriqués au dedans ;
3° Avoir des colonies et les forcer à consommer nos produits, quelque coûteux qu’ils soient, sauf à forcer le pays à consommer, bon gré mal gré, les produits coloniaux.
Ces moyens sont différents, mais ils ont ceci de commun qu’ils soutiennent des industries qui donnent de la perte, perte qu’une cotisation nationale transforme en bénéfice. — Ce qui perpétue ce régime, ce qui le rend populaire, c’est que le bénéfice crève les yeux, tandis que la cotisation qui le constitue passe inaperçue [2].
Les publicistes, qui savent que l’intérêt du consommateur est l’intérêt général, proscrivent de tels expédients. Mais ce n’est pas sous ce point de vue que je les considère dans cet article ; je me borne à rechercher leur influence sur la direction du capital et du travail.
L’erreur des personnes (et elles sont nombreuses) qui soutiennent de bonne foi le régime protecteur, c’est de raisonner toujours comme si cette portion d’industrie que ce système fait surgir était alimentée par des capitaux tombés du ciel. Sans cette supposition toute gratuite, il leur serait impossible d’attribuer à des mesures restrictives aucune influence sur l’accroissement du travail national.
Quelque onéreuse que soit sous un régime libre la production d’un objet, dès qu’on le prohibe, elle peut devenir une bonne affaire. Les capitaux sont sollicités vers ce genre d’entreprise par la hausse artificielle du prix. Mais n’est-il pas évident qu’au moment où le décret est rendu il y avait dans le pays un capital déterminé ? Une partie de ce capital était employée à produire la chose qui s’échangeait contre l’objet exotique. Qu’arrive-t-il ? Ce produit national est moins demandé, son prix baisse, et le capital tend à déserter cet emploi. Au contraire, le produit similaire à l’objet exotique renchérit, et le capital se trouve poussé vers cette nouvelle voie. Il y a évolution, mais non création de capital ; évolution, et non création de travail. L’un entraîne l’autre du champ à l’atelier, du labour à l’usine, de France en Algérie. Entre les partisans de la liberté et ceux de la protection, la question se réduit donc à ceci : la direction artificielle, imprimée au capital et au travail, vaut-elle mieux que leur direction naturelle ?
Un agriculteur de mes amis, sur la foi d’un prospectus qui promettait monts et merveilles, prit cinq actions dans une filature de lin à la mécanique. Certes, on ne prétendra pas que ces 5,000 francs, il les avait tirés du néant. Il les devait à ses sueurs et à ses épargnes. Il aurait pu certainement les employer sur sa ferme, et, de quelque manière qu’il l’eût fait, ils auraient, en définitive, payé de la main-d’œuvre ; car je défie qu’on me prouve qu’une dépense quelconque soit autre chose que le salaire d’un travail actuel ou antérieur.
Ce qui est arrivé à mon ami est arrivé à tous ceux qui se sont lancés dans les industries privilégiées ; et il me semble impossible qu’on se refuse à reconnaître qu’il ne s’agit pas, en tout ceci, de création, mais de direction de capital et de travail.
Or, en supposant (ce qui n’est pas) que la filature eût tenu ses promesses, ces 3,000 francs ont-ils été plus productifs qu’ils ne l’eussent été sur la ferme ?
Oui, si l’on ne voit que le capitaliste ; non, si l’on considère l’ensemble des intérêts nationaux.
Car, si mon ami a tiré 10 pour 100 de ses avances, c’est que la force est intervenue pour contraindre le consommateur à lui payer un tribut. Ce tribut entre peut-être pour les deux tiers ou les trois quarts dans ces 10 pour 100. Sans l’intervention de la force, ces 3,000 francs auraient donné et au delà de quoi payer à l’étranger le filage exécuté en France. Et la preuve, c’est le fait même qu’il a fallu la force pour en déterminer la déviation.
Il me semble qu’on doit commencera entrevoir comment le régime protecteur a porté un coup funeste à notre agriculture.
Il lui a nui de trois manières :
1° En forçant les agriculteurs à surpayer les objets de consommation, fer, instruments aratoires, vêtements, etc., et en empêchant ainsi la formation de capitaux au sein même de l’industrie agricole ;
2° En lui retirant ses avances pour les engager dans les industries protégées ;
3° En décourageant la production agricole dans la mesure de ce qu’elle eût dû produire pour acquitter les services industriels que, sous le régime de la liberté, le France eût demandés au dehors.
La première proposition est évidente de soi ; je crois avoir insisté assez sur la seconde ; la troisième me parait présenter le même degré de certitude.
Lorsqu’un homme, un département, une province, une nation, un continent, un hémisphère même, s’abstiennent de produire une chose parce que les frais de création dépassent ceux d’acquisition, il ne s’ensuit nullement, comme on le répète sans cesse, que le travail de cet homme ou de cette circonscription territoriale diminue de tout ce qu’eût exigé cette création ; il s’ensuit seulement qu’une part de ce travail est consacrée à produire les moyens d’acquisition, et une autre, restée disponible, à satisfaire d’autres besoins. Cette dernière est le profit net de l’échange [3].
Un tailleur donne tout son temps à la confection des vêtements. Il serait bien mauvais praticien, s’il en détachait trois heures pour faire des souliers, et plus mauvais théoricien, s’il s’imaginait avoir par là allongé sa journée.
Il en est de même d’un peuple. Quand le Portugal veut à toute force faire des mouchoirs et des bonnets de coton, il se trompe assurément, s’il ne s’aperçoit pas qu’il appauvrit la culture de la vigne et de l’oranger, qu’il se prive des moyens d’améliorer le lit et de défricher les rives du Tage. D’un autre côté, si l’Angleterre, par des mesures coercitives, force les capitaux à élever la vigne et l’oranger en serre chaude, elle amoindrit d’autant des ressources qui seraient mieux employées dans ses fabriques. Encore une fois, il y a là évolution, et non accroissement des moyens de production.
Ainsi, en même temps que le régime prohibitif a enlevé à l’agriculture la faculté de s’améliorer, il lui en a ôté l’occasion ; car à quoi bon produire les objets, céréales, vins, fruits, soies, lins, etc., pour acquitter des services étrangers qu’il n’est pas permis d’acheter ?
Si le régime protecteur ne nous eût pas entraînés à imiter les Anglais, il est possible que nous ne les égalerions pas dans ces industries qui ont pour agents le fer et le feu ; mais il est certain que nous aurions développé, bien plus que nous ne l’avons fait, celles qui ont pour agents la terre et l’eau. En ce moment nos montagnes seraient reboisées, nos fleuves contenus, notre sol sillonné de canaux et soumis à l’irrigation, la jachère aurait disparu, des récoltes variées se succéderaient sans interruption sur toute la surface du pays ; les campagnes seraient animées, les villages offriraient à l’œil le doux aspect du contentement, de l’aisance et du progrès. Le travail et l’intelligence auraient suivi le capital dans la voie des améliorations agricoles ; des hommes de mérite auraient tourné vers les champs l’activité, les lumières et l’énergie que d’injustes faveurs ont attirées vers les manufactures. Il y aurait peut-être quelques ouvriers de moins au fond des galeries d’Anzin, ou dans les vastes usines de l’Alsace, ou dans les caves de Lille. Mais il y aurait de vigoureux paysans de plus dans nos plaines et sur nos coteaux, et, sous quelque rapport que ce soit, pour la force défensive, pour l’indépendance, pour la sécurité, pour le bien-être, pour la dignité, pour la sécurité de notre population, je ne pense pas que nous eussions rien à envier à nos voisins.
On objectera peut-être que, dans ce cas, la nation française eût été purement agricole : je ne le crois pas ; pas plus que la nation anglaise n’eût été exclusivement manufacturière. Chez l’une, le grand développement de la fabrication eût encouragé l’agriculture. Chez l’autre, la prospérité de l’agriculture eût favorisé la fabrication ; car malgré la liberté la plus complète dans les relations des peuples, il y a toujours des matières premières qu’il est avantageux de mettre en œuvre sur place. On peut même concevoir (et pour moi du moins c’est un phénomène qui n’a rien d’étrange) que, produisant beaucoup plus de matières premières, la France en envoyât une grande partie se manufacturer en Angleterre, et en eût encore assez à fabriquer chez elle pour que son industrie manufacturière dépassât l’activité que nous lui voyons aujourd’hui ; à peu près comme Orléans a probablement plus d’industrie, malgré tout ce qui lui arrive de Paris, que si Paris n’existait pas.
Mais ces manufactures, nées à l’air de la liberté, auraient le pied sur un terrain solide, inébranlable, et elles ne seraient pas à la merci d’un article d’un des cent tarifs de l’Europe.
FN:V. Harmonies, chap. xx. (Note de l’éditeur.)
FN:V. le chap. vii de Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, tome V, page 363. (Note de l’éditeur.)
FN:V. le chap. Échange, tome VI. (Note de l’éditeur.)
Le libre-échange [19 Décembre 1846] ↩
BWV
1846.12.19 “Le libre-échange” (Free Trade) [*Libre-Échange*, 19 Décembre 1846] [OC2.2, p. 4]
Libre-Échange
19 Décembre 1846
On nous reproche ce titre. « Pourquoi ne pas déguiser votre pensée ! nous dit-on. Les villes hésitent, les hommes pratiques sentent qu’il y a quelque chose à faire. Vous les effrayez. N’osant aller à vous et ne pouvant rester neutres, les voilà qui vont grossir les rangs de vos adversaires. »
Quelques défections passagères ne nous feront pas déserter le drapeau auquel nous avons mis notre confiance. Libre-Échange ! Ce mot fait notre force. Il est notre épée et notre bouclier. Libre-Échange ! C’est un de ces mots qui soulèvent des montagnes. Il n’y a pas de sophisme, de préjugé, de ruse, de tyrannie qui lui résiste. Il porte en lui-même et la démonstration d’une Vérité, et la déclaration d’un Droit, et la puissance d’un Principe. Croyez-vous que nous nous sommes associés pour réclamer tel ou tel changement partiel dans la pondération des tarifs ! Non. Nous demandons que tous nos concitoyens, libres de travailler, soient libres d’échanger le fruit de leur travail ; et il y a trop de justice dans cette demande pour que nous essayions de l’arracher à la loi par lambeaux et à l’opinion par surprise.
Cependant, et pour éviter toute fausse interprétation, nous répéterons ici qu’il est à la liberté d’échanger une limite qu’il n’entre pas dans nos vues, en tant qu’association, de conseiller ou de repousser. Échange, propriété, c’est la même chose à nos yeux, malgré l’opinion contraire de M. Billault [1].
Si donc l’État a besoin d’argent, qu’il le prélève sur la propriété ou sur l’échange, nous ne voyons pas là la violation d’un principe. Peut-être l’impôt sur l’échange a-t-il plus d’inconvénients que l’impôt sur la propriété. On le croit en Suisse, on pense le contraire aux Étals-Unis. Peut-être la France, avec son budget, n’est-elle pas libre de choisir. En tout cas, l’association ne s’est pas formée pour comparer entre elles les diverses natures de taxes ; et ceux qui l’accusent de ne point combattre l’octroi prouvent qu’elle sait se renfermer dans sa mission.
Mais si un simple citoyen vient dire à un autre : « Tu as travaillé, tu as touché ton salaire ; je te défends de l’échanger d’une façon qui t’arrange, mais qui me dérange, » nous disons que c’est là une insupportable tyrannie.
Et si, au lieu de prononcer l’interdiction de sa pleine autorité, il a assez de crédit pour la faire prononcer par la loi, nous disons que la tyrannie n’en est que plus insupportable et plus scandaleuse.
Et si, de plus, il a pour lui l’opinion égarée, cela peut bien nous forcer d’agir sur l’opinion pour arriver à la loi ; mais non nous faire reconnaître que l’acte en soit moins tyrannique dans sa nature et dans ses effets.
Nous répétons encore que nous n’avons jamais demandé une réforme brusque et instantanée ; nous désirons qu’elle s’opère avec le moins de dommage possible, en tenant compte de tous les intérêts. Sachons une fois où nous allons, et nous verrons ensuite s’il convient d’aller vite ou lentement. La Presse [2] nous disait ces jours-ci que si elle croyait, comme nous, le régime protecteur injuste et funeste, elle réclamerait la liberté immédiate. Nous l’engageons à faire l’application de ce puritanisme à la question de l’esclavage.
Partisans de l’affranchissement du commerce, si le sentiment de la justice entre pour quelque chose dans vos convictions, levez courageusement le drapeau du Libre-Échange. Ne cherchez pas de détours ; n’essayez pas de surprendre nos adversaires. Ne cherchez point un succès partiel et éphémère par d’inconséquentes transactions. — Ne vous privez pas de tout ce qu’il y a de force dans un principe, qui trouvera tôt ou tard le chemin des intelligences et des cœurs. On vous dira que le pays repousse les abstractions, les généralités, qu’il veut de l’actuel et du positif, qu’il reste sourd à toute idée qui ne s’exprime pas en chiffres. Ne vous rendez pas complice de cette calomnie. La France se passionne pour les principes et aime à les propager. C’est le privilége de sa langue, de sa littérature et de son génie.
La lassitude même dont elle donne au monde le triste spectacle en est la preuve ; car si elle se montre fatiguée des luttes de parti, c’est qu’elle sent bien qu’il n’y a rien derrière que des noms propres. Plutôt que de renoncer aux idées générales, on la verrait s’engouer des systèmes les plus bizarres. N’espérez pas qu’elle se réveille pour une modification accidentelle du tarif. L’aliment qu’il faut à son activité, c’est un principe qui renferme en lui-même tout ce qui, depuis des siècles, a fait battre son cœur. La liberté du commerce, les libres relations des peuples, la libre circulation des choses, des hommes et des idées, la libre disposition pour chacun du fruit de son travail, l’égalité de tous devant la loi, l’extinction des animosités nationales, la paix des nations assurée par leur mutuelle solidarité, toutes les réformes financières rendues possibles et faciles par la paix, les affaires humaines arrachées aux dangereuses mains de la diplomatie, la fusion des idées et par conséquent l’ascendant progressif de l’idée démocratique, voilà ce qui passionnera notre patrie, voilà ce qui est compris dans ce mot : Libre-Échange ; et il ne faut point être surpris si son apparition excite tant de clameurs. Ce fut le sort du libre examen et de toutes les autres libertés dont il tire sa populaire origine.
Ce n’est pas que nous soyons assez fanatiques pour voir dans cette question la solution de tous les problèmes sociaux et politiques. Mais on ne peut nier que la libre communication des peuples ne favorise le mouvement de l’humanité vers le bien-être, l’égalité et la concorde ; et s’il est vrai que chaque peuple ait sa mission et chaque génération sa tâche, la preuve que l’affranchissement de l’échange est bien l’œuvre dévolue à nos jours, c’est que c’est la seule où les hommes de tous les partis trouvent un terrain neutre et peuvent travailler de concert. Gardons-nous donc de compromettre ce principe par des transactions inintelligentes, par le puéril attrait d’un succès partiel et prématuré. Vit-on jamais le système des expédients réaliser dans le monde quelque chose de grand [3] ?
FN:M. Billault, récemment ministre de l’intérieur, a plusieurs fois émis comme avocat et comme représentant, des vues protectionnistes. (V. tome IV, pages 511 et suiv.) (Note de l’éditeur.)
FN:À cette époque, le journal la Presse n’était pas encore converti au principe de la liberté. (Note de l’éditeur.)
FN:V. ci-après, n° 44, la fin du discours prononcé à la salle Taranne, le 3 juillet 1847. (Note de l’éditeur.)
Recettes protectionnistes [Recipes for Protectionism] [27 December 1846] [CW3 ES3.1]↩
BWV
1846.12.27 “Recettes protectionnistes” (Recipes for Protectionism) [*Libre-Échange*, 27 December 1846] [OC2.53, pp. 358-63] [CW3] [ES3.1]
Depuis que nous avons publié un rapport au Roi sur le grand parti qu’on pourrait tirer d’une paralysie générale des mains droites, [54] comme moyen de favoriser le travail, il paraît que beaucoup de cervelles sont en quête de nouvelles recettes protectionnistes. Un de nos abonnés nous envoie, sur ce sujet, une lettre qu’il a l’intention d’adresser au conseil des ministres. Il nous semble qu’elle contient des vues dignes de fixer l’attention des hommes d’État. Nous nous empressons de la reproduire.
Messieurs les ministres,
Au moment où la protection douanière semble compromise, la nation reconnaissante voit avec confiance que vous vous occupez de la ressusciter sous une autre forme. C’est un vaste champ ouvert à l’imagination. Votre système de gaucherie a du bon ; mais il ne me semble pas assez radical, et je prends la liberté de vous suggérer des moyens plus héroïques, toujours fondés sur cet axiome fondamental : l’intensité du travail, abstraction faite de ses résultats, c’est la richesse.
De quoi s’agit-il ? de fournir à l’activité humaine de nouveaux aliments. C’est ce qui lui manque ; et, pour cela, de faire le vide dans les moyens actuels de satisfaction, — de créer une grande demande de produits.
J’avais d’abord pensé qu’on pourrait fonder de grandes espérances sur l’incendie, — sans négliger la guerre et la peste. — Par un bon vent d’ouest mettre le feu aux quatre coins de Paris, ce serait certainement assurer à la population les deux grands bienfaits que le régime protecteur a en vue : travail et cherté. — ou plutôt travail par cherté. Ne voyez-vous pas quel immense mouvement l’incendie de Paris donnerait à l’industrie nationale ? En est-il une seule qui n’aurait de l’ouvrage pour vingt ans ? Que de maisons à reconstruire, de meubles à refaire, d’outils, d’instruments, d’étoffes, de livres et de tableaux à remplacer ! Je vois d’ici le travail gagner de proche en proche et s’accroître par lui-même comme une avalanche, car l’ouvrier occupé en occupera d’autres et ceux-ci d’autres encore. Ce n’est pas vous qui viendrez prendre ici la défense du consommateur, car vous savez trop bien que le producteur et le consommateur ne font qu’un. Qu’est-ce qui arrête la production ? Évidemment les produits existants. Détruisez-les, et la production prendra une nouvelle vie. Qu’est-ce que nos richesses ? ce sont nos besoins, puisque sans besoins point de richesses, sans maladies point de médecins, sans guerres point de soldats, sans procès point d’avocats et de juges. Si les vitres ne se cassaient jamais, les vitriers feraient triste mine ; si les maisons ne s’écroulaient pas, si les meubles étaient indestructibles, que de métiers seraient en souffrance ! Détruire, c’est se mettre dans la nécessité de rétablir. Multiplier les besoins, c’est multiplier la richesse. Répandez donc partout l’incendie, la famine, la guerre, la peste, le vice et l’ignorance, et vous verrez fleurir toutes les professions, car toutes auront un vaste champ d’activité. Ne dites-vous pas vous-mêmes que la rareté et la cherté du fer font la fortune des forges ? N’empêchez-vous pas les Français d’acheter le fer à bon marché ? Ne faites-vous pas en cela prédominer l’intérêt de la production sur celui de la consommation ? Ne créez-vous pas, pour ainsi dire, la maladie afin de donner de la besogne au médecin ? Soyez donc conséquents. Ou c’est l’intérêt du consommateur qui vous guide, et alors recevez le fer ; ou c’est l’intérêt du producteur, et en ce cas, incendiez Paris. Ou vous croyez que la richesse consiste à avoir plus en travaillant moins, et alors laissez entrer le fer ; ou vous pensez qu’elle consiste à avoir moins avec plus de travail, et en ce cas brûlez Paris ; car de dire comme quelques-uns : Nous ne voulons pas de principes absolus, — c’est dire : Nous ne voulons ni la vérité, ni l’erreur, mais un mélange de l’une et de l’autre : erreur, quand cela nous convient, vérité quand cela nous arrange.
Cependant, Messieurs les Ministres, ce système de protection, quoique théoriquement en parfaite harmonie avec le régime prohibitif, pourrait bien être repoussé par l’opinion publique, qui n’a pas encore été suffisamment préparée et éclairée par l’expérience et les travaux du Moniteur industriel. Vous jugerez prudent d’en ajourner l’exécution à des temps meilleurs. Vous le savez, la production surabonde, il y a partout encombrement de marchandises, la faculté de consommer fait défaut à la faculté de produire, les débouchés sont trop restreints, etc., etc. Tout cela nous annonce que l’incendie sera bientôt regardé comme le remède efficace à tant de maux.
En attendant, j’ai inventé un autre mode de protection qui me semble avoir de grandes chances de succès.
Il consiste simplement à substituer un encouragement direct à un encouragement indirect.
Doublez tous les impôts ; cela vous créera un excédant de recettes de 14 à 1,500 millions. Vous répartirez ensuite ce fonds de subvention entre toutes les branches de travail national pour les soutenir, les aider et les mettre en mesure de résister à la concurrence étrangère.
Voici comment les choses se passeront.
Je suppose que le fer français ne puisse se vendre qu’à 350 fr. la tonne. — Le fer belge se présente à 300 fr. — Vite vous prenez 55 fr. sur le fonds de subvention et les donnez à notre maître de forge. — Alors il livre son fer à 295 fr. Le fer belge est exclu, c’est ce que nous voulons. Le fer français reçoit son prix rémunérateur de 350 fr., c’est ce que nous voulons encore.
Le blé étranger a-t-il l’impertinence de s’offrir à 17 fr. quand le blé national exige 18 francs ? Aussitôt vous donnez 1 franc 50 centimes à chaque hectolitre de notre blé qui se vend à 16 francs 50 centimes, et chasse ainsi son concurrent. Vous procéderez de même pour les draps, toiles, houilles, bestiaux, etc., etc. Ainsi le travail national sera protégé, la concurrence étrangère éloignée, le prix rémunérateur assuré, l’inondation prévenue, et tout ira pour le mieux.
« Eh ! morbleu, c’est justement ce que nous faisons, me direz-vous. Entre votre projet et notre pratique, il n’y a pas un atome de différence. Même principe, même résultat. Le procédé seul est légèrement altéré. Les charges de la protection, que vous mettez sur les épaules du contribuable, nous les mettons sur celles du consommateur, ce qui, en définitive, est la même chose. Nous faisons passer directement la subvention du public au protégé. Vous, vous la faites arriver du public au protégé, par l’intermédiaire du Trésor, rouage inutile, en quoi seulement votre invention se distingue de la nôtre. »
Un moment, Messieurs les Ministres, je conviens que je ne propose rien de neuf. Mon système et le vôtre sont identiques. C’est toujours le travail de tous subventionnant le travail de chacun, — pure illusion, — ou de quelques-uns, — criante injustice.
Mais laissez-moi vous faire observer le beau côté de mon procédé. Votre protection indirecte ne protège efficacement qu’un petit nombre d’industries. Je vous offre le moyen de les protéger toutes. Chacune aura sa part à la curée. Agriculteurs, fabricants, négociants, avocats, médecins, fonctionnaires, auteurs, artistes, artisans, ouvriers, tous mettent leur obole à la tirelire de la protection ; n’est-il pas bien juste que tous y puisent quelque chose ?
Sans doute, cela serait juste, mais dans la pratique… — Je vous vois venir. Vous allez me dire : Comment doubler et tripler les impôts ? comment arracher 150 millions à la poste, 300 millions au sel, un milliard à la contribution foncière ?
— Rien de plus simple. — Et d’abord, par vos tarifs vous les arrachez bien réellement au public, et vous allez comprendre que mon procédé ne vous donnera aucun embarras, si ce n’est quelques écritures, car tout se passera sur le papier.
En effet, selon notre droit public, chacun concourt à l’impôt en proportion de sa fortune.
Selon l’équité, l’État doit à tous une égale protection.
Il résulte de là que mon système se réduira, pour M. le ministre des finances, à ouvrir à chaque citoyen un compte qui se composera invariablement de deux articles, ainsi qu’il suit :
Doit N. à la caisse des subventions 100 fr. pour sa part d’impôts.
Avoir N. par la caisse des subventions, 90 fr. pour sa part de protection.
— Mais c’est comme si nous ne faisions rien du tout !
— C’est très-vrai. Et par la douane non plus vous ne feriez rien du tout, si vous pouviez la faire servir à protéger également tout le monde.
— Aussi ne l’appliquons-nous qu’à protéger quelques-uns.
— C’est ce que vous pouvez très-bien faire par mon procédé. Il suffit de désigner d’avance les classes qui seront exclues, quand on partagera les fonds de la tontine, pour que la part des autres soit plus grosse.
— Ce serait une horrible injustice.
— Vous la commettez bien maintenant.
— Du moins, nous ne nous en apercevons pas.
— Ni le public non plus. Voilà pourquoi elle se commet.
— Que faut-il donc faire ?
— Protéger tout le monde, ou ne protéger personne.
À quoi se réduit l'invasion [27 Décembre 1846] [CW3] [ES3.1]↩
BWV
1846.12.27 “A quoi se réduit l'invasion” (What does Invasion amount to?) [*Libre-Échange*, 27 Décembre 1846] [OC2.11, 58]
À quoi se réduit l'invasion
27 Décembre 1846
Si nous avons une foi entière dans le triomphe de notre cause, malgré la formidable opposition qu’elle rencontre, c’est que nous nous attendons à voir les faits venir l’un après l’autre déposer en sa faveur.
Au moment où nous écrivons, les ports de France sont ouverts aux céréales du monde entier.
Excepté Bayonne, où le jeu de l’échelle mobile amène des résultats fort bizarres. — Le froment y manque et est à 28 fr. Le maïs y abonde et ne vaut que 7 fr. Tout naturellement les Rayonnais voudraient échanger du maïs contre du froment. Mais l’opération est doublement contrariée et voici comme. — Je voudrais faire sortir du maïs, dit le Bayonnais. — Payez l’amende, répond le douanier. — Et le motif ? — Le motif, c’est que le froment vaut 28 fr. sur le marché. L’ami, vous choisissez mal votre temps pour exporter des aliments. — Oh ! que l’État soit sans crainte, je n’ai pas envie de mourir de faim. Aussi, en retour du maïs, veux-je faire entrer du froment. — Vous payerez encore l’amende, dit le douanier. — Et la raison ? — La raison, c’est que le froment n’est, ou n’était, il y a deux mois, qu’à 22 fr… à Toulouse. Vous connaissez nos moyennes. Quand Toulouse a mangé, Bayonne doit être rassasié. — Mais, monsieur le douanier, il y a soixante lieues de mauvaises routes d’ici à Toulouse. — Faites venir le froment par la Garonne et Bordeaux. — Mais, monsieur le douanier, vous conviendrez que ce froment de Toulouse reviendra moins cher arrivé à Bordeaux que parvenu à Bayonne. — Cela va sans dire. — Comment donc se fait-il que Bordeaux puisse recevoir du froment étranger, et non pas Bayonne ? — On voit bien que vous ne comprenez rien à nos belles combinaisons de moyennes, de prix et marchés régulateurs, de zones, etc., etc.
Sauf donc Bayonne, tous les ports de France sont ouverts aux céréales du monde entier.
L’inondation qui, selon nos adversaires, devrait suivre cette mesure, avilir les prix, arrêter la culture, rendre les champs aux ronces, cette inondation a-t-elle eu lieu ? Évidemment non, puisque chacun se préoccupe de savoir si nous aurons assez de pain pour passer l’hiver.
Cependant les circonstances n’étaient-elles pas éminemment propres à déterminer l’inondation ?
Cela vaut la peine d’être examiné.
Dans sa circulaire aux préfets, M. le ministre du commerce établit « que dans les trois régions du Nord, ainsi que dans les trois régions du Centre, la récolte en froment, méteil, seigle et orge, a été généralement inférieure à une année ordinaire et que, dans les trois régions du Midi, les rapports accusent une infériorité de récolte encore plus marquée.
« La perte de la pomme de terre paraît aller au quart ou au tiers d’une année commune. »
En outre, « l’année dernière n’a pas été une année favorable, et si elle présentait un boni de quelques millions d’hectolitres, le mauvais résultat de la récolte des pommes de terre, en augmentant la consommation des céréales, l’avait considérablement réduit. » Ainsi , du côté de la France , tout semblait se réunir pour provoquer, en cas d’ouverture des ports, une inondation de blés étrangers.
D’un autre côté, les circonstances extérieures favorisaient au plus haut degré ce phénomène.
« En effet, dit monsieur le ministre, l’approvisionnement des grands marchés est en ce moment très-considérable ; la récolte des grains a été magnifique dans les anciennes provinces polonaises et les gouvernements de la Nouvelle-Russie, qui alimentent les places d’Odessa dans la mer Noire, de Taganrog, Rostow, Marioupole, etc., dans la mer d’Azow. L’énorme exportation des années 1844 et 1845 avait donné dans ces contrées une grande impulsion à la culture des céréales ; la température extraordinairement favorable de l’été en a favorisé le développement…
La récolte en Égypte a été supérieure aux produits d’une année commune. Elle excède de beaucoup les besoins de la consommation ; la moyenne des exportations annuelles est d’environ 990,000 hectolitres ; Alexandrie peut en livrer facilement cette année de 1,700,000 à 1,800,000…
Aux États-Unis, les deux récoltes abondantes de 1845 et 1846 ont accumulé d’importantes quantités de grains disponibles pour l’exportation ; et un rapport officiel du 30 septembre dernier n’évalue pas cette récolte à moins de 26 millions d’hectolitres de maïs, et plus de 49 millions d’hectolitres de froment. »
Les deux phénomènes qui, dans leur coexistence, sont les plus propres à déterminer une invasion de produits étrangers se présentent donc ici, à savoir : déficit chez nous, extrême abondance dans les autres pays producteurs. Nous ajouterons qu’au point de vue du système restrictif, qui se préoccupe surtout de celui qui produit le blé et non de celui qui le mange, il était impossible de choisir un plus mauvais moment pour ouvrir les ports.
Après bien du travail et des fatigues, le laboureur voit son blé détruit par la pluie ; ce qui lui en reste ne peut le récompenser de ses soins et de ses avances qu’autant qu’il le vendra à un prix élevé. Et c’est dans ce moment que vous donnez un libre accès au blé étranger, cultivé sur une terre qui ne coûte rien, par des mains qu’on ne paye pas, dans un pays exempt d’impôts, et où, par surcroit de fatalité, la récolte a été magnifique ? Qu’est donc devenue votre théorie de la lutte à forces égales, de l’égalisation des conditions du travail ?
Vous avez mis tous ces arguments de côté, vous avez ouvert les ports sans ménagements, sans transition, sans ces sages tempéraments qui, dans d’autres circonstances, sont un commode prétexte pour ne rien faire du tout. La peur de la faim a surmonté la peur de l’inondation. Vous vous êtes fait libre-échangiste pratique, dans toute la force du terme. Vous avez été non moins radical que Cobden et plus que sir Robert Peel. Vous avez prononcé, en fait de céréales, la liberté totale, immédiate, sans condition, sans stipuler aucune réciprocité. — C’est une grande expérience. Et que nous apprend-elle ? C’est que l’inondation, loin de nous submerger, ne se fait pas assez vile au gré de vos désirs ; le commerce, la spéculation, la différence des prix, l’inégalité des conditions de production, rien de tout cela ne peut hâter assez cette concurrence étrangère si redoutée ; et pour la surexciter, vous êtes réduit à y appliquer les deniers publics et les vaisseaux de l’État.
Laisserons-nous passer un fait aussi grave sans en retirer quelque enseignement ?
Ce que vous avez fait aujourd’hui sans dommage, évidemment vous pouvez le faire toujours sans danger.
Car enfin, de quelle manière peuvent se combiner les récoltes relatives de la France et de l’étranger ? nous n’en connaissons que quatre, savoir :
Abondance partout ;
Déficit partout ;
Abondance chez nous, déficit ailleurs ;
Abondance ailleurs, déficit chez nous.
Parmi ces quatre combinaisons possibles, il n’y a que la dernière qui puisse rendre l’inondation redoutable.
S’il y a abondance partout, il y a bon marché partout. C’est le cas actuel, sauf que le prix serait plus bas en France, et par conséquent l’importation moins lucrative. Le rayon de l’approvisionnement serait plus restreint.
S’il y a déficit partout, il y a cherté partout. C’est encore le cas actuel, sauf que le prix serait plus élevé en Bessarabie, en Égypte, aux États-Unis ; et nous serions dans le cas de faire plus, s’il était possible, que d’ouvrir les ports.
Quant à la troisième hypothèse, abondance chez nous, déficit ailleurs, c’est certainement celle où la possibilité de l’inondation est à son moindre degré.
Il n’y a donc qu’un cas où cette singulière inondation d’aliments puisse à priori paraître imminente ; c’est le cas où les aliments nous manquent tandis qu’il y en a ailleurs. C’est le cas où nous nous trouvons ; c’est le cas, le seul cas où la loi restrictive ait quelque chose de logique et de justifiable, au point de vue étroit de l’intérêt producteur.
Or, nous y sommes dans cette éventualité, et, par une inconséquence bien remarquable, nous avons rejeté la protection, non-seulement quoique, mais parce que nous nous trouvons dans l’hypothèse même qui lui sert de prétexte et d’excuse. Et qui plus est, nous en sommes à regretter de ne l’avoir pas plus tôt rejetée.
De fait, notre loi céréale est abolie, gardons-nous de la rétablir. Il ne faut pas nous créer pour l’avenir des difficultés. Il ne faut pas fournir un nouvel aliment aux préjugés et aux vaines alarmes des cultivateurs ou plutôt des possesseurs du sol. Les voilà soumis à la concurrence étrangère, il faut les y laisser, puisqu’aussi bien elle ne leur sera jamais aussi préjudiciable qu’elle peut l’être aujourd’hui. Les événements ont fait ce que tous les raisonnements du monde n’auraient pu faire ; la révolution est accomplie ; ce qu’il peut y avoir de fâcheux dans le premier choc est passé ; il ne faut point en perdre le bienfait permanent, en opérant la contre-révolution. Les prix intérieurs et extérieurs sont nivelés, l’agriculture française a subi la concurrence dans les circonstances les plus défavorables pour elle ; il ne faut pas lui restituer d’injustes et inutiles priviléges. Enfin, il faut apprendre dans ce grand fait que le plus important de tous les produits est passé, sans transition, du régime de la restriction à celui de la liberté, et que la réforme, immédiate, absolue, n’en a été que moins douloureuse.
Que toutes les associations du libre-échange s’unissent donc pour empêcher que la loi céréale ne soit jamais ressuscitée. Sur ce terrain elles auront une force immense. Il est plus facile d’obtenir le maintien d’une réforme déjà réalisée que le renversement d’un abus. Dans la prévision d’une liberté prochaine et inévitable, les manufacturiers, qui ont l’intelligence de la situation, seront avec nous. Le peuple ne saurait nous combattre sans déserter, non-seulement son intérêt le plus évident, mais encore son droit le plus sacré, celui d’échanger son salaire contre la plus grande somme possible d’aliments, celui d’acheter le blé au prix réduit par la concurrence, quand il vend son travail au prix réduit par la concurrence. Et quant au propriétaire (car l’agriculteur est hors de cause), croyons qu’il est assez juste envers le peuple pour renoncer à une taxe sur le pain, qui n’a d’antre effet que d’élever artificiellement le capital de la terre. Que si, d’abord, il se tourne contre nous, il nous reviendra quand nous demanderons que les classes manufacturières fassent à leur tour, en toute justice envers lui, l’abandon de leurs injustes et inefficaces priviléges.
Books and Printed Pamphlets↩
Sophismes économiques. [55] Première série [January 1846] [56]↩
BWV
*Sophismes économiques. Première série.* (Paris: Guillaumin, 1846). [published Dec. 1845 or Jan. 1846] [ES1] [OC4.1, p. 1] [CW3]
Source
<http://fr.wikisource.org/wiki/Sophismes_%C3%A9conomiques>
Introduction↩
En économie politique, il y a beaucoup à apprendre et peu à faire. (Bentham.)
J’ai cherché, dans ce petit volume, à réfuter quelques-uns des arguments qu’on oppose à l’affranchissement du commerce.
Ce n’est pas un combat que j’engage avec les protectionistes. C’est un principe que j’essaie de faire pénétrer dans l’esprit des hommes sincères qui hésitent parce qu’ils doutent.
Je ne suis pas de ceux qui disent : La protection s’appuie sur des intérêts. — Je crois qu’elle repose sur des erreurs, ou, si l’on veut, sur des vérités incomplètes. Trop de personnes redoutent la liberté pour que cette appréhension ne soit pas sincère.
C’est placer haut mes prétentions, mais je voudrais, je l’avoue, que cet opuscule devînt comme le manuel des hommes qui sont appelés à prononcer entre les deux principes. Quand on ne s’est pas familiarisé de longue main avec la doctrine de la liberté, les sophismes de la protection reviennent sans cesse à l’esprit sous une forme ou sous une autre. Pour l’en dégager, il faut à chaque fois un long travail d’analyse, et ce travail, tout le monde n’a pas le temps de le faire ; les législateurs moins que personne. C’est pourquoi j’ai essayé de le donner tout fait.
Mais, dira-t-on, les bienfaits de la liberté sont-ils donc si cachés qu’ils ne se montrent qu’aux économistes de profession ?
Oui, nous en convenons, nos adversaires dans la discussion ont sur nous un avantage signalé. Ils peuvent en quelques mots, exposer une vérité incomplète ; et, pour montrer qu’elle est incomplète, il nous faut de longues et arides dissertations.
Cela tient à la nature des choses. La protection réunit sur un point donné le bien qu’elle fait, et infuse dans la masse le mal qu’elle inflige. L’un est sensible à l’œil extérieur, l’autre ne se laisse apercevoir que par l’œil de l’esprit [57]. — C’est précisément le contraire pour la liberté.
Il en est ainsi de presque toutes les questions économiques.
Dites : Voici une machine qui a mis sur le pavé trente ouvriers ;
Ou bien : Voici un prodigue qui encourage toutes les industries ;
Ou encore : La conquête d’Alger a doublé le commerce de Marseille ;
Ou enfin : Le budget assure l’existence de cent mille familles ;
Vous serez compris de tous, vos propositions sont claires, simples et vraies en elles-mêmes. Déduisez-en ces principes :
Les machines sont un mal ;
Le luxe, les conquêtes, les lourds impôts sont un bien ;
Et votre théorie aura d’autant plus de succès que vous pourrez l’appuyer de faits irrécusables.
Mais nous, nous ne pouvons nous en tenir à une cause et à son effet prochain. Nous savons que cet effet même devient cause à son tour. Pour juger une mesure, il faut donc que nous la suivions à travers l’enchaînement des résultats, jusqu’à l’effet définitif. Et, puisqu’il faut lâcher le grand mot, nous sommes réduits à raisonner.
Mais aussitôt nous voilà assaillis par cette clameur : Vous êtes des théoriciens, des métaphysiciens, des idéologues, des utopistes, des hommes à principes, — et toutes les préventions du public se tournent contre nous.
Que faire donc ? invoquer la patience et la bonne foi du lecteur, et jeter dans nos déductions, si nous en sommes capables, une clarté si vive que le vrai et le faux s’y montrent à nu, afin que la victoire, une fois pour toutes, demeure à la restriction ou à la liberté.
J’ai à faire ici une observation essentielle.
Quelques extraits de ce petit volume ont paru dans le Journal des Économistes.
Dans une critique, d’ailleurs très-bienveillante, que M. le vicomte de Romanet a publiée (Voir le Moniteur industriel des 15 et 18 mai 1845), il suppose que je demande la suppression des douanes. M. de Romanet se trompe. Je demande la suppression du régime protecteur. Nous ne refusons pas des taxes au gouvernement ; mais nous voudrions, si cela est possible, dissuader les gouvernés de se taxer les uns les autres. Napoléon a dit : « La douane ne doit pas être un instrument fiscal, mais un moyen de protéger l’industrie. » — Nous plaidons le contraire, et nous disons : La douane ne doit pas être aux mains des travailleurs un instrument de rapine réciproque, mais elle peut être une machine fiscale aussi bonne qu’une autre. Nous sommes si loin, ou, pour n’engager que moi dans la lutte, je suis si loin de demander la suppression des douanes, que j’y vois pour l’avenir l’ancre de salut de nos finances. Je les crois susceptibles de procurer au Trésor des recettes immenses, et, s’il faut dire toute ma pensée, à la lenteur que mettent à se répandre les saines doctrines économiques, à la rapidité avec laquelle notre budget s’accroît, je compte plus, pour la réforme commerciale, sur les nécessités du Trésor que sur la force d’une opinion éclairée.
Mais enfin, me dira-t-on, à quoi concluez-vous ?
Je n’ai pas besoin de conclure. Je combats des sophismes, voilà tout.
Mais, poursuit-on, il ne suffit pas de détruire, il faut édifier. — Je pense que détruire une erreur, c’est édifier la vérité contraire.
Après cela, je n’ai pas de répugnance à dire quel est mon vœu. Je voudrais que l’opinion fût amenée à sanctionner une loi de douanes conçue à peu près en ces termes :
Les objets de première nécessité paieront un droit ad valorem de…5%
Les objets de convenance… 10%
Les objets de luxe… 15 ou 20%
Encore ces distinctions sont prises dans un ordre d’idées entièrement étrangères à l’économie politique proprement dite, et je suis loin de les croire aussi utiles et aussi justes qu’on le suppose communément. Mais ceci n’est plus de mon sujet.
I. Abondance, disette↩
Qu’est-ce qui vaut mieux pour l’homme et pour la société, l’abondance ou la disette ?
Quoi ! s’écriera-t-on, cela peut-il faire une question ? A-t-on jamais avancé, est-il possible de soutenir que la disette est le fondement du bien-être des hommes ?
Oui, cela a été avancé ; oui, cela a été soutenu ; on le soutient tous les jours, et je ne crains pas de dire que la théorie de la disette est de beaucoup la plus populaire. Elle défraie les conversations, les journaux, les livres, la tribune, et, quoique cela puisse paraître extraordinaire, il est certain que l’économie politique aura rempli sa tâche et sa mission pratique quand elle aura vulgarisé et rendu irréfutable cette proposition si simple : « La richesse des hommes, c’est l’abondance des choses. »
N’entend-on pas dire tous les jours : « L’étranger va nous inonder de ses produits ? » Donc on redoute l’abondance.
M. de Saint-Cricq n’a-t-il pas dit : « La production surabonde ? » Donc il craignait l’abondance.
Les ouvriers ne brisent-ils pas les machines ? Donc ils s’effraient de l’excès de la production ou de l’abondance.
M. Bugeaud n’a-t-il pas prononcé ces paroles : « Que le pain soit cher, et l’agriculteur sera riche ! » Or, le pain ne peut être cher que parce qu’il est rare ; donc M. Bugeaud préconisait la disette.
M. d’Argout ne s’est-il pas fait un argument contre l’industrie sucrière de sa fécondité même ? Ne disait-il pas : « La betterave n’a pas d’avenir, et sa culture ne saurait s’étendre, parce qu’il suffirait d’y consacrer quelques hectares par département pour pourvoir à toute la consommation de la France ? » Donc, à ses yeux, le bien est dans la stérilité, dans la disette ; le mal, dans la fertilité, dans l’abondance.
La Presse, le Commerce et la plupart des journaux quotidiens ne publient-ils pas un ou plusieurs articles chaque matin pour démontrer aux chambres et au gouvernement qu’il est d’une saine politique d’élever législativement le prix de toutes choses par l’opération des tarifs ? Les trois pouvoirs n’obtempèrent-ils pas tous les jours à cette injonction de la presse périodique ? Or, les tarifs n’élèvent les prix des choses que parce qu’ils en diminuent la quantité offerte sur le marché ! Donc les journaux, les Chambres, le ministère, mettent en pratique la théorie de la disette, et j’avais raison de dire que cette théorie est de beaucoup la plus populaire.
Comment est-il arrivé qu’aux yeux des travailleurs, des publicistes, des hommes d’État, l’abondance se soit montrée redoutable et la disette avantageuse ? Je me propose de remonter à la source de cette illusion.
On remarque qu’un homme s’enrichit en proportion de ce qu’il tire un meilleur parti de son travail, c’est-à-dire de ce qu’il vend à plus haut prix. Il vend à plus haut prix à proportion de la rareté, de la disette du genre de produit qui fait l’objet de son industrie. On en conclut que, quant à lui du moins, la disette l’enrichit. Appliquant successivement ce raisonnement à tous les travailleurs, on en déduit la théorie de la disette. De là on passe à l’application, et, afin de favoriser tous les travailleurs, on provoque artificiellement la cherté, la disette de toutes choses par la prohibition, la restriction, la suppression des machines et autres moyens analogues.
Il en est de même de l’abondance. On observe que, quand un produit abonde, il se vend à bas prix : donc le producteur gagne moins. Si tous les producteurs sont dans ce cas, ils sont tous misérables : donc c’est l’abondance qui ruine la société. Et comme toute conviction cherche à se traduire en fait, on voit, dans beaucoup de pays, les lois des hommes lutter contre l’abondance des choses.
Ce sophisme, revêtu d’une forme générale, ferait peut-être peu d’impression ; mais appliqué à un ordre particulier de faits, à telle ou telle industrie, à une classe donnée de travailleurs, il est extrêmement spécieux, et cela s’explique. C’est un syllogisme qui n’est pas faux, mais incomplet. Or, ce qu’il y a de vrai dans un syllogisme est toujours et nécessairement présent à l’esprit. Mais l’incomplet est une qualité négative, une donnée absente dont il est fort possible et même fort aisé de ne pas tenir compte.
L’homme produit pour consommer. Il est à la fois producteur et consommateur. Le raisonnement que je viens d’établir ne le considère que sous le premier de ces points de vue. Sous le second, il aurait conduit à une conclusion opposée. Ne pourrait-on pas dire, en effet :
Le consommateur est d’autant plus riche qu’il achète toutes choses à meilleur marché ; il achète les choses à meilleur marché, en proportion de ce qu’elles abondent, donc l’abondance l’enrichit ; et ce raisonnement, étendu à tous les consommateurs, conduirait à la théorie de l’abondance !
C’est la notion imparfaitement comprise de l’échange qui produit ces illusions. Si nous consultons notre intérêt personnel, nous reconnaissons distinctement qu’il est double. Comme vendeurs, nous avons intérêt à la cherté, et par conséquent à la rareté ; comme acheteurs, au bon marché, ou, ce qui revient au même, à l’abondance des choses. Nous ne pouvons donc point baser un raisonnement sur l’un ou l’autre de ces intérêts avant d’avoir reconnu lequel des deux coïncide et s’identifie avec l’intérêt général et permanent de l’espèce humaine.
Si l’homme était un animal solitaire, s’il travaillait exclusivement pour lui, s’il consommait directement le fruit de son labeur, en un mot, s’il n’échangeait pas, jamais la théorie de la disette n’eût pu s’introduire dans le monde. Il est trop évident que l’abondance lui serait avantageuse, de quelque part qu’elle lui vînt, soit qu’elle fût le résultat de son industrie, d’ingénieux outils, de puissantes machines qu’il aurait inventées, soit qu’il la dût à la fertilité du sol, à la libéralité de la nature, ou même à une mystérieuse invasion de produits que le flot aurait apportés du dehors et abandonnés sur le rivage. Jamais l’homme solitaire n’imaginerait, pour donner de l’encouragement, pour assurer un aliment à son propre travail, de briser les instruments qui l’épargnent, de neutraliser la fertilité du sol, de rendre à la mer les biens qu’elle lui aurait apportés. Il comprendrait aisément que le travail n’est pas un but, mais un moyen : qu’il serait absurde de repousser le but, de peur de nuire au moyen. Il comprendrait que, s’il consacre deux heures de la journée à pourvoir à ses besoins, toute circonstance (machine, fertilité, don gratuit, n’importe) qui lui épargne une heure de ce travail, le résultat restant le même, met cette heure à sa disposition, et qu’il peut la consacrer à augmenter son bien-être ; il comprendrait, en un mot, qu’épargne de travail ce n’est autre chose que progrès.
Mais l’échange trouble notre vue sur une vérité si simple. Dans l’état social, et avec la séparation des occupations qu’il amène, la production et la consommation d’un objet ne se confondent pas dans le même individu. Chacun est porté à voir dans son travail non plus un moyen, mais un but. L’échange crée, relativement à chaque objet, deux intérêts, celui du producteur et celui du consommateur, et ces deux intérêts sont toujours immédiatement opposés.
Il est essentiel de les analyser et d’en étudier la nature.
Prenons un producteur quel qu’il soit ; quel est son intérêt immédiat ? Il consiste en ces deux choses, 1° que le plus petit nombre possible de personnes se livrent au même travail que lui ; 2° que le plus grand nombre possible de personnes recherchent le produit de ce même travail ; ce que l’économie politique explique plus succinctement en ces termes : que l’offre soit très-restreinte et la demande très-étendue ; en d’autres termes encore : concurrence limitée, débouchés illimités.
Quel est l’intérêt immédiat du consommateur ? Que l’offre du produit dont il s’agit soit étendue et la demande restreinte.
Puisque ces deux intérêts se contredisent, l’un d’eux doit nécessairement coïncider avec l’intérêt social ou général, et l’autre lui est antipathique.
Mais quel est celui que la législation doit favoriser, comme étant l’expression du bien public, si tant est qu’elle en doive favoriser aucun ?
Pour le savoir, il suffit de rechercher ce qui arriverait si les désirs secrets des hommes étaient accomplis.
En tant que producteurs, il faut bien en convenir, chacun de nous fait des vœux antisociaux. Sommes-nous vignerons ? nous serions peu fâchés qu’il gelât sur toutes les vignes du monde, excepté sur la nôtre : c’est la théorie de la disette. Sommes-nous propriétaires de forges ? nous désirons qu’il n’y ait sur le marché d’autre fer que celui que nous y apportons, quel que soit le besoin que le public en ait, et précisément pour que ce besoin, vivement senti et imparfaitement satisfait, détermine à nous en donner un haut prix : c’est encore la théorie de la disette. Sommes-nous laboureurs ? nous disons, avec M. Bugeaud : Que le pain soit cher, c’est-à-dire rare, et les agriculteurs feront bien leurs affaires : c’est toujours la théorie de la disette.
Sommes-nous médecins ? nous ne pouvons nous empêcher de voir que certaines améliorations physiques, comme l’assainissement du pays, le développement de certaines vertus morales, telles que la modération et la tempérance, le progrès des lumières poussé au point que chacun sût soigner sa propre santé, la découverte de certains remèdes simples et d’une application facile, seraient autant de coups funestes portés à notre profession. En tant que médecins, nos vœux secrets sont antisociaux. Je ne veux pas dire que les médecins forment de tels vœux. J’aime à croire qu’ils accueilleraient avec joie une panacée universelle ; mais, dans ce sentiment, ce n’est pas le médecin, c’est l’homme, c’est le chrétien qui se manifeste ; il se place, par une noble abnégation de lui-même, au point de vue du consommateur. En tant qu’exerçant une profession, en tant que puisant dans cette profession son bien-être, sa considération et jusqu’aux moyens d’existence de sa famille, il ne se peut pas que ses désirs, ou, si l’on veut, ses intérêts, ne soient anti-sociaux.
Fabriquons-nous des étoffes de coton ? nous désirons les vendre au prix le plus avantageux pour nous. Nous consentirions volontiers à ce que toutes les manufactures rivales fussent interdites, et si nous n’osons exprimer publiquement ce vœu ou en poursuivre la réalisation complète avec quelques chances de succès, nous y parvenons pourtant, dans une certaine mesure, par des moyens détournés : par exemple, en excluant les tissus étrangers, afin de diminuer la quantité offerte, et de produire ainsi, par l’emploi de la force et à notre profit, la rareté des vêtements.
Nous passerions ainsi toutes les industries en revue, et nous trouverions toujours que les producteurs, en tant que tels, ont des vues antisociales. « Le marchand, dit Montaigne, ne fait bien ses affaires qu’à la débauche de la jeunesse ; le laboureur, à la cherté des blés ; l’architecte, à la ruine des maisons ; les officiers de justice, aux procez et et aux querelles des hommes. L’honneur même et practique des ministres de la religion se tire de nostre mort et de nos vices. Nul médecin ne prend plaisir à la santé de ses amis mêmes, ni soldats à la paix de sa ville ; ainsi du reste. »
Il suit de là que, si les vœux secrets de chaque producteur étaient réalisés, le monde rétrograderait rapidement vers la barbarie. La voile proscrirait la vapeur, la rame proscrirait la voile, et devrait bientôt céder les transports au chariot, celui-ci au mulet, et le mulet au porte-balle. La laine exclurait le coton, le coton exclurait la laine, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la disette de toutes choses eût fait disparaître l’homme même de dessus la surface du globe.
Supposez pour un moment que la puissance législative et la force publique fussent mises à la disposition du comité Mimerel, et que chacun des membres qui composent cette association eût la faculté de lui faire admettre et sanctionner une petite loi : est-il bien malaisé de deviner à quel code industriel serait soumis le public ?
Si nous venons maintenant à considérer l’intérêt immédiat du consommateur, nous trouverons qu’il est en parfaite harmonie avec l’intérêt général, avec ce que réclame le bien-être de l’humanité. Quand l’acheteur se présente sur le marché, il désire le trouver abondamment pourvu. Que les saisons soient propices à toutes les récoltes ; que des inventions de plus en plus merveilleuses mettent à sa portée un plus grand nombre de produits et de satisfactions ; que le temps et le travail soient épargnés ; que les distances s’effacent ; que l’esprit de paix et de justice permette de diminuer le poids des taxes ; que les barrières de toute nature tombent ; en tout cela, l’intérêt immédiat du consommateur suit parallèlement la même ligne que l’intérêt public bien entendu. Il peut pousser ses vœux secrets jusqu’à la chimère, jusqu’à l’absurde, sans que ses vœux cessent d’être humanitaires. Il peut désirer que le vivre et le couvert, le toit et le foyer, l’instruction et la moralité, la sécurité et la paix, la force et la santé s’obtiennent sans efforts, sans travail et sans mesure, comme la poussière des chemins, l’eau du torrent, l’air qui nous environne, la lumière qui nous baigne, sans que la réalisation de tels désirs soit en contradiction avec le bien de la société.
On dira peut-être que, si ces vœux étaient exaucés, l’œuvre du producteur se restreindrait de plus en plus, et finirait par s’arrêter faute d’aliment. Mais pourquoi ? Parce que, dans cette supposition extrême, tous les besoins et tous les désirs imaginables seraient complétement satisfaits. L’homme, comme la Toute-Puissance, créerait toutes choses par un seul acte de sa volonté. Veut-on bien me dire, dans cette hypothèse, en quoi la production industrielle serait regrettable ?
Je supposais tout à l’heure une assemblée législative composée de travailleurs, dont chaque membre formulerait en loi son vœu secret, en tant que producteur ; et je disais que le code émané de cette assemblée serait le monopole systématisé, la théorie de la disette mise en pratique.
De même, une Chambre, où chacun consulterait exclusivement son intérêt immédiat de consommateur, aboutirait à systématiser la liberté, la suppression de toutes les mesures restrictives, le renversement de toutes les barrières artificielles, en un mot, à réaliser la théorie de l’abondance.
Il suit de là :
Que consulter exclusivement l’intérêt immédiat de la production, c’est consulter un intérêt antisocial ;
Que prendre exclusivement pour base l’intérêt immédiat de la consommation, ce serait prendre pour base l’intérêt général.
Qu’il me soit permis d’insister encore sur ce point de vue, au risque de me répéter.
Un antagonisme radical existe entre le vendeur et l’acheteur [58].
Celui-là désire que l’objet du marché soit rare, peu offert, à un prix élevé.
Celui-ci le souhaite abondant, très-offert, à bas prix.
Les lois, qui devraient être au moins neutres, prennent parti pour le vendeur contre l’acheteur, pour le producteur contre le consommateur, pour la cherté contre le bon marché [59] pour la disette contre l’abondance.
Elles agissent sinon intentionnellement, du moins logiquement sur cette donnée : Une nation est riche quand elle manque de tout.
Car elles disent : C’est le producteur qu’il faut favoriser en lui assurant un bon placement de son produit. Pour cela, il faut en élever le prix ; pour en élever le prix, il faut en restreindre l’offre ; et restreindre l’offre, c’est créer la disette.
Et voyez : je suppose que, dans le monde actuel, où ces lois ont toute leur force, on fasse un inventaire complet, non en valeur, mais en poids, mesures, volumes, quantités, de tous les objets existants en France, propres à satisfaire les besoins et les goûts de ses habitants, blés, viandes, draps, toiles, combustibles, denrées coloniales, etc.
Je suppose encore que l’on renverse le lendemain toutes les barrières qui s’opposent à l’introduction en France des produits étrangers.
Enfin, pour apprécier le résultat de cette réforme, je suppose que l’on procède trois mois après à un nouvel inventaire.
N’est-il pas vrai qu’il se trouvera en France plus de blé, de bestiaux, de drap, de toile, de fer, de houille, de sucre, etc., lors du second qu’à l’époque du premier inventaire ?
Cela est si vrai que nos tarifs protecteurs n’ont pas d’autre but que d’empêcher toutes ces choses de parvenir jusqu’à nous, d’en restreindre l’offre, d’en prévenir la dépréciation, l’abondance.
Maintenant, je le demande, le peuple est-il mieux nourri, sous l’empire de nos lois, parce qu’il y a moins de pain, de viande et de sucre dans le pays ? Est-il mieux vêtu parce qu’il y a moins de fils, de toiles et de draps ? Est-il mieux chauffé parce qu’il y a moins de houille ? Est-il mieux aidé dans ses travaux parce qu’il y a moins de fer, de cuivre, d’outils, de machines ?
Mais, dit-on, si l’étranger nous inonde de ses produits, il emportera notre numéraire.
Eh qu’importe ? L’homme ne se nourrit pas de numéraire, il ne se vêt pas d’or, il ne se chauffe pas avec de l’argent. Qu’importe qu’il y ait plus ou moins de numéraire dans le pays, s’il y a plus de pain aux buffets, plus de viande aux crochets, plus de linge dans les armoires, et plus de bois dans les bûchers ?
Je poserai toujours aux lois restrictives ce dilemme :
Ou vous convenez que vous produisez la disette, ou vous n’en convenez pas.
Si vous en convenez, vous avouerez par cela même que vous faites au peuple tout le mal que vous pouvez lui faire. Si vous n’en convenez pas, alors vous niez avoir restreint l’offre, élevé les prix et, par conséquent, vous niez avoir favorisé le producteur.
Vous êtes funestes ou inefficaces. Vous ne pouvez être utiles [60].
II. Obstacle, cause↩
L’obstacle pris pour la cause, — la disette prise pour l’abondance, — c’est le même sophisme sous un autre aspect. Il est bon de l’étudier sous toutes ses faces.
L’homme est primitivement dépourvu de tout.
Entre son dénûment et la satisfaction de ses besoins, il existe une multitude d’obstacles que le travail a pour but de surmonter. Il est curieux de rechercher comment et pourquoi ces obstacles mêmes à son bien-être sont devenus, à ses yeux, la cause de son bien-être.
J’ai besoin de me transporter à cent lieues. Mais entre les points de départ et d’arrivée s’interposent des montagnes, des rivières, des marais, des forêts impénétrables, des malfaiteurs, en un mot, des obstacles ; et, pour vaincre ces obstacles, il faudra que j’emploie beaucoup d’efforts, ou, ce qui revient au même, que d’autres emploient beaucoup d’efforts, et m’en fassent payer le prix. Il est clair qu’à cet égard j’eusse été dans une condition meilleure si ces obstacles n’eussent pas existé.
Pour traverser la vie et parcourir cette longue série de jours qui sépare le berceau de la tombe, l’homme a besoin de s’assimiler une quantité prodigieuse d’aliments, de se garantir contre l’intempérie des saisons, de se préserver ou de se guérir d’une foule de maux. La faim, la soif, la maladie, le chaud, le froid, sont autant d’obstacles semés sur sa route. Dans l’état d’isolement, il devrait les combattre tous par la chasse, la pêche, la culture, le filage, le tissage, l’architecture, et il est clair qu’il vaudrait mieux pour lui que ces obstacles n’existassent qu’à un moindre degré ou même n’existassent pas du tout. En société, il ne s’attaque pas personnellement à chacun de ces obstacles, mais d’autres le font pour lui ; et, en retour, il éloigne un des obstacles dont ses semblables sont entourés.
Il est clair encore qu’en considérant les choses en masse, il vaudrait mieux, pour l’ensemble des hommes ou pour la société, que les obstacles fussent aussi faibles et aussi peu nombreux que possible.
Mais si l’on scrute les phénomènes sociaux dans leurs détails, et les sentiments des hommes selon que l’échange les a modifiés, on aperçoit bientôt comment ils sont arrivés à confondre les besoins avec la richesse et l’obstacle avec la cause.
La séparation des occupations, résultat de la faculté d’échanger, fait que chaque homme, au lieu de lutter pour son propre compte avec tous les obstacles qui l’environnent, n’en combat qu’un ; le combat non pour lui, mais au profit de ses semblables, qui, à leur tour, lui rendent le même service.
Or, il résulte de là que cet homme voit la cause immédiate de sa richesse dans cet obstacle qu’il fait profession de combattre pour le compte d’autrui. Plus cet obstacle est grand, sérieux, vivement senti, et plus, pour l’avoir vaincu, ses semblables sont disposés à le rémunérer, c’est-à-dire à lever en sa faveur les obstacles qui le gênent.
Un médecin, par exemple, ne s’occupe pas de faire cuire son pain, de fabriquer ses instruments, de tisser ou de confectionner ses habits. D’autres le font pour lui, et, en retour, il combat les maladies qui affligent ses clients. Plus ces maladies sont nombreuses, intenses, réitérées, plus on consent, plus on est forcé même à travailler pour son utilité personnelle. À son point de vue, la maladie, c’est-à-dire un obstacle général au bien-être des hommes, est une cause de bien-être individuel. Tous les producteurs font, en ce qui les concerne, le même raisonnement. L’armateur tire ses profits de l’obstacle qu’on nomme distance ; l’agriculteur, de celui qu’on nomme faim ; le fabricant d’étoffes, de celui qu’on appelle froid ; l’instituteur vit sur l’ignorance, le lapidaire sur la vanité, l’avoué sur la cupidité, le notaire sur la mauvaise foi possible, comme le médecin sur les maladies des hommes. Il est donc très-vrai que chaque profession a un intérêt immédiat à la continuation, à l’extension même de l’obstacle spécial qui fait l’objet de ses efforts.
Ce que voyant, les théoriciens arrivent qui fondent un système sur ces sentiments individuels, et disent : Le besoin, c’est la richesse ; le travail, c’est la richesse ; l’obstacle au bien-être, c’est le bien-être. Multiplier les obstacles, c’est donner de l’aliment à l’industrie.
Puis surviennent les hommes d’État. Ils disposent de la force publique ; et quoi de plus naturel que de la faire servir à développer, à propager les obstacles, puisque aussi bien c’est développer et propager la richesse ? Ils disent, par exemple : Si nous empêchons le fer de venir des lieux où il abonde, nous créerons chez nous un obstacle pour s’en procurer. Cet obstacle, vivement senti, déterminera à payer pour en être affranchi. Un certain nombre de nos concitoyens s’attachera à le combattre, et cet obstacle fera leur fortune. Plus même il sera grand, plus le minerai sera rare, inaccessible, difficile à transporter, éloigné des foyers de consommation, plus cette industrie, dans toutes ses ramifications, occupera de bras. Excluons donc le fer étranger ; créons l’obstacle, afin de créer le travail qui le combat.
Le même raisonnement conduira à proscrire les machines.
Voilà, dira-t-on, des hommes qui ont besoin de loger leur vin. C’est un obstacle ; et voici d’autres hommes qui s’occupent de le lever en fabriquant des tonneaux. Il est donc heureux que l’obstacle existe, puisqu’il alimente une portion du travail national et enrichit un certain nombre de nos concitoyens. Mais voici venir une machine ingénieuse qui abat le chêne, l’équarrit, le partage en une multitude de douves, les assemble et les transforme en vaisseaux vinaires. L’obstacle est bien amoindri, et avec lui la fortune des tonneliers. Maintenons l’un et l’autre par une loi. Proscrivons la machine.
Pour pénétrer au fond de ce sophisme, il suffit de se dire que le travail humain n’est pas un but, mais un moyen. Il ne reste jamais sans emploi. Si un obstacle lui manque, il s’attaque à un autre, et l’humanité est délivrée de deux obstacles par la même somme de travail qui n’en détruisait qu’un seul. — Si le travail des tonneliers devenait jamais inutile, il prendrait une autre direction. — Mais avec quoi, demande-t-on, serait-il rémunéré ? précisément avec ce qui le rémunère aujourd’hui ; car, quand une masse de travail devient disponible par la suppression d’un obstacle, une masse correspondante de rémunération devient disponible aussi. — Pour dire que le travail humain finira par manquer d’emploi, il faudrait prouver que l’humanité cessera de rencontrer des obstacles. — Alors le travail ne serait pas seulement impossible, il serait superflu. Nous n’aurions plus rien à faire, parce que nous serions tout-puissants et qu’il nous suffirait de prononcer un fiat pour que tous nos besoins et tous nos désirs fussent satisfaits [61].
III. Effort, résultat↩
Nous venons de voir qu’entre nos besoins et leur satisfaction s’interposent des obstacles. Nous parvenons à les vaincre ou à les affaiblir par l’emploi de nos facultés. On peut dire d’une manière très-générale que l’industrie est un effort suivi d’un résultat.
Mais sur quoi se mesure notre bien-être, notre richesse? Est-ce sur le résultat de l’effort? est-ce sur l’effort lui-même ? — Il existe toujours un rapport entre l’effort employé et le résultat obtenu. — Le progrès consiste-t-il dans l’accroissement relatif du second ou du premier terme de ce rapport ?
Les deux thèses ont été soutenues ; elles se partagent, en économie politique, le domaine de l’opinion.
Selon le premier système, la richesse est le résultat du travail. Elle s’accroît à mesure que s’accroît le rapport du résultat à l’effort. La perfection absolue, dont le type est en Dieu, consiste dans l’éloignement infini des deux termes, en ce sens : effort nul, résultat infini.
Le second professe que c’est l’effort lui-même qui constitue et mesure la richesse. Progresser, c’est accroître le rapport de l’effort au résultat. Son idéal peut être représenté par l’effort à la fois éternel et stérile de Sisyphe [62].
Naturellement, le premier accueille tout ce qui tend à diminuer la peine et à augmenter le produit : les puissantes machines qui ajoutent aux forces de l’homme, l’échange qui permet de tirer un meilleur parti des agents naturels distribués à diverses mesures sur la surface du globe, l’intelligence qui trouve, l’expérience qui constate, la concurrence qui stimule, etc.
Logiquement aussi le second appelle de ses vœux tout ce qui a pour effet d’augmenter la peine et de diminuer le produit : priviléges, monopoles, restrictions, prohibitions, suppressions de machines, stérilité, etc.
Il est bon de remarquer que la pratique universelle des hommes est toujours dirigée par le principe de la première doctrine. On n’a jamais vu, on ne verra jamais un travailleur, qu’il soit agriculteur, manufacturier, négociant, artisan, militaire, écrivain ou savant, qui ne consacre toutes les forces de son intelligence à faire mieux, à faire plus vite, à faire plus économiquement, en un mot, à faire plus avec moins.
La doctrine opposée est à l’usage des théoriciens, des députés, des journalistes, des hommes d’État, des ministres, des hommes enfin dont le rôle en ce monde est de faire des expériences sur le corps social.
Encore faut-il observer qu’en ce qui les concerne personnellement, ils agissent, comme tout le monde, sur le principe : obtenir du travail la plus grande somme possible d’effets utiles.
On croira peut-être que j’exagère, et qu’il n’y a pas de vrais Sisyphistes.
Si l’on veut dire que, dans la pratique, on ne pousse pas le principe jusqu’à ses plus extrêmes conséquences, j’en conviendrai volontiers. Il en est même toujours ainsi quand on part d’un principe faux. Il mène bientôt à des résultats si absurdes et si malfaisants qu’on est bien forcé de s’arrêter. Voilà pourquoi l’industrie pratique n’admet jamais le Sisyphisme : le châtiment suivrait de trop près l’erreur pour ne pas la dévoiler. Mais, en matière d’industrie spéculative, telle qu’en font les théoriciens et les hommes d’État, on peut suivre longtemps un faux principe avant d’être averti de sa fausseté par des conséquences compliquées auxquelles d’ailleurs on est étranger ; et quand enfin elles se révèlent, on agit selon le principe opposé, on se contredit, et l’on cherche sa justification dans cet axiome moderne d’une incomparable absurdité : en économie politique, il n’y a pas de principe absolu.
Voyons donc si les deux principes opposés que je viens d’établir ne règnent pas tour à tour, l’un dans l’industrie pratique, l’autre dans la législation industrielle.
J’ai déjà rappelé un mot de M. Bugeaud ; mais dans M. Bugeaud il y a deux hommes, l’agriculteur et le législateur.
Comme agriculteur, M. Bugeaud tend de tous ses efforts à cette double fin : épargner du travail, obtenir du pain à bon marché. Lorsqu’il préfère une bonne charrue à une mauvaise ; lorsqu’il perfectionne les engrais ; lorsque, pour ameublir son sol, il substitue, autant qu’il le peut, l’action de l’atmosphère à celle de la herse ou de la houe ; lorsqu’il appelle à son aide tous les procédés dont la science et l’expérience lui ont révélé l’énergie et la perfection, il n’a et ne peut avoir qu’un but : diminuer le rapport de l’effort au résultat. Nous n’avons même point d’autre moyen de reconnaître l’habileté du cultivateur et la perfection du procédé que de mesurer ce qu’ils ont retranché à l’un et ajouté à l’autre ; et comme tous les fermiers du monde agissent sur ce principe, on peut dire que l’humanité entière aspire, sans doute pour son avantage, à obtenir soit le pain, soit tout autre produit, à meilleur marché, — à restreindre la peine nécessaire pour en avoir à sa disposition une quantité donnée.
Cette incontestable tendance de l’humanité une fois constatée devrait suffire, ce semble, pour révéler au législateur le vrai principe, et lui indiquer dans quel sens il doit seconder l’industrie (si tant est qu’il entre dans sa mission de la seconder), car il serait absurde de dire que les lois des hommes doivent opérer en sens inverse des lois de la Providence.
Cependant on a entendu M. Bugeaud, député, s’écrier : « Je ne comprends rien à la théorie du bon marché ; j’aimerais mieux voir le pain plus cher et le travail plus abondant. » Et en conséquence, le député de la Dordogne vote des mesures législatives qui ont pour effet d’entraver les échanges, précisément parce qu’ils nous procurent indirectement ce que la production directe ne peut nous fournir que d’une manière plus dispendieuse.
Or, il est bien évident que le principe de M. Bugeaud, député, est diamétralement opposé à celui de M. Bugeaud, agriculteur. Conséquent avec lui-même, il voterait contre toute restriction à la Chambre, ou bien il transporterait sur sa ferme le principe qu’il proclame à la tribune. On le verrait alors semer son blé sur le champ le plus stérile, car il réussirait ainsi à travailler beaucoup pour obtenir peu. On le verrait proscrire la charrue, puisque la culture à ongles satisferait son double vœu : le pain plus cher et le travail plus abondant.
La restriction a pour but avoué et pour effet reconnu d’augmenter le travail.
Elle a encore pour but avoué et pour effet reconnu de provoquer la cherté, qui n’est autre chose que la rareté des produits. Donc, poussée à ses dernières limites, elle est le Sisyphisme pur, tel que nous l’avons défini : travail infini, produit nul.
M. le baron Charles Dupin, le flambeau de la pairie, dit-on, dans les sciences économiques, accuse les chemins de fer de nuire à la navigation, et il est certain qu’il est dans la nature d’un moyen plus parfait de restreindre l’emploi d’un moyen comparativement plus grossier. Mais les rail-ways ne peuvent nuire aux bateaux qu’en attirant à eux les transports ; ils ne peuvent les attirer qu’en les exécutant à meilleur marché, et ils ne peuvent les exécuter à meilleur marché qu’en diminuant le rapport de l’effort employé au résultat obtenu, puisque c’est cela même qui constitue le bon marché. Lors donc que M. le baron Dupin déplore cette suppression du travail pour un résultat donné, il est dans la doctrine du Sisyphisme. Logiquement, comme il préfère le bateau au rail, il devrait préférer le char au bateau, le bât au char, et la hotte à tous les moyens de transport connus, car c’est celui qui exige le plus de travail pour le moindre résultat.
« Le travail constitue la richesse d’un peuple », disait M. de Saint-Cricq, ce ministre du commerce qui a tant imposé d’entraves au commerce. Il ne faut pas croire que c’était là une proposition elliptique, signifiant : « Les résultats du travail constituent la richesse d’un peuple. » Non, cet économiste entendait bien dire que c’est l’intensité du travail qui mesure la richesse, et la preuve, c’est que, de conséquence en conséquence, de restriction en restriction, il conduisait la France, et il croyait bien faire, à consacrer un travail double pour se pourvoir d’une quantité égale de fer, par exemple. En Angleterre, le fer était alors à 8 fr. ; en France, il revenait à 16 fr. En supposant la journée du travail à 1 fr., il est clair que la France pouvait, par voie d’échange, se procurer un quintal de fer avec huit journées prises sur l’ensemble du travail national. Grâce aux mesures restrictives de M. de Saint-Cricq, il fallait à la France seize journées de travail pour obtenir un quintal de fer par la production directe. — Peine double pour une satisfaction identique, donc richesse double ; donc encore la richesse se mesure non par le résultat, mais par l’intensité du travail. N’est-ce pas là le Sisyphisme dans toute sa pureté !
Et afin qu’il n’y ait pas d’équivoque possible, M. le ministre a soin de compléter plus loin sa pensée, et de même qu’il vient d’appeler richesse l’intensité du travail, on va l’entendre appeler pauvreté l’abondance des résultats du travail ou des choses propres à satisfaire nos besoins. « Partout, dit-il, des machines ont pris la place des bras de l’homme ; partout la production surabonde ; partout l’équilibre entre la faculté de produire et les moyens de consommer est rompu.» On le voit, selon M. de Saint-Cricq, si la France était dans une situation critique, c’est qu’elle produisait trop, c’est que son travail était trop intelligent, trop fructueux. Nous étions trop bien nourris, trop bien vêtus, trop bien pourvus de toutes choses ; la production trop rapide dépassait tous nos désirs. Il fallait bien mettre un terme à ce fléau, et pour cela nous forcer, par des restrictions, à travailler plus pour produire moins.
J’ai rappelé aussi l’opinion d’un autre ministre du commerce, M. d’Argout. Elle mérite que nous nous y arrêtions un instant. Voulant porter un coup terrible à la betterave, il disait : « Sans doute la culture de la betterave est utile, mais cette utilité est limitée. Elle ne comporte pas les gigantesques développements que l’on se plaît à lui prédire. Pour en acquérir la conviction, il suffit de remarquer que cette culture sera nécessairement restreinte dans les bornes de la consommation. Doublez, triplez si vous voulez la consommation actuelle de la France, vous trouverez toujours qu’une très-minime portion du sol suffira aux besoins de cette consommation. (Voilà, certes, un singulier grief !) En voulez-vous la preuve ? Combien y avait-il d’hectares plantés en betterave en 1828 ? 3,130, ce qui équivaut à 1/10540e du sol cultivable. Combien y en a-t-il, aujourd’hui que le sucre indigène a envahi le tiers de la consommation ? 16,700 hectares, soit 1/1978e du sol cultivable, ou 45 centiares par commune. Supposons que le sucre indigène ait déjà envahi toute la consommation, nous n’aurions que 48,000 hectares de cultivés en betterave, ou 1/689e du sol cultivable [63]. »
Il y a deux choses dans cette citation : les faits et la doctrine. Les faits tendent à établir qu’il faut peu de terrain, de capitaux et de main-d’œuvre pour produire beaucoup de sucre, et que chaque commune de France en serait abondamment pourvue en livrant à la culture de la betterave un hectare de son territoire. — La doctrine consiste à regarder cette circonstance comme funeste, et à voir dans la puissance même et la fécondité de la nouvelle industrie la limite de son utilité.
Je n’ai point à me constituer ici le défenseur de la betterave ou le juge des faits étranges avancés par M. d’Argout [64] ; mais il vaut la peine de scruter la doctrine d’un homme d’État à qui la France a confié pendant longtemps le sort de son agriculture et de son commerce.
J’ai dit en commençant qu’il existe un rapport variable entre l’effort industriel et son résultat ; que l’imperfection absolue consiste en un effort infini sans résultat aucun ; la perfection absolue en un résultat illimité sans aucun effort ; et la perfectibilité dans la diminution progressive de l’effort comparé au résultat.
Mais M. d’Argout nous apprend que la mort est là où nous croyons apercevoir la vie, et que l’importance d’une industrie est en raison directe de son impuissance. Qu’attendre, par exemple, de la betterave ? Ne voyez-vous pas que 48,000 hectares de terrain, un capital et une main d’œuvre proportionnés suffiront à approvisionner de sucre toute la France ? Donc c’est une industrie d’une utilité limitée ; limitée, bien entendu, quant au travail qu’elle exige, seule manière dont, selon l’ancien ministre, une industrie puisse être utile. Cette utilité serait bien plus limitée encore si, grâce à la fécondité du sol ou à la richesse de la betterave, nous recueillions sur 24,000 hectares ce que nous ne pouvons obtenir que sur 48,000. Oh ! s’il fallait vingt fois, cent fois plus de terre, de capitaux et de bras pour arriver au même résultat, à la bonne heure, on pourrait fonder sur la nouvelle industrie quelques espérances, et elle serait digue de toute la protection de l’État, car elle offrirait un vaste champ au travail national. Mais produire beaucoup avec peu ! cela est d’un mauvais exemple, et il est bon que la loi y mette ordre.
Mais ce qui est vérité à l’égard du sucre ne saurait être erreur relativement au pain. Si donc l’utilité d’une industrie doit s’apprécier, non par les satisfactions qu’elle est en mesure de procurer avec une quantité de travail déterminée, mais, au contraire, par le développement de travail qu’elle exige pour subvenir à une somme donnée de satisfactions, c e que nous devons désirer évidemment, c’est que chaque hectare de terre produise peu de blé, et chaque grain dé blé peu de substance alimentaire ; en d’autres termes, que notre territoire soit infertile ; car alors la masse de terres, de capitaux, de main d’œuvre qu’il faudra mettre en mouvement pour nourrir ta population sera comparativement bien plus considérable ; on peut même dire que le débouché ouvert au travail humain sera en raison directe de cette infertilité. Les vœux de MM. Bugeaud, Saint Cricq, Dupin, d’Argout, seront satisfaits ; le pain sera cher, le travail abondant, et la France sera riche, riche comme ces messieurs l’entendent.
Ce que nous devons désirer encore, c’est que l’intelligence humaine s’affaiblisse et s’éteigne ; car, tant qu’elle vit, elle cherche incessamment à augmenter le rapport de la fin au moyen et du produit à la peine. C’est même en cela, et exclusivement en cela, qu’elle consiste.
Ainsi le Sisyphisme est la doctrine de tous les hommes qui ont été chargés de nos destinées industrielles. Il ne serait pas juste de leur en faire un reproche. Ce principe ne dirige les ministères que parce qu’il règne dans les Chambres ; il ne règne dans les Chambres que parce qu’il y est envoyé par le corps électoral, et le corps électoral n’en est imbu que parce que l’opinion publique en est saturée.
Je crois devoir répéter ici que je n’accuse pas des hommes tels que MM. Bugeaud, Dupin, Saint-Cricq, d’Argout, d’être absolument, et en toutes circonstances, Sisyphistes. À coup sûr ils ne le sont pas dans leurs transactions privées ; à coup sûr chacun d’entre eux se procure, par voie d’échange, ce qu’il lui en coûterait plus cher de se procurer par voie de production directe. Mais je dis qu’ils sont Sisyphistes lorsqu’ils empêchent le pays d’en faire autant [65].
IV. Égaliser les conditions de production↩
On dit… mais, pour n’être pas accusé de mettre des sophismes dans la bouche des protectionistes, je laisse parler l’un de leurs plus vigoureux athlètes.
« On a pensé que la protection devait être chez nous simplement la représentation de la différence qui existe entre le prix de revient d’une denrée que nous produisons et le prix de revient de la denrée similaire produite chez nos voisins… Un droit protecteur calculé sur ces bases ne fait qu’assurer la libre concurrence… ; la libre concurrence n’existe que lorsqu’il y a égalité de conditions et de charges. Lorsqu’il s’agit d’une course de chevaux, on pèse le fardeau que doit supporter chacun des coureurs, et on égalise les conditions ; sans cela, ce ne sont plus des concurrents. Quand il s’agit de commerce, si l’un des vendeurs peut livrer à meilleur marché, il cesse d’être concurrent et devient monopoleur… Supprimez cette protection représentative de la différence dans le prix de revient, dès lors l’étranger envahit votre marché et le monopole lui est acquis [66]. »
« Chacun doit vouloir pour lui, comme pour les autres, que la production du pays soit protégée contre la concurrence étrangère, toutes les fois que celle-ci pourrait fournir les produits à plus bas prix [67]. »
Cet argument revient sans cesse dans les écrits de l’école protectioniste. Je me propose de l’examiner avec soin, c’est-à-dire que je réclame l’attention et même la patience du lecteur. Je m’occuperai d’abord des inégalités qui tiennent à la nature, ensuite de celles qui se rattachent à la diversité des taxes.
Ici, comme ailleurs, nous retrouvons les théoriciens de la protection placés au point de vue du producteur, tandis que nous prenons en main la cause de ces malheureux consommateurs dont ils ne veulent absolument pas tenir compte. Ils comparent le champ de l’industrie au turf. Mais, au turf, la course est tout à la fois moyen et but. Le public ne prend aucun intérêt à la lutte en dehors de la lutte elle-même. Quand vous lancez vos chevaux dans l’unique but de savoir quel est le meilleur coureur, je conçois que vous égalisiez les fardeaux. Mais si vous aviez pour but de faire parvenir au poteau une nouvelle importante et pressée, pourriez-vous, sans inconséquence, créer des obstacles à celui qui vous offrirait les meilleures conditions de vitesse ? C’est pourtant là ce que vous faites en industrie. Vous oubliez son résultat cherché, qui est le bien-être ; vous en faites abstraction, vous le sacrifiez même par une véritable pétition de principes.
Mais puisque nous ne pouvons amener nos adversaires à notre point de vue, plaçons-nous au leur, et examinons la question sous le rapport de la production.
Je chercherai à établir :
1° Que niveler les conditions du travail, c’est attaquer l’échange dans son principe ;
2° Qu’il n’est pas vrai que le travail d’un pays soit étouffé par la concurrence des contrées plus favorisées ;
3° Que, cela fût-il exact, les droits protecteurs n’égalisent pas les conditions de production ;
4° Que la liberté nivelle ces conditions autant qu’elles peuvent l’être ;
5° Enfin, que ce sont les pays les moins favorisés qui gagnent le plus dans les échanges.
I. Niveler les conditions du travail, ce n’est pas seulement gêner quelques échanges, c’est attaquer l’échange dans son principe, car il est fondé précisément sur cette diversité, ou, si on l’aime mieux, sur ces inégalités de fertilité, d’aptitudes, de climats, de température, que vous voulez effacer. Si la Guyenne envoie des vins à la Bretagne, et la Bretagne des blés à la Guyenne, c’est que ces deux provinces sont placées dans des conditions différentes de production. Y a-t-il une autre loi pour les échanges internationaux ? Encore une fois, se prévaloir contre eux des inégalités de conditions qui les provoquent et les expliquent, c’est les attaquer dans leur raison d’être. Si les protectionistes avaient pour eux assez de logique et de puissance, ils réduiraient les hommes, comme des colimaçons, à l’isolement absolu. Il n’y a pas, du reste, un de leurs sophismes qui, soumis à l’épreuve de déductions rigoureuses, n’aboutisse à la destruction et au néant.
II. Il n’est pas vrai, en fait, que l’inégalité des conditions entre deux industries similaires entraîne nécessairement la chute de celle qui est la moins bien partagée. Au turf, si un des coursiers gagne le prix, l’autre le perd ; mais, quand deux chevaux travaillent a produire des utilités, chacun en produit dans la mesure de ses forces, et de ce que le plus vigoureux rend plus de services, il ne s’ensuit pas que le plus faible n’en rend pas du tout. — On cultive du froment dans tous les départements de la France, quoiqu’il y ait entre eux d’énormes différences de fertilité ; et si par hasard il en est un qui n’en cultive pas, c’est qu’il n’est pas bon, même pour lui, qu’il en cultive. De même, l’analogie nous dit que, sous le régime de la liberté, malgré de semblables différences, on produirait du froment dans tous les royaumes de l’Europe, et s’il en était un qui vînt à renoncer à cette culture, c’est que, dans son intérêt, il trouverait à faire un meilleur emploi de ses terres, de ses capitaux et de sa main d’œuvre. Et pourquoi la fertilité d’un département ne paralyse-t-elle pas l’agriculteur du département voisin moins favorisé ? Parce que les phénomènes économiques ont une souplesse, une élasticité, et, pour ainsi dire, des ressources de nivellement qui paraissent échapper entièrement à l’école protectioniste. Elle nous accuse d’être systématiques ; mais c’est elle qui est systématique au suprême degré, si l’esprit de système consiste à échafauder des raisonnements sur un fait et non sur l’ensemble des faits. — Dans l’exemple ci-dessus, c’est la différence dans la valeur des terres qui compense la différence de leur fertilité. — Votre champ produit trois fois plus que le mien. Oui ; mais il vous a coûté dix fois davantage et je puis encore lutter avec vous. — Voilà tout le mystère. — Et remarquez que la supériorité, sous quelques rapports, amène l’infériorité à d’autres égards. — C’est précisément parce que votre sol est plus fécond qu’il est plus cher, en sorte que ce n’est pas accidentellement, mais nécessairement que l’équilibre s’établit ou tend à s’établir : et peut-on nier que la liberté ne soit le régime qui favorise le plus cette tendance ?
J’ai cité une branche d’agriculture ; j’aurais pu aussi bien citer une branche d’industrie. Il y a des tailleurs à Quimper, et cela n’empêche pas qu’il n’y en ait à Paris, quoique ceux-ci paient bien autrement cher leur loyer, leur ameublement, leurs ouvriers et leur nourriture. Mais aussi ils ont une bien autre clientèle, et cela suffit non-seulement pour rétablir la balance, mais encore pour la faire pencher de leur côté.
Lors donc qu’on parle d’égaliser les conditions du travail, il faudrait au moins examiner si la liberté ne fait pas ce qu’on demande à l’arbitraire.
Ce nivellement naturel des phénomènes économiques est si important dans la question, et, en même temps, si propre à nous faire admirer la sagesse providentielle qui préside au gouvernement égalitaire de la société, que je demande la permission de m’y arrêter un instant.
Messieurs les protectionistes, vous dites : Tel peuple a sur nous l’avantage du bon marché de la houille, du fer, des machines, des capitaux ; nous ne pouvons lutter avec lui.
Cette proposition sera examinée sous d’autres aspects. Quant à présent, je me renferme dans la question, qui est de savoir si, quand une supériorité et une infériorité sont en présence, elles ne portent pas en elles-mêmes, celle-ci la force ascendante, celle-là la force descendante, qui doivent les ramener à un juste équilibre.
Voilà deux pays, A et B. — A possède sur B toutes sortes d’avantages. Vous en concluez que le travail se concentre en A et que B est dans l’impuissance de rien faire. A, dites vous, vend beaucoup plus qu’il n’achète ; B achète beaucoup plus qu’il ne vend. Je pourrais contester, mais je me place sur votre terrain.
Dans l’hypothèse, le travail est très-demandé en A, et bientôt il y renchérit.
Le fer, la houille, les terres, les aliments, les capitaux sont très-demandés en A, et bientôt ils y renchérissent.
Pendant ce temps-là, travail, fer, houille, terres, aliments, capitaux, tout est très-délaissé en B, et bientôt tout y baisse de prix.
Ce n’est pas tout. A vendant toujours, B achetant sans cesse, le numéraire passe de B en A. Il abonde en A, il est rare en B.
Mais abondance de numéraire, cela veut dire qu’il en faut beaucoup pour acheter toute autre chose. Donc, en A, à la cherté réelle qui provient d’une demande très-active, s’ajoute une cherté nominale due à la surproportion des métaux précieux.
Rareté de numéraire, cela signifie qu’il en faut peu pour chaque emplette. Donc en B, un bon marché nominal vient se combiner avec le bon marché réel.
Dans ces circonstances, l’industrie aura toutes sortes de motifs, des motifs, si je puis le dire, portés à la quatrième puissance, pour déserter A et venir s’établir en B.
Ou, pour rentrer dans la vérité, disons qu’elle n’aura pas attendu ce moment, que les brusques déplacements répugnent à sa nature, et que, dès l’origine, sous un régime libre, elle se sera progressivement partagée et distribuée entre A et B, selon les lois de l’offre et de la demande, c’est-à-dire selon les lois de la justice et de l’utilité.
Et quand je dis que, s’il était possible que l’industrie se concentrât sur un point, il surgirait dans son propre sein et par cela même une force irrésistible de décentralisation, je ne fais pas une vaine hypothèse.
Écoutons ce que disait un manufacturier à la chambre de commerce de Manchester (je supprime les chiffres dont il appuyait sa démonstration) :
« Autrefois nous exportions des étoffes ; puis cette exportation a fait place à celle des fils, qui sont la matière première des étoffes ; ensuite à celle des machines, qui sont les instruments de production du fil ; plus tard, à celle des capitaux, avec lesquels nous construisons nos machines, et enfin, à celle de nos ouvriers et de notre génie industriel, qui sont la source de nos capitaux. Tous ces éléments de travail ont été les uns après les autres s’exercer là où ils trouvaient à le faire avec plus d’avantages, là où l’existence est moins chère, la vie plus facile, et l’on peut voir aujourd’hui, en Prusse, en Autriche, en Saxe, en Suisse, en Italie, d’immenses manufactures fondées avec des capitaux anglais, servies par des ouvriers anglais et dirigées par des ingénieurs anglais. »
Vous voyez bien que la nature, ou plutôt la Providence, plus ingénieuse, plus sage, plus prévoyante que ne le suppose votre étroite et rigide théorie, n’a pas voulu cette concentration de travail, ce monopole de toutes les supériorités dont vous arguez comme d’un fait absolu et irrémédiable. Elle a pourvu, par des moyens aussi simples qu’infaillibles, à ce qu’il y eût dispersion, diffusion, solidarité, progrès simultané ; toutes choses que vos lois restrictives paralysent autant qu’il est en elles, car leur tendance, en isolant les peuples, est de rendre la diversité de leur condition beaucoup plus tranchée, de prévenir le nivellement, d’empêcher la fusion, de neutraliser les contre-poids et de parquer les peuples dans leur supériorité ou leur infériorité respective.
III. En troisième lieu, dire que, par un droit protecteur, on égalise les conditions de production, c’est donner une locution fausse pour véhicule à une erreur. Il n’est pas vrai qu’un droit d’entrée égalise les conditions de production. Celles-ci restent après le droit ce qu’elles étaient avant. Ce que le droit égalise tout au plus, ce sont les conditions de la vente. On dira peut-être que je joue sur les mots, mais je renvoie l’accusation à mes adversaires. C’est à eux de prouver que production et vente sont synonymes, sans quoi je suis fondé à leur reprocher, sinon de jouer sur les termes, du moins de les confondre.
Qu’il me soit permis d’éclairer ma pensée par un exemple.
Je suppose qu’il vienne à l’idée de quelques spéculateurs parisiens de se livrer à la production des oranges. Ils savent que les oranges de Portugal peuvent se vendre à Paris 10 centimes, tandis qu’eux, à raison des caisses, des serres qui leur seront nécessaires, à cause du froid qui contrariera souvent leur culture, ne pourront pas exiger moins d’un franc comme prix rémunérateur. Ils demandent que les oranges de Portugal soient frappées d’un droit de 90 centimes. Moyennant ce droit, les conditions de production, disent-ils, seront égalisées, et la Chambre, cédant, comme toujours, à ce raisonnement, inscrit sur le tarif un droit de 90 centimes par orange étrangère.
Eh bien ! je dis que les conditions de production ne sont nullement changées. La loi n’a rien ôté à la chaleur du soleil de Lisbonne, ni à la fréquence ou à l’intensité des gelées de Paris. La maturité des oranges continuera à se faire naturellement sur les rives du Tage et artificiellement sur les rives de la Seine, c’est-à-dire qu’elle exigera beaucoup plus de travail humain dans un pays que dans l’autre. Ce qui sera égalisé, ce sont les conditions de la vente : les Portugais devront nous vendre leurs oranges à 1 franc, dont 90 centimes pour acquitter la taxe. Elle sera payée évidemment par le consommateur français. Et voyez la bizarrerie du résultat. Sur chaque orange portugaise consommée, le pays ne perdra rien ; car les 90 centimes payés en plus par le consommateur entreront au Trésor. Il y aura déplacement, il n’y aura pas perte. Mais, sur chaque orange française consommée, il y aura 90 centimes de perte ou à peu près, car l’acheteur les perdra bien certainement, et le vendeur, bien certainement aussi, ne les gagnera pas, puisque, d’après l’hypothèse même, il n’en aura tiré que le prix de revient. Je laisse aux protectionistes le soin d’enregistrer la conclusion.
IV. Si j’ai insisté sur cette distinction entre les conditions de production et les conditions de vente, distinction que messieurs les prohihitionistes trouveront sans doute paradoxale, c’est qu’elle doit m’amener à les affliger encore d’un autre paradoxe bien plus étrange, et c’est celui-ci : Voulez-vous égaliser réellement les conditions de production ? laissez l’échange libre.
Oh ! pour le coup, dira-t-on, c’est trop fort, et c’est abuser des jeux d’esprit. Eh bien ! ne fût-ce que par curiosité, je prie messieurs les protectionistes de suivre jusqu’au bout mon argumentation. Ce ne sera pas long — Je reprends mon exemple.
Si l’on consent à supposer, pour un moment, que le profit moyen et quotidien de chaque Français est de un franc, il s’ensuivra incontestablement que pour produire directement une orange en France, il faudra une journée de travail ou l’équivalent, tandis que, pour produire la contrevaleur d’une orange portugaise, il ne faudra qu’un dixième de cette journée, ce qui ne veut dire autre chose, si ce n’est que le soleil fait à Lisbonne ce que le travail fait à Paris. Or, n’est-il pas évident que, si je puis produire une orange, ou, ce qui revient au même, de quoi l’acheter, avec un dixième de journée de travail, je suis placé, relativement à cette production, exactement dans les mêmes conditions que le producteur portugais lui-même, sauf le transport, qui doit être à ma charge ? Il est donc certain que la liberté égalise les conditions de production directe ou indirecte, autant qu’elles peuvent être égalisées, puisqu’elle ne laisse plus subsister qu’une différence inévitable, celle du transport.
J’ajoute que la liberté égalise aussi les conditions de jouissance, de satisfaction, de consommation, ce dont on ne s’occupe jamais, et ce qui est pourtant l’essentiel, puisqu’en définitive la consommation est le but final de tous nos efforts industriels. Grâce à l’échange libre, nous jouirions du soleil portugais comme le Portugal lui-même ; les habitants du Havre auraient à leur portée, tout aussi bien que ceux de Londres, et aux mêmes conditions, les avantages que la nature a conférés à Newcastle sous le rapport minéralogique.
V. Messieurs les protectionistes, vous me trouvez en humeur paradoxale : eh bien ! je veux aller plus loin encore. Je dis, et je le pense très-sincèrement, que, si deux pays se trouvent placés dans des conditions de production inégales, c’est celui des deux qui est le moins favorisé de la nature qui a le plus à gagner à la liberté des échanges. — Pour le prouver, je devrai m’écarter un peu de la forme qui convient à cet écrit. Je le ferai néanmoins, d’abord parce que toute la question est là, ensuite parce que cela me fournira l’occasion d’exposer une loi économique de la plus haute importance, et qui, bien comprise, me semble destinée à ramener à la science toutes ces sectes qui, de nos jours, cherchent dans le pays des chimères cette harmonie sociale qu’elles n’ont pu découvrir dans la nature. Je veux parler de la loi de la consommation, que l’on pourrait peut-être reprocher à la plupart des économistes d’avoir beaucoup trop négligée.
La consommation est la fin, la cause finale de tous les phénomènes économiques, et c’est en elle par conséquent que se trouve leur dernière et définitive solution.
Rien de favorable ou de défavorable ne peut s’arrêter d’une manière permanente au producteur. Les avantages que la nature et la société lui prodiguent, les inconvénients dont elles le frappent, glissent sur lui, pour ainsi dire, et tendent insensiblement à aller s’absorber et se fondre dans la communauté, la communauté, considérée au point de vue de la consommation. C’est là une loi admirable dans sa cause et dans ses effets, et celui qui parviendrait à la bien décrire aurait, je crois, le droit de dire : « Je n’ai pas passé sur cette terre sans payer mon tribut à la société. »
Toute circonstance qui favorise l’œuvre de la production est accueillie avec joie par le producteur, car l’effet immédiat est de le mettre à même de rendre plus de services à la communauté et d’en exiger une plus grande rémunération. Toute circonstance qui contrarie la production est accueillie avec peine par le producteur, car l’effet immédiat est de limiter ses services et par suite sa rémunération. Il fallait que les biens et les maux immédiats des circonstances heureuses ou funestes fussent le lot du producteur, afin qu’il fût invinciblement porté à rechercher les unes et à fuir les autres.
De même, quand un travailleur parvient à perfectionner son industrie, le bénéfice immédiat du perfectionnement est recueilli par lui. Cela était nécessaire pour le déterminer à un travail intelligent ; cela était juste, parce qu’il est juste qu’un effort couronné de succès apporte avec lui sa récompense.
Mais je dis que ces effets bons et mauvais, quoique permanents en eux-mêmes, ne le sont pas quant au producteur. S’il en eût été ainsi, un principe d’inégalité progressive et, partant, infinie, eût été introduit parmi les hommes, et c’est pourquoi ces biens et ces maux vont bientôt s’absorber dans les destinées générales de l’humanité.
Comment cela s’opère-t-il ? — Je le ferai comprendre par quelques exemples.
Transportons-nous au treizième siècle. Les hommes qui se livrent à l’art de copier reçoivent, pour le service qu’ils rendent, une rémunération gouvernée par le taux général des profits. — Parmi eux, il s’en rencontre un qui cherche et trouve le moyen de multiplier rapidement les exemplaires d’un même écrit. Il invente l’imprimerie.
D’abord, c’est un homme qui s’enrichit, et beaucoup d’autres qui s’appauvrissent. À ce premier aperçu, quelque merveilleuse que soit la découverte, on hésite à décider si elle n’est pas plus funeste qu’utile. Il semble qu’elle introduit dans le monde, ainsi que je l’ai dit, un élément d’inégalité indéfinie. Gutenberg fait des profits avec son invention et étend son invention avec ses profits, et cela sans terme, jusqu’à ce qu’il ait ruiné tous les copistes. — Quant au public, au consommateur, il gagne peu, car Guttenberg a soin de ne baisser le prix de ses livres que tout juste ce qu’il faut pour sous-vendre ses rivaux.
Mais la pensée qui mit l’harmonie dans le mouvement des corps célestes a su la mettre aussi dans le mécanisme interne de la société. Nous allons voir les avantages économiques de l’invention échapper à l’individualité, et devenir, pour toujours, le patrimoine commun des masses.
En effet, le procédé finit par être connu. Guttenberg n’est plus le seul à imprimer ; d’autres personnes l’imitent. Leurs profits sont d’abord considérables. Elles sont récompensées pour être entrées les premières dans la voie de l’imitation, et cela était encore nécessaire, afin qu’elles y fussent attirées et qu’elles concourussent au grand résultat définitif vers lequel nous approchons. Elles gagnent beaucoup, mais elles gagnent moins que l’inventeur, car la concurrence vient de commencer son œuvre. Le prix des livres va toujours baissant. Les bénéfices des imitateurs diminuent à mesure qu’on s’éloigne du jour de l’invention, c’est-à-dire à mesure que l’imitation devient moins méritoire… Bientôt la nouvelle industrie arrive à son état normal ; en d’autres termes, la rémunération des imprimeurs n’a plus rien d’exceptionnel, et, comme autrefois celle des scribes, elle n’est plus gouvernée que par le taux général des profits. Voilà donc la production, en tant que telle, replacée comme au point de départ. — Cependant l’invention n’en est pas moins acquise ; l’épargne du temps, du travail, de l’effort pour un résultat donné, pour un nombre déterminé d’exemplaires, n’en est pas moins réalisée. Mais comment se manifeste-t-elle ? par le bon marché des livres. Et au profit de qui ? Au profit du consommateur, de la société, de l’humanité. — Les imprimeurs, qui désormais n’ont plus aucun mérite exceptionnel, ne reçoivent pas non plus désormais une rémunération exceptionnelle. Comme hommes, comme consommateurs, ils sont sans doute participants des avantages que l’invention a conférés à la communauté. Mais voilà tout. En tant qu’imprimeurs, en tant que producteurs, ils sont rentrés dans les conditions ordinaires de tous les producteurs du pays. La société les paie pour leur travail, et non pour l’utilité de l’invention. Celle-ci est devenue l’héritage commun et gratuit de l’humanité entière.
J’avoue que la sagesse et la beauté de ces lois me frappent d’admiration et de respect. J’y vois le saint-simonisme : À chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres. — J’y vois le communisme, c’est-à-dire la tendance des biens à devenir le commun héritage des hommes ; — mais un saint-simonisme, un communisme réglés par la prévoyance infinie, et non point abandonnés à la fragilité, aux passions et à l’arbitraire des hommes.
Ce que j’ai dit de l’imprimerie, on peut le dire de tous les instruments de travail, depuis le clou et le marteau jusqu’à la locomotive et au télégraphe électrique. La société jouit de tous par l’abondance de ses consommations, et elle en jouit gratuitement, car leur effet est de diminuer le prix des objets ; et toute cette partie du prix qui a été anéantie, laquelle représente bien l’œuvre de l’invention dans la production, rend évidemment le produit gratuit dans cette mesure. Il ne reste à payer que le travail humain, le travail actuel, et il se paie, abstraction faite du résultat dû à l’invention, du moins quand elle a parcouru le cycle que je viens de décrire et qu’il est dans sa destinée de parcourir. — J’appelle chez moi un ouvrier, il arrive avec une scie, je lui paie sa journée à deux francs, et il me fait vingt-cinq planches. Si la scie n’eût pas été inventée, il n’en aurait peut-être pas fait une, et je ne lui aurais pas moins payé sa journée. L’utilité produite par la scie est donc pour moi un don gratuit de la nature, ou plutôt c’est une portion de l’héritage que j’ai reçu en commun, avec tous mes frères, de l’intelligence de nos ancêtres. — J’ai deux ouvriers dans mon champ. L’un tient les manches d’une charrue, l’autre le manche d’une bêche. Le résultat de leur travail est bien différent, mais le prix de la journée est le même, parce que la rémunération ne se proportionne pas à l’utilité produite, mais à l’effort, au travail exigé.
J’invoque la patience du lecteur et je le prie de croire que je n’ai pas perdu de vue la liberté commerciale. Qu’il veuille bien seulement se rappeler la conclusion à laquelle je suis arrivé : La rémunération ne se proportionne pas aux utilités que le producteur porte sur le marché, mais à son travail [68].
J’ai pris mes exemples dans les inventions humaines. Parlons maintenant des avantages naturels.
Dans tout produit, la nature et l’homme concourent. Mais la part d’utilité qu’y met la nature est toujours gratuite. Il n’y a que cette portion d’utilité qui est due au travail humain qui fait l’objet de l’échange et par conséquent de la rémunération. Celle-ci varie sans doute beaucoup à raison de l’intensité du travail, de son habileté, de sa promptitude, de son à-propos, du besoin qu’on en a, de l’absence momentanée de rivalité, etc., etc. Mais il n’en est pas moins vrai, en principe, que le concours des lois naturelles appartenant à tous, n’entre pour rien dans le prix du produit.
Nous ne payons pas l’air respirable, quoiqu’il nous soit si utile que, sans lui, nous ne saurions vivre deux minutes. Nous ne le payons pas néanmoins, parce que la nature nous le fournit sans l’intervention d’aucun travail humain. Que si nous voulons séparer un des gaz qui le composent, par exemple, pour faire une expérience, il faut nous donner une peine, ou, si nous la faisons prendre à un autre, il faut lui sacrifier une peine équivalente que nous aurons mise dans un autre produit. Par où l’on voit que l’échange s’opère entre des peines, des efforts, des travaux. Ce n’est véritablement pas le gaz oxygène que je paie, puisqu’il est partout à ma disposition, mais le travail qu’il a fallu accomplir pour le dégager, travail qui m’a été épargné et qu’il faut bien que je restitue. Dira-t-on qu’il y a autre chose à payer, des dépenses, des matériaux, des appareils ? mais encore, dans ces choses, c’est du travail que je paie. Le prix de la houille employée représente le travail qu’il a fallu faire pour l’extraire et la transporter.
Nous ne payons pas la lumière du soleil, parce que la nature nous la prodigue. Mais nous payons celle du gaz, du suif, de l’huile, de la cire, parce qu’il y a ici un travail humain à rémunérer ; et remarquez que c’est si bien au travail et non à l’utilité que la rémunération se proportionne, qu’il peut fort bien arriver qu’un de ces éclairages, quoique beaucoup plus intense qu’un autre, coûte cependant moins cher. Il suffit pour cela que la même quantité de travail humain en fournisse davantage.
Quand le porteur d’eau vient approvisionner ma maison, si je le payais à raison de l’utilité absolue de l’eau, ma fortune n’y suffirait pas. Mais je le paie à raison de la peine qu’il a prise. S’il exigeait davantage, d’autres la prendraient, et, en définitive, au besoin, je la prendrais moi-même. L’eau n’est vraiment pas la matière de notre marché, mais bien le travail fait à l’occasion de l’eau. Ce point de vue est si important et les conséquences que j’en vais tirer si lumineuses, quant à la liberté des échanges internationaux, que je crois devoir élucider encore ma pensée par d’autres exemples.
La quantité de substance alimentaire contenue dans les pommes de terre ne nous coûte pas fort cher, parce qu’on en obtient beaucoup avec peu de travail. Nous payons davantage le froment, parce que, pour le produire, la nature exige une plus grande somme de travail humain. Il est évident que, si la nature faisait pour celui-ci ce qu’elle fait pour celles-là, les prix tendraient à se niveler. Il n’est pas possible que le producteur de froment gagne d’une manière permanente beaucoup plus que le producteur de pommes de terre. La loi de la concurrence s’y oppose.
Si, par un heureux miracle, la fertilité de toutes les terres arables venait à s’accroître, ce n’est point l’agriculteur, mais le consommateur qui recueillerait l’avantage de ce phénomène, car il se résoudrait en abondance, en bon marché. Il y aurait moins de travail incorporé dans chaque hectolitre de blé, et l’agriculteur ne pourrait l’échanger que contre un moindre travail incorporé dans tout autre produit. Si, au contraire, la fécondité du sol venait tout à coup à diminuer, la part de la nature dans la production serait moindre, celle du travail plus grande, et le produit plus cher. J’ai donc eu raison de dire que c’est dans la consommation, dans l’humanité que viennent se résoudre, à la longue, tous les phénomènes économiques. Tant qu’on n’a pas suivi leurs effets jusque-là, tant qu’on s’arrête aux effets immédiats, à ceux qui affectent un homme ou une classe d’hommes, en tant que producteurs, on n’est pas économiste ; pas plus que celui-là n’est médecin qui, au lieu de suivre dans tout l’organisme les effets d’un breuvage, se bornerait à observer, pour le juger, comment il affecte le palais ou le gosier.
Les régions tropicales sont très-favorisées pour la production du sucre, du café. Cela veut dire que la nature fait la plus grande partie de la besogne et laisse peu à faire au travail. Mais alors qui recueille les avantages de cette libéralité de la nature ? Ce ne sont point ces régions, car la concurrence les amène à ne recevoir que la rémunération du travail ; mais c’est l’humanité, car le résultat de cette libéralité s’appelle bon marché, et le bon marché appartient à tout le monde.
Voici une zone tempérée où la houille, le minerai de fer, sont à la surface du sol, il ne faut que se baisser pour en prendre. D’abord, les habitants profiteront de cette heureuse circonstance, je le veux bien. Mais bientôt, la concurrence s’en mêlant, le prix de la houille et du fer baissera jusqu’à ce que le don de la nature soit gratuitement acquis à tous, et que le travail humain soit seul rémunéré, selon le taux général des profits.
Ainsi les libéralités de la nature, comme les perfectionnements acquis dans les procédés de la production, sont ou tendent sans cesse à devenir, sous la loi de la concurrence, le patrimoine commun et gratuit des consommateurs, des masses, de l’humanité. Donc, les pays qui ne possèdent pas ces avantages ont tout à gagner à échanger avec ceux qui les possèdent, parce que l’échange s’accomplit entre travaux, abstraction faite des utilités naturelles que ces travaux renferment ; et ce sont évidemment les pays les plus favorisés qui ont incorporé dans un travail donné le plus de ces utilités naturelles. Leurs produits, représentant moins de travail, sont moins rétribués ; en d’autres termes, ils sont à meilleur marché, et si toute la libéralité de la nature se résout en bon marché, évidemment ce n’est pas le pays producteur, mais le pays consommateur, qui en recueille le bienfait.
Par où l’on voit l’énorme absurdité de ce pays consommateur, s’il repousse le produit précisément parce qu’il est à bon marché ; c’est comme s’il disait : « Je ne veux rien de ce que la nature donne. Vous me demandez un effort égal à deux pour me donner un produit que je ne puis créer qu’avec une peine égale à quatre ; vous pouvez le faire, parce que chez vous la nature a fait la moitié de l’œuvre. Eh bien ! moi je le repousse, et j’attendrai que votre climat, devenu plus inclément, vous force à me demander une peine égale à quatre, afin de traiter avec vous sur le pied de l’égalité. »
A est un pays favorisé, B est un pays maltraité de la nature. Je dis que l’échange est avantageux à tous deux, mais surtout à B, parce que l’échange ne consiste pas en utilités contre utilités, mais en valeur contre valeur. Or, A met plus d’utilités sous la même valeur, puisque l’utilité du produit embrasse ce qu’y a mis la nature et ce qu’y a mis le travail, tandis que la valeur ne correspond qu’à ce qu’y a mis le travail. — Donc B fait un marché tout à son avantage. En acquittant au producteur de A simplement son travail, il reçoit par-dessus le marché plus d’utilités naturelles qu’il n’en donne.
Posons la règle générale.
Échange, c’est troc de valeurs ; la valeur étant réduite, par la concurrence, à représenter du travail, échange, c’est troc de travaux égaux. Ce que la nature a fait pour les produits échangés est donné de part et d’autre gratuitement et par-dessus le marché, d’où il suit rigoureusement que les échanges accomplis avec les pays les plus favorisés de la nature sont les plus avantageux.
La théorie dont j’ai essayé, dans ce chapitre, de tracer les lignes et les contours demanderait de grands développements. Je ne l’ai envisagée que dans ses rapports avec mon sujet, la liberté commerciale. Mais peut-être le lecteur attentif y aura-t-il aperçu le germe fécond qui doit dans sa croissance étouffer au-dessous de lui, avec la protection, le fouriérisme, le saint-simonisme, le communisme, et toutes ces écoles qui ont pour objet d’exclure du gouvernement du monde la loi de la concurrence. Considérée au point de vue du producteur, la concurrence froisse sans doute souvent nos intérêts individuels et immédiats ; mais, si l’on se place au point de vue du but général de tous les travaux, du bien-être universel, en un mot, de la consommation, on trouvera que la concurrence joue, dans le monde moral, le même rôle que l’équilibre dans le monde matériel. Elle est le fondement du vrai communisme, du vrai socialisme, de cette égalité de bien-être et de conditions si désirée de nos jours ; et si tant de publicistes sincères, tant de réformateurs de bonne foi les demandent à l’arbitraire, c’est qu’ils ne comprennent pas la liberté [69].
V. Nos produits sont grevés de taxes↩
C’est le même sophisme. On demande que le produit étranger soit taxé, afin de neutraliser les effets de la taxe qui pèse sur le produit national. Il s’agit donc encore d’égaliser les conditions de la production. Nous n’aurions qu’un mot à dire : c’est que la taxe est un obstacle artificiel qui a exactement le même résultat qu’un obstacle naturel, celui de forcer la hausse du prix. Si cette hausse arrive au point qu’il y ait plus de perte à créer le produit lui-même qu’à le tirer du dehors en en créant la contre-valeur, laissez faire. L’intérêt privé saura bien de deux maux choisir le moindre. Je pourrais donc renvoyer le lecteur à la démonstration précédente ; mais le sophisme que j’ai ici à combattre revient si souvent dans les doléances et les requêtes, j’allais dire les sommations de l’école protectioniste, qu’il mérite bien une discussion spéciale.
Si l’on veut parler d’une de ces taxes exceptionnelles qui frappent certains produits, je conviendrai volontiers qu’il est raisonnable d’y soumettre le produit étranger. Par exemple, il serait absurde d’affranchir de l’impôt le sel exotique ; non qu’au point de vue économique la France y perdit rien, au contraire. Quoi qu’on en dise, les principes sont invariables ; et la France y gagnerait, comme elle gagnera toujours à éviter un obstacle naturel ou artificiel. Mais ici l’obstacle a été mis dans un but fiscal. Il faut bien que ce but soit atteint ; et si le sel étranger se vendait sur notre marché, franc de droit, le Trésor ne recouvrerait pas ses cent millions, et il devrait les demander à quelque autre branche de l’impôt. Il y aurait inconséquence évidente à créer un obstacle dans un but pour ne pas l’atteindre. Mieux eût valu s’adresser tout d’abord à cet autre impôt, et ne pas taxer le sel français. Voilà dans quelles circonstances j’admets sur le produit étranger un droit non protecteur, mais fiscal.
Mais prétendre qu’une nation, parce qu’elle est assujettie à des impôts plus lourds que ceux de la nation voisine, doit se protéger par ses tarifs contre la concurrence de sa rivale, c’est là qu’est le sophisme, et c’est là que j’entends l’attaquer.
J’ai dit plusieurs fois que je n’entends faire que de la théorie, et remonter, autant que j’en suis capable, aux sources des erreurs des protectionistes. Si je faisais de la polémique, je leur dirais : Pourquoi dirigez-vous les tarifs principalement contre l’Angleterre et la Belgique, les pays les plus chargés de taxes qui soient au monde ? Ne suis-je pas autorisé à ne voir dans votre argument qu’un prétexte ? — Mais je ne suis pas de ceux qui croient qu’on est prohibitioniste par intérêt et non par conviction. La doctrine de la protection est trop populaire pour n’être pas sincère. Si le grand nombre avait foi dans la liberté, nous serions libres. Sans doute c’est l’intérêt privé qui grève nos tarifs, mais c’est après avoir agi sur les convictions. « La volonté, dit Pascal, est un des principaux organes de la créance. » Mais la créance n’existe pas moins pour avoir sa racine dans la volonté et dans les secrètes inspirations de l’égoïsme.
Revenons au sophisme tiré de l’impôt.
L’État peut faire des impôts un bon ou un mauvais usage : il en fait un bon usage quand il rend au public des services équivalents à la valeur que le public lui livre. Il en fait mauvais usage quand il dissipe cette valeur sans rien donner en retour.
Dans le premier cas, dire que les taxes placent le pays qui les paie dans des conditions de production plus défavorables que celui qui en est affranchi, c’est un sophisme. — Nous payons vingt millions pour la justice et la police, c’est vrai ; mais nous avons la justice et la police, la sécurité qu’elles nous procurent, le temps qu’elles nous épargnent ; et il est très-probable que la production n’est ni plus facile ni plus active parmi les peuples, s’il en est, où chacun se fait justice soi-même. — Nous payons plusieurs centaines de millions pour des routes, des ponts, des ports, des chemins de fer : j’en conviens. Mais nous avons ces chemins, ces ports, ces routes ; et à moins de prétendre que nous faisons une mauvaise affaire en les établissant, on ne peut pas dire qu’ils nous rendent inférieurs aux peuples qui ne supportent pas, il est vrai, de budget de travaux publics, mais qui n’ont pas non plus de travaux publics. — Et ceci explique pourquoi, tout en accusant l’impôt d’être une cause d’infériorité industrielle, nous dirigeons nos tarifs précisément contre les nations qui sont les plus imposées. C’est que les taxes, bien employées, loin de les détériorer, ont amélioré les conditions de production de ces peuples. Ainsi, nous arrivons toujours à cette conclusion, que les sophismes protectionistes ne s’écartent pas seulement du vrai, mais sont le contraire, l’antipode de la vérité [70].
Quant aux impôts qui sont improductifs, supprimez-les, si vous pouvez ; mais la plus étrange manière qu’on puisse imaginer d’en neutraliser les effets, c’est assurément d’ajouter aux taxes publiques des taxes individuelles. Grand merci de la compensation ! L’État nous a trop taxés, dites-vous. Eh ! raison de plus pour ne pas nous taxer encore les uns les autres !
Un droit protecteur est une taxe dirigée contre le produit étranger, mais qui retombe, ne l’oublions jamais, sur le consommateur national. Or le consommateur, c’est le contribuable. Et n’est-ce pas un plaisant langage à lui tenir que de lui dire : « Parce que les impôts sont lourds, nous élèverons pour toi le prix de toutes choses ; parce que l’État prend une partie de ton revenu, nous en livrerons une autre partie au monopole ? »
Mais pénétrons plus avant dans un sophisme si accrédité parmi nos législateurs, quoiqu’il soit assez extraordinaire que ce soient précisément ceux qui maintiennent les impôts improductifs (c’est notre hypothèse actuelle) qui leur attribuent notre prétendue infériorité industrielle, pour la racheter ensuite par d’autres impôts et d’autres entraves.
Il me semble évident que la protection aurait pu, sans changer de nature et d’effets, prendre la forme d’une taxe directe prélevée par l’État et distribuée en primes indemnitaires aux industries privilégiées.
Admettons que le fer étranger puisse se vendre sur notre marché à 8 francs et non plus bas, le fer français à 12 francs et non au-dessous.
Dans cette hypothèse, il y a pour l’État deux manières d’assurer le marché national au producteur.
La première, c’est de frapper le fer étranger d’un droit de 5 francs. Il est clair qu’il sera exclu, puisqu’il ne pourrait plus se vendre qu’à 13 francs, savoir : 8 francs pour le prix de revient et 5 francs pour la taxe, et qu’à ce prix il sera chassé du marché par le fer français, que nous avons supposé être de 12 francs. Dans ce cas, l’acheteur, le consommateur aura fait tous les frais de la protection.
L’État aurait pu encore imposer au public une taxe de 5 francs et la donner en prime au maître de forge. L’effet protecteur eût été le même. Le fer étranger eût été également exclu ; car notre maître de forge aurait vendu à 7 francs, ce qui, avec les 5 francs de prime, lui ferait son prix rémunérateur de 12 francs. Mais en présence du fer à 7 francs, l’étranger ne pourrait livrer le sien à 8.
Je ne puis voir entre ces deux systèmes qu’une seule différence : le principe est le même, l’effet est le même ; seulement dans un cas la protection est payée par quelques-uns, dans l’autre par tous.
J’avoue franchement ma prédilection pour le second système. Il me semble plus juste, plus économique et plus loyal : plus juste, parce que si la société veut faire des largesses à quelques-uns de ses membres, il faut que tous y contribuent ; plus économique, parce qu’il épargnerait beaucoup de frais de perception, et ferait disparaître beaucoup d’entraves ; plus loyal enfin, parce que le public verrait clair dans l’opération et saurait ce qu’on lui fait faire.
Mais si le système protecteur eût pris cette forme, ne serait-ce pas une chose assez risible que d’entendre dire : « Nous payons de lourdes taxes pour l’armée, la marine, la justice, les travaux publics, l’université, la dette, etc. ; cela passe un milliard. C’est pourquoi il serait bon que l’État nous prît encore un autre milliard pour soulager ces pauvres maîtres de forges, ces pauvres actionnaires d’Anzin, ces malheureux propriétaires de forêts, ces utiles pêcheurs de morue. »
Qu’on y regarde de près, et l’on s’assurera que c’est à cela que se réduit la portée du sophisme que je combats. Vous avez beau faire, messieurs, vous ne pouvez donner de l’argent aux uns qu’en le prenant aux autres. Si vous voulez absolument épuiser le contribuable, à la bonne heure ; mais au moins ne le raillez pas, et ne venez pas lui dire : « Je te prends pour compenser ce que je t’ai déjà pris. »
On ne finirait pas si l’on voulait relever tout ce qu’il y a de faux dans ce sophisme. Je me bornerai à trois considérations.
Vous vous prévalez de ce que la France est accablée de taxes, pour en induire qu’il faut protéger telle ou telle industrie. — Mais ces taxes, nous avons à les payer malgré la protection. Si donc une industrie se présente et dit : « Je participe au paiement des taxes ; cela élève le prix de revient de mes produits, et je demande qu’un droit protecteur en élève aussi le prix vénal », que demande-t-elle autre chose, si ce n’est de se décharger de la taxe sur le reste de la communauté ? Sa prétention est de recouvrer, par l’élévation du prix de ses produits, le montant de sa part de taxes. Or, le total des impôts devant toujours rentrer au Trésor, et la masse ayant à supporter cette élévation de prix, elle paie sa taxe et celle de cette industrie. Mais, dites-vous, on protégera tout le monde. — D’abord cela est impossible ; et, cela fût-il possible, où serait le soulagement ? Je paierai pour vous, vous paierez pour moi ; mais il ne faudra pas moins que la taxe se paie.
Ainsi, vous êtes dupes d’une illusion. Vous voulez payer des taxes pour avoir une armée, une marine, un culte, une université, des juges, des routes, etc., et ensuite vous voulez affranchir de sa part de taxes d’abord une industrie, puis une seconde, puis une troisième, toujours en en répartissant le fardeau sur la masse. Mais vous ne faites rien que créer des complications interminables, sans autre résultat que ces complications elles-mêmes. Prouvez-moi que l’élévation du prix due à la protection retombe sur l’étranger, et je pourrai voir dans votre argument quelque chose de spécieux. Mais s’il est vrai que le public français payait la taxe avant la loi et qu’après la loi il paie à la fois et la protection et la taxe, en vérité, je ne puis voir ce qu’il y gagne.
Mais je vais bien plus loin : je dis que, plus nos impôts sont lourds, plus nous devons nous empresser d’ouvrir nos ports et nos frontières à l’étranger moins grevé que nous. Et pourquoi ? Pour lui repasser une plus grande partie de notre fardeau. N’est-ce point un axiome incontestable en économie politique, que les impôts, à la longue, retombent sur le consommateur ? Plus donc nos échanges seront multipliés, plus les consommateurs étrangers nous rembourseront de taxes incorporées dans les produits que nous leur vendrons ; tandis que nous n’aurions à leur faire, à cet égard, qu’une moindre restitution, puisque, d’après notre hypothèse, leurs produits sont moins grevés que les nôtres.
Enfin, ces lourds impôts dont vous arguez pour justifier le régime prohibitif, vous êtes-vous jamais demandé si ce n’est pas ce régime qui les occasionne ? Je voudrais bien qu’on me dit à quoi serviraient les grandes armées permanentes et les puissantes marines militaires si le commerce était libre… Mais ceci regarde les hommes politiques,
Et ne confondons pas, pour trop approfondir, 6370.leurs affaires avec les nôtres [71].
VI. Balance du commerce↩
Nos adversaires ont adopté une tactique qui ne laisse pas que de nous embarrasser. Établissons-nous notre doctrine ? ils l’admettent le plus respectueusement possible. Attaquons-nous leur principe ? ils l’abandonnent de la meilleure grâce du monde ; ils ne demandent qu’une chose, c’est que notre doctrine, qu’ils tiennent pour vraie, soit reléguée dans les livres, et que leur principe, qu’ils reconnaissent vicieux, règne dans la pratique des affaires. Cédez-leur le maniement des tarifs, et ils ne vous disputeront pas le domaine de la théorie.
« Assurément, disait dernièrement M. Gauthier de Rumilly, personne de nous ne veut ressusciter les vieilles théories de la balance du commerce. » — Fort bien ; mais, monsieur Gauthier, ce n’est pas tout que de donner en passant un soufflet à l’erreur : il faudrait encore ne pas raisonner, immédiatement après, et deux heures durant, comme si cette erreur était une vérité.
Parlez-moi de M. Lestiboudois. Voilà un raisonneur conséquent, un argumentateur logicien. Il n’y a rien dans ses conclusions qui ne soit dans ses prémisses : il ne demande rien à la pratique qu’il ne justifie par une théorie. Son principe peut être faux, c’est là la question. Mais enfin il a un principe. Il croit, il proclame tout haut que, si la France donne dix pour recevoir quinze, elle perd cinq, et il est tout simple qu’il fasse des lois en conséquence.
« Ce qu’il y a d’important, dit-il, c’est qu’incessamment le chiffre de l’importation va en augmentant et dépasse le chiffre de l’exportation, c’est-à-dire que tous les ans la France achète plus de produits étrangers et vend moins de produits nationaux. Les chiffres en font foi. Que voyons-nous ? en 1842, nous voyons l’importation dépasser de 200 millions l’exportation. Ces faits me semblent prouver, de la manière la plus nette, que le travail national n’est pas suffisamment protégé, que nous chargeons le travail étranger de notre approvisionnement, que la concurrence de nos rivaux opprime notre industrie. La loi actuelle me semble être une consécration de ce fait, qu’il n’est pas vrai, ainsi que l’ont déclaré les économistes, que, quand on achète, on vend nécessairement une portion correspondante de marchandises. Il est évident qu’on peut acheter, non avec ses produits habituels, non avec son revenu, non avec les fruits du travail permanent, mais avec son capital, avec les produits accumulés, économisés, ceux qui servent à la reproduction, c’est-à-dire qu’on peut dépenser, dissiper les profits des économies antérieures, qu’on peut s’appauvrir, qu’on peut marcher à sa ruine, qu’on peut consommer entièrement le capital national. C’est précisément ce que nous faisons. Tous les ans nous donnons 200 millions à l’étranger. »
Eh bien, voilà un homme avec lequel on peut s’entendre. Il n’y a pas d’hypocrisie dans ce langage. La balance du commerce y est avouée tout net. La France importe 200 millions de plus qu’elle n’exporte. Donc, la France perd 200 millions par an. — Et le remède ? C’est d’empêcher les importations. La conclusion est irréprochable.
C’est donc à M. Lestiboudois que nous allons nous attaquer, car comment lutter avec M. Gauthier ? Si vous lui dites : La balance du commerce est une erreur, il vous répondra : C’est ce que j’ai avancé dans mon exorde. Si vous lui criez : Mais la balance du commerce est une vérité, il vous dira : C’est ce que j’ai consigné dans mes conclusions.
L’école économiste me blâmera sans doute d’argumenter avec M. Lestiboudois. Combattre la balance du commerce, me dira-t-on, c’est combattre un moulin à vent.
Mais, prenez-y garde, la balance du commerce n’est ni si vieille, ni si malade, ni si morte que veut bien le dire M. Gauthier ; car toute la Chambre, y compris M. Gauthier lui-même, s’est associée par ses votes à la théorie de M. Lestiboudois.
Cependant, pour ne pas fatiguer le lecteur, je n’approfondirai pas cette théorie. Je me contenterai de la soumettre à l’épreuve des faits.
On accuse sans cesse nos principes de n’être bons qu’en théorie. Mais, dites-moi, messieurs, croyez-vous que les livres des négociants soient bons en pratique ? Il me semble que, s’il y a quelque chose au monde qui ait une autorité pratique, quand il s’agit de constater des pertes et des profits, c’est la comptabilité commerciale. Apparemment tous les négociants de la terre ne s’entendent pas depuis des siècles pour tenir leurs livres de telle façon qu’ils leur présentent les bénéfices comme des pertes, et les pertes comme des bénéfices. En vérité, j’aimerais mieux croire que M. Lestiboudois est un mauvais économiste.
Or, un négociant de mes amis, ayant fait deux opérations dont les résultats ont été fort différents, j’ai été curieux de comparer à ce sujet la comptabilité du comptoir à celle de la douane, interprétée par M. Lestiboudois avec la sanction de nos six cents législateurs.
M. T… expédia du Havre un bâtiment pour les États-Unis, chargé de marchandises françaises, et principalement de celles qu’on nomme articles de Paris, montant à 200,000 fr. Ce fut le chiffre déclaré en douane. Arrivée à la Nouvelle-Orléans, il se trouva que la cargaison avait fait 10 % de frais et acquitté 30 % de droits, ce qui la faisait ressortir à 280,000 fr. Elle fut vendue avec 20 % de bénéfice, soit 40,000 fr., et produisit au total 320,000 fr., que le consignataire convertit en coton. Ces cotons eurent encore à supporter, pour le transport, assurances, commission, etc., 10 % de frais : en sorte qu’au moment où elle entra au Havre, la nouvelle cargaison, revenait à 352,000 fr., et ce fut le chiffre consigné dans les états de la douane. Enfin, M. T… réalisa encore, sur ce retour, 20 % de profit, soit 70,400 fr. ; en d’autres termes, les cotons se vendirent 422,400 fr.
Si M. Lestiboudois l’exige, je lui enverrai un extrait des livres de M. T… Il y verra figurer au crédit du compte de profits et pertes, c’est-à-dire comme bénéfices, deux articles, l’un de 40,000, l’autre de 70,400 fr., et M. T… est bien persuadé qu’à cet égard sa comptabilité ne le trompe pas.
Cependant, que disent à M. Lestiboudois les chiffres que la douane a recueillis sur cette opération ? Ils lui apprennent que la France a exporté 200,000 fr. et qu’elle a importé 352,000 fr. ; d’où l’honorable député conclut « qu’elle a dépensé et dissipé les profits de ses économies antérieures, qu’elle s’est appauvrie, qu’elle a marché vers sa ruine, qu’elle a donné à l’étranger 452,000 fr. de son capital. »
Quelque temps après, M. T… expédia un autre navire également chargé de 200,000 fr. de produits de notre travail national. Mais le malheureux bâtiment sombra en sortant du port, et il ne resta autre chose à faire à M. T… que d’inscrire sur ses livres deux petits articles ainsi formulés :
Marchandises diverses doivent à X fr. 200,000 pour achats de différents objets expédiés par le navire N.
Profits et pertes doivent à marchandises diverses fr. 200,000 pour perte définitive et totale de la cargaison.
Pendant ce temps-là, la douane inscrivait de son côté fr. 200,000 sur son tableau d’exportations ; et comme elle n’aura jamais rien à faire figurer en regard sur le tableau des importations, il s’ensuit que M. Lestiboudois et la Chambre verront dans ce naufrage un profit clair et net de 200,000 fr. pour la France.
Il y a encore cette conséquence à tirer de là, c’est que, selon la théorie de la balance du commerce, la France a un moyen tout simple de doubler à chaque instant ses capitaux. Il suffit pour cela qu’après les avoir fait passer par la douane, elle les jette à la mer. En ce cas, les exportations seront égales au montant de ses capitaux ; les importations seront nulles et même impossibles, et nous gagnerons tout ce que l’Océan aura englouti.
C’est une plaisanterie, diront les protectionistes. Il est impossible que nous disions de pareilles absurdités. — Vous les dites pourtant, et, qui plus est, vous les réalisez, vous les imposez pratiquement à vos concitoyens, autant du moins que cela dépend de vous.
La vérité est qu’il faudrait prendre la balance du commerce au rebours, et calculer le profit national, dans le commerce extérieur, par l’excédant des importations sur les exportations. Cet excédant, les frais déduits, forme le bénéfice réel. Mais cette théorie, qui est la vraie, mène directement à la liberté des échanges. — Cette théorie, messieurs, je vous la livre comme toutes celles qui ont fait le sujet des précédents chapitres. Exagérez-la tant que vous voudrez, elle n’a rien à redouter de cette épreuve. Supposez, si cela vous amuse, que l’étranger nous inonde de toutes sortes de marchandises utiles, sans nous rien demander ; que nos importations sont infinies et nos exportations nulles, je vous défie de me prouver que nous en serons plus pauvres [72].
VII. Pétition des fabricants de chandelles, etc.↩
PÉTITION
DES FABRICANTS DE CHANDELLES, BOUGIES, LAMPES, CHANDELIERS, RÉVERBÈRES, MOUCHETTES, ÉTEIGNOIRS, ET DES PRODUCTEURS DE SUIF, HUILE, RÉSINE, ALCOOL, ET GÉNÉRALEMENT DE TOUT CE QUI CONCERNE L’ÉCLAIRAGE.
À MM. les membres de la chambre des députés.
« Messieurs,
« Vous êtes dans la bonne voie. Vous repoussez les théories abstraites ; l'abondance, le bon marché vous touchent peu. Vous vous préoccupez surtout du sort du producteur. Vous le voulez affranchir de la concurrence extérieure, en un mot, vous voulez réserver le marché national au travail national.
« Nous venons vous offrir une admirable occasion d'appliquer votre… comment dirons-nous ? votre théorie ? non, rien n'est plus trompeur que la théorie ; votre doctrine ? votre système ? votre principe ? mais vous n'aimez pas les doctrines, vous avez horreur des systèmes, et, quant aux principes, vous déclarez qu'il n'y en a pas en économie sociale ; nous dirons donc votre pratique, votre pratique sans théorie et sans principe.
« Nous subissons l’intolérable concurrence d’un rival étranger placé, à ce qu’il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres, pour la production de la lumière, qu’il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit ; car, aussitôt qu’il se montre, notre vente cesse, tous les consommateurs s’adressent à lui, et une branche d’industrie française, dont les ramifications sont innombrables, est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui n’est autre que le soleil, nous fait une guerre si acharnée, que nous soupçonnons qu’il nous est suscité par la perfide Albion (bonne diplomatie par le temps qui court !), d’autant qu’il a pour cette île orgueilleuse des ménagements dont il se dispense envers nous.
« Nous demandons qu’il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contre-vents, volets, rideaux, vasistas, œils-de-bœuf, stores, en un mot, de toutes ouvertures, trous, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d’avoir doté le pays, qui ne saurait sans ingratitude nous abandonner aujourd’hui à une lutte si inégale.
« Veuillez, messieurs les députés, ne pas prendre notre demande pour une satire, et ne la repoussez pas du moins sans écouter les raisons que nous avons à faire valoir à l’appui.
« Et d’abord, si vous fermez, autant que possible, tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l’industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée ?
« S’il se consomme plus de suif, il faudra plus de bœufs et de moutons, et, par suite, on verra se multiplier les prairies artificielles, la viande, la laine, le cuir, et surtout les engrais, cette base de toute richesse agricole.
« S’il se consomme plus d’huile, on verra s’étendre la culture du pavot, de l’olivier, du colza. Ces plantes riches et épuisantes viendront à propos mettre à profit cette fertilité que l’élève des bestiaux aura communiquée à notre territoire.
« Nos landes se couvriront d’arbres résineux. De nombreux essaims d’abeilles recueilleront sur nos montagnes des trésors parfumés qui s’évaporent aujourd’hui sans utilité, comme les fleurs d’où ils émanent. Il n’est donc pas une branche d’agriculture qui ne prenne un grand développement.
« Il en est de même de la navigation : des milliers de vaisseaux iront à la pêche de la baleine, et dans peu de temps nous aurons une marine capable de soutenir l’honneur de la France et de répondre à la patriotique susceptibilité des pétitionnaires soussignés, marchands de chandelles, etc.
Mais que dirons-nous de l’article Paris ? Voyez d’ici les dorures, les bronzes, les cristaux en chandeliers, en lampes, en lustres, en candélabres, briller dans de spacieux magasins, auprès desquels ceux d’aujourd’hui ne sont que des boutiques.
« Il n’est pas jusqu’au pauvre résinier, au sommet de sa dune, ou au triste mineur, au fond de sa noire galerie, qui ne voie augmenter son salaire et son bien-être.
« Veuillez y réfléchir, messieurs ; et vous resterez convaincus qu’il n’est peut-être pas un Français, depuis l’opulent actionnaire d’Anzin jusqu’au plus humble débitant d’allumettes, dont le succès de notre demande n’améliore la condition.
« Nous prévoyons vos objections, messieurs ; mais vous ne nous en opposerez pas une seule que vous n’alliez la ramasser dans les livres usés des partisans de la liberté commerciale. Nous osons vous mettre au défi de prononcer un mot contre nous qui ne se retourne à l’instant contre vous-mêmes et contre le principe qui dirige toute votre politique.
« Nous direz-vous que, si nous gagnons à cette protection, la France n’y gagnera point, parce que le consommateur en fera les frais ?
« Nous vous répondrons :
« Vous n’avez plus le droit d’invoquer les intérêts du consommateur. Quand il s’est trouvé aux prises avec le producteur, en toutes circonstances vous l’avez sacrifié. — Vous l’avez fait pour encourager le travail, pour accroître le domaine du travail. Par le même motif, vous devez le faire encore.
« Vous avez été vous-mêmes au-devant de l’objection. Lorsqu’on vous disait : le consommateur est intéressé à la libre introduction du fer, de la houille, du sésame, du froment, des tissus. — Oui, disiez-vous, mais le producteur est intéressé à leur exclusion. — Eh bien ! si les consommateurs sont intéressés à l’admission de la lumière naturelle, les producteurs le sont à son interdiction.
« Mais, disiez-vous encore, le producteur et le consommateur ne font qu’un. Si le fabricant gagne par la protection, il fera gagner l’agriculteur. Si l’agriculture prospère, elle ouvrira des débouchés aux fabriques. — Eh bien ! si vous nous conférez le monopole de l’éclairage pendant le jour, d’abord nous achèterons beaucoup de suifs, de charbons, d’huiles, de résines, de cire, d’alcool, d’argent, de fer, de bronzes, de cristaux, pour alimenter notre industrie, et, de plus, nous et nos nombreux fournisseurs, devenus riches, nous consommerons beaucoup et répandrons l’aisance dans toutes les branches du travail national.
« Direz-vous que la lumière du soleil est un don gratuit, et que repousser des dons gratuits, ce serait repousser la richesse même sous prétexte d’encourager les moyens de l’acquérir ?
« Mais prenez garde que vous portez la mort dans le cœur de votre politique ; prenez garde que jusqu’ici vous avez toujours repoussé le produit étranger parce qu’il se rapproche du don gratuit, et d’autant plus qu’il se rapproche du don gratuit. Pour obtempérer aux exigences des autres monopoleurs, vous n’aviez qu’un demi-motif ; pour accueillir notre demande, vous avez un motif complet, et nous repousser précisément en vous fondant sur ce que nous sommes plus fondés que les autres, ce serait poser l’équation : + × + = − ; en d’autres termes, ce serait entasser absurdité sur absurdité.
« Le travail et la nature concourent en proportions diverses, selon les pays et les climats, à la création d’un produit. La part qu’y met la nature est toujours gratuite ; c’est la part du travail qui en fait la valeur et se paie.
« Si une orange de Lisbonne se vend à moitié prix d’une orange de Paris, c’est qu’une chaleur naturelle et par conséquent gratuite fait pour l’une ce que l’autre doit à une chaleur artificielle et partant coûteuse.
« Donc, quand une orange nous arrive de Portugal, on peut dire qu’elle nous est donnée moitié gratuitement, moitié à titre onéreux, ou, en d’autres termes, à moitié prix relativement à celles de Paris.
« Or, c’est précisément de cette demi-gratuité (pardon du mot) que vous arguez pour l’exclure. Vous dites : Comment le travail national pourrait-il soutenir la concurrence du travail étranger quand celui-là a tout à faire, et que celui-ci n’a à accomplir que la moitié de la besogne, le soleil se chargeant du reste ? — Mais si la demi-gratuité vous détermine à repousser la concurrence, comment la gratuité entière vous porterait-elle à admettre la concurrence ? Ou vous n’êtes pas logiciens, ou vous devez, repoussant la demi-gratuité comme nuisible à notre travail national, repousser à fortiori et avec deux fois plus de zèle la gratuité entière.
« Encore une fois, quand un produit, houille, fer, froment ou tissu, nous vient du dehors et que nous pouvons l’acquérir avec moins de travail que si nous le faisions nous-mêmes, la différence est un don gratuit qui nous est conféré. Ce don est plus ou moins considérable, selon que la différence est plus ou moins grande. Il est du quart, de moitié, des trois quarts de la valeur du produit, si l’étranger ne nous demande que les trois quarts, la moitié, le quart du paiement. Il est aussi complet qu’il puisse l’être, quand le donateur, comme fait le soleil pour la lumière, ne nous demande rien. La question, et nous la posons formellement, est de savoir si vous voulez pour la France le bénéfice de la consommation gratuite ou les prétendus avantages de la production onéreuse. Choisissez, mais soyez logiques ; car, tant que vous repousserez, comme vous le faites, la houille, le fer, le froment, les tissus étrangers, en proportion de ce que leur prix se rapproche de zéro, quelle inconséquence ne serait-ce pas d’admettre la lumière du soleil, dont le prix est à zéro, pendant toute la journée ? »
VIII. Droits différentiels↩
Un pauvre cultivateur de la Gironde avait élevé avec amour un plant de vigne. Après bien des fatigues et des travaux, il eut enfin le bonheur de recueillir une pièce de vin, et il oublia que chaque goutte de ce précieux nectar avait coûté à son front une goutte de sueur. « — Je le vendrai, dit-il à sa femme, et avec le prix j’achèterai du fil dont tu feras le trousseau de notre fille. » — L’honnête campagnard se rend à la ville, il rencontre un Belge et un Anglais. Le Belge lui dit : Donnez moi votre pièce de vin, et je vous donnerai en échange quinze paquets de fil. L’Anglais dit : Donnez-moi votre vin, et je vous donnerai vingt paquets de fil ; car, nous autres Anglais, nous filons à meilleur marché que les Belges. Mais un douanier qui se trouvait là dit : Brave homme, échangez avec le Belge, si vous le trouvez bon, mais je suis chargé de vous empêcher d’échanger avec l’Anglais. Quoi ! dit le campagnard, vous voulez que je me contente de quinze paquets de fil venu de Bruxelles, quand je puis en avoir vingt venus de Manchester ? — Certainement ; ne voyez-vous pas que la France perdrait si vous receviez vingt paquets, au lieu de quinze ? — J’ai peine à le comprendre, dit le vigneron. — Et moi à l’expliquer, repartit le douanier ; mais la chose est sûre : car tous les députés, ministres et gazetiers sont d’accord sur ce point, que plus un peuple reçoit en échange d’une quantité donnée de ses produits, plus il s’appauvrit. Il fallut conclure avec le Belge. La fille du campagnard n’eut que les trois quarts de son trousseau, et ces braves gens en sont encore à se demander comment il se fait qu’on se ruine en recevant quatre au lieu de trois, et pourquoi on est plus riche avec trois douzaines de serviettes qu’avec quatre douzaines.
IX. Immense découverte !!!↩
Au moment où tous les esprits sont occupés à chercher des économies sur les moyens de transport ;
Au moment où, pour réaliser ces économies, on nivelle les routes, on canalise les rivières, on perfectionne les bateaux à vapeur, on relie à Paris toutes nos frontières par une étoile de fer, par des systèmes de traction atmosphériques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, etc. ;
Au moment enfin où je dois croire que chacun cherche avec ardeur et sincérité la solution de ce problème :
« Faire que le prix des choses, au lieu de consommation, se rapproche autant que possible du prix qu’elles ont aux lieux de production. »
Je me croirais coupable envers mon pays, envers mon siècle et envers moi-même, si je tenais plus longtemps secrète la découverte merveilleuse que je viens de faire.
Car les illusions de l’inventeur ont beau être proverbiales, j’ai la certitude la plus complète d’avoir trouvé un moyen infaillible pour que les produits du monde entier arrivent en France, et réciproquement, avec une réduction de prix considérable.
Infaillible ! et ce n’est encore qu’un des avantages de mon étonnante invention.
Elle n’exige ni plans, ni devis, ni études préparatoires, ni ingénieurs, ni machinistes, ni entrepreneurs, ni capitaux, ni actionnaires, ni secours du gouvernement !
Elle ne présente aucun danger de naufrages, d’explosions, de chocs, d’incendie, de déraillement !
Elle peut être mise en pratique du jour au lendemain !
Enfin, et ceci la recommandera sans doute au public, elle ne grèvera pas d’un centime le budget ; au contraire. — Elle n’augmentera pas le cadre des fonctionnaires et les exigences de la bureaucratie ; au contraire. — Elle ne coûtera à personne sa liberté ; au contraire.
Ce n’est pas le hasard qui m’a mis en possession de ma découverte, c’est l’observation. Je dois dire ici comment j’y ai été conduit.
J’avais donc cette question à résoudre :
« Pourquoi une chose faite à Bruxelles, par exemple, coûte-t-elle plus cher quand elle est arrivée à Paris ? »
Or, je n’ai pas tardé à m’apercevoir que cela provient de ce qu’il existe entre Paris et Bruxelles des obstacles de plusieurs sortes. C’est d’abord la distance ; on ne peut la franchir sans peine, sans perte de temps ; et il faut bien s’y soumettre soi-même ou payer pour qu’un autre s’y soumette. Viennent ensuite des rivières, des marais, des accidents de terrain, de la boue : ce sont autant de difficultés à surmonter. On y parvient en construisant des chaussées, en bâtissant des ponts, en perçant des routes, en diminuant leur résistance par des pavés, des bandes de fer, etc. Mais tout cela coûte, et il faut que l’objet transporté supporte sa part des frais. Il y a encore des voleurs sur les routes, ce qui exige une gendarmerie, une police, etc.
Or, parmi ces obstacles, il en est un que nous avons jeté nous-mêmes, et à grands frais, entre Bruxelles et Paris. Ce sont des hommes embusqués le long de la frontière, armés jusqu’aux dents et chargés d’opposer des difficultés au transport des marchandises d’un pays à l’autre. On les appelle douaniers. Ils agissent exactement dans le même sens que la boue et les ornières. Ils retardent, ils entravent, ils contribuent à cette différence que nous avons remarquée entre le prix de production et le prix de consommation, différence que notre problème est de réduire le plus possible.
Et voilà le problème résolu. Diminuez le tarif.
— Vous aurez fait le chemin de fer du Nord sans qu’il vous en ait rien coûté. Loin de là, vous épargnerez de gros traitements, et vous commencerez dès le premier jour par mettre un capital dans votre poche.
Vraiment, je me demande comment il a pu entrer assez de bizarrerie dans nos cervelles pour nous déterminer à payer beaucoup de millions dans l’objet de détruire les obstacles naturels qui s’interposent entre la France et l’étranger, et en même temps à payer beaucoup d’autres millions pour y substituer des obstacles artificiels qui ont exactement les mêmes effets, en sorte que, l’obstacle créé et l’obstacle détruit se neutralisant, les choses vont comme devant, et le résidu de l’opération est une double dépense.
Un produit belge vaut à Bruxelles 20 fr., et, rendu à Paris, 30, à cause des frais de transport. Le produit similaire d’industrie parisienne vaut 40 fr. Que faisons-nous ?
D’abord nous mettons un droit d’au moins 10 fr., sur le produit belge, afin d’élever son prix de revient à Paris à 40 fr., et nous payons de nombreux surveillants pour qu’il n’échappe pas à ce droit, en sorte que dans le trajet il est chargé de 10 fr., pour le transport et 10 fr., pour la taxe.
Cela fait, nous raisonnons ainsi : ce transport de Bruxelles à Paris, qui coûte 10 fr., est bien cher. Dépensons deux ou trois cents millions en rail-ways, et nous le réduirons de moitié. — Évidemment, tout ce que nous aurons obtenu, c’est que le produit belge se vendra à Paris 35 fr., savoir :
| 20 | fr. | son prix de Bruxelles. |
| 10 | — | droit. |
| 5 | — | port réduit par le chemin de fer. |
| 35 | fr. | total, ou prix de revient à Paris. |
Eh ! n’aurions-nous pas atteint le même résultat en abaissant le tarif à 5 fr. ? Nous aurions alors :
| 20 | fr. | prix de Bruxelles. |
| 5 | — | droit réduit. |
| 10 | — | port par les routes ordinaires. |
| 35 | fr. | total, ou prix de revient à Paris. |
Et ce procédé nous eût épargné 200 millions que coûte le chemin de fer, plus les frais de surveillance douanière, car ils doivent diminuer à mesure que diminue l’encouragement à la contrebande.
Mais, dit-on, le droit est nécessaire pour protéger l’industrie parisienne. — Soit ; mais alors n’en détruisez pas l’effet par votre chemin de fer.
Car, si vous persistez à vouloir que le produit belge revienne, comme celui de Paris, à 40 fr., il vous faudra porter le droit à 15 fr. pour avoir :
| 20 | fr. | prix de Bruxelles. |
| 15 | — | droit protecteur. |
| 5 | — | port par le chemin de fer. |
| 40 | fr. | total à prix égalisés. |
Alors je demande quelle est, sous ce rapport, l’utilité du chemin de fer.
Franchement, n’y a-t-il pas quelque chose d’humiliant pour le dix-neuvième siècle d’apprêter aux âges futurs le spectacle de pareilles puérilités pratiquées avec un sérieux imperturbable ? Être dupe d’autrui n’est pas déjà très-plaisant ; mais employer le vaste appareil représentatif à se duper soi-même, à se duper doublement, et dans une affaire de numération, voilà qui est bien propre à rabattre un peu l’orgueil du siècle des lumières.
X. Réciprocité↩
Nous venons de voir que tout ce qui, dans le trajet, rend le transport onéreux, agit dans le sens de la protection, ou, si on l’aime mieux, que la protection agit dans le sens de tout ce qui rend le transport onéreux.
Il est donc vrai de dire qu’un tarif est un marais, une ornière, une lacune, une pente roide, en un mot, un obstacle dont l’effet se résout à augmenter la différence du prix de consommation au prix de production. Il est de même incontestable qu’un marais, une fondrière, sont de véritables tarifs protecteurs.
Il y a des gens (en petit nombre, il est vrai, mais il y en a) qui commencent à comprendre que les obstacles, pour être artificiels, n’en sont pas moins des obstacles, et que notre bien-être a plus à gagner à la liberté qu’à la protection, précisément par la même raison qui fait qu’un canal lui est plus favorable qu’un « chemin sablonneux, montant et malaisé ».
Mais, disent-ils, il faut que cette liberté soit réciproque. Si nous abaissions nos barrières devant l’Espagne, sans que l’Espagne les abaissât devant nous, évidemment, nous serions dupes. Faisons donc des traités de commerce sur la base d’une juste réciprocité, concédons pour qu’on nous concède, faisons le sacrifice d’acheter pour obtenir l’avantage de vendre.
Les personnes qui raisonnent ainsi, je suis fâché de le leur dire, sont, qu’elles le sachent ou non, dans le principe de la protection ; seulement elles sont un peu plus inconséquentes que les prohibitionistes absolus.
Je le démontrerai par l’apologue suivant.
Stulta et Puera.
Il y avait, n’importe où, deux villes, Stulta et Puera. Elles construisirent à gros frais une route qui les rattachait l’une à l’autre. Quand cela fut fait, Stulta se dit : Voici que Puera m’inonde de ses produits, il faut y aviser. En conséquence, elle créa et paya un corps d’Enrayeurs, ainsi nommés parce que leur mission était de mettre des obstacles aux convois qui arrivaient de Puera. Bientôt après, Puera eut aussi un corps d’Enrayeurs.
Au bout de quelques siècles, les lumières ayant fait de grands progrès, la capacité de Puera se haussa jusqu’à lui faire découvrir que ces obstacles réciproques pourraient bien n’être que réciproquement nuisibles. Elle envoya un diplomate à Stulta, lequel, sauf la phraséologie officielle, parla en ce sens : « Nous avons créé une route, et maintenant nous embarrassons cette route. Cela est absurde. Mieux eût valu laisser les choses dans leur premier état. Nous n’aurions pas eu à payer la route d’abord, et puis les embarras. Au nom de Puera, je viens vous proposer, non point de renoncer tout à coup à nous opposer des obstacles mutuels, ce serait agir selon un principe, et nous méprisons autant que vous les principes, mais d’atténuer quelque peu ces obstacles, en ayant soin de pondérer équitablement à cet égard nos sacrifices respectifs. » — Ainsi parla le diplomate. Stulta demanda du temps pour réfléchir. Elle consulta tour à tour ses fabricants, ses agriculteurs. Enfin au bout de quelques années, elle déclara que les négociations étaient rompues.
À cette nouvelle, les habitants de Puera tinrent conseil. Un vieillard (on a toujours soupçonné qu’il avait été secrètement acheté par Stulta) se leva et dit : « Les obstacles créés par Stulta nuisent à nos ventes, c’est un malheur. Ceux que nous avons créés nous-mêmes nuisent à nos achats et c’est un autre malheur. Nous ne pouvons rien sur le premier, mais le second dépend de nous. Délivrons-nous au moins de l’un, puisque nous ne pouvons nous défaire des deux. Supprimons nos Enrayeurs sans exiger que Stulta en fasse autant. Un jour sans doute elle apprendra à mieux faire ses comptes. »
Un second conseiller, homme de pratique et de faits, exempt de principes et nourri de la vieille expérience des ancêtres, répliqua : « N’écoutons pas ce rêveur, ce théoricien, ce novateur, cet utopiste, cet économiste, ce stultomane. Nous serions perdus si les embarras de la route n’étaient pas bien égalisés, équilibrés et pondérés entre Stulta et Puera. Il y aurait plus de difficultés, pour aller que pour venir, et pour exporter que pour importer. Nous serions, relativement à Stulta dans les conditions d’infériorité où se trouvent le Havre, Nantes, Bordeaux, Lisbonne, Londres, Hambourg, la Nouvelle-Orléans, par rapport aux villes placées aux sources de la Seine, de la Loire, de la Garonne, de la Tamise, de l’Elbe et du Mississippi ; car il y a plus de difficultés à remonter les fleuves qu’à les descendre. — (Une voix : Les villes des embouchures ont prospéré plus que celles des sources.) — Ce n’est pas possible. — (La même voix : Mais cela est.) — Eh bien, elles ont prospéré contre les règles. » Un raisonnement si concluant ébranla l’assemblée. L’orateur acheva de la convaincre en parlant d’indépendance nationale, d’honneur national, de dignité nationale, de travail national, d’inondation de produits, de tributs, de concurrence meurtrière ; bref, il emporta le maintien des obstacles ; et, si vous en êtes curieux, je puis vous conduire en certain pays où vous verrez de vos yeux des cantonniers et des enrayeurs travaillant de la meilleure intelligence du monde, par décret de la même assemblée législative et aux frais des mêmes contribuables, les uns à déblayer la route et les autres à l’embarrasser.
XI. Prix absolus↩
Voulez-vous juger entre la liberté et la protection ? voulez-vous apprécier la portée d’un phénomène économique ? Recherchez ses effets sur l’abondance ou la rareté des choses, et non sur la hausse ou la baisse des prix. Méfiez-vous des prix absolus : ils vous mèneraient dans un labyrinthe inextricable.
M. Mathieu de Dombasle, après avoir établi que la protection renchérit les choses, ajoute :
« L’excédant du prix augmente les dépenses de la vie, et par conséquent le prix du travail, et chacun retrouve dans l’excédant du prix de ses produits l’excédant du prix de ses dépenses. Ainsi, si tout le monde paie comme consommateur, tout le monde aussi reçoit comme producteur. »
Il est clair qu’on pourrait retourner l’argument et dire :
« Si tout le monde reçoit comme producteur, tout le monde paie comme consommateur. »
Or, qu’est-ce que cela prouve ? Rien autre chose si ce n’est que la protection déplace inutilement et injustement la richesse. Autant en fait la spoliation.
Encore, pour admettre que ce vaste appareil aboutit à de simples compensations, faut-il adhérer au par conséquent de M. de Dombasle, et s’être assuré que le prix du travail s’élève avec le prix des produits protégés. C’est une question de fait que je renvoie à M. Moreau de Jonnès ; qu’il veuille bien chercher si le taux des salaires a progressé comme les actions des mines d’Anzin. Quant à moi, je ne le pense pas, parce que je crois que le prix du travail, comme tous les autres, est gouverné par le rapport de l’offre à la demande. Or, je conçois bien que la restriction diminue l’offre de la houille, et par suite en élève le prix ; mais je n’aperçois pas aussi clairement qu’elle augmente la demande du travail de manière à améliorer le taux des salaires. Je le conçois d’autant moins que la quantité de travail demandé dépend du capital disponible. Or, la protection peut bien déplacer les capitaux, les pousser d’une industrie vers une autre, mais non les accroître d’une obole.
Au surplus, cette question du plus haut intérêt sera examinée ailleurs. Je reviens aux prix absolus, et je dis qu’il n’est pas d’absurdités qu’on ne puisse rendre spécieuses par des raisonnements tels que celui de M. de Dombasle.
Imaginez qu’une nation isolée, possédant une quantité donnée de numéraire, s’amuse à brûler, chaque année, la moitié de tout ce qu’elle produit, je me charge de prouver, avec la théorie de M. de Dombasle, qu’elle n’en sera pas moins riche.
En effet, par suite de l’incendie, toutes choses doubleront de prix, et les inventaires faits avant et après le désastre offriront exactement la même valeur nominale. Mais alors, qui aura perdu ? Si Jean achète le drap plus cher, il vend aussi plus cher son blé ; et si Pierre perd sur l’achat du blé, il se récupère sur la vente de son drap. « Chacun retrouve dans l’excédant du prix de ses produits (dirai-je) l’excédant du montant de ses dépenses ; et si tout le monde paie comme consommateur, tout le monde aussi reçoit comme producteur. »
Tout cela, c’est de l’amphigouri et non de la science. La vérité, réduite à sa plus simple expression, la voici : que les hommes détruisent le drap et le blé par l’incendie ou par l’usage, l’effet est le même quant aux prix, mais non quant à la richesse, car c’est précisément dans l’usage des choses que consiste la richesse ou le bien-être.
De même, la restriction, tout en diminuant l’abondance des choses, peut en hausser le prix de manière à ce que chacun soit, si vous voulez, numérairement parlant, aussi riche. Mais faire figurer dans un inventaire trois hectolitres de blé à 20 francs ou quatre hectolitres à 15 francs, parce que le résultat est toujours 60 francs, cela revient-il au même, au point de vue de la satisfaction des besoins ?
Et c’est à ce point de vue de la consommation que je ne cesserai de ramener les protectionistes, car c’est là qu’est la fin de tous nos efforts et la solution de tous les problèmes [73]. Je leur dirai toujours : N’est-il pas vrai que la restriction, en prévenant les échanges, en bornant la division du travail, en le forçant à s’attaquer à des difficultés de situation et de température, diminue en définitive la quantité produite par une somme d’efforts déterminés ? Et qu’importe que la moindre quantité produite sous le régime de la protection ait la même valeur nominale que la plus grande quantité produite sous le régime de la liberté ? L’homme ne vit pas de valeurs nominales, mais de produits réels, et plus il a de ces produits, n’importe le prix, plus il est riche.
Je ne m’attendais pas, en écrivant ce qui précède, à rencontrer jamais un anti-économiste assez bon logicien pour admettre explicitement que la richesse des peuples dépend de la valeur des choses, abstraction faite de leur abondance. Voici ce que je trouve dans le livre de M. de Saint-Chamans (pag. 210) :
« Si 15 millions de marchandises vendues aux étrangers sont pris sur le produit ordinaire, estimé 50 millions, les 35 millions restants de marchandises, ne pouvant plus suffire aux demandes ordinaires, augmenteront de prix, et s’élèveront à la valeur de 50 millions. Alors, le revenu du pays représentera 15 millions de valeur de plus… Il y aura donc accroissement de richesses de 15 millions pour le pays, précisément le montant de l’importation du numéraire. »
Voilà qui est plaisant ! Si une nation a fait dans l’année pour 50 millions de récoltes et marchandises, il lui suffit d’en vendre le quart à l’étranger pour être d’un quart plus riche ! Donc, si elle en vendait la moitié, elle augmenterait de moitié sa fortune, et si elle échangeait contre des écus son dernier brin de laine et son dernier grain de froment, elle porterait son revenu à cent millions ! Singulière manière de s’enrichir que de produire l’infinie cherté par la rareté absolue !
Au reste, voulez-vous juger des deux doctrines ? soumettez-les à l’épreuve de l’exagération.
Selon celle de M. de Saint-Chamans, les Français seraient tout aussi riches, c’est-à-dire aussi bien pourvus de toutes choses avec la millième partie de leurs produits annuels, parce qu’ils vaudraient mille fois davantage.
Selon la nôtre, les Français seraient infiniment riches si leurs produits annuels étaient d’une abondance infinie, et par conséquent sans valeur aucune [74].
XII. La protection élève-t-elle le taux des salaires↩
Un athée déblatérait contre la religion, contre les prêtres, contre Dieu. « Si vous continuez, lui dit un des assistants, peu orthodoxe lui-même, vous allez me convertir. »
Ainsi, quand on entend nos imberbes écrivailleurs, romanciers, réformateurs, feuilletonistes ambrés, musqués, gorgés de glaces et de champagne, serrant dans leur portefeuille les Ganneron, les Nord et les Mackenzie, ou faisant couvrir d’or leurs tirades contre l’égoïsme, l’individualisme du siècle ; quand on les entend, dis-je, déclamer contre la dureté de nos institutions, gémir sur le salariat et le prolétariat ; quand on les voit lever au ciel des yeux attendris à l’aspect de la misère des classes laborieuses, misère qu’ils ne visitèrent jamais que pour en faire de lucratives peintures, on est tenté de leur dire : Si vous continuez ainsi, vous allez me rendre indifférent au sort des ouvriers.
Oh ! l’affectation ! l’affectation ! voilà la nauséabonde maladie de l’époque ! Ouvriers, un homme grave, un philanthrope sincère a-t-il exposé le tableau de votre détresse, son livre a-t-il fait impression, aussitôt la tourbe des réformateurs jette son grappin sur cette proie. On la tourne, on la retourne, on l’exploite, on l’exagère, on la presse jusqu’au dégoût, jusqu’au ridicule. On vous jette pour tout remède les grands mots : organisation, association ; on vous flatte, on vous flagorne, et bientôt il en sera des ouvriers comme des esclaves : les hommes sérieux auront honte d’embrasser publiquement leur cause, car comment introduire quelques idées sensées au milieu de ces fades déclamations ?
Mais loin de nous cette lâche indifférence que ne justifierait pas l’affectation qui la provoque !
Ouvriers, votre situation est singulière ! on vous dépouille, comme je le prouverai tout à l’heure… Mais non, je retire ce mot ; bannissons de notre langage toute expression violente et fausse peut-être, en ce sens que la spoliation, enveloppée dans les sophismes qui la voilent, s’exerce, il faut le croire, contre le gré du spoliateur et avec l’assentiment du spolié. Mais enfin, on vous ravit la juste rémunération de votre travail, et nul ne s’occupe de vous faire rendre justice. Oh ! s’il ne fallait pour vous consoler que de bruyants appels à la philanthropie, à l’impuissante charité, à la dégradante aumône, s’il suffisait des grands mots organisation, communisme, phalanstère, on ne vous les épargne pas. Mais justice, tout simplement justice, personne ne songe à vous la rendre. Et cependant ne serait-il pas juste que, lorsque après une longue journée de labeur vous avez touché votre modique salaire, vous le puissiez échanger contre la plus grande somme de satisfactions que vous puissiez obtenir volontairement d’un homme quelconque sur la surface de la terre ?
Un jour, peut-être, je vous parlerai aussi d’association, d’organisation, et nous verrons alors ce que vous avez à attendre de ces chimères par lesquelles vous vous laissez égarer sur une fausse quête.
En attendant, recherchons si l’on ne vous fait pas injustice en vous assignant législativement les personnes à qui il vous est permis d’acheter les choses qui vous sont nécessaires : le pain, la viande, la toile, le drap, et, pour ainsi dire, le prix artificiel que vous devez y mettre.
Est-il vrai que la protection, qui, on l’avoue, vous fait payer cher toutes choses et vous nuit en cela, élève proportionnellement le taux de vos salaires ?
De quoi dépend le taux des salaires ?
Un des vôtres l’a dit énergiquement : Quand deux ouvriers courent après un maître, les salaires baissent ; ils haussent quand deux maîtres courent après un ouvrier.
Permettez-moi, pour abréger, de me servir de cette phrase plus scientifique et peut-être moins claire : « Le taux des salaires dépend du rapport de l’offre à la demande du travail. »
Or, de quoi dépend l’offre des bras ?
Du nombre qu’il y en a sur la place ; et sur ce premier élément la protection ne peut rien.
De quoi dépend la demande des bras ?
Du capital national disponible. Mais la loi qui dit : « On ne recevra plus tel produit du dehors ; on le fera au dedans, » augmente-t-elle ce capital ? Pas le moins du monde. Elle le tire d’une voie pour le pousser dans une autre, mais elle ne l’accroît pas d’une obole. Elle n’augmente donc pas la demande des bras.
On montre avec orgueil telle fabrique. — Est-ce qu’elle s’est fondée et s’entretient avec des capitaux tombés de la lune ? Non, il a fallu les soustraire soit à l’agriculture, soit à la navigation, soit à l’industrie vinicole. — Et voilà pourquoi si, depuis le règne des tarifs protecteurs, il y a plus d’ouvriers dans les galeries de nos mines et dans les faubourgs de nos villes manufacturières, il y a moins de marins dans nos ports, moins de laboureurs et de vignerons dans nos champs et sur nos coteaux.
Je pourrais disserter longtemps sur ce thème. J’aime mieux essayer de vous faire comprendre ma pensée par un exemple.
Un campagnard avait un fonds de terre de vingt arpents, qu’il faisait valoir avec un capital de 10,000 francs. Il divisa son domaine en quatre parts et y établit l’assolement suivant : 1° maïs ; 2° froment ; 3° trèfle ; 4° seigle. Il ne fallait pour lui et sa famille qu’une bien modique portion du grain, de la viande, du laitage que produisait la ferme, et il vendait le surplus pour acheter de l’huile, du lin, du vin, etc. — La totalité de son capital était distribuée chaque année en gages, salaires, payements de comptes aux ouvriers du voisinage. Ce capital rentrait par les ventes, et même il s’accroissait d’année en année ; et notre campagnard, sachant fort bien qu’un capital ne produit rien que lorsqu’il est mis en œuvre, faisait profiter la classe ouvrière de ces excédants annuels qu’il consacrait à des clôtures, des défrichements, des améliorations dans ses instruments aratoires et dans les bâtiments de la ferme. Même il plaçait quelques réserves chez le banquier de la ville prochaine, mais celui-ci ne les laissait pas oisives dans son coffre-fort ; il les prêtait à des armateurs, à des entrepreneurs de travaux utiles, en sorte qu’elles allaient toujours se résoudre en salaires.
Cependant le campagnard mourut, et, aussitôt maître de l’héritage, le fils se dit : Il faut avouer que mon père a été dupe toute sa vie. Il achetait de l’huile et payait ainsi tribut à la Provence, tandis que notre terre peut à la rigueur faire végéter des oliviers. Il achetait du vin, du lin, des oranges, et payait tribut à la Bretagne, au Médoc, aux îles d’Hyères, tandis que la vigne, le chanvre et l’oranger peuvent, tant bien que mal, donner chez nous quelques produits. Il payait tribut au meunier, au tisserand, quand nos domestiques peuvent bien tisser notre lin et écraser notre froment entre deux pierres. — Il se ruinait et, en outre, il faisait gagner à des étrangers les salaires qu’il lui était si facile de répandre autour de lui.
Fort de ce raisonnement, notre étourdi changea l’assolement du domaine. Il le divisa en vingt soles. Sur l’une on cultiva l’olivier, sur l’autre le mûrier, sur la troisième le lin, sur la quatrième la vigne, sur la cinquième le froment, etc., etc. Il parvint ainsi à pourvoir sa famille de toutes choses et à se rendre indépendant. Il ne retirait plus rien de la circulation générale ; il est vrai qu’il n’y versait rien non plus. En fut-il plus riche ? Non ; car la terre n’était pas propre à la culture de la vigne ; le climat s’opposait aux succès de l’olivier, et, en définitive, la famille était moins bien pourvue de toutes ces choses que du temps où le père les acquérait par voie d’échanges.
Quant aux ouvriers, il n’y eut pas pour eux plus de travail qu’autrefois. Il y avait bien cinq fois plus de soles à cultiver, mais elles étaient cinq fois plus petites ; on faisait de l’huile, mais on faisait moins de froment ; on n’achetait plus de lin, mais on ne vendait plus de seigle. D’ailleurs, le fermier ne pouvait dépenser en salaires plus que son capital ; et son capital, loin de s’augmenter par la nouvelle distribution des terres, allait sans cesse décroissant. Une grande partie se fixait en bâtiments et ustensiles sans nombre, indispensables à qui veut tout entreprendre. En résultat, l’offre des bras resta la même, mais les moyens de les payer déclinaient, et il y eut forcément réduction de salaires.
Voilà l’image de ce qui se passe chez une nation qui s’isole par le régime prohibitif. Elle multiplie le nombre de ses industries, je le sais ; mais elle en diminue l’importance ; elle se donne, pour ainsi parler, un assolement industriel plus compliqué, mais non plus fécond, au contraire, puisque le même capital et la même main-d’œuvre s’y attaquent à plus de difficultés naturelles. Son capital fixe absorbe une plus grande partie de son capital circulant, c’est-à-dire une plus grande part du fonds destiné aux salaires. Ce qui en reste a beau se ramifier, cela n’en augmente pas la masse. C’est l’eau d’un étang qu’on croit avoir rendue plus abondante, parce que, distribuée dans une multitude de réservoirs, elle touche le sol par plus de points et présente au soleil plus de surface ; et l’on ne s’aperçoit pas que c’est précisément pour cela qu’elle s’absorbe, s’évapore et se perd.
Le capital et la main-d’œuvre étant donnés, ils créent une masse de produits d’autant moins grande qu’ils rencontrent plus d’obstacles. Il n’est pas douteux que les barrières internationales forçant, dans chaque pays, ce capital et cette main d’œuvre à vaincre plus de difficultés de climat et de température, le résultat général est moins de produits créés, ou, ce qui revient au même, moins de satisfactions acquises à l’humanité. Or, s’il y a diminution générale de satisfactions, comment votre part, ouvriers, se trouverait-elle augmentée ? Donc les riches, ceux qui font la loi, auraient arrangé les choses de telle sorte que non-seulement ils subiraient leur prorata de la diminution totale, mais même que leur portion déjà réduite se réduirait encore de tout ce qui s’ajoute, disent-ils, à la vôtre ? Cela est-il possible ? cela est-il croyable ? Oh ! c’est là une générosité suspecte, et vous feriez sagement de la repousser[75].
XIII. Théorie, Pratique↩
Partisans de la liberté des échanges, on nous accuse d’être des théoriciens, de ne pas tenir assez compte de la pratique.
« Quel terrible préjugé contre M. Say, dit M. Ferrier [76], que cette longue suite d’administrateurs distingués, que cette ligue imposante d’écrivains qui tous ont vu autrement que lui, et M. Say ne se le dissimule pas ! Écoutons-le : « On a dit, à l’appui des vieilles erreurs, qu’il faut bien qu’il y ait quelque fondement à des idées si généralement adoptées par toutes les nations. Ne doit-on pas se défier d’observations et de raisonnements qui renversent ce qui a été tenu pour constant jusqu’à ce jour, ce qui a été tenu pour certain par tant de personnages que rendaient recommandables leurs lumières et leurs intentions ? Cet argument, je l’avoue, est digne de faire une profonde impression, et pourrait jeter du doute sur les points les plus incontestables, si l’on n’avait vu tour à tour les opinions les plus fausses, et que maintenant on reconnaît généralement pour telles, reçues et professées par tout le monde pendant une longue suite de siècles. Il n’y a pas encore bien longtemps que toutes les nations, depuis la plus grossière jusqu’à la plus éclairée, et que tous les hommes, depuis le portefaix jusqu’au philosophe le plus savant, admettaient quatre éléments. Personne n’eût songé à contester cette doctrine, qui pourtant est fausse : tellement qu’aujourd’hui il n’y a pas d’aide-naturaliste qui ne se décriât s’il regardait la terre, l’eau et le feu comme des éléments. »
Sur quoi M. Ferrier fait cette observation :
« Si M. Say croit répondre ainsi à l’objection très-forte qu’il s’est proposée, il s’abuse étrangement. Que des hommes, d’ailleurs très-éclairés, se soient trompés pendant plusieurs siècles sur un point quelconque d’histoire naturelle, cela se comprend et ne prouve rien. L’eau, l’air, la terre et le feu, éléments ou non, en étaient-ils moins utiles à l’homme ?… Ces erreurs-là sont sans conséquence ; elles n’amènent pas de bouleversements, ne jettent pas de malaise dans les esprits, elles ne blessent surtout aucun intérêt, raison pour laquelle elles pourraient, sans inconvénient, durer des milliers d’années. Le monde physique marche donc comme si elles n’existaient pas. Mais en peut-il être ainsi des erreurs qui attaquent le monde moral ? Conçoit-on qu’un système d’administration qui serait absolument faux, dommageable par conséquent, pût être suivi, pendant plusieurs siècles et chez plusieurs peuples, avec l’assentiment général de tous les hommes instruits ? Expliquera-t-on comment un tel système pourrait se lier avec la prospérité toujours croissante des nations ? M. Say avoue que l’argument qu’il combat est digne de faire une impression profonde. Oui certes, et cette impression reste, car M. Say l’a plutôt augmentée que détruite. »
Écoutons M. de Saint-Chamans :
« Ce n’est guère qu’au milieu du dernier siècle, de ce dix-huitième siècle où toutes les matières, tous les principes sans exception, furent livrés à la discussion des écrivains, que ces fournisseurs d’idées spéculatives, appliquées à tout sans être applicables à rien, commencèrent à écrire sur l’économie politique. Il existait auparavant un système d’économie politique non écrit, mais pratiqué par les gouvernements. Colbert, dit-on, en était l’inventeur, et il était la règle de tous les États de l’Europe. Ce qu’il y a de plus singulier, c’est qu’il l’est encore, malgré les anathèmes et le mépris, malgré les découvertes de l’école moderne. Ce système, que nos écrivains ont nommé le système mercantile, consistait à… contrarier, par des prohibitions ou des droits d’entrée, les productions étrangères qui pouvaient ruiner nos manufactures par leur concurrence… Ce système a été déclaré inepte, absurde, propre à appauvrir tout pays, par les écrivains économistes de toutes les écoles [77] ; il a été banni de tous les livres, réduit à se réfugier dans la pratique de tous les peuples ; et on ne conçoit pas que, pour ce qui regarde la richesse des nations, les gouvernements ne s’en soient pas rapportés aux savants auteurs plutôt qu’à la vieille expérience d’un système, etc… On ne conçoit pas surtout que le gouvernement français… s’obstine, en économie politique, à résister aux progrès des lumières et à conserver dans sa pratique ces vieilles erreurs que tous nos économistes de plume ont signalées… Mais en voilà trop sur ce système mercantile, qui n’a pour lui que les faits, et qui n’est soutenu par aucun écrivain [78] ! »
Ne dirait-on pas, à entendre ce langage, que les économistes, en réclamant pour chacun la libre disposition de sa propriété, ont fait sortir de leur cervelle, comme les fouriéristes, un ordre social nouveau, chimérique, étrange, une sorte de phalanstère sans précédent dans les annales du genre humain ! Il me semble que, s’il y a, en tout ceci, quelque chose d’inventé, de contingent, ce n’est pas la liberté, mais la protection ; ce n’est pas la faculté d’échanger, mais bien la douane, la douane appliquée à bouleverser artificiellement l’ordre naturel des rémunérations.
Mais il ne s’agit pas de comparer, de juger les deux systèmes ; la question, pour le moment, est de savoir lequel des deux s’appuie sur l’expérience.
Ainsi donc, Messieurs les Monopoleurs, vous prétendez que les faits sont pour vous ; que nous n’avons de notre côté que des théories.
Vous vous flattez même que cette longue série d’actes publics, cette vieille expérience de l’Europe que vous invoquez, a paru imposante à M. Say ; et je conviens qu’il ne vous a pas réfutés avec sa sagacité habituelle. — Pour moi, je ne vous cède pas le domaine des faits, car vous n’avez pour vous que des faits exceptionnels et contraints, et nous avons à leur opposer les faits universels, les actes libres et volontaires de tous les hommes.
Que disons-nous et que dites-vous ?
— Nous disons :
« Il vaut mieux acheter à autrui ce qu’il en coûte plus cher de faire soi-même. »
Et vous, vous dites :
« Il vaut mieux faire les choses soi-même, encore qu’il en coûte moins cher de les acheter à autrui. »
Or, Messieurs, laissant de côté la théorie, la démonstration, le raisonnement, toutes choses qui paraissent vous donner des nausées, quelle est celle de ces deux assertions qui a pour elle la sanction de l’universelle pratique ?
Visitez donc les champs, les ateliers, les usines, les magasins ; regardez au-dessus, au-dessous et autour de vous ; scrutez ce qui s’accomplit dans votre propre ménage ; observez vos propres actes de tous les instants, et dites quel est le principe qui dirige ces laboureurs, ces ouvriers, ces entrepreneurs, ces marchands ; dites quelle est votre pratique personnelle.
Est-ce que l’agriculteur fait ses habits ? est-ce que le tailleur produit le grain qu’il consomme ? est-ce que votre ménagère ne cesse pas de faire le pain à la maison aussitôt qu’elle trouve économie à l’acheter au boulanger ? est-ce que vous quittez la plume pour la brosse, afin de ne pas payer tribut au décrotteur ? est-ce que l’économie tout entière de la société ne repose pas sur la séparation des occupations, sur la division du travail, sur l’échange en un mot ? et l’échange est-il autre chose que ce calcul qui nous fait, à tous tant que nous sommes, discontinuer la production directe, lorsque l’acquisition indirecte nous présente épargne de temps et de peine ?
Vous n’êtes donc pas les hommes de la pratique, puisque vous ne pourriez pas montrer un seul homme, sur toute la surface du globe, qui agisse selon votre principe.
Mais, direz-vous, nous n’avons jamais entendu faire de notre principe la règle des relations individuelles. Nous comprenons bien que ce serait briser le lien social, et forcer les hommes à vivre, comme les colimaçons, chacun dans sa carapace. Nous nous bornons à prétendre qu’il domine de fait les relations qui se sont établies entre les agglomérations de la famille humaine.
Eh bien, cette assertion est encore erronée. La famille, la commune, le canton, le département, la province, sont autant d’agglomérations qui toutes, sans aucune exception, rejettent pratiquement votre principe et n’y ont même jamais songé. Toutes se procurent par voie d’échange ce qu’il leur en coûterait plus de se procurer par voie de production. Autant en feraient les peuples, si vous ne l’empêchiez par la force.
C’est donc nous qui sommes les hommes de pratique et d’expérience ; car, pour combattre l’interdit que vous avez mis exceptionnellement sur quelques échanges internationaux, nous nous fondons sur la pratique et l’expérience de tous les individus et de toutes les agglomérations d’individus dont les actes sont volontaires, et peuvent par conséquent être invoqués en témoignage. Mais vous, vous commencez par contraindre, par empêcher, et puis vous vous emparez d’actes forcés ou prohibés pour vous écrier
« Voyez, la pratique nous justifie ! »
Vous vous élevez contre notre théorie, et même contre la théorie en général. Mais, quand vous posez un principe antagonique au nôtre, vous êtes-vous imaginé, par hasard, que vous ne faisiez pas de la théorie ? Non, non, rayez cela de vos papiers. Vous faites de la théorie comme nous, mais il y a entre la vôtre et la nôtre cette différence :
Notre théorie ne consiste qu’à observer les faits universels, les sentiments universels, les calculs, les procédés universels, et tout au plus à les classer, à les coordonner pour les mieux comprendre.
Elle est si peu opposée à la pratique qu’elle n’est autre chose que la pratique expliquée. Nous regardons agir les hommes mus par l’instinct de la conservation et du progrès, et ce qu’ils font librement, volontairement, c’est cela même que nous appelons économie politique ou économie de la société. Nous allons sans cesse répétant : Chaque homme est pratiquement un excellent économiste, produisant ou échangeant selon qu’il y a plus d’avantage à échanger ou à produire. Chacun, par l’expérience, s’élève à la science, ou plutôt la science n’est que cette même expérience scrupuleusement observée et méthodiquement exposée.
Mais vous, vous faites de la théorie dans le sens défavorable du mot. Vous imaginez, vous inventez des procédés qui ne sont sanctionnés par la pratique d’aucun homme vivant sous la voûte des cieux, et puis vous appelez à votre aide la contrainte et la prohibition. Il faut bien que vous ayez recours à la force, puisque, voulant que les hommes produisent ce qu’il leur est plus avantageux d’acheter, vous voulez qu’ils renoncent à un avantage, vous exigez d’eux qu’ils se conduisent d’après une doctrine qui implique contradiction, même dans ses termes.
Aussi, cette doctrine qui, vous en convenez, serait absurde dans les relations individuelles, je vous défie de l’étendre, même en spéculation, aux transactions entre familles, communes, départements ou provinces. De votre propre aveu, elle n’est applicable qu’aux relations internationales.
Et c’est pourquoi vous êtes réduits à répéter chaque jour :
« Les principes n’ont rien d’absolu. Ce qui est bien dans l’individu, la famille, la commune, la province, est 'mal dans la nation. Ce qui est bon en détail, — savoir : acheter plutôt que produire, quand l’achat est plus avantageux que la production, — cela même est mauvais en masse ; l’économie politique des individus n’est pas celle des peuples, » et autres balivernes ejusdem farinae.
Et tout cela, pourquoi ? Regardez-y de près. Pour nous prouver que nous, consommateurs, nous sommes votre propriété ! que nous vous appartenons en corps et en âme ! que vous avez sur nos estomacs et sur nos membres un droit exclusif ! qu’il vous appartient de nous nourrir et de nous vêtir à votre prix, quelles que soient votre impéritie, votre rapacité ou l’infériorité de votre situation !
Non, vous n’êtes pas les hommes de la pratique, vous êtes des hommes d’abstraction… et d’extorsion [79].
XIV. Conflit de principes↩
Il est une chose qui me confond, et c’est celle-ci :
Des publicistes sincères étudiant, au seul point de vue des producteurs, l’économie des sociétés, sont arrivés à cette double formule :
« Les gouvernements doivent disposer des consommateurs soumis à leurs lois, en faveur du travail national ;
Ils doivent soumettre à leurs lois des consommateurs lointains, pour en disposer en faveur du travail national. »
La première de ces formules s’appelle Protection ; la seconde, Débouchés.
Toutes deux reposent sur cette donnée qu’on nomme Balance du commerce :
« Un peuple s’appauvrit quand il importe, et s’enrichit quand il exporte. »
Car, si tout achat au dehors est un tribut payé, une perte, il est tout simple de restreindre, même de prohiber les importations.
Et si toute vente au dehors est un tribut reçu, un profit, il est tout naturel de se créer des débouchés, même par la force.
Système protecteur, système colonial : ce ne sont donc que deux aspects d’une même théorie. — Empêcher nos concitoyens d’acheter aux étrangers, forcer les étrangers à acheter à nos concitoyens, ce ne sont que deux conséquences d’un principe identique.
Or, il est impossible de ne pas reconnaitre que, selon cette doctrine, si elle est vraie, l’utilité générale repose sur le monopole ou spoliation intérieure, et sur la conquête ou spoliation extérieure.
J’entre dans un des chalets suspendus aux flancs de nos Pyrénées.
Le père de famille n’a reçu, pour son travail, qu’un faible salaire. La bise glaciale fait frissonner ses enfants à demi nus, le foyer est éteint et la table vide. Il y a de la laine et du bois et du maïs par delà la montagne, mais ces biens sont interdits à la famille du pauvre journalier ; car l’autre versant des monts, ce n’est plus la France. Le sapin étranger ne réjouira pas le foyer du châlet ; les enfants du berger ne connaîtront pas le goût de la méture biscaïenne, et la laine de Navarre ne réchauffera pas leurs membres engourdis. Ainsi le veut l’utilité générale : à la bonne heure ! mais convenons qu’elle est ici en contradiction avec la justice.
Disposer législativement des consommateurs, les réserver au travail national, c’est empiétier sur leur liberté, c’est leur interdire une action, l’échange, qui n’a en elle-même rien de contraire à la morale ; en un mot, c’est leur faire injustice.
Et cependant cela est nécessaire, dit-on, sous peine de porter un coup funeste à la prospérité publique.
Les écrivains de l’école protectioniste arrivent donc à cette triste conclusion, qu’il y a incompatibilité radicale entre la Justice et l’Utilité.
D’un autre côté, si chaque peuple est intéressé à vendre et à ne pas acheter, une action et une réaction violentes sont l’état naturel de leurs relations, car chacun cherchera à imposer ses produits à tous, et tous s’efforceront de repousser les produits de chacun.
Une vente, en effet, implique un achat, et puisque, selon cette doctrine, vendre c’est bénéficier, comme acheter c’est perdre, toute transaction internationale implique l’amélioration d’un peuple et la détérioration d’un autre.
Mais, d’une part, les hommes sont fatalement poussés vers ce qui leur profite ; de l’autre, ils résistent instinctivement à ce qui leur nuit : d’où il faut conclure que chaque peuple porte en lui-même une force naturelle d’expansion et une force non moins naturelle de résistance, lesquelles sont également nuisibles à tous les autres ; ou, en d’autres termes, que l’antagonisme et la guerre sont l’état naturel de la société humaine.
Ainsi, la théorie que je discute se résume en ces deux axiomes :
L’Utilité est incompatible avec la Justice au dedans.
L’Utilité est incompatible avec la Paix au dehors.
Eh bien ! ce qui m’étonne, ce qui me confond, c’est qu’un publiciste, un homme d’État, qui a sincèrement adhéré à une doctrine économique dont le principe heurte si violemment d’autres principes incontestables, puisse goûter un instant de calme et de repos d’esprit.
Pour moi, il me semble que, si j’avais pénétré dans la science par cette porte, si je n’apercevais pas clairement que Liberté, Utilité, Justice, Paix, sont choses non-seulement compatibles, mais étroitement liées entre elles, et pour ainsi dire identiques, je m’efforcerais d’oublier tout ce que j’ai appris ; je me dirais :
« Comment Dieu a-t-il pu vouloir que les hommes n’arrivent à la prospérité que par l’injustice et la guerre ? Comment a-t-il pu vouloir qu’ils ne renoncent à la guerre et à l’injustice qu’en renonçant à leur bien-être ? »
« Ne me trompe-t-elle pas, par de fausses lueurs, la science qui m’a conduit à l’horrible blasphème qu’implique cette alternative, et oserai je prendre sur moi d’en faire la base de la législation d’un grand peuple ? Et lorsqu’une longue suite de savants illustres ont recueilli des résultats plus consolants de cette même science à laquelle ils ont consacré toute leur vie, lorsqu’ils affirment que la liberté et l’utilité s’y concilient avec la justice et la paix, que tous ces grands principes suivent, sans se heurter, et pendant l’éternité entière, des parallèles infinis, n’ont-ils pas pour eux la présomption qui résulte de tout ce que nous savons de la bonté et de la sagesse de Dieu, manifestées dans la sublime harmonie de la création matérielle ? Dois-je croire légèrement, contre une telle présomption et contre tant d’imposantes autorités, que ce même Dieu s’est plu à mettre l’antagonisme et la dissonance dans les lois du monde moral ? Non, non, avant de tenir pour certain que tous les principes sociaux se heurtent, se choquent, se neutralisent, et sont entre eux en un conflit anarchique, éternel, irrémédiable ; avant d’imposer à mes concitoyens le système impie auquel mes raisonnements m’ont conduit, je veux en repasser toute la chaîne, et m’assurer s’il n’est pas un point de la route où je me suis égaré. »
Que si, après un sincère examen, vingt fois recommencé, j’arrivais toujours à cette affreuse conclusion, qu’il faut opter entre le Bien et le Bon, découragé, je repousserais la science, je m’enfoncerais dans une ignorance volontaire, surtout je déclinerais toute participation aux affaires de mon pays, laissant à des hommes d’une autre trempe le fardeau et la responsabilité d’un choix si pénible [80].
XV. Encore la réciprocité↩
M. de Saint-Cricq disait : « Sommes-nous sûrs que l’étranger nous fera autant d’achats que de ventes ? »
M. de Dombasle : « Quel motif avons-nous de croire que les producteurs anglais viendront chercher chez nous, plutôt que chez toute autre nation du globe, les produits dont ils pourront avoir besoin, et des produits pour une valeur équivalente à leurs exportations en France ? »
J’admire comme les hommes, qui se disent pratiques avant tout, raisonnent en dehors de toute pratique !
Dans la pratique, se fait-il un échange sur cent, sur mille, sur dix mille peut-être, qui soit un troc direct de produit contre produit ? Depuis qu’il y a des monnaies au monde, jamais aucun cultivateur s’est-il dit : je ne veux acheter des souliers, des chapeaux, des conseils, des leçons, qu’au cordonnier, au chapelier, à l’avocat, au professeur qui m’achètera du blé tout juste pour une valeur équivalente ? — Et pourquoi les nations s’imposeraient-elles cette gêne ?
Comment se passent les choses ?
Supposons un peuple privé de relations extérieures. — Un homme a produit du blé. Il le verse dans la circulation nationale au plus haut cours qu’il peut trouver, et il reçoit en échange… quoi ? Des écus, c’est-à-dire des mandats, des bons fractionnables à l’infini, au moyen desquels il lui sera loisible de retirer aussi de la circulation nationale, quand il le jugera à propos et jusqu’à due concurrence, les objets dont il aura besoin ou envie. En définitive, à la fin de l’opération, il aura retiré de la masse justement l’équivalent de ce qu’il y a versé, et, en valeur, sa consommation égalera exactement sa production.
Si les échanges de cette nation avec le dehors sont libres, ce n’est plus dans la circulation nationale, mais dans la circulation générale, que chacun verse ses produits et puise ses consommations. Il n’a point à se préoccuper si ce qu’il livre à cette circulation générale est acheté par un compatriote ou un étranger ; si les bons qu’il reçoit lui viennent d’un Français ou d’un Anglais ; si les objets contre lesquels il échange ensuite ces bons, à mesure de ses besoins, ont été fabriqués en deçà ou au delà du Rhin ou des Pyrénées. Toujours est-il qu’il y a, pour chaque individu, balance exacte entre ce qu’il verse et ce qu’il puise dans le grand réservoir commun ; et si cela est vrai de chaque individu, cela est vrai de la nation en masse.
La seule différence entre les deux cas, c’est que, dans le dernier, chacun est en face d’un marché plus étendu pour ses ventes et ses achats, et a, par conséquent, plus de chances de bien faire les uns et les autres.
On fait cette objection : Si tout le monde se ligue pour ne pas retirer de la circulation les produits d’un individu déterminé, il ne pourra rien retirer à son tour de la masse. Il en est de même d’un peuple.
Réponse : Si ce peuple ne peut rien retirer de la masse, il n’y versera rien non plus ; il travaillera pour lui-même. Il sera contraint de se soumettre à ce que vous voulez lui imposer d’avance, à savoir : l’isolement.
Et ce sera l’idéal du régime prohibitif.
N’est-il pas plaisant que vous lui infligiez d’ores et déjà ce régime, dans la crainte qu’il ne coure la chance d’y arriver un jour sans vous ?
XVI. Les fleuves obstrués plaidant pour les prohibitionistes↩
Il y a quelques années, j’étais à Madrid. J’allai aux cortès. On y discutait un traité avec le Portugal sur l’amélioration du cours du Duero. Un député se lève et dit : « Si le Duero est canalisé, les transports s’y feront à plus bas prix. Les grains portugais se vendront à meilleur marché dans les Castilles et feront à notre travail national une concurrence redoutable. Je repousse le projet, à moins que MM. les ministres ne s’engagent à relever le tarif des douanes de manière à rétablir l’équilibre. » L’assemblée trouva l’argument sans réplique.
Trois mois après j’étais à Lisbonne. La même question était soumise au sénat. Un noble hidalgo dit : « Senhor presidente, le projet est absurde. Vous placez des gardes, à gros frais, sur les rives du Duero, pour empêcher l’invasion du grain castillan en Portugal, et, en même temps, vous voulez, toujours à gros frais, faciliter cette invasion. C’est une inconséquence à laquelle je ne puis m’associer. Que le Duero passe à nos fils tel que nous l’ont laissé nos pères. »
Plus tard, quand il s’est agi d’améliorer la Garonne, je me suis rappelé les arguments des orateurs ibériens, et je me disais : Si les députés de Toulouse étaient aussi bons économistes que celui de Palencia, et les représentants de Bordeaux aussi forts logiciens que ceux d’Oporto, assurément on laisserait la Garonne
Dormir au bruit flatteur de son urne penchante, car la canalisation de la Garonne favorisera, au préjudice de Bordeaux, l’invasion des produits toulousains, et, au détriment de Toulouse, l’inondation des produits bordelais.
XVII. Un chemin de fer négatif↩
J’ai dit que lorsque, malheureusement, on se plaçait au point de vue de l’intérêt producteur, on ne pouvait manquer de heurter l’intérêt général, parce que le producteur, en tant que tel, ne demande qu’efforts, besoins et obstacles.
J’en trouve un exemple remarquable dans un journal de Bordeaux.
M. Simiot se pose cette question :
Le chemin de fer de Paris en Espagne doit-il offrir une solution de continuité à Bordeaux ?
Il la résout affirmativement par une foule de raisons que je n’ai pas à examiner, mais par celle-ci, entre autres :
Le chemin de fer de Paris à Bayonne doit présenter une lacune à Bordeaux, afin que marchandises et voyageurs, forcés de s’arrêter dans cette ville, y laissent des profits aux bateliers, porte-balles, commissionnaires, consignataires, hôteliers, etc.
Il est clair que c’est encore ici l’intérêt des agents du travail mis avant l’intérêt des consommateurs.
Mais si Bordeaux doit profiter par la lacune, et si ce profit est conforme à l’intérêt public, Angoulême, Poitiers, Tours, Orléans, bien plus, tous les points intermédiaires, Ruffec, Châtellerault, etc., etc., doivent aussi demander des lacunes, et cela dans l’intérêt général, dans l’intérêt bien entendu du travail national, car plus elles seront multipliées, plus seront multipliés aussi les consignations, commissions, transbordements, sur tous les points de la ligne. Avec ce système, on arrive à un chemin de fer composé de lacunes successives, à un chemin de fer négatif.
Que MM. les protectionistes le veuillent ou non, il n’en est pas moins certain que le principe de la restriction est le même que le principe des lacunes : le sacrifice du consommateur au producteur, du but au moyen.
XVIII. Il n'y a pas de principes absolus↩
On ne peut trop s’étonner de la facilité avec laquelle les hommes se résignent à ignorer ce qu’il leur importe le plus de savoir, et l’on peut être sûr qu’ils sont décidés à s’endormir dans leur ignorance, une fois qu’ils en sont venus à proclamer cet axiome : Il n’y a pas de principes absolus.
Vous entrez dans l’enceinte législative. Il y est question de savoir si la loi interdira ou affranchira les échanges internationaux.
Un député se lève et dit :
Si vous tolérez ces échanges, l’étranger vous inondera de ses produits, l’Anglais de tissus, le Belge de houilles, l’Espagnol de laines, l’Italien de soies, le Suisse de bestiaux, le Suédois de fer, le Prussien de blé, en sorte qu’aucune industrie ne sera plus possible chez nous.
Un autre répond :
Si vous prohibez ces échanges, les bienfaits divers que la nature a prodigués à chaque climat seront, pour vous, comme s’ils n’étaient pas. Vous ne participerez pas à l’habileté mécanique des Anglais, à la richesse des mines belges, à la fertilité du sol polonais, à la fécondité des pâturages suisses, au bon marché du travail espagnol, à la chaleur du climat italien, et il vous faudra demander à une production rebelle ce que par l’échange vous eussiez obtenu d’une production facile.
Assurément, l’un de ces députés se trompe. Mais lequel ? Il vaut pourtant la peine de s’en assurer, car il ne s’agit pas seulement d’opinions. Vous êtes en présence de deux routes, il faut choisir, et l’une mène nécessairement à la misère.
Pour sortir d’embarras, on dit : Il n’y a point de principes absolus.
Cet axiome, si à la mode de nos jours, outre qu’il doit sourire à la paresse, convient aussi à l’ambition.
Si la théorie de la prohibition venait à prévaloir, ou bien si la doctrine de la liberté venait à triompher, une toute petite loi ferait tout notre code économique. Dans le premier cas, elle porterait : tout échange au dehors est interdit ; dans le second : tout échange avec l’étranger est libre, et bien des gros personnages perdraient de leur importance.
Mais si l’échange n’a pas une nature qui lui soit propre, s’il n’est gouverné par aucune loi naturelle, s’il est capricieusement utile ou funeste, s’il ne trouve pas son aiguillon dans le bien qu’il fait, sa limite dans le bien qu’il cesse de faire, si ses effets ne peuvent âtre appréciés par ceux qui l’exécutent ; en un mot, s’il n’y a pas de principes absolus, oh ! alors il faut pondérer, équilibrer, réglementer les transactions, il faut égaliser les conditions du travail, chercher le niveau des profits, tâche colossale, bien propre à donner à ceux qui s’en chargent de gros traitements et une haute influence.
En entrant dans Paris, que je suis venu visiter, je me disais : Il y a là un million d’êtres humains qui mourraient tous en peu de jours si des approvisionnements de toute nature n’affluaient vers cette vaste métropole. L’imagination s’effraie quand elle veut apprécier l’immense multiplicité d’objets qui doivent entrer demain par ses barrières, sous peine que la vie de ses habitants ne s’éteigne dans les convulsions de la famine, de l’émeute et du pillage. Et cependant tous dorment en ce moment sans que leur paisible sommeil soit troublé un seul instant par l’idée d’une aussi effroyable perspective. D’un autre côté, quatre-vingts départements ont travaillé aujourd’hui, sans se concerter, sans s’entendre, à l’approvisionnement de Paris. Comment chaque jour amène-t-il ce qu’il faut, rien de plus, rien de moins, sur ce gigantesque marché ? Quelle est donc l’ingénieuse et secrète puissance qui préside à l’étonnante régularité de mouvements si compliqués, régularité en laquelle chacun a une foi si insouciante, quoiqu’il y aille du bien-être et de la vie ? Cette puissance, c’est un principe absolu, le principe de la liberté des transactions. Nous avons foi en cette lumière intime que la Providence a placée au cœur de tous les hommes, à qui elle a confié la conservation et l’amélioration indéfinie de notre espèce, l’intérêt, puisqu’il faut l’appeler par son nom, si actif, si vigilant, si prévoyant, quand il est libre dans son action. Où en seriez-vous, habitants de Paris, si un ministre s’avisait de substituer à cette puissance les combinaisons de son génie, quelque supérieur qu’on le suppose ? s’il imaginait de soumettre à sa direction suprême ce prodigieux mécanisme, d’en réunir tous les ressorts en ses mains, de décider par qui, où, comment, à quelles conditions chaque chose doit être produite, transportée, échangée et consommée ? Oh ! quoiqu’il y ait bien des souffrances dans votre enceinte, quoique la misère, le désespoir, et peut-être l’inanition, y fassent couler plus de larmes que votre ardente charité n’en peut sécher, il est probable, il est certain, j’ose le dire, que l’intervention arbitraire du gouvernement multiplierait à l’infini ces souffrances, et étendrait sur vous tous les maux qui ne frappent qu’un petit nombre de vos concitoyens.
Eh bien ! cette foi que nous avons tous dans un principe, quand il s’agit de nos transactions intérieures, pourquoi ne l’aurions-nous pas, dans le même principe appliqué à nos transactions internationales, assurément moins nombreuses, moins délicates et moins compliquées ? Et s’il n’est pas nécessaire que la préfecture de Paris réglemente nos industries, pondère nos chances, nos profits et nos pertes, se préoccupe de l’épuisement du numéraire, égalise les conditions de notre travail dans le commerce intérieur, pourquoi est-il nécessaire que la douane, sortant de sa mission fiscale, prétende exercer une action protectrice sur notre commerce extérieur [81] ?
XIX.↩
Parmi les arguments qu’on fait valoir en faveur du régime restrictif, il ne faut pas oublier celui qu’on tire de l’indépendance nationale.
« Que ferons-nous en cas de guerre, dit-on, si nous nous sommes mis à la discrétion de l’Angleterre pour le fer et la houille ? »
Les monopoleurs anglais ne manquent pas de s’écrier de leur côté :
« Que deviendra la Grande-Bretagne en temps de guerre, si elle se met, pour les aliments, sous la dépendance des Français ? »
On ne prend pas garde à une chose ; c’est que cette sorte de dépendance qui résulte des échanges, des transactions commerciales, est une dépendance réciproque. Nous ne pouvons dépendre de l’étranger sans que l’étranger dépende de nous. Or c’est là l’essence même de la société. Rompre des relations naturelles, ce n’est pas se placer dans un état d’indépendance, mais dans un état d’isolement.
Et remarquez ceci : on s’isole dans la prévision de la guerre ; mais l’acte même de s’isoler est un commencement de guerre. Il la rend plus facile, moins onéreuse et, partant, moins impopulaire. Que les peuples soient les uns aux autres des débouchés permanents ; que leurs relations ne puissent être rompues sans leur infliger la double souffrance de la privation et de l’encombrement, et ils n’auront plus besoin de ces puissantes marines qui les ruinent, de ces grandes armées qui les écrasent ; la paix du monde ne sera pas compromise par le caprice d’un Thiers ou d’un Palmerston, et la guerre disparaîtra faute d’aliments, de ressources, de motifs, de prétextes et de sympathie populaire.
Je sais bien qu’on me reprochera (c’est la mode du jour) de donner pour base à la fraternité des peuples l’intérêt, le vil et prosaïque intérêt. On aimerait mieux qu’elle eût son principe dans la charité, dans l’amour, qu’il y fallût même un peu d’abnégation, et que, froissant le bien-être matériel des hommes, elle eût le mérite d’un généreux sacrifice.
Quand donc en finirons-nous avec ces puériles déclamations ? Quand bannirons-nous enfin la tartuferie de la science ? Quand cesserons-nous de mettre cette contradiction nauséabonde entre nos écrits et nos actions ? Nous huons, nous conspuons l’intérêt, c’est-à-dire l’utile, le bien (car dire que tous les peuples sont intéressés à une chose, c’est dire que cette chose est bonne en soi), comme si l’intérêt n’était pas le mobile nécessaire, éternel, indestructible, à qui la Providence a confié la perfectibilité humaine ! Ne dirait-on pas que nous sommes tous des anges de désintéressement ? Et pense-t-on que le public ne commence pas à voir avec dégoût que ce langage affecté noircit précisément les pages qu’on lui fait payer le plus cher ? Oh ! l’affectation ! l’affectation ! c’est vraiment la maladie de ce siècle.
Quoi ! parce que le bien-être et la paix sont choses corrélatives, parce qu’il a plu à Dieu d’établir cette belle harmonie dans le monde moral, vous ne voulez pas que j’admire, que j’adore ses décrets et que j’accepte avec gratitude des lois qui font de la justice la condition du bonheur ? Vous ne voulez la paix qu’autant qu’elle froisse le bien-être, et la liberté vous pèse parce qu’elle ne vous impose pas des sacrifices ? Et qui vous empêche, si l’abnégation a pour vous tant de charmes, d’en mettre dans vos actions privées ? La société vous en sera reconnaissante, car quelqu’un au moins en recueillera le fruit ; mais vouloir l’imposer à l’humanité comme un principe, c’est le comble de l’absurdité, car l’abnégation de tous, c’est le sacrifice de tous, c’est le mal érigé en théorie.
Mais, grâce au ciel, on peut écrire et lire beaucoup de ces déclamations sans que pour cela le monde cesse d’obéir à son mobile, qui est, qu’on le veuille ou non, l’intérêt.
Après tout, il est assez singulier de voir invoquer les sentiments de la plus sublime abnégation à l’appui de la spoliation elle-même. Voilà donc à quoi aboutit ce fastueux désintéressement ! Ces hommes si poétiquement délicats qu’ils ne veulent pas de la paix elle-même si elle est fondée sur le vil intérêt des hommes, mettent la main dans la poche d’autrui, et surtout du pauvre ; car quel article du tarif protège le pauvre ? Eh ! messieurs, disposez comme vous l’entendez de ce qui vous appartient, mais laissez-nous disposer aussi du fruit de nos sueurs, nous en servir ou l’échanger à notre gré. Déclamez sur le renoncement à soi-même, car cela est beau ; mais en même temps soyez au moins honnêtes [82].
XX. Travail humain, travail national↩
Briser les machines, — repousser les marchandises étrangères, — ce sont deux actes qui procèdent de la même doctrine.
On voit des hommes qui battent des mains quand une grande invention se révèle au monde, — et qui néanmoins adhèrent au régime protecteur. — Ces hommes sont bien inconséquents !
Que reprochent-ils à la liberté du commerce ? De faire produire par des étrangers plus habiles ou mieux situés que nous des choses que, sans elle, nous produirions nous-mêmes. En un mot, on l’accuse de nuire au travail national.
De même, ne devraient-ils pas reprocher aux machines de faire accomplir par des agents naturels ce qui, sans elles, serait l’œuvre de nos bras, et, par conséquent, de nuire au travail humain ?
L’ouvrier étranger, mieux placé que l’ouvrier français, est, à l’égard de celui-ci, une véritable machine économique qui l’écrase de sa concurrence. De même, une machine qui exécute une opération à un prix moindre qu’un certain nombre de bras est, relativement à ces bras, un vrai concurrent étranger qui les paralyse par sa rivalité.
Si donc il est opportun de protéger le travail national contre la concurrence du travail étranger, il ne l’est pas moins de protéger le travail humain contre la rivalité du travail mécanique.
Aussi, quiconque adhère au régime protecteur, s’il a un peu de logique dans la cervelle, ne doit pas s’arrêter à prohiber les produits étrangers : il doit proscrire encore les produits de la navette et de la charrue.
Et voilà pourquoi j’aime bien mieux la logique des hommes qui, déclamant contre l’invasion des marchandises exotiques, ont au moins le courage de déclamer aussi contre l’excès de production dû à la puissance inventive de l’esprit humain.
Tel est M. de Saint-Chamans. « Un des arguments les plus forts, dit-il, contre la liberté du commerce et le trop grand emploi des machines, c’est que beaucoup d’ouvriers sont privés d’ouvrage ou par la concurrence étrangère qui fait tomber les manufactures, ou par les instruments qui prennent la place des hommes dans les ateliers. » (Du système d’impôts, p. 438.)
M. de Saint-Chamans a parfaitement vu l’analogie, disons mieux, l’identité qui existe entre les importations et les machines ; voilà pourquoi il proscrit les unes et les autres ; et vraiment il y a plaisir à avoir affaire à des argumentateurs intrépides, qui, même dans l’erreur, poussent un raisonnement jusqu’au bout.
Mais voyez la difficulté qui les attend !
S’il est vrai, à priori, que le domaine de l’invention et celui du travail ne puissent s’étendre qu’aux dépens l’un de l’autre, c’est dans les pays où il y a le plus de machines, dans le Lancastre, par exemple, qu’on doit rencontrer le moins d’ouvriers. Et si, au contraire, on constate en fait que la mécanique et la main d’œuvre coexistent à un plus haut degré chez les peuples riches que chez les sauvages, il faut en conclure nécessairement que ces deux puissances ne s’excluent pas.
Je ne puis pas m’expliquer qu’un être pensant puisse goûter quelque repos en présence de ce dilemme :
Ou les inventions de l’homme ne nuisent pas à ses travaux comme les faits généraux l’attestent, puisqu’il y a plus des unes et des autres chez les Anglais et les Français que parmi les Hurons et les Cherokées, et, en ce cas, j’ai fait fausse route, quoique je ne sache ni où ni quand je me suis égaré. Je commettrais un crime de lèse-humanité si j’introduisais mon erreur dans la législation de mon pays.
Ou bien les découvertes de l’esprit limitent le travail des bras, comme les faits particuliers semblent l’indiquer, puisque je vois tous les jours une machine se substituer à vingt, à cent travailleurs, et alors je suis forcé de constater une flagrante, éternelle, incurable antithèse entre la puissance intellectuelle et la puissance physique de l’homme ; entre son progrès et son bien-être, et je ne puis m’empêcher de dire que l’auteur de l’homme devait lui donner de la raison ou des bras, de la force morale ou de la force brutale, mais qu’il s’est joué de lui en lui conférant à la fois des facultés qui s’entre-détruisent.
La difficulté est pressante. Or, savez-vous comment on en sort ? Par ce singulier apophtegme :
En économie politique il n’y a pas de principe absolu.
En langage intelligible et vulgaire, cela veut dire :
« Je ne sais où est le vrai et le faux ; j’ignore ce qui constitue le bien ou le mal général. Je ne m’en mets pas en peine. L’effet immédiat de chaque mesure sur mon bien-être personnel, telle est la seule loi que je consente à reconnaître. »
Il n’y a pas de principes ! mais c’est comme si vous disiez : Il n’y a pas de faits ; car les principes ne sont que des formules qui résument tout un ordre de faits bien constatés.
Les machines, les importations ont certainement des effets. Ces effets sont bons ou mauvais. On peut à cet égard différer d’avis. Mais, quel que soit celui que l’on adopte, il se formule par un de ces deux principes : Les machines sont un bien ; — ou — Les machines sont un mal. Les importations sont favorables, — ou — Les importations sont nuisibles. — Mais dire : Il n’y a pas de principes, c’est certainement le dernier degré d’abaissement où l’esprit humain puisse descendre, et j’avoue que je rougis pour mon pays quand j’entends articuler une si monstrueuse hérésie en face des chambres françaises, avec leur assentiment, c’est-à-dire en face et avec l’assentiment de l’élite de nos concitoyens ; et cela pour se justifier de nous imposer des lois en parfaite ignorance de cause.
Mais enfin, me dira-t-on, détruisez le sophisme. Prouvez que les machines ne nuisent pas au travail humain, ni les importations au travail national.
Dans un ouvrage de la nature de celui-ci, de telles démonstrations ne sauraient être très-complètes. J’ai plus pour but de poser les difficultés que de les résoudre, et d’exciter la réflexion que de la satisfaire. Il n’y a jamais pour l’esprit de conviction bien acquise que celle qu’il doit à son propre travail. J’essayerai néanmoins de le mettre sur la voie.
Ce qui trompe les adversaires des importations et des machines, c’est qu’ils les jugent par leurs effets immédiats et transitoires, au lieu d’aller jusqu’aux conséquences générales et définitives.
L’effet prochain d’une machine ingénieuse est de rendre superflue, pour un résultat donné, une certaine quantité de main-d’œuvre. Mais là ne s’arrête point son action. Par cela même que ce résultat donné est obtenu avec moins d’efforts, il est livré au public à un moindre prix ; et la somme des épargnes ainsi réalisée par tous les acheteurs, leur sert à se procurer d’autres satisfactions, c’est-à-dire à encourager la main-d’œuvre en général, précisément de la quantité soustraite à la main-d’œuvre spéciale de l’industrie récemment perfectionnée. — En sorte que le niveau du travail n’a pas baissé, quoique celui des satisfactions se soit élevé.
Rendons cet ensemble d’effets sensible par un exemple.
Je suppose qu’il se consomme en France dix millions de chapeaux à 15 francs ; cela offre à l’industrie chapelière un aliment de 150 millions. — Une machine est inventée qui permet de donner les chapeaux à 10 francs. — L’aliment pour cette industrie est réduit à 100 millions, en admettant que la consommation n’augmente pas. Mais les autres 50 millions ne sont point pour cela soustraits au travail humain. Économisés par les acheteurs de chapeaux, ils leur serviront à satisfaire d’autres besoins, et par conséquent à rémunérer d’autant l’ensemble de l’industrie. Avec ces 5 francs d’épargne, Jean achètera une paire de souliers, Jacques un livre, Jérôme un meuble, etc. Le travail humain, pris en masse, continuera donc d’être encouragé jusqu’à concurrence de 150 millions ; mais cette somme donnera le même nombre de chapeaux qu’auparavant, plus toutes les satisfactions correspondant aux 50 millions que la machine aura épargnés. Ces satisfactions sont le produit net que la France aura retiré de l’invention. C’est un don gratuit, un tribut que le génie de l’homme aura imposé à la nature. — Nous ne disconvenons pas que, dans le cours de la transformation, une certaine masse de travail aura été déplacée ; mais nous ne pouvons pas accorder qu’elle aura été détruite ou même diminuée.
De même quant aux importations. — Reprenons l’hypothèse.
La France fabriquait dix millions de chapeaux dont le prix de revient était de 15 francs. L’étranger envahit notre marché en nous fournissant les chapeaux à 10 francs. — Je dis que le travail national n’en sera nullement diminué.
Car il devra produire jusqu’à concurrence de 100 millions pour payer 10 millions de chapeaux à 10 francs.
Et puis, il restera à chaque acheteur 5 francs d’économie par chapeau, ou, au total, 50 millions, qui acquitteront d’autres jouissances, c’est-à-dire d’autres travaux.
Donc la masse du travail restera ce qu’elle était, et les jouissances supplémentaires, représentées par 50 millions d’économie sur les chapeaux, formeront le profit net de l’importation ou de la liberté du commerce.
Et il ne faut pas qu’on essaye de nous effrayer par le tableau des souffrances qui, dans cette hypothèse, accompagneraient le déplacement du travail.
Car si la prohibition n’eût jamais existé, le travail se serait classé de lui-même selon la loi de l’échange, et nul déplacement n’aurait eu lieu.
Si, au contraire, la prohibition a amené un classement artificiel et improductif du travail, c’est elle et non la liberté qui est responsable du déplacement inévitable dans la transition du mal au bien.
À moins qu’on ne prétende que, parce qu’un abus ne peut être détruit sans froisser ceux qui en profitent, il suffit qu’il existe un moment pour qu’il doive durer toujours [83].
XXI. Matières premières↩
On dit : Le plus avantageux de tous les commerces est celui où l’on donne des objets fabriqués en échange de matières premières. Car ces matières premières sont un aliment pour le travail national.
Et de là on conclut :
Que la meilleure loi de douanes serait celle qui donnerait le plus de facilités possible à l’entrée des matières premières, et qui opposerait le plus d’obstacles aux objets qui ont reçu leur première façon.
Il n’y a pas, en économie politique, de sophisme plus répandu que celui-là. Il défraye non-seulement l’école protectioniste, mais encore et surtout l’école prétendue libérale ; et c’est là une circonstance fâcheuse, car ce qu’il y a de pire, pour une bonne cause, ce n’est pas d’être bien attaquée, mais d’être mal défendue.
La liberté commerciale aura probablement le sort de toutes les libertés ; elle ne s’introduira dans nos lois qu’après avoir pris possession de nos esprits. Mais s’il est vrai qu’une réforme doive être généralement comprise pour être solidement établie, il s’ensuit que rien ne la peut retarder comme ce qui égare l’opinion ; et quoi de plus propre à l’égarer que les écrits qui réclament la liberté en s’appuyant sur les doctrines du monopole ?
Il y a quelques années, trois grandes villes de France, Lyon, Bordeaux et le Havre, firent une levée de boucliers contre le régime restrictif. Le pays, l’Europe entière s’émurent en voyant se dresser ce qu’ils prirent pour le drapeau de la liberté. — Hélas ! c’était encore le drapeau du monopole ! d’un monopole un peu plus mesquin et beaucoup plus absurde que celui qu’on semblait vouloir renverser. — Grâce au sophisme que je vais essayer de dévoiler, les pétitionnaires ne firent que reproduire, en y ajoutant une inconséquence de plus, la doctrine de la protection au travail national.
Qu’est ce, en effet, que le régime prohibitif ? Écoutons M. de Saint-Cricq.
« Le travail constitue la richesse peuple, parce que seul il crée choses matérielles que réclament nos besoins, et que l’aisance universelle consiste dans l’abondance de ces choses. » — Voilà le principe.
« Mais il faut que cette abondance soit le produit du travail national. Si elle était le produit du travail étranger, le travail national s’arrêterait promptement. » — Voila l’erreur. (Voir le sophisme précédent.)
« Que doit donc faire un pays agricole et manufacturier ? Réserver son marché aux produits de son sol et de son industrie. » — Voilà le but.
« Et pour cela, restreindre par des droits et prohiber au besoin les produits du sol et de l’industrie des autres peuples. » — Voilà le moyen.
Rapprochons de ce système celui de la pétition de Bordeaux.
Elle divisait les marchandises en trois classes.
« La première renferme des objets d’alimentation et des matières premières, vierges de tout travail humain. En principe, une sage économie exigerait que cette classe ne fût pas imposée. » — Ici point de travail, point de protection.
« La seconde est composée d’objets qui ont reçu une préparation. Cette préparation permet qu’on la charge de quelques droits. » — Ici la protection commence parce que, selon les pétitionnaires, commence le travail national.
« La troisième comprend des objets perfectionnés, qui ne peuvent nullement servir au travail national ; nous la considérons comme la plus imposable. » — Ici, le travail, et la protection avec lui, arrivent à leur maximum.
On le voit, les pétitionnaires professaient que le travail étranger nuit au travail national, c’est l’erreur du régime prohibitif.
Ils demandaient que le marché français fût réservé au travail français ; c’est le but du régime prohibitif.
Ils réclamaient que le travail étranger fût soumis à des restrictions et à des taxes. — C’est le moyen du régime prohibitif.
Quelle différence est-il donc possible de découvrir entre les pétitionnaires bordelais et le coryphée de la restriction ? — Une seule : l’extension plus ou moins grande à donner au mot travail.
M. de Saint-Cricq l’étend à tout. — Aussi, veut-il tout protéger.
« Le travail constitue toute la richesse d’un peuple, dit-il : protéger l’industrie agricole, toute l’industrie agricole ; l’industrie manufacturière, toute l’industrie manufacturière, c’est le cri qui retentira toujours dans cette chambre. »
Les pétitionnaires ne voient de travail que celui des fabricants : aussi n’admettent-ils que celui-là aux faveurs de la protection.
« Les matières premières sont vierges de tout travail humain. En principe on ne devrait pas les imposer. Les objets fabriqués ne peuvent plus servir au travail national ; nous les considérons comme les plus imposables. »
Il ne s’agit point ici d’examiner si la protection au travail national est raisonnable. M. de Saint-Cricq et les Bordelais s’accordent sur ce point, et nous, comme on l’a vu dans les chapitres précédents, nous différons à cet égard des uns et des autres.
La question est de savoir qui, de M. de Saint-Cricq ou des Bordelais, donne au mot travail sa juste acception.
Or, sur ce terrain, il faut le dire, M. de Saint-Cricq a mille fois raison, car voici le dialogue qui pourrait s’établir entre eux.
M. de Saint-Cricq. — Vous convenez que le travail national doit être protégé. Vous convenez qu’aucun travail étranger ne peut s’introduire sur notre marché sans y détruire une quantité égale de notre travail national. Seulement vous prétendez qu’il y a une foule de marchandises pourvues de valeur, puisqu’elles se vendent, et qui sont cependant vierges de tout travail humain. Et vous nommez, entre autres choses, les blés, farines, viandes, bestiaux, lard, sel, fer, cuivre, plomb, houille, laines, peaux, semences, etc.
Si vous me prouvez que la valeur de ces choses n’est pas due au travail, je conviendrai qu’il est inutile de les protéger.
Mais aussi, si je vous démontre qu’il y a autant de travail dans cent francs de laine que dans 100 francs de tissus, vous devrez avouer que la protection est due à l’une comme à l’autre.
Or, pourquoi ce sac de laine vaut-il 100 francs ? N’est-ce point parce que c’est son prix de revient ? et le prix de revient est-il autre chose que ce qu’il a fallu distribuer en gages, salaires, main-d’œuvre, intérêts, à tous les travailleurs et capitalistes qui ont concouru à la production de l’objet ?
Les pétitionnaires. — Il est vrai que, pour la laine, vous pourriez avoir raison. Mais un sac de blé, un lingot de fer, un quintal de houille, sont-ils le produit du travail ? N’est-ce point la nature qui les crée ?
M. de Saint-Cricq. — Sans doute, la nature crée les éléments de toutes ces choses, mais c’est le travail qui en produit la valeur. J’ai eu tort moi-même de dire que le travail crée les objets matériels, et cette locution vicieuse m’a conduit à bien d’autres erreurs. — Il n’appartient pas à l’homme de créer et de faire quelque chose de rien, pas plus au fabricant qu’au cultivateur ; si par production on entendait création, tous nos travaux seraient improductifs, et les vôtres, messieurs les négociants, plus que tous les autres, excepté peut-être les miens.
L’agriculteur n’a donc pas la prétention d’avoir créé le blé, mais il a celle d’en avoir créé la valeur, je veux dire, d’avoir, par son travail, celui de ses domestiques, de ses bouviers, de ses moissonneurs, transformé en blé des substances qui n’y ressemblaient nullement. Que fait de plus le meunier qui le convertit en farine, le boulanger qui le façonne en pain ?
Pour que l’homme puisse se vêtir en drap, une foule d’opérations sont nécessaires. Avant l’intervention de tout travail humain, les véritables matières premières de ce produit sont l’air, l’eau, la chaleur, les gaz, la lumière, les sels qui doivent entrer dans sa composition. Voilà les matières premières qui véritablement sont vierges de tout travail humain, puisqu’elles n’ont pas de valeur, et je ne songe pas à les protéger. — Mais un premier travail convertit ces substances en fourrages, un second en laine, un troisième en fil, un quatrième en tissus, un cinquième en vêtements. Qui osera dire que tout, dans cette œuvre, n’est pas travail, depuis le premier coup de charrue qui le commence jusqu’au dernier coup d’aiguille qui le termine ?
Et parce que, pour plus de célérité et de perfection dans l’accomplissement de l’œuvre définitive, qui est un vêtement, les travaux se sont répartis entre plusieurs classes d’industrieux, vous voulez, par une distinction arbitraire, que l’ordre de succession de ces travaux soit la raison unique de leur importance, en sorte que le premier ne mérite pas même le nom de travail, et que le dernier, travail par excellence, soit seul digne des faveurs de la protection ?
Les pétionnaires. — Oui, nous commençons à voir que le blé, non plus que la laine, n’est pas tout à fait vierge de travail humain : mais au moins l’agriculteur n’a pas, comme le fabricant, tout exécuté par lui-même et ses ouvriers ; la nature l’a aidé ; et, s’il y a du travail, tout n’est pas travail dans le blé.
M. de Saint-Cricq. — Mais tout est travail dans sa valeur. Je veux que la nature ait concouru à la formation matérielle du grain. Je veux même qu’il soit exclusivement son ouvrage ; mais convenez que je l’ai contrainte par mon travail : et quand je vous vends du blé, remarquez bien ceci, ce n’est pas le travail de la nature que je vous fais payer, mais le mien.
Et, à votre compte, les objets fabriqués ne seraient pas non plus des produits du travail. Le manufacturier ne se fait-il pas seconder aussi par la nature ? Ne s’empare-t-il pas, à l’aide de la machine à vapeur, du poids de l’atmosphère, comme, à l’aide de la charrue, je m’empare de son humidité ? A-t-il créé les lois de la gravitation, de la transmission des forces, de l’affinité ?
Les pétionnaires. — Allons, va encore pour la laine, mais la houille est assurément l’ouvrage et l’ouvrage exclusif de la nature. Elle est bien vierge de tout travail humain.
M. de Saint-Cricq. — Oui, la nature a fait la houille, mais le travail en a fait la valeur. La houille n’avait aucune valeur pendant les millions d’années où elle était enfouie ignorée à cent pieds sous terre. Il a fallu l’y aller chercher : c’est un travail ; il a fallu la transporter sur le marché : c’est un autre travail ; et, encore une fois, le prix que vous la payez sur le marché n’est autre chose que la rémunération de ces travaux d’extraction et de transport [84].
On voit que jusqu’ici tout l’avantage est du côté de M. de Saint-Cricq ; que la valeur des matières premières, comme celle des matières fabriquées, représente les frais de production, c’est-à-dire du travail ; qu’il n’est pas possible de concevoir un objet pourvu de valeur, et qui soit vierge de tout travail humain ; que la distinction que font les pétitionnaires est futile en théorie ; que, comme base d’une inégale répartition de faveurs, elle serait inique en pratique, puisqu’il en résulterait que le tiers des Français, occupés aux manufactures, obtiendraient les douceurs du monopole, par la raison qu’ils produisent en travaillant, tandis que les deux autres tiers, à savoir la population agricole, seraient abandonnés à la concurrence, sous prétexte qu’ils produisent sans travailler.
On insistera, j’en suis sûr, et l’on dira qu’il y a plus d’avantage pour une nation à importer des matières dites premières, qu’elles soient ou non le produit du travail, et à exporter des objets fabriqués.
C’est là une opinion fort accréditée.
« Plus les matières premières sont abondantes, dit la pétition de Bordeaux, plus les manufactures se multiplient et prennent d’essor. »
« Les matières premières, dit-elle ailleurs, laissent une étendue sans limite à l’œuvre des habitants des pays où elles sont importées. »
« Les matières premières, dit la pétition du Havre, étant les éléments du travail, il faut les soumettre à un régime différent et les admettre de suite au taux le plus faible. »
La même pétition veut que la protection des objets fabriqués soit réduite non de suite, mais dans un temps indéterminé ; non au taux le plus faible, mais à 20 p. 100.
« Entre autres articles dont le bas prix et l’abondance sont une nécessité, dit la pétition de Lyon, les fabricants citent toutes les matières premières. »
Tout cela repose sur une illusion.
Nous avons vu que toute valeur représente du travail. Or, il est très-vrai que le travail manufacturier décuple, centuple quelquefois la valeur d’un produit brut, c’est-à-dire répand dix fois, cent fois plus de profits dans la nation. Dès lors on raisonne ainsi : La production d’un quintal de fer ne fait gagner que 15 francs aux travailleurs de toutes classes. La conversion de ce quintal de fer en ressorts de montres, élève leurs profits à 10,000 francs ; et oserez-vous dire que la nation n’est pas plus intéressée à s’assurer pour 10,000 francs que pour 15 francs de travail ?
On oublie que les échanges internationaux, pas plus que les échanges individuels, ne s’opèrent au poids ou à la mesure. On n’échange pas un quintal de fer brut contre un quintal de ressorts de montre, ni une livre de laine en suint contre une livre de laine en cachemire ; — mais bien une certaine valeur d’une de ces choses contre une valeur égale d’une autre. Or, troquer valeur égale contre valeur égale, c’est troquer travail égal contre travail égal. Il n’est donc pas vrai que la nation qui donne pour 100 francs de tissus ou de ressorts gagne plus que celle qui livre pour 100 francs de laine ou de fer.
Dans un pays où aucune loi ne peut être votée, aucune contribution établie qu’avec le consentement de ceux que cette loi doit régir ou que cet impôt doit frapper, on ne peut voler le public qu’en commençant par le tromper. Notre ignorance est la matière première de toute extorsion qui s’exerce sur nous, et l’on peut être assuré d’avance que tout sophisme est l’avant-coureur d’une spoliation. — Bon public, quand tu vois un sophisme dans une pétition, mets la main sur ta poche, car c’est certainement là que l’on vise.
Voyons donc quelle est la pensée secrète que messieurs les armateurs de Bordeaux et du Havre et messieurs les manufacturiers de Lyon enveloppent dans cette distinction entre les produits agricoles et les objets manufacturés ?
« C’est principalement dans cette première classe (celle qui comprend les matières premières, vierges de tout travail humain) que se trouve, disent les pétitionnaires de Bordeaux, le principal aliment de notre marine marchande… En principe, une sage économie exigerait que cette classe ne fût pas imposée… La seconde (objets qui ont reçu une préparation), on peut la charger. La troisième (objets auxquels le travail n’a plus rien à faire), nous la considérons comme la plus imposable. »
« Considérant, disent les pétitionnaires du Havre, qu’il est indispensable de réduire de suite au taux le plus bas les matières premières, afin que l’industrie puisse successivement mettre en œuvre les forces navales qui lui fourniront ses premiers et indispensables moyens de travail… »
Les manufacturiers ne pouvaient pas demeurer en reste de politesse envers les armateurs. Aussi, la pétition de Lyon demande-t-elle la libre introduction des matières premières, « pour prouver, y est-il dit, que les intérêts des villes manufacturières ne sont pas toujours opposés à ceux des villes maritimes. »
Non ; mais il faut dire que les uns et les autres, entendus comme font les pétitionnaires, sont terriblement opposés aux intérêts des campagnes, de l’agriculture et des consommateurs.
Voilà donc, messieurs, où vous vouliez en venir ! Voilà le but de vos subtiles distinctions économiques ! Vous voulez que la loi s’oppose à ce que les produits achevés traversent l’Océan, afin que le transport beaucoup plus coûteux des matières brutes, sales, chargées de résidus, offre plus d’aliment à votre marine marchande, et mette plus largement en œuvre vos forces navales. C’est là ce que vous appelez une sage économie.
Eh ! que ne demandez-vous aussi qu’on fasse venir les sapins de Russie avec leurs branches, leur écorce et leurs racines ; l’or du Mexique à l’état de minerai ; et les cuirs de Buénos-Ayres encore attachés aux ossements de cadavres infects ?
Bientôt, je m’y attends, les actionnaires des chemins de fer, pour peu qu’ils soient en majorité dans les chambres, feront une loi qui défende de fabriquer à Cognac l’eau-de-vie qui se consomme à Paris. Ordonner législativement le transport de dix pièces de vin pour une pièce d’eau-de-vie, ne serait-ce pas à la fois fournir à l’industrie parisienne l’indispensable aliment de son travail, et mettre en œuvre les forces des locomotives ?
Jusques à quand fermera-t-on les yeux sur cette vérité si simple ?
L’industrie, les forces navales, le travail ont pour but le bien général, le bien public ; créer des industries inutiles, favoriser des transports superflus, alimenter un travail surnuméraire, non pour le bien du public, mais aux dépens du public, c’est réaliser une véritable pétition de principe. Ce n’est pas le travail qui est en soi-même une chose désirable, c’est la consommation : tout travail sans résultat est une perte. Payer des marins pour porter à travers les mers d’inutiles résidus, c’est comme les payer pour faire ricocher des cailloux sur la surface de l’eau. Ainsi nous arrivons à ce résultat, que tous les sophismes économiques, malgré leur infinie variété, ont cela de commun qu’ils confondent le moyen avec le but, et développent l’un aux dépens de l’autre [85].
XXII. Métaphores↩
Quelquefois le sophisme se dilate, pénètre tout le tissu d’une longue et lourde théorie. Plus souvent il se comprime, il se resserre, il se fait principe, et se cache tout entier dans un mot.
Dieu nous garde, disait Paul-Louis, du malin et de la métaphore ! Et, en effet, il serait difficile de dire lequel des deux verse le plus de maux sur notre planète. — C’est le démon, dites-vous ; il nous met à tous, tant que nous sommes, l’esprit de spoliation dans le cœur. Oui, mais il laisse entière la répression des abus par la résistance de ceux qui en souffrent. C’est le sophisme qui paralyse cette résistance. L’épée que la malice met aux mains des assaillants serait impuissante si le sophisme ne brisait pas le bouclier aux bras des assaillis ; et c’est avec raison que Malebranche a inscrit sur le frontispice de son livre cette sentence : L’erreur est la cause de la misère des hommes.
Et voyez ce qui se passe. Des ambitieux hypocrites auront un intérêt sinistre, comme, par exemple, à semer dans le public le germe des haines nationales. Ce germe funeste pourra se développer, amener une conflagration générale, arrêter la civilisation, répandre des torrents de sang, attirer sur le pays le plus terrible des fléaux, l’invasion. En tous cas, et d’avance, ces sentiments haineux nous abaissent dans l’opinion des peuples et réduisent les Français qui ont conservé quelque amour de la justice à rougir de leur patrie. Certes ce sont là de grands maux ; et pour que le public se garantit contre les menées de ceux qui veulent lui faire courir de telles chances, il suffirait qu’il en eût la claire vue. Comment parvient-on à la lui dérober ? Par la métaphore. On altère, on force, on déprave le sens de trois ou quatre mots, et tout est dit.
Tel est le mot invasion lui-même.
Un maître de forges français dit : Préservons-nous de l’invasion des fers anglais. Un landlord anglais s’écrie : Repoussons l’invasion des blés français ! — Et ils proposent d’élever des barrières entre les deux peuples. — Les barrières constituent l’isolement, l’isolement conduit à la haine, la haine à la guerre, la guerre à l’invasion. — Qu’importe ? disent les deux sophistes ; ne vaut-il pas mieux s’exposer à une invasion éventuelle que d’accepter une invasion certaine ? — Et les peuples de croire, et les barrières de persister.
Et pourtant quelle analogie y a-t-il entre un échange et une invasion ?' Quelle similitude est-il possible d’établir entre un vaisseau de guerre qui vient vomir sur nos villes le fer, le feu et la dévastation, — et un navire marchand qui vient nous offrir de troquer librement, volontairement, des produits contre des produits ?
J’en dirai autant du mot inondation. Ce mot se prend ordinairement en mauvaise part, parce qu’il est assez dans les habitudes des inondations de ravager les champs et les moissons. — Si, pourtant, elles laissaient sur le sol une valeur supérieure à celle qu’elles lui enlèvent, comme font les inondations du Nil, il faudrait, à l’exemple des Égyptiens, les bénir, les déifier. — Eh bien ! avant de déclamer contre les inondations des produits étrangers, avant de leur opposer de gênants et coûteux obstacles, se demande-t-on si ce sont là des inondations qui ravagent ou de celles qui fertilisent ? — Que penserions-nous de Méhémet-Ali, si, au lieu d’élever à gros frais des barrages à travers le Nil, pour étendre le domaine de ses inondations, il dépensait ses piastres à lui creuser un lit plus profond, afin que l’Égypte ne fût pas souillée par ce limon étranger descendu des montagnes de la Lune ? Nous exhibons précisément ce degré de sagesse et de raison, quand nous voulons, à grand renfort de millions, préserver notre pays… — De quoi ? — Des bienfaits dont la nature a doté d’autres climats.
Parmi les métaphores qui recèlent toute une funeste théorie, il n’en est pas de plus usitée que celle que présentent les mots tribut, tributaire.
Ces mots sont devenus si usuels, qu’on en fait les synonymes d’achat, acheteur, et l’on se sert indifféremment des uns ou des autres.
Cependant il y a aussi loin d’un tribut à un achat que d’un vol à un échange, et j’aimerais autant entendre dire : Cartouche a enfoncé mon coffre-fort et il y a acheté mille écus, que d’ouïr répéter à nos honorables députés : Nous avons payé à l’Allemagne le tribut de mille chevaux qu’elle nous a vendus.
Car ce qui fait que l’action de Cartouche n’est pas un achat, c’est qu’il n’a pas mis, et de mon consentement, dans mon coffre-fort, une valeur équivalente à celle qu’il a prise.
Et ce qui fait que l’octroi de 500,000 francs que nous avons fait à l’Allemagne n’est pas un tribut, c’est justement qu’elle ne les a pas reçus à titre gratuit, mais bien en nous livrant en échange mille chevaux que nous-mêmes avons jugé valoir nos 500,000 francs.
Faut-il donc relever sérieusement de tels abus de langage ? Pourquoi pas, puisque c’est très-sérieusement qu’on les étale dans les journaux et dans les livres.
Et qu’on n’imagine pas qu’ils échappent à quelques écrivains ignorant jusqu’à leur langue ! Pour un qui s’en abstient, je vous en citerai dix qui se les permettent, et des plus huppés encore, les d’Argout, les Dupin, les Villèle, les pairs, les députés, les ministres, c’est-à-dire les hommes dont les paroles sont des lois, et dont les sophismes les plus choquants servent de base à l’administration du pays.
Un célèbre philosophe moderne a ajouté aux catégories d’Aristote le sophisme qui consiste à renfermer dans un mot une pétition de principe. Il en cite plusieurs exemples. Il aurait pu joindre le mot tributaire à sa nomenclature. — En effet, il s’agit de savoir si les achats faits au dehors sont utiles ou nuisibles. — Ils sont nuisibles, dites-vous. — Et pourquoi ? — Parce qu’ils nous rendent tributaires de l’étranger. — Certes, voilà bien un mot qui pose en fait ce qui est en question.
Comment ce trope abusif s’est-il introduit dans la rhétorique des monopoleurs ?
Des écus sortent du pays pour satisfaire la rapacité d’un ennemi victorieux. — D’autres écus sortent aussi du pays pour solder des marchandises. — On établit l’analogie des deux cas, en ne tenant compte que de la circonstance par laquelle ils se ressemblent et faisant abstraction de celle par laquelle ils diffèrent.
Cependant cette circonstance, c’est-à-dire le non-remboursement dans le premier cas, et le remboursement librement convenu dans le second, établit entre eux une différence telle qu’il n’est réellement pas possible de les classer sous la même étiquette. Livrer 100 francs par force à qui vous serre la gorge, ou volontairement à qui vous donne l’objet de vos désirs, vraiment, ce sont choses qu’on ne peut assimiler. — Autant vaudrait dire qu’il est indifférent de jeter le pain à la rivière ou de le manger, parce que c’est toujours du pain détruit. Le vice de ce raisonnement, comme celui que renferme le mot tribut, consisterait à fonder une entière similitude entre deux cas par leur ressemblance et en faisant abstraction de leur différence.
Conclusion↩
Tous les sophismes que j’ai combattus jusqu’ici se rapportent à une seule question : le système restrictif ; encore, par pitié pour le lecteur, « j’en passe, et des meilleurs » : droits acquis, inopportunité, épuisement du numéraire, etc., etc.
Mais l’économie sociale n’est pas renfermée dans ce cercle étroit. Le fouriérisme, le saint-simonisme, le communisme, le mysticisme, le sentimentalisme, la fausse philanthropie, les aspirations affectées vers une égalité et une fraternité chimériques, les questions relatives au luxe, aux salaires, aux machines, à la prétendue tyrannie du capital, aux colonies, aux débouchés, aux conquêtes, à la population, à l’association, à l’émigration, aux impôts, aux emprunts, ont encombré le champ de la science d’une foule d’arguments parasites, de sophismes qui sollicitent la houe et la binette de l’économiste diligent.
Ce n’est pas que je ne reconnaisse le vice de ce plan ou plutôt de cette absence de plan. Attaquer un à un tant de sophismes incohérents, qui quelquefois se choquent et plus souvent rentrent les uns dans les autres, c’est se condamner à une lutte désordonnée, capricieuse, et s’exposer à de perpétuelles redites.
Combien je préférerais dire simplement comment les choses sont, sans m’occuper de mille aspects sous lesquels l’ignorance les voit !… Exposer les lois selon lesquelles les sociétés prospèrent ou dépérissent, c’est ruiner virtuellement tous les sophismes à la fois. Quand Laplace eut décrit ce qu’on peut savoir jusqu’ici du mouvement des corps célestes, il dissipa, sans même les nommer, toutes les rêveries astrologiques des Égyptiens, des Grecs et des Hindous, bien plus sûrement qu’il n’eût pu le faire en les réfutant directement dans d’innombrables volumes. — La vérité est une ; le livre qui l’expose est un édifice imposant et durable :
Il brave les tyrans avides,
Plus hardi que les Pyramides
Et plus durable que l’airain.
L’erreur est multiple et de nature éphémère ; l’ouvrage qui la combat ne porte pas en lui-même un principe de grandeur et de durée.
Mais si la force et peut-être l’occasion [86] m’ont manqué pour procéder à la manière des Laplace et des Say, je ne puis me refuser à croire que la forme que j’ai adoptée a aussi sa modeste utilité. Elle me semble surtout bien proportionnée aux besoins du siècle, aux rapides instants qu’il peut consacrer à l’étude.
Un traité a sans doute une supériorité incontestable, mais à une condition, c’est d’être lu, médité, approfondi. Il ne s’adresse qu’à un public d’élite. Sa mission est de fixer d’abord et d’agrandir ensuite le cercle des connaissances acquises.
La réfutation des préjugés vulgaires ne saurait avoir cette haute portée. Elle n’aspire qu’à désencombrer la route devant la marche de la vérité, à préparer les esprits, à redresser le sens public, à briser dans des mains impures des armes dangereuses.
C’est surtout en économie sociale que cette lutte corps à corps, que ces combats sans cesse renaissants avec les erreurs populaires ont une véritable utilité pratique.
On pourrait ranger les sciences en deux catégories.
Les unes, à la rigueur, peuvent n’être sues que des savants. Ce sont celles dont l’application occupe des professions spéciales. Le vulgaire en recueille le fruit malgré l’ignorance ; quoiqu’il ne sache pas la mécanique et l’astronomie, il n’en jouit pas moins de l’utilité d’une montre, il n’est pas moins entraîné par la locomotive ou le bateau à vapeur sur la foi de l’ingénieur et du pilote. Nous marchons selon les lois de l’équilibre sans les connaître, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir.
Mais il est des sciences qui n’exercent sur le public qu’une influence proportionnée aux lumières du public lui-même, qui tirent toute leur efficacité non des connaissances accumulées dans quelques têtes exceptionnelles, mais de celles qui sont diffusées dans la raison générale. Telles sont la morale, l’hygiène, l’économie sociale, et, dans les pays où les hommes s’appartiennent à eux-mêmes, la politique. C’est de ces sciences que Bentham aurait pu dire surtout : « Ce qui les répand vaut mieux que ce qui les avance. » Qu’importe qu’un grand homme, un Dieu même, ait promulgué les lois de la morale, aussi longtemps que les hommes, imbus de fausses notions, prennent les vertus pour des vices et les vices pour des vertus ? Qu’importe que Smith, Say, et, selon M. de Saint-Chamans, les économistes de toutes les écoles aient proclamé, en fait de transactions commerciales, la supériorité de la liberté sur la contrainte, si ceux-là sont convaincus du contraire qui font les lois et pour qui les lois sont faites ?
Ces sciences, que l’on a fort bien nommées sociales, ont encore ceci de particulier que, par cela même qu’elles sont d’une application usuelle, nul ne convient qu’il les ignore. — A-t-on besoin de résoudre une question de chimie ou de géométrie ? On ne prétend pas avoir la science infuse ; on n’a pas honte de consulter M. Thénard ; on ne se fait pas difficulté d’ouvrir Legendre ou Bezout. — Mais, dans les sciences sociales, on ne reconnaît guère d’autorités. Comme chacun fait journellement de la morale bonne ou mauvaise, de l’hygiène, de l’économie, de la politique raisonnable ou absurde, chacun se croit apte à gloser, disserter, décider et trancher en ces matières. — Souffrez-vous ? Il n’est pas de bonne vieille qui ne vous dise du premier coup la cause et le remède de vos maux : « Ce sont les humeurs, affirme-t-elle, il faut vous purger. » — Mais qu’est-ce que les humeurs ? et y a-t-il des humeurs ? C’est ce dont elle ne se met pas en peine. — Je songe involontairement à cette bonne vieille quand j’entends expliquer tous les malaises sociaux par ces phrases banales : C’est la surabondance des produits, c’est la tyrannie du capital, c’est la pléthore industrielle, et autres sornettes dont on ne peut pas même dire : Verba et voces, prætereaque nihil, car ce sont autant de funestes erreurs.
De ce qui précède il résulte deux choses : 1° Que les sciences sociales doivent abonder en sophismes beaucoup plus que les autres, parce que ce sont celles où chacun ne consulte que son jugement ou ses instincts ; 2° que c’est dans ces sciences que le sophisme est spécialement malfaisant, parce qu’il égare l’opinion en une matière où l’opinion c’est la force, c’est la loi.
Il faut donc deux sortes de livres à ces sciences : ceux qui les exposent et ceux qui les propagent, ceux qui montrent la vérité et ceux qui combattent l’erreur.
Il me semble que le défaut inhérent à la forme de cet opuscule, la répétition, est ce qui en fait la principale utilité.
Dans la question que j’ai traitée, chaque sophisme a sans doute sa formule propre et sa portée, mais tous ont une racine commune, qui est l’oubli des intérêts des hommes en tant que consommateurs. Montrer que les mille chemins de l’erreur conduisent à ce sophisme générateur, c’est apprendre au public à le reconnaître, à l’apprécier, à s’en défier en toutes circonstances.
Après tout, je n’aspire pas précisément à faire naître des convictions, mais des doutes.
Je n’ai pas la prétention qu’en posant le livre le lecteur s’écrie : Je sais ; plaise au ciel qu’il se dise sincèrement : J’ignore !
« J’ignore, car je commence à craindre qu’il n’y ait quelque chose d’illusoire dans les douceurs de la disette. » (Sophisme I.)
« Je ne suis plus si édifié sur les charmes de l’obstacle. » (Sophisme II.)
« L’effort sans résultat ne me semble plus aussi désirable que le résultat sans effort. » (Sophisme III.)
« Il se pourrait bien que le secret du commerce ne consiste pas, comme celui des armes (selon la définition qu’en donne le spadassin du Bourgeois gentilhomme), à donner et à ne pas recevoir. » (Sophisme VI.)
« Je conçois qu’un objet vaut d’autant plus qu’il a reçu plus de façons ; mais, dans l’échange, deux valeurs égales cessent-elles d’être égales parce que l’une vient de la charrue et l’autre de la Jacquart ? » (Sophisme XXI.)
« J’avoue que je commence à trouver singulier que l’humanité s’améliore par des entraves, s’enrichisse par des taxes ; et franchement je serais soulagé d’un poids importun, j’éprouverais une joie pure, s’il venait à m’être démontré, comme l’assure l’auteur des Sophismes, qu’il n’y a pas incompatibilité entre le bien-être et la justice, entre la paix et la liberté, entre l’extension du travail et les progrès de l’intelligence. » (Sophismes XIV et XX.)
« Donc, sans me tenir pour satisfait par ses arguments, auxquels je ne sais si je dois donner le nom de raisonnements ou de paradoxes, j’interrogerai les maîtres de la science. »
Terminons par un dernier et important aperçu cette monographie du Sophisme.
Le monde ne sait pas assez l’influence que le Sophisme exerce sur lui.
S’il en faut dire ce que je pense, quand le droit du plus fort a été détrôné, le Sophisme a remis l’empire au droit du plus fin, et il serait difficile de dire lequel de ces deux tyrans a été le plus funeste à l’humanité.
Les hommes ont un amour immodéré pour les jouissances, l’influence, la considération, le pouvoir, en un mot, pour les richesses.
Et, en même temps, ils sont poussés par une inclination immense à se procurer ces choses aux dépens d’autrui.
Mais cet autrui, qui est le public, a une inclination non moins grande à garder ce qu’il a acquis, pourvu qu’il le puisse et qu’il le sache.
La spoliation, qui joue un si grand rôle dans les affaires du monde, n’a donc que deux agents : la force et la ruse, et deux limites : le courage et les lumières.
La force appliquée à la spoliation fait le fond des annales humaines. En retracer l’histoire, ce serait reproduire presque en entier l’histoire de tous les peuples : Assyriens, Babyloniens, Mèdes, Perses, Égyptiens, Grecs, Romains, Goths, Francs, Huns, Turcs, Arabes, Mongols, Tartares, sans compter celle des Espagnols en Amérique, des Anglais dans l’Inde, des Français en Afrique, des Russes en Asie, etc., etc.
Mais, du moins, chez les nations civilisées, les hommes qui produisent les richesses sont devenus assez nombreux et assez forts pour les défendre. — Est-ce à dire qu’ils ne sont plus dépouillés ? Point du tout ; ils le sont autant que jamais, et, qui plus est, ils se dépouillent les uns les autres.
Seulement, l’agent est changé : ce n’est plus par force, c’est par ruse qu’on s’empare des richesses publiques.
Pour voler le public, il faut le tromper. Le tromper, c’est lui persuader qu’on le vole pour son avantage ; c’est lui faire accepter en échange de ses biens des services fictifs, et souvent pis. — De là le Sophisme. — Sophisme théocratique, Sophisme économique, Sophisme politique, Sophisme financier. — Donc, depuis que la force est tenue en échec, le Sophisme n’est pas seulement un mal, c’est le génie du mal. Il le faut tenir en échec à son tour. — Et, pour cela, rendre le public plus fin que les fins, comme il est devenu plus fort que les forts.
Bon public, c’est sous le patronage de cette pensée que je t’adresse ce premier essai, — bien que la Préface soit étrangement transposée, et la Dédicace quelque peu tardive [87].
Mugron, 2 novembre 1845.
1847
Correspondence↩
à Richard Cobden: Lettre du 10 janvier 1847 (Paris) ↩
BWV
[CW1.76] [OC1] 76. Paris, 10 janvier 1847. A Richard Cobden
Mon cher ami, j’ai reçu presque en même temps vos deux lettres écrites de Marseille. Je vous approuve de n’avoir fait que passer dans cette ville ; car Dieu sait comment on aurait interprété un plus long séjour. Mon ami, l’obstacle qui nous viendra des préventions nationales est beaucoup plus grave et durera plus que vous ne paraissez le croire. Si les monopoleurs avaient excité l’anglophobie pour le besoin de la cause, cette manœuvre stratégique pourrait être aisément déjouée. En tout cas, la France, en bien peu de temps, découvrirait le piége. Mais ils exploitent un sentiment préexistant, qui a de profondes racines dans les cœurs, — et vous le dirai-je ? qui, quoique égaré et exagéré, a son explication et sa justification. Il n’est pas douteux que l’oligarchie anglaise a pesé douloureusement sur l’Europe ; que sa politique de bascule, tantôt soutenant les despotes du Nord, pour comprimer la liberté au Midi, tantôt excitant le libéralisme au Midi pour contenir le despotisme du Nord, n’ait dû éveiller partout une infaillible réaction. Vous me direz qu’il ne faut jamais confondre les peuples avec leurs gouvernements. C’est bon pour les penseurs. Mais les nations se jugent entre elles par l’action extérieure qu’elles exercent les unes sur les autres. Et puis, je vous l’avoue, cette distinction est un peu subtile. Les peuples sont solidaires jusqu’à un certain point de leurs gouvernements, qu’ils laissent faire quand ils ne les aident pas. La politique constante de l’oligarchie britannique a été de compromettre la nation dans ses intrigues et ses entreprises, afin de la mettre en état d’hostilité avec le génie humain et la tenir ainsi sous sa dépendance. Maintenant cette hostilité générale se manifeste ; c’est un juste châtiment de fautes passées, et il survivra longtemps à ces fautes mêmes.
Ainsi le sentiment national dont les monopoleurs se servent est très-réel. Ajoutez qu’il sert admirablement les partis. Les démocrates, les républicains et l’opposition de la gauche l’exploitent à qui mieux mieux, ceux-là pour dépopulariser le roi, ceux-ci pour renverser M. Guizot. — Vous conviendrez que les monopoleurs ont trouvé là une puissance bien dangereuse.
Pour déjouer cette manœuvre, l’idée m’était venue de commencer par reconnaître le machiavélisme et la politique envahissante de l’oligarchie britannique ; de dire ensuite : « Qui en a souffert plus que le peuple anglais lui-même ? » de montrer le sentiment d’opposition qu’elle a de tout temps rencontré en Angleterre ; de faire voir ce sentiment résistant, en 1773, à la guerre contre l’indépendance américaine, en 1791, à la guerre contre la révolution française. Ce sentiment fut alors comprimé, mais non étouffé, il vit encore, il se fortifie, il grandit, il devient l’opinion publique. C’est lui qui a arraché à l’oligarchie l’émancipation catholique, l’extension du suffrage électoral, l’abolition de l’esclavage et récemment la destruction des monopoles. C’est encore lui qui lui arrachera l’affranchissement commercial des colonies. — Et à ce sujet, je ferai voir que l’affranchissement commercial conduit à l’affranchissement politique. Donc la politique envahissante a cessé d’être, car on ne renonce pas a des envahissements accomplis pour courir après des envahissements nouveaux.
Ensuite, par des traductions de vous, de Fox, de Thompson, je montrerai que la Ligue est l’organe et la manifestation de ce sentiment qui s’harmonise avec celui de l’Europe, etc.. etc., vous devinez le reste. — Mais il faudrait du temps et de la force, et je n’ai ni l’un ni l’autre. — Ne pouvant écrire, tel sera le texte de la fin de mon prochain discours à la salle Montesquieu. Au reste, je ne dirai rien que je ne le pense.
Que vous êtes heureux d’être sous le ciel d’Italie ! quand verrai-je aussi les champs, la mer, les montagnes ! ô rus ! quando ego te aspiciam ! et surtout quand serai-je au milieu de ceux qui m’aiment ! Vous avez fait des sacrifices, vous ; mais c’était pour fonder l’édifice de la civilisation. En conscience, mon ami, est-on tenu à la même abnégation quand on ne peut que porter un grain de sable au monument ? Mais il fallait faire ces réflexions avant ; maintenant, l’épée est sortie du fourreau. Elle n’y rentrera plus. Le monopole ou votre ami iront avant au Père Lachaise.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 mars 1847 (Paris) ↩
BWV
[CW1.77] [OC1] 77. Paris, 11 mars 1847. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, ta lettre est venue bien à propos pour détruire l’inquiétude où m’avait jeté celle de la veille. Pourtant j’avais le pressentiment que tu me donnerais de meilleures nouvelles, et ma confiance venait précisément de cet assoupissement de ma tante qui te donnait des craintes : car, à deux reprises, j’ai pu m’assurer que c’est plutôt un bon signe chez elle. Mais la constitution de notre machine est si bizarre, que cela ne pouvait me rassurer beaucoup. Aussi j’attendais le courrier avec impatience, et le malheur a voulu qu’il fût retardé aujourd’hui de plusieurs heures à cause de la neige. Enfin, j’ai ta lettre et je suis tranquille. Quel supplice pour nous, mon cher Félix, lorsque l’incertitude des circonstances vient s’ajouter à l’incertitude de notre caractère ! Abandonner ma pauvre tante dans ce moment, malade, n’ayant pas un parent auprès d’elle ! Cette pensée est affreuse. D’un autre côté, tous les fils de notre entreprise sont dans ma main : journal, correspondance, comptabilité, puis-je laisser s’écrouler tout l’édifice ? Il y avait comité, je parlai de la nécessité que je prévoyais de faire une absence, et j’ai pu comprendre à quel point je suis engagé. Pourtant un ami m’a offert de faire le journal en mon absence. C’est beaucoup, mais que d’autres obstacles ! Enfin, ma tante est bien. — Ceci me servira de leçon, et je vais manœuvrer de manière à pouvoir au moins, au besoin, disposer de quelques jours. Pour toi, mon cher Félix, aie soin de me tenir bien au courant.
Ta blanche chaumière me sourit. Je t’admire et te félicite de ne placer ton château en Espagne qu’à un point où tu puisses atteindre. Deux métairies en ligne, de justes proportions de champs, de vignes, de prés, quelques vaches, deux familles patriarcales de métayers, deux domestiques qui à la campagne ne coûtent pas cher, la proximité du presbytère, et surtout ta bonne sœur et tes livres. Vraiment il y a là de quoi varier, occuper et adoucir les jours d’automne. Peut-être un jour j’aurai aussi ma chaumière près de la tienne. Pauvre Félix ! tu crois que je poursuis la gloire. Si elle m’était destinée, comme tu le dis, elle m’échapperait ici, où je ne fais rien de sérieux. J’ai, je le sens, une nouvelle exposition de la science économique dans la tête, et elle n’en sortira jamais ! — Adieu, il est déjà peut-être trop tard pour le courrier.
à Richard Cobden: Lettre du 20 mars 1847 (Paris) ↩
BWV
[CW1.78] [OC1] 78. Paris, 20 mars 1847. A Richard Cobden
Quel bien immense notre journal pourrait faire s’il mettait en contraste l’inanité et le danger de la politique actuelle avec la grandeur et la sécurité de la politique libre-échangiste ! Avant la fondation du journal, j’avais le projet de publier chaque mois un petit volume, dans le genre des Sophismes, où j’aurais eu mes coudées franches. Je crois vraiment qu’il eût été plus utile que le journal lui-même.
Notre agitation s’agite fort peu. Il nous manque toujours un homme d’action. Quand surgira-t-il ? je l’ignore. Je devrais être cet homme, j’y suis poussé par la confiance unanime de mes collègues, but I cannot. Le caractère n’y est pas, et tous les conseils du monde ne peuvent point faire d’un roseau un chêne. Enfin, quand la question pressera les esprits, j’espère bien voir apparaître un Wilson.
Je vous envoie les cinq à six derniers numéros du Libre-Échange. Il est bien peu répandu, mais il m’a été assuré qu’il ne laissait pas que d’exercer quelque influence sur plusieurs de nos leading men.
Il paraît que notre ministère n’osera pas présenter cette année une loi de douane qui introduise dans la législation actuelle des changements sérieux. Cela décourage quelques-uns de nos amis. Quant à moi, je ne désire même pas des modifications actuelles. Arrière les lois qui précèdent le progrès de l’opinion ! et je ne désire pas pour mon pays autant le free-trade que l’esprit du free-trade. Le free-trade, c’est un peu plus de richesse ; l’esprit du free-trade, c’est la réforme de l’intelligence même, c’est-à-dire la source de toutes les réformes.
Vous me parlez de Naples, de Rome, de la Sardaigne et du Piémont. Mais vous ne me dites rien de la Toscane. Cependant ce pays doit être très-curieux à observer. Si vous rencontrez quelque bon ouvrage sur l’état de ce pays, tâchez de me l’envoyer. Je ne serais pas fâché d’avoir aussi dans mon humble bibliothèque quelques-uns des plus anciens économistes italiens, par exemple : Nicolo Donato. Je me figure que si la renommée n’était pas quelque peu capricieuse, Turgot et Ad. Smith, tout en conservant la gloire de grands hommes, perdraient celle d’inventeurs.
à Richard Cobden: Lettre du 20 avril 1847 (Paris) ↩
BWV
[CW1.79] [OC1] 79. Paris, 20 avril 1847. A Richard Cobden
Mon cher ami, votre lettre du 7, écrite de Rome, m’a retrouvé à mon poste. Je suis allé passer vingt jours auprès d’une parente malade. J’espérais que ce voyage me rendrait aussi la santé, mais il n’en est pas ainsi. La grippe a dégénéré en rhume obstiné, et dans ce moment je crache le sang. Ce qui m’étonne et m’épouvante, c’est de voir combien quelques gouttes de sang sorties du poumon peuvent affaiblir notre pauvre machine et surtout la tête. Le travail m’est impossible et très-probablement je vais demander au conseil l’autorisation de faire une autre absence. J’en profiterai pour aller à Lyon et à Marseille, afin de resserrer les liens de nos diverses associations, qui ne marchent pas aussi d’accord que je le voudrais.
Je n’ai pas besoin de vous dire combien je partage votre opinion sur les résultats politiques du libre-échange. On nous accuse, dans le parti démocratique et socialiste, d’être voués au culte des intérêts matériels et de tout ramener à des questions de richesses. J’avoue que lorsqu’il s’agit des masses, je n’ai pas ce dédain stoïque pour la richesse. Ce mot ne veut pas dire quelques écus de plus ; il signifie du pain pour ceux qui ont faim, des vêtements pour ceux qui ont froid, de l’éducation, de l’indépendance, de la dignité. — Mais, après tout, si le résultat du libre-échange devait être uniquement d’accroître la richesse publique, je ne m’en occuperais pas plus que de toute autre question agricole ou industrielle. Ce que je vois surtout dans notre agitation, c’est l’occasion de combattre quelques préjugés et de faire pénétrer dans le public quelques idées justes. C’est là un bien indirect cent fois supérieur aux avantages directs de la liberté commerciale ; et si nous éprouvons tant d’obstacles dans la diffusion de notre démonstration économique, je crois que la Providence nous a ménagé ces obstacle, précisément pour que le bien indirect se fasse. Si la liberté était proclamée demain, le public resterait dans l’ornière où il est sous tous les autres rapports ; mais, au début, je suis obligé de ne toucher qu’avec un extrême ménagement à ces idées accessoires, afin de ne pas heurter nos propres collègues. Aussi je consacre mes efforts à élucider le problème économique. Ce sera le point de départ de vues plus élevées. Que Dieu me donne encore trois ou quatre ans de force et de vie ! Quelquefois je me dis que si j’eusse travaillé seul et pour mon compte, je n’aurais pas eu tous ces ménagements à garder, et ma carrière eût été plus utile.
Pendant les vingt jours où j’ai été absent, quelques dissentiments ont éclaté dans le sein de notre association. C’est au sujet de cette difficile nuance entre le droit fiscal et le droit protecteur. Quelques-uns de nos collègues se sont retirés, et il se rencontre que ce sont les plus laborieux. Ils voulaient réserver la question fiscale même à l’occasion du blé. La majorité a demandé la franchise complète sur les subsistances et les matières premières. Voilà une première cause de désorganisation. Il y en a une seconde dans nos finances, qui sont loin de suffire. C’est par ce motif que je désire faire le voyage du Midi. Je ne partirai pas sans vous en prévenir.
Je connaissais la réforme de Naples ; M. Bursotti avait eu la complaisance de m’envoyer des documents là-dessus. Je les donnai à mon collaborateur Garnier, qui sans doute les a égarés, puisqu’il ne me les rapporte pas. Si vous avez occasion de revoir M. Bursotti, veuillez lui présenter mes respects et l’expression de ma profonde estime. J’en dis autant de MM. Pettiti, Scialoja, etc.
Vous me parlez de l’état de notre presse périodique ; mais probablement vous ne connaissez pas toute l’étendue et la profondeur du mal. L’art d’écrire est si vulgaire qu’une foule de jeunes gens de vingt ans régentent le monde par la presse avant d’avoir eux-mêmes rien étudié et rien appris. Mais ce n’est pas là ce qu’il y a de pire. Les meneurs sont tous attachés à des hommes politiques, et toute question devient, entre leurs mains, question ministérielle. Plût à Dieu que le mal s’arrêtât là ! Il y a de plus la vénalité qui n’a pas de bornes. Les préjugés, les erreurs, les calomnies sont tarifés à tant la ligne. L’un se vend aux Russes, l’autre à la protection, celui-ci à l’université, celui-là à la banque, etc… Nous nous disons civilisés ! Mais vraiment je crois que c’est tout au plus si nous avons un pied dans la voie de la civilisation.
Me permettez-vous, mon cher ami, de n’admettre que sous réserve l’exactitude de cet axiome : « Le commerce est l’échange du superflu contre le nécessaire ? » Quand deux hommes, pour exécuter plus de besogne dans le même temps, conviennent de se partager le travail, peut-on dire que l’un des deux, ou même aucun des deux, donne le superflu ? Le pauvre diable qui travaille douze heures par jour pour avoir du pain donne-t-il son superflu ? Le commerce, à ce que je crois, n’est autre chose que la séparation des occupations, la division du travail.
Il serait à désirer que le Pape fît connaître ses vues économiques, alors même qu’il ne pourrait pas les exécuter. Cela disposerait en notre faveur une partie du clergé français, qui n’a pas de grandes lumières sur notre cause, mais qui n’a pas non plus de répugnances contraires.
à Richard Cobden: Lettre du 5 juillet 1847 (Paris) ↩
BWV
[CW1.80] [OC1] 80. Paris, 5 juillet 1847. A Richard Cobden
Mon bien cher ami, les détails que vous me donnez sur l’Italie et l’état des connaissances économiques dans ce pays m’ont vivement intéressé. J’ai reçu la précieuse collection [88] que vous avez eu la bonté de m’envoyer. Hélas ! quand pourrai-je seulement y jeter les yeux ! Du moins, je la tiendrai à la disposition de tous mes amis, afin que, d’une manière ou d’une autre, vos généreuses intentions ne soient pas sans résultat.
Vous voulez bien vous préoccuper de ma santé. Je suis presque toujours enrhumé ; et s’il en est ainsi en juillet, que sera-ce en décembre ? Mais ce qui m’occupe le plus, c’est l’état de mon cerveau. Je ne sais ce que sont devenues les idées qu’il me fournissait autrefois en trop grande abondance. Maintenant, je cours après et ne puis pas les rattraper. Cela m’alarme. — Je sens, mon cher ami, que j’aurais dû rester tout à fait en dehors de l’association et conserver la liberté de mes allures, écrire et parler à mon heure et à ma guise. — Au lieu de cela, je suis enchaîné de la manière la plus indissoluble, par le domicile, par le journal, parles finances, par l’administration, etc., etc. ; et le pis est que cela est irrémédiable, attendu que tous mes collègues sont occupés et ne peuvent guère s’occuper de nos affaires que pendant la durée de nos rares réunions.
Mon ami, l’ignorance et l’indifférence dans ce pays, en matière d’économie politique, dépassent tout ce que j’aurais pu me figurer. Ce n’est pas une raison pour se décourager, au contraire, c’en est une pour nous donner le sentiment de l’utilité, de l’urgence même de nos efforts. Mais je comprends aujourd’hui une chose : c’est que la liberté commerciale est un résultat trop éloigné pour nous. Heureux si nous pouvons déblayer la route de quelques obstacles. — Le plus grand n’est pas le parti protectionniste, mais le socialisme avec ses nombreuses ramifications. — S’il n’y avait que les monopoleurs, ils ne résisteraient pas à la discussion. — Mais le socialisme leur vient en aide. Celui-ci admet la liberté en principe et renvoie l’exécution après l’époque où le monde sera constitué sur le plan de Fourier ou tout autre inventeur de société. — Et, chose singulière, pour prouver que jusque-là la liberté sera nuisible, ils reprennent tous les arguments des monopoleurs : balance du commerce, exportation du numéraire, supériorité de l’Angleterre, etc., etc.
D’après cela, vous me direz que combattre les monopoleurs, c’est combattre les socialistes. — Non. — Les socialistes ont une théorie sur la nature oppressive du capital, par laquelle ils expliquent l’inégalité des conditions, et toutes les souffrances des classes pauvres. Ils parlent aux passions, aux sentiments, et même aux meilleurs instincts des hommes. Ils séduisent la jeunesse, montrant le mal et affirmant qu’ils possèdent le remède. Ce remède consiste en une organisation sociale artificielle de leur invention, qui rendra tous les hommes heureux et égaux, sans qu’ils aient besoin de lumières et de vertus. — Encore si tous les socialistes étaient d’accord sur ce plan d’organisation, on pourrait espérer de le ruiner dans les intelligences. Mais vous comprenez que, dans cet ordre d’idées, et du moment qu’il s’agit de pétrir une société, chacun fait la sienne, et tous les matins nous sommes assaillis par des inventions nouvelles. Nous avons donc à combattre une hydre à qui il repousse dix têtes quand nous lui en coupons une.
Le malheur est que cette méthode a un puissant attrait pour la jeunesse. On lui montre des souffrances ; et par là on commence par toucher son cœur. Ensuite on lui dit que tout peut se guérir, au moyen de quelques combinaisons artificielles ; et par là on met son imagination en campagne. Combien de peine a-t-elle ensuite à vous écouter quand vous venez la désillusionner, en lui exposant les belles mais sévères lois de l’économie sociale, et lui dire : « Pour extirper le mal de ce monde (et encore cette partie du mal sur lequel la puissance humaine a quelque action) le procédé est plus long ; il faut extirper le vice et l’ignorance. »
Frappé du danger de la voie dans laquelle se précipite la jeunesse, j’ai pris le parti de lui demander de m’entendre. J’ai réuni les élèves des écoles de Droit et de Médecine, c’est-à-dire ces jeunes hommes qui dans quelques années gouverneront le monde ou du moins la France. Ils m’ont écouté avec bienveillance, avec sympathie, mais, comme vous pensez bien, sans trop me comprendre. N’importe ; puisque l’expérience est commencée, je la suivrai jusqu’au bout. Vous savez que j’ai toujours dans la tête le plan d’un petit ouvrage intitulé les Harmonies économiques. C’est le point de vue positif dont les sophismes sont le point de vue négatif. Pour préparer le terrain, j’ai distribué à ces jeunes gens les Sophismes. Chacun en a reçu un exemplaire. J’espère que cela désobstruera un peu leur esprit, et, au retour des vacances, je me propose de leur exposer méthodiquement les harmonies.
Vous comprenez à présent, mon ami, combien je tiens à ma santé ! oh ! que la bonté divine me donne au moins encore un an de force ! qu’elle me permette d’exposer devant mes jeunes concitoyens ce que je considère comme la vraie théorie sociale, sous ces douze chapitres : Besoins, production, propriété, concurrence, population, liberté, égalité, responsabilité, solidarité, fraternité, unité, rôle de l’opinion publique ; et je remettrai sans regret, — avec joie, — ma vie entre ses mains !
Adieu, mon ami, veuillez remercier madame Cobden de son bon souvenir et recevez tous deux les vœux que je forme pour votre bonheur.
à M. Félix Coudroy: Lettre d’août 1847, Paris ↩
BWV
[CW1.81] [OC1] 81. Paris, août 1847. A Félix Coudroy
… Je t’envoie le dernier numéro du journal. Tu verras que je me suis lancé devant l’École de droit. La brèche est faite. Si ma santé ne s’y oppose pas, je persisterai certainement ; et à partir de novembre prochain, je ferai à cette jeunesse un cours, non d’économie politique pure, mais d’économie sociale, en prenant ce mot dans l’acception que nous lui donnons, Harmonie des lois sociales. Quelque chose me dit que ce cours, adressé à des jeunes gens, qui ont de la logique dans l’esprit et de la chaleur dans l’âme, ne sera pas sans utilité. Il me semble que je produirai la conviction, et puis j’indiquerai au moins les bonnes sources. Enfin, que le bon Dieu me donne encore un an de force, et mon passage sur cette terre n’aura pas été inutile : diriger le journal, faire un cours à la jeunesse des écoles, cela ne vaut-il pas mieux que d’être député ?
Adieu, mon cher Félix, ton ami.
à M. Horace Say; Lettre d’un lundi d’octobre 1847 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.82] [OC7] 82. Mugron, lundi, octobre 1847. A Horace Say
…Notre pays a bien besoin de recevoir l’instruction économique. L’ignorance à cet égard est telle, que j’en suis épouvanté pour l’avenir. Je crains que les gouvernements n’aient un jour à se repentir amèrement d’avoir mis la lumière sous le boisseau. L’expérience que je viens de faire dans ce voyage me démontre que nos livres et nos journaux ne suffisent pas à répandre nos idées. Outre qu’ils ont bien peu d’abonnés, la plupart de ces abonnés ne les lisent pas. J’ai vu le Journal des économistes encore aussi vierge que le jour où il est sorti de chez notre bon Guillaumin, et le Libre-Échange empilé sur les comptoirs, revêtu de sa bande. N’est-ce pas décourageant ? Je pense que l’enseignement oral doit venir en aide à l’enseignement écrit. Parmi les personnes qui assistent à une séance, il y en a toujours quelques-unes qui conçoivent le désir d’étudier la question. Il faudrait organiser des comités dans les villes et ensuite faire constamment voyager des professeurs. Mais combien en avons-nous qui puissent se dévouer à cette œuvre ? Pour moi, je le ferais volontiers, si je pouvais arriver à l’improvisation complète. Je suis tenté d’en faire l’expérience à Bordeaux. Sans cela, on ne peut que bien peu de chose…
à Richard Cobden: Lettre du 15 octobre 1847 (Paris) ↩
BWV
[CW1.83] [OC1] 83. Paris, 15 octobre 1847. A Richard Cobden
Mon cher ami, j’apprends avec bien du plaisir, par les journaux de ce matin, votre retour à Londres. Il y a si longtemps que je n’ai eu de vos nouvelles ! J’espère que vous ne négligerez pas de m’écrire dès que vous serez un peu reposé de vos fatigues, et que vous me parlerez des dispositions que vous avez rencontrées dans le nord de l’Europe, sur notre question.
Ici, le progrès est lent, si même il y a progrès. La crise des subsistances, la crise financière sont venues obscurcir nos doctrines. Il semble que la Providence accumule les difficultés au commencement de notre œuvre et se plaise à la rendre plus difficile. Peut-être entre-t-il dans ses desseins que le triomphe soit chèrement acheté, qu’aucune objection ne reste en arrière, afin que la liberté n’entre dans nos lois qu’après avoir pris possession de l’opinion publique. Aussi je ne regarderai pas les retards, les difficultés, les obstacles, les épreuves comme un malheur pour notre cause. En prolongeant la lutte, elles nous mettent à même d’éclaircir non-seulement la question principale, mais beaucoup de questions accessoires qui sont aussi importantes que la question principale elle-même. Le succès législatif s’éloigne, mais l’opinion mûrit. Je ne me plaindrais donc pas, si nous étions à la hauteur de notre tâche. Mais nous sommes bien faibles. Notre personnel militant se réduit à quatre ou cinq athlètes presque tous fort occupés d’autre chose. Moi-même je manque d’instruction pratique ; mon genre d’esprit, qui est de creuser dans les principes, me rend impropre à discuter, comme il le faudrait, les événements à mesure qu’ils s’accumulent. De plus, les forces intellectuelles m’abandonnent avec les forces physiques. Si je pouvais traiter avec la nature et échanger dix ans de vie souffreteuse contre deux ans de vigueur et de santé, le marché serait bientôt conclu.
De grands obstacles nous viennent aussi de votre côté de la Manche. Mon cher Cobden, il faut que je vous parle en toute franchise. En adoptant le Libre-Echange, l’Angleterre n’a pas adopté la politique qui dérive logiquement du Libre-Échange. Le fera-t-elle ? Je n’en doute pas ; mais quand ? Voilà la question. La position que vous et vos amis prendrez dans le parlement aura une influence immense sur notre entreprise. Si vous désavouez énergiquement votre diplomatie, si vous parvenez à faire réduire vos forces navales, nous serons forts. Sinon, quelle figure ferons-nous devant le public ? Quand nous prédisons que le Libre-Échange entraînera la politique anglaise dans la voie de la justice, de la paix, de l’économie, de l’affranchissement colonial, est-ce que la France est tenue de nous croire sur parole ? Il existe une défiance invétérée contre l’Angleterre, je dirai même un sentiment d’hostilité, aussi ancien que les noms mêmes de Français et d’Anglais. Eh bien, ce sentiment est excusable. Son tort est d’envelopper tous vos partis et tous vos concitoyens dans la même réprobation. Mais les nations ne doivent-elles pas se juger entre elles par leurs actes extérieurs ? On dit souvent qu’il ne faut pas confondre les nations avec leurs gouvernements. Il y a du vrai et du faux dans cette maxime ; et j’ose dire qu’elle est fausse à l’égard des peuples qui ont des moyens constitutionnels de faire prévaloir l’opinion. Considérez que la France n’a pas d’instruction économique. Lors donc qu’elle lit l’histoire, lorsqu’elle y voit les envahissements successifs de l’Angleterre, quand elle étudie les moyens diplomatiques qui ont amené ces envahissements, quand elle voit un système séculaire suivi avec persévérance, soit que les wighs ou les torys tiennent le timon de l’État, quand elle lit dans vos journaux qu’en ce moment l’Angleterre a 34,000 marins à bord des vaisseaux de guerre, comment voulez-vous qu’elle se fie, pour un changement dans votre politique, à la force d’un principe que d’ailleurs elle ne comprend pas ? Il lui faut autre chose ; il lui faut des faits. Rendez donc la liberté commerciale à vos colonies, détruisez votre Acte de navigation, surtout licenciez votre marine militaire, n’en gardez que ce qui est indispensable pour votre sécurité, diminuez ainsi vos charges, vos dettes, soulagez votre population, ne menacez plus les autres peuples et la liberté des mers ; et alors, soyez-en sûrs, la France ouvrira les yeux.
Mon cher Cobden, dans un discours que j’ai prononcé à Lyon, j’ai osé prédire que cette législature, qui a sept ans devant elle, mettrait votre système politique en harmonie avec votre système économique. « Avant sept ans, ai-je dit, l’Angleterre aura diminué ses armées de terre et de mer de moitié. » Ne me faites pas mentir. — Je n’ai rencontré qu’incrédulité. On me blâme de faire le prophète ; on me prend pour un fanatique à vue courte qui ne comprend pas la ruse britannique ; mais moi j’ai confiance dans deux forces, la force de la vérité, et la force de vos vrais intérêts.
Je ne suis pas très-profondément instruit de ce qui se passe à Athènes et à Madrid. Ce que je puis vous dire, c’est que Palmerston et Bulwer inspirent une défiance universelle. Vous me répondrez que si M. Bulwer intrigue à Madrid, M. de Glucksberg en fait autant. Soit. Mais si l’un agit contre l’intérêt de la France, comme l’autre contre l’intérêt de l’Angleterre, il y a néanmoins cette différence que l’Angleterre se vante de connaître ses intérêts. Nous sommes encore dans les vieilles idées. Est-il surprenant que nos actes s’en ressentent ? Mais vous, qui vous êtes défaits des idées, repoussez donc les actes. Désavouez Palmerston et Bulwer. Rien ne servira autant à nous mettre, nous libre-échangistes, dans une excellente position vis-à-vis du public. Il y a plus, je désirerais que vous me dissiez la position que vous comptez prendre dans cette affaire au parlement. Je commencerais à préparer ici l’opinion publique.
Je vous l’avoue, mon cher ami, quoique ennemi de tout charlatanisme, si vous êtes en majorité et en mesure d’inaugurer une politique nouvelle, conforme aux principes du free-trade, je voudrais que vous le fissiez avec quelque éclat et quelque solennité. Je souhaite, si vous diminuez votre marine militaire, que vous rattachiez explicitement cette mesure au free-trade ; que vous proclamiez bien haut que l’Angleterre a fait fausse route, et que son but actuel étant diamétralement opposé à celui qu’elle a poursuivi jusqu’ici, les moyens doivent être opposés aussi.
Je ne vous parle pas des vins. Je vois que votre situation financière ne vous permet pas de grandes réformes fiscales. Mais une modération de droits qui ne nuise pas à vos revenus, est-ce trop demander ? Je désirerais que ce fût vous personnellement qui fissiez cette proposition ; et je vous dirai pourquoi une autre fois. Je n’ai plus de place que pour vous assurer de mon amitié.
à Richard Cobden: Lettre du 9 novembre 1847 (Paris) ↩
BWV
[CW1.84] [OC1] 84. Paris, 9 novembre 1847. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, j’ai lu avec bien de l’intérêt ce que vous me dites de votre voyage, et je compte retirer autant déplaisir que d’instruction des articles que vous vous proposez d’envoyer au Journal des Économistes. M. Say vous a déjà écrit à ce sujet. Il saisit toujours avec empressement l’occasion de donner de la valeur à ce recueil, dont il est le fondateur et le soutien. Votre correspondance est une bonne fortune pour lui. Je vous adjure très-sincèrement d’y consacrer une partie du temps dont vous pourrez disposer. La cause que nous servons ne se renferme pas dans les limites d’une nation. Elle est universelle et ne trouvera sa solution que dans l’adhésion de tous les peuples. Vous ne pouvez donc rien faire de plus utile que d’accroître le mérite et la circulation du Journal des Économistes. Cette revue ne me satisfait pas complétement ; je regrette maintenant de n’en avoir pas pris la direction. Cette propagande philosophique et rationnelle m’eût mieux convenu que la polémique quotidienne.
Les difficultés s’accumulent autour de nous ; nous n’avons pas pour adversaires seulement des intérêts. L’ignorance publique se révèle maintenant dans toute sa triste étendue. En outre, les partis ont besoin de nous abattre. Par un enchaînement de circonstances, qu’il serait trop long de rapporter, ils sont tous contre nous. Tous aspirent au même but : la Tyrannie. Ils ne diffèrent que sur la question de savoir en quelles mains l’arbitraire sera déposé. Aussi, ce qu’ils redoutent le plus, c’est l’esprit de la vraie liberté. Je vous assure, mon cher Cobden, que si j’avais vingt ans de moins et de la santé, je prendrais le bon sens pour ma cuirasse, la vérité pour ma lance, et je me croirais sûr de les vaincre. Mais hélas ! l’âme, malgré sa noble origine, ne peut rien faire sans le corps.
Ce qui m’afflige surtout, moi qui porte au cœur le sentiment démocratique dans toute son universalité, c’est de voir la démocratie française en tête de l’opposition à la liberté du commerce. Cela tient aux idées belliqueuses, à l’exagération de l’honneur national, passions qui semblent reverdir à chaque révolution. 1830 les a manured. Vous me dites que nous nous sommes trop laissé prendre au piége tendu par les protectionnistes, et que nous aurions dû négliger leurs arguments anglophobes. Je crois que vous avez tort. Il est sans doute utile de tuer la protection, mais il est plus utile encore de tuer les haines nationales. Je connais mon pays ; il porte au cœur un sentiment vivace où le vrai se mêle au faux. Il voit l’Angleterre capable d’écraser toutes les marines du monde ; il la sait d’ailleurs dirigée par une oligarchie sans scrupules. Cela lui trouble la vue et l’empêche de comprendre le Libre-Échange. Je dis plus, quand même il le comprendrait, il n’en voudrait pas pour ses avantages purement économiques. Ce qu’il faut lui montrer surtout, c’est que la liberté des échangea fera disparaitre les dangers militaires qu’il redoute. — Pour moi, j’aimerais mieux combattre quelques années de plus et vaincre les préjugés nationaux aussi bien que les préjugés économiques. Je ne suis pas fâché que les protectionnistes aient choisi ce champ de bataille. — Mon intention est de publier, dans notre journal, les débats du parlement et principalement les discours des free-traders.
à Richard Cobden: Lettre du 15 novembre 1847 (Paris)???↩
[????]
Mon ami, je ne vous cacherai pas que je suis effrayé du vide qui se fait autour de nous. Nos adversaires sont pleins d’audace et d’ardeur. Nos amis au contraire se découragent et deviennent indifférents. Que nous sert d’avoir mille fois raison, si nous ne pouvons nous faire entendre ? La tactique des protectionnistes, bien secondés par les journaux, est de nous laisser avoir raison tout seuls.
Articles and Essays↩
Projet de discours libre-échangiste à prononcer à Bayonne [c. 1847] ↩
BWV
1847.?? “Projet de discours libre-échangiste à prononcer à Bayonne” (Plan for a Speech on Free Trade to be given in Bayonne) [no date] [OC7.38, p. 178]
Projet de discours libre-échangiste à prononcer à Bayonne [1]
Messieurs,
Mon intention est de soumettre à votre examen quelques vues générales sur la liberté du commerce. En cela, je m’écarterai des conseils que m’ont donnés mes amis. On m’a dit souvent : « Partout où vous aurez occasion de parler, traitez la question au point de vue des intérêts de vos auditeurs. » Pour moi, je me suis aperçu que ce qui préoccupe la plupart des hommes, dans l’opposition qu’ils font au libre-échange, ce n’est pas autant leurs intérêts privés que l’intérêt général. Cela est vrai surtout dans les villes de commerce. Là on comprend parfaitement que la liberté des échanges en multiplierait le nombre. Plus d’échanges, c’est plus de consignations, de commissions, de transports, de fret, de négociations, de courtages, de magasinages ; c’est plus d’affaires, plus de travail pour toutes les classes de la population. Si, malgré ces avantages évidents, les villes de commerce sont lentes à se rallier à notre cause, il faut bien qu’elles soient retenues par des considérations d’un autre ordre. Elles peuvent se tromper, je crois sincèrement qu’elles se trompent ; mais leur erreur même témoigne hautement qu’elles ne cèdent pas à un sentiment égoïste ainsi qu’on le répète sans cesse.
Si je voulais prendre mes démonstrations dans des circonstances locales, quelle ville pourrait m’en fournir de plus puissantes ? Ces jours-ci je considérais l’Océan de la pointe de Latalaye. Je voyais, à ma droite, la côte de France dans la direction de Bordeaux, et, à ma gauche, la côte d’Espagne jusqu’au cap Saint-Vincent. Je me disais : Est-il possible que cette économie politique soit la vraie qui nous enseigne que tous les échanges que Bayonne fait avec une de ces côtes sont d’une nature différente de ceux qu’elle fait avec l’autre ? Je voyais l’embouchure de la Bidassoa et je me disais : Quoi ! tous les hommes qui vivent sur la rive gauche de ce ruisseau ont avantage à échanger vers le couchant, et ils ne pourront échanger vers le levant sans se nuire à eux-mêmes ! Ce sera précisément le contraire pour ceux qui sont nés sur la rive droite ! Les uns et les autres devront s’estimer heureux que la loi soit venue détruire ces facilités de transactions que la rivière et la mer leur ont préparées ! Me tournant vers l’embouchure de l’Adour, je me disais : Pourquoi n’est-ce pas à cette limite, plutôt qu’à celles de la Bidassoa, que les échanges commencent à devenir funestes ! Quelle est donc cette économie politique qui, comme dit Pascal, est vérité au delà d’un fleuve, et mensonge en deçà ? L’échange n’a-t-il pas une nature qui lui soit propre ? Est-il possible qu’il soit utile ou funeste selon le caprice de ces délimitations arbitraires ? Non, un tel système ne peut être la vérité. L’intelligence humaine ne peut pas accepter à jamais de pareilles inepties.
Cependant, quelque absurde que soit au premier coup d’œil cette économie politique de la restriction, elle s’appuie sur des arguments spécieux, puisqu’enfin elle a prévalu dans les esprits et dans les lois. Je ne puis aujourd’hui réfuter tous ces arguments. Je m’attacherai à un de ceux qui m’ont paru faire le plus d’impression. C’est celui que l’on tire de la supériorité des capitaux anglais. Je choisis ce sujet, parce qu’il me conduira à examiner aussi les fondements de l’opposition que le parti démocratique paraît être décidé à faire à la liberté du commerce.
On dit : « Nous voulons bien lutter contre les autres peuples, mais à armes égales. S’ils nous sont supérieurs, soit par les dons de la nature, soit par l’abondance et le bon marché des capitaux, ils nous écraseront. Ce ne sera plus de la concurrence, ce sera du monopole en leur faveur contre nous. »
Dans ce raisonnement on oublie une chose. C’est l’intérêt du consommateur national. La supériorité de l’étranger, de quelque nature qu’elle soit, se traduit en bon marché du produit, et le bon marché du produit est tout au profit non du peuple vendeur, mais du peuple acheteur. Cela est vrai des capitaux. Si les Anglais se contentent de tirer 2 pour 100 des capitaux engagés dans leurs usines, ou même si ces capitaux sont amortis, ils chargent d’autant moins le prix du produit, circonstance qui profite exclusivement à celui qui l’achète. C’est une des plus belles et des plus fécondes harmonies de l’ordre naturel des sociétés, harmonie dont les protectionistes ne tiennent pas compte, parce qu’ils ne se préoccupent jamais du consommateur, mais seulement du producteur national.
Eh bien ! je veux me placer à leur point de vue et examiner aussi l’intérêt producteur.
À ce point de vue, la supériorité des capitaux étrangers est un désavantage pour nous.
Mais on m’accordera sans doute que ce serait un bien triste et bien absurde remède que celui qui se bornerait à paralyser dans nos mains le peu de capitaux qui s’y trouvent.
Or c’est là ce que fait le régime protecteur.
Nous nous plaignons que la somme de nos capitaux ou le capital national est faible. Et que fait ce régime ? Il nous astreint à en prélever, pour chaque entreprise déterminée, une portion plus grande que celle qui serait nécessaire sous le régime de la liberté.
Qu’un Anglais fonde en Angleterre une fabrique et qu’un Français veuille établir en France une usine parfaitement identique. En dégageant par la pensée ces opérations de toutes autres circonstances, et ne tenant compte que du régime protecteur, comme il faut le faire pour en apprécier les effets, n’est-il pas vrai que le Français sera obligé, à cause de ce régime, de se pourvoir d’un capital fixe plus considérable que celui de l’Anglais, puisqu’il ne peut pas, comme l’Anglais, aller chercher ses machines partout où elles sont à meilleur marché ? N’est-il pas vrai qu’il en sera de même du capital circulant, puisque ce régime a pour effet et même pour but d’élever le prix de toutes les matières premières ? Ainsi vous vous plaignez de ce que le Français éprouve déjà le désavantage de payer son capital à 5 pour 100 quand l’Anglais ne le paye que 3 pour 100 ; et que faites-vous pour compenser ce désavantage ? Vous obligez le Français à emprunter 400,000 francs pour faire ce que l’Anglais fait avec 300,000 !
Il en est de même en agriculture.
Ou ce qu’on appelle protection à l’agriculture n’a aucun effet, ou elle a pour effet d’élever le prix des produits agricoles. Cela posé, j’ai un champ qui me donne en moyenne 100 francs par an nets. Je puis le vendre pour 2,000 francs. Si, par l’effet du régime protecteur, j’en tire 150 francs, je le vendrai 3,000 francs. — Or voyez ici les conséquences du système. Une fois que j’ai vendu mon champ, ce n’est pas l’agriculture, c’est moi capitaliste qui recueille tout le profit. Le nouveau propriétaire n’est pas enrichi par le système ; car, s’il tire 150 francs au lieu de 100, il a payé 3,000 francs au lieu de 2,000. Le fermier n’est pas plus riche non plus, car, s’il vend le blé un peu plus cher, il paye un fermage de 150 au lieu de 400. Et, quant au manouvrier, il paye le pain plus cher, voilà tout. En définitive l’opération se résume ainsi : La loi fait un cadeau de 50 francs de rentes que le public paye sous forme de cherté du pain.
Et maintenant qu’il s’agisse de faire une entreprise agricole. Il est bien clair que l’entrepreneur aura besoin d’un capital plus fort. S’il achète la terre, il faut qu’il la paye 3,000 francs au lieu de 2,000. S’il la prend à bail, il faut qu’il paye 150 au lieu de 100. Il se refera sans doute en rançonnant à son tour le public par le prix du blé. Mais toujours est-il qu’une entreprise identique exige de lui un capital plus considérable. C’est ce que je voulais prouver.
Le commerce n’échappe pas à cette nécessité. J’en ai eu une preuve bien convaincante à Marseille. Un constructeur de navires à vapeur et en fer, qui a obtenu l’autorisation de travailler à l’entrepôt, c’est-à-dire avec des matériaux étrangers, à la charge de réexporter, avait fait un superbe bâtiment. Un acquéreur se présente. Combien voulez-vous de votre navire ? dit-il au constructeur. — De quel pays êtes-vous ? répond celui-ci. — Que vous importe, pourvu que je vous paye en monnaie française ? — Il m’importe que si vous êtes Français, le navire vous coûtera 300,000 francs, si vous êtes Génois, vous l’aurez pour 250,000. — Comment cela se peut-il ? dit l’acquéreur qui était Français. — Oh ! dit le vendeur, vous êtes protégé, c’est un avantage qu’il faut payer. — En conséquence, les Génois naviguent avec des navires de 250,000 francs, et les Français avec des navires de 300,000 francs, tous construits par des Français et en France.
Vous voyez, Messieurs, les résultats de ce système pour toutes nos industries. À supposer, comme on le dit, qu’elles soient dans un état d’infériorité, il ne fait qu’accroître cette infériorité. C’est certes le plus absurde remède qu’on puisse imaginer.
Mais voyons maintenant son effet sur l’ouvrier.
Puisque sur le capital national, il faut prélever une plus grande part pour chaque entreprise industrielle, agricole ou commerciale, le résultat définitif et nécessaire est une diminution dans le nombre des entreprises. Une foule d’entreprises ne se font pas parce qu’un capital national déterminé ne peut faire face à un même nombre d’entreprises, toutes plus dispendieuses, et aussi parce que souvent la convenance cesse. Telle opération qui pouvait présenter du bénéfice avec un capital de 300,000 francs, offre de la perte s’il faut un capital de 400,000 francs.
Or la réduction dans le nombre des entreprises, c’est la réduction dans la demande de la main-d’œuvre ou dans les salaires.
Ainsi ce système a pour les ouvriers deux conséquences aussi tristes l’une que l’autre. D’un côté, il grève d’une cherté factice leurs aliments, leurs vêtements, leurs outils et tous les objets de leur consommation. De l’autre, il répartit le capital national sur un moins grand nombre d’ entreprises, restreint la demande des bras, et déprime ainsi le taux des salaires.
Oui, je le dis et je le répète sans cesse, parce que c’est là ma conviction profonde, la classe ouvrière souffre doublement de ce régime, et c’est la seule à laquelle il n’offre et ne peut offrir aucune compensation.
Aussi un des phénomènes les plus étranges de notre époque, c’est de voir le parti démocratique se prononcer avec aigreur, avec passion, avec colère, avec haine contre la liberté du commerce.
Ce parti fait profession d’aimer la classe ouvrière, de défendre ses intérêts, de poursuivre le redressement des injustices dont elle peut être l’objet. Comment donc se fait-il qu’il soutienne un régime de restrictions et de monopole qui n’est envers les travailleurs, et surtout ceux qui n’ont que leurs bras, qu’un tissu d’iniquités ?
Pour moi, je le dis hautement, j’ai toujours appartenu au parti démocratique. Rien ne s’oppose à ce que je le déclare ici, car, par cela même que notre Association n’arbore aucune couleur politique, elle ne défend à personne d’avouer son drapeau. Si par le triomphe de la démocratie on entend la participation de tous aux charges et aux avantages sociaux, l’impartialité de la loi envers les petits comme envers les grands, envers les pauvres comme envers les riches, le libre jeu, le libre développement laissé aux tendances sociales vers l’égalité des conditions, je suis du parti démocratique. Et je me félicite de pouvoir le dire ici, devant mes compatriotes, dans cette ville où je suis né, où j’ai passé ma jeunesse, parce que s’il m’échappait une parole qui s’écartât de la vérité, cinquante voix s’élèveraient pour me démentir. Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui puisse citer dans toute ma carrière un mot, un acte qui n’ait été inspiré par l’esprit de la démocratie, par le libéralisme le plus avancé ? S’il en est un, qu’il se lève et qu’il me confonde.
Comment donc se fait-il que, lorsque je mets mes forces, tout insuffisantes qu’elles sont, au service d’une liberté, de la plus précieuse des libertés pour l’homme du peuple, de la liberté du travail et de l’échange, je rencontre sur mon chemin le parti démocratique ?
C’est que ce parti se trompe, et ceux qui le mènent le trompent.
Je dis que ceux qui le mènent le trompent, et je m’explique. Loin de moi la pensée que les hommes du parti démocratique manquent en cette circonstance de sincérité. Je ne crois pas qu’il y ait un homme sur la terre moins disposé que moi à imputer des motifs coupables. J’ai assez réfléchi sur les objets qui divisent les hommes pour savoir ce qu’il y a de spécieux dans les opinions les plus diverses ; et dès lors, quand on ne partage pas la mienne, je ne me permets pas de supposer d’autre motif qu’une conviction, selon moi égarée, mais sincère.
Mais lorsqu’un homme me déclare que j’ai raison en principe, et que néanmoins il fait à ce principe une guerre sourde et incessante, alors je me dis : Cet homme s’écarte de toutes les règles de logique et de moralité qui dirigent les actions humaines ; il va au-devant de toutes les interprétations ; il me donne le droit de rechercher le secret mobile qui détermine chez lui un tel excès d’inconséquence avouée.
Cette inconséquence, je l’ai entendu expliquer ainsi et j’avoue que tout mon être répugne à cette explication. On attribuait aux roués du parti démocratique ce calcul odieux :
« Le peuple souffre, et sous le régime restrictif, ses souffrances ne peuvent qu’augmenter. De plus, il ignore la cause de ses souffrances, et nous pouvons facilement tourner sa haine contre ce qui nous déplaît. Il est dans la condition la plus favorable pour devenir en nos mains un instrument de perturbation. Notre rôle est de l’aigrir, et non de l’éclairer. Au contraire, faisons la guerre à ceux qui lui montrent la vérité, la cause et le remède de ses souffrances ; car si elles venaient à s’adoucir, le peuple se rallierait à l’ordre social actuel, et ne se prêterait plus docilement à nos desseins. »
Une perversité aussi machiavélique ne peut germer que dans bien peu de têtes. J’aime mieux examiner l’explication que donnent les démocrates eux-mêmes de leur opposition au libre-échange, tout en reconnaissant que c’est un principe de vérité et de justice.
Quand je leur ai demandé les motifs de leur opposition, ils m’ont répondu : D’abord, le Gouvernement favorise votre entreprise. Ensuite, le libre-échange, par ses tendances pacifiques, interromprait la grande mission de la France qui est de propager en Europe l’idée démocratique, au besoin par les armes.
Quant au premier motif, je déclare de la manière la plus formelle que l’Association du libre-échange n’a eu avec le Gouvernement aucune communication, si ce n’est pour obtenir l’autorisation exigée par la loi. Pour ce qui me regarde, je n’ai jamais vu M. Guizot ni M. Duchatel. Un discours de M. Guizot me fait présumer qu’il a le sentiment confus qu’en matière d’échanges, la liberté vaut mieux que la restriction. M. Duchatel, avant d’être ministre, a fait une brochure où les vrais principes économiques sont exposés avec une grande clarté. Mais quoi ! sommes-nous tenus de repousser une liberté précieuse parce que M. Duchatel a écrit, dans sa jeunesse, une brochure en sa faveur ?
Et quand il serait vrai que les secrètes sympathies du Ministère fussent pour nous, quand il serait vrai que, fatigués des exigences, des obsessions des protectionistes, les Ministres songeassent à décharger le Gouvernement du joug que le système restrictif fait peser sur lui, devrions-nous pour cela défendre ce système ? Je sais bien que c’est ainsi que raisonnent les partis : Entravons la marche du Gouvernement, ruat cœlum. Jamais je ne m’associerai à cette tactique. Où est le vrai, l’honnête, le juste, le bien et le bon, c’est de ce côté que je me porte, sans examiner si le Gouvernement est pour ou contre. Ergoter contre la vérité uniquement parce que le Gouvernement s’est mis de son côté, c’est fausser sciemment l’esprit public ; et j’ai la confiance qu’un des bienfaits accessoires de notre Association sera de discréditer ce genre d’opposition immorale et dangereuse. Vous ne voulez pas du Ministère, c’est sans doute que vous le croyez mauvais. S’il est mauvais, il est vulnérable ; attaquez-le par là, soit. Mais le combattre sur le terrain de la justice et de la vérité, quand par hasard il s’est placé sur ce terrain, et cela en vous plaçant vous-même sur le terrain de l’injustice et du mensonge, ce n’est plus esprit d’opposition, c’est esprit de faction.
Le parti contre lequel je me défends ici se fonde encore sur ce que la France a pour mission de répandre l’idée démocratique par les armes. J’aime à croire que ce n’est pas là la pensée de la démocratie française, mais de quelques meneurs qui se sont faits ses infidèles organes.
Pour moi, je crois que la doctrine la plus consciencieuse n a qu’un droit, celui de combattre par la parole, de vaincre par la persuasion, de se propager par l’exemple. L’infaillibilité elle-même aurait tort de recourir à la violence. Quand le christianisme voulut s’imposer aux consciences par le déploiement de la force brutale, se fondant sur ce que lui seul possédait la vérité, que lui disait la philosophie ? « Si vous possédez la vérité, prouvez-le. C’est une puissance assez grande pour que vous n’y ajoutiez pas celle des armes. » Faut-il maintenant tenir le même langage à la démocratie ? faut-il lui dire : « Si vous avez la vérité, prouvez-le. Montrez-le au monde par votre exemple. Que la France soit le pays le mieux ordonné, le mieux gouverné, le plus éclairé, le plus moral, le plus heureux de la terre, et pour faire de la propagande, vous n’aurez qu’à ouvrir vos ports et vos frontières, afin que chacun vienne contempler parmi vous les miracles de la liberté. »
« Croyez-vous hâter le triomphe de la démocratie en vous montrant toujours prêt à fondre sur le monde, le cimeterre d’une main et votre Koran de l’autre ? Si les autres peuples sont dans Terreur, l’erreur périt-elle sous le sabre et la baïonnette ? Ne craignez-vous pas qu’ils ne finissent par se dire : « Cette nation prétend avoir reçu du ciel la mission de convertir toutes les autres à la vraie foi politique, qui est la fraternité et voyez : elle transforme ses laboureurs en soldats, ses charrues en épées, ses navires marchands en vaisseaux de guerre ; elle hérisse le sol d’arsenaux, de casernes et de citadelles ; elle gémit sous le poids des taxes, elle a remis toutes ses forces vives entre les mains de quelques chefs d’armée, ah ! gardons-nous de l’imiter ! »
Puisque je suis sur ce sujet, je vous demanderai la permission de montrer l’intime connexité qu’il y a d’un côté entre le régime restrictif et l’esprit de guerre, de l’autre entre le libre-échange et l’esprit de paix. C’est le côté le plus important et peut-être le moins compris de notre belle cause. Je suis forcé de recourir à une dissertation économique, car ce n’est pas aux passions, ni même au sentiment que je m’adresse, mais à la conviction.
Deux systèmes économiques sont en présence.
L’un, celui qui domine dans les législations et dans les intelligences, fait consister le progrès dans l’excédant des ventes sur les achats, dans l’excédant des exportations sur les importations, en un mot dans ce qu’on a appelé la balance du commerce.
L’autre, celui que nous nous efforçons de propager, en est justement le contre-pied. Il ne voit dans ce qu’un peuple exporte que le payement de ce qu’il importe. À nos yeux, l’essentiel, c’est que chaque payement, le moindre possible, réponde à la plus grande somme possible d’importations ; et voilà pourquoi notre maxime est : Laissez à chacun la faculté d’aller acheter là où les produits sont à meilleur marché, et vendre là où ils sont le plus chers ; car évidemment c’est le moyen de donner le moins pour recevoir le plus possible.
C’est, du reste, sur ce dernier principe, que tous les hommes agissent naturellement et instinctivement, quand la loi ne vient pas les contrarier.
Je ne rechercherai pas lequel de ces deux systèmes diamétralement opposés est dans la vérité économique, je me bornerai à montrer leur relation avec l’esprit de guerre et l’esprit de paix, quel est celui qui renferme un levain d’universel antagonisme, et celui qui contient le germe de la fraternité humaine.
Le premier, ai-je dit, se résume ainsi : importer peu ; exporter beaucoup.
Pour atteindre l’un de ces résultats, importer peu, il a les lois restrictives. Il charge des corps armés, sous le nom de douaniers, de repousser les produits étrangers ; et si ce système est bon, nous ne pouvons pas trouver surprenant ni même mauvais que chaque nation en fasse autant.
Reste le complément du système : exporter beaucoup. La chose n’est pas facile. Puisque chaque peuple est occupé de repousser les importations, comment chacun parviendra-t-il à beaucoup exporter ? Il est bien clair que ce qui est exportation pour l’un est importation pour l’autre, et si personne ne veut acheter, il n’y a de vente possible pour personne.
Remarquez que c’est bien là de l’antagonisme, car ne faut-il pas donner ce nom à un ensemble d’efforts qui se font partout en même temps en sens opposé, chacun voyant un bien pour lui, dans la chose même que tous considèrent comme un mal pour eux ? Vous voyez qu’au fond de ce système, il y a cette fameuse et triste maxime : Le profit de l’un est le dommage de l’autre.
Cependant, il faut exporter, c’est la condition du progrès. Mais comment faire, puisque personne ne veut recevoir ? Il n’y a qu’un moyen, la force. Il ne s’agit que de conquérir des consommateurs. Ce système pousse donc logiquement à l’usurpation, à la conquête ; et remarquez qu’il y pousse tous les peuples à la fois.
En définitive, c’est le droit du plus fort ou du plus rusé. La politique des peuples est toute tracée. Emparons-nous d’une île, puis d’une seconde, puis d’une troisième, puis d’un continent, et, en même temps, forçons les habitants à consommer exclusivement nos produits.
Voila le monde, Messieurs, sous le régime prohibitif, si on le suppose conséquent avec lui-même, et il faut que j’aie le jugement bien faussé si ce système n’implique pas que la guerre est l’état naturel de l’homme.
On me dira sans doute : « Mais le monde est sous l’empire du régime restrictif, et cependant nous ne le voyons pas en proie à une guerre universelle. Il vient de traverser quarante années de paix. »
Oui ; mais pourquoi ? Parce que tous les peuples ne peuvent pas être à la fois les plus forts. Il y en a un à qui la prédominance reste. Celui-là s’empare de tout ce dont il peut s’emparer sans trop de danger ; il étend ses conquêtes en Asie, en Afrique, en Amérique, dans les archipels de la Méditerranée comme dans les archipels du grand Océan. Quant aux autres, qu’ils ne se fassent pas illusion, ce n’est pas l’envie qui leur manque, c’est la force. L’Espagne et le Portugal n’ont-ils pas étendu leur domination autant qu’ils l’ont pu ? La Hollande n’a-t-elle pas disputé à l’Angleterre l’Inde, Ceylan et le cap de Bonne-Espérance ? Nous-mêmes, est-ce volontairement que nous sommes réduits à la Martinique et à Bourbon ? que nous avons cédé le Canada, l’île de France et Calcutta ? que nous avons perdu Saint-Domingue ? N’envahissons-nous pas en ce moment le nord de l’Afrique ? Dans ce sens, chaque peuple fait tout ce qu’il peut, voilà la vérité ; s’il obéit à la pensée du régime restrictif, il est conquérant par nature, et s’il s’arrête, sa prétendue modération est de l’impuissance, pas autre chose.
Ainsi, Messieurs, vous voyez que le régime prohibitif, ce régime fondé sur la doctrine de la balance du commerce, ce régime qui voit le bien dans l’excédant des exportations, mène logiquement à l’abus de la force, à la violence, à l’usurpation, et à tout le machiavélisme diplomatique, qui est la ruse des nations mise au service de leur injustice. Prépondérance, prépotence, suprématie, voilà les grands mots sous lesquels chacun cache sa perversité ; et ce qu’il faut bien observer, c’est que si ce système est vrai, l’esprit de haine, de jalousie, d’antagonisme et de domination est indestructible, puisqu’il a sa racine dans la vérité même.
Mais que la doctrine opposée vienne à triompher dans les esprits, que chaque peuple, se considérant comme un être collectif, adopte le raisonnement de l’individu et se dise : Mon avantage est dans la quantité de ce que je reçois, et non dans la quantité de ce que je donne, en d’autres termes, mon avantage est d’acheter à bon marché et de vendre cher, en d’autres termes encore, mon avantage est de laisser faire mes négociants et d’affranchir les échanges ; à l’instant les conséquences changent du tout au tout, comme le principe change du tout au tout. À l’instant ce qui était considéré comme un mal, à savoir l’importation est regardé comme un bien, et le payement que l’on prenait pour le beau côté n’est plus vu que comme le côté désavantageux de l’échange. L’effort de chaque peuple se fait en sens inverse, et au lieu de lutter pour imposer ses produits, il n’a plus d’autre émulation que celle d’ouvrir au plus tôt ses ports et ses frontières aux produits des autres peuples. — Et cela, sans s’inquiéter de l’exportation ou du payement, dont nos fournisseurs s’occuperont pour eux-mêmes. Il est clair que dans ce système l’usurpation, la domination, les colonies, et par suite la force brutale et la ruse diplomatique sont frappées d’inutilité. Il ne faut pas un si grand appareil pour importer. Mais si chaque peuple s’abstient de menacer les autres, non par générosité, mais pour obéir à son intérêt, quel immense changement est introduit dans le monde ! Je ne crains pas de dire que l’adhésion des peuples à notre doctrine sera la plus grande, la plus bienfaisante révolution dont le monde ait été témoin depuis dix-huit siècles.
C’est dans le mois où nous sommes et presque à pareil jour que Christophe Colomb découvrit le nouveau monde [2], et c’est de cette découverte que datent le régime prohibitif ainsi que les guerres et les dissensions qui en ont été la suite ; car ce faux principe était comme enveloppé dans l’or de l’Amérique. Messieurs, signalons aux peuples, dans l’ordre moral, un monde nouveau, un monde de paix, d’harmonie, de bien-être et de fraternité.
Sachons toutefois que cette immense révolution ne sera pas le fruit du libre-échange seulement, mais aussi et surtout de l’esprit du libre-échange. — Le libre-échange pourrait être obtenu par surprise, par un engouement momentané de l’opinion publique, en dehors de convictions générales et bien arrêtées. Il pourrait aussi s’introduire dans la législation sous la pression de circonstances extraordinaires. Mais alors l’esprit du monopole survivrait au monopole. Le principe exclusif dominerait encore les intelligences et menacerait le monde d’autant de maux que s’il régnait encore dans nos lois. Je n’en veux pour preuve que ce qui se passe en Angleterre.
Vous le savez, la Ligue s’efforçait d’étendre dans les trois royaumes l’esprit du libre-échange, mais son œuvre était loin d’être achevée, lorsqu’une maladie mystérieuse, dans le règne végétal, anéantit une grande partie des subsistances du peuple. L’aristocratie cédant, non à la persuasion, mais à la nécessité, se décida à ouvrir les ports, ce qui arracha à Cobden cette réflexion juste et triste : « C’est une chose humiliante et bien propre à rabaisser l’orgueil de l’homme qu’une tache noire sur la plus humble des racines alimentaires ait plus fait pour la liberté du commerce que nos sept années d’efforts, de dévouement et de sacrifices. »
Aussi qu’est-il arrivé ? Une chose à laquelle on devait s’attendre : c’est que l’esprit du monopole qui, au Parlement, a cédé sur un point et sans conviction à l’empire de la nécessité, n’en dirige pas moins la politique de la Grande-Bretagne [3].
FN:C’est au sortir de Marseille (voir t. II, p. 293 et suiv.) que l’auteur eut l’idée de visiter sa ville natale, et d’y prendre la parole en faveur de la liberté d’échanger. J’ignore pourquoi ce projet ne fut pas exécuté. (Note de l’édit.)
FN:Le 5 septembre 1492. (Note de l’édit.)
FN:Ici s’arrête le manuscrit du discours projeté. Quelques notes qui y sont jointes indiquent comment l’auteur entendait le terminer. Il devait exposer que l’esprit de liberté et l’esprit d’oppression se livreraient encore plus d’un combat au Parlement ; que le parti libéral y était devenu plus fort depuis les dernières élections ; que ce parti, d’après ses actes anciens et récents, méritait la confiance et la sympathie de la France. En d’autres termes, il devait développer devant le public de Bayonne la même idée qu’on trouve dans quelques-uns de ses écrits, notamment t. III, p. 459, et au présent volume, dans l’ébauche intitulée et anglomanie, anglophobie.(Note de l’édit.)
Le profit de l'un est le dommage de l'autre [89](c. 1847)[CW3 ES3.15]↩
BWV
1847.?? "Le profit de l'un est le dommage de l'autre" (One Man’s gain is another Man’s Loss) [c. 1847] [OC7.75, p. 327-28] [CW3] or[ES3.15]
Sophisme type, sophisme souche, d’où sortent des multitudes de sophismes, sophisme polype, qu’on ne peut couper en mille que pour donner naissance à mille sophismes, sophisme anti humain, anti-chrétien, anti-logique ; boîte de Pandore d’où sont sortis tous les maux de l’humanité, haines, défiances, jalousies, guerres, conquêtes, oppressions ; mais d’où ne pouvait sortir l’espérance.
Hercule ! qui étranglas Cacus, Thésée ! qui assommas le Minotaure, Apollon ! qui tuas le serpent Python, que chacun de vous me prête sa force, sa massue, ses flèches pour détruire le monstre qui, depuis six mille ans, arme les hommes les uns contre les autres.
Mais, hélas ! il n’est pas de massue qui puisse écraser un sophisme. Il n’est donné à la flèche ni même à la baïonnette de percer une proposition. Tous les canons de l’Europe réunis à Waterloo n’ont pu effacer du cœur des peuples un principe ; et ils n’effaceraient pas davantage une erreur. Cela n’est réservé qu’à la moins matérielle de toutes les armes, à ce symbole de légèreté, la plume.
Donc ce ne sont ni les dieux ni les demi-dieux de l’antiquité qu’il faut invoquer.
Si je voulais parler au cœur, je m’inspirerais du fondateur de la religion chrétienne. — Puisque c’est à l’esprit que je m’adresse et qu’il s’agit d’essayer une démonstration, je me place sous l’invocation d’Euclide et de Bezout, tout en appelant à mon aide les Turgot, les Say, les Tracy, les Ch. Comte. On dira « c’est bien froid ». Qu’importe, pourvu que la démonstration se fasse……
La peur d'un mot [The Fear of a Word] [June 20, 1847] [CW3 ES3.13]↩
BWV
1847.06.20 “La peur d'un mot” (The Fear of a Word), Le Libre-Échange, 20 June, 1847, no. 30, pp. 239-40. [OC2.59, pp. 392-400] [CW3] [ES3.13]
I
Un Économiste. Il est assez singulier que le Français, si plein de courage et même de témérité, qui n’a peur ni de l’épée, ni du canon, ni des revenants, ni guère du diable, se laisse quelquefois terrifier par un mot. Morbleu, j’en veux faire l’expérience. (Il s’approche d’un artisan et dit en grossissant la voix : Libre-Échange !)
L’artisan (tout effaré) : Ciel ! vous m’avez épouvanté. Comment pouvez-vous prononcer ce gros mot ?
— Et quelle idée, s’il vous plaît, y attachez-vous ?
— Aucune ; mais il est certain que ce doit être une horrible chose. Un gros monsieur vient souvent dans nos quartiers, disant : Sauve qui peut ! le libre-échange va arriver. Ah ! si vous entendiez sa voix sépulcrale ! tenez, j’en ai encore la chair de poule.
— Et le gros monsieur ne vous dit pas de quoi il s’agit ?
— Non, mais c’est assurément de quelque invention diabolique, pire que la poudre-coton ou la machine Fieschi, — ou bien de quelque bête fauve récemment trouvée dans l’Atlas, et tenant le milieu entre le tigre et le chacal, — ou encore de quelque terrible épidémie, comme le choléra asiatique.
— À moins que ce ne soit de quelqu’un de ces monstres imaginaires dont on a fait peur aux enfants, Barbe-Bleue, Gargantua ou Croquemitaine.
— Vous riez ? Eh bien ! si vous le savez, dites-moi ce que c’est que le libre-échange.
— Mon ami, c’est l’échange libre.
— Ah ! bah ! rien que cela ?
— Pas autre chose ; le droit de troquer librement nos services entre nous.
— Ainsi, libre-échange et échange libre, c’est blanc bonnet et bonnet blanc ?
— Exactement.
— Eh bien ! tout de même, j’aime mieux échange libre. Je ne sais si c’est un effet de l’habitude, mais libre-échange me fait encore peur. Mais pourquoi le gros monsieur ne nous a-t-il pas dit ce que vous me dites ?
— C’est, voyez-vous, qu’il s’agit d’une discussion assez singulière entre des gens qui veulent la liberté pour tout le monde et d’autres qui la veulent aussi pour tout le monde, excepté pour leurs pratiques. Peut-être le gros monsieur est-il du nombre de ces derniers.
— En tout cas, il peut se vanter de m’avoir fait une fière peur, et je vois bien que j’ai été dupe comme le fut feu mon grand-père.
— Est-ce que feu votre grand-père avait pris aussi le libre-échange pour un dragon à trois têtes ?
— Il m’a souvent conté que dans sa jeunesse on avait réussi à l’exalter beaucoup contre une certaine madame Véto. Il se trouva que c’était une loi qu’il avait prise pour une ogresse.
— Cela prouve que le peuple a encore bien des choses à apprendre, et qu’en attendant qu’il les sache il ne manque pas de personnes, comme votre gros monsieur, disposées à abuser de sa crédulité. [90]
— En sorte donc que tout se réduit à savoir si chacun a le droit de faire ses affaires, ou si ce droit est subordonné aux convenances du gros monsieur ?
— Oui ; la question est de savoir si, subissant la concurrence dans vos ventes, vous ne devez pas en profiter dans vos achats.
— Voudriez-vous m’éclaircir un peu plus la chose ?
— Volontiers. Quand vous faites des souliers, quel est votre but ?
— De gagner quelques écus.
— Et si l’on vous défendait de dépenser ces écus, que feriez-vous ?
— Je cesserais de faire des souliers.
— Votre vrai but n’est donc pas de gagner des écus ?
— Il va sans dire que je ne recherche les écus qu’à cause de ce que je puis me procurer avec : du pain, du vin, un logis, une blouse, un paroissien, une école pour mon fils, un trousseau pour ma fille, et de belles robes pour ma femme. [91]
— Fort bien. Négligeons donc les écus pour un instant, et disons, pour abréger, que lorsque vous faites des souliers c’est pour avoir du pain, du vin, etc. Mais alors pourquoi ne faites-vous pas vous-même ce pain, ce vin, ce paroissien, ces robes ?
— Miséricorde ! pour faire seulement une page de ce paroissien, ma vie entière ne suffirait pas.
— Ainsi, quoique votre état soit bien modeste, il met en votre pouvoir mille fois plus de choses que vous n’en pourriez faire vous-même. [92]
— C’est assez plaisant, surtout quand je songe qu’il en est ainsi de tous les états. Pourtant, comme vous dites, le mien n’est pas des meilleurs, et j’en aimerais mieux un autre, celui d’évêque, par exemple.
— Soit. Mais mieux vaut encore être cordonnier et échanger des souliers contre du pain, du vin, des robes, etc., que de vouloir faire toutes ces choses. Gardez donc votre état, et tâchez d’en tirer le meilleur parti possible.
— J’y fais de mon mieux. Le malheur est que j’ai des concurrents qui me rabattent le caquet. Ah ! si j’étais le seul cordonnier de Paris seulement pendant dix ans, je n’envierais pas le sort du roi, et je ferais joliment la loi à la pratique.
— Mais, mon ami, les autres en disent autant ; et s’il n’y avait qu’un laboureur, un forgeron et un tailleur dans le monde, ils vous feraient joliment la loi aussi. Puisque vous subissez la concurrence, quel est votre intérêt ?
— Eh parbleu ! que ceux à qui j’achète mon pain et mes habits la subissent comme moi.
— Car si le tailleur de la rue Saint-Denis est trop exigeant…
— Je m’adresse à celui de la rue Saint-Martin.
— Et si celui de la rue Saint-Denis obtenait une loi qui vous forçât d’aller à lui ?
— Je le traiterais de…
— Doucement ; ne m’avez-vous pas dit que vous avez un paroissien ?
— Le paroissien ne dit pas que je ne doive pas profiter de la concurrence, puisque je la subis.
— Non ; mais il dit qu’il ne faut maltraiter personne et qu’il faut toujours se croire le plus pécheur de tous les pécheurs.
— Je l’ai lu bien souvent. Et, tout de même, j’ai peine à me croire plus malhonnête homme qu’un fripon.
— Croyez toujours, la foi nous sauve. Bref, il vous paraît que la concurrence doit être la loi de tous ou de personne ?
— Justement.
— Et vous avez reconnu qu’il est impossible d’y soustraire tout le monde ?
— Bien évidemment, à moins de ne laisser qu’un homme dans chaque métier.
— Donc, il faut n’y soustraire personne.
— Cela va tout seul. À chacun liberté de vendre, acheter, marchander, troquer, échanger, — honnêtement néanmoins.
— Eh ! mon ami, c’est ce qui s’appelle libre-échange.
— Pas plus malin que cela ?
— Pas plus malin que cela. (À part : En voilà un de converti.)
— En ce cas, vous pouvez déguerpir et me laisser tranquille avec votre libre-échange. Nous en jouissons complétement. Me donne sa pratique qui veut, et je donne la mienne à qui il me plaît.
— C’est ce qu’il nous reste à voir.
II
— Ah ! monsieur l’éconi… l’écona… l’éconé… comment diable s’appelle votre métier ?
— Vous voulez dire économiste.
— Oui, économiste. En voilà un drôle de métier ! Je gage qu’il rapporte plus que celui de cordonnier ; mais aussi, je lis quelquefois des gazettes où vous êtes joliment habillé ! Quoi qu’il en soit, vous faites bien de venir un dimanche. L’autre jour vous m’avez fait perdre un quart de journée, avec vos échanges.
— Cela se retrouvera. Mais en effet, vous voilà tout endimanché. Dieu ! le bel habit ! L’étoffe en est moelleuse. Où l’avez-vous prise ?
— Chez le marchand.
— Oui ; mais d’où le marchand l’a-t-il tirée ?
— De la fabrique, sans doute.
— Et je suis sûr qu’il a fait un profit dessus. Pourquoi n’êtes-vous pas allé vous-même à la fabrique ?
— C’est trop loin, ou, pour mieux dire, je ne sais où cela est, et n’ai pas le temps de m’en informer.
— Vous vous adressez donc aux marchands ? On dit que ce sont des parasites qui vendent plus cher qu’ils n’achètent, et ont l’audace de se faire payer leurs services.
— Cela m’a toujours paru fort dur ; car enfin, ils ne façonnent pas le drap comme je fais le cuir ; tel qu’ils l’ont acheté, ils me le vendent ; quel droit ont-ils de bénéficier ?
— Aucun. Ils n’ont que celui de vous laisser aller chercher votre drap à Mazamet et vos cuirs à Buenos-Ayres.
— Comme je lis quelquefois la Démocratie pacifique, j’ai pris en horreur les marchands, ces intermédiaires, ces agioteurs, ces accapareurs, ces brocanteurs, ces parasites, et j’ai bien souvent essayé de m’en passer.
— Eh bien ?
— Eh bien ! je ne sais comment cela se fait, mais cela a toujours mal tourné. J’ai eu de mauvaise marchandise, ou elle ne me convenait pas, ou l’on m’en faisait prendre trop à la fois, ou je ne pouvais choisir ; j’en étais pour beaucoup de frais, de ports de lettres, de temps perdu ; et ma femme, qui a bonne tête, celle-là, et qui veut ce qu’elle veut, m’a dit : Jacques, fais des souliers. [93]
— Et elle a eu raison. En sorte que vos échanges se faisant par l’intermédiaire des marchands et négociants, vous ne savez pas même de quel pays sont venus le blé qui vous nourrit, le charbon qui vous chauffe, le cuir dont vous faites des souliers, les clous dont vous les cuirassez, et le marteau qui les enfonce.
— Ma foi, je ne m’en soucie guère, pourvu qu’ils arrivent.
— D’autres s’en soucient pour vous ; n’est-il pas juste qu’ils soient payés de leur temps et de leurs soins ?
— Oui, mais il ne faut pas qu’ils gagnent trop.
— Vous n’avez pas cela à craindre. Ne se font-ils pas aussi concurrence entre eux ?
— Ah ! je n’y pensais pas.
— Vous me disiez l’autre jour que les échanges sont parfaitement libres. Ne faisant pas les vôtres par vous-même, vous ne pouvez le savoir.
— Est-ce que ceux qui les font pour moi ne sont pas libres ?
— Je ne le crois pas. Souvent, en les empêchant d’aller dans un marché où les choses sont à bas prix, on les oblige à aller dans un autre où elles sont chères.
— C’est une horrible injustice qu’on leur fait là !
— Point du tout ; c’est à vous qu’on fait l’injustice, car ce qu’ils ont acheté cher, ils ne peuvent vous le vendre à bon marché.
— Contez-moi cela, je vous prie.
— Le voici. Quelquefois, le drap est cher en France et à bon marché en Belgique. Le marchand qui cherche du drap pour vous va naturellement là où il y en a à bas prix. S’il était libre, voici ce qui arriverait. Il emporterait, par exemple, trois paires de souliers de votre façon, contre lesquels le Belge lui donnerait assez de drap pour vous faire une redingote. Mais il ne le fait pas, sachant qu’il rencontrerait à la frontière un douanier qui lui crierait : Défendu ! Donc le marchand s’adresse à vous et vous demande une quatrième paire de souliers, parce qu’il en faut quatre paires pour obtenir la même quantité de drap français.
— Voyez-la ruse ! Et qui a aposté là ce douanier ?
— Qui pourrait-ce être, sinon le fabricant de drap français ?
— Et quelle est sa raison ?
— C’est qu’il n’aime pas la concurrence.
— Oh ! morguienne, je ne l’aime pas non plus, et il faut bien que je la subisse.
— C’est ce qui nous fait dire que les échanges ne sont pas libres.
— Je pensais que cela regardait les marchands.
— Cela vous regarde, vous, puisqu’en définitive c’est vous qui donnez quatre paires de souliers au lieu de trois pour avoir une redingote.
— C’est fâcheux ; mais cela vaut-il la peine de faire tant de bruit ?
— La même opération se répète pour presque tout ce que vous achetez ; pour le blé, pour la viande, pour le cuir, pour le fer, pour le sucre, en sorte que vous n’avez pour quatre paires de souliers que ce que vous pourriez avoir pour deux.
— Il y a du louche là-dessous. Tout de même, je remarque, d’après ce que vous dites, que les seuls concurrents dont on se débarrasse sont des étrangers.
— C’est vrai.
— Eh bien ! il n’y a que moitié mal ; car, voyez-vous, je suis patriote comme tous les diables.
— À votre aise. Mais remarquez bien ceci : ce n’est pas l’étranger qui perd deux paires de souliers ; c’est vous, et vous êtes Français !
— Je m’en vante !
— Et puis, ne disiez-vous pas que la concurrence doit être pour tous ou pour personne ?
— Ce serait de toute justice.
— Cependant M. Sakoski est étranger, et nul ne l’empêche d’être votre concurrent.
— Et un rude concurrent encore. Comme ça vous trousse une botte !
— Difficile à parer, n’est-ce pas ? Mais puisque la loi laisse nos fashionables choisir entre vos bottes et celles d’un Allemand, pourquoi ne vous laisserait-elle pas choisir entre du drap français et du drap belge ?
— Que faut-il donc faire ?
— D’abord, n’avoir pas peur du libre-échange.
— Dites l’échange libre, c’est moins effrayant. Et ensuite ?
— Ensuite, vous l’avez dit : demander liberté pour tous ou protection pour tous.
— Et comment diable voulez-vous que la douane protége un avocat, un médecin, un artiste, un pauvre ouvrier ?
— C’est parce qu’elle ne le peut pas qu’elle ne doit protéger personne ; car favoriser les ventes de l’un, c’est nécessairement grever les achats de l’autre. [94]
Midi à quatorze heures [Making a Mountain out of a Mole Hill] [c. 1847] [CW3 ES3.16]↩
BWV
1847.?? “Midi à quatorze heures” (Making a Mountain out of a Mole Hill) [an unpublished outline from 1847] [OC2.60, pp. 400-09] [CW3] [ES3.16]
1847
(Ébauche inédite)
On a fait de l’économie politique une science pleine de subtilités et de mystères. Rien ne s’y passe naturellement. On la dédaigne, on la persifle aussitôt qu’elle s’avise de donner à un phénomène simple une explication simple.
— Le Portugal est pauvre, dit-on ; d’où cela vient-il ?
— De ce que les Portugais sont inertes, paresseux, imprévoyants, mal administrés, répond-elle.
— Non, réplique-t-on, c’est l’échange qui fait tout le mal ; — c’est le traité de Méthuen, l’invasion des draps anglais à bon marché, l’épuisement du numéraire, etc.
Puis on ajoute : Les Anglais travaillent beaucoup, et cependant il y a beaucoup de pauvres parmi eux ; comment cela se peut-il ?
— Parce que, répond-elle naïvement, ce qu’ils gagnent par le travail on le leur prend par l’impôt. On le distribue à des colonels, à des commodores, à des gouverneurs, à des diplomates. On va faire au loin des acquisitions de territoire, qui coûtent beaucoup à obtenir et plus à conserver. Or ce qui est gagné une fois ne peut être dépensé deux ; et ce que l’Anglais met à satisfaire sa gloriole, il ne le peut consacrer à satisfaire ses besoins réels.
— Quelle explication misérable et terre à terre ! s’écrie-t-on. Ce sont les colonies qui enrichissent l’Angleterre.
— Vous disiez tout à l’heure qu’elle était pauvre, quoiqu’elle travaillât beaucoup.
— Les travailleurs anglais sont pauvres, mais l’Angleterre est riche.
— C’est cela : le travail produit, la politique détruit ; et voilà pourquoi le travail n’a pas sa récompense.
— Mais c’est la politique qui provoque le travail, en lui donnant les colonies pour tributaires.
— C’est au contraire à ses dépens que sont fondées les colonies ; et c’est parce qu’il sert à cela qu’il ne sert pas à nourrir, vêtir, instruire et moraliser le travailleur.
— Mais voici un peuple qui est laborieux et n’a pas de colonies. Selon vous, il doit s’enrichir.
— C’est probable.
— Eh bien ! cela n’est pas. Tirez-vous de là.
— Voyons, dit-elle : peut-être que ce peuple est imprévoyant et prodigue. Peut-être est-ce sa manie de convertir tous ses revenus en fêtes, jeux, bals, spectacles, brillants costumes, objets de luxe, fortifications, parades militaires ?
— Quelle hérésie ! quand c’est le luxe qui enrichit les nations… Cependant ce peuple souffre. Comment n’a-t-il pas seulement du pain à discrétion ?…
— Sans doute que la récolte a manqué.
— C’est vrai. Mais les hommes n’ont-ils pas le droit de vivre ? D’ailleurs, ne peut-on pas faire venir des aliments du dehors ?
— Peut-être que ce peuple a fait des lois qui s’y opposent.
— C’est encore vrai. Mais n’a-t-il pas bien fait, pour encourager la production des aliments au dedans ?
— Quand il n’y a pas de vivres dans le pays, il faut pourtant bien choisir entre s’en passer ou en faire venir.
— Est-ce là tout ce que vous avez à nous apprendre ? Ne sauriez-vous suggérer à l’État une meilleure solution du problème ?…
Ainsi toujours on veut donner des explications compliquées aux faits les plus simples, et l’on ne se croit savant qu’à la condition d’aller chercher midi à quatorze heures.
Les faits économiques agissant et réagissant les uns sur les autres, effets et causes tour à tour, présentent, il faut en convenir, une complication incontestable. Mais, quant aux lois générales qui gouvernent ces faits, elles sont d’une simplicité admirable, d’une simplicité telle qu’elle embarrasse quelquefois celui qui se charge de les exposer ; car le public est ainsi fait, qu’il se défie autant de ce qui est simple qu’il se fatigue de ce qui ne l’est pas. Lui montrez-vous que le travail, l’ordre, l’épargne, la liberté, la sécurité sont les sources des richesses, — que la paresse, la dissipation, les folles entreprises, les guerres, les atteintes à la propriété, ruinent les nations ; il hausse les épaules, en disant : « Ce n’est que cela ! C’est là l’économie des sociétés !… La plus humble des ménagères se gouverne d’après ces principes. Il n’est pas possible que de telles trivialités soient la base d’une science ; et je vais la chercher ailleurs. Parlez-moi de Fourier.
On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé ;
mais il y a dans ses pivots, ses arômes, ses gammes, ses passions en ton majeur et mineur, ses papillonnes, ses postfaces, cisfaces et transfaces, quelque chose qui ressemble au moins à un appareil scientifique. »
Cependant, à beaucoup d’égards, les besoins, le travail, la prévoyance collective, ressemblent aux besoins, au travail, à la prévoyance individuels.
Donc une question économique nous embarrasse-t-elle, allons observer Robinson dans son île, et nous obtiendrons la solution.
S’agit-il de comparer la liberté à la restriction ?
De savoir ce que c’est que travail et capital ?
De rechercher si l’un opprime l’autre ?
D’apprécier les effets des machines ?
De décider entre le luxe et l’épargne ?
De juger s’il vaut mieux exporter qu’importer ?
Si la production peut surabonder et la consommation lui faire défaut ?
Courons à l’île du pauvre naufragé. Regardons-le agir. Scrutons et le mobile, et la fin, et les conséquences de ses actes. Nous n’y apprendrons pas tout, ni spécialement ce qui concerne la répartition de la richesse au sein d’une société nombreuse ; mais nous y verrons poindre les faits primordiaux. Nous y observerons les lois générales dans leur action la plus simple ; et l’économie politique est là en germe.
Faisons à quelques problèmes seulement l’application de cette méthode.
— Ce qui tue le travail, Monsieur, ne sont-ce pas les machines ? Elles se substituent aux bras ; elles sont cause que la production surabonde et que l’humanité en est réduite à ne pouvoir plus consommer ce qu’elle produit.
— Monsieur, permettez-moi de vous inviter à m’accompagner dans l’île du Désespoir… Voilà Robinson qui a bien de la peine à se procurer de la nourriture. Il chasse et pêche tout le long du jour ; pas un moment ne lui reste pour réparer ses vêtements et se bâtir une cabane. — Mais que fait-il maintenant ? Il rassemble des bouts de ficelle et en fait un filet qu’il place au travers d’un large ruisseau. Le poisson s’y prend de lui-même, et Robinson n’a plus qu’à donner quelques heures par jour à la tâche de se pourvoir d’aliments. Désormais il petit s’occuper de se vêtir et de se loger.
— Que concluez-vous de là ?
— Qu’une machine ne tue pas le travail, mais le laisse disponible, ce qui est bien différent ; car un travail tué, comme lorsque l’on coupe le bras à un homme, est une perte, et un travail rendu disponible, comme si l’on nous gratifiait d’un troisième bras, est un profit.
— En est-il de même dans la société ?
— Sans doute, si vous admettez que les besoins d’une société, comme ceux d’un homme, sont indéfinis.
— Et s’ils n’étaient pas indéfinis ?
— En ce cas, le profit se traduirait en loisirs.
— Cependant vous ne pouvez pas nier que, dans l’état social, une nouvelle machine ne laisse des bras sans ouvrage.
— Momentanément certains bras, j’en conviens ; mais l’ensemble du travail, je le nie. Ce qui produit l’illusion, c’est ceci : on omet de voir que la machine ne peut mettre une certaine quantité de travail en disponibilité, sans mettre aussi en disponibilité une quantité correspondante de rémunération.
— Comment cela ?
— Supposez que Robinson, au lieu d’être seul, vive au sein d’une société et vende le poisson, au lieu de le manger. Si, ayant inventé le filet, il continue à vendre le poisson au même prix, chacun, excepté lui, aura pour s’en procurer à faire le même travail qu’auparavant. S’il le vend à meilleur marché, tous les acheteurs réaliseront une épargne qui ira provoquer et rémunérer du travail. [95]
— Vous venez de parler d’épargne. Oseriez-vous dire que le luxe des riches n’enrichit pas les marchands et les ouvriers ?
— Retournons à l’île de Robinson, pour nous faire une idée juste du luxe. Nous y voici ; que voyez-vous ?
— Je vois que Robinson est devenu Sybarite. Il ne mange plus pour satisfaire sa faim ; il tient à la variété des mets, donne à son appétit une excitation factice, et, de plus, il s’occupe à changer tous les jours la forme et la couleur de ses vêtements.
— Par là il se crée du travail. En est-il réellement plus riche ?
— Non ; car tandis qu’il chiffonne et marmitonne, ses armes se rouillent et sa case se délabre..
— Règle générale bien simple et bien méconnue : chaque travail donne un résultat et non pas deux. Celui qu’on dissipe à contenter des fantaisies puériles ne peut satisfaire des besoins plus réels et d’un ordre plus élevé.
— Est-ce qu’il en est de même dans la société ?
— Exactement. Pour un peuple, le travail qu’exige le goût des modes et des spectacles ne peut être consacré à ses chemins de fer ou à son instruction.
— Si les goûts de ce peuple se tournaient vers l’étude et les voyages, que deviendraient les tailleurs et les comédiens ?
— Professeurs et ingénieurs.
— Avec quoi la société payerait-elle plus de professeurs et d’ingénieurs ?
— Avec ce qu’elle donnerait de moins aux comédiens et aux modistes.
— Voulez-vous insinuer par là que, dans l’état social, les hommes doivent exclure toute diversion, tous les arts, et se couvrir simplement au lieu de se décorer ?
— Ce n’est pas ma pensée. Je dis que le travail qui est employé à une chose est pris sur une autre ; que c’est au bon sens d’un peuple, comme à celui de Robinson, de choisir. Seulement il faut qu’on sache bien que le luxe n’ajoute rien au travail ; il le déplace.
— Est-ce que nous pourrions étudier aussi le traité de Méthuen dans l’île du Désespoir ?
— Pourquoi pas ? Allons y faire une promenade… Voyez : Robinson est occupé à se faire des habits pour se garantir du froid et de la pluie. Il regrette un peu le temps qu’il y consacre ; car il faut manger aussi, et son jardin réclame tous ses soins. Mais voici qu’une pirogue aborde l’île. L’étranger qui en descend montre à Robinson des habits bien chauds et propose de les céder contre quelques légumes, en offrant de continuer à l’avenir ce marché. Robinson regarde d’abord si l’étranger est armé. Le voyant sans flèches ni tomahawk, il se dit : Après tout, il ne peut prétendre à rien que je n’y consente ; examinons. — Il examine les habits, suppute le nombre d’heures qu’il mettrait à les faire lui-même, et le compare au nombre d’heures qu’il devrait ajouter à son travail horticole pour satisfaire l’étranger. — S’il trouve que l’échange, en le laissant tout aussi bien nourri et vêtu, met quelques-unes de ses heures en disponibilité, il accepte, sachant bien que ces heures disponibles sont un profit net, soit qu’il les emploie au travail ou au repos. — Si, au contraire, il croit le marché désavantageux, il le refuse. Qu’est-il besoin, en ce cas, qu’une force extérieure le lui interdise ? Il sait se l’interdire lui-même.
Revenant au traité de Méthuen, je dis : La nation portugaise ne prend aux Anglais du drap contre du vin que parce qu’une quantité donnée de travail lui donne en définitive, par ce procédé, plus de vin à la fois et plus de drap. Après tout, elle échange parce qu’elle veut échanger. Il n’était pas besoin d’un traité pour l’y décider. Remarquez même qu’un traité, dans le sens de l’échange, ne peut être que la destruction de conventions contraires ; si bien que, lorsqu’il arrive à stipuler le libre-échange, il ne stipule plus rien du tout. Il se borne à laisser les parties stipuler pour elles-mêmes. — Le traité de Méthuen ne dit pas : Les Portugais seront forcés de donner du vin pour du drap. Il dit : Les Portugais prendront du drap contre du vin, s’ils veulent.
— … Ah ! ah ! ah ! Vous ne savez pas ?
— Pas encore.
— Je suis allé tout seul à l’île du Désespoir. Robinson est ruiné.
— En êtes-vous bien sûr ?
— Il est ruiné, vous dis-je.
— Et depuis quand ?
— Depuis qu’il donne des légumes contre des vêtements.
— Et pourquoi continue-t-il ?
— Ne savez-vous pas l’arrangement qu’il fit autrefois avec l’insulaire du voisinage ?
— Cet arrangement lui permet de prendre des habits contre des légumes, mais ne l’y force pas.
— Sans doute, mais ce coquin d’insulaire a tant de peaux à sa disposition, il est si habile à les préparer et à les coudre, en un mot, il donne tant d’habits pour si peu de légumes, que Robinson ne résiste pas à la tentation. Il est bien malheureux de n’avoir pas au-dessus de lui un état qui dirigerait sa conduite.
— Que pourrait faire l’État en cette occurrence ?
— Prohiber l’échange.
— En ce cas, Robinson ferait ses vêtements comme autrefois. Qui l’en empêche, si c’est son avantage ?
— Il a essayé ; mais il ne peut les faire aussi vite qu’il fait les légumes qu’on lui demande en retour. Et voilà pourquoi il persiste à échanger. Vraiment, à défaut d’un État, qui n’a pas besoin de raisonner lui, et procède par voie d’injonctions, ne pourrions-nous pas envoyer au pauvre Robinson un numéro du Moniteur industriel pour lui ouvrir les yeux ?
— Mais d’après ce que vous me dites, il doit être plus riche qu’avant.
— Ne pouvez-vous comprendre que l’insulaire offre une quantité toujours plus grande de vêtements contre une quantité de légumes qui reste la même ?
— C’est pour cela que l’affaire devient toujours meilleure pour Robinson.
— Il est ruiné, vous dis-je. C’est un fait. Vous ne prétendez pas raisonner contre un fait.
— Non ; mais contre la cause que vous lui assignez. Faisons donc ensemble un voyage dans l’île… Mais que vois-je ! Pourquoi me cachiez-vous cette circonstance ?
— Laquelle ?
— Voyez donc comme Robinson est changé ! Il est devenu paresseux, indolent, désordonné. Au lieu de bien employer les heures que son marché mettait à sa disposition, il dissipe ces heures-là et les autres. Son jardin est en friche ; il ne fait plus ni vêtements ni légumes ; il gaspille ou détruit ses anciens ouvrages. S’il est ruiné, qu’allez-vous chercher une autre explication ?
— Oui ; mais le Portugal ?
— Le Portugal est-il paresseux ?
— Il l’est, je n’en saurais disconvenir.
— Est-il désordonné ?
— À un degré incontestable.
— Se fait-il la guerre à lui-même ? Nourrit-il des factions, des sinécures, des abus ?
— Les factions le déchirent, les sinécures y pullulent, et c’est la terre des abus.
— Alors sa misère s’explique comme celle de Robinson.
— C’est trop simple. Je ne puis pas me contenter de cela. Le Moniteur industriel vous accommode les choses bien autrement. Ce n’est pas lui qui expliquerait la misère par le désordre et la paresse. Prenez donc la peine d’étudier la science économique pour en venir là ! [96]…
Le petit manuel du consommateur [A Little Manual for Consumers, in other words, for Everyone] [c. 1847] [CW3 ES3.17]↩
BWV
1847.?? “Le petit manuel du consommateur ou de tout le monde” (A Little Manual for Consumers, in other words, for everyone) [an unpublished outline from 1847] [OC2.61, pp. 409-15] [CW3] [ES3.17]
1847
(Ébauche inédite)
Consommer, — Consommateur, — Consommation, — vilains mots qui représentent les hommes comme des coureurs d’estaminet, sans cesse en face de la demi-tasse et du petit verre.
Mais l’économie politique est bien forcée de s’en servir. (Je parle des trois mots et non du petit verre.) Elle n’ose en faire d’autres, ayant trouvé ceux-là tout faits.
Disons pourtant ce qu’ils signifient. Le travail, celui de la tête comme celui du bras, a pour fin de satisfaire un de nos besoins ou de nos désirs. Il y a donc deux termes dans l’évolution économique : la peine et la récompense. Celle-ci est le produit de celle-là. Prendre la peine, c’est produire ; jouir de la récompense, c’est consommer.
On peut donc consommer l’œuvre de l’intelligence comme l’œuvre des bras, — un drame, un livre, une leçon, un tableau, une statue, un sermon, comme du blé, des meubles, des vêtements ; — par les yeux, par les oreilles, par l’intelligence, par le cœur, comme par la bouche et par l’estomac. En ce cas, le mot consommer est bien étroit, bien vulgaire, bien impropre, bien bizarre, — j’en conviens. Mais je n’en sais pas d’autre ; et tout ce que je puis faire, c’est de répéter que j’entends par là — jouir de la récompense d’un travail. [97]
Il n’est aucune échelle métrique, barométrique ou dynamométrique qui puisse donner la mesure normale de la peine et de la récompense ; et il n’y en aura jamais jusqu’à ce qu’on ait trouvé le moyen de toiser une répugnance et de pondérer un désir.
Chacun y est pour soi. La récompense et la charge de l’effort me regardant, c’est à moi de les comparer et de voir si l’une vaut l’autre. À cet égard, la contrainte serait d’autant plus absurde qu’il n’y a pas deux hommes sur la terre qui fassent, dans tous les cas, la même appréciation.
Le troc ne change pas la nature des choses. Règle générale : c’est à celui qui veut la récompense à prendre la peine. S’il veut la récompense de la peine d’autrui, il doit céder en retour la récompense de sa propre peine. Alors il compare la vivacité d’un désir avec la peine qu’il se donnerait pour le satisfaire et dit : Qui veut prendre cette peine pour moi ? j’en prendrai une autre pour lui.
Et comme chacun est seul juge du désir qu’il éprouve, de l’effort qu’on lui demande, le caractère essentiel de ces transactions c’est la liberté.
Quand la liberté en est bannie, soyez sûr que l’une des parties contractantes est soumise à une peine trop grande ou reçoit une récompense trop petite.
De plus, l’action de contraindre son semblable est elle-même un effort, et la résistance à cette action un autre effort, lesquels sont entièrement perdus pour l’humanité.
Il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y a pas une proportion uniforme et immuable entre un effort et sa récompense. L’effort nécessaire pour avoir du blé est moins grand en Sicile qu’au sommet du mont Blanc ; l’effort nécessaire pour obtenir du sucre est moins grand sous les tropiques qu’au Kamtchatka. La bonne distribution du travail, sur les lieux où il est le mieux secondé par la nature, et la perfectibilité de l’intelligence humaine, tendent à diminuer sans cesse la proportion de l’effort à la récompense.
Puisque l’effort est le moyen, le côté onéreux de l’opération, et que la récompense en est le but, la fin et le fruit ; et puisque, d’un autre côté, il n’y a pas une proportion invariable entre ces deux choses, il est bien clair que, pour savoir si une nation est riche, ce n’est pas l’effort qu’il faut regarder, mais le résultat. Le plus ou moins d’efforts ne nous apprend rien. Le plus ou moins de besoins et de désirs satisfaits nous dit tout [98]: C’est ce que les économistes entendent par ces mots, qu’on a si étrangement commentés : « L’intérêt du consommateur ou plutôt de la consommation est l’intérêt général. » Le progrès des satisfactions d’un peuple, c’est évidemment le progrès de ce peuple lui-même. Il n’en est pas nécessairement ainsi du progrès de ses efforts.
Ceci n’est pas une observation oiseuse ; car il est des temps et des pays où l’on a pris, pour pierre de touche du progrès, l’accroissement de l’effort en durée et en intensité. Et qu’est-il arrivé ? La législation s’est appliquée à diminuer le rapport de la récompense à la peine, afin que, poussés par la vivacité des désirs et le cri des besoins, les hommes accrussent incessamment leurs efforts.
Si un ange, un être infaillible, était envoyé pour gouverner la terre, il pourrait dire à chacun comment on doit s’y prendre pour que tout effort soit suivi de la plus grande récompense possible. Cela n’étant pas, il faut se confier à la liberté.
Nous avons déjà dit que la liberté était de toute justice. De plus, elle tend fortement au résultat cherché : obtenir de tout effort la plus grande récompense ou, pour ne pas perdre de vue notre sujet spécial, la plus grande consommation possible.
En effet, sous un régime libre, chacun est non-seulement porté mais contraint à tirer le meilleur parti de ses peines, de ses facultés, de ses capitaux et des avantages naturels qui sont à sa disposition.
Il y est contraint par la concurrence. Si je m’avisais d’extraire le fer du minerai qui se trouve à Montmartre, j’aurais un grand effort à accomplir pour une bien petite récompense. Si je voulais ce fer pour moi-même, je m’apercevrais bientôt que j’en aurais davantage par l’échange, en donnant une autre direction à mon travail. Et si je voulais échanger mon fer, je verrais encore plus vite que, bien qu’il m’ait coûté de grands efforts, on ne veut m’en céder que de très-légers à la place.
Ce qui nous pousse tous à diminuer la proportion de l’effort au résultat, c’est notre intérêt personnel. Mais, chose étrange et admirable ! il y a, dans le libre jeu du mécanisme social, quelque chose qui, à cet égard, nous fait marcher de déception en déception et déjoue nos calculs, mais au profit de l’humanité.
En sorte qu’il est rigoureusement exact de dire que les autres profitent plus que nous de nos propres progrès. Heureusement il y a compensation, et nous profitons infailliblement des progrès d’autrui.
Ceci mérite d’être brièvement expliqué.
Prenez les choses comme vous voudrez, par le haut ou le bas, mais suivez-les attentivement et vous reconnaîtrez toujours ceci :
Que les avantages qui favorisent le producteur et les inconvénients qui le gênent ne font que glisser sur lui, sans pouvoir s’y arrêter. À la longue, ils se traduisent en avantages ou en inconvénients pour le consommateur, qui est le public. Ils se résument en un accroissement ou une diminution des jouissances générales. Je ne veux pas disserter ici, cela viendra plus tard peut-être. Procédons par voie d’exemples.
Je suis menuisier et fais des planches à coups de hache. On me les paye 4 fr. la pièce, car il me faut un jour pour en faire une. — Désirant améliorer mon sort, je cherche un moyen plus expéditif, et j’ai le bonheur d’inventer la scie. Me voilà faisant 20 planches par jour et gagnant 80 fr. — Oui, mais ce gros profit attire l’attention. Chacun veut avoir une scie ; et bientôt on ne me donne plus que 4 fr. pour la façon de 20 planches. — Le consommateur économise les 19/20 de sa dépense, tandis qu’il ne me reste plus que l’avantage d’avoir, comme lui, des planches avec moins de peine quand j’en ai besoin. [99]
Autre exemple, en sens inverse.
On met sur le vin un impôt énorme, perçu à la récolte. C’est une avance exigée du producteur, dont il s’efforce d’obtenir le remboursement du consommateur. La lutte sera longue, la souffrance longtemps partagée. Le vigneron sera réduit peut-être à arracher sa vigne. La valeur de sa terre décroîtra. Il la vendra un jour à perte ; et alors, le nouvel acquéreur, ayant fait entrer l’impôt dans ses calculs, n’aura pas à se plaindre. — Je ne nie pas tous les maux infligés au producteur, pas plus que les avantages momentanément recueillis par lui dans l’exemple précédent. Mais je dis qu’à la longue l’impôt se confond avec les frais de production ; et il faut que le consommateur les rembourse tous, celui-là comme les autres. Au bout d’un siècle, deux siècles peut-être, l’industrie de la vigne se sera arrangée là-dessus ; on aura arraché, aliéné, souffert dans les vignobles, et finalement le consommateur supportera l’impôt. [100]
Pour le dire en passant, ceci prouve que si l’on nous demande quel est l’impôt le moins onéreux, il faut répondre : le plus ancien, celui qui a donné le temps aux inconvénients et dérangements de parcourir tout leur cycle funeste.
De tout ce qui précède, il résulte que le consommateur recueille à la longue tous les avantages d’une bonne législation comme tous les inconvénients d’une mauvaise ; ce qui ne veut pas dire autre chose, si ce n’est que les bonnes lois se traduisent en accroissement, et les mauvaises en diminution de jouissances pour le public. Voilà pourquoi le consommateur, qui est le public, doit avoir l’œil alerte et l’esprit avisé ; et voilà aussi pourquoi je m’adresse à lui.
Malheureusement, le consommateur est d’une bonhomie désespérante, et cela s’explique. Comme les maux ne lui arrivent qu’à la longue et par cascades, il lui faudrait beaucoup de prévoyance. Le producteur, au contraire, reçoit le premier choc ; il est toujours sur le qui-vive.
L’homme, en tant que producteur, est chargé de la partie onéreuse de l’évolution économique, de l’effort. C’est comme consommateur qu’il recueille la récompense.
On a dit que le producteur et le consommateur ne font qu’un.
Si l’on considère un produit isolé, il n’est certainement pas vrai que le producteur et le consommateur ne font qu’un ; et l’on peut avoir souvent le spectacle de l’un exploitant l’autre.
Si l’on généralise, l’axiome est parfaitement exact, et c’est en cela que consiste l’immense déception qui se rencontre au bout de toute injustice, de toute atteinte à la liberté ; le producteur, en voulant rançonner le consommateur, se rançonne lui-même.
Il est des gens qui croient qu’il y a compensation. Non, il n’y a pas compensation : d’abord, parce qu’aucune loi ne peut faire à chacun une part égale d’injustice, ensuite, parce que dans l’opération de l’injustice il y a toujours une déperdition de jouissances, surtout lorsque cette injustice consiste, comme dans le régime restrictif, à déplacer le travail et les capitaux, à diminuer la récompense générale sous prétexte d’accroître le travail général.
En résumé, avez-vous deux lois, deux systèmes à comparer, si vous consultez l’intérêt du producteur, vous pouvez faire fausse route ; si vous consultez l’intérêt du consommateur, vous ne le pouvez pas. Il n’est pas toujours bon d’accroître la généralité des efforts ; il n’est jamais mauvais d’accroître la généralité des satisfactions…
Anglomanie, Anglophobie [c. 1847] [CW1.1.5] or [CW3 ES3.14]↩
BWV
1847.?? “Anglomanie, Anglophobie” (Anglomania and Anglophobia) [sketch from 1847] [OC7.74, p. 309-27] [CW1] or [CW3] [ES3.14]
Anglomanie, anglophobie [101]
Ces deux sentiments sont en présence, et il n’est guères possible, chez nous, de juger l’Angleterre avec impartialité, sans être accusé par les anglomanes d’être anglophobe et par les anglophobes d’être anglomane. Il semble que l’opinion publique exagérant, en France, une ancienne loi de Sparte, nous frappe de mort morale si nous ne nous jetons pas dans une de ces deux extrémités.
Pourtant ces deux sentiments subsistent, ils ont déjà une date ancienne. Donc ils ont leur raison d’être ; car dans le monde des sympathies et des antipathies, comme dans le monde matériel, il n’est pas d’effet sans cause.
Il est facile de se rendre compte de la coexistence de ces deux sentiments. La grande lutte entre la démocratie et l’aristocratie, entre le droit commun et le privilége, se poursuit, sourde ou déclarée, avec plus ou moins d’ardeur, avec plus ou moins de chance, sur tous les points du globe. Mais nulle part, pas même en France, elle n’a autant de retentissement qu’en Angleterre.
Je dis pas même en France. Chez nous, en effet, le privilége, comme principe social, était éteint avant notre révolution. En tous cas, il reçut le coup de grâce dans la nuit du 4 août. Le partage égal de la propriété sape incessamment l’existence de toute classe oisive. L’oisiveté est un accident, le lot éphémère de quelques individus ; et quoi que l’on puisse penser de notre organisation politique, toujours est-il que la démocratie fait le fonds de notre ordre social. Sans doute le cœur humain ne change pas ; ceux qui arrivent à la puissance législative cherchent bien à se créer une petite féodalité administrative, électorale ou industrielle ; mais rien de tout cela n’a de racine. D’une session à l’autre, le souffle du moindre amendement peut renverser le fragile édifice, supprimer toute une curée de places, effacer la protection, ou charger les circonscriptions électorales.
Si nous jetons les yeux sur d’autres grandes nations, comme l’Autriche et la Russie, nous voyons une situation bien différente. Là, le Privilège, appuyé sur la force brutale, règne en maître absolu. C’est à peine si nous pouvons distinguer le sourd bruissement de la démocratie faisant son œuvre souterraine, comme un germe s’enfle et se développe loin de tout regard humain.
En Angleterre, au contraire, les deux puissances sont pleines de force et de vigueur. Je ne dirai rien de la monarchie, espèce d’idole à laquelle les deux armées sont convenues d’imposer une sorte de neutralité. Mais considérons un peu les éléments de force et la trempe des armes avec lesquelles l’aristocratie et la démocratie se livrent combat.
L’aristocratie a pour elle la puissance législative. Elle seule peut entrer à la Chambre des lords, et elle s’est emparée de la Chambre des communes, sans qu’on puisse dire quand et comment elle pourra en être délogée.
Elle a pour elle l’Église établie, dont tous les postes sont envahis par les cadets de famille, institution purement anglaise ou anglicane, comme son nom le dit, et purement politique, dont le monarque est le chef.
Elle a pour elle la propriété héréditaire du sol et les substitutions, garantie contre le morcellement des terres. Par là elle est assurée que sa puissance, concentrée en un petit nombre de mains, ne sera point disséminée et ne perdra pas ce qui la caractérise.
Par la puissance législative, elle a la disposition des taxes ; et ses efforts tendent naturellement à en rejeter le fardeau sur la démocratie, tout en s’en réservant le profit.
Aussi la voit-on commander l’armée et la marine, c’est-à-dire être encore maîtresse de la force brutale ; et la manière dont se recrutent ces corps garantit qu’ils ne passeront pas du côté de la cause populaire. On peut remarquer de plus qu’il y a dans la discipline militaire quelque chose à la fois d’énergique et de dégradant, qui aspire à effacer, dans l’âme de l’armée, toute participation aux sentiments communs de l’humanité.
Avec les trésors et les forces du pays, l’aristocratie anglaise a pu procéder successivement à la conquête de tous les points du globe qu’elles a jugés utiles à sa sécurité et à sa politique. Dans cette œuvre, elle a été merveilleusement secondée par le préjugé populaire, l’orgueil national et le sophisme économique, qui rattachent tant de folles espérances au système colonial.
Enfin toute la diplomatie britannique est concentrée aux mains de l’aristocratie ; et comme il y a toujours un lien sympathique entre tous les priviléges et toutes les aristocraties de la terre, comme elles sont fondées sur le même principe, que ce qui menace l’une menace l’autre, il en résulte que tous les éléments de la vaste puissance que je viens de décrire sont en opposition perpétuelle avec le développement de la démocratie, non seulement en Angleterre, mais dans le monde entier.
Ainsi s’expliquent la guerre contre l’indépendance des États-Unis et la guerre plus acharnée encore contre la Révolution française ; guerre poursuivie non seulement avec le fer, mais encore et surtout avec l’or, soit qu’il servît à soudoyer des coalitions, soit qu’il fût répandu pour entraîner notre démocratie à l’exagération, au désordre, à la guerre civile.
Il n’est pas nécessaire d’entrer en plus de détails, d’indiquer l’intérêt qu’a pu avoir l’aristocratie anglaise à étouffer partout, en même temps que le principe démocratique, tout élément de force, de puissance et de richesse ; il n’est pas nécessaire d’exposer historiquement l’action qu’elle a exercée dans ce sens sur les peuples, — action qui a reçu la dénomination de système de bascule, — pour montrer que l’anglophobie n’est pas un sentiment tout à fait aveugle, et qu’il a, comme je le disais en commençant, sa raison d’être.
Quant à l’anglomanie, si on l’explique par un sentiment puéril, par l’espèce de fascination qu’exerce toujours sur les esprits légers le spectacle de la richesse, de la puissance, de l’énergie, de la persévérance et du succès, ce n’est pas de celle-là que je m’occupe. Je veux parler des causes sérieuses de sympathie que l’Angleterre peut, à bon droit, exciter dans d’autres pays.
Je viens d’énumérer les forces de l’oligarchie anglaise : propriété du sol, chambre des lords, chambre des communes, taxes, église, armée, marine, colonies, diplomatie.
Les forces de la démocratie n’ont rien d’aussi déterminé.
Celle-ci a pour elle la parole, la presse, l’association, le travail, l’économie, la richesse croissante, l’opinion, le bon droit et la vérité.
Il me semble que le progrès de la démocratie est sensible. Voyez quelles larges brèches elle a faites dans le camp opposé.
L’oligarchie anglaise, ai-je dit, avait la possession du sol. Elle l’a encore ; mais ce qu’elle n’a plus, c’est un privilége enté sur ce privilége, la loi céréale.
Elle avait la Chambre des communes. Elle l’a encore ; mais la démocratie est entrée au Parlement par la brèche du Reform-Bill, brèche qui s’élargira sans cesse.
Elle avait l’Église établie. Elle l’a encore ; mais dépouillée de son ascendant exclusif par la multiplication et la popularité des Églises dissidentes et le bill de l’émancipation catholique.
Elle avait les taxes. Elle en dispose encore; mais, depuis 1815, tous les ministres, whigs ou torys, se sont vus forcés de marcher de réforme en réforme, et, à la première difficulté financière, l’incom-tax provisoire sera converti en impôt foncier permanent.
Elle avait l’armée. Elle l’a encore, mais chacun sait avec quel soin jaloux le peuple anglais veut qu’on lui épargne la vue des habits rouges.
Elle avait les colonies, c’était sa plus grande puissance morale ; car c’est par les promesses illusoires du régime colonial qu’elle s’attachait un peuple enorgueilli et égaré. — Et le peuple brise ce lien, en reconnaissant la chimère du système colonial.
Enfin, je dois mentionner ici une autre conquête populaire, et la plus grande sans doute. Par cela même que les armes du peuple sont l’opinion, le bon droit et la vérité, par cela encore qu’il possède dans toute sa plénitude le droit de défendre sa cause par la presse, la parole et l’association, le peuple ne pouvait manquer d’attirer, et il a en effet attiré sous son drapeau les hommes les plus intelligents et les plus honnêtes de l’aristocratie. Car il ne faut pas croire que l’aristocratie anglaise forme un ensemble compacte et déterminé. Nous la voyons, au contraire, se partager dans toutes les grandes circonstances ; et, soit frayeur, habileté, ou philanthropie, ce sont d’illustres privilégiés qui viennent sacrifier aux exigences démocratiques une partie de leurs propres priviléges.
Si l’on veut appeler anglomanes ceux qui prennent intérêt aux péripéties de cette grande lutte et aux progrès de la cause populaire sur le sol britannique, je le déclare, je suis anglomane.
Il me semble qu’il n’y a qu’une vérité, qu’il n’y a qu’une justice, que l’égalité prend partout la même forme, que la liberté a partout les mêmes résultats, et qu’un lien fraternel et sympathique doit unir les faibles et les opprimés de tous les pays.
Je ne puis pas ne pas voir qu’il y a deux Angleterre ; puisqu’il y a, en Angleterre, deux sentiments, deux principes, deux causes éternellement en lutte. [102]
Je ne puis pas oublier que si le principe aristocratique voulut, en 1776, courber sous son joug l’indépendance américaine, il trouva dans quelques démocrates anglais une résistance telle, qu’il lui fallut suspendre la liberté de la presse, l’habeas corpus, et fausser le jury.
Je ne puis pas oublier que si le principe aristocratique voulut, en 1791, étouffer notre glorieuse révolution, il lui fallut commencer par lancer chez lui sa soldatesque sur les hommes du peuple, qui s’opposaient à la perpétration de ce crime contre l’humanité.
J’appelle anglomane celui qui admire indistinctement les faits et gestes des deux partis. J’appelle anglophobe celui qui les enveloppe tous deux dans une réprobation aveugle et insensée.
Au risque d’attirer sur ce pauvre petit volume la lourde massue de l’impopularité, oui, je l’avoue, ce grand, cet éternel, ce gigantesque effort de la démocratie pour se dégager des liens de l’oppression et rentrer dans la plénitude de ses droits, offre à mes yeux, en Angleterre, des circonstances particulièrement intéressantes, qui ne se présentent pas dans les autres pays, au moins au même degré.
En France, l’aristocratie est tombée en 89, avant que la démocratie fut préparée à se gouverner elle-même. Celle-ci n’avait pu développer et perfectionner dans tous les sens ces qualités, ces puissances, ces vertus politiques, qui seules pouvaient conserver le pouvoir dans ses mains et lui en faire faire un prudent et utile usage. Il en est résulté que chaque parti, chaque homme même, a cru pouvoir hériter de l’aristocratie ; et la lutte s’est établie entre le peuple et M. Decaze, le peuple et M. de Villèle, le peuple et M. de Polignac, le peuple et M. Guizot. Dans cette lutte, aux proportions mesquines, nous faisons notre éducation constitutionnelle, et le jour où nous serons assez avancés, rien ne nous empêchera de prendre possession de la direction de nos affaires ; car la chute de notre grand antagoniste, l’aristocratie, a précédé notre éducation politique.
Le peuple anglais, au contraire, grandit, se perfectionne, et s’éclaire par la lutte elle-même. Des circonstances historiques, inutiles à rappeler ici, ont paralysé dans ses mains l’emploi de la force physique. Il a dû recourir à la puissance seule de l’opinion ; et la première condition pour que l’opinion fût une puissance, c’était que le peuple lui-même s’ éclairât sur chaque question particulière jusqu’à l’unanimité. L’opinion n’aura pas à se faire après la lutte, elle s’est faite et se fait pendant, pour et par la lutte même. C’est toujours dans le parlement que se gagne la victoire, et l’aristocratie est forcée de la sanctionner. Nos philosophes et nos poëtes ont brillé avant notre révolution qu’ils ont préparée ; mais, en Angleterre, c’est pendant la lutte que la philosophie et la poésie font leur œuvre. Du sein du parti populaire surgissent de grands écrivains, de puissants orateurs, de nobles poëtes, qui nous sont entièrement inconnus. Nous nous imaginons ici que Milton, Shakespeare, Young, Thompson, Byron forment toute la littérature anglaise. Nous ne nous apercevons pas que, parce que la lutte se poursuit toujours, la chaîne des grands poëtes n’est pas interrompue ; et le feu sacré anime les Burn, les Campbell, les Moore, les Akenside et mille autres, qui travaillent sans cesse à renforcer la démocratie en l’éclairant.
Il résulte encore de cet état de choses que l’aristocratie et la démocratie se retrouvent en présence à propos de toutes les questions. Rien n’est plus propre à les animer, à les grandir. Ce qui ailleurs n’est qu’un débat administratif ou financier est là une guerre sociale. À peine une question a surgi qu’on s’aperçoit, de part et d’autre, que les deux grands principes sont engagés. Dès lors, de part et d’autre, on fait des efforts immenses, on se coalise, on pétitionne, on propage par d’abondantes souscriptions d’innombrables écrits, bien moins pour la question elle-même qu’à cause du principe toujours présent, toujours vivant qui y est engagé. Cela s’est vu non seulement à l’occasion des lois céréales, mais de toute loi qui touche aux taxes, à l’Église, à l’armée, à l’ordre politique, à l’éducation, aux affaires extérieures, etc.
Il est aisé de comprendre que le peuple anglais a dû s’habituer ainsi à remonter, à propos de toute mesure, jusqu’aux principes primordiaux, et à poser la discussion sur cette large base. Aussi, en général, les deux partis sont extrêmes et exclusifs. On veut tout ou rien, parce qu’on sent, des deux côtés, que concéder quelque chose, si peu que ce soit, c’est concéder le principe. Sans doute, dans le vote, il y a quelquefois transaction. On est bien forcé d’accommoder les réformes au temps et aux circonstances ; mais dans les débats on ne transige pas, et la règle invariable de la démocratie est celle-ci : Prendre tout ce qu’on lui accorde et continuer à demander le reste. — Et même elle a eu l’occasion d’apprendre que le plus sûr pour elle est d’exiger tout, pendant cinquante ans s’il le faut, plutôt que de se contenter d’un peu, au bout de quelques sessions.
Aussi les anglophobes les plus prononcés ne peuvent pas se dissimuler que les réformes, en Angleterre, portent un cachet de radicalisme, et parla de grandeur, qui étonne et subjugue l’esprit.
L’abolition de l’esclavage a été emportée tout d’une pièce. À un jour marqué, à une minute déterminée, les fers sont tombés des bras des pauvres noirs dans toutes les possessions de la Grande-Bretagne. On raconte que, dans la nuit du 31 juillet 1838, les esclaves s’étaient rassemblés dans les églises de la Jamaïque. Leur pensée, leur cœur, leur vie tout entière semblaient attachés à l’aiguille de l’horloge. Vainement le prêtre s’efforçait de fixer leur attention sur les plus imposants sujets qui puissent captiver l’intelligence humaine. Vainement il leur parlait de la bonté de Dieu et de leurs futures destinées. Il n’y avait qu’une seule âme dans l’auditoire, et cette âme était dans une fiévreuse attente. Lorsque le marteau fit retentir le premier coup de minuit, un cri de joie, comme jamais oreille humaine n’en avait entendu, ébranla les voûtes du temple. La parole et le geste manquaient à ces pauvres créatures pour donner passage à l’exubérance de leur bonheur. Ils se précipitaient en pleurant dans les bras les uns des autres, jusqu’à ce que, ce paroxysme calmé, on les vit se jeter à genoux, élever vers le ciel leurs bras reconnaissants, puis confondre dans leurs bénédictions et la nation qui les délivrait, et les grands hommes, les Clarkson, les Wilberforce qui avaient embrassé leur cause, et la Providence qui avait fait descendre dans le cœur d’un grand peuple un rayon de justice et d’humanité.
S’il a fallu cinquante ans pour réaliser d’une manière absolue la liberté personnelle, on est arrivé plus vite, mais seulement à une transaction, à une trêve, sur les libertés politique et religieuse. Le reform-bill et le bill de l’émancipation catholique, d’abord soutenus comme principes, ont été livrés à l’expédient. Aussi l’Angleterre a encore deux grandes agitations à traverser : la charte du peuple et le renversement de l’Église établie comme religion officielle.
La campagne contre le régime protecteur est une de celles qui ont été conduites par les chefs sous la sauvegarde et l’autorité du principe. Le principe de la liberté des transactions est vrai ou faux, il devait triompher ou succomber tout entier. Transiger, c’eût été avouer que la propriété et la liberté ne sont pas des droits, mais, selon le temps et le lieu, des circonstances accessoires, utiles ou funestes. Accepter le débat sur ce terrain, c’eût été se priver volontairement de tout ce qui fait l’autorité et la force ; c’eût été renoncer à mettre de son côté le sentiment de justice qui vit dans tous les cœurs. — Le principe de la liberté commerciale a triomphé ; il a été appliqué aux objets nécessaires à la vie, et il le sera promptement à tout ce qui peut faire l’objet des transactions internationales.
Ce culte de l’absolu a été transporté dans des questions d’un ordre inférieur. Quand il s’est agi de la réforme postale, on s’est demandé si les communications individuelles de la pensée, les épanchements de l’amitié, de l’amour maternel, de la piété filiale, étaient une matière imposable. L’opinion a répondu par la négative ; et dès lors on a poursuivi la réforme radicale, absolue, sans s’inquiéter de quelque embarras ou de quelque déficit au Trésor. On a réduit le port de la lettre au taux de la plus petite monnaie anglaise, parce que cela suffisait pour payer à l’État le service rendu et lui rembourser ses frais. Et comme la poste laisse encore un profit, il ne faut pas douter qu’on réduisit encore le port des lettres, s’il y avait en Angleterre une monnaie au-dessous du penny.
J’avoue qu’il y a dans cette audace et cette vigueur quelque chose de grand, qui me fait suivre avec intérêt les débats du parlement anglais et plus encore les débats populaires qui ont lieu dans les associations et les meetings. C’est là que l’avenir s’élabore, c’est là que de longues discussions dégagent au préalable cette inconnue : un principe est-il engagé dans la question ? — Et si la réponse est affirmative, on peut ignorer le jour du triomphe, mais on peut être sûr que le triomphe est assuré.
Avant de revenir au sujet de ce chapitre, l’anglomanie et l’anglophobie, je dois prémunir le lecteur contre une fausse interprétation qui pourrait se glisser dans son esprit. Bien que la lutte entre l’aristocratie et la démocratie , toujours présente et palpitante au fond de chaque question, donne certainement de la chaleur et de la vie aux débats ; bien qu’en retardant et éloignant la solution, elle contribue à mûrir les idées et former les mœurs politiques du peuple ; il ne faut pas conclure de là que je considère comme un désavantage absolu pour mon pays de n’avoir pas le même obstacle à vaincre, et conséquemment de ne pas sentir le même aiguillon, de n’avoir pas les mêmes éléments de vie et d’ardeur.
Les principes ne sont pas moins engagés chez nous qu’en Angleterre. Seulement les débats devraient être, chez nous, beaucoup plus généraux, beaucoup plus humanitaires (puisque le mot est consacré), comme, chez nos voisins, ils doivent être plus nationaux. L’obstacle aristocratique, pour eux, est chez eux. Pour nous, il est dans le monde entier. Rien, certes, ne nous empêcherait de prendre les principes à une hauteur que l’Angleterre ne peut encore atteindre.
Nous ne le faisons pas, et cela dépend uniquement du degré insuffisant de respect, de dévouement pour les principes, auquel nous sommes parvenus.
Si l’anglophobie n’était chez nous qu’une naturelle réaction contre l’oligarchie anglaise, dont la politique est si dangereuse pour les nations et en particulier pour la France, ce ne serait plus de l’anglophobie, mais, qu’on me pardonne ce mot barbare (et qui n’en est que plus juste, puisqu’il réunit deux idées barbares), de l’oligarcophobie.
Malheureusement il n’en est pas ainsi ; et l’occupation la plus constante de nos grands journaux est d’irriter le sentiment national contre la démocratie britannique, contre ces classes laborieuses qui demandent au travail, à l’industrie, à la richesse, au développement de leurs facultés, les forces qui doivent les affranchir. C’est précisément l’accroissement de ces forces démocratiques, la perfection du travail, la supériorité industrielle, l’extension des machines, l’aptitude commerciale, l’accumulation des capitaux, c’est précisément, dis-je, l’accroissement de ces forces qu’on nous représente comme dangereux, comme opposé à nos propres progrès, comme impliquant de toute nécessité un décroissement proportionnel dans les forces analogues de notre pays.
C’est là le sophisme économique que j’ai à combattre, c’est par là que se rattache à l’esprit de ce livre le sujet que je viens de traiter, et qui a pu paraître jusqu’ici une oiseuse digression.
D’abord, si ce que j’appelle ici un sophisme était une vérité, combien elle serait triste et décourageante ! Si le mouvement progressif, qui se manifeste sur un point du globe, occasionnait un mouvement rétrograde sur un autre point, si l’accroissement des richesses d’un pays ne se faisait qu’au moyen d’une perte correspondante répartie sur tous les autres, il n’y aurait évidemment, dans l’ensemble, pas de progrès possible ; et, de plus, toutes les jalousies nationales seraient justifiées. Des idées vagues d’humanité, de fraternité, ne suffiraient certes pas pour déterminer une nation à se réjouir des progrès faits ailleurs, puisqu’ils se seraient faits à ses dépens. Les fraternitaires ne changeront jamais à ce point le cœur humain, et, dans l’hypothèse que j’envisage, cela n’est pas même désirable. Qu’y aurait-il d’honnête, de délicat à me réjouir de ce qu’un peuple s’élève vers le superflu, s’il en doit résulter qu’un autre peuple descende au-dessous du nécessaire ? Non, je ne suis tenu ni moralement ni religieusement à faire, fût-ce au nom de ma patrie, cet acte d’abnégation.
Ce n’est pas tout. Si cette espèce de bascule, était la loi des nations, elle serait aussi la loi des provinces, des communes, des familles. Le progrès national n’est pas d’une autre nature que le progrès individuel ; par où l’on voit que si l’axiome, dont je m’occupe, était une vérité au lieu d’être un sophisme, il n’y a pas un homme sur la terre qui ne dût perpétuellement s’efforcer d’étouffer le progrès de tous les autres, sauf à rencontrer chez tous le même effort contre lui-même. Ce conflit général serait l’état naturel de la société, et la Providence, en décrétant que le profit de l’un est le dommage de l’autre, aurait condamné l’homme à une guerre sans terme, et l’humanité à, un niveau primitif invariable.
Il n’y a donc pas dans les sciences sociales de proposition qu’il soit plus important d’éclaircir. C’est la clef de voûte de tout l’édifice. Il faut absolument connaître la nature propre du progrès, et l’influence que la condition progressive d’un peuple exerce sur la condition des autres peuples. S’il est démontré que le progrès, dans une circonscription donnée, a pour cause ou pour effet une dépression proportionnelle dans le reste de la race humaine, il ne nous reste plus qu’à brûler nos livres, renoncer à toute espérance du bien général, et entrer dans l’universel conflit, avec la ferme volonté d’être le moins possible écrasés en écrasant le plus possible les autres. Ce n’est pas là de l’exagération, c’est de la logique la plus rigoureuse, de la logique trop souvent appliquée. Une mesure politique qui se rattache si bien à l’axiome — le profit de l’un est le dommage de l’autre, — parce qu’elle en est comme l’incarnation, l’acte de navigation de la Grande-Bretagne fut placé ouvertement sous l’invocation de ces paroles célèbres de son préambule : Il faut que l’Angleterre écrase la Hollande ou qu’elle en soit écrasée. Et nous avons vu la Presse invoquer les mêmes paroles pour faire adopter en France la même mesure. Rien de plus simple, dès qu’il n’est pas d’autre alternative pour les peuples, comme pour les individus, que d’écraser ou d’être écrasés. — Par où l’on voit le point où l’erreur et l’atrocité viennent se confondre.
Mais la triste maxime que je mentionne mérite bien d’être combattue dans un chapitre spécial. Il ne s’agit point en effet de lui opposer de vagues déclamations sur l’humanité, la charité, la fraternité, l’abnégation. Il faut la détruire par une démonstration pour ainsi dire mathématique. En me réservant de consacrer quelques pages à cette tâche, je poursuis ce que j’ai à dire sur l’anglophobie.
J’ai dit que ce sentiment, en tant qu’il s’attache à cette politique machiavélique que l’oligarchie anglaise a fait peser si longtemps sur l’Europe, était un sentiment justifiable, qui avait sa raison d’être et ne devait même pas s’appeler anglophobie.
Il ne mérite ce nom que lorsqu’il enveloppe dans la même haine et l’aristocratie et cette portion de la société anglaise qui a souffert autant et plus que nous de la prépondérance oligarchique, et lui a fait résistance, cette classe laborieuse, faible et impuissante d’abord, mais qui a grandi en richesse, en force, en influence assez pour entraîner de son côté une partie de l’aristocratie et tenir l’autre en échec ; classe à laquelle nous devrions tendre la main, dont nous devrions partager les sentiments et les espérances, si nous n’étions retenus par cette funeste et décourageante pensée que les progrès qu’elle doit au travail, à l’industrie et au commerce menacent notre prospérité et notre indépendance ; les menacent sous une autre forme, mais autant que pouvait le faire la politique des Walpole, des Pitt, etc., etc.
C’est ainsi que l’anglophobie s’est généralisée, et j’avoue que je ne puis voir qu’avec dégoût les moyens qui ont été employés pour l’entretenir et l’irriter. Premier moyen bien simple et non moins odieux ; il consiste à tirer parti de la diversité des langues. On a profité de ce que la langue anglaise était peu connue en France pour nous persuader que toute la littérature et le journalisme anglais n’étaient qu’outrages, insultes et calomnies perpétuellement vomis contre la France ; d’où elle ne pouvait manquer de conclure qu’elle était, de l’autre côté du détroit, l’objet d’une haine générale et inextinguible.
En cela on était merveilleusement servi par la liberté illimitée de la presse et de la parole qui existe chez nos voisins. En Angleterre, comme en France, il n’y a pas de question sur laquelle les avis ne se partagent ; en sorte qu’il est toujours possible, dans chaque occasion, de dénicher un orateur ou un journal qui a pris la question du côté qui nous blesse. L’odieuse tactique de nos journaux a été d’aller extraire, de ces discours et ces écrits, les passages les plus propres à humilier notre orgueil national, et de les donner comme l’expression de l’opinion publique en Angleterre, en ayant bien soin de tenir dans l’ombre tout ce qui s’était dit ou écrit dans le sens opposé, même par les journaux les plus influents et les orateurs les plus populaires. Le résultat a été ce qu’il serait, en Espagne, si la presse de ce pays tout entière s’entendait pour puiser toute citation de nos journaux dans la Quotidienne.
Un autre moyen, qui a été employé avec beaucoup de succès, c’est le silence. Chaque fois qu’une grande question s’est agitée, en Angleterre, et qu’elle a été de nature à révéler ce qu’il y avait dans ce pays de vie, de lumière, de chaleur et de sincérité, on peut être sûr que nos journaux se sont attachés à empêcher, par le silence, que le fait ne vînt à la connaissance du public français ; et, s’il l’a fallu, ils se sont imposé dix ans de mutisme. Quelque extraordinaire que cela paraisse, l’agitation anglaise contre le régime protecteur en fait foi.
Enfin, une autre fraude patriotique dont on a usé amplement, ce sont les fausses traductions, les additions, suppressions et substitutions de mots. En altérant ainsi le sens et l’esprit des discours, il n’est pas d’indignation qu’on n’ait pu soulever dans l’âme de nos compatriotes. Il suffisait, par exemple, quand on trouvait gallant French qui veut dire braves français (gallant, c’est le mot vaillant qui a été transporté en Angleterre et qui n’a subi d’autre changement que celui du v initial en p, à l’inverse de ce qui s’est fait pour les mots : garant, warrant, guêpe, wasp, guerre, war), de traduire ainsi : nation efféminée, galante, corrompue. Quelquefois on allait jusqu’à substituer le mot haine au mot amitié, et ainsi de suite. [103]
À ce propos, qu’il me soit permis de raconter l’origine du livre que je publiai, en 1845, sous le titre de Cobden et la Ligue.
J’habitais un village, au fond des Landes. Dans ce village, il y a un cercle, et j’étonnerais probablement beaucoup les membres du Jockey-club, si je transcrivais ici le budget de notre modeste association. Pourtant j’ose croire qu’il y règne une franche gaieté et une verve qui ne déshonorerait pas les somptueux salons du boulevard des Italiens. Quoi qu’il en soit, dans notre cercle on ne rit pas seulement, on politique aussi (ce qui est bien différent) ; car sachez qu’on y reçoit deux journaux. C’est dire que nous étions patriotes renforcés et anglophobes de premier numéro. — Pour moi, aussi versé dans la littérature anglaise qu’on peut l’être au village, je me doutais bien que nos gazettes exagéraient quelque peu la haine que, selon elles, le nom français inspirait à nos voisins, et il m’arrivait parfois d’exprimer des doutes à cet égard. Je ne puis comprendre, disais-je, pour quoi l’esprit qui règne dans le journalisme de la Grande-Bretagne ne règne pas dans ses livres. Mais j’étais toujours battu, pièces en main.
Un jour, le plus anglophobe de mes collègues, la fureur dans les yeux, me présente le journal et me dit : « Lisez et jugez. » Je lus en effet que le premier ministre d’Angleterre terminait ainsi un discours : « Nous n’adopterons pas cette mesure ; si nous l’adoptions, nous tomberions, comme la France, au dernier rang des nations. » — Le rouge du patriotisme me monta aussi au visage.
Cependant, à la réflexion, je me disais : il semble bien extraordinaire qu’un ministre, un chef de cabinet, un homme qui, par position, doit mettre tant de réserve et de mesure dans son langage, se permette envers nous une injure gratuite, que rien ne motive, ne provoque ni ne justifie. M. Peel ne pense pas que la France soit tombée au dernier rang des nations, et, le pensât-il, il ne le dirait pas en plein Parlement.
Je voulus en avoir le cœur net. J’écrivis le jour même à Paris pour qu’on m’abonnât à un journal anglais, en priant qu’on fît remonter l’abonnement à un mois.
Quelques jours après, je reçus une trentaine de numéros du Globe. [104] Je cherchai avec empressement la malencontreuse phrase de M. Peel, et je vis qu’elle disait : « Nous ne pourrions adopter cette mesure sans descendre au dernier rang des nations. » — Les mots comme la France n’y étaient pas.
Ceci me mit sur la voie, et je pus constater depuis lors bien d’autres pieuses fraudes dans la manière de traduire de nos journalistes.
Mais ce n’est pas là tout ce que m’apprit le Globe. Je pus y suivre, pendant deux ans, la marche et les progrès de la Ligue.
À cette époque, j’aimais ardemment, comme aujourd’hui, la cause de la liberté commerciale ; mais je la croyais perdue pour des siècles ; car on n’en parle pas plus chez nous qu’on n’en parlait probablement, en Chine, dans le siècle dernier. Quelles furent ma surprise et ma joie, quand j’appris que cette grande question agitait, d’un bout à l’autre, l’Angleterre et l’Écosse ; quand je vis cette succession non interrompue d’immenses meetings, et l’énergie, la persévérance, les lumières des chefs de cette admirable association !…
Mais ce qui me surprenait bien davantage, c’était de voir que la Ligue s’étendait, grandissait, versait sur l’Angleterre des flots de lumière, absorbait toutes les préoccupations des ministres et du Parlement, sans que nos journaux nous en dissent jamais un mot !…
Naturellement je me doutai qu’il y avait quelque corrélation entre ce silence absolu sur un fait aussi grave, et le système des fraudes pieuses en matière de traduction.
Pensant naïvement qu’il suffisait que ce silence fût rompu une fois pour qu’on n’y pût persister plus longtemps, je me décidai, en tremblant, à me faire écrivain ; et j’envoyai, sur la Ligue, quelques articles à la Sentinelle de Bayonne. Mais les journaux de Paris n’y firent aucune attention. — Je me mis à traduire quelques discours de Cobden, de Bright et de Fox, et les envoyai aux journaux de Paris eux-mêmes ; ils ne les insérèrent pas. — Il n’est pas possible, me dis-je, que le jour où la liberté commerciale sera proclamée en Angleterre nous surprenne dans cette ignorance. Je n’ai qu’une ressource, c’est de faire un livre……
Bornes que s'impose l’Association [3 Janvier 1847] ↩
BWV
1847.01.03 “Bornes que s'impose l'Association pour la liberté des échanges” (Limits which the Free Trade Association imposes) [*Libre-Échange*, 3 Janvier 1847] [OC2.3, p. 7]
Bornes que s’impose l’Association pour la liberté des échanges
3 Janvier 1847
Nous appelons l’impartiale et sérieuse attention du lecteur sur les limites que nous déclarons très-hautement imposer à notre action.
Certes, si nous courions après un succès de vogue, nous nous bornerions à crier : liberté ! liberté ! sans nous embarrasser dans des distinctions subtiles et risquer de consumer de longues veilles à nous faire comprendre. Mais ces subtilités, nous les avons regardées en face ; nous nous sommes assurés qu’elles sont dans la nature des choses et non dans notre esprit. Dès lors, aucune considération ne nous induira à rejeter la difficile tâche qu’elles nous imposent.
Croit-on que nous ne sentions pas tout ce que, en commençant, nous aurions de force si nous nous présentions devant le public avec un programme d’un seul mot : Liberté ? Si nous demandions l’abolition pure et simple de la douane, ou si du moins, ainsi que cela a eu lieu en Angleterre, nous posions comme ultimatum la radiation totale et immédiate d’un article bien impopulaire du tarif ?
Nous ne le faisons pas néanmoins. Et pourquoi ? Parce que nous mettons nos devoirs avant nos succès. Parce que nous sacrifions, volontairement, et les yeux bien ouverts, un moyen certain de popularité à ce que la raison signale comme juste et légitime, acceptant d’avance toutes les lenteurs, tous les travaux auxquels cette résolution nous expose.
La première limite que nous reconnaissons à la liberté des transactions, c’est l’honnêteté. Est-il nécessaire de le dire ? et ces hommes ne se découvrent-ils pas, ne laissent-ils pas voir qu’ils nous cherchent des torts imaginaires, ne pouvant nous en trouver de réels, qui nous accusent d’entendre par liberté le droit de tout faire, le mal comme le bien, — de tromper, frelater, frauder et violenter ?
Le mot liberté implique de lui-même absence de fraude et de violence ; car la fraude et la violence sont des atteintes à la liberté.
En matière d’échanges, nous ne croyons pas que le gouvernement puisse se substituer complétement à l’action individuelle, dispenser chacun de vigilance, de surveillance, avoir des yeux et des oreilles pour tous. Mais nous reconnaissons que sa mission principale est précisément de prévenir et réprimer la fraude et la violence ; et nous croyons même qu’il la remplirait d’autant mieux, qu’on ne mettrait pas à sa charge d’autres soins qui, au fait, ne le regardent pas. Comment voulez-vous qu’il perfectionne l’art de rechercher et punir les transactions déshonnêtes, quand vous le chargez de la tâche difficile et, nous le croyons, impossible, de pondérer les transactions innocentes, d’équilibrer la production et la consommation [1] ?
Une autre limite à la liberté des échanges, c’est l’impôt. Voilà une distinction, ou si l’on veut une subtilité à laquelle nous ne chercherons pas à échapper.
Il est évident pour tous que la douane peut être appliquée à deux objets fort différents, si différents que presque toujours ils se contrarient l’un l’autre. Napoléon a dit : La douane ne doit pas être un instrument fiscal, mais un moyen de protection. — Renversez la phrase, et vous avez tout notre programme.
Ce qui caractérise le droit protecteur, c’est qu’il a pour mission d’empêcher l’échange entre le produit national et le produit étranger.
Ce qui caractérise le droit fiscal, c’est qu’il n’a d’existence que par cet échange.
Moins le produit étranger entre, plus le droit protecteur atteint son but.
Plus le produit étranger entre, plus le droit fiscal atteint le sien.
Le droit protecteur pèse sur tous et profite à quelques-uns.
Le droit fiscal pèse sur tous et profite à tous.
La distinction n’est donc point arbitraire. Ce n’est pas nous qui l’avons imaginée. En l’acceptant nous ne faisons pas une concession, un pas rétrograde. Dès le premier jour, nous avons dit dans notre manifeste : « Les soussignés ne contestent pas à la société le droit d’établir, sur les marchandises qui passent la frontière, des taxes destinées aux dépenses communes, pourvu qu’elles soient déterminées par la seule considération des besoins du trésor. »
Pour rendre notre pensée plus claire, nous comparerons la douane à l’octroi.
Le tarif de l’octroi peut être plus ou moins bien conçu. Mais enfin chacun comprend qu’il a pour but exclusif l’impôt. Si un propriétaire parisien, qui aurait des arbres dans l’enclos de son hôtel, venait dire au conseil municipal : « Quadruplez, décuplez, centuplez le droit d’entrée sur les bûches, prohibez-les même, afin que je tire un meilleur parti de mon bois ; et si, les bûches n’arrivant plus du dehors, vous perdez une partie de vos recettes, frappez un impôt sur le peuple pour combler le vide. » N’est-il pas clair que cet homme voudrait enter sur l’octroi un nouveau principe, une nouvelle pensée ; — qu’il chercherait à le faire dévier de son but ; et ne serait-il pas naturel qu’une société se formât dans Paris pour combattre cette prétention, sans pour cela s’élever contre le tarif fiscal de l’octroi, sans le juger, sans même s’en occuper.
Cet exemple montre quelle est l’altitude que la Société du libre- échange entend garder à l’égard des impôts.
Cette attitude est celle de la neutralité.
Ainsi que nous l’avons dit dans notre manifeste, nous aspirons à ruiner la protection dans les esprits, afin qu’elle disparaisse de nos lois.
Vouloir en outre détruire la douane fiscale, ce serait nous donner une seconde mission toute différente de la première, Ce serait nous charger de juger les impôts, dire ceux qu’il faut supprimer, par quoi il faut les remplacer.
Certes aucun de nous ne renonce au droit sacré de scruter et combattre au besoin telle ou telle taxe. Nous trouvons même naturel que des associations se forment dans ce but. Mais ce n’est pas le nôtre. En tant qu’association, nous n’avons qu’un adversaire, c’est le principe restrictif qui s’est enté sur la douane et s’en est fait un instrument.
On nous demande : Pourquoi, dans ce cas, demander le libre-échange et non l’abolition du régime des douanes ?
Parce que nous ne regardons pas l’impôt en lui-même comme une atteinte à la liberté.
Nous demandons la liberté de l’échange comme on demandait la liberté de la presse, sans exclure qu’une patente dût être payée par l’imprimeur.
Nous demandons la liberté de l’échange comme on demande le respect de la propriété, sans refuser d’admettre l’impôt foncier.
On nous dit : Quand la douane, à vos yeux, cesse-t-elle d’être fiscale pour commencer à être protectrice ?
Quand le droit est tel que, s’il était diminué, il donnerait autant de revenu.
On insiste et l’on dit : Comment reconnaître dans la pratique ce point insaisissable ?
Eh ! mon Dieu, c’est bien simple, avec de la bonne volonté. Que l’opinion soit amenée à comprendre, c’est-à-dire à repousser la protection, et le problème sera bientôt résolu. Il n’y a pas de ministre des finances qui n’y donne la main. La difficulté, la seule difficulté est de faire qu’il soit soutenu par l’opinion publique.
FN:V. au tome IV, pages 327 et 342, les pamphlets l’État, la Loi ; et dans les Harmonies, le chap. xvii. (Note de l’éditeur.)
Organisation et liberté [Janvier 1847] ↩
BWV
1847.01.15 “Organisation et liberté” (Organisation and Liberty) [*Journal des Économistes*, Janvier 1847] [OC2.27, p. 147]
Organisation et liberté
Journal des économistes, Janvier 1847
M. Vidal fait injustice à ce qu’il nomme dédaigneusement les libéraux. (Il est de mode aujourd’hui de traiter du haut en bas la liberté et le libéralisme.) Si les libéraux ne demandent pas l’association dans un centre, puis l’association des centres, ce n’est pas qu’ils méconnaissent la puissance de l’organisation et le progrès qui est réservé à l’humanité dans cette voie. Mais quand on nous parle de demander une organisation à priori et de toutes pièces, qu’on nous dise donc ce qu’il faut demander, et à qui il faut le demander. Faut-il demander l’organisation Fourier, l’organisation Cabet, l’organisation Blanc, ou celle de Proudhon, ou celle de M. Vidal ? Ou bien M. Vidal entend-il que nous devons aussi, tous et chacun de nous, inventer une organisation quelconque ? Suffit-il de jeter sur le papier, ou, plus prudemment, de proclamer qu’on tient en réserve un système impossible-rationnel ou rationnel-impossible, pour être relevés, aux yeux de messieurs les socialistes, du rang infime qu’ils nous assignent dans la science ? N’est-ce qu’à cette condition qu’ils diront de l’économiste :
Dignus, dignus est intrare
In nostro docto corpore !
Que messieurs les socialistes veuillent bien croire une chose, c’est que nous sommes en mesure, nous aussi, d’imaginer des plans magnifiques et qui rendront l’humanité aussi heureuse qu’elle puisse l’être, à la seule condition qu’elle voudra bien les accepter ou se les laisser imposer. — Mais c’est là la difficulté.
Ces messieurs nous disent : Demandez. Mais que faut-il demander ?
Que messieurs les organisateurs me permettent de leur poser cette simple question :
Ils veulent l’association universelle.
Mais entendent-ils que les hommes y entrent librement ou par contrainte ?
Si c’est par contrainte (ce qu’il est permis de supposer, à voir la répugnance que la liberté semble leur inspirer), voici une série de petites difficultés qu’ils ont à résoudre.
1° Trouver l’autorité ou plutôt l’homme qui assujettira tous les mortels à l’organisation demandée. Sera-ce Louis-Philippe ? sera-ce le pape ? sera-ce l’empereur Nicolas ? — Louis-Philippe, on en conviendra, a peu de chances de réussir. — Le pape pourrait quelque chose sur les catholiques, mais bien peu sur les juifs et les protestants. — Et quant à Nicolas, autant il a d’ascendant en Moscovie, autant il en aurait peu en Suisse et aux États-Unis.
2° Mais supposons l’autorité trouvée, il s’agit de la déterminer dans le choix du plan à faire prévaloir. MM. Considérant, Blanc, Proudhon, Cabet, Vidal, etc., etc., défendront chacun le leur, c’est bien naturel ; faudra-t-il se décider après une comparaison approfondie, ou bien tirer à la courte paille ?
3° Cependant le choix est fait, je l’accorde, et ce n’est pas une petite concession. J’admets que le plan Vidal soit préféré. M. Vidal conviendra lui-même que son infaillibilité est bien désirable, car quand une fois le compelle intrare sera universellement en œuvre, il serait bien fâcheux que quelque plan plus beau vînt à se produire, puisque de deux choses l’une, ou il faudrait persévérer dans une organisation comparativement imparfaite, ou force serait à l’humanité de changer tous les matins d’organisation. Le seul moyen de sortir de là, c’est de décréter qu’à partir du jour où l’autorité aura jeté son mouchoir, le flambeau de l’imagination devra s’éteindre dans toutes les cervelles de la terre.
4° Enfin, il restera une difficulté qui n’est pas petite. Quand on aura armé l’autorité, comme il le faut bien dans l’hypothèse, de la puissance nécessaire pour vaincre toutes les résistances physiques, intellectuelles, morales, économiques, religieuses, comment empêchera-t-on cette autorité de devenir despotique et d’exploiter le monde à son profit ?
Il n’est donc pas possible, et il ne m’est pas venu dans la pensée que M. Vidal ait entendu parler d’une association universelle imposée par la force brutale.
Reste donc l’association universellement persuadée, ou autrement dit volontaire.
Ici nous entrons dans une autre série d’obstacles.
Deux hommes ne s’associent volontairement qu’après que les avantages et les inconvénients possibles de l’association ont été par chacun d’eux mûrement pesés, mesurés et calculés. Et encore, le plus souvent, ils se séparent brouillés.
Maintenant, comment déterminer un milliard d’hommes à former une Société ?
Rappelons-nous que les cinq sixièmes ne savent pas lire, qu’ils parlent des langues diverses et ne s’entendent pas entre eux ; qu’ils ont les uns contre les autres des préventions souvent injustes, quelquefois fondées ; qu’un grand nombre, malheureusement, ne cherchent que l’occasion de vivre aux dépens du prochain, qu’ils ne s’accordent jusqu’ici sur rien, pas même sur la question de savoir ce qui vaut mieux de la restriction ou de la liberté. Comment rallier immédiatement, toutes ces convictions à un système quelconque d’organisation ?
Alors surtout qu’on leur en présente une quarantaine à la fois, et que l’imprimerie peut en jeter trente tous les matins sur la place ?
Ramener instantanément le genre humain à une conviction uniforme ! Hélas ! j’ai vu trois hommes s’unir dans la même entreprise, sincèrement persuadés qu’un même principe les animait ; je les ai vus en désaccord après une heure d’explication.
Mais quand un plan, entre mille autres, obtiendrait l’assentiment au moins de la majorité, dans l’exécution vous retrouveriez presque toutes les difficultés de l’association forcée, le choix de l’autorité, la puissance à lui confier, les garanties contre l’abus de cette puissance, etc. [1].
Vous voyez bien qu’une organisation de toutes pièces n’est pas réalisable ; et cela seul devrait nous induire à rechercher s’il n’y a point dans l’ordre social une organisation naturelle non point parfaite, mais tendant au perfectionnement. Pour moi, je le crois, et c’est cette naturelle organisation que j’appelle l’économie de la société.
Les socialistes admettent le libre-échange en principe. Seulement ils en ajournent l’avènement après la réalisation d’un de leurs systèmes quelconques. — C’est plus qu’une question préjudicielle, c’est une fin de non-recevoir absolue. — Mais, après tout, qu’est-ce donc qu’une association volontaire ? Elle suppose au moins que les hommes ont une volonté. Pour mettre en commun sa propriété, il faut avoir une propriété, être libre d’en disposer, ce qui implique le droit de la troquer. L’association elle-même n’est qu’un échange de services, et je présume bien que les socialistes l’entendent ainsi. Dans leur système rationnel, celui qui rendra des services en recevra à son tour, à moins qu’ils n’aient décidé que tous les services rendus seront d’un côté et tous les services reçus de l’autre, comme sur une plantation des Antilles.
Si donc ce à quoi vous aspirez est une association volontaire, c’est-à-dire un échange volontaire de services, c’est précisément ce que nous appelons liberté des échanges, qui n’exclut aucune combinaison, aucune convention particulière, en un mot, aucune association, pourvu qu’elle ne soit ni immorale ni forcée. Que ces messieurs trouvent donc bon que nous réclamions la liberté d’échanger, sans attendre que tous les habitants de notre planète, depuis le Patagon jusqu’au Hottentot, depuis le Cafre jusqu’au Samoïède, se soient préalablement mis d’accord s’ils s’associeront, c’est-à-dire s’ils régleront l’échange de leurs services, selon l’invention Fourier ou selon la découverte Cabet. De grâce, qu’il nous soit permis d’abord d’échanger selon la forme vulgaire : Donne-moi ceci, et je te donnerai cela ; fais ceci pour moi, et je ferai cela pour toi. Plus tard nous adopterons peut-être ces formes perfectionnées par les socialistes, si perfectionnées qu’eux-mêmes les déclarent au-dessus de l’intelligence de notre pays et de notre siècle.
Que les socialistes ne concluent pas de là que nous repoussons l’association. Qui pourrait avoir une telle pensée ? Quand certaines formes d’association, par exemple les sociétés par actions, se sont produites dans le monde, nous ne les avons pas excommuniées au nom de l’économie politique ; seulement, nous ne pensons pas qu’une forme définitive d’association puisse naître, à un jour donné, dans la tête d’un penseur et s’imposer au genre humain. Nous croyons que l’association, comme tous les principes progressifs de l’humanité, s’élabore, se développe, s’étend successivement avec la diffusion des lumières et le perfectionnement des mœurs.
Il ne suffit pas de dire aux hommes : Organisez-vous ! il faut qu’ils aient toutes les connaissances, toute la moralité que l’organisation volontaire suppose ; et pour qu’une organisation universelle prévale dans l’humanité (si c’est sa destinée d’y arriver), il faut que des formes infinies d’associations partielles soient soumises à l’épreuve de l’expérience, et aient développé l’esprit d’association lui-même. En un mot, vous mettez au point de départ et sous une forme arbitraire la grande inconnue vers laquelle gravite l’humanité.
Il y a dix-huit siècles, une parole retentit dans le monde : Aimez-vous les uns les autres. Rien de plus clair, de plus simple, de plus intelligible. En outre, cette parole fut reçue non comme un conseil humain, mais comme une prescription divine. — Et pourtant, c’est au nom de ce précepte que les hommes se sont longtemps entre-égorgés en toute tranquillité de conscience.
Il n’y a donc pas un moment où l’humanité puisse subir une brusque métamorphose, se dépouiller de son passé, de son ignorance, de ses préjugés, pour commencer une existence nouvelle sur un plan arrêté d’avance. Les progrès naissent les uns des autres, à mesure que s’accroît le trésor des connaissances acquises. Chaque siècle ajoute quelque chose à l’imposant édifice, et nous croyons, nous, que l’œuvre spéciale de celui où nous vivons est d’affranchir les relations internationales, de mettre les hommes en contact, les produits en communauté et les idées en harmonie, par la rapidité et la liberté des communications.
Cette œuvre ne vous paraît-elle pas assez grande ? — Vous nous dites : « Commencez par demander l’abolition préalable de la guerre. » Et c’est ce que nous demandons, car certainement l’abolition de la guerre est impliquée dans la liberté du commerce. La liberté assure la paix de deux manières : dans le sens négatif, en extirpant l’esprit de domination et de conquête, et dans le sens positif, en resserrant le lien de solidarité qui unit les hommes. — Vous nous dites : « Provoquez la constitution du congrès de la paix, » Et c’est ce que nous faisons ; nous provoquons un congrès, non d’hommes d’État et de diplomates, car de ces congrès il ne sort bien souvent que des arrangements artificiels, des équilibres factices, des forces nullement combinées et toujours hostiles ; mais le grand congrès des classes laborieuses de tous les pays, le congrès où, sans mémorandum, ultimatum et protocole, se stipulera, par l’entrelacement des intérêts, le traité de paix universelle.
Comment se fait-il donc que les socialistes, dans leur amour de l’humanité, ne travaillent pas avec nous à l’œuvre de la liberté, qui n’est au fond que l’affranchissement et la réhabilitation du travailleur ? — Le dirai-je ? C’est que, lancés à la poursuite d’organisations imaginaires, ils ont trop dédaigné d’étudier l’organisation naturelle, telle qu’elle résulte de la liberté des transactions. Que M. Vidal me permette de le lui dire : je crois sincèrement qu’il condamne l’économie politique sans l’avoir suffisamment approfondie. J’en trouve quelques preuves dans ses lettres à la Presse.
Adoptant la distinction favorite de ce journal, M. Vidal ferait bon marché de la protection agricole et métallurgique, et voici pourquoi :
« Une simple modification dans les tarifs peut jeter la perturbation dans l’industrie manufacturière. À la différence des produits agricoles et des produits des mines, les produits manufacturés peuvent être multipliés indéfiniment… Ici donc il faut opérer avec une prudence extrême. »
Toujours des subtilités pour échapper à la grande loi de justice.
Et ces subtilités, quelle valeur ont-elles en elles-mêmes ? Faites-nous donc la grâce de nous dire comment on peut multiplier indéfiniment le drap, produit manufacturé, sans multiplier indéfiniment la laine, produit agricole ? Comment expliquez-vous que la production du fil et de la toile puisse être illimitée, si celle du lin est forcément bornée ? Le contraire serait plus vrai. La laine étant la matière dont le drap est fait, on peut concevoir qu’il se produise plus de laine que de drap, mais non assurément plus de drap que de laine. Et voilà par quels raisonnements on justifie l’inégalité devant la loi !
« On peut dégrever notablement tous les objets que la France ne produit pas. »
Sans doute, on le peut, en faisant un vide au trésor.
Direz -vous qu’on le comblera avec d’autres impôts ? Reste à savoir s’ils ne seront pas plus onéreux que celui qui grève le thé et le cacao. Direz-vous qu’on diminuera les dépenses publiques ? Reste à savoir s’il ne vaut pas mieux faire servir l’économie à dégrever la poste et le sel que le cacao et le thé.
M. Vidal pose encore ce principe : — « Les tarifs protecteurs devraient toujours tendre à garantir à nos agriculteurs et à nos ouvriers leurs frais rigoureux. »
Ainsi, on ne sera plus déterminé à faire la chose parce qu’elle couvre ses frais, mais l’État assurera les frais, au moyen d’une subvention, parce qu’on se sera déterminé à faire la chose. Il faut convenir que, sous un tel régime, on peut tout entreprendre, même de dessaler l’Océan.
« N’est-il pas étrange, s’écrie M. Vidal, que nos manufacturiers manquent de débouchés, quand les deux tiers de nos concitoyens sont vêtus de haillons ? »
Non, cela n’a rien d’étrange sous un système où l’on commence par ruiner la puissance de consommation des deux tiers de nos concitoyens pour assurer aux industries privilégiées leurs frais rigoureux.
Si les deux tiers de nos concitoyens sont couverts de haillons, cela ne prouve-t-il point qu’il n’y a pas assez de laine et de drap en France, et n’est-ce point un singulier remède à la situation que de défendre à ces Français mal vêtus de faire venir du drap et de la laine des lieux où ces produits surabondent ?
Sans pousser plus loin l’examen de ces paradoxes, nous croyons devoir, avant de terminer, protester avec énergie contre l’attribution d’une doctrine qui, non-seulement n’est pas la nôtre, mais que nous combattons systématiquement comme nos devanciers l’ont combattue, doctrine qu’exclut le mot même économie politique, économie du corps social. Voici les paroles de M. Vidal :
« Le principe fondamental des libéraux, ce qui domine leurs théories politiques et leurs théories économiques, c’est l’individualisme, l’individualisme poussé jusqu’à l’exagération, poussé même jusqu’au point de rendre toute société impossible. Pour eux, tout émane de l’individu, tout se résume en lui. Ne leur parlez point d’un prétendu droit social supérieur au droit individuel, de garanties collectives, de droits réciproques : ils ne reconnaissent que les droits personnels. Ce qui les préoccupe surtout, c’est la liberté dont ils se font une idée fausse, c’est la liberté purement nominale. Selon eux, la liberté est un droit négatif bien plutôt qu’un droit positif ; elle consiste non point dans le développement progressif et harmonique de toutes les facultés humaines, dans la satisfaction de tous les besoins intellectuels, moraux et physiques, mais dans l’absence de tout frein, de toute limite, de toute règle, principalement dans l’absence de subordination à toute autorité quelconque. C’est la faculté de faire tout ce qu’on veut, du moins tout ce qu’on peut, le bien comme le mal, à la rigueur, sans admettre d’autre principe de conduite que l’intérêt personnel.
L’état de société, ils le subissent parce qu’ils sont forcés de reconnaître que l’homme ne peut s’y soustraire : mais leur idéal serait ce qu’ils appellent l’état de nature, ce serait l’état sauvage. L’homme libre par excellence, à leurs yeux, c’est celui qui n’est soumis à aucune règle, à aucun devoir, dont le droit n’est point limité par le droit d’autrui ; c’est l’homme complétement isolé, c’est Robinson dans son ile. Ils voient dans l’état social une dérogation à la loi naturelle ; ils pensent que l’homme ne peut s’associer à ses semblables sans sacrifier une partie de ses droits primitifs, sans aliéner sa liberté.
Ils ne comprennent pas que l’homme, créature intelligente et sympathique, c’est-à-dire essentiellement sociable, nait, vit et se développe en société, et ne peut naître, vivre, se développer sans cela ; que dès lors le véritable état de nature, c’est précisément l’état de société. Dans un accès de misanthropie, ou plutôt dans un accès de colère contre les vices de notre civilisation, Rousseau avait voulu réhabiliter la sauvagerie. Les libéraux sont encore aujourd’hui sous l’influence de cet audacieux sophisme. Ils croient que tous sont d’autant plus libres que chacun peut donner le plus libre essor à ses caprices, à sa liberté personnelle, sans s’inquiéter de la liberté et de la personnalité d’autrui. Autant vaudrait dire : — Dans une sphère déterminée, plus chacun prend d’espace, plus il en reste pour tous les autres. »
M. Vidal nous ferait presque douter qu’il eût jamais ouvert un livre d’économie politique, car ils ne sont autre chose que la réfutation méthodique de ce sophisme que M. Vidal leur impute.
J.-B. Say commence ainsi son cours: « Les sociétés sont des corps vivants, » et ses six volumes ne sont que le développement de cette pensée.
Quant à Rousseau et à son prétendu état de nature, il n’a jamais été réfuté, à ma connaissance, avec autant de logique que par Ch. Comte (Traité de législation).
M. Dunoyer, prenant l’homme à l’état sauvage, et le suivant dans tous les degrés de civilisation, montre que plus il déploie de qualités sociales, plus il approche de sa vraie nature (De la liberté du travail).
Ce n’est donc point dans nos rangs qu’il faut chercher des admirateurs de cette théorie de Rousseau. Pour les trouver dans notre dix-neuvième siècle, il faut s’adresser à une école qui se croit fort avancée, parce que, selon elle, le pays n’est pas en état de la comprendre. Voici ce qu’on lit dans la Revue indépendante. C’est M. Louis Blanc qui donne des conseils aux Allemands :
Après avoir opposé l’école démocratique à l’école libérale ; Après avoir dit que l’école démocratique est issue du Contrat social, qu’elle domina la Révolution par le Comité de salut public, et (afin qu’il n’y ait point de méprise) qu’elle fut vaincue au 9 thermidor ;
Après avoir fait de l’école libérale le même portrait qu’en donne M. Vidal : « elle proclame le laissez faire, elle nie le principe d’autorité, elle livre chacun à ses propres forces, etc. ; »
M. Blanc harangue ainsi son vaste auditoire :
« Et maintenant, souvenez-vous, Allemands, que le représentant de la Démocratie, fondée sur l’unité et la fraternité, au dix-huitième siècle, ce fut J.-J . Rousseau. Or, J.-J. Rousseau n’avait pas été conduit par la pensée dans le désert où quelques-uns de vous s’égarent ; Jean-Jacques n’était pas athée ; Jean-Jacques, de la même plume qui nous donna le Contrat social, écrivait la Profession de foi du vicaire savoyard. Songez-y bien, Allemands, si vous prenez votre point de départ dans la philosophie matérialiste où nous avons pris le nôtre, philosophie que combattit en vain Jean-Jacques, grand homme venu trop tôt, vous exposez l’Allemagne aux troubles mortels qui ont désolé la France. »
Ainsi la filiation est bien tracée : Rousseau pour point de départ, le Comité de salut public et les hommes vaincus au 9 thermidor pour modèles.
À la bonne heure. Mais, quand on nous accuse, d’un côté, de ne pas descendre de Rousseau, on ne devrait pas nous reprocher, de l’autre, d’être sous l’influence de cet audacieux sophiste.
FN:V. t. VI, chap. I. (Note de l’éditeur.)
L’utopiste [17 January 1847] [CW3 ES2.11]↩
BWV
1847.01.17 “L’utopiste" (The Utopian) [*Libre-Échange*, 17 January 1847] [ES2.11] [OC4.2.11, pp. 203-12] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
L'échelle mobile [24 Janvier 1847] ↩
BWV
1847.01.24 “L’échelle mobile” (The Sliding Scale) [*Libre-Échange*, 24 Janvier 1847] [OC2.9, p. 44]
L'échelle mobile
24 Janvier 1847
Le gouvernement a demandé que le jeu de l’échelle mobile fût suspendu pendant les huit mois qui sont devant nous. Hélas ! que n’a-t-il la puissance de donner à cette mesure un effet rétroactif et de faire que l’échelle mobile ait été suspendue pendant les huit mois qui viennent de s’écouler ! Nous n’en serions pas où nous en sommes ; la crise des subsistances et la crise financière auraient probablement passé inaperçues.
Notre loi céréale séduit beaucoup d’esprits par son air de bonhomie et d’impartialité.
Quoi de plus simple ! Y a-t-il abondance ? La porte d’entrée se ferme d’elle-même et l’agriculteur n’est pas ruiné. — Y a-t-il disette? La porte s’ouvre naturellement, et le consommateur n’est pas affamé. Ainsi un niveau salutaire est toujours maintenu par une loi si prévoyante, et personne n’a à se plaindre.
Mais, dans l’application, ce nivellement si désiré rencontre des difficultés qu’on n’avait pas prévues et qu’on n’a pas assez étudiées. D’abord, comment se reconnaît l’abondance ou la disette ? par le prix. Et comment signifier à la douane, à chaque instant donné, le prix réel, afin qu’elle sache si elle doit renforcer ou relâcher ses exigences ? Évidemment cela n’est pas possible. Ce n’est donc jamais le prix réel qui sert de règle, mais un prix ancien, fictif, résultat de moyennes fort difficiles à constater, en sorte que l’action de la loi n’a de relations qu’avec un état de choses passé, que l’on suppose fort gratuitement durer encore quand elle opère.
Nous ne parlerons pas ici des zones qu’il a fallu créer, des marchés qu’il a fallu prendre pour types, des prix régulateurs, des prix moyens, des relations entre le prix du froment et celui des autres grains, toutes choses qui ne constituent qu’une série de fictions, modifiées par d’autres fictions, le tout érigé chaque mois en corps de système.
Et voilà sur quelles bases on veut que le commerce établisse ses opérations ! Le commerce a bien assez des chances que lui présentent les variations naturelles des prix, sans s’exposer à toutes celles qui résultent de ces combinaisons factices. Quand on fait venir du blé, on consent à s’exposera perdre sur la vente, mais non à ce que la vente elle-même soit défendue au moment de l’arrivage. Ainsi, dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune régularité dans les opérations commerciales relatives au blé, et, par conséquent, aucune fixité dans le taux de la subsistance.
La question est de savoir si, avec une entière liberté d’importation et d’exportation, on n’approcherait pas plus sûrement de ce nivellement si recherché, de cette régularité des prix si précieuse.
Supposons que la liberté commerciale fût le droit des nations, et cherchons à nous rendre compte de ce qui serait arrivé cette année.
Certes, nous ne dirons pas qu’il n’y eût pas eu une crise des subsistances. Sous quelque régime que ce soit, la perte d’une récolte ne saurait être une chose indifférente. Il aurait fallu, pour vivre, avoir recours aux blés étrangers et, par conséquent, les payer. Il y aurait donc eu probablement un dérangement dans l’alimentation du peuple, et un dérangement corrélatif dans la circulation monétaire.
Mais combien l’une et l’autre de ces crises n’eussent-elles pas été adoucies et affaiblies !
Dès les premiers symptômes du déficit de la récolte, la spéculation eût commencé son œuvre. Elle aurait préparé ses moyens dans tous nos ports de l’Océan et de la Méditerranée. On n’aurait pas vu des grains devant être consommés à Bayonne aller se dénationaliser à Gênes et acquitter les droits à Cherbourg. On aurait fait des achats considérables dans la mer Noire, dans la Baltique, aux États-Unis, en temps opportun. Ces approvisionnements se seraient présentés, par arrivages successifs, dans chacun de nos ports et en proportion du besoin qui s’y serait manifesté. Les moyens de transport pour l’intérieur se seraient organisés avec ensemble. On n’aurait pas vu des masses énormes arriver le même jour, sans savoir comment se faire interner, mais soumises à une hâte fiévreuse par la crainte de quelque dérangement dans le jeu de notre échelle mobile. La hausse eût été moins brusque, moins sensible, moins effrayante, moins propre à frapper et à exalter les imaginations.
Il est permis de croire que l’ensemble des achats à l’étranger se fût fait à des prix moins élevés. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les ports de la mer Noire ; mais nous serions bien trompés si des ordres considérables, plus ou moins imprévus, se manifestant subitement, n’y ont pas produit de la confusion et une hausse anormale des prix. Probablement ce qui est arrivé ici, pour le transport du point de débarquement au lieu de consommation, a dû se répéter là-bas pour le transport du lieu de production au port d’embarquement. Probablement les détenteurs de blés, les entrepreneurs de charrois, les capitaines de navires ont tiré parti de l’empressement convulsif que chacun mettait à parcourir vite, coûte que coûte, le cercle de la spéculation. Quand on peut être accueilli en France par une loi qui vous dit : la porte est close, — on ne regarde pas à quelques frais.
Si donc le grain fût arrivé successivement, depuis l’instant où le besoin s’est fait sentir, s’il eût coûté moins cher de prix d’achat, s’il eût occasionné moins de frais, soit pour le transport par mer, soit pour les deux transports par terre en Russie et en France, le résultat évident est que nous aurions été mieux approvisionnés et à un taux moins élevé.
En outre, nous aurions eu moins d’argent à payer aux étrangers, soit pour le blé lui-même, soit pour les frais accessoires. L’exportation du numéraire eût été moindre et répartie sur un temps plus long. En d’autres termes, la crise monétaire eût été moins sensible.
Ce n’est pas tout encore ; sous un régime de liberté commerciale établi de longue main, les peuples qui nous envoient des céréales se seraient accoutumés à consommer des produits de notre travail et de notre industrie. Nous les payerions en grande partie en étoffes, en instruments aratoires, en vins, en soieries ; et notre exportation de métaux précieux aurait été neutralisée dans la même proportion.
La loi actuelle n’a donc rien fait pour diminuer les souffrances du peuple, les embarras commerciaux et financiers de notre situation. Elle a, au contraire, beaucoup fait pour aggraver tous les effets de cette crise. — Or, et il faut bien remarquer ceci, cette loi dont les malheurs publics révèlent le vice, puisqu’on la met de côté, n’a pourtant agi que dans le sens de ses propres tendances. Donc ces tendances sont mauvaises. Elles le sont en temps d’abondance comme en temps de disette. Seulement ce n’est que lorsque le malheur arrive que nous ouvrons les yeux, et nous nous figurons alors qu’il suffit de suspendre momentanément la loi. Comme ce malade à qui l’on dit : Ce qui aggrave vos souffrances, c’est que vous suivez un mauvais régime hygiénique. — Eh bien ! répondit-il je vais le suspendre… tant que je souffrirai.
M. de Noailles à la Chambre des pairs [24 January 1847] ↩
BWV
1847.01.24 "M. de Noailles à la Chambre des Pairs" (M. de Noailles to the Chamber of Peers)[*Libre-Échange*, 24 January 1847] [OC2.38, p. 216-19]
M. de Noailles à la chambre des pairs
24 Janvier 1847
Notre mission est de combattre cette fausse et dangereuse économie politique qui fait considérer la propriété d’un peuple comme incompatible avec la prospérité d’un autre peuple, qui assimile le commerce à la conquête, le travail à la domination. Tant que ces idées subsisteront, jamais le monde ne pourra compter sur vingt-quatre heures de paix. Nous dirons plus, la paix serait une absurdité et une inconséquence.
Voici ce que nous lisons dans le discours qu’a prononcé ces jours-ci M. de Noailles à la Chambre des pairs :
« On sait que l’intérêt de l’Angleterre serait l’anéantissetnent du commerce de l’Espagne pour qu’elle pût l’inonder du sien… L’anarchie entretient la faiblesse et la pauvreté, et l’Angleterre trouve son profit à ce que l’Espagne soit faille et pauvre… En un mot, et c’est dans la nature des choses, la politique de l’Angleterre la porte à vouloir posséder l’Espagne pour l’annuler, afin d’avoir… à nourrir et à vêtir un peuple nombreux. » (Très-bien.)
Nous mettons de côté, bien entendu, la question espagnole et diplomatique. Nous nous bornons à signaler l’absurdité et le danger de la théorie professée ici par le noble pair.
Dire qu’un pays commercial et industriel a intérêt à annuler tous les autres, afin de les inonder de ses produits, afin d’en nourrir, vêtir, loger, héberger les habitants, c’est renfermer en deux lignes un si grand nombre de contradictions, qu’on ne sait comment s’y prendre seulement pour les montrer [1].
Ce qui fait la richesse d’un négociant, c’est la richesse de sa clientèle ; et, quand M. de Noailles affirme que l’Angleterre veut appauvrir ses acheteurs, j’aimerais autant lui entendre dire que la maison Delisle, notre voisine, attend pour faire fortune que Paris soit ruiné, qu’on n’y donne plus de bals et que les dames y renoncent à la toilette.
D’un autre côté, il semble, d’après M. de Noailles, qu’un peuple spécialement aspire à nourrir et vêtir tous les autres, — qu’en cela ce peuple fait un calcul, et, ce qui est fort étrange, un bon calcul. Ce peuple désire qu’on ne travaille nulle part, afin de travailler pour tout le monde. Son but est de mettre à la portée de chacun le vivre et le couvert, sans jamais rien accepter de personne, tout ce qu’il accepterait étant une perte pour lui ; et enfin, voici le comble du merveilleux, M. de Noailles croit et dit, sans rire, que c’est par une semblable politique que l’Angleterre, donnant beaucoup et recevant peu, appauvrit les autres et s’enrichit elle-même.
En vérité, il est temps qu’un pareil tissu de banalités cesse d’être la pâture intellectuelle de notre pays. Nous sommes décidés, quant à nous, à flétrir ces doctrines à mesure qu’elles oseront se produire et de quelque bouche qu’elles émanent ; car elles ne sont pas seulement ridiculement absurdes, elles sont surtout anarchiques et antisociales. En effet, à moins de vouloir s’en tenir à de puériles déclamations, il faut bien reconnaître que le mobile qui fait agir les producteurs est le même dans tous les pays. Si donc le travailleur anglais a intérêt à l’abaissement et à la ruine du globe, il en est de même de tous les travailleurs belges, français, espagnols, allemands ; et nous vivons dans un monde où nul ne peut s’élever que par la destruction de l’humanité tout entière.
Mais, dira-t-on, M. de Noailles n’a fait qu’exprimer une idée généralement reçue. N’est-il pas vrai que les Anglais cherchent surtout des débouchés, et que par conséquent leur but principal est de vendre, non d’acheter ?
Non, cela n’est pas vrai, et ne le serait pas alors que les Anglais le croiraient eux-mêmes. Nous convenons que, pour leur malheur et celui du monde, ce faux principe, qui est celui du régime protecteur, a dirigé toute leur politique pendant des siècles ; ce qui explique et justifie les défiances universelles dont M. de Noailles a été l’organe. Mais enfin, l’Angleterre s’est placée aujourd’hui sous l’influence d’un principe diamétralement opposé, le principe de la liberté ; et, dans cet ordre d’idées, ce qui est vrai, le voici ; c’est beaucoup plus simple et beaucoup plus consolant :
Les Anglais désirent jouir d’une foule de choses qui ne viennent pas dans leur île, ou qui n’y viennent qu’en quantité insuffisante. Ils veulent avoir du sucre, du thé, du café, du coton, du bois, des fruits, du blé, du beurre, de la viande, etc. Pour obtenir ces choses au dehors, il faut les payer, et ils les payent avec les produits de leur travail. — Les importations d’un peuple sont les jouissances qu’il se procure, et ses exportations sont le payement de ces jouissances. Le but réel de toute nation (quoi qu’elle en pense elle-même) est d’importer le plus possible et d’exporter le moins possible, comme le but de tout homme, dans ses transactions, est d’obtenir beaucoup en donnant peu.
Que de peine il faut pour faire comprendre une vérité si simple ! — Et pourtant il faut qu’elle soit comprise. La paix du monde est à ce prix.
FN:Cette pensée qui a plus d’une fois excité la juste indignation de Bastiat (V. la page 462 du tome III), est encore le thème favori de l’école protectionniste. Elle a été récemment reproduite, sous une forme pompeuse, par un écrivain de cette école, M. Ch. Gouraud, à la page 259 de son Essai sur la liberté du commerce des nations. (Note de l’éditeur.)
Réflexions sur l'année 1846 [30 Janvier 1847] ↩
BWV
1847.01.30 “Réflexions sur l'année 1846” (Reflections on the year 1846) [*Libre-Échange*, 30 Janvier 1847] [OC2.6, p. 22]
Réflexions sur l’année 1846
30 Janvier 1847
L’année 1846 sera pour l’économiste et l’homme d’État un précieux sujet d’étude. En France et en Angleterre dans les deux pays les plus éclairés, toutes les lois restrictives, qui devaient amener l’abondance, tombent devant la disette. Chose étonnante ! on a recours, pour nourrir le peuple, à cette même liberté qui, disait-on, est un principe de souffrance et de ruine. Il y a là une contradiction flagrante, et s’il est dans la nature de la restriction d’assurer des prix de revient aux industries agricole et manufacturière, et, par suite, des salaires aux ouvriers, c’était le cas plus que jamais de renforcer le système restrictif, alors que les prix de revient échappaient aux agriculteurs, et, par suite, les salaires aux ouvriers ; mais si on eût été assez fou, on n’eût pas été assez fort.
En France comme en Angleterre, les mesures qu’on a décrétées pour ramener l’abondance sont provisoires, comme si l’on voulait que la subsistance du peuple ne fût assurée que provisoirement. Car, enfin, les régimes opposés de la restriction et de la liberté ont chacun leurs tendances. Lequel des deux tend à accroître les moyens de subsistance et de satisfaction ? Si c’est le régime restrictif, il le faut conserver en tout temps, et surtout quand les causes d’un autre ordre menacent nos approvisionnements. Si c’est le régime libre, acceptons donc la liberté, non pas d’une manière transitoire, mais permanente.
Un trait fort caractéristique de notre époque, c’est que sous l’empire de la nécessité, on a eu recours, des deux côtés de la Manche, à des mesures libérales, tout en déclamant contre la liberté. On s’est beaucoup élevé au Parlement et dans nos Chambres contre l’avidité des spéculateurs. On leur reproche les bénéfices qu’ils font, soit sur le blé, soit sur les transports ; et l’on ne prend pas garde que c’est précisément ce bénéfice qui est le stimulant de l’importation, et qui fait surgir, quand le besoin s’en manifeste, des moyens de transport.
Ces moyens ont manqué entre Marseille et Lyon ; et l’on reproche, d’une part, aux voituriers d’avoir haussé le prix de leurs services, et, de l’autre, au gouvernement de n’être pas intervenu pour forcer les entrepreneurs de charrois à travailler sur le principe de la philanthropie [1].
Supposons qu’il y ait 100 tonneaux à transporter d’un point à un autre, et qu’il n’y ait de ressources que pour porter 10 tonneaux. Si l’intervention du gouvernement, ou même le sentiment philanthropique empêche le prix de transport de s’élever, qu’arrivera-t-il ? 10 tonneaux seront transportés à Lyon, et les consommateurs de ces 10 tonneaux, s’ils n’ont point un excédant de prix à payer pour le transport, auront cependant à surpayer le blé, précisément parce que 10 tonneaux seulement seront arrivés. En définitive, Lyon aura 90 tonneaux de déficit et Marseille 90 tonneaux d’excédant. Il y aura perte pour tout le monde. perte pour le spéculateur marseillais, perte pour le consommateur lyonnais, perte pour l’entrepreneur de transport. Si, au contraire, la liberté est maintenue, le transport sera cher, nous en convenons, puisque, dans l’hypothèse, il n’y a de ressources que pour le transport de 10 tonneaux quand il y a 100 tonneaux à transporter. Mais c’est cette cherté même qui fera affluer de tous les points les voitures vers Marseille, en sorte que la concurrence rétablira le prix du fret à un taux équitable, et les 100 tonneaux arriveront à leur destination.
Nous comprenons que, lorsqu’un obstacle se présente, la première pensée qui vienne à l’esprit, c’est de recourir au gouvernement. Le gouvernement dispose de grandes forces ; et, dès lors, il peut presque toujours vaincre l’obstacle qui gêne. Mais est-il raisonnable de s’en tenir à cette première conséquence et de fermer les yeux sur toutes celles qui s’ensuivent ? Or, si le premier effet de l’action gouvernementale est de vaincre l’obstacle présent, le second effet est d’éloigner et de paralyser toutes les forces individuelles, toute l’activité commerciale. Dès lors pour avoir agi une fois, le gouvernement se voit dans la nécessité d’agir toujours. Il arrive ce que nous voyons en Irlande, où l’État a insensiblement accepté la charge impossible de nourrir, vêtir et occuper la population tout entière.
Un autre trait fort remarquable, c’est l’accès inattendu de philanthropie qui a saisi tout à coup les monopoleurs. Eux, qui pendant tant d’années ont opéré systématiquement la cherté du blé à leur profit, ils se révoltent maintenant avec une sainte ardeur contre tout ce qui tend à renchérir le blé, notamment contre les profits du commerce et de la marine. À la Chambre des lords, le fameux protectionniste lord Bentinck a fait une violente sortie contre les spéculateurs ; et rappelant que Nadir Shah avait fait pendre un Arménien pour avoir accumulé du blé et créé ainsi une hausse artificielle : « Je suivrais volontiers cette politique, a-t-il ajouté, seulement en modifiant la forme du châtiment. » Hélas ! si depuis 1815 on avait pendu tous ceux qui ont causé artificiellement une hausse du prix des produits, toute l’Angleterre y aurait passé, à commencer par l’aristocratie, et lord Bentinck en tôle. En France, il faudrait pendre les trois quarts de la nation, et notamment tous les pairs et tous les députés, puisqu’ils viennent de voter qu’au mois d’août prochain la cherté artificielle recommencerait par la résurrection de l’échelle mobile.
FN:Voir le chap. vi de Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, tome V, page 356. (Note de l’éditeur.)
Inanité de la protection de l'agriculture [31 Janvier 1847] ↩
BWV
1847.01.31 “Inanité de la protection de l'agriculture” (The Inanity of the Protection of Agriculture) [*Libre-Échange*, 31 Janvier 1847] [OC2.8, p. 39]
Inanité de la protection de l'agriculture
31 Janvier 1847
Si les agriculteurs, que le passé a si peu instruits, ne commencent pas à ouvrir les yeux sur l’avenir, il faut qu’ils soient étrangement séduits par ce que semble renfermer de promesses ce mot même, protection. — Être protégé ! — Et pourquoi pas, quand on le peut ? Pourquoi refuserions-nous des faveurs, des mesures qui améliorent nos prix de vente, écartent des rivaux redoutables, et, si elles ne nous enrichissent guère, retardent au moins notre ruine ? — Voilà ce qu’ils disent ; mais ne nous laissons pas tromper par un mot, et allons au fond des choses,
La protection est une mesure par laquelle on interdit au producteur national les marchés étrangers, au moins dans une certaine mesure, lui réservant en compensation le marché national.
Qu’on lui ferme, dans une certaine mesure, les marchés extérieurs, cela est évident de soi. Pour s’en convaincre, il suffit de se demander ce qui arriverait si la protection était poussée jusqu’à sa dernière limite. Supposons que tous les produits étrangers fussent prohibés. En ce cas, nous n’aurions aucun payement à exécuter au dehors, et, par conséquent, nous n’exporterions rien. Sans doute, l’étranger pourrait encore, pendant quelque temps, venir nous acheter quelques objets contre des écus. Mais bientôt l’argent abonderait chez nous, il y serait déprécié ; en d’autres termes, nos produits seraient chers et nous ne pourrions plus en vendre. La défense de rien importer équivaudrait à celle de rien exporter.
Dans aucun pays, le système protecteur n’a été poussé jusque-là. Par cela seul qu’il est irrationnel, on ne l’adopte jamais complétement. On y fait de nombreuses exceptions, et il est tout naturel, comme on va le voir, que l’on place dans l’exception, avant tout et principalement, le produit agricole.
Le système protecteur repose sur cette méprise : il considère dans chaque produit, non point son utilité pour la consommation, mais son utilité pour le producteur. Il dit : le fer est utile en ce qu’il procure du travail aux maîtres de forges, le blé est utile en ce qu’il procure du travail au laboureur, etc. C’est là une absurde pétition de principe. Mais cette absurdité, fort difficile à démêler à l’égard de beaucoup de produits, saute aux yeux, quant aux produits agricoles, quand le besoin s’en fait sentir. Dès que la disette arrive, les esprits les plus prévenus comprennent parfaitement que le blé est fait pour l’estomac, et non l’estomac pour le blé. — Et voilà pourquoi, aux premiers symptômes de famine, la théorie protectrice, s’évanouit, et la porte s’ouvre aux blés étrangers.
Ainsi, la protection à la plus importante des productions agricoles, celle des céréales, est complétement illusoire ; car elle ne manque jamais d’être retirée, précisément aux époques où elle aurait quelque efficacité. — Quand la récolte est bonne, il n’y a pas à craindre l’invasion des blés étrangers, et notre loi stipule la protection, mais ne l’opère pas. Quand la récolte manque, c’est alors que l’introduction du blé étranger est provoquée par la différence des prix ; c’est alors aussi que le principe de la protection, qui consiste à voir l’utilité des choses au point de vue du producteur national, c’est alors, disons-nous, que ce principe devrait dominer notre législation. — Et c’est précisément alors qu’il la déserte. Pourquoi ? Parce que ce principe est faux, et que le cri de la faim fait bientôt prévaloir la vérité du principe contraire, l’intérêt du consommateur.
Aussi, le blé est la seule chose qui soit soumise au jeu de l’échelle mobile, parce que c’est la seule chose où la vérité des principes ait surmonté les préjugés protectionnistes. La cherté du fer et du drap est certainement de la même nature que la cherté du blé. Elle produit des inconvénients, sinon égaux, au moins du même ordre, et qui ne différent que par le degré. Mais la loi maintient la cherté du fer et du drap envers et contre tous, parce que la population laisse faire, parce qu’elle peut se passer de fer et de drap sans mourir. En fait de blé, elle ne laisse pas faire. Aussi le blé n’est protégé que dans les années d’abondance, c’est-à-dire qu’il n’est pas protégé du tout.
Car si le tarif, en fait de blé, eût été conséquent à son principe et fidèle à l’intérêt producteur, voici comment il eût raisonné (puisqu’il raisonne ainsi en toute autre matière) :
« Je dois assurer à l’agriculteur le prix de revient de son blé. L’année dernière, l’agriculteur a labouré, hersé, ensemencé et sarclé son champ, qui lui a donné 10 hectolitres de blé. Ses avances et sa juste rémunération s’élèvent à 180 fr. — Il a vendu son blé à 18 fr. Il doit être satisfait. — Cette année il a fait les mêmes avances en labours, hersages, semailles, etc. ; — Mais la moisson a trompé son attente, et il n’a que 5 hectolitres de blé. Il faut donc qu’il le vende à 36 fr., sans quoi il perd, et j’ai été décrété précisément pour le garantir de cette perte, pour lui assurer son prix de revient. »
Or, c’est justement cette année-là que le tarif déserte son principe et dit : L’intérêt des estomacs est l’intérêt dominant. — Il embrasse ainsi involontairement le principe de la liberté, le seul principe vrai et raisonnable, et il ouvre les portes.
Le tarif trompe donc l’agriculteur. Il lui assure le prix de revient quand ce prix est assuré par la nature des choses, et ne s’en mêle plus quand son intervention serait efficace.
Mais ce n’est pas tout. — Une législation basée sur un principe faux s’arrête toujours avant les dernières conséquences, parce que les dernières conséquences d’un faux principe sont elles-mêmes d’une absurdité qui saute aux yeux. Aussi voyons-nous qu’il est de nombreux produits auxquels on n’accorde la protection qu’en tremblant ; ce sont ceux dont l’utilité, pour le consommateur, est tellement palpable, qu’à leur égard le vrai principe se fait jour malgré qu’on en ait. Pour tâcher de réconcilier ici les principes, on a fait de ces produits une classe qu’on appelle matières premières ; et puis on a dit que la protection sur ces produits avait de grands dangers [1]. Or, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire : L’utilité de ces choses, relativement au consommateur, est telle qu’ici du moins nous sommes forcés, sinon de rendre hommage explicitement à la vérité des principes, du moins d’agir comme si nous les reconnaissions, sauf à mettre nos doctrines, à l’abri, en entassant subtilités sur subtilités.
Mais si les agriculteurs voulaient y voir un peu plus loin que le bout de leur nez, ils sauraient à quoi cela mène. Car une chose est bien claire : c’est que le régime restrictif, après leur avoir donné, quant aux céréales, une protection inefficace et illusoire, abandonnera aussi en première ligne, grâce à la fameuse théorie des matières premières, la laine, le lin, le chanvre et tous les produits agricoles.
Et quand les agriculteurs auront livré leurs produits aux manufacturiers au prix fixé par l’universelle concurrence, ils rachèteront ces mêmes produits façonnés en toile et en drap, aux prix du monopole. En d’autres termes, il y aura deux classes de travail en France : le travail agricole non privilégié, et le travail manufacturier privilégié. — L’effet de ce régime sera de faire sortir de plus en plus les hommes et les capitaux de l’agriculture pour les pousser vers les fabriques, jusqu’à ce que ces deux grands effets définitifs se produisent :
1° La concurrence intérieure, parmi les fabricants, leur arrachera les profits que la protection avait prétendu leur conférer ;
2° Un grand déplacement se sera opéré, une grande déperdition de forces se sera accomplie ; pendant que les débouchés extérieurs seront fermés à nos fabriques, la ruine, au dedans, du public consommateur, dont la classe agricole forme les deux tiers, leur fermera aussi les débouchés intérieurs ; et l’industrie manufacturière portera le double châtiment de ses prétentions injustes et de ses funestes erreurs.
On a beau dire et beau faire. Il n’y a qu’une bonne politique : c’est celle de la Justice.
Certainement, nous ne chercherons pas à nous concilier la classe agricole par de trompeuses promesses. Nous lui disons tout net qu’elle ne doit pas être, qu’elle ne peut pas être et qu’elle n’est pas protégée ; que la protection dont elle croit jouir, quant aux céréales, est illusoire ; que celle qu’elle retient encore sur les matières premières va lui échapper. Mais nous ajoutons : si l’on ne peut pas donner aux agriculteurs des suppléments de prix, au moyen de taxes (qu’ils payent eux-mêmes pour les deux tiers), il ne faut pas du moins les forcer, au moyen d’autres taxes, de donner des suppléments de prix aux maîtres de forges, aux manufacturiers, aux armateurs, aux actionnaires de mines. Liberté, justice, égalité pour tout le monde.
FN:V. au tome IV, le chap. xxi, page 105. (Note de l’éditeur.)
L'Angleterre et le libre-échange [6 Février 1847] ↩
BWV
1847.02.06 “L’Angleterre et le libre-échange” (England and Free Trade) [*Libre-Échange*, 6 Février 1847] [OC2.32, p. 177]
L’Angleterre et le libre-échange
6 Février 1847
Pendant quelque temps, la tactique des prohibitionnistes consistait à nous représenter comme des dupes et presque comme des agents de l’Angleterre. Obéissant au mot d’ordre du comité central de Paris, tous les comités de province, d’un bout de la France à l’autre, ont répété que l’Anglais Cobden était venu inspirer et organiser l’Association pour la liberté des échanges. En ce moment encore, une société d’agriculture met en fait que — Cobden parcourt la France pour y propager ses doctrines, et elle ajoute, par voie d’insinuation, que les manufacturiers ses compatriotes ont mis à cet effet deux millions à sa disposition.
Nous avons cru devoir traiter cette stratégie déloyale avec le mépris qu’elle mérite. Les faits répondaient pour nous. L’association du libre-échange a été fondée à Bordeaux le 10 février, à Paris en mars, à Marseille en août, c’est-à-dire plusieurs mois avant le triomphe inattendu de la ligue anglaise, avant les réformes de sir R. Peel, avant que Cobden eût jamais paru en France. C’est plus qu’il n’en faut pour nous justifier d’une accusation plus absurde encore qu’odieuse.
D’ailleurs, Bordeaux n’a-t-il pas réclamé de tout temps contre l’exagération des tarifs ? MM. d’Harcourt et Anisson-Duperron ne défendent-ils pas, depuis qu’il y a une tribune en France, le principe de la liberté commerciale ? M. Blanqui ne l’enseigne-t-il pas depuis dix-sept ans au Conservatoire, et M. Michel Chevalier depuis six ans au Collége de France ? M. Léon Faucher n’a-t-il pas publié, dès 1845, ses Études sur l’Angleterre ? MM. Wolowski, Say, Reybaud, Garnier, Leclerc, Blaise, etc., ne soutiennent-ils pas la même cause dans le Journal des économistes, depuis la fondation de cette revue ? Enfin, la grande lutte entre le Droit commun et le Privilége ne remonte-t-elle pas au temps de Turgot, et même de Colbert et de Sully ?
Loin de croire que ces clameurs ridicules pussent arrêter le progrès de notre cause, il nous paraissait infaillible qu’elles tournassent tôt ou tard à la confusion de ceux qui se les permettent. Nous sommes, disions-nous, devant un public intelligent, par qui de semblables moyens sont bientôt appréciés ce qu’ils valent. Quand une grande question se pose devant lui, calomnier, incriminer les intentions, dénaturer les faits, tout cela n’a qu’un temps. Il arrive un moment où il faut enfin donner des raisons.
C’est là que nous attendions nos adversaires, et c’est là qu’ils seront amenés. Déjà la dernière brochure émanée du comité Odier s’abstient de ces emportements haineux et colériques qui ne prouvent qu’une chose : c’est que ceux qui s’y livrent sentent la faiblesse de leur cause.
Cependant, n’avons-nous pas trop dédaigné les traits empoisonnés de la calomnie ? Il y a longtemps que Basile l’a dit : « Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose. »
Il en reste quelque chose, surtout quand, après avoir émis l’accusation, on a les moyens de la semer dans les ateliers où l’on sait bien que le démenti ne parviendra pas ; quand on s’est assuré le concours de plusieurs organes de la presse, de ceux qui comptent leurs abonnés par dizaines de mille ; quand on peut ainsi répéter un fait faux, le sachant faux, pendant plusieurs mois, tous les matins, imprimé en lettres majuscules.
Oh ! il faut avoir une bien grande foi dans la liberté de la discussion et le triomphe de la vérité, pour ne pas se sentir découragé à l’aspect de cette triple alliance entre la calomnie, le monopole et le journalisme.
Mais une circonstance qui seconde et rend plus dangereuse encore la machiavélique stratégie des monopoleurs, c’est que, lorsqu’ils cherchent à irriter le sentiment de la nationalité et à soulever les passions populaires contre l’Angleterre, ils s’adressent à un sentiment existant dans le pays, qui y a de profondes racines, qui s’explique, nous dirons même qui se justifie par l’histoire. Ils n’ont pas besoin de le faire naître ; il leur suffit de lui donner une mauvaise direction, de l’égarer dans une fausse voie. Nous croyons le moment venu de nous expliquer sur ce point délicat.
Une théorie, que nous croyons radicalement fausse, a dominé les esprits pendant des siècles, sous le nom de système mercantile. Cette théorie, faisant consister la richesse, non dans l’abondance des moyens de satisfaction, mais dans la possession des métaux précieux, inspira aux nations la pensée que, pour s’enrichir, il ne s’agit que de deux choses : acheter aux autres le moins possible, vendre aux autres le plus possible. C’était, pensait-on, un moyen assuré d’acquérir le seul trésor véritable, l’or, et en même temps d’en priver ses rivaux ; en un mot, de mettre de son côté la balance du commerce et de la puissance.
Acheter peu conduisait aux tarifs protecteurs. Il fallait bien préserver, fût-ce par la force, le marché national de produits étrangers qui auraient pu venir s’y échanger contre du numéraire.
Vendre beaucoup menait à imposer, fût-ce par la force, le produit national aux marchés étrangers. Il fallait des consommateurs assujettis. De là, la conquête, la domination, les envahissements, le système colonial.
Beaucoup de bons esprits croient encore à la vérité économique de ce système ; mais il nous semble impossible de ne pas s’apercevoir que, pratiqué en même temps par tous les peuples, il les met dans un état forcé de lutte. Il est manifeste que l’action de chacun y est antagonique à l’action de tous. C’est un ensemble d’efforts perpétuels qui se contrarient. Il se résume dans cet axiome de Montaigne : « Le profit de l’un est le dommage de l’autre. »
Or, cette politique, nul peuple ne l’a embrassée avec autant d’ardeur, ou, si l’on veut, de succès, que le peuple anglais. L’intérêt oligarchique et l’intérêt commercial, ainsi compris, se sont trouvés d’accord pour infliger au monde cette série d’exclusions et d’empiétements qui a enfanté ce qu’il y a d’artificiel dans la puissance britannique telle que nous la voyons aujourd’hui. Le point de départ de cette politique fut l’acte de navigation, et le préambule de ce document disait en propres termes : « Il faut que l’Angleterre écrase la Hollande ou qu’elle soit écrasée. »
Il n’est pas surprenant, il est même très-naturel que cette action malfaisante de l’Angleterre sur le monde ait provoqué une réaction plus ou moins sourde, plus ou moins explicite chez tous les peuples, et particulièrement chez le peuple français ; car l’Angleterre ne peut manquer de rencontrer toujours la France en première ligne sur son chemin, soit que celle-ci, obéissant à la même politique, aspirât à la même domination, soit qu’elle cherchât à propager les idées d’affranchissement et de liberté.
Cet antagonisme d’idées et d’intérêts n’a pu se poursuivre pendant des siècles, amener tant de guerres, se manifester dans tant de négociations, sans déposer dans le cœur de nos concitoyens un levain d’irritation et de défiance toujours prêt à éclater. L’Angleterre, sous l’action du système mercantile, y a subordonné toutes ses forces militaires, navales, financières, diplomatiques. Garantie par la mer contre toute invasion, placée entre le nord et le sud de l’Europe, elle a profité de cette situation pour saper toute puissance qui osait se manifester, tantôt menaçant le despotisme septentrional des mouvements démocratiques du Midi, tantôt étouffant les aspirations libérales du midi sous le despotisme soudoyé du Nord.
Les personnes, et elles sont nombreuses, qui croient encore, par un faux raisonnement ou par un faux instinct, au système mercantile, considèrent et doivent considérer le mal comme irrémédiable et la lutte comme éternelle. C’est ce qu’elles expriment par cette assertion qu’on croit profonde et qui n’est que triste : « Les Français et les Anglais sont des ennemis naturels. »
Cela dépend de savoir si la théorie mercantile, qu’a jusqu’ici professée et pratiquée l’Angleterre, et qui ne pouvait manquer de lui attirer la haine des peuples, est vraie ou fausse, bonne ou mauvaise. Voilà la question.
Nous croyons, nous, qu’elle est fausse et mauvaise : mauvaise pour l’Angleterre elle-même, surtout pour elle ; qu’elle devait aboutir à la mettre en guerre avec le genre humain, à lui créer des résistances sur tous les points du globe, à tendre tous les ressorts de sa puissance, à la mêler à toutes les intrigues diplomatiques, à accroître indéfiniment le nombre de ses fonctions parasites, ses forces de terre et de mer, à l’écraser d’impôts et de dettes, à élever un édifice toujours prêt à crouler, et si dispendieux que toute son énergie industrielle n’y pourrait suffire ; et tout cela pour poursuivre un but chimérique et absurde en lui-même, celui de vendre sans acheter, celui de donner sans recevoir, celui de nourrir et vêtir les peuples ruinés (comme le disait M. de Noailles) [1], c’est-à-dire, en définitive, celui de soumettre ses propres citoyens à un travail excessif et comparativement privé de rémunération effective.
Or, ce système spécieux mais faux, pourquoi ne provoquerait-il pas une réaction parmi les classes laborieuses d’Angleterre, puisque c’est sur elles qu’en devraient retomber à la longue les funestes conséquences ?
Et c’est là tout ce que nous disons. Nous soutenons, non-seulement parce que c’est une déduction rationnelle à notre point de vue, mais encore parce que c’est un fait qui crève les yeux, nous soutenons qu’il y a en Angleterre un parti nombreux, animé d’une foi économique précisément contraire à celle qui a dominé jusqu’ici dans les conseils de cette nation.
Nous affirmons que, par les efforts de ce parti, soutenu par le progrès des lumières et les leçons de l’expérience, l’Angleterre est amenée à changer du tout au tout son système commercial et par suite son système politique.
Nous disons qu’au lieu de chercher la richesse par l’accroissement indéfini des exportations, l’Angleterre comprend enfin que ce qui l’intéresse est de beaucoup importer, et que ce qu’elle donne de ses produits n’est et ne peut être que le payement de ce qu’elle reçoit et consomme de produits étrangers.
C’est là, quoi qu’on en dise, l’inauguration d’une politique toute nouvelle, car si recevoir est l’essentiel, il s’ensuit qu’elle doit ouvrir ses portes au lieu de les fermer ; il s’ensuit qu’elle doit désirer, dans son propre intérêt, le développement du travail et l’activité de la production chez tous les peuples ; il s’ensuit qu’elle doit successivement démolir tout cet échafaudage de monopoles, d’envahissements, d’empiétements et d’exclusion élevé sous l’influence du régime protecteur ; il s’ensuit, enfin, qu’elle doit renoncer à cette politique antisociale qui lui a servi à fonder un monstrueux édifice [2].
Sans doute nos adversaires ne peuvent comprendre ce changement. Attachés par conviction à la théorie mercantile, c’est-à-dire à un principe d’antagonisme international, ils ne peuvent pas se figurer qu’un autre peuple adopte le régime de la liberté, parce que, à leur point de vue, cela supposerait un acte de dévouement, d’abnégation et de pure philanthropie.
Mais ils devraient au moins reconnaître qu’à nos yeux il n’en est pas ainsi. Jamais nous n’avons dit que les réformes accomplies en Angleterre dans le sens libéral, et celles qui se préparent encore, soient dues à un accès de philanthropie qui aurait saisi tout à coup la classe laborieuse de l’autre côté du détroit.
Notre conviction est qu’un peuple qui adopte le régime restrictif se précipite dans une politique antisociale et en même temps fait pour lui-même un mauvais calcul ; qu’au contraire une nation qui affranchit ses échanges fait un bon calcul pour elle-même, tout en agissant dans le sens du bien universel. On peut dire que nous nous faisons illusion ; on ne peut pas dire que ce ne soit pas là notre foi.
Or, si telle est notre foi, comment pourrions-nous, sans inconséquence, envelopper dans la même réprobation et cette ancienne politique qui, depuis l’acte de navigation jusqu’à nos jours, a fait le malheur de l’humanité, et cette politique nouvelle que nous avons vue poindre en Angleterre, et qui grandit à vue d’œil, développée et soutenue par une opinion publique éclairée ?
On nous dit : « Vous êtes dupes d’un simple revirement de tactique ; l’Angleterre change de moyens, elle ne change pas de but : elle aspire toujours à la domination. Maintenant qu’elle a tiré de la protection, de la force, de la diplomatie, du machiavélisme, tout ce qu’ils peuvent donner, elle a recours à la libre concurrence. Elle a commencé l’œuvre de sa domination par la supériorité de ses flottes, elle veut l’achever par la supériorité de son travail et de ses capitaux. Loin de renoncer à ses vues, le moment est venu pour elle de les réaliser et d’étouffer partout le travail et l’industrie sous l’action de sa rivalité irrésistible. »
Voilà ce qu’on dit. Et nous trouvons ces appréhensions très-naturelles chez les personnes qui n’ont point approfondi les lois générales par lesquelles les peuples prospèrent et dépérissent.
Pour nous, nous ne croyons point qu’on puisse arriver à la domination par la supériorité du travail libre. Il répugne à notre intelligence d’assimiler ainsi des choses contradictoires, telles que le travail et la force, la liberté et le monopole, la concurrence et l’exclusion. Si des principes aussi opposés devaient conduire aux mêmes résultats, il faudrait désespérer de la nature humaine et dire que l’anarchie, la guerre et le pillage sont l’état naturel de l’humanité.
Nous examinerons dans un prochain article [3] l’objection que nous venons de reproduire. Ici nous avons voulu expliquer le sentiment de défiance qui existe dans notre pays à l’égard de l’Angleterre. Nous avons voulu dire ce qui le justifie et dans quelle mesure nous le partageons. En Angleterre, deux partis, deux doctrines, deux principes sont en présence et se livrent en ce moment une lutte acharnée. L’un de ces principes s’appelle privilége ; l’autre se nomme droit commun.' Le premier a constamment prévalu jusqu’à nos jours, et c’est à lui que se rattache toute cette politique jalouse, astucieuse et antisociale qui a excité en France, en Europe, et en Angleterre même, parmi les classes laborieuses, un sentiment de répugnance et de résistance que nous comprenons et que nous éprouvons plus que personne. Par un juste retour des choses d’ici-bas, nous pensons que ce sentiment pèsera sur l’Angleterre et lui fera obstacle, même longtemps après qu’elle aura officiellement renoncé à la politique qui l’a fait naître.
Mais nous ne nous croyons pas tenus de partager à cet égard le préjugé vulgaire ; et si nous voyons surgir de l’autre côté du détroit le principe du droit commun, si nous le voyons soutenu par des hommes éclairés et sincères, si c’est notre conviction que ce principe mine en dessous et fera bientôt crouler l’édifice élevé par le principe opposé, nous ne voyons pas pourquoi, tout en attachant sur les manœuvres oligarchiques un regard vigilant, nous n’accompagnerions pas de nos vœux et de nos sympathies un mouvement libéral dans lequel nous voyons le signal de l’affranchissement du monde, le gage de la paix et le triomphe de la justice.
FN:V. ci-après le n° 37. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome III, Deux Angleterres, pages 459 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV, le chap. Domination par le travail, page 265. (Note de l’éditeur.)
Deux principes [Two Principles] [7 February 1847] [CW3 ES3.2]↩
BWV
1847.02.07 “Deux principes” (Two Principles) [*Libre-Échange*, 7 February 1847] [OC2.54, pp. 363-70] [CW3] [ES3.2]
— Je viens de lire un chef-d’œuvre sur le libre-échange.
— Qu’en pensez-vous?
— J’en penserais tout le bien possible, si je n’avais lu immédiatement après un chef-d’œuvre sur la protection.
— Vous donnez donc la préférence à ce dernier ?
— Oui ; si je n’avais lu le premier immédiatement avant.
— Mais enfin, lequel des deux vous a convaincu ?
— Ni l’un ni l’autre, ou plutôt l’un et l’autre ; car, arrivé au bout, je disais comme Henri IV sortant du plaid : Ils ont, ma foi, tous deux raison.
— En sorte que vous n’en êtes pas plus avancé ?
— Heureux si je n’étais pas plus reculé ! car il m’est ensuite tombé sous la main un troisième factum, intitulé : Contradictions économiques, où Liberté et Non-Liberté, ' Protection et Non-Protection sont arrangées de la belle manière. Vraiment, monsieur, la tête m’en tourne.
Vo solcando un mar crudele
Senza vele
E senza sarte.
Orient et Occident, Zénith et Nadir, tout se confond dans ma tête, et je n’ai pas la plus petite boussole pour me reconnaître au milieu de ce dédale. Ceci me rappelle la triste position où je me suis trouvé il y a quelques années.
— Contez-moi cela, je vous prie.
— Nous chassions, Eugène et moi, entre Bordeaux et Bayonne, dans ces vastes landes où rien, ni arbres ni clochers, n’arrête le regard. La brunie était épaisse. Nous fîmes tant de tours et de détours à la poursuite d’un lièvre, qu’enfin…
— Vous le prîtes ?
— Non, ce fut lui qui nous prit, car le drôle parvint à nous désorienter complétement. Le soir une roule ignorée se présente à nous. À ma grande surprise, Eugène et moi nous nous tournons le dos. Où vas-tu, lui dis-je ? — À Bayonne. — Mais tu prends la direction de Bordeaux. — Tu te moques, le vent est Nord et il nous glace les épaules. — C’est qu’il souffle du Sud. — Mais ce matin le soleil s’est levé là. — Non, il a paru ici. — Ne vois-tu pas devant nous les Pyrénées ? — Ce sont des nuages qui bordent la mer. Bref, jamais nous ne pûmes nous entendre.
— Comment cela finit-il ?
— Nous nous assîmes au bord du chemin, attendant qu’un passant nous tirât de peine. Bientôt un voyageur se présente : Monsieur, lui dis-je, voici mon ami qui prétend que Bayonne est à gauche, et je soutiens qu’il est à droite. — Mes beaux Messieurs, répondit-il, vous avez, chacun de vous, un peu tort et un peu raison. Gardez-vous des idées arrêtées et des systèmes absolus. Bonsoir ! — Et il partit. J’étais tenté de lui envoyer une pierre dans le dos, quand j’aperçus un second voyageur qui venait vers nous. — Je l’accostai le plus poliment du monde, et lui dis : Brave homme, nous sommes désorientés. Dites-nous si, pour rentrer à Bayonne, il faut marcher par ici ou par là. — Ce n’est pas la question, nous dit-il : l’essentiel est de ne pas franchir la distance qui vous sépare de Bayonne, d’un seul bond et sans transition. Cela ne serait pas sage, et vous risqueriez de vous casser le nez. — Monsieur, lui dis-je, c’est vous qui n’êtes pas dans la question. Quant à notre nez, vous y prenez trop d’intérêt. Soyez sûr que nous y veillerons nous-mêmes. Cependant, avant de nous décider à marcher vite ou lentement, il faut bien que nous sachions de quel côté il faut marcher. — Mais le maroufle insistant : Marchez progressivement, nous dit-il, et ne mettez jamais un pied devant l’autre sans avoir bien réfléchi aux conséquences. Bon voyage. — Ce fut heureux pour lui qu’il y eût du plomb de loup dans mon fusil ; s’il n’y eût eu que de la grenaille, franchement, j’aurais criblé au moins la croupe de sa monture.
— Pour punir le cavalier. Ô justice distributive !
— Survint un troisième voyageur. Il avait l’air grave et posé. J’en augurai bien, et lui adressai ma question : De quel côté est Bayonne ? — Chasseur diligent, me dit-il, il faut distinguer entre la théorie et la pratique. Étudiez bien la configuration du sol, et si la théorie vous dit que Bayonne est vers le bas, marchez vers le haut.
— Mille bombes! m’écriai-je, avez-vous tous juré ?…
— Ne jurez pas vous-même. Et dites-moi quel parti vous prîtes.
— Celui de suivre la première moitié du dernier conseil. Nous examinâmes l’écorce des bruyères, la pente des eaux. Une fleur nous mit d’accord. Vois, dis-je à Eugène, elle a coutume de se pencher vers le soleil
Et cherche encor le regard de Phébus.
Donc, Bayonne est là. Il se soumit à ce gracieux arbitrage, et nous cheminâmes d’assez bonne intelligence. Mais, chose singulière ! Eugène avait de la peine à laisser le monde tel qu’il est, et l’univers, faisant un demi-tour dans son imagination, le replaçait sans cesse sous l’empire de la même erreur.
— Ce qui est arrivé à votre ami, en géographie, vous arrivera souvent en économie politique. La carte se retourne dans le cerveau, et l’on trouve alors des donneurs d’avis de la même force.
— Que faut-il donc faire ?
— Ce que vous avez fait : apprendre à s’orienter.
— Mais dans les landes de l’économie politique, trouverai-je, pour me guider, une pauvre petite fleur ?
— Non, mais un principe,
— Ce n’est pas si gracieux. Et y a-t-il véritablement une idée claire, simple, qui puisse servir de fil conducteur à travers ce labyrinthe ?
— Il y en a une.
— Dites-la-moi de grâce,
— Je préfère que vous la disiez vous-même. Répondez-moi. À quoi le blé est-il bon ?
— Eh parbleu ! à être mangé.
— Voilà un principe.
— Vous appelez cela un principe ? En ce cas, j’en fais souvent, comme M. Jourdain de la prose, sans le savoir.
— C’est un principe, vous dis-je, et le plus méconnu quoique le plus vrai de tous ceux qui ont jamais figuré dans un corps de doctrine. — Et, dites-moi, le blé n’a-t-il pas encore une autre utilité ?
— À quoi serait-il utile, sinon à être mangé ?
— Cherchez bien.
— Ah ! j’y suis : à procurer du travail au laboureur.
— Vous y êtes en effet. Voilà un autre principe.
— Diantre ! je ne croyais pas qu’il fût si facile de faire des principes. J’en dis un à chaque mot.
— N’est-il pas vrai que tous les produits imaginables ont les deux genres d’utilité que vous venez d’assigner au blé ?
— Que voulez-vous dire ?
— À quoi sert la houille ?
— À nous fournir de la chaleur, de la lumière, de la force.
— Ne sert-elle pas à autre chose ?
— Elle sert encore à procurer du travail aux mineurs, aux voituriers, aux marins.
— Et le drap n’a-t-il pas deux espèces d’utilité ?
— Si fait. Il garantit du froid et de la pluie. De plus, il donne du travail au berger, au fileur, au tisseur.
— Pour vous prouver que vous avez bien réellement émis deux principes, permettez-moi de les revêtir d’une forme générale. Le premier dit : Les produits sont faits pour être consommés ; le second : Les produits sont faits pour être produits.
— Voilà que je recommence à comprendre un peu moins.
— Je vais donc varier le thème :
Premier principe : L’homme travaille pour consommer.
Second principe : L’homme consomme pour travailler.
Premier principe : Le blé est fait pour les estomacs.
Second principe : Les estomacs sont faits pour le blé.
Premier principe : Les moyens sont faits pour le but.
Second principe : Le but est fait pour les moyens.
Premier principe : Le laboureur laboure afin qu’on mange.
Second principe : On mange afin que le laboureur laboure.
Premier principe : Les bœufs vont devant la charrette.
Second principe : La charrette va devant les bœufs.
— Juste ciel ! quand je disais : Le blé est utile parce qu’on le mange, et puis : Le blé est utile parce qu’on le cultive, j’émettais, sans m’en douter, ce torrent de principes ?
Par la sambleu ! Monsieur, je ne croyais pas être
Si savant que je suis.
— Tout beau ! vous n’avez dit que deux principes, et moi, je les ai mis en variations.
— Mais où diable en voulez-vous venir ?
— À vous faire connaître la bonne et la mauvaise boussole, au cas que vous vous égariez jamais dans le dédale économique. Chacune d’elles vous guidera, selon un orientement opposé, l’une vers le temple de la vérité, l’autre dans la région de l’erreur.
— Voulez-vous dire que les deux écoles, libérale et protectionniste, qui se partagent le domaine de l’opinion, diffèrent seulement en ceci, que l’une met les bœufs avant la charrette, et l’autre, la charrette avant les bœufs ?
— Justement. Je dis que si l’on remonte au point précis qui divise ces deux écoles, on le trouve dans l’application vraie ou fausse du mot utilité. Ainsi que vous venez de le dire vous-même, chaque produit a deux espèces d’utilité : l’une est relative au consommateur, et consiste à satisfaire des besoins ; l’autre a trait au producteur, et consiste à être l’occasion d’un travail. On peut donc appeler la première de ces utilités fondamentale, et la seconde occasionnelle. L’une est la boussole de la vraie science, l’autre la boussole de la fausse science. Si l’on a le malheur, comme cela est trop commun, de monter à cheval sur le second principe, c’est-à-dire de ne considérer les produits que dans leurs rapports avec les producteurs, on voyage avec une boussole retournée, on s’égare de plus en plus ; on s’enfonce dans la région des priviléges, des monopoles, de l’antagonisme, des jalousies nationales, de la dissipation, de la réglementation, de la politique de restriction et d’envahissement ; en un mot, on entre dans une série de conséquences subversives de l’humanité, prenant constamment le mal pour le bien, et cherchant dans des maux nouveaux le remède aux maux qu’on a fait surgir de la législation. Si, au contraire, on prend pour flambeau et pour boussole, au point de départ, l’intérêt du consommateur, ou plutôt de la consommation générale, on s’avance vers la liberté, l’égalité, la fraternité, la paix universelle, le bien-être, l’épargne, l’ordre et tous les principes progressifs du genre humain. [105]
— Quoi ! ces deux axiomes : Le blé est fait pour être mangé ; le blé est fait pour être cultivé, peuvent conduire à des résultats si opposés ?
— Très-certainement. Vous savez l’histoire de ces deux navires qui voyageaient de conserve. Un orage vint à éclater. Quand il fut dissipé, il n’y avait rien de changé dans l’univers, si ce n’est qu’une des deux boussoles, par l’effet de l’électricité, se tournait vers le sud. Mais c’est assez pour qu’un navire fasse fausse route pendant l’éternité entière, du moins tant qu’il obéit à celle fausse indication.
— Je vous avoue que je suis à mille lieues de comprendre l’importance que vous attachez à ce que vous appelez deux principes (quoique j’aie eu l’honneur de les trouver), et je serais bien aise que vous me fissiez connaître toute votre pensée.
— Eh bien ! écoutez-moi, je divise mon sujet en…
— Miséricorde ! je n’ai pas le temps de vous écouter. Mais dimanche prochain je suis tout à vous.
— Je voudrais bien pourtant…
— Je suis pressé. Adieu.
— À présent que je vous tiens…
— Oh ! vous ne me tenez pas encore. À dimanche. [106]
— À dimanche, soit. Dieu, que les auditeurs sont légers !
— Ciel ! que les démonstrateurs sont lourds !
Domination par le travail [14 February 1847] [CW3 ES2.17]↩
BWV
1847.02.14 “Domination par le travail” (Domination through Work) [*Libre-Échange*, 14 February 1847] [ES2.17] [OC4.2.17, pp. 265-71] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Curieux phénomène économique. - La Réforme financière en Angleterre [21 Fév. 1847] ↩
BWV
1847.02.21 “Curieux phénomène économique. La Réforme financière en Angleterre” (A Curious Economic Phenomenon. Financial Reform in England) [*Libre-Échange*, 21 Février 1847] [OC2.33, p. 186]
Curieux phénomène économique
21 Février 1847
Dans la séance du 9, M. Léon Faucher a appelé l’attention de la Chambre sur les circonstances financières qui ont hâté en Angleterre l’avènement des réformes commerciales. Il y a là tout un enchaînement de faits, aussi intéressants qu’instructifs, qui nous paraissent mériter d’être soumis aux sérieuses méditations de nos lecteurs, principalement de ceux qui exercent des industries privilégiées. Ils y apprendront peut-être que les monopoles, non plus que les taxes élevées, ne tiennent pas toujours ce qu’ils semblent promettre.
En 1837, l’insurrection du Canada ayant amené un accroissement de dépenses qui vint se combiner avec un affaiblissement dans la recette, l’équilibre des finances fut rompu en Angleterre, et elles présentèrent un premier déficit de 16 millions de francs.
L’année suivante, second déficit de 40 millions ; 1839 laisse un découvert de 37 millions, et 1840 de 40 millions.
L’administration songea sérieusement à fermer cette plaie toujours croissante. Il y avait à choisir entre deux moyens : diminuer les dépenses ou accroître les recettes. Soit qu’aux yeux du ministère, le cercle des réformes possibles, dans la première de ces directions, eût été parcouru depuis 1815, soit que, selon l’usage de tous les gouvernements, il se crût obligé d’épuiser le peuple avant de toucher aux droits acquis des fonctionnaires, toujours est-il que sa première pensée fut celle qui s’offre à tous les ministres : demander à l’impôt tout ce qu’il peut rendre.
En conséquence, le cabinet Russel provoqua, et le parlement vota un bill qui autorisait un prélèvement additionnel de 10 pour 100 sur l’impôt foncier, 5 pour 100 sur la douane et l’accise, et 4 pence par gallon sur les spiritueux.
Avant d’aller plus loin, il est bon de jeter un coup d’œil sur la manière dont étaient réparties, à cette époque, les contributions publiques du Royaume-Uni.
Le chiffre des recettes s’élevait à environ 47 millions sterling.
Elles étaient puisées à trois sources : la douane et l’accise, nature d’impôts qui frappe tout le monde d’une manière à peu près égale, c’est-à-dire qui retombe, dans une proportion énorme, sur les classes laborieuses ; les assessed taxes ou impôt foncier, qui atteint directement le riche, surtout en Angleterre ; et le timbre, qui est d’une nature mixte.
L’impôt du peuple rendait 37 millions ou 9/12 de la totalité ;
L’impôt du riche, 4 millions ou 4/12 de la totalité ;
L’impôt mixte, 2 millions ou 2/12.
D’où il suit que le commerce, l’industrie, le travail, les classes moyennes et pauvres de la société acquittaient les cinq sixièmes des charges publiques, ce qui avait fait dire, sans doute, à M. Cobden : « Si notre code financier parvenait sans commentaires dans la lune, les habitants de ce satellite n’auraient pas besoin d’autre document pour en induire que l’Angleterre est gouvernée par une aristocratie maîtresse du sol et de la législation. »
Faisons remarquer ici en passant, et à l’honneur de la France, que, pendant que les possesseurs de la terre ne payent en Angleterre que 8 pour 100 des contributions totales, chez nous ils acquittent 33 pour 100, et qu’en outre, ils prennent une beaucoup plus grande part, vu leur nombre, dans les impôts de consommation.
D’après ce qui précède, le prélèvement additionnel imaginé par les whigs devait produire :
| 1,426,040 | liv. st. 5 pour 100 sur la douane et l’accise, spiritueux non compris ; |
| 186,000 | liv. st. 4 pence par gallon, sur les spiritueux ; |
| 400,000 | liv. st. 10 pour 100 sur l’impôt foncier. |
Ici encore le peuple était appelé à réparer, dans la proportion des 4/5, le déficit amené par les fautes de l’oligarchie.
Le bill fut mis à exécution au commencement de 1840. Au 5 avril 1841, on procéda avec anxiété à la balance ; et ce ne fut pas sans une surprise mêlée d’effroi qu’on constata, au lieu de l’accroissement attendu de 2,200,000 liv. st., une diminution sur la recette de l’année précédente de quelques centaines de mille livres.
Ce fut une révélation subite. C’était donc en vain que le peuple avait été frappé de nouvelles taxes ; ce serait en vain qu’on aurait recours désormais à ce moyen. L’expérience venait de mettre au jour un fait capital, c’est que l’Angleterre était arrivée à la limite extrême de ses ressources contributives, et qu’il devenait à l’avenir impossible, par l’accroissement des impôts, de lui arracher un schelling. Cependant le déficit était toujours béant. (V. à l’introduction du tome III, pages 42 et suiv.)
Les théoriciens, comme on les appelle, se mirent à étudier le menaçant phénomène. Il leur vint à l’idée qu’on pourrait peut-être augmenter les recettes en diminuant les impôts, idée qui semblait impliquer une contradiction choquante. Outre les raisons théoriques qu’ils alléguaient en faveur de leur opinion, quelques expériences antérieures donnaient une certaine autorité à leur avis. Mais, pour les personnes qui, quoique vouées au culte des faits, n’ont pas cependant horreur de la raison des faits, nous devons dire comment ils soutenaient leur opinion.
« Le produit d’un impôt sur un objet de consommation, disaient-ils, est en raison du taux de la taxe et de la quantité consommée. Exemple : si, l’impôt étant un, il se consomme dix livres de sucre, la recette sera dix. Cette recette s’accroîtra, soit que le taux de la taxe s’élève, la consommation restant la même, soit que la consommation s’étende, le taux de la taxe ne variant pas. Elle baissera si l’un ou l’autre de ces éléments s’altère ; elle baissera encore quoique l’un des deux augmente, si l’autre diminue dans une plus forte proportion. Ainsi, quoiqu’on élève la taxe à 2, si la consommation se réduit à 4, la recette ne sera que de 8. Dans ce dernier cas, la privation pour le peuple sera énorme, — sans profit, bien plus, avec dommage pour le Trésor. »
Cela posé, ce multiplicateur et ce multiplicande sont-ils indépendants entre eux, ou ne peut-on grossir l’un qu’aux dépens de l’autre ? Les théoriciens répondaient : « La taxe agit comme tous les frais de production, elle élève le prix des choses, et les place hors de la portée d’un certain nombre d’hommes. D’où cette conclusion mathématique : si un impôt est graduellement et indéfiniment élevé, par cela même qu’à chaque degré d’élévation il restreint un peu plus la consommation ou la matière imposable, un moment arrive nécessairement où la moindre addition à la taxe diminue la recette. »
Que les protectionnistes sincères, et ils sont nombreux, nous permettent de recommander ce phénomène à leur attention. Nous verrons plus tard que l’excès de la protection leur fait jouer le même rôle qu’au Trésor l’exagération des taxes.
Les théoriciens ne se bornèrent pas à ce théorème arithmétique. Creusant un peu plus dans la question, ils disaient : Si le gouvernement eût mieux connu l’état déplorable des ressources du peuple, il n’aurait pas fait une tentative qui le couvre de confusion.
En effet, si la condition individuelle des citoyens était stationnaire, le revenu des taxes indirectes augmenterait exactement comme la population. Si, en outre, le capital national, et avec lui le bien-être général, vont croissant, le revenu doit augmenter plus vite que le nombre des hommes. Enfin, si les facultés de consommation sont rétrogrades, le Trésor doit en souffrir. Il suit de là que lorsqu’on a sous les yeux ce double phénomène : accroissement de population, diminution de recettes, on a une double raison pour conclure que le peuple est soumis à des privations progressives. Élever dans ce moment le prix des choses, c’est soumettre les citoyens à des privations additionnelles, sans aucun avantage fiscal.
Or, quel était, à ce point de vue, l’état des choses en 1840 ?
Il était constaté que la population augmentait de 360,361 habitants par année.
D’après cela, en supposant les ressources individuelles seulement stationnaires, quel aurait dû être le produit de la douane et de l’accise, et quel fut-il en réalité ? C’est ce qu’on verra dans le tableau suivant
| ANNÉES. | POPULATION. | PRODUIT PROPORTIONNEL 7538.des taxes indirectes. | PRODUIT RÉEL. |
| 1836 | 26,158,524 | 36,392,472 l.s. | 30,392,472 l. s. |
| 1837 | 26,518,885 | 36,938,363 | 33,958,421 |
| 1838 | 26,879,246 | 37,484,254 | 34,478,417 |
| 1839 | 27,239,607 | 38,030,145 | 35,093,633 |
| 1840 | 27,599,968 | 38,567,036 | [1]35,536,469 |
Ainsi, même en l’absence de tout progrès industriel, et par la force seule du nombre, le revenu, qui avait été de 36 millions en 1836, aurait dû être de 38 millions en 1840. Il tomba à 35 millions, malgré la surtaxe de 5 pour 100, résultat que l’affaiblissement des années précédentes aurait dû faire prévoir. Ce qu’il y a de singulier, c’est que dans les cinq années antérieures le contraire était arrivé. La douane et l’accise ayant été dégrévées, le revenu public s’était amélioré dans une proportion supérieure à l’accroissement de la population.
Le lecteur devine peut-être quelles conséquences les théoriciens tiraient de ces observations. Ils disaient au ministère : Vous ne pouvez plus grossir utilement le multiplicateur (le taux de la taxe) sans altérer dans une proportion plus forte le multiplicande (la matière imposable) ; essayez, en abaissant l’impôt, de laisser s’accroître les ressources du peuple.
Mais c’était là une entreprise pleine de périls. En admettant même qu’elle pût être couronnée de succès dans un avenir éloigné, on sait positivement qu’il faut du temps avant que les réductions de taxes comblent les vides qu’elles font, et, ne l’oublions pas, on avait en face le déficit.
Il ne s’agissait donc de rien moins que de creuser de plus en plus cet abîme, de compromettre le crédit de la vieille Angleterre, et d’ouvrir la porte à des catastrophes incalculables.
La difficulté était pressante. Elle accabla le ministère whig. Peel entra aux affaires.
On sait comment il résolut le problème. Il commença par mettre un impôt sur les riches. Il se créa ainsi des ressources, non-seulement pour combler le déficit, mais encore pour parer aux découverts momentanés que devaient entraîner les réformes qu’il méditait.
Grâce à l’income-tax, il soulagea le peuple du fardeau de l’accise, et, à mesure que la Ligue propageait les saines idées économiques, des restrictions de la douane. Aujourd’hui, malgré la suppression de beaucoup de taxes, l’abaissement de toutes les autres, l’Échiquier serait florissant, sans les calamités imprévues qui sont venues fondre sur la Grande-Bretagne.
Il faut en convenir, M. Peel a conduit cette révolution financière avec une énergie, une audace qui étonnent. Ce n’est pas sans raison qu’il caractérisait souvent ces mesures par ces mots : « Bold experiment, » expérience hardie. Ce n’est pas nous qui voudrions altérer la renommée de cet homme d’État et la reconnaissance des classes laborieuses d’Angleterre, et on peut dire de tous les pays. Mais l’exécution c’est assez pour sa gloire, et nous devons dire en toute justice que l’invention appartient tout entière à un théoricien, à un simple journaliste, M. James Wilson, dont les conseils, s’ils étaient suivis, sauveraient peut-être l’Irlande de 1847 comme ils ont sauvé l’Angleterre de 1840.
Maintenant, les hommes qui cherchent les succès de leur industrie dans le monopole nous demanderont quelle analogie il y a entre les faits que nous venons de rappeler et le régime protecteur.
Nous les prions de regarder les choses de près et de voir s’ils ne sont pas dans la position assez ridicule où s’est trouvé l’Échiquier en 1840.
Qu’est-ce que la protection ? Une taxe sur les consommateurs. Vous dites qu’elle vous profite. Sans doute, comme les taxes profitent au Trésor. Mais vous ne pouvez pas empêcher que ces taxes n’amoindrissent les facultés du public consommateur, sa puissance d’acheter, de payer, d’absorber des produits. Certainement, il consomme moins de blé et de drap que s’il lui en venait de toutes les parties du monde. C’est déjà un grand mal, nous dirons même une grande injustice ; mais, relativement à vous, à votre intérêt, la question est de savoir si vous ne subirez pas le sort du fisc ; s’il n’y a pas un moment où cet anéantissement des forces de la consommation vous prive de débouchés dans une telle mesure, que cela fait plus que compenser le taux de la protection ; en d’autres termes, si dans cette lutte entre l’exhaussement artificiel du prix dû au droit protecteur et l’abaissement du prix occasionné par l’impuissance des acheteurs, ce dernier effet ne prévaut pas sur le premier, auquel cas évidemment vous perdriez et sur le prix de vente et sur la quantité vendue.
À cela vous dites qu’il y a contradiction. Que, puisque c’est à l’élévation du prix qu’est imputable l’impuissance relative des consommateurs, on ne peut admettre que, sous le régime de la liberté, le prix s’élevât, sans admettre par cela même un rétrécissement de débouchés ; que, par la même raison, un accroissement de débouchés implique un abaissement du prix, puisque l’un est effet et l’autre cause.
Il y a à répondre que vous vous faites illusion. On peut certainement concevoir un pays où tout le monde soit assez dans l’aisance pour qu’on y puisse vendre les choses même à un bon prix, et un autre pays où tout le monde soit si dénué qu’on n’y peut trouver du débit même à bon marché. C’est vers ce dernier état que nous conduisent et les grosses taxes qui vont au Trésor, et les grosses taxes qui vont aux fabricants ; et il arrive un moment où le Trésor et les fabricants n’ont plus qu’un moyen de maintenir et d’accroître leurs recettes, c’est de relâcher le taux de la taxe et de laisser respirer le public.
Au reste, ce n’est pas là une argumentation dénuée de preuves. Chaque fois qu’on a soustrait un peuple à la pression d’un droit protecteur, il est survenu que deux tendances opposées ont agi sur le prix. L’absence de protection l’a certainement poussé vers la baisse ; mais l’accroissement de demande l’a poussé tout aussi certainement vers la hausse ; en sorte que le prix s’est au moins maintenu, et le profit net de l’opération a été un excédant de consommation. Vous dites que cela n’est pas possible. Nous disons que cela est ; et si vous voulez consulter les prix courants du café, des soieries, du sucre, des laines, en Angleterre, dans les années qui ont suivi la réduction des droits protecteurs, vous en resterez convaincus [2].
FN:Avec la surtaxe de 5 pour 100 votée cette année.
FN:V. tome IV, le chap. Cherté, Bon marché, page 163. (Note de l’éditeur.)
Influence du libre-échange sur les relations des peuples [7 Mars 1847] ↩
BWV
1847.03.07 “Influence du libre-échange sur les relations des peuples” (The Impact of Free Trade on the Relations between People) [*Libre-Échange*, 7 Mars 1847] [OC2.31, p. 170]
Influence du libre-échange sur les relations des peuples
7 Mars 1847
Se conserver, subsister, pourvoir à ses besoins physiques et intellectuels, occupe une si grande place dans la vie d’une nation, qu’il n’y a rien de surprenant à ce que sa politique dépende du système économique sur lequel elle fonde ses moyens d’existence [1].
Certains peuples ont eu recours à la violence. Dépouiller leurs voisins, les réduire en esclavage, telle fut la base de leur prospérité éphémère.
D’autres ne demandent rien qu’au travail et à l’échange.
Entre ces deux systèmes, il en est un, pour ainsi dire mixte. Il est connu sous le nom de Régime prohibitif. Dans ce système, le travail est bien la source de la richesse, mais chaque peuple s’efforce d’imposer ses produits à tous les autres.
Or, il nous semble évident que la politique extérieure d’un peuple, sa diplomatie, son action en dehors doit être toute différente, selon qu’il adopte un de ces trois moyens d’exister et de se développer.
Nous avons dit que l’Angleterre, instruite par l’expérience et obéissant à ses intérêts bien entendus, passe du régime prohibitif à la liberté des transactions, et nous regardons cette révolution comme une des plus imposantes et des plus heureuses dont le monde ait été témoin.
Nous sommes loin de prétendre que cette révolution soit, dès aujourd’hui, accomplie ; que la diplomatie britannique ne se ressentira plus désormais des traditions du passé ; que la politique de ses gouvernants ne doit plus inspirer aucune défiance à l’Europe. Si nous nous exprimions ainsi, les faits contemporains et récents se dresseraient pour condamner notre optimisme. Ne savons-nous pas que le parlement est peuplé de législateurs héréditaires qui représentent le principe d’exclusion, qui ont opposé et opposent encore la résistance la plus opiniâtre et au principe de liberté qui s’est levé à l’horizon, et à la politique de justice et de paix qui en est l’infaillible corollaire ?
Mais cette résistance est vaine. L’échafaudage tout entier s’écroule entraînant dans sa chute et la loi céréale, et l’acte de navigation, et le système colonial, et par conséquent toute la politique d’envahissement et de suprématie qui, sous le régime de liberté qui se prépare, n’a plus même sa raison d’être.
Le Moniteur industriel traite nos idées de folies. Il nous inflige l’épithète de philanthropes. Il nous apprend que, bien que la violence et la liberté soient opposées par nature, elles produisent exactement les mêmes effets, à savoir la domination du fort et l’oppression du faible, et qu’il importe peu à la paix du monde que les peuples échangent volontairement leurs produits ou essayent de se les imposer réciproquement par la force. À cela nous avons dit : S’il est dans la nature de la justice et de la liberté de laisser subsister entre les peuples le même antagonisme qu’ont engendré le monopole et l’exclusion, il faut désespérer de la nature humaine ; et puisque, sous quelque régime que ce soit, la lutte et la guerre sont l’état naturel de l’homme, tous nos efforts sont infructueux et le progrès des lumières n’est qu’un mot. Le Moniteur industriel trouve cette réflexion ridicule, presque impertinente et surtout fort déclamatoire. Ne serait-ce point parce qu’il veut maintenir le monopole et l’exclusion ? Il est du moins bien clair que les accusations qu’il dirige contre nous sont parfaitement conséquentes avec ce dessein. Nous en conviendrons en toute franchise, si le Moniteur industriel parvient à nous prouver que la liberté des transactions doit mettre entre les nations le même esprit de jalousie et d’hostilité que le régime restrictif, nous renoncerons pour toujours à notre entreprise. Nous nous ferons un égoïsme rationnel pour nous y renfermer à jamais, nous efforçant, nous aussi, d’arracher, pour notre part, quelque lambeau de monopole à la législature. Nous lui demanderons d’imposer des taxes à nos concitoyens pour notre avantage, d’aller conquérir des nations lointaines et de les forcer d’acheter exclusivement nos produits à un prix qui nous satisfasse, de nous débarrasser au dedans et au dehors de toute concurrence importune, enfin, de mettre la fortune publique, les vaisseaux de nos ports, les canons de nos arsenaux et la vie de nos soldats au service de notre cupidité.
Il ne peut pas y avoir de recherche plus utile que celle des effets comparés de la liberté et de la restriction sur la politique extérieure des peuples et sur la paix du monde. Nous remercions le Moniteur Industriel de nous provoquer à nous y livrer souvent. C’est ce que nous ne manquerons pas de faire. Aujourd’hui nous nous bornerons à dire quelques mots sur la forme polémique dans laquelle notre antagoniste paraît décide à persévérer. Nous pouvons d’autant plus nous abstenir de traiter la question de fond que nous l’avons fait dans un article de février, intitulé : De la domination par le travail, article resté sans réponse [2]. Il était pourtant naturel que le Moniteur daignât s’en occuper, puisque cet article était la solution d’une objection posée par nous-même dans le numéro précédent. Le Moniteur industriel a préféré reproduire l’objection et passer la réponse sous silence.
Le Moniteur met en fait que nous demandons la liberté pour le compte et dans l’intérêt de l’Angleterre. Ce n’est plus une insinuation, une conjecture, c’est une chose convenue et notoire : L’Angleterre, dit-il, nous prêche et nous fait prêcher la réciprocité des franchises commerciales ; l’Angleterre prêche à la France les doctrines d’une liberté qu’elle est loin d’adopter pour elle-même. L’Association du libre-échange est en France l’instrument le plus actif de la propagande britannique, etc., etc.
Est-il nécessaire d’insister sur ce que cette forme de discussion a d’odieux, nous dirons même de criminel ? Les champions du monopole connaissent l’histoire de notre révolution. Ils savent que c’est avec des imputations de ce genre que les partis se sont décimés, et sans doute ils espèrent nous imposer silence en faisant planer une nouvelle terreur sur nos têtes. Cela ne serait-il pas bien habile et bien commode de nous rançonner, et, à notre première plainte, bien plus, à notre premier effort pour obtenir qu’on discute nos droits, de tourner contre nous toutes les fureurs populaires, si l’on réussissait à les exciter, en disant : « Otez-lui la faculté de parler ; c’est un agent de Pitt et de Cobourg ? » — Faut-il dire toute notre pensée ? Cette tactique, empruntée aux mauvais jours de 93, est plus méprisable aujourd’hui ; et si elle n’est pas aussi dangereuse, rendons-en grâce au bon sens public et non pas aux monopoleurs. Nous disons qu’elle est plus méprisable. À cette funèbre époque au moins les défiances populaires, quels qu’en aient été les terribles effets, étaient au moins sincères. On vivait au milieu de périls imminents, de trahisons quelquefois certaines, l’exaltation était arrivée à son plus haut degré de paroxysme. Aujourd’hui rien de semblable. Les insinuations des monopoleurs ne sont autre chose qu’un froid calcul, une manœuvre préméditée, une combinaison concertée à l’avance. Ils jouent avec l’immoralité de cette rouerie, non pour sauver la patrie, mais pour continuer à accroître leurs richesses mal acquises.
Aussi qu’arrive-t-il ? C’est que, malgré tous leurs efforts, le public ne les croit pas, parce qu’ils ne se croient pas eux-mêmes, et M. Muret de Bord a décrédité à jamais cet odieux machiavélisme, quand il en a glacé l’expression sur les lèvres de M. Grandin, par cette interruption ineffaçable : Vous ne croyez pas ce que vous dites.
Nous comprenons que dans des temps de troubles, de périls, d’émotions populaires, les hommes s’accusent réciproquement de trahison ; mais émettre de telles imputations de sang-froid et sans croire un mot de ce que l’on dit, c’est assurément le plus déplorable moyen auquel puisse avoir recours celui qui aurait la conscience de défendre une cause juste.
Ce n’est pas que nous prétendions soustraire à nos adversaires l’argument tiré de ce que le libre-échange pourrait favoriser l’Angleterre au détriment de la France. C’est leur droit de développer, s’ils la croient vraie, cette théorie, qu’un peuple ne prospère jamais qu’aux dépens d’un autre ; ce que nous demandons, c’est qu’ils veuillent bien croire que nous pouvons, avec tout ce que l’Europe a produit d’hommes éclairés dans les sciences économiques, professer une doctrine toute contraire. Ce que nous leur demandons, c’est de ne pas affirmer, puisque aussi bien ils n’en croient pas un mot, que nous sommes les instruments de la propagande britannique.
Et où avez-vous vu, Messieurs, que le principe de la liberté des transactions fût purement, exclusivement anglais? Ne souhaitons-nous pas tous la liberté des mers et la liberté des mers est-elle autre chose que la liberté commerciale ? Ne nous plaignons-nous pas tous que l’Angleterre, par ses vastes conquêtes, a fermé à nos produits la cinquième partie du globe, et pouvons-nous recouvrer ces relations perdues autrement que par le libre-échange ?
Où avez-vous vu que l’Angleterre prêche et fait prêcher au dehors la réciprocité ? L’Angleterre, par une lutte acharnée et qui remonte au ministère de Huskisson, confère à ses concitoyens le droit d’échanger. Sans s’occuper de la législation des autres peuples, elle modifie sa propre législation selon ses intérêts. Qu’elle compte sur l’influence de l’exemple, sur le progrès des lumières, qu’elle se dise : « Si nous réussissons, les autres peuples entreront dans la même voie, » nous ne le nions pas. N’est-ce pas là de la propagande légitime ? Mais ce qu’elle fait, elle le fait pour elle et non pour nous. Si elle rend à ses concitoyens le droit de se procurer du blé à bas prix, c’est-à-dire de recevoir une plus grande quantité d’aliments contre une somme donnée de travail ; à ses colons le droit d’acheter leurs vêtements sur tous les marchés du monde ; à ses négociants le droit d’exécuter leurs transports avec économie, n’importe par quel pavillon, c’est parce qu’elle juge ces réformes conformes à ses intérêts. Nous le croyons aussi, et il paraît que vous partagez cette conviction : voilà donc un point convenu. En renonçant au régime protecteur, en adoptant la liberté, l’Angleterre suit la ligne de ses intérêts [3].
La question, la vraie question entre nous est de savoir si ces deux principes si opposés par leur nature sont néanmoins identiques dans leurs effets ; si ce sont les intérêts de l’Angleterre tels qu’elle les comprenait autrefois, ou tels qu’elle les comprend aujourd’hui, qui coïncident avec les intérêts de l’humanité ; si le principe restrictif ayant engendré cette politique envahissante et jalouse qui a infligé tant de maux au monde, un autre principe diamétralement opposé à celui-là, le principe de liberté, peut engendrer aussi la même politique. Vous dites oui, nous disons non ; voilà ce qui nous divise. Ne saurait-on puiser une conviction à cet égard que dans les inspirations et peut-être dans la bourse de l’étranger ?
Au reste, le temps est venu où l’abus de ces accusations en émousse le danger sans leur rien ôter de ce qu’elles ont d’odieux. Nous voyons les partis politiques prendre tour à tour cette arme empoisonnée. L’opposition l’a longtemps dirigée sur le centre, le centre la décoche aujourd’hui sur l’opposition. Vous la lancez sur nous, nous pourrions vous la renvoyer, car ne vous proclamez-vous pas sans cesse les serviles imitateurs de l’Angleterre ? Toute votre argumentation ne consiste-t-elle pas à dire : L’Angleterre a prospéré par le régime protecteur ; elle lui doit sa prépondérance, sa force, sa richesse, ses colonies, sa marine : donc la France doit faire comme elle ? « Vous êtes donc les importateurs d’un principe anglais. »
Mais non, nous n’aurons pas recours à ces tristes moyens. Dans vos rangs, il y a des personnes sincèrement attachées à la protection ; elles y voient le boulevard de notre industrie ; à ce titre, elles défendent ce principe et c’est leur droit. Elles n’ont point à se demander s’il est né en France, en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Est-il juste ? est-il utile ? C’est toute la question.
Nous non plus, nous n’avons pas à nous demander si le principe de la liberté est né en Angleterre ou en France. Est-il conforme à la justice ? est-il conforme à nos intérêts permanents et bien entendus ? est-il de nature à replacer toutes les branches de travail, à l’égard les unes des autres, sur le pied de l’égalité ? implique-t-il une plus grande somme de bien-être général en proportion d’un travail donné ? S’il en est ainsi, nous devons le soutenir, se fût-il révélé pour la première fois, ce qui n’est pas, dans un cerveau britannique. Si, de plus, il est en harmonie avec le bien de l’humanité, s’il tend à effacer les jalousies internationales, à détruire les idées d’envahissements et de conquêtes, à unir les peuples, à détrôner celte politique étroite et pleine de périls dont, à l’occasion d’un mariage récent, nous voyons se produire les tristes et derniers efforts ; s’il laisse à chaque peuple toute son influence intellectuelle et morale, toute sa puissance de propagande pacifique, s’il multiplie même les chances des doctrines favorables à l’humanité, nous devons travailler à son triomphe avec un dévouement inaltérable, dussent les sinistres insinuations du Moniteur industriel tourner contre nous des préventions injustes, au lieu d’appeler sur lui le ridicule.
FN:V. le chap. xix, des Harmonies. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV, le chap. xvii de la seconde série des Sophismes, p. 165. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome II, la note de la page 137. (Note de l’éditeur.)
Le parti démocratique et le libre-échange [14 Mars 1847] ↩
BWV
1847.03.14 “Le parti démocratique et le libre-échange” (The Democratic Party and Free Trade) [*Libre-Échange*, 14 Mars 1847] [OC2.17, p. 93]
Le parti démocratique et le libre-échange
14 Mars 1847
Quand nous avons entrepris de défendre la cause de la liberté des échanges, nous avons cru et nous croyons encore travailler principalement dans l’intérêt des classes laborieuses, c’est-à-dire de la démocratie, puisque ces classes forment l’immense majorité de la population.
La restriction douanière nous apparaît comme une taxe sur la communauté au profit de quelques-uns. Cela est si vrai qu’on pourrait y substituer un système de primes qui aurait exactement les mêmes effets. Certes, si, au lieu de mettre un droit de cent pour cent sur l’entrée du fer étranger, on donnait, aux frais du trésor, une prime de cent pour cent au fer national, celui-ci écarterait l’autre du marché tout aussi sûrement qu’au moyen du tarif.
La restriction douanière est donc un privilége conféré par la législature, et l’idée même de démocratie nous semble exclure celle de privilége. On n’accorde pas des faveurs aux masses, mais, au contraire, aux dépens des masses.
Personne ne nie que l’isolement des peuples, l’effort qu’ils font pour tout produire en dedans de leurs frontières ne nuise à la bonne division du travail. Il en résulte donc une diminution dans l’ensemble de la production, et, par une conséquence nécessaire, une diminution correspondante dans la part de chacun au bien-être et aux jouissances de la vie.
Et s’il en est ainsi, comment croire que le peuple en masse ne supporte pas sa part de cette réduction ? comment imaginer que la restriction douanière agit de telle sorte, que, tout en diminuant la masse des objets consommables, elle en met plus à la portée des classes laborieuses, c’est-à-dire de la généralité, de la presque totalité des citoyens ? Il faudrait supposer que les puissants du jour, ceux précisément qui ont fait ces lois, ont voulu être seuls atteints par la réduction, et non-seulement en supporter leur part, mais encore encourir celle qui devait atteindre naturellement l’immense masse de leurs concitoyens.
Or, nous le demandons, est-ce là la nature du privilége ? Sont-ce là ses conséquences naturelles ?
Si nous détachons de la démocratie la classe ouvrière, celle qui vit de salaires, il nous est plus impossible encore d’apercevoir comment, sous l’influence d’une législation qui diminue l’ensemble de la richesse, cette classe parvient à augmenter son lot. On sait quelle est la loi qui gouverne le taux des salaires, c’est la loi de la concurrence. Les industries privilégiées vont sur le marché du travail et y trouvent des bras précisément aux mêmes conditions que les industries non privilégiées. Cette classe de salariés, qui travaillent dans les forges, les mines, les fabriques de drap et de coton, n’ont donc aucune chance de participer au privilége, d’avoir leur quote-part dans la taxe mise sur la communauté. — Et quant à l’ensemble des salariés, puisqu’ils offrent sur le marché un nombre déterminé de bras, et qu’il y a sur ce même marché moins de produits qu’il n’y en aurait sous le régime de la liberté, il faut bien qu’ils donnent plus de travail pour une rémunération égale, ou plus exactement, autant de travail pour une moindre rémunération en produits ; — à moins qu’on ne prétende qu’on peut tirer d’un tout plus petit des parts individuelles plus grandes.
Forts de cette conviction, nous devions nous attendre à rallier à notre cause les organes de la démocratie. Il n’en a pas été ainsi ; et ils croient devoir faire à la liberté des échanges une opposition acerbe, aigre, empreinte d’une couleur haineuse aussi triste que difficile à expliquer. Comment est-il arrivé que ceux qui se posent, devant le pays, comme les défenseurs exclusifs des libertés publiques, aient choisi entre toutes une des plus précieuses de l’homme, celle de disposer du fruit de son travail, pour en faire l’objet de leur ardente opposition ?
Assurément, si les meneurs actuels du parti démocratique (car nous sommes loin d’étendre à tout le parti nos observations) soutenaient systématiquement la restriction douanière, comme chose bonne en soi, nous ne nous reconnaîtrions pas le droit d’élever le moindre doute sur leurs intentions. Les convictions sincères sont toujours respectables, et tout ce qu’il nous resterait à faire, ce serait de ramener ce parti à nos doctrines en les appuyant de démonstrations concluantes. Tout au plus, nous pourrions lui faire observer qu’il a tort de se croire placé en tête des opinions libérales, puisqu’en toute sincérité, il juge dangereuse et funeste la liberté même qui est la plus immédiate manifestation de la société, la liberté d’échanger.
Mais ce n’est point là la position qu’ont prise les organes du parti démocratique. Ils commencent par reconnaître que la liberté des échanges est vraie en principe. Après quoi, ce principe vrai, ils le contrarient dans son développement, et ne perdent pas une occasion de le poursuivre de leurs sarcasmes [1].
Par cette conduite, le parti démocratique nous pousse fort au delà d’une simple discussion de doctrine. Il nous donne le droit et de lui soupçonner des intentions qu’il n’avoue pas et de rechercher quelles peuvent être ces intentions. En effet, qu’on veuille bien suivre par la pensée tout ce qu’implique cette concession : La doctrine du libre-échange est vraie en principe.
Ou cela n’a aucun sens, ou cela veut dire : La cause que vous défendez est celle de la vérité, de la justice et de l’utilité générale. La restriction est un privilége arraché à la législature par quelques-uns aux dépens de la communauté. Nous reconnaissons qu’elle est une atteinte à la liberté, une violation des droits de la propriété et du travail, qu’elle blesse l’égalité des citoyens devant la loi. Nous reconnaissons qu’elle devrait nous être essentiellement antipathique, à nous qui faisons profession de défendre plus spécialement la liberté, l’égalité des droits des travailleurs.
Voilà le sens et la portée de ces mots : Vous avez raison en principe ; ou ils ne sont qu’une stérile formule, une précaution oratoire, indigne d’hommes de cœur et de chefs de parti.
Or, quand des publicistes ont fait une telle déclaration, et qu’on les voit ensuite ardents à étouffer non par le raisonnement, ils n’en ont plus le droit, mais par l’ironie et le sarcasme, le principe dont ils ont proclamé la justice et la vérité, nous disons qu’ils se placent dans une position insoutenable, qu’il y a dans cette tactique quelque chose de faux et d’anormal, une déviation des règles de la polémique sincère, une inconséquence dont nous sommes autorisés à rechercher les secrets motifs.
Qu’il n’y ait pas ici de malentendu. Nous sommes les premiers à respecter dans nos antagonistes le droit de se former une opinion et de la défendre. Nous ne nous croyons pas permis, en général, de suspecter leur sincérité, pas plus que nous ne voudrions qu’ils suspectassent la nôtre. Nous comprenons fort bien qu’on puisse, par une vue, selon nous, fausse ou incomplète du sujet, adopter systématiquement le régime protecteur, quelque opinion politique que l’on professe. À chaque instant nous voyons ce système défendu par des hommes sincères et désintéressés. Quel droit avons-nous de leur supposer un autre mobile que la conviction ? Quel droit avons-nous à opposer à des écrivains comme MM. Ferrier, Saint-Chamans, Mathieu de Dombasie, Dezeimeris, autre chose que le raisonnement ?
Mais notre position est toute différente à l’égard des publicistes qui commencent par nous accorder que nous avons raison en principe. Eux-mêmes nous interdisent par là de raisonner, puisque la seule chose que nous puissions et voulions établir par le raisonnement, c’est justement celle-là, que nous avons raison en principe, en laissant à ce mot son immense portée.
Or, nous le demandons à tout lecteur impartial, quelle que soit d’ailleurs son opinion sur le fond de la question, les journaux qui montrent l’irritation la plus acerbe contre un principe qu’ils proclament vrai, qui se vantent d’être les défenseurs des libertés publiques et proscrivent une des plus précieuses de ces libertés, tout en reconnaissant qu’elle est de droit commun comme les autres, qui étalent tous les jours dans leurs colonnes leur sympathie pour le pauvre peuple, et lui refusent la faculté d’obtenir de son travail la meilleure rémunération, ce qui est d’après eux-mêmes le résultat de la liberté, puisqu’ils la reconnaissent vraie en principe, ces journaux n’agissent-ils pas contre toutes les règles ordinaires ? Ne nous réduisent-ils pas à scruter le but secret d’une inconséquence aussi manifeste ? car enfin, on a un but quand on s’écarte aussi ouvertement de cette ligne de rectitude, en dehors de laquelle il n’y a pas de discussion possible.
On dira sans doute qu’il est fort possible d’admettre sincèrement un principe et d’en juger avec la même sincérité l’application inopportune.
Oui, nous en convenons, cela est possible, quoique à vrai dire il nous soit difficile d’apercevoir ce qu’il y a d’inopportun à restituer aux classes laborieuses la faculté d’accroître leur bien-être, leur dignité, leur indépendance, à ouvrir à la nation de nouvelles sources de prospérité et de vraie puissance, à lui donner de nouveaux gages de sécurité et de paix, toutes choses qui se déduisent logiquement de cette concession, vous avez raison en principe.
Mais enfin, quelque juste, quelque bienfaisante que soit une réforme, nous comprenons qu’à un moment donné elle puisse paraître inopportune à certains esprits prudents jusqu’à la timidité.
Mais si l’opposition, que nous rencontrons dans les meneurs du parti démocratique, était uniquement fondée sur une imprudence excessive, sur la crainte de voir se réaliser trop brusquement ce règne de justice et de vérité auquel ils accordent leur sympathie en principe, on peut croire que leur opposition aurait pris un tout autre caractère. Il est difficile de s’expliquer, même dans cette hypothèse, qu’ils poursuivent de leurs sarcasmes amers les hommes qui, selon eux, défendent la cause de la justice et les droits des travailleurs, et qu’ils s’efforcent de mettre au service de l’injustice et du monopole l’opinion égarée de cette portion du public sur laquelle ils exercent le plus spécialement leur influence, et qui a le plus à souffrir des priviléges attaqués.
De l’aveu du parti démocratique (aveu impliqué dans cette déclaration : Vous avez raison en principe), la question du libre-échange a mis aux prises la justice et l’injustice, la liberté et la restriction, le droit commun et le privilége. En supposant même que ce parti, saisi tout à coup d’un esprit de modération et de longanimité assez nouveau, nous considère comme des défenseurs trop ardents de la justice, de la liberté et du droit commun, est-il naturel, est-ce une chose conséquente à ses précédents, à ses vues ostensibles, et à sa propre déclaration, qu’il s’attache, avec une haine mal déguisée, à ruiner notre cause et à relever celle de nos adversaires ?
De quelque manière donc qu’on envisage la ligne de conduite adoptée par les meneurs du parti démocratique dans ce débat, on arrive à cette conclusion qu’elle a été tracée par des motifs qu’on n’avoue pas. Ces motifs, nous ne les connaissons pas, et nous nous abstiendrons ici de hasarder des conjectures. Nous nous bornerons à dire que, selon nous, les publicistes auxquels nous faisons allusion sont entrés dans une voie qui doit nécessairement les déconsidérer et les perdre aux yeux de leur parti. Se lever ouvertement ou jésuitiquement contre la justice, le bien général, l’intérêt vraiment populaire, l’égalité des droits, la liberté des transactions, ce n’est pas un rôle que l’on puisse mener bien loin, quand on s’adresse à la démocratie et qu’on se dit démocrate. Et la précaution oratoire qu’on aurait prise, de se déclarer pour le principe, ne ferait que rendre l’inconséquence plus évidente et le dénoûment plus prochain.
FN:V. les chap. XIV et XVIII du tome IV, pages 76 et 94. (Note de l’éditeur.)
Sur la défense d'exporter les céréales [20 Mars 1847] ↩
BWV
1847.03.20 “Sur la défense d'exporter les céréales” (On the Prohibition of Exporting Grain) [*Libre-Échange*, 20 Mars 1847] [OC2.14, 72]
Sur la défense d'exporter les céréales
20 Mars 1847
Proposer à un peuple de laisser exporter les aliments en temps de disette, c’est certainement soumettre sa foi dans le libre-échange à la plus rude dé toutes les épreuves. Quoi de plus naturel, quand on est forcé d’aller chercher du blé au dehors, que de commencer par retenir celui qu’on possède ? Au milieu des efforts que font simultanément plusieurs nations pour assurer leurs approvisionnements, pourquoi nous exposerions-nous à ce que la plus riche vînt, à prix d’or, diminuer les nôtres? — Il ne faut donc pas être surpris de voir les gouvernements les plus éclairés faillir aux principes dans les conjonctures difficiles ; alors même qu’ils seraient convaincus de l’inefficacité de semblables restrictions, ils ne seraient pas assez forts pour les refuser aux alarmes populaires ; ce qui nous ramène toujours à ceci : l’opinion fait la loi ; c’est l’opinion qu’il faut éclairer [1].
Le premier inconvénient des mesures qui restreignent l’exportation, c’est d’être fondées sur un principe dont on ne peut guère, quand on en fait l’application générale, refuser sans inconséquence l’application partielle. Devant cette forte tendance, qui se manifeste dans chaque commune, à s’opposer à l’exportation du blé, quelle est la force morale d’un ministère qui vient de signer la prohibition à la sortie ? Chaque localité pourrait lui répondre par les arguments de son exposé des motifs. On peut bien alors avoir recours aux baïonnettes, mais il faut renoncer à invoquer des raisons.
Au moment où les récoltes des pays producteurs sont emmagasinées,l’approvisionnement général du monde est décidé. Si ces récoltes sont insuffisantes, s’il doit y avoir disette, les lois restrictives ne l’empêcheraient pas ; car il n’est pas en leur pouvoir d’ajouter au produit de ces récoltes un seul grain de blé. La question se réduit donc à savoir si ces lois peuvent changer, avec avantage, la distribution naturelle d’une quantité donnée de subsistance. Nous croyons qu’il n’est personne qui ose l’affirmer.
Au reste, l’expérience de cette année, à cet égard, sera fort instructive.
Plusieurs nations, la France entre autres, ont prohibé la sortie des céréales. L’Angleterre, quoique pressée par la disette autant qu’aucune d’elles, a adopté une autre police.
Ainsi, dans ce moment, tout chargement de blé étranger, qui entre en France, n’en peut plus sortir, et n’a devant lui qu’un marché. S’il entre en Angleterre, il peut se diriger ailleurs, et a le choix de tous les marchés du monde.
Qu’en résulte-t-il ? C’est que l’Angleterre tend à devenir l’entrepôt provisoire de tous les pays. Il y a peu de navires, venant du nord de l’Europe ou de l’Amérique, qui ne commencent par aller à Hall ou à Liverpool pour prendre langue, comme on dit ; il y a peu de négociants qui ne donnent ordre à leurs expéditions de se diriger vers la Grande-Bretagne, préférant naturellement, à une époque où les fluctuations de prix peuvent être si brusques, se réserver plusieurs chances que de se réduire à une. Une fois le blé à Liverpool, il s’y vendra à prix égal, ou même à un prix un peu inférieur ; car, dans ce genre d’affaires, le négociant aspire à réaliser, et d’autant plus qu’on approche davantage de l’époque prévue d’une réaction dans les prix.
L’Angleterre, par le fait même qu’elle a laissé l’exportation libre, sera le pays le mieux approvisionné, et de plus elle fera un profit sur l’approvisionnement des autres peuples. (V. tome IV, pages 94 à 97.)
C’est ce que lord John Russell, répondant à M. Baillie, a exposé en ces termes :
« Nous savons parfaitement qu’il y a de grandes demandes de blé en France et en Belgique ; que le prix s’élève et s’élèvera probablement encore dans ces pays. Mais nous sommes d’opinion, généralement parlant, que prohiber l’exportation du blé, c’est le moyen le plus sûr d’en empêcher l’importation dans nos ports. (Assentiment.) Nous croyons que tout marchand importateur, s’il est assuré en introduisant du blé chez nous, soit de le vendre pour le consommateur, soit de pouvoir le porter sur d’autres marchés, selon ses convenances, aura des raisons déterminantes pour le porter ici. (Écoutez, écoutez.) Nous considérons, au contraire, que s’il sait que son blé, une fois entré, ne peut plus sortir, cela le portera à fuir un marché où sa denrée serait emprisonnée. et à la porter ailleurs. »
On trouve dans les Voyages du capitaine Basil-Hall le récit d’un fait analogue. En 1812, l’Inde fut désolée par la famine. Partout on s’empressa d’interdire l’exportation du riz. Il se rencontra, à Bombay, une administration composée d’hommes éclairés et énergiques. En face de la disette, elle maintint la liberté des transactions. Le résultat fut que toutes les expéditions de riz se dirigèrent sur Bombay. C’est là que les navires se rendaient d’abord, pour combiner leurs opérations ultérieures. Très-souvent, ils se défaisaient de leurs cargaisons, même à des prix réduits, préférant recommencer un second voyage. C’est à Bombay que l’Inde alla s’approvisionner, et c’est là aussi que la famine se fit le moins sentir.
Indépendamment du tort général que fait presque toujours l’intervention directe de l’État en matière de commerce, elle est accompagnée, comme tout ce qui est brusque et imprévu, d’inconvénients accessoires dont on ne tient pas assez compte.
Dernièrement, vingt navires furent frétés pour aller charger du maïs à Bayonne. En arrivant dans ce port, les chargeurs signifièrent aux capitaines une ordonnance qui défendait l’exportation du maïs, ou, qui pis est, la soumettait à un droit de 17 fr. par hectolitre ; et, par ce motif, ils voulurent se dispenser d’expédier. Mais les capitaines répondirent : Il n’y a pas force majeure ; acquittez le droit et chargez. Force a été de donner à ceux-ci l’indemnité qu’ils ont exigée, et peut-être en faudra-t-il faire autant envers les destinataires, qui se croiront en droit d’exiger l’exécution des marchés.
Comme le maïs a été très-abondant dans le sud-ouest de la France, le prix en était peu élevé. La défense d’exportation survenue, le prix baissa encore. Alors, les négociants s’avisèrent de faire des marchés à Rouen, à Nantes, à Paris, ce que facilita beaucoup l’énorme différence qui existait entre le cours du maïs et celui du froment.
Ces négociants reviennent à Bayonne exécuter les achats. En arrivant, ils apprennent que les sévères lois de la boulangerie ont été bouleversées, que le mélange de la farine de maïs avec celle de froment a été autorisé, que, par suite de cette résolution aussi subite qu’imprévue, le prix du maïs s’est élevé de 5 à 6 fr. par hectolitre, et que leurs marchés sont devenus inexécutables ou ruineux. Croit-on que le commerce mis, par ces brusques revirements de législation, dans l’impossibilité de rien prévoir, soit très-disposé à remplir sa tâche bienfaisante, qui est de distribuer les produits de la manière la plus uniforme ?
Nous pourrions faire des réflexions analogues au sujet de la détermination qui a été prise par un très-grand nombre de villes d’assurer leurs approvisionnements pour six mois.
L’intention est certainement irréprochable ; mais oserait-on affirmer que le résultat n’a pas été funeste, que ces mesures n’ont pas concouru à la hausse extraordinaire du prix du blé ?
Lorsque les approvisionnements se font dans le pays d’une manière successive, et arrivent dans nos ports de semaine en semaine, si chacun veut mettre dans sa maison la provision de toute l’année, comment est-il possible que le prix ne s’élève pas ? Qu’arriverait-il à la halle aux blés de Paris, si chaque chef de famille s’y présentait pour acheter, à un moment donné, les trois à quatre hectolitres qu’il juge nécessaires à sa subsistance, et à celle de sa femme et de ses enfants pendant six mois ? Les prix s’élèveraient certainement à un taux extravagant, pour faire, bientôt après, une chute non moins considérable.
Les villes annoncent qu’elles revendront ce blé (acheté pendant le paroxysme de la hausse occasionnée par elles-mêmes) au prix coûtant. Et si la baisse arrive, que feront-elles de ce blé ? forceront-elles le consommateur à l’acheter au prix coûtant ? Elles feront des pertes, dira-t-on, ce qui importe peu. Mais qui supporte ces pertes, sinon les consommateurs eux-mêmes, qui acquittent les droits d’octroi et les autres contributions qui forment les revenus municipaux ?
On dira que nous sommes très-décourageants, et que, dans notre foi au laissez faire, nous conseillons de se croiser les bras. À entendre ce langage, il semblerait qu’en dehors de l’État et des municipalités, il n’y a pas d’action dans le monde ; que ceux qui désirent vendre et ceux qui ont besoin d’acheter sont des êtres inertes et privés de tout mobile. Si nous conseillons le laissez faire, ce n’est point parce qu’on ne fera pas, mais parce qu’on fera plus et mieux. Nous persisterons dans cette croyance jusqu’à ce qu’on nous prouve une de ces deux choses : ou que les lois restrictives ajoutent un grain de plus aux récoltes, ou qu’elles rendent la distribution des subsistances plus uniforme et plus équitable.
FN:Sur la souveraineté de l’opinion, voyez tome IV, pages 132 à 146. (Note de l’éditeur.)
Autre chose [21 March 1847] [CW3 ES2.14]↩
BWV
1847.03.21 “Autre chose” (Something Else) [*Libre-Échange*, 21 March 1847] [ES2.14] [OC4.2.14, pp. 241-51] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Hausse des aliments, baisse des salaires [21 Mars 1847] ↩
BWV
1847.03.21 “Hausse des aliments, baisse des salaires” (To increase the price of food is to lower the value of wages) [*Libre-Échange*, 21 Mars 1847] [OC2.15, 77]
Hausse des aliments, baisse des salaires
21 Mars 1847
Quelle est l’influence du prix des aliments sur le taux des salaires ?
C’est un point sur lequel les partisans de la liberté et ceux de la restriction diffèrent complétement.
Les protectionnistes disent :
Quand les aliments sont chers, on est bien obligé de payer de forts salaires, car il faut que l’ouvrier vive. La concurrence réduit la classe ouvrière à se contenter des simples moyens de subsistance. Si celle-ci renchérit, il faut bien que le salaire s’élève. Aussi M. Bugeaud disait : Que le pain et la viande soient chers, tout le monde sera heureux.
Par la même raison, selon ces messieurs, le bon marché de la subsistance entraîne le bon marché des salaires. C’est sur ce principe qu’ils disent et répètent tous les jours que les manufacturiers anglais n’ont renversé les lois-céréales que pour réduire, dans la même proportion, le prix de la main-d’œuvre.
Remarquons en passant que, si ce raisonnement était fondé, la classe ouvrière serait entièrement désintéressée dans tout ce qui arrive en ce monde. Que les restrictions ou les intempéries, ou ces deux fléaux réunis, renchérissent le pain, peu lui importe : 1e salaire se mettra au niveau. Que la liberté ou la récolte amène l’abondance et la baisse, peu lui importe encore : le salaire suivra cette dépression.
Les libre-échangistes répondent :
Quand les objets de première nécessite sont à bas prix, chacun dépense pour vivre une moindre partie de ses profits. Il en reste plus pour se vêtir, pour se meubler, pour acheter des livres, des outils, etc. Ces choses sont plus demandées, il en faut faire davantage ; cela ne se peut sans un surcroît de travail, et tout surcroît de travail provoque la hausse des salaires.
Au rebours, quand le pain est cher, un nombre immense de familles est réduit à se priver d’objets manufacturés, et les gens aisés eux-mêmes sont bien forcés de réduire leurs dépenses. Il s’ensuit que les débouchés se ferment, que les ateliers chôment, que les ouvriers sont congédiés, qu’ils se font concurrence entre eux sous la double pression du chômage et de la faim, en un mot il s’ensuit que les salaires baissent.
Et comment pourrait-il en être autrement ? Eh quoi ! les choses seraient tellement arrangées que lorsque la disette, absolue ou relative, naturelle ou artificielle, désole le pays, la classe ouvrière seule ne supporterait pas sa part de souffrance ? Le salaire venant compenser, par son élévation, la cherté des subsistances, maintiendrait cette classe à un niveau nécessaire et immuable !
Après tout, voici une année qui décidera entre le raisonnement des protectionnistes et le nôtre. — Nous saurons si, malgré tous les efforts qu’on a faits pour accroître le fonds des salaires, malgré les emprunts que se sont imposés les villes, les départements et l’État, malgré qu’on ait fait travailler les ouvriers avec des ressources qui n’existent pas encore, malgré qu’on ait engagé l’avenir, nous saurons si le sort des ouvriers a joui de ce privilége d’immutabilité qu’implique l’étrange doctrine de nos adversaires. Nous demandons que toutes les sources d’informations soient explorées ; qu’on consulte les livres des hôpitaux, des hospices, des prisons, des monts-de-piété ; qu’on dresse la statistique des secours donnés à domicile ; qu’on relève les registres de l’étal civil ; qu’on suppute le nombre des morts, des naissances, des mariages, des abandons, des infanticides, des vols, des faillites, des expropriations ; que l’on compare ces données, pour l’année 1847, avec celles que fournissent les années d’abondance et de bon marché. Si la détresse publique ne se manifeste pas par tous les signes à la fois ; s’il n’y a pas accroissement de misère, de maladie, de mortalité, de crimes, de dettes, de banqueroutes ; s’il ne s’est pas fermé plus d’ateliers, s’il ne règne pas dans la classe ouvrière plus de souffrances et d’appréhensions, pour tout dire en un mot, si le taux du salaire s’est maintenu, alors nous passerons condamnation. Nous nous déclarerons battu sur le terrain des doctrines, et nous baisserons notre drapeau devant celui de la rue Hauteville.
Mais si les faits nous donnent raison, s’il est prouvé que la cherté des blés a versé sur notre pays, et spécialement sur la classe ouvrière, des calamités sans nombre, s’il est démontré que le mot disette a un sens, une signification, et que ce phénomène se manifeste de quelque manière (car la théorie des protectionnistes ne va à rien moins qu’à prétendre que la disette n’est rien), qu’ils nous permettent de réclamer avec une énergie toujours croissante la libre entrée des subsistances et des instruments de travail dans le pays, qu’ils nous permettent de manifester notre aversion pour la disette et surtout pour la disette légale. Elle peut convenir à ceux qui possèdent la source des subsistances, le sel, ou l’instrument du travail, le capital ; ou du moins ils peuvent se le figurer. Mais, qu’ils se fassent ou non illusion (et nous croyons que leur illusion à cet égard est complète), toujours est-il que la rareté des aliments est le plus grand des fléaux pour ceux qui n’ont que des bras. Nous croyons que les produits avec lesquels se paye le travail étant moindres, la masse du travail restant la même, il est inévitable qu’il reçoive une moindre rémunération.
Les protectionnistes diront, sans doute, que nous altérons leur théorie ; qu’ils n’ont jamais poussé l’absurdité au point de préconiser la disette ; qu’ils désirent comme nous l’abondance, mais seulement celle qui est le fruit du travail national.
À quoi nous répondrons que l’abondance dont jouit un peuple est toujours le fruit de son travail, alors même qu’il aurait cédé quelques-uns des produits de ce travail contre une égale valeur de produits étrangers.
Quoi qu’il en soit, la question n’est pas ici de comparer la disette à l’abondance, la cherté au bon marché, dans toutes leurs conséquences, mais seulement dans leurs effets sur le taux des salaires.
Disent-ils ou ne disent-ils pas que le bon marché des subsistances entraîne le bon marché des salaires ? N’est-ce pas sur cette assertion qu’ils s’appuient pour enrôler à leur cause la classe ouvrière ? N’affirment-ils pas tous les jours que les manufacturiers anglais ont voulu ouvrir les portes aux denrées venues du dehors, dans l’unique but de réduire le taux de la main-d’œuvre ?
Nous désirons et nous demandons instamment qu’une enquête soit ouverte sur les fluctuations du salaire et sur le sort des classes laborieuses, dans le cours de cette année. C’est le moyen de vider, une fois pour toutes et par les faits, la grande question qui divise les partisans de la restriction et ceux de la liberté [1].
FN:V. ci-après, n° 46, le second discours prononcé à Lyon, et, au tome VI, le chap. xiv. (Note de l’éditeur.)
Deux modes d'égalisation de taxes [4 April 1847]↩
BWV
1847.04.04 "Deux modes d'égalisation de taxes" (Two Methods of Equalizing Taxes) [*Libre-Échange*, 4 April 1847] [OC2.40, pp. 222-25]
Deux modes d’égalisation de taxes
4 Avril 1847
Les partisans du libre-échange se font un argument de ce qui est advenu au sucre de betterave, pour prouver que la crainte de la concurrence est souvent chimérique.
« Tout ce qu’on prédit de la rivalité extérieure pour le fer, le drap, les bestiaux, disent-ils, on le prédisait, pour la betterave, de la rivalité coloniale. Les industries protégées n’invoquent pas un argument que le sucre indigène n’ait invoqué, quand il fut menacé du régime de l’égalité. Mettre aux prises les deux sucres, c’était condamner à mort le plus faible. Qu’est-il arrivé cependant ? Sous l’aiguillon de la nécessité, les fabricants ont fait des efforts d’intelligence, de bonne administration, d’économie. Ils ont retrouvé de ce côté plus qu’ils ne perdaient du côté de la protection ; en un mot, ils prospèrent plus que jamais. L’analogie ne nous dit-elle pas qu’il en sera de même des autres industries ? La voie du progrès leur est-elle fermée ? Nos manufacturiers ne feront-ils aucun effort pour lutter avec leurs rivaux et reconquérir, par leur habileté, plus qu’ils ne doivent au privilége ? »
Ce raisonnement place le libre-échange sur un terrain défavorable. Il ôte à sa démonstration les deux tiers de ses forces, en insinuant qu’un dégrèvement sur les produits étrangers et une aggravation sur le produit national, — c’est la même chose. Il tend à faire penser qu’en dehors des progrès subits et extraordinaires, il n’y a pas de salut pour nos industries protégées, si la concurrence est permise. Il décourage ceux qui n’ont pas une foi complète dans ces progrès, qui, il faut bien le dire, peuvent bien n’être pas aussi rapides dans les autres branches de travail qu’ils l’ont été dans l’industrie saccharine.
Il ne faut pas laisser croire que le maintien de nos industries, soumises au régime de la liberté, est subordonné à des progrès probables, sans doute, mais dont personne ne saurait préciser la portée.
Ce qu’il faut faire voir, c’est ceci : que l’épreuve de l’égalisation par l’impôt est beaucoup plus dangereuse que celle de l’égalisation par le libre-échange, et que, par conséquent, si le sucre indigène s’est tiré de l’une, à fortiori l’industrie nationale se tirera de l’autre.
Deux circonstances différencient essentiellement ces épreuves.
La première frappe tous les esprits, et nous ne nous y arrêterons pas ; c’est que la réforme douanière apporte par elle-même à chaque industrie un élément de succès et lui ouvre une source d’économie. En même temps que le libre-échange prive certains établissements de protection, il leur fournit à plus bas prix la matière première, le combustible, les machines et la subsistance. C’est là une première compensation que l’impôt et l’exercice n’offraient certes pas au sucre de betterave.
La seconde circonstance est moins aperçue, quoique bien autrement importante. Nous supplions nos amis, et plus encore nos adversaires, d’en peser toute la gravité ; car du jour où ils tiendront compte du phénomène économique dont nous voulons parler, ils cesseront d’être nos adversaires. Telle est du moins notre profonde conviction.
Tout le monde sait que lorsqu’un produit baisse de prix, la consommation s’en accroît. Or, accroissement de consommation implique accroissement de demande, et par suite rehaussement de prix.
Supposons qu’un objet dont le prix de revient (y compris le profit du producteur) est 100 francs, soit grevé de 100 fr. de taxe : le prix vénal sera 200 fr.
Si l’on supprime la taxe, le prix vénal serait de 100 fr. si la consommation restait la même : mais elle augmentera ; par suite, le prix tendra à hausser. Il y aura meilleure rémunération pour l’industrie que ce produit concerne.
Ceci montre que lorsque deux industries similaires sont inégalement imposées, il n’est pas indifférent de ramener l’égalité en surtaxant l’une ou en dégrevant l’autre. Dans le premier cas, on diminue ; dans le second, on favorise le débouché de toutes les deux.
Il est bien évident que si l’on eût égalisé les conditions des deux sucres, en dégrevant le sucre colonial, au lieu d’imposer le sucre indigène, celui-ci eût pu soutenir la lutte plus avantageusement encore qu’il ne l’a fait, car la diminution de l’impôt eût abaissé le prix vénal, élargi la consommation, stimulé la demande, et en définitive, élevé pour l’un et l’autre sucre le prix rémunérateur.
Les libre-échangistes qui arguent de ce qui est arrivé au sucre de betterave pour en déduire ce qui arriverait aux autres industries, si on leur retirait la protection, privent donc leur argument de ce qui fait sa force ; car ils assimilent deux procédés d’égalisation dont l’un est toujours avantageux et dont l’autre peut être mortel.
Avec le libre-échange, l’industrie indigène a trois voies ouvertes pour se mettre au niveau de l’industrie étrangère :
1° L’intervention d’une plus grande dose d’habileté stimulée par la concurrence ;
2° L’abaissement du prix des matières premières, des moteurs, de la subsistance, etc. ;
3° L’accroissement de la consommation, de la demande, et son action sur le prix rémunérateur.
Le sucre de betterave n’a eu pour lutter que la première de ces ressources, et elle a suffi. La liberté commerciale les met toutes trois à la disposition de nos industries. Est-il sérieusement à craindre qu’elles succombent ?
On peut déduire de cette observation une théorie économique sur laquelle nous reviendrons souvent ; et, par ce motif, nous nous bornons, quant à présent, à l’indiquer.
Le système restrictif a la prétention d’élever, au profit du producteur, le prix du produit ; mais il ne peut le faire sans mettre ce produit hors de la portée d’un certain nombre de personnes, sans paralyser les facultés de consommation, sans diminuer la demande, et enfin, sans agir dans le sens de la baisse sur le prix même qu’il aspire à élever [1].
Sa première tendance, nous en convenons, est de renchérir en favorisant le producteur ; sa seconde tendance est de déprécier en éloignant le consommateur ; et cette seconde tendance peut aller jusqu’à surmonter la première.
Et, quand cela est arrivé, le public perd toute la consommation empêchée par la mesure, sans que le producteur gagne rien sur le prix.
Celui-ci joue alors le rôle ridicule dans lequel nous avons fait paraître le fisc anglais. On se rappelle que la taxe s’élevant sans cesse, et la consommation diminuant à mesure, il arriva un moment où, en ajoutant 5 p. % au taux de l’impôt, on eut 5 p. % de moins de recette [2].
FN:V. au tome IV, page 163, le chap. Cherté, Bon marché. (Note de l’éditeur.)
FN:V. le n° 33, page 186. (Note de l’éditeur.)
Le monde renversé [18 Avril 1847] ↩
BWV
1847.04.18 “Le monde renversé” (The World Turned Up-side Down) [*Libre-Échange*, 18 Avril 1847] [OC2.20, p. 110]
Le monde renversé
18 Avril 1847
Un navire arriva au Havre, ces jours-ci, après un long voyage.
Un jeune officier, quelque peu démocrate, débarque, et rencontrant un de ses amis : Oh ! des nouvelles, des nouvelles ! lui dit-il, j’en suis affamé.
— Et nous, nous sommes affamés aussi. Le pain est hors de prix. Chacun emploie à s’en procurer tout ce qu’il gagne ; l’énorme dépense qui en résulte arrête la consommation de tout ce qui n’est pas subsistance, en sorte que l’industrie souffre, les ateliers se ferment, et les ouvriers voient baisser leurs salaires en même temps que le pain renchérit.
— Et que disent les journaux ?
— Ils ne sont pas d’accord. Les uns veulent laisser entrer le blé et la viande afin que le peuple soit soulagé, que les aliments baissent de prix, que toutes les autres consommations reprennent, que le travail soit ranimé et que la prospérité générale renaisse ; les autres font à la libre entrée des subsistances une guerre ouverte ou sourde, mais toujours acharnée.
— Et quels sont les journaux pour et contre?
— Devine.
— Parbleu ! le journal des Débats défend les gros propriétaires, et le National le peuple.
— Non, les Débats réclament la liberté et le National la combat.
— Qu’entends-je ? que s’est-il donc passé ?
— Les mariages espagnols.
— Qu’est-ce que les mariages espagnols, et quel rapport ont-ils avec les souffrances du peuple ?
— Un prince français a épousé une princesse espagnole. Cela a déplu à un homme qui s’appelle lord Palmerston. Or, le National accuse les Débats de vouloir ruiner tous les propriétaires français pour apaiser le courroux de ce lord. — Et le National, qui est très-patriote, veut que le peuple de France paye le pain et la viande cher pour faire pièce au peuple d’Angleterre.
— Quoi ! c’est ainsi qu’on traite la question des subsistances ?
— C’est ainsi que, depuis ton départ, on traite toutes les questions.
Le National [18 Avril 1847] ↩
BWV
1847.04.18 “*Le National*” (*Le National*) [*Libre-Échange*, 18 Avril 1847] [OC2.19, p. 104]
Le National
18 Avril 1847
Le National adresse ce défi au Journal des Débats : « Aidez-nous à renverser l’octroi, nous vous aiderons à renverser le régime protecteur. »
Ceci prouve une chose, que le National, comme il l’a laissé croire jusqu’ici, ne voit pas une calamité publique dans l’échange et le droit de troquer ; car nous ne lui ferons pas l’injure de penser que la phrase puisse se construire ainsi : qu’on nous aide à faire un bien, et nous aiderons à faire un mal.
Cependant le National ajoute : « Le dernier mot des Débats, le secret de leur conduite, le voici : l’alliance anglaise a été compromise par les mariages espagnols, Pour renouer les liens de l’entente cordiale, rien ne doit nous coûter. Immolons aujourd’hui notre agriculture, demain notre industrie à la Grande-Bretagne. »
Si la lutte contre le régime protecteur ne peut être inspirée que par des motifs aussi coupables, et ne peut avoir que d’aussi funestes résultats, comment le National offre-t-il de s’y associer ? Une telle contradiction ne fait que relever le triste aveuglement de la polémique à la mode.
Admettant donc que le National regarde le libre-échange comme un bien, qu’il voudrait voir réaliser sur nos frontières et à nos barrières, il resterait à savoir pourquoi il s’en est montré depuis peu l’ardent adversaire. Peut-être pourrions-nous demander aussi pourquoi il subordonne la poursuite d’une bonne réforme au parti que d’autres croient devoir prendre sur une réforme de tout autre nature ?
Mais laissons de côté ces récriminations inutiles. Que le concours du National nous arrive ; nous l’accueillerons avec joie, convaincus qu’il n’y a pas de journal mieux placé pour jeter la bonne semence en bonne terre. Pour donner même au National la preuve que nous apprécierons son concours, nous allons lui expliquer pourquoi il nous est impossible, en tant qu’association, de combattre à ses côtés dans la lutte qu’il soutient contre l’octroi. Nous saisirons avec d’autant plus d’empressement cette occasion de nous expliquer là-dessus, que ce que nous avons à dire jettera, nous l’espérons, quelque lumière sur le but précis de notre association.
Il y a probablement cent réformes à faire dans notre pays et dans le seul département des finances : douane, hypothèques, postes, boissons, sel, octroi, etc., etc. ; le National nous accordera bien qu’une association ne s’engage pas à les poursuivre toutes, par cela seul qu’elle entreprend d’en obtenir une.
Cependant, au premier coup d’œil, il semble que notre titre : Libre-Échange, nous astreint à embrasser dans notre action la douane et l’octroi. Qu’est-ce que la douane ? un octroi national. Qu’est-ce que l’octroi ? une douane urbaine. L’une restreint les échanges aux frontières ; l’autre les entrave aux barrières. Mais il semble naturel d’affranchir les transactions que nous faisons entre nous, avant de songer à celles que nous faisons avec l’étranger ; et nous ne sommes pas surpris que beaucoup de personnes, à l’exemple du National, nous poussent à guerroyer contre l’octroi [1].
Mais, nous l’avons dit souvent, et nous serons forcés de le répéter bien des fois encore : La similitude, qu’on établit entre la douane et l’octroi, est plus apparente que réelle. Si ces deux institutions se ressemblent par leurs procédés, elles diffèrent par leur esprit : l’une gêne forcément et accidentellement les transactions, pour arriver à procurer aux villes un revenu ; l’autre interdit systématiquement l’échange, même alors qu’il pourrait procurer un revenu au trésor, considérant l’échange comme chose mauvaise en soi, de nature à appauvrir ceux qui le font.
Nous ne voulons pas nous faire ici les champions de l’octroi, mais enfin, personne ne peut dire qu’il a pour but d’interdire des échanges. Ceux qui l’ont institué, ceux qui le maintiennent, ne le considèrent que comme moyen de créer un revenu public aux villes. Tous déplorent qu’il ait pour effet de soumettre les transactions à des entraves gênantes, et de diminuer les consommations des citoyens. Cet effet n’est certainement pas l’objet qu’on a eu en vue. Jamais on n’a entendu dire : Il faut mettre un droit sur le bois à brûler, à l’entrée de Paris, à cette fin que les Parisiens se chauffent moins. On est d’accord que l’octroi a un bon et un mauvais côté ; que le bon côté c’est le revenu, et le mauvais côté, la restriction des consommations et des échanges. On ne peut donc pas dire que, dans la question de l’octroi, le principe du libre-échange soit engagé.
L’octroi est un impôt mauvais, mal établi, gênant, inégal, entaché d’une foule d’inconvénients et de vices, soit ; mais enfin c’est un impôt. Il ne coûte pas un centime au consommateur (sauf les frais de perception), qui ne soit dépensé au profit du public. Dès l’instant que le public veut des fontaines, des pavés, des réverbères, il faut qu’il donne de l’argent. On peut imaginer un mode de percevoir cet argent plus convenable que l’octroi, mais on ne peut supprimer l’octroi sans y substituer un autre impôt, ou sans renoncer aux fontaines, aux pavés et aux réverbères. Les deux questions engagées dans l’octroi sont donc celles-ci :
1° Le revenu provenant de l’octroi rend-il au public autant qu’il lui coûte ?
2° Y a-t-il un mode de prélever ce revenu plus économique et plus juste ?
Ces deux questions peuvent et doivent être posées à propos de toutes les contributions existantes et imaginables. Or, sans nier, de beaucoup s’en faut, l’importance de ces questions, l’association du libre-échange ne s’est pas formée pour les résoudre.
L’octroi entrerait immédiatement dans la sphère d’action de l’Association, si, s’écartant de sa fin avouée, il manifestait la prétention de diminuer les échanges pour satisfaire quelques intérêts privilégiés.
Supposons, par exemple, une ville qui aurait mis sur les légumes un droit de 5 p. 100, dont elle tirerait une recette de 20,000 fr. Supposons que le conseil municipal de cette ville vînt à être changé, et que le nouveau conseil se composât de propriétaires, qui, presque tous, auraient de beaux jardins dans l’enceinte des barrières. Supposons enfin que la majorité du conseil, ainsi constitué, prît la délibération suivante :
« Considérant que l’entrée des légumes fait sortir le numéraire de la ville ;
Que l’horticulture locale est la mère nourricière des citoyens et qu’il faut la protéger ;
Que, vu la cherté de nos terrains (les pauvres gens !), la pesanteur des taxes municipales et l’élévation des salaires en ville, nos jardins ne peuvent pas lutter à armes égales avec les jardins de la campagne placés dans des conditions plus favorables ;
Que, dès lors, il est expédient de défendre à nos concitoyens, par une prohibition absolue ou un droit excessif qui en tienne lieu, de se pourvoir de légumes ailleurs que chez nous ;
Considérant que le profit que nous ferons ainsi à leurs dépens est un gain général ;
Que si l’octroi abandonnait les propriétaires de jardins à une concurrence effrénée, désordonnée, ruineuse, telle qu’elle existe pour tout le monde, ce serait leur imposer un sacrifice ;
Que le libre-échange est une théorie, que les économistes n’ont pas de cœur, ou, en tout cas, n’ont qu’un cœur sec, et que c’est fort mal à propos qu’ils invoquent la justice, puisque la justice est ce qui nous convient ;
Par ces motifs, et bien d’autres inutiles à rappeler, parce qu’on les trouve disséminés dans tous les exposés de motifs des lois de douanes, et dans tous les journaux, même patriotes, nous déclarons que l’entrée des légumes de la campagne est prohibée… ou bien soumise à un droit de 200 p. 100.
Et, attendu que le droit modéré que payaient jusqu’ici les légumes étrangers, faisait rentrer dans la caisse municipale 20,000 francs, que lui fera perdre la prohibition (ou le droit prohibitif), nous décidons en outre qu’il sera ajouté des centimes additionnels à la cote personnelle, sans quoi notre première résolution éteindrait nos quinquets et tarirait nos fontaines. »
Si, disons-nous, l’octroi se modelait ainsi sur la douane (et nous ne voyons pas pourquoi il n’en viendrait pas là, s’il y a quelque vérité dans la doctrine fondée par le double vote et soutenue par la presse démocrate), à l’instant nos coups se dirigeraient sur l’octroi, ou plutôt l’octroi viendrait de lui-même se présenter à nos coups.
Et c’est ce qui est arrivé. Quand Rouen a allégué qu’il élevait le droit d’octroi sur l’eau-de-vie pour protéger le cidre, quand M. le ministre des finances a déclaré qu’il préférait un droit sur l’eau-de-vie, qui dépasse la limite de la loi, à un droit sur le cidre, qui n’atteint pas cette limite, uniquement parce que l’impôt sur le cidre est impopulaire en Normandie, nous avons cru devoir élever la voix.
Maintenant, le National sait pourquoi notre Association combat la douane et non l’octroi. Ce que nous attaquons dans la douane, ce n’est pas la pensée fiscale, mais la pensée féodale ; c’est la protection, la faveur, le privilége, le système économique, la fausse théorie de l’échange, le but avoué de réglementer, de limiter et même d’interdire les transactions.
Comme institution fiscale, la douane a des avantages et des inconvénients. Chaque membre de notre Association a individuellement pleine liberté de la juger, à ce point de vue, selon ses idées. Mais l’Association n’en veut qu’à ce faux principe de monopole qui s’est enté sur l’institution fiscale et l’a détournée de sa destination. Nous faisons ce que pourrait faire, dans la ville dont nous parlions tout à l’heure, une réunion de citoyens qui viendrait s’opposer aux nouvelles prétentions du conseil municipal.
Il nous semble qu’ils pourraient fort bien, et sans inconséquence, formuler ainsi le but précis et limité de leur association :
« Tant qu’un droit modéré sur les légumes a fait entrer 20,000 fr. dans la caisse municipale, c’était une question de savoir si ces 20,000 fr. n’auraient pas pu être recouvrés de quelque autre manière moins onéreuse à la communauté.
Cette question est toujours pendante, s’étend à tous les impôts, et aucun de nous n’entend aliéner, à cet égard, la liberté de son opinion.
Mais voici que quelques propriétaires de jardins veulent systématiquement empêcher l’entrée des légumes afin de mieux vendre les leurs ; voici que, pour justifier cette prétention, ils émettent une bizarre théorie de l’échange, qui représente ce fondement de toute société comme funeste en soi ; voici que cette théorie envahit les convictions de nos concitoyens et que nous sommes menacés de la voir appliquée successivement à tous les articles du tarif de l’octroi ; voici que, grâce à cette théorie qui décrédite les importations, les arrivages vont diminuer, jusqu’à affaiblir les recettes de l’octroi, en sorte que nous verrons accroître dans la même proportion les autres impôts : nous nous associons pour combattre cette théorie, pour la ruiner dans les intelligences, afin que la force de l’opinion fasse cesser l’influence qu’elle a exercée et qu’elle menace d’exercer encore sur nos tarifs. »
FN:Voir notamment le n° 3, page 7. (Note de l’éditeur.)
Programme of the French Free Trade Association (25 Apr. 1847, LE)↩
BWV
T.121 (1847.04.25) "Programme of the French Free Trade Association", Le Libre-Échange, 25 Apr. 1847, no. 22, pp. 169-73. The original: "Declaration of Principles" of 10 May, 1846 signed by Bastiat and the Duc d'Harcourt is reprinted, along with the Association's new programme. [DMH]
Also in JDE, T. 17, no. 66, May 1847, “Programme de l’Association pour la liberté des échanges”, pp. 208-19.
NO AUTHOR GIVEN BUT FB MUST HAVE HAD SOME INPUT??
Text (JDE version)↩
[208]
L'Association pour la liberté des échanges reste fidèle à la déclaration qu'elle avait adoptée lors de sa formation. Elle croit, aujourd'hui comme hier, que, selon l'expression de Turgot, la liberté du commerce est un corollaire du droit de propriété; que le régime prohibitif n'existe qu'en violation des conditions de l'ordre légitime des sociétés; qu'il blesse les hommes dans leur liberté en les empêchant de choisir leur travail et en les induisant, lorsqu'il ne les y contraint pas, à donner une fausse direction à leurs efforts; qu'il nuit à la prospérité publique en provoquant des industries moins productives au préjudice d'industries plus fécondes ; qu'il froisse l'égalité civile et politique en soumettant tous les citoyens à un impôt au profit de quelques-uns ; qu'il compromet la paix entre les peuples, et méconnaît les intentions de la Providence qui, en variant à l'infini les climats et les aptitudes humaines, a indiqué aux hommes qu'ils doivent s'entr'aider et les a conviés à l'universelle fraternité.
Aujourd'hui, comme hier, l'Association regarde comme condamné et moralement détruit le système de protection injuste et aveugle, qui consiste à contraindre les membres d'un Etat à payer plus qu'ils ne valent les produits du travail de leurs concitoyens, et qui favorise ceux-là même qui ne s'aident point par leurs propres efforts. La seule protection qui soit digne des peuples modernes est celle qui tend à améliorer en elles-mêmes les conditions du travail ; celle qui se manifeste par un ensemble de moyens civilisateurs, parmi lesquels se distinguent l'éducation professionnelle, l'extension et le perfectionnement des institutions de crédit, la création de bonnes voies de communication, protection positive dont l'effet infaillible est d'augmenter la puissance productive et la richesse des nations et des individus, en rendant le travailleur plus habile, les capitaux ou instruments de travail plus accessibles à l'homme intelligent, honnête et laborieux, l'écoulement des produits plus aisé et plus régulier; protection intelligente et équitable en ce qu'elle ne confère de privilége à personne, et laisse toutes les chances à l'homme industrieux.
Aujourd'hui, plus encore qu'hier, l'association est persuadée que la liberté du commerce doit prochainement entrer dans le code des peuples avancés, parce que le spectacle des souffrances que présente en ce moment l'Europe témoigne avec une évidence nouvelle combien il importe d'assurer le bon marché des denrées et des choses usuelles. Or, pour que cette question de la vie à bon marché soit résolue, ainsi que le commandent l'honneur et le repos des Etats modernes, il ne faut rien moins que le concours de toutes les grandes nations, mettant en commun leurs efforts et rivalisant d'activité et d'intelligence, sans que rien amortisse leur émulation. Tout grand peuple qui, dans ce mouvement, se reploierait sur lui-même pour s'isoler, reconnaîtrait sa propre déchéance.
L'Association est convaincue enfin que le système prétendu protecteur est particulièrement onéreux pour les classes qui vivent d'un salaire journalier. Ce système, en effet, tend à enchérir les choses nécessaires à la vie, et on lui attribue à tort la vertu [209] d’augmenter dans la même proportion les salaires. Le labeur de l'ouvrier est une marchandise qui ne peut attendre pour la vente, et que par conséquent il faut écouler chaque jour, à quelque condition que ce soit. C'est la concurrence que se font entre eux les ouvriers, en offrant leurs bras et en demandant du travail, qui, plus que toute autre cause, détermine la rétribution qu'ils reçoivent. Ce qui se passe en ce moment sous nos yeux dit assez si le taux des salaires se règle sur la cherté des subsistances.
Mais, ainsi qu'elle l'a déclaré dès le jour où elle s'est constituée, l'Association reconnaît qu'il n'est pas possible de passer du régime actuel à celui de la liberté du commerce, si ce n'est par une transition ménagée sagement. En poursuivant avec fermeté le triomphe des principes, elle admet qu'il faut y mettre le temps, comme à toutes les choses humaines. Il ne nous suffit pas que la suppression des entraves qui nuisent tant à la fécondité du travail, doive être en dernier résultat infiniment avantageuse à la France ; nous tenons aussi à éviter tout ce qui pourrait ressembler à un bouleversement. De grands capitaux se sont engagés dans les industries bien moins nombreuses qu'on ne le dit, auxquelles, toute balance faite, le système protecteur est profitable; et quoique les intéressés aient déjà joui longtemps de la prime qu'en vertu du système ils prélèvent sur le public, il convient de leur laisser encore un délai afin qu'ils achèvent les perfectionnements qu'ils avaient annoncés. Les intérêts du Trésor sont plus dignes encore de sollicitude ; on doit être attentif à ne pas compromettre les revenus de l'Etat dans le passage du régime prohibitif au régime de la liberté. C'est donc graduellement, par des réformes successives, qu'il faut atteindre le but dont il sera impossible de détourner la France désormais.
En témoignage de cette pensée de prudence et de conciliation, nous faisons connaître ici les changements auxquels, dans notre conviction, il est permis et convenable de se réduire pour le présent; ceux qu'on ne peut différer plus longtemps sans porter un grand préjudice aux intérêts français, sans faire rétrograder notre patrie, tandis qu'autour d'elle tout le monde avance ; ceux qui satisfont à la condition de garantir l'existence des grandes industries actuellement privilégiées, sous la seule réserve que les producteurs fassent des efforts intelligents et soutenus; ceux qui ne porteraient aucune atteinte aux revenus publics, et qui au contraire, dans notre opinion, sont propres à les accroître, de manière à favoriser, puissamment peut-être, diverses mesures ardemment désirées.
PROHIBITIONS ET DROITS PROHIBITIFS. -La pensée systématique de nos lois de douanes est d'écarter les produits de l'industrie étrangère. Ce qu'on appelle la protection a pour nom véritable la prohibition. Les partisans du régime prétendu protecteur ne prennent même plus la peine de le dissimuler; ils déclarent hautement que leur principe et leur but est de réserver le marché national au travail national exclusivement, ce qui signifie qu'il faut élever une muraille à pic autour de nos frontières. Conformément à cette pensée, des intérêts privés, exploitant tour à tour les haines nationales, les préjugés publics, la faiblesse des gouvernements, l'inattention de l'opinion qui, assaillie de divers autres côtés, oubliait d'être sur ce point une vigilante gardienne de l'intérêt général, sont parvenus à faire établir des droits excessifs sur presque tous les objets dont les similaires étaient fabriqués à l'intérieur, bien ou mal, en grande masse ou en quantité presque imperceptible.
Le législateur, en instituant ces droits, annonçait la volonté de les réduire après un peu de temps : on les a maintenus indéfiniment, et même on est allé les aggravant sans cesse, sauf un petit nombre d'exceptions. On ne s'est pas contenté de droits prohibitifs, on a voulu la prohibition expresse, celle qui autorise à l'intérieur des violations de domicile, des attentats à la liberté individuelle. Le système de la prohibition absolue, qui prit naissance à l'époque la plus terrible de la Révolution, et qui ne fut mis en vigueur alors que comme mesure de guerre, a reçu ainsi, pour la satisfaction d'intérêts particuliers, des applications de plus en plus étendues. En ce moment, le plus grand nombre des objets usuels est absolument prohibé. Il y a prohibition absolue sur tous les tissus de coton et de laine, sauf quelques rares exceptions, c'est-à-dire sur la majeure partie du vêtement; prohibition absolue sur presque tous les fils de coton et de laine ; prohibition [210] absolue sur la plupart des poteries ;prohibition absolue sur les fontes moulées en général, ce qui comprend une variété infinie d'objets ; prohibition absolue sur la coutellerie, la quincaillerie et cent espèces d'outils en fer, en acier, en fer-blanc, en cuivre et en zinc ; prohibition absolue sur les articles de sellerie et sur les ouvrages en peau ; sur la plupart des objets de verrerie et de cristallerie ; sur la tabletterie. Il y a la prohibition directement inscrite sur le tarif, et la prohibition par interprétation. Le nom des bronzes, par exemple, n'est pas sur le tarif. Les bronzes n'en sont pas moins prohibés.
Dans cet ardent amour pour la prohibition formelle ou déguisée, on a inséré dans le tarif plusieurs centaines de taxes plus ou moins prohibitives, qui grèvent des produits accessoires. Chacune d'elles ne rend au Trésor qu'une somme insignifiante, et, quelque modification qu'on leur fasse subir, elles ne rapporteraient guère davantage. Elles ne servent qu'à vexer le commerce en lui imposant des formalités et des retards, et qu'à rendre hommage au principe de la prohibition dont nous ne craignons pas de dire qu'il est hostile à la civilisation même.
Tel est le régime qu'on a imposé à la France, au grand détriment de l'intérêt général, sans examiner si par la l'industrie française n'était pas privée de beaucoup de matières qu'elle eût mises en œuvre avec profit, et si les conditions de l'existence matérielle des populations n'en étaient pas aggravées. On prétendra peut-être que ces mesures extrêmes étaient nécessaires pour soutenir les premiers pas de l'industrie nationale. Nous croyons le contraire; mais il n'y a pas lieu d'ouvrir une discussion sur ce sujet. En mettant que lorsqu'elle était au berceau, tant de gêne lui fût nécessaire, on reconnaîtra qu'il faut procéder différemment à son égard aujourd'hui qu'elle a acquis, malgré tous les obstacles dont on l'a entourée, une constitution robuste; aujourd'hui que, dans de fréquentes solennités périodiques, on en proclame la supériorité, et que (les relevés de la douane l'attestent) elle verse avec avantage ses productions sur le marché général du monde.
Nous demandons que le nom même de la prohibition, en tant qu'elle a un caractère commercial, disparaisse du tarif. C'est un mot barbare qui doit être effacé de nos règlements commerciaux, comme la confiscation l'a été de notre Code politique. Nous ne discuterons pas ici en détail la quotité des droits par lesquels la prohibition devrait être immédiatement remplacée pour chaque marchandise. Nous croyons cependant pouvoir dire que, dans la plupart des cas, la prime de contrebande en donnerait une mesure approximative. Le commerce alors aimerait mieux payer une redevance à l'Etat qu'aux contrebandiers. Par là on augmenterait les recettes du Trésor tout en faisant disparaître une industrie que la morale condamne et qui est dangereuse pour l'ordre public. D'après cette base, parmi les articles actuellement prohibés, il n'en est pas, de ceux du moins qui sont importants, pour lesquels le droit de douane dût être supérieur à 20 pour 100. Tel devrait être le maximum pour les tissus de coton et de laine.
Il y a quelques industries à l'égard desquelles la liberté entière pourrait immédiatement remplacer la prohibition, tant dans notre tarif la prohibition a été répandue avec intempérance, tant on a mis d'acharnement à l'y maintenir, une fois qu'elle y a été introduite.Telle est l'industrie des bronzes. Il est notoire que nous y excellons, qu'aucun autre peuple ne nous y égale. Nous en exportons de grandes quantités, surtout en Angleterre.
La plupart des grandes industries qui ne sont pas protégées par la prohibition absolue le sont par des droits dont l'élévation est telle qu'ils sont réellement prohibitifs.Nous demandons que ces droits soient modérés, dès à présent, jusqu'au point où l'aiguillon de la concurrence étrangère se ferait légèrement sentir.A partir de ce point, ils seraient encore réduits graduellement, de manière à être ramenés à un minimum qui serait un droit fiscal ; car, nous tenons à ne laisser subsister aucun doute sur ce point; ce n'est pas comme source de revenu public que nous attaquons le tarif. Certains produits venant du dehors peuvent très-légitimement être considérés comme matière imposable. Un impôt sur les denrées dites coloniales ne soulève de notre part aucune objection. Mais il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'on établit une taxe sur un produit étranger [211] qui est fabriqué aussi à l'intérieur, il en résulte, pour le producteur de l'intérieur, une provocation à élever ses prix; le consommateur français paye alors non-seulement une taxe au Trésor pour tout ce que l'étranger envoie, mais encore une prime au producteur français, pour tout ce que celui-ci jette sur le marché; de sorte que le Trésor ne profite que d'une faible portion du sacrifice imposé au public La taxe alors coûte beaucoup aux citoyens, et rapporte peu à l'Etat. Dans ce cas, elle heurte ce que nous croyons être un principe fondamental du droit public chez les nations qui ont inscrit l'égalité devant la loi en tête de leur Code, à savoir, que les citoyens ne doivent d'impôt qu'à l'Etat. Dans ce cas, elle heurte ce que nous croyons être un principe fondamental du droit public chez les nations qui ont inscrit l'égalité devant la loi en tête de leur Code, à savoir, que les citoyens ne doivent d'impôt qu'à l'État.
Il est des industries vers lesquelles l'attention du législateur doit se tourner, afin de réduire spécialement les droits qui les protégent : ce sont les arts chimiques, pour lesquels nous n'avons de supérieurs nulle part, et qui, sous l'empire de circonstances particulières, se sont récemment organisés en monopole. Les divers établissements où se fabriquent les acides, les alcalis et les sels, réunis en un petit nombre de mains, s'entendent pour la vente de leurs produits, et ainsi, à leur égard, le public a entièrement cessé d'avoir pour ses intérêts la garantie de la concurrence. Le législateur ne doit pas permettre que cette garantie soit confisquée. S'il ne peut intervenir pour dissoudre la coalition, qu'il rétablisse la concurrence en supprimant les barrières qui empêchent les produits similaires de l'étranger de se présenter sur le sol français. Il est urgent d'appliquer ce remède partout où le monopole se présente. Il est notoire qu'il existe pour les poteries, pour les glaces et les cristaux. Il est constant aussi que les grands maîtres de forges se sont constitués en monopole pour les fournitures des rails. Dans toutes les adjudications leurs soumissions sont concertées. L'État en a fait l'expérience à ses dépens. Le ministre des travaux publics, plus d'une fois, a dû renouveler des adjudications, parce que les maîtres de forges, d'accord les uns avec les autres, avaient tenté de lui faire la loi.
NÉCESSITÉ DES RÉDUCTIONS GRADUELLES. - Nous insistons sur ce que le moment est venu d'appliquer à notre tarif la méthode des réductions réglées d'avance, année par année. Les manufacturiers alors, embrassant un long avenir, proportionneront mieux leurs efforts aux résultats qu'ils doivent accomplir. L'exemple du sucre de betterave est propre à démontrer aux plus incrédules la puissance du procédé qui consiste à graduer d'avance la modification des droits pour une série d'années. L'industrie de la betterave, ainsi mise en demeure de réaliser de grands perfectionnements, a surmonté des difficultés que ses adversaires avaient jugées invincibles, et qui ébranlaient la confiance de ses admirateurs les plus enthousiastes. Nos industries protégées sont en ce moment bien plus près du but qu'elles sont tenues d'atteindre, que la betterave ne l'était, en 1843, du terme à elle assigné. Lors donc qu'on leur aura fait éprouver, ainsi que l'intérêt général le commande, la pression de la nécessité, il est hors de doute qu'elles franchiront rapidement l'espace qu'il leur reste à parcourir.
Les industries protégées paraissent avoir oublié que la protection qu'on leur accorde se résout en un tribut que leur paye le public, et que ce tribut n'a été consenti par le législateur qu'à la condition expresse que ceux qui le recevraient l'emploieraient à se perfectionner, afin d'en affranchir bientôt le publics Lorsque le droit protecteur sera décroissant d'année en année, les producteurs privilégiés auront continuellement devant les yeux un rappel de l'obligation par eux contractée, et ils ne seront plus libres de ne la pas remplir.
SIMPLIFICATION DU TARIF. - Un autre changement que doit éprouver immédiatement le tarif, consisterait à le simplifier, même après en avoir retranché, ainsi que nous l'avons indiqué, plusieurs centaines d'articles qui concernent des produits accessoires, et ne donnent qu'un revenu insignifiant. En premier lieu, il est nécessaire de faire disparaître des classifications qui sont basées le plus souvent sur d'anciennes méthodes de fabrication, aujourd'hui abandonnées, et qui compliquent étrangement la perception. En [212] second lieu, il faut renoncer à des distinctions qui font varier le droit selon la frontière par où les produits étrangers arrivent, et qui sont en contradiction flagrante avec le principe de l'unité de territoire et de l'unité de législation, justement regardé comme une des plus précieuses conquêtes de la Révolution française. Le fer non ouvré, et considéré seulement comme matière première, et même abstraction faite des frontières diverses où il se présente et des différences de pavillon, est soumis à trente-deux droits, en vertu de trente-deux variations de qualité ou de forme. Si l'on tient compte des différences de droits motivées sur la diversité des frontières ou sur le pavillon, on trouve que le fer est traité par la douane de soixante-quatre manières diverses. Dans le tarif de la Constituante, tous ces articles étaient réduits à huit : le fer en gueuses, le fer en barres, le fer en verges, l'acier, la tôle, le fer-blanc, le fil de fer ou d'acier, et la ferraille; et, de ces huit articles, le premier et le dernier étaient francs de droit; le second et le troisième, d'après le procédé actuel de fabrication, ne devraient plus être séparés.
DE L'INDUSTRIE MARITIME. - Aucune industrie n'est digne de plus d'intérêt que celle de la navigation ; elle figure, à titre d'intermédiaire fort important, dans les échanges internationaux, et elle a plus que toute autre une relation directe et intime avec la puissance nationale. Autrefois notre marine marchande était florissante; mais le système prohibitif lui a causé un dommage qui est devenu presque irréparable. Auprès des marines étrangères, elle est dans une décadence continue. Et comment en serait-il autrement ? Les autres marines ont du fret; la prohibition a retiré à la marine française les transports que la nature des choses lui offrait. Les autres marines reçoivent des facilités pour se procurer au plus bas prix toutes les matières dont elles ont besoin; la marine française, cernée par la prohibition comme par un cercle de fer, ne peut obtenir qu'en les payant cher tous les matériaux, tous les objets qu'elle emploie. Aux autres marines les gouvernements laissent une liberté qu'ils étendent chaque jour; la marine française n'a, dans son action, aucune latitude. A chaque effort, à chaque pas, elle rencontre quelque article de loi ou d'ordonnance, ou quelque circulaire qui l'entrave ou l'arrête. Le système réglementaire est venu se joindre au système prohibitif pour l'accabler, et il pèse sur elle comme il pesait sur les diverses branches de l'industrie manufacturière du temps des corporations. C'est ainsi qu'empirent chaque jour, au grand préjudice de l'industrie française, les conditions auxquelles elle peut exporter ses produits, et que la France cherche vainement les éléments de force navale dont elle sent qu'elle ne peut se passer.
Les surtaxes de pavillon par lesquelles on avait espéré compenser les gênes et les sacrifices imposés à la navigation française, n'ont pas seulement le défaut d'être onéreuses au public lorsqu'elles exercent leur action; elles ont de plus celui d'être dépourvues d'efficacité, illusoires ou inapplicables dans la plupart des circonstances; car le système de la réciprocité s'est introduit dans la législation maritime internationale, et désormais il est supérieur à toutes les attaques qu'on peut diriger contre lui. Il fait chaque jour de nouvelles conquêtes, témoin notre traité récent avec la Russie, quelque incomplet qu'il soit même sous ce rapport; et il n'est pas un homme pratique qui ne considère comme chimérique la pensée conçue par quelques personnes de le renverser. Il faut qu'on cesse de se consumer en stériles efforts pour s'y soustraire, et qu'on en accepte franchement les conséquences. Nous demandons que les relations directes entre nos ports et les principaux entrepôts d'Europe, qui sont interdites aujourd'hui,pour les provenances d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, puissent désormais s'effectuer en liberté, afin que les manufacturiers de Mulhouse, quand le coton est à bas prix à Liverpool plus qu'au Havre, aient le moyen de s'y approvisionner, et que les populations affamées, quand elles voient du blé d'Amérique disponible dans les docks de Londres, aient la faculté d'aller tout droit en acheter. Nous demandons que, pour l'achat des matériaux de construction de tout genre, et pour l'acquisition de navires même tout construits, nos armateurs soient le plus tôt possible rendus libres, comme ils l'étaient autrefois. Nous demandons enfin que l'industrie maritime soit dégagée d'une multitude de clauses réglementaires qui la paralysent complétement.
[212]
ABAISSEMENT DES DROITS SUR LES DENRÉES COLONIALES, FAVORABLE AU REVENU PUBLIC. - Un grand nombre de faits déjà anciens, parfaitement constatés, et des expériences en grand qui se sont récemment passées en Angleterre, démontrent que les droits sur les denrées coloniales, pour rendre au Trésor le maximum de revenu, doivent être modérés. Il n'est plus douteux qu'en France un abaissement des droits fiscaux établis sur ces denrées accroîtrait les recettes publiques et soulagerait les contribuables, en même temps qu'il multiplierait nos échanges avec les régions équinoxiales. Nous demandons, en conséquence, que les droits sur le sucre, le café, le thé, et sur les productions analogues, soient diminués. Les droits actuels sur le sucre et le café remontent à une époque où ces objets valaient le double ou le triple de ce qu'ils se vendent aujourd'hui. Le droit sur le sucre vient d'être réduit, en Angleterre, avec avantage pour l'Etat, de 63fr. à 35 fr. les 100 kilogrammes, et la loi a statué que, dans peu d'années, le droit serait uniforme pour toutes les provenances. Il reste chez nous à 49 fr. 50 c., ce qui est excessif. Cette même exagération des droits écarte complétement de la consommation française beaucoup de produits sucrés qu'il serait facile de préparer en grande quantité aux colonies, de manière même à ouvrir à l'industrie coloniale une carrière féconde.
DES DROITS ET DES FORMALITÉS A LA SORTIE. - A plus forte raison, il convient de faire disparaître tous les droits qui pèsent sur l'exportation des marchandises françaises. Il est incroyable qu'il y ait encore des prohibitions à la sortie. On en compte cependant plusieurs ; une, par exemple, sur le minerai de fer. On a cru enrichir la France en privant l'Espagne des minerais de fer des Pyrénées, dont nous ne savons que faire chez nous, faute de combustible. L'Espagne a riposté en prohibant la sortie des beaux et inépuisables minerais de fer des Asturies, que nous pourrions utiliser ailleurs. Car c'est ainsi que procèdent les Etats qui s'abandonnent aux funestes doctrines de la prohibition; l'on nuit à son voisin en se portant préjudice à soi-même, ou bien on se venge d'un tort du voisin en se faisant à soi-même un dommage de plus. De même, dans quel but maintiendrait-on désormais un droit de 6 fr. 60 c.par kilogramme sur la sortie des soies ? Est-ce parce qu'on tient à ce que le prix des soies reste modéré à l'intérieur ? Dans ce cas, pourquoi conserve-t-on un droit à l'entrée sur les soies étrangères ? Il est à remarquer que nos fabricants de soieries ne réclament pas le maintien du droit à la sortie sur les soies françaises ; mais pour l'honneur du principe restrictif, on s'obstine à leur conserver la prétendue faveur dont ils ne veulent pas.
Ces droits à la sortie, qui ne rapportent rien au Trésor et qui lui coûtent pour la surveillance qu'ils nécessitent, sont vexatoires pour nos producteurs, à cause des formalités auxquelles l'exportation des produits est en conséquence soumise. La fabrique parisienne est ainsi forcée de faire examiner, vérifier, plomber tous les articles qu'elle envoie en si grand nombre au dehors, et qui sont toujours pressés d'arriver. C'est un sacrifice de temps et d'argent qui est très-lourd, et dont on serait répréhensible de ne pas affranchir immédiatement l'industrie française.
DES MATIERES PREMIERES. - Parmi les nombreux produits du travail humain, il en est qui doivent être rangés à part dans le tarif des douanes, comme dans tous les actes par lesquels les pouvoirs de l'Etat manifestent leur sollicitude pour le travail. Ce sont ceux qui servent d'aliment à un travail considérable, ceux qui sont la base de quelque industrie du premier ordre, et, à plus forte raison, ceux qui sont employés par un grand nombre d'industries. Nous demandons que ces matières soient libérées de tout droit, aussitôt qu'il sera possible, en prenant en considération les nécessités du Trésor. C'est une pensée qu'on trouve inscrite sur presque toutes les pages du tarif voté par une assemblée illustre, dont les principes ont tant de droit à notre respect, l'Assemblée constituante. Nous réclamons cette exemption nommément pour le coton en laine, qui supporte aujourd'hui encore le droit dont on l'avait grevé alors qu'il se vendait le triple du prix auquel la concurrence des planteurs américains entre eux l'a fait tomber. Du moment que les Anglais ont supprimé tout droit sur le coton en laine, nous sommes tenus d'en faire autant; autrement nous aurions désormais un désavantage trop réel vis-à-vis d'eux sur le marché général du monde. Les personnes versées dans la pratique [214] reconnaîtront avec nous que le système des drawbacks, quelque efficace qu'il soit en apparence, n'est pas propre à rétablir l'équilibre rompu ainsi entre les Anglais et nous. Par le même motif, il conviendrait de supprimer entièrement les droits sur les matières tinctoriales.
Le droit sur les laines brutes devrait de même disparaître d'ici à peu d'années. C'est une de ces décevantes faveurs dont on s'est servi pour séduire une partie des agriculteurs et les gagner à la cause de la prohibition. Il est démontré maintenant que ce droit n'a point eu l'effet qu'on en attendait, d'elever le prix des laines au profit des agriculteurs ; les faits attestent même que l'élévation du prix, au lieu d'être en raison directe du droit, a été plutôt en raison inverse ; les personnes les mieux informées en ont publiquement fourni plus d'une fois la preuve péremptoire. Le droit sur les laines ne sert qu'à gêner les transactions au dehors et à fausser les positions au dedans.
La réduction et la suppression des droits sur les cotons et les laines entraîneront nécessairement la réduction et la suppression des drawbacks, ou restitutions de droits, que le Trésor paye à la sortie, et qui s'élèvent à une somme très-considérable. Les drawbacks ont le double inconvénient que le Trésor ne les paye pas toujours lorsqu'ils seraient réellement dus, et que, dans d'autres circonstances, il en gratifie des producteurs auxquels il ne les doit pas, puisqu'ils n'ont en aucune façon acquitté les droits ou supporté les charges dont on leur tient compte.
Mais de tous les objets inscrits au tarif, ceux que nous recommandons le plus aux sentiments libéraux du gouvernement, des Chambres et du public, sont les matières premières par excellence, celles dont toutes les industries ont besoin à chaque instant, la houille, le fer et l'acier, trois substances dont la consommation, et par conséquent le bon marché, donnent jusqu'à un certain point la mesure de la civilisation des peuples.
La houille a été justement nommée le pain de l'industrie; c'est d'elle qu'on retire les deux principaux éléments de toute production, le mouvement et la chaleur. Les droits sur la houille datent d'une époque où cette substance n'était presque d'aucun emploi, où la machine à vapeur n'était pas inventée, et où la fabrication du fer à la houille n'avait pas encore été établie chez nous. Aujourd'hui ces droits ne sont maintenus que par l'effet d'une aberration déplorable. On comprendrait un gouvernement qui, dans une disposition jalouse et haineuse contre les peuples voisins, s'appliquant à les gêner dans leur travail, voudrait assurer à ses propres populations la jouissance exclusive de la houille que la nature lui aurait prodiguée sur son territoire, et frapperait cette houille d'un droit de sortie. Mais comment s'expliquer qu'un gouvernement éclairé, qui aspire à développer et à féconder le travail chez lui, impose cette substance précieuse, lorsqu'elle ne demande qu'à entrer, et lorsqu'il n'en possède chez lui que des approvisionnements limités, d'un droit égal quelquefois au prix de vente sur les lieux d'extraction, ou même d'un droit quelconque ? Notre littoral est dépourvu de mines de houille; il n'a de ressources que dans la houille étrangère, et on la lui refuse ou on la lui enchérit, pendant qu'on ne devrait rien négliger pour la lui procurer à bas prix. Dès à présent, le droit sur la houille doit être complétement supprimé à toutes les frontières. Le maintien d'un droit protecteur quelconque sur la houille étrangère n'a même plus de prétexte; car c'est un fait aisé à vérifier, qu'il n'est pas une seule des mines qu'on travaille aujourd'hui sur notre territoire, qui, avec la liberté entière de l'entrée des houilles, ne pût être exploitée avec la même activité et avec succès.
Les droits sur les fers sont abusifs; ils interdisent l'entrée des fers étrangers, quoique la production intérieure soit insuffisante pour les besoins, et c'est ainsi qu'en ce moment beaucoup d'entreprises utiles sont frappées de suspension. L'exemple du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain est connu de tout le monde. Les grandes forges qui fabriquent les rails sont, avons-nous dit, organisées en coalition, et s'entendent pour faire la loi aux compagnies de chemins de fer et à l'Etat lui-même, quand c'est lui qui construit. Pour donner une idée des charges qui en résultent, il suffit de dire qu'il y a telle compagnie de chemin de fer dont les achats en fers de toute espèce et sous toute forme s'élèvent à 65 millions de francs sur une dépense totale de 180.
[215]
ll n'est pas moins notoire qu'à la faveur d'un pareil régime les profits de cette industrie excèdent tout ce qui peut être considéré comme une juste rémunération du travail, et que certaines matières qui y servent, telles que le bois, ont pris une valeur démesurée. Ainsi, l'état présent des choses est éminemment dommageable au public, et ne se justifie par aucune considération. Le moment est venu de procéder franchement à l'abaissement des droits sur les fers, afin de nous rapprocher du terme que l'intérêt général commande d'atteindre, l'affranchissement complet de cet article. Nous demandons que le droit sur la fonte brute soit supprimé dès à présent. Avec un droit égal à 20 pour 100 de la valeur actuelle des qualités communes sur le fer en barres, tous ceux des établissements métallurgiques qui sont viables continueraient de prospérer, et ils auraient pour l'avenir la ressource des perfectionnements ultérieurs qui leur sont faciles, tout autant qu'à la majorité des forges anglaises, et celle des avantages inhérents à un grand accroissement de consommation. Le droit sur les fers devrait être indépendant de toute distinction de provenance et de dimensions ; les motifs qui ont pu exister pour classer le fer en barres sous differents droits ne subsistent plus avec les méthodes de fabrication qui sont admises partout aujourd'hui.
Pareillement il conviendrait d'affranchir dès aujourd'hui de tout droit les fers en barres destinés à la fabrication de l'acier. Rien ne serait plus facile que d'empêcher les fers introduits pour cet usage d'être détournés de leur destination. Lors de la dernière réunion des trois Conseils généraux de l'industrie, le gouvernement s'était montré favorable à cette franchise spéciale.
A l'égard de l'acier, les pouvoirs publics ont à agir avec une fermeté et une promptitude toutes particulières. La partie vive de tous les outils est en acier ; par conséquent, un peuple qui n'a que de l'acier médiocre ou mauvais, contraint par cela même à se servir d'outils défectueux, porte avec lui une cause d'infériorité qui ne le quitte jamais dans son travail, soit que se livrant à la culture du sol, il fauche ou moissonne, abatte les arbres ou les taille; soit que, dans les ateliers de l'industrie manufacturière, il manie la lime ou le rabot, la hache ou le ciseau. C'est un fléau pour une nation industrieuse que d'être réduite à un acier de qualité tout au plus médiocre. Et cependant la nation française y est condamnée de par le régime prohibitif. Sous l'ancien régime, le droit sur l'acier était modéré. La Constituante fixa le droit sur l'acier fondu à 61 fr. par 1,000 kilogrammes. La République le mit successivement à 6 fr. 10 c., 3 fr., 5fr. 10 c., 5 fr. 60 c. Napoléon, dans un de ces accès de volonté impérieuse où il outrait volontiers toute chose, l'éleva subitement à 99 fr. Cette aggravation n'a pas contenté les intéressés, et, depuis 1814, ils ont obtenu que ce droit élevé fût successivement rendu treize ou quatorze fois plus fort. 1l a été porté à 1,320 fr. par navire français, à 1,413 fr. par terre ou par navire étranger. A l'abri de droits pareils, les fabricants français, qui dans cette industrie sont en petit nombre, ont cessé d'être stimulés par la concurrence étrangère ; et c'est ainsi que nous sommes restés tant en arrière des aciers anglais. Il est indispensable de mettre un terme à un système si peu réfléchi et si funeste, véritable surprise faite aux pouvoirs publics. Il ne dépend que de nos fabricants d'acier d'avoir des produits exactement semblables à ceux de la Grande-Bretagne. Ils n'ont qu'à prendre la peine d'aller chercher en Suède les mêmes fers, et qu'à réclamer l'admission de ces fers en franchise pour leur usage special, au lieu de la combattre, ainsi qu'ils l'ont fait, à l'étonnement général. Dans ces circonstances, nous demandons qu'immédiatement le droit sur l'acier soit ramené à ce qu'il était sous l'Empire, et qu'ensuite, dans un délai que le législateur déterminerait par la même loi, il soit mis à néant.
L'abaissement ou la suppression des droits sur la houille, la fonte, le fer et l'acier motiverait suffisamment une diminution proportionnelle des droits sur les machines. C'est une industrie actuellement fort avancée chez nous, et, si elle avait les matières premières à bas prix, elle ne craindrait la concurrence de personne.
DES DENRÉES ALIMENTAIRES. - Nous demandons qu'on avise le plus tôt possible à réparer une grave erreur du régime prohibitif. La viande est un aliment indispensable à l'homme qui travaille de ses bras. C'est, pour ainsi dire, la matière première de la force [216] physique. A ce titre, la viande devrait être exempte de droits. Elle l'était au moment où éclata la Révolution, et, dans les époques antérieures, elle n'avait jamais été soumise qu'à des droits très-faibles. La Constituante en proclama l'entrée en franchise, et cette immunité a été maintenue jusqu'à la Restauration. Le gouvernement d'alors, après avoir établi, en 1816, un petit droit fiscal de 3 fr. 30 c. par tête de bœuf, adopta, en 1822, le droit protecteur actuel de 55 fr. Sans élever d'autant la valeur vénale de la viande sur toute l'étendue du territoire, cette taxe a cependant son effet presque entier dans plusieurs des départements frontières. Mais le gain qui peut en résulter pour les éleveurs est bien loin de balancer les charges sans fin que le régime protecteur inflige à l'agriculture; il est dérisoire en comparaison des profits que la protection procure à l'industrie des fers, par exemple. Seul même, le dommage que l'on cause aux éleveurs en les empêchant de se pourvoir au dehors de bétail maigre pour l'engraissement, compense et au delà le bénéfice qu'ils peuvent retirer du droit de 55 fr. La taxe sur le bétail ne contribue pas peu à maintenir parmi nos agriculteurs cette opinion erronée, qu'ils participent aux profits du régime prohibitif. Elle les accoutume à rechercher la protection qui leur est due là où elle ne réside point. On ne saurait trop le dire, dans un pays d'égalité comme le nôtre, la seule protection qu'on soit fondé à réclamer, et qui se puisse avouer, est celle qui tend à améliorer les conditions du travail en lui-même, et à le rendre plus fécond pour l'homme industrieux. La question des droits de douane sur la viande n'est pas seulement une affaire d'économie publique, c'est aussi, c'est avant tout une affaire d'humanité. L'exemption de cette denrée se présente comme un des éléments essentiels de la solution du problème de la vie à bon marché. En conséquence, nous demandons que prochainement le bétail soit admis en franchise, et que, provisoirement, on lui applique dès aujourd'hui le tarif de 1816.
Les viandes salées devraient immédiatement être exemptes de droits. Il y a tout lieu de croire que l'Amérique pourrait nous en envoyer, à des prix modérés, un approvisionnement considérable qui prendrait place dans la consommation, au grand avantage des classes peu aisées, tandis que les pays qui nous avoisinent ne sont en état de nous fournir de bétail qu'une quantité extrêmement limitée.
La législation sur les céréales appelle une grande réforme. Le système de l'échelle mobile est maintenant jugé. Le commerce qui, pour se livrer avec sécurité à des entreprises de longue haleine, demande des bases stables, ne trouvant que la mobilité, s'abstient, et les opérations commerciales sur les grains ne commencent que quand la disette est déclarée. Ce qui prouve surabondamment non-seulement l'impuissance, mais aussi les dangers de ce système, c'est que, nous le voyons en ce moment, on l'abandonne lorsque les circonstances deviennent graves. Si les céréales devaient continuer d'être frappées d'un droit de douanes, il faudrait que ce fût un droit fixe d'une quotité modérée. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de nous souvenir que l'idée d'imposer les grains à l'entrée est toute moderne ; que l'ancien régime ne l'a pas pratiquée; qu'elle m'a pris place dans la législation anglaise qu'en 1804, dans la nôtre qu'en 1819, et que les Anglais, après une expérience de quarante-deux ans, l'ont considérée comme impolitique et inhumaine, et l'ont écartée pour revenir à la liberté.On ne s'explique pas que ce soit depuis l'avénement des idées démocratiques en France qu'un système, dont la prétention avouée est d'enchérir le pain, se soit fait jour et ait pris pied dans nos lois.
Nous contestons qu'il y ait aucun argument qui puisse établir que la cherté du pain est un bien, et le bon marché du pain un mal; nous n'en tenons pas moins à constater que la crainte exprimée par quelques personnes d'un abaissement extrême du prix du blé, qu'on a représenté comme devant être l'effet de la liberté entière du commerce des grains, est dénuée de fondement. Les approvisionnements de blé, que peuvent livrer les pays producteurs par excellence, sont très-limités : nous en faisons cette année la triste expérience. Si les débats parlementaires qui ont eu lieu dans la Grande-Bretagne, si les renouvellements de baux qui s'y sont effectués depuis que la liberté du commerce des grains y a été proclamée, ont un sens, c'est que l'influence de la liberté complète de l'importation ne saurait avilir les prix au dedans, et se réduirait presque à prévenir les grands [217] écarts, les fortes hausses. Il est constant, en effet, que les baux qui ont été renouvelés depuis que la loi a établi en Angleterre la libre entrée des céréales, l'ont été aux mêmes conditions que par le passé.
Dans la période de transition où l'on maintiendrait un droit sur les céréales, le droit sur les farines, qui présentement est exagéré relativement à celui des grains, devrait y être exactement proportionnel.
RÉVISION DES REGLEMENTS DE LA DOUANE. - Nous demandons enfin que les règlements des douanes soient soumis à une révision générale. Afin d'obtenir une perception des droits qui fût mathématiquement exacte, on a compliqué ces règlements a l'infini, on les a rendus minutieux et vexatoires : il faut qu'ils deviennent simples, conciliants et expéditifs. Ce sera une mesure de haute et intelligente protection pour l'industrie; pour le Trésor public ce sera un profit tout net, puisque le personnel des douanes pourra être beaucoup moins nombreux. La douane paraît ignorer que le temps est précieux pour le commerçant; qu'un délai de quelques jours, et même de quelques heures, quand il s'agit des pays les plus voisins, suffit pour rendre une opération impossible. Pareillement, elle semble avoir pour principe que tout commerçant est un fraudeur-né et ne peut être autre chose. De là le penchant de la douane à multiplier les formalités, à hérisser les règlements de clauses pénales et de dispositions arbitraires. La justice ordinaire a été suspectée, on lui a retiré l'appréciation morale des délits, et on lui a lié les mains dans l'application de la loi. On a créé, au moyen des parts d'amendes et de confiscations, un intérêt personnel, pour chacun des agents de la douane, chefs et inférieurs à la découverte et à la rigoureuse punition pécuniaire de la moindre fraude réelle ou supposée, volontaire ou non.
On a donné par là au commerce vingt mille surveillants fondés à le considérer comme une proie. C'est une source inépuisable de vexations pour les commerçants, les voyageurs, les armateurs, et tout le personnel maritime. La fortune des citoyens, même les plus observateurs des lois, qui se livrent aux échanges internationaux, surtout par la voie maritime, est sans cesse sous le coup d'une confiscation ; car pour constituer un délit qui retombe sur le capitaine et sur l'armateur, et dont le corps même du navire répond, il suffit qu'on trouve à bord quelque objet qui n'aura pas été déclaré ou qu'on n'en retrouve plus un autre dont la déclaration aura été faite. On est allé plus loin encore : sans tenir compte des sentiments d'honneur dont l'autorité doit donner l'exemple, surtout dans ses rapports avec des hommes honorables, on encourage publiquement la délation, pendant qu'on pousse à la fraude, non le commerce qui se respecte, mais quelques subalternes, par l'exagération des droits et par la multiplicité des prohibitions. Le délateur a sa part garantie par la loi et les ordonnances, et on maintient ainsi dans tous nos ports une profession ignominieuse, pratiquée par des gens sans aveu. Assurément, de nos jours, le législateur rougirait d'organiser ou de sanctionner rien de pareil, et la douane ne s'abaisserait pas à le demander. C'est le legs d'un temps où la loi affichait à tout propos des rigueurs draconiennes et où le législateur employait tous les moyens pour satisfaire la violence des passions publiques. La prime donnée par la douane aux dénonciateurs, de même que le système des prohibitions absolues et l'esprit tracassier des règlements, datent de la plus funeste époque de la Révolution. C'étaient des mesures de guerre contre les nations avec lesquelles la France soutenait une lutte à mort.Au jourd'hui, dans notre époque de paix, avec la douceur qu'ont acquise les mœurs publiques, la douane, malgré la bienveillance connue des administrateurs qui la dirigent de Paris, persévère dans ces déplorables traditions, qui sont sans exemple dans la législation même fiscale des peuples civilisés. Enfin la douane, dans sa pratique, a contracté des habitudes que repousse le sentiment de la liberté individuelle, et contre lesquelles se révolte la pudeur publique : telles sont les visites à corps. C'est ainsi que des barbares, nne fois vainqueurs, pourraient se croire autorisés à traiter un peuple conquis. Dans un pays libre, c'est sans excuse, et c'est un abus odieux qu'il devrait suffire de signaler pour qu'il soit supprimé.
RÉSUMÉ. - En résumé, l'Association déclare que le temps est venu de mettre fin à [218] l'isolement commercial ou des intérêts particuliers (se superposant à l'intérêt général), sont parvenus à réduire la France, et de commencer d'une main ferme l'application graduelle du principe de la liberté du commerce, qui, jusqu'à ce jour, avait été écarté, au mépris de la raison et de la justice. Elle proclame hautement qu'en particulier pour les denrées alimentaires, tant du règne végétal que du règne animal, et pour les principales matières sur lesquelles s'exerce le travail agricole ou manufacturier, les intérêts généraux et permanents du pays et les circonstances spéciales de plus en plus graves au milieu desquelles les populations sont placées accidentellement, font une loi de procéder sans délai à un changement de régime; et que le but à atteindre, tant pour les denrées alimentaires que pour les matières premières, est la suppression de toute taxe d'entrée.
Considérant toutefois qu'il est convenable d'accorder un délai aux capitaux qui se sont engagés dans les industries réellement protégées ; que le maintien intégral des recettes publiques sera mieux garanti si l'on procède par gradation; que l'opinion publique elle-même se prononcera avec bien plus d'énergie pour la liberté des échanges, lorsque de premières épreuves en auront fait ressortir les avantages à tous les yeux;
L'ASSOCIATION se borne à demander une loi de douane où son principe serait appliqué dans les limites suivantes :
I. Dispositions que la loi mettrait en vigueur immédiatement. - Toutes les PROHIBITIONS commerciales à l'entrée seraient levées et remplacées par un droit équivalant à la prime de contrebande, ou dans les cas où ce terme de comparaison n'existerait pas, par un droit spécifique dont le chiffre serait calculé de manière à ne pas excéder 20 pour 100 de la valeur.
Tous les droits d'entrée seraient réduits de même à un taux dont le maximum répondrait à 20 pour 100, à l'exception des droits sur les DENRÉES dites COLONIALES, qui, à titre de droits fiscaux, pourraient rester plus élevés. (Voir ci-après, lV.)
Les CÉRÉALES seraient soustraites au régime de l'échelle mobile, et soumises à un droit fixe de 2 fr. par hectolitre.
Le droit sur les FARINES serait exactement proportionnel.
Pour le BÉTAIL, le tarif de 1816 (3fr. 30 c. par tête de bœuf) serait rétabli.
Les VIANDES SALÉES de toute espèce seraient exemptes de droit.
Les droits sur la HOUILLE et sur la FONTE brute seraient supprimés.
Les fers en barres, spécialement destinés à la fabrication de l'acier, seraient affranchis de tout droit.
Le droit sur l'ACIER serait ramené au tarif de l'Empire (99 fr. par 1,000 kil.)
Le droit sur les graines oléagineuses serait ramené au taux où il était avant la loi de 1845.
Les droits sur PLUSIEURS CENTAINES D'ARTICLES qui ne produisent au Trésor que des recettes insignifiantes, seraient supprimés.
Les distinctions qui font varier les droits selon les qualités et les formes des objets d'une même nature seraient, dans la plupart des cas, abolies.
Les distinctions de ZONES et de CLASSES, donnant lieu à des différences de droits, selon les frontières de terre ou de mer où les produits se présentent, seraient abolies.
Tout droit à la sortie serait supprimé.
II. Dispositions qui statueraient pour l'avenir. - A l'expiration d'un délai qui serait détermine d'avance par la loi même de la réforme douanière, tous les droits d'entrée seraient réduits, par voie d'abaissement graduel, de manière à ce qu'aucun n'excédât 10 pour 100; sauf l'exception ci-dessus, relative aux denrées dites coloniales.
Les droits d'entrée sur les principales matières premières, et notamment sur les COTONS EN LAINE, les LAINES EN MASSE, les CHANVRES ET LES LINS bruts, teillés ou peignés, les FERS et les ACIERs en barres, les SUBSTANCES TINCTORIALES, seraient soumis à une réduction immédiate, et ensuite graduellement diminués, de manière à disparaître à l'expiration d'un délai, qui serait déterminé d'avance par la même loi.
A la même époque, les droits sur les CÉRÉALES et sur le BÉTAIL seraient supprimés.
III. Drawbacks. - Les PRIMES A LA SORTIE et les DRAWBACKs seraient de même graduellement supprimes.
[219]
IV. Dispositions relatives aux colonies. - Les droits fiscaux sur les DENRÉEs dites COLONIALES seraient réduits jusques au taux qui, par l'accroissement de la consommation, serait le plus productif pour le Trésor.
L'égalité douanière serait graduellement établie entre les produits des colonies françaises et ceux de provenance étrangère.
V. Dispositions concernant la navigation. - Les règlements et les tarifs auxquels l'industrie maritime est soumise seraient changés, de manière à permettre à la marine marchande de s'approvisionner librement des matériaux et des objets de tous genres qui lui sont nécessaires, jusques et y compris les navires tout construits ;
A laisser aux armateurs toute latitude dans la disposition de leur capital et dans l'organisation de leurs entreprises ;
Et à faciliter les rapports avec les marchés extérieurs, et notamment les relations directes avec les entrepôts étrangers, pour l'importation des produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.
Une loi spéciale déterminerait la progression suivant laquelle les droits différentiels de pavillon iraient en diminuant et le délai après lequel ils seraient supprimés.
VI. Règlements de la douane. - Les règlements de la douane seraient révisés dans le but de simplifier et d'abréger les formalités et de faire disparaître diverses clauses gratuitement vexatoires.
Démocratie et libre-échange [25 Avril 1847] ↩
BWV
1847.04.25 “Démocratie et libre-échange” (Democracy and Free Trade) [*Libre-Échange*, 25 Avril 1847] [OC2.18, p. 100]
Démocratie et libre-échange
25 Avril 1847
Un philosophe devant qui on niait le mouvement se prit à marcher.
C’est un mode d’argumentation que nous mettrons en usage chaque fois que l’on nous en fournira l’occasion.
Nous l’avons déjà employé à propos du traité de Méthuen. On assurait que ce traité avait ruiné le Portugal, nous en avons donné le texte.
Maintenant nous sommes en face d’une autre question.
Les amis du peuple font au libre-échange une opposition haineuse.
Sur quoi nous avons à nous demander :
Le libre-échange, quant aux choses les plus essentielles, est-il ou n’est-il pas dans l’intérêt du peuple ?
Chacun fait, comme il l’entend, parler et agir le peuple. Mais voyons comment le peuple a parlé et agi lui-même quand il en a eu l’occasion.
Depuis un demi-siècle, nous avons eu des constitutions fort diverses.
En 1795, aucun Français n’était exclu du suffrage électoral.
En 1791, il n’y avait d’exclus que ceux qui ne payaient aucun impôt.
En 1817, étaient exclus ceux qui payaient moins de 300 francs.
En 1822, l’influence de la grande propriété fut renforcée par le double vote.
Ces quatre assemblées, émanées de sources diverses, depuis la démocratie la plus extrême jusqu’à l’aristocratie la plus restreinte, ont voté chacune son tarif.
Il nous est donc aisé de comparer la volonté de tous exprimée par tous, à la volonté de quelques-uns exprimée par quelques-uns. Nous soumettons le tableau suivant aux méditations de nos concitoyens de toutes classes.
| TARIF DE 1795 | TARIF DE 1791 | TARIF DE 1817 | TARIF DE 1822 | |||||||||||||||||||||||
| tout français | tout contribuable | cens de 300 francs. | double vote. | |||||||||||||||||||||||
| est électeur. | est électeur. | |||||||||||||||||||||||||
| Aliments. | ||||||||||||||||||||||||||
| Froment, seigle, maïs, orge, avoine, riz, l’hectol. | néant. | néant. | néant. | 25 c. à 15 f. | ||||||||||||||||||||||
| Bœufs | » | » | 3 | f. | 30 | 55 | f. | » | ||||||||||||||||||
| Veaux | » | » | 1 | 10 | 27 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Moutons | » | » | 0 | 27 | 1/2 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||
| Graisse (les 100 kilog.) | » | » | 11 | à | 30 | f. | 11 f. à 30 f. | |||||||||||||||||||
| Huile | d’olive (les 100 kilog.) | 0 | f. | 90 | 9 | f. | » | 27 | f. | 50 | 38 | f. | 50 | et | 44 | f. | » | |||||||||
| de fabrique | 0 | 90 | 9 | » | 16 | 50 | 27 | 50 | 33 | » | ||||||||||||||||
| de graisses grasses | 0 | 90 | 9 | » | 13 | 20 | 27 | 50 | 33 | » | ||||||||||||||||
| Matières nécessaires à l’industrie. | ||||||||||||||||||||||||||
| Acier | fondu (les 100 kilog.) | 0 | 30 | 3 | » | 49 | 50 | 110 | ||||||||||||||||||
| en barres | 0 | 30 | 3 | » | 49 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||
| en tôle | 0 | 30 | 3 | » | 49 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||
| Fonte | brute | néant. | néant. | 2 | 20 | 4 | 40 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| mazée | » | » | 2 | 20 | » | 16 | 50 | » | ||||||||||||||||||
| Fer | en barres, au bois | 0 | f. | 40 | 4 | f. | » | 16 | f. | 50 | et | 27 | f. | 50 | 16 | 50 | 27 | 50 | ||||||||
| en barres, à la houille | néant. | néant. | 16 | 50 | 27 | 50 | 27 | 50 | 55 | » | ||||||||||||||||
| feuillard | 0 | f. | 60 | 6 | f. | » | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
| en tôle | 1 | 20 | 6 | » | 44 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Houille | par terre (100 kilog.) | 0 | 04 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 66 | 1 | 33 | 0 | 66 | |||||||||||||
| par mer | 0 f. 11 et 0 f. 18 | 0 f. 54 et 0 f. 98 | 1 | 10 | 1 | 65 | 1 | 10 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
| Laine commune | brute | néant. | néant. | néant. | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| lavée | » | » | » | 22 | » | 33 | » | |||||||||||||||||||
| Laine fine | brute | » | » | » | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||
| lavée | » | » | » | 44 | » | 66 | » | |||||||||||||||||||
| Lin | taillé | » | » | 3 | f. | 30 | 11 | |||||||||||||||||||
| peigné | » | » | 6 | 60 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Sucre | colonies françaises | » | 3 | f. | 20 | 49 | 50 | 49 | 50 | |||||||||||||||||
| étranger | 3 | f. | 60 | 18 | » | 104 | 50 | 104 | 50 | |||||||||||||||||
| Café | colonies françaises | néant. | 7 | 60 | 55 | f. | » | et | 66 | f. | 50 | 55 | » | 66 | 50 | |||||||||||
| étranger | 6 | f. | » | 60 | » | 104 | » | 110 | » | 104 | » | 110 | » | |||||||||||||
| Suif | néant. | néant. | 2 | 75 | 5 | 50 | 16 | 50 | 19 | 80 | ||||||||||||||||
Certes, nous ne croyons pas que le peuple de 1795 fût plus avancé en économie politique que le corps électoral de 1847.
Mais alors on posait cette question : Ceux qui mangent lie la viande et du pain ou se servent de fer payeront-ils une taxe à ceux qui produisent ces choses ? Et comme les mangeurs de pain étaient en majorité, la majorité disait : Non.
Aujourd’hui on pose la même question. Mais ceux qui font du blé, de la viande ou du fer sont seuls consultés, et ils décident qu’il leur sera payé une gratification, un supplément de prix, une taxe.
Il n’y a rien là qui doive nous surprendre. La Suisse est le seul pays, en Europe, où tout le monde concourt à faire la loi ; c’est aussi le seul pays, en Europe, où des taxes sur le grand nombre en faveur du petit nombre n’ont pu pénétrer.
En Angleterre, la loi était faite exclusivement par les propriétaires du sol. Aussi nulle part on n’avait attribué à la production du blé des primes si exorbitantes.
Aux États-Unis, le parti whig et le parti démocrate se disputent et obtiennent tour à tour l’influence. Aussi le tarif s’élève ou s’abaisse, suivant que le premier l’emporte sur le second ou le second sur le premier.
En présence de ces faits écrasants, quand nous avons soulevé la question du libre-échange, quand nous avons essayé de réagir contre cette prétention d’une classe de faire des lois à son profit, comment est-il arrivé que nous ayons rencontré une opposition ardente et haineuse, parmi les meneurs du parti démocratique ?
C’est ce que nous expliquerons sous peu de manière à être compris.
En attendant, puisse le tableau qui précède, si propre à rendre les hommes du droit commun plus clairvoyants, rendre aussi les hommes du privilége plus circonspects ! Il nous semble difficile qu’ils n’y puisent pas des motifs sérieux de faire tourner au profit de tous, sinon par esprit de justice, au moins par esprit de prudence, cette puissance de faire des lois qui est concentrée en leurs mains.
Pour aujourd’hui, nous terminons par une question, que nous adressons aux prétendus patriotes, à ceux qui disent que le droit d’échanger est d’importation anglaise. Nous leur demanderons si la Constituante et la Convention étaient soudoyées par l’Angleterre ?
Le petit arsenal du libre-échangiste [26 April 1847] [CW3 ES2.15]↩
BWV
1847.04.26 “Le petit arsenal du libre-échangiste (The Free Trader’s Little Arsenal) [a stand alone pamphlet - Frédéric Bastiat, Le Petit Arsenal du libre-échange (impr. de E. Crugy, 1847)] [*Libre-Échange*, 26 April 1847] [ES2.15] [OC4.2.15, pp. 251-57] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
L'échelle mobile et ses effets en Angleterre [1 Mai 1847] ↩
BWV
1847.05.01 “L’échelle mobile et ses effets en Angleterre” (The Sliding Scale and its Impact on England) [*Libre-Échange*, 1 Mai 1847] [OC2.10, p. 48]
L'échelle mobile et ses effets
1er Mai 1847
Si cet article tombe aux mains de quelque agriculteur, nous le prions de le lire avec impartialité.
Les agriculteurs tiennent à l’échelle mobile, et il ne faut pas en être surpris. Cette législation se présente avec toutes les apparences de la modération et de la sagesse. Le principe sur lequel elle repose est celui-ci : Assurer à l’agriculture un prix rémunérateur. Quand le blé tend à descendre au-dessous de ce prix, elle vient en aide au producteur. Quand il tend à le dépasser, elle défend l’intérêt du consommateur.
Quoi de plus raisonnable, du moins si l’on fixe un taux normal qui s’éloigne de toute exagération ? En tous pays, le blé a certainement un prix de revient. Il faut bien que ce prix soit assuré à l’agriculteur si l’on veut qu’il continue ses travaux, sans quoi la subsistance du peuple serait compromise. — D’un autre côté, l’estomac a aussi ses droits, et une fois le prix rémunérateur atteint, il n’est pas juste que le vendeur soit le maître absolu de l’acheteur. Si donc le prix dépasse le taux normal, l’importation sera facilitée. La digue s’élève ou s’abaisse selon que l’inondation est à craindre ou à désirer. Tout le monde ne doit-il pas être satisfait ?
On se promet aussi de ce système un autre avantage : la fixité des prix. Ce simple mécanisme, dit-on, tend évidemment à contenir les grandes fluctuations, puisque le droit, dans sa période croissante, prévient l’encombrement, comme dans sa période décroissante, il prévient la disette. L’excessif bon marché est ainsi rendu aussi impossible que l’excessive cherté, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Nous nous proposons d’exposer les effets de cette législation en Angleterre. On sait que l’échelle mobile était la même, quant au principe, des deux côtés de la Manche. Il n’y avait de différence que dans le degré. La loi française ne place pas aussi haut que la loi anglaise le taux normal du blé. Toutes deux ont donc dû opérer dans le même sens, quoique avec des intensités différentes ; et, si nous découvrons les conséquences de l’une, nous pourrons nous tenir pour assurés que les conséquences de l’autre ont été analogues, quoique moins tranchées. C’est un pendule observé au point le plus éloigné du pivot, parce que c’est là que les oscillations sont le plus sensibles. Mais nous avons la certitude que, sur tous les autres points de la tige, les oscillations sont exactement proportionnelles. Un autre motif nous détermine à étudier l’échelle mobile par les effets qu’elle a produits en Angleterre. C’est tout simplement que la statistique anglaise nous offre plus de matériaux que celle de notre pays. Pendant les dernières années de la guerre, le prix du blé s’était maintenu en Angleterre à 106 et jusqu’à 122 sh. le quarter. — En 1814, il tomba à 72 sh., et en 1815, à 63sh. Ces prix, si inférieurs à ceux auxquels on était habitué, effrayèrent les agriculteurs. Le gouvernement conçut l’idée de maintenir le blé, par l’intervention de la loi, à un taux normal. Il procéda à une enquête, consulta les propriétaires et les fermiers. Ceux-ci, alléguant la cherté des terres, la pesanteur des taxes, le haut prix de la main-d’œuvre, etc., affirmèrent que le vrai prix de revient du blé en Angleterre était de 90 à 100 sh. C’est sur cette donnée que fut basée la loi de 1815. Elle disposa que le blé étranger serait entièrement prohibé, tant que le blé indigène n’aurait pas persévéré, pendant trois mois, à un taux moyen de 80 sh. (Le quarter = 200 litres 78/100.)
La promesse légale d’un prix aussi élevé eut bientôt ses effets naturels. L’on fonda sur la culture des céréales de grandes espérances. Une concurrence active se manifesta pour obtenir des terres à exploiter. La rente s’éleva, ce qui amena le haut prix des terres elles-mêmes ; et le premier effet de la mesure fut d’ajouter au sol une valeur artificielle, de gratifier les Landlords d’un capital factice dont le consommateur de blé devait payer l’intérêt.
Cependant les agriculteurs commencèrent leurs opérations. Elles ne se réglèrent pas sur les besoins du pays, indiqués par le taux naturel du blé, mais bien sur le taux anormal promis par la loi. Ce taux offrait la perspective d’énormes profits. Aussi en ensemença en blé les terres des qualités les plus inférieures, on défricha des landes et des marais, on les fertilisa avec des engrais achetés fort cher et venus de fort loin. Sous l’influence de cette excitation extraordinaire, une portion tout à fait inusitée du capital national déserta les autres canaux de l’industrie pour venir se fixer dans les exploitations agricoles ; et un homme d’État contemporain nous apprend qu’à cette époque le sol de l’Angleterre fut littéralement pavé de guinées.
Nous devons faire observer ici qu’à ce grand développement de l’agriculture répondit une crise commerciale et industrielle. Cela s’explique aisément : d’un côté, le capital désertait le commerce et les manufactures, et, d’un autre côté, la cherté de la subsistance forçait le gros du public à restreindre toutes ses autres consommations.
Mais quelle était la situation des agriculteurs ? Il est facile de comprendre qu’alors même que le haut prix du blé se serait maintenu, tout n’aurait pas été profit pour eux.
D’abord ils payaient de fortes rentes. Ensuite, ils empruntaient des capitaux à un taux élevé et, en outre, ils cultivaient de mauvaises terres par des procédés fort dispendieux. Il saute aux yeux que le prix de revient était beaucoup plus élevé pour eux qu’il ne l’eût été sous un régime libre, et qu’ils étaient loin de profiter de toute la charge imposée au public consommateur. Quand la loi aurait maintenu le blé à 1,000 sh. au lieu de 80, il y eût eu évidemment perte sèche pour la nation, si ce prix eût déterminé les agriculteurs à semer du blé jusque dans les galeries houillères de la Cornouailles, et s’il leur fût revenu à eux-mêmes à 990 sh.
Mais le prix fût-il maintenu à 80 sh. ?
On prévoit d’avance qu’il ne put en être ainsi. La fiévreuse activité imprimée à la culture du froment, par les promesses de la loi, ne tarda pas à jeter sur les marchés anglais des approvisionnements inconsidérés ; et les prix baissèrent successivement comme suit :
| 1817 | 94 | sh. |
| 1818 | 83 | |
| 1819 | 72 | |
| 1820 | 65 | |
| 1821 | 54 | |
| 1822 | 45 |
Soit la moitié environ du prix promis par la loi. Quelle déception !
Et remarquez que ce même blé, qu’on était forcé de vendre à 43 sh., revenait fort cher, puisqu’il n’avait été amené à l’existence que par des efforts dispendieux.
Aussi la fin de cette période d’avilissement dans les prix fut marquée par une épouvantable crise agricole. Les fermiers furent ruinés ; les lords ne purent recouvrer leurs rentes. Les uns et les autres maudirent la culture du froment, naguère l’objet de tant d’espérances. On convertit les terres arables en pâturages, calculant qu’elles donneraient un meilleur revenu livrées à la dépaissance des bestiaux que soumises au travail de l’homme ; et l’on sait qu’à celte époque fut pratiquée, très en grand, l’opération appelée Clearance, qui ne consistait en rien moins qu’à raser des villages entiers, à en chasser les habitants, pour substituer sur le sol la race ovine à la race humaine.
Pendant cette crise agricole, l’esprit d’entreprise reçut une impulsion également désordonnée et non moins funeste. Le capital revenait en masse de l’agriculture à l’industrie. En admettant que la consommation de l’Angleterre soit de 16 millions de quarters de blé, la dépense du pays pour la nourriture présentait, comparativement aux années de cherté, une économie annuelle de 32 millions de livres sterling, ou 800 millions de francs. Une masse aussi énorme de fonds disponibles, à un moment donné et inattendu, occasionna comme une pléthore dans la circulation. Il n’est pas d’opération hasardeuse qui ne parvînt à séduire les capitalistes. C’est alors que furent engouffrées des sommes considérables, et à jamais perdues, dans les mines du Mexique et dans les nombreux emprunts des jeunes républiques américaines.
La réaction devait suivre naturellement. Nous avons vu que la culture du froment, devenue ruineuse, avait été abandonnée dans une proportion énorme. L’encombrement des blés disparut peu à peu et fit place à une nouvelle disette. Les prix firent une nouvelle ascension :
| 1822 | 45 | sh. |
| 1823 | 51 | |
| 1824 | 62 | |
| 1825 | 66 | |
| 1826, et jusqu’en 1831 | 66 | environ. |
Quelle fut alors la situation des fermiers ? Le prix s’était relevé sans doute, mais non à leur profit, ou du moins dans une mesure très-bornée ; car cette disette provenait précisément de ce qu’ils avaient restreint leurs cultures. Ce fut donc l’étranger qui réalisa les grands prix, d’autant que l’échelle mobile, décrétée pendant cette crise (en 1828), diminua l’obstacle absolu mis par la loi antérieure à l’importation.
Aussi, tandis que l’Angleterre n’avait tiré du dehors que six hectolitres de blé, dans les deux dernières années de la période de bon marché (1821 et 1822), elle en importa 14 millions d’hectolitres, au prix de 350 millions de francs, dans les années 1829, 1830 et 1831.
Singulier effet de l’intervention de la loi ! quand l’agriculteur fait de grands efforts, se livre à une culture dispendieuse, en un mot, quand le blé lui revient fort cher, il le vend à vil prix, parce que ces efforts mêmes inondent le marché. Quand, averti par ces cruelles déceptions, il restreint ses travaux, le prix remonte ; mais ce n’est pas lui seul, c’est l’étranger aussi qui vient en profiter.
De ce que les époques de bon marché ont développé des crises dans l’industrie agricole, il ne faut donc pas se hâter de conclure que les temps de cherté lui ont apporté une compensation suffisante.
Mais ces années de cherté eurent, sur toutes les autres branches du travail, les effets désastreux qui suivent toujours la disette. Si nous ne craignions de dépasser les bornes d’un article de journal, nous pourrions apporter ici des preuves nombreuses à l’appui de cette assertion, tirées de la statistique des banques, des importations et des exportations, de la criminalité, de la mortalité, etc.
Cependant, le prix du blé s’était soutenu, comme on vient de le voir, pendant plusieurs années. Les fermiers crurent que l’échelle mobile, inaugurée en 1828, avait résolu le problème de la fixité des prix. La nouvelle loi leur promettait, d’ailleurs, une rémunération avantageuse. Pleins de confiance, ils se mirent à étendre la culture du froment, en confondant toujours le prix naturel, qui indique la réalité des besoins, avec le prix artificiel, qui est l’œuvre éphémère et décevante de la législation.
Ne doutant pas que ce prix de 66 à 70 sh. était désormais invariable, ils travaillèrent eux-mêmes à encombrer de nouveau le marché. À partir de 1831 , l’excès de production amena l’avilissement des prix :
| 1831 | 66 | sh. |
| 1832 | 58 | |
| 1833 | 52 | |
| 1834 | 46 | |
| 1835 | 39 |
Voici de nouveau le cours tombé à environ la moitié de celui promis par la loi [1].
Inutile de dire que tous les effets décrits, pour la période de 1822, se reproduisirent ici.
Crise agricole. Les fermiers ne payent pas leurs rentes. Les propriétaires sont frustrés dans leurs injustes prétentions. L’importation du blé cesse ; l’avilissement du prix retombe exclusivement sur l’agriculteur national. Enfin, la culture du froment est de nouveau découragée, et nous en verrons tout à l’heure les conséquences.
D’un autre côté, dans cette même période, l’industrie reçoit une excitation exagérée. Le capital reflue vers elle et s’accroît par l’économie sur la subsistance. Une demande extraordinaire d’objets manufacturés se manifeste. Des usines s’élèvent de tous côtés, plutôt en proportion de la demande exceptionnelle du moment que des besoins réels de l’avenir. Elles ne suffisent pas à absorber les capitaux disponibles. Les banques regorgent. On entreprend des chemins de fer sur une échelle inconsidérée, etc.
Toute production qui ne couvre pas ses frais cesse ou se restreint. On ne cultive pas longtemps du blé, surtout par des moyens dispendieux, pour le vendre à la moitié du prix attendu. Nous devons donc nous attendre à un affaiblissement dans la production, et, par suite, à un retour vers la hausse. En effet, le prix s’élève, de
| 1835 | 38 | sh. | |
| à | 1836 | 48 | |
| 1837 | 55 | ||
| 1838 | 64 | ||
| 1839 | 70 |
Mêmes faits, toujours suivis des mêmes résultats.
L’agriculture ne profite que dans une mesure fort limitée de ces hauts prix ; car tandis qu’en 1835 et 1836 l’importation n’est que de 95,000 quarters, elle s’élève pour 1838 et 1839 à 4,500,000 quarters, qui coûtent plus de 300 millions de francs.
Et, comme accompagnement obligé, crise monétaire, crise industrielle, crise commerciale, stagnation des ateliers, baisse des salaires, famine, paupérisme, incendiarisme, rébeccaïsme, crimes, mortalité, voilà les traits qui signalent la cherté de ces années 1838 et 1839.
À cette époque, les yeux des fermiers commencèrent à s’ouvrir sur les illusoires promesses de la loi. Ils comprirent qu’il n’était pas au pouvoir du parlement de fixer à un taux élevé le prix du blé, puisque cette élévation même, provoquant la surproduction, amenait l’encombrement des marchés ; et les plus éclairés d’entre eux s’unirent à la Ligue pour renverser la loi céréale.
Ce que nous avons dit jusqu’ici suffit sans doute pour que le lecteur prévoie ce qui s’est passé depuis. Le prix de famine de 1839 marqua l’époque d’un retour vers l’abondance.
| 1839 | 70 | sh. |
| 1840 | 66 | |
| 1841 | 64 | |
| 1842 | 57 | |
| 1843 | 50 | |
| 1844 | 51 | |
| 1845, premiers mois | 45 |
Et cette période n’a pas manqué d’être suivie de la réaction vers la cherté, dont nous sommes témoins aujourd’hui.
Il est de notoriété que la fin de cette première période a été signalée par le phénomène de la pléthore financière et industrielle, qui a jeté l’Angleterre dans des spéculations désordonnées sur les chemins de fer ; et nous n’avons pas besoin de dire que le triste cortège, qui accompagne toujours les années de disette (1846), ne fait pas non plus défaut en 1847.
En résumé, nous voyons quatre époques de disette alterner avec trois époques d’abondance.
Il est des personnes qui seront portées à croire que c’est là un jeu de la nature, un caprice des saisons. Nous pensons au contraire qu’il est peu de produits de l’industrie humaine dont le cours, sous un régime entièrement libre, fût plus régulier que celui du blé. Et, sans entrer ici dans des considérations à l’appui de cette opinion, nous nous contenterons de dire que la permanence des prix a été d’autant plus constante, dans divers pays, que ces pays ont joui de plus de liberté, ou du moins ont adopté une législation moins exagérée que celle de la Grande-Bretagne. Les désastreuses fluctuations que nous venons de décrire sont dues presque exclusivement à l’échelle mobile.
Et qu’on n’imagine pas que les périodes de prospérité, qui ont succédé si régulièrement à des périodes de souffrance, ont été pour l’Angleterre une compensation suffisante. Sans doute, les quatre époques des grandes crises, semblables à celles dont nous sommes témoins aujourd’hui, sont celles où le mal se manifeste ; mais les trois époques de prospérité anormale sont celles où il se prépare. Dans celles-ci, l’énorme épargne, que le pays réalise dans l’achat des subsistances, accumule des capitaux considérables dans les banques et aux mains des classes industrielles. Ces capitaux ne trouvent pas immédiatement un emploi profitable. De là un agiotage effréné, un téméraire esprit d’entreprise ; opérations lointaines et hasardeuses, chemins de fer, usines, tout se développe sur une échelle immense, et comme si l’état de choses actuel devait toujours durer. Mais les époques de cherté surviennent, et alors il se trouve qu’une grande partie du capital national a été aussi certainement englouti que si on l’eût jeté dans la mer.
Il est permis de croire que, sous un régime de liberté, ces excessives fluctuations dans le prix du blé eussent été évitées. Alors le capital se serait partagé, dans des proportions convenables, entre l’agriculture et l’industrie. Elles auraient prospéré d’un pas égal et par l’action réciproque qu’elles exercent l’une sur l’autre. On n’aurait pas eu le triste spectacle de deux grandes moitiés de l’Angleterre paraissant avoir des intérêts opposés, chacune d’elles subissant des crises terribles, précisément quand l’autre était embarrassée de sa prospérité.
Nous regrettons de traiter si à la hâte un sujet de cette importance, forcés que nous sommes de négliger une foule de documents et de considérations qui auraient, nous en sommes sûrs, entraîné les convictions du lecteur. Puissions-nous en avoir dit assez pour lui faire soupçonner que l’intervention de la loi, dans la fixation du prix du blé, est fallacieuse, funeste à tous les intérêts, et principalement à celui qu’elle prétend servir, nous voulons dire l’intérêt agricole.
FN:Il n’est pas inutile de faire remarquer ici qu’en France les propriétaires, dès 1818, jetaient de hauts cris contre l’avilissement ruineux du prix du blé. La loi du 21 juillet 1821, faite sous leur influence, avait la prétention de fixer le taux de 20 à 24 francs. De quelque façon qu’on l’explique, toujours est-il qu’elle trompa cruellement les espérances des agriculteurs. Voici le cours officiel du blé pendant les quatre années
qui ont suivi la loi :
| 1821 | 18 | fr. | 65 | c. |
| 1822 | 15 | 08 | ||
| 1823 | 17 | 20 | ||
| 1824 | 15 | 86 | ||
| 1825 | 14 | 80 |
La logique de M. Cunin-Gridaine [Mr. Cunin-Gridaine’s Logic] [2 May 1847] [CW3 ES3.3]↩
BWV
1847.05.02 “La logique de M. Cunin-Gridaine” (Mr. Cunin-Gridaine’s Logic) [*Libre-Échange*, 2 May 1847] [OC2.55, pp. 370-73] [CW3] [ES3.3]
M. Cunin-Gridaine, parlant des deux associations qui se sont formées, l’une pour demander à rançonner le public, l’autre pour demander que le public ne fût pas rançonné, s’exprime ainsi :
« Rien ne prouve mieux l’exagération que l’exagération qui lui est opposée. C’est le meilleur moyen de montrer aux esprits calmes et désintéressés où est la vérité, qui ne se sépare jamais de la modération. »
Il est certain, selon Aristote, que la vérité se rencontre entre deux exagérations opposées. Le tout est de s’assurer si deux assertions contraires sont également exagérées ; sans quoi, le jugement à intervenir, impartial en apparence, serait inique en réalité.
Pierre et Jean plaidaient devant le juge d’une bourgade. Pierre, demandeur, concluait à bâtonner Jean tous les jours.
Jean, défendeur, concluait à n’être pas bâtonné du tout.
Le juge prononça cette sentence :
« Attendu que rien ne prouve mieux l’exagération que l’exagération qui lui est opposée, coupons le différend par le milieu, et disons que Pierre bâtonnera Jean, mais seulement les jours impairs. »
Jean fit appel, comme on le peut croire ; mais ayant appris la logique, il se garda bien cette fois de conclure à ce que son rude adversaire fût simplement débouté.
Quand donc l’avoué de Pierre eut lu l’exploit introductif d’instance finissant par ces mots : « Plaise au tribunal admettre Pierre à faire pleuvoir une grêle de coups sur les épaules de Jean. »
L’avoué de Jean répliqua par cette demande reconventionnelle : « Plaise au tribunal permettre à Jean de prendre sa revanche sur le dos de Pierre. »
La précaution ne fut pas inutile. Pour le coup, la justice se trouvait bien placée entre deux exagérations. Elle décida que Jean ne serait plus battu par Pierre, ni Pierre par Jean. Au fond, Jean n’aspirait pas à autre chose.
Imitons cet exemple ; prenons nos précautions contre la logique de M. Cunin-Gridaine.
De quoi s’agit-il ? Les Pierre de la rue Hauteville [107] plaident pour être admis à rançonner le public. Les Jean de la rue Choiseul plaident naïvement pour que le public ne soit pas rançonné. Sur quoi M. le ministre prononce gravement que la vérité et la modération sont au point intermédiaire entre ces deux prétentions.
Puisque le jugement doit se fonder sur la supposition que l’association du libre-échange est exagérée ! ce qu’elle a de mieux à faire, c’est de l’être en effet, et de se placer à la même distance de la vérité que l’association prohibitionniste, afin que le juste milieu coïncide quelque peu avec la justice.
Donc, l’une demande un impôt sur le consommateur au profit du producteur ; que l’autre, au lieu de perdre son temps à opposer une fin de non-recevoir, exige formellement un impôt sur le producteur au profit du consommateur.
Et quand le maître de forges dit : Pour chaque quintal de fer que je livre au public, j’entends qu’il me paye, en outre du prix, une prime de 20 fr. ;
Que le public se hâte de répondre : Pour chaque quintal de fer que j’introduirai du dehors, en franchise, je prétends que le maître de forges français me paye une prime de 20 fr.
Alors, il serait vrai de dire que les prétentions des deux parties sont également exagérées, et M. le ministre les mettra hors de cause, disant : « Allez, et ne vous infligez pas de taxes les uns aux autres, » — si du moins il est fidèle à sa logique.
Fidèle à sa logique ? Hélas ! cette logique est toute dans l’exposé des motifs ; elle ne reparaît plus dans les actes. Après avoir posé en fait que l’injustice et la justice sont deux exagérations, que ceux qui veulent le maintien des droits protecteurs et ceux qui en demandent la suppression sont également éloignés de la vérité, que devait faire M. le ministre pour être conséquent ? Se placer au milieu, imiter le juge de village qui se prononça pour la demi-bastonnade ; en un mot, réduire les droits protecteurs de moitié. — Il n’y a pas seulement touché. (V. le n° 50.)
Sa dialectique, commentée par ses actes, revient donc à ceci : Pierre, vous demandez à frapper quatre coups ; Jean, vous demandez à n’en recevoir aucun.
La vérité, qui ne se sépare jamais de la modération, est entre ces deux demandes. Selon ma logique, je ne devrais autoriser que deux coups ; selon mon bon plaisir, j’en permets quatre, comme devant. Et, pour l’exécution de ma sentence, je mets la force publique à la disposition de Pierre, aux frais de Jean.
Mais le plus beau de l’histoire, c’est que Pierre sort de l’audience furieux de ce que le juge a osé, en paroles, comparer son exagération à celle de Jean. (Voir le Moniteur industriel.)
Subsistances [8 Mai 1847] ↩
BWV
1847.05.08 “Subsistances” (Subsistance Farming) [*Libre-Échange*, 8 Mai 1847] [OC2.12, 63]
Subsistances
8 Mai 1847
Quand nous avons entrepris de renverser le régime protecteur, nous nous attendions à rencontrer de grands obstacles.
Nous savions que nous soulèverions contre nous de puissants intérêts, aveuglés par les trompeuses promesses de la législation actuelle, et nous ne nous dissimulions pas l’influence que les grands manufacturiers, les grands propriétaires et les maîtres de forges exercent dans les chambres et sur la presse périodique.
Il n’était pas difficile de prévoir que les industries protégées entraîneraient pour un temps leurs ouvriers. Quoi de plus aise que de faire un épouvantail de la concurrence, quand on ne la montre à chacun que dans ses rapports avec l’industrie qu’il exerce ?
Nous pensions bien que certains chefs de parti, toujours avides de recruter des boules, se poseraient aux yeux des protectionnistes comme les patrons de leurs injustes priviléges, et qu’ils ne manqueraient pas de faire, au nom de l’opposition, une campagne contre la liberté. C’est avec cette triste tactique qu’on s’enfonce dans la dégradation morale ; mais qu’importe, si l’on atteint le but immédiat, celui d’enlever quelques voix à des adversaires politiques ? Mais de tous les obstacles, le plus puissant, c’est l’ignorance du pays en matière économique. L’Université, qui décide ce que les Français apprendront ou n’apprendront pas, juge à propos de leur faire passer leurs premières années parmi des possesseurs d’esclaves, dans les républiques guerrières de la Grèce et de Rome. Est-il surprenant qu’ils ignorent le mécanisme de nos sociétés libres et laborieuses ?
Enfin, nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu’un cabinet quelconque puisse accomplir une réforme importante contre le gré de l’opinion publique ; et eussions-nous eu cette pensée, les faits nous démontraient que celui qui dirige les affaires du pays n’était nullement disposé à risquer son existence dans une telle entreprise.
C’est donc avec la pleine connaissance des difficultés qui nous entouraient que nous avons commencé notre œuvre.
Cependant, nous devons l’avouer, jamais nous n’aurions pu croire que la France offrirait au monde l’étrange et triste spectacle qu’elle présente ;
Que, pendant que l’Angleterre, lés États-Unis et Naples affranchissent leur commerce, pendant que la même réforme s’élabore en Espagne, en Allemagne, en Russie, en Italie, la France se contenterait de répéter, sans oser rien entreprendre : « Je marche à la tête de la civilisation ; »
Que des chambres de commerce, comme celles de Metz, de Mulhouse, de Dunkerque, qui demandaient énergiquement la liberté il y a quelques années, s’en montreraient aujourd’hui épouvantées.
Mais il n’est que trop vrai. Par les efforts combinés des protectionnistes et de certains journaux, le pays a été saisi tout à coup d’une crainte immense, inouïe, et, osons trancher le mot, ridicule.
Car, que voyons-nous ? Nous voyons la disette désoler la population, le pain et la viande hors de prix, des hommes, au dire des journaux, tomber d’inanition dans les rues de nos villes. — Et les ministres n’osent pas déclarer que les Français auront, au moins pendant un an, le droit d’acheter du pain au dehors. Ils n’osent pas le déclarer, parce que le pays n’ose pas le demander ; et le pays n’ose pas le demander, parce que cela déplaît aux journaux protectionnistes, socialistes et soi-disant démocratiques. Oui, nous le disons hautement, avant peu on refusera de croire que la France a étalé aux yeux de l’univers une telle pusillanimité : chacun se vantera d’avoir fait exception, et, comme ces vieux soldais qui disent avec orgueil : « J’étais à Wagram et à Waterloo, » on dira : « En 1847, je déployai un grand courage ; j’osai demander le droit de troquer mon travail contre du pain. »
Où en sommes-nous, grand Dieu ! On écrit de Mulhouse : « La consommation intérieure de nos produits est arrêtée à cause de la cherté de nos subsistances ; les ateliers se ferment, les ouvriers sont sans ouvrage, le blé est à 50 fr. l’hectolitre ; la Suisse est près de nous ; nous serions heureux d’obtenir la permission d’aller y chercher de la viande, mais nous n’osons pas la demander. »
On mande de Lyon qu’il serait dangereux de soumettre aux ouvriers une pétition pour la libre entrée des aliments. Il faudrait, dit-on, que cette proposition émanât du parti démocratique ; et il s’y oppose parce qu’il a fait alliance avec le privilége.
Bien plus. Êtes-vous convaincus que l’entrée libre des blés doit être provoquée ? Il ne vous est pas permis de dire vos raisons. Telle est la libéralité de nos libéraux, qu’ils ne souffrent même pas la discussion sur ce point. De suite, ils vous attribuent des motifs honteux. Vous êtes des pessimistes, des alarmistes, des traîtres, et pis que cela, si c’est possible.
C’est ainsi que le Journal des Débats s’est attiré un torrent d’invectives de ce genre pour avoir demandé la prorogation de la loi qui autorise la libre entrée des céréales, et surtout pour avoir motivé sa demande.
Vous alarmez le pays, lui a-t-on dit ; votre but est de l’agiter ; votre but est de faire baisser les fonds ; votre but est de rompre un chaînon du système protecteur ; votre but est de nous ravir notre popularité, etc., etc.
Alarmer le pays ! Eh quoi ! est-ce que pour un peuple, pas plus que pour un homme, le courage consiste à fermer les yeux devant le danger ? Est-ce que le plus sûr moyen de lutter contre les obstacles et d’en triompher, ce n’est pas de les voir ? Est-il possible d’employer le remède sans parler du mal, et suffit-il de dire : « La récolte sera magnifique, surabondante, précoce ; ne vous préoccupez pas de l’avenir, rapportez-vous-en au hasard ; fiez-vous au ministère, sauf à l’accabler si vos illusions sont trompées [1] ?
Que disait pourtant le Journal des Débats ? Il n’arguait pas d’une mauvaise récolte. Il ne pouvait le faire, puisque c’est encore le secret de l’avenir.
Il se fondait sur des faits connus, incontestables. Il disait : D’une part, la production des substances alimentaires sera diminuée de tout ce qu’on a ensemencé en moins de pommes de terre ; de l’autre, nos greniers seront vides. Or, en temps ordinaire, il y a une réserve. Donc les prix seront plus élevés qu’en temps ordinaire, même en supposant une bonne récolte.
Certes, c’était bien là le langage de la modération et de la prudence.
Pour nous, nous disons aux propriétaires : En premier lieu, vous n’avez pas à craindre que la liberté avilisse le prix des blés l’année prochaine. Il est de notoriété que le blé est cher parce qu’il manque, non-seulement en France, mais sur presque toute la surface de l’Europe, en Angleterre, en Belgique, en Italie. En ce moment même, nous apprenons qu’un des greniers de l’univers, la Prusse, est en proie à des convulsions causées par la cherté du pain. Il est de notoriété que les approvisionnements des autres pays producteurs, l’Égypte, la Crimée, les États-Unis, ne sont pas inépuisables, puisque le blé s’y tient à des prix élevés. Dans de telles circonstances, ne pas permettre au commerce de préparer ses opérations, c’est les empêcher, c’est travailler à perpétuer la famine.
En second lieu et surtout, vous n’avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous abusez de la puissance législative. Le dernier des manœuvres a plus le droit d’échanger, à la fin de sa journée, son chétif salaire contre du pain étranger, que vous n’avez celui de l’en empêcher pour votre avantage. Si vous le faites, c’est de l’oppression dans toute la force du mot ; c’est de la spoliation légale, la pire de toutes. — On parle de la responsabilité du pouvoir. Ce n’est pas à nous de l’en exonérer. Mais nous disons que la plus grande part de responsabilité pèse sur les législateurs-propriétaires. Que la famine se prolonge ; et, si parmi tous les ouvriers de France, il en est un seul qui succombe pour n’avoir pu acheter, avec son salaire, autant de pain qu’il l’eût fait sous un régime libre, qui donc, nous le demandons, devra compte de cette vie ?
Non, cette terreur pusillanime ne peut durer. Il est par trop absurde et insultant de dire aux Français : « Nous voyons le mal qui vous menace, c’est la cherté du pain. Il n’y a qu’un remède possible, c"est la libre entrée du blé étranger. Mais, pour réclamer cette liberté, il faut parler du danger, et vous n’avez pas assez de courage pour qu’on parle, devant vous, même de dangers éventuels. Donc nous n’en parlerons pas ; nous ne souffrirons pas qu’on en parle. Que les autres peuples aillent faire leurs approvisionnements, le commerce français doit rester dans l’oisiveté ; parce que le seul fait d’aller chercher du blé, pour apaiser votre faim, troublerait votre quiétude. »
FN:On se rappelle que le Constitutionnel, après avoir énuméré toutes les raisons qui selon lui font un devoir au ministère de ne pas laisser entrer le blé étranger, terminait ainsi son article : « Cependant, si malheur arrive, nous serons vos plus terribles accusateurs! »
L'empereur de Russie [8 Mai 1847] ↩
BWV
1847.05.08 “L’empereur de Russie” (The Emperor of Russia) [*Libre-Échange*, 8 Mai 1847] [OC2.29, 164]
8 Mai 1847
Il est maintenant certain que l’empereur de Russie, renouvelant l’opération faite récemment avec la Banque de France, envoie une somme considérable à Londres pour y acheter des fonds étrangers.
Certains journaux voient là un acte de perfidie, d’autres un acte de munificence. Il n’y faut voir qu’une spéculation amenée par la nature des choses et l’empire des circonstances.
Un retour aussi prompt du numéraire envoyé en Russie, depuis quelques mois, pour l’achat des céréales, est bien fait, ce nous semble, pour calmer les craintes de ceux qui s’imaginent qu’un pays peut être épuisé de métaux précieux par l’importation de marchandises étrangères [1].
Lorsque des circonstances malheureuses, comme la perte partielle de plusieurs récoltes successives, réduisent une nation à aller acheter à l’étranger d’immenses quantités de blé, par un commerce tout exceptionnel, pour lequel rien n’est préparé de longue main et qui par conséquent ne peut s’exécuter que par l’intervention du numéraire, nous ne nions point qu’il n’en résulte de grands embarras, de la gène et même une crise financière pour le pays importateur.
Nous croyons même que la crise est d’autant plus violente que ce pays s’est plus appliqué à se suffire à lui-même par le régime protecteur ; car alors, il est obligé d’aller se pourvoir dans des contrées qui n’ont pas l’habitude de consommer de ses produits manufacturés, et les achats de blé doivent se faire, non en partie, mais en totalité, contre du numéraire.
Cependant, si l’on y regarde de près, on s’assurera que le vrai malheur n’est pas dans l’exportation de l’argent, mais dans la disette. La disette étant donnée, il est au con- traire fort heureux que l’on puisse au moins, avec de l’argent, se procurer des moyens d’existence. (V. le n° 20.)
Quoi qu’il en soit, le résultat forcé d’une telle situation est que le numéraire devient fort rare et fort recherché dans le pays importateur, et au contraire fort abondant dans le pays exportateur. Il acquiert donc une très-forte tendance à revenir de celui-ci vers celui-là, et remarquez qu’il n’y peut revenir que contre des produits.
Cela posé, examinons l’enchaînement de cette opération si diversement commentée par la presse.
La France et l’Angleterre manquent de blé. — Il y en a en Russie. — Mais la France et l’Angleterre ayant toujours fermé la porte à ce blé, les Russes ne connaissent pas nos objets manufacturés. Si l’on veut avoir leur blé, il faut leur donner de l’argent, et c’est ce qu’on fait ; car, après tout, l’argent ne saurait être mieux employé qu’à se préserver de l’inanition.
Il en résulte une grande gêne monétaire en France et en Angleterre. D’un autre côté, les Russes ont beaucoup plus de numéraire que ne le comporte l’état de leurs transactions. Il tend à revenir au point d’où il est parti.
Comment ce numéraire est-il parvenu en si peu de temps dans le trésor impérial ? C’est ce que nous n’avons pas à expliquer, et nous croyons même que les cent millions dont il s’agit ne sont pas exactement ceux que nous avons exportés. Cela est de peu d’importance ; que ce soient les mêmes pièces d’or ou d’autres, qu’elles reviennent par le commerce, ou par le trésor public, peu importe. Il s’agit de suivre l’opération jusqu’au bout.
Le ministre des finances de Saint-Pétersbourg, voyant que l’état des marchés, relativement au numéraire, s’est modifié de telle sorte qu’il ne se place plus que très-mal en Russie, tandis qu’il se place très-bien en France et en Angleterre, conçoit le projet, non dans notre intérêt, mais dans le sien, de nous envoyer celui dont il ne sait plus que faire.
Or, quand on envoie de l’argent dans un pays, il n’y a pas d’autre moyen de s’en faire donner la contre-valeur que de recevoir des produits en échange, ou de le placer à intérêt. Acheter ou prêter, voilà les deux seuls moyens de se défaire de l’argent.
Si l’empereur de Russie eût acheté en France et en Angleterre pour cent millions de produits, il serait clair qu’en définitive nous pourrions ne pas tenir compte du mouvement des espèces, et nous serions autorisés à dire que nous avons échangé des produits de notre industrie contre du blé.
Mais l’empereur de Russie n’a pas besoin, sans doute, tout présentement de nos produits agricoles ou manufacturés pour une aussi forte somme. En conséquence, il achète des fonds publics, c’est-à-dire qu’il se met au lieu et place des préteurs originaires ou de leurs représentants. La portion d’intérêts afférente à ces cent millions (intérêts que les gouvernements, ou plutôt les contribuables, étaient en tous cas tenus de servir) sera payée désormais à l’empereur de Russie au lieu de l’être aux rentiers actuels. Mais ceux-ci n’ont perdu le droit de toucher 3 francs tous les ans au trésor, que parce qu’ils ont reçu 78 francs une fois de l’autocrate russe.
Tous les six mois, nous aurons donc à lui payer environ un million, pour notre part.
Il y a des personnes que cela alarme. Elles voient dans ce payement une lourde charge au profit de l’étranger. Ces personnes perdent de vue que l’étranger a donné le capital. Sans doute, l’opération, dans son ensemble, peut être mauvaise, si ce capital vient remplacer un autre capital dissipé en guerres ruineuses ou en folles entreprises. Elle serait mauvaise encore si nous prodiguions le nouveau capital en de semblables folies. Mais alors, c’est dans le fait de la dissipation qu’est le mal et non dans le fait de l’emprunt ; car si, par exemple, nous mettons ces fonds qui nous coûtent 4 pour 100 dans des travaux qui en rapportent 10, l’opération est évidemment excellente.
Il reste à savoir comment l’Angleterre et la France payeront à la Russie deux millions tous les six mois. Sera-ce en numéraire ? Cela n’est guère probable, car le numéraire, comme le prouve la transaction elle-même, est une marchandise peu recherchée en Russie.
On peut affirmer que le payement s’exécutera par l’une des deux voies suivantes :
1° Nous enverrons des produits en Russie. Pour nous rembourser nous tirerons des traites sur les négociants russes. Ces traites seront achetées sur place par les banquiers de Londres et de Paris, qui auront reçu les rentes pour compte de l’empereur. Et ces banquiers enverront ces traites à Saint-Pétersbourg, qui les recouvreront et en verseront le produit au trésor impérial.
2° Ou bien, nous enverrons nos marchandises en Italie, en Allemagne, en Amérique. Le mouvement des billets sera un peu plus compliqué, et le résultat sera le même.
Un beau jour, S. M. Impériale nous revendra ses fonds. Alors, tout rentrera dans l’ordre actuel. Toutes les phases de l’opération seront révolues, et on peut les résumer ainsi : Dans un moment de détresse, la Russie nous envoie des blés ; nous les payons peu à peu avec des produits envoyés d’année en année ; dans l’intervalle, nous payons, jusqu’à due concurrence, l’intérêt de la valeur des blés.
Voilà les trois termes réels de l’opération. La circulation du numéraire et des billets n’est que le moyen d’exécution.
FN:Sur la fonction du numéraire, voyez le pamphlet Maudit argent ! tome V, page 64. (Note de l’éditeur.)
De la libre introduction du bétail étranger [14 Mars 1847] ↩
BWV
1847.03.14 “De la libre introduction du bétail étranger” (On the Free Importation of Foreign Cattle) [*Libre-Échange*, 14 Mars 1847] [OC2.13, 68]
De la libre introduction du bétail étranger
14 Mars 1847
La Belgique vient de suspendre le droit d’entrée sur le bétail.
Ainsi, à l’heure qu’il est les Belges, les Anglais, les Suisses, ont le droit de se livrer à tout travail national qui trouve à s’échanger contre de la viande étrangère.
Nous autres, Français, nous n’avons pas ce droit, ou nous devons l’acheter par une taxe, — taxe que nous payons à contre-cœur, car elle ne va pas au Trésor et n’est pas dépensée au profit de la communauté.
En tous temps, un prélèvement, par quelques particuliers, sur le prix de la viande, nous semble injuste. En ce moment, il nous paraît cruel.
Il faut que l’esprit de monopole soit bien enraciné chez nous pour résister, non plus seulement aux démonstrations de la science, mais au cri de la faim.
Quoi ! un ouvrier de Paris, à qui la nature a donné le besoin de manger et des bras pour travailler, ne pourra pas échanger son travail contre des aliments ?
Quoi ! si l’artisan français peut faire sortir de la viande de son marteau, de sa hache ou de sa navette, cela lui sera défendu !
Cela sera défendu à trente-cinq millions de Français, pour plaire à quelques éleveurs !
Ah ! plus que jamais nous persistons à réclamer la liberté de l’échange, qui implique la liberté et le bon choix du travail, non comme une bonne police seulement, mais comme un droit.
S’il plaît à la Providence de nous envoyer la famine, nous nous résignerons. Mais nous ne pouvons nous résigner à ce que la famine, dans une mesure quelconque, soit décrétée par la loi.
Nous défions qui que ce soit de nous prouver que l’ouvrier doive une redevance à l’éleveur, pas plus que l’éleveur à l’ouvrier.
Puisque la loi n’élève pas le taux du salaire, elle ne doit pas élever le taux de la viande
On dit que cette mesure restrictive a pour objet de favoriser l’espèce particulière de travail national qui a pour objet la production de la viande. Mais si ce travail a pour fin unique de fournir des aliments à la consommation, quelle inconséquence n’est-ce pas que de commencer par restreindre la consommation des aliments, sous prétexte d’en protéger la production ?
En fait d’aliments, l’essentiel est d’en avoir, et non point de les produire par tel ou tel procédé. Que les éleveurs fassent de la viande, mais qu’ils nous laissent la liberté d’en faire à coups de hache, d’aiguille, de plume et de marteau, comme nous faisons l’or, le café et le thé.
Nous voudrions éviter (car il n’est pas de notre intérêt d’irriter les passions), mais nous ne pouvons nous empêcher de dire que la loi, qui restreint le travail et les jouissances de tous au profit de quelques-uns, est une loi oppressive. Elle prend une certaine somme dans la poche de Jean pour la mettre dans la poche de Jacques, avec perte définitive d’une somme égale pour la communauté [1].
Il est de mode aujourd’hui de rire du laissez faire. Nous ne disons pas que les gouvernements doivent tout laisser faire. Bien loin de là, nous les croyons institués précisément pour empêcher de faire certaines choses, et entre autres pour empêcher que Jacques ne prenne dans la poche de Jean. Que dire donc d’une loi qui laisse faire, bien plus, qui oblige de faire la chose même qu’elle a pour mission à peu près exclusive d’empêcher ?
On dit qu’il est utile de restreindre l’entrée de la viande pour favoriser notre agriculture ; que cette restriction accroît chez nous la production du bétail et par conséquent de l’engrais. Quelle dérision !
Voyons, sortez de ce dilemme.
Votre taxe à l’entrée augmente-t-elle le prix de la viande, oui ou non ?
Si vous dites oui, nous répondons :
Puisqu’elle accroît le prix moyen de la viande, il y a donc moins de bétail dans le pays sous l’empire de cette taxe ; car d’où peut venir l’augmentation de prix, sinon de la rareté relative de la chose ? Et si, à tous les moments donnés, il y a moins de bétail dans le pays, comment y aurait-il plus d’engrais ?
Si vous dites que le droit n’élève pas le prix, nous vous demanderons pourquoi vous le maintenez ?
On parle toujours de l’intérêt agricole ; mais en a-t-on une vue complète ? Est-ce que l’agriculture n’achète pas autant de bœufs qu’elle en vend ? Est-ce que, parmi nos innombrables métayers et petits propriétaires, il n’y en a pas vingt qui achètent deux bœufs de travail pour un qui vend un bœuf de boucherie ? Est-ce que la restriction n’affecte pas, au préjudice des agriculteurs, le prix de ces quarante bœufs de travail, comme elle affecte, au bénéfice de l’éleveur, le prix du bœuf, qu’il livre à la consommation ? Enfin, est-ce que les agriculteurs, qui forment les deux tiers de notre population, ne mangent pas quelque peu de viande ? et, sous ce rapport, après avoir fait tous les frais de la protection sur les quarante bœufs de travail, ne supportent-ils pas encore, pour les deux tiers ou du moins dans une forte proportion, les frais de la protection accordée sur le bœuf de boucherie ?
Après tout, si l’agriculture a cette grande importance que personne ne conteste, c’est uniquement par le motif qu’elle fournit à la nation des aliments. Il est absurde, contradictoire et cruel, sous prétexte de favoriser l’agriculture, de diminuer l’alimentation du peuple.
FN:La circonstance indiquée par les mots soulignés fait le fond du débat entre le libre-échange et la restriction. (V. ci-après nos 56 et 57.)
Un profit contre deux pertes [One profit versus Two Losses] [9 May 1847] [CW3 ES3.4]↩
BWV
1847.05.09 “Un profit contre deux pertes” (One Profit versus Two Losses) [*Libre-Échange*, 9 May 1847] [OC2.57, pp. 377-84] [CW3] [ES3.4]
Il y a maintenant dix-sept ans qu’un publiciste, que je ne nommerai pas, dirigea contre la protection douanière un argument, sous forme algébrique, qu’il nommait la double incidence de la perte.
Cet argument fit quelque impression. Les privilégiés se hâtèrent de le réfuter ; mais il arriva que tout ce qu’ils firent dans ce but ne servit qu’à élucider la démonstration, à la rendre de plus en plus invincible, et, en outre, à la populariser ; si bien qu’aujourd’hui, dans le pays où s’est passée la chose, la protection n’a plus de partisans.
On me demandera peut-être pourquoi je ne cite pas le nom de l’auteur ? Parce que mon maître de philosophie m’a appris que cela met quelquefois en péril l’effet de la citation. [108]
Il nous dictait un cours parsemé de passages dont quelques-uns étaient empruntés à Voltaire et à Rousseau, invariablement précédés de cette formule : « Un célèbre auteur a dit, etc. » Comme il s’était glissé quelques éditions de ces malencontreux écrivains dans le collége, nous savions fort bien à quoi nous en tenir. Aussi nous ne manquions jamais, en récitant, de remplacer la formule par ces mots : Rousseau a dit, Voltaire a dit. — Mais aussitôt le pédagogue, levant les mains au ciel, s’écriait : « Ne citez pas, l’ami B… ; apprenez que beaucoup de gens admireront la phrase qui la trouveraient détestable s’ils savaient d’où elle est tirée. » C’était le temps où régnait une opinion qui détermina notre grand chansonnier, je devrais dire notre grand poëte, à mettre au jour ce refrain :
C’est la faute de Voltaire,
C’est la faute de Rousseau.
Supprimant donc le nom de l’auteur et la forme algébrique, je reproduirai l’argument qui se borne à établir que toute faveur du tarif entraîne nécessairement :
1° Un profit pour une industrie ;
2° Une perte égale pour une autre industrie ;
3° Une perte égale pour le consommateur.
Ce sont là les effets directs et nécessaires de la protection. En bonne justice, et pour compléter le bilan, il faudrait encore lui imputer de nombreuses pertes accessoires, telles que : frais de surveillance, formalités dispendieuses, incertitudes commerciales, fluctuations de tarifs, opérations contrariées, chances de guerre multipliées, contrebande, répression, etc.
Mais je me restreins ici aux conséquences nécessaires de la protection.
Une anecdote rendra peut-être plus claire la démonstration de notre problème.
Un maître de forges avait besoin de bois pour son usine. Il avait traité avec un pauvre bûcheron, quelque peu clerc, qui, pour 40 sous, devait bûcher du matin au soir, un jour par semaine.
La chose paraîtra singulière ; mais il advint qu’à force d’entendre parler protection, travail national, supériorité de l’étranger, prix de revient, etc., notre bûcheron devint économiste à la manière du Moniteur industriel : si bien qu’une pensée lumineuse se glissa dans son esprit en même temps qu’une pensée de monopole dans son cœur.
Il alla trouver le maître de forges, et lui dit :
— Maître, vous me donnez 2 francs pour un jour de travail ; désormais vous me donnerez 4 francs et je travaillerai deux jours.
— L’ami, répondit le maître de forges, j’ai assez du bois que tu refends dans la journée.
— Je le sais, dit le bûcheron ; aussi j’ai pris mes mesures. Voyez ma hache, comme elle est émoussée, ébréchée. Je vous assure que je mettrai deux jours pleins à hacher le bois que j’expédie maintenant en une journée.
— Je perdrai 2 francs à ce marché.
— Oui, mais je les gagnerai, moi ; et, relativement au bois et à vous, je suis producteur et vous n’êtes que consommateur. Le consommateur ! cela mérite-t-il aucune pitié ?
— Et si je te prouvais qu’indépendamment des 40 sous qu’il me fera perdre, ce marché fera perdre aussi 40 sous à un autre producteur ?
— Alors je dirais que sa perte balance mon gain, et que le résultat définitif de mon invention est pour vous, et par conséquent pour la nation en masse, une perte sèche de 2 francs. Mais quel est ce travailleur qui aura à se plaindre ?
— Ce sera, par exemple, Jacques le jardinier, auquel je ne pourrai plus faire gagner comme aujourd’hui 40 sous par semaine, puisque ces 40 sous, je te les aurai donnés ; et si je n’en prive pas Jacques, j’en priverai un autre.
— C’est juste, je me rends et vais aiguiser ma hache. Au fait, si par la faute de ma hache il se fait moins de besogne dans le monde pour une valeur de 2 francs, c’est une perte, et il faut bien qu’elle retombe sur quelqu’un… Mais, pardon, maître, il me vient une idée. Si vous me faites gagner ces 2 francs, je les ferai gagner au cabaretier, et ce gain compensera la perte de Jacques.
— Mon ami, tu ne ferais là que ce que Jacques fera lui-même tant que je l’emploierai, et ce qu’il ne fera plus si je le renvoie, comme tu le demandes.
— C’est vrai ; je suis pris, et je vois bien qu’il n’y a pas de profit national à ébrécher les haches.
Cependant, notre bûcheron, tout en bûchant, ruminait le cas dans sa tête. Il se disait : Pourtant, j’ai cent fois entendu dire au patron qu’il était avantageux de protéger le producteur aux dépens du consommateur. Il est vrai qu’il a fait apparaître ici un autre producteur auquel je n’avais pas songé.
À quelque temps de là, il se présenta chez le maître de forges, et lui dit :
— Maître, j’ai besoin de 20 kilogrammes de fer, et voici 5 francs pour les payer.
— Mon ami, à ce prix je ne t’en puis donner que 10 kilogrammes.
— C’est fâcheux pour vous, car je sais un Anglais qui me donnera pour mes 5 francs les 20 kilogrammes dont j’ai besoin.
— C’est un coquin.
— Soit.
— Un égoïste, un perfide, un homme que l’intérêt fait agir.
— Soit.
— Un individualiste, un bourgeois, un marchand qui ne sait ce que c’est qu’abnégation, dévouement, fraternité, philanthropie.
— Soit ; mais il me donne pour 5 francs 20 kilogrammes de fer, et vous, si fraternel, si dévoué, si philanthrope, vous ne m’en donnez que 10.
— C’est que ses machines sont plus perfectionnées que les miennes.
— Oh ! Oh ! Monsieur le philanthrope, vous travaillez donc avec une hache obtuse, et vous voulez que ce soit moi qui supporte la perte.
— Mon ami, tu le dois, pour que mon industrie soit favorisée. Dans ce monde, il ne faut pas toujours songer à soi et à son intérêt.
— Mais il me semble que c’est toujours votre tour d’y songer. Ces jours-ci vous n’avez pas voulu me payer pour me servir d’une mauvaise hache, et aujourd’hui vous voulez que je vous paye pour vous servir de mauvaises machines.
— Mon ami, c’est bien différent ; mon industrie est nationale et d’une haute importance.
— Relativement aux 5 francs dont il s’agit, il n’est pas important que vous les gagniez si je dois les perdre.
— Et ne te souvient-il plus que lorsque tu me proposais de fendre mon bois avec une hache émoussée, je te démontrai qu’outre ma perte, il en retomberait sur le pauvre Jacques une seconde, égale à la mienne, et chacune d’elles égale à ton profit, ce qui, en définitive, constituait, pour la nation en masse, une perte sèche de 2 francs ? — Pour qu’il y eût parité dans les deux cas, il te faudrait prouver que mon gain et ta perte se balançant, il y aura encore un préjudice causé à un tiers.
— Je ne vois pas que cette preuve soit très nécessaire ; car, selon vous-même, que j’achète à vous, que j’achète à l’Anglais, la nation ne doit rien perdre ni gagner. Et alors, je ne vois pas pourquoi je disposerais à votre avantage, et non au mien, du fruit de mes sueurs. Au surplus, je crois pouvoir prouver que si je vous donne 10 francs de vos 20 kilogrammes de fer, je perdrai 5 francs, et une autre personne perdra 5 francs ; vous n’en gagnerez que 5, d’où résultera pour la nation entière une perte sèche de 5 francs.
— Je suis curieux de t’entendre bûcher cette démonstration.
— Et si je la refends proprement, conviendrez-vous que votre prétention est injuste ?
— Je ne te promets pas d’en convenir ; car, vois-tu, en fait de ces choses-là, je suis un peu comme le Joueur de la comédie, et je dis à l’économie politique :
Tu peux bien me convaincre, ô science ennemie,
Mais me faire avouer, morbleu, je t’en défie !
Cependant voyons ton argument.
— Il faut d’abord que vous sachiez une chose. L’Anglais n’a pas l’intention d’emporter dans son pays ma pièce de 100 sous. Si nous faisons marché, (— le maître de forges, à part : j’y mettrai bon ordre, —) il m’a chargé d’acheter pour 5 francs deux paires de gants que je lui remettrai en échange de son fer.
— Peu importe, arrive enfin à la preuve.
— Soit ; maintenant calculons. — En ce qui concerne les 5 francs qui représentent le prix naturel du fer, il est clair que l’industrie française ne sera ni plus ni moins encouragée, dans son ensemble, soit que je les donne à vous pour faire le fer directement, soit que je les donne au gantier qui me fournit les gants que l’Anglais demande en échange du fer.
— Cela paraît raisonnable.
— Ne parlons donc plus de ces premiers 100 sous. Restent les autres 5 francs en litige. Vous dites que si je consens à les perdre, vous les gagnerez, et que votre industrie sera favorisée d’autant.
— Sans doute.
— Mais si je conclus avec l’Anglais, ces 100 sous me resteront. Précisément, je me trouve avoir grand besoin de chaussures, et c’est juste ce qu’il faut pour acheter des souliers. Voilà donc un troisième personnage, le cordonnier, intéressé dans la question. — Si je traite avec vous, votre industrie sera encouragée dans la mesure de 5 francs ; celle du cordonnier sera découragée dans la mesure de 5 francs, ce qui fait la balance exacte. — Et, en définitive, je n’aurai pas de souliers ; en sorte que ma perte sera sèche, et la nation, en ma personne, aura perdu 5 francs.
— Pas mal raisonné pour un bûcheron ! mais tu perds de vue une chose, c’est que les 5 francs que tu ferais gagner au cordonnier, — si tu traitais avec l’Anglais, — je les lui ferai gagner moi-même si tu traites avec moi.
— Pardon, excuse, maître ; mais vous m’avez vous-même appris, l’autre jour, à me préserver de cette confusion.
J’ai 10 francs ;
Traitant avec vous, je vous les livre et vous en ferez ce que vous voudrez.
Traitant avec l’Anglais, je les livre, savoir : 5 francs au gantier, 5 francs au cordonnier, et ils en feront ce qu’ils voudront.
Les conséquences ultérieures de la circulation qui sera imprimée à ces 10 francs par vous dans un cas, par le gantier et le cordonnier dans l’autre, sont identiques et se compensent. Il ne doit pas en être question. [109]
Il n’y a donc en tout ceci qu’une différence. Selon le premier marché, je n’aurai pas de souliers ; selon le second, j’en aurai.
Le maître de forges s’en allant : « Ah ! où diable l’économie politique va-t-elle se nicher ? Deux bonnes lois feront cesser ce désordre : une loi de douanes qui me donnera la force, puisque aussi bien je n’ai pas la raison, — et une loi sur l’enseignement, qui envoie toute la jeunesse étudier la société a Sparte et à Rome. Il n’est pas bon que le peuple voie si clair dans ses affaires ! [110] »
De la modération [On Moderation] [22 May 1847] [CW3 ES3.5]↩
BWV
1847.05.22 “De la modération” (On Moderation) [*Libre-Échange*, 22 May 1847] [OC2.50, pp. 343-48] [CW3] [ES3.5]
On nous reproche d’être absolus, exagérés, et cette imputation, soigneusement propagée par nos adversaires, a été reproduite par des hommes auxquels leurs talents et leur haute position donnent de l’autorité, par M. Charles Dupin, pair de France, et M. Cunin-Gridaine, ministre.
Et cela parce que nous avons l’audace de penser que vouloir enrichir les hommes en les entravant, et resserrer les liens sociaux en isolant les nations, c’est une vaine et folle entreprise. — Que la perception des taxes ne se puisse établir sans qu’il en résulte quelque entrave à la liberté des transactions comme à celle du travail, nous le comprenons. Alors ces restrictions incidentes sont un des inconvénients de l’impôt, et ces inconvénients peuvent être tels qu’ils fassent renoncer à l’impôt lui-même. — Mais voir dans les restrictions la source de la richesse et la cause du bien-être ; sur cette donnée, les renforcer et les multiplier systématiquement, non plus pour remplir le trésor, mais aux frais du trésor ; croire que les restrictions ont en elles une vertu productive, qu’il en sort un travail plus intense, mieux réparti, plus assuré de sa rémunération, plus capable d’égaliser les profits, c’est là une théorie absurde, qui ne pouvait conduire qu’une pratique insensée. Par ce motif, nous les combattons l’une et l’autre, non avec exagération, mais avec zèle et persévérance.
Après tout, qu’est-ce que la modération ?
Nous sommes convaincus que deux et un font trois, et nous nous croyons tenus de le dire nettement. Voudrait-on que nous prissions des détours ? que nous dissions, par exemple : Il se peut que deux et un fassent à peu près trois. Nous en soupçonnons quelque chose, mais nous ne nous hâterons pas de l’affirmer, d’autant que certains personnages ont cru de leur intérêt de faire établir la législation du pays sur cette autre donnée qui semble contredire la nôtre : qui de trois paye un reste quatre.
Nous interdire, par l’imputation d’absolutisme, de prouver la vérité de notre thèse, c’est vouloir que le pays n’ouvre jamais les yeux. Nous ne donnerons pas dans le piége.
Oh ! si l’on nous disait : « Il est bien vrai que la ligne droite est la plus courte. Mais que voulez-vous ? on a cru longtemps que c’était la plus longue. La nation s’est habituée à suivre la ligne courbe. Elle y use son temps et ses forces, mais il ne faut reconquérir que peu à peu, et par gradation, ce temps et ces forces perdus, » on nous trouverait d’une modération fort louable. Car que demandons-nous ? Une seule chose : que le public voie clairement ce qu’il perd à prendre la ligne courbe. Après cela, et si, sachant bien ce que la ligne courbe lui coûte en impôts, privations, vexations, vains efforts, il ne veut la quitter que lentement, ou s’il persiste même à s’y tenir, nous n’y saurions que faire. Notre mission est d’exposer la vérité. Nous ne croyons pas, comme les socialistes, que le peuple soit une masse inerte, et que le moteur soit dans celui qui décrit le phénomène, mais dans celui qui en souffre ou en profite. Peut-on être plus modéré ?
D’autres nous taxent d’exagération par un autre motif. C’est, disent-ils, parce que vous attaquez toutes les protections à la fois. Pourquoi ne pas user d’artifice ? pourquoi vous mettre sur les bras en même temps l’agriculture, les manufactures, la marine marchande et les classes ouvrières, sans compter les partis politiques toujours prêts à courtiser le nombre et la force ?
C’est en cela, ce nous semble, que nous faisons preuve de modération et de sincérité.
Combien de fois n’a-t-on pas essayé, et sans doute à bonne intention, de nous faire abandonner le terrain des principes ! On nous conseillait d’attaquer l’abus de la protection accordée à quelques fabriques.
« Vous aurez le concours de l’agriculture, nous disait-on ; avec ce puissant auxiliaire, vous battrez les monopoles industriels les plus onéreux, et vous briserez d’abord un des plus solides anneaux de cette chaîne qui vous fatigue. Ensuite, vous vous retournerez contre l’intérêt agricole, sûr d’avoir cette fois l’appui de l’industrie manufacturière[111] . »
Ceux qui nous donnent ces conseils oublient une chose, c’est que nous n’aspirons pas tant à renverser le régime protecteur qu’à éclairer le public sur ce régime, ou plutôt, si la première de ces tâches est le but, la seconde nous semble le moyen indispensable.
Or, quelle force auraient eue nos arguments, si nous avions soigneusement mis hors de cause le principe même de la protection ? et, en le mettant en cause, comment pouvions-nous éviter d’éveiller les susceptibilités de l’agriculture ? Croit-on que les manufacturiers nous eussent laissé le choix de nos démonstrations ? qu’ils ne nous eussent pas amenés à nous prononcer sur la question de principe, à dire explicitement ou implicitement que la protection est chose mauvaise par nature ? Une fois le mot lâché, l’agriculture se serait tenue sur ses gardes, et nous, nous aurions, qu’on nous pardonne le mot, pataugé dans des précautions et des distinctions subtiles, au milieu desquelles notre polémique aurait perdu toute force, et notre sincérité tout crédit.
Ensuite, le conseil lui-même implique que, au moins dans l’opinion de ceux qui le donnent, et sans doute dans la nôtre, la protection est chose désirable, puisqu, pour l’arracher d’une des branches de l’activité nationale, il faudrait se servir d’une autre branche, à laquelle on laisserait croire que ses priviléges seront respectés ; puisqu’on parle de battre les manufactures par l’agriculture, et celle-ci par celle-là ? Or, c’est ce dont nous ne voulons pas. Au contraire, nous nous sommes engagés dans la lutte parce que nous croyons la protection mauvaise pour tout le monde.
C’est ce que nous nous sommes imposé la tâche de faire comprendre et de vulgariser. — Mais alors, dira-t on, la lutte sera bien longue. — Tant mieux qu’elle soit longue, si cela est indispensable pour que le public s’éclaire.
Supposons que la ruse qu’on nous suggère ait un plein succès (succès que nous croyons chimérique), supposons que la première année les propriétaires des deux Chambres balayent tous les priviléges industriels, et que la seconde année, pour se venger, les manufacturiers emportent tous les priviléges agricoles.
Qu’arrivera-t-il ? En deux ans, la liberté commerciale sera dans nos lois, mais sera-t-elle dans nos intelligences ? Ne voit-on pas qu’à la première crise, au premier désordre, à la première souffrance, le pays s’en prendrait à une réforme mal comprise, attribuerait ses maux à la concurrence étrangère, invoquerait et ferait triompher bien vite le retour de la protection douanière ? Pendant combien d’années, pendant combien de siècles peut-être cette courte période de liberté, accompagnée de souffrances accidentelles, ne défrayerait-elle pas les arguments des prohibitionnistes ? Ils auraient soin de raisonner sur la supposition qu’il y a une connexion nécessaire entre ces souffrances et la liberté, comme ils le font aujourd’hui à propos des traités de Méthuen et de 1786.
C’est une chose bien remarquable, qu’au milieu de la crise qui désole l’Angleterre, pas une voix ne s’élève pour l’attribuer aux réformes libérales accomplies par sir R. Peel. Au contraire, chacun sent que, sans ces mesures, l’Angleterre serait en proie à des convulsions devant lesquelles l’imagination recule d’horreur. D’où provient cette confiance en la liberté ? De ce que la Ligue a travaillé pendant de longues années ; de ce qu’elle a familiarisé toutes les intelligences avec les notions d’économie publique ; de ce que la réforme était dans les esprits, et que les bills du parlement n’ont fait que sanctionner une volonté nationale forte et éclairée.
Enfin, nous avons repoussé ce conseil, malgré ce qu’il avait de séduisant pour l’impatience, la furia francese, par un motif de justice.
C’est notre conviction qu’en détendant la pression du régime protecteur, aussi progressivement que l’on voudra, mais selon une transition arrêtée d’avance et sur tous les points à la fois, on offre à toutes les industries des compensations qui rendent la secousse véritablement insensible. Si le prix du blé est tenu de quelque chose au-dessous de la moyenne actuelle, d’un autre côté, le prix des charrues, des vêtements, des outils et même du pain et de la viande, impose une charge moins lourde aux agriculteurs. De même, si le maître de forge voit baisser de quelques francs la tonne de fer, il a la houille, le bois, l’outillage et les aliments à de meilleures conditions. Or, il nous a paru que ces compensations qui naissent de la liberté, une fois établies, devaient accompagner uniformément la réforme elle-même pendant tout le temps de la transition, pour que celle-ci fût conforme à l’utilité générale et à la justice.
Est-ce là de l’exaltation, de l’exagération ? Est-ce là un plan conçu dans des cerveaux brûlés ? Et à moins qu’on ne veuille nous faire renoncer à notre principe, ce que nous ne ferons jamais tant qu’on ne nous en prouvera pas la fausseté, comment pourrait-on exiger de nous plus de modération et de prudence ?
La modération ne consiste pas à dire qu’on a une demi-conviction, quand on a une conviction entière. Elle consiste à respecter les opinions contraires, à les combattre sans emportement, à ne pas attaquer les personnes, à ne pas provoquer des proscriptions ou des destitutions, à ne pas soulever les ouvriers égarés, à ne pas menacer le gouvernement de l’émeute.
N’est-ce pas ainsi que nous la pratiquons ?
Peuple et Bourgeoisie [The People and the Bourgeoisie] [22 May 1847] [CW3 ES3.6]↩
BWV
1847.05.22 “Peuple et Bourgeoisie” (The People and the Bourgeoisie) [*Libre-Échange*, 22 May 1847] [OC2.51, pp. 348-55] [CW3] [ES3.6]
Les hommes sont facilement dupes des systèmes, pourvu qu’un certain arrangement symétrique en rende l’intelligence facile.
Par exemple, rien n’est plus commun, de nos jours, que d’entendre parler du peuple et de la bourgeoisie comme constituant deux classes opposées, ayant entre elles les mêmes rapports hostiles qui ont armé jadis la bourgeoisie contre l’aristocratie.
« La bourgeoisie, dit-on, était faible d’abord. Elle était opprimée, foulée, exploitée, humiliée par l’aristocratie. Elle a grandi, elle s’est enrichie, elle s’est fortifiée jusqu’à ce que, par l’influence du nombre et de la fortune, elle eût vaincu son adversaire en 89.
Alors elle est devenue elle-même l’aristocratie. Au-dessous d’elle, il y a le peuple, qui grandit, se fortifie et se prépare à vaincre, dans le second acte de guerre sociale. »
Si la symétrie suffisait pour donner de la vérité aux systèmes, on ne voit pas pourquoi celui-ci n’irait pas plus loin. Ne pourrait-on pas ajouter en effet :
Quand le peuple aura triomphé de la bourgeoisie, il dominera et sera par conséquent aristocratie à l’égard des mendiants. Ceux-ci grandiront, se fortifieront à leur tour et prépareront au monde le drame de la troisième guerre sociale.
Le moindre tort de ce système, qui défraye beaucoup de journaux populaires, c’est d’être faux.
Entre une nation et son aristocratie, nous voyons bien une ligne profonde de séparation, une hostilité irrécusable d’intérêts, qui ne peut manquer d’amener tôt ou tard la lutte. L’aristocratie est venue du dehors ; elle a conquis sa place par l’épée ; elle domine par la force. Son but est de faire tourner à son profit le travail des vaincus. Elle s’empare des terres, commande les armées, s’arroge la puissance législative et judiciaire, et même, pour être maîtresse de tous les moyens d’influence, elle ne dédaigne pas les fonctions ou du moins les dignités ecclésiastiques. Afin de ne pas affaiblir l’esprit de corps qui est sa sauvegarde, les priviléges qu’elle a usurpés, elle les transmet de père en fils par ordre de primogéniture. Elle ne se recrute pas en dehors d’elle, ou, si elle le fait, c’est qu’elle est déjà sur la voie de sa perte.
Quelle similitude peut-on trouver entre cette constitution et celle de la bourgeoisie ? Au fait, peut-on dire qu’il y ait une bourgeoisie ? Qu’est-ce que ce mot représente? Appellera-t-on bourgeois quiconque, par son activité, son assiduité, ses privations, s’est mis à même de vivre sur du travail antérieur accumulé, en un mot sur un capital ? Il n’y a qu’une funeste ignorance de l’économie politique qui ait pu suggérer celte pensée : que vivre sur du travail accumulé, c’est vivre sur le travail d’autrui. — Que ceux donc qui définissent ainsi la bourgeoisie commencent par nous dire ce qu’il y a, dans les loisirs laborieusement conquis, dans le développement intellectuel qui en est la suite, dans la formation des capitaux qui en est la base, de nécessairement opposé aux intérêts de l’humanité, de la communauté ou même des classes laborieuses.
Ces loisirs, s’ils ne coûtent rien à qui que ce soit, méritent-ils d’exciter la jalousie [112] ? Ce développement intellectuel ne tourne-t-il pas au profit du progrès, dans l’ordre moral aussi bien que dans l’ordre industriel ? Ces capitaux sans cesse croissants, précisément à cause des avantages qu’ils confèrent, ne sont-ils pas le fonds sur lequel vivent les classes qui ne sont pas encore affranchies du travail manuel ? Et le bien-être de ces classes, toutes choses égales d’ailleurs, n’est-il pas exactement proportionnel à l’abondance de ces capitaux et, par conséquent, à la rapidité avec laquelle ils se forment, à l’activité avec laquelle ils rivalisent ?
Mais, évidemment, le mot bourgeoisie aurait un sens bien restreint si on l’appliquait exclusivement aux hommes de loisir. On entend parler aussi de tous ceux qui ne sont pas salariés, qui travaillent pour leur compte, qui dirigent, à leurs risques et périls, des entreprises agricoles, manufacturières, commerciales, qui se livrent à l’étude des sciences, à l’exercice des arts, aux travaux de l’esprit.
Mais alors il est difficile de concevoir comment on trouve entre la bourgeoisie et le peuple cette opposition radicale qui autoriserait à assimiler leurs rapports à ceux de l’aristocratie et de la démocratie. Toute entreprise n’a-t-elle pas ses chances ? n’est-il pas bien naturel et bien heureux que le mécanisme social permette à ceux qui peuvent perdre de les assumer [113]? Et d’ailleurs n’est-ce pas dans les rangs des travailleurs que se recrute constamment, à toute heure, la bourgeoisie ? N’est-ce pas au sein du peuple que se forment ces capitaux, objet de tant de déclamations si insensées ? Où conduit une telle doctrine ? Quoi ! par cela seul qu’un ouvrier aura toutes les vertus par lesquelles l’homme s’affranchit du joug des besoins immédiats, parce qu’il sera laborieux, économe, ordonné, maître de ses passions, probe ; parce qu’il travaillera avec quelque succès à laisser ses enfants dans une condition meilleure que celle qu’il occupe lui-même, — en un mot à fonder une famille, — on pourra dire que cet ouvrier est dans la mauvaise voie, dans la voie qui éloigne de la cause populaire, et qui mène dans cette région de perdition, la bourgeoisie ! Au contraire, il suffira qu’un homme n’ait aucune vue d’avenir, qu’il dissipe follement ses profits, qu’il ne fasse rien pour mériter la confiance de ceux qui l’occupent, qu’il ne consente à s’imposer aucun sacrifice, pour qu’il soit vrai de dire que c’est là l’homme-peuple par excellence, l’homme qui ne s’élèvera jamais au-dessus du travail le plus brut, l’homme dont les intérêts coïncideront toujours avec l’intérêt social bien entendu !
L’esprit se sent saisir d’une tristesse profonde à l’aspect des conséquences effroyables renfermées dans ces doctrines erronées, et à la propagation desquelles on travaille cependant avec tant d’ardeur. On entend parler d’une guerre sociale comme d’une chose naturelle, inévitable, forcément amenée par la prétendue hostilité radicale du peuple et de la bourgeoisie, semblable à la lutte qui a mis aux mains, dans tous les pays, l’aristocratie et la démocratie. Mais, encore une fois, la similitude est-elle exacte ? Peut-on assimiler la richesse acquise par la force à la richesse acquise par le travail ? Et si le peuple considère toute élévation, même l’élévation naturelle par l’industrie, l’épargne, l’exercice de toutes les vertus, comme un obstacle à renverser, — quel motif, quel stimulant, quelle raison d’être restera-t-il à l’activité et à la prévoyance humaine? [114]
Il est affligeant de penser qu’une erreur, grosse d’éventualités si funestes, est le fruit de la profonde ignorance dans laquelle l’éducation moderne retient les générations actuelles sur tout ce qui a rapport au mécanisme de la société.
Ne voyons donc pas deux nations dans la nation ; il n’y en a qu’une. Des degrés infinis dans l’échelle des fortunes, toutes dues au même principe, ne suffisent pas pour constituer des classes différentes, encore moins des classes hostiles.
Cependant, il faut le dire, il existe dans notre législation, et principalement la législation financière, certaines dispositions qui n’y semblent maintenues que pour alimenter et, pour ainsi dire, justifier l’erreur et l’irritation populaires.
On ne peut nier que l’influence législative concentrée dans les mains du petit nombre, n’ait été quelquefois mise en œuvre avec partialité. La bourgeoisie serait bien forte devant le peuple, si elle pouvait dire : « Notre participation aux biens communs diffère par le degré, mais non par le principe. Nos intérêts sont identiques ; en défendant les miens, je défends les vôtres. Voyez-en la preuve dans nos lois ; elles sont fondées sur l’exacte justice. Elles garantissent également toutes les propriétés, quelle qu’en soit l’importance. »
Mais en est-il ainsi ? La propriété du travail est-elle traitée par nos lois à l’égal de la propriété accumulée fixée dans le sol ou le capital ? Non certes ; mettant de côté la question de la répartition des taxes, on peut dire que le régime protecteur est le terrain spécial sur lequel les intérêts et les classes se livrent le combat le plus acharné, puisque ce régime a la prétention de pondérer les droits et les sacrifices de toutes les industries. Or, dans cette question, comment la classe qui fait la loi a-t-elle traité le travail ? comment s’est-elle traitée elle-même ? On peut affirmer qu’elle n’a rien fait et qu’elle ne peut rien faire pour le travail proprement dit, quoiqu’elle affiche la prétention d’être la gardienne fidèle du travail national. Ce qu’elle a tenté, c’est d’élever le prix de tous les produits, disant que la hausse des salaires s’ensuivrait naturellement. Or, si elle a failli, comme nous le croyons, dans son but immédiat, elle a bien moins réussi encore dans ses intentions philanthropiques. Le taux de la main-d’œuvre dépend exclusivement du rapport entre le capital disponible et le nombre des ouvriers. Or, si la protection ne peut rien changer à ce rapport, si elle ne parvient ni à augmenter la masse du capital, ni à diminuer le nombre des bras, quelque influence qu’elle exerce sur le prix des produits, elle n’en exercera aucune sur le taux des salaires. On nous dira que nous sommes en contradiction ; que, d’une part, nous arguons de ce que les intérêts de toutes les classes sont homogènes, et que nous signalons maintenant un point sur lequel la classe riche abuse de la puissance législative.
Hâtons-nous de le dire, l’oppression exercée, sous cette forme, par une classe sur une autre, n’a eu rien d’intentionnel ; c’est purement une erreur économique, partagée par le peuple et par la bourgeoisie. Nous en donnerons deux preuves irrécusables : la première, c’est que la protection ne profite pas à la longue à ceux qui l’ont établie. La seconde, c’est que si elle nuit aux classes laborieuses, elles l’ignorent complétement, et à ce point qu’elles se montrent mal disposées envers les amis de la liberté.
Cependant il est dans la nature des choses que la cause d’un mal, quand une fois elle est signalée, finisse par être généralement reconnue. Quel terrible argument ne fournirait pas aux récriminations des masses l’injustice du régime protecteur ! Que la classe électorale y prenne garde ! Le peuple n’ira pas toujours chercher la cause de ses souffrances dans l’absence d’un phalanstère, d’une organisation du travail, d’une combinaison chimérique. Un jour il verra l’injustice là où elle est. Un jour il découvrira que l’on fait beaucoup pour les produits, qu’on ne fait rien pour les salaires, et que ce qu’on fait pour les produits est sans influence sur les salaires. Alors il se demandera : Depuis quand les choses sont-elles ainsi ? Quand nos pères pouvaient approcher de l’urne électorale, était-il défendu au peuple, comme aujourd’hui, d’échanger son salaire contre du fer, des outils, du combustible, des vêtements et du pain ? Il trouvera la réponse écrite dans les tarifs de 1791 et de 1795. Et qu’aurez-vous à lui répondre, industriels législateurs, s’il ajoute : « Nous voyons bien qu’une nouvelle aristocratie s’est substituée à l’ancienne ? » (V. n° 18, page 100.)
Si donc la bourgeoisie veut éviter la théocraties sacerdotales, dont les journaux populaires font entendre les grondements lointains, qu’elle ne sépare pas ses intérêts de ceux des masses, qu’elle étudie et comprenne la solidarité qui les lie ; si elle veut que le consentement universel sanctionne son influence, qu’elle la mette au service de la communauté tout entière ; si elle veut qu’on ne s’inquiète pas trop du pouvoir qu’elle a de faire la loi, qu’elle la fasse juste et impartiale ; qu’elle accorde à tous ou à personne la protection douanière. Il est certain que la propriété des bras et des facultés est aussi sacrée que la propriété des produits. Puisque la loi élève le prix des produits, qu’elle élève donc aussi le taux des salaires ; et, si elle ne le peut pas, qu’elle les laisse librement s’échanger les uns contre les autres.
Deux pertes contre un profit [Two Losses versus One Profit] [30 May 1847] [CW3 ES3.7]↩
BWV
1847.05.30 “Deux pertes contre un profit” (Two Losses versus One Profit) [*Libre-Échange*, 30 May 1847] [OC2.58, pp. 384-91] [CW3] [ES3.7]
À M. Arago, de l’Académie des sciences.
Monsieur,
Vous avez le secret de rendre accessibles à tous les esprits les plus hautes vérités de la science. Oh ! ne pourriez-vous, à grand renfort d’x, trouver au théorème suivant une de ces démonstrations par a+b, qui ne laissent plus de place à la controverse ! Son simple énoncé suffira pour montrer l’immense service que vous rendriez au pays et à l’humanité. Le voici :
Si un droit protecteur élève le prix d’un objet d’une quantité donnée, la nation gagne cette quantité une fois et la perd deux fois.
Si cette proposition est vraie, il s’ensuit que les nations s’infligent à elles-mêmes des pertes incalculables. Il faudrait reconnaître qu’il n’est aucun de nous qui ne jette des pièces d’un franc dans la rivière chaque fois qu’il mange ou qu’il boit, qu’il s’avise de toucher à un outil ou à un vêtement.
Et comme il y a longtemps que ce jeu dure, il ne faut pas être surpris si, malgré le progrès des sciences et de l’industrie, une masse bien lourde de misère et de souffrances pèse encore sur nos concitoyens.
D’un autre côté, tout le monde convient que le régime protecteur est une source de maux, d’incertitudes et de dangers, en dehors de ce calcul de profits et de pertes. Il nourrit les animosités nationales, retarde l’union des peuples, multiplie les chances de guerre, fait inscrire dans nos codes, au rang des délits et des crimes, des actions innocentes en elles-mêmes. Ces inconvénients accessoires du système, il faut bien s’y soumettre quand on croit que le système repose lui-même sur cette donnée : que tout renchérissement, de son fait, est un gain national. — Car, Monsieur, je crois avoir observé et vous aurez peut-être observé comme moi que, malgré le grand mépris que les individus et les peuples affichent pour le gain, ils y renoncent difficilement, — mais s’il venait à être prouvé que ce prétendu gain est accompagné d’abord d’une perte égale, ce qui fait compensation, puis d’une seconde perte encore égale, laquelle constitue une duperie bien caractérisée ; comme dans le cœur humain l’horreur des pertes est aussi fortement enracinée que l’amour des profits, il faut croire que le régime protecteur et toutes ses conséquences directes et indirectes s’évanouiraient avec l’illusion qui les a fait naître.
Vous ne serez donc pas surpris, Monsieur, que je désire voir cette démonstration revêtue de l’évidence invincible que communique la langue des équations. Vous ne trouverez pas mauvais non plus que je m’adresse à vous ; car, parmi tous les problèmes qu’offrent les sciences que vous cultivez avec tant de gloire, il n’en est certainement aucun plus digne d’occuper, au moins quelques instants, vos puissantes facultés. J’ose dire que celui qui en donnerait une solution irréfutable, n’eût-il fait que cela dans ce monde, aurait assez fait pour l’humanité et pour sa propre renommée.
Permettez-moi donc d’établir en langue vulgaire ce que je voudrais voir mettre en langue mathématique.
Supposons qu’un couteau anglais se donne en France pour 2 fr.
Cela veut dire qu’il s’échange contre 2 fr. ou tout autre objet valant lui-même 2 fr., par exemple une paire de gants de ce prix.
Admettons qu’un couteau semblable ne puisse se faire chez nous à moins de 3 fr.
Dans ces circonstances, un coutelier français s’adresse au gouvernement et lui dit: Protégez-moi. Empêchez mes compatriotes d’acheter des couteaux anglais, et moi je me charge de les pourvoir à 3 fr.
Je dis que ce renchérissement d’un franc sera gagné une fois, mais j’ajoute qu’il sera perdu deux fois par la France, et que le même phénomène se présentera dans tous les cas analogues.
D’abord, finissons-en avec les 2 fr. qui sont en dehors du renchérissement. En tant que cela concerne ces 2 fr., il est bien clair que l’industrie française n’aura rien gagné ni perdu à la mesure. Que ces 2 fr. aillent au coutelier ou au gantier, cela peut arranger l’un de ces industriels et déranger l’autre, mais cela n’affecte en rien l’ensemble du travail national. Jusque-là, il y a changement de direction, mais non accroissement ou décroissement dans l’industrie : 2 fr. de plus prennent le chemin de la coutellerie, 2 fr. de moins prennent celui de la ganterie, voilà tout. Injuste faveur ici, oppression non moins injuste là, c’est tout ce qu’il est possible d’apercevoir ; ne parlons donc plus de ces 2 fr.
Mais il reste un troisième franc dont il est essentiel de suivre la trace ; il constitue le surenchérissement du couteau ; c’est la quantité donnée dont le prix des couteaux est élevé. C’est celle que je dis être gagnée une fois et perdue deux par le pays.
Qu’elle soit gagnée une fois, cela est hors de doute. Évidemment l’industrie coutelière est favorisée, par la prohibition, dans la mesure de un franc, qui va solder des salaires, des profits, du fer, de l’acier. En d’autres termes, la production des gants n’est découragée que de 2 fr. et celle des couteaux est encouragée de 3 fr., ce qui constitue bien pour l’ensemble de l’industrie nationale, tout balancé jusqu’ici, un excédant d’encouragement de 20 sous, 1 franc ou 100 centimes, comme on voudra les appeler.
Mais il est tout aussi évident que l’acquéreur du couteau, quand il l’obtenait d’Angleterre contre une paire de gants, ne déboursait que 2 fr., tandis que maintenant il en dépense 3. Dans le premier cas, il restait donc à sa disposition un franc au delà du prix du couteau ; et, comme nous sommes tous dans l’habitude de faire servir les francs à quelque chose, nous devons tenir pour certain que ce franc aurait été dépensé d’une manière quelconque et aurait encouragé l’industrie nationale tout autant qu’un franc peut s’étendre.
Si, par exemple, vous étiez cet acheteur, — avant la prohibition vous pouviez acheter une paire de gants pour 2 fr., contre laquelle paire de gants vous auriez obtenu le couteau anglais. — Et, en outre, il vous serait resté 1 fr., avec lequel vous auriez acheté, selon votre bon plaisir, des petits pâtés ou un petit volume in-12.
Si donc nous faisons le compte du travail national, nous trouvons de suite à opposer au gain du coutelier une perte équivalente, savoir celle du pâtissier ou du libraire.
Il me semble impossible de nier que, dans un cas comme dans l’autre, vos 3 fr., puisque vous les aviez, ont encouragé dans une mesure exactement semblable l’industrie du pays. Sous le régime de la liberté, ils se sont partagés entre un gantier et un libraire ; sous le régime de la protection, ils sont allés exclusivement au coutelier, et je crois qu’on pourrait défier le génie de la prohibition lui-même d’ébranler cette vérité.
Ainsi, voilà le franc gagné une fois par le coutelier et perdu une fois par le libraire.
Reste à examiner votre propre situation, vous acheteur, vous consommateur. Ne saute-t-il pas aux yeux qu’avant la prohibition, vous aviez pour vos 3 fr. et un couteau et un petit volume in-12, tandis que depuis, vous ne pouvez avoir pour vos mêmes 3 fr. qu’un couteau et pas de volume in-12 ? Vous perdez donc dans cette affaire un volume, soit l’équivalent d’un franc. Or, si cette seconde perte n’est compensée par aucun profit pour qui que ce soit en France, j’ai raison de dire que ce franc, gagné une fois, est perdu deux fois.
Savez-vous, Monsieur, ce qu’on dit à cela ? car il est bon que vous connaissiez l’objection. On dit que votre perte est compensée par le profit du coutelier, ou, en termes généraux, que la perte du consommateur est compensée par le profit du producteur.
Votre sagacité aura bien vite découvert que la mystification ici consiste à laisser dans l’ombre le fait déjà établi que le profit d’un producteur, le coutelier, est balancé par la perte d’un autre producteur, le libraire ; et que votre franc, par cela même qu’il a été encourager la coutellerie, n’a pu aller encourager, comme il l’aurait fait, la librairie.
Après tout, comme il s’agit de sommes égales, qu’on établisse, si on le préfère, la compensation entre le producteur et le consommateur, peu importe, pourvu qu’on n’oublie pas le libraire, et qu’on ne fasse pas reparaître deux fois le même gain pour l’opposer alternativement à deux pertes bien distinctes.
On dit encore : Tout cela est bien petit, bien mesquin. Il ne vaut guère la peine de faire tant de bruit pour un petit franc, un petit couteau, et un petit volume in-12. Je n’ai pas besoin de vous faire observer que le franc, le couteau et le livre sont mes signes algébriques, qu’ils représentent la vie, la substance des peuples ; et c’est parce que je ne sais pas me servir des a, b, c, qui généralisent les questions, que je mets celle-ci sous votre patronage.
On dira encore ceci : Le franc que le coutelier reçoit en plus, grâce à la protection, il le fait gagner à des travailleurs. — Je réponds: Le franc que le libraire recevrait en plus, grâce à la liberté, il le ferait gagner aussi à d’autres travailleurs ; en sorte que, de ce côté, la compensation n’est pas détruite, et il reste toujours que, sous un régime vous avez un livre, et sous l’autre vous n’en avez pas. — Pour éviter la confusion volontaire ou non qu’on ne manquera pas de faire à ce sujet, il faut bien distinguer la distribution originaire de vos 3 francs d’avec leur circulation ultérieure, laquelle, dans l’une et dans l’autre hypothèse, suit des parallèles infinies, et ne peut jamais affecter notre calcul. [115]
Il me semble qu’il faudrait être de bien mauvaise foi pour venir argumenter de l’importance relative des deux industries comparées, disant: Mieux vaut la coutellerie que la ganterie ou la librairie. Il est clair que mon argumentation n’a rien de commun avec cet ordre d’idées. Je cherche l’effet général de la prohibition sur l’ensemble de l’industrie, et non si l’une a plus d’importance que l’autre. Il m’eût suffi de prendre un autre exemple pour montrer que ce qui, dans mon hypothèse, se résout en privation d’un livre est, dans beaucoup de cas, privation de pain, de vêtements, d’instruction, d’indépendance et de dignité.
Dans l’espoir que vous attacherez à la solution de ce problème l’importance vraiment radicale qu’il me semble mériter, permettez-moi d’insister encore sur quelques objections qu’on pourra faire. — On dit : La perte ne sera pas d’un franc, parce que la concurrence intérieure suffira pour faire tomber les couteaux français à 2 fr. 50, peut-être à 2 fr. 25. Je conviens que cela pourra arriver. Alors il faudra changer mes chiffres. Les deux pertes seront moindres, et le gain aussi ; mais il n’y aura pas moins deux pertes pour un gain tant que la protection protégera.
Enfin, on objectera, sans doute, qu’il faut au moins protéger l’industrie nationale en raison des taxes dont elle est grevée. La réponse se déduit de ma démonstration même. Soumettre le peuple à deux pertes pour un gain, c’est un triste moyen d’alléger ses charges. Qu’on suppose les impôts aussi élevés qu’on voudra ; qu’on suppose que le gouvernement nous prend les 99 centièmes de nos revenus, est-ce un remède proposable, je le demande, que de gratifier le coutelier surtaxé d’un franc pris au libraire surtaxé, avec perte par-dessus le marché d’un franc pour le consommateur surtaxé ?
Je ne sais, Monsieur, si je me fais illusion, mais il me semble que la démonstration rigoureuse que je sollicite de vous, si vous prenez la peine de la formuler, ne sera pas un objet de pure curiosité scientifique, mais dissipera bien des préjugés funestes.
Par exemple, vous savez combien on est impatient de toute concurrence étrangère. C’est le monstre sur lequel se déchargent toutes les colères industrielles. Eh bien ! que voit-on dans le cas proposé ? où est la rivalité réelle ? quel est le vrai, le dangereux concurrent du gantier et du libraire français ? N’est-ce pas le coutelier français qui sollicite l’appui de la loi, pour absorber à lui seul la rémunération de ses deux confrères, même aux dépens d’une perte sèche pour le public ? Et de même, quels sont les vrais, les dangereux antagonistes du coutelier français ? Ce n’est pas le coutelier de Birmingham ; ce sont le libraire et le gantier français, qui, du moins s’ils n’ont pas une taie sur les yeux, feront des efforts incessants pour reprendre au coutelier une clientèle qu’il leur a législativement et injustement ravie. N’est-il pas assez singulier de découvrir que ce monstre de la concurrence, dont nous croyons entendre les rugissements de l’autre côté du détroit, nous le nourrissons au milieu de nous ? D’autres points de vue aussi neufs qu’exacts sortiront de cette équation que j’ose attendre, Monsieur, de vos lumières et de votre patriotisme. [116]
Le Roi libre-échangiste [30 mai 1847] ↩
BWV
1847.05.30 “Le Roi libre-échangiste” (The Free Trade King) [*Libre-Échange*, 30 mai 1847] [OC7.36, p.167]
Le Roi libre-échangiste [1]
Déclamez donc contre les journaux ! Plaignez-vous de ce qu’ils sont aussi peu intéressants qu’instructifs ! quelle calomnie ! Pour nous, nous y trouvons à chaque instant des choses inattendues, surprenantes, merveilleuses.
Par exemple, l’Impartial de Rouen nous révèle qu’un haut personnage est libre-échangiste. Ce personnage, l’Impartial ne le nomme pas, car il craint la charte et les lois de septembre. Or, dire de quelqu’un qu’il est libre-échangiste, c’est, aux yeux de la feuille Normande, lui faire une mortelle injure.
Nous qui n’avons pas les mêmes raisons d’interpréter ainsi la charte, et qui pensons qu’on peut, sans se déshonorer, préférer, en fait de trocs, la liberté aux entraves, nous ne craignons pas de dire, à nos périls et risques, que le personnage dont il s’agit n’est autre que Louis-Philippe, roi des Français.
Le Roi est donc libre-échangiste. C’est de Rouen qu’en vient la nouvelle. Jusqu’ici rien ne nous l’avait fait soupçonner, et nous devons même confesser, peut-être à notre honte, que nous n’avons pas songé à nous en informer. Quelquefois, il est vrai, quand il a plu au caprice de ces rêves, que l’on nomme châteaux en Espagne, de placer sur notre tête la couronne de France, (car
Au moins quelques instants qui n’est roi dans ses rêves ?)
nous nous rappelions ce vers touchant :
Si j’étais roi, je voudrais être juste.
Et nous nous disions : « Nos sujets disposeraient librement du fruit de leurs sueurs ; des restrictions ne seraient pas imposées au Midi pour l’avantage du Nord, ni au Nord pour l’avantage du Midi. Nous voudrions que chaque citoyen, pour améliorer son sort, comptât un peu plus sur lui-même et un peu moins sur la caisse publique. Nous voudrions que l’État fût déchargé de l’effrayante responsabilité qu’il assume en entreprenant de pondérer toutes les industries. Nous voudrions que la vie de notre peuple fût douce et facile ; qu’aucun obstacle ne s’interposât entre la source voisine et sa lèvre altérée. S’il ne lui était pas donné d’échapper à toutes les souffrances, nous voudrions du moins qu’il ne lui en fût infligé aucune par notre administration. Nous voudrions que la liberté des transactions fût pour lui le gage le plus assuré de la paix. Alors nous pourrions rendre à la ferme et à l’atelier ces jeunes hommes dont les familles pleurent l’absence. Alors nous pourrions supprimer toutes les taxes qui pèsent sur les malheureux… »
Ces idées nous venaient trop naturellement, à nous, roi chimérique, pour que nous n’admettions pas qu’elles puissent se présenter aussi à l’esprit des rois sérieux, comme on dit aujourd’hui. Si donc nous sommes resté dans l’indifférence à l’endroit des opinions économiques de l’auguste personnage, c’est que, selon nous, dans le siècle où nous sommes, le libre-échange, comme toutes les grandes choses, est un fruit qui mûrit dans les régions populaires de l’opinion publique et non dans les palais des rois.
Mais enfin il n’est pas indifférent d’avoir, même sans s’en douter, des monarques pour alliés. Aussi nous nous réjouirions de la nouvelle qui nous arrive de Rouen, si elle était fondée sur autre chose que sur une conjecture fort hasardée.
D’où l’Impartial l’a-t-il tirée ? Voici comment lui-même raconte la chose :
En 1789, Philippe-Égalité fut envoyé en mission à Londres. Selon quelques lambeaux de correspondance arrangés par l’Impartial avec toute l’impartialité que son titre lui impose, il paraîtrait que Pitt s’empressa de faire du prince un libre-échangiste, et lui montra en perspective la couronne des Pays-Bas, s’il obtenait la liberté absolue du commerce entre la France et l’Angleterre. Le prince écrivit donc à M. de Montémolin : « Je crois la liberté absolue avantageuse aux deux nations, mais je ne crois ni l’une ni l’autre assez éclairées pour adopter ces grands principes. » Cependant il offrait de travailler à un traité qui s’en rapprochait le plus possible.
Or, vous le savez, en langue protectioniste, rendre à deux nations la liberté de troquer, c’est vendre l’une à l’autre. Il est donc clair que Philippe-Égalité était un traître. Cet homme, dit l’Impartial, trahissait la France et méditait de livrer son commerce à l’Angleterre… » et cela pour être fait roi des Pays-Bas.
Comprenez-vous maintenant ? — Quoi donc ? — Comprenez-vous pourquoi Louis-Philippe ne peut être qu’un libre-échangiste ? — Pas le moins du monde. Est-ce que lord Palmerston a aussi promis au roi des Français la couronne des Pays-Bas contre la liberté absolue du commerce ? — L’Impartial ne le dit pas, mais il le faut bien, car, sans cette identité de motifs, comment la feuille rouennaise pourrait-elle conclure de la politique du père à la politique du fils ? — Morbleu ! parlez-moi de l’art de tirer habilement les conséquences des choses [2] !
FN:'Libre-Échange du 30 mai 1847. (Note de l’éd.)
FN:On a vu, dans un grand nombre des articles qui précèdent, et notamment aux numéros 10 à 12, 14 à 16, 19 à 21, 25, 27, 28, 32 à 36, les premiers efforts de l’auteur pour amener les journaux français à l’étude des vérités économiques, et au respect de la liberté, sous toutes ses formes. La continuation des mêmes efforts est présentée, au tome II, dans les numéros 16 à 29. (Note de l’édit.)
Guerre aux chaires d'économie politique [June 1847] [CW2.14]↩
BWV
1847.06 “Guerre aux chaires d’économie politique” (The War against Chairs of Political Economy) [June 1847. n.p.] [OC5.2, p. 16] [CW2]
Source
<abc>
Guerre aux chaires d’économie politique [1]
1847
On sait avec quelle amertume les hommes qui, pour leur propre avantage, restreignent les échanges d’autrui, se plaignent de ce que l’économie politique s’obstine à ne point exalter le mérite de ces restrictions. S’ils n’espèrent pas obtenir la suppression de la science, ils poursuivent du moins la destitution de ceux qui la professent, tenant de l’inquisition cette sage maxime : « Voulez-vous avoir raison de vos adversaires ? fermez-leur la bouche. »
Nous n’avons donc point été surpris d’apprendre qu’à l’occasion du projet de loi sur l’organisation des facultés ils ont adressé à M. le ministre de l’instruction publique un mémoire fort étendu, dont nous reproduisons quelques extraits.
« Y pensez-vous, monsieur le ministre ? Vous voulez introduire dans les facultés l’enseignement de l’économie politique ! C’est donc un parti pris de déconsidérer nos priviléges ? »
« S’il est une maxime vénérable, c’est assurément celle-ci : En tous pays, l’enseignement doit être en harmonie avec le principe du gouvernement. Croyez-vous qu’à Sparte ou à Rome le trésor public aurait payé des professeurs pour déclamer contre le butin fait à la guerre ou contre l’esclavage ? Et vous voulez qu’en France il soit permis de discréditer la restriction ! [2] »
« La nature, monsieur le ministre, a voulu que les sociétés ne puissent exister que sur les produits du travail, et, en même temps, elle a rendu le travail pénible. Voilà pourquoi, à toutes les époques et dans tous les pays, on remarque parmi les hommes une incurable disposition à s’entre-dépouiller. Il est si doux de mettre la peine à la charge de son voisin et de garder la rémunération pour soi ! »
« La guerre est le premier moyen dont on se soit avisé. Pour s’emparer du bien d’autrui, il n’y en a pas de plus court et de plus simple. »
« L’esclavage est venu ensuite. C’est un moyen plus raffiné, et il est prouvé que ce fut un grand pas vers la civilisation que de réduire le prisonnier en servitude au lieu de le tuer. »
« Enfin, à ces deux modes grossiers de Spoliation, le progrès des temps en a substitué un autre beaucoup plus subtil, et qui, par cela même, a bien plus de chances de durée, d’autant que son nom même, protection, est admirablement trouvé pour en dissimuler l’odieux. Vous n’ignorez pas combien les noms font quelquefois prendre le change sur les choses. »
« Vous le voyez, monsieur le ministre, prêcher contre la protection, dans les temps modernes, ou contre la guerre et l’esclavage, dans l’antiquité, c’est tout un. C’est toujours ébranler l’ordre social et troubler la quiétude d’une classe très-respectable de citoyens. Et si la Rome païenne montra une grande sagesse, un prévoyant esprit de conservation en persécutant cette secte nouvelle qui venait dans son sein faire retentir les mots dangereux : paix et fraternité ; pourquoi aurions-nous plus de pitié aujourd’hui pour les professeurs d’économie politique ? Pourtant, nos mœurs sont si douces, notre modération est si grande, que nous n’exigeons pas que vous les livriez aux bêtes. Défendez-leur de parler, et nous serons satisfaits. »
« Ou du moins, si tant ils ont la rage de discourir ne peuvent-ils le faire avec quelque impartialité ? Ne peuvent-ils accommoder un peu la science à nos souhaits ? Par quelle fatalité les professeurs d’économie politique de tous les pays se sont-ils donné le mot pour tourner contre le régime restrictif l’arme du raisonnement ? Si ce régime a quelques inconvénients, certes, il a aussi des avantages, puisqu’il nous convient. Messieurs les professeurs ne pourraient-ils pas mettre un peu plus les inconvénients dans l’ombre et les avantages en saillie ? »
« D’ailleurs, à quoi servent les savants, sinon à faire la science ? Qui les empêche d’inventer une économie politique exprès pour nous ? Évidemment, il y a de leur part mauvaise volonté. Quand la sainte inquisition de Rome trouva mauvais que Galilée fit tourner la terre, ce grand homme n’hésita pas à la rendre immobile. Il en fit même la déclaration à genoux. Il est vrai qu’en se relevant, il murmurait, dit-on : E pur si muove. Que nos professeurs aussi déclarent publiquement, et à genoux, que la liberté ne vaut rien, et nous leur pardonnerons, s’ils marmottent, pourvu que ce soit entre les dents : E pur è buona. »
« Mais nous voulons subsidiairement pousser la modération plus loin encore. Vous ne disconviendrez pas, monsieur le ministre, qu’il faut être impartial avant tout. Eh bien ! puisqu’il y a dans le monde deux doctrines qui se heurtent, l’une ayant pour devise : laissez échanger, et l’autre : empêchez d’échanger, de grâce, tenez la balance égale, et faites professer l’une comme l’autre. Ordonnez que notre économie politique soit aussi enseignée. »
« N’est-il pas bien décourageant de voir la science se mettre toujours du côté de la liberté, et ne devrait-elle pas partager un peu ses faveurs ? Mais non, une chaire n’est pas plutôt érigée, qu’on y voit apparaître, comme une tête de Méduse, la figure d’un libre-échangiste. »
« C’est ainsi que J. B. Say a donné un exemple, que se sont empressés de suivre MM. Blanqui, Rossi, Michel Chevalier, Joseph Garnier. Que serions-nous devenus si vos prédécesseurs n’avaient eu grand soin de borner cet enseignement funeste ? Qui sait ? Cette année même nous aurions à subir le bon marché du pain. »
« En Angleterre, Ad. Smith, Senior et mille autres ont donné le même scandale. Bien plus, l’université d’Oxford crée une chaire d’économie politique et y place… qui ? un futur archevêque [3] ; et voilà que M. l’archevêque se met à enseigner que la religion s’accorde avec la science pour condamner cette partie de nos profits qui sort du régime restrictif. Aussi qu’est-il advenu ? C’est que peu à peu l’opinion publique s’est laissé séduire, et, avant qu’il soit deux ans, les Anglais auront le malheur d’être libres dans leurs ventes et leurs achats. Puissent-ils être ruinés comme ils le méritent ! »
« Mêmes faits en Italie. Rois, princes et ducs, grands et petits, ont eu l’imprudence d’y tolérer l’enseignement économique, sans imposer aux professeurs l’obligation de faire sortir de la science des vues favorables aux restrictions. Des professeurs innombrables, les Genovesi, les Beccaria, et de nos jours, M. Scialoja, comme il fallait s’y attendre, se sont mis à prêcher la liberté, et voilà la Toscane libre dans ses échanges, et voilà Naples qui sabre ses tarifs. »
« Vous savez quels résultats a eu en Suisse le mouvement intellectuel qui y a toujours dirigé les esprits vers les connaissances économiques. La Suisse est libre, et semble placée au milieu de l’Europe, comme la lumière sur le chandelier, tout exprès pour nous embarrasser. Car, quand nous disons : La liberté a pour conséquence de ruiner l’agriculture, le commerce et l’industrie, on ne manque pas de nous montrer la Suisse. Un moment, nous ne savions que répondre. Grâce au ciel, la Presse nous a tirés de peine en nous fournissant cet argument précieux : La Suisse n’est pas inondée parce qu’elle est petite. »
« La science, la science maudite, menace de faire déborder sur l’Espagne le même fléau. L’Espagne est la terre classique de la protection. Aussi voyez-vous comme elle a prospéré ! Et, sans tenir compte des trésors qu’elle a puisés dans le Nouveau-Monde, de la richesse de son sol, le régime prohibitif suffit bien pour expliquer le degré de splendeur auquel elle est parvenue. Mais l’Espagne a des professeurs d’économie politique, des La Sagra, des Florez Estrada, et voici que le ministre des finances, M. Salamanca, prétend relever le crédit de l’Espagne et gonfler son budget par la seule puissance de la liberté commerciale. »
« Enfin, monsieur le ministre, que voulez-vous de plus ? En Russie, il n’y a qu’un économiste, et il est pour le libre-échange. »
« Vous le voyez, la conspiration de tous les savants du monde contre les entraves commerciales est flagrante. Et quel intérêt les presse ? Aucun. Ils prêcheraient la restriction qu’ils n’en seraient pas plus maigres. C’est donc de leur part méchanceté pure. Cette unanimité a les plus grands dangers. Savez-vous ce qu’on dira ? À les voir si bien d’accord, on finira par croire que ce qui les unit dans la même foi, c’est la même cause qui fait que tous les géomètres du monde pensent de même, depuis Archimède, sur le carré de l’hypoténuse. »
« Lors donc, monsieur le ministre, que nous vous supplions de faire enseigner impartialement deux doctrines contradictoires, ce ne peut être de notre part qu’une demande subsidiaire, car nous pressentons ce qui adviendrait ; et tel que vous chargeriez de professer la restriction pourrait bien, par ses études, être conduit vers la liberté. »
« Le mieux est de proscrire, une bonne fois pour toutes, la science et les savants et de revenir aux sages traditions de l’empire. Au lieu de créer de nouvelles chaires d’économie politique, renversez celles, heureusement en petit nombre, qui sont encore debout. Savez-vous comment on a défini l’économie politique ? La science qui enseigne aux travailleurs à garder ce qui leur appartient. Évidemment un bon quart de l’espèce humaine serait perdu, si cette science funeste venait à se répandre. »
« Tenons-nous-en à la bonne et inoffensive éducation classique. Bourrons nos jeunes gens de grec et de latin. Quand ils scanderaient sur le bout de leurs doigts, du matin au soir, les hexamètres des Bucoliques, quel mal cela peut-il nous faire ? Laissons-les vivre avec la société romaine, avec les Gracques et Brutus, au sein d’un sénat où l’on parle toujours de guerre, et au Forum où il est toujours question de butin ; laissons-les s’imprégner de la douce philosophie d’Horace :
Tra la la la, notre jeunesse,
Tra la la la, se forme là.
« Qu’est-il besoin de leur apprendre les lois du travail et de l’échange ? Rome leur enseigne à mépriser le travail, servile opus, et à ne reconnaître comme légitime d’autre échange que le væ victis du guerrier possesseur d’esclaves. C’est ainsi que nous aurons une jeunesse bien préparée pour la vie de notre moderne société. — Il y a bien quelques petits dangers. Elle sera quelque peu républicaine ; aura d’étranges idées sur la liberté et la propriété ; dans son admiration aveugle pour la force brutale, on la trouvera peut-être un peu disposée à chercher noise à toute l’Europe et à traiter les questions de politique, dans la rue, à coups de pavés. C’est inévitable, et, franchement, monsieur le ministre, grâce à Tite-Live, nous avons tous plus ou moins barboté dans cette ornière. Après tout, ce sont là des dangers dont vous aurez facilement raison avec quelques bons gendarmes. Mais quelle gendarmerie pouvez-vous opposer aux idées subversives des économistes, de ces audacieux qui ont écrit, en tête de leur programme, cette atroce définition de la propriété : Quand, un homme a produit une chose à la sueur de son front, puisqu’il a le droit de la consommer, il a celui de la troquer [4] ? »
« Non, non, avec de telles gens, c’est peine perdue que de recourir à la réfutation. »
« Vite un bâillon, deux bâillons, trois bâillons ! »
FN:Trois ans avant la manifestation qui provoqua le pamphlet précédent, la destitution des professeurs, la suppression des chaires d’économie politique avaient été formellement demandées par les membres du comité Mimerel, qui bientôt se radoucirent et se bornèrent à prétendre que la théorie de la Protection devait être enseignée en même temps que celle de la Liberté.
Ce fut avec l’arme de l’ironie que Bastiat, dans le n° du 13 juin 1847 du journal le Libre-Échange, combattit cette prétention qui se produisait alors pour la première fois.
(Note de l’éditeur.)
FN:Ici se montre le germe de Baccalauréat et Socialisme, qu’on verra plus apparent encore dans les pages qui suivent. Voy. ce pamphlet au tome IV. (Note de l’éditeur.)
FN:M. Whateley, archevêque de Dublin, qui a fondé dans cette ville une chaire d’économie politique, a exercé le professorat à Oxford. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome II, la déclaration de principes de la société du Libre-Échange. (Note de l’éditeur.)
Discours à la salle Duphot [13 juin 1847] ↩
BWV
1847.06.13 “Discours à la salle Duphot” (Speech given in the Duphot Hall) [*Libre-Échange*, 13 juin 1847] [OC7.37, 170]
Discours à la salle Duphot [1]
Messieurs,
Je regrette que, dans son excessive indulgence, notre digne président ait cru devoir m’introduire auprès de vous sous une forme qui vous fera peut-être attendre de moi un discours brillant. Mon intention est simplement de vous soumettre quelques réflexions à l’occasion des comptes qui viennent de vous être présentés, et qui me semblent féconds en utiles enseignements.
Dans une position analogue à celle où se trouvent le conseil et celui qui parle maintenant en son nom, il est de tradition de faire grand étalage des succès obtenus, et de montrer l’avenir sous les couleurs les plus flatteuses. Je ne saurais suivre cet exemple, et je parlerai avec une entière franchise de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, de nos difficultés et de nos espérances. D’ailleurs, le seul fait que le conseil vient vous exposer un compte financier qui n’a rien de brillant, vous prouve qu’il est décidé à agir toujours avec la plus parfaite sincérité.
Vous l’avez vu, les recettes se sont élevées, pour Paris, à 25,000 francs. Pardonnez-moi ce trait de statistique ; sur une population d’un million d’habitants, c’est 2 c. 1/2 par personne. Certes, si nous venons à nous rappeler que nous sommes ici dans la ville la plus intéressée qu’il y ait au monde à la liberté commerciale, celle que le génie de ses habitants met au-dessus de toute rivalité étrangère, celle qui a tout à gagner en richesse et en influence intellectuelle à la libre communication des peuples, celle qui s’épuise en efforts inouïs pour jeter vers nos frontières des lignes de fer qui n’y doivent rencontrer que la barrière de la prohibition, la ville enfin qui a été, en Europe, le berceau de toutes les libertés, on peut s’étonner à bon droit que sa sympathie pour la liberté d’échanger ne se soit manifestée que par une coopération aussi modique.
Mais si la liste de nos souscripteurs n’est pas très longue, elle présente des noms bien faits pour relever notre confiance. Elle vous a été lue. Je n’y reviendrai pas. Je dirai seulement que notre seconde liste, ouverte le 10 mai, présente déjà des adhésions nouvelles et importantes.
Le compte des dépenses n’est pas moins instructif. Elles s’élèvent en tout à 18,000 francs ; savoir : 9,000 pour le journal, et 9,000 pour tout le reste.
Le premier acte de toute œuvre de propagande est la fondation d’un journal. Un journal, c’est la vie, la pensée, le lien, l’organe de toute association. Quelle que fût l’importance des autres moyens que nous aurions désiré mettre en œuvre, nous devions les subordonner tous aux ressources qui nous resteraient après que l’existence de notre journal serait assurée. Or, vous le savez, Messieurs, le cautionnement, le timbre, la poste rendent ces entreprises difficiles. Rien n’est devenu plus hasardeux en France que la fondation d’un journal depuis l’invention de la presse à bon marché, depuis qu’elle est constituée sur ce singulier cercle vicieux : Voulez-vous des abonnés, ayez préalablement des annonces ; voulez-vous des annonces, ayez préalablement des abonnés. Aussi, même en y consacrant la moitié de nos ressources, nous n’aurions pu venir à bout de cette œuvre sans le concours efficace de Bordeaux, Marseille et Lyon.
C’est donc 9,000 francs qui nous sont restés pour faire face à tous nos autres moyens de propagande. De cette somme, veuillez déduire par la pensée les frais accessoires, achat de mobilier, loyer, appointements, frais de bureau, et si vous vous rappelez que nos travaux remontent au mois de mars 1846, vous reconnaîtrez que nous avons dû nous trouver bien limités dans notre action.
Aussi, Messieurs, nous avouons sincèrement que nous n’avons pas fait tout ce que les amis de la liberté commerciale pouvaient attendre de nous. Mais, en tenant compte de l’obstacle dont je viens de parler, et de bien d’autres encore qui se sont rencontrés sur notre route, est-il exact de dire que rien n’a été fait ?
Dans l’espace d’un an, une vaste association s’est fondée. Si elle ne s’est pas manifestée au dehors par une action aussi énergique qu’on aurait pu le désirer, elle a du moins achevé tout le travail de son organisation intérieure. Disséminée dans de grands centres de population fort éloignés les uns des autres, Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, elle a ramené toutes ces sociétés affiliées à une action uniforme et concentré en partie leurs ressources dans un but commun.
Nous nous sommes mis d’accord sur notre déclaration de principe. C’est par là qu’il fallait débuter, car une association ne vit que par son principe. Cette première manifestation n’avait rien de difficile.
Il l’était davantage de formuler l’application du principe à toutes les questions spéciales, car, en voulant, en définitive, la même chose, on diffère souvent sur la durée et le mode de la transition, l’ordre et la priorité des réformes. Nous nous sommes mis d’accord sur tous ces points délicats, et si cette discussion a absorbé une portion notable de notre temps, nous avons enfin un programme que nous pouvons montrer à nos amis et à nos ennemis.
Nous avons réussi à faire accueillir par la population l’exposition publique de nos doctrines. C’était un essai que beaucoup de personnes jugeaient hasardeux. Sept séances ont attiré de plus en plus d’auditeurs à la salle Montesquieu. Nous pouvons donc dire que cet important essai a complétement réussi. En m’exprimant ainsi, je ne fais pas allusion au mérite qui a pu se déployer sur l’estrade. Il ne m’appartient pas de le juger. Je veux parler de ce qui est bien plus important à mes yeux, de cette attention soutenue, de ce sentiment exquis des convenances qui se sont constamment manifestés dans l’auditoire, et qui font du public parisien le premier public du monde.
Cet exemple portera ses fruits en province ; et il est bien acquis maintenant que nous pourrons, sans compromettre le principe de l’association en France, continuer et développer ce moyen de propagande.
Enfin, nous avons établi un journal que les quatre associations sont résolues à maintenir.
Messieurs, fonder quatre associations, toutes pourvues d’une bonne organisation, toutes liées entre elles par le même principe et par une étroite sympathie, s’accorder sur l’exposition de la doctrine et sur la marche pratique des réformes à demander, faire une heureuse expérience de l’enseignement public, établir un journal hebdomadaire, n’est-ce rien pour une première année ?
On demande : Où sont les résultats ? Et quand nous n’aurions d’autres résultats à vous présenter que de nous être préparés à en recueillir, pourrions-nous être accusés d’avoir perdu notre temps ? Nous avons à faire une longue et difficile navigation. Le vaisseau est construit, appareillé, monté d’un bon équipage, il est prêt à faire voile ; il n’attend plus qu’un peu de brise ; elle ne lui manquera pas. (Bien ! bien !)
Mais je vais plus loin, et j’affirme que des résultats ont été déjà obtenus.
Le premier de tous a été de soulever l’opposition des intérêts qui exploitent ou s’imaginent exploiter la protection. Ces intérêts ont fait tout ce qu’ils pouvaient faire ; ils ont épuisé tous leurs sophismes, dépensé toutes leurs munitions. Associations, cotisations, pétitions, écrits, menaces, nos adversaires ont tout mis en œuvre, et à quoi ont-ils abouti ? Remarquez bien ceci : Il y a deux ans, ils dominaient le présent et se croyaient maîtres de l’avenir. Aujourd’hui ils sont partout sur la défensive. Alors, ils n’avaient que cette question à se faire : Quelle nouvelle restriction allons-nous imposer au public ? Maintenant ils se demandent : Quelle restriction pouvons-nous sauver du naufrage ?
N’est-ce rien, Messieurs, que d’avoir ainsi déplacé le terrain de la discussion ? d’avoir organisé la partie de telle sorte que ce n’est plus désormais une liberté, mais une restriction qui en fera l’enjeu.
Et permettez-moi de rappeler ce que je disais, il y a quinze mois, à Bordeaux, à une époque où des mesures récentes sur le sésame et les tissus de lin donnaient peut-être quelque valeur à la prédiction : on était au moment d’ouvrir la souscription qui devait décider du sort de l’Association. « Dans deux heures, disais-je, nous saurons si le mouvement ascensionnel de la protection est arrêté ; si l’arbre du monopole a fini sa croissance. Oui, que Bordeaux fasse aujourd’hui son devoir, — et il le fera, — je défie tous les prohibilionistes, et tous leurs comités, et tous leurs journaux, de faire désormais hausser le chiffre des tarifs d’une obole ! »
Eh bien ! Messieurs, qu’est-il arrivé ? Comparez la loi de douanes actuellement soumise aux Chambres, toute timide, toute mesquine qu’elle est, aux mesures sanctionnées jusqu’ici par la législature. N’êtes-vous pas frappés de ce fait, que le régime protecteur non seulement n’avance plus, mais recule ? (C’est vrai !)
Un autre résultat que nous avons obtenu, et il est considérable, c’est qu’aujourd’hui on peut prononcer le mot Liberté du commerce. On oublie vite en France. Rappelons-nous néanmoins qu’il y a quelque temps ce mot aurait attiré sur le député, assez malheureux pour s’en servir, un torrent d’invectives. Les protectionistes, voulant dépopulariser la chose, avaient été assez habiles pour dépopulariser le nom. Un homme très haut placé, un pair de France, ancien ministre, sincère ami du libre-échange, me disait, il y a quelque temps : « Je ne combats jamais le monopole de front, je lui emprunte ses arguments. Le seul moyen de mater un nouveau privilége, c’est de montrer qu’il compromet un privilége ancien. Invoquer la liberté par le temps qui court, c’est la compromettre ! » Grâce au ciel, ces ruses ne sont pas aujourd’hui nécessaires, et l’on peut, avec un peu de courage, avoir raison sans rougir. J’avoue qu’il est assez triste d’avoir à présenter ce résultat comme un succès.
Nous en avons obtenu un autre bien propre à nous donner des espérances, c’est de fournir à une foule d’hommes éclairés, disséminés sur toute la surface du royaume, l’occasion de se faire connaître et d’entrer bravement dans la lutte. M. Duchevalard à Montbrison, M. Avril à Nevers, M. Godineau à la Rochelle, M. Duvergé à Limoges, M. Darthez à Pau, M. Dufrayer à Mont-de-Marsan, M. d’Haqueville à Lisieux, et bien d’autres encore, ont déjà exercé autour d’eux une influence qui est de bon augure. Ce sont là de précieux auxiliaires, et ils nous font pressentir qu’à la fin de cette campagne, l’Association, au lieu de quatre comités en province, en comptera douze.
Quelques personnes s’effrayent de l’espèce d’unanimité avec laquelle les sociétés d’agriculture, sur la provocation de nos adversaires, se sont prononcées contre nous ; mais qu’on veuille bien remarquer une chose : ce qu’elles paraissent redouter surtout, ce n’est pas la réforme, mais la réforme instantanée. Au fait, après s’être élevées contre la liberté du commerce, toutes concluent à des abaissements graduels du tarif.
Enfin, Messieurs, nous pouvons affirmer, sans trop de présomption, que notre entreprise a éveillé quelque sympathie chez les nations voisines. Des sociétés de Libre-Échange se sont fondées en Espagne, en Italie, en Belgique, en Prusse. Sans doute, les idées favorables à la libre communication des peuples existaient dans ces pays ; mais peut- être notre exemple a-t-il contribué à les mettre en action. Nous savons bien que ce qui s’est passé en Angleterre a eu une grande influence, et cependant nous avons ici une preuve de plus que c’est toujours la France qui a le noble privilége de rendre les questions européennes, et nous avons lu dans un manifeste italien ces propres paroles : « La Ligue anglaise a soulevé une question anglaise ; elle a combattu un obstacle anglais, les corn-laws. L’Association française aura la gloire d’avoir posé la question universelle, la question de principe, dans son titre même, le Libre-Échange. » (Applaudissements prolongés.)
Notre président vient de vous dire que l’Association belge a conçu la pensée de réunir, à Bruxelles, un congrès économique, où cette grande question sera traitée dans une assemblée composée d’hommes de toutes les nations.
Français, Anglais, Belge, Russe, Germain.
Oh ! ce sera un grand et magnifique spectacle que celui d’hommes venus de tous les points du globe pour discuter paisiblement l’utilité et l’opportunité de renverser, par la seule puissance de l’esprit public, les barrières qui les séparent. Et il me semble que ce qui doit sortir de là, c’est la réalisation de ce vœu national, exprimé, il y a déjà longtemps, par le grand interprète de la pensée française :
Peuples, formez une sainte alliance,
Et donnez-vous la main.
(Bravo.)
Mais si quelque chose a été fait, il reste certainement beaucoup plus à faire.
Quand on entreprend de réaliser un grand changement dans une des branches de la législation du pays, non par la force, mais par la conviction publique, on se soumet à traverser quatre phases :
La première est celle de l’organisation. Il est indispensable de constituer d’abord l’Association qui doit donner le mouvement. Tel a été le travail de notre première campagne.
La seconde est celle de la propagande. Il faut bien former cette conviction publique dont on entend faire son seul instrument de succès. Et, dans cette période, tous les soins de l’Association doivent tendre à perfectionner et propager son organe. Son mot d’ordre doit être : Aux abonnements ! aux abonnements ! Il n’est pas un de nos collègues qui ne doive s’imposer le devoir de décider à s’abonner tous ceux de ses amis dont les opinions sont encore incertaines.
À mesure que la conviction se forme dans le pays, il faut l’amener à manifester ses progrès, en exerçant une pression de plus en plus forte sur la législature. Le mot d’ordre de cette période est : Aux pétitions ! aux pétitions !
Enfin, si la législature résiste, il faut se servir du changement de l’opinion publique pour changer par elle la législature elle-même, et alors le mot d’ordre est : Aux élections ! aux élections !
Et n’oublions pas que, si notre mot d’ordre peut varier à chaque période de notre agitation, il en est un qui doit toujours dominer, c’est celui-ci : Aux souscriptions ! aux souscriptions ! (Très bien !)
Sans doute. Messieurs, nous ne renonçons pas à user d’ores et déjà et simultanément de ces trois moyens d’action. Nous ferons des pétitions quand cela sera nécessaire, et nous interviendrons dans les élections toutes les fois que nous pourrons le faire avec avantage. (Adhésion.)
Mais ne l’oublions pas, l’œuvre spéciale de la prochaine campagne, et peut-être de plusieurs années, c’est la propagande. Animer les convictions sympathiques, raffermir les convictions chancelantes, ramener les convictions hostiles, parler, écrire, discuter, donner une grande publicité à tous les travaux de mérite qui surgiront, soit dans la capitale, soit dans les provinces, spécialement à ceux qui se distingueront par la verve et la clarté, organiser des comités dans les départements, correspondre avec eux, les visiter ; telle est pendant longtemps notre laborieuse mission.
Associez-vous énergiquement à cette tâche, Messieurs, et soyons bien convaincus d’une chose, c’est que, s’il est un pays, une ville, appelés plus que tous autres à recueillir en bien-être, en influence morale et politique, les fruits de la libre circulation des produits et des idées, cette ville c’est Paris, ce pays c’est la France. (Applaudissements.)
FN: Libre-Échange du 13 juin 1847.(Note de l’éd.)
L'impôt du sel [20 Juin 1847] ↩
BWV
1846.06.20 "L'impôt du sel" (The Salt Tax) [*Libre-Échange*, 20 June 1847] [OC2.41, pp. 225-28]
L’impôt du sel
20 Juin 1847
Pour la seconde fois, la réduction de l’impôt sur le sel a été votée par la Chambre des députés à la presque unanimité ; ce qui n’aura d’autre conséquence, à ce qu’il paraît, que de déterminer le ministère à mettre la question à l’étude pour l’année prochaine.
Parmi les arguments dont on s’est servi dans le débat, il en est un qui revient à propos de toute réduction de taxes et particulièrement au sujet des droits de douane. Par ce motif, nous croyons utile de rectifier les idées qui ont été émises à ce sujet.
Les députés qui ont soutenu la proposition de M. Demesmay ont cru devoir prédire un accroissement de consommation, d’où ils concluaient que le déficit du Trésor serait bientôt à peu près comblé.
Ceux qui repoussaient la mesure assuraient, au contraire, que la consommation du sel, en ce qui concerne l’emploi qui en est fait directement par l’homme, était aujourd’hui tout ce qu’elle peut être ; qu’elle ne serait point modifiée par la réduction de la taxe, ni même alors que le sel serait gratuit ; d’où la conséquence que le déficit du Trésor serait exactement proportionnel à la diminution de l’impôt.
Sur quoi, nous croyons devoir examiner rapidement et d’une manière générale cette question :
« Une diminution dans la taxe, et par conséquent dans le prix vénal de l’objet taxé, entraîne-t-elle nécessairement un accroissement de consommation ? »
Il est certain que ce phénomène s’est produit si souvent, qu’on pourrait presque le considérer comme une loi générale.
Cependant, il y a une distinction à faire.
Si l’objet que frappe la taxe est d’une nécessité telle que ce soit une des dernières choses dont l’homme consente à se passer, la consommation, quelle que soit la taxe, sera toujours tout ce qu’elle peut être. Alors, à mesure que l’impôt en élève le prix, il arrive qu’on se prive de toute autre chose, mais non de l’objet supposé nécessaire. De même, si le prix baisse par suite d’une réduction d’impôt, ce n’est pas la consommation de cet objet qui augmentera, mais celle des choses dont on avait été forcé de se priver pour ne pas manquer de l’objet indispensable.
Il faut à l’homme, pour respirer, une certaine quantité d’air. Supposons qu’on parvienne à le frapper d’une taxe élevée : l’homme fera évidemment tous ses efforts pour continuer à avoir la quantité d’air sans laquelle il ne pourrait vivre ; il renoncera à ses outils, à ses vêtements et même à ses aliments, avant de renoncer à l’air ; et si l’on vient à diminuer cette odieuse taxe, ce n’est pas la consommation de l’air qui augmentera, mais celle des vêtements, des outils, des aliments [1].
Il nous semble donc que ceux de MM. les députés qui ont repoussé la réduction de l’impôt du sel, en se fondant sur ce que la consommation, malgré la taxe, est tout ce qu’elle peut être, ont, sans s’en douter, produit le plus fort argument qu’on puisse imaginer contre l’exagération de cet impôt. C’est comme s’ils avaient dit : « Le sel est une chose si indispensable à la vie, que, dans tous les rangs, dans toutes les classes, on en consomme toujours, et quel qu’en soit le prix, une quantité déterminée et invariable. Maintenez-le à un prix élevé, n’importe ; l’ouvrier se vêtira de haillons, il se passera de remèdes dans la maladie, il se privera de vin et même de pain plutôt que de renoncer à une portion quelconque du sel qui lui est nécessaire. Diminuez-en le prix, on verra l’ouvrier se mieux vêtir, se mieux nourrir, mais non consommer plus de sel. »
Il est donc impossible d’échapper à ce dilemme :
Ou la consommation du sel augmentera par suite de la réduction du prix ; en ce cas, le trésor n’aura point à subir la perte annoncée ;
Ou elle n’augmentera pas ; et alors, cela prouve que le sel est un objet tellement nécessaire à la vie, que la taxe la plus exagérée n’a pu déterminer les hommes, même les plus pauvres, à en retrancher de leur consommation une quantité quelconque.
Et quant à nous, nous ne pouvons imaginer contre cet impôt un argument plus décisif.
Il est vrai que les besoins du Trésor sont toujours là, comme une fin de non-recevoir insurmontable. Qu’est-ce que cela prouve ? hélas ! une chose bien simple, quoiqu’elle paraisse peu comprise. C’est que, si l’on veut voter ces réductions d’impôts, il ne faut pas commencer par voter sans cesse des accroissements de dépenses. Combien de temps doit durer l’éducation constitutionnelle d’un peuple pour qu’il arrive enfin à la découverte ou du moins à l’application de cette triviale vérité ? C’est un problème qu’il n’est pas aisé de résoudre.
Modérez l’excès des travaux publics, s’est écrié M. Dupin aîné qui, du reste, nous semble avoir donné à tout ce débat sa véritable direction. Nous répéterons ce mot avec une légère variante. Modérez l’excès des services publics, ne laissez à l’État que ses attributions véritables ; alors il sera facile de diminuer les dépenses et par conséquent les impôts [2].
FN: L’accroissement de consommation, par ricochet, est infaillible ici et ne nuit à personne. Il en est tout autrement de ces effets vantés par l’école protectionniste, à l’égard desquels l’auteur a dit : Quand MM. les protectionnistes le voudront, ils me trouveront prêt à examiner le sophisme des ricochets. V. au tome V, la note 2 de la page 13 ; et de plus, au tome IV, les pages 176 à 182. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome V, page 407, le Budget républicain ; et page 468, le Discours sur l’impôt des boissons. (Note de l’éditeur.)
L’Économie politique des généraux [The Political Economy of the Generals] [20 June 1847] [CW3 ES3.8]↩
BWV
1847.06.20 “L'économie politique des généraux” (The Political Economy of the Generals) [*Libre-Échange*, 20 June 1847] [OC2.52, pp. 355-58] [CW3] [ES3.8]
Lorsque, au sein du Parlement, il arrive à un financier, s’aventurant dans la science de Jomini, de faire manœuvrer des escadrons, il se peut qu’il attire le sourire sur les lèvres de MM. les généraux. Il n’est pas surprenant non plus que MM. les généraux fassent quelquefois de l’économie politique peu intelligible pour les hommes qui se sont occupés de cette branche des connaissances humaines.
Il y a cependant cette différence entre la stratégie et l’économie politique. L’une est une science spéciale ; il suffit que les militaires la sachent. L’autre, comme la morale, comme l’hygiène, est une science générale, sur laquelle il est à désirer que chacun ait des idées justes. (V. tome IV, page 122.)
Le général Lamoricière, dans un discours auquel, sous d’autres rapports, nous rendrons pleinement justice, a émis une théorie des débouchés que nous ne pouvons laisser passer sans commentaires.
« Au point de vue de l’économie politique pure, a dit l’honorable général, les débouchés sont quelque chose : dans le temps qui court, on dépense de l’argent et même des hommes pour conserver ou pour conquérir des débouchés. Or, dans la situation de la France sur le marché du monde, n’est-ce donc pas quelque chose pour elle qu’un débouché de 63 millions de produits français ? La France envoie en Afrique pour 17 millions de colons tissés, 7 ou 8 millions de vins, etc. »
Il n’est que trop vrai que, dans le temps qui court, on dépense de l’argent et même des hommes pour conquérir des débouchés ; mais, nous en demandons pardon au général Lamoricière, loin que ce soit au nom de l’économie politique pure, c’est au nom de la mauvaise et très-mauvaise économie politique. Un débouché, c’est-à-dire une vente au dehors, n’a de mérite qu’autant qu’elle couvre tous les frais qu’elle entraîne ; et si, pour la réaliser, il faut avoir recours à l’argent des contribuables, encore que l’industrie que cette vente concerne puisse s’en féliciter, la nation en masse subit une perte quelquefois considérable, sans parler de l’immoralité du procédé et du sang plus qu’inutilement répandu.
C’est bien pis encore quand, pour nous créer de prétendus débouchés, nous envoyons au dehors et l’homme qui doit acheter nos produits, et l’argent avec lequel il doit les payer. Nous ne mettons pas en doute que les fonctionnaires algériens, français ou arabes, à qui on expédie de Paris et aux dépens des contribuables, leurs traitements mensuels, n’en consacrent une faible partie à acheter des cotons et des vins de France. Il paraît que sur 130 millions que nous dépensons en Afrique, 60 millions reçoivent cette destination. L’ économie politique pure enseigne que, si les choses devaient persévérer sur ce pied, voici quel serait le résultat : Nous arrachons un Français à des occupations utiles ; nous lui donnons 130 francs pour vivre. Sur ces 130 francs il nous en rend 60 en échange de produits qui valent exactement cette somme. Total de la perte : 70 francs en argent, 60 francs en produits, et tout ce que le travail de cet homme aurait pu créer en France pendant une année.
Donc, quelque opinion que l’on se fasse de l’utilité de notre conquête en Afrique (question qui n’est pas de notre ressort), il est certain que ce n’est pas par ces débouchés illusoires qu’on peut apprécier cette utilité, mais par la prospérité future de notre colonie. [117]
Aussi, un autre général, M. de Trézel, ministre de la guerre, a-l-il cru devoir présenter, comme compensation à nos sacrifices, non les débouchés présents, mais les produits futurs de l’Algérie. Malheureusement, il nous est impossible de ne pas apercevoir une autre erreur économique dans l’arrière-plan du brillant tableau exhibé par M. le Ministre aux yeux de la Chambre.
Il s’est exprimé ainsi :
« Sa bonne fortune a donné l’Afrique au pays, et certainement nous ne laisserons pas échapper par légèreté, par paresse, ou par la crainte de dépenser de l’argent et des hommes même, un pays qui doit nous donner 200 lieues de côtes sur la Méditerranée, à trente-six heures de notre littoral, qui doit nous donner des productions pour lesquelles nous payons énormément d’argent aux pays voisins.
Ainsi, sans compter les céréales qui autrefois, comme je l’ai déjà dit, ont nourri Rome, l’Afrique nous donne l’olivier qui est une production spéciale de ce pays. Elle nous donne l’huile pour laquelle nous payons 60 millions par année à l’étranger. Nous avons en Afrique le riz et la soie qui s’achètent encore hors de France, parce la France n’en produit pas. Noms avons le tabac. Calculez combien de millions nous payons pour ce produit à l’étranger. Il est certain qu’avant peu d’années, avant vingt-cinq ans peut-être, nous aurons tiré tous ces produits-là de l’Afrique, et nous pourrons considérer alors l’Afrique comme une de nos provinces. »
Ce qui domine dans ce passage, c’est l’idée que la France perd intégralement valeur des objets qu’elle importe de l’étranger. Or, elle ne les importe que parce qu’elle trouve du profit à produire cette même valeur sous la forme des objets qu’elle donne en échange, exactement comme M. de Trézel utilise mieux son temps dans ses travaux administratifs que s’il le passait à coudre ses habits. C’est sur cette erreur qu’est fondé tout le régime restrictif.
D’un autre côté, on nous présente comme un gain national le blé, l’huile, la soie, le tabac que nous fournira, dans vingt-cinq ans, la terre d’Afrique. — Cela dépend de ce que ces choses coûteront, y compris, outre les frais de production, ceux de conquête et de défense. Il est évident que si, avec ces mêmes sommes, nous pouvions produire ces mêmes choses en France, ou, ce qui revient au même, de quoi les achètera l’étranger, et réaliser encore une économie, ce serait une mauvaise spéculation que d’aller les produire en Barbarie, Ceci soit dit en dehors de tous les autres points de vue de l’immense question algérienne. Quelle que soit l’importance, et, si l’on veut, la supériorité des considérations tirées d’un ordre plus élevé, ce n’est pas une raison pour se tromper sous le rapport de l’économie politique pure.
Du Communisme [27 Juin 1847] ↩
BWV
1847.06.27 “Du Communisme” (On Communism) [*Libre-Échange*, 27 Juin 1847] [OC2.22, p. 116]
Du Communisme
27 Juin 1847
Les préjugés économiques ne sont peut-être pas le plus grand obstacle que rencontrera la liberté commerciale. Entre hommes qui diffèrent d’opinion sur un point, à la vérité fort important, d’économie politique, la discussion est possible, et la vérité finit toujours par jaillir de la discussion.
Mais il est des systèmes si complétement étrangers à toutes les notions reçues, qu’entre eux et la science il ne se trouve pas un terrain commun qui puisse servir de point de départ au débat.
Tel est le communisme, tels sont les systèmes qui n’admettent pas la propriété, et ceux qui reposent sur celle donnée : que la société est un arrangement artificiel imaginé et imposé par un homme qu’on appelle législateur, fondateur des États, père des nations, etc.
Sur ces systèmes, l’observation des faits et l’expérience du passé n’ont pas de prise. L’inventeur s’enferme dans son cabinet, ferme les rideaux des croisées et donne libre carrière à son imagination. Il commence par admettre que tous les hommes, sans exception, s’empresseront de se soumettre à la combinaison sociale qui sortira de son cerveau, et, ce point admis, rien ne l’arrête. On conçoit que le nombre de ces combinaisons doit être égal au nombre des inventeurs, tot capita, tot senus. On conçoit encore qu’elles doivent présenter entre elles des différences infinies.
Elles ont cependant un point commun. Comme toutes supposent l’acquiescement universel, toutes visent aussi à réaliser la perfection idéale. Elles promettent à tous les hommes, sans distinction, un lot égal de richesses, de bonheur et même de force et de santé. Il est donc assez naturel que les hommes, qui ont bu à la coupe de ces rêves illusoires, repoussent les réformes partielles et successives, dédaignent cette action incessante que la société exerce sur elle-même pour se délivrer de ses erreurs et de ses maux. Rien ne peut les contenter de ce qui laisse aux générations futures quelque chose à faire.
Notre époque est fertile en inventions de ce genre. Chaque matin en voit éclore, chaque soir en voit mourir. Elles sont trop irréalisables pour être dangereuses en elles-mêmes ; leur plus grand tort est de détourner des saines études sociales une somme énorme d’intelligences.
Pourtant, parmi ces systèmes, il en est un qui menace véritablement l’ordre social, car il est d’une grande simplicité apparente, et, à cause de cette simplicité même, il envahit les esprits dans les classes que le travail manuel détourne de la méditation ; nous voulons parler du communisme [1].
On voit des hommes qui ont du superflu, d’autres qui n’ont pas le nécessaire, et l’on dit : « Si l’on mettait toutes ces richesses en commun, tout le monde serait heureux. » Quoi de plus simple et de plus séduisant, surtout pour ceux qu’affligent des privations réelles ; et c’est le grand nombre ?
Ce n’est pas notre intention de réfuter ici ce système, de montrer qu’il paralyserait complétement dans l’homme le mobile qui le détermine au travail, et tarirait ainsi pour tous la source du bien-être et du progrès ; mais nous croyons devoir prendre acte de la réfutation décisive qui en a été faite, dans le dernier numéro de l’Atelier par de hommes qui appartiennent aux classes ouvrières.
C’est certainement un symptôme consolant de voir des systèmes subversifs repoussés et anéantis, avec une grande force de logique, par des hommes que le sort a placés dans une position telle qu’ils seraient plus excusables que d’autres s’ils s’en laissaient séduire. Cela prouve non-seulement leur sincérité, mais encore que l’intelligence, quand on l’exerce, ne perd jamais le noble privilége de tendre vers la vérité. Pour beaucoup de gens, le communisme n’est pas seulement une doctrine, c’est encore et surtout un moyen d’irriter et de remuer les classes souffrantes. En lisant l’article auquel nous faisons allusion, nous ne pouvions nous empêcher de nous rappeler avoir entendu un fougueux démocrate, appartenant à ce qu’on nomme la classe élevée, dire : « Je ne crois pas au communisme, mais je le prêche parce que c’est le levier qui soulèvera les masses. » Quel contraste !
Une chose nous surprend de la part des rédacteurs de l’Atelier, c’est de les voir s’éloigner de plus en plus de la doctrine de la liberté en matière d’échanges.
Ils repoussent le communisme, donc ils admettent la propriété et la libre disposition de la propriété, qui constitue la propriété elle-même. Ce n’est pas posséder que de ne pouvoir troquer ce qu’on possède. L’Atelier le dit en ces termes :
« Ce que nous prétendons, c’est que la liberté veut et la possession individuelle et la concurrence. Il est absolument impossible de sacrifier ces deux conditions de la liberté sans sacrifier la liberté même. »
Il est vrai que l’Atelier ajoute :
« Mais est-il possible de limiter les droits de la propriété ? Est-il quelque institution qui puisse ôter à la propriété les facultés abusives qu’elle a aujourd’hui ? Nous le croyons, nous sommes certains de cette possibilité, comme aussi nous sommes convaincus que la concurrence peut être disciplinée et ramenée à des termes tels qu’elle ait beaucoup plus le caractère de l’émulation que celui de la lutte. »
Dans ce cercle, il nous semble que l’Atelier et le Libre-Échange ne sont pas loin de s’entendre, et que ce qui les divise, c’est plutôt des questions d’application que des questions de principe.
Nous croyons devoir soumettre à ce journal les réflexions suivantes :
On peut abuser de tout et même des meilleures choses, de la propriété, de la liberté, de la philanthropie, de la charité, de la religion, de la presse, de la parole.
Nous croyons que le gouvernement ou la force collective est institué principalement, et presque exclusivement, pour prévenir et réprimer les abus.
Nous disons presque exclusivement, parce que c’est du moins là sa tâche principale, et il la remplirait d’autant mieux, sans doute, qu’il serait débarrassé d’une foule d’autres attributions, lesquelles peuvent être abandonnées à l’activité privée.
Quand nous parlons de propriété, de liberté, nous n’en voulons pas plus que l’Atelier les abus, et comme lui nous reconnaissons en principe à la force collective le droit et le devoir de les prévenir et de les réprimer.
D’un autre côté, l’Atelier voudra bien reconnaître qu’en fait les mesures répressives, et plus encore les mesures préventives, sont inséparables de dépenses, d’impôts, d’une certaine dose de vexations, de dérangements, d’arbitraire même, et qu’après tout la force publique n’acquiert pas certains développements sans devenir elle-même un danger.
Dans chaque cas particulier, il y a donc ce calcul à faire : les inconvénients inséparables des mesures préventives et répressives sont-ils plus grands que les inconvénients de l’abus qu’il s’agit de prévenir ou de réprimer ?
Ceci ne touche pas au droit de la communauté agissant collectivement, c’est une question d’opportunité, de convenance et non de principe. Elle se résout par la statistique et l’expérience et non par la théorie du droit.
Or, il arrive, et c’est sur ce point que nous appelons l’attention du lecteur, qu’il y a beaucoup d’abus qui portent en eux-mêmes, par une admirable dispensation providentielle, une telle force de répression et de prévention, que la prévention et la répression gouvernementales n’y ajoutent presque rien, et ne se manifestent dès lors que par leurs inconvénients.
Telle est, par exemple, la paresse. Certainement, il serait à désirer qu’il n’y eût pas de paresseux au monde. Mais si le Gouvernement voulait extirper ce vice, il serait forcé de pénétrer dans les familles, de surveiller incessamment les actions individuelles, de multiplier à l’infini le nombre de ses agents, d’ouvrir la porte à un arbitraire inévitable ; en sorte que ce qu’il ajouterait à l’activité nationale pourrait bien n’être pas une compensation suffisante des maux sans nombre dont il accablerait les citoyens, y compris ceux qui n’ont pas besoin, pour être laborieux, de cette intervention. (V. Harmonies, chap. xx.)
Et remarquez qu’elle est d’autant moins indispensable qu’il y a, dans le cœur humain , des stimulants , — dans l’enchaînement des causes et des effets, des récompenses pour l’activité, des châtiments pour la paresse, qui agissent avec une force à laquelle l’action du pouvoir n’ajouterait que peu de chose. Ce sont ces stimulants, c’est cette rétribution naturelle dont ne nous paraissent pas tenir assez compte les écoles qui, faisant bon marché de la liberté, veulent tout réformer par l’interférence du Gouvernement.
Ce n’est pas seulement contre les vices dont les conséquences retombent sur ceux qui s’y livrent que la nature a préparé des moyens de prévention et de répression, mais aussi contre les vices qui affectent les personnes qui en sont innocentes. Dans l’ordre social, outre la loi de responsabilité, il y a une loi de solidarité. Les vices de cette catégorie, par exemple la mauvaise foi, ont la propriété d’exciter une forte réaction de la part de ceux qui en souffrent contre ceux qui en sont atteints, réaction qui a certainement une vertu préventive et répressive, toujours exactement proportionnelle au degré de lumière d’un peuple.
Ce n’est point à dire que le Gouvernement ne puisse concourir aussi à punir ces vices, à prévenir ces abus. Tout ce que nous prétendons, et nous ne pensons pas que cela puisse nous être contesté, c’est que cette pression gouvernementale doit s’arrêter et laisser agir les forces naturelles, au point où elle-même a, pour la communauté, plus d’inconvénients que d’avantages.
Nous ajouterons qu’un des inconvénients de la trop grande intervention du pouvoir en ces matières, est de paralyser la réaction des forces naturelles, en affaiblissant les motifs et l’expérience de cette police que la société exerce sur elle-même. Là où les citoyens comptent trop sur les autorités, ils finissent par ne pas assez compter sur eux-mêmes, et la cause la plus efficace du progrès en est certainement neutralisée [2].
Si ces idées se rapprochent de celles que l’Atelier a développées dans l’article que nous avons en vue, nous ne devons pas être peu surpris du ton d’irritation avec lequel il persiste à s’exprimer sur la liberté du commerce et ce qu’il nomme l’école économique anglaise.
L’Atelier est plein de douceur pour les communistes, qu’il vient de combattre et même de terrasser, mais il conserve envers nous les allures les plus hostiles. C’est une inconséquence que nous ne nous chargeons pas d’expliquer, car il est évidemment beaucoup plus loin du communisme que de la liberté du travail et de l’échange. L’Atelier croit la protection plus nécessaire que la liberté à la prospérité nationale. Nous croyons le contraire, et il conviendra du moins que les doctrines sur la propriété et la liberté, qu’il a opposées aux communistes, mettent la présomption de notre côté. Si la propriété est un droit, si la liberté d’en disposer en est la conséquence, la tâche de prouver la supériorité des restrictions, l’onus probandi, incombe exclusivement à celui qui les réclame.
Nous n’abandonnerons pas le sujet du communisme sans adresser quelques réflexions aux classes qui tiennent de notre constitution le pouvoir législatif, c’est-à-dire aux classes riches.
Le communisme, il ne faut pas se le dissimuler, c’est la guerre de ceux qui ne possèdent pas, ou le grand nombre, contre ceux qui possèdent ou le petit nombre. Partant, les idées communistes sont toujours un danger social pour tout le monde, et surtout pour les classes aisées.
Or ces classes ne jettent-elles pas de nouveaux aliments à la flamme communiste quand elles font en leur propre faveur des lois partiales ? Quoi de plus propre que de telles lois à semer l’irritation au sein du peuple, à faire que, dans son esprit, ses souffrances ont leur cause dans une injustice ; à lui suggérer l’idée que la ligne de démarcation entre le pauvre et le riche est l’œuvre d’une volonté perverse, et qu’une aristocratie nouvelle, sous le nom de bourgeoisie, s’est élevée sur les ruines de l’ancienne aristocratie ? De telles lois ne le disposent-elles pas à embrasser les doctrines les plus chimériques, surtout si elles se présentent avec le cachet d’une simplicité trompeuse ; en un mot ne le poussent-elles pas fatalement vers le communisme ?
Contre le communisme, il n’y a que deux préservatifs. L’un, c’est la diffusion au sein des masses des connaissances économiques ; l’autre, c’est la parfaite équité des lois émanées de la bourgeoisie.
Oh ! puisque, dans l’état actuel des choses, nous voyons des ouvriers eux-mêmes se retourner contre le communisme et faire obstacle à ses progrès, combien la bourgeoisie serait forte contre ce dangereux système si elle pouvait dire aux classes laborieuses :
« De quoi vous plaignez-vous ? De ce que nous jouissons de quelque bien-être ; mais nous l’avons acquis par le travail, l’ordre, l’économie, la privation, la persévérance. Pouvez- vous l’attribuer à d’autres causes ? Examinez nos lois. Vous n’en trouverez pas une qui stipule pour nous des faveurs. Le travail y est traité avec la même impartialité que le capital. L’un et l’autre sont soumis, sans restriction, à la loi de la concurrence. Nous n’avons rien fait pour donner à nos produits une valeur artificielle et exagérée. Les transactions sont libres, et si nous pouvons employer des ouvriers étrangers, de votre côté vous avez la faculté d’échanger vos salaires contre des aliments, des vêtements, du combustible, venus du dehors, quand il arrive que nous tenons les nôtres à un taux élevé. »
La bourgeoisie pourrait-elle aujourd’hui tenir ce langage ? Ne l’a-t-on pas vue, il n’y a pas plus de huit jours, décréter, en face d’une disette éventuelle, que les lois qui font obstacle à l’entrée des substances alimentaires animales n’en seraient pas moins maintenues ? Ne l’a-t-on pas vue prendre une telle résolution, sans admettre même le débat, comme si elle avait eu peur de la lumière, là où elle ne pouvait éclairer qu’un acte d’injuste égoïsme ?
La bourgeoisie persévère dans cette voie, parce qu’elle voit le peuple, impatient de beaucoup d’injustices chimériques, méconnaître la véritable injustice qui lui est faite. Pour le moment, les journaux démocratiques, abandonnant la cause sacrée de la liberté, sont parvenus à égarer ses sympathies et à les concilier à des restrictions dont il n’est victime qu’à son insu. Mais la vérité ne perd pas ses droits ; l’erreur est de nature essentiellement éphémère ; et le jour où le peuple ouvrira les yeux n’est peut-être pas éloigné. Pour le repos de notre pays, puisse-t-il n’apercevoir alors qu’une législation équitable [3] !
FN:V. tome IV, page 275, le pamphlet Propriété et Loi, et tome VI, le chapitre Propriété, Communauté. (Note de l’éditeur.)
FN:V. Harmonies, chap. xx et xxi. (Note de l’éditeur.)
FN:V. tome VI , chap. iv. (Note de l’éditeur.)
La taxe unique en Angleterre, proposition de M. Ewart [27 Juin 1847] ↩
BWV
1847.06.27 “La taxe unique en Angleterre, proposition de M. Ewart” (The Single-Tax in England. The Proposal of Mr. Ewart) [*Libre-Échange*, 27 Juin 1847] [OC2.37, p. 209]
La taxe unique en Angleterre
27 Juin 1847
Quelques journaux, intéressés à tourner contre nous les préventions nationales, font remarquer que nous allons souvent chercher des faits et des enseignements de l’autre côté du détroit. Le Moniteur industriel va même jusqu’à nous appeler un journal anglais, insulte dont le bon sens public fera justice.
Nous devons cependant à notre dignité d’expliquer pourquoi nous suivons avec soin le mouvement des esprits et de la législation en Angleterre, sur les matières qui se rattachent au but spécial de cette feuille.
De quelque manière qu’on juge la politique de l’Angleterre et le rôle qu’elle a pris dans le monde, il est impossible de ne pas convenir qu’en tout ce qui concerne le commerce, l’industrie, les finances et les impôts, elle a passé par des expériences que les autres nations peuvent et doivent étudier avec fruit pour elles-mêmes.
Dans aucun pays, les systèmes divers n’ont été mis en pratique avec plus de rigueur. Quand l’Angleterre a voulu protéger sa marine, elle a imaginé un acte de navigation beaucoup plus sévère que toutes les imitations qui en ont été faites ailleurs. Sa loi-céréale est bien autrement restrictive que celle de notre pays, son système colonial bien autrement étendu. Les dépenses publiques y ont pris depuis longtemps un développement prodigieux, et par conséquent toutes les formes imaginables de l’impôt y ont été essayées. Les banques, les caisses d’épargne, la loi des pauvres y sont déjà anciennes.
Il résulte de là que les effets bons ou mauvais de toutes ces mesures ont dû se manifester en Angleterre plus qu’en tout autre pays ; d’abord parce qu’elles y ont été prises d’une manière plus absolue, ensuite, parce qu’elles y ont eu plus de durée.
En outre, le régime représentatif, la discussion, la publicité, l’usage des enquêtes et la statistique y ont constaté les faits plus que dans aucun autre pays.
Aussi, c’est en Angleterre d’abord qu’a dû se produire la réaction de l’opinion publique contre les faux systèmes, contre les dispositions législatives en contradiction avec les lois de l’économie sociale, contre les institutions séduisantes par leurs effets immédiats, mais désastreuses par leurs conséquences éloignées.
Dans ces circonstances, nous croirions manquer à nos devoirs et faire acte de lâcheté si, nous en laissant imposer par la stratégie du Moniteur industriel et du parti protectionniste, nous nous privions d’une source si riche d’informations. On l’a dit avec raison, l’expérience est le plus rigoureux des maîtres ; et si l’exemple des autres peut nous préserver de quelques fautes, pourquoi n’essayerions-nous pas de faire tourner au profit de notre instruction nationale les essais et les épreuves qui se font ailleurs ?
Une tendance bien digne d’être remarquée, c’est la disposition qui se manifeste en Angleterre, depuis quelque temps, à résoudre les questions d’économie politique par des principes. — Ce qui ne veut pas dire que les réformes s’y accomplissent du soir au lendemain, mais qu’elles ont pour but de réaliser d’une manière complète une pensée qu’on juge fondée sur la justice et l’utilité générale.
Tandis qu’il est de tradition, dans d’autres pays, qu’en matière d’impôts, de finances, de commerce, il n’y a pas de principes, qu’il faut se contenter de tâtonner, replâtrer et modifier au jour le jour, en vue de l’effet le plus prochain, il semble que, de l’autre côté du détroit, le parti réformateur admet comme incontestable cette donnée : L’utilité générale se rencontre dans la justice. Dès lors, tout se borne à examiner si une réforme est en harmonie avec la justice ; et ce point une fois admis par l’opinion publique, on y procède vigoureusement sans trop s’embarrasser des inconvénients inhérents à la transition, sachant fort bien qu’il y a, en définitive, plus de biens que de maux à attendre de substituer ce qui est juste à ce qui ne l’est pas.
C’est ainsi qu’a été opérée l’abolition de l’esclavage.
C’est ainsi qu’a été effectuée la réforme postale. Une fois reconnu que les relations d’affections et d’affaires par correspondance n’étaient pas une matière imposable, on a réduit le port des lettres, ainsi que cela découlait du principe, au prix du service rendu.
La même conformité à un principe préside à la réforme commerciale. Ayant bien constaté que la protection est une déception en ce qu’elle ne profite aux uns qu’aux dépens des autres, avec une perte sèche par-dessus le marché pour la communauté, on a posé en principe ces mots : Plus de protection. Ce principe est destiné à entraîner la chute des lois-céréales, celle de l’acte de navigation, celle du système colonial, le bouleversement complet des vieilles traditions politiques et diplomatiques de la Grande-Bretagne. N’importe, il sera poussé jusqu’au bout. (V. tome III, pages 437 à 518.)
Il s’opère en ce moment un travail dans les esprits pour ramener au principe de liberté l’état religieux, l’éducation et la banque. Ces questions ne sont pas mûres encore ; mais on peut être sûr d’une chose, c’est que si, en ces matières, la liberté sort triomphante de la discussion, elle ne tardera pas à être réalisée en fait.
Voici maintenant qu’un membre de la Ligue, M. Ewart, fait au Parlement la motion de convertir tous les impôts en une taxe unique sur la propriété, entendant par ce mot les capitaux de toute nature. C’est la pensée des physiocrates rectifiée, complétée, élargie, rendue praticable.
On s’imagine peut-être qu’une proposition aussi extraordinaire, qui ne tend à rien moins qu’à la suppression absolue de tous les impôts indirects (la douane comprise), a dû être repoussée et considérée par tout le monde, et spécialement par le ministre des finances, comme l’œuvre d’un rêveur, d’un cerveau fêlé, ou tout au moins d’un homme par trop en avant de son siècle. Point du tout. Voici la réponse du chancelier de l’Échiquier :
« Je crois exprimer l’opinion de toute la Chambre, en disant que l’honorable auteur de la motion n’avait nul besoin de parler de la pureté de ses intentions. Aucun de nos collègues n’a moins besoin de se défendre sur ce terrain, tout le monde sachant combien sont toujours désintéressés les motifs qui le font agir ; et certainement, il est impossible d’attacher trop d’importance à la question qu’il vient de soumettre à la Chambre. En même temps j’espère que mon honorable ami ne regardera pas comme un manque de respect de ma part, si je refuse de le suivre dans tous les détails qu’il nous a soumis sur les impôts indirects, sur l’accise, la douane et le timbre. À la session prochaine, ce sera mon devoir de soumettre au Parlement la révision de notre système contributif. Alors il faudra se décider, d’une manière ou d’une autre, sur une des branches les plus importantes du revenu, l’income-tax ; et ce sera le moment d’examiner la convenance de rendre permanente ou même d’étendre cette nature de taxe directe, en tant qu’opposée aux impôts indirects. On comprendra que ce n’est pas le moment de traiter cette question. Je puis néanmoins assurer la Chambre que c’est mon désir le plus ardent d’établir mon régime financier sur les bases les moins oppressives pour les contribuables, les plus propres à laisser prendre au travail, au commerce et à l’industrie tout le développement dont ils sont susceptibles. »
Sans doute, ce qui a pu déterminer le chancelier de l’Échiquier à accueillir avec tant de bienveillance la motion de M. Ewart, c’est le désir de s’assurer pour l’année prochaine le triomphe définitif de l’income-tax, mesure toujours présentée jusqu’ici comme temporaire. Dans tous les pays, les ministres des finances procèdent ainsi à l’égard des nouveaux impôts. C’est un décime de guerre, un income-tax ; c’est ceci ou cela, né des circonstances, et certainement destiné à disparaître avec elles, mais qui, néanmoins, ne disparaît jamais. Il est donc possible que le chancelier de l’Échiquier se soit montré seulement habile et prévoyant au point de vue fiscal. Mais si l’income-tax ne se développe qu’accompagné de suppressions correspondantes dans les impôts indirects, il sera toujours vrai de dire, quelles que soient les intentions, qu’un grand pas aura été fait vers l’avènement de l’impôt unique.
Quoi qu’il en soit, la question est posée ; elle ne tombera pas.
Il n’entre pas dans nos vues de nous prononcer sur une matière aussi grave et encore si controversée. Nous nous bornerons à soumettre à nos lecteurs quelques réflexions.
Voici ce que disent les partisans de la taxe unique :
De quelque manière qu’on s’y prenne, l’impôt retombe toujours à la longue sur le consommateur. Il est donc indifférent pour lui, quant à la quotité, que la taxe soit saisie par le fisc au moment de la production ou au moment de la consommation. Mais le premier système a l’avantage d’exiger moins de frais de perception, et de débarrasser le contribuable d’une foule de vexations qui gênent les mouvements du travail, la circulation des produits et l’activité des transactions. Il faudrait donc faire le recensement de tous les capitaux, terres, usines, chemins de fer, fonds publics, navires, maisons, machines, etc., etc., et prélever une taxe proportionnelle. Comme rien ne peut se faire sans l’intervention du capital, et que le capitaliste fera entrer la taxe dans son prix de revient, il se trouverait en définitive que l’impôt serait disséminé dans la masse ; et toutes les transactions subséquentes, intérieures ou extérieures, à la seule condition d’être honnêtes, jouiraient de la plus entière liberté.
Les défenseurs des taxes indirectes ne manquent pas non plus de bonnes raisons. La principale est que la taxe, dans ce système, se confond tellement avec le prix vénal de l’objet, que le contribuable ne les distingue plus, et qu’on paye l’impôt sans le savoir ; ce qui ne laisse pas que d’être commode, surtout pour le fisc, qui parvient ainsi progressivement à tirer quelque cinq et six francs d’un objet qui ne vaut pas vingt sous [1].
Après tout, si jamais l’impôt unique se réalise, ce ne sera qu’à la suite d’une discussion prolongée ou d’une grande diffusion des connaissances économiques ; car il est subordonné au triomphe d’autres réformes, plus éloignées encore d’obtenir l’assentiment public.
Nous le croyons, par exemple, incompatible avec une administration dispendieuse, et qui, par conséquent, se mêle de beaucoup de choses.
Quand un gouvernement a besoin d’un, deux ou trois milliards, il est réduit à les soutirer du peuple, pour ainsi dire par ruse. Le problème est de prendre aux citoyens la moitié, les deux tiers, les trois quarts de leurs revenus, goutte à goutte, heure par heure, et sans qu’ils y comprennent rien. C’est là le beau côté des impôts indirects. La taxe s’y confond si intimement avec le prix des objets qu’il est absolument impossible de les démêler. Avec la précaution de n’établir d’abord, selon la politique impériale, qu’un impôt bien modéré, afin de ne pas occasionner une variation trop visible des prix, on peut arriver ensuite à des résultats surprenants. À chaque nouveau renchérissement le fisc dit : « Qu’est-ce qu’un centime ou deux par individu en moyenne ? » ou bien : « Qui nous assure que le renchérissement ne provient pas d’autres causes ? »
Il n’est pas probable qu’avec l’impôt unique, lequel ne saurait s’envelopper de toutes ces subtilités, un gouvernement puisse arriver jamais à absorber la moitié de la fortune des citoyens.
Le premier effet de la proposition de M. Ewart sera donc vraisemblablement de tourner l’opinion publique de l’Angleterre vers la sérieuse réduction des dépenses, c’est-à-dire vers la non-intervention de l’État en toutes matières où cette intervention n’est pas de son essence.
Il me semble impossible de n’être pas frappé de l’effet probable de cette nouvelle direction imprimée au système contributif de la Grande-Bretagne, combiné avec la réforme commerciale.
Si d’une part le système colonial s’écroule, comme il doit nécessairement s’écrouler devant la liberté des échanges ; si d’un autre côté le gouvernement est réduit à l’impuissance de rien prélever sur le public au delà de ce qui est strictement nécessaire pour l’administration du pays, le résultat infaillible doit être de couper jusque dans sa racine cette politique traditionnelle de nos voisins qui, sous les noms d’intervention, influence, prépondérance, prépotence, a jeté dans le monde tant de ferments de guerres et de discordes, a soumis toutes les nations et la nation anglaise plus que toute autre à un si écrasant fardeau de dettes et de contributions.
FN:V. au tome V, le discours sur l’impôt des boissons, p. 468 à 493. (Note de l’éditeur.)
One of Bastiat’s Lectures at Taranne Hall( July 1847) (to translate - 4,753 words)
#BastiatProject/snippets/libreechange/BastiatLecturesJuly1847
Source↩
"Réunion de la rue Taranne", LE, 4 July 1847, no. 32, pp. 252-53.
Also: 1847.07.03 “Troisième discours, à Paris” (Third Speech given in Paris at the Taranne Hall) [la salle Taranne, 3 juillet 1847] [OC2.44, p. 246]
Note:FB's lectures at salle Taranne; interruption/questions by socialist Duvall
Signed “J.” ??
REUNION DE LA RUE TARANNE↩
Hier soir, vendredi, une nombreuse réunion de jeunes gens, appartenant presque tous à l'école de droit, se pressaient dans la salle de la rue Taranne, N° 12, pour entendre M. Frédéric Bastiat, qui s'était proposé d'adresser à la jeunesse des écoles quelques observations générales au sujet de la question du libre échange, si mal étudiée jusqu'à ce jour, et par conséquent si mal comprise. M. Bastiat a surtout voulu démontrer la nécessité de se rattacher à un principe, toutes les fois que l'on aborde des matières de la gravité de celle dont s'occupe l'association pour la liberté des échanges, et il a fait ressortir les inconséquences auxquelles sont conduits les partisans de la protection avec leur système d'expédients. M. Bastiat a ensuite montre la liaison qu'il y a entre la discussion de la question de la liberté du commerce et celle de plusieurs autres problèmes sociaux d'un grand intérêt, ainsi que l'utilité que la jeunesse trouverait à en faire l'objet de ses préoccupations. L'auditoire a suivi cette exposition avec une profonde attention, avec un intérêt vraiment encourageant pour l'orateur ; et lorsque M. Bastiat a eu fini, son adhésion s'est manifestée par d'unanimes applaudissements.
Voici quelques passages du discours de M. Bastiat:
Messieurs,
J'ai ardemment désiré me trouver au milieu de vous. Bien souvent quand, sur des matières qui intéressent l'humanité, je sentais dans mon esprit l'évidence, et dans mou coeur ce besoin d'expansion inséparable de toute foi, je me disais: Que ne puis-je parler devant la jeunesse des écoles! - car la parole est une semence qui germe et fructifie surtout dans les jeunes intelligences. Plus on observe les procédés de la nature, plus on admire leur harmonieux enchaînement. Il est bien clair, par exemple, que le besoin d'instruction se fait sentir surtout au début de la vie. Aussi, voyez avec quelle merveilleuse industrie elle a placé dans cette période la faculté et le désir d'apprendre, non-seulement la souplesse des organes, la fraicheur de la mémoire, la promptitude de la conception, la puissance d'attention, et ces qualités pour ainsi dire physiologiques, qui sont l'heureux privilége de votre âge, mais encore cette condition morale si indispensable pour discerner le vrai du faux, je veux dire le désintéressement.
Loin de moi la pensée de faire ici la satire de la génération dont je suis le contemporain, Mais je puis dire, sans la blesser, qu'elle a moins d'aptitude à secouer le joug des erreurs dominantes. Même dans les sciences naturelles, dans celles qui ne touchent pas aux passions, un progrès a bien de la peine à se faire accepter par elle. Harvey disait n'avoir jamais rencontre un médecin au-dessus de cinquante ans qui ait voulu croire à la circulation du sang. Je dis voulu parce que, selon Pascal, « la volonté est un des principaux organes de la créance. » Et comme l'intérêt agit sur les dispositions de la volonté, est-il surprenant que les hommes que leur âge met aux prises avec les difficultés de la vie, qui sont parvenus au temps de l'action, qui agissent en conséquence des convictions enracinées, qui se sont tracé par elles une route dans le monde, repoussent instinctivement une doctrine qui pourrait déranger leurs combinaisons, et ne croient, en définitive, que ce qu'ils ont intérêt à croire?
Il n'en est pas ainsi de l’âge destiné à l'étude et à l'examen . La nature eût contrarié ses propres desseins si elle n'avait pas rait cet âge désintéressé. II se peut, par exemple, que la doctrine du Libre·Echange froisse les intérêts de quelques-uns d'entre vous ou du moins de leurs familles . Eh bien! j'ai la certitude cet obstacle, insurmontable ailleurs, n'en est pas un dans cette enceinte. Voilà pourquoi j'ai toujours désiré me mettre en communication avec vous.
Et pourtant, vous le comprendrez, je ne puis songer à traiter à fond , ni même à aborder aujourd'hui la question du libre-échange. Une séance ne suffirai t pas. Mon seul objet est de vous montrer son importance et sa connexité avec d'autres questions fort graves, afin de vous inspirer le désir de l'étudier.
Une des accusations les plus fréquentes' qu'on dirige contre l'Association du libre-échange c’est de ne pas se borner à réclamer quelques modifications de tarifs que le temps a rendues opportunes, mais de proclamer le principe même du libre-échange. Ce principe, on ne le combat guère, on le respecte, on le salue quand il passe, mais on le laisse passer. On ne veut à aucun prix ni de lui ni de ceux qui le soutiennent. Ce qui me détermine à choisir ce sujet, ce sont les faits qui viennent de se passer dans une élection récente, et qui peuvent se résumer dans le dialogue suivant entre les électeurs et le candidat:
> « Vous êtes un homme honorable; vos opinions politiques sont les nôtres; votre caractère nous inspire toute confiance; votre passé nous garantit votre avenir; mais vous voulez la réforme des tarifs! — Oui.
> — Nous la voulons aussi. Vous la voulez prudente et graduelle? — Oui.
> — Nous l'entendons de même. Mais vous la rattachez à un principe que vous exprimezpar le mot libre-échange?— Oui.
>En ce ca!', vous n’êtes pas notre homme . (Rires.) Nous avons une foule d'autres candidats qui nous promettent à la fois les avantages de la liberté et les douceurs de la restriction. Nous allons choisir un d'entre eux. »
Messieurs, je crois qu'un des grands malheurs, un des grands dangers de notre époque, c'est cette disposition à repousser les principes qui ne sont après tout que la logique de l'esprit. Par là, on décourage les hommes à conviction; on les induit à introduire dans leur profession de foi des phrases ambiguës, destinées à satisfaire, au moins à demi, les opinions les plus contradictoires. On n'entre pas par cette porte dans la vie publique sans que la pureté de la conscience n'en soit altérée. Je sais bien comment raisonne le candidat en face de ces exigences, Il se dit: Pour cette fois , je vais déserter le principe et avoir recours à l'expédient. Il s'agit de réussir. Mais une fois nommé, je reprendrai toute la sincérité de mes convictions. … Oui, mais quand on a fait un premier pas dans la voie dangereuse de l'équivoque, il se rencontre toujours quelque motif qui décide à en faire un second, jusqu'à ce qu'enfin, alors même que les circonstances extérieures vous rendraient toute votre liberté, le mal a pénétré dans la conscience elle-même, et l'on se trouve descendu de ce niveau de rectitude où l'on aurait voulu se tenir. Et voyez les conséquences! De toutes parts on se plaint et on dit: Les conservateurs n'ont pas de plan ; l'opposition n'a pas de programme. Si l'on remontait à la cause, peut-être le trouverait-on dans l’esprit du corps électoral lui-même, qui exige des candidats la renonciation à un principe , c'est-à-dire à toute idée arrêtée, à toute logique, à toute foi.
Et certes, s'il est un droit qu'on puisse réclamer à titre de droit, c'est-à-dire en conformité et en principe, c’est bien la liberté des échanges.
Ainsi que nous l'avons dit dans notre programme, nous considérons l'échange non-seulement comme un corollaire de la propriété, mais comme se confondant avec la propriété elle-même, comme étant un de ses éléments constitutifs. Il nous est impossible de concevoir la propriété respective de choses que deux hommes ont créées par le travail, si ces deux hommes n'ont pas le droit de les troquer, l’un d'eux fût-il étranger. Et quant au dommage national qui doit, dit-on, résulter de ce troc, nous ne pouvons comprendre qu'on nuise à son pays en cédant à un étranger, contre un objet de valeur équivalente, la chose même qu'on a le droit de de consommer et de détruire.
Je vais plus loin. Je dis que l'échange c'est la Société. Ce qui constitue la sociabilité des hommes, c'est la faculté de se partager les occupations , d'unir leurs forces, en un mot d’échanger leurs services. S' il était vrai que dix nations pussent augmenter leur prospérité en s'isolant les unes des autres, cela serait vrai de dix départements. Je défie que les protectionistes fassent un argument en faveur du travail national , qui ne s'applique au travail départemental, puis au travail communal, puis à celui de la famille, et enfin au travail individuel; d'où il suit que la restriction, poussée à ses dernières conséquences, c'est l'isolement absolu, c'est la destruction de la société.
Nos adversaires disent, il est vrai, qu'ils ne vont pas jusque- là ; qu'ils ne restreignent les échanges que dans certaines circonstances et quand cela leur convient. Ce n'est pas là une justification pour des esprits logiques. Quand nous les combattons, ce n'est pas à l'occasion des échanges qu'ils laissent libres , mais à l'occasion de ceux qu'ils interdisent. C'est dans ce cercle que nous déclarons leur principe faux, nuisible, attentatoire à la propriété, antagonique à la société. Ils ne le poussent pas jusqu'au bout, soit; et c'est précisément ce qui en prouve l'absurdité qu'il ne puisse soutenir cette épreuve.
Vous voyez bien que nous avions en présence un principe faux et que pouvions-nous lui opposer si ce n'est un principe vrai?
Mais , Messieurs, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'une idée a envahi un grand nombre de bons esprits, lorsqu'un sentiment , même instinctif, est généralement répandu, il doit y avoir en eux quelque chose qui les explique et les justifie. Cette terreur du libre-échange, considérée comme principe absolu, terreur qui s'est emparée de ceux-là même qui veulent la réforme commerciale, provient d'une confusion. Permettez-moi de l'éclaircir.
On suppose que vouloir la liberté des échanges, en principe, c’est vouloir que les échanges ne puissent subir de restrictions en aucun cas et sous aucun prétexte.
D'abord, mettons de côté les échanges immoraux, frauduleux ,déshonnêtes. C'est la mission principale de la loi, c'est le droit et le devoir du Gouvernement de réprimer l’abus de toutes les facultés, de celle d'échanger comme de toutes les autres.
Quant aux échanges qui ne blessent pas l'honnêteté, ils peuvent être restreints, nous en convenons, dans un but spécial. Le principe n'est engagé que lorsque la restriction est décrétée à cause de l'avantage qu'on prétend trouver dans la restriction elle-même.
Si, par exemple, l'État a besoin de revenus, et qu'il ne puisse s'en procurer suffisamment, et par d'autres procédés moins onéreux, qu'en taxant certains échanges, il est impossible de dire que la taxe blesse le principe de la liberté, pas plus que l'impôt foncier n'infirme le principe de la propriété. Mais alors tout le monde reconnait que la restriction est un inconvénient attaché à la perception de la taxe. De là à restreindre pour restreindre, il y a l'infini.
Le port des lettres est taxé en moyenne à 45 centimes, et rend au trésor, si je ne me trompe, 20 millions. Mais jamais le ministre des finances n'a dit qu'il a porté la taxe à ce taux pour empêcher d'écrire, parce que les relations épistolaires sont mauvaises en elles-mêmes. S'il pouvait compter sur un revenu égal d'une taxe moindre, il n'hésiterait pas il la réduire. Mais que penseriez-vous s'il venait dire à la tribune: « Il est funeste en principe qu'on s'écrive, et pour l'empêcher, sacrifiant même les 20 millions que je retire de cette taxe, je vais la porter à 10 fr., 50 fr., 100 fr.enfin, jusqu'à ce qu'on n'écrive plus. Et quant au revenu actuel, qui sera compromis, je le retrouverai en frappant sur le peuple d'autres impôts ? »
Messieurs, ne voyez-vous pas qu'entre cette taxe prohibitive et la taxe actuelle il y a toute l'épaisseur d'un principe, puisque, dans le premier cas, ou déplore que la taxe restreigne les relations épistolaires, et que dans le second on a, au contraire, pour but systématique de détruire ces relations?
Et c'est là le caractère que nous combattons dans la douane. Elle restreint, elle prohibe, non point pour un objet particulier, comme de créer des ressources au trésor, mais,au contraire, elle sacrifie le trésor par l’exagération des taxes, et même par la prohibition, dans le but avoué, intentionnel, systématique, d'empêcher des échanges. En tant qu'elle agit ainsi, elle se fonde donc très-expressément sur le principe anti-social de la restriction. Elle cherche la restriction pour la restriction même, la considérant comme bonne en soi, et même comme si bonne, qu'elle vaut la peine d'un sacrifice de revenu. C'est à ce principe que nous opposons le principe de la liberté.
On cherche encore à prévenir, il épouvanter le public de ce que nous voulons, à ce qu'on assure, passer sans transition d'un système à l'autre. Quelle niaiserie ! Et jusqu'à quand la France sera-t-elle dupe de ces manoeuvres stratégiques des sens qui exploitent la restriction ?
Tout ce que nous voulons, c'est faire comprendre à l'opinion que le principe de la liberté est juste, vrai et avantageux, et que celui de la restriction est inique, faux et nuisible,
Nous n'avons jamais dit, nous ne dirons jamais que lorsqu'on est engagé dans une fausse voie, il faut franchir d'un bond la distance qui nous sépare de la bonne. Nous disons qu'il faut faire volte-face, revenir sur ses pas, et marcher vers l'orient au lieu de continuer à marcher vers le couchant.
Et quand nous demanderions une réforme instantanée, est-ce que cela dépend de nous? sommes-nous ministres? disposons-nous de la majorité? n'avons-nous pas assez d’adversaires, assez d'intérêts en présence pour être bien assures que la réforme sera lente, et ne sera que trop Iente ?
Dans quelle direction faut-il marcher ? Faut-il marcher vite ou lentement ? Ce sont deux questions indépendantes l'une de l'autre, et qui n'ont même aucun rapport entre elles. Elles en ont si peu que dans le sein de notre association, encore que nous soyons tous d'accord sur le but qu'il faut atteindre, nous pouvons différer d'avis sur la durée convenable de la transition. Ce sur quoi nous sommes unanimes, c'est pour dire que, puisque la France est engagé dans une mauvaise voie, il faut l'en faire sortir avec le moins de perturbation possible. L'immense majorité de nos collègues pense que cette perturbation sera d'autant plus amoindrie que la transition sera plus lente. Quelques-uns , et je dois dire que je suis du nombre, croient que lu réforme la plus subite, la plus instantanée, la plus générale, serai en même temps la moins douloureuse; et si c'était ici le moment de développer cette thèse, je suis sûr que je l'appuierais sur des raisons dont vous seriez frappés. Je ne suis pas comme ce Champenois qui disait à son chien: « Pauvre bête, il faut que je te coupe le queue; mais sois tranquille , pour t’épargner des souffrances, je ménagerai la transition et ne t’’en couperai qu'un morceau tous les jours. »
Mais, je le répète, la question pour nous n'est pas de savoir combien de kilomètres la réforme fera à l'heure; la seule chose qui nus occupe, c'est de décider l'opinion publique à prendre la roule de la liberté au lieu de prendre celle de la restriction. Nous voyons un équipage qui prétend aller vers les Pyrénées, et qui, selon nous, lui tourne le dos; nous avertissons le cocher et les passagers; nous mettons en oeuvre pour les tirer d'erreur, tout ce que nous savons degéographie etde topographie; voilà tout.
Il y a cependant une différence. Quand on prouve à un cocher qu’il se trompe, son erreur se dissipe tout-à-coup, et iltourne bride au plus tôt. Il n’en est pas ainsi de la réforme commerciale. Elle ne peut que suivre le progrès de l’opinion, et, en ces matières, ce progrès est lent et successif. Vous voyez donc bien que, d’après nous-mêmes, l’instantanéité d’un réforme, fût-elle désirable, est une impossibilité.
Après tout, je m'en console aisément, messieurs, et jevous dirai pourquoi. C'est' que leslumières qu’une discussion prolongée concentrera sur la question du libre-échange, devront nécessairement éclairer d’autres questions économique qui ont, avec le libre-échange, la plus étroite affinité.
Je vous en citerai quelques-unes.
Par exemple, vous connaissez ce vieil adage: Le profit de l’un est le dommage de l'autre. On en a conclu qu'un peuple ne pouvait prospérer qu’aux dépens des autres peuples, et lapolitique internatIonale, il faut le dire, est fondée sur cette triste maxime. Comment a-t-elle pu entrer dans les convictions publiques?
Il n'y a rien qui modifie aussi profondément l’organisation, les institutions, les mœurs et les idées des peuples, que moyens généraux par lesquels ils pourvoient à leur subsistance et, ces moyens, il n'yen a que deux: la spoliation, en prenant ce mot dans son acception la plus étendue, et la production. — Car, messieurs, les ressources que la nature offre spontanément aux hommes sont si limitées, qu'ils nelepeuvent vivre que sur les produits du travail humain, et cesproduits, il faut qu'ils les créent ou qu'ils les ravissent à d'autres hommes qui les ont créés.
Les peuples de l'antiquité, et particulièrement les Romains, dans la société desquels nous passons tous notre jeunesse,qu'on nous accoutume à admirer et que l'on propose sanscesse à notre imitation, vivaient de rapine. Ils détestaient,méprisaient le travail. La guerre, le butin, les tributs et l’esclavage devaient alimenter toutes leurs consommations.
Il en était de même des peuples dont ils étaient environnés.
II est bien évident que dans cet ordre social, cette maxime: le profit de l'un est le dommage de l'autre, était de la plus rigoureuse vérité. Il en est rigoureusement ainsi entre deux hommes ou deux peuples qui cherchent réciproquement à sespolier.
Or, comme c'est chez les Romains que nous allons chercher toutes nos premières impressions, toutes nos premières idées, nos modèles et les sujets de notre vénération presque religieuse, il n'est pas bien surprenant que cette maxime ait été considérée par nos sociétés industrielles comme la loi des relations internationales.
Elle sert de base au système restrictif, et si elle était vraie, il n’y aurait pas de remède contre l'incurable antagonisme que Ia Providence se serai plue à mettre entre les nations.
Mais la doctrine du libre-échange démontre rigoureusement, mathématiquement, la vérité de l'axiome opposé, à savoir: Que le dommage de l'un est le dommage de l'autre, et que chaque peuple est intéressé à la prospérité de tous.
Je n'aborderai pas ici cette démonstration qui résulte d'ailleurs du fait seul que la nature de l'échange et opposée àcelle de la spoliation. Mais votre sagacité vous fera apercevoir d'un coup d'œil les grandes conséquences de cette doctrine, et le changement radical qu'elle introduirait dans la politique des peuples, si elle venait à obtenir leur universelassentiment.
S'il était bien démontré, comme est démontré un théorème de géométrie, que tout progrès fait par un peuple dans une industrie, encore qu'il contrarie chez les autres peuples celui qui livre à l'industrie similaire, n'en est pas moins favorables à l'ensemble de leurs intérêts, que deviendraient ces efforts dangereux vers la prépondérance, ces jalousies nationales, ces guerres de débouchés, etc., et par suite, ces armées permanentes, toutes choses qui sont certainement un reste de barbarie?
L'orateur signale ici quelques autres questions d'une haute gravité qu'une discussion prolongée sur le libreéchange doit éclairer d'une vive lumière, entre autres ce problème fondamental de la science politique: Quellesdoivent être les bornes de l'action gouvernementale?
En appelant votre attention sur quelques-uns des graves problèmes que soulève la question du libre échange, j'ai voulu vous montrer l'importance de cette question et l'importance de la. science économique elle-même.
Depuis quelque temps, de nombreux écrivains se sont élevés contre l’économie politique et ont cru qu'il suffisait, pourla flétrir, d'altérer son nom. Ils l'ont appelée l’économisme. Messieurs , je ne pense pas qu'on ébranlerait les vérités démontrées par la géométrie, en l'appelant géométrisme.
On l’accuse de ne s’occuper que de richesse, et de trop abaisser ainsi l’esprit humain vers la terre. C’est surtout devant vous que je tiens à laver de ce reproche, car vous êtes dans l’âge où il est de natureà faire une vive impression.
D'abord, quand il serait vrai que l'économie politique s'occupât exclusivement de la manière dont se forment et se distribuent les richesses, ce serait déjà une vaste science, si l’on nous veut prendre ce mot richesses, non dans le sens vulgaire qu'il en mais dans son acception scientifique. Dans le monde l’expression richesses implique l’idée du superflu. Scientifiquement,la richesse, c'est l’ensemble des services réciproques que se rendent les hommes, et à l’aide desquels la société existe et se développe. Le progrès de la richesse, c'est plus de pain pour ceux qui ont faim, des vêtements qui non seulement mettent à l'abri des intempéries, mais encore donnent àl'homme le sentiment de la dignité ; la richesse c'est plus de loisirs et par conséquent la culture de l'esprit, c'est pour un peuple des moyens de repousser les agressions étrangères,c'est pour le vieillard le repos dans l'indépendance, pour le père, la faculté de faire élever son fils et de doter sa fille, la richesse c'est le bien-être, l'instruction, l'indépendance, la dignité.
Mais si l'on jugeait que même dans ce cercle étendu l'économie politique est une science qui s’occupe trop d'intérêts matériels, il ne faut pas perdre de vue qu'elle conduit à la solution de problèmes d'un ordre plus élevé, ainsi que vous avez pu vous en convaincre quand j'ai appelé votre attention sur ces deux questions: Est-il vrai que le profit de l'un soit le dommage de l'autre? Quelle est la limite rationnelle de l'action du gouvernement?
Mais ce qui vous surprendra, Messieurs, c’est que les socialistes qui nous reprochent de nous trop préoccuper des biens de ce monde, manifestent eux-mêmes dans l'opposition qu'ils font au Iibre-échange, le culte exclusif et exagéré de la richesse. Que disent-ils en effet? Ils conviennent que la liberté commerciale aurait au point de vue politique et moral, les résultats les plus désirables. Personne ne conteste qu'elle tend à rapprocher les peuples, à éteindre les haines nationales. à consolider la paix, à favoriser la communication des idées, le triomphe de la vérité et le progrès vers l’unité. Sur quoi donc se fondent-ils pour repousser cette liberté? Uniquement sur ce qu'elle nuirait au travail national, soumettrait nos industries de la concurrence étrangère, diminuerait le bien-être des masses et pour trancher le mot la richesse.
En présence de l'objection, ne sommes-nous pas forcés de traiter la question économique, de montrer que nos adversaires ne voient la concurrence que par un de ses cotés, et que la liberté commerciale a autant d'avantages au point de vue matériel que sous tous les autres rapports? Et quand nous le faisons, on nous dit: Vous ne vous occupez que de la richesse; vous donnez trop d'importance à la richesse.
Après avoir repoussé le reproche fait à l'économie politique d'être une science d'importation anglaise, l'orateur termine ainsi:
Messieurs, je m'arrête, et j'ai peut-être déjà trop abusé devotre patience. Je terminerai en vous engageant de toutes mes forces à consacrer quelques instants pris sur vos loisirs à l'étude de l'économie politique. Permettez-moi aussi un autre conseil. Si jamais vous entrez dans l'association du libre-échange, ou tout autre qui ait en vue un grand objet d'utilité publique, n'oubliez pas que les débats de cette nature ont pour juge l'opinion, et qu'ils veulent être soutenus sur le terrain du principe et non sur celui de l'expédient. J'appelle Expédient par opposition à Principe, cette disposition à juger les questions au point de vue des circonstances du moment et même trop souvent des intérêts de classe ou des intérêts individuels. A une association il faut un lien, et ce ne peut être qu'un principe. A l'intelligence il faut un guide, une lumière, et ce ne peut être qu'un principe, Au cœur humain il faut un mobile qui détermine l'action, le dévouement, et au besoin le sacrifice, et l’on ne se dévoue pas à l'expédient, mais au principe. Consultez l'histoire, Messieurs, voyez quels sont les noms chers à l'humanité, et vous reconnaîtrez qu'ils appartiennent à des hommes animés d'une foi vive. Je gémis pour mon siècle et pour mon pays de voir l'expédient en honneur, la dérision et le ridicule réservés au principe; car jamais rien de grand et de beau ne s’accomplit dans le monde que par le dévouement à un principe. Ces deux forces sont souvent aux prises, et il n'est que trop fréquent de voir triompher l'homme qui représente le fait actuel, et succomber le représentant de l'idée générale. Cependant, portez plus loin votre regard, et vous verrez le Principe faire son œuvre, l'Expédient ne laisser aucune trace de son passage.
L'histoire religieuse nous en offre un admirable exemple. Elle nous montre le principe et l'expédient en présence dans le plus mémorable événement dont le monde ait été témoin, Qui jamais fut plus entièrement dévoué à un principe, au principe de la fraternité que le fondateur du christianisme? Il fut dévoué jusqu'à souffrir pour lui la persécution la raillerie, l'abandon et la mort. Il ne paraissait pas se préoccuper des conséquences, il les remettait entre les mains de son père et disait : Que la volonté de Dieu soit Faite.
La même histoire nous montre à cé de ce modèle l'homme de l'Expédient. Caïphe, redoutant la colère des Romains, transige avec le devoir, sacrifie le juste et dit : Il est expédient (expedit) qu'un homme périsse pour le salutde. tous. L’homme de la transaction triomphe, l'homme du principe est crucifié. Mais qu'arrive-t-il? Un demi siècle après, Ie genre humain tout entier, Juifs et Gentils, Grecs et Romains, maitres et esclaves, se rallie à la doctrine de Jésus; et si Caïphe avait vécu à cette époque, il aurait pu voir la charrue passer sur la place où fut cette Jérusalem qu'il avait cru sauver par une lâche et criminelle transaction. (Applaudissements prolongés.)
OC version leaves out this conclusion
Au moment où notre collaborateur venait de finir,M. Jules Duval lui a demandé s'il voulait bien consentir à ce que l'un des adeptes du Socialisme présentât quelques observations, et, en même temps, il s'est dirigé, du fond de l'auditoire où il avait pris place; vers la table où était assis M. Bastiat. M. Bastiat, après avoir fait remarquer qu'il n'avait parlé du socialisme que fort indirectement, et simplement pour appuyer quelques-unes de-ses opinions ; qu'il n'avait pas même voulu aborder dans cette soirée le fond de la question du libre échange, a cédé la parole à M. Jules Duval.
M. Jules Duval est l' un des principaux rédacteurs de la *Démocratie Pacifique*, organe quotidien de la Science sociale, découverte par Fourier, et l'on comprend tout de suite qu'il a dû formuler une série de reproches contre l'organisation actuelle de la société et contre l'école économique, qu'il suppose l'auteur et le défenseur de tout ce qui se fait dans ce monde. La liberté des échanges n'a pas été oubliée dans celte récrimination générale, et pendant les trois quarts d'heure qu'il a parlé, M. Duval a eu le talent de résumer tous les arguments que nous opposent quotidiennement nos adversaires. Néanmoins l'orateur phalanstérien a conclu à la générosité de la doctrine libre échangiste et à sa fécondité, lorsque la société se serait refondue et réorganisée sur les bases de la science sociale.
M. Jules Duval, nous nous plaisons à lui rendre cette justice, a parlé avec un véritable talent; mais son discours, nous devons le dire aussi, venait complètement à côté de celui de M. Bastiat, qui n'avait nullement traité les points qu'il est venu aborder et combattre. Nous ajouterons que tous les arguments de M. Jules Duval sont loin d'être d'accord avec les principes de l'école àlaquelle il appartient, et qu'il nous semble s'être beaucoup trop préoccupé du besoin de défendre le parti protectioniste, dont il a fidèlement reproduit les assertions.
M. Frédéric Bastiat, vu l'heure avancée, n'a pas pu combattre les nombreuses propositions de M. Jules Duval, et il s'est borné à renvoyer ses auditeurs à son écrit intitulé *Sophismes économiques*, dans lequel il s'est attaché à déraciner les plus grosses erreurs de la doctrine protectioniste. La séance a été levée, et chacun de ces jeunes gens a accepté un exemplaire de cet ouvrage, en témoignant, par son empressement du désir d'approfondir les importantes questions sur lesquelles son attention venait d'être appelée.
J.
Troisième discours, à Paris [3 juillet 1847] ↩
BWV
1847.07.03 “Troisième discours, à Paris” (Third Speech given in Paris at the Taranne Hall) [la salle Taranne, 3 juillet 1847] [OC2.44, p. 246]
Troisième discours
Prononcé le 3 juillet 1847, à la salle Taranne, devant une réunion de jeunes gens appartenant presque tous à l’école de droit
[From intro in LE, 4 July 1847, p. 252. Signed “J.”]
[REUNION DE LA RUE TARANNE
Hier soir, vendredi, une nombreuse réunion de jeunes gens, appartenant presque tous à l'école de droit, se pressaient dans la salle de la rue Taranne, N° 12, pour entendre M. Frédéric Bastiat, qui s'était proposé d'adresser à la jeunesse des écoles quelques observations générales au sujet de la question du libre échange, si mal étudiée jusqu'à ce jour, et par conséquent si mal comprise. M. Bastiat a surtout voulu démontrer la nécessité de se rattacher à un principe, toutes les fois que l'on aborde des matières de la gravité de celle dont s'occupe l'association pour la liberté des échanges, et il a fait ressortir les inconséquences auxquelles sont conduits les partisans de la protection avec leur système d'expédients. M. Bastiat a ensuite montre la liaison qu'il y a entre la discussion de la question de la liberté du commerce et celle de plusieurs autres problèmes sociaux d'un grand intérêt, ainsi que l'utilité que la jeunesse trouverait à en faire l'objet de ses préoccupations. L'auditoire a suivi cette exposition avec une profonde attention, avec un intérêt vraiment encourageant pOur l'orateur ; et lorsque M. Bastiat a eu fini, son adhésion s'est manifestée par d'unanimes applaudissements.
Voici quelques passages du discours de M. Bastiat:]
Messieurs,
J’ai ardemment désiré me trouver au milieu de vous. Bien souvent quand, sur des matières qui intéressent l’humanité, je sentais dans mon esprit l’évidence, et dans mon cœur ce besoin d’expansion inséparable de toute foi, je me disais : Que ne puis-je parler devant la jeunesse des écoles ! — car la parole est une semence qui germe et fructifie surtout dans les jeunes intelligences. Plus on observe les procédés de la nature, plus on admire leur harmonieux enchaînement. Il est bien clair, par exemple, que le besoin d’instruction se fait sentir surtout au début de la vie. Aussi, voyez avec quelle merveilleuse industrie elle a placé, dans cette période, la faculté et le désir d’apprendre, non-seulement la souplesse des organes, la fraîcheur de la mémoire, la promptitude de la conception, la puissance d’attention, et ces qualités pour ainsi dire physiologiques, qui sont l’heureux privilége de votre âge, mais encore cette condition morale si indispensable pour discerner le vrai du faux, je veux dire le désintéressement [1].
Loin de moi la pensée de faire ici la satire de la génération dont je suis le contemporain. Mais je puis dire, sans la blesser, qu’elle a moins d’aptitude à secouer le joug des erreurs dominantes. Même dans les sciences naturelles, dans celles qui ne touchent pas aux passions, un progrès a bien de la peine à se faire accepter par elle. Harvey disait n’avoir jamais rencontré un médecin au-dessus de cinquante ans qui ait voulu croire à la circulation du sang. Je dis voulu parce que, selon Pascal, « la volonté est un des principaux organes de la créance. » Et comme l’intérêt agit sur les dispositions de la volonté, est-il surprenant que les hommes que leur âge met aux prises avec les difficultés de la vie, qui sont parvenus au temps de l’action, qui agissent en conséquence de convictions enracinées, qui se sont tracé par elles une route dans le monde, repoussent instinctivement une doctrine qui pourrait déranger leurs combinaisons, et ne croient, en définitive, que ce qu’ils ont intérêt à croire ?
Il n’en est pas ainsi de l’âge destiné à l’étude et à l’examen. La nature eût contrarié ses propres desseins, si elle n’avait pas fait cet âge désintéressé. Il se peut, par exemple, que la doctrine du Libre-Échange froisse les intérêts de quelques-uns d’entre vous ou du moins de leurs familles. Eh bien ! j’ai la certitude que cet obstacle, insurmontable ailleurs, n’en est pas un dans cette enceinte. Voilà pourquoi j’ai toujours désiré me mettre en communication avec vous.
Et pourtant, vous le comprendrez, je ne puis songer à traiter à fond, ni même à aborder aujourd’hui la question du libre-échange. Une séance ne suffirait pas. Mon seul objet est de vous montrer son importance et sa connexité avec d’autres questions fort graves, afin de vous inspirer le désir de l’étudier.
Une des accusations les plus fréquentes qu’on dirige contre l’Association du libre-échange, c’est de ne pas se borner à réclamer quelques modifications de tarifs que le temps a rendues opportunes, mais à proclamer le principe même du libre-échange. Ce principe, on ne le combat guère, on le respecte, on le salue quand il passe ; mais on le laisse passer. On ne veut à aucun prix ni de lui ni de ceux qui le soutiennent. Ce qui me détermine à choisir ce sujet, ce sont les faits qui viennent de se passer dans une élection récente, et qui peuvent se résumer dans le dialogue suivant entre les électeurs et le candidat :
« Vous êtes un homme honorable ; vos opinions politiques sont les nôtres ; votre caractère nous inspire toute confiance ; votre passé nous garantit votre avenir : mais vous voulez la réforme des tarifs ? — Oui.
— Nous la voulons aussi. Vous la voulez prudente et graduelle ? — Oui.
— Nous l’entendons de même. Mais vous la rattachez à un principe que vous exprimez par le mot libre-échange ?
— Oui.
— En ce cas, vous n’êtes pas notre homme. (Rires.) Nous avons une foule d’autres candidats qui nous promettent à la fois les avantages de la liberté et les douceurs de la restriction. Nous allons choisir un d’entre eux. »
Messieurs, je crois qu’un des grands malheurs, un des grands dangers de notre époque, c’est cette disposition à repousser les principes, qui ne sont après tout que la logique de l’esprit. Par là, on décourage les hommes à conviction ; on les induit à introduire dans leur profession de foi des phrases ambiguës, destinées à satisfaire, au moins à demi, les opinions les plus contradictoires. On n’entre pas par cette porte dans la vie publique sans que la pureté de la conscience en soit altérée. Je sais bien comment raisonne le candidat en face de ces exigences. Il se dit : Pour cette fois, je vais déserter le principe et avoir recours à l’expédient. Il s’agit de réussir. Mais une fois nommé, je reprendrai toute la sincérité de mes convictions… Oui, mais quand on a fait un premier pas dans la voie dangereuse de l’équivoque, il se rencontre toujours quelque motif qui décide à en faire un second, jusqu’à ce qu’enfin, alors même que les circonstances extérieures vous rendraient toute votre liberté, le mal a pénétré dans la conscience elle-même ; et l’on se trouve descendu de ce niveau de rectitude où l’on aurait voulu se tenir. Et voyez les conséquences ! De toutes parts on se plaint et on dit : Les conservateurs n’ont pas de plan ; l’opposition n’a pas de programme. Si l’on remontait à la cause, peut-être la trouverait-on dans l’esprit du corps électoral lui-même, qui exige des candidats la renonciation à un principe, c’est-à-dire à toute idée arrêtée, à toute logique, à toute foi.
Et certes, s’il est un droit qu’on puisse réclamer à titre de droit, c’est-à-dire en conformité d’un principe, c’est bien la liberté des échanges.
Ainsi que nous l’avons dit dans notre programme, nous considérons l’échange non-seulement comme un corollaire de la propriété, mais comme se confondant avec la propriété elle-même, comme étant un de ses éléments constitutifs. Il nous est impossible de concevoir la propriété respective de choses que deux hommes ont créées par le travail, si ces deux hommes n’ont pas le droit de les troquer, l’un d’eux fût-il étranger. Et quant au dommage national qui doit, dit-on, résulter de ce troc, nous ne pouvons comprendre qu’on nuise à son pays en cédant à un étranger, contre un objet de valeur équivalente, la chose même qu’on a le droit de consommer et de détruire.
Je vais plus loin. Je dis que l’échange c’est la Société. Ce qui constitue la sociabilité des hommes, c’est la faculté de se partager les occupations, d’unir leurs forces, en un mot d’échanger leurs services. S’il était vrai que dix nations pussent augmenter leur prospérité en s’isolant les unes des autres, cela serait vrai de dix départements. Je défie que les protectionnistes fassent un argument en faveur du travail national, qui ne s’applique au travail départemental, puis au travail communal, puis à celui de la famille, et enfin au travail individuel ; d’où il suit que la restriction, poussée à ses dernières conséquences, c’est l’isolement absolu, c’est la destruction de la société [2].
Nos adversaires disent, il est vrai, qu’ils ne vont pas jusque-là ; qu’ils ne restreignent les échanges que dans certaines circonstances et quand cela leur convient. Ce n’est pas là une justification pour des esprits logiques. Quand nous les combattons, ce n’est pas à l’occasion des échanges qu’ils laissent libres, mais à l’occasion de ceux qu’ils interdisent. C’est dans ce cercle que nous déclarons leur principe faux, nuisible, attentatoire à la propriété, antagonique à la société. Ils ne le poussent pas jusqu’au bout, soit ; et c’est précisément ce qui en prouve l’absurdité qu’il ne puisse soutenir cette épreuve.
Vous voyez bien que nous avions en présence un principe faux. Et que pouvions-nous lui opposer, si ce n’est un principe vrai ?
Mais, Messieurs, je suis de ceux qui pensent que lorsqu’une idée a envahi un grand nombre de bons esprits, lorsqu’un sentiment, même instinctif, est généralement répandu, il doit y avoir en eux quelque chose qui les explique et les justifie. Cette terreur du libre-échange, considérée comme principe absolu, terreur qui s’est emparée de ceux-là mêmes qui veulent la réforme commerciale, provient d’une confusion. Permettez-moi de l’éclaircir.
On suppose que vouloir la liberté des échanges, en principe, c’est vouloir que les échanges ne puissent subir de restrictions en aucun cas et sous aucun prétexte.
D’abord, mettons de côté les échanges immoraux, frauduleux, déshonnêtes. C’est la mission principale de la loi, c’est le droit et le devoir du Gouvernement de réprimer l’abus de toutes les facultés, de celle d’échanger comme de toutes les autres.
Quant aux échanges qui ne blessent pas l’honnêteté, ils peuvent être restreints,, nous en convenons, dans un but spécial. Le principe n’est engagé que lorsque la restriction est décrétée à cause de l’avantage qu’on prétend trouver dans la restriction elle-même.
Si, par exemple, l’État a besoin de revenus, et qu’il ne puisse s’en procurer suffisamment, et par d’autres procédés moins onéreux, qu’en taxant certains échanges, il est impossible de dire que la taxe blesse le principe de la liberté, pas plus que l’impôt foncier n’infirme le principe de la propriété. Mais alors tout le monde reconnaît que la restriction est un inconvénient attaché à la perception de la taxe. De là à restreindre pour restreindre, il y a l’infini.
Le port des lettres est taxé en moyenne à 45 centimes, et rend au Trésor, si je ne me trompe, 20 millions. Mais jamais le ministre des finances n’a dit qu’il a porté la taxe à ce taux pour empêcher d’écrire, parce que les relations épistolaires sont mauvaises en elles-mêmes. S’il pouvait compter sur un revenu égal d’une taxe moindre, il n’hésiterait pas à la réduire. Mais que penseriez-vous, s’il venait dire à la tribune : « Il est funeste en principe qu’on s’écrive, et pour l’empêcher, sacrifiant même les 20 millions que je retire de cette taxe, je vais la porter à 10 fr., 30 fr., 100 fr., enfin, jusqu’à ce qu’on n’écrive plus. Et quant au revenu actuel, qui sera compromis, je le retrouverai en frappant sur le peuple d’autres impôts ? »
Messieurs, ne voyez-vous pas qu’entre cette taxe prohibitive et la taxe actuelle il y a toute l’épaisseur d’un principe, puisque, dans le premier cas, on déplore que la taxe restreigne les relations épistolaires, et que, dans le second, on a, au contraire, pour but systématique de détruire ces relations ?
Et c’est là le caractère que nous combattons dans la douane. Elle restreint, elle prohibe, non point pour un objet particulier, comme de créer des ressources au trésor, mais, au contraire, elle sacrifie le trésor par l’exagération des taxes, et même par la prohibition, dans le but avoué, intentionnel. systématique, d’empêcher des échanges. En tant qu’elle agit ainsi, elle se fonde donc très-expressément sur le principe antisocial de la restriction. Elle cherche la restriction pour la restriction même, la considérant comme bonne en soi, et même comme si bonne, qu’elle vaut la peine d’un sacrifice de revenu. C’est à ce principe que nous opposons le principe de la liberté.
On cherche encore à prévenir, à épouvanter le public de ce que nous voulons, à ce qu’on assure, passer sans transition d’un système à l’autre. Quelle niaiserie ! Et jusqu’à quand la France sera-t-elle dupe de ces manœuvres stratégiques des gens qui exploitent la restriction ?
Tout ce que nous voulons, c’est faire comprendre à l’opinion que le principe de la liberté est juste, vrai et avantageux, — et que celui de la restriction est inique, faux et nuisible.
Nous n’avons jamais dit, nous ne dirons jamais que lorsqu’on est engagé dans une fausse voie, il faut franchir d’un bond la distance qui nous sépare de la bonne. Nous disons qu’il faut faire volte-face, revenir sur ses pas, et marcher vers l’orient au lieu de continuer à marcher vers le couchant.
Et quand nous demanderions une réforme instantanée, est-ce que cela dépend de nous ? sommes-nous ministres ? disposons-nous de la majorité ? n’avons-nous pas assez d’adversaires, assez d’intérêts en présence pour être bien assurés que la réforme sera lente, et ne sera que trop lente ?
Dans quelle direction faut-il marcher ? — Faut-il marcher vite ou lentement ? — Ce sont deux questions indépendantes l’une de l’autre, et qui n’ont même aucun rapport entre elles. Elles en ont si peu, que, dans le sein de notre association, encore que nous soyons tous d’accord sur le but qu’il faut atteindre, nous pouvons différer d’avis sur la durée convenable de la transition. Ce sur quoi nous sommes unanimes, c’est pour dire que, puisque la France est engagée dans une mauvaise voie, il faut l’en faire sortir avec le moins de perturbation possible. L’immense majorité de nos collègues pense que cette perturbation sera d’autant plus amoindrie que la transition sera plus lente. Quelques-uns, et je dois dire que je suis du nombre, croient que la réforme la plus subite, la plus instantanée, la plus générale, serait en même temps la moins douloureuse ; et si c’était ici le moment de développer cette thèse, je suis sûr que je l’appuierais sur des raisons dont vous seriez frappés. Je ne suis pas comme ce Champenois qui disait à son chien: « Pauvre bête, il faut que je te coupe la queue ; mais sois tranquille, pour t’épargner des souffrances, je ménagerai la transition et ne l’en couperai qu’un morceau tous les jours. »
Mais, je le répète, la question pour nous n’est pas de savoir combien de kilomètres la réforme fera à l’heure ; la seule chose qui nous occupe, c’est de décider l’opinion publique à prendre la route de la liberté au lieu de prendre celle de la restriction. Nous voyons un équipage qui prétend aller vers les Pyrénées, et qui, selon nous, y tourne le dos ; nous avertissons le cocher et les passagers ; nous mettons en œuvre, pour les tirer d’erreur, tout ce que nous savons de géographie et de topographie ; voilà tout.
Il y a cependant une différence. Quand on prouve à un cocher qu’il se trompe, son erreur se dissipe tout à coup, et il tourne bride au plus tôt. Il n’en est pas ainsi de la réforme commerciale. Elle ne peut que suivre le progrès de l’opinion, et, en ces matières, ce progrès est lent et successif. Vous voyez donc bien que, d’après nous-mêmes, l’instantanéité d’une réforme, fût-elle désirable, est une impossibilité.
Après tout, je m’en console aisément, Messieurs, et je vous dirai pourquoi. C’est que les lumières qu’une discussion prolongée concentrera sur la question du libre-échange, devront nécessairement éclairer d’autres questions économiques qui ont, avec le libre-échange, la plus étroite affinité.
Je vous en citerai quelques-unes.
Par exemple, vous connaissez ce vieil adage : Le profit de l’un est le dommage de l’autre. On en a conclu qu’un peuple ne pouvait prospérer qu’aux dépens des autres peuples ; et la politique internationale, il faut le dire, est fondée sur cette triste maxime. Comment a-t-elle pu entrer dans les convictions publiques ?
Il n’y a rien qui modifie aussi profondément l’organisation, les institutions, les mœurs et les idées des peuples que les moyens généraux par lesquels ils pourvoient à leur subsistance ; et ces moyens, il n’y en a que deux : la spoliation, en prenant ce mot dans son acception la plus étendue, et la production. — Car, Messieurs, les ressources que la nature offre spontanément aux hommes sont si limitées, qu’ils ne peuvent vivre que sur les produits du travail humain ; et ces produits, il faut qu’ils les créent ou qu’ils les ravissent à d’autres hommes qui les ont créés.
Les peuples de l’antiquité, et particulièrement les Romains, — dans la société desquels nous passons tous notre jeunesse, — qu’on nous accoutume à admirer et que l’on propose sans cesse à notre imitation, vivaient de rapine. Ils détestaient, méprisaient le travail. La guerre, le butin, les tributs et l’esclavage devaient alimenter toutes leurs consommations.
Il en était de même des peuples dont ils étaient environnés.
Il est bien évident que, dans cet ordre social, cette maxime : Le profit de l’un est le dommage de l’autre, était de la plus rigoureuse vérité. Il en est nécessairement ainsi entre deux hommes ou deux peuples qui cherchent réciproquement à se spolier.
Or, comme c’est chez les Romains que nous allons chercher toutes nos premières impressions, toutes nos premières idées, nos modèles et les sujets de notre vénération presque religieuse, il n’est pas bien surprenant que cette maxime ait été considérée par nos sociétés industrielles comme la loi des relations internationales [3].
Elle sert de base au système restrictif ; et si elle était vraie, il n’y aurait pas de remède entre l’incurable antagonisme que la Providence se serait plu à mettre entre les nations.
Mais la doctrine du libre-échange démontre rigoureusement, mathématiquement, la vérité de l’axiome opposé, à savoir : Que le dommage de l’un est le dommage de l’autre, et que chaque peuple est intéressé à la prospérité de tous.
Je n’aborderai pas ici cette démonstration qui résulte d’ailleurs du fait seul que la nature de l’échange est opposée à celle de la spoliation. Mais votre sagacité vous fera apercevoir d’un coup d’œil les grandes conséquences de cette doctrine, et le changement radical qu’elle introduirait dans la politique des peuples, si elle venait à obtenir leur universel assentiment.
S’il était bien démontré, comme est démontré un théorème de géométrie, que tout progrès fait par un peuple dans une industrie, encore qu’il contrarie chez les autres peuples celui qui se livre à l’industrie similaire, n’en est pas moins favorable à l’ensemble de leurs intérêts, que deviendraient ces efforts dangereux vers la prépondérance, ces jalousies nationales, ces guerres de débouchés, etc., et par suite, ces armées permanentes, toutes choses qui sont certainement un reste de barbarie ?
[From editorial comment in LE: L’orateur signale ici quelques questions d’une haute gravité qu’une discussion sur le libre-échange doit éclairer d’une vive lumière, entre autres ce problème fondamental de la science politique : Quelles doivent être les bornes de l’action gouvernementale ?]
En appelant votre attention sur quelques-uns des graves problèmes que soulève la question du libre-échange, j’ai voulu vous montrer l’importance de cette question et l’importance de la science économique elle-même.
Depuis quelque temps, de nombreux écrivains se sont élevés contre l’économie politique et ont cru qu’il suffisait, pour la flétrir, d’altérer son nom. Ils l’ont appelée économisme. Messieurs, je ne pense pas qu’on ébranlerait les vérités démontrées par la géométrie, en l’appelant géométrisme.
On l’accuse de ne s’occuper que de richesse, et de trop abaisser ainsi l’esprit humain vers la terre. C’est surtout devant vous que je tiens à la laver de ce reproche, car vous êtes dans l’Age où il est de nature à faire une vive impression.
D’abord, quand il serait vrai que l’économie politique s’occupât exclusivement de la manière dont se forment et se distribuent les richesses, ce serait déjà une vaste science, si l’on veut prendre ce mot richesses, non dans le sens vulgaire, mais dans son acception scientifique. Dans le monde l’expression richesses implique l’idée du superflu. Scientifiquement, la richesse, c’est l’ensemble des services réciproques que se rendent les hommes, et à l’aide desquels la société existe et se développe. Le progrès de la richesse, c’est plus de pain pour ceux qui ont faim, des vêtements qui non-seulement mettent à l’abri des intempéries, mais encore donnent à l’homme le sentiment de la dignité ; la richesse, c’est plus de loisirs et par conséquent la culture de l’esprit ; c’est, pour un peuple, des moyens de repousser les agressions étrangères ; c’est, pour le vieillard, le repos dans l’indépendance ; pour le père, la faculté de faire élever son fils et de doter sa fille ; la richesse, c’est le bien-être, l’instruction, l’indépendance, la dignité.
Mais si l’on jugeait que même dans ce cercle étendu l’économie politique est une science qui s’occupe trop d’intérêts matériels, il ne faut pas perdre de vue qu’elle conduit à la solution de problèmes d’un ordre plus élevé, ainsi que vous avez pu vous en convaincre quand j’ai appelé votre attention sur ces deux questions : Est-il vrai que le profit de l’un soit le dommage de l’autre ? Quelle est la limite rationnelle de l’action du gouvernement ?
Mais ce qui vous surprendra, Messieurs, c’est que les socialistes, qui nous reprochent de nous trop préoccuper des biens de ce monde, manifestent eux-mêmes, dans l’opposition qu’ils font au libre-échange, le culte exclusif et exagéré de la richesse. Que disent-ils en effet ? Ils conviennent que la liberté commerciale aurait, au point de vue politique et moral, les résultats les plus désirables. Personne ne conteste qu’elle tend à rapprocher les peuples, à éteindre les haines nationales, à consolider la paix, à favoriser la communication des idées, le triomphe de la vérité et le progrès vers l’unité. Sur quoi donc se fondent-ils pour repousser cette liberté ? Uniquement sur ce qu’elle nuirait au travail national, soumettrait nos industries aux inconvénients de la concurrence étrangère, diminuerait le bien-être des masses et, pour trancher le mot, la richesse.
En présence de l’objection, ne sommes-nous pas forcés de traiter la question économique, de montrer que nos adversaires ne voient la concurrence que par un de ses côtés, et que la liberté commerciale a autant d’avantages au point de vue matériel que sous tous les autres rapports ? Et quand nous le faisons, on nous dit : Vous ne vous occupez que de la richesse ; vous donnez trop d’importance à la richesse.
[Editor LE: Après avoir repoussé le reproche fait à l’économie politique d’être une science d’importation anglaise, l’orateur termine ainsi :]
Messieurs, je m’arrête, et j’ai peut-être déjà trop abusé de votre patience. Je terminerai en vous engageant de toutes mes forces à consacrer quelques instants pris sur vos loisirs à l’étude de l’économie politique. Permettez-moi aussi un autre conseil. Si jamais vous entrez dans l’Association du libre-échange, ou toute autre qui ait en vue un grand objet d’utilité publique, n’oubliez pas que les débats de cette nature ont pour juge l’opinion, et qu’ils veulent être soutenus sur le terrain du principe et non sur celui de l’expédient. J’appelle Expédient, par opposition à Principe, cette disposition à juger les questions au point de vue des circonstances du moment, et même, trop souvent, des intérêts de classe ou des intérêts individuels. À une association il faut un lien, et ce ne peut être qu’un principe. À l’intelligence il faut un guide, une lumière, et ce ne peut être qu’un principe. Au cœur humain il faut un mobile qui détermine l’action, le dévouement, et au besoin le sacrifice ; et l’on ne se dévoue pas à l’expédient, mais au principe. Consultez l’histoire, Messieurs, voyez quels sont les noms chers à l’humanité, et vous reconnaîtrez qu’ils appartiennent à des hommes animés d’une foi vive. Je gémis pour mon siècle et pour mon pays de voir l’expédient en honneur, la dérision et le ridicule réservés au principe ; car jamais rien de grand et de beau ne s’accomplit dans le monde que par le dévouement à un principe. Ces deux forces sont souvent aux prises, et il n’est que trop fréquent de voir triompher l’homme qui représente le fait actuel, et succomber le représentant de l’idée générale. Cependant, portez plus loin votre regard, et vous verrez le Principe faire son œuvre, l’Expédient ne laisser aucune trace de son passage.
L’histoire religieuse nous en offre un admirable exemple. Elle nous montre le principe et l’expédient en présence dans le plus mémorable événement dont le monde ait été témoin. Qui jamais fut plus entièrement dévoué à un principe, au principe de la fraternité, que le fondateur du christianisme ? Il fut dévoué jusqu’à souffrir pour lui la persécution, la raillerie, l’abandon et la mort. Il ne paraissait pas se préoccuper des conséquences, il les remettait entre les mains de son Père et disait : Que la volonté de Dieu soit faite.
La même histoire nous montre, à côté de ce modèle, l’homme de l’expédient. Caïphe, redoutant la colère des Romains, transige avec le devoir, sacrifie le juste et dit : « Il est expédient (expedit) qu’un homme périsse pour le salut de tous. » L’homme de la transaction triomphe, l’homme du principe est crucifié. Mais qu’arrive-t-il ? Un demi-siècle après, le genre humain tout entier, Juifs et Gentils, Grecs et Romains, maîtres et esclaves, se rallient à la doctrine de Jésus ; et, si Caïphe avait vécu à cette époque, il aurait pu voir la charrue passer sur la place où fut cette Jérusalem qu’il avait cru sauver par une lâche et criminelle transaction [4]. (Applaudissements prolongés.)
[LE editor relates the following story: not in OC but LE]
Au moment où notre collaborateur venait de finir,M. Jules Duval lui a demandé s'il voulait bien consentir à ce que l'un des adeptes du Socialisme présentât quelques observations, et, en même temps, il s'est dirigé, du fond de l'auditoire où il avait pris place; vers la table où était assis M. Bastiat. M. Bastiat, après avoir fait remarquer qu'il n'avait parlé du socialisme que fort indirectement, et simplement pour appuyer quelques-unes de-ses opinions ; qu'il n'avait pas même voulu aborder dans cette soirée le fond de la question du libre échange, a cédé la parole à M. Jules Duval.
M. Jules Duval est l' un des principaux rédacteurs de la Démocratie Pacifique, organe quotidien de la Science sociale, découverte par Fourier, et l'on comprend tout de suite qu'i1 a dû formuler une série de reproches contre l'organisation actuelle de la société et contre l'école économique, qu'il suppose l'auteur et le défenseur de tout ce qui se fait dans ce monde. La liberté des échanges n'a pas été oubliée dans celte récrimination générale, et pendant les trois quarts d'heure qu'il a parlé, M. Duval a eu le talent de résumer tous les arguments que nous opposent quotidiennement nos adversaires. Néanmoins l'orateur phalanstérien a conclu à la générosité de la doctrine libre échangiste et à sa fécondité, lorsque la société se serait refondue et réorganisée sur les bases de la science sociale.
M. Jules Duval, nous nous plaisons à lui rendre cette justice, a parlé avec un véritable talent; mais son discours, nous devons le dire aussi, venait complètement à côté de celui de M. Bastiat, qui n'avait nullement traité les points qu'il est venu aborder et combattre. Nous ajouterons que tous les arguments de M. Jules Duval sont loin d'être d'accord avec les principes de l'école àlaquelle il appartient, et qu'il nous semble s'être beaucoup trop préoccupé du besoin de défendre le parti protectioniste, dont il a fidèlement reproduit les assertions.
M. Frédéric Bastiat, vu l'heure avancée, n'a pas pu combattre les nombreuses propositions de M. Jules Duval, et il s'est borné à renvoyer ses auditeurs à son écrit intitulé Sophismes économiques, dans lequel il s'est attaché à déraciner les plus grosses erreurs de la doctrine protectioniste. La séance a été levée, et chacun de ces jeunes gens a accepté un exemplaire de cet ouvrage, en témoignant, par son empressement du désir d'approfondir les importantes questions sur lesquelles son attention venait d'être appelée.
J.
FN:V. la dédicace du tome VI. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome VI, le chap. Échange.
FN:V. au tome IV, Baccalauréat et Socialisme, p. 442. (Note de l’éditeur.)
FN:V. les chap. xiv et xviii de la première série des Sophismes, t. IV, p. 86 et 64. (Note de l’éditeur.)
Autre réponse à la Presse sur la nature des échanges [10 Juillet 1847] ↩
BWV
1847.07.10 “Autre réponse à la Presse sur la nature des échanges” (Another Reply to La presse on the Nature of Commerce) [*Libre-Échange*, 10 Juillet 1847] [OC2.28, 158]
Réponse à la Presse sur la nature des échanges
10 Juillet 1847
À propos du tableau des importations et exportations en 1846, récemment publié par le Moniteur, la Presse a fait quelques remarques que nous ne pouvons laisser passer sans commentaire.
Après avoir constaté un accroissement considérable dans l’importation des blés, et une diminution notable dans l’exportation de nos vins et eaux-de-vie, la Presse dit :
« C’est donc avec nos épargnes que nous avons soldé nos achats de blé, non avec notre travail de l’année. Aussi, qu’est-il arrivé ? L’activité de nos usines et de nos manufactures s’est ralentie et devait se ralentir sous peine d’engorgement. Le prix de l’argent s’est élevé à mesure que le numéraire émigrait, et une crise qui dure encore est venue peser sur toutes les affaires. Ce seul fait, qui est aussi visible que le jour, que personne n’osera contester, renverse toute la théorie de ceux qui soutiennent qu’il est indifférent pour un peuple de payer ses acquisitions au dehors avec de l’argent ou avec des produits. Payer avec de l’argent, c’est diminuer à l’intérieur la masse des ressources disponibles, c’est accroître la difficulté des transactions, paralyser le travail, réduire les salaires, nuire plus ou moins profondément à tous les intérêts. Payer avec des produits, c’est, au contraire, fournir de nouveaux aliments au travail, créer des moyens d’utiliser tous les bras, répandre, avec des salaires durables et abondants, l’aisance et le bien-être dans toutes les classes. Il n’est donc pas vrai que ces deux modes d’échanges se ressemblent, et qu’il n’y ait aucun intérêt pour une nation à suivre celui-ci plutôt que celui-là. Chacun a pu, dans la sphère de ses relations ou de ses affaires, en acquérir la preuve depuis un an. »
Nous sommes d’accord avec la Presse sur le fait que, cette année, « la masse des ressources disponibles à l’intérieur a diminué, que la difficulté des transactions s’est accrue, que le travail a été paralysé, que les salaires ont été réduits, que tous les intérêts ont été plus ou moins profondément lésés. »
Nous ne sommes pas d’accord avec la Presse sur la cause de ce fait. Les calamités qu’elle vient de décrire, la Presse les attribue à ce que nous avons payé le blé étranger avec de l’argent. Nous les attribuons, nous, à ce que le blé a été cher ; et comme il a été cher parce que la récolte a manqué, nous considérons tous les malheurs ultérieurs, la baisse des salaires, la difficulté des transactions, etc., etc., comme les conséquences du déficit de nos récoltes.
Nous disons plus : une fois ce déficit décidé, tous les malheurs qui en sont la suite ont été décidés également. Ces malheurs eussent été bien plus grands encore, s’il ne nous était resté au moins la faculté de faire venir du blé du dehors, même contre notre argent, même contre nos épargnes. Cela est si vrai, que les restrictionnistes les plus renforcés ont acquiescé unanimement à l’ouverture de nos ports. Ils ont bien compris que mieux vaut donner son argent pour avoir du pain, que de manquer de pain et garder son argent. Le déficit de la récolte étant donné, l’exportation du numéraire, loin de causer la crise dont on se plaint, l’a atténuée. La Presse prend donc le remède pour le mal ; et, pour être conséquente, elle aurait dû demander, cette année plus que jamais, l’expulsion des blés étrangers.
Mais n’aurait-il pas mieux valu payer les blés avec des vins, des eaux-de-vie et des produits de notre industrie ? — Oui, certes, cela aurait mieux valu ; et probablement c’est de cette manière que nous aurions acquitté nos achats, au moins dans une beaucoup plus forte proportion, si la liberté des échanges avait, de temps immémorial, habitué les peuples producteurs de blé à consommer nos produits, et notre industrie à faire ce qui convient à ces peuples. Il n’en est pas ainsi ; chaque pays veut se suffire à lui-même ; et lorsqu’un fléau enlève à l’un d’entre eux les choses les plus nécessaires à la vie, il faut bien, ou qu’il s’en passe, ce qui équivaut à mourir, ou que, pour les obtenir de l’étranger, il lui livre la seule marchandise qui est partout accueillie, l’instrument de l’échange, le numéraire. Mais, encore une fois, le manque de la récolte et le système restrictif étant supposés, l’exportation de l’argent, loin d’être un mal, est un remède ; à moins qu’on ne prétende qu’il vaut mieux mourir d’inanition que de livrer ses écus contre des aliments. (V. le n°20 qui précède.)
La Presse insistera, nous en sommes persuadés, et dira : Reste toujours que la fameuse maxime : Les produits s’échangent contre des produits, est fausse et s’est montrée fausse dans cette circonstance.
Non, elle ne s’est pas montrée fausse. Les écus que nous avons envoyés en Russie étaient eux-mêmes venus du Mexique ; et de même que, pour les avoir des Français, les Russes ont exporté du blé, pour les obtenir des Mexicains nous avions exporté des tissus, des vins et des soieries. En sorte qu’en définitive nous avons échangé des produits contre des produits.
Il aurait mieux valu garder ses écus, dit-on. — Oui, si nous avions eu assez de blé. Le mieux est d’avoir à la fois le blé et les écus. Mais cela n’est pas possible du jour où la sécheresse brûle nos moissons. Donc c’est là l’origine et la cause du mal.
La Presse affirme que nous avons payé le blé, non-seulement avec nos écus, mais encore avec nos épargnes. — C’est fort possible. — Et rien n’est plus heureux, quand on comptait sur une moisson qui vous manque, que d’avoir au moins des épargnes pour acheter du pain.
Est-ce que la Presse s’attend, par hasard, lorsqu’un fléau emporte nos récoltes, à ce qu’il n’en résulte pas des maux qui se manifestent d’une manière quelconque ? La forme la plus directe de ce malheur c’eût été l’inanition.
Grâce à nos épargnes et au sacrifice que nous avons fait, ce malheur a affecté une autre forme, celle d’une crise commerciale et d’une gène industrielle. Sans doute, il aurait bien mieux valu ne souffrir d’aucune manière, recevoir tout le blé qui nous a manqué, et cependant, voir hausser les salaires, fleurir le travail, n’éprouver aucune difficulté dans nos transactions. Mais cela était-il possible ? Et puisque une année de souffrance a été décidée le jour où les épis de nos champs ont été frappés de mort, ne valait-il pas mieux, qu’à l’inanition générale, qui en était la conséquence naturelle, se substituât une crise financière, quelque déplorables qu’en soient les effets ?
On complique beaucoup ces questions en se méprenant sur les causes, ou en confondant les causes avec les effets. Après tout, une nation n’est qu’une grande famille, un peuple n’est qu’un grand individu collectif ; et les lois de l’économie sociale ne sont autres que celles de l’économie domestique sur un plus vaste développement.
Un cordonnier fait des souliers ; c’est là son gagne-pain. Du produit des souliers qu’il vend, il achète les choses qui lui sont nécessaires ; et certes, pour lui, il est vrai de dire que les produits s’échangent contre des produits, ou, si l’on veut, les services contre des services.
Cependant, il est prévoyant. Il ne veut pas consommer immédiatement tous les services auxquels son travail lui donne droit ; en un mot, il fait des épargnes. L’invention du numéraire sert merveilleusement ses desseins. À mesure qu’il livre ses services à la société, la société lui donne des écus, qui ne sont autre chose que des bons au moyen desquels il peut aller, quand il veut et dans la mesure qu’il veut, puiser dans la communauté des services équivalents à ceux qu’il lui a livrés. Il ne retire de ces services que ce qui lui est indispensable, et ménage prudemment ses bons soit qu’il les accumule, soit qu’il les prête moyennant rétribution.
Un jour fatal survient où notre homme se casse un bras. C’est un grand malheur qui en entraînera bien d’autres. Évidemment les choses ne peuvent aller comme si le malheur ne fût pas arrivé. Au lieu d’augmenter ses épargnes il les entame, et cela durera jusqu’à ce qu’il soit guéri. Il lui est pénible sans doute de toucher à ses épargnes, de se défaire de ses bons si laborieusement acquis. Mais s’il ne le faisait pas, il mourrait, ce qui serait plus pénible encore. Entre deux maux, qui sont la conséquence inévitable du malheur qui lui est survenu, il choisit le moindre. Il s’adresse à la communauté, et, ses bons à la main, il réclame des produits, équitable payement de ceux qu’il lui a livrés : des services, juste rémunération de ceux qu’il lui a rendus. C’est toujours des produits échangés contre des produits ; des services contre des services. Seulement, les services dont le cordonnier réclame le prix effectif, ont été rendus depuis longtemps et par lui transformés en simples bons, en écus.
Maintenant, dira-t-on que le vrai malheur de cet honnête artisan est de se défaire de ses écus ? Non ; son vrai malheur est de s’être cassé le bras.
Faisant abstraction de ce funeste accident, comme on fait abstraction de la perte des récoltes, et appliquant à l’individu ce que la Presse dit de la nation, dira-t-on :
« C’est donc avec ses épargnes que le cordonnier solde ses achats et non avec son travail de chaque jour. Aussi qu’est-il arrivé ? L’activité de son atelier s’est ralentie, et une crise qui dure encore est venue peser sur toutes ses affaires.
Ce seul fait, qui est aussi visible que le jour, que personne n’osera contester, renverse toute la théorie de ceux qui soutiennent qu’il est indifférent pour un cordonnier de payer ses acquisitions avec de l’argent ou avec des souliers. Payer avec de l’argent, c’est diminuer dans l’intérieur de son ménage la masse des ressources disponibles. C’est accroître la difficulté des transactions, paralyser le travail, réduire les salaires de ses ouvriers ou même les renvoyer, nuire plus ou moins profondément à tous les intérêts. Payer avec des souliers, c’est au contraire fournir de nouveaux aliments au travail, créer des moyens d’utiliser les bras, répandre, avec les salaires, l’aisance et le bien-être dans la classe des ouvriers cordonniers. Il n’est donc pas vrai que ces deux modes d’échanges se ressemblent, ni qu’il n’y ait aucun intérêt pour un cordonnier à suivre celui-ci plutôt que celui-là. »
Tout cela est fort vrai ; mais dans le cas national comme dans l’hypothèse individuelle, il y a un fait primitif qu’on laisse dans l’ombre, dont on ne parle même pas, à savoir, la perte de la récolte et le bras cassé. Voilà la vraie calamité, source de toutes les autres. Il est véritablement illogique de n’en pas tenir compte quand on s’afflige de voir une nation exporter son numéraire, ou un artisan se défaire de ses écus ; car c’est la perte de la récolte et le bras cassé qui déterminent le procédé qu’on signale comme la cause du mal, et qui, bien loin d’en être la cause, en est l’effet et même le remède.
Si, pour rendre la comparaison plus exacte, on supposait qu’au lieu de se casser le bras, notre cordonnier a éprouvé un incendie, le raisonnement serait le même.
Mais enfin, où en veut venir la Presse ? à quoi conclut-elle ?
Veut-elle insinuer qu’on a eu tort d’ouvrir nos frontières ? il le semble à son langage. Mais alors qu’elle dise donc nettement que, pour un peuple, l’exportation des écus est pire que la famine. Elle pourra, sans se contredire, invoquer plus que jamais la restriction.
Approuve-t-elle l’ouverture des ports ? C’est dire qu’il valait mieux exporter des écus et importer du blé que mourir de faim ; mais en ce cas, et quand, grâce à la liberté, nous avons pu entre ces deux maux choisir le moindre, quelle inconséquence n’est-ce pas de lui attribuer le moindre mal qu’elle nous a permis de choisir, sans lui tenir compte du mal plus grand qu’elle nous a permis d’éviter [1] ?
FN:V. tome V, pages 336 et suiv.(Note de l’éditeur.)
Sur l'éloge de Ch. Comte [11 July, 1847]↩
BWV
1847.07.11 "Sur l'éloge de Ch. Comte. Par M. Mignet" (On the Eulogy of M. Charles Comte by M. Mignet) [*Libre-Échange*, 11 July 1847] [OC1.11, pp. 434-39]
Sur l’éloge de M. Charles Comte, Par M. Mignet [1].
La vie, a-t-on dit, est un tissu d’illusions et de déceptions. — Oui, mais il s’y mêle quelques souvenirs qui l’imprègnent comme d’un parfum délicieux.
Telle fut pour moi la journée du 30 mai 1846.
Arraché au fond de la province par un caprice inattendu de la fortune, j’assistais pour la première fois à une séance publique de l’Académie des sciences morales et politiques.
Autour du fauteuil du président, M. Dunoyer, se groupaient tous les membres de l’illustre compagnie. En face, les tribunes, les loges, l’amphithéâtre suffisaient à peine à contenir l’élite de la société parisienne.
Le secrétaire perpétuel devait prononcer l’éloge de son prédécesseur, M. Charles Comte.
On se demandait avec anxiété : Comment M. Mignet, quel que soit son talent, parviendra-t-il à intéresser l’auditoire ? Que peut offrir de saisissant la vie d’un publiciste dont tous les jours furent absorbés par une polémique aujourd’hui oubliée et par des travaux approfondis sur la philosophie de la législation ? d’un journaliste probe, consciencieux, sévère, dont la vertu fut poussée jusqu’à la rudesse ? d’un écrivain laborieux et profond, mais qui semble avoir volontairement dédaigné, dans son œuvre, cette partie artistique qui, si elle n’ajoute rien, si elle nuit même quelquefois à la justesse des idées, peut seule néanmoins donner de l’éclat, de la popularité, de la puissance de propagation aux travaux de l’intelligence ?
Cependant M. Mignet commence sa lecture. Sa parole, ni trop lente ni trop rapide, se propage sans effort jusqu’aux extrémités de la salle. Il varie son sujet par des réflexions pleines d’à-propos et de justesse ; il l’égayé en le parsemant avec sobriété de ce sel attique dont on prétend, bien à tort sans doute, que la tradition se perd en France. Un débit toujours clair, des intonations toujours justes ne laissent échapper aucune des finesses du discours, aucune des intentions de l’orateur. Pendant une heure, l’auditoire reste comme enchaîné à ce récit, si pauvre de faits éclatants, mais si riche de nobles et pures émotions.
Mais quoi ! est-ce la phrase correcte, élégante, incisive de l’orateur ; est-ce sa belle diction qui retiennent ainsi l’assemblée captive ? qui font courir sur tous les bancs comme un frisson d’enthousiasme et unissent tous les cœurs dans un commun sentiment de pure joie et d’admiration passionnée ?
Non. — Mais M. Mignet avait vu et montrait à tous les yeux le beau côté de son sujet. Il peignait l’homme de bien, l’homme aux mâles résolutions, l’athlète vigoureux, l’intrépide défenseur des libertés publiques, le publiciste inflexible que ni les tentations de la corruption, ni les menaces, ni la persécution, ni l’attrait de la popularité, ni le besoin du repos, ni aucune considération humaine, ne firent jamais dévier de cette ligne de rectitude tracée par sa profonde conviction à son opiniâtre vertu.
Il semblait que cette chaude peinture d’une si belle vie, faisant contraste avec l’égoïsme et l’indifférence qui caractérisent l’époque actuelle, pénétrait dans toutes les sympathies de l’assemblée, et les remuait avec d’autant plus de puissance qu’on aurait pu les croire depuis plus longtemps assoupies. On aurait dit un public, aux impressions encore fraîches et naïves, recueillant de la bouche de Plutarque le récit d’une des plus nobles vies des héros antiques. Avec quel discernement vraiment français l’auditoire ne saisissait-il pas, pour les applaudir, les traits de courage, d’abnégation, de fière indépendance, dont abonde la noble carrière du publiciste ! Chacun de nous se reportait au temps à jamais passé de notre jeunesse, quand l’orateur disait :
« Le temps où s’est distingué M. Comte est déjà loin de nous. Ils sont loin de nous les souvenirs de ces convictions généreuses, de ces luttes persévérantes, de ces intrépides dévouements qui animaient tant de fermes esprits, qui inspiraient tant de nobles conduites. Alors on croyait aux idées avec une foi vive, on aimait le bien public avec une passion désintéressée. Ces belles croyances, qui sont l’honneur de l’intelligence humaine, M. Comte les a eues jusqu’à l’enthousiasme. Ces fortes vertus, qui sont aussi nécessaires à un peuple pour rester libre que pour le devenir, M. Comte les a portées jusqu’à la rudesse. »
Ah ! malgré le triste et décourageant spectacle qui s’offre de toute part autour de nous, quoique l’on n’aperçoive plus ni convictions énergiques, ni courage civil, ni résistance à la corruption, on ne saurait désespérer d’un pays où le simple récit de la vie de M. Comte éveille une si vive et si unanime satisfaction ! Non, le scepticisme n’a pas tout envahi, tout altéré, tout dégradé là où se montre cette ancre de salut du peuple, — l’intelligence d’honorer ce qui est honorable, — là où la puissance d’admiration vit encore !
Deux circonstances concouraient à jeter un intérêt touchant et comme quelque chose de dramatique sur cette solennité littéraire. Derrière l’orateur, le fauteuil de la présidence était occupé par M. Dunoyer. Chacun sentait que l’éloge de M. Mignet et l’enthousiasme de l’assemblée s’adressaient indirectement au collaborateur, à l’ami de M. Comte, à celui qui avait partagé les mêmes travaux, essuyé les mêmes persécutions, montré le même dévouement. Au premier banc des spectateurs, on voyait vêtus de deuil les quatre enfants de M. Comte, qu’une mort hâtée par le travail et la persécution avait trop tôt privés de leur père. Ils recueillent enfin, après dix longues années, le seul mais précieux héritage que puisse laisser un homme de cette trempe : un solennel hommage, un juste tribut d’admiration rendus à sa mémoire par une bouche éloquente, et sanctionnés par le sympathique et enthousiaste assentiment d’un public éclairé.
Je dois le dire cependant, si l’honorable secrétaire perpétuel fît une juste appréciation de l’homme en ce qui concerne ses actes, son caractère, son courage, ses vertus, il ne me parut pas placer le publiciste à sa véritable hauteur. Peut-être en cela son verdict a-t-il été trop influencé par celui de l’opinion publique, qui semble n’avoir pas suffisamment apprécié, de bien s’en faut, la valeur philosophique des ouvrages de M. Comte. Ce jugement, on pourrait le comprendre s’il se rapportait uniquement au style. Je l’ai déjà dit: dans un ouvrage qui traite, selon la méthode scientifique, ces vastes sujets sur lesquels Rousseau et Montesquieu ont répandu les couleurs de leur brillante imagination, M. Comte ne paraît pas s’être attaché à rendre à ses pensées saillantes par l’éclat de la forme, la variété des tons, l’imprévu des antithèses et toutes les ressources d’une rhétorique étudiée. On conçoit qu’un homme tel que l’a dépeint M. Mignet ait rejeté ces vains ornements qui, dans sa pensée, sont des pièges pour le lecteur quand ils ne le sont pas pour l’écrivain. Plus M. Comte atteignait à la simplicité de l’expression, plus il croyait éloigner de ses écrits les chances de l’erreur ; et la Vérité était le seul objet de son culte, celui auquel il était prêt à sacrifier, s’il l’eût fallu, bien plus que sa renommée littéraire.
Ne croyons pas néanmoins que ses ouvrages soient dépourvus d’éloquence. « Bien qu’il veuille, dit M. Mignet, appliquer dans sa rigueur et sa sécheresse la méthode analytique, M. Comte a l’esprit trop résolu et l’âme trop bouillante pour exposer sans s’émouvoir les longues traverses de l’humanité, je l’en loue, » Et ailleurs : « Sous des formes un peu âpres et avec des apparences froides, il avait cette bonté du cœur, cette chaleur de l’âme, cette élévation des sentiments, cette verve de la conviction qui se montrent à la fois dans ses écrits et dans sa vie. »
Mais si M. Comte s’élève souvent jusqu’à l’éloquence (en laissant à ce mot son acception reçue), lorsqu’il flétrit de sa parole énergique l’injustice et l’abus de la force, j’ose dire qu’une éloquence d’une autre nature et tout aussi vraie règne sur toutes les pages de ses écrits. En les lisant, le lecteur sent toujours comme une lumière qui se fait dans son intelligence. Il se sent épris d’admiration devant l’harmonieuse simplicité des lois que l’auteur expose, et ce sentiment est d’autant plus vif qu’il ne se sépare jamais de celui de la certitude. Je ne connais, quant à moi, aucun artifice de rhétorique capable de remplir l’âme d’aussi délicieuses émotions. N’y a-t-il pas de l’éloquence, la plus vraie de toutes les éloquences, dans la simple et claire exposition de l’harmonie qui préside aux mouvements des corps célestes ? Quand il y a de la beauté et de la grandeur dans un sujet, plus l’auteur parvient à concentrer votre attention sur le tableau, en se faisant oublier lui-même, plus j’ose dire qu’il atteint aux pures sources de l’art.
M. Comte n’a qu’un but : exposer. Mais il expose avec tant de netteté les conséquences des actions humaines, qu’en ne s’adressant qu’à l’intelligence il parle au cœur. Peu d’écrivains communiquent à l’âme une admiration aussi sincère pour ce qui est bien, une haine aussi vigoureuse pour l’injustice et la tyrannie. Non qu’il déclame, il se borne à décrire ; mais le sentiment qu’il ne conseille pas naît de la description, et je crois même, que si la vraie éloquence se fait sentir dans toutes ses pages, c’est que la déclamation en est sévèrement bannie. Quand le lecteur voit clairement l’enchaînement des causes et des effets, la sympathie et l’antipathie naissent à son insu dans son âme pour ne plus s’y éteindre, et sans qu’il soit nécessaire de lui dire ce qu’il faut haïr, ce qu’il faut aimer.
Je n’examinerai pas si le Traité de législation n’eût pas pu être conçu sur un plan plus méthodique ; quand on l’a lu, on comprend qu’il n’est que le frontispice d’une œuvre immense, interrompue par la mort et à jamais soustraite aux ardents désirs des amis de l’humanité.
Ce que je puis dire, c’est ceci : Je ne connais aucun livre qui fasse plus penser, qui jette sur l’homme et la société des aperçus plus neufs et plus féconds, qui produise au même degré le sentiment de l’évidence. Dans l’injuste abandon où la jeunesse studieuse semble laisser ce magnifique monument du génie, je n’aurais peut-être pas le courage de me prononcer ainsi, sachant combien je dois me défier de moi-même, si je ne pouvais mettre mon opinion sous le patronage de deux autorités : l’une est celle de l’Académie, qui a couronné l’ouvrage de M. Comte ; l’autre est celle d’un homme du plus haut mérite, à qui je faisais cette question que les bibliophiles s’adressent souvent : Si vous étiez condamné à la solitude et qu’on ne vous y permît qu’un ouvrage moderne, lequel choisiriez-vous ? Le Traité de législation de M. Comte, me dit-il ; car si ce n’est pas le livre qui dit le plus de choses, c’est celui qui fait le plus penser [2].
FN:Extrait du journal le Libre-Échange, n° du 11 juillet 1847. (Note de l’éditeur.)
FN:Il est peu de personnes, ayant eu des relations avec l’auteur, qui ne l’aient entendu désigner Ch. Comte comme celui de ses initiateurs, de ses maîtres auquel il devait le plus. Voir la correspondance et notamment les pages 60 et 62. (Note de l’éditeur.)
Cherté, bon marché [25 July, 1847] [CW3 ES2.5]↩
BWV
1847.07.25 “Cherté, bon marché” (High Prices and Low Prices) [*Libre-Échange*, 25 July, 1847] [ES2.5] [OC4.2.5, pp. 163-73] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Quatrième discours, à Lyon [août 1847] ↩
BWV
1847.08 “Quatrième discours, à Lyon” (Fourth Speech given in Lyon) [commencement d’août 1847] [OC2.45, p. 260]
Originally published in Libre-Échange, année 1, no. 39, pp. 309-10, “Conséquences comparées du régime protecteur et du libre-échange.”
Quatrième discours
Prononcé à Lyon, au commencement d’août 1847, sur les conséquences comparées du régime protecteur et du libre-échange.
Messieurs, il semble qu’en se permettant de convoquer un grand nombre de ses concitoyens autour d’une chaire pour leur adresser ce qu’on appelle un « discours, » on s’engage par cela même à remplir toutes les difficiles conditions de l’art oratoire. Je suis pourtant bien éloigné d’une telle prétention, et mon insuffisance me force de réclamer toute votre indulgence. Vous serez peut-être portés à me demander pourquoi, me sentant aussi dépourvu des qualités qu’exige la tribune, j’ai la hardiesse de l’aborder. C’est, Messieurs, qu’en considérant attentivement les souffrances et les misères qui affligent l’humanité, — le travail souvent excessif, la rémunération plus souvent insuffisante, — les entraves qui retardent ses progrès et font particulièrement obstacle à ses tendances vers l’égalité des conditions, j’ai cru très-sincèrement qu’une bonne part de ces maux devait être attribuée à une simple erreur d’économie politique, erreur qui s’est emparée d’assez d’intelligences pour devenir l’opinion, et, par elle, la loi du pays ; — et dès lors j’ai considéré comme un devoir de combattre cette erreur avec les deux seules armes honnêtes qui soient à ma disposition, la plume et la parole. Voilà mon excuse, Messieurs. J’espère que vous voudrez bien l’accueillir, car j’ai remarqué de tout temps que les hommes étaient disposés à beaucoup pardonner en faveur de la sincérité des intentions.
J’ai parlé d’une erreur qui prévaut, non-seulement dans la législation, mais encore et surtout dans les esprits. Vous devinez que j’ai en vue le système restrictif, cette barrière par laquelle les nations s’isolent les unes des autres, dans l’objet, à ce qu’elles croient, d’assurer leur indépendance et d’augmenter leur bien-être.
Je ne voudrais pas d’autres preuves de la fausseté de ce système que le langage qu’il a introduit dans l’économie politique, langage toujours emprunté au vocabulaire des batailles. Ce ne sont que tributs, invasions, luttes, armes égales, vainqueurs et vaincus, comme si les effets des échanges pouvaient être les mêmes que ceux de la violence. L’impropriété du langage ne révèle pas seulement la fausseté de l’idée, elle la propage ; car, après s’être servi de ces locutions dans le sens figuré, on les emploie dans leur acception rigoureuse, et l’on a entendu un de nos honorables protectionnistes s’écrier : « J’aimerais mieux une invasion de Cosaques qu’une invasion de bestiaux étrangers. » Je me propose d’exposer aujourd’hui les conséquences comparées du régime protecteur et du libre-échange ; mais, avant, permettez-moi d’analyser une des expressions que je viens de citer, celle de lutte industrielle. Cette expression, comme toutes celles qui trouvent un accès facile dans l’usage, a certainement un côté vrai. Elle n’est pas fausse, elle est incomplète. Elle se réfère à quelques effets, et non à l’ensemble des effets. Elle induit à penser que lorsque, dans un pays, une industrie succombe devant la rivalité de l’industrie similaire du dehors, la nation en masse en est affectée de la même manière que cette industrie. Et c’est là une grande erreur, car la lutte industrielle diffère de la lutte militaire en ceci : Dans la lutte armée, le vaincu est soumis à un tribut, dépouillé de sa propriété, réduit en esclavage ; dans la lutte industrielle, la nation vaincue entre immédiatement en partage du fruit de la victoire. Ceci paraît étrange et semble un paradoxe ; c’est pourtant ce qui constitue la différence entre ce genre de relations humaines qu’on nomme échanges, et cet autre genre de relations qu’on appelle guerres. Et, certes, on conviendra qu’il doit y avoir une dissemblance, quant aux effets, entre deux ordres d’action si différents par leur nature.
Comment se fait-il que le résultat de la lutte industrielle soit de faire participer le vaincu aux avantages de la victoire ? J’expliquerai ceci par un exemple familier, trop familier peut-être pour cette enceinte, mais que je vous demande la permission de vous soumettre comme très-propre à faire comprendre ma pensée.
Dans une petite ville, la maîtresse de maison fait ce qu’on nomme le pain du ménage. Mais voici qu’un boulanger s’établit aux environs. Notre ménagère calcule qu’elle aurait plus de profit à s’adressera l’industrie rivale. Cependant elle essaye de lutter. Elle s’efforce de mieux faire ses achats de blé, de ménager le combustible et le temps. Mais, de son côté, le boulanger fait des efforts semblables. Plus la ménagère diminue son prix de revient, plus le boulanger diminue son prix de vente, jusqu’à ce qu’enfin l’industrie du ménage succombe. Mais remarquez bien qu’elle ne succombe que parce qu’elle confère au ménage plus de profit en succombant qu’elle n’eût fait en se maintenant.
Il en est de même quand deux nations sont en lutte industrielle sur le terrain du bon marché ; et si les Anglais, par exemple, placés dans des conditions plus favorables, nous fournissent de la houille, ou le Brésil du sucre, à si bas prix qu’on n’en puisse plus faire en France, renoncer à en produire chez nous, c’est constater précisément l’avantage supérieur que nous trouvons à l’acheter ailleurs.
Entre ces deux cas, il n’y a qu’une différence : dans l’un, les qualités de producteur et de consommateur se confondent dans la même personne, et dès lors tous les effets de la prétendue défaite se montrent en même temps et sont faciles à comprendre ; dans l’autre, le consommateur de la houille ou du sucre n’est pas le même que le producteur, et il est alors aisé d’introduire dans le débat cette conclusion, qui consiste à ne montrer le résultat de la lutte que par un côté, celui du producteur, faisant abstraction du consommateur. Évidemment pour ne rien négliger dans l’appréciation du résultat général, il faut considérer la nation comme un être collectif qui comprend l’intérêt producteur et l’intérêt consommateur ; et alors on s’apercevra que la lutte industrielle l’affecte exactement comme elle affecte ce ménage que j’ai cité pour exemple. C’est, dans l’un et l’autre cas, l’acquisition par voie d’échange, choisie de préférence à l’acquisition par voie de production directe [1].
Mais, Messieurs, je veux, pour un moment, faire aussi abstraction de cette compensation que le consommateur recueille en cas de défaite industrielle, compensation dont les protectionnistes ne tiennent jamais compte. Je veux examiner la lutte industrielle sous le point de vue exclusif des industries qui y sont engagées, et rechercher si c’est la restriction ou la liberté qui leur donne les meilleures chances.
C’est encore une question intéressante ; car quand une grande ville, comme Lyon, par exemple, a fondé, au moins en grande partie, son existence sur une industrie, il est bien naturel qu’elle ne veuille pas la voir succomber par la considération des avantages qu’en pourraient recueillir les consommateurs.
Quel est le champ de bataille de deux industries rivales ? Le bon marche. Comment l’une peut-elle vaincre l’autre ? Par le bon marché. Si, d’une manière permanente, les Suisses peuvent vendre à 80 fr. la même pièce d’étoffe que vous ne pouvez établir qu’à 100 fr., vous serez battus.
Aussi, voyons-nous tous les hommes poursuivre instinctivement un but : la réduction des prix de revient.
Messieurs, je ne sais pourquoi on a voulu faire de l’économie politique une science mystérieuse, car, s’il est une science qui se tienne toujours près des faits et du bon sens, c’est certainement celle-là. Observez ce qui se passe dans vos comptoirs, dans vos ateliers, dans vos ménages, à la campagne, à la ville : que cherchent tous les hommes sans distinction de rangs, de races, de profession ? À diminuer le prix de revient.
C’est pour cela qu’ils ont substitué la charrue à la houe, la charrette à la hotte, la vapeur au cheval, le rail au pavé, la broche au fuseau; toujours, partout, on veut diminuer le prix de revient. N’est-ce pas une indication que les bons gouvernements doivent faire de même, agir dans le même sens ? Mais, au contraire, ils se sont fait une économie politique en vertu de laquelle, autant qu’il est en eux, ils enflent vos prix de revient ; car que fait le régime protecteur ? Il renchérit tous les éléments qui entrent dans vos prix de revient et les constituent. Ce n’est pas seulement son résultat, c’est sa prétention ; ce n’est pas un accident, c’est un système, un but, un parti pris. Ainsi, il se met en contradiction avec toutes les tendances de l’humanité. Et on appelle cela de l’économie politique sage et prudente !
Mais voyons un peu. De quoi se compose le prix de revient d’une pièce d’étoffe ? D’abord de toutes les matières qui entrent dans sa confection ; ensuite du prix de tous les objets qui ont été consommés par les travailleurs pendant le cours entier de l’opération. Il faut évidemment, pour que l’industrie continue, pour que l’opération se renouvelle, qu’à chaque fois le prix total de la vente couvre tous ces débours partiels.
Or, que fait le régime protecteur ? En tant qu’il agit, il ajoute, et il a la prétention d’ajouter à tous ces prix partiels. Il aspire méthodiquement à les élever. Il dit : Vous payerez un peu plus cher la machine, le combustible, la teinture, le lin, le coton et la laine qui entrent dans cette pièce d’étoffe. Vous payerez un peu plus cher le blé, le vin, la viande, les vêtements que vous et vos ouvriers aurez consommés et usés pendant l’opération, et de tout cela, il résultera pour vous un prix de revient plus élevé qu’il ne devrait l’être ; mais, en compensation, je vous donnerai un privilége sur les consommateurs du pays, et, quant à ceux du dehors, nous tâcherons de les décider à vous surpayer par les ruses diplomatiques, ou par un grand déploiement de forces qui retomberont encore à la charge de votre prix de revient.
Eh quoi ! Messieurs, ai-je besoin de vous dire toute l’inanité et tout le danger d’un pareil système ? À supposer que la contrebande ne vienne pas vous chasser du marché intérieur, ni les belles phrases, ni les canons, ni la complaisance avec laquelle les ministres vantent leur prudence et leur sagesse ne forceront l’étranger à vous donner 100 fr. de ce qu’il trouve ailleurs à 80.
Jusqu’ici vous n’avez peut-être pas beaucoup souffert de ce système (je me place toujours au point de vue producteur), mais pourquoi ? Parce que les autres nations, excepté la Suisse, s’étaient soumises aux mêmes causes d’infériorité. J’ai dit excepté la Suisse ; et remarquez que c’est aussi la Suisse qui vous fait la plus rude concurrence. Et cependant, qu’est-ce que la Suisse ? Elle ne recueille pas des feuilles de mûriers sur ses glaciers ; elle n’a ni le Rhône ni la Saône ; elle vous offusque néanmoins. Que sera-ce donc de l’Italie qui a commencé la réforme, et de l’Angleterre qui l’a accomplie ?
Car, Messieurs, on vous dit sans cesse que l’Angleterre n’a fait qu’un simulacre de réforme ; et, quanta moi, je ne puis assez m’étonner qu’on puisse, en France, au dix-neuvième siècle, en imposer aussi grossièrement au public sans se discréditer. Sans doute l’Angleterre n’a pas complétement achevé sa réforme ; mais pour qui comprend quelque chose dans la marche des événements, il est aussi certain qu’elle l’achèvera, qu’il est certain que l’eau du Rhône, qui passe sous les ponts de Lyon, se rendra à la Méditerranée. Et en attendant, on peut dire que la réforme est si avancée, en ce qui touche notre question, qu’on peut la considérer comme complète. L’Angleterre a affranchi de tous droits, et d’une manière absolue, la soie, la laine, le coton, le lin, le blé, la viande, le beurre, le fromage, la graisse, l’huile, c’est-à-dire les 99/100 de ce qui entre dans la valeur d’une pièce d’étoffe. Et vous n’êtes pas effrayés, voyant ce que peut la Suisse, de ce que pourra bientôt l’Angleterre ! Vous résisterez, je le sais, par la supériorité de votre goût, par les qualités artistiques qui distinguent vos fabricants. Mais il y a une chose à quoi rien ne résiste : c’est le bon marché.
On vous dit : « Pourquoi vous mêler d’économie politique ? Occupez-vous de vos affaires. » Vous le voyez, Messieurs, l’économie politique pénètre au cœur de vos affaires. Elle vous intéresse aussi directement que le bon état de vos machines ou de vos routes, qui ont pour objet de diminuer vos prix de revient.
Hier, on me citait un fait qui doit être ici à la connaissance de tout le monde, et qui est bien propre à vous faire réfléchir. On m’assurait, et je n’ai pas de peine à le croire, car c’est bien naturel, qu’à cause de l’influence de l’octroi sur la cherté de la vie, toutes les industries qui n’ont pas besoin de s’exercer au milieu d’une grande agglomération d’hommes tendaient à aller s’établir à la campagne.
Eh bien ! Messieurs, entre une nation et une autre, la douane fait exactement ce que fait l’octroi entre la ville et la campagne ; et, par la même raison qu’on va tisser aux environs plutôt que de tisser à Lyon, on ira tisser en Angleterre plutôt que de tisser en France.
Et remarquez que l’octroi ne renchérit que les objets de consommation. La douane renchérit et les objets de consommation et toutes les matières qui entrent dans la confection du produit. N’est-il pas clair, Messieurs, que la tendance à laquelle je fais ici allusion serait bien plus manifeste si l’octroi frappait la soie, la teinture, les machines, le fer, le coton et la laine ?
Le régime prohibitif ne surcharge pas les prix de revient seulement par les droits et les entraves ; il les grève encore par la masse énorme d’impôts qu’il traîne à sa suite.
D’abord, il paralyse l’action de la douane, en tant qu’instrument fiscal, cela est évident. Quand on prohibe textuellement ou non le drap et le fer, on renonce à tout revenu public de ce côté. Il faut donc tendre les autres cordes de l’impôt, le sel, la poste, etc.
Une ville a mis un droit d’octroi sur l’entrée des légumes, et tire de cet impôt un revenu de 20,000 fr., indispensable à sa bonne administration. Dans cette ville, il y a plusieurs maisons qui jouissent de l’avantage d’avoir des jardins. Le hasard, ou l’imprévoyance des électeurs, fait que les propriétaires de ces maisons forment la majorité du conseil municipal. Que font-ils ? Pour donner de la valeur à leurs jardins, ils prohibent les légumes de la campagne. Je n’examine point ici le point de vue moral ni le côté économique de cette mesure. Je me renferme dans l’effet fiscal. Il est clair comme le jour que la caisse de la ville aura perdu 20,000 fr., quoique les habitants payent leurs légumes plus cher que jamais ; et je prévois que M. le maire, s’il a un grain de sagesse dans la cervelle, viendra dire à son conseil : Messieurs, je ne puis plus administrer. Il faut de toute nécessité, puisque vous repoussez les légumes étrangers, dans l’intérêt, dites-vous, des habitants, frapper ces mêmes habitants d’un impôt de quelque autre espèce.
C’est ainsi que l’exagération de la douane a conduit à des taxes de nouvelle invention.
Ensuite, le régime prohibitif nécessite un grand développement des forces militaires et navales ; et ceci, Messieurs, mérite que nous nous y arrêtions un instant.
Ce régime est né de l’idée que la richesse, c’est le numéraire. Partant de là, voici comment on a raisonné : il y a une certaine quantité de numéraire dans le monde ; nous ne pouvons augmenter notre part qu’en diminuant celle des autres, — d’où, par parenthèse, cette conclusion désespérante : la prospérité d’un peuple est incompatible avec la prospérité d’un autre peuple.
Mais ensuite, comment faire pour soutirer l’argent des autres nations et pour qu’elles ne nous soutirent pas le nôtre ? Il y a deux moyens. Le premier, c’est de leur acheter le moins possible. Ainsi nous garderons notre numéraire ; de là la restriction et la prohibition. Le second, c’est de leur vendre le plus possible. Ainsi nous attirerons à nous leurs métaux précieux ; de là le système colonial. Car, Messieurs, pour assurer la vente, il faut donner à meilleur marché ; — et la restriction, comme nous venons de voir, est un empêchement invincible. Il a donc fallu songer à vendre cher, plus cher que les autres ; mais cela ne pouvait se faire qu’en subjuguant les consommateurs, en leur imposant nos lois et nos produits ; en un mot, en ayant recours à ce principe de destruction et de mort : la violence.
Mais, si ce principe est bon et vrai pour un pays, il est bon et vrai pour tous les autres. Ils ont donc tous tendu vers ces deux choses contradictoires : vendre sans acheter, — et de plus, vers les acquisitions de colonies et les agrandissements de territoire.
En d’autres termes, le principe de la restriction a jeté dans le monde un antagonisme radical, et un ferment de discorde pour ainsi dire méthodique.
Or, quand les choses en sont là, quand la tendance de tous les peuples à la fois est de se ruiner réciproquement et de se dominer les uns les autres, il est bien clair que chacun doit se soumettre aussi à un autre effort, quelque pénible qu’il soit, celui de se donner de fortes armées permanentes et de puissantes marines militaires.
Et cela ne se peut sans de lourds impôts, d’interminables entraves ; ce qui aboutit encore, et toujours, à augmenter le prix de revient des produits.
Ainsi, entraves, gênes, impôts, priviléges, inégalités, renchérissement des objets de consommation, renchérissement des matières premières, infériorité industrielle, jalousies nationales, principe d’antagonisme, armées permanentes, puissantes marines, guerres imminentes, développement de la force brutale, voilà le programme du régime restrictif. Je voudrais vous présenter aussi celui du libre-échange. Mais quoi ! ai-je autre chose à faire pour cela que de prendre justement le contre-pied de ce que je viens de dire ?
Le libre-échange est non-seulement une grande réforme, mais c’est la source obligée de toutes les réformes financières et contributives.
Quand on a demandé la réduction du port des lettres, l’abaissement de l’impôt du sel, la simple exécution de la loi sur les surtaxes, qu’a-t-il été répondu ? « Rien de tout cela ne peut se faire sans que le fisc perde quelques millions ! » Le problème, l’éternel problème est donc de trouver ces quelques millions, quelque chose qui fasse l’office qu’a fait l’income-tax entre les mains de sir Robert Peel.
Eh bien ! par un bonheur providentiel, pour le salut de nos finances, il se rencontre que la douane se présente, parmi tous nos impôts, avec ce caractère unique, étrange, qu’en soulageant le contribuable on élève le revenu. C’est ce qu’avouent, de la manière la plus explicite, les deux grands apôtres de la restriction ! « Si la douane n’était que fiscale, dit M. Ferrier, elle donnerait peut-être le double de revenu. » « Il n’est pas étonnant, ajoute M. de Saint-Cricq, que la douane rende peu, puisque son objet est précisément d’éloigner les occasions de perception ! »
Donc, en transformant la douane protectrice en douane fiscale, c’est-à-dire en faisant une institution nationale de ce qui n’est qu’une machine à priviléges, vous avez de quoi faire face à la réforme de la poste et du sel.
Mais ce n’est pas tout, je vous ai fait voir que la restriction était un principe de guerre ; par cela même le libre-échange est un principe de paix. Qu’on dise que je suis un rêveur, un enthousiaste, peu m’importe, je soutiens qu’avec le libre-échange et l’entrelacement des intérêts qui en est la suite, nous n’avons plus besoin, pour maintenir notre indépendance, de transformer cinq cent mille laboureurs en cinq cent mille soldats. Quand les Anglais pourront aller, comme nous, à la Martinique et à Bourbon, quand nous pourrons aller, aussi bien qu’eux, à la Jamaïque et dans l’Inde, quel intérêt aurions-nous à nous arracher des colonies et des débouchés ouverts à tout le monde ?
Non, je ne me laisse pas aller ici à un désir, à un sentiment, à une vague espérance. J’obéis à une conviction entière, fondée sur ce qui est pour moi une démonstration rigoureuse, quand je dis que l’esprit du libre-échange est exclusif de l’esprit de guerre, de conquête et de domination. Dès que l’on comprendra que la prospérité réelle, durable, inébranlable de chaque industrie particulière est fondée, non sur les monopoles nuisibles aux masses, mais au contraire sur la prospérité des masses qui sont sa clientèle, c’est-à-dire du monde entier ; quand les Lyonnais croiront que plus les Américains, les anglais, les Russes, seront riches, plus ils achèteront de soieries ; quand la même conviction existera dans chaque centre de population et d’industrie ; en un mot, quand l’opinion publique sanctionnera le libre-échange, je dis que la dernière heure des agressions violentes aura sonné, et que, dès ce moment, nous pourrons diminuer dans une forte proportion nos forces de terre et de mer.
Car le meilleur des boulevards, la plus efficace des fortifications, [118] la moins dispendieuse des armées, c’est le libre-échange, qui fait plus que de repousser la guerre, qui la prévient ; qui fait mieux que de vaincre un ennemi, qui en fait un ami.
Et, à cet égard, ma foi dans le libre-échange est telle que je veux la mettre ici à l’épreuve d’une prédiction, quoique je sache combien il est dangereux de faire le prophète, même hors de son pays. Si ma prédiction ne se vérifie pas, je consens, il le faudra bien, à ce que mes paroles perdent le peu d’autorité qui peut s’y attacher. Mais aussi, si elle s’accomplit, j’aurai peut-être droit à quelque confiance. L’Angleterre a adopté le libre-échange. Je prédis solennellement que d’ici à sept ans, c’est-à-dire pendant le cours de la législation actuelle, elle aura licencié la moitié de ses forces de mer. — On me dira sans doute : Cela est si peu probable que, le jour même où sir Robert Peel a introduit la réforme, et, dans le même exposé des motifs, il a demandé une allocation pour augmenter la marine. — Je le sais, et j’ose dire que c’est la plus grande faute, sous tous les rapports, et la plus grande inconséquence qu’ait faite cet homme d’État, d’ailleurs alors nouveau converti au libre-échange. — Mais cette circonstance, en rendant ma prédiction plus hasardée, ne fait que lui donner plus de poids si elle se réalise [2].
Nos forces de terre et de mer ramenées ainsi successivement à des proportions moins colossales, je n’ai pas besoin de dire la série de réformes financières et contributives qui deviendraient enfin abordables. Trop de précision à cet égard me ferait sortir de mon sujet. Je crois pouvoir dire cependant que, procédant du libre-échange, ces réformes seraient faites dans son esprit et s’attaqueraient d’abord aux impôts qui présentent un caractère évident d’inégalité, ou gênent les mouvements du travail et la circulation des hommes et des produits. C’est nommer l’octroi et la législation des boissons.
Il me sera permis aussi de faire observer qu’une réduction des forces de terre et de mer amènerait de toute nécessité un adoucissement de la loi du recrutement, si lourde pour la population des campagnes, et de l’inscription maritime, plus onéreuse encore pour notre population du littoral, en même temps qu’elle est, après le régime restrictif, le plus grand fléau de notre marine marchande. (V. le n°36.)
Messieurs, je livre ces remarques à vos méditations. Examinez-les en toute sincérité : vous vous convaincrez qu’il n’y a rien de chimérique, rien d’impraticable ; que celui qui vous parle n’est pas un illuminé ; que ces réformes naissent les unes des autres, et ont leur base dans celle de notre législation commerciale. Que faut-il pour réaliser le bien dont je n’ai pu vous tracer qu’une bien incomplète esquisse ? Rien qu’une seule chose, partager l’esprit du libre-échange. Aidez-nous dans cette entreprise ; j’en appelle à vous tous, Messieurs, et particulièrement à ceux d’entre vous qui tiennent en leurs mains les véhicules de l’instruction, les organes de la publicité. Ils savent aussi quelle responsabilité morale se lie à cette puissance. Je les en conjure, qu’aucune considération de personne ou de parti ne les détourne de se dévouer à la cause, à la sainte cause de la libre communication et de l’union des peuples. À Dieu ne plaise que je demande à qui que ce soit le moindre sacrifice de ses convictions politiques ! mais, grâce au ciel, la foi dans le libre-échange peut s’allier avec les opinions les plus divergentes en d’autres matières. On l’a vue soutenue par le journal des Débats, par le Siècle, par le Courrier ; et le National a déclaré que la liberté du travail et de l’échange était la fille de ses œuvres. En voulez-vous un autre exemple? Voyez-la régner de temps immémorial sur le pays le plus démocratique de la terre, la Suisse, et s’établir au sein de la nation la plus aristocratique du monde, l’Angleterre. Hommes de toutes les opinions politiques, unissons-nous pour éclairer l’opinion. Ne disons pas qu’il ne se présentera point un grand ministre pour réaliser nos vœux. L’opinion publique est le foyer où se forment les grands hommes. Quand nous avons eu à défendre ou notre territoire, ou le principe de la révolution française, ce ne sont ni les généraux habiles, ni les soldats dévoués qui nous ont manqué. De même, quand l’opinion voudra la liberté commerciale, ce n’est pas un homme d’État qui nous fera défaut, un homme sincère et dévoué se présentant devant la chambre avec le plan de réforme que je viens d’esquisser, et osant dire : Voilà un programme de justice et de paix ; il triomphera avec moi, ou je tomberai avec lui !
FN:V. le chap. Domination par le travail, tome IV, p. 265.(Note de l’éditeur.)
FN:Voir la note finale du tome III, p. 518. (Note de l’éditeur.)
Cinquième discours, à Lyon [august 1847] ↩
BWV
1847.08 “Cinquième discours, à Lyon” (Fifth Speech given in Lyon) [août 1847] [OC2.46, p. 273]
Cinquième discours
Prononcé dans la seconde réunion publique tenue à Lyon, en août 1847, sur l’influence du régime protecteur à l’égard des salaires
Messieurs,
Si dans ces communications, que vous voulez bien me permettre d’avoir avec vous, j’avais en vue un succès personnel, certes, je ne paraîtrais pas aujourd’hui à cette tribune. Ce n’est pas que, sur le vaste sujet qui m’est proposé, les idées ou les convictions me fassent défaut. Au contraire, car, quand j’ai voulu mettre quelque ordre dans les démonstrations que j’avais à vous soumettre, elles se sont présentées en si grand nombre à mon esprit que, malgré mes efforts, il m’a été impossible de faire entrer tous ces matériaux dans le cadre d’un discours ; et j’ai dû prendre le parti de m’en remettre beaucoup à l’inspiration du moment et à votre bienveillance.
Et cependant, cette grande question du salariat, je dois la circonscrire à un seul point de vue, car vous n’attendez pas que je la traite ici dans tous ses aspects moraux, sociaux, philosophiques et politiques.
Cela me conduirait à scruter les fondements de la propriété, l’origine et les fonctions du capital, les lois de la production, de la répartition des richesses, et même de la population ; à rechercher si le salariat est, pour une portion de l’humanité, une forme naturelle, équitable et utile de participation aux fruits du travail ; si celte forme a toujours existé, si elle est destinée a disparaître, et, enfin, si elle est une transition entre un mode imparfait et un mode moins défectueux de rémunération, entre le servage dans le passé et l’association dans l’avenir.
Loin de moi de blâmer les hardis pionniers de la pensée qui explorent ces vastes régions. Quelquefois, il est vrai, j’ai souhaité de leur voir poser le pied sur le terrain solide des vérités acquises, plutôt que de rester dans le vague ou d’emprunter les ailes de l’imagination. J’ai peu de foi, je l’avoue, dans ces arrangements sociaux, dans ces organisations artificielles que chaque matin voit éclore et que chaque soir voit mourir. Il n’est pas probable qu’à un signal donné l’humanité se laisse jeter dans un moule, quelque séduisante qu’en soit la forme, quel que soit le génie de l’inventeur. La société m’apparaît comme une résultante. Les faits passés qui exercent tant d’influence sur le présent, les traditions, les habitudes, les erreurs dominantes, les vérités acquises, les expériences faites, les préjugés, les passions, les vertus, les vices, voilà les forces diverses qui déterminent nos institutions et nos lois. Comment croire que la société s’en dépouillera tout à coup, comme on rejette un vêtement pour en prendre un à la mode ? — Je n’en rends pas moins justice aux bonnes intentions des publicistes qui poursuivent cette chimère, et je crois qu’ils ont rendu un service à la science en la forçant de scruter ces grandes questions et d’élargir le champ de ses études [1].
Mais s’il est vrai que le progrès soit subordonné à la diffusion de la lumière et de l’expérience, je ne vois pas qu’on puisse blâmer, comme on le fait, un homme ou une association d’hommes qui s’attaquent aune erreur déterminée, laquelle a donné naissance à une institution funeste.
On nous dit sans cesse que le libre-échange ne donne pas la clef du grand problème de l’humanité. Il n’a pas cette prétention. Il ne s’annonce pas comme devant panser toutes les plaies, guérir tous les maux, dissiper tous les préjugés, fonder à lui seul le règne de l’égalité et de la justice parmi les hommes, et ne laisser, après lui, rien à faire à l’humanité.
Nous croyons qu’il est en lui-même un très-grand progrès, et de plus, par l’esprit qu’il propage, par les lumières qu’il suppose, une excellente préparation à d’autres progrès encore. Mais nous nous rendrions coupables d’exagération si nous le présentions, ainsi qu’on nous en accuse souvent, comme une panacée universelle, particulièrement à l’égard des classes laborieuses.
Je me renfermerai donc dans cette question :
Quelle est l’influence du régime restrictif sur le taux des salaires, ou plutôt sur la condition des ouvriers ?
Voilà tout ce que je veux examiner. Je ne cherche pas ce que deviendrait le sort de cette classe dans un phalanstère ou en Icarie. Je prends la société telle qu’elle est, telle que le passé nous l’a léguée. Dans cette société je vois le capital rémunérant le travail. C’est un premier fait. Je vois en outre des légions d’hommes occupés à entraver la circulation des produits ; c’est un second fait. Je cherche comment le second de ces faits agit sur le premier.
Et d’abord une première question se présente à moi. Qui a placé là cette légion armée ? Ce ne sont pas les ouvriers, puisqu’ils n’ont pas la voix au chapitre ; ce sont les maîtres. Donc, en vertu de la maxime : Id fecit cui prodest, la présomption est que cette institution, si elle profite à quelqu’un, profite aux maîtres.
Messieurs, permettez-moi de raisonner provisoirement sur cette hypothèse que le régime restrictif, dans l’ensemble de ses effets, bons et mauvais, entraîne une certaine déperdition de forces utiles ou de richesses. Cette hypothèse n’est pas tellement absurde qu’on ne puisse s’en servir un instant. Je n’ai jamais rencontré personne qui ne m’ait fait cette concession sous cette forme : Vous avez raison en principe. Le fondateur du système restrictif en France l’a lui-même considéré comme transitoire, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait reconnu dans son essence une vertu productive. Il paraît certain qu’empêcher les produits du Midi de pénétrer dans le Nord, et réciproquement, favoriser par là dans le Nord des industries que seconderait mieux le climat du Midi, c’est paralyser partout une certaine portion de ces forces gratuites que la nature avait mises à la disposition des hommes. Je puis donc sans témérité raisonner un instant sur cette hypothèse, admise d’ailleurs par les protectionnistes eux-mêmes, que le régime prohibitif, dans l’ensemble de ses effets, tout compensé, entraîne la déperdition d’une certaine quantité de richesses.
De plus, l’instrument lui-même coûte quelque chose. Les incertitudes que les tarifs sujets à changement font planer sur l’industrie et le commerce, les collisions qu’ils peuvent amener entre les peuples, et contre lesquelles il faut se précautionner, le développement qu’il faut donner à l’action de la justice pour réprimer des actions innocentes en elles-mêmes, que cette législation fait inscrire au nombre des délits et des crimes, les obstacles, les visites, les retards, les erreurs, les contestations, — ce sont autant d’inconvénients inséparables du système, et qui se traduisent en déperdition de forces. Tout le monde sait que le seul retard, apporté cette année à la suspension de l’échelle mobile, a peut-être coûté à la France cinquante millions.
Or, si, au total, dans la généralité de ses effets directs ou indirects, le système restrictif entraîne une déperdition de richesses, il faut nécessairement que cette perte retombe sur quelqu’un.
Lors donc que les législateurs protectionnistes affirment que la classe ouvrière, non-seulement n’entre pas en participation de la perte définitive, mais encore bénéficie par ce régime, c’est comme s’ils disaient:
« Nous, qui faisons la loi, voulant procurer à la classe ouvrière un profit extra-naturel, nous nous infligeons encore une seconde perte égale à tout le bénéfice que nous prétendons conférer aux ouvriers. »
Je le demande : Y a-t-il aucune vraisemblance que les législateurs aient agi ainsi [2] ?
Qu’on me permette de formuler ma pensée dans la langue des chiffres, non pour arriver à des précisions exactes, mais par voie d’élucidation.
Représentons par 100 le revenu national sous l’empire des relations libres. Nous n’avons aucune donnée pour savoir comment le revenu se partage entre le capital et le travail. Mais comme, si les capitalistes sont plus riches, les travailleurs sont plus nombreux, admettons 50 pour les uns, et 50 pour les autres. Survient la restriction. Et d’après notre hypothèse le revenu général descend à 80. — Or, selon les protectionnistes, la part des ouvriers étant augmentée, nous pouvons la supposer de 60, d’où il suit que celle des capitalistes tomberait à 20.
Je défie les protectionnistes de sortir de ce cercle. S’ils conviennent que le régime protecteur entraîne une perte comme résidu général de tous ses effets, et s’ils affirment néanmoins qu’il enrichit les ouvriers, la conséquence nécessaire est que ceux qui n’ont pas fait la loi recueillent un profit, et que ceux qui ont fait la loi encourent deux pertes [3].
Et, s’il en est ainsi, il faudrait regarder comme attaqués de folie les hommes qui, dans l’intérêt des ouvriers, réclament une extension de droits politiques ; car, certes, jamais les ouvriers, dans leur esprit de justice, ne feraient aussi bien leurs affaires, et n’infligeraient aux capitalistes une loi aussi rigoureuse.
Mais voyez à quelle absurde contradiction on arrive. Qui m’expliquera comment il se fait que, le capital se détruisant, le travail se développe, et que, pour comble d’absurdité, la loi qui détruit le capital soit précisément celle qui enrichit le travail ?
Je ne pense pas qu’on puisse contester la rigueur de ces déductions. Seulement, on pourra dire : Elles reposent sur l’assertion que le régime restrictif entraîne une déperdition de forces, et c’est là une concession que les protectionnistes ont faite, il est vrai, mais qu’ils se hâtent de retirer.
Eh ! Messieurs, c’est précisément où je voulais vous amener : à reconnaître qu’il faut étudier le régime restrictif en lui-même ; savoir si, au total, il entraîne ou n’entraîne pas une déperdition de richesses. S’il l’entraîne, il est jugé ; et lorsqu’on met en avant les ouvriers et leurs salaires, je ne dirai pas qu’on ajoute l’hypocrisie à la cupidité, mais qu’on entasse erreur sur erreur.
La vérité est qu’en vertu de la loi de solidarité, de l’effort que chacun fait pour se débarrasser du fardeau, de cette vis medicatrix qui est au fond de la société humaine, le mal tend à se répartir sur tous, maîtres et ouvriers, on proportions diverses.
Ne nous en tenons pas à des présomptions, et attaquons directement le problème.
Un simple ouvrier l’a admirablement posé en ces termes pleins de justesse et de clarté :
Quand deux ouvriers courent après un maître, les salaires baissent.
Quand deux maîtres courent après un ouvrier, les salaires haussent.
L’économie politique ne fait qu’habiller cette pensée d’un vêtement plus doctoral quand elle dit : Le taux du salaire dépend du rapport de l’offre à la demande.
Le capital et le travail, voilà les deux éléments de ce taux. Quand il y a sur le marché une quantité de capital et une quantité de travail déterminées, le taux moyen des salaires s’en déduit de toute nécessité. Les maîtres voulussent-ils l’élever par bienveillance, ils ne le pourraient pas. Si le capital est représenté par 100 fr. et le travail par 100 hommes, le salaire ne peut être que de 1 fr. Si la philanthropie des maîtres ou de la loi le portait à 2 fr., le capital restant à 100, comme de 100 fr. on ne peut tirer que 50 fois 2 fr., il n’y aurait que 50 ouvriers d’employés. L’humanité en masse n’en serait que plus malheureuse, et l’inégalité des conditions plus choquante ; et, sans parler de la perte résultant de l’inactivité de 50 ouvriers, il est clair que la position ne serait plus tenable, que ces 50 ouvriers viendraient offrir leurs bras au rabais, et que la force des choses ramènerait la répartition primitive.
Il n’y a donc pas d’autre moyen au monde d’augmenter le taux des salaires que d’augmenter la proportion du capital disponible, ou de diminuer la quantité du travail offert [4].
Cela posé, voyons comment le régime protecteur agit sur chacun de ces deux éléments.
Une nation est sous le régime libre, et elle possède, de temps immémorial, une fabrique de drap. La présomption est que, puisqu’une certaine portion de capital et de travail a pris naturellement cette direction, cette industrie, malgré la concurrence étrangère, réalise des profils égaux à ceux des autres entreprises analogues. Si elle donnait beaucoup moins, elle ne se serait pas établie ; si elle donnait plus, elle ne serait pas seule.
Cependant elle provoque la prohibition du drap étranger. Voyons ce qui se passe.
D’abord, le premier effet, l’effet le plus immédiat est que le drap renchérit ; et tous les habitants, y compris les ouvriers de toute sorte qui se vêtissent de drap, sont frappés comme d’une taxe. C’est pour eux une perte bien réelle. Je vous prie d’en prendre bonne note, de ne pas la perdre de vue ; je vous la rappellerai plus tard, quand nous aurons vu si nous lui trouvons ou non une compensation.
Puisque le drap est plus cher, notre fabrique fait plus de profits ; et puisque ses profits antérieurs étaient égaux aux profits moyens des industries analogues, ses profits actuels seront supérieurs. Or, vous savez que la tendance des capitaux est de se porter et d’entraîner le travail là où sont les plus gros bénéfices. Il y aura donc, dans la fabrication du drap, un surcroît de demande de travail et un surcroît de capital pour y faire face, c’est-à-dire ce qui constitue précisément les conditions dans lesquelles le salaire hausse. C’est là que les protectionnistes triomphent.
Mais, ainsi que je le répète souvent, les sophismes ne sont pas des raisonnements faux, ce sont des raisonnements incomplets. Ils ont le tort de ne montrer qu’une chose là où il y en a deux ; et la médaille par un seul côté.
D’où sort ce capital qui va étendre la fabrication du drap ? Voilà ce qu’il faut examiner, et voilà sur quoi j’appelle toute votre attention ; car évidemment, Messieurs, si nous venions à découvrir que le plein ne s’est fait d’un côté qu’aux dépens d’un vide qui se serait fait d’un autre, et que la prohibition a agi comme cette servante qui prenait par le dessous d’une pièce de vin de quoi combler ce qui manquait au-dessus, évidemment, dis-je, nous ne serions pas plus avancés, et nous serions en droit de reprocher au sophisme d’avoir dissimulé cette circonstance.
Donc, d’où sort ce capital ? Le soleil ou la lune l’ont-ils envoyé mêlé à leurs rayons, et ces rayons ont-ils fourni au creuset l’or et l’argent, emblèmes de ces astres ? ou bien l’a-t-on trouvé au fond de l’urne d’où est sortie la loi restrictive ? Rien de semblable. Ce capital n’a pas une origine mystérieuse ou miraculeuse. Il a déserté d’autres industries, par exemple, la fabrication des soieries. N’importe d’où il soit sorti, et il est positivement sorti de quelque part, de l’agriculture, du commerce et des chemins de fer, là, il a certainement découragé l’industrie, le travail et les salaires, justement dans la même proportion où il les a encouragés dans la fabrication du drap. — En sorte que vous voyez, Messieurs, que le capital ou une certaine portion de capital ayant été simplement déplacé, sans accroissement quelconque, la part du salaire reste parfaitement la même. Il est impossible de voir, dans ce pur remue-ménage (passez-moi la vulgarité du mot), aucun profit pour la classe ouvrière. Mais, a-t-elle perdu ? Non, elle n’a pas perdu du côté des salaires (si ce n’est par les inconvénients qu’entraîne la perturbation, inconvénients qu’on ne remarque pas quand il s’agit d’établir un abus, mais dont on fait grand bruit et auxquels les protectionnistes s’attachent avec des dents de boule-dogues quand il est question de l’extirper) ; la classe ouvrière n’a rien perdu ni gagné du côté du salaire, puisque le capital n’a été augmenté ni diminué, mais seulement déplacé. Mais reste toujours cette cherté du drap que j’ai constatée tout à l’heure, que je vous ai signalée comme l’effet immédiat, inévitable, incontestable de la mesure ; et à présent, je vous le demande, à cette perte, à cette injustice qui frappe l’ouvrier, où est la compensation ? Si quelqu’un en sait une, qu’il me la signale.
Et songez, Messieurs, qu’une perte semblable se renouvelle vingt fois par jour, — à propos du blé, à propos de la viande, à propos de la hache et de la truelle. L’ouvrier ne peut ni manger, ni se vêtir, ni se chauffer, ni travailler, sans payer ce tribut au monopole. On parle de sa malheureuse condition. Pour moi, ce qui m’étonne, en présence de tels faits, c’est que cette condition ne soit pas cent fois plus malheureuse encore.
Heureusement que cette cherté ne se maintient jamais, grâce au ciel, à la hauteur où les monopoleurs voulaient l’élever. Je le reconnais ici, parce qu’avant tout il faut être vrai. La concurrence intérieure vient toujours déjouer, dans une certaine mesure, les espérances et les calculs des protectionnistes.
Aux entrepreneurs d’industrie, le régime restrictif offre des compensations. S’ils payent plus cher ce qu’ils achètent, ils font payer plus cher ce qu’ils vendent ; non qu’ils ne perdent, en définitive, mais enfin leur perte est atténuée ; pour l’ouvrir, il n’y a aucune atténuation possible.
Aussi, je me représente quelquefois un simple ouvrier, trouvant, je ne sais par quelle issue, accès dans l’enceinte législative. Ce serait certainement un spectacle curieux et même imposant, s’il se présentait à la barre de l’assemblée étonnée, — calme, modéré, mais résolu, et si, au milieu du silence universel, il disait : « Vous avez élevé, par la loi, le prix des aliments, des vêtements, du fer, du combustible ; vous nous promettiez que le ricochet de ces mesures élèverait notre salaire en proportion et même au delà. Nous vous croyions, car l’appât d’un profit, fût-il illégitime, hélas ! rend toujours crédule. Mais votre promesse a failli. Il est bien constaté maintenant que votre loi, n’ayant pu que déplacer le capital et non l’accroître, n’a eu d’autre résultat que de faire peser sur nous, sans compensation, le poids de la cherté. Nous venons vous demander d’élever législativement le taux des salaires, au moins dans la même mesure que vous avez élevé législativement le prix de la subsistance. »
Je sais bien ce qu’on répondrait à ce malencontreux pétitionnaire. On lui dirait, et avec raison : « Il nous est impossible d’élever par la loi le taux du salaire ; car la loi ne peut pas faire qu’on tire d’un capital donné plus de salaires qu’il n’en renferme. »
Mais je me figure que l’ouvrier répliquerait : « Eh bien ! ce que vous dites que la loi ne peut faire directement, elle ne l’a pas fait indirectement selon vos promesses. Puisqu’il n’est pas en votre pouvoir de renchérir le salaire, ne renchérissez pas la vie. Nous ne demandons pas de faveur, nous demandons franc jeu, et que les produits soient purs de toute intervention législative, puisque le salaire est inaccessible à l’intervention législative. »
En vérité, Messieurs, je n’imagine pas ce qu’on pourrait répondre. Et remarquez qu’en bonne justice, ce n’est pas avec des présomptions, des probabilités qu’on peut repousser une telle requête. Il faut une certitude absolue [5].
Beaucoup de personnes se sont laissé séduire par ce fait que les salaires sont plus élevés, par exemple, à Paris qu’en Bretagne, et elles en ont conclu qu’ils tendent à se mettre au niveau du prix de la vie. Mais la question n’est pas de savoir si les divers salaires, qui prennent leur source dans un capital donné, ne peuvent pas varier à l’infini selon une multitude de circonstances. Nous ne mettons pas cela en doute. Ce que nous nions, c’est que l’ensemble ou la grande moyenne des salaires s’élève dans un pays, en vertu d’une loi qui déplace le capital sans l’accroître.
Et, Messieurs, cette objection qu’on nous faisait il y a deux ans, quand nous avons commencé notre œuvre, les événements, avec une voix plus forte que la nôtre, se sont chargés d’y répondre ; car la disette est survenue et la cherté avec elle. Or, qu’a-t-on vu ? On a vu le salaire baisser plutôt que hausser. Ainsi, le fait nous a donné raison. Et, d’ailleurs, le fait s’explique de la manière la plus claire.
Quand le prix de la subsistance renchérit, l’universalité des hommes dépense davantage pour en avoir la quantité nécessaire. Il reste donc moins à dépenser à autre chose. On se prive, et par là on produit la stagnation de l’industrie, qui amène forcément la baisse des salaires. En sorte que, dans les temps de cherté, l’ouvrier est froissé par les deux bouts à la fois, par la diminution de ses profits et par l’élévation du prix de la vie.
La cherté artificielle a exactement les mêmes effets que la cherté naturelle ; seulement, comme elle dure plus, il se fait, j’en conviens, certains arrangements sociaux sur cette donnée, car l’humanité a une souplesse merveilleuse. Mais les arrangements ne changent pas la nature des choses, ils s’y conforment, et savez-vous comment, à la longue, l’équilibre se rétablit ? Par la mort. La mort prend soin, à la longue et après bien des souffrances, de faire descendre la population au niveau de ce que peuvent nourrir des salaires réduits, tout au plus restés invariables, et combinés avec la cherté de la vie.
Puisque j’ai touché à ce formidable sujet de la population, je relèverai une objection qui nous a été faite en sens inverse.
On nous a dit : Le libre-échange est impuissant à conférer à la classe ouvrière un bien permanent. Il est vrai qu’il baissera le prix de la vie sans altérer le salaire, et conférera par conséquent plus de bien-être aux travailleurs ; mais ils multiplieront en vertu de ce bien-être même, et au bout de vingt ans, ils se trouveront replacés dans leur condition actuelle.
D’abord, cela n’est pas sûr ; il est possible que le capital augmente pendant ses vingt années aussi rapidement que la population.
Ensuite, il faut tenir compte des habitudes et des idées de prévoyance que donnent vingt ans de bien-être.
Mais, enfin, en admettant cette loi fatale, ne voit-on pas la faiblesse de l’objection ? N’est-ce rien que vingt années de bien-être ? est-ce une chose à dédaigner ? Mais c’est ainsi que la société progresse. D’ici à vingt ans elle aura accompli quelque autre œuvre qui prolongera le bien-être de vingt ans encore. Et quelle est la réforme à laquelle on ne pourrait opposer la même fin de non-recevoir ? Trouvez-vous un moyen de supprimer l’octroi sans le remplacer par aucun autre impôt ? Avez-vous imaginé un engrais qui ne coûte rien, et qui doit accroître prodigieusement la fertilité de la terre ? Je vous dirai : À quoi bon ? Brûlez votre invention financière ou agricole. Elle soulagerait, il est vrai, les hommes d’un lourd fardeau. Mais quoi ! en vertu de ce bien-être même, ils multiplieraient, et reviendraient, sauf le nombre, au point de départ. Messieurs, l’humanité est ainsi faite que c’est précisément à multiplier qu’elle aime à consacrer ce qu’on lui laisse de bien-être ; et faut-il pour cela considérer ce bien-être comme perdu, le lui refuser d’avance ?
Comment trouverait-on ce raisonnement, s’il s’adressait à un individu au lieu de s’adressera une nation ou à une classe ?
Je suppose un jeune homme qui gagne 1,000 fr. par an. Il désire épouser une jeune personne qui en gagne autant ; cependant il attend pour se mettre en ménage que leurs appointements soient doublés. Le moment arrive, mais le patron leur fait cette morale :
« Mes enfants, vous avez certainement droit à 1,000 fr. entre deux, ils vous sont dus en toute justice. Mais si je vous les donnais, vous vous marieriez ; dans deux ou trois ans vous auriez deux enfants, vous seriez quatre, et ce ne serait jamais que 1,000 fr. par tête. Vous voyez qu’il ne vaut pas la peine que je vous paye le traitement que vous désirez, et dont d’ailleurs je reconnais la parfaite légitimité. »
La réponse que ferait le jeune homme est parfaitement celle que pourrait faire l’humanité à l’objection que je réfute. « Payez-moi ce qui m’est dû, dirait-il. Pourquoi vous occupez-vous de l’usage que j’en ferai, s’il est honnête ? Vous dites qu’après m’être procuré les jouissances de la famille, je n’en serai pas plus riche ; je serai toujours plus riche des jouissances éprouvées. Je sais que si j’emploie ainsi l’excédant de mes appointements, je ne pourrai pas l’employer à autre chose ; mais est-ce une raison de dire que je n’en ai pas profité ? Autant vaudrait me refuser mon dîner d’aujourd’hui sous prétexte que quand je l’aurai mangé, il n’en resterait plus rien. » Appliquée à un peuple, l’objection est de cette force. Elle revient à ceci : Sous le régime prohibitif, dans vingt ans la France aurait 40 millions d’habitants ; sous un régime libre, comme elle aurait joui de plus de bien-être, elle en aurait 50 millions, lesquels, au bout de ce terme, ne seraient pas individuellement plus riches.
Et compte-t-on pour rien 10 millions d’habitants de plus ; toutes les satisfactions que cela suppose, toutes les existences conservées, toutes les affections satisfaites, tous les désordres prévenus, toutes les existences allumées au flambeau de la vie ? Et est-on bien certain que ce bien-être dû à la réforme, le peuple eût pu trouver une autre manière de le dépenser plus morale, plus profitable au pays, plus conforme au vœu de la nature et de la Providence [6] ?
Messieurs, ainsi que je vous l’ai fait pressentir en commençant, je laisse de côté bien des considérations. Si, dans le petit nombre de celles que je vous ai présentées, et malgré le soin que j’ai mis à me renfermer dans mon sujet, il m’est échappé quelques paroles qui aient la moindre tendance à jeter quelque découragement ou quelque irritation dans les esprits, ce serait bien contre mon intention. Ma conviction est qu’il n’y a pas entre les diverses classes de la société cet antagonisme d’intérêts qu’on a voulu y voir. J’aperçois bien un débat passager entre celui qui vend et celui qui achète, entre le producteur et le consommateur, entre le maître et l’ouvrier. Mais tout cela est superficiel ; et, si on va au fond des choses, on découvre le lieu qui unit tous les ordres de fonctions et de travaux, qui est le bien que chacun retire de la prospérité de tous. Regardez-y bien, et vous verrez que c’est là ce qui prévaudra sur de vaines jalousies de nation à nation et de classe à classe. Des classes ! le mot même devrait être banni de notre langue politique. Il n’y a pas de classes en France ; il n’y a qu’un peuple, et des citoyens se partageant les occupations pour rendre plus fructueuse l’œuvre commune. Et par cela même que les occupations sont partagées, que l’échange est intervenu, les intérêts sont liés par une telle solidarité qu’il est impossible de blesser les uns sans que les autres en souffrent.
Moi qui ne crois pas à l’antagonisme réel des nations, comment croirais-je à l’antagonisme fatal des classes ? On dit que l’intérêt divise les hommes. Si cela est, il faut désespérer de l’humanité, et gémir sur les lacunes ou plutôt les contradictions du plan de la Providence ; car, quoique je n’ignore pas l’existence et l’influence d’un autre principe celui de la sympathie, tout nous prouve que l’intérêt a été placé dans le cœur de l’homme comme un mobile indomptable ; et, si sa nature était de diviser, il n’y aurait pas de ressource. Mais je crois, au contraire, que l’intérêt unit, à la condition toutefois d’être bien compris ; et c’est pour cela que Malebranche avait raison de considérer l’erreur comme la source du mal dans le monde. J’en citerai un exemple, tiré de la fausse application qu’on fait souvent de deux mots que j’ai souvent répétés aujourd’hui, les mots travail et capital.
On dit : Le capital fait concurrence au travail, et quand on dit cela, on est bien près d’avoir allumé une guerre plus ou moins sourde entre les travailleurs et les capitalistes. Et si cependant ce prétendu axiome, qu’on répète avec tant de confiance, n’était qu’une erreur, et plus qu’une erreur, un grossier non-sens ! Non, il n’est pas vrai que le capital fasse concurrence au travail. Ce qui est vrai, c’est que les capitaux se font concurrence entre eux, et que le travail se fait concurrence à lui-même. Mais du capital au travail la concurrence est impossible. J’aimerais autant entendre dire que le pain fait concurrence à la faim ; car, au contraire, comme le pain apaise la faim, le capital rémunère et satisfait le travail. Et voyez où conduit celte simple rectification ! Si c’est avec lui-même et non avec le travail que le capital rivalise, que doivent désirer les travailleurs ? Est-ce que les capitalistes soient ruinés ? Oh ! non. S’ils font des vœux conformes à leurs vrais intérêts, ils doivent désirer que les capitaux grossissent, s’accumulent, multiplient, abondent et surabondent, s’offrent au rabais, jusqu’à ce que leur rémunération tombe de degré en degré, jusqu’à ce qu’ils deviennent comme ces éléments que Dieu a mis à la disposition des hommes, sans attacher à sa libéralité aucune condition onéreuse, jusqu’à ce qu’ils descendent enfin autant que cela est possible, dans le domaine gratuit, et par conséquent commun de la famille humaine. Ils n’y arriveront jamais, sans doute ; mais ils s’en rapprocheront sans cesse, et le monde économique est plein de ces asymptotes. Voilà la communauté, je ne dis point le communisme, que l’on ne peut mettre au commencement des temps et au point de départ de la société ; mais la communauté qui est la fin de l’homme, la récompense de ses longs efforts, et la grande consommation des lois providentielles. D’un autre côté, que doivent souhaiter les possesseurs de capitaux ? Est-ce d’être entourés d’une population chétive, souffrante et dégradée ? Non ; mais que toutes les classes croissent en bien-être, en richesse, en dignité, en goûts épurés, afin que la clientèle s’ouvre et s’élargisse indéfiniment devant eux. La clientèle ! j’appelle votre attention sur ce mot ; il est un peu vulgaire ; mais vous trouverez en lui la solution de bien des problèmes, les idées d’union, de concorde et de paix. Sachons détacher nos regards de notre petit cercle, ne pas chercher la prospérité dans les faveurs, les priviléges, l’esprit d’exclusion, toutes choses qui nuisent aux masses et réagissent tôt ou tard sur nous-mêmes par la ruine de la clientèle. Accoutumons-nous au contraire à favoriser, à encourager ce qui étend la prospérité sur la vaste circonférence qui nous entoure, c’est-à-dire sur le monde entier, ne fût-ce qu’en considération du bien qui, sous forme d’une plus vaste et plus riche clientèle, se reflétera infailliblement, à la longue, dans notre propre sphère d’activité.
Enfin, Messieurs, puisque j’en suis à disséquer des mots, j’appellerai encore votre attention sur deux expressions que l’on ne saurait confondre sans danger. Le monde éprouve comme une sorte d’effroi, comme un poids pénible, comme un pressentiment triste, parce qu’il lui semble qu’il s’élabore au sein du corps social une aristocratie d’argent qui, sous le nom de bourgeoisie, va remplacer l’aristocratie de naissance. Il craint que ce phénomène ne prépare à nos fils les difficultés qu’ont surmontées nos pères ; et il se demande si l’humanité est destinée à tourner toujours dans ce cercle de combats suivis de victoires et de victoires suivies de combats. J’ai aussi demandé à ce mot bourgeoisie ce qu’il portait en lui, ce qu’il voulait dire, quelle était sa signification ; et je l’ai trouvé vide. Je vous disais, à la dernière séance, qu’il fallait beaucoup se méfier des métaphores ; et je vous signalais, comme exemple, cette similitude absurde que, par l’abus des mots, on était parvenu à établir entre l’échange et la guerre. Il n’est pas plus vrai qu’il y ait similitude ou même analogie entre une bourgeoisie qui sort du peuple par le travail, et une aristocratie qui domine le peuple par la conquête. Il n’y a pas même d’opposition à établir entre bourgeoisie et peuple, puisque l’une et l’autre s’élèvent par le travail. Sans quoi, il faudrait dire que les vertus par lesquelles l’individualité s’affranchit du joug de la misère, — l’activité, l’ordre, l’économie, la tempérance, — sont le chemin de l’aristocratie et le fléau de l’humanité. Il y a certainement là des idées mal comprises. (V ci-après le n°54.)
Il est vrai que, dans notre pays, un certain degré de richesse confère seul la fonction électorale. Quoi qu’il en soit de ce privilége, que je n’ai pas à examiner ici, il devrait au moins rendre la bourgeoisie attentive, ne fût-ce que par prudence, à ne faire que des lois justes et toujours empreintes de la plus entière impartialité. Or, j’ai eu occasion, aujourd’hui même, de prouver qu’elle n’a pas agi ainsi, quand elle a essayé de changer, par la loi positive, l’ordre et le cours naturel des rémunérations. Mais est-ce intention perverse ? Non ; je crois fermement que c’est simplement erreur. Et je n’en veux qu’une preuve, qui est décisive, c’est que le système qu’elle a établi l’opprime elle-même comme il opprime le peuple, et de la même manière, sinon au même degré. Pour qu’on pût voir le germe d’une aristocratie naissante dans cet acte et les actes analogues, il faudrait commencer par prouver que ceux mêmes qui les votent n’en sont pas victimes. S’ils le sont, leurs intentions sont justifiées ; et le lien de la solidarité humaine n’est pas infirmé.
Une circonstance récente a un moment ébranlé, je l’avoue, ma confiance dans la pureté des intentions. En présence de la cherté des subsistances, deux de mes honorables amis avaient proposé un abaissement des droits sur l’entrée du bétail. La Chambre a repoussé cette mesure. Ce n’est pas de l’avoir repoussée que je la blâme ; en cela elle n’aurait fait que persister dans un système qui, selon moi, n’est imputable qu’à l’erreur. Mais elle a fait plus que de repousser la mesure ; elle a refusé de l’examiner, elle a fui la lumière, elle a mis une sorte de passion à étouffer le débat ; et, par là, il me semble qu’elle a proclamé, à la face du monde, qu’elle avait bien réellement la conscience de son tort.
Mais, à moins que de pareilles expériences ne se renouvellent, je persiste à croire et à dire que la Chambre, ou si l’on veut la bourgeoisie, ne trompe pas le peuple ; elle se trompe elle-même. La Chambre ne sait pas l’économie politique, voilà tout. Et le peuple, la sait-il ? Allez au nord et au midi, au levant et au couchant, interrogez l’immense majorité des hommes, qu’ils payent ou ne payent pas le cens, que trouvez-vous partout ? Des protectionnistes sincères. Et pourquoi ? parce que le système restrictif est tellement spécieux, que la plupart des hommes s’y laissent prendre. Car comment se posent-ils le problème ? le voici : « Admettrons-nous ou n’admettrons-nous pas la concurrence ? » et fort naïvement ils répondent : « Non. » — Ne les blâmons pas trop ; car la concurrence, vous devez le savoir, a une physionomie qui, au premier aspect, ne prévient pas trop en sa faveur. Il faut beaucoup étudier et réfléchir pour reconnaître que, malgré sa rébarbative figure, elle est l’antithèse du privilége, la loi du nivellement rationnel, et la force qui pousse notre race vers les régions de l’égalité. Pourrait-on voir des symptômes aristocratiques dans une loi sur l’hygiène, qui aurait été rendue il y a trois siècles, contrairement à la théorie de la circulation du sang ? et cette loi, en blessant le peuple, ne blesserait-elle pas aussi ceux qui l’auraient faite ?
Qui donc a le droit de reprocher à la législature d’avoir élevé le prix de la vie ? Est-ce les ouvriers ? ne font-ils pas en cela cause commune avec elle ? ne partagent-ils pas les mêmes erreurs, les mêmes craintes, les mêmes illusions ? ne voteraient-ils pas les mêmes restrictions, s’ils y étaient appelés ? Qu’ils commencent donc par étudier la question, par découvrir la fraude, par la dénoncer, par mettre la législature en demeure, par réclamer justice ; et si justice leur est refusée, ils auront acquis le droit de pousser un peu plus loin leurs investigations. Alors, le moment sera venu où ils pourront raisonnablement se poser cette terrible question que m’adressait ces jours-ci un homme illustre, un des plus ardents amis de l’humanité : Quel moyen y a-t-il de renverser une loi que le législateur vote dans son propre intérêt ? — Puisse la législature rendre inutile la solution de ce problème !
FN:V. le chap Ier du tome VI. (Note de l’éditeur.)
FN:V. le chap. VI de la seconde série des Sophismes, t. IV, p. 173. (Note de l’éditeur.)
FN:V. ci-après les numéros 57 et 58. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV. page 74, le chap. xii de la première série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome VI, le chap. des Salaires. (Note de l’éditeur.)
FN:V. tome VI chap. de la Population, des Harmonies.
Sixième discours, à Marseille [24 th ?? août 1847] ↩
BWV
1847.08.15 “Sixième discours, à Marseille” (Sixth Speech given in Marseilles) [Fin d’août 1847] [OC2.47, p. 293]
Editor’s Introduction↩
As was customary, the public meeting of the FFTA was reported on at some length in their journal Le Libre-Échange. In the issue of 12 Sept., pp. 332-33 it is reported that a banquet was held after the meeting and toasts were made to the speakers by the Marseille branch of the association. Toasts were given to Lamartine, Bastiat, Clapier and L. Reybaud (the latter two were deputies representing Marseilles). The toast to Bastiat was proposed by L. Reybaud, a deputy, the VP of the FTA of Marseilles, and President of the Marseilles Chamber of Commerce. Bastiat’s response was published and we reproduce it here:
Messieurs, il me serait difficile d’exprimer les sentiments que m’inspire votre bonne et généreuse hospitalité. Je ne voudrais pas, en déclinant les paroles si bienveillantes dont vient de se servir l’honorable président de la chambre de commerce, étaler ici une modestie exagérée qui ne serait peut-être que de vanité sous une autre forme. mais je vous en prie, que ces éloges restent dans le cercle de notre intimité. Ne créons pas des obstacles à notre cause en voulant trop tôt la personnifier, et attendons pour cela le jour de triomphe. Cependant, parmi ces éloges, il en est un que j’accepte ou du moins que je m’efforcerai toujours de mériter, c;est celui qui s;adresse à mon dévouement. Croyez, Messieurs, qu’il ne se démentira jamais. Et quant à la récompense, je l’ai déjà reçue hier, car, tous les jours de ma vie, je considérerai comme une gloire d’avoir été admis à partager vos travaux, d’avoir parlé à cette même tribune où se sont fait entendre vos deux députés, et d;avoir rattaché mon nom, quoique par un fil bien délicat, au nom immortel de M. de Lamartine. [p. 333]
Sixième discours, à Marseille
Fin d’août 1847
Messieurs,
Se faire valoir en commençant un discours, c’est certainement violer la première règle de la rhétorique. Je crois néanmoins pouvoir dire, sans trop d’inconvenance, que c’est faire preuve de quelque abnégation que de paraître, dans les circonstances où je me trouve, devant une assemblée aussi imposante. Je parle après deux orateurs, l’un aussi familier aux pratiques commerciales qu’aux profondeurs de la science économique, l’autre célèbre dans le monde littéraire où il a cueilli une palme si glorieuse et si méritée, tous deux jugés dignes de représenter dans les conseils de la nation la reine de la Méditerranée. Je parle devant le plus grand orateur du siècle, c’est-à-dire devant le meilleur et le plus redoutable des juges, s’il n’en était, je l’espère, le plus indulgent. Je vois dans l’auditoire cette phalange de publicistes distingués qui, dans ces derniers temps, et précisément sur la question qui nous occupe, ont élevé la presse marseillaise à une hauteur qui n’a été nulle part dépassée. Enfin, l’auditoire tout entier est bien propre à effrayer ma faiblesse ; car l’éclat que jette la presse marseillaise ne peut guère être que l’indice et le reflet des lumières abondamment répandues dans cette grande et belle cité.
Il ne faut pas croire que toutes les objections qu’on a soulevées contre le libre-échange soient prises dans l’économie politique. Il est même probable que si nous n’avions à combattre que des arguments protectionnistes, la victoire ne se ferait pas longtemps attendre. J’ai assisté à beaucoup de conférences, composées d’hommes de lettres ou de jeunes gens parfaitement désintéressés dans la question, et je me suis convaincu qu’un patriotisme et une philanthropie fort respectables, mais peu éclairés, avaient ouvert contre le libre-échange une source d’objections aussi abondante au moins que l’économie politique du Moniteur Industriel.
Les rêveries sociales, qui, de nos jours, ont une circulation très-active, ne sont pas dangereuses, en ce sens qu’il n’y a pas à craindre qu’elles s’emparent jamais de la pratique des affaires ; mais elles ont l’inconvénient de dévorer une masse énorme d’intelligences, surtout parmi les jeunes gens, et de la détourner d’études sérieuses. Par là elles retardent certainement le progrès de notre cause. Ne nous en plaignons pas trop cependant. Elles prouvent que la France est calomniée, et que souvent elle se calomnie elle-même. Non, l’égoïsme n’a pas tout envahi. Quoi que nous voyions à la surface, il existe au fond de la société un sentiment de justice et de bienveillance universelle, une aspiration vers un ordre social qui satisfasse d’une manière plus complète et surtout plus égale les besoins physiques, intellectuels et moraux de tous les hommes. Les utopies mêmes que ce sentiment fait éclore en constatent l’existence ; et si elles sont bien souvent frivoles comme doctrine, elles sont précieuses comme symptôme. De tout temps on a fait des utopies ; elles n’étaient guère que la manifestation de quelques bonnes volontés individuelles. Mais remarquez que de nos jours il n’est pas un écrivain, un orateur qui ne se croie tenu de mettre en tête de ses écrits et de ses discours, ne fût-ce que comme étiquette, ne fût-ce, passez-moi l’expression, que comme réclame, les mots : égalité, fraternité, émancipation du travailleur. Donc ce n’est pas dans celui qui s’adresse au public, mais dans le public lui-même que ce sentiment existe, puisqu’il signale à ceux qui lui parlent la voie qu’il faut qu’ils prennent pour en être écoutés.
Sans doute, Messieurs, guidés par cette indication, par cette exigence des lecteurs, les faiseurs de projets, les inventeurs de sociétés, tourmenteront souvent cette corde de la philanthropie jusqu’à la faire grincer [1] ; mais comme on a dit que l’hypocrisie était un hommage rendu à la vertu, de même on peut dire que l’affectation philanthropique est un hommage à ce sentiment de justice et de bienveillance universelle qui prend de plus en plus possession de notre siècle et de noire pays ; et félicitons-nous de ce que ce sentiment existe, car, dès qu’il sera éclairé, il fera notre force.
C’est pourquoi, Messieurs, je voudrais soumettre à votre examen une vue du libre échange qui réponde tout à la fois aux arguments des protectionnistes et aux scrupules du patriotisme et de la philanthropie. Je le ferai avec d’autant plus de confiance que la question a été parfaitement traitée sous d’autres aspects par les honorables orateurs qui m’ont précédé à cette tribune ; et dès lors il me sera permis, devant une assemblée aussi éclairée, et malgré la défaveur qui s’attache au mot, de me lancer un peu dans le domaine de l’abstraction.
Et puisque ce mot se présente à mes lèvres, permettez-moi une remarque.
J’ai bien souvent maudit la scolastique pour avoir inventé le mot abstraction, qui exige tant de commentaires, quand elle avait à sa disposition le mot si simple et si juste : vérité universelle. Car, regardez-y de près, qu’est-ce qu’une abstraction, si ce n’est une vérité universelle, un de ces faits qui sont vrais partout et toujours ?
Un homme tient deux boules à sa main droite et deux à sa main gauche. Il les réunit et constate que cela fait quatre boules. S’il fait l’expérience pour la première fois, tout ce qu’il peut énoncer, c’est ce fait particulier : « Aujourd’hui, à quatre heures, à Marseille, deux boules et deux boules font quatre boules. » Mais s’il a renouvelé l’expérience de jour et de nuit, sur plusieurs points du globe, avec des objets divers, il peut à chaque fois éliminer les circonstances de temps, de lieux, de sujet, et proclamer que « deux et deux font quatre. » C’est une abstraction de l’école, soit ; mais c’est surtout une vérité universelle, une de ces formules qu’on ne peut interdire à l’arithmétique sans en arrêter immédiatement les progrès.
Et voyez, Messieurs, l’influence des mots. Vous savez combien nos adversaires nous dépopularisent et nous ridiculisent, en nous jetant à la face le mot abstraction. Vous êtes dans l’erreur, s’écrient-ils, car ce que vous dites est une abstraction ! et ils ont les rieurs pour eux. Mais voyez quelle figure ils feraient, si l’école n’eût pas inventé ce mot et qu’ils fussent réduits à nous dire : « Vous êtes dans l’erreur, car ce que vous dites est une vérité universelle. » (Rires.) Vous riez, Messieurs, et cela prouve que les rieurs passeraient de notre côté. (Nouveaux rires.)
La science économique a aussi une formule, promulguée par J. B. Say, formule qui ruine de fond en comble le régime restrictif. C’est celle-ci : Les produits s’échangent contre des produits. On peut contester la vérité de cette formule, mais une fois reconnue vraie, on ne peut nier qu’elle ne renverse tous les arguments protectionnistes, particulièrement celui du travail national ; car si chaque importation implique et provoque une exportation correspondante, il est clair que les importations peuvent aller jusqu’à l’infini sans que le travail national en reçoive aucune atteinte.
Qu’est-ce donc que le commerce ? Je dis que le commerce est un troc, un ensemble, une série, une multitude de trocs.
Un homme se promène sur le port de Marseille. À chaque étranger qui débarque, il fait des propositions de ce genre : « Voulez-vous me donner ces bottes ? je vous donnerai ce chapeau ; » ou : « Voulez-vous me donner ces dattes ? je vous donnerai ces olives. » Est-il possible de voir là une atteinte à l’intérêt des tiers, au travail national ? Quoi ! alors que chacun reconnaît à cet homme la propriété de ces olives, alors qu’on lui reconnaît le droit de les détruire par l’usage, alors que chacun sait qu’elles n’ont pas même d’autre destination au monde que d’être détruites par l’usage, comment pourrait-on dire qu’il nuit aux intérêts des tiers si, au lieu de les consommer, il les échange ? Et si le troc, qui est l’élément du commerce, est avantageux, alors qu’il est déterminé par l’influence si clairvoyante de l’intérêt personnel, comment le commerce, qui n’est qu’un vaste appareil au moyen duquel les négociants, le numéraire, les lettres de change, les routes, les voiles et la vapeur facilitent les trocs et les multiplient ; comment le commerce, dis-je, pourrait-il être nuisible ?
Pour vous assurer que les produits s’échangent contre les produits, suivez par la pensée une cargaison de sucre, par exemple. Assurément tous ceux qui ont concouru à la former ont reçu quelque chose en compensation et, d’un autre côté, lorsque, divisée en fractions infinies, elle est arrivée aux derniers acheteurs, aux destinataires, aux consommateurs, ceux-ci ont donné quelque chose en retour. Donc, quoique l’opération ait pu être fort compliquée, il y a eu, de part et d’autre, produits donnés et produits reçus, ou échanges.
J’avoue cependant qu’il est une autre formule qui me semble plus complète, plus féconde, qui ouvre à la science de grands et admirables horizons, qui donne une solution plus exacte de la question du libre-échange, et qui, lavant l’économie politique du reproche de sécheresse, est destinée, je l’espère, à rallier les écoles dissidentes. Cette formule est celle-ci : Les services s’échangent contre les services.
D’abord, Messieurs, vous remarquerez que cette seconde formule fait rentrer dans le domaine de la science une foule de professions que la première semble en exclure ; car on ne saurait, sans forcer le sens des termes, donner le nom de produit à l’œuvre qu’accomplissent dans la société les magistrats, les militaires, les écrivains, les professeurs, les prêtres et même les négociants ; ils ne créent pas des produits, ils rendent des services.
Ensuite, cette formule efface la fausse distinction qu’on a faite entre les classes dites productives et improductives ; car, si l’on y regarde de près, on reste convaincu que ce qui s’échange entre les hommes, ce n’est précisément pas les produits, mais les services : et ceci devant nous conduire à de vastes aperçus, je vous demande, Messieurs, un instant d’attention.
Si vous décomposez un produit quel qu’il soit, vous vous apercevrez qu’il est le résultat de la coopération de deux forces : une force naturelle et une force humaine. Prenez-les tous, l’un après l’autre, depuis le premier jusqu’au dernier, et vous reconnaîtrez que pour amener une chose à cette condition d’utilité qui la rend propre à notre usage, il faut toujours le concours de la nature et souvent le concours du travail.
Or, il est démontré, pour moi, que ce concours de la nature est toujours gratuit. Ce qui fait l’objet de la rémunération, c’est le service rendu à l’occasion d’un produit. On nous livre un produit ; on nous fait payer la peine, l’effort, la fatigue dont il a été l’occasion, en un mot, le service rendu, mais jamais la coopération des agents naturels [2].
Messieurs, je n’ai certes pas la prétention de faire ici un cours d’économie politique ; mais la distinction que je soumets à votre examen est si importante en elle-même et par ses conséquences, que vous me permettrez de m’y arrêter un moment.
Je dis que la nature et le travail concourent à la création des produits. Or, la coopération de la nature étant nécessairement gratuite, nous payons les produits d’autant moins cher que cette coopération est plus grande. Voilà pourquoi tout progrès industriel consiste à faire concourir la nature dans une proportion toujours plus forte.
Le produit n’a aucune valeur, quelle que soit son utilité, quand la nature, ayant tout fait, ne laisse rien à faire au travail. La lumière du soleil, l’air, l’eau des torrents sont dans ce cas.
Cependant, si vous voulez de la lumière pendant la nuit, vous ne pouvez vous la procurer sans peine ; et là apparaît le principe de la rémunération.
Quoique cette combinaison de gaz, qu’on appelle l’air respirable, soit dans le domaine de la communauté, si vous désirez un des gaz particuliers qui le composent, il faut le séparer ; c’est une peine à prendre, ou à rémunérer si un autre la prend pour vous.
Quand l’eau est à vos pieds et dans un état de pureté qui la rend potable, elle est gratuite ; mais s’il faut l’aller chercher à cent pas, elle coûte. Elle coûte davantage, s’il faut l’aller cherchera mille pas, et davantage encore si, de plus, il faut la clarifier. C’est une peine à votre charge, puisque vous devez en profiter ; et, si un autre la prend pour vous, c’est un service qu’il vous rend et que vous payez par un autre service.
La houille est à cent pieds sous terre ; c’est certainement la nature qui l’a faite et placée là à une époque antédiluvienne. Ce travail de la nature n’a ni valeur ni prix ; il ne peut être le principe d’aucune rémunération ; mais pour avoir la houille, ce que vous avez à rémunérer, c’est la peine que prennent ceux qui l’extraient et la transportent, et ceux qui ont fait les instruments d’extraction ou de transport.
Tenons-nous donc pour assurés que ce ne sont pas les produits qui se payent, mais les services rendus à l’occasion des produits.
Vous me demanderez où je veux en venir et quel rapport il y a entre cette théorie et le libre-échange ; le voici :
S’il est vrai que nous ne payions que le service, cette part d’utilité que le travail a ajoutée au produit, et si nous recevons gratuitement, par-dessus le marché, toute l’utilité qu’a mise dans ce produit la coopération de la nature, il s’ensuit que les marchés les plus avantageux que nous puissions faire sont ceux où, pour un très-léger service humain, on nous donne, par-dessus le marché, une très-grande proportion de services naturels.
Si une marchandise m’est portée dans un bateau à voiles, elle me coûtera moins cher que si elle m’est portée dans un bateau à rames. Pourquoi ? parce que dans le premier cas il y a eu travail de la nature, qui est gratuit.
Afin de me faire comprendre complétement, il me faudrait exposer ici les lois de la concurrence. Cela n’est pas possible ; mais j’en ai dit assez pour vous montrer d’autres conséquences de cette théorie.
Elle doit détruire jusque dans leur germe les jalousies internationales. Remarquez ceci : la nature n’a pas distribué ses bienfaits sur le globe d’une manière uniforme ; un pays a la fertilité, un autre l’humidité, un troisième la chaleur, un quatrième des mines abondantes, etc.
Puisque ces avantages sont gratuits, on ne peut nous les faire payer. Par exemple, les Anglais, pour nous livrer une quantité donnée de houille, exigent de nous un service d’autant moindre, que la nature a été pour eux plus libérale relativement à la houille, et que, par conséquent, ils prennent à cette occasion une moindre peine. Quant à nous, Provençaux, qui n’avons pas de houille, que devons-nous désirer ? Que la houille anglaise soit enfouie dans les entrailles de la terre à des profondeurs inaccessibles ? qu’elle soit éloignée des routes, des canaux, des ports de mer ? Ce ne serait pas seulement un vœu immoral, ce serait un vœu absurde ; car ce serait désirer d’avoir plus de peine à rémunérer, c’est-à-dire plus de peine à prendre nous-mêmes. Dans notre propre intérêt, nous devons donc désirer que tous les pays du monde soient le plus favorisés possible par la nature ; que partout la chaleur, l’humidité, la gravitation, l’électricité entrent dans une grande proportion dans la création des produits, qu’il reste de moins en moins à faire au travail ; car cette peine humaine qu’il reste à prendre est seule la mesure de celle qu’on nous demande pour nous livrer le produit. — Que la houille anglaise soit à la surface du sol, que la mine touche le rivage de la mer, qu’un vent toujours propice la pousse vers nos rivages, que les capitaux en Angleterre soient si abondants que la rémunération en soit de plus en plus réduite, que des inventions merveilleuses viennent diminuer le concours onéreux du travail, ce n’est pas les Anglais qui profiteront de ces avantages, mais nous ; car ils se traduisent tous en ces termes : Bon marché, et le bon marché ne profite pas au vendeur, mais à l’acheteur. Ainsi ce bienfait que la nature semblait avoir accordé à l’Angleterre, c’est à nous qu’elle l’a accordé, ou du moins nous entrons en participation de ce bienfait par l’échange.
D’un autre côté, si les Anglais veulent avoir de l’huile ou de la soie, la nature ne leur ayant accordé qu’une intensité de chaleur qui laisserait beaucoup à faire au travail, quels vœux doivent-ils faire conformément à leur vrai intérêt ? Que les choses se fassent en Provence le plus possible par l’intervention de la nature ; que la nature ne laisse au travail qu’une coopération supplémentaire très-restreinte, puisque c’est cette coopération seule qui se paye [3].
Ainsi, vous le voyez, Messieurs, l’économie politique bien comprise démontre, par le motif que je viens de dire et par bien d’autres, que chaque peuple, loin d’envier les avantages des autres peuples, doit s’en féliciter ; et il s’en félicitera certainement dès qu’il comprendra que ces avantages ont beau nous paraître localisés, — par l’échange, ils sont le domaine commun et gratuit de tous les hommes.
La claire perception de cette vérité réalisera, ce me semble, dans la pratique même des affaires, le dogme de la fraternité.
Sans doute, la fraternité prend aussi sa source dans un autre ordre d’idées plus élevées. La religion nous en fait un devoir ; elle sait que Dieu a placé dans le cœur de l’homme, avec l’intérêt personnel, un autre mobile : la sympathie. L’un dit : Aimez-vous les uns les autres ; et l’autre : Vous n’avez rien à perdre, vous avez tout à gagner à vous aimer les uns les autres. Et n’est-il pas bien consolant que la science vienne démontrer l’accord de deux forces en apparence si contraires ? Messieurs, ne nous faisons pas illusion. On a beau déclamer contre l’intérêt, il vit, et il vit par décret imprescriptible de celui qui a arrangé l’ordre moral. Jetons les yeux autour de nous, regardons agir tous les hommes, descendons dans notre propre conscience ; et nous reconnaîtrons que l’intérêt est dans la société un ressort nécessaire, puisqu’il est indomptable. Ne serait-il pas dès lors bien décourageant qu’il fût par sa nature, et alors même qu’il serait bien compris, un aussi mauvais conseiller qu’on le dit ? et ne faudrait-il pas en conclure qu’il a pour triste mission d’étouffer la sympathie ? Mais s’il y a harmonie et non discordance entre ces deux mobiles, si tous deux tendent à la même fin, c’est un avenir certain ouvert au règne de la fraternité parmi les hommes. Y a-t-il pour l’esprit une satisfaction plus vive, pour le cœur une jouissance plus douce, que de voir deux principes qui semblaient antagonistes, deux lois providentielles qui paraissaient agir en sens opposés sur nos destinées, se réconcilier dans un effet commun et proclamer ainsi que cette parole qui, il y a dix-huit siècles, annonça la fraternité au monde, n’était pas aussi contraire à la pente du cœur humain que le disait naguère une superficielle philosophie ?
Messieurs, après avoir essayé de vous donner une idée de la doctrine du libre-échange, je vous dois une peinture du régime restrictif.
Les personnes qui fréquentent le jardin des Plantes à Paris, ont été à même d’observer un phénomène assez singulier. Vous savez qu’il y a un grand nombre de singes renfermés chacun dans sa cage. Quand le gardien met les aliments dans l’écuelle que chaque cage renferme, on croit d’abord que les singes vont dévorer chacun ce qui lui est attribué. Mais les choses ne se passent pas ainsi. On les voit tous passer les bras entre les barreaux et chercher à se dérober réciproquement la pitance ; ce sont des cris, des grimaces, des contorsions, au milieu desquels bon nombre d’écuelles sont renversées et beaucoup d’aliments gâtés, salis et perdus. Cette perte retombe aujourd’hui sur les uns, demain sur les autres et, à la longue, elle doit se répartir à peu près également sur tous, à moins que quelques singes des plus vigoureux n’y échappent ; mais alors vous comprenez que ce qui n’est pas perdu pour eux retombe en aggravation de perte sur les autres.
Voilà l’image fidèle du régime restrictif.
Pour montrer cette similitude, j’aurais à prouver deux choses : d’abord que le régime restrictif est un système de spoliation réciproque ; ensuite qu’il entraîne nécessairement une déperdition de richesses à répartir sur la communauté.
Cette démonstration, que je pourrais rendre mathématique, m’entraînerait trop loin. Je la confie à votre sagacité ; et vous reconnaîtrez, avec quelque confusion, que si souvent les singes singent les hommes, dans cette circonstance ce sont les hommes qui ont singé les singes.
L’heure me presse, et je ne voudrais pas perdre l’occasion d’appeler votre attention sur un autre aspect de la question : je veux parler des chances qu’ouvre le libre-échange à toutes ces réformes financières après lesquelles nous soupirons tous si ardemment et si vainement. J’en ai parlé à Lyon, et le sujet me paraît si grave que je me suis promis d’en parler partout où je pourrai me faire entendre.
Messieurs, il ne peut pas entrer dans ma pensée de heurter les convictions politiques de qui que ce soit. Mais ne me sera t-il pas permis de dire qu’il n’existe aucun parti politique (je ne dis pas aucun homme politique, mais aucun parti) qui se présente devant les Chambres et devant le pays avec un plan de réforme financière clair, net, précis, actuellement praticable ? Car, si je regarde du côté du ministère, je ne vois rien de semblable dans ses discours, et encore moins dans ses actes ; et si je me tourne du côté de l’opposition, je n’y vois qu’une tendance marquée vers l’accroissement des dépenses, ce qui n’est certes pas un acheminement vers la diminution des charges publiques.
Eh bien ! je ne sais si je me fais illusion (vous allez en juger), mais il me semble que le libre-échangiste tient en ses mains ce programme si désiré.
Je suppose qu’à l’ouverture de la prochaine session, un homme investi de la confiance de la couronne se présente devant les mandataires du pays et leur dise :
« Le libre-échange laissera entrer eu France une multitude d’objets qui maintenant sont repoussés de nos frontières, et qui, par conséquent, verseront dans le Trésor des recettes dont je me servirai pour réduire l’impôt du sel et la taxe des lettres.
Le libre-échange créera plus de sécurité pour la France qu’elle ne peut s’en donner par le développement onéreux de la force brutale. Il me permettra donc de réduire, dans de fortes proportions, nos forces de terre et de mer ; et avec les fonds que cette grande mesure laissera libres, nous doterons les communes de manière à ce qu’elles puissent supprimer leurs octrois, nous transformerons l’impôt des boissons, et nous aurons l’avantage d’adoucir la loi du recrutement et de l’inscription maritime. »
Messieurs, il me semble que ce langage serait de nature à faire quelque impression, même sur les hommes qui ont le plus contracté l’habitude de ce qu’on appelle opposition systématique.
Vous remarquerez, Messieurs, qu’il y a deux parties dans ce programme.
D’abord deux réformes importantes, celles du sel et de la poste, découlent immédiatement de la réforme commerciale. Les autres sont l’effet de la sécurité que, selon nous, le libre-échange doit garantir aux nations.
Quant à la première partie du programme, il n’y a pas d’objection possible. Il est évident que le drap, le fer, les tissus de coton, etc., s’ils pouvaient entrer en acquittant des droits modérés, donneraient un revenu au Trésor. Cet excédant de recettes serait-il suffisant pour combler le déficit laissé par le sel et le port des lettres ? Je le crois tellement, que j’ose dire qu’une compagnie de banquiers assumerait sur elle les chances de cette triple opération, et qu’elle dirait au gouvernement : La douane, le sel et la poste vous donnent actuellement 250 millions. Levez les prohibitions, abaissez les droits prohibitifs, en même temps réduisez l’impôt du sel et la taxe des lettres ; s’il y a déficit, nous le comblerons, s’il y a excédant, vous nous le donnerez. — Et si une telle offre était repoussée, ce serait, certes, la meilleure preuve que le système restrictif n’est pas destiné à protéger, mais à exploiter le public. (V. tome V, pages 407 et suiv.)
Quant à l’étroite relation qui existe entre le libre-échange et la paix des peuples, cela est-il davantage contestable ? Je ne développerai pas théoriquement cette pensée. Mais voyez ce qui se passe en Angleterre : il y a deux ans, elle a aboli la loi céréale, ce qui a été considéré comme une révolution intérieure et même politique. Ne saute-t-il pas aux yeux que par là elle a rendu plus difficile toute collision avec les États-Unis et les autres pays d’où elle tirera désormais ses subsistances? L’année dernière, elle a réformé la législation sur les sucres ; il y a là bien autre chose qu’une révolution intérieure et politique, c’est vraiment une révolution sociale, une ère nouvelle ouverte aux destinées de la Grande-Bretagne et à son action sur le monde.
On nous dit sans cesse que nous sommes anglomanes, et on prend soin de nous rappeler que l’Angleterre a toujours suivi une politique machiavélique et oppressive pour les autres nations. Est-ce que nous ne le savons pas ? Est-ce que l’histoire est lettre close pour nous ? Nous le savons, et nous détestons cette politique plus et mieux que nos adversaires ; car nous en détestons non-seulement les effets, mais encore les causes. Et où cette politique a-t-elle ses racines ? Dans le système restrictif, dans la funeste pensée de vouloir toujours vendre sans jamais acheter. C’est pour cela que l’Angleterre a suscité tant de guerres, mis le Nord aux prises avec le Midi, affaibli les peuples les uns par les autres, afin de profiter de cet affaiblissement général pour étendre ses conquêtes et ses colonies.
Je dis que c’est une pensée de restriction qui la poussait dans cette voie, et à tel point que, tant que cette pensée a pesé dans ses déterminations, la paix des nations n’a pu être qu’une inconséquence de sa politique.
Mais enfin, l’Angleterre a réussi ; elle a des conquêtes, des colonies ; elle est parvenue à ses fins, et peut approvisionner sans concurrence la moitié du globe.
Et que fait-elle ?
Elle dit à ses colonies : Je ne veux plus vous donner des priviléges sur mon marché, mais, en esprit de justice, je ne puis en exiger pour moi sur les vôtres ; et, en conséquence, vous réglerez vous-mêmes vos tarifs.
N’est-ce pas, Messieurs, l’affranchissement réel des colonies, du moins au point de vue commercial et social, sinon au point de vue administratif ? N’est-ce pas revenir au point de départ et proclamer qu’on a fait fausse route [4] ?
Qu’on ne nous fasse point dire que nous voyons là de la générosité, de l’abnégation, de l’héroïsme ; non, nous n’y voyons que de l’intérêt, mais de l’intérêt bien entendu, de l’intérêt qui est d’accord avec l’intérêt de l’humanité.
Le principe restrictif est mauvais à nos yeux ; s’il est mauvais, il entraîne des conséquences funestes, il n’est même mauvais que par là ; s’il entraîne des conséquences funestes, les Anglais, qui ont poussé plus loin ce régime que tout autre peuple, ont dû les premiers apercevoir ces conséquences et en souffrir ; ils changent de route, quoi de surprenant ? Mais je dis que ce changement est une révolution immense dans les affaires du monde, une des plus grandes révolutions dont le globe ait été témoin. Je dis qu’elle est d’autant plus solide que les Anglais l’ont faite, non par abnégation, mais par intérêt ; je dis qu’elle ouvre devant les peuples un avenir de paix et de concorde, puisqu’elle leur enseigne que lorsqu’on arrive à une domination injuste, ce qu’on a de mieux à faire, c’est d’y renoncer. Je dis que plus les nations entreront dans cette voie, plus elles pourront sans danger se soulager du poids des armées permanentes et des mannes militaires.
On dit qu’il y a d’autres causes de guerre que les conflits commerciaux. Je le sais ; mais avec ces trois choses : libre-échange, non-intervention, attachement des citoyens pour les institutions du pays, une nation de 36 millions d’âmes n’est pas seulement invincible, elle est inattaquable.
Mais ce programme, il faut en convenir, a un côté chimérique. L’opinion n’en veut pas ; ce n’est pas une petite objection. Le public est tellement infatué des prétendus avantages du régime protecteur, qu’il repousse la liberté commerciale même avec ce cortège de réformes que je viens d’énumérer. Laissez-moi, dit-il, dans toute leur pesanteur, les impôts du sel, de la poste, des boissons, l’octroi, le recrutement et l’inscription maritime plutôt que de me rendre participant, par l’échange, aux bienfaits que la nature a départis aux autres peuples.
Messieurs, voilà le préjugé qu’il faut détruire ; c’est notre mission, c’est le but de notre Association. L’œuvre est laborieuse, mais elle est grande et belle. Il s’agit de conquérir le libre-échange, et, avec lui, la paix du monde et l’adoucissement des charges publiques. Marseillais, je vous adjure, non-seulement au nom de vos intérêts, mais au nom de ce tribut que nous devons tous à la société, de marcher en esprit d’union et de concorde vers ces paisibles conquêtes, de poursuivre votre tâche avec vigueur et persévérance. Étendez la publicité de vos excellents journaux, provoquez des associations à Aix, à Avignon, à Cette, à Nîmes, à Montpellier, fondez des chaires d’économie politique, unissez-vous intimement à l’Association parisienne, prêtez-lui le concours de votre force morale, de votre intelligence, de votre expérience des affaires, et au besoin de vos finances ; et alors, soyez-en sûrs, vous n’entendrez plus dire ce qu’on répète sans cesse en empruntant et parodiant les paroles de Bossuet : « Le libre-échange se meurt, le libre-échange est mort ! » Le libre-échange est mort ! Je ne sais si ceux qui le disent le croient ; mais, quant à moi, je ne l’ai jamais cru, parce que, s’il y a beaucoup de choses périssables dans ce monde, il y en a une au moins qui ne meurt jamais : c’est la vérité.
Le terrain de la discussion peut être longtemps envahi par des erreurs opposées. La vérité peut être lente à s’y montrer. Mais dès qu’elle y paraît, elle est invincible ; et pour que messieurs les protectionnistes suspendissent les chants funèbres qu’ils ont entonnés sur la tombe imaginaire du libre-échange, il suffirait peut-être qu’ils jetassent les yeux sur cette assemblée si nombreuse, si imposante, si éclairée et si sympathique.
Messieurs, soyons sûrs d’une chose : si le libre-échange pouvait mourir, ce qui le tuerait, ce n’est pas la discussion, c’est l’indifférence. Si on le discute, il vit. Je dirai même qu’il marche vers son triomphe. Or, voyez ce qui se passe. En Suisse et en Toscane, il règne. En Angleterre, il a surmonté des obstacles formidables. Aux États-Unis, l’intérêt national a vaincu le privilége. À Naples, le tarif a subi une réforme profonde. En Prusse, le développement du régime protecteur a été brusquement arrêté. On assure que l’empereur de Russie médite de révolutionner le système des douanes dans un sens libéral. En Espagne même, la discussion est portée sur un terrain officiel par une enquête dont les commencements promettent les plus heureux résultats. Des associations pour le libre-échange se sont formées à Gênes, à Rome, à Amsterdam ; et, dans un mois, des hommes éminents, accourus de tous les points de l’Europe, se réuniront à Bruxelles pour y soutenir la sainte cause de la libre communication des peuples. Sont-ce là des signes de mort ? et ne devons-nous pas plutôt concevoir l’espérance que nous sommes appelés à assister, plus tôt peut-être que nous ne le croyons, à ce grand écroulement des barrières qui séparent les peuples, les condamnent à d’inutiles travaux, tiennent l’incertitude toujours suspendue sur l’industrie et le commerce, fomentent les haines nationales, servent de motif ou de prétexte au développement de la force brutale, transforment les travailleurs en solliciteurs, et jettent parmi les citoyens eux-mêmes la discorde, toujours inséparable du privilége ; car ce qui est privilége pour l’un est servitude pour l’autre.
Je n’ai pas parlé de la France. Mais, Messieurs, qui donc ose dire qu’une grande idée est morte en France, quand cette idée est conforme à la justice et à la vérité, et quand, sans compter Paris, des villes comme Marseille, Lyon, Bordeaux et le Havre se sont unies pour son triomphe ?
Et puis, Messieurs, remarquez que, dans ce grand combat entre la liberté et la restriction, toutes les hautes intelligences dont le pays s’honore, pourvu qu’elles soient affranchies des mauvaises inspirations de l’esprit de parti, sont du côté de la liberté. Sans doute, tout le monde ne peut pas avoir l’expérience du négociant ; tout le monde n’est pas obligé non plus de pénétrer dans toutes les subtilités de la théorie économique. Mais s’il est un homme, au regard d’aigle, qui n’ait pas besoin, comme nous, des lourdes béquilles de la pratique et de l’analyse, et qui ait reçu du ciel, avec le don du génie, l’heureux privilége d’arriver d’un bond et dans toutes les directions jusqu’aux bornes et par delà les bornes des connaissances du siècle, cet homme est avec nous. Tel est, j’ose le dire, l’inimitable poète, l’illustre orateur, le grand historien, dont l’entrée dans cette enceinte a attiré vos avides regards. Vous n’avez pas oublié que M. de Lamartine a défendu la cause de la liberté, dans une circonstance où elle se confondait intimement avec l’intérêt marseillais. Je n’ai pas oublié non plus que M. de Lamartine, avec cette précision, ce bonheur d’expression qui n’appartiennent qu’à lui, a résumé toute notre pensée en ces termes : « La liberté fera aux hommes une justice que l’arbitraire ne saurait leur faire. » (Bruyants applaudissements.) J’espère donc, et j’ai la ferme confiance que M. de Lamartine ne me démentira pas, si je dis que sa présence dans cette assemblée est un témoignage de bienveillance envers des hommes qui essayent leurs premiers pas dans cette carrière du bien public, qu’il parcourt avec tant de gloire, mais qu’elle révèle aussi sa profonde sympathie pour la sainte cause de l’union des peuples et de la libre communication des hommes, des choses et des idées [5].
FN:V. tome IV, page 74.(Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome VI, le chap. v, et au tome IV, le chap. iv. (Note de l’éditeur.)
FN:V. tome IV, pages 36 à 45, et au tome VI, le chap. Concurrence. (Note de l’éditeur.)
FN:V. l’appendice du tome III, et notamment les pages 459 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:À la suite de cet appel, M. de Lamartine prit la parole et termina en ces termes un magnifique discours :
« Vous vous souviendrez alors, vous ou vos enfants, vous vous souviendrez avec reconnaissance de ce missionnaire de bien-être et de richesse, qui est venu vous apporter de si loin et avec un zèle entièrement désintéressé, la vérité gratuite, dont il est l’organe, et la parole de vie matérielle ; et vous placerez le nom de M. Bastiat, ce nom qui grandira à mesure que sa vérité grandira elle-même, vous le placerez à côté de Cobden, de J. W. Fox et de leurs amis de la grande ligue européenne parmi les noms des apôtres de cet évangile du travail émancipé, dont la doctrine est une semence sans ivraie, qui fait germer chez tous les peuples, — sans acception de langue, de patrie ou de nationalité, — la liberté, la justice et la paix !
(Note de l’éditeur.)
Remontrance [A Protest] [30 August 1847] [CW3 ES3.9]↩
BWV
1847.08.30 IX. “Remontrance” (A Protest) [*Libre-Échange*, 30 August 1847] [OC2.62, pp. 415-18] [CW3] [ES3.9]
Mes chers collaborateurs,
Quand la fatigue ou le défaut de véhicules me retient dans une ville, je fais ce que tout voyageur consciencieux doit faire, je visite les monuments, les églises, les promenades et les musées.
Aujourd’hui je suis allé voir la statue érigée à M. d’Étigny, intendant de la généralité d’Auch, par la reconnaissance éclairée des bons habitants de ce pays. Ce grand administrateur, et je puis dire ce grand homme, a sillonné de magnifiques routes la province confiée à ses soins. Sa mémoire en est bénie ; mais il n’en fut pas ainsi de sa personne, car il éprouva une opposition qui ne se manifesta pas toujours en doléances verbales ou écrites. On raconte qu’il fut bien souvent réduit, dans les ateliers, à faire usage de la force extraordinaire dont la nature l’avait doué. Il disait aux habitants des campagnes : « Vous me maudissez, mais vos enfants me béniront. » Quelques jours avant sa mort, il écrivait à M. le contrôleur général ces paroles qui rappellent celles du fondateur de notre religion : « Je me suis fait beaucoup d’ennemis, Dieu m’a fait la grâce de leur pardonner, car ils ne connaissent pas encore la pureté de mes intentions. »
M. d’Étigny est représenté tenant un rouleau de papier à la main droite et un autre sous le bras gauche. Il est naturel de penser que l’un de ces rouleaux est le plan du réseau de routes dont il a doté le pays. Mais à quoi peut faire allusion le second rouleau ? À force de frotter mes yeux et mon binocle, j’ai cru y lire le mot Remontrance. Pensant que le statuaire, dans un esprit de satire, ou plutôt pour donner aux hommes une salutaire leçon, avait voulu perpétuer le souvenir de l’opposition que ce pays avait faite à la création des routes, j’ai couru aux archives de la bibliothèque, et j’y ai découvert le document auquel l’artiste a sans doute voulu faire allusion. Il est en patois du pays ; j’en donne ici la traduction fidèle, pour l’édification du Moniteur industriel et du comité protectionniste. Hélas ! ils n’ont rien inventé. Leurs doctrines florissaient ici il y a près d’un siècle.
Remontrance.
« Monseigneur,
« Les bourgeois et manants de la généralité d’Auch ont entendu parler du projet que vous auriez conçu d’ouvrir, dans toutes les directions, des voies de communications. Ils viennent, les yeux remplis de larmes, vous prier de bien examiner la triste position où vous allez les réduire.
« Y pensez-vous, Monseigneur ? vous voulez mettre la généralité d’Auch en relation avec les pays circonvoisins ! Mais c’est notre ruine certaine que vous méditez. Nous allons être inondés de toutes sortes de denrées. Que voulez-vous que devienne notre travail national devant l’invasion de produits étrangers que vous allez provoquer par l’ouverture de vos routes ? Aujourd’hui, des montagnes et des précipices infranchissables nous protègent. Notre travail s’est développé à l’abri de cette protection. Nous n’exportons guère, mais notre marché au moins nous est réservé et assuré. — Et vous voulez le livrer à l’avide étranger ! Ne nous parlez pas de notre activité, de notre énergie, de notre intelligence, de la fertilité de nos terres. Car, Monseigneur, nous sommes de tous points et à tous égards d’une infériorité désespérante. Remarquez, en effet, que si la nature nous a favorisés d’une terre et d’un climat qui admettent une grande variété de produits, il n’en est aucun pour lequel un des pays voisins ne soit dans des conditions plus favorables. Pouvons-nous lutter pour la culture du blé avec les plaines de la Garonne ? pour celle du vin avec le Bordelais ? pour l’élève du bétail avec les Pyrénées ? pour la production de la laine avec les Landes de Gascogne, où le sol n’a pas de valeur ? Vous voyez bien que si vous ouvrez des communications avec ces diverses contrées, nous aurons à subir un déluge de vin, de blé, de viande et de laines. Ces choses-là sont bien de la richesse ; mais c’est à la condition qu’elles soient le produit du travail national. Si elles étaient le produit du travail étranger, le travail national périrait et la richesse avec lui. [119]
« Monseigneur, ne veuillons point être plus sages que nos pères. Loin de créer pour les denrées de nouvelles voies de circulation, ils obstruaient fort judicieusement celles qui existaient. Ils ont eu soin de placer des douaniers autour de nos frontières pour repousser la concurrence du perfide étranger. Quelle inconséquence ne serait-ce pas à nous de favoriser cette concurrence ?
« Ne veuillons pas être plus sages que la nature. Elle a placé des montagnes et des précipices entre les diverses agglomérations d’hommes, afin que chacune pût travailler paisiblement à l’abri de toute rivalité extérieure. Percer ces montagnes, combler ces précipices, c’est faire un mal analogue et même identique à celui qui résulterait de la suppression des douanes. Qui sait même si votre dessein actuel ne fera pas germer quelque jour cette funeste pensée dans la tête de quelque théoricien ! Prenez-y garde, Monseigneur, la logique est impitoyable. Si une fois vous admettez que la facilité des communications est bonne en elle-même, et qu’en tous cas, si elle froisse les hommes à quelques égards, elle leur confère, dans l’ensemble, plus d’avantages que d’inconvénients, si vous admettez cela, c’en est fait du beau système de M. Colbert. Or, nous vous mettons au défi de prouver que vos projets de routes soient fondés sur autre chose que sur cette absurde supposition.
« Monseigneur, nous ne sommes point des théoriciens, des hommes à principes ; nous n’avons pas de prétention au génie. Mais nous parlons le langage du bon sens. Si vous ouvrez notre pays à toutes les rivalités extérieures, si vous facilitez ainsi l’invasion sur nos marchés du blé de la Garonne, du vin de Bordeaux, du lin du Béarn, de la laine des Landes, des bœufs des Pyrénées, nous voyons clair comme le jour comment s’exportera notre numéraire, comment s’éteindra notre travail, comment se tarira la source des salaires, comment se perdra la valeur de nos propriétés. — Et quant aux compensations que vous nous promettez, elles sont, permettez-nous de le dire, fort problématiques ; il faut se creuser la tête pour les apercevoir.
« Nous osons donc espérer que vous laisserez la généralité d’Auch dans l’heureux isolement où elle est ; car, si nous succombons dans cette lutte contre des rêveurs, qui veulent fonder la facilité du commerce, nous prévoyons bien que nos fils auront à soutenir une autre lutte contre d’autres rêveurs qui voudront fonder aussi la liberté du commerce. »
Minutes of a Public Meeting in Marseilles by the Free Trade Association (5 Sept. 1847, LE)↩
BWV
T.152 (1847.09.15) "Minutes of a Public Meeting in Marseilles by the Free Trade Association: Speech by M. Bastiat: Abstract Ideas. Political Economy agrees with Feelings. What the Protectionist System resembles. The rich possibilities of Reform" (Réunion publique à Marseille de l'Association pour la Liberté des Échanges: Discours de M. Bastiat: L’abstraction. L’économie politique d’accord avec le sentiment. À quoi ressemble le système protecteur. Fécondité de la réforme), Journal des Économistes, Septembre 1847, T. XVIII, no. 70, pp. 163-165. Report also given in Le Libre-Échange, 5 Sept. 1847, no. 41, pp. 325-27. [DMH]
Text (JDE version)↩
[157]
RÉUNION PUBLIQUE A MARSEILLE DE L’ASSOCIATION POUR LA LIBERTÉ DES ÉCHANGES.
ADHÉSION DE M. DE LAMARTINE.
Sommaire. Discours de M. LtocE : Travaux de l'Association. Critique du projet de loi de douanes.— Discours de M. Clapier : Progrès de la question. Opinion du pays, des Chambres et du gouvernement. La victoire est dans l'avenir. — Discours de M. Reybaud : Injustice envers le commerce du Midi.—Discours de M. Bastiat : L'abstraction. L'économie politique d'accord avec le sentiment. A quoi ressemble le système protecteur. Fécondité de la réforme. — Discours de M. de Lamartine Comparaison de la doctrine du libre échange avec celle de la protection.
Plus de mille personnes se pressaient dans la salle Boisselot, le mardi 14 août, dans l'après-midi, pour entendre M. L. Luce, président de l'Association; MM. Clapier et Reybaud, députés de Marseille; M. Frédéric Bastiat et M. de Lamartine. Un grand nombre de dames étaient venues donner un éclat tout particulier à la réunion. A quatre heures, M. le président a pris place au fauteuil, et a ouvert la séance par un exposé des travaux de l'Association marseillaise pendant l'année qui s'est écoulée depuis sa fondation.
M. L. Luce, président de l’Association
La première année, a dit M. Luce, a été une année d'étude pour l'Association marseillaise : la situation de la navigation, la crise des subsistances, la question des bestiaux, celle des fers, celle des graines oléagineuses, plusieurs dispositions violentes du code des douanes, enfin le nouveau projet de loi des douanes, ont tour à tour occupé les réunions particulières de l'Association.—Dans un remarquable travail, l'Association a montré aux armateurs quel était leur véritable intérêt. Elle a rappelé les mesures qui avaient élevé si haut notre marine commerciale et militaire; elle a montré que ces mesures, quoique contemporaines des premiers essais en France du système protecteur, étaient l'application des principes les plus absolus du libre échange, c'est-à-dire de la faculté donnée à l'armateur de se procurer le navire là où il se trouverait le meilleur marché, même à l'étranger. C'est à Colbert que sont dues les mesures libérales qui placèrent la France au premier rang des puissances maritimes. La preuve en est consacrée par les divers actes cités dans ce travail. — L'Association de Marseille a vigoureusement attaqué les effets de la loi - céréale. Elle fait voir que la misère dans les campagnes, qu'on a si souvent attribuée aux bas prix des denrées alimentaires, était rendue par la cherté plus intense que ne saurait jamais le faire l'abondance. Elle a montré le danger qu'il y aurait pour la France à persévérer dans une législation si funeste, en présence de la modification des lois céréales en Angleterre; elle a demandé, comme transition, l'établissement d'un droit fixe et modéré sur les grains, et enfin un retour progressif à la liberté, qui a été la règle constante de l'ancienne monarchie et qui s'est maintenue jusqu'à la fin de l'Empire.—On [158] comprend que la question des graines oléagineuses ait été pour l'association l'objet d'études suivies, et que les faits nouveaux qui se sont reproduits depuis la loi néfaste de 1845, aient été recueillis par elle avec le plus grand soin. Ces faits donnent l'espoir que le gouvernement n'oubliera pas l'engagement qu'il prit à celte époque, pour vaincre la répugnance de la Chambre des pairs, de modifier cette loi par ordonnance, si les résultats en étaient mauvais. Or, détestables pour le commerce du Midi, ces résultats n'ont eu aucune utilité pour la production du Nord.
Le Conseil de l'Association de Marseille s'est beaucoup occupé du projet de loi des douanes. Voici la critique que M. Luce en fait:
Pour débarrasser le tarif d'une foule d'articles inutiles, on propose d'affranchir certaines marchandises de tous droits, quand elles seront importées par navires français. En apparence, c'est là une mesure utile ; en réalité, c'est une mesure sans effet possible. Les marchandises énumérées dans la loi formeront diverses catégories. — Marchandises affranchies de lous droits sans distinction de pavillon importateur. Le pavillon français n'aura rien à y gagner, puisque le même traitement est accordé à l'étranger. — Marchandises affranchies de droits à condition d'être importées par terre ou par navires français. Le pavillon français n'y gagnera rien encore, parce que le droit qui reste imposé aux importations par navires étrangers est insignifiant, et ne pouvait être augmenté en raison même des objets auxquels il s'applique. Pouvait-on, en effet, surcharger de droits les bois à brûler, les charbons, les légumes frais, les tourteaux, etc. ? La position du pavillon français relativement au pavillon étranger sera peu améliorée par les franchises accordées à des marchandises importées de certaines provenances indiquées au projet de loi. — Déjà des surtaxes de navigation suffisantes réservaient le transport de ces marchandises à notre pavillon. L'affranchissement des droits sur certaines marchandises importées par navires français profilera toutefois au consommateur.
Pour favoriser notre construction navale, le projet de loi propose de permettre l'emploi en entrepôt du fer et de quelques autres matériaux. Cette faveur, utile aux constructions en fer, produira, suivant l'exposé des motifs, une économie de 17 pour 100. Sur celles en bois, celte économie eût été de 30 pour 100 si la mesure appliquée dans des vues plus larges eût compris les chaines-câbles, les toiles à voile, les cordages, etc. Les calculs développés dans l'exposé des motifs démontrent que si on allait jusque-là, les industries engagées dans la question seraient peu fondées à se plaindre. Cependant le gouvernement recule devant celte concession. Au lieu de 30 pour 100 d'économie, il n'en offre que 17 à nos constructions. On aurait pu faire plus, on eu convient, mais ces industries qui ne pouvaient se plaindre pouvaient s'effrayer, et on n'a pas voulu troubler la quiétude que leur donne la protection.
La dernière disposition du tarif s'applique au traité de navigation conclu avec la Russie. Vous le savez, messieurs, les ports de la Méditerranée sont exclus des avantages du traité, ces avantages sont réservés aux ports français de l'Océan; c'est pour eux seulement qu'on adoucit la situation déplorable que la loi de 1845 sur les graines oléagineuses nous a faite. L'examen de ce traité a fait l'objet spécial de nos travaux. Déjà nous avons adressé d'énergiques réclamations, nous les continuerons avec la constance et l'ardeur que donne le sentiment d'une profonde injustice.
En finissant, M. Luce a rappelé que le système prohibitif était un système de guerre, adopté par la Convention, le Directoire et l'Empire, qui n'avait plus sa raison d'être de nos jours. 11 a rappelé la force du principe que l'Association a inscrit sur son drapeau, et il a dit à Marseille combien elle avait à gagner à son triomphe.
M. Clapier
M. Clapier s'est surtout attaché, dans son discours, à faire ressortir le progrès fait dans les idées par les Associations, « grâce, dit l'orateur, aux efforts [159] de notre Association, grâce au zèle et aux publications de la grande Association parisienne. » D'abord, à Marseille, il n'y a plus un seul patron de la protection; il n'y a plus un seul adversaire de la liberté commerciale. M. Clapier examine ensuite quelle est la situation des esprits, relativement à cette grande question, dans le pays, dans les Chambres, dans le gouvernement.
Pour connaître le sentiment du Pays, il faut y distinguer la masse, qui est complètement désintéressée, ou qui croit l'être, et les industries qui se croient menacées:
En général, dit M. Clapier, les opinions des masses ne se forment pas par des théories; elles résultent des faits accomplis La protection a existé en Fiance sans partage pendant quarante ans; c'était le droit commun, le fait exclusif. Le public s'était habitué à regarder la nécessité de la protection comme une vérité sur laquelle il n'y a plus à revenir. Quand la doctrine du libre échange s'est produite pour la première fois au grand jour, elle a dû rencontrer un profond sentiment d'incrédulité et de fortes préventions. Cependant la persévérance de tant d'hommes éminents, leurs convictions incontestables, l'exemple de l'Angleterre, la force des arguments, ont frappé les esprits, et, de celle foi inébranlable au système de la protection, le public a passé à un état de doute, à un désir de connaître et d'examiner. Nous avons appelé le pays à examiner, nous avons suscité le doute ; c'est là un premier pas, un résultat important. Ce n'est pas encore la conviction complète, c'est le premier pas vers elle; nous sommes en voie de l'obtenir, par cela seulement que l'on vent étudier, discuter et approfondir.
Il n'en est pas ainsi de la seconde catégorie : là, point de doute, point de désir de s'éclairer, et, de plus, une hostilité ardente, implacable. Ici, M. Clapier passe en revue les vues, les principes, les façons d'agir des prohibitionnistes. D'abord, disent-ils, le traité de Méthuen a ruiné le Portugal ; et la liberté du commerce affaiblit les sentiments de nationalité. Ensuite ils repoussent le mot de prohibition toujours et quand même; mais ils ne formulent aucune réforme, parce qu'il leur faut faire auparavant une enquête universelle de l'industrie; et l'enquête une fois faite, au bout d'un temps indéfini, il faudra encore juger chaque question, chaque industrie par ses nécessités individuelles.
Isoler ainsi chaque question, juger chaque industrie par ses nécessités individuelles sans aucune relation avec l'ensemble des autres industries, avec la grande impulsion que la liberté commerciale doit donner à toutes les branches de la richesse publique, c'est enlever à la question du libre échange son grand caractère et l'un de ses plus féconds éléments. Un exemple suffira pour le prouver. Que l'on demande à l'agriculture si la protection dont elle jouit lui est nécessaire; il lui sera facile de prouver qu'en l'état des charges qui pèsent sur elle, celle protection lui est indispensable. Mais si en lui enlevant la protection dont jouissent ses blés, ses laines et ses bestiaux, on lui offre en compensation des engrais à bas prix et plus abondants par la libre introduction des graines oléagineuses, des instruments à meilleur marché par la libre entrée des fers, une plus grande facilité à se procurer la main-d'œuvre par suite de l'accroissement de population, résultat infaillible du bon marché de toutes les choses nécessaires à la vie; si on lui montre, en outre, ses vins exportés dans le monde entier par suite de relations commerciales pins étendues; ses soies, ses garances, ses huiles, ses amandes, ses chardons, ses graines fourragères doublant de valeur par suite d'exportations plus considérables; oh ! alors, séduite et rassurée par de si préférables compensations, elle n'hésitera pas à répudier un système de protection qui, tout compte fait, n'est pour elle qu'un marché de dupe dans lequel ce qu'elle gagne est bien loin de ce qu'elle perd.
Selon M. Clapier, il y a donc, de la part de l'Association pour la protection du travail national, beaucoup d'habileté à chercher à isoler ainsi toutes les industries, toutes les productions. —Il y a de l'habileté, donc il y a de la faiblesse. [160] Il y a chez elle de la ruse, donc c'est de sa part un aveu à'impuissance. Ce n'est pas ainsi que procède l'Association du libre «change; c'est publiquement, au grand jour, sans habileté, sans détour, qu'elle proclame ses principes; elle marche dans sa force et dans la confiance de son avenir, certaine qu'elle est qu'il ne peut lui échapper.
L'orateur se demande quelle est l'opinion du gouvernement. Et il répond que les ministres actuels sont intelligents; mais qu'ils ne songeront à patroniser la grande réforme économique que lorsqu'ils la verront mûre dans les masses.
Les Chambres, si l'on en excepte quelques partisans déclarés de la liberté et les défenseurs bien connus du vieux système, n'ont pas encore de convictions réfléchies, arrêtées. Cependant l'influence indirecte du libre échange s'y est fait sentir d'une manière très-marquée à propos de la disette des subsistances et du projet de loi des douanes. Dans la première question, vu les circonstances difficiles, elles ont puisé le remède dans la liberté et non dans le monopole. Pour la loi des douanes, la Commission, composée de protectionnistes, veut étendre les réductions des droits au sucre et au café, et accorder ce que les économistes réclament depuis si longtemps.
Persévérez donc, dit M. Clapier à ses concitoyens, vous .aurez la victoire!
Et ne me demandez pas, dit-il en Unissant, si le combat sera long, si la victoire se fera longtemps attendre; je n'en sais rien. Quand on lutte contre des intérêts acharnés, il lie faut pas compter avec le temps, H ne faut compter qu'avec son courage et sa persévérance. Aussi bien, il est dans les décrets de la Providence que le triomphe de la vérité sur la place ne puisse s'obtenir que lentement, laborieusement, avec peine, à la sueur du front. Ces obstacles qu'elle rencontre sont la pierre de touche qui la distingue des illusions passagères et des fantaisies d'un moment; les illusions se dissipent au premier obstacle, la vérité leur résiste et les surmonte. La liberté commerciale en est à ce moment d'épreuve; notre énergie, notre persévérance, notre conviction, la lui feront traverser sans faiblir. Vous obtiendrez pour prix de vos efforts, d'abord, un large accroissement de prospérité, puis l'honneur d'avoir, des premiers, concouru au triomphe de la dernière, mais aussi de la plus utile, la plus pratique, la plus féconde liberté qu'il nous reste à conquérir.
M. L. Reybaud
M. L. Reybaud, encore convalescent à la suite d'une longue maladie, a été accueilli à la tribune par des acclamations universelles et réitérées. Le but de son discours a été surtout de faire ressortir l'injustice du système protecteur et la position désavantageuse qu'il a créée pour le midi de la France.
Messieurs, a dit l'orateur (après avoir expliqué à quel scrupule il avait cédé en arrêtant l'expression de sa pensée d'une manière précise, et en ne rien livrant au hasard de l'improvisation), ce qui m'a toujours tenu en défiance contre le régime qui gouverne actuellement nos intérêts, c'est qu'il blesse dans les cœurs le plus impérieux des instincts, celui de la justice. Etudiez-le avec attention et vous reconnaîtrez qu'il a pour base l'arbitraire, c'est-à-dire la faculté de distribuer au hasard, suivant les passions du temps et l'empire des circonstances, ici la misère, là le bien-être; d'enrichir ceux-ci de la dépouille de ceux-là, de répandre sur un point donné des faveurs exorbitantes, ou d'accomplir sur d'autres d'odieuses exactions. Avec ce régime, point de fixité, point de sécurité pour les intérêts; aucune garantie ne les couvre, aucun principe ne les défend. C'est un état de guerre, et la force seule y prévaut. Point de trêve, d'ailleurs, ni de repos: les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus demain, si la loi du nombre, aveugle comme le destin, cesse de les protéger. Ce régime s'inquiétera peu d'être conséquent avec lui-même; il détruira dans une heure de caprice ce qu'un autre caprice aura créé, Sous le prétexte d'établir un équilibre imaginaire, on le verra bouleverser [161] à tout propos les exigences, prendre le bruit pour la raison, les clameurs pour le droit, les menaces pour l'équité. En butte à des obsessions sans fin, il manquera de force pour les prévenir ou les combattre, et donnera, en mainte occasion, le triste spectacle d'une initiative qui s'abdique, et d'une conviction qui se dément.
…..
Ce que je reproche surtout à ce régime erroné, ce qui forme à mes yeux le grief le plus accablant que l'on puisse invoquer contre lui, c'est qu'il divise le pays en deux camps, celui des intérêts favorisés, celui des intérêts sacrifiés. Ce que je lui reproche, c'est de séparer ce que la liberté et la gloire avaient joints, d'entamer cette unité conquise par la Révolution et raffermie par l'Empire. Ce que je lui reproche, c'est de susciter dans l'activité matérielle du pays des dissentiments qui troublent son activité morale et vont jusqu'à ébranler au sein de quelques esprits la foi dans la vertu et la justice de nos institutions. Je lui reproche encore de désunir les enfants de la même mère, de les armer les uns contre les autres, d'opposer produit à produit, culture à culture, d'engendrer des jalousies entre celles que la pluie féconde et celles que réchauffe le soleil; enfin d'accréditer la pensée qu'une partie de notre territoire soumet l'autre à une exploitation régulière, et cela au point de justifier cette expression d'un homme éminent, d'un ancien ministre 1 : «Malheur aux industries et aux cultures qui tiennent peu de place sur le sol! »
Cette accusation est grave, messieurs, si grave qu'elle a besoin d'être appuyée de preuves sans réplique. Le régime de la protection a-l-il eu, oui ou non, cet effet d'éveiller et d'entretenir des animosités locales? a-t-il écrasé les faibles sans pitié, poussé l'abus de la puissance du nombre jusqu'à l'oppression? A-t-il réussi à introduire dans nos lois, pour les citoyens du même pays, des traitements divers, des conditions différentes? Est-il parvenu à créer, dans la sphère des intérêts, une population d'ilotes pour qui sont les charges, tandis que les avantages sont ailleurs? Se peut-il que dans nn siècle qui a aimé l'égalité jusqu'au délire, un abus pareil, une violence aussi inouïe, n'aient pas fait naître un soulèvement universel et ne soit pas. tombée devant la puissance de l'opinion?
A ces questions, messieurs, il n'est qu'une réponse; vous la trouverez écrite dans nos tarifs. C'est à eux qu'il faut avoir recours quand on veut s'assurer du degré d'habileté avec lequel certaines parties du royaume sont parvenues à s'attribuer la part du lion. Jamais l'esprit de catégories ne s'est montré plus ingénieux ; jamais art plus profond n'a été déployé dans la poursuite d'un but moins légitime. Voici, par exemple, deux régions bien distinctes: le nord et le midi de la France ; elles ont, dans l'ensemble de notre production rurale, chacune leur rôle, chacune leur fonction. Les climats ont créé entre elles des différences qui ne devraient être, d'aucun côté, ni une occasion de dommages, pi une source de profits. Voyons si la loi a ainsi compris son devoir et si elle a maintenu, entre les deux régions, la balance égale.
Le nord de la France produit des céréales; les céréales sont couvertes par un droit qui s'abaisse à peine devant la disette. — Le nord de la France produit du bétail; le bétail étranger est frappé d'un droit qui équivaut à une prohibition, et il n'est pas certain que ce régime capitulât même en présence de la famine. —Le nord de la France produit la betterave, et pour la betterave nous avons enlevé à notre marine un aliment essentiel et à nos colonies un approvisionnement dont elles se croyaient fondées à conserver le privilège.— Le nord de la France produit des graines oléagineuses, et dans l'intérêt de ces cultures on a sacrifié une industrie florissante el quarante mille tonneaux de fret acquis à notre navigation.
Voilà quelle est la part des cultures du nord; la loi ne s'est pas montrée seulement libérale à leur égard, elle a été en outre vengeresse et a semé d'holocaustes la voie dans laquelle elles ont marché vers le succès. Il ne reste plus qu'à vérifier maintenant si elle a réservé aux cultures du midi des faveurs analogues. C'est un compte aisé à faire, essayons-le. — Le midi de la France produit la garance, le nord la consomme: nos tarifs [162]
FN: M. H. Passy.
n'accordent à la garance qu'une protection, d'ailleurs inutile, de 7 à 8 pour 100. — Le midi de la France produit des soies; le nord et le centre les consomment; les soies ne sont pas protégées et supportent la concurrence étrangère; des vœux ont été même exprimés pour les prohiber à la sortie et en réserver l'emploi exclusif au tissage français.— Le midi de la France produit des eaux-de-vie et des vins; c'est principalement sur cet article que porte le dommage occasionné par notre guerre de tarifs et le fardeau des représailles qui en découlent. A l'intérieur on pèse sur eux par des taxes, au dehors on leur ferme un à un tous leurs débouchés.
Maintenant, messieurs, récapitulons. Le Nord a les céréales, le bétail, la betterave, les graines oléifères, tous produits protégés; le Midi a ses garances, les soies, les eaux-de vie et les vins, tous produits que la protection laisse à découvert et qu'elle, n'entoure pas de la même tutelle. Et cependant, tel est le ressort que donne la liberté, tel est l'état du langueur attaché au monopole, que nous n'avons point d'égaux dans le monde pour les produits que nos lois fiscales négligent ou atteignent, pour les soies, pour les garances et pour les vins ; tandis que ceux que la législation favorise, les blés, les graines, le bétail, pourvoient à peine et pourvoient mal aux besoins de notre marché, reconnaissent des maîtres en tous lieux et semblent condamnés à une infériorité irrémédiable. Tant il est vrai que la protection ressemble à cet arbre mortel à l'ombre duquel s'engourdissent et s'éteignent les facultés vitales.
Ce n'est pas tout; le génie du privilège a imaginé, pour l'usage de ses favoris, d'incroyables raffinements et des exceptions dans l'exception même. Ainsi, pour la mercuriale des blés, il a eu le soin d'associer Marseille à Gray et à Toulouse, atin que le prix habituellement très-discret de ces marchés pesât sur le calcul des moyennes et tint les céréales exotiques plus longtemps écartées de notre consommation. Ainsi, dans le département du Nord, un double intérêt existait à propos des graines oléifères, celui de la culture, celui de la trituration. 11 a satisfait l'un en grevant les oléagineux étrangers d'un droit prohibitif; il a apaisé l'autre en lui accordant, par un traité conclu avec la Russie, des franchises d'importation dont le Midi est exclu, et une faculté de travail en entrepôt que nous attendons encore.
Ici M. Reybaud montre ce qu'il y a de triste dans les dissensions qu'un pareil état de choses a engendrées.
Abordant ensuite les moyens, pour la France sacrifiée, de sortir de cette situation désastreuse, il fait remarquer que l'appel à la majorité des pouvoirs publics a été infructueux ; que c'est en vain que les intérêts sacrifiés se sont successivement défendus avec vigueur et talent.
Que faire alors ? A quel expédient recourir? A quelle influence s'adresser quand toutes sont impuissantes ou rebelles? Messieurs, l'historien éminent qui remplit cette assemblée de sa présence, nous a peint,'dans un style dont seul il a le secret, les derniers efforts d'un parti vaincu contre le despotisme d'un parti triomphant. Nous avons pu voir revivre, dans son récit animé, cette croisade aventureuse où les girondins cherchèrent à ressaisir les débris de leur puissance dans la création d'un fédéralisme provincial. Vaine et fatale tentative! Déplorable démembrement où se fût abîmée, sans profit pour personne, la force de la nation! Invoquerons-nous ce triste exemple, et poursuivrons-nous dans la région des intérêts, un fédéralisme nouveau, aux dépens de cette unité qui est le titre et la parure de la civilisation française?
Non, messieurs, de tels moyens sont indignes de nous; comme l'arme à deux tranchants, ils blesseraient ceux qui seraient tentés de s'en servir. A la situation dont souffrent nos intérêts, à l'état de servitude dans lequel ils se meuvent, il n'est qu'une seule issue, c'est de proclamer un principe supérieur de justice qui soit à l'abri des caprices de l'opinion et des passions de l'homme. Ce principe, vous l'avez nommé, c'est la liberté de l'échange. Voilà votre meilleure arme, croyez-moi, la mieux éprouvée et la plus loyale. En vous appuyant sur ce principe vous quittez la sphère orageuse de l’égoïsme pour entrer dans une région plus pure et plus sereine; vous arrivez au seul régime qui puisse [163] rétablir, entre des intérêts opposés, une concorde nécessaire, une paix durable. En rendant toutes les parties du sol a leur destination légitime, tous les bras, toutes les intelligences à leurs fonctions naturelles, ce principe éloignera, par sa seule vertu, les ferments de rivalité qu'engendre une organisation artificielle; il n'y aura dans le monde des affaires ni vainqueurs ni vaincus; l'industrie ne sera plus un champ de bataille. Messieurs, c'est là votre voie, n'en déviez pas; vous y trouverez la seule lumière qui ne vous trompera point. Croyez, à un équilibre spontané, fruit d'un régime impartial; croyez au bien-être qui naît de lui-même, comme une plante qui a trouvé son vrai terrain ; croyez surtout et en toutes choses aux bienfaits de la liberté, de ce mot qui résonne si bien à l'oreille et qu'il m'est toujours doux de prononcer.
Après M. Reybaud, M. Estrangin , secrétaire de l'Association, a voulu assurer la sympathie des dames à la cause du libre échange, par une démonstration élémentaire qui lui a valu les applaudissements de la plus gracieuse partie de l’assemblée.
M. Frédéric Bastiat
M. Frédéric Bastiat a abordé, devant l'auditoire marseillais, quelques-unes de ces démonstrations de principes, qu'il sait présenter avec tant de charme et de finesse. Son exorde ayant amené sur sa bouche le mot d'abstraction, il en a pris texte pour faire les réflexions suivantes:
Et puisque ce mot se présente à mes lèvres, permettez-moi une remarque. J'ai bien souvent maudit la scolastique pour «voir inventé le mot abstraction, qui exige tant de commentaires, quand elle avait à sa disposition le mot si simple et si juste -. vérité universelle. Car, regardez-y de près, qu'est-ce qu'une abstraction, si ce n'est une vérité universelle, un de ces faits qui sont vrais partout et toujours?
Un homme tient deux boules à sa main droite et deux à sa main gauche. Il les réunit, et constate que cela fait quatre boules. S'il fait l'expérience pour la première fois, tout ce qu'il peut énoncer, c'est ce fait particulier : « Aujourd'hui, à quatre heures, à Marseille, deux boules et deux boules font quatre boules. » Mais s'il a renouvelé l'expérience de jour et de nuit, sur plusieurs points du globe, avec des objets divers» il peut à chaque fois éliminer les circonstances de temps, de lieux, de sujets, et proclamer que « deux et deux font quatre. » C'est une abstraction de l'école, soit; mais c'est surtout une vérité universelle, une de ces formules qu'on ne peut interdire à l'arithmétique sans en arrêter immédiatement les progrès.'
Et voyez, messieurs, l'influence des mots. Vous savez combien nos adversaires nous dépopularisent et nous ridiculisent en nous jetant à la face le mot abstraction. Vous êtes dans l'erreur, s'écrient-ils, car ce que vous dites est une abstraction ! et ils ont les rieurs pour eux. Mais voyez quelle ligure ils feraient, si l'école n'eût pas inventé ce mot et qu'ils fussent réduits à nous dire: « Vous êtes dans l'erreur, car ce que vous dites est une vérité universelle. » (Rires.) Vous riez, messieurs, et cela prouve que les rieurs passeraient de notre côté. (Nouveaux rires.)
Ces prémisses lui ont permis d'aborder la démonstration de la proposition de J.-B. Say : Les produits s'échangent contre des produits, qu'il a rendue claire comme le jour, à l'aide des ressources de langage dont il a seul le secret, et qu'il formule plus volontiers de cette manière : Les services s'échangent avec des services. Il choisit pour exemptes la houille des Anglais, l'huile et la soie de la Provence, et il montre que, si la houille est à bon marché, la France en jouira.
Ce bienfait que la nature semblait avoir accordé à l'Angleterre, c'est à nous qu'elle l'a accordé, ou du moins nous entrons en participation de ce bienfait par l'échange. D'un autre côté, si les Anglais veulent avoir de l'huile ou de la soie, la nature ne leur ayant accordé qu'une intensité de chaleur qui laisserait beaucoup à faire au travail, quels vœux [164] doivent-ils faire, conformément à leur vrai intérêt? Que les choses se fassent en Provence le plus possible par l'intervention de la nature; que la nature ne laisse au travail qu'une coopération supplémentaire très-restreinte, puisque c'est cette coopération seule qui se paye.
Ainsi, vous le voyez, messieurs, l'économie politique bien comprise démontre, par le motif que je viens de dire, et par bien d'autres, que chaque peuple, loin d'envier les avantages des autres peuples, doit s'en féliciter, et il s'en félicitera certainement dès qu'il comprendra que ces avantages ont beau nous paraître localisés; par l'échange, ils sont le domaine commun et gratuit de tous les hommes.
La claire perception de cette vérité réalisera, ce me semble, dans la pratique même des affaires, le dogme de la fraternité.
Sans doute, la fraternité prend aussi sa source dans un autre ordre d'idées plus élevé. La religion nous en fait un devoir, et, pour le réaliser, elle a placé dans le cœur de l'homme, avec l'intérêt personnel, un autre mobile, la sympathie. L'un dit : Aimez-vous les uns les autres; et l'autre: Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner à vous aimer les uns les autres. Et n'est-il pas bien consolant que la science vienne démontrer l'accord de deux forces en apparence si contraires ? Messieurs, ne nous faisons pas illusion, on a beau déclamer contre l'intérêt, il vit, et il vit par un décret imprescriptible de celui qui a arrangé l'ordre moral. Jetons les yeux autour de nous, regardons agir tous les hommes, descendons dans notre propre conscience, et nous reconnaîtrons que l'intérêt est dans la société un ressort nécessaire, puisqu'il est indomptable. Ne serait-il pas dès lors bien décourageant qu'il fût par sa nature, et alors même qu'il serait bien compris, un aussi mauvais conseiller qu'on le dit? Et ne faudrait-il pas en conclure qu'il a pour triste mission d'étouffer la sympathie? Mais, s'il y a harmonie et non discordance entre ces deux mobiles, si tous deux tendent à la même fin, c'est un avenir certain ouvert au règne de la fraternité parmi les hommes. Y a-t-il pour l'esprit une satisfaction plus vive ; pour le cœur, une jouissance plus douce, que de voir deux principes qui semblaient antagoniques, deux lois providentielles qui paraissaient agir en sens opposé sur nos destinées, se réconcilier dans un effet commun, et proclamer ainsi que celte parole qui, il y a dix-huit siècles, annonça la fraternité au monde, n'était pas aussi contraire à la pente du cœur humain que le disait naguère une superficielle philosophie?
Messieurs, après avoir essayé de vous donner une idée de la doctrine du libre échange, Je vous dois une peinture du régime restrictif.
Les personnes qui fréquentent le Jardin des Plantes à Paris,, ont été à même d'observer un phénomène assez singulier. Vous savez qu'il y a un grand nombre de singes renfermés chacun dans sa cage. Quand le gardien met les aliments dans l'écuelle que chaque cage renferme, on croit d'abord que les singes vont dévorer chacun ce qui lui est attribué. Mais les choses ne se passent pas ainsi. On les voit tous passer les bras entre les barreaux et chercher à se dérober réciproquement la pitance; ce sont des cris, des grimaces, des contorsions, au milieu desquels bon nombre d'écuelles sont renversées et beaucoup d'aliments gâtés, salis et perdus. Cette perte retombe aujourd'hui sur les uns, demain sur les autres; mais ù la longue elle doit se répartir à peu près également sur tous, à moins que quelques singes des plus vigoureux n'y échappent ; mais alors vous comprenez que ce qui n'est pas perdu pour eux retombe en aggravation de perte sur les autres.
Voilà l'image fidèle du régime restrictif.
Pour montrer celte similitude, j'aurais à prouver deux choses : d'abord, que le régime restrictif est un système de spoliation réciproque; ensuite, qu'il entraîne nécessairement une déperdition de richesses à répartir sur la communauté.
L'orateur a ensuite appelé l'attention de l'auditoire sur le secours que trouveraient nos finances dans la réforme des douanes, et sur la possibilité que cette réforme donnerait à nos ministres pour exécuter les réductions sur le sel et sur la poste, et d'autres non moins instamment demandées.
Les avantages que la paix et la liberté du monde retireraient de la liberté [165] des échanges, et l'explication de la priori té que l'Angleterre a prise dans cette question, ont encore fourni à l'orateur le sujet de sages réflexions. En terminant, il a répété, avec M. Clapier, que l'œuvre de l'Association sera laborieuse, mais aussi qu'elle sera grande et belle, et que déjà la liberté du commerce a obtenu des succès éclatants dans toute l'Europe. Pour toute réponse à ceux qui affectent de dire que le libre échange est mort, il a cité, à côté du triomphe de la ligue, ce qui s'expérimente tous les jours en Suisse et en Toscane, lé changement de tarif aux États-Unis, les réformes de Naples, les idées de la Prusse, l'enquête de Naples, la formation d'Associations libre-échangistes à Gênes, à Rome, à Cadix, à Bruxelles, et le Congrès qui va s'ouvrir dans cette ville; sans parler de la France, dont les plus grandes cités (Paris, Lyon , Bordeaux, Marseille, le Havre), demandent unanimement la réforme. Enfin, pour dernier argument, M. Bastiat cite l'adhésion des hautes intelligences du pays qui ne sont pas sous le joug de l'esprit de parti.
Mais s'il est un homme, au regard d'aigle, qui n'ait pas besoin, comme nous, des lourdes béquilles de la pratique et de l'analyse, et qui ait reçu du Ciel, avec le don du génie, l'heureux privilège d'arriver d'un bond et dans toutes les directions jusqu'aux bornes et par delà les bornes-des connaissances du siècle, cet homme est avec nous. Tel est, j'ose le dire, l'inimitable poète, l'illustre orateur, le grand historien, dont l'entrée dans celle enceinte a attiré vos avides regards. Vous n'avez pas oublié que M. de Lamartine a défendu la cause de la liberté dans une circonstance où elle se confondait intimement avec l'intérêt marseillais. Je n'ai pas oublié non plus que M. de Lamartine, avec cette précision, ce bonheur d'expression qui n'appartiennent qu'à lui, a résumé toute notre pensée en ces termes : « La liberté fera aux hommes une justice que l'arbitraire ne saurait lui faire. » (Bruyants applaudissements.) J'espère donc, et j'ai la ferme confiance que M. de Lamartine ne me démentira pas si je dis que sa présence dans cette assemblée n'est pas seulement un témoignage de bienveillance envers des hommes qui essayent leurs premiers pas dans cette carrière du bien public qu'il parcourt avec tant de gloire, mais qu'elle révèle aussi sa profonde sympathie pour la sainte cause de l'union des peuples et de la libre communication des hommes, des choses et des idées.
M. de Lamartine
Lorsque l'orateur s'est assis, nous écrit-on, tous les regards se portent sur M. de Lamartine. La salle retentit d'acclamations universelles. Le bureau insiste, auprès du brillant orateur, pour le prier de se faire entendre. Alors M. de Lamartine se lève, et prononce le discours suivant, que nous n'osons point analyser, tant l'orateur a bien su marier, comme toujours, et la vérité de la science et le sentiment qui veut être dit, mais qui se refuse à toute analyse.
Messieurs, Si les interpellations bienveillantes et imméritées de vos députés et des éloquents orateurs qui viennent de se faire entendre, si ces applaudissements prématurés qui m'appellent malgré moi à votre tribune pouvaient m'inspirer autant de science et d'idées qu'ils m'inspirent en ce moment de reconnaissance, je n'hésiterais pas à vous dire aussi quelques mots. Mais en présence d'un si imposant auditoire, mais sur un sujet si vaste et si grave, mais sans être préparé, par une méditation préalable, à traiter les im menses questions de faits, de chiffres, de statistique qui s'y rattachent, je craindrais de rester trop au-dessous de ces questions, trop au-dessous de vous, et, permettez-moi de vous le dire aussi, trop au-dessous de l'idée que votre bienveillance exagérée se fait de l'orateur. (Non, non, parlez! parlez! nouveaux applaudissements.;
Cependant, messieurs, malgré ma résolution bien arrêtée de ne pas me permettre de parler dans une cause et dans une Ville où je n'ai pas naturellement la parole, vous sentez, je sens moi-même qu'après des provocations et des interpellations aussi directes et [166] aussi répétées, je ne pourrais m'obstiner au silence sans avoir l'air de désavouer, en ne répondant ni oui ni non, la grande liberté commerciale et politique qui vient de vous être développée par ce missionnaire de justice, de liberté et de richesse, et par vos propres députés. Je me lève donc pour obéir, pour une minute; mais je me lève comme un témoin qui rend témoignage, et non comme un orateur qui veut convaincre ou enseigner. Je n'entrerai dans aucun des développements que celle science infinie dans ses rapports comporterait; je ne me jetterai pas avec vous dans cet algèbre de l'économie politique qui raisonne surtout en chiffres, et dans laquelle je me suis plongé pendant des années entières d'études, pour savoir par moi-même au juste si les chiffres commerciaux, les faits et les statistiques de la richesse et du travail donnaient par hasard des démentis à celle évidence intérieure qui précède chez nous les convictions. Je vais me borner à dire quelle est la considération principale qui m'a de bonne heure incliné l'esprit et le cœur vers vos théories. Oui, le cœur aussi, le cœur surtout, car avant que l'examen eût fait pour moi une conviction de la liberté du travail et des échanges, la nature en avait fait un sentiment. Et pourquoi, messieurs? C'est que la liberté du travail et des échanges est lé principe véritablement populaire et par conséquent véritablement divin; c'est parce que la liberté des commerces, des industries, des échanges, est, par-dessus tout, l'intérêt des masses les plus nombreuses, les plus déshéritées d'autres richesses, les plus travailleuses, les plus écrasées sous le poids du jour,' les plus souffrantes de la société, l'intérêt de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif , de ceux qui ont chaud, de ceux qui ont froid, dans la communauté humaine. C'est ce que j'ai défini l'année dernière à là tribune de la Chambre dans les questions de la houille, de l'introduction du bétail étranger, du pain et du sel, par ce mot de Dieu, si contraire au mot des hommes: « La vie à bon marché! » Le sol, l'air, la lumière, la terre, la maison, le vaisseau, le fer, le logement, le vêlement, le feu, l'eau, les arômes défensives, les aliments, tout cela à bon marché! Si ce n'est pas là, messieurs, le mot delà Providence, il faut renoncer à interpréter se_- desseins! (Applaudissements.) Je dirai plus: si ce n'était pas là le mol et le sens de la Providence, il faudrait nier ou maudire la Providence, car elle serait faite à l'image de nos égoïsmes el de nos cupidités. (Bravos unanimes.)
Oui, oui, c'est là le mot de la Providence el de la nature, el les homme seuls ont pu l'arrêter sur ses lèvres pour lui substituer leur mot à eux, le mot de la nudité et de la faim: « Enchérissons la vie! » Enchérissons la vie, et comment? En commandant aux nations ces abstinences, ces jeûnes forcés à côté des richesses naturelles ou manufacturées dont elles surabondent. Plaçons, ont-ils dit, sur les frontières des peuples, des armées soldées par l'argent du peuple, uniquement employées à intercepter, à murer, à rendre rares, à repousser les aliments, les métaux, les outils, les fruits, les matières premières de travail, afin que tous souffrent de la richesse inutile de chacun et gémissent, non de la misère, mais de la prospérité générale!
Je parle ici des douanes, messieurs; mais entendons-nous bien, je parle des douanes comme instrument de prohibitions arbitraires et dé privilèges pour certaines industries, imposant aux unes une taxe pour favoriser les autres ; et nullement des douanes comme perception surtout d'impôts naturels et modérés, utiles à l'État tout entier. (Applaudissements.)
Oui, je dis que le système prohibitif ou protectionniste est un tel mensonge à Dieu et aux hommes, qu'il est parvenu à faire de la fécondité de la nature, de la diversité de fructification des climats et de la libéralité de la Providence divine un fléau aux yeux des économistes! (Bravos!) Faudrait-il une autre accusation pour le juger? Oui, d'après ce système, le protectionniste, s'il est logique, s'il est conséquent dans son mensonge, doit regarder comme une calamité, par exemple, que ce sucre, dont parlait M. Clapier à côté de moi, que ce sucre des Antilles donne son miel aux tropiques, car ce sucre vient menacer de sa concurrence dans les champs pluvieux du Nord le sucre indigène, deux fois plus coûteux, et le système est obligé d'élever, au détriment de toutes nos navigations, une barrière de douanes entre les colonies el la métropole pour arrêter cette substance bienfaisante qui coulerait dans les aliments du peuple, dans la tisane du malade, [167] dans le lait de l'enfant, ou dans la boisson du pauvre, et d'en élever le prix de cent cinquante pour cent pour le rendre inaccessible à la consommation du peuple. (On applaudit.) Oui, le protectionniste doit regarder comme une calamité que le métal pour le travail, le fer, se trouve en abondance intarissable et en qualité supérieure dans les veines des montagnes de la Suède, car il est obligé de lui fermer les côtes de la France, et de l'enchérir de cent dix pour cent pour que le peuple, depuis le laboureur jusqu'au constructeur de navires, soit forcé de dépenser à la surtaxe du prix de tous les outils du travail humain, de la charrue au poinçon, cent ou cent cinquante millions par an, au lieu de les employer à produire d'autres sillons, d'autres voies de fer, d'autres machines d'industrie, d'autres navires, d'autres arts, d'autres maisons, ou bien à améliorer ses demeures, ses vêtements, ses aliments, sa vie! (Applaudissements.) Le protectionniste est obligé de regarder comme une calamité que le blé croisse comme l'herbe inculte des champs dans les steppes de la mer Noire, dans les limons de l'Egypte ou dans le sol vierge de l'Amérique; car il est obligé de murer ses routes, ses mers, ses ports contre cette invasion, contre ce débordement de pain et de vie qui inonderait d'aliments, d'aisance et de population la France, pour que le peuple paye cinquante pour cent de plus son pain ! (Applaudissements.)
Oui, le protectionniste conséquent est obligé de regarder comme une calamité publique que les vagues de l'Océan laissent évaporer leur sel, car ce sel, nécessaire à l'agriculture et à la nourriture des masses, fait concurrence au sel des fabricateurs patentés de ce produit naturel! Ainsi de tout, messieurs; mais je n'irai pas plus loin en un pareil moment.
Messieurs, j'ai ouvert, j'ai feuilleté tristement quelquefois sur mon banc à la Chambre des députés ce volume que vous connaissez tous ici, ce volume énorme, immense, infini, confus, irrationnel .cette Apocalypse du système prohibitif... (Rires et applaud ); oui, celte , Apocalypse du système protectionniste qu'on appelle le tarif de nos douanes! J'ai frémi, j'ai gémi, j'ai souri de pitié sur nous-mêmes en lisant cette liste intarissable de nos tarifs prétendus protecteurs; liste où, depuis cette graine de sésame que vous citait tout à l'heure un des orateurs, depuis cette graine de sésame, cette poussière végétale imperceptible, coupable de contenir une goutte d'huile dans chaque grain, jusqu'au bœuf en graissé de la Suisse et jusqu'à la baleine du Groenland (On rit.); depuis l'aiguille d'acier anglais, outil de la pauvre lille de vos mansardes qui brode une étoffe ou un voile avec un fil de lin ou de colon surenchéri entre ses doigts, jusqu'au mât du vaisseau qui porte vos Voiles surenchères par un système qui n'a qu'un regret, c'est de ne pouvoir y surenchérir le vent! (Appl.) Tout ce qui sert à l'homme, tout ce qui le nourrit, tout ce qui l'habille, tout ce qui le chauffe, tout ce qui le console, est l'objet d'un prix additionnel au prix naturel, pour élever tout et la vie elle-même au-dessus de la portée du plus grand nombre! (Bravos.) En sorte que ce système protecteur soi-disant du travail national, et appelé ainsi par dérision sans doute de ceux qui l'ont inventé ou qui le défendent, ne protège en réalité que la pénurie, la nudité, la faim, la soif, la dépopulation et la mort de l'empire! (Appl.) El je me disais en feuilletant ce code de nos misères volontaires: « Est-il possible que ce soit le code de Dieu? Est-il possible que ce soit là le livre de vérité? Est-il possible que ce soit là l'évangile de vraie protection et de charité pour les masses du peuple? Non! c'est le code de l'egoïsme! C'est le livre d'or du monopole! C'est l'évangile du mensonge social et de la cupidité aveugle du producteur insatiable contre le consommateur indigent! » (Bravos unanimes.)
Eh bien ! cependant, on a l'air d'hésiter encore et de ne pas savoir où est la vérité entre le système du libre échange et le sytème des prohibitions et des renchérissements! Messieurs, en pareille matière, la vérité n'est pas si difficile à découvrir qu'on le dit. On la trouve d'un coup d'oeil de deux manières, dans un chiffre et dans un sentiment. Oui, dans un chiffre d'abord, car il n'en est pas des vérités commerciales et matérielles comme il en est des vérités métaphysiques, politiques, morales, religieuses, où la minorité, ne fût-elle que d'une tête sur cent millions, a le droit d'avoir raison contre tous, comme la cime de vos montagnes a raison de voir le jour qui se lève quand vos vallées ne le voient pas encore. (Bravos.) Dans l'ordre matériel, c'est le nombre des intéressés qui fait la [168] vérité, car c'est fui qui fait l'intérêt général ou la justice. Eh bien! que les consommateurs se comptent en contraste avec les producteurs protégés, le chiffre de trente-cinq millions contre quelques milliers d'exploitateurs privilégiés d'industries qui murent la France, leur dira où est la vérité, où est l'aisance du peuple, où est la richesse, la force, Ui population, la prospérité du pays! Oui, il n'y a à dire aujourd'hui sur ces matières, que le mol adressé autrefois par Sieyès au peuple exclu des droits civiques par les lois restrictives de la souveraineté nationale : « Comptez-vous! » Mais ici, ce n'est point le mot de la sédition, c'est le cri de la justice et de l'ordre! (Nouveaux applaudissements.)
Il y a, je viens de le dire, une autre manière de juger cet important procès entre deux systèmes dont l'un est la mort, dont l'autre est la vie des masses, c'est le sentiment! Le sentiment qui est éclairé d'en haut comme la conscience, et qui ne se trompe jamais, parce qu'il est en nous la voix involontaire de la nature et de Dieu lui-même qui parle dans nos bons instincts.
Eh bien ! je me suis quelquefois posé à moi-même cette hypothèse étrange dans mes pensées pour juger de la vérité ou de la fausseté des systèmes de gouvernement, en matière de travail et d'échange comme en matière de législation politique. Supposons, me suis-je dit, que le commerce, l'industrie, l'impôt, le travail du peuple soient gouvernés, non par une Chambre de privilégiés de l'industrie et de propriétaires d'usines, exclusivement jaloux de vendre cher les produits de leur fabrication et les fruits de leurs champs, mais par un esprit d'un ordre impartial et supérieur à l'humanité, par un ange, si vous voulez, par un législateur divin, éclairé, animé, dévoré par la lumière, parla justice et par la charité de Dieu lui-même pour ses créatures. Que ferait cet ange chargé de régir, d'équilibrer, de niveler, de gouverner celte province de l'humanité? Evidemment, messieurs, comme la vie est le premier des dons du Ciel, il s'efforcerait de mettre la vie sous toutes ses formes à la portée de la plus grande masse possible des créatures humaines; et puisque toute créature ici-bas, excepté les oiseaux du ciel, est obligée de payer un certain prix pour le loyer de son existence sur la terre, comme un locataire divin d'une partie de temps et d'une partie d'espace sur ce globe, l'esprit céleste mettrait cette location, celte vie, les aliments, les vêtements, les logements, les outils, les nécessités, les jouissances, la reproduction de l'espèce elle-même au plus bas prix possible ; il prendrait notre mot, la vie à bon marché! Il l'inscrirait comme la devise de sa civilisation sur les bannières du peuple, sur le frontispice de son gouvernement! El, pour que ce mot fût une vérité, il favoriserait entre tous les pays, entre tous les climats,, entre tous les produits et toutes les consommations diverses de ce globe, l'échange des aliments, des matières et des outils de travail nécessaires à l'existence, au bien-être, à la paix, à la multiplication du peuple; en un mot, il créerait le libre échange comme vous voulez le créer. Il créerait la fraternité du commerce, du travail et du transport, cette contre-épreuve matérielle de la fraternité morale du genre humain, qui est la loi de Dieu entre des enfants égaux devant la loi! Je le répète, il créerait à l'instant le libre échange, et les biens de la terre prendraient leur niveau comme les eaux de l'Océan, comme l'air vital autour du globe que nous habitons! (Applaudissements. )
Et maintenant, supposons autre chose, messieurs, supposons que Dieu, au lieu de donner ce peuple à un ange, le donne à gouverner à un esprit partial, à un esprit d'iniquité, de ténèbres, de mal et de mort, à un démon si vous voulez. Que fera cet esprit, ennemi de la justice, de la vérité, du bien-être, de la population, ennemi des hommes, en un mot? que fera-t-il pour appauvrir, torturer, amaigrir, affamer, dépeupler la masse de travailleurs qui lui aura été confiée pour leur malheur? Ce qu'il fera, vous l'avez sous les yeux! Il séparera les climats, les mers, les îles, les continents, les nations, les fils d'une même race et d'une même terre en peuples ennemis en pleine paix; il mettra entre eux des barrières infranchissables, ou que l'on ne franchira que l'or à la main; il établira des armées de surveillants sur les frontières de ces peuples, pour empêcher que ce qui est dans la main de l'un ne tombe dans la main de l'autre; il défendra au soleil des tropiques de mûrir la canne à sucre pour l'homme de l'Occident; il interdira aux coteaux du Midi de germer l'olive et la vigne pour les hommes du Nord; aux hommes du Nord, [169] de faire croître le lin pour les hommes du Midi; il fera combler les mines de fer de la Dalécarlie, pour qu'elles ne donnent plus les outils ou le soc aux travailleurs français; il fera languir et mourir de soif et de faim les populations de son empire, à la vue des cargaisons de riz ou de froment qui encombreront les navires étrangers, ou ses entrepôts dans ses propres ports. Eu un mot, il inventera ce mot féroce et stupide dont nos tarifs sont le commentaire en trente mille articles : L'enchérissement de la vie et du travail du peuple! Il créera le système prohibitif; et s'il ajoute l'hypocrisie à la cruauté, il le colorera de sophismes nationaux pour tromper et pour jouer le peuple en l'affamant, et il l'appellera le système protecteur! (Long applaudissement.) Voilà, messieurs, les deux principes face à face et dans leur nudité. A vous déjuger!
Mais nous ne sommes gouvernés ni par des anges, ni par des démons. Nous sommes gouvernés par des hommes; par des hommes souvent bien intentionnés, mais faibles, aveugles, décourages des difficultés, voyant le mal où les vieilles routines et les vieilles oppressions nous ont enfoncés, et ne pouvant le faire disparaître, voyant le mieux et n'ayant pas le courage ou la vertu d'y aspirer hardiment. Ne leur demandons pas plus que ce que l'homme peut faire; mais demandons-leur tout ce que l'homme peut faire; c'est-à-dire non pas de renverser en un seul jour ces digues factices de tarifs, à l'abri desquelles certains grands intérêts respectables aussi, non par leur droit, mais par leur existence, se sont formés; mais de les abaisser peu à peu, un à un; d'ouvrir graduellement les écluses, de niveler insensiblement les droits et les intérêts du consommateur et du producteur, jusqu'à l'équité et à la liberté parfaites, vers lesquelles nous devons marcher d'un pas aussi modéré, aussi prudent, aussi lent que la faiblesse humaine et la lenteur des grands mouvements des nations le comportent, mais vers lesquelles nous devons marcher dès aujourd'hui, marcher toujours, marcher avec résolution et constance; non comme des insensés enivrés d'une théorie nouvelle et l'appliquant au hasard, mais comme des hommes d'Etat qui pèsent dans leurs mains tous les intérêts pour donner à chacun sa valeur, et qui ne sacrifient ni la vérité au temps, ni le temps à la vérité! (Applaudissements.)
Et pour cela que faut-il? Il faut que la loi des douanes soit en discussion permanente et tous les ans devant nos Chambres, et inscrive en réduction de chiffres gradués tout ce que nous inscrivons ici en principes! (Bravos.) Conjurez vos députés ici présents de s'unir à cette œuvre. Ils peuvent compter sur moi comme sur eux-mêmes! Députés de l'agriculture vraie comme de la navigation libre, nous n'avons qu'un même intérêt! Nous finirons par triompher. .
Le lieu est bien choisi ici, messieurs, pour proclamer cette liberté des échanges entre les peuples, au profit des peuples. Marseille est née de cet instinct des nations! C'est son génie prophétique, c'est le génie de la liberté du commerce qui lui inspira, à l'époque de sa migration vers vos côtes, de s'asseoir sur votre rivage, à la proximité de vos rades et de vos ports, et non, comme une ville agricole, d'aller se fonder dans l'intérieur des terres. Ce qui n'est pour les autres villes de France qu'une vérité abstraite, comme la définissait tout à l'heure M. Bastiat, est pour vous une évidence palpable, visible, un intérêt légitime, car il est utile à tous! Les voiles do vos navires, les pointes de vos mâts, la fumée de vos innombrables bateaux à vapeur écrivent à toute heure, sur votre ciel limpide et sur les vagues de toutes les mers, le dogme triomphant de la liberté des échanges. (Bravos prolongés.) Puisse la main de vos députés, à laquelle ma faible main ne faillira pas, l'écrire bientôt dans nos lois ! (Bravos.) Oui, opérons, par des manifestations comme celle-ci, par la pression de l'opinion publique, par le courage que nous donnerons ainsi aux gouvernements en leur faisant sentir que s'ils sont serrés, dominés, emprisonnés par une ligue d'intérêts privilégiés et égoïstes, ils sont soutenus par une nation entière de consommateurs; opérons cette révolution du bon marché, comme je l'ai nommée ailleurs un jour, et rendons au peuple la plus incontestable, la première, la plus sainte des libertés, la liberté de vivre! (Bravos et acclamations.) La liberté de vivre au prix de la nature, au prix de Dieu, et non pas au prix des hommes, au prix des privilégiés et des monopoleurs de la protection! (Applaudissements unanimes et répétés )
[170]
Ce jour-là, messieurs, Marseille, dont j'ai en ce moment le bonheur d'être l'hôte, et dont je serai éternellement l'ami, ce jour-là, Marseille deviendra ce que la nature l'a destinée à devenir: la grande échelle des Gaules vers l'Afrique et vers l'Asie ! (Bravos.) Marseille deviendra la façade de la France sur les mers du Midi et de l'Orient. (Nouveaux bravos.) Marseille deviendra, après l'exécution de nos chemins de fer, le quai de Paris; Marseille deviendra le centre d'une population plus nombreuse et plus active encore, qui élargira ses remparts et ses ports par l'élasticité du commerce. Marseille, enfin, deviendra la capitale de cette vérité qu'on lui annonce aujourd'hui. (Bravos unanimes et prolongés à plusieurs reprises.)
Messieurs, encore un mot qui nous ramène, vous et moi, à l'objet de cette assemblée. Vous vous souviendrez alors, vous ou vos enfants, vous vous souviendrez alors avec reconnaissance de ce missionnaire de bien-être et de richesses, qui est venu vous apporter de si loin, et avec un zèle entièrement désintéressé, la vérité gratuite dont il est l'organe, et la parole de vie matérielle, et vous placerez le nom de M. Bastiat, ce nom qui grandira à mesure que la vérité grandira elle-même, vous le placerez à côté de Cobden, de Fox et de leurs amis de la grande ligue européenne, parmi les noms des apôtres de Cet évangile du travail émancipé, dont la doctrine est une semence sans ivraie qui fait germer chez tous les peuples, sans acception de langue, de patrie ou de nationalité, la liberté, la justice et la paix! (Longues salves d'applaudissements.)
A Letter (to Hippolyte Castille on intellectual property [9 September 1847] ↩
BWV
1847.09.09 "Lettre" (A Letter (to Hippolyte Castille on intellectual property) [Mugron, 9 September 1847] [OC2.49b, pp. 340-42]
Mugron, le 9 septembre 1847
« Monsieur,
J’apprends avec une vive satisfaction l’entrée dans le monde du journal que vous publiez dans le but de défendre la propriété intellectuelle.
Toute ma doctrine économique est renfermée dans ces mots : Les services s’échangent contre des services, ou en termes vulgaires : Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi, ce qui implique la propriété intellectuelle aussi bien que matérielle.
Je crois que les efforts des hommes, sous quelque forme que ce soit, et les résultats de ces efforts, leur appartiennent, ce qui leur donne le droit d’en disposer pour leur usage ou par l’échange. J’admire comme un autre ceux qui en font à leurs semblables le sacrifice volontaire ; mais je ne puis voir aucune moralité ni aucune justice à ce que la loi impose systématiquement ce sacrifice. C’est sur ce principe que je défends le libre-échange, voyant sincèrement dans le régime restrictif une atteinte, sous la forme la plus onéreuse, à la propriété en général, et en particulier à la plus respectable, la plus immédiatement et la plus généralement nécessaire de toutes les propriétés, celle du travail.
Je suis donc, en principe, partisan très-prononcé de la propriété littéraire. Dans l’application, il peut être difficile de garantir ce genre de propriété. Mais la difficulté n’est pas une fin de non-recevoir contre le droit.
La propriété de ce qu’on a produit par le travail, par l’exercice de ses facultés, est l’essence de la société. Antérieure aux lois, loin que les lois doivent la contrarier, elles n’ont guère d’autre objet au monde que de la garantir.
Il me semble que la plus illogique de toutes les législations est celle qui régit chez nous la propriété littéraire. Elle lui donne un règne de vingt ans après la mort de l’auteur. Pourquoi pas quinze ? pourquoi pas soixante ? Sur quel principe a-t-on fixé un nombre arbitraire ? Sur ce malheureux principe que la loi crée la propriété, principe qui peut bouleverser le nombre.
Ce qui est juste est utile : c’est là un axiome dont l’économie politique a souvent occasion de reconnaître la justesse. Il trouve une application de plus dans la question. Lorsque la propriété littéraire n’a qu’une durée légale très-limitée, il arrive que la loi elle-même met toute l’énorme puissance de l’intérêt personnel du côté des œuvres éphémères, des romans futiles, des écrits qui flattent les passions du moment et répondent à la mode du jour. On cherche le débit dans le public actuel que la loi vous donne, et non dans le public futur dont elle vous prive. Pourquoi consumerait-on ses veilles à une œuvre durable, si l’on ne peut transmette à ses enfants qu’une épave ? Plante-t-on des chênes sur un sol communal dont on a obtenu la concession momentanée ? Un auteur serait puissamment encouragé à compléter, corriger, perfectionner son œuvre, s’il pouvait dire à son fils : « Il se peut que de mon vivant ce livre ne soit pas apprécié. Mais il se fera son public par sa valeur propre. C’est le chêne qui vous couvrira, vous et vos enfants, de son ombre.
Je sais, Monsieur, que ces idées paraissent bien mercantiles à beaucoup de gens. C’est la mode aujourd’hui de tout fonder sur le principe du désintéressement chez les autres. Si les déclamateurs voulaient descendre un peu au fond de leur conscience, peut-être ne seraient-ils pas si prompts à proscrire dans l’écrivain le soin de son avenir et de sa famille, ou le sentiment de l’intérêt, puisqu’il faut l’appeler par son nom. — Il y a quelque temps, je passai toute une nuit à lire un petit ouvrage où l’auteur flétrit avec une grande énergie quiconque tire la moindre rémunération du travail intellectuel. Le lendemain matin, j’ouvris un journal, et, par une coïncidence assez bizarre, la première chose que j’y lus, c’est que ce même auteur venait de vendre ses œuvres pour une somme considérable. Voilà tout le désintéressement du siècle, morale que nous nous imposons les uns aux autres, sans nous y conformer nous-mêmes. En tout cas, le désintéressement, tout admirable qu’il est, ne mérite même plus son nom s’il est exigé par la loi, et la loi est bien injuste si elle ne l’exige que des ouvriers de la pensée.
Pour moi, convaincu par une observation constante et par les actes des déclamateurs eux-mêmes, que l’intérêt est un mobile individuel indestructible et un ressort social nécessaire, je suis heureux de comprendre qu’en cette circonstance, comme dans beaucoup d’autres, il coïncide dans ses effets généraux avec la justice et le plus grand bien universel : aussi je m’associe de tout cœur à votre utile entreprise.
Votre bien dévoué.
Frédéric Bastiat,
Rédacteur en chef du Libre-Échange. »
FN: Ce discours diffère de ceux qui précèdent en ce qu’il traite plus particulièrement de la propriété littéraire ; mais il se rattache comme les autres au droit de propriété, qui n’a, quel qu’en soit l’objet, qu’une seule et même base. Avec la lettre dont nous le faisons suivre, ce discours représente tout ce que nous avons pu recueillir de l’auteur sur ce coté spécial du sujet.(Note de l’éditeur.)
FN: V. la même conclusion aux pages 140 et 144 du tome IV. (Note de l’éditeur.)
Réponse au journal l’Atelier [12 Sept. 1847] ↩
BWV
1847.09.12 “Réponse au journal *l’Atelier*” (Reply to the journal *L’Atelier*) [“Application de la liberté: richesse et égoïsme de ses partisans,” in *Libre-Échange*, 12 Septembre 1847, pp. 333-34] [OC2.23, p. 124]
Originally published in JDE: 1847.08.15 "Correspondance. Les trois chefs d'accusation du journal L'Atelier," JDE, 15 Août 1847, T. XVIII, pp. 68-71. [Dated: “Gray, le 28 juillet 1847”].
Réponse au journal l’Atelier [1]
12 Septembre 1847 [120]
Si j’ai eu quelquefois la prétention de faire de la bonne économie politique pour les autres, je dois au moins renoncer à faire de la bonne économie privée pour moi-même.
Comment est-il arrivé que, voulant aller de Paris à Lyon, je me trouve dans un cabaret par delà les Vosges ? Cela pourra vous surprendre, mais ne me surprend pas, moi qui ne vais jamais de la rue Choiseul au Palais-Royal sans me tromper.
Enfin me voici arrêté pour quelques heures, et je vais en profiter pour répondre au violent article que l’Atelier a dirigé contre le Libre-Échange dans son dernier numéro. Si j’y réponds, ce n’est pas parce qu’il est violent, mais parce que cette polémique peut donner lieu à quelques remarques utiles et surtout opportunes.
Dans un précédent numéro de ce journal, nous avions remarqué cette phrase :
« Ce que nous prétendons, c’est que la liberté veut et la possession individuelle et la concurrence. Il est absolument impossible de sacrifier ces deux conditions de la liberté sans sacrifier la liberté elle-même. »
Cette phrase étant l’expression de notre pensée, posant nettement les principes dont nous nous bornons à réclamer les conséquences, il nous semblait que l’Atelier était infiniment plus rapproché de l’Économie politique, qui admet, comme lui, ces trois choses : Propriété, liberté, concurrence, que du Communisme, qui les exclut formellement toutes trois.
C’est pourquoi nous nous étonnions de ce que l’Atelier se montrât plein de douceur pour le communisme et de fiel pour l’économie politique.
Cela nous semblait une inconséquence. Car enfin, à supposer que l’Atelier et le Libre-Échange diffèrent d’avis sur quelques-unes des occasions où l’un peut trouver bon et l’autre mauvais que la loi restreigne la propriété, la liberté et la concurrence ; en admettant que nous ne posions pas exactement à la même place la limite qui sépare l’usage de l’abus, toujours est-il que nous sommes d’accord sur les principes, et que nous différons seulement sur des nuances qu’il s’agit de discuter dans chaque cas particulier, tandis que, entre l’Atelier et le Populaire, il y a autant d’incompatibilité qu’entre un oui universel et un non absolu.
Comment donc expliquer les cajoleries de l’Atelier envers le communisme, et son attitude toujours hostile à l’économie politique ? À cet égard, nous avons préféré nous abstenir que de hasarder des conjectures.
Mais l’Atelier nous donne lui-même les motifs de sa sympathie et de son antipathie.
Ils sont au nombre de trois.
1° Notre doctrine est en cours d’expérience, tandis que celle des communistes est inappliquée et inapplicable ;
2° Les économistes appartiennent à la classe riche et lettrée, tandis que les communistes appartiennent à la classe pauvre et illettrée ;
3° L’économie politique est l’expression du côté inférieur de l’homme et est inspirée par l’égoïsme, tandis que le communisme n’est que l’exagération d’un bon sentiment, du sentiment de la justice.
Voilà pourquoi l’Atelier, fort doucereux envers les communistes, se croit obligé de tirer sur nous, comme il le dit, à boulets rouges et aussi rouges que possible.
Examinons rapidement ces trois chefs d’accusation.
Notre doctrine est en cours d’expérience ! L’Atelier veut-il dire qu’il y a quelque part des possessions individuelles reconnues, et que toute liberté n’est pas détruite ? Mais comment en fait-il une objection contre nous, lui qui veut et la propriété, et la liberté ? Veut-il insinuer que la propriété est trop bien garantie, la liberté trop absolue, et qu’on a laissé prendre à ces deux principes, bons en eux-mêmes, de trop grands développements ? Au point de vue spécial des échanges, nous nous plaignons, il est vrai, du contraire. Nous soutenons que la prohibition est une atteinte à la liberté, une violation de la propriété, et principalement de la propriété du travail et des bras ; d’où il suit que c’est un système de spoliation réciproque, des avantages duquel un grand nombre est néanmoins exclu. Quiconque se déclare à cet égard notre adversaire, est tenu de prouver une de ces choses : ou que la prohibition d’échanger ne restreint pas la propriété, aux dépens des uns et à l’avantage des autres (ce qui est bien spoliation), ou que la spoliation, au moins sous cette forme, est juste en principe et utile à la société.
Ainsi, quant à l’échange, notre doctrine n’est pas appliquée. Et elle ne l’est pas davantage, si l’Atelier veut parler de l’économie politique en général.
Non, certes, elle ne l’est pas, de bien s’en faut ; — pour qu’on puisse dire qu’elle a reçu la sanction de l’expérience, attendons qu’il n’y ait ni priviléges, ni monopoles d’aucune espèce ; attendons que la propriété de l’intelligence, des facultés et des bras soit aussi sacrée que celle du champ et des meulières. Attendons que la loi, égale pour tous, règle le prix de toutes choses, y compris les salaires, ou plutôt qu’elle laisse le prix de toutes choses s’établir naturellement ; attendons qu’on sache quel est le domaine de la loi et qu’on ne confonde pas le gouvernement avec la société ; attendons qu’une grande nation de 36 millions de citoyens, renonçant à menacer jamais l’indépendance des autres peuples, ne croie pas avoir besoin, pour conserver la sienne, de transformer cinq cent mille laboureurs et ouvriers en cinq cent mille soldats ; attendons qu’une énorme réduction dans notre état militaire et naval, la liberté réelle de conscience et d’enseignement, et la circonscription du pouvoir dans ses véritables attributions permettent de réduire le budget d’une bonne moitié ; que, par suite, des taxes faciles à prélever et à répartir avec justice suffisent aux dépenses publiques ; qu’on puisse alors supprimer les plus onéreuses, celles qui, comme l’impôt du sel et de la poste, retombent d’un poids accablant sur les classes le moins en état de les supporter, et celles surtout qui, comme l’octroi, la douane, les droits de mouvement et de circulation, gênent les relations des hommes et entravent l’action du travail ; alors vous pourrez dire que notre doctrine est expérimentée. — Et pourtant, nous ne prédisons pas à la société, comme font beaucoup d’écoles modernes, qu’elle sera exempte de toutes souffrances ; car nous croyons à une rétribution naturelle et nécessaire, établie par Dieu même, et qui fait que, tant qu’il y aura des erreurs et des fautes dans ce monde, elles porteront avec elles les conséquences destinées précisément à châtier et réprimer ces fautes et ces erreurs.
Il y a quelque chose de profondément triste dans le second grief articulé contre nous, tiré de ce que nous appartenons, dit-on, à la classe riche et lettrée.
Nous n’aimons pas cette nomenclature de la société en classe riche et classe pauvre. Nous comprenons qu’on oppose la classe privilégiée à la classe opprimée partout où la force ou la ruse, transformées en loi, ont fondé cette distinction. Mais sous un régime où la carrière du travail serait loyalement ouverte à tous, où la propriété et la liberté, ces deux principes proclamés par l’Atelier, seraient respectées, nous voyons des hommes de fortunes diverses, comme de taille et de santé différentes ; nous ne voyons pas de classes riche et pauvre. Encore moins pouvons-nous admettre que les riches soient un objet de haine pour les pauvres. Si l’économie politique a rendu à la société un service, c’est bien lorsqu’elle a démontré qu’entre la richesse due au travail et celle due à la rapine, légale ou non, il y a cette différence radicale que celle-ci est toujours et celle-là n’est jamais acquise aux dépens d’autrui. Le travail est vraiment créateur, et les avantages qu’il confère aux uns ne sont pas plus soustraits aux autres que sils fussent sortis du néant. Au contraire, il me serait facile de démontrer qu’ils tendent à se répartir sur tous. Et voyez les conséquences du sentiment exprimé par l’Atelier. Il ne va à rien moins qu’à condamner la plupart des vertus humaines. L’artisan honnête, laborieux, économe, ordonné, est sur la route de la fortune ; et il faudrait donc dire qu’en vertu de ses qualités mêmes il court se ranger dans la classe maudite !
La distinction entre classes riches et classes pauvres donne lieu, de nos jours, à tant de déclamations que nous croyons devoir nous expliquer à ce sujet.
Dans l’état actuel de la société, et pour nous en tenir à notre sujet, sous l’empire du régime restrictif, nous croyons qu’il y a une classe privilégiée et une classe opprimée. La loi confère à certaines natures de propriété des monopoles qu’elle ne confère pas au travail, qui est aussi une propriété.
On dit bien que le travail profite par ricochet de ces monopoles, et la société qui s’est formée pour les maintenir a été jusqu’à prendre ce titre : Association pour la défense du travail national, titre dont le mensonge éclatera bientôt à tous les yeux.
Une circonstance aggravante de cet ordre de choses, c’est que la propriété privilégiée par la loi est entre les mains de ceux qui font la loi. C’est même une condition, pour être admis à faire la loi, qu’on ait une certaine mesure de propriété de cette espèce. La propriété opprimée au contraire, celle du travail, n’a voix ni délibérative ni consultative. On pourrait conclure de là que le privilége dont nous parlons est tout simplement la loi du plus fort.
Mais il faut être juste ; ce privilége est plutôt le fruit de l’erreur que d’un dessein prémédité. La classe qui vit de salaires ne paraît pas se douter qu’elle en souffre ; elle fait cause commune contre nous avec ses oppresseurs, et il est permis de croire que, fût-elle admise à voter les lois, elle voterait des lois restrictives. Les journaux démocratiques, ceux en qui la classe ouvrière a mis sa confiance, la maintiennent soigneusement, nous ne savons pourquoi, dans cette erreur déplorable. S’ils agissent en aveugles, nous n’avons rien à dire ; s’ils la trompent sciemment, comme il est permis de le soupçonner, puisqu’ils disent que nous avons raison en principe, ce sont certainement les plus exécrables imposteurs qui aient jamais cherché à égarer le peuple.
Toujours est-il que la classe ouvrière ne sait pas qu’elle est opprimée et ce qui l’opprime. Aussi, tout en défendant ses droits, comme nous l’avons fait jusqu’ici et comme nous continuerons à le faire, nous ne pouvons nous associer à ses plaintes contre les riches, puisque ces plaintes, portant à faux, ne sont que de dangereuses et stériles déclamations.
Nous le disons hautement : ce que nous réclamons pour toutes les classes, dans l’intérêt de toutes les classes, c’est la justice, l’impartialité de la loi ; en un mot, la propriété et la liberté. À cette condition, nous ne voyons pas des classes, mais une nation. Malgré la mode du jour, notre esprit se refuse à admettre que toutes les vertus, toutes les perfections, toutes les pensées généreuses, tous les nobles dévouements résident parmi les pauvres, et qu’il n’y ait parmi les riches que vices, intentions perverses et instincts égoïstes. S’il en était ainsi, si le bien-être, le loisir, la culture de l’esprit pervertissaient nécessairement notre nature, il en faudrait conclure que l’éternel effort de l’humanité, pour vaincre la misère par le travail, est la manifestation d’un mobile à la fois dépravé et indestructible. Il faudrait condamner à jamais le dessein de Dieu sur sa créature de prédilection [2].
Il ne me reste pas d’espace pour réfuter la troisième accusation formulée contre l’économie politique, celle fondée sur cette assertion, qu’elle est l’expression du côté inférieur de l’homme. C’est, du reste, un vaste sujet sur lequel j’aurai occasion de revenir.
Parce que l’économie politique circonscrit le champ de ses investigations, on suppose qu’elle dédaigne tout ce qu’elle ne fait pas rentrer dans sa sphère. Mais, sur ce fondement, quelle science ne devrait-on pas condamner ? L’économie politique, il est vrai, n’embrasse pas l’homme tout entier ; elle laisse leur part de cet inépuisable sujet à l’anatomie, à la physiologie, à la métaphysique, à la politique, à la morale, à la religion. Elle considère surtout l’action des hommes sur les choses, des choses sur les hommes, et des hommes entre eux, en tant qu’elle concerne leurs moyens d’exister et de se développer. Exister, se développer, cela peut paraître aux rédacteurs de l’Atelier chose secondaire et inférieure, même en y comprenant, comme on doit le taire, le développement intellectuel et moral aussi bien que le développement matériel. Pour nous, après ce qui se rapporte aux intérêts d’une autre vie, nous ne savons rien de plus important ; et ce qui prouve que nous n’avons pas tout à fait tort, c’est que tous les hommes, sans exception, ne s’occupent guère d’autre chose. Après tout, il ne peut jamais y avoir contradiction entre ce que les sciences diverses renferment de vérité. Si l’économiste et le moraliste ne sont pas toujours d’accord, c’est que l’un ou l’autre se trompe indubitablement. On peut réfuter tel économiste, comme tel moraliste, comme tel anatomiste ; mais la guerre déclarée à l’économie politique me paraît aussi insensée que celle que l’on ferait à l’anatomie ou à la morale [3].
FN:Écrite en voyage et adressée à l’éditeur du Journal des Économistes.
FN:V. au tome VI, chap. vi, Moralité de la richesse. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV, Justice et Fraternité, p. 298. (Note de l’éditeur.)
Seconde campagne de la ligue [ 7 novembre 1847] ↩
BWV
1847.11.07 “Seconde campagne de la ligue” (The League’s Second Campaign) [*Libre-Échange*, 7 novembre 1847] [OC3.33, p.449]
Le Parlement anglais est convoqué pour le 18 de ce mois.
C’est la situation critique des affaires qui a déterminé le cabinet à hâter cette année la réunion des Communes.
Tout en déplorant la crise qui pèse sur le commerce et l’industrie britanniques, nous ne pouvons nous empêcher d’espérer qu’il en sortira de grandes réformes pour l’Angleterre et pour le monde. Ce ne sera pas la première fois, ni la dernière sans doute, que le progrès aura été enfanté dans la douleur. Le libre arbitre, noble apanage de l’homme, ou la liberté de choisir, implique la possibilité de faire un mauvais choix. L’erreur entraîne des conséquences funestes, et celles-ci sont le plus dur mais le plus efficace des enseignements. Ainsi nous arrivons toujours, à la longue, dans la bonne voie. Si la Prévoyance ne nous y a mis, l’Expérience est là pour nous y ramener.
Nous ne doutons pas que des voix se feront entendre dans le Parlement pour signaler à l’Angleterre la fausse direction de sa politique trop vantée.
« Rendre à toutes les colonies, l’Inde comprise, la liberté d’échanger avec le monde entier, sans privilége pour la métropole.
« Proclamer le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres nations ; mettre fin à toutes les intrigues diplomatiques ; renoncer aux vaines illusions de ce qu’on nomme influence, prépondérance, prépotence, suprématie.
« Abolir les lois de navigation.
« Réduire les forces de terre et de mer à ce qui est indispensable pour la sécurité du pays. »
Tel devra être certainement le programme recommandé et énergiquement soutenu par le parti libéral, par tous les membres de la Ligue, parce qu’il se déduit rigoureusement du libre-échange, parce qu’il est le libre-échange même.
En effet, quand on pénètre les causes qui soumettent à tant de fluctuations et de crises le commerce de la Grande-Bretagne, à tant de souffrances sa laborieuse population, on reste convaincu qu’elles se rattachent à une Erreur d’économie sociale, laquelle, par un enchaînement fatal, entraîne à une fausse politique, à une fausse diplomatie ; en sorte que cette imposante mais vaine apparence qu’on nomme la puissance anglaise repose sur une base fragile comme tout ce qui est artificiel et contre nature.
L’Angleterre a partagé cette erreur commune, que l’habileté commerciale consiste à peu acheter et beaucoup vendre, afin de recevoir la différence en or.
Cette idée implique nécessairement celle de suprématie, et par suite celle de violence.
Pour acheter peu, la violence est nécessaire à l’égard des citoyens. Il faut les soumettre à des restrictions législatives.
Pour vendre beaucoup (alors surtout que les autres nations, sous l’influence de la même idée, voulant acheter peu, se ferment chez elles et défendent leur or), la violence est nécessaire à l’égard des étrangers. Il faut étendre ses conquêtes, assujettir des consommateurs, accaparer des colonies, en chasser les marchands du dehors, et accroître sans cesse le cercle des envahissements.
Dès lors on est entraîné à s’environner de forces considérables, c’est-à-dire à détourner une portion notable du travail national de sa destination naturelle, qui est de satisfaire les besoins des travailleurs.
Ce n’est pas seulement pour étendre indéfiniment ses conquêtes qu’une telle nation a besoin de grandes forces militaires et navales. Le but qu’elle poursuit lui crée partout des jalousies, des inimitiés, des haines contre lesquelles elle a à se prémunir ou à se défendre.
Et comme les inimitiés communes tendent toujours à se coaliser, il ne lui suffit pas d’avoir des forces supérieures à celles de chacun des autres peuples, pris isolément, mais de tous les peuples réunis. Quand un peuple entre dans cette voie, il est condamné à être, coûte que coûte, le plus fort partout et toujours.
La difficulté de soutenir le poids d’un tel établissement militaire le poussera à chercher un auxiliaire dans la ruse. Il entretiendra des agents auprès de toutes les cours ; il fomentera et réchauffera partout les germes de dissensions ; il affaiblira ses rivaux les uns par les autres ; il leur créera des embarras et des obstacles ; il suscitera les rois contre les peuples, et les peuples contre les rois ; il opposera le Nord au Midi ; il se servira des peuples au sein desquels l’esprit de liberté a réveillé quelque énergie pour tenir en échec la puissance des despotes, et en même temps il fera alliance avec les despotes pour comprimer la force que donne ailleurs l’esprit de liberté. Sa diplomatie sera toute ruse et duplicité ; elle invoquera selon les temps et les lieux les principes les plus opposés ; elle sera démocrate ici, aristocrate là ; autocrate plus loin, constitutionnelle, révolutionnaire, philanthrope, déloyale, loyale même au besoin ; elle aura tous les caractères, excepté celui de la sincérité. Enfin, on verra ce peuple, dans la terrible nécessité où il s’est placé, aller jusqu’à contracter des dettes accablantes pour soudoyer les rois, les peuples, les nations qu’il aura mis aux prises.
Mais l’intelligence humaine ne perd jamais ses droits. Bientôt les nations comprendront le but de ces menées. La défiance, l’irritation et la haine ne feront que s’amasser dans leur cœur ; et le peuple dont nous retraçons la triste histoire sera condamné à ne voir dans ses gigantesques efforts que les pierres d’attente, pour ainsi parler, d’efforts plus gigantesques encore.
Or, ces efforts coûtent du travail à ce peuple. — Cela peut paraître extraordinaire, mais il est cependant certain, quoique les hommes n’en soient pas encore bien convaincus, que ce qui est produit une fois ne peut pas être dépensé deux, et que cette portion de travail qui est destinée à atteindre un but ne peut être en même temps consacrée à en obtenir un autre. Si la moitié de l’activité nationale est détournée vers des conquêtes ou la défense d’une sécurité qu’on a systématiquement compromise, il ne peut rester que l’autre moitié de l’activité des travailleurs pour satisfaire les besoins réels (physiques, intellectuels ou moraux) des travailleurs eux-mêmes. On a beau subtiliser et théoriser, les arsenaux ne se font pas d’eux-mêmes, ni les vaisseaux de guerre non plus ; ils ne sont pas pourvus d’armes, de munitions, de canons et de vivres par une opération cabalistique. Les soldats mangent et se vêtissent comme les autres hommes, et les diplomates plus encore. Il faut pourtant bien que quelqu’un produise ce que ces classes consomment ; et si ce dernier genre de consommation va sans cesse croissant comme le système l’exige, un moment arrive de toute nécessité où les vrais travailleurs n’y peuvent suffire.
Remarquez que toutes ces conséquences sont contenues très-logiquement dans cette idée : Pour progresser, un peuple doit vendre plus qu’il n’achète. — Et si cette idée est fausse, même au point de vue économique, à quelle immense déception ne conduit-elle pas un peuple, puisqu’elle exige de lui tant d’efforts, tant de sacrifices et tant d’iniquités pour ne lui offrir en toute compensation qu’une chimère, une ombre ?
Admettons la vérité de cette autre doctrine : les exportations d’un peuple ne sont que le paiement de ses importations.
Puisque le principe est diamétralement opposé, toutes les conséquences économiques, politiques, diplomatiques, doivent être aussi diamétralement opposées.
Si, dans ses relations commerciales, un peuple n’a à se préoccuper que d’acheter au meilleur marché, laissant, comme disent les free-traders, les exportations prendre soin d’elles-mêmes, — comme acheter à bon marché est la tendance universelle des hommes, ils n’ont besoin à cet égard que de liberté. Il n’y a donc pas ici de violence à exercer au dedans. — Il n’y a pas non plus de violences à exercer au dehors ; car il n’est pas besoin de contrainte pour déterminer les autres peuples à vendre.
Dès lors, les colonies, les possessions lointaines sont considérées non-seulement comme des inutilités, mais comme des fardeaux ; dès lors leur acquisition et leur conservation ne peuvent plus servir de prétexte à un grand développement de forces navales ; dès lors on n’excite plus la jalousie et la haine des autres peuples; dès lors la sécurité ne s’achète pas au prix d’immenses sacrifices ; dès lors enfin, le travail national n’est pas détourné de sa vraie destination, qui est de satisfaire les besoins des travailleurs. — Et quant aux étrangers, le seul vœu qu’on forme à leur égard, c’est de les voir prospérer, progresser par une production de plus en plus abondante, de moins en moins dispendieuse, partant toujours de ce point, que tout progrès qui se traduit en abondance et en bon marché profite à tous et surtout au peuple acheteur.
L’importance des effets opposés, qui découlent des deux axiomes économiques que nous avons mis en regard l’un de l’autre, serait notre justification si nous recherchions ici théoriquement de quel côté est la vérité. Nous nous en abstiendrons, puisque cette recherche est après tout l’objet de notre publication tout entière.
Mais on nous accordera bien que les free-traders d’Angleterre professent à cet égard les mêmes opinions que nous-mêmes.
Donc, leur rôle, au prochain Parlement, sera de demander l’entière réalisation du programme que nous avons placé au commencement de cet article.
Les événements de 1846 et de 1847 leur faciliteront cette noble tâche.
En 1846, ils ont détrôné cette vieille maxime, que l’avantage d’un peuple était d’acheter peu et de vendre beaucoup pour recevoir la différence en or. Ils ont fait reconnaître officiellement cette autre doctrine, que les exportations d’un peuple ne sont que le paiement de ses importations. Ayant fait triompher le principe, ils seront bien plus forts pour en réclamer les conséquences. Il serait par trop absurde que l’Angleterre, renonçant à un faux système commercial, retînt le dispendieux et dangereux appareil militaire et diplomatique que ce système seul avait exigé.
Les événements de cette année donneront de la puissance et de l’autorité aux réclamations des free-traders. On aura beau vouloir attribuer la crise actuelle à des causes mystérieuses, il n’y a pas de mystère là-dessous. Le travail énergique, persévérant, intelligent d’un peuple actif et laborieux ne suffit pas à son bien-être ; pourquoi ? parce qu’une portion immense de ce travail est consacrée à autre chose qu’à son bien-être, à payer des marins, des soldats, des diplomates, des gouverneurs de colonies, des vaisseaux de guerre, des subsides, — le désordre, le trouble et l’oppression.
Certainement, la lutte sera ardente au Parlement, et nous n’avons pas l’espoir que les free-traders emportent la place au premier assaut. Les abus, les préjugés, les droits acquis sont les maîtres dans cette citadelle. C’est même là que leurs forces sont concentrées. L’aristocratie anglaise y défendra énergiquement ses positions. Les gouvernements à l’extérieur, les hauts emplois, les grades dans l’armée et la marine, la diplomatie et l’Église, sont à ses yeux son légitime patrimoine ; elle ne le cédera pas sans combat ; et nous qui savons quelle est, dans son aveuglement, la puissance de l’orgueil national, nous ne pouvons nous empêcher de craindre que l’oligarchie britannique ne trouve de trop puissants auxiliaires dans les préjugés populaires, qu’une politique dominatrice a su faire pénétrer au cœur des travailleurs anglais eux-mêmes. Là, comme ailleurs, on leur dira que la destinée des peuples n’est pas le bien-être, qu’ils ont une mission plus noble, et qu’ils doivent repousser toute politique égoïste et matérialiste. — Et tout cela, pour les faire persévérer dans le matérialisme le plus brutal, dans l’égoïsme sous sa forme la plus abjecte : l’appel à la violence pour nuire à autrui en se nuisant à soi-même.
Mais rien ne résiste à la vérité, quand son temps est venu et que les faits, dans leur impérieux langage, la font éclater de toutes parts.
Si le peuple anglais, dans son intérêt, abolit les lois de navigation, s’il rend à ses colonies la liberté commerciale, si tout homme, à quelque nation qu’il appartienne, peut aller échanger dans l’Inde, à la Jamaïque, au Canada, au même titre qu’un Anglais, quel prétexte restera-t-il à l’aristocratie britannique pour retenir les forces qui en ce moment écrasent l’Angleterre ?
Dira-t-elle qu’elle veut conserver les possessions acquises ?
On lui répondra que nul désormais n’est intéressé à les enlever à l’Angleterre, puisque chacun peut en user comme elle, et de plus que l’Angleterre, par le même motif, n’est plus intéressée à les conserver.
Dira-t-elle qu’elle aspire à de nouvelles conquêtes ?
On lui objectera que le moment est singulièrement choisi de courir à de nouvelles conquêtes quand, sous l’inspiration de l’intérêt, d’accord cette fois avec la justice, on renonce à des conquêtes déjà réalisées.
Dira-t-elle qu’il faut s’emparer au moins de positions militaires telles que Gibraltar, Malte, Héligoland ?
On lui répondra que c’est un cercle vicieux ; que ces positions étaient sans doute une partie obligée du système de domination universelle ; mais qu’on ne détruit pas l’ensemble pour en conserver précisément la partie onéreuse.
Fera-telle valoir la nécessité de protéger le commerce, dans les régions lointaines, par la présence de forces imposantes ?
On lui dira que le commerce avec des barbares est une déception, s’il coûte plus indirectement qu’il ne vaut directement.
Exposera-t-elle qu’il faut au moins que l’Angleterre se prémunisse contre tout danger d’invasion ?
On lui accordera que cela est juste et utile. Mais on lui fera observer qu’il est de la nature d’un tel danger de s’affaiblir, à mesure que les étrangers auront moins sujet de haïr la politique britannique et que les Anglais auront plus raison de l’aimer.
On dira sans doute que nous nous faisons une trop haute idée de la philanthropie anglaise.
Nous ne croyons pas que la philanthropie détermine aucun peuple, pas plus le peuple anglais que les autres, à agir sciemment contre ses intérêts permanents.
Mais nous croyons que les intérêts permanents d’un peuple sont d’accord avec la justice, et nous ne voyons pas pourquoi il n’arriverait pas, par la diffusion des lumières, et au besoin par l’expérience, à la connaissance de cette vérité.
En un mot, nous avons foi, une foi entière, dans le principe du libre-échange.
Nous croyons que, selon qu’un peuple prend ou ne prend pas pour règle de son économie industrielle la théorie de la balance du commerce, il doit adopter une politique toute différente.
Dans le premier cas, il veut vendre à toute force ; et ce besoin le conduit à aspirer à la domination universelle.
Dans le second, il ne demande qu’à acheter, sachant que le vendeur prendra soin du paiement ; et, pour acheter, il ne faut faire violence à personne.
Or, si la violence est inutile, ce n’est pas se faire une trop haute idée d’un peuple que de supposer qu’il repoussera les charges et les risques de la violence.
Et si nous sommes pleins de confiance, c’est parce que, sur ce point, le vrai intérêt de l’Angleterre et de ses classes laborieuses nous paraît d’accord avec la cause de la justice et de l’humanité.
Car si nous avions le malheur de croire à l’efficacité du régime restrictif, sachant quelles idées et quels sentiments il développe, nous désespérerions de tout ordre, de toute paix, de toute harmonie. Toutes les déclamations à la mode contre le vil intérêt ne nous feraient pas admettre que l’Angleterre renoncera à sa politique envahissante et turbulente, laquelle, dans cette hypothèse, serait conforme à ses intérêts. Tout au plus, nous pourrions penser qu’arrivée à l’apogée de la grandeur, elle succomberait sous la réaction universelle ; mais seulement pour céder son rôle à un autre peuple, qui, après avoir parcouru le même cercle, le céderait à un troisième, et cela sans fin et sans cesse jusqu’à ce que la dernière des hordes régnât enfin sur des débris. Telle est la triste destinée que la Presse annonçait ces jours derniers aux nations ; et comme elle croit au régime prohibitif, sa prédiction était logique.
Au moment où le Parlement va s’ouvrir, nous avons cru devoir signaler la ligne que suivra, selon nous, le parti libéral. Si le monde est sur le point d’assister à une grande révolution pacifique, à la solution d’un problème terrible : — l’écroulement de la puissance anglaise en ce qu’elle a de pernicieux, et cela non par la force des armes, mais par l’influence d’un principe, — c’est un spectacle assurément bien digne d’attirer les regards impartiaux de la presse française. Est-ce trop exiger d’elle que de l’inviter à ne pas envelopper de silence cette dernière évolution de la Ligue comme elle a fait de la première ? Le drame n’intéresse-t-il pas assez le monde et la France ? Sans doute nous avons été profondément étonnés et affligés de voir la presse française, et principalement la presse démocratique, tout en fulminant tous les jours contre le machiavélisme britannique, faire une monstrueuse alliance avec les hommes et les idées qui sont en Angleterre la vie de ce machiavélisme. C’est le résultat de quelque étrange combinaison d’idées qu’il ne nous est pas donné de pénétrer. Mais, à moins qu’il n’y ait parti pris, ce que nous ne pouvons croire, de tromper le pays jusqu’au bout, nous ne pensons pas que cette combinaison d’idées, quelle qu’elle soit, puisse tenir devant la lutte qui va s’engager dans quelques jours au Parlement.
FN: Libre-Échange, n° du 7 novembre 1847.
Association espagnole pour la défense du travail national [The Spanish Association for the Defense of National Employment] [7 November 1847] [CW3 ES3.10]↩
BWV
1847.11.07 “Association espagnole pour la défense du travail national” (The Spanish Association for the Defense of National Employment) [*Libre-Échange*, 7 November 1847] [OC2.64, pp. 429-35] [CW3] [ES3.10]
L’Espagne a aussi son association pour la défense du travail national.
L’objet qu’elle a en vue est celui-ci :
« Étant donné un capital et le travail qu’il peut mettre en œuvre, les détourner des emplois où ils donneraient du profit, pour les lancer dans une direction où ils donneront de la perte, sauf, par une taxe déguisée, à reporter législativement cette perte sur le public. »
En conséquence, cette société demande, entre autres choses, l’exclusion des produits français, non de ceux qui nous reviennent cher (il n’est pas besoin de lois pour les exclure), mais de ceux que nous pouvons livrer à bon marché. Plus même nous les avons à prix réduit, plus l’Espagne, dit-on, a raison de s’en défendre.
Ceci m’inspire une réflexion que je soumets humblement au lecteur.
Un des caractères de la Vérité c’est l’Universalité.
Veut-on reconnaître si une association est fondée sur un bon principe ; il n’y a qu’à examiner si elle sympathise avec toutes celles, sous quelque degré de latitude que ce soit, qui ont adopté un principe identique.
Telles sont les associations pour le libre-échange. Un de nos collègues peut aller à Madrid, à Lisbonne, à Londres, à New-York, à Saint-Pétersbourg, à Berlin, à Florence et à Rome, même à Pékin ; s’il y a dans ces villes des associations pour le libre-échange, il en sera certainement bien accueilli. Ce qu’il dit ici, il le peut dire là, bien sûr de ne froisser ni les opinions, ni même les intérêts comme ces associations les comprennent. Entre les libre-échangistes de tous les pays, il y a, en cette matière, unité de foi.
En est-il de même parmi les protectionnistes ? Malgré la communauté des idées ou plutôt des arguments, lord Bentinck, venant de voter l’exclusion des bestiaux français, agissait-il conformément aux vues de nos éleveurs ? Celui qui repoussait au parlement notre rouennerie serait-il bienvenu au comité de Rouen ? Ceux qui soutiendront l’année prochaine l’acte de navigation et les droits différentiels dans l’Inde exciteront-ils l’enthousiasme de nos armateurs ? Supposez qu’un membre du comité Odier soit introduit au sein de l’association espagnole pour la défense du travail national ; que pourra-t-il dire ? quelle parole pourra-t-il prononcer sans trahir ou les intérêts de son pays ou ses propres convictions ? Conseillera-t-il aux Espagnols d’ouvrir leurs ports et leurs frontières aux produits de nos manufactures ? de ne pas s’en tenir à la fausse doctrine de la balance du commerce ? de ne point considérer comme avantageuses les industries qui ne se soutiennent que par des taxes sur la communauté ? Leur dira-t-il que les faveurs douanières ne créent pas des capitaux et du travail, mais les déplacent seulement et d’une manière fâcheuse ? Un tel abandon de principes et de dignité personnelle sera peut-être applaudi par ses coreligionnaires de France (car nous nous rappelons qu’il fut beaucoup question, au comité de Rouen, il y a dix-huit mois, de l’opportunité de prêcher le libre-échange… en Espagne), mais à coup sûr il excitera la risée des auditeurs castillans. Mettant donc ses principes au-dessus de ses intérêts, voudra-t-il se montrer héroïque ? Imaginez ce Brutus de la restriction haranguant les Espagnols en ces termes : « Vous faites bien d’exhausser les barrières qui nous séparent. Je vous approuve de repousser nos navires, nos offreurs de services, nos commis-voyageurs, nos tissus de coton, de laine, de fil et de chanvre, nos mules, nos papiers peints, nos machines, nos meubles, nos modes, notre mercerie, notre orfèvrerie, notre poterie, notre horlogerie, notre quincaillerie, notre parfumerie, notre tabletterie, notre ganterie, notre librairie. Ce sont toutes choses que vous devez faire vous-mêmes, quelque travail qu’elles exigent, et même d’autant plus qu’elles en exigent davantage. Je ne vous reproche qu’une chose, c’est de rester à moitié chemin dans cette voie. Vous êtes bien bons de nous payer un tribut de quatre-vingt-dix millions et de vous mettre dans notre dépendance. Méfiez-vous de vos libre-échangistes. Ce sont des idéologues, des niais, des traîtres, etc. » Ce beau discours serait sans doute applaudi en Catalogne. Serait-il approuvé à Lille et à Rouen ?
Il est donc certain que les associations protectionnistes des divers pays sont antagoniques entre elles, quoiqu’elles se donnent la même étiquette et professent en apparence les mêmes doctrines ; et, pour comble de singularité, si elles sympathisent avec quelque chose, d’un pays à l’autre, c’est avec les associations de libre-échange.
La raison en est simple. C’est qu’elles veulent à la fois deux choses contradictoires : des restrictions et des débouchés. Donner et ne pas recevoir, vendre et ne pas acheter, exporter et ne pas importer, voilà le fond de leur bizarre doctrine. Elle les conduit très-logiquement à avoir deux langages, non-seulement différents, mais opposés, l’un pour le pays, l’autre pour l’étranger, avec cette circonstance bien remarquable que, leurs conseils fussent-ils admis des deux côtés, elles n’en seraient pas plus près de leur but.
En effet, à ne considérer que les transactions de deux peuples, ce qui est exportation pour l’un est importation pour l’autre. Voyez ce beau navire qui sillonne la mer et porte dans ses flancs une riche cargaison. Dites-moi, s’il vous plaît, quel nom il faut donner à ces marchandises. Sont-elles importation ou exportation ? N’est-il pas clair qu’elles sont à la fois l’un et l’autre, selon qu’on a en vue le peuple expéditeur ou le peuple destinataire ? Si donc aucun ne veut être destinataire, aucun ne pourra être expéditeur ; et il est infaillible que, dans l’ensemble, les débouchés se restreignent juste autant que les restrictions se resserrent. C’est ainsi qu’on arrive à cette bizarre politique : ici, pour déterminer la cargaison à sortir, on lui confère une prime aux dépens du public ; là, pour l’empêcher d’entrer, on lui impose une taxe aux dépens du public. Se peut-il concevoir une lutte plus insensée ? Et qui restera vainqueur ? Le peuple le plus disposé à payer la plus grosse prime ou la plus grosse taxe.
Non, la vérité n’est pas dans cet amas de contradictions et d’antagonismes. Tout le système repose sur cette idée, que l’échange est une duperie pour la partie qui reçoit ; et, outre que le mot même échange contredit cette idée, puisqu’il implique qu’on reçoit des deux côtés, quel homme ne sent pas la position ridicule où il se place quand il ne peut tenir à l’étranger que ce langage : Je vous conseille d’être dupe, alors surtout qu’il est dupe lui-même de son propre conseil ?
Voici du reste un petit échantillon de la propagande protectionniste au dehors.
Le pont de la Bidassoa.
Un homme partit de Paris, rue Hauteville, avec la prétention d’enseigner aux nations l’économie politique. Il arriva devant la Bidassoa. Il y avait beaucoup de monde sur le pont, et un aussi nombreux auditoire ne pouvait manquer de tenter notre professeur. Il s’appuya donc contre le garde-fou, tournant le dos à l’Océan ; et, ayant eu soin, pour prouver son cosmopolitisme, de mettre sa colonne vertébrale en parfaite coïncidence avec la ligne idéale qui sépare la France de l’Espagne, il commença ainsi :
« Vous tous qui m’écoutez, vous désirez savoir quels sont les bons et les mauvais échanges. Il semble d’abord que je ne devrais avoir rien à vous apprendre à cet égard ; car enfin, chacun de vous connaît ses intérêts, au moins autant que je les connais moi-même ; mais l’intérêt est un signe trompeur, et je fais partie d’une association où l’on méprise ce mobile vulgaire. Je vous apporte une autre règle infaillible et de l’application la plus facile. Avant d’entrer en marché avec un homme, faites-le jaser. Si, lui ayant parlé français, il vous répond en espagnol, ou vice versâ, n’allez pas plus loin, l’épreuve est faite, l’échange est de maligne nature. »
Une voix. — Nous ne parlons ni espagnol ni français ; nous parlons tous la même langue, l’escualdun, que vous appelez basque.
— Malepeste ! Se dit intérieurement l’orateur, je ne m’attendais pas à l’objection. Il faut que je me retourne. — Eh bien ! Mes amis, voici une règle tout aussi aisée : Ceux d’entre vous qui sont nés de ce côté-ci de la ligne (montrant l’Espagne) peuvent échanger, sans inconvénient, avec tout le pays qui s’étend à ma droite jusqu’aux colonnes d’Hercule, et pas au delà ; et ceux qui sont nés de ce côté (montrant la France) peuvent échanger à leur aise dans toute la région qui se développe à ma gauche, jusqu’à cette autre ligne idéale qui passe entre Blanc-Misseron et Quiévrain… Mais pas plus loin. Les échanges ainsi faits vous enrichiront. Quant à ceux que vous feriez par-dessus la Bidassoa, ils vous ruineraient avant que vous puissiez vous en apercevoir.
Une autre voix. — Si les échanges qui se font par-dessus la Nivelle, qui est à deux lieues d’ici, sont bons, comment les échanges qui se font par-dessus la Bidassoa peuvent-ils être mauvais ? Les eaux de la Bidassoa dégagent-elles un gaz particulier qui empoisonne les échanges au passage ?
— Vous êtes bien curieux, répondit le professeur ; beau Basque, mon ami, vous devez me croire sur parole.
Cependant notre homme, ayant réfléchi sur la doctrine qu’il venait d’émettre, se dit en lui-même : « Je n’ai fait encore que la moitié des affaires de mon pays. » Ayant donc demandé du silence, il reprit son discours en ces termes :
« Ne croyez pas que je sois un homme à principes et que ce que je viens de vous dire soit un système. Le ciel m’en préserve ! Mon arrangement commercial est si peu théorique, si naturel, si conforme à votre inclination, quoique vous n’en ayez pas la conscience, que l’on vous y soumettra aisément à grands coups de baïonnette. Les utopistes sont ceux qui ont l’audace de dire que les échanges sont bons quand ceux qui les font les trouvent tels : effroyable doctrine, toute moderne, importée d’Angleterre, et à laquelle les hommes se laisseraient aller tout naturellement si la force armée n’y mettait bon ordre.
Mais, pour vous prouver que je ne suis ni exclusif ni absolu, je vous dirai que ma pensée n’est pas de condamner toutes les transactions que vous pourriez être tentés de faire d’une rive à l’autre de la Bidassoa. J’admets que vos charrettes traversent librement le pont, pourvu qu’elles y arrivent pleines de ce côté-ci (montrant la France), et vides de ce côté-là (montrant l’Espagne). Par cet ingénieux arrangement, vous gagnerez tous : vous, Espagnols, parce que vous recevrez sans donner, et vous, Français, parce que vous donnerez sans recevoir. Surtout ne prenez pas ceci pour un système. »
Les Basques ont la tête dure. On a beau leur répéter : Ceci n’est pas un système, une théorie, une utopie, un principe ; ces précautions oratoires n’ont pas le pouvoir de leur faire comprendre ce qui est inintelligible. Aussi, malgré les beaux conseils du professeur, quand on le leur permet (et même quelquefois quand on ne le leur permet pas), ils échangent selon l’ancienne méthode (qu’on dit nouvelle), c’est-à-dire comme échangeaient leurs pères, et quand ils ne le peuvent faire par-dessus la Bidassoa, ils le font par-dessous, tant ils sont aveugles !
Aux membres du Conseil général de la Seine [14 novembre 1847] ↩
BWV
1847.11.14 “Aux membres du Conseil général de la Seine” (To the Members of the General Council of La Seine) [*Libre-Échange*, 14 novembre 1847] [OC7.39, p. 193]
À MM. les membres du Conseil Général de la Seine [1]
Messieurs,
Pour vous décider à persister dans la réserve où vous avez cru devoir vous renfermer l’année dernière, l’Association qui ne veut pas que les échanges soient libres vous a présenté quelques considérations auxquelles nous espérons que vous nous permettrez de répondre.
Cette Association annonce avoir consulté un grand nombre d’assemblées, et elle a eu, dit-elle, la satisfaction de les voir presque toutes se prononcer en faveur du principe de la protection.
Est-ce une raison pour que vous vous prononciez dans le même sens ? Ce que vous êtes appelés à exprimer, ce n’est pas l’opinion d’autrui, mais la vôtre. Le résultat de semblables enquêtes serait bien illusoire, si chaque conseil général, renonçant à penser pour lui-même, se bornait à rechercher quel a été l’avis des autres conseils, afin d’y conformer le sien.
Or, Messieurs, quand nous voyons les énormes dépenses auxquelles notre pays se soumet pour faciliter ses échanges par les chemins de fer, nous ne pouvons pas croire que l’assemblée qui représente la capitale du monde civilisé consente à émettre un vote favorable au principe de la restriction des échanges.
Un vote contre les chemins de fer serait certainement plus conséquent à ce principe. Car si l’introduction de produits étrangers doit nuire à la richesse du pays, mieux vaut ne pas favoriser cette introduction que de lui créer d’abord de dispendieuses facilités pour lui opposer ensuite de dispendieux obstacles.
Messieurs, nous vous prions d’examiner surtout la question au point de vue de la justice. Est-il juste, par exemple, que les propriétaires français jouissent d’un privilége, dans quelque mesure que ce soit, pour la vente de leur blé ? Posséder le sol, c’est déjà pour eux un grand avantage, et ne devraient-ils pas s’en contenter ? Quand une rare population s’établit dans un pays où, comme aux États-Unis, la terre surabonde et n’a pas de valeur, chacun en prend autant qu’il en peut cultiver. Si quelques hommes exercent d’autres industries, ils ne peuvent pas être opprimés ; car, s’ils l’étaient, ils prendraient aussi de la terre. Mais quand tout le territoire est possédé et que la population continue à s’accroître, les nouveaux venus ne seront-ils pas les esclaves des propriétaires, si ceux-ci s’arrogent le droit exclusif de vendre du blé ? Est-ce qu’une telle prétention n’est pas inique et de nature à ébranler dans les esprits le principe même de la propriété ? Représentants de Paris, déciderez-vous qu’un Français, né après que tout le territoire est possédé, n’a pas le droit de tirer au moins parti de ses facultés, en échangeant son travail contre des aliments étrangers ? N’est-il pas évident d’ailleurs que cette liberté a pour conséquence de retenir la valeur des terres et de leurs produits dans des limites justes et naturelles, et de ne pas leur laisser acquérir une valeur exagérée, factice, précaire, et par là dangereuse pour le propriétaire lui-même ?
On vous dit que chacun est à la fois producteur et consommateur. C’est possible. Nous ne voulons pas discuter ici cette assertion. Mais ce qui est certain, c’est que, sous le régime restrictif, chacun est consommateur payant tribut à ce régime ; tandis que si chacun est producteur, chacun n’est pas du moins producteur protégé. Veuillez, Messieurs, faire le classement des habitants de Paris par métiers et professions ; nous osons affirmer que vous n’en trouverez pas un vingtième, peut-être un centième, parmi les participants aux faveurs de la douane.
Nos adversaires mettent beaucoup d’application à insinuer qu’il s’agit ici d’une question anglaise. Ce qui précède suffit pour montrer qu’elle est française et très française. La question est de savoir si la liberté et l’industrie d’un Français seront sacrifiées aux convenances d’un autre Français.
Après cela, nous ne craignons pas de les suivre sur le terrain étranger.
Ils présentent la crise qui tourmente l’Angleterre comme un résultat de la liberté commerciale.
Quoi ! l’Angleterre souffre parce qu’elle paye moins de droits sur le café, le sucre, le blé et le coton ? C’est là un bien étrange paradoxe.
Mais l’Angleterre est un pays de publicité ; rien n’est plus aisé que de savoir ce qu’elle pense, et nous n’y voyons personne, sauf quelques lords désappointés, donner à la crise une si étrange explication.
Certes, les ouvriers qui manquent de travail et de pain, seraient bien excusables, dans le paroxysme des souffrances, de les attribuer à la réforme récente des tarifs. Cependant, nulle part on ne les voit réclamer le rétablissement des droits élevés.
Pourquoi ? parce qu’ils savent bien qu’en Angleterre, comme en France, la libre introduction du blé a été votée sous l’empire de la nécessité la plus absolue, et que si elle a été un remède insuffisant au mal, elle n’en a pas au moins été la cause.
Ils savent bien qu’une nation ne peut être aussi florissante quand la récolte a été emportée par un fléau que lorsqu’elle a réussi ; quand une partie considérable de substances alimentaires se détériore que lorsqu’elle se conserve.
Ils savent bien qu’ils ne peuvent pas filer et tisser autant de coton quand le coton manque que lorsqu’il ne manque pas.
Ils savent bien que lorsqu’on engage imprudemment plusieurs milliards dans des entreprises qu’on ne peut pas achever, ces milliards font défaut au travail et à l’industrie.
Ils savent bien, ou du moins ils commencent à apprendre que lorsqu’un peuple veut faire des conquêtes et exercer partout une injuste suprématie, lorsqu’il s’accable lui-même d’impôts et de dettes pour payer ses marins, ses soldats, ses diplomates, toute l’activité déployée pour satisfaire sa gloriole est perdue pour la satisfaction de ses justes et légitimes besoins.
Les ouvriers savent cela, et l’on demande au conseil général de Paris de proclamer qu’il l’ignore !
On vous dit encore que si l’année dernière nous avions modifié notre tarif, cette année l’Angleterre nous eût inondés.
Quoi ! c’est au moment où le coton lui manque qu’elle nous eût inondés de coton ? C’est au moment où les Anglais empruntent à 8 pour 100 pour payer leurs dettes les plus pressantes qu’ils auraient agrandi toutes leurs industries à la fois pour nous inonder ? — Mais il y a dans le monde des pays qui jouissent de quelque liberté. Ont-ils été inondés ? L’Union américaine, la Suisse, la Hollande et la Toscane ont-elles été inondées ?
On vous parle ensuite de l’industrie de Paris comme si elle ne s’occupait que de modes et de luxe. Vous savez mieux que personne que la ville que vous représentez a une bien autre importance industrielle. Vous savez aussi qu’elle est en possession d’un noble et légitime monopole, celui du goût ; et lorsqu’on voit quelle immense supériorité, sous le régime de la liberté, le goût, l’art et le génie donnent à Paris sur les provinces, il est permis de croire qu’ils donneraient cette même supériorité à la France sur l’étranger, surtout si, pour satisfaire d’injustes prétentions, l’on ne mettait pas hors de sa portée les matériaux, les instruments et les débouchés de son industrie.
Enfin, Messieurs, on vous fait observer que le Siècle, le National, la Revue nationale, l’Atelier, la presse démocratique, en un mot, repousse ce qu’on nomme notre théorie, c’est-à-dire le droit de disposer du fruit de son travail. Nous ne le nions pas, et c’est pour nous un sujet d’étonnement et d’affliction. Nous sommes profondément surpris et affligés de voir, nous ne dirons pas la démocratie française, mais les meneurs du parti démocratique se ranger, après quelques moments d’hésitation, du côté des restrictions et des priviléges. Quel est leur but ? quel est leur plan ? Nous l’ignorons ; mais ils en ont un, peu susceptible d’être avoué sans doute, puisqu’avant de nous attaquer avec acharnement, ils ont proclamé que nous avions raison en principe, c’est-à-dire que nous avons pour nous la justice et la vérité. Nous ne savons ce qui les a décidés à se tourner contre la justice et la vérité ; mais ce que nous savons, c’est que les démocrates de tous les pays et de tous les temps se lèvent pour les confondre. Aux États-Unis, le peuple vote, et il a repoussé le principe restrictif. En Suisse le peuple vote, et il a voulu la liberté absolue. La Hollande, aux traditions républicaines, a le tarif le plus modéré. L’Italie révolutionnaire aspire au régime commercial de la Toscane. En Angleterre, le combat contre la protection n’est qu’un effort de la démocratie contre l’aristocratie ; et ce qui parle plus haut encore au cœur des vrais démocrates, c’est l’exemple de nos pères. Aujourd’hui chacun fait à sa guise parler le peuple ; mais le peuple a parlé deux fois par lui-même, et deux fois il a fait de la douane un simple instrument de fiscalité, et non une machine à priviléges. La Chambre du double vote a rendu à nos tarifs le caractère aristocratique. 1791 et 1825, voilà deux dates plus significatives que tout ce que nous pourrions dire. Exhumez de vos archives, Messieurs, les deux tarifs qui s’y réfèrent et prononcez.
Et en prononçant, rappelez-vous que les délibérations du Conseil général de la Seine ne sont pas vouées à l’obscurité et à l’oubli. C’est une grave responsabilité que celle de parler au nom du foyer des lumières, des réformes et du progrès, et nous espérons bien qu’il ne sortira pas du sein de votre assemblée un vœu rétrograde qu’avant longtemps Paris aurait à désavouer.
Agréez, Messieurs, etc.
FN: Libre-Échange du 14 novembre 1847.(Note de l’éd.)
D'un plan de campagne proposé à l’Association du libre-échange [14 Novembre 1847] ↩
BWV
1847.11.14 “D’un plan de campagne proposé à l'Association du libre-échange” (A Campaign Strategy proposed to the Free Trade Assocaition) [*Libre-Échange*, 14 Novembre 1847] [OC2.5, p. 15]
D’un plan de campagne proposé à l’Association du libre-échange
14 Novembre 1847
Quelques-uns de nos amis, dans un but louable, nous avertissent que, selon eux, nous manquons de tactique et de savoir-faire.
« Nous pensons comme vous, disent-ils, que les produits s’échangent contre des produits ; qu’on ne doit d’impôt qu’à l’État, etc., etc. » Mais, en poursuivant ces idées générales, pourquoi provoquer à la fois toutes les résistances et la coalition de tous les abus ? Que ne profitez-vous du grand exemple de la Ligue anglaise ? Elle s’est bien gardée de sonner l’alarme et d’ameuter contre elle tous les intérêts, en menaçant le principe même de la protection ; elle a sagement fait un choix et appelé au combat un seul champion, clef de voûte du système, et, cette pièce une fois tombée, l’édifice a été ébranlé.
Voilà bien, ce nous semble, ce que répétait dernièrement encore, dans une occasion solennelle, l’honorable président de la chambre de commerce du Havre. Peut-être aussi est-ce la pensée de quelques hommes d’État, gémissant en secret dans leur servitude, dont ils ne seraient pas fâchés d’être affranchis par une concentration des forces de notre association contre un des monopoles les plus décriés.
Il vaut donc la peine de répondre.
Que nous conseille-t-on?
Selon la chambre de commerce du Havre, nous eussions dû attaquer corps à corps la seule industrie des producteurs de fer.
Eh bien, plaçons-nous dans cette hypothèse. Nous voilà associés dans un but spécial ; nous voilà essayant de démontrer aux consommateurs de fer qu’il serait de leur avantage d’avoir du fer à bon marché.
Nul ne contesterait cela, et les consommateurs de fer moins que personne. Ils font souvent des pétitions dans ce but ; mais les chambres, dominées par les intérêts coalisés, passent à l’ordre du jour motivé sur la nécessité de protéger le travail national ; à quoi le gouvernement ne manque jamais d’ajouter que le travail national doit être protégé.
Nous voilà, dés le début, amenés à discuter cette théorie du travail national ; à prouver qu’il ne peut jamais être compromis par l’échange, parce que celui-ci implique autant d’exportations que d’importations. Nous voilà alarmant, par notre argumentation contre le monopole des fers, tous les monopoles qui vivent du même sophisme. Nos honorables conseillers voudraient-ils bien nous enseigner les moyens d’éviter cet écueil ?
Est-ce qu’on peut tromper ainsi la sagacité de l’égoïsme ? Est-ce que les privilégiés n’étaient pas coalisés longtemps avant notre association ? Est-ce qu’ils n’étaient pas bien convenus entre eux de se soutenir mutuellement, de ne pas permettre qu’on touchât une pierre de l’édifice, de ne se laisser entamer par aucun côté ? Est-ce que d’ailleurs le système tout entier, aussi bien que chacune de ses parties, n’a pas sa base dans une opinion publique égarée ? N’est-ce pas là qu’il faut l’attaquer, et peut-on l’attaquer là autrement que par des raisonnements qui s’appliquent à chaque partie comme à l’ensemble ?
Mais, dit-on, la Ligue anglaise a bien fait ce que nous conseillons.
La réponse est simple : c’est qu’il n’en est rien.
Il est bien vrai que l’anti-corn-law-league, comme son titre l’indique, a d’abord concentré ses efforts contre la loi céréale. Mais pourquoi ?
Parce que le monopole des blés était, dans le régime restrictif de la Grande-Bretagne, la part des mille législateurs anglais.
Dès lors, les Ligueurs disaient avec raison : Si nous parvenons à soustraire à nos mille législateurs leur part de monopole, ils feront bon marché du monopole d’autrui. Voilà pourquoi, quand la loi-céréale a été vaincue, M. Cobden a quitté le champ de bataille ; et quand on lui disait : Il reste encore bien des monopoles à abattre, il répondait : The landlords will do that, les landlords feront cela.
Y a-t-il rien de semblable en France ? Les maîtres de forges sont-ils seuls législateurs et le sont-ils par droit de naissance ? Ont-ils, en cette qualité, accordé quelques bribes de priviléges aux autres industries pour justifier les priviléges énormes qu’ils se seraient votés eux-mêmes ?
Si cela est, la tactique est tout indiquée. Forçons ceux qui font la loi de ne pas la faire à leur profit, et rapportons-nous-en à eux pour ne pas la faire à leur préjudice.
Mais puisque notre position n’est pas celle de la Ligue, qu’on nous permette, tout en admirant ses procédés, de ne pas les prendre pour modèle.
Qu’on ne perde pas de vue d’ailleurs qu’il est arrivé aux manufacturiers anglais précisément ce qui nous arriverait, disons-nous, à nous-mêmes, si nous appelions à notre aide toutes les classes de monopoleurs, hors une, pour attaquer celle-là.
L’aristocratie anglaise n’a pas manqué de dire aux manufacturiers : Vous attaquez nos monopoles, mais vous avez aussi des monopoles ; et les arguments que vous dirigez contre nos priviléges se tournent contre les vôtres.
Qu’ont fait alors les manufacturiers ? Sur la motion de M. Cobden, la chambre de commerce de Manchester a déclaré qu’avant d’attaquer la protection à l’agriculture, elle renonçait solennellement à toute protection en faveur des manufactures.
En mai 1843, le grand conseil de la Ligue formula ainsi son programme : « Abolition totale, immédiate et sans attendre de réciprocité, de tous droits protecteurs quelconques en faveur de l’agriculture, des manufactures, du commerce et de la navigation [1]. »
Maintenant, nous le demandons, pour suivre la même stratégie, sommes-nous dans la même situation ? Les industriels privilégiés, qu’on nous conseille d’enrôler dans une campagne contre les maîtres de forges, sont-ils préparés, dès la première objection, à faire le sacrifice de leurs propres priviléges ? Les fabricants de drap, les éleveurs de bestiaux, les armateurs eux-mêmes sont-ils prêts à dire : Nous voulons soumettre les maîtres de forges à la liberté ; mais il est bien entendu que nous nous y soumettons nous-mêmes. — Si ce langage leur convient, qu’ils viennent, nos rangs leur sont ouverts [2]. Hors de là comment pourraient-ils être nos auxiliaires ? — En ayant l’air de les ménager, vous les amènerez à se fourvoyer, dit-on. Mais, encore une fois, la ruse ne trompe pas des intérêts aussi bien éveillés sur la question, des intérêts qui étaient éveillés, associés et coalisés avant notre existence.
Nous ne pouvons donc accepter de tels conseils. Notre arme n’est pas l’habileté, mais la raison et la bonne foi. Nous attaquons le principe protecteur, parce que c’est lui qui soutient tout l’édifice ; et nous l’attaquons dans l’opinion publique, parce que c’est là qu’il a sa racine et sa force. — La lutte sera longue, dit-on ; cela ne prouve autre chose, sinon que ce principe est fortement enraciné. En ce cas, la lutte serait bien plus longue encore, et même interminable, si nous évitions de le toucher.
Hommes pratiques qui nous offrez ce beau plan de campagne, qui nous conseillez d’appeler à notre aide les monopoleurs eux-mêmes, dites-nous donc comment libre-échangistes et protectionnistes pourraient s’entendre et marcher ensemble seulement pendant vingt-quatre heures ? Ne voyez-vous pas qu’à la première parole, au premier argument, l’association serait rompue ? Ne voyez-vous pas que les concessions de principe, par lesquelles nous aurions dû nécessairement passer pour maintenir un moment cette monstrueuse alliance, nous feraient bientôt tomber, aux yeux de tous, au rang des hommes sans consistance et sans dignité ? Qui resterait alors pour défendre la liberté ? D’autres hommes, direz-vous. — Oui, d’autres hommes, qui auraient appris par notre exemple le danger des alliances impossibles, et qui feraient précisément ce que vous nous reprochez de faire.
On voudrait encore que nous indiquassions, dans les moindres détails, la manière dont il faut opérer la réforme, le temps qu’il y faut consacrer, les articles par lesquels il faut commencer.
Véritablement ce n’est pas notre mission.
Nous ne sommes pas législateurs.
Nous ne sommes pas le gouvernement.
Notre déclaration de principes n’est pas un projet de loi et notre programme se borne à montrer, en vue d’éclairer l’opinion publique, le but auquel nous aspirons, parce que sans le concours de l’opinion publique il n’y a pas de réforme possible, ni même désirable [3]. Or ce but est bien défini :
Ramener la douane au but légitime de son institution ; ne pas tolérer qu’elle soit, aux mains d’une classe de travailleurs, un instrument d’oppression et de spoliation à l’égard de toutes les autres classes.
Quant au choix et à la détermination des réformes, nous attendrons que le gouvernement, à qui appartient l’action, prenne l’initiative ; et alors nous discuterons ses projets, et, autant qu’il est en nous, nous nous efforcerons d’éclairer sa marche, toujours en vue du principe dont nous sommes les défenseurs.
Et quand nous disons à nos amis qu’il ne nous appartient pas d’isoler un monopole pour le combattre corps à corps, il est bon d’observer que la chambre du Havre, qui n’est pourtant pas une association enchaînée à un principe, mais qui, dans son caractère officiel, est un des rouages du gouvernement du pays, a été entraînée, à son insu peut-être, à agir comme nous ; car elle réclame à la fois, et tout d’abord, la réforme des tarifs sur les céréales, sur le fer, la fonte, la houille, le sucre, le café, le bois d’ébénisterie, et jusque sur les bois de construction équarris à la hache, etc., etc. — Sans doute, elle n’entend pas nous conseiller une autre conduite que la sienne ; et pourtant, loin de concentrer ses efforts sur un seul point, elle se montre disposée à n’en exclure guère qu’un seul, celui qui a été déjà réduit à si peu de chose par nos traités de réciprocité.
Nous avons appris sans étonnement l’accueil que la chambre de commerce du Havre a fait aux avances du comité Odier-Mimerel [4]. En fait de liberté commerciale, elle avait fait ses preuves longtemps avant la naissance de notre Association. Nous ne renions certes pas nos parrains ; si nous allons plus loin qu’eux, dans le sens des mêmes principes, sur la question des sucres ou sur celle des lois de navigation, nous n’en resterons pas moins unis de vues générales ainsi que de cœur avec nos honorables devanciers.
FN:V. tome III, pages 30 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:C’est l’exemple qu’ont donné M. Nicolas Kœchlin, M. Bosson de Boulogne, — M. Dufrayer, M. Duchevelard, agriculteurs, ainsi que les armateurs de Bordeaux et de Marseille.
FN:V. les chapitres Responsabilité, Solidarité, dans les Harmonies. (Note de l’éditeur.)
FN:Naturellement, la chambre de commerce avait repoussé de telles avances. (Note de l’éditeur.)
Bastiat's reply to a letter by Blanqui (14 Nov. 1847, LE)↩
BWV
T.157 (1847.11.14) "Bastiat's reply to a letter by Blanqui on purely political matters and free trade", Le Libre-Échange, 14 Nov. 1847, no. 51, p. 407. [OC2.1, footnote pp. 3-4.]
Text↩
Blanqui’s Letter in LE?? See PDF screenshots.
Quelques expressions de la lettre qui précède exigent de nous une explication.
Est-il possible de penser de même sur la liberté commerciale et de différer en politique ?
Il nous suffirait de citer des noms d’hommes et de peuples pour prouver que cela est très-possible et très-fréquent.
Le problème politique, ce nous semble, est celui-ci :
« Quelles sont les formes de gouvernement qui garantissent le mieux et au moindre sacrifice possible à chaque citoyen sa sûreté, sa liberté et sa propriété ? »
Certes, on peut ne pas être d’accord sur les formes gouvernementales qui constituent le mieux cette garantie, et être d’accord sur les choses mêmes qu’il s’agit de garantir.
Voilà pourquoi il y a des conservateurs et des hommes d’opposition parmi les libre-échangistes. Mais, par cela seul qu’ils sont libre-échangistes, ils s’accordent en ceci : que la liberté d’échanger est une des choses qu’il s’agit de garantir.
Ils ne pensent pas que les gouvernements, n’importe leurs formes, aient mission d’arracher ce droit aux uns pour satisfaire la cupidité des autres, mais de le maintenir à tous.
Ils sont encore d’accord sur cet autre point qu’en ce moment l’obstacle à la liberté commerciale n’est pas dans les formes du gouvernement, mais dans l’opinion.
Voilà pourquoi l’Association du libre-échange n’agite pas les questions purement politiques, quoique aucun de ses membres n’entende aliéner à cet égard l’indépendance de ses opinions, de ses votes et de ses actes.
Aux membres du Conseil général de la Nièvre [21 novembre 1847] ↩
BWV
1847.11.21 “Aux membres du Conseil général de la Nièvre” (To the Members of the General Council of La Niève) [*Libre-Échange*, 21 novembre 1847] [OC7.40, p. 199]
À MM. les membres du Conseil Général de la Nièvre [1]
Voici d’abord le vote du conseil général de la Nièvre :
Le Conseil renouvelle le vœu qu’il a émis à la session ordinaire de 1846, dans les termes suivants :
« Le département de la Nièvre a répondu, depuis un demi-siècle, à l’appel des gouvernements qui se sont succédé dans cette grande époque. Il a mis successivement à profit les exigences de la guerre et les ressources de la paix pour développer ses anciennes industries et pour en créer de nouvelles. Il a conquis un des premiers rangs dans l’exercice des arts dont l’importance a le plus grandi, des arts qui procurent aux autres les moyens d’action et de travail.
« Notre département fournit à l’État des armes , des projectiles, des ancres et des câbles de fer ; il fournit à la capitale du chauffage et du bétail ; à la Bourgogne, des blés ; à la France entière des aciers, des fers, des fontes, des tôles, des cuivres étirés ou laminés, des papiers, des verres, des émaux, des produits à tous les degrés de finesse pour les besoins des diverses classes, et surtout des classes inférieures.
« Voilà les industries dont il entend conserver la vie et poursuivre le progrès.
« Le département de la Nièvre rougirait d’appeler liberté, soit pour ses fabriques, soit pour son agriculture, l’exemption des charges publiques exigibles comme contributions indirectes ou directes. Il respecte trop le nom sacré de liberté pour le prostituer au désir de ne pas partager les charges que tous les citoyens doivent supporter.
« Si le commerce prétend qu’il doit introduire en France les produits de l’étranger, en repoussant, comme une atteinte à sa part des droits de l’homme, toute contribution levée sur des produits étrangers similaires aux produits français, qui supportent, eux, de si lourdes charges, l’agriculture et les manufactures protesteront contre cet étrange abus de l’égoïsme et du langage.
« Si l’on invoque ici ce qu’on ose appeler la liberté, nous invoquerons, nous, l’égalité ! L’égalité, moins mensongère et plus puissante auprès des Français, parce qu’elle est essentiellement l’équité, qui passe avant l’immunité.
« Nous demanderons tous à ne plus rien payer pour nos champs, nos charrues, nos outils et nos ateliers, ni pour nos échanges de terres, si le commerce prétend ne rien payer pour ses échanges avec l’étranger ; privilége qu’il appelle habilement son droit et sa liberté.
« Nous exprimons le vœu que le Ministère se préoccupe avant tout, comme font ailleurs les gouvernements avisés et sages, de faciliter aux produits français de nouveaux débouchés, en empêchant que des puissances moins bruyantes, mais plus positives, ne se procurent des avantages à notre détriment auprès des tiers. Voilà la sollicitude que nous préférons à celle qui se propose, avant tout, de remplacer sur notre sol des produits français par des produits étrangers.
« Sur le marché national, nous ne réclamons, pour les produits de la terre et des ateliers, que des protections éclairées et modérées. Mais nous les réclamons suffisantes et surtout persévérantes, afin que les opérations à longs termes, celles qui conduisent aux grandes prospérités, puissent compter sur l’avenir, se fonder avec confiance et se développer en pleine sécurité.
« Nous espérons que le Ministère et les Chambres s’uniront pour procurer plus que jamais à l’industrie française cette indispensable sécurité.
« Nous réclamons, des pouvoirs représentatifs, la déclaration publique et solennelle qu’ils ont la ferme intention de conserver ces bienfaits à notre patrie ; de les conserver aujourd’hui surtout, que la propagande étrangère s’efforce d’égarer l’opinion publique, en fermant les yeux des classes ouvrières sur leurs propres intérêts. Ces intérêts, en effet, se trouveraient sacrifiés par des concurrences qu’une administration patriotique et sage maintiendra toujours en de prudentes limites, qui préviennent aussi bien la ruine des nations que celle des individus. »
Et maintenant voyons.
La Nièvre fournit à l’État des armes et des projectiles. Rien de mieux, si l’État en a besoin, et si la Nièvre ne les lui fait pas surpayer. Ce que nous reprochons au régime protecteur, c’est d’augmenter le besoin de ces choses et d’en rendre l’acquisition plus onéreuse.
La Nièvre fournit à la capitale du chauffage et du bétail. Soit. Mais la Nièvre a-t-elle droit à des mesures législatives qui renchérissent pour le peuple de Paris le combustible et la viande ? Le peuple de Paris n’a-t-il pas le droit de pourvoir, par les moyens les plus économiques possibles, aux besoins de se chauffer et de manger ? Ces besoins ont-ils été créés et mis au monde pour être législativement exploités par les habitants de la Nièvre ? Est-ce l’objet de la loi d’irriter les besoins des uns pour favoriser l’industrie des autres ?
Faute de liberté, un grand nombre de personnes souffriront du froid et de la faim cet hiver à Paris. Ce sera le fait, non de la nature, mais de la loi. Avec la liberté, le besoin qu’ont les Parisiens de combustible et de viande provoquerait la production de ces choses partout où il y a convenance à les échanger contre des produits de l’industrie parisienne. Il s’établirait un prix pour le combustible et le bétail ; et si ce prix convient aux habitants de la Nièvre, rien de plus juste qu’ils en profitent. C’est au prix naturel qu’ont les choses sur le marché à signaler aux producteurs la convenance qu’il y a pour eux à y amener ces choses, et non à la convenance des producteurs de déterminer législativement le prix du marché. Éloigner le combustible et le bétail du marché de Paris, afin que la population y souffre du froid et de la faim, et soit disposée à faire de plus grands sacrifices pour se soustraire à cette souffrance ; en d’autres termes, élever artificiellement le prix du chauffage et de la viande, afin d’augmenter la convenance dans la Nièvre à exploiter les mines et les prairies, c’est une police à rebours dont l’absurdité égale l’injustice.
M. Dupin (non point le député de la Nièvre, mais son frère, qui depuis… mais alors…), M. Ch. Dupin, dans son ouvrage sur les forces commerciales de la France, constate qu’un tiers de nos concitoyens ne mangent jamais de viande ; et récemment tous les journaux ont fait savoir que les arrivages de bétail à Paris avaient subi, le mois dernier, une diminution énorme. C’est la meilleure réponse aux prétentions du conseil général de la Nièvre.
« Le département de la Nièvre rougirait d’appeler liberté l’exemption des charges publiques. Il respecte trop le nom sacré de liberté pour le prostituer au désir de ne pas partager les charges que tous les citoyens doivent supporter. »
Sophistes ! Vous respectez le nom, mais vous ne respectez guère la chose. Qui parle de s’exempter de taxes ? Voulez-vous le savoir ? C’est vous, et de la manière la plus formelle ; voici comment :
Vous arguez de vos taxes pour faire hausser législativement le prix des choses dont vous êtes marchands. Par conséquent, vous demandez à être remboursés de votre part de taxes par vos acheteurs, qui payent leurs taxes aussi. Or, demander d’être remboursé de ses taxes, c’est demander de n’en pas payer ; et demander à en être remboursé aux dépens d’un tiers qui paye déjà les siennes, c’est demander que ce tiers paye deux fois, une fois pour lui et une fois pour vous.
Vous accusez le commerce de repousser les taxes sur les produits étrangers comme une atteinte à sa part des droits de l’homme, mots que vous soulignez pour les livrer, sans doute, à la dérision publique.
Quelle étrange confusion !
D’abord, quand le drap est prohibé, ce n’est pas le commerce qui paye une taxe, c’est le misérable qui a besoin de se garantir du froid et qui est forcé par la loi à surpayer le drap. Cet excédant de prix est une taxe qu’il paye, non au Trésor, mais au fabricant de drap. Et, de plus, le drap étranger, n’étant pas entré, n’a rien payé au Trésor. Le Trésor est vide d’autant. Il faut donc que le malheureux acheteur de drap paye encore une taxe sur son sel et ses ports de lettres, pour remplacer celle que le Trésor a refusé de percevoir sur le drap étranger.
Quant au négociant, il n’est pour rien là dedans, si ce n’est qu’il voit restreindre législativement le nombre de ses affaires. Mais où a-t-on vu qu’il refuse de payer des taxes directes ou indirectes ? Est-ce que le négociant ne paye pas sa patente et sa cote mobilière ? Est-ce que le négociant ne paye pas ses impôts indirects quand il boit du vin, fume du tabac, reçoit ses lettres, joue aux cartes, sucre son café et sale son beurre ? Si vous trouvez que la patente ne soit pas assez forte, élevez-la. Mais quel rapport ont les taxes publiques avec les taxes que la loi nous force à nous payer les uns aux autres, au moyen des restrictions ?
Quand nous demandons la liberté du commerce, ce n’est pas en faveur du négociant, mais du consommateur ; c’est pour que le peuple se chauffe et mange de la viande à meilleur marché que ne le lui permet le conseil général de la Nièvre.
« Si l’on invoque ici ce que l’on ose appeler la liberté, nous invoquerons, nous, l’égalité. »
Soit, l’égalité devant la loi, nous ne demandons pas autre chose. Si vous vous appartenez à vous-même, je demande à m’appartenir à moi-même ; voilà l’égalité dans la liberté. Ou si la loi vous donne le moyen de me rançonner, je demande qu’elle me donne le moyen de vous rançonner à mon tour ; voilà encore l’égalité dans l’oppression. Je demande l’une ou l’autre égalité. Je suis ouvrier ; si la loi n’élève pas le prix de mon salaire, je demande qu’elle n’élève pas le prix de votre viande, et si elle élève le prix de votre viande, je demande qu’elle élève le prix de mon salaire. — Et quand vous, propriétaire de bœufs et de prairies, vous électeur et député, vous législateur, faites une loi qui affranchit vos bœufs de la concurrence et abandonne nos bras à la concurrence, vous commettez l’iniquité ; et si, de plus, vous la commettez au nom de l’égalité, vous joignez à l’injustice le plus détestable des sarcasmes.
L’égalité, dit le conseil général de la Nièvre, est plus puissante que la liberté, parce qu’elle est essentiellement l’équité, qui passe avant l’immunité.
Voilà certes une dissertation en règle, digne des bancs de l’école. Ces messieurs cherchent l’égalité en dehors de la liberté, attendu, sans doute, que l’une exclut l’autre, comme le disait l’an dernier M. Corne. L’égalité, pour eux, consiste dans les priviléges que la Chambre du double vote conféra aux grands propriétaires. C’est cette égalité-là, repoussée par le peuple de 1791, qui est essentiellement l’équité. C’est par pure équité que l’éleveur de bœufs rançonne législativement son maçon, sans que le maçon puisse rançonner législativement l’éleveur de bœufs ; car nous défions tout le conseil général de la Nièvre, son président en tête, de nous dire comment la douane a pourvu à protéger le maçon et tous les artisans et tous les ouvriers de France. — Voilà le genre d’équité qui passe avant l’immunité. et c’est par haine de l’immunité que l’éleveur de bœufs adresse à la loi cette requête ; « Je paye des taxes, et mon maçon en paye aussi ; mais si vous êtes assez bonne pour élever le prix de la viande de deux sous par livre, il se trouvera que ma part de taxes sera repassée sur le dos du maçon, qui payera ainsi sa part et la mienne, et n’y verra que du feu. »
Et voilà les hommes qui nous accusent de réclamer l’immunité, de prostituer le nom sacré de liberté. Nous demandons, nous, s’ils ne prostituent pas hypocritement les noms d’équité et d’égalité.
« Nous exprimons le vœu que le Ministère se préoccupe avant tout, comme font ailleurs les gouvernements avisés et sages, de faciliter aux produits français de nouveaux débouchés, en empêchant que les puissances moins bruyantes, mais plus positives, ne se procurent des avantages à notre détriment auprès des tiers. Voilà la sollicitude que nous préférons à celle qui se propose avant tout de remplacer sur notre sol des produits français par des produits étrangers. »
Des débouchés ! Ah ! voilà le grand mot ! Mais soyez donc justes et logiques une fois dans la vie. Si vous trouvez votre système bon, pourquoi voulez-vous que les autres nations ne le trouvent pas bon aussi ? Si vous ne voulez pas que les produits espagnols remplacent sur notre sol les produits français, pourquoi voulez-vous que les Espagnols consentent à ce que les produits français remplacent sur leur sol les produits espagnols ? L’échange a deux termes, donner et recevoir ; supprimer l’un, c’est les supprimer tous les deux ; absolument comme supprimer le premier terme d’une équation, c’est supprimer l’équation tout entière.
Vous êtes affamés de débouchés. Et que faites-vous ? Non seulement vous fermez les débouchés du dehors, mais vous restreignez les débouchés du dedans ; car à ce même peuple que vous forcez de surpayer votre bétail et votre combustible, il reste d’autant moins de ressources pour se procurer d’autres satisfactions, et par conséquent encourager d’autres industries. Vous voulez des débouchés ; la Presse nous avertit aujourd’hui même qu’un des effets des réformes commerciales de l’Angleterre est de chasser nos soieries des marchés étrangers. Cela est-il surprenant, quand les ouvriers de Lyon sont forcés de payer outre leurs propres impôts, les impôts des éleveurs de bétail?
Le conseil général de la Nièvre ne manque pas de donner à nos efforts le nom de propagande étrangère. Que, dans ce mouvement confus de la presse quotidienne, où chacun cache ses vues et ses passions sous le voile de l’anonyme, de pareilles imputations se fassent jour, cela n’a rien de bien surprenant ni de bien alarmant ; car, ainsi qu’on l’a dit, la presse, comme la lance d’Achille, guérit les blessures qu’elle fait. Mais nous ne pouvons nous empêcher d’éprouver un mouvement d’indignation quand nous voyons un corps officiel abaisser à ce degré de déloyauté la défense d’une mauvaise cause.
Enfin, le conseil général de la Nièvre, après s’être prononcé contre la concurrence étrangère qui ruine les nations, finit par s’élever contre la concurrence intérieure qui ruine les individus. C’est logique, mais ça mène loin. Le conseil aurait dû ajouter son plan communiste à tous ceux qui paraissent chaque jour. Nous disons communiste ; car sans concurrence, il n’y a pas libre disposition de sa propriété, il n’y a pas propriété. Nous recommandons au conseil général de la Nièvre de réparer cet oubli l’année prochaine.
FN: Libre-Échange du 21 novembre 1847. (Note de l’éd.)
Les hommes spéciaux [The Specialists] [28 November 1847] [CW3 ES3.11]↩
BWV
1847.11.28 “Les hommes spéciaux” (The Specialists) [*Libre-Échange*, 28 November 1847] [OC2.56, pp. 373-77] [CW3] [ES3.11]
Il y a des personnes qui s’imaginent que les hommes d’étude, ou ce qu’elles nomment avec trop de bienveillance les savants, sont incompétents pour parler du libre-échange. La liberté et la restriction, disent-elles, c’est une question qui doit être débattue par des hommes pratiques.
Ainsi le Moniteur industriel nous fait observer qu’en Angleterre la réforme commerciale a été due aux efforts des manufacturiers.
Ainsi le comité Odier se montre très-fier du procédé qu’il a adopté, et qui consiste en de prétendues enquêtes, où tout se résume à demander tour à tour à chaque industrie privilégiée si elle veut renoncer à son privilége.
Ainsi un membre du conseil général de la Seine, fabricant de drap, protégé par la prohibition absolue, disait à ses collègues, en parlant d’un de nos collaborateurs : « Je le connais ; c’était un juge de paix de village ; il n’entend rien à la fabrique. »
Nos amis mêmes se laissent quelquefois dominer par cette prévention. Et dernièrement la Chambre de commerce du Havre, faisant allusion à notre déclaration de principes (qui est d’une page), faisait remarquer que nous n’y parlons pas des intérêts maritimes. Puis elle ajoute : « La Chambre ne pouvait jusqu’à un certain point se plaindre de cet oubli, parce que les noms qui figurent au bas de cette déclaration lui inspirent peu de confiance pour l’étude de ces questions, »
Celui de nos collaborateurs qui est ainsi désigné deux fois commence par déclarer très-solennellement qu’il n’a nullement la prétention de connaître les procédés nautiques mieux que les armateurs, les procédés métallurgiques mieux que les maîtres de forges, les procédés agricoles mieux que les agriculteurs, les procédés de tissage mieux que les fabricants, et les procédés de nos dix mille industries mieux que ceux qui les exercent.
Mais, franchement, cela est-il nécessaire pour reconnaître qu’aucune de ces industries ne doit être mise législativement en mesure de rançonner les autres ? Faut-il avoir vieilli dans une fabrique de drap et obtenu de lucratives fournitures pour juger une question de bon sens et de justice, et pour décider que le débat doit être libre entre celui qui vend et celui qui achète ?
Assurément nous sommes loin de méconnaître l’importance du rôle qui est réservé aux hommes pratiques dans la lutte entre le droit commun et le privilége.
C’est par eux surtout que l’opinion publique sera délivrée de ses terreurs imaginaires. Quand un homme comme M. Bacot, de Sedan, vient dire : « Je suis fabricant de drap ; et qu’on me donne les avantages de la liberté, je n’en redoute pas les risques ; » quand M. Bosson, de Boulogne, dit : « Je suis filateur de lin ; et si le régime restrictif, en renchérissant mes produits, ne fermait pas mes débouchés au dehors et n’appauvrissait pas ma clientèle au dedans, ma filature prospérerait davantage ; » quand M. Dufrayer, agriculteur, dit : « Sous prétexte de me protéger, le système restrictif m’a placé au milieu d’une population qui ne consomme ni blé, ni laine, ni viande, en sorte que je ne puis faire que cette agriculture qui convient pays pas pauvres ; » — nous savons tout l’effet que ces paroles doivent exercer sur le public.
Lorsque ensuite la question viendra devant la législature, le rôle des hommes pratiques acquerra une importance à peu près exclusive. Il ne s’agira plus alors du principe, mais de l’exécution. On sera d’accord qu’il faut détruire un état de choses injuste et artificiel, pour rentrer dans une situation équitable et naturelle. Mais par où faut-il commencer ? Dans quelle mesure faut-il procéder? Pour résoudre ces questions d’exécution, il est évident que ce seront les hommes pratiques, du moins ceux qui se sont rangés au principe de la liberté, qui devront surtout être consultés.
Loin de nous donc la pensée de repousser le concours des hommes spéciaux. Il faudrait avoir perdu l’esprit pour méconnaître la valeur de ce concours.
Il n’en est pas moins vrai cependant, qu’il y a, au fond de cette lutte, des questions dominantes, primordiales, qui, pour être résolues, n’ont pas besoin de ces connaissances technologiques universelles qu’on semble exiger de nous.
« Le législateur a-t-il mission de pondérer les profits des diverses industries ?
Le peut-il sans compromettre le bien général ?
Peut-il, sans injustice, augmenter les profits des uns en diminuant les profits des autres ?
Dans cette tentative, arrivera-t-il à répartir d’une manière égale ses faveurs ?
En ce cas même, n’y aurait-il pas, pour résidu de l’opération, toute la déperdition de forces résultant d’une mauvaise direction du travail ?
Et le mal n’est-il pas plus grand encore, s’il est radicalement impossible de favoriser également tous les genres de travaux ?
En définitive, payons-nous un gouvernement pour qu’il nous aide à nous nuire les uns aux autres, ou, au contraire, pour qu’il nous en empêche ? »
Pour résoudre ces questions, il n’est nullement nécessaire d’être un habile armateur, un ingénieux mécanicien, un agriculteur consommé. Il est d’autant moins nécessaire de connaître à fond les procédés de tous les arts et de tous les métiers, que ces procédés n’y font absolument rien. Dira-t-on par exemple qu’il faut bien savoir le prix de revient du drap, pour juger s’il est possible de lutter avec l’étranger à armes égales ? — Oui certes, cela est nécessaire, dans l’esprit du régime protecteur, puisque ce régime a pour but de rechercher si une industrie est en perte afin de faire supporter cette perte par le public ; mais cela n’est pas nécessaire dans l’esprit du libre-échange, car le libre-échange repose sur ce dilemme : Ou votre industrie gagne, et alors la protection vous est inutile ; ou elle perd, et alors la protection est nuisible à la masse.
En quoi donc une enquête spéciale est-elle indispensable, puisque, quel qu’en soit le résultat, la conclusion est toujours la même ?
Supposons qu’il s’agisse de l’esclavage. On accordera sans doute que la question de droit passe avant la question d’exécution. — Que pour arriver à connaître le meilleur mode d’affranchissement, on fasse une enquête, nous le concevons ; mais cela suppose la question de droit résolue. Mais s’il s’agissait de débattre la question de droit devant le public, si la majorité était encore favorable au principe même de l’esclavage, serait-on bien venu de fermer la bouche à un abolitionniste en lui disant : « Vous n’êtes pas compétent ; vous n’êtes pas planteur, vous n’avez pas d’esclaves. » Pourquoi donc oppose-t-on, à ceux qui combattent les monopoles, cette fin de non-recevoir qu’ils n’ont pas de monopoles ?
Les armateurs du Havre ne s’aperçoivent-ils pas que cette même fin de non-recevoir, on la tournera contre eux ? S’ils ont, avec raison, la prétention de connaître à fond la question maritime, ils n’ont pas sans doute celle de posséder des connaissances universelles. Or, d’après leur système, quiconque ose réclamer contre un monopole doit préalablement fournir la preuve qu’il connaît à fond l’industrie à laquelle ce monopole a été conféré. Ils nous disent, à nous, que nous ne sommes pas aptes à juger si la loi doit se mêler de nous faire surpayer les transports, parce que nous n’avons jamais armé de navires. Mais alors on leur dira : Avez-vous jamais dirigé un haut fourneau, une filature, une fabrique de drap ou de porcelaine, une exploitation agricole ? Quel droit avez-vous de vous défendre contre les taxes que ces industries vous imposent ?
La tactique des prohibitionnistes est admirable. Par elle, si le public en est dupe, ils sont toujours sûrs au moins du statu quo. Si vous n’appartenez pas à une industrie protégée, ils déclinent votre compétence. « Tu n’es que rançonné, tu n’as pas la parole. » — Si vous appartenez à une industrie protégée, ils vous permettent de parler, mais seulement de votre intérêt spécial, le seul que vous êtes censé connaître. Ainsi, le monopole ne rencontrerait jamais d’adversaire. [121]
Projet de préface pour les Harmonies [c. late 1847] [CW1.1.4] ↩
BWV
1847.late “Projet de préface pour les Harmonies” (A Draft Preface to the Harmonies) [Late 1847] [OC7.73, p. 303] [CW1, pp. 316-20]
Projet de préface pour les Harmonies [122]
Mon cher Frédéric,
C’en est donc fait : tu as quitté notre village. Tu as abandonné les champs que tu aimais, ce toit paternel où tu jouissais d’une si complète indépendance, tes vieux livres tout étonnés de dormir négligemment sur leurs poudreux rayons, ce jardin où dans nos longues promenades nous causions à perte de vue de omni re scibili et quibusdam aliis, ce coin de terre dernier asile de tant d’êtres que nous chérissions, où nous allions chercher des larmes si douces et de si chères espérances. Te souvient-il comme la racine de la foi reverdissait dans nos âmes à l’aspect de ces tombes chéries ? Avec quelle abondances les idées affluaient dans notre esprit sous l’inspiration de ces cyprès ? À peine pouvions-nous leur donner passage tant elles se pressaient sur nos lèvres. Mais rien n’a pu te retenir. Ni ces bons justiciables de la campagne accoutumés à chercher des décisions dans tes honnêtes instincts plus que dans la loi ; ni notre cercle si fertile en bons mots que deux langues n’y suffisaient pas, et où la douce familiarité, la longue intimité remplaçaient bien les belles manières ; ni ta basse qui semblait renouveler sans cesse la source de tes idées ; ni mon amitié ; ni cet empire absolu sur tes actions, tes heures, tes études, le plus précieux des biens peut-être. Tu as quitté le village et te voilà à Paris, dans ce tourbillon où comme dit Hugo : 9144.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frédéric, nous sommes accoutumés à nous parler à cœur ouvert ; eh bien ! je dois te le dire, ta résolution m’étonne, je dis plus, je ne saurais l’approuver. Tu t’es laissé séduire par l’amour de la renommée, je ne veux pas dire de la gloire, et tu sais bien pourquoi. Combien de fois n’avons-nous pas dit que désormais la gloire ne serait plus le prix que d’intelligences d’une immense supériorité ! Il ne suffit plus d’écrire avec pureté, avec grâce, avec chaleur ; dix mille personnes en France écrivent ainsi. Il ne suffit pas d’avoir de l’esprit ; l’esprit court les rues. Ne te souvient-il pas qu’en lisant les moindres feuilletons, souvent si dépourvus de bon sens et de logique, mais presque toujours si étincelants de verve, si riches d’imagination, nous nous disions : bien écrire va devenir une faculté commune à l’espèce, comme bien marcher et bien s’asseoir. Comment songer à la gloire avec le spectacle que tu as sous les yeux ? Qui pense aujourd’hui à Benjamin Constant, à Manuel ? Que sont devenues ces renommées qui semblaient ne devoir jamais périr ?
À de si grands esprits te crois-tu comparable ?
As-tu fait leurs études ? Possèdes-tu leurs vastes facultés ? As-tu passé comme eux toute ta vie au milieu de la société la plus spirituelle ? As-tu les mêmes occasions de te faire connaître, la même tribune ; es-tu entouré au besoin de la même camaraderie ? Tu me diras peut-être que si tu ne parviens à briller par tes écrits tu te distingueras par tes actions. — Eh bien ! vois où en est la renommée de Lafayette. Feras-tu comme lui retentir ton nom dans les deux mondes et pendant trois quarts de siècle ? Traverseras-tu des temps aussi fertiles en événements ? Seras-tu la figure la plus saillante dans trois grandes révolutions ? Te sera-t-il donné de faire et défaire des rois ? Te verra-t-on martyr à Olmultz et demi-Dieu à l’Hôtel de ville ? Seras-tu commandant-général de toutes les Gardes nationales du royaume ? Et quand ces hautes destinées te seraient réservées, vois où elles aboutissent : à jeter au milieu des nations un nom sans tache, que dans leur indifférence elles ne daignent pas ramasser ; à les accabler de nobles exemples et de grands services qu’elles s’empressent d’oublier.
Mais non, je ne puis croire que l’orgueil t’ait monté à la tête à ce point de te faire sacrifier le bonheur réel à une renommée qui, tu le sais bien, n’est pas faite pour toi, et qui, en tout cas, ne serait que bien éphémère. Ce n’est pas toi qui aspireras jamais à devenir :
Dans les journaux du jour le grand homme du mois.
Tu démentirais tout ton passé. Si ce genre de vanité t’avait séduit, tu aurais commencé par rechercher la députation. Je t’ai vu plusieurs fois candidat, et toujours dédaignant ce qu’il faut faire pour réussir. Tu disais sans cesse : Voici le temps où l’on s’occupe un peu des affaires publiques, où on lit et parle de ce qu’on a lu. J’en profiterai pour distribuer sous le manteau de la candidature quelques vérités utiles, — et au delà tu ne faisais aucune démarche sérieuse.
Ce n’est donc pas l’éperon de l’amour-propre qui a dirigé ta course vers Paris. Mais alors à quelle inspiration as-tu cédé ? Est-ce au désir de contribuer en quelque chose au bien de l’humanité ? Sous ce rapport encore j’ai bien des observations à te faire.
Comme toi j’aime toutes les libertés et, parmi elles, la plus universellement utile à tous les hommes, celle dont on jouit à chaque instant du jour et dans toutes les circonstances de la vie, — la liberté du travail et de l’échange. Je sais que l’appropriation est le pivot de la société et même de la vie humaine. Je sais que l’échange est impliqué dans la propriété ; que restreindre l’un, c’est ébranler les fondements de l’autre. Je t’approuve de te dévouer à la défense de cette liberté, dont le triomphe doit amener le règne de la justice internationale et, par suite, l’extinction des haines, des préventions de peuple à peuple et des guerres qui en sont la suite.
Mais, en vérité, te présentes-tu dans la lice avec des armes qui conviennent et à la renommée, si tant est que tu y songes, et au succès même de ta cause ? De quoi es-tu occupé, exclusivement occupé ? D’une démonstration, d’un calcul, de la solution d’un problème unique, savoir : La restriction ajoute-t-elle à la colonne des profits ou à la colonne des pertes dans le livre de comptes d’une nation ? Voilà sur quel sujet tu épuises toute ton intelligence ! voilà les bornes où tu as circonscrit cette grande question ! Pamphlets, livres, brochures, articles de journaux, discours, tout est consacré à dégager cette inconnue : La nation, par le fait de la liberté, aura-t-elle cent mille francs de plus ou cent mille francs de moins ? Il semble que tu t’attaches à mettre sous le boisseau toute clarté qui ne jette sur ce théorème qu’un jour indirect. Il semble que tu t’appliques à refouler dans ton cœur toutes ces flammes sacrées que l’amour de l’humanité y avait allumées.
Ne crains-tu pas que ton esprit se sèche et se rétrécisse à cette œuvre analytique, à cette éternelle contention toujours concentrée sur un calcul algébrique ?
Rappelle-toi ce que nous avons dit bien souvent : à moins qu’on n’ait la prétention de faire faire un progrès à une branche isolée des connaissances humaines, ou plutôt, à moins qu’on n’ait reçu de la nature un crâne qui ne se distingue que par une protubérance dominatrice ; il vaut mieux, surtout quand on n’est comme nous qu’amateurs philosophes, laisser errer sa pensée dans tout le domaine de l’intelligence, que de l’asservir à la solution d’un problème. Il vaut mieux chercher le rapport des sciences entre elles et l’harmonie des lois sociales, que de s’épuiser à éclairer un point douteux, au risque de perdre jusqu’au sentiment de ce qu’il y a de grandeur et de majesté dans l’ensemble.
C’est pour cela que nos lectures étaient si capricieuses, et que nous mettions tant de soin à secouer le joug des jugements de convention. Tantôt nous lisions Platon, non pour admirer sur la foi des siècles, mais pour nous assurer de l’extrême infériorité de la société antique ; et nous disions : Puisque c’est là la hauteur où s’est élevé le plus beau génie de l’ancien monde, rassurons-nous, l’homme est perfectible et la foi dans ses destinées n’est pas trompeuse. Tantôt nous nous faisions suivre dans nos longues promenades de Bacon, de Lamartine, de Bossuet, de Fox, de Lamennais, et même de Fourrier. L’économie politique n’était qu’une pierre de l’édifice social que nous cherchions à construire dans notre esprit, et nous disions : « Il est utile, il est heureux que des génies patients et infatigables se soient attachés comme Say à observer, classer, et exposer dans un ordre méthodique tous les faits qui composent cette belle science. Désormais, l’intelligence peut poser le pied sur cette base inébranlable pour s’élever à de nouveaux horizons. » Aussi combien nous admirions les travaux de Dunoyer et de Comte qui, sans jamais dévier de la ligne rigoureusement scientifique tracée par M. Say, transportent avec tant de bonheur ces vérités acquises dans le domaine de la morale et de la législation. Je ne te le dissimulerai pas ; quelquefois, en t’écoutant, il me semblait que tu pouvais à ton tour prendre ce même flambeau, des mains de tes devanciers, et en projeter la lumière dans quelques recoins obscurs des sciences sociales, et dans ceux surtout que de folles doctrines ont récemment plongé dans l’obscurité.
Au lieu de cela, te voilà tout occupé d’éclaircir un seul des problèmes économiques que Smith et Say ont déjà démontré cent fois mieux que tu ne pourras le faire. Te voilà analysant, définissant, calculant, distinguant. Te voilà, le scalpel à la main, cherchant ce qu’il y a au juste au fond de ces mots prix, valeur, utilité, cherté, bon marché, importations, exportations.
Mais, enfin, si ce n’est pour toi, si tu ne crains pas de t’hébéter à l’œuvre, crois-tu avoir choisi, dans l’intérêt de la cause, le meilleur plan qu’il y ait à suivre ? Les peuples ne sont pas gouvernés par des X, mais par des instincts généreux, par des sentiments, par des sympathies. Il fallait leur présenter la chute successive de ces barrières qui parquent les hommes en communes ennemies, en provinces jalouses, en nations guerroyantes. Il fallait leur montrer la fusion des races, des intérêts, des langues, des idées, la vérité triomphant de l’erreur dans le choc des intelligences, les institutions progressives remplaçant le régime du despotisme absolu et des castes héréditaires, les guerres extirpées, les armées dissoutes, la puissance morale remplaçant la force physique, et le genre humain se préparant par l’unité aux destinées qui lui sont réservées. Voilà ce qui eût passionné les masses, et non point tes sèches démonstrations.
Et puis, pourquoi te limiter ? pourquoi emprisonner ta pensée ? Il me semble que tu l’as mise au régime cellulaire avec l’uniforme croûte de pain sec pour tout aliment, car te voilà rongeant soir et matin une question d’argent. J’aime autant que toi la liberté commerciale. Mais tous les progrès humains sont-ils renfermés dans cette liberté ? Autrefois, ton cœur battait pour l’affranchissement de la pensée et de la parole, encore enchaînées par les entraves universitaires et les lois contre l’association. Tu t’enflammais pour la réforme parlementaire et la séparation radicale de la souveraineté qui délègue et contrôle, de la puissance exécutive dans toutes ces branches. Toutes les libertés se tiennent. Toutes les idées forment un tout systématique et harmonieux ; il n’en est pas une dont la démonstration n’eût servi à démontrer les autres. Mais tu fais comme un mécanicien qui s’évertue à expliquer, sans en rien omettre, tout ce qu’il y a de minutieux détails dans une pièce isolée de la machine. On est tenté de lui crier : Montrez-moi les autres pièces ; faites-les mouvoir ensemble ; elles s’expliquent les unes par les autres…
Previously unpublished essays which were published in ES2↩
The above titles appeared in Economic Sophisms 2 which appeared in Jan. 1848. They were not published previously but written before Dec. 1847.
BWV
1847.12 “Physiologie de la Spoliation” (The Physiology of Plunder) [n.d.] [ES2.1] [OC4.2.1, pp. 127-48] [CW3]
1847.12 “Deux morales” (Two Moral Philosophies) [n.d.] [ES2.2] [OC4.2.2, pp. 148-56] [CW3]
1847.12 “Les deux haches” (The Two Axes) [n.d.] [ES2.3] [OC4.2.3, pp. 156-59] [CW3]
1847.12 “Conseil inférieur du travail” (The Lower Council of Labor)] [n.d.] [ES2.4] [OC4.2.4, pp. 160-63] [CW3]
1847.12 “Conte chinois” (A Chinese Tale) [n.d.] [ES2.7] [OC4.2.7, pp. 182-87] [CW3]
1847.12 “Le percepteur” (The Tax Collector) [n.d.] [ES2.10] [OC4.2.10, pp. 198-203] [CW3]
1847.12 “La protection ou les trois Échevins” (Protection, or the Three Municipal Magistrates) [n.d.] [ES2.13] [OC4.2.13, pp. 229-41] [CW3]
[See Economic Sophisms 2 for details]
Sur l'exportation du numéraire [11 Décembre 1847] ↩
BWV
1847.12.11 “Sur l'exportation du numéraire” (On the Export of Bullion) [*Libre-Échange*, 11 Décembre 1847] [OC2.21, p. 112]
Sur l'exportation du numéraire
11 Décembre 1847
À l’occasion de la situation financière et commerciale de la Grande-Bretagne, le National s’exprime ainsi :
« La crise a dû être d’autant plus violente, que les produits étrangers, les céréales, ne s’échangeaient pas contre des produits anglais, La balance entre les importations et les exportations était toute au désavantage de la Grande-Bretagne, et la différence se soldait en or. Il y aurait lieu, à cette occasion, d’examiner la part de responsabilité qui revient au libre-échange dans ce résultat; mais nous nous réservons de le faire plus tard. Contentons-nous de constater aujourd’hui que cette vieillerie qu’on appelle la balance du commerce, si dédaignée, si méprisée, du reste, par certaine école économiste, mérite cependant qu’on y prenne garde ; et la Grande-Bretagne, en comparant ce qu’elle a reçu à ce qu’elle a envoyé depuis un an, doit s’apercevoir que les plus belles théories ne peuvent rien contre ce fait très-simple : quand on achète du blé en Russie, et que la Russie ne prend pas en échange du calicot anglais, il faut payer bel et bien ce blé en argent. Or, le blé consommé, l’argent exporté, que reste-t-il à l’acheteur ? Son calicot, peut-être, c’est-à-dire une valeur dont il ne sait que faire et qui dépérit entre ses mains. »
Nous serions curieux de savoir si le National regarde en effet la balance du commerce comme une vieillerie, ou si cette expression, prise dans un sens ironique, a pour objet de railler une certaine école qui se permet de regarder, en effet, la balance du commerce comme une vieillerie. « La question vaut la peine qu’on y prenne garde, » dit le National. Oui, certes, elle en vaut la peine, et c’est pour cela que nous aurions voulu que cette feuille fût un peu plus explicite.
Il est défait que chaque négociant, pris isolément, fort attentif à sa propre balance, ne se préoccupe pas le moins du monde de la balance générale du commerce. Or, il est à remarquer que ces deux balances apprécient les choses d’une manière si opposée, que ce que l’une nomme perte, l’autre l’appelle profit, et vice versâ.
Ainsi, le négociant qui a acheté en France pour 10,000 fr, de vin, et l’a vendu pour le double de celte somme aux États-Unis, recevant en payement et faisant entrer en France 20,000 fr. de coton, croit avoir fait une bonne affaire. — Et la balance du commerce enseigne.qu’il a perdu son capital tout entier.
On conçoit combien il importe de savoir à quoi s’en tenir sur cette doctrine ; car, si elle est juste, les négociants tendent invinciblement à se ruiner, à ruiner le pays, et l’État doit s’empresser de les mettre tous en tutelle, — ce qu’il fait.
Ce n’est pas le seul motif qui oblige tout publiciste digne de ce nom à se faire une opinion sur cette fameuse balance du commerce ; car, selon qu’il y croit ou non, il est conduit nécessairement à une politique toute différente.
Si la théorie de la balance du commerce est vraie, si le profit national consiste à augmenter la masse du numéraire, il faut peu acheter au dehors, afin de ne pas laisser sortir des métaux précieux, et beaucoup vendre, afin d’en faire entrer. Pour cela, il faut empêcher, restreindre et prohiber. Donc, point de liberté au dedans ; — et comme chaque peuple adopte les mêmes mesures, il n’y a d’espoir que dans la force pour réduire l’étranger à la dure condition de consommateur ou tributaire. De là les conquêtes, les colonies, la violence, la guerre, les grandes armées, les puissantes marines, etc.
Si, au contraire, la balance du négociant est un thermomètre plus fidèle que la balance du commerce, — pour toute valeur donnée sortie de France, — il est à désirer qu’il entre la plus grande valeur possible, c’est-à-dire que le chiffre des importations surpasse le plus possible, dans les états de douane, le chiffre des exportations. Or, comme tous les efforts des négociants ont ce résultat en vue, — dès qu’il est conforme au bien général, il n’y a qu’à les laisser faire. La liberté et la paix sont les conséquences nécessaires de cette doctrine.
L’opinion que l’exportation du numéraire constitue une perte étant très-répandue, et selon nous très-funeste, qu’il nous soit permis de saisir cette occasion d’en dire un mot.
Un homme qui a un métier, par exemple un chapelier, rend des services effectifs à ses pratiques. Il garantit leur tête du soleil et de la pluie, et, en récompense, il entend bien recevoir à son tour des services effectifs en aliments, vêtements, logements, etc. Tant qu’il garde les écus qui lui ont été donnés en payement, il n’a pas encore reçu ces services effectifs. Il n’a entre les mains pour ainsi dire que des bons qui lui donnent droit à recevoir ces services. La preuve en est que s’il était condamné, dans sa personne et sa postérité, à ne jamais se servir de ces écus, il ne se donnerait certes pas la peine de faire des chapeaux pour les autres. Il appliquerait son propre travail à ses propres besoins. Par où l’on voit que, par l’intervention de la monnaie, le troc de service contre service se décompose en deux échanges. On rend d’abord un service contre lequel on reçoit de l’argent, et l’on donne ensuite l’argent contre lequel on reçoit un service. Ce n’est qu’alors que le troc est consommé.
Il en est ainsi pour les peuples.
Quand il n’y a pas de mines d’or et d’argent dans un pays, comme c’est le cas pour la France et l’Angleterre, il faut nécessairement rendre des services effectifs aux étrangers pour recevoir leur numéraire. On les nourrit, on les abreuve, on les meuble, etc. ; mais tant qu’on n’a que leur numéraire, on n’a pas encore reçu d’eux les services effectifs auxquels on a droit. Il faut bien en arriver à la satisfaction des besoins réels, en vue de laquelle on a travaillé. La présence même de cet or prouve que la nation a satisfait au dehors des besoins réels et qu’elle est créancière de services équivalant à ceux qu’elle a rendus. Ce n’est donc qu’en exportant cet or contre des produits consommables qu’elle est efficacement payée de ses travaux. (V. tome V, p. 64 et suiv.)
En définitive, les nations entre elles, comme les individus entre eux, se rendent des services réciproques. Le numéraire n’est qu’un moyen ingénieux de faciliter ces trocs de services. Entraver directement ou indirectement l’exportation de l’or, c’est traiter le peuple comme on traiterait ce chapelier à qui l’on défendrait de jamais retirer de la société, en dépensant son argent, des services aussi efficaces que ceux qu’il lui a rendus.
Le National nous oppose la crise actuelle de l’Angleterre ; mais le National tombe dans la même erreur que la Presse, en parlant de l’exportation du numéraire, sans tenir compte de la perte des récoltes, sans même la mentionner.
Le jour où les Anglais, après avoir labouré, hersé, ensemencé leurs champs, ont vu leurs blés détruits et leurs pommes de terre pourries, ce jour-là, il a été décidé qu’ils devaient souffrir d’une manière ou d’une autre. La forme sous laquelle cette souffrance devait naturellement se présenter, vu la nature du phénomène, c’était l’inanition. Heureusement pour eux, ils avaient autrefois rendu des services aux peuples contre ces bons, qu’on appelle monnaies, et qui donnent droit à recevoir, en temps opportun, l’équivalent de ces services. Ils en ont profité dans cette circonstance. Ils ont rendu l’or et reçu du blé ; et la souffrance, au lieu de se manifester sous forme d’inanition, s’est manifestée sous forme d’appauvrissement, ce qui est moins dur. Mais cet appauvrissement, ce n’est pas l’exportation du numéraire qui en est cause, c’est la perte des récoltes.
C’est absolument comme le chapelier dont nous parlions tout à l’heure. Il vendait beaucoup de chapeaux, et, se soumettant à des privations, il réussit à accumuler de l’or. Sa maison brûla. Il fut bien obligé de se défaire de son or pour la reconstruire. Il en resta plus pauvre. Fut-ce parce qu’il s’était défait de son or ? Non, mais parce que sa maison avait brûlé. — Un fléau est un fléau. Il ne le serait pas si l’on était aussi riche après qu’avant.
« Le blé consommé, l’argent exporté, que reste-t-il à l’acheteur ? » demande le National. — Il lui reste de n’être pas mort de faim, ce qui est quelque chose.
Nous demanderons à notre tour : Si l’Angleterre n’eût consommé ce blé et exporté cet argent, que lui resterait-il ? des cadavres [1].
FN:V. sur la balance du commerce, tome IV, page 52, et tome V, page 402 ; puis le chap. Échange, tome VI. (Note de l’éditeur.)
Huitième discours, à Paris. Discours au cercle de la librairie [16 Dec. 1847] ↩
BWV
1847.12.16 "Huitième discours, à Paris : Discours au Cercle de la librairie" (A Speech given to the Publishers Circle) [16 December 1847] [OC2.49a, p.328-39]
Discours au cercle de la librairie [1]
16 décembre 1847
Messieurs,
Un de mes amis, qui assistait dernièrement à une séance de l’Académie des sciences morales et politiques, m’a rapporté que la conversation étant tombée sur la propriété, qui, vous le savez, est fréquemment attaquée de nos jours, sous une forme ou sous une autre, un membre de cette compagnie avait résumé sa pensée sous cette forme : l’homme naît propriétaire. Ce mot, Messieurs, je le répète ici comme l’expression la plus énergique et la plus juste de ma propre pensée
Oui, l’homme naît propriétaire, c’est-à-dire que la propriété est le résultat de son organisation.
On naît propriétaire, car on naît avec des besoins auxquels il faut absolument pourvoir pour se développer, pour se perfectionner et même pour vivre ; et on naît aussi avec un ensemble de facultés coordonnées à ces besoins.
On naît donc avec la propriété de sa personne et de ses facultés. C’est donc la propriété de la personne qui entraîne la propriété des choses, et c’est la propriété des facultés qui entraîne celle de leur produit.
Il résulte de là que la propriété est aussi naturelle que l’existence même de l’homme.
Cela est-il vrai qu’on en voit les rudiments chez les animaux eux-mêmes ; car, en tant qu’il y a de l’analogie entre leurs besoins et leurs facultés et les nôtres, il doit en exister dans les conséquences nécessaires de ces facultés et de ces besoins.
Quand l’hirondelle a butiné des brins de paille et de mousse, qu’elle les a cimentés avec un peu de boue et qu’elle en a construit un nid, on ne voit pas ses compagnes lui ravir le fruit de son travail.
Chez les sauvages aussi, la propriété est reconnue. Quand un homme a pris quelques branches d’arbre, quand il a façonné ces branches en arcs ou en flèches, quand il a consacré à ce travail un temps dérobé à des occupations plus immédiatement utiles, quand il s’est imposé des privations pour arriver à se munir d’armes, toute la tribu reconnaît que ces armes sont sa propriété ; et le bon sens dit que, puisqu’elles doivent servir à quelqu’un et produire une utilité, il est bien naturel que ce soit à celui qui s’est donné la peine de les fabriquer. Un homme plus fort peut certainement les ravir, mais ce n’est pas sans soulever l’indignation générale, et c’est précisément pour mieux prévenir ces extorsions que les gouvernements ont été établis.
Ceci montre, Messieurs, que le droit de propriété est antérieur à la loi. Ce n’est pas la loi qui a donné lieu à la propriété, mais, au contraire, la propriété qui a donné lieu à la loi. Cette observation est importante ; car il est assez commun, surtout parmi les juristes, de faire reposer la propriété sur la loi, d’où la dangereuse conséquence que le législateur peut tout bouleverser en conscience. Cette fausse idée est l’origine des plans d’organisation dont nous sommes inondés. Il faut dire, au contraire, que la loi est le résultat de la propriété, et la propriété, le résultat de l’organisation humaine.
Mais le cercle de la propriété s’étend et se consolide avec la civilisation. Plus la race humaine est faible, ignorante, passionnée, violente, plus la propriété est restreinte et incertaine.
Ainsi, chez les sauvages dont je parlais tout à l’heure, quoique le droit de propriété soit reconnu, l’appropriation du sol ne l’est pas ; la tribu en jouit en commun. À peine même une certaine superficie de terre est-elle reconnue comme propriété à chaque tribu par les tribus voisines. Pour constater ce phénomène, il faut rencontrer un degré plus élevé de civilisation et observer les peuples partout.
Aussi qu’arrive-t-il ? c’est que, dans l’état sauvage, la terre n’étant point personnellement possédée, tous recueillent les fruits spontanés qu’elle donne, mais nul ne songe à la travailler. Dans ces contrées, la population est rare, misérable, décimée par la souffrance, la maladie et la famine.
Chez les nomades, les tribus jouissent en commun d’un espace déterminé ; on peut au moins élever des troupeaux. La terre est plus productive, la population plus nombreuse, plus forte, plus avancée.
Au milieu des peuples civilisés, la propriété a franchi le dernier pas ; elle est devenue individuelle. Chacun, sûr de recueillir le fruit de son travail, fait rendre au sol tout ce qu’il peut rendre. La population s’accroît en nombre et en richesse.
Dans ces diverses conditions sociales, la loi suit les phénomènes et ne les précède pas ; elle régularise les rapports, ramène à la règle ceux qui s’en écartent, mais elle ne crée pas ces rapports.
Je ne puis m’empêcher, Messieurs, de retenir un moment notre attention sur les conséquences de ce droit de propriété personnelle attaché au sol.
Au moment où l’appropriation s’opère, la population est excessivement rare comparée à l’étendue des terres ; chacun peut donc clore une parcelle aussi grande qu’il la peut sans nuire à ses frères, puisqu’il y a surabondamment de la terre pour tout le monde. Non-seulement il ne nuit pas à ses frères, mais il leur est utile, et voici comment : quelque grossière que soit une culture, elle donne toujours plus de produits, en un an, que le cultivateur et sa famille n’en peuvent consommer. Une partie de la population peut donc se livrer, à d’autres travaux, comme la chasse, la pêche, la confection des vêtements, des habitations, des armes, des outils, etc., et échanger avec avantage ce travail contre du travail agricole. Observez, Messieurs, que tant que la terre non encore appropriée abondera, ces deux natures de travaux se développeront parallèlement d’une manière harmonique ; il sera impossible à l’un d’opprimer l’autre. Si la classe agricole mettait ses services à trop haut prix, on déserterait les autres industries pour défricher de nouvelles terres. Si, au contraire, l’industrie exigeait une rémunération exorbitante, on verrait le capital et le travail préférer l’industrie à l’agriculture, en sorte que la population pourrait progresser longtemps et l’équilibre se maintenir, avec quelques dérangements partiels, sans doute, mais d’une manière bien plus régulière que si le législateur y mettait la main.
Mais, lorsque la totalité du territoire est occupée, il se produit un phénomène qu'il faut remarquer.
La population ne laisse pas de croître. Les nouveaux venus n’ont pas le choix de leurs occupations. Il leur faut pourtant plus d’aliments, puisqu’il y a plus de bouches, plus de matières premières, puisqu’il y a plus d’êtres humains à vêtir, loger, chauffer, éclairer, etc.
Il me paraît incontestable que le droit de ces nouveaux venus est de travailler pour des populations étrangères, d’envoyer au dehors leurs produits pour recevoir des aliments. Que si, par la constitution politique du pays, la classe agricole a le pouvoir législatif du pays, et si elle profite de ce pouvoir pour faire une loi qui défende à toute la population de travailler pour le dehors, l’équilibre est rompu ; et il n’y a pas de limite à l’intensité du travail que les propriétaires fonciers pourront exiger en retour d’une quantité donnée de subsistances.
Messieurs, d’après ce que je viens de dire de la propriété en général, il me semble difficile de ne pas reconnaître que la propriété littéraire rentre dans le droit commun. (Adhésions.) Un livre n’est-il pas le produit du travail d’un homme, de ses facultés, de ses efforts, de ses soins, de ses veilles, de l’emploi de son temps, de ses avances ? Ne faut-il pas que cet homme vive pendant qu’il travaille ? Pourquoi donc ne recevrait-il pas des services volontaires de ceux à qui il rend des services ? Pourquoi son livre ne serait-il pas sa propriété ? Le fabriquant de papier, l’imprimeur, le libraire, le relieur, qui ont matériellement concouru à la formation d’un livre, sont rémunérés de leur travail. L’auteur sera-t-il seul exclu des rémunérations dont son livre est l’occasion ?
Ce sera beaucoup avancer la question que de la traiter historiquement. Permettez-moi de vous rendre compte fort succinctement de l’état de la législation sur cette matière.
J’ai défini devant vous la propriété. J’ai dit : « Toute production appartient à celui qui l’a formée, et parce qu’il l’a formée. » Messieurs, il fut un temps où l’on était bien loin de reconnaître un principe qui nous paraît aujourd’hui si simple. Vous comprendrez que ce principe ne pouvait être admis ni dans le droit romain, ni par l’aristocratie féodale, ni par les rois absolus ; car il eût renversé une société fondée sur la conquête, l’usurpation et l’esclavage. Comment voulez-vous que les Romains, qui vivaient sur le travail des nations conquises ou des esclaves, que les Normands, qui vivaient sur le travail des Saxons, pussent donner pour base à leur droit public cette maxime subversive de toute spoliation organisée : « Une production appartient à celui qui l’a formée. »
À l’époque où l’imprimerie fut inventée, un autre droit existait en Europe. Le roi était le maître, le propriétaire universel des choses et des hommes. Permettre de travailler était un droit dominical et royal. La règle était que tout émanait du prince. Nul n’avait le droit d’exercer une profession. Le droit ne pouvait résulter que d’une concession royale. Le roi désignait les personnes qu’il lui plaisait de placer dans l’exception pour un genre de travail déterminé, à qui il voulait bien, par monopole, par privilége, privata lex, conférer la faculté de vivre en travaillant.
La profession d’écrivain ne pouvait échapper à cette règle. Aussi l’édit du 26 août 1686, le premier qui se soit occupé de ces matières, dispose ainsi : « Il est défendu à tous les imprimeurs et libraires d’imprimer et mettre en vente un ouvrage pour lequel aucun privilége n’aura été accordé, sous peine de confiscation et de punition exemplaire. »
Et remarquez, Messieurs, que toute la théorie de la propriété, telle qu’elle est encore enseignée dans nos écoles, est puisée dans le droit romain et féodal. Et, si je ne me trompe, la définition officielle de la propriété sur les bancs de l’école est encore le jus utendi et abutendi. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup de juristes négligent de rechercher des rapports entre la propriété et la nature de l’homme, surtout en ce qui concerne la propriété littéraire.
Il arriva que, relativement au privilégié, le monopole avait tous les effets de la propriété. Déclarer que nul, sinon l’auteur, n’aurait la faculté d’imprimer le livre, c’était faire l’auteur propriétaire, sinon de droit, du moins de fait.
La révolution de 1789 devait renverser cet ordre de choses. C’est ce qui arriva. L’Assemblée constituante reconnut à chacun la faculté d’écrire et de faire imprimer ; mais elle crut avoir tout fait en reconnaissant le droit, et ne songea pas à stipuler des garanties en faveur de la propriété littéraire. Elle proclama un droit de l’homme et non une propriété. Elle détruisait ainsi cette sorte de garantie, qui, sous l’ancien régime, résultait incidemment du monopole. Aussi, pendant quatre ans, chacun put à son gré multiplier et vendre à son profit les copies des livres des auteurs vivants ; c’est comme si l’Assemblée constituante avait dit : « Cultiver la terre est un droit de l’homme, » et qu’en conséquence chacun eût été libre de s’emparer du champ de son voisin.
Par une coïncidence bien singulière, et qui prouve combien les mêmes causes produisent les mêmes effets, les choses s’étaient passées exactement de même en Angleterre. Là aussi le droit de travailler avait été d’émanation royale. Là aussi la faculté n’avait été d’abord qu’une concession, un privilége. Là aussi ces monopoles avaient été détruits et le droit au travail reconnu. Là aussi on avait cru tout faire en paralysant l’action royale ; et en reconnaissant que chacun aurait le droit d’écrire et d’imprimer, on avait omis de stipuler que l’œuvre appartenait à l’ouvrier. Là aussi enfin, cet interrègne de la loi dura trois à quatre années, pendant lesquelles la propriété littéraire fut mise au pillage.
En Angleterre comme en France, l’aspect de ces désordres amena la législation qui, à très-peu de choses près, régit encore les deux pays.
La Convention rendit, sur le rapport de Lackanal, un décret dont les termes méritent d’être cités. (L’orateur les commente.)
Cette dernière observation répond à une objection qu’on a souvent élevée contre la propriété littéraire. On dit : Tant que l’auteur a entre les mains son manuscrit, personne ne lui conteste la propriété de son œuvre ; mais une fois qu’il l’a livré à l’impression, doit-il être propriétaire de toutes les éditions futures ? chacun n’a-t-il pas le droit de multiplier et de faire vendre ces éditions ?
Messieurs, la loi ne doit être ni un jeu de mots ni une surprise ; il n’y a pas d’autre manière de tirer parti d’un livre que d’en multiplier les copies et de les vendre. Accorder cette faculté à ceux qui n’ont pas fait le livre ou qui n’en ont pas obtenu la cession, c’est déclarer que l’œuvre n’appartient pas à l’ouvrier, c’est nier la propriété même. C’est comme si l’on disait : Le champ sera approprié, mais les fruits seront au premier qui s’en emparera. (Applaudissements.)
Après avoir lu les considérants du décret, il est difficile de s’expliquer le décret lui-même. Il se borne à attribuer aux auteurs, comme cadeau législatif, l’usufruit de leur œuvre. En effet, de même que déclarer un homme usufruitier à perpétuité, c’est le déclarer propriétaire, — dire qu’il sera propriétaire pendant un nombre d’années déterminé, c’est dire qu’il sera usufruitier. Ce n’est pas un mot qui constitue le droit : la loi aurait beau dire que je m’appelle empereur ; si elle me laisse dans la situation où je suis, elle ne fait que proclamer un mensonge.
Notre législation actuelle ne me paraît fondée sur aucun principe. Ou la propriété littéraire est un droit supérieur à la loi, et alors la loi ne doit faire autre chose que le constater, le régler et le garantir ; ou l’œuvre littéraire appartient au public, et, en ce cas, on ne voit pas pourquoi l’usufruit est attribué à l’auteur.
Il me semble que cette disposition de la loi se ressent des idées dont notre ancien droit public avait imbu les esprits. La Convention s’est substituée au Roi ; elle a cru faire envers les auteurs un acte de munificence qu’elle était maîtresse de régler et de limiter ; elle a supposé que le fond du droit était en elle et non dans l’auteur, et alors elle en a cédé ce qu’elle a jugé à propos d’en céder. Mais, en ce cas, pourquoi cette solennelle déclaration du droit ?
… Un écrivain de talent a consacré des pages éloquentes à combattre, dans son principe même, la propriété littéraire. Il se fonde sur ce qu’il y a de triste et de dégradant, selon lui, à voir le génie chercher sa récompense dans un peu d’or. Je ne puis m’empêcher de craindre qu’il n’y ait dans cette manière de juger un reste de préventions aristocratiques, et que l’auteur n’ait cédé, à son insu, à ce sentiment de mépris pour le travail, qui était le caractère distinctif des anciens possesseurs d’esclaves, et qui nous est inculqué à tous avec l’éducation universitaire. Les écrivains sont-ils d’une autre nature que les hommes ? N’ont-ils pas des besoins à satisfaire, une famille à élever ? Y a-t-il quelque chose de méprisable en soi à recourir pour cela au travail intellectuel ? Les mots mercantilisme, industrialisme, individualisme, s’accumulent sous la plume de M. Blanc. Est-ce donc une chose basse, ignoble, honteuse, d’échanger librement des services, parce que l’or sert d’intermédiaire à ces échanges ? Sommes-nous tous nobles par nature ? descendons-nous des dieux de l’Olympe ?
Après avoir flétri ce sentiment, je pourrais dire cette nécessité qui soumet les hommes à recevoir des services en échange de ceux qu’ils rendent, et, pour trancher le mot, à travailler en vue d’une rémunération, M. Blanc imagine tout un système de rémunération. Seulement il veut qu’elle soit nationale et non individuelle. Je n’examinerai pas le système de M. Blanc, qui me paraît susceptible de beaucoup d’objections. Mais est-il certain que les écrivains conserveront plus de dignité quand la brigue et les sollicitations seront le chemin des récompenses ? (Rires.)
Je suis d’accord avec M. Blanc que, dans l’état actuel des choses, les livres amusants, dangereux, quelquefois corrupteurs, et toujours faits à la hâte, sont plus lucratifs que les grands et sérieux ouvrages, qui ont exigé beaucoup de travaux et de veilles. Mais pourquoi ? parce que le public demande ces livres ; on lui sert ce qu’il veut. Il en est ainsi de toutes les productions. Partout où les masses sont disposées à faire des sacrifices pour obtenir une chose, cette chose se fait ; il se trouve toujours des gens qui la font. Ce ne sont pas des mesures législatives qui corrigeront cela, c’est le perfectionnement des mœurs. En toutes choses, il n’y a de ressource que dans le progrès de l’opinion publique [2].
On dira que c’est un cercle vicieux, puisque les mauvais livres ne font que corrompre de plus en plus les masses et l’opinion ; je ne le crois pas. Je suis convaincu qu’il y a des natures d’ouvrages que le temps décrédite.
Au reste, il me semble que la propriété littéraire est un obstacle à ce danger. N’est-il pas évident que plus l’usufruit est restreint, plus il y a intérêt à écrire vite, à abonder dans le sens de la vogue ?
Quant au désintéressement dont M. Blanc parle en termes chaleureux, et, je puis le dire, pleins d’élévation et d’éloquence, à Dieu ne plaise que je me sépare de lui sur ce terrain. Certes, les hommes qui veulent rendre sans aucune rémunération des services à la société, dans quelque branche que ce soit, militaire, ecclésiastique, littéraire ou autre, méritent toute notre sympathie, tous nos hommages, et plus encore si, comme les grands modèles qu’il nous cite, ils travaillent dans le dénûment et la douleur. Mais quoi ! serait-il généreux à la société de s’emparer du dévouement d’une classe particulière pour s’en faire un titre contre elle, pour l’imposer comme une obligation légale, et pour refuser à cette classe le droit commun de recevoir des services contre des services ? (Mouvement.)
Parmi les objections que l’on fait, non sur le principe de la propriété littéraire, mais à son application, il en est une qui me paraît très-sérieuse ; c’est l’état de la législation chez les peuples qui nous avoisinent. Il me semble que c’est là un de ces progrès à l’occasion desquels se manifeste le plus la solidarité des nations. À quoi servirait que la propriété littéraire fût reconnue en France, si elle ne l’était pas en Belgique, en Hollande, en Angleterre ; si les imprimeurs et libraires de ces pays pouvaient impunément violer cette propriété ? Tel est l’état des choses actuel, dira-t-on, et il n’empêche pas que notre législation n’ait accordé aux auteurs l’usufruit de leurs œuvres. L’inconvénient ne serait pas pire quant à la propriété.
Mais tout le monde sait dans quelle position anormale la contrefaçon place notre librairie relativement aux ouvrages des auteurs vivants. Que serait-ce donc si la propriété littéraire eût été reconnue en France ? si les œuvres de Corneille, de Racine et de tous les grands hommes des siècles passés étaient encore grevées d’un droit d’auteur dont les éditeurs belges s’affranchiraient ? Aujourd’hui, il y a au moins un fonds immense d’ouvrages pour la reproduction desquels notre librairie est placée sous ce rapport dans les mêmes conditions que la librairie étrangère. Sans cela, il est douteux qu’elle pût exister.
Il y en a qui pensent qu’en m’exprimant ainsi je démens ces principes de liberté commerciale que je recommande en d’autres matières, puisque je parais redouter pour notre librairie la concurrence étrangère.
Je repousse de toutes mes forces l’accusation et l’assimilation.
Si les Belges, grâce à une position naturelle ou à une supériorité personnelle, peuvent imprimer à meilleur marché que nous, je regarderais comme une injustice et une folie de prohiber les livres belges ; car ce serait soutenir une industrie qui perd en mettant une taxe sur les acheteurs de livres. J’attaquerais cette protection comme toutes les autres. Mais quel rapport cela a-t-il avec la question de contrefaçon ? En bonne logique, il faut que les cas soient semblables pour être assimilés. Je suppose qu’il s’établisse une fabrique de drap sur le territoire belge, et que les Belges trouvent le moyen d’aller soustraire dans les fabriques françaises de la laine et des teintures ; évidemment ce ne serait pas là de la concurrence, ce serait de la spoliation. N’aurions-nous pas le droit de réclamer que la législation belge fût réformée, et que la diplomatie française, pour être bonne à quelque chose une fois dans sa vie, provoquât ce grand acte de justice internationale ?
En résumé, Messieurs, si mes vues ne sont pas celles de M. Blanc, j’ose dire que mes désirs sont les siens. Oui, je désire comme lui que notre littérature s’élève, s’épure et se moralise ; je désire que la France conserve et étende de plus en plus la légitime et glorieuse suprématie de sa belle langue, qui, plus que ses baïonnettes, portera jusqu’aux extrémités de la terre le principe de notre Révolution. (Applaudissements.)
L'indiscret [The Man who asked Embarrassing Questions] [12 December 1847] [CW3 ES3.12]↩
BWV
1847.12.12 “L'indiscret” (The Man who asked Embarrassing Questions) [*Libre-Échange*, 12 December 1847] [OC2.65, pp. 435-46] [CW3] [ES3.12]
Protection à l’industrie nationale ! Protection au travail national ! Il faut avoir l’esprit bien de travers et le cœur bien pervers pour décrier une si belle et bonne chose.
— Oui, certes, si nous étions bien convaincus que la protection, telle que l’a décrétée la Chambre du double vote, a augmenté le bien-être de tous les Français, nous compris ; si nous pensions que l’urne de la Chambre du double vote, plus merveilleuse que celle de Cana, a opéré le miracle de la multiplication des aliments, des vêtements, des moyens de travail, de locomotion et d’instruction, — en un mot, de tout ce qui compose la richesse du pays, — il y aurait à nous ineptie et perversité à réclamer le libre-échange.
Et pourquoi, en ce cas, ne voudrions-nous pas de la protection ? Eh ! Messieurs, démontrez-nous que les faveurs qu’elle accorde aux uns ne sont pas faites aux dépens des autres ; prouvez-nous qu’elle fait du bien à tout le monde, au propriétaire, au fermier, au négociant, au manufacturier, à l’artisan, à l’ouvrier, au médecin, à l’avocat, au fonctionnaire, au prêtre, à l’écrivain, à l’artiste, prouvez-nous cela, et nous vous promettons de nous ranger autour de sa bannière ; car, quoi que vous en disiez, nous ne sommes pas fous encore.
Et, en ce qui me concerne, pour vous montrer que ce n’est pas par caprice et par étourderie que je me suis engagé dans la lutte, je vous vais conter mon histoire.
Après avoir fait d’immenses lectures, profondément médité, recueilli de nombreuses observations, suivi de semaine en semaine les fluctuations du marché de mon village, entretenu avec de nombreux négociants une active correspondance, j’étais enfin parvenu à la connaissance de ce phénomène :
Quand la chose manque, le prix s’élève.
D’où j’avais cru pouvoir, sans trop de hardiesse, tirer cette conséquence :
Le prix s’élève quand et parce que la chose manque.
Fort de cette découverte, qui me vaudra au moins autant de célébrité que M. Proudhon en attend de sa fameuse formule : La propriété, c’est le vol, j’enfourchai, nouveau Don Quichotte, mon humble monture, et entrai en campagne.
Je me présentai d’abord chez un riche propriétaire et lui dis :
— Monsieur, faites-moi la grâce de me dire pourquoi vous tenez tant à la mesure que prit en 1822 la Chambre du double vote relativement aux céréales ?
— Eh, morbleu ! la chose est claire, parce qu’elle me fait mieux vendre mon blé.
— Vous pensez donc que, depuis 1822 jusqu’en 1847, le prix du blé a été, en moyenne, plus élevé en France, grâce à cette loi, qu’il ne l’eût été sans elle ?
— Certes oui, je le pense, sans quoi je ne la soutiendrais pas.
— Et si le prix du blé a été plus élevé, il faut qu’il n’y ait pas eu autant de blé en France, sous cette loi que sans cette loi ; car si elle n’eût pas affecté la quantité, elle n’aurait pas affecté le prix.
— Cela va sans dire.
Je tirai alors de ma poche un memorandum où j’écrivis ces paroles :
« De l’aveu du propriétaire, depuis vingt-neuf ans que la loi existe, il y a eu, en définitive, moins de blé en France qu’il n’y en aurait eu sans la loi. »
De là je me rendis chez un éleveur de bœufs.
— Monsieur, seriez-vous assez bon pour me dire par quel motif vous tenez à la restriction qui a été mise à l’entrée des bœufs étrangers par la Chambre du double vote ?
— C’est que, par ce moyen, je vends mes bœufs à un prix plus élevé.
— Mais si le prix des bœufs est plus élevé à cause de cette restriction, c’est un signe certain qu’il y a eu moins de bœufs vendus, tués et mangés dans le pays, depuis vingt-sept ans, qu’il n’y en aurait eu sans la restriction ?
— Belle question ! nous n’avons voté la restriction que pour cela.
J’écrivis sur mon memorandum ces mots :
« De l’aveu de l’éleveur de bœufs, depuis vingt-sept ans que la restriction existe, il y a eu moins de bœufs en France qu’il n’y en aurait eu sans la restriction. »
De là je courus chez un maître de forges.
— Monsieur, ayez l’extrême obligeance de me dire pourquoi vous défendez si vaillamment la protection que la Chambre du double vote a accordée au fer ?
— Parce que, grâce à elle, je vends mon fer à plus haut prix.
— Mais alors, grâce à elle aussi, il y a moins de fer en France qui si elle ne s’en était pas mêlée ; car si la quantité de fer offerte était égale ou supérieure, comment le prix pourrait-il être plus élevé ?
— Il coule de source que la quantité est moindre, puisque cette loi a eu précisément pour but de prévenir l’invasion.
Et j’écrivis sur mes tablettes :
« De l’aveu du maître de forges, depuis vingt-sept ans, la France a eu moins de fer par la protection qu’elle n’en aurait eu par la liberté. »
Voici qui commence à s’éclaircir, me dis-je ; et je courus chez un marchand de drap.
— Monsieur, me refuserez-vous un petit renseignement ? Il y a vingt-sept ans que la Chambre du double vote, dont vous étiez, a voté l’exclusion absolue du drap étranger. Quel a pu être son motif et le vôtre ?
— Ne comprenez-vous pas que c’est afin que je tire meilleur parti de mon drap et fasse plus vite fortune ?
— Je m’en doute. Mais êtes-vous bien sûr d’avoir réussi ? Est-il certain que le prix du drap ait été, pendant ce temps, plus élevé que si la loi eût été rejetée ?
— Cela na peut faire l’objet d’un doute. Sans la loi, la France eût été inondée de drap, et le prix se serait avili ; ce qui eût été un malheur effroyable.
— Je ne cherche pas encore si c’eût été un malheur ; mais, quoi qu’il en soit, vous convenez que le résultat de la loi a été de faire qu’il y ait eu moins de drap en France ?
— Cela a été non-seulement le résultat de la loi, mais son but.
— Fort bien, dis-je ; et j’écrivis sur mon calepin :
« De l’aveu du fabricant, depuis vingt-sept ans, il y a eu moins de drap en France à cause de la prohibition. »
Il serait trop long et trop monotone d’entrer dans plus de détails sur ce curieux voyage d’exploration économique.
Qu’il me suffise de vous dire que je visitai successivement un pasteur marchand de laine, un colon marchand de sucre, un fabricant de sel, un potier, un actionnaire de mines de houille, un fabricant de machines, d’instruments aratoires et d’outils, — et partout j’obtins la même réponse.
Je rentrai chez moi pour revoir mes notes et les mettre en ordre. Je ne puis mieux faire que de les publier ici.
« Depuis vingt-sept ans, grâce aux lois imposées au pays par la Chambre du double vote, il y a eu en France :
Moins de blé ;
Moins de viande ;
Moins de laine ;
Moins de houille ;
Moins de bougies ;
Moins de fer ;
Moins d’acier ;
Moins de machines ;
Moins de charrues ;
Moins d’outils ;
Moins de draps ;
Moins de toiles ;
Moins de fils ;
Moins de calicot ;
Moins de sel ;
Moins de sucre ;
Et moins de toutes les choses qui servent à nourrir, vêtir, loger, meubler, chauffer, éclairer et fortifier les hommes. »
Par le grand Dieu du ciel, m’écriai-je, puisqu’il en est ainsi, la France a été moins riche.
En mon âme et conscience, devant Dieu et devant les hommes, par la mémoire de mon père, de ma mère et de mes sœurs, par mon salut éternel, par tout ce qu’il y a de cher, de précieux, de sacré et de saint en ce monde et dans l’autre, j’ai cru que ma conclusion était juste.
Et si quelqu’un me prouve le contraire, non-seulement je renoncerai à raisonner sur ces matières, mais je renoncerai à raisonner sur quoi que ce soit ; car en quel raisonnement pourrai-je avoir confiance, si je n’en puis avoir en celui-là ?
19 Décembre 1847.
Vous vous rappelez parfaitement, cher lecteur…
— Je ne me rappelle absolument rien.
— Quoi ! huit jours ont suffi pour effacer de votre souvenir l’histoire de cette mémorable campagne !
— Pensez-vous qu’on y va rêver huit jours durant ? C’est une prétention bien indiscrète.
— Je vais donc recommencer.
— Ce serait ajouter une indiscrétion à une indiscrétion.
— Vous m’embarrassez. Si vous voulez que la fin du récit soit intelligible, il faut bien ne pas perdre de vue le commencement.
— Résumez-vous.
— Soit. Je disais qu’à mon retour de ma première pérégrination économique mon calepin constatait ceci : « D’après la déposition de tous les industriels protégés, la France a eu, par l’effet des lois restrictives de la Chambre du double vote, moins de blé, de viande, de fer, de drap, de toile, d’outils, de sucre, et moins de toutes choses qu’elle n’en aurait eu sans ces lois. »
— Vous me remettez sur la voie. Ces industriels disaient même que tel avait été non-seulement le résultat, mais le but des lois de la Chambre du double vote. Elles aspiraient à renchérir les produits en les raréfiant.
— D’où je déduisis ce dilemme : Ou elles n’ont pas raréfié les produits, et alors elles ne les ont pas renchéris, et le but a été manqué ; ou elles les ont renchéris, et en ce cas elles les ont raréfiés, et la France a été moins bien nourrie, vêtue, meublée, chauffée et sucrée.
Plein de foi dans ce raisonnement, j’entrepris une seconde campagne. Je me présentai chez le riche propriétaire et le priai de jeter les yeux sur mon calepin, ce qu’il fit un peu à contre-cœur.
Quand il eut fini sa lecture, Monsieur, lui dis-je, êtes-vous bien sûr que, relativement à vous, les excellentes intentions de la Chambre du double vote aient réussi ?
— Comment auraient-elles manqué de réussir ? répondit-il ; ne savez-vous pas que mieux je vends ma récolte, plus je suis riche ?
— C’est assez vraisemblable.
— Et ne comprenez-vous pas que moins il y a de blé dans le pays, mieux je vends ma récolte ?
— C’est encore vraisemblable.
— Ergo…
— C’est cet ergo qui me préoccupe, et voici d’où viennent mes doutes. Si la Chambre du double vote n’eût stipulé de protection que pour vous, vous vous seriez enrichi aux dépens d’autrui. Mais elle a voulu que d’autres s’enrichissent à vous dépens, comme le constate ce calepin. Êtes-vous bien sûr que la balance de ces gains illicites soit en votre faveur ?
— Je me plais à le croire. La Chambre de double vote était peuplée de gros propriétaires, qui n’avaient pas la cataracte à l’endroit de leurs intérêts.
— En tous cas, vous conviendrez que, dans l’ensemble de ces mesures restrictives, tout n’est pas profit pour vous, et que votre part de gain illicite est fort ébréchée par le gain illicite de ceux qui vous vendent le fer, les charrues, le drap, le sucre, etc.
— Cela va sans dire.
— En outre, je vous prie de peser attentivement cette considération : Si la France a été moins riche, comme le constate mon calepin…
— Indiscret calepin !
— Si, dis-je, la France a été moins riche, elle a dû moins manger. Beaucoup d’hommes qui se seraient nourris de blé et de viande ont été réduits à vivre de pommes de terre et de châtaignes. N’est-il pas possible que ce décroissement de consommation et de demande ait affecté le prix du blé dans le sens de la baisse, pendant que vos lois cherchaient à l’affecter dans le sens de la hausse ? Et cette circonstance venant s’ajouter au tribut que vous payez aux maîtres de forge, aux actionnaires de mines, aux fabricants de drap, etc., ne tourne-t-elle pas, en définitive, contre vous le résultat de l’opération ?
— Monsieur, vous me faites subir un interrogatoire fort indiscret. Je jouis de la protection, cela me suffit ; et vos subtilités et vos généralités ne m’en feront pas démordre.
L’oreille basse, j’enfourchai ma monture et me rendis chez le fabricant de drap.
— Monsieur, lui dis-je, que penseriez-vous de l’architecte qui, pour exhausser une colonne, prendrait à la base de quoi ajouter au sommet ?
— Je demanderais pour lui une place à Bicêtre.
— Et que penseriez-vous d’un fabricant qui, pour accroître son débit, ruinerait sa clientèle ?
— Je l’enverrais tenir compagnie à l’architecte.
— Permettez-moi donc de vous prier de jeter un regard sur ce calepin. Il renferme votre déposition et bien d’autres, d’où il résulte clairement que les lois restrictives émanées de la Chambre du double vote, dont vous étiez, ont fait la France moins riche qu’elle n’eût été sans ces lois. Ne vous est-il jamais tombé dans l’idée que si le monopole vous livre la consommation du pays, il ruine les consommateurs ; et que, s’il vous assure le débouché national, il a aussi pour effet, premièrement, de vous interdire dans une forte proportion vos débouchés au dehors, et de restreindre considérablement vos débouchés au dedans par l’appauvrissement de votre chalandise ?
— Il y a bien là une cause de diminution pour mes profits ; mais le monopole du drap, à lui tout seul, n’a pu appauvrir ma clientèle au point que ma perte surpasse mon bénéfice.
— Je vous prie de considérer que votre clientèle est appauvrie, non-seulement pas le monopole du drap, mais aussi, comme le constate ce calepin, par le monopole du blé, de la viande, du fer, de l’acier, du sucre, du coton, etc.
— Monsieur, votre insistance devient indiscrète. Je fais mes affaires, que ma clientèle fasse les siennes.
— C’est ce que je vais lui conseiller.
Et, pensant que le même accueil m’attendait chez tous les protégés, je me dispensai de poursuivre mes visites. Je serai plus heureux, me dis-je, auprès des non-protégés. Ils ne font pas la loi, mais ils font l’opinion, car ils sont incomparablement les plus nombreux. J’irai donc voir les négociants, banquiers, courtiers, assureurs, professeurs, prêtres, auteurs, imprimeurs, menuisiers, charpentiers, charrons, forgerons, maçons, tailleurs, coiffeurs, jardiniers, meuniers, modistes, avocats, avoués, et, en particulier, cette classe innombrable d’hommes qui n’ont rien au monde que leurs bras.
Justement le hasard me servit, et je tombai au milieu d’un groupe d’ouvriers.
— Mes amis, leur dis-je, voici un précieux calepin. Veuillez y jeter un coup d’œil. Vous le voyez, d’après la déposition des protégés eux-mêmes, la France est moins riche par l’effet des lois de la Chambre du double vote qu’elle ne le serait sans ces lois.
Un ouvrier. Est-il bien sûr que la perte retombe sur nous ?
— Je ne sais, repris-je, c’est ce qu’il s’agit d’examiner ; il est certain qu’il faut qu’elle retombe sur quelqu’un. Or les protégés affirment qu’elle ne les frappe pas ; donc, elle doit frapper les non-protégés.
Un autre ouvrier. Cette perte est-elle bien grande ?
— Il me semble qu’elle doit être énorme pour vous ; car les protégés, tout en avouant que l’effet de ces lois est de diminuer la masse des richesses, affirment que, quoique la masse soit plus petite, ils prennent une part plus grande ; d’où il suit que la perte des non-protégés doit être double.
L’ouvrier. À combien l’estimez-vous ?
— Je ne puis l’apprécier en chiffres, mais je puis me servir ce chiffres pour faire comprendre ma pensée. Représentons par 1,000 la richesse qui existerait en France sans ces lois, et par 500 la part qui reviendrait aux protégés. Celle des non-protégés serait aussi de 500. Puisqu’il est reconnu que les lois restrictives ont diminué le total, nous pouvons le représenter par 800 ; et puisque les protégés affirment qu’ils sont plus riches qu’ils ne le seraient sans ces lois, ils retirent plus de 500. Admettons 600. Il ne vous reste que 200 au lieu de 500. Par où vous voyez que, pour gagner 1, ils vous font perdre 3.
L’ouvrier. Est-ce que ces chiffres sont exacts ?
— Je ne les donne pas pour tels ; je veux seulement vous faire comprendre que, si sur un tout plus petit, les protégés prennent une part plus grande, les non-protégés portent tout le poids non-seulement de la diminution totale, mais encore de l’excédant que les protégés s’attribuent.
L’ouvrier. S’il en est ainsi, ne doit-il pas arriver que la détresse des non-protégés rejaillisse sur les protégés ?
— Je le crois. Je suis convaincu qu’à la longue la perte tend à se répartir sur tout le monde. J’ai essayé de le faire comprendre aux protégés, mais je n’ai pas réussi.
Un autre ouvrier. Quoique la protection ne nous soit pas accordée directement, on assure qu’elle nous arrive par ricochet.
— Alors il faut renverser tout notre raisonnement en partant toujours de ce point fixe et avoué, que la restriction amoindrit le total de la richesse nationale. Si, néanmoins, votre part est plus grande, celle des protégés est doublement ébréchée. En ce cas, pourquoi réclamez-vous le droit de suffrage ? Assurément, vous devez laisser à des hommes si désintéressés le soin de faire les lois.
Un autre ouvrier. Êtes-vous démocrate ?
— Je suis de la démocratie, si vous entendez par ce mot : À chacun la propriété de son travail, liberté pour tous, égalité pour tous, justice pour tous, et paix entre tous.
— Comment se fait-il que les meneurs du parti démocratique soient contre vous ?
— Je n’en sais rien.
— Oh ! ils vous habillent de la belle façon !
— Et que peuvent-ils dire ?
— Ils disent que vous êtes des docteurs ; ils disent en outre que vous avez raison en principe.
— Qu’entendent-ils par là ?
— Ils entendent tout simplement que vous avez raison ; que la restriction est injuste et dommageable ; qu’elle diminue la richesse générale ; que cette réduction frappe tout le monde, et particulièrement, comme vous dites, la classe ouvrière, et que c’est une des causes qui nous empêchent, nous et nos familles, de nous élever en bien-être, en instruction, en dignité et en indépendance. Ils ajoutent qu’il est bon que les choses soient ainsi ; qu’il est fort heureux que nous souffrions et nous méprenions sur la cause de nos souffrances, et que le triomphe de vos doctrines, en soulageant non misères et dissipant nos préjugés, éloignerait les chances de la grande guerre qu’ils attendent avec impatience. [123]
— Ainsi ils se mettent du côté de l’iniquité, de l’erreur et de la souffrance, le tout pour arriver à la grande guerre ?
— Ils font à ce sujet des raisonnements admirables.
— En ce cas, je ne suis ici qu’un indiscret, et je me retire.
Lettre de M. Considérant et réponse [25 Décembre 1847] ↩
BWV
1847.12 “Lettre de M. Considérant et réponse” (A Letter from Mr. Considérant and a Reply) [*Libre-Échange*, 25 Décembre 1847] [OC2.25, p. 134]
Lettre de M. Considérant et réponse
Décembre 1847
À MONSIEUR F. BASTIAT, RÉDACTEUR EN CHEF DU LIBRE-ÉCHANGE.
Paris, 25 décembre 1847.
Monsieur,
Voulez-vous me permettre de répondre quelques mots à l’Avis charitable à la Démocratie pacifique, que vous avez inséré dans votre numéro du 12 de ce mois ?
« Nous avons toujours été surpris, dit l’auteur en débutant, de rencontrer les disciples de Fourier parmi les membres de la coalition qui s’est formée en France contre la liberté des échanges. »
Quelques lignes plus loin, l’auteur cite un fragment d’une brochure que j’ai publiée en 1840, et il veut bien en faire précéder la reproduction des mots suivants : « On a rarement écrit des choses plus fortes, plus pressantes contre le système actuel des douanes. » Après la citation, il ajoute : « Laissons à part la définition de ce que M. Considérant appelle la protection directe… Le régime des douanes est déclaré anti-social, impolitique, ruineux, vexatoire. L’abolition de ce système fait partie de ce qui, selon le chef des phalanstériens, doit être l’âme de la politique française. On a donc lieu d’être surpris de voir M. Considérant et ses amis se ranger de fait parmi les défenseurs de ce régime ; car toutes les fois qu’ils parlent de la liberté des échanges, n’est-ce pas pour la combattre ou la travestir ? Comment des hommes intelligents peuvent-ils ainsi briser un de leurs plus beaux titres, etc. ? »
Permettez-moi, monsieur, de vous faire observer que la personne charitable qui voudrait nous tirer de l’abîme de contradiction où elle nous croit tombés, tombe elle-même dans une étrange méprise. Son erreur vient d’une confusion que j’ai vraiment peine à m’expliquer.
Il y a, monsieur, trois choses : La question de la protection, celle des douanes et celle de la liberté des échanges.
Dans le passage cité de ma brochure, je montre de mon mieux la nécessité d’un système de protection, et j’indique à quelles conditions, à mon tour, ce système peut être bon. Je cherche à prouver que le système douanier est un détestable procédé de protection ; j’expose enfin un système de protection directe qui remplacerait très-avantageusement, suivant moi, celui des douanes. Ce système, dont l’auteur de l’avis charitable « laisse à part la définition, » tout en protégeant les industries qui, toujours suivant moi, doivent être protégées, satisfait à toutes les conditions de la liberté des échanges, puisqu’il enlève toute entrave à l’introduction des produits étrangers.
Nous reconnaissons donc :
1° La nécessité de protéger le développement de beaucoup d’industries nationales, que la concurrence étrangère anéantirait dans leur marche au travail net ;
2° La barbarie du système douanier, au moyen duquel cette protection s’exerce aujourd’hui ;
3° L’excellence du système qui protégerait efficacement et directement les industries qu’il convient de soutenir, sans arrêter par des entraves de douane à la frontière les produits étrangers.
Vous, monsieur, vous ne voulez pas de protection, et vous ne vous élevez pas contre le système douanier. Vous acceptez les douanes, seulement vous voulez qu’elles fonctionnent comme instrument fiscal jusqu’à 20 p. 100, mais non comme instrument protecteur. Nous, nous voulons la protection ; mais nous ne la voulons pas par des douanes.
Tant que l’on n’entrera pas dans le système de protection directe, nous admettons la douane, en vue de la protection qu’elle exerce. Dès qu’on protégera directement avec une efficacité suffisante, nous demanderons la suppression absolue des douanes, que vous voulez conserver à condition qu’elles ne prélèvent pas plus de 20 p. 100. Vous voyez bien, monsieur, que nous n’avons jamais été d’accord, pas plus en 1840 qu’aujourd’hui.
Nous sommes et nous avons toujours été protectionnistes : vous êtes anti-protectionniste.
Nous trouvons barbare et détestable le système douanier ; nous ne le souffrons que temporairement, provisoirement, comme instrument d’une protection dont vous ne voulez pas, mais à laquelle nous tenons beaucoup. — Vous, vous ne repoussez les douanes qu’autant qu’elles font de la protection au-dessus de 20 p. 100 ; vous les maintenez pour donner des revenus au trésor.
En résumé, nous sommes plus libre-échangistes que vous, puisque nous ne voulons pas même de la douane pour cause de fiscalité ; et nous sommes, en même temps, protectionnistes. Vous, monsieur, et vos amis, vous êtes purement et simplement anti-protectionnistes.
Les choses ainsi rétablies dans leur sincérité, vous reconnaîtrez, je l’espère, monsieur, que si nous ne sommes pas d’accord avec vous, nous avons du moins toujours été parfaitement d’accord avec nous-mêmes.
Agréez, etc.
Victor Considérant.
À MONSIEUR CONSIDÉRANT, DIRECTEUR DE LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE, MEMBRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE.
Monsieur,
Il est certainement à désirer que les hommes sincères, qui ont le malheur de différer d’opinions sur un sujet grave, n’altèrent pas la lettre ou l’esprit de ce qu’il leur convient de citer ; sans quoi le public assiste à un tournoi d’esprit au lieu de prendre une part utile à une discussion qui l’intéresse.
Ainsi, nous aurions tort, si, en citant le passage où vous flétrissez, avec tant de force et de bon sens, la protection par la douane, où vous faites une analyse si complète des dommages sans nombre que ce système inflige au pays, nous avions dissimulé que vous étiez partisan d’une protection directe, d’une distribution de primes et de secours aux industries qu’il importe d’acclimater dans le pays. Mais nous ne sommes pas coupable d’une telle omission. Il suffit, pour s’en assurer, de jeter un coup d’œil sur l’article de notre numéro du 12 décembre, qui a donné lieu à votre réclamation.
D’un autre côté, monsieur, permettez-moi de dire que vous interprétez mal la pensée de notre association, quand vous dites qu’elle veut la douane fiscale. Elle ne la veut pas, mais elle ne l’attaque pas. Elle a cru ne devoir se donner qu’une mission simple et spéciale, qui est de montrer l’injustice et les mauvais effets de la protection. Elle n’a pas pensé qu’elle pût agir efficacement dans ce sens, si elle entreprenait en même temps la refonte de notre système contributif. Chaque membre de notre association réserve son opinion sur la préférence à donner à tel ou tel mode de percevoir l’impôt. Supposez, monsieur, que certains propriétaires des hôtels du faubourg Saint-Honoré ou de la rue de Lille, s’emparant du Conseil municipal de la Seine, où vous ont appelé votre mérite et les suffrages de vos concitoyens, fassent subir à l’octroi un grave changement ; qu’ils fassent voter la prohibition du bois à brûler et des légumes, afin de donner plus de valeur aux jardins de ces hôtels. Est-il donc si difficile de comprendre qu’une association pourrait se former ayant pour but de combattre cette énormité, ce fungus parasite enté sur l’octroi, sans néanmoins demander la suppression de l’octroi lui-même, chaque membre de l’association réservant à cet égard son opinion ? N’est-il pas sensible qu’il y a là deux questions fort différentes ? Supprimer l’octroi, c’est s’engager à supprimer des dépenses ou bien à imaginer d’autres impôts. Cela peut faire naître des opinions fort diverses, parmi des hommes parfaitement d’accord, d’ailleurs, pour repousser l’injustice de messieurs les propriétaires de jardins.
Demander, comme vous le faites, la suppression de la douane, c’est demander la suppression de 160 millions de recettes. Si toutes les dépenses actuelles de l’État sont utiles et légitimes, il faudrait donc que nous indiquassions une autre source de contributions ; et quoique notre Association compte dans son sein des hommes d’une imagination très-fertile, je doute beaucoup qu’ils pussent trouver une nouvelle matière imposable. À cet égard le champ de l’invention est épuisé.
C’est donc à la diminution des dépenses qu’il faudrait avoir recours ; mais s’il y a des dépenses superflues dans notre budget pour 160 millions, à supposer que nous réussissions à les éliminer, la question qui se présenterait est celle-ci : Quels sont les impôts les plus vexatoires, les plus onéreux, les plus inégaux ? car, évidemment, c’est ceux-là qu’il faudrait d’abord supprimer. Or, quels que soient les inconvénients de la douane fiscale, il y a peut-être en France des impôts pires encore ; et quant à moi, je vous avoue que je donne la préférence (j’entends préférence d’antipathie) à l’octroi et à l’impôt des boissons tel qu’il est établi.
Nous comprenons que l’État soit réduit à restreindre la liberté, la propriété, l’échange dans un but légitime, tel qu’est la perception de l’impôt. Ce que nous combattons, c’est la restriction pour la restriction, en vue d’avantages qu’on suppose à la restriction même. Évidemment, quand on prohibe le drap étranger, non-seulement sans profit pour le fisc, mais aux dépens du fisc, c’est qu’on se figure que la prohibition en elle-même a plus d’avantages que d’inconvénients.
J’arrive à la protection directe. Mais avant, permettez-moi encore une réflexion.
Vous proposez de supprimer la douane, c’est-à-dire de priver le trésor d’une recette de 160 millions. En même temps vous voulez que le trésor fasse des largesses à l’industrie, et apparemment ces largesses ne seront pas petites, car, pour peu que vous ne mettiez pas de côté l’agriculture, comme il y a plus de 2 millions de propriétaires en France, à 50 fr. chacun, cela passera vite cent millions.
Monsieur, il est par trop facile de mettre la popularité de son côté, et de s’attirer les préventions bienveillantes du public inattentif quand on vient lui dire : « Je vais commencer par te dégrever de toutes les taxes, et quand j’aurai mis le trésor à sec, j’en tirerai encore de grosses sommes pour en faire une distribution gratuite. »
Ce langage peut flatter la cupidité ; mais est-il sérieux ? Dans votre système, je vois bien qui puise au trésor, mais je ne vois pas qui l’alimente. (V. tome IV, pages 327 à 329.)
Vous croyez indispensable que l’État favorise, par des largesses, certaines industries afin qu’elles se développent. Mais d’où l’État tirera-t-il de quoi faire ces largesses ? C’est ce que vous ne dites pas. Du contribuable ? Mais c’est lui que vous prétendez soulager.
Ensuite, quelles sont les industries qu’il faudra soutenir aux dépens du public ? Apparemment celles qui donnent de la perte. Car vous ne voulez pas sans doute que l’État prenne de l’argent dans la poche du menuisier, du maçon, du charpentier, de l’artisan, de l’ouvrier, pour le distribuer aux gens dont l’industrie prospère, aux maîtres de forges, aux actionnaires d’Anzin, etc.
Mais alors, ces industries ruineuses (devenues lucratives par des largesses du public), je vous demanderai avec quoi elles se développeront. Avec du capital, sans doute. Et d’où sortira ce capital ? Des autres canaux de l’industrie où il gagnait sans mettre la main au budget. Ce que vous proposez revient donc à ceci : Décourager les bonnes industries pour encourager les mauvaises ; faire sortir le capital d’une carrière où il s’accroît pour le faire entrer dans une voie où il se détruit, et faire supporter la destruction, non par l’industriel maladroit et malavisé, mais par le contribuable.
N’est-ce pas exactement les mêmes injustices, les mêmes désastres que vous reprochez avec tant de vigueur à la protection indirecte, quand vous dites : « Chose incroyable que les industries vigoureuses soient toutes immolées aux industries débiles, rachitiques ou parasites ! »
Entre la protection directe et la protection indirecte, la similitude est telle, quant aux effets, que souvent nous avons cru démasquer celle-ci en exposant celle-là. Permettez-moi de vous rappeler ce que j’en ai dit moi-même dans un petit volume intitulé : Sophismes économiques. Ce passage commence ainsi (V. tome IV, pages 49 et suiv.) :
« Il me semble que la protection, sans changer de nature et d’effets, aurait pu prendre la forme d’une taxe directe prélevée par l’État et distribuée en primes indemnitaires aux industries privilégiées. »
Et, après avoir analysé les effets de ce mode de protection, j’ajoute :
« J’avoue franchement ma prédilection pour le second système (la protection directe). Il me semble plus juste, plus économique et plus loyal. Plus juste, car si la société veut faire des largesses à quelques-uns de ses membres, il faut que tous y contribuent ; plus économique, parce qu’il épargnerait beaucoup de frais de perception et ferait disparaître beaucoup d’entraves ; plus loyal, enfin, parce que le public verrait clair dans l’opération et saurait ce qu’on lui fait faire. »
Vous voyez, monsieur, que je n’ai pas attendu la lettre dont vous avez bien voulu m’honorer pour reconnaître tous les mérites de la protection directe.
Oui, comme vous, et par d’autres motifs, il me tarde qu’on nous prenne notre argent sous une forme qui nous permette de voir où il passe. Il me tarde que chacun de nous puisse lire sur son bulletin de contribution à combien se monte la redevance que nous imposent MM. tels ou tels [1].
Veuillez recevoir, monsieur, l’expression de mes sentiments de considération et d’estime.
Frédéric Bastiat.
FN:V. au tome V, la note de la page 483. (Note de l’éditeur.)
Books and Printed Pamphlets - 1847↩
- Frédéric Bastiat, *Le Petit Arsenal du libre-échange* (impr. de E. Crugy, 1847)
[see essay]
1848
Correspondence↩
[CW1.85] [OC1] 85. Paris, 5 janvier 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, écrivant à Domenger, je profite de l’occasion uniquement pour te souhaiter une meilleure année que les précédentes.
J’ai honte de faire paraître mon second volume des Sophismes ; ce n’est qu’un ramassis de ce qui a paru déjà dans les journaux. Il faudra un troisième volume pour me relever ; j’en ai les matériaux informes.
Mais je tiendrais bien autrement à publier le cours que je fais à la jeunesse des écoles. Malheureusement je n’ai que le temps de jeter quelques notes sur le papier. J’en enrage, car je puis te le dire à loi, et d’ailleurs tu le sais, nous voyons l’économie politique sous un jour un peu nouveau. Quelque chose me dit qu’elle peut être simplifiée et plus rattachée à la politique et à la morale.
Adieu, je te quitte, je suis réduit à compter les minutes.
[CW1.86] [OC7] 86. Paris, 17 janvier 1848. A Madame Schwabe↩
Madame,
J’apprends avec bien du plaisir que M. Schwabe a fait un heureux voyage et qu’il a trouvé la situation de l’Angleterre en voie d’amélioration. Je vous remercie d’avoir songé à m’envoyer le Punch. J’y trouverai peut-être quelque chose pour le Libre-Échange, après quoi je le ferai passer à M. Anisson, ou vous le reporterai moi-même.
Voici cinq numéros du dernier Libre-Échange. J’ai fait le premier article sur les armements, dans l’espoir qu’il peut exercer quelque influence en Angleterre. Il m’est donc bien agréable d’apprendre que vous vous chargez de l’y faire parvenir.
[CW1.87] [OC1] 87. Paris, 24 janvier 1848. A Félix Coudroy↩
Je ne puis t’écrire que peu de mots, car je me trouve atteint de la même maladie que j’ai eue à Mugron, et qui, entre autres désagréments, a celui de priver de toutes forces. Il m’est impossible de penser, encore plus d’écrire.
Mon ami, je voudrais bien te parler de notre agitation, mais je ne le puis pas. Je ne suis pas du tout content de notre journal, il est faible et pâle comme tout ce qui émane d’une association. Je vais demander le pouvoir absolu, mais hélas ! avec le pouvoir on ne me donnera pas la santé.
Je ne reçois pas le Mémorial (bordelais), et par conséquent je n’ai pas vu ton article Anglophobie ; je le regrette. J’y aurais peut-être puisé quelques idées, ou nous l’aurions reproduit.
[CW1.88] [OC7] 88. Paris, 27 janvier 1848. A Madame Schwabe↩
Je vous prie d’agréer l’hommage d’un petit volume que je viens de faire paraître. C’est bien peu de chose ; il ne contient que la reproduction de quelques plaisanteries déjà publiées dans les journaux. On m’assure que cette forme superficielle a son genre d’utilité. C’est ce qui m’a décidé à persister dans cette voie qui n’est nullement de mon goût [1].
FN:Il s’agit de la deuxième série des Sophismes économiques. (Note de l’éditeur.)
[CW1.89] [OC1] 89. Paris, 13 février 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, je n’ai aucune de tes nouvelles, je ne sais où tu en es de ton procès ; je présume que l’arrêt n’est pas rendu, car tu me l’aurais fait savoir. Dieu veuille que la cour soit bien inspirée ! Plus je pense à cette affaire, plus il me semble que les juges ne peuvent conjecturer contre le droit commun ; dans le doute, l’éternelle loi de la justice (et même le Code) doit prévaloir.
La politique étouffe un peu notre affaire ; d’ailleurs il y a une conspiration du silence bien flagrante, elle a commencé avec notre journal. Si j’avais pu prévoir cela, je ne l’aurais pas fondé. Des raisons de santé m’ont forcé d’abandonner la direction de cette feuille. Je ne m’en occupais pas d’ailleurs avec plaisir, vu que le petit nombre de nos lecteurs, et la divergence des opinions politiques de nos collègues, ne me permettaient pas d’imprimer au journal une direction suffisamment démocratique ; il fallait laisser dans l’ombre les plus beaux aspects de la question.
Si le nombre des abonnés eût été plus grand, j’aurais pu faire de cette feuille ma propriété ; mais l’état de l’opinion s’y oppose, et puis ma santé est un obstacle invincible. Maintenant je pourrai travailler un peu plus capricieusement.
Je fais mon cours aux élèves de droit. Les auditeurs ne sont pas très-nombreux, mais ils viennent assidûment, et prennent des notes ; la semence tombe en bon terrain. J’aurais voulu pouvoir écrire ce cours, mais je ne laisserai probablement que des notes confuses.
Adieu, mon cher Félix, écris-moi, dis-moi où tu en es de tes affaires et de ta santé, il n’est pas impossible que j’aille vous voir avant longtemps ; mes souvenirs affectueux à ta bonne sœur.
[CW1.90] [OC7] 90. Paris, 16 février 1848. A Madame Schwabe↩
Je suis bien reconnaissant de toutes les bontés dont vous m’accablez. J’ai reçu vos excellents sirops qui achèveront ma guérison. J’espère aussi aller ce soir au concert, mais un peu tard, car je dîne chez M. de Lamartine, et vous comprenez qu’il en coûte de quitter la musique de sa parole même pour celle de Chopin. Cependant, comme le concert commence tard, je m’arracherai au charme de la conversation de notre grand poëte.
[CW1.91] [OC1] 91. Paris, 25 février 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher Cobden, vous savez déjà nos événements. Hier nous étions une monarchie, aujourd’hui nous sommes une république.
Je n’ai pas le temps de raconter, je veux seulement vous soumettre un point de vue de la plus haute importance.
La France veut la paix et en a besoin. Ses dépenses vont s’accroître, ses recettes s’affaiblir et son budget est déjà en déficit. Donc, il lui faut la paix et la réduction de son état militaire.
Sans cette réduction, pas d’économie sérieuse possible, par conséquent pas de réforme financière, pas d’abolition de taxes odieuses. — Et sans cela, la révolution se dépopularise.
Or, la France, vous le comprendrez, ne peut pas prendre l’initiative du désarmement. Il serait absurde de le lui demander.
Voyez les conséquences. Ne désarmant pas, elle ne peut rien réformer, et ne réformant rien, ses finances la tuent.
Le seul fait que l’étranger conserve ses forces nous réduit donc à périr. Or, nous ne voulons pas périr. Donc, si les nations étrangères ne nous mettent pas à même de désarmer en désarmant elles-mêmes, s’il nous faut tenir trois ou quatre cent mille hommes sur pied, nous serons entraînés à la guerre de propagande. C’est forcé. Car alors, le seul moyen d’arriver à respirer, chez nous, sera de créer des embarras à tous les rois de l’Europe.
Si donc l’étranger comprend notre situation et ses dangers, il n’hésitera pas à nous donner cette preuve de confiance de désarmer sérieusement. Par là, il nous mettra à même d’en faire autant, de rétablir nos finances, de soulager le peuple, d’accomplir l’œuvre qui nous est dévolue.
Si, au contraire, l’étranger juge prudent de rester armé, je n’hésite pas à dire que cette prétendue prudence est de la plus haute imprudence, car elle nous réduira à l’extrémité que je viens de vous dire.
Plaise au ciel que l’Angleterre comprenne et fasse comprendre ! Elle sauverait l’avenir de l’Europe. Que si elle consulte les traditions de la vieille politique, je vous défie bien de me dire comment nous pourrons échapper aux conséquences.
Méditez cette lettre, cher Cobden, pesez-en toutes les expressions. Voyez par vous-même si tout ce que je vous dis n’est pas inévitable.
Si vous restez armés, nous restons armés sans mauvaise intention. Mais restant armés, nous succomberons sous le poids de taxes impopulaires. Aucun gouvernement n’y pourra tenir. Ils auront beau se succéder, ils rencontreront tous la même difficulté ; et un jour viendra où l’on dira : Puisque nous ne pouvons renvoyer l’armée dans ses foyers, il faut l’envoyer soulever les peuples.
Si vous désarmez dans une forte proportion, si vous vous unissez fortement à nous pour conseiller à la Prusse la même politique, à cette condition, une ère nouvelle peut surgir et surgira du 24 février.
[CW1.92] [OC1] 92. Paris, 26 février 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher Cobden, je donnerais beaucoup d’argent (si j’en avais), pour voir un moment M. de Lamartine notre ministre des Affaires étrangères. Mais je ne puis arriver à lui.
Je voudrais aller à Londres, mais non sans l’avoir vu, parce qu’il faut bien lui soumettre les idées que j’aurais à vous communiquer.
L’Angleterre peut faire un bien immense, sans se nuire le moins du monde. Elle peut substituer chez nous l’attachement sincère à de funestes préventions. Elle n’a qu’à le vouloir. Par exemple, pourquoi ne ferait-elle pas cesser spontanément sa sourde opposition à notre triste conquête algérienne ? Pourquoi ne ferait-elle pas cesser spontanément les dangers qui naissent du droit de visite ? Pourquoi laisser s’enraciner chez nous l’idée qu’elle veut nous humilier ? Pourquoi attendre que les circonstances enveniment ces affaires ? Quel magnifique spectacle si l’Angleterre disait : « Quand la France aura choisi un gouvernement, l’Angleterre s’empressera de le reconnaître, et, pour preuve de sa sympathie, elle reconnaîtra aussi l’Algérie comme française, et renoncera au droit de visite dont elle aperçoit du reste l’inefficacité et les inconvénients ! »
Dites-moi, mon cher Cobden, ce que de tels actes coûteraient à votre pays, s’ils étaient faits, comme je le dis, spontanément ? [unilaterally??]
Ici nous ne pouvons pas tirer de l’idée des Français que l’Angleterre convoite l’Algérie. C’est absurde ; mais les apparences y sont.
Nous ne pouvons pas effacer des esprits la pensée que le droit de visite entre dans votre politique. C’est encore absurde ; mais les apparences y sont.
Au nom de la paix et de l’humanité, provoquez ces grandes mesures ! Faisons donc une fois de la diplomatie populaire, et faisons-la en temps utile.
Écrivez-moi ; dites-moi franchement si un voyage à Londres, entrepris dans ces vues, sous les auspices de M. de Lamartine, aurait quelques chances d’amener un résultat. Je lui montrerai votre lettre.
[CW1.93] [JCPD] 93. Paris, 27 février 1848. A Madame Marsan [missing French]↩
[CW1.94] [OC1] 94. Paris, 29 février 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, malgré les conditions mesquines et ridicules qui te sont faites, je te féliciterai de bon cœur si tu arrives à un arrangement. Nous nous faisons vieux ; un peu de paix et de calme, dans l’arrière-saison, voilà le bien auquel il faut prétendre.
Puisque aussi bien, mon bon ami, je ne puis te donner ni conseils ni consolations sur ce triste dénoûment, tu ne seras pas surpris que je te parle de suite des grands événements qui viennent de s’accomplir.
La révolution de février a été certainement plus héroïque que celle de juillet ; rien d’admirable comme le courage, l’ordre, le calme, la modération de la population parisienne. Mais quelles en seront les suites ? Depuis dix ans, de fausses doctrines, fort en vogue, nourrissent les classes laborieuses d’absurdes illusions. Elles sont maintenant convaincues que l’État est obligé de donner du pain, du travail, de l’instruction à tout le monde. Le gouvernement provisoire en a fait la promesse solennelle ; il sera donc forcé de renforcer tous les impôts pour essayer de tenir cette promesse, et, malgré cela, il ne la tiendra pas. Je n’ai pas besoin de te dire l’avenir que cela nous prépare.
Il y aurait une ressource, ce serait de combattre l’erreur elle-même, mais cette tâche est si impopulaire qu’on ne peut la remplir sans danger ; je suis pourtant résolu de m’y dévouer si le pays m’envoie à l’assemblée nationale.
Il est évident que toutes ces promesses aboutiront à ruiner la province pour satisfaire la population de Paris ; car le gouvernement n’entreprendra jamais de nourrir tous les métayers, ouvriers et artisans des départements, et surtout des campagnes. Si notre pays comprend la situation, il me nommera, je le dis franchement, sinon je remplirai mon devoir avec plus de sécurité comme simple écrivain.
La curée des places est commencée, plusieurs de mes amis sont tout-puissants ; quelques-uns devraient comprendre que mes études spéciales pourraient être utilisées ; mais je n’entends pas parler d’eux. Quant à moi, je ne mettrai les pieds à l’Hôtel de ville que comme curieux ; je regarderai le mât de cocagne, je n’y monterai pas. Pauvre peuple ! que de déceptions on lui a préparées ! Il était si simple et si juste de le soulager par la diminution des taxes ; on veut le faire par la profusion, et il ne voit pas que tout le mécanisme consiste à lui prendre dix pour lui donner huit, sans compter la liberté réelle qui succombera à l’opération !
J’ai essayé de jeter ces idées dans la rue par un journal éphémère qui est né de la circonstance ; croirais-tu que les ouvriers imprimeurs eux-mêmes discutent et désapprouvent l’entreprise ! ils la disent contre-révolutionnaire.
Comment, comment lutter contre une école qui a la force en main et qui promet le bonheur parfait à tout le monde ?
Ami, si l’on me disait : Tu vas faire prévaloir ton idée aujourd’hui, et demain tu mourras dans l’obscurité, j’accepterais de suite ; mais lutter sans chance, sans être même écouté, quelle rude tâche !
Il y a plus, l’ordre et la confiance étant l’intérêt suprême du moment, il faut s’abstenir de toute critique et appuyer le gouvernement provisoire à tout prix, en le ménageant même dans ses erreurs. C’est un devoir qui me force à des ménagements infinis.
Adieu, les élections sont prochaines, nous nous verrons alors ; en attendant, dis-moi si tu remarques quelques bonnes dispositions en ma faveur.
[CW1.95] [OC7] 95. Paris, 4 mars 1848. A M. Domenger, à Mugron↩
Mon cher Domenger,
Vous avez bien raison de conserver votre calme. Outre que nous en aurons tous besoin, il faudrait que la tempête fût bien furieuse pour qu’elle se fît ressentir a Mugron. Jusqu’ici Paris jouit de la tranquillité la plus parfaite, et ce spectacle est, à mes yeux, bien autrement imposant que celui du courage dans la lutte. Nous venons d’assister à la cérémonie funèbre. Il me semble que tout l’univers était sur les boulevards. Je n’ai jamais vu tant de monde. Je dois dire que la population m’a paru sympathique mais froide. On ne peut lui arracher des cris d’enthousiasme. Cela vaut peut-être mieux, et semble prouver que le temps et l’expérience nous ont mûris. Les manifestations emportées ne sont-elles pas plutôt un obstacle à la bonne direction des affaires ?
Le côté politique de l’avenir occupe peu les esprits. Il semble que le suffrage universel et les autres droits populaires sont tellement dans le consentement unanime qu’on n’y pense pas. Mais ce qui assombrit notre perspective, ce sont les questions économiques. À cet égard l’ignorance est si profonde et si générale que l’on a redouter de rudes expériences. L’idée qu’il y a une combinaison encore inconnue, mais facile à trouver, qui doit assurer le bien-être de tous en diminuant le travail, voilà ce qui domine. Comme elle est décorée des beaux noms de fraternité, de générosité, etc., personne n’ose attaquer ces folles illusions. D’ailleurs, on ne le saurait pas. On a bien instinctivement la crainte des conséquences que peuvent entraîner les espérances exagérées de la classe laborieuse ; mais de là à être en état de formuler la vérité, il y a bien loin. Pour moi, je persiste à penser que le sort des ouvriers dépend de la rapidité avec laquelle le capital se forme. Tout ce qui, directement ou indirectement, porte atteinte à la propriété, ébranle la confiance, nuit à la sécurité, est un obstacle à la formation du capital et retombe sur la classe ouvrière. Il en est de même de toutes taxes, entraves et vexations gouvernementales. Que faut-il donc penser des systèmes en vogue aujourd’hui, qui ont tous ces inconvénients à la fois ? Comme écrivain, ou dans une autre situation, si mes concitoyens m’y appellent, je défendrai jusqu’au dernier moment mes principes. La révolution actuelle n’y change rien, non plus qu’à ma ligne de conduite.
Ne parlons plus du propos attribué à F…. C’est bien loin derrière nous. Franchement, ce système factice ne pouvait se soutenir. J’espère qu’on sera satisfait des choix faits dans notre département. Lefranc est un brave et honnête républicain, incapable de tourmenter qui que ce soit, à moins de graves et justes motifs.
[CW1.96] [OC1] 96. Mugron, 5 avril 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher ami, me voici dans ma solitude. Que ne puis-je m’y ensevelir pour toujours, et y travailler paisiblement à celle synthèse économique, que j’ai dans la tête et qui n’en sortira jamais ! — Car, à moins d’un revirement subit dans l’opinion du pays, je vais être envoyé à Paris chargé du terrible mandat de Représentant du Peuple. Si j’avais de la force et de la santé, j’accepterais cette mission avec enthousiasme. Mais que pourront ma faible voix, mon organisation maladive et nerveuse au milieu des tempêtes révolutionnaires ? Combien il eût été plus sage de consacrer mes derniers jours à creuser, dans le silence, le grand problème de la destinée sociale ; d’autant que quelque chose me dit que je serais arrivé à la solution. Pauvre village, humble toit de mes pères, je vais vous dire un éternel adieu ; je vais vous quitter avec le pressentiment que mon nom et ma vie, perdus au sein des orages, n’auront pas même cette modeste utilité pour laquelle vous m’aviez préparé !…
Mon ami, je suis trop loin du théâtre des événements pour vous en parler. Vous les apprenez avant moi ; et au moment où j’écris, peut-être les faits sur lesquels je pourrais raisonner sont-ils de l’histoire ancienne. Si le gouvernement déchu nous avait laissé les finances en bon ordre, j’aurais une foi entière dans l’avenir de la République. Malheureusement le trésor public est écrasé, et je sais assez l’histoire de notre première révolution pour connaître l’influence du délabrement des finances sur les événements. Une mesure urgente entraîne une mesure arbitraire ; et c’est là surtout que la fatalité exerce son empire. Maintenant, le peuple est admirable ; et vous seriez surpris de voir comme le suffrage universel fonctionne bien dès son début. Mais qu’arrivera-t-il quand les impôts, au lieu d’être diminués, seront aggravés, quand l’ouvrage manquera, quand aux plus brillantes espérances succéderont d’amères réalités ? J’avais aperçu une planche de salut, sur laquelle il est vrai je ne comptais guère, car elle supposait de la sagesse et de la prudence dans les rois ; c’était le désarmement simultané de l’Europe. Alors les finances eussent été partout rétablies, les peuples soulagés et rattachés à l’ordre ; l’industrie se serait développée, le travail eût abondé et les peuples eussent attendu avec calme le développement progressif des institutions. Les monarques ont préféré jouer leur va-tout, ou plutôt ils n’ont pas su lire dans le présent et dans l’avenir. Ils pressent un ressort, sans comprendre qu’à mesure que leur force s’épuise celle du ressort augmente.
Supposez qu’ils aient partout désarmé et dégrevé d’autant les impôts, en outre accordé aux nations des institutions d’ailleurs inévitables. La France obérée se fût hâtée d’en faire autant, trop heureuse de pouvoir fonder la République sur la solide base du soulagement réel des souffrances populaires. Le calme et le progrès se fussent donné la main. — Mais le contraire est arrivé. Partout on arme, partout on accroît les dépenses publiques, et les impôts et les entraves, quand les impôts existants sont précisément la cause des révolutions. Tout cela ne finira-t-il pas par une terrible explosion ?
Quoi donc ! la justice est-elle si difficile à pratiquer, la prudence si difficile à comprendre ?
Depuis que je suis ici, je ne vois pas de journaux anglais. Je ne sais rien de ce qui se passe dans votre parlement. J’aurais espéré que l’Angleterre prendrait l’initiative de la politique rationnelle, et qu’elle la prendrait avec cette hardiesse vigoureuse dont elle a donné tant d’exemples. J’aurais espéré qu’elle eût voulu to teach mankind how to live : désarmer, désarmer, abandonner les colonies onéreuses, cesser d’être menaçante, se mettre dans l’impossibilité d’être menacée, supprimer les taxes impopulaires et présenter au monde un beau spectacle d’union, de force, de sagesse, de justice et de sécurité. Mais hélas ! l’Économie politique n’a pas encore assez pénétré les masses, même chez vous.
[CW1.97] [OC7] 97. Mugron, 12 avril 1848. A Horace Say↩
Mon cher ami, je cherche toujours votre nom dans les journaux, mais ils ne s’occupent pas encore d’élections. Il est probable que les clubs leur taillent trop de besogne. Je ne puis m’expliquer que comme cela le silence de la presse parisienne. Peut-être le théâtre de Paris est-il trop agité pour vos habitudes et votre caractère. Je regrette maintenant que vous n’ayez pas songé à aller vous installer dans quelque département. Les folies socialistes y ont excité une telle frayeur qu’à cause de vos précédents bien connus, vous auriez eu là de belles chances. Votre candidature a l’avantage de vous fournir l’occasion de répandre les saines idées. C’est beaucoup, mais ce n’est pas assez pour notre cause. Tentez donc un effort suprême, mettez de côté pour quelques jours votre réserve habituelle, faites de l’agitation, enfin ne négligez rien pour arriver à l’Assemblée constituante. Le salut du pays, je le crois sincèrement, tient à ce que nos principes aient la majorité.
S’il n’y a pas de changement dans l’état de l’opinion ici, mon élection est assurée. Je crois même que j’aurai l’universalité des suffrages, sauf ceux de quelques marchands de résine, effrayés par la liberté du commerce.
Tous les comités cantonaux me portent.
Dimanche prochain, nous avons une réunion générale et centrale. Il faudrait que je fisse un fiasco bien complet pour changer les dispositions des électeurs à mon égard.
Un fait bien étrange, c’est l’ignorance où l’on est dans ce pays, sur les doctrines socialistes. On a horreur du communisme. Mais on ne voit dans le communisme que le partage des terres. Dimanche dernier, dans une nombreuse assemblée publique, pour avoir dit que ce n’était pas sous cette forme que le communisme nous menaçait, on commençait à murmurer. On avait l’air de conclure de ces paroles que je n’étais que fort tièdement opposé à ce communisme-là. La suite de mon discours a effacé cette impression. Vraiment c’est bien dangereux de parler devant un public si peu au courant. On risque de n’être pas compris…
Je vous avoue que l’avenir m’inquiète beaucoup. Comment l’industrie pourra-t-elle reprendre, quand il est admis en principe que le domaine des décrets est illimité ? Quand chaque minute, un décret sur les salaires, sur les heures de travail, sur le prix des choses, etc., peut déranger toutes les combinaisons ?
Adieu, mon cher M. Say, veuillez me rappeler au souvenir de madame Say et de M. Léon.
P. S. La réunion centrale des délégués a eu lieu hier : je ne sais pourquoi elle a été avancée. Après avoir répondu aux questions, je me suis retiré, et ce matin j’apprends que j’ai eu tous les suffrages moins deux. Ayant oublié de jeter ma lettre à la poste avant de partir, je la rouvre pour vous faire part de ce résultat qui peut vous être agréable. Tentez un suprême effort, mon cher ami, pour que l’économie politique, morte au collége de France, [124] soit représentée à la chambre par M. Say. Honte au pays, s’il exclut un tel nom aussi dignement porté !
[CW1.98] [OC1] 98. Paris, 11 mai 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher Cobden, il ne m’est pas possible de vous écrire longuement. D’ailleurs, que vous dirais-je ? Comment prévoir ce qui sortira du sein d’une assemblée de 900 personnes, qui ne sont contenues par aucune règle, par aucun précédent ; qui ne se connaissent pas entre elles ; qui sont sous l’empire de tant d’erreurs ; qui ont à satisfaire tant d’espérances justes ou chimériques, et qui pourtant peuvent à peine s’entendre et délibérer, à cause de leur nombre et de l’immensité de la salle ? Ce que je puis dire, c’est que l’assemblée nationale a de bonnes intentions. L’esprit démocratique y domine. Je voudrais pouvoir en dire autant de l’esprit de paix et de non-intervention. Nous le saurons lundi. C’est ce jour-là qu’on a fixé pour la conversation sur la Pologne et l’Italie.
En attendant j’aborde de suite le sujet de ma lettre.
Vous savez qu’une commission de travailleurs se réunissait au Luxembourg, sous la présidence de L. Blanc. L’assemblée nationale l’a dispersée par sa présence ; mais elle s’est hâtée de fonder, dans son propre sein, une commission chargée de faire une enquête sur la situation des travailleurs industriels et agricoles, ainsi que de proposer les moyens d’améliorer leur sort.
C’est une œuvre immense, et que les illusions qui ont cours rendent périlleuse.
Je suis appelé à faire partie de cette commission. J’ai été nommé loyalement, après avoir exposé mes doctrines sans réticences, mais en les considérant surtout au point de vue du droit de propriété. Ce que j’ai dit et qui m’a valu d’être nommé, je le reproduis, sous forme d’un article intitulé : Loi et propriété, qui paraîtra dans le prochain numéro du Journal des Économistes. Je vous prie de le lire. [125]
Maintenant, je voudrais faire servir cette enquête à faire jaillir la vérité. Que je me trompe ou non, c’est la vérité qu’il nous faut. — Nous n’avons pas en France une grande expérience de cette machinery qu’on nomme enquêtes palementaires. Connaîtriez-vous quelque ouvrage où soit exposé l’art de les conduire de manière à dégager la vérité ? Si vous en connaissez, ayez la bonté de me le signaler, ou mieux encore de me le faire envoyer.
Les préventions antibritanniques sont encore loin d’être éteintes ici. On pense que les Anglais s’appliquent à contrarier, sur le continent, la politique franco-républicaine ; et cela ne m’étonnerait pas de la part de votre aristocratie. Aussi je suivrai avec un vif intérêt votre nouvelle agitation, en faveur des réformes politiques et économiques qui peuvent diminuer l’influence au dehors de la Squirarchy.
[CW1.99] [OC7] 99. Paris, 17 mai 1848. A Madame Schwabe↩
Vous devez me trouver bien peu Français de tarder autant à vous remercier, ainsi que votre mari, de tant de témoignages d’affection que vous m’avez prodigués tous les deux pendant votre séjour à Paris. Ce n’est certainement pas que je les oublie, le souvenir ne s’en effacera jamais de mon cœur ; mais vous savez que je suis allé dans mes chères Pyrénées. D’un autre côté, je ne savais où adresser mes lettres ; celle-ci va suivre l’impulsion du hasard.
L’Assemblée nationale est réunie. Que sortira-t-il de cette fournaise ardente ? la paix ou la guerre ? le bonheur ou le malheur de l’humanité ? Jusqu’à présent elle est comme un enfant qui bégaye avant de parler. Figurez-vous une enceinte vaste comme la place de la Concorde. Là, neuf cents membres délibérants et trois mille spectateurs. Pour avoir la chance de se faire entendre et comprendre, il faut pousser des cris aigus accompagnés de gestes télégraphiques, ce qui ne tarde pas à déterminer, chez l’orateur, une explosion de colère sans motif. Voilà comment nous procédons à notre organisation intérieure. Cela absorbe beaucoup de temps, et le public n’a pas le bon sens de comprendre que cette perte de temps est inévitable.
Les journaux vous ont appris les événements du 15. L’Assemblée a été envahie par les masses populaires. Une manifestation en faveur de la Pologne a été le prétexte. Pendant quatre heures, elles ont essayé de nous arracher les votes les plus subversifs. L’Assemblée a supporté cette tempête avec calme, et, pour rendre justice à notre population et à notre siècle, je dois dire que nous n’avons pas à nous plaindre de violence personnelle. Cet attentat a eu pour résultat de faire connaître les vœux du pays tout entier. Il permet au pouvoir exécutif de prendre des mesures de prudence auxquelles il ne pouvait avoir recours en l’absence de toute provocation. Il est fort heureux que les choses aient été poussées aussi loin. Sans cela les projets des factieux n’auraient jamais été bien constatés. Leur hypocrisie leur faisait des partisans. Ils n’en ont plus ; ils se sont démasqués ; encore une fois le doigt de la Providence s’est montré. Il y avait dix mille chances pour que les choses ne tournassent pas aussi bien.
Je présume que vous voyez madame Cobden. Je vous prie de lui exprimer les sentiments d’admiration que j’ai conçus pour elle, d’après tout ce que vous m’en avez dit.
Adieu, Madame, ne me donnerez-vous pas quelque espoir que nous nous reverrons encore ? Vos enfants ne savent pas assez de français, et l’une d’entre elle est citoyenne et républicaine [1]. Il faudra bien lui faire respirer l’air de la patrie.
Je serre bien affectueusement la main à M. Schwabe.
FN:Une des filles de madame Schwabe, née à Paris, peu après la révolution
de février.(Note de l’éditeur.)
[CW1.100] [OC1] 100. Paris, 27 mai 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher Cobden, je vous remercie de m’avoir procuré l’occasion de faire la connaissance de M. Baines. Je regrette seulement de n’avoir pu m’entretenir qu’un instant avec un homme aussi distingué.
Pardonnez-moi de vous avoir donné la peine de m’écrire au sujet des enquêtes et de leur forme. J’ai déserté notre comité du travail pour celui des finances. C’est là en définitive que viendront aboutir toutes les questions et même toutes les utopies. À moins que le pays ne renonce à l’usage de la raison, il faudra bien qu’il subordonne aux finances, même sa politique extérieure, dans une certaine mesure. Puissions-nous faire triompher la politique de la paix ! Pour moi, je suis convaincu qu’après la guerre immédiate, rien n’est plus funeste à ma patrie que le système inauguré par notre gouvernement, et qu’il a appelé diplomatie armée. À quelque point de vue qu’on le considère, un tel système est injuste, faux et ruineux. Je me désole quand je songe que quelques simples notions d’économie politique suffiraient pour le dépopulariser en France. Mais comment y parvenir, quand l’immense majorité croit que les intérêts des peuples, et même les intérêts en général, sont radicalement et naturellement antagoniques ? Il faut attendre que ce préjugé disparaisse, et ce sera long. Pour ce qui me concerne, rien ne peut m’ôter de l’idée que mon rôle était d’être publiciste campagnard comme autrefois, ou tout au plus professeur. Je ne suis pas né à une époque où ma place soit sur la scène de la politique active.
Quoi de plus simple, en apparence, que de décider la France et l’Angleterre à s’entendre pour désarmer en même temps ? qu’auraient-elles à craindre ? combien de difficultés réelles, imminentes, pressantes, ne se mettraient-elles pas à même de résoudre ! combien d’impôts à réformer ! que de souffrances à soulager ! que d’affections populaires à conquérir ! que de troubles et de révolutions à éloigner ! Et cependant, nous n’y parviendrons pas. L’impossibilité matérielle de recouvrer l’impôt ne suffira pas, chez vous ni chez nous, pour faire adopter un désarmement, d’ailleurs indiqué par la plus simple prudence.
Cependant je dois dire que j’ai été agréablement surpris de trouver dans notre comité, composé de soixante membres, [126] les meilleures dispositions. Dieu veuille que l’esprit qui l’anime se répande d’abord sur l’assemblée et de là sur le public. Mais hélas ! sur quinze comités, il y en a un qui, chargé des voies et moyens, est arrivé à des idées de paix et d’économies. Les autres quatorze comités ne s’occupent que de projets qui, tous, entraînent des dépenses nouvelles, — résistera-t-il au torrent ?
Je crois qu’en ce moment vous avez près de vous madame Cobden, ainsi que M. et madame Schwabe — je vous prie de leur présenter mes civilités affectueuses. Depuis le départ de M. Schwabe, les Champs-Elysées me semblent un désert ; avant je les trouvais bien nommés.
[CW1.101] [OC1] 101. Paris, 9 juin 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, j’ai été en effet bien longtemps sans t’écrire, et il faut me le pardonner, car je ne sais plus où donner de la tête. Voici ma vie : je me lève à six heures ; s’habiller, se raser, déjeuner, parcourir les journaux, cela tient jusqu’à sept heures et sept heures et demie. Vers neuf heures, il faut que je parte, car à dix heures commence la séance du comité des finances auquel j’appartiens ; il dure jusqu’à une heure, et alors c’est la séance publique qui commence et se prolonge jusqu’à sept. Je rentre pour dîner, et il est bien rare qu’après dîner il n’y ait pas réunion des sous-commissions chargées de questions spéciales.
La seule heure à ma disposition, c’est donc de huit à neuf heures du matin, c’est aussi celle où les visites m’arrivent ; de tout cela il résulte que non-seulement je ne puis faire face à ma correspondance, mais que je ne puis rien étudier, quand, mis enfin en contact avec la pratique des affaires, je m’aperçois que j’ai tout à apprendre.
Aussi je suis profondément dégoûté de ce métier, et ce qui se passe n’est pas propre à me relever. L’assemblée est certainement excellente sous le rapport des intentions, elle a bonne volonté, elle veut faire le bien ; mais elle ne le peut pas, d’abord parce que les principes ne sont pas sus, ensuite parce qu’il n’y a d’initiative nulle part. La commission exécutive s’efface complétement, nul ne sait si les membres qui la composent sont d’accord entre eux, ils ne sortent de leur inertie que pour manifester la plus étrange incohérence de vues. La chambre a beau leur réitérer des preuves de confiance pour les encourager à agir, il semble qu’ils ont le parti pris de nous abandonner à nous-mêmes. Juge ce que peut être une assemblée de neuf cents personnes chargées de délibérer et d’agir, ajoute à cela une salle immense où on ne s’entend pas. Pour avoir voulu dire quelques mots aujourd’hui, je me suis retiré avec un rhume ; c’est ce qui fait que je ne sors pas et que j’écris.
Mais d’autres symptômes sont bien plus effrayants ; l’idée dominante, celle qui a envahi toutes les classes de la société, c’est que l’État est chargé de faire vivre tout le monde. C’est une curée générale à laquelle les ouvriers sont enfin appelés ; on les blâme, on les craint, que font-ils ? Ce qu’ont fait jusqu’ici toutes les classes. Les ouvriers sont mieux fondés ; ils disent : « Du pain contre du travail. » Les monopoleurs étaient et sont encore plus exigeants. Mais enfin où cela nous mènera-t-il ? je tremble d’y penser.
Le comité des finances résiste naturellement, sa mission le rend économe et économiste ; aussi il est déjà tombé dans l’impopularité. « Vous défendez le capital ! » avec ce mot on nous tue, car il faut savoir que le capital passe ici pour un monstre dévorant.
Duprat, loin d’être mort, n’est pas malade.
« Les gens que vous tuez se portent assez bien. »
Dans l’émeute du 15, je n’ai été ni frappé ni menacé ; j’ajouterai même que je n’ai pas éprouvé la plus légère émotion, si ce n’est quand j’ai cru qu’une tribune publique allait s’écrouler sous les pieds des factieux. Le sang aurait ruisselé dans la salle, et alors…
Adieu, mon cher Félix.
[CW1.102] [OC1] 102. Paris, 24 juin 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, les journaux te disent l’état affreux de notre triste capitale. Le canon, la fusillade, voilà le bruit qui domine ; la guerre civile a commencé et avec un tel acharnement que nul ne peut prédire les suites. Si ce spectacle m’afflige comme homme, tu dois penser que j’en souffre aussi comme économiste ; la vraie cause du mal c’est bien le faux socialisme.
Tu t’étonneras peut-être, et beaucoup de personnes s’étonnent ici, de ce que je n’aie pas encore exposé notre doctrine à la tribune. Elles me pardonneraient sans doute si elles jetaient un coup d’œil sur cette immense salle où l’on ne peut pas se faire entendre. Et puis notre assemblée est indisciplinée ; si un seul mot choque quelques membres, même avant que la phrase ne soit finie, un orage éclate. Dans ces conditions tu comprends ma répugnance à parler. J’ai concentré ma faible action dans le comité dont je fais partie (celui des finances), et jusqu’ici ce n’est pas tout à fait sans succès.
Je voudrais pouvoir te fixer sur le dénoûment de la terrible bataille qui se livre autour de nous. Si le parti de l’ordre l’emporte, jusqu’où ira la réaction ? Si c’est le parti de l’émeute, jusqu’où iront ses prétentions ? On frémit d’y penser. S’il s’agissait d’une lutte accidentelle, je ne serais pas découragé. Mais ce qui travaille la société, c’est une erreur manifeste qui ira jusqu’au bout, car elle est plus ou moins partagée par ceux-là mêmes qui en combattent les manifestations exagérées. Puisse la France ne pas devenir une Turquie !
[CW1.103] [OC1] 103. Paris, 27 juin 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher Cobden, vous avez appris l’immense catastrophe qui vient d’affliger la France et qui afflige le monde. Je crois que vous serez bien aise d’avoir de mes nouvelles, mais je n’entrerai pas dans beaucoup de détails. C’est vraiment une chose trop pénible, pour un Français, même pour un Français cosmopolite, d’avoir à raconter ces scènes lugubres à un Anglais.
Permettez-moi donc de laisser à nos journaux le soin de vous apprendre les faits. Je vous dirai quelques mots sur les causes. Selon moi, elles sont toutes dans le socialisme. Depuis longtemps nos gouvernants ont empêché autant qu’ils l’ont pu la diffusion des connaissances économiques. Ils ont fait plus. Par ignorance, ils ont préparé les esprits à recevoir les erreurs du socialisme et du faux républicanisme, car c’est là l’évidente tendance de l’éducation classique et universitaire. La nation s’est engouée de l’idée qu’on pouvait faire de la fraternité avec la loi. — On a exigé de l’État qu’il fit directement le bonheur des citoyens. Mais qu’est-il arrivé ? En vertu des penchants naturels du cœur humain, chacun s’est mis à réclamer pour soi, de l’État, une plus grande part de bien-être. C’est-à-dire que l’État ou le trésor public a été mis au pillage. Toutes les classes ont demandé à l’État, comme en vertu d’un droit, des moyens d’existence. Les efforts faits dans ce sens par l’État n’ont abouti qu’à des impôts et des entraves, et à l’augmentation de la misère ; et alors les exigences du peuple sont devenues plus impérieuses. — À mes yeux, le régime protecteur a été la première manifestation de ce désordre. Les propriétaires, les agriculteurs, les manufacturiers, les armateurs ont invoqué l’intervention de la loi pour accroître leur part de richesse. La loi n’a pu les satisfaire qu’en créant la détresse des autres classes, et surtout des ouvriers. — Alors ceux-ci se sont mis sur les rangs, et au lieu de demander que la spoliation cessât, ils ont demandé que la loi les admît aussi à participer à la spoliation. — Elle est devenue générale, universelle. Elle a entraîné la ruine de toutes les industries. Les ouvriers, plus malheureux que jamais, ont pensé que le dogme de la fraternité ne s’était pas réalisé pour eux, et ils ont pris les armes. Vous savez le reste : un carnage affreux qui a désolé pendant quatre jours la capitale du monde civilisé et qui n’est pas encore terminé.
Il me semble, mon cher Cobden, que je suis le seul à l’assemblée nationale qui voie la cause du mal et par conséquent le remède. Mais je suis obligé de me taire, car à quoi bon parler pour n’être pas compris ? aussi je me demande quelquefois si je ne suis pas un maniaque, comme tant d’autres, enfoncé dans ma vieille erreur ; mais cette pensée ne peut prévaloir, car je connais trop, ce me semble, tous les détails du problème. D’ailleurs, je médis toujours : En définitive, ce que je demande, c’est le triomphe des harmonieuses et simples lois de la Providence. Est-il présumable qu’elle s’est trompée ?
Je regrette aujourd’hui très-profondément d’avoir accepté le mandat qui m’a été confié. — Je n’y suis bon à rien, tandis que, comme simple publiciste, j’aurais pu être utile à mon pays.
[CW1.104] [JCPD] 104. Paris, 29 juin 1848. A Julie Marsan [missing French]↩
[CW1.105] [OC1] 105. Paris, 7 août 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher Cobden, je quitte l’assemblée pour répondre quelques lignes à votre lettre du 5. J’espérais voir nos ministres pour conférer avec eux sur la communication que vous me faites, mais ils ne sont pas venus. En attendant d’autres détails, voici ce que je sais.
Nous nous sommes trouvés, pour 1848, en face d’un déficit impossible à combler par l’impôt. Le ministre des finances a pris la résolution d’y pourvoir par l’emprunt et d’organiser son budget de 1849 de manière à équilibrer les recettes et les dépenses, sans en appeler de nouveau au crédit. L’intention est bonne, le tout est d’y être fidèle.
Dans cette pensée, il a reconnu que les recettes ordinaires ne pouvaient faire face aux dépenses de 1849, qu’autant que celles-ci seraient réduites d’un chiffre assez considérable. Il a donc déclaré à tous ses collègues qu’ils devaient aviser à une réduction à répartir entre tous les services. Le département de la marine est compris pour 30 millions dans la réduction proposée ; et comme il y a dans ce département des chapitres qu’il est impossible de toucher, tels que dépenses coloniales, bagnes, vivres, solde, etc., il s’ensuit que la réduction portera exclusivement sur les armements nouveaux à faire.
Cette résolution n’est pas immuable. Elle ne part pas d’un parti pris de diminuer nos forces militaires. Mais il est certain que le gouvernement et l’assemblée seraient fortement encouragés à persévérer dans cette voie, si l’Angleterre offrait de nous y suivre et surtout de nous y précéder dans une proportion convenable. C’est sur quoi je vais appeler l’attention de Bastide.
En ce moment, il circule, à l’occasion de l’Italie, des bruits qui sont de nature à faire échouer les bonnes dispositions du ministre des finances. Je crains bien que la paix de l’Europe ne puisse pas être maintenue. Dieu veuille au moins que nos deux pays marchent d’accord !
Adieu, mon cher Cobden. Je vous écrirai prochainement.
[CW1.106] [OC7] 106. Paris, 1er juillet 1848. A M. Schwabe↩
Mon cher Monsieur,
Je vous remercie de l’intérêt affectueux qui vous a fait penser à moi, à l’occasion des terribles événements qui ont affligé cette capitale. Grâce au ciel, la cause de l’ordre et de la civilisation l’a emporté. Nos excellents amis MM. Say et Anisson étaient à la campagne, l’un à Versailles, l’autre en Normandie. Leurs fils ont pris part à la lutte et en sont sortis avec honneur, mais sans blessure.
Ce sont les fausses idées socialistes qui ont mis les armes à la main à nos frères. Il faut dire aussi que la misère y a beaucoup contribué ; mais cette misère elle-même peut être attribuée à la même cause, car depuis qu’on a voulu faire de la fraternité une prescription légale, les capitaux n’osent plus se montrer.
Voici un moment bien favorable pour prêcher la vérité. Pendant tous ces jours de troubles, il m’est arrivé de parcourir les rangs de la garde nationale, essayant de montrer que chacun devait demander à sa propre énergie les moyens d’existence et n’attendre de l’État que justice et sécurité. Je vous assure que celle doctrine a été pour la première fois bien accueillie, et quelques amis m’ont facilité les moyens de la développer en public, ce que je commencerai lundi.
Vous me demanderez peut-être pourquoi je ne remplis pas cette mission au sein de l’Assemblée nationale, dont la tribune est si retentissante. C’est que l’enceinte est si vaste et l’auditoire si impatient que toute démonstration y est impossible.
C’est bien malheureux, car je ne crois pas qu’il y ait jamais eu, en aucun pays, une assemblée mieux intentionnée, plus démocratique, plus sincère amie du bien, plus dévouée. Elle fait honneur au suffrage universel, mais il faut avouer qu’elle partage les préjugés dominants.
Si vous jetez un coup d’œil sur la carte de Paris, vous vous convaincrez que l’insurrection a été plus forte que vous ne paraissez le croire. Quand elle a éclaté, Paris n’avait pas plus de huit mille hommes de troupes, qu’en bonne tactique il fallait concentrer, puisque c’était insuffisant pour opérer. Aussi l’émeute s’est bientôt rendue maîtresse de tous les faubourgs, et il ne s’en est pas fallu de deux heures qu’elle n’envahît notre rue. D’un autre côté elle attaquait l’Hôtel de ville, et, par le Gros-Caillou, menaçait l’Assemblée nationale, au point que nous avons été réduits, nous aussi, à la ressource des barricades. Mais, au bout de deux jours, les renforts nous sont arrivés de province.
Vous me demandez si cette insurrection sera la dernière. J’ose l’espérer. Nous avons maintenant de la fermeté et de l’unité dans le pouvoir. La chambre est animée d’un esprit d’ordre et de justice, mais non de vengeance. Aujourd’hui notre plus grand ennemi, c’est la misère, le manque de travail. Si le gouvernement rétablit la sécurité, les affaires reprendront, et ce sera notre salut.
Vous ne devez pas douter, mon cher Monsieur, de l’empressement avec lequel je me rendrais à votre bonne invitation et à celle de madame Schwabe, si je le pouvais. Quinze jours passés auprès de vous, à causer, promener, faire de la musique, caresser vos beaux enfants, ce serait pour moi le bonheur. Mais, selon toute apparence, je serai obligé de me le refuser. Je crains bien que notre session ne dure longtemps. Soyez sûr, du moins, que si je puis m’échapper, je n’y manquerai pas.
[CW1.107] [OC1] 107. Paris, 18 août 1848. A Richard Cobden↩
Mon cher Cobden, j’ai reçu votre lettre et le beau discours de M. Molesworth. Si j’avais eu du temps à ma disposition, je l’aurais traduit pour le Journal des Économistes. Mais le temps me manque et plus encore la force. Elle m’échappe, et je vous avoue que me voilà saisi de la manie de tous les écrivains. Je voudrais consacrer le peu de santé qui me reste, d’abord à établir les vrais principes d’économie politique tels que je les conçois, et ensuite à montrer leurs relations avec toutes les autres sciences morales. C’est toujours ma chimère des Harmonies économiques. Si cet ouvrage était fait, il me semble qu’il rallierait à nous une foule de belles intelligences, que le cœur entraîne vers le socialisme. Malheureusement, pour qu’un livre surnage et soit lu, il doit être à la fois court, clair, précis et empreint de sentiments autant que d’idées. C’est vous dire qu’il ne doit pas contenir un mot qui ne soit pesé. Il doit se former goutte à goutte comme le cristal, et, comme lui encore, dans le silence et l’obscurité. Aussi je pousse bien des soupirs vers mes chères Landes et Pyrénées.
Il ne m’a pas paru encore opportun de faire une ouverture à Cavaignac relativement à l’objet de votre lettre. [127] Le moment me semble mal choisi. Il faut attendre que les affaires d’Italie soient un peu éclaircies. Rien ne serait plus impopulaire en ce moment qu’une diminution dans l’armée. Tous les partis se réuniraient pour la condamner : les politiques, à cause de l’état de l’Europe ; les propriétaires et négociants, à cause des passions démagogiques. L’armée française est admirable de dévouement et de discipline. Elle est, pour le moment, notre ancre de salut. — Ses chefs les plus aimés sont au pouvoir et ne voudront rien faire qui puisse altérer son affection.
Quant à la marine, il n’est pas probable que la France entrerait dans une négociation qui aurait pour objet la réduction proportionnelle. Il faudrait que l’Angleterre allât plus loin, et je crains bien qu’elle n’y soit pas préparée. Je voudrais savoir au moins ce que l’on pourrait espérer d’obtenir.
L’esprit public, de ce côté du détroit, rend une négociation semblable extrêmement difficile, surtout avec l’Angleterre seule. Il faudrait tâcher de l’étendre à toutes les puissances.
C’est pourquoi je n’ai pas osé compromettre le succès, en demandant à Cavaignac une audience ad hoc. Je tâcherai de sonder ses idées occasionnellement et je vous les communiquerai.
Il est impossible de se proposer un plus noble but. J’ai vu avec plaisir que la Presse entre dans cette voie. Je vais tâcher d’y faire entrer aussi les Débats. Mais la difficulté est d’y entraîner les journaux populaires ; cependant je n’en désespère pas.
Adieu, je suis forcé de vous quitter.
[CW1.108] [OC1] 108. Paris, 26 août 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, j’éprouve une bien vive peine de voir, malgré mon désir, notre correspondance aussi languissante. Il me serait bien doux de continuer par lettres cet échange de sentiments et d’idées qui, pendant tant d’années, a suffi à notre bonheur. Tes lettres d’ailleurs me seraient bien nécessaires. Ici, au milieu des faits, dans le tumulte des passions, je sens que la netteté des principes s’efface, parce que la vie se passe à transiger. Je demeure aujourd’hui convaincu que la pratique des affaires exclut la possibilité de produire une œuvre vraiment scientifique ; et pourtant, je ne te le cache pas, je conserve toujours cette ancienne chimère de mes Harmonies sociales, et je ne puis me défendre de l’idée que, si j’étais resté auprès de toi, je serais parvenu à jeter une idée utile dans le monde. Aussi il me tarde bien de prendre ma retraite.
Nous avons terminé ce matin cette grande affaire de l’enquête, qui pesait si lourdement sur l’assemblée et sur le pays. Un vote de la chambre autorise des poursuites contre L. Blanc et Caussidière, pour la part qu’ils ont pu prendre à l’attentat du 15 mai. On sera peut-être un peu surpris, dans le pays, que j’aie voté en cette circonstance contre le gouvernement. C’était autrefois mon projet de faire connaître à mes commettants le motif de mes votes. Le défaut de temps et de force peut seul me faire manquer à ce devoir ; mais ce vote est si grave que je voudrais faire savoir ce qui l’a déterminé. Le gouvernement croyait les poursuites contre ces deux collègues nécessaires ; on allait jusqu’à dire qu’on ne pouvait compter qu’à cette condition sur l’appui de la garde nationale. Je ne me suis pas cru le droit, même pour ce motif, de faire taire la voix de ma conscience. Tu sais que les doctrines de L. Blanc n’ont pas, peut-être dans toute la France, un adversaire plus décidé que moi. Je ne doute pas que ces doctrines n’aient eu une influence funeste sur les idées des ouvriers et, par suite, sur leurs actes. Mais étions-nous appelés à nous prononcer sur des doctrines ? Quiconque a une croyance doit considérer comme funeste la doctrine contraire à cette croyance. Quand les catholiques faisaient brûler les protestants, ce n’était pas parce que ceux-ci étaient dans l’erreur, mais parce que cette erreur était réputée dangereuse. Sur ce principe, nous nous tuerions les uns les autres.
Il y avait donc à examiner si L. Blanc s’était rendu vraiment coupable des faits de conspiration et insurrection. Je ne l’ai pas cru, et quiconque lira sa défense ne pourra le croire. En attendant, je ne puis oublier les circonstances où nous sommes : l’état de siège est en vigueur, la justice ordinaire est suspendue, la presse est bâillonnée. Pouvais-je livrer deux collègues à des adversaires politiques au moment où il n’y a plus aucune garantie ? C’est un acte auquel je ne pouvais m’associer, un premier pas que je n’ai pas voulu faire.
Je ne blâme pas Cavaignac d’avoir suspendu momentanément toutes les libertés, je crois que cette triste nécessité lui a été aussi douloureuse qu’à nous ; et elle peut être justifiée par ce qui justifie tout, le salut public. Mais le salut public exigeait-il que deux de nos collègues fussent livrés ? Je ne l’ai pas pensé. Bien au contraire, j’ai cru qu’un tel acte ne pouvait que semer parmi nous le désordre, envenimer les haines, creuser l’abîme entre les partis, non-seulement dans l’assemblée, mais dans la France entière; j’ai pensé qu’en présence des circonstances intérieures et extérieures, quand le pays souffre, quand il a besoin d’ordre, de confiance, d’institutions, d’union, le moment était mal choisi de jeter dans la représentation nationale un brandon de discorde. Il me semble que nous ferions mieux d’oublier nos griefs, nos rancunes, pour travailler au bien du pays ; et je m’estimais heureux qu’il n’y eût pas de faits précis à la charge de nos collègues, puisque par là j’étais dispensé de les livrer.
La majorité a pensé autrement. Puisse-t-elle ne s’être pas trompée ! puisse ce vote n’être pas fatal à la république !
Si tu le juges à propos, je t’autorise à envoyer un extrait de cette lettre au journal du pays.
[CW1.109] [OC7] 109. Paris, 3 septembre 1848. A M. Domenger↩
Demain nous commençons à discuter la Constitution. Mais, quoiqu’on en dise, cette œuvre portera toujours au cœur un chancre dévorant, puisqu’elle sera discutée sous le régime de l’état de siège et en l’absence de la liberté de la presse. Quant à nous représentants, nous nous sentons parfaitement libres, mais cela ne suffit pas. Les partis exploiteront ce qu’il y a d’anormal dans notre situation pour miner et décréditer la constitution. Aussi j’ai voté hier contre l’état de siège. Je crois que Cavaignac fait la faute vulgaire et bien naturelle de sacrifier l’avenir au présent. Tout disposé que je suis à prêter de la force à ce gouvernement honnête et bien intentionné que nous avons érigé, je ne puis aller jusque-là. Me voilà donc votant encore avec la république rouge, mais ce n’est pas ma faute. Il ne faut pas regarder avec qui, mais pourquoi l’on vote.
Je présume qu’un nouvel effort sera tenté en faveur de la liberté de la presse. Je m’y associerai, avant tout je veux que la constitution soit respectée. S’il y a à Paris des ferments de désordre tels qu’on ne puisse maintenir l’empire des lois, eh bien, j’aime mieux que la lutte recommence, et que le pays apprenne à se défendre lui-même.
Il n’est bruit que de conspirations légitimistes. Je ne puis pas y croire. Quoi ! les légitimistes, impuissants en 89, espéreraient être forts en 1848 ! Ah ! Dieu les préserve de réveiller le lion révolutionnaire ! Si vous avez occasion de les voir, dites-leur bien qu’il ne faut pas qu’ils se fassent illusion. Ils ont contre eux tous les ouvriers, tous les socialistes, tous les républicains, tout le peuple, avec des chefs capables de pousser les choses jusqu’à la dernière extrémité. Que le clergé surtout soit circonspect. Les hommes à principes qui, comme moi, ont foi dans la puissance de la vérité, ne demandent que la libre discussion et acceptent d’avance le triomphe de l’opinion, quand même (sauf à la faire changer), ces hommes sont en petit nombre. Ceux qui acceptent la lutte ailleurs, sur le champ du combat, sont innombrables, décidés à pousser les choses jusqu’au bout. Que les légitimistes et le clergé ne donnent pas le signal de l’action ; ils seraient écrasés. Le légitimisme sait bien que son principe a fait son temps, et quant au clergé, s’il n’est pas tout à fait aveugle, il ne peut ignorer son côté vulnérable. Qu’une certaine irritation populaire provenant de la crise industrielle et des embarras financiers ne leur inspire pas de dangereuses et folles espérances, à moins qu’ils ne veuillent une bonne fois jouer leur va tout.
Employez votre influence à préserver notre cher département des suites d’une lutte affreuse. À Dieu ne plaise que je veuille priver qui que ce soit du droit d’exprimer et de faire valoir ses idées ! Mais qu’on évite avec soin tout ce qui pourrait ressembler à la conspiration.
[CW1.110] [OC1] 110. Paris, 7 septembre 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, ta lettre ne me laissait pas le choix du parti que j’avais à prendre. Je viens d’envoyer ma démission de membre du conseil général ; je ne donne pas celle de représentant, et tu en comprends les motifs. En définitive, ce n’est pas quelques Mugronnais qui m’ont conféré ce titre.
Je voudrais savoir combien il y en a, parmi ceux qui me blâment, qui ont lu dans le Moniteur la défense de L. Blanc ; et, s’ils ne l’ont pas lue, il faut avouer que leur audace est grande à se prononcer.
On dit que j’ai cédé à la peur ; la peur était toute de l’autre côté. Ces messieurs pensent-ils qu’il faut moins de courage à Paris que dans les départements pour heurter les passions du jour ? On nous menaçait de la colère de la garde nationale, si nous repoussions le projet de poursuites. Cette menace venait du quartier qui dispose de la force militaire.
La peur a donc pu influencer les boules noires, mais non les boules blanches. Il faut un degré peu commun d’absurdité et de sottise pour croire que c’est un acte de courage que de voter du côté de la force, de l’armée, de la garde nationale, de la majorité, de la passion du moment, de l’autorité.
As-tu lu l’enquête ? as-tu lu la déposition d’un ex-ministre, Trélat ? Elle dit : « Je suis allé à Clichy, je n’y ai pas vu L. Blanc, je n’ai pas appris qu’il y soit allé ; mais j’ai reconnu des traces de son passage à l’attitude, aux gestes, à la physionomie et jusqu’aux articulations des ouvriers. » A-t-on jamais vu la passion se manifester par des tendances plus dangereuses ? Et les trois quarts de l’enquête sont dans cet esprit !
Bref, en conscience, je crois que L. Blanc a fait beaucoup de mal, complice en cela de tous les socialistes, et il y en a beaucoup qui le sont, sans le savoir, même parmi ceux qui crient contre lui ; mais je ne crois pas qu’il ait pris part aux attentats de mai et juin, et je n’ai pas d’autres raisons à donner de ma conduite.
Je te remercie de m’avoir tenu au courant de l’état des esprits. Je connais trop le cœur humain pour en vouloir à personne. À leur point de vue, ceux qui me blâment ont raison. Puissent-ils se préserver longtemps de cette peste du socialisme ! Je me sens soulagé d’un grand poids depuis que ma lettre au préfet est à la poste. Le pays verra que j’entends qu’il se fasse représenter à son gré. Quand viendra la réélection, prie instamment M. Domenger de ne point appuyer ma candidature. En l’acceptant, je m’étais laissé entraîner par le désir de revoir mon pays ; c’était un sentiment tout personnel ; j’en ai été puni. Maintenant je ne désire autre chose que de me débarrasser d’un mandat plus pénible.
[CW1.111] [OC7] 111. Douvres, 7 octobre 1848. A M. Schwabe↩
Je ne veux pas quitter le sol d’Angleterre, mon cher Monsieur, sans vous exprimer le sentiment de reconnaissance que j’emporte, et aussi sans vous demander un peu pardon pour tous les embarras que vous a occasionnés mon séjour auprès de vous. Vous serez peut-être surpris de voir la date de cette lettre. Pendant que je cherchais M. Faulkner à Folkestone, le bateau à vapeur m’a fait l’impolitesse de prendre le large, me laissant sur le quai, indécis si je sauterais à bord. Il y a vingt ans je l’aurais essayé. Mais je me suis contenté de le regarder, et ayant appris qu’un autre steamer part ce soir de Douvres, je suis venu ici, et je ne regrette pas l’accident, car Douvres vaut bien la peine de rester un jour de plus en Angleterre. C’est même ce que je ferais, si je n’étais dépourvu de tous mes effets. Enfin j’ai pu faire votre commission à M. Faulkner tout à mon aise.
…Les deux jours que j’ai passés avec M. Cobden ont été bien agréables. Son impopularité momentanée n’a pas altéré la gaieté et l’égalité de son humeur. Il dit, et je crois avec raison, qu’il est plus près du désarmement aujourd’hui qu’il n’était près du free-trade quand il fonda la ligue. C’est un grand homme ; et je le reconnais à ceci : que son intérêt, sa réputation, sa gloire ne sont jamais mis par lui en balance avec l’intérêt de la justice et de l’humanité.
Veuillez, etc.
[CW1.112] [OC7] 112. Paris, 25 octobre 1848. A M. Schwabe↩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je vous remercie de vos offres obligeantes. On ne quitte jamais d’aussi bons amis sans projeter de les revoir. Il serait trop cruel de ne pas nourrir cette espérance. Mais hélas ! elle n’est souvent qu’une illusion, car la vie est bien courte et Manchester est bien loin. Peut-être me sera-t-il donné de vous faire les honneurs de mes chères Pyrénées. Je rêve souvent que votre famille, celle de Cobden, celle de Say et moi, nous nous trouverons un jour tous réunis dans une de mes fraîches vallées. Ce sont là des plans que les hommes exécuteraient certainement s’ils savaient vivre.
Paris continue à être tranquille. Les boulevards sont gais et brillants, les spectacles attirent la foule, le caractère français se montre dans toute sa légère insouciance. Ceci vaut encore cent fois mieux que Londres, et pour peu que les révolutions d’Allemagne continuent, je ne désespère pas de voir notre Paris devenir l’asile de ceux qui fuiront les tempêtes politiques. Que nous manque-t-il pour être la plus heureuse des nations ? Un grain de bon sens. Il semble que c’est bien peu de chose.
Je conçois que le choléra vous effraye, vous qui êtes entouré d’une aussi aimable et nombreuse famille. Plus nous sommes heureux par nos affections, plus aussi nous courons de dangers. Celui qui est seul n’est vulnérable que par le point le moins sensible, qui est lui-même. Heureusement que ce redoutable fléau semble tout confus de son impuissance, comme un tigre sans dents et sans griffes. Je me réjouis, à cause de mes amis de l’autre côté du détroit, de voir par les journaux que le choléra n’a de redoutable que le nom, et qu’au fait, il fait moins de ravage que le rhume de cerveau.
Adieu, etc.
[CW1.113] [CH] 113. Paris, novembre 1848. A Madame Cheuvreux↩
Madame,
Il y a, à l’hôtel Saint-Georges, trois santés tellement sympathiques entre elles que si l’une décline, les autres sont menacées. Permettez-moi de faire demander comment vous vous portez. À Mugron, dès neuf heures du matin, nous savions des nouvelles de tous nos amis. Ah ! croyez que la monotonie provinciale a ses compensations.
Si vous avez sous la main l’adresse du savant pharmacien qui a trouvé l’art de rendre supportable l’huile de foie de morue, veuillez me l’envoyer. Je voudrais bien que ce précieux alchimiste pût m’enseigner le secret de faire aussi de l’économie politique épurée ; c’est un remède dont notre société malade a bon besoin, mais elle refuse d’en prendre la moindre cuillerée tant il est répugnant.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
[CW1.114] [OC7] 114. Paris, 14 novembre 1848. A Madame Schwabe↩
Madame,
Si ma pensée, guidée par le souvenir d’une bonne et cordiale hospitalité, prend souvent la direction de Crumpsall-house et de Manchester, elle y a été portée avec plus de force encore hier au soir : car on jouait la Sonnambula aux Italiens, et je n’ai pu m’empêcher de violer l’ordonnance des médecins pour aller revoir cette pièce. Chaque morceau, chaque motif me transportait en Angleterre ; et soit attendrissement soit faiblesse de constitution, je sentais toujours mes yeux prêts à déborder. Qui pourrait expliquer ce qu’il y a d’intime dans la musique ! Pendant que j’entendais le duo si touchant et le beau finale du premier acte, il me semblait que plusieurs mois s’étaient anéantis, et que, les deux représentations se confondant ensemble, je n’éprouvais qu’une même sensation. Cependant, je dois le dire, sans vouloir critiquer vos chanteurs, la pièce est infiniment mieux exécutée ici, et si votre premier ténor égale le nôtre, il est certain que madame Persiani surpasse infiniment votre prima donna. — Et puis cette langue italienne a été inventée et faite exprès pour la musique. Quand j’ai entendu, dans le récitatif, madame Persiani s’écrier : Sono innocente, je n’ai pu m’empêcher de me rappeler le singulier effet que produit cette traduction rhythmée de la même manière : I am not guilty. — Que voulez- vous ? La langue des affaires, de la mer et de l’économie politique ne peut pas être celle de la musique.
[CW1.115] [OC1] 115. Paris, 26 novembre 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, vous avez dû m’attendre à Mugron. Mon projet était d’abord d’y aller ; quand j’ai accepté d’être du conseil général, je dois avouer, à ma honte, que j’ai un peu été déterminé par la perspective de ce voyage. L’air natal a toujours tant d’attraits ! et puis j’aurais été heureux de te serrer la main. À cette époque, c’était une chose comme arrêtée que l’assemblée se prorogerait pendant la session du conseil. Depuis les choses ont changé ; on a vu un danger à dissoudre la seule autorité debout dans notre pays, et, partageant ce sentiment, j’ai dû rester à mon poste. Il est vrai que j’ai été malade et retenu souvent dans ma chambre, quelquefois dans mon lit, mais enfin j’étais à Paris, prêt à faire, dans la mesure de mes forces, ce que les circonstances auraient exigé.
Cette détérioration de ma santé, qui se traduit surtout en faiblesse et en apathie, est venue dans un mauvais moment. En vérité, mon ami, je crois que j’aurais pu être utile. Je remarque toujours que nos doctrines nous font trouver la solution des difficultés qui se présentent, et de plus, que ces solutions exposées avec simplicité sont toujours bien accueillies. Si l’économie politique, un peu élargie et spiritualisée, eût trouvé un organe à l’assemblée, elle y eût été une puissance ; car, on a beau dire, cette assemblée peut manquer de lumières, mais jamais il n’y en eut une qui eût meilleure volonté. Les erreurs, les systèmes les plus étranges et les plus menaçants sont venus s’étaler à la tribune, comme pour dresser un piédestal à l’économie politique et faire ombre à sa lumière. J’étais là, témoin cloué sur mon banc, je sentais en moi ce qu’il fallait pour rallier les intelligences et même les cœurs sincères, et ma misérable santé me condamnait au silence. Bien plus, dans les comités, dans les commissions, dans les bureaux, j’ai dû mettre une grande attention à m’annuler, sentant que si une fois j’étais poussé sur la scène, je ne pourrais y remplir mon rôle. C’est une cruelle épreuve. Aussi il faudra que je renonce à la vie publique, et toute mon ambition est maintenant d’avoir trois ou quatre mois de tranquillité devant moi, pour écrire mes pauvres Harmonies économiques. Elles sont dans ma tête, mais j’ai peur qu’elles n’en sortent jamais.
Les journaux d’aujourd’hui vous porteront la séance d’hier. Elle s’est prolongée jusqu’à minuit. Elle était attendue avec anxiété et même avec inquiétude. J’espère qu’elle produira un bon effet sur l’opinion publique.
Tu me demandes mon opinion sur les prochaines élections. Je ne puis comprendre comment, avec des principes identiques, le milieu où nous vivons suffit pour nous faire voir les choses à un point de vue si différent. Quels journaux, quelles informations recevez-vous, pour dire que Cavaignac penche du côté de la Montagne ? Cavaignac a été mis où il est pour soutenir la république, et il le fera consciencieusement. L’aimerait-on mieux s’il la trahissait ? En même temps qu’il veut la république, il comprend les conditions de sa durée. Reportons-nous à l’époque des élections générales. Quel était alors le sentiment à peu près universel ? Il y avait un certain nombre de vrais et honnêtes républicains, ensuite une multitude immense jusque-là divisée, qui n’avait ni demandé ni désiré la république, mais à qui la révolution de février avait ouvert les yeux. Elle comprit que la monarchie avait fait son temps, elle voulait se rallier à l’ordre nouveau et le soumettre à l’expérience. J’ose dire que ce fut là l’esprit dominant, comme l’atteste le résultat électoral. La masse choisit ses représentants parmi les républicains dont j’ai parlé ; en sorte qu’on peut considérer ces deux catégories comme composant la nation. Cependant, au-dessus et au-dessous de ce corps immense, il y a deux partis. Celui de dessus s’appelle république rouge et se compose d’hommes qui font assaut d’exagération quand il s’agit de flatter les passions populaires ; celui de dessous s’appelle réaction. Il reçoit tous ceux qui aspirent à renverser la république, à lui tendre des pièges et à embarrasser sa marche.
Voilà la situation des premiers jours de mai ; et pour comprendre la suite, il ne faut pas oublier que le pouvoir était alors aux mains de la république rouge, dominée encore par des partis plus extrêmes et plus violents.
Où en sommes-nous venus à force de temps, de patience, à travers bien des périls ? à rendre le pouvoir homogène avec cette masse immense qui forme la nation même. En effet, où Cavaignac a-t-il pris son ministère ? en partie parmi les républicains honnêtes de la veille, en partie parmi les hommes sincèrement ralliés. Remarque qu’il ne pouvait négliger aucun de ces éléments, ni monter jusqu’à la Montagne, ni descendre jusqu’à la réaction. C’eût été manquer de sincérité et de bonne politique. Il a pris assez de francs républicains pour qu’on ne pût douter de la république, et, parmi les hommes d’une autre époque, il a choisi ceux que leur loyauté notoire ne permet pas de tenir pour suspects, comme Vivien et Dufaure.
Dans cette marche descendante vers le point précis qui coïncide avec l’opinion et avec la stabilité de la république, nous avons froissé le parti exagéré, qui nous a fait sentir tout son mécontentement par les 15 mai et 23 juin ; nous avons déçu les réactionnaires, qui se vengent par leur choix…
Maintenant, si cette multitude immense, qui s’était montrée franchement ralliée, oubliant les difficultés qu’a rencontrées l’assemblée, se dissout et renonce au but qu’elle s’était proposé, je ne sais plus où nous allons. Si elle persiste, elle doit le prouver en nommant Cavaignac.
Les rouges, qui ont au moins le mérite d’être conséquents et sincères, portent leurs voix sur Ledru-Rollin et Raspail… Que devons-nous faire, nous ? Je m’en rapporte à ta sagacité.
Sauf aux journées de juin, où, comme tous mes collègues, j’allais, en revenant des barricades, dire au chef du pouvoir exécutif ce que j’avais vu, je n’ai jamais parlé à Cavaignac, je n’ai jamais été dans ses salons, et très-probablement il ne sait pas si j’existe. Mais j’ai écouté ses paroles, j’ai observé ses actes, et si je ne les ai pas tous approuvés, si j’ai souvent voté contre lui, notamment chaque fois qu’il m’a paru que les mesures exceptionnelles, nées des nécessités de juin, se prolongeaient trop longtemps, je puis le dire, du moins en mon âme et conscience, je crois Cavaignac honnête…
[CW1.116] [OC1] 116. Paris, 5 décembre 1848. A Félix Coudroy↩
Mon cher Félix, je profite d’une réponse que j’adresse à Hiard pour t’écrire deux lignes.
Les élections approchent. J’ai écrit une lettre aux journaux des Landes. J’ignore si elle a paru. Dans mon intérêt, il eût été plus prudent de me taire ; mais il m’a semblé que je devais faire connaître mon opinion. Si je ne suis pas renommé, je m’en consolerai aisément.
Jusqu’ici on n’a aucune nouvelle du pape. Voilà une grande question soulevée. Si le pape veut consentir à devenir le premier des évêques, le catholicisme peut avoir un grand avenir. Quoi qu’en dise Montalembert, la puissance temporelle est une grande difficulté. Nous ne sommes plus dans un temps où il soit possible de dire : « Tous les peuples seront libres et se donneront le gouvernement qu’ils veulent, excepté les Romains, parce que cela nous arrange. »
Adieu.
[CW1.117] [OC7] 117. Paris, 21 décembre 1848. A M. le Comte Arrivabene↩
Mon cher Monsieur,
Le doute que vous m’exprimez est bien naturel. Il est possible que, forçant un peu les termes, je sois allé au delà de ma pensée. Les mots : par anticipation insérés dans le passage que vous rapportez vous annoncent que j’ai l’intention de traiter la question à fond. Dans un prochain article je parlerai de l’échange, ensuite j’exposerai ce que j’ai la hardiesse d’appeler ma théorie de la valeur. Je vous prie de vouloir bien suspendre jusqu’alors votre jugement. Vous ne devez pas douter qu’après cela j’accueillerai vos observations avec reconnaissance, car elles me mettront à même ou de mieux expliquer ou de rectifier, selon l’occasion.
Vous reconnaîtrez, j’espère, que ce qui paraît nous diviser n’est pas très sérieux. Je crois que la valeur est dans les services échangés et non dans les choses. Matériaux et forces matérielles sont fournis gratuitement par la nature, et passent gratuitement de main en main. Mais je ne dis pas que deux travaux, considérés comme égaux en intensité et durée, soient également rémunérés. Celui qui est placé de manière à rendre un service plus précieux à cause des matériaux ou des forces dont il dispose, se fait mieux rétribuer ; son travail est plus intelligent, plus heureux si vous voulez, mais la valeur est dans ce travail et non dans les choses. La preuve en est que le même phénomène se montre, alors même qu’aucun objet matériel ne se présente pour nous faire illusion et paraître revêtir la valeur. Ainsi, si j’éprouve le désir d’entendre la plus belle voix du monde, si je suis disposé pour cela à faire de grands sacrifices, je m’adresserai à Jenny Lind. Comme elle est la seule au monde qui puisse me rendre ce service, elle y mettra le prix qu’elle voudra. Son travail sera plus rétribué qu’un autre, il aura plus de valeur ; mais cette valeur est dans le service.
Je crois qu’il en est de même quand un objet matériel intervient ; et si nous lui attribuons la valeur, c’est par pure métonymie. Prenons un de vos exemples. Un homme écrase son blé entre deux pierres. Plus tard il profite de ce qu’il est placé sur une hauteur visitée par les vents et établit un moulin. Je réclame de lui le service de moudre mon blé. Beaucoup d’autres personnes en font autant, et comme il dispose d’une grande force, il peut rendre beaucoup de services semblables. Il est fortement rétribué. Qu’est-ce que cela prouve ? que son intelligence est récompensée, que son travail est heureux, mais non que la valeur soit dans le vent. La nature ne reçoit jamais aucune rétribution ; je ne la donne qu’à un homme, et je ne la lui donne que parce qu’il me rend un service. Ce service, je l’apprécie par ce qu’il m’en coûterait pour me le rendre à moi-même ou pour le réclamer à d’autres. Donc la valeur est dans l’appréciation comparée des divers services échangés.
Cela est si vrai que, si la concurrence s’en mêle, le meunier baissera son prix ; son service plus offert aura moins de valeur, quoique l’action du vent reste la même et conserve toute son utilité. C’est moi, consommateur, qui profiterai gratuitement de cette baisse. Ce n’est pas l’utilité du vent qui a changé, c’est la valeur du service.
Vous voyez qu’au fond c’est une dispute de mots. Qu’importe, me direz-vous, que la valeur soit dans une force naturelle ou dans le service que me rend, par l’intermédiaire de cette force, celui qui s’en est emparé ? le résultat est le même pour moi.
Je ne puis dire ici les conséquences, selon moi très importantes, qui découlent de cette distinction. Je crois sincèrement que si je parviens à faire prévaloir ma thèse, j’aurai brisé tous les arguments socialistes, communistes, etc. tout comme j’aurai redressé beaucoup d’erreurs échappées aux économistes relativement à la propriété, à la rente, au crédit, etc. C’est peut-être une illusion d’auteur, mais j’avoue qu’elle s’est emparée de tout mon être, et je regrette de n’avoir que quelques instants à consacrer à cette étude.
Veuillez recevoir, mon cher Monsieur, l’assurance de mon respectueux attachement.
[CW1.118] [OC7] 118. Paris, 28 décembre 1848. A Madame Schwabe↩
Je reconnais votre bonté et celle de M. Schwabe à l’insistance que vous mettez à m’attirer une seconde fois sous le toit hospitalier de Crumpsall-house. Croyez que je n’ai pas besoin d’autres excitations que celles de mon cœur, alors même que vous ne m’offririez pas en perspective le bonheur de serrer la main à Cobden et d’entendre la grande artiste Jenny Lind. Mais vraiment Manchester est trop loin. Ceci n’est peut-être pas très galant pour un Français ; mais à mon âge on peut bien parler raison. Acceptez au moins l’expression de ma vive reconnaissance.
Est-ce que mademoiselle Jenny Lind a conçu de la haine pour ma chère patrie ? D’après ce que vous me dites, son cœur doit être étranger à ce vilain sentiment. Oh ! qu’elle vienne donc à Paris ! Elle y sera environnée d’hommages et d’enthousiasme. Qu’elle vienne jeter un rayon de joie sur cette ville désolée, si passionnée pour tout ce qui est généreux et beau ! Je suis sûr que Jenny Lind nous fera oublier nos discordes civiles. Si j’osais dire toute ma pensée, j’entrevois pour elle la plus belle palme à cueillir. Elle pourrait arranger les choses de manière à rapporter, sinon beaucoup d’argent, au moins le plus doux souvenir de sa vie. Ne paraître à Paris que dans deux concerts et choisir elle-même les bienfaits à répandre. Quelle pure gloire et quelle noble manière de se venger, s’il est vrai, comme on le dit, qu’elle y a été méconnue ! Voyez, bonne madame Schwabe, à prendre la grande cantatrice par cette corde du cœur. Je réponds du succès sur ma tête.
Nous touchons à une nouvelle année. Je fais des vœux pour qu’elle répande la joie et la prospérité sur vous et sur tout ce qui vous entoure.
Articles and Essays↩
Barataria [c. 1848???] ↩
BWV
1848.?? "Barataria" (Barataria) [an unpublished fragment of what was intended as a short pamphlet.] [OC7.77, pp. 343-51]
Barataria [1]
Il n’est rien de tel que les eaux des Pyrénées. On y rencontre des hommes de tout pays, gens qui ont beaucoup vu et beaucoup retenu, prêts d’ailleurs à beaucoup raconter. Ce qui n’est pas moins précieux, on y trouve aussi en grand nombre, surtout aux Eaux-Bonnes, d’autres hommes disposés à beaucoup écouter, et pour cause.
Depuis plusieurs jours, nous, vrais malades, malades sérieux, comme on dit aujourd’hui (ce qui ne nous empêche pas d’être gais), nous faisons cercle autour d’un hidalgo valencian, qui a visité en détail l’île de Barataria, et nous en conte des choses merveilleuses. On sait que cette île a eu pour législateur le grand Sancho Pança, qui crut devoir s’écarter, dans ses institutions, des données classiques de Minos, Lycurgae, Solon, Numa et Platon. À Barataria, le principe du gouvernement est de laisser les gouvernés juger et décider pour eux-mêmes en toutes matières, et de n’exiger rien d’eux que le respect de la justice. Le gouvernement ne promet rien non plus ; il ne se charge de rien et ne répond de rien que de la sécurité universelle.
Une autre fois je vous raconterai les effets de ce système, au dire de don Juan Jose. Pour aujourd’hui, je me borne à transcrire ici quelques lettres qui furent échangées entre don Quichotte et Sancho, pendant le règne du célèbre laboureur Manchego, lettres qu’on conserve précieusement dans la bibliothèque de Barataria.
Malheureusement le chevalier de la Triste-Figure, non plus que son écuyer, n’ont eu soin de dater leur correspondance. On suppose qu’elle n’a dû avoir lieu que plusieurs mois après que Sancho eut pris possession de son île. Cela se reconnaît au style. Il dénote chez don Quichotte la perte du peu de bon sens qui lui restait, et, chez Sancho, une moindre dose d’aimable naïveté. Quoi qu’il en soit, tout ce qui vient de ces deux héros est trop précieux pour n’être pas conservé.
don quichotte à sancho.
Ami Sancho, je ne puis me rappeler combien est difficile le gouvernement des hommes, sans éprouver quelques remords de t’avoir préposé à gouverner l’île de Barataria, mission pour laquelle ta tête et ton cœur n’avaient pas été peut-être assez préparés. C’est pourquoi je prends la résolution de te donner désormais de fréquents avis, que tu suivras, j’espère, avec cette docilité qui est imposée aux écuyers par les lois de la chevalerie.
Combien tu dois maintenant déplorer la grossière existence que tu as menée jusqu’au jour où tu t’associas, avec ton âne, à mes glorieuses entreprises, à mes nobles destinées. Les hauts faits dont tu as été témoin et auxquels tu n’as pas laissé, à l’occasion, que de prendre part, auront arraché ton âme aux préoccupations vulgaires du village. Mais a-t-elle eu le temps de s’élever à toute la hauteur que doit atteindre l’âme d’un législateur ?
Je crains, ami Sancho, qu’appelé à jouer sur la scène du monde le rôle d’un Minos, d’un Lycurgue, d’un Solon, d’un Numa, tu ne te sois pas encore assez identifié avec la pensée et le but de ces grands hommes. Comme eux, tu es plus que prince, tu es législateur ; et sais-tu ce que c’est qu’un législateur ?
« Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive, en quelque sorte, sa vie et son être ; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer ; de substituer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses propres forces pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui [2]. »
Ami Sancho, tu as à être l’inventeur d’abord, puis le mécanicien d’une machine, dont les Baratariens seront les matériaux et les ressorts. N’oublie pas que, dans cette machine tout doit être combiné, non pour la gloire de l’inventeur ou le bonheur du mécanicien, mais pour le bonheur et la gloire de la machine elle-même.
La première difficulté que tu vas rencontrer sera de faire accepter tes lois. Il ne serait pas mal que tu puisses persuader aux Baratariens que tu es en commerce secret avec quelque déesse. Tu proclamerais ta législation un jour d’orage, au milieu du tonnerre et des éclairs. Elle s’imprimerait ainsi dans leur âme avec le sentiment d’une salutaire terreur. Ton code ne serait pas seulement un code, il serait une religion ; violer la loi serait commettre un sacrilège, et encourir non seulement des châtiments humains, mais encore le courroux des dieux. C’est de cette manière que tu donneras de la stabilité à ta ville, et que tu forceras les citoyens à porter docilement le joug de la félicité publique.
Une telle imposture serait, il est vrai, odieuse chez tout autre, mais elle est très permise à un législateur. Tous s’en sont servis, depuis Lycurgue jusqu’à Mahomet, et de nos jours encore, si tu lis les écrits des publicistes qui aspirent à refaire la société, tu y remarqueras un ton de mysticisme qui prouve qu’ils ne seraient pas fâchés de passer pour des inspirés et des prophètes. Ceux qui ont recours à ces supercheries sont plus qu’excusables, ils sont méritoires puisqu’ils honorent les dieux de leur propre sagesse.
Tu auras ensuite à résoudre cette question importante : établiras-tu ou non l’esclavage ?
Il y a beaucoup de pour et de contre.
Si, comme nous gens éclairés, tu avais passé toute ta jeunesse avec les Grecs et les Romains, tu saurais que la vertu est incompatible avec le travail ; qu’il n’y a de noble que le métier des armes, de grand que la guerre, et que nos mains ne sauraient dignement s’exercer qu’aux arts qui servent à la domination ou à la destruction ; ceux qui nous font exister étant essentiellement bas, honteux et serviles.
Il suit de là que, pour faire fleurir la vertu dans ton île, il faut en bannir le travail. Mais en bannir le travail, ce serait en bannir la vie.
Voici comment tu pourrais résoudre la difficulté.
Tu partagerais les Baratariens en deux classes.
Les uns (à peu près 95 sur 100) seraient voués, sous le nom d’esclaves, aux travaux serviles. On les marquerait au front pour les reconnaître ; on les enchaînerait au cou pour prévenir les révoltes.
Les autres vivraient alors noblement. Ils s’exerceraient à la lutte, au pugilat ; ils se perfectionneraient dans l’art de tuer, en un mot, leur seule occupation serait la vertu. C’est ainsi que tu réaliseras la liberté. — Quoi donc ! me diras-tu, la liberté ne peut-elle fleurir qu’à l’aide de la servitude ? — Peut-être.
Médite ces paroles, ami Sancho, et réponds-moi sans retard.
réponse de sancho.
Je me suis fait lire votre lettre par mon secrétaire, et, quoique j’y comprenne fort peu de chose, je m’empresse d’y répondre. À vous dire vrai, je ne m’aperçois pas que j’aie rien appris de bien utile à mon gouvernement pendant le cours de nos aventures ; et même il y a cela d’étrange que la plupart de vos discours me sont sortis de la tète, tandis que les sentences de notre curé, les proverbes de Carasco et surtout les maximes de Thérèse Pança me sont aujourd’hui d’un grand secours. Quant aux exploits dont vous parlez et auxquels vous avez la bonté de dire que j’ai pris ma part, je ne me les rappelle pas non plus, ne pouvant guère considérer comme tels vos singulières luttes contre des moulins ou des moutons, dont d’ailleurs je suis resté le témoin inactif. Mais, au contraire, je me rappelle fort bien les coups de bâton qui m’ont rompu les os, dans le bois où nous avons combattu vingt muletiers.
Enfin me voici, comme vous dites, législateur, prince et gouverneur.
Je prends note d’abord qu’à votre avis la Société baratarienne doit être une machine dont les Baratariens seront les matériaux et dont je dois être l’inventeur, l’exécuteur et le mécanicien. Je me suis fait relire trois fois ce passage de votre honorée lettre, sans jamais pouvoir en comprendre le premier mot.
Les Baratariens, que vous n’avez peut-être jamais vus, sont faits comme vous et moi, ou approchant, car il n’y en a guère qui atteignent à votre maigreur ou à ma rotondité. À cela près, ils nous ressemblent beaucoup. Ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et leur tête, si je ne me trompe, contient une cervelle. Ils se meuvent, pensent, parient et paraissent tous fort occupés des arrangements qu’ils ont à prendre pour être heureux. À vrai dire, ils ne s’occupent jamais d’autre chose, et je ne comprends pas que vous les ayez pris pour des matériaux.
J’ai remarqué aussi que les Baratariens ont un autre trait de ressemblance avec les habitants de mon village, en ce que chacun d’eux est si avide de bonheur qu’il le recherche quelquefois aux dépens d’autrui. Pendant plusieurs semaines, mon secrétaire n’a fait que me lire des pétitions étonnantes sous ce rapport. Toutes, soit qu’elles émanent d’individus ou de communautés, peuvent se résumer en ces deux mots : — Ne nous prenez pas d’argent, donnez-nous de l’argent. — Cela m’a fait beaucoup réfléchir.
J’ai envoyé quérir mon ministre de la hacienda, et je lui ai demandé s’il connaissait un moyen de donner toujours de l’argent aux Baratariens sans jamais leur en prendre. — Le ministre m’a affirmé que ce moyen lui était inconnu. — Je lui ai demandé si je ne pourrais pas au moins donner aux Baratariens un peu plus d’argent que je ne leur en prendrais. — Il m’a répondu que c’était tout le contraire, et qu’il était de totale impossibilité de donner dix à mes sujets sans leur prendre au moins douze, à cause des frais.
Alors je me suis fait ce raisonnement : si je donne à chaque Baratarien ce que je lui ai pris, sauf les frais, l’opération est ridicule. Si je donne plus aux uns, c’est que je donnerai moins aux autres ; et l’opération sera injuste.
Tout bien considéré, je me suis décidé à agir d’une autre manière et selon ce qui m’a paru être juste et raisonnable.
J’ai donc convoqué une grande assemblée de Baratariens et je leur ai parlé ainsi :
Baratariens !
« En examinant comment vous êtes faits et comment je suis fait moi-même, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de ressemblance. Dès lors j’en ai conclu qu’il ne m’était pas plus possible qu’il ne le serait au premier venu d’entre vous de faire votre bonheur à tous ; et je viens vous dire que j’y renonce. N’avez-vous pas des bras, des jambes et une volonté pour les diriger ? Faites donc votre bonheur vous-mêmes.
« Dieu vous a donné des terres ; cultivez-les, façonnez-en les produits. Échangez les uns avec les autres. Que ceux-ci labourent, que ceux-là tissent, que d’autres enseignent, plaident, guérissent, que chacun travaille selon son goût.
« Pour moi, mon devoir est de garantir à chacun ces deux choses : la liberté d’action, — la libre disposition des fruits de son travail.
« Je m’appliquerai constamment à réprimer, où qu’il se manifeste, le funeste penchant à vous dépouiller les uns les autres. Je vous donnerai à tous une entière sécurité. Chargez-vous du reste.
« N’est-ce pas une chose absurde que vous me demandiez autre chose ? Que signifient ces monceaux de pétitions ? Si je les en croyais, tout le monde volerait tout le monde, à Barataria, — et cela par mon intermédiaire !… Je crois, au contraire, avoir pour mission d’empêcher que personne ne vole personne.
« Baratariens, il y a bien de la différence entre ces deux systèmes. Si je dois être, suivant vous, l’instrument au moyen duquel tout le monde vole tout le monde, c’est comme si vous disiez que toutes vos propriétés m’appartiennent, que j’en puis disposer ainsi que de votre liberté. Vous n’êtes plus des hommes, vous êtes des brutes.
« Si je dois être l’instrument au moyen duquel il n’y ait personne de volé, ma mission sera d’autant plus restreinte que vous serez plus justes. Alors je ne vous demanderai qu’un très petit impôt ; alors vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-mêmes de tout ce qui vous arrivera ; en tout cas, vous ne pourrez pas avec justice vous en prendre à moi. Ma responsabilité en sera bien réduite, et ma stabilité d’autant mieux assurée.
« Baratariens, voici donc nos conventions :
« Faites comme vous l’entendrez ; levez-vous tard ou de bonne heure, — travaillez ou vous reposez, — faites ripaille ou maigre chère, — dépensez ou économisez, — agissez isolément ou en commun, entendez-vous ou ne vous entendez pas. Je vous tiens trop pour des hommes, je vous respecte trop pour intervenir dans ces choses-là. Elles ne me sont certes pas indifférentes. J’aimerais mieux vous voir actifs que paresseux, économes que prodigues, sobres qu’intempérants, charitables qu’impitoyables ; mais je n’ai pas le droit, et, en tout cas, je n’ai pas la puissance de vous jeter dans le moule qui me convient. Je m’en fie à vous-mêmes et à cette loi de responsabilité à laquelle Dieu a soumis l’homme.
« Tout ce que je ferai de la force publique qui m’est confiée, c’est de l’appliquer à ce que chacun se contente de sa liberté, de sa propriété, et soit contenu dans les bornes de la justice. »
Voilà ce que j’ai dit, mon cher maître. Vous ayant fait connaître ainsi mes paroles, faits et gestes, je désire savoir ce que vous en pensez avant de répondre au surplus de votre lettre. J’ai d’ailleurs grand besoin de me reposer, car je n’avais encore rien dicté d’aussi long.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FN:En publiant ce court fragment d’une brochure projetée, il est de mon devoir de rapporter une réflexion de l’auteur. Je parlais avec regret, devant lui, peu de jours avant sa mort, de ce projet deux fois formé et deux fois abandonné. Il s’empressa de dire qu’il avait bien fait de laisser là ce sujet, et que, dans l’opinion des masses, l’économie politique n’était que trop entachée de positivisme et d’égoïsme. C’eût été, ajouta-t-il, alimenter ce préjugé défavorable que de placer le langage du bon sens, de la vérité économique dans la bouche de Sancho Pança, et le langage du socialisme, de l’utopie dans la bouche de Don Quichotte. (Note de l’éditeur.)
FN:Nous avions quelque peine à comprendre comment Don Quichotte avait pu citer Rousseau, et il nous est naturellement venu à la pensée que ce pouvait bien être Rousseau qui avait fait des emprunts à Don Quichotte. Mais considérant que l’antiquité est le seul sujet d’étude et d’admiration des modernes, nous préférons croire à une simple coïncidence, qui n’a rien de surprenant.(Note de l’auteur.)
Tous les passages placés entre guillemets ou écrits en italique, sont tirés du Contrat social.(Note de l’éditeur.)
Réponse à divers [1 Jan. 1848] ↩
BWV
1848.01.01 “Réponse à divers” (Reply to Various Other People) [*Libre-Échange*, 1 Janvier 1848] [OC2.24, p. 131]
Réponse à divers
1er Janvier 1848
Un journal émané de la classe laborieuse, la Ruche populaire, fait remonter au travail l’origine de la propriété. On est propriétaire de son œuvre. Nous pensons absolument comme ce journal.
En même temps, il attaque la liberté d’échanger. Nous l’adjurons de dire, la main sur la conscience, s’il ne se sent pas en contradiction avec lui-même. Est-ce être propriétaire de son œuvre que de ne la pouvoir échanger sans blesser l’honnêteté et en payant l’impôt à l’État ? Suis-je propriétaire de mon vin, si je ne le puis céder à un Belge contre du drap, parce qu’il déplaît à M. Grandin que j’use du drap belge ?
Il est vrai que la Ruche populaire ne donne pas d’autre raison de son opposition au libre-échange, si ce n’est qu’il se produit dans notre pays à l’encontre des journaux indépendants. En cela, fait-elle preuve elle-même d’indépendance ? L’indépendance, selon nous, consiste à penser pour soi-même, et à oser défendre la liberté, même à l’encontre des journaux dits indépendants.
La même considération paraît avoir décidé une feuille de Lyon et une autre de Bayonne à se mettre du côté du privilége. « Comment ne serions-nous pas pour le privilége, disent-elles, quand nous le voyons attaquer par les journaux ministériels ? » Donc, si le ministère s’avisait de réformer les contributions indirectes, ces journaux se croiraient tenus de les défendre ? Il est triste de voir les abonnés se laisser traiter avec un tel mépris.
Mais laissons parler le Courrier de Vasconie :
« Il est très-vrai que le Libre-Échange a trouvé pour prôneurs tous les journaux ministériels de France et de Navarre, ce qui prouve, pour nous, une impulsion partie de haut lieu. »
Ce qu’il y a de pire dans ces assertions, c’est que ceux qui se les permettent n’en croient pas un mot eux-mêmes. Ils savent bien, et Bayonne en fournit de nombreux exemples, que l’on peut être partisan de la liberté sans être nécessairement ministériel, sans recevoir l’impulsion de haut lieu. Ils savent bien que la liberté commerciale, comme les autres, est la cause du peuple, et le sera toujours jusqu’à ce qu’on nous montre un article du tarif qui protége directement le travail des bras ; car, quant à cette protection par ricochet dont on berce le peuple, pourquoi les manufacturiers ne la prennent-ils pas pour eux ? pourquoi ne font-ils pas une loi qui double les salaires, en vue du bien qu’il leur en reviendra par ricochet ? Les journaux, auxquels nous répondons ici, savent bien que toutes les démocraties du monde sont pour le libre-échange ; qu’en Angleterre la lutte est entre l’aristocratie et la démocratie ; que la Suisse démocratique n’a pas de douanes ; que l’Italie révolutionnaire proclame la liberté ; que le triomphe de la démocratie aux États-Unis a fait tomber la protection ; que 89 et 93 décrétèrent le droit d’échanger, et que la Chambre du double vote le confisqua. Ils savent cela, et ce sera l’éternelle honte de nos journaux indépendants d’avoir déserté la cause du peuple. Un jour viendra, et il n’est pas loin, où on leur demandera compte de leur alliance avec le privilége, surtout à ceux d’entre eux qui ont commencé par déclarer que la cause du Libre-Échange était vraie, juste et sainte en principe.
Quant à l’accusation, ou conjecture du Courrier de Vasconie, nous lui déclarons qu’elle est fausse. Le signataire du Libre-Échange affirme sur l’honneur qu’il n’a jamais été en haut lieu, qu’il ne connaît aucun ministre, même de vue, qu’il n’a eu avec aucun d’entre eux la moindre relation directe ou indirecte, que ses impulsions ne partent que de ses convictions et de sa conscience.
La liberté a donné du pain aux Anglais [1 Janvier 1848] ↩
BWV
1848.01.01 “La liberté a donné du pain au peuple anglais” (Liberty has given Bread to the English People) [*Libre-Échange*, 1er Janvier 1848] [OC2.30, p. 168]
La liberté a donné du pain au peuple anglais
1er Janvier 1848
La Presse analyse les documents statistiques émanés du Board of trade et constate ces trois faits :
1° Récolte très-abondante de blé ;
2° Importation de viande et de blé toujours croissante et plus considérable aujourd’hui que pendant la disette même ;
3° Affluence des métaux précieux.
À ces trois faits, nous en ajouterons deux autres non moins certains :
4° Le prix du blé n’est pas avili au point de faire supposer qu’on refuse de l’acheter ;
5° Les fermiers sont de toutes les classes laborieuses celle qui se plaint le moins.
Maintenant, des deux premiers faits, il nous semble impossible de ne pas tirer cette conclusion, que le peuple d’Angleterre est mieux nourri qu’il ne l’était autrefois.
Si la récolte a été abondante, s’il arrive du dehors des avalanches de blé, et si cependant tout se vend comme l’indique la fermeté des prix, la Presse peut en être contrariée, mais enfin elle ne peut se refuser à reconnaître qu’on mange en Angleterre plus de pain que jamais. (V. le n° 20.)
Et ceci nous montre que le peuple anglais a dû bien souffrir avant la réforme des tarifs, et qu’il n’avait pas si tort de se plaindre, puisque, quand les récoltes étaient moins abondantes, et que néanmoins l’importation était défendue, il devait y avoir nécessairement en Angleterre moins de pain qu’aujourd’hui dans une énorme proportion.
Qu’on raisonne tant qu’on voudra sur les autres effets de la réforme, celui-ci est du moins certain : le peuple est mieux nourri ; et c’est quelque chose.
Protectionnistes, démocrates, socialistes, généreux patrons des classes souffrantes, vous qui vous remplissez sans cesse la bouche des mots philanthropie, générosité, abnégation, dévouement ; vous qui gémissez sur le malheureux sort de nos voisins d’outre-Manche qui voient les métaux précieux abandonner leurs rivages, avouez du moins que ce malheur, s’il existe, n’est pas sans compensation.
Vous disiez qu’en Angleterre les riches étaient trop riches, et les pauvres trop pauvres ; mais voici, ce nous semble, une mesure qui commence à rapprocher les rangs ; car si l’or s’en va, ce n’est pas de la poche des pauvres qu’il sort, et si la consommation du blé dépasse tout ce qu’on aurait pu prévoir, ce n’est pas dans l’estomac du riche qu’il s’engloutit.
Mais, quoi ! il n’est pas même vrai que le numéraire s’exporte. Vous constatez vous-mêmes qu’il rentre à pleins chargements.
Moralité. Quand les hommes qui font la loi veulent se servir de leur puissance pour ôter à leurs concitoyens la liberté, cette maudite liberté, cette liberté si impopulaire aujourd’hui auprès de nos démocrates, — ils devraient au moins commencer par avouer qu’elle donne du pain au peuple, et affirmer ensuite, s’ils l’osent, que c’est là un affreux malheur.
Septième discours, à Paris [7 Jan 1848] ↩
BWV
1848.01.07 “Septième discours, à Paris” (Seventh Speech given in Paris in the Montesquieu Hall) [Paris, salle Montesquieu, 7 Janvier 1848] [OC2.48, p. 311]
Septième discours, à Paris, salle Montesquieu
7 Janvier 1848
Messieurs, je me propose de démontrer que le libre-échange est la cause, ou du moins un des aspects de la grande cause du peuple, des masses, de la démocratie.
Mais, avant, permettez-moi de vous citer un fait qui vient à l’appui de la proposition que vient de développer avec tant de chaleur et de talent mon ami M. Coquelin.
J’ai visité à Marseille les ateliers d’un grand fabricant de machines. Cette entreprise se faisait d’abord sur de faibles dimensions, et vous en devinez le motif : le fer est fort cher en France ; il est dans la nature de la cherté de diminuer la consommation, et l’on ne peut pas faire beaucoup de machines et de navires en fer là où le haut prix de la matière première restreint l’usage de ces choses. L’établissement n’avait donc qu’une médiocre importance, lorsque le chef se décida à demander l’autorisation de travailler à l’entrepôt. Vous savez, messieurs, ce que c’est que travailler à l’entrepôt. C’est mettre en œuvre des matières que l’on va chercher partout où on les trouve au plus bas prix, à la condition, soit d’exporter le produit, soit de payer le droit de douane, si on le livre à la consommation française.
Dès cet instant la fabrique prit des proportions considérables, et il fallut bientôt lui adjoindre une succursale. Les machines qui en sortent, faites avec du fer anglais ou suédois, vont se vendre sur les marchés extérieurs, en Italie, en Égypte, en Turquie, où elles rencontrent la concurrence étrangère. Et puisque l’établissement prospère, puisqu’il occupe 1,000 à 1,200 ouvriers français, c’est une preuve sans réplique que notre pays n’est pas affligé de cette infériorité dont on parle sans cesse, même à l’égard d’une fabrication où les Anglais excellent.
C’est là du libre-échange, mais, remarquez bien ceci, du libre-échange absolu quant au côté onéreux, et fort incomplet quant au côté favorable à cet établissement.
En effet, le manufacturier dont je parle ne jouit d’aucune espèce de privilége pour la vente sur les marchés neutres. Mais, pour la fabrication, il est loin de posséder tous les avantages de la liberté.
D’abord, ni lui ni ses ouvriers ne reçoivent en franchise les objets de leur consommation personnelle, comme les Anglais. Ensuite, on ne travaille à l’entrepôt qu’à la condition de se soumettre à beaucoup d’entraves. La douane estampille tout le fer étranger, et, en le manipulant, il faut s’y prendre de manière à laisser paraître le poinçon sacré, ce qui entraîne beaucoup de fausses manœuvres et de déchets. Enfin, la houille et l’outillage ont payé d’énormes droits.
Malgré cela, la fabrique prospère ; et, chose bien remarquable, elle emploie aujourd’hui plus de fer national qu’elle n’en consommait avant d’être autorisée à mettre en œuvre du fer étranger. Pourquoi ? Parce qu’alors ce n’était qu’un établissement mesquin, et aujourd’hui c’est une usine considérable ; parce qu’elle a décuplé ses produits, et que le fer français étant nécessaire pour certaines pièces il en entre plus partiellement dans dix machines qu’il n’en entrait exclusivement dans une seule.
Voilà qui est assez satisfaisant pour notre pays, mais voici qui l’est beaucoup moins.
Quand un acquéreur se présente, notre manufacturier écoute attentivement de quelle manière il prononce le mot machine, car cela a une grande influence sur la transaction qui doit suivre.
Si le client dit : Combien cette maquina ou macine ? le manufacturier répond : 20,000 francs. Mais si le client a le malheur d’articuler en bon français machine, on lui demande sans pitié 30,000 francs. Pourquoi cette différence ?
Quel rapport y a-t-il entre le prix de la machine et la manière dont le mot se prononce ? Il y en a un très-intime ; et notre fabricant, qui a beaucoup de sagacité, devine que le client qui dit macine est un Italien, et que le client qui dit machine est un Français. Or le Français, en qualité de citoyen protégé (rire prolongé), doit payer un travail exécuté en France un tiers de plus que l’étranger ; car si la machine entre dans la consommation française, elle a 33 p. 100 de droits à acquitter, d’où il résulte que les étrangers nous battent avec nos propres armes. Mais que voulez-vous ? la protection est une si bonne chose, qu’il faut bien subir quelques inconvénients pour elle. Nous aurions tort de nous plaindre, puisque nous sommes protégés, battus et contents. (Bruyante hilarité.)
Messieurs, cette machine française, vendue plus cher à nos compatriotes qu’aux étrangers, me met sur la voie d’une autre considération fort importante que je crois devoir vous soumettre.
Vous avez sans doute entendu dire que l’une des raisons qui rendent la concurrence anglaise si redoutable, c’est la supériorité des capitaux britanniques. Il y a un grand nombre de personnes qui disent : C’est ce capital anglais qui nous effraie. Sous tous les autres rapports, beauté du climat, fertilité du sol, habileté des ouvriers, nous avons des avantages réels ; et, quant au fer et à la houille, nous les aurions, par la liberté, au même prix, à très-peu de chose près, que nos rivaux eux-mêmes. Mais le capital, le capital, comment lutter contre ce colosse ?
Messieurs, je crois que je pourrais prouver que la richesse d’un peuple n’est pas nuisible à l’industrie d’un peuple voisin, par la même raison que la richesse de Paris n’a pas fait tort aux Batignolles. Mais j’accepte l’objection. Admettons que l’infériorité de notre capital nous place vis-à-vis des Anglais dans une position fâcheuse. Je vous le demande, serait-ce un bon moyen de rétablir l’équilibre que de frapper d’inertie une partie de notre capital déjà si chétif ? Si vous me disiez : Comme notre capital est fort exigu, il faut tâcher de faire rendre à 100,000 francs autant de services qu’à 120.000, je vous comprendrais. Mais que faites-vous ? Autant de fois il y a 100,000 francs en France, autant de fois, par la protection, vous les transformez en 80,000 fr. Est-ce là un bon remède au mal dont vous vous plaignez ? Est-ce là un bon moyen de rétablir l’équilibre entre les capitaux français et anglais ?
Je suppose qu’un manufacturier de Rouen et un manufacturier de Manchester élèvent, en même temps, chacun une usine, conçues absolument sur le même plan, destinées à donner exactement les mêmes produits ; enfin, identiques en tout.
Ne voyez-vous pas qu’il faudra au Rouennais un capital beaucoup plus considérable, par le fait du régime protecteur ? Il lui faudra un plus grand capital fixe, puisque ses bâtisses et ses machines lui coûteront plus cher. La disproportion sera plus grande encore dans le capital circulant, puisque, pour mettre en mouvement, la même quantité de coton, de bouille, de teinture, on devra faire de plus grandes avances en France qu’en Angleterre. En sorte que si l’Anglais peut commencer l’opération avec 400,000 francs, il en faudra 600,000 au Français.
Et remarquez que cela se répète pour toutes les opérations, depuis la plus gigantesque jusqu’à la plus humble, car il n’y a si mince atelier où l’outillage n’exige, en France, une plus forte dépense à cause du régime protecteur.
Maintenant, si chaque entrepreneur français, grand ou petit, faisait son inventaire, on trouverait que la France, dans un moment donné, a un capital déterminé. Donc, si dans chaque entreprise le capital est plus grand qu’il ne devrait être pour l’effet produit, il s’ensuit rigoureusement que le nombre des entreprises doit être moindre, à moins que l’on n’aille jusqu’à prétendre que, d’un tout connu, on peut tirer un égal nombre de fractions, soit qu’on les tienne grandes ou petites.
Le résultat est donc un moins grand nombre d’entreprises, une moins grande quantité de matière mise en œuvre, un moins grand nombre de produits, et par suite, plus d’ouvriers se faisant concurrence sur la place, diminution de travail et de salaires. Singulière façon de rétablir l’équilibre entre le capital français et le capital anglais ! Autant vaudrait garder la liberté et jeter un quart de nos capitaux dans la rivière. Et c’est là ce qu’on appelle mettre notre pays à même de lutter à forces égales.
C’est bien pis encore si nous considérons l’industrie agricole ; et jamais il n’y eut mystification plus grande que celle qui nous fait voir, dans la restriction, un moyen de favoriser l’agriculture.
Vous savez, Messieurs, que les terres s’achètent d’autant plus cher qu’elles donnent plus de revenu. C’est encore là une généralité, et c’est précisément pourquoi c’est une vérité.
Cela posé, admettons que les restrictions imaginées par la Chambre du double vote aient réussi à maintenir, en France, le prix du blé à un taux un peu plus élevé, un franc, par exemple, en moyenne. Il est clair que si ces mesures n’ont pas eu ce résultat, elles ont été inefficaces et ont créé des entraves inutiles, ce dont nos adversaires ne conviennent pas. Pour les combattre, il faut raisonner dans leur hypothèse. Mettons donc que le blé, qui se serait vendu 19 francs sous un régime libre, s’est vendu 20 francs sous le système protecteur.
L’hectare de terre, qui produit dix hectolitres, a donc donné 10 francs de plus par an. Il peut donc se vendre 200 francs plus cher, à 5 p. 100, à supposer que ce soit le taux auquel les terres se vendent.
Ainsi, le propriétaire a été plus riche de 200 francs en capital, et la rente lui en a été servie par ceux qui mangent du pain, lesquels ont payé les dix hectolitres de blé au prix de 20 francs chaque au lieu de 19.
Quant à l’agriculture, elle n’a pas été le moins du monde encouragée. Qu’importe au fermier de vendre ce blé 19 francs, en payant 10 francs de moins, ou de le vendre 20 francs, en payant 10 francs de plus au propriétaire ? Il n’y a pas un centime de différence dans sa rémunération, et ce prétendu encouragement ne lui fera pas produire un grain de blé de plus. Tout cela aboutit à cette chose véritablement monstrueuse : supposer au propriétaire de cet hectare de terre un capital fictif de 200 francs, et lui en faire servir la rente par quiconque mange du pain. Il eût été beaucoup plus simple de lui donner un titre pour aller loucher 10 francs tous les ans à la rue de Rivoli, en votant en même temps un impôt spécial pour ce service. Ah ! croyons que les électeurs à 1,000 francs savaient ce qu’ils faisaient.
Je voulais parler, Messieurs, sur la connexité qu’il y a entre le libre-échange et la cause démocratique ; et je crois vraiment que la digression à laquelle je viens de me livrer ne m’a pas trop écarté de mon sujet. Je regrette seulement que le temps qu’elle a pris ne me permette plus de donner à ma pensée tout le développement dont elle est susceptible.
Messieurs, en fondant notre Association, nous avons eu un but spécial, et notre première règle est de ne pas nous occuper d’autre chose. Nous ne nous demandons pas les uns aux autres notre profession de foi sur des matières étrangères au but précis de l’Association ; mais cela ne veut pas dire que chacun de nous ne réserve pas complétement ses convictions et ses actes politiques. Il n’a pu entrer dans notre pensée d’aliéner ainsi notre indépendance ; et comme je ne serais nullement choqué qu’un de mes collègues vînt déclarer ici qu’il est ce qu’on appelle conservateur, je ne vois aucun inconvénient à dire que, quant à moi, j’appartiens, cœur et âme, à la cause de la démocratie, si l’on entend par ce mot le progrès indéfini vers l’égalité et la fraternité, par la liberté. D’autres ajoutent : Et par l’association, — soit ; pourvu qu’elle soit volontaire ; auquel cas, c’est toujours la liberté.
Messieurs, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans des considérations métaphysiques sur la liberté, mais permettez-moi seulement une observation. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que toutes les sociétés modernes ont leur point de départ dans l’esclavage, dans un état de choses où un homme avec ses facultés, les fruits de son travail et sa personnalité tout entière, était la propriété d’un autre homme. L’esclave n’a pas de droits, ou au moins il n’a pas de droits reconnus. Sa parole, sa pensée, sa conscience, son travail, tout appartient au maître.
Le grand travail de l’humanité, travail préparatoire si l’on veut, mais qui absorbe ses forces jusqu’à ce qu’il soit accompli, c’est de faire tomber successivement ces injustes usurpations. Nous avons reconquis la liberté de penser, de parler, d’écrire, de travailler, d’aller d’un lieu à un autre ; et c’est la réunion de toutes ces libertés, avec les garanties qui les préservent de nouvelles atteintes, qui constitue la liberté !
La liberté n’est donc autre chose que la propriété de soi-même, de ses facultés, de ses œuvres.
Or, Messieurs, sommes-nous propriétaires de nos œuvres si nous n’en pouvons disposer par l’échange, parce que cela contrarie un autre homme ? Si, à force de soins et de travail, j’ai produit une chose, un meuble, par exemple, en suis-je le vrai propriétaire si je ne le puis envoyer en Belgique pour avoir du drap ? Et remarquez qu’il importe peu que l’échange se fasse ainsi directement. Qu’il me convienne d’envoyer ce meuble en Belgique pour l’échanger contre du drap, ou en Angleterre pour recevoir une lettre de change, ou en Arabie pour recevoir du café, ou au Pérou pour recevoir de l’or, — qui me servent à acquitter le drap belge, — si mes membres m’appartiennent, si les garantir du froid est une affaire qui me regarde, je dois être libre de choisir entre ces divers moyens de me procurer des vêtements. Lorsqu’un tiers s’interpose entre mes membres et moi et a la prétention de m’imposer la manière la plus dispendieuse de me vêtir, parce que cette interposition qui me nuit lui profite, il porte atteinte à ma propriété, à ma liberté. Non-seulement il m’empêche de recevoir le drap belge, mais du même coup il m’empêche implicitement de fabriquer le meuble, ou il diminue l’avantage que j’ai à le faire. Je ne suis plus un homme libre, mais un homme exploité ; nous sommes dans le principe de l’esclavage, esclavage fort adouci dans ses formes, fort adroit, fort subtil, dont peut-être ni celui qui en souffre ni celui qui en profite n’ont la conscience, mais qui n’en est pas moins de l’esclavage. (Sensation marquée.)
Et, Messieurs, voulez-vous que la chose vous paraisse sensible ? Imaginez-vous que cette interposition s’opère en dehors de la loi. Figurez-vous que les fabricants de drap et de coton se présentent devant la législature, et qu’ils tiennent aux députés ce langage : « Il nous est venu dans l’idée qu’il y a trop de draps et de calicots dans le pays ; que si l’on chassait les produits étrangers, nos articles seraient très-recherchés et hausseraient de prix, ce qui serait un grand avantage pour nous. Nous venons vous demander de placer des hommes sur la frontière aux frais du Trésor, pour repousser les draps et les calicots. » Supposons que les députés répondent : « Nous comprenons que cette mesure serait très-lucrative pour vous ; mais, en bonne conscience, nous ne pouvons faire supporter au public les frais de l’opération. Si le drap belge vous importune, chassez-le vous-mêmes, c’est bien le moins. » (Rires.)
Si, en conséquence de cette résolution, messieurs les fabricants faisaient garder la frontière par leurs domestiques, s’ils vous interdisaient ainsi et les moyens de vous pourvoir au dehors et les moyens d’y envoyer le fruit de votre travail, ne seriez-vous pas révoltés ?
Eh quoi! vous croyez-vous dans une position plus brillante et surtout plus digne, parce que messieurs les prohibitionnistes ont obtenu beaucoup plus, — parce que la législature met le Trésor public à leur disposition, et vous fait payer à vous-mêmes ce qu’il en coûte pour vous ravir votre liberté ? (Vive émotion.) Un homme célèbre a dit : La France est assez riche pour payer sa liberté ; la France est assez riche pour payer sa gloire. Dira-t-on aussi : La France est assez riche pour payer ses chaînes ? (Rires.)
Mais, Messieurs, étudions la question non plus économiquement, mais géographiquement. Si la restriction a été imaginée dans l’intérêt des masses, la liberté doit être un produit aristocratique, quoique assurément ces deux mots, liberté, aristocratie, hurlent de se trouver ensemble.
Voici d’abord la Suisse : c’est le pays le plus démocratique de l’Europe. Là, l’ouvrier a un suffrage qui pèse autant que celui de son chef. Et la Suisse n’a pas voulu de douane même fiscale.
Ce n’est pas qu’il ait manqué de gros propriétaires de champs et de forêts, de gros entrepreneurs qui aient essayé d’implanter en Suisse la restriction. Ces hommes qui vendent des produits disaient à ceux qui vendent leur travail : Soyez bonnes gens ; laissez-nous renchérir nos produits, nous nous enrichirons, nous ferons de la dépense, et il vous en reviendra de gros avantages par ricochet. (Hilarité.) Mais jamais ils n’ont pu persuader au peuple suisse qu’il fût de son avantage de payer cher ce qu’il peut avoir à bon marché. La doctrine des ricochets n’a pas fait fortune dans ce pays. Et, en effet, il n’y a pas d’abus qu’on ne puisse justifier par elle. Avant 1830, on pouvait dire aussi : C’est un grand bonheur que le peuple paye une liste civile de 36 millions. La cour mène grand train, et l’industrie profite par ricochet…
En vérité, je crois que, dans certain petit volume, j’ai négligé d’introduire un article intitulé : Sophisme des ricochets.
Je réparerai cet oubli à la prochaine édition [1]. (Hilarité prolongée.)
Nos adversaires disent que l’exemple de la Suisse ne conclut pas, parce que c’est un pays de montagnes. (Rires.)
Voyons donc un pays de plaines.
La Hollande jouissait en même temps de la liberté politique et de la liberté commerciale ; et, comme le disait tout à l’heure notre honorable président, elle regrette ce régime de libre-échange, sous lequel elle était devenue, malgré l’infériorité de sa position, un des pays les plus florissants et même les plus puissants de l’Europe.
Voyez encore l’Italie. A l’aurore de son affranchissement sa première pensée — non, sa seconde pensée, la première est pour l’indépendance nationale (applaudissements) — sa seconde pensée est pour la liberté du commerce et la destruction de tous les monopoles.
Traversons l’Océan. Vous savez que l’Amérique septentrionale est une démocratie. Il y a cependant des nuances, il y a le parti whig et le parti populaire. L’un veut la restriction, l’autre la liberté. Ce dernier a triomphé, en 1846, et a porté M. Polk à la présidence. Tout l’effort de la lutte a porté précisément sur cette question des tarifs ; et, malgré la résistance acharnée des whigs, résistance poussée jusqu’à cette limite après laquelle il n’y a plus que la guerre civile, le principe de la protection a été exclu du tarif. Quel a été le résultat ? Vous le savez ; le président Polk l’a hautement proclamé dans son message. Mais que dis-je ? non, vous ne le savez pas, car la traduction qu’ont donnée de ce document nos journaux, à commencer par le Moniteur, est très-habilement arrangée pour vous égarer.
[Ici l’orateur donne lecture du message et compare les traductions.]
Je dois cependant dire que d’autres journaux, entre autres le National, ont reproduit les passages supprimés par le Moniteur et la Presse. Mais, hélas ! par je ne sais quelle fatalité, le National a omis ce qui intéressait le plus son public, les paragraphes qui se rapportent à la marine marchande et à la hausse des salaires.
Enfin, Messieurs, que se passe-t-il en Angleterre ? N’est-il pas de notoriété publique que c’est la démocratie qui réalise la liberté commerciale, et que l’aristocratie lui oppose une résistance désespérée ? Ignorez -vous que les lords anglais, ces vigilants conservateurs de tout ce qui porte quelque stigmate de féodalité, ont rejeté d’au milieu d’eux et chassé du pouvoir sir R. Peel lui-même, leur général, pour avoir, en présence de la famine, laissé entrer le blé étranger ?
J’ai nommé l’Angleterre. C’est un sujet que les passions du jour rendent délicat ; l’heure avancée ne me permettant pas de dire ma pensée tout entière, j’aime mieux m’abstenir. Sans cela, croyez que je m’expliquerais ouvertement ; car je ne crois pas qu’un acte d’indépendance puisse être mal accueilli devant un auditoire français. Je ne crains pas d’être réfuté, je ne crains pas d’être critiqué ; mais il m’est bien permis de craindre d’être mal compris. (Approbation.)
Je dirai cependant que l’aristocratie britannique a la vue longue. Elle sait tout ce que la liberté commerciale porte dans ses flancs. Elle sait que c’est la fin du régime colonial, la mort de l’acte de navigation, le renversement de sa diplomatie traditionnelle, le terme de sa politique envahissante et jalouse. Ce qu’elle regrette, ce n’est pas seulement le monopole du blé, c’est un autre monopole qu’elle voit compromis, l’exploitation de l’armée, de la marine, des gouvernements lointains et des ambassades. Aussi la voyons-nous en ce moment même pousser un ridicule cri d’alarme. À l’entendre, l’Angleterre est au moment d’être envahie. Il faut courir aux armes, multiplier les places fortes, les bataillons, les vaisseaux de guerre, c’est-à-dire les Commodores et les colonels (on rit), en un mot les charges publiques, son riche domaine. Selon sa tactique constante, elle essaye de mettre le peuple de son côté, en réveillant ses plus mauvais instincts, en faussant en lui le sentiment national.
Voilà le spectacle que nous offre aujourd’hui même l’aristocratie anglaise. Mais les hommes éclairés de la démocratie ont les yeux ouverts sur ces menées. Ils ne laisseront pas ce déploiement de force brutale, venant à la suite des mesures de l’année dernière, aller dans toute l’Europe décréditer et amoindrir le libre-échange. Il y a quelques mois, M. Cobden paraissait rassasié par la reconnaissance publique. Et aujourd’hui le voilà affrontant une impopularité passagère, parce qu’il réclame, avec le libre-échange, toutes les conséquences du libre-échange, c’est-à-dire un changement complet dans la politique de son pays, et le bienfait du désarmement, suivi de l’allégement des taxes publiques. Il rentre dans l’agitation ; car il s’aperçoit que son œuvre est incomplète, et qu’après avoir fait triompher le libre-échange dans les lois, il lui reste à faire pénétrer l’esprit du libre échange dans les cœurs. Et je dis que quiconque ne sympathise avec ses nobles efforts n’a pas l’intelligence de l’avenir. (Applaudissements prolongés.) (V. tome III, pages 459 à 492.)
Mais qu’ai-je besoin de chercher des exemples au dehors ? Pour montrer que notre cause est celle des masses, ne suffit-il pas de jeter un coup d’œil sur notre histoire contemporaine ? Il y en a, parmi vous, qui ont pu voir les éléments démocratique et aristocratique parvenir à leur apogée, je dirai même à leur exagération, l’un en 93, l’autre en 1822. La Convention la Chambre du double vote, voilà les points extrêmes des deux principes. Or, qu’ont fait ces assemblées ? L’une a mis toutes les restrictions à la sortie des produits, l’autre à leur entrée.
Je ne nie pas qu’il n’y eût des prohibitions à l’entrée sous la République. Elles furent établies, comme mesures de guerre, par un décret d’urgence du Comité de salut public.
Mais quant au tarif, permettez-moi de vous dire dans quel esprit il était conçu.
En 93, les législateurs étaient nommés par la foule. On peut même dire qu’ils étaient sous la dépendance immédiate, constante, ombrageuse de la foule. Aussi, à quel résultat aspire le tarif ? À créer la plus grande abondance possible des aliments, des vêtements et de tous les objets de consommation générale. Pour atteindre ce but, que fait-on ? On décrète que toutes les choses vraiment utiles pourront librement entrer ; et afin que la masse n’en soit pas ébréchée par l’exportation, on décrète qu’elles ne pourront pas sortir.
Certes, Messieurs, je ne justifie pas cette dernière mesure. C’est une atteinte à la propriété, à la liberté, au travail ; et je suis convaincu qu’elle allait contre le but qu’on avait en vue.
Mais il n’en reste pas moins que toute la préoccupation du législateur, à cette époque, était de mettre la plus grande abondance possible à la portée du peuple ; et pour cela il allait jusqu’à violer la propriété.
Voici quelques articles entièrement exempts de droits à l’entrée :
Bestiaux de toutes sortes, grains de toutes sortes, beurres frais, fondu et salé, bois de toutes sortes, chair salée de toutes sortes, chanvre, même apprêté, charbon de bois, coton en rame et en laine, cuivre, fer en gueuse et tenaille (le fer en barre payait 1 franc par quintal, l’acier 1 fr. 50 c), laines, lard frais, légumes, lin teillé ou apprêté, mais de vaisseaux, suif, etc., et les farines de toutes sortes sauf la farine d’avoine. Et voyez, Messieurs, quelle minutieuse sollicitude se révèle jusque dans cette singulière exception.
Pourquoi exclure seulement la farine d’avoine ? Cela ne peut s’expliquer que par la crainte que les spéculateurs ne mêlassent à la nourriture du peuple un ingrédient grossier indigne de l’homme.
Maintenant voici quelques articles dont la sortie est entièrement prohibée :
Argent et or, bestiaux, matières résineuses, chanvre, coton en laine, cuirs, cuivre, grains et farines de toutes sortes, laines, lins, engrais, matières premières du papier, suif, etc., etc.
Messieurs, le peuple de 93 n’était pas plus profond économiste que celui de 1822 ; mais on le consultait alors. On lui demandait : Veux-tu qu’on taxe le froment étranger afin d’élever le prix du froment naturel ? Et, avec ce bon sens que je vous ai signalé chez les Suisses, il répondit : Non. (Rire général.)
Une preuve que ce n’est pas le progrès de l’économie politique qui dirigeait le législateur en veste, c’est un article bien remarquable que je dois encore vous lire.
On voulait tout laisser entrer ; on ne voulait rien laisser sortir. C’était une contradiction. Évidemment pour recevoir, il faut payer. On se condamnait donc à tout payer en or. Mais à cette époque, comme aujourd’hui, on était convaincu que la sortie de l’or est une calamité publique. Comment donc échapper à la difficulté ?
On décréta qu’il serait défendu, sous des peines sévères (en harmonie avec les mœurs de l’époque), d’exporter de l’or, « à moins qu’on ne prouve, dit le décret, qu’on en fait entrer la contre-valeur en objets nécessaires à la consommation du peuple ; » et à la suite on désigne toujours les mêmes objets : Bestiaux, grains, farines, lin, suifs, etc.
En sorte que, pendant que nous justifions l’exclusion des choses utiles par la peur que l’or ne sorte, les importer était le motif même pour lequel la Convention permettait la sortie de l’or.
1822 arriva, et avec lui le triomphe de la grande propriété, le principe aristocratique, la Chambre du double vote.
Et que fait-elle, cette Chambre ? Précisément le contraire de ce qu’avait fait la Convention. Elle s’oppose à l’entrée des produits pour en provoquer la cherté, et, par le même motif, elle en favorise la sortie.
Se peut-il concevoir deux législations plus opposées et qui, dans leur exagération, portent plus manifestement l’empreinte de leur origine ? L’une pousse la passion démocratique jusqu’à violer la propriété du riche, dans l’intérêt mal entendu du pauvre ; l’autre pousse la passion aristocratique jusqu’à violer la propriété du pauvre, dans l’intérêt mal entendu du riche ! (Sensation.)
Pour nous, nous disons : La justice est dans la liberté du travail et de l’échange. (Applaudissements.)
En présence de ces faits, en présence du triomphe de l’élément aristocratique qui éclate dans notre tarif, est-il rien de plus surprenant et de plus triste, Messieurs, que de voir une partie considérable du parti démocratique, en France, porter toutes ses forces et toutes ses sympathies du côté de la restriction? (V. les nos 17, 18, 19, 22 et 23.)
Comment les chefs de ce bizarre mouvement expliquent-ils ce que je puis bien appeler cette désertion de la cause du peuple ?
Ils disent qu’ils se défient de notre association, parce qu’il y a dans son sein des conservateurs ! Mais n’y en a-t-il pas parmi les protectionnistes ?
Mais, Messieurs, quand on fonde une association dans un but spécial, a-t-on à demander aux associés leur profession de foi sur des objets étrangers au but de l’Association ? Pourquoi les hommes de la démocratie ne sont-ils pas venus à nous ? Ils auraient été certainement bien accueillis, à la seule condition de ne pas vouloir détourner l’Association de son but.
N’est-il pas aisé de voir d’ailleurs comment le libre-échange peut attirer les sympathies des conservateurs sincères ? Je dis sincères, car celui qui n’est pas sincère n’est d’aucun parti, il n’est rien. Mettons-nous à leur point de vue ; ils doivent raisonner ainsi : Ce que nous redoutons avant tout, c’est le désordre et l’anarchie. Et quel meilleur moyen de prévenir le désordre que de diminuer les souffrances du pauvre, que de mettre à sa portée la plus grande quantité possible d’objets de consommation, que de l’élever ainsi non-seulement en bien-être, mais en dignité, que d’alléger le poids de ses charges ? Et comment diminuer sérieusement les impôts sans diminuer l’armée ? Et comment diminuer l’armée, tant que les jalousies commerciales tiennent l’éventualité d’une guerre toujours suspendue sur nos têtes ?
Les chefs de l’opposition disent encore que nous avons raison en principe (on rit), ce qui ne signifie absolument rien, si cela ne veut dire que nous avons pour nous la vérité, le droit, la justice et l’utilité générale. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas avec nous ? C’est, disent-ils, qu’avant d’adopter le libre-échange, la France a une grande mission à remplir, celle de propager et faire triompher en Europe l’idée démocratique.
Eh ! Messieurs, est-ce que le libre-échange est un obstacle à cette propagande ? Est-ce que notre principe n’aura pas de plus belles chances quand les étrangers pourront venir librement en France puiser des produits et des idées, quand nous pourrons librement leur porter nos idées et nos produits ?
Veut-on insinuer que la France doit accomplir sa mission par les armes ? Alors, je l’avoue, on a raison de repousser le libre-échange ; mais il reste à prouver que l’on peut faire pénétrer la vérité dans les cœurs à la pointe de la baïonnette.
Messieurs, la propagande n’a que deux instruments efficaces et légitimes, la persuasion et l’exemple. La persuasion, la France en a le noble privilége par la supériorité de sa littérature et l’universalité de sa langue. Et, quant à l’exemple, il dépend de nous de le donner. Soyons le peuple le plus éclairé, le mieux gouverné, le mieux ordonné, le plus exempt de charges, d’entraves et d’abus, le plus heureux de la terre. Voilà la meilleure propagande.
Et c’est parce que la libre communication des peuples nous parait un des moyens les plus efficaces d’atteindre ces résultats, que nous en appelons à vous pour nous aider à tenir haut et ferme le drapeau du Libre-Échange.
FN:V. tome V. page 13, pages 80 à 83, et au même tome, page 336, le pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. (Note de l’éditeur.)
Les armements en Angleterre [15 Janvier 1848] ↩
BWV
1848.01.15 “Les armements en Angleterre” (Armaments in England) [*Libre-Échange*, 15 Janvier 1848] [OC2.34, p. 194]
Les armements en Angleterre
15 Janvier 1848
S’il n’y avait pas, quoi qu’on en dise, dans un principe, dans la vérité, plus de force que dans un fait contingent et éphémère, rien ne serait plus affligeant, plus décourageant pour les défenseurs de la liberté commerciale sur toute la surface du globe, que cette perversion étonnante et momentanée de l’esprit public dont l’Angleterre nous donne en ce moment le spectacle. Elle se prépare à augmenter son armée et sa marine.
Disons-le d’abord, nous avons la confiance, la certitude même que la liberté commerciale tend à accroître et à égaliser le bien-être au sein de toute nation qui l’adoptera ; mais ce motif, quoique grave, n’est pourtant pas le seul qui nous ait déterminés à consacrer nos efforts au service de cette cause. Ce n’est même pas, il s’en faut de beaucoup, le plus puissant.
Nous sommes profondément convaincus que le libre-échange, c’est l’harmonie des intérêts et la paix des nations ; et certes nous plaçons cet effet indirect et social mille fois au-dessus de l’effet direct ou purement économique.
Car la paix assurée des nations, c’est le désarmement, c’est le discrédit de la force brutale, c’est la révision, l’allégement et la juste répartition des taxes publiques, c’est, pour les peuples, le point de départ d’une ère nouvelle.
Supposant donc que la nation qui proclame la première le libre-échange était pénétrée et imbue de l’esprit du libre-échange, nous nous croyons fondés à penser qu’elle serait aussi la première à réduire son état militaire.
La raison dominante des onéreux efforts auxquels les nations modernes se soumettent, dans le sens du développement de la force brutale, étant manifestement la jalousie industrielle, l’ambition des débouchés exclusifs et le régime colonial, il nous paraissait absurde, contradictoire, qu’un peuple voulût se soumettre à l’aggravation de ce lourd fardeau militaire, précisément au moment où, par d’autres mesures, il rend ce fardeau irrationnel et inutile.
Nous concevrions, sans l’approuver, que l’Angleterre armât si elle avait des craintes pour ses colonies, ou l’arrière-pensée d’en acquérir de nouvelles.
Mais, quant à ses possessions actuelles, jamais elle n’a eu moins raison de craindre, puisqu’elle entre dans un système commercial qui ôte aux nations rivales tout intérêt à s’en emparer.
Quelle raison aura la France de se jeter dans les hasards d’une guerre pour conquérir le Canada ou la Jamaïque, quand, sans aucuns frais de surveillance, d’administration et de défense, elle pourra y porter ses produits sur ses propres navires, y accomplir ses ventes, ses achats et ses transactions aux mêmes conditions que les Anglais eux-mêmes ?
S’il plaît aux Anglais de s’imposer tous les frais du gouvernement de l’Inde, quel motif aurons-nous de leur disputer, l’arme au poing, ce singulier privilége, quand, du reste, par la liberté des échanges, nous retirerons du commerce de l’Inde tous les avantages dont pourrait nous investir la possession elle-même ?
Tant que les Anglais nous excluent, nous et les autres peuples, d’une partie considérable de la surface du globe, c’est une violence ; et il est clair que toute violence, constamment menacée, ne se maintient qu’à l’aide de la force. Armer, dans cette position, c’est une nécessité fatale ; ce n’est pas au moins une inconséquence.
Mais armer pour défendre des possessions qu’on ouvre au libre commerce du monde entier, c’est planter un arbre et en rejeter soi-même les fruits les plus précieux.
Est-ce pour voler à de nouvelles conquêtes que l’Angleterre renforce ses escadres et ses bataillons ?
Cela peut entrer dans les vues de l’aristocratie. Elle recouvrerait par là plus qu’elle n’a perdu dans le monopole du blé ! Mais de la part du peuple travailleur, c’est une contradiction manifeste.
Pour justifier de nouvelles conquêtes, même aux yeux de sa propre ambition, il faudrait commencer par reconnaître qu’on s’est bien trouvé des conquêtes déjà accomplies. Or, on y renonce, et on y renonce, non par abnégation, mais par calcul, mais parce qu’en posant des chiffres on trouve que la perte surpasse le profit. Le moment ne serait-il pas bien choisi pour recommencer l’expérience ?
En agissant ainsi, le peuple anglais ressemblerait à ce manufacturier qui, à côté d’une ancienne usine, en élevait une nouvelle. Il renouvelait toutes les machines du vieil établissement, parce que, les jugeant mauvaises, il voulait les remplacer par un mécanisme plus perfectionné, et, en même temps, il faisait construire à grands frais des machines de l’ancien modèle pour le nouvel établissement.
Dans l’esprit du système exclusif, un peuple augmente ses colonies pour élargir le cercle de ses débouchés privilégiés ; mais lorsqu’il s’aperçoit enfin que c’est là une politique décevante ; lorsqu’il est forcé par son propre intérêt d’ouvrir au commerce du monde les colonies déjà acquises : lorsqu’il renonce par calcul à la seule chose qui les lui avait fait acquérir, le privilége, ne faudrait-il pas qu’il fût frappé de vertige pour songer à augmenter ses possessions ? Et pourquoi y songerait-il ? Serait-ce pour arriver encore à l’affranchissement en passant par cette route de guerres, de violences, de dangers, de taxes et de monopoles, alors qu’il déclare la route ruineuse, et, qui pis est, le but absurde ?
Le parti guerroyant, en Angleterre, assigne, il est vrai, un autre motif aux mesures qu’il sollicite. Il redoute l’esprit militaire de la France ; il craint une invasion.
Le moment est singulièrement choisi. Cependant, qu’en conséquence de cette crainte, l’Angleterre organisât ses forces défensives, qu’elle constituât ses milices, nous n’y trouverions rien à redire ; mais qu’elle accroisse ses armées permanentes et sa marine militaire, en un mot, ses forces agressives, c’est là une politique qui nous semble en complète contradiction avec le système commercial qu’elle vient d’inaugurer, et qui n’aura d’autre résultat que d’ébranler toute foi dans l’influence pacifique du libre-échange.
On accuse souvent l’Angleterre de n’avoir décrété la liberté commerciale que pour entraîner les autres nations dans cette voie. Ce qui se passe donne un triste démenti à cette accusation.
Certes, si l’Angleterre avait voulu agir fortement sur l’opinion du dehors, si elle avait eu elle-même une foi complète au principe du libre-échange considéré dans tous ses aspects et dans tous ses effets, son premier soin aurait été d’en recueillir les véritables fruits, de réduire ses régiments, ses vaisseaux de guerre, d’alléger le poids des taxes publiques, et de faire disparaître ainsi les entraves que les exigences d’une vaste perception infligent toujours au travail du peuple.
Et, dans cette politique, l’Angleterre aurait trouvé, par surcroît, les deux grandes sources de toute sécurité : la diminution du danger et l’accroissement des véritables énergies défensives. — Car, d’une part, c’est affaiblir le danger de l’invasion que de suivre envers tous les peuples une politique de justice et de paix, que de leur présenter un front moins menaçant, que de leur donner accès sur tous les points du globe aux mêmes titres qu’à soi-même, que de laisser libres toutes les routes de l’Océan, que de renoncer à cette diplomatie embrouillée et mystérieuse qui avait pour but de préparer de nouvelles usurpations. — Et, d’un autre côté, le meilleur moyen de fonder la défense nationale sur une base inébranlable, c’est d’attacher tout un peuple aux institutions de son pays, de le convaincre qu’il est le plus sagement gouverné de tous les peuples, d’effacer successivement tous les abus de sa législation financière, et de faire qu’il n’y ait pas un homme sur tout le territoire qui n’ait toutes sortes de motifs d’aimer sa patrie et de voler au besoin à sa défense.
Pendant que cette ridicule panique se manifeste en Angleterre (et nous devons dire que la réaction de l’opinion commence à en faire justice), le contre-coup s’en fait ressentir de ce côté-ci du détroit. Ici, l’on se persuade que, sous prétexte de défense, l’Angleterre, en réalité, prépare des moyens d’invasion ; et certes nos conjectures sont au moins aussi fondées que celles de nos voisins. Déjà la presse commence à demander des mesures de précaution ; car, de toutes les classes d’hommes, la plus belliqueuse c’est certainement celle des journalistes. Ils ont le bonheur de ne laisser sur le champ de bataille ni leurs jambes, ni leurs bras ; c’est le paysan qui est la chair à canon, et quant à eux, ils ne contribuent aux frais de la guerre qu’autant que leur coûtent une fiole d’encre et une main de papier. Il est si commode d’exciter les armées, de les faire manœuvrer, de critiquer les généraux, de montrer le plus ardent patriotisme, la bravoure la plus héroïque, et tout cela du fond de son cabinet, au coin d’un bon feu !… Mais les journaux font l’opinion.
Donc, nous armerons aussi de notre côté. Nos ministres se laisseront sommer d’accroître le personnel et le matériel de guerre. Ils auront l’air de céder à des exigences irrésistibles, et puis ils viendront dire : « Vous voyez bien qu’on ne peut toucher ni au sel ni à la poste. Bien au contraire, c’est le moment d’inventer de nouveaux impôts ; difficile problème, mais nous avons parmi nous d’habiles financiers. »
Il nous semble qu’il y a quelques hommes qui doivent rire dans leur barbe de tout ceci.
D’abord ceux qui, dans les deux pays, vivent sur le développement de la force brutale ; ceux à qui les mésintelligences internationales, les intrigues diplomatiques et les préjugés des peuples, ouvrent la carrière des places, des grades, des croix, des avancements, de la fortune, du pouvoir et de la gloire.
Ensuite, les monopoleurs. Outre que leurs priviléges ont d’autant plus de chances de durée que les peuples, redoutant la guerre, n’osent pas se fier les uns aux autres pour leurs approvisionnements, quel beau thème pour le British-Lion et le Moniteur industriel, son confrère, si le free-trade aboutissait momentanément à cette mystification de faire courir les nations aux armes.
Enfin les gouvernements, s’il en est qui cherchent à exploiter le public, à multiplier le nombre de leurs créatures, ne seront pas fâchés non plus de cette belle occasion de disposer de plus de places, de plus d’argent et de plus de forces. Qu’on aille après leur demander des réformes : on trouvera à qui parler.
Nous avons la ferme confiance que cette ridicule panique, qui a agité un moment l’Angleterre, est un mouvement factice dont il n’est pas bien difficile de deviner l’origine. Nous ne doutons pas qu’elle ne se dissipe devant le bon sens public, et nous en avons pour garants les organes les plus accrédités de l’opinion, entre autres le Times, et surtout le Punch, car c’est une affaire de sa compétence [1].
FN:V. au tome III la relation d’un Meeting à Manchester, pages 463 à 492. (Note de l’éditeur.)
T.176 (1848.01.15) "Natural and Artificial Organisation" (JDE, Jan. 1848) (Fr, PDF)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against PDF: 26 Nov. 2015
Checked against EH: 27 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Identical to chap I in EH except for sentence. Structurally identical except for “artisan” and one sentence, and footnote on Considerant.
Source↩
T.176 (1848.01.15) "Natural and Artificial Organisation" (Organisation naturelle Organisation artificielle), Journal des Économistes, T. XIX, No. 74, Jan 1848, pp. 113-26; also EH1. [OC6]??
EH 1st ed. Jan. 1850, pp. 25-51.
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
Text↩
[113]
Est-il bien certain que le mécanisme social, comme le mécanisme céleste, comme le mécanisme du corps humain, obéisse à des lois générales? Est-il bien certain que ce soit un ensemble harmonieusement organisé? Ce qui s'y fait remarquer surtout, n’est-ce pas l’absence de toute organisation? N’est-ce pas précisément une organisation que recherchent aujourd’hui tous les hommes de cœur et d'avenir, tous les publicistes avancés, tous les pionniers de la pensée? Ne sommes—nous pas une pure jute-position d’individus sans liens, sans harmonie, livrés aux mouvements d’une liberté anarchique? Des masses innombrables, après avoir recouvré péniblement, et l'une après l'autre toutes les libertés, n’attendent-elles qu’un grand génie les coordonne dans un ensemble harmonique? Après avoir détruit ne faut-il pas fonder?
Si ces questions n’avaient d'autre portée que celle—ci: la société peut-elle se passer de lois écrites, de règles, de mesures répressives? chaque homme peut—il faire un usage illimité de ses facultés, alors même qu’il porte atteinte aux libertés d’autrui, ou qu'il inflige un ' dommage à la communauté tout entière ?- en un mot, faut—il voir dans cette maxime : laissez faire, laissez passer, la formule absolue de l'économie politique?
Si, dis-je, c’était là la question, la solution ne pourrait être douteuse pour personne. Les économistes ne disent pas qu’un homme peut tuer, saccager, incendier, et que la société n’a qu’à le laisser faire; ils disent que la résistance sociale à de tels actes se manifesterait de fait, même en l'absence de tout code; que, par conséquent, cette résistance est une loi générale de l'humanité; ils disent que les lois civiles ou pénales doivent régulariser, et non contrarier l’action de ces lois générales qu'elles supposent. Il y a loin d’une organisation sociale fondée sur les lois générales de l’humanité à une organisation artificielle, imaginée, inventée, telle que semblent vouloir l’imposer plusieurs écoles modernes.
Car, s'il y a des lois générales qui agissent indépendamment des lois écrites, et dont celles-ci ne doivent que régulariser l'action, il faut étudier ces lois générales ;elles peuvent être l’objet d’une science, [114] et l‘économie politique existe. Si. au contraire, la société est une invention humaine, si les hommes ne sont que de la matière inerte, auxquels un grand génie, comme dit Rousseau, doit donner le sentiment et la volonté, le mouvement et la vie, alors il n’y a pas d'économie politique; il n’y a qu’un nombre indéfini d’arrangements possibles et contingents, et le sort des nations dépend du fondateur auquel le hasard aura confié leurs destinées.
Pour prouver que la société est soumise à des lois générales, je ne me livrerai pas à de longues dissertations. Je me bornerai à signaler quelques faits qui, pour être un peu vulgaires, n’en sont pas moins importants.
Rousseau a dit : « Il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont trop près de nous. »
Tels sont les phénomènes sociaux au milieu desquels nous vivons et nous mouvons. L’habitude nous a tellement familiarisés avec ces phénomènes, que nous n’y faisons, pour ainsi dire, plus attention, à moins qu’ils n’aient quelque chose de brusque et d’anormal qui les impose à notre observation.
Prenons un homme appartenant à une classe modeste de la société, un menuisier de village, par exemple, et observons tous les services qu’il rend ‘_ société et tous ceux qu’il en reçoit; nous ne tarderons pas à re frappés de l'énorme disproportion apparente.
Cet homme passe sa journée à raboter des planches, monter des bois de lits, fabriquer des tables et des armoires; il se plaint de sa condition, et cependant que reçoit-il en réalité de cette société, en échange de son travail?
D’abord, tous les jours en se levant, il s’habille et il n’a personnellement fait aucune des nombreuses pièces de son vêtement. Or, pour . que ces vêtements, tout simples qu’ils sont, soient à sa disposition, il faut qu’une énorme quantité de travail, d’industrie, de transports, d’inventions ingénieuses, aient été accomplis. Il faut que des Américains aient produit du coton, que des Indiens aient produit de l’indigo, que des Français aient produit de la laine et du lin, que des Brésiliens aient produit des cuirs, que tous ces matériaux aient été transportés en certains lieux, qu’ils y aient été ouvrés, filés, tissés, teints, etc.
Ensuite il déjeune. Pour que le pain qu’il mange lui arrive tous les matins, il faut que des terres aient été défrichées, closes, labourées, fumées, ensemencées; il faut que les récoltes aient été préservées avec soin du pillage; il faut qu’une certaine sécurité ait régné au milieu d'une innombrable multitude; il faut que le froment ait été récolté, broyé, pétri et préparé; il faut que le fer, l’acier, le bois, la pierre, aient été convertis par le travail en instruments de travail; que certains hommes se soient emparés de la force des animaux, d’autres du poids d’une chute d’eau, etc.; toutes choses dont [115] chacune, prise isolément, suppose une masse incalculable de travail mies en jeu, non-seulement dans l’espace, mais dans le temps.
Cet homme ne passera pas la journée sans employer un peu de sucre, un peu d’huile, quelques ustensiles.
Il enverra son fils à l’école, et là l’enfant recevra une instruction, qui, quoique bornée, n’e'n suppose pas moins des recherches, des études antérieures, des connaissances dont l’imagination est effrayée.
Il sort; il trouve une rue pavée et éclairée.
On lui conteste une propriété : il trouvera des avocats pour défendre ses droits, des juges pour l’y maintenir, des officiers de justice pour faire exécuter la sentence; toutes choses qui supposent encore des Connaissances acquises, par conséquent des lumières et des moyens d'existence.
Il va à l’église: elle est un monument prodigieux, et le livre qu'il y porte est un monument peut-être plus prodigieux encore de l’intelligence humaine. On lui enseigne la morale, on éclaire son esprit, un élève son âme; et, pour que tout cela se fasse, il faut qu’un autre homme ait pu recueillir dans une bibliothèque, dans des séminaires, toutes les sources de la tradition humaine, et pour cela qu’il ait pu vivre sans rien faire pour pourvoir directement aux besoins de son corps.
Si notre menuisier [artisan in EH1, artisan again in EH2] entreprend un voyage, il trouve que, pour lui épargner du temps et diminuer sa peine, d’autres hommes ont aplani, nivelé le sol, comblé des vallées, abaissé des montagnes, amoindri tous les frottements, placé des véhicules à roues sur des blocs de grès ou des bandes de fer, dompté les chevaux ou la vapeur, etc.
Il est impossible de ne pas être frappé de la disproportion véritablement incommensurable qui existe entre les satisfactions que cet homme puise dans la société et celles qu’il pourrait se donner s’il était réduit à ses propres forces. J’ose dire que, dans une seule journée, il consomme des choses qu’il ne pourrait produire lui—même dans dix siècles.
Ce qui rend le phénomène plus étrange encore, c’est que tous les autres hommes sont dans le même cas que lui. Chacun de ceux qui composent la société a absorbé des millions de fois plus qu’il n’aurait pu produire; et cependant ils ne se sont rien dérobé mutuellement. Et si l’on regarde les choses de près, on s'aperçoit que ce menuisier a payé en services tous les services qui lui ont été rendus. S’il tenait ses comptes avec une rigoureuse exactitude, on se convaincrait qu’il n’a rien reçu sans le payer au moyen de sa modeste industrie ; que quiconque a été employé à son service, dans le temps ou dans l’espace, a reçu ou recevra sa rémunération.
Il faut donc que le mécanisme social soit bien ingénieux, bien puissant, puisqu’il conduit à ce singulier résultat, que chaque homme, même celui que le sort a placé dans la condition la plus humble, a [116] plus de satisfactions en un jour qu’il n'en pourrait produire en plusieurs siècles.
Ce n’est pas tout, et ce mécanisme social paraîtra bien plus ingénieux encore, si le lecteur veut bien tourner ses regards sur lui-même.
Je le suppose simple étudiant. Que fait-il à Paris ? Comment y vit—il? On ne peut nier que la société ne mette à sa disposition des aliments, des vêtements, un logement, des diversions, des livres, des moyens d’instruction, une multitude de choses enfin, dont la production, seulement pour être expliquée, exigerait un temps considérable, à plus forte raison pour être exécutée. Et, en retour de toutes ces choses, qui ont demandé tant de travail, de sueurs, de fatigues, d'efforts physiques ou intellectuels, de transports, d’inventions, de transactions, quels services cet étudiant rend-il à la société ? Aucun; seulement il se prépare à lui en rendre. Comment donc ces millions d’hommes qui se sont livrés à un travail positif, effectif et productif, lui en ont-ils abandonné les fruits? Voici l’explication : c'est que le père de cet étudiant, qui était avocat ou médecin, avait rendu autrefois des services à la société (aux antipodes peut-être), et en avait retiré , non des services immédiats, mais des droits à des services qu’il pourrait réclamer dans le temps, dans le lieu, et sous la forme qu’il lui conviendrait. C’est de ces services lointains et passés que la société s’acquitte aujourd’hui; et, chose étonnante ! si l’on suivait par la pensée la marche des transactions infinies qui ont dû avoir lieu pour atteindre le résultat, on verrait que chacun a été rémunéré de sa peine; que ces droits ont passé de main en main, tantôt se fractionnant, tantôt se groupant jusqu’à ce que, par la consommation de cet étudiant, tout ait été balancé. N’est-ce pas là un phénomène bien étrange ?
On fermerait les yeux à la lumière si l’on refusait de reconnaître que la société ne peut présenter des combinaisons si compliquées, dans lesquelles les lois civiles et pénales prennent si peu de part, sans obéir à un mécanisme prodigieusement ingénieux. Ce mécanisme est l’objet qu’étudie l’Économie politique.
Une chose encore digne de remarque, c’est que dans ce nombre, vraiment incalculable de transactions, qui ont abouti à faire vivre pendant un jour un étudiant, il n’y en a peut—être pas la millionième partie qui se soient faites directement. Les choses dont il a joui aujourd’hui, et qui sont innombrables, sont l’œuvre d'hommes dont un grand nombre a disparu depuis longtemps de la surface de la terre. Et pourtant ils ont été rémunérés, comme ils l’entendaient, bien que celui qui profite aujourd’hui du produit de leur travail n’ait rien fait pour eux. Il ne les a pas connus, il ne les connaîtra jamais. Celui qui lit cette page, au moment même où il aa lit, a la puissance, quoiqu’il n’en ait peut-être pas la conscience, de mettre en mouvement des hommes de tous les pays, de toutes les races , et je dirai presque de tous les [117] temps, des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes; il fait concourir à ses satisfactions actuelles des générations éteintes, et cette puissance extraordinaire, il la doit à ce que son père a rendu autrefois des services à d’autres hommes qui, en apparence, n’ont rien de commun avec ceux dont le travail est mis en œuvre aujourd’hui. Cependant, il s’est opéré une telle balance dans le temps et dans l’espace, que chacun a été rémunéré et a reçu ce qu'il avait calculé devoir recevoir.
En vérité, tout cela a-t-il pu se faire? des phénomènes aussi extraordinaires ont-ils pu s’accomplir sans qu'il y eût, dans la société, une naturelle et savante organisation qui agit pour ainsi dire à notre insu?
On parle beaucoup de nos jours d’inventer une nouvelle organisation. Est-il bien certain qu’aucun penseur, quelque génie qu’on lui suppose, quelque autorité qu’on lui donne, puisse inventer et faire prévaloir une organisation supérieure à celle dont je viens de décrire quelques résultats ?
Que serait-ce, si j’en décrivais aussi les rouages, les résultats et les mobiles.
Ces rouages sont des hommes, c’est-à-dire des êtres capables d’apprendre, de réfléchir, de raisonner, de se tromper, de se rectifier, et par conséquent d’agir sur l’amélioration ou sur la détérioration du mécanisme lui-même. Je dois ajouter aussi que ces ressorts sont capables de satisfaction et de douleur, et c’est en cela qu’ils sont non— seulement les rouages, mais les ressorts du mécanisme. Ils sont plus que cela encore, ils en sont l'objet même et le but, puisque c’est en satisfactions et en douleurs individuelles que tout se résout en définitive.
Or, on a remarqué, et malheureusement il n’a pas été difficile de remarquer, que dans l'action. le développement et même le progrès (par ceux qui l’ad mettent) de ce puissant mécanisme, bien des rouages étaient inévitablement, fatalement écrasés; que pour un grand nombre d’êtres humains. la somme des douleurs, même des douleurs imméritées, surpassait de beaucoup la somme des jouissances.
A cet aspect, beaucoup d’esprits sincères, beaucoup de cœurs généreux ont douté du mécanisme lui-même. Ils l’ont nié, ils ont refusé de l’étudier, ils ont attaqué, souvent avec violence, “ceux qui en avaient recherché et exposé les lois; ils se sont levés_ contre la nature des choses, et enfin ils ont proposé d’organiser la société sur un plan‘ nouveau où l’injustice, la souffrance et l’erreur ne sauraient trouver place.
A Dieu ne plaise que je m’élève ici contre des intentions manifestement philanthropiques et pures! Mais je déserterais mes convictions, je reculerais devant les injonctions de ma propre conscience, si je ne di sais que, selon moi, ces hommes sont dans une fausse voie.
En premier lieu, ils sont réduits, par la nature même de leur [118] propagande , à la triste nécessité de méconnaître le bien que la société produit, de nier ses progrès, de lui imputer tous les maux, de les rechercher avec un soin presque avide et de les exagérer outre mesure.
Quand on croit avoir découvert une organisation sociale différente de celle qui est résultée des naturelles tendances de l’humanité, il faut bien, pour faire accepter son invention. décrire sous les couleurs les plus sombres les résultats de l'organisation qu’on veut abolir. Aussi, les publicistes auxquels je fais allusion, après avoir proclamé la perfectibilité humaine, tombent dans l'étrange contradiction de dire que la société se détériore de plus en plus. A les entendre, les hommes sont mille fois plus malheureux qu’ils ne l’étaient dans les temps anciens, sous le régime féodal et sous le régime de l'esclavage; le monde est devenu un enfer. S’il était possible d'évoquer le Paris du dixième siècle, j’ose croire qu’une telle thèse serait insoutenable.
Ensuite, ils sont conduits à condamner le principe même d’action des hommes, je veux dire l'intérêt personnel, puisqu’il a amené un tel état de choses. Remarquons que l'homme est organisé de telle façon qu'il recherche la satisfaction et évite la peine; c’est de là, j'en conviens, que naissent tous les maux sociaux, la guerre, l'esclavage, la spoliation, le monopole, le privilège; mais c'est de la aussi que viennent tous les biens, puisque la satisfaction des besoins et la répugnance pour la douleur sont les mobiles de l’homme. La question est donc de savoir si ce mobile qui, d'individu devient social, n'est pas en lui-même un principe de progrès.
En tous cas, les inventeurs d’organisations nouvelles ne s'aperçoivent-ils pas que ce principe, inhérent à la nature même de l'homme, les suivra dans leurs organisations, et que là il fera bien d'autres ravages que dans notre organisation naturelle, où les prétentions injustes et l’intérêt de l’un sont au moins contenus par la résistance de tous? Ces publicistes supposent toujours deux choses inadmissibles: la première, que la société telle qu’ils la conçoivent sera dirigée par des hommes infaillibles et dénués de ce mobile : l'intérêt; la seconde. que la masse se laissera diriger par ces hommes.
Enfin. les organisateurs ne paraissent pas se préoccuper le moins du monde des moyens d'exécution. Comment feront-ils prévaloir leur système? comment décideront-ils tous les hommes a la fois à renoncer à ce mobile qui les fait mouvoir : l’attrait pour les satisfactions, la répugnance pour les douleurs? Il faudra donc, comme disait Rousseau : changer la constitution morale et physique de l'homme?
Pour déterminer tous les hommes à la fois à rejeter comme un vêtement incommode l'ordre social actuel dans lequel l'humanité a vécu et s'est développée depuis son origine jusqu'à nos jours, à adopter une organisation d’invention humaine et à devenir les pièces dociles d’un autre mécanisme, il n'y a, ce me semble, que deux moyens: la force, ou l’assentiment universel.
[119]
Il faut, ou bien que l’organisateur dispose d’une force capable de vaincre toutes les résistances, de manière à ce que l’humanité ne soit entre ses mains qu’une cire molle qui se laisse pétrir et façonner à sa fantaisie; ou obtenir, par la persuasion, un assentiment si complet, si exclusif, si aveugle même, qu’il rende inutile l’emploi de la force.
Je défie qu’on me cite un troisième moyen de faire triompher, de faire entrer dans la pratique humaine une organisation sociale artificielle.
Or, s’il n’y a que ces deux moyens, et si l’on démontre que l’un est aussi impraticable que l’autre, on prouve par cela même que les organisateurs perdent leur temps et leur peine.
Quant à disposer d’une force matérielle qui leur soumette tous les rois et tous les peuples de la terre, c’est à quoi les rêveurs, tout rêveurs qu’ils sont, n’ont jamais songé. Le roi Alphonse avait bien l’orgueil de dire : « Si j’étais entré dans les conseils de Dieu. le monde planétaire serait mieux arrangé.» Mais s’il mettait sa propre sagesse au-dessus de celle du créateur, il n’avait pas au moins la folie de vouloir lutter de puissance avec Dieu, et l’histoire ne rapporte pas qu’il ait essayé de faire tourner les étoiles selon les lois de son invention. Des? cartes aussi se contenta de composer un petit monde de dés et de ti— celles, sachant bien qu’il n’était pas assez fort pour remuer l’univers. Nous ne connaissons que Xercès qui, dans l’enivrement de sa puissance, ait osé dire aux flots: «Vous n’irez pas plus loin. » Les flots cependant ne reculèrent pas devant Xercès; mais Xercès recula devant les flots, et sans cette humiliante, mais sage précaution, il aurait été englouti.
La force manque donc aux organisateurs pour soumettre l’humanité à leurs expérimentations. Quand ils gagneraient à leur cause l’autocrate russe, le shah de Perse, le khan des Tartares et tous les chefs des nations qui exercent sur leurs sujets un empire absolu, ils ne parviendraient pas encore à disposer d’une force suffisante pour distribuer les hommes en groupes et séries, et anéantir les lois générales de la propriété, de l’échange, de l’hérédité et de la famille; car même en Russie, même en Perse et en Tartarie, il faut compter plus ou moins avec les hommes. Si l’empereur de Russie s’avisait de vouloir altérer la constitution morale et physique de ses sujets, il est probable qu’il aurait bientôt un successeur , et que ce successeur ne serait pas .tenté de poursuivre l’expérience.
Puisque la force est un moyen tout à fait hors de portée de nos nombreux organisateurs, il ne leur reste d'autre ressource que d'obtenir l’assentiment universel.
Il y a pour cela deux moyens : la persuasion et l'imposture.
La persuasion ! mais on n’a jamais vu deux intelligences s’accorder perfaitement [parfaitement in EH] sur tous les points d’une seule science. Comment donc tous les hommes de langues, de races, de mœurs diverses, répandus sur la surface du globe, la plupart ne sachant pas lire, [120] destinés à mourir sans entendre parler du réformateur, accepteront-ils unanimement la science universelle? De quoi s'agit-il?De changer le mode de travail, d’échanges, de relations domestiques, civiles, religieuses; en un mot, d’altérer la constitution physique et morale de l’homme ; et l’on espérerait rallier l’humanité tout entière par la conviction!
Vraiment, la tâche paraît bien ardue.
Quand on vient dire à ses semblables :
«Depuis cinq mille ans, il y a eu un malentendu entre Dieu et l’humanité;
«Depuis Adam jusqu’à nous, le genre humain fait fausse route, et pour peu qu’il me croie, je le vais remettre en bon chemin ;
«Dieu voulait que l’humanité marchât différemment, elle ne l’a pas voulu, et voilà pourquoi le mal s'est introduit dans le monde. Qu’elle se retourne tout entière à ma voix pour prendre une direction inverse, et le bonheur universel va luire sur elle.»
Quand, dis-je, on débute ainsi, c'est beaucoup , si l'on est cru de cinq ou six adeptes; delà à être cru d’un milliard d’hommes , il y a loin. bien loin! si loin, que la distance est incalculable.
Et puis, songez que le nombre des inventions sociales est aussi illimité que le domaine de l’imagination ; qu’il n’y a pas un publiciste qui, se renfermant pendant quelques heures dans son cabinet, n'en puisse sortir avec un plan d’organisation artificielle à la main; que les inventions de Fourier, Saint-Simon, Owen, Cabet, Blanc, etc., ne se ressemblent nullement entre elles; qu’il n’y a pas de jour qui n’en voie éclore d’autres encore; que, véritablement, l’humanité a quel-— que peu raison de se recueillir et d'hésiter avant de rejeter l’organisation sociale que Dieu lui a donnée, pour faire entre tant d'inventions sociales un choix définitif et irrévocable. Car, qu’arriverait—il si, lorsqu’elle aurait choisi un de ces plans, il s’en présentait Un meilleur“? Peut—elle chaque jour constituer la propriété. la famille, le travail, l’échange sur des bases différentes? doit-elle s’exposer à changer d’organisation tous les matins?
«Ainsi donc, comme dit Rousseau, le législateur ne pouvant employer ni la force, ni le raisonnement, c'est une nécessité qu’il recoure à une autorité d'un autre ordre qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre.»
Quelle est cette autorité? L’imposture. Rousseau n’ose pas articuler le mot, mais, selon son usage invariable en pareil cas, il le ‘place derrière le voile transparent d’une tirade d’éloquence.
« Voilà ce qui força de tous les temps les pères des nations de recourir à l’intervention du Ciel et d’honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples soumis aux lois de l’Etat comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la Formation de l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent [121] docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui l’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, etc.»
Et pour qu’on ne s’y trompe pas, il laisse à Machiavel , en le citant, le soin d’achever sa pensée. Mai non fu alcuno ordinatore di leggi STRAORDINARIE in un popolo' che non ricorresse a Dio.
Pourquoi Machiavel conseille-t-il de recourir à Dieu, et Rousseau aux dieux, aux immortels? Je laisse au lecteur de résoudre la question.
Certes, je n’accuse pas les modernes pères des nations d’en venir à ces indignes supercheries. Cependant, il ne faut pas se dissimuler que lorsqu'on se place à leur point de vue, on comprend qu’ils se laissent facilement entraîner par le désir de réussir. Quand un homme sincère et philanthrope est bien convaincu qu’il possède un. secret social au moyen duquel tous ses semblables jouiraient dans ce monde d’une félicité sans borne; quand il voit clairement qu’il ne peut faire prévaloir son idée ni par la force, ni par le raisonnement, et que la supercherie est la seule ressource, il doit éprouver une bien forte tentation. On sait que les ministres même de la religion qui professe au plus haut degré l’horreur du mensonge, n’ont pas toujours reculé devant les fraudes pieuses; et l’on voit par l’exemple de Rousseau , cet austère écrivain qui a inscrit cette devise en tête de tous ses ouvrages : Vitam impendere vero, que la fameuse maxime: la fin justifie les moyens, peut séduire l’orgueilleuse philosophie elle-même. Qu’y aurait-il de surprenant à ce que les organisateurs modernes songeassent aussi à honorer les dieux de leur propre sagesse, à mettre leurs décisions dans la bouche des immortels, à entraîner sans violence et persuader sans convaincre?
On sait qu’à l’exemple de Moïse , Fourier a fait précéder son Deutéronome d’une Genèse. Saint-Simon et ses disciples avaient été plus loin dans cette voie. D’autres, plus avisés, se rattachent à la religion la plus étendue, en la modifiant selon leurs vues, sous le nom de néo-christianisme, et il n’y a personne qui ne soit frappé du ton d’afféterie mystique que presque tous les réformateurs modernes introduisent dans leur prédication.
Mais les efforts qui ont été essayés dans ce sens n’ont servi qu’à prouver une chose qui a. il est vrai, son importance : c’est que, de nos jours, n’est pas prophète qui veut. On a beau se proclamer dieu, on n’est cru de personne, ni du public, ni de ses compères, ni de soi-même.
Puisque j’ai parlé de Rousseau, je me permettrai de faire ici quelques réflexions sur cet organisateur, d’autant qu’elles serviront à faire [122] comprendre en quoi les organisations artificielles différent de l’organisation naturelle. Cette digression n’est pas d’ailleurs tout à fait intempestive, puisque, depuis quelque temps, on signale le Contrat social comme l’oracle de l’avenir.
Rousseau était convaincu que l’isolement était l’état de nature de l’homme, et que par conséquent. la société était d’invention humaine, «L’ordre social, dit-il en débutant, ne vient pas de la nature; il est donc fondé sur des conventions. »
En outre, ce philosophe, quoique aimant avec passion la liberté, avait une triste opinion des hommes. Il les croyait tout à fait incapables de se donner une bonne institution. L’intervention d’un fondateur, d’un législateur, d’un père des nations, était donc indispensable.
« Le peuple soumis aux lois, dit-il, en doit être l’auteur. Il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société; mais comment les régleront-ils? sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite? Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu’elle veut, parce que rarement elle sait ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation 7... Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent ; le public veut le bien qu’il ne voit pas; tous ont également besoin de guides... Voilà d’où naît la nécessité d’un législateur. »
Ce législateur, on l’a déjà vu, «ne pouvant employer la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre n , c’est-à-dire, en bon français, à la fourberie.
Rien ne peut donner une idée de l’immense hauteur au-dessus des autres hommes où Rousseau place son législateur.
« Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes... Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine..., d’altérer la constitution de l’homme pour le renforcer... Il faut qu’il ôte à l’homme ses propres forces pour lui en donner qui lui soient étrangères... Le législateur est, à tous égards, un homme extraordinaire dans l’Etat...; son emploi est une fonction particulière et supérieure, qui n’a rien de commun avec l'empire humain... S’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand législateur? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit lui proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine; celui-là n'est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. »
Et qu’est donc l’humanité en tout cela? la vile matière dont la machine est composée.
En vérité, n’est-ce pas là l’orgueil porté jusqu’au délire? Ainsi, les hommes sont les matériaux d’une machine que le prince fait marcher‘;le législateur en propose le modèle, et le philosophe se place à une distance incommensurable du vulgaire, du prince et du [123] législateur; il plane sur le genre humain, le ment, le transforme, la pétrit, ou plutôt enseigne aux pères des nations comment il faut s’y prendre.
Cependant le fondateur d’un peuple doit se proposer un but. Il a de la matière humaine, à mettre en œuvre, et il faut bien qu’il l’ordonne à une fin. Comme les hommes sont dépourvus d'initiative et que tout dépend du législateur, celui-ci décidera si un peuple doit être ou commerçant, ou agriculteur, ou barbare et ichtyophage, etc.; mais il est à désirer que le législateur ne se trompe pas et ne fasse pas trop violence à la nature des choses.
Les hommes, en convenant [italic??] de s’associer, ou plutôt en s’associant par la volonté du législateur, ont donc un but très—précis. « C‘est ainsi, dit Rousseau, que les Hébreux, et récemment les Arabes, ont en pour principal objet la religion ;‘les Athéniens, les lettres; Carthage et Tyr, le commerce; Rhodes, la marine; Sparte, la guerre, et Rome, la vertu.»
Quel sera l’objet qui nous décidera, nous Français. à sortir de l’isolement ou de l’état de nature pour former une société? Ou plutôt, car nous ne sommes que de la matière inerte, les matériaux de la machine, vers quel objet nous dirigera notre grand instituteur?
Dans les idées de Rousseau, ce ne pouvait guère être ni les lettres, ni le commerce, ni la marine. La guerre est un plus noble but, et la vertu un bat plus noble encore. Cependant, il y en a un très-supérieur. «Ce qui doit être, la fin de tout système de législation, c’est la liberté et l’égalité. »
Mais il faut savoir ce que Rousseau entendait par la liberté. Jouir de la liberté, selon lui, ce n’est pas être libre. c’est donner son suffrage, alors même qu’on serait entraîné sans violence et persuadé sans être convaincu; car alors on obéit avec liberté et l’on porte facilement le joug de la félicité publique.
« Chez les Grecs. dit—il, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même; il était sans cesse assemblé sur la place, il habitait un climat doux, il n’était point avide, des esclaves faisaient tous ses travaux, sa grande affaire était sa liberté.
«Le peuple anglais, dit-il ailleurs, croit être libre; il se trompe fort. Il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement; sitôt qu’ils sont élus. il est esclave, il n’est rien.»
Le peuple doit donc faire par lui-même tout ce qui est service public, s’il veut être libre, car c’est en cela que consiste la liberté. Il doit toujours nommer, toujours être sur la place publique. Malheur à lui, s’il songe à travailler pour vivre; sitôt qu’un seul citoyen s’avise de soigner ses propres affaires, à l’instant (c’est une locution que Rousseau aime beaucoup), tout est perdu.
Mais, certes, la difficulté n’est pas petite. Comment faire? car enfin, même pour pratiquer la vertu, même pour exercer la liberté, encore faut-il vivra.
[124]
On a vu tout à l’heure sous quelle enveloppe oratoire Rousseau avait caché le mot imposture. On va le voir maintenant recourir à un trait d'éloquence pour faire passer la conclusion de tout son livre, l’esclavage.
« Vos durs climats vous donnent des besoins ; six mois de l’année la place publique n’est pas tenable, vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en plein air, et vous craignez bien moins l’esclavage que la misère. »
Vous voyez bien que vous ne pouvez être libres.
« Quoi! la liberté ne se maintient qu’à l’appui de la servitude? Peut-être. »
Si Rousseau s’était arrêté à ce mot affreux, le lecteur eût été révolté. Il fallait recourir aux déclamations imposantes. Rousseau n’y manque pas.
«Tout ce qui n’est point dans la nature (c’est de la société qu’il s’agit) a ses inconvénients, et la société civile plus que tout le reste. Il y a des positions malheureuses où l’on ne peut conserver sa liberté qu’aux dépens de celle d’autrui, et où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l’esclave ne soit extrêmement esclave. Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves, mais vous l'êtes ; v0us payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j’y trouve plus de lâcheté que d’humanité. »
Je le demande : cela ne veut-il pas dire : Peuples modernes, vous feriez bien mieux de n’être pas esclaves et d’en avoir?
Je demande pardon au lecteur de cette longue digression; j'ai cru qu’elle n’était pas inutile. [In EcHarm: Que le lecteur veuille bien excuser cette longue digression, j’ai cru qu’elle n’était pas inutile.] Depuis quelque temps on nous représente Rousseau et ses disciples de la Convention comme les apôtres de la fraternité humaine. — Des hommes pour matériaux, un prince pour mécanicien, un père des nations pour inventeur, un philosophe par-dessus tout cela, l’imposture pour moyen, l’esclavage pour résultat, est-ce donc là la fraternité qu’on nous promet?
Il m’a semblé aussi que cette étude du Contrat social était propre à faire voir ce qui caractérise les organisations sociales artificielles. Partir de cette idée que la société est un état contre nature; chercher les combinaisons auxquelles on pourrait soumettre l’humanité; perdre de vue qu’elle a son mobile en elle-même; considérer les hommes comme de vils matériaux; aspirer à leur donner le mouvement et la volonté, le sentiment et la vie; se placer ainsi, et à une hauteur in— commensurable, au-dessus du genre humain, voilà les traits communs à tous les inventeurs d’organisations sociales. Les inventions diffèrent, les inventeurs se ressemblent.
Parmi les arrangements nouveaux auxquels les faibles humains sont conviés , il en est un qui se présente en termes qui le rendent digne d’attention. Sa formule est : Association progressive et volontaire.
Mais l’économie politique est précisément fondée sur cette donnée, que société n’est autre chose qu’association (ainsi que ces trois mots [125] le disent), association fort imparfaite d’abord, parce que l'homme est. imparfait; mais se perfectionnant avec lui. c’est-à-dire progressive. Veut—on parler d’une association plus intime entre le travail, le capital et le talent, d’où doive résulter pour les membres de la famille humaine plus de bien-être et un bien-être mieux réparti? A la condition que ces associations soient volontaires; que la force et la contrainte n’interviennent pas; que les associés n’aient pas.la prétention de faire supporter les frais de leur établissement par ceux qui refusent d’y entrer, en quoi répugnent-elles à l’économie politique? Est-ce que l’économie politique, comme science, n’est pas tenue d’examiner les formes diverses par lesquelles il plaît aux hommes d’unir leurs forces et de se partager les occupations en vue d’un bien-être plus grand et mieux réparti? Est-ce que le commerce ne nous donne.pas fréquemment l’exemple de deux, trois, quatre personnes formant entre elles des associations? Est-ce que le métayage n’est pas une sorte d’association, informe, si l’on veut, du capital et du travail? Est-ce que nous n’avons pas vu dans ces derniers temps se produire les compagnies par actions, qui donnent au plus petit capital le pouvoir de prendre part aux plus grandes entreprises? Est—ce qu’il n’y a pas à la surface du pays quelques fabriques où l’on essaye d’associer tous les cotravailleurs aux résultats? Est-ce que l’économie politique condamne ces essais et les efforts que font les hommes pour tirer un meilleur parti de leurs forces? Est-ce qu’elle a affirmé quelque part que l’humanité a dit son dernier mot? C’est tout le contraire; et je crois qu’il n’est aucune science qui démontre plus clairement que la société est dans l’enfance.
Mais quelques espérances que l’on conçoive pour l’avenir, quelques idées que l’on se fasse des formes que l’humanité pourra trouver pour le perfectionnement de ses relations et la diffusion du bien-être, des connaissances et de la moralité, il faut pourtant bien reconnaître que la société est une organisation qui a pour élément un agent intelligent, moral, doué de libre arbitre et perfectible. Si vous en ôtez la liberté, ce n’est plus qu’un triste et grossier mécanisme.
La liberté! il semble qu’on n’en veuille plus de nos jours. sur cette terre de France, empire privilégié de la mode, il semble que la liberté ne soit plus de mise. Et moi, je dis: quiconque repousse la liberté n’a pas foi dans l’humanité. On prétend avoir fait récemment cette désolante découverte que la liberté conduit fatalement au monopole. [128] Non , cet enchaînement monstrueux, cet accouplement contre nature n’existent pas; il est le fruit imaginaire d’une erreur qui se dissipe bientôt au flambeau de l’économie politique. La liberté engendrer le monopole! L’oppression naître naturellement de la liberté ! Mais , prenons-y garde , affirmer cela , c'est affirmer que les tendances de l’humanité sont radicalement mauvaises, mauvaises en elles-mêmes, mauvaises par nature, mauvaises par essence; [126] c’est affirmer que la pente naturelle de l’homme est vers sa détérioration et l’attrait irrésistible de l’esprit vers l'erreur. Mais alors à quoi bon nos écoles, nos études, nos recherches, nos discussions, sinon à nous imprimer une impulsion plus rapide sur cette pente fa— tale, puisque, pour l’humanité, apprendre à choisir, c’est apprendre à se suicider? Et si les tendances de l’humanité sont essentiellement perverses, où donc, pour les changer, les organisateurs chercheront-ils leur point d’appui? D’après les prémisses, ce point d’appui doit être placé en dehors de l’humanité. Le chercheront-ils en eux-mêmes, dans ' leur intelligence, dans leur cœur? Mais ils ne sont pas des dieux encore ; ils sont hommes aussi, et par conséquent poussés avec l’humanité tout entière vers le fatal abîme. Invoqueront-ils l’intervention de l’Etat? Mais l’Etat est composé d’hommes, et il faudrait prouver que ces hommes forment une classe à part pour qui les lois générales ' de la société ne sont pas faites, puisque c’est eux-mêmes qui doivent faire ces lois. Sans cette preuve, la difficulté n’est pas même reculée.
Ne condamnons pas ainsi l’humanité avant d’en avoir étudié les lois, les forces, les énergies, les tendances. Depuis qu’il eut reconnu l’attraction, Newton ne prononçait plus le nom de Dieu sans se découvrir. Autant l’intelligence est au-dessus de la matière, autant le monde social est au-dessus de celui qu’admirait Newton, car la mécanique céleste obéit à des lois dont elle n'a pas la conscience. Combien plus-de raison aurons-nous de nous incliner devant la Sagesse éternelle à l’aspect de la mécanique sociale, où vit aussi la pensée universelle, mens agitat molem, mais qui présente de plus ce phénomène extraordinaire que chaque atome est un être animé, pensant, doué de cette énergie merveilleuse, de ce principe de tente moralité, de toute dignité, de tout progrès, attribut exclusif de l’homme, la liberté!
Minutes of the Seventh Meeting of the Free Trade Association (Jan. 1848, JDE)↩
BWV
T.175 (1848.01.15) "Minutes of the Seventh Meeting of the Free Trade Association - remarks by Anisson-Dupéron, Joseph Garnier, Ch. Coquelin, F. Bastiat" (Septième séance de l'Association pour la liberté des échanges; discours de MM. Anisson-Dupéron, Joseph Garnier, Ch. Coquelin, F. Bastiat). Summary of Bastiat's remarks, JDE Janvier 1848, T. XIX, pp. 214-215. [DMH]
Text↩
CHRONIQUE.
SOMMAIRE. Message de M. Polk; - Les finances et la guerre du Mexique.-Septième séance de l'Association pour la liberté d'échanges; discours de MM. Anisson-Dupéron, Joseph Garnier, Ch. Coquelin, F. Bastiat. - Réunion publique de l'Association belge. – L'équilibre du budget. - Curieux projet de réforme de l'impôt du sel et du tarif des lettres. - Promesses du discours de la couronne. - Le projet de loi des Monts-de-Piété. - L'inauguration du chemin de Marseille à Avignon et Lucifer. - La liberté du commerce en Suède, en Hollande. - Cobden neutralise Wellington.
…
[212]
– L’Association pour la liberté des échanges a repris ses manifestations publiques. Elle a réuni, le 7 janvier, dans la vaste salle Montesquieu, malgré le mauvais temps, un brillant auditoire au sein duquel nous avons remarqué un grand nombre de notabilités industrielles, commerciales et administratives de la capitale; plus, çà et là, quelques groupes protectionnistes, chuchotant entre eux, prononçant des oh ! et des ah ! timides, et ne ménageant nullement, comme on le pense bien, les orateurs libre-échangistes. Quatre membres du Conseil de l'Association ont pris la parole dans cette solennité : M. Anisson-Dupéron, vice-président de l'Association, président de la réunion, M. Joseph Garnier, M. Ch. Coquelin et M. Frédéric Bastiat.
L'honorable M. ANISSONN-DUPÉRON a ouvert la séance par une allocution dans laquelle il a simplement rappelé les faits qui se sont produits dans ces derniers temps en Europe. -1° le Congrès de Bruxelles, où deux cents hommes des plus notables de toute l'Europe ont proclamé à l'unanimité la justice et la fécondité des doctrines de la liberté du commerce ; 2° la promesse faite par le ministère belge de ne pas redemander la reprise de la loi céréale de 1854; 5° les bienfaits de la liberté du commerce des céréales en Angleterre ; 4° les bons résultats financiers et économiques de la réforme antiprotectionniste aux États-Unis (V. le message du président, p. 190) ; 5° l'abandon du système de l'échelle mobile en Hollande, et l'ouverture des ports de la colonie de Surinam à tous les navires; 6° la ligue italienne; 7° la présentation d'un projet de loi aux États de Suède, qui abolit toutes les prohibitions, réduit les taxes restrictives à des taxes fiscales, et simplifie les bases de la perception ; 8° la leçon donnée à nos prohibitionnistes par leurs coreligionnaires d'Espagne (V. notre dernière chronique).
Cette énumération ne manque pas d'éloquence, et elle a frappé les esprits sérieux de l'assemblée. Après lui, M. JOSEPH GARNIER a pris à partie le rapport de l'honorable M. [213] Lanyer. Il en a fait l'histoire et l'analyse ;il a signalé les influences protectionnistes qui en ont retardé la publication jusqu'au 11 décembre et qui en ont dicté toutes les conclusions négatives; il en a montré les contradictions, les bévues et le cynisme ; enfin, il a fait ressortir quelques arguments favoris de la Commission, qu'il a nommés : un premier, l'argument de l'amour-propre, un second, l'argument du chlorure de chaux, et un troisième, l'argument des cordages.
Premier argument.Comment, vous tenez à la levée de ce droit ? mais, c'est si peu de chose ! n'êtes-vous pas bien au-dessus d'une pareille vétille ?
Deuxième argument. Vous dites qu'on exporte du chlorure de chaux? Tant mieux; cela prouve que nous pouvons nous en passer, et qu'il n'y a nul inconvénient à fermer notre porte.
Troisième argument. Mais vous ne voyez donc pas que si l'on vous accordait la franchise des chanvres pour fabriquer vos cordages en entrepôt, vous seriez tourmentés par la douane, qui est vraiment vexatoire ?
M. Joseph Garnier a fini son discours par les paroles suivantes : « Je m'arrête, messieurs, et me résume en deux mots.Vous avez dans vos mains le programme de notre Association ; comparez la doctrine qui l'a inspirée à celle qui a dicté le rapport dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir, et dites quels sont ceux qui comprennent et ceux qui méconnaissent les vrais intérêts du pays. (Très-bien !) Pour mon compte, permettez-moi de vous l'avouer, il me semble qu'après deux ou trois rapports parlementaires semblables à celui-ci, on aura le droit de dire que les Français aspirent à être les Chinois de l'Europe.» (Rires et applaudissements.)
M. CH. COQUELIN a attaqué dans ses fondements la théorie protectionniste. « La liberté du commerce, a-t-il dit, est un droit qui se défend par son nom seul, tandis qu'on peut mettre sur la sellette un système établi en violation de ce droit, pour l'interroger sur ses actes, pour lui demander par quelles raisons, au nom de quels intérêts, il manque à ces principes de justice qui sont, après tout, le fondement des sociétés humaines (Applaudissements.) »
L'orateur examine ensuite la prétention des protectionnistes, qui disent agir dans l'intérêt public, et il conduit l'auditoire au sein même des industries protégées. Il fait voir que le système protecteur augmente le prix des marchandises indigènes sur le marché français, et ne peut avoir aucun effet sur les articles d'exportation, d'où une inégalité choquante. Pour rendre un compte exact de ceux qui profitent réellement de l'augmentation des prix à l'intérieur, M. Coquelin partage les industries en deux classes : celles qui jouissent d'un monopole naturel, et celles qui sont soumises à l'action indéfinie de la concurrence. Les premières gagnent, en général, à la protection; presque toutes les autres y perdent. Dans le premier cas, se trouvent les houillères, les usines à fer, les terres labourables. Le prix du revient étant à peu près le même pour toutes les houillères françaises, le prix de vente varie comme l'intensité du monopole. Nos producteurs de fer sont, en général, dans des conditions aussi favorables que les Anglais et les Belges, et, si leurs prix sont élevés, c'est qu'il y a dans ces prix l'influence du monopole.Quant aux terres, il est évident que celles de Bretagne ne faisant pas concurrence à celles de la Sologne, ni celles-ci à celles du Soissonnais, la plupart des propriétaires jouissent d'un monopole réel.
L'orateur entre, pour ces trois grandes industries, dans des détails qui témoignent d'une instruction très-positive et d'une connaissance très-circonstanciée [214] de la situation de nos diverses industries. - Voilà donc, dit-il en terminant, quelles sont les industries qui profitent, ou du moins qui peuvent profiter des priviléges conférés par le système protecteur. En profitent-elles toujours ? Non. Les bénéfices qu'elles devraient en retirer se perdent par diverses causes, dont la première est que l'usage du monopole engendre la langueur, et qu'elles sont presque toujours mal conduites. Mais il est certain, du moins, qu'elles en profitent ou non, qu'elles imposent généralement au consommateur un vrai tribut. Quant à toutes les industries qui ne sont pas placées dans des conditions semblables, pour lesquelles le commerce est sans bornes, elles ont toutes à souffrir du régime protecteur, et même celles qui en réclament le plus ardemment le maintien.
L'heure avancée n'a pas permis à l'orateur de développer cette seconde partie de son sujet.
Une allocution de M. BASTIAT, pleine de sens et d'esprit, a clos cette séance. M. Bastiat s'était proposé de démontrer que le libre échange est la cause ou du moins un des aspects de la grande cause du peuple, des masses, de la démocratie. Dans une première partie de son discours, il a habilement groupé quelques raisonnements qui prouvent les inconvénients de la protection pour le travail. Il a cité une manufacture de machines à Marseille prospérant avec la permission de travailler à l'entrepôt , en franchise, et amenée à vendre plus cher aux nationaux protégés qu'aux étrangers non protégés. Il a fait remarquer que la protection augmentant le prix de l'outillage des travailleurs, c'est comme si elle les privait d'une partie de leur capital. ll a rappelé que ce système, appliqué à l'industrie agricole, n'avait d'autre but que de surenchérir la rente du landlord français. Puis, il a établi avec logique, que la protection, prenant en faveur des uns une partie du fruit du travail des autres, était un vestige de la théorie de l'esclavage, et il a fait ressortir son idée en disant ce que le système aurait d'abominable aux yeux de tous, si nos lois permettaient aux industriels protégés de faire eux-mêmes la police à la frontière, directement, à l'aide de leurs commis et de leurs valets. « Eh quoi ! a-t-il ajouté, vous croyez-vous dans une position plus brillante et plus digne, parce que MM. les prohibitionnistes ont obtenu beaucoup plus; parce que la législature met le Trésor public à leur disposition, et vous fait payer à vous-mêmes ce qu'il en coûte pour vous ravir votre liberté?»
M. Bastiat ensuite fait la démonstration de sa thèse géographiquement pour ainsi dire, en citant la Hollande, jadis très-prospère, parce qu'elle était très-libre ; l'Italie qui, à l'aurore de son affranchissement, tourne ses premières préoccupations vers la liberté commerciale; les États-Unis, où le parti démocratique, en arrivant aux affaires, a réformé le tarif et rompu avec le système protectionniste ; et, enfin, l'Angleterre, où les free-traders ont porté un si rude coup à l'aristocratie, en supprimant le tarif des céréales et en réclamant les franchises de l'industrie et du commerce.
Arrivé à la France, M. Bastiat a fait voir par quelques citations que le tarif de 1795, fait par et pour la multitude, qui avait agi dans son intérêt, était d'un libéralisme absolu et qu'il ne violait la propriété qu'à l'exportation, tandis que celui de 1822, dû à la Chambre du double vote, était essentiellement restrictif et violait la propriété à l'importation, se préoccupant fort peu des consommateurs, à l'inverse de la Convention, qui s'en préoccupait au delà des bornes de la justice, et mal par conséquent.
[215]
En finissant, M. Bastiat a posé à l'assemblée l'énigme que nous donnent tous les jours à résoudre ceux qui se croient les interprètes des intérêts des masses, et qui, après avoir admis le libre échange en principe, le combattent dans l'application. On comprend très-bien que les partisans de la propagande à coups de canon s'opposent au libre échange, à l'instar de l'aristocratie anglaise qui voit dans la protection des places de colonels, d'amiraux et de gouverneurs des colonies pour ses fils ; mais l'orateur a plus de confiance dans la propagande par la persuasion et l'exemple. Ces idées ont été couvertes d'applaudissements, et l'auditoire nous a semblé encore mieux comprendre l'esprit du libre échange que le libre échange lui-même.
En résumé, cette première séance, qu'on avait hésité à tenir, parce qu'on craignait que l'attention publique ne fut exclusivement préoccupée des débats que soulèvent en général les discussions de l'adresse à cette époque de l'année , cette première séance a eu un plein succès; elle a révélé au sein de l'Association des forces nouvelles, et dans le publie le maintien et la recrudescence de ses sympathies pour une cause qui sera difficile à gagner, mais qui ne peut être perdue.
Paresse et restriction [16 Jan. 1848]↩
BWV
1848.01.16 "Paresse et restriction" (Laziness and Trade Restrictions) [*Libre-Échange*, 16 January 1848] [OC2.39, p. 219-21]
Paresse et restriction
16 Janvier 1848
Un de nos abonnés hommes de beaucoup de lumières et d’expérience, placé dans une haute position sociale, nous soumet l’objection suivante, à laquelle nous nous empressons de répondre, parce qu’elle préoccupe beaucoup d’esprits sincères.
« Comme le travail est une fatigue, beaucoup d’entre nous aiment mieux s’abstenir du travail que d’avoir à se reposer de la fatigue. Le climat nous y dispose plus ou moins. L’Espagnol, par exemple, est paresseux d’esprit et de corps. Admettez la liberté des échanges en Espagne. L’habitant sera mieux logé, nourri, vêtu, parce qu’avec ses produits il achètera à l’étranger des produits meilleurs et à plus bas prix que ceux qu’il pourrait fabriquer ; mais il n’achètera toujours que dans la proportion de ce qu’il produit lui-même. La première amélioration obtenue, il en restera là, parce qu’il ne sait, ne veut et ne peut produire davantage. La protection (peu importe la forme) mesurée, limitée aux industries vitales, a pour but de le solliciter à vaincre sa tendance naturelle en lui assurant un dédommagement de ses efforts. L’homme d’État ne pourrait-il lui tenir ce langage : « Livré à tes instincts naturels, tu produis peu, tu achètes peu, tu restes pauvre ; il est utile que que tu produises davantage pour que tu puisses acheter un jour davantage. Pour te dédommager de ta peine, pour te stimuler à l’étude qui te donnera plus de savoir, à l’industrie qui te donnera de meilleurs instruments, à la pratique qui te donnera plus d’habileté, nous allons nous imposer un sacrifice. Produis, nous renoncerons, pour un temps, à acquérir les mêmes produits à l’étranger ; nous te les payerons plus cher, afin que tu rentres dans tes avances, afin que tu nous donnes une production nouvelle, et par conséquent un nouveau moyen d’échanger, une faculté plus grande d’acheter. »
Ainsi, comme nous, notre honorable correspondant voit dans la restriction un appauvrissement, un dommage, une souffrance, une perte, un sacrifice, infligés à la population. Seulement, il se demande si elle ne peut pas agir comme stimulant, afin de faire sortir la population de son inertie naturelle.
La paresse d’un peuple étant posée en fait, notre correspondant conviendra bien que si ce peuple est pauvre, c’est à sa paresse et non aux importations qu’il doit s’en prendre. Celles-ci le mettent au contraire à même de retirer plus de jouissances du peu de travail auquel il se livre.
Si un homme d’État intervient et dit : « Nous allons exclure le produit étranger ; tu le feras toi-même, et tes concitoyens te le payeront plus cher, afin de te déterminer au travail par l’appât d’un plus grand gain, » le résultat sera que tous ses concitoyens, payant le produit plus cher, seront moins riches d’autant, et favoriseront dans une moindre proportion des industries déjà existantes dans le pays. Tout ce qu’on aura fait, c’est d’encourager une forme de travail en en décourageant dix autres, et l’on ne voit pas alors comment le sacrifice atteint le but, qui est de détruire la paresse.
Mais voici qui est plus grave. On peut se demander si c’est bien la mission d’un homme d’État de diminuer les moyens de satisfaction d’un peuple, dans l’espérance de secouer son inertie. Après avoir établi sans arrière-doute, ainsi que le fait notre correspondant, que la restriction est un sacrifice général, demander si elle ne peut pas être utile comme moyen de forcer les hommes au travail, c’est demander s’il ne serait pas bon dans le même but, à supposer que cela fût praticable, de diminuer la fertilité du sol, d’enfoncer le minerai plus avant dans les entrailles de la terre, de rendre le climat plus rude, de prolonger les rigueurs de l’hiver, d’abréger la durée des jours, de donner à l’Espagne le climat de l’Écosse, afin de solliciter par la vive piqûre des besoins l’énergie des habitants. Il est possible que cela réussît. Mais est-ce là la mission des gouvernements ? Le droit des hommes d’État va-t-il jusque-là ? Et parce qu’un homme a été poussé par le vent des circonstances au limon des affaires, parce qu’il a reçu une commission de ministre, son omnipotence légitime sur tous ses semblables va-t-elle jusqu’au point de les faire souffrir, d’accumuler autour d’eux les difficultés et les obstacles, afin de les rendre actifs et laborieux [1] ?
Une telle pensée a sa source dans cette doctrine fort répandue de nos jours, que les gouvernés sont de la matière inerte sur laquelle les gouvernants peuvent faire toutes sortes d’expériences.
Beaucoup de publicistes ont eu le tort de ne pas donner assez d’importance aux fonctionnaires publics et de les considérer comme une classe improductive. Les écoles modernes nous semblent tomber dans l’exagération contraire, en faisant des gouvernants des êtres à part, placés en dehors et au-dessus de l’humanité, ayant mission, comme dit Rousseau, de lui donner le sentiment et la volonté, le mouvement et la vie [2].
Nous contestons au législateur une telle autocratie, et plus encore quand elle se manifeste par des mesures qui, après tout, n’encouragent l’un dans une certaine proportion qu’en décourageant l’autre dans une proportion plus grande encore, comme c’est le propre du système protecteur, selon notre honorable correspondant lui-même.
FN:V. au tome IV, page 342, le pamphlet La Loi ; et les chap. xvii et xx des Harmonies.(Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV, page 442, le pamphlet, Baccalauréat et socialisme. (Note de l’éditeur.)
Lettre À M. Jobard [22 Jan. 1848] ↩
BWV
1848.01.22 “À M. Jobard” (Letter to M. Jobard) [22 January 1848] [L’Economiste Belge, 1 September 1860] [OC7.41, pp. 207-10]
Monsieur Jobard,
Vous me provoquez à exprimer mon opinion sur le grand problème de la propriété intellectuelle. Je n’ai pas à cet égard des idées assez arrêtées pour prétendre à ce qu’elles exercent la moindre influence sur les hommes qui peuvent, par leur position, réaliser vos vues.
Je vous ai dit, il est vrai, que si l’on faisait jamais passer la région intellectuelle dans le domaine de la propriété, cette grande Révolution étendrait le champ de l’économie politique, sans changer aucune de ses lois, aucune de ses notions fondamentales ; je persiste dans cette opinion.
Je crois que si un sauvage Joway faisait de l’économie politique, il arriverait aux mêmes notions que nous sur la nature de la richesse, de la valeur, du capital, de l’échange, etc., etc. Je crois que l’économie politique, comme science, est la même dans le département des Landes où il y a beaucoup de terres communales, et dans celui de la Seine où il n’y en a pas ; dans une ville où il y a une fontaine commune, et dans une autre où chaque maison a son puits ; au Maroc et en France, quoique la propriété foncière y soit constituée sur des bases différentes.
Mais si le sauvage Joway, après avoir été appelé à expliquer les lois économiques, était interrogé sur les effets qui résulteraient de l’appropriation personnelle du sol, il serait forcé de se livrer à des conjectures, ou, si vous voulez, à des déductions, ce phénomène n’étant jamais tombé sous l’épreuve de l’observation directe.
C’est à peu près la position où je me trouve à l’égard de la propriété des inventions.
Je me pose deux questions :
1° Y a-t-il dans l’invention, l’élément constitutif de la propriété ?
2° Dans cette hypothèse, est-il au pouvoir du gouvernement de garantir cette propriété ? En d’autres termes, avez-vous pour vous la vérité du principe, et la possibilité de l’application ?
Je reconnais que l’élément constitutif de la propriété me semble se manifester dans une invention. La propriété, selon moi, n’est que l’attribution de la satisfaction qui suit un effort, à celui qui a fait cet effort. Ici il y a travail, il y a jouissance, et il paraît naturel que la jouissance soit la rémunération de celui qui a fait le travail.
Mais celui qui a inventé et exécuté une charrue, a-t-il un droit exclusif, non seulement sur cette charrue, mais encore sur le modèle même de cette charrue, de sorte que nul n’en puisse construire une semblable ?
Si cela est, l’imitation est exclue de ce monde, et j’avoue que j’attache à l’imitation une très grande et très bienfaisante importance. Je ne puis exposer mes raisons dans une lettre, mais je les ai consignées dans un article du Journal des économistes, intitulé : De la concurrence.
Permettez-moi, Monsieur, de soumettre votre principe à une épreuve, celle de l’exagération. Il y a beaucoup de gens qui n’admettent pas cette méthode ; je la crois excellente. Quand un principe est bon, plus il agit sans obstacles, plus il répand de bienfaits. Sismondi s’élevant contre les machines, se demande que deviendrait l’humanité, si un roi pouvait tout produire en tournant une manivelle ? Je réponds : Que chaque homme ait une semblable manivelle, et nous serons tous infiniment riches, à moins de prétendre que Dieu est le plus misérable des êtres, parce qu’il n’a pas même besoin de manivelle et qu’un fiat lui suffit.
Cela posé, supposons qu’il existe encore un descendant de Triptolème, et que la propriété du droit de faire des charrues se soit conservée de père en fils jusqu’à lui. C’est la circonstance la plus favorable pour votre principe, s’il est bon. J’admets que cette famille ait temporairement délégué ce droit, pour en retirer tout le profit possible. Mais pensez-vous que l’humanité aurait retiré de la charrue tous les avantages que cet instrument a répandus ? D’une antre part, un tel droit n’aurait-il pas introduit dans le monde, le germe d’une inégalité sans limites ?
Et puis ce mot invention me paraît bien élastique. Parce que j’aurais été le premier à mettre des sabots, tous les hommes sur la surface de la terre, sont-ils tenus en droit d’aller pieds nus ?
Voilà mes doutes, Monsieur ; vous me direz que ce n’est pas un doute, mais une solution. Non, car, ainsi que je l’ai dit en commençant, je suis dans la position de l’Ioway. Il aurait pu être, et il aurait été probablement très frappé des inconvénients de la propriété foncière, et la force de son intelligence n’aurait pas suffi à lui en révéler tous les avantages. Il me semble aussi que, dans l’appropriation du domaine intellectuel, il y a toute une révolution aussi imposante, peut-être aussi bienfaisante que celle qui a fait passer le sol de l’état commun à l’état de propriété privée. Ce que je crains, c’est l’abus. Ce que je n’aperçois pas clairement, c’est la limite entre ce qui constitue réellement l’invention et cette multitude de choses que nous inventons tous journellement. Je redoute l’accaparement des procédés les plus usuels [2]. Peut-être, absorbé par d’autres travaux, n’ai-je pas assez étudié vos ouvrages, au point de vue pratique. Ce que je puis dire, Monsieur, c’est qu’il y a dans votre pensée quelque chose de grand, de séduisant, de logique, qui ne contredit pas, comme les projets socialistes, les notions fondamentales de la science, et j’admire sincèrement le dévouement et la persévérance avec laquelle vous en poursuivez la réalisation.
Je suis, etc.
FN:Lettre publiée par l’Économiste belge, n° du 1er septembre 1860.(Note de l’édit.)
FN:L’expropriation pour cause d’utilité publique y remédie.(Note de M. Jobard)
Sur l'inscription maritime [23 Janvier 1848] ↩
BWV
1848.01.23 “Sur l'inscription maritime” (On Maritime Registration) [*Libre-Échange*, 223 Janvier 1848] [OC2.36, p. 205]
Sur l’inscription maritime
22 Janvier 1847
Un journal annonce que le gouvernement anglais, sentant que la presse des matelots serait inexécutable, est sur le point de constituer quelque chose de semblable à notre inscription maritime.
Si nous étions de ceux qui pensent que ce qui nuit à une nation profite nécessairement à une autre, nous encouragerions de toutes nos forces nos voisins à entrer dans cette voie. S’il est vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous pourrions en conclure qu’une institution qui a été funeste à notre marine marchande, et par suite à notre marine militaire, ne le serait pas moins à la marine britannique.
Que notre marine marchande soit en décadence, c’est un fait qui n’a plus besoin de preuves. Sans doute, ainsi que l’a parfaitement démontré la chambre de commerce de Bordeaux, la cause principale en est dans le régime restrictif. Les chiffres et les paradoxes du comité Odier ne parviendront jamais à ébranler cette vérité, que si la France expédiait et recevait plus de marchandises, elle aurait plus de transports à faire. Le comité Odier cite avec complaisance le chiffre de nos importations et de nos exportations. Nous prendrons la liberté de lui faire observer que ce qui entre en France n’y entre pas en vertu du régime restrictif, mais malgré ce régime. Il nuit à notre marine, non en raison des choses qu’il laisse entrer, mais en raison de celles qu’il empêche d’entrer.
D’ailleurs, ce n’est pas seulement par la diminution sur l’ensemble de nos échanges qu’il froisse la navigation, mais par la fausse position où il met nos navires. Supposez la liberté absolue, et il est aisé de comprendre comment le prix du fret pourrait s’abaisser sans préjudice pour les armateurs.
Quand un bâtiment prend charge au Havre ou à Bordeaux, si l’armateur pouvait se dire : « Partout où ira mon navire, le capitaine s’adressera aux courtiers et prendra la première cargaison venue, n’importe la destination. Au Brésil, il n’attendra pas qu’il se présente du fret pour le Havre : il pourrait attendre longtemps, puisque nous ne voulons rien recevoir en France du Brésil. Mais s’il trouve à charger des cuirs pour New-York, si à New-York il rencontre du blé pour l’Angleterre, et en Angleterre du sucre pour Dantzick, il sera libre d’exécuter ces transports ; ses périodes d’attente et d’inaction, ses chances de retour à vide en seront fort diminuées ; » si, dis-je, l’armateur français pouvait faire ce raisonnement, il est probable qu’il serait plus facile relativement au prix du fret. On dit à cela qu’il est bien forcé par la concurrence de réduire ses prétentions au même niveau que les autres navigateurs. Cela est vrai ; et c’est précisément pour cela qu’on construit moins et qu’on navigue moins en France, parce qu’à ce niveau la convenance ne s’y trouve plus, et la rémunération est insuffisante.
Nous ignorons combien il faudra de temps pour que les nations apprennent à ne pas voir un gain dans le tort qu’elles se font ainsi les unes aux autres.
Mais, si nous sommes bien informés, l’inscription maritime travaille presque aussi efficacement que le régime exclusif à la décadence de notre marine marchande.
Le métier de marin, qui a naturellement tant d’attraits pour la jeunesse de nos côtes, est aujourd’hui évité avec le plus grand soin. Les pères font des sacrifices pour empêcher leurs fils d’entrer dans cette noble carrière, car on n’y peut entrer sans perdre toute indépendance pour le reste de ses jours. Souvent, sans doute, l’attrait d’une profession aventureuse l’emporte sur les calculs de la prévoyance ; mais alors le marin se dégoûte bientôt d’une carrière qui lui fait sentir constamment le poids d’une chaîne inflexible, et nous avons entendu des hommes pratiques se demander très-sérieusement si les sinistres fréquents, dont notre marine militaire est affligée depuis quelque temps, ne devaient pas être attribués à une certaine force d’inertie qui naît, dans le marin, de la répugnance avec laquelle il subit la triste destinée que lui fait l’inscription maritime. Quoi qu’il en soit, si l’on faisait une enquête sur les rivages de l’Océan, nous osons affirmer qu’elle révélerait, dans la population, une inclination toujours croissante à s’éloigner de toutes les professions qui assujettissent à l’inscription maritime.
Admettons pour un instant que ce régime vînt à être effacé de nos lois, et que, pour se procurer des marins, l’État n’eût d’autres ressources, comme aux États-Unis et en Angleterre, que de les payer à un taux plus élevé que celui du commerce.
Il pourrait en résulter une plus grande difficulté pour armer instantanément un grand nombre de vaisseaux de guerre. Il n’est pas douteux qu’avec un pouvoir despotique on va toujours plus vite en besogne. Mais cet inconvénient ne serait-il pas bien compensé par l’avantage de faire renaître le goût de la mer, de diminuer les entraves de notre marine marchande, et d’avoir ainsi à sa disposition une population maritime à la fois plus nombreuse et plus dévouée ?
Il nous semble que les inconvénients, s’il y en a, porteraient sur nos moyens agressifs, l’agression exigeant toujours beaucoup de promptitude. Mais pour nos moyens de défense, ils seraient certainement fort accrus par le régime de la liberté. Raison de plus pour que nous lui accordions toutes nos sympathies.
Revenant à l’Angleterre, nous serions fâchés, par les motifs que nous venons d’exposer, de la voir entrer dans le système de l’inscription maritime. Ce système, il est vrai, peut faciliter ses moyens d’attaque, car il est commode de n’avoir qu’un ordre à signer pour réunir dans un moment et sur un point donné une grande force ; mais en même temps, il nous paraît de nature à diminuer les vrais éléments de défense, qui sont et seront toujours, quand il s’agit de la mer, une navigation marchande florissante, une population maritime nombreuse et fortement attachée, par le sentiment de son indépendance et de sa dignité, aux institutions de son pays et aux nobles travaux de la mer.
C’est une circonstance heureuse, pour l’avenir de l’humanité, que les meilleurs moyens d’agression soient pour ainsi dire exclusifs de bons moyens de défense. Les premiers exigent qu’une multitude immense d’êtres humains soient sous la dépendance absolue d’un seul homme. Le despotisme en est l’âme ; c’est l’inscription maritime pour la mer et l’armée permanente pour la terre. Les seconds ne demandent qu’une bonne organisation des citoyens paisibles et l’amour de la patrie : la garde nationale pour la défense des frontières et le service volontaire pour la défense des côtes. Aucun peuple impartial et raisonnable ne peut se formaliser de ce qu’une autre nation pourvoie à sa défense par des mesures qui excluent le danger de l’agression ; mais, sous prétexte de défense, accroître les moyens agressifs, même aux dépens des vrais moyens défensifs, c’est répandre au loin des craintes, c’est provoquer des mesures analogues, c’est créer partout le danger, c’est agglomérer des forces qui ne demandent pas mieux que d’être utilisées. C’est, en un mot, retarder le progrès de la civilisation.
Encore les armements en Angleterre [29 Janvier 1848] ↩
BWV
1848.01.29 “Encore les armements en Angleterre” More on Armaments in England) [*Libre-Échange*, 29 Janvier 1848] [OC2.35, p. 200]
Encore les armements en Angleterre
29 Janvier 1848
Il est assez ordinaire de voir les hommes qui ont épousé une cause ou un parti arranger les faits, les tourmenter, les supposer même dans l’intérêt de l’opinion qu’ils défendent.
C’est sans doute la tactique du Moniteur de la prohibition, car il ne tient pas à lui que nous n’entrions dans cette voie d’hypocrisie et de charlatanisme.
Cette feuille épluche avec grand soin nos colonnes, pour y trouver ce qu’elle appelle nos aveux.
Constatons-nous que certains journaux, qui se prétendent les défenseurs exclusifs de la liberté, ont déserté la liberté commerciale ? Aveu.
Sommes-nous surpris que les ouvriers se montrent indifférents à l’égard d’un système qui élève le prix du pain, de la viande, du combustible, des outils, du vêtement, sans rien faire pour les salaires ? Aveu.
Cherchons-nous à détruire les alarmes imaginaires que la liberté des transactions inspire à quelques esprits prévenus ? Aveu.
Gémissons-nous de voir l’aristocratie britannique, un an après que le principe de la liberté lui a été imposé par l’opinion populaire, s’efforcer d’entraîner cette opinion dans la dangereuse et inconséquente voie des armements ? Aveu.
Que faudrait-il donc faire pour se mettre à l’abri de la vigilance du Moniteur industriel ? Eh ! parbleu, la chose est simple : imiter les charlatans de tous les partis ; affirmer que le régime protecteur n’a les sympathies de personne ; que l’immense majorité des citoyens, soit en dedans, soit en dehors du pouvoir, possède assez de connaissances économiques pour apercevoir tout ce qu’il y a d’injustice et de déception dans ce système ; nier les faits, en un mot, avocasser.
Mais alors comment expliquer notre Association ? Si nous étions sûrs que l’opinion publique est parfaitement éclairée, qu’elle est pour nous, qu’elle n’a plus rien à apprendre, pourquoi nous serions-nous associés ?
Dussions-nous fournir encore souvent au Moniteur industriel l’occasion de se réjouir de nos aveux, nous continuerons à exposer devant nos lecteurs tous les faits qui intéressent notre cause, aussi bien ceux qui peuvent retarder que ceux qui doivent hâter son succès.
Car nous avons foi dans la puissance de la vérité ; et lorsque les temps sont arrivés, il n’y a rien qui ne concoure à son triomphe, même les obstacles apparents.
C’est ce qui arrivera certainement à l’occasion des fameux armements britanniques. Si, comme nous en avons la ferme espérance, l’opinion du peuple, un moment surprise, vient à se raviser, si elle s’oppose à un nouveau développement de forces brutales, si elle en demande même la réduction, ne sera-ce pas la plus forte preuve de la connexité qui existe entre la cause de la liberté commerciale et celle de la stabilité de la paix ?
Le Moniteur industriel, par cela même qu’il soutient une mauvaise cause, ne peut, lui, rien laisser passer dans ses colonnes de ce qui ressemble à des aveux. Aussi s’en garde-t-il bien. Demandez-lui qu’il imprime le message du président ou le rapport du ministre des finances des États-Unis ; demandez-lui qu’il rende compte des nombreux meetings où les hommes de la classe industrielle, chefs et ouvriers, combattent Angleterre les desseins belliqueux de l’oligarchie : il ne le fera pas ; car quand on soutient une mauvaise cause, ce qu’il faut surtout empêcher, c’est que la lumière ne se fasse.
Aussi, nous sommes quelquefois surpris que le comité protectionniste permette au Moniteur industriel de soutenir la discussion. Quand on a tort, la discussion ne vaut rien. Il eût été plus prudent de suivre les bons conseils du Journal d’Elbeuf (quoique le Journal d’Elbeuf ne les suive pas toujours lui-même) et de faire entrer aussi le Moniteur industriel dans la conspiration du silence.
Discutons donc avec le Moniteur industriel la question des armements.
Il fait à ce sujet un long article qui se termine ainsi :
« En résumé, les armements de l’Angleterre que les libre-échangistes s’efforcent de présenter comme en contradiction avec sa conduite économique, participent au contraire du même esprit et tendent au même but : le Libre-Échange a été une campagne dirigée par l’industrie britannique contre l’industrie étrangère, et les armements ont pour but d’obtenir à un jour donné par la force ce qu’elle n’aura pu obtenir par la propagande, à l’aide de l’esprit d’imitation. »
Que de choses à relever dans ces quelques lignes !
Singulière campagne de l’industrie britannique contre l’industrie étrangère, laquelle s’est terminée par l’abolition des droits sur les céréales, les bestiaux, le beurre, le fromage, la laine et tous les produits agricoles ! L’Angleterre a donc espéré par là inonder le monde de blé, de viande, de laine et de beurre ?
Singulière propagande que celle de la ligue qui a agité pendant sept ans les Trois-Royaumes, sans que personne en France en sût rien ! (V. l’introduction du tome III.)
Mais le principal paradoxe du Moniteur consiste surtout à représenter l’Angleterre comme agissant sous l’influence d’une pensée unique et unanime. Le Moniteur ne veut pas voir, ou du moins il ne veut pas convenir qu’il y a deux Angleterres : l’une qui exploite et l’autre qui est exploitée : l’une qui dissipe et l’autre qui travaille ; l’une qui soutient les monopoles et les profusions gouvernementales, l’autre qui les combat ; l’une qui s’appelle oligarchie, l’autre qui s’appelle peuple.
Or, ce sont précisément les mêmes hommes qui, il y a deux ans, se mettaient en frais d’éloquence pour maintenir la restriction, les prohibitions, les priviléges, les monopoles ; ce sont précisément ces mêmes hommes qui demandent aujourd’hui qu’on augmente le nombre des vaisseaux et des régiments et le chiffre des impôts. Pourquoi ? parce que les impôts sont leur patrimoine, comme l’étaient les monopoles.
Et ce sont les mêmes hommes qui combattaient contre le monopole qui combattent aujourd’hui contre les armements. (V. tome III, pages 459 et suiv.)
Quels étaient, il y a deux ans, les chefs de la croisade protectionniste ? c’étaient bien MM. Bentinck, Sibthorp, et le Morning-Post.
Quels étaient les chefs de la ligue ? c’étaient bien Cobden, Bright, Villiers, Thompson, Fox, Wilson, Hume.
En Angleterre, les journaux publient les noms des membres du Parlement qui votent pour ou contre une mesure.
Nous saurons donc bientôt qui veut les armements et qui ne les veut pas.
Et si nous trouvons dans le parti belliqueux les nobles lords, les Bentinck, les Sibthorp, les Stanley et le Morning-Post ; si nous retrouvons dans le parti de la paix les Cobden, les Bright, les Villiers, les Fox, etc., que devrons-nous en conclure ?
Qu’il y a donc une connexité de fait, comme il y a une connexité en théorie, entre la liberté du commerce, la paix des nations et la modicité des taxes publiques.
Et qu’il y a aussi une connexité de fait, comme il y a une connexité en théorie, entre les monopoles, les idées de violence brutale et l’exagération des impôts.
Nous devrons tirer encore de là une autre conclusion.
Le Moniteur industriel nous accuse souvent d’anglomanie ; mais il est pour le moins aussi anglomane que nous. Nous sympathisons, il est vrai, avec les idées de justice, de liberté, d’égalité, de paix, partout où nous les voyons se produire, fût-ce en Angleterre. Et c’est pour cela, soit qu’il s’agisse de liberté de commerce ou de réduction de forces brutales, qu’on nous voit du côté des Cobden, des Bright et des Villiers.
Le Moniteur industriel prêche l’exploitation du public par une classe. C’est pour cela qu’on le voit du côté des Bentinck et des Sibthorp, soit que l’exploilation se fasse par le monopole, soit qu’elle se fasse par l’abus des fonctions et des impôts.
La discussion sur les armements aura lieu bientôt à la Chambre des communes. Nous attendons là le Moniteur industriel. Lui qui nous reproche de sympathiser avec la cause du peuple anglais, nous verrons s’il ne s’enrôle pas encore cette fois à la suite de l’oligarchie britannique et du Morning-Post.
Messieurs les monopoleurs, permettez-nous de vous le dire : vous faites un grand étalage de sentiments patriotiques ; mais votre patriotisme n’est pas de bon aloi.
Votre grand argument contre la liberté des transactions est : Que ferions-nous en cas de guerre, si nous tirions une partie de nos approvisionnements de l’étranger ?
C’est par cet argument que vous parvenez à retenir l’opinion publique près de vous abandonner.
Vous aviez donc besoin, non pas de la guerre (ce serait une perversité dont nous vous croyons incapables), mais de l’éventualité toujours imminente d’une guerre. La durée de vos monopoles est à ce prix.
Vous êtes ainsi conduits a semer partout des alarmes, à faire alliance avec les partis qui, en tous pays, appellent la guerre, à flatter sans cesse, à égarer le plus délicat et le plus dangereux des sentiments, l’orgueil national ; à empêcher autant qu’il est en vous que l’Europe ne réduise son état militaire, à cacher avec soin les garanties que la liberté donne à la paix.
Voilà le secret de ce prétendu patriotisme dont vous faites étalage.
Ce patriotisme, qu’en faisiez-vous quand il fut question d’une union douanière entre la France et la Belgique ? Oh ! alors vous avez bien su en sevrer vos lèvres et le mettre en réserve au fond de vos cœurs pour une autre occasion. Il se montre ou se cache selon les exigences de vos priviléges.
Nous voyons par les journaux anglais qu’une vraie panique a été habilement semée de l’autre côté du détroit parmi le peuple. Le ministère whig veut augmenter ses armements. Le résultat sera que la France augmentera les siens. Ce spectacle nous attriste, nous ne le cachons pas. — Il vous réjouit, vous ; c’est tout aussi naturel. Votre joie éclate dans les colonnes du Moniteur industriel. Vous ne pouvez pas le contenir. Vous nous raillez, vous triomphez ; car cela retarde le jour où vous serez bien forcés de rentrer dans le droit commun. Ce patriotisme-là nous, vous en laissons le triste monopole.
Le maire d'Énios [The Mayor of Enios] [6 February 1848] [CW3 ES3.18]↩
BWV
1848.02.06 “Le maire d'Énios” (The Mayor of Énios]) [*Libre-Échange*, 6 February 1848] [OC2.63, pp. 418-29] [CW3] [ES3.18]
C’était un singulier Maire que le maire d’Énios. D’un caractère… Mais il est bon que le lecteur sache d’abord ce que c’est qu’Énios.
Énios est une commune de Béarn placée…
Pourtant, il semble plus logique d’introduire d’abord monsieur le Maire.
Bon ! Me voilà bien empêché dès le début. J’aimerais mieux avoir l’algèbre à prouver que Peau d’âne à conter.
Ô Balzac ! ô Dumas ! ô Suë ! ô génies de la fiction et du roman moderne, vous qui, dans des volumes plus pressés que la grêle d’août, pouvez dévider, sans les embrouiller, tous les fils d’une interminable intrigue, dites-moi au moins s’il vaut mieux peindre le héros avant la scène ou la scène avant le héros.
Peut-être me direz-vous que ce n’est ni le sujet ni le lieu, mais le temps qui doit avoir la priorité.
Eh bien donc, c’était l’époque où les mines d’asphalte…
Mais je ferai mieux, je crois, de conter à ma manière.
Énios est une commune adossée du côté du midi à une montagne haute et escarpée, en sorte que l’ennemi (c’est de l’échange dont je parle), malgré sa ruse et son audace, ne peut, comme on dit en stratégie, ni tomber sur ses derrières, ni le prendre à revers.
Au nord, Énios s’étale sur la croupe arrondie de la montagne dont un Gave impétueux baigne le pied gigantesque.
Ainsi protégé, d’un côté par des pics inaccessibles, de l’autre par un torrent infranchissable, Énios se trouverait complétement isolé du reste de la France, si messieurs des ponts et chaussées n’avaient jeté au travers du Gave un pont hardi, dont, pour me conformer au faire moderne, je suis tenté de vous donner la description et l’histoire.
Cela me conduirait tout naturellement à faire l’histoire de notre bureaucratie : je raconterais la guerre entre le génie civil et le génie militaire, entre le conseil municipal, le conseil général, le conseil des ponts et chaussées, le conseil des fortifications et une foule d’autres conseils ; je peindrais les armes, qui sont des plumes, et les projectiles, qui sont des dossiers. Je dirais comment l’un voulait le pont en bois, l’autre en pierre, celui-ci en fer, celui-là en fil de fer ; comment, pendant cette lutte, le pont ne se faisait pas ; comment ensuite, grâce aux sages combinaisons de notre budget, on commença plusieurs années de suite les travaux en plein hiver, de manière à ce qu’au printemps il n’en restât plus vestige ; comment, quand le pont fut fait, on s’aperçut qu’on avait oublié la route pour y aboutir ; ici, fureur du maire, confusion du préfet, etc. Enfin, je ferais une histoire de trente ans, trois fois plus intéressante par conséquent que celle de M. Louis Blanc. Mais à quoi bon ? Apprendrais-je rien à personne ?
Ensuite qui m’empêcherait de faire, en un demi-volume, la description du pont d’Énios, de ses culées, de ses piles, de son tablier, de ses garde-fous ? N’aurais-je pas à ma disposition toutes les ressources du style à la mode, surtout la personnification ? Au lieu de dire : On balaye le pont d’Énios tous les matins, je dirais : Le pont d’Énios est un petit maître, un dandy, un fashionable, un lion. Tous les matins son valet de chambre le coiffe, le frise, car il ne veut se montrer aux belles tigresses du Béarn, qu’après s’être assuré, en se mirant dans les eaux du Gave, que sa cravate est bien nouée, ses bottes bien vernies et sa toilette irréprochable. — Qui sait ? On dirait peut-être du narrateur, comme Géronte de Damis : Vraiment il a du goût !
C’est selon ces règles nouvelles que je me propose de raconter, dès que j’aurai fait rencontre d’un éditeur bénévole à qui cela convienne. En attendant, je reprends la manière de ceux qui n’ont à leur disposition que deux ou trois petites colonnes de journal.
Figurez-vous donc Énios, ses vertes prairies, au bord du torrent, et, d’étage en étage, ses vignes, ses champs, ses pâturages, ses forêts et les sommets neigeux de la montagne pour dominer et fermer le tableau.
L’aisance et le contentement régnaient dans la commune. Le Gave donnait le mouvement à des moulins et à des scieries ; les troupeaux fournissaient du lait et de la laine ; les champs, du blé ; la cour, de la volaille ; les vignes, un vin généreux ; la forêt, un combustible abondant. Quand un habitant du village était parvenu à faire quelques épargnes, il se demandait à quoi il valait mieux les consacrer, et le prix des choses le déterminait. Si, par exemple, avec ses économies il avait pu opter entre fabriquer un chapeau ou bien élever deux moutons, dans le cas où de l’autre côté du Gave on ne lui aurait demandé qu’un mouton pour un chapeau, il aurait cru que faire le chapeau eût été un acte de folie ; car la civilisation, et avec elle le Moniteur industriel, n’avaient pas encore pénétré dans ce village.
Il était réservé au maire d’Énios de changer tout cela. Ce n’est pas un maire comme un autre que le maire d’Énios : c’était un vrai pacha.
Jadis, Napoléon l’avait frappé sur l’épaule. Depuis, il était plus Napoléoniste que Roustan, et plus Napoléonien que M. Thiers.
« Voilà un homme, disait-il, en parlant de l’empereur ; celui-là ne discutait pas, il agissait ; il ne consultait pas, il commandait. C’est ainsi qu’on gouverne bien un peuple. Le Français surtout a besoin d’être mené à la baguette. »
Quand il avait besoin de prestations pour les routes de sa commune, il mandait un paysan : Combien dois-tu de corvées (on dit encore corvées dans ce pays, quoique prestations soit bien mieux). — Trois, répond le paysan. — Combien en as-tu déjà fait ? — Deux. — Donc il t’en reste deux à faire. — Mais, monsieur le Maire, deux et deux font… — Oui, ailleurs, mais…
Dans le pays béarnois,
Deux et deux font trois ;
et le paysan faisait quatre corvées, je veux dire prestations.
Insensiblement, M. le maire s’était habitué à regarder tous les hommes comme des niais, que la liberté de l’enseignement rendrait ignorants, la liberté religieuse athées, la liberté du commerce gueux, qui n’écriraient que des sottises avec la liberté de la presse, et feraient contrôler les fonctions par les fonctionnaires avec la liberté électorale. « Il faut organiser et mener toute cette tourbe, » répétait-il souvent. Et quand on lui demandait : « Qui mènera ? » — « Moi, » répondait-il fièrement.
Là où il brillait surtout, c’était dans les délibérations du conseil municipal. Il les discutait et les votait à lui tout seul dans sa chambre, formant à la fois majorité, minorité et unanimité. Puis il disait à l’appariteur :
« C’est aujourd’hui dimanche ? — Oui, monsieur le Maire.
— Les municipaux iront chanter vêpres ? — Oui, monsieur le Maire.
— De là ils se rendront au cabaret ? — Oui, monsieur le Maire.
— Ils se griseront ? — Oui, monsieur le Maire.
— Eh bien, prends ce papier. — Oui, monsieur le Maire.
— Tu iras ce soir au cabaret. — Oui, monsieur le Maire.
— À l’heure où l’on y voit encore assez pour signer.
— Oui, monsieur le Maire.
— Mais où l’on n’y voit déjà plus assez pour lire. — Oui, monsieur le Maire.
— Tu présenteras à mes braves municipaux cette pancarte ainsi qu’une plume trempée d’encre, et tu leur diras, de ma part, de lire et de signer. — Oui, monsieur le Maire.
— Ils signeront sans lire et je serai en règle envers mon préfet. Voilà comment je comprends le gouvernement représentatif. »
Un jour, il recueillit dans un journal ce mot célèbre : La légalité nous tue. Ah ! s’écria-t-il, je ne mourrai pas sans avoir embrassé M. Viennet.
Il est pourtant bon de dire que, quand la légalité lui profitait, il s’y accrochait comme un vrai dogue. Quelques hommes sont ainsi faits ; ils sont rares, mais il y en a.
Tel était le maire d’Énios. Et maintenant que j’ai décrit et le théâtre et le héros de mon histoire, je vais la mener bon train et sans digressions.
Vers l’époque où les Parisiens allaient cherchant dans les Pyrénées des mines d’asphalte, déjà mises en actions au capital d’un nombre indéfini de millions, M. le maire donna l’hospitalité à un voyageur qui oublia chez lui deux ou trois précieux numéros du Moniteur industriel… Il les lut avidement, et je laisse à penser l’effet que dut produire sur une telle tête une telle lecture. Morbleu ! s’écria-t-il, voilà un gazetier qui en sait long. Défendre, empêcher, repousser, restreindre, prohiber, ah ! la belle doctrine ! C’est clair comme le jour. Je disais bien, moi, que les hommes se ruineraient tous, si on les laissait libres de faire des trocs ! Il est bien vrai que la légalité nous tue quelquefois, mais souvent aussi c’est l’absence de légalité. On ne fait pas assez de lois en France, surtout pour prohiber. Et, par exemple, on prohibe aux frontières du royaume, pourquoi ne pas prohiber aux frontières des communes ? Que diable, il faut être logique.
Puis, relisant le Moniteur industriel, il faisait à sa localité l’application des principes de ce fameux journal. Mais cela va comme un gant, disait-il, il n’y a qu’un mot à changer ; il suffit de substituer travail communal à travail national.
Le maire d’Énios se vantait, comme M. Chasseloup-Laubat, de n’être point théoricien ; aussi, comme son modèle, il n’eut ni paix ni trêve qu’il n’eût soumis tous ses administrés à la théorie (car c’en est bien une) de la protection.
La topographie d’Énios servit merveilleusement ses projets. Il assembla son conseil (c’est-à-dire il s’enferma dans sa chambre), il discuta, délibéra, vota et sanctionna un nouveau tarif pour le passage du pont, tarif un peu compliqué, mais dont l’esprit peut se résumer ainsi :
Pour sortir de la commune, zéro par tête.
Pour entrer dans la commune, cent francs par tête.
Cela fait, M. le maire réunit, cette fois tout de bon, le conseil municipal, et prononça le discours suivant que nous rapporterons en mentionnant les interruptions.
« Mes amis, vous savez que le pont nous a coûté cher ; il a fallu emprunter pour le faire, et nous avons à rembourser intérêts et principal ; c’est pourquoi je vais frapper sur vous une contribution additionnelle.
Jérôme. Est-ce que le péage ne suffit plus ?
— Un bon système de péage, dit le maire d’un ton doctoral, doit avoir en vue la protection et non le revenu. — Jusqu’ici le pont s’est suffit à lui-même, mais j’ai arrangé les choses de manière à ce qu’il ne rapportera plus rien. En effet, les denrées du dedans passeront sans rien payer, et celles du dehors ne passeront pas du tout.
Mathurin. Et que gagnerons-nous à cela ?
— Vous êtes des novices, reprit le maire ; et déployant devant lui le Moniteur industriel, afin d’y trouver réponse au besoin à toutes les objections, il se mit à expliquer le mécanisme de son système, en ces termes :
Jacques, ne serais-tu pas bien aise de faire payer ton beurre un peu plus cher aux cuisinières d’Énios ?
— Cela m’irait, dit Jacques.
— Eh bien, pour cela, il faut empêcher le beurre étranger d’arriver par le pont. Et toi, Jean, pourquoi ne fais-tu pas promptement fortune avec tes poules ?
— C’est qu’il y en a trop sur le marché, dit Jean.
— Tu comprends donc bien l’avantage d’en exclure celles du voisinage. Quant à toi, Guillaume, je sais que tu as encore deux vieux bœufs sur les bras. Pourquoi cela ?
— Parce que François, avec qui j’étais en marché, dit Guillaume, est allé acheter des bœufs à la foire voisine.
— Tu vois bien que s’il n’eût pu leur faire passer le pont, tu aurais bien vendu tes bœufs, et Énios aurait conservé 5 ou 600 francs de numéraire.
Mes amis, ce qui nous ruine, ce qui nous empêche au moins de nous enrichir, c’est l’invasion des produits étrangers.
N’est-il pas juste que le marché communal soit réservé au travail communal ?
Soit qu’il s’agisse de prés, de champs ou de vignes, n’y a-t-il pas quelque part une commune plus fertile que la nôtre pour une de ces choses ? Et elle viendrait jusque chez nous nous enlever notre propre travail ! Ce ne serait pas de la concurrence, mais du monopole ; mettons-nous en mesure, en nous rançonnant les uns les autres, de lutter à armes égales.
Pierre, le sabotier. En ce moment, j’ai besoin d’huile, et on n’en fait pas dans notre village.
— De l’huile ! vos ardoises en sont pleines. Il ne s’agit que de l’en retirer. C’est là une nouvelle source de travail, et le travail c’est la richesse. Pierre, ne vois-tu pas que cette maudite huile étrangère nous faisait perdre toute la richesse que la nature a mise dans nos ardoises ?
Le maître d’école. Pendant que Pierre pilera des ardoises, il ne fera pas de sabots. Si, dans le même espace de temps, avec le même travail, il peut avoir plus d’huile en pilant des ardoises qu’en faisant des sabots, votre tarif est inutile. Il est nuisible si, au contraire, Pierre obtient plus d’huile en faisant des sabots qu’en pilant des ardoises. Aujourd’hui, il a le choix entre les deux procédés ; votre mesure va le réduire à un seul, et probablement au plus mauvais, puisqu’on ne s’en sert pas. Ce n’est pas tout qu’il y ait de l’huile dans les ardoises, il faut encore qu’elle vaille la peine d’être extraite ; et il faut, de plus, que le temps ainsi employé ne puisse être mieux employé à autre chose. Que risquez-vous à nous laisser la liberté du choix ? »
Ici, les yeux de M. le maire semblèrent dévorer le Moniteur industriel pour y chercher réponse au syllogisme ; mais ils ne l’y rencontrèrent pas, le Moniteur ayant toujours évité ce côté de la question. M. le maire ne resta pas court pour cela. Il lui vint même à l’esprit le plus victorieux des arguments : « Monsieur le régent, dit-il, je vous ôte la parole et vous destitue. »
Un membre voulut faire observer que le nouveau tarif dérangerait beaucoup d’intérêts, et qu’il fallait au moins ménager la transition. — La transition ! s’écria le maire, excellent prétexte contre les gens qui réclament la liberté ; mais quand il s’agit de la leur ôter, ajouta-t-il avec beaucoup de sagacité, où avez-vous entendu parler de transition ?
Enfin, on alla aux voix, et le tarif fut voté à une grande majorité. Cela vous étonne ? Il n’y a pas de quoi.
Remarquez, en effet, qu’il y a plus d’art qu’il ne semble dans le discours du premier magistrat d’Énios.
N’avait-il pas parlé à chacun de son intérêt particulier ? De beurre à Jacques le pasteur, de vin à Jean le vigneron, de bœufs à Guillaume l’éleveur ? N’avait-il pas constamment laissé dans l’ombre l’intérêt général ?
Cependant, ses efforts, son éloquence municipale, ses conceptions administratives, ses vues profondes d’économie sociale, tout devait venir se briser contre les pierres de l’hôtel de la Préfecture.
M. le préfet, brutalement, sans ménagement aucun, cassa le tarif protecteur du pont d’Énios.
M. le maire, accouru au chef-lieu, défendit vaillamment son œuvre, ce noble fruit de sa pensée fécondée par le Moniteur industriel. Il en résulta, entre les deux athlètes, la plus singulière discussion du monde, le plus bizarre dialogue qu’on puisse entendre ; car il faut savoir que M. le préfet était pair de France et fougueux protectionniste. En sorte que tout le bien que M. le préfet disait du tarif des douanes, M. le maire s’en emparait au profit du tarif du pont d’Énios ; et tout le mal que M. le préfet attribuait au tarif du pont, M. le maire le retournait contre le tarif des douanes.
« Quoi ! Disait M. le préfet, vous voulez empêcher le drap du voisinage d’entrer à Énios !
— Vous empêchez bien le drap du voisinage d’entrer en France.
— C’est bien différent, mon but est de protéger le travail national.
— Et le mien de protéger le travail communal.
— N’est-il pas juste que les Chambres françaises défendent les fabriques françaises contre la concurrence étrangère ?
— N’est-il pas juste que la municipalité d’Énios défende les fabriques d’Énios contre la concurrence du dehors ?
— Mais votre tarif nuit à votre commerce, il écrase les consommateurs, il n’accroît pas le travail, il le déplace. Il provoque de nouvelles industries, mais aux dépens des anciennes. Comme vous l’a dit le maître d’école, si Pierre veut de l’huile, il pilera des ardoises ; mais alors il ne fera plus de sabots pour les communes environnantes. Vous vous privez de tous les avantages d’une bonne direction du travail.
— C’est justement ce que les théoriciens du libre-échange disent de vos mesures restrictives.
— Les libre-échangistes sont des utopistes qui ne voient jamais les choses qu’au point de vue général. S’ils se bornaient à considérer isolement chaque industrie protégée, sans tenir compte des consommateurs ni des autres branches de travail, ils comprendraient toute l’utilité des restrictions.
— Pourquoi donc me parlez-vous des consommateurs d’Énios ?
— Mais, à la longue, votre péage nuira aux industries mêmes que vous voulez favoriser ; car, en ruinant les consommateurs, vous ruinez la clientèle, et c’est la richesse de la clientèle qui fait la prospérité de chaque industrie.
— C’est encore là ce que vous objectent les libre-échangistes. Ils disent que vouloir développer une branche de travail par des mesures qui lui ferment les débouchés extérieurs, et qui, si elles lui assurent la clientèle du dedans, vont sans cesse affaiblissant cette clientèle, c’est vouloir bâtir une pyramide en commençant par la pointe.
— Monsieur le maire, vous êtes contrariant, je n’ai pas de compte à vous rendre, et je casse la délibération du conseil municipal d’Énios. »
Le maire reprit tristement le chemin de sa commune, en maugréant contre les hommes qui ont deux poids et deux mesures, qui soufflent le chaud et le froid, et croient très-sincèrement que ce qui est vérité et justice dans un cercle de cinq mille hectares, devient mensonge et iniquité dans un cercle de cinquante mille lieues carrées. Comme il était bonhomme au fond : J’aime mieux, se dit-il, la loyale opposition du régent de la commune, et je révoquerai sa destitution.
En arrivant à Énios, il convoqua le conseil pour lui annoncer d’un ton piteux sa triste déconvenue. Mes amis, dit-il, nous avons tous manqué notre fortune. M. le préfet, qui vote chaque année des restrictions nationales, repousse les restrictions communales. Il casse votre délibération et vous livre sans défense à la concurrence étrangère. Mais il nous reste une ressource. Puisque l’inondation des produits étrangers nous étouffe, puisqu’il ne nous est pas permis de les repousser par la force, pourquoi ne les refuserions-nous pas volontairement ? Que tous les habitants d’Énios conviennent entre eux de ne jamais rien acheter au dehors.
Mais les habitants d’Énios continuèrent à acheter au dehors ce qu’il leur en coûtait plus de faire au dedans ; ce qui confirma de plus en plus M. le maire dans cette opinion, que les hommes inclinent naturellement vers leur ruine quand ils ont le malheur d’être libres.
Deux Angleterre [6 février 1848] ↩
BWV
1848.02.06 “Deux Angleterre” (Two Englands) [*Libre-Échange*, 6 février 1848] [OC3.34, p. 459]
Quand nous avons entrepris d’appeler l’attention de nos concitoyens sur la question de la liberté commerciale, nous n’avons pas pensé ni pu penser que nous nous faisions les organes d’une opinion en majorité dans le pays, et qu’il ne s’agit pour nous que d’enfoncer une porte ouverte.
D’après les délibérations bien connues de nombreuses chambres de commerce, nous pouvions espérer, il est vrai, d’être soutenus par une forte minorité, qui, ayant pour elle le bon sens et le bien général, n’aurait que quelques efforts à faire pour devenir majorité.
Mais cela ne nous empêchait pas de prévoir que notre association provoquerait la résistance désespérée de quelques privilégiés, appuyée sur les alarmes sincères du grand nombre.
Nous ne mettions pas en doute qu’on saisirait toutes les occasions de grossir ces alarmes. L’expérience du passé nous disait que les protectionnistes exploiteraient surtout le sentiment national, si facile à égarer dans tous les pays. Nous prévoyions que la politique fournirait de nombreux aliments à cette tactique ; que, sur ce terrain, il serait facile aux monopoleurs de faire alliance avec les partis mécontents ; qu’ils nous créeraient tous les obstacles d’une impopularité factice et qu’ils iraient au besoin jusqu’à élever contre nous ce cri : Vous êtes les agents de Pitt et de Cobourg. Il faudrait que nous n’eussions jamais ouvert un livre d’histoire, si nous ne savions que le privilége ne succombe jamais sans avoir épuisé tous les moyens de vivre.
Mais nous avions foi dans la vérité. Nous étions convaincus, comme nous le sommes encore, qu’il n’y a pas une Angleterre, mais deux Angleterre. Il y a l’Angleterre oligarchique et monopoliste, celle qui a infligé tant de maux au monde, exercé et étendu partout une injuste domination, celle qui a fait l’acte de navigation, celle qui a fait la loi-céréale, celle qui a fait de l’Église établie une institution politique, celle qui a fait la guerre à l’indépendance des États-Unis, celle qui a d’abord exaspéré et ensuite combattu à outrance la révolution française, et accumulé, en définitive, des maux sans nombre, non-seulement sur tous les peuples, mais sur le peuple anglais lui-même. — Et nous disons que, s’il y a des Français qui manquent de patriotisme, ce sont ceux qui sympathisent avec cette Angleterre.
Il y a ensuite l’Angleterre démocratique et laborieuse, celle qui a besoin d’ordre, de paix et de liberté, celle qui a besoin pour prospérer que tous les peuples prospèrent, celle qui a renversé la loi-céréale, celle qui s’apprête à renverser la loi de navigation, celle qui sape le système colonial, cause de tant de guerres, celle qui a obtenu le bill de la réforme, celle qui a obtenu l’émancipation catholique, celle qui demande l’abolition des substitutions, cette clef de voûte de l’édifice oligarchique, celle qui applaudit, en 1787, à l’acte par lequel l’Amérique proclama son indépendance, celle qu’il fallut sabrer dans les rues de Londres avant de faire la guerre de 1792, celle qui, en 1830, renversa les torys prêts à former contre la Franco une nouvelle coalition. — Et nous disons que c’est abuser étrangement de la crédulité publique que de représenter comme manquant de patriotisme ceux qui sympathisent avec cette Angleterre.
Après tout, le meilleur moyen de les juger, c’est de les voir agir ; et certes ce serait le devoir de la presse de faire assister le public à cette grande lutte, à laquelle se rattachent l’indépendance du monde et la sécurité de l’avenir.
Absorbée par d’autres soins, influencée par des motifs qu’il ne nous est pas donné de comprendre, elle répudie cette mission. On sait que la plus puissante manifestation de l’esprit du siècle, agissant par la Ligue contre la loi-céréale, a agité pendant sept ans les trois royaumes, sans que nos journaux aient daigné s’en occuper.
Après les réformes de 1846, après l’abrogation du privilége foncier, au moment où la lutte va s’engager en Angleterre sur un terrain plus brûlant encore, l’acte de navigation, qui a été le principe, le symbole, l’instrument et l’incarnation du régime restrictif, on aurait pu croire que la presse française, renonçant enfin à son silence systématique, ne pourrait s’empêcher de donner quelque attention à une expérience qui nous touche de si près, à une révolution économique qui, de quelque manière qu’on la juge, est destinée à exercer une si grande influence sur le monde commercial et politique.
Mais puisqu’elle continue à la tenir dans l’ombre, c’est à nous de la mettre en lumière. C’est pourquoi nous publions le compte rendu de la séance par laquelle les chefs de la Ligue viennent pour ainsi dire de réorganiser à Manchester cette puissante association.
Nous appelons l’attention de nos lecteurs sur les discours qui ont été prononcés dans celte assemblée, et nous leur demanderons de dire, la main sur la conscience, de quel côté est le vrai patriotisme ; s’il est en nous, qui sympathisons de tout notre cœur avec l’infaillible et prochain triomphe de la Ligne, ou s’il est dans nos adversaires, qui réservent toute leur admiration pour la cause du privilége, du monopole, du régime colonial, des grands armements, des haines nationales et de l’oligarchie britannique.
Après avoir lu le discours, si nourri de faits, de M. Gibson, vice-président du Board of trade, l’éloquente et chaleureuse allocution de M. Bright, et ces nobles paroles par lesquelles M. Cobden a prouvé qu’il était prêt à tout sacrifier, même l’avenir qui s’ouvre devant lui, même sa popularité, pour accomplir sa belle mais rude mission, nous demandons à nos lecteurs de dire, la main sur la conscience, si ces orateurs ne défendent pas ces vrais intérêts britanniques qui coïncident et se confondent avec les vrais intérêts de l’humanité ?
Le Moniteur industriel et le Journal d’Elbeuf ne manqueront pas de dire : « Tout cela est du machiavélisme ; depuis dix ans M. Gobden, M. Bright, sir R. Peel, jouent la comédie. Les discours qu’ils prononcent, comédie ; l’enthousiasme des auditeurs, comédie ; les faits accomplis, comédie ; le rappel de la loi-céréale, comédie ; l’abolition des droits sur tous les aliments et sur toutes les matières premières, comédie ; le renversement de l’acte de navigation, comédie ; l’affranchissement commercial des colonies, comédie ; et, comme disait il y a quelques jours un journal protectionniste, l’Angleterre se coupe la gorge devant l’Europe sur le simple espoir que l’Europe l’imitera.
Et nous, nous disons que s’il y a une ridicule comédie au monde, c’est ce langage des protectionnistes. Certes, il faut prendre en considération les longues, et nous ajouterons les justes préventions de notre pays ; mais ne faudrait-il pas rougir enfin de sa crédulité, si cette comédie pouvait être plus longtemps représentée devant lui au bruit de ses applaudissements ?
FN: Libre-Échange du 6 février 1848.
Le sucre antédiluvien [Antediluvian Sugar] [13 February 1848] [CW3 ES3.19]↩
BWV
1848.02.13 “Le sucre antédiluvien” (Antediluvian Sugar) [*Libre-Échange*, 13 February 1848]. [OC2.66, pp. 446-51] [CW3] [ES3.19]
On croit que le sucre est d’invention moderne ; c’est une erreur. L’art de le fabriquer a pu se perdre au déluge ; mais il était connu avant ce cataclysme, ainsi que le prouve un curieux document historique, trouvé dans les grottes de Karnak, et dont on doit la traduction au savant polyglotte, l’illustre cardinal Mezzofante. Nous reproduisons cet intéressant écrit, qui confirme d’ailleurs cette sentence de Salomon : Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.
« En ce temps-là, entre le 42e et le 52e parallèle, il y avait une grande, riche, puissante, spirituelle et brave nation de plus de 36 millions d’habitants, qui tous aimaient le sucre. Le nom de ce peuple est perdu : nous l’appellerons Welche.
Comme leur climat n’admettait pas la culture du saccharum officinarum, les Welches furent d’abord fort embarrassés.
Cependant ils s’avisèrent d’un expédient fort étrange et qui n’avait qu’un tort, celui d’être essentiellement théorique, c’est-à-dire raisonnable.
Ne pouvant créer le sucre en nature, ils imaginèrent d’en créer la valeur.
C’est-à-dire qu’ils faisaient du vin, de la soie, du drap, de la toile et autres marchandises, qu’ils envoyaient dans l’autre hémisphère pour recevoir du sucre en échange.
Un nombre immense de négociants, armateurs, navires et marins étaient occupés à accomplir cette transaction.
D’abord, les Welches crurent bonnement avoir trouvé le moyen le plus simple, dans leur situation, de se sucrer. Comme ils pouvaient choisir, sur plus de la moitié du globe, le point où l’on donnait le plus de sucre contre le moins de vin ou de toile, ils se disaient : Vraiment, si nous faisions le sucre nous-mêmes, à travail égal, nous n’en obtiendrions pas la dixième partie !
C’était trop simple, en effet, pour des Welches, et cela ne pouvait durer.
Un grand homme d’État (amiral sans emploi) jeta un jour parmi eux cette terrible pensée : « Si jamais nous avons une guerre maritime, comment ferons-nous pour aller chercher du sucre ? »
À cette réflexion judicieuse tous les esprits furent troublés, et voici de quoi l’on s’avisa.
On se mit en devoir d’accaparer, précisément dans cet autre hémisphère avec lequel on craignait de voir les communications interrompues, un imperceptible lopin de terre, disant : « Que cet atome soit à nous, et notre provision de sucre est assurée. »
Donc, en prévision d’une guerre possible, on fit une guerre réelle qui dura cent ans. Enfin, elle se termina par un traité qui mit les Welches en possession du lopin de terre convoité, lequel prit nom : Saccharique.
Ils s’imposèrent de nouvelles taxes pour payer les frais de la guerre ; puis de nouvelles taxes encore pour organiser une puissante marine afin de conserver le lopin.
Cela fait, il fut question de tirer parti de la précieuse conquête.
Le petit recoin des antipodes était rebelle à la culture. Il avait besoin de protection. Il fut décidé que le commerce de la moitié du globe serait désormais interdit aux Welches, et que pas un d’entre eux ne pourrait sucer une boule de sucre qui ne vînt du lopin en question.
Ayant ainsi tout arrangé, taxes et restrictions, on se frotta les mains, disant : Ceci n’est pas de la théorie.
Cependant quelques Welches, traversant l’Océan, allèrent à Saccharique pour y cultiver la canne. Mais il se trouva qu’ils ne pouvaient supporter le travail sous ce climat énervant. On alla alors dans une autre partie du monde, puis, y ayant enlevé des hommes tout noirs, on les transporta sur l’îlot, et on les contraignit, à grands coups de bâton, à le cultiver.
Malgré cet expédient énergique, le petit îlot ne pouvait fournir le demi-quart du sucre qui était nécessaire à la nation Welche. Le prix s’en éleva, ainsi qu’il arrive toujours quand dix personnes recherchent une chose dont il n’y a que pour une. Les plus riches d’entre les Welches purent seuls se sucrer.
La cherté du sucre eut un autre effet. Elle excita les planteurs de Saccharique à aller enlever un plus grand nombre d’hommes noirs, afin de les assujettir, toujours à grands coups de bâton, à cultiver la canne jusque sur les sables et les rochers les plus arides. On vit alors ce qui ne s’était jamais vu, les habitants d’un pays ne rien faire directement pour pourvoir à leur subsistance et à leur vêtement, et ne travailler que pour l’exportation.
Et les Welches disaient : C’est merveilleux de voir comme le travail se développe sur notre îlot des antipodes.
Pourtant, dans la suite des temps, les plus pauvres d’entre eux se prirent à murmurer en ces termes :
« Qu’avons-nous fait ? Voilà que le sucre n’est plus à notre portée. En outre, nous ne faisons plus le vin, la soie et la toile qui se répandaient dans tout un hémisphère. Notre commerce est réduit à ce qu’un petit rocher peut donner et recevoir. Notre marine marchande est aux abois, et les taxes nous accablent. »
Mais on leur répondait avec raison : N’est-ce pas une gloire pour vous d’avoir une possession aux antipodes ? Quant au vin, buvez-le. Quant à la toile et au drap, on vous en fera faire en vous accordant des priviléges. Et pour ce qui est des taxes, il n’y a rien de perdu, puisque l’argent qui sort de vos poches entre dans les nôtres.
Quelquefois ces mêmes rêveurs demandaient : À quoi bon cette grande marine militaire ? On leur répondait : À conserver la colonie. — Et s’ils insistaient, disant : À quoi bon la colonie ? on leur répliquait sans hésiter : À conserver la marine militaire.
Ainsi les pauvres utopistes étaient battus sur tous les points.
Cette situation, déjà fort compliquée, s’embrouilla encore par un événement imprévu.
Les hommes d’État du pays des Welches, se fondant sur ce que l’avantage d’avoir une colonie entraînait de grandes dépenses, avaient jugé qu’en bonne justice, elles devaient retomber, du moins en partie, sur les mangeurs de sucre. En conséquence, ils l’avaient frappé d’un lourd impôt.
En sorte que le sucre, déjà fort cher, renchérit encore de tout le montant de la taxe.
Or, quoique le pays des Welches ne fût pas propre à la culture de la canne, comme il n’y a rien qu’on ne puisse faire moyennant une suffisante dose de travail et de capital, les chimistes, alléchés par les hauts prix, se mirent à chercher du sucre partout, dans la terre, dans l’eau, dans l’air, dans le lait, dans le raisin, dans la carotte, dans le maïs, dans la citrouille ; et ils firent tant qu’ils finirent par en trouver un peu dans un modeste légume, dans une plante jugée jusque-là si insignifiante, qu’on lui avait donné ce nom doublement humiliant : Beta vulgaris.
On fit donc du sucre chez les Welches ; et cette industrie, contrariée par la nature, mais secondée par l’intelligence de travailleurs libres et surtout par l’élévation factice des prix, fit de rapides progrès.
Bon Dieu ! qui pourrait dire la confusion que cette découverte jeta dans la situation économique des Welches. Bientôt, elle compromit tout à la fois et la production si dispendieuse du sucre dans le petit îlot des antipodes, et ce qui restait de marine marchande occupée à faire le commerce de cet îlot, et la marine militaire elle-même, qui ne peut se recruter que dans la marine marchande.
En présence de cette perturbation inattendue, tous les Welches se mirent à chercher une issue raisonnable.
Les uns disaient : Revenons peu à peu à l’état de choses qui s’était établi naturellement ; avant que d’absurdes systèmes ne nous eussent jetés dans ce désordre. Comme autrefois, faisons du sucre sous forme de vin, de soie, et de toile ; ou plutôt laissons ceux qui veulent du sucre en créer la valeur sous la forme qui leur convient. Alors nous aurons du commerce avec un hémisphère tout entier ; alors notre marine marchande se relèvera et notre marine militaire aussi, si besoin est. Le travail libre, essentiellement progressif, surmontera le travail esclave, essentiellement stationnaire. L’esclavage mourra de sa belle mort, sans qu’il soit nécessaire que les peuples fassent des uns aux autres une police pleine de dangers. Le travail et les capitaux prendront partout la direction la plus avantageuse. Sans doute, pendant la transition, il y aura quelques intérêts froissés. Nous leur viendrons en aide le plus possible. Mais quand on a fait depuis longtemps fausse route, il est puéril de refuser d’entrer dans la bonne voie parce qu’il faut se donner quelque peine.
Ceux qui parlaient ainsi furent traités de novateurs, d’idéologues, de métaphysiciens, de visionnaires, de traîtres, de perturbateurs du repos public.
Les hommes d’État disaient : « Il est indigne de nous de chercher à sortir d’une situation artificielle par un retour vers une situation naturelle. On n’est pas grand homme pour si peu. Le comble de l’art est de tout arranger sans rien déranger. Ne touchons pas à l’esclavage, ce serait dangereux ; ni au sucre de betterave, ce serait injuste ; n’admettons pas le commerce libre avec tout l’autre hémisphère, ce serait la mort de notre colonie ; ne renonçons pas à la colonie, ce serait la mort de notre marine ; et ne restons pas dans le statu quo, ce serait la mort de tous les intérêts. »
Ceux-ci acquirent un grand renom d’hommes modérés et pratiques. On disait d’eux : Voilà d’habiles administrateurs, qui savent tenir compte de toutes les difficultés.
Tant il y a que, pendant qu’on cherchait un changement qui ne changeât rien, les choses furent toujours en empirant, jusqu’à ce que survint la solution suprême, le déluge, qui a tranché, en les engloutissant, cette question et bien d’autres. »
Monita secreta [Monita Secreta: The Secret Book of Instructions] [20 February 1848] [CW3 ES3.20]↩
BWV
1848.02.20 “Monita secreta” (Monita secreta) [*Libre-Échange*, 20 February 1848] [OC2.67, pp. 452-58] [CW3] [ES3.20]
Un grand nombre d’électeurs protectionnistes catalans ont rédigé, pour leur député, une sorte de Cahier dont une copie nous a été communiquée. En voici quelques extraits assez curieux.
N’oubliez jamais que votre mission est de maintenir et étendre nos priviléges. Vous êtes Catalan d’abord et Espagnol ensuite.
Le ministre vous promettra faveur pour faveur. Il vous dira : Votez les lois qui me conviennent ; j’étendrai ensuite vos monopoles. Ne vous laissez pas prendre à ce piége, et répondez : Étendez d’abord nos monopoles, et je voterai ensuite vos lois.
Ne vous asseyez ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Quand on est inféodé au ministère, on n’obtient pas grand’chose ; et quand on lui fait de l’opposition systématique, on n’obtient rien. Prenez votre siège au centre gauche, ou au centre droit. Les positions intermédiaires sont les meilleures. L’expérience le prouve. Là, on se rend redoutable par les boules noires, et l’on se fait bien venir par les boules blanches.
Lisez à fond dans l’âme du ministre, et aussi dans celle du chef de parti qui aspire à le remplacer. Si l’un est restrictionniste par nécessité et l’autre par instinct, poussez à un changement de cabinet. Le nouvel occupant vous donnera deux garanties au lieu d’une.
Il n’est pas probable que le ministre vous demande jamais des sacrifices par amour de la justice, de la liberté, de l’égalité ; mais il pourrait y être conduit par les nécessités du Trésor. Il se peut qu’il vous dise un jour : « Je n’y puis plus tenir. L’équilibre de mon budget est rompu. Il faut que je laisse entrer les produits français pour avoir une occasion de perception. »
Tenez-vous prêt pour cette éventualité, qui est la plus menaçante et même la seule menaçante en ce moment. Il faut avoir deux cordes à votre arc. Entendez-vous avec vos corestrictionnistes du centre, et menacez de faire passer un gros bataillon à gauche. Le ministre effrayé aura recours à un emprunt, et nous y gagnerons un an, peut-être deux ; le peuple payera les intérêts.
Si pourtant le ministre insiste, ayez à lui proposer un nouvel impôt ; par exemple, une taxe sur le vin. Dites que le vin est la matière imposable par excellence. Cela est vrai, puisque le vigneron est par excellence le contribuable débonnaire.
Surtout ne vous avisez pas, par un zèle mal entendu, de parer le coup en faisant allusion à la moindre réduction de dépenses. Vous vous aliéneriez tous les ministres présents et futurs, et de plus, tous les journalistes, ce qui est fort grave.
Vous pouvez bien parler d’économies en général, cela rend populaire. Tenez-vous-en au mot. Cela suffit aux électeurs.
Nous venons de parler des journalistes. Vous savez que la presse est le quatrième pouvoir de l’État, nous pourrions dire le premier. Vous ne sauriez employer avec elle une diplomatie trop profonde.
Si, par le plus grand des hasards, il se rencontre un journal disposé à vendre les questions, achetez la nôtre. C’est un moyen fort expéditif. Mais il serait encore mieux d’acheter le silence ; c’est moins coûteux, et, à coup sûr, plus prudent. Quand on a contre soi la raison et la justice, le plus sûr est d’étouffer la discussion.
Quant aux théories que vous aurez à soutenir, voici la grande règle :
S’il y a deux manières de produire une chose, que l’une de ces manières soit dispendieuse et l’autre économique, frappez d’une taxe la manière économique au profit de la manière dispendieuse. Par exemple, si avec soixante journées de travail consacré à produire de la laine, les Espagnols peuvent faire venir de France dix varas de drap, et qu’il leur faille cent journées de travail pour obtenir ces dix varas de drap en les fabriquant eux-mêmes, favorisez le second mode aux dépens du premier. Vous ne pouvez vous figurer tous les avantages qu’il en résultera.
D’abord, tous les hommes qui emploient la manière dispendieuse vous seront reconnaissants et dévoués. Vous aurez en eux un fort appui.
Ensuite, le mode économique disparaissant peu à peu du pays et le mode dispendieux s’étendant sans cesse, vous verrez grossir le nombre de vos partisans et s’affaiblir celui de vos adversaires.
Enfin, comme un mode plus dispendieux implique plus de travail, vous aurez pour vous tous les ouvriers et tous les philanthropes. Il vous sera aisé, en effet, de montrer combien le travail serait affecté, si on laissait se relever le mode économique.
Tenez-vous-en à cette première apparence et ne souffrez pas qu’on aille au fond des choses, car qu’arriverait-il ?
Il arriverait que certains esprits, trop enclins à l’investigation, découvriraient bientôt la supercherie. Ils s’apercevraient que si la production des dix varas de drap occupe cent journées, il y a soixante journées de moins consacrées à la production de la laine, contre laquelle on recevait autrefois dix varas de drap français.
Ne disputez pas sur cette première compensation ; c’est trop clair, vous seriez battu ; mais montrez toujours les autres quarante journées mises en activité par le mode dispendieux.
Alors on vous répondra : « Si nous nous en étions tenus au mode économique, le capital qui a été détourné vers la production directe du drap aurait été disponible dans le pays ; il y aurait produit des choses utiles et aurait fait travailler ces quarante ouvriers que vous prétendez avoir tirés de l’oisiveté. Et quant aux produits de leur travail, ils auraient été achetés précisément par les consommateurs de drap, puisque obtenant à meilleur marché le drap français, une somme de rémunération suffisante pour payer quarante ouvriers serait restée disponible aussi entre leurs mains. »
Ne vous engagez pas dans ces subtilités. Traitez de rêveurs, idéologues, utopistes et économistes ceux qui raisonnent de la sorte.
Ne perdez jamais ceci de vue. Dans ce moment, le public ne pousse pas l’investigation aussi loin. Le plus sûr moyen de lui faire ouvrir les yeux, ce serait de discuter. Vous avez pour vous l’apparence, tenez-vous-y et riez du reste.
Il se peut qu’un beau jour les ouvriers, ouvrant les yeux, disent :
« Puisque vous forcez la cherté des produits par l’opération de la loi, vous devriez bien aussi, pour être justes, forcer la cherté des salaires par l’opération de la loi. »
Laissez tomber l’argument aussi longtemps que possible. Quand vous ne pourrez plus vous taire, répondez : La cherté des produits nous encourage à en faire davantage ; pour cela, il nous faut plus d’ouvriers. Cet accroissement de demande de main-d’œuvre hausse vos salaires, et c’est ainsi que nos priviléges s’étendent à vous par ricochet.
L’ouvrier vous répondra peut-être : « Cela serait vrai si l’excédant de production excité par la cherté se faisait au moyen de capitaux tombés de la lune. Mais si vous ne pouvez que les soutirer à d’autres industries, n’y ayant pas augmentation de capital, il ne peut y avoir augmentation de salaires. Nous en sommes pour payer plus cher les choses qui nous sont nécessaires, et votre ricochet est une déception. »
Donnez-vous alors beaucoup de mal pour expliquer et embrouiller le mécanisme du ricochet.
L’ouvrier pourra insister et vous dire :
« Puisque vous avez tant de confiance dans les ricochets, changeons de rôle. Ne protégez plus les produits, mais protégez les salaires. Fixez-les législativement à un taux élevé. Tous les prolétaires deviendront riches ; ils achèteront beaucoup de vos produits, et vous vous enrichirez par ricochet. [129] »
Nous faisons ainsi parler un ouvrier, pour vous montrer combien il est dangereux d’approfondir les questions. C’est ce que vous devez éviter avec soin. Heureusement, les ouvriers, travaillant matin et soir, n’ont guère le temps de réfléchir. Profitez-en ; parlez à leurs passions ; déclamez contre l’étranger, contre la concurrence, contre la liberté, contre le capital, afin de détourner leur attention du privilége.
Attaquez vertement, en toute occasion, les professeurs d’économie politique. S’il est un point sur lequel ils ne s’accordent pas, concluez qu’il faut repousser les choses sur lesquelles ils s’accordent.
Voici le syllogisme dont vous pourrez faire usage :
« Les économistes sont d’accord que les hommes doivent être égaux devant la loi ;
Mais ils ne sont pas d’accord sur la théorie de la rente ;
Donc ils ne sont pas d’accord sur tous les points ;
Donc il n’est pas certain qu’ils aient raison quand ils disent que les hommes doivent être égaux devant la loi ;
Donc il faut que les lois créent des priviléges pour nous aux dépens de nos concitoyens. »
Ce raisonnement fera un très-bon effet.
Il est un autre mode d’argumentation que vous pourrez employer avec beaucoup de succès.
Observez ce qui se passe sur la surface du globe, et s’il y survient un accident fâcheux quelconque, dites : Voilà ce que fait la liberté.
Si donc Madrid est incendié, et si, pour le reconstruire à moins de frais, on laisse entrer du bois et du fer étrangers, attribuez l’incendie, ou du moins tous les effets de l’incendie, à cette liberté.
Un peuple a labouré, fumé, hersé, semé et sarclé tout son territoire. Au moment de récolter, sa moisson est emportée par un fléau ; ce peuple est placé dans l’alternative ou de mourir de faim, ou de faire venir des subsistances du dehors. S’il prend ce dernier parti, et il le prendra certainement, il y aura un grand dérangement dans ses affaires ordinaires ; cela est infaillible : il éprouvera une crise industrielle et financière. Dissimulez avec soin que cela vaut mieux, après tout, que de mourir d’inanition, et dites : « Si ce peuple n’avait pas eu la liberté de faire venir des subsistances du dehors, il n’aurait pas subi une crise industrielle et financière. » (V. les nos 21 et 30.)
Nous pouvons vous assurer, par expérience, que ce raisonnement vous fera grand honneur.
Quelquefois on invoquera les principes. Moquez-vous des principes, ridiculisez les principes, bafouez les principes. Cela fait très-bien auprès d’une nation sceptique.
Vous passerez pour un homme pratique, et vous inspirerez une grande confiance.
D’ailleurs vous induirez ainsi la législature à mettre, dans chaque cas particulier, toutes les vérités en question, ce qui nous fera gagner du temps. Songez où en serait l’astronomie, si ce théorème : Les trois angles d’un triangle sont égaux à deux angles droits, n’était pas admis, après {{tiret|dé|monstrationx} {{tiret2|dé|monstrationx}, une fois pour toutes, et s’il fallait le prouver en toute rencontre ? On n’en finirait pas.
De même, si vos adversaires prouvent que toute restriction entraîne deux pertes pour un profit, exigez qu’ils recommencent la démonstration dans chaque cas particulier, et dites hardiment qu’en économie politique il n’y a pas de vérité absolue. [130]
Profitez de l’immense avantage d’avoir affaire à une nation qui pense que rien n’est vrai ni faux.
Conservez toujours votre position actuelle à l’égard de nos adversaires.
Que demandons-nous ? des priviléges.
Que demandent-ils ? la liberté.
Ils ne veulent pas usurper nos droits, ils se contentent de défendre les leurs.
Heureusement, dans leur ardeur impatiente, ils sont assez mauvais tacticiens pour chercher des preuves. Laissez-les faire. Ils s’imposent ainsi le rôle qui nous revient. Faites semblant de croire qu’ils proposent un système nouveau, étrange, compliqué, hasardeux, et que l’onus probandi leur incombe. Dites que vous, au contraire, ne mettez en avant ni théorie ni système. Vous serez affranchi de rien prouver. Tous les hommes modérés seront pour vous.
La République française [26 Feb. - 28 Mar, 1848]↩
[La République française. A daily journal. Signed by the editors: F. Bastiat, Hippolyte Castille, Gustave de Molinari. It appeared from 26 February to 28 March in 30 issues.]
ToC↩
- 1848.02.26 “Quelques mots d'abord sur le titre de notre journal” (A Few Words about the Title of Our Journal) [La République française, 26 February 1848] [CW3.??]
- 1848.02.26 “Sous la République” (Under the Republic) [La République française, 26 February 1848] [OC7.42, p. 210] [CW1]
- 1848.02.26 [no title] [La République française, 26 February 1848] [OC7.43, p. 212] [CW1]
- 1848.02.27 [no title] [La République française, 27 February 1848] [OC7.44, p. 213] [CW1]
- 1848.02.27 [no title] [La République française, 27 February 1848] [OC7.45, p. 215] [CW1]
- 1848.02.27 [no title] [La République française, 27 February 1848] [OC7.46, p. 218] [CW1]
- 1848.02.29 “Les rois doivent désarmer” (The Kings must disarm) [La République française, 29 February 1848.] [OC7.48, p. 22] [CW1
- 1848.02.29 “Les sous-préfectures” (The Sub-Prefects) [La République française, 29 février 1848] [OC7.49, p. 223] [CW??]
- 1848.02.29 [no title] [La République française, 29 February 1848] [OC7.47, p. 218] [CW1]
- 1848.03.01 “La Presse parisienne” (The Parisian Press) [La République française, 1 March 1848] [OC7.51, p. 226] [CW1]
- 1848.03.01 [no title] [La République française, 1 March 1848] [OC7.50, p. 223] [CW1]
- 1848.03.02 “Pétition d'un Economiste” (Petition of an Economist) [La République française, 2 March 1848] [OC7.52, p. 227] [CW1]
- 1848.03.04 “Liberté de l'enseignement” (On the Freedom of Education) [La République française, 4 March 1848] [OC7.53, p.231] [CW1]
- 1848.03.05 “Curée des Places” (The Scramble for Positions) [La République française, 5 March 1848] [OC7.54, p. 232] [CW1]
- 1848.03.06 “Entraves et Taxes” (Burdens and Taxes) [La République française, 6 March 1848] [OC7.55, p. 234] [CW1]
- 1848.03.12 “Soulagement immédiat du peuple” (The Immediate Relief of the People) [OC2.68a, pp. 459-60] [CW3] [ES3.21]
- 1848.03.12 “Funeste remède” (A Disastrous Remedy) [OC2.68b, pp. 460-61] [CW3] [ES3.22]
- 1848.03.19 “Circulaires d'un ministère introuvable” (Circulars from a Government that is nowhere to be found) [La République française, 19 March 1848] [OC2.69, pp. 462-65] [CW3] [ES3.23]
Statement of Principles: Quelques mots d'abord sur le titre de notre journal. [CW3.??]↩
BWV
1848.02.26 “Quelques mots d'abord sur le titre de notre journal” (A Few Words about the Title of Our Journal) [La République française, 26 February 1848] [CW3]
Hatin's long quote from La République française (possibly from 1st issue??? 26 February 1848), pp. 491-2.
Hatin's explanation: Nous avons cité un peu longuement, parce que c'est une des premières voix qui s'élevèrent au milieu des barricades. Cette République française était venue au monde, comme on lé voit, presque en même temps que la République tout court, celle de Bareste. Olindes Rodrigues essaya un rapprochement entre les deux feuilles; mais déjà, ajoute M. Castille, qui nous fournit ce renseignement, de toutes les imprimeries de Paris surgissaient une multitude de journaux de toutes nuances, écrits dans tous les patois auxquels peut prêter l'élasticité de l'idiome parisien.
Quelques mots d'abord sur le titre de notre journal.
Le gouvernement provisoire veut la république, sauf ratification par le peuple. Nous avons entendu aujourd'hui le peuple de Paris proclamer unanimement le gouvernement républicain du haut de ses glorieuses barricades, et nous avons la ferme conviction que la France entière ratifiera le vœu des vainqueurs de février. Mais, quoi qu'il advienne, alors même que ce vœu serait méconnu, nous conserverons le titre que nous ont jeté toutes les voix du peuple. Quelle que soit la forme de gouvernement à laquelle s'arrête la nation, la presse doit désormais demeurer libre; aucune entrave ne saurait plus être apportée à la manifestation de la pensée. Cette liberté sacrée de la pensée humaine, naguère si impudemment violée, le peuple l'a reconquise, et il saura la garder. Donc, quoiqu'il advienne, fermement convaincus que la forme républicaine est la seule qui convienne à un peuple libre, la seule qui comporte le plein et entier développement de toutes les libertés, nous adoptons et nous maintiendrons notre titre de:
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Le temps et les événements nous pressent; nous ne pouvons consacrer que quelques lignes à notre programme.
La France vient de se débarrasser d'un régime qui lui était odieux; mais il ne suffit pas de changer les hommes, il faut changer aussi les choses.
Or, quelle était la base même de ce régime?
La restriction, le privilège! Non-seulement la monarchie que les efforts héroïques du peuple de Paris viennent de renverser s'appuyait sur un monopole électoral, mais encore elle rattachait à elle par les liens invisibles du privilège une foule de branches de l'activité humaine. De là, la corruption qui souillait ce régime. Nous ne voulons plus de corruption, nous ne voulons plus de privilèges.
Nous voulons que le travail soit désormais pleinement libre; plus de lois sur les coalitions, plus de règlements qui empêchent les capitalistes et les travailleurs de porter ceux-là leurs fonds, ceux-ci leur travail, dans les industries qui leur conviennent. La liberté du travail proclamée par Turgot et par l'Assemblée constituante doit être désormais la loi de la France démocratique.
Suffrage universel.
Plus de cultes salariés. Que chacun salarie le culte dont il se sert.
Liberté absolue de l'enseignement.
Liberté du commerce, autant que le comportent les besoins du fisc. Suppression des droits sur les denrées alimentaires, comme sous la Convention. La vie à bon marché pour le peuple!
Plus de conscription; recrutement volontaire.
Des institutions qui permettent aux ouvriers de connaître les lieux on le travail abonde, et qui leur apprennent jour par jour le taux des salaires sur toute l'étendue du territoire.
Respect inviolable de la propriété. Toute propriété a sa source dans le travail: atteindre la propriété, c'est atteindre le travail.
Enfin, pour couronner l'œuvre de notre glorieuse régénération, nous demandons la clémence au dedans et la paix au dehors. Oublions le passé, élançons-nous vers l'avenir le cœur pur de toute haine, fraternisons avec tous les peuples de la terre, et bientôt sonnera l'heure où la liberté, l'égalité et la fraternité seront la loi du monde!
Sous la République [27 février 1848] [CW1.4.11]↩
BWV
1848.02.26 “Sous la République” (Under the Republic) [La République française, 26 February 1848] [OC7.42, p. 210] [CW1]
Source
La République française, n° du 27 février 1848.
42. Sous la République
Article paru dans La République Française [131]
Paris, 26 février 1848 [132]
Nul ne peut dire quel sera, en Europe, le contre-coup de la Révolution. Plaise au ciel que tous les peuples sachent se soustraire à la triste nécessité de se précipiter les uns sur les autres, au signal des aristocraties et des rois.
Mais supposons que les puissances absolues conservent encore, pendant quelque temps, leurs moyens d’action au dehors.
Nous posons ici deux faits qui nous paraissent incontestables et dont on va voir les conséquences :
1° La France ne peut pas prendre l’initiative du désarmement.
2° Sans le désarmement, la Révolution ne peut remplir que très imparfaitement les espérances du peuple.
Ces deux faits, disons-nous, sont incontestables.
Quant au désarmement, le plus grand ennemi de la France ne pourrait le lui conseiller, tant que les puissances absolues sont armées. Il est inutile d’insister là-dessus.
Le second fait est aussi évident. Se tenir armée de manière à garantir l’indépendance nationale, c’est avoir trois ou quatre cent mille hommes sous les drapeaux ; c’est être dans l’impossibilité de faire, sur les dépenses publiques, aucun retranchement assez sérieux pour remanier immédiatement notre système d’impôts. Accordons que, par une taxe somptuaire, on puisse réformer l’impôt du sel et quelques autres contributions exorbitantes. Est-ce là une chose dont puisse se contenter le peuple français ?
On réduira, dit-on, la bureaucratie : soit. Mais, nous l’avons dit hier, la diminution probable des recettes compensera et au delà ces réformes partielles, et, ne l’oublions pas, le dernier budget a été réglé en déficit.
Or, si la Révolution est mise dans l’impossibilité de remanier un système d’impôts iniques, mal répartis, qui frappent le peuple et paralysent le travail, elle est compromise.
Mais la Révolution ne veut pas périr.
Voici, relativement aux étrangers, les conséquences nécessaires de cette situation. Certes, ce n’est pas nous qui conseillerons jamais des guerres d’agression. Mais la dernière chose qu’on puisse demander à un peuple, c’est de se suicider.
Si donc, même sans nous attaquer directement, l’étranger, par son attitude armée, nous forçait à tenir trois ou quatre cent mille hommes sur pied, c’est comme s’il nous demandait de nous suicider.
Pour nous, il est de la dernière évidence que si la France est placée dans la situation que nous venons de décrire, qu’elle le veuille ou non, elle jettera sur l’Europe la lave révolutionnaire.
Ce sera le seul moyen de créer aux rois des embarras chez eux, qui nous permettent de respirer chez nous.
Que les étrangers le comprennent. Ils ne peuvent échapper au danger qu’en prenant avec loyauté l’initiative du désarmement. Le conseil leur paraîtra bien téméraire. Ils se hâteront de dire : « Ce serait une imprudence. » Et nous, nous disons : Ce serait de la prudence la plus consommée.
C’est ce que nous nous chargerons de démontrer.
43. Article 2 [26 February 1848] [CW1.4.14a]↩
BWV
1848.02.26 [no title] [La République française, 26 February 1848] [OC7.43, p. 212] [CW1]
Article paru dans La République Française
26 février 1848
Lorsqu’on parcourt les rues de Paris, à peine assez spacieuses pour contenir les flots de la population, et qu’on vient à se rappeler qu’il n’y a dans cette immense métropole, en ce moment, ni roi, ni cour, ni gardes municipaux, ni troupes, ni police autre que celle que les citoyens exercent eux-mêmes ; quand on songe que quelques hommes, sortis hier de nos rangs, s’occupent seuls des affaires publiques ; — à l’aspect de la joie, de la sécurité, de la confiance qui respire dans toutes les physionomies, le premier sentiment est celui de l’admiration et de la fierté.
Mais bientôt on fait un retour sur le passé, et l’on se dit : « Il n’est donc pas si difficile à un peuple de se gouverner qu’on voulait nous le persuader, et le gouvernement à bon marché n’est pas une utopie. »
Il ne faut pas se le dissimuler : en France on nous a habitués à être gouvernés outre mesure, à merci et miséricorde. Nous avions fini par croire que nous nous déchirerions tous les uns les autres, si nous jouissions de la moindre liberté, et si l’État ne réglait pas tous nos mouvements.
Voici une grande expérience qui démontre qu’il y a dans le cœur des hommes d’indestructibles principes d’ordre. L’ordre est un besoin et le premier des besoins, sinon pour tous, du moins pour l’immense majorité. Ayons donc confiance et tirons de là cette leçon que le grand et dispendieux appareil gouvernemental, que les intéressés nous représentaient comme indispensable, peut et doit être simplifié.
44. Article 3 [27 February 1848] [CW1.4.14b]↩
BWV
1848.02.27 [no title] [La République française, 27 February 1848] [OC7.44, p. 213] [CW1]
Article paru dans La République Française
27 février 1848 [133]
Nous partageons cette pensée de la Presse :
« Ce qu’il faut demander à un gouvernement provisoire, à des hommes qui se dévouent au salut public au milieu d’incalculables difficultés, ce n’est pas de gouverner exactement selon toutes nos idées, mais de gouverner. Il faut lui prêter assistance, le soutenir, lui faciliter sa rude tâche et renvoyer à un autre temps la discussion des doctrines. Ce ne sera pas un des phénomènes les moins glorieux de notre révolution que l’accord de tous les journaux dans cette voie. »
Nous pouvons nous rendre le témoignage que nous payons autant qu’il est en nous ce tribut d’abnégation au salut de la cause commune.
Dans quelques-uns des décrets qui se succèdent, nous voyons poindre l’application d’une doctrine qui n’est pas la nôtre. Nous l’avons combattue, nous la combattrons encore en temps opportun.
Deux systèmes sont en présence : tous deux émanent de convictions sincères, tous deux ont pour but le bien général. Mais, il faut le dire, ils procèdent de deux idées différentes, et, qui plus est, opposées.
Le premier, plus séduisant, plus populaire, consiste à prendre beaucoup au peuple, sous forme d’impôts, pour beaucoup répandre sur le peuple, sous forme d’institutions philanthropiques.
Le second veut que l’État prenne peu, donne peu, garantisse la sécurité, laisse un libre champ à l’exercice honnête de toutes les facultés : l’un consiste à étendre indéfiniment, l’autre à restreindre le plus possible les attributions du pouvoir.
Celui de ces deux systèmes auquel nous sommes attachés [134] par une entière conviction a peu d’organes dans la presse ; il ne pouvait avoir beaucoup de représentants au pouvoir.
Mais pleins de confiance dans la droiture des citoyens auxquels l’opinion publique a confié la mission de jeter un pont entre la monarchie déchue et la république régulière qui s’avance, nous ajournons volontiers la manifestation de notre doctrine et nous nous bornons à semer des idées d’ordre, de mutuelle confiance et de gratitude envers le gouvernement provisoire.
Sur le désarmement [27 février 1848] [CW1.4.12]↩
BWV
1848.02.27 [no title] [La République française, 27 February 1848] [OC7.45, p. 215] [CW1]
45. Article 4
Article paru dans La République Française
Paris, 27 février 1848
Le National examine aujourd’hui notre situation à l’égard de l’étranger.
Il se demande : Serons-nous attaqués ? Et après avoir jetés un coup d’œil sur les difficultés de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie, il se prononce pour la négative.
Nous partageons entièrement cet avis.
Ce que nous redoutons, ce n’est pas d’être attaqués, c’est que les puissances absolues, avec ou sans préméditation, et par le seul maintien du statu quo militaire, ne nous réduisent à chercher dans la propagande armée le salut de la révolution.
Nous n’hésitons pas à nous répéter afin d’être compris ici et ailleurs. Ce que nous disons avec une entière conviction, c’est ceci : nous ne pouvons pas prendre l’initiative du désarmement, et néanmoins le simple statu quo militaire nous met dans l’alternative de périr ou de nous battre ; c’est aux rois de l’Europe à calculer la portée de cette alternative fatale. Ils n’ont qu’un moyen de se sauver, c’est de désarmer les premiers et immédiatement.
Qu’on nous permette une fiction.
Supposez une petite île qui a été, pendant longues années, plutôt exploitée que gouvernée ; les impôts, les entraves, les abus y sont innombrables ; le peuple succombe sous le faix, et, en outre, pour se prémunir contre les menaces continuelles du dehors, il arrache au travail, tient sur pied, arme et nourrit une grande partie de sa population valide.
Tout à coup il détruit son gouvernement oppresseur ; il aspire à se délivrer du poids des taxes et des abus.
Mais le gouvernement tombé lui laisse le fardeau d’une dette énorme.
Mais, au premier moment, toutes les dépenses s’accroissent.
Mais, dans les premiers temps, toutes les sources de revenus diminuent.
Mais il y a des taxes si odieuses qu’il est moralement et matériellement impossible de les maintenir, même provisoirement.
Dans cette situation, les chefs qui exploitent toutes les îles voisines tiennent à la République naissante ce langage :
« Nous te détestons, mais nous ne voulons pas t’attaquer, de peur que mal ne nous en arrive. Nous nous contenterons de t’entourer d’une ceinture de soldats et de canons. »
Dès lors la jeune République est forcée de lever aussi beaucoup de soldats et de canons.
Elle ne peut retrancher aucune taxe, même la plus impopulaire.
Elle ne peut tenir envers le peuple aucune de ses promesses.
Elle ne peut pas remplir les espérances de ses citoyens.
Elle se débat dans les difficultés financières ; elle multiplie les impôts avec leur cortège d’entraves. Elle ravit à la population, à mesure qu’il se forme, le capital qui est la source des salaires.
Dans cette situation extrême, rien au monde peut-il l’empêcher de répondre : « Votre prétendue modération nous tue. Nous forcer à tenir sur pied de grandes armées, c’est nous pousser vers des convulsions sociales. Nous ne voulons pas périr, et, plutôt, nous irons soulever chez vous tous les éléments de désaffection que vous avez accumulés au sein de vos peuples, puisqu’aussi bien vous ne nous laissez pas d’autre planche de salut. »
Voilà bien notre position à l’égard des rois et des aristocraties de l’Europe.
Les rois, nous le craignons, ne le comprendront pas. Quand les a-t-on vus se sauver par la prudence et la justice ?
Nous ne devons pas moins le leur dire. Il ne leur reste qu’une ressource : être justes envers leurs peuples, les soulager du poids de l’oppression, et prendre-sur-le champ l’initiative du désarmement.
Hors de là, leur couronne est livrée au hasard d’une grande et suprême lutte. Ce n’est pas la fièvre révolutionnaire, ce sont les précédents et la nature même des choses qui l’ordonnent.
Les rois diront : N’est-ce pas notre droit de rester armés ?
Sans doute, c’est leur droit, à leurs risques et périls.
Ils diront encore : La simple prudence n’exige-t-elle pas que nous restions armés ?
La prudence veut qu’ils désarment de suite et plutôt aujourd’hui que demain.
Car tous les motifs qui pousseront la France au dehors, si on la force à armer, la retiendront au dedans, si on la met à même de réduire ses forces militaires.
Alors la République sera intéressée à supprimer en toute hâte les impôts les plus odieux ; à laisser respirer le peuple ; à laisser se développer le capital et le travail ; à abolir les gênes et les entraves inséparables des lourdes taxes.
Elle accueillera avec joie la possibilité de réaliser ce grand principe de fraternité qu’elle vient d’inscrire sur son drapeau.
46. Article 5 [27 February 1848] [CW1.4.14c]↩
BWV
1848.02.27 [no title] [La République française, 27 February 1848] [OC7.46, p. 218] [CW1]
Article paru dans La République Française
27 février 1848
Tout notre concours, toute notre faible part d’influence sont acquis au gouvernement provisoire.
Certains de la pureté de ses intentions, nous n’avons pas à discuter en détail toutes ses mesures. Ce serait être bien exigeants, et nous dirons même bien injustes, que de réclamer la perfection dans des travaux d’urgence dont le poids dépasse presque la limite des forces humaines.
Nous trouvons tout naturel que, dans ce moment où la municipalité a besoin de tant de ressources, l’octroi soit maintenu ; et c’est un devoir pour tous les citoyens de veiller à ce que ses recettes soient fructueuses.
Mais nous aurions désiré que le gouvernement provisoire ne se donnât pas l’apparence de préjuger une grande question par ces mots : Cet impôt doit être revisé ; il le sera prochainement ; il doit être modifié de manière à le rendre moins pesant pour les classes ouvrières.
Nous pensons qu’il ne faut pas chercher à modifier l’octroi, mais viser à le supprimer.
47. Article 6 [29 February 1848] [CW1.4.14d]↩
BWV
1848.02.29 [no title] [La République française, 29 February 1848] [OC7.47, p. 218] [CW1]
Article paru dans La République Française
Paris, 28 février 1848 [135]
Le bien général, la plus grande somme possible de bonheur pour tous, le soulagement immédiat des classes souffrantes, — c’est l’objet de tous les désirs, de tous les vœux, de toutes les préoccupations.
C’est aussi la plus grande garantie de l’ordre. Les hommes ne sont jamais mieux disposés à s’entr’aider que lorsqu’ils ne souffrent pas, ou du moins quand ils ne peuvent accuser personne, ni surtout le gouvernement, de ces souffrances inséparables de l’imperfection humaine.
La révolution a commencé au cri de Réforme. Alors ce mot s’appliquait seulement à une des dispositions de notre constitution. Aujourd’hui c’est encore la réforme que l’on veut, mais la réforme dans le fond des choses, dans l’organisation économique du pays.
Le peuple, rendu à toute sa liberté, va se gouverner lui-même. Est-ce à dire qu’il arrivera de plein saut à la réalisation de toutes ses espérances ? Ce serait une chimère que d’y compter. Le peuple choisira les mesures qui lui paraîtront les mieux coordonnées à son but, choisir implique la possibilité de se tromper. Mais le grand avantage du gouvernement de la nation par la nation, c’est qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même du résultat de ses erreurs, et qu’elle est toujours en mesure de mettre à profit son expérience. Sa prudence maintenant doit consister à ne pas permettre que les faiseurs de systèmes fassent trop d’expérience sur elle et à ses dépens.
Ainsi que nous l’avons dit, deux systèmes longtemps débattus par les polémistes sont en présence.
L’un aspire à faire le bonheur du peuple par des mesures directes.
Il dit : « Si quelqu’un souffre de quelque manière que ce soit, l’Etat se chargera de le soulager. Il donnera du pain, des vêtements, du travail, des soins, de l’instruction à tous ceux qui en auront besoin. Si ce système était possible, il faudrait être un monstre pour ne pas l’embrasser. Si l’État a quelque part, dans la lune par exemple, une source toujours accessible et inépuisable d’aliments, de vêtements et de remèdes, qui pourrait le blâmer d’y puiser à pleines mains, au profit de ceux qui sont pauvres et dénués ?
Mais si l’État ne possède par lui-même et ne produit aucune de ces choses ; si elles ne peuvent être créées que par le travail ; si tout ce que peut faire l’État, c’est de les prendre par l’impôt aux travailleurs qui les ont créées, pour les livrer à ceux qui ne les ont pas créées ; si le résultat naturel de cette opération doit être, loin d’augmenter la masse de ces choses, d’en décourager la production ; si, sur cette masse réduite, l’État en garde forcément une partie pour ses agents ; si ces agents chargés de l’opération sont eux-mêmes soustraits au travail utile ; si, en définitive, ce système, tout séduisant qu’il est au premier abord, doit engendrer beaucoup plus de misères qu’il n’en guérit, alors il est bien permis de concevoir des doutes et de rechercher si le bonheur des masses ne peut pas naître d’un autre procédé.
Celui que nous venons de décrire ne peut évidemment être mis en œuvre que par l’extension indéfinie de l’impôt. À moins de ressembler à ces enfants qui se dépitent de ce qu’on ne leur donne pas la lune à la première réquisition, il faut bien reconnaître que, si nous chargeons l’État de répandre partout l’abondance, il faut lui permettre d’étendre partout l’impôt : il ne peut rien donner qu’il ne l’ait pris.
Or de grands impôts impliquent toujours de grandes entraves. S’il ne s’agissait de demander à la France que cinq à six cents millions, on peut concevoir, pour les recueillir, un mécanisme financier extrêmement simple. Mais s’il faut lui arracher quinze à dix-huit cents millions, il faut avoir recours à toutes les ruses imaginables de la fiscalité. Il faut l’octroi, — l’impôt du sel, l’impôt des boissons, la taxe exorbitante des sucres ; il faut entraver la circulation, grever l’industrie, restreindre le consommateur ; il faut une armée de percepteurs ; il faut une bureaucratie innombrable ; il faut empiéter sur la liberté des citoyens ; — et tout cela entraîne les abus, la convoitise des fonctions publiques, la corruption, etc., etc.
On voit que si le système de l’abondance puisée par l’État dans le peuple, pour être par lui répandue sur le peuple, a un côté séduisant, c’est néanmoins aussi une médaille qui a son revers.
Nous sommes convaincus, nous, que ce système est mauvais et qu’il en est un autre pour faire le bien du peuple, ou plutôt pour que le peuple fasse son propre bien : celui-ci consiste à donner à l’État tout ce qu’il faut pour qu’il remplisse bien sa mission essentielle, qui est de garantir la sécurité extérieure et intérieure, le respect des personnes et des propriétés, le libre exercice des facultés, la répression des crimes, délits et fraudes, — et après avoir libéralement donné cela à l’État, à garder le reste pour soi.
Puisque enfin le peuple est appelé à exercer son droit, qui est de choisir entre ces deux systèmes, nous les comparerons souvent devant lui, sous tous leurs aspects politiques, moraux, financiers — et économiques.
Les rois doivent désarmer [29 février 1848] [CW1.4.13]↩
BWV
1848.02.29 “Les rois doivent désarmer” (The Kings must disarm) [La République française, 29 February 1848.] [OC7.48, p. 22] [CW1]
Source
La République française, n° du 29 février 1848.
48. Les Rois doivent désarmer [136]
Si les rois de l’Europe étaient seulement prudents, que feraient-ils ?
L’Angleterre renoncerait spontanément au droit de visite ; elle reconnaîtrait spontanément l’Algérie comme française ; elle n’attendrait pas que ces questions brûlantes fussent soulevées, et licencierait la moitié de sa marine ; elle ferait tourner cette économie au profit du peuple, en dégrevant les droits sur le thé et le vin.
Le roi de Prusse libéraliserait l’informe constitution de son pays, et, donnant congé aux deux tiers de son armée, il s’assurerait l’attachement du peuple en le soulageant du poids des taxes et du service militaire.
L’empereur d’Autriche évacuerait en toute hâte la Lombardie, et se mettrait en mesure, par la réduction de l’armée, d’accroître la proverbiale puissance des Autrichiens.
L’empereur de Russie rendrait la Pologne aux Polonais.
Alors la France, tranquille pour son avenir, s’absorberait dans ses réformes intérieures et laisserait agir l’influence morale seule.
Mais les rois de l’Europe croiraient se perdre par cette conduite qui seule peut les sauver.
Ils feront tout le contraire ; ils voudront étouffer le libéralisme. Pour cela ils armeront ; les peuples armeront aussi. La Lombardie, la Pologne, peut-être la Prusse, deviendront le théâtre de la lutte. Cette alternative posée par Napoléon : L’Europe sera républicaine ou cosaque, devra se résoudre à coups de canon. La France, malgré son ardent amour pour la paix manifesté par l’unanimité des journaux, mais forcée par son intérêt évident, ne pourra s’empêcher de jeter son épée dans la balance, et… les rois périssent ; les peuples ne périssent pas.
“Les sous-préfectures” (The Sub-Prefects) [29 février 1848] [CW ??]↩
BWV
1848.02.29 “Les sous-préfectures” (The Sub-Prefects) [La République française, 29 février 1848] [OC7.49, p. 223] [CW??]
Article dans La République Française [29 février 1848] [CW1.4.6]↩
BWV
1848.03.01 [no title] [La République française, 1 March 1848] [OC7.50, p. 223] [CW1]
50. Article 6
Article paru dans La République Française
Paris, 29 février 1848 [137]
Un journal n’atteint pas à une immense circulation sans répondre à quelques idées dominantes dans le pays. Nous reconnaissons que la Presse a toujours su parler aux instincts du moment, et même qu’elle a souvent donné de bons conseils ; c’est ainsi qu’elle a pu semer, sur le sol de la patrie, avec le bon grain, beaucoup d’ivraie qu’il faudra bien du temps pour extirper.
Depuis la révolution, il faut le dire, son attitude est franche et décidée.
Nous adhérons complétement, pour notre compte, aux deux cris qu’elle fait entendre aujourd’hui : pas de diplomatie ! pas de curée de places !
Pas de diplomatie ! Qu’a affaire la république de cette institution, qui a fait tant de mal et qui n’a peut-être jamais fait de bien ; où la rouerie est tellement traditionnelle qu’on en met aux choses les plus simples ; où la sincérité est réputée niaiserie ? C’est par un diplomate et pour la diplomatie qu’a été dit ce mot : La parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée.
Un des plus purs démocrates anglais, M. Cobden, passant à Madrid, y reçut la visite de M. Bulwer. Il lui dit : « Monsieur l’ambassadeur, dans dix ans l’Europe n’aura plus besoin de vous. »
Quand il est de principe que les nations sont la propriété des rois, on conçoit la diplomatie et même la rouerie diplomatique. Il faut préparer de loin des événements, des alliances, des guerres, qui agrandissent le domaine du maître.
Mais un peuple qui s’appartient, qu’a-t-il à négocier ? Toute sa diplomatie se fait au grand jour des assemblées délibérantes : ses négociants sont ses négociateurs, diplomates d’union et de paix.
Il est vrai que, même pour les peuples libres, il y a une question territoriale de la plus haute importance, celle des frontières naturelles. Mais cette question exige-t-elle l’intervention de la diplomatie ?
Les nations savent bien qu’il est de l’intérêt commun, intérêt d’ordre et de paix, que chacune d’elles ait ses frontières. Elles savent que si la France rentrait dans ses limites, ce serait un gage de plus donné à la sécurité de l’Europe.
En outre, le principe que les peuples s’appartiennent à eux-mêmes garantit que, si la fusion doit se faire, elle se fera par le libre consentement des intéressés, et non par l’invasion armée. La république n’a qu’à proclamer hautement à cet égard ses droits, ses vœux et ses espérances. Il n’est pas besoin d’ambassadeurs ni de roueries pour cela.
Sans les ambassadeurs et les rois, nous n’aurions pas eu, dans ces derniers temps, la question des mariages espagnols. S’est-on jamais préoccupé du mariage d’un président des États-Unis ?
Quant à la curée des places, notre vœu est celui de la Presse. Nous voudrions bien que la France de février ne donnât pas au monde ce triste et dégoûtant spectacle. Mais nous ne l’espérons guère, car nous ne pouvons nous faire illusion sur les faiblesses du cœur humain. Le moyen de réduire la curée, c’est de réduire les places elles-mêmes. Il est puéril d’attendre que les solliciteurs se contiennent eux-mêmes ; c’est au public de les contenir.
C’est pour cela que nous répéterons sans cesse : Supprimez toutes les fonctions inutiles. On donne pour conseil aux enfants de tourner trois fois la langue dans la bouche avant de dire une chose hasardée. Et nous, nous disons au gouvernement : Brisez trente plumes avant de signer la création d’une place nouvelle.
Une sinécure supprimée contrarie le titulaire et ne l’irrite pas ; une sinécure passant de mains en mains exaspère le destitué, désappointe dix postulants et mécontente le public.
La partie la plus pénible de la tâche dévolue au gouvernement provisoire sera sans doute de résister au torrent des sollicitations.
D’autant que quelques écoles, fort en faveur aujourd’hui, aspirent à élargir indéfiniment les attributions du gouvernement et à tout faire faire par l’État, c’est-à-dire à coups de contributions.
D’autres disent : Il faut bien que l’État dépense beaucoup pour faire vivre beaucoup de monde.
Est-il donc si difficile de voir que, lorsque le gouvernement dépense l’argent des contribuables, les contribuables ne le dépensent pas ?
La Presse parisienne [1 mars 1848] [CW1.4.4]↩
BWV
1848.03.01 “La Presse parisienne” (The Parisian Press) [La République française, 1 March 1848] [OC7.51, p. 226] [CW1]
Source
N° du 1er mars 1848 de la République française.
51. La presse parisienne [138]
La presse parisienne n’offre pas un spectacle moins extraordinaire, moins imposant que la population des barricades.
Qu’est devenue cette ardente et souvent brutale polémique des derniers temps ?
Les vives discussions reviendront sans doute. Mais n’est-il pas bien consolant de voir qu’au moment du danger, quand la patrie a besoin avant tout de sécurité, d’ordre, de confiance, toutes les rancunes s’oublient, et que même les doctrines les plus excentriques s’efforcent de se présenter sous des formes rassurantes ?
Ainsi le Populaire, journal des communistes, s’écrie : Respect à la propriété ! M. Cabet rappelle à ses adhérents qu’ils ne doivent chercher le triomphe de leurs idées que dans la discussion et les convictions publiques.
La Fraternité, journal des ouvriers, publie un long programme que les économistes pourraient avouer tout entier, sauf peut-être une ou deux maximes plus illusoires que dangereuses.
L’Atelier, autre journal rédigé par des ouvriers, conjure ses frères d’arrêter le mouvement irréfléchi qui les portait, dans le premier moment, à briser les machines.
Tous les journaux s’efforcent à l’envi de calmer et de flétrir un autre sentiment barbare que malheureusement l’esprit de parti avait travaillé pendant quinze ans à soulever ; nous voulons parler des préventions nationales. Il semble qu’un jour de révolution a fait disparaître, en la rendant inutile, cette machine de guerre de toutes les oppositions.
Paix extérieure, ordre intérieur, confiance, vigilance, fraternité, voilà les mots d’ordre de toute la presse. [139]
Pétition d'un Economiste [2 mars 1848] [CW1.4.5]↩
BWV
1848.03.02 “Pétition d'un Economiste” (Petition of an Economist) [La République française, 2 March 1848] [OC7.52, p. 227] [CW1]
Source
N° du 2 mars 1848 de la République française.
52. Pétition d’un économiste [140]
On signe en ce moment une pétition qui demande :
Un ministère du progrès ou de l’organisation du travail. À ce sujet la Démocratie pacifique s’exprime ainsi :
« Pour organiser le travail dans la société française, il faut savoir l’organiser dans l’atelier alvéolaire de la nation, dans la commune. Toute doctrine sérieuse de transformation sociale doit donc pouvoir se résoudre dans une organisation de l’atelier élémentaire, et s’expérimenter d’abord sur une lieue carrée de terrain. Que la république crée donc un ministère du progrès et de l’organisation du travail, dont la fonction sera d’étudier tous les plans proposés par les différentes doctrines socialistes, et d’en favoriser l’expérience locale, libre et volontaire sur l’unité territoriale, la lieue carrée. »
Si cette idée se réalise, nous demanderons qu’on nous donne aussi notre lieue carrée pour expérimenter notre système.
Car enfin pourquoi les différentes écoles socialistes auraient-elles seules le privilége d’avoir à leur disposition des lieues carrées, des ateliers alvéolaires, des éléments territoriaux, en un mot, des communes ?
On dit qu’il s’agit d’expériences libres et volontaires. Entend-on que les habitants de la commune qu’il s’agit de soumettre à l’expérimentation socialiste devront y consentir, et que, d’une autre part, l’État ne devra pas intervenir avec des contributions levées sur les autres communes ? Alors à quoi bon la pétition, et qui empêche les habitants des communes de faire librement, volontairement et à leurs frais, une expérience socialiste sur eux-mêmes ?
Ou bien veut-on que l’expérience soit forcée, ou tout au moins secondée par des fonds prélevés sur la communauté tout entière ?
Mais cela même rendra l’expérience fort peu concluante. Il est bien évident qu’avec toutes les ressources de la nation on peut verser une grande somme de bien-être sur une lieue carrée de terrain.
En tout cas, si chaque inventeur d’organisation sociale est appelé à faire son expérience, nous nous inscrivons et demandons formellement une commune à organiser.
Notre plan du reste est fort simple.
Nous percevrons sur chaque famille, et par l’impôt unique, une très petite part de son revenu, afin d’assurer le respect des personnes et des propriétés, la répression des fraudes, des délits et des crimes. Cela fait, nous observerons avec soin comment les hommes s’organisent d’eux-mêmes.
Les cultes, l’enseignement, le travail, l’échange y seront parfaitement libres. Nous espérons que sous ce régime de liberté et de sécurité, chaque habitant ayant la faculté, par la liberté des échanges, de créer, sous la forme qui lui conviendra, la plus grande somme de valeur possible, les capitaux se formeront avec une grande rapidité. Tout capital cherchant à s’employer, il y aura une grande concurrence parmi les capitalistes. Donc les salaires s’élèveront ; donc les ouvriers, s’ils sont prévoyants et économes, auront une grande facilité pour devenir capitalistes ; et alors il pourra se faire entre eux des combinaisons, des associations dont l’idée sera conçue et mûrie par eux-mêmes.
La taxe unique étant excessivement modérée, il y aura peu de fonctions publiques, peu de fonctionnaires, pas de forces perdues, peu d’hommes soustraits à la production.
L’État n’ayant que des attributions fort restreintes et bien définies, les habitants jouiront de toute liberté dans le choix de leurs travaux ; car il faut bien remarquer que toute fonction publique inutile n’est pas seulement une charge pour la communauté, mais une atteinte à la liberté des citoyens. Dans la fonction publique qui s’impose au public et ne se débat pas, il n’y a pas de milieu : elle est utile ou sinon essentiellement nuisible ; elle ne saurait être neutre. Quand un homme exerce avec autorité une action, non sur les choses, mais sur ses semblables, s’il ne leur fait pas de bien, il doit nécessairement leur faire du mal.
Les impôts ainsi réduits au minimum indispensable pour procurer à tous la sécurité, les solliciteurs, les abus, les priviléges, l’exploitation des lois dans des intérêts particuliers seront aussi réduits au minimum.
Les habitants de cette commune expérimentale ayant, par la liberté d’échanger, la faculté de produire le maximum de valeur avec le minimum de travail, la lieue carrée fournira autant de bien-être que l’état des connaissances, de l’activité, de l’ordre et de l’économie individuelle le permettra.
Ce bien-être tendra à se répartir d’une manière toujours plus égale ; car les services les plus rétribués étant les plus recherchés, [141] il sera impossible d’acquérir d’immenses fortunes ; d’autant que la modicité de l’impôt n’admettra ni grands marchés publics, ni emprunts, ni agiotage, sources des fortunes scandaleuses que nous voyons s’accumuler dans quelques mains.
Cette petite communauté étant intéressée à n’attaquer personne, et toutes les autres étant intéressées à ne pas l’attaquer, elle jouira de la paix la plus profonde.
Les citoyens s’attacheront au pays, parce qu’ils ne s’y sentiront jamais froissés et restreints par les agents du pouvoir ; et à ses lois, parce qu’ils reconnaîtront qu’elles sont fondées sur la justice.
Convaincu que ce système, qui a au moins le mérite d’être simple et de respecter la dignité humaine, est d’autant meilleur qu’il s’applique à un territoire plus étendu et à une population plus nombreuse, parce que c’est là qu’on obtient le plus de sécurité avec le moins d’impôts ; nous en concluons que s’il réussit sur une commune il réussira sur la nation.
Transcribed from original Rep. fr.
La République française, jeudi 2 mars 1848, no. 6, p. 2.
PÉTITION D'UN ÉCONOMISTE.
On signe en ce moment une pétition qui demande:
*Un ministère du progrès ou de l'organisation du travail.*
A ce sujet, la *Démocratie pacifique s'exprime ainsi:
« Pour organiser le travail dans la société française, il faut savoir l'organiser dans l'atelier alvéolaire de la nation,dans la commune. Toute doctrine sérieuse de transformation sociale doit donc pouvoir se résoudre dans une organisation de l'atelier élémentaire, et s'expérimenter d'abord sur une lieue carrée de terrain. Que la République crée donc un ministère du progrès et de l'organisation du travail dont la fonction sera d'étudier *tous les plans proposés* par les différentes doctrines socialistes, et d'en favoriser l'expérience locale, libre et volontaire sur l'unité territoriale, *la lieue carrée*. »
Si cette idée se réal[se, nous demanderons qu'on nous donne aussi notre *lieue carrée* pour expérimenter notre système.
Car enfin, pourquoi les différentes écoles socialistes auraient-elles seules le privilége d'avoir à leur disposition *des lieues carrées*, des ateliers alvéolaires, des éléments territoriaux, en un mot des communes?
On dit qu'il s'agit d'expériences *libres* et *volontaires*, Entend-on que les habitants de la commune qu'il s'agit de soumettre à l'expérimentation socialiste devront y consentir, et que, d'une autre part, l'État ne devra pas intervenir avec les contributions levées sur les autres communes? Alors, à quoi bon la pétition, et qui empêche les habitants des communes de faire librement, volontairement et à leurs frais, une expérience socialiste sur eux-mémes?
Ou bien veut-on que l'expérience soit forcée, ou tout au moins secondée par des fonds prélevés sur la communauté tout entière?
Mais cela même rendra l'expérience fort peu concluante. Il est bien évident qu'avec toutes les ressources de la nation on peut verser une grande somme de bien-être sur une lieue carrée Ue terrain.
En tous cas, si chaque inventeur d'organisation sociale est appelé il faire son expérience, nous nous inscrivons et demandons formellement une commune à organiser.
Notre plan est du reste fort simple.
Nous percevrons sur chaque famille, et par l’impôt unique, une très-petite part de son revenu, afin d'assurer le respect des personnes et des propriétés, le répression des fraudes, des délits et des crimes. Cela fait, nous observerons avec soin comment les hommes s'organisent d'eux-mêmes.
Les cultes, l'enseignement, le travail, l'échange, y seront parfaitement libres. Nous espérons que sous ce régime de liberté et de sécurité, chaque habitant ayant la faculté, par la liberté des échanges, de créer sous la forme qui lui conviendra la plus grande somme de valeur possible, les capitaux se formeront avec une grande rapidité. Tout capital cherchant à s'employer, il y aura donc une grande concurrence parmi les capitalistes. Donc, les salaires s'élèveront,donc, les ouvriers, s'ils sont prévoyants et économes, auront une grande facilité, pour devenir capitalistes, et alors, il pourra se faire entre eux des combinaisons, des associations dont l'idée sera conçue et mûrie par eux-mêmes.
La taxe unique étant excessivement modérée, il y aura peu de fonctions publiques, peu de fonctionnaires, pas de forces perdues, peu d'hommes soustraits à la production.
L'État n'ayant que des attributions fort restreintes et bien définies, les habitants jouiront de toute liberté dans le choix de leurs travaux; car Il faut bien remarquer que toute fonction publique inutile n'est pas seulement une charge pour la communauté, mais une atteinte à la liberté des citoyens. Dans la fonction publique, qui s'impose au public et ne se débat pas, il n'y a pas de milieu: elle est utile ou sinon essentiellement *nuisible*; elle ne saurait être neutre. Quand un homme exerce *avec autorité* une action, non sur les choses, mais sur ses semblables, s'il ne leur fait pas de bien, il doit nécessairement leur faire du mal.
Les impôts ainsi réduits au minimum indispensable pour procurer à tous la *sécurité*, les solliciteurs, les abus, les priviléges, l'exploitation des lois dans des intérêts particuliers seront aussi réduits au *minimum*.
Les habitants de cette commune expérimentale ayant, par la liberté d'échanger, la faculté de produire le maximum de valeur avec le minimum de travail, la lieue carrée fournira autant de bien-être que l'état des connaissances, de l'activité, de l'ordre et de l'économie individuelle le permettra.
Ce bien-être tendra il se répartir d'une manière toujours plus égale; car les services les plus rétribués étant les plus recherchés, il sera impossible d'acquérir d'immenses fortunes, d'autant que la modicité de l'impôt n'admettra ni grands marchés publics, ni emprunts, ni agiotage, sources des fortunes scandaleuses que nous voyons s'accumuler dans quelques mains.
Cette petite communauté étant intéressée à n'attaquer personne, et toutes les autres étant intéressées à ne pas l'attaquer, elle jouira de la paix là plus profonde.
Les citoyens s'attacheront au pays parce qu'ils ne s'y sentiront jamais froissés et restreints par les agents du pouvoir, et à ses lois, parce qu'ils reconnaîtront qu'elles sont fondées sur la justice.
Convaincus que ce système, qui a au moins le mérite d'être simple et de respecter la dignité humaine, est d'autant meilleur qu'il s'applique il un territoire plus étendu et il une population plus nombreuse, parce que c’est là où on obtient le plus de sécurité avec le moins d'impôts ; nous en concluons que s’il réussit sur une commune, il réussira sur une nation.
Fréd. Bastiat.
Liberté de l'enseignement [4 mars 1848] [CW1.4.2]↩
BWV
1848.03.04 “Liberté de l'enseignement” (On the Freedom of Education) [La République française, 4 March 1848] [OC7.53, p.231] [CW1]
Source
N° du 4 mars 1848 de la République française
53. Liberté d’enseignement [142]
Tous les actes du gouvernement provisoire relatifs à l’instruction publique sont conçus, nous sommes fâchés de le dire, dans un esprit qui suppose que la France a renoncé à la liberté de l’enseignement.
On a pu s’en convaincre par la circulaire du ministre aux recteurs.
Voici venir un décret qui crée une commission des études scientifiques et littéraires.
Sur vingt membres qui la composent, il y en a quinze, au moins, si nous ne nous trompons, qui appartiennent à l’Université.
En outre, le dernier article de l’arrêté dispose que cette commission s’adjoindra dix membres, choisis par elle, est-il dit, parmi les fonctionnaires de l’instruction primaire et secondaire.
Nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer ici que, de toutes les branches de l’activité nationale, celle peut-être qui a fait le moins de progrès, c’est l’enseignement. Il est encore à peu près ce qu’il était dans le moyen âge. Les idylles de Théocrite et les odes d’Horace sont encore la base de l’instruction qu’on donne à la jeunesse du dix-neuvième siècle. Cela semble indiquer qu’il n’y a rien de moins progressif et de plus immuable que ce qui se fait par le monopole gouvernemental.
Il y a en France une école nombreuse qui pense que, sauf répression légale de l’abus, tout citoyen doit être en possession du libre exercice de ses facultés. Non seulement c’est le droit, mais c’est la condition du progrès. C’est ainsi qu’on comprend la liberté aux États-Unis, et cette expérience vaut bien celles qu’on a faites en Europe du monopole. Il est à remarquer qu’aucun des hommes qui appartiennent à cette école, connue sous le nom d’école économiste, n’a été appelé dans aucune des commissions qu’on vient d’organiser.
Qu’ils aient été tenus éloignés des fonctions publiques rétribuées, cela n’est pas surprenant. Ils s’en sont tenus éloignés eux-mêmes, et ils le devaient, puisque leur idéal est de réduire les places à ce qui est indispensable pour maintenir l’ordre, la sécurité intérieure et extérieure, le respect des personnes et des propriétés, et, tout au plus, la création de quelques travaux d’utilité nationale.
Mais que l’on dédaigne systématiquement leur témoignage dans de simples enquêtes, c’est un symptôme significatif ; il prouve que le torrent nous entraîne vers le développement illimité de l’action gouvernementale, vers la compression indéfinie de la vraie liberté.
Curée des Places [5 mars 1848] [CW1.4.7]↩
BWV
1848.03.05 “Curée des Places” (The Scramble for Positions) [La République française, 5 March 1848] [OC7.54, p. 232] [CW1, pp. 431-32.]
Source
N° du 5 mars 1848 de la République française.
54. Curée des places [143]
Tous les journaux, sans exception, s’élèvent contre la curée des places dont l’Hôtel de ville donne le triste spectacle. Cette rapacité effrénée nous indigne et nous dégoûte plus que personne.
Mais enfin il faut voir la cause du mal, et il serait puéril d’exiger que le cœur humain fût fait autrement qu’il n’a plu à la nature de le faire.
Dans un pays où, depuis un temps immémorial, le travail libre est partout gêné et comprimé, où l’éducation propose pour modèle à toute la jeunesse les mœurs de la Grèce et de Rome, où le commerce et l’industrie sont constamment exposés par la presse à la risée des citoyens sous les noms de mercantilisme, industrialisme, individualisme, où la carrière des places mène seule à la fortune, à la considération, à la puissance, où l’État fait tout et se mêle de tout par ses innombrables agents, — il est assez naturel que les fonctions publiques soient avidement convoitées.
Comment détourner l’ambition de cette direction funeste et refouler l’activité des classes éclairées vers les carrières productives ?
Évidemment en supprimant beaucoup de fonctions, en limitant l’action gouvernementale, en laissant un champ plus vaste, plus libre et plus honoré à l’activité privée, en diminuant le salaire des hautes positions publiques.
Que faut-il donc penser de ces systèmes, si en vogue de nos jours, qui aspirent à faire passer dans le domaine des fonctions rétribuées ce qui était encore resté dans la sphère de l’industrie ? La Démocratie pacifique veut que l’État fasse les assurances, le transport des voyageurs, le roulage, le commerce des blés, etc., etc., etc. ?
N’est-ce pas fournir de nouveaux aliments à cette funeste passion qui indigne tous les citoyens honnêtes ?
Nous ne voulons pas parler ici des autres inconvénients de ce système. Examinez l’une après l’autre toutes les industries exercées par l’État, et voyez si ce ne sont pas celles au moyen desquelles les citoyens sont le plus mal et le plus chèrement pourvus.
Voyez l’enseignement qui se borne obstinément à l’étude de deux langues mortes depuis deux mille ans.
Voyez quel tabac on vous donne et pour quel prix.
Comparez, sous le rapport de la régularité et du bon marché, la distribution des imprimés exécutée par l’administration publique de la rue Jean-Jacques-Rousseau, ou par les entreprises particulières de la rue de la Jussienne.
Mais, en mettant de côté ces considérations, n’est-il pas évident que la curée des places est et sera toujours en proportion de l’aliment offert à cette curée ?
N’est-il pas évident que faire exercer l’industrie par l’État, c’est soustraire du travail à l’activité honnête pour le livrer à l’intrigue paresseuse et nonchalante ?
N’est-il pas évident, enfin, que c’est rendre permanent et progressif ce désordre dont l’Hôtel de ville est témoin et qui attriste les membres du gouvernement provisoire ?
Entraves et Taxes [6 mars 1848] [CW1.4.8]↩
BWV
1848.03.06 “Entraves et Taxes” (Burdens and Taxes) [La République française, 6 March 1848] [OC7.55, p. 234] [CW1]
Source
N° du 6 mars 1848 de la République française.
55. Entraves et taxes [144]
Pendant qu’un mouvement peut-être irrésistible nous emporte vers l’extension indéfinie des attributions de l’État, vers la multiplication des taxes ainsi que des entraves et des vexations qui en sont le cortège inévitable, une évolution en sens contraire, très prononcée, se manifeste en Angleterre et entraînera peut-être la chute du ministère.
Là, chaque expérience, chaque effort pour réaliser le bien par l’intervention de l’État, aboutit à une déception. Bientôt on s’aperçoit que le bien ne se réalise pas et que l’expérience ne laisse après elle qu’une chose : la taxe.
Ainsi, l’année dernière, on a fait une loi pour régler le travail des manufactures, et l’exécution de cette loi a exigé la création d’un corps de fonctionnaires. Aujourd’hui, entrepreneurs, ouvriers, inspecteurs et magistrats s’accordent pour reconnaître que la loi a lésé tous les intérêts dont elle s’est mêlée. Il n’en reste que deux choses : le désordre et la taxe.
Il y a deux ans, la législature bâcla une constitution pour la Nouvelle-Zélande, et vota de grandes dépenses pour la mettre en vigueur. Or ladite constitution a fait une lourde chute. Mais il y a une chose qui n’est pas tombée, c’est la taxe.
Lord Palmerston a cru devoir intervenir dans les affaires du Portugal. Il a ainsi attiré sur le nom anglais la haine d’une nation alliée, et cela au prix de quinze millions de francs ou d’une forte taxe.
Lord Palmerston persiste à saisir les navires brésiliens engagés dans la traite. Pour cela il expose la vie d’un nombre considérable de marins anglais ; il appelle des avanies sur les sujets britanniques établis au Brésil ; il rend impossible un traité entre l’Angleterre et Rio-Janeiro ; et tous ces dommages s’achètent au prix de flottes et de tribunaux, c’est-à-dire de taxes.
Ainsi il se trouve que les Anglais payent, non pour recevoir des avantages, mais pour éprouver des dommages.
La conclusion que nos voisins paraissent vouloir tirer de ce phénomène est celle-ci : Que le peuple, après avoir payé à l’administration ce qui est nécessaire pour garantir sa sécurité, garde le reste pour lui.
C’est une pensée bien simple, mais elle fera le tour du monde.
Soulagement immédiat du peuple [The Immediate Relief of the People] [12 March 1848] [CW3 ES3.21]↩
BWV
1848.03.12 XIX. “Soulagement immédiat du peuple” (The Immediate Relief of the People) [*La République fr. 12 March, 1848] [OC2.68a, pp. 459-60] [CW3] [ES3.21]
Note
Petites affiches de Jacques Bonhomme [Small posters by Jacques Bonhomme] [12 March 1848, Jacques Bonhomme] [editor’s note] [145]
Peuple,
On te dit : « Tu n’as pas assez pour vivre ; que l’État y ajoute ce qui manque. » Qui ne le voudrait, si cela était possible ?
Mais, hélas ! La caisse du percepteur n’est pas l’urne de Cana.
Quand notre seigneur mettait un litre de vin dans cette urne, il en sortait deux ; mais quand tu mets cent sous dans la caisse du buraliste, il n’en sort pas dix francs ; il n’en sort même pas cent sous, car le buraliste en garde quelques-uns pour lui.
Comment donc ce procédé augmenterait-il ton travail ou ton salaire ?
Ce qu’on te conseille se réduit à ceci : Tu donneras cinq francs à l’État contre rien, et l’État te donnera quatre francs contre ton travail. Marché de dupe.
Peuple, comment l’État pourra-t-il te faire vivre, puisque c’est toi qui fait vivre l’État ?
Voilà le mécanisme des ateliers de charité réduits en système: [146]
L’État te prend six pains, il en mange deux, et exige ton travail pour t’en rendre quatre. Si, maintenant, tu lui demandes huit pains, il ne peut faire autre chose que ceci : t’en prendre douze, en manger quatre, et te faire gagner le reste.
Peuple, sois plus avisé ; fait comme les républicains d’Amérique : donne à l’État le strict nécessaire et garde le reste pour toi.
Demande la suppression des fonctions inutiles, la réduction des gros traitements, l’abolition des priviléges, monopoles et entraves, la simplification des rouages administratifs.
Au moyen de ces économies, exige la suppression de l’octroi, celle de l’impôt du sel, celle de la taxe sur les bestiaux et le blé.
Ainsi la vie sera à meilleur marché, et, étant à meilleur marché, chacun aura un petit reliquat sur son salaire actuel ; — et au moyen de ce petit reliquat multiplié par trente-six millions d’habitants, chacun pourra aborder et payer une consommation nouvelle ; — et chacun consommant un peu plus, nous nous procurerons tous un peu plus de travail les uns aux autres ; — et puisque le travail sera plus demandé dans le pays, les salaires hausseront ; — et alors, peuple, tu auras résolu le problème : gagner plus de sous et obtenir plus de choses pour chaque sou.
Ce n’est pas si brillant que la prétendue urne de Cana du Luxembourg, mais c’est sûr, solide, praticable, immédiat et juste.
Funeste remède [A Disastrous Remedy] [12 March 1848] [CW3 ES3.22]↩
BWV
1848.03.12 XX. “Funeste remède” (A Disastrous Remedy) [*La République fr. * 12 march 1848] [OC2.68b, pp. 460-61] [CW3] [ES3.22]
Quand notre frère souffre, il faut le soulager.
Mais ce n’est pas la bonté de l’intention qui fait la bonté de la potion. On peut très-charitablement donner un remède qui tue.
Un pauvre ouvrier était malade ; le docteur arrive, lui tâte le pouls, lui fait tirer la langue et lui dit : Brave homme, vous n’êtes pas assez nourri. — Je le crois, dit le moribond ; j’avais pourtant un vieux médecin fort habile. Il me donnait les trois quarts d’un pain tous les soirs. Il est vrai qu’il m’avait pris le pain tout entier le matin, et en avait gardé le quart pour ses honoraires. Je l’ai chassé, voyant que ce régime ne me guérissait pas. — L’ami, mon confrère était un ignorant intéressé. Il ne voyait pas que votre sang est appauvri. Il faut réorganiser cela. Je vais vous introduire du sang nouveau dans le bras gauche ; pour cela il faudra que je vous le tire du bras droit. Mais pourvu que vous ne teniez aucun compte ni du sang qui sortira du bras droit ni de celui qui se perdra dans l’opération, vous trouverez ma recette admirable.
Voilà où nous en sommes. L’État dit au peuple : « Tu n’as pas assez de pain, je vais t’en donner. Mais comme je n’en fais pas, je commencerai par te le prendre, et, après avoir satisfait mon appétit, qui n’est pas petit, je te ferai gagner le reste. »
Ou bien : « Tu n’as pas assez de salaires ; paye-moi plus d’impôts. J’en distribuerai une partie à mes agents, et avec le surplus, je te ferai travailler. »
Et si le peuple, n’ayant des yeux que pour le pain qu’on lui donne, perd de vue celui qu’on lui prend ; si, voyant le petit salaire que la taxe lui procure, il ne voit pas le gros salaire qu’elle lui ôte, on peut prédire que sa maladie s’aggravera.
Circulaires d'un ministère introuvable [Circulars from a Government that is Nowhere to be Found] [19 March 1848] [CW3 ES3.23]↩
BWV
1848.03.19 XXI. “Circulaires d'un ministère introuvable” (Circulars from a Government that is nowhere to be found) [La République française, 19 March 1848] [OC2.69, pp. 462-65] [CW3] [ES3.23]
Le ministre de l’intérieur à MM. les commissaires du gouvernement, préfets, maires, etc.
Les élections approchent ; vous désirez que je vous indique la ligne de conduite que vous avez à tenir ; la voici : Comme citoyens, je n’ai rien à vous prescrire, si ce n’est de puiser vos inspirations dans votre conscience et dans l’amour du bien public. Comme fonctionnaires, respectez et faites respecter les libertés des citoyens.
Nous interrogeons le pays. Ce n’est pas pour lui arracher, par l’intimidation ou la ruse, une réponse mensongère. Si l’Assemblée nationale a des vues conformes aux nôtres, nous gouvernerons, grâce à cette union, avec une autorité immense. Si elle ne pense pas comme nous, il ne nous restera qu’à nous retirer et nous efforcer de la ramener à nous par une discussion loyale. L’expérience nous avertit de ce qu’il en coûte de vouloir gouverner avec des majorités factices.
Le ministre du commerce aux négociants de la République.
Citoyens,
Mes prédécesseurs ont fait ou ont eu l’air de faire de grands efforts pour vous procurer des affaires. Ils s’y sont pris de toutes façons, sans autre résultat que celui-ci : aggraver les charges de la nation et nous créer des obstacles. Tantôt ils forçaient les exportations par des primes, tantôt ils gênaient les importations par des entraves. Il leur est arrivé souvent de s’entendre avec leurs collègues de la marine et de la guerre pour s’emparer d’une petite île perdue dans l’Océan, et quand, après force emprunts et batailles, on avait réussi, on vous donnait, comme Français, le privilége exclusif de trafiquer avec la petite île, à la condition de ne plus trafiquer avec le reste du monde.
Tous ces tâtonnements ont conduit à reconnaître la vérité de cette règle, dans laquelle se confondent et votre intérêt propre, et l’intérêt national, et l’intérêt de l’humanité : acheter et vendre là où on peut le faire avec le plus d’avantage.
Or, comme c’est là ce que vous faites naturellement sans que je m’en mêle, je suis réduit à avouer que mes fonctions sont plus qu’inutiles ; je ne suis pas même la mouche du coche.
C’est pourquoi je vous donne avis que mon ministère est supprimé. La République supprime en même temps toutes les entraves dans lesquelles mes prédécesseurs vous ont enlacés, et tous les impôts qu’il faut bien faire payer au peuple pour mettre ces entraves en action. Je vous prie de me pardonner le tort que je vous ai fait ; et pour me prouver que vous n’avez pas de rancune, j’espère que l’un d’entre vous voudra bien m’admettre comme commis dans ses bureaux, afin que j’apprenne le commerce, pour lequel mon court passage au ministère m’a donné du goût.
Le ministre de l’agriculture aux agriculteurs.
Citoyens,
Un heureux hasard m’a suggéré une pensée qui ne s’était jamais présentée à l’esprit de mes prédécesseurs ; c’est que vous appartenez comme moi à l’espèce humaine. Vous avez une intelligence pour vous en servir, et, de plus, cette source véritable de tous progrès, le désir d’améliorer votre condition.
Partant de là, je me demande à quoi je puis vous servir. Vous enseignerai-je l’agriculture ? Mais il est probable que vous la savez mieux que moi. Vous inspirerai-je le désir de substituer les bonnes pratiques aux mauvaises ? Mais ce désir est en vous au moins autant qu’en moi. Votre intérêt le fait naître, et je ne vois pas comment mes circulaires pourraient parler à vos oreilles plus haut que votre propre intérêt.
Le prix des choses vous est connu. Vous avez donc une règle qui vous indique ce qu’il vaut mieux produire ou ne produire pas. Mon prédécesseur voulait vous procurer du travail manufacturier pour occuper vos jours de chômage. Vous pourriez, disait-il, vous livrer à ce travail avec avantage pour vous et pour le consommateur. Mais de deux choses l’une : ou cela est vrai, et alors qu’est-il besoin d’un ministère pour vous signaler un travail lucratif à votre portée ? Vous le découvrirez bien vous-mêmes, si vous n’êtes pas d’une race inférieure frappée d’idiotisme ; hypothèse sur laquelle est basé mon ministère et que je n’admets pas. Ou cela n’est pas vrai ; en ce cas, combien ne serait-il pas dommageable que le ministre imposât un travail stérile à tous les agriculteurs de France, par mesure administrative !
Jusqu’ici, mes collaborateurs et moi nous sommes donné beaucoup de mouvement sans aucun résultat, si ce n’est de vous faire payer des taxes, car notez bien qu’à chacun de nos mouvements répond une taxe. Cette circulaire même n’est pas gratuite. Ce sera la dernière. Désormais, pour faire prospérer l’agriculture, comptez sur vos efforts et non sur ceux de mes bureaucrates ; tournez vos yeux sur vos champs et non sur un hôtel de la rue de Grenelle.
Le ministre des cultes aux ministres de la religion.
Citoyens,
Cette lettre a pour objet de prendre congé de vous. La liberté des cultes est proclamée. Vous n’aurez affaire désormais, comme tous les citoyens, qu’au ministre de la justice. Je veux dire que si, ce que je suis loin de prévoir, vous usez de votre liberté de manière à blesser la liberté d’autrui, troubler l’ordre, ou choquer l’honnêteté, vous rencontrerez infailliblement la répression légale, à laquelle nul ne doit être soustrait. Hors de là, vous agirez comme vous l’entendrez, et cela étant, je ne vois pas en quoi je puis vous être utile. Moi et toute la vaste administration que je dirige, nous devenons un fardeau pour le public. Ce n’est pas assez dire ; car à quoi pourrions-nous occuper notre temps sans porter atteinte à la liberté de conscience ? Évidemment, tout fonctionnaire qui ne fait pas une chose utile, en fait une nuisible par cela seul qu’il agit. En nous retirant, nous remplissons donc deux conditions du programme républicain : économie, liberté.
Le Secrétaire du ministère introuvable,
F. B.
Funestes illusions [Disastrous Illusions] [March 1848] [CW3 ES3.24]↩
BWV
1848.03.15 “Funestes illusions. Les citoyens font vivre l'État. L'État ne peut faire vivre les citoyens.” (Disastrous Illusions. Citizens make the State thrive. The State cannot make the citizens thrive) [*Journal des Économistes*, March 1848, T. 19, pp. 323-33.] [OC2.70, pp. 466-82] [CW3] [ES3.24]
les citoyens font vivre l’état. l’état ne peut faire vivre les citoyens.
Il m’est quelquefois arrivé de combattre le Privilége par la plaisanterie. C’était, ce me semble, bien excusable. Quand quelques-uns veulent vivre aux dépens de tous, il est bien permis d’infliger la piqûre du ridicule au petit nombre qui exploite et à la masse exploitée.
Aujourd’hui, je me trouve en face d’une autre illusion. Il ne s’agit plus de priviléges particuliers, il s’agit de transformer le privilége en droit commun. La nation tout entière a conçu l’idée étrange qu’elle pouvait accroître indéfiniment la substance de sa vie, en la livrant à l’État sous forme d’impôts, afin que l’État la lui rende en partie sous forme de travail, de profits et de salaires. On demande que l’État assure le bien-être à tous les citoyens ; et une longue et triste procession, où tous les ordres de travailleurs sont représentés, depuis le roi des banquiers jusqu’à l’humble blanchisseuse, défile devant le grand organisateur pour solliciter une assistance pécuniaire.
Je me tairais s’il n’était question que de mesures provisoires, nécessitées et en quelque sorte justifiées par la commotion de la grande révolution que nous venons d’accomplir ; mais ce qu’on réclame, ce ne sont pas des remèdes exceptionnels, c’est l’application d’un système. Oubliant que la bourse des citoyens alimente celle de l’État, on veut que la bourse de l’État alimente celle des citoyens.
Ah ! ce n’est pas avec l’ironie et le sarcasme que je m’efforcerai de dissiper cette funeste illusion ; car, à mes yeux du moins, elle jette un voile sombre sur l’avenir ; et c’est là, je le crains bien, l’écueil de notre chère République.
D’ailleurs, comment avoir le courage de s’en prendre au peuple, s’il ignore ce qu’on lui a toujours défendu d’apprendre, s’il nourrit dans son cœur des espérances chimériques qu’on s’est appliqué à y faire naître ?
Que faisaient naguère et que font encore les puissants du siècle, les grands propriétaires, les grands manufacturiers ? Ils demandaient à la loi des suppléments de profits, au détriment de la masse. Est-il surprenant que la masse, aujourd’hui en position de faire la loi, lui demande aussi un supplément de salaires ? Mais, hélas ! il n’y a pas au-dessous d’elle une autre masse d’où cette source de subventions puisse jaillir. Le regard attaché sur le pouvoir, les industriels s’étaient transformés en solliciteurs. Faites-moi vendre mieux mon blé ! faites-moi tirer un meilleur parti de ma viande ! Élevez artificiellement le prix de mon fer, de mon drap, de ma houille ! Tels étaient les cris qui assourdissaient la Chambre privilégiée. Est-il surprenant que le peuple victorieux se fasse solliciteur à son tour ! Mais, hélas ! si la loi peut, à la rigueur, faire des largesses à quelques privilégiés, aux dépens de la nation, comment concevoir qu’elle fasse des largesses à la nation tout entière ?
Quel exemple donne en ce moment même la classe moyenne ? On la voit obséder le gouvernement provisoire et se jeter sur le budget comme sur une proie. Est-il surprenant que le peuple manifeste aussi l’ambition bien humble de vivre au moins en travaillant ?
Que disaient sans cesse les gouvernants ? À la moindre lueur de prospérité, ils s’en attribuaient sans façon tout le mérite ; ils ne parlaient pas des vertus populaires qui en sont la base, de l’activité, de l’ordre, de l’économie des travailleurs. Non, cette prospérité, d’ailleurs fort douteuse, ils s’en disaient les auteurs. Il n’y a pas encore deux mois que j’entendais le ministre du commerce dire : « Grâce à l’intervention active du gouvernement, grâce à la sagesse du roi, grâce au patronage des sciences, toutes les classes industrielles sont florissantes. » Faut-il s’étonner que le peuple ait fini par croire que le bien-être lui venait d’en haut comme une manne céleste, et qu’il tourne maintenant ses regards vers les régions du pouvoir ? Quand on s’attribue le mérite de tout le bien qui arrive, on encourt la responsabilité de tout le mal qui survient.
Ceci me rappelle un curé de notre pays. Pendant les premières années de sa résidence, il ne tomba pas de grêle dans la commune ; et il était parvenu à persuader aux bons villageois que ses prières avaient l’infaillible vertu de chasser les orages. Cela fut bien tant qu’il ne grêla pas ; mais, à la première apparition du fléau, il fut chassé de la paroisse. On lui disait : C’est donc par mauvaise volonté que vous avez permis à la tempête de nous frapper ?
La République s’est inaugurée par une semblable déception. Elle a jeté cette parole au peuple, si bien préparé d’ailleurs à la recevoir : « Je garantis le bien-être à tous les citoyens. » Et puisse cette parole ne pas attirer des tempêtes sur notre patrie !
Le peuple de Paris s’est acquis une gloire éternelle par son courage.
Il a excité l’admiration du monde entier par son amour pour l’ordre public, son respect pour tous les droits et toutes les propriétés.
Il lui reste à accomplir une tâche bien autrement difficile, il lui reste à repousser de ses lèvres la coupe empoisonnée qu’on lui présente. Je le dis avec conviction, tout l’avenir de la République repose aujourd’hui sur son bon sens. Il n’est plus question de la droiture de ses intentions, personne ne peut les méconnaître ; il s’agit de la droiture de ses instincts. La glorieuse révolution qu’il a accomplie par son courage, qu’il a préservée par sa sagesse, n’a plus à courir qu’un danger : la déception ; et contre ce danger, il n’y a qu’une planche de salut : la sagacité du peuple.
Oui, si des voix amies avertissent le peuple, si des mains courageuses lui ouvrent les yeux, quelque chose me dit que la République évitera le gouffre béant qui s’ouvre devant elle ; et alors quel magnifique spectacle la France donnera au monde ! Un peuple triomphant de ses ennemis et de ses faux amis, un peuple vainqueur des passions d’autrui et de ses propres illusions !
Je commence par dire que les institutions qui pesaient sur nous, il y a à peine quelques jours, n’ont pas été renversées, que la République, ou le gouvernement de tous par tous, n’a pas été fondé pour laisser le peuple (et par ce mot j’entends maintenant la classe des travailleurs, des salariés, ou ce qu’on appelait des prolétaires) dans la même condition où elle était avant.
C’est la volonté de tous, et c’est sa propre volonté, que sa condition change.
Mais deux moyens se présentent, et ces moyens ne sont pas seulement différents, ils sont, il faut bien le dire, diamétralement opposés.
L’école qu’on appelle économiste propose la destruction immédiate de tous les priviléges, de tous les monopoles, la suppression immédiate de toutes les fonctions inutiles, la réduction immédiate de tous les traitements exagérés, une diminution profonde des dépenses publiques, le remaniement de l’impôt, de manière à faire disparaître tous ceux qui pèsent sur les consommations du peuple, qui enchaînent ses mouvements et paralysent le travail. Elle demande, par exemple, que l’octroi, l’impôt sur le sel, les taxes sur l’entrée des subsistances et des instruments de travail, soient sur-le-champ abolis.
Elle demande que ce mot liberté, qui flotte avec toutes nos bannières, qui est inscrit sur tous nos édifices, soit enfin une vérité.
Elle demande qu’après avoir payé au gouvernement ce qui est indispensable pour maintenir la sécurité intérieure et extérieure, pour réprimer les fraudes, les délits et les crimes, et pour subvenir aux grands travaux d’utilité nationale, le peuple garde le reste pour lui.
Elle assure que mieux le peuple pourvoira à la sûreté des personnes et des propriétés, plus rapidement se formeront les capitaux.
Qu’ils se formeront avec d’autant plus de rapidité, que le peuple saura mieux garder pour lui ses salaires, au lieu de les livrer, par l’impôt, à l’État.
Que la formation rapide des capitaux implique nécessairement la hausse rapide des salaires, et par conséquent l’élévation progressive des classes ouvrières en bien-être, en indépendance, en instruction et en dignité.
Ce système n’a pas l’avantage de promettre la réalisation instantanée du bonheur universel ; mais il nous paraît simple, immédiatement praticable, conforme à la justice, fidèle à la liberté, et de nature à favoriser toutes les tendances humaines vers l’égalité et la fraternité. J’y reviendrai après avoir exposé et approfondi les vues d’une autre école, qui paraît en ce moment prévaloir dans les sympathies populaires.
Celle-ci veut aussi le bien du peuple ; mais elle prétend le réaliser par voie directe. Sa prétention ne va à rien moins qu’à augmenter le bien-être des masses, c’est-à-dire accroître leurs consommations tout en diminuant leur travail ; et, pour accomplir ce miracle, elle imagine de puiser des suppléments de salaires soit dans la caisse commune, soit dans les profits exagérés des entrepreneurs d’industrie.
C’est ce système dont je me propose de signaler les dangers.
Qu’on ne se méprenne pas à mes paroles. Je n’entends pas ici condamner l’association volontaire. Je crois sincèrement que l’association fera faire de grands progrès en tous sens à l’humanité. Des essais sont faits en ce moment, notamment par l’administration du chemin du Nord et celle du journal la Presse. Qui pourrait blâmer ces tentatives ? Moi-même, avant d’avoir jamais entendu parler de l’école sociétaire, j’avais conçu un projet d’association agricole destiné à perfectionner le métayage. Des raisons de santé m’ont seules détourné de cette entreprise.
Mes doutes ont pour objet, ou, pour parler franchement, ma conviction énergique repousse de toutes ses forces cette tendance manifeste, que vous avez sans doute remarquée, qui vous entraîne aussi peut-être, à invoquer en toutes choses l’intervention de l’État, c’est-à-dire la réalisation de nos utopies, ou, si l’on veut, de nos systèmes, avec la contrainte légale pour principe, et l’argent du public pour moyen.
On a beau inscrire sur son drapeau Association volontaire, je dis que lorsqu’on appelle à son aide la loi et l’impôt, l’enseigne est aussi menteuse qu’elle puisse l’être, puisqu’il n’y a plus alors ni association ni volonté.
Je m’attacherai à démontrer que l’intervention exagérée de l’État ne peut accroître le bien-être des masses, et qu’elle tend au contraire à le diminuer ;
Qu’elle efface le premier mot de notre devise républicaine, le mot liberté ;
Que si elle est fausse en principe, elle est particulièrement dangereuse pour la France, et qu’elle menace d’engloutir, dans un grand et irréparable désastre, et les fortunes particulières, et la fortune publique, et le sort des classes ouvrières, et les institutions, et la République.
Je dis, d’abord, que les promesses de ce déplorable système sont illusoires.
Et, en vérité, cela me semble si clair, que j’aurais honte de me livrer à cet égard à une longue démonstration, si des faits éclatants ne me prouvaient que cette démonstration est nécessaire.
Car quel spectacle nous offre le pays ?
À l’Hôtel-de-Ville la curée des places, au Luxembourg la curée des salaires. Là, ignominie ; ici, cruelle déception.
Quant à la curée des places, il semble que le remède serait de supprimer toutes les fonctions inutiles, de réduire le traitement de celles qui excitent la convoitise ; mais on laisse cette proie tout entière à l’avidité de la bourgeoisie, et elle s’y précipite avec fureur.
Aussi qu’arrive-t-il ? Le peuple, de son côté, le peuple des travailleurs, témoin des douceurs d’une existence assurée sur les ressources du public, oubliant qu’il est lui même ce public, oubliant que le budget est formé de sa chair et de son sang, demande, lui aussi, qu’on lui prépare une curée.
De longues députations se pressent au Luxembourg, et que demandent-elles ? L’accroissement des salaires, c’est-à-dire, en définitive, une amélioration dans les moyens d’existence des travailleurs.
Mais ceux qui assistent personnellement à ces députations, n’agissent pas seulement pour leur propre compte. Ils entendent bien représenter toute la grande confraternité des travailleurs qui peuplent nos villes aussi bien que nos campagnes.
Le bien-être matériel ne consiste pas à gagner plus d’argent. Il consiste à être mieux nourri, vêtu, logé, chauffé, éclairé, instruit, etc., etc.
Ce qu’ils demandent donc, en allant au fond des choses, c’est qu’à dater de l’ère glorieuse de notre révolution, chaque Français appartenant aux classes laborieuses ait plus de pain, de vin, de viande, de linge, de meubles, de fer, de combustible, de livres, etc., etc.
Et, chose qui passe toute croyance, plusieurs veulent en même temps que le travail qui produit ces choses soit diminué. Quelques-uns même, heureusement en petit nombre, vont jusqu’à solliciter la destruction des machines.
Se peut-il concevoir une contradiction plus flagrante ?
À moins que le miracle de l’urne de Cana ne se renouvelle dans la caisse du percepteur, comment veut-on que l’État y puise plus que le peuple n’y a mis ? Croit-on que, pour chaque pièce de cent sous qui y entre, il soit possible d’en faire sortir dix francs ? Hélas ! c’est tout le contraire. La pièce de cent sous que le peuple y jette tout entière n’en sort que fort ébréchée, car il faut bien que le percepteur en garde une partie pour lui.
En outre, que signifie l’argent ? Quand il serait vrai qu’on peut puiser dans le Trésor public un fonds de salaires autre que celui que le public lui-même y a mis, en serait-on plus avancé ? Ce n’est pas d’argent qu’il s’agit, mais d’aliments, de vêtements, de logement, etc.
Or, l’organisateur qui siége au Luxembourg a-t-il la puissance de multiplier ces choses par des décrets ? ou peut-il faire que, si la France produit 60 millions d’hectolitres de blé, chacun de nos 36 millions de concitoyens en reçoive 3 hectolitres, et de même pour le fer, le drap, le combustible ?
Le recours au Trésor public, comme système général, est donc déplorablement faux. Il prépare au peuple une cruelle déception.
On dira sans doute : « Nul ne songe à de telles absurdités. Mais il est certain que les uns ont trop en France, et les autres pas assez. Ce à quoi l’on vise, c’est à un juste nivellement, à une plus équitable répartition. »
Examinons la question à ce point de vue.
Si l’on voulait dire qu’après avoir retranché tous les impôts qui peuvent l’être, il faut, autant que possible, faire peser ceux qui restent sur la classe qui peut le mieux les supporter, on ne ferait qu’exprimer nos vœux. Mais cela est trop simple pour des organisateurs ; c’est bon pour des économistes.
Ce qu’on veut, c’est que tout Français soit bien pourvu de toutes choses. On a annoncé d’avance que l’État garantissait le bien-être à tout le monde ; et la question est de savoir s’il y a moyen de presser assez la classe riche, en faveur de la classe des travailleurs, des salariés, ou ce qu’on appelait des prolétaires), pour atteindre ce résultat.
Poser la question, c’est la résoudre ; car, pour que tout le monde ait plus de pain, de vin, de viande, de drap, etc., il faut que le pays en produise davantage ; et comment pourrait-on en prendre à une seule classe, même à la classe riche, plus que toutes les classes ensemble n’en produisent ?
D’ailleurs, remarquez-le bien : il s’agit ici de l’impôt. Il s’élève déjà à un milliard et demi. Les tendances que je combats, loin de permettre aucun retranchement, conduisent à des aggravations inévitables.
Permettez-moi un calcul approximatif.
Il est fort difficile de poser le chiffre exact des deux classes ; cependant on peut en approcher.
Sous le régime qui vient de tomber il y avait 250 mille électeurs. À quatre individus par famille, cela répond à un million d’habitants, et chacun sait que l’électeur à 200 francs était bien près d’appartenir à la classe des propriétaires malaisés. Cependant, pour éviter toute contestation, attribuons à la classe riche, non-seulement ce million d’habitants, mais seize fois ce nombre. La concession est déjà raisonnable. Nous avons donc seize millions de riches et vingt millions sinon de pauvres, du moins de frères qui ont besoin d’être secourus. Si l’on suppose qu’un supplément bien modique de 25 cent. par jour est indispensable pour réaliser des vues philanthropiques plus bienveillantes qu’éclairées, c’est un impôt de cinq millions par jour ou près de deux milliards par an, nous pouvons même dire deux milliards avec les frais de perception.
Nous payons déjà un milliard et demi. J’admets qu’avec un système d’administration plus économique on réduise ce chiffre d’un tiers : il faudrait toujours prélever trois milliards. Or, je le demande, peut-on songer à prélever trois milliards sur les seize millions d’habitants les plus riches du pays ?
Un tel impôt serait de la confiscation, et voyez les conséquences. Si, en fait, toute propriété était confisquée à mesure qu’elle se forme, qui est-ce qui se donnerait la peine de créer de la propriété ? On ne travaille pas seulement pour vivre au jour le jour. Parmi les stimulants du travail, le plus puissant peut-être, c’est l’espoir d’acquérir quelque chose pour ses vieux jours, d’établir ses enfants, d’améliorer le sort de sa famille. Mais si vous arrangez votre système financier de telle sorte que toute propriété soit confisquée à mesure de sa formation, alors, nul n’étant intéressé ni au travail ni à l’épargne, le capital ne se formera pas ; il décroîtra avec rapidité, si même il ne déserte pas subitement à l’étranger ; et, alors, que deviendra le sort de cette classe même que vous aurez voulu soulager ?
J’ajouterai ici une vérité qu’il faut bien que le peuple apprenne.
Quand dans un pays l’impôt est très-modéré, il est possible de le répartir selon les règles de la justice et de le prélever à peu de frais. Supposez, par exemple, que le budget de la France ne s’élevât pas au delà de cinq à six cents millions. Je crois sincèrement qu’on pourrait, dans cette hypothèse, inaugurer l’impôt unique, assis sur la propriété réalisée (mobilière et immobilière).
Mais lorsque l’État soutire à la nation le quart, le tiers, la moitié de ses revenus, il est réduit à agir de ruse, à multiplier les sources de recettes, à inventer les taxes les plus bizarres, et en même temps les plus vexatoires. Il fait en sorte que la taxe se confonde avec le prix des choses, afin que le contribuable la paye sans s’en douter. De là les impôts de consommation, si funestes aux libres mouvements de l’industrie. Or quiconque s’est occupé de finances sait bien que ce genre d’impôt n’est productif qu’à la condition de frapper les objets de la consommation la plus générale. On a beau fonder des espérances sur les taxes somptuaires, je les appelle de tous mes vœux par des motifs d’équité, mais elles ne peuvent jamais apporter qu’un faible contingent à un gros budget. Le peuple se ferait donc complétement illusion s’il pensait qu’il est possible, même au gouvernement le plus populaire, d’aggraver les dépenses publiques, déjà si lourdes, et en même temps de les mettre exclusivement à la charge de la classe riche.
Ce qu’il faut remarquer, c’est que, dès l’instant qu’on a recours aux impôts de consommation (ce qui est la conséquence nécessaire d’un lourd budget), l’égalité des charges est rompue, parce que les objets frappés de taxes entrent beaucoup plus dans la consommation du pauvre que dans celle du riche, proportionnellement à leurs ressources respectives.
En outre, à moins d’entrer dans les inextricables difficultés des classifications, on met sur un objet donné, le vin, par exemple, un impôt uniforme, et l’injustice saute aux yeux. Le travailleur, qui achète un litre de vin de 50 c. le litre, grevé d’un impôt de 50 c., paye 100 pour 100. Le millionnaire, qui boit du vin de Lafitte de 10 francs la bouteille, paye 5 pour 100.
Sous tous les rapports, c’est donc la classe ouvrière qui est intéressée à ce que le budget soit réduit à des proportions qui permettent de simplifier et égaliser les impôts. Mais pour cela il ne faut pas qu’elle se laisse éblouir par tous ces projets philanthropiques, qui n’ont qu’un seul résultat certain : celui d’exagérer les charges nationales.
Si l’exagération de l’impôt est incompatible avec l’égalité contributive, et avec cette sécurité indispensable pour que le capital se forme et s’accroisse, elle n’est pas moins incompatible avec la liberté.
Je me rappelle avoir lu dans ma jeunesse une de ces sentences si familières à M. Guizot, alors simple professeur suppléant. Pour justifier les lourds budgets, qui semblent les corollaires obligés des monarchies constitutionnelles, il disait : La liberté est un bien si précieux qu’un peuple ne doit jamais la marchander. Dès ce jour, je me dis : M. Guizot peut avoir des facultés éminentes, mais ce serait assurément un pitoyable homme d’État.
En effet, la liberté est un bien très-précieux et qu’un peuple ne saurait payer trop cher. Mais la question est précisément de savoir si un peuple surtaxé peut être libre, s’il n’y a pas incompatibilité radicale entre la liberté et l’exagération de l’impôt.
Or, j’affirme que cette incompatibilité est radicale.
Remarquons, en effet, que la fonction publique n’agit pas sur les choses, mais sur les hommes ; et elle agit sur eux avec autorité. Or l’action que certains hommes exercent sur d’autres hommes, avec l’appui de la loi et de la force publique, ne saurait jamais être neutre. Elle est essentiellement nuisible, si elle n’est pas essentiellement utile.
Le service de fonctionnaire public n’est pas de ceux dont on débat le prix, qu’on est maître d’accepter ou de refuser. Par sa nature, il est imposé. Quand un peuple ne peut faire mieux que de confier un service à la force publique, comme lorsqu’il s’agit de sécurité, d’indépendance nationale, de répression des délits et des crimes, il faut bien qu’il crée cette autorité et s’y soumette.
Mais s’il fait passer dans le service public ce qui aurait fort bien pu rester dans le domaine des services privés, il s’ôte la faculté de débattre le sacrifice qu’il veut faire en échange de ces services, il se prive du droit de les refuser ; il diminue la sphère de sa liberté.
On ne peut multiplier les fonctionnaires sans multiplier les fonctions. Ce serait trop criant. Or, multiplier les fonctions, c’est multiplier les atteintes à la liberté.
Comment un monarque peut-il confisquer la liberté des cultes ? En ayant un clergé à gages.
Comment peut-il confisquer la liberté de l’enseignement ? En ayant une université à gages.
Que propose-t-on aujourd’hui ? De faire le commerce et les transports par des fonctionnaires publics. Si ce plan se réalise, nous payerons plus d’impôts, et nous seront moins libres.
Vous voyez donc bien que, sous des apparences philanthropiques, le système qu’on préconise aujourd’hui est illusoire, injuste, qu’il détruit la sécurité, qu’il nuit à la formation des capitaux et, par là, à l’accroissement des salaires, enfin, qu’il porte atteinte à la liberté des citoyens.
Je pourrais lui adresser bien d’autres reproches. Il me serait facile de prouver qu’il est un obstacle insurmontable à tout progrès, parce qu’il paralyse le ressort même du progrès, la vigilance de l’intérêt privé.
Quels sont les modes d’activité humaine qui offrent le spectacle de la stagnation la plus complète ? Ne sont-ce pas précisément ceux qui sont confiés aux services publics ? Voyez l’enseignement. Il en est encore où il en était au moyen âge. Il n’est pas sorti de l’étude de deux langues mortes, étude si rationnelle autrefois, et si irrationnelle aujourd’hui. Non-seulement on enseigne les mêmes choses, mais on les enseigne par les mêmes méthodes. Quelle industrie, excepté celle-là, en est restée où elle en était il y a cinq siècles ?
Je pourrais accuser aussi l’exagération de l’impôt et la multiplication des fonctions de développer cette ardeur effrénée pour les places qui, en elle-même et par ses conséquences, est la plus grande plaie des temps modernes. Mais l’espace me manque, et je confie ces considérations à la sagacité du lecteur.
Je ne puis m’empêcher, cependant, de considérer la question au point de vue de la situation particulière où la révolution de Février a placé la France.
Je n’hésite pas à le dire : si le bon sens du peuple, si le bon sens des ouvriers ne fait pas bonne et prompte justice des folles et chimériques espérances que, dans une soif désordonnée de popularité, on a jetées au milieu d’eux, ces espérances déçues seront la fatalité de la République.
Or elles seront déçues, parce qu’elles sont chimériques. Je l’ai prouvé. On a promis ce qu’il est matériellement impossible de tenir.
Quelle est notre situation ? En mourant, la monarchie constitutionnelle nous laisse pour héritage une dette dont l’intérêt seul grève nos finances d’un fardeau annuel de trois cents millions, sans compter une somme égale de dette flottante.
Elle nous laisse l’Algérie, qui nous coûtera pendant longtemps cent millions par an.
Sans nous attaquer, sans même nous menacer, les rois absolus de l’Europe n’ont qu’à maintenir leurs forces militaires actuelles pour nous forcer à conserver les nôtres. De ce chef, c’est cinq à six cents millions à inscrire au budget de la guerre et de la marine.
Enfin, il reste tous les services publics, tous les frais de perception, tous les travaux d’utilité nationale.
Faites le compte, arrangez les chiffres comme vous voudrez, et vous verrez que le budget des dépenses est inévitablement énorme.
Il est à présumer que les sources ordinaires des recettes seront moins productives, dès la première année de la révolution. Supposez que le déficit qu’elles présenteront soit compensé par la suppression des sinécures et le retranchement des fonctions parasites.
Le résultat forcé n’en est pas moins qu’il est déjà bien difficile de donner actuellement satisfaction au contribuable.
Et c’est dans ce moment que l’on jette au milieu du peuple le vain espoir qu’il peut, lui aussi, puiser la vie dans ce même trésor, qu’il alimente de sa propre vie !
C’est dans ce moment, où l’industrie, le commerce, le capital et le travail auraient besoin de sécurité et de liberté pour élargir la source des impôts et des salaires, c’est dans ce moment que vous suspendez sur leur tête la menace d’une foule de combinaisons arbitraires, d’institutions mal digérées, mal conçues, de plans d’organisation éclos dans le cerveau de publicistes, pour la plupart étrangers à cette matière !
Mais qu’arrivera-t-il, au jour de la déception, et ce jour doit nécessairement arriver ?
Qu’arrivera-t-il quand l’ouvrier s’apercevra que le travail fourni par l’État n’est pas un travail ajouté à celui du pays, mais soustrait par l’impôt sur un point pour être versé par la charité sur un autre, avec toute la diminution qu’implique la création d’administrations nouvelles ?
Qu’arrivera-t-il quand vous serez réduit à venir dire au contribuable : Nous ne pouvons toucher ni à l’impôt du sel, ni à l’octroi, ni à la taxe sur les boissons, ni à aucune des inventions fiscales les plus impopulaires ; bien loin de là, nous sommes forcés d’en imaginer de nouvelles ?
Qu’arrivera-t-il quand la prétention d’accroître forcément la masse des salaires, abstraction faite d’un accroissement correspondant de capital (ce qui implique la contradiction la plus manifeste), aura désorganisé tous les ateliers, sous prétexte d’organisation, et forcé peut-être le capital à chercher ailleurs l’air vivifiant de la liberté ?
Je ne veux pas m’appesantir sur les conséquences. Il me suffit d’avoir signalé le danger tel que je le vois.
Mais quoi ! dira-t-on, après la grande révolution de Février, n’y avait-il donc rien à faire ? n’y avait-il aucune satisfaction à donner au peuple ? Fallait-il laisser les choses précisément au point où elles étaient avant ? N’y avait-il aucune souffrance à soulager ?
Telle n’est pas notre pensée.
Selon nous, l’accroissement des salaires ne dépend ni des intentions bienveillantes, ni des décrets philanthropiques. Il dépend, et il dépend uniquement de l’accroissement du capital. Quand dans un pays, comme aux États-Unis, le capital se forme rapidement, les salaires haussent et le peuple est heureux.
Or, pour que les capitaux se forment, il faut deux choses : sécurité et liberté. Il faut de plus qu’ils ne soient pas ravis à mesure par l’impôt.
C’est là, ce nous semble, qu’étaient la règle de conduite et les devoirs du gouvernement.
Les combinaisons nouvelles, les arrangements, les organisations, les associations devaient être abandonnés au bon sens, à l’expérience et à l’initiative des citoyens. Ce sont choses qui ne se font pas à coups de taxes et de décrets.
Pourvoir à la sécurité universelle en rassurant les fonctionnaires paisibles, et, par le choix éclairé des fonctionnaires nouveaux, fonder la vraie liberté par la destruction des priviléges et des monopoles, laisser librement entrer les subsistances et les objets les plus nécessaires au travail, se créer, sans frais, des ressources par l’abaissement des droits exagérés et l’abolition de la prohibition, simplifier tous les rouages administratifs, tailler en plein drap dans la bureaucratie, supprimer les fonctions parasites, réduire les gros traitements, négocier immédiatement avec les puissances étrangères la réduction des armées, abolir l’octroi et l’impôt sur le sel, et remanier profondément l’impôt des boissons, créer une taxe somptuaire, telle est, ce me semble, la mission d’un gouvernement populaire, telle est la mission de notre république.
Sous un tel régime d’ordre, de sécurité et de liberté, on verrait les capitaux se former et vivifier toutes les branches d’industrie, le commerce s’étendre, l’agriculture progresser, le travail recevoir une active impulsion, la main-d’œuvre recherchée et bien rétribuée, les salaires profiter de la concurrence des capitaux de plus en plus abondants, et toutes ces forces vives de la nation, actuellement absorbées par des administrations inutiles ou nuisibles, tourner à l’avantage physique, intellectuel et moral du peuple tout entier.
Profession de foi électorale de 1848 [22 mars 1848] [CW1.2.2]↩
BWV
1848.03.22 “Profession de foi électorale de 1848. Aux électeurs des Landes
Mugron, 22 mars 1848” (Statement of Electoral Principles. To the Electors of Les Landes, 22 March, 1848) [OC1.16, p. 506] [CW1]
Profession de foi électorale de 1848
Aux électeurs des Landes
Mugron, 22 mars 1848.
Mes chers concitoyens,
Vous allez confier à des représentants de votre choix les destinées de la France, celles du monde peut-être, et je n’ai pas besoin de dire combien je me trouverai honoré si vous me jugez digne de votre confiance.
Vous ne pouvez attendre que j’expose ici mes vues sur les travaux si nombreux et si graves qui doivent occuper l’assemblée nationale ; vous trouverez, j’espère, dans mon passé, quelques garanties de l’avenir. Je suis prêt d’ailleurs à répondre, par la voie des journaux ou dans des réunions publiques, aux questions qui me seraient adressées.
Voici dans quel esprit j’appuierai de tout mon dévouement la République :
Guerre à tous les abus : un peuple enlacé dans les liens du privilége, de la bureaucratie et de la fiscalité, est comme un arbre rongé de plantes parasites.
Protection à tous les droits : ceux de la Conscience comme ceux de l’Intelligence ; ceux de la Propriété comme ceux du Travail ; ceux de la Famille comme ceux de la Commune ; ceux de la Patrie comme ceux de l’Humanité. Je n’ai d’autre idéal que la Justice universelle ; d’autre devise que celle de notre drapeau : Liberté, Égalité, Fraternité.
Votre dévoué compatriote…
Lettre à un ecclésiastique [28 mars 1848] [CW1.4.20]↩
BWV
1848.03.28 “Lettre à un ecclésiastique” (Letter to a Member of the Church) [Mugron, 28 March 1848] [*L’Économiste belge*,14 January 1860] [OC7.78, p. 351] [CW1]
Lettre à un ecclésiastique [147]
Mugron, 28 mars 1848.
Monsieur et honoré compatriote,
En arrivant de Bayonne, j’ai trouvé votre lettre du 22, par laquelle vous me faites savoir que vous subordonnez votre suffrage en ma faveur à une question que vous m’adressez. En même temps, on me met à la même épreuve dans le Maransin.
Je serais un singulier représentant si j’entrais à l’Assemblée nationale après et pour avoir renié la liberté commerciale et la liberté religieuse. Il ne me manquerait plus que d’abandonner aussi la liberté d’enseignement pour me concilier certains votes. En tout cas, mon cher monsieur, je vous remercie d’avoir cru à la sincérité de ma réponse. Vous désirez connaître mon opinion sur le traitement alloué au clergé ; je ne dois pas déguiser ma pensée même pour m’attirer des suffrages dont je pourrais à bon droit m’honorer.
Il est vrai que j’ai écrit que chacun devrait concourir librement à soutenir le culte qu’il professe ; cette opinion, je l’ai exprimée et je la soutiendrai comme publiciste et comme législateur, sans entêtement cependant, et jusqu’à ce que de bonnes raisons me fassent changer. Ainsi que je l’ai dit dans ma profession de foi, [148] mon idéal c’est la justice universelle. Les rapports de l’Église et de l’État ne me semblent pas fondés actuellement sur la justice : d’une part on force les catholiques à salarier les cultes protestant et judaïque, avant peu vous payerez peut-être l’abbé Châtel, — cela peut froisser quelques consciences ; d’un autre côté, l’État se prévaut de ce qu’il dispose de votre budget pour intervenir dans les affaires du clergé ou pour y exercer une influence que je n’admets pas. Il est pour quelque chose dans la nomination des évêques, des chanoines, des curés de canton ; et certes la république peut prendre une direction telle, que ce joug ne vous plaira plus. Cela me paraît contraire à la liberté et multiplie entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle de dangereux points de contact.
En outre, j’ai foi dans une fusion future entre toutes les religions chrétiennes, ou, si vous voulez, dans l’absorption des sectes dissidentes par le catholicisme. Mais pour cela il ne faut pas que les Églises soient des institutions politiques. Vous ne pouvez nier que le rôle attribué à Victoria, dans la religion anglicane, et à Nicolas, dans la religion russe, ne soit un grand obstacle à la réunion de tout le troupeau sous un même pasteur.
Quant à l’objection tirée de la situation où placerait trente mille prêtres une mesure telle que la suppression de leur traitement par l’État, vous raisonnez, je crois, dans l’hypothèse où elle serait prise violemment et non dans un esprit de charité. Dans ma pensée, elle implique l’indépendance absolue du clergé ; et, en outre, en la décrétant, on devrait tenir compte du traité intervenu en 89, et que vous rappelez.
Il me faudrait un volume pour développer ma thèse ; mais après avoir aussi franchement exprimé ma manière de voir et réservé toute mon indépendance comme législateur et comme publiciste, j’espère que vous ne révoquerez pas en doute la sincérité de ce qu’il me reste à vous dire.
Je crois que la réforme dont je vous entretiens doit être et sera, pendant bien des années encore, peut-être pendant bien des générations, matière à discussion plutôt que matière à législation. La prochaine Assemblée nationale aura simplement pour mission de concilier les esprits, de rassurer les consciences ; et je ne pense pas qu’elle veuille soulever, et encore moins résoudre, dans un sens contraire à l’opinion des masses, la question que vous me soumettez.
Considérez, en effet, qu’alors même que mon opinion serait la vérité, elle n’est professée que par un bien petit nombre d’hommes ; si elle triomphait maintenant dans l’enceinte législative, ce ne pourrait être sans alarmer et jeter dans l’opposition la presque totalité de la nation. C’est donc, pour ceux qui pensent comme moi, une croyance à défendre et propager, non une mesure de réalisation immédiate.
Je diffère de bien d’autres en ceci que je ne me crois pas infaillible ; je suis tellement frappé de l’infirmité native de la raison individuelle que je ne cherche ni ne chercherai jamais à imposer mes systèmes. Je les expose, les développe, et, pour la réalisation, j’attends que la raison publique se prononce. S’ils sont justes, ce temps arrivera certainement ; s’ils sont erronés, ils mourront avant moi. J’ai toujours pensé qu’aucune réforme ne pouvait être considérée comme mûre, ayant de profondes racines, en un mot, comme utile, que lorsqu’un long débat lui avait concilié l’opinion des masses.
C’est sur ce principe que j’ai agi relativement à la liberté commerciale. Je ne me suis pas adressé au pouvoir, mais au public et me suis efforcé de le ramener à mon avis. Je considérerais la liberté commerciale comme un présent funeste si elle était décrétée avant que la raison publique la réclame. Je vous jure sur mon honneur que si j’étais sorti des barricades membre du gouvernement provisoire, avec une dictature illimitée, je n’en aurais pas profité, à l’exemple de Louis Blanc, pour imposer à mes concitoyens mes vues personnelles. La raison en est simple : c’est qu’à mes yeux une réforme ainsi introduite par surprise n’a aucun fondement solide et succombe à la première occasion. Il en est de même de la question que vous me proposez. Cela dépendrait de moi que je n’accomplirais pas violemment la séparation de l’Église et de l’État ; non que cette séparation ne me paraisse bonne en soi, mais parce que l’opinion publique, qui est la reine du monde, selon Pascal, la repousse encore. C’est cette opinion qu’il faut conquérir. Sur cette question et sur quelques autres, il ne m’en coûtera pas de rester toute ma vie peut-être dans une imperceptible minorité. Un jour viendra, je le crois, où le clergé lui-même sentira le besoin, par une nouvelle transaction avec l’État, de reconquérir son indépendance.
En attendant, j’espère que mon opinion, qu’on peut considérer comme purement spéculative, et qui, en tout cas, est bien loin d’être hostile à la religion, ne me fera pas perdre l’honneur de votre suffrage. Si cependant vous croyez devoir me le retirer, je ne regretterai pas pour cela de vous avoir répondu sincèrement.
Votre dévoué compatriote, etc.
Propriété et loi [15 May 1848] [CW2.4]↩
BWV
1848.05.15 “Propriété et loi” (Property and Law)] [*Journal des Économistes*, 15 May 1848] [OC4.13, p. 275] [CW2]
Source
OC vol. 4 Sophismes économiques — Petits pamphlets, I (1863 ed.): <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_4.djvu>.
La confiance de mes concitoyens m’a revêtu du titre de législateur.
Ce titre, je l’aurais certes décliné, si je l’avais compris comme faisait Rousseau.
« Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple, dit-il, doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu qui, par lui-même, est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être ; d’altérer la constitution physique de l’homme pour la renforcer, etc., etc… S’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. »
Rousseau, étant convaincu que l’état social était d’invention humaine, devait placer très-haut la loi et le législateur. Entre le législateur et le reste des hommes, il voyait la distance ou plutôt l’abîme qui sépare le mécanicien de la matière inerte dont la machine est composée.
Selon lui, la loi devait transformer les personnes, créer ou ne créer pas la propriété. Selon moi, la société, les personnes et les propriétés existent antérieurement aux lois, et, pour me renfermer dans un sujet spécial, je dirai : Ce n’est pas parce qu’il y a des lois qu’il y a des propriétés, mais parce qu’il y a des propriétés qu’il y a des lois.
L’opposition de ces deux systèmes est radicale. Les conséquences qui en dérivent vont s’éloignant sans cesse ; qu’il me soit donc permis de bien préciser la question.
J’avertis d’abord que je prends le mot propriété dans le sens général, et non au sens restreint de propriété foncière. Je regrette, et probablement tous les économistes regrettent avec moi, que ce mot réveille involontairement en nous l’idée de la possession du sol. J’entends par propriété le droit qu’a le travailleur sur la valeur qu’il a créée par son travail.
Cela posé, je me demande si ce droit est de création légale, ou s’il n’est pas au contraire antérieur et supérieur à la loi ? S’il a fallu que la loi vint donner naissance au droit de propriété, ou si, au contraire, la propriété était un fait et un droit préexistants qui ont donné naissance à la loi ? Dans le premier cas, le législateur a pour mission d’organiser, modifier, supprimer même la propriété, s’il le trouve bon ; dans le second, ses attributions se bornent à la garantir, à la faire respecter.
Dans le préambule d’un projet de constitution publié par un des plus grands penseurs des temps modernes, M. Lamennais, je lis ces mots :
« Le peuple français déclare qu’il reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs à toutes les lois positives et indépendants d’elles.
Ces droits et ces devoirs, directement émanés de Dieu, se résument dans le triple dogme qu’expriment ces mots sacrés : Égalité, Liberté, Fraternité. »
Je me demande si le droit de Propriété n’est pas un de ceux qui, bien loin de dériver de la loi positive, précédent la loi et sont sa raison d’être ?
Ce n’est pas, comme on pourrait le croire, une question subtile et oiseuse. Elle est immense, elle est fondamentale. Sa solution intéresse au plus haut degré la société, et l’on en sera convaincu, j’espère, quand j’aurai comparé, dans leur origine et par leurs effets, les deux systèmes en présence.
Les économistes pensent que la Propriété est un fait providentiel comme la Personne. Le Code ne donne pas l’existence à l’une plus qu’à l’autre. La Propriété est une conséquence nécessaire de la constitution de l’homme.
Dans la force du mot, l’homme naît propriétaire, parce qu’il naît avec des besoins dont la satisfaction est indispensable à la vie, avec des organes et des facultés dont l’exercice est indispensable à la satisfaction de ces besoins. Les facultés ne sont que le prolongement de la personne ; la propriété n’est que le prolongement des facultés. Séparer l’homme de ses facultés, c’est le faire mourir ; séparer l’homme du produit de ses facultés, c’est encore le faire mourir.
Il y a des publicistes qui se préoccupent beaucoup de savoir comment Dieu aurait dû faire l’homme : pour nous, nous étudions l’homme tel que Dieu l’a fait ; nous constatons qu’il ne peut vivre sans pourvoir à ses besoins ; qu’il ne peut pourvoir à ses besoins sans travail, et qu’il ne peut travailler s’il n’est pas SÛR d’appliquer à ses besoins le fruit de son travail.
Voilà pourquoi nous pensons que la Propriété est d’institution divine, et que c’est sa sûreté ou sa sécurité qui est l’objet de la loi humaine.
Il est si vrai que la Propriété est antérieure à la loi, qu’elle est reconnue même parmi les sauvages qui n’ont pas de lois, ou du moins de lois écrites. Quand un sauvage a consacré son travail à se construire une hutte, personne ne lui en dispute la possession ou la Propriété. Sans doute un autre sauvage plus vigoureux peut l’en chasser, mais ce n’est pas sans indigner et alarmer la tribu tout entière. C’est même cet abus de la force qui donne naissance à l’association, à la convention, à la loi, qui met la force publique au service de la Propriété. Donc la Loi naît de la Propriété, bien loin que la Propriété naisse de la Loi.
On peut dire que le principe de la propriété est reconnu jusque parmi les animaux. L’hirondelle soigne paisiblement sa jeune famille dans le nid qu’elle a construit par ses efforts.
La plante même vit et se développe par assimilation, par appropriation. Elle s’approprie les substances, les gaz, les sels qui sont à sa portée. Il suffirait d’interrompre ce phénomène pour la faire dessécher et périr.
De même l’homme vit et se développe par appropriation. L’appropriation est un phénomène naturel, providentiel, essentiel à la vie, et la propriété n’est que l’appropriation devenue un droit par le travail. Quand le travail a rendu assimilables, appropriables des substances qui ne l’étaient pas, je ne vois vraiment pas comment on pourrait prétendre que, de droit, le phénomène de l’appropriation doit s’accomplir au profit d’un autre individu que celui qui a exécuté le travail.
C’est en raison de ces faits primordiaux, conséquences nécessaires de la constitution même de l’homme, que la Loi intervient. Comme l’aspiration vers la vie et le développement peut porter l’homme fort à dépouiller l’homme faible, et à violer ainsi le droit du travail, il a été convenu que la force de tous serait consacrée à prévenir et réprimer la violence. La mission de la Loi est donc de faire respecter la Propriété. Ce n’est pas la Propriété qui est conventionnelle, mais la Loi.
Recherchons maintenant l’origine du système opposé.
Toutes nos constitutions passées proclament que la Propriété est sacrée, ce qui semble assigner pour but à l’association commune le libre développement, soit des individualités, soit des associations particulières, par le travail. Ceci implique que la Propriété est un droit antérieur à la Loi, puisque la Loi n’aurait pour objet que de garantir la Propriété.
Mais je me demande si cette déclaration n’a pas été introduite dans nos chartes pour ainsi dire instinctivement, à titre de phraséologie, de lettre morte, et si surtout elle est au fond de toutes les convictions sociales ?
Or, s’il est vrai, comme on l’a dit, que la littérature soit l’expression de la société, il est permis de concevoir des doutes à cet égard ; car jamais, certes, les publicistes, après avoir respectueusement salué le principe de la propriété, n’ont autant invoqué l’intervention de la loi, non pour faire respecter la Propriété, mais pour modifier, altérer, transformer, équilibrer, pondérer, et organiser la propriété, le crédit et le travail.
Or, ceci suppose qu’on attribue à la Loi, et par suite au Législateur, une puissance absolue sur les personnes et les propriétés.
Nous pouvons en être affligés, nous ne devons pas en être surpris.
Où puisons-nous nos idées sur ces matières et jusqu’à la notion du Droit ? Dans les livres latins, dans le Droit romain.
Je n’ai pas fait mon Droit, mais il me suffit de savoir que c’est là la source de nos théories, pour affirmer qu’elles sont fausses. Les Romains devaient considérer la Propriété comme un fait purement conventionnel, comme un produit, comme une création artificielle de la Loi écrite. Évidemment, ils ne pouvaient, ainsi que le fait l’économie politique, remonter jusqu’à la constitution même de l’homme, et apercevoir le rapport et l’enchaînement nécessaire qui existent entre ces phénomènes : besoins, facultés, travail, propriété. C’eût été un contre-sens et un suicide. Comment eux, qui vivaient de rapine, dont toutes les propriétés étaient le fruit de la spoliation, qui avaient fondé leurs moyens d’existence sur le labeur des esclaves, comment auraient-ils pu, sans ébranler les fondements de leur société, introduire dans la législation cette pensée, que le vrai titre de la propriété, c’est le travail qui l’a produite ? Non, ils ne pouvaient ni le dire, ni le penser. Ils devaient avoir recours à cette définition empirique de la propriété, jus utendi et abutendi, définition qui n’a de relation qu’avec les effets, et non avec les causes, non avec les origines ; car les origines, ils étaient bien forcés de les tenir dans l’ombre.
Il est triste de penser que la science du Droit, chez nous, au dix-neuvième siècle, en est encore aux idées que la présence de l’Esclavage avait dû susciter dans l’antiquité ; mais cela s’explique. L’enseignement du Droit est monopolisé en France, et le monopole exclut le progrès.
Il est vrai que les juristes ne font pas toute l’opinion publique ; mais il faut dire que l’éducation universitaire et cléricale prépare merveilleusement la jeunesse française à recevoir, sur ces matières, les fausses notions des juristes, puisque, comme pour mieux s’en assurer, elle nous plonge tous, pendant les dix plus belles années de notre vie, dans cette atmosphère de guerre et d’esclavage qui enveloppait et pénétrait la société romaine.
Ne soyons donc pas surpris de voir se reproduire, dans le dix-huitième siècle, cette idée romaine que la propriété est un fait conventionnel et d’institution légale ; que, bien loin que la Loi soit un corollaire de la Propriété, c’est la Propriété qui est un corollaire de la Loi. On sait que, selon Rousseau, non-seulement la propriété, mais la société tout entière était le résultat d’un contrat, d’une invention née dans la tête du Législateur.
« L’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature. Il est donc fondé sur les conventions. »
Ainsi le droit qui sert de base à tous les autres est purement conventionnel. Donc la propriété, qui est un droit postérieur, est conventionnelle aussi. Elle ne vient pas de la nature.
Robespierre était imbu des idées de Rousseau. Dans ce que dit l’élève sur la propriété, on reconnaîtra les théories et jusqu’aux formes oratoires du maître.
« Citoyens, je vous proposerai d’abord quelques articles nécessaires pour compléter votre théorie de la propriété. Que ce mot n’alarme personne. Âmes de boue, qui n’estimez que l’or, je ne veux pas toucher à vos trésors, quelque impure qu’en soit la source… Pour moi, j’aimerais mieux être né dans la cabane de Fabricius que dans le palais de Lucullus, etc., etc. »
Je ferai observer ici que, lorsqu’on analyse la notion de propriété, il est irrationnel et dangereux de faire de ce mot le synonyme d’opulence, et surtout d’opulence mal acquise. La chaumière de Fabricius est une propriété aussi bien que le palais de Lucullus. Mais qu’il me soit permis d’appeler l’attention du lecteur sur la phrase suivante, qui renferme tout le système :
« En définissant la liberté, ce premier besoin de l’homme, le plus sacré des droits qu’il tient de la nature, nous avons dit, avec raison, qu’elle avait pour limite le droit d’autrui. Pourquoi n’avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale, comme si les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes ? »
Après ces préambules, Robespierre établit les principes en ces termes :
« Art, 1er. La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.
Art. 2. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui. »
Ainsi Robespierre met en opposition la Liberté et la Propriété. Ce sont deux droits d’origine différente : l’un vient de la nature, l’autre est d’institution sociale. Le premier est naturel, le second conventionnel.
La limite uniforme que Robespierre pose à ces deux droits aurait dû, ce semble, l’induire à penser qu’ils ont la même source. Soit qu’il s’agisse de liberté ou de propriété, respecter le droit d’autrui, ce n’est pas détruire ou altérer le droit, c’est le reconnaître et le confirmer. C’est précisément parce que la propriété est un droit antérieur à la loi, aussi bien que la liberté, que l’un et l’autre n’existent qu’à la condition de respecter le droit d’autrui, et la loi a pour mission de faire respecter cette limite, ce qui est reconnaître et maintenir le principe même.
Quoi qu’il en soit, il est certain que Robespierre, à l’exemple de Rousseau, considérait la propriété comme une institution sociale, comme une convention. Il ne la rattachait nullement à son véritable titre, qui est le travail. C’est le droit, disait-il, de disposer de la portion de biens garantie par la loi.
Je n’ai pas besoin de rappeler ici qu’à travers Rousseau et Robespierre la notion romaine sur la propriété s’est transmise à toutes nos écoles dites socialistes. On sait que le premier volume de Louis Blanc, sur la Révolution, est un dithyrambe au philosophe de Genève et au chef de la Convention.
Ainsi, cette idée que le droit de propriété est d’institution sociale, qu’il est une invention du législateur, une création de la loi, en d’autres termes, qu’il est inconnu à l’homme dans l’état de nature, cette idée, dis-je, s’est transmise des Romains jusqu’à nous, à travers l’enseignement du droit, les études classiques, les publicistes du dix-huitième siècle, les révolutionnaires de 93, et les modernes organisateurs.
Passons maintenant aux conséquences des deux systèmes que je viens de mettre en opposition, et commençons par le système juriste.
La première est d’ouvrir un champ sans limite à l’imagination des utopistes.
Cela est évident. Une fois qu’on pose en principe que la Propriété tient son existence de la Loi, il y a autant de modes possibles d’organisation du travail, qu’il y a de lois possibles dans la tête des rêveurs. Une fois qu’on pose en principe que le législateur est chargé d’arranger, combiner et pétrir à son gré les personnes et les propriétés, il n’y a pas de bornes aux modes imaginables selon lesquels les personnes et les propriétés pourront être arrangées, combinées et pétries. En ce moment, il y a certainement en circulation, à Paris, plus de cinq cents projets sur l’organisation du travail, sans compter un nombre égal de projets sur l’organisation du crédit. Sans doute ces plans sont contradictoires entre eux, mais tous ont cela de commun qu’ils reposent sur cette pensée : La loi crée le droit de propriété ; le législateur dispose en maître absolu des travailleurs et des fruits du travail.
Parmi ces projets, ceux qui ont le plus attiré l’attention publique sont ceux de Fourier, de Saint-Simon, d’Owen, de Cabet, de Louis Blanc. Mais ce serait folie de croire qu’il n’y a que ces cinq modes possibles d’organisation. Le nombre en est illimité. Chaque matin peut en faire éclore un nouveau, plus séduisant que celui de la veille, et je laisse à penser ce qu’il adviendrait de l’humanité si, alors qu’une de ces inventions lui serait imposée, il s’en révélait tout à coup une autre plus spécieuse. Elle serait réduite à l’alternative ou de changer tous les matins son mode d’existence, ou de persévérer à tout jamais dans une voie reconnue fausse, par cela seul qu’elle y serait une fois entrée.
Une seconde conséquence est d’exciter chez tous les rêveurs la soif du pouvoir. J’imagine une organisation du travail. Exposer mon système et attendre que les hommes l’adoptent s’il est bon, ce serait supposer que le principe d’action est en eux. Mais dans le système que j’examine, le principe d’action réside dans le Législateur. « Le législateur, comme dit Rousseau, doit se sentir de force à transformer la nature humaine. » Donc, ce à quoi je dois aspirer, c’est à devenir législateur afin d’imposer l’ordre social de mon invention.
Il est clair encore que les systèmes qui ont pour base cette idée que le droit de propriété est d’institution sociale, aboutissent tous ou au privilége le plus concentré, ou au communisme le plus intégral, selon les mauvaises ou les bonnes intentions de l’inventeur. S’il a des desseins sinistres, il se servira de la loi pour enrichir quelques-uns aux dépens de tous. S’il obéit à des sentiments philanthropiques, il voudra égaliser le bien-être, et, pour cela, il pensera à stipuler en faveur de chacun une participation légale et uniforme aux produits créés. Reste à savoir si, dans cette donnée, la création des produits est possible.
À cet égard, le Luxembourg nous a présenté récemment un spectacle fort extraordinaire. N’a-t-on pas entendu, en en plein dix-neuvième siècle, quelques jours après la révolution de Février, faite au nom de la liberté, un homme plus qu’un ministre, un membre du gouvernement provisoire, un fonctionnaire revêtu d’une autorité révolutionnaire et illimitée, demander froidement si, dans la répartition des salaires, il était bon d’avoir égard à la force, au talent, à l’activité, à l’habileté de l’ouvrier, c’est-à-dire à la richesse produite ; ou bien si, ne tenant aucun compte de ces vertus personnelles, ni de leur effet utile, il ne vaudrait pas mieux donner à tous désormais une rémunération uniforme ? Question qui revient à celle-ci : Un mètre de drap porté sur le marché par un paresseux se vendra-t-il pour le même prix que deux mètres offerts par un homme laborieux ? Et, chose qui passe toute croyance, cet homme a proclamé qu’il préférait l’uniformité des profits, quel que fût le travail offert en vente, et il a décidé ainsi, dans sa sagesse, que, quoique deux soient deux par nature, ils ne seraient plus qu’un de par la loi.
Voilà où l’on arrive quand on part de ce point que la loi est plus forte que la nature.
L’auditoire, à ce qu’il paraît, a compris que la constitution même de l’homme se révoltait contre un tel arbitraire ; que jamais on ne ferait qu’un mètre de drap donnât droit à la même rémunération que deux mètres. Que s’il en était ainsi, la concurrence qu’on veut anéantir serait remplacée par une autre concurrence mille fois plus funeste ; que chacun ferait à qui travaillerait moins, à qui déploierait la moindre activité, puisque aussi bien, de par la loi, la récompense serait toujours garantie et égale pour tous.
Mais le citoyen Blanc avait prévu l’objection, et, pour prévenir ce doux far-niente, hélas ! si naturel à l’homme, quand le travail n’est pas rémunéré, il a imaginé de faire dresser dans chaque commune un poteau où seraient inscrits les noms des paresseux. Mais il n’a pas dit s’il y aurait des inquisiteurs pour découvrir le péché de paresse, des tribunaux pour le juger, et des gendarmes pour exécuter la sentence. Il est à remarquer que les utopistes ne se préoccupent jamais de l’immense machine gouvernementale, qui peut seule mettre en mouvement leur mécanique légale.
Comme les délégués du Luxembourg se montraient quelque peu incrédules, est apparu le citoyen Vidal, secrétaire du citoyen Blanc, qui a achevé la pensée du maître. À l’exemple de Rousseau, le citoyen Vidal ne se propose rien moins que de changer la nature de l’homme et les lois de la Providence [2].
Il a plu à la Providence de placer dans l’individu les besoins et leurs conséquences, les facultés et leurs conséquences, créant ainsi l’intérêt personnel, autrement dit, l’instinct de la conservation et l’amour du développement comme le grand ressort de l’humanité. M. Vidal va changer tout cela. Il a regardé l’œuvre de Dieu, et il a vu qu’elle n’était pas bonne. En conséquence, partant de ce principe que la loi et le législateur peuvent tout, il va supprimer, par décret, l’intérêt personnel. Il y substitue le point d’honneur.
Ce n’est plus pour vivre, faire vivre et élever leur famille que les hommes travailleront, mais pour obéir au point d’honneur, pour éviter le fatal poteau, comme si ce nouveau mobile n’était pas encore de l’intérêt personnel d’une autre espèce.
M. Vidal cite sans cesse ce que le point d’honneur fait faire aux armées. Mais, hélas ! il faut tout dire, et si l’on veut enrégimenter les travailleurs, qu’on nous dise donc si le Code militaire, avec ses trente cas de peine de mort, deviendra le Code des ouvriers ?
Un effet plus frappant encore du principe funeste que je m’efforce ici de combattre, c’est l’incertitude qu’il tient toujours suspendue, comme l’épée de Damoclès, sur le travail, le capital, le commerce et l’industrie ; et ceci est si grave que j’ose réclamer toute l’attention du lecteur.
Dans un pays, comme aux États-Unis, où l’on place le droit de Propriété au-dessus de la Loi, où la force publique n’a pour mission que de faire respecter ce droit naturel, chacun peut en toute confiance consacrer à la production son capital et ses bras. Il n’a pas à craindre que ses plans et ses combinaisons soient d’un instant à l’autre bouleversés par la puissance législative.
Mais quand, au contraire, posant en principe que ce n’est pas le travail, mais la Loi qui est le fondement de la Propriété, on admet tous les faiseurs d’utopies à imposer leurs combinaisons, d’une manière générale et par l’autorité des décrets, qui ne voit qu’on tourne contre le progrès industriel tout ce que la nature a mis de prévoyance et de prudence dans le cœur de l’homme ?
Quel est en ce moment le hardi spéculateur qui oserait monter une usine ou se livrer à une entreprise ? Hier on décrète qu’il ne sera permis de travailler que pendant un nombre d’heure déterminé. Aujourd’hui on décrète que le salaire de tel genre de travail sera fixé ; qui peut prévoir le décret de demain, celui d’après-demain, ceux des jours suivants ? Une fois que le législateur se place à cette distance incommensurable des autres hommes ; qu’il croit, en toute conscience, pouvoir disposer de leur temps, de leur travail, de leurs transactions, toutes choses qui sont des Propriétés, quel homme, sur la surface du pays, a la moindre connaissance de la position forcée où la Loi le placera demain, lui et sa profession ? Et, dans de telles conditions, qui peut et veut rien entreprendre ?
Je ne nie certes pas que, parmi les innombrables systèmes que ce faux principe fait éclore, un grand nombre, le plus grand nombre même ne partent d’intentions bienveillantes et généreuses. Mais ce qui est redoutable, c’est le principe lui-même. Le but manifeste de chaque combinaison particulière est d’égaliser le bien-être. Mais l’effet plus manifeste encore du principe sur lequel ces combinaisons sont fondées, c’est d’égaliser la misère ; je ne dis pas assez ; c’est de faire descendre aux rangs des misérables les familles aisées, et de décimer par la maladie et l’inanition les familles pauvres.
J’avoue que je suis effrayé pour l’avenir de mon pays, quand je songe à la gravité des difficultés financières que ce dangereux principe vient aggraver encore.
Au 24 février, nous avons trouvé un budget qui dépasse les proportions auxquelles la France peut raisonnablement atteindre ; et, en outre, selon le ministre actuel des finances, pour près d’un milliard de dettes immédiatement exigibles.
À partir de cette situation, déjà si alarmante, les dépenses ont été toujours grandissant, et les recettes diminuant sans cesse.
Ce n’est pas tout. On a jeté au public, avec une prodigalité sans mesure, deux sortes de promesses. Selon les unes, on va le mettre en possession d’une foule innombrable d’institutions bienfaisantes, mais coûteuses. Selon les autres, on va dégrever tous les impôts. Ainsi, d’une part, on va multiplier les crèches, les salles d’asile, les écoles primaires, les écoles secondaires gratuites, les ateliers de travail, les pensions de retraite de l’industrie. On va indemniser les propriétaires d’esclaves, dédommager les esclaves eux-mêmes ; l’État va fonder des institutions de crédit ; prêter aux travailleurs des instruments de travail ; il double l’armée, réorganise la marine, etc., etc., et d’autre part, il supprime l’impôt du sel, l’octroi et toutes les contributions les plus impopulaires.
Certes, quelque idée qu’on se fasse des ressources de la France, on admettra du moins qu’il faut que ces ressources se développent pour faire face à cette double entreprise si gigantesque et, en apparence, si contradictoire.
Mais voici qu’au milieu de ce mouvement extraordinaire, et qu’on pourrait considérer comme au-dessus des forces humaines, même alors que toutes les énergies du pays seraient dirigées vers le travail productif, un cri s’élève : Le droit de propriété est une création de la loi. En conséquence, le législateur peut rendre à chaque instant, et selon les théories systématiques dont il est imbu, des décrets qui bouleversent toutes les combinaisons de l’industrie. Le travailleur n’est pas propriétaire d’une chose ou d’une valeur parce qu’il l’a créée par le travail, mais parce que la loi d’aujourd’hui la lui garantit. La loi de demain peut retirer cette garantie, et alors la propriété n’est plus légitime.
Je le demande, que doit-il arriver ? C’est que le capital et le travail s’épouvantent ; c’est qu’ils ne puissent plus compter sur l’avenir. Le capital, sous le coup d’une telle doctrine, se cachera, désertera, s’anéantira. Et que deviendront alors les ouvriers, ces ouvriers pour qui vous professez une affection si vive, si sincère, mais si peu éclairée ? Seront-ils mieux nourris quand la production agricole sera arrêtée ? Seront-ils mieux vêtus quand nul n’osera fonder une fabrique ? Seront-ils plus occupés quand les capitaux auront disparu ?
Et l’impôt, d’où le tirerez-vous ? Et les finances, comment se rétabliront-elles ? Comment paierez-vous l’armée ? Comment acquitterez-vous vos dettes ? Avec quel argent prêterez-vous les instruments du travail ? Avec quelles ressources soutiendrez-vous ces institutions charitables, si faciles à décréter ?
Je me hâte d’abandonner ces tristes considérations. Il me reste à examiner dans ses conséquences le principe opposé à celui qui prévaut aujourd’hui, le principe économiste, le principe qui fait remonter au travail, et non à la loi, le droit de propriété, le principe qui dit : La Propriété existe avant la Loi ; la loi n’a pour mission que de faire respecter la propriété partout où elle est, partout où elle se forme, de quelque manière que le travailleur la crée, isolément ou par association, pourvu qu’il respecte le droit d’autrui.
D’abord, comme le principe des juristes renferme virtuellement l’esclavage, celui des économistes contient la liberté. La propriété, le droit de jouir du fruit de son travail, le droit de travailler, de se développer, d’exercer ses facultés, comme on l’entend, sans que l’État intervienne autrement que par son action protectrice, c’est la liberté. — Et je ne puis encore comprendre pourquoi les nombreux partisans des systèmes opposés laissent subsister sur le drapeau de la République le mot liberté. On dit que quelques-uns d’entre eux l’ont effacé pour y substituer le mot solidarité. Ceux-là sont plus francs et plus conséquents. Seulement, ils auraient dû dire communisme, et non solidarité ; car la solidarité des intérêts, comme la propriété, existe en dehors de la loi.
Il implique encore l’unité. Nous l’avons déjà vu. Si le législateur crée le droit de propriété, il y a pour la propriété autant de manières d’être qu’il peut y avoir d’erreurs dans les têtes d’utopistes, c’est-à-dire l’infini. Si, au contraire, le droit de propriété est un fait providentiel, antérieur à toute législation humaine, et que la législation humaine a pour but de faire respecter, il n’y a place pour aucun autre système.
C’est encore la sécurité, et ceci est de toute évidence : qu’il soit bien reconnu, au sein d’un peuple, que chacun doit pourvoir à ses moyens d’existence, mais aussi que chacun a aux fruits de son travail un droit antérieur et supérieur à la loi ; que la loi humaine n’a été nécessaire et n’est intervenue que pour garantir à tous la liberté du travail et la propriété de ses fruits, il est bien évident qu’un avenir de sécurité complète s’ouvre devant l’activité humaine. Elle n’a plus à craindre que la puissance législative vienne, décret sur décret, arrêter ses efforts, déranger ses combinaisons, dérouter sa prévoyance. À l’abri de cette sécurité, les capitaux se formeront rapidement. L’accroissement rapide des capitaux, de son côté, est la raison unique de l’accroissement dans la valeur du travail. Les classes ouvrières seront donc dans l’aisance ; elles-mêmes concourront à former de nouveaux capitaux. Elles seront plus en mesure de s’affranchir du salariat, de s’associer aux entreprises, d’en fonder pour leur compte, de reconquérir leur dignité.
Enfin, le principe éternel que l’État ne doit pas être producteur, mais procurer la sécurité aux producteurs, entraîne nécessairement l’économie et l’ordre dans les finances publiques ; par conséquent, seul il rend possible la bonne assiette et la juste répartition de l’impôt.
En effet, l’État, ne l’oublions jamais, n’a pas de ressources qui lui soient propres. Il n’a rien, il ne possède rien qu’il ne le prenne aux travailleurs. Lors donc qu’il s’ingère de tout, il substitue la triste et coûteuse activité de ses agents à l’activité privée. Si, comme aux États-Unis, on en venait à reconnaître que la mission de l’État est de procurer à tous une complète sécurité, cette mission, il pourrait la remplir avec quelques centaines de millions. Grâce à cette économie, combinée avec la prospérité industrielle, il serait enfin possible d’établir l’impôt direct, unique, frappant exclusivement la propriété réalisée de toute nature.
Mais, pour cela, il faut attendre que des expériences, peut-être cruelles, aient diminué quelque peu notre foi dans l’État et augmenté notre foi dans l’Humanité.
Je terminerai par quelques mots sur l’Association du libre-échange. On lui a beaucoup reproché ce titre. Ses adversaires se sont réjouis, ses partisans se sont affligés de ce que les uns et les autres considéraient comme une faute.
« Pourquoi semer ainsi l’alarme ? disaient ces derniers. Pourquoi inscrire sur votre drapeau un principe ? Pourquoi ne pas vous borner à réclamer dans le tarif des douanes ces modifications sages et prudentes que le temps a rendues nécessaires, et dont l’expérience a constaté l’opportunité ? »
Pourquoi ? parce que, à mes yeux du moins, jamais le libre-échange n’a été une question de douane et de tarif, mais une question de droit, de justice, d’ordre public, de Propriété. Parce que le privilége, sous quelque forme qu’il se manifeste, implique la négation ou le mépris de la propriété ; parce que l’intervention de l’État pour niveler les fortunes, pour grossir la part des uns aux dépens des autres, c’est du communisme, comme une goutte d’eau est aussi bien de l’eau que l’Océan tout entier ; parce que je prévoyais que le principe de la propriété, une fois ébranlé sous une forme, ne tarderait pas à être attaqué sous mille formes diverses ; parce que je n’avais pas quitté ma solitude pour poursuivre une modification partielle de tarifs, qui aurait impliqué mon adhésion à cette fausse notion que la loi est antérieure à la propriété, mais pour voler au secours du principe opposé, compromis par le régime protecteur ; parce que j’étais convaincu que les propriétaires fonciers et les capitalistes avaient eux-mêmes déposé, dans le tarif, le germe de ce communisme qui les effraie maintenant, puisqu’ils demandaient à la loi des suppléments de profits, au préjudice des classes ouvrières. Je voyais bien que ces classes ne tarderaient pas à réclamer aussi, en vertu de l’égalité, le bénéfice de la loi appliquée à niveler le bien-être, ce qui est le communisme.
Qu’on lise le premier acte émané de notre Association, le programme rédigé dans une séance préparatoire, le 10 mai 1846 ; on se convaincra que ce fut là notre pensée dominante.
« L’échange est un droit naturel comme la Propriété. Tout citoyen qui a créé ou acquis un produit, doit avoir l’option ou de l’appliquer immédiatement à son usage, ou de le céder à quiconque, sur la surface du globe, consent à lui donner en échange l’objet de ses désirs. Le priver de cette faculté, quand il n’en fait aucun usage contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et uniquement pour satisfaire la convenance d’un autre citoyen, c’est légitimer une spoliation, c’est blesser la loi de justice. »
« C’est encore violer les conditions de l’ordre ; car quel ordre peut exister au sein d’une société où chaque industrie, aidée en cela par la loi et la force publique, cherche ses succès dans l’oppression de toutes les autres ? »
Nous placions tellement la question au-dessus des tarifs que nous ajoutions :
« Les soussignés ne contestent pas à la société le droit d’établir, sur les marchandises qui passent la frontière, des taxes destinées aux dépenses communes, pourvu qu’elles soient déterminées par les besoins du Trésor. »
« Mais sitôt que la taxe, perdant son caractère fiscal, a pour but de repousser le produit étranger, au détriment du fisc lui-même, afin d’exhausser artificiellement le prix du produit national similaire, et de rançonner ainsi la communauté au profit d’une classe, dès ce moment la Protection, ou plutôt la Spoliation se manifeste, et c’est là le principe que l’Association aspire à ruiner dans les esprits et à effacer complétement de nos lois. »
Certes, si nous n’avions poursuivi qu’une modification immédiate des tarifs, si nous avions été, comme on l’a prétendu, les agents de quelques intérêts commerciaux, nous nous serions bien gardés d’inscrire sur notre drapeau un mot qui implique un principe. Croit-on que je n’aie pas pressenti les obstacles que nous susciterait cette déclaration de guerre à l’injustice ? Ne savais-je pas très bien qu’en louvoyant, en cachant le but, en voilant la moitié de notre pensée, nous arriverions plus tôt à telle ou telle conquête partielle ? Mais en quoi ces triomphes, d’ailleurs éphémères, eussent-ils dégagé et sauvegardé le grand principe de la Propriété, que nous aurions nous-mêmes tenu dans l’ombre et mis hors de cause ?
Je le répète, nous demandions l’abolition du régime protecteur, non comme une bonne mesure gouvernementale, mais comme une justice, comme la réalisation de la liberté, comme la conséquence rigoureuse d’un droit supérieur à la loi. Ce que nous voulions au fond, nous ne devions pas le dissimuler dans la forme [3].
Le temps approche où l’on reconnaîtra que nous avons eu raison de ne pas consentir à mettre, dans le titre de notre Association, un leurre, un piége, une surprise, une équivoque, mais la franche expression d’un principe éternel d’ordre et de justice, car il n’y a de puissance que dans les principes ; eux seuls sont le flambeau des intelligences, le point de ralliement des convictions égarées.
Dans ces derniers temps, un tressaillement universel a parcouru, comme un frisson d’effroi, la France tout entière. Au seul mot de communisme, toutes les existences se sont alarmées. En voyant se produire au grand jour et presque officiellement les systèmes les plus étranges, en voyant se succéder des décrets subversifs, qui peuvent être suivis de décrets plus subversifs encore, chacun s’est demandé dans quelle voie nous marchions. Les capitaux se sont effrayés, le crédit a fui, le travail a été suspendu, la scie et le marteau se sont arrêtés au milieu de leur œuvre, comme si un funeste et universel courant électrique eût paralysé tout à coup les intelligences et les bras. Et pourquoi ? Parce que le principe de la propriété, déjà compromis essentiellement par le régime protecteur, a éprouvé de nouvelles secousses, conséquences de la première ; parce que l’intervention de la Loi en matière d’industrie, et comme moyen de pondérer les valeurs et d’équilibrer les richesses, intervention dont le régime protecteur a été la première manifestation, menace de se manifester sous mille formes connues ou inconnues. Oui, je le dis hautement, ce sont les propriétaires fonciers, ceux que l’on considère comme les propriétaires par excellence, qui ont ébranlé le principe de la propriété, puisqu’ils en ont appelé à la loi pour donner à leurs terres et à leurs produits une valeur factice. Ce sont les capitalistes qui ont suggéré l’idée du nivellement des fortunes par la loi. Le protectionisme a été l’avant-coureur du communisme ; je dis plus, il a été sa première manifestation. Car, que demandent aujourd’hui les classes souffrantes ? Elles ne demandent pas autre chose que ce qu’ont demandé et obtenu les capitalistes et les propriétaires fonciers. Elles demandent l’intervention de la loi pour équilibrer, pondérer, égaliser la richesse. Ce qu’ils ont fait par la douane, elles veulent le faire par d’autres institutions ; mais le principe est toujours le même, prendre législativement aux uns pour donner aux autres ; et certes, puisque c’est vous, propriétaires et capitalistes, qui avez fait admettre ce funeste principe, ne vous récriez donc pas si de plus malheureux que vous en réclament le bénéfice. Ils y ont au moins un titre que vous n’aviez pas [4].
Mais on ouvre les yeux enfin, on voit vers quel abîme nous pousse cette première atteinte portée aux conditions essentielles de toute sécurité sociale. N’est-ce pas une terrible leçon, une preuve sensible de cet enchaînement de causes et d’effets, par lequel apparaît à la longue la justice des rétributions providentielles, que de voir aujourd’hui les riches s’épouvanter devant l’envahissement d’une fausse doctrine, dont ils ont eux-mêmes posé les bases iniques, et dont ils croyaient faire paisiblement tourner les conséquences à leur seul profit ? Oui, prohibitionistes, vous avez été les promoteurs du communisme. Oui, propriétaires, vous avez détruit dans les esprits la vraie notion de la Propriété. Cette notion, c’est l’Économie politique qui la donne, et vous avez proscrit l’Économie politique, parce que, au nom du droit de propriété, elle combattait vos injustes priviléges [5]. — Et quand elles ont saisi le pouvoir, quelle a été aussi la première pensée de ces écoles modernes qui vous effraient ? C’est de supprimer l’Économie politique, car la science économique, c’est une protestation perpétuelle contre ce nivellement légal que vous avez recherché et que d’autres recherchent aujourd’hui à votre exemple. Vous avez demandé à la Loi autre chose et plus qu’il ne faut demander à la Loi, autre chose et plus que la Loi ne peut donner. Vous lui avez demandé, non la sécurité (c’eût été votre droit), mais la plus-value de ce qui vous appartient, ce qui ne pouvait vous être accordé sans porter atteinte aux droits d’autrui. Et maintenant, la folie de vos prétentions est devenue la folie universelle. — Et si vous voulez conjurer l’orage qui menace de vous engloutir, il ne vous reste qu’une ressource. Reconnaissez votre erreur ; renoncez à vos priviléges ; faites rentrer la Loi dans ses attributions, renfermez le Législateur dans son rôle. Vous nous avez délaissés, vous nous avez attaqués, parce que vous ne nous compreniez pas sans doute. À l’aspect de l’abîme que vous avez ouvert de vos propres mains, hâtez-vous de vous rallier à nous, dans notre propagande en faveur du droit de propriété, en donnant, je le répète, à ce mot sa signification la plus large, en y comprenant et les facultés de l’homme et tout ce qu’elles parviennent à produire, qu’il s’agisse de travail ou d’échange !
La doctrine que nous défendons excite une certaine défiance, à raison de son extrême simplicité ; elle se borne à demander à la loi sécurité pour tous. On a de la peine à croire que le mécanisme gouvernemental puisse être réduit à ces proportions. De plus, comme cette doctrine renferme la Loi dans les limites de la Justice universelle, on lui reproche d’exclure la Fraternité. L’Économie politique n’accepte pas l’accusation. Ce sera l’objet d’un prochain article.
FN:Article inséré au n° du 15 mai 1848 du Journal des Économistes (Note de l’Éditeur.)
FN:Voy., au tome Ier, le compte rendu de l’ouvrage de M. Vidal sur la Répartition des richesses, et au tome II, la réponse à cinq lettres publiées par M. Vidal dans le journal la Presse. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome Ier, la lettre adressée, dès janvier 1845, à M. de Lamartine sur le Droit au travail.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome II, la réunion des articles sur la question des subsistances et, ci-après, Protectionisme et Communisme.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome V, Spoliation et Loi ; — Guerre aux chaires d’économie politique.(Note de l’éditeur.)
*Jacques Bonhomme* [11 June to 13 July, 1848]↩
[*Jacques Bonhomme*. Editor J. Lobet. Founded by Bastiat with Gustave de Molinari, Charles Coquelin, Alcide Fonteyraud, and Joseph Garnier. It appeared approximately weekly with 4 issues between 11 June to 13 July; with a break between 24 June and 9 July because of the rioting during the June Days uprising.]
ToC↩
1848.06.11 “La liberté” (On Liberty) [*Jacques Bonhomme*, 11-15 June 1848] [OC7.56, p. 235] [CW1.4.9]
1848.06.11 “Laissez-Faire” (Laissez-faire) [*Jacques Bonhomme*, 11-15 June 1848] [OC7.57, p. 237] [CW1.4.10]
1848.06.11-15 “L’Assemblée Nationale” (The National Assembly) [*Jacques Bonhomme*, 11-15 June 1848] [OC7.58, p. 237] [CW1.4.17]
1848.06.11-15 “L’État” (The State (draft)) [*Jacques Bonhomme*, 11–15 June 1848] [OC7.59, p. 238] [CW2.8]
1848.06.15 "Prendre cinq et rendre quatre ce n'est pas donner" (Taking Five and Returning Four is not Giving) [*Jacques Bonhomme*, issue n° 2, 15 to 18 June 1848] [OC7.60, pp. 240-42]
1848.06.15 "Une mystification" (Trickery and Deceit) [*Jacques Bonhomme*, issue n° 2, 15 to 18 June 1848] [OC7.61, pp. 242-44]
1848.06.20 "Funeste gradation" (A Dreadful Escalation) [*Jacques Bonhomme*, issue n° 3, 20 to 23 June 1848] [OC7.62, pp. 244-46]
1848.06.20-23 “Aux citoyens Lamartine et Ledru-Rollin” (To Citizens Lamartine and Ledru-Rollin) [*Jacques Bonhomme*, 20-23 June 1848.] [OC7.63, p. 246] [CW1.4.15]
La liberté [11-15 June 1848] [CW1.4.9]↩
BWV
1848.06.11 “La liberté” (On Liberty) [*Jacques Bonhomme*, 11-15 June 1848] [OC7.56, p. 235] [CW1]
56. La liberté [149]
J’ai beaucoup vécu, beaucoup vu, observé, comparé, étudié, et je sais arrivé à cette conclusion :
Nos pères avaient raison de vouloir être libres, et nous devons le vouloir aussi.
Ce n’est pas que la liberté n’ait des inconvénients ; tout en a. Arguer contre elle de ces inconvénients, c’est dire à un homme qui est dans le bourbier : N’en sortez pas, car vous ne le pouvez sans quelque effort.
Ainsi il serait à souhaiter qu’il n’y eût qu’une foi dans le monde, pourvu que ce fût la vraie. Mais où est l’autorité infaillible qui nous l’imposera ? En attendant qu’elle se montre, maintenons la liberté d’examen et de conscience.
Il serait heureux que le meilleur mode d’enseignement fût universellement adopté. Mais qui le possède, et où est son titre ? Réclamons donc la liberté d’enseignement.
On peut s’affliger de voir des écrivains se complaire à remuer toutes les mauvaises passions. Mais entraver la presse, c’est entraver la vérité aussi bien que le mensonge. Ne laissons donc jamais périr la liberté de la presse.
C’est une chose fâcheuse que l’homme soit réduit à gagner son pain à la sueur de son front. Il vaudrait mieux que l’État nourrît tout le monde ; mais c’est impossible. Ayons du moins la liberté du travail.
En s’associant, les hommes peuvent tirer un plus grand parti de leurs forces. Mais les formes de l’association sont infinies ; quelle est la meilleure ? Ne courons pas la chance que l’État nous impose la plus mauvaise, cherchons à tâtons la bonne et réclamons la liberté d’association.
Un peuple a deux manières de se procurer une chose : la première, c’est de la faire ; la seconde, c’est d’en faire une autre et de la troquer. Il vaut certainement mieux avoir l’option que de ne l’avoir pas. Exigeons donc la liberté de l’échange.
Je me mêle aux débats publics, je m’efforce de pénétrer dans la foule pour prêcher toutes les libertés dont l’ensemble forme la liberté.
Laissez-Faire [11 au 15 juin 1848] [CW1.4.10]↩
BWV
1848.06.11 “Laissez-Faire” (Laissez-faire) [*Jacques Bonhomme*, 11-15 June 1848] [OC7.57, p. 237] [CW1]
Source
1er numéro du Jacques Bonhomme, du 11 au 15 juin 1848
57. Laissez faire [150]
Laissez faire ! — Je commence par dire, pour prévenir tonte équivoque, que laissez faire s’applique ici aux choses honnêtes, l’État étant institué précisément pour empêcher les choses déshonnêtes.
Cela posé, et quant aux choses innocentes par elles-mêmes, comme le travail, l’échange, l’enseignement, l’association, la banque, etc., il faut pourtant opter. Il faut que l’État laisse faire ou empêche de faire.
S’il laisse faire, nous serons libres et économiquement administrés, rien ne coûtant moins que de laisser faire.
S’il empêche de faire, malheur à notre liberté et à notre bourse. À notre liberté, puisqu’empêcher c’est lier les bras : à notre bourse, car pour empêcher, il faut des agents, et pour avoir des agents, il faut de l’argent.
À cela les socialistes disent : Laissez faire ! mais c’est une horreur ! — Et pourquoi, s’il vous plaît? — Parce que, quand on les laisse faire, les hommes font mal et agissent contre leurs intérêts. Il est bon que l’État les dirige.
Voilà qui est plaisant. Quoi ! vous avez une telle foi dans la sagacité humaine que vous voulez le suffrage universel et le gouvernement de tous par tous ; et puis, ces mêmes hommes que vous jugez aptes à gouverner les autres, vous les proclamez inaptes à se gouverner eux-mêmes !
L'Assemblée Nationale [11-15 June 1848] [CW1.4.17]↩
BWV
1848.06.11-15 “L’Assemblée Nationale” (The National Assembly) [*Jacques Bonhomme*, 11-15 June 1848] [OC7.58, p. 237] [CW1]
58. L’Assemblée Nationale [151]
— Maître Jacques, que pensez-vous de l’Assemblée nationale ?
— Je la crois excellente, bien intentionnée, passionnée pour le bien. Elle est peuple, elle aime le peuple, elle le voudrait heureux et libre. Elle fait honneur au suffrage universel.
— Cependant que d’hésitation ! que de lenteurs ! que d’orages sans causes ! que de temps perdu ! Quels biens a-t-elle réalisés ? quels maux a-t-elle empêchés ? Le peuple souffre, l’industrie s’éteint, le travail s’arrête, le trésor se ruine, et l’Assemblée passe son temps à écouter d’ennuyeuses harangues.
— Que voulez-vous ? L’Assemblée ne peut changer la nature des choses. La nature des choses s’oppose à ce que neuf cents personnes gouvernent avec une volonté ferme, logique et rapide. Aussi voyez comme elle attend un pouvoir qui réfléchisse sa pensée, comme elle est prête à lui donner une majorité compacte de sept cents voix dans le sens des idées démocratiques. Mais ce pouvoir ne surgit pas, et ne peut guère surgir dans le provisoire où nous sommes.
— Que faut-il donc que fasse l’Assemblée ?
— Trois choses : pourvoir à l’urgence, faire la Constitution, et s’en aller.
L'Etat (note) [11–15 June 1848] [CW2.4]↩
BWV
1848.06.11-15 “L’État” (The State (draft)) [*Jacques Bonhomme*, 11–15 June 1848] [OC7.59, p. 238] [CW2]
Source
T.212 “L’État” (The State), Jacques Bonhomme, no. 1, 11-15 June 1848, p. 2. [OC, vol. 7, 59. pp. 238-40.] [CW, vol. 2, pp. 105-6]. First version 376 words. The Institut Coppet has reprinted this essay in Jacques Bonhomme: L’éphémère journal de Frédéric Bastiat et Gustave de Molinari (11 juin – 13 juillet 1848). Recueil de tous les articles, augmenté d’une introduction. Ed. Benoît Malbranque (Paris: Institut Coppet, 2014), pp. 23-25
Il y en a qui disent : C’est un homme de finances qui nous tirera de là, Thiers, Fould, Goudchaux, Girardin. Je crois qu’ils se trompent.
— Qui donc nous en tirera ?
— Le peuple.
— Quand ?
— Quand il aura appris cette leçon : L’État, n’ayant rien qu’il ne l’ait pris au peuple, ne peut pas faire au peuple des largesses.
— Le peuple sait cela, car il ne cesse de demander des réductions de taxes.
— C’est vrai ; mais, en même temps, il ne cesse de demander à l’État, sous toutes les formes, des libéralités.
Il veut que l’État fonde des crèches, des salles d’asile et des écoles gratuites pour la jeunesse ; des ateliers nationaux pour l’âge mûr et des pensions de retraite pour la vieillesse.
Il veut que l’État aille guerroyer en Italie et en Pologne.
Il veut que l’État fonde des colonies agricoles.
Il veut que l’État fasse les chemins de fer.
Il veut que l’État défriche l’Algérie.
Il veut que l’État prête dix milliards aux propriétaires.
Il veut que l’État fournisse le capital aux travailleurs.
Il veut que l’État reboise les montagnes.
Il veut que l’État endigue les rivières.
Il veut que l’État paye des rentes sans en avoir.
Il veut que l’État fasse la loi à l’Europe.
Il veut que l’État favorise l’agriculture.
Il veut que l’État donne des primes à l’industrie.
Il veut que l’État protège le commerce.
Il veut que l’État ait une armée redoutable.
Il veut que l’État ait une marine imposante.
Il veut que l’État…
— Avez-vous tout dit?
— J’en ai encore pour une bonne heure.
— Mais enfin, où en voulez-vous venir ?
— À ceci : tant que le peuple voudra tout cela, il faudra qu’il le paye. Il n’y a pas d’homme de finances qui fasse quelque chose avec rien.
Jacques Bonhomme fonde un prix de cinquante mille (in JB 500,000) francs à décerner à celui qui donnera une bonne définition de ce mot, l’état ; car celui-là sera le sauveur des finances, de l’industrie, du commerce et du travail [2].
Prendre cinq et rendre quatre, ce n'est pas donner. [15 to 18 June 1848]↩
BWV
1848.06.15 "Prendre cinq et rendre quatre ce n'est pas donner" (Taking Five and Returning Four is not Giving) [*Jacques Bonhomme*, issue n° 2, 15 to 18 June 1848] [OC7.60, pp. 240-42]
Prendre cinq et rendre quatre ce n’est pas donner [1]
Là, soyons de bon compte, qu’est-ce que l’État ? N’est-ce pas la collection de tous les fonctionnaires publics ? Il y a donc dans le monde deux espèces d’hommes, savoir : les fonctionnaires de toute sorte qui forment l’État, et les travailleurs de tout genre qui composent la société. Cela posé, sont-ce les fonctionnaires qui font vivre les travailleurs, ou les travailleurs qui font vivre les fonctionnaires ? En d’autres termes, l’État fait-il vivre la société, ou la société fait-elle vivre l’État ?
Je ne suis pas un savant, mais un pauvre diable qui s’appelle Jacques Bonhomme, qui n’est et n’a jamais pu être que travailleur.
Or, en qualité de travailleur, payant l’impôt sur mon pain, sur mon vin, sur ma viande, sur mon sel, sur ma fenêtre, sur ma porte, sur le fer et l’acier de mes outils, sur mon tabac, etc., etc., j’attache une grande importance à cette question et je la répète :
Les fonctionnaires font-ils vivre les travailleurs, ou les travailleurs font-ils vivre les fonctionnaires ?
Vous me demanderez pourquoi j’attache de l’importance à cette question, le voici :
Depuis quelque temps, je remarque une disposition énorme chez tout le monde à demander à l’État des moyens d’existence.
Les agriculteurs lui disent : Donnez-nous des primes, de l’instruction, de meilleures charrues, de plus belles races de bestiaux, etc.
Les manufacturiers : Faites-nous gagner un peu plus sur nos draps, sur nos toiles, sur nos fers.
Les ouvriers : Donnez-nous de l’ouvrage, des salaires et des instruments de travail.
Je trouve ces demandes bien naturelles, et je voudrais bien que l’État pût donner tout ce qu’on exige de lui.
Mais, pour le donner, où le prend-il ? Hélas ! il prend un peu plus sur mon pain, un peu plus sur mon vin, un peu plus sur ma viande, un peu plus sur mon sel, un peu plus sur mon tabac, etc., etc.
En sorte que ce qu’il me donne, il me le prend et ne peut pas ne pas me le prendre. Ne vaudrait-il pas mieux qu’il me donnât moins et me prît moins ?
Car enfin, il ne me donne jamais tout ce qu’il me prend. Même pour prendre et donner, il a besoin d’agents qui gardent une partie de ce qui est pris.
Ne suis-je pas une grande dupe de faire avec l’État le marché suivant ? — J’ai besoin d’ouvrage. Pour m’en faire avoir tu retiendras cinq francs sur mon pain, cinq francs sur mon vin, cinq francs sur mon sel et cinq francs sur mon tabac. Cela fera vingt francs. Tu en garderas six pour vivre et tu me feras une demande d’ouvrage pour quatorze. Évidemment je serai un peu plus pauvre qu’avant ; j’en appellerai à toi pour rétablir mes affaires, et voici ce que tu feras. Tu récidiveras. Tu prélèveras autres cinq francs sur mon pain, autres cinq francs sur mon vin, autres cinq francs sur mon sel, autres cinq francs sur mon tabac ; ce qui fera autres vingt francs. Sur quoi tu mettras autres six francs dans ta poche et me feras gagner autres quatorze francs. Cela fait, je serai encore d’un degré plus misérable. J’aurai de nouveau recours à toi, etc.
Si maladia
Opiniatria 10847.Non vult se guarire, 10848.Quid illi facere ? 10849.— Purgare, saignare, clysterisare,
Repurgare, resaignare, reclysterisare.
Jacques Bonhomme ! Jacques Bonhomme ! J’ai peine à croire que tu aies été assez fou pour te soumettre à ce régime, parce qu’il a plu à quelques écrivailleurs de le baptiser : Organisation et Fraternité.
FN:N° 2 de Jacques Bonhomme, du 15 au 18 juin 1847.
Une mystification [JB, 15 au 18 juin 1848] ↩
BWV
1848.06.15 "Une mystification" (A Hoax) [*Jacques Bonhomme*, issue n° 2, 15 to 18 June 1848] [OC7.61, pp. 242-44]
[N° 2 de Jacques Bonhomme, du 15 au 18 juin 1848.]
Ainsi que vous savez, j’ai beaucoup voyagé et j’ai beaucoup à raconter.
Parcourant un pays lointain, je fus frappé de la triste condition dans laquelle paraissait être le peuple, malgré son activité et la fertilité du territoire.
Pour avoir l’explication de ce phénomène, je m’adressai à un grand ministre, qui s’appelait Budget. Voici ce qu’il me dit :
« J’ai fait faire le dénombrement des ouvriers. Il y en a un a million. Ils se plaignant de n’avoir pas assez de salaire, et j’ai dû m’occuper d’améliorer leur sort.
« D’abord j’imaginai de prélever deux sous sur le salaire quotidien de chaque travailleur. Cela faisait rentrer 100,000 fr. tous les matins dans mes coffres, soit trente millions par an.
« Sur ces trente millions, j’en retenais dix pour moi et mes agents.
« Ensuite je disais aux ouvriers : il me reste vingt millions, avec lesquels je ferai exécuter des travaux, et ce sera un grand avantage pour vous.
« En effet, pendant quelque temps ils furent émerveillés. Ce sont d’honnêtes créatures, qui n’ont pas beaucoup de temps à eux pour réfléchir. Ils étaient bien un peu contrariés de ce qu’on leur subtilisât deux sous par jour ; mais leurs yeux étaient beaucoup plus frappés des millions ostensiblement dépensés par l’État.
« Peu à peu, cependant, ils se ravisèrent. Les plus fins d’entre eux disaient : — Il faut avouer que nous sommes de grandes dupes. Le ministre Budget commence par prendre à chacun de nous trente francs par an, et gratis ; puis il nous rend vingt francs, non pas gratis, mais contre du travail. Tout compte fait, nous perdons dix francs et nos journées à cette manœuvre. »
— Il me semble, seigneur Budget, que ces ouvriers-là raisonnaient assez bien.
« — J’en jugeai de même, et je vis bien que je ne pouvais continuer à leur soutirer leurs gros sous d’une façon aussi naïve. Avec un peu plus de ruse, me dis-je, au lieu de deux j’en aurai quatre.
« C’est alors que j’inventai l’impôt indirect. Maintenant, chaque fois que l’ouvrier achète pour deux sous de vin, il y a un sou pour moi. Je prends sur le tabac, je prends sur le sel, je prends sur la viande, je prends sur le pain, je prends partout et toujours. Je réunis ainsi, aux dépens des travailleurs, non plus trente millions, mais cent. Je fais bombance dans de beaux hôtels, je me prélasse dans de beaux carrosses, je me fais servir par de beaux laquais, le tout jusqu’à concurrence de dix millions. J’en donne vingt à mes agents pour guetter le vin, le sel, le tabac, la viande, etc ; et, avec ce qui me reste de leur propre argent, je fais travailler les ouvriers. »
— Et ils ne s’aperçoivent pas de la mystification ?
— « Pas le moins du monde. La manière dont je les épuise est si subtile qu’elle leur échappe. Mais les grands travaux que je fais exécuter éblouissent leurs regards. Ils se disent entre eux : Morbleu ! voilà un bon moyen d’extirper la misère. Vive le citoyen Budget ! Que deviendrions-nous, s’il ne nous donnait de l’ouvrage ? »
— Est-ce qu’ils ne s’aperçoivent pas qu’en ce cas vous ne leur prendriez plus leurs gros sous, et que, les dépensant eux-mêmes, ils se procureraient de l’ouvrage les uns aux autres ?
— « Ils ne s’en doutent pas. Ils ne cessent de me crier : Grand homme d’État, fais-nous travailler un peu plus encore. Et ce cri me réjouit, car je l’interprète ainsi : Grand homme d’État, sur notre vin, sur notre sel, sur notre tabac, sur notre viande, prends-nous un plus grand nombre de sous encore. »
Funeste gradation [JB, 20 to 23 June 1848] ↩
BWV
1848.06.20 "Funeste gradation" (A Dreadful Escalation) [*Jacques Bonhomme*, issue n° 3, 20 to 23 June 1848] [OC7.62, pp. 244-46]
Funeste gradation [1]
Les dépenses ordinaires de l’État sont fixées, par le budget de 1848, à un milliard sept cents millions.
Même avec l’impôt des 45 centimes, on ne peut arracher au peuple plus de un milliard cinq cents millions.
Reste un déficit net de deux cents millions.
En outre l’État doit deux cent cinquante millions de bons du trésor, trois cents millions aux caisses d’Épargne, sommes actuelleme exigibles.
Comment faire ? L’impôt est arrivé à sa dernière limite. Comment faire ? L’État a une idée : s’emparer des industries lucratives et les exploiter pour son compte. Il va commencer par les chemins de fer et les assurances ; puis viendront les mines, le roulage, les papeteries, les messageries, etc., etc.
Imposer, emprunter, usurper, funeste gradation !
L’État, je le crains bien, suit la route qui perdit le père Mathurin. J’allai le voir un jour, le père Mathurin. Eh bien ! lui dis-je, comment vont les affaires ?
— Mal, répondit-il ; j’ai peine à joindre les deux bouts. Mes dépenses débordent mes recettes.
— Il faut tâcher de gagner un peu plus.
— C’est impossible.
— Alors, il faut se résoudre à dépenser un peu moins.
— À d’autres ! Jacques Bonhomme, vous aimez à donner des conseils, et moi, je n’aime pas à en recevoir.
À quelque temps de là, je rencontrai le père Mathurin brillant et reluisant, en gants jaunes et bottes vernies. Il vint à moi sans rancune. Cela va admirablement ! s’écria-t-il. J’ai trouvé des prêteurs d’une complaisance charmante. Grâce à eux, mon budget, chaque année, s’équilibre avec une facilité délicieuse.
— Et, à part ces emprunts, avez-vous augmenté vos recettes ?
— Pas d’une obole.
— Avez-vous diminué vos dépenses?
— Le ciel m’en préserve ! bien au contraire. Admirez cet habit, ce gilet, ce gibus ! Ah! si vous voyiez mon hôtel, mes laquais, mes chevaux !
— Fort bien ; mais calculons. Si l’an passé vous ne pouviez joindre les deux bouts, comment les joindrez-vous, maintenant que, sans augmenter vos recettes, vous augmentez vos dépenses et avez des arrérages à payer ?
— Jacques Bonhomme, il n’y a pas de plaisir à causer avec vous. Je n’ai jamais vu un interlocuteur plus maussade.
Cependant ce qui devait arriver arriva. Mathurin mécontenta ses prêteurs, qui disparurent tous. Cruel embarras !
Il vint me trouver. Jacques, mon bon Jacques, me dit-il, je suis aux abois ; que faut-il faire ?
— Vous priver de tout superflu, travailler beaucoup, vivre de peu, payer au moins les intérêts de vos dettes, et intéresser ainsi à votre sort quelque juif charitable qui vous prêtera de quoi passer un an ou deux. Dans l’intervalle, vous renverrez vos commis inutiles, vous vous logerez modestement, vous vendrez vos équipages, et, peu à peu, vous rétablirez vos affaires.
— Maître Jacques, vous êtes toujours le même ; vous ne savez pas donner un conseil agréable et qui flatte le goût des gens. Adieu. Je ne prendrai conseil que de moi-même. J’ai épuisé mes ressources, j’ai épuisé les emprunts ; maintenant je vais me mettre à…
— N’achevez pas, je vous devine.
FN:N° 3 du Jacques Bonhomme, du 20 au 23 juin 1848.
Aux citoyens Lamartine et Ledru-Rollin [20 au 23 juin 1848] [CW1.4.10]↩
BWV
1848.06.20-23 “Aux citoyens Lamartine et Ledru-Rollin” (To Citizens Lamartine and Ledru-Rollin) [*Jacques Bonhomme*, 20-23 June 1848.] [OC7.63, p. 246] [CW1]
Source
N° 3 du Jacques Bonhomme, du 20 au 23 juin 1848.
63. Aux citoyens Lamartine et Ledru-Rollin [152]
Dissolvez les ateliers nationaux. Dissolvez-les avec tous les ménagements que l’humanité commande, mais dissolvez-les.
Si vous voulez que la confiance renaisse, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que l’industrie reprenne, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que les boutiques se vident et s’emplissent, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que les fabriques se rouvrent, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que la province se calme, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que la garde nationale se repose, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que le peuple vous bénisse, y compris cent mille travailleurs de ces ateliers sur cent trois mille, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous n’avez pas résolu que la stagnation des affaires, et puis celle du travail, et puis la misère, et puis l’inanition, et puis la guerre civile, et puis la désolation, deviennent le cortège de la république, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous n’avez pas résolu de ruiner les finances, d’écraser les provinces, d’exaspérer les paysans, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas que la nation tout entière vous soupçonne de faire à dessein planer incessamment l’émeute sur l’Assemblée nationale, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas affamer le peuple, après l’avoir démoralisé, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas être accusés d’avoir imaginé un moyen d’oppression, d’épouvante, de terreur et de ruine qui dépasse tout ce que les plus grands tyrans avaient inventé, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous n’avez pas l’arrière-pensée de détruire la république en la faisant haïr, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas être maudits dans le présent, si vous ne voulez pas que votre mémoire soit exécrée de génération en génération, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne dissolvez pas les ateliers nationaux, vous attirerez sur la patrie tous les fléaux à la fois.
Si vous ne dissolvez pas les ateliers nationaux, que deviendront les ouvriers lorsque vous n’aurez plus de pain à leur donner et que l’industrie privée sera morte ?
Si vous conservez les ateliers nationaux dans des desseins sinistres, la postérité dira de vous : C’est sans doute par lâcheté qu’ils proclamaient la république, puisqu’ils l’ont tuée par trahison.
Justice et fraternité [15 juin 1848] [CW2.5]↩
BWV
1848.06.15 “Justice et fraternité" (Justice and Fraternity) [*Journal des Économistes*, 15 June 1848] [OC4.4, p. 298] [CW2]
Source
OC vol. 4 Sophismes économiques — Petits pamphlets, I (1863 ed.): <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_4.djvu>.
L’École économiste est en opposition, sur une foule de points, avec les nombreuses Écoles socialistes, qui se disent plus avancées, et qui sont, j’en conviens volontiers, plus actives et plus populaires. Nous avons pour adversaires (je ne veux pas dire pour détracteurs) les communistes, les fouriéristes, les owénistes, Cabet, L. Blanc, Proudhon, P. Leroux et bien d’autres.
Ce qu’il y a de singulier, c’est que ces écoles diffèrent entre elles au moins autant qu’elles diffèrent de nous. Il faut donc, d’abord, qu’elles admettent un principe commun à toutes, que nous n’admettons pas ; ensuite, que ce principe se prête à l’infinie diversité que nous voyons entre elles.
Je crois que ce qui nous sépare radicalement, c’est ceci :
L’Économie politique conclut à ne demander à la loi que la Justice universelle.
Le Socialisme, dans ses branches diverses, et par des applications dont le nombre est naturellement indéfini, demande de plus à la loi la réalisation du dogme de la Fraternité.
Or, qu’est-il arrivé ? Le Socialisme admet, avec Rousseau, que l’ordre social tout entier est dans la Loi. On sait que Rousseau faisait reposer la société sur un contrat. Louis Blanc, dès la première page de son livre sur la Révolution, dit : « Le principe de la fraternité est celui qui, regardant comme solidaires les membres de la grande famille, tend à organiser un jour les sociétés, œuvre de l’homme, sur le modèle du corps humain, œuvre de Dieu. »
Partant de ce point, que la société est l’œuvre de l’homme, l’œuvre de la loi, les socialistes doivent en induire que rien n’existe dans la société, qui n’ait été ordonné et arrangé d’avance par le Législateur.
Donc, voyant l’Économie politique se borner à demander à la loi Justice partout et pour tous, Justice universelle, ils ont pensé qu’elle n’admettait pas la Fraternité dans les relations sociales.
Le raisonnement est serré. « Puisque la société est toute dans la loi, disent-ils, et puisque vous ne demandez à la loi que la justice, vous excluez donc la fraternité de la loi, et par conséquent de la société. »
De là ces imputations de rigidité, de froideur, de dureté, de sécheresse, qu’on a accumulées sur la science économique et sur ceux qui la professent.
Mais la majeure est-elle admissible ? Est-il vrai que toute la société soit renfermée dans la loi ? On voit de suite que si cela n’est pas, toutes ces imputations croulent.
Eh quoi ! dire que la loi positive, qui agit toujours avec autorité, par voie de contrainte, appuyée sur une force coercitive, montrant pour sanction la baïonnette ou le cachot, aboutissant à une clause pénale ; dire que la loi qui ne décrète ni l’affection, ni l’amitié, ni l’amour, ni l’abnégation, ni le dévouement, ni le sacrifice, ne peut davantage décréter ce qui les résume, la Fraternité, est-ce donc anéantir ou nier ces nobles attributs de notre nature ? Non certes ; c’est dire seulement que la société est plus vaste que la loi ; qu’un grand nombre d’actes s’accomplissent, qu’une foule de sentiments se meuvent en dehors et au-dessus de la loi.
Quant à moi, au nom de la science, je proteste de toutes mes forces contre cette interprétation misérable, selon laquelle, parce que nous reconnaissons à la loi une limite, on nous accuse de nier tout ce qui est au-delà de cette limite. Ah ! qu’on veuille le croire, nous aussi nous saluons avec transport ce mot Fraternité, tombé il y a dix-huit siècles du haut de la montagne sainte et inscrit pour toujours sur notre drapeau républicain. Nous aussi nous désirons voir les individus, les familles, les nations s’associer, s’entr’aider, s’entre-secourir dans le pénible voyage de la vie mortelle. Nous aussi nous sentons battre notre cœur et couler nos larmes au récit des actions généreuses, soit qu’elles brillent dans la vie des simples citoyens, soit qu’elles rapprochent et confondent les classes diverses, soit surtout qu’elles précipitent les peuples prédestinés aux avant-postes du progrès et de la civilisation.
Et nous réduira-t-on à parler de nous-mêmes ? Eh bien ! qu’on scrute nos actes. Certes, nous voulons bien admettre que ces nombreux publicistes qui, de nos jours, veulent étouffer dans le cœur de l’homme jusqu’au sentiment de l’intérêt, qui se montrent si impitoyables envers ce qu’ils appellent l’individualisme, dont la bouche se remplit incessamment des mots dévouement, sacrifice, fraternité ; nous voulons bien admettre qu’ils obéissent exclusivement à ces sublimes mobiles qu’ils conseillent aux autres, qu’ils donnent des exemples aussi bien que des conseils, qu’ils ont eu soin de mettre leur conduite en harmonie avec leurs doctrines ; nous voulons bien les croire, sur leur parole, pleins de désintéressement et de charité ; mais enfin, il nous sera permis de dire que sous ce rapport nous ne redoutons pas la comparaison.
Chacun de ces Décius a un plan qui doit réaliser le bonheur de l’humanité, et tous ont l’air de dire que si nous les combattons, c’est parce que nous craignons ou pour notre fortune, ou pour d’autres avantages sociaux. Non ; nous les combattons, parce que nous tenons leurs idées pour fausses, leurs projets pour aussi puérils que désastreux. Que s’il nous était démontré qu’on peut faire descendre à jamais le bonheur sur terre par une organisation factice, ou en décrétant la fraternité, il en est parmi nous qui, quoique économistes, signeraient avec joie ce décret de la dernière goutte de leur sang.
Mais il ne nous est pas démontré que la fraternité se puisse imposer. Si même, partout où elle se manifeste, elle excite si vivement notre sympathie, c’est parce qu’elle agit en dehors de toute contrainte légale. La fraternité est spontanée, ou n’est pas. La décréter, c’est l’anéantir. La loi peut bien forcer l’homme à rester juste ; vainement elle essaierait de le forcer à être dévoué.
Ce n’est pas moi, du reste, qui ai inventé cette distinction. Ainsi que je le disais tout à l’heure, il y a dix-huit siècles, ces paroles sortirent de la bouche du divin fondateur de notre religion :
« La loi vous dit : Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait.
Et moi, je vous dis : Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fissent pour vous. »
Je crois que ces paroles fixent la limite qui sépare la Justice de la Fraternité. Je crois qu’elles tracent en outre une ligne de démarcation, je ne dirai pas absolue et infranchissable, mais théorique et rationnelle, entre le domaine circonscrit de la loi et la région sans borne de la spontanéité humaine.
Quand un grand nombre de familles, qui toutes, pour vivre, se développer et se perfectionner, ont besoin de travailler, soit isolément, soit par association, mettent en commun une partie de leurs forces, que peuvent-elles demander à cette force commune, si ce n’est la protection de toutes les personnes, de tous les travaux, de toutes les propriétés, de tous les droits, de tous les intérêts ? cela, qu’est-ce autre chose que la Justice universelle ? Évidemment le droit de chacun a pour limite le droit absolument semblable de tous les autres. La loi ne peut donc faire autre chose que reconnaître cette limite et la faire respecter. Si elle permettait à quelques-uns de la franchir, ce serait au détriment de quelques autres. La loi serait injuste. Elle le serait bien plus encore si, au lieu de tolérer cet empiétement, elle l’ordonnait.
Qu’il s’agisse, par exemple, de propriété : le principe est que ce que chacun a fait par son travail lui appartient, encore que ce travail ait été comparativement plus ou moins habile, persévérant, heureux, et par suite plus ou moins productif. Que si deux travailleurs veulent unir leurs forces, pour partager le produit suivant des proportions convenues, ou échanger entre eux leurs produits, ou si l’un veut faire à l’autre un prêt ou un don, qu’est-ce qu’a à faire la loi ? Rien, ce me semble, si ce n’est exiger l’exécution des conventions, empêcher ou punir le dol, la violence et la fraude.
Cela veut-il dire qu’elle interdira les actes de dévouement et de générosité ? Qui pourrait avoir une telle pensée ? Mais ira-t-elle jusqu’à les ordonner ? Voilà précisément le point qui divise les économistes et les socialistes.
Si les socialistes veulent dire que, pour des circonstances extraordinaires, pour des cas urgents, l’État doit préparer quelques ressources, secourir certaines infortunes, ménager certaines transitions, mon Dieu, nous serons d’accord ; cela s’est fait ; nous désirons que cela se fasse mieux. Il est cependant un point, dans cette voie, qu’il ne faut pas dépasser ; c’est celui où la prévoyance gouvernementale viendrait anéantir la prévoyance individuelle en s’y substituant. Il est de toute évidence que la charité organisée ferait, en ce cas, beaucoup plus de mal permanent que de bien passager.
Mais il ne s’agit pas ici de mesures exceptionnelles. Ce que nous recherchons, c’est ceci : la Loi, considérée au point de vue général et théorique, a-t-elle pour mission de constater et faire respecter la limite des droits réciproques préexistants, ou bien de faire directement le bonheur des hommes, en provoquant des actes de dévouement, d’abnégation et de sacrifices mutuels ?
Ce qui me frappe dans ce dernier système (et c’est pour cela que dans cet écrit fait à la hâte j’y reviendrai souvent), c’est l’incertitude qu’il fait planer sur l’activité humaine et ses résultats, c’est l’inconnu devant lequel il place la société, inconnu qui est de nature à paralyser toutes ses forces.
La Justice, on sait ce qu’elle est, où elle est. C’est un point fixe, immuable. Que la loi la prenne pour guide, chacun sait à quoi s’en tenir, et s’arrange en conséquence.
Mais la Fraternité, où est son point déterminé ? quelle est sa limite ? quelle est sa forme ? Évidemment c’est l’infini. La fraternité, en définitive, consiste à faire un sacrifice pour autrui, à travailler pour autrui. Quand elle est libre, spontanée, volontaire, je la conçois, et j’y applaudis. J’admire d’autant plus le sacrifice qu’il est plus entier. Mais quand on pose au sein d’une société ce principe, que la Fraternité sera imposée par la loi, c’est-à-dire, en bon français, que la répartition des fruits du travail sera faite législativement, sans égard pour les droits du travail lui-même ; qui peut dire dans quelle mesure ce principe agira, de quelle forme un caprice du législateur peut le revêtir, dans quelles institutions un décret peut du soir au lendemain l’incarner ? Or, je demande si, à ces conditions, une société peut exister ?
Remarquez que le Sacrifice, de sa nature, n’est pas, comme la Justice, une chose qui ait une limite. Il peut s’étendre, depuis le don de l’obole jetée dans la sébile du mendiant jusqu’au don de la vie, usque ad mortem, mortem autem crucis. L’Évangile, qui a enseigné la Fraternité aux hommes, l’a expliquée par ses conseils. Il nous a dit : « Lorsqu’on vous frappera sur la joue droite, présentez la joue gauche. Si quelqu’un veut vous prendre votre veste, donnez-lui encore votre manteau. » Il a fait plus que de nous expliquer la fraternité, il nous en a donné le plus complet, le plus touchant et le plus sublime exemple au sommet du Golgotha.
Eh bien ! dira-t-on que la Législation doit pousser jusque-là la réalisation, par mesure administrative, du dogme de la Fraternité ? Ou bien s’arrêtera-t-elle en chemin ? Mais à quel degré s’arrêtera-t-elle, et selon quelle règle ? Cela dépendra aujourd’hui d’un scrutin, demain d’un autre.
Même incertitude quant à la forme. Il s’agit d’imposer des sacrifices à quelques-uns pour tous, ou à tous pour quelques-uns. Qui peut me dire comment s’y prendra la loi ? car on ne peut nier que le nombre des formules fraternitaires ne soit indéfini. Il n’y a pas de jour où il ne m’en arrive cinq ou six par la poste, et toutes, remarquez-le bien, complétement différentes. En vérité, n’est-ce pas folie de croire qu’une nation peut goûter quelque repos moral et quelque prospérité matérielle, quand il est admis en principe que, du soir au lendemain, le législateur peut la jeter toute entière dans l’un des cent mille moules fraternitaires qu’il aura momentanément préféré ?
Qu’il me soit permis de mettre en présence, dans leurs conséquences les plus saillantes, le système économiste et le système socialiste.
Supposons d’abord une nation qui adopte pour base de sa législation la Justice, la Justice universelle.
Supposons que les citoyens disent au gouvernement : « Nous prenons sur nous la responsabilité de notre propre existence ; nous nous chargeons de notre travail, de nos transactions, de notre instruction, de nos progrès, de notre culte ; pour vous, votre seule mission sera de nous contenir tous, et sous tous les rapports, dans les limites de nos droits. »
Vraiment, on a essayé tant de choses, je voudrais que la fantaisie prit un jour à mon pays, ou à un pays quelconque, sur la surface du globe, d’essayer au moins celle-là. Certes, le mécanisme, on ne le niera pas, est d’une simplicité merveilleuse. Chacun exerce tous ses droits comme il l’entend, pourvu qu’il n’empiète pas sur les droits d’autrui. L’épreuve serait d’autant plus intéressante, qu’en point de fait, les peuples qui se rapprochent le plus de ce système surpassent tous les autres en sécurité, en prospérité, en égalité et en dignité. Oui, s’il me reste dix ans de vie, j’en donnerais volontiers neuf pour assister, pendant un an, à une telle expérience faite dans ma patrie. — Car voici, ce me semble, ce dont je serais l’heureux témoin.
En premier lieu, chacun serait fixé sur son avenir, en tant qu’il peut être affecté par la loi. Ainsi que je l’ai fait remarquer, la justice exacte est une chose tellement déterminée, que la législation qui n’aurait qu’elle en vue serait à peu près immuable. Elle ne pourrait varier que sur les moyens d’atteindre de plus en plus ce but unique : faire respecter les personnes et leurs droits. Ainsi, chacun pourrait se livrer à toutes sortes d’entreprises honnêtes sans crainte et sans incertitude. Toutes les carrières seraient ouvertes à tous ; chacun pourrait exercer ses facultés librement, selon qu’il serait déterminé par son intérêt, son penchant, son aptitude, ou les circonstances ; il n’y aurait ni priviléges, ni monopoles, ni restrictions d’aucune sorte.
Ensuite, toutes les forces du gouvernement étant appliquées à prévenir et à réprimer les dols, les fraudes, les délits, les crimes, les violences, il est à croire qu’elles atteindraient d’autant mieux ce but qu’elles ne seraient pas disséminées, comme aujourd’hui, sur une foule innombrable d’objets étrangers à leurs attributions essentielles. Nos adversaires eux-mêmes ne nieront pas que prévenir et réprimer l’injustice ne soit la mission principale de l’État. Pourquoi donc cet art précieux de la prévention et de la répression a-t-il fait si peu de progrès chez nous ? Parce que l’État le néglige pour les mille autres fonctions dont on l’a chargé. Aussi la Sécurité n’est pas, il s’en faut de beaucoup, le trait distinctif de la société française. Elle serait complète sous le régime dont je me suis fait, pour le moment, l’analyste ; sécurité dans l’avenir, puisque aucune utopie ne pourrait s’imposer en empruntant la force publique ; sécurité dans le présent, puisque cette force serait exclusivement consacrée à combattre et anéantir l’injustice.
Ici, il faut bien que je dise un mot des conséquences qu’engendre la Sécurité. Voilà donc la Propriété sous ses formes diverses, foncière, mobilière, industrielle, intellectuelle, manuelle, complétement garantie. La voilà à l’abri des atteintes des malfaiteurs et, qui plus est, des atteintes de la Loi. Quelle que soit la nature des services que les travailleurs rendent à la société ou se rendent entre eux, ou échangent au-dehors, ces services auront toujours leur valeur naturelle. Cette valeur sera bien encore affectée par les événements, mais au moins elle ne pourra jamais l’être par les caprices de la loi, par les exigences de l’impôt, par les intrigues, les prétentions et les influences parlementaires. Le prix des choses et du travail subira donc le minimum possible de fluctuation, et sous l’ensemble de toutes ces conditions réunies, il n’est pas possible que l’industrie ne se développe, que les richesses ne s’accroissent, que les capitaux ne s’accumulent avec une prodigieuse rapidité.
Or, quand les capitaux se multiplient, ils se font concurrence entre eux ; leur rémunération diminue, ou, en d’autres termes, l’intérêt baisse. Il pèse de moins en moins sur le prix des produits. La part proportionnelle du capital dans l’œuvre commune va décroissant sans cesse. Cet agent du travail plus répandu devient à la portée d’un plus grand nombre d’hommes. Le prix des objets de consommation est soulagé de toute la part que le capital prélève en moins ; la vie est à bon marché, et c’est une première condition essentielle pour l’affranchissement des classes ouvrières [2].
En même temps, et par un effet de la même cause (l’accroissement rapide du capital), les salaires haussent de toute nécessité. Les capitaux, en effet, ne rendent absolument rien qu’à la condition d’être mis en œuvre. Plus ce fonds des salaires est grand et occupé, relativement à un nombre déterminé d’ouvriers, plus le salaire hausse.
Ainsi, le résultat nécessaire de ce régime de justice exacte, et par conséquent de liberté et de sécurité, c’est de relever les classes souffrantes de deux manières, d’abord en leur donnant la vie à bon marché, ensuite en élevant le taux des salaires.
Il n’est pas possible que le sort des ouvriers soit ainsi naturellement et doublement amélioré, sans que leur condition morale s’élève et s’épure. Nous sommes donc dans la voie de l’Égalité. Je ne parle pas seulement de cette égalité devant la loi, que le système implique évidemment puisqu’il exclut toute injustice, mais de l’égalité de fait, au physique et au moral, résultant de ce que la rémunération du travail augmente à mesure et par cela même que celle du capital diminue.
Si nous jetons les yeux sur les rapports de ce peuple avec les autres nations, nous trouvons qu’ils sont tous favorables à la paix. Se prémunir contre toute agression, voilà sa seule politique. Il ne menace ni n’est menacé. Il n’a pas de diplomatie et bien moins encore de diplomatie armée. En vertu du principe de Justice universelle, nul citoyen ne pouvant, dans son intérêt, faire intervenir la loi pour empêcher un autre citoyen d’acheter ou de vendre au-dehors, les relations commerciales de ce peuple seront libres et très étendues. Personne ne conteste que ces relations ne contribuent au maintien de la paix. Elles constitueront pour lui un véritable et précieux système de défense, qui rendra à peu près inutiles les arsenaux, les places fortes, la marine militaire et les armées permanentes. Ainsi, toutes les forces de ce peuple seront affectées à des travaux productifs, nouvelle cause d’accroissement de capitaux avec toutes les conséquences qui en dérivent.
Il est aisé de voir qu’au sein de ce peuple, le gouvernement est réduit à des proportions fort exiguës, et les rouages administratifs à une grande simplicité. De quoi s’agit-il ? de donner à la force publique la mission unique de faire régner la justice parmi les citoyens. Or, cela se peut faire à peu de frais et ne coûte aujourd’hui même en France que vingt-six millions. Donc cette nation ne paiera pour ainsi dire pas d’impôts. Il est même certain que la civilisation et le progrès tendront à y rendre le gouvernement de plus en plus simple et économique, car plus la justice sera le fruit de bonnes habitudes sociales, plus il sera opportun de réduire la force organisée pour l’imposer.
Quand une nation est écrasée de taxes, rien n’est plus difficile et je pourrais dire impossible que de les répartir également. Les statisticiens et les financiers n’y aspirent plus. Il y a cependant une chose plus impossible encore, c’est de les rejeter sur les riches. L’État ne peut avoir beaucoup d’argent qu’en épuisant tout le monde et les masses surtout. Mais dans le régime si simple, auquel je consacre cet inutile plaidoyer, régime qui ne réclame que quelques dizaines de millions, rien n’est plus aisé qu’une répartition équitable. Une contribution unique, proportionnelle à la propriété réalisée, prélevée en famille et sans frais au sein des conseils municipaux, y suffit. Plus de cette fiscalité tenace, de cette bureaucratie dévorante, qui sont la mousse et la vermine du corps social ; plus de ces contributions indirectes, de cet argent arraché par force et par ruse, de ces piéges fiscaux tendus sur toutes les voies du travail, de ces entraves qui nous font plus de mal encore par les libertés qu’elles nous ôtent que par les ressources dont elles nous privent.
Ai-je besoin de montrer que l’ordre serait le résultat infaillible d’un tel régime ? D’où pourrait venir le désordre ? Ce n’est pas de la misère ; elle serait probablement inconnue dans le pays, au moins à l’état chronique ; et si, après tout, il se révélait des souffrances accidentelles et passagères, nul ne songerait à s’en prendre à l’État, au gouvernement, à la loi. Aujourd’hui qu’on a admis en principe que l’État est institué pour distribuer la richesse à tout le monde, il est naturel qu’on lui demande compte de cet engagement. Pour le tenir, il multiplie les taxes et fait plus de misères qu’il n’en guérit. Nouvelles exigences de la part du public, nouvelles taxes de la part de l’État, et nous ne pouvons que marcher de révolution en révolution. Mais s’il était bien entendu que l’État ne doit prendre aux travailleurs que ce qui est rigoureusement indispensable pour les garantir contre toute fraude et toute violence, je ne puis apercevoir de quel côté viendrait le désordre.
Il est des personnes qui penseront que, sous un régime aussi simple, aussi facilement réalisable, la société serait bien morne et bien triste. Que deviendrait la grande politique ? à quoi serviraient les hommes d’État ? La représentation nationale elle-même, réduite à perfectionner le Code civil et le Code pénal, ne cesserait-elle pas d’offrir à la curieuse avidité du public le spectacle de ses débats passionnés et de ses luttes dramatiques ?
Ce singulier scrupule vient de l’idée que gouvernement et société, c’est une seule et même chose ; idée fausse et funeste s’il en fut. Si cette identité existait, simplifier le gouvernement, ce serait, en effet, amoindrir la société.
Mais est-ce que, par cela seul que la force publique se bornerait à faire régner la justice, cela retrancherait quelque chose à l’initiative des citoyens ? Est-ce que leur action est renfermée, même aujourd’hui, dans des limites fixées par la loi ? Ne leur serait-il pas loisible, pourvu qu’ils ne s’écartassent pas de la justice, de former des combinaisons infinies, des associations de toute nature, religieuses, charitables, industrielles, agricoles, intellectuelles, et même phalanstériennes et icariennes ? N’est-il pas certain, au contraire, que l’abondance des capitaux favoriserait toutes ces entreprises ? Seulement, chacun s’y associerait volontairement à ses périls et risques. Ce que l’on veut, par l’intervention de l’État, c’est s’y associer aux risques et aux frais du public.
On dira sans doute : Dans ce régime, nous voyons bien la justice, l’économie, la liberté, la richesse, la paix, l’ordre et l’égalité, mais nous n’y voyons pas la fraternité.
Encore une fois, n’y a-t-il dans le cœur de l’homme que ce que le législateur y a mis ? A-t-il fallu, pour que la fraternité fit son apparition sur la terre, qu’elle sortit de l’urne d’un scrutin ? Est-ce que la loi vous interdit la charité, par cela seul qu’elle ne vous impose que la justice ? Croit-on que les femmes cesseront d’avoir du dévouement et un cœur accessible à la pitié, parce que le dévouement et la pitié ne leur seront pas ordonnés par le Code ? Et quel est donc l’article du Code qui, arrachant la jeune fille aux caresses de sa mère, la pousse vers ces tristes asiles où s’étalent les plaies hideuses du corps et les plaies plus hideuses encore de l’intelligence ? Quel est l’article du Code qui détermine la vocation du prêtre ? À quelle loi écrite, à quelle intervention gouvernementale faut-il rapporter la fondation du christianisme, le zèle des apôtres, le courage des martyrs, la bienfaisance de Fénelon ou de François de Paule, l’abnégation de tant d’hommes qui, de nos jours, ont exposé mille fois leur vie pour le triomphe de la cause populaire [3] ?
Chaque fois que nous jugeons un acte bon et beau, nous voudrions, c’est bien naturel, qu’il se généralisât. Or, voyant au sein de la société une force à qui tout cède, notre première pensée est de la faire concourir à décréter et imposer l’acte dont il s’agit. Mais la question est de savoir si l’on ne déprave pas ainsi et la nature de cette force et la nature de l’acte, rendu obligatoire de volontaire qu’il était. Pour ce qui me concerne, il ne peut pas m’entrer dans la tête que la loi, qui est la force, puisse être utilement appliquée à autre chose qu’à réprimer les torts et maintenir les droits.
Je viens de décrire une nation où il en serait ainsi. Supposons maintenant qu’au sein de ce peuple l’opinion prévale que la loi ne se bornera plus à imposer la justice ; qu’elle aspirera encore à imposer la fraternité.
Qu’arrivera-t-il ? Je ne serai pas long à le dire, car le lecteur n’a qu’à refaire en le renversant le tableau qui précède.
D’abord, une incertitude effroyable, une insécurité mortelle planera sur tout le domaine de l’activité privée ; car la fraternité peut revêtir des milliards de formes inconnues, et, par conséquent, des milliards de décrets imprévus. D’innombrables projets viendront chaque jour menacer toutes les relations établies. Au nom de la fraternité, l’un demandera l’uniformité des salaires, et voilà les classes laborieuses réduites à l’état de castes indiennes ; ni l’habileté, ni le courage, ni l’assiduité, ni l’intelligence ne pourront les relever ; une loi de plomb pèsera sur elles. Ce monde leur sera comme l’enfer du Dante : Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. — Au nom de la fraternité, un autre demandera que le travail soit réduit à dix, à huit, à six à quatre heures ; et voilà la production arrêtée. — Comme il n’y aura plus de pain pour apaiser la faim, de drap pour garantir du froid, un troisième imaginera de remplacer le pain et le drap par du papier-monnaie forcé. N’est-ce pas avec des écus que nous achetons ces choses ? Multiplier les écus, dira-t-il, c’est multiplier le pain et le drap ; multiplier le papier, c’est multiplier les écus. Concluez. — Un quatrième exigera qu’on décrète l’abolition de la concurrence ; — un cinquième, l’abolition de l’intérêt personnel ; — celui-ci voudra que l’État fournisse du travail ; celui-là, de l’instruction, et cet autre, des pensions à tous les citoyens. — En voici un autre qui veut abattre tous les rois sur la surface du globe, et décréter, au nom de la fraternité, la guerre universelle. Je m’arrête. Il est bien évident que, dans cette voie, la source des utopies est inépuisable. Elles seront repoussées, dira-t-on. Soit ; mais il est possible qu’elles ne le soient pas, et cela suffit pour créer l’incertitude, le plus grand fléau du travail.
Sous ce régime, les capitaux ne pourront se former. Ils seront rares, chers, concentrés. Cela veut dire que les salaires baisseront, et que l’inégalité creusera, entre les classes, un abîme de plus en plus profond.
Les finances publiques ne tarderont pas d’arriver à un complet désarroi. Comment pourrait-il en être autrement quand l’État est chargé de fournir tout à tous ? Le peuple sera écrasé d’impôts, on fera emprunt sur emprunt ; après avoir épuisé le présent, on dévorera l’avenir.
Enfin, comme il sera admis en principe que l’État est chargé de faire de la fraternité en faveur des citoyens, on verra le peuple tout entier transformé en solliciteur. Propriété foncière, agriculture, industrie, commerce, marine, compagnies industrielles, tout s’agitera pour réclamer les faveurs de l’État. Le Trésor public sera littéralement au pillage. Chacun aura de bonnes raisons pour prouver que la fraternité légale doit être entendue dans ce sens : « Les avantages pour moi et les charges pour les autres. » L’effort de tous tendra à arracher à la législature un lambeau de privilége fraternel. Les classes souffrantes, quoique ayant le plus de titres, n’auront pas toujours le plus de succès ; or, leur multitude s’accroîtra sans cesse, d’où il suit qu’on ne pourra marcher que de révolution en révolution.
En un mot, on verra se dérouler tout le sombre spectacle dont, pour avoir adopté cette funeste idée de fraternité légale, quelques sociétés modernes nous offrent la préface.
Je n’ai pas besoin de le dire : cette pensée a sa source dans des sentiments généreux, dans des intentions pures. C’est même par là qu’elle s’est concilié si rapidement la sympathie des masses, et c’est par là aussi qu’elle ouvre un abîme sous nos pas, si elle est fausse.
J’ajoute que je serai heureux, pour mon compte, si on me démontre qu’elle ne l’est pas. Eh ! mon Dieu, si l’on peut décréter la fraternité universelle, et donner efficacement à ce décret la sanction de la force publique ; si, comme le veut Louis Blanc, on peut faire disparaître du monde, par assis et levé, le ressort de l’intérêt personnel ; si l’on peut réaliser législativement cet article du programme de la Démocratie pacifique : Plus d’égoïsme ; si l’on peut faire que l’État donne tout à tous, sans rien recevoir de personne, qu’on le fasse. Certes, je voterai le décret et me réjouirai que l’humanité arrive à la perfection et au bonheur par un chemin si court et si facile.
Mais, il faut bien le dire, de telles conceptions nous semblent chimériques et futiles jusqu’à la puérilité. Qu’elles aient éveillé des espérances dans la classe qui travaille, qui souffre, et n’a pas le temps de réfléchir, cela n’est pas surprenant. Mais comment peuvent-elles égarer des publicistes de mérite ?
À l’aspect des souffrances qui accablent un grand nombre de nos frères, ces publicistes ont pensé qu’elles étaient imputables à la liberté qui est la justice. Ils sont partis de cette idée que le système de la liberté, de la justice exacte, avait été mis légalement à l’épreuve, et qu’il avait failli. Ils en ont conclu que le temps était venu de faire faire à la législation un pas de plus, et qu’elle devait enfin s’imprégner du principe de la fraternité. De là, ces écoles saint-simoniennes, fouriéristes, communistes, owénistes ; de là, ces tentatives d’organisation du travail ; ces déclarations que l’État doit la subsistance, le bien-être, l’éducation à tous les citoyens ; qu’il doit être généreux, charitable, présent à tout, dévoué à tous ; que sa mission est d’allaiter l’enfance, d’instruire la jeunesse, d’assurer du travail aux forts, de donner des retraites aux faibles ; en un mot, qu’il a à intervenir directement pour soulager toutes les souffrances, satisfaire et prévenir tous les besoins, fournir des capitaux à toutes les entreprises, des lumières à toutes les intelligences, des baumes à toutes les plaies, des asiles à toutes les infortunes, et même des secours et du sang français à tous les opprimés sur la surface du globe.
Encore une fois, qui ne voudrait voir tous ces bienfaits découler sur le monde de la loi comme d’une source intarissable ? Qui ne serait heureux de voir l’État assumer sur lui toute peine, toute prévoyance, toute responsabilité, tout devoir, tout ce qu’une Providence, dont les desseins sont impénétrables, a mis de laborieux et de lourd à la charge de l’humanité, et réserver aux individus dont elle se compose le côté attrayant et facile, les satisfactions, les jouissances, la certitude, le calme, le repos, un présent toujours assuré, un avenir toujours riant, la fortune sans soins, la famille sans charges, le crédit sans garanties, l’existence sans efforts ?
Certes, nous voudrions tout cela, si c’était possible. Mais, est-ce possible ? Voilà la question. Nous ne pouvons comprendre ce qu’on désigne par l’État. Nous croyons qu’il y a, dans cette perpétuelle personnification de l’État, la plus étrange, la plus humiliante des mystifications. Qu’est-ce donc que cet État qui prend à sa charge toutes les vertus, tous les devoirs, toutes les libéralités ? D’où tire-t-il ces ressources, qu’on le provoque à épancher en bienfaits sur les individus ? N’est-ce pas des individus eux-mêmes ? Comment donc ces ressources peuvent-elles s’accroître en passant par les mains d’un intermédiaire parasite et dévorant ? N’est-il pas clair, au contraire, que ce rouage est de nature à absorber beaucoup de forces utiles et à réduire d’autant la part des travailleurs ? Ne voit-on pas aussi que ceux-ci y laisseront, avec une portion de leur bien-être, une portion de leur liberté ?
À quelque point de vue que je considère la loi humaine, je ne vois pas qu’on puisse raisonnablement lui demander autre chose que la Justice.
Qu’il s’agisse, par exemple, de religion. Certes, il serait à désirer qu’il n’y eût qu’une croyance, une foi, un culte dans le monde, à la condition que ce fût la vraie foi. Mais, quelque désirable que soit l’Unité, — la diversité, c’est-à-dire la recherche et la discussion valent mieux encore, tant que ne luira pas pour les intelligences le signe infaillible auquel cette vraie foi se fera reconnaître. L’intervention de l’État, alors même qu’elle prendrait pour prétexte la Fraternité, serait donc une oppression, une injustice, si elle prétendait fonder l’Unité ; car qui nous répond que l’État, à son insu peut-être, ne travaillerait pas à étouffer la vérité au profit de l’erreur ? L’Unité doit résulter de l’universel assentiment de convictions libres et de la naturelle attraction que la vérité exerce sur l’esprit des hommes. Tout ce qu’on peut donc demander à la loi, c’est la liberté pour toutes les croyances, quelque anarchie qui doive en résulter dans le monde pensant. Car, qu’est-ce que cette anarchie prouve ? que l’Unité n’est pas à l’origine, mais à la fin de l’évolution intellectuelle. Elle n’est pas un point de départ, elle est une résultante. La loi qui l’imposerait serait injuste, et si la justice n’implique pas nécessairement la fraternité, on conviendra du moins que la fraternité exclut l’injustice.
De même pour l’enseignement. Qui ne convient que, si l’on pouvait être d’accord sur le meilleur enseignement possible, quant à la matière et quant à la méthode, l’enseignement unitaire ou gouvernemental serait préférable, puisque, dans l’hypothèse, il ne pourrait exclure législativement que l’erreur ? Mais, tant que ce critérium n’est pas trouvé, tant que le législateur, le ministre de l’Instruction publique, ne porteront pas sur leur front un signe irrécusable d’infaillibilité, la meilleure chance pour que la vraie méthode se découvre et absorbe les autres, c’est la diversité, les épreuves, l’expérience, les efforts individuels, placés sous l’influence de l’intérêt au succès, en un mot, la liberté. La pire chance, c’est l’éducation décrétée et uniforme ; car, dans ce régime, l’Erreur est permanente, universelle et irrémédiable. Ceux donc qui, poussés par le sentiment de la fraternité, demandent que la loi dirige et impose l’éducation, devraient se dire qu’ils courent la chance que la loi ne dirige et n’impose que l’erreur ; que l’interdiction légale peut frapper la Vérité, en frappant les intelligences qui croient en avoir la possession. Or, je le demande, est-ce une fraternité véritable que celle qui a recours à la force pour imposer, ou tout au moins pour risquer d’imposer l’Erreur ? On redoute la diversité, on la flétrit sous le nom d’anarchie ; mais elle résulte forcément de la diversité même des intelligences et des convictions, diversité qui tend d’ailleurs à s’effacer par la discussion, l’étude et l’expérience. En attendant, quel titre a un système à prévaloir sur les autres par la loi ou la force ? Ici encore nous trouvons que cette prétendue fraternité, qui invoque la loi, ou la contrainte légale, est en opposition avec la Justice.
Je pourrais faire les mêmes réflexions pour la presse, et, en vérité, j’ai peine à comprendre pourquoi ceux qui demandent l’Éducation Unitaire par l’État, ne réclament pas la Presse Unitaire par l’État. La presse est un enseignement aussi. La presse admet la discussion, puisqu’elle en vit. Il y a donc là aussi diversité, anarchie. Pourquoi pas, dans ces idées, créer un ministère de la publicité et le charger d’inspirer tous les livres et tous les journaux de France ? Ou l’État est infaillible, et alors nous ne saurions mieux faire que de lui soumettre le domaine entier des intelligences ; ou il ne l’est pas, et, en ce cas, il n’est pas plus rationnel de lui livrer l’éducation que la presse.
Si je considère nos relations avec les étrangers, je ne vois pas non plus d’autre règle prudente, solide, acceptable pour tous, telle enfin qu’elle puisse devenir une loi, que la Justice. Soumettre ces relations au principe de la fraternité légale, forcée, c’est décréter la guerre perpétuelle, universelle, car c’est mettre obligatoirement notre force, le sang et la fortune des citoyens, au service de quiconque les réclamera pour servir une cause qui excite la sympathie du législateur. Singulière fraternité. Il y a longtemps que Cervantes en a personnifié la vanité ridicule.
Mais c’est surtout en matière de travail que le dogme de la fraternité me semble dangereux, lorsque, contrairement à l’idée qui fait l’essence de ce mot sacré, on songe à le faire entrer dans nos Codes, avec accompagnement de la disposition pénale qui sanctionne toute loi positive.
La fraternité implique toujours l’idée de dévouement, de sacrifice, c’est en cela qu’elle ne se manifeste pas sans arracher des larmes d’admiration. Si l’on dit, comme certains socialistes, que ses actes sont profitables à leur auteur, il n’y a pas à les décréter ; les hommes n’ont pas besoin d’une loi pour être déterminés à faire des profits. En outre, ce point de vue ravale et ternit beaucoup l’idée de fraternité.
Laissons-lui donc son caractère, qui est renfermé dans ces mots : Sacrifice volontaire déterminé par le sentiment fraternel.
Si vous faites de la fraternité une prescription légale, dont les actes soient prévus et rendus obligatoires par le Code industriel, que reste-t-il de cette définition ? Rien qu’une chose : le sacrifice ; mais le sacrifice involontaire, forcé, déterminé par la crainte du châtiment. Et, de bonne foi, qu’est-ce qu’un sacrifice de cette nature, imposé à l’un au profit de l’autre ? Est-ce de la fraternité ? Non, c’est de l’injustice ; il faut dire le mot, c’est de la spoliation légale, la pire des spoliations, puisqu’elle est systématique, permanente et inévitable.
Que faisait Barbès quand, dans la séance du 15 mai, il décrétait un impôt d’un milliard en faveur des classes souffrantes ? Il mettait en pratique votre principe. Cela est si vrai, que la proclamation de Sobrier, qui conclut comme le discours de Barbès, est précédée de ce préambule : « Considérant qu’il faut que la fraternité ne soit plus un vain mot, mais se manifeste par des actes, décrète : les capitalistes, connus comme tels, verseront, etc. »
Vous qui vous récriez, quel droit avez-vous de blâmer Barbès et Sobrier ? Qu’ont-ils fait, si ce n’est être un peu plus conséquents que vous, et pousser un peu plus loin votre propre principe ?
Je dis que lorsque ce principe est introduit dans la législation, alors même qu’il n’y ferait d’abord qu’une apparition timide, il frappe d’inertie le capital et le travail ; car rien ne garantit qu’il ne se développera pas indéfiniment. Faut-il donc tant de raisonnements pour démontrer que, lorsque les hommes n’ont plus la certitude de jouir du fruit de leur travail, ils ne travaillent pas ou travaillent moins ? L’insécurité, qu’on le sache bien, est, pour les capitaux, le principal agent de la paralysation. Elle les chasse, elle les empêche de se former ; et que deviennent alors les classes mêmes dont on prétendait soulager les souffrances ? Je le pense sincèrement, cette cause seule suffit pour faire descendre en peu de temps la nation la plus prospère au-dessous de la Turquie.
Le sacrifice imposé aux uns en faveur des autres, par l’opération des taxes, perd évidemment le caractère de fraternité. Qui donc en a le mérite ? Est-ce le législateur ? Il ne lui en coûte que de déposer une boule dans l’urne. Est-ce le percepteur ? Il obéit à la crainte d’être destitué. Est-ce le contribuable ? Il paie à son corps défendant. À qui donc rapportera-t-on le mérite que le dévouement implique ? Où en cherchera-t-on la moralité ?
La spoliation extra-légale soulève toutes les répugnances, elle tourne contre elle toutes les forces de l’opinion et les met en harmonie avec les notions de justice. La spoliation légale s’accomplit, au contraire, sans que la conscience en soit troublée, ce qui ne peut qu’affaiblir au sein d’un peuple le sentiment moral.
Avec du courage et de la prudence, on peut se mettre à l’abri de la spoliation contraire aux lois. Rien ne peut soustraire à la spoliation légale. Si quelqu’un l’essaie, quel est l’affligeant spectacle qui s’offre à la société ? Un spoliateur armé de la loi, une victime résistant à la loi.
Quand, sous prétexte de fraternité, le Code impose aux citoyens des sacrifices réciproques, la nature humaine ne perd pas pour cela ses droits. L’effort de chacun consiste alors à apporter peu à la masse des sacrifices, et à en retirer beaucoup. Or, dans cette lutte, sont-ce les plus malheureux qui gagnent ? Non certes, mais les plus influents et les plus intrigants.
L’union, la concorde, l’harmonie, sont-elles au moins le fruit de la fraternité ainsi comprise ? Ah ! sans doute, la fraternité, c’est la chaîne divine qui, à la longue, confondra dans l’unité les individus, les familles, les nations et les races ; mais c’est à la condition de rester ce qu’elle est, c’est-à-dire le plus libre, le plus spontané, le plus volontaire, le plus méritoire, le plus religieux des sentiments. Ce n’est pas son masque qui accomplira le prodige, et la spoliation légale aura beau emprunter le nom de la fraternité, et sa figure, et ses formules, et ses insignes ; elle ne sera jamais qu’un principe de discorde, de confusion, de prétentions injustes, d’effroi, de misère, d’inertie et de haines.
On nous fait une grave objection. On nous dit : Il est bien vrai que la liberté, l’égalité devant la loi, c’est la justice. Mais la justice exacte reste neutre entre le riche et le pauvre, le fort et le faible, le savant et l’ignorant, le propriétaire et le prolétaire, le compatriote et l’étranger. Or, les intérêts étant naturellement antagoniques, laisser aux hommes leur liberté, ne faire intervenir entre eux que des lois justes, c’est sacrifier le pauvre, le faible, l’ignorant, le prolétaire, l’athlète qui se présente désarmé au combat.
« Que pouvait-il résulter, dit M. Considérant, de cette liberté industrielle, sur laquelle on avait tant compté, de ce fameux principe de libre concurrence, que l’on croyait si fortement doué d’un caractère d’organisation démocratique ? Il n’en pouvait sortir que l’asservissement général, l’inféodation collective des masses dépourvues de capitaux, d’armes industrielles, d’instruments de travail, d’éducation enfin, à la classe industriellement pourvue et bien armée. On dit : « La lice est ouverte, tous les individus sont appelés au combat, les conditions sont égales pour tous les combattants. » Fort bien, on n’oublie qu’une seule chose, c’est que, sur ce grand champ de guerre, les uns sont instruits, aguerris, équipés, armés jusqu’aux dents, qu’ils ont en leur possession un grand train d’approvisionnement, de matériel, de munitions et de machines de guerre, qu’ils occupent toutes les positions, et que les autres dépouillés, nus, ignorants, affamés, sont obligés, pour vivre au jour le jour et faire vivre leurs femmes et leurs enfants, d’implorer de leurs adversaires eux-mêmes un travail quelconque et un maigre salaire [4]. »
Quoi ! l’on compare le travail à la guerre ! Ces armes, qu’on nomme capitaux, qui consistent en approvisionnements de toute espèce, et qui ne peuvent jamais être employés qu’à vaincre la nature rebelle, on les assimile, par un sophisme déplorable, à ces armes sanglantes que, dans les combats, les hommes tournent les uns contre les autres ! En vérité, il est trop facile de calomnier l’ordre industriel quand, pour le décrire, on emprunte tout le vocabulaire des batailles.
La dissidence profonde, irréconciliable sur ce point entre les socialistes et les économistes, consiste en ceci : les socialistes croient à l’antagonisme essentiel des intérêts. Les économistes croient à l’harmonie naturelle, ou plutôt à l’harmonisation nécessaire et progressive des intérêts. Tout est là.
Partant de cette donnée que les intérêts sont naturellement antagoniques, les socialistes sont conduits, par la force de la logique, à chercher pour les intérêts une organisation artificielle, ou même à étouffer, s’ils le peuvent, dans le cœur de l’homme, le sentiment de l’intérêt. C’est ce qu’ils ont essayé au Luxembourg. Mais s’ils sont assez fous, ils ne sont pas assez forts, et il va sans dire qu’après avoir déclamé, dans leurs livres, contre l’individualisme, ils vendent leurs livres et se conduisent absolument comme le vulgaire dans le train ordinaire de la vie.
Ah ! sans doute, si les intérêts sont naturellement antagoniques, il faut fouler aux pieds la Justice, la Liberté, l’Égalité devant la loi. Il faut refaire le monde, ou, comme ils disent, reconstituer la société sur un des plans nombreux qu’ils ne cessent d’inventer. À l’intérêt, principe désorganisateur, il faut substituer le dévouement légal, imposé, involontaire, forcé, en un mot la Spoliation organisée ; et comme ce nouveau principe ne peut que soulever des répugnances et des résistances infinies, on essaiera d’abord de le faire accepter sous le nom menteur de Fraternité, après quoi on invoquera la loi, qui est la force.
Mais si la Providence ne s’est pas trompée, si elle a arrangé les choses de telle sorte que les intérêts, sous la loi de justice, arrivent naturellement aux combinaisons les plus harmoniques ; si, selon l’expression de M. de Lamartine, ils se font par la liberté une justice que l’arbitraire ne peut leur faire ; si l’égalité des droits est l’acheminement le plus certain, le plus direct vers l’égalité de fait, oh ! alors, nous pouvons ne demander à la loi que justice, liberté, égalité, comme on ne demande que l’éloignement des obstacles pour que chacune des gouttes d’eau qui forment l’Océan prenne son niveau.
Et c’est là la conclusion à laquelle arrive l’Économie politique. Cette conclusion, elle ne la cherche pas, elle la trouve ; mais elle se réjouit de la trouver ; car enfin, n’est-ce pas une vive satisfaction pour l’esprit que de voir l’harmonie dans la liberté, quand d’autres sont réduits à la demander à l’arbitraire ?
Les paroles haineuses que nous adressent souvent les socialistes sont en vérité bien étranges ! Eh quoi ! si par malheur nous avons tort, ne devraient-ils pas le déplorer ? Que disons-nous ? Nous disons : Après mûr examen, il faut reconnaître que Dieu a bien fait, en sorte que la meilleure condition du progrès, c’est la justice et la liberté.
Les Socialistes nous croient dans l’erreur ; c’est leur droit. Mais ils devraient au moins s’en affliger ; car notre erreur, si elle est démontrée, implique l’urgence de substituer l’artificiel au naturel, l’arbitraire à la liberté, l’invention contingente et humaine à la conception éternelle et divine.
Supposons qu’un professeur de chimie vienne dire : « Le monde est menacé d’une grande catastrophe ; Dieu n’a pas bien pris ses précautions. J’ai analysé l’air qui s’échappe des poumons humains, et j’ai reconnu qu’il n’était plus propre à la respiration ; en sorte qu’en calculant le volume de l’atmosphère, je puis prédire le jour où il sera vicié tout entier, et où l’humanité périra par la phtisie, à moins qu’elle n’adopte un mode de respiration artificielle de mon invention. »
Un autre professeur se présente et dit : « Non, l’humanité ne périra pas ainsi. Il est vrai que l’air qui a servi à la vie animale est vicié pour cette fin ; mais il est propre à la vie végétale, et celui qu’exhalent les végétaux est favorable à la respiration de l’homme. Une étude incomplète avait induit à penser que Dieu s’était trompé ; une recherche plus exacte montre qu’il a mis l’harmonie dans ses œuvres. Les hommes peuvent continuer à respirer comme la nature l’a voulu. »
Que dirait-on si le premier professeur accablait le second d’injures, en disant : « Vous êtes un chimiste au cœur dur, sec et froid ; vous prêchez l’horrible laisser-faire ; vous n’aimez pas l’humanité, puisque vous démontrez l’inutilité de mon appareil respiratoire ? »
Voilà toute notre querelle avec les socialistes. Les uns et les autres nous voulons l’harmonie. Ils la cherchent dans les combinaisons innombrables qu’ils veulent que la loi impose aux hommes ; nous la trouvons dans la nature des hommes et des choses.
Ce serait ici le lieu de démontrer que les intérêts tendent à l’harmonie, car c’est toute la question ; mais il faudrait faire un cours d’économie politique, et le lecteur m’en dispensera pour le moment [5]. Je dirai seulement ceci : Si l’Économie politique arrive à reconnaître l’harmonie des intérêts, c’est qu’elle ne s’arrête pas, comme le Socialisme, aux conséquences immédiates des phénomènes, mais qu’elle va jusqu’aux effets ultérieurs et définitifs. C’est là tout le secret. Les deux écoles différent exactement comme les deux chimistes dont je viens de parler ; l’une voit la partie, et l’autre l’ensemble. Par exemple, quand les socialistes voudront se donner la peine de suivre jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au consommateur, au lieu de s’arrêter au producteur, les effets de la concurrence, ils verront qu’elle est le plus puissant agent égalitaire et progressif, qu’elle se fasse à l’intérieur ou qu’elle vienne du dehors. Et c’est parce que l’économie politique trouve, dans cet effet définitif, ce qui constitue l’harmonie, qu’elle dit : Dans mon domaine, il y a beaucoup à apprendre et peu à faire. Beaucoup à apprendre, puisque l’enchaînement des effets ne peut être suivi qu’avec une grande application ; peu à faire, puisque de l’effet définitif sort l’harmonie du phénomène tout entier.
Il m’est arrivé de discuter cette question avec l’homme éminent que la Révolution a élevé à une si grande hauteur. Je lui disais : La loi agissant par voie de contrainte, on ne peut lui demander que la justice. Il pensait que les peuples peuvent de plus attendre d’elle la Fraternité. Au mois d’août dernier, il m’écrivait : « Si jamais, dans un temps de crise, je parviens au timon des affaires, votre idée sera la moitié de mon symbole. » Et moi, je lui réponds ici : « La seconde moitié de votre symbole étouffera la première, car vous ne pouvez faire de la fraternité légale sans faire de l’injustice légale [6]. »
En terminant, je dirai aux Socialistes : Si vous croyez que l’économie politique repousse l’association, l’organisation, la fraternité, vous êtes dans l’erreur.
L’association ! Et ne savons-nous pas que c’est la société même se perfectionnant sans cesse ?
L’organisation ! Et ne savons-nous pas qu’elle fait toute la différence qu’il y a entre un amas d’éléments hétérogènes et les chefs-d’œuvre de la nature ?
La fraternité ! Et ne savons-nous pas qu’elle est à la justice ce que les élans du cœur sont aux froids calculs de l’esprit ?
Nous sommes d’accord avec vous là-dessus ; nous applaudissons à vos efforts pour répandre sur le champ de l’humanité une semence qui portera ses fruits dans l’avenir.
Mais nous nous opposons à vous, dès l’instant que vous faites intervenir la loi et la taxe, c’est-à-dire la contrainte et la spoliation ; car, outre que ce recours à la force témoigne que vous avez plus de foi en vous que dans le génie de l’humanité, il suffit, selon nous, pour altérer la nature même et l’essence de ce dogme dont vous poursuivez la réalisation [7].
FN:Article inséré au n° du 15 juin 1848, du Journal des économistes. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome V, le pamphlet Capital et Rente, et aux Harmonies économiques, tome VI, le chapitre vii.(Note de l’éditeur.)
FN:Dans la pratique, les hommes ont toujours distingué entre un marché et un acte de pure bienveillance. Je me suis plu quelquefois à observer l’homme le plus charitable, le cœur le plus dévoué, l’âme la plus fraternelle que je connaisse. Le curé de mon village pousse à un rare degré l’amour du prochain et particulièrement du pauvre. Cela va si loin que lorsque, pour venir au secours du pauvre, il s’agit de soutirer l’argent du riche, le brave homme n’est pas très-scrupuleux sur le choix des moyens.
Il avait retiré chez lui une religieuse septuagénaire, de celles que la révolution avait dispersées dans le monde. Pour donner une heure de distraction à sa pensionnaire, lui, qui n’avait jamais touché une carte, apprit le piquet ; et il fallait le voir se donner l’air d’être passionné pour le jeu, afin que la religieuse se persuadât à elle-même qu’elle était utile à son bienfaiteur. Cela a duré quinze ans. Mais voici ce qui transforme un acte de simple condescendance en véritable héroïsme. — La bonne religieuse était dévorée d’un cancer, qui répandait autour d’elle une horrible puanteur, dont elle n’avait pas la conscience. Or, on remarqua que le curé ne prenait jamais de tabac pendant la partie, de peur d’éclairer la pauvre infirme sur sa triste position. — Combien de gens ont eu la croix, ce 1er mai, incapables de faire un seul jour ce que mon vieux prêtre a fait pendant quinze années !
Eh bien ! j’ai observé ce prêtre et je puis assurer que, lorsqu’il faisait un marché, il était tout aussi vigilant qu’un honorable commerçant du Marais. Il défendait son terrain, regardait au poids, à la mesure, à la qualité, au prix, et ne se croyait nullement tenu de mêler la charité et la fraternité à cette affaire.
Dépouillons donc ce mot Fraternité de tout ce que, dans ces derniers temps, on y a joint de faux, de puéril et de déclamatoire.(Ébauche inédite de l’auteur, écrite vers la fin de 1847.)
FN:Voy., ci-après Propriété et Spoliation, y compris la note finale. Voy. aussi, au tome II, la réponse à une lettre de M. Considérant.(Note de l’éditeur.)
FN:Déjà plusieurs chapitres des Harmonies économiques avaient alors été publiés dans le Journal des Économistes, et l’auteur ne devait pas tarder à continuer cet ouvrage.(Note de l’éditeur.)
FN:Au moment où l’on préparait à Marseille, en août 1847, une réunion publique en faveur de la liberté des échanges, Bastiat rencontra M. de Lamartine en cette ville et s’entretint longuement avec lui de la liberté commerciale, puis de la liberté en toute chose, dogme fondamental de l’économie politique. — Voy., au t. II, la note qui suit le discours prononcé à Marseille. Voy. aussi, au t. Ier, les deux lettres à M. de Lamartine. (Note de l’éditeur.
FN:« Il y a trois régions pour l’Humanité : une inférieure, celle de la Spoliation ; — une supérieure, celle de la Charité ; — une intermédiaire, celle de la Justice. »
« Les Gouvernements n’exercent jamais qu’une action qui a pour sanction la Force. Or, il est permis de forcer quelqu’un d’être juste, non de le forcer d’être charitable. La Loi, quand elle veut faire par la force ce que la morale fait faire par la persuasion, bien loin de s’élever à la région de la Charité, tombe dans le domaine de la Spoliation. »
« Le propre domaine de la Loi et des Gouvernements, c’est la Justice. »
Cette pensée de l’auteur fut écrite de sa main sur un album d’autographes, qu’envoya la Société des gens de lettres, en 1850, à l’exposition de Londres. Nous la reproduisons là, parce qu’elle nous semble résumer le pamphlet qui précède.(Note de l’éditeur.)
Individualisme et fraternité [June 1848] [CW2.6]↩
BWV
1848.06 “Individualisme et fraternité” (Individualism and Fraternity) [June 1848] [OC7.76, p. 328] [CW2]
Source
<abc>
Une vue systématique de l’histoire et de la destinée de l’homme s’est récemment produite qui me semble aussi fausse que dangereuse.
Selon ce système, trois principes se partagent le monde : l’Autorité, l’Individualisme et la Fraternité.
L’autorité répond aux âges aristocratiques ; l’Individualisme au règne de la bourgeoisie ; la Fraternité au triomphe du peuple.
Le premier de ces principes s’est surtout incarné dans le Pape. Il mène à l’oppression par l’étouffement de la personnalité.
Le second, inauguré par Luther, mène à l’oppression par l’anarchie.
Le troisième, annoncé par les penseurs de la Montagne, enfante la vraie liberté, en enveloppant les hommes dans les liens d’une harmonieuse association.
Le peuple n’ayant été le maître que dans un pays, la France, et dans une courte période, celle de 93, nous ne connaissons encore la valeur théorique et les charmes pratiques de la fraternité que par l’essai qui en fut fait tumultueusement à cette époque. Malheureusement l’union et l’amour, personnifiés dans Robespierre, ne purent étouffer qu’à demi l’Individualisme, qui reparut le lendemain du 9 thermidor. Il règne encore.
Qu’est-ce donc que l’Individualisme ? L’auteur de l’ouvrage auquel nous faisons allusion le définit ainsi :
« Le principe d’individualisme est celui qui, prenant l’homme en dehors de la société, le rend seul juge de ce qui l’entoure et de lui-même, lui donne un sentiment exalté de ses droits sans lui indiquer ses devoirs, l’abandonne à ses propres forces, et, pour tout gouvernement, proclame le laisser-faire [1]. »
Ce n’est pas tout. L’Individualisme, ce mobile de la bourgeoisie, devait envahir les trois grandes branches de l’activité humaine, la religion, la politique et l’industrie. De là trois grandes écoles individualistes : l’école philosophique, dont Voltaire fut le chef, en demandant la liberté de penser, nous a amenés à une profonde anarchie morale ; l’école politique, fondée par Montesquieu, au lieu de la liberté politique, nous a valu une oligarchie de censitaires ; et l’école économiste, représentée par Turgot, au lieu de la liberté de l’industrie, nous a légué la concurrence du riche et du pauvre, au profit du riche [2].
On voit que l’humanité a été bien mal inspirée jusqu’ici, et qu’elle s’est trompée dans toutes les directions. Ce n’a pourtant pas été faute d’avertissements, car le principe de la fraternité a toujours fait ses protestations et ses réserves par la voix de Jean Huss, de Morelli, de Mably, de Rousseau et par les efforts de Robespierre.
Mais qu’est-ce que la fraternité ? « Le principe de la fraternité est celui qui, regardant comme solidaires les membres de la grande famille, tend à organiser un jour les sociétés, œuvre de l’homme, sur le modèle du corps humain, œuvre de Dieu, et fonde la puissance de gouverner sur la persuasion, sur le volontaire assentiment du cœur [3]. »
Tel est le système de M. Blanc. Ce qui le rend dangereux, à mes yeux, outre le talent avec lequel il est exposé, c’est que le vrai et le faux s’y mêlent en proportions qu’il est difficile d’apprécier. Je n’ai pas l’intention de l’examiner dans toutes ses branches symétriques. Pour me conformer aux exigences de ce recueil, je le considérerai principalement au point de vue de l’économie politique.
J’avoue que lorsqu’il s’agit d’énoncer le principe qui, à une époque donnée, anime le corps social, je voudrais qu’il fût exprimé par des mots moins vagues que ceux d’individualisme et fraternité.
L’individualisme est un mot nouveau simplement substitué au mot égoïsme. C’est l’exagération du sentiment de la personnalité.
L’homme est un être essentiellement sympathique. Plus sa puissance de sympathie se concentre sur lui-même, plus il est égoïste. Plus elle se répand sur ses semblables, plus il est philanthrope.
L’égoïsme est donc comme tous les autres vices, comme toutes les autres déviations de nos qualités morales, c’est-à-dire aussi ancien que l’homme même. On en peut dire autant de la philanthropie. À toutes les époques, sous tous les régimes, dans toutes les classes, il y a eu des hommes durs, froids, personnels, rapportant tout à eux-mêmes, et d’autres bons, généreux, humains, dévoués. Il ne me semble pas qu’on puisse faire d’une de ces dispositions de l’âme, pas plus que de la colère ou de la douceur, de l’énergie ou de la faiblesse, le principe sur lequel repose la société.
Il est donc impossible d’admettre qu’à partir d’une date déterminée dans l’histoire, par exemple à partir de Luther, tous les efforts de l’humanité aient été, systématiquement et pour ainsi dire providentiellement, consacrés au triomphe de l’individualisme.
Sur quel fondement pourrait-on prétendre que l’exagération du sentiment de la personnalité est née dans les temps modernes ? Est ce que les peuples anciens, quand ils pillaient et ravageaient le monde, quand ils réduisaient les vaincus en esclavage, n’agissaient pas sous l’influence d’un égoïsme porté au plus haut degré ? Si, pour s’assurer la victoire, pour vaincre la résistance, pour échapper au sort affreux qu’elles réservaient à ceux qu’elles appelaient barbares, ces associations guerrières sentaient le besoin de l’union, si même l’individu était disposé à y faire de véritables sacrifices, l’égoïsme, pour être collectif, en était-il moins de l’égoïsme ?
J’en dirai autant de la domination par l’autorité théologique. Que, pour asservir les hommes, on emploie la force ou la ruse, qu’on exploite leur faiblesse ou leur crédulité, le fait même d’une domination injuste ne révèle-t-il pas dans le dominateur le sentiment de l’égoïsme ? Le prêtre égyptien, qui imposait de fausses croyances à ses semblables pour se rendre maître de leurs actions et même de leurs pensées, ne recherchait-il pas son avantage personnel par les moyens les plus immoraux ?
À mesure que les peuples sont devenus forts, ils ont repoussé la spoliation réalisée par la force. — Ils se sont avancés vers la propriété du travail et la liberté de l’industrie ; et voilà que vous découvrez dans la liberté de l’industrie une première manifestation de l’individualisme !
Mais vous qui ne voulez pas que le travail soit libre, vous voulez donc qu’il soit contraint, car il n’y a pas de terme moyen. Il y en a un, dites-vous, l’association. — C’est une confusion de mots, car si l’association est volontaire, le travail ne cesse pas d’être libre. Ce n’est pas aliéner sa liberté que de former avec ses semblables des conventions, des associations volontaires.
À mesure que les hommes se sont éclairés, ils ont réagi contre les superstitions, les fausses croyances, les opinions imposées. Et voilà que vous découvrez dans le libre examen une seconde manifestation de l’Individualisme !
Mais vous qui n’admettez ni l’autorité ni le libre examen, que mettez vous donc à la place ? La fraternité, dites-vous. La fraternité mettra-t-elle dans mon intelligence des idées qui ne soient ni reçues par elle toutes faites, ni élaborées par son propre exercice ?
Vous ne voulez pas que l’homme examine les opinions ! Je conçois cette intolérance dans les théologiens. Ils sont conséquents. Ils disent : cherchez la vérité en toutes choses, traditus est mundus disputotionibus eorum, quand Dieu ne l’a pas révélée. Là où il a dit : voilà la vérité, il serait absurde que vous voulussiez examiner.
Mais les modernes socialistes, de quel droit nous refusent-ils le libre examen dont ils usent si amplement ? Ils n’ont qu’un moyen de courber nos esprits ; c’est de se prétendre inspirés. Quelques-uns l’ont essayé, mais jusqu’ici ils n’ont pas montré leurs titres de prophètes.
Sans accuser les intentions, je dis qu’il y a au fond de ces doctrines le plus irrationnel de tous les despotismes, et, par conséquent, de tous les individualismes. Quoi de plus tyrannique que de vouloir régenter notre travail et notre intelligence, abstraction faite de toute autorité surnaturelle qu’on n’invoque même pas ? Il n’est pas surprenant qu’on aboutisse avoir le type, le héros, l’apôtre de la fraternité ainsi comprise dans Robespierre.
Si l’individualisme n’est pas le mobile exclusif d’une période prise dans l’histoire moderne, il n’est pas davantage le principe qui dirige une classe à l’exclusion de toutes les autres.
Dans les sciences morales, une certaine symétrie d’exposition se prend souvent pour la vérité. Méfions-nous de cette superficielle apparence.
C’est ainsi que s’est accréditée cette opinion que les nations modernes se composent de trois classes : aristocratie, bourgeoisie, peuple. De là on conclut qu’il y a le même antagonisme entre les deux dernières classes qu’entre les deux premières. La bourgeoisie, dit-on, a renversé l’aristocratie et s est mise à sa place. À l’égard du peuple, elle constitue une autre aristocratie et sera à son tour renversée par lui.
Pour moi, je ne vois dans la société que deux classes. Des conquérants qui fondant sur un pays, s’emparent des terres, des richesses, de la puissance législative et judiciaire ; et un peuple vaincu, qui souffre, travaille, grandit, brise ses chaînes, reconquiert ses droits, se gouverne tant bien que mal, fort mal pendant longtemps, est dupe de beaucoup de charlatans, est souvent trahi par les siens, s’éclaire par l’expérience et arrive progressivement à l’égalité par la liberté, et à la fraternité par l’égalité.
Chacune de ces deux classes obéit au sentiment indestructible de la personnalité. Mais si ce sentiment mérite le nom d’individualisme, c’est certainement dans la classe conquérante et dominatrice.
Il est vrai qu’au sein du peuple, il y a des hommes plus ou moins riches à des degrés infinis. Mais la différence de richesses ne suffit pas pour constituer deux classes. Tant qu’un homme du peuple ne se retourne pas contre le peuple lui-même pour l’exploiter, tant qu’il ne doit sa fortune qu’au travail, à l’ordre, à l’économie, quelques richesses qu’il acquière, quelque influence que lui donnent les richesses, il reste peuple ; et c’est un abus de mots que de prétendre qu’il entre dans une autre classe, dans une classe aristocratique.
S’il en était ainsi, voyez quelles seraient les conséquences. L’artisan honnête, laborieux, prévoyant, qui s’impose de dures privations, qui accroît sa clientèle par la confiance qu’il inspire, qui donne à son fils une éducation un peu plus complète que celle qu’il a reçue lui-même, cet artisan serai sur le chemin de la bourgeoisie. C’est un homme dont il faut se méfier, c’est un aristocrate en herbe, c’est un individualiste.
S’il est, au contraire, paresseux, dissipé, imprévoyant, s’il manque tout à fait de cette énergie si nécessaire pour accumuler quelques épargnes, alors on sera sûr qu’il restera peuple. Il appartiendra au principe de la fraternité.
Et maintenant, tous ces hommes retenus dans les rangs les plus infimes de la société par l’imprévoyance, le vice, et trop souvent, j’en conviens, par le malheur, comment entendront-ils le principe de l’égalité et de la fraternité ? Qui sera leur défenseur, leur idole, leur apôtre ? ai-je besoin de le nommer ?…
Abandonnant le terrain de la polémique, j’essayerai, autant que mes forces et le temps me le permettent, de considérer la personnalité et la fraternité au point de vue de l’économie politique.
Je commencerai par le déclarer très franchement : le sentiment de la personnalité, l’amour du moi, l’instinct de la conservation, le désir indestructible que l’homme porte en lui-même de se développer, d’accroître la sphère de son action, d’augmenter son influence, l’aspiration vers le bonheur, en un mot, l’individualité me semble être le point de départ, le mobile, le ressort universel auquel la Providence a confié le progrès de l’humanité. C’est bien vainement que ce principe soulèverait l’animadversion des socialistes modernes. Hélas ! qu’ils rentrent en eux-mêmes, qu’ils descendent au fond de leur conscience, et ils y retrouveront ce principe, comme on trouve la gravitation dans toutes les molécules de la matière. Ils peuvent reprocher à la Providence d’avoir fait l’homme tel qu’il est ; rechercher, par passe-temps, ce qu’il adviendrait de la société, si la Divinité, les admettant dans son conseil, modifiait sa créature sur un autre plan. Ce sont des rêveries qui peuvent amuser l’imagination ; mais ce n’est pas sur elles qu’on fondera les sciences sociales.
Il n’est aucun sentiment qui exerce dans l’homme une action aussi constante, aussi énergique que le sentiment de la personnalité.
Nous pouvons différer sur la manière de comprendre le bonheur, le chercher dans la richesse, dans la puissance, dans la gloire, dans la terreur que nous inspirons, dans la sympathie de nos semblables, dans les satisfactions de la vanité, dans la couronne des élus ; mais nous le cherchons toujours et nous ne pouvons pas ne pas le chercher.
De là il faut conclure que l’individualisme, qui est le sentiment de la personnalité pris dans un mauvais sens, est aussi ancien que ce sentiment lui-même, car il n’est pas une de ses qualités, surtout la plus inhérente à sa nature, dont l’homme ne puisse abuser, et n’ait abusé à toutes les époques. Prétendre que le sentiment de la personnalité a toujours été contenu dans de justes bornes, excepté depuis le temps de Luther et parmi les bourgeois, cela ne peut être considéré que comme un jeu d’esprit.
Je pense qu’on pourrait avec plus de raison soutenir la thèse contraire, en tous cas plus consolante, et voici mes raisons.
C’est une vérité triste, mais d’expérience, que les hommes en général donnent pleine carrière au sentiment de la personnalité, et par conséquent en abusent, jusqu’au point où ils le peuvent faire avec impunité. Je dis en général, parce que je suis loin de prétendre que les inspirations de la conscience, la bienveillance naturelle, les prescriptions religieuses n’aient pas suffi souvent pour empêcher la personnalité de dégénérer en égoïsme. Mais on peut affirmer que l’obstacle général au développement exagéré, à l’abus de la personnalité n’est pas en nous, mais hors de nous. Il est dans les autres personnalités dont nous sommes entourés et qui réagissent, quand nous les froissons, au point de nous tenir en échec, qu’on me pardonne cette expression.
Cela posé, plus une agglomération d’hommes s’est trouvée environnée d’êtres faibles ou crédules, moins elle a rencontré d’obstacles en eux, plus en elle le sentiment de la personnalité a dû acquérir d’énergie, et franchir les limites conciliables avec le bien général.
Aussi, nous voyons les peuples de l’antiquité désolés par la guerre, l’esclavage, la superstition et le despotisme, toutes manifestations de l’égoïsme chez les hommes plus forts ou plus éclairés que leurs semblables. Ce n’est jamais par son action sur lui-même, pour obéir aux lois de la morale, que le sentiment de la personnalité est rentré dans ses justes limites. Pour l’y réduire, il a fallu que la force et la lumière devinssent l’héritage commun des masses ; et alors il a bien fallu que, manifesté par la force, l’individualisme s’ arrêtât devant une force supérieure, et que, manifesté par la ruse, il pérît faute d’être alimenté par la crédulité publique.
On trouvera peut-être que représenter les personnalités comme dans un état d’antagonisme toujours virtuellement existant, et qui ne peut être contenu que par l’équilibre des forces et des lumières, c’est une doctrine bien triste. Il s’ensuivrait que, dès que cet équilibre est rompu, dès qu’un peuple ou une classe se reconnaissent doués d’une force irrésistible, ou d’une supériorité intellectuelle propre à leur asservir les autres peuples ou les autres classes, le sentiment de la personnalité est toujours prêt à franchir ses limites et à dégénérer en égoïsme, en oppression.
Il ne s’agit pas de savoir si cette doctrine est triste, mais si elle est vraie, et si la constitution de l’homme n’est pas telle qu’il doive conquérir son indépendance, sa sécurité par le développement de ses forces et de son intelligence. La vie est un combat. Cela a été vrai jusqu’ici, et nous n’avons aucune raison de croire que cela cessera de l’être jamais, tant que l’homme portera dans son cœur ce sentiment de la personnalité, toujours si disposé à sortir de ses bornes.
Les écoles socialistes s’efforcent de remplir le monde d’espérances que nous ne pouvons nous empêcher de considérer comme chimériques, précisément parce qu’elles ne tiennent aucun compte, dans leurs vaines théories, de ce sentiment indélébile et de la pente irrésistible qui le pousse, s’il n’est contenu, vers sa propre exagération.
Nous avons beau chercher, dans leurs systèmes de séries, d’harmonies, l’obstacle à l’abus de la personnalité, nous ne le trouvons jamais. Les socialistes nous paraissent tourner sans cesse dans ce cercle vicieux : si tous les hommes voulaient être dévoués, nous avons trouvé des formes sociales qui maintiendront entre eux la fraternité et l’harmonie.
Aussi, quand ils arrivent à proposer quelque chose qui ressemble à de la pratique, on les voit toujours diviser l’humanité en deux parts. D’un côté l’État, le pouvoir dirigeant, qu’ils supposent infaillible, impeccable, dénué de tout sentiment de personnalité ; de l’autre le peuple, n’ayant plus besoin de prévoyance ni de garanties.
Pour réaliser leurs plans, ils sont réduits à confier la direction du monde à une puissance prise, pour ainsi dire, en dehors de l’humanité. Ils inventent un mot : l’État. Ils supposent que l’État est un être existant par lui-même, possédant des richesses inépuisables, indépendantes de celles de la société ; qu’au moyen de ces richesses, l’État peut fournir du travail à tous, assurer l’existence de tous. Ils ne prennent pas garde que l’État ne peut jamais que rendre à la société des biens qu’il a commencé par lui prendre ; qu’il ne peut même lui en rendre qu’une partie ; que de plus l’État est composé d’hommes, et que ces hommes portent aussi en eux-mêmes le sentiment de la personnalité, enclin chez eux, comme chez les gouvernés, à dégénérer en abus ; qu’une des plus grandes tentations pour que la personnalité d’un homme froisse celle de ses semblables, c’est que cet homme soit puissant, en mesure de vaincre les résistances. Les socialistes, à la vérité, espèrent sans doute, quoiqu’ils ne s’expliquent guère à ce sujet, que l’État sera soutenu par des institutions, par les lumières, la prévoyance, la surveillance assidue et sévère des masses. Mais, s’il en est ainsi, il faut que ces masses soient éclairées et prévoyantes ; et le système que j’examine tend précisément à détruire la prévoyance dans les masses, puisqu’il charge l’État de pourvoir à toutes les nécessités, de combattre tous les obstacles, de prévoir pour tout le monde.
Mais, dira-t-on, si le sentiment de la personnalité est indestructible, s’il a une pente funeste à dégénérer en abus, si la force qui le réprime n’est pas en nous, mais hors de nous, s’il n’est contenu dans de justes bornes que par la résistance et la réaction des autres personnalités, si les hommes qui exercent le pouvoir n’échappent pas plus à cette loi que les hommes sur qui le pouvoir s’exerce, alors la société ne peut se maintenir dans le bon ordre que par une vigilance incessante de tous ses membres à l’égard les uns des autres, et spécialement des gouvernés à l’égard des gouvernants, un antagonisme radical est irrémédiable ; nous n’avons d’autres garanties contre l’oppression qu’une sorte d’équilibre entre tous les individualismes repoussés les uns par les autres, et la fraternité, ce principe si consolant, dont le seul nom touche et attire les cœurs, qui pourrait réaliser les espérances de tous les hommes de bien, unir les hommes par les liens de la sympathie, ce principe proclamé, il y a dix-huit siècles, par une voix que l’humanité presque tout entière a tenue pour divine, serait à jamais banni du monde.
À Dieu ne plaise que telle soit notre pensée. Nous avons constaté que le sentiment de l’individualité était la loi générale de l’homme, et nous croyons ce fait hors de doute.
Il s’agit maintenant de savoir si l’intérêt bien entendu et permanent d’un homme, d’une classe, d’une nation est radicalement opposé à l’intérêt d’un autre homme, d’une autre classe, d’une autre nation. S’il en est ainsi, il faut le déclarer avec douleur, mais avec vérité : la fraternité n’est qu’un rêve ; car il ne faut pas s’attendre à ce que chacun se sacrifie aux autres ; et cela fût-il, on ne voit pas ce que l’humanité y gagnerait, puisque le sacrifice de chacun équivaudrait au sacrifice de l’humanité entière : ce serait le malheur universel.
Mais si, au contraire, en étudiant l’action que les hommes exercent les uns sur les autres, nous découvrons que leurs intérêts généraux concordent, que le progrès, la moralité, la richesse de tous sont la condition du progrès, de la moralité, de la richesse de chacun, alors nous comprendrons comment le sentiment de l’individualité se réconcilie avec celui de la fraternité.
À une condition cependant : c’est que cet accord ne consiste pas en une vaine déclamation ; c’est qu’il soit clairement, rigoureusement, scientifiquement démontré.
Alors, à mesure que cette démonstration sera mieux comprise, qu’elle pénétrera dans un plus grand nombre d’intelligences, c’est-à-dire à mesure du progrès des lumières et de la science morale, le principe de la fraternité s’étendra de plus en plus sur l’humanité.
Or c’est cette démonstration consolante que nous nous croyons en mesure de faire.
Et d’abord que faut-il entendre par le mot fraternité ?
Faut-il prendre ce mot, comme on dit, au pied de la lettre ? et implique t-il que nous devons aimer tous les hommes actuellement vivants sur la surface du globe comme nous aimons le frère qui a été conçu dans les mêmes entrailles, nouri du même lait, dont nous avons partagé le berceau, les jeux, les émotions, les souffrances et les joies ? Évidemment ce n’est pas dans ce sens qu’il faut comprendre ce mot. Il n’est pas un homme qui pût exister quelques minutes, si chaque douleur, chaque revers, chaque décès qui survient dans le monde devait exciter en lui la même émotion que s’il s’agissait de son frère ; et si MM. les socialistes sont exigeants à ce point (et ils le sont beaucoup… pour les autres), il faut leur dire que la nature a été moins exigeante. Nous aurions beau nous battre les flancs, tomber dans l’affectation, si commune de nos jours, en paroles, nous ne pourrions jamais, et fort heureusement, exalter notre sensibilité à ce degré. Si la nature s’y oppose, la morale nous le défend aussi. Nous avons tous des devoirs à remplir envers nous-mêmes, envers nos proches, nos amis, nos collègues, les personnes dont l’existence dépend de nous. Nous nous devons aussi à la profession, aux fonctions qui nous sont dévolues. Pour la plupart d’entre nous, ces devoirs absorbent toute notre activité ; et il est impossible que nous puissions avoir toujours à la pensée et pour but immédiat l’intérêt général de l’humanité. La question est de savoir si la force des choses, telle qu’elle résulte de l’organsation de l’homme et de sa perfectibilité, ne fait pas que l’intérêt de chacun se confond de plus en plus avec l’intérêt de tous, si nous ne sommes pas graduellement amenés par l’observation, et au besoin par l’expérience, à désirer le bien général, et, par conséquent, à y contribuer ; auquel cas, le principe de la fraternité naîtrait du sentiment même de la personnalité avec lequel il semble, au premier coup d’œil, en opposition.
Ici j’ai besoin de revenir sur une idée fondamentale, que j’ai déjà exposée dans ce recueil, aux articles intitulés : concurrence, population.
À l’exception des relations de parenté et des actes de pure bienveillance et d’abnégation, je crois qu’on peut dire que toute l’économie de la société repose sur un échange volontaire de services.
Mais, pour prévenir toute fausse interprétation, je dois dire un mot de l’abnégation, qui est le sacrifice volontaire du sentiment de la personnalité.
On accuse les économistes de ne pas tenir compte de l’abnégation, peut-être de la dédaigner. À Dieu ne plaise que nous voulions méconnaître ce qu’il y a de puissance et de grandeur dans l’abnégation. Rien de grand, rien de généreux, rien de ce qui excite la sympathie et l’admiration des hommes ne s’est accompli que par le dévouement. L’homme n’est pas seulement une intelligence, il n’est pas seulement calculateur. Il a une âme, dans cette âme il y a un germe sympathique, et ce germe peut être développé jusqu’à l’amour universel, jusqu’au sacrifice le plus absolu, jusqu’à produire ces actions généreuses dont le simple récit appelle les larmes à nos paupières.
Mais les économistes ne pensent pas que le train ordinaire de la vie, les actes journaliers, continus, par lesquels les hommes pourvoient à leur conservation, à leur subsistance et à leur développement, puissent être fondés sur le principe de l’abnégation. Or ce sont ces actes, ces transactions librement débattues qui font l’objet de l’économie politique. Le domaine en est assez vaste pour constituer une science. Les actions des hommes ressortent de plusieurs sciences : en tant qu’elles donnent lieu à la contestation, elles appartiennent à la science du droit ; en tant qu’elles sont soumises à l’influence directe du pouvoir établi, elles appartiennent à la politique ; en tant qu’elles exigent cet effort qu’on nomme vertu, elles ressortent de la morale ou de la religion.
Aucune de ces sciences ne peut se passer des autres, encore moins les contredire. Mais il ne faut pas exiger qu’une seule les embrasse toutes complétement. Et quoique les économistes parlent peu d’abnégation, parce que ce n’est pas leur sujet, nous osons affirmer que leur biographie, sous ce rapport, peut soutenir le parallèle avec celle des écrivains qui ont embrassé d’autres doctrines. De même le prêtre qui parle peu de valeur, de concurrence, parce que ces choses ne rentrent que bien indirectement dans la sphère de ses prédications, exécute ses achats et ses ventes absolument comme le vulgaire. On en peut dire autant des socialistes.
Disons donc que, dans les actions humaines, celles qui font le sujet de la science économique consistent en échange de services.
Peut-être trouvera-t-on que c’est ravaler la science ; mais je crois sincèrement qu’elle est considérable, quoique plus simple qu’on ne le suppose, et qu’elle repose tout entière sur ces vulgarités : donne-moi ceci, et je te donnerai cela ; fais ceci pour moi, et je ferai cela pour toi. Je ne puis pas concevoir d’autres formes aux transactions humaines. L’intervention de la monnaie, des négociants, des intermédiaires, peut compliquer cette forme élémentaire, et nous en obscurcir la vue. Elle n’en est pas moins le type de tous les faits économiques……
FN: Histoire de la Révolution française, par Louis Blanc, t. Ier, p. 9.
FN:Louis Blanc, Histoire de la Révolution, t. Ier, p. 360.
FN:Bastiat n’ayant pas achevé de copier de sa main, sur son manuscrit, le passage du livre dont il s’occupe, j’ai dû combler cette lacune et donner la phrase entière. À propos des derniers mots, je me permets de dire qu’ils impliquent contradiction avec la pensée de réaliser un système social quelconque par l’intervention de l’État, c’est-à-dire par la force. Ceux qui proposent des systèmes sociaux de leur invention ne bornent, pas plus que Robespierre, leur prétention à persuader, à obtenir le volontaire assentiment des cœurs, et ne sont pas mieux fondés que lui à se placer sous le drapeau de la liberté. (Note de l’éditeur.)
Propriété et spoliation [24 July 1848] [CW2.10]↩
BWV
1848.07.24 “Propriété et spoliation” (Property and Plunder) [*Journal des débats*, 24 July 1848] [OC4.7, p. 394] [CW2]
Source
OC vol. 4 Sophismes économiques — Petits pamphlets, I (1863 ed.): <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_4.djvu>.
Première lettre [1].
Juillet 1848.
L’assemblée nationale est saisie d’une question immense, dont la solution intéresse au plus haut degré la prospérité et le repos de la France. Un Droit nouveau frappe à la porte de la Constitution : c’est le Droit au travail. Il n’y demande pas seulement une place ; il prétend y prendre, en tout ou en partie, celle du Droit de propriété.
M. Louis Blanc a déjà proclamé provisoirement ce droit nouveau, et l’on sait avec quel succès ;
M. Proudhon le réclame pour tuer la Propriété ;
M. Considérant, pour la raffermir, en la légitimant.
Ainsi selon ces publicistes, la Propriété porte en elle quelque chose d’injuste et de faux, un germe de mort. Je prétends démontrer qu’elle est la vérité et la justice même, et que ce qu’elle porte dans son sein, c’est le principe du progrès et de la vie.
Ils paraissent croire que, dans la lutte qui va s’engager, les pauvres sont intéressés au triomphe du droit au travail et les riches à la défense du droit de propriété. Je me crois en mesure de prouver que le droit de propriété est essentiellement démocratique, et que tout ce qui le nie ou le viole est fondamentalement aristocratique et anarchique.
J’ai hésité à demander place dans un journal pour une dissertation d’économie sociale. Voici ce qui peut justifier cette tentative :
D’abord, la gravité et l’actualité du sujet.
Ensuite, MM. Louis Blanc, Considérant, Proudhon ne sont pas seulement publicistes ; ils sont aussi chefs d’écoles ; ils ont derrière eux de nombreux et ardents sectateurs, comme le témoigne leur présence à l’assemblée nationale. Leurs doctrines exercent dès aujourd’hui une influence considérable, — selon moi, funeste dans le monde des affaires, — et, ce qui ne laisse pas d’être grave, elles peuvent s’étayer de concessions échappées à l’orthodoxie des maîtres de la science.
Enfin, pourquoi ne l’avouerais-je pas ? quelque chose, au fond de ma conscience, me dit qu’au milieu de cette controverse brûlante, il me sera peut-être donné de jeter un de ces rayons inattendus de clarté qui illuminent le terrain où s’opère quelquefois la réconciliation des écoles les plus divergentes.
C’en est assez, j’espère, pour que ces lettres trouvent grâce auprès des lecteurs.
Je dois établir d’abord le reproche qu’on adresse à la Propriété.
Voici en résumé comment M. Considérant s’en explique. Je ne crois pas altérer sa théorie, en l’abrégeant [2].
« Tout homme possède légitimement la chose que son activité a créée. Il peut la consommer, la donner, l’échanger, la transmettre, sans que personne, ni même la société tout entière, ait rien à y voir.
Le propriétaire possède donc légitimement non-seulement les produits qu’il a créés sur le sol, mais encore la plus-value qu’il a donnée au sol lui-même par la culture.
Mais il y a une chose qu’il n’a pas créée, qui n’est le fruit d’aucun travail ; c’est la terre brute, c’est le capital primitif, c’est la puissance productive des agents naturels. Or, le propriétaire s’est emparé de ce capital. Là est l’usurpation, la confiscation, l’injustice, l’illégitimité permanente.
L’espèce humaine est placée sur ce globe pour y vivre et se développer. L’espèce est donc usufruitière de la surface du globe. Or, maintenant, cette surface est confisquée par le petit nombre, à l’exclusion du grand nombre.
Il est vrai que cette confiscation est inévitable ; car comment cultiver, si chacun peut exercer à l’aventure et en liberté ses droits naturels, c’est-à-dire les droits de la sauvagerie ?
Il ne faut donc pas détruire la propriété, mais il faut la légitimer. Comment ? par la reconnaissance du droit au travail.
En effet, les sauvages n’exercent leurs quatre droits (chasse, pêche, cueillette et pâture) que sous la condition du travail ; c’est donc sous la même condition que la société doit aux prolétaires l’équivalent de l’usufruit dont elle les a dépouillés.
En définitive, la société doit à tous les membres de l’espèce, à charge de travail, un salaire qui les place dans une condition telle, qu’elle puisse être jugée aussi favorable que celle des sauvages.
Alors la propriété sera légitime de tous points, et la réconciliation sera faite entre les riches et les pauvres. »
Voilà toute la théorie de M. Considérant [3]. Il affirme que cette question de la propriété est des plus simples, qu’il ne faut qu’un peu de bon sens pour la résoudre, et que cependant personne, avant lui, n’y avait rien compris.
Le compliment n’est pas flatteur pour le genre humain ; mais, en compensation, je ne puis qu’admirer l’extrême modestie que l’auteur met dans ses conclusions.
Que demande-t-il, en effet, à la société ?
Qu’elle reconnaisse le Droit au travail comme l’équivalent, au profit de l’espèce, de l’usufruit de la terre brute.
Et à combien estime-t-il cet équivalent ?
À ce que la terre brute peut faire vivre de sauvages.
Comme c’est à peu près un habitant par lieue carrée, les propriétaires du sol français peuvent légitimer leur usurpation à très-bon marché assurément. Ils n’ont qu’à prendre l’engagement que trente à quarante mille non-propriétaires s’élèveront, à leur côté, à toute la hauteur des Esquimaux.
Mais, que dis-je ? Pourquoi parler de la France ? Dans ce système, il n’y a plus de France, il n’y a plus de propriété nationale, puisque l’usufruit de la terre appartient, de plein droit, à l’espèce.
Au reste, je n’ai pas l’intention d’examiner en détail la théorie de M. Considérant, cela me mènerait trop loin. Je ne veux m’attaquer qu’à ce qu’il y a de grave et de sérieux au fond de cette théorie, je veux dire la question de la Rente.
Le système de M. Considérant peut se résumer ainsi :
Un produit agricole existe par le concours de deux actions :
L’action de l’homme, ou le travail, qui donne ouverture au droit de propriété ;
L’action de la nature, qui devrait être gratuite, et que les propriétaires font injustement tourner à leur profit. C’est là ce qui constitue l’usurpation des droits de l’espèce.
Si donc je venais à prouver que les hommes, dans leurs transactions, ne se font réciproquement payer que leur travail, qu’ils ne font pas entrer dans le prix des choses échangées l’action de la nature, M. Considérant devrait se tenir pour complétement satisfait.
Les griefs de M. Proudhon contre la propriété sont absolument les mêmes. « La propriété, dit-il, cessera d’être abusive par la mutualité des services. » Donc, si je démontre que les hommes n’échangent entre eux que des services, sans jamais se débiter réciproquement d’une obole pour l’usage de ces forces naturelles que Dieu a données gratuitement à tous, M. Proudhon, de son côté, devra convenir que son utopie est réalisée.
Ces deux publicistes ne seront pas fondés à réclamer le droit au travail. Peu importe que ce droit fameux soit considéré par eux sous un jour si diamétralement opposé que, selon M. Considérant, il doit légitimer la propriété, tandis que, selon M. Proudhon, il doit la tuer ; toujours est-il qu’il n’en sera plus question, pourvu qu’il soit bien prouvé que, sous le régime propriétaire, les hommes échangent peine contre peine, effort contre effort, travail contre travail, service contre service, le concours de la nature étant toujours livré par-dessus le marché ; en sorte que les forces naturelles, gratuites par destination, ne cessent pas de rester gratuites à travers toutes les transactions humaines.
On voit que ce qui est contesté, c’est la légitimité de la Rente, parce qu’on suppose qu’elle est, en tout ou en partie, un paiement injuste que le consommateur fait au propriétaire, non pour un service personnel, mais pour des bienfaits gratuits de la nature.
J’ai dit que les réformateurs modernes pouvaient s’appuyer sur l’opinion des principaux économistes [4].
En effet, Adam Smith dit que la Rente est souvent un intérêt raisonnable du capital dépensé sur les terres en amélioration, mais que souvent aussi cet intérêt n’est qu’une partie de la Rente.
Sur quoi Mac-Culloch fait cette déclaration positive :
« Ce qu’on nomme proprement la Rente, c’est la somme payée pour l’usage des forces naturelles et de la puissance inhérente au sol. Elle est entièrement distincte de la somme payée à raison des constructions, clôtures, routes et autres améliorations foncières. La rente est donc toujours un monopole. »
Buchanan va jusqu’à dire que « la Rente est une portion du revenu des consommateurs qui passe dans la poche du propriétaire. »
Ricardo :
« Une portion de la Rente est payée pour l’usage du capital qui a été employé à améliorer la qualité de la terre, élever des bâtisses, etc. ; l’autre est donnée pour l’usage des puissances primitives et indestructibles du sol. »
Scrope :
« La valeur de la terre et la faculté d’en tirer une rente sont dues à deux circonstances : 1° à l’appropriation de ses puissances naturelles ; 2° au travail appliqué à son amélioration. Sous le premier rapport, la Rente est un monopole. C’est une restriction à l’usufruit des dons que le Créateur a faits aux hommes pour leurs besoins. Cette restriction n’est juste qu’autant qu’elle est nécessaire pour le bien commun. »
Senior :
« Les instruments de la production sont le travail et les agents naturels. Les agents naturels ayant été appropriés, les propriétaires s’en font payer l’usage sous forme de rente, qui n’est la récompense d’aucun sacrifice quelconque, et est reçue par ceux qui n’ont ni travaillé ni fait des avances, mais qui se bornent à tendre la main pour recevoir les offrandes de la communauté. »
Après avoir dit qu’une partie de la Rente est l’intérêt du capital. Senior ajoute :
« Le surplus est prélevé par le propriétaire des agents naturels et forme sa récompense, non pour avoir travaillé ou épargné, mais simplement pour n’avoir pas gardé quand il pouvait garder, pour avoir permis que les dons de la nature fussent acceptés. »
Certes, au moment d’entrer en lutte avec des hommes qui proclament une doctrine spécieuse en elle-même, propre à faire naître des espérances et des sympathies parmi les classes souffrantes, et qui s’appuie sur de telles autorités, il ne suffit pas de fermer les yeux sur la gravité de la situation ; il ne suffit pas de s’écrier dédaigneusement qu’on n’a devant soi que des rêveurs, des utopistes, des insensés, ou même des factieux ; il faut étudier et résoudre la question une fois pour toutes. Elle vaut bien un moment d’ennui.
Je crois qu’elle sera résolue d’une manière satisfaisante pour tous, si je prouve que la propriété non-seulement laisse à ce qu’on nomme les prolétaires l’usufruit gratuit des agents naturels, mais encore décuple et centuple cet usufruit. J’ose espérer qu’il sortira de cette démonstration la claire vue de quelques harmonies propres à satisfaire l’intelligence et à apaiser les prétentions de toutes les écoles économistes, socialistes et même communistes [5].
Deuxième lettre.
Quelle inflexible puissance que celle de la Logique !
De rudes conquérants se partagent une île ; ils vivent de Rentes dans le loisir et le faste, au milieu des vaincus laborieux et pauvres. Il y a donc, dit la Science, une autre source de valeurs que le travail.
Alors elle se met à décomposer la Rente et jette au monde cette théorie :
« La Rente, c’est, pour une partie, l’intérêt d’un capital dépensé. Pour une autre partie, c’est le monopole d’agents naturels usurpés et confisqués. »
Bientôt cette économie politique de l’école anglaise passe le détroit. La Logique socialiste s’en empare et dit aux travailleurs : Prenez garde ! dans le prix du pain que vous mangez, il entre trois éléments. Il y a le travail du laboureur, vous le devez ; il y a le travail du propriétaire, vous le devez ; il y a le travail de la nature, vous ne le devez pas. Ce que l’on vous prend à ce titre, c’est un monopole, comme dit Scrope ; c’est une taxe prélevée sur les dons que Dieu vous a faits, comme dit Senior.
La Science voit le danger de sa distinction. Elle ne la retire pas néanmoins, mais l’explique : « Dans le mécanisme social, il est vrai, dit-elle, que le rôle du propriétaire est commode, mais il est nécessaire. On travaille pour lui, et il paie avec la chaleur du soleil et la fraîcheur des rosées. Il faut en passer par là, sans quoi il n’y aurait pas de culture. »
« Qu’à cela ne tienne, répond la Logique, j’ai mille organisations en réserve pour effacer l’injustice, qui d’ailleurs n’est jamais nécessaire. »
Donc, grâce à un faux principe, ramassé dans l’école anglaise, la Logique bat en brèche la propriété foncière. S’arrêtera-t-elle là ? Gardez-vous de le croire. Elle ne serait pas la Logique.
Comme elle a dit à l’agriculteur : La loi de la vie végétale ne peut être une propriété et donner un profit ;
Elle dira au fabricant de drap : La loi de la gravitation ne peut être une propriété et donner un profit ;
Au fabricant de toiles : La loi de l’élasticité des vapeurs ne peut être une propriété et donner un profit ;
Au maître de forges : La loi de la combustion ne peut être une propriété et donner un profit ;
Au marin : Les lois de l’hydrostatique ne peuvent être une propriété et donner un profit ;
Au charpentier, an menuisier, au bûcheron : Vous vous servez de scies, de haches, de marteaux ; vous faites concourir ainsi à votre œuvre la dureté des corps et la résistance des milieux. Ces lois appartiennent à tout le monde, et ne doivent pas donner lieu à un profit.
Oui, la Logique ira jusque-là, au risque de bouleverser la société entière ; après avoir nié la Propriété foncière, elle niera la productivité du capital, toujours en se fondant sur celle donnée que le Propriétaire et le Capitaliste se font rétribuer pour l’usage des puissances naturelles. C’est pour cela qu’il importe de lui prouver qu’elle part d’un faux principe ; qu’il n’est pas vrai que dans aucun art, dans aucun métier, dans aucune industrie, on se fasse payer les forces de la nature, et qu’à cet égard l’agriculture n’est pas privilégiée.
Il est des choses qui sont utiles sans que le travail intervienne : la terre, l’air, l’eau, la lumière et la chaleur du soleil, les matériaux et les forces que nous fournit la nature.
Il en est d’autres qui ne deviennent utiles que parce que le travail s’exerce sur ces matériaux et s’empare de ces forces.
L’utilité est donc due quelquefois à la nature seule, quelquefois au travail seul, presque toujours à l’activité combinée du travail et de la nature.
Que d’autres se perdent dans les définitions. Pour moi, j’entends par Utilité ce que tout le monde comprend par ce mot, dont l’étymologie marque très-exactement le sens. Tout ce qui sert, que ce soit de par la nature, de par le travail ou de par les deux, est Utile.
J’appelle Valeur cette portion seulement d’utilité que le travail communique ou ajoute aux choses, en sorte que deux choses se valent quand ceux qui les ont travaillées les échangent librement l’une contre l’autre. Voici mes motifs :
Qu’est-ce qui fait qu’un homme refuse un échange ? c’est la connaissance qu’il a que la chose qu’on lui offre exigerait de lui moins de travail que celle qu’on lui demande. On aura beau lui dire : J’ai moins travaillé que vous, mais la gravitation m’a aidé, et je la mets en ligne de compte ; il répondra : Je puis aussi me servir de la gravitation, avec un travail égal au vôtre.
Quand deux hommes sont isolés, s’ils travaillent, c’est pour se rendre service à eux-mêmes ; que l’échange intervienne, chacun rend service à l’autre et en reçoit un service équivalent. Si l’un d’eux se fait aider par une puissance naturelle qui soit à la disposition de l’autre, cette puissance ne comptera pas dans le marché ; le droit de refus s’y oppose.
Robinson chasse et Vendredi pêche. Il est clair que la quantité de poisson échangée contre du gibier sera déterminée par le travail. Si Robinson disait à Vendredi : « La nature prend plus de peine pour faire un oiseau que pour faire un poisson ; donne-moi donc plus de ton travail que je ne t’en donne du mien, puisque je te cède, en compensation, un plus grand effort de la nature… » Vendredi ne manquerait pas de répondre : « Il ne t’est pas donné, non plus qu’à moi, d’apprécier les efforts de la nature. Ce qu’il faut comparer, c’est ton travail au mien, et si tu veux établir nos relations sur ce pied que je devrai, d’une manière permanente, travailler plus que toi, je vais me mettre à chasser, et tu pêcheras si tu veux. »
On voit que la libéralité de la nature, dans cette hypothèse, ne peut devenir un monopole à moins de violence. On voit encore que si elle entre pour beaucoup dans l’utilité, elle n’entre pour rien dans la valeur.
J’ai signalé autrefois la métaphore comme un ennemi de l’économie politique, j’accuserai ici la métonymie du même méfait [6].
Se sert-on d’un langage bien exact quand on dit : « L’eau vaut deux sous ? »
On raconte qu’un célèbre astronome ne pouvait se décider à dire : Ah ! le beau coucher du soleil ! Même en présence des dames, il s’écriait, dans son étrange enthousiasme : Ah ! le beau spectacle que celui de la rotation de la terre, quand les rayons du soleil la frappent par la tangente !
Cet astronome était exact et ridicule. Un économiste ne le serait pas moins qui dirait : Le travail qu’il faut faire pour aller chercher l’eau à la source vaut deux sous.
L’étrangeté de la périphrase n’en empêche pas l’exactitude.
En effet, l’eau ne vaut pas. Elle n’a pas de valeur, quoiqu’elle ait de l’utilité. Si nous avions tous et toujours une source à nos pieds, évidemment l’eau n’aurait aucune valeur, puisqu’elle ne pourrait donner lieu à aucun échange. Mais est-elle à un quart de lieue, il faut l’aller chercher, c’est un travail, et voilà l’origine de la valeur. Est-elle à une demi-lieue, c’est un travail double, et, partant, une valeur double, quoique l’utilité reste la même. L’eau est pour moi un don gratuit de la nature, à la condition de l’aller chercher. Si je le fais moi-même, je me rends un service moyennant une peine. Si j’en charge un autre, je lui donne une peine et lui dois un service. Ce sont deux peines, deux services à comparer, à débattre. Le don de la nature reste toujours gratuit. En vérité, il me semble que c’est dans le travail et non dans l’eau que réside la valeur, et qu’on fait une métonymie aussi bien quand on dit : L’eau vaut deux sous, que lorsqu’on dit : J’ai bu une bouteille.
L’air est un don gratuit de la nature, il n’a pas de valeur. Les économistes disent : Il n’a pas de valeur d’échange, mais il a de la valeur d’usage. Quelle langue ! Eh ! Messieurs, avez-vous pris à tâche de dégoûter de la science ? Pourquoi ne pas dire tout simplement : Il n’a pas de valeur, mais il a de l’utilité ? Il a de l’utilité parce qu’il sert. Il n’a pas de valeur parce que la nature a fait tout et le travail rien. Si le travail n’y est pour rien, personne n’a à cet égard de service à rendre, à recevoir ou à rémunérer. Il n’y a ni peine à prendre, ni échange à faire ; il n’y a rien à comparer, il n’y a pas de valeur.
Mais entrez dans une cloche à plongeur et chargez un homme de vous envoyer de l’air par une pompe pendant deux heures ; il prendra une peine, il vous rendra un service ; vous aurez à vous acquitter. Est-ce l’air que vous paierez ? Non, c’est le travail. Donc, est-ce l’air qui a acquis de la valeur ? Parlez ainsi pour abréger, si vous voulez, mais n’oubliez pas que c’est une métonymie ; que l’air reste gratuit ; et qu’aucune intelligence humaine ne saurait lui assigner une valeur ; que s’il en a une, c’est celle qui se mesure par la peine prise, comparée à la peine donnée en échange.
Un blanchisseur est obligé de faire sécher le linge dans un grand établissement par l’action du feu. Un autre se contente de l’exposer au soleil. Ce dernier prend moins de peine ; il n’est ni ne peut être aussi exigeant. Il ne me fait donc pas payer la chaleur des rayons du soleil, et c’est moi consommateur qui en profite.
Ainsi la grande loi économique est celle-ci :
Les services s’échangent contre des services.
Do ut des ; do ut facias ; facio ut des ; facio ut facias ; fais ceci pour moi, et je ferai cela pour toi, c’est bien trivial, bien vulgaire ; ce n’en est pas moins le commencement, le milieu et la fin de la science [7].
Nous pouvons tirer de ces trois exemples cette conclusion générale : Le consommateur rémunère tous les services qu’on lui rend, toute la peine qu’on lui épargne, tous les travaux qu’il occasionne ; mais il jouit, sans les payer, des dons gratuits de la nature et des puissances que le producteur a mises en œuvre.
Voilà trois hommes qui ont mis à ma disposition de l’air, de l’eau et de la chaleur, sans se rien faire payer que leur peine.
Qu’est-ce donc qui a pu faire croire que l’agriculteur, qui se sert aussi de l’air, de l’eau et de la chaleur, me fait payer la prétendue valeur intrinsèque de ces agents naturels ? qu’il me porte en compte de l’utilité créée et de l’utilité non créée ? que, par exemple, le prix du blé vendu à 18 fr. se décompose ainsi :
| 12 fr. pour le travail actuel, | propriété légitime ; | |
| 3 fr. pour le travail antérieur, | ||
| 3 fr. pour l’air, la pluie, le soleil, la vie végétale, propriété illégitime ? | ||
Pourquoi tous les économistes de l’école anglaise croient-ils que ce dernier élément s’est furtivement introduit dans la valeur du blé ?
Troisième lettre.
Les services s’échangent contre des services. Je suis obligé de me faire violence pour résister à la tentation de montrer ce qu’il y a de simplicité, de vérité et de fécondité dans cet axiome.
Que deviennent devant lui toutes ces subtilités : Valeur d’usage et valeur d’échange, produits matériels et produits immatériels, classes productives et classes improductives ? Industriels, avocats, médecins, fonctionnaires, banquiers, négociants, marins, militaires, artistes, ouvriers, tous tant que nous sommes, à l’exception des hommes de rapine, nous rendons et recevons des services. Or, ces services réciproques étant seuls commensurables entre eux, c’est en eux seuls que réside la valeur, et non dans la matière gratuite et dans les agents naturels gratuits qu’ils mettent en œuvre. Qu’on ne dise donc point, comme c’est aujourd’hui la mode, que le négociant est un intermédiaire parasite. Prend-il ou ne prend-il pas une peine ? Nous épargne-t-il ou non du travail ? Rend-il ou non des services ? S’il rend des services, il crée de la valeur aussi bien que le fabricant [8].
Comme le fabricant, pour faire tourner ses mille broches, s’empare, par la machine à vapeur, du poids de l’atmosphère et de l’expansibilité des gaz, de même le négociant, pour exécuter ses transports, se sert de la direction des vents et de la fluidité de l’eau. Mais ni l’un ni l’autre ne nous font payer ces forces naturelles, car plus ils en sont secondés, plus ils sont forcés de baisser leurs prix. Elles restent donc ce que Dieu a voulu qu’elles fussent, un don gratuit, sous la condition du travail, pour l’humanité tout entière.
En est-il autrement en agriculture ? C’est ce que j’ai à examiner.
Supposons une île immense habitée par quelques sauvages. L’un d’entre eux conçoit la pensée de se livrer à la culture. Il s’y prépare de longue main, car il sait que l’entreprise absorbera bien des journées de travail avant de donner la moindre récompense. Il accumule des provisions, il fabrique de grossiers instruments. Enfin le voilà prêt ; il clôt et défriche un lopin de terre.
Ici deux questions :
Ce sauvage blesse-t-il les Droits de la communauté ?
Blesse-t-il ses Intérêts ?
Puisqu’il y a cent mille fois plus de terres que la communauté n’en pourrait cultiver, il ne blesse pas plus ses droits que je ne blesse ceux de mes compatriotes quand je puise dans la Seine un verre d’eau pour boire, ou dans l’atmosphère un pied cube d’air pour respirer.
Il ne blesse pas davantage ses intérêts. Bien au contraire : ne chassant plus ou chassant moins, ses compagnons ont proportionnellement plus d’espace ; en outre, s’il produit plus de subsistances qu’il n’en peut consommer, il lui reste un excédant à échanger.
Dans cet échange, exerce-t-il la moindre oppression sur ses semblables ? Non, puisque ceux-ci sont libres d’accepter ou de refuser.
Se fait-il payer le concours de la terre, du soleil et de la pluie ? Non, puisque chacun peut recourir, comme lui, à ces agents de production.
Veut-il vendre son lopin de terre, que pourra-t-il obtenir ? L’équivalent de son travail, et voilà tout. S’il disait : Donnez-moi d’abord autant de votre temps que j’en ai consacré à l’opération, et ensuite une autre portion de votre temps pour la valeur de la terre brute ; on lui répondrait : Il y a de la terre brute à côté de la vôtre, je ne puis que vous restituer votre temps, puisque, avec un temps égal, rien ne m’empêche de me placer dans une condition semblable à la vôtre. C’est justement la réponse que nous ferions au porteur d’eau qui nous demanderait deux sous pour la valeur de son service et deux pour la valeur de l’eau ; par où l’on voit que la terre et l’eau ont cela de commun, que l’une et l’autre beaucoup d’utilité, et que ni l’une ni l’autre n’ont de valeur.
Que si notre sauvage voulait affermer son champ, il ne trouverait jamais que la rémunération de son travail sous une autre forme. Des prétentions plus exagérées rencontreraient toujours cette inexorable réponse : « Il y a des terres dans l’île », réponse plus décisive que celle du meunier de Sans-Souci : « Il y a des juges à Berlin [9]. »
Ainsi, à l’origine du moins, le propriétaire, soit qu’il vende les produits de sa terre, ou sa terre elle-même, soit qu’il l’afferme, ne fait autre chose que rendre et recevoir des services sur le pied de l’égalité. Ce sont ces services qui se comparent, et par conséquent qui valent, la valeur n’étant attribuée au sol que par abréviation ou métonymie.
Voyons ce qui survient à mesure que l’île se peuple et se cultive.
Il est bien évident que la facilité de se procurer des matières premières, des subsistances et du travail y augmente pour tout le monde, sans privilége pour personne, comme on le voit aux États-Unis. Là, il est absolument impossible aux propriétaires de se placer dans une position plus favorable que les autres travailleurs, puisque, à cause de l’abondance des terres, chacun a le choix de se porter vers l’agriculture si elle devient plus lucrative que les autres carrières. Cette liberté suffit pour maintenir l’équilibre des services. Elle suffit aussi pour que les agents naturels, dont on se sert dans un grand nombre d’industries aussi bien qu’en agriculture, ne profitent pas aux producteurs, en tant que tels, mais au public consommateur.
Deux frères se séparent ; l’un va à la pêche de la baleine, l’autre va défricher des terres dans le Far-West. Ils échangent ensuite de l’huile contre du blé. L’un porte-t-il plus en compte la valeur du sol que la valeur de la baleine ? La comparaison ne peut porter que sur les services reçus et rendus. Ces services seuls ont donc de la valeur.
Cela est si vrai que, si la nature a été très-libérale du côté de la terre, c’est-à-dire si la récolte est abondante, le prix du blé baisse, et c’est le pêcheur qui en profite. Si la nature a été libérale du côté de l’Océan, en d’autres termes, si la pêche a été heureuse, c’est l’huile qui est à bon marché, au profit de l’agriculteur. Rien ne prouve mieux que le don gratuit de la nature, quoique mis en œuvre par le producteur, reste toujours gratuit pour les masses, à la seule condition de payer cette mise en œuvre qui est le service.
Donc, tant qu’il y aura abondance de terres incultes dans le pays, l’équilibre se maintiendra entre les services réciproques, et tout avantage exceptionnel sera refusé aux propriétaires.
Il n’en serait pas ainsi, si les propriétaires parvenaient à interdire tout nouveau défrichement. En ce cas, il est bien clair qu’ils feraient la loi au reste de la communauté. La population augmentant, le besoin de subsistance se faisant de plus en plus sentir, il est clair qu’ils seraient en mesure de se faire payer plus cher leurs services, ce que le langage ordinaire exprimerait ainsi, par métonymie : Le sol a plus de valeur. Mais la preuve que ce privilége inique conférerait une valeur factice non à la matière, mais aux services, c’est ce que nous voyons en France et à Paris même. Par un procédé semblable à celui que nous venons de décrire, la loi limite le nombre des courtiers, agents de change, notaires, bouchers ; et qu’arrive-t-il ? C’est qu’en les mettant à même de mettre à haut prix leurs services, elle crée en leur faveur un capital qui n’est incorporé dans aucune matière. Le besoin d’abréger fait dire alors : « Cette étude, ce cabinet, ce brevet valent tant, » et la métonymie est évidente. Il en est de même pour le sol.
Nous arrivons à la dernière hypothèse, celle où le sol de l’île entière est soumis à l’appropriation individuelle et à la culture.
Ici il semble que la position relative des deux classes va changer.
En effet, la population continue de s’accroître ; elle va encombrer toutes les carrières, excepté la seule où la place soit prise. Le propriétaire fera donc la loi de l’échange ! Ce qui limite la valeur d’un service, ce n’est jamais la volonté de celui qui le rend, c’est quand celui à qui on l’offre peut s’en passer, ou se le rendre à lui-même, ou s’adresser à d’autres. Le prolétaire n’a plus aucune de ces alternatives. Autrefois il disait au propriétaire : « Si vous me demandez plus que la rémunération de votre travail, je cultiverai moi-même ; » et le propriétaire était forcé de se soumettre. Aujourd’hui le propriétaire a trouvé cette réplique : « Il n’y a plus de place dans le pays. » Ainsi, qu’on voie la Valeur dans les choses ou dans les services, l’agriculteur profitera de l’absence de toute concurrence, et comme les propriétaires feront la loi aux fermiers et aux ouvriers des campagnes, en définitive ils la feront à tout le monde.
Cette situation nouvelle a évidemment pour cause unique ce fait, que les non-propriétaires ne peuvent plus contenir les exigences des possesseurs du sol par ce mot : « Il reste du sol à défricher. »
Que faudrait-il donc pour que l’équilibre des services fût maintenu, pour que l’hypothèse actuelle rentrât à l’instant dans l’hypothèse précédente ? Une seule chose : c’est qu’à côté de notre île il en surgît une seconde, ou, mieux encore, des continents non entièrement envahis par la culture.
Alors le travail continuerait à se développer, se répartissant dans de justes proportions entre l’agriculture et les autres industries, sans oppression possible de part ni d’autre, puisque si le propriétaire disait à l’artisan : « Je te vendrai mon blé à un prix qui dépasse la rémunération normale du travail, » celui-ci se hâterait de répondre : « Je travaillerai pour les propriétaires du continent, qui ne peuvent avoir de telles prétentions. »
Cette période arrivée, la vraie garantie des masses est donc dans la liberté de l’échange, dans le droit du travail [10].
Le droit du travail, c’est la liberté, c’est la propriété. L’artisan est propriétaire de son œuvre, de ses services ou du prix qu’il en a retiré, aussi bien que le propriétaire du sol. Tant que, en vertu de ce droit, il peut les échanger sur toute la surface du globe contre des produits agricoles, il maintient forcément le propriétaire foncier dans cette position d’égalité que j’ai précédemment décrite, où les services s’échangent contre des services, sans que la possession du sol confère par elle-même, pas plus que la possession d’une machine à vapeur ou du plus simple outil, un avantage indépendant du travail.
Mais si, usurpant la puissance législative, les propriétaires défendent aux prolétaires de travailler pour le dehors contre de la subsistance, alors l’équilibre des services est rompu. Par respect pour l’exactitude scientifique, je ne dirai pas que par là ils élèvent artificiellement la valeur du sol ou des agents naturels ; mais je dirai qu’ils élèvent artificiellement la valeur de leurs services. Avec moins de travail ils paient plus de travail. Ils oppriment. Ils font comme tous les monopoleurs brevetés ; ils font comme les propriétaires de l’autre période qui prohibaient les défrichements ; ils introduisent dans la société une cause d’inégalité et de misère ; ils altèrent les notions de justice et de propriété ; ils creusent sous leurs pas un abîme [11].
Mais quel soulagement pourraient trouver les non-propriétaires dans la proclamation du droit au travail ? En quoi ce droit nouveau accroîtrait-il les subsistances ou les travaux à distribuer aux masses ? Est-ce que tous les capitaux ne sont pas consacrés à faire travailler ? Est-ce qu’ils grossissent en passant par les coffres de l’État ? Est-ce qu’en les ravissant au peuple par l’impôt, l’État ne ferme pas au moins autant de sources de travail d’un côté qu’il en ouvre de l’autre ?
Et puis, en faveur de qui stipulez-vous ce droit ? Selon la théorie qui vous l’a révélé, ce serait en faveur de quiconque n’a plus sa part d’usufruit de la terre brute. Mais les banquiers, négociants, manufacturiers, légistes, médecins, fonctionnaires, artistes, artisans ne sont pas propriétaires fonciers. Voulez-vous dire que les possesseurs du sol seront tenus d’assurer du travail à tous ces citoyens ? Mais tous se créent des débouchés les uns aux autres. Entendez-vous seulement que les riches, propriétaires ou non-propriétaires du sol, doivent venir au secours des pauvres ? Alors vous parlez d’assistance, et non d’un droit ayant sa source dans l’appropriation du sol.
En fait de droits, celui qu’il faut réclamer, parce qu’il est incontestable, rigoureux, sacré, c’est le droit du travail ; c’est la liberté, c’est la propriété, non celle du sol seulement, mais celle des bras, de l’intelligence, des facultés, de la personnalité, propriété qui est violée si une classe peut interdire aux autres l’échange libre des services au dehors comme au dedans. Tant que cette liberté existe, la propriété foncière n’est pas un privilége ; elle n’est, comme toutes les autres, que la propriété d’un travail.
Il me reste à déduire quelques conséquences de cette doctrine.
Quatrième lettre.
Les physiocrates disaient : La terre seule est productive.
Certains économistes ont dit : Le travail seul est productif.
Quand on voit le laboureur courbé sur le sillon qu’il arrose de ses sueurs, on ne peut guère nier son concours à l’œuvre de la production. D’un autre côté, la nature ne se repose pas. Et le rayon qui perce la nue, et la nue que chasse le vent, et le vent qui amène la pluie, et la pluie qui dissout les substances fertilisantes, et ces substances qui développent dans la jeune plante le mystère de la vie, toutes les puissances connues et inconnues de la nature préparent la moisson pendant que le laboureur cherche dans le sommeil une trêve à ses fatigues.
Il est donc impossible de ne pas le reconnaître : le Travail et la nature se combinent pour accomplir le phénomène de la production. L’utilité, qui est le fonds sur lequel vit le genre humain, résulte de cette coopération, et cela est aussi vrai de presque toutes les industries que de l’agriculture.
Mais, dans les échanges que les hommes accomplissent entre eux, il n’y a qu’une chose qui se compare et se puisse comparer, c’est le travail humain, c’est le service reçu et rendu. Ces services sont seuls commensurables entre eux ; c’est donc eux seuls qui sont rémunérables, c’est en eux seuls que réside la Valeur, et il est très-exact de dire qu’en définitive l’homme n’est propriétaire que de son œuvre propre.
Quant à la portion d’utilité due au concours de la nature, quoique très-réelle, quoique immensément supérieure à tout ce que l’homme pourrait accomplir, elle est gratuite ; elle se transmet de main en main par-dessus le marché ; elle est sans Valeur proprement dite. Et qui pourrait apprécier, mesurer, déterminer la valeur des lois naturelles qui agissent, depuis le commencement du monde, pour produire un effet quand le travail les sollicite ? à quoi les comparer ? comment les évaluer ? Si elles avaient une Valeur, elles figureraient sur nos comptes et nos inventaires ; nous nous ferions rétribuer pour leur usage. Et comment y parviendrions-nous, puisqu’elles sont à la disposition de tous sous la même condition, celle du travail [12] ?
Ainsi, toute production utile est l’œuvre de la nature qui agit gratuitement et du travail qui se rémunère.
Mais, pour arriver à la production d’une utilité donnée, ces deux contingents, travail humain, forces naturelles, ne sont pas dans des rapports fixes et immuables. Bien loin de là. Le progrès consiste à faire que la proportion du concours naturel s’accroisse sans cesse et vienne diminuer d’autant, en s’y substituant, la proportion du travail humain. En d’autres termes, pour une quantité donnée d’utilité, la coopération gratuite de la nature tend à remplacer de plus en plus la coopération onéreuse du travail. La partie commune s’accroît aux dépens de la partie rémunérable et appropriée.
Si vous aviez à transporter un fardeau d’un quintal, de Paris à Lille, sans l’intervention d’aucune force naturelle, c’est-à-dire à dos d’homme, il vous faudrait un mois de fatigue ; si, au lieu de prendre cette peine vous-même, vous la donniez à un autre, vous auriez à lui restituer une peine égale, sans quoi il ne la prendrait pas. Viennent le traîneau, puis la charrette, puis le chemin de fer ; à chaque progrès, c’est une partie de l’œuvre mise à la charge des forces naturelles, c’est une diminution de peine à prendre ou à rémunérer. Or, il est évident que toute rémunération anéantie est une conquête, non au profit de celui qui rend le service, mais de celui qui le reçoit, c’est-à-dire de l’humanité.
Avant l’invention de l’imprimerie, un scribe ne pouvait copier une Bible en moins d’un an, et c’était la mesure de la rémunération qu’il était en droit d’exiger. Aujourd’hui, on peut avoir une Bible pour 5 francs, ce qui ne répond guère qu’à une journée de travail. La force naturelle et gratuite s’est donc substituée à la force rémunérable pour deux cent quatre-vingt-dix-neuf parties sur trois cents ; une partie représente le service humain et reste Propriété personnelle ; deux cent quatre-vingt-dix-neuf parties représentent le concours naturel, ne se paient plus et sont par conséquent tombées dans le domaine de la gratuité et de la communauté.
Il n’y a pas un outil, un instrument, une machine qui n’ait eu pour résultat de diminuer le concours du travail humain, soit la Valeur du produit, soit encore ce qui fait le fondement de la Propriété.
Cette observation qui, j’en conviens, n’est que bien imparfaitement exposée ici, me semble devoir rallier sur un terrain commun, celui de la Propriété et de la Liberté, les écoles qui se partagent aujourd’hui d’une manière si fâcheuse l’empire de l’opinion.
Toutes les écoles se résument en un axiome.
Axiome Économiste : Laissez faire, laissez passer.
Axiome Égalitaire : Mutualité des services.
Axiome Saint-Simonien : À chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres.
Axiome Socialiste : Partage équitable entre le capital, le talent et le travail.
Axiome Communiste : Communauté des biens.
Je vais indiquer (car je ne puis faire ici autre chose) que la doctrine exposée dans les lignes précédentes satisfait à tous ces vœux.
Économistes. Il n’est guère nécessaire de prouver que les Économistes doivent accueillir une doctrine qui procède évidemment de Smith et de Say, et ne fait que montrer une conséquence des lois générales qu’ils ont découvertes. Laissez faire, laissez passer, c’est ce que résume le mot liberté, et je demande s’il est possible de concevoir la notion de propriété sans liberté. Suis-je propriétaire de mes œuvres, de mes facultés, de mes bras, si je ne puis les employer à rendre des services volontairement acceptés ? Ne dois-je pas être libre ou d’exercer mes forces isolément, ce qui entraîne la nécessité de l’échange, ou de les unir à celles de mes frères, ce qui est association ou échange sous une autre forme ?
Et si la liberté est gênée, n’est-ce pas la Propriété elle-même qui est atteinte ? D’un autre côté, comment les services réciproques auront-ils tous leur juste Valeur relative, s’ils ne s’échangent pas librement, si la loi défend au travail humain de se porter vers ceux qui sont les mieux rémunérés ? La propriété, la justice, l’égalité, l’équilibre des services ne peuvent évidemment résulter que de la Liberté. C’est encore la Liberté qui fait tomber le concours des forces naturelles dans le domaine commun ; car, tant qu’un privilége légal m’attribue l’exploitation exclusive d’une force naturelle, je me fais payer non-seulement pour mon travail, mais pour l’usage de cette force. Je sais combien il est de mode aujourd’hui de maudire la liberté. Le siècle semble avoir pris au sérieux l’ironique refrain de notre grand chansonnier :
Mon cœur en belle haine 11268.A pris la liberté. 11269.Fi de la liberté ! 11270.À bas la liberté !
Pour moi, qui l’aimai toujours par instinct, je la défendrai toujours par raison.
Égalitaires. La mutualité des services à laquelle ils aspirent est justement ce qui résulte du régime propriétaire.
En apparence, l’homme est propriétaire de la chose tout entière, de toute l’utilité que cette chose renferme. En réalité, il n’est propriétaire que de sa Valeur, de cette portion d’utilité communiquée par le travail, puisque, en la cédant, il ne peut se faire rémunérer que pour le service qu’il rend. Le représentant des égalitaires condamnait ces jours-ci à la tribune la Propriété, restreignant ce mot à ce qu’il nomme les usures, l’usage du sol, de l’argent, des maisons, du crédit, etc. Mais ces usures sont du travail et ne peuvent être que du travail. Recevoir un service implique l’obligation de le rendre. C’est en quoi consiste la mutualité des services. Quand je prête une chose que j’ai produite à la sueur de mon front, et dont je pourrais tirer parti, je rends un service à l’emprunteur, lequel me doit aussi un service. Il ne m’en rendrait aucun s’il se bornait à me restituer la chose au bout de l’an. Pendant cet intervalle, il aurait profité de mon travail à mon détriment. Si je me faisais rémunérer pour autre chose que pour mon travail, l’objection des Égalitaires serait spécieuse. Mais il n’en est rien. Une fois donc qu’ils se seront assurés de la vérité de la théorie exposée dans ces articles, s’ils sont conséquents, ils se réuniront à nous pour raffermir la Propriété et réclamer ce qui la complète ou plutôt ce qui la constitue, la Liberté.
Saint-Simoniens : À chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres.
C’est encore ce que réalise le régime propriétaire.
Nous nous rendons des services réciproques ; mais ces services ne sont pas proportionnels à la durée ou à l’intensité du travail. Ils ne se mesurent pas au dynamomètre ou au chronomètre. Que j’aie pris une peine d’une heure ou d’un jour, peu importe à celui à qui j’offre mon service. Ce qu’il regarde, ce n’est pas la peine que je prends, mais celle que je lui épargne [13]. Pour économiser de la fatigue et du temps, je cherche à me faire aider par une force naturelle. Tant que nul, excepté moi, ne sait tirer parti de cette force, je rends aux autres, à temps égal, plus de services qu’ils ne s’en peuvent rendre eux-mêmes. Je suis bien rémunéré, je m’enrichis sans nuire à personne. La force naturelle tourne à mon seul profit, ma capacité est récompensée : À chacun selon sa capacité. Mais bientôt mon secret se divulgue. L’imitation s’empare de mon procédé, la concurrence me force à réduire mes prétentions. Le prix du produit baisse jusqu’à ce que mon travail ne reçoive plus que la rémunération normale de tous les travaux analogues. La force naturelle n’est pas perdue pour cela ; elle m’échappe, mais elle est recueillie par l’humanité tout entière, qui désormais se procure une satisfaction égale avec un moindre travail. Quiconque exploite cette force pour son propre usage prend moins de peine qu’autrefois et, par suite, quiconque l’exploite pour autrui a droit à une moindre rémunération. S’il veut accroître son bien-être, il ne lui reste d’autre ressource que d’accroître son travail. À chaque capacité selon ses œuvres. En définitive, il s’agit de travailler mieux ou de travailler plus, ce qui est la traduction rigoureuse de l’axiome saint-simonien.
Socialistes. Partage équitable entre le talent, le capital et le travail.
L’équité dans le partage résulte de la loi : les services s’échangent contre les services, pourvu que ces échanges soient libres, c’est-à-dire pourvu que la Propriété soit reconnue et respectée.
Il est bien clair d’abord que celui qui a plus de talent rend plus de services, à peine égale ; d’où il suit qu’on lui alloue volontairement une plus grande rémunération.
Quant au Capital et au Travail, c’est un sujet sur lequel je regrette de ne pouvoir m’étendre ici, car il n’en est pas qui ait été présenté au public sous un jour plus faux et plus funeste.
On représente souvent le Capital comme un monstre dévorant, comme l’ennemi du Travail. On est parvenu ainsi à jeter une sorte d’antagonisme irrationnel entre deux puissances qui, au fond, sont de même origine, de même nature, concourent, s’entr’aident, et ne peuvent se passer l’une de l’autre. Quand je vois le Travail s’irriter contre le Capital, il me semble voir l’Inanition repousser les aliments.
Je définis le Capital ainsi : Des matériaux, des instruments et des provisions, dont l’usage est gratuit, ne l’oublions pas, en tant que la nature a concouru à les produire, et dont la Valeur seule, fruit du travail, se fait payer.
Pour exécuter une œuvre utile, il faut des matériaux ; pour peu qu’elle soit compliquée, il faut des instruments ; pour peu qu’elle soit de longue haleine, il faut des provisions. Par exemple : pour qu’un chemin de fer soit entrepris, il faut que la société ait épargné assez de moyens d’existence pour faire vivre des milliers d’hommes pendant plusieurs années.
Matériaux, instruments, provisions sont eux-mêmes le fruit d’un travail antérieur, lequel n’a pas encore été rémunéré. Lors donc que le travail antérieur et le travail actuel se combinent pour une fin, pour une œuvre commune, ils se rémunèrent l’un par l’autre ; il y a là échange de travaux, échange de services à conditions débattues. Quelle est celle des deux parties qui obtiendra les meilleures conditions ? Celle qui a moins besoin de l’autre. Nous rencontrons ici l’inexorable loi de l’offre et de la demande ; s’en plaindre c’est une puérilité et une contradiction. Dire que le travail doit être très-rémunéré quand les travailleurs sont nombreux et les capitaux exigus, c’est dire que chacun doit être d’autant mieux pourvu que la provision est plus petite.
Pour que le travail soit demandé et bien payé, il faut donc qu’il y ait dans le pays beaucoup de matériaux, d’instruments et de provisions, autrement dit, beaucoup de Capital.
Il suit de là que l’intérêt fondamental des ouvriers est que le capital se forme rapidement ; que par leur prompte accumulation, les matériaux, les instruments et les provisions se fassent entre eux une active concurrence. Il n’y a que cela qui puisse améliorer le sort des travailleurs. Et quelle est la condition essentielle pour que les capitaux se forment ? C’est que chacun soit sûr d’être réellement propriétaire, dans toute l’étendue du mot, de son travail et de ses épargnes. Propriété, sécurité, liberté, ordre, paix, économie, voilà ce qui intéresse tout le monde, mais surtout, et au plus haut degré, les prolétaires.
Communistes. À toutes les époques, il s’est rencontré des cœurs honnêtes et bienveillants, des Thomas Morus, des Harrington, des Fénelon, qui, blessés par le spectacle des souffrances humaines et de l’inégalité des conditions, ont cherché un refuge dans l’utopie communiste.
Quelque étrange que cela puisse paraître, j’affirme que le régime propriétaire tend à réaliser de plus en plus, sous nos yeux, cette utopie. C’est pour cela que j’ai dit en commençant que la propriété était essentiellement démocratique.
Sur quel fonds vit et se développe l’humanité ? sur tout ce qui sert, sur tout ce qui est utile. Parmi les choses utiles, il y en a auxquelles le travail humain reste étranger, l’air, l’eau, la lumière du soleil ; pour celles-là la gratuité, la Communauté est entière. Il y en a d’autres qui ne deviennent utiles que par la coopération du travail et de la nature. L’utilité se décompose donc en elles. Une portion y est mise par le Travail, et celle-là seule est rémunérable, a de la Valeur et constitue la Propriété. L’autre portion y est mise par les agents naturels, et celle-ci reste gratuite et Commune.
Or, de ces deux forces qui concourent à produire l’utilité, la seconde, celle qui est gratuite et commune, se substitue incessamment à la première, celle qui est onéreuse et par suite rémunérable. C’est la loi du progrès. Il n’y a pas d’homme sur la terre qui ne cherche un auxiliaire dans les puissances de la nature, et quand il l’a trouvé, aussitôt il en fait jouir l’humanité tout entière, en abaissant proportionnellement le prix du produit.
Ainsi, dans chaque produit donné, la portion d’utilité qui est à titre gratuit se substitue peu à peu à cette autre portion qui reste à titre onéreux.
Le fonds commun tend donc à dépasser dans des proportions indéfinies le fonds approprié, et l’on peut dire qu’au sein de l’humanité le domaine de la communauté s’élargit sans cesse.
D’un autre côté, il est clair que, sous l’influence de la liberté, la portion d’utilité qui reste rémunérable ou appropriable tend à se répartir d’une manière sinon rigoureusement égale, du moins proportionnelle aux services rendus, puisque ces services mêmes sont la mesure de la rémunération.
On voit par là avec quelle irrésistible puissance le principe de la Propriété tend à réaliser l’égalité parmi les hommes. Il fonde d’abord un fonds commun que chaque progrès grossit sans cesse, et à l’égard duquel l’égalité est parfaite, car tous les hommes sont égaux devant une valeur anéantie, devant une utilité qui a cessé d’être rémunérable. Tous les hommes sont égaux devant cette portion du prix des livres que l’imprimerie a fait disparaître.
Ensuite, quant à la portion d’utilité qui correspond au travail humain, à la peine ou à l’habileté, la concurrence tend à établir l’équilibre des rémunérations, et il ne reste d’inégalité que celle qui se justifie par l’inégalité même des efforts, de la fatigue, du travail, de l’habileté, en un mot, des services rendus ; et, outre qu’une telle inégalité sera éternellement juste, qui ne comprend que, sans elle, les efforts s’arrêteraient tout à coup ?
Je pressens l’objection ! Voilà bien, dira-t-on, l’optimisme des économistes. Ils vivent dans leurs théories et ne daignent pas jeter les yeux sur les faits. Où sont, dans la réalité, ces tendances égalitaires ? Le monde entier ne présente-t-il pas le lamentable spectacle de l’opulence à côté du paupérisme ? du faste insultant le dénûment ? de l’oisiveté et de la fatigue? de la satiété et de l’inanition ?
Cette illégalité, ces misères, ces souffrances, je ne les nie pas. Et qui pourrait les nier ? Mais je dis : Loin que ce soit le principe de la Propriété qui les engendre, elles sont imputables au principe opposé, au principe de la Spoliation.
C’est ce qui me reste à démontrer.
Cinquième lettre.
Non, les économistes ne pensent pas, comme on le leur reproche, que nous soyons dans le meilleur des mondes. Ils ne ferment ni leurs yeux aux plaies de la société, ni leurs oreilles aux gémissements de ceux qui souffrent. Mais, ces douleurs, ils en cherchent la cause, et ils croient avoir reconnu que, parmi celles sur lesquelles la société peut agir, il n’en est pas de plus active, de plus générale que l’injustice. Voilà pourquoi ce qu’ils invoquent, avant tout et surtout, c’est la justice, la justice universelle.
L’homme veut améliorer son sort, c’est sa première loi. Pour que cette amélioration s’accomplisse, un travail préalable ou une peine est nécessaire. Le même principe qui pousse l’homme vers son bien-être le porte aussi à éviter cette peine qui en est le moyen. Avant de s’adresser à son propre travail, il a trop souvent recours au travail d’autrui.
On peut donc appliquer à l’intérêt personnel ce qu’Esope disait de la langue : Rien au monde n’a fait plus de bien ni plus de mal. L’intérêt personnel crée tout ce par quoi l’humanité vit et se développe ; il stimule le travail, il enfante la propriété. Mais, en même temps, il introduit sur la terre toutes les injustices qui, selon leurs formes, prennent des noms divers et se résument dans ce mot : Spoliation.
Propriété, spoliation, sœurs nées du même père, salut et fléau de la société, génie du bien et génie du mal, puissances qui se disputent, depuis le commencement, l’empire et les destinées du monde !
Il est aisé d’expliquer, par cette origine commune à la Propriété et à la Spoliation, la facilité avec laquelle Rousseau et ses modernes disciples ont pu calomnier et ébranler l’ordre social. Il suffisait de ne montrer l’Intérêt personnel que par une de ses faces.
Nous avons vu que les hommes sont naturellement Propriétaires de leurs œuvres, et qu’en se transmettant des uns aux autres ces propriétés ils se rendent des services réciproques.
Cela posé, le caractère général de la Spoliation consiste à employer la force ou la ruse pour altérer à notre profit l’équivalence des services.
Les combinaisons de la Spoliation sont inépuisables, comme les ressources de la sagacité humaine. Il faut deux conditions pour que les services échangés puissent être tenus pour légitimement équivalents. La première, c’est que le jugement de l’une des parties contractantes ne soit pas faussé par les manœuvres de l’autre ; la seconde, c’est que la transaction soit libre. Si un homme parvient à extorquer de son semblable un service réel, en lui faisant croire que ce qu’il lui donne en retour est aussi un service réel, tandis que ce n’est qu’un service illusoire, il y a spoliation. À plus forte raison, s’il a recours à la force.
On est d’abord porté à penser que la Spoliation ne se manifeste que sous la forme de ces vols définis et punis par le Code. S’il en était ainsi, je donnerais, en effet, une trop grande importance sociale à des faits exceptionnels, que la conscience publique réprouve et que la loi réprime. Mais, hélas ! il y a la spoliation qui s’exerce avec le consentement de la loi, par l’opération de la loi, avec l’assentiment et souvent aux applaudissements de la société. C’est cette Spoliation seule qui peut prendre des proportions énormes, suffisantes pour altérer la distribution de la richesse dans le corps social, paralyser pour longtemps la force de nivellement qui est dans la Liberté, créer l’inégalité permanente des conditions, ouvrir le gouffre de la misère, et répandre sur le monde ce déluge de maux que des esprits superficiels attribuent à la Propriété. Voilà la Spoliation dont je parle, quand je dis qu’elle dispute au principe opposé, depuis l’origine, l’empire du monde. Signalons brièvement quelques-unes de ses manifestations.
Qu’est-ce d’abord que la guerre, telle surtout qu’on la comprenait dans l’antiquité ? Des hommes s’associaient, se formaient en corps de nation, dédaignaient d’appliquer leurs facultés à l’exploitation de la nature pour en obtenir des moyens d’existence ; mais, attendant que d’autres peuples eussent formé des propriétés, ils les attaquaient, le fer et le feu à la main, et les dépouillaient périodiquement de leurs biens. Aux vainqueurs alors non-seulement le butin, mais la gloire, les chants des poëtes, les acclamations des femmes, les récompenses nationales et l’admiration de la postérité ! Certes, un tel régime, de telles idées universellement acceptées devaient infliger bien des tortures, bien des souffrances, amener une bien grande inégalité parmi les hommes. Est-ce la faute de la Propriété ?
Plus tard, les spoliateurs se raffinèrent. Passer les vaincus au fil de l’épée, ce fut, à leurs yeux, détruire un trésor. Ne ravir que des propriétés, c’était une spoliation transitoire ; ravir les hommes avec les choses, c’était organiser la spoliation permanente. De là l’esclavage, qui est la spoliation poussée jusqu’à sa limite idéale, puisqu’elle dépouille le vaincu de toute propriété actuelle et de toute propriété future, de ses œuvres, de ses bras, de son intelligence, de ses facultés, de ses affections, de sa personnalité tout entière. Il se résume en ceci : exiger d’un homme tous les services que la force peut lui arracher, et ne lui en rendre aucun. Tel a été l’état du monde jusqu’à une époque qui n’est pas très-éloignée de nous. Tel il était en particulier à Athènes, à Sparte, à Rome, et il est triste de penser que ce sont les idées et les mœurs de ces républiques que l’éducation offre à notre engouement et fait pénétrer en nous par tous les pores. Nous ressemblons à ces plantes, auxquelles l’horticulteur a fait absorber des eaux colorées et qui reçoivent ainsi une teinte artificielle ineffaçable. Et l’on s’étonne que des générations ainsi instruites ne puissent fonder une République honnête ! Quoi qu’il en soit, on conviendra qu’il y avait là une cause d’inégalité qui n’est certes pas imputable au régime propriétaire tel qu’il a été défini dans les précédents articles.
Je passe par-dessus le servage, le régime féodal et ce qui l’a suivi jusqu’en 89. Mais je ne puis m’empêcher de mentionner la Spoliation qui s’est si longtemps exercée par l’abus des influences religieuses. Recevoir des hommes des services positifs, et ne leur rendre en retour que des services imaginaires, frauduleux, illusoires et dérisoires, c’est les spolier de leur consentement, il est vrai ; circonstance aggravante, puisqu’elle implique qu’on a commencé par pervertir la source même de tout progrès, le jugement. Je n’insisterai pas là-dessus. Tout le monde sait ce que l’exploitation de la crédulité publique, par l’abus des religions vraies ou fausses, avait mis de distance entre le sacerdoce et le vulgaire dans l’Inde, en Égypte, en Italie, en Espagne. Est-ce encore la faute de la Propriété ?
Nous venons au dix-neuvième siècle, après ces grandes iniquités sociales qui ont imprimé sur le sol une trace profonde ; et qui peut nier qu’il faut du temps pour qu’elle s’efface, alors même que nous ferions prévaloir dès aujourd’hui dans toutes nos lois, dans toutes nos relations, le principe de la propriété, qui n’est que la liberté, qui n’est que l’expression de la justice universelle ? Rappelons-nous que le servage couvre, de nos jours, la moitié de l’Europe ; qu’en France, il y a à peine un demi-siècle que la féodalité a reçu le dernier coup ; qu’elle est encore dans toute sa splendeur en Angleterre ; que toutes les nations font des efforts inouïs pour tenir debout de puissantes armées, ce qui implique ou qu’elles menacent réciproquement leurs propriétés, ou que ces armées ne sont elles-mêmes qu’une grande spoliation. Rappelons-nous que tous les peuples succombent sous le poids de dettes dont il faut bien rattacher l’origine à des folies passées ; n’oublions pas que nous-mêmes nous payons des millions annuellement pour prolonger la vie artificielle de colonies à esclaves, d’autres millions pour empêcher la traite sur les côtes d’Afrique (ce qui nous a impliqués dans une de nos plus grandes difficultés diplomatiques), et que nous sommes sur le point de livrer 100 millions aux planteurs pour couronner les sacrifices que ce genre de spoliation nous a infligés sous tant de formes.
Ainsi le passé nous tient, quoi que nous puissions dire. Nous ne nous en dégageons que progressivement. Est-il surprenant qu’il y ait de l’Inégalité parmi les hommes, puisque le principe Égalitaire, la Propriété, a été jusqu’ici si peu respecté ? D’où viendra le nivellement des conditions qui est le vœu ardent de notre époque et qui la caractérise d’une manière si honorable ? Il viendra de la simple Justice, de la réalisation de cette loi : Service pour service. Pour que deux services s’échangent selon leur valeur réelle, il faut deux choses aux parties contractantes : lumières dans le jugement, liberté dans la transaction. Si le jugement n’est pas éclairé, en retour de services réels, on acceptera, même librement, des services dérisoires. C’est encore pis si la force intervient dans le contrat.
Ceci posé, et reconnaissant qu’il y a entre les hommes une inégalité dont les causes sont historiques, et ne peuvent céder qu’à l’action du temps, voyons si du moins notre siècle, faisant prévaloir partout la justice, va enfin bannir la force et la ruse des transactions humaines, laisser s’établir naturellement l’équivalence des services, et faire triompher la cause démocratique et égalitaire de la Propriété.
Hélas ! je rencontre ici tant d’abus naissants, tant d’exceptions, tant de déviations directes ou indirectes, apparaissant à l’horizon du nouvel ordre social, que je ne sais par où commencer.
Nous avons d’abord les priviléges de toute espèce. Nul ne peut se faire avocat, médecin, professeur, agent de change, courtier, notaire, avoué, pharmacien, imprimeur, boucher, boulanger, sans rencontrer des prohibitions légales. Ce sont autant de services qu’il est défendu de rendre, et, par suite, ceux à qui l’autorisation est accordée les mettent à plus haut prix, à ce point que ce privilége seul, sans travail, a souvent une grande valeur. Ce dont je me plains ici, ce n’est pas qu’on exige des garanties de ceux qui rendent ces services, quoiqu’à vrai dire la garantie efficace se trouve en ceux qui les reçoivent et les paient. Mais encore faudrait-il que ces garanties n’eussent rien d’exclusif. Exigez de moi que je sache ce qu’il faut savoir pour être avocat ou médecin, soit ; mais n’exigez pas que je l’aie appris en telle ville, en tel nombre d’années, etc.
Vient ensuite le prix artificiel, la valeur supplémentaire qu’on essaie de donner, par le jeu des tarifs, à la plupart des choses nécessaires, blé, viande, étoffes, fer, outils, etc.
Il y a là évidemment un effort pour détruire l’équivalence des services, une atteinte violente à la plus sacrée de toutes les propriétés, celle des bras et des facultés. Ainsi que je l’ai précédemment démontré, quand le sol d’un pays a été successivement occupé, si la population ouvrière continue à croître, son droit est de limiter les prétentions du propriétaire foncier, en travaillant pour le dehors, en faisant venir du dehors sa subsistance. Cette population n’a que du travail à livrer en échange des produits, et il est clair que si le premier terme s’accroît sans cesse, quand le second demeure stationnaire, il faudra donner plus de travail contre moins de produits. Cet effet se manifeste par la baisse des salaires, le plus grand des malheurs, quand elle est due à des causes naturelles, le plus grand des crimes, quand elle provient de la loi.
Arrive ensuite l’impôt. Il est devenu un moyen de vivre très-recherché. On sait que le nombre des places a toujours été croissant et que le nombre des solliciteurs s’accroît encore plus vite que le nombre des places. Or, quel est le solliciteur qui se demande s’il rendra au public des services équivalents à ceux qu’il en attend ? Ce fléau est-il près de cesser ? Comment le croire, quand on voit que l’opinion publique elle-même pousse à tout faire faire par cet être fictif l’État, qui signifie une collection d’agents salariés ? Après avoir jugé tous les hommes sans exception capables de gouverner le pays, nous les déclarons incapables de se gouverner eux-mêmes. Bientôt il y aura deux ou trois agents salariés auprès de chaque Français, l’un pour l’empêcher de trop travailler, l’autre pour faire son éducation, un troisième pour lui fournir du crédit, un quatrième pour entraver ses transactions, etc., etc. Où nous conduira cette illusion qui nous porte à croire que l’État est un personnage qui a une fortune inépuisable indépendante de la nôtre ?
Le peuple commence à savoir que la machine gouvernementale est coûteuse. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que le fardeau retombe inévitablement sur lui. On lui fait croire que si jusqu’ici sa part a été lourde, la République a un moyen, tout en augmentant le fardeau général, d’en repasser au moins la plus grande partie sur les épaules du riche. Funeste illusion ! Sans doute on peut arrivera à ce que le percepteur s’adresse à telle personne plutôt qu’à telle autre, et que, matériellement, il reçoive l’argent de la main du riche. Mais l’impôt une fois payé, tout n’est pas fini. Il se fait un travail ultérieur dans la société, il s’opère des réactions sur la valeur respective des services, et l’on ne peut pas éviter que la charge ne se répartisse à la longue sur tout le monde, le pauvre compris. Son véritable intérêt est donc, non qu’on frappe une classe, mais qu’on les ménage toutes, à cause de la solidarité qui les lie.
Or, rien annonce-t-il que le temps soit venu où les taxes vont être diminuées ?
Je le dis sincèrement : je crois que nous entrons dans une voie où, avec des formes fort douces, fort subtiles, fort ingénieuses, revêtues des beaux noms de solidarité et de fraternité, la spoliation va prendre des développements dont l’imagination ose à peine mesurer l’étendue. Cette forme, la voici : Sous la dénomination d’État, on considère la collection des citoyens comme un être réel, ayant sa vie propre, sa richesse propre, indépendamment de la vie et de la richesse des citoyens eux-mêmes, et puis chacun s’adresse à cet être fictif pour en obtenir qui l’instruction, qui le travail, qui le crédit, qui les aliments, etc., etc. Or, l’État ne peut rien donner aux citoyens qu’il n’ait commencé par le leur prendre. Les seuls effets de cet intermédiaire, c’est d’abord une grande déperdition de forces, et ensuite la complète destruction de l’équivalence des services, car l’effort de chacun sera de livrer le moins possible aux caisses de l’État et d’en retirer le plus possible. En d’autres termes, le Trésor public sera au pillage. Et ne voyons-nous pas dès aujourd’hui quelque chose de semblable ? Quelle classe ne sollicite pas les faveurs de l’État ? Il semble que c’est en lui qu’est le principe de vie. Sans compter la race innombrable de ses propres agents, l’agriculture, les manufactures, le commerce, les arts, les théâtres, les colonies, la navigation attendent tout de lui. On veut qu’il défriche, qu’il irrigue, qu’il colonise, qu’il enseigne et même qu’il amuse. Chacun mendie une prime, une subvention, un encouragement et surtout la gratuité de certains services, comme l’instruction et le crédit. Et pourquoi pas demander à l’État la gratuité de tous les services ? pourquoi pas exiger de l’État qu’il nourrisse, abreuve, loge et babille gratuitement tous les citoyens ?
Une classe était restée étrangère à ces folles prétentions,
Une pauvre servante au moins m’était restée,
Qui de ce mauvais air n’était pas infectée ;
c’était le peuple proprement dit, l’innombrable classe des travailleurs. Mais la voilà aussi sur les rangs. Elle verse largement au Trésor ; en toute justice, en vertu du principe de l’égalité, elle a les mêmes droits à cette dilapidation universelle dont les autres classes lui ont donné le signal. Regrettons profondément que le jour où sa voix s’est fait entendre, ç’ait été pour demander part au pillage et non pour le faire cesser. Mais cette classe pouvait-elle être plus éclairée que les autres ? N’est-elle pas excusable d’être dupe de l’illusion qui nous aveugle tous ?
Cependant, par le seul fait du nombre des solliciteurs, qui est aujourd’hui égal au nombre des citoyens, l’erreur que je signale ici ne peut être de longue durée, et l’on en viendra bientôt, je l’espère, à ne demander à l’État que les seuls services de sa compétence, justice, défense nationale, travaux publics, etc.
Nous sommes en présence d’une autre cause d’inégalité, plus active peut-être que toutes les autres, la guerre au Capital. Le Prolétariat ne peut s’affranchir que d’une seule manière, par l’accroissement du capital national. Quand le capital s’accroît plus rapidement que la population, il s’ensuit deux effets infaillibles qui tous deux concourent à améliorer le sort des ouvriers : baisse des produits, hausse des salaires. Mais, pour que le capital s’accroisse, il lui faut avant tout de la sécurité. S’il a peur, il se cache, s’exile, se dissipe et se détruit. C’est alors que le travail s’arrête et que les bras s’offrent au rabais. Le plus grand de tous les malheurs pour la classe ouvrière, c’est donc de s’être laissé entraîner par des flatteurs à une guerre contre le capital, aussi absurde que funeste. C’est une menace perpétuelle de spoliation pire que la spoliation même.
En résumé, s’il est vrai, comme j’ai essayé de le démontrer, que la Liberté, qui est la libre disposition des propriétés, et, par conséquent, la consécration suprême du Droit de Propriété ; s’il est vrai, dis-je, que la Liberté tend invinciblement à amener la juste équivalence des services, à réaliser progressivement l’Égalité, à rapprocher tous les hommes d’un même niveau qui s’élève sans cesse, ce n’est pas à la Propriété qu’il faut imputer l’Inégalité désolante dont le monde nous offre encore le triste aspect, mais au principe opposé, à la Spoliation, qui a déchaîné sur notre planète les guerres, l’esclavage, le servage, la féodalité, l’exploitation de l’ignorance et de la crédulité publiques, les priviléges, les monopoles, les restrictions, les emprunts publics, les fraudes commerciales, les impôts excessifs, et, en dernier lieu, la guerre au capital et l’absurde prétention de chacun de vivre et se développer aux dépens de tous.
RÉCLAMATION DE M. CONSIDÉRANT ET RÉPONSE DE F. BASTIAT,
Publiées par le Journal des Débats, dans son n° du 28 juillet 1848.
Monsieur,
Dans les discussions graves dont la question sociale va être l’objet, je suis bien décidé à ne pas permettre que l’on donne au public, comme m’appartenant, des opinions qui ne sont pas les miennes, ou qu’on présente les miennes sous un jour qui les altère et les défigure.
Je n’ai pas défendu le principe de la propriété, pendant vingt ans, contre les Saint-Simoniens qui niaient le droit d’hérédité, contre les Babouvistes, les Owenistes, et contre toutes les variétés de Communistes, pour consentir à me voir rangé parmi les adversaires de ce droit de propriété dont je crois avoir établi la légitimité logique sur des bases assez difficiles à ébranler.
Je n’ai pas combattu, au Luxembourg, les doctrines de M. Louis Blanc, je n’ai pas été maintes fois attaqué par M. Proudhon comme un des défenseurs les plus acharnés de la propriété, pour pouvoir laisser, sans réclamation, M. Bastiat me faire figurer chez vous, avec ces deux socialistes, dans une sorte de triumvirat anti-propriétaire.
Comme je voudrais d’ailleurs n’être pas forcé de réclamer de votre loyauté des insertions trop considérables de ma prose dans vos colonnes, et qu’en ceci vous devez être d’accord avec mon désir, je vous demande la permission de faire à M. Bastiat, avant qu’il aille plus loin, quelques observations propres à abréger beaucoup les réponses qu’il peut me forcer de lui faire et peut-être même à m’en dispenser complétement.
1° Je ne voudrais pas que M. Bastiat, lors même qu’il croit analyser ma pensée très-fidèlement, donnât, en guillemettant et comme citations textuelles de ma brochure sur le droit de propriété et le droit au travail, ou de tout autre écrit, des phrases qui sont de lui, et qui, notamment dans l’avant-dernière de celles qu’il me prête, rendent inexactement mes idées. Ce procédé n’est pas heureux, et peut mener celui qui l’emploie beaucoup plus loin qu’il ne le voudrait lui-même. Abrégez et analysez comme vous l’entendez, c’est votre droit ; mais ne donnez pas à votre abréviation analytique le caractère d’une citation textuelle.
2° M. Bastiat dit : « Ils (les trois socialistes parmi lesquels je figure) paraissent croire que dans la lutte qui va s’engager, les pauvres sont intéressés au triomphe du droit au travail, et les riches à la défense du droit de propriété. » Je ne crois pour ma part, et même je ne crois pas paraître croire rien de semblable. Je crois, au contraire, que les riches sont aujourd’hui plus sérieusement intéressés que les pauvres à la reconnaissance du droit au travail. C’est la pensée qui domine tout mon écrit, publié pour la première fois, non pas aujourd’hui, mais il y a dix ans, et composé pour donner aux gouvernants et à la propriété un avertissement salutaire, en même temps que pour défendre la propriété contre la logique redoutable de ses adversaires. Je crois, en outre, que le droit de propriété est tout autant dans l’intérêt des pauvres que dans celui des riches ; car je regarde la négation de ce droit comme la négation du principe de l’individualité ; et sa suppression, en quelque état de société que ce fût, me paraîtrait le signal d’un retour à l’état sauvage, dont je ne me suis jamais, que je sache, montré très-partisan.
3° Enfin M. Bastiat s’exprime ainsi :
« Au reste, je n’ai pas l’intention d’examiner en détail la théorie de M. Considérant… Je ne veux m’attaquer qu’à ce qu’il y a de grave et de sérieux au fond de cette théorie, je veux dire la question de la Rente. Le système de M. Considérant peut se résumer ainsi : Un produit agricole existe par le concours de deux actions : l’action de l’homme, ou le travail, qui donne ouverture au droit de propriété ; l’action de la nature, qui devrait être gratuite, et que les propriétaires font injustement tourner à leur profit. C’est là ce qui constitue l’usurpation des droits de l’espèce. »
J’en demande mille fois pardon à M. Bastiat, mais il n’y a pas un mot dans ma brochure qui puisse l’autoriser à me prêter les opinions qu’il m’attribue bien gratuitement ici. En général, je déguise peu ma pensée, et quand je pense midi, je n’ai pas l’habitude de dire quatorze heures. Que M. Bastiat donc, s’il veut me faire l’honneur de battre ma brochure en brèche, combatte ce que j’y ai mis et non ce qu’il y met. Je n’y ai pas écrit un mot contre la Rente ; la question de la Rente, que je connais comme tout le monde, n’y figure ni de près ni de loin, ni en espèce ni même en apparence ; et quand M. Bastiat me fait dire « que l’action de la nature devrait être gratuite, que les propriétaires la font injustement tourner à leur profit, et que c’est là ce qui constitue, suivant moi, l’usurpation des droits de l’espèce, » il reste encore et toujours dans un ordre d’idées que je n’ai pas le moins du monde abordé ; il me prête une opinion que je considère comme absurde, et qui est même diamétralement opposée à toute la doctrine de mon écrit. Je ne me plains pas du tout, en effet, de ce que les propriétaires jouissent de l’action de la nature ; je demande, pour ceux qui n’en jouissent pas, le droit à un travail qui leur permette de pouvoir, à côté des propriétaires, créer des produits et vivre en travaillant, quand la propriété (agricole ou industrielle) ne leur en offre pas le moyen.
Au reste, Monsieur, je n’ai pas la prétention grande de discuter, contradictoirement avec M. Bastiat, mes opinions dans vos colonnes. C’est une faveur et un honneur auxquels je ne suis point réservé. Que M. Bastiat fasse donc de mon système des décombres et de la poussière, je ne me croirai en droit de réclamer votre hospitalité pour mes observations que quand, faute d’avoir compris, il m’attribuera des doctrines dont je n’aurai point pris la responsabilité. Je sais bien qu’il devient souvent facile de terrasser les gens quand on leur fait dire ce que l’on veut en place de ce qu’ils disent ; je sais bien surtout qu’on a toujours plus aisément raison contre les socialistes, quand on les combat confusément et en bloc que quand ou les prend chacun pour ce qu’ils proposent ; mais, à tort ou à raison, je tiens pour mon compte à ne porter d’autre responsabilité que la mienne.
La discussion qu’engage dans vos colonnes M. Bastiat porte, monsieur le Rédacteur, sur des sujets trop délicats et trop graves pour que, en ceci du moins, vous ne soyez pas de mon avis. Je me tiens donc pour assuré que vous approuverez ma juste susceptibilité, et que vous donnerez loyalement à ma réclamation, dans vos colonnes, une place visible et un caractère lisible.
V. Considérant,
Représentant du peuple.
Paris, le 24 juillet 1848.
M. Considérant se plaint de ce que j’ai altéré ou défiguré son opinion sur la propriété. Si j’ai commis cette faute, c’est bien involontairement, et je ne saurais mieux faire, pour la réparer, que de citer des textes.
Après avoir établi qu’il y a deux sortes de Droits, le Droit naturel, qui est l’expression des rapport résultant de la nature même des êtres ou des choses, et le Droit conventionnel ou légal, qui n’existe qu’à la condition de régir des rapports faux, M. Considérant poursuit ainsi :
« Cela posé, nous dirons nettement que la Propriété telle qu’elle a été généralement constituée chez tous les peuples industrieux jusqu’à nos jours, est entachée d’illégitimité et pèche contre le Droit… L’espèce humaine est placée sur la terre pour y vivre et se développer. L’espèce est donc usufruitière de la surface du globe…
Or, sous le régime qui constitue la Propriété dans toutes les nations civilisées, le fonds commun sur lequel l’Espèce a plein droit d’usufruit a été envahi ; il se trouve confisqué par le petit nombre à l’exclusion du grand nombre. Eh bien ! n’y eût-il en fait qu’un seul homme exclu de son droit à l’usufruit du fonds commun par la nature du régime de propriété, cette exclusion constituerait à elle seule une atteinte au Droit, et le régime de propriété qui la consacrerait serait certainement injuste, illégitime.
Tout homme qui venant au monde dans une société civilisée ne possède rien et trouve la terre confisquée tout autour de lui, ne pourrait-il pas dire à ceux qui lui prêchent le respect pour le régime existant de la propriété, en alléguant le respect qu’on doit au droit de propriété : « Mes amis, entendons-nous et distinguons un peu les choses ; je suis fort partisan du droit de propriété et très-disposé à le respecter à l’égard d’autrui, à la seule condition qu’autrui le respecte à mon égard. Or, en tant que membre de l’espèce, j’ai droit à l’usufruit du fonds, qui est la propriété commune de l’espèce et que la nature n’a pas, que je sache, donné aux uns au détriment des autres. En vertu du régime de propriété que je trouve établi en arrivant ici, le fonds commun est confisqué et très-bien gardé. Votre régime de propriété est donc fondé sur la spoliation de mon droit d’usufruit. Ne confondez pas le droit de propriété avec le régime particulier de propriété que je trouve établi par votre droit factice. »
Le régime actuel de la propriété est donc illégitime et repose sur une fondamentale spoliation. »
M. Considérant arrive enfin à poser le principe fondamental du droit de propriété en ces termes :
« Tout homme possède légitimement la chose que son travail, son intelligence, ou plus généralement que son activité a créée. »
Pour montrer la portée de ce principe, il suppose une première génération cultivant une île isolée. Les résultats du travail de cette génération se divisent en deux catégories.
« La première comprend les produits du sol qui appartenaient à cette première génération en sa qualité d’usufruitière, augmentés, raffinés ou fabriqués par son travail, par son industrie : ces produits bruts ou fabriqués consistent soit en objets de consommation, soit en instruments de travail. Il est clair que ces produits appartiennent en toute et légitime propriété à ceux qui les ont créés par leur activité…
Non-seulement cette génération a créé les produits que nous venons de désigner… mais encore elle a ajouté une plus-value à la valeur primitive du sol par la culture, par les constructions, par tous les travaux de fonds et immobiliers qu’elle a exécutés.
Cette plus-value constitue évidemment un produit, une valeur due à l’activité de la première génération. »
M. Considérant reconnaît que cette seconde valeur est aussi une propriété légitime. Puis il ajoute :
« Nous pouvons donc parfaitement reconnaître que, quand la seconde génération arrivera, elle trouvera sur la terre deux sortes de capitaux :
A. Le capital primitif ou naturel, qui n’a pas été créé par les hommes de la première génération , c’est-à-dire la valeur de la terre brute.
B. Le capital créé par la première génération, comprenant, 1° les produits, denrées et instruments qui n’auront pas été consommés et usés par la première génération ; 2° la plus-value que le travail de la première génération aura ajoutée à la valeur de la terre brute.
Il est donc évident et il résulte clairement et nécessairement du principe fondamental du Droit de propriété tout à l’heure établi, que chaque individu de la deuxième génération a un Droit égal au capital Primitif ou Naturel, tandis qu’il n’a aucun Droit à l’autre Capital, au Capital Créé par la première génération. Chaque individu de celle-ci pourra donc disposer de sa part du Capital Créé en faveur de tels ou tels individus de la seconde génération qu’il lui plaira choisir, enfants, amis, etc. »
Ainsi dans cette seconde génération il y a deux sortes d’individus, ceux qui héritent du capital créé et ceux qui n’en héritent pas. Il y a aussi deux sortes de capitaux, le capital primitif ou naturel et le capital créé. Ce dernier appartient légitimement aux héritiers, mais le premier appartient légitimement à tout le monde. Chaque individu de la seconde génération a un droit égal au capital primitif. Or il est arrivé que les héritiers du capital créé se sont emparés aussi du capital non créé, l’ont envahi, usurpé, confisqué. Voilà pourquoi et en quoi le régime actuel de la propriété est illégitime, contraire au droit et repose sur une fondamentale spoliation.
Je puis certainement me tromper ; mais il me semble que cette doctrine reproduit exactement, quoique en d’autres termes, celle de Buchanan, Mac-Culloch et Senior sur la Rente. Eux aussi reconnaissent la propriété légitime de ce qu’on a créé par le travail. Mais ils regardent comme illégitime l’usurpation de ce que M. Considérant appelle la valeur de la terre brute, et de ce qu’ils nomment force productive de la terre.
Voyons maintenant comment cette injustice peut être réparée.
« Le sauvage jouit, au milieu des forêts, des savanes, des quatre droits naturels : chasse, pêche, cueillette, pâture. Telle est la première forme du Droit.
Dans toutes les sociétés civilisées, l’homme du peuple, le prolétaire, qui n’hérite de rien et ne possède rien, est purement et simplement dépouillé de ces droits. On ne peut donc pas dire que le droit primitif ait ici changé de forme, puisqu’il n’existe plus. La forme a disparu avec le fond.
Or quelle serait la forme sous laquelle le Droit pourrait se concilier avec les conditions d’une société industrieuse ? La réponse est facile. Dans l’état sauvage, pour user de son droit, l’homme est obligé d’agir. Les travaux de la pêche, de la chasse, de la cueillette, de la pâture, sont les conditions de l’exercice de son droit. Le droit primitif n’est donc que le droit à ces travaux.
Eh bien ! qu’une société industrieuse, qui a pris possession de la terre, et qui enlève à l’homme la faculté d’exercer à l’aventure et en liberté sur la surface du sol ses quatre droits naturels ; que cette société reconnaisse à l’individu, en compensation de ces droits, dont elle le dépouille, le droit au travail, — alors en principe, et sauf application convenable, l’individu n’aura plus à se plaindre. En effet, son droit primitif était le droit au travail exercé au sein d’un atelier pauvre, au sein de la nature brute ; son droit actuel serait le même droit exercé dans un atelier mieux pourvu, plus riche, où l’activité individuelle doit être plus productive.
La condition sine quâ non, pour la légitimité de la propriété, est donc que la société reconnaisse au prolétaire le droit au travail, et qu’elle lui assure au moins autant de moyens de subsistance, pour un exercice d’activité donné, que cet exercice eût pu lui en procurer dans l’état primitif. »
Maintenant je laisse au lecteur à juger si j’avais altéré ou défiguré les opinions de M. Considérant.
M. Considérant croit être un défenseur acharné du droit de propriété. Sans doute il défend ce droit tel qu’il le comprend, mais il le comprend à sa manière, et la question est de savoir si c’est la bonne. En tout cas, ce n’est pas celle de tout le monde.
Il dit lui-même que, quoiqu’il ne fallût qu’une modeste dose de bon sens pour résoudre la question de la propriété, elle n’a jamais été bien comprise. Il m’est bien permis de ne pas souscrire à cette condamnation de l’intelligence humaine.
Ce n’est pas seulement la théorie que M. Considérant accuse. Je la lui abandonnerais, pensant avec lui qu’en cette matière, comme en bien d’autres, elle s’est souvent fourvoyée.
Mais il condamne aussi la pratique universelle. Il dit nettement :
« La propriété, telle qu’elle a été généralement constituée chez tous les peuples industrieux jusqu’à nos jours, est entachée d’illégitimité et pèche singulièrement contre le droit. »
Si donc M. Considérant est un défenseur acharné de la propriété, c’est au moins d’un mode de propriété différent de celui qui a été reconnu et pratiqué parmi les hommes depuis le commencement du monde.
Je suis bien convaincu que M. Louis Blanc et M. Proudhon se disent aussi défenseurs de la propriété comme ils l’entendent.
Moi-même je n’ai pas d’autre prétention que de donner de la propriété une explication que je crois vraie et qui peut-être est fausse.
Je crois que la propriété foncière, telle qu’elle se forme naturellement, est toujours le fruit du travail ; qu’elle repose par conséquent sur le principe même établi par M. Considérant ; qu’elle n’exclut pas les prolétaires de l’usufruit de la terre brute ; qu’au contraire elle décuple et centuple pour eux cet usufruit : qu’elle n’est donc pas entachée d’illégitimité, et que tout ce qui l’ébranle dans les faits et dans les convictions est une calamité autant pour ceux qui ne possèdent pas le sol que pour ceux qui le possèdent.
C’est ce que je voudrais m’efforcer de démontrer, autant que cela se peut faire dans les colonnes d’un journal.
F. Bastiat.
T.223 Economic Harmonies I, II, III in JDE (Sept. 1848) (Fr, PDF1, PDF2)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Checked against EH PDF: 27 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.223 (1848.09.01) "Economic Harmonies: I., II., and III. The Needs of Man" (Harmonie économiques. I, II, III. Des besoins de l’homme), Journal des économistes, T. XXI, No. 87, 1 Sept. 1848, pp. 105-20; also in EH 1-3. [OC6]
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
I: structurally identical with EH1 except for insertion of new sentence about disturbing facts at tend of second last para.
II: extensively rewritten. Some sections kept, others cut.
III: largely the same except for several new pages inserted. Part IV of JDE is part of this Section III in EH1.
Text: I, II, III. HARMONIES ÉCONOMIQUES.↩
[105]
I. [153]
Quel spectacle profondément affligeant nous offre la France!
Il serait difficile de dire si l'anarchie a passé des idées aux faits ou des faits aux idées, mais il est certain qu'elle a tout envahi.
Le pauvre s'élève contre le riche; le prolétariat contre la propriété; le peuple contre la bourgeoisie; le travail contre le capital; l'agriculture contre l'industrie; la campagne contre la ville; la province contre la capitale; le regnicole contre l'étranger.
Et les théoriciens surviennent, qui font un système de cet antagonisme. « Il est, disent-ils, le résultat fatal de la nature des choses, c'est-à-dire, de la Liberté. L'homme s'aime lui-même, et voilà d'où vient tout le mal; car puisqu'il s'aime, il tend vers son propre bienêtre, et il ne le peut trouver que dans le malheur de ses frères. Empêchons donc qu'il n'obéisse à ses tendances, étouffons sa liberté; changeons le cœur humain; substituons un autre mobile à celui que Dieu y a placé; inventons et dirigeons une société artificielle!
Quand on est là, une carrière sans limites s'ouvre devant la logique ou l'imagination. Si l'on est doué d'un esprit dialecticien combiné avec une nature chagrine, on s'acharne dans l'analyse du Mal ; on le dissèque, on le met au creuset, on lui demande son dernier mot, on remonte à ses causes, on le poursuit dans ses conséquences, et comme, à raison de notre imperfection native, il n'est étranger à rien, il n'est rien qu'on ne dénigre. On ne montre la Propriété, la Famille, le Capital, l'Industrie, la Concurrence, la Liberté, l'Intérêt personnel, que par un de leurs aspects, par le côté qui détruit ou qui blesse ; on fait pour ainsi dire contenir l'histoire naturelle de l'homme dans la clinique. On jette à Dieu le défi de concilier ce qu'on dit de sa bonté infinie avec l'existence du mal. On souille tout, on dégoûte de tout, on nie tout, et l'on ne laisse pas cependant que d'obtenir un triste et dangereux succès auprès de ces classes que la souffrance n'incline que trop vers le désespoir.
Si, au contraire, on porte un cœur ouvert à la bienveillance, un esprit qui se complaise aux illusions, on s'élance vers la région des chimères. On rêve des Oceana, des Atlantide, des Salente, des Spensonie, des Icarie, des Utopie, des Phalanstère; on les peuple d'êtres dociles, aimants, dévoués, qui n'ont garde de faire jamais obstacle à la fantaisie du rêveur. Celui-ci s'installe complaisamment dans [106] son rôle deProvidence. Il arrange, il dispose, il fait les hommes à son gré; rien ne l'arrête, jamais il ne rencontre de déceptions; il ressemble à ce prédicateur romain qui, après avoir transformé son bonnet carré en Rousseau, réfutait chaleureusement le Contrat social, et triomphait d'avoir réduit son adversaire au silence. C'est ainsi que notre réformateur fait briller aux yeux de ceux qui souffrent les séduisants tableaux d'une félicité idéale bien propre à dégoûter des rudes nécessités de la vie réelle.
Cependant, il est rare que l'utopiste s'en tienne à ses innocentes chimères. Dès qu'il veut y entraîner l'humanité, il éprouve qu'elle n'est pas facile à se laisser transformer. Elle résiste, il s'aigrit. Pour la déterminer, il ne lui parle pas seulement du bonheur qu'elle refuse, il lui parle surtout des maux dont il prétend la délivrer. Il ne saurait en faire une peinture trop saisissante. Il s'habitue à charger sa palette, à renforcer ses couleurs. Il cherche le mal, dans la société actuelle, avec autant de passion qu'un autre en mettrait à y découvrir fe bien. Il ne voit que souffrances, haillons, maigreur, inanition, douleurs, oppression. Il s'étonne, il s'irrite de ce que la société n'ait pas un sentiment assez vif de ses misères. Il ne néglige rien pour lui faire perdre son insensibilité, et, après avoir commencé par la bienveillance, lui aussi finit par la misanthropie. [154]
A Dieu ne plaise que j'accuse ici la sincérité de qui que ce soit. Mais en vérité, je ne puis m'expliquer que ces publicistes, qui voient un antagonisme radical au fond de l'ordre naturel des sociétés, puissent goûter un instant de calme et de repos. Il me semble que le découragement et le désespoir doivent être leur triste partage. Car enfin, si la nature s'est trompée en faisant de l'intérêt personnel le grand ressort des sociétés humaines (et son erreur est évidente, dès qu'il est admis que les intérêts sont fatalement antagoniques), comment ne s'aperçoivent-ils pas que le mal est irrémédiable? Hommes, où prendrons-nous notre point d'appui pour changer les tendances de l'humanité? Invoquerons-nous la Police, la Magistrature, l'Etat, le Législateur? Mais c'est avoir recours à des hommes, c'est-à-dire à des êtres sujets à l'infirmité commune. Nous adresserons-nous au Suffrage Universel? Mais c'est donner le cours le plus libre à l'universelle tendance.
Il ne reste donc qu'une ressource à ces publicistes. C'est de se donner pour des révélateurs, pour des prophètes, pétris d'un autre limon, puisant leurs inspirations à d'autres sources que le reste des hommes, et c'est pourquoi, sans doute, on les voit si souvent envelopper leurs systèmes et leurs conseils dans une phraséologie mystique. Mais s'ils sont des envoyés de Dieu, qu'ils prouvent donc leur mission. En définitive ce qu'ils demandent, c'est la puissance souveraine, c'est le despotisme le plus absolu qui fut jamais. Non-seulement ils veulent gouverner nos actes, mais ils prétendent altérer jusqu'à l'essence même de nos sentiments. C'est bien le moins qu'ils nous montrent leurs [107] titres. Espèrent-ils que l'humanité les croira sur parole, alors surtout qu'ils ne s'entendent pas entre eux?
Mais avant même d'examiner leurs projets de sociétés artificielles, n'y a-t-il pas une chose dont il faut s'assurer, à savoir, s'ils ne se trompent pas dès le point de départ? Est-il bien certain Que Les Intérêts soient Naturellement Antagoniques, qu’une cause irrémédiable d'inégalité se développe fatalement dans l'ordre naturel des sociétés humaines, et que dès lors Dieu se soit manifestement trompé, quand il a ordonné que l'homme tendrait vers le bien-être?
C'est ce que je me propose de rechercher.
Prenant l'homme, tel qu'il a plu à Dieu de le faire, susceptible de prévoyance et d'expérience, perfectible, s'aimant lui-même, c'est incontestable, mais d'une affection tempérée par le principe sympathique, et, en tous cas, contenue, équilibrée par la rencontre d'un sentiment analogue universellement répandu dans le milieu où elle agit, je me demande quel ordre social doit nécessairement résulter de la combinaison et des libres tendances de ces éléments.
Si nous trouvons que ce résultat n'est autre chose qu'une marche progressive vers le bien-être, le perfectionnement et l'égalité; une approximation soutenue de toutes les classes vers un même niveau physique, intellectuel et moral, en même temps qu'une constante élévation de ce niveau, l'œuvre de Dieu sera justifiée, et nous apprendrons avec bonheur que l'ordre social n'est pas le seul, dans la création, qui serait dépourvu de ces forces harmoniques devant lesquelles s'inclinait Newton et qui arrachaient au psalmiste ce cri : Cœli enarrant gloriam Dei.
Rousseau disait : Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire, je le ferais ou je me tairais.
Je ne suis pas prince, mais la confiance de mes concitoyens m'a fait législateur. Peut-être me diront-ils que c'est pour moi le temps d'agir et non d'écrire.
Qu'ils me pardonnent; que ce soit la vérité elle-même qui me presse ou que je sois dupe d'une illusion, toujours est-il que je sens le besoin de concentrer dans un faisceau des idées que je n'ai pu faire accepter jusqu'ici pour les avoir présentées éparses et par lambeaux. Il me semble que j'aperçois dans le jeu des lois naturelles de la société de sublimes et consolantes harmonies. Ce que je vois ou crois voir, ne dois-je pas essayer de le montrer à d'autres, afin de rallier ainsi autour d'une pensée de concorde et de fraternité bien des intelligences égarées, bien des cœurs aigris? Si, quand le vaisseau adoré de la patrie est battu parla tempête, je parais m'éloigner quelquefois, pour me recueillir, du poste auquel j'ai été appelé, c'est que mes faibles mains sont inutiles à la manœuvre. Est-ce d'ailleurs trahir mon mandat que de réfléchir sur les causes de la tempête elle-même, et m'efforcer [108] d’agir sur ces causes? Et puis, ce que je ne ferais pas aujourd'hui, qui sait s'il me serait donné de le faire demain?
Je commencerai par établir quelques notions économiques. M'aidant des travaux de mes devanciers, je m'efforcerai de résumer la Science dans un principe vrai, simple et fécond, qu'elle entrevit dès l'origine, dont elle s'est constamment approchée et dont peut-être le moment est venu de fixer la formule. Ensuite, à la clarté de ce flambeau, j'essayerai de résoudre quelques-uns des problèmes encore controversés, concurrence, machines, commerce extérieur, luxe, capital, rente, etc. Enfin, je montrerai [signalerai in EH1] les relations ou plutôt les harmonies de l'économie politique avec les autres sciences morales et sociales, en jetant un coup d'œil sur les graves sujets exprimés par ces mots : Intérêt personnel, Propriété, Liberté, Responsabilité, Solidarité, Egalité, Fraternité, Unité. [adds new sentence about disturbing factors in EH1: Enfin j’appellerai l’attention du lecteur sur les obstacles artificiels que rencontre le développement pacifique, régulier et progressif des sociétés humaines. De ces deux idées : Lois naturelles harmoniques, causes artificielles perturbatrices, se déduira la solution du Problème social.]
Il serait difficile de ne pas apercevoir le double écueil qui attend cette entreprise. Au milieu du tourbillon qui nous emporte, si ce livre est abstrait, on ne le lira pas; s'il obtient d'être lu, c'est que les questions n'y seront qu'effleurées. Comment concilier les droits de la science avec les exigences du lecteur? Pour satisfaire à toutes les conditions de fond et de forme, il faudrait peser chaque mot et étudier la place qui lui convient. C'est ainsi que le cristal s'élabore goutte à goutte dans le silence et l'obscurité. Silence, obscurité, temps, liberté d'esprit, tout me manque à la fois, et je suis réduit à me confier à la sagacité du public en invoquant son indulgence.
II. [155]
L'économie politique a pour sujet l'Homme. [156]
Mais elle n'embrasse pas l'Homme tout entier. Par exemple, elle ne s'occupe pas de ses rapports avec ses futures destinées. Elle ne l'envisage que par un certain côté.
Notre premier soin doit donc être d'étudier l'homme à ce point de vue. [EH1 reuses text from here on?? but revised extensively] Ainsi, je suis obligé de remonter aux phénomènes primordiaux de la sensibilité et de l'activité humaines. Que le lecteur se rassure cependant, notre séjour ne sera pas long dans les nuageuses régions de la Métaphysique, et je n'emprunterai à cette science que des notions simples, claires, et, je l'espère, incontestées.
L'âme (ou pour ne rien faire dépendre de la question de spiritualité), l'homme est doué de sensibilité. Que la sensation soit dans l'âme ou dans le corps, toujours est-il que l'homme, comme être passif, éprouve des Sensations pénibles ou agréables. Comme être actif, il fait Effort pour éloigner les unes et multiplier les autres. Le résultat est une Satisfaction.
De l'idée générale sensibilité, naissent les idées plus précises, désirs, appétits, besoins.
[109]
De l'idée générale activité, naissent les idées plus précises, effort, fatigue, travail, production.
De l'idée générale satisfaction, naissent les idées plus précises, plaisir, jouissances, consommation.
La sensation est personnelle; le plaisir et la douleur affectent l'individu. L'effort qu'ils y déterminent part de l'individu et est personnel aussi. Cet ensemble de phénomènes constitue l’intérêt personnel, qui est le grand ressort du monde social.
La notion de Propriété se déduit de ces prémisses. Puisque c'est l'individu qui éprouve la sensation, puisque c'est lui qui fait l’effort, il faut bien que la satisfaction aboutisse à lui, sans quoi l'effort n'aurait pas sa raison d'être.
Il en est de même de l'hérédité. Aucune théorie, aucune déclamation, ne fera que les pères et mères n'aiment leurs enfants. Les gens qui se plaisent à arranger des sociétés imaginaires peuvent trouver cela fort déplacé, mais c'est ainsi. Un père fait autant d'efforts, plus peut-être pour la satisfaction de ses enfants que pour la sienne propre. Si donc une loi contre nature interdisait la transmission de la propriété du père au fils, la moitié au moins des efforts humains seraient paralysés.
J'aurai occasion de revenir sur ces sujets : Intérêt personnel, Propriété, Hérédité.
Aujourd'hui, je me bornerai à chercher la circonscription, pour ainsi dire, du domaine de la science qui nous occupe.
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une science a, par elle-même, des frontières naturelles et immuables. Dans le domaine des idées, comme dans celui des faits, tout se lie, tout s'enchaîne, toutes les vérités se fondent les unes dans les autres, et il n'y a pas de science qui, pour être complète, ne dût les embrasser toutes. On a dit avec raison que, pour une intelligence infinie, il n'y aurait qu'une seule vérité. C'est donc notre faiblesse qui nous réduit à étudier isolément un certain ordre de phénomènes, et les classifications qui en résultent ne peuvent échapper à un certain arbitraire.
Le vrai mérite est d'exposer avec exactitude les faits, leurs causes et leurs conséquences. C'en est un aussi, mais beaucoup moindre et purement relatif, de déterminer d'une manière, non point rigoureuse, cela est impossible, mais rationnelle, l'ordre de faits que l'on se propose d'étudier.
Je dis ceci pour qu'on ne suppose pas que j'entends faire la critique de mes devanciers, s'il m'arrive de donner à l'économie politique des limites un peu différentes de celles qu'ils lui ont assignées.
Dans ces derniers temps, on a beaucoup reproché aux économistes de s'être trop attachés à étudier la richesse. On aurait voulu qu'ils fissent entrer dans la science tout ce qui, de près ou de loin, contribue au bonheur ou aux souffrances de l'humanité, et on a été jusqu'à [110] supposer qu'ils niaient tout ce dont ils ne s'occupaient pas, par exemple, les phénomènes du principe sympathique, aussi naturel au cœur de l'homme que le principe de l'intérêt personnel. C'est comme si l'on accusait le minéralogiste de nier l'existence du règne animal. Eh quoi! la Richesse, les lois de sa production, de sa distribution, de sa consommation, n'est-ce pas un sujet assez vaste, assez important pour faire l'objet d'une science spéciale? Si les conclusions de l'économiste étaient en contradiction avec celles de la politique ou de la morale, je concevrais l'accusation. On pourrait lui dire : «En vous limitant, vous vous êtes égaré, car il n'est pas possible que deux vérités se heurtent. » Peut-être résultera-t-il du travail que je soumets au public que la science de la richesse est en parfaite harmonie avec toutes les autres.
Besoins, efforts, satisfactions, voilà le fond général de toutes les sciences, qui ont l'homme pour objet.
Mais il s'en faut bien que l'économie politique embrasse un domaine aussi vaste.
Respirer est un besoin. Il exige un effort et amène une satisfaction. Cependant, personne ne songe à faire entrer le phénomène de la respiration dans le cercle de l'économie politique.
Un homme s'efforce de gagner l'estime, l'affection, la considération de ses semblables? Le succès est sa récompense. Dira-t-on que ce soit Jà un sujet d'étude pour l'économiste?
Il en est de même des efforts que font les hommes pour conquérir, les uns la gloire, les autres la couronne des élus.
On comprend qu'une science se refuse à embrasser, dans ses recherches, toutes les impressions, tous les efforts, toutes les satisfactions dans l'ordre physique, intellectuel et moral.
Imposer à l'économie politique cette vaste étendue, ce serait exiger d'elle d'être la science universelle, ce serait lui interdire de limiter le champ de ses investigations.
Besoin, effort, satisfaction, ces trois éléments doivent se rencontrer pour qu'un phénomène appartienne à l'économie politique. Mais puisque tous ceux qui présentent ce triple caractère n'y peuvent entrer, à quoi reconnaîtrons-nous ceux qu'il faut laisser en dehors?
Ce point de départ, je dois le dire, a divisé les Economistes.
En général, ils ont cherché dans le dernier terme, et en dégageant de l'idée générale satisfaction ce qu'on appelle en logique la différence propre, ce qui pouvait caractériser et limiter la science économique.
C'était bien naturel. Ils voulaient traiter de la richesse. Ils ne pouvaient la voir ni dans nos besoins, ni dans nos efforts. Ils devaient donc la chercher là où elle réside réellement, dans les objets propres à satisfaire nos désirs.
Adam Smith exigeait deux conditions pour que les choses fussent [111] de la richesse: qu'elles fussent échangeables et accumulables. Ces deux conditions en impliquaient une troisième, c'est qu'elles fussent tangibles ou matérielles, car comment concevoir que ce qui est immatériel soit susceptible d'accumulation?
La langue de l'économie politique s'est faite malheureusement sur cette donnée. Aussi toutes les expressions qui entrent dans son vocabulaire sont empreintes de matérialité, et particulièrement les deux termes extrêmes : production, consommation.
Selon cette définition, Smith aurait dù laisser une foule de professions en dehors de l'économie politique, et en exclure tous les hommes qui ne créent pas des produits tangibles, mais rendent des services, magistrats, auteurs, prêtres, jurisconsultes, militaires, médecins, artistes, professeurs, négociants, banquiers, assureurs, entrepreneurs de transports, etc., etc. Cependant il s'en est beaucoup occupé, se contentant de dire que ces professions sont utiles mais improductives, ce qui atteste un vice dans la définition même.
L'influence de cette imperfection a fortement obscurci la notion de la Valeur, ainsi que je l'expliquerai plus tard.
J.-B. Say s'approcha beaucoup plus du vrai dans son Traité, et, au fond, on peut dire qu'il l'atteignit dans son Cours.
Dans le premier de ces ouvrages, il avait d'abord adopté le point de départ de Smith; mais son esprit investigateur lui montra bientôt que cette distinction entre les produits et les services séparait des choses qui ont le même but, les mêmes effets, la même origine et la même nature.
Aussi, dans son Cours, il fit entrer positivement les services dans l'Economie sociale, leur reconnaissant ce qui fait le fondement de la richesse, la Valeur. Il a même été plus loin dans ses lettres à Malthus, puisqu'il y déclare que toute valeur est immatérielle. C'était reconnaître implicitement que les produits eux-mêmes n'ont de valeur qu'à cause des services dont ils sont l'occasion. Toute la théorie que je soumets aujourd'hui au public repose sur cette observation.
Ainsi J.-B. Say est l'auteur de la découverte qui, en même temps qu'elle a élargi la science, en a fixé les vraies limites.
Mais a-t-il tiré de sa découverte toutes les conséquences qu'elle renferme? On peut en douter sans manquer au respect que méritent ses vastes travaux. Mieux que personne, J.-B. Say savait qu'aucune science humaine n'est jamais achevée, et nul ne sent mieux ce qui reste à apprendre, que celui qui a le plus appris. Ce n'est pas un homme aux profondes et sérieuses études, mais un poëte enthousiaste, qui a pu s'écrier:
«A tous nos successeurs ne laissons rien à dire. »
Ne serait-il pas contradictoire, d'ailleurs, d'exiger que celui qui est arrivé, malgré l'autorité de ses prédécesseurs, malgré ses propres [112] opinions primitives, par de laborieuses et successives investigations, à un résultat inattendu, eût fait de ce résultat la base de son exposition? C'est trop demander à la fugitive rapidité d'une vie d'homme. C'est une grande gloire pour le savant de transmettre à ses successeurs une belle idée, une semence féconde. Comment en recueillerait-il les fruits, puisqu'elle est elle-même le fruit de son génie? Les sciences s'avancent ainsi; ce qui fut glorieuse conclusion pour le maître devient facile point de départ pour le disciple, et les générations, selon l'expression de M. Say, voient se grossir sans cesse le trésor de leurs connaissances.
J.-B. Say, il ne faut pas l'oublier, était parti de l'idée de Smith. Il avait longtemps tenu son attention fixée sur le produit. Ce n'est qu'à force de logique qu'il arriva à reconnaître de la Valeur dans les services. Il ne pouvait donc partir de la complète fusion de ces deux éléments, encore moins de la complète annihilation du premier dans le second. Tout ce qu'il put faire, ce fut de les juxtaposer plutôt que de les identifier. Dans ses ouvrages, le produit conserve une sorte de prééminence, et le service forme tout au plus une classe particulière et accessoire de produits, sous le nom de produits immatériels, expressions un peu étonnées de se trouver accouplées; car l'esprit humain se refusera toujours à voir un produit dans ce qui est immatériel, dans le chant de Malibran, dans la décision du juge, dans le conseil du médecin ou de l'avocat, dans la leçon du professeur.
Il est résulté de là que l'homme qui a découvert l'immatérialité de la Valeur n'en a pas moins conservé le vocabulaire consacré de l'économie politique, dont tous les termes, comme production, consommation, etc., portent le cachet de la matérialité; et, certes, il est à craindre que la science ne traîne longtemps encore après elle le fardeau de cette imperfection , car quel hardi néologiste oserait refaire la langue?
Cependant, grâce à cette approximation successive vers la solution du problème, le moment est venu de faire un pas décisif. Partant de ce point, que la valeur est immatérielle, un des objets de cet écrit est de démontrer que les services ne sont pas des produits, parce qu'ils ont de la valeur, mais qu'au contraire les produits n'ont de la valeur que parce que et en tant qu'ils sont des services, en sorte que ceux-ci, en définitive, restent seuls en possession de la science.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en opérant sur la satisfaction et en cherchant dans ce phénomène une distinction spécifique, la matérialité, que Smith pouvait trouver l'objet véritable et les limites rationnelles de la science. J'avoue que ce procédé me semble arbitraire et empirique. Smith lui-même en prouve l'insuffisance. Qu'est-ce qu'une économie sociale qui ne tient pas compte de la moitié de la société, ou se trouve réduite, en s'en occupant, à être inconséquente?
Cherchons donc une autre solution.
[new paras inserted in EH1 - above this completely rewritten, no mention of Smith, Say, Maliban in EH1]
[113]
[following paras identical in EH1 p. 67]
De(s?) ces trois termes qui renferment les destinées humaines : sensation, effort, satisfaction, le premier et le dernier se confondent toujours et nécessairement dans la même individualité. Il est impossible de les concevoir séparés. On peut concevoir une sensation non satisfaite, un besoin inassouvi ;jamais personne ne comprendra le besoin dans un homme et sa satisfaction dans un autre.
S'il en était de même pour le terme moyen, l'Effort, l'homme serait un être complétement solitaire. Le phénomène économique s'accomplirait intégralement dans l'individu isolé. Il pourrait y avoir une juxtaposition de personnes, il n'y aurait pas de société. Il pourrait y avoir une Economie personnelle, il ne pourrait exister d'Economie politique.
Mais il n'en est pas ainsi. Il est fort possible et fort fréquent que le Besoin de l'un doive sa Satisfaction à l'Effort de l'autre. C'est un fait. Si chacun de nous veut passer en revue toutes les satisfactions qui aboutissent à lui, il reconnaîtra qu'il les doit pour la plupart à des efforts qu'il n'a pas faits ; et de même, le travail que nous accomplissons, chacun dans notre profession, va presque toujours satisfaire des désirs qui ne sont pas en nous.
Ceci nous avertit que ce n'est ni dans les besoins ni dans les satisfactions, phénomènes essentiellement personnels et intransmisssibles, mais dans la nature du terme moyen, des Efforts humains, qu'il fallait chercher le principe social, l'origine de l'économie politique.
C'est, en effet, cette faculté donnée aux hommes, et aux hommes seuls entre toutes les créatures, de travailler les uns pour les autres ; c'est cette transmission d'efforts, cet échange de services, avec toutes les combinaisons infinies et compliquées auxquelles il donne lieu à travers le temps et l'espace, C'EST LA précisément ce qui constitue la science économique, en montre l'origine et en détermine les limites.
Je dis donc :
Forment le domaine de l'économie politique tout effort susceptible de satisfaire, à charge de retour, les besoins d'une personne autre que celle qui l'a accompli, et, par suite, les besoins et satisfactions relatifs à cette nature d'efforts.
Ainsi, pour citer un exemple, je disais tout à l'heure que l'action de respirer, quoiqu'elle contienne les trois termes qui constituent le phénomène économique, n'appartient pourtant pas à cette science, et l’on en voit la raison : c'est qu'il s'agit ici d'un effort généralement intransmissible. Nous n'invoquons l'assistance de personne pour respirer; il n'y a là ni service à recevoir ni service à rendre; il y a un fait individuel par nature et non social, qui ne peut, par conséquent, entrer dans une science toute de relation, comme l'indique son nom même.
Mais que, dans des circonstances particulières, des hommes aient à s'entr'aider pour respirer, comme lorsqu'un ouvrier descend dans une [114] cloche à plongeur, ou quand un médecin agit sur l'appareil pulmonaire, ou quand la police prend des mesures pour purifier l'air, alors il y a un besoin satisfait par l'effort d'une autre personne que celle qui l'éprouve, il y a service rendu, et la respiration même entre, sous ce rapport du moins, quant à l'assistance et à la rémunération, dans le cercle de l'économie politique.
Il n'est pas nécessaire que la transaction soit effectuée, il suffit qu'elle soit possible pour que le travail soit de nature économique. Le laboureur qui cultive du blé pour son usage accomplit un fait économique par cela seul que le blé est susceptible d'être échangé.
Accomplir un effort pour satisfaire le besoin d'autrui, c'est lui rendre un service. Si un service est stipulé en retour, il y a échange de services, et comme c'est le cas le plus ordinaire, l'économie politique peut être définie : la théorie de l'échange.
Quelle que soit pour l'une des parties contractantes la vivacité du besoin, pour l'autre l'intensité de l'effort, si l'échange est libre les deux services échangés se valent. La Valeur consiste donc dans l'appréciation comparative des services réciproques, et l'on peut dire encore que l'économie politique est la théorie de la valeur.
[4 new paras inserted here]
[following paras to end are identical toi EH1, p. 72]
Je ferai ici une remarque qui prouvera combien les sciences se touchent et sont près de se confondre.
Je viens de définir le service. C'est l'effort dans un homme, tandis que le besoin et la satisfaction sont dans un autre. Quelquefois le service est rendu gratuitement, sans rémunération, sans qu'aucun service soit exigé en retour. Il part alors du principe sympathique plutôt que du principe de l'intérêt personnel. Il constitue le don et non l'échange. Par suite, il semble qu'il n'appartient pas à l'économie politique (qui est la théorie de l'échange), mais à la morale. En effet, les actes de cette nature sont, à cause de leur mobile, plutôt moraux qu'économiques. Nous verrons cependant que, par leurs effets, ils intéressent la science qui nous occupe. D'un autre côté, les services rendus à titre onéreux, sous condition de retour, et par ce motif, essentiellement économiques, ne restent pas pour cela, quant à leurs effets, étrangers à la morale.
Aussi ces deux branches de connaissances ont des points de contact infinis, et comme deux vérités ne sauraient être antagoniques, quand l'économiste assigne à un phénomène des conséquences funestes en même temps que le moraliste lui attribue des effets heureux, on peut affirmer que l'un ou l'autre s'égare. C'est ainsi que les sciences se vérifient l'une par l'autre.
III. [157]
Des besoins de l'homme.
Il est peut-être impossible et, en tous cas, il ne serait pas fort utile de présenter une nomenclature complète et méthodique des besoins [115] de l'homme. Presque tous ceux qui ont une importance réelle sont compris dans l'énumération suivante:
Respiration. (Je maintiens ici ce besoin comme marquant la limite où commence la transmission du travail ou l'échange des services.)— Alimentation.—Vêtement. —Logement. — Conservation et rétablissement de la santé.— Locomotion. —-Sécurité. — Instruction.— Diversion. [adds “Sensation de beau” in EH1]
Les besoins existent. C'est un fait. Il serait puéril de rechercher s'il vaudrait mieux qu'ils n'existassent pas et pourquoi Dieu nous y a assujettis.
Il est certain que l'homme souffre et même qu'il meurt lorsqu'il ne peut satisfaire aux besoins qu'il tient de son organisation. Il est certain qu'il souffre et même qu'il peut mourir lorsqu'il satisfait avec excès à certains d'entre eux.
Nous ne pouvons satisfaire la plupart de nos besoins qu'à la condition de nous donner une peine, laquelle peut être considérée comme une souffrance. Il en est de même de l'acte par lequel, exerçant un noble empire sur nos appétits, nous nous imposons une privation.
Ainsi la souffrance est pour nous inévitable, et il ne nous reste guère que le choix des maux. En outre, elle est tout ce qu'il y a au monde de plus intime, de plus personnel; d'où il suit que l'intérêt personnel, ce sentiment qu'on flétrit de nos jours sous les noms d'égoïsme, d'individualisme, est indestructible. La nature a placé la sensibilité à l'extrémité de nos nerfs, à toutes les avenues du cœur et de l'intelligence, comme une sentinelle avancée, pour nous avertir quand il y a défaut, quand il y a excès de satisfaction. La douleur a donc une destination, une mission. On a demandé souvent si l'existence du mal pouvait se concilier avec la bonté infinie du créateur, redoutable problème que la philosophie agitera toujours et ne parviendra probablement jamais à résoudre. Quant à l'économie politique, elle doit prendre l'homme tel qu'il est, d'autant qu'il n'est pas donné à l'imagination elle-même de se figurer, encore moins à la raison de concevoir un être animé et mortel exempt de douleur. Tous nos efforts seraient vains pour comprendre la sensibilité sans douleur ou l'homme sans sensibilité.
De nos jours, quelques écoles sentimentalistes rejettent comme fausse toute science sociale qui n'est pas arrivée à une combinaison au moyen de laquelle la douleur disparaisse de ce monde. Elles jugent sévèrement l'économie politique, parce qu'elle admet ce qu'il est impossible de nier : la souffrance. Elles vont plus loin, elles l'en rendent responsable. C'est comme si l'on attribuait la fragilité de nos organes au physiologiste qui les étudie.
Sans doute, on peut se rendre pour quelque temps populaire, on peut attirer à soi les hommes qui souffrent et les irriter contre l'ordre naturel des sociétés, en annonçant qu'on a dans la tête un plan [116] d’arrangement social artificiel, où la douleur, sous aucune forme, ne peut pénétrer. On peut même prétendre avoir dérobé le secret de Dieu et interprété sa volonté présumée en bannissant le mal de dessus la terre. Et l'on ne manque pas de traiter d'impie la science qui n'affiche pas une telle prétention, l'accusant de méconnaître ou de nier la prévoyance ou la puissance de l'auteur des choses.
En même temps, ces écoles font une peinture effroyable des sociétés actuelles, et elles ne s'aperçoivent pas que, s'il y a impiété à prévoir la souffrance dans l'avenir, il n'y en a pas moins à la constater dans le passé ou dans le présent. Car l'infini n'admet pas de limites, et si, depuis la création, un seul homme a souffert dans le monde, cela suffit pour qu'on puisse admettre, sans impiété, que la douleur est entrée dans le plan providentiel.
Il est certainement plus scientifique et plus viril de reconnaître l'existence des grands faits naturels, qui non-seulement existent, mais sans lesquels l'humanité ne se peut concevoir.
Ainsi, l'homme est sujet à la souffrance, et, par conséquent, la société aussi.
La souffrance a une fonction dans l'individu, et par conséquent dans la société aussi.
L'étude des lois sociales nous révélera que la mission de la souffrance est de détruire progressivement ses propres causes et de se circonscrire elle-même dans des limites de plus en plus étroites.
La nomenclature qui précède met en première ligne les besoins matériels.
Nous vivons dans un temps qui me force de prémunir encore ici le lecteur contre une sorte d'afféterie sentimentaliste fort à la mode.
Il y a des gens qui font très-bon marché de ce qu'ils appellent dédaigneusement besoins matériels, satisfactions matérielles. Ils me diront, sans doute, comme Belise à Chrysale:
Le corps, cette guenille, est-il d'une importance,
D'un prix à mériter seulement qu'on y pense?
Et, quoiqu'en général bien pourvus de tout, ce dont je les félicite sincèrement, ils me blâmeront d'avoir indiqué comme un de nos premiers besoins, celui de l'alimentation, par exemple.
Certes, je reconnais que le perfectionnement moral est d'un ordre plus élevé que la conservation physique. Mais, enfin, sommes-nous tellement envahis par cette manie d'affectation déclamatoire, qu'il ne soit plus permis de dire que, pour se perfectionner, encore faut-il vivre? Préservons-nous de ces puérilités qui font obstacle à la science. A force de vouloir passer pour philanthrope, on devient faux; car c'est une chose contraire au raisonnement comme aux faits, que le développement moral, le soin de la dignité, la culture des sentiments délicats, puissent précéder les exigences de la simple [117] conservation. Cette sorte de pruderie est toute moderne. Rousseau, ce panégyriste enthousiaste de l'homme de la nature, s'en était préservé, et un homme doué d'une délicatesse exquise, d'une tendresse de cœur pleine d'onction, spiritualiste jusqu'au quiétisme, et stoïcien pour lui-même, Fénelon, disait : «Après tout, la solidité de l'esprit consiste à vouloir s'instruire exactement de la manière dont se font les choses qui sont le fondement de la vie humaine. Toutes les grandes affaires roulent là-dessus. »
Sans prétendre donc classer les besoins dans un ordre rigoureusement méthodique, nous pouvons dire que l'homme ne saurait diriger ses efforts vers la satisfaction des besoins moraux de l'ordre le plus noble et le plus élevé, qu'après avoir pourvu à ceux qui concernent la conservation et l'entretien de la vie. D'où nous pouvons déjà conclure que tout ce qui rend la vie matérielle difficile nuit à la vie morale des nations. [adds half sentence on “harmonie” p. 77]
[adds large section wealth and vice, dissonances, inequality, pp. 78-80. Then resumes same text]
J'ai à faire sur les besoins humains une remarque importante, fondamentale même, en économie politique : c'est que les besoins ne sont pas une quantité fixe, immuable. Ils ne sont pas stationnaires, mais progressifs par nature.
Ce caractère se remarque même dans nos besoins les plus matériels; il devient plus sensible à mesure qu'on s'élève à ces désirs et à ces goûts intellectuels qui distinguent l'homme de la brute.
Il semble que s'il est quelque chose en quoi les hommes doivent se ressembler, c'est le besoin d'alimentation, car, sauf les cas anormaux, les estomacs sont à peu près les mêmes.
Cependant les aliments qui auraient été recherchés à une époque sont devenus vulgaires à une autre époque, et le régime qui suffit à un lazzarone soumettrait un Hollandais à la torture. Ainsi ce besoin, le plus immédiat, le plus grossier, et, par conséquent, le plus uniforme de tous, varie encore suivant l'âge, le sexe, le tempérament, le climat et l'habitude.
Il en est ainsi de tous les autres. A peine l'homme est abrité, qu'il veut se loger; à peine il est vêtu, qu'il veut se décorer; à peine il a satisfait les exigences de son corps, que l'étude, la science, l'art, ouvrent devant ses désirs un champ sans limites.
C'est un phénomène bien digne de remarque, que la promptitude avec laquelle, par la continuité de la satisfaction, ce qui n'était d'abord qu'un vague désir devient un goût, et ce qui n'était qu'un goût se transforme en besoin, et même en besoin impérieux.
Voyez ce rude et laborieux artisan. Habitué à une alimentation grossière, à d'humbles vêtements, à un logement médiocre, il lui semble qu'il serait le plus heureux des hommes, qu'il ne formerait plus de désirs, s'il pouvait arriver à ce degré de l'échelle qu'il aperçoit immédiatement au-dessus de lui. Il s'étonne que ceux qui y sont [118] parvenus se tourmentent encore. En effet, vienne la modeste fortune qu'il a rêvée, et le voilà heureux, heureux, hélas! pour quelques jours.
Car bientôt il se familiarise avec sa nouvelle position, et, peu à peu, il cesse même de sentir son prétendu bonheur. Il revêt avec indifférence ce vêtement après lequel il a soupiré. Il s'est fait un autre milieu, il fréquente d'autres personnes, il porte de temps en temps ses lèvres à une autre coupe, et, pour peu qu'il fasse un retour sur lui-même, il sent bien que si sa fortune a changé, son âme est restée ce qu'elle était, une source intarissable de désirs.
Il semble que la nature a attaché cette singulière puissance à l'habitude, afin qu'elle fût en nous ce qu'est la roue à rochet en mécanique, et que l'humanité, toujours poussée vers des régions de plus en plus élevées, ne pût s'arrêter à aucun degré de civilisation.
Le sentiment de la dignité agit peut-être avec plus de force encore dans le même sens. La philosophie stoïcienne a souvent blâmé l'homme de vouloir plutôt paraître qu'être. Mais, en considérant les choses d'une manière générale, est-il bien sûr que le paraître ne soit pas pour l'homme un des modes de l'être?
Quand, par le travail, l'ordre, l'économie, une famille s’élève de degré en degré vers ces régions sociales où les goûts deviennent de plus en plus délicats, les relations plus polies, les sentiments plus épurés, l'intelligence plus cultivée, qui ne sait de quelles douleurs poignantes est accompagné un retour de fortune qui la force à descendre? C'est qu'alors le corps ne souffre pas seul. L'abaissement rompt des habitudes qui sont devenues, comme on dit, une seconde nature; il froisse le sentiment de la dignité et avec lui toutes les puissances de l'âme. Aussi il n'est pas rare, dans ce cas, de voir la victime, succombant au désespoir, tomber sans transition dans un dégradant abrutissement. Il en est du milieu social comme de l'atmosphère. Le montagnard habitué à un air pur dépérit bientôt dans les rues étroites de nos cités.
J'entends qu'on me crie : Economiste, tu bronches déjà. Tu avais annoncé que ta science s'accordait avec la morale, et te voilà justifiant le sybaritisme. — Philosophe, dirai-je à mon tour, dépouille ces vêtements qui ne furent jamais ceux de l'homme primitif, brise tes meubles, brûle tes livres, nourris-toi de la chair crue des animaux, et je répondrai alors à ton objection. Il est trop commode de contester cette puissance de l'habitude dont on consent bien à être soi-même la preuve vivante.
On peut critiquer cette disposition que la nature a donnée à nos organes; mais la critique ne fera pas qu'elle ne soit universelle. On la constate chez tous les peuples, anciens et modernes, sauvages et civilisés, aux antipodes comme en France. Sans elle, il est impossible d'expliquer la civilisation. Or, quand une disposition du cœur humain est universelle et indestructible, est-il permis à la science sociale de n'en pas tenir compte?
[119]
L'objection sera faite par des publicistes qui s'honorent d'être les disciples de Rousseau. Mais Rousseau n'a jamais nié le phénomène dont je parle. Il constate positivement et l'élasticité indéfinie des besoins, et la puissance de l'habitude, et le rôle même que je lui assigne, qui consiste à prévenir dans l'humanité un mouvement rétrograde. Seulement ce que j'admire il le déplore, et cela devait être. Rousseau suppose qu'il a été un temps où les hommes n'avaient ni droits, ni devoirs, ni relations, ni affections, ni langage, et c'est alors, selon lui, qu'ils étaient heureux et parfaits. Il devait donc abhorrer ce rouage de la mécanique sociale qui éloigne sans cesse l'humanité de la perfection idéale. Ceux qui pensent qu'au contraire la perfection n'est pas au commencement, mais à la fin de de l'évolution humaine, admirent le ressort qui nous pousse en avant. Mais quant à l'existence et au jeu du ressort lui-même, nous sommes d'accord.
« Les hommes, dit-il, jouissant d'un fort grand loisir, l'employèrent à se procurer plusieurs sortes de commodités inconnues à leurs pères, et ce fut là le premier joug qu'ils s'imposèrent sans y songer, et la première source des maux qu'ils préparèrent à leurs descendants; car, outre qu'ils continuèrent ainsi à s'amollir le corps et l'esprit, ces commodités ayant, par l'habitude, perdu presque tout leur agrément, et étant en même temps dégénérées en de vrais besoins, la privation en devint beaucoup plus cruelle que la possession n'en était douce, et l'on était malheureux de les perdre sans être heureux de les posséder.»
Rousseau était convaincu que Dieu, la nature et l'humanité avaient tort. Je sais que cette opinion domine encore beaucoup d'esprits, mais ce n'est pas la mienne.
Après tout, à Dieu ne plaise que je veuille m'élever ici contre le plus noble apanage, la plus belle vertu de l'homme, l'empire sur lui-même, la domination sur ses passions, la modération des désirs, le mépris des jouissances fastueuses. Je ne dis pas qu'il doit se rendre esclave de tel ou tel besoin factice. Je dis que le besoin, considéré d'une manière générale et tel qu'il résulte de la nature à la fois corporelle et immatérielle de l'homme, combiné avec la puissance de l'habitude et le sentiment de la dignité, est indéfiniment expansible, parce qu'il naît d'une source intarissable, le désir. Qui blâmera l'homme opulent s'il est sobre, peu recherché dans ses vêtements, s'il fuit le faste et la mollesse? Mais n'est-il pas des désirs plus élevés auxquels il lui est permis de céder? Le besoin de l'instruction a-t-il des limites? Des efforts pour rendre service à son pays, pour encourager les arts, pour propager les idées utiles, pour secourir des frères malheureux, ont-ils rien d'incompatible avec l'usage bien entendu des richesses?
Au surplus, que la philosophie le trouve bon ou mauvais, le besoin humain n'est pas une quantité fixe et immuable. C'est là un fait certain, irrécusable, universel. Sous aucun rapport, quant à [120] l’alimentation, au logement, à la locomotion, à l'instruction, les besoins du quatorzième siècle n'étaient pas ceux du nôtre, et l'on peut prédire que les nôtres n'égalent pas ceux auxquels nos descendants seront assujettis.
C'est, du reste, une observation qui est commune à tous les éléments qui entrent dans l'économie politique, richesses, travail, valeurs, services, etc., toutes choses qui participent de l'extrême mobilité du sujet principal, l'homme. L'économie politique n'a pas, comme la géométrie ou la physique, l'avantage de spéculer sur des objets qui se laissent peser ou mesurer, et c'est là une de ses difficultés d'abord, et puis une perpétuelle cause d'erreurs, car lorsque l'esprit humain s'applique à un ordre de phénomènes, il est naturellement enclin à chercher un critérium, une mesure commune à laquelle il puisse tout rapporter, afin de donner à la branche de connaissances dont il s'occupe le caractère d'une science exacte. Aussi nous voyons la plupart des auteurs chercher la fixité les uns dans la valeur, les autres dans la monnaie, celui-ci dans le blé, celui-là dans le travail, c'est-à-dire dans la mobilité même.
Beaucoup d'erreurs économiques proviennent de ce que l'on considère les besoins humains comme une quantité donnée; et c'est pourquoi j'ai cru devoir m'étendre sur ce sujet. Je ne crains pas d'anticiper en disant brièvement comment on raisonne. On prend toutes les satisfactions générales du temps où l'on est, et l'on suppose que l'humanité n'en admet pas d'autre. Dès lors, si la libéralité de la nature, ou la puissance des machines, ou des habitudes de tempérance et de modération viennent paralyser, pour un temps, une portion du travail humain, on s'inquiète de ce progrès, on le considère comme un désastre, on se retranche derrière des formules absurdes mais spécieuses, telles que celle-ci: La production surabonde, nous périssons de pléthore, la puissance de produire a dépassé la puissance de consommer, etc., etc. Il n'est pas possible de trouver une bonne solution à la question des machines, à celle de la concurrence extérieure, à celle du luxe, quand on considère le besoin comme une quantité invariable , quand on ne se rend pas compte de son expansibilité indéfinie.
Mais si, dans l'homme, le besoin est indéfini, progressif, doué de croissance comme le désir, source intarissable où il s'alimente sans cesse, il faut, sous peine de discordance et de contradiction dans les lois économiques de la société, que la nature ait placé dans l'homme et autour de lui des moyens indéfinis et progressifs de satisfaction, l'équilibre entre les moyens et la fin étant la première condition de toute harmonie. C'est ce que nous examinerons dans le prochain article.
[adds new section in EH1, p. 87-110 - part IV of JDE articles]
FRÉDÉRIC BASTIAT.
L’État JDD version [25 September 1848]↩
BWV
T.222 “L’État,” Le Journal des débats politiques et littéraires (25 September 1848), pp. 1-2. Second revised and enlarged version 2,400 words.
Source
Le Journal des débats (25 September 1848), pp. 1-2.
Text
Je voudrais qu’on fondât un prix, non de cinq cents francs, mais d’un million, avec couronnes, croix et rubans, en faveur de celui qui donnerait une bonne, simple et intelligible définition de ce mot l'ETAT.
Quel immense service ne rendrait-il pas à la société!
L’ETAT! Qu'est-ce? où est-il? que fait-il ? que devrait-il faire?
Tout ce que nous en savons, c'est que c'est un personnage mystérieux, et assurément le plus sollicité, le plus tourmenté, le plus affairé le plus conseillé, le plus accusé, le plus invoqué et le plus provoqué qu'il y ait au monde.
Car Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître mais je gage dix contre un que depuis [2] six mois vous faites des utopies, et si vous en faites, je gage dix contre un que vous chargez l'ETAT de les réaliser.
Et vous, Madame, je suis sûr que vous désirez du fond du coeur guérir tous les maux de la triste humanité, et que vous n'y seriez nullement embarrassée, si l’ETAT voulait seulement s'y prêter.
Mais, hélas! le malheureux, comme Figaro, ne sait ni qui entendre, ni de quel côté se tourner. Les cent mille bouches de la presse et de la tribune lui crient à la fois:
Organisez le travail et les travailleurs.
Extirpez l'égotisme.
Réprimez l'insolence et la tyrannie du capital.
Faites des expériences sur le fumier et sur les oeufs.
Fondez des fermes-modèles.
Fondez des ateliers harmoniques.
Colonisez l'Algérie.
Allaitez les enfans.
Instruisez la jeunesse.
Secourez la vieillesse.
Envoyez dans les campagnes les habitans des villes.
Pondérez les profits de toutes les industries.
Prêtez de l'argent, et sans intérêt, à ceux qui en désirent.
Affranchissez l'Italie, la Pologne et la Hongrie.
Elevez et perfectionnez le cheval de selle.
Encouragez l'art, formez-nous des musiciens et des danseuses.
Prohibez le commerce et créez une marine marchande.
Découvrez la vérité et jetez dans nos têtes un grain de raison. L'Etat a pour mission d'éclairer, de développer, d'agrandir, de fortifier, de spiritualiser et de sanctifier l'âme des peuples.
Eh! Messieurs, un peu de patience, répond l'ETAT d'un air piteux.
Uno a la volta, per carità!
J'essaierai de vous satisfaire, mais pour cela il me faut quelques ressources. J'ai préparé des projets concernant cinq ou six impôts tout nouveaux et les plus bénins du monde. Vous verrez quel plaisir on a à les payer.
Mais alors un grand cri s'élève. Haro! haro! le beau mérite de faire quelque chose avec des ressources! Il ne vaudrait pas la peine de s'appeler l'État. Loin de nous frapper de nouvelles taxes, nous vous sommons de retirer les anciennes. Supprimez
L'impôt du sel,
L'impôt des boissons,
L'impôt des lettres,
L'octroi, les patentes, les prestations.
Au milieu de ce tumulte, et après que le pays a changé deux ou trois fois son Etat pour n'avoir pas satisfait à toutes ces demandes, j'ai voulu faire observer qu'elles étaient contradictoires. De quoi me suis-je avisé, bon Dieu! ne pouvais-je garder pour moi cette malencontreuse remarque ? Me voilà discrédité à tout jamais, et il est maintenant reçu que je suis un homme sans coeur et sans entrailles, un philosophe sec, un individualiste, et, pour tout dire en un mot, un économiste de l'école anglaise ou américaine.
Oh pardonnez-moi, écrivains sublimes, que rien n'arrête, pas même les contradictions. J'ai tort, sans doute, et je me rétracie de grand coeur. Je ne demande pas mieux, soyez-en sûrs, que vous ayez vraiment découvert, en dehors de nous, un être bienfaisant et inépuisable, s'appelant l'ETAT, qui ait du pain pour toutes les bouches, du travail pour tous les bras, des capitaux pour toutes les entreprises, du crédit pour tous les projets, de l'huile pour toutes les plaies, du baume pour toutes les souffrances, des conseils pour toutes les perplexités, des solutions pour tous les doutes, des vérités pour toutes les intelligences, des distractions pour tous les ennuis, du lait pour l'enfance et du vin pour la vieillesse, qui pourvoie àtous; nos besoins, prévienne tous nos désirs, satisfasse toutes nos curiosités, redresse toutes nos erreurs, répare toutes nos fautes, et nous dispense tous désormais de prévoyance, de prudence, de jugement, de sagacité, d'expérience, d'ordre, d'économie, de tempérance et d'activité.
Eh! pourquoi ne le désirerais-je pas? Dieu me pardonne, plus j'y réfléchis, plus je trouve que la chose est commode et il me tarde d'avoir moi aussi, à ma portée, cette source intarissable de richesses et de lumières ce médecin universel, ce trésor sans fonds, ce conseiller infaillible que vous nommez I'ETAT.
Aussi je demande qu'on me le montre, qu'on me lé définisse, et c'est pourquoi je propose la fondation d'un prix pour le premier qui découvrira ce phénix. Car enfin, on m'accordera bien que cette découverte précieuse n'a pas encore été faite puisque, jusqu'ici, tout ce qui se présente sous le nom d'ETAT, le peuple le renverse aussitôt, précisément parce qu'il ne remplit pas aux conditions le quelque peu contradictoires du programme.
Faut-il le dire? je crains que nous ne soyons, à cet égard, dupes d'une des plus bizarres illusions qui se soient jamais emparées de l'esprit humain.
La plupart, la presque totalité des choses qui peuvent nous procurer une satisfaction, ou nous délivrer d'une souffrance, doivent être achetées par un effort, une peine. Or à toutes les époques, on a pu remarquer chez les hommes un triste penchant à séparer en deux ce lot complexe de la vie, gardant pour eux la satisfaction et rejetant la peine sur autrui. Ce fut l'objet de l'Esclavage; c'est encore l'objet de la Spoliation, quelque forme qu'elle prenne, abus monstrueux, mais conséquens, on ne peut le nier, avec le but qui leur a donné naissance.
L'Esclavage a disparu, grâce au ciel, et la Spoliation directe et naïve n'est pas facile. Une seule chose est restée, ce malheureux penchant primitif à faire deux parts des conditions de la vie. Il ne s'agissait plus que de trouver le bouc émissaire (scapegoat) sur qui en rejeter la portion fatigante et onéreuse. L'ETAT s'est présenté fort à propos.
Donc, en attendant une autre définition, voici la mienne : **L'Etat, c'est la grande fiction à travers laquelle *tout le monde* s'efforce de vivre aux dépens *de tout le monde*.**
Car, aujourd'hui comme autrefois, chacun un peu plus, un peu moins voudrait bien vivre du travail d'autrui. Ce sentiment, on n'ose l'afficher, on se le dissimule à soi-même; et alors que fait-on ? On imagine un intermédiaire, et chaque classe tour à tour vient dire à l'Etat : « Vous qui pouvez prendre légalement, honnêtement, prenez au public et nous partagerons. » L'Etat n'a que trop de pente à suivre ce diabolique conseil. C'est ainsi qu'il multiplie le nombre de ses agens, élargit le cercle de ses attributions et finit par acquérir des proportions écrasantes. Quand donc le public s'avisera-t-il enfin de comparer ce qu'on lui prend avec ce qu'on lui rend? Quand reconnaîtra-t-il que le pillage réciproque n'en est pas moins onéreux, parce qu'il s'exécute avec ordre par un intermédiaire dispendieux?
Remontons à la source de cette illusion.
Nous sommes trente-cinq millions d'individualités, et de même qu'on nomme *blancheur* cette qualité commune à tous les objets *blancs*, nous désignons la réunion de tous les Français par ces appellations collectives France, République, Etat.
Ensuite, nous nous plaisons à supposer dans celle *abstraction* de l'intelligence, de la prévoyance, des richesses, une volonté, une vie propre et distincte de la vie individuelle. C'est cette *abstraction* que nous voulons follement substituer à l'Esclavage antique. C'est sur elle que nous rejetons la peine, la fatigue, le fardeau et la responsabilité des existences réelles et comme s'il y avait une France en dehors des Français, une cité en dehors des citoyens, nous donnons au monde cet étrange spectacle de citoyens attendant tout de la cité, de réalités vivantes attendant tout d'une vaine abstraction.
Cette chimère apparaît au début mème de notre Constitution.
Voici les premières paroles du préambule :
« La France s'est constituée en République pour appeler tous les citoyens à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être. »
Ainsi les citoyens qui sont les *réalités* en qui réside le principe de vie et d'intelligence d'où jaillissent la moralité, les lumières et le bien-être les attendent de qui? De la France, qui est l'*abstraction*.Pour montrer l'inanité de la proposition, il suffit de la retourner. Certes, il eût été tout aussi exact de dire : « Les citoyens se sont constitués en République pour appeler la France à un degré toujours plus élevé, etc. »
Les Américains se faisaient une autre idée des relations des citoyens et de l'Etat, quand ils placèrent en tête de leur Constitution ces simples paroles:
« Nous, le peuple des Etats-Unis, pour former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, pourvoir à la défense commune, accroître le bien-être général et assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, décrétons, etc. »
Il ne s'agit pas ici, comme on pourrait le croire, d'une subtilité métaphysique. Je prétends que cette *personnification* de l'Etat a été dans le passé et sera dans l'avenir une source féconde de calamités et de révolutions.
Voilà donc le public d'un côté, l'Etat de l'autre, considérés comme deux êtres distincts; celui-ci chargé d'épandre sur celui-là le torrent des félicités humaines. Que doit-il arriver?
Au fait, l'Etat ne peut conférer aucun avantage particulier à une des individualités qui composent le public sans infliger un dommage supérieur à la communauté tout entière.
Il se trouve donc placé, sous les noms de *pouvoir*, *gouvernement*, *ministère*, dans un cercle vicieux manifeste.
S'il refuse le *bien direct* qu'on attend de lui, il est accusé d'impuissance, de mauvais vouloir, d'impéritie. S'il essaie de le réaliser, il est réduit à frapper le peuple de taxes redoublées, et attire sur lui la désaffection générale.
Ainsi, dans le public, deux espérances dans le gouvernement, deux promesses : *Beaucoup de bienfaits, et peu d'impôts*; espérances et promesses qui, étant contradictoires, ne se réalisent jamais.
N'est-ce pas là la cause de toutes nos révolutions? Car entre l'Etat qui, prodigue les promesses impossibles, et le public qui a conçu des espérances irréalisables, viennent s'interposer deux classes d'hommes : les ambitieux et les utopistes. Leur rôle est tout tracé par la situation. Il suffit à ces courtisans de popularité de crier aux oreilles du peuple : « Le pouvoir te trompe si nous étions à sa place, nous te comblerions de bienfaits et t'affranchirions de taxes. »
Et le peuple croit, et le peuple espère, et le peuple fait une révolution.
Ses amis ne sont pas plutôt aux affaires, qu'ils sont sommés de s'exécuter. « Donnez-moi donc du travail, du pain, des secours, du crédit, de l'instruction, des colonies, dit le peuple, et cependant, selon vos promesses, délivrez-moi des serres du fisc. »
L'*Etat* nouveau n'est pas moins embarrassé que l'Etat ancien, car, en fait d'impossible, on peut bien promettre, mais non tenir. Il cherche à gagner du temps, il lui en faut pour mûrir ses vastes projets. D'abord il fait quelques timides essais d'un côté, il étend quelque peu l'instruction primaire; de l'autre, il modifie quelque peu l'impôt des boissons (1830). Mais la contradiction se dresse toujours devant lui : s'il veut être philanthrope, il est forcé de rester fiscal, et s'il renonce à la fiscalité, il faut qu'il renonce aussi à la philanthropie. De ces deux anciennes promesses, il y en a toujours une qui échoue nécessairement. Alors il prend bravement son parti, il réunit des forces pour se maintenir; il déclare qu'on ne peut administrer qu'à la condition d'être impopulaire, et que l'expérience l'a rendu *gouvernemental*.
Et c'est là que d'autres courtisans de popularité l'attendent. Ils exploitent la même illusion, passent par la même voie, obtiennent le même succès, et vont bientôt s'engloutir dans le même gouffre.
C'est ainsi que nous sommes arrivés en Février. A cette époque, l'illusion qui fait le sujet de cet article avait pénétré plus avant que jamais dans les idées du peuple, avec les doctrines socialistes. Plus que jamais, il s'attendait à ce que l'*Etat*, sous la forme républicaine, ouvrirait toute grande la source des bienfaits et fermerait celle de l'impôt.
« On m'a souvent trompé, disait le peuple, mais je veillerai moi-même à ce qu'on ne me trompe pas encore une fois. » `
Que pouvait faire le gouvernement provisoire ? Hélas! ce qu'on fait toujours en pareille conjoncture promettre et gagner du temps. Il n'y manqua pas, et pour donner à ses promesses plus de-solennité il les fixa dans des décrets. « Augmentation de bien-être, diminution de travail, secours, crédits, instruction gratuite, colonies agricoles, défrichemens et en même temps réduction sur la taxe du sel, des boissons, des lettres, de la viande, tout te sera accordé, vienne l'Assemblée Nationale. »
L'Assemblée Nationale est venue, et comme on ne peut réaliser deux contradictions, sa tâche, sa triste tâche s'est bornée à retirer, le plus doucement possible, l'un après l'autre, tous les décrets du gouvernement provisoire.
Cependant, pour ne pas rendre la déception trop cruelle, il a bien fallu transiger quelque peu. Certains engagemens ont été maintenus, d'autres ont reçu un tout petit commencement d'exécution. Aussi l'administration actuelle s'efforce-t-elle d'imaginer de nouvelles taxes.
Maintenant je me transporte par la pensée à quelques mois dans l'avenir, et je me demande, la tristesse dans l'âme, ce qu'il adviendra quand des agens de nouvelle création iront dans nos campagnes prélever les nouveaux impôts sur les successions, sur les revenus, sur les profits de l'exploitation agricole. Que le ciel démente mes presentimens, mais je vois encore là un rôle à jouer pour les courtisans de popularité.
Il faut donc que le peuple de France apprenne cette grande leçon : Personnifier l'Etat, et attendre de lui qu'il prodigue les bienfaits en réduisant les taxes, c'est une véritable puérilité, mais une puérilité d'où sont sorties et d'où peuvent sortir encore bien des tempêtes. Le gouffre des révolutions ne se refermera pas tant que nous ne prendrons pas l'*Etat* pour ce qu'il est, la *force commune* instituée, non pour être entre les citoyens un instrument d'oppression réciproque, mais au contraire pour faire régner entre eux la justice et la sécurité.
T.224 (1848.10.??) "Opinion of Bastiat on the right to work." (Garnier Book) (Fr, PDF)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Translation: done for CW3??
Compared to PDF: 26 Nov. 2015
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.224 (1848.10.??) "Opinion of Bastiat on the right to work." During the summer and fall of 1848 the National Assembly debated the issue of the right to work" (le droit au travail) and its possible inclusion in the new constitution. This is a letter to the editor Garnier on this matter. Le droit au travail à l'Assemblée nationale (Guillaumin, 1848). [DMH] ??
V. Lettre de M. Frédéric Bastiat, représentant des Landes, à M. Joseph Garnier, pp. 373-76.
Editor’s Introduction↩
[to come]
Fb wasnot able to attend the debate in the Chamber for some reason ?? but sent the editor Garnier a letter with is opinion on the topic.
Text: V. Opinion De M. Frédéric Bastiat (1). ↩
(1) M. FrédéricBastiat, nommé représentant du département des Landes, a exercé les fonctions de juge de paix à Mugron. Il est depuis plusieurs années membre du conseil général. M. Bastiat s'est d'abord fait connaître par ses articles dans le Journal des Économistes, qu'il a ensuite publiés sous le titre de Sophismes Economiques; par sa traduction des discours des Ligueurs de Manchester, et pour la part qu'il a prise à la lutte des libres échangistes, en 1846 ut 1847. Il a été nommé membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques; il est de la Société d'économie politique. M. Frédéric Bastiat est né à Bayonne en 1801, dans une famille de négociants. Argumentateur ingénieux, écrivain original, il s'est fait une brillante réputation, bien que son premier écrit n'ait paru dans le Journal des Économiste qu'en octobre 1844.
[373]
Mon Cher Garnier,
Vous me demandez mon opinion sur le droit au travail et vous paraissez surpris que je ne l'aie pas manifestée à la tribune [374] de l'Assemblée nationale. Mon silence a tenu uniquement à ce que, quand j'ai demandé la parole, trente de mes collègues l'avaient retenue avant moi.
Si l'on entendait par droit au travail le droit de travailler (qui implique le droit de jouir du fruit de son travail), il ne saurait y avoir de doute. Quant à moi, je ne crois pas avoir jamais écrit deux lignes qui n'ait eu pour but de le défendre.
Mais par droit au travail on entend le droit qu'aurait l'individu d'exiger de l'État, et par force, au besoin, de l'ouvrage et un salaire. Sous aucun rapport cette thèse bizarre ne me semble pouvoir supporter l'examen.
D'abord, l'État a-t il des droits et des devoirs autres que ceux qui préexistent déjà dans les citoyens? J'ai toujours pensé que sa mission était de protéger les droits existants. Par exemple, même abstraction faite de l'État, j'ai le droit de travailler, de disposer du fruit de mon travail. Mes compatriotes ont des droits égaux, et nous avons, en outre, celui de les défendre même par la force. Voilà pourquoi la *communauté*, la *force commune*, l'État peut et doit nous protéger dans l'exercice de ces droits. C'est l'action collective et régulière substituée à l'action individuelle et désordonnée, et celle-ci est la raison d'être de celle-là.
Mais ai-je le droit d'exiger par force d'un de mes concitoyens qu'il me fournisse de l'ouvrage et des salaires? Ce droit serait évidemment distinct de son droit de propriété. Et si je ne l'ai pas; si aucun des citoyens qui composent la communauté ne l'a pas davantage, comment lui donnerons-nous naissance en l'exerçant les uns à l'égard des autres par l'intermédiaire de l'État? Quoi! Pierre n'a pas le droit d'exiger par force que Paul lui fournisse du travail et des salaires; mais si tous deux, à frais communs, instituent une force commune, Pierre a le droit d'invoquer cette force, de la tourner contre Paul, afin que [375] celui-ci soit forcé de lui fournir de l'ouvrage? Par la création de cette force *commune*, le droit au travail est né pour Pierre et le droit de propriété est mort pour Paul! Quelle confusion! quelle logomachie!
Ensuite, il faut qu'on soit parvenu à pervertir singulièrement l'esprit des ouvriers pour leur faire croire que ce prétendu droit leur offre quelque ressource et quelques garanties. On leur montre toujours l'État comme un père de famille, un tuteur qui a des trésors inépuisables et à qui il ne manque qu'un peu de générosité! N'est-il pas bien évident cependant que si l'État, afin de faire travailler Pierre, prend cent francs à Paul, Paul aura cent francs de moins pour faire travailler Jacques? Les choses se passeront exactement comme si Pierre eût exercé directement à l'égard de Paul ce prétendu droit, ou plutôt cette oppression. L'intervention de l'État aura pu être commode pour vaincre les résistances; elle peut même rendre le droit d'oppression spécieux et faire taire la conscience; mais elle ne change pas la nature des choses. La propriété de Paul n'en a pas moins été violée, et s'il y a quelque chose de clair au monde, c'est que la classe ouvrière prise dans son ensemble n'aura pas plus d'ouvrage pour la valeur d'une obole. C'est vraiment une chose triste que les hommes d'intelligence en soient réduits, au xixe siècle, à combattre cette puérilité qui nous fait tenir les yeux toujours ouverts à l'ouvrage que l'État distribue avec l'argent des contribuables, et toujours fermés à l'ouvrage que les contribuables distribueraient eux-mêmes si l'État ne leur eût pas pris cet argent!
Enfin, quand les ouvriers voudront y réfléchir, ils s'apercevront que le *droit au travail* serait pour eux l'inauguration de la misère. L'existence de ce droit a pour collectif nécessaire la non-existence du droit de propriété. Pour s'en convaincre, il suffit de faire abstraction un instant de l'intervention de l'Etat, et de se demander ce qui arriverait si nous exercions directement ce prétendu droit les uns envers les autres: il est bien clair que la notion même de propriété serait anéantie. Or, sans propriété il n'y a pas de formation possible de capital, et sans formation de capital il n'y a pas d'ouvrage possible pour les ouvriers. Le droit au travail, c'est donc, en résumé, la misère universelle poussée jusqu'à la destruction. Le jour où ou l'a seulement mis en discussion, le travail a diminué pour les ouvriers dans [376] une proportion énorme; le jour où il serait promulgué, il n'y aurait plus de travail que pendant le court espace de temps nécessaire pour que l'État pût consommer la destruction de tous les capitaux.
Frédéric Bastiat.
T.273 (1848.10.10) SEP: Séance de 10 oct. 1848 (on an income tax) (Fr, PDF1, PDF2)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against PDF: 26 Nov. 2015
JDE PDF: 26 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source Info↩
T.273 (1848.10.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 oct. 1848) (on tax). In “Chronique,” JDE, T. 21, no. 90, 15 Oct. 1848, pp. 339-40; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 68-69. Not in OC.
Use JDE titles??
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
Sommaire. — Les milliards hypothécaires; les Comités d'agriculture; M. Flandin, M. Thiers , M. Léon Faucher, etc. — Le maximum des heures de travail et l'impôt sur le revenu, à la Société d'économie politique.—L'enseignement agricole ; ce qu'est la ferme-école et ce que veut M. Dezeimeris. — Sept millions d'écharpes et de drapeaux. — Premier départ de colons pour l'Algérie. — Proposition sur la douane du même pays. — Le nankin et le grass-cloth proscrits par la Chambre de commerce de Roubaix. — Compte-rendu du commerce intérieur pour 1847. — Situation de la Banque. — Proposition de M. A. Martin sur une création de Banques départementales. — La tourmente de l'Europe : Vienne, l'Italie, M. Rossi. — L'intérieur : le cabinet, la Constitution , le Conseil d'Etat.
—La dernière réunion de la Société des économistes s'est prolongée bien avant dans la soirée. La compagnie était nombreuse : deux discussions ont longtemps occupé l'attention des convives. M. Horace Say, qui présidait, a d'abord appelé l'attention de la réunion sur la difficulté de mettre en application le dernier décret, qui fixe à douze heures la journée du travail. En ce moment, les Chambres de commerce sont consultées par M. le ministre de l'intérieur (M. Senard, grand partisan de la réglementation), sur les exceptions qu'il y a à faire, exceptions qui ont été prévues dans le décret : or, il paraît que la plupart des industries demandent à être exceptées! M. Hippolyte Dussard, préfet de la Seine-Inférieure, et dont les administrés se sont vivement préoccupés de cette question, a donné d'intéressants détails sur la situation de l'industrie cotonnière de la Normandie et sur la condition générale et actuelle des ouvriers fileurs et des ouvriers tisseurs. M. Léon Faucher a fait une vive critique du nouveau décret réglementaire qui a, entre autres inconvénients, celui de créer un privilège au profit des ouvriers fileurs les mieux rétribués, au détriment des pauvres tisseurs qui sont éparpillés dans les campagnes, et se livrent dans leur intérieur à un travail exténuant pour gagner des salaires misérables. MM. Howyn deTranchère, Wolowski, représentants du peuple, et MM. Emile Pereire et de Colmont sont ceux des membres de la réunion qui ont ensuite pris le plus de part à cette intéressante discussion.
M.David (du Gers), membre du Comité des finances dcl'Assemblée nationale, a soumis à la réunion quelques-unes des raisons qui l'avaient engagé à combattre le projet de la Commission dont M. Parieu est le rapporteur, et à repousser l'impôt du revenu que cette Commission propose. M. Parieu a reproduit avec une grande lucidité les principaux motifs qu'il a déduits dans son rapport. MM. Horace Say, de Colmont, Bastiat, etc., ont aussi pris part à ce débat, au sujet duquel se sont tout naturellement présentées les questions fondamentales de la nature et de l'assiette de l'impôt. M. de Colmont ne croit au nouvel impôt, s'il est admis par l'Assemblée, que comme impôt temporaire, ou plutôt comme emprunt forcé. M. Bastiat a reproduit l'idée de l'impôt unique sur le revenu; mais il a justement fait remarquer qu'il ne fallait songer à la réalisation de cette utopie que le jour où le gouvernement, seulement occupé de maintenir la sécurité entre les citoyens, pourrait administrer la France avec deux cents millions. Alors l'impôt serait minime, et chaque contribuable déclarerait franchement son revenu.
Text: Séance du 10 octobre 1848. (ASEP version)↩
Cette réunion s'est prolongée bien avant dans la soirée. La compagnie était nombreuse; deux discussions ont longtemps occupé l'attention des convives. M. Horace Say, qui présidait, a d'abord appelé l'attention de la réunion sur la difficulté de mettre en application le dernier décret, qui fixe à douze heures la journée de travail. En ce moment, les Chambres de commerce sont consultées par M. le ministre de l'intérieur (M. Senard, grand partisan de la réglementation), sur les exceptions qu'il y a à faire, exceptions qui ont été prévues dans le décret ; or, il paraît que la plupart des industries demandent à être exceptées! M. Hippolyte Dussard, préfet de la Seine-Inférieure, et dont les administrés se sont vivement préoccupés de cette question, a donné d'intéressants détails sur la situation de l'industrie cotonnière de la Normandie et sur la condition générale et actuelle des ouvriers fileurs et des ouvriers tisseurs. M. Léon Faucher a fait une vive critique du nouveau décret réglementaire qui a, entre autres inconvénients, celui de créer un privilège au profit des ouvriers fileurs les mieux rétribués, au détriment des pauvres, qui sont éparpillés dans les campagnes, et se livrent dans leur intérieur à un travail exténuant pour gagner des salaires misérables. MM. Howyn De Tranchère, Louis Wolowski, représentants du peuple, et MM. Emile Pereire et De Colmont, sont ceux des membres de la réunion qui ont ensuite pris le plus de part à cette intéressante discussion.
M. David (du Gers), membre du comité des finances de l'Assemblée nationale, a soumis à la réunion quelques-unes des raisons qui l'avaient engagé à combattre le projet de la commission,dont M. E.de Parieu est le rapporteur, et à repousser l'impôt sur le revenu que cette commission propose. M. De Parieu a reproduit avec une grande lucidité les principaux motifs qu'il a déduits dans son rapport. MM. Horace Say, De Colmont, Bastiat, etc., ont aussi pris part à ce débat, au sujet duquel se sont tout naturellement présentées les questions fondamentales de la nature et de l'assiette de l'impôt. M. de Colmont ne croit au nouvel impôt, s'il est admis par l'Assemblée, que comme impôt temporaire, ou plutôt comme emprunt forcé. M. Bastiat a reproduit l'idée de l'impôt unique sur le revenu; mais il a justement fait remarquer qu'il ne fallait songer à la réalisation de cette utopie que le jour où le gouvernement, seulement occupé de maintenir la sécurité entre les citoyens, pourrait administrer la France avec 200 millions. Alors l'impôt serait minime, et chaque contribuable déclarerait franchement son revenu.
T.274 (1848.12.10) SEP: Séance de 10 dec. 1848 (on the emancipation of the colonies) (Fr, PDF1, PDF2)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against PDF: 26 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source Info↩
T.274 (1848.12.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 dec. 1848) (on the economic emancipation of the colonies).In “Chronique,” JDE, T. 22, no. 93, 15 Dec. 1848, pp. 116-17; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 70-72.Not in OC.
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
Sommaire. — Société des économistes : proposition relative à M. Rossi. Remerciements à M. Barthélémy Saint-Hilaire. Nouvelle discussion sur l'émancipation des colonies. — Le nombre des lois organiques. — Le Conseil d'État supplémentaire et provisoire. — A propos du budget rectifié. — Les promesses économiques de Louis Bonaparte dans son manifeste. — Session des Conseils généraux. —De nouveau la question des sucres. —Décret sur les sels nécessaires à la pêche. — Nouveau projet sur l'impôt du sel.—Les dissensions politiques. — Le socialisme et M. Louis Bonaparte. — Deux grands symptômes de paix à l'intérieur.
Dans la dernière réunion de la Société des économistes, encore plus nombreuse que de coutume, il a été décidé, sur la proposition de M. Louis Leclerc, qu'une lettre de condoléance serait adressée par le président de la Société à Mm» veuve Rossi, pour lui témoigner la haute estime que ses divers membres professaient pour le caractère et les éminentes qualités de son illustre époux, ainsi que la douleur profonde qu'ils ont ressentie à la nouvelle de l'affreux malheur qui l'a frappée.
M. Michel Chevalier a ensuite communiqué à la réunion le discours remarquable, à tous égards, que M. Whateley, archevêque de Dublin, a prononcé dans la séance solennelle de la Société de statistique, fondée depuis un an dans cette ville, et duquel il résulte qu'à l'heure qu'il est les notions élémentaires sur l'économie sociale et sur les effets de la charité sont enseignées en Irlande dans quatre mille écoles! Nos lecteurs trouveront dans ce discours, que nous reproduisons en entier, des considérations pleines d'élévation et de justesse, qui prouvent qu'on peut être un digne archevêque, un économiste très-orthodoxe et un philanthrope de bon aloi.
Le docteur Lardner, présent à la séance , a rappelé la haute estime qu'on avait en Angleterre pour le savant archevêque de Dublin.
En donnant connaissance de ce curieux discours, M. Michel Chevalier a trouvé naturellement l'occasion de remercier, tant en ce qui le concerne, qu'au nom de la science, MM. Léon Faucher, Barthélemy Saint-Hilaire et Wolowski, présents à la séance, des heureux efforts qu'ils ont tentés à l'Assemblée nationale pour faire réhabiliter la chaire d'économie politique au collège de France. La Société s'est vivement associée à ces sentiments de M. Michel Chevalier, et elle a fait comprendre à M. Barthélémy Saint-Hilaire combien elle était heureuse d'avoir à adresser ses remerciements à un savant qui cultive la philosophie, et auquel personne ne pouvait objecter qu'il réclamait pro domo sua. D'ailleurs, M. Michel Chevalier a fort bien fait remarquer que l'économie politique était une des plus belles branches du grand arbre de la philosophie. Smith, avant d'écrire sur la richesse des nations, avait publié la théorie des sentiments moraux ; Tracy a classé son traité d'économie politique dans son cours d'idéologie; Turgot est vénéré des philosophes ; et qui oserait dire que des hommes comme J.-B. Say, Rossi et tant d'autres ne sont pas des esprits éminemment philosophiques?
La conversation a été ensuite reprise sur le sujet déjà traité dans la dernière séance : l'émancipation économique des colonies. M. Bastiat a lu un acte du Parlement anglais, en date du mois de mars, qui a passé inaperçu chez nous à cause de la tourmente politique, mais duquel il résulte que désormais il y a, pour la navigation dans l'Inde, égalité parfaite entre les navires anglais et ceux des autres nations. M. Bastiat est entré dans quelques considérations à cet égard, et a dit que la réforme commerciale opérée chez nos voisins a produit deux résultats inattendus. D'abord, les soulagements apportés par les mesures économiques provoquées par les free-traders ont enrayé l'action du chartisme, variété de communisme anglais. Ensuite, la logique a conduit les ligueurs de la réforme des tarifs à la liberté coloniale ; et celle-ci les pousse, on le voit déjà, à l'abandon politique de ces établissements qui coûtent énormément plus qu'ils ne rapportent.—La discussion, provoquée par M. Bastiat, s'est animée entre MM. Rodet, Dunoyer, Wolowsky, de Colmont, Léon Faucher et Fonteyraud. L'argumentation de MM. de Colmont et Rodet avait pour but de bien constater que l'Angleterre n'a jamais agi par philanthropie, mais bien par intérêt. A quoi, M. Dunoyer a répondu que les Anglais pratiquent à merveille l'égoïsme du vrai, cet égoïsme qui ne sert bien leurs intérêts que parce qu'il profite aussi aux intérêts des autres. M. Fonteyraud, en rappelant les efforts inouïs des ligueurs de Manchester, la division profonde dans laquelle l'Angleterre s'était trouvée au sujet du libre échange, et la difficulté que Cobden et sus amis avaient eue à conquérir la majorité par la force et l'excellence de la raison, a répondu, au scepticisme de M. Rodet et aux questions de M. de Colmont, d'une manière qui nous paraît concluante.
Text: Séance du 10 décembre 1848. (ASEP version)↩
Dans cette réunion encore plus nombreuse que de coutume, il a été décidé, sur la proposition de M. Louis Leclerc, qu'une lettre de condoléance serait adressée à Mme veuve Rossi, pour lui témoigner la haute estime que ses divers membres professaient pour le caractère et les éminentes qualités de son illustre époux, ainsi que la douleur profonde qu'ils ont ressentie à la nouvelle de l'affreux malheur qui l'a frappée.
M. Michel Chevalier a ensuite communiqué à la réunion le discours remarquable, à tous égards, que M. Richard Whately, archevêque de Dublin, a prononcé [71] dans la séance solennelle de la Société de statistique, fondée depuis un an dans cette ville, et duquel il résulte qu'à l'heure qu'il est les notions élémentaires sur l'économie sociale et sur les effets de la charité sont enseignées en Irlande dans quatre mille écoles! Nos lecteurs trouveront dans ce discours, que nous reproduisons en entier, des considérations pleines d'élévation et de justesse, qui prouvent qu'on peut être un digne archevêque, un économiste très orthodoxe et un philanthrope de bon aloi.
Le docteur Lardner, présent à la séance, a rappelé la haute estime qu'on avait en Angleterre pour le savant archevêque de Dublin.
En donnant connaissance de ce curieux discours, M. Michel Chevalier a trouvé naturellement l'occasion de remercier tant en ce qui le concerne, qu'au nom de la science, MM. Léon Faucher, Barthélemy Saint-Hilaire et Wolowski, présents à la séance, des heureux efforts qu'ils ont tentés à l'Assemblée nationale pour faire rétablir la chaire d'économie politique au Collège de France. La Société s'est vivement associée à ces sentiments de M. Michel Chevalier, et elle a fait comprendre à M. Barthélemy Saint-Hilaire combien elle était heureuse d'avoir à adresser ses remerciements à un savant qui cultive la philosophie, et auquel personne ne pouvait objecter qu'il réclamait pro domo sua. D'ailleurs, M. Michel Chevalier a fort bien fait remarquer que l'économie politique était une des plus belles branches du grand arbre de la philosophie. Smith, avant d'écrire sur la richesse des nations, avait publié la théorie des sentiments moraux; Tracy a classé son traité d'économie politique dans son cours d'idéologie; Turgot est vénéré des philosophes; et qui oserait dire que des hommes comme J.-B. Say, Rossi et tant d'autres ne sont pas des esprits éminemment philosophiques?
[72]
La conversation a été ensuite reprise sur le sujet déjà traité dans la dernière séance : l'émancipation économique des colonies. M. Bastiat a lu un acte du Parlement anglais, en date du mois de mars, qui a passé inaperçu chez nous à cause de la tourmente politique, mais duquel il résulte que, désormais, il y a, pour la navigation dans l'Inde, égalité parfaite entre les navires anglais et ceux des autres nations. M. Bastiat est entré dans quelques considérations à cet égard, et a dit que la réforme commerciale opérée chez nos voisins a produit deux résultats inattendus. D'abord, les soulagements apportés par les mesures économiques provoquées par les free-traders ont enrayé l'action du chartisme, variété de communisme anglais. Ensuite, la logique a conduit les ligueurs de la réforme des tarifs à la liberté coloniale, et celle-ci les pousse, on le voit déjà, à l'abandon politique de ces établissements qui coûtent énormément plus qu'ils ne rapportent. La discussion, provoquée par M. Bastiat, s'est animée entre MM. Rodet, Dunoyer, L.Wolowski, de Colmont, Léon Faucher et Fonteyraud. L'argumentation de MM. de Colmont et Rodet avait pour but de bien constater que l'Angleterre n'a jamais agi par philanthropie, mais bien par intérêt. A quoi, M. Dunoyer a répondu que les Anglais pratiquent à merveille l'égoïsme du vrai, cet égoïsme qui ne sert bien leurs intérêts que parce qu'il profite aussi aux intérêts des autres. M. FonteyRaud, en rappelant les efforts inouïs des ligueurs de Manchester, la division profonde dans laquelle l'Angleterre s'était trouvée au sujet du libre échange, et la difficulté que Cobden et ses amis avaient eue à conquérir la majorité par la force et l'excellence de la raison, a répondu au scepticisme de M: Rodet et aux questions de M. de Colmont d'une manière concluante.
T.225 Economic Harmonies IV in JDE (15 Dec. 1848) (Fr, PDF1)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Checked against EH PDF: 27 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.225 (1848.12.15) "Economic Harmonies IV" (Harmonie économiques. IV), Journal des Économistes, T. XXII, No. 93, 15 Dec. 1848, pp. 7-18; also in EH 4. [OC6]
This is concluding part of Chap III in EH1, p. 87 ff.
Structurally identical to JDE article. Minor changes to tense and refs to articles.
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
Sounds like lecture notes: “Nous avons aujourd'hui à examiner cette question”
Text: Harmonies Économiques IV↩
[7]
IV. [158]
J'ai dit, en commençant cet écrit, que l'économie politique avait pour objet l’homme, considéré au point de vue de ses besoins et des moyens par lesquels il lui est donné d'y pourvoir.
Il est donc naturel de commencer par étudier l'homme et son organisation.
Mais nous avons vu aussi qu'il n'est pas un être solitaire; si ses besoins et ses satisfactions, en vertu de la nature de la sensibilité, sont inséparables de son être, il n'en est pas de même de ses efforts, qui naissent du principe actif. Ceux-ci sont susceptibles de transmission. En un mot, les hommes travaillent les uns pour les autres.
Or, il arrive une chose fort singulière.
Quand on considère d'une manière générale et, pour ainsi dire, abstraite, l'homme, ses besoins, ses efforts, ses satisfactions, sa constitution, ses penchants, ses tendances, on aboutit à une série d'observations qui paraissent à l'abri du doute et se montrent dans tout l'éclat de l'évidence, chacun en trouvant la preuve en lui-même. C'est au point que l'écrivain ne sait trop comment s'y prendre pour soumettre au public des vérités si palpables et si vulgaires : il craint de provoquer le sourire du dédain. Il lui semble, avec quelque raison , que le lecteur courroucé va jeter le livre, en s'écriant : « Je ne perdrai pas mon temps k apprendre ces trivialités.»
Et cependant ces vérités, tenues pour si incontestables tant qu'elles sont présentées d'une manière générale, que nous souffrons à peine qu'elles nous soient rappelées, ne passent plus que pour des erreurs ridicules, des théories absurdes sitôt que l'on observe l'homme dans le milieu social. Qui jamais, en considérant l'homme isolé, s'aviserait de dire : La production surabonde; la faculté de consommer ne peut suivre la faculté de produire; le luxe et les goûts factices sont la source de la richesse; l'invention des machines anéantit le travail; et autres apophthegmes de la même force qui, appliqués à des agglomérations humaines, passent cependant pour des axiomes si bien établis qu'on en fait la base de nos lois industrielles et commerciales? L'échange produit à cet égard une illusion dont ne savent pas se préserver les esprits de la meilleure trempe, et j'affirme que l'économie politique aura atteint son but et rempli sa mission quand elle aura définitivement démontré ceci : Ce qui est vrai de l'homme est vrai de la société. [8] L'homme isolé est à la fois producteur et consommateur, inventeur et entrepreneur, capitaliste et ouvrier; tous les phénomènes économiques s'accomplissent en lui, et il est comme un résumé de la société. De môme l'humanité, vue dans son ensemble, est un homme immense, collectif, multiple, auquel s'appliquent exactement les vérités observées sur l'individualité même.
J'avais besoin de faire cette remarque, qui, je l'espère, sera mieux justifiée par la suite, avant de continuer les études sur l'homme commencées dans le chapitre précédent. Sans cela, j'aurais craint que le lecteur ne rejetât, comme superflus, les développements, les véritables truismes qui vont suivre.
Dans le dernier article, j'ai parlé des besoins de l'homme, et après en avoir présenté une énumération approximative, j'ai fait observer qu'ils n'étaient pas d'une nature stationnaire, mais progressive; cela est vrai, soit qu'on les considère chacun en lui-même, soit surtout qu'on embrasse leur ensemble dans l'ordre physique, intellectuel et moral. Comment en pourrait-il être autrement? Il est des besoins . dont la satisfaction est exigée, sous peine de mort, par notre organisation, et, jusqu'à un certain point, on pourrait soutenir que ceux-là sont des quantités fixes, encore que cela ne soit certes pas rigoureusement exact, car, pour peu qu'on veuille bien ne pas négliger un élément essentiel, la puissance de l'habitude, et pour peu qu'on condescende à s'examiner soi-même avec quelque bonne foi, on sera forcé de convenir que les besoins même les plus grossiers, comme celui de manger, subissent, sous l'influence de l'habitude, d'incontestables transformations, et tel qui déclamera ici contre cette remarque, la taxant de matérialisme et d'épicuréisme, se trouverait bien malheureux si, le prenant au mot, on le réduisait à la pitance d'un anachorète. Mais en tous cas, quand les besoins de cet ordre sont satisfaits d'une manière assurée et permanente, il en est d'autres qui prennent leur source dans la plus expansible de nos facultés, le désir. Conçoit-on un moment où l'homme ne puisse plus former de désirs , même raisonnables? N'oublions pas qu'un désir qui est déraisonnable à un certain degré de civilisation, à une époque où toutes les puissances humaines sont absorbées pour la satisfaction des besoins inférieurs, cesse d'être tel quand le perfectionnement de ces puissances ouvre devant elles un champ plus étendu. C'est ainsi qu'il eût été déraisonnable, il y a deux siècles, et qu'il ne l'est pas aujourd'hui, d'aspirer à faire dix lieues à l'heure. Prétendre que les besoins et les désirs de l'homme sont des quantités fixes et stationnaires, c'est méconnaître la nature de l'âme, c'est nier les faits, c'est rendre la civilisation inexplicable.
Elle serait inexplicable encore si, à côté du développement indéfini des besoins, ne venait se placer, comme possible, le développement indéfini des moyens d'y pourvoir. Qu'importerait, pour la réalisation du progrès, la nature expansible des besoins, si, à une certaine limite, nos [9] facultés ne pouvaient plus avancer, si elles rencontraient une borne immuable?
Ainsi, à moins que la nature, la Providence, quelle que soit la puissance qui préside à nos destinées, ne soit tombée dans la plus choquante, la plus cruelle contradiction, nos désirs étant indéfinis, la présomption est que nos moyens d'y pourvoir le sont aussi.
Je dis indéfinis et non point infinis, car rien de ce qui tient à l'homme n'est infini. C'est précisément parce que nos désirs et nos facultés se développent dans l'infini, qu'ils n'ont pas de limites assignables, quoiqu'ils aient des limites absolues. On peut citer une multitude de points, au-dessus de l'humanité, auxquels elle ne parviendra jamais, sans qu'on puisse dire pour cela qu'il arrivera un instant où elle cessera de s'en rapprocher. [159]
Je ne voudrais pas dire non plus que le désir et le moyen marchent parallèlement et d'un pas égal. Le désir court, et le moyen suit en boitant.
Cette nature prompte et aventureuse du désir, comparée à la lenteur de nos facultés, nous avertit qu'à tous les degrés de la civilisation, à tous les échelons du progrès, la souffrance, dans une certaine mesure, est et sera toujours le partage de l'homme. Mais elle nous enseigne aussi que cette souffrance a une mission, puisqu'il serait impossible de comprendre que le désir fût l'aiguillon de nos facultés, s'il les suivait au lieu de les précéder. Cependant n'accusons pas la nature d'avoir mis de la cruauté dans ce mécanisme, car il faut remarquer que le désir ne se transforme en véritable besoin, c'est-à-dire en désir douloureux, que lorsqu'il a été fait tel par ['habitude d'une satisfaction permanente, en d'autres termes, quand le moyen a été trouvé et mis irrévocablement à notre portée. [160]
Nous avons aujourd'hui à examiner cette question : Quels sont les moyens que nous avons de pourvoir à nos besoins?
Il me semble évident qu'il y en a deux : la nature et le travail, les dons de Dieu et les fruits de nos efforts, ou, si l'on veut, l'application de nos facultés aux choses que la nature a mises à notre service.
Aucune école, que je sache, n'a attribué à la nature seule la satisfaction de nos besoins. Une telle assertion est trop démentie par l'expérience , et nous n'avons pas à étudier l'économie politique pour nous apercevoir que l'intervention de nos facultés est nécessaire.
Mais il y a des écoles qui ont rapporté au travail seul ce privilège. Leur axiome est : Toute richesse vient du travaille travail, c'est la richesse.
Je ne puis m'empêcher de prévenir ici que ces formules, prises au [10] pied de la lettre , ont conduit à des erreurs de doctrine énormes et, par suite, à des mesures législatives déplorables. J'en parlerai ailleurs.
Ici, je me borne à établir, en fait, que la nature et le travail coopèrent à la satisfaction de nos besoins et de nos désirs.
Examinons les faits.
Le premier besoin que nous avons placé en tête de notre nomenclature, c'est celui de respirer. A cet égard, nous avons déjà constaté que la nature fait, en général, tous les frais, et que le travail humain n'a à intervenir que dans certains cas exceptionnels , comme , par exemple, quand il est nécessaire de purifier l'air.
Le besoin de nous désaltérer est plus ou moins satisfait par la Nature, selon qu'elle nous fournit une eau plus ou moins rapprochée, limpide, abondante, et le Travail a à concourir d'autant plus, qu'il faut aller chercher l'eau plus loin, la clarifier, suppléer à sa rareté par des puits et des citernes.
La nature n'est pas non plus uniformément libérale envers nous quant à l’alimentation, car qui dira que le travail qui reste à notre charge soit toujours le même si le terrain est fertile ou s'il est ingrat, si la forêt est giboyeuse, si la rivière est poissonneuse , ou dans les hypothèses contraires?
Pour l'éclairage, le travail humain a certainement moins à faire là où la nuit est courte que là où il a plu au soleil qu'elle fût longue.
Je n'oserais pas poser ceci comme une règle absolue, mais il me semble qu'à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des besoins, la coopération de la nature s'amoindrit et laisse plus de place à nos facultés. Le peintre, le statuaire, l'écrivain même sont réduits à s'aider de matériaux et d'instruments que la nature seule fournit; mais il faut avouer qu'ils puisent dans leur propre génie ce qui fait le charme, le mérite, l'utilité et la valeur de leurs oeuvres. Apprendre est un besoin que satisfait presque exclusivement l'exercice bien dirigé de nos facultés intellectuelles. Cependant ne pourrait-on pas dire qu'ici encore la nature nous aide en nous offrant, à des degrés divers, des objets d'observation et de comparaison? A travail égal, la botanique, la géologie, l'histoire naturelle peuvent-elles faire partout des progrès égaux?
Il serait superflu de citer d'autres exemples. Nous pouvons déjà constater que la nature nous donne des moyens de satisfaction à des degrés plus ou moins avancés d'utilité (ce mot est pris dans le sens étymologique, propriété de servir). Dans beaucoup de cas, dans presque tous les cas, il reste quelque chose à faire au travail pour rendre cette utilité complète, et l'on comprend que cette action du travail est susceptible de plus ou de moins, dans chaque circonstance donnée, selon que la nature a elle-même plus ou moins avancé l'opération.
On peut donc poser ces deux formules.
1° L'Utilité est communiquée, quelquefois par la Valuer seule, quelquefois par le Travail seul, [11] presque toujours par la coopération de la Nature et du Travail;
2° Pour amener une chose à son état complet d'Utilité, l'action du Travail est en raison inverse de l'action de la Nature.
De ces deux propositions combinées avec ce que nous avons dit de l'expansibilité indéfinie des besoins, qu'il me soit permis de tirer une déduction dont ln suite démontrera ('importance. Si deux hommes, supposés être sans relations entre eux, se trouvent placés dans des situations inégales, de telle sorte que la nature, libérale pour l'un, ait été avare pour l'autre, le premier aura évidemment moins de travail à faire pour chaque satisfaction donnée; s'ensuit-il que cette partie de ses forces, pour ainsi dire laissées ainsi en disponibilité, sera nécessairement frappée d'inertie, et que cet homme, à cause de la libéralité de la nature, sera réduit à une oisiveté forcée? Non; ce qu'il s'ensuit, c'est qu'il pourra, s'il le veut, disposer de ces forces pour agrandir le cercle de ses jouissances; qu'à travail égal, il se procurera deux satisfactions au lieu d'une; en un mot, que le progrès lui sera plus facile.
Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble qu'aucune science, pas même la géométrie, ne présente, à son point de départ, des vérités plus inattaquables. Que si l'on venait à me prouver cependant que toutes ces vérités sont autant d erreurs , on aurait détruit en moi non-seulement la confiance qu'elles m'inspirent, mais la base de toute certitude et la foi en l'évidence même ; car de quel raisonnement se pourrait-on servir, qui méritât mieux l'acquiescement de ma raison que celui qu'on aurait renversé? Le jour où on aura trouvé un axiome qui contredise cet autre axiome : la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, ce jour-là l'esprit humain n'aura plus d'autre refuge , si c'en est un , que le scepticisme absolu.
Aussi, j'éprouve une véritable confusion à insister sur des vérités primordiales si claires, qu'elles en semblent puériles. Cependant, il faut bien le dire, à travers les complications des transactions humaines , ces simples vérités ont été méconnues, et pour me justifier auprès du lecteur de le retenir si longtemps sur ce que les Anglais appellent des truismes, je lui signalerai ici le singulier égarement auquel d'excellents esprits se sont laissé entraîner. Mettant de côté, négligeant entièrement la coopération de la nature, relativement à la satisfaction de nos besoins, ils ont posé ce principe absolu : Toute richesse vient du travail. Sur cette prémisse ils ont bâti le syllogisme suivant:
11700. « 11701.Toute richesse vient du travail:
11703. « 11704.Donc la richesse est proportionnelle au travail.
11706. « 11707.Or, le travail est en raison inverse de la libéralité de la nature.
11709. « 11710.Donc la richesse est en raison inverse de la libéralité de la nature ! »
Et, qu'on le veuille ou non, beaucoup de nos lois économiques ont [12] été inspirées par ce singulier raisonnement. Ces lois ne peuvent qu'être funestes au développement et à la distribution des richesses. C'est là ce qui me justifie de préparer d'avance, par l'exposition de vérités fort triviales en apparence, la réfutation d'erreurs et de préjugés déplorables sous lesquels se débat la société actuelle.
Décomposons maintenant ce concours de la nature.
Elle met deux choses à notre disposition : des matériaux et des forces.
La plupart des objets matériels qui servent à la satisfaction de nos besoins et de nos désirs ne sont amenés à l'état d'utilité qui les rend propres à notre usage que par l'intervention du travail, par l'application des facultés humaines. Mais en tous cas, les éléments, les atomes, si l'on veut, dont ces objets sont composés sont des dons, et j'ajoute des dons gratuits de la nature. Cette observation est de la plus haute importance, et jettera, je crois, un jour nouveau sur la théorie de la richesse.
Je désire que le lecteur veuille bien se rappeler que j'étudie ici d'une manière générale la constitution physique et morale de l'homme, ses besoins, ses facultés et ses relations avec la nature , abstraction faite de l'échange, que je n'aborderai que dans l'article suivant; nous verrons alors en quoi et comment les transactions sociales modifient les phénomènes.
Il est bien évident que si l’homme isolé doit, pour parler ainsi, acheter la plupart de ses satisfactions par un travail, par un effort, il est rigoureusement exact dédire, qu'avant qu'aucun travail, aucun effort de sa part ne soit intervenu , les matériaux qu'il trouve à sa portée sont des dons gratuits de la nature. Après le premier effort, quelque léger qu'il soit, ils cessent d'être gratuits, et si le langage de l'économie politique eût toujours été exact, c'est à cet état des objets matériels, antérieurement à toute action humaine, qu'eût été réservé le nom de matières premières.
Je répète ici que cette gratuité des dons de la nature, avant l'intervention du travail, est de la plus haute importance. En effet, j'ai dit dans le premier article, que l'économie politique était la théorie de la valeur. J'ajoute maintenant, et par anticipation, que les choses ne commencent à avoir de la valeur que lorsque le travail la leur donne. Je prétends démontrer, plus tard, que tout ce qui est gratuit pour l'homme isolé reste gratuit pour l'homme social, et que les dons gratuits de la nature, quelle que soit leur Utilité, n'ont pas de Valeur.. Je dis qu'un homme, qui recueille directement et sans aucun effort un bienfait de la nature, ne peut être considéré comme se rendant à lui-même un service onéreux, et que, par conséquent, il ne peut rendre aucun service à autrui à l'occasion de choses communes à tous. Or, là où il n'y a pas de services rendus et reçus, il n'y a pas de valeur.
Tout ce que je dis ici des matériaux s'applique aussi aux forces que nous fournit la nature, La gravitation, l'élasticité des gaz, la [13] puissance des vents, les lois de l'équilibre, la vie végétale, la vie animale, ce sont autant de forces que nous apprenons à faire tourner à notre avantage. La peine, l'intelligence que nous dépensons pour cela sont toujours susceptibles de rémunération, car nous ne pouvons être tenus de consacrer gratuitement nos efforts à l'avantage d'autrui. Mais ces forces naturelles, considérées en elles-mêmes, et abstraction faite de tout travail intellectuel ou musculaire, sont des dons gratuits de la Providence , et, à ce titre, elles restent sans valeur à travers toutes les complications des transactions humaines. C'est la pensée dominante de cet écrit.
Cette observation aurait peu d'importance, je l'avoue, si la coopération naturelle était constamment uniforme, si chaque homme, en tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances, recevait de la nature un concours toujours égal, invariable. En ce cas, la science serait excusable de ne pas tenir compte d'un élément qui, restant toujours et partout le même, affecterait les services échangés dans des proportions exactes de toutes parts. Comme on élimine, en géométrie, les portions de lignes communes aux deux figures comparées, elle pourrait négliger cette coopération immuablement présente, et se contenter de dire, ainsi qu'elle l'a fait jusqu'ici : « Il y a des richesses naturelles; l'économie politique le constate une fois pour toutes et ne s'en occupe plus.. »
Mais les choses ne se passent pas ainsi. La tendance invincible de l'intelligence humaine* en cela stimulée par l'intérêt et secondée par la série des découvertes, est de substituer le concours naturel et gratuit au concours humain et onéreux, de telle sorte qu'une utilité donnée, quoique restant la même quant à son résultat, quant à la satisfaction qu'elle procure, répond cependant à un travail de plus en plus réduit. Certes, il est impossible de ne pas apercevoir l'immense influence de ce merveilleux phénomène sur la notion de la Valeur. Car qu'en résulte-t-il? C'est qu'en tout produit la partie gratuite tend à remplacer la partie onéreuse. C'est que l'utilité étant une résultante de deux collaborations dont l'une se rémunère et l'autre ne se rémunère pas, la Valeur qui n'a de rapport qu'avec la première de ces collaborations, diminue pour une utilité identique, à mesure que la nature est contrainte à un concours plus efficace. En sorte qu'où peut dire que l'humanité à d'autant plus de satisfactions ou de richesses qu'elle a moins de valeurs. Or, la plupart des auteurs ayant établi une sorte de synonymie entre ces trois expressions : utilités, richesses, valeurs, il en est résulté une théorie non-seulement fausse, mais en sens inverse de la vérité. Je crois sincèrement qu'une description plus exacte de cette combinaison des forces naturelles et des forces humaines dans l'œuvre de la production, autrement dit une définition plus juste de la Valeur, fera cesser des confusions théoriques inextricables et conciliera des écoles aujourd'hui divergentes, [14] et si j'anticipe aujourd'hui sur la suite de cette exposition, c'est pour me justifier auprès du lecteur de m'arrêter sur des notions dont il lui serait difficile sans cela de s'expliquer l'importance.
Après cette digression, je reprends mon étude sur l'homme considéré uniquement au point de vue économique.
Une autre observation due à J.-B. Say, et qui saute aux yeux par son évidence, quoique trop souvent négligée par beaucoup d'auteurs, c'est que l'homme ne crée ni les matériaux, ni les forces de la nature, si l'on prend le mot créer dans son acception rigoureuse. Ces matériaux, ces forces existent par eux-mêmes. L'homme se borne à les combiner, à les déplacer pour son avantage ou pour l'avantage d'autrui. Si c'est pour son avantage, il se rend service à lui-même. Si c'est pour l'avantage d'autrui, il rend service à son semblable, et est en droit d'en exiger un service équivalent; d'où il suit encore que la valeur est proportionnelle au service rendu, et non point du tout à l'utilité absolue de la chose. Car cette utilité peut être, en très-grande partie, le résultat de l'action gratuite de la nature, auquel cas le service humain, le service onéreux et rémunérable est de peu de Valeur. Cela résulte de l'axiome établi ci-dessus : Pour amener une chose à l'état complet d'utilité, l'action de l'homme est en raison inverse de l'action de la nature.
Cette observation renverse la doctrine dont j'ai parlé dans le premier article [revised slightly], et qui place la valeur dans la matérialité des choses. C'est le contraire qui est vrai. La matérialité est une qualité donnée par la nature et par conséquent gratuite, dépourvue de valeur, quoique d'une utilité incontestable. L'action humaine, laquelle ne peut jamais arriver à créer de la matière, constitue seule le service que l'homme isolé se rend à lui-même ou que les hommes en société se rendent les uns aux autres, et c'est la libre appréciation de ces services qui est le fondement de la valeur; bien loin donc que, comme le voulait Smith, la Valeur ne se puisse concevoir qu'incorporée dans la Matière, entre matière et valeur il n'y a pas de rapports possibles.
La doctrine erronée à laquelle je fais allusion avait rigoureusement déduit de son principe que ces classes seules sont productives, qui opèrent sur la matière. Smith avait ainsi préparé l'erreur des socialistes modernes, qui ne cessent de représenter comme des parasites improductifs ce qu’ils appellent les intermédiaires entre le producteur et le consommateur, tels que le négociant, le marchand, etc. Rendent-ils de» services? Nous épargnent-ils une peine en se la donnant pour nous? En ce cas, ils créent de la valeur, quoiqu'ils ne créent pas de la matière, et même, comme nul ne crée de la matière, comme nous nous bornons tous à nous rendre des services réciproques, il est très-exact de dire que nous sommes tous, y compris les agriculteurs et les fabricants, des intermédiaires à l'égard les uns des autres.
Voilà ce que j'avais à dire, pour le moment, sur le concours de la [15] nature. Elle met à notre disposition, dans une mesure fort diverse, selon les climats, les saisons, et l'avancement de nos connaissances, mais toujours gratuitement, des matériaux et des forces. Donc ces matériaux et ces forces n'ont «as de valeur; il serait bien étrange qu'ils en eussent. D'après quelle règle l'estimerions-nous? Comment comprendre que la nature se fasse payer, rétribuer, rémunérer? Nous verrons plus tard que l'échange est nécessaire pour déterminer la valeur. Nous n'achetons pas les biens naturels, nous les recueillons; et si, pour les recueillir, i) faut faire un effort quelconque, c'est dans cet effort, non dans le don de la nature, qu'est le principe de la valeur.
Passons à l'action de l'homme, désignée d'une manière générale sous le nom de travail.
Le mot travail, comme presque tous ceux qu'emploie l'économie politique, est fort vague; chaque auteur lui donne un sens plus ou moins étendu. L'économie politique n'a pas eu, comme la plupart des sciences, la chimie, par exemple, l'avantage de faire son vocabulaire. Traitant de choses qui occupent les hommes depuis le commencement du monde et font le sujet habituel de leurs conversations, elle a trouvé des expressions toutes faites, et est forcée de s'en servir.
On restreint souvent le sens du mot travail à l'action presque exclusivement musculaire de l'homme sur les choses. C'est ainsi qu'on appelle classes travailleuses celles qui exécutent la partie mécanique de la production.
Le lecteur comprendra que je donne à ce mot un sens plus étendu. J'entends par travail l'application de nos facultés à la satisfaction de nos besoins. Besoin, effort, satisfaction, voilà le cercle de l'économie politique. L'effort peut être physique, intellectuel ou même moral, comme nous allons le voir.
Il n'est pas nécessaire de montrer ici que tous nos organes, toutes ou presque toutes nos facultés peuvent concourir et concourent en effet à la production. L'attention, la sagacité, l'intelligence, l'imagination, y ont certainement leur part.
M. Dunoyer, dans son beau livre sur la Liberté du travail, a fait entrer, et cela avec toute la rigueur scientifique, nos facultés morales parmi les éléments auxquels nous devons nos richesses; c'est une idée neuve et féconde autant que juste; elle est destinée à agrandir et à ennoblir le champ de l'économie politique.
Je n'insisterai aujourd'hui sur cette idée qu'autant qu'elle me fournit l'occasion de jeter une première lueur sur l'origine d'un puissant agent de production dont je n'ai pas encore parlé : Le Capital.
Si nous examinons successivement les objets matériels qui servent à la satisfaction de nos besoins, nous reconnaîtrons sans peine que tous ou presque tous exigent, pour être confectionnés, plus de temps, une plus grande portion de notre vie que l'homme n'en peut dépenser sans réparer ses forces, c'est-à-dire sans satisfaire des besoins. [16] Cela suppose donc que ceux qui ont exécuté ces choses avaient préalablement réservé, mis de côté, accumulé des provisions pour vivre pendant l'opération.
Il en est de même pour les satisfactions où n'apparaît rien de matériel. Un prêtre ne pourrait se consacrer à la prédication, un professeur à l'enseignement, un magistrat au maintien de l'ordre, si par eux-mêmes ou par d'autres ils ne trouvaient à leur portée des moyens d'existence tout créés.
Remontons plus haut. Supposons un homme isolé et réduit à vivre de chasse. Il est aisé de comprendre que si, chaque soir, il avait consommé tout le gibier pris dans la journée, jamais il ne pourrait entreprendre aucun autre ouvrage, bâtir une hutte, réparer ses armes; tout progrès lui serait à jamais interdit.
Ce n'est pas ici le lieu de définir la nature et les fonctions du Capital; mon seul but est de faire voir que certaines vertus morales concourent très-directement à l'amélioration de notre condition, même au point de vue exclusif des richesses, et, entre autres, l'ordre, la prévoyance, l'empire sur soi-même, l'économie.
Prévoir est un des beaux privilèges de l'homme, et il est à peine nécessaire de dire que, dans presque toutes les circonstances de la vie, celui-là a des chances plus favorables qui sait le mieux quelles seront les conséquences de ses déterminations et de ses actes.
Réprimer ses appétits, gouverner ses passions, sacrifier le présent à l'avenir, se soumettre à une privation actuelle en vue d'un avantage supérieur mais éloigné, ce sont des conditions essentielles pour la formation des capitaux, et les capitaux, nous l'avons entrevu, sont eux-mêmes la condition essentielle de tout travail un peu compliqué ou prolongé. Il est de toute évidence que si deux hommes étaient placés dans des conditions parfaitement identiques, si on leur supposait, en outre, le même degré d'intelligence et d'activité, celui-là ferait plus de progrès qui, accumulant des provisions, se mettrait à même d'entreprendre des ouvrages de longue haleine, de perfectionner ses instruments, et de faire concourir ainsi les forces de la nature à la réalisation de ses desseins.
Je n'insisterai pas là-dessus; il suffit de jeter un regard autour de soi pour rester convaincu que toutes nos forces, toutes nos facultés, toutes nos vertus, concourent à l'avancement de l'homme et de la société.
Par la même raison, il n'est aucun de nos vices qui ne soit une cause directe ou indirecte de misère. La paresse paralyse le nerf même de la production, l'Effort. L'ignorance et l'erreur lui donnent une fausse direction; l'imprévoyance nous prépare des déceptions; l'abandon aux appétits du moment empêche l'accumulation ou la formation du capital; la vanité nous conduit à consacrer nos efforts à des satisfactions factices aux dépens de satisfactions réelles; la violence, la ruse, provoquant des représailles, nous forcent à nous [17] environner de précautions onéreuses, et entraînent ainsi une grande déperdition de forces.
Je terminerai cette étude préliminaire de l'homme par une observation que j'ai déjà faite à l'occasion des besoins. C'est que les éléments signalés dans cet article, qui entrent dans la science économique et la constituent, sont essentiellement mobiles et divers. Besoins, désirs, matériaux et puissances fournis par la nature, forces musculaires, organes, facultés intellectuelles, qualités morales, tout cela est variable selon l'individu, le temps et le lieu. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent sous chacun de ces rapports, ni, à plus forte raison, sur tous. Bien plus, aucun homme ne se ressemble exactement à lui-même deux heures de suite; ce que l'un sait, l'autre l'ignore ; ce que celui-ci apprécie, celui-là le dédaigne; ici, la nature a été prodigue, là, avare; une vertu qui est difficile à pratiquer à un certain dégré de température, devient facile sous un autre climat. La science économique n'a donc pas, comme les sciences dites exactes, l'avantage de posséder une mesure, un absolu auquel elle peut tout rapporter, une ligne graduée, un mètre qui lui serve à mesurer l'intensité des désirs, des efforts et des satisfactions. Si nous étions voués au travail solitaire, comme certains animaux, nous serions tous placés dans des circonstances différant par quelques points, et, ces circonstances extérieures fussent-elles semblables, le milieu dans lequel nous agirions fût-il identique pour tous, nous différerions encore par nos désirs, nos besoins, nos idées, notre sagacité, notre énergie, notre manière d'estimer et d'apprécier les choses, notre prévoyance, notre activité; en sorte qu'une grande et inévitable inégalité se manifesterait parmi les hommes. Certes, l'isolement absolu, l'absence de toutes relations entre les hommes, ce n'est qu'une vision chimérique née dans l'imagination de Rousseau. Mais, à supposer que cet état antisocial dit état de nature ait jamais existé, je me demande par quelle série d'idées Rousseau et ses adeptes sont arrivés à y placer l'Egalité? Nous verrons plus tard qu'elle est, comme la Richesse, comme la Liberté, comme la Fraternité, comme l'Unité, une fin et non un point de départ. Elle surgit du développement naturel et régulier des sociétés. L'humanité ne s'en éloigne pas, elle y tend. C'est plus consolant et plus vrai.
Après avoir parlé de nos besoins et des moyens que nous avons d'y pourvoir, il me reste à dire un mot de nos satisfactions. Elles sont la résultante du mécanisme entier. C'est par le plus ou moins de satisfactions physiques, intellectuelles et morales dont jouit l'humanité, que nous reconnaissons si la machine fonctionne bien ou mal. C'est pourquoi le mot consommation, adopté par les économistes, aurait un sens profond, si, lui conservant sa signification étymologique, on en faisait le synonyme de fin, accomplissement. Par malheur, dans le langage vulgaire et même dans la langue scientifique, il présente à l'esprit un [18] sens matériel et grossier, exact sans doute quant aux besoins physiques, mais qui cesse de l'être à l'égard des besoins d'un ordre plus élevé. La culture du blé, le tissage de la laine se terminent pat une consommation. En est-il de même des travaux de l'artiste, des chants du poëte, des méditations du jurisconsulte, des enseignements du professeur, des prédications du prêtre? Ici encore nous retrouvons les inconvénients de cette erreur fondamentale qui détermina A. Smith à circonscrire l'économie politique dans un cercle de matérialité, et le lecteur me pardonnera de me servir souvent du mot satisfaction, comme s'appliquant à tous nos besoins et à tous nos désirs, comme répondant mieux du cadre élargi que j'ai cru pouvoir donner à la science.
On a souvent reproché aux économistes de se préoccuper exclusivement des intérêts du consommateur; « Vous oubliez le producteur » , ajoutait-on. Mais la satisfaction étant le but, la fin de tous les efforts, et comme la grande consommation des phénomènes économiques, n'est-il pas évident que c'est en elle qu'est la pierre de touche du progrès? Le bien-être d'un homme ne se mesure pas à ses efforts, mais à ses satisfactions ; cela est vrai aussi pour les agglomérations d'hommes. C'est encore là une de ces Vérités que nul ne conteste quand il s'agit de l'homme isolé, et contre laquelle on dispute sans cesse dès qu'elle est appliquée à la société. La phrase incriminée n'a pas tan autre séns que celui-ci : toute mesure économique s'apprécie, non par la peine qu'elle occasionne, mais par l'effet utile qui en résulte, lequel se résout en un accroissement ou une diminution du bien-être général.
Nous avons dit à propos des besoins et des désirs qu'il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent. Il en est de même pour nos satisfactions. Elles ne sont pas également appréciées par tous, ce qui revient à cette banalité ! les goûts diffèrent. Or, c'est la vivacité des désirs, la variété des goûts qui déterminent la direction des efforts. Ici l'influence de la morale sur l'industrie est manifeste. On peut concevoir un homme isolé, esclave de goûts factices, puérils, immoraux. En ce cas, il saute aux yeux que ses forces,qui sont limitées, ne satisferont des désirs dépravés qu'aux dépens de désirs plus intelligents et mieux entendus. Mais, est-il question de la société, cet axiome évident est considéré comme une erreur. On est porté à croire que les goûts factices, les satisfactions illusoires, que l'on reconnaît être une source de misère individuelle) sont néanmoins une source de richesses nationales, parce qu'elles ouvrent des débouchés à une foule d'industries. S'il en était ainsi, nous arriverions à une Conclusion bien triste r d'est que l'état social place l'homme entre la misère et l'immoralité. Encore une fois, l'économie politique résout de la manière la plus satisfaisante et la plus rigoureuse ces apparentes contradictions.
Frédéric Bastiat
Lettre sur le référendum pour le président de la république (JCPD) [late 1848 ???]↩
[not available] [CW??]
Books and Printed Pamphlets↩
ToC↩
- *Sophismes économiques. Deuxième série.* (Paris: Guillaumin, 1848). [published Jan. 1848] [ES2] [OC4.2, p. 127] [CW3]
- *Propriété et Loi* [after May 1848]
- *Justice et Fraternité* [after June 1848]]
- *Propriété et Spoliation* [after July 1848]
- *L’État* [after Sept. 1848]
Sophismes économiques. Deuxième série [161] [January 1848] [CW3]↩
BWV
*Sophismes économiques. Deuxième série.* (Paris: Guillaumin, 1848). [published Jan. 1848] [ES2] [OC4.2, p. 127] [CW3]
Source
<http://fr.wikisource.org/wiki/Sophismes_%C3%A9conomiques>
I. Physiologie de la Spoliation↩
La requête de l’industrie au gouvernement est aussi modeste que celle de Diogène à Alexandre : Ôte-toi de mon soleil. (Bentham.)
Pourquoi irais-je m’aheurter à cette science aride, l’Économie politique ?
Pourquoi ? — La question est judicieuse. Tout travail est assez répugnant de sa nature, pour qu’on ait le droit de demander où il mène.
Voyons, cherchons.
Je ne m’adresse pas à ces philosophes qui font profession d’adorer la misère, sinon en leur nom, du moins au nom de l’humanité.
Je parle à quiconque tient la Richesse pour quelque chose. — Entendons par ce mot, non l’opulence de quelques-uns, mais l’aisance, le bien-être, la sécurité, l’indépendance, l’instruction, la dignité de tous.
Il n’y a que deux moyens de se procurer les choses nécessaires à la conservation, à l’embellissement et au perfectionnement de la vie : la Production et la Spoliation.
Quelques personnes disent : La Spoliation est un accident, un abus local et passager, flétri par la morale, réprouvé par la loi, indigne d’occuper l’Économie politique.
Cependant, quelque bienveillance, quelque optimisme que l’on porte au cœur, on est forcé de reconnaître que la Spoliation s’exerce dans ce monde sur une trop vaste échelle, qu’elle se mêle trop universellement à tous les grands faits humains pour qu’aucune science sociale, et l’Économie politique surtout, puisse se dispenser d’en tenir compte.
Je vais plus loin. Ce qui sépare l’ordre social de la perfection (du moins de toute celle dont il est susceptible), c’est le constant effort de ses membres pour vivre et se développer aux dépens les uns des autres.
En sorte que si la Spoliation n’existait pas, la société étant parfaite, les sciences sociales seraient sans objet.
Je vais plus loin encore. Lorsque la Spoliation est devenue le moyen d’existence d’une agglomération d’hommes unis entre eux par le lien social, ils se font bientôt une loi qui la sanctionne, une morale qui la glorifie.
Il suffit de nommer quelques-unes des formes les plus tranchées de la Spoliation pour montrer quelle place elle occupe dans les transactions humaines.
C’est d’abord la Guerre. — Chez les sauvages, le vainqueur tue le vaincu pour acquérir au gibier un droit, sinon incontestable, du moins incontesté.
C’est ensuite l’Esclavage. — Quand l’homme comprend qu’il est possible de féconder la terre par le travail, il fait avec son frère ce partage : « À toi la fatigue, à moi le produit. »
Vient la Théocratie. — « Selon ce que tu me donneras ou me refuseras de ce qui t’appartient, je t’ouvrirai la porte du ciel ou de l’enfer. »
Enfin arrive le Monopole. — Son caractère distinctif est de laisser subsister la grande loi sociale : Service pour service, mais de faire intervenir la force dans le débat, et par suite, d’altérer la juste proportion entre le service reçu et le service rendu.
La Spoliation porte toujours dans son sein le germe de mort qui la tue. Rarement c’est le grand nombre qui spolie le petit nombre. En ce cas, celui-ci se réduirait promptement au point de ne pouvoir plus satisfaire la cupidité de celui-là, et la Spoliation périrait faute d’aliment.
Presque toujours c’est le grand nombre qui est opprimé, et la Spoliation n’en est pas moins frappée d’un arrêt fatal.
Car si elle a pour agent la Force, comme dans la Guerre et l’Esclavage, il est naturel que la Force à la longue passe du côté du grand nombre.
Et si c’est la Ruse, comme dans la Théocratie et le Monopole, il est naturel que le grand nombre s’éclaire, sans quoi l’intelligence ne serait pas l’intelligence.
Une autre loi providentielle dépose un second germe de mort au cœur de la Spoliation, c’est celle-ci :
La Spoliation ne déplace pas seulement la richesse, elle en détruit toujours une partie.
La Guerre anéantit bien des valeurs.
L’Esclavage paralyse bien des facultés.
La Théocratie détourne bien des efforts vers des objets puérils ou funestes.
Le Monopole aussi fait passer la richesse d’une poche à l’autre ; mais il s’en perd beaucoup dans le trajet.
Cette loi est admirable. — Sans elle, pourvu qu’il y eût équilibre de force entre les oppresseurs et les opprimés, la Spoliation n’aurait pas de terme. — Grâce à elle, cet équilibre tend toujours à se rompre, soit parce que les Spoliateurs se font conscience d’une telle déperdition de richesses, soit, en l’absence de ce sentiment, parce que le mal empire sans cesse, et qu’il est dans la nature de ce qui empire toujours de finir.
Il arrive en effet un moment où, dans son accélération progressive, la déperdition des richesses est telle que le Spoliateur est moins riche qu’il n’eût été en restant honnête.
Tel est un peuple à qui les frais de guerre coûtent plus que ne vaut le butin.
Un maître qui paie plus cher le travail esclave que le travail libre.
Une Théocratie qui a tellement hébété le peuple et détruit son énergie qu’elle n’en peut plus rien tirer.
Un Monopole qui agrandit ses efforts d’absorption à mesure qu’il y a moins à absorber, comme l’effort de traire s’accroît à mesure que le pis est plus desséché.
Le Monopole, on le voit, est une Espèce du Genre Spoliation. Il a plusieurs Variétés, entre autres la Sinécure, le Privilége, la Restriction.
Parmi les formes qu’il revêt, il y en a de simples et naïves. Tels étaient les droits féodaux. Sous ce régime la masse est spoliée et le sait. Il implique l’abus de la force et tombe avec elle.
D’autres sont très-compliquées. Souvent alors la masse est spoliée et ne le sait pas. Il peut même arriver qu’elle croie tout devoir à la Spoliation, et ce qu’on lui laisse, et ce qu’on lui prend, et ce qui se perd dans l’opération. Il y a plus, j’affirme que, dans la suite des temps, et grâce au mécanisme si ingénieux de la coutume, beaucoup de Spoliateurs le sont sans le savoir et sans le vouloir. Les Monopoles de cette variété sont engendrés par la Ruse et nourris par l’Erreur. Ils ne s’évanouissent que devant la Lumière.
J’en ai dit assez pour montrer que l’Économie politique a une utilité pratique évidente. C’est le flambeau qui, dévoilant la Ruse et dissipant l’Erreur, détruit ce désordre social, la Spoliation. Quelqu’un, je crois que c’est une femme, et elle avait bien raison, l’a ainsi définie : C’est la serrure de sûreté du pécule populaire.
Commentaire.
Si ce petit livre était destiné à traverser trois ou quatre mille ans, à être lu, relu, médité, étudié phrase à phrase, mot à mot, lettre à lettre, de génération en génération, comme un Koran nouveau ; s’il devait attirer dans toutes les bibliothèques du monde des avalanches d’annotations, éclaircissements et paraphrases, je pourrais abandonner à leur sort, dans leur concision un peu obscure, les pensées qui précèdent. Mais puisqu’elles ont besoin de commentaire, il me paraît prudent de les commenter moi-même.
La véritable et équitable loi des hommes, c’est : Échange librement débattu de service contre service. La Spoliation consiste à bannir par force ou par ruse la liberté du débat afin de recevoir un service sans le rendre.
La Spoliation par la force s’exerce ainsi : On attend qu’un homme ait produit quelque chose, qu’on lui arrache, l’arme au poing.
Elle est formellement condamnée par le Décalogue : Tu ne prendras point.
Quand elle se passe d’individu à individu, elle se nomme vol et mène au bagne ; quand c’est de nation à nation, elle prend nom conquête et conduit à la gloire.
Pourquoi cette différence ? Il est bon d’en rechercher la cause. Elle nous révélera une puissance irrésistible, l’Opinion, qui, comme l’atmosphère, nous enveloppe d’une manière si absolue, que nous ne la remarquons plus. Car Rousseau n’a jamais dit une vérité plus vraie que celle-ci : « Il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont trop près de nous. »
Le voleur, par cela même qu’il agit isolément, a contre lui l’opinion publique. Il alarme tous ceux qui l’entourent. Cependant, s’il a quelques associés, il s’enorgueillit devant eux de ses prouesses, et l’on peut commencer à remarquer ici la force de l’Opinion ; car il suffit de l’approbation de ses complices pour lui ôter le sentiment de sa turpitude et même le rendre vain de son ignominie.
Le guerrier vit dans un autre milieu. L’Opinion qui le flétrit est ailleurs, chez les nations vaincues ; il n’en sent pas la pression. Mais l’Opinion qui est autour de lui l’approuve et le soutient. Ses compagnons et lui sentent vivement la solidarité qui les lie. La patrie, qui s’est créé des ennemis et des dangers, a besoin d’exalter le courage de ses enfants. Elle décerne aux plus hardis, à ceux qui, élargissant ses frontières, y ont apporté le plus de butin, les honneurs, la renommée, la gloire. Les poëtes chantent leurs exploits et les femmes leur tressent des couronnes. Et telle est la puissance de l’Opinion, qu’elle sépare de la Spoliation l’idée d’injustice et ôte au spoliateur jusqu’à la conscience de ses torts.
L’Opinion, qui réagit contre la spoliation militaire, placée non chez le peuple spoliateur, mais chez le peuple spolié, n’exerce que bien peu d’influence. Cependant, elle n’est pas tout à fait inefficace, et d’autant moins que les nations se fréquentent et se comprennent davantage. Sous ce rapport, on voit que l’étude des langues et la libre communication des peuples tendent à faire prédominer l’opinion contraire à ce genre de spoliation.
Malheureusement, il arrive souvent que les nations qui entourent le peuple spoliateur sont elles-mêmes spoliatrices, quand elles le peuvent, et dès lors imbues des mêmes préjugés.
Alors, il n’y a qu’un remède : le temps. Il faut que les peuples aient appris, par une rude expérience, l’énorme désavantage de se spolier les uns les autres.
On parlera d’un autre frein : la moralisation. Mais la moralisation a pour but de multiplier les actions vertueuses. Comment donc restreindrait-elle les actes spoliateurs quand ces actes sont mis par l’Opinion au rang des plus hautes vertus ? Y a-t-il un moyen plus puissant de moraliser un peuple que la Religion ? Y eut-il jamais Religion plus favorable à la paix et plus universellement admise que le Christianisme ? Et cependant qu’a-t-on vu pendant dix-huit siècles ? On a vu les hommes se battre non-seulement malgré la Religion, mais au nom de la Religion même.
Un peuple conquérant ne fait pas toujours la guerre offensive. Il a aussi de mauvais jours. Alors ses soldats défendent le foyer domestique, la propriété, la famille, l’indépendance, la liberté. La guerre prend un caractère de sainteté et de grandeur. Le drapeau, bénit par les ministres du Dieu de paix, représente tout ce qu’il y a de sacré sur la terre ; on s’y attache comme à la vivante image de la patrie et de l’honneur ; et les vertus guerrières sont exaltées au-dessus de toutes les autres vertus. — Mais le danger passé, l’Opinion subsiste, et, par une naturelle réaction de l’esprit de vengeance qui se confond avec le patriotisme, on aime à promener le drapeau chéri de capitale en capitale. Il semble que la nature ait préparé ainsi le châtiment de l’agresseur.
C’est la crainte de ce châtiment, et non les progrès de la philosophie, qui retient les armes dans les arsenaux, car, on ne peut pas le nier, les peuples les plus avancés en civilisation font la guerre, et se préoccupent bien peu de justice quand ils n’ont pas de représailles à redouter. Témoin l’Hymalaya, l’Atlas et le Caucase.
Si la Religion a été impuissante, si la philosophie est impuissante, comment donc finira la guerre ?
L’Économie politique démontre que, même à ne considérer que le peuple victorieux, la guerre se fait toujours dans l’intérêt du petit nombre et aux dépens des masses. Il suffit donc que les masses aperçoivent clairement cette vérité. Le poids de l’Opinion, qui se partage encore, pèsera tout entier du côté de la paix [162].
La Spoliation exercée par la force prend encore une autre forme. On n’attend pas qu’un homme ait produit une chose pour la lui arracher. On s’empare de l’homme lui-même ; on le dépouille de sa propre personnalité ; on le contraint au travail ; on ne lui dit pas : Si tu prends cette peine pour moi, je prendrai cette peine pour toi, on lui dit : À toi toutes les fatigues, à moi toutes les jouissances. C’est l’Esclavage, qui implique toujours l’abus de la force.
Or, c’est une grande question de savoir s’il n’est pas dans la nature d’une force incontestablement dominante d’abuser toujours d’elle-même. Quant à moi, je ne m’y fie pas, et j’aimerais autant attendre d’une pierre qui tombe la puissance qui doit l’arrêter dans sa chute, que de confier à la force sa propre limite.
Je voudrais, au moins, qu’on me montrât un pays, une époque où l’Esclavage a été aboli par la libre et gracieuse volonté des maîtres.
L’Esclavage fournit un second et frappant exemple de l’insuffisance des sentiments religieux et philanthropiques aux prises avec l’énergique sentiment de l’intérêt. Cela peut paraître triste à quelques Écoles modernes qui cherchent dans l’abnégation le principe réformateur de la société. Qu’elles commencent donc par réformer la nature de l’homme.
Aux Antilles, les maîtres professent de père en fils, depuis l’institution de l’esclavage, la Religion chrétienne. Plusieurs fois par jour ils répètent ces paroles : « Tous les hommes sont frères ; aimer son prochain, c’est accomplir toute la loi. » — Et pourtant ils ont des esclaves. Rien ne leur semble plus naturel et plus légitime. Les réformateurs modernes espèrent-ils que leur morale sera jamais aussi universellement acceptée, aussi populaire, aussi forte d’autorité, aussi souvent sur toutes les lèvres que l’Évangile ? Et si l’Évangile n’a pu passer des lèvres au cœur par-dessus ou à travers la grande barrière de l’intérêt, comment espèrent-ils que leur morale fasse ce miracle ?
Mais quoi ! l’Esclavage est-il donc invulnérable ? Non ; ce qui l’a fondé le détruira, je veux dire l’Intérêt, pourvu que, pour favoriser les intérêts spéciaux qui ont créé la plaie, on ne contrarie pas les intérêts généraux qui doivent la guérir.
C’est encore une vérité démontrée par l’Économie politique, que le travail libre est essentiellement progressif et le travail esclave nécessairement stationnaire. En sorte que le triomphe du premier sur le second est inévitable. Qu’est devenue la culture de l’indigo par les noirs ?
Le travail libre appliqué à la production du sucre en fera baisser de plus en plus le prix. À mesure, l’esclave sera de moins en moins lucratif pour son maître. L’esclavage serait depuis longtemps tombé de lui-même en Amérique, si, en Europe, les lois n’eussent élevé artificiellement le prix du sucre. Aussi nous voyons les maîtres, leurs créanciers et leurs délégués travailler activement à maintenir ces lois, qui sont aujourd’hui les colonnes de l’édifice.
Malheureusement, elles ont encore la sympathie des populations du sein desquelles l’esclavage a disparu ; par où l’on voit qu’encore ici l’Opinion est souveraine.
Si elle est souveraine, même dans la région de la Force, elle l’est à bien plus forte raison dans le monde de la Ruse. À vrai dire, c’est là son domaine. La Ruse, c’est l’abus de l’intelligence ; le progrès de l’opinion, c’est le progrès des intelligences. Les deux puissances sont au moins de même nature. Imposture chez le spoliateur implique crédulité chez le spolié, et l’antidote naturel de la crédulité c’est la vérité. Il s’ensuit qu’éclairer les esprits, c’est ôter à ce genre de spoliation son aliment.
Je passerai brièvement en revue quelques-unes des spoliations qui s’exercent par la Ruse sur une très-grande échelle.
La première qui se présente c’est la Spoliation par ruse théocratique.
De quoi s’agit-il ? De se faire rendre en aliments, vêtements, luxe, considération, influence, pouvoir, des services réels contre des services fictifs.
Si je disais à un homme : — « Je vais te rendre des services immédiats, » — il faudrait bien tenir parole ; faute de quoi cet homme saurait bientôt à quoi s’en tenir, et ma ruse serait promptement démasquée.
Mais si je lui dis : — « En échange de tes services, je te rendrai d’immenses services, non dans ce monde, mais dans l’autre. Après cette vie, tu peux être éternellement heureux ou malheureux, et cela dépend de moi ; je suis un être intermédiaire entre Dieu et sa créature, et puis, à mon gré, t’ouvrir les portes du ciel ou de l’enfer. » — Pour peu que cet homme me croie, il est à ma discrétion.
Ce genre d’imposture a été pratiqué très en grand depuis l’origine du monde, et l’on sait à quel degré de toute-puissance étaient arrivés les prêtres égyptiens.
Il est aisé de savoir comment procèdent les imposteurs. Il suffit de se demander ce qu’on ferait à leur place.
Si j’arrivais, avec des vues de cette nature, au milieu d’une peuplade ignorante, et que je parvinsse, par quelque acte extraordinaire et d’une apparence merveilleuse, à me faire passer pour un être surnaturel, je me donnerais pour un envoyé de Dieu, ayant sur les futures destinées des hommes un empire absolu.
Ensuite, j’interdirais l’examen de mes titres ; je ferais plus : comme la raison serait mon ennemi le plus dangereux, j’interdirais l’usage de la raison même, au moins appliquée à ce sujet redoutable. Je ferais de cette question, et de toutes celles qui s’y rapportent, des questions tabou, comme disent les sauvages. Les résoudre, les agiter, y penser même, serait un crime irrémissible.
Certes, ce serait le comble de l’art de mettre une barrière tabou à toutes les avenues intellectuelles qui pourraient conduire à la découverte de ma supercherie. Quelle meilleure garantie de sa durée que de rendre le doute même sacrilége ?
Cependant, à cette garantie fondamentale, j’en ajouterais d’accessoires. Par exemple, pour que la lumière ne pût jamais descendre dans les masses, je m’attribuerais, ainsi qu’à mes complices, le monopole de toutes les connaissances, je les cacherais sous les voiles d’une langue morte et d’une écriture hiéroglyphique, et, pour n’être jamais surpris par aucun danger, j’aurais soin d’inventer une institution qui me ferait pénétrer, jour par jour, dans le secret de toutes les consciences.
Il ne serait pas mal non plus que je satisfisse à quelques besoins réels de mon peuple, surtout si, en le faisant, je pouvais accroître mon influence et mon autorité. Ainsi les hommes ont un grand besoin d’instruction et de morale : je m’en ferais le dispensateur. Par là je dirigerais à mon gré l’esprit et le cœur de mon peuple. J’entrelacerais dans une chaîne indissoluble la morale et mon autorité ; je les représenterais comme ne pouvant exister l’une sans l’autre, en sorte que si quelque audacieux tentait enfin de remuer une question tabou, la société tout entière, qui ne peut se passer de morale, sentirait le terrain trembler sous ses pas, et se tournerait avec rage contre ce novateur téméraire.
Quand les choses en seraient là, il est clair que ce peuple m’appartiendrait plus que s’il était mon esclave. L’esclave maudit sa chaîne, mon peuple bénirait la sienne, et je serais parvenu à imprimer, non sur les fronts, mais au fond des consciences, le sceau de la servitude.
L’Opinion seule peut renverser un tel édifice d’iniquité ; mais par où l’entamera-t-elle, si chaque pierre est tabou ? — C’est l’affaire du temps et de l’imprimerie.
À Dieu ne plaise que je veuille ébranler ici ces croyances consolantes qui relient cette vie d’épreuves à une vie de félicités ! Mais qu’on ait abusé de l’irrésistible pente qui nous entraîne vers elles, c’est ce que personne, pas même le chef de la chrétienté, ne pourrait contester. Il y a, ce me semble, un signe pour reconnaître si un peuple est dupe ou ne l’est pas. Examinez la Religion et le prêtre ; examinez si le prêtre est l’instrument de la Religion, ou si la Religion est l’instrument du prêtre.
Si le prêtre est l’instrument de la Religion, s’il ne songe qu’à étendre sur la terre sa morale et ses bienfaits, il sera doux, tolérant, humble, charitable, plein de zèle ; sa vie reflétera celle de son divin modèle ; il prêchera la liberté et l’égalité parmi les hommes, la paix et la fraternité entre les nations ; il repoussera les séductions de la puissance temporelle, ne voulant pas faire alliance avec ce qui a le plus besoin de frein en ce monde ; il sera l’homme du peuple, l’homme des bons conseils et des douces consolations, l’homme de l’Opinion, l’homme de l’Évangile.
Si, au contraire, la Religion est l’instrument du prêtre, il la traitera comme on traite un instrument qu’on altère, qu’on plie, qu’on retourne en toutes façons, de manière à en tirer le plus grand avantage pour soi. Il multipliera les questions tabou ; sa morale sera flexible comme les temps, les hommes et les circonstances. Il cherchera à en imposer par des gestes et des attitudes étudiés ; il marmottera cent fois par jour des mots dont le sens sera évaporé, et qui ne seront plus qu’un vain conventionalisme. Il trafiquera des choses saintes, mais tout juste assez pour ne pas ébranler la foi en leur sainteté, et il aura soin que le trafic soit d’autant moins ostensiblement actif que le peuple est plus clairvoyant. Il se mêlera des intrigues de la terre ; il se mettra toujours du côté des puissants à la seule condition que les puissants se mettront de son côté. En un mot, dans tous ses actes, on reconnaîtra qu’il ne veut pas faire avancer la Religion par le clergé, mais le clergé par la Religion ; et comme tant d’efforts supposent un but, comme ce but, dans cette hypothèse, ne peut être autre que la puissance et la richesse, le signe définitif que le peuple est dupe, c’est quand le prêtre est riche et puissant.
Il est bien évident qu’on peut abuser d’une Religion vraie comme d’une Religion fausse. Plus même son autorité est respectable, plus il est à craindre qu’on ne pousse loin l’épreuve. Mais il y a bien de la différence dans les résultats. L’abus insurge toujours une partie saine, éclairée, indépendante d’un peuple. Il ne se peut pas que la foi n’en soit ébranlée, et l’affaiblissement d’une religion vraie est bien autrement funeste que l’ébranlement d’une Religion fausse.
La Spoliation par ce procédé et la clairvoyance d’un peuple sont toujours en proportion inverse l’une de l’autre, car il est de la nature des abus d’aller tant qu’ils trouvent du chemin. Non qu’au milieu de la population la plus ignorante, il ne se rencontre des prêtres purs et dévoués, mais comment empêcher la fourbe de revêtir la soutane et l’ambition de ceindre la mitre ? Les spoliateurs obéissent à la loi malthusienne : ils multiplient comme les moyens d’existence ; et les moyens d’existence des fourbes, c’est la crédulité de leurs dupes. On a beau chercher, on trouve toujours qu’il faut que l’Opinion s’éclaire. Il n’y a pas d’autre Panacée.
Une autre variété de Spoliation par la ruse s’appelle fraude commerciale, nom qui me semble beaucoup trop restreint, car ne s’en rend pas coupable seulement le marchand qui altère la denrée ou raccourcit son mètre, mais aussi le médecin qui se fait payer des conseils funestes, l’avocat qui embrouille les procès, etc. Dans l’échange entre deux services, l’un est de mauvais aloi ; mais ici, le service reçu étant toujours préalablement et volontairement agréé, il est clair que la Spoliation de cette espèce doit reculer à mesure que la clairvoyance publique avance.
Vient ensuite l’abus des services publics, champ immense de Spoliation, tellement immense que nous ne pouvons y jeter qu’un coup d’œil.
Si Dieu avait fait de l’homme un animal solitaire, chacun travaillerait pour soi. La richesse individuelle serait en proportion des services que chacun se rendrait à soi-même.
Mais l’homme étant sociable, les services s’échangent les uns contre les autres, proposition que vous pouvez, si cela vous convient, construire à rebours.
Il y a dans la société des besoins tellement généraux, tellement universels, que ses membres y pourvoient en organisant des services publics. Tel est le besoin de la sécurité. On se concerte, on se cotise pour rémunérer en services divers ceux qui rendent le service de veiller à la sécurité commune.
Il n’y a rien là qui soit en dehors de l’Économie politique : Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. L’essence de la transaction est la même, le procédé rémunératoire seul est différent ; mais cette circonstance a une grande portée.
Dans les transactions ordinaires chacun reste juge soit du service qu’il reçoit, soit du service qu’il rend. Il peut toujours ou refuser l’échange ou le faire ailleurs, d’où la nécessité de n’apporter sur le marché que des services qui se feront volontairement agréer.
Il n’en est pas ainsi avec l’État, surtout avant l’avénement des gouvernements représentatifs. Que nous ayons ou non besoin de ses services, qu’ils soient de bon ou de mauvais aloi, il nous faut toujours les accepter tels qu’il les fournit et les payer au prix qu’il y met.
Or, c’est la tendance de tous les hommes de voir par le petit bout de la lunette les services qu’ils rendent, et par le gros bout les services qu’ils reçoivent ; et les choses iraient bon train si nous n’avions pas, dans les transactions privées, la garantie du prix débattu.
Cette garantie, nous ne l’avons pas ou nous ne l’avons guère dans les transactions publiques. — Et cependant, l’État, composé d’hommes (quoique de nos jours on insinue le contraire), obéit à l’universelle tendance. [163] Il veut nous servir beaucoup, nous servir plus que nous ne voulons, et nous faire agréer comme service vrai ce qui est quelquefois loin de l’être, et cela, pour nous imposer en retour des services ou contributions.
L’État aussi est soumis à la loi malthusienne. Il tend à dépasser le niveau de ses moyens d’existence, il grossit en proportion de ces moyens, et ce qui le fait exister c’est la substance des peuples. Malheur donc aux peuples qui ne savent pas limiter la sphère d’action de l’État. Liberté, activité privée, richesse, bien-être, indépendance, dignité, tout y passera.
Car il y a une circonstance qu’il faut remarquer, c’est celle-ci : Parmi les services que nous demandons à l’État, le principal est la sécurité. Pour nous la garantir, il faut qu’il dispose d’une force capable de vaincre toutes les forces, particulières ou collectives, intérieures ou extérieures, qui pourraient la compromettre. Combinée avec cette fâcheuse disposition que nous remarquons dans les hommes à vivre aux dépens des autres, il y a là un danger qui saute aux yeux.
Aussi, voyez sur quelle immense échelle, depuis les temps historiques, s’est exercée la Spoliation par abus et excès du gouvernement ? Qu’on se demande quels services ont rendus aux populations et quels services en ont retirés les pouvoirs publics chez les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains, les Persans, les Turcs, les Chinois, les Russes, les Anglais, les Espagnols, les Français ? L’imagination s’effraie devant cette énorme disproportion.
Enfin, on a inventé le gouvernement représentatif et, à priori, on aurait pu croire que le désordre allait cesser comme par enchantement.
En effet, le principe de ces gouvernements est celui-ci :
« La population elle-même, par ses représentants, décidera la nature et l’étendue des fonctions qu’elle juge à propos de constituer en services publics, et la quotité de la rémunération qu’elle entend attacher à ces services. »
La tendance à s’emparer du bien d’autrui et la tendance à défendre son bien étaient ainsi mises en présence. On devait penser que la seconde surmonterait la première.
Certes, je suis convaincu que la chose réussira à la longue. Mais il faut bien avouer que jusqu’ici elle n’a pas réussi.
Pourquoi ? par deux motifs bien simples : les gouvernements ont eu trop, et les populations pas assez de sagacité.
Les gouvernements sont fort habiles. Ils agissent avec méthode, avec suite, sur un plan bien combiné et constamment perfectionné par la tradition et l’expérience. Ils étudient les hommes et leurs passions. S’ils reconnaissent, par exemple, qu’ils ont l’instinct de la guerre, ils attisent, ils excitent ce funeste penchant. Ils environnent la nation de dangers par l’action de la diplomatie, et tout naturellement ensuite, ils lui demandent des soldats, des marins, des arsenaux, des fortifications : [164] souvent même ils n’ont que la peine de les laisser offrir ; alors ils ont des grades, des pensions et des places à distribuer. Pour cela, il faut beaucoup d’argent ; les impôts et les emprunts sont là.
Si la nation est généreuse, ils s’offrent à guérir tous les maux de l’humanité. Ils relèveront, disent-ils, le commerce, feront prospérer l’agriculture, développeront les fabriques, encourageront les lettres et les arts, extirperont la misère, etc., etc. Il ne s’agit que de créer des fonctions et payer des fonctionnaires.
En un mot, la tactique consiste à présenter comme services effectifs ce qui n’est qu’entraves ; alors la nation paie non pour être servie, mais desservie. Les gouvernements, prenant des proportions gigantesques, finissent par absorber la moitié de tous les revenus. Et le peuple s’étonne de travailler autant, d’entendre annoncer des inventions merveilleuses qui doivent multiplier à l’infini les produits et… d’être toujours Gros-Jean comme devant.
C’est que, pendant que le gouvernement déploie tant d’habileté, le peuple n’en montre guère. Ainsi, appelé à choisir ses chargés de pouvoirs, ceux qui doivent déterminer la sphère et la rémunération de l’action gouvernementale, qui choisit-il ? Les agents du gouvernement. Il charge le pouvoir exécutif de fixer lui-même la limite de son activité et de ses exigences. Il fait comme le Bourgeois gentilhomme, qui, pour le choix et le nombre de ses habits, s’en remet… à son tailleur [165].
Cependant les choses vont de mal en pis, et le peuple ouvre enfin les yeux, non sur le remède (il n’en est pas là encore), mais sur le mal.
Gouverner est un métier si doux que tout le monde y aspire. Aussi les conseillers du peuple ne cessent de lui dire : Nous voyons tes souffrances et nous les déplorons. Il en serait autrement si nous te gouvernions.
Cette période, qui est ordinairement fort longue, est celle des rébellions et des émeutes. Quand le peuple est vaincu, les frais de la guerre s’ajoutent à ses charges. Quand il est vainqueur, le personnel gouvernemental change et les abus restent.
Et cela dure jusqu’à ce qu’enfin le peuple apprenne à connaître et à défendre ses vrais intérêts. Nous arrivons donc toujours à ceci : Il n’y a de ressource que dans le progrès de la Raison publique.
Certaines nations paraissent merveilleusement disposées à devenir la proie de la Spoliation gouvernementale. Ce sont celles où les hommes, ne tenant aucun compte de leur propre dignité et de leur propre énergie, se croiraient perdus s’ils n’étaient administrés et gouvernés en toutes choses. Sans avoir beaucoup voyagé, j’ai vu des pays où l’on pense que l’agriculture ne peut faire aucun progrès si l’État n’entretient des fermes expérimentales ; qu’il n’y aura bientôt plus de chevaux, si l’État n’a pas de haras ; que les pères ne feront pas élever leurs enfants ou ne leur feront enseigner que des choses immorales, si l’État ne décide pas ce qu’il est bon d’apprendre, etc., etc. Dans un tel pays, les révolutions peuvent se succéder rapidement, les gouvernants tomber les uns sur les autres. Mais les gouvernés n’en seront pas moins gouvernés à merci et miséricorde (car la disposition que je signale ici est l’étoffe même dont les gouvernements sont faits), jusqu’à ce qu’enfin le peuple s’aperçoive qu’il vaut mieux laisser le plus grand nombre possible de services dans la catégorie de ceux que les parties intéressées échangent à prix débattu [166].
Nous avons vu que la société est échange des services. Elle ne devrait être qu’échange de bons et loyaux services. Mais nous avons constaté aussi que les hommes avaient un grand intérêt et, par suite, une pente irrésistible à exagérer la valeur relative des services qu’ils rendent. Et véritablement, je ne puis apercevoir d’autre limite à cette prétention que la libre acceptation ou le libre refus de ceux à qui ces services sont offerts.
De là il arrive que certains hommes ont recours à la loi pour qu’elle diminue chez les autres les naturelles prérogatives de cette liberté. Ce genre de spoliation s’appelle Privilége ou Monopole. Marquons-en bien l’origine et le caractère.
Chacun sait que les services qu’il apporte dans le marché général y seront d’autant plus appréciés et rémunérés qu’ils y seront plus rares. Chacun implorera donc l’intervention de la loi pour éloigner du marché tous ceux qui viennent y offrir des services analogues, — ou, ce qui revient au même, si le concours d’un instrument est indispensable pour que le service soit rendu, il en demandera à la loi la possession exclusive [167].
Cette variété de Spoliation étant l’objet principal de ce volume, j’en dirai peu de chose ici, et me bornerai à une remarque.
Quand le monopole est un fait isolé, il ne manque pas d’enrichir celui que la loi en a investi. Il peut arriver alors que chaque classe de travailleurs, au lieu de poursuivre la chute de ce monopole, réclame pour elle-même un monopole semblable. Cette nature de Spoliation, ainsi réduite en système, devient alors la plus ridicule des mystifications pour tout le monde, et le résultat définitif est que chacun croit retirer plus d’un marché général appauvri de tout.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter que ce singulier régime introduit en outre un antagonisme universel entre toutes les classes, toutes les professions, tous les peuples ; qu’il exige une interférence constante, mais toujours incertaine de l’action gouvernementale ; qu’il abonde ainsi dans le sens des abus qui font l’objet du précédent paragraphe ; qu’il place toutes les industries dans une insécurité irrémédiable, et qu’il accoutume les hommes à mettre sur la loi, et non sur eux-mêmes, la responsabilité de leur propre existence. Il serait difficile d’imaginer une cause plus active de perturbation sociale [168].
Justification.
On dira : « Pourquoi ce vilain mot : Spoliation ? Outre qu’il est grossier, il blesse, il irrite, il tourne contre vous les hommes calmes et modérés, il envenime la lutte. »
Je le déclare hautement, je respecte les personnes ; je crois à la sincérité de presque tous les partisans de la Protection ; et je ne me reconnais le droit de suspecter la probité personnelle, la délicatesse, la philanthropie de qui que ce soit. Je répète encore que la Protection est l’œuvre, l’œuvre funeste, d’une commune erreur dont tout le monde, ou du moins la grande majorité, est à la fois victime et complice. — Après cela je ne puis pas empêcher que les choses ne soient ce qu’elles sont.
Qu’on se figure une espèce de Diogène mettant la tête hors de son tonneau, et disant : « Athéniens, vous vous faites servir par des esclaves. N’avez-vous jamais pensé que vous exerciez sur vos frères la plus inique des spoliations ? »
Ou encore, un tribun parlant ainsi dans le Forum : « Romains, vous avez fondé tous vos moyens d’existence sur le pillage successif de tous les peuples. »
Certes, ils ne feraient qu’exprimer une vérité incontestable. Faudrait-il en conclure qu’Athènes et Rome n’étaient habitées que par de malhonnêtes gens ? que Socrate et Platon, Caton et Cincinnatus étaient des personnages méprisables ?
Qui pourrait avoir une telle pensée ? Mais ces grands hommes vivaient dans un milieu qui leur ôtait la conscience de leur injustice. On sait qu’Aristote ne pouvait pas même se faire l’idée qu’une société pût exister sans esclavage.
Dans les temps modernes, l’esclavage a vécu jusqu’à nos jours sans exciter beaucoup de scrupules dans l’âme des planteurs. Des armées ont servi d’instrument à de grandes conquêtes, c’est-à-dire à de grandes spoliations. Est-ce à dire qu’elles ne fourmillent pas de soldats et d’officiers, personnellement aussi délicats, plus délicats peut-être qu’on ne l’est généralement dans les carrières industrielles ; d’hommes à qui la pensée seule d’un vol ferait monter le rouge au front, et qui affronteraient mille morts plutôt que de descendre à une bassesse ?
Ce qui est blâmable ce ne sont pas les individus, mais le mouvement général qui les entraîne et les aveugle, mouvement dont la société entière est coupable.
Il en est ainsi du Monopole. J’accuse le système, et non point les individus ; la société en masse, et non tel ou tel de ses membres. Si les plus grands philosophes ont pu se faire illusion sur l’iniquité de l’esclavage, à combien plus forte raison des agriculteurs et des fabricants peuvent-ils se tromper sur la nature et les effets du régime restrictif ?
II. Deux morales↩
Arrivé, s’il y arrive, au bout du chapitre précédent, je crois entendre le lecteur s’écrier :
« Eh bien ! est-ce à tort qu’on reproche aux économistes d’être secs et froids ? Quelle peinture de l’humanité ! Quoi ! la Spoliation serait une puissance fatale, presque normale, prenant toutes les formes, s’exerçant sous tous les prétextes, hors la loi et par la loi, abusant des choses les plus saintes, exploitant tour à tour la faiblesse et la crédulité, et progressant en proportion de ce que ce double aliment abonde autour d’elle ! Peut-on faire du monde un plus triste tableau ? »
La question n’est pas de savoir s’il est triste, mais s’il est vrai. L’histoire est là pour le dire.
Il est assez singulier que ceux qui décrient l’économie politique (ou l’économisme, comme il leur plaît de nommer cette science), parce qu’elle étudie l’homme et le monde tels qu’ils sont, poussent bien plus loin qu’elle le pessimisme, au moins quant au passé et au présent. Ouvrez leurs livres et leurs journaux. Qu’y voyez-vous ? L’aigreur, la haine contre la société ; jusque-là que le mot même civilisation est pour eux synonyme d’injustice, désordre et anarchie. Ils en sont venus à maudire la liberté, tant ils ont peu de confiance dans le développement de la race humaine, résultat de sa naturelle organisation. La liberté ! c’est elle, selon eux, qui nous pousse de plus en plus vers l’abîme.
Il est vrai qu’ils sont optimistes pour l’avenir. Car si l’humanité, incapable par elle-même, fait fausse route depuis six mille ans, un révélateur est venu, qui lui a signalé la voie du salut, et pour peu que le troupeau soit docile à la houlette du pasteur, il sera conduit dans cette terre promise où le bien-être se réalise sans efforts, où l’ordre, la sécurité et l’harmonie sont le facile prix de l’imprévoyance.
Il ne s’agit pour l’humanité que de consentir à ce que les réformateurs changent, comme dit Rousseau, sa constitution physique et morale.
L’économie politique ne s’est pas donné la mission de rechercher ce que serait la société si Dieu avait fait l’homme autrement qu’il ne lui a plu de le faire. Il peut être fâcheux que la Providence ait oublié d’appeler, au commencement, dans ses conseils, quelques-uns de nos organisateurs modernes. Et comme la mécanique céleste serait toute différente, si le Créateur eût consulté Alphonse le Sage ; de même, s’il n’eût pas négligé les avis de Fourier, l’ordre social ne ressemblerait en rien à celui où nous sommes forcés de respirer, vivre et nous mouvoir. Mais, puisque nous y sommes, puisque in eo vivimus, movemur et sumus, il ne nous reste qu’à l’étudier et en connaître les lois, surtout si son amélioration dépend essentiellement de cette connaissance.
Nous ne pouvons pas empêcher que le cœur de l’homme ne soit un foyer de désirs insatiables.
Nous ne pouvons pas faire que ces désirs, pour être satisfaits, n’exigent du travail.
Nous ne pouvons pas éviter que l’homme n’ait autant de répugnance pour le travail que d’attrait pour la satisfaction.
Nous ne pouvons pas empêcher que, de cette organisation, ne résulte un effort perpétuel parmi les hommes pour accroître leur part de jouissances, en se rejetant, par la force ou la ruse, des uns aux autres, le fardeau de la peine.
Il ne dépend pas de nous d’effacer l’histoire universelle, d’étouffer la voix du passé attestant que les choses se sont ainsi passées dès l’origine. Nous ne pouvons pas nier que la guerre, l’esclavage, le servage, la théocratie, l’abus du gouvernement, les priviléges, les fraudes de toute nature et les monopoles n’aient été les incontestables et terribles manifestations de ces deux sentiments combinés dans le cœur de l’homme : attrait pour les jouissances ; répugnance pour la fatigue.
« Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » — Mais chacun veut le plus de pain et le moins de sueur possible. C’est la conclusion de l’histoire.
Grâce au ciel, l’histoire montre aussi que la répartition des jouissances et des peines tend à se faire d’une manière de plus en plus égale parmi les hommes.
À moins de nier la clarté du soleil, il faut bien admettre que la société a fait, sous ce rapport, quelques progrès.
S’il en est ainsi, il y a donc en elle une force naturelle et providentielle, une loi qui fait reculer de plus en plus le principe de l’iniquité et réalise de plus en plus le principe de la justice.
Nous disons que cette force est dans la société et que Dieu l’y a placée. Si elle n’y était pas, nous serions réduits, comme les utopistes, à la chercher dans des moyens artificiels, dans des arrangements qui exigent l’altération préalable de la constitution physique et morale de l’homme, ou plutôt nous croirions cette recherche inutile et vaine, parce que nous ne pouvons comprendre l’action d’un levier sans point d’appui.
Essayons donc de signaler la force bienfaisante qui tend à surmonter progressivement la force malfaisante, à laquelle nous avons donné le nom de Spoliation, et dont la présence n’est que trop expliquée par le raisonnement et constatée par l’expérience.
Tout acte malfaisant a nécessairement deux termes : le point d’où il émane et le point où il aboutit ; l’homme qui exerce l’acte, et l’homme sur qui l’acte est exercé ; ou, comme dit l’école, l’agent et le patient.
Il y a donc deux chances pour que l’acte malfaisant soit supprimé : l’abstention volontaire de l’être actif, et la résistance de l’être passif.
De là deux morales qui, bien loin de se contrarier, concourent : la morale religieuse ou philosophique, et la morale que je me permettrai d’appeler économique.
La morale religieuse, pour arriver à la suppression de l’acte malfaisant, s’adresse à son auteur, à l’homme en tant qu’agent. Elle lui dit : « Corrige-toi ; épure-toi ; cesse de faire le mal ; fais le bien, dompte tes passions ; sacrifie tes intérêts ; n’opprime pas ton prochain que ton devoir est d’aimer et soulager ; sois juste d’abord et charitable ensuite. » Cette morale sera éternellement la plus belle, la plus touchante, celle qui montrera la race humaine dans toute sa majesté ; qui se prêtera le plus aux mouvements de l’éloquence et excitera le plus l’admiration et la sympathie des hommes.
La morale économique aspire au même résultat, mais s’adresse surtout à l’homme en tant que patient. Elle lui montre les effets des actions humaines, et, par cette simple exposition, elle le stimule à réagir contre celles qui le blessent, à honorer celles qui lui sont utiles. Elle s’efforce de répandre assez de bon sens, de lumière et de juste défiance dans la masse opprimée pour rendre de plus en plus l’oppression difficile et dangereuse.
Il faut remarquer que la morale économique ne laisse pas que d’agir aussi sur l’oppresseur. Un acte malfaisant produit des biens et des maux : des maux pour celui qui le subit, et des biens pour celui qui l’exerce, sans quoi il ne se produirait pas. Mais il s’en faut de beaucoup qu’il y ait compensation. La somme des maux l’emporte toujours, et nécessairement, sur celle des biens, parce que le fait même d’opprimer entraîne une déperdition de forces, crée des dangers, provoque des représailles, exige de coûteuses précautions. La simple exposition de ces effets ne se borne donc pas à provoquer la réaction des opprimés, elle met du côté de la justice tous ceux dont le cœur n’est pas perverti, et trouble la sécurité des oppresseurs eux-mêmes.
Mais il est aisé de comprendre que cette morale, plutôt virtuelle qu’explicite, qui n’est après tout qu’une démonstration scientifique ; qui perdrait même de son efficacité, si elle changeait de caractère ; qui ne s’adresse pas au cœur, mais à l’intelligence ; qui ne cherche pas à persuader, mais à convaincre ; qui ne donne pas des conseils, mais des preuves ; dont la mission n’est pas de toucher, mais d’éclairer, et qui n’obtient sur le vice d’autre victoire que de le priver d’aliments ; il est aisé de comprendre, dis-je, que cette morale ait été accusée de sécheresse et de prosaïsme.
Le reproche est vrai sans être juste. Il revient à dire que l’économie politique ne dit pas tout, n’embrasse pas tout, n’est pas la science universelle. Mais qui donc a jamais affiché, en son nom, une prétention aussi exorbitante ?
L’accusation ne serait fondée qu’autant que l’économie politique présenterait ses procédés comme exclusifs, et aurait l’outrecuidance, comme on dit, d’interdire à la philosophie et à la religion tous leurs moyens propres et directs de travailler au perfectionnement de l’homme.
Admettons donc l’action simultanée de la morale proprement dite et de l’économie politique, l’une flétrissant l’acte malfaisant dans son mobile, par la vue de sa laideur, l’autre le discréditant dans nos convictions par le tableau de ses effets.
Avouons même que le triomphe du moraliste religieux, quand il se réalise, est plus beau, plus consolant et plus radical. Mais en même temps il est difficile de ne pas reconnaître que celui de la science économique ne soit plus facile et plus sûr.
Dans quelques lignes qui valent mieux que beaucoup de gros volumes, J.-B. Say a déjà fait observer que pour faire cesser le désordre introduit par l’hypocrisie dans une famille honorable, il y avait deux moyens : corriger Tartuffe ou déniaiser Orgon. Molière, ce grand peintre du cœur humain, paraît avoir constamment eu en vue le second procédé, comme le plus efficace.
Il en est ainsi sur le théâtre du monde.
Dites-moi ce que fit César, et je vous dirai ce qu’étaient les Romains de son temps.
Dites-moi ce qu’accomplit la diplomatie moderne, et je vous dirai l’état moral des nations.
Nous ne payerions pas près de deux milliards d’impôts, si nous ne donnions mission de les voter à ceux qui les mangent.
Nous n’aurions pas toutes les difficultés et toutes les charges de la question africaine, si nous étions bien convaincus que deux et deux font quatre en économie politique comme en arithmétique.
M. Guizot n’aurait pas eu occasion de dire : La France est assez riche pour payer sa gloire, si la France ne s’était jamais éprise de la fausse gloire.
Le même homme d’État n’aurait jamais dit : La liberté est assez précieuse pour que la France ne la marchande pas, si la France comprenait bien que lourd budget et liberté sont incompatibles.
Ce ne sont pas, comme on croit, les monopoleurs, mais les monopolés qui maintiennent les monopoles.
Et, en matière d’élections, ce n’est pas parce qu’il y a des corrupteurs qu’il y a des corruptibles, c’est le contraire ; et la preuve, c’est que les corruptibles payent tous les frais de la corruption. Ne serait-ce point à eux à la faire cesser ?
Que la morale religieuse touche donc le cœur, si elle le peut, des Tartuffes, des Césars, des colonistes, des sinécuristes, des monopolistes, etc. La tâche de l’économie politique est d’éclairer leurs dupes.
De ces deux procédés, quel est celui qui travaille le plus efficacement au progrès social ? Faut-il le dire ? Je crois que c’est le second. Je crains que l’humanité ne puisse échapper à la nécessité d’apprendre d’abord la morale défensive.
J’ai beau regarder, lire, observer, interroger, je ne vois aucun abus, s’exerçant sur une échelle un peu vaste, qui ait péri par la volontaire renonciation de ceux qui en profitent.
J’en vois beaucoup, au contraire, qui cèdent à la virile résistance de ceux qui en souffrent.
Décrire les conséquences des abus, c’est donc le moyen le plus efficace de les détruire. — Et combien cela est vrai, surtout quand il s’agit d’abus qui, comme le régime restrictif, tout en infligeant des maux réels aux masses, ne renferment, pour ceux qui croient en profiter, qu’illusion et déception !
Après cela, ce genre de moralisation réalisera-t-il à lui seul toute la perfection sociale que la nature sympathique de l’âme humaine et de ses plus nobles facultés fait espérer et prévoir ? Je suis loin de le prétendre. Admettons la complète diffusion de la morale défensive, qui n’est après tout que la connaissance des intérêts bien entendus toujours d’accord avec l’utilité générale et la justice. Cette société, quoique certainement bien ordonnée, pourrait être fort peu attrayante, où il n’y aurait plus de fripons, uniquement parce qu’il n’y aurait plus de dupes ; où le vice, toujours latent et pour ainsi dire engourdi par famine, n’aurait besoin que de quelque aliment pour revivre ; où la prudence de chacun serait commandée par la vigilance de tous, et où la réforme enfin, régularisant les actes extérieurs, mais s’arrêtant à l’épiderme, n’aurait pas pénétré jusqu’au fond des consciences. Une telle société nous apparaît quelquefois sous la figure d’un de ces hommes exacts, rigoureux, justes, prêts à repousser la plus légère usurpation de leurs droits, habiles à ne se laisser entamer d’aucun côté. Vous l’estimez ; vous l’admirez peut-être ; vous en feriez votre député, vous n’en feriez pas votre ami.
Que les deux morales, au lieu de s’entre-décrier, travaillent donc de concert, attaquant le vice par les deux pôles. Pendant que les économistes font leur œuvre, dessillent les yeux des Orgons, déracinent les préjugés, excitent de justes et nécessaires défiances, étudient et exposent la vraie nature des choses et des actions, que le moraliste religieux accomplisse de son côté ses travaux plus attrayants mais plus difficiles. Qu’il attaque l’iniquité corps à corps ; qu’il la poursuive dans les fibres les plus déliées du cœur ; qu’il peigne les charmes de la bienfaisance, de l’abnégation, du dévouement ; qu’il ouvre la source des vertus là où nous ne pouvons que tarir la source des vices, c’est sa tâche, elle est noble et belle. Mais pourquoi contesterait-il l’utilité de celle qui nous est dévolue ?
Dans une société qui, sans être intimement vertueuse, serait néanmoins bien ordonnée par l’action de la morale économique (qui est la connaissance de l’économie du corps social), les chances du progrès ne s’ouvriraient-elles pas devant la morale religieuse ?
L’habitude, a-t-on dit, est une seconde nature.
Un pays où, de longue main, chacun serait déshabitué de l’injustice par la seule résistance d’un public éclairé, pourrait être triste encore. Mais il serait, ce me semble, bien préparé à recevoir un enseignement plus élevé et plut pur. C’est un grand acheminement vers le bien que d’être désaccoutumé du mal. Les hommes ne peuvent rester stationnaires. Détournés du chemin du vice, alors qu’il ne conduirait plus qu’à l’infamie, ils sentiraient d’autant plus l’attrait de la vertu.
La société doit peut-être passer par ce prosaïque état, où les hommes pratiqueront la vertu par calcul, pour de là s’élever à cette région plus poétique, où elle n’aura plus besoin de ce mobile.
III. Les deux haches↩
PÉTITION DE JACQUES BONHOMME, CHARPENTIER, À M. CUNIN-GRIDAINE, MINISTRE DU COMMERCE.
Monsieur le fabricant ministre,
Je suis charpentier, comme fut Jésus ; je manie la hache et l’herminette pour vous servir.
Or, hachant et bûchant, depuis l’aube jusqu’à la nuit faite, sur les terres de notre seigneur le roi, il m’est tombé dans l’idée que mon travail était national autant que le vôtre.
Et dès lors, je ne vois pas pourquoi la Protection ne visiterait pas mon chantier, comme votre atelier.
Car enfin, si vous faites des draps, je fais des toits. Tous deux, par des moyens divers, nous abritons nos clients du froid et de la pluie.
Cependant, je cours après la pratique, et la pratique court après vous. Vous l’y avez bien su forcer en l’empêchant de se pourvoir ailleurs, tandis que la mienne s’adresse à qui bon lui semble.
Quoi d’étonnant ? M. Cunin, ministre, s’est rappelé M. Cunin, tisserand ; c’est bien naturel. Mais, hélas ! mon humble métier n’a pas donné un ministre à la France, quoiqu’il ait donné un Dieu au monde.
Et ce Dieu, dans le code immortel qu’il légua aux hommes, n’a pas glissé le plus petit mot dont les charpentiers se puissent autoriser pour s’enrichir, comme vous faites, aux dépens d’autrui.
Aussi, voyez ma position. Je gagne trente sous par jour, quand il n’est pas dimanche ou jour chômé. Si je me présente à vous en même temps qu’un charpentier flamand, pour un sou de rabais vous lui accordez la préférence.
Mais me veux-je vêtir ? si un tisserand belge met son drap à côté du vôtre, vous le chassez, lui et son drap, hors du pays.
En sorte que, forcément conduit à votre boutique, qui est la plus chère, mes pauvres trente sous n’en valent, en réalité, que vingt-huit.
Que dis-je ? ils n’en valent pas vingt-six ! car, au lieu d’expulser le tisserand belge à vos frais (ce serait bien le moins), vous me faites payer les gens que, dans votre intérêt, vous mettez à ses trousses.
Et comme un grand nombre de vos co-législateurs, avec qui vous vous entendez à merveille, me prennent chacun un sou ou deux, sous couleur de protéger qui le fer, qui la houille, celui-ci l’huile et celui-là le blé, il se trouve, tout compte fait, que je ne sauve pas quinze sous, sur les trente, du pillage.
Vous me direz sans doute que ces petits sous, qui passent ainsi, sans compensation, de ma poche dans la vôtre, font vivre du monde autour de votre château, vous mettant à même de mener grand train. — À quoi je vous ferai observer que, si vous me les laissiez, ils feraient vivre du monde autour de moi.
Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre-fabricant, sachant que je serais mal reçu, je ne viens pas vous sommer, comme j’en aurais bien le droit, de renoncer à la restriction que vous imposez à votre clientèle ; j’aime mieux suivre la pente commune et réclamer, moi aussi, un petit brin de protection.
Ici vous m’opposerez une difficulté : « L’ami, me direz-vous, je voudrais bien te protéger, toi et tes pareils ; mais comment conférer des faveurs douanières au travail des charpentiers ? Faut-il prohiber l’entrée des maisons par terre et par mer ? »
Cela serait passablement dérisoire ; mais, à force d’y rêver, j’ai découvert un autre moyen de favoriser les enfants de Saint-Joseph ; et vous l’accueillerez d’autant plus volontiers, je l’espère, qu’il ne diffère en rien de celui qui constitue le privilége que vous vous votez chaque année à vous-même.
Ce moyen merveilleux, c’est d’interdire en France l’usage des haches aiguisées.
Je dis que cette restriction ne serait ni plus illogique ni plus arbitraire que celle à laquelle vous nous soumettez à l’occasion de votre drap.
Pourquoi chassez-vous les Belges ? Parce qu’ils vendent à meilleur marché que vous. Et pourquoi vendent-ils à meilleur marché que vous ? Parce qu’ils ont sur vous, comme tisserands, une supériorité quelconque.
Entre vous et un Belge il y a donc tout juste la différence d’une hache obtuse à une hache affilée.
Et vous me forcez, moi charpentier, de vous acheter le produit de la hache obtuse !
Considérez la France comme un ouvrier qui veut, par son travail, se procurer toutes choses, et entre autres du drap.
Pour cela il y a deux moyens :
Le premier, c’est de filer et de tisser la laine ;
Le second, c’est de fabriquer, par exemple, des pendules, des papiers peints ou des vins, et de les livrer aux Belges contre du drap.
Celui de ces deux procédés qui donne le meilleur résultat peut être représenté par la hache affilée, l’autre par la hache obtuse.
Vous ne niez pas qu’actuellement, en France, on obtient avec plus de peine une pièce d’étoffe d’un métier à tisser (c’est la hache obtuse) que d’un plant de vigne (c’est la hache affilée). Vous le niez si peu, que c’est justement par la considération de cet excédant de peine (en quoi vous faites consister la richesse) que vous recommandez, bien plus que vous imposez la plus mauvaise des deux haches.
Eh bien ! soyez conséquent, soyez impartial, si vous ne voulez être juste, et traitez les pauvres charpentiers comme vous vous traitez vous-même.
Faites une loi qui porte :
« Nul ne pourra se servir que de poutres et solives produits de haches obtuses. »
À l’instant voici ce qui va arriver.
Là où nous donnons cent coups de hache, nous en donnerons trois cents. Ce que nous faisons en une heure en exigera trois. Quel puissant encouragement pour le travail ! Apprentis, compagnons et maîtres, nous n’y pourrons plus suffire. Nous serons recherchés, partant bien payés. Qui voudra jouir d’un toit sera bien obligé d’en passer par nos exigences, comme qui veut avoir du drap est obligé de se soumettre aux vôtres.
Et que ces théoriciens du libre échange osent jamais révoquer en doute l’utilité de la mesure, nous saurons bien où chercher une réfutation victorieuse. Votre enquête de 1834 est là. Nous les battrons avec, car vous y avez admirablement plaidé la cause des prohibitions et des haches émoussées, ce qui est tout un.
IV. Conseil inférieur du travail↩
« Quoi ! vous avez le front de demander pour tout citoyen le droit de vendre, acheter, troquer, échanger, rendre et recevoir service pour service et juger pour lui-même à la seule condition de ne pas blesser l’honnêteté et de satisfaire le trésor public ? Vous voulez donc ravir aux ouvriers le travail, le salaire et le pain ? »
Voilà ce qu’on nous dit. Je sais qu’en penser ; mais j’ai voulu savoir ce qu’en pensent les ouvriers eux-mêmes.
J’avais sous la main un excellent instrument d’enquête.
Ce n’étaient point ces conseils supérieurs de l’industrie, où de gros propriétaires qui se disent laboureurs, de puissants armateurs qui se croient marins, et de riches actionnaires qui se prétendent travailleurs, font de cette philanthropie que l’on sait.
Non ; c’étaient des ouvriers pour tout de bon, des ouvriers sérieux, comme on dit aujourd’hui, menuisiers, charpentiers, maçons, tailleurs, cordonniers, teinturiers, forgerons, aubergistes, épiciers, etc., etc., qui, dans mon village, ont fondé une société de secours mutuels.
Je la transformai, de mon autorité privée, en conseil inférieur du travail, et j’en obtins une enquête qui en vaut bien une autre, quoiqu’elle ne soit pas bourrée de chiffres et enflée aux proportions d’un in-quarto imprimé aux frais de l’État.
Il s’agissait d’interroger ces braves gens sur la manière dont ils sont, ou se croient affectés par le régime protecteur. Le président me fit bien observer que c’était enfreindre quelque peu les conditions d’existence de l’association. Car, en France, sur cette terre de liberté, les gens qui s’associent renoncent à s’entretenir de politique, c’est-à-dire de leurs communs intérêts. Cependant, après beaucoup d’hésitation, il mit la question à l’ordre du jour.
On divisa l’assemblée en autant de commissions qu’elle présentait de groupes formant des corps de métiers. On délivra à chacune un tableau qu’elle devait remplir après quinze jours de discussions.
Au jour marqué, le vénérable président prit place au fauteuil (style officiel, car c’était une chaise), et trouva sur le bureau (encore style officiel, car c’était une table en bois de peuplier) une quinzaine de rapports, dont il donna successivement lecture.
Le premier qui se présenta fut celui des tailleurs. Le voici aussi exact que s’il était autographié.
EFFETS DE LA PROTECTION. — RAPPORT DES TAILLEURS.
| Inconvénients. | Avantages. | |
1° À cause du régime protecteur, nous payons plus cher le pain, la viande, le sucre, le bois, le fil, les aiguilles, etc., ce qui équivaut pour nous à une diminution considérable de salaire ; 2° À cause du régime protecteur, nos clients aussi payent plus cher toutes choses, ce qui fait qu’il leur reste moins à dépenser en vêtements, d’où il suit que nous avons moins de travail, partant moins de profits ; 3° À cause du régime protecteur, les étoffes sont chères, on fait durer plus longtemps les habits ou l’on s’en passe. C’est encore une diminution d’ouvrage qui nous force à offrir nos services au rabais. |
Néant ¹. ¹ Nous avons eu beau prendre nos mesures, il nous a été impossible d’apercevoir un côté quelconque par lequel le régime protecteur fût avantageux à notre commerce. |
Voici un autre tableau :
EFFETS DE LA PROTECTION. — RAPPORT DES FORGERONS.
| Inconvénients. | Avantages. | |
1° Le régime protecteur nous frappe d’une taxe, qui ne va pas au Trésor, chaque fois que nous mangeons, buvons, nous chauffons et nous habillons ; 2° Il frappe d’une taxe semblable tous nos concitoyens qui ne sont pas forgerons ; et, étant moins riches d’autant, la plupart d’entre eux font des clous de bois et des loquets de ficelle, ce qui nous prive de travail ; 3° Il tient le fer à si haut prix qu’on ne l’emploie dans le pays ni aux charrues, ni aux grilles, ni aux balcons, et notre métier, qui pourrait fournir du travail à tant de gens qui en manquent, nous en laisse manquer à nous-mêmes ; 4° Ce que le fisc manque de recouvrer à l’occasion des marchandises qui n’entrent pas, est pris sur notre sel et sur nos lettres. |
Néant. |
Tous les autres tableaux, que j’épargne au lecteur, chantaient le même refrain. Jardiniers, charpentiers, cordonniers, sabotiers, bateliers, meuniers, tous exhalaient les mêmes doléances.
Je déplorai qu’il n’y eût pas de laboureurs dans notre association. Leur rapport eût été assurément fort instructif.
Mais, hélas ! dans notre pays des Landes, les pauvres laboureurs, tout protégés qu’ils sont, n’ont pas le sou, et, après y avoir mis leurs bestiaux, ils ne peuvent entrer eux-mêmes dans des sociétés de secours mutuels. Les prétendues faveurs de la protection ne les empêchent pas d’être les parias de notre ordre social. Que dirai-je des vignerons ?
Ce que je remarquai surtout, c’est le bon sens avec lequel nos villageois avaient aperçu non-seulement le mal direct que leur fait le régime protecteur, mais aussi le mal indirect qui, frappant leur clientèle, retombe par ricochet sur eux.
C’est ce que ne paraissent pas comprendre, me dis-je, les économistes du Moniteur industriel.
Et peut-être les hommes, dont un peu de protection fascine les yeux, notamment les agriculteurs, y renonceraient-ils volontiers, s’ils apercevaient ce côté de la question.
Ils se diraient peut-être : « Mieux vaut se soutenir par soi-même, au milieu d’une clientèle aisée, que d’être protégé au milieu d’une clientèle appauvrie. »
Car vouloir enrichir tour à tour chaque industrie, en faisant successivement le vide autour d’elles, c’est un effort aussi vain que d’entreprendre de sauter par-dessus son ombre.
V. Cherté, bon marché↩
Je crois devoir soumettre aux lecteurs quelques remarques, hélas ! théoriques, sur les illusions qui naissent des mots cherté, bon marché. Au premier coup d’œil on sera disposé, je le sais, à trouver ces remarques un peu subtiles ; mais, subtiles ou non, la question est de savoir si elles sont vraies. Or, je les crois parfaitement vraies et surtout très-propres à faire réfléchir les hommes, en grand nombre, qui ont une foi sincère en l’efficacité du régime protecteur.
Partisans de la liberté, défenseurs de la restriction, nous sommes tous réduits à nous servir de ces expressions cherté, bon marché. Les premiers se déclarent pour le bon marché, ayant en vue l’intérêt du consommateur ; les seconds se prononcent pour la cherté, se préoccupant surtout du producteur. D’autres interviennent disant : Producteur et consommateur ne font qu’un ; ce qui laisse parfaitement indécise la question de savoir si la loi doit poursuivre le bon marché ou la cherté.
Au milieu de ce conflit, il semble qu’il n’y a, pour la loi, qu’un parti à prendre, c’est de laisser les prix s’établir naturellement. Mais alors on rencontre les ennemis acharnés du laissez faire. Ils veulent absolument que la loi agisse, même sans savoir dans quel sens elle doit agir. Cependant ce serait à celui qui veut faire servir la loi à provoquer une cherté artificielle ou un bon marché hors de nature, à exposer et faire prévaloir le motif de sa préférence. L’onus probandi lui incombe exclusivement. D’où il suit que la liberté est toujours censée bonne jusqu’à preuve contraire, car laisser les prix s’établir naturellement, c’est la liberté.
Mais les rôles sont changés. Les partisans de la cherté ont fait triompher leur système, et c’est aux défenseurs des prix naturels à prouver la bonté du leur. De part et d’autre on argumente avec deux mots. Il est donc bien essentiel de savoir ce que ces deux mots contiennent.
Disons d’abord qu’il s’est produit une série de faits propres à déconcerter les champions des deux camps.
Pour engendrer la cherté, les restrictionistes ont obtenu des droits protecteurs, et un bon marché, pour eux inexplicable, est venu tromper leurs espérances.
Pour arriver au bon marché, les libres échangistes ont quelquefois fait prévaloir la liberté, et, à leur grand étonnement, c’est l’élévation des prix qui s’en est suivie.
Exemple : En France, pour favoriser l’agriculture, on a frappé la laine étrangère d’un droit de 22 p. 100, et il est arrivé que la laine nationale s’est vendue à plus vil prix après la mesure qu’avant.
En Angleterre, pour soulager le consommateur, on a dégrevé et finalement affranchi la laine étrangère, et il est advenu que celle du pays s’est vendue plus cher que jamais.
Et ce n’est pas là un fait isolé, car le prix de la laine n’a pas une nature qui lui soit propre et le dérobe à la loi générale qui gouverne les prix. Ce même fait s’est reproduit dans toutes les circonstances analogues. Contre toute attente, la protection a amené plutôt la baisse, la concurrence plutôt la hausse des produits.
Alors la confusion dans le débat a été à son comble, les protectionistes disant à leurs adversaires : « Ce bon marché que vous nous vantez tant, c’est notre système qui le réalise. » Et ceux-ci répondant : « Cette cherté que vous trouviez si utile, c’est la liberté qui la provoque [169]. »
Ne serait-ce pas plaisant de voir ainsi le bon marché devenir le mot d’ordre à la rue Hauteville, et la cherté à la rue Choiseul ?
Évidemment, il y a en tout ceci une méprise, une illusion qu’il faut détruire. C’est ce que je vais essayer de faire.
Supposons deux nations isolées, chacune composée d’un million d’habitants. Admettons que, toutes choses égales d’ailleurs, il y ait chez l’une juste une fois plus de toutes sortes de choses que chez l’autre, le double de blé, de viande, de fer, de meubles, de combustible, de livres, de vêtements, etc.
On conviendra que la première sera le double plus riche.
Cependant il n’y a aucune raison pour affirmer que les prix absolus différeront chez ces deux peuples. Peut-être même seront-ils plus élevés chez le plus riche. Il se peut qu’aux États-Unis tout soit nominalement plus cher qu’en Pologne, et que les hommes y soient néanmoins mieux pourvus de toutes choses ; par où l’on voit que ce n’est pas le prix absolu des produits, mais leur abondance, qui fait la richesse. Lors donc qu’on veut juger comparativement la restriction et la liberté, il ne faut pas se demander laquelle des deux engendre le bon marché ou la cherté, mais laquelle des deux amène l’abondance ou la disette.
Car, remarquez ceci : les produits s’échangeant les uns contre les autres, une rareté relative de tout et une abondance relative de tout laissent exactement au même point le prix absolu des choses, mais non la condition des hommes.
Pénétrons un peu plus avant dans le sujet.
Quand on a vu les aggravations et les diminutions de droits produire des effets si opposés à ceux qu’on en attendait, la dépréciation suivre souvent la taxe et le renchérissement accompagner quelquefois la franchise, il a bien fallu que l’économie politique cherchât l’explication d’un phénomène qui bouleversait les idées reçues ; car, on a beau dire, la science, si elle est digne de ce nom, n’est que la fidèle exposition et la juste explication des faits.
Or, celui que nous signalons ici s’explique fort bien par une circonstance qu’il ne faut jamais perdre de vue.
C’est que la cherté a deux causes, et non une.
Il en est de même du bon marché [170].
C’est un des points les mieux acquis à l’économie politique, que le prix est déterminé par l’état de l’Offre comparé à celui de la Demande.
Il y a donc deux termes qui affectent le prix : l’Offre et la Demande. Ces termes sont essentiellement variables. Ils peuvent se combiner dans le même sens, en sens opposé et dans des proportions infinies. De là des combinaisons de prix inépuisables.
Le prix hausse, soit parce que l’Offre diminue, soit parce que la Demande augmente.
Il baisse, soit que l’Offre augmente ou que la Demande diminue.
De là deux natures de cherté et deux natures de bon marché ;
Il y a la cherté de mauvaise nature, c’est celle qui provient de la diminution de l’Offre ; car celle-là implique rareté, implique privation (telle est celle qui s’est fait ressentir cette année sur le blé) ; il y a la cherté de bonne nature, c’est celle qui résulte d’un accroissement de demande ; car celle-ci suppose le développement de la richesse générale.
De même, il y a un bon marché désirable, c’est celui qui a sa source dans l’abondance ; et un bon marché funeste, celui qui a pour cause l’abandon de la demande, la ruine de la clientèle.
Maintenant, veuillez remarquer ceci : la restriction tend à provoquer à la fois et celle de ces deux chertés et celui de ces deux bons marchés qui sont de mauvaise nature : la mauvaise cherté, en ce qu’elle diminue l’Offre, c’est même son but avoué, et le mauvais bon marché, en ce qu’elle diminue aussi la Demande, puisqu’elle donne une fausse direction aux capitaux et au travail, et accable la clientèle de taxes et d’entraves.
En sorte que, quant au prix, ces deux tendances se neutralisent ; et voilà pourquoi, ce système, restreignant la Demande en même temps que l’Offre, ne réalise pas même, en définitive, celte cherté qui est son objet.
Mais, relativement à la condition du peuple, elles ne se neutralisent pas ; elles concourent au contraire à l’empirer.
L’effet de la liberté est justement opposé. Dans son résultat général, il se peut qu’elle ne réalise pas non plus le bon marché qu’elle promettait ; car elle a aussi deux tendances, l’une vers le bon marché désirable par l’extension de l’Offre ou l’abondance, l’autre vers la cherté appréciable par le développement de la Demande ou de la richesse générale. Ces deux tendances se neutralisent en ce qui concerne les prix absolus ; mais elles concourent en ce qui touche l’amélioration du sort des hommes.
En un mot, sous le régime restrictif, et en tant qu’il agit, les hommes reculent vers un état de choses où tout s’affaiblit, Offre et Demande ; sous le régime de la liberté, ils progressent vers un état de choses où elles se développent d’un pas égal, sans que le prix absolu des choses doive être nécessairement affecté. Ce prix n’est pas un bon critérium de la richesse. Il peut fort bien rester le même, soit que la société tombe dans la misère la plus abjecte, soit qu’elle s’avance vers une grande prospérité.
Qu’il nous soit permis de faire en peu de mots l’application de cette doctrine.
Un cultivateur du Midi croit tenir le Pérou parce qu’il est protégé par des droits contre la rivalité extérieure. Il est pauvre comme Job, n’importe ; il n’en suppose pas moins que la protection l’enrichira tôt ou tard. Dans ces circonstances, si on lui pose, comme le fait le comité Odier, la question en ces termes :
« Voulez-vous, oui ou non, être assujetti à la concurrence étrangère ? » son premier mouvement est de répondre : « Non. » — Et le comité Odier donne fièrement un grand éclat à cette réponse.
Cependant il faut aller un peu plus au fond des choses. Sans doute, la concurrence étrangère, et même la concurrence en général, est toujours importune ; et si une profession pouvait s’en affranchir seule, elle ferait pendant quelque temps de bonnes affaires.
Mais la protection n’est pas une faveur isolée, c’est un système. Si elle tend à produire, au profit de ce cultivateur, la rareté du blé et de la viande, elle tend aussi à produire, au profit d’autres industriels, la rareté du fer, du drap, du combustible, des outils, etc., soit la rareté en toutes choses.
Or, si la rareté du blé agit dans le sens de son enchérissement, par la diminution de l’Offre, la rareté de tous les autres objets contre lesquels le blé s’échange agit dans le sens de la dépréciation du blé par la diminution de la Demande ; en sorte qu’il n’est nullement certain qu’en définitive le blé soit d’un centime plus cher que sous le régime de la liberté. Il n’y a de certain que ceci : que, comme il y a moins de toutes choses dans le pays, chacun doit être moins bien pourvu de toutes choses.
Le cultivateur devrait bien se demander s’il ne vaudrait pas mieux pour lui qu’il entrât du dehors un peu de blé et de bétail, mais que, d’un autre côté, il fût entouré d’une population aisée, habile à consommer et à payer toutes sortes de produits agricoles.
Il y a tel département où les hommes sont couverts de haillons, habitent des masures, se nourrissent de châtaignes. Comment voulez-vous que l’agriculture y soit florissante ? Que faire produire à la terre avec l’espoir fondé d’une juste rémunération ? De la viande ? On n’en mange pas. Du lait ? On ne boit que l’eau des fontaines. Du beurre ? C’est du luxe. De la laine ? On s’en passe le plus possible. Pense-t-on que tous les objets de consommation puissent être ainsi délaissés par les masses, sans que cet abandon agisse sur les prix dans le sens de la baisse, en même temps que la protection agit dans le sens de la hausse ?
Ce que nous disons d’un cultivateur, nous pouvons le dire d’un manufacturier. Les fabricants de draps assurent que la concurrence extérieure avilira les prix par l’accroissement de l’Offre. Soit ; mais ces prix ne se relèveront-ils pas par l’accroissement de la Demande ? La consommation du drap est-elle une quantité fixe, invariable ? Chacun en est-il aussi bien pourvu qu’il pourrait et devrait l’être ? et si la richesse générale se développait par l’abolition de toutes ces taxes et de toutes ces entraves, le premier usage qu’en ferait la population ne serait-il pas de se mieux vêtir ?
La question, l’éternelle question, n’est donc pas de savoir si la protection favorise telle ou telle branche spéciale d’industrie, mais si, tout compensé, tout calcul fait, la restriction est, par sa nature, plus productive que la liberté.
Or, personne n’ose le soutenir. C’est même ce qui explique cet aveu qu’on nous fait sans cesse : « Vous avez raison en principe. »
S’il en est ainsi, si la restriction ne fait du bien à chaque industrie spéciale qu’en faisant un plus grand mal à la richesse générale, comprenons donc que le prix lui-même, à ne considérer que lui, exprime un rapport entre chaque industrie spéciale et l’industrie générale, entre l’Offre et la Demande, et que, d’après ces prémisses, ce prix rémunérateur, objet de la protection, est plus contrarié que favorisé par elle [171].
Complément.
Sous ce titre, cherté, bon marché, nous avons publié un article qui nous a valu les deux lettres suivantes. Nous les faisons suivre de la réponse.
Monsieur le rédacteur,
Vous bouleversez toutes mes idées. Je faisais de la propagande au profit du libre-échange et trouvais si commode de mettre en avant le bon marché ! J’allais partout disant : « Avec la liberté, le pain, la viande, le drap, le linge, le fer, le combustible, vont baisser de prix. » Cela déplaisait à ceux qui en vendent, mais faisait plaisir à ceux qui en achètent. Aujourd’hui vous mettez en doute que le résultat du libre-échange soit le bon marché. Mais alors à quoi servira-t-il ? Que gagnera le peuple, si la concurrence étrangère, qui peut le froisser dans ses ventes, ne le favorise pas dans ses achats ?
Monsieur le libre-échangiste,
Permettez-nous de vous dire que vous n’avez lu qu’à demi l’article qui a provoqué votre lettre. Nous avons dit que le libre-échange agissait exactement comme les routes, les canaux, les chemins de fer, comme tout ce qui facilite les communications, comme tout ce qui détruit des obstacles. Sa première tendance est d’augmenter l’abondance de l’article affranchi, et par conséquent d’en baisser le prix. Mais en augmentant en même temps l’abondance de toutes les choses contre lesquelles cet article s’échange, il en accroît la demande, et le prix se relève par cet autre côté. Vous nous demandez ce que gagnera le peuple ? Supposez qu’il a une balance à plusieurs plateaux, dans chacun desquels il a, pour son usage, une certaine quantité des objets que vous avez énumérés. Si l’on ajoute un peu de blé dans un plateau, il tendra à s’abaisser ; mais si l’on ajoute un peu de drap, un peu de fer, un peu de combustible aux autres bassins, l’équilibre sera maintenu. À ne regarder que le fléau, il n’y aura rien de changé. À regarder le peuple, on le verra mieux nourri, mieux vêtu et mieux chauffé.
Monsieur le rédacteur,
Je suis fabricant de drap et protectioniste. J’avoue que votre article sur la cherté et le bon marché me fait réfléchir. Il y a là quelque chose de spécieux qui n’aurait besoin que d’être bien établi pour opérer une conversion.
Monsieur le protectioniste,
Nous disons que vos mesures restrictives ont pour but une chose inique, la cherté artificielle. Mais nous ne disons pas qu’elles réalisent toujours l’espoir de ceux qui les provoquent. Il est certain qu’elles infligent au consommateur tout le mal de la cherté. Il n’est pas certain qu’elles en confèrent le profit au producteur. Pourquoi ? parce que si elles diminuent l’offre, elles diminuent aussi la demande.
Cela prouve qu’il y a dans l’arrangement économique de ce monde une force morale, vis medicatrix, qui fait qu’à la longue l’ambition injuste vient s’aheurter à une déception.
Veuillez remarquer, monsieur, qu’un des éléments de la prospérité de chaque industrie particulière, c’est la richesse générale. Le prix d’une maison est non-seulement en raison de ce qu’elle a coûté, mais encore en raison du nombre et de la fortune des locataires. Deux maisons exactement semblables ont-elles nécessairement le même prix ? Non certes, si l’une est située à Paris et l’autre en Basse-Bretagne. Ne parlons jamais de prix sans tenir compte des milieux, et sachons bien qu’il n’y a pas de tentative plus vaine que celle de vouloir fonder la prospérité des fractions sur la ruine du tout. C’est pourtant là la prétention du régime restrictif.
La concurrence a toujours été et sera toujours importune à ceux qui la subissent. Aussi voit-on, en tous temps et en tous lieux, les hommes faire effort pour s’en débarrasser. Nous connaissons (et vous aussi peut-être) un conseil municipal où les marchands résidents font aux marchands forains une guerre acharnée. Leurs projectiles sont des droits d’octroi, de placage, d’étalage, de péage, etc., etc.
Or, considérez ce qui serait advenu de Paris, par exemple, si cette guerre s’y était faite avec succès.
Supposez que le premier cordonnier qui s’y est établi eût réussi à évincer tous les autres ; que le premier tailleur, le premier maçon, le premier imprimeur, le premier horloger, le premier coiffeur, le premier médecin, le premier boulanger, eussent été aussi heureux. Paris serait encore aujourd’hui un village de 12 à 1,500 habitants. — Il n’en a pas été ainsi. Chacun (sauf ceux que vous éloignez encore) est venu exploiter ce marché, et c’est justement ce qui l’a agrandi. Ce n’a été qu’une longue suite de froissements pour les ennemis de la concurrence ; et de froissements en froissements, Paris est devenu une ville d’un million d’habitants. La richesse générale y a gagné, sans doute ; mais la richesse particulière des cordonniers et des tailleurs y a-t-elle perdu ? Pour vous, voilà la question. À mesure que les concurrents arrivaient, vous auriez dit : le prix des bottes va baisser. Et en a-t-il été ainsi ? Non ; car si l’offre a augmenté, la demande a augmenté aussi.
Il en sera ainsi du drap, monsieur ; laissez-le entrer. Vous aurez plus de concurrents, c’est vrai ; mais aussi vous aurez plus de clientèle, et surtout une clientèle plus riche. Hé quoi ! n’y avez-vous jamais songé en voyant les neuf dixièmes de vos compatriotes privés pendant l’hiver de ce drap que vous fabriquez si bien ?
C’est une leçon bien longue à apprendre que celle-ci : Voulez-vous prospérer ? laissez prospérer votre clientèle.
Mais quand elle sera sue, chacun cherchera son bien dans le bien général. Alors, les jalousies d’individu à individu, de ville à ville, de province à province, de nation à nation, ne troubleront plus le monde.
VI. Aux artisans et ouvriers[172] ↩
Plusieurs journaux m'ont attaqué devant vous. Ne voudrez-vous pas lire ma défense ?
Je ne suis pas défiant. Quand un homme écrit ou parle, je crois qu'il pense ce qu'il dit.
Pourtant, j'ai beau lire et relire les journaux auxquels je réponds, il me semble y découvrir de tristes tendances.
De quoi s'agissait-il ? de rechercher ce qui vous est le plus favorable, la restriction ou la liberté.
Je crois que c'est la liberté, — ils croient que c'est la restriction ; — à chacun de prouver sa thèse.
Etait-il nécessaire d'insinuer que nous sommes les agents de l'Angleterre, du Midi, du Gouvernement?
Voyez combien la récrimination, sur ce terrain, nous serait facile.
Nous sommes, disent-ils, agents des Anglais, parce que quelques-uns d'entre nous se sont servis des mots meeting, free-trader !
Et ne se servent-ils pas des mots drawback, budget ?
Nous imitons Cobden et la démocratie anglaise !
Et eux, ne parodient-ils pas Bentinck et l'aristocratie britannique?
Nous empruntons à la perfide Albion la doctrine de la liberté !
Et eux, ne lui empruntent-ils pas les arguties de la protection ?
Nous suivons l’impulsion de Bordeaux et du Midi !
Et eux, ne servent-ils pas la cupidité de Lille et du Nord ?
Nous favorisons les secrets desseins du ministère, qui veut détourner l’attention de sa politique !
Et eux, ne favorisent-ils pas les vues de la liste civile, qui gagne, par le régime protecteur, plus que qui que ce soit au monde ?
Vous voyez donc bien que, si nous ne méprisions cette guerre de dénigrement, les armes ne nous manqueraient pas.
Mais ce n’est pas ce dont il s’agit.
La question, et je ne la perdrai pas de vue, est celle-ci :
Qu’est-ce qui vaut mieux pour les classes laborieuses, être libres, ou n’être pas libres d’acheter au dehors ?
Ouvriers, on vous dit : « Si vous êtes libres d’acheter au dehors ce que vous faites maintenant vous-mêmes, vous ne le ferez plus ; vous serez sans travail, sans salaire et sans pain ; c’est donc pour votre bien qu’on restreint votre liberté. »
Cette objection revient sous toutes les formes. On dit, par exemple : « Si nous nous habillons avec du drap anglais, si nous faisons nos charrues avec du fer anglais, si nous coupons notre pain avec des couteaux anglais, si nous essuyons nos mains dans des serviettes anglaises, que deviendront les ouvriers français, que deviendra le travail national ? »
Dites-moi, ouvriers, si un homme se tenait sur le port de Boulogne, et qu’à chaque Anglais qui débarque, il dit : Voulez-vous me donner ces bottes anglaises, je vous donnerai ce chapeau français ? — Ou bien : Voulez-vous me céder ce cheval anglais, je vous céderai ce tilbury français — Ou bien : Vous plaît-il d’échanger cette machine de Birmingham contre cette pendule de Paris ? — Ou encore : Vous arrange-t-il de troquer cette houille de Newcastle contre ce vin de Champagne ? — Je vous le demande, en supposant que notre homme mît quelque discernement dans ses propositions, peut-on dire que notre travail national, pris en masse, en serait affecté ?
Le serait-il davantage quand il y aurait vingt de ces offreurs de services à Boulogne au lieu d’un, quand il se ferait un million de trocs au lieu de quatre, et quand on ferait intervenir les négociants et la monnaie pour les faciliter et les multiplier à l’infini ?
Or, qu’un pays achète à l’autre en gros pour revendre en détail, ou en détail pour revendre en gros, si on suit la chose jusqu’au bout, on trouvera toujours que le commerce n’est qu’un ensemble de trocs pour trocs, produits contre produits, services pour services. Si donc un troc ne nuit pas au travail national, puisqu’il implique autant de travail national donné que de travail étranger reçu, cent mille millions de trocs ne lui nuiront pas davantage.
Mais où sera le profit ? Direz-vous. — Le profit est de faire le meilleur emploi des ressources de chaque pays, de manière à ce qu’une même somme de travail donne partout plus de satisfaction et de bien-être.
Il y en a qui emploient envers vous une singulière tactique. Ils commencent par convenir de la supériorité du système libre sur le système prohibitif, sans doute pour n’avoir pas à se défendre sur ce terrain.
Ensuite, ils font observer que, dans le passage d’un système à l’autre, il y aura quelque déplacement de travail.
Puis, ils s’étendent sur les souffrances que doit entraîner, selon eux, ce déplacement. Ils les exagèrent, ils les grossissent, ils en font le sujet principal de la question, ils les présentent comme le résultat exclusif et définitif de la réforme, et s’efforcent ainsi de vous enrôler sous le drapeau du monopole.
C’est du reste une tactique qui a été mise au service de tous les abus ; et je dois avouer naïvement une chose, c’est qu’elle embarrasse toujours les amis des réformes même les plus utiles au peuple. — Vous allez comprendre pourquoi.
Quand un abus existe, tout s’arrange là-dessus.
Des existences s’y rattachent, d’autres à celles-là, et puis d’autres encore, et cela forme un grand édifice.
Y voulez-vous porter la main ? Chacun se récrie et — remarquez bien ceci — les criards paraissent toujours, au premier coup d’œil, avoir raison, parce qu’il est plus facile de montrer le dérangement, qui doit accompagner la réforme, que l’arrangement qui doit la suivre.
Les partisans de l’abus citent des faits particuliers ; ils nomment les personnes et leurs fournisseurs et leurs ouvriers qui vont être froissés, — tandis que le pauvre diable de réformateur ne peut s’en référer qu’au bien général qui doit se répandre insensiblement dans les masses. — Cela ne fait pas, à beaucoup près, autant d’effet.
Ainsi, est-il question d’abolir l’esclavage ? — « Malheureux ! dit-on aux noirs, qui va désormais vous nourrir ? Le commandeur distribue des coups de fouet, mais il distribue aussi le manioc. »
Et l’esclave regrette sa chaîne, car il se demande : D’où me viendra le manioc ?
Il ne voit pas que ce n’est pas le commandeur qui le nourrit, mais son propre travail, lequel nourrit aussi le commandeur.
Quand, en Espagne, on réforma les couvents, on disait aux mendiants : « Où trouverez-vous le potage et la bure ? Le prieur est votre Providence. N’est-il pas bien commode de s’adresser à lui ? »
Et les mendiants de dire : « C’est vrai. Si le prieur s’en va, nous voyons bien ce que nous perdrons, mais nous ne voyons pas ce qui nous viendra à la place. »
Ils ne prenaient pas garde que si les couvents faisaient des aumônes, ils en vivaient ; en sorte que le peuple avait plus à leur donner qu’à en recevoir.
De même, ouvriers, le monopole vous met à tous imperceptiblement des taxes sur les épaules, et puis, avec le produit de ces taxes, il vous fait travailler.
Et vos faux amis vous disent : S’il n’y avait pas de monopole, qui vous ferait travailler ?
Et vous répondez : C’est vrai, c’est vrai. Le travail que nous procurent les monopoleurs est certain. Les promesses de la liberté sont incertaines.
Car vous ne voyez pas qu’on vous soutire de l’argent d’abord, et qu’ensuite on vous rend une partie de cet argent contre votre travail.
Vous demandez qui vous fera travailler ? Eh, morbleu ! vous vous donnerez du travail les uns aux autres ! Avec l’argent qu’on ne vous prendra plus, le cordonnier se vêtira mieux et fera travailler le tailleur. Le tailleur renouvellera plus souvent sa chaussure et fera travailler le cordonnier. Et ainsi de suite pour tous les états.
On dit qu’avec la liberté il y aura moins d’ouvriers aux mines et aux filatures.
Je ne le crois pas. Mais si cela arrive, c’est nécessairement qu’il y en aura plus travaillant librement en chambre et au soleil.
Car si ces mines et ces filatures ne se soutiennent, comme on le dit, qu’à l’aide de taxes mises à leur profit sur tout le monde, une fois ces taxes abolies, tout le monde en sera plus aisé, et c’est l’aisance de tous qui alimente le travail de chacun.
Pardonnez-moi si je m’arrête encore sur cette démonstration. Je voudrais tant vous voir du côté de la liberté !
En France, les capitaux engagés dans l’industrie donnent, je suppose, 5 p. 100 de profit. — Mais voici Mondor qui a dans une usine 100,000 fr. qui lui laissent 5 p. 100 de perte. — De la perte au gain, la différence est 10,000 fr. — Que fait-on ? — Tout chattement, on répartit entre vous un petit impôt de 10,000 fr, qu’on donne à Mondor ; vous ne vous en apercevez pas, car la chose est fort habilement déguisée. Ce n’est pas le percepteur qui vient vous demander votre part de l’impôt ; mais vous le payez à Mondor, maître de forges, chaque fois que vous achetez vos haches, vos truelles et vos rabots. — Ensuite on vous dit : Si vous ne payez pas cet impôt, Mondor ne fera plus travailler ; ses ouvriers, Jean et Jacques, seront sans ouvrage. Corbleu ! si on vous remettait l’impôt, ne feriez-vous pas travailler vous-mêmes, et pour votre compte encore ?
Et puis, soyez tranquilles, quand il n’aura plus ce doux oreiller du supplément de prix par l’impôt, Mondor s’ingéniera pour convertir sa perte en bénéfice, et Jean et Jacques ne seront pas renvoyés. Alors, tout sera profit pour tous.
Vous insisterez peut-être, disant : « Nous comprenons qu’après la réforme, il y aura en général plus d’ouvrage qu’avant ; mais, en attendant, Jean et Jacques seront sur la rue. »
À quoi je réponds :
1° Quand l’ouvrage ne se déplace que pour augmenter, l’homme qui a du cœur et des bras n’est pas longtemps sur la rue ;
2° Rien n’empêche que l’État ne réserve quelques fonds pour prévenir, dans la transition, des chômages auxquels, quant à moi, je ne crois pas ;
3° Enfin, si, pour sortir d’une ornière et entrer dans un état meilleur pour tous, et surtout plus juste, il faut absolument braver quelques instants pénibles, les ouvriers sont prêts, ou je les connais mal. Plaise à Dieu qu’il en soit de même des entrepreneurs !
Eh quoi ! parce que vous êtes ouvriers, n’êtes-vous pas intelligents et moraux ? Il semble que vos prétendus amis l’oublient. N’est-il pas surprenant qu’ils traitent devant vous une telle question, parlant de salaires et d’intérêts, sans prononcer seulement le mot justice ? Ils savent pourtant bien que la restriction est injuste. Pourquoi donc n’ont-ils pas le courage de vous en prévenir et de vous dire : « Ouvriers, une iniquité prévaut dans le pays, mais elle vous profite, il faut la soutenir. » — Pourquoi ? parce qu’ils savent que vous répondriez : Non.
Mais il n’est pas vrai que cette iniquité vous profite. Prêtez-moi encore quelques moments d’attention, et jugez vous-mêmes.
Que protége-t-on en France ? Des choses qui se font par de gros entrepreneurs dans de grosses usines, le fer, la houille, le drap, les tissus, et l’on vous dit que c’est, non dans l’intérêt des entrepreneurs, mais dans le vôtre, et pour vous assurer du travail.
Cependant toutes les fois que le travail étranger se présente sur notre marché sous une forme telle qu’il puisse vous nuire, mais qu’il serve les gros entrepreneurs, ne le laisse-t-on pas entrer ?
N’y a-t-il pas à Paris trente mille Allemands qui font des habits et des souliers ? Pourquoi les laisse-t-on s’établir à vos côtés, quand on repousse le drap ? Parce que le drap se fait dans de grandes usines appartenant à des fabricants législateurs. Mais les habits se font en chambre par des ouvriers. Pour convertir la laine en drap, ces messieurs ne veulent pas de concurrence, parce que c’est leur métier ; mais, pour convertir le drap en habits, ils l’admettent fort bien, parce que c’est le vôtre.
Quand on a fait des chemins de fer, on a repoussé les rails anglais, mais on a fait venir des ouvriers anglais. Pourquoi ? Eh ! c’est tout simple : parce que les rails anglais font concurrence aux grandes usines, et que les bras anglais ne font concurrence qu’à vos bras.
Nous ne demandons pas, nous, qu’on repousse les tailleurs allemands et les terrassiers anglais. Nous demandons qu’on laisse entrer les draps et les rails. Nous demandons justice pour tous, égalité devant la loi pour tous !
C’est une dérision que de venir nous dire que la restriction douanière a en vue votre avantage. Tailleurs, cordonniers, charpentiers, menuisiers, maçons, forgerons, marchands, épiciers, horlogers, bouchers, boulangers, tapissiers, modistes, je vous mets au défi de me citer une seule manière dont la restriction vous profite et, quand vous voudrez, je vous en citerai quatre par où elle vous nuit.
Et après tout, cette abnégation que vos journaux attribuent aux monopoleurs, voyez combien elle est vraisemblable.
Je crois qu’on peut appeler taux naturel des salaires celui qui s’établirait naturellement sous le régime de la liberté. Lors donc qu’on vous dit que la restriction vous profite, c’est comme si on vous disait qu’elle ajoute un excédant à vos salaires naturels. Or, un excédant extra-naturel de salaires doit être pris quelque part ; il ne tombe pas de la lune, et il doit être pris sur ceux qui le payent.
Vous êtes donc conduits à cette conclusion que, selon vos prétendus amis, le régime protecteur a été créé et mis au monde pour que les capitalistes fussent sacrifiés aux ouvriers.
Dites, cela est-il probable ?
Où est donc votre place à la chambre des pairs ? Quand est-ce que vous avez siégé au Palais-Bourbon ? Qui vous a consultés ? D’où vous est venue cette idée d’établir le régime protecteur ?
Je vous entends me répondre : Ce n’est pas nous qui l’avons établi. Hélas ! nous ne sommes ni pairs ni députés, ni conseillers d’État. Ce sont les capitalistes qui ont fait la chose.
Par le grand Dieu du ciel ! Ils étaient donc bien disposés ce jour-là ! Quoi ! les capitalistes ont fait la loi ; ils ont établi le régime prohibitif, et cela pour que vous, ouvriers, fissiez des profits à leurs dépens !
Mais voici qui est plus étrange encore.
Comment se fait il que vos prétendus amis, qui vous parlent aujourd’hui de la bonté, de la générosité, de l’abnégation des capitalistes, vous plaignent sans cesse de ne pas jouir de vos droits politiques ? À leur point de vue, qu’en pourriez-vous faire ? — Les capitalistes ont le monopole de la législation ; c’est vrai. Grâce à ce monopole, ils se sont adjugé le monopole du fer, du drap, de la toile, de la houille, du bois, de la viande, c’est encore vrai. Mais voici vos prétendus amis qui disent qu’en agissant ainsi, les capitalistes se sont dépouillés sans y être obligés, pour vous enrichir sans que vous y eussiez droit ! Assurément, si vous étiez électeurs et députés, vous ne feriez pas mieux vos affaires ; vous ne les feriez même pas si bien.
Si l’organisation industrielle qui nous régit est faite dans votre intérêt, c’est donc une perfidie de réclamer pour vous des droits politiques ; car ces démocrates d’un nouveau genre ne sortiront jamais de ce dilemme : la loi, faite par la bourgeoisie, vous donne plus ou vous donne moins que vos salaires naturels. Si elle vous donne moins, ils vous trompent en vous invitant à la soutenir. Si elle vous donne plus, ils vous trompent encore en vous engageant à réclamer des droits politiques, alors que la bourgeoisie vous fait des sacrifices que, dans votre honnêteté, vous n’oseriez pas voter.
Ouvriers, à Dieu ne plaise que cet écrit ait pour effet de jeter dans vos cœurs des germes d’irritation contre les classes riches ! Si des intérêts mal entendus ou sincèrement alarmés soutiennent encore le monopole, n’oublions pas qu’il a sa racine dans des erreurs qui sont communes aux capitalistes et aux ouvriers. Loin donc de les exciter les uns contre les autres, travaillons à les rapprocher. Et pour cela que faut-il faire ? S’il est vrai que les naturelles tendances sociales concourent à effacer l’inégalité parmi les hommes, il ne faut que laisser agir ces tendances, éloigner les obstructions artificielles qui en suspendent l’effet, et laisser les relations des classes diverses s’établir sur le principe de la justice qui se confond, du moins dans mon esprit, avec le principe de la liberté [173].
VII. Conte chinois↩
On crie à la cupidité, à l’égoïsme du siècle !
Pour moi, je vois que le monde, Paris surtout, est peuplé de Décius.
Ouvrez les mille volumes, les mille journaux, les mille feuilletons que les presses parisiennes vomissent tous les jours sur le pays ; tout cela n’est il pas l’œuvre de petits saints ?
Quelle verve dans la peinture des vices du temps ! Quelle tendresse touchante pour les masses ! Avec quelle libéralité on invite les riches à partager avec les pauvres, sinon les pauvres à partager avec les riches ! Que de plans de réformes sociales, d’améliorations sociales, d’organisations sociales ! Est-il si mince écrivain qui ne se dévoue au bien-être des classes laborieuses ? Il ne s’agit que de leur avancer quelques écus pour leur procurer le loisir de se livrer à leurs élucubrations humanitaires.
Et l’on parle ensuite de l’égoïsme, de l’individualisme de notre époque !
Il n’y a rien qu’on n’ait la prétention de faire servir au bien-être et à la moralisation du peuple, rien, pas même la Douane. — Vous croyez peut être que c’est une machine à impôts, comme l’octroi, comme le péage au bout du pont ? Point du tout. C’est une institution essentiellement civilisatrice, fraternitaire et égalitaire. Que voulez-vous ? c’est la mode. Il faut mettre ou affecter de mettre du sentiment, du sentimentalisme partout, jusque dans la guérite du qu’as-tu là ?
Mais pour réaliser ces aspirations philanthropiques, la douane, il faut l’avouer, a de singuliers procédés.
Elle met sur pied une armée de directeurs, sous-directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, contrôleurs, vérificateurs, receveurs, chefs, sous-chefs, commis, surnuméraires, aspirants-surnuméraires et aspirants à l’aspirance, sans compter le service actif, et tout cela pour arriver à exercer sur l’industrie du peuple cette action négative qui se résume par le mot empêcher.
Remarquez que je ne dis pas taxer, mais bien réellement empêcher.
Et empêcher non des actes réprouvés par les mœurs ou contraires à l’ordre public, mais des transactions innocentes et mêmes favorables, on en convient, à la paix et à l’union des peuples.
Cependant l’humanité est si flexible et si souple que, de manière ou d’autre, elle surmonte toujours les empêchements. C’est l’affaire d’un surcroît de travail.
Empêche-t-on un peuple de tirer ses aliments du dehors, il les produit au dedans. C’est plus pénible, mais il faut vivre. L’empêche-t-on de traverser la vallée, il franchit les pics. C’est plus long, mais il faut arriver.
Voilà qui est triste, mais voici qui est plaisant. Quand la loi a créé ainsi une certaine somme d’obstacles, et que, pour les vaincre, l’humanité a détourné une somme correspondante de travail, vous n’êtes plus admis à demander la réforme de la loi ; car si vous montrez l’obstacle, on vous montre le travail qu’il occasionne, et si vous dites : Ce n’est pas là du travail créé, mais détourné, on vous répond comme l’Esprit public : — « L’appauvrissement seul est certain et immédiat ; quant à l’enrichissement, il est plus qu’hypothétique. »
Ceci me rappelle une histoire chinoise que je vais vous conter.
Il y avait en Chine deux grandes villes : Tchin et Tchan. Un magnifique canal les unissait. L’empereur jugea à propos d’y faire jeter d’énormes quartiers de roche pour le mettre hors de service.
Ce que voyant, Kouang, son premier mandarin, lui dit :
— Fils du Ciel, vous faites une faute.
À quoi l’empereur répondit :
— Kouang, vous dites une sottise.
Je ne rapporte ici, bien entendu, que la substance du dialogue.
Au bout de trois lunes, le céleste empereur fit venir le mandarin et lui dit :
— Kouang, regardez.
Et Kouang, ouvrant les yeux, regarda.
Et il vit, à une certaine distance du canal, une multitude d’hommes travaillant. Les uns faisaient des déblais, les autres des remblais, ceux-ci nivelaient, ceux-là pavaient, et le mandarin, qui était fort lettré, pensa en lui-même : Ils font une route.
Au bout de trois autres lunes, l’empereur, ayant appelé Kouang, lui dit :
— Regardez.
Et Kouang regarda.
Et il vit que la route était faite, et il remarqua que le long du chemin, de distance en distance, s’élevaient des hôtelleries. Une cohue de piétons, de chars, de palanquins allaient et venaient, et d’innombrables Chinois, accablés par la fatigue, portaient et reportaient de lourds fardeaux de Tchin à Tchan et de Tchan à Tchin. — Et Kouang se dit : C’est la destruction du canal qui donne du travail à ces pauvres gens. Mais l’idée ne lui vint pas que ce travail était détourné d’autres emplois.
Et trois lunes se passèrent, et l’empereur dit à Kouang :
— Regardez.
Et Kouang regarda.
Et il vit que les hôtelleries étaient toujours pleines de voyageurs, et que ces voyageurs ayant faim, il s’était groupé autour d’elles des boutiques de bouchers, boulangers, charcutiers et marchands de nids d’hirondelles. — Et que ces honnêtes artisans ne pouvant aller nus, il s’était aussi établi des tailleurs, des cordonniers, des marchands de parasols et d’éventails, et que, comme on ne couche pas à la belle étoile, même dans le Céleste Empire, des charpentiers, des maçons et couvreurs étaient accourus. Puis vinrent des officiers de police, des juges, des fakirs ; en un mot, il se forma une ville avec ses faubourgs autour de chaque hôtellerie.
Et l’empereur dit à Kouang : Que vous en semble ?
Et Kouang répondit : Je n’aurais jamais cru que la destruction d’un canal put créer pour le peuple autant de travail ; car l’idée ne lui vint pas que ce n’était pas du travail créé, mais détourné ; que les voyageurs mangeaient, lorsqu’ils passaient sur le canal aussi bien que depuis qu’ils étaient forcés de passer sur la route.
Cependant, au grand étonnement des Chinois, l’empereur mourut et ce fils du Ciel fut mis en terre.
Son successeur manda Kouang, et lui dit : Faites déblayer le canal.
Et Kouang dit au nouvel empereur :
— Fils du Ciel, vous faites une faute.
Et l’empereur répondit :
— Kouang, vous dites une sottise.
Mais Kouang insista et dit : Sire, quel est votre but ?
— Mon but, dit l’empereur, est de faciliter la circulation des hommes et des choses entre Tchin et Tchan, de rendre le transport moins dispendieux, afin que le peuple ait du thé et des vêtements à meilleur marché.
Mais Kouang était tout préparé. Il avait reçu la veille quelques numéros du Moniteur industriel, journal chinois. Sachant bien sa leçon, il demanda la permission de répondre, et l’ayant obtenue, après avoir frappé du front le parquet par neuf fois, il dit :
« Sire, vous aspirez à réduire, par la facilité du transport, le prix des objets de consommation pour les mettre à la portée du peuple, et pour cela, vous commencez par lui faire perdre tout le travail que la destruction du canal avait fait naître. Sire, en économie politique, le bon marché absolu… — L’empereur : Je crois que vous récitez. — Kouang : C’est vrai : il me sera plus commode de lire. — Et ayant déployé l’Esprit public, il lut : « En économie politique, le bon marché absolu des objets de consommation n’est que la question secondaire. Le problème réside dans l’équilibre du prix du travail avec celui des objets nécessaires à l’existence. L’abondance du travail est la richesse des nations, et le meilleur système économique est celui qui leur fournit la plus grande somme de travail possible. N’allez pas demander s’il faut mieux payer une tasse de thé 4 cash ou 8 cash, une chemise 5 taels ou 10 taels. Ce sont là des puérilités indignes d’un esprit grave. Personne ne conteste votre proposition. La question est de savoir s’il vaut mieux payer un objet plus cher et avoir, par l’abondance et le prix du travail, plus de moyens de l’acquérir ; ou bien s’il vaut mieux appauvrir les sources du travail, diminuer la masse de la population nationale, transporter par des chemins qui marchent les objets de consommation, à meilleur marché, il est vrai, mais en même temps enlever à une portion de nos travailleurs les possibilités de les acheter même à ces prix réduits. »
L’empereur n’étant pas bien convaincu, Kouang lui dit : Sire, daignez attendre. J’ai encore le Moniteur industriel à citer.
Mais l’empereur dit :
— Je n’ai pas besoin de vos journaux chinois pour savoir que créer des obstacles, c’est appeler le travail de ce côté. Mais ce n’est pas ma mission. Allez, désobstruez le canal. Ensuite nous réformerons la douane.
Et Kouang s’en alla, s’arrachant la barbe et criant : Ô Fô ! ô Pê ! ô Lî ! et tous les dieux monosyllabiques et circonflexes du Cathay, prenez en pitié votre peuple ; car il nous est venu un empereur de l’école anglaise, et je vois bien qu’avant peu nous manquerons de tout, puisque nous n’aurons plus besoin de rien faire.
VIII. Post hoc, ergo proper hoc↩
Le plus commun et le plus faux des raisonnements.
Des souffrances réelles se manifestent en Angleterre.
Ce fait vient à la suite de deux autres :
1° La réforme douanière ;
2° La perte de deux récoltes consécutives.
À laquelle de ces deux dernières circonstances faut-il attribuer la première ?
Les protectionistes ne manquent pas de s’écrier : « C’est cette liberté maudite qui fait tout le mal. Elle nous promettait monts et merveilles, nous l’avons accueillie, et voilà que les fabriques s’arrêtent et le peuple souffre : Cum hoc, ergo propter hoc. »
La liberté commerciale distribue de la manière la plus uniforme et la plus équitable les fruits que la Providence accorde au travail de l’homme. Si ces fruits sont enlevés, en partie, par un fléau, elle ne préside pas moins à la bonne distribution de ce qui en reste. Les hommes sont moins bien pourvus, sans doute ; mais faut-il s’en prendre à la liberté ou au fléau ?
La liberté agit sur le même principe que les assurances. Quand un sinistre survient, elle répartit sur un grand nombre d’hommes, sur un grand nombre d’années, des maux qui, sans elle, s’accumuleraient sur un peuple et sur un temps. Or, s’est-on jamais avisé de dire que l’incendie n’est plus un fléau depuis qu’il y a des assurances ?
Eu 1842, 43 et 44, la réduction des taxes a commencé en Angleterre. En même temps les récoltes y ont été très-abondantes, et il est permis de croire que ces deux circonstances ont concouru à la prospérité inouïe dont ce pays a donné le spectacle pendant cette période.
En 1845, la récolte a été mauvaise : en 1846, plus mauvaise encore.
Les aliments ont renchéri ; le peuple a dépensé ses ressources pour se nourrir, et restreint ses autres consommations. Les vêtements ont été moins demandés, les fabriques moins occupées, et le salaire a manifesté une tendance à la baisse. Heureusement que, dans cette même année, les barrières restrictives ayant été de nouveau abaissées, une masse énorme d’aliments a pu parvenir sur le marché anglais. Sans cette circonstance, il est à peu près certain qu’en ce moment une révolution terrible ensanglanterait la Grande-Bretagne.
Et l’on vient accuser la liberté des désastres qu’elle prévient et répare du moins en partie !
Un pauvre lépreux vivait dans la solitude. Ce qu’il avait touché, nul ne le voulait toucher. Réduit à se suffire à lui-même, il traînait dans ce monde une misérable existence. Un grand médecin le guérit. Voilà notre solitaire eu pleine possession de la liberté des échanges. Quelle belle perspective s’ouvrait devant lui ! Il se plaisait à calculer le bon parti que, grâce à ses relations avec les autres hommes, il pourrait tirer de ses bras vigoureux. Il vint à se les rompre tous les deux. Hélas ! son sort fut plus horrible. Les journalistes de ce pays, témoins de sa misère, disaient : « Voyez à quoi l’a réduit la faculté d’échanger ! Vraiment, il était moins à plaindre quand il vivait seul. — Eh ! quoi, répondait le médecin, ne tenez-vous aucun compte de ses deux bras cassés ? n’entrent-ils pour rien dans sa triste destinée ? Son malheur est d’avoir perdu les bras, et non point d’être guéri de la lèpre. Il serait bien plus à plaindre s’il était manchot et lépreux par dessus le marché. »
Post hoc, ergo propter hoc ; méfiez-vous de ce sophisme.
IX. Le vol à la prime↩
On trouve mon petit livre des Sophismes trop théorique, scientifique, métaphysique. Soit. Essayons du genre trivial, banal, et, s’il le faut, brutal. Convaincu que le public est dupe à l’endroit de la protection, je le lui ai voulu prouver. Il préfère qu’on le lui crie. Donc vociférons :
Midas, le roi Midas a des oreilles d’àne !
Une explosion de franchise fait mieux souvent que les circonlocutions les plus polies. Vous vous rappelez Oronte et le mal qu’a le misanthrope, tout misanthrope qu’il est, à le convaincre de sa folie.
| Alceste. | On s’expose à jouer un mauvais personnage. |
| Oronte. | Est-ce que vous voulez me déclarer par là 12194.Que j’ai tort de vouloir… |
| Alceste. | Je ne dis pas cela. Mais… |
| Oronte. | Est-ce que j’écris mal ? |
| Alceste. | Je ne dis pas cela. Mais enfin… |
| Oronte. | Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet ?… |
| Alceste. | Franchement, il est bon à mettre au cabinet. |
Franchement, bon public, on te vole. C’est cru, mais c’est clair.
Les mots vol, voler, voleur, paraîtront de mauvais goût à beaucoup de gens. Je leur demanderai comme Harpagon à Élise : Est-ce le mot ou la chose qui vous fait peur ?
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. » (C. pén. art. 379.)
Voler : Prendre furtivement ou par force. (Dictionnaire de l’Académie.)
Voleur : Celui qui exige plus qu’il ne lui est dû. (Id.)
Or, le monopoleur qui, de par une loi de sa façon, m’oblige à lui payer 20 fr. ce que je puis avoir ailleurs pour 15, ne me soustrait-il pas frauduleusement 5 fr. qui m’appartiennent ?
Ne prend-il pas furtivement ou par force ?
N’exige-t-il pas plus qu’il ne lui est dû ?
Il soustrait, il prend, il exige, dira-t-on ; mais non point furtivement ou par force ; ce qui caractériserait le vol.
Lorsque nos bulletins de contributions se trouvent chargés des 5 fr. pour la prime, que soustrait, prend ou exige le monopoleur, quoi de plus furtif, puisque si peu d’entre nous s’en doutent ? Et pour ceux qui ne sont pas dupes, quoi de plus forcé, puisqu’au premier refus le garnisaire est à nos portes ?
Au reste, que les monopoleurs se rassurent. Les vols à la prime ou au tarif, s’ils blessent l’équité tout aussi bien que le vol à l’américaine, ne violent pas la loi ; ils se commettent, au contraire, de par la loi ; ils n’en sont que pires, mais ils n’ont rien à démêler avec la correctionnelle.
D’ailleurs, bon gré, mal gré, nous sommes tous voleurs et volés en cette affaire. L’auteur de ce volume a beau crier au voleur quand il achète, on peut crier après lui quand il vend [174] ; s’il diffère de beaucoup de ses compatriotes, c’est seulement en ceci : il sait qu’il perd au jeu plus qu’il n’y gagne, et eux ne le savent pas ; s’ils le savaient, le jeu cesserait bientôt.
Je ne me vante pas, au surplus, d’avoir le premier restitué à la chose son vrai nom. Voici plus de soixante ans que Smith disait :
« Quand des industriels s’assemblent, on peut s’attendre à ce qu’une conspiration va s’ourdir contre les poches du public. » Faut-il s’en étonner, puisque le public n’en prend aucun souci ?
Or donc, une assemblée d’industriels délibère officiellement sous le nom de Conseils généraux. Que s’y passe-t-il et qu’sy résout-on ?
Voici, fort en abrégé, le procès-verbal d’une séance.
« Un armateur. Notre marine est aux abois (digression belliqueuse). Cela n’est pas surprenant, je ne saurais construire sans fer. J’en trouve bien 10 fr. sur le marché du monde ; mais, de par la loi, le maître de forges français me force à le lui payer 15 fr. : c’est donc 5 fr. qu’il me soustrait. Je demande la liberté d’acheter où bon me semble.
« Un maître de forges. Sur le marché du monde, je trouve à faire opérer des transports à 20 fr. — Législativement, l’armateur en exige 30 : c’est donc 10 fr. qu’il me prend. Il me pille, je le pille ; tout est pour le mieux.
« Un homme d’État. La conclusion de l’armateur est bien imprudente. Oh ! cultivons l’union touchante qui fait notre force ; si nous effaçons un iota à la théorie de la protection, adieu la théorie entière.
« L’armateur. Mais pour nous la protection a failli : je répète que la marine est aux abois.
« Un marin. Eh bien ! relevons la surtaxe, et que l’armateur, qui prend 30 au public pour son fret, en prenne 40.
« Un ministre. Le gouvernement poussera jusqu’aux dernières limites le beau mécanisme de la surtaxe ; mais je crains que cela ne suffise pas [175].
« Un fonctionnaire. Vous voilà tous bien empêchés pour peu de chose. N’y a-t-il de salut que dans le tarif, et oubliez-vous l’impôt ? Si le consommateur est bénévole, le contribuable ne l’est pas moins. Accablons-le de taxes, et que l’armateur soit satisfait. Je propose 5 fr. de prime, à prendre sur les contributions publiques, pour être livrés au constructeur pour chaque quintal de fer qu’il emploiera.
« Voix confuses. Appuyé, appuyé ! Un agriculteur : À moi 3 fr. de prime par hectolitre de blé ! Un tisserand : À moi 2 fr. de prime par mètre de toile ! etc., etc.
« Le président. Voilà qui est entendu ; notre session aura enfanté le système des primes, et ce sera sa gloire éternelle. Quelle industrie pourra perdre désormais, puisque nous avons deux moyens si simples de convertir les pertes en profits : le tarif et la prime ? La séance est levée. »
Il faut que quelque vision surnaturelle m’ait montré en songe la prochaine apparition de la prime (qui sait même si je n’en ai pas suggéré la pensée à M. Dupin), lorsqu’il y a quelques mois j’écrivais ces paroles :
« Il me semble évident que la protection aurait pu, sans changer de nature et d’effets, prendre la forme d’une taxe directe prélevée par l’État et distribuée en primes indemnitaires aux industries privilégiées. »
Et après avoir comparé le droit protecteur à la prime :
« J’avoue franchement ma prédilection pour ce dernier système ; il me semble plus juste, plus économique et plus loyal. Plus juste, parce que si la société veut faire des largesses à quelques-uns de ses membres, il faut que tous y contribuent ; plus économique, parce qu’il épargnerait beaucoup de frais de perception et ferait disparaître beaucoup d’entraves ; plus loyal enfin, parce que le public verrait clair dans l’opération et saurait ce qu’on lui fait faire [176]. »
Puisque l’occasion nous en est si bénévolement offerte, étudions le vol à la prime. Aussi bien, ce qu’on en peut dire s’applique au vol au tarif, et comme celui-ci est un peu mieux déguisé, le filoutage direct aidera à comprendre le filoutage indirect. L’esprit procède ainsi du simple au composé.
Mais quoi ! n’y a-t-il pas quelque variété de vol plus simple encore ? Si fait, il y a le vol de grand chemin : il ne lui manque que d’être légalisé, monopolisé, ou, comme on dit aujourd’hui, organisé.
Or, voici ce que je lis dans un récit de voyages :
« Quand nous arrivâmes au royaume de A…, toutes les industries se disaient en souffrance. L’agriculture gémissait, la fabrique se plaignait, le commerce murmurait, la marine grognait et le gouvernement ne savait à qui entendre. D’abord, il eut la pensée de taxer d’importance tous les mécontents, et de leur distribuer le produit de ces taxes, après s’être fait sa part : c’eût été comme, dans notre chère Espagne, la loterie. Vous êtes mille, l’État vous prend une piastre à chacun ; puis subtilement il escamote 250 piastres, et en répartit 750, en lots plus ou moins forts, entre les joueurs. Le brave Hidalgo qui reçoit trois quarts de piastre, oubliant qu’il a donné piastre entière, ne se possède pas de joie et court dépenser ses quinze réaux au cabaret. C’eût été encore quelque chose comme ce qui se passe en France. Quoi qu’il en soit, tout barbare qu’était le pays, le gouvernement ne compta pas assez sur la stupidité des habitants pour leur faire accepter de si singulières protections, et voici ce qu’il imagine.
« La contrée était sillonnée de routes. Le gouvernement les fit exactement kilométrer, puis il dit à l’agriculteur : « Tout ce que tu pourrais voler aux passants entre ces deux bornes est à toi : que cela te serve de prime, de protection, d’encouragement. » Ensuite, il assigna à chaque manufacturier, à chaque armateur, une portion de route à exploiter, selon cette formule :
Dono tibi et concendo
Virtutem et puissantiam
Volandi,
Pillandi,
Derobandi,
Filoutandi,
Et escroquandi,
Impunè per totam istam
Viam.
« Or, il est arrivé que les naturels du royaume de A… sont aujourd’hui si familiarisés avec ce régime, si habitués à ne tenir compte que de ce qu’ils volent et non de ce qui leur est volé, si profondément enclins à ne considérer le pillage qu’au point de vue du pillard, qu’ils regardent comme un profit national la somme de tous les vols particuliers, et refusent de renoncer à un système de protection en dehors duquel, disent-ils, il n’est pas une industrie qui puisse se suffire. »
Vous vous récriez ? Il n’est pas possible, dites-vous, que tout un peuple consente à voir un surcroît de richesses dans ce que les habitants se dérobent les uns aux autres.
Et pourquoi pas ? Nous avons bien cette conviction en France, et tous les jours nous y organisons et perfectionnons le vol réciproque sous le nom de primes et tarifs protecteurs.
N’exagérons rien toutefois : convenons que, sous le rapport du mode de perception et quant aux circonstances collatérales, le système du royaume de A… peut être pire que le nôtre ; mais disons aussi que, quant aux principes et aux effets nécessaires, il n’y a pas un atome de différence entre toutes ces espèces de vols légalement organisés pour fournir des suppléments de profits à l’industrie.
Remarquez que si le vol de grand chemin présente quelques inconvénients d’exécution, il a aussi des avantages qu’on ne trouve pas dans le vol au tarif.
Par exemple : on en peut faire une répartition équitable entre tous les producteurs. Il n’en est pas de même des droits de douane. Ceux-ci sont impuissants par leur nature à protéger certaines classes de la société, telles que artisans, marchands, hommes de lettres, hommes de robe, hommes d’épée, hommes de peine, etc, etc.
Il est vrai que le vol à la prime se prête aussi à des subdivisions infinies, et, sous ce rapport, il ne le cède pas en perfection au vol de grand chemin ; mais, d’un autre côté, il conduit souvent à des résultats si bizarres, si jocrisses, que les naturels du royaume de A… s’en pourraient moquer avec grande raison.
Ce que perd le volé, dans le vol de grand chemin, est gagné par le voleur. L’objet dérobé reste au moins dans le pays. Mais, sous l’empire du vol à la prime, ce que l’impôt soustrait aux Français est conféré souvent aux Chinois, aux Hottentots, aux Cafres, aux Algonquins, et voici comme :
Une pièce de drap vaut cent francs à Bordeaux. Il est impossible de la vendre au-dessous, sans y perdre. Il est impossible de la vendre au-dessus, la concurrence entre les marchands s’y oppose. Dans ces circonstances, si un Français se présente pour avoir ce drap, il faudra qu’il le paie cent francs, ou qu’il s’en passe. Mais si c’est un Anglais, alors le gouvernement intervient et dit au marchand : Vends ton drap, je te ferai donner vingt francs par les contribuables. Le marchand, qui ne veut ni ne peut tirer que cent francs de son drap, le livre à l’Anglais pour 80 francs. Cette somme, ajoutée aux 20 francs, produit du vol à la prime, fait tout juste son compte. C’est donc exactement comme si les contribuables eussent donné 20 francs à l’Anglais, sous la condition d’acheter du drap français à 20 francs de rabais, à 20 francs au-dessous des frais de production, à 20 francs au-dessous de ce qu’il nous coûte à nous-mêmes. Donc, le vol à la prime a ceci de particulier, que les volés sont dans le pays qui le tolère, et les voleurs disséminés sur la surface du globe.
Vraiment, il est miraculeux que l’on persiste à tenir pour démontrée cette proposition : Tout ce que l’individu vole à la masse est un gain général. Le mouvement perpétuel, la pierre philosophale, la quadrature du cercle sont tombés dans l’oubli ; mais la théorie du Progrès par le vol est encore en honneur. À priori pourtant, on aurait pu croire que de toutes les puérilités c’était la moins viable.
Il y en a qui nous disent : Vous êtes donc les partisans du laissez passer ? des économistes de l’école surannée des Smith et des Say ? Vous ne voulez donc pas l’organisation du travail ? Eh ! messieurs, organisez le travail tant qu’il vous plaira. Mais nous veillerons, nous, à ce que vous n’organisiez pas le vol.
D’autres plus nombreux répètent : primes, tarifs, tout cela a pu être exagéré. Il en faut user sans en abuser. Une sage liberté, combinée avec une protection modérée, voilà ce que réclament les hommes sérieux et pratiques. Gardons-nous des principes absolus.
C’est précisément, selon le voyageur espagnol, ce qui se disait au royaume de A… « Le vol de grand chemin, disaient les sages, n’est ni bon ni mauvais ; cela dépend des circonstances. Il ne s’agit que de bien pondérer les choses, et de nous bien payer, nous fonctionnaires, pour cette œuvre de pondération. Peut-être a-t-on laissé au pillage trop de latitude, peut-être pas assez. Voyons, examinons, balançons les comptes de chaque travailleur. À ceux qui ne gagnent pas assez, nous donnerons un peu plus de route à exploiter. Pour ceux qui gagnent trop, nous réduirons les heures, jours ou mois de pillage, »
Ceux qui parlaient ainsi s’acquirent un grand renom de modération, de prudence et de sagesse. Ils ne manquaient jamais de parvenir aux plus hautes fonctions de l’État.
Quant à ceux qui disaient : Réprimons les injustices et les fractions d’injustice ; ne souffrons ni vol, ni demi-vol ni quart de vol, ceux-là passaient pour des idéologues, des rêveurs ennuyeux qui répétaient toujours la même chose. Le peuple, d’ailleurs, trouvait leurs raisonnements trop à sa portée. Le moyen de croire vrai ce qui est si simple !
X. Le percepteur↩
Jacques Bonhomme, Vigneron ;
M. Lasouche, Percepteur.
L. Vous avez récolté vingt tonneaux de vin ?
J. Oui, à force de soins et de sueurs.
— Ayez la bonté de m’en délivrer six et des meilleurs.
— Six tonneaux sur vingt ! bonté du ciel ! vous me voulez ruiner. Et, s’il vous plaît, à quoi les destinez-vous ?
— Le premier sera livré aux créanciers de l’État. Quand on a des dettes, c’est bien le moins d’en servir les intérêts.
— Et où a passé le capital ?
— Ce serait trop long à dire. Une partie fut mise jadis en cartouches qui firent la plus belle fumée du monde. Un autre soldait des hommes se faisant estropier sur la terre étrangère après l’avoir ravagée. Puis, quand ces dépenses eurent attiré chez nous nos amis les ennemis, ils n’ont pas voulu déguerpir sans emporter de l’argent, qu’il fallut emprunter.
— Et que m’en revient-il aujourd’hui ?
— La satisfaction de dire :
Que je suis fier d’être Français
Quand je regarde la colonne !
— Et l’humiliation de laisser à mes héritiers une terre grevée d’une rente perpétuelle. Enfin, il faut bien payer ce qu’on doit, quelque fol usage qu’on en ait fait. Va pour un tonneau, mais les cinq autres ?
— Il en faut un pour acquitter les services publics, la liste civile, les juges qui vous font restituer le sillon que votre voisin veut s’approprier, les gendarmes qui chassent aux larrons pendant que vous dormez, le cantonnier qui entretient le chemin qui vous mène à la ville, le curé qui baptise vos enfants, l’instituteur qui les élève, et votre serviteur qui ne travaille pas pour rien.
— À la bonne heure, service pour service. Il n’y rien à dire. J’aimerais tout autant m’arranger directement avec mon curé et mon maître d’école ; mais je n’insiste pas là-dessus, va pour le second tonneau. Il y a loin jusqu’à six.
— Croyez-vous que ce soit trop de deux tonneaux pour votre contingent aux frais de l’armée et de la marine ?
— Hélas ! c’est peu de chose, eu égard à ce qu’elles me coûtent déjà ; car elles m’ont enlevé deux fils que j’aimais tendrement.
— Il faut bien maintenir l’équilibre des forces européennes.
— Eh, mon Dieu ! l’équilibre serait le même, si l’on réduisait partout ces forces de moitié ou des trois quarts. Nous conserverions nos enfants et nos revenus. Il ne faudrait que s’entendre.
— Oui ; mais on ne s’entend pas.
— C’est ce qui m’abasourdit. Car, enfin, chacun en souffre.
— Tu l’as voulu, Jacques Bonhomme.
— Vous faites le plaisant, monsieur le percepteur, est-ce que j’ai voix au chapitre ?
— Qui avez-vous nommé pour député ?
— Un brave général d’armée, qui sera maréchal sous peu si Dieu lui prête vie.
— Et sur quoi vit le brave général ?
— Sur mes tonneaux, à ce que j’imagine.
— Et qu’adviendrait-il s’il votait la réduction de l’armée et de votre contingent ?
— Au lieu d’être fait maréchal, il serait mis à la retraite.
— Comprenez-vous maintenant que vous avez vous-même…
— Passons au cinquième tonneau, je vous prie.
— Celui-ci part pour l’Algérie.
— Pour l’Algérie ! Et l’on assure que tous les musulmans sont œnophobes, les barbares ! Je me suis même demandé souvent s’ils ignorent le médoc parce qu’ils sont mécréants, ou, ce qui est plus probable, s’ils sont mécréants parce qu’ils ignorent le médoc. D’ailleurs, quels services me rendent-ils en retour de cette ambroisie qui m’a tant coûté de travaux ?
— Aucun ; aussi n’est-elle pas destinée à des musulmans, mais à de bons chrétiens qui passent tous les jours en Barbarie.
— Et qu’y vont-ils faire qui puisse m’être utile ?
— Exécuter des razzias et en subir ; tuer et se faire tuer ; gagner des dyssenteries et revenir se faire traiter ; creuser des ports, percer des routes, bâtir des villages et les peupler de Maltais, d’Italiens, d’Espagnols et de Suisses qui vivent sur votre tonneau et bien d’autres tonneaux que je viendrai vous demander encore.
— Miséricorde ! ceci est trop fort, je vous refuse net mon tonneau. On enverrait à Bicêtre un vigneron qui ferait de telles folies. Percer des routes dans l’Atlas, grand Dieu ! quand je ne puis sortir de chez moi ! Creuser des ports en Barbarie quand la Garonne s’ensable tous les jours ! M’enlever mes enfants que j’aime pour aller tourmenter les Kabyles ! Me faire payer les maisons, les semences et les chevaux qu’on livre aux Grecs et aux Maltais, quand il y a tant de pauvres autour de nous !
— Des pauvres ! justement, on débarrasse le pays de ce trop-plein.
— Grand merci ! en les faisant suivre en Algérie du capital qui les ferait vivre ici.
— Et puis vous jetez les bases d’un grand empire, vous portez la civilisation en Afrique, et vous décorez votre patrie d’une gloire immortelle.
— Vous êtes poëte, monsieur le percepteur ; mais moi je sui s vigneron, et je refuse.
— Considérez que, dans quelque mille ans, vous recouvrerez vos avances au centuple. C’est ce que disent ceux qui dirigent l’entreprise.
— En attendant, ils ne demandaient d’abord, pour parer aux frais, qu’une pièce de vin, puis deux, puis trois, et me voilà taxé à un tonneau ! Je persiste dans mon refus.
— Il n’est plus temps. Votre chargé de pouvoirs a stipulé pour vous l’octroi d’un tonneau ou quatre pièces entières.
— Il n’est que trop vrai. Maudite faiblesse ! Il me semblait aussi en lui donnant ma procuration que je commettais une imprudence, car qu’y a-t-il de commun entre un général d’armée et un vigneron ?
— Vous voyez bien qu’il y a quelque chose de commun entre vous, ne fût-ce que le vin que vous récoltez et qu’il se vote à lui-même, en votre nom.
— Raillez-moi, je le mérite, monsieur le percepteur. Mais soyez raisonnable, là, laissez-moi au moins le sixième tonneau. Voilà l’intérêt des dettes payé, la liste civile pourvue, les services publics assurés, la guerre d’Afrique perpétuée. Que voulez-vous de plus ?
— On ne marchande pas avec moi. Il fallait dire vos intentions à M. le général. Maintenant, il a disposé de votre vendange.
— Maudit grognard ! Mais enfin, que voulez-vous faire de ce pauvre tonneau, la fleur de mon chai ? Tenez, goûtez ce vin. Comme il est moelleux, corsé, étoffé, velouté, rubané !…
— Excellent ! délicieux ! Il fera bien l’affaire de M. D… le fabricant de draps.
— De M. D… le fabricant ? Que voulez-vous dire ?
— Qu’il en tirera un bon parti.
— Comment ? qu’est-ce ? Du diable si je vous comprends !
— Ne savez-vous pas que M. D… a fondé une superbe entreprise, fort utile au pays, laquelle, tout balancé, laisse chaque année une perte considérable ?
— Je le plains de tout mon cœur. Mais qu’y puis-je faire ?
— La Chambre a compris que, si cela continuait ainsi, M. D… serait dans l’alternative ou de mieux opérer ou de fermer son usine.
— Mais quel rapport y a-t-il entre les fausses spéculations de M. D… et mon tonneau ?
— La Chambre a pensé que si elle livrait à M. D… un peu d e vin pris dans votre cave, quelques hectolitres de blé prélevés chez vos voisins, quelques sous retranchés aux salaires des ouvriers, ses pertes se changeraient en bénéfices.
— La recette est infaillible autant qu’ingénieuse. Mais, morbleu ! elle est terriblement inique. Quoi ! M. D… se couvrira de ses pertes en me prenant mon vin ?
— Non pas précisément le vin, mais le prix. C’est ce qu’on nomme primes d’encouragement. Mais vous voilà tout ébahi ! Ne voyez-vous pas le grand service que vous rendez à la patrie ?
— Vous voulez dire à M. D… ?
— À la patrie. M. D… assure que son industrie prospère, grâce à cet arrangement, et c’est ainsi, dit-il, que le pays s’enrichit. C’est ce qu’il répétait ces jours-ci à la Chambre dont il fait partie.
— C’est une supercherie insigne ! Quoi ! un malotru fera une sotte entreprise, il dissipera ses capitaux ; et s’il m’extorque assez de vin ou de blé pour réparer ses pertes et se ménager même des profits, on verra là un gain général !
— Votre fondé de pouvoir l’ayant jugé ainsi, il ne vous reste plus qu’à me livrer les six tonneaux de vin et à vendre le mieux possible les quatorze tonneaux que je vous laisse.
— C’est mon affaire.
— C’est, voyez-vous, qu’il serait bien fâcheux que vous n’en tirassiez pas un grand prix.
— J’y aviserai.
— Car il y a bien des choses à quoi ce prix doit faire face.
— Je le sais, Monsieur, je le sais.
— D’abord, si vous achetez du fer pour renouveler vos bêches et vos charrues, une loi décide que vous le paierez a u maître de forges deux fois ce qu’il vaut.
— Ah çà, mais c’est donc la forêt Noire ?
— Ensuite, si vous avez besoin d’huile, de viande, de toile, de houille, de laine, de sucre, chacun, de par la loi, vous les cotera au double de leur valeur.
— Mais c’est horrible, affreux, abominable !
— À quoi bon ces plaintes ? Vous-même, par votre chargé de procuration…
— Laissez-moi en paix avec ma procuration. Je l’ai étrangement placée, c’est vrai. Mais on ne m’y prendra plus et je me ferai représenter par bonne et franche paysannerie.
— Bah ! vous renommerez le brave général.
— Moi, je renommerai le général, pour distribuer mon vin aux Africains et aux fabricants ?
— Vous le renommerez, vous dis-je.
— C’est un peu fort. Je ne le renommerai pas, si je ne veux pas.
— Mais vous voudrez et vous le renommerez.
— Qu’il vienne s’y frotter. Il trouvera à qui parler.
— Nous verrons bien. Adieu. J’emmène vos six tonneaux et vais en faire la répartition, comme le général l’a décidé [177].
XI. L'utopiste↩
— Si j’étais ministre de Sa Majesté !…
— Eh bien, que feriez-vous ?
— Je commencerais par… par…, ma foi, par être fort embarrassé. Car enfin, je ne serais ministre que parce que j’aurais la majorité ; je n’aurais la majorité que parce que je me la serais faite ; je ne me la serais faite, honnêtement du moins, qu’en gouvernant selon ses idées… Donc, si j’entreprenais de faire prévaloir les miennes en contrariant les siennes, je n’aurais plus la majorité, et si je n’avais pas la majorité, je ne serais pas ministre de Sa Majesté.
— Je suppose que vous le soyez et que par conséquent la majorité ne soit pas pour vous un obstacle ; que feriez-vous ?
— Je rechercherais de quel côté est le juste.
— Et ensuite ?
— Je chercherais de quel côté est l’utile.
— Et puis ?
— Je chercherais s’ils s’accordent ou se gourment entre eux.
— Et si vous trouviez qu’ils ne s’accordent pas ?
— Je dirais au roi Philippe :
Reprenez votre portefeuille.
La rime n’est pas riche et le style en est vieux ;
Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux
Que ces transactions dont le bon sens murmure,
Et que l’honnêteté parle là toute pure ?
— Mais si vous reconnaissez que le juste et l’utile c’est tout un ?
— Alors, j’irai droit en avant.
— Fort bien. Mais pour réaliser l’utilité par la justice, il faut une troisième chose.
— Laquelle ?
— La possibilité.
— Vous me l’avez accordée.
— Quand ?
— Tout à l’heure.
— Comment ?
— En me concédant la majorité.
— Il me semblait aussi que la concesion était fort hasardée, car enfin elle implique que la majorité voit clairement ce qui est juste, voit clairement ce qui est utile, et voit clairement qu’ils sont en parfaite harmonie.
— Et si elle voyait clairement tout cela, le bien se ferait, pour ainsi dire, tout seul.
— Voilà où vous m’amenez constamment : à ne voir de réforme possible que par le progrès de la raison générale.
— Comme à voir, parce progrès, toute réforme infaillible.
— À merveille. Mais ce progrès préalable est lui-même un peu long. Supposons-le accompli. Que feriez-vous ? car je suis pressé de vous voir à l’œuvre, à l’exécution, à la pratique.
— D’abord, je réduirais la taxe des lettres à 10 centimes.
— Je vous avais entendu parler de 5 centimes [178].
— Oui ; mais comme j’ai d’autres réformes en vue, je dois procéder avec prudence pour éviter le déficit.
— Tudieu ! quelle prudence ! Vous voilà déjà en déficit de 30 millions.
— Ensuite, je réduirais l’impôt du sel à 10 fr.
— Bon ! vous voilà en déficit de 30 autres millions. Vous avez sans doute inventé un nouvel impôt ?
— Le ciel m’en préserve ! D’ailleurs, je ne me flatte pas d’avoir l’esprit si inventif.
— Il faut pourtant bien… ah ! j’y suis. Où avais-je la tête ? Vous allez simplement diminuer la dépense. Je n’y pensais pas.
— Vous n’êtes pas le seul. — J’y arriverai, mais, pour le moment, ce n’est pas sur quoi je compte.
— Oui-dà ! vous diminuez la recette sans diminuer la dépense, et vous évitez le déficit ?
— Oui, en diminuant en même temps d’autres taxes
(Ici l’interlocuteur, posant l’index de la main droite sur son sinciput, hoche la tête, ce qui peut se traduire ainsi : il bat la campagne).
— Par ma foi ! le procédé est ingénieux. Je verse 100 francs au trésor, vous me dégrevez de 5 francs sur le sel, de 5 francs sur la poste ; et pour que le trésor n’en reçoive pas moins 100 francs, vous me dégrevez de 10 francs sur quelque autre taxe?
— Touchez là ; vous m’avez compris.
— Du diable si c’est vrai ! Je ne suis pas même sûr de vous avoir entendu.
— Je répète que je balance un dégrèvement par un autre.
— Morbleu ! j’ai quelques instants à perdre : autant vaut que je vous écoute développer ce paradoxe.
— Voici tout le mystère : je sais une taxe qui vous coûte 20 francs et dont il ne rentre pas une obole au trésor ; je vous fais remise de moitié et fais prendre à l’autre moitié le chemin de l’hôtel de la rue de Rivoli.
— Vraiment ! vous êtes un financier sans pareil. Il n’y a qu’une difficulté. En quoi est-ce, s’il vous plaît, que je paie une taxe qui ne va pas au trésor ?
— Combien vous coûte cet habit ?
— 100 francs.
— Et si vous eussiez fait venir le drap de Verviers, combien vous coûterait-il ?
— 80 francs.
— Pourquoi donc ne l’avez-vous pas demandé à Verviers ?
— Parce que cela est défendu.
— Et pourquoi cela est-il défendu ?
— Pour que l’habit me revienne à 100 francs au lieu de 80.
— Cette défense vous coûte donc 20 francs ?
— Sans aucun doute.
— Et où passent-ils, ces 20 francs ?
— Et où passeraient-ils ? Chez le fabricant de drap.
— Eh bien ! donnez-moi 10 francs pour le trésor, je ferai lever la défense, et vous gagnerez encore 10 francs.
— Oh ! oh ! je commence à y voir clair. Voici le compte du trésor : il perd 5 francs sur la poste, 5 sur le sel, et gagne 10 francs sur le drap. Partant quitte.
— Et voici votre compte à vous : vous gagnez 5 francs sur le sel, 5 francs sur la poste et 10 francs sur le drap.
— Total, 20 francs. Ce plan me sourit assez. Mais que deviendra le pauvre fabricant de draps ?
— Oh ! j’ai pensé à lui. Je lui ménage des compensations, toujours au moyen de dégrèvements profitables au trésor ; et ce que j’ai fait pour vous à l’occasion du drap, je le fais pour lui à l’égard de la laine, de la houille, des machines, etc. ; en sorte qu’il pourra baisser son prix sans perdre.
— Mais êtes-vous sûr qu’il y aura balance ?
— Elle penchera de son côté. Les 20 francs que je vous fais gagner sur le drap, s’augmenteront de ceux que je vous économiserai encore sur le blé, la viande, le combustible, etc. Cela montera haut ; et une épargne semblable sera réalisée par chacun de vos trente-cinq millions de concitoyens. Il y a là de quoi épuiser les draps de Verviers et ceux d’Elbeuf. La nation sera mieux vêtue, voilà tout.
— J’y réfléchirai ; car tout cela se brouille un peu dans ma tête.
— Après tout, en fait de vêtements, l’essentiel est d’être vêtu. Vos membres sont votre propriété et non celle du fabricant. Les mettre à l’abri de grelotter est votre affaire, et non la sienne ! Si la loi prend parti pour lui contre vous, la loi est injuste, et vous m’avez autorisé à raisonner dans l’hypothèse que ce qui est injuste est nuisible.
— Peut-être me suis-je trop avancé ; mais poursuivez l’exposé de votre plan financier.
— Je ferai donc une loi de douanes.
— En deux volumes in-folio ?
— Non, en deux articles.
— Pour le coup, on ne dira plus que ce fameux axiome : « Nul n’est censé ignorer la loi, » est une fiction. Voyons donc votre tarif.
— Le voici :
Art. 1er. Toute marchandise importée paiera une taxe de 5 p. 100 de la valeur.
— Même les matières premières ?
— À moins qu’elles n’aient point de valeur.
— Mais elles en ont toutes, peu ou prou.
— En ce cas, elles paieront peu ou prou.
— Comment voulez-vous que nos fabriques luttent avec les fabriques étrangères qui ont les matières premières en franchise ?
— Les dépenses de l’État étant données, si nous fermons cette source de revenus, il en faudra ouvrir une autre : cela ne diminuera pas l’infériorité relative de nos fabriques, et il y aura une administration de plus à créer et à payer.
— Il est vrai ; je raisonnais comme s’il s’agissait d’annuler la taxe et non de la déplacer. J’y réfléchirai. Voyons votre second article ?…
— Art. 2. Toute marchandise exportée paiera une taxe de 5 p. % de la valeur.
— Miséricorde ! monsieur l’utopiste. Vous allez vous faire lapider, et au besoin je jetterai la première pierre.
— Nous avons admis que la majorité est éclairée.
— Éclairée ! soutiendrez-vous qu’un droit de sortie ne soit pas onéreux ?
— Toute taxe est onéreuse, mais celle-ci moins qu’une autre.
— Le carnaval justifie bien des excentricités. Donnez-vous le plaisir de rendre spécieux, si cela est possible, ce nouveau paradoxe.
— Combien avez-vous payé ce vin?
— Un franc le litre.
— Combien l’auriez-vous payé hors barrière ?
— Cinquante centimes.
— Pourquoi cette différence ?
— Demandez-le à l’octroi qui a prélevé dix sous dessus.
— Et qui a établi l’octroi ?
— La commune de Paris, afin de paver et d’éclairer les rues.
— C’est donc un droit d’importation. Mais si c’étaient les communes limitrophes qui eussent érigé l’octroi à leur profit, qu’arriverait-il ?
— Je n’en paierais pas moins 1 fr. mon vin de 50 c., et les autres 50 c. paveraient et éclaireraient Montmartre et les Batignoles.
— En sorte qu’en définitive c’est le consommateur qui paie la taxe ?
— Cela est hors de doute.
— Donc, en mettant un droit à l’exportation, vous faites contribuer l’étranger à vos dépenses.
— Je vous prends en faute, ce n’est plus de la justice.
— Pourquoi pas ? Pour qu’un produit se fasse, il faut qu’il y ait dans le pays de l’instruction, de la sécurité, des routes, des choses qui coûtent. Pourquoi l’étranger ne supporterait-il pas les charges occasionnées par ce produit, lui qui, en définitive, va le consommer ?
— Cela est contraire aux idées reçues.
— Pas le moins du monde. Le dernier acheteur doit rembourser tous les frais de production directs ou indirects.
— Vous avez beau dire, il saute aux yeux qu’une telle mesure paralyserait le commerce et nous fermerait des débouchés.
— C’est une illusion. Si vous payiez cette taxe en sus de toutes les autres, vous avez raison. Mais si les 100 millions prélevés par cette voie dégrèvent d’autant d’autres impôts, vous reparaissez sur les marchés du dehors avec tous vos avantages, et même avec plus d’avantages, si cet impôt a moins occasionné d’embarras et de dépenses.
— J’y réfléchirai. — Ainsi, voilà le sel, la poste et la douane réglés. Tout est-il fini là ?
— À peine je commence.
— De grâce, initiez-moi à vos autres utopies.
— J’avais perdu 60 millions sur le sel et la poste. La douane me les fait retrouver ; mais elle me donne quelque chose de plus précieux.
— Et quoi donc, s’il vous plaît ?
— Des rapports internationaux fondés sur la justice, et une probabilité de paix qui équivaut à une certitude. Je congédie l’armée.
— L’armée tout entière ?
— Excepté les armes spéciales, qui se recruteront volontairement comme toutes les autres professions. Vous le voyez, la conscription est abolie.
— Monsieur, il faut dire le recrutement.
— Ah ! j’oubliais. J’admire comme il est aisé, en certains pays, de perpétuer les choses les plus impopulaires en leur donnant un autre nom.
— C’est comme les droits réunis, qui sont devenus des contributions indirectes.
— Et les gendarmes qui ont pris nom gardes municipaux.
— Bref, vous désarmez le pays sur la foi d’une utopie.
— J’ai dit que je licenciais l’armée et non que je désarmais le pays. J’entends lui donner au contraire une force invincible.
— Comment arrangez-vous cet amas de contradictions ?
— J’appelle tous les citoyens au service.
— Il valait bien la peine d’en dispenser quelques-uns pour y appeler tout le monde.
— Vous ne m’avez pas fait ministre pour laisser les choses comme elles sont. Aussi, à mon avènement au pouvoir, je dirai comme Richelieu : « Les maximes de l’État sont changées. » Et ma première maxime, celle qui servira de base à mon administration, c’est celle-ci : Tout citoyen doit savoir deux choses : pourvoir à son existence et défendre son pays.
— Il me semble bien, au premier abord, qu’il y a quelque étincelle de bon sens là-dessous.
— En conséquence, je fonde la défense nationale sur une loi en deux articles :
Art. 1er. Tout citoyen valide, sans exception, restera sous les drapeaux pendant quatre années, de 21 à 25 ans, pour y recevoir l’instruction militaire.
— Voilà une belle économie ! vous congédiez 400,000 soldats et vous en faites 10 millions.
— Attendez mon second article.
Art. 2. À moins qu’il ne prouve, à 21 ans, savoir parfaitement l’école de peloton.
— Je ne m’attendais pas à cette chute. Il est certain que pour éviter quatre ans de service, il y aurait une terrible émulation, dans notre jeunesse, à apprendre le par le flanc droit et la charge en douze temps. L’idée est bizarre.
— Elle est mieux que cela. Car enfin, sans jeter la douleur dans les familles, et sans froisser l’égalité, n’assure-t-elle pas au pays, d’une manière simple et peu dispendieuse, 10 millions de défenseurs capables de défier la coalition de toutes les armées permanentes du globe ?
— Vraiment, si je n’étais sur mes gardes, je finirais par m’intéresser à vos fantaisies.
L’utopiste s’échauffant : Grâce au ciel, voilà mon budget soulagé de 200 millions ! Je supprime l’octroi, je refonds les contributions indirectes, je…
— Eh ! monsieur l’utopiste !
L’utopiste s’échauffant de plus en plus : Je proclame la liberté des cultes, la liberté d’enseignement. Nouvelles ressources. J’achète les chemins de fer, je rembourse la dette, j’affame l’agiotage.
— Monsieur l’utopiste !
— Débarrassé de soins trop nombreux, je concentre toutes les forces du gouvernement à réprimer la fraude, distribuer à tous prompte et bonne justice, je…
— Monsieur l’utopiste, vous entreprenez trop de choses, la nation ne vous suivra pas !
— Vous m’avez donné la majorité.
— Je vous la retire.
— À la bonne heure ! alors je ne suis plus ministre, et mes plans restent ce qu’ils sont, des utopies.
XII. Le sel, la poste et la douane↩
1846.
On s’attendait, il y a quelques jours, à voir le mécanisme représentatif enfanter un produit tout nouveau et que ses rouages n’étaient pas encore parvenus à élaborer : le soulagement du contribuable.
Chacun était attentif : l’expérience était intéressante autant que nouvelle. Les forces aspirantes de cette machine ne donnent d’inquiétude à personne. Elle fonctionne, sous ce rapport, d’une manière admirable, quels que soient le temps, le lieu, la saison et la circonstance.
Mais, quant aux réformes qui tendent à simplifier, égaliser et alléger les charges publiques, nul ne sait encore ce qu’elle peut faire.
On disait : Vous allez voir : voici le moment ; c’est l’œuvre des quatrièmes sessions, alors que la popularité est bonne à quelque chose. 1842 nous valut les chemins de fer ; 1846 va nous donner l’abaissement de la taxe du sel et des lettres ; 1850 nous réserve le remaniement des tarifs et des contributions indirectes. La quatrième session, c’est le jubilé du contribuable.
Chacun était donc plein d’espoir, et tout semblait favoriser l’expérience. Le Moniteur avait annoncé que, de trimestre en trimestre, les sources du revenu vont toujours grossissant ; et quel meilleur usage pouvait-on faire de ces rentrées inattendues, que de permettre au villageois un grain de sel de plus pour son eau tiède, une lettre de plus du champ de bataille où se joue la vie de son fils ?
Mais qu’est-il arrivé ? Comme ces deux matières sucrées qui, dit-on, s’empêchent réciproquement de cristalliser ; ou comme ces deux chiens dont la lutte fut si acharnée qu’il n’en resta que les deux queues, les deux réformes se sont entre-dévorées. Il ne nous en reste que les queues, c’est-à-dire force projets de lois, exposés des motifs, rapports, statistiques et annexes, où nous avons la consolation de voir nos souffrances philanthropiquement appréciées et homœopathiquement calculées. — Quant aux réformes elles-mêmes, elles n’ont pas cristallisé. Il ne sort rien du creuset, et l’expérience a failli.
Bientôt les chimistes se présenteront devant le jury pour expliquer cette déconvenue, et ils diront,
L’un : « J’avais proposé la réforme postale ; mais la Chambre a voulu dégrever le sel, et j’ai dû la retirer. »
L’autre : « J’avais voté le dégrèvement du sel ; mais le ministère a proposé la réforme postale, et le vote n’a pas abouti. »
Et le jury, trouvant la raison excellente, recommencera l’épreuve sur les mêmes données, et renverra à l’œuvre les mêmes chimistes.
Ceci nous prouve qu’il pourrait bien y avoir quelque chose de raisonnable, malgré la source, dans la pratique qui s’est introduite depuis un demi-siècle de l’autre côté du détroit, et qui consiste, pour le public, à ne poursuivre qu’une réforme à la fois. C’est long, c’est ennuyeux ; mais ça mène à quelque chose.
Nous avons une douzaine de réformes sur le chantier ; elles se pressent comme les ombres à la porte de l’oubli, et pas une n’entre.
Ohimè ! che lasso !
Una a la volta, per carità.
C’est ce que disait Jacques Bonhomme dans un dialogue avec John Bull sur la réforme postale. Il vaut la peine d’être rapporté.
jacques bonhomme, john bull.
Jacques Bonhomme. Oh ! qui me délivrera de cet ouragan de réformes ! J’en ai la tête fendue. Je crois qu’on en invente tous les jours : réforme universitaire, financière, sanitaire, parlementaire ; réforme électorale, réforme commerciale, réforme sociale, et voici venir la réforme postale !
John Bull. Pour celle-ci, elle est si facile à faire et si utile, comme nous l’éprouvons chez nous, que je me hasarde à vous la conseiller.
Jacques. On dit pourtant que ça a mal tourné en Angleterre, et que votre Échiquier y a laissé dix millions.
John. Qui en ont enfanté cent dans le public.
Jacques. Cela est-il bien certain ?
John. Voyez tous les signes par lesquels se manifeste la satisfaction publique. Voyez la nation, Peel et Russel en tête, donner à M. Rowland-Hill, à la façon britannique, des témoignages substantiels de gratitude. Voyez le pauvre peuple ne faire circuler ses lettres qu’après y avoir déposé l’empreinte de ses sentiments au moyen de pains à cacheter qui portent cette devise : À la réforme postale, le peuple reconnaissant. Voyez les chefs de la ligue déclarer en plein parlement que, sans elle, il leur eût fallu trente ans pour accomplir leur grande entreprise, pour affranchir la nourriture du pauvre. Voyez les officiers du Board of trade déclarer qu’il est fâcheux que la monnaie anglaise ne se prête pas à une réduction plus radicale encore du port des lettres ! Quelles preuves vous faut-il de plus ?
Jacques. Oui, mais le Trésor ?
John. Est-ce que le Trésor et le public ne sont pas dans la même barque ?
Jacques. Pas tout à fait. — Et puis, est-il bien certain que notre système postal ait besoin d’être réformé ?
John. C’est là la question. Voyons un peu comment se passent les choses. Que deviennent les lettres qui sont mises à la poste ?
Jacques. Oh ! c’est un mécanisme d’une simplicité admirable : le directeur ouvre la boîte à une certaine heure, et il en retire, je suppose, cent lettres.
John. Et ensuite ?
Jacques. Ensuite il les inspecte l’une après l’autre. Un tableau géographique sous les yeux, et une balance en main, il cherche à quelle catégorie chacune d’elles appartient sous le double rapport de la distance et du poids. Il n’y a que onze zones et autant de degrés de pesanteur.
John. Cela fait bien 121 combinaisons pour chaque lettre.
Jacques. Oui, et il faut doubler ce nombre, parce que la lettre peut appartenir ou ne pas appartenir au service rural.
John. C’est donc 24,200 recherches pour les cent lettres. — Que fait ensuite M. le directeur?
Jacques. Il inscrit le poids sur un coin et la taxe au beau milieu de l’adresse, sons la figure d’un hiéroglyphe convenu dans l’administration.
John. Et ensuite ?
Jacques. Il timbre ; il partage les lettres en dix paquets, selon les bureaux avec lesquels il correspond. Il additionne le total des taxes des dix paquets.
John. Et ensuite ?
Jacques. Ensuite il inscrit les dix sommes, en long, sur un registre et, en travers, sur un autre.
John. Et ensuite ?
Jacques. Ensuite il écrit une lettre à chacun des dix directeurs correspondants, pour l’informer de l’article de comptabilité qui le concerne.
John. Et si les lettres sont affranchies ?
Jacques. Oh ! alors j’avoue que le service se complique un peu. Il faut recevoir la lettre, la peser et mesurer, comme devant, toucher le payement et rendre monnaie ; choisir parmi trente timbres celui qui convient ; constater sur la lettre son numéro d’ordre, son poids et sa taxe ; transcrire l’adresse tout entière sur un premier registre, puis sur un second, puis sur un troisième, puis sur un bulletin détaché ; envelopper la lettre dans le bulletin, envoyer le tout bien ficelé au directeur correspondant, et relater chacune de ces circonstances dans une douzaine de colonnes choisies parmi cinquante qui bariolent les sommiers.
John. Et tout cela pour 40 centimes !
Jacques. Oui, en moyenne.
John. Je vois qu’en effet le départ est assez simple. Voyons comment les choses se passent à l’arrivée.
Jacques. Le directeur ouvre la dépêche.
John. Et après ?
Jacques. Il lit les dix avis de ses correspondants.
John. Et après ?
Jacques. Il compare le total accusé par chaque avis avec le total qui résulte de chacun des dix paquets de lettres.
John. Et après ?
Jacques. Il fait le total des totaux, et sait de quelle somme en bloc il rendra les facteurs responsables.
John. Et après ?
Jacques. Après, tableau des distances et balance en main, il vérifie et rectifie la taxe de chaque lettre.
John. Et après ?
Jacques. Il inscrit de registre en registre, de colonne en colonne, selon d’innombrables occurrences, les plus trouvés et les moins trouvés.
John. Et après?
Jacques. Il se met en correspondance avec les dix directeurs pour signaler des erreurs de 10 ou 20 centimes.
John. Et après ?
Jacques. Il remanie toutes les lettres reçues pour les donner aux facteurs.
John. Et après ?
Jacques. Il fait le total des taxes que chaque facteur prend en charge.
John. Et après ?
Jacques. Le facteur vérifie ; on discute la signification des hiéroglyphes. Le facteur avance la somme, et il part.
John. Go on.
Jacques. Le facteur va chez le destinataire; il frappe à la porte, un domestique descend. Il y a six lettres à cette adresse. On additionne les taxes, séparément d’abord, puis en commun. On en trouve pour 2 fr. 70 cent.
John. Go on.
Jacques. Le domestique va trouver son maître ; celui-ci procède à la vérification des hiéroglyphes. Il prend les 3 pour des 2, et les 9 pour des 4 ; il a des doutes sur les poids et les distances ; bref, il faut faire monter le facteur, et, en l’attendant, il cherche à deviner le signataire des lettres, pensant qu’il serait sage de les refuser.
John. Go on.
Jacques. Le facteur arrive et plaide la cause de l’administration. On discute, on examine, on pèse, on mesure ; enfin le destinataire reçoit cinq lettres et en rebute une.
John. Go on.
Jacques. Il ne s’agit plus que du payement. Le domestique va chez l’épicier chercher de la monnaie. Enfin, au bout de vingt minutes, le facteur est libre et il court recommencer de porte en porte la même cérémonie.
John. Go on.
Jacques. Il revient au bureau. Il compte et recompte avec le directeur. Il remet les lettres rebutées et se fait restituer ses avances. Il rend compte des objections des destinataires relativement aux poids et aux distances.
John. Go on.
Jacques. Le directeur cherche les registres, les sommiers, les bulletins spéciaux, pour faire ses comptes de rebuts.
John. Go on, if you please.
Jacques. Et ma foi, je ne suis pas directeur. Nous arriverions ici aux comptes de dizaines, de vingtaines, de fin du mois ; aux moyens imaginés, non-seulement pour établir, mais pour contrôler une comptabilité si minutieuse portant sur 50 millions de francs, résultant de taxes moyennes de 43 centimes, et de 116 millions de lettres, chacune desquelles peut appartenir à 242 catégories.
John. Voilà une simplicité très-compliquée. Certes, l’homme qui a résolu ce problème devait avoir cent fois plus de génie que votre M. Piron ou notre Rowland-Hill.
Jacques. Mais vous, qui avez l’air de rire de notre système, expliquez-moi le vôtre.
John. En Angleterre, le gouvernement fait vendre, dans tous les lieux où il le juge utile, des enveloppes et des bandes à un penny pièce.
Jacques. Et après ?
John. Vous écrivez, pliez votre lettre en quatre, la mettez dans une de ces enveloppes, la jetez ou l’envoyez à la poste.
Jacques. Et après ?
John. Après, tout est dit. Il n’y a ni poids, ni distances, ni plus trouvés, ni moins trouvés, ni rebuts, ni bulletins, ni registres, ni sommiers, ni colonnes, ni comptabilité, ni contrôle, ni monnaie à donner et à recevoir, ni hiéroglyphes, ni discussions et interprétations, ni forcement en recette, etc., etc.
Jacques. Vraiment, cela paraît simple. Mais ce ne l’est-il pas trop ? Un enfant comprendrait cela. C’est avec de pareilles réformes qu’on étouffe le génie des grands administrateurs. Pour moi, je tiens à la manière Française. Et puis, votre taxe uniforme a le plus grand de tous les défauts. Elle est injuste.
John. Pourquoi donc ?
Jacques. Parce qu’il est injuste de faire payer autant pour une lettre qu’on porte au voisinage que pour celle qu’on porte à cent lieues.
John. En tous cas, vous conviendrez que l’injustice est renfermée dans les limites d’un penny.
Jacques. Qu’importe ? c’est toujours une injustice.
John. Elle ne peut même jamais s’étendre qu’à un demi-penny, car l’autre moitié est afférente à des frais fixes pour toutes les lettres, quelle que soit la distance.
Jacques. Penny ou demi-penny, il y a toujours là un principe d’injustice.
John. Enfin cette injustice qui, au maximum, ne peut aller qu’à un demi-penny dans un cas particulier, s’efface pour chaque citoyen dans l’ensemble de sa correspondance, puisque chacun écrit tantôt au loin, tantôt au voisinage.
Jacques. Je n’en démords pas. L’injustice est atténuée à l’infini si vous voulez, elle est inappréciable, infinitésimale, homœopathique, mais elle existe.
John. L’État vous fait-il payer plus cher le gramme de tabac que vous achetez à la rue de Clichy que celui qu’on vous débite au quai d’Orsay ?
Jacques. Quel rapport y a-t-il entre les deux objets de comparaison ?
John. C’est que, dans un cas comme dans l’autre, il a fallu faire les frais d’un transport. Il serait juste, mathématiquement, que chaque prise de tabac fût plus chère rue de Clichy qu’au quai d’Orsay de quelque millionième de centime.
Jacques. C’est vrai, il ne faut vouloir que ce qui est possible.
John. Ajoutez que votre système de poste n’est juste qu’en apparence. Deux maisons se trouvent côte à côte, mais l’une en dehors, l’autre en dedans de la zone. La première payera 10 centimes de plus que la seconde, juste autant que coûte en Angleterre le port entier de la lettre. Vous voyez bien que, malgré les apparences, l’injustice se commet chez vous sur une bien plus grande échelle.
Jacques. Cela semble bien vrai. Mon objection ne vaut pas grand’chose, mais reste toujours la perte du revenu.
Ici, je cessai d’entendre les deux interlocuteurs. Il paraît cependant que Jacques Bonhomme fut entièrement converti ; car, quelques jours après, le rapport de M. de Vuitry ayant paru, il écrivit la lettre suivante à l’honorable législateur :
j. bonhomme à m. de vuitry, député, rapporteur de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif à la taxe des lettres.
« Monsieur,
Bien que je n’ignore pas l’extrême défaveur qu’on crée contre soi quand on se fait l’avocat d’une théorie absolue, je ne crois pas devoir abandonner la cause de la taxe unique et réduite au simple remboursement du service rendu.
En m’adressant à vous, je vous fais beau jeu assurément. D’un côté, un cerveau brûlé, un réformateur de cabinet, qui parle de renverser tout un système brusquement, sans transition ; un rêveur qui n’a peut-être pas jeté les yeux sur cette montagne de lois, ordonnances, tableaux, annexes, statistiques qui accompagnent votre rapport ; et, pour tout dire en un mot, un théoricien ! — De l’autre, un législateur grave, prudent, modéré, qui a pesé et comparé, qui ménage les intérêts divers, qui rejette tous les systèmes, ou, ce qui revient au même, en compose un de ce qu’il emprunte à tous les autres : certes, l’issue de la lutte ne saurait être douteuse.
Néanmoins, tant que la question est pendante, les convictions ont le droit de se produire. Je sais que la mienne est assez tranchée pour appeler sur les lèvres du lecteur le sourire de la raillerie. Tout ce que j’ose attendre de lui, c’est de me le prodiguer, s’il y a lieu, après et non avant d’avoir écouté mes raisons.
Car enfin, moi aussi, je puis invoquer l’expérience. Un grand peuple en a fait l’épreuve. Comment la juge-t-il ? On ne nie pas qu’il ne soit habile en ces matières, et son jugement a quelque poids.
Eh bien, il n’y a pas une voix en Angleterre qui ne bénisse la réforme postale. J’en ai pour témoin la souscription ouverte en faveur de M. Rowland-Hill ; j’en ai pour témoin la manière originale dont le peuple, à ce que me disait John Bull, exprime sa reconnaissance ; j’en ai pour témoin cet aveu si souvent réitéré de la Ligue : « Jamais, sans le penny-postage, nous n’aurions développé l’opinion publique qui renverse aujourd’hui le système protecteur. » J’en ai pour témoin ce que je lis dans un ouvrage émané d’une plume officielle :
« La taxe des lettres doit être réglée non dans un but de fiscalité, mais dans l’unique objet de couvrir la dépense. »
À quoi M. Mac-Gregor ajoute :
« Il est vrai que la taxe étant descendue au niveau de notre plus petite monnaie, il n’est pas possible de l’abaisser davantage, quoiqu’elle donne du revenu. Mais ce revenu, qui ira sans cesse grossissant, doit être consacré à améliorer le service et à développer notre système de paquebots sur toutes les mers. »
Ceci me conduit à examiner la pensée fondamentale de la commission, qui est, au contraire, que la taxe des lettres doit être pour l’État une source de revenus.
Cette pensée domine tout votre rapport, et j’avoue que, sous l’empire de cette préoccupation, vous ne pouviez arriver à rien de grand, à rien de complet ; heureux si, en voulant concilier tous les systèmes, vous n’en avez pas combiné les inconvénients divers.
La première question qui se présente est donc celle-ci : La correspondance entre les particuliers est-elle une bonne matière imposable ?
Je ne remonterai pas aux principes abstraits. Je ne ferai pas remarquer que la société n’étant que la communication des idées, l’objet de tout gouvernement doit être de favoriser et non de contrarier cette communication,
J’examinerai les faits existants.
La longueur totale des routes royales, départementales et vicinales est d’un million de kilomètres ; en supposant que chacun a coûté 100,000 francs, cela fait un capital de cent milliards dépensé par l’État pour favoriser la locomotion des choses et des hommes.
Or, je vous le demande, si un de vos honorables collègues proposait à la Chambre un projet de loi ainsi conçu :
« À partir du 1er janvier 1847, l’État percevra sur tous les voyageurs une taxe calculée, non-seulement pour couvrir les dépenses des routes, mais encore pour faire rentrer dans ses caisses quatre ou cinq fois le montant de cette dépense… »
Ne trouveriez-vous pas cette proposition antisociale et monstrueuse ?
Comment se fait-il que cette pensée de bénéfice, que dis-je ? de simple rémunération, ne se soit jamais présentée à l’esprit, quand il s’est agi de la circulation des choses, et qu’elle vous paraisse si naturelle, quand il est question de la circulation des idées ?
J’ose dire que cela tient à l’habitude. S’il était question de créer la poste, à coup sûr il paraîtrait monstrueux de l’établir sur le principe fiscal.
Et veuillez remarquer qu’ici l’oppression est mieux caractérisée.
Quand l’État a ouvert une route, il ne force personne à s’en servir. (Il le ferait sans doute si l’usage de la route était taxé.) Mais quand la poste royale existe, nul n’a plus la faculté d’écrire par une autre voie, fût-ce à sa mère.
Donc, en principe, la taxe des lettres devrait être rémunératoire, et, par ce motif, uniforme.
Que si l’on part de cette idée, comment ne pas être émerveillé de la facilité, de la beauté, de la simplicité de la réforme ?
La voici tout entière, et, sauf rédaction, formulée en projet de loi :
« Art. 1er. À partir du 1er janvier 1847, il sera exposé en vente, partout où l’administration le jugera utile, des enveloppes et des bandes timbrées au prix de cinq (ou dix) centimes.
2. Toute lettre mise dans une de ces enveloppes et ne dépassant pas le poids de 15 grammes, tout journal ou imprimé mis sous une de ces bandes et ne dépassant pas … grammes, sera porté et remis, sans frais, à son adresse.
3. La comptabilité de la poste est entièrement supprimée.
4. Toute criminalité et pénalité en matière de ports de lettres sont abolies. »
Cela est bien simple, je l’avoue, beaucoup trop simple, et je m’attends à une nuée d’objections.
Mais, à supposer que ce système ait des inconvénients, ce n’est pas la question ; il s’agit de savoir si le vôtre n’en a pas de plus grands encore.
Et de bonne foi, peut-il, sous quelque aspect que ce soit (sauf le revenu), supporter un instant la comparaison ?
Examinez-les tous les deux ; comparez-les sous les rapports de la facilité, de la commodité, de la célérité, de la simplicité, de l’ordre, de l’économie, de la justice, de l’égalité, de la multiplication des affaires, de la satisfaction des sentiments, du développement intellectuel et moral, de la puissance civilisatrice, et dites, la main sur la conscience, s’il est possible d’hésiter un moment.
Je me garderai bien de développer chacune de ces considérations. Je vous donne les en-tête de douze chapitres et laisse le reste en blanc, persuadé que personne n’est mieux en état que vous de les remplir.
Mais, puisqu’il n’y a qu’une seule objection, le revenu, il faut bien que j’en dise un mot.
Vous avez fait un tableau duquel il résulte que la taxe unique, même à 20 centimes, constituerait le Trésor en perte de 22 millions.
À 10 centimes, la perte serait de 28 millions, et à 5 centimes, de 33 millions, hypothèses si effrayantes que vous ne les formulez même pas.
Mais permettez-moi de vous dire que les chiffres, dans votre rapport, dansent avec un peu trop de laisser aller. Dans tous vos tableaux, dans tous vos calculs, vous sous-entendez ces mots : Toutes choses égales d’ailleurs. Vous supposez les mêmes frais avec une administration simple qu’avec une administration compliquée ; le même nombre de lettres avec la taxe moyenne de 43 qu’avec la taxe unique à 20 cent. Vous vous bornez à cette règle de trois : 87 millions de lettres à 42 cent. 1/2 ont donné tant. Donc, à 20 cent, elles donneraient tant ; admettant néanmoins quelques distinctions quand elles sont contraires à la réforme.
Pour évaluer le sacrifice réel du Trésor, il faudrait savoir d’abord ce qu’on économiserait sur le service ; ensuite, dans quelle proportion s’augmenterait l’activité de la correspondance. Ne tenons compte que de cette dernière donnée, parce que nous pouvons supposer que l’épargne réalisée sur les frais se réduirait à ceci, que le personnel actuel ferait face à un service plus développé.
Sans doute il n’est pas possible de fixer le chiffre de l’accroissement dans la circulation des lettres ; mais, en ces matières, une analogie raisonnable a toujours été admise.
Vous dites vous-même qu’en Angleterre une réduction de 7/8 dans la taxe a amené une augmentation de 360 pour cent dans la correspondance.
Chez nous, l’abaissement à 5 cent, de la taxe qui est actuellement, en moyenne, de 43 cent., constituerait aussi une réduction de 7/8. Il est donc permis d’attendre le même résultat, c’est-à-dire 417 millions de lettres, au lieu de 116 millions.
Mais calculons sur 300 millions.
Y a-t-il exagération à admettre qu’avec une taxe de moitié moindre, nous arriverons à 8 lettres par habitant, quand les Anglais sont parvenus à 13 ?
| Or, 300 millions de lettres à 5 c. donnent… | 15 | mil. |
| 100 millions de journaux et imprimés à 5 c… | 5 | |
| Voyageurs par les malles-postes… | 4 | |
| Articles d’argent… | 4 | |
| Total des recettes… | 28 | mil. |
| La dépense actuelle (qui pourra diminuer) est de… | 31 | mil. |
| À déduire celle des paquebots… | 5 | |
| Reste sur les dépêches, voyageurs et articles d’argent… | 26 | mil. |
| Produit net… | 2 | |
| Aujourd’hui le produit net est de… | 19 | |
| Perte, ou plutôt réduction de gain… | 17 | mil. |
Maintenant je demande si l’État, qui fait un sacrifice positif de 800 millions par an pour faciliter la circulation gratuite des personnes, ne doit pas faire un sacrifice négatif de 17 millions pour ne pas gagner sur la circulation des idées ?
Mais enfin le fisc, je le sais, a ses habitudes ; et autant il contracte avec facilité celle de voir grossir les recettes, autant il s’accoutume malaisément à les voir diminuer d’une obole. Il semble qu’il soit pourvu de ces valvules admirables qui, dans notre organisation, laissent le sang affluer dans une direction, mais l’empêchent de rétrograder. Soit. Le fisc est un peu vieux pour que nous puissions changer ses allures. N’espérons donc pas le décider à se dessaisir. Mais que dirait-il, si moi, Jacques Bonhomme, je lui indiquais un moyen simple, facile, commode, essentiellement pratique, de faire un grand bien au pays, sans qu’il lui en coûtât un centime !
| La poste donne brut au Trésor… | 50 | mil. |
| Le sel… | 70 | |
| La douane… | 160 | |
| Total pour ces trois services… | 280 | mil. |
Eh bien ! mettez la taxe des lettres au taux uniforme de 5 cent.
Abaissez la taxe du sel à 10 fr. le quintal, comme la Chambre l’a voté.
Donnez-moi la faculté de modifier le tarif des douanes, en ce sens qu’il me sera formellement interdit d’élever aucun droit, mais qu’il me sera loisible de les abaisser à mon gré.
Et moi, Jacques Bonhomme, je vous garantis, non pas 280, mais 300 millions. Deux cents banquiers de France seront mes cautions. Je ne demande pour ma prime que ce que ces trois impôts produiront en sus des 300 millions.
Maintenant ai-je besoin d’énumérer les avantages de ma proposition ?
1° Le peuple recueillera tout le bénéfice du bon marché dans le prix d’un objet de première nécessité, le sel.
2° Les pères pourront écrire à leurs fils, les mères à leurs filles. Les affections, les sentiments, les épanchements de l’amour et de l’amitié ne seront pas, comme aujourd’hui, refoulés par la main du fisc au fond des cœurs.
3° Porter une lettre d’un ami à un ami ne sera pas inscrit sur nos codes comme une action criminelle.
4° Le commerce refleurira avec la liberté ; notre marine marchande se relèvera de son humiliation.
5° Le fisc gagnera d’abord vingt millions ; ensuite, tout ce que fera affluer vers les autres branches de contributions l’épargne réalisée par chaque citoyen sur le sel, les lettres et sur les objets dont les droits auront été abaissés.
Si ma proposition n’est pas acceptée, que devrai-je en conclure ? Pourvu que la compagnie de banquiers que je présente offre des garanties suffisantes, sous quel prétexte pourrait-on rejeter mon offre ? Il n’est pas possible d’invoquer l’équilibre des budgets. Il sera bien rompu, mais rompu de manière à ce que les recettes excèdent les dépenses. Il ne s’agit pas ici d’une théorie, d’un système, d’une statistique, d’une probabilité, d’une conjecture ; c’est une offre, une offre comme celle d’une compagnie qui demande la concession d’un chemin de fer. Le fisc me dit ce qu’il retire de la poste, du sel et de la douane. J’offre de lui donner plus. L’objection ne peut donc pas venir de lui. J’offre de diminuer le tarif du sel, de la poste et de la douane ; je m’engage à ne pas l’élever ; l’objection ne peut donc pas venir des contribuables. — De qui viendrait-elle donc? — Des monopoleurs ? — Reste à savoir si leur voix doit étouffer en France celle de l’État et celle du peuple. Pour nous en assurer, je vous prie de transmettre ma proposition au conseil des ministres.
Jacques Bonhomme. »
« P. S. Voici le texte de mon offre :
Moi, Jacques Bonhomme, représentant une compagnie de banquiers et capitalistes, prête à donner toutes garanties et à déposer tous cautionnements qui seront nécessaires ;
Ayant appris que l’État ne tire que 280 millions de la douane, de la poste et du sel, au moyen des droits tels qu’ils sont actuellement fixés ;
J’offre de lui donner 300 millions du produit brut de ces trois services ;
Même alors qu’il réduirait la taxe du sel de 30 francs à 10 francs ;
Même alors qu’il réduirait la taxe des lettres de 42 1/2 cent, en moyenne, à une taxe unique et uniforme de 5 à 10 centimes ;
À la seule condition qu’il me sera permis non point d’élever (ce qui me sera formellement interdit), mais d’abaisser, autant que je le voudrai, les droits de douane.
Jacques Bonhomme. »
Mais vous êtes fou, dis-je à Jacques Bonhomme, qui me communiquait sa lettre ; vous n’avez jamais rien su prendre avec modération. L’autre jour vous vous récriiez contre l’ouragan des réformes, et voilà que vous en réclamez trois, faisant de l’une la condition des deux autres. Vous vous ruinerez. — Soyez tranquille, dit-il, j’ai fait tous mes calculs. Plaise à Dieu qu’ils acceptent ! Mais ils n’accepteront pas. — Là-dessus, nous nous quittâmes la tête pleine, lui de chiffres, moi de réflexions, que j’épargne au lecteur.
XIII. Les trois Échevins↩
Démonstration en quatre tableaux.
premier tableau.
(La scène se passe dans l’hôtel de l’échevin Pierre. La fenêtre donne sur un beau parc ; trois personnages sont attablés près d’un bon feu.)
Pierre. Ma foi ! vive le feu quand Gaster est satisfait. Il
faut convenir que c’est une douce chose. Mais, hélas ! que de braves gens, comme le Roi d’Yvetot,
Soufflent, faute de bois,
Dans leurs doigts.
Malheureuses créatures ! le ciel m’inspire une pensée charitable. Vous voyez ces beaux arbres, je les veux abattre et distribuer le bois aux pauvres.
Paul et Jean. Quoi ! gratis ?
Pierre. Pas précisément. C’en serait bientôt fait de mes bonnes œuvres, si je dissipais ainsi mon bien. J’estime que mon parc vaut vingt mille livres ; en l’abattant j’en tirerai bien davantage.
Paul. Erreur. Votre bois sur pied a plus de valeur que celui des forêts voisines, car il rend des services que celui-ci ne peut pas rendre. Abattu, il ne sera bon, comme l’autre, qu’au chauffage, et ne vaudra pas un denier de plus la voie.
Pierre. Oh ! oh ! Monsieur le théoricien, vous oubliez que je suis, moi, un homme de pratique. Je croyais ma réputation de spéculateur assez bien établie, pour me mettre à l’abri d’être taxé de niaiserie. Pensez-vous que je vais m’amuser à vendre mon bois au prix du bois flotté ?
Paul. Il le faudra bien.
Pierre. Innocent ! Et si j’empêche le bois flotté d’arriver à Paris ?
Paul. Ceci changerait la question. Mais comment vous y prendrez-vous ?
Pierre. Voici tout le secret. Vous savez que le bois flotté paie à l’entrée dix sur la voie. Demain je décide que les Échevins à porter le droit à 100, 200, 300 livres, enfin, assez haut pour qu’il n’entre pas de quoi faire une bûche. — Eh ! saisissez-vous ? — Si le bon peuple ne veut pas crever de froid, il faudra bien qu’il vienne à mon chantier. On se battra pour avoir mon bois, je le vendrai au poids de l’or, et cette charité bien ordonnée me mettra à même d’en faire d’autres.
Paul. Morbleu ! la belle invention ! elle m’en suggère une autre de même force.
Jean. Voyons, qu’est-ce ? La philanthropie est-elle aussi en jeu ?
Paul. Comment avez-vous trouvé ce beurre de Normandie ?
Jean. Excellent.
Paul. Hé, hé ! il me paraissait passable tout à l’heure. Mais ne trouvez-vous pas qu’il prend à la gorge ? J’en veux faire de meilleurs à Paris. J’aurai quatre ou cinq cents vaches ; je ferai au pauvre peuple une distribution de lait, de beurre et de fromage.
Pierre et Paul. Quoi ! charitablement ?
Paul. Bah ! mettons toujours la charité en avant. C’est une si belle figure que son masque même est un excellent passe-port. Je donnerai mon beurre au peuple, le peuple me donnera son argent. Est-ce que cela s’appelle vendre ?
Jean. Non, selon le Bourgeois gentilhomme ; mais appelez-le comme il vous plaira, vous vous ruinerez. Est-ce que Paris peut lutter avec la Normandie pour l’élève des vaches ?
Paul. J’aurai pour moi l’économie du transport.
Jean. Soit. Mais encore, en payant le transport, les Normands sont à même de battre les Parisiens.
Paul. Appelez-vous battre quelqu’un, lui livrer les choses à bas prix ?
Jean. C’est le mot consacré. Toujours est-il que vous serez battu, vous.
Paul. Oui, comme Don Quichotte. Les coups retomberont sur Sancho. Jean, mon ami, vous oubliez l’octroi.
Jean. L’octroi ! qu’a-t-il à démêler avec votre beurre ?
Paul. Dès demain, je réclame protection ; je décide la commune à prohiber le beurre de Normandie et de Bretagne. Il faudra bien que le peuple s’en passe, ou qu’il achète le mien, et à mon prix encore.
Jean. Par la sambleu, Messieurs, votre philanthropie m’entraîne.
On apprend à hurler, dit l’autre, avec les loups.
Mon parti est pris. Il ne sera pas dit que je suis Échevin indigne. Pierre, ce feu pétillant a enflammé votre âme ; Paul, ce beurre a donné du jeu aux ressorts de votre esprit ; eh bien ! je sens aussi que cette pièce de salaison stimule mon intelligence. Demain, je vote et fais voter l’exclusion des porcs, morts ou vifs ; cela fait, je construis de superbes loges en plein Paris,
Pour l’animal immonde aux Hébreux défendu.
Je me fais porcher et charcutier. Voyons comment le bon peuple lutécien évitera de venir s’approvisionner à ma boutique.
Pierre. Eh, Messieurs, doucement, si vous renchérissez ainsi le beurre et le salé, vous rognez d’avance le profit que j’attendais de mon bois.
Paul. Dame ! ma spéculation n’est plus aussi merveilleuse, si vous me rançonnez avec vos bûches et vos jambons.
Jean. Et moi, que gagnerai-je à vous faire surpayer mes saucisses, si vous me faites surpayer les tartines et les falourdes ?
Pierre. Eh bien ! voilà-t-il que nous allons nous quereller ? Unissons-nous plutôt. Faisons-nous des concessions réciproques. D’ailleurs, il n’est pas bon de n’écouter que le vil intérêt ; l’humanité est là, ne faut-il pas assurer le chauffage du peuple ?
Paul. C’est juste. Et il faut que le peuple ait du beurre à étendre sur son pain.
Jean. Sans doute. Et il faut qu’il puisse mettre du lard dans son pot-au-feu.
Ensemble. En avant la charité ! vive la philanthropie ! à demain ! à demain ! nous prenons l’octroi d’assaut.
Pierre. Ah ! j’oubliais. Encore un mot : c’est essentiel. Mes amis, dans ce siècle d’égoïsme, le monde est méfiant ; et les intentions les plus pures sont souvent mal interprétées. Paul, plaidez pour le bois ; Jean, défendez le beurre, et moi je me voue au cochon local. Il est bon de prévenir les soupçons malveillants.
Paul et Jean (en sortant). Par ma foi ! voilà un habile homme !
deuxième tableau.
Conseil des échevins.
Paul. Mes chers collègues, il entre tous les jours des masses de bois à Paris, ce qui en fait sortir des masses de numéraire. De ce train, nous sommes tous ruinés en trois ans, et que deviendra le pauvre peuple ? (Bravo !) Prohibons le bois étranger. — Ce n’est pas pour moi que je parle, car, de tout le bois que je possède, on ne ferait pas un cure-dents. Je suis donc parfaitement désintéressé dans la question. (Bien, bien !) Mais voici Pierre qui a un parc, il assurera le chauffage à nos concitoyens, qui ne seront plus sous la dépendance des charbonniers de l’Yonne. Avez-vous jamais songé au danger que nous courons de mourir de froid, s’il prenait fantaisie aux propriétaires des forêts étrangères de ne plus porter de bois à Paris ? Prohibons donc le bois. Par là nous préviendrons l’épuisement de notre numéraire, nous créerons l’industrie bûcheronne, et nous ouvrirons à nos ouvriers une nouvelle source de travail et de salaires. (Applaudissements.)
Jean. J’appuie la proposition si philanthropique, et surtout, si désintéressée, ainsi qu’il le disait lui-même, de l’honorable préopinant. Il est temps que nous arrêtions cet insolent laissez passer, qui a amené sur notre marché une concurrence effrénée, en sorte qu’il n’est pas une province un peu bien située, pour quelque production que ce soit, qui ne vienne nous inonder, nous la vendre à vil prix, et détruire le travail parisien. C’est à l’État à niveler les conditions de production par les droits sagement pondérés, à ne laisser entrer du dehors que ce qui y est plus cher qu’à Paris, et à nous soustraire ainsi à une lutte inégale. Comment, par exemple, veut-on que nous puissions faire du lait et du beurre à Paris, en présence de la Bretagne et de la Normandie ? Songez donc, Messieurs, que les Bretons ont la terre à meilleur marché, le foin plus à portée, la main d’œuvre à des conditions plus avantageuses. Le bon sens ne dit-il pas qu’il faut égaliser les chances par un tarif d’octroi protecteur ? Je demande que le droit sur le lait et le beurre soit porté à 1,000 p. 100, et plus s’il le faut. Le déjeuner du peuple en sera un peu plus cher, mais aussi comme ses salaires vont hausser ! nous verrons s’élever des étables, des laiteries, se multiplier des barates, et se fonder de nouvelles industries. — Ce n’est pas que j’aie le moindre intérêt à ma proposition. Je ne suis pas vacher, ni ne veux l’être. Je suis mû par le seul désir d’être utile aux classes laborieuses. (Mouvement d’adhésion.)
Pierre. Je suis heureux de voir dans cette assemblée des hommes d’États aussi purs, aussi éclairés, aussi dévoués aux intérêts du peuple. (Bravos.) J’admire leur abnégation, et je ne saurais mieux faire que d’imiter un si noble exemple. J’appuie leur motion, et j’y ajoute celle de prohiber les porcs du Poitou. Ce n’est pas que je veuille me faire porcher ni charcutier ; en ce cas, ma conscience me ferait un devoir de m’abstenir. Mais n’est-il pas honteux, Messieurs, que nous soyons tributaires de ces paysans poitevins, qui ont l’audace de venir, jusque sur notre propre marché, s’emparer d’un travail que nous pourrions faire nous-même ; qui, après nous avoir inondés de saucisses et de jambons, ne nous prennent peut-être rien en retour ? En tout cas, qui nous dit que la balance du commerce n’est pas en leur faveur et que nous ne sommes pas obligés de leur payer un solde en argent ? N’est-il pas clair que, si l’industrie poitevine s’implantait à Paris, elle ouvrirait des débouchés assurés au travail parisien ? — Et puis, Messieurs, n’est-il pas fort possible, comme le disait si bien M. Lestiboudois [179], que nous achetions le salé poitevin, non pas avec nos revenus, mais avec nos capitaux ? Où cela nous mènerait-il ? Ne souffrons donc pas que des rivaux avides, cupides, perfides, viennent vendre ici les choses à bon marché, et nous mettre dans l’impossibilité de les faire nous-mêmes. Échevins, Paris nous a donné sa confiance, c’est à nous de la justifier. Le peuple est sans ouvrage, c’est à nous de lui en créer, et si le salé lui coûte un peu plus cher, nous aurons du moins la conscience d’avoir sacrifié nos intérêts à ceux des masses comme tout bon échevin doit faire. (Tonnerres d’applaudissements.)
Une voix. J’entends qu’on parle beaucoup du pauvre peuple, mais, sous prétexte de lui donner du travail, on commence par lui enlever ce qui vaut mieux que le travail même, le bois, le beurre et la soupe.
Pierre, Paul et Jean. Aux voix ! aux voix ! à bas les utopistes, les théoriciens, les généralisateurs. Aux voix ! aux voix ! (Les trois propositions sont admises.)
troisième tableau.
Vingt ans après.
Le Fils. Père, décidez-vous, il faut quitter Paris. On n’y peut plus vivre. L’ouvrage manque et tout y est cher.
Le Père. Mon enfant, tu ne sais pas ce qu’il en coûte d’abandonner le lieu qui nous a vus naître.
Le Fils. Le pire de tout est d’y périr de misère.
Le Père. Va, mon fils, cherche une terre plus hospitalière. Pour moi je ne m’éloignerai pas de cette fosse, où sont descendus ta mère, tes frères et tes sœurs. Il me tarde d’y trouver enfin, auprès d’eux, le repos qui m’a été refusé dans cette ville de désolation.
Le Fils. Du courage, bon père, nous trouverons du travail à l’étranger, en Poitou, en Normandie, en Bretagne. On dit que toute l’industrie de Paris se transporte peu à peu dans ces contrées lointaines.
Le Père. C’est bien naturel. Ne pouvant plus vendre du bois et des aliments, elles ont cessé d’en produire au delà de leurs besoins ; ce qu’elles ont de temps et de capitaux disponibles, elles les consacrent à faire elles-mêmes ce que nous leur fournissions autrefois.
Le Fils. De même qu’à Paris on cesse de faire de beaux meubles et de beaux vêtements, pour planter des arbres, élever des porcs et des vaches. Quoique bien jeune, j’ai vu de vastes magasins, de somptueux quartiers, des quais animés sur ces bords de la Seine, envahis maintenant par des prés et des taillis.
Le Père. Pendant que la province se couvre de villes, Paris se fait campagne. Quelle affreuse révolution ! Et il a suffi de trois Échevins égarés, aidés de l’ignorance publique, pour attirer sur nous cette terrible calamité.
Le Fils. Contez-moi cette histoire, mon père.
Le Père. Elle est bien simple. Sous prétexte d’implanter à Paris trois industries nouvelles et de donner ainsi de l’aliment au travail des ouvriers, ces hommes firent prohiber le bois, le beurre et la viande. Ils s’arrogèrent le droit d’en approvisionner leurs concitoyens. Ces objets s’élevèrent d’abord à un prix exorbitant. Personne ne gagnait assez pour s’en procurer, et le petit nombre de ceux qui pouvaient en obtenir, y mettant tous leurs profits, étaient hors d’état d’acheter autre chose ; toutes les industries par cette cause s’arrêtèrent à la fois, d’autant plus vite que les provinces n’offraient non plus aucuns débouchés. La misère, la mort, l’émigration commencèrent à dépeupler Paris.
Le Fils. Et quand cela s’arrêtera-t-il ?
Le Père. Quand Paris sera devenue une forêt et une prairie.
Le Fils. Les trois Échevins doivent avoir fait une grande fortune ?
Le Père. D’abord, ils réalisèrent d’énormes profits ; mais à la longue ils ont été enveloppés dans la misère commune.
Le Fils. Comment cela est-il possible ?
Le Père. Tu vois cette ruine, c’était un magnifique hôtel entouré d’un beau parc. Si Paris eût continué à progresser, maître Pierre en tirerait plus de rentes qu’il ne vaut aujourd’hui en capital.
Le Fils. Comment cela se peut-il, puisqu’il s’est débarrassé de la concurrence ?
Le Père. La concurrence pour vendre a disparu, mais la concurrence pour acheter disparaît aussi tous les jours et continuera de disparaître, jusqu’à ce que Paris soit rase campagne et que le taillis de maître Pierre n’ait plus de valeur qu’une égale superficie de taillis dans la forêt de Bondy. C’est ainsi que le monopole, comme toute injustice, porte en lui-même son propre châtiment.
Le Fils. Cela ne me semble pas bien clair, mais ce qui est incontestable, c’est la décadence de Paris. N’y a-t-il donc aucun moyen de renverser cette mesure unique que Pierre et ses collègues firent adopter il y vingt ans ?
Le Père. Je vais te confier mon secret. Je reste à Paris pour cela ; j’appellerai le peuple à mon aide. Il dépend de lui de replacer l’octroi sur ses anciennes bases, de le dégager de ce funeste principe qui s’est enté dessus et y a végété comme un fungus parasite.
Le Fils. Vous devez réussir dès le premier jour.
Le Père. Oh ! l’œuvre est au contraire difficile et laborieuse. Pierre, Paul et Jean s’entendent à merveille. Ils sont prêts à tout plutôt que laisser entrer le bois, le beurre et la viande à Paris. Ils ont pour eux le peuple même, qui voit clairement le travail que lui donnent les trois industries protégées, qui sait à combien de bûcherons et de vachers elles donnent de l’emploi, mais qui ne peut avoir une idée aussi précise du travail qui se développerait au grand air de la liberté.
Le Fils. Si ce n’est que cela, vous l’éclairerez.
Le Père. Enfant, à ton âge on ne doute de rien. Si j’écris, le peuple ne lira pas ; car, pour soutenir sa malheureuse existence, il n’a pas trop de toutes ses heures. Si je parle, les Échevins me fermeront la bouche. Le peuple restera donc longtemps dans son funeste égarement ; les partis politiques, qui fondent leurs espérances sur ses passions, s’occuperont moins de dissiper ses préjugés que de les exploiter. J’aurai donc à la fois sur les bras les puissants du jour, le peuple et les partis. Oh ! je vois un orage effroyable prêt à fondre sur la tête de l’audacieux qui osera s’élever contre une iniquité si enracinée dans le pays.
Le Fils. Vous aurez pour vous la justice et la vérité.
Le Père. Et ils auront pour eux la force et la calomnie. Encore, si j’étais jeune ! mais l’âge et la souffrance ont épuisé mes forces.
Le Fils. Eh bien, père, ce qui vous en reste, consacrez-le au service de la patrie. Commencez cette œuvre d’affranchissement et laissez-moi pour héritage le soin de l’achever.
quatrième tableau.
L’agitation.
Jacques Bonhomme. Parisiens, demandons la réforme de l’octroi ; qu’il soit rendu à sa première destination. Que tout citoyen soit libre d’acheter du bois, du beurre et de la viande où bon lui semble.
Le Peuple. Vive, vive la liberté !
Pierre. Parisiens, ne vous laissez pas séduire à ce mot. Que vous importe la liberté d’acheter, si vous n’en avez pas les moyens ? et comment en aurez-vous les moyens, si l’ouvrage vous manque ? Paris peut-il produire du bois à aussi bon marché que la forêt de Bondy ? de la viande à aussi bas prix que le Poitou ? du beurre d’aussi bonnes conditions que la Normandie ? Si vous ouvrez la porte à deux battants à ces produits rivaux, que deviendront les vachers, les bûcherons et les charcutiers ? Ils ne peuvent se passer de protection.
Le Peuple. Vive, vive la protection !
Jacques. La protection ! Mais vous protége-t-on, vous, ouvriers ? ne vous faites-vous pas concurrence les uns aux autres ? Que les marchands de bois souffrent donc la concurrence à leur tour. Ils n’ont pas le droit d’élever par la loi le prix de leurs bois, à moins qu’il n’élèvent aussi, par la loi, le taux des salaires. N’êtes-vous plus ce peuple amant de l’égalité ?
Le Peuple. Vive, vive l’égalité !
Pierre. N’écoutez pas ce factieux. Nous avons élevé le prix du bois, de la viande et du beurre, c’est vrai ; mais c’est pour pouvoir donner de bons salaires aux ouvriers. Nous sommes mus par la charité.
Le Peuple. Vive, vive la charité !
Jacques. Faites servir l’octroi, si vous pouvez, à hausser les salaires, ou ne le faites pas servir à renchérir les produits. Les Parisiens ne demandent pas la charité, mais la justice.
Le Peuple. Vive, vive la justice !
Pierre. C’est précisément la cherté des produits qui amènera la cherté des salaires.
Le Peuple. Vive, vive la cherté !
Jacques. Si le beurre est cher, ce n’est pas parce que vous payez chèrement les ouvriers ; ce n’est pas même que vous fassiez de grands profits, c’est uniquement parce que Paris est mal placé pour cette industrie, parce que vous avez voulu qu’on fît à la ville ce qu’on doit faire à la campagne, et à la campagne ce qui se faisait à la ville. Le peuple n’a pas plus de travail, seulement il travaille à autre chose. Il n’a plus de salaires, seulement il n’achète plus les choses à aussi bon marché.
Le Peuple. Vive, vive le bon marché !
Pierre. Cet homme vous séduit par ses belles phrases. Posons la question dans toute sa simplicité. N’est-il pas vrai que si nous admettons le beurre, le bois et la viande, nous en serons inondés ? nous périrons de pléthore. Il n’y a donc d’autre moyen, pour nous préserver de cette invasion de nouvelle espèce, que de lui fermer la porte, et pour maintenir le prix des choses, que d’en occasionner artificiellement la rareté.
Quelques voix fort rares. Vive, vive la rareté !
Jacques. Posons la question dans toute sa vérité. Entre tous les Parisiens, on ne peut partager que ce qu’il y a dans Paris ; s’il y a moins de bois, de viande, de beurre, la part de chacun sera plus petite. Or il y en aura moins, si nous les repoussons que si nous les laissons entrer. Parisiens, il ne peut y avoir abondance pour chacun, qu’autant qu’il y aabondance générale.
Le peuple. Vive, vive l’abondance !
Pierre. Cet homme a beau dire, il ne vous prouvera pas que vous soyez intéressés à subir une concurrence effrénée.
Le peuple. À bas, à bas la concurrence !
Jacques. Cet homme a beau déclamer, il ne vous fera pas goûter à la restriction.
Le peuple. À bas, à bas la restriction !
Pierre. Et moi, je déclare que si l’on prive les pauvres vachers et les porchers de leur gagne-pain, si on les sacrifie à des théories, je ne réponds plus de l’ordre public. Ouvriers, méfiez-vous de cet homme. C’est agent de la perfide Normandie, il va chercher ses inspirations à l’étranger. C’est un traître, il faut le pendre. (Le peuple garde le silence.)
Jacques. Parisiens, tout ce que je dis aujourd’hui, je le disais il y a vingt ans, lorsque Pierre s’avisa d’exploiter l’octroi à son profit et à votre préjudice. Je ne suis donc pas un agent des Normands. Pendez-moi si vous voulez, mais cela n’empêchera pas l’oppression d’être oppression. Amis, ce n’est ni Jacques ni Pierre qu’il faut tuer, mais la liberté si elle vous fait peur, ou la restriction si elle vous fait mal.
Le peuple. Ne pendons personne et affranchissons tout le monde.
XIV. Autre chose↩
— Qu’est-ce que la restriction ?
— C’est une prohibition partielle.
— Qu’est-ce la prohibition ?
— C’est une restriction absolue.
— En sorte que ce que l’on dit de l’une est vrai de l’autre ?
— Oui, sauf le degré. Il y a entre elles le même rapport qu’entre l’arc de cercle et le cercle.
— Donc, si la prohibition est mauvaise, la restriction ne saurait être bonne ?
— Pas plus que l’arc ne peut être droit si le cercle est courbe.
— Quel est le nom commun à la restriction et à la prohibition ?
— Protection.
— Quel est l’effet définitif de la protection ?
— D’exiger des hommes un plus grand travail pour un même résultat.
— Pourquoi les hommes sont-ils si attachés au régime protecteur ?
— Parce que la liberté devant amener un même résultat pour un moindre travail, cette diminution apparente de travail les effraie.
— Pourquoi dites-vous apparente ?
— Parce que tout travail épargné peut être consacré à autre chose.
— À quelle autre chose ?
— C’est ce qui ne peut être précisé et n’a pas besoin de l’être.
— Pourquoi ?
— Parce que, si la somme des satisfactions de la France actuelle pouvait être acquise avec une diminution d’un dixième sur la somme de son travail, nul ne peut préciser quelles satisfactions nouvelles elle voudrait se procurer avec le travail resté disponible. L’un voudrait être mieux vêtu, l’autre mieux nourri, celui-ci mieux instruit, celui-là plus amusé.
— Expliquez-moi le mécanisme et les effets de la protection.
— La chose n’est pas aisée. Avant d’aborder le cas compliqué, il faudrait l’étudier dans le cas le plus simple.
— Prenez le cas le plus simple que vous voudrez.
— Vous rappelez-vous comment s’y prit Robinson, n’ayant pas de scie, pour faire une planche ?
— Oui. Il abattit un arbre, et puis avec sa hache taillant la tige à droite et à gauche, il la réduisit à l’épaisseur d’un madrier.
— Et cela lui donna bien du travail ?
— Quinze jours pleins.
— Et pendant ce temps de quoi vécut-il ?
— De ses provisions.
— Et qu’advint-il à la hache ?
— Elle en fut tout émoussée.
— Fort bien. Mais vous ne savez peut-être pas ceci : au moment de donner le premier coup de hache, Robinson aperçut une planche jetée par le flot sur le rivage.
— Oh ! l’heureux à-propos ! il courut la ramasser ?
— Ce fut son premier mouvement ; mais il s’arrêta, raisonnant ainsi :
« Si je vais chercher cette planche, il ne m’en coûtera que la fatigue de la porter, le temps de descendre et de remonter la falaise.
Mais si je fais une planche avec ma hache, d’abord je me procurerai du travail pour quinze jours, ensuite j’userai ma hache, ce qui me fournira l’occasion de la réparer, et je dévorerai mes provisions, troisième source de travail, puisqu’il faudra les remplacer. Or, le travail, c’est la richesse. Il est clair que je me ruinerais en allant ramasser la planche naufragée. Il m’importe de protéger mon travail personnel, et même, à présent que j’y songe, je puis me créer un travail additionnel, en allant repousser du pied cette planche dans la mer ! »
— Mais ce raisonnement était absurde !
— Soit. Ce n’en est pas moins celui que fait toute nation qui se protége par la prohibition. Elle repousse la planche qui lui est offerte en échange d’un petit travail, afin de se donner un travail plus grand. Il n’y a pas jusqu’au travail du douanier dans lequel elle ne voie un gain. Il est représenté par la peine que se donna Robinson pour aller rendre aux flots le présent qu’ils voulaient lui faire. Considérez la nation comme un être collectif, et vous ne trouverez pas entre son raisonnement et celui de Robinson un atome de différence.
— Robinson ne voyait-il pas que le temps épargné, il le pouvait consacrer à faire autre chose ?
— Quelle autre chose ?
— Tant qu’on a devant soi des besoins et du temps, on a toujours quelque chose à faire. Je ne suis pas tenu de préciser le travail qu’il pouvait entreprendre.
— Je précise bien celui qui lui aurait échappé.
— Et moi, je soutiens que Robinson, par un aveuglement incroyable, confondait le travail avec son résultat, le but avec les moyens, et je vais vous le prouver…
— Je vous en dispense. Toujours est-il que voilà le système restrictif ou prohibitif dans sa plus simple expression. S’il vous paraît absurde sous cette forme, c’est que les deux qualités de producteur et de consommateur se confondent ici dans le même individu.
— Passez donc à un exemple plus compliqué.
— Volontiers. — À quelque temps de là, Robinson ayant rencontré Vendredi, ils se lièrent et se mirent à travailler en commun. Le matin, ils chassaient pendant six heures et rapportaient quatre paniers de gibier. Le soir, ils jardinaient six heures et obtenaient quatre paniers de légumes.
Un jour une pirogue aborda l’Île du Désespoir. Un bel étranger en descendit et fut admis à la table de nos deux solitaires. Il goûta et vanta beaucoup les produits du jardin et, avant de prendre congé de ses hôtes, il leur tint ce langage :
« Généreux insulaires, j’habite une terre beaucoup plus giboyeuse que celle-ci, mais où l’horticulture est inconnue. Il me sera facile de vous apporter tous les soirs quatre paniers de gibier, si vous voulez me céder seulement deux paniers de légumes. »
À ces mots, Robinson et Vendredi s’éloignèrent pour tenir conseil, et le débat qu’ils eurent est trop intéressant pour que je ne le rapporte pas ici in extenso.
Vendredi. — Ami, que t’en semble ?
Robinson. — Si nous acceptons, nous sommes ruinés.
V. — Est-ce bien sûr ? Calculons.
R. — C’est tout calculé. Écrasés par la concurrence, la chasse est pour nous une industrie perdue.
V. — Qu’importe ? si nous avons le gibier.
R. — Théorie ! Il ne sera pas le produit de notre travail.
V. — Si fait, morbleu, puisque, pour l’avoir, il faudra donner des légumes !
R. — Alors que gagnerons-nous ?
V. — Les quatre paniers de gibier nous coûtent six heures de travail. L’étranger nous les donne contre deux paniers de légumes qui ne nous prennent que trois heures. — C’est donc trois heures qui restent à notre disposition.
R. — Dis donc, qui sont soustraites à notre activité. C’est là précisément notre perte. Le travail, c’est la richesse, et si nous perdons un quart de notre temps, nous serons d’un quart moins riches.
V. — Ami, tu fais une méprise énorme. Même gibier, mêmes légumes, et, par-dessus le marché, trois heures disponibles, c’est du progrès, ou il n’y en a pas dans ce monde.
R. — Généralité ! Que ferons-nous de ces trois heures ?
V. — Nous ferons autre chose.
R. — Ah ! je t’y prends. Tu ne peux rien préciser. Autre chose, autre chose, c’est bientôt dit.
V. — Nous pêcherons, nous embellirons notre case, nous lirons la Bible.
R. — Utopie ! Est-il bien certain que nous ferons ceci plutôt que cela ?
V. — Eh bien, si les besoins nous font défaut, nous nous reposerons. N’est-ce rien que le repos ?
R. — Mais quand on se repose, on meurt de faim.
V. — Ami, tu es dans un cercle vicieux. Je te parle d’un repos qui ne retranche rien sur notre gibier ni sur nos légumes. Tu oublies toujours qu’au moyen de notre commerce avec l’étranger, neuf heures de travail nous donneront autant de provisions qu’aujourd’hui douze.
R. — On voit bien que tu n’as pas été élevé en Europe. Tu n’as peut-être jamais lu le Moniteur industriel ? Il t’aurait appris ceci : « Tout le temps épargné est une perte sèche. Ce n’est pas de manger qui importe, c’est de travailler. Tout ce que nous consommons, si ce n’est pas le produit direct de notre travail, ne compte pas. Veux-tu savoir si tu es riche ? Ne regarde pas à tes satisfactions, mais à ta peine. » Voilà ce que le Moniteur industriel t’aurait appris. Pour moi, qui ne suis pas un théoricien, je ne vois que la perte de notre chasse.
V. — Quel étrange renversement d’idées ! Mais…
R. — Pas de mais. D’ailleurs, il y a des raisons politiques pour repousser les offres intéressées du perfide étranger.
V. — Des raisons politiques !
R. — Oui. D’abord, il ne nous fait ces offres que parce qu’elles lui sont avantageuses.
V. — Tant mieux, puisqu’elles nous le sont aussi.
R. — Ensuite, par ces trocs, nous nous mettrons dans sa dépendance.
V. — Et lui dans la nôtre. Nous aurons besoin de son gibier, lui de nos légumes, et nous vivrons en bonne amitié.
R. — Système ! Veux-tu que je te mette sans parole ?
V. — Voyons ; j’attends encore une bonne raison.
R. — Je suppose que l’étranger apprenne à cultiver un jardin et que son île soit plus fertile que la nôtre. Vois-tu la conséquence ?
V. — Oui. Nos relations avec l’étranger cesseront. Il ne nous prendra plus de légumes, puisqu’il en aura chez lui avec moins de peine. Il ne nous apportera plus de gibier, puisque nous n’aurons rien à lui donner en échange, et nous serons justement alors comme tu veux que nous soyons aujourd’hui.
R. — Sauvage imprévoyant ! Tu ne vois pas qu’après avoir tué notre chasse en nous inondant de gibier, il tuera notre jardinage en nous inondant de légumes.
V. — Mais ce ne sera jamais qu’autant que nous lui donnerons autre chose, c’est-à-dire que nous trouverons autre chose à produire avec économie de travail pour nous.
R. — Autre chose, autre chose ! Tu en viens toujours là. Tu es dans le vague, ami Vendredi ; il n’y a rien de pratique dans tes vues.
La lutte se prolongea longtemps et laissa chacun, ainsi qu’il arrive souvent, dans sa conviction. Cependant, Robinson ayant sur Vendredi un grand ascendant, son avis prévalut, et quand l’étranger vint chercher la réponse, Robinson lui dit :
« — Étranger, pour que votre proposition soit acceptée, il faudrait que nous fussions bien sûrs de deux choses :
La première, que votre île n’est pas plus giboyeuse que la nôtre ; car nous ne voulons lutter qu’à armes égales.
La seconde, que vous perdrez au marché. Car, comme dans tout échange il y a nécessairement un gagnant et un perdant, nous serions dupes si vous ne l’étiez pas. — Qu’avez-vous à dire ? »
« — Rien, dit l’étranger. » Et ayant éclaté de rire, il regagna sa pirogue.
— Le conte ne serait pas mal, si Robinson n’était pas si absurde.
— Il ne l’est pas plus que le comité de la rue Hauteville.
— Oh ! c’est bien différent. Vous supposez tantôt un homme seul, tantôt, ce qui revient au même, deux hommes vivant en communauté. Ce n’est pas là notre monde ; la séparation des occupations, l’intervention des négociants et du numéraire changent bien la question.
— Cela complique en effet les transactions, mais n’en change pas la nature.
— Quoi ! vous voulez comparer le commerce moderne à de simples trocs ?
— Le commerce n’est qu’une multitude de trocs ; la nature propre du troc est identique à la nature propre du commerce, comme un petit travail est de même nature qu’un grand, comme la gravitation qui pousse un atome est de même nature que celle qui entraîne un monde.
— Ainsi, selon vous, ces raisonnements si faux dans la bouche de Robinson ne le sont pas moins dans la bouche de nos protectionistes ?
— Non ; seulement l’erreur s’y cache mieux sous la complication des circonstances.
— Eh bien ! arrivez donc à un exemple pris dans l’ordre actuel des faits.
— Soit ; en France, vu les exigences du climat et des habitudes, le drap est une chose utile. L’essentiel est-il d’en faire ou d’en avoir ?
— Belle question ! pour en avoir, il faut en faire.
— Ce n’est pas indispensable. Pour en avoir, il faut que quelqu’un le fasse, voilà qui est certain ; mais il n’est pas d’obligation que ce soit la personne ou le pays qui le consomme, qui le produise. Vous n’avez pas fait celui qui vous habille si bien ; la France n’a pas fait le café dont elle déjeune.
— Mais j’ai acheté mon drap, et la France son café.
— Précisément, et avec quoi ?
— Avec de l’argent.
— Mais vous n’avez pas fait l’argent, ni la France non plus.
— Nous l’avons acheté.
— Avec quoi ?
— Avec nos produits qui sont allés au Pérou.
— C’est donc en réalité votre travail que vous échangez contre du drap, et le travail français qui s’est échangé contre du café.
— Assurément.
— Il n’est donc pas de nécessité rigoureuse de faire ce qu’on consomme ?
— Non, si l’on fait autre chose que l’on donne en échange.
— En d’autres termes, la France a deux moyens de se procurer une quantité donnée de drap. Le premier, c’est de le faire ; le second, c’est de faire autre chose, et de troquer cette autre chose à l’étranger contre du drap. De ces deux moyens, quel est le meilleur ?
— Je ne sais pas trop.
— N’est-ce pas celui qui, pour un travail déterminé, donne une plus grande quantité de drap ?
— Il semble bien.
— Et lequel vaut mieux, pour une nation, d’avoir le choix entre ces deux moyens ou que la loi lui en interdise un, au risque de tomber justement sur le meilleur ?
— Il me paraît qu’il vaut mieux pour elle avoir le choix, d’autant qu’en ces matières elle choisit toujours bien.
— La loi, qui prohibe le drap étranger, décide donc que si la France veut avoir du drap, il faut qu’elle le fasse en nature, et qu’il lui est interdit de faire cette autre chose avec laquelle elle pourrait acheter du drap étranger ?
— Il est vrai.
— Et comme elle oblige à faire le drap et défend de faire l’autre chose, précisément parce que cette autre chose exigerait moins de travail (sans quoi elle n’aurait pas besoin de s’en mêler), elle décrète donc virtuellement que, par un travail déterminé, la France n’aura qu’un mètre de drap en le faisant, quand, pour le même travail, elle en aurait eu deux mètres en faisant l’autre chose.
— Mais, pour Dieu ! quelle autre chose ?
— Eh ! pour Dieu ! qu’importe ? ayant le choix, elle ne fera autre chose qu’autant qu’il y ait quelque autre chose à faire.
— C’est possible ; mais, je me préoccupe toujours de l’idée que l’étranger nous envoie du drap et ne nous prenne pas l’autre chose, auquel cas nous serions bien attrapés. En tout cas, voici l’objection, même à votre point de vue. Vous convenez que la France fera cette autre chose à échanger contre du drap, avec moins de travail que si elle eût fait le drap lui-même.
— Sans doute.
— Il y aura donc une certaine quantité de son travail frappée d’inertie.
— Oui, mais sans qu’elle soit moins bien vêtue, petite circonstance qui fait toute la méprise. Robinson la perdait de vue ; nos protectionistes ne la voient pas ou la dissimulent. La planche naufragée frappait aussi d’inertie, pour quinze jours, le travail de Robinson, en tant qu’appliqué à faire une planche, mais s’en l’en priver. Distinguez donc entre ces deux espèces de diminution de travail, celle qui a pour effet la privation et celle qui a pour cause la satisfaction. Ces deux choses sont fort différentes et, si vous les assimilez, vous raisonnez comme Robinson. Dans les cas les plus compliqués, comme dans les cas les plus simples, le sophisme consiste en ceci : Juger de l’utilité du travail par sa durée et son intensité, et non par ses résultats ; ce qui conduit à cette police économique : Réduire les résultats du travail dans le but d’en augmenter la durée et l’intensité [180] .
XV. Le petit arsenal du libre-échangiste↩
— Si l’on vous dit : Il n’y a point de principes absolus. La prohibition peut être mauvaise et la restriction bonne.
Répondez : La restriction prohibe tout ce qu’elle empêche d’entrer.
— Si l’on vous dit : L’agriculture est la mère nourricière du pays.
Répondez : Ce qui nourrit le pays, ce n’est précisément pas l’agriculture, mais le blé.
— Si l’on vous dit : La base de l’alimentation du peuple, c’est l’agriculture.
Répondez : La base de l’alimentation du peuple, c’est le blé. Voilà pourquoi une loi qui fait obtenir, par du travail agricole, deux hectolitres de blé, aux dépens de quatre hectolitres qu’aurait obtenus, sans elle, un même travail industriel, loin d’être une loi d’alimentation, est une loi d’inanition.
— Si l’on vous dit : La restriction à l’entrée du blé étranger induit à plus de culture et, par conséquent, à plus de production intérieure.
Répondez : Elle induit à semer sur les roches des montagnes et sur les sables de la mer. Traire une vache et traire
toujours donne plus de lait ; car qui peut dire le moment
où l’on n’obtiendra plus une goutte ? Mais la goutte coûte cher.
— Si l’on vous dit : Que le pain soit cher, et l’agriculteur devenu riche enrichira l’industriel.
Répondez : Le pain est cher quand il y en a peu, ce qui ne peut faire que des pauvres, ou, si vous voulez, des riches affamés.
— Si l’on insiste, disant : Quand le pain renchérit, les salaires s’élèvent.
Répondez en montrant, en avril 1847, les cinq sixièmes des ouvriers à l’aumône.
— Si l’on vous dit : Les profits des ouvriers doivent suivre la cherté de la subsistance.
Répondez : Cela revient à dire que, dans un navire sans provisions, tout le monde a autant de biscuit, qu’il y en ait ou qu’il n’y en ait pas.
— Si l’on vous dit : Il faut assurer un bon salaire à celui qui vend du blé.
Répondez : Soit ; mais alors, il faut assurer un bon salaire à celui qui l’achète.
— Si l’on vous dit : Les propriétaires, qui font la loi, ont élevé le prix du pain sans s’occuper des salaires, parce qu’ils savent que, quand le pain renchérit, les salaires haussent tout naturellement.
Répondez : Sur ce principe, quand les ouvriers feront la loi, ne les blâmez pas, s’ils fixent un bon taux des salaires, sans s’occuper de protéger le blé, car ils savent que, si les salaires sont élevés, les substances renchérissent tout naturellement.
— Si l’on vous dit : Que faut-il donc faire ?
Répondez : Être juste envers tout le monde.
— Si l’on vous dit : Il est essentiel qu’un grand pays ait l’industrie du fer.
Répondez : ce qui est plus essentiel, c’est que ce grand pays ait du fer.
— Si l’on vous dit : Il est indispensable qu’un grand pays ait l’industrie du drap.
Répondez : Ce qui est plus indispensable, c’est que, dans ce grand pays, les citoyens ait du drap.
— Si l’on vous dit : Le travail c’est la richesse.
Répondez : C’est faux.
Et, par voie de développement, ajoutez : Une saignée n’est pas la santé ; et la preuve qu’elle n’est pas la santé, c’est qu’elle a pour but de la rendre.
— Si l’on vous dit : Forcer les hommes à labourer des roches et à tirer une once de fer d’un quintal de minerai, c’est accroître leur travail et par suite leur richesse.
Répondez : Forcer les hommes à creuser des puits en leur interdisant l’eau de la rivière, c’est accroître leur travail inutile, mais non leur richesse.
— Si l’on vous dit : Le soleil donne sa chaleur et sa lumière sans rémunération.
Répondez : Tant mieux pour moi, il ne m’en coûte rien pour voir clair.
— Et si l’on vous réplique : L’industrie, en général, perd ce que vous auriez payé pour l’éclairage.
Ripostez : Non ; car n’ayant rien payé au soleil, ce qu’il m’épargne me sert à payer des habits, des meubles et des bougies.
— De même si l’on vous dit : Ces coquins d’Anglais ont des capitaux amortis.
Répondez : Tant mieux pour nous, ils ne nous feront pas payer l’intérêt.
— Si l’on vous dit : Ces perfides Anglais trouvent le fer et la houille au même gîte.
Répondez : Tant mieux pour nous, ils ne nous feront rien payer pour les rapprocher.
— Si l’on vous dit : Les Suisses ont de gras pâturages qui coûtent peu.
Répondez : L’avantage est pour nous, car ils nous demanderont une moindre quantité de travail pour fournir des moteurs à notre agriculture et des aliments à nos estomacs.
— Si l’on vous dit : Les terres de Crimée n’ont pas de valeur et ne paient pas de taxes.
Répondez : Le profit est pour nous qui achetons du blé exempt de ces charges.
— Si l’on vous dit : Les serfs de Pologne travaillent sans salaire.
Répondez : Le malheur est pour eux et le profit pour nous, puisque leur travail est déduit du prix du blé que leurs maîtres nous vendent.
— Enfin, si l’on vous dit : Les autres nations ont sur nous une foule d’avantages.
Répondez : Par l’échange, elles sont bien forcées de nous y faire participer.
— Si l’on vous dit : Avec la liberté, nous allons être inondés de pain, de bœuf à la mode, de houille et de paletots.
Répondez : Nous n’aurons ni faim ni froid.
— Si l’on vous dit : Avec quoi paierons-nous ?
Répondez : Que cela ne vous inquiète pas. Si nous sommes inondés, c’est que nous aurons pu payer, et si nous ne pouvons pas payer, nous ne serons pas inondés.
— Si l’on vous dit : J’admettrais le libre-échange, si l’étranger, en nous portant un produit, nous en prenait un autre ; mais il emportera notre numéraire.
Répondez : Le numéraire, pas plus que le café, ne pousse dans les champs de la Beauce, et ne sort des ateliers d’Elbeuf. Pour nous, payer l’étranger avec du numéraire, c’est comme le payer avec du café.
— Si l’on vous dit : Mangez de la viande.
Répondez : Laissez-la entrer.
— Si l’on vous dit, comme la Presse : Quand on n’a pas de quoi acheter du pain, il faut acheter du bœuf.
Répondez : Conseil aussi judicieux que celui de M. Vautour à son locataire :
Quand on n’a pas de quoi payer son terme,
Il faut avoir une maison à soi.
— Si l’on vous dit, comme la Presse : L’État doit enseigner au peuple pourquoi et comment il faut manger du bœuf.
Répondez : Que l’État laisse seulement entrer le bœuf, et quant à le manger, le peuple le plus civilisé du monde est assez grand garçon pour l’apprendre sans maître.
— Si l’on vous dit : L’État doit tout savoir et tout prévoir pour diriger le peuple, et le peuple n’a qu’à se laisser diriger.
Répondez : Y a-t-il un État en dehors du peuple et une prévoyance humaine en dehors de l’humanité ? Archimède aurait pu répéter tous les jours de sa vie : Avec un levier et un point d’appui, je remuerai le monde, qu’il ne l’aurait pas pour cela remué, faute de point d’appui et de levier. — Le point d’appui de l’État, c’est la nation, et rien de plus insensé que de fonder tant d’espérances sur l’État, c’est-à-dire de supposer la science et la prévoyance collectives, après avoir posé en fait l’imbécillité et l’imprévoyance individuelles.
— Si l’on vous dit : Mon Dieu ! je ne demande pas de faveur, mais seulement un droit sur le blé et la viande, qui compense les lourdes taxes auxquelles la France est assujettie ; un simple petit droit égal à ce que ces taxes ajoutent au prix de revient de mon blé.
Répondez : Mille pardons, mais moi aussi je paie des taxes. Si donc la protection, que vous vous votez à vous-même, a cet effet de grever pour moi votre blé tout juste de votre quote-part aux taxes, votre doucereuse demande ne tend à rien moins qu’à établir entre nous cet arrangement par vous formulé : « Attendu que les charges publiques sont pesantes, moi, vendeur de blé, je ne paierai rien du tout, et toi, mon voisin l’acheteur, tu paieras deux parts, savoir : la tienne et la mienne. » Marchand de blé, mon voisin, tu peux avoir pour toi la force ; mais à coup sûr, tu n’as pas pour toi la raison.
— Si l’on vous dit : Il est pourtant bien dur pour moi, qui paie des taxes, de lutter sur mon propre marché, avec l’étranger qui n’en paie pas.
Répondez :
1° D’abord, ce n’est pas votre marché, mais notre marché. Moi, qui vis de blé et qui le paie, je dois être compté pour quelque chose ;
2° Peu d’étrangers, par le temps qui court, sont exempts de taxes ;
3° Si la taxe que vous votez vous rend, en routes, canaux, sécurité, etc., plus qu’elle ne vous coûte, vous n’êtes pas justifiés de repousser, à mes dépens, la concurrence d’étrangers qui ne paient pas la taxe, mais n’ont pas non plus la sécurité, les routes, les canaux. Autant vaudrait dire : Je demande un droit compensateur, parce que j’ai de plus beaux habits, de plus forts chevaux, de meilleures charrues que le laboureur russe ;
4° Si la taxe ne rend pas ce qu’elle coûte, ne la votez pas ;
5° Et en définitive, après avoir voté la taxe, vous plaît-il de vous y soustraire ? Imaginez un système qui la rejette sur l’étranger. Mais le tarif fait retomber votre quote-part sur moi, qui ai déjà bien assez de la mienne.
— Si l’on vous dit : Chez les Russes, la liberté du commerce est nécessaire pour échanger leurs produits avec avantage. (Opinion de M. Thiers dans les bureaux, avril 1847.)
Répondez : La liberté est nécessaire partout et par le même motif.
— Si l’on vous dit : Chaque pays a ses besoins. C’est d’après cela qu’il faut agir. (M. Thiers.)
Répondez : C’est d’après cela qu’il agit de lui-même quand on ne l’en empêche pas.
— Si l’on vous dit : Puisque nous n’avons pas de tôles, il faut en permettre l’introduction. (M. Thiers.)
Répondez : Grand merci.
— Si l’on vous dit : Il faut du fret à la marine marchande. Le défaut de chargement au retour fait que notre marine ne peut lutter contre la marine étrangère. (M. Thiers.)
Répondez : Quand on veut tout faire chez soi, on ne peut avoir de fret ni à l’aller ni au retour. Il est aussi absurde de vouloir une marine avec le régime prohibitif, qu’il le serait de vouloir des charrettes là où l’on aurait défendu tous transports.
— Si l’on vous dit : À supposer que la protection soit injuste, tout s’est arrangé là-dessus ; il y a des capitaux engagés, des droits acquis ; on ne peut sortir de là sans souffrance.
Répondez : Toute injustice profite à quelqu’un (excepté, peut-être, la restriction qui à la longue ne profite à personne) ; arguer du dérangement que la cessation de l’injustice occasionne à celui qui en profite, c’est dire qu’une injustice, par cela seul qu’elle a existé un moment, doit être éternelle.
XVI. La main droite et la main gauche↩
(Rapport au roi.)
Sire,
Quand on voit ces hommes du Libre-Échange répandre audacieusement leur doctrine, soutenir que le droit d’acheter et de vendre est impliqué dans le droit de propriété (insolence que M. Billault a relevée en vrai avocat), il est permis de concevoir de sérieuses alarmes sur le sort du travail national ; car que feront les Français de leurs bras et de leur intelligence quand ils seront libres ?
L’administration que vous avez honorée de votre confiance a dû se préoccuper d’une situation aussi grave, et chercher dans sa sagesse une protection qu’on puisse substituer à celle qui parait compromise. – Elle vous propose d’interdire à vos fidèles sujets l’usage de la main droite.
Sire, ne nous faites pas l’injure de penser que nous avons adopté légèrement une mesure qui, au premier aspect, peut paraître bizarre. L’étude approfondie du régime protecteur nous a révélé ce syllogisme, sur lequel il repose tout entier :
Plus on travaille, plus on est riche ;
Plus on a de difficultés à vaincre, plus on travaille ;
Ergo, plus on a de difficultés à vaincre, plus on est riche.
Qu’est-ce, en effet, que la protection, sinon une application ingénieuse de ce raisonnement en forme, et si serré qu’il résisterait à la subtilité de M. Billault lui-même ?
Personnifions le pays. Considérons-le comme un être collectif aux trente millions de bouches, et, par une conséquence naturelle, aux soixante millions de bras. Le voilà qui fait une pendule, qu’il prétend troquer en Belgique contre dix quintaux de fer. — Mais nous lui disons : Fais le fer toi-même. — Je ne le puis, répond-il, cela me prendrait trop de temps, je n’en ferais pas cinq quintaux pendant que je fais une pendule. — Utopiste ! répliquons-nous, c’est pour cela même que nous te défendons de faire la pendule et t’ordonnons de faire le fer. Ne vois-tu pas que nous te créons du travail ?
Sire, il n’aura pas échappé à votre sagacité que c’est absolument comme si nous disions au pays : Travaille de la main gauche et non de la droite.
Créer des obstacles pour fournir au travail l’occasion de se développer, tel est le principe de la restriction qui se meurt. C’est aussi le principe de la restriction qui va naître. Sire, réglementer ainsi, ce n’est pas innover, c’est persévérer.
Quant à l’efficacité de la mesure, elle est incontestable. Il est malaisé, beaucoup plus malaisé qu’on ne pense, d’exécuter de la main gauche ce qu’on avait coutume de faire de la droite. Vous vous en convaincrez, Sire, si vous daignez condescendre à expérimenter notre système sur un acte qui vous soit familier, comme, par exemple, celui de brouiller des cartes. Nous pouvons donc nous flatter d’ouvrir au travail une carrière illimitée.
Quand les ouvriers de toute sorte seront réduits à leur main gauche, représentons-nous, Sire, le nombre immense qu’il en faudra pour faire face à l’ensemble de la consommation actuelle, en la supposant invariable, ce que nous faisons toujours quand nous comparons entre eux des systèmes de production opposés. Une demande si prodigieuse de main-d’œuvre ne peut manquer de déterminer une hausse considérable des salaires, et le paupérisme disparaîtra du pays comme par enchantement.
Sire, votre cœur paternel se réjouira de penser que les bienfaits de l’ordonnance s’étendront aussi sur cette intéressante portion de la grande famille dont le sort excite toute votre sollicitude. Quelle est la destinée des femmes en France ? Le sexe le plus audacieux et le plus endurci aux fatigues les chasse insensiblement de toutes les carrières.
Autrefois elles avaient la ressource des bureaux de loterie. Ils ont été fermés par une philanthropie impitoyable ; et sous quel prétexte ? « Pour épargner disait-elle, le denier du pauvre. » Hélas ! Le pauvre a-t-il jamais obtenu, d’une pièce de monnaie, des jouissances aussi douces et aussi innocentes que celle que renfermait pour lui l’urne mystérieuse de la Fortune ? Sevré de toutes les douceurs de la vie, quand il mettait, de quinzaine en quinzaine, le prix d’une journée de travail sur un quaterne sec, combien d’heures délicieuses n’introduisait-il pas au sein de sa famille ? L’espérance avait toujours sa place au foyer domestique. La mansarde se peuplait d’illusions : la femme se promettait d’éclipser ses voisines par l’éclat de sa mise, le fils se voyait tambour-major, la fille se sentait entraînée vers l’autel au bras de son fiancé.
C’est quelque chose encore que de faire un beau rêve !
Oh ! La loterie, c’était la poésie du pauvre, et nous l’avons laissée échapper !
La loterie défunte, quels moyens avons-nous de pourvoir nos protégées ? Le tabac et la poste.
Le tabac à la bonne heure ; il progresse, grâce au ciel et aux habitudes distinguées que d’augustes exemples ont su, fort habilement, faire prévaloir parmi notre élégante jeunesse.
Mais la poste !… Nous n’en dirons rien, elle fera l’objet d’un rapport spécial.
Sauf donc le tabac, que reste-t-il à vos sujettes ? Rien que la broderie, le tricot et la couture, tristes ressources qu’une science barbare, la mécanique, restreint de plus en plus.
Mais sitôt que votre ordonnance aura paru, sitôt que les mains droites seront coupées ou attachées, tout va changer de face. Vingt fois, trente fois plus de brodeuses, lisseuses et repasseuses, lingères, couturières et chemisières ne suffiront pas à la consommation (honni soit qui mal y pense) du royaume ; toujours en la supposant invariable, selon notre manière de raisonner.
Il est vrai que cette supposition pourra être contestée par de froids théoriciens, car les robes seront plus chères et les chemises aussi. Autant ils en disent du fer, que la France tire de nos mines, comparé à celui qu’elle pourrait 'vendanger sur nos coteaux. Cet argument n’est donc pas plus recevable contre la gaucherie que contre la protection ; car cette cherté même est le résultat et le signe de l’excédant d’efforts et de travaux qui est justement la base sur laquelle, dans un cas comme dans l’autre, nous prétendons fonder la prospérité de la classe ouvrière.
Oui, nous nous faisons un touchant tableau de la prospérité de l’industrie couturière. Quel mouvement ! quelle activité ! quelle vie ! Chaque robe occupera cent doigts au lieu de dix. Il n’y aura plus une jeune fille oisive, et nous n’avons pas besoin. Sire, de signaler à votre perspicacité les conséquences morales de cette grande révolution. Non-seulement il y aura plus de filles occupées, mais chacune d’elles gagnera davantage, car elles ne pourront suffire à la demande ; et si la concurrence se montre encore, ce ne sera plus entre les ouvrières qui font les robes, mais entre les belles dames qui les portent.
Vous le voyez, Sire, notre proposition n’est pas seulement conforme aux traditions économiques du gouvernement, elle est encore essentiellement morale et démocratique.
Pour apprécier ses effets, supposons-la réalisée, transportons-nous par la pensée dans l’avenir ; imaginons le système en action depuis vingt ans. L’oisiveté est bannie du pays ; l’aisance et la concorde, le contentement et la moralité ont pénétré avec le travail dans toutes les familles ; plus de misère, plus de prostitution. La main gauche étant fort gauche à la besogne, l’ouvrage surabonde et la rémunération est satisfaisante. Tout s’est arrangé là-dessus ; les ateliers se sont peuplés en conséquence. N’est-il pas vrai, Sire, que si, tout à coup, des utopistes venaient réclamer la liberté de la main droite, ils jetteraient l’alarme dans le pays ? N’est-il pas vrai que cette prétendue réforme bouleverserait toutes les existences ? Donc notre système est bon, puisqu’on ne le pourrait détruire sans douleurs.
Et cependant, nous avons le triste pressentiment qu’un jour il se formera (tant est grande la perversité humaine !) une association pour la liberté des mains droites.
Il nous semble déjà entendre les libre-dextéristes tenir, à la salle Montesquieu, ce langage :
« Peuple, tu te crois plus riche parce qu’on l’a ôté l’usage d’une main ; tu ne vois que le surcroît de travail qui t’en revient. Mais regarde donc aussi la cherté qui en résulte, le décroissement forcé de toutes les consommations. Cette mesure n’a pas rendu plus abondante la source des salaires, le capital. Les eaux qui coulent de ce grand réservoir sont dirigées vers d’autres canaux, leur volume n’est pas augmenté, et le résultat définitif est, pour la nation en masse, une déperdition de bien-être égale à tout ce que des millions de mains droites peuvent produire de plus qu’un égal nombre de mains gauches. Donc, liguons-nous, et, au prix de quelques dérangements inévitables, conquérons le droit de travailler de toutes mains. »
Heureusement, Sire, il se formera une association pour la défense du travail par la main gauche, et les Sinistristes n’auront pas de peine à réduire à néant toutes ces généralités et idéalités, suppositions et abstractions, rêveries et utopies. Ils n’auront qu’à exhumer le Moniteur industriel de 1846 : ils y trouveront, contre la liberté des échanges, des arguments tout faits, qui pulvérisent si merveilleusement la liberté de la main droite, qu’il leur suffira de substituer un mot à l’autre.
« La ligue parisienne pour la liberté du commerce ne doutait pas du concours des ouvriers. Mais les ouvriers ne sont plus des hommes que l’on mène par le bout du nez. Ils ont les yeux ouverts et ils savent mieux l’économie politique que nos professeurs patentés… La liberté du commerce, ont-ils répondu, nous enlèverait notre travail, et le travail c’est notre propriété réelle, grande, souveraine : avec le travail, avec beaucoup de travail, le prix des marchandises n’est jamais inaccessible. Mais sans travail, le pain ne coûtât-il qu’un sou la livre, l’ouvrier est forcé de mourir de faim. Or, vos doctrines, au lieu d’augmenter la somme actuelle du travail en France, la diminueront, c’est-à-dire que vous nous réduirez à la misère. » (Numéro du 13 octobre 1846.) »
« Quand il y a trop de marchandises à vendre, leur prix s’abaisse à la vérité ; mais comme le salaire diminue quand la marchandise perd de sa valeur, il en résulte qu’au lieu d’être en état d’acheter, nous ne pouvons plus rien acheter. C’est donc quand la marchandise est à vil prix que l’ouvrier est le plus malheureux. » (Gauthier de Rumilly, Moniteur industriel du 17 novembre.)
Il ne sera pas mal que les Sinistristes entremêlent quelques menaces dans leurs belles théories. En voici le modèle :
« Quoi ! vouloir substituer le travail de la main droite à celui de la main gauche et amener ainsi l’abaissement forcé, sinon l’anéantissement du salaire, seule ressource de presque toute la nation !
Et cela au moment où des récoltes incomplètes imposent déjà de pénibles sacrifices à l’ouvrier, l’inquiètent sur son avenir, le rendent plus accessible aux mauvais conseils et prêt à sortir de cette conduite si sage qu’il a tenue jusqu’ici ! »
Nous avons la confiance, Sire, que, grâce à des raisonnements si savants, si la lutte s’engage, la main gauche en sortira victorieuse.
Peut-être se formera-t-il aussi une association, dans le but de rechercher si la main droite et la main gauche n’ont pas tort toutes deux, et s’il n’y a point entre elles une troisième main, afin de tout concilier.
Après avoir peint les Dextéristes comme séduits par la libéralité apparente d’un principe dont l’expérience n’a pas encore vérifié l’exactitude, et les Sinistristes comme se cantonnant dans des positions acquises :
« Et l’on nie, dira-t-elle, qu’il y ait un troisième parti à prendre au milieu du conflit ! et l’on ne voit pas que les ouvriers ont à se défendre à la fois et contre ceux qui ne veulent rien changer à la situation actuelle, parce qu’ils y trouvent avantage, et contre ceux qui rêvent un bouleversement économique dont ils n’ont calculé ni l’étendue ni la portée ! » (National du 16 octobre.)
Nous ne voulons pourtant pas dissimuler à Votre Majesté, Sire, que notre projet a un côté vulnérable. On pourra nous dire : Dans vingt ans, toutes les mains gauches seront aussi habiles que le sont maintenant les mains droites, et vous ne pourrez plus compter sur la gaucherie pour accroître le travail national.
À cela, nous répondons que, selon de doctes médecins, la partie gauche du corps humain a une faiblesse naturelle tout à fait rassurante pour l’avenir du travail.
Et, après tout, consentez, Sire, à signer l’ordonnance, et un grand principe aura prévalu : Toute richesse provient de l’intensité du travail. Il nous sera facile d’en étendre et varier les applications. Nous décréterons, par exemple,
qu’il ne sera plus permis de travailler qu’avec le pied. Cela
n’est pas plus impossible (puisque cela s’est vu) que d’extraire du fer des vases de la Seine. On a vu même des hommes écrire avec le dos. Vous voyez, Sire, que les moyens d’accroître le travail national ne nous manqueront pas. En désespoir de cause, il nous resterait la ressource illimitée des amputations.
Enfin, Sire, si ce rapport n’était destiné à la publicité, nous appellerions votre attention sur la grande influence que tous les systèmes analogues à celui que nous vous soumettons sont de nature à donner aux hommes du pouvoir. Mais c’est une matière que nous nous réservons de traiter en conseil privé.
XVII. Domination par le travail↩
« De même qu’en temps de guerre on arrive à la domination par la supériorité des armes, peut-on, en temps de paix, arriver à la domination par la supériorité du travail? »
Cette question est du plus haut intérêt, à une époque où on ne paraît pas mettre en doute que, dans le champ de l’industrie, comme sur le champ de bataille, le plus fort écrase le plus faible.
Pour qu’il en soit ainsi, il faut que l’on ait découvert, entre le travail qui s’exerce sur les choses et la violence qui s’exerce sur les hommes, une triste et décourageante analogie ; car comment ces deux sortes d’actions seraient-elles identiques dans leurs effets, si elles étaient opposées par leur nature ?
Et s’il est vrai qu’en industrie comme en guerre, la domination est le résultat nécessaire de la supériorité, qu’avons-nous à nous occuper de progrès, d’économie sociale, puisque nous sommes dans un monde où tout a été arrangé de telle sorte, par la Providence, qu’un même effet, l’oppression, sort fatalement des principes les plus opposés ?
À propos de la politique toute nouvelle où la liberté commerciale entraîne l’Angleterre ; beaucoup de personnes font cette objection qui préoccupe, j’en conviens, les esprits les plus sincères : « L’Angleterre fait-elle autre chose que poursuivre le même but par un autre moyen ? N’aspire-t-elle pas toujours à l’universelle suprématie ? Sûre de la supériorité de ses capitaux et de son travail, n’appelle-t-elle pas la libre concurrence pour étouffer l’industrie du continent, régner en souveraine, et conquérir le privilége de nourrir et vêtir les peuples ruinés ? »
Il me serait facile de démontrer que ces alarmes sont chimériques ; que notre prétendue infériorité est de beaucoup exagérée ; qu’il n’est aucune de nos grandes industries qui, non-seulement ne résiste, mais encore ne se développe sous l’action de la concurrence extérieure, et que son effet infaillible est d’amener un accroissement de consommation générale, capable d’absorber à la fois les produits du dehors et ceux du dedans.
Aujourd’hui je veux attaquer l’objection de front, lui laissant toute sa force et tout l’avantage du terrain qu’elle a choisi. Mettant de côté les Anglais et les Français, je rechercherai, d’une manière générale, si, alors même que, par sa supériorité dans une branche d’industrie, un peuple vient à étouffer l’industrie similaire d’un autre peuple, celui-là a fait un pas vers la domination et celui-ci vers la dépendance ; en d’autres termes, si tous deux ne gagnent pas dans l’opération, et si ce n’est pas le vaincu qui y gagne davantage.
Si l’on ne voit dans un produit que l’occasion d’un travail, il est certain que les alarmes des protectionistes sont fondées. À ne considérer le fer, par exemple, que dans ses rapports avec les maîtres de forges, on pourrait craindre que la concurrence d’un pays, où il serait un don gratuit de la nature, n’éteignît les hauts fourneaux dans un autre pays où il y aurait rareté de minerai et de combustible.
Mais est-ce là une vue complète du sujet ? Le fer n’a-t-il des rapports qu’avec ceux qui le font ? est-il étranger à ceux qui l’emploient ? sa destination définitive, unique, est-elle d’être produit ? et, s’il est utile, non à cause du travail dont il est l’occasion, mais à raison des qualités qu’il possède, des nombreux services auxquels sa dureté, sa malléabilité le rendent propre, ne s’ensuit-il pas que l’étranger ne peut en réduire le prix, même au point d’en empêcher la production chez nous, sans nous faire plus de bien, sous ce dernier rapport, qu’il ne nous fait de mal sous le premier ?
Qu’on veuille bien considérer qu’il est une foule de choses que les étrangers, par les avantages naturels dont ils sont entourés, nous empêchent de produire directement, et à l’égard desquelles nous sommes placés, en réalité, dans la position hypothétique que nous examinons quant au fer. Nous ne produisons chez nous ni le thé, ni le café, ni l’or, ni l’argent. Est-ce à dire que notre travail en masse en est diminué ? Non ; seulement, pour créer la contre-valeur de ces choses, pour les acquérir par voie d’échange, nous détachons de notre travail général une portion moins grande qu’il n’en faudrait pour les produire nous-mêmes. Il nous en reste plus à consacrer à d’autres satisfactions. Nous sommes plus riches, plus forts d’autant. Tout ce qu’a pu faire la rivalité extérieure, même dans les cas où elle nous interdit d’une manière absolue une forme déterminée de travail, c’est de l’économiser, d’accroître notre puissance productive. Est-ce là, pour l’étranger, le chemin de la domination ?
Si l’on trouvait en France une mine d’or, il ne s’ensuit pas que nous eussions intérêt à l’exploiter. Il est même certain que l’entreprise devrait être négligée, si chaque once d’or absorbait plus de notre travail qu’une once d’or achetée au Mexique avec du drap. En ce cas, il vaudrait mieux continuer à voir nos mines dans nos métiers. — Ce qui est vrai de l’or l’est du fer.
L’illusion provient de ce qu’on ne voit pas une chose. C’est que la supériorité étrangère n’empêche jamais le travail national que sous une forme déterminée, et ne le rend superflu sous cette forme qu’en mettant à notre disposition le résultat même du travail ainsi anéanti. Si les hommes vivaient dans des cloches, sous une couche d’eau, et qu’ils dussent se pourvoir d’air par l’action de la pompe, il y aurait là une source immense de travail. Porter atteinte à ce travail, en laissant les hommes dans cette condition, ce serait leur infliger un effroyable dommage. Mais si le travail ne cesse que parce que la nécessité n’y est plus, parce que les hommes sont placés dans un autre milieu, où l’air est mis, sans effort, en contact avec leurs poumons, alors la perte de ce travail n’est nullement regrettable, si ce n’est aux yeux de ceux qui s’obstinent à n’apprécier, dans le travail, que le travail même.
C’est là précisément cette nature de travail qu’anéantissent graduellement les machines, la liberté commerciale, le progrès en tout genre ; non le travail utile, mais le travail devenu superflu, surnuméraire, sans objet, sans résultat. Par contre, la protection le remet en œuvre ; elle nous replace sous la couche d’eau, pour nous fournir l’occasion de pomper ; elle nous force à demander l’or à la mine nationale inaccessible, plutôt qu’à nos métiers nationaux. Tout son effet est dans ce mot : déperdition de forces.
On comprend que je parle ici des effets généraux, et non des froissements temporaires qu’occasionne le passage d’un mauvais système à un bon. Un dérangement momentané accompagne nécessairement tout progrès. Ce peut être une raison pour adoucir la transition ; ce n’en est pas une pour interdire systématiquement tout progrès, encore moins pour le méconnaître.
On nous représente l’industrie comme une lutte. Cela n’est pas vrai, ou cela n’est vrai que si l’on se borne à considérer chaque industrie dans ses effets, sur une autre industrie similaire, en les isolant toutes deux, par la pensée, du reste de l’humanité. Mais il y a autre chose ; il y a les effets sur la consommation, sur le bien-être général.
Voilà pourquoi il n’est pas permis d’assimiler, comme on le fait, le travail à la guerre.
Dans la guerre, le plus fort accable le plus faible.
Dans le travail, le plus fort communique de la force au plus faible. Cela détruit radicalement l’analogie.
Les Anglais ont beau être forts et habiles, avoir des capitaux énormes et amortis, disposer de deux grandes puissances de production, le fer et le feu ; tout cela se traduit en bon marché du produit. Et qui gagne au bon marché du produit ? Celui qui l’achète.
Il n’est pas en leur puissance d’anéantir d’une manière absolue une portion quelconque de notre travail. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de le rendre superflu pour un résultat acquis, de donner l’air en même temps qu’ils suppriment la pompe, d’accroître ainsi notre force disponible, et de rendre, chose remarquable, leur prétendue domination d’autant plus impossible que leur supériorité serait plus incontestable.
Ainsi nous arrivons, par une démonstration rigoureuse et consolante, à cette conclusion, que le travail et la violence, si opposés par leur nature, ne le sont pas moins, quoi qu’en disent protectionistes et socialistes, par leurs effets.
Il nous a suffi pour cela de distinguer entre du travail anéanti et du travail économisé.
Avoir moins de fer parce qu’on travaille moins, ou avoir plus de fer quoiqu’on travaille moins, ce sont choses plus que différentes ; elles sont opposées. Les protectionistes les confondent, nous ne les confondons pas. Voilà tout.
Qu’on se persuade bien une chose. Si les Anglais mettent en œuvre beaucoup d’activité, de travail de capitaux, d’intelligence, de forces naturelles, ce n’est pas pour nos beaux yeux. C’est pour se donner à eux-mêmes beaucoup de satisfactions, en échange de leurs produits. Ils veulent certainement recevoir au moins autant qu’ils donnent, et ils fabriquent chez eux le paiement de ce qu’ils achètent ailleurs. Si donc ils nous inondent de leurs produits, c’est qu’ils entendent être inondés des nôtres. Dans ce cas, le meilleur moyen d’en avoir beaucoup pour nous-mêmes, c’est d’être libres de choisir, pour l’acquisition, entre ces deux procédés : production immédiate, production médiate. Tout le machiavélisme britannique ne nous fera pas faire un mauvais choix.
Cessons donc d’assimiler puérilement la concurrence industrielle à la guerre ; fausse assimilation qui tire tout ce qu’elle a de spécieux de ce qu’on isole deux industries rivales pour juger les effets de la concurrence. Sitôt qu’on fait entrer en ligne de compte l’effet produit sur le bien-être général, l’analogie disparaît.
Dans une bataille, celui qui est tué est bien tué, et l’armée est affaiblie d’autant. En industrie, une usine ne succombe qu’autant que l’ensemble du travail national remplace ce qu’elle produisait, avec un excédant. Imaginons un état de choses où, pour un homme resté sur le carreau, il en ressuscite deux pleins de force et de vigueur. S’il est une planète où les choses se passent ainsi, il faut convenir que la guerre s’y fait, dans des conditions si différentes de ce que nous la voyons ici-bas, qu’elle n’en mérite pas même le nom.
Or, c’est là le caractère distinctif de ce qu’on a nommé si mal à propos guerre industrielle.
Que les Belges et les Anglais baissent le prix de leur fer, s’ils le peuvent, qu’ils le baissent encore et toujours, jusqu’à l’anéantir. Ils peuvent bien par là éteindre un de nos hauts fourneaux, tuer un de nos soldats ; mais je les défie d’empêcher qu’aussitôt, et par une conséquence nécessaire de ce bon marché lui-même, mille autres industries ne ressuscitent, ne se développent, plus profitables que l’industrie mise hors de combat.
Concluons que la domination par le travail est impossible et contradictoire, puisque toute supériorité qui se manifeste chez un peuple se traduit en bon marché et n’aboutit qu’à communiquer de la force à tous les autres. Bannissons de l’économie politique toutes ces expressions empruntées au vocabulaire des batailles : Lutter à armes égales, vaincre, écraser, étouffer, être battu, invasion, tribut. Que signifient ces locutions ? Pressez-les, et il n’en sort rien… Nous nous trompons, il en sort d’absurdes erreurs et de funestes préjugés. Ce sont ces mots qui arrêtent la fusion des peuples, leur pacifique, universelle, indissoluble alliance, et le progrès de l’humanité !
1849
Correspondence↩
à M. et madame Cheuvreux: Lettre de 1849 (Bruxelles, hôtel de Bellevue) Paris???↩
????
… Pour moi, j’en suis réduit à aimer une abstraction, à me passionner pour l’humanité, pour la science. D’autres portent leurs aspirations vers Dieu. Ce n’est pas trop des deux.
C’est ce que je pensais tout à l’heure en sortant d’une salle d’asile dirigée par des religieuses qui se vouent à soigner des enfants malades, idiots, rachitiques, scrofuleux. Quel dévouement ! quelle abnégation ! Et après tout, cette vie de sacrifices ne doit pas être douloureuse, puisqu’elle laisse sur la physionomie de telles empreintes de sérénité. Quelques économistes nient le bien que font ces saintes femmes. Mais ce dont on ne peut douter, c’est la sympathique influence d’un tel spectacle. Il touche, il attendrit, il élève ; on se sent meilleur, on se sent capable d’une lointaine imitation à l’aspect d’une vertu si sublime et si modeste. — Je me disais : Je ne puis me faire moine, mais j’aimerai la science et je ferai passer tout mon cœur dans ma tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letters to Cheuvreux Family: Janvier 1849, Paris↩
BWV
[CW1.119] [CH] 119 Paris, janvier 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
On vient de me dire que, demain mardi, à deux heures, on exécutera dans l’église Saint-Louis d’Antin de la musique très-curieuse. Ce sont des chants du xiiie siècle, retrouvés aux archives de la sainte chapelle, et empreints de toute la naïveté de l’époque. D’autres assurent que ces chants ne peuvent être anciens, attendu qu’au xiiie siècle on ne connaissait pas l’art de noter la musique.
Quoi qu’il en soit, la solennité offrira un vif intérêt ; il y a là une question moins difficile à juger par impression que par érudition.
J’ai repris hier soir cet affreux breuvage, non sans un terrible combat entre mon estomac et ma volonté. Est—il possible que quelque chose de si détestable soit bon, et messieurs les Médecins ne se moquent-ils pas de nous ?
Au reste, tous les remèdes sont désagréables.
Que faudrait-il à ma chère mademoiselle Louise ? Un peu plus de mouvement physique, un peu moins d’exercice mental : mais elle ne veut pas. Que faudrait-il à sa mère ? Rechercher un peu moins le martyre du salon : mais elle ne veut pas. Que m’ordonne-t-on ? L’huile de foie de morue ? décidément l’art de se bien porter, c’est l’art de se bien contrarier.
F. Bastiat.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 1er janvier 1849, Paris ↩
BWV
[CW1.120] [OC1] 120. Paris, 1er janvier 1849. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je veux me donner le plaisir de profiter de la reforme postale, puisque aussi bien j’y ai contribué. Je la voulais radicale, nous n’en avons que la préface ; telle qu’elle est, elle permettra au moins les épanchements de l’amitié.
Depuis février, nous avons traversé des jours difficiles, mais je crois que jamais l’avenir ne s’est montré aussi sombre, et je crains bien que l’élection de Bonaparte ne résolve pas les difficultés. Au premier moment, je me félicitais de la majorité qui l’a porté à la présidence. J’ai nommé Cavaignac, parce que je suis sûr de sa parfaite loyauté et de son intelligence ; mais tout en le nommant, je sentais que le pouvoir lui serait lourd. Il a fait tête à un orage terrible, il s’est attiré des haines inextinguibles, le parti du désordre ne lui pardonnera jamais. Si c’était un avantage, un homme dont le républicanisme fût assuré et qui en même temps ne pût plus pactiser avec les rouges, d’un autre côté, ce passé même lui créait de grandes difficultés. Un moment j’ai espéré que l’apparition sur la scène d’un personnage nouveau, sans relations avec les partis, pouvait inaugurer une ère nouvelle… Quoi qu’il en soit, moi et tous les républicains sincères avons pris le parti de nous rattacher à ce produit du suffrage universel. Je n’ai pas vu dans la chambre l’ombre d’une opposition systématique…
D’un autre côté, les partisans des dynasties déchues, sauf à se battre entre eux plus tard, commencent par démolir la république. Ils savent bien que l’assemblée est notre ancre de salut ; aussi ils s’ingénient à la faire dissoudre, et provoquent des pétitions dans ce sens. Un coup d’État est imminent. D’où viendra-t-il ? qu’amènera-t-il ? Ce qu’il y a de pis, c’est que les masses préfèrent le président à l’assemblée.
Pour moi, mon cher Félix, je me tiens en dehors de toutes ces intrigues. Autant que mes forces me le permettent, je m’occupe de faire prévaloir mon programme. Tu le connais dans sa généralité. Voici le plan pratique : réformer la poste, le sel et les boissons ; de là déficit dans le budget des recettes, qui sera réduit à 12 ou 1,300 millions ; — exiger du pouvoir qu’il y conforme le budget des dépenses ; lui déclarer que nous n’entendons pas qu’il dépense une obole de plus ; le forcer ainsi à renoncer, au dehors, à toute intervention, au dedans, à toutes les utopies socialistes ; en un mot exiger ces deux principes, les obtenir de la nécessité, puisque nous n’avons pu les obtenir de la raison publique.
Ce projet, je le pousse partout. J’en ai parlé aux ministres qui sont mes amis ; ils ne m’ont guère écouté. Je le prêche dans les réunions de députés. J’espère qu’il prévaudra. Déjà les deux premiers actes sont accomplis ; restent les boissons. Le crédit en souffrira pendant quelque temps, la Bourse est en émoi ; mais il n’y a pas à reculer. Nous sommes devant un gouffre qui s’élargit sans cesse ; il ne faut pas espérer de le fermer sans que personne en souffre. Le temps des ménagements est passé. Nous prêterons appui au président, à tous les ministres, mais nous voulons les trois réformes, non pas tant pour elles-mêmes, que comme infaillible et seul moyen de réaliser notre devise : Paix et liberté.
Adieu, mon ami, reçois mes vœux de nouvelle année.
Lettre à M. George Wilson [15 Jan. 1849], Paris ↩
BWV
[CW1.121] [OC7] 121. Paris, 15 janvier 1849. A M. George Wilson
Lettre à M. George Wilson, président de l’Anti-Corn Laws League [1]
Paris, 15 janvier 1849
Monsieur,
Veuillez exprimer à votre Comité toute ma reconnaissance pour l’invitation flatteuse que vous m’adressez en son nom.
Il m’eût été bien doux de m’y rendre : car, monsieur, je le dis hautement, il ne s’est rien accompli de plus grand dans le monde, à mon avis, que cette réforme que vous vous apprêtez à célébrer. J’éprouve l’admiration la plus profonde pour les hommes que j’eusse rencontrés à ce banquet, pour les George Wilson, les Villiers, les Bright, les Cobden, les Thompson et tant d’autres qui ont réalisé le triomphe de la liberté commerciale, ou plutôt, donné à cette grande cause une première et décisive impulsion. Je ne sais ce que j’admire le plus de la grandeur du but que vous avez poursuivi ou de la moralité des moyens que vous avez mis en œuvre. Mon esprit hésite quand il compare le bien direct que vous avez fait au bien indirect que vous avez préparé ; quand il cherche à apprécier, d’un côté, la réforme même que vous avez opérée, et, de l’autre, l’art de poursuivre légalement et pacifiquement toutes les réformes, art précieux dont vous avez donné la théorie et le modèle.
Autant que qui que ce soit au monde, j’apprécie les bienfaits de la liberté commerciale, et cependant je ne puis borner à ce point de vue les espérances que l’humanité doit fonder sur le triomphe de votre agitation.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger sans discuter et consolider, chemin faisant, le droit de propriété. Et peut-être l’Angleterre doit-elle à votre propagande de n’être pas, à l’heure qu’il est, infestée, comme le continent, de ces fausses doctrines communistes qui ne sont, ainsi que le protectionisme, que des négations, sous formes diverses, du droit de propriété.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger, sans éclairer d’une vive lumière les légitimes attributions du gouvernement et les limites naturelles de la loi. Or une fois ces attributions comprises, ces limites fixées, les gouvernés n’attendront plus des gouvernements prospérité, bien-être, bonheur absolu, mais justice égale pour tous. Dès lors les gouvernements, circonscrits dans leur action simple, ne comprimant plus les énergies individuelles, ne dissipant plus la richesse publique à mesure qu’elle se forme, seront eux-mêmes dégagés de l’immense responsabilité que les espérances chimériques des peuples font peser sur eux. On ne les culbutera pas à chaque déception inévitable, et la principale cause des révolutions violentes sera détruite.
Vous n’avez pu démontrer, au point de vue économique, la doctrine du libre échange, sans ruiner à jamais dans les esprits ce triste et funeste aphorisme : Le bien de l’un c’est le dommage de l’autre. Tant que cette odieuse maxime a été la foi du monde, il y avait incompatibilité radicale entre la prospérité simultanée et la paix des nations. Prouver l’harmonie des intérêts, c’était donc préparer la voie à l’universelle fraternité.
Dans ses aspects plus immédiatement pratiques, je suis convaincu que votre réforme commerciale n’est que le premier chaînon d’une longue série de réformes plus précieuses encore. Peut-elle manquer, par exemple, de faire sortir la Grande-Bretagne de cette situation violente, anormale, antipathique aux autres peuples, et par conséquent pleine de dangers, où le régime protecteur l’avait entraînée ? L’idée d’accaparer les consommateurs vous avait conduits à poursuivre la domination sur tout le globe. Eh bien ! je ne puis plus douter que votre système colonial ne soit sur le point de subir la plus heureuse transformation. Je n’oserai prédire, bien que ce soit ma pensée, que vous serez amenés, par la loi de votre intérêt, à vous séparer volontairement de vos colonies ; mais alors même que vous les retiendriez, elles s’ouvriront au commerce du monde, et ne pourront plus être raisonnablement un objet de jalousie et de convoitise pour personne.
Dès lors que deviendra ce célèbre argument en cercle vicieux : « Il faut une marine pour avoir des colonies, il faut des colonies pour avoir une marine. » Le peuple anglais se fatiguera de payer seul les frais de ses nombreuses possessions dans lesquelles il n’aura pas plus de priviléges qu’il n’en a aux États-Unis. Vous diminuerez vos armées et vos flottes ; car il serait absurde, après avoir anéanti le danger, de retenir les précautions onéreuses que ce danger seul pouvait justifier. Il y a encore là un double et solide gage pour la paix du monde.
Je m’arrête : ma lettre prendrait des proportions inconvenantes, si je voulais y signaler tous les fruits dont le libre échange est le germe.
Convaincu de la fécondité de cette grande cause, j’aurais voulu y travailler activement dans mon pays. Nulle part les intelligences ne sont plus vives ; nulle part les cœurs ne sont plus embrasés de l’amour de la justice universelle, du bien absolu, de la perfection idéale. La France se fût passionnée pour la grandeur, la moralité, la simplicité, la vérité du libre-échange. Il ne s’agissait que de vaincre un préjugé purement économique, d’établir pour ainsi dire un compte commercial, et de prouver que l’échange, loin de nuire au travail national, s’étend toujours tant qu’il fait du bien, et s’arrête, par sa nature, en vertu de sa propre loi, quand il commencerait à faire du mal : d’où il suit qu’il n’a pas besoin d’obstacles artificiels et législatifs. L’occasion était belle, au milieu du choc des doctrines qui se sont heurtées dans ce pays, pour y élever le drapeau de la liberté. Il eût certainement rallié à lui toutes les espérances et toutes les convictions. C’est dans ce moment qu’il a plu à la Providence, dont je ne bénis pas moins les décrets, de me retirer ce qu’elle m’avait accordé de force et de santé. Ce sera donc à un autre d’accomplir l’œuvre que j’avais rêvée ; et puisse-t-il se lever bientôt !
C’est ce motif de santé, ainsi que mes devoirs parlementaires, qui me forcent de m’abstenir de paraître à la démocratique solennité à laquelle vous me conviez. Je le regrette profondément, c’eût été un bel épisode de ma vie et un précieux souvenir pour le reste de mes jours. Veuillez faire agréer mes excuses au Comité, et permettez-moi, en terminant, de m’associer de cœur à votre fête par ce toast :
À la liberté commerciale des peuples ! à la libre circulation des hommes, des choses et des idées ! au libre échange universel et à toutes ses conséquences économiques, politiques et morales !
Je suis, Monsieur, votre très-dévoué.
FN:Voici le texte de l’invitation à laquelle Bastiat répond : (Note de l’éditeur.)
BANQUET TO CELEBRATE THE FINAL REPEAL OF THE CORN LAWS.
Newall’s Buildings, Manchester, January 9, 1849.
My dear Sir,
The Act for the Repeal of our Corn Laws will corne into operation on the 1st February next, and it has been resolved to celebrate the event by a banquet in the Free Trade Hall in this City, on the 31st January.
The prominent part you have taken in your own country, in the adversary of the principles of Commercial Freedom, and the warm sympathy you have always manifested in our movement, has induced the Committee to direct me respectfully to invite you to be present as a Guest. In conveying this invitation, permit me to hope that you may be able to make it convenient to make one among us at our festival.
Believe me, dear Sir,
Your faithful and obedient servant,
George Wilson, Chairman.
à M. Domenger: Lettre du 18 janvier 1849, Paris↩
BWV
[CW1.122] [OC7] 122. Paris, 18 janvier 1849. A M. Domenger
Nous sommes à peu près tous d’accord ici sur la nécessité de nous dissoudre. Cependant un très grand nombre (et sans la crainte des élections ce serait la totalité) ne voudraient pas céder à une pression violente et factice. Beaucoup craignent aussi pour l’existence même de la République. S’il n’y avait qu’un prétendant, ce serait l’affaire d’une révolution (dont Dieu nous préserve) ; mais comme il y en a plusieurs, c’est une question de guerre civile. Il est bien permis d’hésiter.
[CW1.123] [CH] 123. Paris, février 1849. A Madame Cheuvreux ???↩
Letters to Cheuvreux Family: Mercredi, février 1849↩
BWV
[CW1.124] [CH] 124. Paris, février 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
C’est avec un peu de confusion que je vous communique l’issue ressemblant à un fisaco, de ma démarche auprès de Faucher ; mais que voulez-vous, je suis le plus mauvais solliciteur du monde. C’est peut-être heureux. En fait de sollicitations, si j’avais l’habitude du succès, qui sait où je m’arrêterais, puisqu’il est bien reconnu que je n’ai pas d’empire sur moi-même.
M. Ramel peut faire toucher au ministère de l’intérieur, 150 francs ; les formes administratives obligent de donner à cela le nom de secours et non de pension !
J’ai eu toute la nuit la musique d’hier soir dans la tête : Io vorrei saper perche et autres chants délicieux.
Adieu, Madame, je suis votre dévoué et celui de Mlle Louise.
F. Bastiat.
à M. Domenger: Lettre du 3 février 1849, Paris↩
BWV
[CW1.125] [OC7] 125. Paris, 3 février 1849. A M. Domenger
???? e vais m’occuper de la ferme du Peyrat et du canal. C’est pourquoi je remets à une autre fois de vous en parler.
Le mauvais état de ma santé coïncide avec le coup de feu du travail. Tenant ou croyant tenir une pensée financière, je l’ai exposée à mon bureau. Elle a fait fortune, puisqu’il m’a nommé de la commission du Budget à la presque unanimité, Devant cette commission je voulais renouveler l’épreuve mais sous prétexte de gagner du temps, elle a interdit la discussion générale. Il a donc fallu aborder d’emblée les détails, ce qui interdit à toute vue d’ensemble de se produire. Que dites-vous d’un tel procédé en face d’une situation financière désespérée et qui ne peut être sauvée que par une grande pensée, s’il s’en présente ? Alors j’ai cru devoir en appeler à l’Assemblée et au public par une brochure dont je me suis occupé hier et ce matin.
Je ne me dissimule pas que tout cela ne peut guère aboutir. Les grandes assemblées n’ont pas d’initiative. Les vues y sont trop diverses, et rien de bien ne se fait si le cabinet est inerte. Or le nôtre est systématiquement inerte : je crois sincèrement que c’est une calamité publique. Le ministère actuel pouvait faire du bien. J’y compte plusieurs amis, et je sais qu’ils sont capables. Malheureusement, il est arrivé au pouvoir avec l’idée préconçue qu’il n’aurait pas le concours de l’Assemblée et qu’il fallait manœuvrer pour la renvoyer. J’ai la certitude absolue qu’il s’est trompé ; et, en tout cas, n’était-ce pas son devoir d’essayer ? S’il était venu dire à la chambre : « L’élection du 10 décembre clôt la période révolutionnaire ; maintenant occupons-nous de concert du bien du peuple et de réformes administratives et financières, » la chambre l’aurait suivi avec passion, car elle a la passion du bien et n’a besoin que d’être guidée. Au lieu de cela, le ministère a commencé par bouder. Il a conjecturé le désaccord, en se fondant sur ce que l’assemblée s’était montrée sympathique à Cavaignac. Mais il y a une chose que l’Assemblée met mille fois au-dessus de Cavaignac, c’est la volonté du peuple, manifestée par le suffrage universel. Pour montrer sa parfaite soumission, elle eût prodigué son concours au chef du pouvoir exécutif. Que de bien pouvait en résulter ! Au lieu de cela le ministère s’est renfermé dans l’inertie et la taquinerie. Il ne propose rien ou ne propose que l’inacceptable. Sa tactique est de prolonger la stagnation des affaires par l’inertie, bien certain que la nation s’en prendra à l’Assemblée. Le pays a perdu une magnifique occasion de marcher, et il ne la trouvera plus, car je crains bien que d’autres orages n’attendent la prochaine assemblée.
à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris↩
BWV
[CW1.126] [OC7] 126. Paris, sans date, 1849. A M. Domenger
Mon malencontreux rhume m’ôtant la possibilité de me servir de la tribune, j’ai quelquefois recours à la plume. Je vous envoie deux brochures. L’une n’a guère d’intérêt pour la province. Elle est intitulée Capital et rente. Mon but est de combattre un préjugé qui a fait de grands ravages parmi les ouvriers et même parmi les jeunes gens des écoles. Ce préjugé consiste à penser que l’intérêt d’un capital est un vol. J’ai donc cherché à exposer la nature intime et la raison d’être de l’intérêt. J’aurais pu rendre cette brochure piquante, le sujet y prêtait. J’ai cru devoir m’en abstenir pour ne pas irriter ceux que je voulais convaincre. Il en est résulté que je suis tombé dans la pesanteur et la monotonie. Si jamais je fais une seconde édition, je refondrai tout cela.
L’autre brochure est un projet de budget, ou plutôt la pensée fondamentale qui, selon moi, doit présider à la réforme graduelle de notre système financier. Elle se ressent de la rapidité de l’exécution. Il y a des longueurs, des omissions, etc. Quoi qu’il en soit, l’idée dominante y est assez en relief.
Je ne me suis pas borné à écrire ces idées, je les ai exposées dans les bureaux et devant la commission du Budget dont je fais partie. Ce qui me semble de la prudence la plus vulgaire, y passe pour de la témérité insensée. D’ailleurs, le ministère étant résolu à demeurer dans l’inertie, il est impossible que la commission fasse rien de bon. Une réunion nombreuse d’hommes, privés des ressources que fournit l’administration, ne peut poursuivre un plan systématique. Les projets s’y heurtent. Les idées générales sont repoussées comme perte de temps, et l’on finit par ne s’occuper que des détails. Notre Budget de 1849 sera un fiasco. Je crois que l’histoire en rejettera la responsabilité sur le cabinet.
Les élections approchent : j’ignore ce que l’Assemblée décidera relativement aux congés. Pourrai-je aller vous voir ? Je le désire sous plusieurs rapports. D’abord pour respirer l’air du pays et serrer la main à mes amis ; ensuite pour combattre quelques préventions qui ont pu s’attacher à ma conduite parlementaire ; enfin, pour dire aux électeurs dans quel esprit il me semble qu’ils doivent faire leurs choix. Selon moi, ils ne sauraient mieux faire que de rester fidèles à l’esprit qui les dirigea en avril 1848. Ils ne croient pas avoir fait une bonne assemblée. J’affirme le contraire. Elle s’est un peu altérée par les élections partielles qui nous ont envoyé d’un côté plusieurs révolutionnaires, de l’autre beaucoup d’intrigants. Dieu préserve mon pays de recourir ainsi aux extrêmes exagérations des deux partis ! Il en résulterait un choc violent. Sans doute le pays ne peut nommer que d’après ses impressions et ses opinions actuelles. S’il est réactionnaire, il nommera des réactionnaires. Mais qu’il choisisse au moins des hommes nouveaux. S’il envoie d’anciens députés, au cœur plein de rancunes, rompus aux intrigues parlementaires, décidés à tout renverser, à tendre des pièges aux institutions nouvelles, à faire saillir le plus tôt possible les défauts qui peuvent entacher notre Constitution, tout est perdu ! Nous en avons bien la preuve. Notre Constitution met en présence deux pouvoirs égaux sans moyen de résoudre les conflits possibles. C’est un grand vice. Et qu’est-il arrivé ? Au lieu d’attendre au moins que ce vice se révélât et que le temps amenât le conflit, le ministère s’est hâté de le faire surgir sans nécessité. — C’est la pensée d’un homme qui a hâte de faire sortir des faits la critique de nos institutions. Et pourquoi cet homme a-t-il agi ainsi ? Est-ce nécessité ? Non. Mais il est un de ceux que la révolution a cruellement froissés, et, sans s’en rendre compte, il prend plaisir à se venger aux dépens du pays.
Quant à mon sort personnel, j’ignore ce qu’il sera. Le pays pourra me reprocher d’avoir peu travaillé ! En vérité, ma santé a été un obstacle invincible. Elle a paralysé mes forces physiques et morales. J’ai ainsi trompé l’attente de mes amis. Mais est-ce ma faute ? Quoi qu’il en soit, si le mandat m’est retiré, je reprendrai, sans trop d’amertume, mes chères habitudes solitaires. Adieu.
à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris↩
BWV
[CW1.127] [OC7] 127. Paris, sans date 1849. A M. Domenger
Votre lettre m’arrive accolée à celle de M. Dup… M. le ministre du commerce m’avait d’abord fait des promesses. Plus tard j’ai su que Duv… insistait avec l’acharnement que vous lui connaissez. Hier soir, je me suis rendu chez Buffet, emmenant avec moi Turpin. Comme celui-ci a assisté au Conseil général, il pouvait attester ce qui s’y est passé, et il l’a fait en termes très formels. Nous y avons rencontré Dampierre, qui nous a aidés. Malgré tout cela, j’ai vu que le ministre était mal à l’aise ; il faut que les obsessions de Duv… lui fassent peur. Il nous a dit : Si je refuse à Duv… sa ferme, il en mourra.
J’avais déjà écrit à Buffet une lettre très motivée, j’en vais faire une autre que je terminerai ainsi : La France désire la décentralisation administrative. Si M. le ministre, quand il s’agit de savoir où sera établie une ferme, croit pouvoir dédaigner les vœux de tous les organes réguliers du département pour ne faire que sa propre volonté, il peut certes supprimer l’institution des Conseils généraux, ils ne sont qu’une mystification.
Je vous prie, mon cher D., de vouloir m’excuser auprès de M. Dup., si je ne lui réponds pas aujourd’hui. Je le ferai quand je saurai quelque chose. Vous voyez combien la loi des clubs agite Paris. Le ministre a été bien imprudent de soulever cette question. Mais sa malheureuse tactique est de déconsidérer l’Assemblée ; et je crois qu’il voulait se faire refuser la loi pour jeter sur elle toute la responsabilité de l’avenir.
Jamais vote ne m’a plus coûté que celui que j’ai émis hier. Vous savez que j’ai été toujours pour la liberté sauf la répression des abus. J’avoue qu’en face des clubs ce principe m’a paru devoir fléchir. Quand je considère la frayeur qu’ils inspirent à tous les gens tranquilles, les souvenirs qu’ils réveillent, etc., etc., je me dis que ceux qui aiment sincèrement la République devraient comprendre qu’il faut la faire aimer. C’est la compromettre que de vouloir imposer forcément au pays une institution ou même une liberté qui l’épouvante. — J’ai donc voté pour la suppression des clubs.
En agissant ainsi je ne me suis pas dissimulé les inconvénients personnels d’une telle conduite. Pour réussir en politique, il faut s’attacher à un parti, et si l’on peut, au parti le plus fort. — Voter consciencieusement tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche, c’est s’exposer à être abandonné de tous deux. — Mais avant d’arriver ici j’avais pris la résolution de ne consulter jamais que mon jugement et ma conscience et de ne pas émettre un vote de parti. Cela se rattache à la proposition que j’ai faite. Ces majorités et minorités systématiques sont la mort du gouvernement représentatif.
Je crois que notre gouvernement fera de grands efforts pour éviter la guerre. Autrefois on aurait pu craindre qu’il ne fût entraîné par les sympathies populaires en faveur de l’Italie ; mais les choses sont bien changées. Les désordres de la Péninsule ont calmé ces sympathies. Il est probable que Ch. Albert sera battu, sans qu’on ait le temps de délibérer sur l’opportunité de ce qu’il y a à faire. Mais une fois les Autrichiens à Turin, tout ne sera pas fini, il s’en faut. Je ne sais même si ce n’est pas alors que les difficultés sérieuses commenceront. Oh ! comme les hommes ont de la peine à s’en- tendre, quand ce serait si facile !
Letters to Cheuvreux Family: Lundi, mars 1849, Paris↩
BWV
[CW1.128] [CH] 128. Paris, mars 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Décidément, j’ai laissé chez vous quelque chose de bien précieux ; quelque chose dont les hommes de mon âge ne devraient plus se séparer ; quelque chose que nous devrions toujours sentir sous la main, quand elle se porte sur le côté gauche de notre poitrine, quelque chose dont la perte nous transforme en étourdis et en aveugles, en un mot, mes lunettes. Si par hasard on les a retrouvées dans votre salon, je vous serai obligé de les faire remettre à ma messagère.
Je profite de cette occasion, pour avoir des nouvelles de la santé de votre Louisette, puisque c’est le nom que vous aimez à lui donner ; je serai heureux d’apprendre qu’elle pourra nous faire entendre demain sa douce voix ; avouez donc que vous en êtes orgueilleuse ?
Oh ! vous avez bien raison ; je n’ose pas trop le répéter ; mais j’aime mieux une romance chantée par elle, qu’un concert tout entier renforcé de vocalises et de tours de force ; après tout, n’est-ce pas la bonne règle de juger des choses et surtout des arts, par l’impression que nous en recevons ? Quand votre enfant chante, tous les cœurs sont attentifs, toutes les haleines suspendues, d’où je conclus que c’est la vraie musique.
Je défends intrépidement ma santé ; j’y tiens beaucoup, ayant la faiblesse de croire qu’elle pourrait encore être bonne à quelque chose.
Hier, je fus voir Mme de Planat. À travers quelques brouillards germaniques, son intelligence laisse distinguer un grand fonds de bon sens, des appréciations neuves ; tout juste assez d’érudition pour qu’il n’y en ait pas trop ; et une parfaite impartialité : nos malheureuses discordes civiles ne troublent pas la sûreté de ses jugements ; c’est une femme qui pense par elle-même ; je voudrais que vous la connussiez. Mais elle m’a fait parler un peu trop.
Je n’ai pas été chez Victor Hugo, croyant qu’il demeurait au Marais ; si j’avais su qu’il habitât vos quartiers, j’aurais fait mon entrée dans son salon, qui doit être curieux, car la pente vers cette région de Paris est facile.
Adieu, je serre la main affectueusement à ce que vous nommez le Trio, que j’aime de tout mon cœur.
F. Bastiat.
à M. et madame Schwabe: Lettre du 11 mars 1849, Paris↩
BWV
[CW1.129] [OC7] 129. Paris, 11 mars 1849. A Madame Schwabe
Je suis en effet d’une négligence horrible ; horrible, c’est le mot, car elle approche de l’ingratitude. Comment pourrais-je l’excuser, après toutes les bontés dont j’ai été comblé à Crumpsall-house ?
Mais il est certain que mes occupations sont au-dessus de mes forces. J’en serai peut-être débarrassé bientôt. D’après les avis que je reçois de mon pays, je ne serai pas returned. On m’avait envoyé pour maintenir la République. Maintenant on me reproche d’avoir été fidèle à ma mission. Ce sera une blessure pour mon cœur, car je n’ai pas mérité cet abandon ; et en outre, il faut gémir sur un pays qui décourage jusqu’à l’honnêteté. Mais ce qui me console, c’est que je pourrai reprendre mes relations d’amitié et les chers travaux de la solitude.
…C’est avec surprise et satisfaction que j’apprends votre prochain passage à Paris. Je n’ai pas besoin de vous dire avec quel plaisir je vous serrerai la main ainsi qu’à M. Schwabe. Seulement je crains que cette date ne coïncide précisément avec celle de nos élections. En ce cas, je serai à deux cents lieues, si du moins je me décide à courir les chances du scrutin. Mon esprit n’est pas encore fixé là-dessus.
Comme vous pensez bien, je suis avec le plus vif intérêt les efforts de notre ami Cobden. J’en fais même ici la contre-partie. Hier, nous avons eu de la commission du budget un retranchement de deux cent mille hommes sur notre effectif militaire. Il n’est pas probable que l’Assemblée et le ministère acceptent un changement aussi complet ; mais n’est-ce pas un bon symptôme que ce succès auprès d’une commission nommée par l’Assemblée elle-même ?
… Adieu, Madame, je me propose de vous écrire plus régulièrement bientôt. Aujourd’hui je suis absorbé par un débat important que j’ai soulevé dans l’Assemblée et qui me force à quelques recherches.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 15 mars 1849, Paris ↩
BWV
[CW1.130] [OC1] 130. Paris, 15 mars 1849. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, tes lettres sont en effet bien rares, mais elles me sont douces comme cette sensation qu’on éprouve quand on revoit après longtemps le clocher de son village.
C’est une tâche pénible que d’être et de vouloir rester patriote et conséquent. Par je ne sais quelle illusion d’optique, on vous attribue les changements qui s’opèrent autour de vous. J’ai rempli mon mandat dans l’esprit où je l’avais reçu ; mon pays a le droit de changer et par conséquent de changer ses mandataires ; mais il n’a pas le droit de dire que c’est moi qui ai changé.
Tu as vu par les journaux que j’avais présenté ma motion. Que les représentants restent représentants, ai-je dit, car si la loi fait brillera leurs yeux d’autres perspectives, à l’instant le mandat est vicié, exploité ; et comme il constitue l’essence même du régime représentatif, c’est ce régime tout entier qui est faussé dans sa source et dans son principe.
Chose extraordinaire ! Quand je suis monté à la tribune, je n’avais pas dix adhérents, quand j’en suis descendu, j’avais la majorité. Ce n’est certainement pas la puissance oratoire qui avait opéré ce phénomène, mais la puissance du sens commun. Les ministres et tous ceux qui aspirent à le devenir étaient dans les transes ; on allait voter, quand la commission, M. Billaut en tête, a évoqué l’amendement. Il a été renvoyé de droit à cette commission. Dimanche et lundi il y a eu une réaction de l’opinion d’ailleurs fort peu préparée, si bien que mardi chacun disait : Les représentants rester représentants ! mais c’est un danger effroyable, c’est pire que la Terreur ! — Tous les journaux avaient tronqué, altéré, supprimé mes paroles, mis des absurdités dans ma bouche. Toutes les réunions, rue de Poitiers, etc., avaient jeté le cri d’alarme… enfin les moyens ordinaires.
Bref, je suis resté avec une minorité, composée de quelques exaltés, qui ne m’ont pas mieux compris que les autres ; mais il est certain que l’impression a été vive et ne s’effacera pas de sitôt. Plus de cent membres m’ont dit qu’ils penchaient pour ma proposition, mais qu’ils votaient contre, craignant de se tromper sur une innovation de cette importance, à laquelle ils n’avaient pas assez réfléchi.
Tu me connais assez pour penser que je n’aurais pas voulu réussir par surprise. Plus tard, l’opinion aurait attribué à mon amendement toutes les calamités que le temps peut nous réserver.
Au point de vue personnel, ce qu’il y a de triste c’est le charlatanisme qui règne ici dans les journaux. C’est un parti pris d’exalter certains hommes et d’en rabaisser certains autres. Que faire ? il me serait facile d’avoir aussi un grand nombre d’amis dans la presse ; mais il faudrait pour cela se donner un soin que je ne prendrai pas, la chaîne est trop lourde.
Quant aux élections, j’ignore si je pourrai y assister, je n’irai qu’autant que l’assemblée se dissoudra : membre de la commission du budget, il faut bien que je reste à mon poste : que le pays m’en punisse s’il le veut, j’ai fait mon devoir. Je n’ai qu’une chose à me reprocher, c’est de n’avoir pas assez travaillé, encore j’ai pour excuse ma santé fort délabrée, et l’impossibilité de lutter avec mes faibles poumons contre les orages parlementaires. Ne pouvant parler, j’ai pris le parti d’écrire. Il n’est pas une question brûlante qui n’ait donné lieu à une brochure de moi. Il est vrai que j’y traitais moins la question pratique que celle de principe ; en cela j’obéissais à la nature de mon esprit qui est de remonter à la source des erreurs, chacun se rend utile à sa manière. Au milieu des passions déchaînées, je ne pouvais exercer d’action sur les effets, j’ai signalé les causes ; suis-je resté inactif ?
À la doctrine de L. Blanc, j’ai opposé mon écrit Individualisme et Fraternité. — La propriété est attaquée, je fais la brochure Propriété et Loi. — On se rejette sur la rente des terres, je fais les cinq articles des Débats : Propriété et Spoliation. — La source pratique du communisme se montre, je fais la brochure Protectionnisme et Communisme. — Proudhon et ses adhérents prêchent la gratuité du crédit., doctrine qui gagne comme un incendie, je fais la brochure Capital et Rente. — Il est clair qu’on va chercher l’équilibre par de nouveaux impôts, je fais la brochure Paix et Liberté. — Nous sommes en présence d’une loi qui favorise les coalitions parlementaires, je fais la brochure des Incompatibilités. On nous menace du papier-monnaie, je fais la brochure Maudit argent. — Toutes ces brochures distribuées gratuitement, en grand nombre, m’ont beaucoup coûté ; sous ce rapport, les électeurs n’ont rien à me reprocher. Sous le rapport de l’action, je n’ai pas non plus trahi leur confiance. Au 15 mai, dans les journées de juin, j’ai pris part au péril. Après cela, que leur verdict me condamne, je le ressentirai peut-être dans mon cœur, mais non dans ma conscience.
Adieu.
à M. Domenger: Lettre du 25 mars 1849, Paris↩
BWV
[CW1.131] [OC7] 131. Paris, 25 mars 1849. A M. Domenger
La dernière fois que je vous ai écrit, je l’ai fait fort à la hâte et ai oublié, je crois, de vous parler élections. Le moment approche, et puisque vous êtes déterminé à me placer sur votre liste, je vous serai bien obligé de me faire savoir de temps en temps ce qui se dit et ce qui se fait. Je me doute qu’il y a dans le pays beaucoup de préventions contre moi, et qu’elles sont entretenues, peut-être envenimées par les aspirants ou quelqu’un d’entre eux. Je sens combien une explication avec mes commettants serait utile, et cependant je ne puis quitter l’Assemblée nationale qu’au moment où elle prononcera sa dissolution. C’est pourquoi j’enverrai bientôt un compte rendu.
Je me doute que j’aurai peu d’appui là où il me serait le plus nécessaire, c’est-à-dire à Saint-Sever. S’il s’opère un arrangement entre les trois arrondissements, et que chacun présente deux candidats, je ne serai sans doute pas sur la liste de Saint-Sever ; et alors même que les deux autres arrondissements en auraient quelques regrets, ces regrets n’iront pas jusqu’à rompre la transaction. Je serai donc, comme on dit, entre trois selles etc.
Ayant la conscience que j’ai fait mon devoir, l’échec pourra m’être sensible au premier moment. Je m’en consolerai bientôt, je l’espère. Je ne manque pas d’autres travaux à faire, en dehors de la législature.
Mais, au point de vue politique, je regarderai comme un grand malheur que les élections donnent un résultat fort différent de celles de 1848. Si on voulait y réfléchir avec quelque impartialité, on reconnaîtrait que l’Assemblée a rempli sa mission, qu’elle a surmonté les plus grandes difficultés matérielles et morales, qu’elle a fini par ramener l’ordre dans les faits et le calme dans les esprits, que les utopies les plus dangereuses sont venues se briser devant elle, quoiqu’elle-même, à l’origine, fût fort imbue de chimériques espérances. Cette assemblée est dans la bonne voie. Elle aurait accompli en finances, si elle en eût eu le temps, tout ce qu’il est possible de faire. Est-ce le moment de la chasser, de la remplacer par d’autres hommes, imbus d’un autre esprit, le cœur plein de rancune ? Je puis vous dire que le ministère est fort inquiet de l’avenir à cet égard. Ne cesserons-nous jamais de courir les aventures ? Il me semble donc que ce qu’il y aurait de mieux à faire, ce serait de persévérer dans l’esprit électoral de 1848, sauf à éliminer les hommes, en petit nombre, qui se sont montrés, à droite et à gauche, animés d’un mauvais esprit de turbulence.
Dans notre département on ne peut guère adresser ce reproche aux représentants. Un seul a produit, de bonne foi sans doute, un système dangereux, l’impôt progressif, l’accaparement par l’État de plusieurs industries privées. Maintenir la République honnête, telle a été la devise de la députation. La question devrait donc se poser ainsi : renverra-t-on les mêmes représentants, ou fera-t-on de nouveaux choix dans de nouvelles vues ?
Ce sera, l’expérience me le prouve, une chose bien petite que la lutte des arrondissements, si elle éclate. Je puis vous assurer que l’arrondissement de Saint-Sever est celui qui me donne le moins d’affaires. Je ne me rappelle pas d’avoir reçu une seule lettre des chefs-lieux, de Hagermau, d’Amon, de Geaune, d’Aire. Mugron même m’en a envoyé seulement trois pour des choses qui ne sont pas incompatibles avec le mandat de député. Dax et le Saint-Esprit m’en ont fourni davantage. Au total, je suis édifié de voir combien l’esprit de sollicitation s’est épuisé.
à M. Domenger: Lettre du 8 avril 1849, Paris↩
BWV
[CW1.132] [OC7] 132. Paris, 8 avril 1849. A M. Domenger
Vos lettres me sont toujours précieuses, c’est une consolation pour moi de penser que des amis impartiaux et éclairés ne se laissent pas entamer par les préventions dont je suis l’objet.
J’ai en effet parlé de nouveau à Buffet. Je lui ai lâché l’argument le plus propre à faire effet. Je lui ai dit : Si, quand il s’agit d’une question de pure localité, de savoir où une ferme modèle peut rendre le plus de services, le vœu unanime de trente conseillers généraux est mis de côté, ne nous parlez plus de décentralisation. — Il m’a répondu : Je suis décidé, dans les questions semblables, à céder aux vœux du pays. — Malgré cela sa résolution n’est pas prise, il redoute notre persévérant et obstiné adversaire. On m’assure que celui-ci se répand contre moi en invectives. C’est un libéral d’une singulière espèce.
J’ai reçu une lettre de M. Dup… Il me demande d’adresser une note au Ministre. Je lui ai déjà adressé un mémoire. Comptez que nous ne négligerons rien pour faire triompher la note du Conseil général.
Mon ami, je voudrais vous parler élections et politique. Mais, en vérité, il y a tant à dire que je n’ose l’entreprendre. Le besoin d’ordre, de sécurité, de confiance, est ce qui domine dans le pays. C’est bien naturel. Mais je suis convaincu qu’il égare en ce moment les populations sur les rapports du ministère et de l’Assemblée. Je voudrais bien pouvoir aller dans le département pour rectifier de funestes malentendus. L’Assemblée devrait se dissoudre et permettre ainsi aux représentants d’aller s’expliquer, non dans leur intérêt, mais dans un intérêt d’avenir. Car il importe que les élections ne s’accomplissent pas sous l’influence de fausses préoccupations.
Les ministres actuels sont honnêtes, bien intentionnés, et décidés à maintenir l’ordre. Ce sont mes amis personnels, et je crois qu’ils comprennent la vraie liberté. Malheureusement ils sont entrés au pouvoir avec l’idée préconçue que l’Assemblée qui s’était montrée pour Cavaignac, devait nécessairement faire de l’opposition à Bonaparte. En mon âme et conscience, c’était une fausse appréciation ; et elle a eu les conséquences les plus funestes. Les ministres n’ont plus songé qu’à renvoyer l’Assemblée et, pour cela, qu’à la déconsidérer. Ils affectent de ne faire aucun cas de ses votes, même quand elle réclame l’exécution des lois. Ils s’abstiennent de toute initiative. Ils nous laissent la bride sur le cou. Ils assistent aux délibérations comme les étrangers des tribunes. Se sentant soutenus par le vent de l’opinion, ils animent la lutte, parce qu’ils pensent qu’elle tournera à leur avantage aux yeux du pays. Ils l’habituent ainsi à placer fort bas le premier pouvoir de tout gouvernement représentatif. Ils font plus, ils présentent des lois inadmissibles pour en provoquer le rejet. C’est ce qui arrive pour les Clubs. Vous me dites que mon vote sur cette loi m’a réconcilié quelque peu avec les électeurs. Eh bien ! je dois vous annoncer que ce vote est le seul que j’aie sur la conscience, car il est contraire à tous mes principes ; et si j’avais eu quelques minutes de réflexion calme, je ne l’aurais certes pas émis. Ce qui me détermina, c’est ceci. Je disais à mes voisins : Si nous voulons que la République se maintienne, il faut la faire aimer, il ne faut pas la rendre redoutable. Le pays a peur des clubs, il en a horreur ; sachons les sacrifier. — La suite de la loi a prouvé qu’il eût mieux valu adhérer aux principes, accorder tous les moyens de répression possibles, mais ne pas supprimer la liberté. Cette loi ne fait autre chose qu’organiser les sociétés secrètes.
Depuis j’ai voté trois fois, et toujours à regret, contre le Ministère. On m’en voudra dans le pays, et cependant ces votes sont consciencieux.
1° Affaire d’Italie. — Comme la montagne, j’ai repoussé l’ordre du jour qui pousse à une invasion dans le Piémont, mais par un motif opposé. La Montagne ne trouvait pas cet ordre du jour assez belliqueux ; je le trouvais trop. Vous savez que je suis contre l’intervention : cela explique mon vote. D’ailleurs, je n’approuve pas la diplomatie faite en parlement. On prend des engagements téméraires qui embarrassent plus tard. Je préférais l’ordre du jour pur et simple pour lequel j’ai voté.
2° L’affaire des préfets. — Si le Ministère eût fait un aveu franc, j’aurais passé par dessus. Mais il a voulu soutenir que quarante préfets s’étaient trouvés infirmes le même jour. Ce sont de ces subtilités qui révoltent le sens commun.
3° L’affaire Changarnier. — Même raison. Si le Ministère eût demandé la prolongation d’un état de choses contraire aux lois en se fondant sur les nécessités de l’ordre, on eût accordé. Mais il vient dire : Nous demandons l’arbitraire, et l’Assemblée nationale n’est pas juge du temps que cet arbitraire doit durer ! Le plus grand despote du monde ne peut pas demander autre chose. Je ne pouvais acquiescer.
Quant aux élections, elles seront ce que le bon Dieu voudra. Si je dois succomber, j’en ai pris mon parti d’avance ; car j’ai bien des travaux à faire en dehors du Parlement. J’ai un ouvrage dans la tête dont je crains de ne pouvoir accoucher. Si les électeurs me font des loisirs, je m’en consolerai en travaillant à ce livre, qui est ma chimère. Je désire seulement qu’ils ne me remplacent pas d’une manière trop indigne. Il est tel nom qui, mis à ma place, ne ferait pas honneur au département.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 25 avril 1849, Paris ↩
BWV
[CW1.133] [OC1] 133. Paris, 25 avril 1849. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, les élections ont beau approcher, je ne reçois aucune nouvelle directe. Une bonne et affectueuse lettre de Domenger, voilà toute ma pitance. Je puis présumer que je suis le seul représentant à ce régime, qui me fait pressentir mon sort. D’ailleurs j’ai quelques information indirectes par Dampierre. Il ne m’a pas laissé ignorer que le pays a fait un mouvement qui implique le retrait de cette confiance qu’il avait mise en moi. Je n’en suis ni surpris ni guère contrarié, en ce qui me concerne. Nous sommes dans un temps où il faut se jeter dans un des partis extrêmes si l’on veut réussir. Quiconque voit d’un œil froid les exagérations des partis et les combat, reste délaissé et écrasé au milieu. Je crains que nous ne marchions vers une guerre sociale, vers la guerre des pauvres contre les riches, qui pourrait bien être le fait dominant de la fin du siècle. Les pauvres sont ignorants, violents, travaillés d’idées chimériques, absurdes, et le mouvement qui les emporte est malheureusement justifié, dans une certaine mesure, par des griefs réels, car les contributions indirectes sont pour eux l’impôt progressif pris à rebours. — Cela étant ainsi, je ne pouvais avoir qu’un plan : combattre les erreurs du peuple et aller au-devant des griefs fondés, afin de ne jamais laisser la justice de son côté. De là mes huit ou dix brochures, et mes votes pour toutes les réformes financières.
Mais il s’est rencontré que les riches, profitant du besoin de sécurité, qui est le trait saillant de l’opinion publique, exploitent ce besoin au profit de leur injustice. Ils restent froids, égoïstes, ils flétrissent tout effort qu’on fait pour les sauver, et ne rêvent que la restauration du petit nombre d’abus que la révolution a ébranlés.
Dans cette situation, le choc me semble inévitable, et il sera terrible. Les riches comptent beaucoup sur l’armée ; l’expérience du passé devrait les rendre un peu moins confiants à cet égard.
Quant à moi, je devais déplaire aux deux partis, par cela même que je m’occupais plus de les combattre dans leurs torts que de m’enrôler sous leur bannière ; moi et tous les autres hommes de conciliation scientifique, je veux dire fondée sur la justice expliquée par la science, nous resterons sur le carreau. La chambre prochaine, qui aurait dû être la même que celle-ci, sans les extrêmes, sera au contraire formée des deux camps exagérés ; la prudence intermédiaire en sera bannie. S’il en est ainsi, il ne me reste qu’une chose à dire : Dieu protège la France ! Mon ami, en restant dans l’obscurité, j’aurai des motifs de me consoler, si du moins mes tristes prévisions ne se réalisent pas. J’ai ma théorie à rédiger ; de puissants encouragements m’arrivent fort à propos. Hier, je lisais dans une revue anglaise ces mots : En économie politique, l’école française a eu trois phases, exprimées par ces trois noms : Quesnay, Say, Bastiat.
Certes, c’est prématurément qu’on m’assigne ce rang et ce rôle ; mais il est certain que j’ai une idée neuve, féconde et que je crois vraie. Cette idée, je ne l’ai jamais développée méthodiquement. Elle a percé presque accidentellement dans quelques-uns de mes articles ; et puisque cela a suffi pour qu’elle attirât l’attention des savants, puisqu’on lui fait déjà l’honneur de la considérer comme une époque dans la science, je suis maintenant sûr que lorsque j’en donnerai la théorie complète elle sera au moins examinée. N’est-ce pas tout ce que je pouvais désirer ? Avec quelle ardeur je vais mettre à profit ma retraite pour élaborer cette doctrine, ayant la certitude d’avoir des juges qui comprennent et qui attendent !
D’un autre côté, les professeurs d’économie politique belges essayent d’enseigner ma Théorie de la valeur, mais ils tâtonnent. Aux États-Unis, elle a fait impression, et hier à l’assemblée, une députation d’Américains m’a remis une traduction de mes ouvrages. La préface prouve qu’on attend l’idée fondamentale jusqu’ici plutôt indiquée que formulée. Il en est de même en Allemagne et en Italie. Tout cela se passe, il est vrai, dans le cercle étroit des professeurs ; mais c’est par là que les idées font leur entrée dans le monde.
Je suis donc prêt à accepter résolument la vie naturellement fort dure qui va m’être faite. Ce qui me donne du cœur, ce n’est pas le non omnis moriar d’Horace, mais la pensée que peut-être ma vie n’aura pas été inutile à l’humanité.
Maintenant, où me fixerai-je pour accomplir ma tâche ? Sera-ce à Paris ? sera-ce à Mugron ? Je n’ai encore rien résolu, mais je sens qu’auprès de toi l’œuvre serait mieux élaborée. N’avoir qu’une pensée et la soumettre à un ami éclairé, c’est certainement la meilleure condition du succès.
à M. Domenger: Lettre du 29 avril 1849, Paris↩
BWV
[CW1.134] [OC7] 134. Paris, 29 avril 1849. A M. Domenger
J’ai bien tardé de répondre à votre lettre du 14, que voulez-vous ? La nature m’a pétri de bizarrerie ; et il semble que je deviens plus inerte au moment où j’aurais besoin de plus d’activité. Ainsi depuis qu’il est question d’élections, je me suis mis en tête un travail de pure théorie qui m’attache, m’absorbe et me prend tous les moments dont je puis disposer.
Les nouvelles fort rares qui me parviennent ne me laissent guère de doutes sur le résultat du vote en ce qui me concerne ; j’ai perdu la confiance du pays. Je me l’explique : mon tort, et ce n’en est un qu’au point de vue personnel, a été de voir les deux exagérations opposées et de ne m’associer à aucune. Mon ami, elles nous conduisent à la guerre civile, à la guerre du pauvre contre le riche. Le pauvre demande plus que ce qui est juste ; le riche ne veut pas accorder même ce qui est juste. Voilà le danger. On a repoussé l’impôt progressif avec la richesse, et l’on a eu raison ; mais on maintient l’impôt progressif avec la misère, et par là on fournit de bons arguments au peuple. Personne ne sait mieux que moi combien il fait de réclamations absurdes, mais je sais aussi qu’il a des griefs fondés. La simple prudence, à défaut d’équité, me traçait donc la conduite à suivre. Combattre les exigences chimériques du peuple, faire droit à ses requêtes fondées. Mais, hélas ! la notion de justice est faussée dans l’esprit des pauvres, et le sentiment de justice est éteint dans le cœur du riche. J’ai donc dû m’aliéner les deux classes. Il ne me reste qu’à me résigner.
Puissé-je être un faux prophète ! Avant février, je disais [1] : « Une résistance toujours croissante dans le Ministère, un mouvement toujours plus actif dans l’opposition, cela ne peut finir que par un déchirement. Cherchons le point où est la justice, il nous sauvera. » Je ne me suis pas trompé. Les deux partis ont persisté, et la révolution s’est faite.
Aujourd’hui je dis : Le pauvre demande trop, le riche n’accorde pas assez, cherchons la justice ; c’est là qu’est la conciliation et la sécurité ! — Mais les partis persistent, et nous aurons la guerre sociale.
Nous l’aurons, je le crains bien, dans des conditions fâcheuses, car plus on refuse au peuple ce qui est équitable, plus ou donne de force morale et matérielle à sa cause. Aussi elle fait des progrès effrayants. Ces progrès sont masqués par une réaction momentanée et déterminée par le besoin général de sécurité ; mais ils sont réels. L’explosion sera retardée, mais elle éclatera.
J’en étais là de ma lettre, quand j’en ai reçu une de nos amis de Mugron. Je vous ai quitté pour leur répondre, et naturellement, j’ai répété ce qui précède ; car je ne puis dire que ce dont mon cœur est plein. On me presse d’aller au pays, mais qu’y ferais-je ? Est-on disposé à former de grandes réunions ? Sans cela comment pourrais-je entrer en relation avec un si grand nombre d’électeurs ?
Je reçois, 30 avril, votre lettre du 27. Je vais aller tout à l’heure à l’Assemblée, et je verrai si je puis, sans inconvénient, obtenir un congé. Je répugnerais beaucoup à le demander au moment où l’on va discuter le budget de la guerre. J’ai concouru à le préparer, et je serai peut-être appelé à le défendre.
Tout le monde veut l’économie en général. Mais tout le monde combat chaque économie en particulier.
FN:Ceci nous donne la date de la profession de foi en forme de lettre à
MM. Tonnelier, Degon, Bergeron etc. Fin du tome Ier. (Note de l’édit.)
Letters to Cheuvreux Family: 3 mai 1849, Paris↩
BWV
[CW1.135] [CH] 135. Paris, 3 mai 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Permettez-moi de vous envoyer une copie de ma lettre aux électeurs. Ce n’es certes pas pour avoir votre avis politique, mais ces documents sont surtout une affaire de tact et de délicatesse. Il y fait parler beaucoup de soi, comment éviter la fausse modestie ou la vanité blessante ? Comment se montrer sensible à l’ingratitude, sans tomber dans la ridicule classe des incompris ? Il est bien difficile de concilier à la fois la dignité et la vérité. Il me semble qu’une femme est surtout propre à signaler les fautes de ce genre si elle veut avoir la franchise de les dire. C’est pour cela que je vous envoie ce factum, espérant que vous voudrez bien le lire et m’aider au besoin à éviter des inconvenances. J’ai appris que vous rouvriez vos salons ce soir. Si je puis m’échapper d’une réunion où je serai retenu un peu tard, j’irai recevoir vos conseils. N’est-ce pas une singulière mission que je vous donne, et le cas de dire avec Faucher : « Il faut bien venir des grandes Landes pour être galant de cette manière. » Avez-vous eu la patience de lire la séance d’hier? [181] Quelle triste lutte ! Selon moi, un acte d’une moralité plus que douteuse serait devenu excusable par un simple aveu, d’autant que la responsabilité en remontait aux prédécesseurs de Faucher. C’est le système de défense qui est pitoyable. Et puis les représentants, aspirants ministres, sont venus envenimer et exploiter la faute. Ah ! madame, suis-je condamné à tomber ici de déception en déception ! Faudra-t-il que, parti croyant de mon pays, j’y rentre sceptique ? Ce n’est pas ma foi en l’humanité que je crains de perdre ; elle est inébranlable ; mais j’ai besoin de croire aussi en quelques-uns de mes contemporains, aux personnes que je vous et qui m’entourent. La foi en une généralité ne suffit pas.
Voici une brochure sur Biarritz, je suis sûr qu’en la lisant vous direz : C’est là qu’il fait nous rendre [182] pour faire une forte constitution à ma bien-aimée Louise. »
L’auteur de cette brochure voulait que je la remisse à un de mes amis placé auprès du président de la République (toujours ce Protée de la sollicitation) ; je n’ai pu m’acquitter de sa commission à cause du mot prince, effacé maladroitement devant le mot Joinville ; cet auteur médecin m’avait aussi prié de faire sa préface en matière de réclame. « Mais je n’entends rien en médecine, lui dis-je. — Eh bien, cachez la science derrière le sentiment. » Je me mis donc à l’œuvre. Cette introduction n’a d’autre mérite qu’une certaine sobriété de descriptions, sobriété peu à la mode. Comme je suis passionné pour Biarritz, je cherche à faire de la propagande.
Mais quelle longue lettre ! je vais distancer M. Blondel.
Adieu, madame.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris↩
BWV
[CW1.136] [OC7] 136. Paris, sans date, 1849. A M. Domenger
Mon élection, que j’appris il y a deux jours, va me donner plus d’affaires après qu’avant : car, si j’ai pu la négliger un peu, je ne dois pas au moins oublier d’exprimer à mes amis toute ma reconnaissance, non pas du service qu’ils m’ont rendu, mais de l’attachement et de la confiance qu’ils m’ont témoignés. Vous êtes en première ligne, et je suis profondément touché du zèle que vous y avez mis, d’autant que cela a dû beaucoup vous coûter. Je sais que vous répugnez à cette agitation électorale et que depuis longtemps vous aspirez à n’y prendre qu’une part toute personnelle. D’un autre côté, vous avez dû vous mettre en opposition avec beaucoup de vos amis. Croyez que toutes ces circonstances me font d’autant plus apprécier votre dévouement.
Quelle sera la destinée de la nouvelle assemblée ? On fonde sur elle de grandes espérances. Dieu veuille que ce ne soient pas de grandes illusions. Elle ne sera certainement pas mieux intentionnée que celle qui vient de mourir. Mais que font les intentions ? Je pense comme la Presse ; la meilleure assemblée ne vaut rien que pour empêcher le mal. Pour faire le bien, il faut l’initiative d’un pouvoir plus concentré ; nous en avons la preuve depuis cinq mois. Le ministère a borné son rôle à susciter et soutenir un conflit, et la chambre avec ses bonnes intentions n’a pu rien faire.
Ce qui rend l’avenir redoutable, c’est l’ignorance. La classe pauvre s’enrégimente et marche comme un seul homme à une guerre insensée, sans se douter qu’elle se suicide elle-même, car quand elle aura détruit le capital et le mobile même qui le forme, quel sera son sort ?
Au fond, il ne devrait y avoir entre les deux classes qu’une question d’impôts. Arriver à l’impôt proportionnel, c’est tout ce que la justice exige ; au delà il n’y a qu’injustice, oppression et malheur pour tous. Mais comment le faire comprendre à des hommes qui s’en prennent au principe même de la propriété ?
Je vous dirai que j’ai dans la tête une pensée qui m’absorbe, me détourne de mes devoirs et me fait négliger mes amis. C’est une explication nouvelle de ces deux mots : Propriété, Communauté. Je crois pouvoir démontrer de la manière la plus évidente que l’ordre naturel des sociétés fonde, sur la propriété même, la plus belle, la plus large et la plus progressive communauté. Cela vous paraîtra paradoxal, mais j’ai dans l’esprit certitude complète. Il me tarde de pouvoir jeter cette pensée dans le public, car il me semble qu’elle réconciliera les hommes sincères de toutes les écoles. Elle ne ramènera pas sans doute les chefs de sectes. Mais elle empêchera la jeunesse des écoles d’aller s’enrôler sous les drapeaux du communisme. Suis-je sous l’empire d’une illusion ? — C’est possible, mais le fait est que je sèche du désir de publier mon idée. Je crains toujours de n’avoir pas le temps, et lorsque le choléra décimait l’Assemblée, je disais à Dieu : Ne me retirez pas de ce monde avant que je n’aie accompli ma mission.
[CW1.137] [CH] 137. Bruxelles, hôtel de Bellevue, juin 1849. A Madame Cheuvreux????↩
BWV
[CW1.137] [CH] 137. Bruxelles, hôtel de Bellevue, juin 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
L’absence de votre beau-frère fera un mauvais effet sur les amis de la paix ; ils s’attendent à une réception qu’ils ne trouveront pas. M. Say est du nombre de ceux qui ont signé l’invitation. Sur cette circulaire plusieurs centaines d’étrangers vont se rendre à Paris, les uns traversant la Manche, les autres l’Océan ; ils s’imaginent trouver chez nous un zèle ardent. Quelle déception, quand on verra la cause de la paix en France représentée pas Guillaumin, Garnier et Bastiat. En Angleterre elle met en mouvement les populations entières, hommes et femmes, prêtres et laïques ; faut-il que mon pays se laisse toujours devancer ?
Je rentrerai à Paris en passant par Gand et Bruges ; je voudrais arriver deux jours avant le Congrès, pour savoir quelles dispositions ont été prises ; car, je vous avoue, que je me sens inquiet sur ce point ; il faut, au moins, que je m’acquitte des devoirs de l’hospitalité envers Cobden ; pour cela peut-être aurais-je recours à votre inépuisable bonté ; je vous demanderai la permission de vous présenter un des hommes les plus remarquables de notre temps. Si je parviens, comme je l’espère, à arriver à Paris samedi, je prendrai la liberté d’aller dimanche à la Jonchère ; n’y trouverais-je rien de changé ?
Mlle Louise sera-t-elle en pleine possession de sa santé et de sa voix ? C’est une bien douce, mais bien impérieuse habitude, que celle d’être informé, jour par jour, de ce qui intéresse ; elle rend pénible la plus courte absence.
Tout bien considéré, mesdames, permettez-moi de ne pas abuser de votre indulgence et de retenir la relation de ma pointe sur Anvers. À quoi bon vous l’envoyer et vous donner la fatigue d’une lecture quand je pourrai y suppléer bientôt par quelques minutes de conversation. D’ailleurs en relisant ces notes, je m’aperçois qu’elles parlent de tout, excepté d’Anvers. J’ai trouvé les Belges très-fiers du bon sens dont ils ont fait preuve pendant ces deux dernières années de troubles européens ; ils se sont hâtés de mettre fin à leurs discordes par des concessions réciproques ; le Roi a donné l’exemple, les Chambres et le peuple ont suivi ; bref, ils sont tous enchantés les uns des autres et d’eux-mêmes. Cependant les doctrines socialistes et communistes ne cessent de continuer leur œuvre souterraine et il me semble qu’on en est assez effrayé. Cela a fait surgir dans ma tête un projet que je vous communiquerai ; mais qu’est-ce que des projets ? Ils ressemblent à ces petites bulles qui paraissent et disparaissent à la surface d’une eau agitée.
Adieu, madame ; n’allez pas croire qu’il en est des sentiments comme des projets ; l’affection que je sens pour vous, pour votre famille, est trop profonde, elle a des bases trop solides pour ne pas durer autant que ma vie et j’espère au delà.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: Juin 1849, Bruxelles, hôtel de Bellevue↩
BWV
[CW1.138] [CH] 138. Bruxelles, juin 1849. A Madame Cheuvreux
Bruxelles, hôtel de Bellevue, juin 1849.
Madame,
Vous avez désiré que je vous envoie mes impressions de voyage jetées pêle-mêle sur le papier ; ne saviez-vous pas que le journal a ses dangers ? Il ressemble aux mémoires, on n’y parle que de soi. Oh ! que j’aimerais mieux vous entretenir de vous, de votre Louise bien-aimée, de ses occupations, de ses plaisirs, de ses perspectives, de la Jonchère et quelque peu aussi du Buttard: [183] là tout est poésie, on n’en peut dire autant du Brabant, cette terre classique du travail, de l’ordre, de l’économie et des estomacs satisfaits ; au reste, je n’en parle que par ouï dire, car je n’y suis que depuis hier soir, et ne l’ai vue que par la fenêtre ; à la vérité elle me sert bien puisqu’elle étale devant mes yeux le palais du roi. Ainsi, il y a quelques heures, je respirais un air infecté de républicanisme ; et, me voici plongé dans une atmosphère monarchique ; et bien ! le croiriez-vous, je ne me suis pas même aperçu de la transition ; le dernier mot que j’ai entendu de l’autre côté de la frontière est justement le même qu’on m’a adressé de celui-ci : « Votre passe-port. » Hélas ! je n’en avais pas. Un moment, j’ai espéré qu’on allait me renvoyer à Paris et le cœur m’a battu ; mais tout se civilise, même le gendarme, même le douanier ; bref, on m’a laissé passer, en me recommandant de venir faire une déclaration au ministère de la justice, car, ajoutait le gendarme, « nous y avons été pris plusieurs fois et récemment encore nous avons failli laisser échapper M. Proudhon. » — « Je ne suis pas surpris, ai-je répondu, que vous soyez devenu si avisé, et certes j’irai faire ma déclaration pour encourager la gendarmerie dans cette voie. » Mais reprenons les choses de plus haut ; samedi, en sortant de la séance (vous voyez que j’écris un journal consciencieux) j’articule le mot Bruxelles : « J’y vais demain, à huit heures et demie, dit Barthélemy Saint-Hilaire, partons ensemble. » Là-dessus je me rends rue La Fayette, croyant arriver à l’heure dite ; le convoi était parti, il m’a fallu attendre celui de midi. Que faire dans l’intervalle ? La butte Montmartre n’est pas loin et l’horizon y est sans bornes. Vers cinq heures, nous avons passé de France à Belgique et j’ai été surpris de n’éprouver aucune émotion ; ce n’est pas ainsi que je franchis pour la première fois notre frontière ; mais, j’avais dix-huit ans et j’entrais en Espagne ! C’était au temps de la guerre civile ; j’étais monté sur un superbe coursier navarrais, et toujours homme de précaution, j’avais mis une paire de pistolets dans mon porte-manteau ; car l’Ibérie est la terre des grandes aventures ; ces distractions sont inconnues en Belgique ; serait-il vrai que la bonne police tue la poésie ? Je me rappelle encore l’impression que faisaient sur moi les fiers Castillans quand je les rencontrais sur une route, à cheval, et flanqués de deux escopettes. Ils avaient l’air de dire : Je ne paie personne pour me protéger, mais je me protége moi-même. Dans tous les genres, il semble que la civilisation qui élève le niveau des masses diminue la valeur des caractères individuels ; je crains que ce pays-ci ne confirme l’observation.
Il est impossible de n’être pas frappé de l’aspect d’aisance et de bien-être qu’offre la Belgique : d’immenses usines qu’on rencontre à chaque pas, annoncent au voyageur une heureuse confiance en l’avenir ; je me demande si le monde industriel, avec ses monuments, son confort, ses chemins de fer, sa vapeur, ses télégraphes électriques, ses torrents de livres et de journaux, réalisant l’ubiquité, la gratuité et la communauté des biens matériels et intellectuels, n’aura pas aussi sa poésie, poésie collective, bien entendu. N’y a-t-il d’idéal que dans les mœurs bibliques, guerrières ou féodales ? Faut-il, sous ce rapport, regretter la sauvagerie, la barbarie, la chevalerie ? Ne ce cas, c’est en vain que je cherche l’harmonie dans la civilisation ; car l’harmonie est incompatible avec le prosaïsme. Mais, je crois que ce qui nous fait apparaître sous des couleurs si poétiques les temps passés, la tente de l’Arabe, la grotte de l’anachorète, le donjon du châtelain, c’est la distance ; c’est l’illusion de l’optique ; nous admirons ce qui tranche sur nos habitudes ; la vie du désert nous émeut, pendant qu’Abd-el-Kader s’extasie sur les merveilles de la civilisation. Croyez-vous qu’il y ait jamais eu autant de poésie dans une des héroïnes de l’antiquité que dans une femme de notre époque ? Que leur esprit fût aussi cultivé, leurs sentiments aussi délicats, qu’elles eussent la même tendresse de cœur, la même grâce de mouvements et de langage ?
Oh ! ne calomnions pas la civilisation !
Pardonnez-moi, mesdames, cette dissertation, vous l’avez voulue, en me disant d’écrire au hasard, avec abandon ; c’est ce que je fais ; il faut bien que je laisse aller la tête, car deux sources d’idées me sont fermées : les yeux et le cœur ; mes pauvres yeux ne savent pas voir ; la nature leur a refusé l’étendue et la rapidité ; je ne puis donc faire ni descriptions de villes ou de paysages. Quant à mon cœur, il en est réduit à essayer d’aimer une abstraction, à se passionner pour l’humanité, pour la science ; d’autres portent leurs aspirations vers Dieu ; ce n’est pas trop des deux ; c’est ce que je pensais, tout à l’heure en sortant d’une salle d’asile dirigée par des religieuses vouées à soigner des enfants malades, idiots, rachitiques, scrofuleux ; quel dévouement ! quelle abnégation ! Et après tout cette vie de sacrifice ne doit pas être douloureuse, puisqu’elle laisse sur la physionomie de telles empreintes de sérénité. Quelques économistes nient le bien que font ces saintes femmes ; ce dont on ne peut douter, c’est la sympathique influence d’un tel spectacle : il touche, il attendrit, il élève ; on se sent meilleur, on se sent capable d’une lointaine imitation, à l’aspect d’une vertu si sublime et si modeste.
Le papier me manque, sans quoi vous n’échapperiez pas à un long commentaire sur le catholicisme, le protestantisme, le pape et M. de Falloux.
Donnez-moi des nouvelles de M. Cheuvreux ; puisse-t-il trouver aux aux la santé et le calme moral, si troublé par les agitations de notre triste politique ! Il n’est pas comme moi, un être isolé et sans responsabilité. Il pense à vous et à sa Louise ; je comprends son irritation contre les perturbateurs et me reproche de ne l’avoir pas toujours assez respectée.
Adieu, je présente mes hommages à la mère et à la fille.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: Juin 1849, Notes prises d’Anvers↩
BWV
[CW1.139] [CH] 139. Anvers, juin 1849. A Madame Cheuvreux
notes prises d’anvers
Les extrêmes se touchent. C’est ce qu’on éprouve en chemin de fer : l’extrême multiplicité des impressions les annule. On voit trop de choses pour voir quelque chose. Singulière manière de voyager ; on ne parle pas ; l’œil et l’oreille s’endorment ; on se renferme avec sa pensée, dans la solitude. Le présent qui devrait être tout, n’est rien. Mais aussi, avec quel attendrissement le cœur revient sur le passé ; avec quelle avidité il s’élance vers l’avenir. « Il y a huit jours… dans huit jours. » Ne voilà-t-il pas des textes de méditations bien choisis, quand, pour la première fois, et Vilvorde, et Malines, et le Brabant fuient sous un regard qui ne regarde pas ! Ce matin j’étais à Bruxelles ; ce soir à cinq heures j’étais encore à Bruxelles ; dans l’intervalle j’ai vu Anvers, ses églises, son musée, son port, ses fortifications. Est-ce là voyager ? J’appelle voyager, pénétrer la société qu’on visite ; connaître l’état des esprits, les goûts, les occupations, les plaisirs, les relations des classes, le niveau moral, intellectuel et artistique auquel elles sont parvenues ; ce qu’ont peut en attendre pour l’avancement de l’humanité ; je voudrais interroger les hommes d’État, les négociants, les laboureurs, les ouvriers, les enfants, les femmes surtout, puisque ce sont les femmes qui préparent les générations et dirigent les mœurs.
Au lieu de cela, on me montre une centaine de tableaux, cinquante confessionnaux, vingt clochers, je ne sais combien de statues en pierre, en marbre, en bois ; et l’on me dit : Voilà la Belgique.
À la vérité, il y a pour l’observateur une ressource c’est la table d’hôte ; elle réunissait aujourd’hui autour d’elle, soixante dîneurs, dont pas un belge ; on y remarquait cinq Français et cinq longues barbes ; les cinq longues barbes appartenaient aux cinq Français, ou plutôt les cinq Français aux cinq barbes, car il ne faut pas prendre le principal pour l’accessoire.
Aussitôt, je me suis posé cette question : Pourquoi les Belges, les Anglais, les Hollandais, les Allemands se rasent-ils ? Et pourquoi les Français ne se rasent-ils pas ? En tout pays les hommes aiment à laisser croire qu’ils possèdent les qualités qu’on y prise le plus ; si la mode tournait aux perruques blondes, je me dirais que ce peuple est efféminé ; si dans les portraits je remarquais un développement exagéré du front, je penserais : ce peuple a voué un culte à l’intelligence ; quand les sauvages se défigurent pour se rendre effroyables, j’en conclus qu’ils placent au-dessus de tout la force brutale. C’est pourquoi, j’éprouvais aujourd’hui un sentiment d’humiliation pénible, en voyant tous les efforts de mes compatriotes pour se donner l’air farouche : pourquoi cette barbe et ces moustaches ? Pourquoi ce tatouage militaire ? À qui veulent-ils faire peur et pourquoi ? La peur ! Est-ce là le tribut que mon pays apporte à la civilisation ?
Ce ne sont pas seulement les commis voyageurs qui donnent dans ce ridicule travers ; ne serait-ce pas aux femmes à le combattre ? Mais, est-ce là tout ce que je rapporte d’Anvers ? Il valait bien la peine de faire des lieues sans fin ni compte. J’ai vu des Rubens dans leur patrie ; vous pensez bien que j’ai cherché dans la nature vivante les modèles de ces amples carnations que reproduit si complaisamment le maître de l’école flamande. Je ne les ai pas trouvés, car vraiment, je crois que la race brabançonne est au-dessous de la race normande. On me dit d’aller à Bruges ; j’irais à Amsterdam si c’était mon type de prédilection ; ces chairs rouges ne sont pas mon idéal. Le sentiment, la grâce : voilà le femme, ou du moins la femme digne du pinceau.
F. Bastiat.
à M. Domenger: Lettre d’un mardi 13 (été de 1849), Paris↩
BWV
[CW1.140] [OC7] 140. Paris, mardi 13, été 1849. A M. Domenger
Vous me demandez de vous donner des nouvelles. Savez-vous que je pourrais en demander ? Depuis quelques jours je me suis fait ermite, et ce qui m’arrive tient du rêve. J’étais fatigué, indisposé ; bref je me décidai à demander un congé, et je le passe au pavillon du Butard. Qu’est-ce que le Butard ? Le voici :
Connaissez-vous la contrée qui s’étend de Versailles à Saint-Germain, embrassant Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Vaucresson, Marly, etc. ? C’est le pays le plus délicieux, le plus accidenté et certes le plus boisé, après les forêts d’Amérique, qu’il y ait au monde. C’est pourquoi Louis XIV, n’ayant pas assez de vue à Versailles, fit bâtir le château de Marly ; aussitôt les Montespan, Maintenon et plus tard Dubarry, firent construire les délicieuses villas de Luciennes, Malmaison, Lajonchère, Beauregard, etc.
Aujourd’hui tout cela est habité par des personnes de ma connaissance. Vers le centre, au milieu d’une forêt épaisse, isolé comme un nid d’aigle, s’élève le pavillon du Butard, que le Roi avait placé au point convergent de mille avenues comme rendez-vous de chasse. Il tire son nom de sa position élevée.
Or, un réactionnaire, qui a su que depuis longtemps je désirais goûter de ce pittoresque et sauvage séjour, et que je méditais quelque chose sur la Propriété, m’a laissé camper dans son Butard, qu’il a loué de l’État avec les chasses environnantes. Me voici donc tout seul, et je me plais tellement à cette vie qu’à l’expiration de mon congé, je me propose d’aller à la chambre et de revenir ici tous les jours. Je lis, je me promène, je joue de la basse, j’écris, et le soir j’enfile une des avenues, qui me conduit chez un ami. C’est ainsi que j’ai appris hier la mort de Bugeaud. C’est un homme à regretter. Sa franchise militaire inspirait la confiance ; et il est telle situation donnée (fort possible) où il nous aurait été bien utile.
Je suis venu à Paris. J’y trouve les affaires dans un bien triste état. La stupide audace de ********* passe toute croyance… Ces hommes s’amusent à fouler aux pieds toutes les règles du gouvernement représentatif, Constitution, Lois, Décrets ; ils ne s’aperçoivent pas qu’ils rendent impossible même cette monarchie qu’ils rêvent ! En outre, ils se jouent de l’honneur, de la parole et même de la sécurité de la France ; ils compromettent son propre principe, et noient la justice dans le sang. C’est plus que du délire.
Dans de telles circonstances, je vais être forcé de quitter mon Butard, ou, du moins, de passer une partie des journées sur les grands chemins. Je devrai aussi interrompre l’ouvrage que j’avais commencé à ébaucher, et que j’étais décidé à faire paraître même à l’état informe.
à M. Paillottet: Lettre du 14 juillet 1849 (Paris) ↩
BWV
[CW1.141] [OC7] 141. Paris, 14 juillet 1849. A M. Paillottet
Mon cher Paillottet, je vous suis bien reconnaissant de vous être souvenu de moi dans nos Pyrénées, et en même temps je suis fier de l’impression qu’elles ont faite sur vous. Que j’aurais été heureux de vous suivre dans vos courses ! Nous aurions peut-être refroidi et vulgarisé ces beaux paysages, en y mêlant de l’économie politique. Mais non ; les lois sociales ont leurs harmonies comme les lois du monde physique. C’est ce que je m’efforce de démontrer dans le livre que j’ai en ce moment sur le métier. — Je dois avouer que je ne suis pas content de ce qu’il est. J’avais un magnifique sujet, je l’ai manqué et ne suis plus à temps de refaire, parce que les premières feuilles sont sous presse. Peut-être ce fiasco n’est-il pas de ma faute. C’est une chose difficile sinon impossible de parler dignement des harmonies sociales à un public qui ignore ou conteste les notions les plus élémentaires. Il faut tout prouver jusqu’à la légitimité de l’intérêt, etc. — C’est comme si Arago voulait montrer l’harmonie des mouvements planétaires à des gens qui ne sauraient pas la numération.
En outre, je suis mal disposé et ne sais à quoi l’attribuer, car ma santé est bonne. J’habite le Butard, où je croyais trouver des inspirations ; au lieu de cela, elles se sont envolées.
On assure que l’Assemblée va se proroger du 15 août au 1er octobre. Dieu le veuille ! J’essayerai de me relever dans mon second volume, où je tirerai les conséquences du premier par rapport à notre situation actuelle. Problème social. — Problème français…
L’économie politique vous doit beaucoup et moi aussi pour votre zèle à nous recommander. Continuez, je vous prie. Un converti en fait d’autres. Le pays a bien besoin de cette science qui le sauvera.
Adieu ! Votre bien dévoué.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 30 juillet 1849, Paris ↩
BWV
[CW1.142] [OC1] 142. Paris, 30 juillet 1849. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, tu as vu que la prorogation, pour six semaines, a passé à une majorité assez faible. Je compte partir le 12 ou le 13. Je te laisse à penser avec quel bonheur je reverrai Mugron et mes parents et mes amis. Dieu veuille que l’on me laisse tout ce temps dans ma solitude ! Avec ton concours, j’achèverai peut-être la première partie de mon ouvrage. J’y tiens beaucoup. Il est mal engagé, contient trop de controverse, sent trop le métier, etc., etc. ; malgré cela il me tarde de le lancer dans le monde, parce que je suis résolu à ne jouer aucun rôle parlementaire avant de pouvoir m’appuyer sur cette base. M. Thiers provoquait l’autre jour ceux qui croient tenir la solution du problème social. Je grillais sur mon banc, mais je m’y sentais cloué par l’impossibilité de me faire comprendre. Une fois le livre publié, j’aurai la ressource d’y renvoyer les hommes de peu de foi.
Puisque nous devons avoir le bonheur de nous voir et de reprendre nos délicieuses conversations, il est inutile que je réponde à la partie politique de ta lettre. Nous ne pouvons nous séparer sur les principes ; il est impossible que nous ne portions pas le même jugement sur les faits actuels et sur les hommes.
Je porterai les livres que tu me demandes et aussi peut-être ceux des ouvrages qui me seront nécessaires. Rends-moi le service de faire dire à ma tante que je me porte à merveille et que je vais commencer mes préparatifs de départ.
Letters to Cheuvreux Family: 30 août 1849, Mont-de-Marsan↩
BWV
[CW1.143] [CH] 143. Mont-de-Marsan, 30 août 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Les organisation un peu éthériques ont le malheur d’être fort sensibles aux contrariétés et aux déceptions ; mais combien elles le sont aussi aux joies inattendues qui leur arrivent ! Qui m’aurait dit que je recevrais aujourd’hui des nouvelles de la Jonchère. L’espace fait l’effet du temps, et parce que je suis séparé de mon cher Buttard par beaucoup de lieues, il me semble que j’en suis séparé aussi par beaucoup de jours passés et à venir ; vous et Mlle Louise, qui êtres si indulgentes, vous me pardonnerez mon expansion à ce sujet ; c’est peut-être parce que je me sens profondément dégoûté du sentimentalisme politique et sociale que je suis devenu un peu sentimental en affection : que voulez-vous, le cœur a besoin de revanche, et puis, mère et fille, je ne sais comment vous faites, vous avez le don et l’art de rendre si contents, si heureux tous ceux qui vous approchent, qu’ils sont bien excusables d’en laisser paraître quelque chose. J’étais sûre que M. Cheuvreux regretterait ne n’avoir pu s’associer à vous pour le bon accueil fait à Cobden chez lui… Mais je suis bien aise de l’apprendre. N’aurait-il pas pu trouver un peu indiscrète ma manière d’exercer l’hospitalité ? Je voulais que la France et l’Angleterre se présentassent l’une à l’autre sous leur plus beau jour. Avec les dames Cheuvreux j’étais fier de Cobden ; avec Cobden j’étais fier des dames Cheuvreux. Il fait que ces insulaires sachent bien que chacun des deux pays a quelque chose à envier à l’autre. C’est d’un bon augure que M. Cheuvreux prolonge son séjour aux eaux, cela prouve qu’il s’en trouve bien.
Le voyage aurait dû me fatiguer davantage ; deux diligences marchaient toujours de conserve, la nôtre à la suite, c’est-à-dire dans un nuage de poussière. J’avais de tristes compagnons de route ; grâce au ciel je me parle à moi-même, et l’imagination me suffit ; elle a produit le plus beau plan, le plus utile à l’humanité qu’on puisse concevoir ; il ne manque plus que la mise en œuvre ; mais encore cette fois j’en serai pour les bonnes intentions. — Que Dieu m’en tienne compte, et je suis sauvé !
Jugez, mesdames, comme je dois trouver amusant d’être retenu ici par le conseil général, sachant que ma tante et mon ami m’attendent à Mugron : ce n’est pas tout, je porte le poids de ma renommée ; ne m’avait-on point réservé les dossiers les plus ardus pour me faire les honneurs de la session ? C’était le cas d’être modeste et Gascon ; j’ai été l’un et l’autre ; et, pour me délivrer de cette étrange politesse, j’ai parlé de ma fatigue ; cependant je en perds pas l’occasion de faire de la propagande économiste, attendu que notre préfet vient d’infecter son discours de socialisme ; cette lèpre prend partout. Demain je saurai laquelle des deux écoles aura la majorité au conseil. Mes concitoyens sont excellents pour moi : ils ont bien des petites peccadilles à me reprocher, mais ils me traitent en enfant gâté, et semble comprendre qu’il faut me laisser agir, travailler et voter capricieusement.
Je voudrais porter à Mlle Louise un souvenir de nos Landes, mais quoi ? Irai-je chercher à Bayonne quelques romances très-tendres du temps de la Restauration, ou bien des boléros espagnols ?
Mesdames, prenez pitié d’un pauvre exilé : n’est-pas singulier d’être exilé quand on est chez soi ? Pour le coup, vous allez me dire que j’aime les paradoxes, celui-là est une vérité bien sentie. Donc écrivez-moi de temps en temps ; je n’ose trop demander ce sacrifice à Mlle Louise : je vous prie d’agréer l’une et l’autre l’expression de mon attachement.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 12 septembre 1849, Mugron↩
BWV
[CW1.144] [CH] 144. Mugron, 12 septembre 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Il me semble que vingt courriers sont arrivés sans m’apporter de lettres. Le temps, comme ma montre, s’est-il arrêté depuis mon retour ici ? ou bien Mlle Louise m’a-t-elle pris au mot ? Mais un savant calcul, déjà refait cent fois, m’avertit qu’il n’y a pas huit jours que ma lettre est partie. Ce n’est pas votre chère fille qui a tort, c’est mon impatience. Je voudrais savoir si M. Cheuvreux vous est revenu en possession de toute sa santé, si vous-même êtes délivrée de ces tristes insomnies ; enfin, s’il y a autant de bonheur à la Jonchère qu’en on mérite, et que j’en souhaite ? Que le télégraphe électrique sera une bonne invention quand on le mettra au service de l’amitié !! Peut-être un jour aura-t-elle une lorgnette qui lui permette de voir à deux cent lieues. L’éloignement alors serait supportable ; maintenant, par exemple, je la tournerais vers votre salon. Mlle Louise est au piano ; je devine, à sa physionomie, la romance qu’elle chante. M. Cheuvreux et vous éprouvez la plus douce joie qu’on puisse ressentir sur cette terre, vos amis oublient que le dernier convoi va passer. — Ce tableau fait du bien au cœur. — Est-ce qu’il y aurait quelque chose de déplacé et de par trop provincial à vous dire que ce spectacle de vertus, de bonheur et d’union, dont votre famille m’a rendu témoin, a été pour moi un antidote contre le scepticisme à la mode, et un préservatif contre le préjugé anti-parisien. Que signifie cette apostrophe de Rousseau : « Paris, ville de boue, etc. ? » Tout à l’heure il m’est tombé sous la main un roman de Jules Janin. Quelle triste et funeste peinture de la société ! — « L’écurie et l’Église se tiennent, » dit-il, pour exprimer qu’on est estimé à Paris que par le cheval qu’on fait parader au bois, ou par l’hypocrisie. Dites-moi, je vous prie, que vous n’avez jamais connu cet homme, ou plutôt qu’il ne vous a jamais connus. — Ces romanciers, à force de présenter la richesse et l’égoïsme comme deux faces d’une même médaille, ont fourni des armes aux déclamations socialistes. J’avais besoin pour mes harmonies de m’assurer que la fortune non-seulement est compatible avec les qualités du cœur, mais qu’elle les perfectionne. Je suis fixé maintenant, et me sens proof, comme disent les Anglais, contre le scepticisme.
À présent, madame, voulez-vous que je vous passe un instant ma lorgnette merveilleuse ? Vraiment, je voudrais que vous pussiez voir derrière le rideau ces scènes de la vie de province : le matin, nous nous promenons dans ma chambre, Félix et moi, lisant quelques pages de Mme de Staël ou un psaume de David ; à la nuit tombante, je vais cherche au cimetière une tombe, mon pied la sait, la voilà ! Le soir, quatre heures de tête-à-tête avec ma bonne tante. Pendant que je suis enfoncé dans mon Shakespeare, elle parle avec l’animation la plus sincère, ayant la complaisance de faire les demandes et les réponses. Mais voici que la femme de chambre, qui se doute que les heures sont longues, se croit obligée de les varier ; elle survient et nous raconte ses tribulations électorales. La pauvre fille a fait de la propagande pour moi : on lui objectait toujours le libre échange ; elle, d’argumenter. Hélas ! quels arguments ; elle me les répète avec orgueil, et pendant qu’elle disserte en jargon basque, patois et français, je me rappelle ce mot de Patru : « Rien de tel qu’un mauvais avocat pour gâter une bonne cause. » Enfin l’heure du souper arrive, chiens et chats font irruptions dans la salle, escortant la garbure. Ma tante entre en fureur. « Maudites bêtes ! s’écrie-t-elle, voyez comme elles s’enhardissent dès que Monsieur arrive ! » Pauvre tante ! cette grande colère n’est qu’une ruse de sa tendresse ; traduisez : voyez comme Frédéric est bon. Je ne dis pas que cela soit, mais ma tante veut qu’on le pense.
Je vous le disais bien, madame, que des lettres du village sont redoutables, nous ne pouvons trouver nos sujets épistolaires que dans le milieu qui nous environne ou dans notre propre fonds.
Quel milieu que Paris pour celui qui écrit ! arts, politique, nouvelles, tout abonde ; mais ici l’extérieur est stérile. Il faut avoir recours à l’autre monde, celui de l’intimité. En un mot, il faut parler de soi ; cette considération aurait dû me déterminer à choisir le plus petit format ; au lieu de cela, je vous envoie maladroitement un arpent de bavardage ; ce qui me rassure, c’est que mon indiscrétion aura beau faire, elle n’épuisera pas votre indulgence.
Je crois que la prorogation a calmé quelque peu l’effervescence politique ; ce serait un grand bien et, sous ce rapport, il faudrait désirer qu’elle ne fût pas si près de son terme. Je voudrais qu’à notre retour le ministère nous livrât en pâture une foule de loi pour absorber notre temps et nous détourner de débats stériles, ou plutôt fertiles, seulement, en haines et exagération.
Veuillez exprimer à M. Cheuvreux et à Mlle Louise tout le plaisir que je me promets de les revoir bientôt. Peut-être le dimanche 30 septembre me retrouverai-je à la Jonchère.
Si je suis à Paris, j’irai m’offrir pour cavalier à Mme Girard, heureux d’être le confident de ses joies et de ses sollicitudes maternelles. Quant aux touristes, je me propose d’écrire prochainement à M. Say.
Adieu, madame, permettez-moi de vous assurer de ma respectueuse affection.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 16 septembre 1849, Mugron↩
BWV
[CW1.145] [CH] 145. Mugron, 16 septembre 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Vous êtes probablement de retour des eaux, mon cher monsieur Cheuvreux. Je suis un peu surpris d’en être réduit aux conjectures.
Il est de triste époques où les imaginations ébranlées se frappent aisément ; peut-on s’éloigner de Paris sans songer qu’on y a laissé le choléra ? Le silence de nos amis, pénible en tout temps, devient aujourd’hui difficile à supporter.
La pureté de la Jonchère me rassure. Mais vous avez de nombreux parents à Paris, et vous-même n’y êtes-vous pas retenu presque tous les jours par vos devoirs judiciaires ? Ces dames n’ont pas songé, sans doute, à m’épargner ce genre d’inquiétude. J’aime à attribuer leur silence à des causes moins lugubres : affaires, plaisirs, promenades, visites, musique, causeries, etc., et puis elles ont tant de correspondants ! Il faut bien que chacun attende son tour ; cependant je serais heureux d’apprendre que l’on jouit d’une bonne santé chez vous, chez M. Say, chez les Renouard, à Croissy, etc.
En arrivant ici, j’ai organisé une chasse aux ortolans. J’en partage le produit entre l’hôtel Saint-Georges et la rue Boursault.
Hier, pour mettre de l’ordre dans cette affaire de chasse, je suis allé passer la journée à la campagne, où j’ai vécu autrefois tantôt seul, tantôt entouré. Il y a une grande similitude entre ce pays-ci et celui que vous habitez : chaîné de coteaux, rivière au pied et plaines indéfinies au delà ; le village est au sommet du coteau, ma propriété sur la rive opposée au fleuve. Mais si l’art a plus fait sur les bords de la Seine, la nature est plus nature sur ceux de l’Adour. Il me serait impossible de vous dire l’impression que j’ai éprouvée en revoyant ces longues avenues de vieux chènes, cette maison aux appartements immenses, qui n’ont de meubles que les souvenirs, ces paysans aux vêtements de couleur tranchée, parlant une langue naïve que ne ne puis m’empêcher d’associer avec la vie des champs ; car il me semble toujours qu’un homme en blouse et en casquette, parlant français, n’est pas paysan pour de bon ; et puis ces rapports bienveillants de propriétaire à métayer me paraissent, par l’habitude, une autre condition indispensable pour constituer la vraie campagne. Quel ciel ! quelles nuits ! quelles ténèbres ! quel silence, interrompu seulement par l’aboiement lointain des chiens qui se répondent, ou par la note vibrante et prolongée que projette dans l’espace la voix mélancolique de quelque bouvier attardé ! Ces scènes parlent plus au cœur qu’aux yeux.
Mais me voici de retour au village. Le village ! c’est devenu un degré vers Paris. On y lit la gazette. On y dispute, selon le temps, sur Taïti, ou Saint-Jean d’Acre, sur Rome ou Comorn. [184] Je comptais sur les vacances pour calmer un peu les effervescences politiques ; mais voici que le souffle des passions se ranime. La France est de nouveau placée entre deux impossibilités. La république a été amenée par la ruse et la violence sur un terrain où le légitimisme la battra très-logiquement. Il est triste de penser que M. de Falloux est conséquent et que la France du xixe ne l’est pas. La population a pourtant du bon sens ; elle veut le bien et le comprend ; mais elle a désappris à agir par elle-même. Quelques mouches du coche parviennent toujours à la lancer dans des difficultés inextricables. Mais laissons ce triste sujet.
J’espérais avancer ici mon livre, [185] nouvelle déception. Du reste, je ne suis plus si pressé, car au lieu d’une actualité, il s’est transformé en un ouvrage de pure doctrine et ne pourra avoir d’effet, s’il en a, que sur quelques théoriciens. La véritable solution du problème social aurait besoin, tout en s’appuyant sur un gros livre, d’être propagée par un journal. J’ai quelque idée d’entreprendre une publication mensuelle comme celles de Lamartine et de Louis Blanc. Il me semble que notre doctrine gagnerait comme un incendie, ou plutôt comme une lumière, car elle n’a certes rien d’incendiaire. Partout où je la prêche, je trouve les esprits merveilleusement disposés à la recevoir. J’en ai fait l’expérience sur mes collègues du conseil général. Deux obstacles m’effrayent : la santé et le cautionnement. Nous en causerons bientôt, car j’ai l’espoir de passer avec vous la journée du 30 septembre.
Adieu, mon cher monsieur, si vous avez un moment à perdre, épargnez à ces dames la peine de m’écrire. Veuillez les assurer que le régime de privation où elles me tiennent ne me fait pas oublier leur bienveillance inépuisable.
F. Bastiat.
à M. Horace Say; Lettre du 16 septembre 1849 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.146] [OC7] 146. Mugron, 16 septembre 1849. A Horace Say
Voici nos vacances qui, à peine commencées, vont finir, terminer le gâchis catholique ? Hélas ! il est à craindre que nous ne fassions que le gâcher encore un peu plus. Nous voilà dans une impasse sans issue. La République, par la volonté du ministère et au mépris de l’assemblée nationale, s’est mise au service de l’inquisition. Il faut maintenant de deux choses l’une : ou qu’elle aille jusqu’au bout, se faisant plus jésuite que le jésuitisme, ou qu’elle revienne sur ses pas, donnant raison à la Constituante, brisant le ministère et la majorité actuelle, courant la chance du désordre intérieur et de la guerre universelle. Les principes sont, de même que l’honneur,
…comme une île escarpée et sans bords ;
On n’y peut plus rentrer dès qu’on en est dehors.
Et encore les difficultés politiques sont ce qui m’effraye le moins. Ce qu’il y a de désolant pour ce pays, c’est de voir tous les hommes en évidence sacrifier l’un après l’autre toute dignité morale et tout esprit de consistance. Il résulte de là que toute foi se perd dans la population, et qu’elle cède au plus irrémédiable des dissolvants, le scepticisme.
C’est pourquoi je voudrais que la solution du problème social, telle que la donne l’économie politique la plus sévère, c’est-à-dire le self-government, eût un organe spécial. Il faut soumettre cette idée au public : que l’État garantisse à chacun sa sécurité et qu’il ne se mêle pas d’autre chose. Une publication mensuelle qui aurait ce but et se distriburait, comme celles de L. Blanc et Lamartine, à six francs par an pourrait être un tirailleur utile auprès du Journal des économistes. Nous en causerons bientôt, car je compte partir de Bordeaux le 28, si j’ai place au courrier…
Letters to Cheuvreux Family: 18 septembre 1849, Mugron↩
BWV
[CW1.147] [CH] 147. Mugron, 18 septembre 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Il y a un fond de tristesse dans votre lettre, madame, c’est bien naturel. Vous veniez de perdre une amie d’enfance. Dans ces circonstances, le premier sentiment est celui du regret, ensuite on jette un regard troublé sur son entourage, et on finit par faire un retour sur soi-même ; l’esprit interroge le grand inconnu et, ne recevant aucune réponse, il s’épouvante ; c’est qu’il y a là un mystère qui n’est pas accessible à l’esprit, mais au cœur. — Peut-on douter sur un tombeau ? Madame, permettez-moi de vous rappeler que que vous n’avez pas le droit d’être longtemps triste. Votre âme est un diapazon pour tous ceux qui vous chérissent et vous être tenue d’être heureuse, sous peine de rendre malheureux votre mère, votre mari et cette délicieuse enfant que vous aimez tant que vous forceriez tout le monde à l’aimer, si elle n’y pourvoyait fort bien elle-même.
Mes idées ont pris la même direction, car nous avons aussi nos épreuves ; le choléra n’a pas visité ce pays, mais li y a envoyé un fâcheux émissaire : la femme de chambre de ma tante est gravement atteinte ; on espère pourtant la sauver ; du même coup il semble que ma tante a perdu vingt ans, car elle est sur pied nuit et jour. Pour moi, je m’humilie devant de tels dévouements, et je vous soutiendrai toujours, mesdames, que vous valez cent fois plus que nous. Il est vrai que je ne suis pas d’accord avec les autres économistes sur le sens du mot valeur. [186]
Vouliez-vous me railler, madame, en me reprochant de ne pas écrire ? — Cinq lettres en quatre semaines ! Mais qu’est donc devenue la précieuse missive dont vous me parlez ? Je ne me consolerais pas qu’elle fût définitivement égarée.
Quel sujet traitait M. Augier pour que vous ayez eu l’aimable attention de m’adresser son œuvre ? J’aime bien les vers du jeune poëte, et je me rappellerai la vive impression que nous avons ressentie à la lecture de son drame. [187] Enfin cette pièce pourra se retrouver ; il en a sans doute conservé la copie, et li voudra bien me la communiquer.
Mais votre lettre, celle de Mlle Louise sont-elles perdues pour toujours ? En ce cas serez-vous en état de me les réciter ? Soyez sûre que je vous le demanderai.
C’est samedi que je pars pour Bayonne ; je n’ai plus que quatre jours à rester ici. Quoique Mugron soit la monotonie réalisée, je regretterai ce séjour de calme, cette parfaite indépendance, cette libre disposition de tout mon temps, ces heures si semblables l’une à l’autre qu’on ne les distingue pas.
L’uniforme habitude
Qui lie au jour le jour ;
Point de gloire ou d’étude,
Rien que la solitude,
La prière et. . . .
Je n’achète pas le vers, car mon maître de littérature m’a appris qu’il ne fallait jamais sacrifier la raison à la rime.
Le 19. — Dans deux heures, j’irai moi-même à Tartas pour remettre au courrier les boîtes contenant des ortolans. Ils partiront jeudi matin et arriveront à Paris samedi ; si, par hasard, on ne les portait pas à l’hôtel Saint-Georges, il faudrait que vous prissiez la peine de faire passer à la poste ; car la ponctualité est nécessaire envers ces petites bêtes.
Je souhaite que mes compatriotes ne se laissent pas corrompre en route, et que vous n’ayez pas à répéter le mot de Faucher à propos des incompatibilités : « Que peut-il venir de bon des grandes Landes ? » Notre ami de Labadie est déjà une bonne protestation ; qu’en pensez-vous, mademoiselle Louise ? Puisque je m’adresse à vous, laissez-moi dire que mes pauvres oreilles sont ici comme dans le vide. Elles ont faim et soif de musique. Réservez-moi une jolie romance, tout ce qu’il y a de plus mineur. Ne voudrez-vous pas aussi perfectionner cette « Nuit des Tropiques » ? Elle finira par vous plaire.
De la musique aux Harmonies la transition est bien tentante. Mais comme il s’agit d’harmonies économiques, cela refroidit un peu. Aussi je ne vous en parlerai pas ; seulement je vous avouerai que mon livre, à cause des développements auxquels j’ai été entraîné, ne touchera plus que les hommes du métier ; je suis donc à peu près résolu, ainsi que je l’ai dit à M. Cheuvreux, à entreprendre une publication mensuelle. Je m’adresserai à vous pour placer des billets. En fait de journaux le placement importe au moins autant que la confection. C’est ce que nos confrères oublient trop. Il faudra que vous intéressiez les femmes à cette œuvre.
Adieu, madame, rappelez-moi au souvenir de M. Cheuvreux. Je ne suis pas surpris qu’il trouve que l’air de la Jonchère vaut mieux que celui de Vichy. Je prie Mlle Louise de me permettre le mot amitié. On est toujours embarrassé avec ces charmantes créatures ; hommages, c’est bien respectueux ; affection, c’est bien familier. Il y a de tout cela ; et on ne sait comment l’exprimer. Il faut qu’elles devinent un peu.
Votre bien dévoué,
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 7 octobre 1849, Paris↩
BWV
[CW1.148] [CH] 148. Paris, 7 octobre 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Il m’arrive ce matin de mes chères Landes une caisse que je suppose contenir des ortolans. Je vous l’envoie sans l’ouvrir. Si c’était des bas de laine ! Oh ! je serais bien confus ; mais en fin j’en serais quitte pour quelques plaisanteries. Hier soir, dans mon empressement et avec le tact qui me caractérise, je suis arrivé chez M. Say au beau milieu du dîner. Pour célébrer la réouverture des lundis, tous les amis se trouvaient là. L’entrain était grand à en juger par les éclats qui me parvenaient au salon. Le vestibule orné de nombreuses pelisses noires, blanches, roses, annonçait qu’il n’y avait pas que des économistes. Après le dîner je m’approche de la belle-sœur de M. D… et, sachant qu’elle arrivait de Belgique, je lui demande si ce voyage avait été agréable. Voici sa réponse : « Monsieur, j’ai éprouvé l’indicible bonheur de ne voir la figure d’aucun républicain parce que je les déteste. » La conversation ne pouvait se soutenir longtemps sur ce texte, je m’adresse donc à sa voisine, qui se met à me parler des douces impressions que lui avait fait éprouver le royalisme belge. « Quand le roi passe, disait-elle, tout est fête : cris de joie, devises, banderoles, rubans et lampions. » Je vois bien que pour ne pas trop déplaire aux dames il faut se hâter d’élire un roi. L’embarras est de savoir lequel, car nous en avons trois en perspective ; qui l’emportera (après une guerre civile) ?
Force m’a été de me réfugier vers les groupes masculins, car vraiment la passion politique grimace sur la figure des femmes. Ces messieurs mettaient leur scepticisme en commun. Fameux propagandistes qui ne croient pas à ce qu’ils prêchent. Ou, plutôt ils ne doutent pas, seulement ils affectent de douter. Dites-moi ce qu’il y a de pire, l’affectation du doute ou l’affectation de la foi ? Vraiment il faut que les économistes cessent cette comédie. Demain il y aura beaucoup de convives au dîner. J’y poserai la question d’un journal destiné à propager un principe absolu. Je regrette que M. Cheuvreux ne puisse être des nôtres. Quoiqu’en dissidence avec lui sur des faits particuliers, sur des appréciations d’hommes ou de circonstances, nous sommes d’accord sur les idées et le fond des choses. Il m’appuierait.
Adieu, madame ; permettez-moi de me dire le plus dévoué comme le plus respectueux de vos amis.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 8 octobre 1849, Paris↩
BWV
[CW1.149] [CH] 149. Paris, 8 octobre 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Le hasard fait que le journal des Landes indique la manière traditionnelle dans mon pays d’accompagner les orolans ; le seigneur Trompette ne se blessera pas, sans doute, si je lui adresse par votre intermédiaire un document aussi précieux. Hier, quand je fus porter ma boîte, rue Saint-Georges, M. Cheuvreux n’avait point paru, c’était pourtant jour d’audience. Aujourd’hui nous avions rendez-vous pour aller visiter le télégraphe électrique. Il ne vient pas, serait-il indisposé ?
La discussion sur le socialisme a été très-belle ; Ch. Dupin fort au-dessus de ce qu’on pouvait attendre. Dufaure admirable, la Montagne violente, insensée, ignorante. Quelle triste arène pour cette Chambre ! combien elle est au-dessous, pour les intentions, de la Constituante ! Alors l’immense majorité avait la passion du bien. À présent chacun ne rêve que de révolution et l’on n’est retenu que par le choix. Quoi qu’il en soit, la société progresse. Nul ne peut répondre des accidents particuliers, et je suis fâché que cela contrarie l’aimable Mme Alexandre, mais certainement le mouvement général est vers l’ordre et la sécurité.
Pour vous, mesdames, vous vous êtes préparé, à tout événement, des ressources de bonheur dans l’affection de ceux qui vous approchent, et la mère et la fille ne seront-elles pas toujours l’une pour l’autre des anges de consolation ?
Permettez-moi aussi d’espérer que vous compterez pour quelque chose l’inaltérable dévouement de votre respectueux ami.
F. Bastiat.
à M. et madame Schwabe: Lettre du 14 octobre 1849, Paris↩
BWV
[CW1.150] [OC7] 150. Paris, 14 octobre 1849. A Madame Schwabe
Ne craignez pas, Madame , que vos conseils m’importunent. Est-ce qu’ils ne prennent pas leur source dans l’amitié ? Est-ce qu’ils n’en sont pas le plus sûr témoignage ?…
C’est en vain que vous présentez l’avenir à mes yeux comme renfermant des chances d’un tardif bonheur. Il n’en est plus pour moi, même dans la poursuite, même dans le triomphe d’une idée utile à l’humanité ; car ma santé me condamne à détester le combat. Chère dame, je n’ai versé dans votre cœur qu’une goutte de ce calice d’amertume qui remplit le mien. Voyez, par exemple, quelle est ma pénible position politique, et vous jugerez si je puis accepter la perspective que vous m’offrez.
De tout temps j’ai eu une pensée politique simple, vraie, intelligible pour tous et pourtant méconnue. Que me manquait-il ? Un théâtre où je pusse l’exposer. La révolution de février est venue. Elle me donne un auditoire de neuf cents personnes, l’élite de la nation déléguée par le suffrage universel, ayant autorité pour la réalisation de mes vues — Ces neuf cents personnes sont animées des meilleures intentions. L’avenir les effraye. Elles attendent, elles cherchent une idée de salut. Elles font silence dans l’espoir qu’une voix va s’élever ; elles sont prêtes à s’y rallier. Je suis là ; c’est mon droit et mon devoir de parler. J’ai la conscience que mes paroles seront accueillies par l’Assemblée et retentiront dans les masses. Je sens l’idée fermenter dans ma tête et dans mon cœur et je suis forcé de me taire. Connaissez-vous une torture plus grande ? Je suis forcé de me taire, parce que c’est dans ce moment même qu’il a plu à Dieu de m’ôter toute force ; et quand d’immenses révolutions se sont accomplies pour m’élever une tribune, je ne puis y monter. Je me sens hors d’état non seulement de parler, mais même d’écrire. Quelle amère déception ! quelle cruelle ironie !
Depuis mon retour, pour avoir voulu seulement faire un article de journal, me voilà confiné dans ma chambre.
Ce n’est pas tout, un espoir me restait. C’était, avant de disparaître de ce monde, de jeter cette pensée sur le papier, afin qu’elle ne pérît pas avec moi. Je sais bien que c’est une triste ressource, car on ne lit guère aujourd’hui que les auteurs à grande renommée. Un froid volume ne peut certes pas remplacer la prédication sur le premier théâtre politique du monde. Mais enfin l’idée qui me tourmente m’aurait survécu. Eh bien ! la force d’écrire, de mettre en ordre un système tout entier, je ne l’ai plus. Il me semble que l’intelligence se paralyse dans ma tête. N’est-ce pas une affliction bien poignante ?
Mais de quoi vais-je vous entretenir ? Il faut que je compte bien sur votre indulgence. C’est que j’ai si longtemps renfermé mes peines en moi-même, qu’en présence d’un bon cœur je sens toutes mes confidences prêtes à s’échapper.
Je voudrais envoyer à vos chers enfants un petit ouvrage français plein d’âme et de vérité, qui a fait le charme de presque toutes les jeunes générations françaises. Il fut mon compagnon d’enfance ; plus tard, il n’y a pas bien longtemps encore, dans les soirées d’hiver, une femme, ses deux enfants et moi nous mêlions nos larmes à cette lecture. — Malheureusement M. Héron est parti ; je ne sais plus comment m’y prendre. J’essaierai de le faire parvenir à M. Faulkner de Folkestone.
Adieu, chère dame, je suis forcé de vous quitter. Quoique souffrant, il faut que j’aille défendre la cause des Noirs dans un de nos comités, sauf à regagner ensuite mon seul ami, l’oreiller.
à Richard Cobden: Lettre du 17 octobre 1849, Paris ↩
BWV
[CW1.151] [OC1] 151. Paris, 17 octobre 1849. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, vous ne devez pas douter de mon empressement à assister au meeting du 30 octobre, si mes devoirs parlementaires n’y font pas un obstacle absolu. Avoir le plaisir de vous serrer la main et être témoin du progrès de l’opinion en Angleterre, en faveur de la paix, ce sera pour moi une double bonne fortune. Il me sera bien agréable aussi de remercier M. B. Smith [188] de sa gracieuse hospitalité, que j’accepte avec reconnaissance.
Vous sentez que je ferai tous mes efforts pour entraîner notre excellent ami M. Say. Je crains que ses occupations du conseil d’État ne le retiennent. Je tiendrais d’autant plus à l’avoir pour compagnon de voyage que sa foi n’est pas entière à l’endroit du congrès de la paix. Le spectacle de vos meetings ne pourra que retremper sa confiance. Je le verrai ce soir.
Mon ami, les nations comme les individus subissent la loi de la responsabilité. L’Angleterre aura bien de la peine à faire croire à la sincérité de ses efforts pacifiques. Pendant longtemps, pendant des siècles peut-être, on dira sur le continent : L’Angleterre prêche la modération et la paix ; mais elle a cinquante-trois colonies et deux cents millions de sujets dans l’Inde. — Ce seul mot neutralisera beaucoup de beaux discours. Quand est-ce que l’Angleterre sera assez avancée pour renoncer volontairement à quelques-unes de ses onéreuses conquêtes ? ce serait un beau moyen de propagande.
Croyez-vous qu’il fût imprudent ou déplacé de toucher ce sujet délicat ?
à Richard Cobden: Lettre du 24 octobre 1849, Paris ↩
BWV
[CW1.152] [OC1] 152. Paris, 24 octobre 1849. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, Say a dû vous écrire que nous nous proposions de partir dimanche soir, pour être à Londres lundi matin. Il amène avec lui son fils. Quant à Michel Chevalier, il est toujours dans les Cévennes.
Mais voici une autre circonstance. Le beau-frère de M. Say, M. Cheuvreux, qui était absent quand nous fûmes passer une journée chez lui à la campagne, et qui a bien regretté d’avoir perdu cette occasion de faire votre connaissance, a le projet de se réunir à nous. Il désire d’ailleurs ardemment assister au mouvement de l’opinion publique de l’Angleterre, en faveur de la paix et du désarmement. Mais tenant à ne pas me séparer de M. Cheuvreux, je me vois forcé d’écrire à M. Smith pour lui témoigner toute ma reconnaissance et lui expliquer les motifs qui me mettent dans l’impossibilité de profiter de sa généreuse hospitalité.
Pendant que j’écris, on discute l’abrogation des lois de proscription. Je crains bien que notre Assemblée n’ait pas le courage d’ouvrir les portes de la France aux dynasties déchues. À mon avis, cet acte de justice consoliderait la république.
Letters to Cheuvreux Family: Novembre 1849, Paris↩
BWV
[CW1.153] [CH] 153. Paris, novembre 1849. A Madame Cheuvreux
Madame,
Voici un document qui vous intéressera. Pour moi, je n’ai pu le lire sans être touché jusqu’aux larmes (nature de montagne n’est pas toujours nature de rocher ) ; pour faire partager mes impressions, à qui m’adresser, si ce n’est à vous ?
Je vais être obligé de discuter l’opinion de mes amis, cela me coûte. Mais je ne sais quel Grec disait : « J’aime Platon, mais j’aime mieux la vérité. » Il me semble à présent indubitable que l’économie politique a ouvert la porte au communisme ; c’est à elle à la fermer.
Si vous avez cinq minutes à perdre, oserais-je vous prier de me donner des nouvelles du trio ?
Votre bien dévoué,
F. Bastiat.
à M. Domenger: Lettre du 13 novembre 1849, Paris↩
BWV
[CW1.154] [OC7] 154. Paris, 13 novembre 1849. A M. Domenger
La Haute-Cour de Versailles vient de prononcer son verdict. On ne le connaît pas encore dans tous ses détails, on sait seulement que onze prévenus, dont un représentant, ont été acquittés. Tous les autres représentants sont condamnés à la déportation, ainsi que Guinard. Je n’ai pas assez suivi les débats pour avoir une opinion. Je m’incline devant la justice et regrette seulement que la défense ait été circonscrite dans ses moyens. C’est toujours un fâcheux précédent. — L’autorité de la cause jugée n’y gagne pas.
Vous avez sans doute appris mon rapide voyage en Angleterre. Parti le lundi soir après la séance, j’étais de retour le samedi matin ; et pendant quatre jours je n’ai vu que grandes choses et grands hommes, du moins selon mon jugement.
En arrivant, j’ai reçu une sorte de cartel fort courtois des socialistes. Il s’agit de discuter à fond devant le public ouvrier, et contre Proudhon, la question de savoir si l’intérêt des capitaux est légitime : question plus difficile et plus dangereuse que celle de la propriété, en ce qu’elle est plus générale. J’ai cru pouvoir faire quelque bien en acceptant la lutte.
À ce propos, je vous dirai, mon cher Domenger, que les électeurs landais pourront bien se lasser de mon inaction apparente. Il est vrai que j’ai le travail capricieux ; il faut me prendre avec mes défauts. Mais je crois sincèrement que le danger actuel n’est ni au pouvoir ni à l’Assemblée ; il est dans les égarements de l’opinion populaire. C’est aussi de ce côté que je porte mes faibles efforts. Je souhaite que le bon sens de nos compatriotes leur fasse comprendre que chacun a sa mission en ce monde et que je remplis la mienne.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 13 décembre 1849 (Paris) ↩
BWV
[CW1.155] [OC1] 155. Paris, 13 décembre 1849. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, c’est une chose triste que notre correspondance se soit ainsi ralentie. Ne va pas en conclure, je t’en prie, que ma vieille amitié pour toi se soit refroidie ; au contraire, il semble que le temps et la distance, ces deux grands poëtes, prêtent un charme au souvenir de nos promenades et de nos conversations. Bien souvent je regrette Mugron, et son calme philosophique, et ses loisirs féconds. Ici, la vie s’use à ne rien faire, ou du moins à ne rien produire.
Hier, j’ai parlé dans la discussion des boissons. Comme j’use rarement de la tribune, j’ai voulu y poser nos idées. Avec un peu de persévérance, on les ferait triompher. Il faut bien qu’on les ait jugées dignes d’examen, puisque l’assemblée tout entière les a écoutées avec recueillement, sans qu’on puisse attribuer ce rare phénomène au talent ou à la renommée de l’orateur. Mais ce qui est affligeant, c’est que ces efforts sont perdus pour le public, grâce à la mauvaise constitution de la presse périodique. Chaque journal m’endosse ses propres pensées. S’ils se bornaient à défigurer, ridiculiser, j’en prendrais mon parti ; mais ils me prêtent les hérésies mêmes que je combats. Que faire ? — Au reste, je t’envoie le Moniteur ; amuse-toi à comparer.
Je n’ai pas dit tout ce que je voulais dire, ni comme je voulais le dire : notre volubilité méridionale est un fléau oratoire. Quand la phrase est finie, on pense à la manière dont la phrase eût dû être tournée. Cependant le geste, l’intonation et l’action aidant, on se fait comprendre des auditeurs. Mais cette parole sténographiée n’est plus qu’un tissu lâche ; moi-même je n’en puis supporter la lecture.
Nous sommes vraiment ici over-worked, comme disent les Anglais. Ces longues séances, bureaux, commissions, tout cela assomme sans profit. Ce sont dix heures perdues qui font perdre le reste de la journée ; car (au moins aux têtes faibles) elles suffisent pour ôter la faculté du travail. Aussi quand pourrai-je faire mon second volume, sur lequel je compte bien plus pour la propagande que sur le premier ? Je ne sais si on reçoit à Mugron la Voix du Peuple. Le socialisme s’est renfermé aujourd’hui dans une formule, la gratuité du crédit. Il dit de lui-même : Je suis cela ou je ne suis rien. Donc, c’est sur ce terrain que je l’ai attaqué dans une série de lettres auxquelles répond Proudhon. Je crois qu’elles ont fait un grand bien en désillusionnant beaucoup d’adeptes égarés. Mais voici qui t’étonnera : la classe bourgeoise est si aveugle, si passionnée, si confiante dans sa force naturelle, qu’elle juge à propos de ne pas m’aider. Mes lettres sont dans la Voix du peuple, cela suffit pour qu’elles soient dédaignées de ces messieurs ; comme si elles pouvaient faire du bien ailleurs. Eh ! quand il s’agit de ramener les ouvriers, ne vaut-il pas mieux dire la vérité dans le journal qu’ils lisent ?
Mardi, je commence mon cours à la jeunesse des écoles. Tu vois que la besogne ne manque pas ; et, pour m’arranger, ma poitrine subit un traitement qui me prend deux heures tous les jours. Il est vrai que je m’en trouve à merveille.
Je ne te parle que de moi, mon cher Félix, imite cet exemple, et parle-moi beaucoup de toi. Si tu voulais suivre mon conseil, je t’engagerais fortement à faire quelque chose d’utile ; par exemple, une série de petits pamphlets. Ils sont longs à pénétrer dans les masses, mais ils finissent par faire leur œuvre.
à M. Domenger: Lettre du 25 décembre 1849, Paris↩
BWV
[CW1.156] [OC7] 156. Paris, 25 décembre 1849. A M. Domenger
Je ne puis vous écrire que quelques mots, car mon rhume m’a mis sur le flanc. Je vous assure qu’il me rend l’existence pénible.
L’affaire de l’hospice est de celles pour lesquelles je me décide à aller m’égarer dans le labyrinthe des bureaux. Hier je me suis assuré que l’approbation de l’échange ne rencontrerait aucune difficulté, et le décret qui l’autorise a été rédigé sous mes yeux. Mais il ne peut être porté à l’Élysée pour la signature que sur l’avis du Conseil d’État. Un de mes amis m’a promis de faire expédier cette affaire le plus tôt possible.
Quant à la subvention, vous aurez quelque chose, mais non 1,000 francs. Le fonds à ce destiné n’est que de 300,000 francs pour toute la France, et les besoins sont illimités, de telle sorte que chaque année dévore d’avance l’allocation de l’année suivante : — je persiste à croire qu’il vaudrait mieux que le gouvernement ne se mêlât pas de cela, puisque aussi bien il met une foule d’employés en mouvement pour aboutir à une mystification.
Et n’est-ce pas une chose bien ridicule que Mugron et M. Lafaurie ne puissent échanger leurs maisons sans l’avis du Conseil d’État et la permission du prisonnier de Ham ? Vraiment la France se crée des embarras et des entraves pour avoir le plaisir d’en faire les frais.
Il m’est impossible de vous envoyer ma polémique avec Proudhon, car je n’ai pas conservé les numéros de la Voix du Peuple où sont nos lettres ; mais on m’assure qu’elles vont être recueillies en un volume que je vous ferai adresser. C’est du reste assez ennuyeux.
à Richard Cobden: Lettre du 31 décembre 1849, Paris ↩
BWV
[CW1.157] [OC1] 157. Paris, 31 décembre 1849. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, je suis enchanté du meeting de Bradford, et je vous félicite sincèrement d’avoir abordé enfin la question coloniale. Je sais que ce sujet vous a toujours paru délicat ; il touche aux fibres les plus irritables des cœurs patriotiques. Renoncer à l’empire du quart du globe ! Oh ! jamais une telle preuve de bon sens et de foi dans la science n’a été donnée par aucun peuple ! Il est surprenant qu’on vous ait laissé aller jusqu’au bout. Aussi ce que j’admire le plus dans ce meeting, ce n’est pas l’orateur (permettez-moi de le dire), c’est l’auditoire. Que ne ferez-vous pas avec un peuple qui analyse froidement ses plus chères illusions et qui souffre qu’on recherche devant lui ce qu’il y a de fumée dans la gloire !
Je me rappelle vous avoir témérairement insinué, dans le temps, le conseil de diriger vos coups sur le régime colonial avec lequel le free-trade est incompatible. Vous me répondîtes que l’orgueil national est une plante qui croît dans tous les pays et surtout dans le vôtre ; qu’il ne fallait pas essayer de l’extirper brusquement et que le free-trade en rongerait peu à peu les racines. Je me rendis à cette observation de bon sens pratique, tout en déplorant la nécessité qui vous fermait la bouche ; car je savais bien une chose, c’est que tant que l’Angleterre aurait quarante colonies, jamais l’Europe ne croirait à la sincérité de sa propagande. Pour mon compte, j’avais beau dire : « Les colonies sont un fardeau, » cela paraissait une assertion aussi paradoxale que celle-ci : « C’est un grand malheur pour un gentleman d’avoir de belles fermes. » Évidemment il faut que l’assertion et la preuve viennent de l’Angleterre elle-même. En avant donc, mon cher Cobden, redoublez d’efforts, triomphez, affranchissez vos colonies, et vous aurez réalisé la plus grande chose qui se soit faite sous le soleil, depuis qu’il éclaire les folies et les belles actions des hommes. Plus la Grande-Bretagne s’enorgueillit de son colosse colonial, plus vous devez montrer ce colosse aux pieds d’argile dévorant la substance de vos travailleurs. Faites que l’Angleterre, librement, mûrement, en toute connaissance de cause, dise au Canada, à l’Australie, au Cap : « Gouvernez-vous vous-mêmes ; » et la liberté aura remporté sa grande victoire, et l’économie politique en action sera enseignée au monde.
Car il faudra bien que les protectionnistes européens ouvrent enfin les yeux.
D’abord ils disaient : « L’Angleterre admet chez elle les objets manufacturés. Belle générosité, puisqu’elle a à cet égard une supériorité incontestable ! Mais elle ne retirera pas la protection à l’agriculture, parce que, sous ce rapport, elle ne peut soutenir la concurrence des pays où le sol et la main-d’œuvre sont pour rien. » Vous avez répondu en affranchissant le blé, les bestiaux et tous les produits agricoles.
Alors ils ont dit : « L’Angleterre joue la comédie ; et la preuve, c’est qu’elle ne touche pas à ses lois de navigation, car l’empire des mers c’est sa vie. » Et vous avez réformé ces lois, non pour perdre votre marine, mais pour la renforcer.
Maintenant ils disent: « L’Angleterre peut bien décréter la liberté commerciale et maritime, car, par ses quarante colonies, elle a accaparé les débouchés du monde. Elle ne portera pas la main sur son système colonial. » Renversez le vieux système, et je ne sais plus dans quelle prophétie les protectionnistes devront se réfugier. À propos de prophétie, j’ai osé en faire une il y a deux ans. C’était à Lyon, devant une nombreuse assemblée. Je disais : « Avant dix ans, l’Angleterre abattra elle-même volontairement le régime colonial. » Ne me faites pas passer ici pour un faux prophète.
Les questions économiques s’agitent en France comme en Angleterre, mais dans une autre direction. On remue tous les fondements de la science. Propriété, capital, tout est mis en question ; et, chose déplorable, les bonnes raisons ne sont pas toujours du côté de la raison. Cela tient à l’universelle ignorance en ces matières. On combat le communisme avec des arguments communistes. Mais enfin, l’intelligence si vive de ce pays est à l’œuvre. Que sortira-t-il de ce travail ? du bien pour l’humanité sans doute, mais ce bien ne sera-t-il pas chèrement acheté ? Passerons-nous par la banqueroute, par les assignats, etc. ? that is the question.
Vous aurez été surpris, sans doute, de me voir publier en ce moment un livre de pure théorie ; et j’imagine que vous ne pourrez en soutenir la lecture. Je crois cependant qu’il aurait de l’utilité dans ce pays, si j’avais songé à faire une édition à bon marché et surtout si j’avais pu enfanter le second volume. Ma non ho fiato, au physique comme au moral, le souffle me manque.
J’ai envoyé un exemplaire de ce livre à M. Porter. Mon ami, nos renommées sont comme nos vins ; les uns comme les autres ont besoin de traverser la mer pour acquérir toute leur saveur. Je voudrais donc que vous me fissiez connaître quelques personnes à qui je pourrais adresser mon volume, afin que, par votre bonne influence, elles en rendissent compte dans les journaux. Il est bien entendu que je ne quête pas des éloges, mais la consciencieuse opinion de mes juges.
Articles and Essays↩
Le Capital [1849] ↩
BWV
1849.?? “Le capital” (Capital) [*Almanach Républicain pour 1849* (Paris: Pagnerre, 1849). [OC7.64, pp. 248-55.]
Le Capital [1]
Qui ne se rappelle le frisson d’épouvante qui fit tressaillir l’Europe stupéfaite, lorsque des voyageurs, revenant de pays lointains, jetèrent à ses oreilles cette nouvelle : « L’Inde a vomi sur le monde le choléra-morbus ! Il grandit, il s’étend, il s’avance, décimant les populations sur son passage, et notre civilisation ne l’arrêtera pas. »
Serait-il vrai que la civilisation à son tour, jalouse de la barbarie, eût enfanté un fléau mille fois plus terrible, un monstre dévorant, un cancer s’attaquant à ce qu’il y a de plus sacré, au travail, cet aliment de la vie des peuples, un tyran implacable toujours occupé à creuser entre les hommes le gouffre de l’inégalité, à appauvrir le pauvre pour enrichir le riche, à semer sur ses pas la misère, l’exténuation, la faim, l’envie, la rage et l’émeute, à remplir incessamment les bagnes, les prisons, les hospices et les tombeaux, fléau plus funeste dans son action continue et éternelle que le choléra et la peste, le capital, puisqu’il faut l’appeler par son nom !
En vérité, les hommes ne sont pas près de s’entendre, car ce même Capital que les uns peignent sous des couleurs si odieuses, d’autres, et je suis du nombre, en font le pain des pauvres, l’universel agent de l’égalité, l’instigateur du progrès, le libérateur des classes laborieuses et souffrantes.
Qui a tort, qui a raison ? Ce n’est pas une question de pure curiosité, car enfin, si le capital est un fléau destructeur, nous devons nous ranger dans les rangs nombreux de ceux qui lui font une guerre acharnée. Si, au contraire, il est le bienfaiteur de l’humanité, cette guerre insensée a cela d’étrange que les assaillants se portent à eux-mêmes tous les coups qu’ils dirigent contre lui.
Qu’est-ce donc que le capital ? Quelle est son origine ? Quelle est sa nature? Quelle est sa mission ? Quels sont ses éléments ? Quels sont ses effets ?
Les uns disent : C’est le sol, cette source de toute richesse, qui a été accaparé par quelques-uns. D’autres disent : C’est l’argent, ce vil métal objet de tant de sales cupidités qui ensanglantent la terre depuis qu’elle est habitée.
Assistons à la naissance, à la première formation du capital ; c’est le moyen de nous en faire une idée juste.
Quand ce héros pacifique éternellement chéri de toutes les générations d’enfants, Robinson Crusoé, se trouva jeté par la tempête sur une île déserte, le besoin le plus impérieux de notre fragile nature le força à poursuivre, au jour le jour, la proie qui devait l’empêcher de mourir. Il aurait bien voulu construire une hutte, clore un jardin, réparer ses vêtements, fabriquer des armes ; mais il s’apercevait que, pour se livrer à ces travaux, il faut des matériaux, des instruments, et surtout des provisions, car nos besoins sont gradués de telle sorte qu’on ne peut travailler à satisfaire les uns que lorsqu’on a accumulé de quoi satisfaire les autres. Eût-il vécu pendant l’éternité tout entière, jamais Robinson n’aurait pu entreprendre la construction d’une hutte ou la confection d’un outil, s’il n’avait préalablement mis en réserve ou épargné du gibier ou du poisson.
C’est pourquoi il se disait souvent : Je suis le plus grand propriétaire du monde et le plus misérable des hommes. Le sol n’est pas pour moi un capital. J’aurais sauvé du naufrage un sac de louis que je n’en serais pas plus avancé, l’argent ne serait pas pour moi un capital. Mon travail unique et forcé, c’est la chasse. La seule chose qui pourrait me permettre de passer à d’autres occupations, ce serait de prendre chaque jour un peu plus de gibier qu’il ne m’en faut pour la journée, et d’avoir ainsi des provisions. Pendant que je vivrais sur ces provisions, je pourrais fabriquer des armes qui rendraient ma chasse plus productive, me permettraient d’augmenter mes provisions, et mettraient mon temps en disponibilité pour des travaux de plus longue haleine. Je vois bien que le premier des capitaux, ce sont les provisions, le second, les instruments.
Matériaux, instruments, provisions, voilà le capital de l’homme isolé, trois choses sans lesquelles il est enchaîné à la poursuite de la pure subsistance, trois choses sans lesquelles il n’y a pour lui ni travail ultérieur, ni par conséquent progrès possible, trois choses qui supposent que sa consommation a pu être moindre que sa production, qu’une réserve, une épargne a pu être réalisée.
Et voilà aussi, pour l’homme en société, la vraie définition du capital. Le capital d’une nation, c’est la totalité de ses matériaux, provisions et instruments.
Quand je parle des matériaux, je désigne ceux qui sont le fruit du travail et de l’épargne. Sans cette condition, ils n’appartiennent à personne. Sous cette condition, ils appartiennent naturellement à ceux qui les ont produits, et qui, pouvant les consommer, se sont abstenus.
Pour faire quoi que ce soit en ce monde, il faut dans une mesure quelconque une ou deux de ces choses ou les trois réunies. Comment pourrions-nous bâtir, construire, labourer, tisser, filer, forger, lire, étudier, si, par le travail et l’épargne, nous n’avions acquis des matériaux, des instruments et, en tout cas, quelques provisions ?
Quand, pendant son travail actuel, un homme consomme du capital qu’il a lui-même formé, on peut le considérer comme réunissant toutes les qualités de producteur, consommateur, prêteur, emprunteur, débiteur, créancier, capitaliste, ouvrier ; et, le phénomène économique s’accomplissant tout entier dans un seul individu, le mécanisme en est d’une simplicité extrême, ainsi que nous le montre l’exemple de Robinson.
Mais, si cet homme use des matériaux, instruments et provisions travaillés et épargnés par autrui, le phénomène se complique. Il ne les obtient qu’à la suite d’une transaction, et cette transaction stipule toujours une rémunération en faveur du prêteur. Celui qui emprunte ainsi, pour un an, par exemple, les trois choses sans lesquelles il ne pourrait rien faire et mourrait de faim, doit-il autre chose que la simple et intégrale restitution des objets empruntés ? L’affirmative me paraît incontestable, et elle a été telle pour tous les hommes depuis le commencement du monde jusqu’à Proudhon. En effet, si Robinson se prive aujourd’hui d’une partie de sa nourriture, s’il met du gibier de côté, afin de pouvoir se livrer demain à un travail plus profitable que la chasse, et si Vendredi lui emprunte ce gibier, il est clair qu’il ne pourra l’obtenir moyennant la simple restitution, à moins que, pour rendre service, Robinson ne veuille s’infliger à lui-même un dommage. La base de la transaction sera celle-ci :
Robinson prêtera, s’il calcule que sa journée du lendemain employée à la chasse, plus la rétribution stipulée, lui vaudront mieux que le travail qu’il se proposait de faire.
Vendredi empruntera, s’il calcule que le travail auquel cet emprunt lui permet de se livrer, déduction faite de la rétribution stipulée, lui vaudra encore mieux que celui auquel il serait réduit sans cet emprunt.
Ainsi on peut affirmer qu’il y a dans le capital le principe d’une rémunération. Puisqu’il est avantageux à celui qui l’a formé, celui-ci ne peut être justement tenu de le céder sans compensation.
Cette compensation prend des noms fort divers selon la nature de l’objet prêté. Si c’est une maison, on l’appelle loyer ; si c’est une terre, fermage, etc.
Dans les sociétés compliquées, il est rare que le prêteur ait justement la chose dont l’emprunteur a besoin. C’est pourquoi le prêteur convertit son capital (matériaux, instruments et provisions) en numéraire, et il prête l’argent à l’emprunteur qui peut alors se procurer le genre de matériaux, instruments et provisions qui lui sont nécessaires. La rétribution du capital prêté sous cette forme s’appelle intérêt.
Comme la plupart des prêts exigent pour la commodité, cette double conversion préalable du capital en numéraire et du numéraire en capital, on a fini par confondre le capital avec le numéraire. C’est une des plus funestes erreurs en économie politique.
L’argent n’est qu’un moyen de faire passer les choses, les réalités, d’une main à l’autre. Aussi, souvent de simples billets, de simples revirements de comptes suffisent. Combien donc ne se fait-on pas illusion, quand on croit augmenter les matériaux, les instruments et les provisions du pays en augmentant l’argent et les billets !
Naturellement nous venons tous au monde sans capital, ce que l’on est trop porté à oublier. Les uns en reçoivent beaucoup de leur père, les autres un peu, d’autres pas du tout.
Ces derniers seraient comme Robinson dans son île, si personne avant eux et autour d’eux n’avait travaillé et épargné.
Ils sont donc forcés d’emprunter, ce qui, nous l’avons vu, signifie travailler sur des matériaux, avec des instruments, et en vivant de provisions que d’autres ont produites et épargnées, — et en payant pour cela une rétribution.
Cela posé, quel est leur intérêt ? C’est que cette rétribution leur soit aussi peu onéreuse que possible ; c’est-à-dire que la part à céder sur le travail pour l’usage du capital se restreigne dans des limites de plus en plus étroites. Plus sera réduite, en effet, cette part que le capitaliste prélève sur le prolétaire, plus celui-ci sera en mesure d’épargner à son tour, de former du capital.
Oui, que le prolétaire le sache et qu’il en reste bien convaincu, son intérêt, son intérêt dominant et fondamental, c’est que le capital abonde autour de lui, c’est que le pays regorge de matériaux, d’instruments et de provisions, car ces choses aussi se font concurrence entre elles. Plus il y en a dans le pays, moins on exige de rétribution de ceux à qui on les prête. Le prolétaire est intéressé à pouvoir mettre ses bras aux enchères, à pouvoir quitter un capitaliste exigeant pour un autre plus facile.
Quand les capitaux abondent, le salaire hausse : cela est aussi sûr qu’il est sûr que le plateau d’une balance baisse quand on y jette des poids.
Prolétaires, ne vous en laissez pas imposer. Rien n’est plus beau, plus doux que la fraternité. Elle peut guérir bien des maux partiels, jeter du baume sur bien des plaies. Mais ce qu’elle ne peut faire, c’est de hausser le taux général des salaires. Non, elle ne peut pas le faire, parce que ni les mots, ni les sentiments, ni les vœux ne peuvent faire qu’une quantité donnée d’instruments et de matériaux donne plus d’ouvrage, qu’une quantité donnée de provisions donne à chacun une part plus grande.
On vous dit que le capital tire à lui le plus clair des profits. Oui, quand il est rare ; non, quand il est abondant.
On vous dit que le capital fait concurrence au travail : c’est plus qu’une erreur, c’est une absurdité ridicule. L’abondance des instruments et des matériaux ne peut nuire au travail ; l’abondance des provisions ne peut irriter les besoins.
Les travailleurs se font concurrence entre eux ; le travail se fait concurrence à lui-même.
Les capitalistes se font concurrence entre eux ; le capital se fait concurrence à lui-même.
Voilà la vérité. Mais dire que le capital fait concurrence au travail, c’est dire que le pain fait concurrence à la faim, que la lumière fait obstacle à la vue.
Et s’il est vrai, prolétaires, que vous n’ayez qu’une planche de salut, qui est l’accroissement indéfini du capital, l’accumulation incessante des matériaux, instruments et provisions, que devez-vous désirer ?
C’est que la société soit dans les conditions les plus favorables à cet accroissement, à cette accumulation.
Quelles sont ces conditions ?
La première de toutes c’est la sécurité. Si les hommes ne sont pas sûrs de jouir du fruit de leur travail, ils ne travaillent pas, ils n’accumulent pas. Dans un régime d’incertitude et de frayeur, le capital ancien se cache, se dissipe ou déserte, le capital nouveau ne se forme pas. La masse des provisions s’ébrèche, la part de chacun diminue, à commencer par la vôtre. Demandez donc au gouvernement sécurité, et aidez-le à la fonder.
La seconde c’est la liberté. Quand on ne peut travailler librement, on travaille moins, la part de l’épargne est moindre, le capital ne s’accroît pas en proportion du nombre des bras, le salaire baisse et la misère vous décime. Alors, la charité elle-même est un vain remède, sinon pour quelques individus, au moins pour les masses ; car, si elle a des mérites immenses, elle n’a pas, comme le travail, celui de multiplier les pains.
La troisième c’est l’économie. Quand toutes les épargnes annuelles d’une nation sont dissipées par les folies de son gouvernement ou par le luxe des particuliers, le capital ne peut grossir.
Français, faut-il le dire ? notre chère patrie brille aux yeux des peuples par des qualités éminentes ; mais ce n’est pas parmi nous qu’il faut chercher ces trois conditions essentielles pour la formation des capitaux : sécurité, liberté, économie. C’est là, et là seulement, qu’est la cause du paupérisme.
FN: Almanach républicain pour 1849, 1 vol. in- 32, Paris, Pagnerre.
N’oublions pas qu’à cette époque des voix retentissantes prodiguaient au capital les épithètes d’infâme et d’infernal.(Note de l’édit.)
De la séparation du temporel et du spirituel [1849] [CW1.4.22]↩
BWV
1849.?? “De la séparation du temporel et du spirituel” (On the Separation of Temporal and Spiritual Powers) [extract from one of Bastiat’s notebooks was probably written in 1849.] [OC7.80, p. 357] [CW1]
De la séparation du temporel et du spirituel. [189] (Ébauche inédite)
Les affaires de Rome ont-elles une solution possible ? — Oui. — Laquelle? — Qu’il se rencontre un pape qui dise :
« Mon royaume n’est pas de ce monde. » — Vous croyez que ce serait la solution de la question romaine ? — Oui, et de la question catholique et de la question religieuse.
Si, en 1847, quelqu’un eût proposé d’anéantir la Charte et d’investir Louis-Philippe du pouvoir absolu, c’eût été contre une telle proposition une clameur générale.
Si, de plus, on eût proposé de remettre à Louis-Philippe, outre le pouvoir temporel, la puissance spirituelle, la proposition n’eût pas succombé sous les clameurs, mais sous le dédain.
Pourquoi cela ? Parce que nous trouvons que le droit de gouverner les actes est déjà bien grand, et qu’il n’y faut pas joindre encore celui de régenter les consciences.
Mais quoi ! à celui qui a le pouvoir temporel donner la puissance spirituelle, ou bien à celui qui est le chef spirituel accorder le pouvoir temporel, est-ce donc bien différent ? et le résultat n’est-il pas absolument le même ?
Nous nous ferions hacher plutôt que de nous laisser imposer une telle combinaison ; et nous l’imposons aux autres !
Dialogue.
— Mais, enfin, cet ordre de choses que vous critiquez a prévalu pendant des siècles.
— C’est vrai ; mais il a fini par révolter les Romains.
— Ne me parlez pas des Romains. Ce sont des brigands, des assassins, des hommes dégénérés, sans courage, sans vertu, sans bonne foi, sans lumières ; et je ne puis comprendre que vous preniez leur parti contre le Saint-Père.
— Et moi, je ne puis comprendre que vous preniez le parti d’une institution qui a fait un peuple tel que vous le décrivez.
Le monde est plein d’honnêtes gens qui voudraient être catholiques et ne le peuvent pas. Hélas ! c’est à peine s’ils osent le paraître.
Et ne pouvant pas être catholiques, ils ne sont rien. Ils ont au cœur une racine de foi ; mais ils n’ont pas de foi. Ils soupirent après une religion, et n’ont pas de religion.
Ce qu’il y a de pire, c’est que cette désertion s’accroît tous les jours ; elle pousse tous les hommes hors de l’Église, à commencer par les plus éclairés.
Ainsi la foi s’éteint sans que rien la remplace ; et ceux mêmes qui, par politique, ou effrayés de l’avenir, défendent la religion, n’ont pas de religion. — À tout homme que j’entends déclamer en faveur du catholicisme, j’adresse cette question : « Vous confessez-vous ? » — Et il baisse la tête.
Certes, c’est là un état de choses qui n’est pas naturel.
Quelle en est la cause ?
Je le dirai franchement : selon moi, elle est toute entière dans l’union des deux puissances sur la même tête.
Dès le moment que le clergé a le pouvoir politique, la religion devient pour lui un instrument politique. Le clergé ne sert plus la religion ; c’est la religion qui sert le clergé.
El bientôt le pays est couvert d’institutions dont le but, religieux en apparence, est intéressé en fait.
Et la religion est profanée.
Et nul ne veut jouer ce rôle ridicule de laisser exploiter jusqu’à sa conscience.
Et le peuple repousse ce qu’il y a en elle de vrai avec ce qui s’y est mêlé de faux.
Et alors le temps est venu où le prêtre a beau crier : « Soyez dévots, » on ne veut pas même être pieux.
Supposons que les deux puissances fussent séparées.
Alors la religion ne pourrait procurer aucun avantage politique.
Alors le clergé n’aurait pas besoin de la surcharger d’une foule de rites, de cérémonies propres à étouffer la raison.
Et chacun sentirait reverdir au fond de son cœur cette racine de foi qui ne se dessèche jamais entièrement.
Et les formes religieuses n’ayant plus rien de dégradant, le prêtre n’aurait plus à lutter contre le respect humain.
Et la fusion de toutes les sectes chrétiennes en une communion ne rencontrerait plus d’obstacles.
Et l’histoire de l’humanité ne présenterait pas une plus belle révolution.
Mais le sacerdoce serait l’instrument de la religion, la religion ne serait pas l’instrument du sacerdoce.
Tout est là.
Un des plus grands besoins de l’homme, c’est celui de la morale. Comme père, comme époux, comme maître, comme citoyen, l’homme sent qu’il n’a aucune garantie, si la morale n’est un frein pour ses semblables.
Ce besoin généralement senti, il se trouve toujours des gens disposés à le satisfaire.
À l’origine des sociétés, la morale est renfermée dans une religion. La raison en est simple. La morale proprement dite serait obligée de raisonner ; on a droit de mettre ses maximes en quarantaine. En attendant le monde... [190] La religion va au plus pressé. Elle parle avec autorité. Elle ne conseille pas, elle impose. « Tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas. » — Pourquoi ? — « J’ai le droit de le dire, répond la religion, et j’ai celui de ne pas le dire, parce que je parle au nom de Dieu, qui ne trompe ni ne se trompe. »
La religion a donc pour base la morale. De plus elle a des dogmes, des faits, une histoire, des cérémonies, enfin des ministres.
Au sein d’un peuple, les ministres de la religion sont des hommes très influents. Indépendamment du respect qu’ils s’attirent comme interprètes de la volonté de Dieu, ils sont encore les distributeurs d’une des choses dont les hommes ont le plus besoin, la morale……
Pensée
N’en est-il pas en religion comme en économie politique ? et n’a-t-on point le tort de chercher la solution dans une unité factice, imposée, intolérante, persécutrice, socialiste, incapable d’ailleurs de fournir ses titres à la domination et ses preuves de vérité ?
L’unité, en toutes choses, est la consommation suprême, le point vers lequel gravite et gravitera éternellement, sans jamais l’atteindre, l’esprit humain. Si elle devait se réaliser dans l’humanité, ce ne serait qu’à la fin de toutes les libres évolutions sociales.
C’est la variété, la diversité qui sont au commencement, à l’origine, au point de départ de l’humanité, car la diversité des opinions doit être d’autant plus grande que le trésor des vérités acquises est plus petit et que l’esprit des hommes s’est mis d’accord, par la science, sur un moins grand nombre de points……
Rapport du Conseil général des Landes sur les communaux [1849] [CW1.4.16]↩
BWV
1849.?? “Rapport présenté au Conseil Général des Landes, session de 1849, sur la question des communaux” (Report presented to the 1849 Session of the General Council of the Landes on the Question of the Communes] [OC7.66, p. 263] [CW1]
Rapport présenté au Conseil Général des Landes, session de 1849, sur la question des communaux
Messieurs,
Vous avez renvoyé à votre troisième Commission la question des communaux. Elle m’a chargé de vous faire son rapport. Qu’il me soit permis de regretter que ce travail n’ait pu être achevé par celui de vos collègues, [191] qui, l’année dernière, l’avait si bien commencé.
Deux idées diamétralement opposées ont toujours dominé dans cette question.
Les uns, frappés du spectacle de stérilité qu’offrent partout ces terres flétries du nom de vagues et vaines, sachant, d’ailleurs, que ce qui est à tous est bien exploité par tous, mais n’est soigné par personne, ont hâte de voir le domaine commun passer dans le domaine privé et invoquent, pour la réalisation de leur système, le secours de la loi.
D’autres font observer que l’agriculture et, par conséquent, tous les moyens d’existence de ce pays reposent sur le communal. Ils demandent ce que deviendrait le domaine privé sans les ressources du domaine commun. À moins qu’on ne trouve un assolement qui permette de se passer d’engrais (révolution agricole qui n’est pas près de s’accomplir) ils considèrent l’aliénation comme une calamité publique et, pour la prévenir, ils invoquent, eux aussi, le secours de la loi.
Il a semblé à votre Commission que ni l’une ni l’autre de ces conclusions ne tenaient assez compte d’un fait qui domine toute la matière, et simplifie beaucoup la tâche du législateur. Le fait, c’est la propriété devant laquelle le législateur lui-même doit s’incliner.
En effet, demander si la loi doit forcer, ou si elle doit empêcher les aliénations, n’est-ce pas commencer par donner aux communes le droit de propriété ?
Nous avons été frappés du peu de cas qu’on fait de ce droit, soit dans les questions posées par les Ministres, soit dans les réponses émanées du Conseil, antérieurement à la révolution de février.
Voici comment la circulaire ministérielle établissait le problème en 1846 :
« Quel est le meilleur emploi à faire des communaux ? Faut-il les laisser tels qu’ils sont aujourd’hui ? Ou les louer à court ou long bail ? Ou les partager, ou les vendre ? »
Est-ce là une question qu’on puisse faire quand il s’agit d’une propriété, à moins qu’on ne la nie ?
Et quelle a été la réponse du Conseil ?
Après avoir parlé en termes justificatifs, presque laudatifs des anciens moyens d’appropriation, tels que la perprise et l’usurpation, moyens qui n’existent plus aujourd’hui, il concluait à la nécessité d’aliéner, et ajoutait :
« Le consentement des Conseils municipaux qui, néanmoins, seront toujours consultés, ne serait pas absolument indispensable pour l’aliénation des communaux à l’état de landes ou vacants… »
Et plus loin :
« Le Conseil municipal serait consulté sur la nécessité d’aliéner, et, quel que fût son avis, la proposition communiquée au Conseil d’arrondissement, soumise au Conseil général, et par celui-ci approuvée, motiverait l’ordonnance qui autoriserait l’acte de vente ? »
Il faut avouer que ce dialogue entre le Ministre et le Conseil méconnaissait entièrement le droit de propriété. Or, il est dangereux de laisser croire que ce droit s’efface devant la volonté du législateur. Sans doute, on invoquait des raisons de bien public et de progrès ; mais n’invoquaient-ils pas aussi ces raisons, ceux qu’on a vus depuis faire si bon marché de la propriété privée ?
Et ici il était d’autant plus fâcheux que le droit de la commune fût perdu de vue, que c’est précisément dans ce droit que réside la solution des nombreuses difficultés qui se rattachent à la question des communaux.
Quelle est, en effet, la principale de ces difficultés ? C’est l’extrême différence que l’on observe entre les situations et les intérêts des localités diverses. On voudrait bien faire une loi générale ; mais quand on met la main à l’œuvre, on se heurte contre l’impossible et l’on commence à comprendre qu’il faudrait, pour satisfaire à toutes les nécessités, faire autant de lois qu’il y a de communes. Pourquoi ? Parce que chaque commune, selon ses antécédents, ses méthodes agricoles, ses besoins, ses usages, l’état de ses communications, la valeur vénale des terres, a, relativement à ses communaux, des intérêts différents.
La délibération du Conseil général de 1846 en convenait en ces termes :
« Le développement des considérations qui doivent décider à consulter, pour chaque département et chaque commune, la situation des intérêts particuliers, conduirait trop loin. On se contente d’énoncer, ici, que rien n’est possible si cette première loi n’est pas observée ; c’est surtout en cette matière que l’usage local doit tenir une grande place dans la loi, et que la loi elle-même, dans ses dispositions capitales, doit laisser une grande liberté et une grande autorité aux corps électifs chargés de représenter ou de protéger la commune. »
L’impossibilité de faire une loi générale ressort, à chaque page, du rapport que vous fit l’année dernière M. Lefranc.
« Parmi les destinations que l’on peut donner à nos biens communaux, disait-il, il faut, dans chaque département, choisir celle qui permettra, ici le dessèchement et l’irrigation, là, les transports faciles et prompts ; dans les Landes, les semis et les plantations ; dans la Chalosse, le perfectionnement de l’agriculture, etc. »
En vérité, il me semble que cela veut dire : puisqu’il y a autant d’intérêts distincts que de communes, laissons chaque commune administrer son communal. En d’autres termes, ce qu’il y a à faire, ce n’est pas de violer la propriété communale, mais de la respecter.
Alors, celle qui n’a que les communaux indispensables à la dépaissance des troupeaux ou à la confection des engrais, les gardera.
Celle qui a plus de landes qu’il ne lui en faut, les vendra, les affermera, les mettra en valeur, suivant les circonstances et l’occasion.
N’est-il pas heureux que, dans cette occasion, comme dans bien d’autres, le respect du droit, en harmonie avec l’utilité publique, soit, en définitive, la meilleure solution.
Cette solution paraîtra bien simple ; trop simple peut-être. Nous sommes enclins, de nos jours, à vouloir faire des expériences sur les autres. Nous ne souffrons pas qu’ils décident pour eux-mêmes, et quand nous avons enfanté une théorie, nous cherchons à la faire prévaloir, pour aller plus vite, par mesure coercitive. Laisser les communes disposer de leurs communaux, cela paraîtra une folie aux partisans comme aux adversaires de l’amélioration. Les communes sont routinières, diront les premiers, elles ne voudront jamais vendre ; elles sont imprévoyantes, diront les autres, et ne sauront rien garder.
Ces deux craintes se détruisent l’une par l’autre. Rien d’ailleurs ne les justifie.
En premier lieu, le fait prouve que les communes ne font pas à l’aliénation une opposition absolue. Depuis dix ans, plus de quinze mille hectares ont passé dans le domaine privé, et l’on peut prévoir que le mouvement s’accélérera avec le perfectionnement de la viabilité, l’accroissement de la population et la hausse de la valeur vénale des terres.
Quant à la crainte de voir les communes s’empresser de se dépouiller, elle est plus chimérique encore. Toutes les fois que le zèle administratif s’est tourné vers les aliéntions, n’a-t-il pas rencontré la résistance des communes ? N’est-ce pas cette résistance, dite routinière, qui provoque incessamment le législateur et toutes nos délibérations ? M. Lefranc ne vous rappelait-il pas, l’année dernière, que la Convention elle-même n’avait pu faire prévaloir dans ce pays un mode d’aliénation qui devait sembler bien séduisant aux communiers : le partage ! Je ne puis me refuser à citer ici les paroles de notre collègue :
« Pour qu’un législateur, aussi puissant dans son action, aussi radical dans sa volonté, que l’était le législateur de 1793, ait hésité à prescrire le partage d’une manière uniforme, et à violenter ce qu’il appelait les idées rétrogrades des provinces, il fallait qu’il eût le sentiment intime, invincible, d’un droit sacré, d’un intérêt puissant, d’une nécessité impérieuse, cachés sous la routine des traditions. Pour que des populations aussi violemment entraînées dans le courant révolutionnaire n’aient pas, d’une manière presque unanime, trouvé, dans leur sein, un tiers des voix amies de la nouveauté, désireuses d’une satisfaction immédiate et personnelle, oublieuses, à ce prix, de l’intérêt et du droit du communal, décidées à introduire, au milieu des résistances, le niveau d’une loi uniforme, il fallait que l’état de choses qu’on voulait détruire eût sa raison d’être ailleurs que dans la routine et dans l’ignorance. »
D’après ce qui précède, Messieurs, vous pressentez la conclusion : que la loi à intervenir se borne à reconnaître aux communes leur droit de propriété avec toutes ses conséquences.
Mais la propriété communale n’est pas placée sous la seule sauvegarde des Conseils municipaux. Ces Conseils se renouvellent fréquemment. Il peut se rencontrer dans l’un d’eux une majorité qui soit le produit d’une surprise momentanée, surtout sous l’empire d’une loi toute nouvelle, et qui est, pour ainsi dire, à l’état d’expérience. Il ne faut pas qu’une intrigue puisse entraîner pour la commune un dommage irrémédiable. Encore que les conseillers municipaux soient les administrateurs naturels des communaux, il a semblé à votre commission, qu’à l’égard des mesures importantes, comme serait l’aliénation par grandes masses, le Conseil général pouvait être armé d’un veto suspensif, sans que le droit de propriété fût compromis. Il aurait le droit d’ajourner l’exécution de la délibération du conseil municipal, jusqu’à ce qu’une élection eût mis les habitants de la commune à même de faire connaître leur opinion sur l’importance de la mesure.
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans attirer votre attention sur l’opinion qui a été émise par M. le Préfet, [192] non que nous partagions en tout ses vues, mais parce qu’elles respirent les sentiments les plus généreux envers les classes pauvres, et témoignent de toute sa sollicitude pour le bien public.
M. le Préfet fonde de grandes espérances sur le communal, non comme moyen d’accroître la richesse du pays, car il convient que l’appropriation personnelle remplit mieux ce but, mais comme moyen de l’égaliser.
Il est difficile de comprendre, je l’avoue, comment il peut se faire que l’exploitation du commun, si elle donne moins de blé, moins de vin, moins de laine, moins de viande que l’appropriation personnelle, arrive néanmoins à ce résultat, de faire que tous, et même les pauvres, soient mieux pourvus de toutes choses.
Je ne veux pas discuter ici cette théorie, mais je dois faire remarquer ceci : la foi de M. le Préfet dans la puissance du communal est telle qu’il se prononce, non seulement pour l’inaliénabilité absolue, mais encore pour la formation d’un communal là où il n’y en a plus. Quoi donc ! entrerons-nous maintenant dans la voie de faire passer le domaine privé dans le domaine commun, lorsque tant d’années ont été consacrées par l’Administration à faire passer le domaine commun dans le domaine privé ?
Rien n’est plus propre, ce me semble, à nous donner confiance en la solution que nous vous avons présentée : le respect de la propriété avec toutes ses conséquences. Il faut que la loi s’arrête là où elle rencontre le droit qu’elle est chargée de maintenir et non de détruire. Car enfin, si pendant une série d’années la loi force l’aliénation du communal, parce que cette idée prévaut : Que le communal est nuisible ; et si pendant une autre série d’années la loi force la reconstitution du communal, parce qu’on pense qu’il est utile ; que deviendront les pauvres habitants des campagnes ? Il faudra donc qu’ils soient poussés dans des directions opposées, par une force extérieure et selon la théorie du jour ?
Ceci vous avertit que la question est mal posée, quand on demande : Que faut-il faire du communal ? Ce n’est pas au législateur, mais au propriétaire, qu’il appartient d’en disposer.
Mais la commission s’associe pleinement aux vues de M. le Préfet, quand il parle de l’utilité qu’il y aurait, pour les communes, à mettre en valeur les terres vagues qui ne sont pas indispensables aux besoins de l’agriculture. Le conseil secondera, sans doute, ses efforts dans ce sens, et le pays le récompensera par sa reconnaissance.
Par ces motifs, la troisième commission me charge de vous soumettre le projet de délibération suivante :
Le Conseil général pense qu’une loi sur les communaux ne peut faire autre chose que de reconnaître ce genre de propriétés et de régler le mode de leur administration ;
Il estime que le Conseil municipal doit être naturellement chargé de cette administration, au nom des habitants de la commune ;
Il est d’avis que, dans le cas où le Conseil municipal aurait voté une aliénation, le Conseil général doit avoir le droit de suspendre, s’il le juge utile, l’effet de ce vote, jusqu’à ce qu’il soit confirmé par le Conseil municipal de l’élection suivante.
Protectionnisme et communisme [January 1849] [CW2.12]↩
BWV
1849.01 “Protectionisme et communisme” (Protectionism and Communism) [January 1849] [OC4.9, p. 504] [CW2]
Source
OC vol. 4 Sophismes économiques — Petits pamphlets, I (1863 ed.): <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_4.djvu>.
À MONSIEUR THIERS.
Monsieur,
Ne soyez point ingrat envers la révolution de Février. Elle vous a surpris, froissé peut-être ; mais aussi elle vous a préparé, comme auteur, comme orateur, comme conseiller intime [1], des triomphes inattendus. Parmi ces succès, il en est un assurément fort extraordinaire. Ces jours derniers on lisait dans la Presse :
« L’association pour la défense du travail national (l’ancien comité Mimerel) vient d’adresser à tous ses correspondants une circulaire, pour leur annoncer qu’une souscription est ouverte à l’effet de concourir à la propagation dans les ateliers du livre de M. Thiers sur la Propriété. L’association souscrit elle-même pour 5,000 exemplaires. »
J’aurais voulu être présent quand cette flatteuse annonce est tombée sous vos yeux. Elle a dû y faire briller un éclair de joie railleuse.
On a bien raison de le dire : les voies de Dieu sont aussi infaillibles qu’impénétrables. Car si vous voulez bien m’accorder pour un instant (ce que j’essaierai bientôt de démontrer) que le Protectionisme, en se généralisant, devient Communisme, comme un carpillon devient carpe, pourvu que Dieu lui prête vie, il est déjà assez singulier que ce soit un champion du Protectionisme qui se pose comme le pourfendeur du Communisme ; mais ce qui est plus extraordinaire et plus consolant encore, c’est qu’une puissante association, qui s’était formée pour propager théoriquement et pratiquement le principe communiste (dans la mesure qu’elle jugeait profitable à ses membres), consacre aujourd’hui la moitié de ses ressources à détruire le mal qu’elle a fait avec l’autre moitié.
Je le répète, c’est là un spectacle consolant. Il nous rassure sur l’inévitable triomphe de la vérité, puisqu’il nous montre les vrais et premiers propagateurs des doctrines subversives, effrayés de leurs succès, élaborer maintenant le contre-poison et le poison dans la même officine.
Ceci suppose, il est vrai, l’identité du principe Communiste et du principe Prohibitioniste, et peut-être n’admettez vous pas cette identité, quoique à vrai dire, il ne me paraît pas possible que vous ayez pu, sans en être frappé, écrire quatre cents pages sur la Propriété. Peut-être pensez-vous que quelques efforts consacrés à la liberté commerciale ou plutôt au Libre-Échange, l’impatience d’une discussion sans résultat, l’ardeur du combat, la vivacité de la lutte m’ont fait voir, comme cela ne nous arrive que trop souvent à nous autres polémistes, les erreurs de mes adversaires à travers un verre grossissant. Sans doute, c’est mon imagination, afin d’en avoir plus facilement raison, qui gonfle la théorie du Moniteur industriel aux proportions de celle du Populaire. Quelle apparence que de grands manufacturiers, d’honnêtes propriétaires, de riches banquiers, d’habiles hommes d’État se soient faits, sans le savoir et sans le vouloir, les initiateurs, les apôtres du Communisme en France ? — Et pourquoi pas, je vous prie ? Il y a bien des ouvriers, pleins d’une foi sincère dans le droit au travail, par conséquent communistes sans le savoir, sans le vouloir, qui ne souffriraient pas qu’on les considérât comme tels. La raison en est que, dans toutes les classes, l’intérêt incline la volonté, et la volonté, comme dit Pascal, est le principal organe de la créance. Sous un autre nom, beaucoup d’industriels, fort honnêtes gens d’ailleurs, font du Communisme comme on en fait toujours, c’est-à-dire à la condition que le bien d’autrui sera seul mis en partage. Mais sitôt que, le principe gagnant du terrain, il s’agit de livrer aussi au partage leur propre bien, oh ! alors le Communisme leur fait horreur. Ils répandaient le Moniteur industriel, maintenant ils propagent le livre de la Propriété. Pour s’en étonner, il faudrait ignorer le cœur humain, ses ressorts secrets, et combien il a de pente à se faire habile casuiste.
Non, Monsieur, ce n’est pas la chaleur de la lutte qui m’a fait voir sous ce jour la doctrine prohibitioniste, car c’est au contraire parce que je la voyais sous ce jour, avant la lutte, que je me suis engagé [2]. Veuillez me croire ; étendre quelque peu notre commerce extérieur, résultat accessoire qui n’est certes pas à dédaigner, ce ne fut jamais mon motif déterminant. J’ai cru et crois encore que la Propriété est engagée dans la question. J’ai cru et je crois encore que notre tarif douanier, à cause de l’esprit qui lui a donné naissance et des arguments par lesquels on le défend, a fait au principe même de la Propriété une brèche par laquelle tout le reste de notre législation menace de passer.
En considérant l’état des esprits, il m’a semblé qu’un Communisme qui, je dois le dire pour être juste, n’a pas la conscience de lui-même et de sa portée, était sur le point de nous déborder. Il m’a semblé que ce Communisme-là (car il y en a de plusieurs espèces) se prévalait très-logiquement de l’argumentation prohibitioniste et se bornait à en presser les déductions. C’est donc sur ce terrain qu’il m’a paru utile de le combattre ; car puisqu’il s’armait de sophismes propagés par le comité Mimerel, il n’y avait pas espoir de le vaincre tant que ces sophismes resteraient debout et triomphants dans la conscience publique. C’est à ce point de vue que nous nous sommes placés à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Lyon, quand nous avons fondé l’Association du Libre-Échange. La liberté commerciale, considérée en elle-même, est sans doute pour les peuples un bien précieux ; mais enfin, si nous n’avions eu qu’elle en vue, nous aurions donné à notre association le titre d’Association pour la liberté commerciale, ou, plus politiquement encore, pour la réforme graduelle des tarifs. Mais le mot Libre-Échange implique libre disposition du fruit de son travail, en d’autres termes Propriété, et c’est pour cela que nous l’avons préféré [3]. Certes, nous savions que ce mot nous susciterait bien des difficultés. Il affirmait un principe, et, dès lors, il devait ranger parmi nos adversaires tous les partisans du principe opposé. Bien plus, il répugnait extrêmement aux hommes même les mieux disposés à nous seconder, c’est-à-dire aux négociants, plus préoccupés alors de réformer la douane que de vaincre le Communisme. Le Havre, tout en sympathisant à nos vues, refusa d’adopter notre bannière. De toute part on me disait : « Nous obtiendrons plutôt quelques adoucissements à notre tarif en n’affichant pas des prétentions absolues. » Je répondais : Si vous n’avez que cela en vue, agissez par vos chambres de commerce. On me disait encore : « Le mot Libre-Échange effraie et éloigne le succès. » Rien n’était plus vrai ; mais je tirais de l’effroi même causé par ce mot mon plus fort argument pour son adoption. Plus il épouvante, disais-je, plus cela prouve que la notion de Propriété s’efface des esprits. La doctrine Prohibitioniste à faussé les idées, et les fausses idées ont produit la Protection. Obtenir par surprise ou par le bon vouloir du ministre une amélioration accidentelle du tarif, c’est pallier un effet, non détruire une cause. Je maintins donc le mot Libre-Échange, non en dépit, mais en raison des obstacles qu’il devait nous créer ; obstacles qui, révélant la maladie des esprits, étaient la preuve certaine que les bases mêmes de l’ordre social étaient menacées.
Il ne suffisait pas de signaler notre but par un mot ; il fallait encore le définir. C’est ce que nous fîmes et je transcris ici, comme pièce à l’appui, le premier acte ou le manifeste de cette association.
Au moment de s’unir pour la défense d’une grande cause, les soussignés sentent le besoin d’exposer leur croyance ; de proclamer le but, la limite, les moyens et l’esprit de leur association.
L’Échange est un droit naturel comme la Propriété. Tout citoyen qui a créé ou acquis un produit doit avoir l’option ou de l’appliquer immédiatement à son usage, ou de le céder à quiconque, sur la surface du globe, consent à lui donner en échange l’objet qu’il préfère. Le priver de cette faculté, quand il n’en fait aucun usage contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et uniquement pour satisfaire la convenance d’un autre citoyen, c’est légitimer une spoliation, c’est blesser la loi de la Justice.
C’est encore violer les conditions de l’Ordre ; car quel ordre peut exister au sein d’une société où chaque industrie, aidée en cela par la loi et la force publique, cherche ses succès dans l’oppression de toutes les autres ?
C’est méconnaître la pensée providentielle qui préside aux destinées humaines, manifestée par l’infinie variété des climats, des saisons, des forces naturelles et des aptitudes, biens que Dieu n’a si inégalement répartis entre les hommes que pour les unir, par l’échange, dans les liens d’une universelle fraternité.
C’est contrarier le développement de la prospérité publique, puisque celui qui n’est pas libre d’échanger ne l’est pas de choisir son travail, et se voit contraint de donner une fausse direction à ses efforts, à ses facultés, à ses capitaux, et aux agents que la nature avait mis à sa disposition.
Enfin, c’est compromettre la paix entre les peuples ; car c’est briser les relations qui les unissent et qui rendent les guerres impossibles, à force de les rendre onéreuses.
L’Association a donc pour but la Liberté des Échanges.
Les soussignés ne contestent pas à la société le droit d’établir, sur les marchandises qui passent la frontière, des taxes destinées aux dépenses communes, pourvu qu’elles soient déterminées par la seule considération des besoins du Trésor.
Mais sitôt que la taxe, perdant son caractère fiscal, a pour but de repousser le produit étranger, au détriment du fisc lui-même, afin d’exhausser artificiellement le prix du produit national similaire, et de rançonner ainsi la communauté au profit d’une classe, dès cet instant la Protection ou plutôt la Spoliation se manifeste, et c’est là le principe que l’Association aspire à ruiner dans les esprits et à effacer complétement de nos lois, indépendamment de toute réciprocité et des systèmes qui prévalent ailleurs.
De ce que l’Association poursuit la destruction complète du régime protecteur, il ne s’ensuit pas qu’elle demande qu’une telle réforme s’accomplisse en un jour, et sorte d’un seul scrutin. Même pour revenir du mal au bien et d’un état de choses artificiel à une situation naturelle, des précautions peuvent être commandées par la prudence. Ces détails d’exécution appartiennent aux pouvoirs de l’État ; la mission de l’Association est de propager, de populariser le Principe.
Quant aux moyens qu’elle entend mettre en œuvre, jamais elle ne les cherchera ailleurs que dans les voies constitutionnelles et légales.
Enfin l’Association se place en dehors de tous les partis politiques. Elle ne se met au service d’aucune industrie, d’aucune classe, d’aucune portion du territoire. Elle embrasse la cause de l’éternelle justice, de la paix, de l’union, de la libre communication, de la fraternité entre tous les hommes, la cause de l’intérét général, qui se confond partout, et sous tous les aspects, avec celle du Public consommateur.
Y a-t-il un mot dans ce programme qui ne révèle le désir ardent de raffermir ou même de rétablir dans les esprits la notion de Propriété, pervertie par le Régime Restrictif ? N’est-il pas évident que l’intérêt commercial y est au second plan et l’intérêt social au premier ? Remarquez que le tarif, en lui-même, bon ou mauvais au point de vue administratif ou fiscal, nous occupe peu. Mais sitôt qu’il agit intentionnellement dans le sens protecteur, c’est-à-dire sitôt qu’il manifeste une pensée de spoliation et la négation, en principe, du droit de Propriété, nous le combattons non comme tarif, mais comme système. C’est là, disons-nous, la pensée que nous nous efforcerons de ruiner dans les intelligences afin de la faire disparaître de nos lois.
On demandera sans doute pourquoi, ayant en vue une question générale de cette importance, nous avons circonscrit la lutte sur le terrain d’une question spéciale.
La raison en est simple. Il fallait opposer association à association, engager des intérêts et des soldats dans notre armée. Nous savions bien qu’entre Prohibitionistes et Libres-Échangistes la polémique ne peut se prolonger sans remuer et, à la fin, résoudre toutes les questions morales, politiques, philosophiques, économiques qui se rattachent à la Propriété ; et puisque le comité Mimerel, en ne s’occupant que d’un but spécial, avait compromis ce principe, nous devions espérer relever ce principe en poursuivant, nous aussi, le but spécial opposé.
Mais qu’importe ce que j’ai pu dire ou penser en d’autres temps ? Qu’importe que j’aie aperçu ou cru apercevoir une certaine connexité entre le Protectionisme et le Communisme ? L’essentiel est de savoir si cette connexité existe. C’est ce que je vais examiner.
Vous vous rappelez sans doute le jour où, avec votre habileté ordinaire, vous fîtes arriver sur les lèvres de M. Proudhon cet aveu devenu célèbre : « Donnez-moi Le Droit au travail, et je vous abandonne le Droit de propriété. » M. Proudhon ne cachait pas qu’à ses yeux ces deux Droits sont incompatibles.
Si la Propriété est incompatible avec le Droit au travail, et si le Droit au travail est fondé sur le même principe que la Protection, qu’en devrons-nous conclure, sinon que la Protection est elle-même incompatible avec la Propriété ? En géométrie on regarde comme une vérité incontestable que deux choses égales à une troisième sont égales entre elles.
Or, il est arrivé qu’un orateur éminent, M. Billault, a cru devoir soutenir à la tribune le Droit au travail. Cela n’était pas facile en présence de l’aveu échappé à M. Proudhon. M. Billault comprenait fort bien que faire intervenir l’État pour pondérer les fortunes et niveler les situations, c’est se mettre sur la pente du Communisme ; et qu’a-t-il dit pour déterminer l’Assemblée nationale à violer la propriété et son principe ? Il vous a dit tout simplement que ce qu’il vous demandait de faire vous le faisiez déjà par vos tarifs. Sa prétention ne va pas au delà d’une application un peu plus large de doctrines par vous admises et appliquées. Voici ses paroles :
Portez vos regards sur nos tarifs de douane ; par leurs prohibitions, leurs taxes différentielles, leurs primes, leurs combinaisons de tous genres, c’est la société qui aide, qui soutient, qui retarde ou avance toutes les combinaisons du travail national (très-bien) ; elle ne tient pas seulement la balance entre le travail français, qu’elle protége, et le travail étranger, mais, sur le sol de la patrie, les diverses industries la voient encore, et sans cesse, intervenir entre elles. Entendez devant son tribunal les réclamations perpétuelles des unes contre les autres ; voyez, par exemple, les industries qui emploient le fer se plaignant de la protection accordée au fer français contre le fer étranger ; celles qui emploient le lin ou le coton filés protestant contre la protection accordée au fil français, contre l’exclusion du fil étranger, et ainsi des autres. La société (il fallait dire le gouvernement) se trouve donc forcément mêlée à toutes les luttes, à tous les embarras du travail ; elle y intervient activement tous les jours, directement, indirectement, et la première fois que vous aurez des questions de douane, vous le verrez, vous serez, bon gré mal gré, forcés de prendre fait et cause, et de faire par vous-mêmes la part de tous les intérêts.
Ce ne saurait donc être une objection contre la dette de la société envers le travailleur dénué, que cette nécessité qu’elle créerait au gouvernement d’intervenir dans la question du travail.
Et veuillez bien remarquer que M. Billault, dans son argumentation, n’a nullement eu la pensée de vous infliger une sanglante ironie. Ce n’est pas un Libre-Échangiste déguisé se complaisant à rendre palpable l’inconséquence des Protectionistes. Non, M. Billault est lui-même protectioniste bonâ fide. Il aspire au nivellement des fortunes par la Loi. Dans cette voie, il juge l’action des tarifs utile ; et rencontrant comme obstacle le Droit de propriété, il saute par-dessus, comme vous faites. On lui montre ensuite le Droit au travail qui est un second pas dans la même voie. Il rencontre encore comme obstacle le Droit de propriété ; il saute encore par-dessus. Mais, se retournant, il est tout surpris de voir que vous ne le suivez plus. Il vous en demande le motif. Si vous lui répondiez : J’admets en principe que la loi peut violer la propriété, mais je trouve inopportun qu’elle le fasse sous la forme du Droit au travail ; M. Billault vous comprendrait, et discuterait avec vous cette question secondaire d’opportunité. Mais vous lui opposez le Principe même de la Propriété. Cela l’étonne et il se croit en droit de vous dire : Ne faites pas aujourd’hui le bon apôtre, et si vous repoussez le Droit au travail, que ce ne soit pas au moins en vous fondant sur le Droit de Propriété, puisque ce Droit vous le violez par vos tarifs quand cela vous convient. Il pourrait ajouter avec quelque raison : Par les tarifs protecteurs vous violez souvent la propriété du pauvre au profit du riche. Par le Droit au travail vous violeriez la propriété du riche à l’avantage du pauvre. Par quel malheur le scrupule s’empare-t-il si tard de vous [4] ?
Entre M. Billault et vous il n’y a donc qu’une différence. Tous deux vous cheminez dans la même voie, celle du Communisme. Seulement, vous n’y avez fait qu’un pas, et il en a fait deux. Sous ce rapport, l’avantage, à mes yeux du moins, est de votre côté. Mais vous le perdez du côté de la logique. Car, puisque vous marchez comme lui, le dos tourné à la Propriété, il est au moins fort plaisant que vous vous posiez comme son chevalier. C’est une inconséquence que M. Billault a su éviter. Mais, hélas ! c’est pour tomber, lui aussi, dans une triste logomachie ! M. Billault est trop éclairé pour ne pas sentir, au moins confusément, le danger de chacun de ses pas dans une voie qui aboutit au Communisme. Il ne se donne pas le ridicule de se poser en champion de la Propriété au moment où il la viole ; mais qu’imagine-t-il pour se justifier ? Il invoque l’axiome favori de quiconque veut concilier deux choses inconciliables : Il n’y a pas de principes. Propriété, Communisme, prenons un peu partout, selon la circonstance.
« À mon sens, le pendule de la civilisation, qui oscille de l’un à l’autre principe, selon les besoins du moment, mais qui s’en va toujours marinant un progrès de plus, après avoir fortement incliné vers la liberté absolue de l’individualisme, revient vers la nécessité de l’action gouvernementale. »
Il n’y a donc rien de vrai dans le monde, il n’y a pas de principes puisque le pendule doit osciller d’un principe à l’autre selon les besoins du moment. Ô métaphore, où nous conduirais-tu, si l’on te laissait faire [5] !
Ainsi que vous le disiez fort judicieusement à la tribune, on ne peut pas dire — encore moins écrire — tout à la fois. Il doit être bien entendu que je n’examine pas ici le côté économique du régime protecteur ; je ne recherche pas encore si, au point de vue de la richesse nationale, il fait plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien. Le seul point que je veux prouver c’est qu’il n’est autre chose qu’une manifestation du Communisme. MM. Billault et Proudhon ont commencé la démonstration. Je vais essayer de la compléter.
Et d’abord que faut-il entendre par Communisme ? Il y a plusieurs manières, sinon de réaliser la communauté des biens, du moins de le tenter. M. de Lamartine en comptait quatre. Vous pensez qu’il y en a mille et je suis de votre avis. Cependant je crois que toutes peuvent rentrer dans trois catégories générales, dont une seule, selon moi, offre de véritables dangers.
Premièrement, deux ou plusieurs hommes peuvent imaginer de mettre leur travail et leur vie en commun. Tant qu’ils ne cherchent ni à troubler la sécurité, ni à restreindre la liberté, ni à usurper la propriété d’autrui, ni directement ni indirectement, s’ils font du mal ils se le font à eux-mêmes. La tendance de ces hommes sera toujours d’aller poursuivre dans de lointains déserts la réalisation de leur rêve. Quiconque a réfléchi sur ces matières sait que les malheureux périront à la peine, victimes de leurs illusions. De nos jours, les communistes de cette espèce ont donné à leur chimérique Élysée le nom d’Icarie, comme s’ils avaient eu le triste pressentiment du dénouement affreux vers lequel on les précipite. Nous devons gémir sur leur aveuglement, nous devrions les avertir s’ils étaient en état de nous entendre, mais la société n’a rien à redouter de leurs chimères.
Une autre forme du Communisme, et assurément la plus brutale, c’est celle-ci : Faire une masse de toutes les valeurs existantes et partager ex æquo. C’est la spoliation devenue règle dominante et universelle. C’est la destruction non-seulement de la Propriété, mais encore du travail et du mobile même qui détermine l’homme à travailler. Ce Communisme-là est si violent, si absurde, si monstrueux, qu’en vérité je ne puis le croire dangereux. C’est ce que je disais, il y a quelque temps, devant une assemblée considérable d’électeurs appartenant en grande majorité aux classes souffrantes. Une explosion de murmures accueillit mes paroles.
J’en témoignai ma surprise. « Quoi ! disait-on, M. Bastiat ose dire que le Communisme n’est pas dangereux ! Il est donc communiste ! Eh bien, nous nous en doutions, car communistes, socialistes, économistes, ce sont fils de même lignage, comme c’est prouvé par la rime. » J’eus quelque peine à me tirer de ce mauvais pas. Mais cette interruption même prouvait la vérité de ma proposition. Non, le Communisme n’est pas dangereux quand il se montre dans sa forme la plus naïve, celle de la pure et simple spoliation ; il n’est pas dangereux puisqu’il fait horreur.
Je me hâte de dire que si le Protectionisme peut être et doit être assimilé au Communisme, ce n’est pas à celui que je viens de décrire.
Mais le Communisme revêt une troisième forme.
Faire intervenir l’État, lui donner pour mission de pondérer les profits et d’équilibrer les fortunes, en prenant aux uns, sans consentement, pour donner aux autres, sans rétribution, le charger de réaliser l’œuvre du nivellement par voie de spoliation, assurément c’est bien là du Communisme. Les procédés employés par l’État, dans ce but, non plus que les beaux noms dont on décore cette pensée, n’y font rien. Qu’il en poursuive la réalisation par des moyens directs ou indirects, par la restriction ou par l’impôt, par les tarifs ou par le Droit au travail ; qu’il la place sous l’invocation de l’égalité, de la solidarité, de la fraternité, cela ne change pas la nature des choses ; le pillage des propriétés n’en est pas moins du pillage parce qu’il s’accomplit avec régularité, avec ordre, systématiquement et par l’action de la loi.
J’ajoute que c’est là, à notre époque, le Communisme vraiment dangereux. Pourquoi ? Parce que, sous cette forme, nous le voyons incessamment prêt à tout envahir. Et voyez ! l’un demande que l’État fournisse gratuitement aux artisans, aux laboureurs des instruments de travail ; c’est l’inviter à les ravir à d’autres artisans et laboureurs. L’autre veut que l’État prête sans intérêt ; il ne le peut faire sans violer la propriété. Un troisième réclame l’éducation gratuite à tous les degrés ; gratuite ! cela veut dire : aux dépens des contribuables. Un quatrième exige que l’État subventionne les associations d’ouvriers, les théâtres, les artistes, etc. Mais ces subventions, c’est autant de valeur soustraite à ceux qui l’avaient légitimement gagnée. Un cinquième n’a pas de repos que l’État n’ait fait artificiellement hausser le prix d’un produit pour l’avantage de celui qui le vend ; mais c’est au détriment de celui qui l’achète. Oui, sous cette forme, il est bien peu de personnes qui, une fois ou autre, ne soient communistes. Vous l’êtes, M. Billault l’est, et je crains qu’en France nous ne le soyons tous à quelque degré. Il semble que l’intervention de l’État nous réconcilie avec la spoliation, en en rejetant la responsabilité sur tout le monde, c’est-à-dire sur personne, ce qui fait qu’on jouit du bien d’autrui en parfaite tranquillité de conscience. Cet honnête M. Tourret, un des hommes les plus probes qui se soient jamais assis sur les bancs ministériels, ne commençait-il pas ainsi son exposé des motifs du projet de loi sur les avances à l’agriculture ? « Il ne suffit pas de donner l’instruction pour cultiver les arts, il faut encore fournir les instruments de travail. » Après ce préambule, il soumet à l’Assemblée nationale un projet de loi dont le premier article est ainsi conçu :
Art. 1er. Il est ouvert, sur le budget de 1849, au ministre de l’agriculture et du commerce, un crédit de 10 millions destiné à faire des avances aux propriétaires et associations de propriétaires de fonds ruraux.
Avouez que si la langue législative se piquait d’exactitude, l’article devrait être ainsi rédigé :
Le ministre de l’agriculture et du commerce est autorisé, pendant l’année 1849, à prendre 10 millions dans la poche des laboureurs qui en ont grand besoin et à qui ils appartiennent, pour les verser dans la poche d’autres laboureurs qui en ont également besoin et à qui ils n’appartiennent pas.
N’est-ce pas là un fait communiste, et en se généralisant ne constitue-t-il pas le Communisme ?
Tel manufacturier, qui se laisserait mourir plutôt que de dérober une obole, ne se fait pas le moindre scrupule de porter à la législature cette requête : « Faites une loi qui élève le prix de mon drap, de mon fer, de ma houille, et me mette à même de rançonner mes acheteurs. » Comme le motif sur lequel il se fonde est qu’il n’est pas content de son gain, tel que le fait l’échange libre ou le libre-échange (ce que je déclare être la même chose, quoi qu’on en dise), comme, d’un autre côté, nous sommes tous mécontents de notre gain et disposés à invoquer la législature, il est clair, du moins à mes yeux, que si elle ne se hâte de répondre : « Cela ne me regarde pas ; je ne suis pas chargée de violer les propriétés, mais de les garantir, » il est clair, dis-je, que nous sommes en plein Communisme. Les moyens d’exécution mis en œuvre par l’État peuvent différer, mais ils ont le même but et se rattachent au même principe.
Supposez que je me présente à la barre de l’Assemblée nationale, et que je dise : J’exerce un métier, et je ne trouve pas que mes profits soient suffisants. C’est pourquoi je vous prie de faire un décret qui autorise MM. les percepteurs à prélever, à mon profit, seulement un pauvre petit centime sur chaque famille française. — Si la législature accueille ma demande, on pourra, si l’on veut, ne voir là qu’un fait isolé de spoliation légale, qui ne mérite pas encore le nom de Communisme. Mais si tous les Français, les uns après les autres, viennent faire la même supplique, et si la législature les examine dans le but avoué de réaliser l’égalité des fortunes, c’est dans ce principe, suivi d’effets, que je vois et que vous ne pouvez vous empêcher de voir le Communisme.
Que pour réaliser sa pensée la législature se serve du douanier ou du percepteur, de la contribution directe ou de l’impôt indirect, de la restriction ou de la prime, peu importe. Se croit-elle autorisée à prendre et à donner sans compensation ? Croit-elle que sa mission est d’équilibrer les profits ? Agit-elle en conséquence de cette croyance ? Le gros du public approuve-t-il, provoque-t-il cette façon d’agir ? En ce cas, je dis que nous sommes sur la pente du Communisme, soit que nous en ayons ou non la conscience.
Et si l’on me dit : L’État n’agit point ainsi en faveur de tout le monde, mais seulement en faveur de quelques classes, je répondrai : Alors il a trouvé le moyen d’empirer le communisme lui-même.
Je sens, Monsieur, qu’on peut jeter du doute sur ces déductions, à l’aide d’une confusion fort facile. On me citera des faits administratifs très-légitimes, des cas où l’intervention de l’État est aussi équitable qu’utile ; puis, établissant une apparente analogie entre ces cas et ceux contre lesquels je me récrie, on me mettra dans mon tort, on me dira : Ou vous ne devez pas voir le Communisme dans la Protection, ou vous devez le voir dans toute action gouvernementale.
C’est un piége dans lequel je ne veux pas tomber. C’est pourquoi je suis obligé de rechercher quelle est la circonstance précise qui imprime à l’intervention de l’État le caractère communiste.
Quelle est la mission de l’État ? Quelles sont les choses que les citoyens doivent confier à la force commune ? quelles sont celles qu’ils doivent réserver à l’activité privée ? Répondre à ces questions, ce serait faire un cours de politique. Heureusement je n’en ai pas besoin pour résoudre le problème qui nous occupe.
Quand les citoyens, au lieu de se rendre à eux-mêmes un Service, le transforment en Service public, c’est-à-dire quand ils jugent à propos de se cotiser pour faire exécuter un travail ou se procurer une satisfaction en commun, je n’appelle pas cela du Communisme, parce que je n’y vois pas ce qui fait son cachet spécial : le nivellement par voie de spoliation. L’État prend, il est vrai, par l’Impôt, mais rend par le Service. C’est une forme particulière, mais légitime, de ce fondement de toute société, l’échange. Je vais plus loin. En confiant un service spécial à l’État, les citoyens peuvent faire une bonne ou une mauvaise opération. Ils la font bonne si, par ce moyen, le service est fait avec plus de perfection et d’économie. Elle est mauvaise dans l’hypothèse contraire ; mais, dans aucun cas, je ne vois apparaître le principe communiste. Dans le premier, les citoyens ont réussi ; dans le second, ils se sont trompés, voilà tout ; et si le Communisme est une erreur, il ne s’ensuit pas que toute erreur soit du Communisme.
Les économistes sont en général très-défiants à l’endroit de l’intervention gouvernementale. Ils y voient des inconvénients de toute sorte, une dépression de la liberté, de l’énergie, de la prévoyance et de l’expérience individuelles, qui sont le fonds le plus précieux des sociétés. Il leur arrive donc souvent de combattre cette intervention. Mais ce n’est pas du tout du même point de vue et par le même motif qui leur fait repousser la Protection. Qu’on ne se fasse donc pas un argument contre nous de notre prédilection, trop prononcée peut-être, pour la liberté, et qu’on ne dise pas : Il n’est pas surprenant que ces messieurs repoussent le régime protecteur, car ils repoussent l’intervention de l’État en toutes choses.
D’abord, il n’est pas vrai que nous la repoussions en toutes choses. Nous admettons que c’est la mission de l’État de maintenir l’ordre, la sécurité, de faire respecter les personnes et les propriétés, de réprimer les fraudes et les violences. Quant aux services qui ont un caractère, pour ainsi parler, industriel, nous n’avons pas d’autre règle que celle-ci : que l’État s’en charge s’il en doit résulter pour la masse une économie de forces. Mais, pour Dieu, que, dans le calcul, on fasse entrer en ligne de compte tous les inconvénients innombrables du travail monopolisé par l’État.
Ensuite, je suis forcé de le répéter, autre chose est de voter contre une nouvelle attribution faite à l’État sur le fondement que, tout calcul fait, elle est désavantageuse et constitue une perte nationale ; autre chose est de voter contre cette nouvelle attribution parce qu’elle est illégitime, spoliatrice, et qu’elle donne pour mission au gouvernement de faire précisément ce que sa mission rationnelle est d’empêcher et de punir. Or, nous avons contre le Régime dit Protecteur ces deux natures d’objections, mais la dernière l’emporte de beaucoup dans notre détermination de lui faire, bien entendu par les voies légales, une guerre acharnée.
Ainsi, qu’on soumette, par exemple, à un conseil municipal la question de savoir s’il vaut mieux laisser chaque famille envoyer chercher sa provision d’eau à un quart de lieue, ou s’il est préférable que l’autorité prélève une cotisation pour faire venir l’eau sur la place du village ; je n’aurai aucune objection de principe à faire à l’examen de cette question. Le calcul des avantages et des inconvénients pour tous sera le seul élément de la décision. On pourra se tromper dans ce calcul, mais l’erreur même qui entraînera une perte de propriété, ne constituera pas une violation systématique de la propriété.
Mais que M. le maire propose de fouler une industrie pour le profit d’une autre, d’interdire les sabots pour l’avantage des cordonniers, ou quelque chose d’analogue ; alors je lui dirai qu’il ne s’agit plus ici d’un calcul d’avantages et d’inconvénients, il s’agit d’une perversion de l’autorité, d’un détournement abusif de la force publique ; je lui dirai : Vous qui êtes dépositaire de l’autorité et de la force publiques pour châtier la spoliation, comment osez-vous appliquer l’autorité et la force publiques à protéger et systématiser la spoliation ?
Que si la pensée de M. le maire triomphe, si je vois, par suite de ce précédent, toutes les industries du village s’agiter pour solliciter des faveurs aux dépens les unes des autres, si, au milieu de ce tumulte d’ambitions sans scrupule, je vois sombrer jusqu’à la notion même de Propriété, il me sera bien permis de penser que, pour la sauver du naufrage, la première chose à faire est de signaler ce qu’il y a d’inique dans la mesure qui a été le premier anneau de cette chaîne déplorable.
Il ne me serait pas difficile, Monsieur, de trouver dans votre ouvrage des passages qui vont à mon sujet et corroborent mes vues. À vrai dire, il me suffirait de l’ouvrir au hasard. Oui, si, renouvelant un jeu d’enfant, j’enfonçais une épingle dans ce livre, je trouverais, à la page indiquée par le sort, la condamnation implicite où explicite du Régime Protecteur, la preuve de l’identité de ce régime, en principe, avec le Communisme. Et pourquoi ne ferais-je pas cette épreuve ? Bon, m’y voilà. L’épingle a désigné la page 283 ; j’y lis :
« C’est donc une grave erreur que de s’en prendre à la concurrence, et de n’avoir pas aperçu que si le peuple est producteur, il est consommateur aussi, et que recevant moins d’un côté (ce que je nie, et vous le niez vous-même quelques lignes plus bas), payant moins de l’autre, reste alors, au profit de tous, la différence d’un système qui retient l’activité humaine, à un système qui la lance à l’infini dans la carrière en lui disant de ne s’arrêter jamais. »
Je vous défie de dire que ceci ne s’applique pas aussi bien à la concurrence qui se fait par-dessus la Bidassoa qu’à celle qui se fait par-dessus la Loire. — Donnons encore un coup d’épingle. C’est fait ; nous voici à la page 325.
« Les droits sont on ne sont pas : s’ils sont, ils entraînent des conséquences absolues… Il y a plus, si le droit est, il est de tous les instants ; il est entier aujourd’hui, hier, demain, après-demain, en été comme en hiver, non pas quand il vous plaira de le déclarer en vigueur, mais quand il plaira à l’ouvrier de l’invoquer ! »
Soutiendrez-vous qu’un maître de forges a le droit indéfini, perpétuel, de m’empêcher de produire indirectement deux quintaux de fer dans mon usine, qui est une vigne, pour l’avantage d’en produire directement un seul dans son usine, qui est une forge ? Ce droit aussi est ou n’est pas. S’il est, il est entier aujourd’hui, hier, demain, après demain, en été comme en hiver, non pas quand il vous plaira de le déclarer en vigueur, mais quand il plaira au maître de forges de l’invoquer !
Tentons encore le sort. Il nous désigne la page 63 ; j’y lis cet aphorisme :
« La Propriété n’est pas, si je ne puis la donner aussi bien que la consommer. »
Nous disons, nous : « La Propriété n’est pas, si je ne puis l’échanger aussi bien que la consommer. » Et permettez-moi d’ajouter que le droit d’échanger est au moins aussi précieux, aussi socialement important, aussi caractéristique de la propriété que le droit de donner. Il est à regretter que dans un ouvrage destiné à examiner la propriété sous tous ses aspects, vous ayez cru devoir consacrer deux chapitres au Don, qui n’est guère en péril, et pas une ligne à l’Échange, si impudemment violé sous l’autorité même des lois du pays.
Encore un coup d’épingles. Ah ! il nous met à la page 47.
« L’homme a une première propriété dans sa personne et ses facultés. Il en a une seconde, moins adhérente à son être, mais non moins sacrée, dans le produit de ces facultés qui embrasse tout ce qu’on appelle les biens de ce monde, et que la société est intéressée au plus haut point à lui garantir, car, sans cette garantie, point de travail, sans travail, pas de civilisation, pas même le nécessaire, mais la misère, le brigandage et la barbarie. »
Eh bien, Monsieur, dissertons, si vous le voulez, sur ce texte.
Comme vous, je vois la propriété d’abord dans la libre disposition de la personne, ensuite des facultés, enfin du produit des facultés, ce qui prouve, pour le dire en passant, qu’à un certain point de vue, Liberté et Propriété se confondent.
À peine oserais-je dire, comme vous, que la Propriété du produit de nos facultés est moins adhérente à notre être que celle de ces facultés elles-mêmes. Matériellement, cela est incontestable ; mais qu’on prive un homme de ses facultés ou de leur produit, le résultat est le même, et ce résultat s’appelle Esclavage. Nouvelle preuve d’une identité de nature entre la Liberté et la Propriété. Si je fais tourner par force tout le travail d’un homme à mon profit, cet homme est mon esclave. Il l’est encore si, le laissant travailler librement, je trouve le moyen, par force ou par ruse, de m’emparer du fruit de son travail. Le premier genre d’oppression est plus odieux, le second est plus habile. Comme on a remarqué que le travail libre est plus intelligent et plus productif, les maîtres se sont dit : N’usurpons pas directement les facultés de nos esclaves, mais accaparons le produit plus riche de leurs facultés libres, et donnons à cette forme nouvelle de servitude le beau nom de protection.
Vous dites encore que la société est intéressée à garantir la propriété. Nous sommes d’accord ; seulement je vais plus loin que vous, et si par la société vous entendez le gouvernement, je dis que sa seule mission, en ce qui concerne la propriété, est de la garantir ; que s’il essaie de la pondérer, par cela même, au lieu de la garantir, il la viole. Ceci mérite d’être examiné.
Quand un certain nombre d’hommes, qui ne peuvent vivre sans travail et sans propriétés, se cotisent pour solder une force commune, évidemment ils ont pour but de travailler et de jouir du fruit de leur travail en toute sécurité, et non point de mettre leurs facultés et propriétés à la merci de cette force. Même avant toute forme de gouvernement régulier, je ne crois pas qu’on puisse contester aux individualités le droit de défense, le droit de défendre leurs personnes, leurs facultés et leurs biens.
Sans prétendre philosopher ici sur l’origine et l’étendue des droits des gouvernements, vaste sujet bien propre à effrayer ma faiblesse, permettez-moi de vous soumettre une idée. Il me semble que les droits de l’État ne peuvent être que la régularisation de droits personnels préexistants. Je ne puis, quant à moi, concevoir un droit collectif qui n’ait sa racine dans le droit individuel et ne le suppose. Donc, pour savoir si l’État est légitimement investi d’un droit, il faut se demander si ce droit réside dans l’individu en vertu de son organisation et en l’absence de tout gouvernement. C’est sur cette idée que je repoussais, il y a quelques jours, le droit au travail. Je disais : Puisque Pierre n’a pas le droit d’exiger directement de Paul que celui-ci lui donne du travail, il n’est pas davantage fondé à exercer ce prétendu droit par l’intermédiaire de l’État, car l’État n’est que la force commune créée par Pierre et par Paul, à leurs frais, dans un but déterminé, lequel ne saurait jamais être de rendre juste ce qui ne l’est pas. C’est à cette pierre de touche que je juge aussi entre la garantie et la pondération des propriétés par l’État. Pourquoi l’État a-t-il le droit de garantir, même par force, à chacun sa Propriété ? Parce que ce droit préexiste dans l’individu. On ne peut contester aux individualités, le droit de légitime défense, le droit d’employer la force au besoin pour repousser les atteintes dirigées contre leurs personnes, leurs facultés et leurs biens. On conçoit que ce droit individuel, puisqu’il réside en tous les citoyens, puisse revêtir la forme collective et légitimer la force commune. Et pourquoi l’État n’a-t-il pas le droit de pondérer les propriétés ? Parce que pour les pondérer il faut les ravir aux uns et en gratifier les autres. Or, aucun des trente millions de Français n’ayant le droit de prendre, par force, sous prétexte d’arriver à l’égalité, on ne voit pas comment ils pourraient investir de ce droit la force commune.
Et remarquez que le droit de pondération est destructif du droit de garantie. Voilà des sauvages. Ils n’ont pas encore fondé de gouvernement. Mais chacun d’eux a le droit de légitime défense, et il n’est pas difficile de voir que c’est ce droit qui deviendra la base d’une force commune légitime. Si l’un de ces sauvages a consacré son temps, ses forces, son intelligence à se créer un arc et des flèches, et qu’un autre veuille les lui ravir, toutes les sympathies de la tribu seront pour la victime ; et si la cause est soumise au jugement des vieillards, le spoliateur sera infailliblement condamné. Il n’y a de là qu’un pas à organiser la force publique. Mais, je vous le demande, cette force a-t-elle pour mission, du moins pour mission légitime, de régulariser l’acte de celui qui défend, en vertu du droit, sa propriété, ou l’acte de celui qui viole, contre le droit, la propriété d’autrui ? Il serait assez singulier que la force collective fût fondée non sur le droit individuel, mais sur sa violation permanente et systématique ! Non, l’auteur du livre que j’ai sous les yeux ne peut soutenir une semblable thèse. Mais ce n’est pas tout qu’il ne la soutienne pas, il eût peut être dû la combattre. Ce n’est pas tout d’attaquer ce Communisme grossier et absurde que quelques sectaires posent dans des feuilles décriées. Il eût peut-être été bon de dévoiler et de flétrir cet autre Communisme audacieux et subtil qui, par la simple perversion de la juste idée des droits de l’État, s’est insinué dans quelques branches de notre législation et menace de les envahir toutes.
Car, Monsieur, il est bien incontestable que par le jeu des tarifs, au moyen du régime dit Protecteur, les gouvernements réalisent cette monstruosité dont je parlais tout à l’heure. Ils désertent ce droit de légitime défense préexistant dans chaque citoyen, source et raison d’être de leur propre mission, pour s’attribuer un prétendu droit de nivellement par voie de spoliation, droit qui ne résidant antérieurement en personne ne peut résider davantage dans la communauté.
Mais à quoi bon insister sur ces idées générales ? À quoi bon démontrer ici l’absurdité du Communisme, puisque vous l’avez fait vous-même (sauf quant à une de ses manifestations, et selon moi la plus pratiquement menaçante), beaucoup mieux que je ne saurais le faire ?
Peut-être me dites-vous que le principe du Régime Protecteur n’est pas en opposition avec le principe de la Propriété. Voyons donc les procédés de ce régime.
Il y en a deux : la prime et la restriction.
Quant à la prime, cela est évident. J’ose défier qui que ce soit de soutenir que le dernier terme du système des primes, poussé jusqu’au bout, ne soit pas le Communisme absolu. Les citoyens travaillent à l’abri de la force commune chargée, comme vous dites, de garantir à chacun le sien, suum cuique. Mais voici que l’État, avec les plus philanthropiques intentions du monde, entreprend une tâche toute nouvelle, toute différente, et, selon moi, non-seulement exclusive, mais destructive de la première. Il lui plaît de se faire juge des profits, de décider que tel travail n’est pas assez rémunéré, que tel autre l’est trop ; il lui plaît de se poser en pondérateur et de faire, comme dit M. Billault, osciller le pendule de la civilisation du côté opposé à la liberté de l’individualisme. En conséquence, il frappe sur la communauté tout entière une contribution pour faire un cadeau, sous le nom de primes, aux exportateurs d’une nature particulière de produits. Sa prétention est de favoriser l’industrie ; il devrait dire une industrie aux dépens de toutes les autres. Je ne m’arrêterai pas à montrer qu’il stimule la branche gourmande aux dépens des branches à fruits ; mais, je vous le demande, en entrant dans cette voie, n’autorise-t-il pas tout travailleur à venir réclamer une prime, s’il apporte la preuve qu’il ne gagne pas autant que son voisin ? L’État a-t-il pour mission d’écouter, d’apprécier toutes ces requêtes et d’y faire droit ? Je ne crois pas ; mais ceux qui le croient doivent avoir le courage de revêtir leur pensée de sa formule et de dire : Le gouvernement n’est pas chargé de garantir les propriétés, mais de les niveler. En d’autres termes : il n’y a pas de Propriété.
Je ne traite ici qu’une question de principe. Si je voulais scruter les primes à l’exportation dans leurs effets économiques, je les montrerais sous le jour le plus ridicule, car elles ne sont qu’un don gratuit fait par la France à l’étranger. Ce n’est pas le vendeur qui la reçoit, mais l’acheteur, en vertu de cette loi que vous avez vous-même constatée à propos de l’impôt : le consommateur, en définitive, supporte toutes les charges, comme il recueille tous les avantages de la production. Aussi, il nous est arrivé au sujet de ces primes la chose la plus mortifiante et la plus mystifiante possible. Quelques gouvernements étrangers ont fait ce raisonnement : « Si nous élevons nos droits d’entrée d’un chiffre égal à la prime payée par les contribuables français, il est clair que rien ne sera changé pour nos consommateurs, car le prix de revient sera pour eux le même. La marchandise dégrévée de 5 fr. à la frontière française paiera 5 fr. de plus à la frontière allemande ; c’est un moyen infaillible de mettre nos dépenses publiques à la charge du Trésor français. » Mais d’autres gouvernements, m’assure-t-on, ont été plus ingénieux encore. Ils se sont dit : « La prime donnée par la France est bien un cadeau qu’elle nous fait ; mais si nous élevons le droit, il n’y a pas de raison pour qu’il entre chez nous plus de cette marchandise que par le passé ; nous mettons nous-mêmes une borne à la générosité de ces excellents Français. Abolissons, au contraire, provisoirement ces droits ; provoquons ainsi une introduction inusitée de leurs draps, puisque chaque mètre porte avec lui un pur don gratuit. » Dans le premier cas, nos primes ont été au fisc étranger ; dans le second, elles ont profité, mais sur une plus large échelle, aux simples citoyens.
Passons à la restriction.
Je suis artisan, menuisier, par exemple. J’ai un petit atelier, des outils, quelques matériaux. Tout cela est incontestablement à moi, car j’ai fait ces choses, ou, ce qui revient au même, je les ai achetées et payées. De plus, j’ai des bras vigoureux, un peu d’intelligence et beaucoup de bonne volonté. C’est avec ce fonds que je dois pourvoir à mes besoins et à ceux de ma famille. Remarquez que je ne puis produire directement rien de ce qui m’est nécessaire, ni fer, ni bois, ni pain, ni vin, ni viandes, ni étoffes, etc., mais j’en puis produire la valeur. En définitive, ces choses doivent, pour ainsi dire, sortir, sous une autre forme, de ma scie et de mon rabot. Mon intérêt est d’en recevoir honnêtement la plus grande quantité possible contre chaque quantité donnée de mon travail. Je dis honnêtement, car je ne désire violer la propriété et la liberté de personne. Mais Je voudrais bien qu’on ne violât pas non plus ma propriété ni ma liberté. Les autres travailleurs et moi, d’accord sur ce point, nous nous imposons des sacrifices, nous cédons une partie de notre travail à des hommes appelés fonctionnaires, parce que nous leur donnons la fonction spéciale de garantir notre travail et ses fruits de toute atteinte, qu’elle vienne du dehors ou du dedans.
Les choses ainsi arrangées, je m’apprête à mettre en activité mon intelligence, mes bras, ma scie et mon rabot. Naturellement j’ai toujours les yeux fixés sur les choses qui sont nécessaires à mon existence. Ce sont ces choses que je dois produire indirectement en en créant la valeur. Le problème est pour moi de les produire le plus avantageusement possible. En conséquence, je jette un coup d’œil sur le monde des valeurs, résumé dans ce qu’on appelle un prix courant. Je constate, d’après les données de ce prix courant, que le moyen pour moi d’avoir la plus grande quantité possible de combustible, par exemple, avec la plus petite quantité possible de travail, c’est de faire un meuble, de le livrer à un Belge, qui me donnera en retour de la houille.
Mais il y a en France un travailleur qui cherche de la houille dans les entrailles de la terre. Or, il est arrivé que les fonctionnaires, que le mineur et moi contribuons à payer pour maintenir à chacun de nous la liberté du travail, et la libre disposition de ses produits (ce qui est la Propriété), il est arrivé, dis-je, que ces fonctionnaires ont conçu une autre pensée, et se sont donné une autre mission. Ils se sont mis en tête qu’ils devaient pondérer mon travail et celui du mineur. En conséquence, ils m’ont défendu de me chauffer avec du combustible belge, et quand je vais à la frontière avec mon meuble pour recevoir la houille, je trouve que ces fonctionnaires empêchent la houille d’entrer, ce qui revient au même que s’ils empêchaient mon meuble de sortir. Je me dis alors : Si nous n’avions pas imaginé de payer des fonctionnaires afin de nous épargner le soin de défendre nous-mêmes notre propriété, le mineur aurait-il eu le droit d’aller à la frontière m’interdire un échange avantageux, sous le prétexte qu’il vaut mieux pour lui que cet échange ne s’accomplisse pas ? Assurément non. S’il avait fait une tentative aussi injuste, nous nous serions battus sur place, lui, poussé par son injuste prétention, moi, fort de mon droit de légitime défense. Nous avions nommé et nous payions un fonctionnaire précisément pour éviter de tels combats. Comment donc se fait-il que je trouve le mineur et le fonctionnaire d’accord pour restreindre ma liberté et mon industrie, pour rétrécir le cercle où mes facultés pourront s’exercer ? Si le fonctionnaire avait pris mon parti, je concevrais son droit ; il dériverait du mien, car la légitime défense est bien un droit. Mais où a-t-il puisé celui d’aider le mineur dans sou injustice ? J’apprends alors que le fonctionnaire a changé de rôle. Ce n’est plus un simple mortel investi de droits à lui délégués par d’autres hommes qui, par conséquent, les possédaient. Non. Il est un être supérieur à l’humanité, puisant ses droits en lui même, et parmi ses droits, il s’arroge celui de pondérer les profits, de tenir l’équilibre entre toutes les positions et conditions. C’est fort bien, dis-je, en ce cas, je vais l’accabler de réclamations et de requêtes, tant que je verrai un homme plus riche que moi sur la surface du pays. Il ne vous écoutera pas, m’est-il répondu, car s’il vous écoutait il serait Communiste, et il se garde bien d’oublier que sa mission est de garantir les propriétés, non de les niveler.
Quel désordre, quelle confusion dans les faits ! et comment voulez-vous qu’il n’en résulte pas du désordre et de la confusion dans les idées ? Vous avez beau combattre le Communisme, tant qu’on vous verra le ménager, le choyer, le caresser dans cette partie de la législation qu’il a envahie, vos efforts seront vains. C’est un serpent qui, avec votre approbation, par vos soins, a glissé sa tête dans nos lois et dans nos mœurs, et maintenant vous vous indignez de ce que la queue s’y montre à son tour !
Il est possible, Monsieur, que vous me fassiez une concession ; vous me direz, peut-être : Le régime protecteur repose sur le principe communiste. Il est contraire au droit, à la propriété, à la liberté ; il jette le gouvernement hors de sa voie et l’investit d’attributions arbitraires qui n’ont pas d’origine rationnelle. Tout cela n’est que trop vrai ; mais le régime protecteur est utile ; sans lui le pays, succombant sous la concurrence étrangère, serait ruiné.
Ceci nous conduirait à examiner la restriction au point du vue économique. Mettant de côté toute considération de justice, de droit, d’équité, de propriété, de liberté, nous aurions à résoudre la question de pure utilité, la question vénale, pour ainsi parler, et vous conviendrez que cela n’est pas mon sujet. Prenez garde d’ailleurs qu’en vous prévalant de l’utilité pour justifier le mépris du droit, c’est comme si vous disiez : « Le Communisme, ou la spoliation, condamné par la justice, peut néanmoins être admis comme expédient. » Et convenez qu’un tel aveu est plein de dangers.
Sans chercher à résoudre ici le problème économique, permettez-moi une assertion. J’affirme que j’ai soumis au calcul arithmétique les avantages et les inconvénients de la protection au point de vue de la seule richesse, et toute considération d’un ordre supérieur mise de côté. J’affirme, en outre, que je suis arrivé à ce résultat : que toute mesure restrictive produit un avantage et deux inconvénients, ou, si vous voulez, un profit et deux pertes, chacune de ces pertes égale au profit, d’où il résulte une perte sèche, définitive, laquelle vient rendre ce consolant témoignage qu’en ceci, comme en bien d’autres choses, et j’ose dire en tout, Utilité et Justice concordent.
Ceci n’est qu’une affirmation, c’est vrai ; mais on peut l’appuyer de preuves mathématiques.
Ce qui fait que l’opinion publique s’égare sur ce point, c’est que le Profit de la protection est visible à l’œil nu, tandis que des deux Pertes égales qu’elle entraîne, l’une se divise à l’infini entre tous les citoyens, et l’autre ne se montre qu’à l’œil investigateur de l’esprit.
Sans prétendre faire ici cette démonstration, qu’il me soit permis d’en indiquer la base.
Deux produits, A et B, ont en France une valeur normale de 50 et 40. Admettons que A ne vaille en Belgique que 40. Ceci posé, si la France est soumise au régime restrictif, elle aura la jouissance de A et de B en détournant de l’ensemble de ses efforts une quantité égale à 90, car elle sera réduite à produire A directement. Si elle est libre, cette somme d’efforts, égale à 90, fera face : 1° à la production de B qu’elle livrera à la Belgique pour en obtenir A ; 2° la production d’un autre B pour elle-même ; 3° à la production de C.
C’est cette portion de travail disponible appliqué à la production de C dans le second cas, c’est-à-dire créant une nouvelle richesse égale à 10, sans que pour cela la France soit privée ni de A ni de B, qui fait toute la difficulté. À la place de A, mettez du fer ; à la place de B, du vin, de la soie, des articles Paris ; à la place de C, mettez de la richesse absente, vous trouverez toujours que la Restriction restreint le bien-être national [6].
Voulez-vous que nous sortions de cette pesante algèbre ? je le veux bien. Vous ne nierez pas que si le régime prohibitif est parvenu à faire quelque bien à l’industrie houillère ce n’est qu’en élevant le prix de la houille. Vous ne nierez pas non plus que cet excédant de prix, depuis 1822 jusqu’à nos jours, n’ait occasionné une dépense supérieure, pour chaque satisfaction déterminée, à tous ceux qui emploient ce combustible, en d’autres termes, qu’il ne représente une perte. Peut-on dire que les producteurs de houille, outre l’intérêt de leurs capitaux et les profits ordinaires de l’industrie, ont recueilli, par le fait de la restriction, un extra-bénéfice équivalent à cette perte ? Il le faudrait pour que la protection, sans cesser d’être injuste, odieuse, spoliatrice et communiste, fût au moins neutre au point de vue purement économique. Il le faudrait pour qu’elle méritat d’être assimilée à la simple Spoliation qui déplace la richesse sans la détruire. Mais vous affirmez vous-même, page 236, « que les mines de l’Aveyron, d’Alais, de Saint-Etienne, du Creuzot, d’Anzin, les plus célèbres de toutes, n’ont pas produit un revenu de 4 p. 100 du capital engagé ! » Pour qu’un capital en France donne 4 p. 100, il n’a pas besoin de protection. Où est donc ici le profit à opposer à la perte signalée ?
Ce n’est pas tout. Il y a là une autre perte nationale. Puisque, par le renchérissement relatif du combustible, tous les consommateurs de houille ont perdu, ils ont dû restreindre proportionnellement leurs autres consommations, et l’ensemble du travail national a été nécessairement découragé dans cette mesure. C’est cette perte qu’on ne fait jamais entrer en ligne de compte, parce qu’elle ne frappe pas les regards.
Permettez-moi encore une observation dont je suis surpris qu’on ne se soit pas plus frappé. C’est que la protection appliquée aux produits agricoles se montre dans toute son odieuse iniquité à l’égard de ce qu’on nomme les Prolétaires, tout en nuisant, à la longue, aux propriétaires fonciers eux-mêmes.
Imaginons dans les mers du Sud une île dont le sol soit devenu la propriété privée d’un certain nombre d’habitants.
Imaginons, sur ce territoire approprié et borné, une population prolétaire toujours croissante ou tendant à s’accroître [7].
Cette dernière classe ne pourra rien produire directement de ce qui est indispensable à la vie. Il faudra qu’elle livre son travail à des hommes qui soient en mesure de lui fournir en échange des aliments, et même des matériaux de travail ; des céréales, des fruits, des légumes, de la viande, de la laine, du lin, du cuir, du bois, etc.
Son intérêt évident est que le marché où se vendent ces choses soit le plus étendu possible. Plus elle se trouvera en présence d’une plus grande abondance de ces produits agricoles, plus elle en recevra pour chaque quantité donnée de son propre travail.
Sous un régime libre, on verra une foule d’embarcations aller chercher des aliments et des matériaux dans les îles et les continents voisins, et y porter en paiement des produits façonnés. Les propriétaires jouiront de toute la prospérité à laquelle ils ont droit de prétendre ; un juste équilibre sera maintenu entre la valeur du travail industriel et celle du travail agricole.
Mais, dans cette situation, les propriétaires de l’île font ce calcul : Si nous empêchions les prolétaires de travailler pour les étrangers et d’en recevoir en échange des subsistances et des matières premières, ils seraient bien forcés de s’adresser à nous. Comme leur nombre croît sans cesse, et que la concurrence qu’ils se font entre eux est toujours plus active, ils se presseraient sur cette portion d’aliments et de matériaux qu’il nous resterait à exposer en vente, après avoir prélevé ce qui nous est nécessaire, et nous ne pourrions manquer de vendre nos produits à très-haut prix. En d’autres termes, l’équilibre serait rompu dans la valeur relative de leur travail et du nôtre. Ils consacreraient à nos satisfactions un plus grand nombre d’heures de labeur. Faisons donc une loi prohibitive de ce commerce qui nous gêne, et, pour l’exécution de cette loi, créons un corps de fonctionnaires que les prolétaires contribueront avec nous à payer.
Je vous le demande, ne serait-ce pas le comble de l’oppression, une violation flagrante de la plus précieuse de toutes les Libertés, de la première et de la plus sacrée de toutes les Propriétés ?
Cependant, remarquez-le bien, il ne serait peut-être pas difficile aux propriétaires fonciers de faire accepter cette loi comme un bienfait par les travailleurs. Ils ne manqueraient pas de leur dire :
« Ce n’est pas pour nous, honnêtes créatures, que nous l’avons faite, mais pour vous. Notre intérêt nous touche peu, nous ne pensons qu’au vôtre. Grâce à cette sage mesure, l’agriculture va prospérer ; nous, propriétaires, nous deviendrons riches, ce qui nous mettra à même de vous faire beaucoup travailler, et de vous payer de bons salaires. Sans elle nous serions réduits à la misère, et que deviendriez-vous ? L’île serait inondée de subsistances et de matériaux de travail venus du dehors, vos barques seraient toujours à la mer ; quelle calamité nationale ! L’abondance, il est vrai, régnerait autour de vous, mais y prendriez-vous-part ? Ne dites pas que vos salaires se maintiendraient et s’élèveraient parce que les étrangers ne feraient qu’augmenter le nombre de ceux qui vous commandent du travail. Qui vous assure qu’il ne leur prendra pas fantaisie de vous livrer leurs produits pour rien ? En ce cas, n’ayant plus ni travail ni salaire, vous périrez d’inanition au milieu de l’abondance. Croyez-nous, acceptez notre loi avec reconnaissance. Croissez et multipliez ; ce qu’il restera de vivres dans l’île au delà de notre consommation, vous sera livré contre votre travail, qui, par ce moyen, vous sera toujours assuré. Surtout gardez-vous de croire qu’il s’agit ici d’un débat entre vous et nous, dans lequel votre liberté et votre propriété sont en jeu. N’écoutez jamais ceux qui vous le disent. Tenez pour certain que le débat est entre vous et l’étranger, ce barbare étranger, que Dieu maudisse, et qui veut évidemment vous exploiter en vous offrant des transactions perfides, que vous êtes libres d’accepter ou de repousser. »
Il n’est pas invraisemblable qu’un pareil discours, convenablement assaisonné de sophismes sur le numéraire, la balance du commerce, le travail national, l’agriculture nourricière de l’État, la perspective d’une guerre, etc., etc., n’obtînt le plus grand succès, et ne fît sanctionner le décret oppresseur par les opprimés eux-mêmes, s’ils étaient consultés. Cela s’est vu et se verra.
Mais les préventions des propriétaires et des prolétaires ne changent pas la nature des choses. Le résultat sera une population misérable, affamée, ignorante, pervertie, moissonnée par l’inanition, la maladie et le vice. Le résultat sera encore le triste naufrage, dans les intelligences, des notions du Droit, de la Propriété, de la Liberté et des vraies attributions de l’État.
Et ce que je voudrais bien pouvoir démontrer ici, c’est que le châtiment remontera bientôt aux propriétaires eux-mêmes, qui auront préparé leur propre ruine par la ruine du public consommateur ; car, dans cette île, on verra la population, de plus en plus abaissée, se jeter sur les aliments les plus inférieurs. Ici elle se nourrira de châtaignes, là de maïs, plus loin de millet, de sarrasin, d’avoine, de pommes de terre. Elle ne connaîtra plus le goût du blé et de la viande. Les propriétaires seront tout étonnés de voir l’agriculture décliner. Ils auront beau s’agiter, se réunir en comices, y ressasser éternellement le fameux adage : « Faisons des fourrages ; avec des fourrages, on a des bestiaux ; avec des bestiaux, des engrais ; avec des engrais, du blé. » Ils auront beau créer de nouveaux impôts pour distribuer des primes aux producteurs de trèfle et de luzerne ; ils se briseront toujours contre cet obstacle : une population misérable hors d’état de payer la viande, et, par conséquent, de donner le premier mouvement à cette triviale rotation. Ils finiront par apprendre, à leurs dépens, que mieux vaut subir la concurrence, en face d’une clientèle riche, que d’être investi d’un monopole en présence d’une clientèle ruinée.
Voilà pourquoi je dis : non-seulement la prohibition c’est du Communisme, mais c’est du Communisme de la pire espèce. Il commence par mettre les facultés et le travail du pauvre, sa seule Propriété, à la discrétion du riche : il entraîne une perte sèche pour la masse, et finit par envelopper le riche lui-même dans la ruine commune. Il investit l’État du singulier droit de prendre à ceux qui ont peu pour donner à ceux qui ont beaucoup ; et quand, en vertu de ce principe, les déshérités du monde invoqueront l’intervention de l’État pour opérer un nivellement en sens inverse, je ne sais vraiment pas ce qu’il y aura à leur répondre. En tout cas, la première réponse, et la meilleure, serait de renoncer à l’oppression.
Mais j’ai hâte d’en finir avec ces calculs. Après tout, quelle est la position du débat ? Que disons-nous et que dites-vous ? Il y a un point, et c’est le point capital, sur lequel nous sommes d’accord : c’est que l’intervention du législateur pour niveler les fortunes en prenant aux uns de quoi gratifier les autres, c’est du communisme, c’est la mort de tout travail, de toute épargne, de tout bien-être, de toute justice, de toute société.
Vous vous apercevez que cette doctrine funeste envahit sous toutes les formes les journaux et les livres, en un mot le domaine de la spéculation, et vous l’y attaquez avec vigueur.
Moi, je crois reconnaître qu’elle avait précédemment pénétré, avec votre assentiment et votre assistance, dans la législation et dans le domaine de la pratique, et c’est là que je m’efforce de la combattre.
Ensuite, je vous fais remarquer l’inconséquence où vous tomberiez si, combattant le Communisme en perspective, vous ménagiez, bien plus, vous encouragiez le Communisme en action.
Si vous me répondez : « J’agis ainsi parce que le Communisme réalisé par les tarifs, quoique opposé à la Liberté, à la Propriété, à la Justice, est néanmoins d’accord avec l’Utilité générale, et cette considération me fait passer par-dessus toutes les autres ; » si vous me répondez cela, ne sentez-vous pas que vous ruinez d’avance tout le succès de votre livre, que vous en détruisez la portée, que vous le privez de sa force et donnez raison, au moins sur la partie philosophique et morale de la question, aux communistes de toutes les nuances ?
Et puis, Monsieur, un esprit aussi éclairé que le vôtre pourrait-il admettre l’hypothèse d’un antagonisme radical entre l’Utile et le Juste ? Voulez-vous que je parle franchement ? Plutôt que de hasarder une assertion aussi subversive, aussi impie, j’aimerais mieux dire : « Voici une question spéciale dans laquelle, au premier coup d’œil, il me semble que l’Utilité et la Justice se heurtent. Je me réjouis que tous les hommes qui ont passé leur vie à l’approfondir en jugent autrement ; je ne l’ai sans doute pas assez étudiée. » Je ne l’ai pas assez étudiée ! Est-ce donc un aveu si pénible que, pour ne pas le faire, on se jette dans l’inconséquence jusqu’à nier la sagesse des lois providentielles qui président au développement des sociétés humaines ? Car quelle plus formelle négation de la Sagesse Divine que de décider l’incompatibilité essentielle de la Justice et de l’Utilité ! Il m’a toujours paru que la plus cruelle angoisse dont un esprit intelligent et consciencieux puisse être affligé, c’est de trébucher à cette borne. De quel côté se mettre, en effet, quel parti prendre en face d’une telle alternative ? Se prononcera-t-on pour l’Utilité ? c’est à quoi inclinent les hommes qui se disent pratiques. Mais à moins qu’ils ne sachent pas lier deux idées, ils s’effraieront sans doute devant les conséquences de la spoliation et de l’iniquité réduites en système. Embrassera-t-on résolûment, et quoi qu’il en coûte, la cause de la Justice, disant : Fais ce que dois, advienne que pourra ? C’est à quoi penchent les âmes honnêtes ; mais qui voudrait prendre la responsabilité de plonger son pays et l’humanité dans la misère, la désolation et la mort ? Je défie qui que ce soit, s’il est convaincu de cet antagonisme, de se décider.
Je me trompe. On se décidera, et le cœur humain est ainsi fait qu’on mettra l’intérêt avant la conscience. C’est ce que le fait démontre, puisque partout où l’on a cru le régime protecteur favorable au bien-être du peuple, on l’a adopté, en dépit de toute considération de justice ; mais alors les conséquences sont arrivées. La foi dans la propriété s’est effacée. On a dit comme M. Billault : Puisque la propriété a été violée par la Protection, pourquoi ne le serait-elle pas par le droit au travail ? D’autres, derrière M. Billault, feront un troisième pas, et d’autres, derrière ceux-là, un quatrième, jusqu’à ce que le Communisme ait prévalu [8].
De bons et solides esprits, comme le vôtre, s’épouvantent devant la rapidité de cette pente. Ils s’efforcent de la remonter ; ils la remontent, en effet, ainsi que vous l’avez fait dans votre livre, jusqu’au régime restrictif, qui est le premier élan et le seul élan pratique de la société sur la déclivité fatale ; mais en présence de cette négation vivante du droit de propriété, si, à la place de cette maxime de votre livre : « Les droits sont ou ne sont pas ; s’ils sont, ils entraînent des conséquences absolues, » vous substituez celle-ci : « Voici un cas particulier où le bien national exige le sacrifice du droit ; » à l’instant, tout ce que vous avez cru mettre de force et de raison dans cet ouvrage, n’est que faiblesse et inconséquence.
C’est pourquoi, Monsieur, si vous voulez achever votre œuvre, il faut que vous vous prononciez sur le régime restrictif, et pour cela il est indispensable de commencer par résoudre le problème économique ; il faut bien être fixé sur la prétendue Utilité de ce régime. Car, à supposer même que j’obtinsse de vous son arrêt de condamnation, au point de vue de la Justice, cela ne suffirait pas pour le tuer. Je le répète, les hommes sont ainsi faits que lorsqu’ils se croient placés entre le bien réel et le juste abstrait la cause de la justice court un grand danger. En voulez-vous une preuve palpable ? C’est ce qui m’est survenu à moi-même.
Quand j’arrivai à Paris, je me trouvai en présence d’écoles dites démocratiques et socialistes, où, comme vous savez, on fait grand usage des mots principe, dévouement, sacrifice, fraternité, droit, union. La richesse y est traitée de haut en bas, comme chose sinon méprisable, du moins secondaire ; jusque-là que, parce que nous en tenons grand compte, on nous y traite, nous, de froids économistes, d’égoïstes, d’individualistes, de bourgeois, d’hommes sans entrailles, ne reconnaissant pour Dieu que le vil intérêt [9]. Bon, me dis-je, voilà de nobles cœurs avec lesquels je n’ai pas besoin de discuter le point de vue économique, qui est fort subtil et exige plus d’application que les publicistes parisiens n’en peuvent, en général, accorder à une étude de ce genre. Mais, avec ceux-ci, la question d’Intérêt ne saurait être un obstacle ; ou ils le croiront, sur la foi de la Sagesse Divine, en harmonie avec la justice, ou ils le sacrifieront de grand cœur, car ils ont soif de Dévouement. Si donc ils m’accordent une fois que le Libre-Échange, c’est le droit abstrait, ils s’enrôleront résolûment sous sa bannière. En conséquence, je leur adressai mon appel. Savez-vous ce qu’ils me répondirent ? Le voici :
Votre Libre-Échange est une belle utopie. Il est fondé en droit et en justice ; il réalise la liberté ; il consacre la propriété ; il aurait pour conséquence l’union des peuples, le règne de la fraternité parmi les hommes. Vous avez mille fois raison en principe, mais nous vous combattrons à outrance et par tous les moyens, parce que la concurrence étrangère serait fatale au travail national.
Je pris la liberté de leur adresser cette réponse :
Je nie que la concurrence étrangère fût fatale au travail national. En tout cas, s’il en était ainsi, vous seriez placés entre l’Intérêt qui, selon vous, est du côté de la restriction, et la Justice qui, de votre aveu, est du côté de la liberté ! Or, quand moi, l’adorateur du veau d’or, je vous mets en demeure de faire votre choix, d’où vient que vous, les hommes de l’abnégation, vous foulez aux pieds les principes pour vous cramponner à l’intérêt ? Ne déclamez donc pas tant contre un mobile qui vous gouverne, comme il gouverne les simples mortels.
Cette expérience m’avertit qu’il fallait avant tout résoudre cet effrayant problème : Y a-t-il harmonie ou antagonisme entre la Justice et l’Utilité ? et, par conséquent, scruter le côté économique du régime restrictif ; car, puisque les Fraternitaires eux-mêmes lâchaient pied devant une prétendue perte d’argent, il devenait clair que ce n’est pas tout de mettre à l’abri du doute la cause de la Justice Universelle, il faut encore donner satisfaction à ce mobile indigne, abject, méprisable et méprisé, mais tout-puissant, l’Intérêt.
C’est ce qui a donné lieu à une petite démonstration en deux volumes, que je prends la liberté de vous envoyer avec la présente [10], bien convaincu, Monsieur, que si, comme les économistes, vous jugez sévèrement le régime protecteur, quant à sa moralité, et si nous ne différons qu’en ce qui concerne son utilité, vous ne refuserez pas de rechercher avec quelque soin, si ces deux grands éléments de la solution définitive s’excluent ou concordent.
Cette harmonie existe, ou du moins elle est aussi évidente pour moi que la lumière du soleil. Puisse-t-elle se révéler à vous ! C’est alors qu’appliquant votre talent éminemment propagateur à combattre le Communisme dans sa manifestation la plus dangereuse, vous lui porteriez un coup mortel.
Voyez ce qui se passe en Angleterre. Il semble que si le Communisme avait dû trouver quelque part une terre qui lui fût favorable, ce devait être le sol britannique. Là les institutions féodales plaçant partout, en face l’une de l’autre, l’extrême misère et l’extrême opulence, avaient dû préparer les esprits à l’infection des fausses doctrines. Et pourtant que voyons-nous ? Pendant qu’elles bouleversent le continent, elles n’ont pas seulement troublé la surface de la société anglaise. Le Chartisme n’a pas pu y prendre racine. Savez-vous pourquoi ? Parce que l’association qui, pendant dix ans, a discuté le régime protecteur n’en a triomphé qu’en jetant de vives lumières sur le principe de la Propriété et sur les fonctions rationnelles de l’État [11].
Sans doute, si démasquer le Prohibitionisme c’est atteindre le Communisme, par la même raison, et à cause de leur étroite connexité, on peut aussi les frapper tous deux en suivant, comme vous avez fait, la marche inverse. La restriction ne saurait résister longtemps devant une bonne définition du Droit de Propriété. Aussi, si quelque chose m’a surpris et réjoui, c’est de voir l’association pour la défense des monopoles consacrer ses ressources à propager votre livre. C’est un spectacle des plus piquants, et il me console de l’inutilité de mes efforts passés. Cette résolution du comité Mimerel vous obligera sans doute à multiplier les éditions de votre ouvrage. En ce cas, permettez-moi de vous faire observer que, tel qu’il est, il présente une grave lacune. Au nom de la science, au nom de la vérité, au nom du bien public, je vous adjure de la combler, et vous mets en demeure de répondre à ces deux questions :
1° Y a-t-il incompatibilité, en principe, entre le régime protecteur et le droit de propriété ?
2° La fonction du gouvernement est-elle de garantir à chacun le libre exercice de ses facultés et la libre disposition du fruit de son travail, c’est-à-dire la Propriété, ou bien de prendre aux uns pour donner aux autres, de manière à pondérer les profits, les chances et le bien-être ?
Ah ! Monsieur, si vous arriviez aux mêmes conclusions que moi ; si, grâce à votre talent, à votre renommée, à votre influence, vous faisiez prévaloir ces conclusions dans l’opinion publique, qui peut calculer l’étendue du service que vous rendriez à la société française ? On verrait l’État se renfermer dans sa mission, qui est de garantir à chacun l’exercice de ses facultés et la libre disposition de ses biens. On le verrait se décharger à la fois et de ses colossales attributions illégitimes et de l’effrayante responsabilité qui s’y attache. Il se bornerait à réprimer les abus de la liberté, ce qui est réaliser la liberté même. Il assurerait la justice à tous, et ne promettrait plus la fortune à personne. Les citoyens apprendraient à distinguer ce qu’il est raisonnable et ce qu’il est puéril de lui demander. Ils ne l’accableraient plus de prétentions et d’exigences ; ils ne l’accuseraient plus de leurs maux ; ils ne fonderaient plus sur lui des espérances chimériques ; et, dans cette ardente poursuite d’un bien dont il n’est pas le dispensateur, on ne les verrait pas, à chaque déception, accuser le législateur et la loi, changer les hommes et les formes du gouvernement, entasser institutions sur institutions et débris sur débris. On verrait s’éteindre cette universelle fièvre de spoliation réciproque par l’intervention si coûteuse et si périlleuse de l’État. Le gouvernement, limité dans son but et sa responsabilité, simple dans son action, peu dispendieux, ne faisant plus peser sur les gouvernés les frais de leurs propres chaînes, soutenu par le bon sens public, aurait une solidité qui, dans notre pays, n’a jamais été son partage, et nous aurions enfin résolu ce grand problème : Fermer à jamais l’abîme des révolutions.
FN:Au moment où parut cet opuscule, c’est-à-dire en janvier 1849, M. Thiers était fort en crédit à l’Élysée.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome Ier, les lettres adressées à M. de Lamartine en janvier 1845 et octobre 1846, et, au tome II, l’article Communisme, du 27 juin 1847.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome II, l’article Libre-Échange, du 20 décembre 1846.(Note de l’éditeur.)
FN:Cette pensée par laquelle, suivant l’auteur, M. Billault pouvait fortifier son argumentation, un autre protectioniste devait l’adopter bientôt. Elle fut développée par M. Mimerel, dans un discours prononcé le 27 avril 1850, devant le conseil général de l’agriculture, des manufactures et du commerce. Voy. le passage de ce discours cité au tome V, dans l’opuscule Spoliation et Loi.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au présent volume, page 94, le chap. xviii des Sophismes. Voy. aussi les p. 101 et 102.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome II, les articles Un profit contre deux pertes, Deux pertes contre un profit
FN:Voy., au présent tome, la 3e lettre de l’opuscule Propriété et Spoliation, p. 407 et suiv.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome V, les dernières pages du pamphlet intitulé Spoliation et Loi. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy. au tome II, la plupart des articles compris sous cette rubrique : Polémique contre les journaux, et notamment l’article intitulé : Le Parti démocratique et le Libre-Échange. (Note de l’éditeur.)
FN:Ces deux petits volumes, que l’auteur envoya en effet à M. Thiers, étaient la première et la seconde série des Sophismes.(Note de l’éditeur.)
FN:Voy. au tome II, l’introduction. (Note de l’éditeur.)
Conséquences de la réduction sur l’impôt du sel [1 Jan. 1849] [CW ??]↩
BWV
1849.01.01 “Conséquences de la réduction sur l’impôt du sel” (The Consequences of the Reduction in the Salt Tax) [*Journal des Débats*, 1 Jan. 1849] [OC5.9, p. 464] [CW ??]
(Journal des Débats, 1er janvier 1849.)
La réduction immédiate de l’impôt du sel a désorienté le cabinet sous un rapport ; il y a de quoi. On est, dit-on, à la recherche d’impôts nouveaux pour combler le vide. Est-ce bien là ce que l’Assemblée a voulu ? Dégréver pour regrever, ce ne serait qu’un jeu, et un de ces tristes jeux où tout le monde perd. Quelle est donc la signification de son vote ? La voici : Les dépenses vont toujours croissant ; il n’y a qu’un moyen de forcer l’État à les réduire, c’est de le mettre dans l’impossibilité absolue de faire autrement.
Le moyen qu’elle a pris est héroïque, il faut en convenir. Ce qu’il y a de plus grave encore, c’est que la réforme du sel avait été précédée de la réforme des postes, et sera suivie probablement de la réforme des boissons.
Le ministère est désorienté. Eh bien ! moi je dis que l’Assemblée ne pouvait lui faire une plus belle position. Voilà, pour lui, une occasion admirable, et pour ainsi dire providentielle, d’entrer dans une voie nouvelle, d’en finir avec la fausse philanthropie et les passions belliqueuses ; et, convertissant son échec en triomphe, de faire sortir la sécurité, la confiance, le crédit, la prospérité, d’un vote qui semblait les compromettre, et de fonder enfin la politique républicaine sur ces deux grands principes : Paix et liberté.
Après la résolution de l’Assemblée, je m’attendais, je l’avoue, à ce que le président du conseil montât à la tribune, et y tînt à peu près ce langage :
« Citoyens représentants,
Votre vote d’hier nous montre une nouvelle voie ; bien plus, il nous force d’y entrer.
Vous savez combien la révolution de Février avait éveillé d’espérances chimériques et de systèmes dangereux. Ces espérances, ces systèmes, revêtus des fausses couleurs de la philanthropie, et pénétrant dans cette enceinte sous forme de projets de loi, n’allaient à rien moins qu’à ruiner la liberté et à engloutir la fortune publique. Nous ne savions quel parti prendre. Repousser tous ces projets, c’était heurter l’opinion populaire momentanément exaltée ; les admettre, c’était compromettre l’avenir, violer tous les droits, et fausser les attributions de l’État. Que pouvions-nous faire ? Atermoyer, transiger, composer avec l’erreur, donner une demi-satisfaction aux utopistes, éclairer le peuple par la dure leçon de l’expérience, créer des administrations avec l’arrière-pensée de les anéantir plus tard, ce qui n’est pas facile. Maintenant, grâce à l’Assemblée, nous voici à l’aise. Ne venez plus nous demander de monopoliser l’instruction, de monopoliser le crédit, de commanditer l’agriculture, de privilégier certaines industries, de systématiser l’aumône. Nous en avons fini avec la mauvaise queue du socialisme. Votre vote a porté le coup mortel à ses rêveries. Nous n’avons plus même à les discuter ; car à quoi mènerait la discussion, puisque vous nous avez ôté les moyens de faire ces dangereuses expériences ? Si quelqu’un sait le secret de faire de la philanthropie officielle sans argent, qu’il se présente ; voici nos portefeuilles, nous les lui céderons avec joie. Tant qu’ils resteront en nos mains, dans la nouvelle position qui nous est faite, il ne nous reste qu’à proclamer, comme principe de notre politique intérieure, la liberté, la liberté des arts, des sciences, de l’agriculture, de l’industrie, du travail, de l’échange, de la presse, de l’enseignement ; car la liberté est le seul système compatible avec un budget réduit. Il faut de l’argent à l’État pour réglementer et opprimer. Point d’argent, point de réglementation. Notre rôle, fort peu dispendieux, se bornera désormais à réprimer les abus, c’est-à-dire à empêcher que la liberté d’un citoyen ne s’exerce aux dépens de celle d’un autre.
Notre politique extérieure n’est pas moins indiquée et forcée. Nous tergiversions, nous tâtonnions encore ; maintenant nous sommes irrévocablement fixés, non par choix seulement, mais par nécessité. Heureux, mille fois heureux que cette nécessité nous impose justement la politique que nous aurions adopté par choix ! Nous sommes résolus à réduire notre état militaire. Remarquez bien qu’il n’y a pas à raisonner là-dessus, il faut agir ; car nous sommes placés entre le désarmement et la banqueroute. De deux maux, dit-on, il faut choisir le moindre. Ici, il n’y a à choisir, selon nous, qu’entre un bien immense et un mal effroyable ; et cependant, hier encore ce choix ne nous était, pas facile : la fausse philanthropie, les passions belliqueuses nous faisaient obstacle ; il fallait compter avec elles. Aujourd’hui elles sont forcément réduites au silence ; car, quoiqu’on dise que la passion ne raisonne pas, néanmoins elle ne peut déraisonner au point d’exiger que nous fassions la guerre sans argent. Nous venons donc proclamer à cette tribune le fait du désarmement, et comme conséquence, comme principe de notre politique extérieure, la non-intervention. Que l’on ne nous parle plus de prépondérance, de prépotence ; qu’on ne nous montre plus comme champ de gloire et de carnage la Hongrie, l’Italie, la Pologne. Nous savons ce qu’on peut dire pour ou contre la propagande armée, quand on a le choix. Mais vous ne disconviendrez pas que, quand on ne l’a plus, la controverse est superflue. L’armée va être réduite à ce qui est nécessaire pour garantir l’indépendance du pays, et du même coup, toutes les nations pourront compter désormais, en ce qui nous concerne, sur leur indépendance. Qu’elles réalisent leurs réformes comme elles l’entendront ; qu’elles n’entreprennent que ce qu’elles peuvent accomplir. Nous leur faisons savoir hautement et définitivement qu’aucun des partis qui les divisent n’ont plus à compter sur le concours de nos baïonnettes. Que dis-je ? ils n’ont pas même besoin de nos protestations, car ces baïonnettes vont rentrer dans le fourreau, ou plutôt, pour plus de sûreté, se convertir en charrues. J’entends des interruptions descendre de ces bancs, vous dites : C’est la politique du chacun chez soi, chacun pour soi. Hier encore nous aurions pu discuter la valeur de cette politique, puisque nous étions libres d’en adopter une autre. Hier, j’aurais invoqué des raisons. J’aurais dit : Oui, chacun chez soi, chacun pour soi, autant qu’il s’agit de force brutale. Ce n’est pas à dire que les liens des peuples seront brisés. Ayons avec tous des relations philosophiques, scientifiques, artistiques, littéraires, commerciales. C’est par là que l’humanité s’éclaire et progresse. Mais des rapports à coups de sabre et de fusil, je n’en veux pas. Parce que des familles parfaitement unies ne vont pas les unes chez les autres à main armée, dire qu’elles se conduisent sur la maxime chacun chez soi, c’est un étrange abus de mots. D’ailleurs, que dirions-nous si, pour terminer nos dissensions, lord Palmerston nous envoyait des régiments anglais ? Le rouge de l’indignation ne nous monterait-il pas au front ? Comment donc refusons-nous de croire que les autres peuples chérissent aussi leur dignité et leur indépendance ? Voilà ce que j’aurais dit hier, car quand on a le choix entre deux politiques, il faut justifier par des raisons celle qu’on préfère. Aujourd’hui je n’invoque que la nécessité, parce que l’option ne nous appartient plus. La majorité, qui nous a refusé les recettes pour nous forcer à diminuer les dépenses, ne sera pas assez inconséquente pour nous imposer une politique ruineuse. Si quelqu’un, sachant que l’impôt des postes, du sel et des boissons va être considérablement réduit ; sachant que nous sommes en présence d’un déficit de 500 millions, a encore l’audace de proclamer le principe de la propagande armée, qui, menaçant l’Europe, nous force, même en temps de paix, à des efforts ruineux, qu’il se lève et prenne ce portefeuille. Quant à nous, nous n’assumerons pas la honte d’une telle puérilité. Donc dès aujourd’hui la politique de la non-intervention est proclamée. Dès aujourd’hui des mesures sont prises pour licencier une partie de l’armée. Dès aujourd’hui des ordres partent pour supprimer d’inutiles ambassades.
Paix et liberté ! voilà la politique que nous eussions adoptée par conviction. Nous remercions l’Assemblée de nous en avoir fait une nécessité absolue et évidente. Elle fera le salut, la gloire et la prospérité de la République ; elle marquera nos noms dans l’histoire. »
Voilà, ce me semble, ce qu’eût dû dire le cabinet actuel. Sa parole eût rencontré l’universel assentiment de l’Assemblée, de la France et de l’Europe.
FN:Pamphlet publié en février 1849. — L’auteur avait écrit, un mois avant, dans le Journal des Débats, un article qu’à raison de l’identité du sujet nous reproduisons à la fin de Paix et Liberté. (Note de l’éditeur.)
FN:Sur les opinions politiques de l’auteur, V. au tome Ier, ses écrits et professions de foi publiés à l’occasion des élections. (Note de l’éditeur.)
FN:V. le pamphlet l’État, tome IV, page 327. (Note de l’éditeur.)
FN:We have got the bounds of profitable taxation. (Peel.)
FN:Je dis mien pour abréger ; mais je ne dois pas me poser en inventeur. Le directeur de la Presse a plusieurs fois émis l’idée fondamentale que je reproduis ici. Qui plus est, il en a fait, avec succès, l’application. Suum cuique.
FN:V. au tome IV, page 163, le chapitre intitulé Cherté, Bon marché. (Note de l’éditeur.)
FN:Dans le pamphlet Spoliation et Loi, qui commence ce volume, on a pu voir que l’auteur n’avait pas tardé à reconnaître combien il s’était trompé, en s’imaginant que les protectionistes étaient devenus raisonnables. Mais il est vrai qu’au commencement de 1849 ils se montraient beaucoup plus traitables qu’ils ne le furent un an plus tard. (Note de l’éditeur.)
FN:Le traité passé entre nos pères et le clergé est un obstacle à cette réforme si désirable. Justice avant tout.
FN:Cet aveuglement de l’opinion publique attristait l’auteur, depuis longtemps, et dès qu’une tentative pour consolider le bandeau placé sur les yeux de nos concitoyens lui était connue, il sentait le besoin de la combattre. Mais, dans sa retraite de Mugron, les moyens de publicité lui manquaient. Aussi la lettre suivante, écrite par lui, depuis nombre d’années, est-elle jusqu’à présent restée inédite.
À M. SAULNIER,
Éditeur de la Revue britannique.
Monsieur,
Vous avez transporté de joie tous ceux qui trouvent le mot économie absurde, ridicule, insupportable, bourgeois, mesquin. Le Journal des Débats vous prône, le président du conseil vous cite et les faveurs du pouvoir vous attendent. Qu’avez-vous fait cependant, Monsieur, pour mériter tant d’applaudissements ? Vous avez établi par des chiffres (et l’on sait que les chiffres ne trompent jamais), qu’il en coûte plus aux citoyens des États-Unis qu’aux sujets français pour être gouvernés. D’où la conséquence rigoureuse (rigoureuse pour le peuple en effet), qu’il est absurde de vouloir en France mettre des bornes aux profusions du pouvoir.
Mais, Monsieur, j’en demande pardon à vous, aux centres et à la statistique, vos chiffres, en les supposant exacts, ne me semblent pas défavorables au gouvernement américain.
En premier lieu, établir qu’un gouvernement dépense plus qu’un autre, ce n’est rien apprendre sur leur bonté relative. Si l’un d’eux, par exemple, administre une nation naissante, qui a toutes ses routes à percer, tous ses canaux à creuser, toutes ses villes à paver, tous ses établissements publics à créer, il est naturel qu’il dépense plus que celui qui n’a guère qu’à entretenir des établissements existants. Or, vous le savez comme moi, Monsieur, dépenser ainsi c’est épargner, c’est capitaliser. S’il s’agissait d’un agriculteur, confondriez-vous les mises de fonds qu’exige un premier établissement avec ses dépenses annuelles ?
Cependant cette différence de situation très-importante n’entraîne, d’après vos chiffres, qu’un surcroît de dépense de trois francs pour chaque citoyen de l’Union. Cet excédent est-il réel ? Non, d’après vos propres données. — Cela vous surprend, car vous avez fixé à 36 fr. la contribution de chaque Américain, et à 33 fr. celle de chaque Français ; or 36 = 33 + 3, en bonne arithmétique. — Oui, mais, en économie politique, 33 valent souvent plus que 36. Vous allez en juger. L’argent, relativement à la main-d’œuvre et aux marchandises, n’a pas autant de valeur aux États-Unis qu’en France. Vous fixez vous-même le prix de la journée à 4 fr. 50 c. aux États-Unis et à 1 fr. 50 c. en France. Il en résulte, je crois, qu’un Américain paye 36 fr. avec huit journées, tandis qu’il faut à un Français vingt-deux journées de travail pour payer 33 fr. — Il est vrai que vous dites aussi qu’on se rachète des corvées aux États-Unis avec 3 fr. et que, par conséquent, le prix de la journée y doit être établi à 3 fr. — À cela, deux réponses. On se rachète de la corvée, en France, avec 1 fr. (car nous avons aussi nos corvées dont vous ne parlez pas) ; et ensuite, si la journée aux États-Unis ne vaut que 3 fr., les Américains ne payent plus 36 fr., puisque, pour arriver à ce chiffre, vous avez porté à 4 fr. 50 c. toutes les journées que ces citoyens emploient à remplir leurs devoirs de miliciens, de corvéables, de jurés, etc.
Ce n’est pas la seule subtilité dont vous avez usé pour élever à 36 fr. la contribution annuelle de chaque Américain.
Vous imputez au gouvernement des États-Unis des dépenses dont il ne se mêle en aucune façon. Pour justifier cette étrange manière de procéder, vous dites que ces dépenses n’en sont pas moins supportées par les citoyens. Mais s’agit-il de rechercher quelles sont les dépenses volontaires des citoyens ou quelles sont les dépenses du gouvernement ?
Un gouvernement est institué pour remplir certaines fonctions. Quand il sort de son attribution, il faut qu’il fasse un appel à la bourse des citoyens et qu’il diminue ainsi cette portion de revenus dont ils avaient la libre disposition. Il devient à la fois spoliateur et oppresseur.
Une nation qui est assez sage pour forcer son gouvernement à se borner à garantir à chacun sa sûreté, et qui ne paye que ce qui est rigoureusement indispensable pour cela, consomme le reste de ses revenus selon son génie, ses besoins et ses goûts.
Mais une nation, chez laquelle le gouvernement se mêle de tout, ne dépense rien par elle et pour elle, mais par le pouvoir et pour le pouvoir ; et si le public français pense comme vous, Monsieur, qu’il est indifférent que sa richesse passe par les mains des fonctionnaires, je ne désespère pas que nous ne soyons tous un jour logés, nourris et vêtus aux frais de l’État. Ce sont choses qui nous coûtent, et d’après vous, il importe peu que nous nous les procurions par voie de contribution ou par des achats directs. Le cas que nos ministres font de cette opinion me persuade que nous aurons bientôt des habits de leur façon, comme nous avons des prêtres, des avocats, des professeurs, des médecins, des chevaux et du tabac de leur façon.
J’ai l’honneur, etc.
Frédéric Bastiat.
(Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV, le pamphlet la Loi, page 342, et notamment le passage compris dans les pages 381 à 386. (Note de l’éditeur.)
FN:Nous trouvons dans les manuscrits de l’auteur la pensée suivante, qui se rapporte au sujet spécial dont il s’occupe ici :
« Pourquoi nos finances sont-elles dérangées ? » — « Parce que, pour les Représentants, il n’y a rien de plus facile que de voter une Dépense, et rien de plus difficile que de voter une Recette. »
« Si vous l’aimez mieux,
Parce que les Traitements sont fort doux et les Impôts fort durs. »
« J’en sais encore une raison. »
« Tout le monde veut vivre aux dépens de l’État, et on oublie que l’État vit aux dépens de tout le monde. » (Note de l’éditeur.)
FN:Allusion à l’inepte accusation portée contre les libre-échangistes d’être vendus à l’Angleterre. (Note de l’éditeur.)
Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849 ↩
BWV
1849.01.15 “Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849” (Letter from Bastiat to Mr. G. Wilson, 15 january 1849) [OC3.36, p.492]
À partir de la révolution de Février, des devoirs nouveaux et impérieux réclament tous les instants de Bastiat. Il s’y dévoue avec une ardeur funeste à sa santé et interrompt la tâche qu’il s’était donnée de signaler à la France les bienfaits de la liberté commerciale en Angleterre.
Une invitation lui parvint, le 11 janvier 1849, de la part des free-traders, qui avaient résolu de célébrer à Manchester le 1er février, ce jour où, conformément aux prescriptions législatives, toute restriction sur le commerce des grains devait cesser. Nous reproduisons la réponse qu’il fit alors à M. George Wilson, l’ancien président de la Ligue et l’organe du comité chargé des préparatifs de cette fête.
Monsieur,
« Veuillez exprimer à votre comité toute ma reconnaissance pour l’invitation flatteuse que vous m’adressez en son nom. Il m’eût été bien doux de m’y rendre, car, Monsieur, je le dis hautement, il ne s’est rien accompli de plus grand dans ce monde, à mon avis, que cette réforme que vous vous apprêtez à célébrer. J’éprouve l’admiration la plus profonde pour les hommes que j’eusse rencontrés à ce banquet, pour les George Wilson, les Villiers, les Bright, les Cobden, les Thompson et tant d’autres qui ont réalisé le triomphe de la liberté commerciale, ou plutôt, donné à cette grande cause une première et décisive impulsion. Je ne sais ce que j’admire le plus de la grandeur du but que vous avez poursuivi ou de la moralité des moyens que vous avez mis en œuvre. Mon esprit hésite quand il compare le bien direct que vous avez fait au bien indirect que vous avez préparé ; quand il cherche à apprécier, d’un côté, la réforme même que vous avez opérée, et de l’autre, l’art de poursuivre légalement et pacifiquement toutes les réformes, art précieux dont vous avez donné la théorie et le modèle.
Autant que qui que ce soit au monde, j’apprécie les bienfaits de la liberté commerciale, et cependant je ne puis borner à ce point de vue les espérances que l’humanité doit fonder sur le triomphe de votre agitation.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger, sans discuter et consolider, chemin faisant, le droit de propriété. Et peut-être l’Angleterre doit-elle à votre propagande de n’être pas, à l’heure qu’il est infestée, comme le continent, de ces fausses doctrines communistes qui ne sont, ainsi que le protectionnisme, que des négations, sous formes diverses, du droit de propriété.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger, sans éclairer d’une vive lumière les légitimes attributions du gouvernement et les limites naturelles de la loi. Or, une fois ces attributions comprises, ces limites fixées, les gouvernés n’attendront plus des gouvernements prospérité, bien-être, bonheur absolu ; mais justice égale pour tous. Dès lors les gouvernements, circonscrits dans leur action simple, ne comprimant plus les énergies individuelles, ne dissipant plus la richesse publique à mesure qu’elle se forme, seront eux-mêmes dégagés de l’immense responsabilité que les espérances chimériques des peuples font peser sur eux. On ne les culbutera pas à chaque déception inévitable, et la principale cause des révolutions violentes sera détruite.
Vous n’avez pu démontrer, au point de vue économique, la doctrine du libre-échange sans ruiner à jamais dans les esprits ce triste et funeste aphorisme : Le bien de l’un, c’est le dommage de l’autre. Tant que cette odieuse maxime a été la foi du monde, il y avait incompatibilité radicale entre la prospérité simultanée et la paix des nations. Prouver l’harmonie des intérêts, c’était donc préparer la voie à l’universelle fraternité.
Dans ses aspects plus immédiatement pratiques, je suis convaincu que votre réforme commerciale n’est que le premier chaînon d’une longue série de réformes plus précieuses encore. Peut-elle manquer, par exemple, de faire sortir la Grande-Bretagne de cette situation violente, anormale, antipathique aux autres peuples, et par conséquent pleine de dangers, où le régime protecteur l’avait entraînée ? L’idée d’accaparer les consommateurs vous avait conduits à poursuivre la domination sur tout le globe. Eh bien ! je ne puis plus douter que votre système colonial ne soit sur le point de subir la plus heureuse transformation. Je n’oserais prédire, bien que ce soit ma pensée, que vous serez amenés, par la loi de votre intérêt, à vous séparer volontairement de vos colonies ; mais alors même que vous les retiendrez, elles s’ouvriront au commerce du monde, et ne pourront plus être raisonnablement un objet de jalousie et de convoitise pour personne.
Dès lors que deviendra ce célèbre argument en cercle vicieux : « Il faut une marine pour avoir des colonies, il faut des colonies pour avoir une marine ? » Le peuple anglais se fatiguera de payer seul les frais de ses nombreuses possessions, dans lesquelles il n’aura pas plus de priviléges qu’il n’en a aux États-Unis. Vous diminuerez vos armées et vos flottes ; car il serait absurde, après avoir anéanti le danger, de retenir les précautions onéreuses que ce danger seul pouvait justifier. Il y a encore là un double et solide gage pour la paix du monde.
Je m’arrête, ma lettre prendrait des proportions inconvenantes, si je voulais y signaler tous les fruits dont le libre échange est le germe.
Convaincu de la fécondité de cette grande cause, j’aurais voulu y travailler activement dans mon pays. Nulle part les intelligences ne sont plus vives ; nulle part les cœurs ne sont plus embrasés de l’amour de la justice universelle, du bien absolu, de la perfection idéale. La France se fût passionnée pour la grandeur, la moralité, la simplicité, la vérité du libre-échange. Il ne s’agissait que de vaincre un préjugé purement économique, d’établir pour ainsi dire un compte commercial, et de prouver que l’échange, loin de nuire au travail national, s’étend toujours tant qu’il fait du bien, et s’arrête, par sa nature, en vertu de sa propre loi, quand il commencerait à faire du mal ; d’où il suit qu’il n’a pas besoin d’obstacles artificiels et législatifs. L’occasion était belle, — au milieu du choc des doctrines qui se sont heurtées dans ce pays, — pour y élever le drapeau de la liberté. Il eût certainement rallié à lui toutes les espérances et toutes les convictions. C’est dans ce moment qu’il a plu à la Providence, dont je ne bénis pas moins les décrets, de me retirer ce qu’elle m’avait accordé de force et de santé ; ce sera donc à un autre d’accomplir l’œuvre que j’avais rêvée, et puisse-t-il se lever bientôt !
C’est ce motif de santé, ainsi que mes devoirs parlementaires, qui me forcent à m’abstenir de paraître à la démocratique solennité à laquelle vous me conviez. Je le regrette profondément, c’eût été un bel épisode de ma vie et un précieux souvenir pour le reste de mes jours. Veuillez faire agréer mes excuses au comité et permettez-moi, en terminant, de m’associer de cœur à votre fête par ce toast :
À la liberté commerciale des peuples ! à la libre circulation des hommes, des choses et des idées ! au libre-échange universel et à toutes ses conséquences économiques, politiques et morales !
Je suis, Monsieur, votre très-dévoué,
Frédéric Bastiat.
15 janvier 1849.
À M. George Wilson.
Capital et rente [February 1849] ↩
BWV
1849.02 “Capitale et rente” (Capital and Rent) [February 1849] [Published as pamphlet, *Capitale et rente* (Paris: Guillaumin, 1849)] [OC5.3, p. 23-63]
Capital et Rente [1] 1849
Introduction
Dans cet écrit, j’essaie de pénétrer la nature intime de ce qu’on nomme l’Intérêt des capitaux, afin d’en prouver la légitimité et d’en expliquer la perpétuité.
Ceci paraîtra bizarre ; mais il est certain que ce que je redoute, ce n’est pas d’être obscur, mais d’être trop clair. Je crains que le lecteur ne se laisse rebuter par une série de véritables Truismes. Comment éviter un tel écueil quand on n’a à s’occuper que de faits connus de chacun par une expérience personnelle, familière, quotidienne ?
Alors, me dira-t-on, à quoi bon cet écrit ? Que sert d’expliquer ce que tout le monde sait ?
Distinguons, s’il vous plaît. Une fois l’explication donnée, plus elle est claire et simple, plus elle semble superflue. Chacun est porté à s’écrier : « Je n’avais pas besoin qu’on résolût pour moi le problème. » C’est l’œuf de Colomb.
Mais ce problème si simple le paraîtrait peut-être beaucoup moins, si on se bornait à le poser.
Je l’établis en ces termes : « Mondor prête aujourd’hui un instrument de travail qui sera anéanti dans quelques jours. Le capital n’en produira pas moins intérêt à Mondor ou à ses héritiers pendant l’éternité tout entière. » Lecteur, la main sur la conscience, sentez-vous la solution au bord de vos lèvres ?
Je n’ai pas le temps de recourir aux économistes. Autant que je puis le savoir, ils ne se sont guère occupés de scruter l’Intérêt jusque dans sa raison d’être. On ne peut les en blâmer. À l’époque où ils écrivaient, l’Intérêt n’était pas mis en question.
Il n’en est plus ainsi. Les hommes qui se disent et se croient beaucoup plus avancés que leur siècle, ont organisé une propagande active contre le Capital et la Rente. Ils attaquent, non pas dans quelques applications abusives, mais en principe, la Productivité des capitaux.
Un journal a été fondé pour servir de véhicule à cette propagande. Il est dirigé par M. Proudhon et a, dit-on, une immense publicité. Le premier numéro de cette feuille contenait le Manifeste électoral du Peuple. On y lit : « La Productivité du capital, ce que le Christianisme a condamné sous le nom d’usure, telle est la vraie cause de la misère, le vrai principe du prolétariat, l’éternel obstacle à l’établissement de la République. »
Un autre journal, la Ruche populaire, après avoir dit d’excellentes choses sur le travail, ajoute : « Mais avant tout, il faut que l’exercice du travail soit libre, c’est-à-dire que le travail soit organisé de telle sorte, qu’il ne faille pas payer aux argentiers et aux patrons ou maîtres cette liberté du travail, ce droit du travail que mettent à si haut prix les exploiteurs d’hommes. »
La seule pensée que je relève ici, c’est celle exprimée dans les mots soulignés comme impliquant la négation de l’Intérêt. Elle est, du reste, commentée par la suite de l’article.
Voici comment s’exprime le célèbre démocrate socialiste Thoré :
« La Révolution sera toujours à recommencer tant qu’on s’attaquera seulement aux conséquences, sans avoir la logique et le courage d’abolir le principe lui-même. »
Ce principe c’est le capital, la fausse propriété, le revenu, la rente, l’usure que l’ancien régime fait peser sur le travail.
Le jour, — il y a bien longtemps, — où les aristocrates ont inventé cette incroyable fiction : Que le capital avait la vertu de se reproduire tout seul, — les travailleurs ont été à la merci des oisifs.
Est-ce qu’au bout d’un an vous trouverez un écu de cent sous de plus dans un sac de cent francs ?
Est-ce qu’au bout de quatorze ans vos écus ont doublé dans le sac ?
Est-ce qu’une œuvre d’art ou d’industrie en produit une autre au bout de quatorze ans ?
Commençons donc par l’anéantissement de cette fiction funeste. »
Ici je ne discute ni ne réfute ; je cite, pour établir que la productivité du capital est considérée, par un grand nombre de personnes, comme un principe faux, funeste et inique. Mais qu’ai-je besoin de citations ? N’est-ce pas un fait bien connu que le peuple attribue ses souffrances à ce qu’il appelle l’exploitation de l’homme par l’homme ? et cette locution : — Tyrannie du capital, — n’est-elle pas devenue proverbiale ?
Il ne peut pas exister un homme au monde, ce me semble, qui ne comprenne toute la gravité de cette question :
« L’intérêt du capital est-il naturel, juste, légitime et aussi utile à celui qui le paye, qu’à celui qui le perçoit ? »
On répond : non, moi je dis : oui. Nous différons du tout au tout sur la solution, mais il est une chose sur laquelle nous ne pouvons différer, c’est le danger de faire accepter par l’opinion la fausse solution quelle qu’elle soit.
Encore, si l’erreur est de mon côté, le mal n’est pas très-grand. Il en faudra conclure que je ne comprends rien aux vrais intérêts des masses, à la marche du progrès humain, et que tous mes raisonnements sont autant de grains de sable, qui n’arrêteront certes pas le char de la Révolution.
Mais si MM. Proudhon et Thoré se trompent, il s’ensuit qu’ils égarent le peuple, qu’ils lui montrent le mal là où il n’est pas, qu’ils donnent une fausse direction à ses idées, à ses antipathies, à ses haines et à ses coups ; il s’ensuit que le peuple égaré se précipite dans une lutte horrible et absurde, où la victoire lui serait plus funeste que la défaite, puisque, dans cette hypothèse, ce qu’il poursuit, c’est la réalisation du mal universel, la destruction de tous ses moyens d’affranchissement, la consommation de sa propre misère.
C’est ce que reconnaissait M. Proudhon avec une entière bonne foi. « La pierre fondamentale de mon système, me disait-il, c’est la gratuité du crédit. Si je me trompe là-dessus, le socialisme est un vrai rêve. » J’ajoute : c’est un rêve pendant lequel le peuple se déchire lui-même ; faudra-t-il s’étonner s’il se trouve tout meurtri et tout sanglant au réveil ?
En voilà assez pour ma justification, si dans le cours du débat, je me suis laissé entraîner à quelques trivialités et à quelques longueurs [2].
Capital et Rente
J’adresse cet écrit aux ouvriers de Paris, particulièrement à ceux qui se sont rangés sous la bannière de la démocratie socialiste.
J’y traite ces deux questions :
1° Est-il conforme à la nature des choses et à la justice que le capital produise une Rente ?
2° Est-il conforme à la nature des choses et à la justice que la Rente du capital soit perpétuelle ?
Les ouvriers de Paris voudront bien reconnaître qu’on ne saurait agiter un sujet plus important.
Depuis le commencement du monde, il avait été reconnu, du moins en fait, que le capital devait produire un Intérêt.
Dans ces derniers temps, on affirme que c’est précisément là l’erreur sociale qui est la cause du paupérisme et de l’inégalité.
Il est donc bien essentiel de savoir à quoi s’en tenir.
Car si le prélèvement d’un Intérêt au profit du Capital est une iniquité, c’est à bon droit que les travailleurs se soulèvent contre l’ordre social actuel ; et on a beau leur dire qu’ils ne doivent avoir recours qu’aux moyens légaux et pacifiques, c’est là une recommandation hypocrite. Quand il y a d’un côté un homme fort pauvre et volé, et de l’autre un homme faible, riche et voleur, il est assez singulier qu’on dise au premier, avec l’espoir de le persuader : « Attends que ton oppresseur renonce volontairement à l’oppression ou qu’elle cesse d’elle-même. » Cela ne peut pas être, et ceux qui enseignent que le Capital est stérile par nature doivent savoir qu’ils provoquent une lutte terrible et immédiate.
Si, au contraire, l’Intérêt du Capital est naturel, légitime, conforme au bien général, aussi favorable à l’emprunteur qu’au prêteur, les publicistes qui le nient, les tribuns qui exploitent cette prétendue plaie sociale, conduisent les ouvriers à une lutte insensée, injuste, qui ne peut avoir d’autre issue que le malheur de tous.
En définitive, on arme le Travail contre le Capital. Tant mieux si ces deux puissances sont antagoniques ! et que la lutte soit bientôt finie ! Mais si elles sont harmoniques, la lutte est le plus grand des maux qu’on puisse infliger à la société.
Vous voyez donc bien, ouvriers, qu’il n’y a pas de question plus importante que celle-ci : la rente du capital est-elle ou non légitime ? Dans le premier cas, vous devez renoncer immédiatement à la lutte vers laquelle on vous pousse ; dans le second, vous devez la mener vivement et jusqu’au bout.
Productivité du capital ; Perpétuité de la rente. Ces questions sont difficiles à traiter. Je m’efforcerai d’être clair. Pour cela, j’aurai recours à l’exemple plus qu’à la démonstration, ou plutôt je mettrai la démonstration dans l’exemple.
Je commence par convenir qu’à la première vue, il doit vous paraître singulier que le capital prétende à une rémunération, et surtout à une rémunération perpétuelle.
Vous devez vous dire : Voilà deux hommes. L’un travaille soir et matin, d’un bout d’année à l’autre et, s’il a consommé tout ce qu’il a gagné, fût-ce par force majeure, il reste pauvre. Quand vient la Saint-Sylvestre, il ne se trouve pas plus avancé qu’au Premier de l’an et sa seule perspective est de recommencer. L’autre ne fait rien de ses bras ni de son intelligence, du moins, s’il s’en sert, c’est pour son plaisir ; il lui est loisible de n’en rien faire, car il a une rente. Il ne travaille pas ; et cependant il vit bien, tout lui arrive en abondance, mets délicats, meubles somptueux, élégants équipages ; c’est-à-dire qu’il détruit chaque jour des choses que les travailleurs ont dû produire à la sueur de leur front, car ces choses ne se sont pas faites d’elles-mêmes, et, quant à lui, il n’y a pas mis les mains. C’est nous, travailleurs, qui avons fait germer ce blé, verni ces meubles, tissé ces tapis ; ce sont nos femmes et nos filles qui ont filé, découpé, cousu, brodé ces étoffes. Nous travaillons donc pour lui et pour nous ; pour lui d’abord, et pour nous s’il en reste. Mais voici quelque chose de plus fort : si le premier de ces deux hommes, le travailleur, consomme dans l’année ce qu’on lui a laissé de profit dans l’année, il en est toujours au point de départ, et sa destinée le condamne à tourner sans cesse dans un cercle éternel et monotone de fatigues. Le travail n’est donc rémunéré qu’une fois. Mais si le second, le rentier, consomme dans l’année sa rente de l’année, il a, l’année d’après, et les années suivantes, et pendant l’éternité entière, une rente toujours égale, intarissable, perpétuelle. Le capital est donc rémunéré non pas une fois ou deux fois, mais un nombre indéfini de fois ! En sorte qu’au bout de cent ans, la famille qui a placé vingt mille francs à 5 pour 100 aura touché cent mille francs, ce qui ne l’empêchera pas d’en toucher encore cent mille dans le siècle suivant. En d’autres termes, pour vingt mille francs qui représentent son travail, elle aura prélevé, en deux siècles, une valeur décuple sur le travail d’autrui. N’y a-t-il pas dans cet ordre social un vice monstrueux à réformer ? Ce n’est pas tout encore. S’il plaît à cette famille de restreindre quelque peu ses jouissances, de ne dépenser, par exemple, que neuf cents francs au lieu de mille, — sans aucun travail, sans autre peine que celle de placer cent francs par an, elle peut accroître son Capital et sa Rente dans une progression si rapide qu’elle sera bientôt en mesure de consommer autant que cent familles d’ouvriers laborieux. Tout cela ne dénote-t-il pas que la société actuelle porte dans son sein un cancer hideux, qu’il faut extirper, au risque de quelques souffrances passagères ?
Voilà, ce me semble, les tristes et irritantes réflexions que doit susciter dans votre esprit l’active et trop facile propagande qui se fait contre le capital et la rente.
D’un autre côté, j’en suis bien convaincu, il y a des moments où votre intelligence conçoit des doutes et votre conscience des scrupules. Vous devez vous dire quelquefois : Mais proclamer que le capital ne doit pas produire d’intérêts, c’est proclamer que le prêt doit être gratuit, c’est dire que celui qui a créé des Instruments de travail, ou des Matériaux, ou des Provisions de toute espèce, doit les céder sans compensation. Cela est-il juste ? et puis, s’il en est ainsi, qui voudra prêter ces instruments, ces matériaux, ces provisions ? qui voudra les mettre en réserve ? qui voudra même les créer ? chacun les consommera à mesure, et l’humanité ne fera jamais un pas en avant. Le capital ne se formera plus, puisqu’il n’y aura plus intérêt à le former. Il sera d’une rareté excessive. Singulier acheminement vers le prêt gratuit ! singulier moyen d’améliorer le sort des emprunteurs que de les mettre dans l’impossibilité d’emprunter à aucun prix ! Que deviendra le travail lui-même ? car il n’y aura plus d’avances dans la société, et l’on ne saurait citer un seul genre de travail, pas même la chasse, qui se puisse exécuter sans avances. Et nous-mêmes, que deviendrons-nous ? Quoi ! il ne nous sera plus permis d’emprunter, pour travailler, dans l’âge de la force, et de prêter, pour nous reposer, dans nos vieux jours ? La loi nous ravira la perspective d’amasser un peu de bien, puisqu’elle nous interdira d’en tirer aucun parti ? Elle détruira en nous et le stimulant de l’épargne dans le présent, et l’espérance du repos dans l’avenir ? Nous aurons beau nous exténuer de fatigue, il faut renoncer à transmettre à nos fils et à nos filles un petit pécule, puisque la science moderne le frappe de stérilité, puisque nous deviendrions des exploiteurs d’hommes si nous le prêtions à intérêt ! Ah ! ce monde, qu’on ouvre devant nous comme un idéal, est encore plus triste et plus aride que celui que l’on condamne, car de celui-ci, au moins, l’espérance n’est pas bannie !
Ainsi, sous tous les rapports, à tous les points de vue, la question est grave. Hâtons-nous d’en chercher la solution.
Le Code civil a un chapitre intitulé : de la manière dont se transmet la propriété. Je ne crois pas qu’il donne à cet égard une nomenclature bien complète. Quand un homme a fait par son travail, une chose utile, en d’autres termes, quand il a créé une valeur, elle ne peut passer entre les mains d’un autre homme que par un de ces cinq modes : le don, l’hérédité, l’échange, le prêt ou le vol. Un mot sur chacun d’eux, excepté sur le dernier, quoiqu’il joue dans le monde un plus grand rôle qu’on ne croit [3].
Le don n’a pas besoin d’être défini. Il est essentiellement volontaire et spontané. Il dépend exclusivement du donateur et l’on ne peut pas dire que le donataire y a droit. Sans doute la morale et la religion font souvent un devoir aux hommes, surtout aux riches, de se défaire gratuitement de ce qui est leur propriété, en faveur de leurs frères malheureux. Mais c’est là une obligation toute morale. S’il était proclamé en principe, s’il était admis en pratique, s’il était consacré par la loi que chacun a droit à la propriété d’autrui, le don n’aurait plus de mérite, la charité et la reconnaissance ne seraient plus des vertus. En outre, une telle doctrine arrêterait tout à coup et universellement le travail et la production, comme un froid rigoureux pétrifie l’eau et suspend la vie ; car qui travaillerait quand il n’y aurait plus aucune connexité entre notre travail et la satisfaction de nos besoins ? L’économie politique ne s’est pas occupée du don. On en a conclu qu’elle le repoussait, que c’était une science sans entrailles. C’est là une accusation ridicule. Cette science, étudiant les lois qui résultent de la mutualité des services, n’avait pas à rechercher les conséquences de la générosité à l’égard de celui qui reçoit, ni ses effets, peut-être plus précieux encore, à l’égard de celui qui donne ; de telles considérations appartiennent évidemment à la morale. Il faut bien permettre aux sciences de se restreindre ; il ne faut pas surtout les accuser de nier ou de flétrir ce qu’elles se bornent à juger étranger à leur domaine.
L’Hérédité, contre laquelle, dans ces derniers temps, on s’est beaucoup élevé, est une des formes du Don et assurément la plus naturelle. Ce que l’homme a produit il le peut consommer, échanger, donner ; quoi de plus naturel qu’il le donne à ses enfants ? C’est cette faculté, plus que toute autre, qui lui inspire le courage de travailler et d’épargner. Savez-vous pourquoi on conteste le principe de l’Hérédité ? parce qu’on s’imagine que les biens ainsi transmis sont dérobés à la masse. C’est là une erreur funeste ; l’économie politique démontre de la manière la plus péremptoire que toute valeur produite est une création qui ne fait tort à qui que ce soit [4]. Voilà pourquoi on peut la consommer et, à plus forte raison, la transmettre, sans nuire à personne ; mais je n’insisterai pas sur ces réflexions qui ne sont pas de mon sujet.
L’Échange, c’est le domaine principal de l’économie politique, parce que c’est, de beaucoup, le mode le plus fréquent de la transmission des propriétés, selon des conventions libres et volontaires, dont cette science étudie les lois et les effets.
À proprement parler, l’Échange c’est la mutualité des services. Les parties se disent entre elles : « Donne-moi ceci, et je te donnerai cela ; » ou bien : « Fais ceci pour moi, et je ferai cela pour toi. » Il est bon de remarquer (car cela jettera un jour nouveau sur la notion de valeur) que la seconde formule est toujours impliquée dans la première. Quand on dit : « Fais ceci pour moi, et je ferai cela pour toi, » on propose d’échanger service contre service. De même quand on dit : « Donne-moi ceci, et je te donnerai cela, » c’est comme si l’on disait : « Je te cède ceci que j’ai fait, cède-moi cela que tu as fait. » Le travail est passé au lieu d’être actuel ; mais l’Échange n’en est pas moins gouverné par l’appréciation comparée des deux services, en sorte qu’il est très-vrai de dire que le principe de la valeur est dans les services rendus et reçus à l’occasion des produits échangés, plutôt que dans les produits eux-mêmes.
En réalité, les services ne s’échangent presque jamais directement. Il y a un intermédiaire qu’on appelle monnaie. Paul a confectionné un habit, contre lequel il veut recevoir un peu de pain, un peu de vin, un peu d’huile, une visite du médecin, une place au parterre, etc. L’Échange ne se peut accomplir en nature ; que fait Paul ? Il échange d’abord son habit contre de l’argent, ce qui s’appelle vente ; puis il échange encore cet argent contre les objets qu’il désire, ce qui se nomme achat ; ce n’est qu’alors que la mutualité des services a fini son évolution ; ce n’est qu’alors que le travail et la satisfaction se balancent dans le même individu ; ce n’est qu’alors qu’il peut dire : « J’ai fait ceci pour la société, elle a fait cela pour moi. » En un mot, ce n’est qu’alors que l’Échange est réellement accompli. Rien n’est donc plus exact que cette observation de J. B. Say : « Depuis l’introduction de la monnaie, chaque échange se décompose en deux facteurs, la vente et l’achat. » C’est la réunion de ces deux facteurs qui constitue l’échange complet.
Il faut dire aussi que la constante apparition de l’argent dans chaque échange a bouleversé et égaré toutes les idées ; les hommes ont fini par croire que l’argent était la vraie richesse, et que le multiplier c’était multiplier les services et les produits. De là le régime prohibitif, de là le papier-monnaie, de là le célèbre aphorisme : « Ce que l’un gagne, l’autre le perd, » et autres erreurs qui ont ruiné et ensanglanté la terre [5].
Après avoir beaucoup cherché, on a trouvé que pour que deux services échangés eussent une valeur équivalente, pour que l’échange fût équitable, le meilleur moyen c’était qu’il fût libre, Quelque séduisante que soit au premier coup d’œil l’intervention de l’État, on s’aperçoit bientôt qu’elle est toujours oppressive pour l’une ou l’autre des parties contractantes. Quand on scrute ces matières, on est forcé de raisonner toujours sur cette donnée que l’équivalence résulte de la liberté. Nous n’avons en effet aucun autre moyen de savoir si, dans un moment déterminé, deux services se valent, que d’examiner s’ils s’échangent couramment et librement entre eux. Faites intervenir l’État, qui est la force, d’un côté ou de l’autre, à l’instant tout moyen d’appréciation se complique et s’embrouille, au lieu de s’éclaircir. Le rôle de l’État semble être de prévenir et surtout de réprimer le dol et la fraude, c’est-à-dire de garantir la liberté et non de la violer.
Je me suis un peu étendu sur l’Échange, quoique j’aie à m’occuper principalement du Prêt. Mon excuse est que, selon moi, il y a dans le prêt un véritable échange, un véritable service rendu par le prêteur et qui met un service équivalent à la charge de l’emprunteur, — deux services dont la valeur comparée ne peut être appréciée, comme celle de tous les services possibles, que par la liberté.
Or, s’il en est ainsi, la parfaite légitimité de ce qu’on nomme loyer, fermage, intérêt, sera expliquée et justifiée.
Considérons donc le Prêt.
Supposons que deux hommes échangent deux services ou deux choses dont l’équivalence soit à l’abri de toute contestation. Supposons par exemple que Pierre disse à Paul : « Donne-moi dix pièces de dix sous contre une pièce de cinq francs. » Il n’est pas possible d’imaginer une équivalence plus incontestable. Quand ce troc est fait, aucune des parties n’a rien à réclamer à l’autre. Les services échangés se valent. Il résulte de là que si l’une des parties veut introduire dans le marché une clause additionnelle, qui lui soit avantageuse et qui soit défavorable à l’autre partie, il faudra qu’elle consente à une seconde clause qui rétablisse l’équilibre et la loi de justice. Voir l’injustice dans cette seconde clause de compensation, voilà certainement qui serait absurde. Cela posé, supposons que Pierre, après avoir dit à Paul : « Donne-moi dix pièces de dix sous, je te donnerai une pièce de cent sous, » ajoute : « Tu me donneras les dix pièces de dix sous actuellement, et moi je ne te donnerai la pièce de cent sous que dans un an ; » il est bien évident que cette nouvelle proposition change les charges et les avantages du marché, qu’elle altère la proportion des deux services. Ne saute-t-il pas aux yeux, en effet, que Pierre demande à Paul un service nouveau, supplémentaire et d’une autre espèce ? N’est-ce pas comme s’il disait : « Rends-moi le service de me laisser utiliser à mon profit pendant un an cinq francs qui t’appartiennent et que tu pourrais utiliser pour toi-même. » Et quelle bonne raison peut-on avoir de soutenir que Paul est tenu de rendre gratuitement ce service spécial ; qu’il ne doit rien demander de plus en vue de cette exigence ; que l’État doit intervenir pour le forcer de la subir ? Comment comprendre que le publiciste qui prêche au peuple une telle doctrine la concilie avec son principe : la mutualité des services ?
J’ai introduit ici le numéraire. J’y ai été conduit par le désir de mettre en présence deux objets d’échange d’une égalité de valeur parfaite et incontestable. Je voulais prévenir des objections ; mais, à un autre point de vue, ma démonstration eût été plus frappante encore, si j’avais fait porter la convention sur les services ou les produits eux-mêmes.
Supposez, par exemple, une Maison et un Navire de valeurs si parfaitement égales que leurs propriétaires soient disposés à les échanger troc pour troc, sans soulte ni remise. En effet, le marché se conclut par-devant notaire. Au moment de se mettre réciproquement en possession, l’armateur dit au citadin : « Fort bien, la transaction est faite, et rien ne prouve mieux sa parfaite équité que notre libre et volontaire consentement. Nos conditions ainsi fixées, je viens vous proposer une petite modification pratique. C’est que vous me livrerez bien votre Maison aujourd’hui, mais moi, je ne vous mettrai en possession de mon Navire que dans un an, et la raison qui me détermine à vous faire cette demande c’est que, pendant cette année de terme, je puis utiliser le navire. » Pour ne pas nous embarrasser dans les considérations relatives à la détérioration de l’objet prêté je supposerai que l’armateur ajoute : « Je m’obligerai à vous remettre au bout de l’an le navire dans l’état où il est aujourd’hui. » Je le demande à tout homme de bonne foi, je le demande à M. Proudhon lui-même, le citadin ne sera-t-il pas en droit de répondre : « La nouvelle clause que vous me proposez change entièrement la proportion ou l’équivalence des services échangés. Par elle, je serai privé, pendant un an, tout à la fois de ma maison et de votre navire. Par elle, vous utiliserez l’une et l’autre. Si, en l’absence de cette clause, le troc pour troc était juste, par cette raison même, la clause m’est onéreuse. Elle stipule un désavantage pour moi et un avantage pour vous. C’est un service nouveau que vous me demandez ; j’ai donc le droit de vous le refuser, ou de vous demander, en compensation, un service équivalent. »
Si les parties tombent d’accord sur cette compensation, dont le principe est incontestable, on pourra distinguer aisément deux transactions dans une, deux échanges de services dans un. Il y a d’abord le troc de la maison contre le navire ; il y a ensuite le délai accordé par l’une des parties, et la compensation corrélative à ce délai concédée par l’autre. Ces deux nouveaux services prennent les noms génériques et abstraits de crédit et intérêt ; mais les noms ne changent pas la nature des choses, et je défie qu’on ose soutenir qu’il n’y a pas là, au fond, service contre service ou mutualité de services. Dire que l’un de ces services ne provoque pas l’autre, dire que le premier doit être rendu gratuitement, à moins d’injustice, c’est dire que l’injustice consiste dans la réciprocité des services, que la justice consiste à ce que l’une des partie donne et ne reçoive pas, ce qui est contradictoire dans les termes.
Pour donner une idée de l’intérêt de son mécanisme, qu’il me soit permis de recourir à deux ou trois anecdotes. Mais, avant, je dois dire quelques mots du capital.
Il y a des personnes qui se figurent que le capital c’est de l’argent, et c’est précisément pourquoi on nie sa productivité ; car, comme dit M. Thoré, les écus ne sont pas doués de la faculté de se reproduire. Mais il n’est pas vrai que Capital soit synonyme d’argent. Avant la découverte des métaux précieux, il y avait des capitalistes dans le monde, et j’ose même dire qu’alors, comme aujourd’hui, chacun l’était à quelque degré.
Qu’est-ce donc que le capital ? Il se compose de trois choses :
1° Des Matériaux sur lesquels les hommes travaillent, quand ces matériaux ont déjà une valeur communiquée par un effort humain quelconque, qui ait mis en eux le principe de la rémunération ; laine, lin, cuir, soie, bois, etc.
2° Des Instruments dont ils se servent pour travailler ; outils, machines, navires, voitures, etc., etc.
3° Des Provisions qu’ils consomment pendant la durée du travail ; vivres, étoffes, maisons, etc.
Sans ces choses, le travail de l’homme serait ingrat et à peu près nul, et cependant ces choses ont elles-mêmes exigé un long travail, surtout à l’origine. Voilà pourquoi on attache un grand prix à les posséder, et c’est aussi la raison pour laquelle il est parfaitement légitime de les échanger et vendre, d’en tirer avantage si on les met en œuvre, d’en tirer une rémunération si on les prête [6].
J’arrive à mes anecdotes.
Le sac de blé.
Mathurin, d’ailleurs pauvre comme Job, et réduit à gagner sa vie au jour le jour, était cependant propriétaire, par je ne sais quel héritage, d’un beau lopin de terre inculte. Il souhaitait ardemment le défricher. Hélas ! se disait-il, creuser des fossés, élever des clôtures, défoncer le sol, le débarrasser de ronces et de pierres, l’ameublir, l’ensemencer, tout cela pourrait bien me donner à manger dans un an ou deux, mais non certes aujourd’hui et demain. Il m’est impossible de me livrer à la culture avant d’avoir préalablement accumulé quelques Provisions qui me fassent subsister jusqu’à la récolte, et j’apprends par expérience que le travail antérieur est indispensable pour rendre vraiment productif le travail actuel. Le bon Mathurin ne se borna pas à faire ces réflexions. Il prit aussi la résolution de travailler à la journée et de faire des épargnes sur son salaire, pour acheter une bêche et un sac de blé, choses sans lesquelles il faut renoncer aux plus beaux projets agricoles. Il fit si bien, il fut si actif et si sobre, qu’enfin il se vit en possession du bienheureux sac de blé. « Je le porterai au moulin, dit-il, et j’aurai là de quoi vivre jusqu’à ce que mon champ se couvre d’une riche moisson. » Comme il allait partir, Jérôme vint lui emprunter son trésor. « Si tu veux me prêter ce sac de blé, disait Jérôme, tu me rendras un grand service, car j’ai en vue un travail très-lucratif, qu’il m’est impossible d’entreprendre faute de Provisions pour vivre jusqu’à ce qu’il soit terminé. — J’étais dans le même cas, répondit Mathurin, et si maintenant j’ai du pain assuré pour quelques mois, je l’ai gagné aux dépens de mes bras et de mon estomac. Sur quel principe de justice serait-il maintenant consacré à la réalisation de ton entreprise et non de la mienne ? »
On peut penser que le marché fut long. Il se termina cependant, et voici sur quelles bases :
Premièrement, Jérôme promit de rendre au bout de l’an un sac de blé de même qualité, de même poids, sans qu’il y manquât un seul grain. Cette première clause est de toute justice, disait-il, sans elle Mathurin ne prêterait pas, il donnerait.
Secondement, il s’obligea à livrer cinq litres de blé en sus de l’hectolitre. Cette clause n’est pas moins juste que l’autre, pensait-il ; sans elle, Mathurin me rendrait un service sans compensation, il s’infligerait une privation, il renoncerait à sa chère entreprise, il me mettrait à même d’accomplir la mienne, il me ferait jouir, pendant un an, du fruit de ses épargnes et tout cela gratuitement. Puisqu’il ajourne son défrichement, puisqu’il me met à même de réaliser un travail lucratif, il est bien naturel que je le fasse participer, dans une mesure quelconque, à des profits que je ne devrai qu’à son sacrifice.
De son côté, Mathurin, qui était quelque peu clerc, faisait ce raisonnement. Puisqu’en vertu de la première clause, le sac de blé me rentrera au bout de l’an, se disait-il, je pourrai lui prêter de nouveau ; il me reviendra, à la seconde année ; je le prêterai encore et ainsi de suite pendant l’éternité. Cependant, je ne puis nier qu’il aura été mangé depuis longtemps. Voilà qui est bizarre que je sois éternellement propriétaire d’un sac de blé, bien que celui que j’ai prêté ait été détruit à jamais. Mais ceci s’explique : il sera détruit au service de Jérôme. Il mettra Jérôme en mesure de produire une valeur supérieure, et par conséquent Jérôme pourra me rendre un sac de blé ou la valeur, sans éprouver aucun dommage ; au contraire. Et quant à moi, cette valeur doit être ma propriété tant que je ne la détruirai pas à mon usage ; si je m’en étais servi pour défricher ma terre, je l’aurais bien retrouvée sous forme de belle moisson. Au lieu de cela, je la prête, je dois la retrouver sous forme de restitution.
Je tire de la seconde clause un autre enseignement. Au bout de l’an, il me rentrera cinq litres de blé en sus des cent litres que je viens de prêter. Si donc je continuais à travailler à la journée, et à épargner sur mon salaire, comme j’ai fait, dans quelque temps, je pourrais prêter deux sacs de blé, puis trois, puis quatre, et lorsque j’en aurais placé un assez grand nombre pour pouvoir vivre sur la somme de ces rétributions de cinq litres, afférentes à chacun d’eux, il me serait permis de prendre, sur mes vieux jours, un peu de repos. Mais quoi ! en ce cas, ne vivrais-je pas aux dépens d’autrui ? Non certes, puisqu’il vient d’être reconnu qu’en prêtant je rends service, je perfectionne le travail de mes emprunteurs, et ne prélève qu’une faible partie de cet excédant de production dû à mon prêt et à mes épargnes. C’est une chose merveilleuse que l’homme puisse ainsi réaliser un loisir qui ne nuit à personne et ne saurait être jalousé sans injustice.
La maison.
Mondor avait une maison. Pour la construire, il n’avait rien extorqué à qui que ce soit. Il la devait à son travail personnel. ou, ce qui est identique, à du travail équitablement rétribué. Son premier soin fut de passer un marché avec un architecte, en vertu duquel, moyennant cent écus par an, celui-ci s’obligea à entretenir la maison toujours en bon état. Mondor se félicitait déjà des jours heureux qu’il allait couler dans cet asile, déclaré sacré par notre Constitution. Mais Valère prétendit en faire sa demeure. Y pensez-vous ? dit Mondor, c’est moi qui l’ai construite, elle m’a coûté dix ans de pénibles travaux, et c’est vous qui en jouiriez ! On convint de s’en rapporter à des juges. On ne fut pas chercher de profonds économistes, il n’y en avait pas dans le pays. Mais on choisit des hommes justes et de bon sens ; cela revient au même : économie politique, justice, bon sens, c’est tout un. Or voici ce que les juges décidèrent. Si Valère veut occuper pendant un an la maison de Mondor, il sera tenu de se soumettre à trois conditions. La première, de déguerpir au bout de l’an et de rendre la maison en bon état sauf les dégradations inévitables qui résultent de la seule durée. La seconde, de rembourser à Mondor les 300 francs que celui-ci paie annuellement à l’architecte pour réparer les outrages du temps ; car ces outrages survenant pendant que la maison est au service de Valère, il est de toute justice qu’il en supporte les conséquences. La troisième, c’est de rendre à Mondor un service équivalent à celui qu’il en reçoit. Quant à cette équivalence de services, elle devra être librement débattue entre Mondor et Valère.
Le rabot.
Il y a bien longtemps, bien longtemps vivait, dans un pauvre village, un menuisier philosophe, car mes personnages le sont tous quelque peu. Jacques travaillait matin et soir de ses deux bras robustes, mais son intelligence n’était pas pour cela oisive. Il aimait à se rendre compte de ses actions, de leurs causes et de leurs suites. Il se disait quelquefois : Avec ma hache, ma scie et mon marteau, je ne puis faire que des meubles grossiers, et on me les paie comme tels. Si j’avais un rabot, je contenterais mieux ma clientèle, et elle me contenterait mieux aussi. C’est trop juste ; je n’en puis attendre que des services proportionnés à ceux que je lui rends moi-même. Oui, ma résolution est prise, et je me fabriquerai un Rabot.
Cependant au moment de mettre la main à l’œuvre, Jacques fit encore cette réflexion : Je travaille pour ma clientèle trois cent jours dans l’année. Si j’en mets dix à faire mon rabot, à supposer qu’il me dure un an, il ne me restera plus que 290 jours, pour confectionner des meubles. Il faut donc, pour que je ne sois pas dupe en tout ceci, qu’aidé du rabot, je gagne désormais autant en 290 jours que je fais maintenant en 300 jours. Il faut même que je gagne davantage, car sans cela il ne vaudrait pas la peine que je me lançasse dans les innovations. Jacques se mit donc à calculer. Il s’assura qu’il vendrait ses meubles perfectionnés à un prix qui le récompenserait amplement des dix jours consacrés à faire le Rabot. Et quand il eut toute certitude à cet égard, il se mit à l’ouvrage.
Je prie le lecteur de remarquer que cette puissance, qui est dans l’outil, d’augmenter la productivité du travail, est la base de la solution qui va suivre.
Au bout de dix jours, Jacques eut en sa possession un admirable Rabot, d’autant plus précieux qu’il l’avait fait lui-même. Il en sauta de joie, car, comme la bonne Perrette, il supputait tout le profit qu’il allait tirer de l’ingénieux instrument ; mais plus heureux qu’elle, il ne se vit pas réduit à dire : « Adieu veau, vache, cochon, couvée ! »
Il en était à édifier ses beaux châteaux en Espagne, quand il fut interrompu par son confrère Guillaume, menuisier au village voisin. Guillaume, ayant admiré le Rabot, fut frappé des avantages qu’on en pouvait retirer. Il dit à Jacques :
— Il faut que tu nue rendes un service.
— Lequel ?
— Prête-moi ce rabot pour un an.
Comme on pense bien, à cette proposition, Jacques ne manqua pas de se récrier :
— Y penses-tu, Guillaume ? Et si je te rends ce service, quel service me rendras-tu de ton côté ?
— Aucun. Ne sais-tu pas que le prêt doit être gratuit ? ne sais-tu pas que le capital est naturellement improductif ? ne sais-tu pas que l’on a proclamé la Fraternité ? Si tu ne me rendais un service que pour en recevoir un de moi, quel serait ton mérite ?
— Guillaume, mon ami, la Fraternité ne veut pas dire que tous les sacrifices seront d’un côté, sans cela, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas du tien. Je ne sais si le prêt doit être gratuit ; mais je sais que si je te prêtais gratuitement mon rabot pour un an, ce serait te le donner. À te dire vrai, je ne l’ai pas fait pour cela.
— Et bien ! passons un peu par-dessus les modernes axiomes fraternitaires découverts par messieurs les socialistes. Je réclame de toi un service ; quel service me demandes-tu en échange ?
— D’abord, dans un an, il faudra mettre le rabot au rebut ; il ne sera plus bon à rien. Il est donc juste que tu m’en rendes un autre exactement semblable, ou que tu me donnes assez d’argent pour le faire réparer, ou que tu me remplaces les dix journées que je devrai consacrer à le refaire. De manière ou d’autre, il faut que le Rabot me revienne en bon état comme je te le livre.
— C’est trop juste, je me soumets à cette condition. Je m’engage à te rendre ou ton rabot semblable ou la valeur. Je pense que te voilà satisfait et que tu n’as plus rien à me demander.
— Je pense le contraire. J’ai fait ce rabot pour moi et non pour toi. J’en attendais un avantage, un travail plus achevé et mieux rétribué, une amélioration dans mon sort. Je ne puis te céder tout cela gratuitement. Quelle raison y a-t-il pour que ce soit moi qui aie fait le Rabot et que ce soit toi qui en tires le profit ? Autant vaudrait que je te demandasse ta scie et ta hache. Quelle confusion ! et n’est-il pas plus naturel que chacun garde ce qu’il a fait de ses propres mains, comme il garde ses mains elles-mêmes ? Se servir, sans rétribution, des mains d’autrui, cela s’appelle esclavage ; se servir, sans rétribution, du rabot d’autrui, cela peut-il s’appeler fraternité ?
— Mais puisqu’il est convenu que je te le rendrai au bout de l’an, aussi poli et aussi affilé qu’il l’est maintenant.
— Il ne s’agit plus de l’année prochaine ; il s’agit de cette année-ci. J’ai fait ce Rabot pour améliorer mon travail et mon sort ; si tu te bornes à me le rendre dans un an, c’est toi qui en auras le profit pendant toute une année ; je ne suis pas tenu de te rendre un tel service sans en recevoir aucun de toi : si donc tu veux mon Rabot, indépendamment de la restitution intégrale déjà stipulée, il faut que tu me rendes un service que nous allons débattre ; il faut que tu m’accordes une rétribution.
Et cela fut fait ainsi ; Guillaume accorda une rétribution calculée de telle sorte, que Jacques eut à la fin de l’année un rabot tout neuf et, de plus, une compensation, consistant en une planche, pour les avantages dont il s’était privé et qu’il avait cédés à son confrère.
Et il fut impossible à quiconque eut connaissance de cette transaction d’y découvrir la moindre trace d’oppression et d’injustice.
Ce qu’il y a de singulier, c’est que, au bout de l’an, le Rabot entra en la possession de Jacques qui le prêta derechef, le recouvra et le prêta une troisième et une quatrième fois. Il a passé dans les mains de son fils, qui le loue encore. Pauvre Rabot ! combien de fois n’a-t-il pas vu changer tantôt sa lame, tantôt son manche ! Ce n’est plus le même Rabot, mais c’est toujours la même Valeur, du moins pour la postérité de Jacques.
Ouvriers, dissertons maintenant sur ces historiettes.
J’affirme d’abord que le Sac de blé et le Rabot sont ici le type, le modèle, la représentation fidèle, le symbole de tout Capital, comme les cinq litres de blé et la planche sont le type, le modèle, la représentation, le symbole de tout Intérêt. Cela posé, voici, ce me semble, une série de conséquences dont il est impossible de contester la justesse :
1° Si l’abandon d’une planche par l’emprunteur au prêteur est une rétribution naturelle, équitable, légitime, juste prix d’un service réel, nous pouvons en conclure, en généralisant, qu’il est dans la nature du Capital de produire un Intérêt. Quand ce capital, comme dans les exemples précédents, revêt la forme d’un Instrument de travail, il est bien clair qu’il doit procurer un avantage à son possesseur, à celui qui l’a fait, qui y a consacré son temps, son intelligence et ses forces ; sans cela, pourquoi l’eût-il fait ? on ne satisfait immédiatement aucun besoin avec des instruments de travail ; on ne mange pas des rabots, on ne boit pas des scies, si ce n’est chez Fagotin. Pour qu’un homme se soit décidé à détourner son temps vers de telles productions, il faut bien qu’il y ait été déterminé par la considération de la puissance que ces instruments ajoutent à sa puissance, du temps qu’ils lui épargnent, de la perfection et de la rapidité qu’ils donnent à son travail, en un mot, des avantages qu’ils procurent. Or, ces avantages qu’on s’était préparés par le labeur, par le sacrifice d’un temps qu’on eût pu utiliser d’une manière plus immédiate, alors qu’on est enfin à même de les recueillir, est-on tenu de les conférer gratuitement à autrui ? Serait-ce un progrès, dans l’ordre social, que la Loi en décidât ainsi, et que les citoyens payassent des fonctionnaires pour faire exécuter par la force une telle Loi ? J’ose dire qu’il n’y en a pas un seul parmi vous qui le soutienne. Ce serait légaliser, organiser, systématiser l’injustice elle-même, car ce serait proclamer qu’il y a des hommes nés pour rendre et d’autres nés pour recevoir des services gratuits. Posons donc en fait que l’intérêt est juste, naturel et légitime.
2° Une seconde conséquence, non moins remarquable que la première, et, s’il se peut, plus satisfaisante encore, sur laquelle j’appelle votre attention, c’est celle-ci : L’intérêt ne nuit pas à l’emprunteur ; je veux dire : L’obligation où se trouve l’emprunteur de payer une rétribution pour avoir la jouissance d’un capital ne peut empirer sa condition [7].
Remarquez, en effet, que Jacques et Guillaume sont parfaitement libres relativement à la transaction à laquelle le Rabot peut donner lieu. Cette transaction ne peut s’accomplir qu’autant qu’elle convienne à l’un comme à l’autre. Le pis qui puisse arriver, c’est que Jacques soit trop exigeant, et, en ce cas, Guillaume, refusant le prêt, restera comme il était avant. Par cela même qu’il souscrit à l’emprunt, il constate qu’il le considère comme avantageux ; il constate que, tout calcul fait, et en tenant compte de la rétribution, quelle qu’elle soit, mise à sa charge, il trouve encore plus profitable d’emprunter que de n’emprunter pas. Il ne se détermine que parce qu’il a comparé les inconvénients aux avantages. Il a calculé que le jour où il restituera le Rabot, accompagné de la rétribution convenue, il aura encore fait plus d’ouvrage à travail égal, grâce à cet outil. Il lui restera un profit ; sans quoi, il n’emprunterait pas.
Les deux services dont il est ici question s’échangent selon la Loi qui gouverne tous les Échanges : la loi de l’offre et de la demande. Les prétentions de Jacques ont une limite naturelle et infranchissable. C’est le point où la rétribution par lui demandée absorberait tout l’avantage que Guillaume peut trouver à se servir d’un Rabot. En ce cas, l’emprunt ne se réaliserait pas. Guillaume serait tenu ou de se fabriquer lui-même un Rabot ou de s’en passer, ce qui le laisserait dans sa situation primitive. Il emprunte, donc il gagne à emprunter.
Je sais bien ce qu’on me dira. On me dira : Guillaume peut se tromper, ou bien il peut être maîtrisé par la nécessité et subir une dure loi.
J’en conviens ; mais je réponds : Quant aux erreurs de calcul, elles tiennent à l’infirmité de notre nature, et en arguer contre la transaction dont s’agit, c’est opposer une fin de non-recevoir à toutes les transactions imaginables, à toutes les actions humaines. L’erreur est un fait accidentel que l’expérience redresse sans cesse. En définitive, c’est à chacun d’y veiller. — En ce qui concerne les dures nécessités qui réduisent à des emprunts onéreux, il est clair que ces nécessités existent antérieurement à l’emprunt. Si Guillaume est dans une situation telle qu’il ne peut absolument pas se passer d’un Rabot, et qu’il soit forcé d’en emprunter un à tout prix, cette situation provient-elle de ce que Jacques s’est donné la peine de fabriquer cet outil ? n’existe-t-elle pas indépendamment de cette circonstance ? quelque dur, quelque âpre que soit Jacques, jamais il ne parviendra à empirer la position supposée de Guillaume. Certes, moralement, le prêteur pourra être blâmable ; mais au point de vue économique, jamais le prêt lui-même ne saurait être considéré comme responsable de nécessités antérieures, qu’il n’a pas créées et qu’il adoucit toujours dans une mesure quelconque.
Mais ceci prouve une chose sur laquelle je reviendrai, c’est que l’intérêt évident de Guillaume, personnifiant ici les emprunteurs, est qu’il y ait beaucoup de Jacques et de Rabots, autrement dit, de prêteurs et de capitaux. Il est bien clair que si Guillaume peut dire à Jacques : « Vos prétentions sont exorbitantes, je vais m’adresser à d’autres, il ne manque pas de Rabots dans le monde ; » — il sera dans une situation meilleure que si le rabot de Jacques est le seul qui se puisse prêter. Assurément, il n’y a pas d’aphorisme plus vrai que celui-ci : service pour service. Mais n’oublions jamais qu’aucun service n’a, comparativement aux autres, une valeur fixe et absolue. Les parties contractantes sont libres. Chacune d’elles porte ses exigences au point le plus élevé possible, et la circonstance la plus favorable à ces exigences, c’est l’absence de rivalité. Il suit de là que s’il y a une classe d’hommes plus intéressée que toute autre à la formation, à la multiplication, à l’abondance des capitaux, c’est surtout la classe emprunteuse. Or, puisque les capitaux ne se forment et s’accumulent que sous le stimulant et par la perspective d’une juste rémunération, qu’elle comprenne donc le dommage qu’elle s’inflige à elle-même, quand elle nie la légitimité de l’intérêt, quand elle proclame la gratuité du crédit, quand elle déclame contre la prétendue tyrannie du capital, quand elle décourage l’épargne, et pousse ainsi à la rareté des capitaux et, par suite, à l’élévation de la rente.
3° L’anecdote que je vous ai racontée vous met aussi sur la voie d’expliquer ce phénomène, en apparence, bizarre, qu’on appelle la pérennité ou la perpétuité de l’intérêt. Puisque, en prêtant son rabot, Jacques a pu très-légitimement stipuler cette condition qu’il lui serait rendu an bout de l’an dans l’état même ou il l’a cédé, n’est-il pas bien clair qu’il peut, à partir de cette échéance, soit l’employer à son usage, soit le prêter de nouveau, sous la même condition ? S’il prend ce dernier parti, le rabot lui reviendra au bout de chaque année et cela indéfiniment. Jacques sera donc en mesure de le prêter aussi indéfiniment, c’est-à-dire d’en tirer une rente perpétuelle. On dira que le rabot s’use. Cela est vrai, mais il s’use par la main et au profit de l’emprunteur. Celui-ci a fait entrer cette déperdition graduelle en ligne de compte et en a assumé sur lui, comme il le devait, les conséquences. Il a calculé qu’il tirerait de cet outil un avantage suffisant pour consentir à le rendre dans son état intégral, après avoir réalisé encore un bénéfice. Aussi longtemps que Jacques n’usera pas ce capital par lui-même et pour son propre avantage, aussi longtemps qu’il renoncera à ces avantages, qui permettent de le rétablir dans son intégrité, il aura un droit incontestable à la restitution, et cela, indépendamment de l’intérêt.
Remarquez, en outre, que si, comme je crois l’avoir démontré, Jacques, bien loin de faire tort à Guillaume, lui a rendu service en lui prêtant son rabot pour un an, par la même raison, il ne fera pas tort, mais, au contraire, il rendra service à un second, à un troisième, à un quatrième emprunteur dans les périodes subséquentes. Par où vous pourrez comprendre que l’intérêt d’un capital est aussi naturel, aussi légitime, aussi utile la millième année que la première.
Allons plus loin encore. Il se peut que Jacques ne prête pas qu’un seul rabot. Il est possible qu’à force de travail, d’épargnes, de privations, d’ordre, d’activité, il parvienne à prêter une multitude de rabots et de scies, c’est-à-dire à rendre une multitude de services. J’insiste sur ce point que si le premier prêt a été un bien social, il en sera de même de tous les autres, car ils sont tous homogènes et fondés sur le même principe. Il pourra donc arriver que la somme de toutes les rétributions reçues par notre honnête artisan, en échange des services par lui rendus, suffise pour le faire subsister. En ce cas, il y aura un homme, dans le monde, qui aura le droit de vivre sans travailler. Je ne dis pas qu’il fera bien de se livrer au repos ; je dis qu’il en aura le droit, et s’il en use, ce ne sera aux dépens de qui que ce soit, bien au contraire. Que si la société comprend un peu la nature des choses, elle reconnaîtra que cet homme subsiste sur des services qu’il reçoit sans doute (ainsi faisons-nous tous), mais qu’il reçoit très-légitimement en échange d’autres services qu’il a lui-même rendus, qu’il continue à rendre et qui sont très-réels, puisqu’ils sont librement et volontairement acceptés.
Et ici on peut entrevoir une des plus belles harmonies du monde social. Je veux parler du Loisir, non de ce loisir que s’arrogent les castes guerrières et dominatrices par la spoliation des travailleurs, mais du loisir, fruit légitime et innocent de l’activité passée et de l’épargne. En m’exprimant ainsi, je sais que je choque bien des idées reçues. Mais voyez ! le loisir n’est-il pas un ressort essentiel dans la mécanique sociale ? sans lui, il n’y aurait jamais eu dans le monde ni de Newton, ni de Pascal, ni de Fénelon ; l’humanité ne connaîtrait ni les arts, ni les sciences, ni ces merveilleuses inventions préparées, à l’origine, par des investigations de pure curiosité ; la pensée serait inerte, l’homme ne serait pas perfectible. D’un autre côté, si le loisir ne se pouvait expliquer que par la spoliation et l’oppression, s’il était un bien dont on ne peut jouir qu’injustement et aux dépens d’autrui, il n’y aurait pas de milieu entre ces deux maux : ou l’humanité serait réduite à croupir dans la vie végétative et stationnaire, dans l’ignorance éternelle, par l’absence d’un des rouages de son mécanisme ; ou bien, elle devrait conquérir ce rouage au prix d’une inévitable injustice et offrir de toute nécessité le triste spectacle, sous une forme ou une autre, de l’antique classification des êtres humains en Maîtres et en Esclaves. Je défie qu’on me signale, dans cette hypothèse, une autre alternative. Nous serions réduits à contempler le plan providentiel qui gouverne la société avec le regret de penser qu’il présente une déplorable lacune. Le mobile du progrès y serait oublié, ou, ce qui est pis, ce mobile ne serait autre que l’injustice elle-même. — Mais non, Dieu n’a pas laissé une telle lacune dans son œuvre de prédilection. Gardons-nous de méconnaître sa sagesse et sa puissance ; que ceux dont les méditations incomplètes ne peuvent expliquer la légitimité du loisir, imitent du moins cet astronome qui disait : À tel point du ciel, il doit exister une planète qu’on finira par découvrir, car sans elle le monde céleste n’est pas harmonie, mais discordance.
Eh bien ! je dis que, bien comprise, l’histoire de mon humble Rabot, quoique bien modeste, suffit pour nous élever jusqu’à la contemplation d’une des harmonies sociales les plus consolantes et les plus méconnues.
Il n’est pas vrai qu’il faille opter entre la négation ou l’illégitimité du loisir ; grâce à la rente et à sa naturelle pérennité, le loisir peut surgir du travail et de l’épargne. C’est une douce perspective que chacun peut avoir en vue ; c’est une noble récompense à laquelle chacun peut aspirer. Il fait son apparition dans le monde, il s’y étend, il s’y distribue proportionnellement à l’exercice de certaines vertus ; il ouvre toutes les voies de l’intelligence, il ennoblit, il moralise, il spiritualise l’âme de l’humanité, non-seulement sans peser d’un poids quelconque sur ceux de nos frères que les conditions de la vie vouent encore à de rudes labeurs, mais de plus en les soulageant progressivement de ce que ce labeur a de plus lourd et de plus répugnant. Il suffit que les capitaux se forment, s’accumulent, se multiplient, se prêtent à des conditions de moins en moins onéreuses, qu’ils descendent, qu’ils pénètrent dans toutes les couches sociales et que, par une progression admirable, après avoir affranchi les prêteurs, ils hâtent l’affranchissement des emprunteurs eux-mêmes. Pour cela, il faut que les lois et les mœurs soient toutes favorables à l’épargne, source du capital. C’est assez dire que la première de toutes les conditions c’est de ne pas effrayer, attaquer, combattre, nier ce qui est le stimulant de l’épargne et sa raison d’être : la rente.
Tant que nous ne voyons passer de main en main, à titre de prêt, que des provisions, des matériaux et des instruments, choses indispensables à la productivité du travail lui-même, les idées exposées jusqu’ici ne trouveront pas beaucoup de contradicteurs. Qui sait même si l’on ne me reprochera pas d’avoir fait un grand effort pour enfoncer, comme on dit, une porte ouverte. Mais sitôt que c’est le numéraire qui se montre, comme matière de la transaction (et c’est lui qui se montre presque toujours), aussitôt les objections renaissent en foule. L’argent, dira-t-on, ne se reproduit pas de lui-même ainsi que votre sac de blé ; il n’aide pas le travail comme votre rabot ; il ne donne pas directement une satisfaction comme votre maison. Il est donc impuissant, par sa nature, à produire un intérêt, à se multiplier, et la rémunération qu’il exige est une véritable extorsion.
Qui ne voit où est le sophisme ? Qui ne voit que le numéraire n’est qu’une forme transitoire que les hommes donnent un moment à d’autres valeurs, à des utilités réelles, dans le seul but de faciliter leurs arrangements ? Au milieu des complications sociales, l’homme qui est en mesure de prêter n’a presque jamais la chose même dont l’emprunteur a besoin. Jacques a bien un rabot ; mais peut-être que Guillaume désire une scie. Ils ne pourraient pas s’entendre ; la transaction favorable à tous les deux ne pourrait avoir lieu, et alors qu’arrive-t-il ? Il arrive que Jacques échange d’abord son rabot contre de l’argent ; il prête l’argent à Guillaume, et Guillaume échange l’argent contre une scie. La transaction s’est compliquée, elle s’est décomposée en deux facteurs, ainsi que je l’ai exposé plus haut en parlant de l’échange. Mais elle n’a pas pour cela changé de nature. Elle ne contient pas moins tous les éléments du prêt direct. Jacques ne s’en est pas moins défait d’un outil qui lui était utile ; Guillaume n’en a pas moins reçu un instrument qui perfectionne son travail et augmente ses profits ; il n’y a pas moins service rendu de la part du prêteur, lui donnant droit à recevoir un service équivalent de la part de l’emprunteur ; cette juste équivalence ne s’établit pas moins par le débat libre et contradictoire ; l’obligation bien naturelle de restituer à l’échéance la valeur intégrale n’en constitue pas moins le principe de la pérennité de l’intérêt.
« Est-ce qu’au bout d’un an, dit M. Thoré, vous trouverez un écu de plus dans un sac de cent francs ? »
Non, certes, si l’emprunteur jette le sac de cent francs dans un coin. À cette condition, le rabot non plus, ni le sac de blé, ne se reproduisent d’eux-mêmes. Mais ce n’est pas pour laisser l’argent dans le sac ou le rabot au crochet qu’on les emprunte. On emprunte le rabot pour s’en servir, ou l’argent pour se procurer un rabot. Et s’il est bien démontré que cet outil met l’emprunteur à même de faire des profits qu’il n’eût pas faits sans lui, s’il est démontré que le prêteur a renoncé à créer pour lui-même cet excédant de profits, on comprend que la stipulation d’une part de cet excédant de profits en faveur du prêteur est équitable et légitime.
L’ignorance du vrai rôle que joue le numéraire dans les transactions humaines est la source des plus funestes erreurs. Je me propose de lui consacrer un pamphlet tout entier [8].
D’après ce qu’on peut induire des écrits de M. Proudhon, ce qui l’a amené à penser que la gratuité du crédit était une conséquence logique et définitive du progrès social, c’est l’observation de ce phénomène qui nous montre l’intérêt décroissant à peu près en raison directe de la civilisation. À des époques de barbarie, on le voit en effet à 100 pour 100, et au delà. Plus tard, il descend à 80, à 60, à 50, à 40, à 20, à 40, à 8, à 5, à 4, à 3 pour 100. On l’a même vu en Hollande à 2 pour 100. On en tire cette conclusion : « Puisque l’intérêt se rapproche de zéro à mesure que la société se perfectionne, il atteindra zéro quand la société sera parfaite. En d’autres termes, ce qui caractérise la perfection sociale c’est la gratuité du crédit. Abolissons donc l’intérêt, et nous aurons atteint le dernier terme du progrès [9]. »
Ceci n’est que spécieux, et puisque cette fausse argumentation peut contribuer à populariser le dogme injuste, dangereux, subversif de la gratuité du crédit, en le représentant comme coïncidant avec la perfection sociale, le lecteur me permettra d’examiner en peu de mots ce nouveau point de vue de la question.
Qu’est-ce que l’intérêt ? c’est le service rendu, après libre débat, par l’emprunteur au prêteur, en rémunération du service qu’il en a reçu par le prêt.
D’après quelle loi s’établit le taux de ces services rémunératoires du prêt ? D’après la loi générale qui règle l’équivalence de tous les services, c’est-à-dire d’après la loi de l’offre et de la demande. Plus une chose est facile à se procurer, moins on rend service en la cédant ou prêtant. L’homme qui me donne un verre d’eau, dans les Pyrénées, ne me rend pas un aussi grand service que celui qui me céderait un verre d’eau, dans le désert de Sahara. S’il y a beaucoup de rabots, de sacs de blé, de maisons dans un pays, on en obtient l’usage (cæteris paribus) à des conditions plus favorables que s’il y en a peu, par la simple raison que le prêteur rend en ce cas un moindre service relatif.
Il n’est donc pas surprenant que plus les capitaux abondent, plus l’intérêt baisse.
Est-ce à dire qu’il arrivera jamais à zéro ? non, parce que, je le répète, le principe d’une rémunération est invinciblement dans le prêt. Dire que l’intérêt s’anéantira, c’est dire qu’il n’y aura plus aucun motif d’épargner, de se priver, de former de nouveaux capitaux, ni même de conserver les anciens. En ce cas, la dissipation ferait immédiatement le vide, et l’intérêt reparaîtrait aussitôt [10].
En cela, le genre de services dont nous nous occupons ne diffère d’aucun autre. Grâce au progrès industriel, une paire de bas qui valait 6 fr., n’a plus valu successivement que 4 fr., 3 fr., 2 fr. Nul ne petit dire jusqu’à quel point cette valeur descendra, mais ce qu’on peut affirmer c’est qu’elle ne descendra jamais à zéro, à moins que les bas ne finissent par se produire spontanément. Pourquoi ? Parce que le principe de la rémunération est dans le travail ; parce que celui qui travaille pour autrui rend un service et doit recevoir un service : si l’on ne payait plus les bas, on cesserait d’en faire et, avec la rareté, le prix ne manquerait pas de reparaître.
Le sophisme que je combats ici a sa racine dans la divisibilité à l’infini, qui s’applique à la valeur comme à la matière.
Il paraît d’abord paradoxal, mais il est bien su de tous les mathématiciens qu’on peut de minute en minute, pendant l’éternité entière, ôter des fractions à un poids, sans jamais parvenir à anéantir le poids lui-même. Il suffit que chaque fraction successive soit moindre que la précédente, dans une proportion déterminée et régulière.
Il est des pays où l’on s’attache à accroître la taille des chevaux ou à diminuer, dans la race ovine, le volume de la tête. Il est impossible de préciser jusqu’où on arrivera dans cette voie. Nul ne peut dire qu’il a vu le plus grand cheval ou la plus petite tête de mouton qui paraîtra jamais dans le monde. Mais l’on peut dire que la taille des chevaux n’atteindra jamais l’Infini, non plus que les têtes de moutons le Néant.
De même, nul ne peut dire jusqu’où descendra le prix des bas ou l’intérêt des capitaux, mais on peut affirmer, quand on connait la nature des choses, que ni l’un ni l’autre n’arriveront jamais à zéro, car le travail et le capital ne peuvent pas plus vivre sans récompense que le mouton sans tête.
L’argumentation de M. Proudhon se réduit donc à ceci : Puisque les plus habiles agriculteurs sont ceux qui ont le plus réduit la tête des moutons, nous serons arrivés à la perfection agricole quand les moutons seront acéphales. Donc, pour réaliser nous-même cette perfection, coupons-leur le cou.
Me voici au terme de cette ennuyeuse dissertation. Pourquoi faut-il que le vent des mauvaises doctrines ait rendu nécessaire de pénétrer ainsi jusque dans la nature intime de la rente ? Je ne terminerai pas sans faire remarquer une belle moralité que l’on peut tirer de cette loi : « La baisse de l’intérêt est proportionnelle à l’abondance des capitaux. » Cette loi étant donnée, s’il y a une classe d’hommes plus particulièrement intéressée que toute autre à ce que les capitaux se forment, s’accumulent, se multiplient, abondent et surabondent, c’est certainement la classe qui les emprunte, directement ou indirectement ; ce sont les hommes qui mettent en œuvre les matériaux, qui se font aider par des instruments, qui vivent sur des provisions, produits et économisés par d’autres hommes.
Imaginez, dans une vaste et fertile contrée, une peuplade de mille habitants, dénués de tout Capital ainsi défini. Elle périra infailliblement dans les tortures de la faim. — Passons à une hypothèse moins cruelle. Supposons que dix de ces sauvages soient pourvus d’Instruments et de Provisions en quantité suffisante pour travailler et vivre eux-mêmes jusqu’à la récolte, ainsi que pour rémunérer les services de quatre-vingt-dix travailleurs. Le résultat forcé sera la mort de neuf cents êtres humains. Il est clair encore que puisque 990 hommes, poussés par le besoin, se presseront sur des subsistances qui n’en peuvent maintenir que cent, les dix capitalistes seront maîtres du marché. Ils obtiendront le travail aux conditions les plus dures, car ils le mettront aux enchères. Et remarquez ceci : Si ces capitalistes portent au cœur des sentiments dévoués, qui les induisent à s’imposer des privations personnelles afin de diminuer les souffrances de quelques-uns de leurs frères, cette générosité, qui se rattache à la morale, sera aussi noble dans son principe qu’utile dans ses effets. Mais si, dupes de cette fausse philanthropie qu’on veut si inconsidérément mêler aux lois économiques, ils ont la prétention de rémunérer largement le travail, loin de faire du bien, ils feront du mal. Ils donneront double salaire, soit. Mais alors quarante-cinq hommes seront mieux pourvus, tandis que quarante-cinq autres hommes viendront augmenter le nombre de ceux que la tombe va dévorer. L’hypothèse étant donnée, ce n’est pas l’abaissement du salaire qui est le vrai fléau, mais la rareté du capital. L’abaissement du salaire n’est pas la cause, mais l’effet du mal. J’ajoute qu’il en est, dans une certaine mesure, le remède. Il agit dans ce sens qu’il distribue le fardeau de la souffrance autant qu’il peut l’être et sauve autant de vies qu’une quantité déterminée de subsistances permet d’en sauver.
Supposez maintenant qu’au lieu de dix capitalistes, il y en ait cent, deux cents, cinq cents, n’est-il pas évident que la condition de toute la peuplade, et surtout celle des prolétaires, sera de plus en plus améliorée ? N’est-il pas évident que, toute considération de générosité à part, ils obtiendront plus de travail et un meilleur prix de leur travail ? qu’eux-mêmes seront plus en mesure de former des capitaux, sans qu’on puisse assigner de limite à cette facilité toujours croissante de réaliser l’égalité et le bien-être ? Combien ne seraient-ils donc pas insensés s’ils admettaient des doctrines et se livraient à des actes de nature à tarir la source des salaires, à paralyser le mobile et le stimulant de l’épargne ! Qu’ils apprennent donc cette leçon : sans doute les capitaux sont bons pour ceux qui les ont, qui le nie ? mais ils sont utiles aussi à ceux qui n’ont pu encore en former, et il importe à ceux qui n’en ont pas que d’autres en aient.
Oui, si les prolétaires connaissaient leurs vrais intérêts, ils rechercheraient avec le plus grand soin quelles sont les circonstances favorables ou défavorables à l’épargne, afin de favoriser les premières et de décourager les secondes. Ils accueilleraient avec sympathie toute mesure qui tend à la prompte formation des capitaux. Ils s’enthousiasmeraient pour la paix, la liberté, l’ordre, la sécurité, l’union des classes et des peuples, l’économie, la modération des dépenses publiques, et la simplicité du mécanisme gouvernemental ; car c’est sous l’empire de toutes ces circonstances que l’épargne fait son œuvre, met l’abondance à la portée des masses, appelle à former des capitaux ceux même qui, autrefois, étaient réduits à les emprunter à de dures conditions. Ils repousseraient avec énergie l’esprit guerrier qui détourne de sa véritable fin une si grande part du travail humain, l’esprit de monopole qui dérange l’équitable distribution des richesses telle que la liberté seule peut la réaliser, la multiplicité des services publics qui n’entreprennent sur notre bourse que pour gêner notre liberté, et enfin ces doctrines subversives, haineuses, irréfléchies qui effrayent le capital, l’empêchent de se former, le forcent à fuir, et en définitive le renchérissent, au détriment surtout des travailleurs qui le mettent en œuvre.
Eh quoi ! à cet égard, la Révolution de Février n’est-elle qu’une dure leçon ? n’est-il pas évident que l’insécurité qu’elle a jetée dans le monde des affaires d’une part, et, de l’autre, l’avénement des théories funestes auxquelles je fais allusion et qui, des clubs, ont jailli pénétrer dans les régions législatives, ont élevé partout le taux de l’intérêt ? N’est-il pas évident que dès lors il a été plus difficile aux prolétaires de se procurer ces matériaux, instruments et provisions sans lesquels le travail est impossible ? n’est-ce pas là ce qui amène le chômage, et le chômage n’amène-t-il pas à son tour la baisse des salaires ? Ainsi le travail manque aux prolétaires précisément par la même cause qui grève d’un surcroît de prix, en raison de la hausse de l’intérêt, les objets qu’ils consomment. Hausse d’intérêts, baisse des salaires, cela veut dire, en d’autres termes, que le même objet conserve son prix, mais que la part du capitaliste a envahi, sans profit pour lui, celle de l’ouvrier.
Un de mes amis, chargé de faire une enquête sur l’industrie parisienne, m’a assuré que les fabricants lui ont révélé un fait bien saisissant et qui prouve mieux que tous les raisonnements combien l’insécurité et l’incertitude nuisent à la formation des capitaux. On avait remarqué que, pendant la période la plus fâcheuse, les dépenses populaires de pure fantaisie n’avaient pas diminué. Les petits théâtres, les barrières, les cabarets, les débits de tabac étaient aussi fréquentés qu’aux jours de prospérité. Dans l’enquête, les travailleurs eux-mêmes ont ainsi expliqué ce phénomène. « À quoi bon épargner ? qui sait le sort qui nous attend ? qui sait si l’intérêt ne va pas être aboli ? qui sait si l’État, devenu prêteur universel à titre gratuit, ne voudra pas faire avorter tous les fruits que nous pourrions attendre de nos économies ? » Eh bien ! je dis que si de telles idées pouvaient prévaloir pendant deux années seulement, c’en serait assez pour faire de notre belle France une Turquie. La misère y deviendrait générale et endémique ; et, à coup sûr, les premiers frappés seraient les plus pauvres.
Ouvriers, on vous parle beaucoup d’organisation artificielle du travail ; savez-vous pourquoi ? Parce qu’on ignore les lois de son organisation naturelle, c’est-à-dire de cette organisation merveilleuse qui résulte de la liberté. On vous dit que la liberté fait saillir ce qu’on nomme l’antagonisme radical des classes ; qu’elle crée et met aux prises deux intérêts opposés, l’intérêt des capitalistes et ceux des prolétaires. Mais il faudrait commencer par prouver que cet antagonisme existe par le vœu de la nature ; et ensuite, il resterait à démontrer comment les arrangements de la contrainte valent mieux que ceux de la liberté, car entre Liberté et Contrainte je ne vois pas de milieu. Il resterait à démontrer encore que la contrainte s’exercera toujours à votre avantage et au préjudice des riches. — Mais non, cet antagonisme radical, cette opposition naturelle d’intérêts n’existent pas. Ce n’est qu’un mauvais rêve d’imaginations perverties et en délire. Non, un plan si défectueux n’est pas sorti de la Pensée Divine. Pour l’affirmer, il faut commencer par nier Dieu. Et voyez comme, en vertu des lois sociales et par cela seul que les hommes échangent librement entre eux leurs travaux et leurs produits, voyez quel lien harmonique rattache les classes les unes aux autres ! Voilà des propriétaires de terre : quel est leur intérêt ? que le sol soit fécond et le soleil bienfaisant ; mais qu’en résulte-t-il ? que le blé abonde, qu’il baisse de prix, et l’avantage tourne au profit de ceux qui n’ont pas eu de patrimoine. Voilà des fabricants : quelle est leur constante pensée ? de perfectionner leur travail, d’augmenter la puissance de leurs machines, de se procurer, aux meilleures conditions, les matières premières. Et à quoi tout cela aboutit-il ? à l’abondance et au bas prix des produits, c’est-à-dire que tous les efforts des fabricants, et sans qu’ils s’en doutent, se résolvent en un profit pour le public consommateur, dont vous faites partie. Cela est ainsi pour toutes les professions. Eh bien ! les capitalistes n’échappent pas à cette loi. Les voilà fort occupés de faire valoir, d’économiser, de tirer bon parti de leurs avances. C’est fort bien, mais mieux ils réussissent, plus ils favorisent l’abondance des capitaux, et, par une suite nécessaire, la baisse de l’intérêt. Or, à qui profite la baisse de l’intérêt ? n’est-ce pas à l’emprunteur d’abord, et, en définitive, aux consommateurs des choses que les capitaux concourent à produire [11] ?
Il est donc certain que le résultat final des efforts de chaque classe, c’est le bien commun de toutes.
On vous dit que le capital tyrannise le travail. Je ne disconviens pas que chacun ne cherche à tirer le meilleur parti possible de sa situation, mais, dans ce sens, on ne réalise que ce qui est possible. Or, jamais il n’est possible aux capitaux de tyranniser le travail que lorsqu’ils sont rares, car alors ils font la loi, ils mettent la main-d’œuvre aux enchères. Jamais cette tyrannie ne leur est plus impossible que lorsqu’ils sont abondants, car, en ce cas, c’est le travail qui commande.
Arrière donc les jalousies de classes, les malveillances, les haines sans fondement, les défiances injustes. Ces passions dépravées nuisent à ceux qui les nourrissent dans leur cœur. Ce n’est pas là de la morale déclamatoire ; c’est un enchaînement de causes et d’effets susceptible d’être rigoureusement, mathématiquement démontré ; et il n’en est pas moins sublime parce qu’il satisfait autant l’intelligence que le sentiment.
Je résume toute cette dissertation par ces mots : Ouvriers, travailleurs, prolétaires, classes dénuées et souffrantes, voulez-vous améliorer votre sort ? Vous n’y réussirez pas par la lutte, l’insurrection, la haine et l’erreur. Mais il y a trois choses qui ne peuvent perfectionner la communauté tout entière sans étendre sur vous leurs bienfaits, ces trois choses sont : Paix, Liberté et Sécurité.
FN:Cet opuscule fut publié en février 1849. (Note de l’éditeur.)
FN:Le but de l’auteur n’a pas été d’analyser ici l’intérêt et d’en exposer tous les éléments, dont quelques-uns ne soulèvent aucune objection de la part des socialistes eux-mêmes. Telle est, par exemple, la prime d’assurance ou la compensation relative au risque couru par le prêteur de ne pas recouvrer le montant de sa créance. — Il s’est borné à défendre ce qui était attaqué, la productivité du capital, et s’est efforcé de rendre cette vérité accessible à toutes les intelligences. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome IV, le chap. i de la seconde série des Sophismes et, au tome VI, les chap. xviii, xix et xviii. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., pour la théorie de la valeur, le chap. v du tome VI. (Note de l’éditeur.)
FN:Cette erreur est combattue dans le pamphlet intitulé Maudit argent ! — Il vient immédiatement après celui-ci. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., sur la notion du capital, le chap. vii du tome VI. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy. la 8ème lettre du pamphlet Gratuité du crédit, au présent volume. (Note de l’éditeur.)
FN:Celui qui suit, sous le titre Maudit argent ! (Note de l’éditeur.)
FN:Voy. la 10e lettre du pamphlet Gratuité du crédit. (Note de l’éditeur.)
FN:Pour la distinction entre les divers éléments de l’intérêt, voy., au pamphlet Gratuité du crédit, les dernières pages de la 12e lettre. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy. les pages 36 à 45 du tome IV. - Voy. aussi le chap. viii du tome VI. (Note de l’éditeur.)
Paix et liberté du le budget républicain [février 1849] [CW2.15]↩
BWV
1849.02 “Paix et liberté ou le budget républicain” (Peace and Freedom or the Republican Budget) [February 1849. n.p.] [OC5.9, p. 407] [CW2]
Paix et liberté ou le Budget Républicain [1]
1849
Un programme ! un programme ! voilà le cri qui s’élève de toutes parts vers le cabinet.
Comment comprenez-vous l’administration intérieure ? Quelle sera votre politique au dehors ? Par quelles grandes mesures entendez-vous élever les recettes ? Vous faites-vous fort d’éloigner de nous ce triple fléau qui semble planer sur nos têtes : la guerre, les révolutions, la banqueroute ? Pouvons-nous enfin nous livrer avec quelque sécurité au travail, à l’industrie, aux grandes entreprises ? Qu’avez-vous imaginé pour nous assurer ce lendemain que vous promîtes à tous les citoyens, le jour où vous prîtes la direction des affaires ?
Voilà ce que chacun demande ; mais, hélas ! le ministère ne répond rien. Qui pis est, il semble systématiquement résolu à ne rien répondre.
Que faut-il en conclure ? Ou le cabinet n’a pas de plan, ou s’il en a un, il le cache.
Eh bien ! je dis que, dans l’une ou l’autre hypothèse, il manque à son devoir. S’il cache son plan, il fait une chose qu’il n’a pas le droit de faire ; car un plan gouvernemental n’appartient pas au gouvernement, mais au public. C’est nous qu’il intéresse, puisque notre bien-être et notre sécurité en dépendent. Nous devons être gouvernés non selon la volonté cachée du ministère, mais selon sa volonté connue et approuvée. Au cabinet, l’exposition, la proposition, l’initiative ; à nous, le jugement ; à nous, l’acceptation ou le refus. Mais pour juger, il faut connaître. Celui qui monte sur le siège et s’empare des guides, déclare, par cela même, qu’il sait ou croit savoir le but qu’il faut atteindre et la route qu’il faut prendre. C’est bien le moins qu’il n’en fasse pas mystère aux voyageurs, quand ces voyageurs forment une grande nation tout entière.
Que s’il n’a pas de plan, qu’il juge lui-même ce qu’il a à faire. À toutes les époques, pour gouverner il faut une pensée ; mais cela est vrai, surtout aujourd’hui. Il est bien certain qu’on ne peut plus suivre les vieilles ornières, ces ornières qui déjà trois fois ont versé le char dans la boue. Le statu quo est impossible, la tradition insuffisante. Il faut des réformes ; et, quoique le mot soit malsonnant, je dirai : Il faut du nouveau ; non point du nouveau qui ébranle, renverse, effraie, mais du nouveau qui maintienne, consolide, rassure et rallie.
Donc, dans mon ardent désir de voir apparaître le vrai Budget républicain, découragé par le silence ministériel, je me suis rappelé le vieux proverbe : Veux-tu être bien servi, sers-toi toi-même ; et pour être sûr d’avoir un programme, j’en ai fait un. Je le livre au bon sens public.
Et d’abord, je dois dire dans quel esprit il est conçu.
J’aime la République, — et j’ajoute, pour faire ici un aveu dont quelques-uns pourront être surpris [2], — je l’aime beaucoup plus qu’au 24 février. Voici mes raisons.
Comme tous les publicistes, même ceux de l’école monarchique, entre autres Chateaubriand, je crois que la République est la forme naturelle d’un gouvernement normal. Peuple, Roi, Aristocratie, ce sont trois puissances qui ne peuvent coexister que pendant leur lutte. Cette lutte a des armistices qu’on appelle des chartes. Chaque pouvoir stipule dans ces chartes une part relative à ses victoires. C’est en vain que les théoriciens sont intervenus et ont dit : « Le comble de l’art, c’est de régler les attributions des trois jouteurs, de telle sorte qu’ils s’empêchent réciproquement. » La nature des choses veut que, pendant et par la trêve, l’une des trois puissances se fortifie et grandisse. La lutte recommence, et aboutit, de lassitude, à une charte nouvelle un peu plus démocratique, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le régime républicain ait triomphé.
Mais il peut arriver que le peuple, parvenu à se gouverner lui-même, se gouverne mal. Il souffre et soupire après un changement. Le prétendant exilé met à profit l’occasion, il remonte sur le trône. Alors la lutte, les trêves et le règne des chartes recommencent, pour aboutir de nouveau à la République. Combien de fois peut se renouveler l’expérience ? C’est ce que j’ignore. Mais ce qui est certain, c’est qu’elle ne sera définitive que lorsque le peuple aura appris à se gouverner.
Or, au 24 février, j’ai pu craindre, comme bien d’autres, que la nation ne fût pas préparée à se gouverner elle-même. Je redoutais, je l’avoue, l’influence des idées grecques et romaines qui nous sont imposées à tous par le monopole universitaire, idées radicalement exclusives de toute justice, de tout ordre, de toute liberté, idées devenues plus fausses encore dans les théories prépondérantes de Montesquieu et de Rousseau. Je redoutais aussi la terreur maladive des uns et l’admiration aveugle des autres, inspirées par le souvenir de la première République. Je me disais : Tant que dureront ces tristes associations d’idées, le règne paisible de la Démocratie sur elle-même n’est pas assuré.
Mais les événements ne se sont pas réglés sur ces prévisions. La République a été proclamée ; pour revenir à la Monarchie, il faudrait une révolution, peut-être deux ou trois, puisqu’il y a plusieurs Prétendants. En outre, ces révolutions ne seraient que le prélude d’une révolution nouvelle, puisque le triomphe définitif de la forme républicaine est la loi nécessaire et fatale du progrès social.
Que le ciel nous préserve de telles calamités. Nous sommes en République, restons-y ; restons-y, puisqu’elle reviendrait tôt ou tard ; restons-y, puisqu’en sortir ce serait rouvrir l’ère des bouleversements et des guerres civiles.
Mais pour que la République se maintienne, il faut que le peuple l’aime. Il faut qu’elle jette d’innombrables et profondes racines dans l’universelle sympathie des masses. Il faut que la confiance renaisse, que le travail fructifie, que les capitaux se forment, que les salaires haussent, que la vie soit plus facile, que la nation soit fière de son œuvre, en la montrant à l’Europe toute resplendissante de vraie grandeur, de justice et de dignité morale. Donc, inaugurons la politique de la Paix et de la Liberté.
Paix et Liberté ! Il n’est certes pas possible d’aspirer vers deux objets plus élevés dans l’ordre social. Mais que peuvent-ils avoir de commun avec les chiffres glacés d’un vulgaire budget ?
Ah ! la liaison est aussi intime qu’elle puisse l’être. Une guerre, une menace de guerre, une négociation pouvant aboutir à la guerre, rien de tout cela n’arrive à l’existence que par la vertu d’un petit article inscrit sur ce gros volume, effroi du contribuable. Et, de même, je vous défie d’imaginer une oppression, une limitation à la liberté des citoyens, une chaîne à leur bras ou à leur cou, qui ne soit née du budget des recettes et n’en subsiste.
Montrez-moi un peuple se nourrissant d’injustes idées de domination extérieure, d’influence abusive, de prépondérance, de prépotence ; s’immisçant dans les affaires des nations voisines, sans cesse menaçant ou menacé ; et je vous montrerai un peuple accablé de taxes.
Montrez-moi un peuple qui s’est donné des institutions d’une telle nature que les citoyens ne peuvent penser, écrire, imprimer, enseigner, travailler, échanger, s’assembler sans qu’une tourbe de fonctionnaires ne vienne entraver leurs mouvements ; et je vous montrerai un peuple accablé de taxes.
Car je vois bien comment il ne m’en coûte rien pour vivre en paix avec tout le monde. Mais je ne puis concevoir comment je devrais m’y prendre pour m’exposer à des querelles continuelles, sans m’assujettir à des frais énormes, soit pour attaquer, soit pour me défendre.
Et je vois bien aussi comment il ne m’en coûte rien pour être libre ; mais je ne puis comprendre comment l’État pourrait agir sur moi d’une manière funeste à ma liberté, si je n’ai commencé par remettre en ses mains, et à mes frais, de coûteux instruments d’oppression.
Cherchons donc l’économie. Cherchons-la, parce qu’elle est le seul moyen de satisfaire le peuple, de lui faire aimer la République, de tenir en échec, par la sympathie des masses, l’esprit de turbulence et de révolution. Cherchons l’économie, — Paix et Liberté nous seront données par surcroît.
L’Économie est comme l’Intérêt personnel. Ce sont deux mobiles vulgaires, mais ils développent des principes plus nobles qu’eux-mêmes.
Le but spécial et actuel d’une réforme financière est de rétablir l’Équilibre entre la recette et la dépense. Son but ultérieur, ou plutôt son effet, est de restaurer le Crédit public. Enfin, un autre but plus important qu’elle doit atteindre pour mériter ce beau nom de réforme, c’est de soulager le peuple, de faire aimer les institutions et d’épargner ainsi au pays de nouvelles commotions politiques.
Si j’apprécie à ces divers points de vue les systèmes qui se sont produits, je ne puis m’empêcher de les juger ou bien incomplets ou illusoires.
Un mot sur deux de ces systèmes : celui des praticiens et celui des utopistes.
Je commence par déclarer que j’ai le plus profond respect pour la science et l’expérience des financiers. Ils ont passé leur vie à étudier le mécanisme de nos finances, ils en connaissent tous les ressorts ; et s’il ne s’agissait que d’atteindre cet équilibre, qui est à peu près l’objet exclusif de leur poursuite, peut-être n’y aurait-il rien de mieux à faire que de leur confier cette tâche déjà bien difficile. En rognant quelque peu nos dépenses, en élevant quelque peu nos recettes, je veux croire qu’au bout de trois ou quatre ans, ils nous mèneraient à ce port si désiré qu’ils nomment le budget normal.
Mais il est clair que la pensée fondamentale, qui gouverne notre mécanisme financier, resterait la même, sauf quelques améliorations dans les détails. Or, la question que je pose est celle-ci : en restant sous l’empire de cette pensée fondamentale, en replâtrant notre système contributif, si profondément ébranlé par la révolution de Février, avons-nous devant nous les trois ou quatre ans qui nous séparent du fameux équilibre ? En d’autres termes, notre système financier, même dégagé de quelques abus, porte-t-il en lui-même des conditions de durée et de vie ? N’est-il pas l’outre d’Éole, et ne renferme-t-il pas dans ses flancs les vents et les tempêtes ?
Si c’est précisément de ce système que sont sortis les bouleversements, que devons-nous attendre de sa simple restauration ?
Les hommes de la finance, je parle de ceux pour qui le beau idéal est de rétablir les choses, sauf quelques détails, comme elles étaient avant Février, ces hommes, qu’ils me permettent de le dire, veulent bâtir sur le sable et avancer dans un cercle vicieux. Ils ne s’aperçoivent pas que le vieux système qu’ils préconisent, bien loin de fonder l’abondance des recettes publiques sur la prospérité des classes travailleuses, aspire à gonfler le budget à force de tarir la source qui l’alimente.
Indépendamment de ce que c’est là un vice radical au point de vue financier, c’est encore un effroyable danger politique. Quoi ! vous venez de voir quelle atteinte, presque mortelle, une révolution a portée à nos finances ; vous ne pouvez pas douter qu’une des causes, sinon la seule, de cette commotion, c’est la désaffection née dans le cœur du peuple du poids des taxes, et la chose à laquelle vous aspirez, c’est de nous remettre au point de départ, et de remonter péniblement le char justement au sommet de la déclivité fatale !
Alors même qu’une révolution ne se serait pas accomplie, alors même qu’elle n’aurait pas éveillé au sein des masses des espérances et des exigences nouvelles, je crois vraiment que votre entreprise serait irréalisable. Mais ce qui eût été prudence, avant Février, n’est-il pas devenu nécessité ? Est-ce que vous croyez que vos trois ou quatre années d’efforts à la poursuite exclusive de l’équilibre peuvent s’écouler paisiblement, si le peuple ne voit rien venir que de taxes nouvelles ? si la République ne se montre à lui que par la plus grande âpreté des percepteurs ? si, sur le fruit de son travail, de moins en moins rémunéré, il faut qu’il fasse à l’État et à ses agents une part toujours plus grande ? Non, ne l’espérez pas. Un bouleversement nouveau viendra interrompre vos froides élucubrations, et alors, je vous le demande à vous-mêmes, qu’adviendra-t-il de cet équilibre et de ce crédit qui sont, à vos yeux, le sublime de l’art et le terme de tout effort intelligent ?
Je crois donc que les hommes pratiques perdent complétement de vue le troisième but (et le premier en importance) que j’ai assigné à la réforme financière, à savoir : soulager le contribuable, faire aimer la République.
Nous en avons eu une preuve récente. L’Assemblée nationale a réduit l’impôt du sel et la taxe des lettres. Eh bien ! non-seulement les financiers désapprouvent ces mesures, mais encore ils ne peuvent pas se mettre dans la tête que l’Assemblée ait agi conformément à sa propre volonté. Ils supposent toujours, et de très-bonne foi, qu’elle a été victime d’une surprise et qu’elle la déplore, tant toute idée de réforme leur répugne.
À Dieu ne plaise que je veuille insinuer par là que la coopération des financiers est à repousser ! Quelle que soit l’idée nouvelle qui surgisse, elle ne peut guère être mise en œuvre que par le concours de leur utile expérience. Mais il est probable qu’elle ne surgira pas dans leur cerveau. Ils ont trop vécu pour cela dans les errements du passé. Si, avant les campagnes d’Italie, Napoléon avait usé trente années de sa vie à étudier et appliquer toutes les combinaisons de l’ancienne stratégie, croit-on qu’il eût été frappé de cette inspiration qui a révolutionné l’art de la guerre et jeté un si grand éclat sur les armes françaises ?
À côté de cette école pleine de jours et d’expérience, qui offrira à l’exécution des ressources précieuses, mais d’où ne jaillira pas, je le crains, l’idée féconde que la France attend pour son salut, sa gloire et sa sécurité, il y a une autre école ou plutôt un nombre à peu près infini d’autres écoles, aux idées desquelles, si l’on peut reprocher quelque chose, ce n’est pas du moins de manquer de nouveauté. Je n’ai pas l’intention d’examiner tous les systèmes qu’elles ont mis au jour. Je me bornerai à dire quelques mots sur la pensée qui m’a paru dominer dans le manifeste des républicains dits avancés.
Ce manifeste me semble reposer sur un cercle vicieux beaucoup plus caractérisé encore que celui des financiers. À vrai dire, il n’est qu’une perpétuelle et puérile contradiction. Dire au peuple : « La république va faire pour toi un miracle. Elle va te dégager de toute cette lourde responsabilité qui pèse sur la condition humaine. Elle te prendra au berceau, et après t’avoir conduit, à ses frais, de la crèche à la salle d’asile, de la salle d’asile à l’école primaire, de l’école primaire aux écoles secondaires et spéciales, de là à l’atelier de travail, et de l’atelier de travail aux maisons de refuge, elle te rendra à la tombe, sans que tu aies eu besoin, pour ainsi dire, de prendre soin de toi-même. As-tu besoin de crédit ? te manque-t-il des instruments de travail, ou du travail ? désires-tu de l’instruction ? quelque sinistre est-il venu visiter ton champ ou ton atelier ? l’État est là, comme un père opulent et généreux, pour pourvoir à tout, pour tout réparer. Bien plus, il étendra sa sollicitude sur toute la surface du globe, en vertu du dogme de la Solidarité ; et, au cas qu’il te prenne fantaisie d’aller semer au loin tes idées et tes vues politiques, il tiendra toujours une grande armée prête à entrer en campagne. Voilà sa mission, elle est vaste, et pour l’accomplir il ne te demande rien. Sel, boissons, postes, octrois, contributions de toutes sortes, il va renoncer à tout. Un bon père donne à ses enfants, mais ne leur demande pas. Que si l’État ne suit pas cet exemple, s’il ne remplit pas envers toi le double et contradictoire devoir que nous signalons, il aura trahi sa mission, il ne te restera qu’à le renverser. » Je le demande, se peut-il rien imaginer de plus chimérique en même temps que de plus dangereux ?
Il est vrai que pour masquer ces grossières impossibilités, on ajoute : L’impôt sera transformé ; on le prendra sur le superflu des riches.
Mais il faut bien que le peuple le sache. Ce n’est là qu’une chimère de plus. Imposer à l’État des attributions exorbitantes, et persuader qu’il pourra y faire face avec l’argent prélevé sur le superflu des riches, c’est donner au public une vaine espérance. Combien y a-t-il de riches en France ? Quand il fallait payer 200 francs pour avoir droit de suffrage, le nombre des électeurs était de deux cent mille, et sur ce nombre, la moitié peut-être n’avait pas de superflu. Et l’on voudrait affirmer aujourd’hui que l’État peut remplir l’immense mission qu’on lui donne en se bornant à imposer les riches ! Il suffira que deux cent mille familles livrent au gouvernement le superflu de leurs richesses pour que celui-ci prodigue toute sorte de bienfaits aux huit millions de familles moins aisées. Mais on ne voit donc pas une chose : c’est qu’un système d’impôt ainsi conçu donnerait à peine de quoi pourvoir à sa propre perception.
La vérité est, et le peuple ne devrait jamais le perdre de vue, que la contribution publique s’adressera toujours et nécessairement aux objets de la consommation la plus générale, c’est-à-dire la plus populaire. C’est précisément là le motif qui doit pousser le peuple, s’il est prudent, à restreindre les dépenses publiques, c’est-à-dire l’action, les attributions et la responsabilité du gouvernement. Il ne faut pas qu’il s’attende à ce que l’État le fasse vivre, puisque c’est lui qui fait vivre l’État [3].
D’autres espèrent beaucoup dans la découverte de quelque nouvelle matière imposable. Je suis loin de prétendre qu’il n’y a rien à essayer dans cette voie, mais je soumets au lecteur ces trois observations :
1° Tous les gouvernements antérieurs ont aimé avec passion à prendre beaucoup au public pour pouvoir beaucoup dépenser. Il n’est guère probable qu’en fait d’impôts, aucune mine précieuse et d’une exploitation facile eût échappé au génie de la fiscalité. S’il a été arrêté par quelque chose, ce n’a pu être que par la crainte des répugnances nationales.
2° Si de nouvelles sources d’impôts ne peuvent s’ouvrir sans heurter les habitudes et exciter le mécontentement, le moment serait-il bien choisi, après une révolution, de tenter une telle expérience ? Ne serait-ce pas compromettre la République ? Figurons-nous l’effet produit sur les contribuables par cette nouvelle : l’Assemblée nationale vient de vous assujettir à des taxes, de vous jusqu’ici inconnues et devant lesquelles la monarchie avait reculé !
3° Au point de vue actuel et pratique, chercher et découvrir de nouveaux impôts, c’est un sûr moyen de ne rien faire et de négliger le corps pour l’ombre. L’Assemblée nationale n’a que deux ou trois mois à vivre. D’ici là, il faut qu’elle ait fait le budget. Je laisse au lecteur le soin de tirer la conclusion.
Après avoir rappelé les systèmes qui sont les plus en vogue et les plus inadmissibles, il me reste à signaler celui que je voudrais voir prévaloir.
Établissons d’abord la situation financière à laquelle il faut faire face.
Nous sommes en déficit (car le mot insuffisance est devenu insuffisant). Ce déficit, je n’en chercherai pas le chiffre exact. J’ignore comment notre comptabilité est tenue ; ce que je sais, c’est que jamais, au grand jamais, deux chiffres officiels, pour le même fait, ne se ressemblent. Quoi qu’il en soit, la plaie est énorme. Le dernier budget (vol. 1, p. 62) contient ce renseignement :
| Anciens découverts (autre joli mot), années 1846 et antérieures | 184,156,000 | fr. |
| Budget de 1847 | 43,179,000 | |
| Indemnité aux caisses d’épargne | 38,000,000 | |
| Budget de 1848 | 71,167,000 | |
| Budget de 1849 | 213,960,534 | |
| Total des découverts | 550,462,534 | fr. |
Voilà le résultat des budgets passés. Donc le mal ira toujours croissant à l’avenir, si nous ne parvenons, soit à augmenter les recettes, soit à diminuer les dépenses, non-seulement de manière à les aligner, mais encore à trouver un excédant de recettes qui absorbe peu à peu les découverts antérieurs.
Il ne sert de rien de se le dissimuler, hors de là, c’est la banqueroute et ses suites.
Et, ce qui rend la situation plus difficile, c’est cette considération que j’ai déjà indiquée et sur laquelle j’insiste de toutes mes forces, à savoir que, si l’on cherche le remède ou partie du remède dans une aggravation d’impôts, ainsi que cela se présente naturellement à l’esprit, on provoquera des révolutions. Or, l’effet financier des révolutions, à ne parler que de celui-là, étant d’accroître les dépenses et de tarir les sources du revenu (je m’abstiens de démonstration), le procédé, au lieu de détourner la catastrophe, n’est propre qu’à la précipiter.
Je vais plus loin. La difficulté est bien plus grande encore, car j’affirme (telle est du moins ma conviction profonde) que l’on ne peut pas même maintenir tous les impôts existants sans mettre contre soi les chances les plus terribles. Une révolution s’est faite ; elle s’est proclamée démocratique, la démocratie en veut sentir les bienfaits. Elle a tort ou elle a raison, mais c’est ainsi. Malheur aux gouvernements, malheur au pays, si cette pensée n’est pas toujours présente à l’esprit des Représentants du peuple.
La question ainsi posée, que faut-il faire ?
Car, d’un autre côté, si l’on peut diminuer les dépenses, il y a des bornes à ces retranchements. Il ne faut pas aller jusqu’à désorganiser les services, ce serait encore faire arriver les révolutions par l’autre extrémité de l’horizon financier.
Que faut-il donc faire ?
Voici ma pensée. Je la formule dans toute sa naïveté, au risque de faire dresser les cheveux sur la tête à tous les financiers et praticiens.
Diminuer les impôts. — Diminuer les dépenses dans une proportion plus forte encore.
Et, pour revêtir cette pensée financière de sa formule politique, j’ajoute :
Liberté au dedans. — Paix au dehors.
Voilà tout le programme.
Vous vous récriez ! « Il est aussi contradictoire, dites-vous, que le manifeste montagnard ; il renferme un cercle vicieux au moins aussi évident que ceux que vous avez précédemment signalés dans les autres systèmes. »
Je le nie, j’accorde seulement que la tentative est hardie. Mais si la gravité de la situation est bien établie, d’une part ; si, de l’autre, il est prouvé que les moyens traditionnels ne nous en feront pas sortir, il me semble que ma pensée a quelque droit au moins à l’attention de mes collègues.
Qu’il me soit donc permis d’examiner mes deux propositions, et que le lecteur, se rappelant qu’elles forment un tout indivisible, veuille bien suspendre son jugement, et peut-être son arrêt.
Il y a d’abord une vérité qu’il faut rappeler, parce qu’on n’en tient pas assez compte : c’est que, par la nature de notre système contributif, qui repose en très-grande partie sur une perception indirecte, c’est-à-dire demandée à la consommation, il y a une connexité étroite, une relation intime entre la prospérité générale et la prospérité des finances publiques.
Ceci nous mène à cette conclusion : il n’est pas rigoureusement exact de dire que soulager le contribuable c’est infailliblement porter atteinte au revenu.
Si, par exemple, dans un pays comme le nôtre, le gouvernement, poussé par une exagération d’ardeur fiscale, élevait les taxes jusqu’au point de ruiner les facultés du consommateur ; s’il doublait et triplait le prix vénal des choses les plus nécessaires, s’il renchérissait encore les matériaux et les instruments de travail ; si, par suite, une partie considérable de la population était réduite à se priver de tout, à vivre de châtaignes, de pommes de terre, de sarrasin, de maïs, il est clair que la stérilité du budget des recettes pourrait être attribuée, avec quelque fondement, à l’exagération même des taxes.
Et, dans cette hypothèse, il est clair encore que le vrai moyen, le moyen rationnel de faire fleurir les finances publiques, ce ne serait pas de porter de nouveaux coups à la richesse générale, mais au contraire de la laisser s’accroître ; ce ne serait pas de tendre l’impôt mais de le détendre.
Théoriquement, je ne crois pas que ceci puisse être contesté : l’impôt, dans son développement successif, peut arriver à ce point que ce que l’on ajoute à son chiffre on le retranche à son produit. Quand les choses en sont là, il est aussi vain, il est aussi fou, il est aussi contradictoire de chercher une addition aux recettes, dans une addition aux impôts, qu’il le serait de vouloir élever le liquide, dans le manomètre, par des moyens qui auraient pour effet de diminuer la chaleur dans la chaudière.
Ceci posé, il faut savoir si, en fait, notre pays n’en est pas là.
Si j’examine les principaux objets de consommation universelle, auxquels l’État demande son revenu, je les trouve chargés de taxes tellement exorbitantes qu’on ne peut expliquer que par la puissance de l’habitude la soumission du contribuable.
Dire que quelques-unes de ces taxes équivalent à la confiscation, ce serait employer une expression bien insuffisante.
Viennent d’abord le sucre et le café. Nous pourrions les avoir à bas prix, si nous avions la liberté d’aller les chercher sur les marchés vers lesquels notre intérêt nous pousse. Mais, dans le but bien arrêté de nous fermer le commerce du monde, le fisc nous soumet à une grosse amende quand nous commettons le délit d’échange avec l’Inde, la Havane ou le Brésil. Que si, dociles à sa volonté, nous limitons notre commerce à celui que peuvent alimenter trois petits rochers perdus au milieu des océans ; alors nous payons, il est vrai, le sucre et le café beaucoup plus cher, mais le fisc radouci ne nous prend, sous forme de taxe, que cent pour cent de la valeur, environ.
On appelle cela de l’économie politique profonde. Notez que, pour acquérir les petits rochers, il nous en a coûté des torrents de sang et des tonnes d’or, dont la rente nous grèvera pendant toute l’éternité. Par voie de compensation, nous payons en outre des tonnes d’or pour les conserver.
Il existe, en France, un produit qui est national s’il en fut et dont l’usage est inséparable des habitudes populaires. Pour réparer les forces des travailleurs, la nature a donné la viande aux Anglais et le vin aux Français ; ce vin, on peut se le procurer partout à 8 ou 10 fr. l’hectolitre, mais le fisc intervient et vous taxe à 15 fr.
Je ne dirai rien de l’impôt des tabacs, qui est assez bien accepté par l’opinion. Il n’en est pas moins vrai que cette substance est taxée à plusieurs fois sa valeur.
L’État dépense 5 c., 10 c. au plus pour transporter une lettre d’un point à l’autre du territoire. Jusqu’à ces derniers temps, il vous forçait d’abord de vous adresser à lui ; ensuite, quand il vous tenait, il vous faisait payer 80 c., 1 fr. et 1 fr. 20 c. ce qui lui coûtait un sou.
Parlerai-je du sel ? Il a été bien constaté, dans une discussion récente, qu’on peut faire du sel en quantité indéfinie, dans le midi de la France, à 50 c. Le fisc le frappait d’un droit de 30 fr. Soixante fois la valeur de la chose ! et on appelle cela une contribution ! Je contribue pour soixante, parce que je possède un ! Je gagnerais 6,000 pour cent à abandonner ma propriété au gouvernement !
Ce serait bien pis, si je parlais de la douane. Ici le gouvernement a deux buts bien arrêtés : le premier, d’élever le prix des choses, de soustraire au travail ses matériaux, d’augmenter les difficultés de la vie ; le second, de combiner et grossir les taxes, de telle sorte que le fisc n’en perçoive rien, rappelant ce mot d’un petit maître à son tailleur, à propos d’un haut-de-chausses : « Si j’y entre, je ne le prends pas. »
Enfin l’exorbitante exagération de ces taxes ne peut manquer de stimuler l’esprit de fraude. Dès lors le gouvernement est obligé de s’entourer de plusieurs armées de fonctionnaires, de mettre toute la nation en suspicion, d’imaginer toutes sortes d’entraves, de formalités, toutes choses qui paralysent le travail et s’alimentent au budget.
Tel est notre système contributif. Nous n’avons aucun moyen d’exprimer en chiffres ses conséquences. Mais quand, d’un côté, on étudie ce mécanisme, et que, de l’autre, on constate dans une grande partie de notre population l’impuissance de consommer, n’est-il pas permis de se demander si ces deux faits ne sont pas entre eux dans les rapports de cause à effet ? N’est-il pas permis de se demander si nous relèverons ce pays-ci et ses finances en persévérant dans la même voie, à supposer même que la désaffection publique nous en laisse le temps ? Vraiment, il me semble que nous ressemblons un peu à un homme qui, étant sorti péniblement d’un abîme, où son imprudence l’a plusieurs fois jeté, n’imaginerait rien de mieux que de se placer au même point de départ, et de suivre, seulement avec un peu plus de précipitation, la même ornière.
En théorie, tout le monde conviendra que les taxes peuvent être portées à un tel degré d’exagération qu’il est impossible d’y rien ajouter, sans pétrifier la richesse générale, de manière à compromettre le trésor public lui-même. Cette éventualité théorique s’est manifestée en fait d’une façon si éclatante, dans un pays voisin, que je demande à m’étayer de cet exemple, puisque aussi bien, si le phénomène n’était pas reconnu possible, toute ma dissertation, aussi bien que toutes mes conclusions subséquentes, serait sans valeur et sans portée. Je sais qu’on n’est pas très-bien venu, en France, quand on cherche un enseignement dans l’expérience britannique ; nous aimons mieux faire les expériences à nos propres dépens. Mais je prie le lecteur de vouloir bien admettre pour un instant que, d’un côté de la Manche comme de l’autre, deux et deux font quatre.
Il y a quelques années, l’Angleterre se trouva, financièrement parlant, dans une situation fort analogue à celle où nous sommes. Pendant plusieurs années consécutives, chaque budget se réglait en déficit, si bien qu’il fallut songer à des moyens héroïques. Le premier qui se présenta à l’esprit des financiers, on le devine, ce fut d’augmenter les taxes. Le cabinet whig ne se mit pas en frais d’invention. Il se borna purement et simplement à décider qu’une surtaxe de 5 pour cent serait ajoutée aux impôts. Il raisonnait ainsi : « Si 100 schellings de taxes nous donnent 100 schellings de recettes, 105 schellings de taxes nous donneront 105 schellings de recettes ; ou du moins, car il faut prévoir une légère dépression de consommation, 104 1/2 ou 104 schellings. » Rien ne paraissait plus mathématiquement assuré. Cependant, au bout de l’an, on fut tout ébahi de n’avoir recouvré ni 105 ni 104, ni même 100, mais seulement 96 ou 97.
C’est alors que s’échappa des poitrines aristocratiques ce cri de douleur : « C’en est fait, nous ne pouvons plus ajouter une obole à notre liste civile. Nous sommes arrivés à la dernière limite de la taxation profitable [4]. Il n’y a plus de ressource pour nous, puisque imposer plus, c’est recevoir moins. »
Le cabinet whig fut renversé du coup. Il fallut bien éprouver d’autres habiletés. Sir Robert Peel se présenta. C’était certainement un financier pratique. Cela ne l’empêcha pas de faire ce raisonnement qui, sorti de mes lèvres novices, a paru subtil et peut-être absurde : « Puisque l’impôt a créé la misère des masses, et puisqu’à son tour la misère des masses a limité la productivité de l’impôt, c’est une conséquence rigoureuse, quoiqu’à physionomie paradoxale, que pour faire prospérer les taxes il les faut diminuer. Essayons donc si le fisc, qui a perdu à être trop avide, ne gagnera pas à se faire généreux. » La générosité dans le fisc ! certes, voilà une expérience toute nouvelle. Elle vaut bien la peine d’être étudiée. Messieurs les financiers ne seraient-ils pas bien heureux, s’ils venaient à découvrir que la générosité même peut être quelquefois lucrative ? Il est vrai qu’alors elle devrait s’appeler : intérêt bien entendu. Soit. Ne disputons pas sur les mots.
Donc, sir Robert Peel se mit à dégréver, dégréver, dégréver. Il laissa entrer le blé, le bétail, la laine, le beurre, malgré les clameurs des landlords, pensant, avec quelque apparence de raison, que le peuple n’est jamais mieux nourri que lorsqu’il y a beaucoup d’aliments dans le pays, proposition regardée ailleurs comme séditieuse. Savon, papier, drêche, sucre, café, coton, teintures, sel, poste, verre, acier, tout ce que le travailleur emploie ou consomme passa par la réforme.
Cependant, sir Robert, qui n’est pas un cerveau brûlé, savait bien que si un tel système, en provoquant la prospérité publique, doit réagir favorablement sur l’échiquier, ce ne peut être qu’à la longue. Or, les déficits, insuffisances, découverts, comme on voudra les appeler, étaient actuels et pressants. Abandonner, même provisoirement, une partie du revenu, c’eût été aggraver la situation, ébranler le crédit. Il y avait à traverser une période difficile, rendue plus difficile par l’entreprise elle-même. Aussi, diminuer l’impôt, ce n’était que la moitié du système de sir Robert, comme ce n’est que la moitié de celui que je propose en toute humilité. On a vu que le complément nécessaire du mien [5] consiste à diminuer les défenses dans une proportion supérieure. Le complément du système Peel se rapprochait plus des traditions financières et fiscales. Il songea à chercher une autre source de revenu, et l’income-tax fut décrété.
Ainsi, en face des déficits, la première pensée avait été d’aggraver l’impôt ; la seconde, de le transformer, de le demander à qui peut le payer. C’était un progrès. Pourquoi ne me ferais-je pas la douce idée que diminuer les dépenses serait un progrès plus décisif encore ?
Je suis forcé, malgré la lenteur que cela m’impose, d’examiner brièvement cette question : L’expérience britannique a-t-elle réussi ? J’y suis forcé, car à quoi servirait un exemple qui aurait échoué, si ce n’est à en éviter l’imitation ? Ce n’est certes pas la conclusion où j’ai voulu amener le lecteur.
Or, beaucoup de personnes affirment que l’entreprise de sir Robert Peel a été désastreuse ; et leur affirmation est d’autant plus spécieuse que, précisément à partir du jour où la réforme contributive a été inaugurée, une longue et terrible crise commerciale et financière est venue désoler la Grande-Bretagne.
Mais d’abord, je dois faire observer qu’alors même qu’on pourrait attribuer, en partie, les récents désastres industriels de l’Angleterre à la réforme de sir Robert Peel, on ne devrait pas en arguer contre celle que je propose, puisque ces deux réformes diffèrent par le point le plus capital. Ce qu’elles ont de commun, c’est ceci : chercher l’accroissement ultérieur des recettes dans la prospérité des masses, c’est-à-dire dans l’adoucissement de l’impôt quant à son chiffre. Ce qu’elles ont de différent, c’est ceci : Sir Robert Peel s’est ménagé les moyens de traverser les difficultés de la transition, par l’établissement d’un nouvel impôt. Ces moyens, je les demande à une profonde réduction de dépenses. Sir Robert fut si loin de diriger ses idées de ce côté que, dans le même document où il exposa devant l’Angleterre attentive son plan financier, il réclamait, pour le développement des forces militaires et navales, une augmentation considérable de subsides.
Or, puisque les deux systèmes, dans la première partie, se confondent en ce qu’ils aspirent à fonder à la longue la prospérité du trésor public sur le soulagement des classes travailleuses, n’est il pas évident que la réduction des dépenses ou le dégrèvement pur et simple est plus en harmonie avec cette pensée que le déplacement de la taxe ?
Je ne puis m’empêcher de croire que le second membre du système de Peel était de nature à contrarier le premier. C’est sans doute un bien immense que de mieux répartir les taxes. Mais enfin, quand on connaît un peu ces matières, quand on a étudié le mécanisme naturel des impôts, leurs ricochets, leurs contre-coups, on sait bien que ce que le fisc demande à une classe est payé en grande partie par une autre. Il n’est pas possible que les travailleurs anglais n’aient été atteints directement ou indirectement par l’income-tax. Ainsi, en les soulageant d’un côté, on les a, dans une mesure quelconque, frappés de l’autre.
Mais laissons de côté ces considérations, et examinons s’il est possible, en présence des faits éclatants qui expliquent d’une manière si naturelle la crise anglaise, de l’attribuer à la réforme. L’éternel sophisme des gens décidés à incriminer une chose, c’est de lui attribuer tous les maux qui surviennent dans le monde. Post hoc, ergo propter hoc. L’idée préconçue est et sera toujours le fléau du raisonnement, car, par sa nature, elle fuit la vérité quand elle a la douleur de l’entrevoir.
L’Angleterre a eu d’autres crises commerciales que celle qu’elle vient de traverser. Toutes s’expliquent par des causes palpables. Une fois elle fut saisie d’une fièvre de spéculations mal conçues. D’immenses capitaux, désertant la production, prirent la route des emprunts américains et des mines de métaux précieux. Il en résulta une grande perturbation dans l’industrie et les finances. — Une autre fois, c’est la récolte qui est emportée, et il est facile d’apprécier les conséquences. Quand une portion considérable du travail de tout un peuple a été dirigée vers la création de sa propre subsistance, quand on a labouré, hersé, semé et arrosé, pendant un an, la terre de sueurs pour faire germer les moissons, si, au moment d’être recueillie, elles sont détruites par un fléau, le peuple est dans l’alternative ou de mourir de faim, ou de faire venir inopinément, rapidement des masses énormes de substances alimentaires. Il faut que toutes les opérations ordinaires de l’industrie soient interrompues, pour que les capitaux qu’elles occupaient fassent tête à cette opération gigantesque, inattendue et irrémissible. Que de forces perdues ! que de valeurs détruites ! et comment n’en résulterait-il pas une crise ? — Elle se manifeste encore quand la récolte du coton vient à manquer aux États-Unis, par la simple raison que les fabriques ne peuvent être aussi activement occupées quand elles manquent de coton que lorsqu’elles n’en manquent pas ; et ce n’est jamais impunément que la stagnation s’étend sur les districts manufacturiers de la Grande-Bretagne. — Des insurrections en Irlande, des troubles sur le continent, qui viennent interrompre le commerce britannique et diminuer dans sa clientèle la puissance de consommation, ce sont encore des causes évidentes de gêne, d’embarras et de perturbations financières.
L’histoire industrielle de l’Angleterre nous apprend qu’une seule de ces causes a toujours suffi pour déterminer une crise dans ce pays.
Or, il est arrivé que, juste au moment où sir Robert Peel a introduit la Réforme, tous ces fléaux à la fois, et à un degré d’intensité jusqu’alors inconnu, sont venus fondre sur l’Angleterre.
Il en est résulté, pour le peuple, de grandes souffrances, et aussitôt l’Idée préconçue de s’écrier : Vous le voyez, c’est la Réforme qui écrase le peuple !
Mais, je le demande : Est-ce donc la Réforme financière et commerciale qui a amené deux pertes successives de récolte en 1845 et 1846, et forcé l’Angleterre à dépenser deux milliards pour remplacer le blé perdu ?
Est-ce la Réforme financière et commerciale qui a causé la destruction de la pomme de terre en Irlande, pendant quatre années, et forcé l’Angleterre de nourrir, à ses frais, tout un peuple affamé ?
Est-ce la Réforme financière et commerciale qui a fait avorter le coton deux années de suite en Amérique, et croit-on que le maintien de la taxe à l’entrée eut été un remède efficace ?
Est-ce la Réforme financière et commerciale qui a fait naître et développé le Railway-mania, et soustrait brusquement deux ou trois milliards au travail productif et accoutumé, pour les jeter dans des entreprises qu’on ne peut terminer ; folie, qui, d’après tous les observateurs, a fait plus de mal actuel que tous les autres fléaux réunis ?
Est-ce la Réforme financière et commerciale qui a allumé sur le continent le feu des révolutions, et diminué l’absorption de tous les produits britanniques ?
Ah ! quand je songe à cette combinaison inouïe d’agents destructeurs coopérant dans le même sens ; à ce tissu serré de calamités de toutes sortes accumulées, par une fatalité sans précédents, sur une époque déterminée, je ne puis m’empêcher de conclure juste au rebours de l’Idée préconçue, et je me demande : Que serait-il advenu de l’Angleterre, de sa puissance, de sa grandeur, de sa richesse, si la Providence n’avait suscité un homme au moment précis et solennel ? Tout n’eût-il pas été emporté dans une effroyable convulsion ? Oui, je le crois sincèrement, la Réforme qu’on accuse des maux de l’Angleterre les a neutralisés en partie. Et le peuple anglais le comprend, car, bien que la partie la plus délicate de cette réforme, le Libre-Échange, ait été soumis, dès son avènement, aux épreuves les plus rudes et les plus inattendues, la foi populaire n’en a pas été ébranlée et, au moment où j’écris, l’œuvre commencée se poursuit et marche vers son glorieux accomplissement.
Repassons donc le Détroit, et que la confiance nous accompagne ; il n’y a pas lieu de la laisser de l’autre côté de la Manche.
Nous sommes au budget des Recettes. L’Assemblée a déjà dégrévé le sel et le port des lettres. Dans mon opinion, elle doit agir de même pour les boissons. Sur cet article, je pense que l’État devrait consentir à perdre cinquante millions. Il faudrait, autant que possible, distribuer la taxe restante sur la totalité des vins consommés. On comprend que trente à quarante millions, répartis sur quarante-cinq millions d’hectolitres, seraient beaucoup plus faciles à payer que cent millions accumulés sur une quantité trois fois moindre. Il faudrait aussi diminuer les frais et surtout les entraves qu’entraîne le mode actuel de perception.
L’État devra consentir encore à baisser considérablement les droits sur le sucre et le café. L’accroissement de consommation résoudra à la fois la question fiscale et la question coloniale.
Une autre grande et populaire mesure serait l’abolition de l’octroi. À ce sujet, j’ai été frappé du parti que l’on pourrait tirer d’un avis ouvert par M. Guichard. Tout le monde reconnaît qu’une taxe sur le revenu serait juste et conforme aux vrais principes. Si l’on recule, c’est devant les difficultés d’exécution. On redoute pour l’État, et je crois avec raison, la lourde responsabilité que feraient peser sur lui les investigations importunes dont cet impôt paraît inséparable. Il n’est pas bon que le gouvernement républicain se montre au contribuable sous la figure d’un avide inquisiteur. Dans la Commune, les fortunes se connaissent. Elles s’y peuvent apprécier en famille, et si on lui donnait la faculté d’établir l’impôt du revenu dans le but précis de remplacer l’octroi, il est vraisemblable que cette transformation, fondée sur la justice, serait favorablement accueillie. À la longue, la France se préparerait ainsi le cadastre des fortunes mobilières et les moyens de faire entrer dans la voie de la vérité son système contributif. Je ne pense pas qu’une telle mesure, qui aurait encore l’avantage de commencer la décentralisation, soit au-dessus d’un homme d’État habile. Elle n’eût certes pas fait reculer Napoléon.
Je suis forcé de dire un mot de la douane ; et, pour me mettre à l’abri des préventions que je vois d’ici s’éveiller, je ne la considérerai qu’au point de vue fiscal, puisque aussi bien il ne s’agit que du budget. Ce n’est pas que je ne sois fortement tenté de faire une pointe dans le Libre-Échange ; mais ne me comparera-t-on pas à ce brave général, célèbre par sa prédilection pour l’hippiatrique? À quelque point de l’horizon intellectuel que vous placiez le point de départ de la conversation, chimie, physique, astronomie, musique ou marine, vous le verrez bientôt enfourcher le cheval de selle, et vous serez bien forcé de monter en croupe après lui. Nous avons tous une idée chérie, un dada, en style shandyen. Mon idée chérie, pourquoi ne l’avouerais-je pas ? c’est la liberté ; et s’il m’arrive de défendre plus particulièrement la liberté d’échanger, c’est qu’elle est, de toutes, la plus méconnue et la plus compromise.
Examinons donc la douane au point de vue fiscal, et que le lecteur me pardonne si, m’échappant par la tangente, j’effleure quelque peu la question de droit, de propriété, de liberté.
Un des plus sincères et des plus habiles protectionistes de ce pays, M. Ferrier, avouait que, si l’on voulait conserver à la douane le caractère fiscal, on en pourrait tirer le double de revenu pour le Trésor. Elle donne environ cent millions ; donc, indépendamment de la charge que la protection nous impose comme consommateurs, elle nous fait perdre cent millions comme contribuables. Car il est bien clair que ce que le fisc refuse de recouvrer par la douane, il faut qu’il le demande à d’autre impôts. Ce mécanisme vaut la peine d’être scruté.
Supposons que le Trésor a besoin de 100 : Supposons encore que, si le fer étranger pouvait entrer moyennant un droit raisonnable, il fournît 5 au revenu. Mais une classe d’industriels représente qu’elle a avantage à ce que le fer étranger n’entre pas. La loi, prenant son parti, décrète la prohibition, ou, ce qui revient au même, un droit prohibitif. En conséquence, toute occasion de perception est volontairement sacrifiée. Les 5 ne rentrent pas ; et le Trésor n’a que 95. Mais comme nous avons admis qu’il a besoin de 100, nous devons bien consentir à ce qu’il nous prenne 5 de quelque autre manière, par le sel, par la poste ou par le tabac.
Et ce qui se passe pour le fer se reproduit à propos de tous les objets de consommation imaginables.
Quelle est donc, en présence de ce bizarre régime, la condition du consommateur-contribuable ?
La voici.
1° Il paie un impôt considérable destiné à entretenir une vaste armée à la frontière, armée qui est placée là, à l’instigation, pour compte, et au profit du maître de forges ou tout autre privilégié dont elle fait les affaires.
2° Il paie le fer au-dessus de son prix naturel.
3° Il lui est défendu de faire la chose contre laquelle l’étranger lui aurait livré son fer ; car empêcher une valeur d’entrer, c’est empêcher, du même coup, une autre valeur de sortir.
4° Il paie un impôt pour combler le vide du Trésor ; car prévenir une importation, c’est prévenir une perception, et, les besoins du fisc étant donnés, si une perception manque, il faut bien la remplacer par une autre.
Voilà, certes, pour le consommateur-contribuable, une position singulière. Est-elle plus malheureuse que ridicule ou plus ridicule que malheureuse ? On pourrait être embarrassé pour répondre.
Et tout cela pourquoi ? Pour qu’un maître de forges ne tire de son travail et de son capital aucun profit extraordinaire, mais seulement pour qu’il soit en mesure de s’attaquer à de plus grandes difficultés de production !
Quand donc se décidera-t-on, en ces matières, par la considération du grand nombre et non du petit nombre ? L’intérêt du grand nombre, voilà la règle économique qui n’égare jamais, car elle se confond avec la justice.
Il faut bien convenir d’une chose : c’est que, pour que la protection fût juste, sans cesser d’être désastreuse, il faudrait au moins qu’elle fût égale pour tous. Or, cela est-il même abstractivement possible ?
Les hommes échangent entre eux ou des produits contre des produits, ou des produits contre des services, ou des services contre des services. Même, comme les produits n’ont de valeur qu’à cause des services dont ils sont l’occasion, on peut affirmer que tout se réduit à une mutualité de services.
Or, la douane ne peut évidemment protéger que ce genre de services dont la valeur s’est incorporée dans un produit matériel, susceptible d’être arrêté ou saisi à la frontière. Elle est radicalement impuissante à protéger, en en élevant la valeur, les services directs rendus par le médecin, l’avocat, le prêtre, le magistrat, le militaire, le négociant, l’homme de lettres, l’artiste, l’artisan, ce qui constitue déjà une partie notable de la population. Elle est également impuissante à protéger l’homme qui loue son travail, car celui-ci ne vend pas des produits, mais rend des services. Voilà donc encore tous les ouvriers et journaliers exclus des prétendus avantages de la protection. Mais si la protection ne leur profite pas, elle leur nuit ; et, ici, il faut bien découvrir le contrecoup dont doivent se ressentir les protégés eux-mêmes.
Les deux seules classes protégées, et cela dans une mesure fort inégale, ce sont les manufacturiers et les agriculteurs. Ces deux classes voient une providence dans la douane, et cependant nous sommes témoins qu’elles ne cessent de gémir sur leur détresse. Il faut bien que la protection n’ait pas eu à leur égard toute l’efficacité qu’elles en attendaient. Qui osera dire que l’agriculture et les manufactures sont plus prospères dans les pays les plus protégés, comme la France, l’Espagne, les États Romains, que chez les peuples qui ont fait moins bon marché de leur liberté, comme les Suisses, les Anglais, les Belges, les Hollandais, les Toscans ?
C’est qu’il se passe, relativement à la protection, quelque chose d’analogue ou plutôt d’identique à ce que nous avons constaté tout à l’heure pour l’impôt. Comme il y a une limite à la taxation profitable, il y en a une à la protection profitable. Cette limite, c’est l’anéantissement de la faculté de consommer, anéantissement qui tend à amener la protection de même que l’impôt. Le fisc prospère par la prospérité des contribuables. De même, une industrie ne vaut que par la richesse de sa clientèle. Il suit de là que, lorsque le fisc ou le monopole cherchent leur développement dans des moyens qui ont pour effet nécessaire de ruiner le consommateur, l’un et l’autre entrent dans le même cercle vicieux. Il arrive un moment où plus ils renforcent le chiffre de la taxe, plus ils affaiblissent celui de la recette. Les protégés ne peuvent se rendre compte de l’état de dépression qui pèse sur leur industrie, malgré les faveurs du régime prohibitif. Comme le fisc, ils cherchent le remède dans l’exagération de ce régime. Qu’ils se demandent donc enfin si ce ne sont pas ces faveurs mêmes qui les oppriment. Qu’ils contemplent la moitié, les deux tiers de notre population réduite, par l’effet de ces injustes faveurs, à se priver de fer, de viande, de drap, de blé, à construire des charrues avec des branches de saule, à se vêtir de bure, à se nourrir de millet, comme les oiseaux, ou de châtaignes, comme des créatures moins poétiques [6] !
Puisque je me suis laissé entraîner à cette dissertation, qu’il me soit permis de la terminer par une espèce d’apologue.
Il y avait, dans un parc royal, une multitude de petites pièces d’eau, toutes mises en communication les unes avec les autres par des conduits souterrains, de telle sorte que l’eau avait une tendance invincible à s’y établir dans un parfait niveau. Ces réservoirs étaient alimentés par un grand canal. L’un d’eux, quelque peu ambitieux, voulut attirer vers lui une grande partie de l’approvisionnement destiné à tous. Il n’y aurait pas eu grand mal, à cause de l’inévitable nivellement qui devait suivre la tentative, si le moyen imaginé par l’avide et imprudent réservoir n’avait entraîné une déperdition nécessaire de liquide, dans le canal d’alimentation. On devine ce qui arriva. Le niveau baissa partout, même dans le réservoir favorisé. Il se disait, car dans les apologues il n’y a rien qui ne parle, même les réservoirs : « C’est singulier ; j’attire à moi plus d’eau qu’autrefois ; je réussis pendant un moment imperceptible à me tenir au-dessus du niveau de mes frères, et cependant, je vois avec douleur que nous marchons tous, moi comme les autres, vers la complète siccité. » Ce réservoir-là, aussi ignorant sans doute en hydraulique qu’en morale, fermait les yeux à deux circonstances : l’une, c’est la communication souterraine de tous les réservoirs entre eux, obstacle invincible à ce qu’il profitât d’une manière exclusive et permanente de son injustice ; l’autre, la déperdition générale de liquide inhérente au moyen imaginé par lui, et qui devait amener fatalement une dépression générale et continue du niveau.
Or, je dis que l’ordre social présente aussi ces deux circonstances et qu’on raisonne mal, si l’on n’en tient compte. Il y a d’abord entre toutes les industries des communications cachées, des transmissions de travail et de capital, qui ne permettent pas à l’une d’elles d’élever son niveau normal au-dessus des autres d’une manière permanente. Il y a ensuite, dans le moyen imaginé pour réaliser l’injustice, c’est-à-dire dans la protection, ce vice radical qu’elle implique une perte définitive de richesse totale ; et, de ces deux circonstances, il suit que le niveau du bien-être baisse partout, même au sein des industries protégées, comme celui de l’eau, même au sein de l’avide et stupide réservoir.
Je savais bien que le Libre-Échange m’entraînerait hors de ma voie. Passion ! passion ! ton empire est irrésistible ! Mais revenons au fisc.
Je dirai aux protectionistes : ne consentirez-vous pas, en vue des nécessités impérieuses de la République, à mettre quelque borne à votre avidité ? Quoi ! quand le Trésor est aux abois, quand la banqueroute menace d’engloutir votre fortune et votre sécurité, quand la douane nous offre une planche de salut vraiment providentielle, quand elle peut remplir les caisses publiques sans nuire aux masses, mais au contraire en les soulageant du poids qui les opprime, serez-vous inflexibles dans votre égoïsme ? Vous devriez, de vous-mêmes, dans ce moment solennel et décisif, faire sur l’autel de la patrie le sacrifice, — ce que vous appelez et ce que très-sincèrement vous croyez être — le sacrifice d’une partie de vos priviléges. Vous en seriez récompensés par l’estime publique, et, j’ose le prédire, la prospérité matérielle vous serait donnée par surcroît.
Est-ce donc trop exiger que de vous demander de substituer aux prohibitions, devenues incompatibles avec notre loi constitutionnelle, des droits de 20 à 30 pour cent ? une réduction de moitié au tarif du fer et de l’acier, ces muscles du travail ; de la houille, ce pain de l’industrie ; de la laine, du lin, du coton, ces matériaux de la main-d’œuvre ; du blé et de la viande, ces principes de force et de vie ?
Mais je vois que vous devenez raisonnables [7] ; vous accueillez mon humble requête, et nous pouvons maintenant jeter un coup d’œil, tant moral que financier, sur notre budget vraiment rectifié.
Voilà d’abord bien des choses devenues enfin accessibles aux mains ou aux lèvres du peuple : le sel, le port des lettres, les boissons, le sucre, le café, le fer, l’acier, le combustible, la laine, le lin, le coton, la viande et le pain ! Si l’on ajoute à cela l’abolition de l’octroi, la profonde modification, sinon l’abolition complète de cette terrible loi du recrutement, terreur et fléau de nos campagnes ; je le demande, la République n’aura-t-elle pas enfoncé ses racines dans toutes les fibres des sympathies populaires ? Sera-t-il facile de l’ébranler ? Faudra-t-il cinq cent mille baïonnettes pour être l’effroi des partis… ou leur espérance ? Ne serons-nous pas à l’abri de ces commotions effroyables, dont il semble que l’air même soit maintenant chargé ? Ne pourrons-nous pas concevoir l’espoir fondé que le sentiment du bien-être, et la conscience que le pouvoir est enfin entré résolûment dans la voie de la justice, fasse renaître le travail, la confiance, la sécurité et le crédit ? Est-il chimérique de penser que ces causes bienfaisantes réagiront sur nos finances plus sûrement que ne pourrait le faire un surcroît de taxes et d’entraves ?
Et quant à notre situation financière actuelle et immédiate, voyons comment elle sera affectée.
Voici les réductions résultant du système proposé :
| 2 | millions, poste. | ||
| 45 | millions, sel. | ||
| 50 | millions, boissons. | ||
| 33 | millions, sucre et café, ci… | 130,000,000 | |
| Ce n’est pas trop se flatter que d’attendre 30 millions de plus par l’accroissement de la consommation générale et par le caractère fiscal rendu à la douane, ci, à déduire… | 30,000,000 | fr. | |
| Total de la perte de revenu provenant de la réforme… | 100,000,000 | fr. | |
— Perte qui doit diminuer, par sa nature, d’année en année.
Diminuer les impôts (ce qui ne veut pas toujours dire diminuer les recettes), voilà donc la première moitié du programme financier républicain. — Vous dites : en face du déficit, cela est bien hardi. Et moi je réponds : non, ce n’est pas hardiesse, c’est prudence. Ce qui est hardi, ce qui est téméraire, ce qui est insensé, c’est de persévérer dans la voie qui nous a rapprochés de l’abîme. Et voyez où vous en êtes ! Vous ne l’avez pas caché : l’impôt indirect vous donne des inquiétudes, et quant à l’impôt direct lui-même, vous ne comptez sur son recouvrement qu’à la condition d’y employer des colonnes mobiles. Sommes-nous donc sur la terre des miri et des razzias ? Comment les choses n’en seraient-elles pas arrivées là ? — Voilà cent hommes ; ils se soumettent à une cotisation afin de constituer, pour leur sûreté, une force commune. Peu à peu, on détourne cette force commune de sa destination et on met à sa charge une foule d’attributions irrationnelles. Par ce fait, le nombre des hommes qui vivent sur la cotisation s’accroît, la cotisation elle-même grossit et le nombre des cotisés diminue. Le mécontentement, la désaffection s’en mêlent, et que va-t-on faire ? rendre la force commune à sa destination ? Ce serait trop vulgaire, et, dit-on, trop hardi. Nos hommes d’État sont plus avisés ; ils imaginent de diminuer encore le nombre des payants pour augmenter celui des payés ; il nous faut de nouvelles taxes, disent-ils, pour entretenir des colonnes mobiles, et des colonnes mobiles pour recouvrer les nouvelles taxes ! — Et l’on ne veut pas voir là un cercle vicieux ! — Nous arriverons ainsi à ce beau résultat, que la moitié des citoyens sera occupée à comprimer et rançonner l’autre moitié. Voilà ce qu’on appelle de la politique sage et pratique. Tout le reste n’est qu’utopie. Donnez-nous encore quelques années, disent les financiers, laissez-nous pousser à bout le système, et vous verrez que nous arriverons enfin à ce fameux équilibre, que nous poursuivons depuis si longtemps, et qu’ont dérangé précisément ces procédés que, depuis vingt ans, nous mettons en œuvre.
Il n’est donc pas si paradoxal qu’il le semble, au premier coup d’œil, de prendre la marche inverse, et de chercher l’équilibre dans l’allégement des taxes. Est-ce que l’équilibre méritera moins ce nom, parce qu’au lieu de le chercher à 1500 millions on rencontrera à 1200 ?
Mais cette première partie du programme républicain appelle impérieusement son complément nécessaire : la diminution des dépenses. Sans ce complément, le système est une utopie, j’en conviens. Avec ce complément, je défie qui que ce soit, sauf les intéressés, d’oser dire qu’il ne va pas droit au but, et par le chemin le moins périlleux.
J’ajoute que la diminution des dépenses doit être supérieure à celle des recettes ; sans cela on courrait en vain après le nivellement.
Enfin, il faut bien le dire, un ensemble de mesures ainsi compris ne peut donner, dans un seul exercice, tous les résultats qu’on a droit d’en attendre.
On a vu, quant aux recettes, que, pour mettre en elles cette force de croissance qui a son principe dans la prospérité générale, il fallait commencer par les faire reculer. C’est dire que le temps est nécessaire au développement de cette force.
Il en est ainsi des dépenses ; leur réduction ne peut être que progressive. En voici une raison, entre autres.
Quand un gouvernement a porté ses frais à un chiffre exagéré et accablant, cela signifie, en d’autres termes, que beaucoup d’existences sont attachées à ses prodigalités et s’en nourrissent. L’idée de réaliser des économies sans froisser personne implique contradiction. Arguer de ces souffrances contre la réforme qui les implique nécessairement, c’est opposer une fin de non-recevoir radicale à tout acte réparateur, c’est dire : « Par cela même qu’une injustice s’est introduite dans le monde, il est bon qu’elle s’y perpétue à jamais. » — Éternel sophisme des adorateurs des abus.
Mais de ce que des souffrances individuelles sont la conséquence forcée de toute réforme, il ne s’ensuit pas qu’il ne soit du devoir du législateur de les adoucir autant qu’il est en lui. Je ne suis pas, quant à moi, de ceux qui admettent que quand un membre de la société a été par elle attiré vers une carrière, quand il y a vieilli, quand il s’en est fait une spécialité, quand il est incapable de demander à toute autre occupation des moyens d’existence, elle le puisse jeter, sans feu ni lieu, sur la place publique. Toute suppression d’emploi grève donc la société d’une charge temporaire commandée par l’humanité et, selon moi, par la stricte justice.
Il suit de là que les modifications apportées au budget des dépenses, non plus que celles introduites au budget des recettes, ne peuvent produire immédiatement leurs résultats ; ce sont des germes dont la nature est de se développer, et le système complet implique que les dépenses décroîtront d’année en année avec les extinctions, que les recettes grossiront d’année en année parallèlement à la prospérité générale, de telle sorte que le résultat final doit être l’équilibre ou quelque chose de mieux.
Quant à la prétendue désaffection qui pourrait se manifester, dans la classe si nombreuse des fonctionnaires, j’avoue qu’avec les tempéraments auxquels je viens de faire allusion, je ne la crains pas. Le scrupule est d’ailleurs singulier. Il n’a jamais arrêté, que je sache, les destitutions en masse après chaque révolution. Et pourtant, quelle différence ! chasser un employé pour donner sa place à un autre, c’est plus que froisser ses intérêts, c’est blesser en lui la dignité et le sentiment énergique du droit. Mais quand une révocation, d’ailleurs équitablement ménagée, résulte d’une suppression d’emploi, elle peut nuire encore, elle n’irrite pas. La blessure est moins vive, et celui qu’elle atteint se console par la considération d’un avantage public.
J’avais besoin de soumettre ces réflexions au lecteur au moment de parler de réformes profondes, qui entraînent de toute nécessité la mise en disponibilité de beaucoup de nos concitoyens.
Je renonce à passer en revue tous les articles de dépenses sur lesquels il me paraîtrait utile et politique de faire des retranchements. Le budget c’est toute la politique. Il s’enfle ou diminue selon que l’Opinion publique exige plus ou moins de l’État. À quoi servirait de montrer que la suppression de tel service gouvernemental entraîne telle économie importante, si le contribuable lui-même préfère le service à l’économie ? Il y a des réformes qui doivent être précédées de longs débats, d’une lente élaboration de l’opinion publique ; et je ne vois pas pourquoi je m’engagerais dans une voie où il est certain qu’elle ne me suivrait pas. Aujourd’hui même, l’Assemblée nationale a décidé qu’elle ferait le premier budget républicain. Elle n’a plus pour cette œuvre qu’un temps limité et fort court. En vue de signaler une réforme immédiatement praticable, je dois me détourner des considérations générales et philosophiques qu’il était d’abord dans ma pensée de soumettre au lecteur. Je me bornerai à les indiquer.
Ce qui rejette dans un avenir éloigné toute réforme financière radicale, c’est qu’en France on n’aime pas la Liberté ; on n’aime pas à se sentir responsable de soi-même, on n’a pas confiance en sa propre énergie, on n’est un peu rassuré que lorsqu’on sent de toutes parts l’impression des lisières gouvernementales ; — et ce sont justement ces lisières qui coûtent cher.
Si, par exemple, on avait foi dans la liberté de l’enseignement, qu’y aurait-il à faire, sinon à supprimer le budget de l’instruction publique ?
Si l’on tenait véritablement à la liberté de conscience, comment la réaliserait-on autrement qu’en supprimant le budget des cultes [8] ?
Si l’on comprenait que l’agriculture se perfectionne par les agriculteurs, et le commerce par les commerçants, on arriverait à cette conclusion : le budget de l’agriculture et du commerce est une superfétation, que les peuples les plus avancés ont soin de ne pas s’infliger.
Que si, sur quelques points, comme pour la surveillance, l’État a nécessairement à intervenir en matière d’instruction, de cultes, de commerce, une Division de plus au ministère de l’Intérieur y suffirait ; il ne faut pas trois Ministères pour cela.
Ainsi, la liberté, voilà la première et la plus féconde source des économies.
Mais cette source n’est pas faite pour nos lèvres. Pourquoi ? Uniquement parce que l’Opinion la repousse [9].
Nos enfants continueront donc, sous le monopole universitaire, à s’abreuver de fausses idées grecques et romaines, à s’imprégner de l’esprit guerrier et révolutionnaire des auteurs latins, à scander les vers licencieux d’Horace, à se rendre impropres à la vie des sociétés modernes ; nous continuerons à n’être pas libres, et par conséquent à payer notre servitude, car les peuples ne peuvent être tenus dans la servitude qu’à gros frais.
Nous continuerons à voir l’agriculture et le commerce languir et succomber sous l’étreinte de nos lois restrictives ; et, de plus, à payer la dépense de cette torpeur, car les entraves, les réglementations, les formalités inutiles, tout cela ne peut être mis en œuvre que par des agents de la force publique, et les agents de la force publique ne peuvent vivre que sur le budget.
Et le mal, il faut bien le répéter, est sans remède actuellement applicable, puisque l’opinion attribue à l’oppression tout le développement intellectuel et industriel que cette oppression ne parvient pas à étouffer.
Une idée aussi bizarre que funeste s’est emparée des esprits. Quand il s’agit de politique, on suppose que le moteur social, si je puis m’exprimer ainsi, est dans les intérêts et les opinions individuelles. On s’attache à l’axiome de Rousseau : La volonté générale ne peut errer. Et, sur ce principe, on décrète avec enthousiasme le suffrage universel.
Mais, à tous les autres points de vue, on adopte justement l’hypothèse contraire. On n’admet pas que le mobile du progrès soit dans l’individualité, dans son aspiration naturelle vers le bien-être, aspiration de plus en plus éclairée par l’intelligence et guidée par l’expérience. Non. On part de cette donnée que l’humanité est partagée en deux : D’un côté, il y a les individus inertes, privés de tout ressort, de tout principe progressif, ou obéissant à des impulsions dépravées qui, abandonnées à elles-mêmes, tendent invinciblement vers le mal absolu ; de l’autre, il y a l’être collectif, la force commune, le gouvernement, en un mot, auquel on attribue la science infuse, la naturelle passion du bien, et la mission de changer la direction des tendances individuelles. On suppose que, s’ils étaient libres, les hommes s’abstiendraient de toute instruction, de toute religion, de toute industrie, ou, qui pis est, qu’ils rechercheraient l’instruction pour arriver à l’erreur, la religion pour aboutir à l’athéisme, et le travail pour consommer leur ruine. Cela posé, il faut que les individualités se soumettent à l’action réglementaire de l’être collectif, qui n’est pourtant autre chose que la réunion de ces individualités elles-mêmes. Or, je le demande, si les penchants naturels de toutes les fractions tendent au mal, comment les penchants naturels de l’entier tendent-ils au bien ? Si toutes les forces natives de l’homme se dirigent vers le néant, — où le gouvernement, qui est composé d’hommes, prendra-t-il son point d’appui pour changer cette direction [10] ?
Quoi qu’il en soit, tant que cette bizarre théorie prévaudra, il faudra renoncer à la liberté et aux économies qui en découlent. Il faut bien payer ses chaînes quand on les aime, car L’État ne nous donne jamais rien gratis, pas même des fers.
Le budget n’est pas seulement toute la Politique, il est encore, à bien des égards, la Morale du peuple. C’est le miroir où, comme Renaud, nous pourrions voir l’image et le châtiment de nos préjugés, de nos vices et de nos folles prétentions. Ici encore, il y a des torrents de mauvaises dépenses que nous sommes réduits à laisser couler, car elles ont pour cause des penchants auxquels nous ne sommes pas prêts à renoncer ; et quoi de plus vain que de vouloir neutraliser l’effet tant que la cause subsiste ? Je citerai, entre autres, ce que je ne crains pas d’appeler, quoique le mot soit dur, l’esprit de mendicité, qui a envahi toutes les classes, celle des riches comme celle des pauvres [11].
Assurément, dans le cercle des relations privées, le caractère français n’a pas de comparaison à redouter, en ce qui concerne l’indépendance et la fierté. À Dieu ne plaise que je diffame mon pays, encore moins que je le calomnie. Mais je ne sais comment il s’est fait que les mêmes hommes qui, même pressés par la détresse, rougiraient de tendre la main vers leurs semblables, perdent tout scrupule, pourvu que l’État intervienne et voile aux yeux de la conscience la bassesse d’un tel acte. Dès que la requête ne s’adresse pas à la libéralité individuelle, dès que l’État se fait l’intermédiaire de l’œuvre, il semble que la dignité du solliciteur soit à couvert, que la mendicité ne soit plus une honte ni la spoliation une injustice. Agriculteurs, manufacturiers, négociants, armateurs, artistes, chanteurs, danseurs, hommes de lettres, fonctionnaires de tout ordre, entrepreneurs, fournisseurs, banquiers, tout le monde demande, en France, et tout le monde s’adresse au budget. Et voici que le peuple, en masse, s’est mis de la partie. L’un veut des places, l’autre des pensions, celui-ci des primes, celui-là des subventions, ce cinquième des encouragements, ce sixième des restrictions, ce septième du crédit, ce huitième du travail. La société tout entière se soulève pour arracher, sous une forme ou sous une autre, une part au budget ; et, dans sa fièvre californienne, elle oublie que le budget n’est pas un Sacramento où la nature a déposé de l’or, mais qu’il n’en contient que ce que cette société quêteuse elle-même y a versé. Elle oublie que la générosité du pouvoir ne peut jamais égaler son avidité, puisque, sur ce fonds de largesses, il faut bien qu’il retienne de quoi payer le double service de la perception et de la distribution.
Afin de donner à ces dispositions, quelque peu abjectes, l’autorité et le vernis d’un Système, on les a rattachées à ce qu’on nomme le principe de la Solidarité, mot qui, ainsi entendu, ne signifie autre chose que l’effort de tous les citoyens pour se dépouiller les uns les autres, par l’intervention coûteuse de l’État. Or, on comprend qu’une fois que l’esprit de mendicité devient système et presque science, en fait d’institutions ruineuses, l’imagination n’a plus de bornes.
Mais, j’en conviens, il n’y a rien à faire en ce moment de ce côté, et je termine par cette question : Pense-t-on que l’esprit de mendicité, quand il est porté au point de pousser toute la nation au pillage du budget, ne compromette pas plus encore la sécurité que la fortune publique ?
Par la même cause, une autre économie considérable nous est encore invinciblement interdite. Je veux parler de l’Algérie. Il faut s’incliner et payer, jusqu’à ce que la nation ait compris que transporter cent hommes dans une colonie, et y transporter du même coup dix fois le capital qui les ferait vivre en France, ce n’est soulager personne mais grever tout le monde.
Cherchons donc ailleurs les moyens de salut.
Le lecteur voudra bien reconnaître que, pour un utopiste, je suis de bonne composition en fait de retranchements. J’en passe, et des meilleurs. Restrictions à toutes nos plus précieuses libertés, manie des sollicitations, infatuation d’une funeste conquête, j’ai tout concédé à l’Opinion. Qu’elle me permette de prendre ma revanche et d’être quelque peu radical, en fait de politique extérieure.
Car enfin, si elle prétend fermer l’accès à toute réforme, si elle est décidée d’avance à maintenir tout ce qui est, à n’admettre aucun changement sur quoi que ce soit qui concerne nos dépenses, alors tout mon système croule, tous les plans financiers sont impuissants ; il ne nous reste autre chose à faire que de laisser le peuple fléchir sous le poids des taxes, et marcher tête baissée vers la banqueroute, les révolutions, la désorganisation et la guerre sociale.
En abordant notre politique extérieure, je commencerai par établir nettement ces deux propositions, hors desquelles, j’ose le dire, il n’y a pas de salut.
1° Le développement de la force brutale n’est pas nécessaire et est nuisible à l’influence de la France.
2° Le développement de la force brutale n’est pas nécessaire et est nuisible à notre sécurité extérieure ou intérieure.
De ces deux propositions, il en sort, comme conséquence, une troisième, et c’est celle-ci :
Il faut désarmer sur terre et sur mer, et cela au plus tôt.
Faux patriotes ! donnez-vous-en à cœur joie. Un jour vous m’appelâtes traître, parce que je demandais la Liberté ; que sera-ce aujourd’hui que j’invoque la Paix [12] ?
Ici encore, on rencontre, comme obstacle, au premier chef, l’opinion publique. Elle a été saturée de ces mots : grandeur nationale, puissance, influence, prépondérance, prépotence ; on lui répète sans cesse qu’elle ne doit pas déchoir du rang qu’elle occupe parmi les nations ; après avoir parlé à son orgueil, on s’adresse à son intérêt. On lui dit qu’il faut manifester les signes de la force pour appuyer d’utiles négociations ; qu’il faut promener sur toutes les mers le pavillon français pour protéger notre commerce et commander les marchés lointains.
Qu’est-ce que tout cela ? Ballon gonflé, qu’un coup d’épingle suffit à détendre.
Où est aujourd’hui l’influence ? Est-elle à la gueule des canons ou à la pointe des baïonnettes ? Non, elle est dans les idées, dans les institutions et dans le spectacle de leur succès.
Les peuples agissent les uns sur les autres par les arts, par la littérature, par la philosophie, par le journalisme, par les transactions commerciales, par l’exemple surtout ; et s’ils agissent aussi quelquefois par la contrainte et la menace, je ne puis croire que ce genre d’influence soit de nature à développer les principes favorables aux progrès de l’humanité.
La renaissance de la littérature et des arts en Italie, la révolution de 1688, en Angleterre, l’acte d’indépendance des États-Unis, ont sans doute concouru à cet élan généreux qui, en 89, fit accomplir de si grandes choses à nos pères. En tout cela, où voyons-nous la main de la force brutale ?
On dit : Le triomphe des armes françaises, au commencement de ce siècle, a semé partout nos idées et laissé sur toute la surface de l’Europe l’empreinte de notre politique.
Mais savons-nous, pouvons-nous savoir ce qui serait arrivé dans une autre hypothèse ? Si, la France n’eût pas été attaquée, si la révolution poussée à bout par la résistance n’eût pas glissé dans le sang, si elle n’eût pas abouti au despotisme militaire, si au lieu de contrister, effrayer, et soulever l’Europe, elle lui eût montré le sublime spectacle d’un grand peuple accomplissant paisiblement ses destinées, d’institutions rationnelles et bienfaisantes, réalisant le bonheur des citoyens ; y a-t-il personne qui puisse affirmer qu’un tel exemple n’eût pas excité, autour de nous, l’ardeur des opprimés et affaibli les répugnances des oppresseurs ? Y-a-t-il personne qui puisse dire que le triomphe de la démocratie, en Europe, ne serait pas, à l’heure qu’il est, plus avancé ? Qu’on calcule donc toute la déperdition de temps, d’idées justes, de richesses, de force réelle que ces grandes guerres ont coûtée à la démocratie, qu’on tienne compte des doutes qu’elles ont jetés, pendant un quart de siècle, sur le droit populaire et sur la vérité politique !
Et puis, comment se fait-il qu’il n’y ait pas assez d’impartialité, au fond de notre conscience nationale, pour comprendre combien nos prétentions à imposer une idée, par la force, blessent au cœur nos frères du dehors ? Quoi ! nous, le peuple le plus susceptible de l’Europe ; nous, qui, avec raison, ne souffririons pas l’intervention d’un régiment anglais, fût-ce pour venir ériger sur le sol de la patrie la statue de la liberté, et nous enseigner la perfection sociale elle-même ; quand tous, jusqu’aux vieux débris de Coblentz, nous sommes d’accord sur ce point qu’il faudrait nous unir pour briser la main étrangère qui viendrait, armée, s’immiscer dans nos tristes débats, c’est nous qui avons toujours sur les lèvres ce mot irritant : prépondérance ; et nous ne savons montrer la liberté à nos frères, qu’une épée au poing tournée vers leur poitrine ! Comment en sommes-nous venus à nous imaginer que le cœur humain n’est pas partout le même ; qu’il n’a pas partout la même fierté, la même horreur de la dépendance ?
Mais enfin, cette Prépondérance illibérale que nous poursuivons avec tant d’aveuglement et, selon moi, avec tant d’injustice, où est-elle, et l’avons-nous jamais saisie ? Je vois bien les efforts, mais je ne vois pas les résultats. Je vois bien que nous avons, depuis longtemps, une immense armée, une puissante marine, qui écrasent le peuple, ruinent le travailleur, engendrent la désaffection, nous poussent vers la banqueroute, nous menacent de calamités effroyables sur lesquelles les yeux même de l’imagination tremblent de se fixer ; je vois tout cela, mais la prépondérance, je ne la vois nulle part, et si nous pesons dans les destinées de l’Europe, ce n’est pas par la force brutale, mais en dépit d’elle. Fiers de notre prodigieux état militaire, nous avons eu un différend avec les États-Unis, et nous avons cédé ; nous avons eu des contestations au sujet de l’Égypte, et nous avons cédé ; nous avons, d’année en année, prodigué des promesses à la Pologne, à l’Italie, et l’on n’en a pas tenu compte. Pourquoi ? parce que le déploiement de nos forces a provoqué un déploiement semblable sur toute l’Europe ; dès lors, nous n’avons plus pu douter que la moindre lutte, à propos de la cause la plus futile, ne menaçât de prendre les proportions d’une guerre universelle, et l’humanité autant que la prudence ont fait une loi aux hommes d’État de décliner une telle responsabilité.
Ce qu’il y a de remarquable et de bien instructif, c’est que le peuple qui a poussé le plus loin cette politique prétentieuse et tracassière, qui nous y a entraînés par son exemple, et nous en a fait peut-être une dure nécessité, le peuple anglais, en a recueilli les mêmes déceptions. Nul plus que lui n’a manifesté la prétention de se faire le régulateur exclusif de l’Equilibre européen, et cet équilibre a été dix fois compromis sans qu’il ait bougé. — Il s’était arrogé le monopole des colonies ; et nous avons pris Alger et les Marquises, sans qu’il ait bougé. Il est vrai qu’en ceci il pourrait être soupçonné de nous avoir vus, avec une mauvaise humeur apparente et une joie secrète, nous attacher aux pieds deux boulets. — Il se disait propriétaire de l’Orégon, patron du Texas ; et les États-Unis ont pris l’Orégon, le Texas, et une partie du Mexique par-dessus le marché, sans qu’il ait bougé. — Tout cela nous prouve que, si l’esprit des gouvernants est à la guerre, l’esprit des gouvernés est à la paix ; et, quant à moi, je ne vois pas pourquoi nous aurions fait une révolution démocratique, si ce n’est pour faire triompher l’esprit de la démocratie, de cette démocratie laborieuse qui paie bien les frais d’un appareil militaire, mais qui n’en peut jamais rien retirer que ruine, dangers et oppression.
Je crois donc que le moment est venu où tout le génie de la révolution française doit se résumer, se manifester et se glorifier solennellement, par un de ces actes de grandeur, de loyauté, de progrès, de foi en lui-même et de confiance en sa force, tel que le soleil n’en a jamais éclairé. Je crois que le moment est venu où la France doit déclarer résolument qu’elle voit la Solidarité des peuples dans l’enchaînement de leurs intérêts et la communication de leurs idées, et non dans l’interposition de la force brutale. Et pour donner à cette déclaration un poids irrésistible, — car qu’est-ce qu’un manifeste, quelque éloquent qu’il soit ? — je crois que le moment est venu pour elle de dissoudre cette force brutale elle-même.
Si notre chère et glorieuse patrie prenait en Europe l’initiative de cette révolution, quelles en seraient les conséquences ?
D’abord, pour rentrer dans mon sujet, voilà, d’un seul coup, nos finances alignées. Voilà la première partie de ma réforme devenue immédiatement exécutoire : voilà les impôts adoucis ; voilà le travail, la confiance, le bien-être, le crédit, la consommation pénétrant dans les masses ; voilà la République aimée, admirée, consolidée de tout ce que donnent de forces aux institutions les sympathies populaires ; voilà le fantôme menaçant de la banqueroute effacé des imaginations ; voilà les commotions politiques reléguées dans l’histoire du passé ; voilà enfin la France heureuse et glorieuse entre toutes les nations, faisant rayonner autour d’elle l’irrésistible empire de l’exemple.
Non-seulement la réalisation de l’œuvre démocratique enflammerait les cœurs, au dehors, à la vue de ce spectacle, mais il la rendrait certainement plus facile. Ailleurs, comme chez nous, on éprouve la difficulté de faire aimer des révolutions qui se traduisent en taxes nouvelles. Ailleurs, comme chez nous, on éprouve le besoin de sortir de ce cercle. Notre attitude menaçante est, pour les gouvernements étrangers, une raison ou un prétexte toujours debout pour extraire du sein du peuple de l’argent et des soldats. Combien l’œuvre de la régénération ne serait-elle pas facilitée sur toute l’Europe, si elle s’y pouvait accomplir sous l’influence de ces réformes contributives, qui, au fond, sont des questions de sympathie et d’antipathie, des questions de vie ou de mort pour les institutions nouvelles !
À cela, qu’objecte-t-on ?
La dignité nationale. J’ai déjà indiqué la réponse. Est-ce au profit de leur dignité que la France et l’Angleterre, après s’être écrasées de taxes pour développer de grandes forces, ont toujours refusé de faire ce qu’elles avaient annoncé ? Il y a, dans cette manière de comprendre la dignité nationale, une trace de notre éducation romaine. À l’époque où les peuples vivaient de pillage, il leur importait d’inspirer au loin de la terreur par l’aspect d’un grand appareil militaire. En est-il de même pour ceux qui fondent leurs progrès sur le travail ? — On reproche au peuple américain de manquer de dignité. Si cela est, ce n’est pas au moins dans sa politique extérieure, à laquelle une pensée traditionnelle de paix et de non-intervention donne un caractère si imposant de justice et de grandeur.
Chacun chez soi, chacun pour soi, c’est la politique de l’Égoïsme ; voilà ce, qu’on dira. — Terrible objection, si elle avait le sens commun. — Oui, chacun chez soi, en fait de force brutale ; mais que les rayons de la force morale, intellectuelle et industrielle, émanés de chaque centre national, se croisent librement et dégagent par leur contact, la lumière et la fraternité au profit de la race humaine. Il est bien étrange qu’on nous accuse d’Égoïsme, nous qui prenons toujours parti pour l’Expansion contre la Restriction. Notre principe est celui-ci : « Le moins de contact possible entre les gouvernements ; le plus de contact possible entre les peuples. » Pourquoi ? Parce que le contact des gouvernements compromet la Paix, tandis que le contact des peuples la garantit.
Sécurité extérieure. Oui, il y a là, j’en conviens, une question préjudicielle à résoudre. Sommes-nous ou ne sommes-nous pas menacés d’invasion ? Il y en a qui croient sincèrement au danger. Les rois, disent-ils, sont trop intéressés à éteindre en France le foyer révolutionnaire, pour ne pas l’inonder de leurs soldats, si elle désarmait. Ceux qui pensent ainsi ont raison de demander le maintien de nos forces. Mais qu’ils acceptent les conséquences. Si nous maintenons nos forces, nous ne pouvons diminuer sérieusement nos dépenses, nous ne devons pas adoucir les impôts, c’est même notre devoir de les aggraver, puisque les budgets se règlent chaque année en déficit. Si nous aggravons nos impôts, il est une chose dont nous ne sommes pas sûrs, c’est d’accroître nos recettes ; mais il en est une autre sur laquelle il n’y a pas de doute possible, c’est que nous engendrerons dans ce pays-ci la désaffection, la haine, la résistance, et nous n’aurons acquis la sécurité au dehors qu’aux dépens de la sécurité au dedans.
Pour moi, je n’hésiterai pas à voter le désarmement, parce que je ne crois pas aux invasions. D’où nous viendraient-elles ? De l’Espagne ? de l’Italie ? de la Prusse ? de l’Autriche ? c’est impossible. Reste l’Angleterre et la Russie. L’Angleterre ! elle a déjà fait cette expérience, et vingt-deux milliards de dettes, dont les travailleurs paient encore l’intérêt, sont une leçon qui ne peut être perdue. La Russie ! Mais c’est une chimère. Le contact avec la France n’est pas ce qu’elle cherche, mais ce qu’elle évite. Et si l’empereur Nicolas s’avisait de nous envoyer deux cent mille Moscovites, je crois sincèrement que ce que nous aurions de mieux à faire, ce serait de les bien accueillir, de leur faire goûter la douceur de nos vins, de leur montrer nos rues, nos magasins, nos musées, le bonheur du peuple, la douceur et l’égalité de nos lois pénales, après quoi nous leur dirions : Reprenez, le plus tôt possible, le chemin de vos steppes et allez dire à vos frères ce que vous avez vu.
Protection au commerce. Ne faut-il pas, dit-on, une puissante marine pour ouvrir des voies nouvelles à notre commerce et commander les marchés lointains ? — Vraiment les façons du gouvernement envers le commerce sont étranges. Il commence par l’entraver, le gêner, le restreindre, l’étouffer, et cela, à gros frais. Puis, s’il en échappe quelque parcelle, le voilà qui s’éprend d’une tendre sollicitude pour ces bribes qui ont réussi à passer au travers des mailles de la douane. Je veux protéger les négociants, dit-il, et pour cela j’arracherai 150 millions au public, afin de couvrir les mers de vaisseaux et de canons. — Mais, d’abord, les quatre-vingt-dix-neuf centièmes du commerce français se font avec des pays où notre pavillon n’a jamais paru ni ne paraîtra. Est-ce que nous avons des stations en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, dans le Zolwerein, en Russie ? C’est donc de Mayotte et de Nossibé qu’il s’agit ; c’est-à-dire qu’on nous prend, par l’impôt, plus de francs qu’il ne nous rentrera de centimes par ce commerce.
Et puis, qu’est-ce qui commande les débouchés ? Une seule chose : le bon marché. Envoyez où vous voudrez des produits qui coûtent cinq sous de plus que les similaires anglais ou suisses, les vaisseaux et les canons ne vous les feront pas vendre. Envoyez-y des produits qui coûtent cinq sous de moins, vous n’aurez pas besoin pour les vendre de canons et de vaisseaux. Ne sait-on pas que la Suisse, qui n’a pas une barque, si ce n’est sur ses lacs, a chassé de Gibraltar même certains tissus anglais, malgré la garde qui veille à la porte ? Si donc c’est le bon marché qui est le vrai protecteur du commerce, comment notre gouvernement s’y prend-il pour le réaliser ? D’abord, il hausse par ses tarifs le prix des matières premières, de tous les instruments de travail, de tous les objets de consommation ; ensuite, par voie de compensation, il nous accablé d’impôts sous prétexte d’envoyer sa marine à la quête des débouchés. C’est de la barbarie, de la barbarie la plus barbare, et le temps n’est pas loin où l’on dira : Ces Français du XIXe siècle avaient de singuliers systèmes commerciaux, mais ils auraient dû au moins s’abstenir de se croire au siècle des lumières.
Équilibre européen. Il nous faut une armée pour veiller à l’équilibre européen. — Autant en disent les Anglais — et l’équilibre devient ce que le fait le vent des révolutions. Le sujet est trop vaste pour que je l’aborde ici. Je ne dirai qu’un mot. Méfions-nous de la métaphore, disait Paul-Louis, et il avait bien raison. La voilà qui se présente à nous, par trois fois, sous forme de balances. Nous avons d’abord la Balance des puissances européennes — ensuite la Balance des pouvoirs — puis enfin la Balance du commerce. Pour énumérer les maux qui sont sortis de ces prétendues balances, il faudrait des volumes et je ne fais qu’une brochure.
Sécurité intérieure. Le pire ennemi de la logique, après la métaphore, c’est le cercle vicieux. Or, ici nous en rencontrons un vicieux au superlatif. « Écrasons le contribuable pour avoir une grande armée, puis ayons une grande armée pour contenir le contribuable. ». N’est-ce pas là que nous en sommes ? Quelle sécurité intérieure peut-on attendre d’un système financier qui a pour effet la désaffection générale, et pour résultat la banqueroute et ses suites politiques ? Je crois, moi, que si on laissait respirer les travailleurs, s’ils avaient la conscience qu’on fait pour eux tout ce qu’on peut faire, les perturbateurs du repos public n’auraient à leur disposition que bien peu d’éléments de trouble. Certes, la garde nationale, la police et la gendarmerie suffiraient à les contenir. Mais enfin, il faut tenir compte des frayeurs particulières à l’époque où nous vivons. Elles sont bien naturelles et bien justifiées. Transigeons avec elles et accordons-leur deux cent mille hommes, jusqu’à des temps meilleurs. On voit que l’esprit de système ne me rend ni absolu ni entêté.
Récapitulons maintenant.
Nous avons ainsi formulé notre programme :
diminuer les impôts. — diminuer les dépenses dans une plus forte proportion.
Programme qui aboutit forcément à l’équilibre, non par le chemin de la détresse, mais par celui de la prospérité générale.
Nous avons proposé, dans la première partie de cet écrit, un dégrèvement de taxes diverses impliquant une perte de revenu de cent millions, comparativement au budget présenté par le cabinet.
Notre programme sera donc rempli, si nous faisons résulter des considérations précédentes une diminution de dépenses supérieure à cent millions.
Or, indépendamment des retranchements qu’il serait possible d’opérer sur plusieurs services, si seulement on avait un peu de foi dans la liberté, retranchements que je ne demande pas par respect pour l’opinion publique égarée, nous avons les item suivants :.
1° Frais de perception. Dès l’instant que les impôts indirects sont adoucis, le stimulant à la fraude est émoussé. Il faut moins d’entraves, moins de formalités gênantes, moins de surveillance inquisitoriale, en un mot, moins d’employés. Ce qu’on peut faire, à cet égard, dans le seul service de la douane est énorme. — Posons 10 millions.
2° Frais de justice criminelle. Il n’y a pas, dans tout l’univers matériel, deux faits qui soient entre eux dans une connexité plus intime que la misère et le crime. Si donc, la mise à exécution de notre plan a pour effet nécessaire d’accroître le bien-être et le travail du peuple, il n’est pas possible que les frais de poursuite, de répression et de châtiment n’en soient diminués. — Mémoire.
3° Assistance. Il en faut dire autant de l’assistance, qui doit décroître en raison de l’accroissement du bien-être. — Mémoire.
4° Affaires étrangères. — La politique de non-intervention, celle que nos pères avaient acclamée en 89, celle que Lamartine eût inaugurée sans la pression de circonstances plus fortes que lui, celle que Cavaignac eût été fier de réaliser, cette politique entraîne la suppression de toutes les ambassades. C’est peu au point de vue financier. C’est beaucoup au point de vue politique et moral. — Mémoire.
5° Armée. Nous avons concédé 200,000 hommes aux exigences du moment. C’est 200 millions. Ajoutons-en 50 pour cas imprévus, retraites, traitements de disponibilité, etc. Comparativement au budget officiel, l’économie est de 100 millions.
6° Marine. On demande 130 millions. Accordons-en 80 et rendons-en 50 aux contribuables. Le commerce ne s’en portera que mieux.
7° Travaux publics. Je ne suis pas grand partisan, je l’avoue, d’économies qui ont pour résultat le sommeil ou la mort de capitaux engagés. Cependant, il faut s’incliner devant la nécessité. On nous demande 194 millions. Retranchons-en 30.
Nous obtenons ainsi, sans trop d’efforts, en chiffres ronds, 200 millions d’économies sur les dépenses, — contre cent millions sur les recettes. Donc nous sommes sur le chemin de l’équilibre, et ma tâche est remplie.
Mais celle du cabinet et de l’Assemblée nationale commence. Et ici je dirai, en terminant, ma pensée tout entière.
Je crois que le plan proposé, ou tout autre fondé sur les mêmes principes, peut seul sauver la République, le pays, la société. Ce plan est lié dans toutes ses parties. Si vous n’en prenez que la première, — diminuer l’impôt, — vous allez aux révolutions par la banqueroute ; si vous n’en prenez que la seconde, — diminuer la dépense, — vous allez aux révolutions par la misère. En l’adoptant dans son ensemble, vous évitez tout à la fois la banqueroute, la misère, les révolutions, et vous faites, par-dessus le marché, le bien du peuple. Il forme donc un système complet, qui doit triompher ou succomber tout entier.
Or, je crains qu’un plan unitaire et méthodique ne puisse jaillir de neuf cents cervelles. Il en peut bien sortir neuf cents projets qui se heurtent, mais non un qui triomphe.
Malgré le bon vouloir de l’Assemblée nationale, l’occasion est donc manquée et le pays perdu, si le cabinet ne s’empare vigoureusement de l’initiative.
Mais cette initiative, le cabinet la repousse. Il a présenté son budget, qui ne fait rien pour le contribuable et aboutit à un déficit effrayant. Puis il a dit : « Je n’ai pas à émettre des vues d’ensemble, je discuterai les détails quand le moment sera venu. » En d’autres termes : Je livre au hasard, ou plutôt à des chances aussi effroyables que certaines, les destinées de la France.
Et cela, pourquoi ? Le cabinet est composé pourtant d’hommes capables, patriotes, financiers. Il est douteux qu’aucun autre ministère eût pu mieux accomplir l’œuvre du salut commun.
Il ne l’essaye même pas. Et pourquoi ? Parce qu’il est entré aux affaires avec une idée préconçue. Idée préconçue ! que j’aurais dû te placer, comme fléau de tout raisonnement et de toute conduite, par delà la métaphore et le cercle vicieux !
Le ministère s’est dit : « Il n’y a rien à faire avec cette Assemblée, je n’y aurais pas la majorité ! »
Je n’examine pas ici toutes les funestes conséquences de cette idée préconçue.
Quand on croit qu’une assemblée est un obstacle, on est bien près de vouloir la dissoudre.
Quand on veut la dissoudre, on est bien près de travailler, sinon de manœuvrer dans ce sens.
Ainsi de grands efforts se sont faits pour réaliser le mal, au moment où il était si urgent de les consacrer à faire du bien.
Le temps et les forces se sont usés dans un conflit déplorable. Et, je le dis la main sur la conscience, dans ce conflit, je crois que le cabinet avait tort.
Car enfin, pour régler son action ou plutôt son inertie sur cette donnée : Je n’aurai pas la majorité ; il fallait du moins proposer quelque chose d’utile, et attendre un refus de concours.
Le président de la République avait tracé une voie plus sage quand il avait dit, le jour de son installation : « Je n’ai aucune raison de croire que je ne serai pas d’accord avec l’Assemblée nationale. »
Sur quoi donc s’est fondé le cabinet pour poser d’avance, dans l’idée contraire, le point de départ de sa politique ? Sur ce que l’Assemblée nationale avait montré de la sympathie pour la candidature du général Cavaignac.
Mais le cabinet n’a donc pas compris qu’il y a une chose que l’Assemblée met cent fois et mille fois au-dessus du général Cavaignac ! C’est la volonté du peuple, exprimée par le suffrage universel, en vertu d’une constitution qu’elle-même avait formulée.
Et moi je dis que, pour témoigner de son respect pour la volonté du peuple et la constitution, nos deux ancres de salut, elle eût été peut-être plus facile avec Bonaparte qu’avec Cavaignac lui-même.
Oui, si le ministère, au lieu de débuter par élever le conflit, fût venu dire à l’Assemblée : « L’élection du 20 décembre ferme la période agitée de notre révolution. Maintenant, occupons-nous de concert du bien du peuple, de réformes administratives et financières. » Je le dis avec certitude, l’Assemblée l’aurait suivi avec passion, car elle a la passion du bien et ne peut en avoir d’autre.
Maintenant l’occasion est perdue, et si nous ne la faisons renaître, malheur à nos finances, malheur au pays, pendant des siècles.
Eh bien ! je crois que, si chacun oublie ses griefs et comprime ses rancunes, la France peut encore être sauvée.
Ministres de la République, ne dites pas : Nous agirons plus tard. Nous chercherons des réformes avec une autre Assemblée. — Ne dites pas cela, car la France est sur le bord d’un gouffre. Elle n’a pas le temps de vous attendre.
Un ministère inerte par système ! Mais cela ne s’est jamais vu. Et quel temps choisissez-vous pour nous donner ce spectacle ? Il est vrai que le pays ruiné, blessé, meurtri, ne s’en prend pas à vous de ses souffrances. Toutes ses préventions sont tournées contre l’Assemblée nationale ; c’est assurément une circonstance aussi commode que rare pour un cabinet. Mais ne savez-vous pas que toute prévention fausse est éphémère ? Si, par une initiative vigoureuse, vous aviez mis l’Assemblée en demeure et qu’elle eût refusé de vous suivre, vous seriez justifiés et le pays aurait raison. Mais vous ne l’avez pas fait. Il ne se peut pas que, tôt ou tard, il n’ouvre les yeux, et si vous persistez à ne rien proposer, à ne rien essayer, à ne rien diriger ; si, par suite, la situation de nos finances devient irréparable, la Prévention du moment pourra bien vous absoudre, l’Histoire ne vous absoudra pas.
Il est maintenant décidé que l’Assemblée nationale fera le budget. Mais est-ce qu’une assemblée de neuf cents membres, abandonnée à elle-même, peut accomplir une œuvre si compliquée et qui exige tant de concordance entre toutes ses parties ? Du tumulte parlementaire il peut bien sortir des tâtonnements, des velléités, des aspirations : il ne peut sortir un plan de finances.
Telle est du moins ma conviction. S’il entre dans les vues du cabinet de laisser flotter au hasard les rênes, qui ne lui ont pas été sans doute confiées à cette fin ; s’il est résolu à rester spectateur impassible et indifférent des vains efforts de l’Assemblée, qu’elle se garde d’entreprendre une œuvre qu’elle ne peut accomplir seule ; qu’elle décline la responsabilité d’une situation qu’elle n’a pas faite.
Mais il n’en sera pas ainsi. Non, la France n’aura pas encore cette calamité à traverser. Le cabinet prendra énergiquement, sans arrière-pensée, avec dévouement, l’initiative qui lui appartient. Il présentera un plan de réforme financière fondée sur ce double principe : Diminuer les impôts. Diminuer les dépenses dans une plus forte proportion. Et l’Assemblée votera d’enthousiasme, sans s’éterniser et se perdre dans les détails.
Soulager le Peuple, faire aimer la République, fonder la Sécurité sur la sympathie populaire, combler le Déficit, relever la Confiance, ranimer le Travail, rétablir le Crédit, faire reculer la Misère, rassurer l’Europe, réaliser la Justice, la Liberté, la Paix, offrir au monde le spectacle d’un grand peuple qui n’a jamais été mieux gouverné que lorsqu’il s’est gouverné lui-même ; n’y a-t-il pas là de quoi éveiller la noble ambition d’un ministère et échauffer l’âme de celui qui porte l’héritage de ce nom : Napoléon ! — Héritage, quelle que soit la gloire qui l’environne, où deux fleurons brillent par leur absence : Paix et Liberté !
FN:Pamphlet publié en février 1849. — L’auteur avait écrit, un mois avant, dans le Journal des Débats, un article qu’à raison de l’identité du sujet nous reproduisons à la fin de Paix et Liberté. (Note de l’éditeur.)
FN:Sur les opinions politiques de l’auteur, V. au tome Ier, ses écrits et professions de foi publiés à l’occasion des élections. (Note de l’éditeur.)
FN:V. le pamphlet l’État, tome IV, page 327. (Note de l’éditeur.)
FN:We have got the bounds of profitable taxation. (Peel.)
FN:Je dis mien pour abréger ; mais je ne dois pas me poser en inventeur. Le directeur de la Presse a plusieurs fois émis l’idée fondamentale que je reproduis ici. Qui plus est, il en a fait, avec succès, l’application. Suum cuique.
FN:V. au tome IV, page 163, le chapitre intitulé Cherté, Bon marché. (Note de l’éditeur.)
FN:Dans le pamphlet Spoliation et Loi, qui commence ce volume, on a pu voir que l’auteur n’avait pas tardé à reconnaître combien il s’était trompé, en s’imaginant que les protectionistes étaient devenus raisonnables. Mais il est vrai qu’au commencement de 1849 ils se montraient beaucoup plus traitables qu’ils ne le furent un an plus tard. (Note de l’éditeur.)
FN:Le traité passé entre nos pères et le clergé est un obstacle à cette réforme si désirable. Justice avant tout.
FN:Cet aveuglement de l’opinion publique attristait l’auteur, depuis longtemps, et dès qu’une tentative pour consolider le bandeau placé sur les yeux de nos concitoyens lui était connue, il sentait le besoin de la combattre. Mais, dans sa retraite de Mugron, les moyens de publicité lui manquaient. Aussi la lettre suivante, écrite par lui, depuis nombre d’années, est-elle jusqu’à présent restée inédite.
À M. SAULNIER,
Éditeur de la Revue britannique.
Monsieur,
Vous avez transporté de joie tous ceux qui trouvent le mot économie absurde, ridicule, insupportable, bourgeois, mesquin. Le Journal des Débats vous prône, le président du conseil vous cite et les faveurs du pouvoir vous attendent. Qu’avez-vous fait cependant, Monsieur, pour mériter tant d’applaudissements ? Vous avez établi par des chiffres (et l’on sait que les chiffres ne trompent jamais), qu’il en coûte plus aux citoyens des États-Unis qu’aux sujets français pour être gouvernés. D’où la conséquence rigoureuse (rigoureuse pour le peuple en effet), qu’il est absurde de vouloir en France mettre des bornes aux profusions du pouvoir.
Mais, Monsieur, j’en demande pardon à vous, aux centres et à la statistique, vos chiffres, en les supposant exacts, ne me semblent pas défavorables au gouvernement américain.
En premier lieu, établir qu’un gouvernement dépense plus qu’un autre, ce n’est rien apprendre sur leur bonté relative. Si l’un d’eux, par exemple, administre une nation naissante, qui a toutes ses routes à percer, tous ses canaux à creuser, toutes ses villes à paver, tous ses établissements publics à créer, il est naturel qu’il dépense plus que celui qui n’a guère qu’à entretenir des établissements existants. Or, vous le savez comme moi, Monsieur, dépenser ainsi c’est épargner, c’est capitaliser. S’il s’agissait d’un agriculteur, confondriez-vous les mises de fonds qu’exige un premier établissement avec ses dépenses annuelles ?
Cependant cette différence de situation très-importante n’entraîne, d’après vos chiffres, qu’un surcroît de dépense de trois francs pour chaque citoyen de l’Union. Cet excédent est-il réel ? Non, d’après vos propres données. — Cela vous surprend, car vous avez fixé à 36 fr. la contribution de chaque Américain, et à 33 fr. celle de chaque Français ; or 36 = 33 + 3, en bonne arithmétique. — Oui, mais, en économie politique, 33 valent souvent plus que 36. Vous allez en juger. L’argent, relativement à la main-d’œuvre et aux marchandises, n’a pas autant de valeur aux États-Unis qu’en France. Vous fixez vous-même le prix de la journée à 4 fr. 50 c. aux États-Unis et à 1 fr. 50 c. en France. Il en résulte, je crois, qu’un Américain paye 36 fr. avec huit journées, tandis qu’il faut à un Français vingt-deux journées de travail pour payer 33 fr. — Il est vrai que vous dites aussi qu’on se rachète des corvées aux États-Unis avec 3 fr. et que, par conséquent, le prix de la journée y doit être établi à 3 fr. — À cela, deux réponses. On se rachète de la corvée, en France, avec 1 fr. (car nous avons aussi nos corvées dont vous ne parlez pas) ; et ensuite, si la journée aux États-Unis ne vaut que 3 fr., les Américains ne payent plus 36 fr., puisque, pour arriver à ce chiffre, vous avez porté à 4 fr. 50 c. toutes les journées que ces citoyens emploient à remplir leurs devoirs de miliciens, de corvéables, de jurés, etc.
Ce n’est pas la seule subtilité dont vous avez usé pour élever à 36 fr. la contribution annuelle de chaque Américain.
Vous imputez au gouvernement des États-Unis des dépenses dont il ne se mêle en aucune façon. Pour justifier cette étrange manière de procéder, vous dites que ces dépenses n’en sont pas moins supportées par les citoyens. Mais s’agit-il de rechercher quelles sont les dépenses volontaires des citoyens ou quelles sont les dépenses du gouvernement ?
Un gouvernement est institué pour remplir certaines fonctions. Quand il sort de son attribution, il faut qu’il fasse un appel à la bourse des citoyens et qu’il diminue ainsi cette portion de revenus dont ils avaient la libre disposition. Il devient à la fois spoliateur et oppresseur.
Une nation qui est assez sage pour forcer son gouvernement à se borner à garantir à chacun sa sûreté, et qui ne paye que ce qui est rigoureusement indispensable pour cela, consomme le reste de ses revenus selon son génie, ses besoins et ses goûts.
Mais une nation, chez laquelle le gouvernement se mêle de tout, ne dépense rien par elle et pour elle, mais par le pouvoir et pour le pouvoir ; et si le public français pense comme vous, Monsieur, qu’il est indifférent que sa richesse passe par les mains des fonctionnaires, je ne désespère pas que nous ne soyons tous un jour logés, nourris et vêtus aux frais de l’État. Ce sont choses qui nous coûtent, et d’après vous, il importe peu que nous nous les procurions par voie de contribution ou par des achats directs. Le cas que nos ministres font de cette opinion me persuade que nous aurons bientôt des habits de leur façon, comme nous avons des prêtres, des avocats, des professeurs, des médecins, des chevaux et du tabac de leur façon.
J’ai l’honneur, etc.
Frédéric Bastiat.
(Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV, le pamphlet la Loi, page 342, et notamment le passage compris dans les pages 381 à 386. (Note de l’éditeur.)
FN:Nous trouvons dans les manuscrits de l’auteur la pensée suivante, qui se rapporte au sujet spécial dont il s’occupe ici :
« Pourquoi nos finances sont-elles dérangées ? » — « Parce que, pour les Représentants, il n’y a rien de plus facile que de voter une Dépense, et rien de plus difficile que de voter une Recette. »
« Si vous l’aimez mieux,
Parce que les Traitements sont fort doux et les Impôts fort durs. »
« J’en sais encore une raison. »
« Tout le monde veut vivre aux dépens de l’État, et on oublie que l’État vit aux dépens de tout le monde. » (Note de l’éditeur.)
FN:Allusion à l’inepte accusation portée contre les libre-échangistes d’être vendus à l’Angleterre. (Note de l’éditeur.)
T.275 (1849.02.10) SEP: Séance de 10 fev. 1849 (financial reform) (Fr, PDF1, PDF2)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against PDF: 26 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source Info↩
T.275 (1849.02.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 fev. 1849) (on financial reform). In “Chronique,” JDE, T. 22, no. 95, 15 Feb. 1849, p. 339; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), p. 73. Not in OC.
Editor’s Introduction↩
[to come]
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
Sommaire : La réforme financière. — Une variété de nouveaux réformateurs. — L'assemblée nationale ne peut voler le budget. — Réunion de la Société d'économie politique. — La Reforme financière en Angleterre. — Le mouvement libre-échangiste en Allemagne.—Elections tie l'Académie des sciences morales et politiques. — Les académiciens politiques. — Circulaire de M. Léon Faucher sur les coalitions. — Le monopole des placeurs d'ouvriers boulangers. — M. Proudbon propriétaire et banquier. — La curieuse déclaration. — Grand combat singulier entra lui et M. Considérant. — Celui-ci promet d'expliquer ses théories.
Deux préoccupations importantes, après la journée du 29 janvier, ont dominé la situation depuis un mois : la fixation de l'époque du départ de l'Assemblée nationale; la réforme financière.
Nous ne faisons pas, Dieu merci, de la politique j et nous sommes dispensé de discourir sur les propositions Rateau, Lanjuinais, Dtiplan, Péan , etc. Seulement nous nous féliciterons qu'il ait été décidé quelque chose. Le provisoire est un dissolvant dans les temps de crise ; c'est ce que n'ont compris ni le gouvernement provisoire, ni l'Assemblée. A l'heure qu'il est l'Assemblée constituante pourrait certainement avoir voté, avec la Constitution et les lois de circonstance, la plupart des lois organiques et le budget.
Le budget, M. Garnier-Pagès nous l'avait promis normal et républicain, c'est-à-dire, si nous avons compris, plus mince et mieux ordonné. On a même entendu dire à son successeur qu'il ferait appel, pour cette œuvre importante, aux lumières d'une Commission composée des hommes compétents de tous les partis. Mais..., nous en sommes toujours au même point, et aussi avancés qu'en 18*7, M. Billault et quelques autres députés, opposants au ministère actuel, ont essayé de faire de la réforme financière une machine de guerre; ils ont demandé qu'on réglât le budget des recettes avant celui des dépenses, pour modérer celles-ci sur celles-là, contrairement à la pratique habituelle. En temps calme, avec un gouvernement assis et un pays tranquille, la thèse que M. Billault a empruntée aux économistes et au sens commun, aurait pu être soutenue avec avantage. Juste au fond, elle était, selon nous, inopportune, et M. Passy n'a pas eu de peine à combattre l'argumentation, d'ailleurs très-peu serrée, de M. Billault. La proposition de ce représentant n'a cependant été repoussée qu'à une majorité de sept voix seulement.
Il s'est d'ailleurs fait un singulier revirement à l'Assemblée. La plupart de ceux qui ont voté, il y a quelques mois, contre l'amendement Bauchart, promettant dans la Constitution la diminution des charges, sont aujourd'hui fanatiques de rélbrmcs financières. Seulement, quand on leur parle de la réforme de l'impôt des boissons, ou de celle des tarifs, ou de la diminution des dépenses militaires de terre et de mer, ou de la réduction des travaux publics, ils remontent à cheval sur tous leurs préjugés belliqueux, despotiques, réglementaires et même communistes. Poussés les uns par leur bonne volonté, les autres par le désir de plaire aux électeurs, d'aucuns par le désir d'allonger la courroie des 25 francs, un grand nombre de représentants veulent voter le budget de 1849. Or, pour adopter des réformes réfléchies et fécondes, il faut plus de temps qu'il n'en reste ; il faut surtout qu'un Peel quelconque (et nous ne doutons pas que, sous ce rapport, M. Passy ou M. Faucher ne soient trèspropres à une pareille tâche;, conçoive, étudie, coordonne un plan et puisse le faire accepter à la majorité. Eh hien ! ni la Chambre, ni l'opinion publique, ni le ministère, ne sont préparés à des discussions aussi importantes. Alors, de deux choses l'une :ou l'Assemblée fera un budget vulgaire, désorganisateur et insignifiant, comme celui de 1848 rectifié ; ou bien elle se laissera entraîner à des modifications mal conçues, et la Chambre future devra perdre son temps à défaire sa besogne.
La réforme financière a fait le sujet de la conversation à la dernière réunion des économistes, présidée par M. Horace Say, et à laquelle assistait M. Bankroft, ambassadeur des États Unis à Londres. Plusieurs membres ont pris la parole dans cette intéressante discussion, MM. Howyn de Tranchère, Frédéric Bastiat, Wolowski, représentants du peuple, Renouant, conseiller à la Cour de cassation, Dussard, ex-préfet de la Seine-Inférieure, Joseph Garnier, Anisson, Louis Leclerc, Du Puynode, etc. Le sentiment général a été pour une réforme prompte et radicale. Les divergences ne se sont manifestées que sur les questions d'opportunité et de politique du jour qui s'y rattachent. La majorité de la réunion trouve dans les désarmements successifs et dans la réforme douanière, des ressources capables de balancer de nouvelles réductions, telles, par exemple, que celle de l'impôt des boissons.
La question s'était engagée à propos de l'augmentation notable de la consommation du sel depuis la réduction de l'impôt que M. Biaise, conseiller de préfecture dans le département de la Seine, et présent à la réunion, avait eu occasion de constater. Diverses explications ont été données de ce fait sur lequel il n'y aura sous peu de temps plus de doute '.
Text: Séance du 10 février 1849(1). (ASEP version)↩
La réforme financière a fait le sujet de la conversation de cette réunion, présidée par M. Horace Say, et à laquelle assistait M. G. Bancroft, ambassadeur des ÉtatsUnis à Londres. Plusieurs membres ont pris la parole dans cette intéressante discussion : MM. Howynde Tranchère, Frédéric Bastiat, Louis Wolowski, représentants du peuple, Renouard, conseiller à la Cour de cassation, Dussard, ex-préfet de la Seine-Inférieure, Joseph Garnier, Anisson, Louis Leclerc, du Puynode, etc. Le sentiment général a été pour une réforme prompte et radicale. Les divergences ne se sont manifestées que sur les questions d'opportunité et de politique du jour qui s'y rattachent. La majorité de la réunion trouve dans les désarmements successifs et dans la réforme douanière, des ressources capables de balancer de nouvelles réductions, telles, par exemple, que celle de l'impôt des boissons.
La question s'était engagée à propos de l'augmentation notable de la consommation du sel depuis la réduction de l'impôt que M. Biaise, conseiller de préfecture dans le département de la Seine, et présent à la réunion, avait eu occasion de constater. Diverses explications ont été données de ce fait sur lequel il n'y aura sous peu de temps plus de doutes.
Incompatibilités parlementaires [March 1849] [CW2.19]↩
BWV
1849.03 “Incompatibilités parlementaires” (Parliamentary Conflicts of Interest) [March 1850] [OC5.13, p. 518] [CW2]
Source
<abc>
Incompatibilités parlementaires [1]
1849
Citoyens représentants,
Je vous conjure de donner quelque attention à cet écrit.
— « Est-il bon d’exclure de l’Assemblée nationale des catégories de citoyens ? »
— « Est-il bon de faire briller aux yeux des représentants les hautes situations politiques ? »
Voilà les deux questions que j’y traite. La constitution elle-même n’en a pas soulevé de plus importantes.
Cependant, chose étrange, l’une d’elles, la seconde, — a été décidée sans discussion.
Le ministère doit-il se recruter dans la Chambre ? — L’Angleterre dit : Oui, et s’en trouve mal. L’Amérique dit : Non, et s’en trouve bien. — 89 adopta la pensée américaine ; 1814 préféra l’idée anglaise. — Entre de telles autorités, il y a, ce semble, de quoi balancer. Cependant l’Assemblée nationale s’est prononcée pour le système de la Restauration, importé d’Angleterre ; et cela, sans débat.
L’auteur de cet écrit avait proposé un amendement. Pendant qu’il montait les degrés de la tribune… la question était tranchée. Je propose, dit-il… — La Chambre a voté, s’écrie M. le président. — Quoi ! sans m’admettre à… — La Chambre a voté. — Mais personne ne s’en est aperçu ! — Consultez le bureau, la Chambre a voté.
Certes, cette fois, on ne reprochera pas à l’Assemblée une lenteur systématique !
Que faire ? saisir l’Assemblée avant le vote définitif. Je le fais par écrit, dans l’espoir que quelque voix plus exercée me viendra en aide.
D’ailleurs, pour l’épreuve d’une discussion orale, il faut des poumons de Stentor s’adressant à des oreilles attentives. Décidément, le plus sûr est d’écrire.
Citoyens représentants, en mon âme et conscience, je crois que le titre IV de la Loi électorale est à refaire. Tel qu’il est, il organise l’anarchie. Il en est temps encore, ne léguons pas ce fléau au pays.
Les Incompatibilités parlementaires soulèvent deux questions profondément distinctes, quoiqu’on les ait souvent confondues.
— La représentation nationale sera-t-elle ouverte ou fermée à ceux qui suivent la carrière des fonctions publiques ?
— La carrière des fonctions publiques sera-t-elle ouverte ou fermée aux représentants ?
Ce sont là certainement deux questions différentes et qui n’ont même entre elles aucun rapport, si bien que la solution de l’une ne préjuge rien quant à la solution de l’autre. La députation peut être accessible aux fonctionnaires, sans que les fonctions soient accessibles aux députés, et réciproquement.
La loi que nous discutons est très-sévère quant à l’admission des fonctionnaires à la Chambre, très-tolérante en ce qui concerne l’admission des représentants aux hautes situations politiques. Dans le premier cas, elle me semble s’être laissée entraîner à un radicalisme de mauvais aloi. En revanche, dans le second, elle n’est pas même prudente.
Je ne dissimule pas que j’arrive, dans cet écrit, à des conclusions tout opposées.
Pour passer des places à la Chambre, pas d’exclusion, mais précautions suffisantes.
Pour passer de la Chambre aux places, exclusion absolue.
Respect au suffrage universel ! Ceux qu’il fait représentants doivent être représentants, et rester représentants. Pas d’exclusion à l’entrée, exclusion absolue à la sortie. Voilà le principe. Nous allons voir qu’il est d’accord avec l’utilité générale.
§ I. Les électeurs peuvent-ils se faire représenter par des
fonctionnaires ?
Je réponds : Oui, sauf à la société à s’entourer de précautions suffisantes.
Ici je rencontre une première difficulté, qui semble opposer d’avance à tout ce que je pourrai dire une fin de non-recevoir insurmontable. La constitution elle-même proclame le principe de l’incompatibilité entre toute fonction publique rétribuée et le mandat de représentant du peuple. Or, comme dit le rapport, il ne s’agit pas d’éluder mais d’appliquer ce principe, désormais fondamental.
Je demande s’il y a excès de subtilité à se prévaloir du mot fonction dont se sert la constitution, pour dire : Ce qu’elle a entendu exclure, ce n’est pas l’homme, ce n’est pas même le fonctionnaire, c’est la fonction, c’est le danger qu’elle pourrait introduire au sein de l’Assemblée législative. Pourvu donc que la fonction n’entre pas et reste à la porte, dut-elle être reprise à la fin de la législature, par le titulaire, le vœu de la constitution est satisfait.
L’Assemblée nationale a interprété ainsi l’article 28 de la constitution, à l’occasion de l’armée, et comme je n’arrive à autre chose qu’à étendre cette interprétation à tous les fonctionnaires, j’ai lieu de croire qu’il me sera permis de ne pas m’arrêter à la fin de non-recevoir que le rapport met sur mon chemin.
Ce que je demande en effet, c’est ceci : Que tout électeur soit éligible. Que les colléges électoraux puissent se faire représenter par quiconque a mérité leur confiance. Mais si le choix des électeurs tombe sur un fonctionnaire public, c’est l’homme et non la fonction qui entre à la Chambre. Le fonctionnaire ne perdra pas pour cela ses droits antérieurs et ses titres. On n’exigera pas de lui le sacrifice d’une véritable propriété acquise, par de longs et utiles travaux. La société n’a que faire d’exigences superflues et doit se contenter de précautions suffisantes. Ainsi, le fonctionnaire sera soustrait à l’influence du pouvoir exécutif ; il ne pourra être promu ou destitué. Il sera mis à l’abri des suggestions de l’espérance et de la crainte. Il ne pourra exercer ses fonctions ou en percevoir les émoluments. En un mot, il sera représentant, ne sera que représentant, pendant toute la durée de son mandat. Sa vie administrative sera, pour ainsi dire, suspendue et comme absorbée par sa vie parlementaire. C’est bien là ce qu’on a fait pour les militaires, grâce à la distinction entre le grade et l’emploi. Par quel motif ne le ferait-on pas pour les magistrats ?
Qu’on veuille bien le remarquer : l’incompatibilité, prise dans le sens de l’exclusion, est une idée qui dut naturellement se présenter et se populariser sous le régime déchu.
À cette époque, aucune indemnité n’était accordée aux députés non fonctionnaires, mais ils pouvaient se faire de la députation un marche pied vers les places lucratives. Au contraire, les fonctionnaires publics nommés députés continuaient à recevoir leurs traitements. À vrai dire, ils étaient payés, non comme fonctionnaires, mais comme députés, puisqu’ils ne remplissaient pas leurs fonctions, et que, si le ministre était mécontent de leurs votes, il pouvait, en les destituant, leur retirer tout salaire.
Les résultats d’une telle combinaison devaient être et furent, en effet, déplorables. D’un côté, les candidats non fonctionnaires étaient fort rares dans la plupart des arrondissements. Les électeurs étaient libres de choisir ; oui, mais le cercle du choix ne s’étendait pas au delà de cinq à six personnes. La première condition de l’éligibilité était une fortune considérable. Que si un homme, seulement dans l’aisance, se présentait, il était repoussé avec quelque raison, car on le soupçonnait d’avoir de ces vues ultérieures que la charte n’interdisait pas.
D’un autre côté, les candidats fonctionnaires pullulaient. C’était tout simple. D’abord une indemnité leur était allouée. Ensuite la députation était pour eux un moyen assuré de rapide avancement.
Lorsque l’on considère que la guerre aux portefeuilles, conséquence nécessaire de l’accessibilité des ministères aux députés (vaste sujet que je traiterai dans le paragraphe suivant), quand on considère, dis-je, que la guerre aux porte-feuilles suscitait, au sein du parlement, des coalitions systématiquement organisées pour renverser le cabinet, que celui-ci ne pouvait résister qu’à l’aide d’une majorité également systématique, compacte, dévouée ; il est aisé de comprendre à quoi devait aboutir cette double facilité donnée aux hommes à places, pour devenir députés, et aux députés, pour devenir hommes à places.
Le résultat devait être et a été : les services publics convertis en exploitation ; le gouvernement absorbant le domaine de l’activité privée ; la perte de nos libertés, la ruine de nos finances ; la corruption descendant de proche en proche des hautes régions parlementaires jusqu’aux dernières couches électorales.
Dans ces circonstances, il ne faut pas s’étonner si la nation s’attacha au principe de l’incompatibilité comme à un ancre de salut. Tout le monde se souvient que le cri de ralliement des électeurs honnêtes était : « Plus de fonctionnaires à la Chambre ! » Et le programme des candidats : « Je promets de n’accepter ni places, ni faveurs. »
Cependant, la révolution de Février n’a-t-elle rien changé à cet ordre de choses, qui expliquait et justifiait le courant de l’opinion publique ?
D’abord, nous avons le suffrage universel, et évidemment l’influence du gouvernement sur les élections sera bien affaiblie, si même il en reste quelque vestige.
Ensuite, il n’aura aucun intérêt à faire nommer de préférence des fonctionnaires complétement soustraits à son action.
En outre, nous avons l’indemnité égale accordée à tous les représentants, circonstance qui, à elle seule, change complétement la situation.
En effet, nous n’avons plus à redouter, comme autrefois, que les candidats fassent défaut aux élections. Il est plus à craindre que la difficulté vienne de l’embarras du choix. Il sera donc impossible que les fonctionnaires envahissent la Chambre, J’ajoute qu’ils n’y auront aucun intérêt, puisque la députation ne sera plus pour eux un moyen de parvenir. Autrefois, le fonctionnaire accueillait une candidature comme une bonne fortune. Aujourd’hui, il ne pourra l’accepter que comme un véritable sacrifice, au moins au point de vue de sa carrière.
Des changements aussi profonds dans la situation respective des deux classes sont de nature, ce me semble, à modifier les idées que nous nous étions faites de l’incompatibilité, sous l’empire de circonstances toutes différentes. Je crois qu’il y a lieu d’envisager le vrai principe et l’utilité commune, non au flambeau de l’ancienne charte, mais à celui de la nouvelle constitution.
L’Incompatibilité, en tant que synonyme d’Exclusion, présente trois grands inconvénients :
1° C’en est un énorme que de restreindre les choix du suffrage universel. Le suffrage universel est un principe aussi jaloux qu’absolu. Quand une population tout entière aura environné d’estime, de respect, de confiance, d’admiration, un conseiller de Cour d’appel, par exemple, quand elle aura foi dans ses lumières et ses vertus ; croyez-vous qu’il sera facile de lui faire comprendre qu’elle peut confier à qui bon lui semble le soin de corriger sa législation, excepté à ce digne magistrat?
2° Ce n’est pas une tentative moins exorbitante que celle de dépouiller du plus beau droit politique, de la plus noble récompense de longs et loyaux services, récompense décernée par le libre choix des électeurs, toute une catégorie de citoyens. On pourrait presque se demander jusqu’à quel point l’Assemblée nationale a ce droit.
3° Au point de vue de l’utilité pratique, il saute aux yeux que le niveau de l’expérience et des lumières doit se trouver bien abaissé dans une Chambre, renouvelable tous les trois ans, et d’où sont exclus tous les hommes rompus aux affaires publiques. Quoi! voilà une assemblée qui doit s’occuper de marine, et il n’y aura pas un marin ! d’armée, et il n’y aura pas de militaire ! de législation civile et criminelle, et il n’y aura pas de magistrat !
Il est vrai que les militaires et les marins sont admis, grâce à une loi étrangère à la matière et par des motifs qui ne sont pas pris du fond de la question. Mais cela même est un quatrième et grave inconvénient ajouté aux trois autres. Le peuple ne comprendra pas que, dans l’enceinte où se font les lois, l’épée soit présente et la robe absente, parce qu’en 1832 ou 1834 une organisation particulière fut introduite dans l’armée. Une inégalité si choquante, dira-t-il, ne devait pas résulter d’une loi ancienne et tout à fait contingente. Vous étiez chargé, de faire une loi électorale complète, il en valait bien la peine, et vous ne deviez pas y introduire une inconséquence monstrueuse, à la faveur d’un article perdu du Code militaire. Mieux eût valu l’Incompatibilité absolue. Elle eût eu au moins le prestige d’un principe.
Quelques mots maintenant sur les précautions que la société me semble avoir le droit de prendre à l’égard des fonctionnaires nommés représentants.
On pourra essayer de me faire tomber dans l’inconséquence et médire : Puisque vous n’admettez pas de limites au choix du suffrage universel, puisque vous ne croyez pas qu’on puisse priver une catégorie de citoyens de leurs droits politiques, comment admettez-vous que l’on prenne, à l’égard des uns, des précautions plus ou moins restrictives, dont les autres sont affranchis ?
Ces précautions, remarquez-le bien, se bornent à une chose : assurer, dans l’intérêt public, l’indépendance, l’impartialité du représentant ; mettre le député fonctionnaire, à l’égard du pouvoir exécutif, sur le pied de l’égalité la plus complète avec le député non fonctionnaire. Quand un magistrat accepte le mandat législatif, que la loi du pays lui dise : Votre vie parlementaire commence ; tant qu’elle durera, votre vie judiciaire sera suspendue. — Qu’y a-t-il là d’exorbitant et de contraire aux principes ? Quand la fonction est interrompue de fait, pourquoi ne le serait-elle pas aussi de droit, puisque aussi bien c’est là ce qui soustrait le fonctionnaire à toute pernicieuse influence ? Je ne veux pas qu’il puisse être promu ou destitué par le pouvoir exécutif, parce que s’il l’était, ce ne serait pas pour des actes relatifs à la fonction, qui n’est plus remplie, mais pour des votes. Or, qui admet que le pouvoir exécutif puisse récompenser ou punir des votes ? — Ces précautions ne sont pas arbitraires. Elles n’ont pas pour but de restreindre le choix du suffrage universel ou les droits politiques d’une classe de citoyens, mais au contraire de les universaliser, puisque, sans elles, il en faudrait venir à l’incompatibilité absolue.
L’homme qui, à quelque degré que ce soit, fait partie de la hiérarchie gouvernementale, ne doit pas se dissimuler qu’il est, vis-à-vis de la société, et sur un point capital relativement au sujet qui nous occupe, dans une position fort différente de celle des autres citoyens.
Entre les fonctions publiques et les industries privées, il y a quelque chose de commun et quelque chose de différent. Ce qu’il y a de commun, c’est que les unes et les autres satisfont à des besoins sociaux. Celles-ci nous préservent de la faim, du froid, des maladies, de l’ignorance ; celles-là de la guerre, du désordre, de l’injustice, de la violence. C’est toujours des services rendus contre une rémunération. Mais voici ce qu’il y a de différent. Chacun est libre d’accepter ou de refuser les services privés, de les recevoir dans la mesure qui lui convient et d’en débattre le prix. Je ne puis forcer qui que ce soit à acheter mes pamphlets, à les lire, à les payer au taux auquel l’éditeur les mettrait, s’il en avait la puissance.
Mais tout ce qui concerne les services publics est réglé d’avance par la loi. Ce n’est pas moi qui juge ce que j’achèterai de sécurité et combien je la paierai. Le fonctionnaire m’en donne tout autant que la loi lui prescrit de m’en donner, et je le paie pour cela tout autant que la loi me prescrit de le payer. Mon libre arbitre n’y est pour rien.
Il est donc bien essentiel de savoir qui fera cette loi.
Comme il est dans la nature de l’homme de vendre le plus possible, la plus mauvaise marchandise possible, au plus haut prix possible, il est à croire que nous serions horriblement et chèrement administrés, si ceux qui ont le privilége de vendre les produits gouvernementaux avaient aussi celui d’en déterminer la quantité, la qualité et le prix [2].
C’est pourquoi, en présence de cette vaste organisation qu’on appelle le gouvernement, et qui, comme tous les corps organisés, aspire incessamment à s’accroître , la nation, représentée par ses députés, décide elle-même sur quels points, dans quelle mesure, à quel prix elle entend être gouvernée et administrée.
Que si, pour régler ces choses, elle choisit les gouvernants eux-mêmes, il est fort à croire qu’elle sera bientôt administrée à merci et miséricorde, jusqu’à épuisement de sa bourse.
Aussi je comprends que les hommes portés vers les moyens extrêmes aient songé à dire à la nation : « Je te défends de te faire représenter par des fonctionnaires. » C’est l’incompatibilité absolue.
Pour moi , je suis très-porté à tenir à la nation le même langage, mais seulement à titre de conseil. Je ne suis pas bien sûr d’avoir le droit de convertir ce conseil en prohibition. Assurément, si le suffrage universel est laissé libre, cela veut dire qu’il pourra se tromper. S’ensuit-il que, pour prévenir ses erreurs, nous devions le dépouiller de sa liberté ?
Mais ce que nous avons le droit de faire, comme chargés de formuler une loi électorale, c’est d’assurer l’indépendance du fonctionnaire élu représentant, de le mettre sur le pied de l’égalité avec ses collègues, de le soustraire aux caprices de ses chefs, et de régler sa position, pendant la durée du mandat, en ce qu’elle pourrait avoir d’antagonique au bien public.
C’est le but de la première partie de mon amendement.
Il me semble tout concilier.
Il respecte le droit des électeurs.
Il respecte, dans le fonctionnaire, le droit du citoyen.
Il détruit cet intérêt spécial qui, autrefois, poussait les fonctionnaires vers la députation.
Il restreint le nombre de ceux par qui elle sera recherchée.
Il assure l’indépendance de ceux par qui elle sera obtenue.
Il laisse entier le droit tout en anéantissant l’abus.
Il élève le niveau de l’expérience et des lumières dans la Chambre.
En un mot, il concilie les principes avec l’utilité.
Mais, si ce n’est pas avant l’élection qu’il faut placer l’incompatibilité, il faut certainement la placer après. Les deux parties de mon amendement se tiennent, et j’aimerais mieux cent fois le voir repoussé tout entier qu’accueilli à moitié.
§ II. Les représentants peuvent-ils devenir fonctionnaires ?
À toutes les époques, lorsqu’il a été question de réforme parlementaire, on a senti la nécessité de fermer aux députés la carrière des fonctions publiques.
On se fondait sur ce raisonnement, qui est en effet très-concluant : Les gouvernés nomment des mandataires pour surveiller, contrôler, limiter et, au besoin, accuser les gouvernants. Pour remplir cette mission, il faut qu’ils conservent, à l’égard du pouvoir, toute leur indépendance. Que si celui-ci enrôle les représentants dans ses cadres, le but de l’institution est manqué. — Voilà l’objection constitutionnelle.
L’objection morale n’est pas moins forte. Quoi de plus triste que de voir les mandataires du peuple, trahissant l’un après l’autre la confiance dont ils avaient été investis, vendre, pour une place, et leurs votes et les intérêts de leurs commettants ?
On avait d’abord espéré tout concilier par la réélection. L’expérience a démontré l’inefficacité de ce palliatif.
L’opinion publique s’attacha donc fortement à ce second aspect de l’incompatibilité, et l’article 28 de la constitution n’est autre chose que la manifestation de son triomphe.
Mais, à toutes les époques aussi, l’opinion publique a pensé que l’Incompatibilité devait souffrir une exception, et que, s’il était sage d’interdire les emplois subalternes aux députés, il n’en devait pas être de même des ministères, des ambassades, et de ce qu’on nomme les hautes situations politiques.
Aussi, dans tous les plans de réforme parlementaire qui se sont produits avant Février, dans celui de M. Gauguier, comme dans celui de M. de Rumilly, comme dans celui de M. Thiers, si l’article 1er posait toujours hardiment le principe, l’article 2 reproduisait invariablement l’exception.
À vrai dire, je crois qu’il ne venait à la pensée de personne qu’il en pût être autrement.
Et comme l’opinion publique, qu’elle ait tort ou raison, finit toujours par l’emporter, l’art. 79 du projet de la Loi électorale n’est encore qu’une seconde manifestation de son triomphe.
Cet article dispose ainsi :
Art. 79. Les fonctions publiques rétribuées auxquelles, par exception à l’article 28 de la Constitution, les membres de l’Assemblée nationale peuvent être appelés, pendant la durée de la législature, par le choix du pouvoir exécutif, sont celles de :
Ministre ;
Sous-secrétaire d’État ;
Commandant supérieur des gardes nationales de la Seine ;
Procureur général à la Cour de cassation ;
Procureur général à la Cour d’appel de Paris ;
Préfet de la Seine.
L’opinion publique ne se modifie pas en un jour. C’est donc sans aucune espérance dans le succès actuel que je m’adresse à l’Assemblée nationale. Elle n’effacera pas cet article de la loi. Mais j’accomplis un devoir, car je prévois (et puissé-je me tromper !) que cet article couvrira notre malheureuse patrie de ruines et de débris.
Certes, je n’ai pas une foi telle dans ma propre infaillibilité que je ne sache me défier de ma pensée, quand je la trouve en opposition avec la pensée publique. Qu’il me soit donc permis de me mettre à l’abri derrière des autorités qui ne sont pas à dédaigner.
Des députés-ministres ! c’est bien là une importation anglaise. C’est de l’Angleterre, ce berceau du gouvernement représentatif, que nous est venue cette irrationnelle et monstrueuse alliance. Mais il faut remarquer qu’en Angleterre le régime représentatif tout entier n’est qu’un moyen ingénieux de mettre et maintenir la puissance aux mains de quelques familles parlementaires. Dans l’esprit de la constitution britannique, il eût été absurde de fermer aux députés l’accès du pouvoir, puisque cette constitution a précisément pour but de le leur livrer. — Et nous verrons bientôt cependant quelles conséquences hideuses et terribles a eues, pour l’Angleterre même, cette déviation aux plus simples indications du bon sens.
Mais, d’un autre côté, les fondateurs de la république américaine ont sagement repoussé cet élément de troubles et de convulsions politiques. Nos pères, en 89, avaient fait de même. Je ne viens donc pas soutenir une pensée purement personnelle, une innovation sans précédents et sans autorité.
Comme Washington, comme Franklin, comme les auteurs de la constitution de 91, je ne puis m’empêcher de voir dans l’admissibilité des députés au ministère une cause toujours agissante de trouble et d’instabilité. Je ne pense pas qu’il soit possible d’imaginer une combinaison plus destructive de toute force, de toute suite dans l’action du gouvernement, un oreiller plus anguleux pour la tête des rois ou des présidents de républiques. Rien au monde ne me semble plus propre à éveiller l’esprit de parti, à alimenter les luttes factieuses, à corrompre toutes les sources d’information et de publicité, à dénaturer l’action de la Tribune et de la Presse, à égarer l’Opinion après l’avoir passionnée, à dépopulariser le vrai pour populariser le faux, à entraver l’administration, à fomenter les haines nationales, à provoquer les guerres extérieures, à ruiner les finances publiques, à user et déconsidérer les gouvernements, à décourager et pervertir les gouvernés, à fausser, en un mot, tous les ressorts du régime représentatif. Je ne connais aucune plaie sociale qui se puisse comparer à celle-là, et je crois que si Dieu lui-même nous eût envoyé, par un de ses anges, une constitution, il suffirait que l’Assemblée nationale y intercalât cet article 70 pour que l’œuvre divine devînt le fléau de notre patrie.
C’est ce que je me propose de démontrer.
J’avertis que mon argumentation est un long syllogisme reposant sur cette prémisse, tenue pour accordée : « les hommes aiment la puissance. Ils l’adorent avec tant de fureur que, pour la conquérir ou la conserver, il n’est rien qu’ils ne sacrifient, même le repos et le bonheur de leur pays. »
On ne contestera pas d’avance cette vérité d’observation universelle. Mais quand, de conséquence en conséquence, j’aurai conduit le lecteur à ma conclusion, savoir : Le ministère doit être fermé aux représentants ; — il se peut que, ne trouvant à rompre aucune maille de mon raisonnement, il revienne sur le point de départ et me dise : « Nego majorem, vous n’avez pas prouvé l’attrait de la puissance. »
Eh bien ! je m’obstine à maintenir ma proportion dénuée de preuves ! Des preuves ! Mais ouvrez donc au hasard les annales de l’humanité ! Consultez l’histoire ancienne ou moderne, sacrée ou profane, demandez-vous d’où sont venues toutes ces guerres de races, de classes, de nations, de familles ! Vous obtiendrez toujours cette réponse invariable : De la soif du pouvoir.
Cela posé, la loi n’agit-elle pas avec une bien aveugle imprudence, quand elle offre la candidature du pouvoir aux hommes mêmes qu’elle charge de contrôler, critiquer, accuser et juger ceux qui le détiennent ? Je ne me défie pas plus qu’un autre du cœur de tel ou tel homme ; mais je me défie du cœur humain, quand il est placé, par une loi téméraire, entre le devoir et l’intérêt. Malgré les plus éloquentes déclamations du monde sur la pureté et le désintéressement de la magistrature, je n’aimerais pas à avoir mon petit pécule dans un pays où le juge pourrait prononcer la confiscation à son profit. De même, je plains le ministre qui a à se dire :
« La nation m’oblige à rendre compte à des hommes qui ont bonne envie de me remplacer, et qui le peuvent pourvu qu’ils me trouvent en faute. » Allez donc prouver votre innocence à de tels juges !
Mais ce n’est pas le ministre seulement qu’il faut plaindre ; c’est surtout la nation. Une lutte terrible va s’ouvrir, c’est elle qui fera l’enjeu ; et cet enjeu c’est son repos, son bien-être, sa moralité et jusqu’à la justesse de ses idées.
Les fonctions salariées auxquelles, par exception à l’article 28 de la constitution, les membres de l’Assemblée nationale peuvent être appelés, pendant la durée de la législature, par le choix du pouvoir exécutif, sont celles de Ministre.
Oh ! il y a là un péril si grand, si palpable que, si nous n’avions à cet égard aucune expérience, si nous étions réduits à juger par un à priori, par le simple bon sens, nous n’hésiterions pas une minute.
Je suppose que vous n’avez aucune notion du régime représentatif. L’on vous transporte, nouvel Astolphe, dans la lune et l’on vous dit : Parmi les nations qui peuplent ce monde, en voici une qui ne sait ce que c’est que repos, calme, sécurité, paix, stabilité. — N’est-elle pas gouvernée ? demandez-vous. Oh ! il n’en est pas de plus gouvernée dans l’univers, vous est-il répondu ; et pour en trouver une autre aussi gouvernée que celle-là, vous parcourriez inutilement toutes les planètes, excepté peut-être la terre. Le pouvoir y est immense, horriblement lourd et dispendieux. Les cinq sixièmes des gens qui reçoivent quelque éducation y sont fonctionnaires publics. Mais enfin les gouvernés y ont conquis un droit précieux. Ils nomment périodiquement des représentants qui font toutes les lois, tiennent les cordons de la bourse et forcent le pouvoir, soit dans son action, soit dans sa dépense, à se conformer à leur décision. — Oh ! quel bel ordre, quelle sage économie doivent résulter de ce simple mécanisme ! dites-vous. Certainement ce peuple a dû trouver ou trouvera, à force de tâtonner, le point précis où le gouvernement réalisera le plus de bienfaits, aux moindres frais. Comment donc m’annoncez-vous que tout est trouble et confusion sous un si merveilleux régime ? — Il faut que vous sachiez, répond votre cicerone, que si les habitants de la lune, ou les Lunatiques, aiment prodigieusement à être gouvernés, il y a une chose qu’ils aiment plus prodigieusement encore, c’est de gouverner. Or, ils ont introduit dans leur admirable constitution un petit article, perdu au milieu de beaucoup d’autres, et dont voici le sens : « Les représentants joignent à la faculté de renverser les ministres celle de les remplacer. En conséquence, s’il se forme, — au sein du parlement, — des partis, des oppositions systématiques, des coalitions qui, à force de bruit et de clameurs, à force de grossir et de fausser toutes les questions, parviennent à dépopulariser et faire succomber le ministère, sous les coups d’une majorité convenablement préparée à cet effet, les meneurs de ces partis, oppositions et coalitions seront ministres ipao facto ; et pendant que ces éléments hétérogènes se disputeront le pouvoir, les ministres déchus, redevenus simples représentants, iront fomenter des intrigues, des alliances, des oppositions et des coalitions nouvelles. » — Par le grand Dieu du ciel ! vous écriez-vous, puisqu’il en est ainsi, je ne suis pas surpris que l’histoire de ce peuple ne soit que l’histoire d’une affreuse et permanente convulsion !
Mais revenons de la lune, heureux si, comme Astolphe, nous en rapportons une petite fiole de bon sens. Nous en ferons hommage à qui de droit, lors de la troisième lecture de notre Loi électorale.
Je demande à insister encore sur mon à priori. Seulement nous l’appliquerons à des faits existants qui se passent sous nos yeux.
Il y a en France quatre-vingts et quelques parlements au petit pied. On les appelle conseils généraux. Les rapports de préfet à conseil général ressemblent, à beaucoup d’égards, aux rapports de ministre à Assemblée nationale. D’un côté, des mandataires du public qui décident, en son nom, comment, dans quelle mesure, à quel prix il entend être administré. De l’autre, un agent du pouvoir exécutif qui étudie les mesures à prendre, les fait admettre, s’il peut, et une fois admises, pourvoit à leur exécution. Voilà une expérience qui se renouvelle près de cent fois par an sous nos yeux, et que nous apprend-elle ? Certes, le cœur des conseillers généraux est pétri du même limon que celui des représentants du peuple. Il en est peu parmi eux qui ne désirassent autant devenir préfets qu’un député peut souhaiter de devenir ministre. Mais cette idée ne leur vient pas même à l’esprit, et la raison en est simple : la loi n’a pas fait du titre de conseiller un marchepied vers les préfectures. Les hommes, quelque ambitieux qu’ils soient (et ils le sont presque tous), ne poursuivent cependant, per fas et nefas, que ce qu’il est possible de saisir. Devant l’impossibilité radicale, le désir s’éteint faute d’aliment. On voit des enfants pleurer pour avoir la lune, mais quand la raison survient, ils n’y pensent plus. Ceci s’adresse à ceux qui me disent : Croyez-vous donc extirper l’ambition du cœur de l’homme ? — Non certes, et je ne le désire même pas. Mais ce qui est très-possible, c’est de détourner l’ambition d’une voie donnée en anéantissant l’appât qu’on y avait imprudemment placé. Vous aurez beau élever des mâts de cocagne, personne n’y montera s’il n’y a pas une proie au bout.
Il est certain que, si une opposition systématique, une coalition mi-blanche et mi-rouge se formait au sein du conseil général, elle pourrait fort bien faire sauter le préfet, mais non mettre les meneurs à sa place. Ce qui est certain aussi, l’expérience le démontre, c’est que, en conséquence de cette impossibilité, de telles coalitions ne s’y forment pas. Le préfet propose ses plans, le conseil les discute, les examine en eux-mêmes, en apprécie la valeur propre au point de vue du bien général. Je veux bien que l’un se laisse influencer par l’esprit de localité, un autre par son intérêt personnel. La loi ne peut refaire le cœur humain, c’est aux électeurs à y pourvoir. Mais il est bien positif qu’on ne repousse pas systématiquement les propositions du préfet, uniquement pour lui faire pièce, pour l’entraver, pour le faire tomber, s’emparer de sa place. Cette guerre insensée, dont en définitive le pays ferait les frais, cette guerre, si fréquente dans nos assemblées législatives qu’elle en est l’histoire et la vie, ne s’est jamais vue dans les assemblées départementales ; mais voulez-vous l’y voir ? Il y a un moyen bien simple. Constituez ces petits parlements sur le patron du grand ; introduisez dans la loi de l’organisation des conseils généraux un petit article ainsi conçu :
« Si une mesure bonne ou mauvaise, proposée par le préfet, est repoussée, il sera destitué. Celui des membres du conseil qui aura dirigé l’opposition sera nommé à sa place, et distribuera à ses compagnons de fortune toutes les grandes fonctions du département, recette générale, direction des contributions directes et indirectes, etc. »
Je le demande, parmi mes neuf cents collègues, y en a-t-il un seul qui osât voter une pareille disposition ? Ne croirait-il pas faire au pays le présent le plus funeste ? Pourrait-on mieux choisir, si l’on était décidé à le voir agoniser sous l’étreinte des factions ? N’est-il pas certain que ce seul article bouleverserait complétement l’esprit des conseils généraux ? N’est-il pas certain que ces cent enceintes, où règnent aujourd’hui le calme, l’indépendance et l’impartialité, seraient converties en autant d’arènes de luttes et de brigues ? N’est-il pas clair que chaque proposition préfectorale, au lieu d’être envisagée en elle-même et dans ses rapports avec le bien public, deviendrait le champ de bataille d’un conflit de personnes ? que chacun n’y chercherait autre chose que des chances pour son parti ? Maintenant, admettons qu’il y a des journaux dans le département ; les parties belligérantes ne feront-elles pas tous leurs efforts pour les attacher à leur fortune ? La polémique de ces journaux ne s’empreindra-t-elle pas des passions qui agitent le conseil ? Toutes les questions n’arriveront-elles pas altérées et faussées devant le public ? Viennent les élections ; comment ce public égaré ou circonvenu pourra-t-il être bon juge ? Ne voyez-vous pas, d’ailleurs, que la corruption et l’intrigue, surexcitées par l’ardeur du combat, ne connaîtront plus de bornes ?
Ces périls vous frappent ; ils vous effraient. Représentants du peuple, vous vous laisseriez brûler la main droite plutôt que de voter, pour les conseils généraux, une organisation aussi absurde et aussi anarchique. Et cependant, qu’allez-vous faire ? Vous allez déposer, dans la constitution de l’Assemblée nationale, ce fléau destructeur, cet effroyable dissolvant que vous repoussez avec horreur des assemblées départementales. Par l’article 79, vous allez proclamer bien haut que ce poison, dont vous préservez les veines, vous en saturez le cœur du corps social.
Vous dites : C’est bien différent. Les attributions des conseils généraux sont très-limitées. Leurs discussions n’ont pas une grande importance ; la politique en est bannie ; ils ne donnent pas des lois au pays, et puis la préfecture n’est pas un objet de convoitise bien séduisant.
Est-ce que vous ne comprenez pas que chacune de vos prétendues objections met à ma portée autant d’à fortiori aussi clairs que le jour ? Quoi ! la lutte sera-t-elle moins acharnée, infligera-t-elle au pays de moindres maux, parce que l’arène est plus vaste, le théâtre plus élevé, le champ de bataille plus étendu, l’aliment des passions plus excitant, le prix du combat plus convoité, les questions qui servent de machines de guerre plus brûlantes, plus difficiles, et partant plus propres à égarer le sentiment et le jugement de la multitude ? S’il est fâcheux que l’esprit public se trompe quand il s’agit d’un chemin vicinal, n’est-il pas mille fois plus malheureux qu’il s’égare quand il est question de paix ou de guerre, d’équilibre ou de banqueroute, d’ordre public ou d’anarchie ?
Je dis que l’article 79, qu’il s’applique aux conseils généraux ou aux assemblées nationales, c’est le désordre savamment organisé sur le même modèle ; dans le premier cas sur une petite échelle, dans le second sur une échelle immense.
Mais coupons un peu, par un appel à l’expérience, la monotonie des raisonnements.
En Angleterre, c’est toujours parmi les membres du parlement que le roi choisit ses ministres.
Je ne sais si, dans ce pays, le principe de la séparation des fonctions est stipulé au moins sur le papier. Ce qu’il y a de certain , c’est que l’ombre même de ce principe ne se révèle pas dans les faits. Toute la puissance exécutive, législative, judiciaire et spirituelle réside dans une classe à son profit, la classe oligarchique. Si elle rencontre un frein, c’est dans l’opinion, et ce frein est bien récent. Aussi le peuple anglais n’a pas été jusqu’ici gouverné, mais exploité ; ainsi que l’attestent deux milliards de taxes et vingt-deux milliards de dettes. Si depuis quelque temps ses finances sont mieux administrées, l’Angleterre n’en doit pas rendre grâce à la confusion des pouvoirs, mais à l’opinion qui, même privée de moyens constitutionnels, exerce une grande influence, et à cette prudence vulgaire des exploiteurs, qui les a décidés à s’arrêter au moment où ils allaient s’engloutir, avec la nation tout entière, dans le gouffre ouvert par leur rapacité.
Dans un pays où toutes les branches du gouvernement ne sont que les parties d’une même exploitation, au profit des familles parlementaires, il n’est pas surprenant que les ministères soient ouverts aux membres du parlement. Ce qui serait surprenant, c’est qu’il n’en fût pas ainsi, et ce qui l’est bien davantage encore, c’est que cette bizarre organisation soit imitée par un peuple qui a la prétention de se gouverner lui-même, et, qui plus est, de se bien gouverner.
Quoi qu’il en soit, qu’a-t-elle produit en Angleterre même ?
On n’attend pas sans doute que je fasse ici l’histoire des coalitions qui ont agité l’Angleterre. Ce serait entreprendre son histoire constitutionnelle tout entière. Mais je ne puis me dispenser d’en rappeler quelques traits.
Walpole est ministre : une coalition se forme. Elle est dirigée par Pulteney et Carteret pour les wighs dissidents (ceux que Walpole n’a pu placer), par Windham pour les torys qui, soupçonnés de jacobitisme, sont condamnés au stérile honneur de servir d’auxiliaires à toutes les oppositions.
C’est dans cette coalition que le premier des Pitt (depuis lord Chatham) commence sa brillante carrière.
L’esprit jacobite, encore vivace, pouvant fournir à la France l’occasion d’une puissante diversion en cas d’hostilité, la politique de Walpole est à la paix. Donc, la coalition sera à la guerre.
« Mettre fin au système de corruption qui asservit le parlement aux volontés du ministère, remplacer dans les rapports extérieurs, par une politique plus fière, plus digne, la politique timide et exclusivement pacifique de Walpole, » tel est le double but que se propose la coalition. Je laisse à penser ce qu’on y dit de la France.
On ne joue pas impunément avec le sentiment patriotique d’un peuple qui sent sa force. La coalition parle tant et si haut aux Anglais de leur humiliation qu’ils finissent par y croire. Ils appellent la guerre à grands cris. Elle éclate à l’occasion d’un droit de visite.
Autant que ses adversaires, Walpole aimait le pouvoir. Plutôt que de s’en dessaisir, il prétend conduire les opérations. Il présente un bill de subsides, la coalition le repousse. Elle a voulu la guerre et refusé les moyens de la faire. Voici son calcul : la guerre faite sans ressources suffisantes sera désastreuse ; alors nous dirons : « C’est la faute du ministre qui l’a faite à contre-cœur. » — Quand une coalition met dans un des plateaux de la balance l’honneur du pays et dans l’autre son propre succès, ce n’est pas l’honneur du pays qui l’emporte.
Cette combinaison réussit. La guerre fut malheureuse et Walpole tomba. L’opposition, moins Pitt, entre aux affaires ; mais composée d’éléments hétérogènes, elle ne peut s’entendre. Pendant cette lutte intestine, l’Angleterre est toujours battue. Une nouvelle coalition se forme. Pitt en est l’âme. Il se tourne contre Carteret. Avec lui, il voulait la guerre ; contre lui, il veut la paix. Il le traite de ministre exécrable, traître, lui reprochant un subside aux troupes hanovriennes. Quelques années après, on retrouve ces deux hommes fort bons amis, assis côte à côte dans le même conseil. Pitt dit de Carteret : « Je m’enorgueillis de déclarer que je dois à son patronage, à son amitié, à ses leçons tout ce que je suis. »
Cependant la nouvelle coalition amène une crise ministérielle. Les frères Pelham sont ministres. Quatrième coalition formée par Pulteney et Carteret. Ils renversent les Pelham. Mais ils sont renversés eux-mêmes au bout de trois jours. Pendant que le parlement est en proie à ces intrigues, la guerre continue, et le Prétendant, qui a mis l’occasion à profit, fait des progrès en Écosse. Mais cette considération n’arrête pas les ambitions personnelles.
Pitt conquiert enfin une position officielle assez modeste. Il se fait gouvernemental pendant quelques jours. Il approuve tout ce qu’il a blâmé, entre autres le subside aux Hanovriens. Il blâme tout ce qu’il a approuvé, entre autres la résistance au droit de visite, invoqué par les Espagnols, et qui lui a servi de prétexte pour fomenter la guerre, guerre qui n’avait été elle-même qu’un prétexte pour renverser Walpole. « L’expérience m’a mûri, dit-il ; j’ai maintenant acquis la conviction que l’Espagne est dans son droit. » — Enfin, la paix se conclut par le traité d’Aix-la-Chapelle, qui replace toutes choses comme elles étaient avant et ne mentionne même pas le droit de visite, qui a mis l’Europe en feu.
Survient une cinquième coalition contre Pitt. Elle n’aboutit pas. Puis une sixième qui présente un caractère particulier ; elle est dirigée par une moitié du cabinet contre l’autre. Pitt et Fox sont bien ministres, mais l’un et l’autre veut être premier ministre. Ils s’unissent, sauf à se combattre bientôt. En effet, Fox s’élève, Pitt tombe, et il n’a rien de plus pressé que d’aller fomenter une septième coalition. Enfin, les circonstances aidant (ces circonstances sont la ruine et l’abaissement de l’Angleterre), Pitt arrive au but de ses efforts. Il est premier ministre de fait. Il aura quatre ans devant lui pour s’immortaliser, car John Bull commence à être révolté de toutes ces luttes.
Au bout de quatre ans, Pitt tombe victime d’intrigues parlementaires. Ses adversaires ont d’autant plus facilement raison de lui qu’ils lui jettent sans cesse à la face ses anciens discours. Ici commence une interminable série de crises ministérielles. C’est au point que Pitt, ayant ressaisi un moment le pouvoir au milieu de ces péripéties et croyant faire trop d’honneur au grand Frédéric, en lui proposant une alliance, celui-ci lui fit cette réponse accablante : « Il est bien difficile d’entrer dans un concert de quelque portée avec un pays qui, par l’effet de changements continuels d’administration, n’offre aucune garantie de persistance et de stabilité. »
Mais laissons le vieux Chatham user ses derniers jours dans ces tristes combats. Voici une génération nouvelle, d’autres hommes portant les mêmes noms, un autre Pitt, un autre Fox, qui, pour l’éloquence et le génie, ne le cèdent en rien à leurs devanciers. Mais la loi est restée la même. Les députés peuvent devenir ministres. Aussi nous allons retrouver les mêmes coalitions, les mêmes désastres, la même immoralité.
Lord North est chef du cabinet. L’opposition présente un faisceau de noms illustres : Burke, Fox, Pitt, Sheridan, Erskine, etc.
Chatham avait rencontré à son début un ministère pacifique, et naturellement il demandait la guerre. Le second Pitt entre an parlement pendant la guerre ; son rôle est de réclamer la paix.
North résistait au fils, comme Walpole avait résisté au père. L’opposition arriva à la plus extrême violence. Fox alla jusqu’à demander la tète de North.
Celui-ci tombe, un nouveau ministère est composé. Burke, Fox, Sheridan y entrent ; Pitt n’y est pas compris. Quatre mois après, nouveau remaniement, qui fit entrer Pitt dans l’administration et en fit sortir Sheridan, Fox et Burke. Avec qui pense-t-on que Fox va se coaliser ? avec ce même North ! Étrange spectacle ! Fox voulut d’abord la paix parce que le ministère était belliqueux. Maintenant il veut la guerre parce que le ministère est pacifique. On le voit, guerre ou paix sont de la pure stratégie parlementaire.
Tout absurde et odieuse qu’est cette coalition, elle réussit. Pitt succombe, North est mandé au palais. Mais les ambitions individuelles sont arrivées à ce point, qu’il est impossible de mettre un terme à la crise ministérielle. Elle dure deux mois. Message des Chambres, pétitions des citoyens, embarras du roi, rien n’y fait. Les députés candidats-ministres ne démordent pas de leurs exigences. Georges III songe à jeter au vent une couronne si lourde, et je crois qu’on peut faire remonter à cette époque l’origine de la cruelle maladie dont il fut plus tard affligé. En vérité, il y avait bien de quoi perdre la tête.
Enfin on s’accorde. Voilà Fox ministre, laissant North et Pitt dans l’opposition. Nouvelle crise ; nouvelles difficultés. Pitt triomphe et, malgré la fureur de Fox, devenu chef d’une autre coalition, parvient à se maintenir. Fox ne se contient plus et se répand en grossières injures. « Compatissant comme je fais, lui répond Pitt, à la situation de l’honorable préopinant, aux tortures de ses espérances trompées, de ses illusions détruites, de son ambition déçue, je déclare que je me croirais inexcusable, si les emportements d’un esprit, succombant sous le poids de regrets dévorants, pouvaient exciter en moi une autre émotion que celle de la pitié. Je proteste qu’ils n’ont pas la puissance de provoquer mon courroux, pas même mon mépris. »
Je m’arrête. En vérité, cette histoire n’aurait pas de fin. Si j’ai cité des noms illustres, ce n’est certes pas pour le vain plaisir de dénigrer de grandes renommées. J’ai pensé que ma démonstration en aurait d’autant plus de force. Si une loi imprudente a pu abaisser à ce point des hommes tels que les Pitt et les Fox, qu’a-t-elle produit sur des âmes plus vulgaires, — des Walpole, des Burke, des North ?
Ce qu’il faut remarquer surtout, c’est que l’Angleterre a été le jouet et la victime de ces coalitions. L’une aboutit à une guerre ruineuse ; l’autre à une paix humiliante. Une troisième fait échouer le plan de justice et de réparation conçu par Pitt en faveur de l’Irlande. Que de souffrances et de honte ce plan n’eût-il pas épargnées à l’Angleterre et à l’humanité !
Triste spectacle que celui de ces hommes d’Etat livrés à la honte de contradictions perpétuelles ! Chatham, dans l’opposition, enseigne que le moindre symptôme de prospérité commerciale, en France, est une calamité pour la Grande-Bretagne. Chatham, ministre, conclut la paix avec la France, et professe que la prospérité d’un peuple est un bienfait pour tous les autres. Nous sommes habitués à voir dans Fox le défenseur des idées françaises. Il le fut sans doute, quand Pitt nous faisait la guerre. Mais quand Pitt négociait le traité de 1786, Fox disait en propres termes que l’hostilité était l’état naturel, la condition normale des relations des deux peuples.
Malheureusement, ces variations, qui ne sont pour les coalitions que des manœuvres stratégiques, sont prises au sérieux par les peuples. C’est ainsi qu’on les voit implorer tour à tour la paix ou la guerre, au gré des chefs momentanément populaires. C’est là le danger sérieux des coalitions.
On pourra dire avec raison que, depuis quelques années, ces sortes de manœuvres sont si décriées en Angleterre, que les hommes d’État n’osent plus s’y livrer. Qu’est-ce que cela prouve, si ce n’est que, par leurs effets désastreux, elles ont enfin ouvert les yeux du peuple et formé son expérience ? Je sais bien que l’homme est naturellement progressif, qu’il finit toujours par être éclairé, sinon par la prévoyance, du moins par l’expérience, et qu’une institution vicieuse perd à la longue son efficacité pour le mal, à force d’en faire. Est-ce une raison pour l’adopter ? Il ne faut pas croire, d’ailleurs, que l’Angleterre ait échappé depuis bien longtemps à ce fléau. Nous l’avons vue de nos jours en éprouver les cruels effets.
En 1824, l’état des finances étant désespéré, un habile ministre, Huskisson, songea à une grande réforme, qui alors était fort impopulaire. Huskisson dut se contenter de faire quelques expériences pour préparer et éclairer l’opinion.
Il y avait alors dans le parlement un jeune homme, profond économiste, et qui comprit toute la grandeur, toute la portée de cette réforme. Si, en sa qualité de député, l’accès du ministère lui eût été interdit, il n’aurait eu rien de mieux à faire qu’à aider Huskisson dans sa difficile entreprise. Mais il y a aussi dans la constitution anglaise un fatal article 79. Et sir Robert Peel, car c’était lui, se dit : « Cette réforme est belle, c’est moi, moi seul qui l’accomplirai. » Mais pour cela, il fallait être ministre. Pour être ministre, il fallait renverser Huskisson ; pour le renverser, il fallait le dépopulariser ; pour le dépopulariser, il fallait décrier l’œuvre qu’on admirait au fond du cœur. C’est à quoi sir Robert s’attacha.
Huskisson mourut sans réaliser sa pensée. Les finances étaient aux abois. Il fallut songer à un moyen héroïque. Russell proposa un bill qui commençait et impliquait la réforme. Sir Robert ne manqua pas d’y faire une opposition furieuse. Le bill échoua. Lord John Russell conseilla au roi, tant la situation était grave, de dissoudre le parlement et d’en appeler aux électeurs. Sir Robert remplit l’Angleterre d’arguments protectionistes, contraires à ses convictions, mais nécessaires à ses vues. Les vieux préjugés l’emportèrent. La nouvelle chambre renversa Russell, et Peel entra au ministère avec la mission expresse de s’opposer à toute réforme. Vous voyez qu’il ne redoutait pas de prendre le chemin le plus long.
Mais sir Robert avait compté sur un auxiliaire qui ne tarda pas à paraître : la détresse publique. La réforme ayant été retardée par ses soins, les finances allaient naturellement de mal en pis. Tous les budgets aboutissaient à des déficit effrayants. Les aliments ne pouvant pénétrer dans la Grande-Bretagne, elle fut en proie à la famine escortée, comme toujours, du crime, de la débauche, de la maladie, de la mortalité. La détresse ! rien n’est plus propre à rendre les peuples changeants. L’opinion, secondée par une ligue puissante, réclama la liberté. Les choses étaient arrivées au point où sir Robert les voulait ; et alors, trahissant son passé, trahissant ses commettants, trahissant son parti parlementaire, un beau jour, il se proclame converti à l’économie politique et réalise lui-même cette réforme, que, pour le malheur de l’Angleterre, il a retardée de dix ans, dans le seul but d’en ravir la gloire à d’autres. Cette gloire, il l’a conquise ; mais l’abandon de tous ses amis et les reproches de sa conscience la lui font payer chèrement.
Nous avons aussi notre histoire constitutionnelle, autrement dit : l’histoire de la guerre aux portefeuilles, guerre qui agite et souvent pervertit le pays tout entier. Je ne m’y arrêterai pas longtemps ; aussi bien, ce ne serait que la reproduction de ce qu’on vient de lire, sauf le nom des personnages et quelques détails de mise en scène.
Le point sur lequel je voudrais surtout attirer l’attention du lecteur, ce n’est pas autant sur ce qu’il y a de déplorable dans les manœuvres des coalitions parlementaires que sur ce qu’il y a de plus dangereux dans un de leurs effets, qui est celui-ci : populariser, pour un temps, l’injustice et l’absurdité ; dépopulariser la vérité même.
Un jour, M. de Villèle s’aperçut que l’État avait du crédit et qu’il pouvait emprunter à 4 1/2 pour cent. Nous avions alors une lourde dette, dont l’intérêt nous coûtait 5 pour cent. M. de Villèle songea à faire aux créanciers de l’État cette proposition : Soumettez-vous à ne toucher désormais que l’intérêt tel qu’il prévaut aujourd’hui dans toutes les transactions, ou bien reprenez votre capital ; je suis prêt à vous le rendre. Quoi de plus raisonnable, quoi de plus juste, et combien de fois la France a-t-elle vainement réclamé depuis cette mesure si simple ?
Mais il y avait, à la Chambre, des députés qui voulaient être ministres. Leur rôle naturel, en conséquence de ce désir, était de trouver M. de Villèle en faute en tout et sur tout. Ils décrièrent donc la conversion avec tant de bruit et d’acharnement, que la France n’en voulut à aucun prix. Il semblait que restituer quelques millions aux contribuables, c’était leur arracher les entrailles. Ce bon M. Laffitte, dominé par son expérience financière au point d’oublier son rôle de coalisé, s’étant avisé de dire : « Après tout, la conversion a du bon, » fut à l’instant considéré comme renégat, et Paris n’en voulut plus pour député. Rendre impopulaire une juste diminution des intérêts payés aux rentiers !
Puisque les coalitions ont fait ce tour de force, elles en feront bien d’autres. — Tant y a, qu’à l’heure qu’il est nous payons encore cette leçon, et, qui pis est, nous ne paraissons pas disposés à en profiter.
Mais voici M. Molé au pouvoir. Deux hommes de talent sont entrés à la Chambre sous l’empire de la charte nouvelle, qui a aussi son article 79. Cet article a soufflé dans l’oreille de nos deux députés ces mots séducteurs : « Si vous parvenez à faire périr M. Molé à force d’impopularité, un de vous prendra sa place. » Et nos deux champions, qui n’ont jamais pu s’entendre sur rien, s’entendent parfaitement pour amasser sur la tête de M. Molé des flots d’impopularité.
Quel terrain vont-ils choisir ? Ce sera celui des questions extérieures. C’est à peu près le seul où deux hommes d’opinions politiques opposées puissent momentanément se rencontrer. D’ailleurs, il est merveilleusement propre au but qu’on a en vue. « Le ministère est lâche, traître, il humilie le drapeau français ; nous sommes, nous, les vrais patriotes, les défenseurs de l’honneur national. » Quoi de mieux calculé pour abaisser son adversaire et s’élever soi-même aux yeux d’une opinion publique, qu’on sait être si chatouilleuse en fait de point d’honneur ? Il est vrai que si on pousse trop loin, dans les masses, cette exaltation de patriotisme, il en pourra résulter d’abord une échauffourée, ensuite une conflagration universelle. Mais ce n’est là qu’une éventualité secondaire aux yeux d’une coalition, l’essentiel est de saisir le pouvoir.
À l’époque dont nous parlons, M. Molé avait trouvé la France engagée par un traité qui portait textuellement, si je ne me trompe, cette clause : « Quand les Autrichiens quitteront les Légations, les Français quitteront Ancône. » Or, les Autrichiens ayant évacué les Légations, les Français évacuèrent Ancône. Rien au monde de plus naturel et de plus juste. À moins de prétendre que la gloire de la France consiste à violer les traités et que la parole lui a été donnée pour tromper ceux avec qui elle traite, M. Molé avait mille fois raison.
C’est pourtant sur cette question que MM. Thiers et Guizot, secondés par l’opinion égarée, parvinrent à le renverser. Et ce fut à cette occasion que M. Thiers professa, sur la valeur des engagements internationaux, cette fameuse doctrine qui en a fait un homme impossible, car elle ne tendait à rien moins qu’à faire de la France elle-même une nation impossible, au moins parmi les peuples civilisés. Mais le propre des coalitions est de créer à ceux qui y entrent des embarras et des obstacles futurs. La raison en est simple. Pendant qu’on est de l’opposition systématique, on affiche des principes sublimes, on étale un patriotisme farouche, on se revêt d’un rigorisme outré. Quand vient l’heure du succès, on entre au ministère ; mais on est bien forcé de laisser tout ce bagage déclamatoire à la porte, et l’on suit humblement la politique de son prédécesseur. C’est ainsi que toute foi s’éteint dans la conscience publique. Le peuple voit se perpétuer une politique qu’on lui a enseigné à trouver pitoyable. Il se dit tristement : Les hommes qui avaient gagné ma confiance par leurs beaux discours d’opposition, ne manquent jamais de la trahir quand ils sont ministres. — Heureux s’il n’ajoute pas : Je m’adresserai dorénavant, non à des discoureurs, mais à des hommes d’action.
Nous venons de voir MM. Thiers et Guizot diriger, au sein du parlement, contre M. Molé, les batteries d’Ancône. Je pourrais montrer maintenant d’autres coalitions battre M. Guizot en brèche avec les batteries de Taïti, du Maroc, de Syrie. Mais vraiment l’histoire en deviendrait fastidieuse. C’est toujours la même chose. Deux ou trois députés, appartenant à des partis divers, souvent opposés, quelquefois irréconciliables, se mettent en tête qu’ils doivent être ministres, quoi qu’il puisse arriver. Ils calculent que tous ces partis réunis peuvent faire une majorité ou en approcher. Donc, ils se coalisent. Ils ne s’occupent pas de réformes administratives ou financières sérieuses, pouvant réaliser le bien public. Non, ils ne seraient pas d’accord là-dessus. D’ailleurs, le rôle d’une coalition est d’attaquer violemment les hommes et mollement les abus ! Détruire les abus ! mais ce serait amoindrir l’héritage auquel elle aspire ! Nos deux ou trois meneurs se campent sur les questions extérieures. Ils se remplissent la bouche des mots : Honneur national, patriotisme, grandeur de la France, prépondérance. Ils entraînent les journaux, puis l’opinion ; ils l’exaltent, la passionnent, la surexcitent, tantôt au sujet du pacha d’Égypte, tantôt à l’occasion du droit de visite, une autre fois à propos d’un Pritchard. Ils nous conduisent jusqu’à la limite de la guerre. L’Europe est dans l’anxiété. De toute part les armées grossissent et les budgets avec elles. « Encore un effort ! dit la coalition, il faut que le ministère tombe ou que l’Europe soit en feu. » Le ministère tombe en effet ; mais les armées restent et les budgets aussi. Un des heureux vainqueurs entre au pouvoir, les deux autres restent en route, et s’en vont former, avec les ministres déchus, une coalition nouvelle, qui passe par les mêmes intrigues pour aboutir aux mêmes résultats. Que si l’on s’avise de dire au ministère de fraîche date : Maintenant diminuez donc l’armée et le budget, il répond : Eh quoi ! ne voyez-vous pas combien les dangers de guerre renaissent fréquemment en Europe? — Et le peuple dit : Il a raison. — Et la charge s’accroît, à chaque crise ministérielle, jusqu’à ce que, devenue insupportable, les périls factices du dehors sont remplacés par des périls réels au dedans. — Et le ministre dit : Il faut bien armer la moitié de la nation pour tenir l’autre moitié couchée en joue. — Et le peuple, ou du moins cette partie du peuple à qui il reste quelque chose à perdre, dit : Il a raison.
Tel est le triste spectacle qu’offrent au monde la France et l’Angleterre ; si bien que beaucoup de gens sensés en sont venus à se demander si le régime représentatif, quelque logique que la théorie le montre, n’était pas, par sa nature, une cruelle mystification. Cela dépend. Sans l’article 79, il répond aux espérances qu’il avait fait naître, comme le prouve l’exemple des États-Unis. Avec l’article 79, il n’est pour les peuples qu’un enchaînement d’illusions et de déceptions.
Et comment en serait-il autrement ? Les hommes ont rêvé de grandeur, d’influence, de fortune et de gloire. Qui n’y rêve quelquefois ? Tout à coup le vent de l’élection les jette dans l’enceinte législative. Si la constitution du pays leur disait : « Tu y entres représentant et tu y resteras représentant, » quel intérêt auraient-ils, je le demande, à tourmenter, entraver, déconsidérer et renverser le pouvoir ? Mais, loin de leur tenir ce langage, elle dit à l’un : « Le ministre a besoin de grossir ses phalanges, et il dispose de hautes positions politiques que je ne t’interdis pas ; » à l’autre : « Tu as de l’audace et du talent, voilà le banc des ministres ; si tu parviens à les en chasser, ta place y est marquée. »
Alors, et cela est infaillible, alors commencent ces tumultes d’accusations furieuses, ces efforts inouïs pour mettre de son côté la force d’une popularité éphémère, cet étalage fastueux de principes irréalisables, quand on attaque, et de concessions abjectes, quand on se défend. Ce n’est que piéges et contre-piéges, feintes et contre-feintes, mines et contre-mines. La politique devient une stratégie. Les opérations se poursuivent au dehors, dans les bureaux, dans les commissions, dans les comités. Le moindre petit accident parlementaire, une élection de questeur est un symptôme qui fait palpiter les cœurs de crainte ou d’espérance ; s’il s’agissait du Code civil lui-même, on n’y prendrait pas tant d’intérêt. On voit se liguer les éléments les plus hétérogènes et se dissoudre les plus naturelles alliances. Ici, l’esprit de parti forme une coalition. Là, la souterraine habileté ministérielle en fait échouer une autre. S’agit-il d’une loi d’où dépend le bien-être du peuple, mais qui n’implique pas la question de confiance, la salle est déserte. En revanche, tout événement que le temps amène, portât-il dans ses flancs une conflagration générale, est toujours le bienvenu, s’il présente un terrain où se puissent appuyer les échelles d’assaut. Ancône, Taïti, Maroc, Syrie, Pritchard, droit de visite, fortifications, tout est bon, pourvu que la coalition y trouve la force qui renversera le cabinet. Alors, nous sommes saturés de ces lamentations dont la forme est stéréotypée : « Au dedans la France est souffrante, etc., etc. ; au dehors la France est humiliée, etc., etc. » Est-ce vrai ? est-ce faux ? On ne s’en met pas en peine. Cette mesure nous brouillera-t-elle avec l’Europe ? Nous forcera-t-elle à tenir éternellement cinq cent mille hommes sur pied ? Arrêtera-t-elle la marche de la civilisation ? Créera-t-elle des obstacles à toute administration future ? Ce n’est pas ce dont il s’agit. Au fond, une seule chose intéresse : la chute ou le triomphe d’un nom propre.
Et ne croyez pas que cette perversité politique n’envahisse au sein du parlement que les âmes vulgaires, les cœurs dévorés d’une ambition de bas étage, les prosaïques amants de places bien rémunérées. Non, elle s’attaque encore et surtout aux âmes d’élite, aux nobles cœurs, aux intelligences puissantes. Pour dompter de tels hommes, il suffit que l’art. 79 éveille au fond de leur conscience, au lieu de cette pensée triviale : Tu réaliseras tes rêves de fortune, cette autre pensée bien autrement dominatrice : Tu réaliseras tes rêves de bien public. Lord Chatham avait donné des preuves d’un grand désintéressement ; M. Guizot n’a jamais été accusé d’adorer le veau d’or. On a vu ces deux hommes dans les coalitions, et qu’y faisaient-ils ? Tout ce que peut suggérer la soif du pouvoir et pis peut-être que ne pourrait suggérer la soif des richesses. Afficher des sentiments qu’ils n’avaient pas ; se parer d’un patriotisme farouche qu’ils n’approuvaient pas ; susciter des embarras au gouvernement de leur pays, faire échouer les négociations les plus importantes, pousser le journalisme et l’esprit public dans les voies les plus périlleuses, créer à leur propre ministère futur les difficultés de tels précédents, se préparer d’avance de honteuses palinodies ; voilà ce qu’ils faisaient. Et pourquoi ? Parce que le démon tentateur, caché sous la forme d’un article 79, avait murmuré à leur oreille ces mots dont, depuis l’origine, il sait la séduction : « Eritis sicut dii ; renversez tout sur votre passage, mais arrivez au pouvoir et vous serez la providence des peuples. » Et le député succombant prononce des discours, expose des doctrines, se livre à des actes que sa conscience réprouve. Il se dit : « Il le faut bien pour me frayer la route. Que je parvienne enfin au ministère, je saurai bien reprendre ma pensée réelle et mes vrais principes. »
Il est donc bien peu de députés que la perspective du ministère ne fasse dévier de cette ligne de rectitude, où leurs commettants avaient le droit de les voir marcher. Encore, si la guerre des portefeuilles, ce fléau que le fabuliste aurait pu faire entrer dans sa triste énumération entre la peste et la famine, si, dis-je, la guerre aux portefeuilles se renfermait dans l’enceinte du palais national ! Mais le champ de bataille s’élargit peu à peu jusqu’aux frontières, et par delà les frontières du pays. Les masses belligérantes sont partout ; les chefs seuls sont dans la Chambre. Ils savent que, pour arriver au corps de la place, il faut commencer par emporter les ouvrages extérieurs, le journalisme, la popularité, l’opinion, les majorités électorales. Il est donc fatal que toutes ces forces, à mesure qu’elles s’enrôlent pour ou contre la coalition, s’imprègnent et s’imbibent des passions qui s’agitent dans le parlement. Le journalisme, d’un bout à l’autre de la France, ne discute plus, il plaide. Il plaide chaque loi, chaque mesure, non point en ce qu’elles ont de bon ou de mauvais, mais au seul point de vue de l’assistance qu’elles peuvent prêter momentanément à tel ou tel champion. La presse ministérielle n’a plus qu’une devise : E sempre bene ; et la presse opposante, comme la vieille femme de la satire, laisse lire sur son jupon ce mot : Argumentabor.
Quand le journalisme est ainsi décidé à tromper le public et à se tromper lui-même, il peut accomplir en ce genre des miracles surprenants. Rappelons-nous le droit de visite. Pendant je ne sais combien d’années ce traité s’exécutait sans que personne en prit souci. Mais une coalition ayant eu besoin d’un expédient stratégique, elle déterra ce malencontreux traité, et en fit la base de ses opérations. Bientôt, aidée du journalisme, elle parvint à faire croire à tous les Français qu’il ne renfermait qu’une clause ainsi conçue : « Les navires de guerre anglais auront le droit de visiter les navires du commerce français. » Il n’est pas besoin de dire l’explosion de patriotisme que devait faire éclater une telle hypothèse. Ce fut au point qu’on ne comprend pas encore comment une guerre universelle put être évitée. Je me rappelle m’être trouvé à cette époque dans un cercle nombreux où l’on fulminait contre l’odieux traité. Quelqu’un s’avisa de dire : Qui de vous l’a lu ? Il fut heureux pour lui que les auditeurs ne trouvassent pas de pierres sous leur main, il aurait été infailliblement lapidé.
Au reste, l’enrôlement des journaux dans la guerre de portefeuilles et le rôle qu’ils y jouent ont été dévoilés par l’un d’eux en termes qui méritent d’être reproduits ici (Presse du 17 novembre 1845) :
« M. Petetin décrit la presse telle qu’il la comprend, comme il se plaît à la rêver. De bonne foi, croit-il que lorsque le Constitutionnel, le Siècle, etc., s’attaquent à M. Guizot, que lorsqu’à son tour le Journal des Débats s’en prend à M. Thiers, ces feuilles combattent uniquement pour l’idée pure, pour la vérité, provoquées par le besoin intérieur de la conscience ? Définir ainsi la presse, c’est la peindre telle qu’on l’imagine, ce n’est pas la peindre telle qu’elle est. Il ne nous en coûte aucunement de le déclarer, car si nous sommes journaliste, nous le sommes moins par vocation que par circonstance. Nous voyons tous les jours la presse au service des passions humaines, des ambitions rivales, des combinaisons ministérielles, des intrigues parlementaires, des calculs politiques les plus divers, les plus opposés, les moins nobles ; nous la voyons s’y associer étroitement. Mais nous la voyons rarement au service des idées ; et quand, par hasard, il arrive à un journal de s’emparer d’une idée, ce n’est jamais pour elle-même, c’est toujours comme instrument de défense ou d’attaque ministérielle. Celui qui écrit ces lignes parle ici avec expérience. Toutes les fois qu’il a essayé de faire sortir le journalisme de l’ornière des partis pour le faire entrer dans le champ des idées et des réformes, dans la voie des saines applications de la science économique à l’administration publique, il s’est trouvé tout seul, et il a dû reconnaître qu’en dehors du cercle étroit tracé par les lettres assemblées de quatre ou cinq noms propres, il n’y avait pas de discussion possible, il n’y avait pas de politique. »
En vérité, je ne sais plus à quelle démonstration recourir si le lecteur n’est pas scandalisé, épouvanté d’un si effroyable aveu !
Enfin, comme le mal, parti du parlement, envahit le journalisme ; par le journalisme il envahit l’opinion publique tout entière. Comment le public ne serait-il pas égaré, quand, jour après jour, la Tribune et la Presse s’appliquent à ne laisser arriver jusqu’à lui que de fausses lueurs, de faux jugements, de fausses citations et de fausses assertions ?
Nous avons vu que le terrain sur lequel se livre ordinairement la bataille ministérielle, c’est la question extérieure d’abord, ensuite la corruption parlementaire et électorale.
Quant à la question extérieure, tout le monde comprend le danger de ce travail incessant auquel se livrent les coalitions pour attiser les haines nationales, irriter l’orgueil patriotique, persuader au pays que l’étranger ne songe qu’à l’humilier et le pouvoir exécutif qu’à le trahir ! Qu’il me soit permis de dire que ce danger est peut-être plus grand en France que partout ailleurs. Notre civilisation nous fait une nécessité du travail. C’est notre moyen d’existence et de progrès. Le travail se développe par la sécurité, la liberté, l’ordre et la paix.
Malheureusement l’éducation universitaire est en contradiction flagrante avec ces besoins de notre temps. En nous faisant vivre pendant toute notre jeunesse de la vie des Spartiates et des Romains, elle entretient dans nos âmes ce sentiment commun aux enfants et aux barbares : l’admiration de la force brutale. La vue d’un beau régiment, le bruit des fanfares, l’aspect de ces machines que les hommes ont inventées pour se casser réciproquement les bras et les jambes, les poses d’un tambour-major, tout cela nous met en extase. Comme les barbares, nous croyons que patriotisme signifie haine de l’étranger. Dès que notre intelligence commence à poindre, on ne l’entretient que des vertus militaires, de la grande politique des Romains, de leur profonde diplomatie, de la force de leurs légions. Nous apprenons la morale dans Tite-Live. Notre catéchisme, c’est Quinte-Curce, et on offre à notre enthousiasme, comme l’idéal de la civilisation, un peuple qui avait fondé ses moyens d’existence sur le pillage méthodique du monde entier. Il est aisé de comprendre combien les efforts des coalitions parlementaires, toujours dirigés dans le sens de la guerre, nous trouvent bien disposés à les seconder. Elles ne sauraient semer sur un champ mieux préparé. Aussi il a tenu à bien peu de chose que, dans l’espace de quelques années, elles ne nous aient mis aux prises avec l’Espagne, avec le Maroc, avec la Turquie, avec la Russie, avec l’Autriche, et trois fois avec l’Angleterre. Où en serait la France si de telles calamités n’eussent pas été détournées, à grand’peine et presque malgré elle ? Louis-Philippe est tombé, mais rien ne m’empêchera de dire qu’il a rendu au monde l’immense service de maintenir la paix. Que de sueurs lui a coûtées ce succès digne des bénédictions des peuples ! Et pourquoi ? (c’est ici le cœur de ma thèse) parce qu’à un moment donné la paix n’avait plus pour elle l’opinion publique. Et pourquoi n’avait-elle pas pour elle l’opinion ? Parce qu’elle ne convenait pas aux journaux. Et pourquoi ne convenait-elle pas aux journaux ? Parce qu’elle était importune à tel député, candidat-ministre. Et pourquoi enfin était-elle importune à ce député ? Parce que les accusations de faiblesse, de trahison, ont été, sont et seront toujours l’arme favorite des députés qui, aspirant aux portefeuilles, ont besoin de renverser ceux qui les tiennent.
L’autre point sur lequel les coalitions attaquent ordinairement le ministère, c’est la corruption. À cet égard, pendant le dernier régime, elles avaient beau jeu. Mais cette corruption même, les coalitions n’en font-elles pas, pour ainsi dire, une fatalité ? Le pouvoir qu’on attaque sur un sujet où il a raison, comme, par exemple, quand on veut le pousser à une guerre injuste, se défend d’abord par la raison. Mais bientôt il s’aperçoit qu’elle est impuissante et quelle vient se briser contre une opposition systématique. Alors, quelle ressource lui reste ? C’est de se créer à tout prix une majorité compacte et d’opposer parti pris à parti pris. Ce fut l’arme défensive de Walpole, ça été celle de M. Guizot. On ne m’accusera pas, j’espère, de présenter ici l’apologie ou la justification de la corruption. Mais je dis ceci : le cœur humain étant donné, les coalitions la rendent fatale. Le contraire implique contradiction, car si le ministère était honnête, il tomberait. Il existe, donc il corrompt. Il n’y a jamais eu de cabinets un peu stables que ceux qui se sont créé ainsi une majorité quand même : Walpole , North, Villèle, Guizot.
Et maintenant que le lecteur veuille bien se représenter un pays où les grandes réunions politiques, les Chambres, les corps électoraux sont incessamment travaillés, d’un côté, par les manœuvres de l’opposition systématique, aidée du journalisme, semant la haine, le mensonge et les idées belliqueuses ; de l’autre, par les manœuvres ministérielles infiltrant la vénalité et la corruption jusqu’aux dernières fibres du corps social ! Et cela dure des siècles. Et cela devient l’état permanent du régime représentatif. Faut-il s’étonner si les honnêtes gens finissent par en désespérer ? Il est vrai que l’on voit de temps en temps les meneurs changer de rôle. Mais cette circonstance ne fait que substituer aux derniers vestiges de la foi un scepticisme universel et indélébile.
Il faut finir. Je terminerai par une considération de la plus haute importance.
L’Assemblée nationale a fait une constitution. Nous devons la respecter profondément. C’est l’ancre de salut de nos destinées. Ce n’est pourtant pas une raison pour fermer les yeux aux dangers qu’à titre d’œuvre humaine elle peut présenter, si surtout nous nous proposons pour but, dans cet examen consciencieux, d’éloigner de toutes les institutions accessoires ce qui serait de nature à développer un germe funeste.
Tout le monde est d’accord, je crois, sur ce point que le danger de notre constitution est de mettre en présence deux pouvoirs qui sont ou peuvent se croire rivaux et égaux, parce qu’ils se prévalent tous deux du suffrage universel d’où ils émanent. Déjà la possibilité d’un conflit insoluble alarme beaucoup d’esprits et adonné naissance à deux théories bien tranchées. Les uns prétendent que la révolution de Février, dirigée contre l’ancien pouvoir exécutif, n’a pu vouloir amoindrir la prépondérance du pouvoir législatif. Le président du conseil a soutenu, au contraire, que si autrefois le ministère devait reculer devant les majorités, il n’en était pas de même aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, tous les amis sincères de la sécurité, de la stabilité, doivent désirer ardemment que l’occasion même de ce conflit de pouvoirs ne naisse pas, et que le danger, s’il existe, reste à l’état latent.
S’il en est ainsi, irons nous déposer de gaieté de cœur, dans la loi électorale, une cause évidente de crises ministérielles factices ? En présence de l’énorme difficulté constitutionnelle qui nous frappe et nous épouvante, organiserons- nous, avant de nous séparer, les luttes parlementaires, comme pour multiplier à plaisir les chances du conflit ?
Qu’on songe donc à ceci : ce qu’on appelait autrefois crises ministérielles, s’appellera désormais conflit de pouvoirs, et en prendra les gigantesques proportions. Nous l’avons déjà vu, quoique la constitution ait à peine deux mois d’existence, et sans l’admirable modération de l’Assemblée nationale, nous serions maintenant en pleine tempête révolutionnaire.
Certes, voilà un motif puissant pour que nous évitions de créer des causes factices de crises ministérielles. Sous la monarchie représentative, elles ont fait beaucoup de mal ; mais enfin, il y avait une solution. Le roi pouvait dissoudre la Chambre et en appeler au pays. Si le pays condamnait l’opposition, cela résultait de la majorité nouvelle, et l’harmonie des pouvoirs était rétablie. S’il condamnait le ministère, cela résultait encore de la majorité, et le roi ne pouvait se refuser à céder.
Maintenant la question ne se pose plus entre l’opposition et le ministère. Elle se pose entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, tous deux ayant un mandat d’une durée déterminée, c’est-à-dire qu’elle se pose entre deux manifestations du suffrage universel.
Encore une fois, je ne recherche pas ici qui doit céder, je me borne à dire : Acceptons l’épreuve, si elle nous arrive naturellement ; mais ne commettons pas l’imprudence de la faire naître artificiellement plusieurs fois par année.
Or, je le demande, en m’appuyant sur les leçons du passé, déclarer que les représentants peuvent aspirer aux portefeuilles, n’est-ce pas fomenter les coalitions, multiplier les crises ministérielles, ou, pour mieux dire, les conflits de pouvoirs ? Je livre cette réflexion à mes collègues.
Maintenant j’aborde deux objections.
On dit : Vous voyez bien des choses dans l’admissibilité des députés au ministère. À vous entendre, il semble que, sans elle, la république serait un paradis. En leur fermant la porte du pouvoir, croyez-vous donc éteindre toutes les passions ? N’avez-vous pas déclaré vous-même qu’en Angleterre les coalitions deviennent impossibles à force d’être impopulaires, et n’a-t-on pas vu Peel et Russell se prêter réciproquement un loyal concours ?
Cet argument revient à ceci : De ce qu’il y aura toujours de mauvaises passions, concluons qu’il faut mettre dans la loi un aliment à la plus mauvaise de toutes. — Qu’avec le temps et à force de faire du mal les coalitions s’usent, je le crois. Il n’y a pas de fléau dont on n’en puisse dire autant, et c’est un singulier motif pour en mettre le germe dans nos lois. Des guerres inutiles, des, impôts accablants, fruit des coalitions, ont appris à l’Angleterre à les mépriser. Je ne dis pas qu’au bout de deux ou trois siècles, au prix des mêmes calamités, nous ne puissions apprendre la même leçon. La question est de savoir s’il vaut mieux repousser une mauvaise loi, ou l’adopter sur ce fondement que l’excès du mal qui en sortira provoquera, dans cent ans, une réaction vers le bien.
On dit encore : Interdire le ministère aux députés, c’est priver le pays de tous les grands talents qui se révèlent dans l’Assemblée nationale.
Je dis, moi, que c’est au contraire retenir les grands talents au service du bien général. Montrer à un homme de génie qui est représentant la perspective du pouvoir, c’est l’entraîner à faire cent fois plus de mal, comme membre d’une coalition, qu’il ne fera jamais de bien comme membre d’un cabinet. C’est tourner son génie même contre le repos public.
Ne nous faisons-nous pas d’ailleurs illusion, quand nous nous imaginons que tous les grands talents sont à la Chambre ? Croit-on qu’il n’y a pas, dans toute l’armée, de quoi faire un bon ministre de la Guerre ? dans toute la magistrature, de quoi fournir un bon ministre de la Justice ?
S’il y a des hommes de génie à la Chambre, qu’ils y restent. Ils exerceront une bonne influence sur les majorités et sur les ministères, d’autant qu’ils n’auront plus intérêt à en exercer une mauvaise.
Au reste, l’objection eût-elle quelque valeur, elle s’efface devant les dangers incommensurablement supérieurs des coalitions, conséquences fatales de l’article que je combats. Espérons-nous trouver une solution qui n’ait aucun inconvénient ? De deux maux, sachons choisir le moindre. C’est une singulière logique, à l’usage de tous les sophistes, que celle-ci : Votre proposition a un petit inconvénient ; la mienne en a d’énormes. Donc, il faut repousser la vôtre, à cause du petit inconvénient qui y est attaché.
Résumons cette trop longue et en même temps trop courte dissertation.
La question des incompatibilités parlementaires, c’est le cœur même de la Constitution. Nous n’en avons remué aucune, depuis un an, qu’il importe autant de bien résoudre.
La solution conforme à la justice, à l’utilité générale me semble résider dans deux principes clairs, simples, incontestables.
1° Pour arriver à l’Assemblée nationale, pas d’exclusion, mais seulement des précautions à l’égard des fonctionnaires publics.
2° Pour passer de la représentation aux places, exclusion absolue.
Eu d’autres termes :
Tout électeur est éligible.
Tout représentant doit rester représentant.
Tout cela se trouve dans l’amendement que j’ai formulé en ces termes :
1° Le fonctionnaire public, nommé représentant, sans perdre ses droits et ses titres, ne pourra être promu ni destitué ; il ne pourra exercer ses fonctions ni en percevoir le traitement pendant toute la durée de son mandat.
2° Un représentant ne peut accepter aucune fonction publique, et notamment celle de Ministre.
FN:Cet opuscule, publié en mars 1849, fut réimprimé, en 1850, peu de mois avant la mort de l’auteur. L’opinion qu’il y développe avait dans son esprit des racines profondes, ainsi qu’on peut le voir, au tome 1er, par sa Lettre à M. Larnac, qui date de 1846, et, de plus, par l’écrit de 1830, intitulé : Aux Électeurs du département des Landes. (Note de l’éditeur.)
FN:V. au tome IV, les pages 10 et 11 ; au tome VI, le chap. xvii ; et, au présent tome, la page 443 et suiv. (Note de l’éditeur.)
Profession de foi électorale de 1849 [April 1849] [CW2.2.6]↩
BWV
1849.04 “Profession de foi électorale d’avril 1849” (Statement of Electoral Principles in April 1849) [OC7.65, p. 255] [CW1]
Mes chers Compatriotes,
Vous m’avez donné un mandat qui touche à son terme. Je l’ai rempli dans l’esprit qui me l’a fait donner.
Rappelez-vous les élections de 1848. Que vouliez-vous ?
Quelques-uns d’entre vous avaient salué avec transport l’avènement de la République ; d’autres ne l’avaient ni provoquée ni désirée ; d’autres encore la redoutaient. Mais, par un élan de bon sens admirable, vous vous unîtes tous dans cette double pensée :
1° Maintenir et essayer loyalement la République ;
2° La faire rentrer dans la voie de l’ordre et de la sécurité.
L’histoire dira que l’Assemblée nationale, au milieu d’immenses périls, a été fidèle à ce programme. En se séparant elle laisse l’anarchie et la réaction vaincues ; la sécurité rétablie ; les utopies subversives frappées d’impuissance ; un gouvernement régulier ; une Constitution qui admet des perfectionnements ultérieurs ; la paix maintenue ; des finances échappées aux plus grands dangers. Oui, quoique souvent battue par l’orage, votre Assemblée a été l’expression de votre volonté. Elle m’apparaît comme un miracle inespéré du suffrage universel. La calomnier, c’est vous calomnier vous-mêmes.
Pour moi, je me suis toujours retrempé de l’esprit qui vous animait tous, en avril 1848. Bien souvent, quand, sous la pression de difficultés terribles, je voyais vaciller le flambeau qui devait me guider, j’ai évoqué le souvenir des nombreuses réunions où j’avais comparu devant vous, et je me suis dit : « Il faut vouloir ce que mes commettants ont voulu : La République honnête. »
Compatriotes, je suis forcé de vous parler de moi, je me bornerai à des faits.
Au 23 février, je n’ai pas pris part à l’insurrection. Par hasard, je me suis trouvé à la fusillade de l’hôtel des Capucines. Pendant que la foule fuyait éperdue, je remontai le courant et, en face de ce bataillon dont les fusils étaient encore chauds, aidé de deux ouvriers, j’ai donné mes soins, pendant cette nuit funèbre, aux victimes mortellement frappées.
Dès le 25, j’ai pu prévoir le débordement des idées subversives dont le foyer devait se concentrer bientôt au Luxembourg. Pour les combattre, je fondai un journal. Voici le jugement qu’en porte une Revue qui me tombe sous la main et qui n’est pas suspecte, elle est intitulée : Bibliographie catholique, destinée aux prêtres, aux séminaires, aux écoles, etc. « La République française, feuille qui a paru le lendemain de la Révolution ; écrite avec talent, modération et sagesse, en opposition au socialisme, au Luxembourg et aux circulaires. »
Survint ce qu’on a appelé avec raison la curée des places. Plusieurs de mes amis étaient tout-puissants, entre autres M. de Lamartine, qui m’avait écrit quelques jours avant : « Si jamais l’orage me porte au Pouvoir, vous m’aiderez à faire triompher nos idées. » Il m’était facile d’arriver à de hautes positions ; je n’y ai seulement pas pensé.
Élu par vous, à la presque unanimité, j’entrai à l’Assemblée le 5 mai. Le 15 nous fûmes envahis. Ce jour-là mon rôle s’est borné à rester à mon poste, comme tous mes collègues.
Nommé membre et vice-président du comité des Finances, il fut bientôt manifeste que nous aurions à résister à une opinion alors fort accréditée parce qu’elle est fort séduisante. Sous prétexte de donner satisfaction au peuple, on voulait investir d’une puissance exorbitante le Gouvernement révolutionnaire ; on voulait que l’État suspendît le remboursement des caisses d’Épargne et des Bons du Trésor ; qu’il s’emparât des chemins de fer, des assurances, des transports. Le ministère poussait dans cette voie, qui ne me semble autre chose que la spoliation régularisée par la loi et exécutée par l’impôt. J’ose dire que j’ai contribué à préserver mon pays d’une telle calamité.
Cependant une collision effroyable était menaçante. Le travail vrai des ateliers particuliers était remplacé par le travail mensonger des ateliers nationaux. Le peuple de Paris organisé et armé était le jouet d’utopistes ignorants et d’instigateurs de troubles. L’Assemblée, forcée de détruire une à une, par ses votes, ces illusions trompeuses, prévoyait le choc et n’avait guère, pour y résister, que la force morale qu’elle tenait de vous. Convaincu qu’il ne suffisait pas de voter, mais qu’il fallait éclairer les masses, je fondai un autre journal qui aspirait à parler le simple langage du bon sens, et que, par ce motif, j’intitulai Jacques Bonhomme, Il ne cessait de réclamer la dissolution, à tout prix, des forces insurrectionnelles. La veille même des Journées de Juin, il contenait un article de moi sur les ateliers nationaux. [193] Cet article, placardé sur tous les murs de Paris, fit quelque sensation. Pour répondre à certaines imputations, je le fis reproduire dans les journaux du Département.
La tempête éclata le 24 juin. Entré des premiers dans le faubourg Saint-Antoine, après l’enlèvement des formidables barricades qui en défendaient l’accès, j’y accomplis une double et pénible tâche : Sauver des malheureux qu’on allait fusiller sur des indices incertains ; pénétrer dans les quartiers les plus écartés pour y concourir au désarmement. Cette dernière partie de ma mission volontaire, accomplie au bruit de la fusillade, n’était pas sans danger. Chaque chambre pouvait cacher un piège ; chaque fenêtre, chaque soupirail pouvait masquer un fusil.
Après la victoire, j’ai prêté un concours loyal à l’administration du Général Cavaignac, que je tiens pour un des plus nobles caractères que la Révolution ait fait surgir. Néanmoins, j’ai résisté à tout ce qui m’a paru mesure arbitraire, car je sais que l’exagération dans le succès le compromet. L’empire sur soi-même, la modération en tous sens, telle a été ma règle, ou plutôt mon instinct. Au faubourg Saint-Antoine, d’une main je désarmais les insurgés, de l’autre je sauvais les prisonniers. C’est le symbole de ma conduite parlementaire.
Vers cette époque, j’ai été atteint d’une maladie de poitrine qui, se combinant avec l’immensité de l’enceinte de nos délibérations, m’a interdit la tribune. Je ne suis pas pour cela resté oisif. La vraie cause des maux et des dangers de la société résidait, selon moi, dans un certain nombre d’idées erronées, pour lesquelles ces classes qui ont pour elle le nombre et la force s’étaient malheureusement enthousiasmées. Il n’est pas une de ces erreurs que je n’aie combattues. Certes, je savais que l’action qu’on cherche à exercer sur les causes est toujours très lente, qu’elle ne suffit pas quand le danger fait explosion. Mais pourriez-vous me reprocher d’avoir travaillé pour l’avenir, après avoir fait pour le présent tout ce qu’il m’a été possible de faire ?
Aux doctrines de Louis Blanc, j’ai opposé un écrit intitulé : Individualisme et Fraternité. [194]
La Propriété est menacée dans son principe même ; on cherche à tourner contre elle la législation : je fais la brochure : Propriété et loi.
On attaque cette forme de Propriété particulière qui consiste dans l’appropriation individuelle du sol : je fais la brochure : Propriété et spoliation, laquelle, selon les économistes anglais et américains, a jeté quelque lumière sur la difficile question de la rente des terres.
On veut fonder la fraternité sur la contrainte légale ; je fais la brochure : Justice et Fraternité.
On ameute le travail contre le capital ; on berce le Peuple de la chimère de la Gratuité du crédit ; je fais la brochure : Capital et rente.
Le communisme nous déborde. Je l’attaque dans sa manifestation la plus pratique, par la brochure : Protectionisme et Communisme.
L’École purement révolutionnaire veut faire intervenir l’État en toutes choses et ramener ainsi l’accroissement indéfini des impôts ; je fais la brochure intitulée : l’État, spécialement dirigée contre le manifeste montagnard.
Il m’est démontré qu’une des causes de l’instabilité du Pouvoir et de l’envahissement désordonné de la fausse politique, c’est la guerre des Portefeuilles ; je fais la brochure : Incompatibilités parlementaires.
Il m’apparaît que presque toutes les erreurs économiques qui désolent ce pays proviennent d’une fausse notion sur les fonctions du numéraire ; je fais la brochure : Maudit argent.
Je vois qu’on va procéder à la réforme financière par des procédés illogiques et incomplets ; je fais la brochure : Paix et liberté, ou le Budget Républicain.
Ainsi, dans la rue par l’action, dans les esprits par la controverse, je n’ai pas laissé échapper une occasion, autant que ma santé me l’a permis, de combattre l’erreur, qu’elle vînt du Socialisme ou du Communisme, de la Montagne ou de la Plaine.
Voilà pourquoi j’ai dû voter quelquefois avec la gauche, quelquefois avec la droite ; avec la gauche quand elle défendait la liberté et la république, avec la droite quand elle défendait l’ordre et la sécurité.
Et si l’on me reproche cette prétendue double alliance, je répondrai : je n’ai fait alliance avec personne, je ne me suis affilié à aucune coterie, J’ai voté, dans chaque question, selon l’inspiration de ma conscience. Tous ceux qui ont bien voulu lire mes écrits, à quelque époque qu’ils aient été publiés, savent que j’ai toujours eu en horreur les majorités et les oppositions systématiques.
Est arrivée l’Élection du Président de la République. Nous étions encore en face de grands dangers, entre autres la guerre extérieure. Je ne savais ce qu’on pouvait attendre de Napoléon, je savais ce qu’on pouvait attendre de Cavaignac, qui s’était prononcé pour la Paix. J’ai eu mes préférences, je les ai loyalement exprimées. C’était mon droit, c’était même mon devoir, de dire ce que je faisais et pourquoi je le faisais. C’est à cela que je me suis borné. Le suffrage universel m’a donné tort. Je me suis rallié comme je le devais à sa volonté toute-puissante. Je défie qu’on me signale un vote d’opposition systématique à l’Élu du 20 décembre. Je me considérerais comme un factieux, si j’entravais, par une rancune ridicule, la grande et utile mission qu’il a reçue du Pays.
Comme membre du Comité des finances et plus tard de la commission du Budget, j’ai travaillé, autant que l’état de nos finances le permettait, aux réformes qui, vous le savez, ont toujours été le but de mes efforts. J’ai concouru à la réduction de l’impôt du sel et de la poste. Membre de la Commission des boissons, nous avions préparé une réforme radicale, que les moments comptés de l’Assemblée ajournent à un autre temps. J’ai fortement insisté pour la diminution de l’armée, et j’aurais voulu arriver à adoucir la dure loi du recrutement.
Sur la question de la dissolution de l’Assemblée, je n’ai jamais varié. Faire les lois organiques indispensables à la mise en œuvre de la constitution, rien de plus, rien de moins.
Compatriotes, voilà mes actes, je les livre à votre impartialité.
Si vous jugez à propos de me réélire, je vous déclare que je persévérerai dans la ligne que vous m’avez tracée, en avril 1848 : Maintenir la République ; fonder la sécurité.
Que si, sous l’influence des jours mauvais que vous avez traversés, vous avez conçu d’autres idées, d’autres espérances, si vous voulez poursuivre un but nouveau et tenter de nouvelles aventures, alors je ne puis plus être votre mandataire ; je ne renoncerai pas à l’œuvre que nous avons entreprise en commun, au moment de recueillir le fruit de nos efforts. La sécurité est sans doute le premier besoin de notre époque et le premier des biens en tous temps. Mais je ne puis croire qu’on la fonde d’une manière solide par l’abus du triomphe, par l’irritation, par la violence, par les emportements de la réaction. Celui que vous honorerez de vos suffrages n’est pas le représentant d’une classe mais de toutes. Il ne doit pas oublier qu’il y a de grandes souffrances, de profondes misères, de criantes injustices dans le pays. Comprimer, toujours comprimer, cela n’est ni juste, ni même prudent. Rechercher les causes de la souffrance, y apporter tous les remèdes compatibles avec la justice, c’est un devoir aussi sacré que celui de maintenir l’ordre. Sans doute il ne faut pas transiger avec la vérité ; il ne faut pas flatter les espérances chimériques, il ne faut pas céder aux préjugés populaires, et moins que jamais, quand ils se manifestent par l’insurrection. Mes actes et mes écrits sont là pour témoigner que, sous ce rapport, on n’a pas de reproche à me faire. Mais qu’on ne me demande pas non plus de m’abandonner à des mouvements de colère et de haine contre des frères malheureux et égarés, que leur ignorance expose trop souvent à de perfides suggestions. Le devoir d’une assemblée nationale, émanée du suffrage universel, est de les éclairer, de les ramener, d’écouter leurs vœux, de ne leur laisser aucun doute sur son ardente sympathie. Aimer, c’est toute la loi, a dit un grand apôtre. Nous sommes à une époque où cette maxime est aussi vraie en politique qu’en morale.
Je suis, chers compatriotes, votre dévoué
Maudit argent [avril 1849]↩
BWV
1849.04.15 "Maudit argent" (Damned Money) [April 1849] [*Journal des Économistes*, 15 Avril 1849, T. 23, no. 97, pp. 1-20] [Published as book or pamphlet: Bastiat, *L’État. Maudit argent!* (Paris: Guillaumin, 1849)] [OC5.4, pp. 64-93]
Maudit argent !
Publié dans le numéro d’avril 1849 du Journal des économistes. [1]
— Maudit argent ! maudit argent ! s’écriait d’un air désolé F* l’économiste, au sortir du Comité des finances où l’on venait de discuter un projet de papier-monnaie.
— Qu’avez-vous ? lui dis-je. D’où vient ce dégoût subit pour la plus encensée des divinités de ce monde ?
— Maudit argent ! maudit argent !
— Vous m’alarmez. Il n’est rien qu’une fois ou autre je n’aie entendu blasphémer, la paix, la liberté, la vie, et Brutus a été jusqu’à dire : Vertu ! tu n’es qu’un nom ! Mais si quelque chose a échappé jusqu’ici…
— Maudit argent ! maudit argent !
— Allons, un peu de philosophie. Que vous est-il arrivé ? Crésus vient-il de vous éclabousser ? Mondor vous a-t-il ravi l’amour de votre mie ? ou bien Zoïle a-t-il acheté contre vous une diatribe au gazetier ?
— Je n’envie pas le char de Crésus ; ma renommée, par son néant, échappe à la langue de Zoïle ; et quant à ma mie, jamais, jamais l’ombre même de la tâche la plus légère…
— Ah ! j’y suis. Où avais-je la tête ? Vous êtes, vous aussi, inventeur d’une réorganisation sociale, système F*. Votre société, vous la voulez plus parfaite que celle de Sparte, et pour cela toute monnaie doit en être sévèrement bannie. Ce qui vous embarrasse, c’est de décider vos adeptes à vider leur escarcelle. Que voulez-vous ? c’est l’écueil de tous les réorganisateurs. Il n’en est pas un qui ne fît merveille s’il parvenait à vaincre toutes les résistances, et si l’humanité tout entière consentait à devenir entre ses doigts cire molle ; mais elle s’entête à n’être pas cire molle. Elle écoute, applaudit ou dédaigne, et…. va comme devant.
— Grâce au Ciel, je résiste encore à cette manie du jour. Au lieu d’inventer des lois sociales, j’étudie celles qu’il a plu à Dieu d’inventer, ayant d’ailleurs le bonheur de les trouver admirables dans leur développement progressif. Et c’est pour cela que je répète : Maudit argent ! maudit argent !
— Vous êtes donc proudhonien ou proudhoniste ? Eh, morbleu ! vous avez un moyen simple de vous satisfaire. Jetez votre bourse dans la Seine, ne vous réservant que cent sous pour prendre une action de la Banque d’échange.
— Puisque je maudis l’argent, jugez si j’en dois maudire le signe trompeur !
— Alors, il ne me reste plus qu’une hypothèse. Vous êtes un nouveau Diogène, et vous allez m’affadir d’une tirade à la Sénèque, sur le mépris des richesses.
— Le Ciel m’en préserve ! Car la richesse, voyez-vous, ce n’est pas un peu plus ou un peu moins d’argent. C’est du pain pour ceux qui ont faim, des vêtements pour ceux qui sont nus, du bois qui réchauffe, de l’huile qui allonge le jour, une carrière ouverte à votre fils, une dot assurée à votre fille, un jour de repos pour la fatigue, un cordial pour la défaillance, un secours glissé dans la main du pauvre honteux, un toit contre l’orage, des ailes aux amis qui se rapprochent, une diversion pour la tête que la pensée fait plier, l’incomparable joie de rendre heureux ceux qui nous sont chers. La richesse, c’est l’instruction, l’indépendance, la dignité, la confiance, la charité, tout ce que le développement de nos facultés peut livrer aux besoins du corps et de l’esprit ; c’est le progrès, c’est la civilisation. La richesse, c’est l’admirable résultat civilisateur de deux admirables agents, plus civilisateurs encore qu’elle-même : le travail et l’échange [2].
— Bon ! n’allez-vous pas maintenant entonner un dithyrambe à la richesse, quand, il n’y a qu’un instant, vous accabliez l’or de vos imprécations ?
— Eh ! ne comprenez-vous pas que c’était tout simplement une boutade d’économiste ! Je maudis l’argent précisément parce qu’on le confond, comme vous venez de faire, avec la richesse, et que de cette confusion sortent des erreurs et des calamités sans nombre. Je le maudis, parce que sa fonction dans la société est mal comprise et très-difficile à faire comprendre. Je le maudis, parce qu’il brouille toutes les idées, fait prendre le moyen pour le but, l’obstacle pour la cause, alpha pour oméga ; parce que sa présence dans le monde, bienfaisante par elle-même, y a cependant introduit une notion funeste, une pétition de principes, une théorie à rebours, qui, dans ses formes multiples, a appauvri les hommes et ensanglanté la terre. Je le maudis, parce que je me sens incapable de lutter contre l’erreur à laquelle il a donné naissance autrement que par une longue et fastidieuse dissertation que personne n’écoutera. Ah ! si je tenais au moins sous ma main un auditeur patient et bénévole !
— Morbleu ! il ne sera pas dit que faute d’une victime vous resterez dans l’état d’irritation où je vous vois. J’écoute ; parlez, dissertez, ne vous gênez en aucune façon.
— Vous me promettez de prendre intérêt…
— Je vous promets de prendre patience.
— C’est bien peu.
— C’est tout ce dont je puis disposer. Commencez, et expliquez-moi d’abord comment une méprise sur le numéraire, si méprise il y a, se trouve au fond de toutes les erreurs économiques.
— Là, franchement, la main sur la conscience, ne vous est-il jamais arrivé de confondre la richesse avec l’argent ?
— Je ne sais ; je ne me suis jamais morfondu sur l’économie politique. Mais, après tout, qu’en résulterait-il ?
— Pas grand’chose. Une erreur dans votre cervelle sans influence sur vos actes ; car, voyez-vous, en matière de travail et d’échange, quoiqu’il y ait autant d’opinions que de têtes, nous agissons tous de la même manière.
— À peu près comme nous marchons d’après les mêmes principes, encore que nous ne soyons pas d’accord sur la théorie de l’équilibre et de la gravitation.
— Justement. Quelqu’un qui serait conduit par ses inductions à croire que, pendant la nuit, nous avons la tête en bas et les pieds en haut, pourrait faire là-dessus de beaux livres, mais il se tiendrait comme tout le monde.
— Je le crois bien. Sinon, il serait vite puni d’être trop bon logicien.
— De même, cet homme mourrait bientôt de faim qui, s’étant persuadé que l’argent est la richesse réelle, serait conséquent jusqu’au bout. Voilà pourquoi cette théorie est fausse, car il n’y a de théorie vraie que celle qui résulte des faits mêmes, tels qu’ils se manifestent en tous temps ou en tous lieux.
— Je comprends que, dans la pratique et sous l’influence de l’intérêt personnel, la conséquence funeste de l’acte erroné tend incessamment à redresser l’erreur. Mais si celle dont vous parlez a si peu d’influence, pourquoi vous donne-t-elle tant d’humeur ?
— C’est que, quand un homme, au lieu d’agir pour lui-même, décide pour autrui, l’intérêt personnel, cette sentinelle si vigilante et si sensible, n’est plus là pour crier : Aïe ! La responsabilité est déplacée. C’est Pierre qui se trompe, et c’est Jean qui souffre ; le faux système du législateur devient forcément la règle d’action de populations entières. Et voyez la différence. Quand vous avez de l’argent et grand’faim, quelle que soit votre théorie du numéraire, que faites-vous ?
— J’entre chez un boulanger et j’achète du pain.
— Vous n’hésitez pas à vous défaire de votre argent ?
— Je ne l’ai que pour cela.
— Et si, à son tour, ce boulanger a soif, que fait-il ?
— Il va chez le marchand de vin et boit un canon avec l’argent que je lui ai donné.
— Quoi ! il ne craint pas de se ruiner ?
— La véritable ruine serait de ne manger ni boire.
— Et tous les hommes qui sont sur la terre, s’ils sont libres, agissent de même ?
— Sans aucun doute. Voulez-vous qu’ils meurent de faim pour entasser des sous ?
— Loin de là, je trouve qu’ils agissent sagement, et je voudrais que la théorie ne fût autre chose que la fidèle image de cette universelle pratique. Mais supposons maintenant que vous êtes le législateur, le roi absolu d’un vaste empire où il n’y a pas de mines d’or.
— La fiction me plaît assez.
— Supposons encore que vous êtes parfaitement convaincu de ceci : La richesse consiste uniquement et exclusivement dans le numéraire ; qu’en concluriez-vous ?
— J’en conclurais qu’il n’y a pas d’autre moyen pour moi d’enrichir mon peuple, ou pour lui de s’enrichir lui-même, que de soutirer le numéraire des autres peuples.
— C’est-à-dire de les appauvrir. La première conséquence à laquelle vous arriveriez serait donc celle-ci : Une nation ne peut gagner que ce qu’une autre perd.
— Cet axiome a pour lui l’autorité de Bacon et de Montaigne.
— Il n’en est pas moins triste, car enfin il revient à dire : Le progrès est impossible. Deux peuples, pas plus que deux hommes, ne peuvent prospérer côte à côte.
— Il semble bien que cela résulte du principe.
— Et comme tous les hommes aspirent à s’enrichir, il faut dire que tous aspirent, en vertu d’une loi providentielle, à ruiner leurs semblables.
— Ce n’est pas du christianisme, mais c’est de l’économie politique.
— Détestable. Mais poursuivons. Je vous ai fait roi absolu. Ce n’est pas pour raisonner, mais pour agir. Rien ne limite votre puissance. Qu’allez-vous faire en vertu de cette doctrine : la richesse, c’est l’argent ?
— Mes vues se porteront à accroître sans cesse, au sein de mon peuple, la masse du numéraire.
— Mais il n’y a pas de mines dans votre royaume. Comment vous y prendrez-vous ? Qu’ordonnerez-vous ?
— Je n’ordonnerai rien ; je défendrai. Je défendrai, sous peine de mort, de faire sortir un écu du pays.
— Et si votre peuple, ayant de l’argent, a faim aussi ?
— N’importe. Dans le système où nous raisonnons, lui permettre d’exporter des écus, ce serait lui permettre de s’appauvrir.
— En sorte que, de votre aveu, vous le forceriez à se conduire sur un principe opposé à celui qui vous guide vous-même dans des circonstances semblables. Pourquoi cela ?
— C’est sans doute parce que ma propre faim me pique, et que la faim des peuples ne pique pas les législateurs.
— Eh bien ! je puis vous dire que votre plan échouerait, et qu’il n’y a pas de surveillance assez vigilante pour empêcher, quand le peuple a faim, les écus de sortir, si le blé a la liberté d’entrer.
— En ce cas, ce plan, erroné ou non, est inefficace pour le bien comme pour le mal, et nous n’avons plus à nous en occuper.
— Vous oubliez que vous êtes législateur. Est-ce qu’un législateur se rebute pour si peu, quand il fait ses expériences sur autrui ? Le premier décret ayant échoué, ne chercheriez-vous pas un autre moyen d’atteindre votre but ?
— Quel but ?
— Vous avez la mémoire courte ; celui d’accroître, au sein de votre peuple, la masse du numéraire supposé être la seule et vraie richesse.
— Ah ! vous m’y remettez ; pardon. Mais c’est que, voyez-vous, on a dit de la musique : Pas trop n’en faut ; je crois que c’est encore plus vrai de l’économie politique. M’y revoilà. Mais je ne sais vraiment qu’imaginer…
— Cherchez bien. D’abord, je vous ferai remarquer que votre premier décret ne résolvait le problème que négativement. Empêcher les écus de sortir, c’est bien empêcher la richesse de diminuer, mais ce n’est pas l’accroître.
— Ah ! je suis sur la voie… ce blé libre d’entrer… Il me vient une idée lumineuse… Oui, le détour est ingénieux, le moyen infaillible, je touche au but.
— À mon tour, je vous demanderai : quel but ?
— Eh ! morbleu, d’accroître la masse du numéraire.
— Comment vous y prendrez-vous, s’il vous plaît ?
— N’est-il pas vrai que pour que la pile d’argent s’élève toujours, la première condition est qu’on ne l’entame jamais ?
— Bien.
— Et la seconde qu’on y ajoute toujours ?
— Très-bien.
— Donc le problème sera résolu, en négatif et positif, comme disent les socialistes, si d’un côté j’empêche l’étranger d’y puiser, et si, de l’autre, je le force à y verser.
— De mieux en mieux.
— Et pour cela deux simples décrets où le numéraire ne sera pas même mentionné. Par l’un, il sera défendu à mes sujets de rien acheter au dehors ; par l’autre, il leur sera ordonné d’y beaucoup vendre.
— C’est un plan fort bien conçu.
— Est-il nouveau ? Je vais aller me pourvoir d’un brevet d’invention.
— Ne vous donnez pas cette peine ; la priorité vous serait contestée. Mais prenez garde à une chose.
— Laquelle ?
— Je vous ai fait roi tout-puissant. Je comprends que vous empêcherez vos sujets d’acheter des produits étrangers. Il suffira d’en prohiber l’entrée. Trente ou quarante mille douaniers feront l’affaire.
— C’est un peu cher. Qu’importe ? L’argent qu’on leur donne ne sort pas du pays.
— Sans doute ; et dans notre système, c’est l’essentiel. Mais pour forcer la vente au dehors, comment procéderez-vous ?
— Je l’encouragerai par des primes, au moyen de quelques bons impôts frappés sur mon peuple.
— En ce cas, les exportateurs, contraints par leur propre rivalité, baisseront leurs prix d’autant, et c’est comme si vous faisiez cadeau à l’étranger de ces primes ou de ces impôts.
— Toujours est-il que l’argent ne sortira pas du pays.
— C’est juste. Cela répond à tout ; mais si votre système est si avantageux, les rois vos voisins l’adopteront. Ils reproduiront vos décrets ; ils auront des douaniers et repousseront vos produits, afin que chez eux non plus la pile d’argent ne diminue pas.
— J’aurai une armée et je forcerai leurs barrières.
— Ils auront une armée et forceront les vôtres.
— J’armerai des navires, je ferai des conquêtes, j’acquerrai des colonies, et créerai à mon peuple des consommateurs qui seront bien obligés de manger notre blé et boire notre vin [3].
— Les autres rois en feront autant. Ils vous disputeront vos conquêtes, vos colonies et vos consommateurs. Voilà la guerre partout et le monde en feu.
— J’augmenterai mes impôts, mes douaniers, ma marine et mon armée.
— Les autres vous imiteront.
— Je redoublerai d’efforts.
— Ils feront de même. En attendant, rien ne prouve que vous aurez réussi à beaucoup vendre.
— Il n’est que trop vrai. Bienheureux si les efforts commerciaux se neutralisent.
— Ainsi que les efforts militaires. Et dites-moi, ces douaniers, ces soldats, ces vaisseaux, ces contributions écrasantes, cette tension perpétuelle vers un résultat impossible, cet état permanent de guerre ouverte ou secrète avec le monde entier, ne sont-ils pas la conséquence logique, nécessaire de ce que le législateur s’est coiffé de cette idée (qui n’est, vous en êtes convenu, à l’usage d’aucun homme agissant pour lui-même) : « La richesse, c’est le numéraire ; accroître le numéraire, c’est accroître la richesse ? »
— J’en conviens. Ou l’axiome est vrai, et alors le législateur doit agir dans le sens que j’ai dit, bien que ce soit la guerre universelle. Ou il est faux et, en ce cas, c’est pour se ruiner que les hommes se déchirent.
— Et souvenez-vous qu’avant d’être roi, ce même axiome vous avait conduit par la logique à ces maximes : « Ce que l’un gagne, l’autre le perd. Le profit de l’un est le dommage de l’autre ; » lesquelles impliquent un antagonisme irrémédiable entre tous les hommes.
— Il n’est que trop certain. Philosophe ou législateur, soit que je raisonne ou que j’agisse, partant de ce principe : l’argent, c’est la richesse, — j’arrive toujours à cette conclusion ou à ce résultat : la guerre universelle. Avant de le discuter, vous avez bien fait de m’en signaler les conséquences ; sans cela, je n’aurais jamais eu le courage de vous suivre jusqu’au bout dans votre dissertation économique ; car, à vous parler net, cela n’est pas divertissant.
— À qui le dites-vous ? C’est à quoi je pensais quand vous m’entendiez murmurer : Maudit argent ! Je gémissais de ce que mes compatriotes n’ont pas le courage d’étudier ce qu’il leur importe tant de savoir.
— Et pourtant, les conséquences sont effrayantes.
— Les conséquences ! Je ne vous en ai signalé qu’une. J’aurais pu vous en montrer de plus funestes encore.
— Vous me faites dresser les cheveux sur la tête ! Quels autres maux a pu infliger à l’humanité cette confusion entre l’Argent et la Richesse ?
— Il me faudra longtemps pour les énumérer. C’est une doctrine qui a une nombreuse lignée. Son fils aîné, nous venons de faire sa connaissance, s’appelle régime prohibitif ; le cadet, système colonial ; le troisième, haine au capital ; le Benjamin, papier-monnaie.
— Quoi ! le papier-monnaie procède de la même erreur ?
— Directement. Quand les législateurs, après avoir ruiné les hommes par la guerre et l’impôt, persévèrent dans leur idée, ils se disent : « Si le peuple souffre, c’est qu’il n’a pas assez d’argent. Il en faut faire. » Et comme il n’est pas aisé de multiplier les métaux précieux, surtout quand on a épuisé les prétendues ressources de la prohibition, « nous ferons du numéraire fictif, ajoutent-ils, rien n’est plus aisé, et chaque citoyen en aura plein son portefeuille ! ils seront tous riches. »
— En effet, ce procédé est plus expéditif que l’autre, et puis il n’aboutit pas à la guerre étrangère.
— Non, mais à la guerre civile.
— Vous êtes bien pessimiste. Hâtez-vous donc de traiter la question au fond. Je suis tout surpris de désirer, pour la première fois, savoir si l’argent (ou son signe) est la richesse.
— Vous m’accorderez bien que les hommes ne satisfont immédiatement aucun de leurs besoins avec des écus. S’ils ont faim, c’est du pain qu’il leur faut ; s’ils sont nus, des vêtements ; s’ils sont malades, des remèdes ; s’ils ont froid, un abri, du combustible ; s’ils aspirent à apprendre, des livres ; s’ils désirent se déplacer, des véhicules, et ainsi de suite. La richesse d’un pays se reconnaît à l’abondance et à la bonne distribution de toutes ces choses.
Par où vous devez reconnaître avec bonheur combien est fausse cette triste maxime de Bacon : Ce qu’un peuple gagne, l’autre le perd nécessairement ; maxime exprimée d’une manière plus désolante encore par Montaigne, en ces termes : Le profit de l’un est le dommage de l’autre. Lorsque Sem, Cham et Japhet se partagèrent les vastes solitudes de cette terre, assurément chacun d’eux put bâtir, dessécher, semer, récolter, se mieux loger, se mieux nourrir, se mieux vêtir, se mieux instruire, se perfectionner, s’enrichir, en un mot, et accroître ses jouissances, sans qu’il en résultât une dépression nécessaire dans les jouissances analogues de ses frères. Il en est de même de deux peuples.
— Sans doute, deux peuples, comme deux hommes, sans relations entre eux, peuvent, en travaillant plus, en travaillant mieux, prospérer côte à côte sans se nuire. Ce n’est pas là ce qui est nié par les axiomes de Montaigne et de Bacon. Ils signifient seulement que, dans le commerce qui se fait entre deux peuples ou deux hommes, si l’un gagne, il faut que l’autre perde. Et cela est évident de soi ; l’échange n’ajoutant rien par lui-même à la masse de ces choses utiles dont vous parliez, si après l’échange une des parties se trouve en avoir plus, il faut bien que l’autre partie se trouve en avoir moins.
— Vous vous faites de l’échange une idée bien incomplète, incomplète au point d’en devenir fausse. Si Sem est sur une plaine fertile en blé, Japhet sur un coteau propre à produire du vin, Cham sur de gras pâturages, il se peut que la séparation des occupations, loin de nuire à l’un d’eux, les fasse prospérer tous les trois. Cela doit même arriver, car la distribution du travail, introduite par l’échange, aura pour effet d’accroître la masse du blé, du vin et de la viande à partager. Comment en serait-il autrement, si vous admettez la liberté de ces transactions ? Dès l’instant que l’un des trois frères s’apercevrait que le travail, pour ainsi dire sociétaire, le constitue en perte permanente, comparativement au travail solitaire, il renoncerait à échanger. L’échange porte avec lui-même son titre à notre reconnaissance. Il s’accomplit, donc il est bon [4].
— Mais l’axiome de Bacon est vrai quand il s’agit d’or et d’argent. Si l’on admet qu’à un moment déterminé il en existe dans le monde une quantité donnée, il est bien clair qu’une bourse ne se peut emplir qu’une autre bourse ne se vide.
— Et si l’on professe que l’or est la richesse, la conclusion est qu’il y a parmi les hommes des déplacements de fortune et jamais de progrès général. C’est justement ce que je disais en commençant. Que si, au contraire, vous voyez la vraie richesse dans l’abondance des choses utiles propres à satisfaire nos besoins et nos goûts, vous comprendrez comme possible la prospérité simultanée. Le numéraire ne sert qu’à faciliter la transmission d’une main à l’autre de ces choses utiles, ce qui s’accomplit aussi bien avec une once de métal rare, comme l’or, qu’avec une livre de métal plus abondant, comme l’argent, ou avec un demi-quintal de métal plus abondant encore, comme le cuivre. D’après cela, s’il y avait à la disposition de tous les Français une fois plus de toutes ces choses utiles, la France serait le double plus riche, bien que la quantité de numéraire restât la même ; mais il n’en serait pas ainsi s’il y avait le double de numéraire, la masse des choses utiles n’augmentant pas.
— La question est de savoir si la présence d’un plus grand nombre d’écus n’a pas précisément pour effet d’augmenter la masse des choses utiles.
— Quel rapport peut-il y avoir entre ces deux termes ? Les aliments, les vêtements, les maisons, le combustible, tout cela vient de la nature et du travail, d’un travail plus ou moins habile s’exerçant sur une nature plus ou moins libérale.
— Vous oubliez une grande force, qui est l’échange. Si vous avouez que c’est une force, comme vous êtes convenu que les écus le facilitent, vous devez convenir qu’ils ont une puissance indirecte de production.
— Mais j’ai ajouté qu’un peu de métal rare facilite autant de transactions que beaucoup de métal abondant, d’où il suit qu’on n’enrichit pas un peuple en le forçant de donner des choses utiles pour avoir plus d’argent.
— Ainsi, selon vous, les trésors qu’on trouve en Californie n’accroîtront pas la richesse du monde ?
— Je ne crois pas qu’ils ajoutent beaucoup aux jouissances, aux satisfactions réelles de l’humanité prise dans son ensemble. Si l’or de la Californie ne fait que remplacer dans le monde celui qui se perd et se détruit, cela peut avoir son utilité. S’il en augmente la masse, il la dépréciera. Les chercheurs d’or seront plus riches qu’ils n’eussent été sans cela. Mais ceux entre les mains de qui se trouvera l’or actuel au moment de la dépréciation, se procureront moins de satisfactions à somme égale. Je ne puis voir là un accroissement, mais un déplacement de la vraie richesse, telle que je l’ai définie.
— Tout cela est fort subtil. Mais vous aurez bien de la peine à me faire comprendre que je ne suis pas plus riche, toutes choses égales d’ailleurs, si j’ai deux écus, que si je n’en ai qu’un.
— Aussi n’est-ce pas ce que je dis.
— Et ce qui est vrai de moi l’est de mon voisin, et du voisin de mon voisin, et ainsi de suite, de proche en proche, en faisant le tour du pays. Donc, si chaque Français a plus d’écus, la France est plus riche.
— Et voilà votre erreur, l’erreur commune, consistant à conclure de un à tous et du particulier au général.
— Quoi ! n’est-ce pas de toutes les conclusions la plus concluante ? Ce qui est vrai de chacun ne l’est-il pas de tous ? Qu’est-ce que tous, sinon les chacuns nommés en une seule fois ? Autant vaudrait me dire que chaque Français pourrait tout à coup grandir d’un pouce, sans que la taille moyenne de tous les Français fût plus élevée.
— Le raisonnement est spécieux, j’en conviens, et voilà justement pourquoi l’illusion qu’il recèle est si commune. Examinons pourtant.
Dix joueurs se réunissaient dans un salon. Pour plus de facilité, ils avaient coutume de prendre chacun dix jetons contre lesquels ils déposaient cent francs sous le chandelier, de manière à ce que chaque jeton correspondît à dix francs. Après la partie on réglait les comptes, et les joueurs retiraient du chandelier autant de fois dix francs qu’ils pouvaient représenter de jetons. Ce que voyant, l’un d’eux, grand arithméticien peut-être, mais pauvre raisonneur, dit : Messieurs, une expérience invariable m’apprend qu’à la fin de la partie je me trouve d’autant plus riche que j’ai plus de jetons. N’avez-vous pas fait la même observation sur vous-mêmes ? Ainsi ce qui est vrai de moi est successivement vrai de chacun de vous, et ce qui est vrai de chacun l’est de tous. Donc nous serions tous plus riches, en fin de jeu, si tous nous avions plus de jetons. Or, rien n’est plus aisé ; il suffit d’en distribuer le double. C’est ce qui fut fait. Mais quand, la partie terminée, on en vint au règlement, on s’aperçut que les mille francs du chandelier ne s’étaient pas miraculeusement multipliés, suivant l’attente générale. Il fallut les partager, comme on dit, au prorata, et le seul résultat (bien chimérique !) obtenu, fut celui-ci : chacun avait bien le double de jetons, mais chaque jeton, au lieu de correspondre à dix francs, n’en représentait plus que cinq. Il fut alors parfaitement constaté que ce qui est vrai de chacun ne l’est pas toujours de tous.
— Je le crois bien : vous supposez un accroissement général de jetons, sans un accroissement correspondant de la mise sous le chandelier.
— Et vous, vous supposez un accroissement général d’écus sans un accroissement correspondant des choses dont ces écus facilitent l’échange.
— Est-ce que vous assimilez les écus à des jetons ?
— Non certes, à d’autres égards ; oui, au point de vue du raisonnement que vous m’opposiez et que j’avais à combattre. Remarquez une chose. Pour qu’il y ait accroissement général d’écus dans un pays, il faut, ou que ce pays ait des mines, ou que son commerce se fasse de telle façon qu’il donne des choses utiles pour recevoir du numéraire. Hors de ces deux hypothèses, un accroissement universel est impossible, les écus ne faisant que changer de mains, et, dans ce cas, encore qu’il soit bien vrai que chacun pris individuellement soit d’autant plus riche qu’il a plus d’écus, on n’en peut pas déduire la généralisation que vous faisiez tout à l’heure, puisqu’un écu de plus dans une bourse implique de toute nécessité un écu de moins dans une autre. C’est comme dans votre comparaison avec la taille moyenne. Si chacun de nous ne grandissait qu’aux dépens d’autrui, il serait bien vrai de chacun pris individuellement qu’il sera plus bel homme, s’il a la bonne chance, mais cela ne sera jamais vrai de tous pris collectivement.
— Soit. Mais dans les deux hypothèses que vous avez signalées, l’accroissement est réel, et vous conviendrez que j’ai raison.
— Jusqu’à un certain point.
L’or et l’argent ont une valeur. Pour en obtenir, les hommes consentent à donner des choses utiles qui ont une valeur aussi. Lors donc qu’il y a des mines dans un pays, si ce pays en extrait assez d’or pour acheter au dehors une chose utile, par exemple, une locomotive, il s’enrichit de toutes les jouissances que peut procurer une locomotive, exactement comme s’il l’avait faite. La question pour lui est de savoir s’il dépense plus d’efforts dans le premier procédé que dans le second. Que s’il n’exportait pas cet or, il se déprécierait et il arriverait quelque chose de pis que ce que vous voyez en Californie, car là du moins on se sert des métaux précieux pour acheter des choses utiles faites ailleurs. Malgré cela, on y court risque de mourir de faim sur des monceaux d’or. Que serait-ce, si la loi en défendait l’exportation ?
Quant à la seconde hypothèse, celle de l’or qui nous arrive par le commerce, c’est un avantage ou un inconvénient, selon que le pays en a plus ou moins besoin, comparativement au besoin qu’il a aussi des choses utiles dont il faut se défaire pour l’acquérir. C’est aux intéressés à en juger, et non à la loi ; car si la loi part de ce principe, que l’or est préférable aux choses utiles, n’importe la valeur, et si elle parvient à agir efficacement dans ce sens, elle tend à faire de la France une Californie retournée, où il y aura beaucoup de numéraire pour acheter, et rien à acheter. C’est toujours le système dont Midas est le symbole.
— L’or qui entre implique une chose utile qui sort, j’en conviens, et, sous ce rapport, il y a une satisfaction soustraite au pays. Mais n’est-elle pas remplacée avec avantage ? et de combien de satisfactions nouvelles cet or ne sera-t-il pas la source, en circulant de main en main, en provoquant le travail et l’industrie, jusqu’à ce qu’enfin il sorte à son tour, et implique l’entrée d’une chose utile ?
— Vous voilà au cœur de la question. Est-il vrai qu’un écu soit le principe qui fait produire tous les objets dont il facilite l’échange ? On convient bien qu’un écu de cinq francs ne vaut que cinq francs ; mais on est porté à croire que cette valeur a un caractère particulier ; qu’elle ne se détruit pas comme les autres, ou ne se détruit que très à la longue ; qu’elle se renouvelle, pour ainsi dire, à chaque transmission ; et qu’en définitive cet écu a valu autant de fois cinq francs qu’il a fait accomplir de transactions, qu’il vaut à lui seul autant que toutes les choses contre lesquelles il s’est successivement échangé ; et on croit cela, parce qu’on suppose que, sans cet écu, ces choses ne se seraient pas même produites. On dit : Sans lui, le cordonnier aurait vendu une paire de souliers de moins ; par conséquent, il aurait acheté moins de boucherie ; le boucher aurait été moins souvent chez l’épicier, l’épicier chez le médecin, le médecin chez l’avocat, et ainsi de suite.
— Cela me paraît incontestable.
— C’est bien le moment d’analyser la vraie fonction du numéraire, abstraction faite des mines et de l’importation.
Vous avez un écu. Que signifie-t-il en vos mains ? Il y est comme le témoin et la preuve que vous avez, à une époque quelconque, exécuté un travail, dont, au lieu de profiter, vous avez fait jouir la société, en la personne de votre client. Cet écu témoigne que vous avez rendu un service à la société, et, de plus, il en constate la valeur. Il témoigne, en outre, que vous n’avez pas encore retiré de la société un service réel équivalent, comme c’était votre droit. Pour vous mettre à même de l’exercer, quand et comme il vous plaira, la société, par les mains de votre client, vous a donné une reconnaissance, un titre, un bon de la République, un jeton, un écu enfin, qui ne diffère des titres fiduciaires qu’en ce qu’il porte sa valeur en lui-même, et si vous savez lire, avec les yeux de l’esprit, les inscriptions dont il est chargé, vous déchiffrerez distinctement ces mots : « Rendez au porteur un service équivalent à celui qu’il a rendu à la société, valeur reçue constatée, prouvée et mesurée par celle qui est en moi-même [5]. »
Maintenant, vous me cédez votre écu. Ou c’est à titre gratuit, ou c’est à titre onéreux. Si vous me le donnez comme prix d’un service, voici ce qui en résulte : votre compte de satisfactions réelles avec la société se trouve réglé, balancé et fermé. Vous lui aviez rendu un service contre un écu, vous lui restituez maintenant l’écu contre un service ; partant quitte quant à vous. Pour moi je suis justement dans la position où vous étiez tout à l’heure. C’est moi qui maintenant suis en avance envers la société du service que je viens de lui rendre en votre personne. C’est moi qui deviens son créancier de la valeur du travail que je vous ai livré, et que je pouvais me consacrer à moi-même. C’est donc entre mes mains que doit passer le titre de cette créance, le témoin et la preuve de la dette sociale. Vous ne pouvez pas dire que je suis plus riche, car si j’ai à recevoir, c’est parce que j’ai donné. Vous ne pouvez pas dire surtout que la société est plus riche d’un écu, parce qu’un de ses membres a un écu de plus, puisqu’un autre l’a de moins.
Que si vous me cédez cet écu gratuitement, en ce cas, il est certain que j’en serai d’autant plus riche, mais vous en serez d’autant plus pauvre, et la fortune sociale, prise en masse, ne sera pas changée ; car cette fortune, je l’ai déjà dit, consiste en services réels, en satisfactions effectives, en choses utiles. Vous étiez créancier de la société, vous m’avez substitué à vos droits, et il importe peu à la société, qui est redevable d’un service, de le rendre à vous ou à moi. Elle s’acquitte en le rendant au porteur du titre.
— Mais si nous avions tous beaucoup d’écus, nous retirerions tous de la société beaucoup de services. Cela ne serait-il pas bien agréable ?
— Vous oubliez que dans l’ordre que je viens de décrire, et qui est l’image de la réalité, on ne retire du milieu social des services que parce qu’on y en a versé. Qui dit service, dit à la fois service reçu et rendu, car ces deux termes s’impliquent, en sorte qu’il doit toujours y avoir balance. Vous ne pouvez songer à ce que la société rende plus de services qu’elle n’en reçoit, et c’est pourtant là la chimère qu’on poursuit au moyen de la multiplication des écus, de l’altération des monnaies, du papier-monnaie, etc.
— Tout cela paraît assez raisonnable en théorie, mais, dans la pratique, je ne puis me tirer de la tête, quand je vois comment les choses se passent, que si, par un heureux miracle, le nombre des écus venait à se multiplier, de telle sorte que chacun de nous en vît doubler sa petite provision, nous serions tous plus à l’aise ; nous ferions tous plus d’achats, et l’industrie en recevrait un puissant encouragement.
— Plus d’achats ! Mais acheter quoi ? Sans doute des objets utiles, des choses propres à procurer des satisfactions efficaces, des vivres des étoffes, des maisons, des livres, des tableaux. Vous devriez donc commencer par prouver que toutes ces choses s’engendrent d’elles-mêmes, par cela seul qu’on fond à l’hôtel des Monnaies des lingots tombés de la lune, ou qu’on met en mouvement à l’Imprimerie nationale la planche aux assignats ; car vous ne pouvez raisonnablement penser que si la quantité de blé, de draps, de navires, de chapeaux, de souliers reste la même, la part de chacun puisse être plus grande, parce que nous nous présenterons tous sur le marché avec une plus grande quantité de francs métalliques ou fictifs. Rappelez-vous nos joueurs. Dans l’ordre social, les choses utiles sont ce que les travailleurs eux-mêmes mettent sous le chandelier, et les écus qui circulent de main en main, ce sont les jetons. Si vous multipliez les francs, sans multiplier les choses utiles, il en résultera seulement qu’il faudra plus de francs pour chaque échange, comme il fallut aux joueurs plus de jetons pour chaque mise. Vous en avez la preuve dans ce qui se passe pour l’or, l’argent et le cuivre. Pourquoi le même troc exige-t-il plus de cuivre que d’argent, plus d’argent que d’or ? N’est-ce pas parce que ces métaux sont répandus dans le monde en proportions diverses ? Quelle raison avez-vous de croire que si l’or devenait tout à coup aussi abondant que l’argent, il ne faudrait pas autant de l’un que de l’autre pour acheter une maison ?
— Vous pouvez avoir raison, mais je désire que vous ayez tort. Au milieu des souffrances qui nous environnent, si cruelles en elles-mêmes, si dangereuses par leurs conséquences, je trouvais quelque consolation à penser qu’il y avait un moyen facile de rendre heureux tous les membres de la société.
— L’or et l’argent fussent-ils la richesse, il n’est déjà pas si facile d’en augmenter la masse dans un pays privé de mines.
— Non, mais il est aisé d’y substituer autre chose. Je suis d’accord avec vous que l’or et l’argent ne rendent guère de services que comme instruments d’échanges. Autant en fait le papier-monnaie, le billet de banque, etc. Si donc nous avions tous beaucoup de cette monnaie-là, si facile à créer, nous pourrions tous beaucoup acheter, nous ne manquerions de rien. Votre cruelle théorie dissipe des espérances, des illusions, si vous voulez, dont le principe est assurément bien philanthropique.
— Oui, comme tous les vœux stériles que l’on peut former pour la félicité universelle. L’extrême facilité du moyen que vous invoquez suffit pour en démontrer l’inanité. Croyez-vous que s’il suffisait d’imprimer des billets de banque pour que nous pussions tous satisfaire nos besoins, nos goûts, nos désirs, l’humanité serait arrivée jusqu’ici sans recourir à ce moyen ? Je conviens avec vous que la découverte est séduisante. Elle bannirait immédiatement du monde, non-seulement la spoliation sous ses formes si déplorables, mais le travail lui-même, sauf celui de la planche aux assignats. Reste à comprendre comment les assignats achèteraient des maisons que nul n’aurait bâties, du blé que nul n’aurait cultivé, des étoffes que nul n’aurait pris la peine de tisser [6].
— Une chose me frappe dans votre argumentation. D’après vous-même, s’il n’y a pas gain, il n’y a pas perte non plus à multiplier l’instrument de l’échange, ainsi qu’on le voit par l’exemple de vos joueurs, qui en furent quittes pour une déception fort bénigne. Alors pourquoi repousser la pierre philosophale, qui nous apprendrait enfin le secret de changer les cailloux en or, et, en attendant, le papier-monnaie ? Êtes-vous si entêté de votre logique, que vous refusiez une expérience sans risques ? Si vous vous trompez, vous privez la nation, au dire de vos nombreux adversaires, d’un bienfait immense. Si l’erreur est de leur côté, il ne s’agit pour le peuple, d’après vous-même, que d’une espérance déçue. La mesure, excellente selon eux, est neutre selon vous. Laissez donc essayer, puisque le pis qui puisse arriver, ce n’est pas la réalisation d’un mal, mais la non-réalisation d’un bien.
— D’abord, c’est déjà un grand mal, pour un peuple, qu’une espérance déçue. C’en est un autre que le gouvernement annonce la remise de plusieurs impôts sur la foi d’une ressource qui doit infailliblement s’évanouir. Néanmoins votre remarque aurait de la force, si, après l’émission du papier-monnaie et sa dépréciation, l’équilibre des valeurs se faisait instantanément, avec une parfaite simultanéité, en toutes choses et sur tous les points du territoire. La mesure aboutirait, ainsi que dans mon salon de jeu, à une mystification universelle, dont le mieux serait de rire en nous regardant les uns les autres. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se passent. L’expérience en a été faite, et chaque fois que les despotes ont altéré la monnaie…
— Qui propose d’altérer les monnaies ?
— Eh, mon Dieu ! forcer les gens à prendre en paiement des chiffons de papier qu’on a officiellement baptisés francs, ou les forcer de recevoir comme pesant cinq grammes une pièce d’argent qui n’en pèse que deux et demi, mais qu’on a officiellement appelée franc, c’est tout un, si ce n’est pis ; et tous les raisonnements qu’on peut faire en faveur des assignats ont été faits en faveur de la fausse monnaie légale. Certes, en se plaçant au point de vue où vous étiez tout à l’heure, et où vous paraissez être encore, lorsqu’on croyait que multiplier l’instrument des échanges c’était multiplier les échanges eux-mêmes, ainsi que les choses échangées, on devait penser de très-bonne foi que le moyen le plus simple était de dédoubler les écus et de donner législativement aux moitiés la dénomination et la valeur du tout. Eh bien ! dans un cas comme dans l’autre, la dépréciation est infaillible. Je crois vous en avoir dit la cause. Ce qu’il me reste à vous démontrer, c’est que cette dépréciation, qui, pour le papier, peut aller jusqu’à zéro, s’opère en faisant successivement des dupes parmi lesquelles les pauvres, les gens simples, les ouvriers, les campagnards occupent le premier rang.
— J’écoute ; mais abrégez. La dose d’Économie politique est un peu forte pour une fois.
— Soit. Nous sommes donc bien fixés sur ce point, que la richesse c’est l’ensemble des choses utiles que nous produisons par le travail, ou mieux encore, les résultats de tous les efforts que nous faisons pour la satisfaction de nos besoins et de nos goûts. Ces choses utiles s’échangent les unes contre les autres, selon les convenances de ceux à qui elles appartiennent. Il y a deux formes à ces transactions : l’une s’appelle troc ; c’est celle où l’on rend un service pour recevoir immédiatement un service équivalent. Sous cette forme, les transactions seraient extrêmement limitées. Pour qu’elles pussent se multiplier, s’accomplir à travers le temps et l’espace, entre personnes inconnues et par fractions infinies, il a fallu l’intervention d’un agent intermédiaire : c’est la monnaie. Elle donne lieu à l’échange, qui n’est autre chose qu’un troc complexe. C’est là ce qu’il faut remarquer et comprendre. L’échange se décompose en deux trocs, en deux facteurs, la vente et l’achat, dont la réunion est nécessaire pour le constituer. Vous vendez un service contre un écu, puis, avec cet écu, vous achetez un service. Ce n’est qu’alors que le troc est complet ; ce n’est qu’alors que votre effort a été suivi d’une satisfaction réelle. Évidemment vous ne travaillez à satisfaire les besoins d’autrui que pour qu’autrui travaille à satisfaire les vôtres. Tant que vous n’avez en vos mains que l’écu qui vous a été donné contre votre travail, vous êtes seulement en mesure de réclamer le travail d’une autre personne. Et c’est quand vous l’aurez fait, que l’évolution économique sera accomplie quant à vous, puisqu’alors seulement vous aurez obtenu, par une satisfaction réelle, la vraie récompense de votre peine. L’idée de troc implique service rendu et service reçu. Pourquoi n’en serait-il pas de même de celle d’échange, qui n’est qu’un troc en partie double ?
Et ici, il y a deux remarques à faire : d’abord, c’est une circonstance assez insignifiante qu’il y ait beaucoup ou peu de numéraire dans le monde. S’il y en a beaucoup, il en faut beaucoup ; s’il y en a peu, il en faut peu pour chaque transaction ; voilà tout. La seconde observation, c’est celle-ci : comme on voit toujours reparaître la monnaie à chaque échange, on a fini par la regarder comme le signe et la mesure des choses échangées.
— Nierez-vous encore que le numéraire ne soit le signe des choses utiles dont vous parlez ?
— Un louis n’est pas plus le signe d’un sac de blé qu’un sac de blé n’est le signe d’un louis.
— Quel mal y a-t-il à ce que l’on considère la monnaie comme le signe de la richesse ?
— Il y a cet inconvénient, qu’on croit qu’il suffit d’augmenter le signe pour augmenter les choses signifiées, et l’on tombe dans toutes les fausses mesures que vous preniez vous-même quand je vous avais fait roi absolu. On va plus loin. De même qu’on voit dans l’argent le signe de la richesse, on voit aussi dans le papier-monnaie le signe de l’argent, et l’on en conclut qu’il y a un moyen très-facile et très-simple de procurer à tout le monde les douceurs de la fortune.
— Mais vous n’irez certes pas jusqu’à contester que la monnaie ne soit la mesure des valeurs ?
— Si fait certes, j’irai jusque-là, car c’est là justement que réside l’illusion.
Il est passé dans l’usage de rapporter la valeur de toutes choses à celle du numéraire. On dit : ceci vaut 5, 10, 20, fr., comme on dit : ceci pèse 5, 10, 20 grammes, ceci mesure 5, 10, 20 mètres, cette terre contient 5, 40, 20 ares, etc., et de là on a conclu que la monnaie était la mesure des valeurs.
— Morbleu, c’est que l’apparence y est.
— Oui, l’apparence, et c’est ce dont je me plains, mais non la réalité. Une mesure de longueur, de capacité, de pesanteur, de superficie est une quantité convenue et immuable. Il n’en est pas de même de la valeur de l’or et de l’argent. Elle varie tout aussi bien que celle du blé, du vin, du drap, du travail, et par les mêmes causes, car elle a la même source et subit les mêmes lois. L’or est mis à notre portée absolument comme le fer, par le travail des mineurs, les avances des capitalistes, le concours des marins et des négociants. Il vaut plus ou moins selon qu’il coûte plus ou moins à produire, qu’il y en a plus ou moins sur le marché, qu’il y est plus ou moins recherché ; en un mot, il subit, quant à ses fluctuations, la destinée de toutes les productions humaines. Mais voici quelque chose d’étrange et qui cause beaucoup d’illusions. Quand la valeur du numéraire varie, c’est aux autres produits contre lesquels il s’échange que le langage attribue la variation. Ainsi, je suppose que toutes les circonstances relatives à l’or restent les mêmes, et que la récolte du blé soit emportée. Le blé haussera ; on dira : L’hectolitre de blé qui valait 20 fr. en vaut 30, et on aura raison, car c’est bien la valeur du blé qui a varié, et le langage ici est d’accord avec le fait. Mais faisons la supposition inverse : supposons que toutes les circonstances relatives au blé restent les mêmes, et que la moitié de tout l’or existant dans le monde soit engloutie ; cette fois, c’est la valeur de l’or qui haussera. Il semble qu’on devrait dire : Ce napoléon qui valait 20 fr. en vaut 40. Or, savez-vous comment on s’exprime ? Comme si c’était l’autre terme de comparaison qui eût baissé, et l’on dit : Le blé qui valait 20 fr. n’en vaut que dix.
— Cela revient parfaitement au même, quant au résultat.
— Sans doute ; mais figurez-vous toutes les perturbations, toutes les duperies qui doivent se produire dans les échanges, quand la valeur de l’intermédiaire varie, sans qu’on en soit averti par un changement de dénomination. On émet des pièces altérées ou des billets qui portent le nom de vingt francs, et conserveront ce nom à travers toutes les dépréciations ultérieures. La valeur sera réduite d’un quart, de moitié, qu’ils ne s’en appelleront pas moins des pièces ou billets de vingt francs. Les gens habiles auront soin de ne livrer leurs produits que contre un nombre de billets plus grand. En d’autres termes, ils demanderont quarante francs de ce qu’ils vendaient autrefois pour vingt. Mais les simples s’y laisseront prendre. Il se passera bien des années avant que l’évolution soit accomplie pour toutes les valeurs. Sous l’influence de l’ignorance et de la coutume, la journée du manœuvre de nos campagnes restera longtemps à un franc, quand le prix vénal de tous les objets de consommation se sera élevé autour de lui. Il tombera dans une affreuse misère, sans en pouvoir discerner la cause. Enfin, Monsieur, puisque vous désirez que je finisse, je vous prie, en terminant, de porter toute votre attention sur ce point essentiel. Une fois la fausse monnaie, quelque forme qu’elle prenne, mise en circulation, il faut que la dépréciation survienne, et se manifeste par la hausse universelle de tout ce qui est susceptible de se vendre. Mais cette hausse n’est pas instantanée et égale pour toutes choses. Les habiles, les brocanteurs, les gens d’affaires s’en tirent assez bien ; car c’est leur métier d’observer les fluctuations des prix, d’en reconnaître la cause, et même de spéculer dessus. Mais les petits marchands, les campagnards, les ouvriers, reçoivent tout le choc. Le riche n’en est pas plus riche, le pauvre en devient plus pauvre. Les expédients de cette espèce ont donc pour effet d’augmenter la distance qui sépare l’opulence de la misère, de paralyser les tendances sociales qui rapprochent incessamment les hommes d’un même niveau, et il faut ensuite des siècles aux classes souffrantes pour regagner le terrain qu’elles ont perdu dans leur marche vers l’égalité des conditions.
— Adieu, Monsieur ; je vous quitte pour aller méditer sur la dissertation à laquelle vous venez de vous livrer avec tant de complaisance.
— Êtes-vous déjà à bout de la vôtre ? C’est à peine si j’ai commencé. Je ne vous ai pas encore parlé de la haine du capital, de la gratuité du crédit ; sentiment funeste, erreur déplorable, qui s’alimente à la même source !
— Quoi ! ce soulèvement effrayant des Prolétaires contre les Capitalistes provient aussi de ce qu’on confond l’Argent avec la Richesse ?
— Il est le fruit de causes diverses. Malheureusement, certains capitalistes se sont arrogé des monopoles, des priviléges, qui suffiraient pour expliquer ce sentiment. Mais, lorsque les théoriciens de la démagogie ont voulu le justifier, le systématiser, lui donner l’apparence d’une opinion raisonnée, et le tourner contre la nature même du capital, ils ont eu recours à cette fausse économie politique au fond de laquelle se retrouve toujours la même confusion. Ils ont dit au peuple : « Prends un écu, mets-le sous verre ; oublie-le là pendant un an ; va regarder ensuite, et tu te convaincras qu’il n’a engendré ni dix sous ni cinq sous, ni aucune fraction de sou. Donc l’argent ne produit pas d’intérêts. » Puis, substituant au mot argent son prétendu synonyme, capital, ils ont fait subir à leur ergo cette modification : « Donc le capital ne produit pas d’intérêts [7]. » Ensuite est venue la série des conséquences : « Donc celui qui prête un capital n’en doit rien retirer ; donc celui qui te prête un capital, s’il en retire quelque chose, te vole ; donc tous les capitalistes sont des voleurs ; donc les richesses, devant servir gratuitement à ceux qui les empruntent, appartiennent en réalité à ceux à qui elles n’appartiennent pas ; donc il n’y a pas de propriété ; donc, tout est à tous ; donc…. »
— Ceci est grave, d’autant plus grave que le syllogisme, je vous l’avoue, me semble admirablement enchaîné. Je voudrais bien éclaircir la question. Mais, hélas ! je ne suis plus maître de mon attention. Je sens dans ma tête un bourdonnement confus des mots numéraire, argent, services, capital, intérêts ; c’est au point que, vraiment, je ne m’y reconnais plus. Remettons, s’il vous plaît, l’entretien à un autre jour.
— En attendant, voici un petit volume intitulé Capital et Rente. Il dissipera peut-être quelques-uns de vos doutes. Jetez-y un coup d’œil quand vous vous ennuierez.
— Pour me désennuyer ?
— Qui sait ! Un clou chasse l’autre ; un ennui chasse un autre ennui ; similia similibus…
— Je ne décide pas si vous voyez sous leur vrai jour les fonctions du numéraire et l’économie politique en général. Mais, de votre conversation, il me reste ceci : c’est que ces questions sont de la plus haute importance ; car, la paix ou la guerre, l’ordre ou l’anarchie, l’union ou l’antagonisme des citoyens sont au bout de la solution. Comment se fait-il qu’en France on sache si peu une science qui nous touche tous de si près, et dont la diffusion aurait une influence si décisive sur le sort de l’humanité ? Serait-ce que l’État ne la fait pas assez enseigner ?
— Pas précisément. Cela tient à ce que, sans le savoir, il s’applique avec un soin infini à saturer tous les cerveaux de préjuigés et tous les cœurs de sentiments favorables à l’esprit d’anarchie, de guerre et de haine. En sorte que, lorsqu’une doctrine d’ordre, de paix et d’union se présente, elle a beau avoir pour elle la clarté et la vérité, elle trouve la place prise.
— Décidément, vous êtes un affreux pessimiste. Quel intérêt l’État peut-il avoir à fausser les intelligences au profit des révolutions, des guerres civiles et étrangères ? Il y a certainement de l’exagération dans ce que vous dites.
— Jugez-en. À l’époque où nos facultés intellectuelles commencent à se développer, à l’âge où les impressions sont si vives, où les habitudes de l’esprit se contractent avec une si grande facilité ; quand nous pourrions jeter un regard sur notre société et la comprendre, en un mot, quand nous arrivons à sept ou huit ans, que fait l’État ? Il nous met un bandeau sur les yeux, nous fait sortir tout doucement du milieu social qui nous environne, pour nous plonger avec notre esprit si prompt, notre cœur si impressionnable, dans le sein de la société romaine. Il nous retient là une dizaine d’années, tout le temps nécessaire pour donner à notre cerveau un empreinte ineffaçable. Or, remarquez que la société romaine est directement l’opposé de ce qu’est ou devrait être notre société. Là, on vivait de guerre ; ici, nous devrions haïr la guerre. Là, on haïssait le travail ; ici, nous devons vivre du travail. Là, on fondait les moyens de subsistance sur l’esclavage et la rapine ; ici, sur l’industrie libre. La société romaine s’était organisée en conséquence de son principe. Elle devait admirer ce qui la faisait prospérer. On y devait appeler vertus ce qu’ici nous appelons vices. Ses poëtes, ses historiens devaient exalter ce qu’ici nous devons mépriser. Les mots mêmes : liberté, ordre, justice, peuple, honneur, influence, etc., ne pouvaient avoir la même signification à Rome qu’ils ont, ou devraient avoir à Paris. Comment voulez-vous que toute cette jeunesse, qui sort des écoles universitaires ou monacales, qui a eu pour catéchisme Tite-Live et Quinte-Curce, ne comprenne pas la liberté comme les Gracques, la vertu comme Caton, le patriotisme comme César ? Comment voulez-vous qu’elle ne soit pas factieuse et guerrière ? Comment voulez-vous surtout qu’elle prenne le moindre intérêt au mécanisme de notre ordre social ? Croyez vous que son esprit est bien préparé le comprendre ? Ne voyez-vous pas qu’elle devrait, pour cela, se défaire de ses impressions pour en recevoir de tout opposées ?
— Que concluez-vous de là ?
— Le voici : le plus pressé, ce n’est pas que l’État enseigne, mais qu’il laisse enseigner. Tous les monopoles sont détestables, mais le pire de tous, c’est le monopole de l’enseignement [8].
FN: Note de l’éditeur.
FN:Voy. le chap. vi du tome VI. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome II, l’introduction de Cobden et la Ligue. (Note de l’éditeur.
FN:Voy. le chap. iv du tome VI. (Note de l’éditeur.)
FN: Mutualité des services. D’après tout ce qui précède, la société peut être considérée comme un immense bazar où chacun va d’abord déposer ses produits, en faire reconnaître et fixer la valeur. Après cela, il est autorisé à prélever, sur l’ensemble de tous ces dépôts, des produits à son choix pour une valeur égale. Or, comment s’apprécie cette valeur ? par le service reçu et rendu. Nous avons donc exactement ce que demandait M. Proudhon. Nous avons ce bazar d’échange, dont on a tant ri ; et la société, plus ingénieuse que M. Proudhon, nous le donne en nous épargnant le dérangement matériel d’y transporter nos marchandises. Pour cela, elle a inventé la monnaie, moyennant quoi elle réalise l’entrepôt à domicile. (Ébauche inédite de l’auteur.)
FN:Voy. la 12e lettre du pamphlet Gratuité du crédit. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy. l’introduction de Capital et Rente, page 25. (Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome IV, Baccalauréat et Socialisme. (Note de l’éditeur.)
L’État [April 1849 pamphlet version] [CW2.7]↩
T.320 A third revised and enlarged version with a new section on the Montagnards’ economic policies was published twice in 1849: as an article in Annuaire de l’économie politique et de la statistique pour 1849, par MM. Joseph Garnier et Guillaumin et al. Sixième année (Paris: Guillaumin, 1849), pp. 356-68; and in a pamphlet L’État. Maudit Argent (Paris: Guillaumin, 1849), pp. 5-23. The third version is 3,900 words. The third edition also appeared in OC4, pp. 327-41.
Source
OC vol. 4 Sophismes économiques — Petits pamphlets, I (1863 ed.): <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_4.djvu>.
Je voudrais qu’on fondât un prix, non de cinq cents francs, mais d’un million, avec couronnes, croix et rubans, en faveur de celui qui donnerait une bonne, simple et intelligible définition de ce mot : l’État.
Quel immense service ne rendrait-il pas à la société !
L’État ! Qu’est-ce ? où est-il ? que fait-il ? que devrait-il faire ?
Tout ce que nous en savons, c’est que c’est un personnage mystérieux, et assurément le plus sollicité, le plus tourmenté, le plus affairé, le plus conseillé, le plus accusé, le plus invoqué et le plus provoqué qu’il y ait au monde.
Car, Monsieur, je n’ai pas l’honneur de vous connaître, mais je gage dix contre un que depuis six mois vous faites des utopies ; et si vous en faites, je gage dix contre un que vous chargez l’État de les réaliser.
Et vous, Madame, je suis sûr que vous désirez du fond du cœur guérir tous les maux de la triste humanité, et que vous n’y seriez nullement embarrassée si l’État voulait seulement s’y prêter.
Mais, hélas ! le malheureux, comme Figaro, ne sait ni qui entendre, ni de quel côté se tourner. Les cent mille bouches de la presse et de la tribune lui crient à la fois :
« Organisez le travail et les travailleurs.
Extirpez l’égoïsme.
Réprimez l’insolence et la tyrannie du capital.
Faites des expériences sur le fumier et sur les œufs.
Sillonnez le pays de chemins de fer.
Irriguez les plaines.
Boisez les montagnes.
Fondez des fermes-modèles
Fondez des ateliers harmoniques.
Colonisez l’Algérie.
Allaitez les enfants.
Instruisez la jeunesse.
Secourez la vieillesse.
Envoyez dans les campagnes les habitants des villes.
Pondérez les profits de toutes les industries.
Prêtez de l’argent, et sans intérêt, à ceux qui en désirent.
Affranchissez l’Italie, la Pologne et la Hongrie.
Élevez et perfectionnez le cheval de selle.
Encouragez l’art, formez-nous des musiciens et des danseuses.
Prohibez le commerce et, du même coup, créez une marine marchande.
Découvrez la vérité et jetez dans nos têtes un grain de raison. L’État a pour mission d’éclairer, de développer, d’agrandir, de fortifier, de spiritualiser et de sanctifier l’âme des peuples [2]. » [quote from Lamartine’s Statement of Principles]
— « Eh ! Messieurs, un peu de patience, répond l’État, d’un air piteux. »
« J’essaierai de vous satisfaire, mais pour cela il me faut quelques ressources. J’ai préparé des projets concernant cinq ou six impôts tout nouveaux et les plus bénins du monde. Vous verrez quel plaisir on a à les payer. »
Mais alors un grand cri s’élève : « Haro ! haro ! le beau mérite de faire quelque chose avec des ressources ! Il ne vaudrait pas la peine de s’appeler l’État. Loin de nous frapper de nouvelles taxes, nous vous sommons de retirer les anciennes. Supprimez :
L’impôt du sel ;
L’impôt des boissons ;
L’impôt des lettres ;
L’octroi ;
Les patentes ;
Les prestations. »
Au milieu de ce tumulte, et après que le pays a changé deux ou trois fois son État pour n’avoir pas satisfait à toutes ces demandes, j’ai voulu faire observer qu’elles étaient contradictoires. De quoi me suis-je avisé, bon Dieu ! ne pouvais-je garder pour moi cette malencontreuse remarque ?
Me voilà discrédité à tout jamais ; et il est maintenant reçu que je suis un homme sans cœur et sans entrailles, un philosophe sec, un individualiste, un bourgeois, et, pour tout dire en un mot, un économiste de l’école anglaise ou américaine.
Oh ! pardonnez-moi, écrivains sublimes, que rien n’arrête, pas même les contradictions. J’ai tort, sans doute, et je me rétracte de grand cœur. Je ne demande pas mieux, soyez-en sûrs, que vous ayez vraiment découvert, en dehors de nous, un être bienfaisant et inépuisable, s’appelant l’État, qui ait du pain pour toutes les bouches, du travail pour tous les bras, des capitaux pour toutes les entreprises, du crédit pour tous les projets, de l’huile pour toutes les plaies, du baume pour toutes les souffrances, des conseils pour toutes les perplexités, des solutions pour tous les doutes, des vérités pour toutes les intelligences, des distractions pour tous les ennuis, du lait pour l’enfance, du vin pour la vieillesse, qui pourvoie à tous nos besoins, prévienne tous nos désirs, satisfasse toutes nos curiosités, redresse toutes nos erreurs, toutes nos fautes, et nous dispense tous désormais de prévoyance, de prudence, de jugement, de sagacité, d’expérience, d’ordre, d’économie, de tempérance et d’activité.
Et pourquoi ne le désirerais-je pas ? Dieu me pardonne, plus j’y réfléchis, plus je trouve que la chose est commode, et il me tarde d’avoir, moi aussi, à ma portée, cette source intarissable de richesses et de lumières, ce médecin universel, ce trésor sans fond, ce conseiller infaillible que vous nommez l’État.
Aussi je demande qu’on me le montre, qu’on me le définisse, et c’est pourquoi je propose la fondation d’un prix pour le premier qui découvrira ce phénix. Car enfin, on m’accordera bien que cette découverte précieuse n’a pas encore été faite, puisque, jusqu’ici, tout ce qui se présente sous le nom d’État, le peuple le renverse aussitôt, précisément parce qu’il ne remplit pas les conditions quelque peu contradictoires du programme.
Faut-il le dire ? Je crains que nous ne soyons, à cet égard, dupes d’une des plus bizarres illusions qui se soient jamais emparées de l’esprit humain.
L’homme répugne à la Peine, à la Souffrance. Et cependant il est condamné par la nature à la Souffrance de la Privation, s’il ne prend pas la Peine du Travail. Il n’a donc que le choix entre ces deux maux. Comment faire pour les éviter tous deux ? Il n’a jusqu’ici trouvé et ne trouvera jamais qu’un moyen : c’est de jouir du travail d’autrui ; c’est de faire en sorte que la Peine et la Satisfaction n’incombent pas à chacun selon la proportion naturelle, mais que toute la peine soit pour les uns et toutes les satisfactions pour les autres. De là l’esclavage, de là encore la spoliation, quelque forme qu’elle prenne : guerres, impostures, violences, restrictions, fraudes, etc., abus monstrueux, mais conséquents avec la pensée qui leur a donné naissance. On doit haïr et combattre les oppresseurs, on ne peut pas dire qu’ils soient absurdes.
L’esclavage s’en va, grâce au Ciel, et, d’un autre côté, cette disposition où nous sommes à défendre notre bien, fait que la Spoliation directe et naïve n’est pas facile. Une chose cependant est restée. C’est ce malheureux penchant primitif que portent en eux tous les hommes à faire deux parts du lot complexe de la vie, rejetant la Peine sur autrui et gardant la Satisfaction pour eux-mêmes. Reste à voir sous quelle forme nouvelle se manifeste cette triste tendance.
L’oppresseur n’agit plus directement par ses propres forces sur l’opprimé. Non, notre conscience est devenue trop méticuleuse pour cela. Il y a bien encore le tyran et la victime, mais entre eux se place un intermédiaire qui est l’État, c’est-à-dire la loi elle-même. Quoi de plus propre à faire taire nos scrupules et, ce qui est peut-être plus apprécié, à vaincre les résistances ? Donc, tous, à un titre quelconque, sous un prétexte ou sous un autre, nous nous adressons à l’État. Nous lui disons : « Je ne trouve pas qu’il y ait, entre mes jouissances et mon travail, une proportion qui me satisfasse. Je voudrais bien, pour établir l’équilibre désiré, prendre quelque peu sur le bien d’autrui. Mais c’est dangereux. Ne pourriez-vous me faciliter la chose ? ne pourriez-vous me donner une bonne place ? ou bien gêner l’industrie de mes concurrents ? ou bien encore me prêter gratuitement des capitaux que vous aurez pris à leurs possesseurs ? ou élever mes enfants aux frais du public ? ou m’accorder des primes d’encouragement ? ou m’assurer le bien-être quand j’aurai cinquante ans ? Par ce moyen, j’arriverai à mon but en toute quiétude de conscience, car la loi elle-même aura agi pour moi, et j’aurai tous les avantages de la spoliation sans en avoir ni les risques ni l’odieux ! »
Comme il est certain, d’un côté, que nous adressons tous à l’État quelque requête semblable, et que, d’une autre part, il est avéré que l’État ne peut procurer satisfaction aux uns sans ajouter au travail des autres, en attendant une autre définition de l’État, je me crois autorisé à donner ici la mienne. Qui sait si elle ne remportera pas le prix ? La voici :
L’État, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde.
Car, aujourd’hui comme autrefois, chacun, un peu plus, un peu moins, voudrait bien profiter du travail d’autrui. Ce sentiment, on n’ose l’afficher, on se le dissimule à soi-même ; et alors que fait-on ? On imagine un intermédiaire, on s’adresse à l’État, et chaque classe tour à tour vient lui dire : « Vous qui pouvez prendre loyalement, honnêtement, prenez au public, et nous partagerons. » Hélas ! l’État n’a que trop de pente à suivre le diabolique conseil ; car il est composé de ministres, de fonctionnaires, d’hommes enfin, qui, comme tous les hommes, portent au cœur le désir et saisissent toujours avec empressement l’occasion de voir grandir leurs richesses et leur influence. L’État comprend donc bien vite le parti qu’il peut tirer du rôle que le public lui confie. Il sera l’arbitre, le maître de toutes les destinées : il prendra beaucoup, donc il lui restera beaucoup à lui-même ; il multipliera le nombre de ses agents, il élargira le cercle de ses attributions ; il finira par acquérir des proportions écrasantes.
Mais ce qu’il faut bien remarquer, c’est l’étonnant aveuglement du public en tout ceci. Quand des soldats heureux réduisaient les vaincus en esclavage, ils étaient barbares, mais ils n’étaient pas absurdes. Leur but, comme le nôtre, était de vivre aux dépens d’autrui ; mais, comme nous, ils ne le manquaient pas. Que devons-nous penser d’un peuple où l’on ne paraît pas se douter que le pillage réciproque n’en est pas moins pillage parce qu’il est réciproque ; qu’il n’en est pas moins criminel parce qu’il s’exécute légalement et avec ordre ; qu’il n’ajoute rien au bien-être public ; qu’il le diminue au contraire de tout ce que coûte cet intermédiaire dispendieux que nous nommons l’État ?
Et cette grande chimère, nous l’avons placée, pour l’édification du peuple, au frontispice de la Constitution. Voici les premiers mots du préambule :
« La France s’est constituée en République pour… appeler tous les citoyens à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. »
Ainsi, c’est la France ou l’abstraction, qui appelle les Français ou les réalités à la moralité, au bien-être, etc. N’est-ce pas abonder dans le sens de cette bizarre illusion qui nous porte à tout attendre d’une autre énergie que la nôtre ? N’est-ce pas donner à entendre qu’il y a, à côté et en dehors des Français, un être vertueux, éclairé, riche, qui peut et doit verser sur eux ses bienfaits ? N’est-ce pas supposer, et certes bien gratuitement, qu’il y a entre la France et les Français, entre la simple dénomination abrégée, abstraite, de toutes les individualités et ces individualités mêmes, des rapports de père à fils, de tuteur à pupille, de professeur à écolier ? Je sais bien qu’on dit quelquefois métaphoriquement : La patrie est une mère tendre. Mais pour prendre en flagrant délit d’inanité la proposition constitutionnelle, il suffit de montrer qu’elle peut être retournée, je ne dirai pas sans inconvénient, mais même avec avantage. L’exactitude souffrirait-elle si le préambule avait dit :
« Les Français se sont constitués en République pour appeler la France à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être ? »
Or, quelle est la valeur d’un axiome où le sujet et l’ attribut peuvent chasser-croiser sans inconvénient ? Tout le monde comprend qu’on dise : la mère allaitera l’enfant. Mais il serait ridicule de dire : l’enfant allaitera la mère.
Les Américains se faisaient une autre idée des relations des citoyens avec l’État, quand ils placèrent en tête de leur Constitution ces simples paroles :
« Nous, le peuple des États-Unis, pour former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, pourvoir à la défense commune, accroître le bien-être général et assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, décrétons, etc. »
Ici point de création chimérique, point d’abstraction à laquelle les citoyens demandent tout. Ils n’attendent rien que d’eux-mêmes et de leur propre énergie.
Si je me suis permis de critiquer les premières paroles de notre Constitution, c’est qu’il ne s’agit pas, comme on pourrait le croire, d’une pure subtilité métaphysique. Je prétends que cette personnification de l’État a été dans le passé et sera dans l’avenir une source féconde de calamités et de révolutions.
Voilà le Public d’un côté, l’État de l’autre, considérés comme deux être distincts, celui-ci tenu d’épandre sur celui-là, celui-là ayant droit de réclamer de celui-ci le torrent des félicités humaines. Que doit-il arriver ?
Au fait, l’État n’est pas manchot et ne peut l’être. Il a deux mains, l’une pour recevoir et l’autre pour donner, autrement dit, la main rude et la main douce. L’activité de la seconde est nécessairement subordonnée à l’activité de la première. À la rigueur, l’État peut prendre et ne pas rendre. Cela s’est vu et s’explique par la nature poreuse et absorbante de ses mains, qui retiennent toujours une partie et quelquefois la totalité de ce qu’elles touchent. Mais ce qui ne s’est jamais vu, ce qui ne se verra jamais et ne se peut même concevoir, c’est que l’État rende au public plus qu’il ne lui a pris. C’est donc bien follement que nous prenons autour de lui l’humble attitude de mendiants. Il lui est radicalement impossible de conférer un avantage particulier à quelques-unes des individualités qui constituent la communauté, sans infliger un dommage supérieur à la communauté entière.
Il se trouve donc placé, par nos exigences, dans un cercle vicieux manifeste.
S’il refuse le bien qu’on exige de lui, il est accusé d’impuissance, de mauvais vouloir, d’incapacité. S’il essaie de le réaliser, il est réduit à frapper le peuple de taxes redoublées, à faire plus de mal que de bien, et à s’attirer, par un autre bout, la désaffection générale.
Ainsi, dans le public des espérances, dans le gouvernement deux promesses : beaucoup de bienfaits et pas d’impôts. Espérances et promesses qui, étant contradictoires, ne se réalisent jamais.
N’est-ce pas là la cause de toutes nos révolutions ? Car entre l’État, qui prodigue les promesses impossibles, et le public, qui a conçu des espérances irréalisables, viennent s’interposer deux classes d’hommes : les ambitieux et les utopistes. Leur rôle est tout tracé par la situation. Il suffit à ces courtisans de popularité de crier aux oreilles du peuple : « Le pouvoir te trompe ; si nous étions à sa place, nous te comblerions de bienfaits et t’affranchirions de taxes. »
Et le peuple croit, et le peuple espère, et le peuple fait une révolution.
Ses amis ne sont pas plus tôt aux affaires, qu’ils sont sommés de s’exécuter. « Donnez-moi donc du travail, du pain, des secours, du crédit, de l’instruction, des colonies, dit le peuple, et cependant, selon vos promesses, délivrez-moi des serres du fisc. »
L’État nouveau n’est pas moins embarrassé que l’État ancien, car, en fait d’impossible, on peut bien promettre, mais non tenir. Il cherche à gagner du temps, il lui en faut pour mûrir ses vastes projets. D’abord, il fait quelques timides essais ; d’un côté, il étend quelque peu l’instruction primaire ; de l’autre, il modifie quelque peu l’impôt des boissons (1830). Mais la contradiction se dresse toujours devant lui : s’il veut être philanthrope, il est forcé de rester fiscal ; et s’il renonce à la fiscalité, il faut qu’il renonce aussi à la philanthropie.
Ces deux promesses s’empêchent toujours et nécessairement l’une l’autre. User du crédit, c’est-à-dire dévorer l’avenir, est bien un moyen actuel de les concilier ; on essaie de faire un peu de bien dans le présent aux dépens de beaucoup de mal dans l’avenir. Mais ce procédé évoque le spectre de la banqueroute qui chasse le crédit. Que faire donc ? Alors l’État nouveau prend son parti en brave ; il réunit des forces pour se maintenir, il étouffe l’opinion, il a recours à l’arbitraire, il ridiculise ses anciennes maximes, il déclare qu’on ne peut administrer qu’à la condition d’être impopulaire ; bref, il se proclame gouvernemental.
Et c’est là que d’autres courtisans de popularité l’attendent. Ils exploitent la même illusion, passent par la même voie, obtiennent le même succès, et vont bientôt s’engloutir dans le même gouffre.
C’est ainsi que nous sommes arrivés en Février. À cette époque, l’illusion qui fait le sujet de cet article avait pénétré plus avant que jamais dans les idées du peuple, avec les doctrines socialistes. Plus que jamais, il s’attendait à ce que l’État sous la forme républicaine, ouvrirait toute grande la source des bienfaits et fermerait celle de l’impôt. « On m’a souvent trompé, disait le peuple, mais je veillerai moi-même à ce qu’on ne me trompe pas encore une fois. »
Que pouvait faire le gouvernement provisoire ? Hélas ! ce qu’on fait toujours en pareille conjoncture : promettre, et gagner du temps. Il n’y manque pas, et pour donner à ses promesses plus de solennité, il les fixa dans des décrets. « Augmentation de bien-être, diminution de travail, secours, crédit, instruction gratuite, colonies agricoles, défrichements, et en même temps réduction sur la taxe du sel, des boissons, des lettres, de la viande, tout sera accordé… vienne l’Assemblée nationale ».
L’Assemblée nationale est venue, et comme on ne peut réaliser deux contradictions, sa tâche, sa triste tâche, s’est bornée à retirer, le plus doucement possible, l’un après l’autre, tous les décrets du gouvernement provisoire.
Cependant, pour ne pas rendre la déception trop cruelle, il a bien fallu transiger quelque peu. Certains engagements ont été maintenus, d’autres ont reçu un tout petit commencement d’exécution. Aussi l’administration actuelle s’efforce-t-elle d’imaginer de nouvelles taxes.
Maintenant je me transporte par la pensée à quelques mois dans l’avenir, et je me demande, la tristesse dans l’âme, ce qu’il adviendra quand des agents de nouvelle création iront dans nos campagnes prélever les nouveaux impôts sur les successions, sur les revenus, sur les profits de l’exploitation agricole. Que le Ciel démente mes pressentiments, mais je vois encore là un rôle à jouer pour les courtisans de popularité.
Lisez le dernier Manifeste des Montagnards, celui qu’ils ont émis à propos de l’élection présidentielle. Il est un peu long, mais, après tout, il se résume en deux mots : L’État doit beaucoup donner aux citoyens et peu leur prendre. C’est toujours la même tactique, ou, si l’on veut, la même erreur.
« L’État doit gratuitement l’instruction et l’éducation à tous les citoyens. ».
Il doit :
« Un enseignement général et professionnel approprié autant que possible, aux besoins, aux vocations et aux capacités de chaque citoyen. »
Il doit :
« Lui apprendre ses devoirs envers Dieu, envers les hommes et envers lui-même ; développer ses sentiments, ses aptitudes et ses facultés, lui donner enfin la science de son travail, l’intelligence de ses intérêts et la connaissance de ses droits. »
Il doit :
« Mettre à la portée de tous les lettres et les arts, le patrimoine de la pensée, les trésors de l’esprit, toutes les jouissances intellectuelles qui élèvent et fortifient l’âme. »
Il doit :
« Réparer tout sinistre, incendie, inondation, etc. (cet et caetera en dit plus qu’il n’est gros) éprouvé par un citoyen. »
Il doit :
« Intervenir dans les rapports du capital avec le travail et se faire le régulateur du crédit. »
Il doit :
« À l’agriculture des encouragements sérieux et une protection efficace. »
Il doit :
« Racheter les chemins de fer, les canaux, les mines, » et sans doute aussi les administrer avec cette capacité industrielle qui le caractérise.
Il doit :
« Provoquer les tentatives généreuses, les encourager et les aider par toutes les ressources capables de les faire triompher. Régulateur du crédit, il commanditera largement les associations industrielles et agricoles, afin d’en assurer le succès. »
L’État doit tout cela, sans préjudice des services auxquels il fait face aujourd’hui ; et, par exemple, il faudra qu’il soit toujours à l’égard des étrangers dans une attitude menaçante ; car, disent les signataires du programme, « liés par cette solidarité sainte et par les précédents de la France républicaine, nous portons nos vœux et nos espérances au-delà des barrières que le despotisme élève entre les nations : le droit que nous voulons pour nous, nous le voulons pour tous ceux qu’opprime le joug des tyrannies ; nous voulons que notre glorieuse armée soit encore, s’il le faut, l’armée de la liberté. »
Vous voyez que la main douce de l’État, cette bonne main qui donne et qui répand, sera fort occupée sous le gouvernement des Montagnards. Vous croyez peut-être qu’il en sera de même de la main rude, de cette main qui pénètre et puise dans nos poches ?
Détrompez-vous. Les courtisans de popularité ne sauraient pas leur métier, s’ils n’avaient l’art, en montrant la main douce, de cacher la main rude.
Leur règne sera assurément le jubilé du contribuable.
« C’est le superflu, disent-ils, non le nécessaire que l’impôt doit atteindre. »
Ne sera-ce pas un bon temps que celui où, pour nous accabler de bienfaits, le fisc se contentera d’écorner notre superflu ?
Ce n’est pas tout. Les Montagnards aspirent à ce que « l’impôt perde son caractère oppressif et ne soit plus qu’un acte de fraternité. »
Bonté du ciel ! je savais bien qu’il est de mode de fourrer la fraternité partout, mais je ne me doutais pas qu’on la pût mettre dans le bulletin du percepteur.
Arrivant aux détails, les signataires du programme disent :
« Nous voulons l’abolition immédiate des impôts qui frappent les objets de première nécessité, comme le sel, les boissons, et caetera. »
« La réforme de l’impôt foncier, des octrois, des patentes. »
« La justice gratuite, c’est-à-dire la simplification des formes et la réduction des frais. » (Ceci a sans doute trait au timbre.)
Ainsi, impôt foncier, octrois, patentes, timbre, sel, boissons, postes, tout y passe. Ces messieurs ont trouvé le secret de donner une activité brûlante à la main douce de l’État tout en paralysant sa main rude.
Eh bien, je le demande au lecteur impartial, n’est-ce pas là de l’enfantillage, et, de plus, de l’enfantillage dangereux ? Comment le peuple ne ferait-il pas révolution sur révolution, s’il est une fois décidé à ne s’arrêter que lorsqu’il aura réalisé cette contradiction : « Ne rien donner à l’État et en recevoir beaucoup ! »
Croit-on que si les Montagnards arrivaient au pouvoir, ils ne seraient pas les victimes des moyens qu’ils emploient pour le saisir ?
Citoyens, dans tous les temps deux systèmes politiques ont été en présence, et tous les deux peuvent se soutenir par de bonnes raisons. Selon l’un, l’État doit beaucoup faire, mais aussi il doit beaucoup prendre. D’après l’autre, sa double action doit se faire peu sentir. Entre ces deux systèmes il faut opter. Mais quant au troisième système, participant des deux autres, et qui consiste à tout exiger de l’État sans lui rien donner, il est chimérique, absurde, puéril, contradictoire, dangereux. Ceux qui le mettent en avant, pour se donner le plaisir d’accuser tous les gouvernements d’impuissance et les exposer ainsi à vos coups, ceux-là vous flattent et vous trompent, ou du moins ils se trompent eux-mêmes.
Quant à nous, nous pensons que l’État, ce n’est ou ce ne devrait être autre chose que la force commune instituée, non pour être entre tous les citoyens un instrument d’ oppression et de spoliation réciproque, mais, au contraire, pour garantir à chacun le sien, et faire régner la justice et la sécurité [3].
FN:Pour expliquer la forme de cette composition, rappelons qu’elle fut insérée au Journal des Débats, n° du 25 septembre 1848. (Note de l’éditeur.)
FN:Cette dernière phrase est de M. de Lamartine. L’auteur la cite de nouveau dans le pamphlet qui va suivre. (Note de l’éditeur)
FN:Voy. au tome VI, le chap. XVII des Harmonies, et au tome 1er, l’opuscule de 1830, intitulé : Aux
“Profession de foi électorale de 1849. À MM. Tonnelier, Oegos, Bergeron, Camors, Oubroca, Pomeoe, Fauret, etc.” [May, 1849] [CW2.2.5]↩
BWV
1849.05 “Profession de foi électorale de 1849. À MM. Tonnelier, Oegos, Bergeron, Camors, Oubroca, Pomeoe, Fauret, etc.” (Statement of Electoral Principles in 1849. To MM. Tonnelier, Oegos, Bergeron, Camors, Oubroca, Pomeoe, Fauret, etc.) [OC1.17, p. 507] [CW1]
Profession de foi électorale de 1849
À MM. Tonnelier, Oegos, Bergeron, Camors, Oubroca, Pomeoe, Fauret, etc.
1849.
Mes Amis,
Merci pour votre bonne lettre. Le pays peut disposer de moi comme il l’entendra ; votre persévérante confiance me sera un encouragement… ou une consolation.
Vous me dites qu’on me fait passer pour un socialiste. Que puis-je répondre ? Mes écrits sont là. À la doctrine de Louis Blanc n’ai-je pas opposé Propriété et Loi ; à la doctrine de Considérant, Propriété et Spoliation ; à la doctrine Leroux, Justice et Fraternité ; à la doctrine Proudhon, Capital et Rente ; au comité Mimerel, Protectionnisme et Communisme ; au papier-monnaie, Maudit Argent ; au Manifeste Montagnard, L’Etat ? — Je passe ma vie à combattre le socialisme. Il serait bien douloureux pour moi qu’on me rendît cette justice partout, excepté dans le département des Landes.
On a rapproché mes votes de ceux de l’extrême gauche. Pourquoi n’a-t-on pas signalé aussi les occasions où j’ai voté avec la droite ?
Mais, me direz-vous, comment avez-vous pu vous trouver alternativement dans deux camps si opposés ? Je vais m’expliquer.
Depuis un siècle, les partis prennent beaucoup de noms, beaucoup de prétextes ; au fond, il s’agit toujours de la même chose : la lutte des pauvres contre les riches.
Or, les pauvres demandent plus que ce qui est juste, et les riches refusent même ce qui est juste. Si cela continue, la guerre sociale, dont nos pères ont vu le premier acte en 93, dont nous avons vu le second acte en juin, — cette guerre affreuse et fratricide n’est pas près de finir. Il n’y a de conciliation possible que sur le terrain de la justice, en tout et pour tous.
Après février, le peuple a mis en avant une foule de prétentions iniques et absurdes, mêlées à des réclamations fondées.
Que fallait-il pour conjurer la guerre sociale ?
Deux choses :
1° Réfuter comme écrivain, repousser comme législateur les prétentions iniques ;
2° Appuyer comme écrivain, admettre comme législateur les réclamations fondées.
C’est la clef de ma conduite.
Au premier moment de la Révolution, les espérances populaires étaient très exaltées et ne connaissaient pas de limites, même dans notre département ; et rappelez-vous qu’on ne me trouvait pas assez rouge. C’était bien pis à Paris ; les ouvriers étaient organisés, armés, maîtres du terrain, à la merci des plus fougueux démagogues.
Le début de l’Assemblée nationale dut être une œuvre de résistance. Elle se concentra surtout dans le Comité des finances, composé d’hommes appartenant à la classe riche. Résister aux exigences folles et subversives, repousser l’impôt progressif, le papier-monnaie, l’accaparement de l’industrie privée par l’État, la suspension des dettes nationales, telle fut sa laborieuse tâche. J’y ai pris ma part ; et, je vous le demande, Citoyens, si j’avais été socialiste, ce comité m’aurait-il appelé huit fois de suite à la vice-présidence ?
Une fois l’œuvre de résistance accomplie, restait à réaliser l’œuvre de réforme, à l’occasion du budget de 1849. Que de taxes mal réparties à modifier ! que d’entraves à supprimer ! Car, enfin, cette conscription (appelée depuis recrutement), impôt de sept ans de vie, tiré au sort ! ces droits réunis (appelés aujourd’hui contributions indirectes), impôt progressif à rebours, puisqu’il frappe en proportion de la misère ; ne sont-ce pas là des griefs fondés de la part du peuple ? Après les journées de juin, quand l’anarchie a été vaincue, l’Assemblée nationale a pensé que le temps était venu d’entrer résolument, spontanément, dans cette voie de réparation commandée par l’équité et même par la prudence.
Le Comité des finances, par sa composition, était moins disposé à cette seconde tâche qu’à la première. De nouveaux éléments s’y étaient introduits par les élections partielles, et l’on y entendait dire à chaque instant : Loin de modifier les taxes, nous serions bien heureux, si nous pouvions rétablir les choses absolument comme elles étaient avant février.
C’est pourquoi l’Assemblée confia à une commission de trente membres le soin de préparer le budget. Elle chargea une autre commission de mettre l’impôt des boissons en harmonie avec les principes de liberté et d’égalité inscrits dans la Constitution. J’ai fait partie des deux ; et autant j’avais été ardent à repousser les exigences utopiques, autant je l’ai été à réaliser de justes réformes.
Il serait trop long de raconter ici comment les bonnes intentions de l’Assemblée ont été paralysées. L’histoire le dira. Mais vous pouvez comprendre ma ligne de conduite. Ce qu’on me reproche, c’est précisément ce dont je m’honore. Oui, j’ai voté avec la droite contre la gauche, quand il s’est agi de résister au débordement des fausses idées populaires. Oui, j’ai voté avec la gauche contre la droite, quand les légitimes griefs de la classe pauvre et souffrante ont été méconnus.
Il se peut que, par là, je me sois aliéné les deux partis, et que je reste écrasé au milieu. N’importe. J’ai la conscience d’avoir été fidèle à mes engagements, logique, impartial, juste, prudent, maître de moi-même. Ceux qui m’accusent se sentent, sans doute, la force de mieux faire. S’il en est ainsi, que le pays les nomme à ma place. Je m’efforcerai d’oublier que j’ai perdu sa confiance, en me rappelant que je l’ai obtenue une fois ; et ce n’est pas un léger froissement d’amour-propre qui effacera la profonde reconnaissance que je lui dois.
Je suis, mes chers Compatriotes, votre dévoué.
T.276 (1849.05.10) SEP: Séance de 10 mai 1849 (on the Peace Congress and state support for socialist programs) (Fr)↩
French text acquired: 27 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.276 (1849.05.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 mai 1849) (on the state supporting socialist programs). In “Chronique,” JDE, T. 23, no. 98, 15 mai 1849, p. 216; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889),Not in OC.
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
Sommaire. — La lutte électorale. — La coalition rouge-socialiste et les facilités que lu1 ont faites les organes de l'opinion modérée. — Utilité et dangers de la nomination des candidats socialistes. — Les circulaires. — Circulaire de M. Michel Chevalier. — Le budget. — Retour à l'industrie privée des paquebots de la Méditerranée. — Nombre des demandes de bureaux de tabac. — La banqueroute proposée au gouvernement provisoire. — Adjudication de l'emprunt de Paris.—L'indemnité accordée aux colons. — Le Conseil d'Etat; MM. Vivien, Dunoyer, H. Say et Dussard.—Complications extérieures. — Le Congrès de la paix. —Les essais socialistes à la Société des Economistes.
— Malgré ces tristes épisodes de la situation actuelle, nous voyons avec une grande satisfaction que le zèle des amis de la paixn e se ralentit pas. MM. Elihu Burritt, président de la Société fraternelle des Etats-Unis ; Richard, secrétaire de la Société de la Paix à Londres, et M. Wisschers, président du dernier Congrès de la paix à Londres, ont passé quelques jours à Paris pour jeter les bases d'un Congrès qui aurait lieu à Paris dans les premiers jours d'août. Plusieurs notabilités religieuses, politiques et scientifiques du parlement et de la presse ont promis leur concours à cette manifestation. La Société des économistes a décidé dans sa dernière séance qu'elle chargeait son bureau de la représenter au Congrès de la paix.
Dans cette même séance, présidée par M. Horace Say, à laquelle assistaient plusieurs membres de l'Assemblée constituante qui se sont montrés (et entre autres M.Victor Lefranc) très-favorables à l'idée de ce Congrès, la conversation a été également portée sur la question de savoir si l'Etat doit encourager les essais socialistes. La négative a été soutenue par MM. Bastiat, Howyn de Tranchère et Raudot. M. Bastiat a invoqué surtout le grand principe de la nonintervention de l'Etat, sans lequel la besogne et la dépense du gouvernement n'auraient pas de limites. M. Howyn de Tranchère a fait des systèmes socialistes et de leur inanité une critique pleine d'esprit et de bon sens; enfin, M. Raudot a prouvé par quelques chiffres qu'avec les millions qu'absorberaient les chefs d'école pour faire prospérer quelques centaines de citoyens, le contribuable se verrait bientôt dans l'impossibilité de continuer ses largesses, et que, dans tous les cas, pût-il y suffire, il n'y aurait pas besoin de mécanisme sociétaire nouveau pour faire des heureux à raison de dix à vingt mille francs par tête.
M. Joseph Garnier, sans contester en rien les principes, les critiques et les chiffres invoqués par ces honorables représentants, a soutenu que la subvention de l'Etat devait être offerte et donnée aux chefs d'école, pour les mettre au pied du mur et pour travailler ainsi au désillusionnement des hommes qui ont combattu l'ordre social les armes à la main, et qui ont coûté à la société tout entière des torrents de sang et des milliards. M. Joseph Garnier a d'ailleurs indiqué les garanties qu'il fallait exiger de M. Considérant, qui a demandé, dans une des dernières séances de la Chambre, 15 à 1,800 hectares près de Paris, plus un capital de 4 à 5 millions, pour y établir une phalange fouriériste de cinq cents personnes.
Text: Séance du 10 mai 1849 (ASEP version)↩
La Société d'économie politique a décidé, dans cette séance, qu'elle chargeait son Bureau de la représenter au Congrès de la paix.
Dans cette même séance, présidée par M.Horace Say, et à laquelle assistaient plusieurs membres de l'Assemblée constituante qui se sont montrés (entre autres M. Victor Lefranc) très favorables à l'idée de ce congrès, la conversation a été également portée sur la question de savoir si l'État doit encourager les essais socialistes. La négative a été soutenue par MM. Bastiat, Howyn de Tranchère et Raudot. M. Bastiat a invoqué surtout le grand principe de la non-intervention de l'État, sans lequel la besogne et la dépense du gouvernement n'auraient pas de limites. M. Howyn De Tranchèrer fait des systèmes socialistes et de leur inanité une critique pleine d'esprit et de bon sens; enfin, M. Raudot a prouvé par quelques chiffres qu'avec les millions qu'absorberaient les chefs d'école pour faire prospérer quelques centaines de citoyens, le contribuable se verrait bientôt dans l'impossibilité de continuer ses largesses; et que, dans tous les cas, pût-il y suffire, il n'y aurait pas besoin de mécanisme sociétaire nouveau pour faire des heureux à raison de 10 à 20000 francs par tête.
M. Joseph Garnier, sans contester en rien les principes, les critiques et les chiffres invoqués par ces honorables représentants, a soutenu que la subvention de l'État devait être offerte et donnée aux chefs d'école, pour les mettre au pied du mur et pour travailler ainsi au désillusionnement des hommes qui ont combattu l'ordre social les armes à la main, et qui ont coûté à la société tout entière des torrents de sang et des milliards. M. Joseph Garnier a d'ailleurs indiqué les garanties qu'il fallait exiger de M. Considérant, qui a demandé, dans une des dernières séances de la Chambre, 15 à 1800 hectares près de Paris, plus un capital de 4 à 5 millions, pour y établir une phalange fouriériste de cinq cents personnes.
T.240 (1849.08.22) A speech on "Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement." (Longer English trans.)↩
French text acquired: use English version from CW3
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.240 (1849.08.22) A speech on "Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement." A speech at the Friends of Peace Conference in Paris, 22 Aug., 1849. Short version in French in Joseph Garnier, Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris en 1849; longer version in English in Report of the Proceedings of the Second General Peace Congress, held in Paris, on the 22nd, 23rd and 24th of August, 1849. [DMH] [CW3] ??
Original Edition
Joseph Garnier, Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris en 1849 : compte-rendu, séances des 22, 23, 24 Aout; - Résolutions adoptées; discours de Mm. Victor Hugo, Visschers, Rév. John Burnett; Rév. Asa Mahan, de l'Ohio; Henri Vincent, de Londres; Ath. Coquerel; Suringar, d'Amsterdam; Francisque Bouvet, Émile de Girardin; Ewart, membre du Parlement; Frédéric Bastiat; Richard Cobden, Elihu Burritt, Deguerry; Amasa Walker, de Massachussets; Ch. Hindley, membre du Parlement, etc., etc.; Compte-rendu d'une visite au Président de la République, de trois meetings en Angleterre; statistique des membres du congrès, etc.; précédé d'une Note historique sur le mouvement en faveur de la paix, par M. Joseph Garnier. (Paris: Guillaumin, 1850). This is a shorter version of Bastiat’s speech than in the English version below, pp. 25-26.
Translation used
Report of the Proceedings of the Second General Peace Congress, held in Paris, on the 22nd, 23rd and 24th of August, 1849. Compiled from Authentic Documents, under the Superintendence of the Peace Congress Committee. (London: Charles Gilpin, 5, Bishopsgate Street Without, 1849). Frédéric Bastiat's Speech on "Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement", pp. 49-52. Brief Bio of the Author: Frédéric Bastiat (1801-1850)
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
French version from Garnier↩
M. Bastiat, représentant du peuple. (L'orateur est accueilli avec des applaudissements réitérés. )
Messieurs, notre excellent et savant collègue, M. Coquerel, nous parlait tout à l'heure de cette maladie cruelle dont la France est travaillée, le scepticisme. Elle est le fruit de nos révolutions sans issue, de nos entreprises sans résultats, et de ce torrent de projets visionnaires qui a envahi notre politique. J'espère que ce mal sera passager, et, en tous cas, je ne sais rien de plus propre à le guérir que le spectacle imposant que j'ai maintenant devant les yeux; car si je considère le nombre et l'importance des hommes qui me font l'honneur de m'écouter, si je tiens compte qu'un grand nombre d'entre eux n'agissent pas en leur nom, mais au nom des villes et des provinces qui les ont délégués à ce Congrès, je n'hésite pas à dire que la cause de la paix réunit aujourd'hui dans cette assemblée plus de force religieuse, intellectuelle et morale, plus d'influence réelle qu'aucune autre cause quelconque n'en pourrait rassembler autour d'elle sur aucun point du globe. Oui, c'est là un grand et magnifique spectacle, et je ne crois pas que le soleil eu ait jamais éclairé de semblable. Voici des hommes qui ont traversé l'Atlantique; d'autres ont abandonné en Angleterre de vastes entreprises; d'autres encore ont quitté le sol tremblant de l'Allemagne ou les paisibles terres de la Hollande et de la Belgique. Paris est leur rendez-vous. Et qu'y viennent-ils faire? Sont-ils attirés par la cupidité, la vanité ou la curiosité, ces trois moteurs auxquels on a coutume d'attribuer les actions des fils d'Adam? Non, ils viennent, poussés par l'espoir de réaliser du bien pour l'humanité, les yeux bien ouverts sur les difficultés de l'entreprise, et sachant qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais au profit des générations futures. Hommes de dévouement et de foi, soyez les bienvenus sur cette terre de France. La foi est contagieuse comme le scepticisme. Mon pays ne vous fera pas défaut; lui aussi apportera son tribut à votre généreuse entreprise. (Applaudissements.)
(L'orateur s'attache à développer cette pensée, que, dans l'état actuel des esprits en France et en Europe, on né peut compter sur l'ordre intérieur si l'on n'égalise pas les charges entre les citoyens. Il prouve que l'égalité des charges est incompatible avec certains impôts très-productifs; que l'on ne saurait abolir les impôts que par le désarmement; d'où il conclut que le désarmement est la seule garantie de l'ordre intérieur aussi bien que de la paix extérieure. Après cette démonstration, l'orateur poursuit ainsi: )
J'ai prononcé le mot désarmement. Certes, c'est l'objet de nos vœux universels. Et cependant, par une de ces contradictions inexplicables du cœur humain, je suis sûr qu'il ne manque pas de personnes, tant en France qu'en Angleterre, qui le verraient réaliser avec peine. Que deviendrai!, diraient-elles, notre prépondérance? Consentirons-nous à perdre cette influence que nous avons acquise comme grande et puissante nation? O illusion fatale! Etrange interprétation des mots! Eh quoi! les grandes nations n'exercent-elles d'influence que par les canons et les baïonnettes? Est-ce que l'Angleterre ne doit pas son influence à son industrie, à son commerce, à sa richesse, à l'exercice de ses antiques et libres institutions? Est-ce qu'elle ne la doit pas surtout à ces gigantesques efforts que nous lui avons vu faire, avec tant de persévérance et de sagacité, pour réaliser le triomphe de quelques grands principes, tels que la liberté de la presse, l'extension des franchises électorales, l'émancipation catholique, l'abolition de l'esclavage, la liberté du commerce?
C'est par de tels exemples, j'ose le dire, que l'Angleterre exercera ce genre d'influence qui n'entraîne à sa suite ni désastres, ni haines, ni représailles, qui n'éveille d'autres sentiments que ceux de l'admiration et de la reconnaissance. Et quant à mon pays, je suis fier de le dire, il possède d'autres sources et de plus pures sources d'influence que celle des armes. Que dis-je? celle-ci pourrait être contestée, si l'on pressait la question et si l'on mesurait l'influence aux résultats. Mais ce qui ne peut être contesté, ce qu'on ne peut nous enlever, c'est l'universalité de notre langue, l'éclat incomparable de notre littérature, le génie de nos poètes, de nos philosophes, de nos historiens, de nos romanciers et même de nos feuilletonistes, le dévouement de nos patriotes. La France doit son influence à celte chaîne non interrompue de grands hommes qui commence à Montaigne, Descartes, Pascal, et passant par Bossuet, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, n'ira pas se perdre, grâce au Ciel, dans la tombe de Chateaubriand. Oh! que ma patrie ne craigne pas de perdre son influence tant que son sol sera capable de produire ce noble fruit qu'on nomme le génie, qu'on rencontre toujours du côté de la liberté et de la démocratie. Et en ce moment même, mes frères, vous qui êtes nés sous d'autres cieux et parlez une autre langue, ne voyez-vous pas toutes les illustrations de mon pays s'unir à vous pour le triomphe de la paix universelle? Ne sommes-nous pas présidés par ce grand et noble poète qui a eu la gloire et le privilège d'entraîner toute une génération dans les voies d'une littérature renovée? Ne déplorons-nous pas l'absence d'un autre poète orateur, à l'intelligence puissante, au noble cœur, qui, j'en suis sûr, regrette autant de ne pouvoir élever sa voix parmi nous, que nous regrettons de ne pas l'entendre? N'avons-nous pas emprunté à notre chansonnier ou plutôt à notre barde national notre touchante devise? ( Applaudissements. )
Ne comptons-nous pas dans nos rangs cet infatigable et courageux publiciste qui n'a pas attendu votre présence ici pour mettre au service de la non-intervention absolue l'immense publicité qu'il a su créer et la grande influence dont il dispose? Et n'avons-nous pas, parmi nous, des ministres de la religion chrétienne? ( Applaudissements. ) Au sein de cette illustre galerie, permettez-moi de réclamer une humble place pour mes frères en économie politique; car, messieurs, je crois sincèrement qu'aucune science n'apportera à la cause de la paix un contingent plus précieux. La religion et la morale ne cherchent pas si les intérêts humains sont entre eux harmoniques ou antagoniques. Elles disent aux hommes: « Vivez en paix, que cela vous soit profitable ou nuisible, car c'est votre devoir.» L'économie politique intervient et ajoute: « Vivez en paix, car vos intérêts sont harmoniques, et l'antagonisme apparent qui vous met souvent les armes à la main est une grossière erreur. » Sans doute, ce serait un noble spectacle de voir les hommes réaliser la paix aux dépens de leurs intérêts. Mais, pour qui connaît la faiblesse de notre nature, il est consolant de penser que l'Intérêt et le Devoir ne sont pas des forces hostiles, et le cœur se repose avec confiance dans cette maxime: Cherchez d'abord la justice, le reste vous sera donné par surcroît. (Applaudissements.)
Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement↩
M. Frederic Bastiat, member of the French National Assembly, spoke as follows :—
Gentlemen, our excellent and learned colleague, M. Coquerel, spoke to us a little while since, of a cruel malady with which French society is afflicted, namely, scepticism. This malady is the fruit of our long dissensions, of our revolutions which have failed to bring about the desired end, of our attempts without results, and of that torrent of visionary projects which has recently overflowed our policy. This strange evil will, I hope, be only temporary: at all events, I know of no more efficacious remedy for it, than the extraordinary spectacle which I have now before my eyes, for if I consider the number and the importance of the men who now do me the honour of listening to me, if I consider that many of them do not act in their individual capacity, but in the name of large constituencies, who have delegated them to this Congress, I have no hesitation in saying that the cause of peace unites to-day in this assembly, more religious, intellectual, and moral force, more positive power, than could be brought together for any other imaginable cause, in any other part of the world. Yes, this is a grand and magnificent spectacle, and I do not think that the sun has often shone on one equal to it in interest and importance. Here are men who have traversed the wide Atlantic: others have left vast undertakings in England, and others have come from the disturbed land of Germany, or from the peaceful soil of Belgium or of Holland. Paris is the place of their rendezvous. And what have they come to do ? Are they drawn hither by cupidity, by vanity, or by curiosity, those three motives to which are customarily attributed all the actions of the sons of Adam? No; they come, led on by the generous hope of being able to do some good to humanity, without having lost sight of the difficulties of their task, and knowing well that they are working less for themselves, than for the benefit of future generations. Thrice welcome then, ye men of faith, to the land of France. Faith is as contagious as scepticism. France will not fail you. She also will yield her tribute to your generous enterprise. At the present stage of the discussion, I shall only trespass on your time to make a few observations on the subject of disarmament. They have been suggested to me by a passage in the speech of our eloquent President, who said yesterday, that the cause of external peace was also that of internal order. He very reasonably based this assertion on the fact that a powerful military state is forced to exact heavy taxes, which engender misery, which in its turn engenders the spirit of turbulence and of revolution. I also wish to speak on the subject of taxes, and I shall consider them with regard to their distribution. That the maintenance of large military and naval forces requires heavy taxes, is a self-evident fact. But I make this additional remark: these heavy taxes, notwithstanding the best intentions on the part of the legislator, are necessarily most unfairly distributed ; whence it follows that great armaments present two causes of revolution—misery in the first place, and secondly, the deep feeling that this misery is the result of injustice. The first species of military taxation that I meet with is, that which is called, according to circumstances, conscription or recruitment. [195] The young man who belongs to a wealthy family, escapes by the payment of two or three thousand francs ; the son of an artizan or a labourer, is forced to throw away the seven best years of his life. Can we imagine a more dreadful inequality ? Do we not know that it caused the people to revolt even under the empire, and do we imagine that it can long survive the revolution of February ?
With regard to taxes, there is one principle universally admitted in France, namely, that they ought to be proportional to the resources and capabilities of the citizens. This principle was not only proclaimed by our last constitution, but will be found in the charter of 1830, as well as in that of 1814. Now, after having given my almost undivided attention to these matters, I affirm that in order that a tax may be proportional, it must be very moderate, and if the state is under the necessity of taking a very large part of the revenues of its citizens, it can only be done by means of an indirect contribution, which is utterly at variance with proportionality, that is to say, with justice. And this is a grave matter, gentlemen. The correctness of my statement may be doubted, but if it be correct, we cannot shut our eyes to the consequences which it entails, without being guilty of the greatest folly. I only know of one country in the world where all the public expenses, with very slight exceptions, are covered by a direct and proportional taxation. I refer to the State of Massachusetts. But there also, precisely, because the taxation is direct, and every body knows what he has to pay, the public expenditure is as limited as possible. The citizens prefer acting by themselves in a multitude of cases, in which elsewhere the intervention of the state would be required. If the government of France would be contented with asking of us five, six, or even ten per cent of our income, we should consider the tax a direct and proportional one. In such a case, the tax might be levied according to the declaration of the tax-payers, care being taken that these declarations were correct, although, even if some of them were false, no very serious consequences would ensue. But suppose that the treasury had need of 1,500 or 1,800 millions of money. Does it come directly to us and ask us for a quarter, a third, or a half of our incomes? No: that would be impracticable; and consequently, to arrive at the desired end, it has recourse to a trick, and gets our money from us without our perceiving it, by subjecting us to an indirect tax laid on food. And this is why the Minister of Finance, when he proposed to renew the tax on drinks, said that this tax had one great recommendation, that it was so entirely mixed up with the price of the article, that the tax-payer, as it were, paid without knowing it. This certainly is a recommendation of taxes on articles of consumption: but they have this bad characteristic, they are unequal and unjust, and are levied just in inverse proportion to the capabilities of the tax-payer. [196] For, whoever has studied these matters, even very superficially, knows well that these taxes are productive and valuable only when laid upon articles of universal consumption, such as salt, wine, tobacco, sugar and such like ; and when we speak of universal consumption, we necessarily speak of those things on which the labouring classes spend the whole of their small incomes. From this it follows, that these classes do not make a single purchase which is not increased to a great extent by taxation, while such is not the case with the rich.
Gentlemen, I venture to call your close attention to these facts. Large armaments necessarily entail heavy taxes : heavy taxes force governments to have recourse to indirect taxation. Indirect taxation cannot possibly be proportionate, and the want of proportion in taxation is a crying injustice inflicted upon the poor to the advantage of the rich. This question, then, alone remains to be considered : Are not injustice and misery, combined together, an always imminent cause of revolutions ? Gentlemen, it is no use to be willfully blind. At this moment, in France, the need which is most imperious and most universally felt, is doubtless that of order, and of security. Rich and poor, labourers and proprietors, all are disposed to make great sacrifices to secure such precious benefits, even to abandon their political affections and convictions, and, as we have seen, their liberty. But, in fine, can we reasonably hope, by the aid of this sentiment, to perpetuate, to systematize, injustice in this country? Is it not certain that injustice will, sooner or later, engender disaffection? disaffection all the more dangerous because it is legitimate, because its complaints are well-founded, because it has reason on its side, because it is supported by all men of upright minds and generous hearts, and, at the same time, is cleverly managed by persons whose intentions are less pure, and who seek to make it an instrument for the execution of their ambitious designs. We talk about reconciling the peoples. Ah! let us pursue this object with all the more ardour, because at the same time we seek to reconcile the classes of society. In France because, in consequence of our ancient electoral law?, [197] the wealthy class had the management of public business, the people think that the inequality of the taxes is the fruit of a systematic cupidity. On the contrary, it is the necessary consequence of their exaggeration. I am convinced that if the wealthy class could, by a single blow, assess the taxes in a more equitable manner, they would do so instantly. And in doing so, they would be actuated more by motives of justice than by motives of prudence. They do not do it, because they cannot, and if those who complain were the governors of the country, they would not be able to do it any more than those now in power ; for I repeat, the very nature of things has placed a radical incompatibility between the exaggeration and the equal distribution of taxes. There is, then, only one means of diverting from this country the calamities which menace it, and that is, to equalize taxation ; to equalize it, we must reduce it; to reduce it, we must diminish our military force. For this reason, amongst others, I support with all my heart the resolution in favour of a simultaneous disarmament.
I have just uttered the word "disarmament." This subject occupies the thoughts and the wishes of all ; and nevertheless, by one of those inexplicable contradictions of the human heart, there are some persons, both in France and England, who, I am sure, would be sorry to see it carried into effect. What will become, they will say, of our preponderance? Shall we allow the influence which, as a great and powerful nation, we possess, to depart from us? Oh, fatal illusion! Oh, strange misconception of the meaning of a word! What! can great nations exert an influence only by means of cannon and bayonets ? Does the influence of England consist not in her industry, her commerce, her wealth, and the exercise of her free and ancient institutions ? Does it not consist, above all, in those gigantic efforts, which we have seen made there, with so much perseverance and sagacity, for obtaining the triumph of some great principle, such as the liberty of the press, the extension of the electoral franchise, Catholic emancipation, the abolition of slavery, and free-trade. And as I have alluded to this last and glorious triumph of public opinion in England, as we have amongst us many valiant champions of commercial liberty, who, adopting the motto of Caesar,—
"Nil actum reputans, dum quid superesset agendum," [198]
have no sooner gained one great victory than they hasten to another still greater, let me be permitted to say for how immense a moral influence England is indebted to them, less on account of the object, all glorious as it was, which they attained, than on account of the means which they employed for obtaining it, and which they thus made known to all nations. Yes ! from this school the peoples may learn to ally moral force with reason ; there we ought to study the strategy of those pacific agitations which possess the double advantage of rendering every dangerous innovation impossible, and every useful reform irresistible.
By such examples as these, I venture to say, Great Britain will exercise that species of influence which brings no disasters, no hatreds, no reprisals in its train, but, on the contrary, awakens no feelings but those of admiration and of gratitude. And with regard to my own country, I am proud to say, it possesses other and purer sources of influence than that of arms. But even this last might be contested, if the question were pressed, and influence measured by results. But that which cannot be taken away from us, nor be contested for a moment, is the universality of our language, the incomparable brilliancy of our literature, the genius of our poets, of our philosophers, of our historians, of our novelists, and even of our feuilletonistes, and, last though not least, the devotedness of our patriots. France owes her true influence to that almost unbroken chain of great men which, beginning with Montaigne, Descartes, and Pascal, and passing on by Bossuet, Voltaire, Montesquieu and Rousseau, has not, thanks to heaven, come to an end in the tomb of Chateaubriand. [199] Ah ! let my country fear nothing for her influence, so long as her soil is not unable to produce that noble fruit which is called Genius, and which is ever to be seen on the side of liberty and democracy. And, at this moment, my brethren, you who were born in other lands, and who speak another language, do you not behold all the illustrious men of my country uniting with you to secure the triumph of universal peace? Are we not presided over by that great and noble poet, whose glory and privilege it has been to introduce a whole generation into the path of a renovated literature ? Do we not deplore the absence of that other poet-orator, of powerful intellect and noble heart, who, I am sure, will as much regret his inability to raise his voice amongst us, as you will regret not to have heard it ? Have we not borrowed from the songs of our national bard the touching device,—
"Peuples, formez une sainte alliance, 14778.Et donnez vous la main !" [200]
Do we not number in our ranks that indefatigable and courageous journalist, who did not wait for your arrival to place at the service of absolute non-intervention the immense publicity, and the immense influence which he has at his command ? And have we not amongst us, as fellow-labourers, ministers of nearly all Christian religions ? Amidst this illustrious galaxy, permit me to claim a humble place for my brethren, the political economists ; for, gentlemen, I sincerely believe that no science will bring a more valorous contingent to serve under the standard of peace than political economy. Religion and morality do not endeavour to discover whether the interests of men are antagonistic or harmonious. They say to them : Live in peace, no matter whether it be profitable or hurtful to you, for it is your duty to do so. Political economy steps in and adds : Live in peace, for the interests of men are harmonious, and the apparent antagonism which leads them to take up arms is only a gross error. Doubtless, it would be a noble sight to behold men realize peace at the expense of their material interests ; but for those who know the weakness of human nature, it is consoling to think that duty and interest are not here two hostile forces, and the heart rests with confidence upon this maxim: "Seek first after righteousness, and all things shall be added unto you." [201]
T.277 (1849.10.10) SEP: Séance de 10 oct. 1849 (limits to the functions of the state and the individual - GdM's new book) (Fr, PDF1, PDF2)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Compared with JDE and Annales SEP:
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.277 (1849.10.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 oct. 1849) (limits to the functions of the state - GdM's new book). In “Chronique,” JDE, T. 24, no. 103, Oct. 1849, pp. 315-16; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 74-75. Not in OC.
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
Text: JDE version↩
Chronique
Sommaire. — Progrès de l'enseignement économique. — Question des limites de l'action de l'Etat et de l'action individuelle débattue à la Société d'économie politique. — Meeting contre l'emprunt d'Autriche. — Discours de M. Cobden et de lord .Dudley Stuart. — Embarras de la Commission des finances. — Nouveaux projets sur le timbre et les patentes. — Plan financier de M. de Girardin. — Projet de loi sur les coalitions. — Triomphe de M. Charles Dupin sur M. Pelletier.— Mouvement de la presse quotidienne socialiste. —La politique: arrestation de M. Scialoja, etc.
Dans sa dernière séance, la Société des économistes a écouté avec intérêt des détails sur quelques progrès de l'enseignement de l'économie politique.
Le budget pour 1850, proposé par M. Passy. porte la création d'une chaire à l'Ecole forestière de Nancy, d'où les jeunes gens sortent imbus de ce socialisme réglementaire qui infecte nos administrations et qui ressemble tant à l'autre socialisme. Cette chaire sera désignée sous le nom bâtard d'économie forestière ; mais il y a tout lieu d'espérer que M. le ministre des finances ne laissera pas sacrifier, dans le programme, les notions de la science a des détails de technologie ou de manutention forestière, qui doivent avoir leur place dans un autre cours.
Le collège municipal (aujourd'hui Chaptal et naguère François 1er, avant les décrets de M. H. Carnot) que la ville de Paris a établi, il y a quelques années, pour soustraire une partie des enfants de la classe moyenne à l'influence de l'enseignement exclusivement classique, aura cette année un cours d'économie politique pour les élèves de sixième année. Ce cours, porté au programme sanctionné par le Conseil de l'Université lui-même, n'avait point encore pu être fait, parce que c'est la première fois que les cours de sixième année sont professés dans cette école. Nous remarquons également, dans la liste des études de cette sixième année, des leçons de statistique rationnelle.
Conformément à la loi qui a été votée par l'Assemblée constituante sur l'enseignement agricole, il y aura à l'Institut agronomique supérieur de Versailles un cours dit d'économie rurale. Le programme de ce cours a été dressé par une Commission mixte d'agriculteurs et d'économistes. Sous peu de jours, le ministre du commerce doit faire connaître les termes de ce programme ainsi que l'époque du concours, qui aura bientôt lieu.
Très-probablement aussi, le collège Arménien établi à Paris aura un cours d'économie politique.
Dans un de ses derniers numéros la Gazette de Madrid, en annonçant l'ouverture du cours de statistique fondé depuis quelques années par la Société économique de Madrid, disait que les élèves, pour être admis, devaient avoir étudié les mathématiques et l'économie politique. Et, en effet, cette dernière science est maintenant cultivée dans la plupart des Universités espagnoles. Nous en avons acquis l'assurance en lisant, dans le même journal, l'annonce du dépôt à tous les secrétariats de ces Universités, de la traduction des Éléments d'économie politique de M. Joseph Garnier, que vient de publier, en espagnol, M. Eugène de Ochoa, employé au ministère du commerce de Madrid.
M. H. Say a ensuite rappelé que l'économie politique a été introduite récemment dans le programme pour l'admission des auditeurs au Conseil d'État, comme elle l'avait été, il y a deux ans, par les efforts de M. Michel Chevalier, dans le programme pour l'admission des élèves consuls.
Après ces communications, M. Say, qui présidait, a proposé de porter la conversation sur un sujet très-délicat (qui avait déjà été abandonné dans une séance précédente par une digression relative à l'assistance), sur la question de savoir quelles sont les limites des fonctions de l'État et de l'action individuelle ; si ces limites sont bien tranchées, et s'il y a moyen de les préciser. Malheureusement, comme M. Say a dit que ce sujet lui était suggéré par la lecture de l'ouvrage que vient de publier M. Molinari (Les Soirées de Saint-Lazare, dialogues sur divers principes d'économie sociale), il n'en a pas fallu davantage pour que la question principale fût encore une fois abordée très-timidement et que la discussion portât sur divers autres sujets traités par M. de Molinari, et notamment sur le principe d'expropriation pour cause d'utilité publique, que cet écrivain a combattu de la manière la plus absolue. Néanmoins, la conversation a été à la fois très-vive et très-instructive. MM. Coquelin, Bastiat, de Parieu, Wolowski, Dunoyer, Sainte-Beuve, représentant de l'Oise (qui assistait pour la première fois à la réunion, ainsi que M. Lopès-Dubec, représentant de la Gironde), Rodet et Raudot, de Saône-et-Loire, ont successivement demandé la parole.
M. Coquelin, ayant pris pour point de départ de la discussion l'opinion de M. de Molinari (qui pense que, dans l'avenir, la concurrence pourra s'établir entre des Compagnies d'assurance, capables de garantir la sécurité aux citoyens qui seraient leurs clients), a fait remarquer que M. de Molinari n'avait pas pris garde que, sans une autorité suprême, la justice n'avait pas de sanction, et que la concurrence, qui est le seul remède contre la fraude et la violence, qui seule est capable de faire triompher la nature des choses dans les rapports des hommes entre eux, ne pouvait pas exister sans cette autorité suprême, sans l'Etat. Au-dessous de l'Etat, la concurrence est possible et féconde ; au-dessus, elle est impossible à appliquer et même à concevoir. M. Bastiat a parlé dans le même sens que M. Coquelin; il croit que les fonctions de l'Etat doivent être circonscrites dans la garantie de la justice et de la sécurité; mais, comme cette garantie n'existe que par la force, et que la force ne peut être que l'attribut d'un pouvoir suprême, il ne comprend pas la société avec un pareil pouvoir attribué à des corps égaux entre eux, et qui n'auraient pas un point d'appui supérieur. M. Bastiat s'est ensuite demandé si l'exposé bien net, bien clair et bien palpable de cette idée, que l'Etat ne doit avoir d'autre fonction que la garantie de la sécurité, ne serait pas une propagande utile et efficace en présence du socialisme qui se manifeste partout, même dans l'esprit de ceux qui voudraient le combattre.
M. de Parieu , suivant M. de Molinari dans la discussion d'un idéal très-lointain, pense que la question soulevée par ce dernier est celle de la lutte entre la liberté et la nationalité. Or, il n'est pas impossible que ces deux principes se concilient assez naturellement. Déjà la Suisse offre des exemples de populations qui se séparent d'anciens cantons, pour fonder des Etats indépendants. Ils se décentralisent d'une certaine manière ; mais ils restent unis sous le rap- port de la nationalité. M. Rodet a également cité les exemples analogues que présente l'histoire des développements de l'Union américaine.
M. Wolowski a émis l'opinion que la civilisation des peuples comporte la coexistence de deux principes marchant parallèlement : le principe de la liberté de l'individu, et le principe de l'état social, qu'il ne faut pas méconnaître, et qui est doué de sa vie propre. L'honorable représentant ne pense pas que l'avenir soit au morcellement des nations, il croit au contraire à leur agrandissement par voie d'annexions successives.
M. Dunoyer, comme M. Coquelin et M. Bastiat, pense que M. de Molinari s'est laissé égarer par des illusions de logique; et que la concurrence entre des compagnies gouvernementales est chimérique, parce qu'elle conduit à des luttes violentes.Or, ces luttes ne finiraient que par la force, et il est plus prudent de laisser la force là où la civilisation l'a mise, dans l'Etat. Toutefois, M. Dunoyer croit que la concurrence s'introduit en fait dans le gouvernement par le jeu des institutions représentatives. En France, par exemple, tous les partis se font une véritable concurrence, et chacun d'eux offre ses services au public, qui choisit bien réellement toutes les fois qu'il vote au scrutin. M. Dunoyer a voulu dire aussi que si M. de Molinari avait été trop absolu en proscrivant toute espèce d'expropriation pour cause d'utilité publique, on avait été, dans ces derniers temps, trop enclin à violer la propriété; il a cité les tendances du gouvernement avant février 1848, ainsi que les doctrines émises au sein de la Constituante, avec l'adhésion, pour ainsi dire, de la majorité. M. Sainte-Beuve et M. Bastiat n'ont pas accepté l'accusation dirigée contre la majorité d'une assemblée à laquelle ils ont appartenu. Toujours est-il que si, en fait, l'Assemblée constituante n'a pris aucune détermination dans le sens dont a parlé M. Dunoyer, il y a tout lieu de croire que ce n'est pas par un jugement parfaitement sain de la majorité, que ce n'est pas par raison économique, mais bien par esprit de réaction politique contre l'extrême gauche, dominée par le socialisme, qu'elle a agi ainsi.
M. Raudot, qui a parlé le dernier, a partagé l'avis de M. Wolowski sur la probabilité en faveur de la formation d'États de plus en plus grands dans l'avenir; mais il pense que cette concentration conduirait les peuples à la plus grande tyrannie et à la plus grande misère, si l'Etat continuait à vouloir tout absorber et à laisser les municipalités sous une tutelle qui énerve la vie des communes et engendre le socialisme, dont on commence à comprendre les dangers.
Comme on le voit, la question primitive indiquée par M. Say n'a pas été spécialement traitée, mais plusieurs membres de la réunion se sont promis d'y revenir.
Text: ASEP version↩
Séance du 10 octobre 1849.
La Société d'économie politique écoute avec intérêt des détails sur quelques progrès faits dans l'enseignement de l'économie politique.
Le budget pour 1850, proposé par M. Passy, porte la création d'une chaire à l'École forestière de Nancy, d'où les jeunes gens sortent imbus de ce socialisme réglementaire qui infecte nos administrations et qui ressemble tant à l'autre socialisme. Cette chaire sera désignée sous le nom bâtard d'économie forestière; mais il y a tout lieu d'espérer que M. le ministre des finances ne laissera pas sacrifier, dans le programme, les notions de la science à des détails de technologie ou de manutention forestière, qui doivent avoir leur place dans un autre cours.
Le Collège municipal (aujourd'hui Chaptal et naguère François Ier, avant les décrets de M. H. Carnot) que la ville de Paris a établi, il y a quelques années, pour soustraire une partie des enfants de la classe moyenne à l'influence de l'enseignement exclusivement classique, aura cette année un cours d'économie politique pour les élèves de sixième année. Ce cours, porté au programme sanctionné par le conseil de l'Université lui-même, n'avait point encore pu être fait, parce que c'est la première fois que les cours de sixième année sont professés dans cette école. Nous remarquons également, dans la liste des études de cette sixième année, des leçons de statistique rationnelle.
Conformément à la loi qui a été votée par l'Assemblée constituante sur l'enseignement agricole, il y aura à l'Institut agronomique supérieur de Versailles un cours dit d'économie rurale. Le programme de ce cours a été dressé par une commission mixte d'agriculteurs et d'économistes. Sous peu de jours, le ministre du commerce doit faire connaître les termes de ce programme ainsi que l'époque du concours, qui aura lieu bientôt.
Très probablement aussi, le collège Arménien établi à Paris aura un cours d'économie politique.
Dans un de ses derniers numéros la Gazette de Madrid, en annonçant l'ouverture du cours de statistique fondé depuis quelques années par la Société économique de Madrid, disait que les élèves, pour être admis, devaient avoir étudié les mathématiques et l'économie politique. Et, en effet, cette dernière science est maintenant cultivée dans la plupart des universités espagnoles. Nous en avons acquis l'assurance en lisant, dans le même journal, l'annonce du dépôt, à tous les secrétariats de ces universités, de la traduction des Eléments d'économie politique de M. Joseph Garnier, que vient de publier, en espagnol, M. Eugène de Ochoa, employé au ministère du commerce de Madrid.
M. H. Say a ensuite rappelé que l'économie politique a été récemment introduite dans le programme pour l'admission des auditeurs au conseil d'État, comme elle l'avait été, il y a deux ans, par les efforts de M. Michel Chevalier, dans le programme pour l'admission des élèves-consuls.
Après ces communications, M. Say, qui présidait, a proposé de porter la conversation sur un sujet très délicat (qui avait déjà été abandonné dans une séance précédente par une digression relative à l'assistance), sur la question de savoir quelles sont les limites des fonctions de l’État et de l'action individuelle; si ces limites sont bien tranchées et s'il y a moyen de les préciser. Malheureusement, comme M. Say a dit que ce sujet lui était suggéré par la lecture de l'ouvrage que vient de publier M. de Molinari (les Soirées de la rue Saint-Lazare, entretiens sur les lois économiques), il n'en a pas fallu davantage pour que la question principale fût encore une fois abordée très timidement et que la discussion portât sur divers autres sujets traités par M. de Molinari, et notamment sur le principe d'expropriation pour cause d'utilité publique, que cet écrivain a combattu de la manière la plus absolue. Néanmoins, la conversation a été à la fois très vive et très instructive. MM. Coquelin, Bastiat, De Parieu, Wolowski, Dunoyer, Sainte-beuve, représentant de l'Oise (qui assistait pour la première fois à la réunion, ainsi que M. Lopès-dubec, représentant de la Gironde), Rodet et Raudot, de Saône-et-Loire, ont successivement demandé la parole.
M. Coquelin, ayant pris pour point de départ de la discussion l'opinion de M. de Molinari (qui pense que, dans l'avenir, la concurrence pourra s'établir entre des compagnies d'assurance, capables de garantir la sécurité aux citoyens qui seraient leurs clients), a fait remarquer que M. de Molinari n'avait pas pris garde que, sans une autorité suprême, la justice n'avait pas de sanction, et que la concurrence, qui est le seul remède contre la fraude et la violence, qui seule est capable de faire triompher la nature des choses dans les rapports des hommes entre eux, ne pouvait pas exister sans cette autorité suprême, sans l'État. Au-dessous de l'Etat, la concurrence est possible et féconde; au-dessus, elle est impossible à appliquer et même à concevoir.
M. Bastiat a parlé dans le même sens que M.Coquelin; il croit que les fonctions de l'Etat doivent être circonscrites dans la garantie de la justice et de la sécurité; mais, comme cette garantie n'existe que par la force, et que la force ne peut être que l'attribut d'un pouvoir suprême, il ne comprend pas la société avec un pareil pouvoir attribué à des corps égaux entre eux, et qui n'auraient pas un point d'appui supérieur. M. Bastiat s'est ensuite demandé si l'exposé bien net, bien clair et bien palpable de cette idée, que l'État ne doit avoir d'autre fonction que la garantie de la sécurité, ne serait pas une propagande utile et efficace en présence du socialisme qui se manifeste partout, même dans l'esprit de ceux qui voudraient le combattre.
M.E. De Parieu, suivantM. de Molinari dans la discussion d'un idéal très lointain, pense que la question soulevée par ce dernier est celle de la lutte entre la liberté et la nationalité. Or, il n'est pas impossible que ces deux principes se concilient assez naturellement. Déjà la Suisse offre des exemples de populations qui se séparent d'anciens cantons, pour fonder des États indépendants. Ils se décentralisent d'une certaine manière ; mais ils restent unis sous le rapport de la nationalité. M. Rodet a également cité les exemples analogues que présente l'histoire des développements de l'Union américaine.
M. Wolowski a émis l'opinion que la civilisation des peuples comporte la coexistence de deux principes marchant parallèlement : le principe de la liberté de l'individu et le principe de l'état social, qu'il ne faut pas méconnaître, et qui est doué de sa vie propre. L'honorable représentant ne pense pas que l'avenir soit au morcellement des nations, il croit au contraire à leur agrandissement par voie d'annexions successives.
M. Dunoyer, comme MM. Coquelin et Bastiat, pense que M. de Molinari s'est laissé égarer par des illusions de logique; et que la concurrence entre des compagnies gouvernementales est chimérique, parce qu'elle conduit à des luttes violentes. Or, ces luttes ne finiraient que par a force, et il est plus prudent de laisser la force là où la civilisation l'a mise, dans l'État. Toutefois, M. Dunoyer croit que la concurrence s'introduit en fait dans le gouvernement par le jeu des institutions représentatives. En France, par exemple, tous les partis se font une véritable concurrence, et chacun d'eux offre ses services au public, qui choisit bien réellement toutes les fois qu'il vote au scrutin. M. Dunoyer a voulu dire aussi que si M. de Molinari avait été trop absolu en proscrivant toute espèce d'expropriation pour cause d'utilité publique, on avait été, dans ces derniers temps, trop enclin à violer la propriété; il a cité les tendances du gouvernement avant février 1848, ainsi que les doctrines émises au sein de la Constituante, avec l'adhésion, pour ainsi dire, de la majorité.
MM. Sainte-Beuve et Bastiat n'ont pas accepté l'accusation dirigée contre la majorité d'une assemblée à laquelle ils ont appartenu. Toujours est-il que si, en fait, l'Assemblée constituante n'a pris aucune détermination dans le sens dont a parlé M. Dunoyer, il y a tout lieu de croire que ce n'est pas par un jugement parfaitement sain de la majorité, ou par raison économique, mais bien par esprit de réaction politique contre l'extrême gauche, dominée par le socialisme, qu'elle a agi ainsi.
M. Raudot, qui a parlé le dernier, a partagé l'avis de M. Wolowski sur la probabilité en faveur de la formation d'Etats de plus en plus grands dans l'avenir; mais il pense que cette concentration conduirait les peuples à la plus grande tyrannie et à la plus grande misère, si l'État continuait à vouloir tout absorber et à laisser les municipalités sous une tutelle qui énerve la vie des communes et engendre le socialisme, dont on commence à comprendre les dangers.
Gomme on le voit, la question primitivement indiquée par M. H. Say n'a pas été spécialement traitée; mais plusieurs membres de la réunion se sont promis d'y revenir.
T.242 (1849.11.10) SEP: Séance de 10 nov. 1849 (on war, disarmament, and socialism) (Fr, PDF1, PDF2)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Checked against ASEP PDF:
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.242 (1849.11.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 nov. 1849) (on disarmament and the English peace movement). In “Chronique,” JDE, 15 Nov. 1849, T. XXIV, pp. 438-440; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 86-90. Not in OC.
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
[438]
Sommaire. — La question du désarmement à la Société d'économie politique; caractère des guerres actuelles; socialisme, recrutement. — Vœu remarquable du jury de l'Exposition des produits de l'industrie. — Distribution des récompenses; préjugé et injustice. — Le discours de M. le président de la République. — La révolution ministérielle.—Les idées de M. Fould et de la Commission des finances. — La chaire d'économie de l'Institut de Versailles. Les votes de l'Assemblée i Chemin d'Avignon, caisses de retraite, instruction publique.
Bien que plusieurs membres de l'Assemblée législative n'aient pas pu venir à la dernière séance de la Société des économistes, bien que le secrétaire eût fait connaître des lettres et de avis touchant les circonstances qui empêchaient MM. le duc d'Harcourt, Vivien, Léon Faucher, Walras, de Tracy etPassy de se rendre au dîner annuel, et malgré l'éloignement de Paris de quelques autres membres, la réunion a été une de celles qui ont été les plus nombreuses, les plus brillantes, les plus animées. On y remarquait, pour la première fois, la présence de M. Fournier, représentant de Marseille, et celle de M. Dupuit, ingénieur en chef des ponts et chaussées, l'auteur d'un article de critique très-remarqué, que nous avons publié dans un récent numéro, sur la législation actuelle des voies de transport.
Au dessert, M. Dunoyer, président, ayant invité M. Horace Say à donner quelques détails sur l'intéressant voyage des Amis de la paix en Angleterre, la conversation a pris cette direction et s'est prolongée jusqu'à dix heures et demie, suivie par tous les membres avec un vif intérêt.
M. Horace Say a donné à son récit un charme qui témoignait de l'excellent souvenir qu'il rapportait des trois meetings de Londres, de Birmingham et de Manchester. Il a fait comprendre à la réunion combien les efforts combinés des quakers et des dissenters, avec ceux des partisans des idées économiques, rendaient ce mouvement en faveur de la paix sérieux et digne d'attention. M. Frédéric Bastiat a dit, à son tour, que la classe moyenne et la classe populaire s'aperçoivent bien clairement en Angleterre que les gros armements sont une duperie, comme elles se sont aperçues que les hauts tarifs étaient une duperie, comme elles commencent à s'apercevoir que le système colonial est une duperie; il a ajouté que toutes ces choses : armements, protection, colonies et fortes dépenses alimentent chez nous le socialisme.
Ces assertions ont trouvé dans M. Gabriel Lafond un contradicteur assez endurci. L'ancien compagnon de Dumont-D’Urville a fait une dissertation pleine d'érudition géographique pour prouver que les Anglais étaient surtout friands de bonnes intentions maritimes, et qu'ils n'avaient émancipé les esclaves que par calcul commercial. Sans entrer dans cet ordre d'idées, M. Dunoyer avait [439] fait remarquer que l'agitation des amis de la paix, excellente en elle-même, était néanmoins venue à un moment inopportun, alors que la guerre n'est plus internationale, mais intérieure, et que le désarmement ne se ferait {plus au détriment de la guerre étrangère, mais peut-être à l'avantage des ennemis de l'ordre intérieur et de l'ordre social.
Répondant à ces deux membres, M. Joseph Garnier a cité comme faits qui se sont passés sous nos yeux depuis deux ans : la guerre internationale de l'Allemagne ou plutôt de la Prusse et du Danemarck ; la guerre de pure nationalité entre l'Italie et l'Autriche; une guerre semblable entre la Hongrie et l'Autriche; l'intervention internationale de la Russie en faveur de l'Autriche et contre la Hongrie; l'intervention internationale de la France, de l'Autriche et de l'Espagne dans les affaires d'Italie. Tous ces sièges, tous ces assauts, toutes ces dépenses, toutes ces dévastations, toutes ces boucheries, tout ce carnage, n'ont-ils pas pour point de départ le système d'intervention internationale et le système de recours aux armes que veulent abolir les amis de la paix?
Quant au socialisme, M. Joseph Garnier, dépassant même l'avis de M. Bastiat, a pensé que non-seulement les fortes armées permanentes fortifient le socialisme en nécessitant d'excessives dépenses qui allourdissent les impôts et empêchent d'utiles réformes; mais encore qu'elles sont, comme le reste de la société, attaquables et attaquées par ce ver rongeur; qu’on a tort, selon lui, de compter sur la force armée pour défendre à toujours l'ordre social ; qu'il faudrait surtout attaquer l'erreur par l'enseignement et la discussion, — parce que l'erreur socialiste, à l'esprit de révolution près, est dans la masse de la nation, dans le sein de la réaction proprement dite, et jusque dans la majorité parlementaire dont cinquante membres au plus lui paraissent complètement sains et purs de socialisme, très-apparent chez les uns, bâtard ou latent chez les autres, mais dangereux chez tous. Nous devons dire que ces assertions, appuyées par M. Coquelin, n'ont pas reçu une générale approbation.—M. Joseph Garnier a aussi répondu à M. Gabriel Lafond que la perfide Albion, loin d'avoir inspiré l'émancipation des esclaves, avait été vaincue par les hommes religieux de l'Angleterre, les mêmes qui ont fait alliance avec les ligueurs dans les questions du free trade, les mêmes qui se joignent à eux dans la question des réformes financières, de la réforme coloniale et du désarmement, et que pour faire proclamer l'égalité, ils n'ont nullement songé aux intérêts des colonies, mais à ceux de l'humanité, en disant, périssent les colonies plutôt que l'Évangile!
M. Natalis Rondot avait déjà répondu à M. Gabriel Lafond, au sujet des points maritimes occupés par les Anglais, que, lors de son voyage en Chine, il avait pu juger par lui-même et par le sentiment d'autres navigateurs, combien il était utile que l'Angleterre eût pris possession sur divers parages du globe, puisqu'on était ainsi sûr d'y trouver une protection que d'autres nations n'y eussent point établie sans elle.
M. Wolowski a pensé qu'il ne fallait pas confondre le socialisme d'amélioration avec le socialisme spoliateur, contre lequel il faudrait toujours avoir une force armée toute prête. Il n'a vu de possibilité que pour un désarmement partiel, et encore l'Angleterre ne lui a-t-elle pas paru la seule nation à imiter. C'est aussi du Nord que doit venir la peur...—Il est à regretter, ce nous semble, que M. Wolowski appelle du nom de socialisme les aspirations vers le [440] progrès, tandis qu'on devrait, scientifiquement du moins, réserver cette dénomination à l'action de tous ceux qui, le sachant ou l'ignorant, voulant employer la conviction ou la force, tendent au communisme. Il y a quelque danger à pactiser ainsi avec le diable. En ce qui touche le désarmement, on pourrait faire remarquer à l'honorable représentant de la Seine que la France étant le peuple le plus belliqueux et le plus redouté de l'Europe, c'est à lui à donner l'exemple. Ainsi l'Angleterre devrait faire pour la marine. 11 faut bien que quelqu'un commence.
AprèsM.Wolowski, l'honorable M. de La Farelle, correspondant de l'Institut et ancien membre de la Chambre des députés, a très-clairement résumé la discussion, et s'est ensuite demandé si la solution ne se trouvait pas dans une meilleure organisation des armées, organisation qui emprunterait en même temps au système d'enrôlement volontaire des Anglais pour les forces à opposer aux dangers du dehors, au système prussien de la landwher (sic) pour les forces à opposer aux dangers intérieurs. M. de Colmont, ancien secrétaire général du ministre des finances, a appuyé M. de La Fa Farelle, et a formulé son opinion en disant qu'il ne s'agissait que d'une meilleure assiette de l'impôt du recrutement.
La soirée touchant à sa fin, M. Raudot, représentant de Saône-et-Loire, n'a voulu ajouter que quelques mots pour dire qu'il croyait, lui aussi, la société et ses représentants officiels plus empêtrés qu'ils ne le croient dans les ambages socialistes. (Le rire parcourt en ce moment un des coins de la table, où un membre de la société, ancien ministre, raconte comme quoi M. Raudot lui-même est réputé socialiste par les partisans de la centralisation, auxquels M. Raudot a publiquement adressé avec raison des reproches de communisme.) M. Raudot a encore dit qu'il ne faudrait pas oublier, quand on s'occupera de réorganiser la force publique, que l'armement de tous les citoyens pour obtenir la paix publique est une illusion. Lorsque tous les citoyens sont armés, les perturbateurs le sont aussi, et alors il faut, pour surveiller les populations ayant fusil, des milices régulières plus nombreuses que pour surveiller des populations sans armes. C'est une violation du grand principe de la division du travail.
Text: ASEP version↩
Séance du 10 novembre 1849.
Bien que plusieurs membres de l'Assemblée législative n'aient pas pu venir à cette séance, bien que le secrétaire eût fait connaître des lettres et des avis touchant les circonstances qui empêchaient MM. le duc d'Harcourt, Aug. Vivien, Léon Faucher, A. Walras, V. de Tracy et Hipp. Passy, de se rendre au dîner annuel, enfin malgré l'éloignement de Paris de quelques autres membres, la réunion a été une de celles qui ont été les plus nombreuses, les plus brillantes, les plus animées. On y remarquait, pour la première fois, la présence de M. Fournier, représentant de Marseille, et celle de M. Dupuit, ingénieur en chef des ponts et chaussées, l'auteur d'un article de critique très remarqué, que nous avons publié dans un récent numéro, sur la législation actuelle des voies de transport.
Au dessert, M. Dunoyer, président, ayant invité M. Horace Say à donner quelques détails sur l'intéressant voyage des Amis de la paix en Angleterre, la conversation a pris cette direction et s'est prolongée jusqu'à dix heures et demie, suivie par tous les membres avec un vif intérêt.
M. Horace Say a donné à son récit un charme qui témoignait de l'excellent souvenir qu'il rapportait des trois meetings de Londres, de Birmingham et de Manchester. Il a fait comprendre à la réunion combien les efforts combinés des quakers et des dissenters, avec ceux des partisans des idées économiques, rendaient ce mouvement en faveur de la paix sérieux et digne d'attention. M. Frédéric Bastiat a dit, à son tour, que la classe moyenne et la classe populaire s'aperçoivent bien clairement en Angleterre que les gros armements sont une duperie, comme elles se sont aperçues que les hauts tarifs étaient une duperie, comme elles commencent à s'apercevoir que le système colonial est une duperie ; il a ajouté que toutes ces choses: armements, protection, colonies et fortes dépenses, alimentent chez nous le socialisme.
Ces assertions ont trouvé dans M. Gabriel Lafond un contradicteur assez endurci. L'ancien compagnon de Dumont-d'Urville a fait une dissertation pleine d'érudition géographique pour prouver que les Anglais étaient surtout friands de bonnes intentions maritimes, et qu'ils n'avaient émancipé les esclaves que par calcul commercial. Sans entrer dans cet ordre d'idées, M. Dunoyer avait fait remarquer que l'agitation des Amis de la paix, excellente en elle-même, était néanmoins venue à un moment inopportun, alors que la guerre n'est plus internationale, mais intérieure, et que le désarmement ne se ferait plus au détriment de la guerre étrangère, mais peut-être à l'avantage de ses ennemis de l'ordre intérieur et de l'ordre social.
Répondant à ces deux membres, M. Joseph Garnier a cité comme faits qui se sont passés sous nos yeux depuis deux ans : la guerre internationale de l'Allemagne ou plutôt de la Prusse et du Danemark; la guerre de pure nationalité entre l'Italie et l'Autriche; une guerre semblable entre la Hongrie et l'Autriche; l'intervention internationale de la Russie en faveur de l'Autriche et contre la Hongrie; l'intervention internationale de la France, de l'Autriche et de l'Espagne dans les affaires d'Italie. Tous ces sièges, tous ces assauts, toutes ces dépenses, toutes ces dévastations, toutes ces boucheries, tout ce carnage, n'ont-ils pas pour point de départ le système d'intervention internationale et le système de recours aux armes que veulent abolir les Amis de la paix?
Quant au socialisme, M. Joseph Garnier, dépassant même l'avis de M. Bastiat, a pensé que non seulement les fortes armées permanentes fortifient le socialisme en nécessitant d'excessives dépenses qui alourdissent les impôts et empêchent d'utiles réformes; mais encore qu'elles sont, comme le reste de la société, attaquables et attaquées par ce ver rongeur; qu'on a tort, selon lui, de compter sur la force armée pour défendre à toujours l'ordre social; qu'il faudrait surtout attaquer l'erreur par l'enseignement et la discussion, parce que l'erreur socialiste, à l'esprit de révolution près, est dans la masse de la nation, dans le sein de la réaction proprement dite, et jusque dans la majorité parlementaire, dont cinquante membres au plus lui paraissent complètement sains et purs de socialisme, très apparent chez les uns, bâtard ou latent chez les autres, mais dangereux chez tous. Nous devons dire que ces assertions, appuyées par M. Coquelin, n'ont pas reçu une générale approbation. — M. Joseph Garnier a aussi répondu à M. Gabriel Lafond que la perfide Albion, loin d'avoir inspiré l'émancipation des esclaves, avait été vaincue par les hommes religieux de l'Angleterre, les mêmes qui ont fait alliance avec les ligueurs dans les questions du free-trade, les mêmes qui se joignent à eux dans la question des réformes financières, de la réforme coloniale et du désarmement, et que, pour faire proclamer l'égalité, ils n'ont nullement songé aux intérêts des colonies, mais à ceux de l'humanité, en disant : Périssent les colonies plutôt que l'Évangile!
M. Natalis Rondot avait déjà répondu à M. Gabriel Lafond, au sujet des points maritimes occupés par les Anglais, que, lors de son voyage en Chine, il avait pu juger par lui-même et par le sentiment d'autres navigateurs, combien il était utile que l'Angleterre eût pris possession sur divers parages du globe, puisqu'on était ainsi sûr d'y trouver un instrument de protection que d'autres nations n'y eussent point établi sans elle.
M. Wolowski a pensé qu'il ne fallait pas confondre le socialisme d'amélioration avec le socialisme spoliateur, contre lequel il faudrait toujours avoir une force armée toute prête. Il n'a vu de possibilité que pour un désarmement partiel, et encore l'Angleterre ne lui a-t-elle pas paru la seule nation à imiter. C'est aussi du Nord que doit venir la peur...
Après M. Wolowski, l'honorable M. de la Farelle, correspondant de l'Institut et ancien membre de la Chambre des députés, a très clairement résumé la discussion, et s'est ensuite demandé si la solution ne se trouvait pas dans une meilleure organisation des armées, organisation qui emprunterait en même temps au système d'enrôlement volontaire des Anglais pour les forces à opposer aux dangers du dehors, au système prussien de la landwehr pour les forces à opposer aux dangers intérieurs. M. de Colmont, ancien secrétaire général du ministre des finances, a appuyé M. de la Farelle et a formulé son opinion en disant qu'il ne s'agissait que d'une meilleure assiette de l'impôt du recrutement.
La soirée touchant à sa fin, M. Raudot, représentant de Saône-et-Loire, n'a voulu ajouter que quelques mots pour dire qu'il croyait, lui aussi, la société et ses représentants officiels plus empêtrés qu'ils ne le croient dans les ambages socialistes. (Le rire parcourt en ce moment un des coins de la table, où un membre de la Société, ancien ministre, raconte comme quoi M. Raudot lui-même est réputé socialiste par les partisans de la centralisation, auxquels M. Raudot a publiquement adressé avec raison des reproches de communisme.) M. Raudot a encore dit qu'il ne faudrait pas oublier, quand on s'occupera de réorganiser la force publique, que l'armement de tous les citoyens pour obtenir la paix publique est une illusion. Lorsque tous les citoyens sont armés, les perturbateurs le sont aussi, et alors il faut, pour surveiller les populations ayant fusil, des milices régulières plus nombreuses que pour surveiller des populations sans armes. C'est une violation du grand principe de la division du travail.
Dans le cours de la même séance, M. Wolowski, qui est un des membres du jury de l'Exposition des produits de l'industrie, a communiqué à la réunion un vœu remarquable émis par le jury, grâce aux efforts de MM. Wolowski, Blanqui, N. Rondot, Persoz, et des autres amis intelligents du progrès qu'il renferme dans son sein.
Le jury a émis le vœu que le gouvernement abaisse tous les tarifs, autant que la réduction peut se combiner avec la production nationale. Nous savons tout ce qui peut se cacher de protectionnisme sous ces mots, et nous aurions préféré quelque chose de plus franc; quelque chose, comme la suppression des prohibitions, que nos amis avaient d'abord demandée; mais, quoi qu'il en soit, il est maintenant un fait d'une grande portée : c'est que la Commission des tissus, la plus importante du jury, à la majorité de dix-sept voix contre deux, et la majorité du jury lui-même ont demandé au gouvernement l’abaissement des tarifs, pour tous les produits qui n'auraient pas à en souffrir. Or, il est patent que l'abaissement des tarifs, non seulement ne nuirait pas à la production nationale, mais aiderait puissamment cette production.
Discours sur la répression des coalitions industrielles [17 Nov. 1849] [CW2.17]↩
BWV
1849.11.17 “Coalitions industrielles” (Speech on The Repression of Industrial Unions [part of the debate in the Chamber on 17 November 1849] [OC5.11, p. 494] [CW2]
Discours sur la répression des coalitions industrielles [1]
1849
Citoyens représentants,
Je viens appuyer l’amendement de mon honorable ami M. Morin ; je ne puis pas l’appuyer sans examiner aussi le projet de la commission. Il est impossible de discuter l’amendement de M. Morin, sans entrer, pour ainsi dire involontairement, dans la discussion générale, car cela oblige à discuter aussi la proposition de la commission.
En effet, l’amendement de M. Morin n’est pas seulement une modification à la proposition principale ; il oppose un système à un autre système, et pour se décider il faut bien comparer.
Citoyens, je n’apporte dans cette discussion aucun esprit de parti, aucun préjugé de classe, je ne parlerai pas aux passions ; mais l’Assemblée voit que mes poumons ne peuvent lutter contre des orages parlementaires ; j’ai besoin de sa plus bienveillante attention.
Pour apprécier le système de la commission, permettez-moi de rappeler quelques paroles de l’honorable rapporteur, M. de Vatimesnil. Il disait : « Il y a un principe général dans les articles 44 et suivants du Code pénal ; ce principe général est celui-ci : La coalition, soit entre patrons, soit entre ouvriers, constitue un délit, à une condition, c’est qu’il y ait eu tentative ou commencement d’exécution. » Cela est écrit dans la loi, et c’est ce qui répond tout de suite à une observation présentée par l’honorable M. Morin. Il vous a dit : « Les ouvriers ne pourront donc pas se réunir, venir chez leur patron débattre honorablement avec lui (c’est l’expression dont il s’est servi), débattre honorablement avec lui leurs salaires ! »
« Pardonnez-moi, ils pourront se réunir, ajoute M. de Vatimesnil, ils le pourront parfaitement, ils le pourront soit en venant tous, soit en nommant des commissions, pour traiter avec leurs patrons ; pas de difficulté quant à cela ; le délit, aux termes du Code, ne commence que quand il y a eu tentative ou commencement d’exécution de coalition, c’est-à-dire lorsque, après avoir débattu les conditions, et malgré l’esprit de conciliation que les patrons, dans leur propre intérêt, apportent toujours dans ces sortes d’affaires, on leur dit : « Mais, après tout, comme vous ne nous donnez pas tout ce que nous vous demandons, nous allons nous retirer, et nous allons, par notre influence, par les influences qui sont bien connues et qui tiennent à l’identité d’intérêt et à la camaraderie, nous allons déterminer tous les autres ouvriers des autres ateliers à se mettre en chômage. »
Après cette lecture, je me demande où est le délit ; – car dans cette Assemblée, il ne peut y avoir, ce me semble, sur une pareille question, ce qu’on appelle majorité ou minorité systématique. Ce que nous voulons tous, c’est réprimer des délits ; ce que nous cherchons tous, c’est de ne pas introduire dans le Code pénal des délits fictifs, imaginaires, pour avoir le plaisir de les punir.
Je me demande où est le délit. Est-il dans la coalition, — dans le chômage, — dans l’influence à laquelle on fait allusion ? On dit : C’est la coalition elle-même qui constitue le délit. J’avoue que je ne puis admettre cette doctrine, parce que le mot coalition est synonyme d’association ; c’est la même étymologie, le même sens. La coalition, abstraction faite du but qu’elle se propose, des moyens qu’elle emploie, ne peut être considérée comme un délit, et M. le rapporteur le sent lui-même ; car répondant à M. Morin, qui demandait si les ouvriers pouvaient débattre avec les patrons, les salaires, l’honorable M. de Vatimesnil disait : « Ils le pourront certainement ; ils pourront se présenter isolément ou tous ensemble, nommer des commissions. » Or, pour nommer des commissions, il faut certainement s’entendre, se concerter, s’associer ; il faut faire une coalition. À strictement parler, ce n’est donc pas dans le fait même de la coalition qu’est le délit.
Cependant, on voudrait l’y mettre, et l’on dit : « Il faut qu’il y ait un commencement d’exécution. » Mais le commencement d’exécution d’une action innocente peut-il rendre cette action coupable ? Je ne le crois pas. Si une action est mauvaise en elle-même, il est certain que la loi ne peut l’atteindre qu’autant qu’il y a un commencement d’exécution. Je dirai même : C’est le commencement d’exécution qui fait l’existence de l’action. Votre langage, au contraire, revient à celui-ci : « Le regard est un délit, mais il ne devient un délit que lorsqu’on commence à regarder. » M. de Vatimesnil reconnaît lui-même qu’on ne peut pas aller rechercher la pensée d’une action coupable. Or, quand l’action est innocente en elle-même, et qu’elle se manifeste par des faits innocents, il est évident que cela n’incrimine pas et ne peut jamais changer sa nature.
Maintenant, qu’est-ce que l’on entend par ces mots « commencement d’exécution ? »
Une coalition peut se manifester, peut commencer à être exécutée de mille manières différentes. Mais non, on ne s’occupe pas de ces mille manières, on se concentre sur le chômage. En ce cas, si c’est le chômage qui est nécessairement le commencement d’exécution de la coalition, dites donc que le chômage est, par lui-même, un délit ; punissez donc le chômage ; dites que le chômage sera puni ; que quiconque aura refusé de travailler au taux qui ne lui convient pas sera puni. Alors votre loi sera sincère.
Mais y a-t-il une conscience qui puisse admettre que le chômage, en lui-même, indépendamment des moyens qu’on emploie, est un délit ? Est-ce qu’un homme n’a pas le droit de refuser de vendre son travail à un taux qui ne lui convient pas ?
On me répondra : Tout cela est vrai quand il s’agit d’un homme isolé, mais cela n’est pas vrai quand il s’agit d’hommes qui sont associés entre eux.
Mais, messieurs, une action qui est innocente en soi n’est pas criminelle parce qu’elle se multiplie par un certain nombre d’hommes. Lorsqu’une action est mauvaise en elle-même, je conçois que, si cette action est faite par un certain nombre d’individus, on puisse dire qu’il y a aggravation ; mais quand elle est innocente en elle-même, elle ne peut pas devenir coupable parce qu’elle est le fait d’un grand nombre d’individus. Je ne conçois donc pas comment on peut dire que le chômage est coupable. Si un homme a le droit de dire à un autre : « Je ne veux pas travailler à telle ou telle condition, » deux ou trois mille hommes ont le même droit ; ils ont le droit de se retirer. C’est là un droit naturel, qui doit être aussi un droit légal.
Cependant on a besoin de jeter un vernis de culpabilité sur le chômage, et alors comment s’y prend-on ? On glisse entre parenthèse ces mots : « Comme vous ne nous donnez pas ce que nous vous demandons, nous allons nous retirer ; nous allons, par des influences qui sont bien connues et qui tiennent à l’identité d’industrie, à la camaraderie… »
Voilà donc le délit ; ce sont les influences bien connues, ce sont les violences, les intimidations ; c’est là qu’est le délit ; c’est là que vous devez frapper. Eh bien, c’est là que frappe l’amendement de l’honorable M. Morin. Comment lui refuseriez-vous vos suffrages ?
Mais on nous rapporte une autre suite de raisonnements et on dit ceci :
« La coalition porte les deux caractères qui peuvent la faire classer dans le nombre des délits ; la coalition est blâmable en elle et ensuite elle produit des conséquences funestes, funestes pour l’ouvrier, funestes pour le patron, funestes pour la société tout entière. »
D’abord, que la coalition soit blâmable, c’est précisément le point sur lequel on n’est pas d’accord, quod erat demonstrandum, c’est ce qu’il faut prouver ; elle est blâmable selon le but qu’elle se propose et surtout selon les moyens qu’elle emploie. Si la coalition se borne à la force d’inertie, à la passiveté, si les ouvriers se sont concertés, se sont entendus et qu’ils disent : Nous ne voulons pas vendre notre marchandise, qui est du travail, à tel prix, nous en voulons tel autre, et si vous refusez, nous allons rentrer dans nos foyers ou chercher de l’ouvrage ailleurs, — il me semble qu’il est impossible de dire que ce soit là une action blâmable.
Mais vous prétendez qu’elle est funeste. Ici, malgré tout le respect que je professe pour le talent de M. le rapporteur, je crois qu’il est entré dans un ordre de raisonnements au moins fort confus. Il dit : Le chômage est nuisible au patron, car c’est une chose fâcheuse pour le patron qu’un ou plusieurs ouvriers se retirent. Cela nuit à son industrie, de manière que l’ouvrier porte atteinte à la liberté du patron, et par suite à l’art. 13 de la Constitution.
En vérité, c’est là un renversement complet d’idées.
Quoi ! je suis en face d’un patron, nous débattons le prix, celui qu’il m’offre ne me convient pas, je ne commets aucune violence, je me retire, — et vous dites que c’est moi qui porte atteinte à la liberté du patron, parce que je nuis à son industrie ! Faites attention que ce que vous proclamez n’est pas autre chose que l’esclavage. Car qu’est-ce qu’un esclave, si ce n’est l’homme forcé, par la loi, de travailler à des conditions qu’il repousse ? (À gauche. Très bien) !
Vous demandez que la loi intervienne parce que c’est moi qui viole la propriété du patron ; ne voyez-vous pas, au contraire, que c’est le patron qui viole la mienne ? S’il fait intervenir la loi pour que sa volonté me soit imposée, où est la liberté, où est l’égalité ? (À gauche. Très bien) !
Ne dites pas que je tronque votre raisonnement, car il est tout entier dans le rapport et dans votre discours.
Vous dites ensuite que les ouvriers, quand ils se coalisent, se font du tort à eux-mêmes, et vous partez de là pour dire que la loi doit empêcher le chômage. Je suis d’accord avec vous que, dans la plupart des cas, les ouvriers se nuisent à eux-mêmes. Mais c’est précisément pour cela que je voudrais qu’ils fussent libres, parce que la liberté leur apprendrait qu’ils se nuisent à eux-mêmes ; et vous, vous en tirez cette conséquence, qu’il faut que la loi intervienne et les attache à l’atelier.
Mais vous faites entrer la loi dans une voie bien large et bien dangereuse.
Tous les jours, vous accusez les socialistes de vouloir faire intervenir la loi en toutes choses, de vouloir effacer la responsabilité personnelle.
Tous les jours, vous vous plaigniez de ce que, partout où il y a un mal, une souffrance, une douleur, l’homme invoque sans cesse la loi et l’État.
Quant à moi, je ne veux pas que, parce qu’un homme chôme et que par cela même il dévore une partie de ses économies, la loi puisse lui dire : « Tu travailleras dans cet atelier, quoiqu’on ne t’accorde pas le prix que tu demandes. » Je n’admets pas cette théorie.
Enfin vous dites qu’il nuit à la société tout entière.
Il n’y a pas de doute qu’il nuit à la société ; mais c’est le même raisonnement ; un homme juge qu’en cessant de travailler il obtiendra un meilleur taux de salaire dans huit ou dix jours ; sans doute c’est une déperdition de travail pour la société, mais que voulez-vous faire ? Voulez-vous que la loi remédie à tout ? C’est impossible ; il faudrait alors dire qu’un marchand qui attend, pour vendre son café, son sucre, de meilleurs temps, nuit à la société ; il faudrait donc invoquer toujours la loi, toujours l’État !
On avait fait contre le projet de la commission une objection qu’il me semble qu’on a traitée bien légèrement, trop légèrement, car elle est fort sérieuse. On avait dit : De quoi s’agit-il ? Il y a des patrons d’un côté, des ouvriers de l’autre ; il s’agit de règlement de salaires. Évidemment, ce qu’il faut désirer, le salaire se réglant par le jeu naturel de l’offre et de la demande, c’est que la demande et l’offre soient aussi libres, ou, si vous voulez, aussi contraintes l’une que l’autre. Pour cela, il n’y a que deux moyens : il faut, ou laisser les coalitions parfaitement libres, ou les supprimer tout à fait.
On vous objecte, — et vous avouez — qu’il est tout à fait impossible à votre loi de tenir la balance équitable ; que les coalitions d’ouvriers, se faisant toujours sur une très grande échelle et en plein jour, sont bien plus faciles à saisir que les coalitions de patrons.
Vous avouez la difficulté ; mais vous ajoutez aussitôt : La loi ne s’arrête pas à ces détails. — Je réponds qu’elle doit s’y arrêter. Si la loi ne peut réprimer un prétendu délit qu’en commettant envers toute une classe de citoyens la plus criante et la plus énorme des injustices, elle doit s’arrêter. Il y a mille cas analogues où la loi s’arrête.
Vous avouez vous-même que, sous l’empire de votre législation, l’offre et la demande ne sont plus à deux de jeu, puisque la coalition des patrons ne peut pas être saisie ; et c’est évident : deux, trois patrons, déjeunent ensemble, font une coalition, personne n’en sait rien. Celle des ouvriers sera toujours saisie puisqu’elle se fait au grand jour.
Puisque les uns échappent à votre loi, et que les autres n’y échappent pas, elle a pour résultat nécessaire de peser sur l’offre et de ne pas peser sur la demande, d’altérer, au moins en tant qu’elle agit, le taux naturel des salaires, et cela d’une manière systématique et permanente. C’est ce que je ne puis pas approuver. Je dis que, puisque vous ne pouvez pas faire une loi également applicable à tous les intérêts qui sont en présence, puisque vous ne pouvez leur donner l’égalité, laissez-leur la liberté, qui comprend en même temps l’égalité.
Mais si l’égalité n’a pas pu être atteinte comme résultat dans le projet de la commission, l’est-elle au moins sur le papier ? Oui, je crois que la commission, et j’en suis certain, a fait de grands efforts pour atteindre au moins l’égalité apparente. Cependant elle n’y a pas encore réussi, et, pour s’en convaincre, il suffit de comparer l’art. 414 l’art. 415, celui qui concerne les patrons à celui qui concerne les ouvriers. Le premier est excessivement simple ; on ne peut s’y tromper ; la justice quand elle poursuivra, — le délinquant quand il se défendra, — sauront parfaitement à quoi s’en tenir.
« Sera punie… 1° toute coalition entre ceux qui font travailler les ouvriers, tendant à forcer l’abaissement des salaires, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution. »
J’appelle votre attention sur le mot forcer, qui ouvre une grande latitude à la défense des patrons : il est vrai, diront-ils, que nous nous sommes réunis deux ou trois ; nous avons pris des mesures pour produire la baisse des salaires, mais nous n’avons pas essayé de forcer. — C’est un mot très important qui ne se trouve pas dans l’article suivant.
En effet, l’article suivant est extrêmement élastique ; il ne comprend pas un seul fait, il en comprend un très grand nombre.
« Toute coalition d’ouvriers pour faire cesser en même temps les travaux, pour interdire le travail dans les ateliers, pour empêcher de s’y rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux (il n’y a pas forcer) s’il y a tentative ou commencement d’exécution, etc. »
Et si l’on disait que j’épilogue sur le mot forcer, j’appellerais l’attention de la commission sur l’importance qu’elle a donnée elle-même à ce mot. (Bruit.)
Un membre à gauche. La droite n’accorde pas le silence. Quand on dit de bonnes choses, on interrompt toujours. Racontez une histoire, on vous écoutera.
M. Frédéric Bastiat. Dans le désir d’arriver, au moins sur le papier, puisque c’est impossible en fait, à une certaine égalité, la commission avait deux voies à prendre relativement aux expressions injustement et abusivement que contient l’art. 414.
Il fallait évidemment ou supprimer, dans l’art. 414, ces mots qui ouvraient une voie très large à la défense des patrons, ou l’introduire dans l’art. 415 pour ouvrir la même porte aux ouvriers. La commission a préféré la suppression des mots injustement et abusivement. Sur quoi s’est-elle fondée ? Elle s’est fondée précisément sur ce que, immédiatement après ces mots, venait le mot forcer, et ce mot, souligné cinq fois dans une seule page de son rapport, prouve qu’elle y attache une grande importance. Mais elle s’en est exprimée très catégoriquement ; elle a dit :
« Quand un concert de mesures contraires aux lois a été établi pour forcer l’abaissement des salaires, il est impossible de le justifier. Un tel fait est nécessairement injuste et abusif ; car forcer l’abaissement des salaires, c’est produire, par un pacte aussi illicite que contraire à l’humanité, un abaissement de salaires qui ne serait pas résulté des circonstances industrielles et de la libre concurrence ; d’où il suit que l’emploi de ces mots injustement et abusivement choque le bon sens. »
Ainsi, comment a-t-on justifié l’élimination qu’on a faite des mots injustement et abusivement ? On a dit : C’est un pléonasme ; le mot forcer remplace tout cela.
Mais, messieurs, quand il s’est agi des ouvriers, on n’a plus mis le mot forcer, et dès lors les ouvriers n’ont plus la même chance de défense ; on a mis seulement qu’ils ne pourraient enchérir les salaires, non plus en forcer injustement ou abusivement l’élévation, mais les enchérir seulement. Il y a encore là, au moins dans la rédaction, un vice, une inégalité qui vient s’enter sur l’inégalité bien plus grave dont j’ai parlé tout à l’heure.
Tel est, messieurs, le système de la commission, système qui, selon moi, est vicieux de tout point, vicieux théoriquement, et vicieux pratiquement, système qui nous laisse dans une incertitude complète sur ce que c’est que le délit. Est-ce la coalition ; est-ce le chômage, est-ce l’abus, est-ce la force ? On n’en sait rien. Je défie qui que ce soit, l’esprit le plus logique, de voir où commence et où finit l’impunité. Vous me dites : « La coalition est un délit. Cependant vous pouvez nommer une commission. » — Mais je ne suis pas sûr de pouvoir nommer une commission et envoyer des délégués, quand votre rapport est plein de considérations, desquelles il résulte que la coalition est l’essence même du délit.
Je dis ensuite que, pratiquement, votre loi est pleine d’inégalités ; elle ne s’applique pas exactement et proportionnellement aux deux partis dont vous voulez faire cesser l’antagonisme. Singulière manière de faire cesser l’antagonisme entre deux partis, que de les traiter d’une manière inégale !
Quant au système de M. Morin, je ne m’y arrêterai pas longtemps ; il est parfaitement clair, parfaitement lucide ; il repose sur un principe inébranlable et admis par tout le monde : liberté dans l’usage et répression dans l’abus. Il n’y a pas d’intelligence quelconque qui ne donne son adhésion à un pareil principe.
Demandez au premier venu, à qui vous voudrez, si la loi est injuste, partiale lorsqu’elle se contente de réprimer l’intimidation, la violence ? Tout le monde vous dira : Ce sont là de vrais délits. D’ailleurs, les lois sont faites pour les ignorants comme pour les savants. Il faut que la définition d’un délit saisisse les intelligences, il faut que la conscience y donne son assentiment ; il faut qu’en lisant la loi on dise : En effet, c’est un délit. Vous parlez du respect des lois ; c’est là une partie constitutive du respect des lois. Comment voulez-vous qu’on respecte une loi inintelligente et inintelligible ? Cela est impossible. (Approbation à gauche.)
Ce qui se passe ici, messieurs, me semble tirer quelque importance de l’analogie parfaite avec ce qui s’est passé dans un autre pays, dont a parlé hier M. de Vatimesnil, l’Angleterre, qui a une si grande expérience en matière de coalitions, de luttes, de difficultés de cette nature. Je crois que cette expérience vaut la peine d’être consultée et apportée à cette tribune.
On vous a parlé des nombreuses et formidables coalitions qui s’y sont manifestées depuis l’abrogation de la loi ou des lois ; mais on ne vous a rien dit de celles qui avaient eu lieu auparavant. C’est ce dont il fallait parler aussi ; car, pour juger les deux systèmes, il faut les comparer.
Avant 1824, l’Angleterre avait été désolée par des coalitions si nombreuses, si terribles, si énergiques, qu’on avait opposé à ce fléau trente-sept statuts dans un pays où, comme vous le savez, l’antiquité fait, pour ainsi dire, partie de la loi, où l’on respecte des lois même absurdes, uniquement parce qu’elles sont anciennes. Il faut que ce pays ait été bien travaillé, bien tourmenté par le mal pour qu’il se soit décidé à faire, coup sur coup, et dans un court espace de temps, trente-sept statuts, tous plus énergiques les uns que les autres. Eh bien ! qu’est-il arrivé ? On n’en est pas venu à bout ; le mal allait toujours s’aggravant. Un beau jour on s’est dit : Nous avons essayé bien des systèmes, trente-sept statuts ont été faits ; essayons si nous pourrons réussir par un moyen bien simple, la justice et la liberté. — Je voudrais que l’on appliquât ce raisonnement dans bien des questions, et l’on trouverait que leur solution n’est pas si difficile qu’on le pense ; mais enfin, cette fois, on a fait et appliqué ce raisonnement en Angleterre.
Donc, en 1824, une loi intervint sur la proposition de M. Hume, proposition qui ressemblait tout à fait à celle de MM. Doutre, Greppo, Benoît et Fond : c’était l’abrogation complète, totale, de ce qui avait existé jusqu’alors. La justice, en Angleterre, se trouva alors désarmée en face des coalitions, même contre la violence, l’intimidation et les menaces, faits qui cependant viennent aggraver la coalition. À ces faits-là, on ne pouvait appliquer que les lois relatives aux menaces, aux rixes accidentelles qui ont lieu dans les rues ; de sorte que, l’année d’après, en 1825, le ministre de la justice vint demander une loi spéciale qui laisserait la liberté complète aux coalitions, mais qui aggraverait la peine appliquée aux violences ordinaires : le système de la loi de 1825 est là tout entier.
L’art. 3 porte : « Sera puni d’un emprisonnement et d’une amende, etc., quiconque par intimidation, menaces ou violences, aura…, etc. »
Les mots intimidation, menaces et violences reviennent à chaque phrase. Le mot coalition n’est pas même mentionné.
Et puis viennent deux autres articles extrêmement remarquables, que l’on n’admettrait pas probablement en France, parce qu’ils sont virtuellement renfermés dans cette maxime : Ce que la loi ne défend pas est permis.
Il y est dit : « Ne seront pas passibles de cette peine ceux qui se seront réunis, ceux qui se seront coalisés et auront cherché à influer sur le taux des salaires, ceux qui seront entrés dans des conventions verbales ou écrites, etc… »
Enfin, la liberté la plus large et la plus complète y est expressément accordée.
Je dis qu’il y a de l’analogie dans la situation, car ce que vous propose la commission, c’est l’ancien système anglais, celui des statuts. La proposition de M. Doutre et de ses collègues, c’est la proposition de M. Hume qui abolit tout, et qui ne laissait aucune aggravation pour les violences qui étaient concertées, quoique l’on ne puisse méconnaître que les violences méditées par un certain nombre d’hommes offrent plus de dangers que la violence individuelle commise dans la rue. Enfin la proposition de l’honorable M. Morin répond parfaitement à celle qui a amené en Angleterre la loi définitive de 1825.
Maintenant on vous dit : Depuis 1825, l’Angleterre ne se trouve pas bien de ce système. — Elle ne s’en trouve pas bien ! Mais je trouve, moi, que vous vous prononcez sur cette question sans l’avoir assez approfondie. J’ai parcouru l’Angleterre plusieurs fois, j’ai interrogé sur cette question un grand nombre de manufacturiers. Eh bien, je puis affirmer que jamais je n’ai rencontré une personne qui ne s’en applaudit et qui ne fût très satisfaite de ce que l’Angleterre, en cette circonstance, a osé regarder la liberté en face. Et c’est peut-être à cause de cela que, plus tard, dans beaucoup d’autres questions, elle a osé encore regarder la liberté en face.
Vous citez la coalition de 1832, qui, en effet, fut une coalition formidable ; mais il faut bien prendre garde et ne pas présenter les faits isolément. Cette année-là, il y avait disette, le blé valait 95 schellings le quarter ; il y avait famine, et cette famine a duré plusieurs années…
M. de Vatimesnil, rapporteur. J’ai cité la coalition de 1842.
M. Bastiat. Il y a eu une famine en 1832 et une autre plus forte en 1842.
M. le Rapporteur. J’ai parlé de la coalition de 1842.
M. Bastiat. Mon argumentation s’applique avec plus de force encore à l’année 1842. Dans ces temps de disette, qu’arrive-t-il ? c’est que les revenus de presque toute la population servent à acheter les objets nécessaires à leur subsistance. On n’achète pas d’objets manufacturés, les ateliers chôment, on est obligé de renvoyer beaucoup d’ouvriers ; il y a concurrence de bras, et les salaires baissent.
Eh bien, lorsque, dans les salaires, une grande baisse se manifeste, et que cela se combine avec une famine épouvantable, il n’est pas étonnant que, dans un pays de liberté complète, des coalitions se forment.
C’est ce qui a lieu en Angleterre. Est-ce qu’on a changé de loi pour cela ? Pas du tout.
On a vu les causes de ces coalitions, mais on les a bravées. On a puni les menaces, les violences, partout où elles se manifestaient, mais on n’a pas fait autre chose.
On vous a présenté un tableau effrayant de ces associations et on a dit qu’elles tendaient à devenir politiques.
Messieurs, à l’époque dont je parle, il s’agitait une grande question en Angleterre, et cette question était envenimée encore par les circonstances, par la disette ; il y avait lutte entre la population industrielle et les propriétaires, c’est-à-dire l’aristocratie qui voulait vendre le blé le plus cher possible, et qui, pour cela, prohibait les blés étrangers. Qu’est-il arrivé ? Ces unions, qu’on appelait hier plaisamment trade-unions, ces unions, qui jouissaient de la liberté de coalition, voyant que tous les efforts faits par leur coalition n’étaient pas parvenus à faire élever le taux des salaires…
Une voix. C’est ce qui est mauvais.
M. Bastiat. Vous dites que c’est un mal ; je dis, au contraire, que c’est un grand bien. Les ouvriers se sont aperçus que le taux des salaires ne dépendait pas des patrons, mais d’autres lois sociales, et ils se dirent : « Pourquoi nos salaires ne se sont-ils pas élevés ? La raison en est simple : c’est parce qu’il nous est défendu de travailler pour l’étranger, ou du moins de recevoir en paiement du blé étranger. C’est donc à tort que nous nous en prenons à nos patrons ; il faut nous en prendre à cette classe aristocratique qui non seulement possède le sol, mais encore qui fait la loi, et nous n’aurons d’influence sur les salaires que lorsque nous aurons reconquis nos droits politiques. »
À gauche. Très bien ! très bien !
M. Bastiat. En vérité, messieurs, trouver quelque chose d’extraordinaire dans cette conduite si simple et si naturelle des ouvriers anglais, c’est presque apporter à cette tribune une protestation contre le suffrage universel en France. (Nouvel assentiment à gauche.)
Il résulte de là que les ouvriers anglais ont appris une grande leçon par la liberté ; ils ont appris qu’il ne dépendait pas de leurs patrons d’élever ou d’abaisser le taux des salaires ; et aujourd’hui l’Angleterre vient de traverser deux ou trois années très difficiles par suite de la pourriture des pommes de terre, du manque de récolte, de la manie des chemins de fer, et par suite aussi des révolutions qui ont désolé l’Europe et fermé les débouchés à ses produits industriels ; jamais elle n’avait passé par des crises semblables. Cependant il n’y a pas eu un fait de coalition répréhensible et pas un seul fait de violence ; les ouvriers y ont renoncé par suite de leur expérience ; c’est là un exemple à apporter et à méditer dans notre pays. (Approbation à gauche.)
Enfin il y a une considération qui me frappe et qui est plus importante que tout cela. Vous voulez le respect des lois, et vous avez bien raison ; mais il ne faut pas oblitérer le sens de la justice chez les hommes.
Voilà deux systèmes en présence, celui de la commission et celui de M. Morin.
Figurez-vous qu’alternativement, en vertu de l’un et de l’autre système, on traduise des ouvriers en justice. Eh bien ! voilà des ouvriers traduits en justice en vertu de la loi actuelle sur les coalitions ; ils ne savent même pas ce qu’on leur demande ; ils ont cru qu’ils avaient le droit, jusqu’à un certain point, de se coaliser, de se concerter, et vous le reconnaissez vous-mêmes dans une certaine mesure. Ils disent : Nous avons mangé notre pécule, nous sommes ruinés ; ce n’est pas notre faute, c’est celle de la société qui nous tourmente, de patrons qui nous vexent, de la justice qui nous poursuit. Ils se présentent devant les tribunaux l’irritation dans le cœur, ils se posent en victimes, et non seulement ils résistent, mais ceux qui ne sont pas poursuivis sympathisent avec eux ; la jeunesse, toujours si ardente, les publicistes se mettent de leur côté. Croyez-vous que ce soit là une position bien belle, bien favorable pour la justice du pays ?
Au contraire, poursuivez des ouvriers en vertu du système de M. Morin ; qu’ils soient traduits devant la justice ; que le procureur de la République dise : Nous ne vous poursuivons pas parce que vous vous êtes coalisés, vous étiez parfaitement libres. Vous avez demandé une augmentation de salaires, nous n’avons rien dit ; vous vous êtes concertés, nous n’avons rien dit ; vous avez voulu le chômage, nous n’avons rien dit ; vous avez cherché à agir par la persuasion sur vos camarades, nous n’avons rien dit. Mais vous avez employé les armes, la violence, la menace ; nous vous avons traduits devant les tribunaux.
L’ouvrier que vous poursuivrez ainsi courbera la tête, parce qu’il aura le sentiment de son tort et qu’il reconnaîtra que la justice de son pays a été impartiale et juste. (Très bien !)
Je terminerai, messieurs, par une autre considération, et c’est celle-ci :
Selon moi, il y a une foule de questions agitées maintenant parmi les classes ouvrières, et au sujet desquelles, dans mon opinion très intime et très profonde, les ouvriers s’égarent ; et j’appelle votre attention sur ce point : toujours lorsqu’une révolution éclate dans un pays où il y a plusieurs classes échelonnées, superposées et où la première classe s’était attribué certains priviléges, c’est la seconde qui arrive ; elle avait invoqué naturellement le sentiment du droit et de la justice pour se faire aider par les autres. La révolution se fait ; la seconde classe arrive. Elle ne tarde pas le plus souvent à se constituer aussi des priviléges. Ainsi de la troisième, ainsi de la quatrième. Tout cela est odieux, mais c’est toujours possible, tant qu’il y a en bas une classe qui peut faire les frais de ces priviléges qu’on se dispute.
Mais il est arrivé ceci, qu’à la révolution de Février c’est la nation tout entière, le peuple tout entier, dans toutes les profondeurs de ses masses, qui est arrivé, ou qui peut arriver, par l’élection, par le suffrage universel, à se gouverner lui-même. Et alors, par un esprit d’imitation que je déplore, mais qui me semble assez naturel, il a pensé qu’il pourrait guérir ses souffrances en se constituant aussi des priviléges, car je regarde le droit au crédit, le droit au travail et bien d’autres prétentions, comme de véritables priviléges. (Mouvement.)
Et en effet, messieurs, ils pourraient lui être accordés, si au-dessous de lui, ou à sa portée, il y avait une autre classe encore plus nombreuse, trois cents millions de Chinois, par exemple, qui pussent en faire les frais. (Rires d’assentiment.) Or cela n’existe pas ; c’est pourquoi chacun des priviléges, les hommes du peuple se les paieraient les uns aux autres, sans profit possible pour eux, au moyen d’un appareil compliqué et en subissant, au contraire, toute la déperdition causée par l’appareil.
Eh bien ! l’Assemblée législative pourra être appelée à lutter contre ces prétentions, qu’il ne faut pas traiter trop légèrement, parce que, malgré tout, elles sont sincères. Vous serez obligés de lutter. Comment lutteriez-vous avec avantage si vous refoulez la classe ouvrière lorsqu’elle ne demande rien que de raisonnable ; lorsqu’elle demande purement et simplement justice et liberté ? Je crois que vous acquerrez une grande force en donnant ici une preuve d’impartialité ; vous serez mieux écoutés, vous serez regardés comme le tuteur de toutes les classes et particulièrement de cette classe, si vous vous montrez complétement impartial et juste envers elle. (Vive approbation à gauche.)
En résumé, je repousse le projet de la commission, parce qu’il n’est qu’un Expédient, et que le caractère de tout expédient ; c’est la faiblesse et l’injustice. J’appuie la proposition de M. Morin, parce qu’elle se fonde sur un Principe ; et il n’y a que les principes qui aient la puissance de satisfaire les esprits, d’entraîner les cœurs, et de se mettre à l’unisson des consciences. On nous a dit : Voulez-vous donc proclamer la liberté par un amour platonique de la liberté ? Pour ce qui me regarde, je réponds : Oui. La liberté peut réserver aux nations quelques épreuves, mais elle seule les éclaire, les élève et les moralise. Hors de la liberté, il n’y a qu’Oppression, et, sachez-le bien, amis de l’ordre, le temps n’est plus, s’il a jamais existé, où l’on puisse fonder sur l’Oppression l’union des classes, le respect des lois, la sécurité des intérêts et la tranquillité des peuples.
FN:Les articles 413, 415 et 416 du Code pénal punissent, mais d’une manière bien inégale, les coalitions des patrons et celles des ouvriers. Une proposition d’abroger ces trois articles avait été renvoyée par l’Assemblée législative à l’examen d’une commission, qui ne la jugea pas admissible et pensa qu’il était indispensable de maintenir les dispositions répressives, en les modifiant, toutefois, pour les rendre impartiales.
Ce but, il est permis de le dire, ne fut pas atteint par les modifications formulées. M. Morin, manufacturier et représentant de la Drôme, persuadé que la seule base sur laquelle puisse s’établir le bon accord entre les ouvriers et les patrons, c’est l’égalité devant la loi, voulut amender les conclusions de la commission conformément à ce principe. L’amendement qu’il présenta fut appuyé par Bastiat, dans la séance du 17 novembre 1849. (Note de l’éditeur.)
T.245 (1849.12.10) SEP: Séance de 10 dec. 1849 (state support for popularising political economy and FB’s new book EH) (Fr, PDF1, PDF2)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Checked against ASEP PDF: 26 Nov.2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.245 (1849.12.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 dec. 1849) (state support for popularising political economy). In “Chronique,” JDE, 15 Dec. 1849, T. XXV, pp. 110-112; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 91-94. Not in OC.
Editor’s Introduction (to do)↩
[to come]
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
SOMMAIRE. Notice sur M. Rossi, par M. :Mignet — Propagande économiste à Berlin. — Discussions à la Société d'économie politique. - La discussion de l'impôt des boisson : M. Bastiat et M. Montalembert. — Nouvelles querelles des grands prêtres socialistes à propos de l'an-archie. - Le fisc à Zaatcha. - Votes de l'Assemblée relatifs au chemin de Marseille à Avignon, aux coalitions, aux subventions aux associations ouvrières, etc.
Après la communication de M. Paillottet, la conversation s'est engagée sur les difficultés de répandre en France les notions de l'économie politique. Différentes appréciations ont été émises sur les efforts à faire pour arriver à ce résultat si désirable; et la société a prié son bureau de s'occuper de l'étude des voies et moyens, avec le concours de ceux des membres qui ont du temps à consacrer à cette œuvre.
La discussion n'a pas seulement porté sur des moyens de propagande, mais aussi sur une grave question de principe. Quelques membres, et de ce nombre MM. Bastiat et Raudot, représentants du peuple, ont soutenu que la Société d'économie politique, qui prêche la non-intervention du gouvernement en général, ne devait pas s'adresser à lui pour la vulgarisation des principes de la science, sans se montrer inconséquente, sans exposer ces principices au danger des programmes et des professeurs officiels, universitaires et monopolistes. M. Horace Say, conseiller d'État, M.Morin, représentant du peuple, et M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, ont combattu ce rigorisme trop exclusif, et ont pensé qu'en attendant la liberté d'enseignement, qui se ferait encore longtemps désirer, il était utile et sage de profiter des ressources de l'organisation actuelle de l'instruction publique, et d'inviter le gouvernement à introduire l’étude de l’économie politique dans toutes les branches de l'enseignement public. Cette étude est aujourd'hui une nécessité, abstraction faite de toute espèce de système sur la constitution de l'Enseignement et de l'Université. Quant aux difficultés tirées de la restriction des programmes, du peu de liberté et d'indépendance des professeurs, ainsi que de la peine qu'on aurait à les trouver, nous sommes convaincus qu'elles se lèveraient peu à peu, d'elles-mêmes pour ainsi dire, et que l'on verrait se produire plus d'une fois le phénomène de la transformation d'un esprit réglementaire, ignorant ou à préjugés, en un véritable professeur d'économie politique.
A une heure déjà avancée de la soirée et lorsqu'une partie des membres de la Société était partie, une autre conversation d'un grand intérêt s'est engagée à propos de quelques doctrines soutenues par M. Bastiat, dans son dernier volume intitulé: Harmonies économiques, et notamment à propos de sa manière de considérer la propriété foncière. M. Bastiat nie la Rente de la terre; il croit et soutient qu'il n'y a jamais autre chose dans le prix courant que la valeur des services, et il semble exclusivement entendre par ce mot la rémunération du travail et du capital, ou les frais de production. M. Buffet, ancien ministre du commerce, M. Coquelin, M. Joseph Garnier et M. Walras ont adressé à M. Bastiat des arguments très-vifs et très-pressants. M. Buffet, surtout, a exposé avec une clarté parfaite et une entente remarquable du sujet les caractères spéciaux de la terre considérée comme moyen de production, l'influence des monopoles naturels sur le prix des choses, et l'apparition par conséquent de la rente dans plusieurs phases de la production. Mais ce sont là des questions trop délicates pour être traitées au milieu de toutes les interruptions et de tous les accidents d'une conversation : aussi était-il difficile que M. Bastiat répondit catégoriquement et victorieusement, eût-il la vérité pour lui, ce qui pour nous est encore une question.
–- La discussion sur l'impôt des boissons, sur la question de savoir si on le rétablira ou si on maintiendra avec plus ou moins d'amendement le décret de la Constituante qui l'abolit, portera ses fruits, quoi qu'il arrive pour le moment.S'il était aboli, ce serait le commencement de la possibilité d'une réforme radicale dans les finances.S'il est maintenu, il ne le sera qu'à la condition qu'on le réduira et qu'on le remaniera complétement, après une enquête qui sera très-instructive. C'est ce qui résulte des discours mêmes des représentants qui se sont faits les champions de l'impôt, et notamment du discours de M. Faucher, qui n'a pas voulu suivre M. de Montalembert dans son éloquent mais ridicule optimisme. Pour M. de Montalembert, critiquer l'impôt des boissons, trouver que l'exercice est un grand désagrément pour les populations, que les vins payent trop souvent l'impôt (15 à 16 fois), que le budget ne doit pas s'élever à 1,800 millions, que nos finances sont dans un piteux état, et que nous courons à l'abîme, c'est être un révolutionnaire, c'est sacrifier aux dieux du socialisme. En vérité, c'est abuser de l'esprit de parti, de la parole et du talent, que de se livrer à de pareilles exagérations que le Chavari a spirituellement caractérisées par cette invocation qu'il prête à l'orateur : In nomine inquisitionis, reactionis et Gabelou sancti.- Amen.
Le seul argument à faire valoir en faveur de l'impôt des boissons, c'est qu'on en a besoin pour payer ses dépenses et ses dettes. Reste à prouver la légitimité des dépenses, ce qui conduit à rechercher quelles sont les dépenses et les fonctions naturelles de l'Etat. C'est sur ce terrain que s'est placé M. Bastiat, qui a tenu, ce jour-là, avec éclat le drapeau économique sur la tribune. L'Assemblée et la presse ont compris que si c'étaient là des idées inaccoutumées et inacceptables quant à présent, l'avenir leur appartenait. M. Bastiat a obtenu un beau succès pour lui, et il a rendu un grand service aux idées économiques.
Comme l'esprit de parti gâte tout dans notre pays et détruit toute indépendance, les journaux de la majorité veulent maintenir l'impôt, et les journaux rouges et socialistes en demandent la suppression. Ce départ est artificiel et ne répond ni au sentiment de la population, ni aux convictions raisonnées qui ont pu se former dans le pays sur cette question.
Ainsi s'explique l'approbation de M. Bastiat voulant simplifier l'Etat, par la Démocratie pacifique et autres dont le système consiste à surcharger l'Etat d'attributions et de le compliquer !
A cette occasion, la Voix du Peuple qui, malgré d'étonnantes contradictions, [112] et tout en dépassant le but, soutient depuis sa création, la thèse d'un gouvernement à action circonscrite, a adressé à M. Frédéric Bastiat ce burlesque compliment : à la bonne heure, économiste de la vieille école, à la bonne heure, vous franchissez le Rubicon socialiste, vous venez à nous.-Cette naïveté est habituelle aux socialistes. Quand la polémique leur fait mettre la main sur une bonne idée jusque-là méconnue par eux seuls, ils croient la découvrir et vous la prêchent, pensant vous avoir convertis quand ils vous trouvent de leur avis.
Il est vrai que M. Proudhon a toujours en réserve quelque formule tamtamique qui fait dresser l'oreille aux passants.Avec lui, il ne s'agit pas de savoir si l'Etat n'aura que des fonctions restreintes et qu'il saura bien remplir. M. Proudhon ne reconnaît pas d'Etat, il veut l'An-Archie ! La gratuité du crédit et l'an-archie, tout le socialisme est là, a-t-il dit, en réponse à M. Louis Blanc qui écrit aux hommes du peuple (lisez les délégués du Luxembourg) : l'Etat, c'est vous (lisez c'est moi).
Ces assertions ont provoqué de nouvelles homélies et de petites malices de M. Pierre Leroux que M. Proudhon a repris après M. Louis Blanc pour le retourner comme un chat fait d'une souris. - « Ah! mon cher Pierre Leroux, vous m'appelez malthusien, moi qui ai créé cette injure. Perfide !. Mais prenez garde que je ne vous marque si brûlant et si avant qu'il en sera question dans la génération future… théoglosse, théopompe que vous êtes. »
Cette lutte des coryphées socialistes portera quelques fruits; nous la suivons en détail, pour y revenir, s'il y a lieu, quand elle sera épuisée.
Text: ASEP version↩
[91]
Séance du 10 décembre 1849.
M. Paillottet, ex-vice-président du Conseil des prud'hommes et membre du Conseil d'encouragement des associations ouvrières, communiquée la réunion une intéressante nouvelle.
Il apprend à la Société qu'il s'est formé à Berlin une association pour la propagation des meilleurs écrits d'économie politique, entraînant avec eux le véritable antidote du socialisme.il adonné connaissance d'une publication de M. Prince-Smith, que nous avons eu le plaisir d'entendre au Congrès des économistes à Bruxelles, en 1847, et qui est un des promoteurs de cette utile association que nous saluons avec la plus cordiale sympathie.
M. Prince-smith, après avoir établi le système de l'amélioration populaire, rappelé l'erreur des hommes du statu quo et de ceux qui invoquent des moyens de violence et de spoliation, ajoute:
L'économie politique intervient et dit: Quand il y a des estomacs affamés et des bras inactifs, les bras doivent être mis en mouvement pour satisfaire les estomacs. Quand des besoins existent, il ne manque pas de but au travail; mais les moyens de travail peuvent manquer. Il faut donc que les moyens de travail, c'est-à-dire les capitaux, s'augmentent jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour que tous les bras soient occupés, et c'est ce qui arrive mieux et plus vite dans un ordre de choses naturel.
Que la propriété et l'hérédité soient protégées par la paix extérieure et intérieure, en vue de l'intérêt de tous, et nous n'aurons plus besoin d'entretenir une force armée qui compromet les véritables intérêts de l'État, et augmente, en dévorant les ressources du peuple, les conflits qu'elle a mission de réprimer. Si les peuples, si toutes les classes du peuple avaient mieux compris leur intérêt commun, la Prusse, pour ne citer qu'elle, aurait pu, depuis la paix, conserver une force publique suffisante, tout en économisant sur ce chapitre 10 millions de thalers par an, et l'on aurait maintenant, en Prusse, des instruments de travail pour un million d'ouvriers de plus, du pain de plus pour un million [92] de familles. Quoi d'étonnant à ce que le pain manque dans un ordre de choses qui oblige l'Etat, chaque année, à consommer, pour le maintien d'une force improductive, les moyens d'occuper au moins cent mille familles de travailleurs, le fonds d'entretien d'un demi-million d'hommes!
Le peu de succès de nos efforts pour améliorer cette situation montre combien nous sommes dépourvus des lumières de l'économie politique, et combien il nous importe que son étoile se lève pour guider nos pas vers un avenir meilleur.
En Allemagne, il n'a presque pas été publié, jusqu'ici, d'écrits populaires sur l'économie politique, ou du moins, ils ne se sont pas fait accueillir facilement. Notre association, fidèle aux vrais principes de cette science, a cru devoir traduire les écrits de l'ingénieux Bastiat, et se procurer ainsi, par l'importation, ce qu'elle ne pouvait obtenir ici ni à si bon compte, ni de si bonne qualité. Comme les importations de l'étranger, en se créant un marché dans notre pays, y développent les besoins qu'elles sont destinées à satisfaire, il y a tout lieu d'espérer que notre esprit national, averti et stimulé par la concurrence étrangère, ne tardera pas plus longtemps à déployer ses propres efforts.
J. Prince-smith, directeur. 14979.Berlin, 26 octobre 1849.
On devient membre de l'Association en s'engageant, par écrit, à répandre annuellement pour au moins 2 thalers (7 fr. 80) de ces brochures. Il est urgent de recommander la réunion de plusieurs personnes dans une même localité pour opérer l'écoulement et la propagation des écrits publiés par l'Association.
Les exemplaires de brochures diverses, achetées simultanément, sont comptés ensemble et vendus aux prix réduits, s'ils atteignent les nombres fixés.
Prix d'un exemplaire : 2 groschen; de vingt-cinq exemplaires, 1 thaler; de cent exemplaires, 2 thalers 1/3; c'est-à-dire 5 sous, 3 sous et 2 sous la pièce, suivant l'importance des achats.
Les brochures déjà publiées par l'Association sont des articles du Journal des Économistes, par M. Bastiat, et qui ont été ensuite rééditées sous les titres : Capital et rente, Protectionnisme et communisme, l'État, Maudit argent!
Après la communication de M. Paillottet, la conversation s'est engagée sur les difficultés de répandre en [93] France les notions de l'économie politique. Différentes appréciations ont été émises sur les efforts à faire pour arriver à ce résultat si désirable; et la Société a prié son Bureau de s'occuper de l'étude des voies et moyens, avec le concours de ceux des membres qui ont du temps à consacrer à cette œuvre.
La discussion n'a pas seulement porté sur des moyens de propagande, mais aussi sur une grave question de principe. Quelques membres, et de ce nombre MM. Bastiat et Raudot, représentants du peuple, ont soutenu que la Société d'économie politique, qui prêche la non-intervention du gouvernement en général, ne devait pas s'adresser à lui pour la vulgarisation des principes de la science, sans se montrer inconséquente, sans exposer ces principes au danger des programmes et des professeurs officiels, universitaires et monopoleurs. M. Horace Say, conseiller d'État; M. Morin, représentant du peuple, et M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, ont combattu ce rigorisme exclusif, et ont pensé qu'en attendant la liberté d'enseignement, qui se ferait encore longtemps désirer, il était utile et sage de profiter des ressources de l'organisation actuelle de l'instruction publique, et d'inviter le gouvernement à introduire l'étude de l'économie politique dans toutes les branches de l'enseignement public. Cette étude est aujourd'hui une nécessité, abstraction faite de toute espèce de système sur la constitution de l'enseignement et de l'Université.
Quant aux difficultés tirées de la restriction des programmes, du peu de liberté et d'indépendance des professeurs, ainsi que de la peine qu'on aurait à les trouver, nous sommes convaincus qu'elles se lèveraient peu à peu, d'elles-mêmes, pour ainsi dire, et que l'on verrait se produire plus d'une fois le phénomène de la transformation [94] d’un esprit réglementaire, ignorant ou à préjugés, en un véritable professeur d'économie politique.
A une heure déjà avancée de la soirée et lorsqu'une partie des membres de la Société était partis, une autre conversation d'un grand intérêt s'est engagée à propos de quelques doctrines soutenues par M. Bastiat, dans son dernier volume intitulé : Harmonies économiques, et notamment à propos de sa manière de considérer la propriété foncière. M. Bastiat nie la Rente de la terre; il croit et soutient qu'il n'y a jamais autre chose dans le prix courant que la valeur des services, et il semble exclusivement entendre par ce mot la rémunération du travail et du capital, ou les frais de production. MM. Buffet, ancien ministre du commerce, Coquelin, Joseph Garnier et A. Walras ont adressé à M. Bastiat des arguments très vifs et très pressants. M. Buffet, surtout, a exposé, avec une clarté parfaite et une entente remarquable du sujet, les caractères spéciaux de la terre considérée comme moyen de production, l'influence des monopoles naturels sur le prix des choses, et l'apparition par conséquent de la rente dans plusieurs phases de la production. Mais ce sont là dis questions trop délicates pour être traitées au milieu de toutes les interruptions et de tous les accidents d'une conversation: aussi était-il difficile que M. Bastiat répondît catégoriquement et victorieusement, eût-il la vérité pour lui.
Discours sur l'impôt des boissons [12 Dec. 1849] [CW2.16]↩
BWV
1849.12.12 “Discours sur l’impôt des boissons” (Speech on the Tax on Wines and Spirits [delivered to the Legislative Assembly on 12 December 1849] [OC5.10, p. 468] [CW2]
Source
Cette improvisation fut prononcée à l’Assemblée législative le 12 décembre 1849.
Discours sur l’impôt des boissons [1]
1849
Citoyens représentants,
Je voulais aborder la question de l’impôt des boissons telle qu’elle me paraissait se poser dans toutes vos consciences, c’est-à-dire au point de vue de la nécessité financière et politique. Je croyais, en effet, que la nécessité était le seul motif invoqué à l’appui du maintien de cet impôt ; je croyais qu’à vos yeux il réunissait tous les caractères auxquels la science enseigne à reconnaître les mauvais impôts ; je croyais qu’il était admis que cet impôt est injuste, inégal, d’une perception accompagnée de formalités vexatoires. Mais, puisque ces reproches dirigés contre l’impôt, depuis son établissement, par tous les hommes d’État, sont aujourd’hui contestés, j’en dirai seulement quelques mots, — très-rapidement.
D’abord, nous prétendons que l’impôt est injuste, et nous nous fondons sur ceci : Voilà des terres qui sont à côté les unes des autres, et qui sont assujetties à un impôt foncier, à un impôt direct ; ces terres sont classées, comparées entre elles et taxées selon leur valeur ; ensuite chacun peut y faire croître ce qu’il veut ; les uns du blé, les autres, des herbages, les autres, des œillets et des roses, d’autres, du vin.
Eh bien, de tous ces produits, il y en a un, il y en a un seul qui, une fois entré dans la circulation, est grevé d’un impôt qui rend au Trésor 106 millions. Tous les autres produits agricoles sont affranchis de cette taxe.
On peut dire que l’impôt est utile, nécessaire, ce n’est pas la question que j’aborde ; mais on ne peut pas dire qu’il ne soit injuste, au point de vue du propriétaire.
Il est vrai qu’on dit que l’impôt ne retombe pas sur le producteur. C’est ce que j’examinerai tout à l’heure.
Nous disons ensuite que l’impôt est mal réparti.
En vérité, j’ai été fort surpris que cela ait été contesté, car enfin… (Interruption.)
Un membre à droite. Parlez un peu plus haut !
M. le Président. J’invite l’Assemblée au silence.
M. F. Bastiat. Je veux même abandonner cet argument pour aller plus vite.
Voix diverses. Parlez ! parlez !
M. F. Bastiat. Il me semble que la chose est tellement claire, qu’il est tellement évident que l’impôt est mal réparti, que véritablement on est embarrassé de le démontrer.
Quand on voit, par exemple, qu’un homme qui, dans une orgie, boit pour 6 francs de vin de Champagne, paie le même impôt que l’ouvrier, qui a besoin de réparer ses forces pour le travail, et boit pour 6 sous de vin commun, il est impossible de dire qu’il n’y a pas une inégalité, une monstruosité dans la répartition de l’impôt sur les boissons. (Très-bien !)
On a presque fait un calcul infinitésimal pour établir que l’impôt est peu de chose, que ce sont des fractions de centime, et qu’on ne devrait pas en tenir compte. C’est ainsi qu’on met sur le dos d’une classe de citoyens 106 millions d’un impôt inique, en leur disant : Ce n’est rien ; vous devez vous estimer fort heureux ! Les hommes qui invoquent cet argument devraient vous dire ceci : Nous exerçons telle industrie, et nous sommes tellement convaincus que l’impôt, en se divisant, est insensible pour le consommateur sur lequel il retombe, que nous nous assujettissons nous-mêmes à l’impôt indirect et à l’exercice, relativement à l’industrie que nous professons. Le jour où ces hommes viendraient déclarer cela à cette tribune, je dirais : Ils sont sincères dans leur défense de l’impôt sur les boissons.
Mais enfin voici des chiffres. Dans le département de l’Ain, le prix moyen des vins en gros est de 11 fr. ; le prix moyen de la vente, au détail, est de 41 fr. Voilà un écart considérable ; il est évident que celui qui peut acheter du vin en gros paye 11 fr., et que celui qui est obligé d’aller l’acheter au détail paye 41 fr. Entre 11 et 41 fr :, la différence est de 30 fr. (Interruption.)
Un membre à droite. Ce n’est pas l’impôt qui fait cette différence ; il en est de même pour toutes les marchandises.
M. le Président. M. de Charancey a fait ses calculs, laissez l’orateur faire les siens.
M. F. Bastiat. Je pourrais citer d’autres départements ; j’ai pris le premier sur la liste. Sans doute, il y a le bénéfice du débitant ; mais l’impôt entre pour une proportion considérable dans un tel écart.
On a cherché à prouver des choses si extraordinaires, depuis deux jours, que vraiment je ne serais pas étonné que l’on cherchât à prouver celle-ci, que l’impôt ne nuit à personne, ni au producteur, ni au consommateur. Mais alors imposons tout, non-seulement les vins, mais tous les produits !
Je dis ensuite que l’impôt est d’une perception très-dispendieuse. Je n’invoquerai pas de chiffres pour le prouver ; par les chiffres on prouve beaucoup de choses. Quand on avance des chiffres à cette tribune, on croit leur donner une autorité très-grande en disant : ce sont des chiffres officiels. Mais les chiffres officiels trompent comme les autres ; cela dépend de l’emploi qu’on en fait.
Le fait est que, lorsque nous voyons le territoire de la France tout entière couvert d’agents, et d’agents bien rétribués, pour la perception de cet impôt, il est bien permis de croire que cette perception coûte fort cher.
Enfin, nous disons que cet impôt est accompagné, dans sa perception, de formalités vexatoires. C’est un point que les orateurs qui m’ont précédé à cette tribune, n’ont pas abordé. Cela ne m’étonne pas, car ils appartiennent tous ou presque tous à des départements qui ne cultivent pas la vigne. S’ils habitaient nos départements, ils sauraient que les griefs des propriétaires de vignes contre l’impôt des boissons sont moins dirigés contre l’impôt lui-même, contre son chiffre, que contre ces formalités gênantes, vexatoires et dangereuses, contre les piéges à chaque instant tendus sous leurs pas. (Approbation à gauche.)
Tout le monde comprend que, lorsque l’on conçut cette pensée si extraordinaire, cette immense utopie, car c’en était une grande alors, d’établir un droit sur la circulation des vins, sans qu’un inventaire préalable eut été fait ; tout le monde, dis-je, comprend qu’il a fallu, pour assurer la perception de ce droit, imaginer le code le plus préventif, le plus vexatoire même, car autrement, comment aurait-on fait ? Il faut que, chaque fois qu’une pièce de vin circule sur la surface du territoire, il y ait là un employé pour savoir si elle est en règle ou non. Cela ne peut se faire sans une armée d’employés et une foule de vexations, contre lesquelles, je le répète, les contribuables protestent plus encore que contre la taxe elle-même.
L’impôt des boissons a une autre conséquence très-grave que je n’ai pas entendu signaler à cette tribune.
L’impôt des boissons a jeté la perturbation dans ce grand phénomène économique que l’on appelle la division du travail. Autrefois on cultivait les vins dans les terres qui sont propres à cette culture, sur les coteaux, sur les graviers ; on cultivait le blé sur les plateaux, dans les plaines, sur les terrains d’alluvion. Au commencement, on avait imaginé l’inventaire ; mais ce mode de perception d’impôt souleva tous les propriétaires. Ils invoquèrent le droit de propriété ; et, comme ils étaient trois millions, ils furent écoutés. Alors on rejeta le fardeau sur les cabaretiers ; et, comme ils n’étaient que trois cent mille, il fut déclaré, en principe, que la propriété de 300,000 hommes n’était pas aussi bien une propriété que celle de trois millions d’hommes, quoique cependant la propriété n’ait, selon moi, qu’un seul principe.
Mais quel fut le résultat pour les propriétaires ? je crois que les propriétaires portent eux-mêmes le poids de la faute et de l’injustice qu’ils commirent alors. Comme ils avaient la faveur de consommer leurs produits sans payer de taxe, il arriva que, soit pour se soustraire à la taxe, soit pour se soustraire surtout et avant tout aux formalités et aux risques que cette perception fait courir, les propriétaires des plaines, des alluvions, voulurent tous avoir du vin chez eux pour leur consommation. Dans le département que je représente ici, ou du moins dans une grande partie de ce département, je puis affirmer qu’il n’y a pas une métairie où l’on ne plante assez de vignes pour la consommation de la famille : ces vignes produisent du vin très-mauvais, mais cela offre l’immense avantage d’être délivré de l’intervention des contributions indirectes et de tous les risques qui s’attachent à ses visites.
Ce fait explique, jusqu’à un certain point, l’accroissement que l’on a signalé dans la plantation des vignes. On retourne beaucoup cet accroissement contre les plaintes des propriétaires, qui se prétendent victimes d’une injustice ; on a l’air de leur dire : Cette injustice ne compte pas, elle n’est rien, puisqu’on plante des vignes en France.
D’abord, je voudrais bien qu’on me citât une industrie qui, depuis 1788 jusqu’à 1850, dans l’espace de soixante-deux ans, ne se soit pas développée dans cette proportion. Je voudrais savoir, par exemple, si l’industrie de la houille, si l’industrie du fer, si l’industrie du drap ne se sont pas développées dans cette proportion. Je voudrais savoir s’il y a aucune industrie dont on puisse dire qu’elle ne s’est pas accrue d’un quart dans l’espace de soixante ans. Serait-il donc bien étonnant qu’en suivant sa marche naturelle, l’industrie la plus enracinée de notre sol, l’industrie qui pourrait fournir de ses produits l’univers entier, se fût augmentée dans cette proportion ? Mais cet accroissement, messieurs, est provoqué par la loi elle-même. C’est la loi qui fait que l’on arrache la vigne sur les coteaux et qu’on en plante dans les plaines, pour se soustraire aux vexations des contributions indirectes. C’est là une perturbation énorme, manifeste.
Je vous prie de me permettre d’appeler toute votre attention sur un fait presque local, puisqu’il ne concerne qu’un seul arrondissement, mais qui a une grande importance, au moins à mes yeux, parce qu’il se rattache à une loi générale.
Ce fait, messieurs, servira aussi à répondre à cet argument qu’on a porté à cette tribune, quand, invoquant l’autorité d’Adam Smith, on a dit que l’impôt retombe toujours sur le consommateur ; d’où il résulte que, depuis quarante ans, tous les propriétaires de vignobles de France ont tort de se plaindre et ne savent ce qu’ils disent. Oui, je suis de ceux qui croient que l’impôt retombe sur le consommateur ; j’ajoute cependant cette parenthèse : c’est à la longue, avec beaucoup de temps, quand toutes les propriétés ont changé de mains, à la suite d’arrangements économiques qui sont longs à se faire, que ce grand résultat est atteint ; et, pendant tout le temps que dure cette révolution, les souffrances peuvent être très-grandes, énormes. Je vais en citer un exemple.
Dans mon arrondissement qui est vinicole, il y avait autrefois une très-grande prospérité ; l’aisance était générale ; on cultivait la vigne ; le vin était consommé soit sur les lieux, soit dans les plaines environnantes, où l’on ne cultivait pas la vigne, soit à l’étranger, dans le nord de l’Europe.
Tout à coup, la guerre des douanes, d’un côté, la guerre des octrois, de l’autre, et les droits réunis sont venus et ont déprécié la valeur de ce vin.
Le pays dont je parle était cultivé tout entier, surtout en ce qui concerne la vigne, par des métayers. Le métayer avait la moitié, le propriétaire, l’autre moitié du produit. La superficie des métairies était cultivée de telle sorte qu’un métayer et sa famille pouvaient vivre du produit de la moitié du vin qui leur revenait ; mais la valeur du vin se trouvant dépréciée, il est arrivé que le métayer n’a plus pu vivre avec sa portion. Alors il s’est adressé à son propriétaire et il lui a dit : Je ne puis plus cultiver votre vigne si vous ne me nourrissez pas. Le propriétaire lui a donné du maïs pour vivre, et puis, au bout de l’année, il a pris toute la récolte pour se rembourser de ses avances. La récolte n’ayant pas suffi au recouvrement de ses avances, le contrat s’est modifié non pas devant le notaire, mais de fait ; le propriétaire a eu des ouvriers auxquels il n’a donné, pour tout prix de leur travail, que leur nourriture en maïs.
Mais il a fallu sortir de cet état de choses, et voici comment la révolution s’est opérée. On a agrandi les métairies, c’est-à-dire que de trois on en a fait deux, ou de deux une ; puis, en arrachant quelques champs de vigne, et en mettant du maïs à la place, on a dit : Avec ce maïs le métayer pourra vivre, et le propriétaire ne sera plus obligé de lui donner de quoi suffire à sa subsistance.
Sur tout le territoire, on a donc vu abattre des maisons et détruire des métairies. La conséquence, c’est qu’on a détruit autant de familles que de métairies ; la dépopulation a été énorme, et, depuis vingt-cinq ans le nombre des décès a dépassé celui des naissances.
Sans doute, quand la révolution se sera complétement faite, quand les propriétaires auront acheté pour 10,000 fr., ce qu’ils payaient autrefois 30,000 fr., quand le nombre des métayers sera réduit au niveau des moyens de subsistance que le pays peut fournir, alors je crois que la population ne pourra plus s’en prendre à l’impôt des boissons ; la révolution se sera faite, l’impôt retombera sur le consommateur ; mais cette révolution se sera faite au prix de souffrances qui auront duré un siècle ou deux.
Je demande si c’est pour cela que nous faisons des lois. Je demande si nous prélevons des impôts pour tourmenter les populations, pour les forcer de transporter le travail du coteau à la plaine et de la plaine au coteau. Je demande si c’est là le but de la législation. Quant à moi, je ne le crois pas.
Mais, messieurs, nous avons beau attaquer l’impôt, dire qu’il est inégal, vexatoire, dispendieux, injuste, il y a une raison devant laquelle tout le monde courbe la tête : c’est la nécessité. C’est la nécessité qu’on invoque ; c’est la nécessité qui vous engage à porter à cette tribune des paroles pour justifier l’impôt ; c’est la nécessité, rien que la nécessité qui vous détermine. On craint les embarras financiers, on craint les résultats d’une réforme (car je puis bien l’appeler une réforme) qui aurait pour conséquence immédiate de soustraire 100 millions au Trésor public : c’est donc de la nécessité que je veux parler.
Messieurs, la nécessité, j’en conviens, elle existe, elle est très-pressante. Oui, le bilan, non pas de la France, mais du gouvernement français, peut se faire en bien peu de mots. Depuis vingt ou vingt-cinq ans, les contribuables fournissent au Trésor une somme qui, je crois, a doublé dans cet espace de temps. Les gouvernements qui se sont succédé ont trouvé le moyen de dévorer la somme première, l’excédant fourni par les contribuables ; d’ajouter une dette publique de 1 milliard ou de 2 milliards ; d’arriver, à l’entrée de l’année, avec un déficit de 5 à 600 millions ; enfin de commencer l’année prochaine avec un découvert assuré de 300 millions.
Voilà où nous en sommes. Je crois que cela vaut bien la peine de se demander quelle est la cause de cet état de choses, et s’il est bien prudent, en face de cette situation, de venir nous dire que, ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de rétablir tout juste les choses comme elles étaient avant ; c’est de ne rien changer ou presque rien, ou d’une manière imperceptible, à notre système financier, soit du côté des recettes, soit du côté des dépenses. Il me semble voir un ingénieur, qui a lancé une locomotive et qui est arrivé à une catastrophe, découvrir ensuite où est le vice, où est le défaut, et, sans s’en préoccuper davantage, la remettre sur les mêmes rails, et courir une seconde fois le même danger. (Approbation à gauche.)
Oui, la nécessité existe ; mais elle est double. Il y a deux nécessités.
Vous ne parlez que d’une nécessité, monsieur le ministre des finances ; mais je vous en signalerai une autre, et elle est très-grave ; je la crois même plus grave que celle dont vous parlez. Cette nécessité est renfermée dans un seul mot : la révolution de Février.
Il est intervenu, par suite des abus (car je puis appeler abus tout ce qui a conduit nos finances à l’état où elles sont maintenant), il est intervenu un fait ; ce fait, on l’a caractérisé quelquefois en disant que c’était une surprise. Je ne crois pas que ce fût une surprise. Il est possible que le fait extérieur soit le résultat d’un accident qui aurait été arrêté…
M. Barthélemy Saint-Hiliaire. Retardé !
Plusieurs autres membres à gauche. Oui ! oui ! retardé.
M. Bastiat. Mais les causes générales ne sont pas du tout fortuites. C’est absolument comme si vous me disiez, — alors qu’une brise, en passant, a fait tomber un fruit de son arbre, — que, si on avait pu empêcher la brise de passer, le fruit ne serait pas tombé. Oui, mais à une condition, c’est que le fruit n’eût pas été pourri et rongé. (Approbation à gauche.) Ce fait est arrivé, ce fait a donné une puissance politique à la masse entière de la population ; c’est un fait grave.
M. Fould, ministre des finances. Pourquoi le gouvernement provisoire n’a-t-il pas supprimé l’impôt des boissons ?
M. Bastiat. Il ne m’a pas consulté, il ne m’a pas soumis de projet de loi, je n’ai pas été appelé à lui donner des conseils ; mais nous avons ici un projet, et en repoussant votre projet, il m’est bien permis de vous dire sur quels motifs je me fonde. Je me fonde sur celui-ci : il pèse sur votre tête, non pas une nécessité, mais deux ; la seconde nécessité, aussi impérieuse que la première, c’est de faire justice à tous les citoyens. (Assentiment à gauche.)
Eh bien ! je dis qu’après la révolution qui s’est faite, vous devez vous préoccuper de l’état politique où est la France, et que cet état politique est déplorable, permettez-moi le mot ; je n’attribue pas cela aux hommes qui gouvernent aujourd’hui, cela remonte haut.
Est-ce qu’en France vous ne voyez pas une bureaucratie devenue aristocratie dévorer le pays ? L’industrie périt, le peuple souffre. Je sais bien qu’il cherche le remède dans des utopies folles ; mais ce n’est pas une raison pour leur ouvrir la porte en laissant subsister des injustices criantes, comme celles que je signale à cette tribune.
Je crois qu’on ne se préoccupe pas assez de l’état de souffrance dans lequel se trouve ce pays et des causes qui ont amené cet état de souffrance. Ces causes sont dans ces 1,500 millions prélevés sur un pays qui ne peut les payer.
Je vous supplie de faire une réflexion bien triviale, mais enfin je la fais souvent. Je me demande ce que sont devenus mes amis d’enfance et mes camarades de collége . Et savez-vous quelle est la réponse ? Sur vingt, il y en a quinze qui sont fonctionnaires ; et je suis persuadé que si vous faites le calcul, vous arriverez au même résultat. (Rires approbatifs à gauche.)
M. Bérard. C’est là la cause des révolutions.
M. Bastiat. Je me fais encore une autre question, c’est celle-ci :
En les prenant un à un, en bonne conscience, rendent-ils au pays des services réels équivalant à ce que le pays leur paye ? Et presque toujours je suis forcé de répondre : Il n’en est pas ainsi.
N’est-il pas déplorable que cette masse énorme de travail, d’intelligence, soit soustraite à la production réelle du pays pour alimenter des fonctionnaires inutiles et presque toujours nuisibles ? Car, en fait de fonctionnaires publics, il n’y a pas de neutralité : s’ils ne sont pas très-utiles, ils sont nuisibles ; s’ils ne maintiennent pas la liberté des citoyens, ils l’oppriment. (Approbation à gauche.)
Je dis que cela crée au gouvernement une nécessité, une nécessité immense. Quel est le plan qu’on nous propose ? Je le dis franchement, si le ministre était venu dire : Il faut maintenir l’impôt pendant quelque temps ; mais voici une réforme financière que je propose ; la voici dans son ensemble ; seulement il faut une certaine période pour qu’elle puisse aboutir, il faut quatre ou cinq ans, nous ne pouvons pas tout faire à la fois ; j’aurais compris cette nécessité, et j’aurais pu y céder.
Mais il n’y a rien de cela ; on nous dit : Rétablissons l’impôt des boissons. Je ne sais même pas si l’on ne nous fait pas pressentir qu’on rétablira l’impôt du sel et celui de la poste.
Quant à vos diminutions de dépenses, elles sont dérisoires : c’est 3 ou 4,000 soldats de plus ou de moins ; mais c’est le même système financier, qui me semble ne pouvoir plus tenir dans ce pays sans le perdre. (Nouvelle approbation à gauche.)
Messieurs, il est impossible de traiter ce sujet sans le traiter à ce point de vue. La France sera-t-elle perdue, dans un très-court espace du temps ? car j’oserai demander à M. le ministre des finances combien de temps il croit pouvoir prolonger ce système. Ce n’est pas tout que d’aboutir à la fin de l’année, en équilibrant tant bien que mal les recettes et les dépenses ; il faut savoir si cela peut continuer.
Mais, à ce point de vue, je suis obligé de traiter la question de l’impôt en général. (Marques d’impatience à droite.)
Voix nombreuses. Parlez ! parlez !
M. le Président Vous êtes dans la question.
M. Bastiat. Je crois, messieurs, que j’ai le droit de venir ici, sous ma responsabilité, exprimer même des idées absurdes. D’autres orateurs sont venus apporter ici leurs idées, et j’ose croire que leurs idées n’étaient pas plus claires que les miennes. Vous les avez écoutés avec patience ; vous n’avez pas accueilli le plan de liquidation générale de M. Proudhon, non plus que le phalanstère de M. Considérant ; mais vous les avez écoutés ; vous avez été plus loin : par l’organe de M. Thiers, vous avez dit que quiconque croyait avoir une pensée utile était obligé de l’apporter à cette tribune. Eh bien ! lorsqu’on dit : Parlez ! lorsqu’on jette une espèce de défi, il faut au moins écouter. (Très-bien ! très-bien !)
Messieurs, dans ces derniers temps, on s’est beaucoup préoccupé de la question de l’impôt. L’impôt doit-il être direct ou indirect ?
Tout à l’heure nous avons entendu faire l’éloge de l’impôt indirect.
Eh bien ! moi, c’est contre l’impôt indirect en général que je viens m’élever.
Je crois qu’il y a une loi de l’impôt qui domine toute la question, et que je renferme dans cette formule : L’inégalité de l’impôt est en raison de sa masse. Je veux dire par là que plus un impôt est léger, plus il est facile de le répartir équitablement ; que plus, au contraire, il est lourd, plus, malgré toute la bonne volonté du législateur, il tend à se répartir inégalement, plus, comme on pourrait le dire, il tend à devenir progressif au rebours, c’est-à-dire à frapper les citoyens en raison inverse de leurs facultés. Je crois que c’est une loi grave, inévitable ; et ses conséquences sont tellement importantes, que je vous demande la permission de l’éclaircir.
Je suppose que la France fût gouvernée depuis longtemps par un système qui est le mien, qui consisterait à ce que le gouvernement maintînt chaque citoyen dans la limite de ses droits et de la justice, et qu’il abandonnât le reste à la responsabilité de chacun. Je suppose cela. Il est aisé de voir qu’alors la France pourrait être gouvernée avec 200 ou 300 millions. Il est clair que si la France était gouvernée avec 200 millions, il serait facile d’établir une taxe unique et proportionnelle. (Bruit.)
Cette hypothèse que je fais, elle aura sa réalité ; seulement, la question est de savoir si elle l’aura en vertu de la prévoyance du législateur ou en vertu d’éternelles convulsions politiques. (Approbation à gauche.)
L’idée ne m’appartient pas ; si elle m’appartenait, je m’en défierais ; mais nous voyons que tous les peuples du monde sont plus ou moins heureux selon qu’ils se rapprochent ou s’écartent de la réalisation de cette idée. Elle est réalisée d’une manière à peu près complète aux États-Unis.
Dans le Massachusets , on ne connaît d’autre impôt que l’impôt direct, unique et proportionnel ; par conséquent, s’il en était ainsi, et il est aisé de le comprendre, car je n’élucide que le principe, rien ne serait plus facile que de demander aux citoyens une part proportionnelle à leurs valeurs réalisées ; ce serait si peu de chose que nul ne serait intéressé à cacher, dans une grande proportion au moins, sa fortune pour y échapper.
Voilà la première partie de mon axiome.
Mais si vous demandez aux citoyens, non pas 200 millions, mais 500, 600, 800 millions ; alors, à mesure que vous augmentez l’impôt, l’impôt direct vous échappe, et il est évident que vous arrivez à un moment où un citoyen prendrait plutôt le fusil que de payer à l’État, par exemple, la moitié de sa fortune.
Un membre. Comme dans l’Ardèche.
M. Bastiat. Alors on ne vous payera pas. Que faut-il donc faire ? Il faut avoir recours aux impôts indirects ; c’est ce qui a lieu partout où l’on a voulu faire de grandes dépenses. Partout, dès que l’État veut donner aux citoyens toutes sortes de bienfaits, l’instruction, la religion, la moralité, on est obligé de donner à cet État des taxes indirectes considérables.
Eh bien ! je dis que lorsqu’on est dans cette voie l’on tombe dans l’inégalité des impôts. L’inégalité provient toujours des taxes indirectes elles-mêmes. La raison en est simple. Si la dépense était restreinte dans certaines limites, on pourrait très-certainement trouver certains impôts indirects qui blesseraient l’égalité, mais qui ne blesseraient pas le sentiment de la justice, parce que ce seraient des impôts somptuaires ; mais lorsqu’on veut prélever beaucoup d’argent, alors on émet un principe vrai, dans l’hypothèse où je me place, en disant que le meilleur impôt est celui qui frappe les objets de la consommation la plus générale. C’est un principe que tous nos financiers et tous nos hommes d’État avouent. Et, en effet, il est très-conséquent dans les gouvernements où il s’agit de prendre le plus d’argent au peuple ; mais alors vous arrivez à l’inégalité la plus choquante.
Qu’est-ce que c’est qu’un objet dont la consommation est très-générale ? C’est un objet que le pauvre consomme dans la même proportion que le riche ; c’est un objet sur lequel l’ouvrier dépense tout son salaire.
Ainsi, un agent de change gagne 500 fr. par jour, un ouvrier gagne 500 fr. par an. ; et la justice voudrait que les 500 fr. de l’agent de change fournissent autant au Trésor que les 500 fr. de l’ouvrier. Mais il n’en est pas ainsi ; car l’agent de change achètera des tentures, des bronzes, des objets de luxe avec son argent, c’est-à-dire des objets de consommation restreinte qui ne payent pas de taxe, tandis que l’ouvrier achète du vin, du sel, du tabac, c’est-à-dire des objets de consommation générale qui en sont accablés. (Bruit et interruptions diverses.)
M. Lacaze. Si l’agent de change n’achetait pas ces objets, il ne ferait pas vivre l’ouvrier.
M. Bastiat. Est-ce que la suppression de l’impôt des boissons empêcherait l’agent de change d’acheter des bronzes et des tentures ? Aucun financier ne me démentira. Dans le système des impôts indirects, il n’y a de raisonnable, de vraiment raisonnable, dans ce système que je n’approuve pas, que les impôts qui s’adressent aux objets de la consommation la plus générale. Ainsi, vous commencez à frapper l’air respirable par l’impôt des portes et fenêtres, puis le sel, puis les boissons, puis le tabac, enfin ce qui est à la portée de tout le monde.
Je dis que ce système ne peut tenir en présence du suffrage universel. J’ajoute : bien aveugle, bien imprudent qui ne voit pas aussi la nécessité de ce côté, et ne voit que la nécessité à laquelle je faisais allusion tout à l’heure. (Vive approbation à gauche.)
Je fais un autre reproche à l’impôt indirect, c’est celui de créer précisément ces nécessités dont on vous parle, ces nécessités financières. Croyez-vous que, si l’on demandait la part contributive de chaque citoyen sous la forme directe ; si on lui envoyait un bulletin de contribution portant, non-seulement le chiffre de ce qu’il doit pour l’année, mais le détail de ses contributions ; car c’est facile à décomposer : tant pour la justice, tant pour la police, tant pour l’Algérie, tant pour l’expédition de Rome, etc. ; croyez-vous pour cela que le pays ne serait pas bien gouverné [2] ? M. Charencey nous disait tout à l’heure qu’avec l’impôt indirect le pays était sûr d’être bien gouverné. Eh bien, moi, je dis le contraire. Avec tous ces impôts détournés, dus à la ruse, le peuple souffre, murmure et s’en prend à tout : au capital, à la propriété, à la monarchie, à la république, et c’est l’impôt qui est le coupable. (C’est vrai ! c’est vrai !)
Voilà pourquoi le gouvernement, trouvant toujours des facilités, a tant augmenté les dépenses. Quand s’est-il arrêté ? quand a-t-il dit : Nous avons un excédant de recettes, nous allons dégréver ? Jamais il n’a fait cela. Quand on a de trop, on trouve à l’employer ; c’est ainsi que le nombre des fonctionnaires est monté à un chiffre énorme.
On nous accuse d’être malthusiens ; oui, je suis malthusien en ce qui concerne les fonctionnaires publics. Je sais bien qu’ils ont suivi parfaitement cette grande loi, que les populations se mettent au niveau des moyens de subsistance. Vous avez donné 800 millions, les fonctionnaires publics ont dévoré 800 millions ; vous leur donneriez 2 milliards, il y aurait des fonctionnaires pour dévorer ces deux milliards. (Approbation sur plusieurs bancs.)
Un changement dans un système financier en entraîne nécessairement un correspondant dans le système politique ; car un pays ne peut pas suivre la même politique, lorsque la population lui donne 2 miliards , que lorsqu’elle ne lui donne que 200 ou 300 millions. Et ici, vous me trouverez peut-être profondément en désaccord avec un grand nombre de membres qui siégent de ce côté (la gauche). La conséquence forcée, pour tout homme sérieux, de la théorie financière que je développe ici, est évidemment celle-ci : que, puisqu’on ne veut pas donner beaucoup à l’État, il faut savoir ne pas lui demander beaucoup. (Assentiment.)
Il est évident que si vous vous mettez dans la tête, ce qui est une profonde illusion, que la société a deux facteurs : d’un côté, les hommes qui la composent, et, de l’autre, un être fictif qu’on appelle l’État, le gouvernement, auquel vous supposez une moralité à toute épreuve, une religion, un crédit, la facilité de répandre des bienfaits, de faire de l’assistance ; il est bien évident qu’alors vous vous placez dans la position ridicule d’hommes qui disent : Donnez-nous sans nous rien prendre, — ou qui disent : Restez dans le système funeste où nous sommes à présent engagés.
Il faut savoir renoncer à ces idées ; il faut savoir être hommes, et se dire : Nous avons la responsabilité de notre existence, et nous la supporterons. (Très-bien ! très-bien !)
Encore aujourd’hui, je reçois une pétition d’habitants de mon pays, où des vignerons disent : Nous ne demandons rien de tout cela au gouvernement ; qu’il nous laisse libres, qu’il nous laisse agir, travailler ; voilà tout ce que nous lui demandons ; qu’il protége notre liberté et notre sécurité.
Eh bien, je crois que c’est là une leçon, émanée de pauvres vignerons, qui devrait être écoutée dans les plus grandes villes. (Très-bien !)
Le système de politique intérieure dans lequel ce système financier nous forcerait d’entrer, c’est évidemment le système de la liberté, car, remarquez-le, la liberté est incompatible avec les grands impôts, quoi qu’on en dise.
J’ai lu un mot d’un homme d’État très-célèbre, M. Guizot, le voici : « La liberté est un bien trop précieux pour qu’un peuple la marchande. »
Eh bien, quand j’ai lu cette sentence il y a longtemps, je me suis dit : « Si jamais cet homme gouverne le pays, il perdra non-seulement les finances, mais la liberté de la France. »
Et, en effet, je vous prie de remarquer, comme je le disais tout à l’heure, que les fonctions publiques ne sont jamais neutres ; si elles ne sont pas indispensables, elles sont nuisibles.
Je dis qu’il y a incompatibilité radicale entre un impôt exagéré et la liberté.
Le maximum de l’impôt, c’est la servitude ; car l’esclave est l’homme à qui l’on prend tout, même la liberté de ses bras et de ses facultés. (Très-bien !)
Eh bien, est-ce que si l’État ne payait pas à nos dépens un culte, par exemple, nous n’aurions pas la liberté des cultes ? Est-ce que si l’État ne payait pas à nos dépens l’université, nous n’aurions pas la liberté de l’instruction publique ? Est-ce que si l’État ne payait pas à nos dépens une bureaucratie très-nombreuse, nous n’aurions pas la liberté communale et départementale ? Est-ce que si l’État ne payait pas à nos dépens des douaniers, nous n’aurions pas la liberté du commerce ? (Très-bien ! très-bien ! — Mouvement prolongé.)
Car qu’est-ce qui manque le plus aux hommes de ce pays-ci ? Un peu de confiance en eux-mêmes, le sentiment de leur responsabilité. Il n’est pas bien étonnant qu’ils l’aient perdu, on les a habitués à le perdre à force de les gouverner. Ce pays est trop gouverné, voilà le mal.
Le remède est qu’il apprenne à se gouverner lui-même, qu’il apprenne à faire la distinction entre les attributions essentielles de l’État et celles qu’il a usurpées, à nos frais, sur l’activité privée.
Tout le problème est là.
Quant à moi, je dis : Le nombre des choses qui rentrent dans les attributions essentielles du gouvernement est très-limité : faire régner l’ordre, la sécurité, maintenir chacun dans la justice, c’est-à-dire réprimer les délits et les crimes, et exécuter quelques grands travaux d’utilité publique, d’utilité nationale, voilà, je crois, quelles sont ses attributions essentielles ; et nous n’aurons de repos, nous n’aurons de finances, nous n’aurons abattu l’hydre des révolutions que lorsque nous serons rentrés, par des voies progressives, si vous voulez, dans ce système vers lequel nous devons nous diriger. (Très-bien !)
La seconde condition de ce système, c’est qu’il faut vouloir sincèrement la paix ; car il est évident que non-seulement la guerre, mais même l’esprit de guerre, les tendances belliqueuses sont incompatibles avec un pareil système. Je sais bien que le mot paix fait quelquefois circuler le sourire de l’ironie sur ces bancs ; mais, véritablement, je ne crois pas que des hommes sérieux puissent accueillir ce mot avec ironie. Comment ! l’expérience ne nous apprendra-t’elle jamais rien ?
Depuis 1815, par exemple, nous entretenons des armées nombreuses, des armées énormes ; et je puis dire que ce sont précisément ces grandes forces militaires qui nous ont entraînés malgré nous dans des affaires, dans des guerres dont nous ne nous serions pas mêlés assurément, si nous n’avions pas eu ces grandes forces derrière nous. Nous n’aurions pas eu la guerre d’Espagne, en 1823 ; nous n’aurions pas eu, l’année dernière, l’expédition de Rome ; nous aurions laissé le pape et les Romains s’arranger entre eux, si notre appareil militaire eût été restreint à des proportions plus modestes. (Mouvements divers.)
Une voix à droite. Et en juin, vous n’avez pas été fâché d’avoir l’armée !
M. Bastiat. Vous me répondez par le mois de juin. Moi, je vous dis que si vous n’aviez pas eu ces grosses armées, vous n’auriez pas eu le mois de juin. (Hilarité prolongée à droite. — Longue agitation.)
Une voix à droite. C’est comme si vous disiez qu’il n’y aurait pas de voleurs s’il n’y avait pas de gendarmes.
M. Bérard. Mais ce sont les fonctionnaires publics des ateliers nationaux qui ont fait le mois de juin.
M. Bastiat. Je raisonne dans l’hypothèse où la France aurait été bien gouvernée, presque idéalement gouvernée, et alors il m’est bien permis de croire que nous n’aurions pas eu les funestes journées de juin, comme nous n’aurions pas eu le 24 février 1848, 1830, ni peut-être 1814.
Quoi qu’il en soit, la liberté et la paix, voilà les deux colonnes du système que je développe ici. Et remarquez bien que je ne le présente pas seulement comme bon en lui-même, mais comme commandé par la nécessité la plus impérieuse.
Maintenant il y a des personnes qui se préoccupent, et avec raison, de la sécurité. Je m’en préoccupe aussi et autant que qui que ce soit ; c’est un bien aussi précieux que les deux autres ; mais nous sommes dans un pays habitué à être tellement gouverné qu’on ne peut s’imaginer qu’il puisse y avoir un peu d’ordre et de sécurité avec moins de réglementation. Je crois que c’est précisément dans cette surabondance de gouvernement que se trouve la cause de presque tous les troubles, les agitations, les révolutions dont nous sommes les tristes témoins et quelquefois les victimes.
Voyons ce que cela implique.
La société se divise alors en deux parties : les exploitants et les exploités. (Allons donc ! — Longue interruption.)
Une voix à droite. Ce n’est pas une telle distinction qui peut ramener la paix.
M. Bastiat. Messieurs, il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque ; je ne fais aucune espèce d’allusion, ni à la la propriété, ni au capital ; je parle seulement de 1,800 millions qui sont payés d’un côté et qui sont reçus de l’autre. J’ai peut-être eu tort de dire exploités, car, dans ces 1,800 millions, il y en a une partie considérable qui va à des hommes qui rendent des services très-réels. Je retire donc l’expression. (Rumeurs au pied de la tribune.).
M. le Président. Messieurs, gardez donc le silence ; vous n’êtes là qu’à la condition de garder le silence plus que tous les autres.
M. Bastiat. Je veux faire observer que cet état de choses, cette manière d’être, ces immenses dépenses du gouvernement doivent toujours être justifiées pour expliquées de quelque façon ; par conséquent, cette prétention du gouvernement de tout faire, de tout diriger, de tout gouverner, a dû faire naître naturellement une pensée dangereuse dans le pays : cette population qui est au-dessous attend tout du gouvernement, elle attend l’impossible de ce gouvernement. (Très-bien ! très-bien !)
Nous parlons des vignerons : j’ai vu des vignerons les jours de grêle, les jours où ils sont ruinés ; ils pleurent, mais ils ne se plaignent pas du gouvernement ; ils savent qu’entre la grêle et lui n’existe aucune connexité. Mais lorsque vous induisez la population à croire que tous les maux qui n’ont pas un caractère aussi abrupt que la grêle, que tous les autres maux viennent du gouvernement, que le gouvernement le laisse croire lui-même, puisqu’il ne reçoit cette énorme contribution qu’à la condition de faire quelque bien au peuple ; il est évident que, lorsque les choses en sont là, vous avez des révolutions perpétuelles dans le pays, parce qu’à raison du système financier dont je parlais tout à l’heure, le bien que peut faire le gouvernement n’est rien en comparaison du mal qu’il fait lui-même par les contributions qu’il soutire.
Alors le peuple, au lieu d’être mieux, est plus mal, il souffre, il s’en prend au gouvernement ; et il ne manque pas d’hommes dans l’opposition qui viennent et qui lui disent : Voyez-vous ce gouvernement qui vous a promis ceci, promis cela…, qui devait diminuer tous les impôts, vous combler de bienfaits ; voyez-vous ce gouvernement comme il tient ses promesses ! Mettez-nous à sa place, et vous verrez comme nous ferons autre chose ! (Hilarité générale. — Marques d’approbation) Alors on renverse le gouvernement. Et cependant les hommes qui arrivent au pouvoir se trouvent précisément dans la même situation que ceux qui les ont précédés ; ils sont obligés de retirer peu à peu toutes leurs promesses ; ils disent à ceux qui les pressent de les réaliser : Le temps n’est pas venu, mais comptez sur l’amélioration de la situation, comptez sur les exportations, comptez sur une prospérité future. Mais, comme, en réalité, ils ne font pas plus que leurs prédécesseurs, on a plus de griefs contre eux, on finit par les renverser, et l’on marche de révolution en révolution. Je ne crois pas qu’une révolution soit possible là où le gouvernement n’a d’autres relations avec les citoyens que de garantir à chacun sa sécurité, sa liberté. (Très-bien ! très-bien !) Pourquoi se révolte-t-on contre un gouvernement ? C’est parce qu’il manque à sa promesse. Avez-vous jamais vu le peuple se révolter contre la magistrature, par exemple ? Elle a mission de rendre la justice et la rend ; nul ne songe à lui demander plus. (Très-bien !)
Persuadez-vous bien d’une chose, c’est que l’amour de l’ordre, l’amour de la sécurité, l’amour de la tranquillité n’est un monopole pour personne. Il existe, il est inhérent à la nature humaine. Interrogez tous ces hommes mécontents, parmi lesquels il y a bien quelques perturbateurs sans doute… Eh ! mon Dieu, il y a toujours des exceptions. Mais interrogez les hommes de toutes les classes, ils vous diront tous combien, dans ce temps-ci, ils sont effrayés de voir l’ordre compromis ; ils aiment l’ordre, ils l’aiment au point de lui faire de grands sacrifices, des sacrifices d’opinion et des sacrifices de liberté ; nous le voyons tous les jours. Eh bien ! ce sentiment serait assez fort pour maintenir la sécurité, surtout si les opinions contraires n’étaient pas sans cesse alimentées par la mauvaise constitution du gouvernement.
Je n’ajouterai qu’un mot relativement à la sécurité.
Je ne suis pas un profond jurisconsulte, mais je crois véritablement que si le gouvernement était renfermé dans les limites dont je parle, et que toute la force de son intelligence, de sa capacité fût dirigée sur ce point-là : améliorer les conditions de sécurité des hommes, je crois qu’on pourrait faire dans cette carrière des progrès immenses. Je ne crois pas que l’art de réprimer les délits et les vices, de moraliser et de réformer les prisonniers, ait fait encore tous les progrès qu’il peut faire. Je dis et je répète que si le gouvernement excitait moins de jalousies, d’un côté, moins de préjugés, d’un autre côté, et que toutes ses forces pussent être dirigées vers l’amélioration civile et pénale, la société aurait tout à y gagner.
Je m’arrête. J’ai une conviction si profonde que les idées que j’apporte à cette tribune remplissent toutes les conditions d’un programme gouvernemental, qu’elles concilient tellement la liberté, la justice, les nécessités financières et le besoin de l’ordre et tous les grands principes qui soutiennent les peuples et l’humanité ; j’ai cette conviction si bien arrêtée, que j’ai peine à croire qu’on puisse taxer ce projet d’utopie. Et, au contraire, il me semble véritablement que si Napoléon, par exemple, revenait dans ce monde (Exclamations à droite) et qu’on lui dit : Voilà deux systèmes ; dans l’un, il s’agit de restreindre, de limiter les attributions gouvernementales et par conséquent les impôts ; dans l’autre, il s’agit d’étendre indéfiniment les attributions gouvernementales et par conséquent les impôts, et par suite il faut faire accepter à la France les droits réunis, — j’ai la conviction et j’affirme que Napoléon dirait que la véritable utopie est de ce dernier côté, car il a été bien plus difficile d’établir les droits réunis, qu’il ne le serait d’entrer dans le système que je viens de proclamer à cette tribune.
Maintenant on me demandera pourquoi je refuse aujourd’hui et sur-le-champ l’impôt des boissons ; je le dirai. Je viens d’exposer le système, la théorie dans laquelle je voudrais que le gouvernement entrât. Mais comme je n’ai jamais vu un gouvernement qui voulût exécuter sur lui ce qu’il regarde comme une sorte de demi-suicide, retrancher toutes les attributions qui ne lui sont pas essentielles, je me vois obligé de le forcer, et je ne le puis qu’en lui refusant les moyens de persévérer dans une voie funeste. C’est pour cela que j’ai voté pour la réduction de l’impôt du sel ; c’est pour cela que j’ai voté pour la réforme postale ; c’est pour cela que je voterai contre l’impôt des boissons. (Assentiment à gauche.)
C’est ma conviction intime que la France, si elle a foi, si elle a confiance en elle-même, si elle a la certitude qu’on ne viendra pas l’attaquer, du moment qu’elle est décidée à ne pas attaquer les autres, c’est ma conviction intime qu’il est facile de diminuer les dépenses publiques dans une proportion énorme, et que, même avec la suppression de l’impôt sur les boissons, il restera suffisamment, non-seulement pour aligner les recettes avec les dépenses, mais encore pour diminuer la dette publique. (Marques nombreuses d’approbation.)
FN:Cette improvisation fut prononcée à l’Assemblée législative le 12 décembre 1849. (Note de l’éditeur.)
FN:On peut dire que c’est instinctivement que les contribuables se récrient sur la pesanteur des impôts, car il en est peu qui sachent au juste ce qu’il leur en coûte pour être gouvernés. Nous connaissons bien notre quote-part dans la contribution foncière, mais non ce que nous enlèvent les impôts de consommation. — J’ai toujours pensé que rien ne serait plus favorable à l’avancement de nos connaissances et de nos mœurs constitutionnelles qu’un système de comptabilité individuelle, au moyen duquel chacun serait fixé sur sa cotisation, sous le double rapport du quantum et du quarè.
En attendant que M. le ministre des finances fasse distribuer tous les ans à chacun de nous, avec le bulletin des contributions directes, notre compte courant au Trésor, j’ai essayé d’en dresser la formule, le budget de 1842 à la main.
Voici le compte de M. N…, propriétaire payant 500 fr. de contributions directes, ce qui suppose un revenu de 2,400 à 2,600 fr, au plus.
Doit. Le Trésor public, son compte courant avec M. N.
Sommes reçues de M. N. en 1843 :
| Par contribution directe | 500 | fr. | “ | c. |
| Enregistrement, timbre, domaine | 504 | 17 | ||
| Douanes et sels | 158 | “ | ||
| Forêts et Pèches | 30 | 10 | ||
| Contributions indirectes | 206 | 67 | ||
| Postes | 39 | “ | ||
| Produits universitaires | 2 | 50 | ||
| Produits divers | 21 | 87 | ||
| 1,162 | fr. | 31 | c. | |
Avoir. Sommes acquittées dans l’intérét de M. N. :
| Pour intérêts de la dette publique | 353 | fr. | “ | c. |
| Liste civile | 4 | “ | ||
| Distribution de la Justice | 20 | “ | ||
| Religion | 36 | “ | ||
| Diplomatie | 8 | “ | ||
| Instruction publique | 16 | “ | ||
| Dépenses secrètes | 1 | “ | ||
| Télégraphes | 1 | “ | ||
| Encouragements aux musiciens et danseuses | 3 | “ | ||
| Indigents, malades, infirmes | 1 | 10 | ||
| Secours aux réfugiés | 2 | 15 | ||
| Encouragements à l’agriculture | “ | 80 | ||
| — aux pèches maritimes | 4 | “ | ||
| — aux manufactures | “ | 23 | ||
| Haras | 2 | “ | ||
| Bergeries | “ | 63 | ||
| Secours aux colons | “ | 87 | ||
| — aux inondés et incendiés | 1 | 90 | ||
| Services départementaux | 72 | “ | ||
| Préfets et sous-préfets | 7 | 20 | ||
| Routes, canaux, ponts et ports | 52 | 60 | ||
| Armée | 364 | “ | ||
| Marine | 114 | “ | ||
| Colonies | 26 | “ | ||
| Recouvrement de l’impôt et administration | 150 | “ | ||
| 1,251 | fr. | 48 | c. | |
Entre le doit 1,162 fr. 31 c. et l’avoir 1,251 fr. 48 c., la différence est 89,17. — Ce solde signifie que le Trésor a dépensé pour compte de M. N., 89 fr. 17 c. de plus qu’il n’a reçu de lui. Mais que M. N. se rassure. MM. Rothschild et consorts ont bien voulu faire l’avance de cette somme, et il suffira à M. N. d’en servir l’intérêt à perpétuité ; c’est-à-dire de payer dorénavant 4 à 5 fr. de plus par an.(Ébauche inédite datée de 1843.)
Books and Printed Pamphlets - 1849↩
ToC↩
- *Protectionnisme et communisme* [Jan. 1849]
- *Capitale et rente* (Paris: Guillaumin, 1849)
- *Paix et liberté ou le budget républicain*” [Feb. 1849]
- *Les incompatibilités parlementaires* [March 1849]
- *Maudit argent* [after April 1849]
1850
Correspondence↩
à M. Félix Coudroy: Lettre du Commencement de 1850, Paris ↩
BWV
[CW1.158] [OC1] 158. Paris, janvier 1850. A Félix Coudroy
Il n’y a pas de jour, mon cher Félix, où je ne pense à te répondre. Toujours par la même cause, j’ai la tète si faible que le moindre travail m’assomme. Pour peu que je sois engagé dans quelques-unes de ces affaires qui commandent, le peu de temps que je puis consacrera tenir une plume est absorbé ; et me voilà forcé de renvoyer de jour en jour ma correspondance. Mais enfin, si je dois trouver de l’indulgence quelque part, c’est bien dans mes amis.
Tu me disais, dans une lettre précédente, que tu avais un projet et que tu me le communiquerais. J’attends, très-disposé à te seconder ; mais s’il s’agit de journaux, je dois te prévenir que j’ai très-peu de relations avec eux, et tu devines pourquoi. Il serait impossible de se lier avec eux sans y laisser son indépendance. Je suis décidé, quoi qu’il arrive, à n’être pas un homme de parti. Avec nos idées, c’est un rôle impossible. Je sais bien qu’en ce temps s’isoler c’est s’annuler, mais j’aime mieux cela. Si j’avais la force que j’avais autrefois, le moment serait venu d’exercer une véritable action sur l’opinion publique, et mon éloignement de toute faction me viendrait en aide. Mais je vois l’occasion m’échapper, et c’est bien triste. Il n’y a pas de jour où l’on ne me fournisse l’occasion de dire ou écrire quelque vérité utile. La concordance entre tous les points de notre doctrine finirait par frapper les esprits, qui y sont d’ailleurs préparés par les nombreuses déceptions dont ils ont été dupes. Je vois cela, beaucoup d’amis me pressent de me jeter dans la mêlée, et je ne puis pas. — Je t’assure que j’apprends la résignation ; et, quand j’en aurai besoin, je m’en trouverai bien pourvu.
Les Harmonies passent inaperçues ici, si ce n’est d’une douzaine de connaisseurs. Je m’y attendais ; il ne pouvait en être autrement. Je n’ai pas même pour moi le zèle accoutumé de notre petite église, qui m’accuse d’hétérodoxie ; malgré cela j’ai la confiance que ce livre se fera faire place petit à petit. En Allemagne, il a été bien autrement reçu. On le creuse, on le pioche, on le laboure, on y cherche ce qui y est et ce qui n’y est pas. Pouvais-je souhaiter mieux ?
Maintenant je demanderais au ciel de m’accorder un an pour faire le second volume, qui n’est pas même commencé, après quoi je chanterais le Nunc dimittis.
Le socialisme se propage d’une manière effrayante ; mais, comme toutes les contagions, en s’étendant il s’affaiblit et même se transforme. Il périra par là. Le nom pourra rester, mais non la chose. Aujourd’hui, socialisme est devenu synonyme de progrès ; est socialiste quiconque veut un changement quelconque. Vous réfutez L. Blanc, Proudhon, Leroux, Considérant ; vous n’en êtes pas moins socialiste, si vous ne demandez pas le statu quo en toutes choses. Ceci aboutit à une mystification. Un jour tous les hommes se rencontreront avec cette étiquette sur leur chapeau ; et comme, pour cela, ils ne seront pas plus d’accord sur les réformes à faire, il faudra inventer d’autres noms, la guerre s’introduira parmi les socialistes. Elle y est déjà, et c’est ce qui sauve la France.
Adieu, mon cher Félix, fais dire à ma tante que je me porte bien.
Letters to Cheuvreux Family: 2 janvier 1850, Paris↩
BWV
[CW1.159] [CH] 159. Paris, 2 janvier 1850. A Madame Cheuvreux
Madame,
On me tire de mon assoupissement pour me remettre trois volumes, que vous me renvoyez sans les accompagner d’un seul mot ; aurais-je été assez malheureux pour vous déplaire ?
Hier, vous avez réuni autour de votre table votre famille et quelques amis, pour inaugurer le nouvel an ; ce repas ne devait être que fête, joie et cordialité ; hélas ! la politique s’en est mêlée ; il est bien vrai que, sans moi, la politique n’eût pu y jeter ses sombres reflets, car tout le monde peut-être eût été d’accord.
Mais suis-je coupable ? N’ai-je pas longtemps gardé le silence, et n’ai-je pas mis sur le compte de généralités ce que j’aurais pu prendre pour des personnalités ? Des paroles qui ressemblaient à des provocations ?… — Que deviendrais-je, madame, si cette réserve ne suffit pas ?
Isolé, retenant à peine pour le travail un reste de force qui m’échappe, faudra-t-il perdre encore les douceurs de l’intimité, seul charme qui me rattache à l’existence ?
Entre M. Cheuvreux et moi, qu’importe une dissidence d’opinion, alors surtout qu’elle ne porte pas sur le but, sur aucun principe essentiel, mais seulement sur les moyens de surmonter les difficultés du moment ?
C’est par égard pour lui, autant que pour vous, madame, que j’ai dévoré le calice que ces messieurs ont approché de mes lèvres. Et, après tout, ces opinions qu’on me reproche, sont-elles donc si extravagantes ?
Je souhaiterais bien que l’on consentît à me considérer comme un solitaire, un philosophe, un rêveur, si vous voulez, qui ne veut se livrer à un parti, mais qui les étudie tous, pour voir où est le péril et si l’on peut essayer de le conjurer.
Je vois, en France, deux grandes classes qui, chacune, se subdivise en deux. Pour me servir de termes consacrés, quoique improprement, je les appellerai le peuple et la bourgeoisie.
Le peuple, c’est une multitude de millions d’êtres humains, ignorants et souffrants, par conséquent dangereux ; comme je l’ai dit, il se partage en deux, la grande masse assez attachée à l’ordre, à la sécurité, à tous les principes conservateurs ; mais, à cause de son ignorance et de sa souffrance, proie facile des ambitieux et des sophistes ;cette masse est travaillée par quelques fous sincères et par un plus grand nombre d’agitateurs, de révolutionnaires, de gens qui ont un penchant inné pour le désordre, ou qui comptent sur le désordre pour s’élever à la fortune et à la puissance.
La bourgeoisie, il ne faudrait jamais l’oublier ; c’est le très-petit nombre ; cette classe a aussi son ignorance et sa souffrance, quoiqu’à un autre degré ; elle offre aussi des dangers d’une autre nature. Elle se décompose aussi en un grand nombre de gens paisibles, tranquilles, amis de la justice et de la liberté, et un petit nombre de meneurs. La bourgeoisie a gouverné ce pays-ci, comment s’est-elle conduite ? Le petit nombre a fait le mal, le grand nombre l’a laissé faire ; non sans en profiter à l’occasion.
Voilà la statistique morale et sociale de notre pays.
Tenant très-peu et croyant encore moins aux formes politiques, irai-je consumer mes efforts et déclamer contre la république ou la monarchie ? Conspirer pour changer des institutions que je regarde comme sans importance ? Non ; mais quand j’ai l’occasion de m’adresser au peuple, je lui parle de ses erreurs, de ses fausses aspirations ; je cherche à démasquer à ses yeux les imposteurs qui l’égarent, je lui dis : « Ne demande que justice, car il n’y a que la justice qui puisse t’être bonne à quelque chose. » — Et quand je parle à la bourgeoisie, je lui dis : « Ce ne sont pas les fureurs ni les déclamations qui te sauveront, il faut en toutes rencontres accorder au peuple ce que la justice exige, afin d’être assez fort pour lui refuser tout ce qui dépasse la justice. »
Et c’est pourquoi les catholiques me disent que j’ai une doctrine à deux tranchants ; et c’est pourquoi le « Journal des Débats » dit que je dois m’habituer à déplaire aux deux partis. Eh ! mon Dieu, ne serait-il pas plus commode pour moi de me lancer corps et âme dans un des deux camps, d’en épouser les haines et les illusions, de me faire le flagorneur du peuple ou de la bourgeoisie, de m’affilier aux mauvaises fractions des deux armées.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: Janvier 1850, Paris↩
BWV
[CW1.160] [CH] 160. Paris, janvier 1850. A Madame Cheuvreux
Madame,
Je viens de rencontrer le commandant Matt, qui prétend qu’on sera souffrant demain à l’hôtel Saint-Georges. Puisse-t-il être aussi mauvais prophète que brave soldat ! Soyez assez bonne pour me faire savoir la vérité. Vous ne permettrez pas que je parle de santé sans dire quelque chose de la mienne. Je suis mieux et Charruau, comme Sgnarelle, assure que je dois être guéri. Cependant hier soir, une quinte fatigante a déterminé ce symptôme rouge aussi effrayant en physiologie qu’en politique. Malgré tout, j’aurais encore bien assez de force pour me charger de ce qu’il peut rester de toux à votre Louisette, si cela était possible ; mais l’affection ne peut faire ce miracle, c’est une harmonie qui manque à ce monde.
Adieu, madame.
F. Bastiat.
Samedi.
Letters to Cheuvreux Family: Février 1850, Paris↩
BWV
[CW1.161] [CH] 161. Paris, février 1850. A Madame Cheuvreux
Madame,
Je vous rends, à regret, le discours prononcé par M. de Boislembert, à l’occasion de l’inauguration du buste de M. Girard, en vous rappelant que vous m’en avez promis un exemplaire. Je l’ai lu avec enthousiasme, et voudrais le relire une fois par mois, pour me retremper. C’est une vie de Plutarque, en harmonie avec notre siècle. Que j’admire cette vie si belle, si digne, si bien remplie ! Quelle magnifique réunion de toutes les qualités qui honorent le plus la nature humaine : génie, talent, activité, courage, persévérance, désintéressement, grandeur, force d’âme dans les revers ! Jusque-là, pourtant, le portrait est bien imposant et ne représente que des lignes pures, mais sévères ; on admire, on n’aime pas encore ; mais bientôt la sympathie est complète quand l’auteur nous peint, avec trop de sobriété peut-être, sa verve étincelante, cette gaieté douce, cette inépuisable bienveillance, que M. Girard rapportait toujours au foyer domestique, dons du ciel les plus précieux de tous, que votre père n’a pas emportés dans la tombe. Ces nobles figures, madame, font paraître les hommes bien petits, et l’humanité bien grande.
F. Bastiat.
à M. Domenger: Lettre du 18 février 1850, Paris↩
BWV
[CW1.162] [OC7] 162. Paris, 18 février 1850. A M. Domenger
L’avenir politique est toujours bien sombre. Aux griefs réels se mêlent malheureusement beaucoup de passions et de soupçons factices : c’est toujours ainsi en révolution. Moi qui vois des hommes de tous les partis, je puis pour ainsi dire mesurer ce qu’il y a de faux dans leurs accusations réciproques. Mais la haine, fondée ou non, produit les mêmes effets. Je crois que la majorité comprend que ce qu’il y a de plus prudent c’est de rester en république. Son tort est de ne pas en prendre assez résolument son parti. À quoi bon dénigrer et menacer sans cesse ce qu’on ne veut pas changer ? De son côté, la minorité cherche à ressaisir le pouvoir par des moyens qui lui en rendraient le fardeau bien lourd. Elle excite des espérances qu’elle ne pourrait satisfaire.
Cependant je ne désespère pas, la discussion éclairant bien des questions. Le tout est de gagner du temps.
Letters to Cheuvreux Family: Mars 1850, Paris↩
BWV
[CW1.163] [CH] 163. Paris, mars 1850. A Madame Cheuvreux
Madame,
Comment voulez-vous guérir ? Votre rhume est la proie de tous ceux à qui il plaît de le faire jaser, et le nombre en est grand.
Depuis samedi jusqu’à hier matin, je n’ai eu qu’une quinte. Elle a duré douze heures. Je Je ne puis comprendre comment les fragiles enveloppes de la respiration et de la pensée n’éclatent pas sous ces secousses violents et prolongées. Au moins je n’ai rien à me reprocher, j’obéis docilement à mon médecin. Retenu pendant ces deux jours, il faudra bien que j’aille, ce soir, chez M. Say, me mêler à mes coreligionnaires. C’est un effort. Vous ne sauriez croire avec quelle vivacité mon indisposition fait renaître en moi mes vieux penchants solitaires, mes inclinaisons provinciales. Une chambre paisible pleine de soleil, une plume, quelques livres, un ami de cœur, une douce affection : c’était tout ce qu’il me fallait pour vivre. En faut-il davantage pour mourir ? Ce peu, je l’avais au village, et quand le temps sera venu dans beaucoup d’années je ne le retrouverai plus.
J’envoie à Mlle Louise quelques stances sur la femme qui m’ont plu. Elles sont pourtant d’un poëte économiste, car il a été surnommé The free-trade rhymer : le poëte du libre échange. Si j’en avais la force je ferais de cette pièce une traduction libre en prose et en trente pages ; cela ferait bien dans le journal de Guillaumin. Votre chère petite railleuse (je n’oublie pas qu’elle possède au plus haut degré l’art de railler, non-seulement sans blesser, mais presqu’en caressant) n’a pas grande foi dans la poésie industrielle ; elle a bien raison. C’est que j’aurais dû dire Poésie sociale, celle qui désormais, je l’espère, ne prendra plus pour sujet de ses chants les qualités destructives de l’homme, les exploits de la guerre, le carnage, la violation des lois divines et la dégradation de la dignité morale, mais les biens et les maux de le vie réelle, les luttes de la pensée, toutes les combinaisons et affinités intellectuelles, industrielles, politiques, religieuses, tous les sentiments qui élèvent, perfectionnent et glorifient l’humanité. Dans cette épopée nouvelle, la femme occupera une place digne d’elle et non celle qui lui est faite dans les vieilles Iliades. Son rôle était-il de compter parmi le butin ?
Aux premières phases de l’humanité, la force étant le principe dominant, l’action de la femme s’efface. Elle a été successivement bête de somme, esclave, servante, pur instrument de plaisir. Quand le principe de la force cède à celui de l’opinion et des mœurs, elle recouvre son titre à l’égalité, son influence, son empire ; c’est ce qu’exprime bien le dernier trait de la petite pièce de vers que j’adresse Mlle Louise.
Vous voyez combien les lettres des pauvres reclus sont dangereuses et indiscrètes. Pardonnez-moi ce bavardage, pour toute réponse je ne demande qu’à être rassuré sur la santé de votre fille.
F. Bastiat.
Lundi.
à M. Domenger: Lettre du 22 mars 1850 (Paris)↩
BWV
[CW1.164] [OC7] 164. Paris, 22 mars 1850. A M. Domenger
J’ai lieu de croire que le décret qui autorise l’échange d’immeubles de l’hospice de Mugron arrivera à la préfecture des Landes le jour où cette lettre vous parviendra. Je me suis assuré que le Président de la République l’a signé ; que le secrétariat du ministère de l’Intérieur en a fait donner l’ampliation, et que le bureau des hospices se tient prêt. — Le reste vous regarde.
Il y a déjà deux ou trois jours que j’ai donné l’ordre à mon éditeur de vous expédier trois exemplaires de ma discussion avec Proudhon, et trois de mon discours sur l’enseignement, dégénéré en brochure ; car mon rhume est devenu extinction de voix. — Ce n’est certes pas que je veuille vous faire avaler trois fois ces élucubrations ; mais je vous prie de donner de ma part un exemplaire de chaque à Félix et à Justin.
Les journaux me dispensent de vous parler politique. Je cois que l’aveuglement réactionnaire est dans ce moment notre plus grand danger : on nous mène à une catastrophe. Quel moment choisit-on pour faire de telles expériences ? Celui où le peuple paraît se discipliner et renoncer aux moyens illégaux. Le grand parti dit de l’ordre a rencontré cent trente mille adversaires aux élections et n’y a mené que cent vingt-cinq mille adhérents. Quel va être le résultat des lois proposées ? Ce sera de faire passer immédiatement quarante ou cinquante mille individus de droite à gauche, de donner ainsi à la gauche plus de force et le sentiment du droit, et de concentrer cette force sur un moins grand nombre de journaux, ce qui revient à lui communiquer plus d’homogénéité, de suite et de stratégie : cela me semble de la folie. Je l’avais prévu du jour où Bordeaux nous envoya les Thiers et les Molé, c’est dire des ennemis de la République. Aujourd’hui nous sommes comme à la veille de 1830 et de 1848 : même pente, même char et mêmes cochers. Mais alors l’esprit pouvait saisir le contenu d’une révolution ; aujourd’hui qui peut dire ce qui succédera à la République ?
Letters to Cheuvreux Family: Vendredi, avril 1850, Paris↩
BWV
[CW1.165] [CH] 165 Paris, 11 avril 1850. A Madame Cheuvreux
Bien chère madame Cheuvreux,
Pardonnez-moi ce mot échappé à un moment d’effusion. Nous autres souffreteux, nous avons, comme les enfants, besoin d’indulgence, car, plus le corps est faible, plus l’âme s’amollit et il semble que la vie, à son dernier comme à son premier crépuscule, souffle au cœur le besoin de cherche partout des attaches. Ces attendrissements involontaires sont l’effet de tous les déclins ; fin du jour, fin de l’année, demi-jour de basiliques, etc., etc., je l’éprouvais hier sous les sombres allées des Tuileries. Ne vous alarmez pas, cependant, de ce diapason élégiaque. Je ne suis point Millevoie, et les feuilles qui s’ouvrent à peine ne sont pas près de tomber. Bref, je ne me trouve pas plus mal, au contraire, mais seulement plus faible, et je ne puis guère reculer devant la demande d’un congé. C’est, en perspective, une solitude encore plus solitaire ; autrefois je l’aimais ; je savais la peupler de lectures, de travaux capricieux, de rêves politiques, avec intermèdes de violoncelle ; momentanément, tous ces vieux amis me délaissent, même cette fidèle compagne de l’isolement, la méditation. Ce n’est pas que ma pensée sommeille, elle n’a jamais été si active ; à chaque instant elle saisit de nouvelles harmonies et il semble que le livre de l’humanité s’ouvre devant elle ; mais c’est un tourment de plus, puisque je ne puis continuer à transcrire les pages de ce livre mystérieux, sur un livre plus palpable édité par Guillaumin ; je chasse donc ces chers fantômes, et comme ce tambour-major grognard qui disait : « Je donne ma démission, que le gouvernement s’arrange comme il le pourra ; » moi aussi, je donne ma démission d’économiste et que la postérité s’en tire, si elle peut. Bon, voilà une jérémiade pour expliquer une maladresse. On dit des malheurs, qu’ils n’arrivent jamais seuls ; cela est encore plus vrai des maladresses ; que de mots pour en justifier un que vous auriez pardonné, sans tous ces commentaires, car vous ne m’en voudrez pas si, dans cette indigence d’occupations, ma pensée se réfugie vers l’hôtel Saint-Georges, où l’on est toujours si bon pour moi. Ce cher hôtel ! il est maintenant tout plein d’une préoccupation très-grave. L’avenir de votre Louise s’y décide peut-être, et par conséquent le vôtre et celui de M. Cheuvreux. L’idée que tant de paix, d’union et de bonheur domestique vont être domestique vont être mis à l’épreuve d’une révolution décisive est vraiment effrayante. Mais prenez courage, vous avez tant de bonnes chances !
Vraiment, mes lettres dépassent de cent coudées celles de M. B… Je vous prie, madame, d’accepter mes excuses. La plus valable, c’est que je n’ose guère paraître chez vous ce soir ; n’est-ce pas bien de l’égoïsme d’aller chercher des distractions là où on ne peut apporter de quintenses importunités ? Bien entendu, je ne dis pas cela pour mes amis ; ce serait de l’ingratitude. Mais la société est-elle solidaire de votre bienveillance ?
Adieu, madame ; croyez-moi votre dévoué,
F. Bastiat.
Mme Shwabe vient d’arriver sans ses enfants. Je désire vous faire faire sa connaissance.
Cheuvreux ???↩
…Nous autres souffreteux, nous avons, comme les enfants, besoin d’indulgence ; car plus le corps est faible, plus l’âme s’amollit, et il semble que la vie à son premier comme à son dernier crépuscule souffle au cœur le besoin de chercher partout des attaches. Ces attendrissements involontaires sont l’effet de tous les déclins ; fin du jour, fin de l’année, demi-jour des basiliques, etc. Je l’éprouvais hier sous les sombres allées des Tuileries… Ne vous alarmez cependant pas de ce diapason élégiaque. Je ne suis pas Millevoye, et les feuilles, qui s’ouvrent à peine, ne sont pas près de tomber. Bref, je ne me trouve pas plus mal, au contraire, mais seulement plus faible ; et je ne puis plus guère reculer devant la demande d’un congé. C’est en perspective une solitude encore plus solitaire. Autrefois je l’aimais ; je savais la peupler de lectures, de travaux capricieux, de rêves politiques avec intermèdes de violoncelle. Maintenant tous ces vieux amis me délaissent, même cette fidèle compagne de l’isolement, la méditation. Ce n’est pas que ma pensée sommeille. Elle n’a jamais été plus active ; à chaque instant elle saisit de nouvelles harmonies, et il semble que le livre de l’humanité s’ouvre devant elle. Mais c’est un tourment de plus, puisque je ne puis transcrire aucune page de ce livre mystérieux sur un livre plus palpable édité par Guillaumin. Aussi je chasse ces chers fantômes, et comme le tambour-major grognard qui disait : Je donne ma démission et que le gouvernement s’arrange comme il pourra ; — moi aussi, je donne ma démission d’économiste et que la postérité s’en tire, si elle peut…
Letters to Cheuvreux Family: Mai 1850, Bordeaux↩
BWV
[CW1.166] [CH] 166 Bordeaux, mai 1850. A Madame Cheuvreux
Me voici à Bordeaux plongé avec délice dans l’atmosphère du midi. Quoique je quitte le tumulte parisien pour aller retrouver le calme du toit paternel, je vous assure que ma pensée, tout le long de la route, s’est retournée bien plus souvent en arrière qu’elle ne s’est portée en avant ; aussi je m’empresse de déployer le secrétaire de voyage que je dois aux soins si délicats de M. Cheuvreux.
En être réduit à faire de ma santé le premier chapitre de mes lettres, m’humilie un peu, mais votre bonté l’exige ; je le comprends, les maladies dont la toux se mêle ont le tort de trop alarmer nos amis. Elles portent avec elles comme une cloche importune qui ne cesse de poser cette question : qui l’emportera, du rhume ou de l’enrhumé ? Le voyage, au lieu de me fatiguer, m’a soulagé ; il est vrai que j’ai eu à ma disposition, pendant trois jours, un excellent remède, le silence ; ce n’est que depuis Ruffec que je me suis un peu écarté à cet égard de vos prescriptions ; mes deux compagnons, montés tour à tour dans le cabriolet du courrier, pour se livrer aux douceurs du cigare, ont eu la curiosité de visiter la feuille de route. — Or il s’est rencontré que c’étaient deux enthousiastes d’économie politique ; en reprenant leur place, ils ont tenu à me montrer qu’ils connaissaient mes opuscules (car le titre même des harmonies ne leur était pas parvenu) et, alors l’occasion, l’herbe tendue, et sans doute quelque diable aussi me poussant, j’ai tondu de ce pré (la causerie) la largeur de ma langue ; je n’en avais nul doit, puisqu’on me l’avait défendu. Mais, j’ai donc succombé et le larynx n’a pas manqué de m’en punir ; ne me grondez pas, madame ; est-ce que le silence n’est pas un régime qui vous conviendrait quelquefois, autant qu’à moi ? et pourtant c’est le dernier auquel vous vous soumettiez.
Que Mme Girard, maintenant près de vous, interpose son autorité pour vous mettre sous le séquestre ; que vous sert de rester dans vos appartements si vous en faites ouvrir les portes à deux battants depuis dix heures du matin ? Ne sauriez-vous sacrifier à votre santé quelques moments de conversation ? Mais vous savez que le sacrifice retomberait sur les autres, et c’est pour cela que vous ne voulez pas le faire. Vous voyez que je connais la vieille tactique qui est de gronder le premier afin de n’être pas grondé. Après tout, je vois bien que nous descendons tous de notre mère Ève. Votre fille, elle-même, qui a tant de raison, se laisse souvent prendre au piége de la musique. À propos de musique, on a bien tort de s’imaginer qu’un son s’éteint dans l’étroit espace d’un salon et d’une seconde ; une note, ou plutôt un cri de l’âme que j’ai entendu samedi, a fait avec moi deux cents lieues ; il vibre encore dans mon oreille, pour ne pas dire plus.
Pauvre chère enfant, je crois bien avoir deviné la pensée dont elle a empreint le triste chant de Pergolèse ; cette voix touchante, dont les derniers accents semblaient se perdre dans une larme, ne disait-elle pas adieu aux illusions du jeune âge, aux beaux rêves d’une félicité idéale ? Oui, il semblait que votre chère Louise se sentait amenée par les circonstances à cette limite fatale et solennelle qui sépare la région des songes du monde de la réalité. Puisse la vie réelle lui apporter au moins un bonheur calme, solide, quoiqu’un peu grave ; pour cela, que faut-il ? Un bon cœur et du bon sens dans celui qui sera chargé de ses destinées ; c’est la première condition ; les hommes dont l’imagination ardente et artistique jette un grand éclat, offrent des chances souvent dangereuses ; mais n’en doutons pas, les nobles aspirations de votre enfant trouveront un jour satisfaction.
Comment allez-vous passer le mois prochain ? Resterez-vous à Paris ? Irez-vous à Auteuil, à Saint-Germain ou à Londres ? Je voterais assez pour l’Angleterre, c’est là que vous trouveriez une désirable combinaison de tranquillité et de distraction ; à la vérité, mes votes ne sont pas en bonne odeur, quoiqu’ils aient consciencieusement pour but d’éloigner les malheurs que vous redoutez ; mais ne glissons pas sur la pente de la politique. Il y a tant d’imprévu dans vos résolutions qu’il me tarde de savoir à quoi vous vous arrêterez. Je crains d’apprendre votre départ pour Moscou ou Constantinople. De grâce, que je vous retrouve confortablement installés aux environs de Paris ; la France est comme la Française, elle peut avoir quelques caprices, mais après tout, c’est la plus aimable, la plus gracieuse, la meilleur femme du monde et aussi la plus aimée.
Adieu, mesdames ; que ces deux mois d’absence ne m’effacent pas de votre mémoire ; adieu encore, monsieur Cheuvreux et mademoiselle Louise.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
à M. Paillottet: Lettre du 19 mai 1850 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.167] [OC7] 167 Mugron, 19 mai 1850. A M. Paillottet
Mon cher Paillottet, je vous remercie de l’intérêt que vous prenez à ma santé et à mon voyage. Celui-ci s’est fait très heureusement et plus régulièrement que vous ne l’aviez prévu. Il n’y a pas eu de malentendu entre ma place et moi. En route, de Tours à Bordeaux, j’ai rencontré de fervents adeptes de l’économie politique, ce qui m’a fait plaisir, mais m’a forcé de parler un peu trop. À Bordeaux, je n’ai pu éviter quelque chose de pis que la simple causerie, car la réaction y est arrivée à un tel excès qu’il faudrait être de marbre pour écouter froidement ses blasphèmes. — Tout cela fait que mon larynx est arrivé ici un peu fatigué, et les épanchements de l’amitié, quelque délicieux qu’ils soient, ne sont pas propres à le délasser. Pourtant, considérant les choses en gros, je me trouve un peu mieux ; j’ai plus de force de corps et de tête. Voilà certes un long bulletin de ma santé ; votre amitié me l’a demandé, prenez-vous-en à elle.
Je reçus hier le Journal des économistes, en même temps que votre lettre ; j’ai lu mon article. Je ne sais comment vous vous y êtes pris, mais il m’a été impossible d’y reconnaître les reprises, tant elles se confondent avec le tissu. L’idée dominante de cet article n’y est peut-être pas mise assez en saillie. Malgré cela, elle devrait frapper les bons esprits ; et si j’avais été à Paris, j’aurais fait tirer à part 500 copies pour les distribuer à l’Assemblée. L’article n’étant pas long, il me semble que la Voix du peuple devrait le reproduire dans un de ses lundis. Si vous en entendez parler, faites-moi savoir ce qu’on en dit.
…Vous voilà chargé de mes affaires publiques et privées. En tout cas, n’y consacrez, je vous prie, que vos moments perdus. Vous voudriez beaucoup faire une renommée à mes pauvres Harmonies. Cela vous sera difficile. Le temps seul y réussira, si elles valent la peine que le temps s’occupe d’elles. — J’ai obtenu tout ce que je pouvais raisonnablement désirer, savoir : que quelques jeunes hommes de bonne volonté étudient le livre. Cela suffit pour qu’il ne tombe pas, s’il mérite de se tenir debout. M. de Fontenay aura beaucoup fait pour moi, s’il réussit à obtenir l’insertion d’un compte rendu dans la Revue des deux mondes. Il fera plus encore à l’avenir par les développements qu’il saura donner à l’idée principale. C’est tout un continent à défricher. Je ne suis qu’un pionnier, commençant avec des instruments fort imparfaits. La culture perfectionnée viendra plus tard, et je ne saurais trop encourager de Fontenay à s’y préparer. En attendant, tâchez, par notre ami Michel Chevalier, de nous rendre M. Buloz favorable.
J’oublie probablement bien des choses, mais cela se retrouvera ; car j’espère que vous voudrez bien m’écrire le plus souvent possible, et quant à moi, je vous donnerai souvent de mon écriture à débrouiller.
Letters to Cheuvreux Family: 20 mai 1850, Mugron↩
BWV
[CW1.168] [CH] 168 Mugron, 20 mai 1850. A Madame Cheuvreux
Combien je vous remercie, madame, de penser à l’exilé des Landes au milieu de toutes vos préoccupations ; j’oserais à peine vous demander de continuer cette œuvre charitable si je ne savais combien la bonté est en vous persévérante ; croyez bien qu’il n’y a ni cordial ni pectoral qui vaillent pour moi quelques lignes venues de Paris, et ma santé dépend plus du facteur que du pharmacien ; la plume, il est vrai, est une lourde et fatigante machine ; ne m’envoyez pas de longues lettres, mais quelques mots le plus souvent possible, afin que je sache ce qu’on fait, ce qu’on pense, ce qu’on sent, ce qu’on résout à l’hôtel Saint-Georges. Voici, par exemple, une péripétie que je ne puis dire complétement inattendue ; quelques paroles de M. Cheuvreux me l’avaient fait pressentir ; ce pauvre M. D… est congédié, je suis sûr que le cœur de votre Louise est bien soulagé, c’est toujours cela de gagné ; si mes vœux s’accomplissaient, elle traverserait la vie sans toutes ces épreuves.
Après vous avoir écrit de Bordeaux, je fis des visites ; heureusement plusieurs de mes amis étaient absents, car je n’aurais pu éviter de parler et de crier beaucoup ; ceux que j’ai rencontrés sont dans un tel état d’exaltation que la conversation calme n’est pas possible avec eux ; les malheureux sont persuadés que depuis deux ans on n’ose pas ouvrir les magasins à Paris ; partant de cette donnée, ils veulent à tout prix d’une pareille situation et pour cela ne reculent pas même devant l’idée d’une guerre civile ou de la guerre étrangère. Mon département m’a paru plus modéré ; notre préfet s’y consacrait sans relâche à concilier les opinions ; aussi il a été destitué le jour le mon passage à Mont-de-Marsan ; on nous en envoie un qui saura chauffer un peu mieux les esprits.
J’arrivai vendredi ; en revoyant le clocher de mon village, je fus surpris de ne pas éprouver ces vives émotions que sa vue ne manquait jamais autrefois de faire naître. — Sommes-nous de la nature des végétaux et les fibres du cœur deviennent-elles ligneuses avec l’âge, ou bien ai-je maintenant deux patries ? — Je me rappelle que Mlle Louise m’avait prédit que la vie rustique aurait perdu pour moi beaucoup de ses charmes.
Dans un conseil de famille composé de ma tante, de sa femme de chambre et de moi (et je pourrais dire, résumé dans sa femme de chambre), il a été décidé que Mugron valait les Eaux-Bonnes, et qu’en tout cas il ne faisait pas encore assez chaud pour les Pyrénées ; donc me voici Landais jusqu’à nouvel ordre. Ceci conclu, notre Basquaise s’est mise à visiter ma malle ; bientôt nous l’avons vue rentrer au salon toute bouleversée et s’écriant : « Mademoiselle, le linge de Monsieur, il est tout perrec, perrec, perrec ! » Je regrette que de Labadie ne soit plus auprès de vous pour expliquer l’énergie de ce mot perrec ; il renferme les trois idées de lambeaux, chiffons et haillons ; quel profond mépris doit ressentir la pauvre fille pour Paris et ses blanchisseuses ! — C’est à donner sa démission de représentant !
Samedi, je vus voir le reste de ma famille à la campagne ; j’en revins fatigué. Les quintes ont reparu assez fortes pour que la respiration n’y pût suffire ; je pensais à la description de la pêche de la baleine que vous faisait votre cousin : « Tout va bien, disait-il, quand on peut donner du câble à l’animal blessé ; » la toux est peu de chose aussi, tant que les poumons peuvent lui donner du câble ; après quoi, la position devient incommode.
Vraiment, madame, ces détails vous prouvent que je me laisse aller à l’affection que j’ai pour vous et que je compte bien sur la vôtre ; aussi que cela ne sorte pas, je vous en prie, de ce que nous appelons le trio.
Le courrier m’apporte une lettre ; comment vous exprimer ma reconnaissance ! Vous avez donc deviné mes vœux ? Ma tante et moi avons commencé à disputer sur le nord et le midi ; elle exalte la supériorité du Midi, sans doute pour que j’y reste ; je lui soutiens que ce tout ce qu’il y a de bon vient du Nord, même le soleil. (C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumière), il m’envoie votre bon souvenir, des nouvelles rassurantes sur Mlle Louise, quelques détails sur ces douces scènes d’intérieur, dont j’ai été souvent témoin et que je sais si bien apprécier.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 23 mai 1850, Mugron↩
BWV
[CW1.169] [CH] 169 Mugron, 23 mai 1850. A Madame Cheuvreux
Chère madame Cheuvreux, ma dernière lettre a à peine atteint l’autre extrémité de la longue ligne qui nous sépare, qu’en voici une seconde prête à se lancer sur la même voie ; n’y a-t-il pas dans cet empressement indiscrétion, ou inconvenance ? Je n’en sais rien, car je ne suis par encore bien rompu aux usages du monde ; mais soyez indulgente ; bien plus, permettez-moi de vous écrire capricieusement sans trop regarder aux dates, et sous l’empire de l’impulsion, cette loi des natures faibles. Si vous saviez combien Mugron est vide et triste, vous me pardonneriez de tourner toujours mes regards vers Paris. Ma pauvre tante, qui fait à peu près toute ma société, a bien vieilli, la mémoire l’abandonne ; elle n’est plus qu’un cœur ; il semble que ses facultés affectives gagnent tout ce que perdent les autres ; aussi je l’aime plus que jamais, mais, en sa présence même, je ne puis retenir mon imagination voyageuse, et puis ne suis-je pas malade ? À quoi donc les maladies seraient-elles bonnes, si elles ne donnaient le privilége de faire tolérer nos fantaisies ? Ainsi, voilà chose convenue, je mets mon indiscrétion sous le patronage de mes prétendues souffrances ; c’est une ruse dont un cœur de femme sera toujours dupe ; pourtant ceci ne doit pas m’induire à vous tromper et à me représenter comme un moribond. Voici le bulletin : la toux est moins fréquente, les forces reviennent ; je puis monter l’escalier sans être hors d’haleine ; je retrouve ma voix, qui peut fredonner dans toute l’étendue d’un octave complet ; la seule chose qui m’importune est une petite douleur au larynx, mais je ne lui en donne pas pour quatre jours ; enfin, quoique je n’en sois pas encore à offrir aux regards dangereux de Mlle Louise une figure au milieu d’un visage, il me semble que j’ai meilleure mine.
Me voilà quitte envers ma conscience et obéissant à vos ordres. À propos de Mlle Louise et du visage en question, cette chère enfant est toujours destinée à être en proie à un doute douloureux pour une jeune fille : c’est d’ignorer, malgré son tact exquis, si on la recherche pour elle-même… c’est un des revers de médaille de la fortune ; mais ce qui doit la rassurer, c’est que fût-on d’abord attiré par cette fortune on l’appréciera bien vite pour sa propre valeur ; je vous ai dit que je bonté de cœur pouvait remplacer toutes les autres qualités ; je me trompais, quelque chose peut-être vaut mieux encore : c’est le sentiment du devoir ; une disposition naturelle à se conformer à la règle, disposition que le bon cœur n’implique pas toujours.
Quels que soient le nombre et le mérite de vos amis, conservez-moi une place dans votre affection ; pour moi, je puis bien vous le dire, à mesure que le temps et la mort brisent des liens autour de moi, à mesure que je perds la faculté de me réfugier dans la vie politique ou studieuse, votre bienveillance, celle de votre famille, me deviennent de plus en plus nécessaires ; c’est la dernière lumière qui brille sur ma vie, c’est pour cela, sans doute, qu’elle est aussi la plus douce, la plus pure, la plus pénétrante ; après elle viendra la nuit, que ce soit au moins la nuit du tombeau.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 27 mai 1850, Mugron↩
BWV
[CW1.170] [CH] 170 Mugron, 27 mai 1850. A Madame Cheuvreux
J’étais brouillé avec le calendrier, et voilà que mon exil a opéré la réconciliation ; nous sommes au 27.
Mon congé date du 12, en sorte que le quart des deux mois est écoulé, encore trois fois autant de temps et je reverrai Paris.
Je fais, madame, un autre calcul qui me sourit moins, votre dernière lettre porte le timbre du 17. Il y a dix jours que vous l’avez écrite, et huit que je l’ai reçue ; huit jours ! Ce n’est rien pour vous, qui les passez tantôt entourée des vôtres, tantôt parcourant les bords de la Seine ou de la Marne, causant presque toujours délicieusement avec votre fille et votre mari ! Si au moins je pouvais être sûr qu’aucun rhume ne vous empêche d’écrire !
Hier on reçut une dépêche télégraphique annonçant le vote de l’article Ier ; je pensai que je télégraphe pourrait être mieux employé, du moins en ce qui me touche.
Vous avez des myriades d’amis et d’amies qui, tout en vous recommandant le repos, vous poursuivent du matin au soir ; comme il me tarde d’apprendre que vous avez mis pas mal de kilomètres entre leur empressement et votre gracieuseté !
Je dois avouer, madame, que La Fontaine avait raison et que bon nombre d’hommes sont femmes à l’endroit du babil ; en venant chercher ici la santé, je n’avais pas songé que j’y rencontrerais l’impossibilité absolue d’y éviter les longues causeries ; les Mugronais n’ont rien à faire, aussi ne tiennent-ils pas compte des heures, si ce n’est de celles du dîner et du souper ; puis ils ressemblent un peu à Pope : ce sont des points d’interrogations ; je vous laisse à penser s’il faut enfiler des paroles. Par une manœuvre habile je les mets bien sur les cancans du village ou sur le dada de leur originalité ; par là je gagne quelque répit, mais en définitive franchement, je parle trop et c’est ce qui m’a valu encore une crise qui heureusement n’a pas eu de suite. Maintenant je suis beaucoup mieux, et prêt à partir pour les Eaux-Bonnes, quand il plaira au soleil de jouer son rôle, mais c’est un paresseux ; nous voyons d’ici les montagnes couvertes de neige, elles ne seront guère habitables avant le mois de juin.
En regardant Mugron avec des yeux devenus citadins, je crois que j’aurais honte de vous le montrer, je rougirais pour lui de ses maisons enfumées, de son unique rue déserte, de ses mobiliers patriarcaux, de sa police négligée ; son seul charme consiste dans une rusticité naïve, une pauvreté qui ne cherche pas à se cacher, une nature toujours silencieuse et calme, une complète absence d’agitation, toutes choses qui ne plaisent et ne sont comprises que par l’habitude ; pourtant, dans cette uniformité d’existence placez deux affections et je soutiens que c’est l’uniformité de bonheur ; comme cela aussi devient l’uniformité de l’ennui et du néant, si ces affections. J’y ai retrouvé celle de Félix. Il est impossible de dire avec quelle joie nous avons repris nos entretiens interrompus, et ce qu’il y a d’attrait dans ce commerce de deux âmes sympathiques, de deux intelligences parallèles nées le même jour, jetées au même monde, nourries du même lait, et portant sur toutes chose un jugement identique ; religion, philosophie, politique, économie sociale, tout y passe sans que sur aucun sujet nous réussissions à voir poindre entre nous la moindre dissidence ; cette identité d’appréciation nous est une grande garantie de certitude, d’autant que, n’ayant jamais eu que très-peu de livres, ce sont bien nos opinions propres qui sont en contact, et non l’opinion d’un maître commun ; mais, malgré les douceurs de cette société, il y a ici un vide ; Félix et moi, nous nous touchons surtout par l’intelligence ; quelque chose manque au cœur : me voilà en pleine personnalité ; j’en ai honte et pour me punir je vous quitte jusqu’à demain.
Le 28. — Le courrier arrive, les mains vides ; car qu’est-ce que ce tas de lettres et de journaux ? Pourtant je reconnais l’écriture de Paillottet, que peut-il me dire ? Il ne vous connaît pas, il n’aura pas rencontré M. Cheuvreux ; je regrette maintenant de n’avoir pas osé vous le présenter, car je pressentais qu’il serait exact, qu’il serait bon pour moi. Oh ! j’espère bien qu’il n’est rien survenu d’affligeant à l’hôtel Saint-Georges.
Adieu, mesdames, je sens que je recommence à écrire en fa mineur ; il vaut mieux m’arrêter en vous assurant de mon attachement respectueux et dévoué.
F. Bastiat.
à M. Paillottet: Lettre du 2 juin 1850 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.171] [OC7] 171 Mugron, 2 juin 1850. A M. Paillottet
…Mon cousin est parti avant-hier pour Paris. Il y arrivera à peu près en même temps que cette lettre et vous remettra une bonne moitié de l’article que je fais pour compléter la brochure.[202] Mais cet article a pris un tel développement que nous ne pouvons lui faire suivre cette destination. Il y aura près de cinquante pages de mon écriture, c’est-à-dire de quoi faire un nouveau pamphlet, s’il en vaut la peine. C’est un essai. Vous savez que j’ai toujours eu l’idée de savoir ce qu’il adviendrait si je m’abstenais de refaire. Ceci a été écrit à peu près par improvisation. Aussi je crains que cela ne manque de la précision nécessaire au genre pamphlet. Dans quelques jours, je vous enverrai la suite. Quand vous aurez l’ensemble, vous déciderez.
à M. Horace Say; Lettre du 3 juin 1850 (Mugron) ↩
BWV
[CW1.172] [OC7] 172 Mugron, 3 juin 1850. A Horace Say
Mon cher ami,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pourquoi avez-vous renfermé dans des limites si étroites l’excellente lettre que vous avez envoyée au dernier numéro du Journal des économistes ? En ce qui concerne les faits et les causes, elle est pleine de sagacité et décèle une expérience des affaires dont on nous reproche souvent, et avec quelque raison, de manquer. De tels articles satisfont toujours les lecteurs, et avancent les principes sans en parler. Vous devriez développer la pensée que vous ne faites qu’indiquer à la fin de votre lettre. Oui, par l’absence de spéculation, les céréales sont à un prix plus bas qu’elles ne devraient être, et il est infaillible qu’elles ne dépassent bientôt le taux normal. C’est la loi générale de l’action et de la réaction. La spéculation aurait rapproché les deux extrêmes d’une moyenne. Bien plus, elle aurait abaissé la moyenne elle-même, car elle aurait prévenu des gaspillages et des exportations imprudentes. Un travail de vous sur ce sujet serait fort utile tant au point de vue pratique qu’au point de vue scientifique. Sous ce dernier rapport, il dissiperait le funeste préjugé contre les intermédiaires et l’accaparement. Mettez- vous donc à l’œuvre.
Quoique je m’occupe peu de politique, j’ai pu me convaincre, avec douleur, que nos grands hommes d’État n’ont que trop bien réussi dans la première partie de leur plan de campagne qui est de semer l’alarme pour l’exploiter. Partout où j’ai passé, j’ai vu régner une terreur vraiment maladive. Il semble que la loi agraire nous menace. On croit Paris sur un volcan. On va jusqu’à invoquer la lutte immédiate ou l’invasion étrangère, non par des sentiments pervers, mais par peur de pis. On maudit la République, les républicains et même les résignés ; on blesse les classes inférieures par un luxe d’épithètes outrageantes. Bref, il me semble qu’on oublie tout, même la prudence. Dieu veuille que ce paroxysme passe vite ! où nous mènerait-il ?…
Letters to Cheuvreux Family: 11 juin 1850, Mugron↩
BWV
[CW1.173] [CH] 173 Mugron, 11 juin 1850. A Melle Louise Cheuvreux
Chère demoiselle,
C’était ma résolution, toujours bien arrêtée, de laisser passer une grande semaine sans vous écrire ; car, on a beau compter sur la bienveillance de l’amitié, encore faut-il n’en pas abuser ; mais il me semble que mon empressement a bien des excuses ; vous m’annoncez que votre mère est souffrante et je suis au bout du monde, je ne puis plus envoyer ma rustique Franc-comtoise à l’hôtel Saint-Georges, pour y prendre des informations. Enfin, vous voilà installés à Fontainebleau, loin du bruit ; il faut espérer que huit jours de retraite et de silence rétabliront toutes les santés ébranlées ; c’est hier, pas M. Say, que j’ai appris votre disparition. Cette nouvelle m’a d’abord fait un singulier effet, comme si une autre centaine de lieues était venue se placer entre nous ; c’est que n’ayant jamais été à Fontainebleau, mon imagination est toute déroutée.
Je ne puis assez, chère demoiselle, vous remercier de tout ce que vous me dites d’affectueux ; vous m’envoyez des paroles si douces qu’elles ressemblent à ces réminiscences d’accords ou de parfums, dont les gens se souviennent quelquefois tout à coup, et auxquels se mêlent quelque souvenirs d’enfance.
Mais, je distingue dans votre lettre que la gaieté ne vous est pas encore revenue , voyons si je me trope : vous avez ce noble empire sur vous-même qui fait, dès qu’il le faut, vaincre les émotions, mais vous n’avez pas cette insouciance qui les fait oublier ; votre nature excitera toujours la sympathie et l’admiration, mais elle rencontrera difficilement dans ce monde le calme, d’où naît la gaieté durable. Que dites-vous de cet essai psychologique ? Juste ou non, je vous le livre, de grâce ne cherchez pas à vous changer, vous n’y gagneriez rien.
Je pars demain pour les Eaux-Bonnes ; c’est encore une excuse dont cette lettre se précautionne ; ce mot Eaux-Bonnes me rappelle la triste chance que je cours ; qui sait si je n’en partirai pas au moment où vous y arriverez ? Qui sait si votre chaise de poste ne croisera pas l’énorme véhicule qui me reportera à Paris ? — Avouez que ce serait bien dépitant pour moi.
Oh ! venez aux Pyrénées ! venez dès à présent respirer cet air pur toujours embaumé ; venez jouir de cette nature si paisible, si imposante ; là, vous oublierez les troubles de cet hivers et la politique ; là vous éviterez les ardeurs de l’été ; tous les jours vous varierez vos promenades, vos excursions, vous contemplerez de nouvelles merveilles ; les forces, la santé, l’élasticité morale vous reviendront, vous vous réconcilierez avec l’exercice physique, vous aurez la joie de voir votre père perdre de vue toutes ces inquiétudes, trop inséparables aujourd’hui de la vie parisienne ; décidez-vous donc ; je vous mènerai à Biarritz, à Saint-Sébastien, dans le pays basque ; voyage pour voyage, cela ne vaut-il pas mieux que le Belgique et la Hollande ?
Il n’y a que deux peuples au monde, dit un écrivain : « Celui de la bière et celui du vin. » Si vous voulez savoir comment on gagne de l’argent, allez étudier le peuple de la bière ; si vous préférez voir comment on rit, on chante, on danse, venez visiter le peuple du vin.
Je m’étais fait un peu d’illusion sur l’influence de l’air natal ; quoique la toux soit moins fréquente, j’ai toutes les nuits un peu de fièvre, mais la fièvre et les Eaux-Bonnes n’ont jamais pu marcher ensemble.
Je voudrais bien guérir aussi d’un noir dans l’âme, que je ne sais m’expliquer. D’où vient-il ? Est-ce des lugubres changements que Mugron a subis depuis quelques années ? Est-ce de que les idées me fuient sans que j’aie la force de les fixer sur le papier au grand dommage de la postérité ? Est-ce… Est-ce ? Mais, se je le savais, cette tristesse aurait une cause et elle n’en a pas… Je m’arrête tout court, avant d’entamer la fade jérémiade des spleenitiques, des incompris, des blasés, des génies méconnus, des âmes qui cherchent une âme, race maudite que je déteste ; j’aime mieux qu’on me dise tout simplement comme à Bazile : c’est la fièvre, buono sera.
Adieu, dites à votre père et à votre mère combien je suis sensible à leur souvenir. Adieu, quand vous reverrai-je tous ? Adieu, je répète ce mot qui n’est jamais neutre ; car c’est le plus pénible ou le plus doux qui puisse sortir de mes lèvres.
Croyez, chère demoiselle, au tendre attachement de votre dévoué,
F. Bastiat.
à M. et madame Cheuvreux: Lettre de juin 1850 (Mugron) ???↩
Cheuvreux [???]
…Je m’étais fait un peu d’illusion sur l’influence de l’air natal. Quoique la toux soit moins fréquente, les forces ne reviennent pas. Cela tient à ce que j’ai, toutes les nuits, un peu de fièvre. Mais la fièvre et les Eaux-Bonnes n’ont jamais pu compatir ensemble. Aussi dans quatre jours je serai guéri. Je voudrais bien guérir aussi d’un noir dans l’âme que je ne puis m’expliquer. D’où vient-il ? Est-ce des lugubres changements que Mugron a subis depuis quelques années ? Est-ce de ce que les idées me fuient sans que j’aie la force de les fixer sur le papier, au grand dommage de la postérité ? Est-ce… est-ce… ? mais si je le savais, cette tristesse aurait une cause, et elle n’en a pas. — Je m’arrête tout court, de peur d’entonner la fade jérémiade des spleenétiques, des incompris, des blasés, des génies méconnus, des âmes qui cherchent une âme, — race maudite, vaniteuse et fastidieuse, que je déteste de tout mon cœur, et à laquelle je ne veux pas me mêler. J’aime mieux qu’on me dise tout simplement comme à Basile : C’est la fièvre ; buona sera…
Letters to Cheuvreux Family: 15 juin 1850, Eaux-Bonnes↩
BWV
[CW1.174] [CH] 174 Eaux-Bonnes, 15 juin 1850. A Madame Cheuvreux
Ma chère madame Cheuvreux,
Arrivé hier soir aux Eaux-Bonnes, je suis allé ce matin à la poste ; la raison me disait qu’il n’y aura rien, et le pressentiment murmurait il y aura quelque chose ; en effet, la raison a eu tort, comme il advient souvent malgré son nom.
Ainsi, grâce à votre bonté, je me sens un fonds de joie qui m’avait abandonné, et notre délicieuse vallée ne perdra rien à ce que je la revoie sous ces impressions.
Jeudi, j’entrai à Pau vers spet heures ; je fus à la rue du Collége, où je crois avoir deviné l’hôtel que vous avez habité. Que cette vue de Pau est à la fois riante et imposante ; de légers nuages cachaient la montagne, on ne jouissait que du premier plan : le Gave, Gélos, Bizanos, les coteaux et les villas de Jurançon.
Si mon astre, en naissant, m’avait créé poëte, au lieu de faire de moi un froid économiste, je vous adresserais des stances, car il y avait en moi un peu de Lamartine ; vous et votre Louise, n’avez-vous pas envoyé bien des sourires à ce paysage, et, ne semble-t-il pas en avoir gardé le souvenir ! Mais la poésie a des a des licences que la prose n’admet pas.
J’ai pris aux Eaux-Bonnes une chambre à trois croisées, bien aérée ; bien soleillée, mon horizon est admirable. Pour la première nuit, j’ai dormi douze heures, au murmure du Valentin ; déjà en me levant, je me sentais dans la meilleure disposition, quand est survenue l’aimable surprise de votre lettre ; elle m’a accompagnée dans mon excursion matinale et me voici mieux d’esprit et de corps, que je ne l’ai été depuis longtemps. Avis à mes amis ; il ne faut jamais prendre trop au sérieux les élégies d’un homme nerveux.
Vous me grondez, mesdames, d’avoir été infidèle à mes chères Harmonies ; mais ne m’ont-elles pas montré le mauvais exemple ? — Quel gage m’ont-elles donné de leur affection ? Depuis six mois elles ne m’adressent la parole que par la bienveillante entremise de ce bon Paillottet ; — sérieusement, je vois bien que ce livre, s’il doit jamais être utile, ne le sera que dans un temps fort éloigné ; et peut-être cette appréciation est-elle encore un refuge de l’amour-propre. L’occasion s’étant présentée de faire une petite brochure plus actuelle, je l’ai saisie ; j’en ai une seconde dans la tête ; je voudrais peindre tel que je le comprends l’état moral de la nation française ; analyser et disséquer les éléments très-divers qui constituent nos deux grands partis politiques : le socialisme et la réaction ; distinguer ce qu’il y a en eux de justifiable, de raisonnable de ce qu’ils contiennent de faux, d’exagéré, d’égoïste et d’imprudent ; le tout terminé par une solution, ou l’aperçu de ce qu’il y a à faire ou plutôt à défaire.
Les élections n’auront lieu qu’en 1854 ; ne portons pas pas si loin notre prévoyance ; je sais dans quel esprit les électeurs m’ont nommé et je ne m’en suis jamais écarté. Ils ont changé, c’est leur droit. Mais je suis convaincu qu’ils ont mal fait de changer ; il avait été convenu qu’on essayerait loyalement la forme républicaine, pour laquelle je n’ai, quant moi, aucun engouement ; peut-être n’eût-elle pas résisté à l’expérience même sincère ; alors, elle serait tombée naturellement, sans secousse, de bon accord, sous le poids de l’opinion politique : au lieu de cela, on essaye de la renverser par l’intrigue, le mensonge, l’injustice, les frayeurs organisées, calculées, le discrédit ; on l’empêche de marcher, on lui impute ce qui n’est pas son fait ; et on agit ainsi contrairement aux conventions, sans avoir rien à mettre à la place.
Ne serait-il pas singulier qu’après tant de projets et d’hésitation, vous en revinssiez tout simplement à la Jonchère ? Cette campagne a été un peu calomniée ; demandez plutôt à la jardinière ? Au demeurant, vous y avez passé un bon été. J’irai vous y voir le plus souvent possible. M. Piscatore veut m’offrir son Buttard une seconde fois.
Votre prochaine lettre me dira ce qui a été résolu. Savez-vous que sous ce rapport, elles sont redoutables ! Jamais la précédente ne me laisse entrevoir ce qu’annonce la suivante ; passe encore pour quatre jours à Fontainebleau, mais je crains que vous ne finissiez par m’écrire de Rome ou de Spa.
Mlle Louise sera rentrée à temps pour jouir des jeunes cousines dont elle s’éloigne à regret ; pourquoi donc ne veut-elle pas s’assurer dans ce genre, un bonheur rapproché, plus direct, plus permanent ? Elle devrait quelquefois se poser cette simple question : que seraient mon père et ma mère s’ils ne m’avaient pas ?
En vous disant adieu, je pense, avec une joie bien vive, que ce n’est pas un adieu à grande distance, un adieu pour plusieurs mois ; je serai à Paris à l’expiration du congé.
Votre ami respectueux et dévoué,
F. Bastiat.
à M. Paillottet: Lettre du 23 juin 1850 (Eaux-Bonnes) ↩
BWV
[CW1.175] [OC7] 175 Eaux-Bonnes, 23 juin 1850. A M. Paillottet
…Me voici à la prétendue source de la santé. Je fais les choses en conscience ; c’est vous dire que je travaille très peu. N’ayant pas envie de me mettre à continuer les Harmonies, j’achève le pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, et je serai probablement en mesure de vous l’envoyer d’ici à quelques jours.
Je vous remercie de l’article que vous avez inséré dans l’Ordre. Il vient d’être reproduit dans les journaux de mon département. C’est probablement tout ce qu’on y saura jamais de mon livre.
Un autre compte rendu a paru dans le Journal des Economistes. Je ne puis comprendre comment M. Clément a jugé à propos de critiquer mon chapitre futur sur la Population. Ce qui a paru offre bien assez de prise, sans aller s’en prendre d’avance à ce qui n’a pas paru. J’ai annoncé, il est vrai, que j’essayerai de démontrer cette thèse : La densité de la population équivaut à une facilité croissante de production. — Il faudra bien que M. Clément en convienne, ou qu’il nie la vertu de l’échange et de la division du travail.
La critique qu’il fait du chapitre Propriété foncière me fait penser qu’il serait peut-être utile de réimprimer en brochure les quatre ou cinq articles qui ont paru dans les Débats sous le litre de Propriété et Spoliation. [203] Ce sera d’ailleurs un anneau de notre propagande, nécessaire à ceux qui n’ont pas la patience de lire les Harmonies.
Ne m’oubliez pas auprès de MM. Quijano et de Fontenay.
Letters to Cheuvreux Family: 23 juin 1850, Eaux-Bonnes↩
BWV
[CW1.176] [CH] 176 Eaux-Bonnes, 23 juin 1850. A Madame Cheuvreux
Vous vous êtes donc concertée avec Mlle Louise, madame, pour me faire supporter l’éloignement. Au milieu des soucis d’une installation, vous avez trouvé le temps de m’écrire et, qui plus est, vous me faites pressentir que les absents ne perdront rien à vos loisirs de la Jonchère. Oh ! qu’il y a de bonté dans les cœurs de femmes ! Je sais bien que je dois beaucoup à ma chétive santé ; rappelez-vous que je disais un jour que les moments dont je me souvenais avec le plus de plaisir étaient ceux de la souffrance, à cause des soins touchants qu’elle m’avait valus de la part de ma bonne tante ; vraiment, mesdames, vous donneriez envie d’être malade ; pourtant il ne faut pas que je fasse ici l’hypocrite ; et, dût votre prochaine lettre en être retardée de vingt-quatre heures, je dois bien avouer que je suis mieux ; je prends les eaux avec précaution, quoique sans l’assistance d’un médecin ; à quoi bon ? Les médecins des eaux sont comme les confesseurs, ils ont toujours le même remède. Mais, n’abusez pas de mon aveu, et si vous ne m’écrivez pas à cause de ma santé, écrivez-moi pour me parler des vôtres.
Vous voilà à la Jonchère ; puisque vous vous vantez d’être franches campagnardes, tâchez de vous lever plus matin et de gagner chaque jour quelques minutes ; promenez-vous beaucoup plus ; lisez un peu, le moins possible de journaux ; n’attirez près de vous qu’un petit nombre d’amis à la fois : telle est ma consultation, elle nargue celle de M. Chaumel qui a perdu ma confiance.
Les Eaux-Bonnes commencent à être fort peuplées ; ma table d’hôte n’est cependant pas aussi bien composée qu’à mon dernier voyage ; il se peut que le soin d’éviter la politique refroidisse la conversation ; aujourd’hui, il est arrivé deux Hâvrais qui m’ont mis sur le chapitre de ma Solution du problème social. J’ai profité de l’occasion pour faire de la propagande à fond, récitant à peu près une brochure, que j’ai écrite à Mugron. Chose singulière ! tous disent c’est cela ! c’est cela ! jusqu’à l’application ; là, on m’abandonne. Il est déplorable que les classes qui font la loi ne veuillent pas pas être justes quoi qu’il en coûte, car alors chaque classe veut faire la loi : fabricant, agriculteur, armateur, père de famille, contribuable, artiste, ouvrier ; chacun est socialiste pour lui-même, et sollicite une part d’injustice ; puis on veut bien consentir envers les autres à l’aumône légale, qui est une seconde injustice ; tant qu’on regardera ainsi l’État comme une source de faveurs, notre histoire ne présentera que deux phases : les temps de luttes, à qui s’emparera de l’État ; et les temps de trêve qui seront le règne éphémère d’une oppression triomphante, présage d’une lutte nouvelle. Mais, Dieu me pardonne, je me crois encore à table d’hôte ; je vais me coucher, il vaut mieux jeter la plume que d’en abuser.
24 juin.
Vous avez vu les Pyrénées à Paris ; moi, je retrouve Paris aux Pyrénées ; ce ne sont que belles dames, belles toilettes, comtesses et marquises ; ce matin, des enfants ont chassé loin d’eux un de leurs camarades, parce qu’il était vêtu en coutil : vous n’êtes pas assez beau ! voilà les propres expressions ; le père, médecin, en était tout humilié.
Ces jours-ci, j’ai été au village d’Aas, vous savez qu’il faut descendre la vallée et la remonter de l’autre côté ; je fus visiter le cimetière, il est chargé de monuments : jeunes hommes et jeunes filles sont venues aux Eaux-Bonnes chercher la fin de leurs souffrances ; ils ont réussi plus qu’ils ne l’espéraient ; faut-il envier leurs sort ? Oh non ! pas encore. Je rencontrai deux dames, et me retirai avec elles ; la fille était faible, svelte, pensive, et redoutant la marche elle cheminait à cheval ; la mère était bien portante, infatigable ; ajoutez à cela le langage le plus pur, les manières les plus distinguées et vous comprendrez que cela devait me rappeler une promenade de la Jonchère.
Hier dimanche, nous avons eu quelques réjouissances ; mais, hélas ! toute couleur locale s’en va ; les montagnards faisaient leur ronde au son du violon, et des Espagnols ont dansé le fandango en blouse : tambourins, castagnettes, vestes bariolées, résilles et mantilles, qu’allez-vous devenir ? Le violon envahit tout, et pour la blouse il n’y a plus de Pyrénées. Oh ! la blouse, ce sera le symbole du siècle prochain ! Mais, après tout, ce qui nous semble une profanation, n’est-il pas un progrès ? Nous sommes plaisants, nous autres civilisés, si fiers de nos arts et de nos toilettes, de vouloir qu’ailleurs on conserve à tout jamais, pour distraire les touristes, la culotte et le galoubet.
Ai-je bien lu, mesdames, vous me parlez de l’impossibilité de revenir à Paris sans être guéri ; de la nécessité de passer l’hiver à Mugron ! Vous me trouvez donc d’une bien aimable absence ?
Ah ! vous avez beau faire, je prends vos paroles pour des marques d’intérêt, car je suis le plus complaisant interprète du monde ; aussi j’espère rentrer à Paris le 20 juillet, à moins que la Chambre ne se proroge ; ce sera un retard de huit jours sur mon congé : il serait plaisant que l’Assemblée me mît en pénitence pour être revenu trop tard, tandis que vous me gronderiez pour être revenu trop tôt.
Qu’il me tarde d’avoir une lettre de la Jonchère, de savoir si M. Cheuvreux s’est décidé à prendre quelque repos ; si vous poursuivez vos projets de solitude ? Une solitude à trois ! mais c’est l’univers : et puis Croissy n’est-il pas à portée de la main ? et la famille Renouard, les Say, Mme Freppa ? En conscience, je ne puis m’apitoyer sur votre sort !
Mon Dieu ! que j’abuse du joli pupitre de M. Cheuvreux : il a résolu pour moi le problème des plumes ; aussi je n’ai jamais écrit de lettres si incommensurables !
Obtenez mon pardon de Mlle Louise ; et ce que d’autres pourraient appeler indiscrétion, appelez-le amitié.
Adieu, votre dévoué,
F. Bastiat.
[CW1.177] [CH] 177 Eaux-Bonnes, 24 juin 1850. A Madame Cheuvreux????↩
BWV
[CW1.177] [CH] 177 Eaux-Bonnes, 24 juin 1850. A Madame Cheuvreux
à M. Paillottet: Lettre du 28 juin 1850 (Eaux-Bonnes) ↩
BWV
[CW1.178] [OC7] 178 Eaux-Bonnes, 28 juin 1850. A M. Paillottet
…Voici la première partie de l’article Loi. [204] Je n’ai rien ajouté. Je suppose l’autre partie en route. — C’est bien sérieux pour un pamphlet. Mais l’expérience m’a appris que ce sur quoi l’on compte le moins réussit quelquefois le mieux, et que l’esprit est nuisible à l’idée.
Je voulais vous envoyer Ce quon voit ; mais je ne le trouve pas réussi. Là j’aurais dû reprendre la plaisanterie, au lieu de tourner au sérieux, et qui pis est au genre géométrique. [205]
C’est avec plaisir que je recevrai l’ouvrage de Michel Chevalier. S’il me fait l’honneur de m’emprunter quelques points de vue, en revanche il me donne beaucoup de faits et d’exemples : c’est du libre Échange. Notre propagande a bon besoin de sa plume.
à M. Paillottet: Lettre du 2 juillet 1850 (Eaux-Bonnes) ↩
BWV
[CW1.179] [OC7] 179 Eaux-Bonnes, 2 juillet 1850. A M. Paillottet
…Votre observation sur la Loi est juste. Je n’ai pas prouvé comment l’égoïsme qui pervertit la loi est inintelligent. Mais maintenant il n’est plus temps. Cette preuve, d’ailleurs, résulte de l’ensemble des brochures précédentes et résultera mieux encore des suivantes. On verra que la main sévère de la justice providentielle s’appesantit tôt ou tard cruellement sur ces égoïsmes. Je crains bien que la classe moyenne de notre époque n’en fasse l’expérience. C’est une leçon qui n’a pas manqué aux rois, aux prêtres, aux aristocraties, aux Romains, aux Conventionnels, à Napoléon.
J’écrirais à M. de Fontenay pour le remercier de sa bonne lettre, s’il ne m’annonçait son départ pour la campagne. — Il y a de l’étoffe chez ce collègue. D’ailleurs, les jeunes gens de notre temps ont une souplesse de style au moyen de laquelle ils nous dépasseront. Ainsi va et doit aller le monde. Je m’en félicite. À quoi servirait qu’un auteur fit une découverte, si d’autres ne venaient la féconder, la rectifier au besoin, et surtout la propager ?
Mon intention est de partir d’ici le 8 et d’arriver à Paris vers le 20. Je mettrai ma santé sous votre direction.
Lettre à M. de Fontenay [3 july 1850] Eaux-Bonnes ↩
BWV
[CW1.180] [OC1] 180 Eaux-Bonnes, 3 juillet 1850. A M. de Fontenay
Paris, 3 juillet 1850
… Peut-être prenez-vous avec un peu trop de feu parti pour les Harmonies contre l’opposition du Journal des Économistes. Des hommes d’un certain âge ne renoncent pas facilement à des idées faites et longtemps caressées. Aussi ce n’est pas à eux, mais aux jeunes gens, que j’ai adressé et soumis mon livre. On finira par reconnaître que la valeur ne peut jamais être dans la matière et les forces naturelles. De là résulte la gratuité absolue des dons de Dieu, sous toutes les formes et à travers toutes les transactions humaines : ceci conduit à la mutualité des services, à l’absence de tout motif pour que les hommes se jalousent et se haïssent. Cette théorie doit ramener toutes les écoles sur un terrain commun. Vivant avec cette foi, j’attends patiemment ; car plus je vieillis, plus je m’aperçois de la lenteur des évolutions humaines.
Je ne dissimule pas cependant un vœu personnel. Oui, je désire que cette théorie rencontre, de mon vivant, assez d’adeptes (ne fût-ce que deux ou trois) pour être assuré, avant de mourir, qu’elle ne tombera pas si elle est vraie. Que mon livre en suscite seulement un autre, et je serai satisfait. Voilà pourquoi je ne saurais trop vous engager à concentrer vos méditations sur le capital, sujet immense et qui peut bien être le pivot d’une économie politique. Je ne l’ai qu’effleuré : vous irez plus loin que moi, vous me rectifierez au besoin. Ne craignez pas que je m’en formalise. Les horizons économiques n’ont pas de limites : en apercevoir de nouveaux, c’est mon bonheur, que je les découvre ou qu’un autre me les montre.
… Oui, vous avez raison. Il y a toute une science à élever sur le vilain mot consommation : c’est ce que j’établirai au commencement de mon second volume. Quant à la population, il est incompréhensible que M. Clément m’attaque sur un sujet que je n’ai pas encore abordé ! Et au fond, nier cet axiome : La densité de la population est une facilité de production, c’est nier toute la puissance de l’échange et de la division du travail. De plus c’est nier des faits qui crèvent les yeux. — Sans doute la population s’arrange naturellement de manière à produire le plus possible ; et pour cela, selon l’occurrence, elle diverge ou converge, elle obéit à une double tendance de dissémination et de concentration ; mais plus elle augmente, cœteris paribus, — c’est-à-dire à égalité de vertus, de prévoyance, de dignité, — plus les services se divisent, se rendent facilement, plus chacun tire parti de ses moindres qualités spéciales, etc…
Letters to Cheuvreux Family: 4 juillet 1850, Eaux-Bonnes↩
BWV
[CW1.181] [CH] 181 Eaux-Bonnes, 4 juillet 1850. A Madame Cheuvreux
Enfin, j’ai une lettre de la Jonchère, ma chère madame, et je suis maintenant bien sûr que vous êtes quelque part. De plus, vous m’annoncez que vos débuts à la campagne ont été heureux, que vous faites de longues promenades dans les bois, et que vous recevez de fort aimables visites, puisque vous avez aujourd’hui la famille Say.
Comme j’ai votre première lettre de la Jonchère, voici, je crois, ma dernière lettre des Eaux-Bonnes. Je les quitterai le 8, à moins que d’ici-là je n’apprenne que l’Assemblée prendra des vacances. Mais, dans le doute, il faut que je parte. Ce n’est pas que je sois radicalement guéri ; si ma santé s’améliore, le larynx s’opiniâtre à souffrir.
Décidément aux Eaux-Bonnes, cette année, le ridicule de la gentilhommerie est poussé si loin qu’il gâte tout. On s’y donne un accent, une tournure et des manières dignes du pinceau de Molière ; je ne vois ici que Mme de Latour-Maubourg qui persiste à être simple. Si c’est une leçon qu’elle offre aux précieuses qui l’entourent, cette leçon est perdue ; bien entendu, je n’abuse pas de ce monde-là, car j’ai remarqué qu’on n’y accueille que les personnes qui fournissent l’occasion de dire : « J’étais avec M. de … nous nous sommes promenés avec le comte de, etc. » Ma société se compose d’un lieutenant bien malade, d’un jeune Espagnol presque mort et d’un Parisien de vingt-trois ans, aussi souffrant que deux autres.
Je suis surpris que ce temps d’exil, dont je désirais si vivement le terme, m’ait paru si court : « Tout ce qui doit finir passe vite. » Ce mot est aussi vrai que triste. Au fait, ce n’est pas sans quelques charmes que j’avais retrouvé mes habitudes provinciales. Indépendance, heures libres, travaux et loisirs capricieux, lectures au hasard, pensées errantes au gré de l’impulsion, promenades solitaires, admirable nature, calme et silence, voilà ce qu’on rencontre dans nos montagnes, et la puissance d’un si, d’un seul si en ferait un paradis. Que faudrait-il autre chose qu’une goutte de cette ambroisie qui parfume tous les détail de la vie, et qu’on nomme l’amitié ?
Vous avez vu dans les journaux les succès et les ovations de MM. Scribe et Halevy ; cela vous aura réjouie et fait sans doute un peu regretter de n’en pas être témoin. Mlle Louise avait le pressentiment que d’agréables diversions l’attendaient à Londres. Félicitons-nous de tout ce qui rapproche et unit les peuples : sous ce rapport, la tentative de vos amis portera de bons fruits. Elle induira de plus en plus de nos voisins à étudier le français. La réciprocité serait bien utile, car nous aurions beaucoup à apprendre de l’autre côté de la Manche. J’ai vu avec bonheur que Richard Cobden, dans une circonstance difficile, qui devait être pour lui une épreuve cruelle, n’a ni glissé ni bronché. Il est resté conséquent avec lui-même ; mais ce sont choses que nos journaux ne remarquent pas.
Avez-vous lu, dans la Revue des Deux Mondes, l’article de M. de Broglie sur Chateaubriand ? Je n’ai pas été fâché de voir ce châtiment infligé à une vanité poussée jusqu’à l’enfantillage. Avec un si exclusif égoïsme au cœur, on peut être grand écrivain, mais croyez-vous qu’on puisse être un grand homme ? Pour moi, je déteste ces aveugles orgueilleux qui passent leur vie à poser, à se draper ; qui mettent l’humanité dans le plateau d’une balance, se placent sur l’autre >et croient l’emporter. Je regrette que M. de Broglie n’ait pas cherché à apprécier la valeur philosophique de Chateaubriand ; il aurait trouvé qu’elle est bien légère. Dans le onzième volume de ses mémoires, j’ai copié ce paradoxe : « La perception du bien et du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence s’éclaire ; la conscience se rétrécit à mesure que les idées s’élargissent. »
S’il en est ainsi, l’humanité est condamnée à une dégradation fatale et irrémédiable : un homme qui a écrit ces lignes est un homme jugé.
Le 5 juillet.
Voici une autre lettre de la Jonchère, mais qui ne confirme pas la précédente. Dans l’intervalle, j’avais eu des nouvelles par M. Say, et je croyais que vous étiez tous en bonne santé. Je vois que le sommeil vous boude, que Mlle Louise est fatiguée par la chaleur, et que M. Cheuvreux lui-même est indisposé ! Voilà un trio bien organisé ! Ce qui me contrarie vivement, c’est que je ne saurai rien de vous d’ici au 20 juillet, à moins que vous ne soyez assez bonne pour m’écrire encore une fois, ne fût-ce qu’un billet à Mugron. Décidément je quitte les Eaux-Bonnes en répétant le refrain de notre ballade :
Aigues caoutes, aigues rèdes,
Lou mein maou n’es pot guari.
« Eaux chaudes, eaux froides, rien ne peut guérir mon mal. » Il est vrai que le bon chevalier parlait sans doute de quelque blessure étrange, sur laquelle toutes les sources des Pyrénées ne peuvent rien. J’étais plus fondé à compter sur elles pour mon larynx ; il a résisté ; que faire ?
J’aurai probablement de rudes assauts à soutenir à Mugron pour obtenir là aussi un congé. Mais je résisterai, ne pouvant me dispenser de paraître à l’Assemblée.
Voulez-vous aller visiter les Cormiers! [206] c’est un lieu bien calme, frais et solitaire. Si j’y passe deux mois, je viendrai peut-être à bout de me lancer dans le monde des Harmonies. Ici je ne m’en suis pas occupé ; mon éditeur me presse : je lui dis que la froideur du public me refroidit. En cela, j’ai le tort de mentir. Les auteurs ne perdent pas courage pour si peu. Dans ces sortes de mésaventures, l’ange ou le démon, l’orgueil leur crie : « C’est le public qui se trompe, il est trop distrait pour te lire, ou trop arriéré pour te comprendre. — C’est fort bien, dis-je à mon ange, mais alors je puis me dispenser de travailler pour lui. — Il t’appréciera dans un siècle, et c’est assez pour la gloire », répond l’opiniâtre tentateur.
La gloire ! Le ciel m’est témoin que je n’y prétendais pas ; et si un de ses rayons égarés, bien faible, était tombé sur ce livre, je m’en serais réjoui pour l’avancement de la cause, et aussi quelque peu pour la satisfaction de mes amis ; qu’ils m’aiment sans cela et je n’y penserai plus.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
à M. et madame Cheuvreux: Lettre de juillet 1850 (Mugron) ???↩
[???]
… Vous veniez de perdre une amie d’enfance. Dans ces circonstances, le premier sentiment est celui du regret ; ensuite on jette un regard troublé autour de soi, et on finit par faire un retour sur soi-même. L’esprit interroge le grand inconnu, et, ne recevant aucune réponse, il s’épouvante. C’est qu’il y a là un mystère qui n’est pas accessible à l’esprit, mais au cœur. — Peut-on douter sur un tombeau ?…
à M. Horace Say; Lettre du 4 juillet 1850 (Eaux-Bonnes) ↩
BWV
[CW1.182] [OC1] 182 Eaux-Bonnes, 4 juillet 1850. A Horace Say
Mon cher ami,
...J’ai lu l’article de M. Clément sur les Harmonies. Si je croyais une controverse utile, je l’accepterais ; mais qui la lirait ? M. Clément a l’air de penser que c’est manquer de respect à nos maîtres que d’approfondir des problèmes qu’ils ont à peine effleurés, — parce qu’au temps où ils écrivaient, ces problèmes n’étaient pas posés. Selon lui, ils ont tout dit, tout vu, ne nous ont rien laissé à faire. — Ce n’est pas mon opinion et ce n’était certainement pas la leur. Entre les premières et les dernières pages de votre père, il y a un progrès trop sensible pour qu’il ne vît pas lui-même qu’il n’avait pas touché l’horizon et que nul ne le touchera jamais. Pour moi, les Harmonies fussent-elles finies à ma satisfaction (ce qui ne sera pas), que je ne les regarderais encore que comme un point d’où nos successeurs tireront un monde. Comment pourrions-nous aller bien avant, quand nous sommes obligés de consacrer les trois quarts de notre temps à élucider, pour un public égaré, les questions les plus simples ?
… Si vous faites dans le Dictionnaire de Guillaumin l’article Assurance, faites bien remarquer que ce ne sont pas seulement les compagnies qui s’associent, mais encore et surtout les assurés. Ce sont eux qui forment, sans s’en douter, une association qui n’en est pas moins réelle pour être volontaire et parce qu’on y entre et en sort quand on veut.
[CW1.183] [OC7] 183 Mugron, juillet 1850. A Madame Cheuvreux↩
à M. et madame Cheuvreux: Lettre du 14 juillet 1850 (Mugron) ???↩
[CW1.184] [CH] 184 Mugron, 14 juillet 1850. A M. Cheuvreux ???↩
… Vous êtes bien bon, mon cher Monsieur, de m’encourager à reprendre ces insaisissables Harmonies Je sens aussi que j’ai le devoir de les terminer, et je tâcherai de prendre sur moi d’y consacrer ces vacances. Le champ est si vaste qu’il m’effraye. En disant que les lois de l’économie politique sont harmoniques, je n’ai pu entendre seulement qu’elles sont harmoniques entre elles, mais encore avec les lois de la politique, de la morale et même de la religion (en faisant abstraction des formes particulières à chaque culte). S’il n’en était pas ainsi, à quoi servirait qu’un ensemble d’idées présentât de l’harmonie, s’il était en discordance avec des groupes d’idées non moins essentielles ? — Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble que c’est par là, et par là seulement, que renaîtront au sein de l’humanité ces vives et fécondes croyances dont M.… déplore la perte. — Les croyances éteintes ne se ranimeront plus, et les efforts qu’on fait, dans un moment de frayeur et de danger, pour donner cette ancre à la société, sont plus méritoires qu’efficaces. Je crois qu’une épreuve inévitable attend le catholicisme. Un acquiescement de pure apparence, que chacun exige des autres et dont chacun se dispense pour lui-même, ce ne peut être un état permanent.
Le plan que j’avais conçu exigeait que l’économie politique d’abord fût ramenée à la certitude rigoureuse, puisque c’est la base. Cette certitude, il paraît que je l’ai mal établie, puisqu’elle n’a frappé personne, pas même les économistes de profession. Peut-être le second volume donnera-t-il plus de consistance au premier…
Letters to Cheuvreux Family: 14 juillet 1850, Mugron↩
BWV
[CW1.184] [CH] 184 Mugron, 14 juillet 1850. A M. Cheuvreux
Votre bonne lettre, mon cher monsieur Cheuvreux, m’est remise à l’instant. Quelques heures plus tard, elle aurait eu à refaire le voyage de Paris dans la même malle que son destinataire, car je me prépare à partir demain. J’ai tort sans doute ; il faut bien que cela soit, puisque tout le monde le dit, et j’ai essuyé déjà je ne sais combien de bourrasques verbales et épistolaires. Je ne prétends pas avoir raison contre tous, quoique Mme Cheuvreux me traite, d’avance, de sophiste. La vérité est que je ne pouvais guère me dispenser de faire acte de présence à la Chambre avant les vacances ; après cela, j’avoue que je cède un peu à la fantaisie. Depuis quelque temps, j’ai une douleur toute locale au larynx, insupportable à cause de sa continuité ; il me semble que je trouverai du soulagement en changeant de place.
Mlle Louise peut craindre que sa lettre se soit égarée dans les Pyrénées. Veuillez la rassurer, on me l’a remise ici à mon arrivée ; vraiment, c’eût été pour moi une grande privation, car votre chère enfant a l’art (si c’est un art) de mettre dans ses lettres son âme et sa bonté. Elle me parle de l’impression que fait sur elle la littérature anglaise ; puis elle déplore la perte des croyances qui caractérise la nôtre.
Je me disposais à répondre une dissertation sur ce texte, mais je la lui épargne ; puisque je pars demain ; je prendrai de vive voix ma revanche.
Vous avez raison, bien cher monsieur Cheuvreux, de m’encourager à continuer ces insaisissables Harmonies. Je sens aussi que c’est un devoir pour moi de les terminer, et je tâcherai d’y consacrer mes vacances.
Le champ est si vaste qu’il m’effraie.
En disant que les lois de l’économie politique sont harmoniques, je n’ai pas entendu seulement qu’elles sont harmoniques entre elles, mais encore avec les lois de la politique, de la morale et même de la religion (en faisant abstraction des formes particulières à chaque culte) ; s’il n’en était pas ainsi, à quoi servirait qu’un ensemble d’idées présentât de l’harmonie, si cet ensemble était en discordance avec des groupes d’idées non moins essentielles ?
Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble que c’est par là, et par là seulement, que renaîtront au sein de l’humanité ces vives et fécondes croyances que Mlle Louise déplore la perte. Les croyances éteintes ne se ranimeront plus et les efforts qu’on fait, dans un moment de frayer et de danger, pour donner cette ancre à la société sont plus méritoires qu’ils ne seront efficaces. Je crois qu’une épreuve inévitable attend le catholicisme. Un acquiescement de pure apparence que chacun exige des autres, et dont chacun se dispense pour lui-même, ce ne peut être un état permanent.
Le plan que j’avais conçu exigeait que l’harmonie politique fût ramenée à la certitude rigoureuse puisque c’est la base ; cette certitude, il paraît que je l’ai mal établie, car elle n’a frappée personne, pas même les économistes de profession. Peut-être le second volume donnera-t-il plus de consistance au premier. Je me recommande à vous et à Mme pour me détourner dorénavant avant de faire autre chose.
Adieu, mon cher monsieur,
Votre dévoué,
F. Bastiat.
à Richard Cobden: Lettre du 3 août 1850, Paris ↩
BWV
[CW1.185] [OC1] 185 Paris, 3 août 1850. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, depuis le départ de nos bons amis les Schwabe, je n’ai plus l’occasion de m’entretenir de vous. Cependant, je ne vous ai pas tout à fait perdu de vue, et, dans une occasion récente, j’ai remarqué avec joie, mais sans étonnement, que vous vous étiez séparé de nos amis pour rester fidèle à vos convictions. Je veux parler du vote sur Palmerston. Cette bouffée d’orgueil britannique qui a caractérisé cet épisode, n’est pas d’accord avec la marche naturelle des événements et le progrès de la raison publique en Angleterre. Vous avez bien fait de résister. C’est cette parfaite concordance de toutes vos actions et de tous vos votes qui donnera plus tard à votre nom et à votre exemple une autorité irrésistible.
Je suis allé dans mon pays pour voir à guérir ces malheureux poumons, qui me sont des serviteurs fort capricieux. Je suis revenu un peu mieux, mais atteint d’une maladie de larynx accompagnée d’une extinction de voix complète. Le médecin m’ordonne le silence absolu. C’est pourquoi je vais aller passer deux mois à la campagne aux environs de Paris. Là, j’essayerai de faire le second volume des Harmonies économiques. Le premier est passé à peu près inaperçu dans le monde savant. Je ne serais pas auteur, si je souscrivais à cet arrêt. J’en appelle à l’avenir, j’ai la conscience que ce livre contient une idée importante, une idée mère. Le temps me viendra en aide.
Aujourd’hui je voulais vous dire quelques mots en faveur de notre confrère en économie politique, A. Scialoja. Vous savez qu’il était professeur à Turin. Les événements en ont fait, pendant quelques jours, un ministre du commerce à Naples. C’était à l’époque de la Constitution. Au retour du pouvoir absolu, Scialoja, pensant qu’un ministère du commerce n’est pas assez politique pour compromettre son titulaire, ne voulut pas fuir. Mal lui en prit. Il a été arrêté et mis en prison. Voilà dix mois qu’il sollicite en vain son élargissement ou un jugement.
J’ai fait quelques démarches ici afin d’intéresser notre diplomatie. (Que la diplomatie soit bonne à quelque chose une fois dans la vie !) On m’a répondu que notre ambassade ferait ce qu’elle pourrait, mais qu’elle avait peu de chances. Scialoja serait, dit-on, beaucoup mieux protégé par la bienveillance anglaise. Voyez donc à lui ménager l’appui de votre ambassadeur à Naples.
Scialoja demande à être jugé ! j’aimerais mieux pour lui qu’on lui donnât un passe-port pour Londres ou Paris ; car un jugement napolitain ne me paraît pas offrir de grandes garanties, même à l’innocence la plus blanche.
Irez-vous à Francfort ? Pour moi, il est inutile que j’assiste au congrès, puisque je suis devenu muet ; mais il me serait bien agréable de vous voir à votre passage à Paris, et mon appartement, rue d’Alger, n°3, est à votre disposition.
à Richard Cobden: Lettre du 17 août 1850, Paris ↩
BWV
[CW1.186] [OC1] 186 Paris, 17 août 1850. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, connaissant ma misérable santé, vous n’aurez pas été surpris de mon absence au congrès de Francfort ; surtout vous n’aurez pas songé à l’attribuer à un défaut de zèle. Indépendamment du plaisir d’être un de vos collaborateurs dans cette noble entreprise, il m’eût été bien agréable de rencontrer à Francfort des amis que j’ai rarement l’occasion de voir, et d’y faire connaissance avec une foule d’hommes distingués de ces deux excellentes races : la race anglo-saxonne et la race germanique. Enfin, je suis privé de cette consolation comme de bien d’autres. Depuis longtemps la bonne nature m’accoutume peu à peu à toutes sortes de privations, comme pour me familiariser avec la dernière qui les comprend toutes.
N’ayant pas de vos nouvelles, j’ai ignoré un moment si vous vous rendiez au congrès, car l’idée ne m’était pas venue qu’on pouvait se rendre d’Angleterre à Francfort sans passer à Paris ; et ne pensant pas non plus que vous traverseriez notre capitale sans me prévenir, je concluais que vous étiez vous-même empêché. On m’assure que non, et j’en félicite le congrès. Tâchez de porter un coup vigoureux à ce monstre de la guerre, ogre presque aussi dévorant quand il fait sa digestion, que lorsqu’il fait ses repas ; car, vraiment, je crois que les armements font presque autant de mal aux nations que la guerre elle-même. De plus, ils empêchent le bien. Pour moi, j’en reviens toujours à ceci qui me paraît clair comme le jour : tant que le désarmement ne permettra pas à la France de remanier ses finances, réformer ses impôts et satisfaire les justes espérances des travailleurs, ce sera toujours une nation convulsive… et Dieu sait les conséquences.
Un homme que j’aurais désiré voir, à cause de toutes les marques d’intérêt dont il m’a comblé, c’est M. Prince Smith, de Berlin ; s’il est au congrès, veuillez lui exprimer l’extrême désir que j’ai de faire sa connaissance personnelle. Que je serais heureux, mon cher Cobden, si vous vous décidiez à passer par Paris, et si vous obteniez de M. Prince Smith de vous accompagner dans cette excursion ! mais je n’ose m’arrêter à de telles espérances. Les bonnes fortunes ne semblent pas faites pour moi. Depuis longtemps je m’exerce à prendre le bien quand il vient, mais sans jamais l’attendre.
Il me semble qu’un petit séjour à Paris doit avoir de l’intérêt pour des politiques et des économistes. Venez voir de quel calme profond nous jouissons ici, quoi qu’on en puisse dire dans les journaux. Assurément, la paix intérieure et extérieure, en face d’un passé si agité et d’un avenir si incertain, c’est un phénomène qui atteste un grand progrès dans le bon sens public. Puisque la France s’est tirée de là, elle se tirera de bien d’autres difficultés.
On a beau dire, l’esprit humain progresse, les intérêts bien entendus acquièrent de la prépondérance, les discordances sont moins profondes et moins durables, l’harmonie se fait.
Lettre au président du Congrès de la paix, à Francfort [17 Aug. 1850], Paris ↩
BWV
[CW1.187] [OC1] 187 Paris, 17 août 1850. Au Président du Congrès de la Paix
Paris, 17 août 1850
Monsieur le président,
Une maladie de larynx n’aurait pas suffi pour me retenir loin du congrès, d’autant que mon rôle y serait plutôt d’écouter que de parler, si je ne subissais un traitement qui m’oblige à rester à Paris. Veuillez exprimer mes regrets à vos collaborateurs. Pénétré de ce qu’il y a de grand et de nouveau dans ce spectacle d’hommes de toutes les races et de toutes les langues, accourus de tous les points du globe pour travailler en commun au triomphe de la paix universelle, c’est avec zèle, c’est avec enthousiasme que j’aurais joint mes efforts aux vôtres, en faveur d’une si sainte cause.
À la vérité, la paix universelle est considérée, en beaucoup de lieux, comme une chimère, et, par suite, le congrès comme un effort honorable mais sans portée. Ce sentiment règne peut-être plus en France qu’ailleurs, parce que c’est le pays où l’on est le plus fatigué d’utopies et où le ridicule est le plus redoutable.
Aussi, s’il m’eût été donné de parler au congrès, je me serais attaché à rectifier une si fausse appréciation.
Sans doute, il a été un temps où un congrès de la paix n’aurait eu aucune chance de succès. Quand les hommes se faisaient la guerre pour conquérir du butin, des terres ou des esclaves, il eût été difficile de les arrêter par des considérations morales ou économiques. Les religions mêmes y ont échoué.
Mais aujourd’hui deux circonstances ont tout à fait changé la question.
La première, c’est que les guerres n’ont plus l’intérêt pour cause ni même pour prétexte, étant toujours contraires aux vrais intérêts des masses.
La seconde, c’est qu’elles ne dépendent plus du caprice d’un chef, mais de l’opinion publique.
Il résulte de la combinaison de ces deux circonstances, que les guerres doivent s’éloigner de plus en plus, et enfin disparaître, par la seule force des choses, et indépendamment de toute intervention du congrès, car un fait qui blesse le public et dépend du public doit nécessairement cesser.
Quel est donc le rôle du congrès ? C’est de hâter ce dénoûment d’ailleurs inévitable, en montrant à ceux qui ne le voient pas encore en quoi et comment les guerres et les armements blessent les intérêts généraux.
Or, qu’y a-t-il d’utopique dans une telle mission ?
Depuis quelques années, le monde a traversé des circonstances qui, certes, à d’autres époques, eussent amené de longues et cruelles guerres. Pourquoi ont-elles été évitées ? Parce que, s’il y a en Europe un parti de la guerre, il y a aussi des amis de la paix ; s’il y a des hommes toujours prêts à guerroyer, qu’une éducation stupide a imbus d’idées antiques et de préjugés barbares, qui attachent l’honneur au seul courage physique et ne voient de gloire que pour les faits militaires, il y a heureusement d’autres hommes à la fois plus religieux, plus moraux, plus prévoyants et meilleurs calculateurs. N’est-il pas bien naturel que ceux-ci cherchent à faire parmi ceux-là des prosélytes ? Combien de fois la civilisation, comme en 1830, en 1840, en 1848, n’a-t-elle pas été, pour ainsi dire, suspendue à cette question : Qui l’emportera du parti de la guerre ou du parti de la paix ? Jusqu’ici le parti de la paix a triomphé, et, il faut le dire, ce n’est peut-être ni par l’ardeur ni par le nombre, mais parce qu’il avait l’influence politique.
Ainsi la paix et la guerre dépendent de l’opinion, et l’opinion est partagée. Donc il y a un danger toujours imminent. Dans ces circonstances, le congrès n’entreprend-il pas une chose utile, sérieuse, efficace, j’oserais même dire facile, quand il s’efforce de recruter pour l’opinion pacifique de manière à lui donner enfin une prépondérance décisive ?
Qu’y a-t-il là de chimérique ? S’agit-il de venir dire aux hommes : « Nous venons vous sommer de fouler aux pieds vos intérêts, d’agir désormais sur le principe du dévouement, du sacrifice, du renoncement à soi-même ? » Oh ! s’il en était ainsi, l’entreprise serait en effet bien hasardée !…
Mais nous venons au contraire leur dire : « Consultez non-seulement vos intérêts de l’autre vie, mais encore ceux de celle-ci. Examinez les effets de la guerre. Voyez s’ils ne vous sont pas funestes ? voyez si les guerres et les gros armements n’amènent pas des interruptions de travail, des crises industrielles, des déperditions de force, des dettes écrasantes, de lourds impôts, des impossibilités financières, des mécontentements, des révolutions, sans compter de déplorables habitudes morales et de coupables violations de la loi religieuse ? »
N’est-il pas permis d’espérer que ce langage sera entendu ? Courage donc, hommes de foi et de dévouement, courage et confiance ! ceux qui ne peuvent aujourd’hui se mêler à vos rangs vous suivent de l’œil et du cœur.
Recevez, Monsieur le président, l’assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.
à Richard Cobden: Lettre du 9 septembre 1850, Paris ↩
BWV
[CW1.188] [OC1] 188 Paris, 9 septembre 1850. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, je suis sensible à l’intérêt que vous voulez bien prendre à ma santé. Elle est toujours chancelante. En ce moment j’ai une grande inflammation, et probablement des ulcérations à ces deux tubes qui conduisent l’air au poumon et les aliments à l’estomac. La question est de savoir si ce mal s’arrêtera ou fera des progrès. Dans ce dernier cas, il n’y aurait plus moyen de respirer ni de manger, a very awkward situation indeed. J’espère n’être pas soumis à cette épreuve, à laquelle cependant je ne néglige pas de me préparer, en m’exerçant à la patience et à la résignation. Est-ce qu’il n’y a pas une source inépuisable de consolation et de force dans ces mots : Non sicut ego volo, sed sicut tu.
Une chose qui m’afflige plus que ces perspectives physiologiques, c’est la faiblesse intellectuelle dont je sens si bien le progrès. Il faudra que je renonce sans doute à achever l’œuvre commencée. Mais, après tout, ce livre a-t-il toute l’importance que je me plaisais à y attacher ? La postérité ne pourra-t-elle pas fort bien s’en passer ? Et s’il faut combattre l’amour désordonné de la conservation matérielle, n’est-il pas bon d’étouffer aussi les bouffées de vanité d’auteur, qui s’interposent entre notre cœur et le seul objet qui soit digne de ses aspirations ?
D’ailleurs, je commence à croire que l’idée principale que j’ai cherché à propager n’est pas perdue ; et hier un jeune homme m’a envoyé en communication un travail intitulé : Essai sur le capital. J’y ai lu cette phrase :
« Le capital est le signe caractéristique et la mesure du progrès. Il en est le véhicule nécessaire et unique, sa mission spéciale est de servir de transition de la valeur à la gratuité. Par conséquent, au lieu de peser sur le prix naturel, comme on dit, son rôle constant est de l’abaisser sans cesse » (voir ci-après la lettre page 204).
Or, cette phrase renferme et résume le plus fécond des phénomènes économiques que j’aie essayé de décrire. En elle est le gage d’une réconciliation inévitable entre les classes propriétaires et prolétaires. Puisque ce point de vue de l’ordre social n’est pas tombé, puisqu’il a été aperçu par d’autres, qui l’exposeront à tous les yeux mieux que je ne pourrais faire, je n’ai pas tout à fait perdu mon temps, et je puis chanter, avec un peu moins de répugnance, mon Nunc dimittis.
J’ai lu la relation du congrès de Francfort. Vous êtes le seul qui sachiez donner à cette œuvre un caractère pratique, une action sur le monde des affaires. Les autres orateurs s’en tiennent à des lieux communs fort usés. Mais je persiste toujours à penser que l’association finira par avoir une grande influence indirecte, en éveillant et formant l’opinion publique. Sans doute, vous ne ferez pas décréter officiellement la paix universelle ; mais vous rendrez les guerres plus impopulaires, plus difficiles, plus rares, plus odieuses.
Il ne faut pourtant pas se dissimuler que l’affaire de Grèce a porté un très-rude coup aux amis de la paix ; et il faudra bien du temps pour qu’ils s’en relèvent. Quel est, par exemple, le député français assez hardi pour seulement parler de désarmement partiel, en présence du principe international impliqué dans cette affaire grecque, avec l’assentiment (et c’est là surtout ce qui est grave) de la nation britannique ? Désarmer ! s’écrierait-on, désarmer au moment où une puissance formidable agit ouvertement en vertu de ce principe, qu’au moindre grief, qu’elle se croira contre un autre gouvernement, elle pourra non-seulement employer la force contre ce gouvernement, mais encore saisir les propriétés privées de ses citoyens ! Tant qu’un tel principe restera debout, coûte que coûte, il faut que nous restions tous armés jusqu’aux dents.
Il fut un temps, mon ami, où la diplomatie elle-même essaya de faire prévaloir le respect des propriétés particulières en mer, pendant la guerre. Ce principe est entré dans nos mœurs militaires. En 1814, les Anglais n’ont rien pris, dans le midi de la France, sans le payer. En 1823, nous avons fait la guerre en Espagne sur les mêmes errements ; et quelque injuste que fût cette guerre, au point de vue politique, elle marqua admirablement la distinction, désormais reçue, entre le domaine public et la propriété personnelle. M. de Chateaubriand essaya à cette époque de faire admettre, dans le droit international, la suppression de la course, des lettres de marque, en un mot, le respect de la propriété privée. Il échoua ; mais ses efforts attestent un grand progrès de la civilisation.
Combien lord Palmerston nous rejette loin de ce temps ! Il est donc admis maintenant que, si l’Angleterre a à se plaindre du roi Othon, il n’est pas un Grec qui puisse se dire propriétaire d’une barque, ou d’un tonneau de marchandise. Par la même raison, si la France a quelque grief contre la Belgique, la Suisse, le Piémont, elle peut envoyer des bataillons s’emparer des maisons, des récoltes, des bestiaux, etc. ; c’est de la barbarie… Je le répète, avec un tel système, il faut que chacun reste armé jusqu’aux dents, et se tienne prêt à défendre son bien. — Car, mon ami, les hommes ne sont pas encore des Quakers. Ils n’ont pas renoncé au droit de défense personnelle, et probablement ils n’y renonceront jamais.
Si encore tout se bornait aux doctrines et aux actes de lord Palmerston, ce serait une iniquité de plus à la charge de la diplomatie ; voilà tout. Mais ce qui est grave, ce qui est menaçant, c’est l’approbation inattendue donnée à cette politique par la nation anglaise. Il me reste un espoir : c’est que cette approbation soit une surprise.
Mais tout en politiquant, j’oublie de vous dire que, pour me conformer aux ordonnances des médecins, sans y avoir grand’foi, je pars pour l’Italie. Ils m’ont condamné à passer cet hiver à Pise, en Toscane. De là, j’irai sans doute visiter Florence et Rome. Si vous avez là quelques amis assez intimes pour que je puisse me présenter à eux, veuillez me les signaler, sans vous donner la peine de faire des lettres de recommandation. Si je savais où trouver monsieur et madame Schwabe, je les préviendrais de cette excursion afin de prendre leurs ordres. Quand vous aurez occasion de leur écrire, veuillez leur faire part de ce voyage.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 9 septembre 1850 (Paris) ↩
BWV
[CW1.189] [OC1] 189 Paris, 9 septembre 1850. A Félix Coudroy
Mon cher Félix, je t’écris au moment de me lancer dans un grand voyage. La maladie, que j’avais quand je t’ai vu, s’est fixée au larynx et à la gorge. Par la continuité de la douleur, et l’affaiblissement qu’elle occasionne, elle devient un véritable supplice. J’espère pourtant que la résignation ne me fera pas défaut. Les médecins m’ont ordonné de passer l’hiver à Pise ; j’obéis, encore que ces messieurs ne m’aient pas habitué à avoir foi en eux.
Adieu, je te quitte parce que ma tête ne me permet plus guère d’écrire. J’espère être plus vigoureux en route.
Letters to Cheuvreux Family: 9 septembre 1850, Paris ????↩
[????]
Après avoir quitté les Pyrénées au mois de juillet, Bastiat s’établit aux environs de Paris. Il passe ses matinées en solitaire au Buttard et la fin de ses journées à la Jonchère. Mais cette cruelle laryngite s’aggrave ; un travail suivi lui devient chaque jour plus difficile. Ses amis, qui l’avaient vu l’année précédente écrire plusieurs chapitres des Harmonies au milieu du bruit, du mouvement, dans un coin de leur salon, sur le bord d’une table, trempant sa plume unique au fond d’une bouteille d’encre, simple appareil qu’il tirait de sa poche ; ses amis le surprenaient alors repoussant d’un geste impatient le papier posé devant lui ; inactif, et le front courbe, Bastiat restait muet jusqu’au moment où son ardente pensait jaillissait comme une fusée brillante en paroles éloquentes. Mais cette parole ramenait bien vite la douleur de gorge et lui imposait de nouveau le silence.
Le 9 septembre 1850, le malade, avec un sang-froid stoïque, rendait compte lui-même à Richard Cobden des conséquences redoutables de sa situation.
Mon cher Cobden, je suis sensible à l’intérêt que vous voulez bien prendre à ma santé. Elle est toujours chancelante. En ce moment, j’ai une grande inflammation, et probablement des ulcérations à ces deux tubes qui conduisent l’air aux poumons et les aliments à l’estomac. La question est de savoir si ce mal s’arrêtera ou fera des progrès. Dans ce dernier cas, il n’y aurait plus moyen de respirer, ni de manger, a very awkward situation indeed. J’espère n’être pas soumis à cette épreuve, à laquelle cependant je ne néglige pas de me préparer, en m’exerçant à la patience et à la résignation. Est-ce qu’il n’y a pas une source inépuisable de consolation et de force dans ces mots : Non sicut ego volo, sed sicut tu ? Une chose qui m’afflige plus que ces perspectives physiologiques, c’est la faiblesse intellectuelle dont je sens si bien le progrès. Il faudra que je renonce sans doute à achever l’œuvre commencée. Mais, après tout, ce livre a-t-il toute l’importance que je me plaisais à y attacher ? La postérité ne pourra-t-elle pas fort bien s’en passer ? Et s’il faut combattre l’amour désordonné de la conservation matérielle, n’est-il pas bon d’étouffer aussi les bouffées de vanité d’auteur, qui s’interposent entre notre cœur et le seul objet qui soit digne des aspirations ? D’ailleurs, je commence à croire que l’idée principale que j’ai cherché à propager n’est pas perdue ; et hier un jeune homme m’a envoyé en communication un travail intitulé : Essai sur le capital. J’y ai lu cette phrase :
« Le capital est le signe caractéristique et la mesure du progrès. Il en est le véhicule nécessaire et unique, sa mission spéciale est de servir de transition de la valeur à la gratuité. Par conséquent, au lieu de peser sur le prix naturel, comme on dit, son rôle constant est de l’abaisser sans cesse. »
Or cette phrase renferme et résume le plus fécond des phénomènes économiques que j’aie essayé de décrire. En elle est le gage d’une réconciliation inévitable entre les classes propriétaires et prolétaires. Puisque ce point de vue de l’ordre social n’est pas tombé, puisqu’il a été aperçu par d’autres qui l’exposeront à tous les yeux mieux que je ne pourrais faire, je n’ai pas tout à fait perdu mon temps, et je puis chanter avec un peu moins de répugnance mon Nunc dimittis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tout en politiquant, écrit-il plus loin, j’oubliais de vous dire que, pour me conformer aux ordonnances des médecins, sans y avoir grand foi, je pars pour l’Italie. Ils m’ont condamnée à passer cet hiver à Pise, en Toscane ; de là, j’irai sans doute visiter Florence et Rome. Si vous avez à quelques amis assez intimes pour que je puisse me présenter à eux, veuillez me les signaler sans vous donner la peine de faire des lettres de recommandation. . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
F. Bastiat.
à M. Paillottet: Lettre du 14 septembre 1850 (Lyon) ↩
BWV
[CW1.190] [OC7] 190 Lyon, 14 septembre 1850. A M. Paillottet
Je ne veux pas me lancer dans la seconde moitié de mon voyage, sans vous dire que tout s’est assez bien passé jusqu’ici. Je n’ai été un peu éprouvé que dans le trajet de Tonnerre à Dijon ; mais cela était presque inévitable. Je crois que le mieux eût été de sacrifier une nuit et de prendre le courrier. C’est toujours le meilleur système. Coucher en route vous assujettit à prendre des pataches, des coucous, à être jeté sur l’impériale au milieu d’hommes ivres, etc. ; et vous arrivez dans un mauvais cabaret pour recommencer le lendemain.
Je ne vous ai pas dit, mon ami, combien j’ai été sensible à l’idée qui vous a un moment traversé l’esprit de m’accompagner jusqu’en Italie. Je vous suis tout aussi reconnaissant que si vous eussiez exécuté ce projet. Mais je ne l’aurais pas souffert. C’eût été priver madame Paillottet de l’occasion de voir un jour ce beau pays, ou du moins c’eût été diminuer ses chances. D’ailleurs, ne pouvant pas causer, tout le charme de voyager ensemble eût été perdu. Ou nous aurions souvent violé la consigne, ce qui nous eût causé des remords ; ou nous l’aurions observée, et ce n’eût pas été sans une lutte pénible et perpétuelle. Quoiqu’il en soit, je vous remercie du fond du cœur ; et si madame Paillottet en a le courage, venez me chercher ce printemps, quand je ne serai plus muet.
Rappelez à de Fontenay mon conseil, je dis plus, ma pressante invitation de faire imprimer son Capital.
Letters to Cheuvreux Family: 14 septembre 1850, Lyon↩
BWV
[CW1.191] [CH] 191 Lyon, 14 septembre 1850. A Melle Louise Cheuvreux
Chère demoiselle Louise,
Me voici à Lyon depuis hier soir ; à la rigueur vous auriez pu avoir cette lettre vingt-quatre heures plus tôt, mais en arrivant j’ai hésité entre le pupitre et le lit. Le cœur me poussait vers l’un et le corps vers l’autre : qui m’eût jamais dit que celui-ci l’emporterait dans une lutte de ce genre ? Cependant à peine couché il a été en proie à une forte fièvre, ce qui explique sa victoire et me justifie à ses mes propres yeux. Du reste, soyez sans inquiétude sur cette fièvre, elle est tout accidentelle et ce matin il n’y paraît plus. Mardi, après vous avoir quittés, j’assistai au dîner des Économistes. M. Say nous présidait. Par suite de cette fatigue qui me prend toujours le soir, il me fut impossible d’aller dire adieu à Mme Say, ce dont j’ai bien du regret.
Mercredi je partis à dix heures et demie. Jusqu’à Tonnerre le voyage se fait à Merveille. Nous allions si rapidement que l’on pouvait à peine jouir du paysage ; en sorte que mes yeux s’étant fixés sur un nuage probablement visible à la Jonchère, je me rappelai que vous étiez peu satisfaite des paroles qu’on a mises à la jolie mélodie de Félicien David.
J’en adressai d’autres à mon nuage. Malheureusement elles ne sont pas rimées ; il est donc inutile que je les reproduise ici. De Tonnerre à Dijon commencent des tribulations de toutes sortes. Si vous suivez cette route, comme je l’espère, il faut que M. Cheuvreux se mette en rapport épistolaire avec M. G… qui procure des voitures de poste.
N’étant responsable que de moi-même, je me suis confié au hasard qui aurait pu mieux me servir. Nous étions six dans une rotonde faite pour quatre. Sur six personnes il y avait quatre femmes ; c’est vous dire que nous avions sous les pieds, sur les genoux, dans les flancs, force paquets, cabas, paniers, etc., etc. Vraiment les femmes, si adorables d’abnégation dans la vie domestique, semblent ne pas comprendre que l’on se doit aussi quelque chose, même entre inconnus, dans la vie publique.
De Châtillon à Dijon, j’ai été huché sur une impériale, en quatorzième. C’est pendant ce trajet qu’on franchit le point culminant dont un côté regarde l’Océan, l’autre la Méditerranée. Quand on traverse cette ligne, il me semble qu’on se sépare une seconde fois de ses amis, car on ne respire plus le même air, on n’est plus sous le même ciel. Enfin de Dijon à Châlon, il ne s’agit que de deux heures en chemin de fer, et de Châlon à Lyon c’est une ravissante promenade sur l’eau.
Mais est-ce que je puis dire que je voyage ? J’assiste à une succession de paysages, voilà tout. Ni dans les voitures, ni sur les bateaux, ni dans les hôtels, je n’entre ne communication avec personne. Plus les physionomies paraissent sympathiques, plus je m’en éloigne. Le chapitre des aventures fortuites, des rencontres imprévues, n’existe pas pour moi. Je parcours l’espace comme un ballot de marchandises, sauf quelques jouissances pour les yeux qui en sont bientôt rassasiés.
Vous me disiez, chère demoiselle, que la poétique Italie me serait une source d’émotions nouvelles. Oh ! je crains bien qu’elle ne puisse me tirer de cet engourdissement qui s’empare peu à peu de toutes mes facultés. Vous m’avez donné bien des encouragements et des conseils, mais pour que je fusse impressionnable à la nature et à l’art, il aurait fallu me prêter votre âme, cette âme qui voudrait s’épanouir au bonheur, qui se met si vite à l’unisson de tout ce qui est beau, gracieux, doux, aimable ; qui a tant d’affinité avec ce qu’il y a d’harmonieux dans la lumière, les couleurs, les sons, la vie. Non que ce besoin de bonheur révèle en elle rien d’égoïste, au contraire ; si elle le cherche, si elle l’attire, si elle le désire, c’est pour le concentrer en elle comme en un foyer, et de là le répandre autour d’elle en esprit, en fine malice, en obligeance perpétuelle, en consolations et en affection. C’est avec une telle disposition de l’âme que je voudrais voyager, car il n’y a pas de prisme qui embellisse plus les objets extérieurs. Mais je change de dieux et de ciel sous une bien autre influence.
Oh ! combien est profonde la fragilité humaine ! Me voici le jouet d’un petit bouton naissant dans mon larynx ; c’est lui qui me pousse du midi au nord et du nord au midi ; c’est lui qui ploie mes genoux et vide ma tête ; c’est lui qui me rend indifférent à ces perspectives italiennes dont vous me parlez. Bientôt je n’aurai plus de pensées et d’attention que pour lui, comme ces vieux infirmes qui remplissent toutes leurs conversations et toutes leurs lettres d’une seule idée. Il me semble que me voilà pas mal sur le chemin.
Pour en sortir, mon imagination a une voie toujours ouverte, c’est d’aller à la Jonchère. Je me figure que vous jouissez avec délice des belles journées que septembre tenait en réserve. Vous voilà tous réunis ! Votre cher père et M. Édouard sont revenus de Cherbourg enchantés des magnificences dont ils ont été témoins, et bien pourvus de narrations. Ne fut-ce que la présence de Marguerite, cela suffirait pour faire de votre montagne un séjour charmant. En voilà une qui pourra se vanter d’avoir été caressée ! J’aime beaucoup entendre les parents se reprocher mutuellement de gâter les enfants, petite guerre bien innocente, car les plus gâtés, c’est-à-dire les plus aimés, sont ceux qui réussissent le mieux.
Chère demoiselle, permettez-moi de vous rappeler qu’il ne faut pas chanter trop longtemps, surtout avec les fenêtres ouvertes. Défiez-vous des fraîcheurs de l’automne, évitez de prendre un rhume en cette saison. Songez que s’il vous survenait par votre faute, ce serait comme si vous rendiez malades tous ceux qui vous aiment. Redoutez ces retours de Chatou à onze heures de la nuit. Pour concilier le soin de votre santé et votre goût pour la musique, les soirées ne pourraient-elles pas se transformer en matinées ? Adieu, chère mademoiselle Louise.
Permettez-moi de vous offrir l’expression de toute mon affection.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: Le soir, 14 septembre 1850, Lyon↩
BWV
[CW1.192] [CH] 192 Lyon, 14 septembre 1850. A Madame Cheuvreux
Chère madame Cheuvreux,
Je pars demain pour Marseille. En prenant le bateau de onze heures, on n’a que l’inconvénient de coucher à Valence, et ce n’en sera pas un pour moi puisque j’aurai le plaisir de porter des nouvelles à votre frère le capitaine.
Si vous passez à Lyon ne manquez pas de gravir Fourvières ! C’est un horizon admirable où l’on embrasse d’un coup d’œil les Alpes, les Cévennes, les montagnes du Forez et celles de l’Auvergne. Quelle image du monde que ce Fourvières ! En bas, le travail et ses insurrections ; au milieu, des canons et des soldats ; en haut, la religion avec toutes ses tristes excroissances. N’est-ce pas l’histoire de l’humanité ?
En contemplant le théâtre de tant de luttes sanglantes, je pensais qu’il n’est pas de besoin plus impérieux chez l’homme que celui de la confiance dans un avenir qui offre quelque fixité. Ce qui trouble les ouvriers, ce n’est pas tant la modicité des salaires que leur incertitude ; et si les hommes qui sont arrivés à la fortune voulaient faire un retour sur eux-mêmes, en voyant avec quelle ardeur ils aiment la sécurité, ils seraient peut-être un peu indulgents pour les classes qui ont toujours, pour une cause ou une autre, le chômage en perspective. Une des plus belles harmonies économiques c’est l’accession successive de toutes les classes à une fixité de situation de jour en jour plus stable. La société réalise cette fixité à mesure que la civilisation se fait, par le salaire, le traitement, la rente, l’intérêt, enfin par toute ce que repoussent les socialistes. De telle sorte que leurs plans ne font que ramener l’humanité à son point de départ, c’est-à-dire au moment où l’incertitude arrive au plus haut degré pour tout le monde… Il y a là un sujet de recherches nouvelles pour l’économie politique… Mais de quoi vais-je vous entretenir à propos de Fourvières ! Quelle poésie, grand Dieu ! Pour l’oreille délicate d’une femme !… Aideu encore, pardonnez ce torrent de paroles ; je me venge de mon silence, mais est-il juste que vous en soyez victime ?
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 18 septembre 1850, Marseille↩
BWV
[CW1.193] [CH] 193 Marseille, 18 septembre 1850. A M. Cheuvreux
Mon cher monsieur Cheuvreux,
Il m’a été pénible de quitter Paris sans vous serrer la main, mais je ne pouvais retarder mon départ sous peine de manquer ici le paquebot-poste. En effet, je suis arrivé hier et n’ai qu’un jour pour tous mes préparatifs, passe-port, etc.
Il n’est pas même certain que je m’embarque ; j’apprends que les voyageurs qui suivent la voie de mer sont accueillis en Italie par une quarantaine. Trois jours de lazaret, c’est fort peu séduisant !
En arrivant à Marseille, ma première visite a été pour la poste, j’espérais y trouver une lettre ; savoir que vous jouissiez tous les trois d’une bonne santé à la Jonchère m’aurait rendu si heureux ! cette lettre n’y était pas. La réflexion m’a fait comprendre mon trop d’exigence, car enfin il y a à peine huit jours que j’ai quitté cette chère montagne ; le silence fait paraître le temps si long ; il n’est point étonnant que j’attache tant de prix à la réception d’une lettre.
Qu’il me tarde d’être à Pise, qu’il me tarde de savoir si ce beau climat raffermira ma tête et mettra à sa disposition deux heures de travail par jour. Deux heures ! ce n’est pas trop demander, et pourtant c’est encore là une vanité.
Sans doute comme à André Chénier, comme à tous les auteurs, il me semble que j’ai quelque chose là ; mais cette bouffée d’orgueil ne dure guère. Que j’envoie à la postérité deux volumes ou un seul, la marche des affaires humaines n’en sera pas changée.
N’importe, je réclame mes deux heures, sinon pour les générations futures, du moins dans mon propre intérêt. Car, si l’interdiction du travail doit s’ajouter à tant d’autres, que deviendrai-je dans cette tombe anticipée ! J’ai passé à Valence la nuit du dimanche au lundi. Malgré le désir que j’avais de voir le capitaine et les efforts que j’ai faits pour cela, je n’ai pu réussir.... ... ... ... ... ... ... ...
Le 19. Décidément je pars demain et par terre. Me voici lancé dans une entreprise dont je ne vois pas le terme.
Ce matin j’espérais encore une lettre, je serais parti plus gaiement ; maintenant le bon Dieu sait où et quand j’entendrai parler de vous tous ; me faudra-t-il attendre quinze jours ?
Veuillez, cher monsieur Cheuvreux, me rappeler au souvenir de la mère et de la fille, les assurer de ma profonde amitié. Ne m’oubliez pas non plus auprès de M. Édouard et de Mme Anna, qui me permettront bien d’embrasser tendrement, quoique de bien loin, leur aimable enfant.
Adieu, cher monsieur Cheuvreux.
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 22 septembre 1850, Marseille (à bord du Castor)↩
BWV
[CW1.194] [CH] 194 Marseille, 22 septembre 1850. A Madame Cheuvreux
Chère madame Cheuvreux,
Avant de quitter la France, permettez-moi de vous adresser quelques lignes. La date de cette feuille va vous surprendre, en voici l’explication. Vous savez que, résolu à prendre la voie de terre, j’ai laissé partir le bateau du 19. Dès lors un jour plus tôt ou plus tard n’importait guère, et je ne pouvais me décider à quitter Marseille, sachant qu’une de vos lettres était sur le point d’arriver. J’ai attendu et j’ai bien fait, puisque je reçois enfin vos encouragements si bienveillants, si affectueux, et de plus je sais la grande détermination prise à la Jonchère.
Bref, hier je devais partir par la diligence, mais je ne me dissimulais pas que, pour éviter le Lazaret, je tombais dans d’autres inconvénients : traverser des flots de poussière, aller d’auberge en auberge, de voiturin en voiturin, lutter du larynx avec les portefaix ; toute cela ne me souriait guère. À 11 heures, lisant le journal de Marseille, je vis que le Castor partait pour Livourne dans l’après-midi. Quoique vous me recommandiez d’éviter l’imprévu, je fis arrêter et payer une place, pensant que la quarantaine devrait s’avaler d’un trait en fermant les yeux. Le soir la mer fut si grosse que le bateau ne sortit pas, et voilà comment je griffonne maintenant cette épître pendant qu’on lève l’ancre. Depuis que je suis à bord, je m’aperçois qu’on a bien tort d’arrêter sa place le dernier. Au lieu d’avoir une bonne cabine pour soi, on a sa part de la cabine commune.
O imprévoyant ! tu traverseras la Méditerranée dans la cabine commune d’un paquebot, tu mourras dans la salle commune d’un hôpital, et tu seras jeté dans la fosse commune d’un Campo santo ! Qu’importe ! si le bonheur que j’ai rêvé dans ce monde-ci m’attend dans l’autre. Pourtant mieux vaut avoir une cabine à soi ; c’est pour cela que je vous écris afin que vous preniez toutes vos précautions.
Votre voyage me préoccupe ; je croyais d’abord tenir une solution (qui ne cherche des solutions, aujourd’hui ?). Je pensais que Sa Sainteté, qui met son infaillibilité sous la protection de nos baïonnettes, devait épargner une quarantaine dérisoire à ses soldats. Dès lors il eût été facile à M. Cheuvreux et à M. Édouard Bertin d’obtenir passage sur un vaisseau de l’État allant à Civita-Vecchia ; mais il paraît que nos troupes mêmes sont soumises aux mesures sanitaires (mauvaise solution). Enfin, un voyage à travers les Apennins me paraît bien hasardé à la fin d’octobre.
Je comptais écrire à Mlle Louise, car, ainsi qu’un bon gouvernement veut bien prélever beaucoup d’impôts mais les répartit également, je sens la nécessité de diviser le poids de mes lamentations ; ma lettre n’eût pas été aimable, hélas ! En route je n’ai su voir que le côté répréhensible et critiquable des choses. Les couleurs ne sont pas sur les objets, je le sens ben, elles sont en nous-mêmes. Selon qu’on est noir ou rose, on voit tout en noir ou en rose.
Adieu, je ne puis plus tenir la plume sous le frémissement de la vapeur.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Letters to Cheuvreux Family: 2 octobre 1850, Pise↩
BWV
[CW1.195] [CH] 195 Pise, 2 octobre 1850. A Madame Cheuvreux
Chère madame Cheuvreux,
Sans doute nous nous plaignons tous deux l’un de l’autre : vous de ce déluge de lettres dont je vous accable, et moi je me désole de n’en recevoir aucune. Mais je ne vous accuse pas, il est impossible que vous ayez laissé passer tout ce temps sans m’écrire ; j’attribue mon désappointement à quelque malentendu de la poste italienne. Cette explication est d’autant plus vraisemblable que je suis aussi sans nouvelles de ma famille et de Paillottet. J’ignore si vous persistez dans votre projet de voyage, quelle route vous prendrez, etc. Je suis allé à Livourne pour m’assurer de l’état du Lazaret. Ces grands appartements manquent de meubles ; mais dès que je serai fixé sur votre arrivée, je m’occuperai de préparer deux chambres. Un traiteur passable pourvoira à la nourriture, puis, si vous le permettez, je me mettrai aussi avec plaisir en quarantaine : « … et Phèdre au labyrinthe. » Malheureux ! j’oublie que je ne puis parler et que ma société n’est qu’un nuisance.
Si vous saviez, madame, combien votre entreprise me préoccupe pour Mlle Louise. Ce n’est pas qu’elle présente le moindre danger ; j’espère même du beau temps en octobre, puisque les vents soufflent au mois de septembre, mais je crains que vous ne souffriez toutes deux. J’invoque les bénignes influences du ciel et de la mer !
Enfin voici un moment de bonheur ! Je l’ai lue votre lettre du 25, elle m’arrive accompagnée d’une missive de ma tante et d’une autre de Cobden. Je voudrais que vous me vissiez, je ne suis plus le même.
Est-ce bien digne d’un homme de se mettre ainsi tout entier sous la dépendance d’un événement extérieur, d’un accident de poste ? N’y a-t-il pas pour moi des circonstances atténuantes ? Ma vie n’est qu’une longue privation. La conversation, le travail, la lecture, les projets d’avenir, tout me manque. Est-il étonnant que je m’attache, peut-être avec trop d’abandon, à ceux qui veulent bien s’intéresser à ce fantôme d’existence ? Oh ! leur affection est plus surprenante que la mienne. Vous partez donc le 10 ? Si cette lettre vous parvient, répondez-y de suite.
Vous me recommandez de vous parler comme à la justice, de dire la vérité, toute la vérité ; je le voudrais bien, mais il m’est impossible de savoir si je vais mieux ou plus mal. La marche de cette maladie, qu’elle avance ou qu’elle recule, est si lente, si imperceptible qu’on n’aperçoit aucune différence entre la veille et le lendemain. Il faut prendre des points de comparaison plus éloignés. Par exemple, comment étais-je il y a un an au Buttard ? comment y étais-je cette année, et comment suis-je maintenant ? Voilà trois époques, et je dois avouer que le résultat de cet examen n’est pas favorable.
Le départ de votre frère et de sa famille aura laissé un grand vide à la Jonchère, il suffit d’une gentille enfant comme Marguerite pour remplir toute une maison.
Adieu, chère madame Cheuvreux.
Venez, venez bientôt rendre un peu de mouvement à cette Italie qui me semble morte. Quand vous y serez tous j’apprécierai mieux son soleil, son climat, ses arts. Jusque-là je vais suivre votre conseil, m’occuper exclusivement de mon corps, en faire une idole, lui vouer un culte et me mettre en adoration devant lui. Puissé-je réussir à recouvrer la parole quand vous serez là ! car, madame, auprès de vous le mutisme est pénible ; vous avez une collection de paradoxes que vous défendez fort bien, mais auxquels on est bien aise de répondre.
Adieu, M. Cheuvreux ne va pas être le moins occupé des trois. Je vois prie de croire à ma vive et respectueuse affection.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
à M. Domenger: Lettre du 8 octobre 1850 (Pise)↩
BWV
[CW1.196] [OC7] 196 Pise, 8 octobre 1850. A M. Domenger
Qui nous aurait dit, la dernière fois que j’eus le plaisir de vous voir, que ma première lettre serait datée d’Italie ? J’y suis venu par les prescriptions formelles de la faculté. Je ne doute pas en effet, s’il est encore temps que ma gorge soit modifiée par quelque chose, que ce ne soit par l’air pur et chaud de Pise. Malheureusement, ce n’est qu’un côté de la question. Le plus beau climat du monde n’empêche pas que lorsqu’on ne peut parler, ni écrire, ni lire, ni travailler, il ne soit bien triste d’être seul dans un pays étranger. Cela me fait regretter Mugron, et je crois que j’aimerais mieux grelotter en Chalosse que de me réchauffer en Toscane. J’éprouve ici toute espèce de déceptions. Par exemple, il me serait facile d’avoir des relations avec tous les hommes distingués de ce pays-ci. La raison en est que, l’économie politique entrant dans l’étude du droit, cette science est cultivée par presque tous les hommes instruits. En voulez-vous une preuve singulière ? à Turin, quoiqu’on y parle principalement italien, il s’est vendu plus de mes Harmonies (édition française [1]) qu’à Marseille, Bordeaux, Lyon, Rouen, Lille réunis, et il en est de même de tous les ouvrages économiques. Vous voyez, mon cher, dans quelle illusion nous vivons en France, quand nous croyons être à la tête de la civilisation intellectuelle. — Ainsi, je me trouvais avoir accès auprès de toutes les notabilités et personnages, j’étais parfaitement placé pour étudier ce pays à fond. — Eh bien, ma préoccupation constante est de ne voir personne, d’éviter les connaissances. Bien plus, des amis intimes vont m’arriver de Paris ; ils visiteront Florence et Rome en vrais connaisseurs, car ils apprécient les arts et y sont fort initiés. Quelle bonne fortune en toute autre circonstance ou avec une tout autre maladie ! Mais le mutisme est un abîme qui isole, et je serai forcé de les fuir. Oh ! je vous assure que j’apprends bien la patience.
Parlons des dames X… J’ai toujours remarqué que la dévotion habituelle ne changeait rien à la manière d’agir des hommes, et je doute beaucoup qu’il y ait plus de probité, plus de douceur, plus de respects et d’égards les uns pour les autres, parmi nos très dévotes populations du Midi, que parmi les populations indifférentes du Nord. De jeunes et aimables personnes assisteront tous les jours au sacrifice sanglant de leur Rédempteur, et lui promettront beaucoup plus que la simple équité ; tous les soirs elles pareront de fleurs les autels de Marie ; elles répéteront à chaque instant : Préservez-nous du mal, ne nous laissez pas succomber ; le bien d’autrui tu ne prendras ni retiendras, etc., etc. — Et puis, que l’occasion se présente, elles prendront le plus possible dans l’héritage paternel aux dépens de leurs frères, juste comme feraient des mécréants. Pourquoi pas ? n’en est-on pas quitte avec un acte de contrition et un autre de ferme propos ? On fait de bonnes œuvres, on donne un liard aux pauvres, moyennant quoi on a l’absolution. Et alors qu’a-t-on à craindre ? qu’a-t-on à se reprocher, puisqu’on a réussi à se donner le ministre de Dieu et Dieu lui-même pour complices ?
Il me semble que Mme D… avait quelque idée de faire la semaine sainte à Rome. Si ce projet se réalisait, je ferais peut-être mes dévotions auprès d’elle : sa présence et par conséquent la vôtre me seraient bien agréables, du moins si je puis articuler quelques mots. Autrement, à ne considérer que moi, j’aime autant que vous restiez où vous êtes, car vous savoir près de moi et être réduit à vous éviter serait un supplice de plus.
FN:Deux mois plus tard, je rencontrai, à Livourne, la contrefaçon belge
qui s’y vendait fort bien.(Note de l’éditeur.)
à M. Paillottet: Lettre du 11 octobre 1850 (Pise) ↩
BWV
[CW1.197] [OC1, O[CW1.7] 197 Pise, 11 octobre 1850. A M. Paillottet
…J’ignore combien durera la législation actuelle sur la presse et la signature obligatoire. En attendant voilà, pour nos amis, une bonne occasion de se faire dans la presse une honorable renommée. J’ai remarqué avec plaisir des articles de Garnier, bien traités, bien soignés, et où l’on voit qu’il ne veut pas compromettre l’honneur du professorat. Je l’engage à continuer. Sous tous les rapports, le moment est favorable. Il peut se faire une belle position en répandant une doctrine pour laquelle les sympathies publiques sont prêtes à s’éveiller. — Dites-lui de ma part que, si l’occasion s’en présente, il ne permette ni à M. de Saint-Chamans ni à qui que ce soit d’assimiler ma position à celle de M. Benoist d’Azy dans la question des tarifs. — Il y a ces trois différences essentielles :
1° D’abord, quand il serait vrai que je suis poussé par l’amour de ma province, cela n’est pas la même chose que d’être poussé par l’amour de l’argent.
2° Tout mon patrimoine, tout ce que j’ai au monde est protégé par nos tarifs. Plus donc M. de Saint-Chamans me suppose intéressé, plus il doit me croire sincère quand je dis que la protection est un fléau.
3° Mais ce qui ne permet, en aucune façon, d’assimiler le rôle à la Chambre des protectionistes et des libre-échangistes, c’est l’abîme qui sépare leur requête. Ce que M. Benoist d’Azy demande à la loi, c’est qu’elle me dépouille à son profit. Ce que je demande à la loi, c’est qu’elle soit neutre entre nous et qu’elle garantisse ma propriété comme celle du maître de forges.
Molinari est chargé, à ce qu’il paraît, dans la Patrie, d’une partie plus vive et plus saillante. De grâce, qu’il ne la traite pas à la légère. Que de bien il peut faire en montrant combien sont infectées de socialisme les feuilles qui s’en doutent le moins ! Comment a-t-il laissé passer l’article du National sur le livre de Ledru-Rollin et cette phrase :
« En Angleterre, il y a dix monopoles entés les uns sur les autres ; donc c’est la libre concurrence qui fait tout le mal.
L’Angleterre ne jouit que d’une prospérité précaire a parce qu’elle repose sur l’injustice. Voilà pourquoi, si l’Angleterre rentre dans les voies de la justice, comme le propose Cobden, sa décadence est inévitable. »
Et c’est pour avoir fait ces découvertes que le National décerne à Ledru-Rollin le titre de grand homme d’État !…
Adieu, je suis fatigué.
à M. Paillottet: Lettre du 11 octobre 1850 (Pise) ↩
BWV
[CW1.197] [OC1, O[CW1.7] 197 Pise, 11 octobre 1850. A M. Paillottet
Je me sens envie de vivre, mon cher Paillottet, quand je lis la relation de vos anxiétés à la nouvelle de ma mort. — Grâce au ciel, je ne suis pas mort, ni même guère plus malade. J’ai vu ce matin un médecin qui va essayer de me débarrasser au moins quelques instants de cette douleur à la gorge, dont la continuité est si importune. — Mais enfin, si la nouvelle eût été vraie, il aurait bien fallu l’accepter et se résigner. — Je voudrais que tous mes amis pussent acquérir, à cet égard, la philosophie que j’ai acquise moi-même. Je vous assure que je rendrais le dernier souffle sans peine, presque avec joie, si je pouvais être sûr de laisser, après moi, à ceux qui m’aiment, non de cuisants regrets, mais un souvenir doux, affectueux, un peu mélancolique. Quand je serai plus malade, c’est à quoi je les préparerai…
Letters to Cheuvreux Family: 14 octobre 1850, Pise↩
BWV
[CW1.198] [CH] 198 Pise, 14 octobre 1850. A Madame Cheuvreux
Chère madame Cheuvreux,
Enfin ! si rien n’a dérangé vos combinaisons, s’il n’y a pas eu un coup d’État à Paris, si Mlle Louise ne s’est pas laissé gagner par quelque maudite indisposition, ou M. Cheuvreux par la migraine, s’il s’est mis en règle envers son tribunal, si… si vous avez fait en ce moment le premier pas, le plus difficile, celui qui coûte le plus, vous voilà sur le rail-way, en route pour Tonnerre. Chaque soir je pourrai dire : Il y a cinquante lieues de moins entre nous. Oh ! que nos neveux seront heureux d’avoir des télégraphes électriques qui leur diront : « Le départ s’est effectué il y a une minute ! » Et maintenant, mesdames, pourquoi les vœux de l’amitié sont-ils complétement inutiles ? Si les miens pouvaient être exaucés, votre voyage ne serait qu’une succession d’impressions agréables ; vous auriez un beau soleil pour constante société, sans compter d’aimables rencontres tout le long du chemin ; Mlle Louise sentirait ses forces s’accroître d’heure en heure, sa gaieté, son intérêt sympathique à tout ne se démentirait pas un instant. Cette disposition gagnerait son père et sa mère, et vous arriveriez ainsi à Marseille. Là vous trouveriez la mer unie comme une glace, la quarantaine supprimée, etc. Mais tous les souhaits du monde n’empêcheront pas que vous n’ayez choisi le jour de votre départ de manière à grossir beaucoup les difficultés du voyage. Cela tient un peu à ma mauvaise réputation. Vous êtes si convaincu que je ne sais pas discerner la gauche de la droite, à force de le répéter, vos préventions à cet égard sont tellement invétérées, que je passe pour absolument incapable d’exécuter la moindre manœuvre, et bien plus encore de conseiller les autres. C’est pourquoi vous n’avez pas lu un seul mot de tout ce que j’ai écrit à ce sujet. D’après ce que vous me dites, il est clair comme le jour que vous avez sauté à pieds joints tous les passages de mes lettres où je me pose en donneur d’avis. Mais il est inutile de revenir là-dessus, puisque ces avis, en supposant que vous en fissiez cas, arriveront trop tard.
Au lieu d’un bon paquebot français, n’aurez-vous pas un petit bateau sarde bourré de marchandises, couvert de toute espèce de passagers, sans police ni discipline, où les voyageurs de seconde envahissent les premières places et viennent fumer sous le nez des dames ? ce dont on peut se plaindre d’autant moins au capitaine que celui-ci donne l’exemple de toutes les infractions à la règle. Enfin ce pèlerinage commence à la grâce de Dieu, il faut bien qu’il se termine de même.
Bien chère madame, comment finir cette lettre sans solliciter un pardon dont j’ai bien besoin ? Je me suis beaucoup récrié à propos de votre silence ; j’étais ben ingrat, bien injuste, car j’ai reçu plus de lettres, non pas que je n’en désirais, mais que je n’osais en espérer. Seulement, la première a tardé et s’est trouvée un peu laconique ; voilà la cause de tout ce bruit. Soyez indulgente pour les doléances des malades : on les plaint, on les excuse, on y condescend quand on est bonne comme vous, mais on ne s’en fâche pas.
Adieu, votre dévoué,
F. Bastiat.
à Richard Cobden: Lettre du 18 octobre 1850 (Pise) ↩
BWV
[CW1.199] [OC1] 199 Pise, 18 octobre 1850. A Richard Cobden
Mon cher Cobden, je vous remercie de l’intérêt que vous prenez à ma santé. Je ne puis pas dire qu’elle soit meilleure ou plus mauvaise. Sa marche est si imperceptible que je sais à peine vers quel dénoûment elle me conduit. Tout ce que je demande au ciel maintenant, c’est que les tubes qui descendent de la bouche au poumon et à l’estomac ne deviennent pas plus douloureux. Je n’avais jamais pensé au rôle immense qu’ils jouent dans notre vie. Le boire, le manger, la respiration, la parole, tout passe par là. S’ils ne fonctionnent pas, on est mort ; s’ils fonctionnent mal, c’est bien pis.
Le premier aspect de l’Italie, et particulièrement de la Toscane, ne fait pas sur moi la même impression qu’il avait faite sur vous. Cela n’est pas surprenant : vous arriviez ici en triomphateur, après avoir fait faire à l’humanité un de ses plus notables progrès ; vous étiez accueilli et fêté par tout ce qu’il y a dans ce pays d’hommes éclairés, libéraux, amis du bien public ; vous voyiez la Toscane par le haut. — Moi,j’y entre par l’extrémité opposée ; tous mes rapports jusqu’ici ont été avec des bateliers, des voituriers, des garçons d’auberge, des mendiants et des facchini, ce qui constitue la race d’hommes la plus rapace, la plus tenace, la plus abjecte qu’on puisse rencontrer. Je me dis souvent qu’il ne faut pas se hâter de juger, que très-probablement ma disposition intérieure me met un verre noirci sur la vue. En effet, il est bien difficile qu’un homme qui ne peut pas parler, ni guère se tenir debout, ne soit fort irritable, et partant injuste. Cependant, mon ami, je ne crois pas me tromper en disant ceci : — Quand les hommes n’ont aucun soin de leur dignité, quand ils ne reconnaissent d’autre loi que le sans gêne, quand ils ne veulent se soumettre à aucun ordre, à aucune discipline volontaire, il n’y a pas de ressource. — Ici les hommes sont très-bienveillants les uns envers les autres ; et cette qualité est poussée si loin, qu’elle devient un défaut et un obstacle invincible à toute tentative sérieuse vers l’indépendance et la liberté. Dans les rues, dans les bateaux à vapeur, dans les chemins de fer, vous verrez toujours les règlements violés. On fume là où il est défendu de fumer, les gens des secondes envahissent les premières, ceux qui ne payent pas prennent la place de ceux qui payent. Ce sont choses reçues dont nul ne se fâche, pas même les victimes. Ils ont l’air de dire : Il ne s’est pas gêné, il a eu raison, j’en ferais autant à sa place. Quant aux préposés, gardiens, capitaines, comment feraient-ils respecter la règle, puisqu’ils sont toujours les premiers à la violer ?
Au reste, mon cher Cobden, ne prenez ces paroles que pour ce qu’elles sont, les boutades d’un misanthrope. Avant-hier soir, l’ennui me poussa vers Florence. J’y arrivai à trois heures de l’après-midi. Comme je n’avais d’autre suite et d’autre bagage qu’un petit sac de nuit, on ne voulut me recevoir dans aucun hôtel. La fatigue m’accablait et je ne pouvais m’expliquer, puisque la voix me fait défaut. Enfin, dans une auberge plus hospitalière, on me donna une chambre froide et obscure, dans les combles. Aussi, hier, je me suis empressé de quitter cette ville des fleurs, qui n’a été pour moi que la ville des soucis. Cependant, j’ai eu le plaisir de voir le marquis de Ridolfi. Nous avons beaucoup causé de vous. Plus tard, si mes cordes vocales reprennent un peu de sonorité, j’irai me réconcilier avec la ville des Médicis.
à M. Horace Say; Lettre du 20 octobre 1850 (Pise) ↩
BWV
[CW1.200] [OC1] 200 Pise, 20 octobre 1850. A Horace Say
Mon cher ami, nous nous écrivions presque au même moment, le jour du dîner mensuel, en sorte que nos lettres se sont croisées entre Paris et Pise. Depuis, je n’observe aucun progrès, en avant ni en arrière, dans ma maladie. Seulement le sentiment de la souffrance s’irrite par la durée. Faiblesse, isolement, ennui, je ferais bon marché de tout, n’était cette maudite déchirure à la gorge qui me rend si pénibles toutes les fonctions, si nombreuses et si indispensables, qui s’accomplissent par là. Oh ! que je voudrais avoir un jour de trêve ! — mais toutes les invocations du monde n’y peuvent rien. — À la bizarrerie de mes rêves et à la transpiration qui suit toujours le sommeil, je reconnais que j’ai chaque nuit un peu de fièvre. Cependant, comme je ne tousse pas plus qu’autrefois, je pense que cette fièvre est plutôt un effet de ce malaise continuel qu’un symptôme de la maladie constitutionnelle.
… Je crois en effet que l’économie politique est plus sue ici qu’en France, par la raison qu’elle fait partie du Droit. C’est énorme que de donner une teinture de cette science aux hommes qui se rattachent de près ou de loin à l’exécution des lois ; car ces mêmes hommes entrent pour beaucoup dans leur confection, et d’ailleurs ils forment le fond de ce que l’on appelle la classe éclairée. Je n’espère jamais voir l’économie politique prendre domicile à l’École de Droit en France. À cet égard, l’aveuglement des gouvernements est incompréhensible. Ils ne veulent pas qu’on enseigne la seule science qui leur donne des garanties de durée et de stabilité. N’est-ce pas un fait caractéristique que le ministre du commerce et celui de l’instruction publique, me renvoyant de l’un à l’autre comme une balle, m’aient, de fait, refusé un local pour faire un cours gratuit ?
Puisque vous êtes notre Cappoletto, notre Leader, vous devriez bien endoctriner nos amis Garnier et Molinari pour qu’ils mettent à profit cette occasion unique de la signature, laquelle, quoi qu’on en dise, donne de la dignité au journal. Il dépend d’eux, je crois, de donnera à la Patrie ce qu’elle n’a jamais eu, une couleur, un caractère. Ils auront à agir avec beaucoup de prudence et de circonspection, puisque le journal n’est économiste, ni au point de vue du directeur, ni à celui des actionnaires, ni à celui des abonnés. Le cachet ne devra apparaître distinctement que peu à peu. Je pense que nos amis ne doivent nullement agir comme s’ils étaient dans un journal franchement économiste et ayant arboré le drapeau. Il s’agirait là de rompre des lances avec les adversaires. Mais dans la Patrie, la tactique ne doit pas être la même. Il faut d’abord ne traiter que de loin en loin les questions de liberté commerciale, particulièrement les plus ardues (comme les lois de navigation). Il vaut mieux prendre la question de plus haut, à une hauteur qui embrasse à la fois la politique, l’économie politique et le socialisme, c’est-à-dire : l’intervention de l’État. Encore ne doivent-ils pas, selon moi, présenter la non-intervention comme un système, comme un principe. Seulement ils doivent appeler l’attention du lecteur là-dessus chaque fois que l’occasion s’en présente. Leur rôle, — afin de ne pas éveiller la défiance, — est de montrer, dans chaque question spéciale, les avantages et les inconvénients de l’intervention. Les avantages, pourquoi les dissimuler ? Il faut bien qu’il y en ait puisque cette intervention est si populaire. Ils devront donc avouer que lorsqu’il y a un bien à faire ou un mal à combattre, l’appel à la force publique paraît d’abord le moyen le plus court, le plus économique, le plus efficace ; à cet égard même, à leur place, je me montrerais très-large et très-conciliant envers les gouvernementaux, car ils sont bien nombreux et il s’agit moins de les réfuter que de les ramener. Mais après avoir reconnu les avantages immédiats, j’appellerais leur attention sur les inconvénients ultérieurs. Je dirais : C’est ainsi qu’on crée de nouvelles fonctions, de nouveaux fonctionnaires, de nouveaux impôts, de nouvelles sources de désaffection, de nouveaux embarras financiers. Puis, en substituant à l’activité privée la force publique, n’ôte-t-on pas à l’individualité sa valeur propre et les moyens de l’acquérir ? Ne fait-on pas de tous les citoyens des hommes qui ne savent pas se conduire eux-mêmes, prendre une résolution, repousser une surprise, un coup de main ? Ne prépare-ton pas des éléments au socialisme, qui n’est autre chose que la pensée d’un homme substituée à toutes les volontés ?
Les diverses questions spéciales qui peuvent se présenter, discutées à ce point de vue, avec impartialité, la part du pour et du contre étant bien faite, je crois que le public s’y intéresserait beaucoup et ne tarderait pas à reconnaître la véritable cause de nos malheurs. — Les circulaires de M. Dumas offrent un bon texte pour le début.
Adieu, mon cher ami, croiriez-vous que je suis fatigué pour avoir barbouillé ces quelques lignes ? Il me reste cependant la force de me rappeler au bon souvenir de madame Say et de Léon.
à M. le comte Arrivabene: Lettre du 28 octobre 1850 (Pise)↩
BWV
[CW1.201] [OC7] 201 Pise, 28 octobre 1850. A M. le Comte Arrivabene
J’ai été profondément touché, mon cher Monsieur, de la marque si spontanée et si délicate d’intérêt que vous me donnez en m’envoyant une lettre d’introduction auprès de madame Primi. Vous avez bien deviné ce qui va à ma position et surtout à mon caractère, et je vous avoue que non seulement la Toscane, mais encore le Paradis lui-même auraient pour moi peu de charmes si je n’y rencontrais un cœur sympathique. Jugez donc avec quel empressement j’aurais fait la connaissance de madame Primi. Malheureusement elle est en villégiature ; et je crains bien de n’avoir plus l’occasion de lui rendre mes devoirs, car je me dispose à transporter mes pénates à Rome pour cet hiver. C’est justement le besoin de quelques relations affectueuses qui me détermine. À Rome je trouverai un de mes parents, excellent prêtre, et le beau-frère de M. Say avec sa famille. Ne pouvant aller en société et, ce qui est bien pire, ne pouvant travailler, je n’aurais en face de moi qu’un isolement forcé, désœuvré, insupportable, si quelques amis ne voulaient bien me supporter, moi et mes misères.
Tout ce que vous me dites de madame Primi et de sa sœur me fait vivement regretter de manquer cette occasion de faire leur connaissance. Si je suis mieux au printemps, il est probable que je traverserai de nouveau la Toscane en revenant en France : car on ne peut guère, quand on a fait tant que de venir ici, se dispenser d’étudier un pays aussi curieux par ses institutions et son histoire. En ce cas, je me dédommagerai de la privation que mon départ subit m’impose aujourd’hui.
Je me suis rappelé qu’à notre dernière entrevue à Paris, vous m’aviez parlé de M. Gioberti. Je suis allé le voir et je lui dois d’excellentes recommandations pour lesquelles ma reconnaissance remonte jusqu’à vous.
Adieu, mon cher Monsieur, votre dévoué.
FN:La lettre de M. le comte Arrivabene, à laquelle Bastiat répond, était relative à un passage du chapitre III des Harmonies, publié en décembre 1848 dans le Journal des Économistes. Ce passage se trouve pages 73 et 74 du tome VI. (Note de l’éditeur.)
Letters to Cheuvreux Family: 29 octobre 1850, Pise↩
BWV
[CW1.202] [CH] 202 Pise, 29 octobre 1850. A Madame Cheuvreux
Chère madame Cheuvreux,
Que votre voyage de Florence à Rome a dû être pénible! [207] Malgré ce fonds de philosophie avec lequel vous savez prendre les contrariétés, malgré la bonne humeur que chacun de vous aura apporté à la communauté, il n’est pas possible que vous n’ayez pas souffert avec un si horrible temps, à travers des routes défoncées et dans un pays sans ressources. Mon imagination ose à peine vous suivre dans cette Odyssée ; toutes les prédictions de M. Sturler se dressent devant elle. Combien je bénis pourtant l’heureuse inspiration qui vous a fait prendre la mer à Marseille le 19 ! Deux jours plus tard la traversée est devenue dangereuse, la Méditerranée s’est soulevée au point de désorganiser tous les services, et le bateau arrivé à Gênes, qui vous a suivis, n’a pu parvenir jusqu’à Livourne. Il a relâché à la Spezzia, où il a abandonné ses passagers. Grâce au ciel, vous avez échappé à ces périls, et cette idée me console un peu de vos privations actuelles, qui heureusement finiront ce soir. La vue de la ville éternelle fait tout oublier. Cette ville éternelle, je compte y entrer samedi 2 novembre. Je partirai de Livourne par le paquebot de l’État (tempo permettendo), et vous comprenez que je ne m’arrêterai pas à Civita-Vecchia. Chère madame, ne parlons pas de ma santé, c’est une sonate dont j’aurai tout le temps de vous étourdir à Rome. Quand je pense que vous êtes venue pour procurer à votre mari, à votre fille surtout, plaisirs et distractions, j’ai quelques remords de me jeter au milieu de vous comme un trouble-fête, car je m’aperçois bien que depuis longtemps je tourne au Victor Hugo, à ses Derniers jours d’un condamné, ce qui devient peu récréatif pour mes amis. Encore je m’avise de trouver le héros de Victor Hugo bien heureux ; car enfin il pouvait penser et parler ; il était dans la même position que Socrate, pourquoi n’a-t-il pas pris les choses comme lui ?
Ce petit livre que je vous ai demandé nous montre ce philosophe athénien, condamné à mort, dissertant sur son âme et son avenir ; cependant Socrate était païen, il était réduit à se créer, par le raisonnement, des espérances incertaines. Un condamné chrétien n’a pas ce chemin à parcourir ; la révélation le lui épargne, et son point de départ est précisément cette espérance, devenue une certitude, qui pour Socrate était une conclusion. Voilà pourquoi le condamné de Victor Hugo n’est qu’un être pusillanime. Ne vaut-il pas mieux avoir devant soi un mois de force et de santé, un mois de vigueur de corps et d’âme, et la ciguë au bout, qu’un an ou deux de déclin, d’affaiblissement, de dégoût, pendant lesquels tous les liens se rompent, la nature ne semblant plus prendre d’autre soin que de vous détacher de la terrestre existence ? Enfin, à Dieu d’ordonner, à nous de nous résigner.
Il me paraît bien que je suis un peu mieux ; j’ai pu faire d’assez longues séances chez M. Mure, de plus j’ai reçu un très-grand nombre de visites.
Paillottet m’a écrit ; c’est toujours le même homme, bon, obligeant, dévoué et de plus naïf, ce qui est assez rare à Paris. Ma famille me donne aussi de ses nouvelles.
Adieu, chère madame Cheuvreux, à samedi ou dimanche ; d’ici là, veuillez assurer M. Cheuvreux et votre fille de toute mon amitié, n’oubliez pas le capitaine et veuillez présenter mes compliments et mes respects à M. Édouard et à Mme Bertin.
F. Bastiat.
à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 novembre 1850 (Rome) ↩
BWV
[CW1.203] [OC1] 203 Rome, 11 novembre 1850. A Félix Coudroy
Si je renvoie de jour en jour à t’écrire, mon cher Félix, c’est qu’il me semble toujours que sous peu j’aurai la force de me livrer à une longue causerie. Au lieu de cela, je suis forcé de restreindre toujours davantage mes lettres, soit que ma faiblesse augmente, soit que je me déshabitue de la plume. — Me voici dans la ville éternelle, mon ami, malheureusement fort peu disposé à en visiter les merveilles. J’y suis infiniment mieux qu’à Pise, entouré d’excellents amis qui m’enveloppent de la sollicitude la plus affectueuse. De plus, j’y ai retrouvé Eugène, qui vient passer avec moi une partie de la journée. Enfin, si je sors, je puis toujours donner à mes promenades un but intéressant. Je ne demanderais qu’une chose, être soulagé de ce que mon mal au larynx a d’aigu ; celle continuité de souffrance me désole. Les repas sont pour moi de vrais supplices. Parler, boire, manger, avaler la salive, tousser, tout cela sont des opérations douloureuses. Une promenade à pied me fatigue, la promenade en voiture m’irrite la gorge, je ne puis pas travailler ni même lire sérieusement. Tu vois où j’en suis réduit. Vraiment, je ne serai bientôt plus qu’un cadavre qui a retenu la faculté de souffrir : j’espère que les soins que je suis décidé à prendre, les remèdes qu’on me fait, et la douceur du climat, adouciront bientôt un peu ma situation si déplorable.
Mon ami, je ne te parlerai que vaguement d’un des objets dont tu m’entretiens. J’y avais déjà songé, et il doit y avoir, parmi mes papiers, quelque ébauche d’articles sous forme de lettres à toi adressées. Si la santé me revient et que je puisse faire le second volume des Harmonies, je te le dédierai. Sinon, je mettrai une courte dédicace à la seconde édition du premier volume. Dans cette dernière hypothèse, qui implique la fin de ma carrière, je pourrai t’exposer mon plan et te léguer la mission de le remplir.
Ici on a de la peine à trouver des journaux. Il m’en est tombé un vieux sous la main, du temps où l’engouement était à l’amélioration du sort des classes ouvrières. L’avenir des ouvriers, la condition des ouvriers, les éternelles vertus des ouvriers, c’était le texte de tout livre, brochure, revue ou journal. Et penser que ce sont les mêmes écrivains, qui accablent le peuple d’injures, enrôlés qu’ils sont à l’une des trois dynasties qui, se disputant notre pauvre France, font tout le mal de la situation. Sais-tu rien de plus triste ?
Je te remercie d’avoir bien voulu envoyer quelques renseignements biographiques à M. Paillottet. Ma vie n’offre aucun intérêt au public, si ce n’est la circonstance qui m’a tiré de Mugron. Si j’avais su qu’on s’occupait de cette notice, j’aurais raconté ce fait curieux.
Adieu, mon cher Félix, à moins d’être tout à fait hors d’état de voyager ou tout à fait guéri, je compte passer le mois d’avril à Mugron, puisqu’il m’est défendu de rentrer à Paris avant le mois de mai. Je gémis de ne pouvoir remplir mes devoirs de représentant, mais il est malheureusement certain que ce n’est pas ma faute. — En Italie, ainsi qu’en Espagne, on est souvent témoin du peu d’influence de la dévotion extérieure sur la morale.
Mes souvenirs à tous les amis ; donne de mes nouvelles à ma tante ; présente mes amitiés à ta sœur.
à M. Paillottet: Lettre du 26 novembre 1850 (Rome) ↩
BWV
[CW1.204] [OC1] 204 Rome, 26 novembre 1850. A M. Paillottet
Mon cher Paillottet, chaque fois que je reçois une lettre de Paris, il me semble que mes correspondants sont des Toinette, et que je suis un Argan.
« La coquine a soutenu pendant une heure durant que je n’étais pas malade ! vous savez, m’amour, ce qui en est. »
Vous prenez bien tous un intérêt amical à mon mal ; mais vous me traitez ensuite en homme bien portant. Vous me préparez des occupations, vous me demandez mon avis sur plusieurs sujets graves, puis vous me dites de ne vous écrire que quelques lignes. Je voudrais bien que vous eussiez mis dans votre lettre le secret, en même temps que le conseil, de tout dire en quelques mots. Comment puis-je vous parler des Incompatibilités parlementaires, des corrections à y apporter, des raisons qui me font penser que ce sujet ne peut être accolé, ni pour le fond ni pour la forme, avec le discours sur l’impôt des boissons, — le tout en une ligne ? Et puis il faut bien que je dise quelque chose de Carey, puisque vous m’envoyez ses épreuves en Toscane ; — des Harmonies, puisque vous m’annoncez que l’édition est épuisée.
Dans votre bonne lettre, que je reçois aujourd’hui, vous manifestez la crainte qu’à la vue de Rome, l’enthousiasme ne me saisisse et ne nuise à ma guérison en ébranlant mes nerfs. Vous me placez toujours là dans l’hypothèse d’un homme bien portant. Figurez-vous, mon ami, qu’il y a deux raisons, aussi fortes l’une que l’autre, pour que les monuments de Rome ne fassent pas éclater en moi un enthousiasme dangereux. La première, c’est que je ne vois aucun de ces monuments, étant à peu près confiné dans ma chambre au milieu des cendres et des cafetières ; la seconde, c’est que la source de l’enthousiasme est en moi complétement tarie, toutes les forces de mon attention et de mon imagination se portant sur les moyens d’avaler un peu de nourriture on de boisson, et d’accrocher un peu de sommeil entre deux quintes.
J’ai beau écrire à Florence, je suis sans aucune nouvelle des épreuves de Carey. Dieu sait quand elles m’arriveront.
Adieu ! je finis brusquement. J’aurais mille choses à vous dire pour M. et MMe Planat, pour M. de Fontenay, pour M. Manin. Bientôt, quand je serai mieux, je causerai plus longtemps avec vous. Maintenant c’est tout ce que j’ai pu faire que d’arriver à cette page.
à M. Domenger: Lettre du 28 novembre 1850 (Rome)↩
BWV
[CW1.205] [OC7] 205 Rome, 28 novembre 1850. A M. Domenger
Rome, le … novembre 1850 [1]
Je suis bien heureux d’être venu à Rome où j’ai trouvé des soins et quelques ressources, je ne sais comment je m’en serais tiré à Pise. La gorge est devenue si douloureuse que c’est pour moi une grande affaire que de manger et de boire. Il faut qu’on me fasse des préparations spéciales, et sous ce rapport mes amis m’ont été bien utiles. — Je ne puis vous dire si je suis mieux. D’un jour à l’autre je n’aperçois pas de changement ; mais si je me compare à moi-même de mois en mois, je ne puis m’empêcher de reconnaître un affaiblissement progressif assez prononcé. Puissé-je, mon cher D…, avoir la force, au mois de février, de regagner Mugron ! On a beau célébrer les vertus du climat, il ne remplace pas le chez soi. D’ailleurs j’envisage ma maladie dans les deux hypothèses de la guérison et de la grande conclusion. Si je dois succomber, je voudrais être couché dans le dortoir où dorment mes amis et mes parents. Je voudrais que nos amis du cercle m’accompagnassent à cette dernière demeure et que ce fût notre excellent curé de Mugron qui prononçât pour moi ce vœu sublime : Lux perpetua luceat ei ! etc., etc. — Aussi, si je le puis, je me propose de profiter des beaux jours de février pour aller à Marseille, où Justin pourra me venir chercher.
Si jamais je rentre au gîte, ce sera pour moi un grand crève-cœur d’avoir passé plusieurs mois à Rome et de n’y avoir rien vu. Je n’ai visité que Saint-Pierre, à cause de l’immuabilité de sa température. Je me borne à aller tous les jours m’exposer au soleil sur le mont Pincio, où je ne puis rester longtemps, puisqu’il n’y a pas de bancs. Je n’aurai donc vu Rome qu’à vol d’oiseau. Malgré cela, quelques connaissances vous arrivent toujours par la lecture, la conversation, l’atmosphère. Ce qui me frappe le plus, c’est la solidité de la tradition chrétienne et l’abondance des témoignages irrécusables.
Mon ami, le récent dénouement politique me fait bien plaisir, puisqu’il donne du répit à notre France. Il me semble justifier complétement ma ligne de conduite. Lors des premières élections je promis d’essayer loyalement la République honnête, et je suis sûr que c’était le vœu général. Par un motif ou par un autre, prêtres, nobles, plébéiens s’accordaient là-dessus, quoique avec des espérances diverses. Légitimistes et Orléanistes s’effacèrent complétement en tant que tels. Mais qu’est-il arrivé ? dès qu’ils l’ont pu ils se sont mis à décrier, fausser, calomnier, embarrasser la République au profit du légitimisme, de l’orléanisme, du bonapartisme. Tout cela échoue. Et maintenant ils font ce qu’ils avaient promis de faire, ce que j’ai fait et ce dont ils se sont écartés pendant deux ans. Ils ont agité la France inutilement.
J’ai eu très grand tort, je l’avoue, de vous parler comme je l’ai fait des dames X… j’étais sous l’empire de cette idée que la dévotion, quand elle se charge de pratiques minutieuses, oublie la vraie morale, et j’en avais sous les yeux de frappants exemples. Mais il est certain que cela n’avait rien de commun avec ces dames.
FN:Ici la date précise importe, à cause des appréciations politiques qui suivent, et Bastiat a laissé le quantième en blanc ; mais la suscription offre très net le timbre de la Sardaigne du 1er décembre, d’où il suit que la lettre fut probablement écrite et jetée à la poste à Rome le 28 novembre. (Note de l’éditeur.)
à M. Paillottet: Lettre du 8 décembre 1850 (Rome) ↩
BWV
[CW1.206] [OC1] 206 Rome, 8 décembre 1850. A M. Paillottet
Cher Paillottet, suis-je mieux ? Je ne puis le dire ; je me sens toujours plus faible. Mes amis croient que les forces me reviennent. Qui a raison ?
La famille Cheuvreux quitte Rome immédiatement, par suite de la maladie de madame Girard. Jugez de ma douleur. J’aime à croire qu’elle vient surtout de celle de ces bons amis ; mais assurément des motifs plus égoïstes y ont une grande part.
Par un hasard providentiel, hier j’écrivis à ma famille pour qu’on m’expédiât une espèce de Michel Morin, homme plein de gaieté et de ressources, cocher, cuisinier, etc., etc., qui m’a souvent servi et qui m’est entièrement dévoué. Dès qu’il sera ici, je serai maître de partir quand je voudrai pour la France. Car il faut que vous sachiez que le médecin et mes amis ont pris à ce sujet une délibération solennelle. Ils ont pensé que la nature de ma maladie me crée des difficultés si nombreuses, que tous les avantages du climat ne compensent pas les soins domestiques.
D’après ces dispositions, mon cher Paillottet, vous ne viendrez pas à Rome, gagner auprès de moi les œuvres de miséricorde. L’affection que vous m’avez vouée est telle que vous en serez contrarié, j’en suis sûr. Mais consolez-vous en pensant qu’à raison de la nature de ma maladie, vous auriez pu faire bien peu pour moi, si ce n’est de venir me tenir compagnie deux heures par jour, chose encore plus agréable que raisonnable. Je voudrais pouvoir vous donner à ce sujet des explications. Mais, bon Dieu ! des explications ! il faudrait beaucoup écrire, et je ne puis. Mon ami, sous des milliers de rapports j’éprouve le supplice de Tantale. En voici un nouvel exemple : je voudrais vous dire toute ma pensée, et je n’en ai pas la force…
Ce que vous et Guillaumin aurez fait pour les Incompatibilités sera bien fait.
Quant à l’affaire Carey, je vous avoue qu’elle me présente un peu de louche. D’un côté, Garnier annonce que le journal prend parti pour la propriété-monopole. D’une autre part, Guillaumin m’apprend que M. Clément va intervenir dans la lutte. Si le Journal des Économistes veut me punir d’avoir traité avec indépendance une question scientifique, il est bien peu généreux de choisir le moment où je suis sur un grabat, privé de la faculté de lire, d’écrire, de penser, et cherchant à conserver au moins celle de manger, de boire et de dormir qui me quitte.
Pressentant que je ne pourrais accepter le combat, j’ai ajouté à ma réponse à Carey quelques considérations adressées au Journal des Économistes. Vous me direz comment elles ont été reçues.
Fontenay ne sera-t-il donc jamais prêt à entrer en lice ? Il doit comprendre combien son assistance me serait nécessaire. Garnier dit : Nous avons pour nous Smith, Ricardo, Malthus, J. B. Say, Rossi et tous les économistes, moins Carey et Bastiat. J’espère bien que la foi dans la légitimité de la propriété foncière trouvera bientôt d’autres défenseurs, et je compte surtout sur Fontenay.
Je vous prie d’écrire à Michel Chevalier, de lui dire combien je suis reconnaissant de son excellent article sur mon livre. Il n’a d’autre défaut que d’être trop bienveillant et de laisser trop peu de place à la critique. Dites à Chevalier que je n’attends qu’un peu de force pour lui adresser moi-même l’expression de mes vifs sentiments de gratitude. Je fais des vœux sincères pour qu’il hérite du fauteuil de M. Droz ; ce ne sera que tardive justice.
Letters to Cheuvreux Family: Samedi 14 décembre 1850, Rome↩
BWV
[CW1.207] [CH] 207 Rome, 14,15,6,17 décembre 1850. A Madame Cheuvreux
Bien chère madame Cheuvreux,
J’espère m’asseoir quelquefois à ce pupitre, ajouter une ligne à une ligne pour vous envoyer un souvenir.
Je n’ai jamais été si près du néant et je voudrais être tout-puissant pour rendre la mer calme comme un lac.
Quelles émotions, quels devoirs vous attendent à Paris ! Ma seule consolation, c’est de me dire que vous êtes prête à entrer, avec une courageuse énergie, dans la voie que Dieu vous aura préparée, fût-ce la plus pénible.
Ma santé est la même. Si j’entreprenais d’en parler, ce ne pourrait être que par une série de petits détails qui, le lendemain, n’ont plus aucune importance.
Au fond, je crois que le docteur Lacauchy a raison de ne pas écouter un mot de ce que je lui dis.
Je me réjouis à l’idée que M. Cheuvreux verra bientôt l’excellent, le trop excellent Paillottet et le décidera à renoncer à un acte de dévouement aujourd’hui tout à fait inutile. Je crains bien que sa présence à Paris ne me soit absolument indispensable si on réimprime les Harmonies. Je ne pourrai pas m’en occuper, tout retombera sur lui.
Dimanche, 15 décembre.
Vous voilà à Gênes, encore un peu de patience et vous voilà en France. Il est cinq heures, c’est l’heure où vous veniez me voir. Alors je savais quelle galerie Mlle Louise avait visitée, quelle ruine, quel tableau l’avait intéressée. Cela éclairait un peu ma vie. Tout est fini, je suis seul vingt-quatre-heures, sauf les deux visites de mon cousin de Monclar. L’heure à laquelle je fais allusion est devenue amère parce qu’elle était trop douce ; vous me prouviez avec la science de votre père que j’avais raison d’être le plus maussade, le plus bête, le pus irritable et souvent le plus injuste des hommes. Au reste, il me semble que j’apprends la résignation et que j’y trouve un certain parfum.
Lundi, 16 décembre.
Quand Joseph est venu me faire ses adieux, le pauvre homme s’est confondu en remercîments. Hélas ! des remercîments, personne ne m’en doit et j’en doit à tout le monde, surtout à Joseph, qui m’a été d’un secours si réel.
Nouvelle découverte ! Un mouvement précipité m’a ôté toute respiration. Une haleine ne pouvant joindre l’autre, c’est une souffrance des plus pénibles. J’en ai conclu que je devais agir en tout lentement comme un automate.
Mardi, 17 décembre. [208]
Paillottet est arrivé. Il m’annonce l’affreux événement. Oh ! pauvre femme ! pauvre enfant ! vous avez reçu le coup le plus terrible, le plus inattendu. Comment l’aurez-vous supporté avec une âme si peu faite pour souffrir ? Louise saura se posséder davantage dans la douleur. Jetez-vous dans les bras de cette force divine, la seule force qui puisse soutenir en de telles épreuves. Que cette force ne vous abandonne jamais. Chers amis, je n’ai pas le courage de continuer ces mots sans suite, ces propos interrompus.
Adieu, malgré mon état d’anéantissement je retrouve encore de vives étincelles de sympathie pour le malheur qui est venu vous visiter.
Adieu, votre ami,
Frédéric Bastiat.
Lettre de M. Paillottet à Mme Cheuvreux, Rome, 22 décembre 1850 ???↩
[???]
Rome, 22 décembre 1850.
Madame,
J’acquitte une dette personnelle et remplis les intentions de notre ami en vous donnant de ses nouvelles. vous vous faisiez peu d’illusion lorsque vous l’avez quitté ; et cependant vous ne pouviez croire que le déclin de ses forces serait aussi rapide. Ce déclin est bien sensible depuis mon arrivée ici. Le pauvre malade s’en aperçoit et s’en réjouit intérieurement comme d’une faveur du ciel qui veut abréger ses souffrances. Il a d’abord protesté en paroles et en gestes contre ce qu’il appelait ma folie. Nous avons eu peine à lui faire entendre raison à ce sujet M. de Monclar et moi. Toutefois je n’ai pas tardé à reconnaître que ma présence était une consolation et je vous sais un gré infini, madame, de m’avoir mis à même de la lui procurer. « Puisque vous avez accompli ce voyage, je suis bien aise maintenant que vous soyez ici, » m’a-t-il dit le troisième jour. Il ne manque jamais d’ailleurs de me demander lorsque je le quitte : « Et à quelle heure vous verrai-je demain ? »
Voici comment, avec M. de Monclar, dont tout naturellement j’ai consulté les convenances, nous nous sommes partagé ses journées. M. de Monclar lui fait une visite matinale et se retire au moment où j’arrive, c’est-à-dire à onze heures et demie. Moi, je lui tiens compagnie jusqu’à cinq heures après midi, et, dans l’après-dîner, c’est M. de Monclar qui revient.
C’est un bien douloureux spectacle que celui auquel j’assiste ; mais je regretterais beaucoup, par affection et par devoir, de n’être pas là. Presque toujours, la mort est en tiers dans nos entretiens. Nous évitons, lui et moi, d’en prononcer le nom ; lui pour ne pas m’affliger, moi pour ne pas lui donner l’exemple de l’attendrissement et des pleurs, lorsqu’il me donne celui du courage. Il meurt, en effet, comme j’ai toujours pensé qu’il devait mourir, en regardant la mort en face et avec une complète résignation.
Les sujets de nos entretiens sont les amis absents, parmi lesquels vous et les vôtres avez la première place ; puis sa science chérie, cette économie politique pour laquelle il a tant fait, pour laquelle il eût voulu tant faire encore. Je n’ai pas besoin de vous dire que ces entretiens sont fort courts et que c’est de loin en loin que j’approche mon oreille de ses lèvres. Les quelques phrases qu’il prononce, je les recueille avec un religieux respect.
Hier nous avons fait une promenade qui l’a ravi. En sortant par la porte del Popolo, nous sommes allés au ponte Molle et revenus par la porte Angelica. Un beau soleil illuminait les sites que nous avions sous les yeux. Il me répétait souvent : « Quelle délicieuse promenade ! Comme nous avons bien réussi ! » La sérénité du ciel avait passé dans son âme. Il adressait comme un dernier adieu aux splendeurs de la nature qui ont si souvent excité son enthousiasme.
Depuis le 20 de ce mois il s’est confessé. « Je veux, m’a-t-il dit, mourir dans la religion de mes pères. Je l’ai toujours aimée, quoique je n’en aie pas suivi les pratiques extérieures. »
Je me borne à ces quelques détails et peut-être même dois-je m’excuser de vous les présenter, à vous qui êtes déjà sous le poids de la plus légitime affliction causée par la plus cruelle des pertes.
Il s’en est peu fallu que je ne vous rencontrasse à Livourne, où nous étions, à ce qu’il paraît, le même jour, ce que j’ai su depuis. Je me suis d’ailleurs applaudi de ce que cette rencontre n’avait pas eu lieu, car vous aviez encore alors un reste d’espoir qu’il m’eût été difficile de ne pas vous enlever.
Veuillez bien offrir, madame, à M. Cheuvreux mes affectueux souvenirs et recevoir, ainsi que Mlle Cheuvreux, l’hommage de mon respectueux dévouement.
P. Paillottet.
Lettre au Journal des Économistes [209][date?]???↩
[???]
Mon livre est entre les mains du public. Je ne crains pas qu’il se rencontre une seule personne qui, après l’avoir lu, dise : « Ceci est l’ouvrage d’un plagiaire. » Une lente assimilation, fruit des méditations de toute ma vie, s’y laisse trop voir, surtout si on le rapproche de mes autres écrits.
Mais qui dit assimilation, avoue qu’il n’a pas tout tiré de sa propre substance.
Oh ! oui, je dois beaucoup à M. Carey ; je dois à Smith, à J. B. Say, à Comte, à Dunoyer ; je dois à mes adversaires ; je dois à l’air que j’ai respiré ; je dois aux entretiens intimes d’un ami de cœur, M. Félix Coudroy, avec qui, pendant vingt ans, j’ai remué toutes ces questions dans la solitude, sans que jamais il se soit manifesté dans nos appréciations et nos idées la moindre divergence ; phénomène bien rare dans l’histoire de l’esprit humain, et bien propre à faire goûter les délices de la certitude.
C’est dire que je ne revendique pas le titre d’inventeur à l’égard de l’harmonie. Je crois même que c’est la marque d’un petit esprit, incapable de rattacher le présent au passé, que de se croire inventeur de principes. Les sciences ont une croissance comme les plantes ; elles s’étendent, s’élèvent, s’épurent. Mais quel successeur ne doit rien à ses devanciers ?
En particulier, l’Harmonie des intérêts ne saurait être une invention individuelle. Eh quoi ! n’est-elle pas le pressentiment et l’aspiration de l’humanité, le but de son évolution éternelle ? Comment un publiciste oserait-il s’arroger l’invention d’une idée, qui est la foi instinctive de tous les hommes ?
Cette harmonie, la science économique l’a proclamée dès l’origine. Cela est attesté par le titre seul des livres physiocrates. Sans doute, les savants l’ont souvent mal démontrée ; ils ont laissé pénétrer dans leurs ouvrages beaucoup d’erreurs, qui, par cela seul qu’elles étaient des erreurs, contredisaient leur foi. Qu’est-ce que cela prouve ? que les savants se trompent. Cependant, à travers bien des tâtonnements, la grande idée de l’harmonie des intérêts a toujours brillé sur l’école économiste, comme son étoile polaire. Je n’en veux pour preuve que cette devise qu’on lui a reprochée : Laissez faire, laissez passer. Certes, elle implique la croyance que les intérêts se font justice entre eux, sous l’empire de la liberté.
Ceci dit, je n’hésite pas à rendre justice à M. Carey. Il y a peu de temps que je connais ses ouvrages ; je les ai lus fort superficiellement, à cause de mes occupations, de mes souffrances, et surtout à cause de la singulière divergence qui, en fait de méthode, caractérise l’esprit anglais et l’esprit français. Nous généralisons, et c’est ce que nos voisins dédaignent. Eux vont particularisant à travers des milliers et des milliers de pages, et c’est à quoi notre attention ne peut suffire. Quoi qu’il en soit, je reconnais que cette grande et consolante cause, l’accord des intérêts des classes, ne doit à personne plus qu’à M. Carey. Il l’a signalée et prouvée sous un très-grand nombre de points de vue divers, de manière à ce qu’il ne puisse pas rester de doute sur la loi générale.
M. Carey se plaint de ce que je ne l’ai pas cité ; c’est peut-être un tort de ma part, mais il ne remonte pas à l’intention. M. Carey a pu me montrer des aperçus nouveaux, me fournir des arguments, mais il ne m’a révélé aucun principe. Je ne pouvais le citer dans mon chapitre sur l’échange, qui est la base de tout ; ni dans ceux sur la valeur, sur la communauté progressive, sur la concurrence. Le moment de m’étayer de son autorité eût été à propos de la propriété foncière ; mais, dans ce premier volume, je traitais la question par ma propre théorie de la valeur, qui n’est pas celle de M. Carey. À ce moment, je me proposais de faire un chapitre spécial sur la rente foncière, et je croyais fermement que mon second volume suivrait de près le premier. C’est là que j’aurais cité M. Carey ; et non-seulement je l’aurais cité, mais je me serais effacé, pour lui attribuer sur la scène le premier rôle : c’était l’intérêt de la cause. En effet, sur la question foncière, M. Carey ne peut manquer d’être une autorité importante. Pour étudier la primitive et naturelle formation de cette propriété, il n’a qu’à ouvrir les yeux ; pour l’exposer, il n’a qu’à décrire ce qu’il voit ; plus heureux que Ricardo, Malthus, Say et nous tous, économistes européens, qui ne voyons qu’une propriété foncière soumise aux mille combinaisons factices de la conquête. En Europe, pour remonter au principe de la propriété foncière, il faut employer le difficile procédé dont se servait Cuvier pour reconstruire un mastodonte ; il n’est pas très-surprenant que la plupart de nos écrivains se soient trompés dans cet effort d’analogie. En Amérique, il y a des mastodontes dans toutes les carrières ; il suffit d’ouvrir les yeux. J’avais donc tout à gagner, ou plutôt la cause avait tout à gagner à ce que j’invoquasse le témoignage d’un économiste américain.
En terminant, je ne puis m’empêcher de faire observer à M. Carey qu’un Français ne peut guère lui rendre justice, sans un grand effort d’impartialité ; et comme je suis Français, j’étais loin de m’attendre à ce qu’il daignât s’occuper de moi et de mon livre. M. Carey professe pour la France et les Français le mépris le plus profond et une haine qui va jusqu’au délire. Il a déversé ces sentiments dans un bon tiers de ses volumineux écrits ; et il s’est donné la peine de réunir, sans aucun discernement, il est vrai, de nombreux documents statistiques, pour prouver que c’est à peine si, dans l’échelle de l’humanité, nous sommes au-dessus des Indous. À la vérité, M. Carey, dans son livre, nie cette haine. Mais, en la niant, il la prouve ; car comment expliquer un tel déni ? qui l’a provoqué ? C’est la conscience même de M. Carey, qui, surpris lui-même, sans doute, de toutes les preuves de haine contre la France qu’il a accumulées dans son livre, a cru devoir proclamer qu’il ne haïssait pas la France. Combien de fois n’ai-je pas dit à M. Guillaumin : Il y a d’excellentes choses dans les ouvrages de M. Carey, et il serait bien de les faire traduire ; ils contribueraient à faire avancer l’économie politique dans notre pays. Mais aussitôt j’étais forcé d’ajouter : Pouvons-nous jeter dans le public français de pareilles diatribes contre la France, et ne risquons-nous pas de manquer notre but ? Le public ne repoussera-t-il pas ce qu’il y a de bon dans ces livres, à cause de ce qu’il y a de blessant et d’injuste ?
Qu’il me soit permis de finir par une réflexion sur le mot plagiat, dont je me suis servi au début de cette lettre. Les personnes auxquelles je puis avoir emprunté un aperçu ou un argument pensent que je leur suis très-redevable ; je suis convaincu du contraire. Si je ne m’étais laissé entraîner à aucune controverse, si je n’avais examiné aucun système, si je n’avais cité aucun nom propre, si je m’étais borné à établir ces deux propositions : Les services s’échangent contre des services ; La valeur est le rapport des services échangés ; — si ensuite j’eusse expliqué, par ces principes, toutes les classes si compliquées des transactions humaines, je crois que le monument que j’ai cherché à élever eût beaucoup gagné (trop, peut-être, pour cette époque) en clarté, en grandeur et en simplicité.
P. S. Je laisse M. Carey, et je m’adresse, peut-être pour la dernière fois, c’est-à-dire dans les sentiments de la plus intime bienveillance, à nos collègues de la rédaction du Journal des Économistes. Dans la note de ce journal qui a provoqué la réclamation de M. Carey, la direction annonce qu’elle se prononce, sur la propriété foncière, pour la théorie de Ricardo. La raison qu’elle en donne, c’est que cette théorie a pour elle l’autorité de Ricardo d’abord, puis Malthus, Say et tous les économistes, « MM. Bastiat et Carey exceptés. » L’épigramme est aiguë, et il est certain que l’économiste américain et moi faisons bien humble figure dans l’antithèse.
Quoiqu’il en soit, je répète que la direction du journal prend une résolution décisive pour son autorité scientifique.
N’oubliez pas que la théorie de Ricardo se résume ainsi :
« La propriété foncière est un monopole injuste, mais nécessaire, dont l’effet est de rendre fatalement le riche toujours plus riche et le pauvre toujours plus pauvre.
Cette formule a pour premier inconvénient d’exciter, par son simple énoncé, une répugnance invincible, et de froisser, dans le cœur de l’homme, je ne dis pas tout ce qu’il y a de généreux et de philanthropique, mais de plus simplement et de plus grossièrement honnête. Son second tort est d’être fondée sur une observation inachevée, et par conséquent de choquer la logique.
Ce n’est pas ici le lieu de démontrer la légitimité de la rente foncière ; mais devant donner à cet écrit un but utile, je dirai, en peu de mots, comment je la comprends, et en quoi errent mes adversaires.
Vous avez certainement connu à Paris des marchands qui voient leurs profits s’augmenter annuellement, sans qu’on puisse en conclure qu’ils grèvent chaque année le prix de leurs marchandises. Bien au contraire ; et il n’y a rien de plus vulgaire et de plus vrai que ce proverbe : Se rattraper sur la quantité. — C’est même une loi générale du débit commercial, que plus il s’étend, plus le marchand augmente la remise à sa clientèle, tout en faisant de meilleures affaires. Pour vous en convaincre, vous n’avez qu’à comparer ce que gagnent, par chapeau, un chapelier de Paris et un chapelier de village. Voilà donc un exemple bien connu d’un cas où, quand la prospérité publique se développe, le vendeur s’enrichit toujours et l’acheteur aussi.
Or, je dis que ce n’est pas seulement la loi générale des profits, mais encore la loi générale des Capitaux et des Intérêts comme je l’ai prouvé à M. Proudhon, et la loi générale de la Rente foncière, comme je le prouverais, si je n’étais exténué.
Oui, quand la France prospère, il s’ensuit une hausse générale de la Rente foncière, et « le riche devient toujours plus riche. » Jusque-là Ricardo a raison. Mais il ne s’ensuit pas que chaque produit agricole soit grevé au préjudice des travailleurs ; il ne s’ensuit pas que chaque travailleur soit réduit à donner une plus forte proportion de son travail pour un hectolitre de blé ; il ne s’ensuit pas, enfin, que « le pauvre devienne toujours plus pauvre. » C’est justement le contraire qui est vrai. À mesure que la rente augmente, par l’effet naturel de la prospérité publique, elle grève de moins en moins des produits plus abondants, absolument comme le chapelier ménage d’autant plus sa clientèle, qu’il est dans un milieu plus favorable au débit.
Croyez-moi, mes chers collègues, n’excitons pas légèrement le Journal des Économistes à repousser ces explications.
Enfin, le troisième et peut-être le plus grand tort, scientifiquement, de la théorie Ricardienne, c’est qu’elle est démentie par tous les faits particuliers et généraux qui se produisent sur le globe. Selon cette théorie, nous aurions dû voir, depuis un siècle, les richesses mobilières, industrielles et commerciales entraînées vers un déclin rapide et fatal, relativement aux fortunes foncières. Nous devrions constater la barbarie, l’obscurité et la malpropreté des villes, la difficulté des moyens de locomotion nous envahissant. En outre, les marchands, les artisans, les ouvriers étant réduits à donner une proportion toujours croissante de leur travail pour obtenir une quantité donnée de blé, nous devrions voir l’usage du blé diminuer, ou du moins nul ne pouvant se permettre la même consommation de pain, sans se refuser d’autres jouissances. — Je vous le demande, mes chers collègues, le monde civilisé présente-t-il rien de semblable ?
Et puis, quelle mission donnerez-vous au journal ? Ira-t-il dire aux propriétaires : « Vous êtes riches, c’est que vous jouissez d’un monopole injuste mais nécessaire ; et puisqu’il est nécessaire, jouissez-en sans scrupule, d’autant qu’il vous réserve des richesses toujours croissantes ! » — Puis vous tournant vers les travailleurs de toutes classes : « Vous êtes pauvres ; vos enfants le seront plus que vous, et vos petits-enfants davantage encore, jusqu’à ce que s’ensuive la mort par inanition. Cela tient à ce que vous subissez un monopole injuste, mais nécessaire ; et puisqu’il est nécessaire, résignez-vous sagement ; que la richesse toujours croissante des riches vous console ! »
Certes, je ne demande pas que qui que ce soit adopte mes idées sans examen ; mais je crois que le Journal des Économistes ferait mieux de mettre la question à l’étude que de se prononcer d’ores et déjà. Oh ! ne croyons pas facilement que Ricardo, Say, Malthus, Rossi, que de si grands et solides esprits se sont trompés. Mais n’admettons pas non plus légèrement une théorie qui aboutit à de telles monstruosités.
Articles and Essays↩
Les trois conseils [c. 1850]↩
BWV
1850.?? “Les trois conseils” (The Three Pieces of Advice) [early 1850] [published posthumously by Molinari in L’Économiste belge, 3 June 1860] [OC7.82, p. 361] [CW1]
Source
Ébauche publiée par l’Économiste belge, n° du 3 juin 1860.
Les trois conseils [210]
« Quand la patrie est en danger, chacun lui doit le tribut de ce qu’il peut avoir acquis de lumière et d’expérience. »
C’est ainsi que débute tout donneur d’avis. L’impôt du conseil ! En est-il de plus abondant et de plus volontaire ?
Je veux aussi payer cet impôt, ainsi que tous les autres, afin de n’être en reste, sous aucun rapport, envers mon pays.
Quoique les millions et les millions de conseils qu’il reçoit diffèrent entre eux, ils ont cependant un point de ressemblance. Tous ont la prétention de sauver la société ; et ceux qui les donnent se bornent à dire : voici mon système, les choses iraient merveilleusement si tout le monde voulait penser comme moi. Cela revient à ceci : si nous étions d’accord, nous nous accorderions.
Mettons-nous tous en phalanstère, dit l’un, et toutes nos disputes cesseront. — C’est fort bien ; mais les 9999/10000 des Français ont horreur du phalanstère. — Organisons, d’un consentement unanime, l’atelier social, dit l’autre, et la société marchera comme sur des roulettes. — Sans doute ; mais ceux à qui on s’adresse aimeraient autant le bagne. — Inclinons-nous tous devant la Constitution, s’écrie un troisième ; fût-elle mauvaise, si chacun l’exécute, elle sera bonne. — Rien n’est plus vrai, et je crois que c’est le plus sage et le plus plausible. Mais comment y amener ceux qui, détestant la Constitution, s’y soumettent quand l’anarchie les menace, et la menacent dès que l’ordre leur donne du cœur ?
Il y en a qui disent : Le mal provient de ce que toute foi est éteinte. Soyons bons catholiques, et les plaies sociales seront cicatrisées. — Vous parlez ainsi parce que vous êtes catholique vous-même… et encore. Mais comment faire pour que ceux qui ne le sont pas le soient ?
D’autres, selon leurs prédilections, vous répètent : « Unissons-nous tous à la république ! » — « Rallions-nous tous à la monarchie ! » — « Remontons d’un commun accord vers le passé ! » — « Elançons-nous avec courage vers l’avenir ! »
Enfin chacun consulte son opinion personnelle, rien de plus naturel, — et proclame que le monde est sauvé si elle prévaut, — rien de plus sûr.
Mais aucune ne prévaut ni ne peut prévaloir, car tous ces efforts se neutralisent et chacun reste ce qu’il est.
Parmi ces myriades de doctrines, il en est une seule, — je n’ai pas besoin de dire que c’est la mienne, — qui aurait le droit de réunir l’assentiment commun. Pourquoi aurait-elle seule ce privilége ? Parce que c’est la doctrine de la Liberté, parce qu’elle est tolérante et juste pour toutes les autres. Fondez un phalanstère, si cela vous plaît ; — réunissez-vous en atelier social, si tel est votre bon plaisir ; discutez la Constitution tant qu’il vous plaira ; manifestez ouvertement vos préférences pour la république ou la monarchie ; allez à confesse, si le cœur vous y porte ; en un mot, usez de tous les droits de l’individu : pourvu que vous respectiez ces mêmes droits en autrui, je me tiens pour satisfait ; et, telle est ma conviction, la société, pour être juste, ordonnée et progressive, n’a pas autre chose à vous demander.
Mais je n’ai pas la prétention aujourd’hui de développer ce système, qui devrait, ce me semble, être aussitôt adopté qu’exposé. Est-il rien de plus raisonnable ? Nous ne pouvons nous accorder sur les doctrines : eh bien ! conservons, propageons chacun la nôtre, et convenons de bannir d’entre nous toute oppression, toute violence.
Me plaçant au point de vue des faits tels qu’ils sont, de la situation telle que les événements l’ont faite, supposant, comme je le dois, que je m’adresse à des personnes qui, avant tout, veulent le repos et le bonheur de la France, je voudrais donner trois conseils pratiques, — l’un à M. le président de la République, l’autre à la majorité delà Chambre, le troisième à la minorité.
——
Je voudrais que M. le président de la République se présentât solennellement devant l’Assemblée nationale et y fît l’allocution suivante :
Citoyens représentants,
Le plus grand fléau de ce temps et de notre pays, c’est l’incertitude de l’avenir. En tant que cette incertitude peut se rattacher à mes projets et à mes vues, mon devoir est de la faire cesser ; c’est aussi ma volonté.
On se demande : Qu’arrivera-t-il dans deux ans ? À la face de mon pays, sous l’œil de Dieu, par le nom que je porte, je jure que le … mai 1852, je descendrai du fauteuil de la présidence.
J’ai reçu du peuple un mandat en vertu de la Constitution. Je remettrai au peuple ce mandat conformément a la Constitution.
Il y en a qui disent : Mais si le peuple vous renomme ? À quoi je réponds : Le peuple ne me fera pas l’injure de me renommer malgré moi ; et si quelques citoyens oublient à ce point leurs devoirs, je tiens d’avance pour nuls et non avenus les bulletins qui, aux prochaines élections, porteraient mon nom.
D’autres, se croyant beaucoup plus sages, pensent qu’on peut prolonger ma présidence en modifiant la Constitution d’après les formes qu’elle a elle-même établies.
Il ne m’appartient pas d’imposer des limites à l’exercice légal des droits de l’Assemblée. Mais, si elle est maîtresse de ses résolutions régulières, je suis maître des miennes ; et je déclare formellement que, la Constitution fût-elle modifiée, ma première présidence ne sera pas immédiatement suivie d’une seconde.
J’y ai réfléchi, et voici sur quoi je me fonde :
Notre règle d’action est contenue dans ces mots : La France avant tout. De quoi souffre la France ? De l’incertitude. S’il en est ainsi, citoyens, est-ce le moyen de faire cesser l’incertitude que de remettre tout en question ? Quoi ! la Constitution n’a qu’un an d’existence, et déjà vous jetteriez au milieu de vous cette question brûlante : Faut-il faire une autre Constitution ? Si votre réponse est négative, les passions du dehors en seront-elles calmées ? — Si elle est affirmative, il faudra donc convoquer une nouvelle Constituante, remuer de nouveau tous les fondements de notre existence nationale, nous élancer vers un autre inconnu, et procéder, dans quelques mois, à trois élections générales.
Ce parti extrême me semble le comble de l’imprudence. Je n’ai pas le droit de m’y opposer autrement qu’en déclarant de la manière la plus expresse qu’il n’avancerait en rien mes partisans ; car, je le répète, je n’accepterai pas la présidence, sous quelque forme et de quelque manière qu’elle m’arrive.
Telle est ma première résolution. Je l’ai prise par devoir ; je la proclame avec joie, parce qu’elle peut contribuer au repos de notre patrie. Je serai assez récompensé si elle me donne pour successeur un républicain honnête, qui n’apporte à la première fonction de l’Etat, ni rancune, ni utopie, ni engagement envers les partis.
J’ai maintenant une seconde résolution à vous communiquer. Par la volonté du peuple, je dois exercer le pouvoir exécutif pendant deux ans encore.
Je comprends le sens de ce mot pouvoir exécutifs et je suis résolu à m’y renfermer d’une manière absolue.
La nation adonné deux délégations. À ses représentants, elle a conféré le droit de faire des lois. À moi, elle m’a confié la mission de les faire exécuter.
Représentants, faites les lois que vous croirez les meilleures, les plus justes, les plus utiles au pays. Quelles qu’elles soient, je les exécuterai à la lettre.
Si elles sont bonnes, leur exécution le prouvera ; si elles sont mauvaises, l’exécution en révélera les défauts, et vous les réformerez. Je n’ai pas le droit et je n’accepte pas la responsabilité de les juger.
Tout ceci, sous la réserve de la faculté qui m’est attribuée par l’article ... de la Constitution.
J’exécuterai donc vos décrets sans distinction. Il en est cependant auxquels je me crois tenu, par le vœu national, de donner une attention toute spéciale. Ce sont ceux qui concernent la répression des délits et des crimes, l’ordre dans les rues, le respect dû aux personnes et aux propriétés, prenant ce mot propriété dans l’acception la plus large, qui comprend aussi bien le libre exercice des facultés et des bras que la paisible jouissance de la richesse acquise.
Ainsi, représentants, faites des lois. Que les citoyens discutent toutes les questions politiques et sociales dans leurs réunions et dans leurs journaux. Mais que nul ne trouble l’ordre de la cité, la paix des familles, la sécurité de l’industrie. Au premier signal de révolte ou d’émeute, je serai là. J’y serai avec tous les bons citoyens, avec les vrais républicains ; j’y serai avec la brave garde nationale, j’y serai avec notre admirable armée.
Il y en a qui disent : Peut-on compter sur le zèle de la garde nationale, sur la fidélité de l’armée ?
Oui, dans la ligne que je viens de tracer, on peut y compter. J’y compte comme sur moi-même, et nul n’a le droit de faire à notre force armée l’injure de croire qu’elle prendrait parti pour les perturbateurs du repos public.
Je veux, — j’ai le droit de vouloir, puisque le peuple m’a donné cette mission expresse, et que ma volonté en ceci c’est la sienne, — je veux que l’ordre et la sécurité soient partout respectés. Je le veux, et cela sera. Je suis entouré de soldats fidèles, d’officiers éprouvés ; j’ai pour moi la force, le droit, le bon sens public ; et si je ne craignais de blesser par l’apparence d’un doute les justes susceptibilités de ceux dont le concours m’est assuré, je dirais que les défections même ne me feraient pas fléchir. L’ordre légal régnera, dussé-je y laisser la présidence et la vie.
Telle est, citoyens, ma seconde résolution. Voici la troisième.
Je me demande quelle est la cause de ces luttes incessantes et passionnées entre la Nation et le Gouvernement qu’elle-même s’est donné.
Il faut peut-être l’attribuer à des habitudes invétérées d’opposition. Combattre le pouvoir, c’est se donner un rôle qu’on croit héroïque, parce qu’en effet cela a pu être glorieux et dangereux autrefois. À cela je ne sais d’autre remède que le temps.
Mais, comme ces luttes perpétuelles, le langage haineux et exagéré qu’elles suscitent, sont un des grands fléaux de notre République, j’ai dû rechercher si elles n’avaient pas d’autres causes que des traditions irrationnelles, afin de faire cesser celles de ces causes sur lesquelles je puis avoir quelque action.
Je crois sincèrement que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif mêlent et confondent trop leurs rôles.
Je suis résolu à me renfermer dans le mien, qui est de faire exécuter les lois quand vous les aurez votées. De la sorte, aux yeux même des plus susceptibles, je n’aurai qu’une responsabilité restreinte. Si la nation est mal gouvernée, pourvu que j’exécute les lois, elle ne pourra pas s’en prendre à moi. Le gouvernement et moi nous serons hors de cause dans les débats de la tribune et de la presse.
Je prendrai mes ministres hors de l’Assemblée. Par là s’accomplira une séparation logique entre les deux pouvoirs. Par là avorteront au sein de la Chambre les coalitions et les guerres de portefeuilles, si funestes au pays.
Mes ministres seront mes agents directs. Ils ne se rendront à l’Assemblée que lorsqu’ils y seront appelés, pour répondre à des questions posées d’avance par la voie de messages réguliers.
Ainsi vous serez parfaitement libres et dans des conditions parfaites d’impartialité pour la confection des lois. Mon gouvernement n’exercera sur vous, à cet égard, aucune influence. De votre côté, vous n’en aurez aucune sur l’exécution. Le contrôle vous appartient sans doute, mais l’exécution proprement dite est à moi.
Et alors, citoyens, est-il possible de concevoir une collision ? Est-ce que vous n’aurez pas le plus grand intérêt à ce qu’il ne sorte de vos délibérations que de bonnes lois ? Est-ce que je pourrais en avoir un autre que leur bonne exécution ?
Dans deux ans, la nation sera appelée à nommer un autre président. Son choix, saus doute, se portera sur le plus digne, et nous n’aurons à redouter de lui aucun attentat contre la liberté et les lois. En tout cas, j’aurai la satisfaction de lui léguer des précédents qui l’enchaîneront. Quand la présidence ne se sera pas fixée sur le nom de Napoléon, sur l’élu de sept millions de suffrages, est-il quelqu’un en France qui puisse rêver pour lui-même un coup d’État et aspirer à l’empire ?
Bannissons donc de vaines terreurs. Nous traverserons, sans danger, une première, une seconde, une troisième présidence…
Baccalauréat et socialisme [early 1850]↩
BWV
1850.?? “Baccalaureate et socialisme” (Baccalaureate and Socialism) [early 1850] [OC4.8, p. 442] [CW2]
Source
OC vol. 4 Sophismes économiques — Petits pamphlets, I (1863 ed.): <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_4.djvu>.
Citoyens représentants,
J’ai soumis à l’Assemblée un amendement qui a pour objet la suppression des grades universitaires. Ma santé ne me permet pas de le développer à la tribune. Permettez-moi d’avoir recours à la plume [1].
La question est extrêmement grave. Quelque défectueuse que soit la loi qui a été élaborée par votre commission, je crois qu’elle marquerait un progrès signalé sur l’état actuel de l’instruction publique, si elle était amendée ainsi que je le propose.
Les grades universitaires ont le triple inconvénient d’uniformiser l’enseignement (l’uniformité n’est pas l’unité) et de l’immobiliser après lui avoir imprimé la direction la plus funeste.
S’il y a quelque chose au monde qui soit progressif par nature, c’est l’enseignement. Qu’est-ce, en effet, sinon la transmission, de génération en génération, des connaissances acquises par la société, c’est-à-dire d’un trésor qui s’épure et s’accroît tous les jours ?
Comment est-il arrivé que l’enseignement, en France, soit demeuré uniforme et stationnaire, à partir des ténèbres du moyen âge ? Parce qu’il a été monopolisé et renfermé, par les grades universitaires, dans un cercle infranchissable.
Il fut un temps où, pour arriver à quelque connaissance que ce soit, il était aussi nécessaire d’apprendre le latin et le grec, qu’il était indispensable aux Basques et aux Bas-Bretons de commencer par apprendre le français. Les langues vivantes n’étaient pas fixées ; l’imprimerie n’avait pas été découverte ; l’esprit humain ne s’était pas appliqué à pénétrer les secrets de la nature. Être instruit, c’était savoir ce qu’avaient pensé Épicure et Aristote. Dans les rangs élevés on se vantait de ne savoir pas lire. Une seule classe possédait et communiquait l’instruction, celle des Clercs. Quelle pouvait être alors cette instruction ? Évidemment, elle devait être bornée à la connaissance des langues mortes, et principalement du latin. Il n’y avait que des livres latins ; on n’écrivait qu’en latin ; le latin était la langue de la religion ; les Clercs ne pouvaient enseigner que ce qu’ils avaient appris, le latin.
On comprend donc qu’au moyen âge l’enseignement fût circonscrit à l’étude des langues mortes, fort improprement dites savantes.
Est-il naturel, est-il bon qu’il en soit ainsi au dix-neuvième siècle ? Le latin est-il un instrument nécessaire à l’acquisition des connaissances ? Est-ce dans les écrits que nous ont laissés les Romains qu’on peut apprendre la religion, la physique, la chimie, l’astronomie, la physiologie, l’histoire, le droit, la morale, la technologie industrielle, ou la science sociale ?
Savoir une langue, comme savoir lire, c’est posséder un instrument. Et n’est-il pas étrange que nous passions toute notre jeunesse à nous rendre maîtres d’un instrument qui n’est plus bon à rien, — ou pas à grand’chose, puisqu’on n’a rien de plus pressé, quand on commence à le savoir, que de l’oublier ? — Hélas ! que ne peut-on oublier aussi vite les impressions que laisse cette funeste étude !
Que dirions-nous si, à Saint-Cyr, pour préparer la jeunesse aux sciences militaires modernes, on lui enseignait exclusivement à lancer des pierres avec la fronde ?
La loi de notre pays décide que les carrières les plus honorables seront fermées à quiconque n’est pas Bachelier. Elle décide, en outre, que pour être bachelier il faut avoir bourré sa tête de latinité, au point de n’y pas laisser entrer autre chose. Or, qu’arrive-t-il, de l’aveu de tout le monde ? C’est que les jeunes gens ont calculé la juste mesure rigoureusement nécessaire pour atteindre le grade, et ils s’en tiennent là. Vous vous récriez, vous gémissez. Eh ! ne comprenez-vous pas que c’est le cri de la conscience publique qui ne veut pas se laisser imposer un effort inutile ?
Enseigner un instrument qui, dès qu’on le sait, ne rend plus aucun son, c’est une anomalie bien bizarre ! Comment s’est-elle perpétuée jusqu’à nos jours ? L’explication est dans ce seul mot : Monopole. Le monopole est ainsi fait qu’il frappe d’immobilisme tout ce qu’il touche.
Aussi, j’aurais désiré que l’Assemblée législative réalisât la liberté, c’est-à-dire le progrès de l’enseignement. Il est maintenant décidé qu’il n’en sera pas ainsi. Nous n’aurons pas la liberté complète. Qu’il me soit permis de tenter un effort pour en sauver un lambeau.
La liberté peut être considérée au point de vue des personnes et relativement aux matières — ratione personæ et ratione materiæ, comme disent les légistes ; car supprimer la concurrence des méthodes, ce n’est pas un moindre attentat à la liberté que de supprimer la concurrence des hommes.
Il y en a qui disent : « La carrière de l’enseignement va être libre, car chacun y pourra entrer. » C’est une grande illusion.
L’État, ou pour mieux dire le parti, la faction, la secte, l’homme qui s’empare momentanément, et même très-légalement, de l’influence gouvernementale, peut donner à l’enseignement la direction qui lui plaît, et façonner à son gré toutes les intelligences par le seul mécanisme des grades.
Donnez à un homme la collation des grades, et, tout en vous laissant libres d’enseigner, l’enseignement sera, de fait, dans la servitude.
Moi, père de famille, et le professeur avec lequel je me concerte pour l’éducation de mon fils, nous pouvons croire que la véritable instruction consiste à savoir ce que les choses sont et ce qu’elles produisent, tant dans l’ordre physique que dans l’ordre moral. Nous pouvons penser que celui-là est le mieux instruit qui se fait l’idée la plus exacte des phénomènes et sait le mieux l’enchaînement des effets aux causes. Nous voudrions baser l’enseignement sur cette donnée. — Mais l’État a une autre idée. Il pense qu’être savant c’est être en mesure de scander les vers de Plaute, et de citer, sur le feu et sur l’air, les opinions de Thalès et de Pythagore.
Or que fait l’État ? Il nous dit : Enseignez ce que vous voudrez à votre élève ; mais quand il aura vingt ans, je le ferai interroger sur les opinions de Pythagore et de Thalès, je lui ferai scander les vers de Plaute, et, s’il n’est assez fort en ces matières pour me prouver qu’il y a consacré toute sa jeunesse, il ne pourra être ni médecin, ni avocat, ni magistrat, ni consul, ni diplomate, ni professeur.
Dès lors, je suis bien forcé de me soumettre, car je ne prendrai pas sur moi la responsabilité de fermer à mon fils tant de si belles carrières. Vous aurez beau me dire que je suis libre ; j’affirme que je ne le suis pas, puisque vous me réduisez à faire de mon fils, du moins à mon point de vue, un pédant, — peut être un affreux petit rhéteur, — et, à coup sûr, un turbulent factieux.
Car si encore les connaissances exigées par le Baccalauréat avaient quelques rapports avec les besoins et les intérêts de notre époque ! si du moins elles n’étaient qu’inutiles ! mais elles sont déplorablement funestes. Fausser l’esprit humain, c’est le problème que semblent s’être posé et qu’ont résolu les corps auxquels a été livré le monopole de l’enseignement. C’est ce que je vais essayer de démontrer.
Depuis le commencement de ce débat, l’Université et le Clergé se renvoient les accusations comme des balles. Vous pervertissez la jeunesse avec votre rationalisme philosophique, dit le Clergé ; vous l’abrutissez avec votre dogmatisme religieux, répond l’Université.
Surviennent les conciliateurs qui disent : La religion et la philosophie sont sœurs. Fusionnons le libre examen et l’autorité. Université, Clergé, vous avez eu tour à tour le monopole ; partagez-le, et que ça finisse.
Nous avons entendu le vénérable évêque de Langres apostropher ainsi l’Université : « C’est vous qui nous avez donné la génération socialiste de 1848. »
Et M. Crémieux s’est hâté de rétorquer l’apostrophe en ces termes : « C’est vous qui avez élevé la génération révolutionnaire de 1793. »
S’il y a du vrai dans ces allégations, que faut-il en conclure ? Que les deux enseignements ont été funestes, non par ce qui les différencie, mais par ce qui leur est commun.
Oui, c’est ma conviction : il y a entre ces deux enseignements un point commun, c’est l’abus des études classiques, et c’est par là que tous deux ont perverti le jugement et la moralité du pays. Ils diffèrent en ce que l’un fait prédominer l’élément religieux, l’autre l’élément philosophique ; mais ces éléments, loin d’avoir fait le mal, comme on se le reproche, l’ont atténué. Nous leur devons de n’être pas aussi barbares que les barbares sans cesse proposés, par le latinisme, à notre imitation.
Qu’on me permette une supposition un peu forcée, mais qui fera comprendre ma pensée.
Je suppose donc qu’il existe quelque part, aux antipodes, une nation qui, haïssant et méprisant le travail, ait fondé tous ses moyens d’existence sur le pillage successif de tous les peuples voisins et sur l’esclavage. Cette nation s’est fait une politique, une morale, une religion, une opinion publique conformes au principe brutal qui la conserve et la développe. La France ayant donné au Clergé le monopole de l’éducation, celui-ci ne trouve rien de mieux à faire que d’envoyer toute la jeunesse française chez ce peuple, vivre de sa vie, s’inspirer de ses sentiments, s’enthousiasmer de ses enthousiasmes, et respirer ses idées comme l’air. Seulement il a soin que chaque écolier parte muni d’un petit volume appelé : l’Évangile. Les générations ainsi élevées reviennent sur le sol de la patrie ; une révolution éclate : je laisse à penser le rôle qu’elles y jouent.
Ce que voyant, l’État arrache au Clergé le monopole de l’enseignement et le remet à l’Université. L’Université, fidèle aux traditions, envoie, elle aussi, la jeunesse aux antipodes, chez le peuple pillard et possesseur d’esclaves, après l’avoir toutefois approvisionnée d’un petit volume intitulé : Philosophie. Cinq ou six générations ainsi élevées ont à peine revu le sol natal qu’une seconde révolution vient à éclater. Formées à la même école que leurs devancières, elles s’en montrent les dignes émules.
Alors vient la guerre entre les monopoleurs. C’est votre petit livre qui a fait tout le mal, dit le Clergé. C’est le vôtre, répond l’Université.
Eh non, Messieurs, vos petits livres ne sont pour rien en tout ceci. Ce qui a fait le mal, c’est l’idée bizarre, par vous deux conçue et exécutée, d’envoyer la jeunesse française, destinée au travail, à la paix, à la liberté, s’imprégner, s’imbiber et se saturer des sentiments et des opinions d’un peuple de brigands et d’esclaves.
J’affirme ceci : Les doctrines subversives auxquelles on a donné le nom de socialisme ou communisme sont le fruit de l’enseignement classique, qu’il soit distribué par le Clergé ou par l’Université. J’ajoute que le Baccalauréat imposera de force l’enseignement classique même à ces écoles prétendues libres qui doivent, dit-on, surgir de la loi. C’est pour cela que je demande la suppression des grades.
On vante beaucoup l’étude du latin comme moyen de développer l’intelligence ; c’est du pur conventionalisme. Les Grecs, qui n’apprenaient pas le latin, ne manquaient pas d’intelligence, et nous ne voyons pas que les femmes françaises en soient dépourvues, non plus que de bon sens. Il serait étrange que l’esprit humain ne pût se renforcer qu’en se faussant ; et ne comprendra-t-on jamais que l’avantage très-problématique qu’on allègue, s’il existe, est bien chèrement acheté par le redoutable inconvénient de faire pénétrer dans l’âme de la France, avec la langue des Romains, leurs idées, leurs sentiments, leurs opinions et la caricature de leurs mœurs ?
Depuis que Dieu a prononcé sur les hommes cet arrêt : Vous mangerez votre pain à la sueur de votre front, — l’existence est pour eux une si grande, si absorbante affaire que, selon les moyens qu’ils prennent pour y pourvoir, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs opinions, leur morale, leurs arrangements sociaux doivent présenter de grandes différences.
Un peuple qui vit de chasse ne peut ressembler à un peuple qui vit de pêche, ni une nation de pasteurs à une nation de marins.
Mais ces différences ne sont encore rien en comparaison de celle qui doit caractériser deux peuples dont l’un vit de travail et l’autre de vol.
Car entre chasseurs, pêcheurs, pasteurs, laboureurs, commerçants, fabricants, il y a ceci de commun, que tous cherchent la satisfaction de leurs besoins dans l’action qu’ils exercent sur les choses. Ce qu’ils veulent soumettre à leur empire, c’est la nature.
Mais les hommes qui fondent leurs moyens d’existence sur le pillage exercent leur action sur d’autres hommes ; ce qu’ils aspirent ardemment à dominer, ce sont leurs semblables.
Pour que les hommes existent, il faut nécessairement que cette action sur la nature, qu’on nomme travail, soit exercée.
Il se peut que les fruits de cette action profitent à la nation qui s’y livre ; il est possible aussi qu’ils arrivent de seconde main, et par force, à un autre peuple superposé sur le peuple travailleur.
Je ne puis développer ici toute cette pensée ; mais qu’on veuille bien y réfléchir, et l’on restera convaincu qu’entre deux agglomérations d’hommes placées dans des conditions si opposées tout doit différer, mœurs, coutumes, jugements, organisation, morale, religion ; et à ce point que les mots mêmes destinés à exprimer les relations les plus fondamentales, comme les mots famille, propriété, liberté, vertu, société, gouvernement, république, peuple, ne peuvent représenter, chez l’une et chez l’autre, les mêmes idées.
Un peuple de guerrier comprend bientôt que la Famille peut affaiblir le dévouement militaire (nous le sentons nous-mêmes, puisque nous l’interdisons à nos soldats) ; cependant, il ne faut pas que la population s’arrête. Comment résoudre le problème ? Comme firent Platon en théorie et et Lycurgue en pratique : par la promiscuité. Platon, Lycurgue, voilà pourtant des noms qu’on nous habitue à ne prononcer qu’avec idolâtrie.
Pour ce qui est de la Propriété, je défie qu’on en trouve dans toute l’antiquité une définition passable. Nous disons, nous : l’homme est propriétaire de lui-même, par conséquent de ses facultés, et, par suite, du produit de ses facultés. Mais les Romains pouvaient-ils concevoir une telle notion ? Possesseurs d’esclaves, pouvaient-ils dire : l’homme s’appartient ? Méprisant le travail, pouvaient-ils dire : l’homme est propriétaire du produit de ses facultés ? C’eût été ériger en système le suicide collectif.
Sur quoi donc l’antiquité faisait-elle reposer la propriété ? Sur la loi, — idée funeste, la plus funeste qui se soit jamais introduite dans le monde, puisqu’elle justifie l’usage et l’abus de tout ce qu’il plaît à la loi de déclarer propriété, même des fruits du vol, même de l’homme.
Dans ces temps de barbarie, la Liberté ne pouvait être mieux comprise. Qu’est-ce que la Liberté ? C’est l’ensemble des libertés. Être libre, sous sa responsabilité, de penser et d’agir, de parler et d’écrire, de travailler et d’échanger, d’enseigner et d’apprendre, cela seul est être libre. Une nation disciplinée en vue d’une bataille sans fin peut-elle ainsi concevoir la Liberté ? Non, les Romains prostituaient ce nom à une certaine audace dans les luttes intestines que suscitait entre eux le partage du butin. Les chefs voulaient tout ; le peuple exigeait sa part. De là les orages du Forum, les retraites au mont Aventin, les lois agraires, l’intervention des tribuns, la popularité des conspirateurs ; de là cette maxime : Malo periculosam libertatem, etc., passée dans notre langue, et dont j’enrichissais, au collége, tous mes livres de classe :
Ô liberté ! que tes orages
Ont de charme pour les grands cœurs ! Beaux exemples, sublimes préceptes, précieuses semences à déposer dans l’âme de la jeunesse française !
Que dire de la morale romaine ? Et je ne parle pas ici des rapports de père à fils, d’époux à épouse, de patron à client, de maître à serviteur, d’homme à Dieu, rapports que l’esclavage, à lui tout seul, ne pouvait manquer de transformer en un tissu de turpitudes ; je veux ne m’arrêter qu’à ce qu’on nomme le beau côté de la république, le patriotisme. Qu’est-ce que ce patriotisme ? la haine de l’étranger. Détruire toute civilisation, étouffer tout progrès, promener sur le monde la torche et l’épée, enchaîner des femmes, des enfants, des vieillards aux chars de triomphe, c’était là la gloire, c’était là la vertu. C’est à ces atrocités qu’étaient réservés le marbre des statuaires et le chant des poëtes. Combien de fois nos jeunes cœurs n’ont-ils pas palpité d’admiration, hélas ! et d’émulation à ce spectacle ! C’est ainsi que nos professeurs, prêtres vénérables, pleins de jours et de charité, nous préparaient à la vie chrétienne et civilisée, tant est grande la puissance du conventionalisme !
La leçon n’a pas été perdue ; et c’est de Rome sans doute que nous vient cette sentence vraie du vol, fausse du travail : Un peuple perd ce qu’un autre gagne, sentence qui gouverne encore le monde.
Pour nous faire une idée de la morale romaine, imaginons, au milieu de Paris, une association d’hommes haïssant le travail, décidés à se procurer des jouissances par la ruse et la force, par conséquent en guerre avec la société.
Il ne faut pas douter qu’il ne se formât bientôt au sein de cette association une certaine morale et même de fortes vertus. Courage, persévérance, dissimulation, prudence, discipline, constance dans le malheur, secret profond, point d’honneur, dévouement à la communauté, telles seront sans doute les vertus que la nécessité et l’opinion développeraient parmi ces brigands ; telles furent celles des flibustiers ; telles furent celles des Romains. On dira que, quant à ceux-ci, la grandeur de leur entreprise et l’immensité du succès a jeté sur leurs crimes un voile assez glorieux pour les transformer en vertus. — Et c’est pour cela que cette école est si pernicieuse. Ce n’est pas le vice abject, c’est le vice couronné de splendeur qui séduit les âmes.
Enfin, relativement à la société, le monde ancien a légué au nouveau deux fausses notions qui l’ébranlent et l’ébranleront longtemps encore.
L’une : Que la société est un état hors de nature, né d’un contrat. Cette idée n’était pas aussi erronée autrefois qu’elle l’est de nos jours. Rome, Sparte, c’était bien deux associations d’hommes ayant un but commun et déterminé : le pillage ; ce n’était pas précisément des sociétés, mais des armées.
L’autre, corollaire de la précédente : Que la loi créé les droits, et que, par suite, le législateur et l’humanité sont entre eux dans les mêmes rapports que le potier et l’argile. Minos, Lycurgue, Solon, Numa avaient fabriqué les sociétés crétoise, lacédémonienne, athénienne, romaine. Platon était fabriquant de républiques imaginaires devant servir de modèles aux futurs instituteurs des peuples et pères des nations.
Or, remarquez-le bien, ces deux idées forment le caractère spécial, le cachet distinctif du socialisme, en prenant ce mot dans le sens défavorable et comme la commune étiquette de toutes les utopies sociales.
Quiconque, ignorant que le corps social est un ensemble de lois naturelles, comme le corps humain, rêve de créer une société artificielle, et se prend à manipuler à son gré la famille, la propriété, le droit, l’humanité, est socialiste. Il ne fait pas de la physiologie, il fait de la statuaire ; il n’observe pas, il invente ; il ne croit pas en Dieu, il croit en lui-même ; il n’est pas savant, il est tyran ; il ne sert pas les hommes, il en dispose ; il n’étudie pas leur nature, il la change, suivant le conseil de Rousseau [2]. Il s’inspire de l’antiquité ; il procède de Lycurgue et de Platon. — Et pour tout dire, à coup sûr, il est bachelier.
Vous exagérez, me dira-t-on, il n’est pas possible que notre studieuse jeunesse puise, dans la belle antiquité, des opinions et des sentiments si déplorables.
Et que voulez-vous qu’elle y puise que ce qui y est ? Faites un effort de mémoire et rappelez-vous dans quelle disposition d’esprit, au sortir du collége, vous êtes entré dans le monde. Est-ce que vous ne brûliez pas du désir d’imiter les ravageurs de la terre et les agitateurs du Forum ? Pour moi, quand je vois la société actuelle jeter les jeunes gens, par dizaines de mille, dans le moule des Brutus et des Gracques, pour les lancer ensuite, incapables de tout travail honnête (opus servile), dans la presse et dans la rue, je m’étonne qu’elle résiste à cette épreuve. Car l’enseignement classique n’a pas seulement l’imprudence de nous plonger dans la vie romaine. Il nous y plonge en nous habituant à nous passionner pour elle, à la considérer comme le beau idéal de l’humanité, type sublime, trop haut placé pour les âmes modernes, mais que nous devons nous efforcer d’imiter sans jamais prétendre à l’atteindre [3].
Objectera-t-on que le Socialisme a envahi les classes qui n’aspirent pas au Baccalauréat ?
Je répondrai avec M. Thiers :
« L’enseignement secondaire apprend aux enfants des classes aisées les langues anciennes… Ce ne sont pas seulement des mots qu’on apprend aux enfants en leur apprenant le grec et le latin, ce sont de nobles et sublimes choses (la spoliation, la guerre et l’esclavage), c’est l’histoire de l’humanité sous des images simples, grandes, ineffaçables… L’instruction secondaire forme ce qu’on appelle les classes éclairées d’une nation. Or, si les classes éclairées ne sont pas la nation tout entière, elles la caractérisent. Leurs vices, leurs qualités, leurs penchants bons et mauvais sont bientôt ceux de la nation tout entière, elles font le peuple lui-même par la contagion de leurs idées et de leurs sentiments [4]. » (Très-bien.)
Rien n’est plus vrai, et rien n’explique mieux les déviations funestes et factices de nos révolutions.
« L’antiquité, ajoutait M. Thiers, osons le dire à un siècle orgueilleux de lui-même, l’antiquité est ce qu’il y a de plus beau au monde. Laissons, Messieurs, laissons l’enfance dans l’antiquité, comme dans un asile calme, paisible et sain, destiné à la conserver fraîche et pure. »
Le calme de Rome ! la paix de Rome ! la pureté de Rome ! oh ! si la longue expérience et le remarquable bon sens de M. Thiers n’ont pu le préserver d’un engouement si étrange, comment voulez-vous que notre ardente jeunesse s’en défende [5] ?
Ces jours-ci l’Assemblée nationale a assisté à un dialogue comique, digne assurément du pinceau de Molière.
M. Thiers, s’adressant du haut de la tribune, et sans rire, à M. Barthélemy Saint-Hilaire : « Vous avez tort, non pas sous le rapport de l’art, mais sous le rapport moral, de préférer pour des Français surtout, qui sont une nation latine, les lettres grecques aux latines. »
M. Barthélemy Saint-Hilaire, aussi sans rire : « Et Platon ! »
M. Thiers, toujours sans rire : « On a bien fait, on fait bien de soigner les études grecques et latines. Je préfère les latines dans un but moral. Mais on a voulu que ces pauvres jeunes gens sussent en même temps l’allemand, l’anglais, les sciences exactes, les sciences physiques, l’histoire, etc. »
Savoir ce qui est, voilà le mal. S’imprégner des mœurs romaines, voilà la moralité !
M. Thiers n’est ni le premier ni le seul qui ait succombé à cette illusion, j’ai presque dit à cette mystification. Qu’il me soit permis de signaler, en peu de mots, l’empreinte profonde (et quelle empreinte !) que l’enseignement classique a imprimée à la littérature, à la morale et à la politique de notre pays.
C’est un tableau que je n’ai ni le loisir ni la prétention d’achever, car quel écrivain ne devrait comparaître ? Contentons-nous d’une esquisse.
Je ne remonterai pas à Montaigne. Chacun sait qu’il était aussi Spartiate par ses velléités qu’il l’était peu par ses goûts.
Quant à Corneille, dont je suis l’admirateur sincère, je crois qu’il a rendu un triste service à l’esprit du siècle en revêtant de beaux vers, en donnant un cachet de grandeur sublime à des sentiments forcés, outrés, farouches, anti-sociaux, tels que ceux-ci :
Mais vouloir au public immoler ce qu’on aime,
S’attacher an combat contre un autre soi-même…
Une telle vertu n’appartenait qu’à nous…
Rome a choisi mon bras, je n’examine rien,
Avec une allégresse aussi pleine et sincère
Que j’épousai la sœur, je combattrai le frère.
Et j’avoue que je me sens disposé à partager le sentiment de Curiace, en en faisant l’application non à un fait particulier, mais à l’histoire de Rome tout entière, quand il dit :
Je rends grâces aux dieux de n’être pas Romain
Pour conserver encor quelque chose d’humain.
Fénelon. Aujourd’hui, le Communisme nous fait horreur, parce qu’il nous effraie ; mais la longue fréquentation des anciens n’avait-elle pas fait un communiste de Fénelon, de cet homme que l’Europe moderne regarde avec raison comme le plus beau type de la perfection morale ? Lisez son Télémaque, ce livre qu’on se hâte de mettre dans les mains de l’enfance ; vous y verrez Fénelon empruntant les traits de la Sagesse elle-même pour instruire les législateurs. Et sur quel plan organise-t-il sa société-modèle ? D’un côté, le législateur pense, invente, agit ; de l’autre, la société, impassible et inerte, se laisse faire. Le mobile moral, le principe d’action est ainsi arraché à tous les hommes pour être l’attribut d’un seul. Fénelon, précurseur de nos modernes organisateurs les plus hardis, décide de l’alimentation, du logement, du vêtement, des jeux, des occupations de tous les Salentins. Il dit ce qu’il leur sera permis de boire et de manger, sur quel plan leurs maisons devront être bâties, combien elles auront de chambres, comment elles seront meublées.
Il dit… mais je lui cède la parole.
« Mentor établit des magistrats à qui les marchands rendaient compte de leurs effets, de leurs profits, de leurs dépenses et de leurs entreprises… D’ailleurs, la liberté du commerce était entière… Il défendit toutes les marchandises de pays étrangers qui pouvaient introduire le luxe et la mollesse… Il retrancha un nombre prodigieux de marchands qui vendaient des étoffes façonnées, etc… Il régla les habits, la nourriture, les meubles, la grandeur et l’ornement des maisons pour toutes les conditions différentes.
Réglez les conditions par la naissance, disait-il au roi… ; les personnes du premier rang, après vous, seront vêtues de blanc… ; celles du second rang, de bleu… ; les troisièmes, de vert… ; les quatrièmes d’un jaune aurore… ; les cinquièmes, d’un rouge pâle ou rose… ; les sixièmes, d’un gris de lin… ; et les septièmes, qui seront les dernières du peuple, d’une couleur mêlée de jaune et de blanc. Voilà les habits de sept conditions différentes pour les hommes libres. Tous les esclaves seront vêtus de gris brun. On [6] ne souffrira jamais aucun changement, ni pour la nature des étoffes, ni pour la forme des habits.
Il régla de même la nourriture des citoyens et des esclaves.
Il retrancha ensuite la musique molle et efféminée.
Il donna des modèles d’une architecture simple et gracieuse. Il voulut que chaque maison un peu considérable eût un salon et un péristyle, avec de petites chambres pour toutes les personnes libres.
Au reste, la modération et la frugalité de Mentor n’empêchèrent pas qu’il n’autorisât tous les grands bâtiments destinés aux courses de chevaux et de chariots, aux combats de lutteurs et à ceux du ceste.
La peinture et la sculpture parurent à Mentor des arts qu’il n’est pas permis d’abandonner ; mais il voulut qu’on souffrît dans Salente peu d’hommes attachés à ces arts. »
Ne reconnaît-on pas là une imagination enflammée par la lecture de Platon et l’exemple de Lycurgue, s’amusant à faire ses expériences sur les hommes comme sur de la vile matière ?
Et qu’on ne justifie pas de telles chimères en disant qu’elles sont le fruit d’une excessive bienveillance. Autant il en est de tous les organisateurs et désorganisateurs de sociétés.
Rollin. Il est un autre homme, presque l’égal de Fénelon par l’intelligence et par le cœur, et qui, plus que Fénelon, s’est occupé d’éducation, c’est Rollin. Eh bien ! à quel degré d’abjection intellectuelle et morale la longue fréquentation de l’antiquité n’avait-elle pas réduit ce bonhomme Rollin ! On ne peut lire ses livres sans se sentir saisi de tristesse et de pitié. On ne sait s’il est chrétien ou païen, tant il se montre impartial entre Dieu et les dieux. Les miracles de la Bible et les légendes des temps héroïques trouvent en lui la même crédulité. Sur sa physionomie placide on voit toujours errer l’ombre des passions guerrières ; il ne parle que de javelots, d’épées et de catapultes. C’est pour lui, comme pour Bossuet, un des problèmes sociaux les plus intéressants, de savoir si la phalange macédonienne valait mieux que la légion romaine. Il exalte les Romains pour ne s’être adonnés qu’aux sciences qui ont pour objet la domination : l’éloquence, la politique, la guerre. À ses yeux, toutes les autres connaissances sont des sources de corruption, et ne sont propres qu’à incliner les hommes vers la paix ; aussi il les bannit soigneusement de ses colléges, aux applaudissements de M. Thiers. Tout son encens est pour Mars et Bellone ; à peine s’il en détourne quelques grains pour le Christ. Triste jouet du conventionalisme qu’a fait prédominer l’instruction classique, il est si décidé d’avance à admirer les Romains, que, en ce qui les concerne, la simple abstention des plus grands forfaits est mise par lui au niveau des plus hautes vertus. Alexandre, pour avoir regretté d’avoir assassiné son meilleur ami, Scipion, pour n’avoir pas enlevé une femme à son époux, font preuve, à ses yeux, d’un héroïsme inimitable. Enfin, s’il a fait de chacun de nous une contradiction vivante, il en est, certes, le plus parfait modèle.
On pense bien que Rollin était enthousiaste du Communisme et des institutions lacédémoniennes. Rendons-lui justice, cependant ; son admiration n’est pas exclusive. Il reprend, avec les ménagements convenables, ce législateur d’avoir imprimé à son œuvre quatre taches légères :
1° L’oisiveté,
2° La promiscuité,
3° Le meurtre des enfants,
4° L’assassinat en masse des esclaves.
Ces quatre réserves une fois faites, le bonhomme, rentrant dans le conventionalisme classique, voit en Lycurgue non un homme, mais un dieu, et trouve sa police parfaite.
L’intervention du législateur en toutes choses paraît à Rollin si indispensable, qu’il félicite très-sérieusement les Grecs de ce qu’un homme nommé Pélasge soit venu leur enseigner à manger du gland. Avant, dit-il, ils broutaient l’herbe comme les bêtes.
Ailleurs, il dit :
« Dieu devait l’empire du monde aux Romains en récompense de leurs grandes vertus, qui ne sont qu’apparentes. Il n’aurait pas fait justice s’il avait accordé à ces vertus, qui n’ont rien de réel, un moindre prix. »
Ne voit-on pas clairement ici le conventionalisme et le christianisme se disputer, dans la personne de Rollin, une pauvre âme en peine ? L’esprit de cette phrase, c’est l’esprit de tous les ouvrages du fondateur de l’enseignement en France. Se contredire, faire Dieu se contredire et nous apprendre à nous contredire, c’est tout Rollin, c’est tout le Baccalauréat.
Si la Promiscuité et l’Infanticide éveillent les scrupules de Rollin, à l’égard des institutions de Lycurgue, il se passionne pour tout le reste, et trouve même moyen de justifier le vol. Voici comment. Le trait est curieux, et se rattache assez à mon sujet pour mériter d’être rapporté.
Rollin commence par poser en principe que la loi crée la propriété, — principe funeste, commun à tous les organisateurs, et que nous retrouverons bientôt dans la bouche de Rousseau, de Mably, de Mirabeau, de Robespierre et de Babeuf. Or, puisque la loi est la raison d’être de la propriété, ne peut-elle pas être aussi bien la raison d’être du vol ? Qu’opposer à ce raisonnement ?
« Le vol était permis à Sparte, dit Rollin, il était sévèrement puni chez les Scythes. La raison de cette différence est sensible, c’est que la loi, qui seule décide de la propriété et de l’usage des biens, n’avait rien accordé chez les Scythes à un particulier sur le bien d’un autre, et que la loi, chez les Lacédémoniens, avait fait tout le contraire. »
Ensuite, le bon Rollin, dans l’ardeur de son plaidoyer en faveur du vol et de Lycurgue, invoque la plus incontestable des autorités, celle de Dieu :
« Rien n’est plus ordinaire, dit-il, que des droits semblables accordés sur le bien d’autrui : c’est ainsi que Dieu non-seulement avait donné aux pauvres le pouvoir de cueillir du raisin dans les vignes et de glaner dans les champs, et d’en emporter les gerbes entières, mais avait encore accordé à tout passant sans distinction la liberté d’entrer autant de fois qu’il lui plaisait dans la vigne d’autrui, et d’en manger autant de raisin qu’il voulait, malgré le maître de la vigne. Dieu en rend lui-même la première raison. C’est que la terre d’Israël était à lui et que les Israélites n’en jouissaient qu’à cette condition onéreuse. »
On dira, sans doute, que c’est là une doctrine personnelle à Rollin. C’est justement ce que je dis. Je cherche à montrer à quel état d’infirmité morale la fréquentation habituelle de l’effroyable Société antique peut réduire les plus belles et les plus honnêtes intelligences.
Montesquieu. On a dit de Montesquieu qu’il avait retrouvé les titres du genre humain. C’est un de ces grands écrivains dont chaque phrase a le privilége de faire autorité. À Dieu ne plaise que je veuille amoindrir sa gloire ! Mais que ne faut-il pas penser de l’éducation classique, si elle est parvenue à égarer cette noble intelligence au point de lui faire admirer dans l’antiquité les institutions les plus barbares ?
Les anciens Grecs, pénétrés de la nécessité que les peuples qui vivaient sous un gouvernement populaire fussent élevés à la vertu, firent pour l’inspirer des institutions singulières. Les lois de Crète étaient l’original de celles de Lacédémone ; et celles de Platon en étaient la correction.
Je prie qu’on fasse un peu d’attention à l’étendue de génie qu’il fallut à ces législateurs pour voir qu’en choquant tous les usages reçus, en confondant toutes les vertus, ils montreraient à l’univers leur sagesse. Lycurgue, mêlant le larcin avec l’esprit de justice, le plus dur esclavage avec l’extrême liberté, les sentiments les plus atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité à sa ville. Il sembla lui ôter toutes les ressources, les arts, le commerce, l’argent, les murailles ; on y a de l’ambition sans espérance d’être mieux ; on y a les sentiments naturels, et on n’y est ni enfant, ni mari, ni père ; la pudeur même est ôtée à la chasteté. C’est par ces chemins que Sparte est menée à la grandeur et à la gloire ; mais avec une telle infaillibilité de ses institutions, qu’on n’obtenait rien contre elle en gagnant des batailles, si on ne parvenait à lui ôter sa police. (Esprit des Lois, livre IV, chap. viii.)
Ceux qui voudront faire des institutions pareilles établiront la communauté des biens de la république de Platon ; ce respect qu’il demandait pour les dieux, cette séparation d’avec les étrangers, pour la conservation des mœurs, et la cité faisant le commerce et non pas les citoyens ; ils donneront nos arts sans notre luxe, et nos besoins sans nos désirs.
Montesquieu explique en ces termes la grande influence que les anciens attribuaient à la musique.
…Je crois que je pourrais expliquer ceci : Il faut se mettre dans l’esprit que dans les villes grecques, surtout celles qui avaient pour principal objet la guerre, tous les travaux et toutes les professions qui pouvaient conduire à gagner de l’argent étaient regardés comme indignes d’un homme libre. « La plupart des arts, dit Xénophon, corrompent le corps de ceux qui les exercent ; ils obligent à s’asseoir à l’ombre ou près du feu : on n’a de temps ni pour ses amis ni pour la république. » Ce ne fut que dans la corruption de quelques démocraties que les artisans parvinrent à être citoyens. C’est ce qu’Aristote nous apprend ; et il soutient qu’une bonne république ne leur donnera jamais le droit de cité.
L’agriculture était encore une profession servile, et ordinairement c’était quelque peuple vaincu qui l’exerçait : les Ilotes, chez les Lacédémoniens ; les Périéciens chez les Crétois ; les Pénestes, chez les Thessaliens ; d’autres peuples esclaves, dans d’autres républiques.
Enfin tout le commerce était infâme chez les Grecs. Il aurait fallu qu’un citoyen eût rendu des services à un esclave, à un locataire, à un étranger : cette idée choquait l’esprit de la liberté grecque. Aussi Platon veut-il dans ses lois qu’on punisse un citoyen qui ferait le commerce…
On était donc fort embarrassé dans les républiques grecques : On ne voulait pas que les citoyens travaillassent au commerce, à l’agriculture ni aux arts ; on ne voulait pas non plus qu’ils fussent oisifs. Ils trouvaient une occupation dans les exercices qui dépendent de la gymnastique et dans ceux qui avaient du rapport à la guerre. L’institution ne leur en donnait point d’autres. Il faut donc regarder les Grecs comme une société d’athlètes et de combattants. Or ces exercices, si propres à faire des gens durs et sauvages, avaient besoin d’être tempérés par d’autres qui pussent adoucir les mœurs. La musique, qui tient à l’esprit par les organes du corps, était très-propre à cela. (Esprit des Lois, livre V.)
Voilà l’idée que l’enseignement classique nous donne de la Liberté. Voici maintenant comment il nous enseigne à comprendre l’Égalité et la Frugalité :
Quoique dans la démocratie l’égalité réelle soit l’âme de l’État, cependant elle est si difficile à établir qu’une exactitude extrême à cet égard ne conviendrait pas toujours. Il suffit que l’on établisse un cens qui réduise ou fixe les différences à un certain point ; après quoi c’est à des lois particulières à égaliser pour ainsi dire les inégalités, par les charges qu’elles imposent aux riches et le soulagement qu’elles accordent aux pauvres. (Esprit des Lois, livre V, chap. v.)
Il ne suffit pas dans une bonne démocratie que les portions de terre soient égales ; il faut qu’elles soient petites comme chez les Romains…
Comme l’égalité des fortunes entretient la frugalité, la frugalité maintient l’égalité des fortunes. Ces choses, quoique différentes, sont telles qu’elles ne peuvent subsister l’une sans l’autre. (Esprit des Lois, chap. vi.)
Les Samnites avaient une coutume qui, dans une petite république, et surtout dans la situation où était la leur, devait produire d’admirables effets. On assemblait tous les jeunes gens et on les jugeait. Celui qui était déclaré le meilleur de tous prenait pour sa femme la fille qu’il voulait ; celui qui avait les suffrages après lui choisissait encore, et ainsi de suite… Il serait difficile d’imaginer une récompense plus noble, plus grande, moins à charge à un petit État, plus capable d’agir sur l’un et l’autre sexe.
Les Samnites descendaient des Lacédémoniens ; et, Platon, dont les institutions ne sont que la perfection des lois de Lycurgue, donna à peu près une pareille loi. (Esprit des Lois, livre VII, chap. xvi.)
Rousseau. Aucun homme n’a exercé sur la révolution française autant d’influence que Rousseau. « Ses ouvrages, dit L. Blanc, étaient sur la table du comité de salut public. » « Ses paradoxes, dit-il encore, que son siècle prit pour des hardiesses littéraires, devaient bientôt retentir dans les assemblées de la nation sous la forme de vérités dogmatiques et tranchantes comme l’épée. » Et, afin que le lien moral qui rattache Rousseau à l’antiquité ne soit pas méconnu, le même panégyriste ajoute : « Son style rappelait le langage pathétique et véhément d’un fils de Cornélie. »
Qui ne sait, d’ailleurs, que Rousseau était l’admirateur le plus passionné des idées et des mœurs qu’on est convenu d’attribuer aux Romains et aux Spartiates ? Il dit lui-même que la lecture de Plutarque l’a fait ce qu’il est.
Son premier écrit fut dirigé contre l’intelligence humaine. Aussi, dès les premières pages, il s’écrie :
Oublierai-je que ce fut dans le sein de la Grèce qu’on vit s’élever cette cité aussi célèbre par son heureuse ignorance que par la sagesse de ses lois ; cette république de demi-dieux plutôt que d’hommes, tant leurs vertus semblaient supérieures à l’humanité ? Ô Sparte ! opprobre éternel d’une vaine doctrine ! tandis que les vices conduits par les beaux-arts s’introduisaient dans Athènes, tandis qu’un tyran y rassemblait avec tant de soin les ouvrages du prince des poëtes, tu chassais de tes murs les arts et les artistes, les sciences et les savants ! (Discours sur le rétablissement des sciences et des arts.)
Dans son second ouvrage, le Discours sur l’inégalité des conditions, il s’emporta avec plus de véhémence encore contre toutes les bases de la société et de la civilisation. C’est pourquoi il se croyait l’interprète de la sagesse antique :
« Je me supposerai dans le lycée d’Athènes, répétant les leçons de mes maîtres, ayant les Platon et les Xénocrate pour juges, et le genre humain pour auditeur. »
L’idée dominante de ce discours célèbre peut se résumer ainsi : Le sort le plus affreux attend ceux qui, ayant le malheur de naître après nous, ajouteront leurs connaissances aux nôtres. Le développement de nos facultés nous rend déjà très-malheureux. Nos pères l’étaient moins étant plus ignorants. Rome approchait de la perfection ; Sparte l’avait réalisée, autant que la perfection est compatible avec l’état social. Mais le vrai bonheur pour l’homme, c’est de vivre dans les bois, seul, nu, sans liens, sans affections, sans langage, sans religion, sans idées, sans famille, enfin dans cet état où il était si rapproché de la bête qu’il est fort douteux qu’il se tint debout et que ses mains ne fussent pas des pieds.
Malheureusement, cet âge d’or ne s’est pas perpétué. Les hommes ont passé par un état intermédiaire qui ne laissait pas que d’avoir des charmes :
« Tant qu’ils se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se contentèrent de coudre leurs habits de peaux avec des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs… tant qu’ils ne s’occupèrent que des ouvrages qu’un seul pouvait faire, ils vécurent libres, sains, bons et heureux. »
Hélas ! ils ne surent pas s’arrêter à ce premier degré de culture :
« Dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre (voilà la société qui fait sa funeste apparition) ; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire…
La métallurgie et l’agriculture furent les deux arts dont l’invention produisit cette grande révolution. Pour le poëte, c’est l’or et l’argent, pour le philosophe, c’est le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain. »
Il fallut donc sortir de l’état de nature pour entrer dans la société. Ceci est l’occasion du troisième ouvrage de Rousseau, le Contrat social.
Il n’entre pas dans mon sujet d’analyser ici cette œuvre ; je me bornerai à faire remarquer que les idées gréco-romaines s’y reproduisent à chaque page.
Puisque la société est un pacte, chacun a droit de stipuler pour lui-même.
Il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société.
Mais cela n’est pas facile.
Comment les régleront-ils ? sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite ?… Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu’elle veut, exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ?… De là la nécessité d’un législateur.
Ainsi le suffrage universel est aussitôt escamoté en pratique qu’admis en théorie.
Car comment s’y prendra ce législateur, qui doit être, à tous égards, un homme extraordinaire, qui, osant entreprendre d’instituer un peuple, doit se sentir en état de changer la nature humaine, d’altérer la constitution physique et morale de l’homme, qui doit, en un mot, inventer la machine dont les hommes sont la matière ?
Rousseau prouve fort bien ici que le législateur ne peut compter ni sur la force, ni sur la persuasion. Comment sortir de ce pas ? Par l’imposture.
« Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations à recourir à l’intervention du ciel et d’honorer les dieux de leur propre sagesse… Cette raison sublime, qui s’élève au-dessus des âmes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner, par l’autorité divine, ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n’appartient pas à tout le monde de faire parler les dieux. » (Les Dieux ! les Immortels ! réminiscence classique.)
Comme Platon et Lycurgue, ses maîtres, comme les Spartiates et les Romains, ses héros, Rousseau donnait aux mots travail et liberté un sens selon lequel ils expriment deux idées incompatibles. Dans l’état social, il faut donc opter : renoncer à être libre, ou mourir de faim. Il y a cependant une issue à la difficulté, c’est l’esclavage.
« À l’instant qu’un peuple se donne des représentants, il n’est plus libre ; il n’est plus !
Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait lui-même. Il était sans cesse assemblé sur la place ; des esclaves faisaient ses travaux ; sa grande affaire était la liberté. N’ayant plus les mêmes avantages, comment conserver les mêmes droits ? Vous donnez plus à votre gain qu’à votre liberté, et vous craignez bien moins l’esclavage que la misère.
Quoi ! la liberté ne se maintient qu’à l’appui de la servitude ? Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout ce qui n’est pas dans la nature a ses inconvénients, et la société civile plus que tout le reste. Il y a telles positions malheureuses où on ne peut sauver sa liberté qu’aux dépens de celle d’autrui, et où le citoyen ne peut être extrêmement libre que l’esclave ne soit extrêmement esclave. Telle était la position de Sparte. Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves, mais vous l’êtes, etc. »
Voilà bien le conventionalisme classique. Les anciens avaient été poussés à se donner des esclaves par leurs instincts brutaux. Mais comme c’est un parti pris, une tradition de collége de trouver beau tout ce qu’ils ont fait, on leur attribue des raisonnements raffinés sur la quintessence de la liberté.
L’opposition qu’établit Rousseau entre l’état de la nature et l’état social est aussi funeste à la morale privée qu’à la morale publique. Selon ce système, la société est le résultat d’un pacte qui donne naissance à la Loi, laquelle, à son tour, tire du néant la justice et la moralité. Dans l’état de nature, il n’y a ni moralité ni justice. Le père n’a aucun devoir envers son fils, le fils envers son père, le mari envers sa femme, la femme envers son mari. « Je ne dois rien à qui je n’ai rien promis ; je ne reconnais à autrui que ce qui m’est inutile ; j’ai un droit illimité à tout ce qui me tente et que je puis atteindre. »
Il suit de là que si le pacte social une fois conclu vient à être dissous, tout s’écroule à la fois, société, loi, moralité, justice, devoir. « Chacun, dit Rousseau, rentre dans ses droits primitifs, et reprend sa liberté naturelle en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. »
Or, il faut savoir qu’il faut bien peu de chose pour que le pacte social soit dissous. Cela arrive toutes les fois qu’un particulier viole ses engagements ou se soustrait à l’exécution d’une loi quelconque. Qu’un condamné s’évade quand la société lui dit : Il est expédient que tu meures ; qu’un citoyen refuse l’impôt, qu’un comptable mette la main dans la caisse publique, à l’instant le contrat social est violé, tous les devoirs moraux cessent, la justice n’existe plus, les pères, les mères, les enfants, les époux ne se doivent rien ; chacun a un droit illimité à tout ce qui le tente ; en un mot, la population tout entière rentre dans l’état de nature.
Je laisse à penser les ravages que doivent faire de pareilles doctrines aux époques révolutionnaires.
Elles ne sont pas moins funestes à la morale privée. Quel est le jeune homme, entrant dans le monde plein de fougue et de désirs, qui ne se dise : « Les impulsions de mon cœur sont la voix de la nature, qui ne se trompe jamais. Les institutions qui me font obstacle viennent des hommes, et ne sont que des conventions arbitraires auxquelles je n’ai pas concouru. En foulant aux pieds ces institutions, j’aurai le double plaisir de satisfaire mes penchants et de me croire un héros. »
Faut-il rappeler ici cette triste et douloureuse page des Confessions ?
« Mon troisième enfant fut donc mis aux Enfants trouvés, ainsi que les deux premiers. Il en fut de même des deux suivants, car j’en ai eu cinq en tout. Cet arrangement me parut si bon, que, si je ne m’en vantai pas, ce fut uniquement par égard pour leur mère… En livrant mes enfants à l’éducation publique… je me regardais comme un membre de la république de Platon !»
Mably. Il n’est pas besoin de citations pour prouver la gréco-romano-manie de l’abbé Mably. Homme tout d’une pièce, d’un esprit plus étroit, d’un cœur moins sensible que Rousseau, l’idée chez lui admettait moins de tempéraments et de mélanges. Aussi fut-il franchement platonicien, c’est-à-dire communiste. Convaincu, comme tous les classiques, que l’humanité est une matière première pour les `, comme tous les classiques aussi, il aimait mieux être fabricant que matière première. En conséquence, il se pose comme Législateur. À ce titre, il fut d’abord appelé à instituer la Pologne, et il ne paraît pas avoir réussi. Ensuite, il offrit aux Anglo-Américains le brouet noir des Spartiates, à quoi il ne put les décider. Outré de cet aveuglement, il prédit la chute de l’Union et ne lui donna pas pour cinq ans d’existence.
Qu’il me soit permis de faire ici une réserve. En citant les doctrines absurdes et subversives d’hommes tels que Fénelon, Rollin, Montesquieu, Rousseau, je n’entends certes pas dire qu’on ne doive à ces grands écrivains des pages pleines de raison et de moralité. Mais ce qu’il y a de faux dans leurs livres vient du conventionalisme classique, et ce qu’il y a de vrai dérive d’une autre source. C’est précisément ma thèse que l’enseignement exclusif des lettres grecques et latines fait de nous tous des contradictions vivantes. Il nous tire violemment vers un passé dont il glorifie jusqu’aux horreurs, pendant que le christianisme, l’esprit du siècle et ce fonds de bon sens qui ne perd jamais ses droits, nous montrent l’idéal dans l’avenir.
Je vous fais grâce de Morelly, Brissot, Raynal, justifiant, que dis-je ? exaltant à l’envi la guerre, l’esclavage, l’imposture sacerdotale, la communauté des biens, l’oisiveté. Qui pourrait se méprendre sur la source impure de pareilles doctrines ? Cette source, j’ai pourtant besoin de la nommer encore, c’est l’éducation classique telle qu’elle nous est imposée à tous par le Baccalauréat.
Ce n’est pas seulement dans les œuvres littéraires que la calme, paisible et pure antiquité a versé son poison, mais encore dans les livres des jurisconsultes. Je défie bien qu’on trouve dans aucun de nos légistes quelque chose qui approche d’une notion raisonnable sur le droit de propriété. Et que peut être une législation d’où cette notion est absente ? Ces jours-ci, j’ai eu l’occasion d’ouvrir le Traité du droit des gens, par Vattel. J’y vois que l’auteur a consacré un chapitre à l’examen de cette question : Est-il permis d’enlever des femmes ? Il est clair que la légende des Romains et des Sabines nous a valu ce précieux morceau. L’auteur, après avoir pesé, avec le plus grand sérieux, le pour et le contre, se décide en faveur de l’affirmative. Il devait cela à la gloire de Rome. Est-ce que les Romains ont eu jamais tort ? Il y a un conventionalisme qui nous défend de le penser ; ils sont Romains, cela suffit. Incendie, pillage, rapt, tout ce qui vient d’eux est calme, paisible et pur.
Alléguera-t-on que ce ne sont là que des appréciations personnelles ! Il faudrait que notre société jouât de bonheur pour que l’action uniforme de l’enseignement classique, renforcée par l’assentiment de Montaigne, Corneille, Fénelon, Rollin, Montesquieu, Rousseau, Raynal, Mably, ne concourût pas à former l’opinion générale. C’est ce que nous verrons.
En attendant, nous avons la preuve que l’idée communiste ne s’était pas emparée seulement de quelques individualités, mais de corporations entières, et les plus instruites comme les plus influentes. Quand les jésuites voulurent organiser un ordre social au Paraguay, quels furent les plans que leur suggérèrent leurs études passées ? Ceux de Minos, Platon et Lycurgue. Ils réalisèrent le communisme, qui, à son tour, ne manqua pas de réaliser ses tristes conséquences. Les Indiens descendirent à quelques degrés au-dessous de l’état sauvage. Cependant, telle était la prévention invétérée des Européens en faveur des institutions communistes, toujours présentées comme le type de la perfection, qu’on célébrait de toutes parts le bonheur et la vertu de ces êtres sans nom (car ce n’étaient plus des hommes), végétant sous la houlette des jésuites.
Rousseau, Mably, Montesquieu, Raynal, ces grands prôneurs des Missions, avaient-ils vérifié les faits ? Pas le moins du monde. Est-ce que les livres grecs et latins peuvent tromper ? Est-ce qu’on peut s’égarer en prenant pour guide Platon ? Donc, les Indiens du Paraguay étaient heureux ou devaient l’être, sous peine d’être misérables contre toutes les règles. Azara, Bougainville et d’autres voyageurs partirent sous l’influence de ces idées préconçues pour aller admirer tant de merveilles. D’abord, la triste réalité avait beau leur crever les yeux, ils ne pouvaient y croire. Il fallut pourtant se rendre à l’évidence, et ils finirent par constater, à leur grand regret, que le communisme, séduisante chimère, est une affreuse réalité.
La logique est inflexible. Il est bien clair que les auteurs que je viens de citer n’avaient pas osé pousser leur doctrine jusqu’au bout. Morelly et Brissot se chargèrent de réparer cette inconséquence. En vrais platoniciens, ils prêchèrent ouvertement la communauté des biens et des femmes, et cela, remarquons-le bien, en invoquant sans cesse les exemples et les préceptes de cette belle antiquité que tout le monde est convenu d’admirer.
Tel était, sur la Famille, la Propriété, la Liberté, la Société, l’état où l’éducation donnée par le clergé avait réduit l’opinion publique en France, quand éclata la Révolution. Elle s’explique, sans doute, par des causes étrangères à l’enseignement classique. Mais est-il permis de douter que cet enseignement n’y ait mêlé une foule d’idées fausses, de sentiments brutaux, d’utopies subversives, d’expérimentations fatales ? Qu’on lise les discours prononcés à l’Assemblée législative et à la Convention. C’est la langue de Rousseau et de Mably. Ce ne sont que prosopopées, invocations, apostrophes à Fabricius, à Caton, aux deux Brutus, aux Gracques, à Catilina. Va-t-on commettre une atrocité ? On trouve toujours, pour la glorifier, l’exemple d’un Romain. Ce que l’éducation a mis dans l’esprit passe dans les actes. Il est convenu que Sparte et Rome sont des modèles ; donc il faut les imiter ou les parodier. L’un veut instituer les jeux Olympiques, l’autre les lois agraires et un troisième le brouet noir dans les rues.
Je ne puis songer à épuiser ici cette question, bien digne qu’une main exercée y consacre autre chose qu’un pamphlet : « De l’influence des lettres grecques et latines sur l’esprit de nos révolutions. » Je dois me borner à quelques traits.
Deux grandes figures dominent la Révolution française et semblent la personnifier : Mirabeau et Robespierre. Quelle était leur doctrine sur la Propriété ?
Nous avons vu que les peuples qui, dans l’antiquité, avaient fondé leurs moyens d’existence sur la rapine et l’esclavage ne pouvaient rattacher la propriété à son véritable principe. Ils étaient obligés de la considérer comme un fait de convention, et ils la faisaient reposer sur la loi, ce qui permet d’y faire entrer l’esclavage et le vol, comme l’explique si naïvement Rollin.
Rousseau avait dit aussi : « La propriété est de convention et d’institution humaine, au lieu que la liberté est un don de la nature. »
Mirabeau professait la même doctrine :
« La propriété, dit-il, est une création sociale. Les lois ne protégent pas, ne maintiennent pas seulement la propriété, elles la font naître, elles la déterminent, elles lui donnent le rang et l’étendue qu’elle occupe dans les droits des citoyens. »
Et quand Mirabeau s’exprimait ainsi, ce n’était pas pour faire de la théorie. Son but actuel était d’engager le législateur à limiter l’exercice d’un droit qui était bien à sa discrétion, puisqu’il l’avait créé.
Robespierre reproduit les définitions de Rousseau.
« En définissant la Liberté, ce premier besoin de l’homme, le plus sacré des droits qu’il tient de la nature, nous avons dit, avec raison, qu’elle a pour limite le droit d’autrui. Pourquoi n’avez-vous pas appliqué ce principe à la Propriété, qui est une institution sociale, comme si les lois de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes ? »
Après ce préambule, Robespierre passe à la définition.
« La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer des biens qui lui sont garantis par la loi. »
Ainsi voilà l’opposition bien marquée entre la Liberté et la Propriété. Ce sont deux droits d’origine différente. L’un vient de la nature, l’autre est d’institution sociale. Le premier est naturel, le second conventionnel.
Or, qui fait la loi ? Le législateur. Il peut donc mettre à l’exercice du droit de propriété, puisqu’il le confère, les conditions qu’il lui plaît.
Aussi Robespierre se hâte de déduire de sa définition le droit au travail, le droit à l’assistance et l’impôt progressif.
« La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant des moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
Les secours nécessaires à l’indigence sont une dette du riche envers le pauvre. Il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée.
Les citoyens dont le revenu n’excède pas ce qui est nécessaire à leur subsistance sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres doivent les supporter progressivement, selon l’étendue de leur fortune. »
Robespierre, dit M. Sudre, adoptait ainsi toutes les mesures qui, dans l’esprit de leurs inventeurs, comme dans la réalité, constituent la transition de la propriété au communisme. Par l’application du Traité des lois de Platon, il s’acheminait, sans le savoir, vers la réalisation de l’état social décrit dans le livre de la République.
(On sait que Platon a fait deux livres : l’un pour signaler la perfection idéale — communauté des biens et des femmes — c’est le livre de la République ; l’autre pour enseigner les moyens de transition, c’est le Traité des lois.)
Robespierre peut être considéré, d’ailleurs, comme un enthousiaste de la calme, paisible et pure antiquité. Son discours même sur la Propriété abonde en déclamations du goût de celles-ci : « Aristide n’aurait pas envié les trésors de Crassus ! La chaumière de Fabricius n’a rien à envier au palais de Crassus ! » etc.
Une fois que Mirabeau et Robespierre attribuaient, en principe, au législateur la faculté de fixer la limite du droit de propriété, il importe peu de savoir à quel degré ils jugeaient opportun de placer cette limite. Il pouvait leur convenir de ne pas aller plus loin que le droit au travail, le droit à l’assistance et l’impôt progressif. Mais d’autres, plus conséquents, ne s’arrêtaient pas là. Si la loi, qui crée la propriété et en dispose, peut faire un pas vers l’égalité, pourquoi n’en ferait-elle pas deux ? Pourquoi ne réaliserait-elle pas l’égalité absolue ?
Aussi Robespierre fut dépassé par Saint-Just, cela devait être, et Saint-Just par Babeuf, cela devait être encore. Dans cette voie, il n’y a qu’un terme raisonnable. Il a été marqué par le divin Platon.
Saint-Just… mais je me laisse trop circonscrire dans la question de propriété. J’oublie que j’ai entrepris de montrer comment l’éducation classique a perverti toutes les notions morales. Convaincu que le lecteur voudra bien me croire sur parole, quand j’affirme que Saint-Just a dépassé Robespierre dans la voie du communisme, je reprends mon sujet.
Il faut d’abord savoir que les erreurs de Saint-Just se rattachaient aux études classiques. Comme tous les hommes de son temps et du nôtre, il était imprégné d’Antiquité. Il se croyait un Brutus. Retenu loin de Paris par son parti, il écrivait :
« Ô Dieu ! faut-il que Brutus languisse, oublié, loin de Rome ! Mon parti est pris, cependant, et si Brutus ne tue point les autres, il se tuera lui-même. »
Tuer ! il semble que ce soit ici-bas la destination de l’homme.
Tous les hellénistes et latinistes sont convenus que le principe d’une république, c’est la vertu, et Dieu sait ce qu’ils entendent par ce mot ! C’est pourquoi Saint-Just écrivait.
« Un gouvernement républicain a la Vertu pour principe, sinon la Terreur. »
C’est encore un opinion dominante dans l’antiquité que le travail est infâme. Aussi Saint-Just le condamnait en ces termes :
« Un métier s’accorde mal avec le véritable citoyen. La main de l’homme n’est faite que pour la terre et pour les armes. »
Et c’est pour que personne ne pût s’avilir à exercer un métier qu’il voulait distribuer des terres à tout le monde.
Nous avons vu que, selon les idées des anciens, le législateur est à l’humanité ce que le potier est à l’argile. Malheureusement, quand cette idée domine, nul ne veut être argile et chacun veut être potier. On pense bien que Saint-Just s’attribuait le beau rôle :
« Le jour où je me serai convaincu qu’il est impossible de donner aux Français des mœurs douces, sensibles et inexorables pour la tyrannie et l’injustice, je me poignarderai.
S’il y avait des mœurs, tout irait bien ; il faut des institutions pour les épurer. Pour réformer les mœurs, il faut commencer par contenter le besoin et l’intérêt. Il faut donner quelques terres à tout le monde.
Les enfants sont vêtus de toile en toute saison. Ils couchent sur des nattes et dorment huit heures. Ils sont nourris en commun, et ne vivent que de racines, de fruits, de légumes, de pain et d’eau. Ils ne peuvent goûter de chair qu’après l’âge de seize ans.
Les hommes âgés de vingt-cinq ans seront tenus de déclarer tous les ans, dans le temple, les noms de leurs amis. Celui qui abandonne son ami sans raison suffisante sera banni ! »
Ainsi Saint-Just, à l’imitation de Lycurgue, Platon, Fénelon, Rousseau, s’attribue à lui-même sur les mœurs, les sentiments, les richesses et les enfants des Français, plus de droits et de puissance que n’en ont tous les Français ensemble. Que l’humanité est petite auprès de lui ! ou plutôt elle ne vit qu’en lui. Son cerveau est le cerveau, son cœur est le cœur de l’humanité.
Voilà donc la marche imprimée à la révolution par le conventionalisme greco-latin. Platon a marqué l’idéal. Prêtres et laïques, au dix-septième et au-dix-huitième siècle, se mettent à célébrer cette merveille. Vient l’heure de l’action : Mirabeau descend le premier degré, Robespierre le second, Saint-Just le troisième, Antonelle le quatrième, et Babeuf, plus logique que tous ses prédécesseurs, se dresse au dernier, au communisme absolu, au platonisme pur. Je devrais citer ici ses écrits ; je me bornerai à dire, car ceci est caractéristique, qu’il les signait Caius Gracchus.
L’esprit de la révolution, au point de vue qui nous occupe, se montre tout entier dans quelques citations. Que voulait Robespierre ? « Élever les âmes à la hauteur des vertus républicaines des peuples antiques. » (3 nivôse an III.) Que voulait Saint-Just ? « Nous offrir le bonheur de Sparte et d’Athènes. » (23 nivôse an III.) Il voulait en outre « Que tous les citoyens portassent sous leur habit le couteau de Brutus. » (Ibid.) Que voulait le sanguinaire Carrier ? « Que toute la jeunesse envisage désormais le brasier de Scœvola, la ciguë de Socrate, la mort de Cicéron et l’épée de Caton. » Que voulait Rabaut Saint-Étienne ? « Que, suivant les principes des Crétois et des Spartiates, l’État s’empare de l’homme dès le berceau et même avant la naissance. » (16 décembre 1692). Que voulait la section des Quinze-Vingts ? « Qu’on consacre une église à la liberté, et qu’on fasse élever un autel sur lequel brûlera un feu perpétuel entretenu par de jeunes vestales. » (21 novembre 1794.) Que voulait la Convention tout entière ? « Que nos communes ne renferment désormais que des Brutus et des Publicola. » (19 mars 1794.)
Tous ces sectaires étaient de bonne foi cependant, et ils n’en étaient que plus dangereux ; car la sincérité dans l’erreur, c’est du fanatisme, et le fanatisme est une force, surtout quand il agit sur des masses préparées à subir son action. L’universel enthousiasme en faveur d’un type social ne peut être toujours stérile, et l’opinion publique, éclairée ou égarée, n’en est pas moins la reine du monde. Quand une de ces erreurs fondamentales, — telle que la Glorification de l’Antiquité, — pénétrant par l’enseignement dans tous les cerveaux avec les premières lueurs de l’intelligence, s’y fixe à l’état de conventionalisme, elle tend à passer des esprits aux actes. Qu’une révolution fasse alors sonner l’heure des expériences, et qui peut dire sous quel nom terrible apparaîtra celui qui, cent ans plus tôt, se fût appelé Fénélon ? Il eût déposé son idée dans un roman, il meurt pour elle sur l’échafaud ; il eût été poëte, il se fait martyr ; il eût amusé la société, il la bouleverse.
Cependant il y a dans la réalité une puissance supérieure au conventionalisme le plus universel. Quand l’éducation a déposé dans le corps social une semence funeste, il y a en lui une force de conservation, vis medicatrix, qui le fait se débarrasser à la longue, à travers les souffrances et les larmes, du germe délétère.
Lors donc que le communisme eut assez effrayé et compromis la société, une réaction devint infaillible. La France se prit à reculer vers le despotisme. Dans son ardeur, elle eût fait bon marché même des légitimes conquêtes de la Révolution. Elle eut le Consulat et l’Empire. Mais, hélas ! ai-je besoin de faire observer que l’infatuation romaine la suivit dans cette phase nouvelle ? L’Antiquité est là, toujours là pour justifier toutes les formes de la violence. Depuis Lycurgue jusqu’à César, que de modèles à choisir ! Donc, — et j’emprunte ici le langage de M. Thiers, — « nous qui, après avoir été Athéniens avec Voltaire, avons un moment voulu être Spartiates sous la Convention, nous nous fîmes soldats de César sous Napoléon. » Peut-on méconnaître l’empreinte que notre engouement pour Rome a laissée sur cette époque ? Eh ! mon Dieu, cette enpreinte est partout. Elle est dans les édifices, dans les monuments, dans la littérature, dans les modes même de la France impériale : elle est dans les noms ridicules imposés à toutes nos institutions. Ce n’est pas par hasard, sans doute, que nous vîmes surgir de toute part des Consuls, un Empereur, des Sénateurs, des Tribuns, des Préfets, des Sénatus-consultes, des Aigles, des Colonnes trajanes, des Légions, des Champs de Mars, des Prytanées, des Lycées.
La lutte entre les principes révolutionnaires et contre-révolutionnaires semblait devoir se terminer aux journées de Juillet 1830. Depuis cette époque, les forces intellectuelles de ce pays se sont tournées vers l’étude des questions sociales, ce qui n’a rien en soi que de naturel et d’utile. Malheureusement, l’Université donne le premier branle à la marche de l’esprit humain, et le dirige encore vers les sources empoisonnées de l’Antiquité ; de telle sorte que notre malheureuse patrie en est réduite à recommencer son passé et à traverser les mêmes épreuves. Il semble qu’elle soit condamnée à tourner dans ce cercle : Utopie, expérimentation, réaction. — Platonisme littéraire, communisme révolutionnaire, despotisme militaire. — Fénelon, Robespierre, Napoléon ! — Peut-il en être autrement ? La jeunesse, où se recrutent la littérature et le journalisme, au lieu de chercher à découvrir et à exposer les lois naturelles de la société, se borne à reprendre en sous-œuvre cet axiome grœco-romain : L’ordre social est une création du Législateur. Point de départ déplorable qui ouvre une carrière sans limites à l’imagination, et n’est que l’enfantement perpétuel du Socialisme. — Car, si la société est une invention, qui ne veut être l’inventeur ? qui ne veut être ou Minos, ou Lycurgue, ou Platon, ou Numa, ou Fénelon, ou Robespierre, ou Babeuf, ou Saint-Simon, ou Fourier, ou Louis Blanc, ou Proudhon ? Qui ne trouve glorieux d’instituer un Peuple ? Qui ne se complaît dans le titre de Père des nations ? Qui n’aspire à combiner, comme des éléments chimiques, la Famille et la Propriété ?
Mais, pour donner carrière à sa fantaisie ailleurs que dans les colonnes d’un journal, il faut tenir le pouvoir, il faut occuper le point central où aboutissent tous les fils de la puissance publique. C’est le préalable obligé de toute expérimentation. Chaque secte, chaque école fera donc tous ses efforts pour chasser du gouvernement l’école ou la secte dominante, en sorte que, sous l’influence de l’enseignement classique, la vie sociale ne peut être qu’une interminable série de luttes et de révolutions, ayant pour objet la question de savoir à quel utopiste restera la faculté de faire sur le peuple, comme sur une vile matière, des expériences !
Oui, j’accuse le Baccalauréat de préparer, comme à plaisir, toute la jeunesse française aux utopies socialistes, aux expérimentations sociales. Et c’est là sans doute la raison d’un phénomène fort étrange, je veux parier de l’impuissance que manifestent à réfuter le socialisme ceux-là mêmes qui s’en croient menacés. Hommes de la bourgeoisie, propriétaires, capitalistes, les systèmes de Saint-Simon, de Fourier, de Louis Blanc, de Leroux, de Proudhon ne sont, après tout, que des doctrines. Elles sont fausses, dites-vous. Pourquoi ne les réfutez-vous pas ? Parce que vous avez bu à la même coupe : parce que la fréquentation des anciens, parce que votre engouement de convention pour tout ce qui est Grec ou Romain vous ont inoculé le socialisme.
Vous en êtes un peu dans votre âme entiché.
Votre nivellement des fortunes par l’action des tarifs, votre loi d’assistance, vos appels à l’instruction gratuite, vos primes d’encouragement, votre centralisation, votre foi dans l’État, votre littérature, votre théâtre, tout atteste que vous êtes socialistes. Vous différez des apôtres par le degré, mais vous êtes sur la même pente. Voilà pourquoi, quand vous vous sentez distancés, au lieu de réfuter, — ce que vous ne savez pas faire, et ce que vous ne pourriez faire sans vous condamner vous-mêmes, — vous vous tordez les bras, vous vous arrachez les cheveux, vous en appelez à la compression, et vous dites piteusement : La France s’en va !
Non, la France ne s’en va pas. Car voici ce qui arrive : pendant que vous vous livrez à vos stériles lamentations, les socialistes se réfutent eux-mêmes. Ses docteurs sont en guerre ouverte. Le phalanstère y est resté ; la triade y est restée, l’atelier national y est resté ; votre nivellement des conditions par la Loi y restera. Qu’y a-t-il encore debout ? Le crédit gratuit. Que n’en démontrez-vous l’absurdité ? Hélas ! c’est vous qui l’avez inventé. Vous l’avez prêché pendant mille ans. Quand vous n’avez pu étouffer l’Intérêt, vous l’avez réglementé. Vous l’avez soumis au maximum, donnant ainsi à penser que la propriété est une création de la Loi, ce qui est justement l’idée de Platon, de Lycurgue, de Fénelon, de Rollin, de Robespierre ; ce qui est, je ne crains pas de l’affirmer, l’essence et la quintessence non-seulement du socialisme, mais du communisme. Ne me vantez donc pas un enseignement qui ne vous a rien enseigné de ce que vous devriez savoir, et qui vous laisse consternés et muets devant la première chimère qu’il plaît à un fou d’imaginer. Vous n’êtes pas en mesure d’opposer la vérité à l’erreur ; laissez au moins les erreurs se détruire les unes par les autres. Gardez-vous de bâillonner les utopistes, et d’élever ainsi leur propagande sur le piédestal de la persécution. L’esprit des masses laborieuses, sinon des classes moyennes, s’est attaché aux grandes questions sociales. Il les résoudra. Il arrivera à trouver pour ces mots : Famille, Propriété, Liberté, Justice, Société, d’autres définitions que celles que nous fournit votre enseignement. Il vaincra non-seulement le socialisme qui se proclame tel, mais encore le socialisme qui s’ignore. Il tuera votre universelle intervention de l’État, votre centralisation, votre unité factice, votre système protecteur, votre philanthropie officielle, vos lois sur l’usure, votre diplomatie barbare, votre enseignement monopolisé.
Et c’est pourquoi je dis : Non, la France ne s’en va pas. Elle sortira de la lutte, plus heureuse, plus éclairée, mieux ordonnée, plus grande, plus libre, plus morale, plus religieuse que vous ne l’avez faite.
Après tout, veuillez bien remarquer ceci : quand je m’élève contre les études classiques, je ne demande pas qu’elles soient interdites ; je demande seulement qu’elles ne soient pas imposées. Je n’interpelle pas l’État pour lui dire : Soumettez tout le monde à mon opinion, mais bien : Ne me courbez pas sous l’opinion d’autrui. La différence est grande, et qu’il n’y ait pas de méprise à cet égard.
M. Thiers, M. de Riancey, M. de Montalembert, M. Barthélemy Saint-Hilaire, pensent que l’atmosphère romaine est excellente pour former le cœur et l’esprit de la jeunesse, soit. Qu’ils y plongent leurs enfants ; je les laisse libres. Mais qu’ils me laissent libre aussi d’en éloigner les miens comme d’un air pestiféré. Messieurs les réglementaires, ce qui vous paraît sublime me semble odieux, ce qui satisfait votre conscience alarme la mienne. Eh bien ! suivez vos inspirations, mais laissez-moi suivre la mienne. Je ne vous force pas, pourquoi me forceriez-vous ?
Vous êtes très-convaincus qu’au point de vue social et moral le beau idéal est dans le passé. Moi, je le vois dans l’avenir. « Osons le dire à un siècle orgueilleux de lui-même, disait M. Thiers, l’antiquité est ce qu’il y a de plus beau au monde. » Pour moi, j’ai le bonheur de ne pas partager cette opinion désolante. Je dis désolante, car elle implique que, par une loi fatale, l’humanité va se détériorant sans cesse. Vous placez la perfection à l’origine des temps, je la mets à la fin. Vous croyez la société rétrograde, je la crois progressive. Vous croyez que nos opinions, nos idées, nos mœurs doivent, autant que possible, être jetées dans le moule antique ; j’ai beau étudier l’ordre social de Sparte et de Rome, je n’y vois que violences, injustices, impostures, guerres perpétuelles, esclavage, turpitudes, fausse politique, fausse morale, fausse religion. Ce que vous admirez, je l’abhorre. Mais enfin, gardez votre jugement et laissez-moi le mien. Nous ne sommes pas ici des avocats plaidant l’un pour l’enseignement classique, l’autre contre, devant une assemblée chargée de décider en violentant ma conscience ou la vôtre. Je ne demande à l’État que sa neutralité. Je demande la liberté pour vous comme pour moi. J’ai du moins sur vous l’avantage de l’impartialité, de la modération et de la modestie.
Trois sources d’enseignement vont s’ouvrir : celui de l’État, celui du Clergé, celui des Instituteurs prétendus libres.
Ce que je demande, c’est que ceux-ci soient libres, en effet, de tenter, dans la carrière, des voies nouvelles et fécondes. Que l’Université enseigne ce qu’elle chérit, le grec et le latin ; que le Clergé enseigne ce qu’il sait, le grec et le latin. Que l’une et l’autre fassent des platoniciens et des tribuns ; mais qu’ils ne nous empêchent pas de former, par d’autres procédés, des hommes pour notre pays et pour notre siècle.
Car, si cette liberté nous est interdite, quelle amère dérision n’est-ce pas que de venir nous dire à chaque instant : Vous êtes libres !
Dans la séance du 23 février, M. Thiers est venu dire pour la quatrième fois :
« Je répéterai éternellement ce que j’ai dit : La liberté que donne la loi que nous avons rédigée, c’est la liberté selon la Constitution.
Je vous mets au défi de prouver autre chose. Prouvez-moi que ce n’est pas la liberté ; pour moi, je soutiens qu’il n’y en a pas d’autre possible.
Autrefois, on ne pouvait pas enseigner sans la permission du gouvernement. Nous avons supprimé l’autorisation préalable ; tout le monde pourra enseigner.
Autrefois on disait : Enseignez telles choses ; n’enseignez pas telles autres. Aujourd’hui nous disons : Enseignez tout ce que vous voudrez enseigner. »
C’est une chose douloureuse de s’entendre adresser un tel défi et d’être condamné au silence. Si la faiblesse de ma voix ne m’eût interdit la tribune, j’aurais répondu à M. Thiers.
Voyons donc à quoi se réduit, au point de vue de l’instituteur, du père de famille et de la société, cette Liberté que vous dites si entière.
En vertu de votre loi, je fonde un collége. Avec le prix de la pension, il me faut acheter ou louer le local, pourvoir à l’alimentation des élèves et payer les professeurs. Mais à côté de mon Collége, il y a un Lycée. Il n’a pas à s’occuper du local et des professeurs. Les contribuables, moi compris, en font les frais. Il peut donc baisser le prix de la pension de manière à rendre mon entreprise impossible. Est-ce là de la liberté ? Une ressource me reste cependant ; c’est de donner une instruction si supérieure à la vôtre, tellement recherchée du public, qu’il s’adresse à moi malgré la cherté relative à laquelle vous m’avez réduit. Mais ici, je vous rencontre, et vous me dites : Enseignez ce que vous voudrez, mais, si vous vous écartez de ma routine, toutes les carrières libérales seront fermées à vos élèves. Est-ce là de la liberté ?
Maintenant je me suppose père de famille ; je mets mes fils dans une institution libre : quelle est la position qui m’est faite ? Comme père, je paye l’éducation de mes enfants, sans que nul me vienne en aide ; comme contribuable et comme catholique, je paye l’éducation des enfants des autres, car je ne puis refuser l’impôt qui soudoie les Lycées, ni guère me dispenser, en temps de carême, de jeter dans le bonnet du frère quêteur l’obole qui doit soutenir les Séminaires. En ceci, du moins, je suis libre. Mais le suis-je quant à l’impôt ? Non, non, dites que vous faites de la Solidarité, au sens socialiste, mais n’ayez pas la prétention de faire de la Liberté.
Et ce n’est là que le très-petit côté de la question. Voici qui est plus grave. Je donne la préférence à l’enseignement libre, parce que votre enseignement officiel (auquel vous me forcez à concourir, sans en profiter) me semble communiste et païen ; ma conscience répugne à ce que mes fils s’imprègnent des idées spartiates et romaines qui, à mes yeux du moins, ne sont que la violence et le brigandage glorifiés. En conséquence, je me soumets à payer la pension pour mes fils, et l’impôt pour les fils des autres. Mais qu’est-ce que je trouve ? Je trouve que votre enseignement mythologique et guerrier a été indirectement imposé au collége libre, par l’ingénieux mécanisme de vos grades, et que je dois courber ma conscience à vos vues sous peine de faire de mes enfants des parias de la société. — Vous m’avez dit quatre fois que j’étais libre. Vous me le diriez cent fois, que cent fois je vous répondrais : Je ne le suis pas.
Soyez inconséquents, puisque vous ne pouvez l’éviter, et je vous concède que dans l’état actuel de l’opinion publique vous ne pouviez fermer les colléges officiels. Mais posez une limite à votre inconséquence. Ne vous plaignez-vous pas tous les jours de l’esprit de la jeunesse ? de ses tendances socialistes ? de son éloignement pour les idées religieuses ? de sa passion pour les expéditions guerrières, passion telle, que, dans nos assemblées délibérantes, il est à peine permis de prononcer le mot de paix, et il faut prendre les précautions oratoires les plus ingénieuses pour parler de justice quand il s’agit de l’étranger ? Des dispositions si déplorables ont une cause sans doute. À la rigueur ne serait-il pas possible que votre enseignement mythologique, platonicien, belliqueux et factieux y fût pour quelque chose ? Je ne vous dis pas de le changer cependant, ce serait trop exiger de vous. Mais je vous dis : Puisque vous laissez naître à côté de vos Lycées, et dans des conditions déjà bien difficiles, des écoles dites libres, permettez-leur d’essayer, à leurs périls et risques, les voies chrétiennes et scientifiques. L’expérience vaut la peine d’être faite. Qui sait ? Peut-être, sera-t-elle un progrès. Et vous voulez l’étouffer dans son germe !
Enfin, examinons la question au point de vue de la Société, et remarquons d’abord qu’il serait étrange que la société fût libre, en matière d’enseignement, si les instituteurs et les pères de famille ne le sont pas.
La première phrase du rapport de M. Thiers sur l’instruction secondaire, en 1844, proclamait cette terrible vérité :
« L’éducation publique est l’intérêt peut-être le plus grand d’une nation civilisée, et, par ce motif, le plus grand objet de l’ambition des partis. »
Il semble que la conclusion à tirer de là, c’est qu’une nation qui ne veut pas être la proie des partis doit se hâter de supprimer l’éducation publique, c’est-à-dire par l’État, et de proclamer la liberté de l’enseignement. S’il y a une éducation confiée au pouvoir, les partis auront un motif de plus pour chercher à s’emparer du pouvoir, puisque, du même coup, ce sera s’emparer de l’enseignement, le plus grand objet de leur ambition. La soif de gouverner n’inspire-t-elle pas déjà assez de convoitise ? ne provoque-t-elle pas assez de luttes, de révolutions et de désordres ? et est-il sage de l’irriter encore par l’appât d’une si haute influence ?
Et pourquoi les partis ambitionnent-ils la direction des études ? Parce qu’ils connaissent ce mot de Leibnitz : « Faites-moi maître de l’enseignement, et je me charge de changer la face du monde. » L’enseignement par le pouvoir, c’est donc l’enseignement par un parti, par une secte momentanément triomphante ; c’est l’enseignement au profit d’une idée, d’un système exclusif. « Nous avons fait la république, disait Robespierre, il nous reste à faire des républicains » ; tentative qui a été renouvelée en 1848. Bonaparte ne voulait faire que des soldats, Frayssinous que des dévots, Villemain que des rhéteurs. M. Guizot ne ferait que doctrinaires, Enfantin que des saint-simoniens, et tel qui s’indigne de voir l’humanité ainsi dégradée, s’il était jamais en position de dire l’État c’est moi, serait peut-être tenté de ne faire que des économistes. Eh quoi ! ne verra-t-on jamais le danger de fournir aux partis, à mesure qu’ils s’arrachent le pouvoir, l’occasion d’imposer universellement et uniformément leurs opinions, que dis-je ? leurs erreurs par la force ? Car c’est bien employer la force que d’interdire législativement toute autre idée que celle dont on est soi-même infatué.
Une telle prétention est essentiellement monarchiste, encore que nul ne l’affiche plus résolûment que le parti républicain ; car elle repose sur cette donnée que les gouvernés sont faits pour les gouvernants, que la société appartient au pouvoir, qu’il doit la façonner à son image ; tandis que, selon notre droit public, assez chèrement conquis, le pouvoir n’est qu’une émanation de la société, une des manifestations de sa pensée.
Je ne puis concevoir, quant à moi, surtout dans la bouche des républicains, un cercle vicieux plus absurde que celui-ci : D’année en année, par le mécanisme du suffrage universel, la pensée nationale s’incarnera dans les magistrats, et puis ces magistrats façonneront à leur gré la pensée nationale.
Cette doctrine implique ces deux assertions : Pensée nationale fausse, pensée gouvernementale infaillible.
Et s’il en est ainsi, républicains, rétablissez donc tout à la fois Autocratie, Enseignement par l’État, Légitimité, Droit divin, Pouvoir absolu, irresponsable et infaillible, toutes institutions qui ont un principe commun et émanent de la même source.
S’il y a, dans le monde, un homme (ou une secte) infaillible, remettons-lui non-seulement l’éducation, mais tous les pouvoirs, et que ça finisse. Sinon, éclairons-nous le mieux que nous pourrons, mais n’abdiquons pas.
Maintenant, je répète ma question : Au point de vue social, la loi que nous discutons réalise-t-elle la liberté ?
Autrefois il y avait une Université. Pour enseigner, il fallait sa permission. Elle imposait ses idées et ses méthodes, et force était d’en passer par là. Elle était donc, selon la pensée de Leibnitz, maîtresse des générations, et c’est pour cela sans doute que son chef prenait le titre significatif de grand maître.
Maintenant tout cela est renversé. Il ne restera-à l’Université que deux attributions : 1° le droit de dire ce qu’il faudra savoir pour obtenir les grades : 2° le droit de fermer d’innombrables carrières à ceux qui ne se seront pas soumis.
Ce n’est presque rien, dit-on. Et moi je dis : Ce rien est tout.
Ceci m’entraîne à dire quelque chose d’un mot qui a été souvent prononcé dans ce débat : c’est le mot unité ; car beaucoup de personnes voient dans le Baccalauréat le moyen d’imprimer à toutes les intelligences une direction, sinon raisonnable et utile, du moins uniforme, et bonne en cela.
Les admirateurs de l’Unité sont fort nombreux, et cela se conçoit. Par décret providentiel, nous avons tous foi dans notre propre jugement, et nous croyons qu’il n’y a au monde qu’une opinion juste, à savoir : la nôtre. Aussi nous pensons que le législateur ne pourrait mieux faire que de l’imposer à tous, et, pour plus de sûreté, nous voulons tous être ce législateur. Mais les législateurs se succèdent, et qu’arrive-t-il ? C’est qu’à chaque changement, une Unité en remplace une autre. L’enseignement par l’État fait donc prévaloir l’uniformité en considérant isolément chaque période ; mais, si l’on compare les périodes successives, par exemple, la Convention, le Directoire, l’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la République, on retrouve la diversité et, qui pis est, la plus subversive de toutes les diversités, celle qui produit, dans le domaine intellectuel, comme sur un théâtre, des changements à vue, selon le caprice des machinistes. Laisserons-nous toujours descendre l’intelligence nationale, la conscience publique à ce degré d’abaissement et d’indignité ?
Il y a deux sortes d’Unités. L’une est un point de départ. Elle est imposée par la force, par ceux qui détiennent momentanément la force. L’autre est un résultat, la grande consommation de la perfectibilité humaine. Elle résulte de la naturelle gravitation des intelligences vers la vérité.
La première Unité a pour principe le mépris de l’espèce humaine, et pour instrument le despotisme. Robespierre était Unitaire quand il disait : « J’ai fait la république ; je vais me mettre à faire des républicains. » Napoléon était Unitaire quand il disait : « J’aime la guerre, et je ferai de tous les Français des guerriers. » Frayssinous était Unitaire quand il disait : « J’ai une foi, et par l’éducation je plierai à cette foi toutes les consciences. » Procuste était Unitaire quand il disait : « Voilà un lit : je raccourcirai ou j’allongerai quiconque en dépassera ou n’en atteindra pas les dimensions. » Le Baccalauréat est Unitaire quand il dit : « La vie sociale sera interdite à quiconque ne subit pas mon programme. » Et qu’on n’allègue pas que le conseil supérieur pourra tous les ans changer ce programme ; car, certes, on ne pourrait imaginer une circonstance plus aggravante. Quoi donc ! la nation tout entière serait assimilée à l’argile que le potier brise quand il n’est pas satisfait de la forme qu’il lui a donnée ?
Dans son rapport de 1844, M. Thiers se montrait admirateur très-ardent de cette nature d’Unité, tout en regrettant qu’elle fût peu conforme au génie des nations modernes.
« Le pays où ne règne pas la liberté d’enseignement, disait-il, serait celui où l’État, animé d’une volonté absolue, voulant jeter la jeunesse dans le même moule, la frapper, comme une monnaie, à son effigie, ne souffrirait aucune diversité dans le régime d’éducation, et, pendant plusieurs années, ferait vivre tous les enfants sous le même habit, les nourrirait des mêmes aliments, les appliquerait aux mêmes études, les soumettrait aux mêmes exercices, les plierait, etc…
Gardons nous, ajoutait-il, de calomnier cette prétention de l’État d’imposer l’unité de caractère à la nation, et de la regarder comme une inspiration de la tyrannie. On pourrait presque dire, au contraire, que cette volonté forte de l’État d’amener tous les citoyens à un type commun, s’est proportionnée au patriotisme de chaque pays. C’est dans les républiques anciennes, où la patrie était le plus adorée, le mieux servie, qu’elle montrait des exigences les plus grandes à l’égard des mœurs et de l’esprit des citoyens… Et nous qui, dans le siècle écoulé, avons présenté toutes les faces de la société humaine, nous qui, après avoir été Athéniens avec Voltaire, avons un moment voulu être Spartiates sous la Convention, soldats de César sous Napoléon, si nous avons un moment songé à imposer d’une manière absolue le joug de l’État sur l’éducation, c’est sous la Convention nationale, au moment de la plus grande exaltation patriotique. »
Rendons justice à M. Thiers. Il ne proposait pas de suivre de tels exemples. « Il ne faut, disait-il, ni les imiter ni les flétrir. C’était du délire, mais le délire du patriotisme. »
Il n’en reste pas moins que M. Thiers se montre encore ici fidèle à ce jugement par lui prononcé : « L’Antiquité est ce qu’il y a de plus beau au monde. » Il montre une prédilection secrète pour le despotisme absolu de l’État, une admiration instinctive pour les institutions de Crète et de Lacédémone qui donnaient au législateur le pouvoir de jeter toute la jeunesse dans le moule, de la frapper, comme une monnaie, à son effigie, etc., etc.
Et je ne puis m’empêcher de signaler ici, car cela rentre bien dans mon sujet, les traces de ce conventionalisme classique qui nous fait admirer dans l’antiquité, comme des vertus, ce qui était le résultat de la plus dure et de la plus immorale des nécessités. Ces anciens qu’on exalte, je ne saurais trop le répéter, vivaient de brigandage, et, pour rien au monde, n’auraient touché un outil. Ils avaient pour ennemi le genre humain tout entier. Ils s’étaient condamnés à une guerre perpétuelle et placés dans l’alternative de toujours vaincre ou de périr. Dès lors il n’y avait et ne pouvait y avoir pour eux qu’un métier, celui de soldat. La communauté devait s’attacher à développer uniformément chez tous les citoyens les qualités militaires, et les citoyens se soumettaient à cette unité qui était la garantie de leur existence [7].
Mais qu’y a-t-il de commun entre ces temps de barbarie et les temps modernes ?
Aujourd’hui, dans quel objet précis et bien déterminé frapperait-on tous les citoyens, comme une monnaie, à la même effigie ? Est-ce parce qu’ils se destinent tous à des carrières diverses ? Sur quoi se fonderait-on pour les jeter dans le même moule ?… et qui tiendra le moule ? Question terrible, qui devrait nous faire réfléchir. Qui tiendra le moule ? S’il y a un moule (et le Baccalauréat en est un), chacun en voudra tenir le manche, M. Thiers, M. Parisis, M. Barthélemy Saint-Hilaire, moi, les rouges, les blancs, les bleus, les noirs. Il faudra donc se battre pour vider cette question préalable, qui renaîtra sans cesse. N’est-il pas plus simple de briser ce moule fatal, et de proclamer loyalement la Liberté ?
D’autant que la Liberté, c’est le terrain où germe la véritable Unité et l’atmosphère qui la féconde. La concurrence a pour effet de provoquer, révéler et universaliser les bonnes méthodes, et de faire sombrer les mauvaises. Il faut bien admettre que l’esprit humain a une plus naturelle proportion avec la vérité qu’avec l’erreur, avec ce qui est bien qu’avec ce qui est mal, avec ce qui est utile qu’avec ce qui est funeste. S’il n’en était pas ainsi, si la chute était naturellement réservée au Vrai, et le triomphe au Faux, tous nos efforts seraient vains ; l’humanité serait fatalement poussée, comme le croyait Rousseau, vers une dégradation inévitable et progressive. Il faudrait dire, avec M. Thiers : L’antiquité est ce qu’il y a de plus beau au monde, ce qui n’est pas seulement une erreur, mais un blasphème. — Les intérêts des hommes, bien compris, sont harmoniques, et la lumière qui les leur fait comprendre brille d’un éclat toujours plus vif. Donc les efforts individuels et collectifs, l’expérience, les tâtonnements, les déceptions même, la concurrence, en un mot, la Liberté — font graviter les hommes vers cette Unité, qui est l’expression des lois de leur nature, et la réalisation du bien général.
Comment est-il arrivé que le parti libéral soit tombé dans cette étrange contradiction de méconnaître la liberté, la dignité, la perfectibilité de l’homme, et de leur préférer une Unité factice, stationnaire, dégradante, imposée tour à tour par tous les despotismes au profit des systèmes les plus divers ?
Il y a à cela plusieurs raisons : c’est d’abord qu’il a reçu, lui aussi, l’empreinte romaine de l’éducation classique. N’a-t-il pas pour meneurs des Bacheliers ? Ensuite, à travers les péripéties parlementaires, il espère bien voir tomber en ses mains cet instrument précieux, ce moule intellectuel, objet, selon M. Thiers, de toutes les ambitions. Enfin les nécessités de la défense contre l’injuste agression de l’Europe, en 92, n’ont pas peu contribué à populariser en France l’idée d’une puissante Unité.
Mais de tous les mobiles qui déterminent le libéralisme à sacrifier la liberté, le plus puissant est la crainte que lui inspirent, en matière d’éducation, les envahissements du clergé.
Cette crainte je ne la partage pas, mais je la comprends.
Considérez, dit le libéralisme, la situation du clergé en France, sa savante hiérarchie, sa forte discipline, sa milice de quarante mille membres, tous célibataires et occupant le premier poste dans chaque commune du pays, l’influence qu’il doit à la nature de ses fonctions, celle qu’il tire de la parole qu’il fait retentir sans contradiction et avec autorité en chaire, ou qu’il murmure au confessionnal, les liens qui l’attachent à l’État par le budget des cultes, ceux qui l’assujettissent à un chef spirituel qui est en même temps roi étranger, le concours que lui prête une compagnie ardente et dévouée, les ressources qu’il trouve dans les aumônes dont il est le distributeur ; considérez qu’il regarde comme son premier devoir de s’emparer de l’éducation, et dites si, dans ces conditions, la liberté de l’enseignement n’est pas un leurre.
Il faudrait un volume pour traiter cette vaste question et toutes celles qui s’y rattachent. Je me bornerai à une considération, et je dis :
Sous un régime libre, ce n’est pas le Clergé qui fera la conquête de l’Enseignement, mais l’Enseignement qui fera la conquête du Clergé. Ce n’est pas le Clergé qui frappera le Siècle à son effigie, mais le Siècle qui fera le Clergé à son image.
Peut-on douter que l’enseignement, dégagé des entraves universitaires, soustrait, par la suppression des grades, au conventionalisme classique, ne s’élançât, sous l’aiguillon de la rivalité, dans des voies nouvelles et fécondes ? Les institutions libres, qui surgiront laborieusement entre les lycées et les séminaires, sentiront la nécessité de donner à l’intelligence humaine sa véritable nourriture, à savoir : la science de ce que les choses sont et non la science de ce qu’on en disait il y a deux mille ans. « L’antiquité des temps est l’enfance du monde, dit Bacon, et, à proprement parler, c’est notre temps qui est l’antiquité, le monde ayant acquis du savoir et de l’expérience en vieillissant. » L’étude des œuvres de Dieu et de la nature dans l’ordre moral et dans l’ordre matériel, voilà la véritable instruction, voilà celle qui dominera dans les institutions libres. Les jeunes gens qui l’auront reçue se montreront supérieurs par la force de l’intelligence, la sûreté du jugement, l’aptitude à la pratique de la vie, aux affreux petits rhéteurs que l’université et le clergé auront saturés de doctrines aussi fausses que surannées. Pendant que les uns seront préparés aux fonctions sociales de notre époque, les autres seront réduits d’abord à oublier, s’ils peuvent, ce qu’ils auront appris, ensuite à apprendre ce qu’ils devraient savoir. En présence de ces résultats, la tendance des pères de famille sera de préférer les écoles libres, pleines de séve et de vie, à ces autres écoles succombant sous l’esclavage de la routine.
Qu’arrivera-t-il alors ? Le clergé, toujours ambitieux de conserver son influence, n’aura d’autre ressource que de substituer, lui aussi, l’enseignement des choses à l’enseignement des mots, l’étude des vérités positives à celle des doctrines de convention, et la substance à l’apparence.
Mais, pour enseigner, il faut savoir, et, pour savoir, il faut apprendre. Le clergé sera donc forcé de changer la direction de ses propres études, et la rénovation s’introduira jusque dans les séminaires. Or, pense-t-on qu’une autre nourriture ne fasse pas d’autres tempéraments ? Car, prenons-y garde, il ne s’agit pas ici seulement de changer la matière, mais la méthode de l’enseignement clérical. La connaissance des œuvres de Dieu et de la nature s’acquiert par d’autres procédés intellectuels que celle des théogonies. Observer les faits et leur enchaînement est une chose ; admettre sans examen un texte tabou et en tirer les conséquences en est une autre. Quand la science remplace l’intuition, l’examen se substitue à l’autorité, la méthode philosophique à la méthode dogmatique ; un autre but exige un autre procédé, et d’autres procédés donnent à l’esprit d’autres habitudes.
Il n’est donc pas douteux que l’introduction de la science dans les séminaires, résultat infaillible de la liberté d’enseignement, ne doive avoir pour effet de modifier, au sein de ces institutions, jusqu’aux habitudes intellectuelles. Et c’est là, j’en ai la conviction, l’aurore d’une grande et désirable révolution, celle qui réalisera l’Unité religieuse.
Je disais tout à l’heure que le conventionalisme classique faisait de nous tous des contradictions vivantes, Français par nécessité et Romains par l’éducation. Ne pourrait-on pas dire aussi qu’au point de vue religieux nous sommes des contradictions vivantes ?
Nous sentons tous dans le cœur une puissance irrésistible qui nous pousse vers la religion, et en même temps nous sentons dans notre intelligence une force non moins irrésistible qui nous en éloigne, et d’autant plus, c’est un point de fait, que l’intelligence est plus cultivée, en sorte qu’un grand docteur a pu dire : Litterati minus credunt.
Oh ! c’est un triste spectacle ! Depuis quelque temps surtout, nous entendons pousser de profonds gémissements sur l’affaiblissement des croyances religieuses, et, chose étrange, ceux-là mêmes qui ont laissé s’éteindre dans leur âme jusqu’à la dernière étincelle de la foi sont le plus disposés à trouver le doute impertinent… chez les autres. « Soumets ta raison, disent-ils au peuple, sans quoi tout est perdu. C’est bon à moi de m’en rapporter à la mienne, car elle est d’une trempe particulière, et, pour observer le Décalogue, je n’ai pas besoin de le croire révélé. Même quand je m’en écarterais quelque peu, le mal n’est pas grand ; mais toi, c’est différent, tu ne peux l’enfreindre sans mettre en péril la société… et mon repos. »
C’est ainsi que la peur cherche un refuge dans l’hypocrisie. On ne croit pas, mais on fait semblant de croire. Pendant que le scepticisme est au fond, une religiosité de calcul se montre à la surface, et voici qu’un conventionalisme nouveau, et de la pire espèce, déshonore l’esprit humain.
Et cependant tout n’est pas hypocrisie dans ce langage. Encore qu’on ne croie pas tout, encore qu’on ne pratique rien, il y a au fond des cœurs, comme dit Lamennais, une racine de foi qui ne sèche jamais.
D’où vient cette bizarre et dangereuse situation ? ne serait-ce pas qu’aux vérités religieuses, primordiales et fondamentales, auxquelles toutes les sectes et toutes les écoles adhèrent d’un consentement commun, se sont agrégés, avec le temps, des institutions, des pratiques, des rites, que l’intelligence, malgré qu’on en ait, ne peut admettre ? Et ces additions humaines ont-elles aucun autre support, dans l’esprit même du clergé, que le dogmatisme par lequel il les rattache aux vérités primordiales non contestées ?
L’Unité religieuse se fera, mais elle ne se fera que lorsque chaque secte aura abandonné ces institutions parasites auxquelles je fais allusion. Qu’on se rappelle que Bossuet en faisait bon marché quand il discutait avec Leibnitz sur les moyens de ramener à l’Unité toutes les confessions chrétiennes. Ce qui paraissait possible et bon au grand docteur du dix-septième siècle, serait-il regardé comme trop audacieux par les docteurs du dix-neuvième ? Quoi qu’il en soit, la liberté de l’enseignement, en faisant pénétrer d’autres habitudes intellectuelles dans le clergé, sera sans doute un des plus puissants instruments de la grande rénovation religieuse qui seule peut désormais satisfaire les consciences et sauver la société [8].
Les sociétés ont un tel besoin de morale, que le corps qui s’en fait, au nom de Dieu, le gardien et le distributeur, acquiert sur elles une influence sans bornes. Or, il est d’expérience que rien ne pervertit plus les hommes que l’influence illimitée. Il arrive donc un temps où, loin que le sacerdoce persiste à n’être que l’instrument de la religion, c’est la religion qui devient l’instrument du sacerdoce. Dès ce moment un antagonisme fatal s’introduit dans le monde. La Foi et l’Intelligence, chacune de leur côté, tirent tout à elles. Le prêtre ne cesse d’ajouter, à des vérités sacrées, des erreurs qu’il proclame non moins sacrées, offrant ainsi à l’opposition du laïque des motifs de plus en plus solides, des arguments de plus en plus sérieux. L’un cherche à faire passer le faux avec le vrai. L’autre ébranle le vrai avec le faux. La religion devient superstition, et la philosophie incrédulité. Entre ces deux extrêmes, la masse flotte dans le doute, et on peut dire que l’humanité traverse une époque critique. Cependant l’abîme se creuse toujours plus profond, et la lutte se poursuit non-seulement d’homme à homme, mais encore dans la conscience de chaque homme, avec des chances diverses. Une commotion politique vient-elle épouvanter la société, elle se jette, par peur, du côté de la foi ; une sorte de religiosité hypocrite prend le dessus, et le prêtre se croit vainqueur. Mais le calme n’a pas plutôt reparu, le prêtre n’a pas plutôt essayé de mettre à profit la victoire, que l’intelligence reprend ses droits et recommence son œuvre. Quand donc cessera cette anarchie ? quand est-ce que se scellera l’alliance entre l’intelligence et la foi ? — Quand la foi ne sera plus une arme ; quand le sacerdoce, redevenu ce qu’il doit être, l’instrument de la religion, abandonnera les formes qui l’intéressent, pour le fond qui intéresse l’humanité. Alors ce ne sera pas assez de dire que la religion et la philosophie sont sœurs, il faudra dire qu’elles se confondent dans l’Unité.
Mais je descends de ces régions élevées, et, revenant aux grades universitaires, je me demande si le clergé éprouvera une grande répugnance à abandonner les voies routinières de l’enseignement classique, ce à quoi, d’ailleurs, il ne sera nullement obligé.
Il serait plaisant que le communisme platonicien, le paganisme, les idées et les mœurs façonnées par l’esclavage et le brigandage, les odes d’Horace, les métamorphoses d’Ovide, trouvassent leurs derniers défenseurs et professeurs dans les prêtres de France ! Il ne m’appartient pas de leur donner des avis. Mais ils me permettront bien de citer ici l’extrait d’un journal qui, si je ne me trompe, est rédigé par des ecclésiastiques :
Quels sont donc, parmi les docteurs de l’Église, les apologistes de l’enseignement païen ? Est-ce saint Clément, qui a écrit que la science profane est semblable aux fruits et aux confitures qu’on ne doit servir qu’à la fin du repas? Est-ce Origène, qui a écrit que, dans les coupes dorées de la poésie païenne, il y a des poisons mortels ? Est-ce Tertullien qui appelle les philosophes païens les patriarches des hérétiques : Patriarchæ hæreticorum ? Est-ce saint Irénée, qui déclare que Platon a été l’assaisonnement de toutes les hérésies? Est-ce Lactance, qui constatait que de son temps les hommes lettrés étaient ceux qui avaient le moins de foi? Est-ce saint Ambroise disant qu’il est très-dangereux pour les chrétiens de s’occuper de l’éloquence profane? Est-ce saint Jérôme enfin, qui, dans sa lettre à Eustochie, condamnant avec énergie l’étude des païens, disait : Qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord peut-il exister entre le Christ et Bélial ? Qu’a affaire Horace avec le Psautier, Virgile avec l’Évangile ?… Saint Jérôme qui regrette si cruellement le temps qu’il a consacré dans sa jeunesse à l’étude des lettres païennes : « Malheureux que j’étais, je me privais de nourriture pour ne pas quitter Cicéron ; dès le grand matin, j’avais Plaute dans les mains. Si quelquefois, rentrant en moi-même, je commençais la lecture des prophètes, leur style me paraissait inculte, et, parce que j’étais aveugle, je niais la lumière. »
Mais écoutons parler saint Augustin :
« Les études par lesquelles je suis parvenu à lire les écrits des autres et à écrire ce que je pense étaient pourtant bien plus utiles et bien plus solides que celles auxquelles on me força depuis de m’adonner, qui concernaient les aventures de je ne sais quel Énée, et qui me faisaient pleurer sur le sort de Didon, mourant d’amour, tandis qu’oubliant mes propres fautes, je trouvais moi-même la mort dans ces lectures funestes… Ce sont pourtant ces folies qu’on appelle les belles et honnêtes lettres : Tales dementiæ honestiores et uberiores litteræ putantur… Qu’ils crient contre moi ces marchands de belles-lettres, je ne les crains pas, et je m’applique à sortir des mauvaises voies que j’ai suivies… Il est vrai que, de ces études, j’ai retenu beaucoup d’expressions qu’il est utile de savoir, mais tout cela peut s’apprendre ailleurs que dans des lectures si frivoles, et on devrait conduire les enfants dans une voie moins dangereuse. Mais qui ose te résister, ô maudit torrent de la coutume !… N’est-ce pas pour suivre ton cours qu’on m’a fait lire l’histoire de Jupiter qui, en même temps, tient la foudre et commet l’adultère ? On sait bien que c’est inconciliable ; mais, à l’aide de ce faux tonnerre, on diminue l’horreur qu’inspire l’adultère et on porte les jeunes gens à imiter les actions d’un dieu criminel.
Et néanmoins, ô torrent infernal, on précipite dans tes flots tous les enfants, on fait de cet usage coupable une grande affaire. Cela s’accomplit publiquement, sous les yeux des magistrats, pour un salaire convenu… C’est le vin de l’erreur que nous présentaient dans notre enfance des maîtres ivres ; ils nous châtiaient quand nous refusions de nous en abreuver, et nous ne pouvions en appeler de leur sentence à aucun juge qui ne fût ivre comme eux. Mon âme était ainsi la proie des esprits impurs, car ce n’est pas d’une seule manière qu’on offre des sacrifices aux démons. »
Ces plaintes si éloquentes, ajoute la feuille catholique, cette critique si amère, ces reproches si durs, ces regrets si touchants, ces conseils si judicieux, ne s’adressent-ils pas aussi bien à notre siècle qu’à celui pour lequel écrivait saint Augustin ? Ne conserve-t-on pas, sous le nom d’enseignement classique, le même système d’études contre lequel saint Augustin s’élève avec tant de force ? Ce torrent du paganisme n’a-t-il pas inondé le monde ? Ne précipite-t-on pas chaque année, dans ses flots, des milliers d’enfants qui y perdent la foi, les mœurs, le sentiment et la dignité humaine, l’amour de la liberté, la connaissance de leurs droits et de leurs devoirs, qui en sortent tout imprégnés des fausses idées du paganisme, de sa fausse morale, de ses fausses vertus, non moins que de ses vices et de son profond mépris pour l’humanité ?
Et cet effroyable désordre moral ne naît pas d’une perversion de volontés individuelles abandonnées à leur libre arbitre. Non, il est législativement imposé par le mécanisme des grades universitaires. M. de Montalembert lui-même, tout en regrettant que l’étude des lettres antiques ne fût pas assez forte, a cité les rapports des inspecteurs et doyens des facultés. Ils sont unanimes pour constater la résistance, je dirai presque la révolte du sentiment public contre une tyrannie si absurde et si funeste. Tous constatent que la jeunesse française calcule avec une précision mathématique ce qu’on l’oblige d’apprendre et ce qu’on lui permet d’ignorer, en fait d’études classiques, et qu’elle s’arrête juste à la limite où les grades s’obtiennent. En est-il de même dans les autres branches des connaissances humaines, et n’est-il pas de notoriété publique que, pour dix admissions, il se présente cent candidats tous supérieurs à ce qu’exigent les programmes ? Que le législateur compte donc la raison publique et l’esprit des temps pour quelque chose.
Est-ce un barbare, un Welche, un Gépide qui ose ici prendre la parole ? Méconnaît-il la suprême beauté des monuments littéraires légués par l’antiquité, ou les services rendus à la cause de la civilisation par les démocraties grecques ?
Non certes, il ne saurait trop répéter qu’il ne demande pas à la loi de proscrire, mais de ne pas prescrire. Qu’elle laisse les citoyens libres. Ils sauront bien remettre l’histoire dans son véritable jour, admirer ce qui est digne d’admiration, flétrir ce qui mérite le mépris, et se délivrer de ce conventionalisme classique qui est la plaie funeste des sociétés modernes. Sous l’influence de la liberté, les sciences naturelles et les lettres profanes, le christianisme et le paganisme, sauront bien se faire, dans l’éducation, la juste part qui leur revient, et c’est ainsi que se rétablira entre les idées, les mœurs et les intérêts, l’Harmonie qui est, pour les consciences comme pour les sociétés, la condition de l’ordre.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ [9]
Les mots ont leurs changeantes destinées comme les hommes. En voici deux que tour à tour l’humanité divinise ou maudit, — de telle sorte qu’il est bien difficile à la philosophie d’en parler de sang-froid. — Il fut un temps où celui-là eût risqué sa tête qui aurait osé examiner les syllabes sacrées, car l’examen suppose un doute ou la possibilité d’un doute. Aujourd’hui, au contraire, il n’est pas prudent de les prononcer en certain lieu, et ce lieu est celui d’où sortent les lois qui dirigent la France ! — Grâce au ciel, je n’ai à m’occuper ici de la Liberté et de l’Égalité qu’au point de vue économique. Par ce motif, j’espère que le titre de ce chapitre n’affectera pas d’une manière trop douloureuse les nerfs du lecteur.
Mais comment se fait-il que le mot Liberté fasse quelquefois palpiter tous les cœurs, enflamme l’enthousiasme des peuples et soit le signal des actions les plus héroïques, tandis que, dans d’autres circonstances, il semble ne s’échapper du rauque gosier populaire que pour répandre partout le découragement et l’effroi ? Sans doute il n’a pas toujours le même sens et ne réveille pas la même idée.
Je ne puis m’empêcher de croire que notre éducation toute romaine entre pour beaucoup dans cette anomalie…
Pendant de longues années le mot Liberté frappe nos jeunes organes, portant avec lui un sens qui ne peut s’ajuster aux mœurs modernes. Nous en faisons le synonyme de suprématie nationale au dehors, et d’une certaine équité, au dedans, pour le partage du butin conquis. Ce partage était en effet, entre le peuple romain et le sénat, le grand sujet des dissentions, au récit desquelles nos jeunes âmes prennent toujours parti pour le peuple. C’est ainsi que luttes du Forum et liberté finissent par former dans notre esprit une association d’idées indestructibles. Être libre, c’est lutter ; la région de la liberté, c’est la région des orages…
Ne nous tardait-il pas de quitter le collége pour aller tonner dans les places publiques contre le barbare étranger et l’avide patricien ?
Comment la liberté ainsi comprise peut-elle manquer d’être tour à tour un objet d’enthousiasme ou d’effroi pour une population laborieuse ?…
Les peuples ont été et sont encore tellement opprimés, qu’ils n’ont pu et ne peuvent conquérir la liberté que par la lutte. Ils s’y résignent quand ils sentent vivement l’oppression, et ils entourent les défenseurs de la liberté de leurs hommages et de leur reconnaissance. Mais la lutte est souvent longue, sanglante, mêlée de triomphes et de revers ; elle peut engendrer des fléaux pires que l’oppression… Alors le peuple, fatigué du combat, sent le besoin de reprendre haleine. Il se tourne contre les hommes qui exigent de lui des sacrifices au-dessus de ses forces, et se prend à redouter le mot magique au nom duquel on le prive de sécurité et même de liberté…
Quoique la lutte soit nécessaire pour conquérir la liberté, n’oublions pas que la liberté n’est pas la lutte, pas plus que le port n’est la manœuvre. Les écrivains, les politiques, les discoureurs imbus de l’idée romaine font cette confusion. Les masses ne la font pas. Lutter pour lutter leur répugne, et c’est en cela qu’elles justifient le mot profond : Il y a quelqu’un qui a plus d’esprit que les gens d’esprit, ce quelqu’un, c’est tout le monde…
Un fonds commun d’idées rattache les uns aux autres les mots Liberté, égalité, propriété, sécurité.
Liberté, qui a pour étymologie poids, balance, implique l’idée de justice, d’égalité, d’harmonie, d’équilibre — ce qui exclut la lutte, ce qui est justement l’inverse de l’interprétation romaine.
D’un autre côté, liberté c’est propriété généralisée. Mes facultés m’appartiennent-elles si je ne suis pas libre d’en faire usage, et l’esclavage n’est-il pas la négation la plus compléte de la propriété comme de la liberté ?
Enfin, liberté c’est sécurité, car sécurité c’est encore propriété garantie non-seulement dans le présent mais dans l’avenir…
Puisque les Romains, j’insiste là-dessus, vivaient de butin et chérissaient la liberté ; — puisqu’ils avaient des esclaves et chérissaient la liberté, — il est bien évident que l’idée de liberté n’était pour eux nullement incompatible avec les idées de vol et d’esclavage. — Donc il doit en être de même de toutes nos générations collégiennes, et ce sont celles qui régentent le monde. Dans leur esprit la propriété du produit des facultés, ou la propriété des facultés elles-mêmes n’a rien de commun avec la liberté, est un bien infiniment moins précieux. Aussi les atteintes théoriques à la propriété ne les émeuvent guère. Loin de là, pour peu que les lois y procèdent avec une certaine symétrie et dans un but en apparence philanthropique, cette sorte de communisme les charme…
Il ne faut pas croire que ces idées disparaissent quand le premier feu de la jeunesse est éteint, quand on s’est passé la fantaisie de troubler, à la manière des tribuns romains, le repos de la cité ; quand on a eu le bonheur de prendre part à quatre ou cinq insurrections, et qu’on a fini par choisir un état, travailler et acquérir de la propriété. — Non, ces idées ne passent pas. Sans doute on tient à sa propriété, on la défend avec énergie ; mais on fait peu de cas de la propriété d’autrui… Qu’il s’agisse de la violer, pourvu que ce soit par l’intervention de la loi, on n’en a pas le moindre scrupule… — Notre préoccupation à tous est de courtiser la loi, de tâcher de nous mettre dans ses bonnes grâces ; et, si elle a pour nous un sourire, vite nous lui demandons de violer à notre profit la propriété ou la liberté d’autrui… Cela se fait avec une naïveté charmante non-seulement par ceux qui s’avouent communistes ou communautaires, mais encore par ceux qui se proclament fanatiques de la propriété, par ceux que le seul mot de communisme met en fureur, par des courtiers, des fabricants, des armateurs, et même par les propriétaires par excellence, les propriétaires fonciers…
FN:Vingt ans auparavant, l’auteur, dans son premier écrit, signalait déjà la liberté de l’enseignement comme l’une des réformes que la nation devait s’efforcer d’obtenir. Voy., au tome Ier, l’opuscule intitulé : Aux électeurs du département des Landes.(Note de l’éditeur.)
FN:« Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine…, d’altérer la constitution physique et morale de l’homme, etc. » (Contrat social, chap. vii.)
FN:Voy. les pages 365 à 380 du présent volume.(Note de l’éditeur.)
FN:Rapport de M. Thiers sur la loi de l’instruction secondaire. 1844.
FN:L’éloignement ne contribue pas peu à donner à des figures antiques un caractère de grandeur. Si l’on nous parle du citoyen romain, nous ne nous représentons pas ordinairement un brigand occupé d’acquérir, aux dépens de peuples pacifiques, du butin et des esclaves ; nous ne le voyons pas circuler, à demi nu, hideux de malpropreté, dans des rues bourbeuses ; nous ne le surprenons pas fouettant jusqu’au sang ou mettant à mort l’esclave qui montre un peu d’énergie et de fierté. — Nous préférons nous représenter une belle tête supportée par un buste plein de force et de majesté, et drapé comme une statue antique. Nous aimons à contempler ce personnage dans ses méditations sur les hautes destinées de sa patrie. Il nous semble voir sa famille entourant le foyer qu’honore la présence des dieux ; l’épouse préparant le simple repas du guerrier et jetant un regard de confiance et d’admiration sur le front de son époux ; les jeunes enfants attentifs aux discours d’un vieillard qui endort les heures par le récit des exploits et des vertus de leur père…
Oh ! que d’illusions seraient dissipées si nous pouvions évoquer le passé, nous promener dans les rues de Rome, et voir de près les hommes que, de loin, nous admirons de si bonne foi ! …(Ébauche inédite de l’auteur, un peu antérieure à 1830.)
FN:Les pétrisseurs de sociétés ont quelquefois assez de pudeur pour ne pas dire : Je ferai, Je disposerai. Ils se servent volontiers de cette forme détournée, mais équivalente : On fera, On ne souffrira pas.
FN:Dans l’ébauche à laquelle nous avons emprunté la note précédente (page 454), l’auteur examine ces deux questions :
1° Si le renoncement à soi-même est un ressort politique préférable à l’intérêt personnel ;
2° Si les peuples anciens, et notamment les Romains, ont mieux pratiqué ce renoncement que les modernes.
Il se prononce, on le pense bien, pour la négative sur la première comme sur la seconde. Voici l’un de ses motifs à l’égard de celle-ci :
« Lorsque je sacrifie une partie de ma fortune à faire construire des murs et un toit, qui me préservent des voleurs et de l’intempérie des saisons, on ne peut pas dire que je sois animé du renoncement à moi-même, mais qu’au contraire, j’aspire à ma conservation.
De même lorsque les Romains sacrifiaient leurs divisions intestines à leur salut, lorsqu’ils exposaient leur vie dans les combats, lorsqu’ils se soumettaient au joug d’une discipline presque insupportable, ils ne renonçaient pas à eux-mêmes ; bien au contraire, ils embrassaient le seul moyen qu’ils eussent de se conserver et d’échapper à l’extermination dont les menaçait sans cesse la réaction des peuples contre leurs violences.
Je sais que plusieurs Romains ont fait preuve d’une grande abnégation personnelle, et se sont dévoués pour le salut de Rome. Mais cela s’explique aisément. L’intérêt qui détermina leur organisation politique n’était pas leur seul mobile. Des hommes habitués à vaincre ensemble, à détester tout ce qui est étranger à leur association, doivent avoir un orgueil national, un patriotisme très-exalté. Toutes les nations guerrières, depuis les hordes sauvages jusqu’aux peuples civilisés, qui ne font la guerre qu’accidentellement, tombent dans l’exaltation patriotique. À plus forte raison les Romains dont l’existence même était une guerre permanente. Cet orgueil national si exalté, joint au courage que donnent les habitudes guerrière, au mépris de la mort qu’il inspire, à l’amour de la gloire, au désir de vivre dans la postérité, devait fréquemment produire des actions éclatantes.
Aussi, je ne dis pas qu’aucune vertu ne puisse surgir d’une société purement militaire. Je serais démenti par les faits, et les bandes de brigands elles-mêmes nous offrent des exemples de courage, d’énergie, de dévouement, de mépris de la mort, de libéralité, etc. — Mais je prétends que, comme les bandes de pillards, les peuples pillards, au point de vue du renoncement à soi-même, ne l’emportent pas sur les peuples industrieux, et j’ajoute que les vices énormes et permanents de ceux-là ne peuvent être effacés par quelques actions éclatantes, indignes peut-être du nom de vertu, puisqu’elles tournent au détriment de l’humanité. »(Ébauche inédite de l’auteur, un peu antérieure à 1830.)
FN:Voir, dans Justice et Fraternité, les pages 316 et 317.(Note de l’éditeur.)
FN:Dans les premiers mois de 1850, l’auteur, qui travaillait au second volume des Harmonies, commençait pour ce volume un chapitre intitulé : Liberté, Égalité. Il renonça bientôt à lui donner cette destination et ne l’acheva point. Nous reproduisons ici ce fragment qui rentre dans l’idée de l’opuscule qu’on vient de lire.(Note de l’éditeur.)
T.250 (1850.01.10) SEP: Séance de 10 jan. 1850 (What is the Limit of the Functions of the State? Part II)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Checked against ASEP:
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source
T.250 (1850.01.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 jan. 1850) (What is the Limit of the Functions of the State?). In “Chronique,” JDE, 15 Jan. 1850, T. XXV, pp. 202-205; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 94-100. Not in OC.
Text: JDE version
[202]
CHRONIQUE.
Sommaire.—Quelle est la limite des fonctions de l'Etat? Discussion à la Société d'économie politique. — Le message du nouveau président des Etats-Unis: La communication entre les deux Océans, l'Esclavage, le Tarif. — La lettre de Robert Peel. — Le revenu public en Angleterre et en France. — Les ligueurs déclarent la guerre au système colonial. — Une mêlée de free-traders et de protectionnistes à Stafford. — Les décisions de l'Assemblée législative : l'impôt des boissons; — la guerre avec Rosas; — la guerre aux instituteurs primaires; — la loi sur l'enseignement secondaire.
Une des questions les plus délicates qu'on puisse examiner, qui tient à la fois à l'économie politique et à toutes les autres sciences, y compris la philosophie politique, a été abordée, et en plusieurs points traitée à fond, dans la dernière réunion de la Société d'économie politique.
Déjà plus d'une fois, sur l'insistance de quelques membres, cette question avait été mise à l'ordre du jour, mais la conversation s'était constamment jetée dans une digression ou un cas particulier : l'assistance, l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc. Cette fois, bien que les membres qui ont pris part à cette intéressante discussion se soient complu dans des questions spéciales, telles que le monopole des assurances par l'Etat, le crédit foncier et d'autres, nous avons été heureux de voir que la difficulté était franchement abordée, sondée, creusée, précisée, et même en partie résolue.
[203]
La parole a été donnée d'abord à M. Wolowski, représentant du peuple, qui voudrait agrandir les fonctions de l'Etat, et faire servir les rouages de l'administration et les avantages de la centralisation à une meilleure constitution d'assurances, et à la fondation, en France, d'institutions de crédit foncier, analogues à celles qui sont établies en Allemagne et en Pologne. M. Wolowski croit qu'il serait utile et avantageux que l'Etat, sans se mêler d'opérations de banque proprement dites, pût centraliser les payements des intérêts de la dette foncière et de l'amortissement, les remboursements de cette dette, et donner une garantie considérable aux papiers représentatifs de ces créances et des propriétés hypothéquées. Il croit encore que le mécanisme de l'Etat peut être utilement employé à l'organisation des caisses de retraite, car il inspire la plus grande confiance possible pour les versements, et la plus grande sécurité pour le payement des pensions de retraite.
Dans tout cela, M. Wolowski pense qu'on peut agir sans contrainte aucune, et seulement par la voie de facilités offertes, de manière à provoquer, à féconder la prévoyance des citoyens, tout en faisant disparaître du corps social des emplois parasites. L'honorable représentant croit bien que notre pays est trop porté à l'intervention de l'Etat; mais, s'il redoute cette intervention toutes les fois qu'il s'agit de la production de la richesse, il la trouve avantageuse dans toutes les institutions dont le but est la conservation de cette richesse.
M. Hovyn-Tranchère a fait le procès à la manie de l'intervention de l'Etat en général; il y a vu avec raison le socialisme pur et simple; et il a montré qu'entre les doctrines économiques du Luxembourg et celles de beaucoup d'hommes appartenant aux partis les plus opposés, il n'y a d'autre différence que la logique poussée à l'extrême par les révolutionnaires de l’espèce dont nous venons de parler, et qui est incomplète chez les autres. L'intervention de l'Etat est la plaie de notre temps; M. Hovyn-Tranchère pense qu'il faut la combattre partout et à outrance, et qu'en ce moment il est même dangereux de s'arrêter à la discussion des questions spéciales où il y aurait peut-être avantage à laisser l'Etat intervenir plus ou moins.
Jetant les yeux sur la question du crédit foncier, M. Hovyn-Tranchère a dit, avec une grande raison, que les nombreuses illusions qui ont couru à cet égard (et qui ont été caressées par tant de membres de la Constituante, et notamment par le Comité d'agriculture ; voir le si étonnant rapport de M. Flandin) n'ont pas d'autre cause que l'ignorance des notions les plus élémentaires de l'économie politique. Après y avoir réfléchi, l'honorable représentant pense que le plus grand service et le seul service que l'on puisse rendre au crédit foncier et aux propriétaires obérés, c'est de faciliter la vente des biens et la liquidation des fortunes par la diminution des droits de mutation.
Ce sujet a conduit naturellement l'honorable membre à parler de l'enseignement actuel, qu'il juge avec la plus grande sévérité, d'après les fruits qu'il a portés. La plupart des hommes qui arrivent aux affaires font des concessions au socialisme. Ils ont des paroles éloquentes pour l'ordre et la liberté; ils font preuve de courage, mais ils ne laissent aucune trace de leur passage. Puisque le niveau de l'intelligence et de la moralité publique s'abaisse, l'honorable membre en conclut que si l'arbre donne de tels fruits depuis si longtemps, c'est qu'il est véreux et qu'il y a lieu de l'arracher.
Comme conclusion générale, M. Hovyn-Tranchère pense que les hommes [204] chargés de l'administration du pays doivent s'arrêter nettement et brusquement dans la voie d'intervention qui nous perdra.
M. Bastiat a parlé dans le même sens que M. Hovyn. Il s'est précisément servi du progrès de l'industrie des assurances pour montrer combien l'association a d'avenir, et le danger qu'il y aurait à ce que l'Etat s'emparât de cette branche de l'activité humaine, qui se trouverait ipso facto arrêtée et paralysée, et qui n'aurait jamais progressé si, dès le début, l'Etat était intervenu avec ses entraves et ses traditions bureaucratiques. Il trouve les mêmes arguments dans le développement des caisses de secours mutuels des ouvriers, et il insiste surtout sur ce point que l'Etat, en intervenant, arrête l'activité individuelle, énerve l'action sociale et détrempe le ressort qui pousse l'espèce humaine vers son amélioration et son développement. M. Bastiat ne connaît et n'admet l'utilité de l'intervention de l'Etat que dans le maintien et la garantie de la sécurité, lesquels peuvent nécessiter l'emploi de la force.
L'honorable membre, combattant une proposition de M. Wolowski, pense que l'Etat a encore moins à se mêler de la conservation de la richesse que de sa production, puisqu'il faut plus de mérite, de prévoyance et de ressort individuel pour garder ce qu'on a que pour le gagner.
M. Cherbuliez, rentrant tout à fait dans le sujet de la conversation, s'est demandé quels pouvaient être pour la solution de la difficulté que s'est proposée la Société d'économie politique, les principes généraux, supérieurs, et dirigeants, pour ainsi dire, à l'aide desquels il serait possible de déterminer, une fonction étant donnée, si elle est d'ordre gouvernemental ou si elle doit être laissée à l'industrie particulière.
En analysant l'action de l'Etat, M. Cherbuliez croit qu'elle comprend trois choses : l'unité début, l'unité de direction, et la concentration de forces pour atteindre ce but.
Essayant la sécurité et l'enseignement à cette pierre de touche, il montre qu'en fait de sécurité il y a nécessairement unité de but et de direction pour tous les membres de la société, tous intéressés à ce que l'ordre soit maintenu et la justice rendue de la même manière ; et, finalement, que, pour arriver à ce résultat, il est indispensable que la société concentre toutes ses forces. Il n'en est pas de même pour l'enseignement. Là, l'unité de but n'existe pas ; les citoyens sont catholiques, protestants, juifs, etc., croyants ou non croyants; ils ont mille routes ouvertes devant eux pour l'instruction de leurs enfants, et l'unité de direction conduit simplement à la tyrannie pour l'éducation, et pour l'instruction à ce niveau bâtard, sous lequel nous gémissons.
M. de Colmont, suivant la discussion sur ce terrain de la recherche d'un principe général, pense que l'action du gouvernement doit porter sur la défense de tous les intérêts, et être restreinte au maintien de toutes les libertés ou de toutes les facultés, expressions qui sont, pour ainsi dire, synonymes. C'est ainsi qu'il doit s'occuper de l'administration de la justice et de la perception des taxes que ce soin nécessite. C'est ainsi que le gouvernement, entraîné par la force des choses, doit se réserver le monopole de la fabrication des monnaies, puisqu'il y a avantage et sécurité pour tous à ce que cette fabrication soit confiée à ses soins uniques. Il en est de même du service postal et de toutes les fonctions où il est reconnu que l'action de l'Etat est indispensable pour maintenir le plein exercice des libertés et des facultés de chacun.
Aux yeux de M. Say, le critérium le plus pratique pour juger si une [205] fonction doit être réservée à l'Etat, ou lui être interdite, est celui-ci: —L'Etat fait-il mieux ou fait-il plus mal que l'industrie privée ? — Analysant le travail et le développement des sociétés d'assurance, par exemple, M. Say démontre que l'Etat n'aurait jamais pu se tirer des difficultés qu'offre cette industrie; qu'il n'aurait jamais su apprécier les risques, et qu'il n'aurait pas su lutter contre les fausses déclarations et les fausses manœuvres avec la même habileté que les Compagnies stimulées par l'intérêt privé. C'est tout le contraire pour la sécurité, à propos de laquelle il est impossible de mieux faire que de mettre une partie du revenu en commun, afin que les agents d'une association générale nous garantissent la sécurité, la justice, l'ordre et la liberté de travailler, de consommer, de tester, de donner notre bien, et de l'échanger avec qui bon nous semble. Il va sans dire que, sur ces divers points, l'Etat ne remplit nullement son but, et que la liberté est encore singulièrement méconnue par lui.
M. Coquelin a rappelé un principe général qu'il avait déjà émis dans une précédente discussion. L'Etat, selon lui, ne peut pas ne pas intervenir en matière de sécurité et de justice :lui seul, planant au-dessus de toutes les activités, comme sur un Sinaï, peut garantir la liberté et la concurrence, qui sont la vie de toutes les industries. Mais, au-dessous de ce Sinaï, M. Coquelin n'admet pas d'exceptions, pas même celle des chemins de fer, pour lesquels cependant il conçoit qu'on ait pu hésiter.
Avant de lever la séance, M. Ch.Dunoyer, président, a tenu à faire une observation de quelque utilité surtout pour ceux qui concluraient de la tendance générale des économistes à simplifier les fonctions de l'Etat, que l'action de celui-ci serait réduite à néant. Il a dit que le gouvernement le plus simple, celui qui ne s'occuperait que de garantir la sécurité, la justice, la liberté, la propriété aux citoyens, interviendrait encore nécessairement dans toutes les actions des hommes ; que seulement il n'interviendrait plus que d'une manière légitime pour la confection de bonnes lois répressives de tout ce qui est mauvais et abusif, ainsi que pour l'application de ces lois. Ce n'est pas un médiocre service, par exemple, que de rendre la justice; aujourd'hui elle n'est rendue que d'une manière très-incomplète, et ce n'est qu'en se renfermant dans sa grande et belle spécialité que l'Etat parviendra à perfectionner son action, à mieux garantir la sécurité, à mieux faire triompher la liberté et l'égalité parmi les hommes, à mieux servir la civilisation.
Sur l'observation de M. Joseph Garnier, que cette discussion avait amené la production de plusieurs principes, qui avaient besoin d'être médités, rapprochés comparés, la Société a décidé qu'elle la reprendrait dans une prochaine séance.
Text: ASEP version
Séance du 10 janvier 1850.
Une des questions les plus délicates qu'on puisse examiner, qui tient à la fois à l'économie politique et à toutes les autres sciences, y compris la philosophie politique, a été abordée, et en plusieurs points traitée à fond, dans cette réunion.
Déjà plus d'une fois, sur l'insistance de quelques membres, cette question avait été mise à l'ordre du jour, mais la conversation s'était constamment jetée dans une digression ou un cas particulier : l'assistance, l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc. Cette fois, bien que les membres qui ont pris part à cette intéressante discussion se soient complu dans des questions spéciales, telles que le monopole des assurances par l'État, le crédit foncier et d'autres, nous avons été heureux de voir que la difficulté était franchement abordée, sondée, creusée, précisée, et même en partie résolue.
La parole a été donnée d'abord à M. Wolowski, représentant du peuple, qui voudrait agrandir les fonctions de l'État, et faire servir les rouages de l'administration et les avantages de la centralisation àune meilleure constitution d'assurances, et à la fondation, en France, d'institutions de crédit foncier, analogues à celles qui sont établies en Allemagne et en Pologne. M. Wolowski croit qu'il serait utile et avantageux que l'État, sans se mêler d'opérations de banque proprement dites, pût centraliser les payements des intérêts de la dette foncière et de l'amortissement, les remboursements de cette dette, et donner une garantie considérable aux papiers représentatifs de ces créances et des propriétés hypothéquées. Il croit encore que le mécanisme de l'État peut être utilement employé à l'organisation des caisses de retraite, car il inspire la plus grande confiance possible pour les versements, et la plus grande sécurité pour le payement des pensions de retraite.
Dans tout cela, M. Wolowski pense qu'on peut agir sans contrainte aucune, et seulement par la voie de facilités offertes, de manière à provoquer, à féconder la prévoyance des citoyens, tout en faisant disparaître du corps social des emplois parasites. L'honorable représentant croit bien que notre pays est trop porté à l'intervention de l'État; mais, s'il redoute cette intervention toutes les fois qu'il s'agit de la production de la richesse, il la trouve avantageuse dans toutes les institutions dont le but est la conservation de cette richesse.
M. Jules Howyn de Tranchère a fait le procès à la manie de l'intervention de l'État en général; il y a vu le socialisme pur et simple; et il a montré qu'entre les doctrines économiques du Luxembourg et celles de beaucoup d'hommes appartenant aux partis les plus opposés, il n'y a d'autre différence que la logique poussée à l'extrême par les révolutionnaires de l'espèce dont nous venons de parler, et qui est incomplète chez les autres. L'intervention de l'Etat est la plaie de notre temps. M. Howyn de Tranchère pense qu'il faut la combattre partout et à outrance, et qu'en ce moment il est même dangereux de s'arrêter à la discussion des questions spéciales où il y aurait peut-être avantage àlaisser l'État intervenir plus ou moins.
Jetant les yeux sur la question du crédit foncier, M. Howyn de Tranchère a dit que les nombreuses illusions qui ont couru à cet égard (et qui ont été caressées par tant de membres de la Constituante, et notamment par le Comité d'agriculture) voir le si étonnant rapport de M. Flandin) n'ont pas d'autre cause que l'ignorance des notions les plus élémentaires de l'économie politique. Après y avoir réfléchi, l'honorable représentant pense que le plus grand service et le seul service que l'on puisse rendre au crédit foncier et aux propriétaires obérés, c'est de faciliter la vente des biens et la liquidation des fortunes par la diminution des droits de mutation.
Ce sujet a conduit naturellement l'honorable membre à parler de l'enseignement actuel, qu'il juge avec la plus grande sévérité, d'après les fruits qu'il a portés. La plupart des hommes qui arrivent aux affaires font des concessions au socialisme. Ils ont des paroles éloquentes pour l'ordre et la liberté; ils font preuve de courage, mais ils ne laissent aucune trace de leur passage. Puisque le niveau de l'intelligence et de la moralité publique s'abaisse, l'honorable membre en conclut que si l'arbre donne de tels fruits depuis si longtemps, c'est qu'il est véreux et qu'il y a lieu de l'arracher.
Comme conclusion générale, M. Howyn de Tranchère pense que les hommes chargés de l'administration du pays doivent s'arrêter nettement et brusquement dans la voie d'intervention qui nous perdra.
M. Bastiat a parlé dans le même sens que M. Howyn. Il s'est précisément servi du progrès de l'industrie des assurances pour montrer combien l'association a d'avenir, et le danger qu'il y aurait à ce que l'Etat s'emparât de cette branche de l'activité humaine, qui se trouverait ipso facto arrêtée et paralysée, et qui n'aurait jamais progressé si, dès le début, l'Etat était intervenu avec ses entraves et ses traditions bureaucratiques. Il trouve les mêmes arguments dans le développement des caisses de secours mutuels des ouvriers, et il insiste surtout sur ce point que l'Etat, en intervenant, arrête l'activité individuelle, énerve l'action sociale et détrempe le ressort qui pousse l'espèce humaine vers son amélioration et son développement. M. Bastiat ne connaît et n'admet l'utilité de l'intervention de l'Etat que dans le maintien et la garantie de la sécurité, lesquels peuvent nécessiter l'emploi dela force.
L'honorable membre, combattant une proposition de M. Wolowski, pense que l'Etat a encore moins à se mêler de la conservation de la richesse que de sa production, puisqu'il faut plus de mérite, de prévoyance et de ressort individuel pour garder ce qu'on a que pour le gagner.
M. A.-E. Cherbuliez, rentrant tout à fait dans le sujet de la conversation, s'est demandé quels pouvaient être pour la solution de la difficulté que s'est proposée la Société d'économie politique, les principes généraux, supérieurs, et dirigeants, pour ainsi dire, à l'aide desquels il serait possible de déterminer, une fonction étant donnée, si elle est d'ordre gouvernemental ou si elle doit être laissée à l'industrie particulière.
En analysant l'action de l'Etat, M. Cherbuliez croit qu'elle comprend trois choses : l'unité de but, l'unité de direction et la concentration de forces pour atteindre ce but.
Essayant la sécurité et l'enseignement à cette pierre de touche, il montre qu'en fait de sécurité il y a nécessairement unité de but et de direction pour tous les membres de la société, tous intéressés à ce que l'ordre soit maintenu et la justice rendue de la même manière,et, finalement, que pour arriver à ce résultat il est indispensable que la société concentre toutes ses forces. Il n'en est pas de même pour l'enseignement. Là, l'unité de but n'existe pas; les citoyens sont catholiques, protestants, juifs, etc., croyants ou non croyants ; ils ont mille routes ouvertes devant eux pour l'instruction de leurs enfants, et l'unité de direction conduit simplement à la tyrannie pour l'éducation, et pour l'instruction, à ce niveau bâtard sous lequel nous gémissons.
M. S.-J. de Colmont, suivant la discussion sur ce terrain de la recherche d'un principe général, pense que l'action du gouvernement doit porter sur la défense de tous les intérêts, et être restreinte au maintien de toutes les libertés ou de toutes les facultés, expressions qui sont, pour ainsi dire, synonymes. C'est ainsi qu'il doit s'occuper de l'administration de la justice et de la perception des taxes que ce soin nécessite. C'est ainsi que le gouvernement, entraîné par la force des choses, doit se réserver le monopole de la fabrication des monnaies, puisqu'il y a avantage et sécurité pour tous à ce que cette fabrication soit confiée à ses soins uniques. Il en est de même du service postal et de toutes les fonctions où il est reconnu que l'action de l'Etat est indispensable pour maintenir le plein exercice des libertés et des facultés de chacun.
Aux yeux de M. H.SAY, le criterium le plus pratique pour juger si une fonction doit être réservée à l'Etat, ou lui être interdite, est celui-ci : — L'Etat fait-il mieux ou fait-il plus mal que l'industrie privée? — Analysant le travail et le développement des sociétés d'assurance, par exemple, M. Say démontre que l'Etat n'avait jamais pu se tirer des difficultés qu'offre cette industrie; qu'il n'aurait jamais su apprécier les risques, et qu'il n'aurait pas su lutter contre les fausses déclarations et les fausses manœuvres avec la même habileté que les compagnies stimulées par l'intérêt privé. C'est tout le contraire pour la sécurité, à propos de laquelle il est impossible de mieux faire que de mettre une partie du revenu en commun, afin que les agents d'une association générale nous garantissent la sécurité, la justice, l'ordre et la liberté de travailler, de consommer, de tester, de donner notre bien, et de l'échanger avec qui bon nous semble. Il va sans dire que, sur ces divers points, l'Etat ne remplit nullement son but, et que la liberté est encore singulièrement méconnue par lui.
M. Coquelin a rappelé un principe général qu'il avait déjà émis dans une précédente discussion. L'Etat, selon lui, ne peut pas ne pas intervenir en matière de sécurité et de justice ; lui seul, planant au-dessus de toutes les activités, comme sur un Sinaï, peut garantir la liberté et la concurrence, qui sont la vie de toutes les industries. Mais, au-dessous de ce Sinaï, M. Coquelin n'admet pas d'exception, pas même celle des chemins de fer, pour lesquels cependant il conçoit qu'on ait pu hésiter.
Avant de lever la séance, M. Ch. Dunoyer, président, a tenu à faire une observation de quelque utilité surtout pour ceux qui concluraient de la tendance générale des économistes à simplifier les fonctions de l'Etat, que l'action de celui-ci serait réduite au néant. Il a dit que le gouvernement le plus simple, celui qui ne s'occuperait que de garantir la sécurité, la justice, la liberté, la propriété aux citoyens, interviendrait encore nécessairement dans toutes les actions des hommes; que seulement il n'interviendrait plus que d'une manière légitime pour la confection de bonnes lois répressives de tout ce qui est mauvais et abusif, ainsi que pour l'application de ces lois. Ce n'est pas un médiocre service, par exemple, que de rendre la justice ; aujourd'hui elle n'est rendue que d'une manière très incomplète, et ce n'est qu'en se renfermant dans sa grande et belle spécialité que l'Etat parviendra à perfectionner son action, à mieux garantir la sécurité, à mieux faire triompher la liberté et l'égalité parmi les hommes, à mieux servir la civilisation.
Sur l'observation de M. Joseph Garnier, que cette discussion avait amené l'émission de plusieurs principes, qui avaient besoin d'être médités, rapprochés, comparés, la Société a décidé qu'elle la reprendrait dans une prochaine séance.
T.251 (1850.02.10) SEP: Séance de 10 fev. 1850 (the limits to state power - Part 3??)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against PDF:
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source Info
T.251 (1850.02.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 fev. 1850) (What is the Limit of the Functions of the State? cont.). In “Chronique,” JDE, T. XXV, no. 107, 15 fev., 1850, pp. 314-17; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 100-5. Not in OC.
[need to compare with JDE version]
3rd debate in SEP on this topic (second formal discussion but a topic they have touched on before) . In same issue of JDE feb 1850 A. Clément has article summarizing situation??
“Des attributions rationnelles de l’autorité publique,” pp. 228-250.
Reaction to GdM’s challenge?? and socialists of 1848-49??
Text: JDE version
CHRONIQUE.
SOMMAIRE. - Plan d'union économique de l'Autriche avec l'Allemagne ; programme de M. de Bruck, ministre du commerce en Autriche. - Seconde discussion à la Société d'économie politique, sur les limites rationnelles de l'autorité. - Nouvelle loi des céréales en Belgique; progrès des idées libérales dans ce pays. - L'agitation protectionniste battue en Angleterre. - La réforme coloniale devant le Parlement. Soulouque suit les conseils des socialistes et des réglementaires. - Election de M. Lavergne à la chaire d'économie rurale de Versailles. - La chaire d'économie politique de l'école des ponts et chaussées devant la Commission des finances.-Discussion sur la loi de l'enseignement. - Vote sur les associations ouvrières.- Vote du traité belge, etc.
–Nous publions un article étudié, de notre collaborateur M. A. Clément, sur la question fondamentale de la limite des attributions rationnelles de l'autorité, dont la Société d'économie politique s'est occupée dans ses deux dernières réunions.
Nous avons résumé le gros des idées émises sur ce sujet délicat dans la séance du 10 janvier, et nous allons retracer, en peu de lignes également, les [315] opinions des membres qui ont pris la parole dans la dernière réunion, après un résumé de la discussion précédente, présenté par M. Joseph Garnier, sur l'invitation de M. Dunoyer, président.
M. Michel Chevalier a établi en principe que la solution du problème posé ne se rencontrait que dans un idéal dont la civilisation se rapproche progressivement, idéal qui consiste dans un maximum de liberté accordé aux citoyens, et dans un minimum d'attributions réservées au gouvernement. Mais il est difficile de préciser ce maximum et ce minimum; car ils dépendent de la virtualité de l'industrie individuelle, des aptitudes des citoyens et du ressort public. Il faut même renoncer à vouloir formuler ces limites ; et imiter les Anglais et les Américains qui, toutes les fois qu'ils ont eu à faire intervenir l'Etat dans de grandes entreprises, n'ont pas songé à ériger leur conduite du moment en un système général, et lui ont laissé le caractère d'expediency.
Quand il s'est agi du canal Erié, on n'a pas agité la question de savoir s'il valait mieux que l'Etat fît les canaux ou n'en fît pas; on s'est demandé qui pouvait le faire : et comme il a été constaté que les particuliers seuls ne pouvaient pas entreprendre cette voie d'utilité publique, l'Etat est intervenu ; mais l'intervention de l'Etat a été la règle momentanée, et plus tard on a laissé agir les compagnies. Les faits se sont passés de même en Angleterre.
Dans l'Etat de New-York encore, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de professeurs supérieurs, qu'il n'y en avait pas assez pour les besoins publics; et le gouvernement, sans poser ce principe qu'il accaparait l'enseignement, a formé une université, tout en ne se mêlant d'ailleurs pas de l'instruction secondaire à laquelle suffisait pleinement l'enseignement libre.
En France, nous avons trop l'habitude de vouloir généraliser et poser des principes immuables à propos de tout. Ainsi ont fait ceux qui, érigeant quelques faits en principe, en ont conclu qu'à jamais l'Etat serait chargé seul des chemins de fer. Ainsi ont fait les adversaires de la liberté commerciale, qui ont poussé leur protestation à l'extrême, et l'ont érigée en cette folle théorie de travail national incompatible avec tout progrès, toute réforme.
M. Bastiat a fait remarquer que les Anglais lui ont paru beaucoup plus disposés à aborder la question de principes que ne l'a dit M. Michel Chevalier. Quand il s'est agi parmi eux du free trade, M. Cobden et ses amis sont tout d'abord descendus au fond de la doctrine, et ils n'ont cessé, pendant leur mémorable campagne d'en proclamer la légitimité et d'en déduire la démonstration.
Revenant au point principal de la discussion, M. Bastiat a dit que la société étant basée sur un échange général de services, cet échange doit se faire librement; et que l'État, en intervenant et en voulant rendre des services, viole la liberté des acheteurs de ces services, en les forçant de les accepter et de les payer à un prix de maximum. D'où il a conclu de nouveau à l'injustice de l'intervention du gouvernement partout ailleurs que dans la production de la sécurité et la gestion de quelques propriétés communes, fontaines, fleuves, etc., au sujet desquelles l'ensemble des citoyens, l'être collectif, délègue ses droits et sa force pour les soutenir.
M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, et l'un des vice-présidents de la Société, a reconnu pour l'État deux devoirs en dehors desquels son intervention lui paraît nuisible.
Le premier des devoirs de l'Etat est de ne pas s'opposer au libre développement de la moralité et de la liberté en s'immisçant dans les fonctions des [316] citoyens; le second est de bien gérer ce qui forme l'intérêt de tous, de maintenir la sécurité et la justice intérieure, de garantir l'indépendance du territoire, de bien conduire les relations de l'association avec les autres associations du monde, et de constituer une force publique suffisante en hommes et en finances pour inspirer le respect. En dehors de l'accomplissement de ces devoirs, le gouvernement usurpe ses attributions.
M. Renouard a insisté, dans une vive et spirituelle conversation, sur l'importance de ne pas faire mal : assurément le bien est ce qu'il y a de préférable; mais, à défaut de bien , l'absence du mal est un grand bien relatif à côté du mal. Or, c'est en s'abstenant de plus en plus d'accaparer les diverses branches de travail que les gouvernements cesseront au moins de faire un certain mal, et laisseront la société se dégager elle-même de ses langes et s'avancer vers la liberté, la moralité, et la civilisation. M. Renouard s'est plu à constater qu'à tout prendre, l'humanité s'avançait constamment vers le progrès, et qu'on pouvait s'apercevoir de cette marche en considérant seulement des périodes de temps même assez courtes. La société vaut mieux qu'il y a cinquante ans, et il y a cinquante ans, elle valait mieux que du temps de Louis XIV, qui fut un grand roi, mais sous lequel personne de nous ne voudrait vivre.
La parole a ensuite été donnée à M. Rodière, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, et faisant, en même temps, un cours libre d'économie politique aux étudiants de cette ville. M. Rodière, actuellement à Paris, comme examinateur des concours de l'Ecole de droit de Paris, avait été invité à la réunion au nom de la Société. M. Rodière a fait remarquer qu'il n'y avait dans cette grave question que deux opinions logiques : celle des socialistes, qui veulent que l'Etat fasse tout, et celle des économistes, qui veulent que l'Etat ne s'occupe que de ce qui est nécessaire ou indispensable. L'Etat doit faire respecter le bon droit, de nation à nation, d'individu à individu ; il doit maintenir la sécurité, la justice, organiser une force publique, et s'occuper des accessoires nécessaires. En ce moment, en France, il a évidemment dépassé les limites de ces fonctions naturelles, puisqu'il a un agent sur seize habitants, et même un sur neuf, si l'on fait entrer l'armée dans cette moyenne. En allant au fond des choses, on voit dans ce fait la cause principale des tiraillements et des révolutions qui se succèdent dans notre pays.
M. Dussart, ancien conseiller d'Etat, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d'exercer son contrôle sur tout. ll a cité, à ce sujet, l'action des autorités communales, qui doivent surveiller l'éclairage, le pavage, l'écoulement des eaux, etc., action qui avait été négligée en Angleterre, au point qu'en recherchant les causes de la grande mortalité pendant le choléra, dans certains quartiers de Londres, on a constaté que des égouts et des fosses d'aisance n'étaient pas vidés depuis cinquante ans. Il a cité cette loi récente du Parlement qui ordonne au propriétaire irlandais de faire justice à sa terre, c'est-à-dire d'y mettre le capital nécessaire, ou de l'abandonner. De ces faits et d'autres, M. Dussart a conclu, sans trop préciser, à une intervention de l'Etat fort large.Ses observations ont provoqué plusieurs réclamations. Personne ne nie que la commune n'ait le devoir de s'occuper de quelques soins généraux, mais ces soins sont très-restreints. Quant à la loi sur l'Irlande, il est douteux que l'expérience la démontre profitable, et que cette [317] atteinte à la liberté des propriétaires soit utile aux malheureux de ce pays.
M. Rodet, qui s'est complétement rallié à l'opinion exprimée par M. Michel Chevalier, a fait remarquer à M. Dussart qu'avec le système d'intervention, de prévention et de centralisation par l'autorité, la ville de Bourges n'aurait jamais pu donner une chaire à Cujas. Aujourd'hui l'Etat dirait à la municipalité de cette ville : C'est moi seul qui dois enseigner le droit. M. Rodet ajoute que l'Etat ne doit faire que ce que les communes ne peuvent pas faire, et celles-ci ne s'occuper que de quelques soins généraux étrangers aux travaux des citoyens.
M. Howyn-Tranchère a clos la séance en précisant bien ce fait qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, cités par M. Michel Chevalier et M. Rodet, le principe de non-intervention est accepté; que le problème est résolu dans l'esprit public et dans l'esprit des gouvernements ; que c'est tout le contraire dans notre pays, où, par conséquent, le principe de non-intervention doit être rappelé toutes les fois qu'on s'en écarte. M. Howyn fait remarquer, en outre, que les actes d'intervention qu'on a cités sont ceux d'un Etat particulier, et non de l'Etat général, de l'Etat politique; tandis que chez nous l'intervention part toujours de l'Etat central, de la bureaucratie centrale.
Text: ASEP version
[100]
Séance du 10 février 1850.
Nous avons résumé le gros des idées sur la question fondamentale de la limite des attributions rationnelles de l'autorité, dont la Société d'économie politique s'est occupée dans sa réunion du 10 janvier 1850. Nous allons retracer, en peu de lignes également, les opinions des [101] membres qui ont pris la parole, dans la réunion du 10 février, après un résumé de la discussion précédente, présenté par M. Joseph Garnier, sur l'invitation de M. Dunoyer, président.
M. Michel Chevalier a établi en principe que la solution du problème posé ne se rencontrait que dans un idéal dont la civilisation se rapproche progressivement, idéal qui consiste dans un maximum de liberté accordé aux citoyens, et dans un minimum d'attributions réservées au gouvernement. Mais il est difficile de préciser ce maximum et ce minimum; car ils dépendent de la virtualité de l'industrie individuelle, des aptitudes des citoyens et du ressort public. Il faut même renoncer à vouloir formuler ces limites, et imiter les Anglais et les Américains qui, toutes les fois qu'ils ont eu à faire intervenir l'Etat dans de grandes entreprises, n'ont pas songé à ériger leur conduite du moment en un système général, et lui ont laissé le caractère d’expediency.
Quand il s'est agi du canal Erié, on n'a pas agité la question de savoir s'il valait mieux que l'Etat fit les canaux ou n'en fit pas; on s'est demandé qui pouvait le faire ; et comme il a été constaté que les particuliers seuls ne pouvaient pas entreprendre cette voie d'utilité publique, l'Etat est intervenu; mais l'intervention de l'Etat a été la règle momentanée, et plus tard on a laissé agir les compagnies. Les faits se sont passés de même en Angleterre.
Dans l'Etat de New-York encore, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de professeurs supérieurs, qu'il n'y en avait pas assez pour les besoins publics; et le gouvernement, sans poser ce principe qu'il accaparait l'enseignement, a formé une Université, tout en ne se mêlant d'ailleurs pas de l'instruction secondaire à laquelle suffisait pleinement l'enseignement libre.
[102]
En France, nous avons trop l'habitude de vouloir généraliser et poser des principes immuables à propos de tout. Ainsi ont fait ceux qui, érigeant quelques faits en principe, en ont conclu qu'à jamais l'Etat serait chargé seul des chemins de fer. Ainsi ont fait les adversaires de la liberté commerciale, qui ont poussé leur protestation à l'extrême, et l'ont érigée en cette folle théorie de travail national incompatible avec tout progrès, toute réforme.
M. Bastiat a fait remarquer que les Anglais lui ont paru beaucoup plus disposés à aborder la question de principe que ne l'a dit M. Michel Chevalier. Quand il s'est agi parmi eux du free-trade, M. Cobden et ses amis sont tout d'abord descendus au fond de la doctrine, et ils n'ont cessé, pendant leur mémorable campagne, d'en proclamer la légitimité et d'en déduire la démonstration.
Revenant au point principal de la discussion, M. Bastiat a dit que, la société étant basée sur un échange général de services, cet échange doit se faire librement; et que l'Etat, en intervenant et en voulant rendre des services, viole la liberté des acheteurs de ces services, en les forçant de les accepter et de les payer à un prix de maximum. D'où il a conclu de nouveau à l'injustice de l'intervention du gouvernement partout ailleurs que dans la production de la sécurité et la gestion de quelques propriétés communes, fontaines, fleuves, etc., au sujet desquelles l'ensemble des citoyens, l'être collectif, délègue ses droits et sa force pour le soutenir.
M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation et l'un des vice-présidents de la Société, a reconnu pour l'Etat deux devoirs en dehors desquels son intervention lui paraît nuisible.
Le premier des devoirs de l'Etat est de ne pas s'opposer au libre développement de la moralité et de la [103] liberté en s'immisçant dans les fonctions des citoyens ; le second est de bien gérer ce qui forme l'intérêt de tous, de maintenir la sécurité et la justice intérieure, de garantir l'indépendance du territoire, de bien conduire les relations de l'association avec les autres associations du monde, et de constituer une force publique suffisante en hommes et en finances pour inspirer le respect. En dehors de l'accomplissement de ces devoirs, le gouvernement usurpe ses attributions.
M. Renouard a insisté, dans une vive et spirituelle conversation, sur l'importance de ne pas faire de mal; assurément le bien est ce qu'il y a de préférable; mais, à défaut de bien, l'absence du mal est un grand bien relatif à côté du mal. Or, c'est en s'abstenant de plus en plus d'accaparer les diverses branches de travail que les gouvernements cesseront au moins de faire un certain mal, et laisseront la société se dégager elle-même de ses langes et s'avancer vers la liberté, la moralité et la civilisation. M. Renouard s'est plu à constater que, à tout prendre, l'humanité s'avançait constamment vers le progrès, et qu'on pouvait s'apercevoir de cette marche en considérant seulement des périodes de temps même assez courtes. La société vaut mieux qu'il y a cinquante ans, et, il y a cinquante ans, elle valait mieux que du temps de Louis XIV, qui fut un grand roi, mais sous lequel personne de nous ne voudrait vivre.
La parole a ensuite été donnée à M. Rodière, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, et faisant, en même temps, un cours libre d'économie politique aux étudiants de cette ville. M. Rodière, actuellement à Paris, comme examinateur des concours de l'Ecole de droit de Paris, avait été invité à la réunion au nom de la Société.
M. Rodière a fait remarquer qu'il n'y avait dans cette grave question que deux opinions logiques : celle des socialistes, qui veulent que l'Etat fasse tout, et celle des [104] économistes, qui veulent que l'Etat ne s'occupe que de ce qui est nécessaire ou indispensable. L'Etat doit faire respecter le bon droit, de nation à nation, d'individu à individu; il doit maintenir la sécurité, la justice, organiser une force publique et s'occuper des accessoires nécessaires. En ce moment, en France, il a évidemment dépassé les limites de ces fonctions naturelles, puisqu'il a un agent sur seize habitants et même un sur neuf, si l'on fait entrer l'armée dans cette moyenne. En allant au fond des choses, on voit dans ce fait la cause principale des tiraillements et des révolutions qui se succèdent dans notre pays.
M. Dussart, ancien conseiller d'Etat, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d'exercer son contrôle sur tout. Il a cité, à ce sujet, l'action des autorités communales, qui doivent surveiller l'éclairage, le pavage, l'écoulement des eaux, etc., action qui avait été négligée en Angleterre, au point qu'en recherchant les causes de la grande mortalité pendant le choléra, dans certains quartiers de Londres, on a constaté que des égouts et des fosses d'aisances n'étaient pas vidés depuis cinquante ans. Il a cité cette loi récente du Parlement, qui ordonne au propriétaire irlandais de faire justice à sa terre, c’est-à-dire d'y mettre le capital nécessaire, ou de l'abandonner. De ces faits et d'autres, M. Dussart a conclu, sans trop préciser, à une intervention de l'Etat fort large. Ses observations ont provoqué plusieurs réclamations.
M. Rodet, qui s'est complètement rallié à l'opinion exprimée par M. Michel Chevalier, a fait remarquer à M. Dussart qu'avec le système d'intervention, de prévention et de centralisation par l'autorité, la ville de Bourges n'aurait jamais pu donner une chaire à Cujas. Aujourd'hui l'Etat dirait à la municipalité de cette ville: [105] C'est moi seul qui dois enseigner le droit. M. Rodet ajoute que l'Etat ne doit faire que ce que les communes ne peuvent pas faire, et celles-ci ne s'occuper que de quelques soins généraux étrangers aux travaux des citoyens. M. Howyn De Tranchère a clos la séance en précisant bien ce fait qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, cités par M. Michel Chevalier et M. Rodet, le principe de non-intervention est accepté; que le problème est résolu dans l'esprit public et dans l'esprit des gouvernements; que c'est tout le contraire dans notre pays, où, par conséquent, le principe de non-intervention doit être rappelé toutes les fois qu'on s'en écarte. M. Howyn fait remarquer, en outre, que les actes d'intervention qu'on a cités sont ceux d'un Etat particulier, et non de l'Etat général, de l'État politique ; tandis que chez nous l'intervention part toujours de l'Etat central, de la bureaucratie centrale.
Balance du commerce [29 March 1850] ↩
BWV
1850.03.29 “Balance du commerce” (Balance of Trade) [29 March 1850] [written on 29 March 1850 for an unnamed journal] [OC5.8, pp. 402-406]
BALANCE DU COMMERCE [1].
La balance du commerce est un article de foi.
On sait en quoi elle consiste : un pays importe-t-il plus qu’il n’exporte ; il perd la différence. Réciproquement, ses exportations dépassent-elles ses importations ; l’excédant forme son bénéfice. Cela est tenu pour un axiome et on légifère en conséquence.
Sur cette donnée, M. Mauguin nous a avertis avant-hier, chiffres en main, que la France fait au dehors un commerce dans lequel elle a trouvé le moyen de perdre bénévolement, et sans que rien l’y oblige, 200 millions tous les ans.
« Vous avez perdu sur votre commerce, dans onze années, 2 milliards, entendez-vous ! »
Puis, appliquant son infaillible règle aux détails, il nous a dit : « En objets fabriqués, vous avez vendu, en 1847, pour 605 millions, et vous n’avez acheté que pour 152 millions. Vous avez donc gagné 450 millions. »
« En objets naturels, vous avez acheté pour 804 millions, et vous n’avez vendu que pour 114 millions ; vous avez donc perdu 690 millions. »
Ce que c’est que de tirer, avec une naïveté intrépide, toutes les conséquences d’un principe absurde ! M. Mauguin a trouvé le secret de faire rire, aux dépens de la balance du commerce, jusqu’à MM. Darblay et Lebeuf. C’est un beau succès, et il m’est permis d’en être jaloux.
Permettez-moi d’apprécier le mérite de la règle selon laquelle M. Mauguin et tous les prohibitionistes calculent les profits et les pertes. Je le ferai en racontant deux opérations commerciales que j’ai eu l’occasion de faire.
J’étais à Bordeaux. J’avais une pièce de vin qui valait 50 fr. ; je l’envoyai à Liverpool, et la douane constata sur ses registres une exportation de 50 francs.
Arrivé à Liverpool, le vin se vendit à 70 fr. Mon correspondant convertit les 70 fr. en houille, laquelle se trouva valoir, sur la place de Bordeaux, 90 fr. La douane se hâta d’enregistrer une importation de 90 francs.
Balance du commerce en excédant de l’importation, 40 fr.
Ces 40 fr., j’ai toujours cru, sur la foi de mes livres, que je les avais gagnés. M. Mauguin m’apprend que je les ai perdus, et que la France les a perdus en ma personne.
Et pourquoi M. Mauguin voit-il là une perte ? Parce qu’il suppose que tout excédant de l’importation sur l’exportation implique nécessairement un solde qu’il faut payer en écus. Mais où est, dans l’opération que je raconte, et qui est l’image de toutes les opérations commerciales lucratives, le solde à payer ? Est-il donc si difficile de comprendre qu’un négociant compare les prix courants des diverses places et ne se décide à opérer que lorsqu’il a la certitude, ou du moins la chance, de voir la valeur exportée lui revenir grossie ? Donc ce que M. Mauguin appelle perte doit s’appeler profit.
Peu de jours après mon opération, j’eus la bonhomie d’éprouver un regret ; je fus fâché de ne l’avoir pas retardée. En effet, le vin baissa à Bordeaux et haussa à Liverpool ; de sorte que si je ne m’étais pas autant pressé, j’aurais acheté à 40 fr. et vendu à 100 fr. En vérité, je croyais que sur ces bases mon profit eût été plus grand. J’apprends par M. Mauguin que c’est la perte qui eût été plus écrasante.
Ma seconde opération, monsieur le rédacteur, eut une issue bien différente.
J’avais fait venir du Périgord des truffes qui me coûtaient 100 fr. : elles étaient destinées à deux célèbres ministériels anglais, pour un très-haut prix, que je me proposais de convertir en livres. Hélas ! j’aurais mieux fait de les dévorer moi-même (je parle des truffes, non des livres ni des torys). Tout n’eût pas été perdu, comme il arriva, car le navire qui les emportait périt à la sortie du port. La douane, qui avait constaté à cette occasion une sortie de 100 fr., n’a jamais eu aucune rentrée à inscrire en regard.
Donc, dira M. Mauguin, la France a gagné 100 fr. ; car c’est bien de cette somme que, grâce au naufrage, l’exportation surpasse l’importation. Si l’affaire eût autrement tourné, s’il m’était arrivé pour 2 ou 300 fr. de livres, c’est alors que la balance du commerce eût été défavorable et que la France eût été en perte.
Au point de vue de la science, il est triste de penser que toutes les entreprises commerciales qui laissent de la perte selon les négociants, donnent du profit suivant cette classe de théoriciens qui déclament toujours contre la théorie.
Mais au point de vue de la pratique, cela est bien plus triste encore, car qu’en résulte-t-il ?
Supposons que M. Mauguin eût le pouvoir (et, dans une certaine mesure, il l’a par ses votes) de substituer ses calculs et sa volonté aux calculs et à la volonté des négociants, et de donner, selon ses expressions, « une bonne organisation commerciale et industrielle au pays, une bonne impulsion au travail national », que fera-t-il ?
Toutes les opérations qui consisteraient à acheter à bon marché au dedans pour vendre cher au dehors, et à convertir le produit en denrées très-recherchées chez nous, M. Mauguin les supprimera législativement, car ce sont justement celles où la valeur importée surpasse la valeur exportée.
En compensation, il tolérera, il favorisera au besoin par des primes (des taxes sur le public) toutes les entreprises qui seront basées sur cette donnée : Acheter cher en France pour vendre à bon marché à l’étranger, en d’autres termes, exporter ce qui nous est utile pour rapporter ce qui ne nous est bon à rien. Ainsi, il nous laissera parfaitement libres, par exemple, d’envoyer des fromages de Paris à Amsterdam pour rapporter des articles de modes d’Amsterdam à Paris, car on peut affirmer que, dans ce trafic, la balance du commerce serait toute en notre faveur.
Oui, c’est une chose triste, et j’ose ajouter dégradante, que le législateur ne veuille pas laisser les intéressés décider et agir pour eux-mêmes en ces matières, à leurs périls et risques. Au moins alors chacun a la responsabilité de ses actes ; celui qui se trompe est puni et se redresse. Mais quand le législateur impose et prohibe, s’il a une erreur monstrueuse dans la cervelle, il faut que cette erreur devienne la règle de conduite de toute une grande nation. En France, nous aimons beaucoup la liberté, mais nous ne la comprenons guère. Oh ! tâchons de la mieux comprendre, nous ne l’en aimerons pas moins.
M. Mauguin a affirmé avec un aplomb imperturbable qu’il n’y a pas en Angleterre un homme d’État qui ne professe la doctrine de la balance du commerce. Après avoir calculé la perte qui, selon lui, résulte de l’excédant de nos importations, il s’est écrié : « Si l’on faisait à l’Angleterre un semblable tableau, elle en frémirait, et il n’y a pas un membre de la Chambre des Communes qui ne se crût menacé sur son banc. »
Et moi j’affirme que si l’on venait dire à la Chambre des Communes : « La valeur totale de ce qui sort du pays surpasse la valeur totale de ce qui y entre », c’est alors qu’on se croirait menacé, et je doute qu’il se trouvât un seul orateur qui osât ajouter : La différence est un profit.
En Angleterre, on est convaincu qu’il importe à la nation de recevoir plus qu’elle ne donne. De plus, on s’est aperçu que c’est la tendance de tous les négociants, et c’est pourquoi on y a pris le parti de les laisser faire, et de rendre aux échanges la Liberté.
FN:Lors de la discussion du budget général des dépenses pour l’exercice de 1850, M. Mauguin exposa naïvement à la tribune la vieille et fausse théorie de la balance du commerce. (Moniteur du 27 mars.) Bastiat, qui l’avait déjà réfutée dans ses Sophismes, crut devoir l’attaquer de nouveau ; et comme sa santé ne lui permettait plus de monter à la tribune, il adressa, le 29 mars 1850, à une feuille quotidienne, les réflexions que nous reproduisons. Il est à remarquer qu’il simplifie les calculs hypothétiques, au moyen desquels il élucide sa thèse, en excluant quelques-uns des éléments qu’il avait employés en 1845. (V. tome IV, page 52.) (Note de l’éditeur de l’édition originale.)
T.255 (1850.04.15) "England’s New Colonial Policy. Lord John Russel’s Plan" (JDE, 15 Apr, 1850) (Fr, PDF)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015; found English original 25 Nov. 2015
Checked against PDF: 26 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source
T.255 (1850.04.15) "England’s New Colonial Policy. Lord John Russel’s Plan" (Nouvelle politique coloniale de l'Angleterre. Plan de Lord John Russel), Journal des Economistes, 15 April 1850, T. XXVI, pp. 8-15. [DMH] ??
In appendix in Cobden and the League???
Hansard: lord John Russell, à la Chambre des communes, dans la séance 8 février dernier.
Text
[8]
Si l'on se demandait quel est le phénomène économique qui, dans les temps modernes, a exercé le plus d'influence sur les destinées de l'Europe, peut-être pourrait-on répondre : c'est l'aspiration de certains peuples, et particulièrement du peuple anglais, vers les colonies.
Existe-t-il au monde une source qui ait vomi sur l'humanité autant de guerres, de luttes, d'oppression, de coalitions, d'intrigues diplomatiques, de haines, de jalousies internationales, de sang versé, de travail déplacé, de crises industrielles, de préjugés sociaux, de déceptions, de monopoles, de misères de toutes sortes?
Le premier coup porté volontairement, scientifiquement au système colonial, dans le pays même où il a été pratiqué avec le plus de succès, est donc un des plus grands faits que puissent présenter les annales delà civilisation. Il faudrait être dépourvu de la faculté de rattacher les effets aux causes pour n'y point voir l'aurore d'une ère nouvelle dans l'industrie, le commerce et la politique des peuples.
Avoir de nombreuses colonies et constituer ces colonies, à l'égard [9] de là mère patrie, sur les bases du monopole réciproque, telle est la pensée qui domine depuis des siècles la politique de la Grande-Bretagne. Or, ai-je besoin de dire quelle est cette politique? S'emparer d'un territoire, briser pour toujours ses communications avec le reste du monde, c'est là un acte de violence qui ne peut être accompli que par la force. [I provoque la réaction du pays conquis, celle des pays exclus, et la résistance de la nature même des choses. Un peuple qui entre dans cette voie se met dans la nécessité d'être partout et toujours le plus Tort, de travailler sans cesse à affaiblir les autres peuples.
Supposez qu'au bout de ce système, l'Angleterre ait rencontré une déception? Supposez qu'elle ait constaté, pour ainsi dire arithmétiquement, que ses colonies, organisées sur ce principe, ont été pour elle un fardeau; qu'en conséquence, son intérêt est de les laisser se gouverner elles-mêmes , autrement dit, de les affranchir ; — il est aisé de voir que, dans cette hypothèse , l'action funeste que la puissance britannique a exercée sur la marche des événements humains, se transformerait en une action bienfaisante.
Or, il est certain qu'il y a en Angleterre des hommes qui, acceptant dans tout leur ensemble les enseignements de la science économique, réclament, non par philanthropie, mais par intérêt, en vue de ce qu'ils considèrent comme le bien général de l'Angleterre elle-même , la rupture du lien qui enchaîne la métropole à ses cinquante colonies.
Mais ils ont à lutter contre deux grandes puissances : l'orgueil national et l'intérêt aristocratique.
La lutte est commencée. Il appartenait à M. Cobden de frapper le premier coup. Nous avons porté à la connaissance de nos lecteurs le discours prononcé au meeting de Bradfort, par l'illustre réformateur (n° du 15 février), aujourd'hui nous avons à leur faire connaître le plan adopté par le gouvernement anglais, tel qu'il a été exposé par le chef du cabinet, lord John Russell, à la Chambre des communes, dans la séance 8 février dernier.
Le premier ministre commence par faire l'énumération des colonies anglaises.
Ensuite il signale les principes sur lesquels elles ont été organisées:
En premier lieu, dit-il, l'objet de l'Angleterre semble avoir été d'envoyer de ce pays des émigrants pour coloniser ces contrées lointaines. Mais en second lieu, ce fut évidemment le système de ce pays, — comme celui de toutes les nations européennes à cette époque , — de maintenir strictement le monopole commercial entre la mère patrie et ses possessions. Par une multitude de statuts, nous avons eu soin de centraliser en Angleterre tout le commerce des colonies, de faire arriver ici toutes leurs productions, et de ne pas souffrir qu'aucune autre nation pût aller les acheter pour les porter ici ou ailleurs. C'était l'opinion universelle, que nous tirions de grands avantages de ce monopole, et cette opinion persistait encore en 1796, comme on le voit par un discours de M. Dundas, qui disait: « Si nous ne nous assurons pas, par le monopole, le commerce des colonies, leurs denrées trouveront d'autres débouchés, au grand détriment de la nation.
Un autre trait fort remarquable caractérisait nos rapports avec nos colonies, et c'est celui-ci : il était de principe que partout où des citoyens anglais jugeaient à propos de s'établir, ils portaient en eux-mêmes la liberté des institutions de la mère patrie.
In the first place, the object seems to have been to send out settlers from this country, and to enable them to colonise these distant islands. But, in the next place, it was [538] evidently the system of this country—as at that time it was the system of all the European countries—to maintain strict commercial monopoly in relation to its colonies. By various statutes, to which I need not further allude, several of which have been very recently under the consideration of the House, we took care that all the trade of the colonies should centre in this country; that all their productions should be sent here, and that no other nation should bring those products to this country, or carry them abroad. It was conceived that we derived great advantages from this monopoly; and Mr. Dundas, so late as 1796, speaking of the colonies, expressed the opinion, that unless the trade of our colonies was secured by us with monopoly, they would find a market for their goods elsewhere, which would be productive of great loss and detriment to the nation.
But there was another and a most remarkable characteristic attending these colonies, and this was, that wherever Englishmen have been sent, or have chosen to settle, they have carried with them the freedom and the institutions of the mother country.
A ce propos, lord John Russell cite des lettres patentes émanées de Charles Ier, desquelles il résulte que les premiers fondateurs des colonies avaient le droit de faire des lois, avec le consentement, l'assentiment et l'approbation des habitants libres des dites provinces; que leurs successeurs auraient les mêmes droits, comme s'ils étaient nés en Angleterre, possédant toutes les libertés, franchises et privilèges attachés à la qualité de citoyens anglais.
Il est aisé de comprendre que ces deux principes, savoir : 1° le monopole réciproque commercial; 2° le droit pour les colonies de se gouverner elles-mêmes , ne pouvaient pas marcher ensemble. Le premier a anéanti le second, ou du moins il n'en est resté que la faculté assez illusoire de décider ces petites affaires municipales, qui ne sauraient froisser les préjugés restrictifs dominants à cette époque.
Mais ces préjugés ont succombé dans l'opinion publique. Ils ont aussi succombé dans la législation par la réforme commerciale accomplie dans ces dernières années.
En vertu de cette réforme, les Anglais de la mère patrie et les Anglais des colonies sont rentrés dans la liberté d'acheter et de vendre selon leurs convenances respectives et leurs intérêts. Le lien du monopole est donc brisé, et la franchise commerciale étant réalisée, rien ne s'oppose plus à proclamer aussi la franchise politique.
Je pense qu'il est absolument nécessaire que le gouvernement et la Chambre proclament les principes qui doivent désormais les diriger; s'il est de notre devoir, comme je le crois fermement, de conserver notre grand et précieux empire colonial, veillons à ce qu'il ne repose que sur des principes justes, propres à faire honneur à ce pays et à contribuer au bonheur, à la prospérité de nos possessions.
… I think it is absolutely necessary that the Government and the House should determine and declare what are the principles upon which they will hereafter proceed. If, as I firmly believe, it is our duty to maintain our great and valuable colonial empire, let us see that those principles are sound which we adopt in our colonial administration; let us see that they are likely to conduce to the credit of this country, and to contribute to the happiness and prosperity of our colonies.
En ce qui concerne notre politique commerciale, j'ai déjà dit que le système entier du monopole n'est plus. La seule précaution que nous ayons désormais à prendre, c'est que nos colonies n'accordent aucun privilège à une nation au détriment d'une autre, et qu'elles n'imposent pas des droits assez élevés sur nos profits pour équivaloir à une prohibition. Je crois que nous sommes fondés à leur faire cette, demande en retour de la sécurité que nous leur procurons.
With regard to our commercial policy, I have already said that the whole system of monopoly is swept away. What we have in future to provide for is, that there [549] shall be no duties of monopoly in favour of one nation, and against another, and that there shall be no duties so high as to be prohibitory against the produce and manufactures of this country. I think we have a right to ask this in return for the protection which we afford to the colonies.
J'arrive maintenant au mode de gouvernement de nos colonies. Je crois que, comme règle générale, nous ne' pouvons mieux faire que de nous référer à ces maximes de politique qui guidaient nos ancêtres en cette matière. Il me semble qu'ils agissaient avec justice et sagesse quand ils prenaient soin que partout où les Anglais s'établissaient, ils jouissent de la liberté anglaise et qu'ils eussent des institutions anglaises. Une telle politique était certainement calculée pour faire naître des sentiments de bienveillance entre la mère patrie et les colonies ; et elle mettait ceux de nos concitoyens qui se transportaient dans des contrées lointaines, à même de jeter les semences de vastes communautés, dont l'Angleterre peut être fière
I now come to the question, as to the mode of governing our colonies. I think that, as a general rule, we cannot do better than refer to those maxims of policy by which our ancestors were guided upon this subject. It appears to me, that in providing that wherever Englishmen went, they should enjoy English freedom, and have English institutions, they acted justly and wisely. They adopted a course which was calculated to promote a harmonious feeling between the mother country and the colonies, and which enabled those who went out to these distant possessions to sow the seeds of communities of which England may always be proud.
…..
Canada. — Jusqu'en 1828, il y a eu de graves dissensions entre les ministres de la couronne et le peuple canadien. Le gouvernement de ce pays crut pouvoir régler les impôts du Canada sans l'autorité et le consentement des habitants de la colonie. M. Huskisson proposa une enquête à ce sujet. Le Parlement s'en occupa longuement: des comités furent réunis, des commissions furent envoyées sur les lieux; mais à la fin une insurrection éclata. Le gouvernement, dont je faisais partie, jugea à propos de suspendre, pour un temps, la constitution de la colonie. Plus tard , il proposa de réunir les deux provinces et de leur donner d'amples pouvoirs législatifs. En établissant ce mode de gouvernement dans une colonie si importante, nous rencontrâmes une question, qui, je l'espère, a été résolue à la satisfaction du peuple canadien, quoiqu'elle ne pût pas être tranchée de la même manière dans une province moins vaste et moins peuplée. Le parti populaire du Canada réclamait ce qu'il appelait un gouvernement responsable, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas d'une législature librement élue, mais il voulait encore que le gouverneur général, au lieu de nommer son ministère , abstraction faite de l'opinion de la législature, ainsi que cela était devenu l'usage, fût obligé de le choisir dans la majorité de l’Assemblée. Ce plan fut adopté.
Up to 1828 there were very grave dissensions between the Ministers of the Crown in this country and the Canadian people. The Government of this country thought themselves justified in applying the taxes of Canada without the authority or consent of the inhabitants of the colony. Mr. Huskisson proposed an inquiry into that subject. Parliament, for a long time, turned its attention to the matter. Commissions were sent out; Committees were appointed; but, in the end, an insurrection broke out in Canada, and blood was shed both in the Upper and Lower Provinces. The Government of which I was a Member thought it necessary, for a time, to suspend the constitution of the colony. We afterwards proposed the union of the two provinces, and also to give the colony ample powers of legislation. In establishing that kind of government in so important a province, a question arose which, I trust, has been solved to the satisfaction of the people of Canada, although it is one which could not be solved in the same manner in a province of less importance, and of less extensive population. The popular party in Canada, proposed that they should have what they called responsible government—that is to say, that not only should there be a legislature freely elected, but that instead of what had become the custom, that the Ministry should be named by the Governor General totally irrespective of the prevailing opinions of the Legislature, they should be taken from that party in the Assembly which was supported by a majority. That plan was adopted.
… Dans ces dernières années, le gouvernement a été dirigé, en conformité de ce que les ministres de Sa Majesté croient être l'opinion du peuple canadien. Quand lord Elgin vit que son ministère n'avait qu'une majorité insignifiante, il proposa, soit de le maintenir jusqu'à ce qu'il rencontrât des votes décidément adverses, soit de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée fut dissoute. Les élections donnèrent la majorité à l'opposition, et lord Elgin donna les portefeuilles à ses adversaires. Je ne crois pas qu'il fût possible de respecter plus complètement et plus loyalement le principe de laisser !a colonie s'administrer elle-même.
That government [551] has been conducted of late years in conformity with what Her Majesty's Ministers believe to be the opinion of the people of Canada. When Lord Elgin saw that the Ministry he had found in office had narrow majorities in the Assembly, he proposed either that they should continue in office until they were obstructed by adverse votes, or that they should dissolve the Assembly. They preferred to dissolve the Assembly. The new Assembly which was returned gave a great majority to their adversaries, and Lord Elgin placed their adversaries in office. I do not think that it would be possible to carry out more fairly, or more fully, the principle of allowing the province to manage its own affairs.
New-Brunswick et Nouvelle-Ecosse. —Le ministre rappelle que, dans ces provinces, le conseil exécutif est récemment devenu électif, de telle sorte que les affaires du pays se traitent par les habitants eux-mêmes, ce qui a fait cesser lès malheureuses dissensions qui agitaient ces provinces.
??? With respect, likewise, to Nova Scotia [552] and New Brunswick, no very long time ago the Executive Council was the same body as the Legislative Council, and there was no separate Legislative Council; but—I think it was when Lord Glenelg held the seals of office—a change was made, and the councillors have been chosen, if not from a particular party, in such a manner as to conciliate the opinion of the province, and to command the support of a majority of the Legislature in Nova Scotia and for New Brunswick. We have not heard of late years of those unhappy dissensions which used to prevail when the Executive Councillors of the Government found themselves in a small minority in the Assembly.
Cap de Bonne-Espérance. — Le ministre annonce qu'après de longues discussions et malgré de sérieuses difficultés, il a été décidé que le gouvernement représentatif serait introduit au cap de Bonne-Espérance. L'Assemblée représentative sera élue par les habitants qui présenteront certaines garanties. On demandera des garanties plus étendues pour élire les membres du Conseil. Les membres de l'Assemblée seront élus pour cinq ans, ceux du Conseil pour dix ans, renouvelables, par moitié , tous les cinq ans.
?? With respect to the Cape of Good Hope, there has been, of late years, a discussion with regard to the introduction of representative government. Lord Stanley had that question under his consideration; and without at all refusing the introduction of representative government, he pointed out many difficulties which had to be considered before the decision was ultimately come to. Those difficulties, and indeed every topic connected with the subject, have been discussed in the Cape by the Governor and his advisers, by the Colonial Secretary, the Chief Justice, and others, who are fully competent to form an opinion from their general knowledge of the principles of the Government, and likewise from their local knowledge of the interests of the colony; and the result is, that Her Majesty's Government have come to the decision that representative institutions shall be introduced [553] at the Cape. With respect to the representative assembly, they have adopted a franchise, into the particulars of which I shall not now enter, for the papers are in the hands of Members, enabling them to judge of the proposal; a representative assembly will be chosen by persons having a certain amount of property, and qualified in the manner which has been specified. But a question arose as to the formation of what is called in other colonies the legislative council; and, upon the whole, Her Majesty's Government came to the opinion, that, instead of imitating the constitution of Jamaica, or that of Canada, it Would be advisable to introduce into the Cape of Good Hope a council which should be elective, but elected by persons having a considerably higher qualification than that of the electors of the representative assembly. These, it was considered, might be persons who had been named by the Crown as persons of weight and influence, as magistrates and others, or persons who had been selected by municipal councils as persons entitled to the highest offices which they could confer. It is proposed that the representative assembly should have a duration of five years, and the legislative council a duration of ten years, but half to resign their seats at the expiration of five years.
Australie. — Je ne propose pas, pour l'Australie, une Assemblée et un Conseil, en imitation de nos institutions métropolitaines, mais un seul Conseil élu, pour les deux tiers, par le peuple, et pour un tiers, par le gouverneur. Ce qui m'a fait arriver à cette résolution , c'est que cette forme a prévalu avec succès dans la Nouvelle-Galles du Sud, et autant que nous pouvons en juger, elle y est préférée par l'opinion populaire à des institutions plus analogues à celles de la mère patrie (écoutez, écoutez, et cris: non, non). Tout ce que je puis dire, c'est que nous avons cru adopter la forme la plus agréable à la colonie, et s'il eût existé, dans la NouvelleGalles du Sud, une opinion bien arrêtée sur la convenance de substituer un Conseil et une Assemblée à la constitution actuelle, nous nous serions hâtés d'accéder à ce vœu.... J'ajoute que, tout en proposant pour la colonie cette forme de gouvernement, notre intention est de lui laisser la faculté d'en changer. Si c'est l'opinion des habitants, qu'ils se trouveraient mieux d'un Conseil et d'une Assemblée, ils ne rencontreront pas d'opposition de la part de la couronne.
?? Now, with regard to Australia, the Bill which I have to ask that the Chairman should obtain leave to bring in, will propose legislation by Parliament upon that subject. The measure which I propose, and which is nearly the same as one that Was proposed last year, goes not on the [554] principle of having a council and assembly, as hitherto, in imitation of the Government of this country, has been usually the form most palatable and popular in our colonies; but it is proposed that there should be but one council, a council of which two-thirds shall be formed of representatives elected by the people, and one-third named by the Governor. The reason for adopting this proposal is, that after a great deal of deliberation, that plan was adopted some years ago, and, I think, was finally enacted by Parliament in 1842. Since that time, the scheme has been found so far acceptable to the people of New South Wales, that upon the whole, so far as we could ascertain their sentiments, they appear to prefer that form of popular government to I that which is more in analogy with the Government of this country. ["Hear, hear!" and "No!"] Well, for my part, I can only say that we have been anxious to adopt that form which was the most agreeable to the views of the colony, and that, if in New South Wales there had been a clear and prevalent opinion that it was advisable to leave their present constitution, and to adopt the form of council and assembly, the Government would have been quite ready to take that course, and that the Committee of the Council, to which this question was referred, would have proposed that constitution.
L'année dernière nous avions proposé que les droits de douane actuellement existant à la Nouvelle-Galles du Sud fussent étendus, par acte du Parlement, à toutes les colonies australiennes. Quelque désirable que soit cette uniformité, nous ne croyons pas qu'il soit convenable de l'imposer par l'autorité du Parlement, et nous préférons laisser chacune de ces colonies voter son propre tarif, et décider pour elle-même.
?? With respect to other matters, there is a change, though not a very considerable change, in the Bill as it was first proposed last year; for we then proposed that the customs' duties which now prevail in New South Wales should be enacted by Parliament for the whole of the Australian colonies, and should be binding till they were altered by the proper authorities. We have thought that although it is a most desirable object that the customs' duties should not vary in the different Australian colonies, it is not advisable to enact that uniformity by authority of Parliament, but that it is better to leave them to settle for themselves whether they will not adopt a similar tariff for all the various parts of Australia.
Nous proposons qu'un Conseil électif, semblable à celui de la NouvelleGalles du Sud, soit accordé au district de Port-Philippe, un autre à la terre de Van-Diémen , un autre à l'Australie Méridionale.
Nous proposons, en outre, que sur la demande de deux de ces colonies, il y ait une réunion générale de tous les Conseils australiens, afin de régler, en commun, des affaires communes, comme l'uniformité du tarif, l'uniformité de la mise à prix des terres à vendre.
?? We propose that the Port Phillip district shall be separated from New South Wales, and that it should likewise have its council; and that there should likewise be introduced in Van Diemen's Land, where it has not existed before, a popular element into the Legislative Council, forming that council upon the same principle as the others, and that in South Australia there should be a similar body.
We propose, likewise, that on the proposition of two of these colonies there should be an assembly of these different Australian councils, that they should have the power of framing the same tariff for all, and that they should have various other powers which we think might be found useful, to pervade the whole of these colonies. To that body, likewise, we propose to refer the power of dealing with that question, which is so important to our Australian colonies—the price of the waste lands.
Je n'entrerai pas dans plus de détails sur la portée de ce bill, puisqu'il est sous vos yeux. J'en ai dit assez pour montrer notre disposition à introduire , soit dans nos colonies américaines, soit dans nos colonies australiennes , des institutions représentatives, de donner pleine carrière à la volonté de leurs habitants, afin qu'ils apprennent à se frayer eux-mêmes la voie vers leur propre prospérité, d'une manière beaucoup plus sûre que si leurs affaires étaient réglementées et contrôlées par des décrets émanés de la mère patrie.
I do not know that I need enter further into the description of this Bill, because the Bill itself was in the hands of Members at the end of last Session; as I have said, there are no great alterations from what was then proposed, and in a few days I trust Members will again have the Bill in their hands, and they can canvass its contents. But I have stated enough to show that both in the North American colonies and in the Australian it is our disposition to introduce representative institutions, give full scope to the will of the people of those colonies, and thereby enable them to work their way to their own prosperity far better than if they were controlled and regulated by any ordinances that went from this country.
Nouvelle-Zélande. — En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, nous montrâmes dès 1846, et peut-être d'une manière un peu précipitée, notre disposition à introduire dans ce pays des institutions représentatives. L'homme supérieur qui gouverne en ce moment la colonie nous a signalé la différence qui existe entre les naturels de la Nouvelle-Zélande et ceux de nos autres possessions, soit en Amérique, soit en Afrique, dans la NouvelleHollande, ou la terre de Van-Diémen. Il nous a fait remarquer leur aptitude à la civilisation et avec quelle répugnance ils supporteraient la suprématie d'un petit nombre de personnes de race anglaise, seules chargées de l'autorité législative. Ces objections ont frappé le gouvernement par leur justesse, et en conséquence, nous proposâmes de suspendre la Constitution. Maintenant le gouverneur écrit qu'il a institué un Conseil législatif dans la partie méridionale de la Nouvelle-Zélande. Il nous informe en outre que, dans son opinion, les institutions représentatives peuvent être introduites sans danger et avec utilité dans toute la colonie. En conséquence, et croyant son opinion fondée, nous n'attendons plus, pour agir, que quelques nouvelles informations de détail et le terme fixé par l'acte du Parlement.
Le ministre expose ensuite le. plan qu'il se propose de suivre à l'égard de la Jamaïque, des Barbades, delà Guyane anglaise, de la Trinité, de Maurice et de Malte. Il parle de la répugnance que manifestent toutes les colonies à recevoir les condamnés à la transportation, et en conclut à la nécessité de restreindre ce mode de châtiment.
Quant à l'émigration qui, dans ces dernières années surtout, a acquis des proportions énormes, il se félicite de ce que le gouvernement s'est abstenu de toute intervention au delà de quelques primes et secours temporaires. « L'émigration, dit-il, s'est élevée, depuis trois ans, à deux cent soixante-cinq mille personnes annuellement. » Il n'estime pas à moins de 1,500,000 livres sterling la dépense qu'elle a entraînée.
Les classes laborieuses ont trouvé pour elles-mêmes les combinaisons les plus ingénieuses. Par les relations qui existent entre les anciens émigrants et ceux qui désirent émigrer, des fonds se trouvent préparés, des moyens de travail et d'existence assurés à ces derniers, au moment même où ils mettent le pied sur ces terres lointaines. Si nous avions mis à la charge du trésor cette somme de 1,500,000 livres sterling, indépendamment du fardeau qui en serait résulté pour le peuple de ce pays, nous aurions provoqué toutes sortes d'abus. Nous aurions facilité l'émigration de personnes impropres ou dangereuses, qui auraient été accueillies avec malédiction aux Etats-Unis et dans nos propres colonies. Ces contrées n'auraient pas manqué de nous dire : « Ne nous envoyez pas vos paresseux, vos impotents, vos estropiés, la lie de votre population. Si tel est le caractère de votre émigration, nous aurons certainement le droit d'intervenir pour la repousser. » Telle eût été, je n'en doute pas, la conséquence de l'intervention gouvernementale exercée sur une grande échelle.
With respect to New Zealand, we began very soon, in 1846, showing at least a disposition for representative institutions; showing, perhaps, too much haste in the manner in which we adopted them; but we began by enacting a Bill for the purpose of introducing representative institutions in New Zealand. The very able Governor of that colony pointed out the difference which exists between the native race of New Zealand and any of those native races with which the British people had hitherto had to deal, whether in North America, whether at the Cape of Good Hope, or whether in New Holland and Van Diemen's Land. He pointed out their capacity for civilisation; he pointed out how ill they would brook the interference and government of a small number of persons of the English race, who should have the sole legislative authority over them. His objections, when they reached this country, were felt by my noble Friend and by the Government to be founded in reason—founded in his knowledge of the people among whom he dwelt, and whom he was commissioned to govern; and we therefore proposed to suspend that constitution. The Governor now writes that he has introduced a Legislative Council in the southern part of New Zealand; he writes also that it is his opinion that at the expiration of the term fixed by Parliament, representative institutions can safely and usefully be introduced into New Zealand. Therefore, believing his opinion to be well founded, we propose only to wait for any further representations from him as to any alterations that should be made in the Act which passed with respect to New Zealand; and with regard to time, to [557] introduce those alterations, that the constitution may be put into operation at the time which has been already fixed by Parliament.
Après quelques autres considérations, lord John Russell termine ainsi:
Voici ce qui résulte de tout ce que je viens de dire. En premier lieu, quelque soit le mécontentement, souvent bien fondé, qu'a fait naître la transition pénible pour nos colonies du système du monopole au système du libre-échange, nous ne reviendrons pas sur cette résolution que désormais votre commerce avec les colonies est fondé sur ce principe : vous êtes libres de recevoir les produits de tous les pays qui peuvent vous les fournir à meilleur marché et de meilleure qualité que les colonies, et d'un autre côté les colonies sont libres de commercer avec toutes les parties du globe, de la manière qu'elles jugeront la plus avantageuse à leurs intérêts. C'est là, dis-je, qu'est pour l'avenir le point cardinal de notre politique.
The whole result of what I have to say is, that in the first place, whatever discontent—and, in some places, well-founded discontent, it must be owned—has arisen from a transition painful to the colonists, from a system of monopoly, as regards the colonies, to a system of free trade, we ought not to attempt to go back, in any respect, from that decision, but that you shall trade with your colonies on the principle that you are at liberty to obtain productions from other countries where they may be produced better or cheaper than in the colonies, and that the colonies should be at liberty to trade with all parts of the world in the manner which may seem to them most advantageous. That, I say, must in future be a cardinal point in our policy.
En second lieu, conformément à la politique que vous avez suivie à l'égard des colonies de l'Amérique du Nord, vous agirez sur ce principe d'introduire et maintenir, autant que possible, la liberté politique dans toutes vos colonies. Je crois que toutes les fois que vous affirmerez que la liberté politique ne peut pas être introduite, c'est à vous de donner des raisons pour l'exception; et il vous incombe de démontrer qu'il s'agit d'une race qui ne peut encore admettre les institutions libres; que la colonie n'est pas composée de citoyens anglais, ou qu'ils n'y sont qu'en trop faible proportion pour pouvoir soutenir de telles institutions avec quelque sécurité. A moins que vous ne fassiez cette preuve, et chaque fois qu'il s'agira d'une population britannique capable de se gouverner elle-même, si vous continuez à être leurs représentants en ce qui concerne la politique extérieure, vous n'avez plus à intervenir dans leurs affaires domestiques au delà de ce qui est clairement et décidément indispensable pour prévenir un conflit dans la colonie elle-même.
The next point, I think, is, that in conformity with the policy on which you have governed your British North American colonies, you should, as far as possible, proceed upon the principle of introducing and maintaining political freedom in all your colonies. I think whenever you say political freedom cannot be introduced, you are bound to show the reasons for the exemption, and to show that the people are a race among whom it is impossible to carry out free institutions—that you must show the colony is not formed of the British people, or even that there is no such admixture of the British population as to make it safe to introduce representative institutions. Unless you can show that, I think the general rule would be that, you [566] should send to the different parts of the world, and maintain in your different colonies men of the British race, and capable of governing themselves; men whom you tell they shall have full liberty of governing themselves, and that while you are their representative with respect to all foreign concerns, you wish to interfere no further in their domestic concerns than may be clearly and decidedly necessary to prevent a conflict in the colony itself.
Je crois que ce sont là les deux principes sur lesquels vous devez agir. Je suis sûr au moins que ce sont ceux que le gouvernement actuel a adoptés, et je ne doute pas qu'ils n'obtiennent l'assentiment de la Chambre …
I believe these are the sound principles on which we ought to proceed. I am sure, at least, they are the principles on which the present Government intends to proceed, and I believe they are those which in their general features will obtain the assent and approbation of the House.
Non-seulement je crois que ces principes sont ceux qui doivent vous diriger, sans aucun danger pour le présent, mais je pense encore qu'ils serviront à résoudre, dans l'avenir, de graves questions, sans nous exposer à une collision aussi malheureuse que celle qui marqua la fin du dernier siècle. En revenant sur l'origine de cette guerre fatale avec les contrées qui sont devenues les Etats-Unis de l'Amérique, je ne puis m'empêcher de croire qu'elle fut le résultat non d'une simple erreur, d'une simple faute, mais d'une série répétée de fautes et d'erreurs, d'une politique malheureuse de concessions tardives et d'exigences inopportunes. J'ai la confiance que nous n'aurons plus à déplorer de tels conflits. Sans doute je prévois, avec tous les bons esprits, que quelques-unes de nos colonies grandiront tellement en population et en richesse qu'elles viendront nous dire un jour: « Nous avons assez de force pour être indépendantes de l'Angleterre. Le lien qui nous attache à elle nous est devenu onéreux et le moment est arrivé où, en toute amitié et en bonne alliance avec la mère patrie, nous voulons maintenir notre indépendance. » Je ne crois pas que ce temps soit très-rapproché, mais faisons tout ce qui est en nous pour les rendre aptes à se gouverner elles-mêmes. Donnons-leur autant que possible la faculté de diriger leurs propres affaires. Qu'elles croissent en nombre et en bien-être, et, quelque chose qui arrive, nous, citoyens de ce grand empire, nous aurons la consolation de dire que nous avons contribué au bonheur du monde.
I believe not only that you may proceed on those principles without any danger for the present, but there may be questions arising hereafter which you may solve without any danger of such an unhappy conflict as that which took place with what are now the United States of America. On looking back at the origin of that unhappy contest, I cannot but think that it was not a single error or a single blunder which got us into that contest, but a series of repeated errors and repeated blunders—of a policy asserted and then retreated from [567] —again asserted, and then concessions made when they were too late—and of obstinacy when it was unseasonable. I believe that it was by such a course we entered into the unhappy contest with what were at its commencement the loyal provinces of North America. I trust we shall never again have to deplore such a contest. I anticipate indeed with others that some of the colonies may so grow in population and wealth that they may say—" Our strength is sufficient to enable us to be independent of England. The link is now become onerous to us—the time is come when we think we can, in amity and alliance with England, maintain our independence." I do not think that that time is yet approaching. But let us make them as far as possible, fit to govern themselves—let us give them, as far as we can, the capacity of ruling their own affairs—let them increase in wealth and population, and whatever may happen, we of this great empire shall have the consolation of saying that We have contributed to the happiness of the world.
Il n'est pas possible d'annoncer de plus grandes choses avec plus de simplicité, et c'est ainsi que, sans la chercher, on rencontre la véritable éloquence.
T.256 (1850.04.15) SEP: Séance du 10 Avril 1850 (Land Credit) (Fr, PDF1, PDF2)
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against JDE PDF: 26 Nov. 2015
Checked against ASEP PDF: 26 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source↩
T.256 (1850.04.15) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 Avril 1850 (Land Credit). "Chronique," JDE, 15 April 1850, T. XXVI, pp. 99-101; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), pp. 109-13. [DMH] Not in OC.
[to come]
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
Sommaire. — Le budget en 1851. — Première huitaine de la session du Comité général de l'agriculture, des manufactures et du commerce: — Le discours du président de la République. — Un mot à M. Dumas, ministre du commerce. — M. Dupin avocat de l'intérêt général.—Les recettes évaluées pour 1850. — Discussion du budget de 1850 :—Plan socialiste de M. Lepelletier;—Critiques de MM. Hovyu et Raudot; — Les bourgeois instruits aux frais de l'Etat. — Le crédit foncier à la Société d'économie politique. —Deuxième délibération sur la ligne de Paris à Avignon. —Le timbre proportionnel sur le transfert des rentes.— Vole de la loi sur l'instruction; — des traités avec le Brésil et Costa-Rica; de la convention postale avec la Suisse; de la loi des logements insalubres. — L'Assemblée ne veut pas toucher à la loi des successions;—elle veut examiner l'article 1781 du Code civil et le système des concordais par abandon. — Présentation de la loi sur les hypothèques. — Politique et folie.
[99]
—A sa dernière réunion la Société d'économie politique s'est occupée d'un sujet mis à l'ordre du jour du Congrès agricole, du Conseil de l'agriculture, des manufactures et du commerce, et dont l'Assemblée elle-même est saisie par une proposition de l'honorable M. Wolowski, —nous voulons parler du crédit foncier, sujet faisant naturellement suite à la constitution des banques, traitée dans la réunion précédente.
Nous n'avons pas besoin de dire que jamais la Société d'économie politique n'a confondu les facilités données au propriétaire d'emprunter sur son gage, facilités que l'on a improprement appelées le crédit foncier, avec le crédit de l'exploitant rural, ou crédit agricole analogue au crédit des autres producteurs. Pas besoin n'est d'ajouter non plus que depuis qu'on parle de toutes ces questions, la Société d'économie politique ne s'est pas fait les illusions qu'on a eues ailleurs sur les merveilles d'un mécanisme de crédit foncier et de crédit agricole, merveilles telles qu'on voulait en faire profiter l'Etat, que les propriétaires français devaient être en peu de temps exonérés de 11 à 12 milliards d'hypothèques, que le pays devait avoir une masse de richesses en papier à cours forcé et forçant ce scélérat de numéraire à circuler et ce tyran de capital à produire.
Si la Société d'économie politique a le plaisir de prouver qu'elle n'a jamais perdu la raison, elle voit avec satisfaction que cette raison commence à revenir aussi dans l’esprit public, à propos de ces questions de crédit agricole et foncier.
M. Bastiat, représentant du peuple, qui, le premier, a pris la parole, a d'abord caractérisé les illusions qu'on s'est faites généralement sur l'application du crédit à la production agricole, et a montré qu'au lieu de chercher des secours imaginaires pour l'agriculture, il fallait tout simplement lui ôter les obstacles qui empêchent la transmission de la propriété foncière.
M. Howyn-Tranchère a signalé ensuite le progrès que les mœurs ont à faire à la campagne, où tout le monde achète toujours trop de champs, et se prive, pour satisfaire la passion d'acquérir, du capital d'exploitation indispensable à la culture. L'honorable représentant craint que le crédit foncier, en le supposant organisé et fécond, ne réponde nullement aux besoins de l'agriculture, et que les ressources qu'il offrira ne soient consacrées, non pas à la culture, mais à de nouveaux achats de terre. — Au fond, dit-il, il ne faut rechercher dans tout cela que les moyens de rendre la liquidation d'une propriété hypothéquée plus facile, par la vente d'une partie dégageant le reste. Or, le moyen le plus simple d'arriver à ce résultat est d'abaisser les droits de mutation et de transmission des titres.
M. Horace Say, abondant dans cette idée générale que la question dite de l'organisation du crédit foncier est sur tout une question d'obstacles à faire disparaître de nos Codes et de notre administration, expose et précise la nature de ces obstacles. Il explique d'abord comment la valeur des terres a été surélevée par le jeu des lois de protection douanière, de façon telle que le gage repose en partie sur un élément tout à fait artificiel. En second lieu, tant parce que nous avons hérité des préjugés de nos pères à l'endroit de la propriété foncière qui a longtemps donné des droits et dos avantages que ne donnaient pas les autres [100] propriétés, que parce qu'à travers foules nos époques révolutionnaires la propriété terrienne a offert plus de sécurité, les fortunes se sont portées sur l'acquisition des terres dont la valeur a également surenchéri par cette prédominance de la demande. De sorte qu'en définitive le crédit foncier se trouve actuellement basé sur deux valeurs en partie fictives.
En troisième lieu, toutes nos lois hypothécaires, imprégnées d'esprit féodal et aristocratique, ont été combinées de façon à empêcher l'éviction du propriétaire foncier; sans compter la protection spéciale, qu'on a voulu accorder aux femmes et aux mineurs, et qui n'a pas, en fait, tourné à leur avantage.
Quatrièmement, si vous voulez prêter ou emprunter sur gage, vous rencontrez le Code de procédure avec ses formalités, sa fiscalité, ses empêchements, qui sont comme des ouvrages avancés dirigés contre les Juifs, les Lombards et les usuriers, mais atteignant et arrêtant tous les prêteurs indistinctement, et les laissant mourir de faim en face d'un prêt dont ils ne peuvent se faire rembourser.
Le mal, la réforme, le crédit foncier, tout cela est dans la diminution et la suppression des obstacles suivants : 1° les lois de douanes; 2° les préjugés et les autres causes qui portent les acheteurs vers les terres: 3° le Code hypothécaire; 4° le Code de procédure.
M. Louis Leclerc, après avoir complètement admis les observations de MM. Bastiat, Howyn et Say, rappelle que, outre toutes les améliorations dont il vient d'être question, il serait désirable de voir s'introduire en France des institutions analogues à celles qui fonctionnent depuis longtemps en Pologne, en Silésie et dans d'autres localités d'Allemagne, qui facilitent les emprunts des propriétaires et les prêts des capitalistes, par l'émission de lettres de gage portant un intérêt très-peu élevé, comme il le faut à l'agriculture, et étant amorties dans l'espace d'une quarantaine d'années par des remboursements successifs.
A cet égard, M. Leclerc a rappelé le vœu raisonnable, cette année, des cinq cents membres du Congrès agricole, rejetant presque à l'unanimité le cours forcé et la direction des institutions de crédit foncier par le gouvernement.
Au sujet de ces institutions polonaises et prussiennes, M. Rodet, membre de la Chambre de commerce, a fait observer qu'elles ne trouveraient pas dans notre pays les mêmes éléments de réussite. En effet, en Pologne, en Silésie, en Allemagne, la propriété est encore féodale ; les propriétaires sont dans des conditions de solidarité qui n'existent plus en France.
M. Rodet est ensuite entré dans quelques détails sur la nature spéciale de la production agricole, du revenu de la terre. Il a fini en rappelant que, en Angleterre, les hommes qui sont parvenus à se former un capital songent à rester fermiers; tandis qu'en France c'est le contraire qui arrive, et qu'il est rare que le fils du fermier, s'il a prospéré, continue le métier de son père: c'est là un fait de mœurs qui explique en partie la situation de notre industrie agricole.
Après la levée de la séance, la conversation s'e-t prolongée entre divers groupes de la réunion, encore plus nombreuse que la précédente, qui était déjà la plus nombreuse que nous eussions vue. M. Bommart, ancien député, inspecteur des éludes à l'Ecole des ponts et chaussées, avait élé invité à cette séance par la Société, à laquelle assistaient aussi MM. Javal et Def'ontenay, [101] invités par des membres de la Société, et MM. Giraud, membre de l'Institut, Vée, ancien maire du cinquième arrondissement, de Billing, ancien ambassadeur en Danemarck, récemment nommés membres de la Société.
Text: ASEP version↩
Séance du 10 avril 1850.
A cette réunion, la Société d'économie politique s'est occupée d'un sujet mis à l'ordre du jour du congrès agricole, du conseil de l'agriculture; des manufactures et du commerce, et dont l'Assemblée elle-même est saisie par une proposition de l'honorable M. Wolowski ; nous voulons parler du crédit foncier, sujet faisant naturellement suite à la constitution des banques, traitée dans la réunion précédente.
Nous n'avons pas besoin de dire que jamais la Société d'économie politique n'a confondu les facilités données au propriétaire d'emprunter sur son gage, facilités que l'on a improprement appelées le crédit foncier, avec le crédit de l'exploitant rural, ou crédit analogue au crédit des autres producteurs. Pas n'est besoin d'ajouter non plus que depuis qu'on parle de toutes ces questions, la Société d'économie politique ne s'est pas fait les illusions qu'on a eues ailleurs sur les merveilles d'un mécanisme de crédit foncier et de crédit agricole, merveilles telles qu'on voulait en faire profiter l'Etat, que les propriétaires français devaient être en peu de temps exonérés de 11 à 12 milliards d'hypothèques, que le pays devait avoir une masse de richesses en papier à cours forcé et forçant ce scélérat de numéraire à circuler et ce tyran de capital à produire.
Si la Société d'économie politique a le plaisir de prouver qu'elle n'a jamais perdu la raison, elle voit avec satisfaction que cette raison commence à revenir aussi dans l'esprit public, à propos de ces questions de crédit agricole et foncier.
M. Bastiat, représentant du peuple, qui, le premier, a pris la parole, a d'abord caractérisé les illusions qu'on s'est faites généralement sur l'application du crédit à la production agricole, et a montré qu'au lieu de chercher des secours imaginaires pour l'agriculture, il fallait tout simplement lui ôter les obstacles qui empêchent la transmission de la propriété foncière.
M. Howyn De Tranghèhe a signalé ensuite le progrès que les mœurs ont à faire à la campagne, où tout le monde achète toujours trop de champs, et se prive, pour satisfaire la passion d'acquérir, du capital d'exploitation indispensable à la culture. L'honorable représentant craint que le crédit foncier, en le supposant organisé et fécond. ne réponde nullement aux besoins de l'agriculture, et que les ressources qu'il offrira ne soient consacrées, non pas à la culture, mais à de nouveaux achats de terre. «Au fond, dit-il, il ne faut rechercher dans tout cela que les moyens de rendre la liquidation d'une propriété hypothéquée plus facile, par la vente d'une partie dégageant le reste. Or, le moyen le plus simple d'arriver à ce résultat est d'abaisser les droits de mutation et de transmission des titres. »
M. Horace Say, abondant dans cette idée générale que la question dite de l'organisation du crédit foncier est surtout une question d'obstacles à faire disparaître de nos Codes et de notre administration, expose et précise la nature de ces obstacles. 11 explique d'abord comment la valeur des terres a été surélevée par le jeu des lois de protection douanière, de façon telle que le gage repose en partie sur un élément tout à fait artificiel. En second lieu, tant parce que nous avons hérité des préjugés de nos pères à l'endroit de la propriété foncière qui a longtemps concédé des droits et des avantages que ne donnaient pas les autres propriétés, que parce qu'à travers toutes nos époques révolutionnaires la propriété terrienne a offert plus de sécurité, les fortunes se sont portées sur l'acquisition des terres dont la valeur a également surenchéri par cette prédominance de la demande. De sorte qu'en définitive le crédit se trouve actuellement basé sur deux valeurs en partie fictives.
En troisième lieu, toutes nos lois hypothécaires, imprégnées d'esprit féodal et aristocratique, ont été combinées de façon à empêcher l'éviction du propriétaire foncier; sans compter la protection spéciale qu'on a voulu accorder aux femmes et aux mineurs, et qui n'a pas, en fait, tourné à leur avantage.
Quatrièmement, si vous voulez prêter ou emprunter sur gages, vous rencontrez le Code de procédure avec ses formalités, sa fiscalité, ses empêchements, qui sont comme des ouvrages avancés dirigés contre les juifs, les lombards et les usuriers, mais atteignant et arrêtant tous les prêteurs indistinctement, et les laissant mourir de faim en face d'un prêt dont ils ne peuvent se faire rembourser.
Le mal, la réforme, le crédit foncier, tout cela est dans la diminution et la suppression des obstacles suivants: 1° les lois de douane; 23 les préjugés et les autres causes qui portent les acheteurs vers les terres; 3° le Code hypothécaire; 4° le Code de procédure.
M. Louis Leclerc, après avoir complètement admis les observations de MM. Bastiat, Howyn et Say, rappelle que, outre toutes les améliorations dont il vient d'être question, il serait désirable de voir s'introduire en France des institutions analogues à celles qui fonctionnent depuis longtemps en Pologne, en Silésie et dans d'autres localités d'Allemagne, qui facilitent les emprunts des propriétaires et les prêts des capitalistes, par l'émission de lettres de gage portant un intérêt très peu élevé, comme il le faut à l'agriculture, et étant amorties dans l'espace d'une quarantaine d'années par des remboursements successifs.
A cet égard, M. Leclerc a rappelé le vœu raisonnable, cette année, des cinq cents membres du Congrès agricole, rejetant presque à l'unanimité le cours forcé et la direction des institutions de crédit foncier par le gouvernement.
Au sujet de ces institutions polonaises et prussiennes, M. Rodet, membre de la Chambre de commerce, a fait observer qu'elles ne trouveraient pas dans notre pays les mêmes éléments de réussite. En effet, en Pologne, en Silésie, en Allemagne, la propriété est encore féodale; les propriétaires sont dans des conditions de solidarité qui n'existent plus en France.
M. Rodet est ensuite entré dans quelques détails sur la nature spéciale de la production agricole, du revenu de la terre. Il a fini en rappelant que, en Angleterre, les hommes qui sont parvenus à se former un capital songent à rester fermiers, tandis qu'en France c'est le contraire qui arrive, et qu'il est rare que le fils du fermier, s'il a prospéré, continue le métier de son père : c'est là un fait de mœurs qui explique en partie la situation de notre industrie agricole.
Après la levée de la séance, la conversation s'est prolongée entre divers groupes de la réunion, encore plus nombreuse que la précédente, qui était déjà la plus nombreuse que nous eussions vue. MM. Bommart, ancien député, inspecteur des études à l'Ecole des ponts et chaussées, avait été invité à cette séance par la Société, à laquelle assistaient aussi MM. Léopold Javal et Roger de Fontenay, invités par des membres de la Société, et MM. Giraud, membre de l'Institut; Vée, ancien maire du cinquième arrondissement; de Billing, ancien ambassadeur en Danemark, récemment nommés membres de la Société.
Spoliation et loi [15 mai 1850]↩
BWV
1850.05.15 “Spoliation et loi” (Plunder and Law) [*Journal des Économistes*, 15 May 1850] [OC5.1, p. 1] [CW2] [“Spoliation et loi” is the title given by PP in OC5 with the subtitle “À Messieurs les Protectionnistes du Conseil général des Manufactures.” The latter is the title of the piece originally in JDE May 1850]
Spoliation et Loi [1]
Publié dans le Journal des Économistes du 15 mai 1850
À Messieurs les Protectionnistes du Conseil général des Manufactures.
Messieurs les protectionistes, causons un moment avec modération et de bonne amitié.
Vous ne voulez pas que l’économie politique croie et enseigne le libre-échange.
C’est comme si vous disiez : « Nous ne voulons pas que l’économie politique s’occupe de Société, d’Échange, de Valeur, de Droit, de Justice, de Propriété. Nous ne reconnaissons que deux principes, l’Oppression et la Spoliation. »
Vous est-il possible de concevoir l’économie politique sans société ? la société sans échanges ? l’échange sans un rapport d’appréciation entre les deux objets ou les deux services échangés ? Vous est-il possible de concevoir ce rapport, nommé valeur, autrement que comme résultant du libre consentement des échangistes ? Pouvez-vous concevoir qu’un produit en vaut un autre si, dans le troc, une des parties n’est pas libre [2] ? Vous est-il possible de concevoir le libre consentement des deux parties sans liberté ? Vous est-il possible de concevoir que l’un des contractants soit privé de liberté, à moins qu’il ne soit opprimé par l’autre ? Vous est-il possible de concevoir l’échange entre un oppresseur et un opprimé, sans que l’équivalence des services en soit altérée, sans que, par conséquent, une atteinte soit portée au droit, à la justice, à la propriété ?
Que voulez-vous donc ? dites-le franchement.
Vous ne voulez pas que l’échange soit libre !
Vous voulez donc qu’il ne soit pas libre ?
Vous voulez donc qu’il se fasse sous l’influence de l’oppression ? car s’il ne se faisait pas sous l’influence de l’oppression, il se ferait sous celle de la liberté, et c’est ce que vous ne voulez pas.
Convenez-en, ce qui vous gêne, c’est le droit, c’est la justice ; ce qui vous gêne, c’est la propriété, non la vôtre, bien entendu, mais celle d’autrui. Vous souffrez difficilement que les autres disposent librement de leur propriété (seule manière d’être propriétaire) ; vous entendez disposer de la vôtre… et de la leur.
Et puis vous demandez aux économistes d’arranger en corps de doctrine cet amas d’absurdités et de monstruosités ; de faire, à votre usage, la théorie de la Spoliation.
Mais c’est ce qu’ils ne feront jamais ; car, à leurs yeux, la Spoliation est un principe de haine et de désordre, et si elle revêt une forme plus particulièrement odieuse, c’est surtout la forme légale [3] .
Ici, monsieur Benoît d’Azy, je vous prends à partie. Vous êtes un homme modéré, impartial, généreux. Vous ne tenez ni à vos intérêts, ni à votre fortune ; c’est ce que vous proclamez sans cesse. Dernièrement, au Conseil général, vous disiez : « S’il suffisait que les riches abandonnassent ce qu’ils ont pour que le peuple fût riche, nous serions tous prêts à le faire. » (Oui ! oui ! c’est vrai !) Et hier, à l’Assemblée nationale : « Si je croyais qu’il dépendît de moi de donner à tous les ouvriers le travail dont ils ont besoin, je donnerais tout ce que je possède pour réaliser ce bienfait…, malheureusement impossible. »
Encore que l’inutilité du sacrifice vous donne le vif chagrin de ne le point faire, et de dire, comme Basile : « L’argent ! l’argent ! je le méprise…, mais je le garde, » assurément, nul ne doutera d’une générosité si retentissante, quoique si stérile. C’est une vertu qui aime à s’envelopper d’un voile de pudeur, surtout quand elle est purement latente et négative. Pour vous, vous ne perdez pas une occasion de l’afficher, en vue de toute la France, sur le piédestal de la tribune, au Luxembourg et au Palais législatif. C’est une preuve que vous ne pouvez en contenir les élans, bien que vous en conteniez à regret les effets.
Mais enfin, cet abandon de votre fortune, personne ne vous le demande, et je conviens qu’il ne résoudrait pas le problème social.
Vous voudriez être généreux, et vous ne le pouvez avec fruit ; ce que j’ose vous demander, c’est d’être juste. Gardez votre fortune, mais permettez-moi de garder la mienne. Respectez ma propriété comme je respecte la vôtre. Est-ce de ma part une requête trop hardie ?
Supposons que nous soyons dans un pays où règne la liberté d’échanger, où chacun puisse disposer de son travail et de sa propriété. — Vos cheveux se hérissent ? Rassurez-vous, ce n’est qu’une hypothèse.
Nous sommes donc aussi libres l’un que l’autre. Il y a bien une Loi dans le Code, mais cette Loi, toute impartialité et justice, loin de nuire à notre liberté, la garantit. Elle n’entrera en action qu’autant que nous essayerions d’exercer l’oppression, vous sur moi ou moi sur vous. Il y a une force publique, il y a des magistrats, des gendarmes, mais ils ne font qu’exécuter la Loi.
Les choses étant ainsi, vous êtes maître de forges et je suis chapelier. J’ai besoin de fer, pour mon usage ou pour mon industrie. Naturellement, je me pose ce problème : « Quel est pour moi le moyen de me procurer le fer, qui m’est nécessaire, avec la moindre somme possible de travail ? » En tenant compte de ma situation, de mes connaissances, je découvre que le mieux pour moi est de faire des chapeaux et de les livrer à un Belge, qui me donnera du fer en retour.
Mais vous êtes maître de forges, et vous vous dites : Je saurai bien forcer ce coquin-là (c’est de moi qu’il s’agit) de venir à ma boutique.
En conséquence, vous garnissez votre ceinture de sabres et de pistolets, vous armez vos nombreux domestiques, vous vous rendez sur la frontière, et là, au moment où je vais exécuter mon troc, vous me criez : — Arrête ! ou je te brûle la cervelle. — Mais, seigneur, j’ai besoin de fer. — J’en ai à vendre. — Mais, seigneur, vous le tenez fort cher. — J’ai mes raisons pour cela. — Mais, seigneur, j’ai mes raisons aussi pour préférer le fer à bon marché. — Eh bien ! entre tes raisons et les miennes, voici qui va décider. Valets, en joue !
Bref, vous empêchez le fer belge d’entrer, et, du même coup, vous empêchez mes chapeaux de sortir.
Dans l’hypothèse où nous sommes, c’est-à-dire sous le régime de la liberté, vous ne pouvez contester que ce ne soit là, de votre part, un acte manifeste d’Oppression et de Spoliation.
Aussi, je m’empresse d’invoquer la Loi, le magistrat, la force publique. Ils interviennent ; vous êtes jugé, condamné et justement châtié.
Mais tout ceci vous suggère une idée lumineuse.
Vous vous dites : J’ai été bien simple de me donner tant de peine ; quoi ! m’exposer à tuer ou à être tué ! me déplacer ! mettre en mouvement mes domestiques ! encourir des frais énormes ! me donner le caractère d’un spoliateur ! mériter d’être frappé par la justice du pays ! et tout cela, pour forcer un misérable chapelier à venir à ma boutique acheter du fer à mon prix ! Si je mettais dans mes intérêts la Loi, le magistrat et la force publique ! si je leur faisais faire, sur la frontière, cet acte odieux que j’y allais faire moi-même !
Échauffé par cette séduisante perspective, vous vous faites nommer législateur et votez un décret conçu en ces termes :
Art. 1er. Il sera prélevé une taxe sur tout le monde (et notamment sur mon maudit chapelier).
Art. 2. Avec le produit de cette taxe on paiera des hommes qui feront bonne garde à la frontière, dans l’intérêt des maîtres de forges.
Art. 3. Ils veilleront à ce que nul ne puisse échanger avec des Belges les chapeaux ou autres marchandises contre du fer.
Art. 4. Les ministres, procureurs de la République, douaniers, percepteurs et geôliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi.
Je conviens, Monsieur, que, sous cette forme, la Spoliation vous serait infiniment plus douce, plus lucrative, moins périlleuse que sous celle dont vous vous étiez d’abord avisé.
Je conviens qu’elle aurait pour vous un côté fort plaisant. Certes, vous en pourriez rire dans votre barbe, car vous en auriez fait passer tous les frais sur mes épaules.
Mais j’affirme que vous auriez introduit dans la société un principe de ruine, d’immoralité, de désordre, de haines et de révolutions incessantes ; que vous auriez ouvert la porte à tous les essais du socialisme et du communisme [4].
Vous trouvez, sans doute, mon hypothèse très-hardie. Eh bien ! retournons-la contre moi. J’y consens pour l’amour de la démonstration.
Me voici ouvrier ; vous êtes toujours maître de forges.
Il me serait avantageux d’avoir à bon marché, et même pour rien, des instruments de travail. Or, je sais qu’il y a dans votre magasin des haches et des scies. Donc, sans plus de façons, je pénètre chez vous et fais main basse sur tout ce qui me convient.
Mais vous, usant du droit de légitime défense, vous repoussez d’abord la force par la force ; ensuite, appelant à votre aide la Loi, le magistrat, la force publique, vous me faites jeter en prison et bien vous faites.
Oh ! oh ! me dis-je ; j’ai été gauche en tout ceci. Quand on veut jouir du bien d’autrui, ce n’est pas en dépit, c’est en vertu de la Loi qu’il faut agir, si l’on n’est pas un sot. En conséquence, comme vous vous êtes fait protectioniste, je me fais socialiste. Comme vous vous êtes arrogé le droit au profit, j’invoque le droit au travail ou aux instruments de travail.
D’ailleurs, en prison, j’ai lu mon Louis Blanc, et je sais par cœur cette doctrine : « Ce qui manque aux prolétaires pour s’affranchir, ce sont les instruments de travail ; la fonction du gouvernement est de les leur fournir. » Et encore : « Dès qui on admet qu’il faut à l’homme, pour être vraiment libre, le pouvoir d’exercer et de développer ses facultés, il en résulte que la société doit à chacun de ses membres, et l’instruction, sans laquelle l’esprit humain ne peut se déployer, et les instruments de travail, sans lesquels l’activité humaine ne peut se donner carrière. Or, par l’intervention de qui la société donnera-t-elle à chacun de ses membres l’instruction convenable et les instruments de travail nécessaires, si ce n’est par l’intervention de l’État [5] ? »
Donc, moi aussi, fallût-il pour cela révolutionner mon pays, je force les portes du Palais législatif. Je pervertis la Loi et lui fais accomplir, à mon profit et à vos dépens, l’acte même pour lequel elle m’avait jusqu’ici châtié.
Mon décret est calqué sur le vôtre.
Art. 1er. Il sera prélevé une taxe sur tous les citoyens et spécialement sur les maîtres de forges.
Art. 2. Avec le produit de cette taxe, l’État soldera un corps armé, lequel prendra le titre de gendarmerie fraternelle.
Art. 3. Les gendarmes fraternels entreront dans les magasins de haches, scies, etc., s’empareront de ces instruments et les distribueront aux ouvriers qui en désirent.
Grâce à cette combinaison habile, vous voyez bien, Monsieur, que je n’aurai plus les risques, ni les frais, ni l’odieux, ni les scrupules de la Spoliation. L’État volera pour moi, comme il fait pour vous. Nous serons à deux de jeu.
Reste à savoir comment se trouverait la société française de la réalisation de ma seconde hypothèse, ou, tout au moins, comment elle se trouve de la réalisation à peu près complète de la première.
Je ne veux pas traiter ici le point de vue économique de la question. On croit que, lorsque nous réclamons le libre-échange, nous sommes mus uniquement par le désir de laisser au travail et aux capitaux la faculté de prendre leur direction la plus avantageuse. On se trompe : cette considération n’est pour nous que secondaire ; ce qui nous blesse, ce qui nous afflige, ce qui nous épouvante dans le régime protecteur, c’est qu’il est la négation du droit, de la justice, de la propriété ; c’est qu’il tourne, contre la propriété et la justice, la Loi qui devait les garantir ; c’est qu’il bouleverse ainsi et pervertit les conditions d’existence de la société. — Et c’est sur ce côté de la question que j’appelle vos méditations les plus sérieuses.
Qu’est-ce donc que la Loi, ou du moins que devrait-elle être ? quelle est sa mission rationnelle et morale ? n’est-ce point de tenir la balance exacte entre tous les droits, toutes les libertés, toutes les propriétés ? n’est-ce pas de faire régner entre tous la justice ? n’est-ce pas de prévenir et de réprimer l’Oppression et la Spoliation de quelque part qu’elles viennent ?
Et n’êtes-vous pas effrayé de l’immense, radicale et déplorable innovation qui s’introduit dans le monde, le jour où la Loi est chargée d’accomplir elle-même le crime que sa mission était de châtier ? le jour où elle se tourne, en principe et en fait, contre la liberté et la propriété ?
Vous déplorez les symptômes que présente la société moderne ; vous gémissez sur le désordre qui règne dans les institutions et dans les idées. Mais n’est-ce pas votre principe qui a tout perverti, idées et institutions ?
Quoi ! la Loi n’est plus le refuge de l’opprimé, mais l’arme de l’oppresseur ! La Loi n’est plus une égide, mais une épée ! La Loi ne tient plus dans ses mains augustes une balance, mais de faux poids et de fausses clefs ! Et vous voulez que la société soit bien ordonnée !
Votre principe a écrit sur le fronton du Palais législatif ces mots : Quiconque acquiert ici quelque influence peut y obtenir sa part de Spoliation légale.
Et qu’est-il arrivé ? Toutes les classes se sont ruées sur les portes de ce palais, criant : à moi, à moi une part de Spoliation !
Après la révolution de Février, quand le suffrage universel a été proclamé, j’ai espéré un moment que sa grande voix allait se faire entendre pour dire : « Plus de Spoliation pour personne, justice pour tous. » — Et c’est là qu’était la vraie solution du problème social. Il n’en a pas été ainsi ; la propagande protectioniste avait trop profondément altéré, depuis des siècles, les sentiments et les idées.
Non, en faisant irruption dans l’Assemblée nationale, chaque classe est venue pour s’y faire, en vertu de votre principe, de la Loi un instrument de rapine. On a demandé l’impôt progressif, le crédit gratuit, le droit au travail, le droit à l’assistance, la garantie de l’intérêt, d’un minimum de salaire, l’instruction gratuite, les avances à l’industrie, etc., etc. ; bref, chacun a voulu vivre et se développer aux dépens d’autrui.
Et sous quelle autorité a-t-on placé ces prétentions ? Sous l’autorité de vos précédents. Quels sophismes a-t-on invoqués ? Ceux que vous propagez depuis des siècles. Ainsi que vous, on a parlé de niveler les conditions du travail.
Ainsi que vous, on a déclamé contre la concurrence anarchique. Ainsi que vous, on a bafoué le laissez faire, c’est-à dire la liberté. Ainsi que vous, on a dit que la Loi ne devait pas se borner à être juste, mais qu’elle devait venir en aide aux industries chancelantes, protéger le faible contre le fort, assurer des profits aux individus aux dépens de la communauté, etc., etc. Bref, le socialisme est venu faire, selon l’expression de M. Ch. Dupin, la théorie de la Spoliation. Il a fait ce que vous faites, ce que vous voulez que fassent avec vous et pour vous les professeurs d’économie politique.
Vous avez beau être habiles, messieurs les restrictionistes, vous avez beau radoucir le ton, vanter votre générosité latente, prendre vos adversaires par les sentiments, vous n’empêcherez pas la logique d’être la logique.
Vous n’empêcherez pas M. Billault de dire au législateur : Vous accordez des faveurs aux uns, il faut en accorder à tous.
Vous n’empêcherez pas M. Crémieux de dire au législateur : Vous enrichissez les manufacturiers, il faut enrichir les prolétaires.
Vous n’empêcherez pas M. Nadeau de dire au législateur : Vous ne pouvez refuser de faire pour les classes souffrantes ce que vous faites pour les classes privilégiées.
Vous n’empêcherez pas même votre coryphée M. Mimerel de dire au législateur : « Je demande 25,000 primes pour les caisses de retraite d’ouvriers, » et de développer ainsi sa motion :
« Est-ce le premier exemple de cette nature qu’offre notre législation ? Établirez-vous en système que l’État peut tout encourager, ouvrir à ses frais des cours de sciences, subventionner les beaux-arts, pensionner les théâtres, donner aux classes déjà favorisées de la fortune la haute instruction, les délassements les plus variés, les jouissances des arts, le repos de la vieillesse, donner tout cela à ceux qui ne connaissent pas de privations, faire payer leur part de ces sacrifices à ceux qui n’ont rien, et leur refuser tout, même pour les indispensabilités de la vie ?… »
… « Messieurs, notre société française, nos mœurs, nos lois sont ainsi faites, que l’intervention de l’État, si regrettable qu’on la suppose, se rencontre partout, et que rien ne paraît stable, rien ne parait durable si l’État n’y montre sa main. C’est l’État qui fait les porcelaines de Sèvres, les tapisseries des Gobelins ; c’est l’État qui expose périodiquement, et à ses frais, les produits de nos artistes, ceux de nos manufactures ; c’est l’État qui récompense nos éleveurs de bestiaux et nos armateurs de pêche. Il en coûte beaucoup pour tout cela ; c’est là encore un impôt que tout le monde paye ; tout le monde, entendez-vous bien ! Et quel bien direct en retire le peuple ? Quel bien direct lui font vos porcelaines, vos tapisseries, vos expositions ? Ce principe de résister à ce que vous appelez un état d’entraînement, on peut le comprendre, quoique hier encore vous ayez voté des primes pour le lin ; on peut le comprendre, mais à condition de consulter le temps ; à la condition surtout de faire preuve d’impartialité. S’il est vrai que, par tous les moyens que je viens d’indiquer, l’État ait eu jusqu’ici l’apparence de venir plus directement au-devant des besoins des classes aisées que de celles moins favorisées, il faut que cette apparence disparaisse. Sera-ce en fermant nos manufactures des Gobelins, en proscrivant nos expositions ? assurément non ; mais en faisant la part directe du pauvre dans cette distribution de bienfaits [6]. »
Dans cette longue énumération de faveurs accordées à quelques-uns aux dépens de tous, on remarque l’extrême prudence avec laquelle M. Mimerel a laissé dans l’ombre les faveurs douanières, encore qu’elles soient la manifestation la plus explicite de la Spoliation légale. Tous les orateurs qui l’ont appuyé ou contredit se sont imposé la même réserve. C’est fort habile ! Peut-être espèrent-ils, en faisant la part du pauvre, dans cette distribution de bienfaits, sauver la grande iniquité dont ils profitent, mais dont ils ne parlent pas.
Ils se font illusion. Croient-ils qu’après avoir réalisé la spoliation partielle par l’institution des douanes, d’autres classes ne voudront pas, par d’autres institutions, réaliser la Spoliation universelle ?
Je sais bien que vous avez un sophisme toujours prêt ; vous dites : « Les faveurs que la loi nous accorde ne s’adressent pas à l’industriel, mais à l’industrie. Les profits qu’elle nous permet de préveler, aux dépens des consommateurs, ne sont qu’un dépôt entre nos mains [7]. »
« Ils nous enrichissent, c’est vrai, mais notre richesse, nous mettant à même de dépenser davantage, d’agrandir nos entreprises, retombe comme une rosée féconde sur la classe ouvrière. »
Tel est votre langage ; et ce que je déplore, c’est que vos misérables sophismes ont assez perverti l’esprit public pour qu’on les invoque aujourd’hui à l’appui de tous les procédés de Spoliation légale. Les classes souffrantes disent aussi : Laissez-nous prendre législativement le bien d’autrui. Nous aurons plus d’aisance ; nous achèterons plus de blé, plus de viande, plus de draps, plus de fer, et ce que nous aurons reçu par l’impôt reviendra en pluie bienfaisante aux capitalistes et aux propriétaires.
Mais, je l’ai déjà dit, je ne discute pas aujourd’hui les conséquences économiques de la Spoliation légale. Quand MM. les protectionistes le voudront, ils me trouveront prêt à examiner le sophisme des ricochets [8], qui du reste peut être invoqué pour tous les genres de vols et de fraudes.
Bornons-nous aux effets politiques et moraux de l’échange législativement privé de liberté.
Je dis : le temps est venu de savoir enfin ce qu’est la Loi, ce qu’elle doit être.
Si vous faites de la Loi, pour tous les citoyens, le palladium de la liberté et de la propriété, si elle n’est que l’organisation du droit individuel de légitime défense, vous fonderez sur la Justice un gouvernement rationnel, simple, économique, compris de tous, aimé de tous, utile à tous, soutenu par tous, chargé d’une responsabilité parfaitement définie et fort restreinte, doué d’une solidité inébranlable.
Si, au contraire, vous faites de la Loi, dans l’intérêt des individus ou des classes, un instrument de Spoliation, chacun d’abord voudra faire la Loi, chacun ensuite voudra la faire à son profit. Il y aura cohue à la porte du Palais législatif, il y aura lutte acharnée au dedans, anarchie dans les esprits, naufrage de toute moralité, violence dans les organes des intérêts, ardentes luttes électorales, accusations, récriminations, jalousies, haines inextinguibles, force publique mise au service des rapacités injustes au lieu de les contenir, notion du vrai et du faux effacée de tous les esprits, comme notion du juste et de l’injuste effacée de toutes les consciences, gouvernement responsable de toutes les existences et pliant sous le poids d’une telle responsabilité, convulsions politiques, révolutions sans issue, ruines sur lesquelles viendront s’essayer toutes les formes du socialisme et du communisme : tels sont les fléaux que ne peut manquer de déchaîner la perversion de la Loi.
Tels sont, par conséquent, messieurs les prohibitionistes, les fléaux auxquels vous avez ouvert la porte, en vous servant de la Loi pour étouffer la liberté dans l’échange, c’est-à-dire pour étouffer le droit de propriété. Ne déclamez pas contre le socialisme, vous en faites. Ne déclamez pas contre le communisme, vous en faites. Et maintenant vous nous demandez, à nous économistes, de vous faire une théorie qui vous donne raison et vous justifie ! Morbleu ! faites-la vous-mêmes [9].
FN:Le 27 avril 1850, à la suite d’une discussion très-curieuse, que le Moniteur a reproduite, le Conseil général de l’agriculture, des manufactures et du commerce émit le vœu suivant :
« Que l’économie politique soit enseignée, par les professeurs rétribués par le gouvernement, non plus seulement au point de vue théorique du libre-échange, mais aussi et surtout au point de vue des faits et de la législation qui régit l’industrie française. »
C’est à ce vœu que répondit Bastiat par le pamphlet Spoliation et Loi, publié d’abord dans le Journal des Économistes, le 15 mai 1850. (Note de l’éditeur.)
FN:Voir la théorie de la valeur, au chap. v du tome VI. (Note de l’éditeur.)
FN:L’auteur avait exprimé cette opinion, trois ans auparavant, dans le numéro du 28 novembre 1847 du journal le Libre-Échange. Répondant au Moniteur industriel, il avait dit :
« Que le lecteur nous pardonne si nous nous faisons casuiste pour un instant. Notre adversaire nous force à mettre le bonnet de docteur. Aussi bien c’est sous le nom de docteur qu’il lui plaît souvent de nous désigner.
Un acte illégal est toujours immoral par cela seul qu’il est une désobéissance à la loi ; mais il ne s’ensuit pas qu’il soit immoral en lui-même. Quand un maçon (nous demandons pardon à notre confrère d’appeler son attention sur si peu de chose), après une rude journée de labeur, échange son salaire contre un coupon de drap belge, il ne fait pas une action intrinsèquement immorale. Ce n’est pas l’action en elle-même qui est immorale, c’est la violation de la loi. Et la preuve, c’est que si la loi vient à changer, nul ne trouvera à reprendre à cet échange. Il n’a rien d’immoral eu Suisse. Or ce qui est immoral de soi l’est partout et toujours. Le Moniteur industriel soutiendra-t-il que la moralité des actes dépend des temps et des lieux ?S’il y a des actes illégaux sans être immoraux, il y en a qui sont immoraux sans être illégaux. Quand notre confrère altère nos paroles en s’efforçant d’y trouver un sens qui n’y est pas ; quand certains personnages, après avoir déclaré dans l’intimité qu’ils sont pour la liberté, écrivent et votent contre ; quand un maître fait travailler son esclave à coups de bâton, le Code peut ne pas être violé, mais la conscience de tous les honnêtes gens est révoltée. C’est dans la catégorie de ces actes et au premier rang que nous plaçons les restrictions. Qu’un Français dise à un autre Français, son égal ou qui devrait l’être : — Je t’interdis d’acheter du drap belge, parce que je veux que tu sois forcé de venir à ma boutique. Si cela te dérange, cela m’arrange ; tu perdras quatre, mais je gagnerai deux, et cela suffit. — Nous disons que c’est une action immorale. Que celui qui se la permet l’exécute par ses propres forces ou à l’aide de la loi, cela ne change rien au caractère de l’acte. Il est immoral par nature, par essence ; il l’eût été il y a dix mille ans, il le serait aux antipodes, il le serait dans la lune, parce que, quoi qu’en dise le Moniteur industriel, la loi qui peut beaucoup ne peut cependant pas faire que ce qui est mal soit bien.
Nous ne craignons pas même de dire que le concours de la loi aggrave l’immoralité du fait. Si elle ne s’en mêlait pas, si, par exemple, le fabricant faisait exécuter sa volonté restrictive par des gens à ses gages, l’immoralité crèverait les yeux du Moniteur industriel lui-même. Eh quoi ! parce que ce fabricant a su s’épargner ce souci, parce qu’il a su faire mettre à son service la force publique et rejeter sur l’opprimé une partie des frais de l’oppression, ce qui était immoral est devenu méritoire !
Il peut arriver, il est vrai, que les gens ainsi foulés s’imaginent que c’est pour leur plus grand bien, et que l’oppression résulte d’une erreur commune aux oppresseurs et aux opprimés. Cela suffit pour justifier les intentions et ôter à l’acte ce qu’il aurait d’odieux sans cela. En ce cas, la majorité sanctionne la loi. Il faut s’y soumettre ; nous ne dirons jamais le contraire. Mais rien ne nous empêchera de dire à la majorité que, selon nous, elle se trompe. »
(Note de l’éditeur.)
FN:Voy., au tome IV, Protectionisme et Communisme. (Note de l’éditeur.)
FN: Organisation du travail, pages 17 et 24 de l’introduction.
FN: Moniteur du 28 avril 1850.
FN: Moniteur du 28 avril. Voir l’opinion de M. Devinck.
FN:Il se trouve implicitement réfuté aux chap. xii de la première série, iv et xiii de la seconde série des Sophismes. Voy., tome IV, pages 74, 160 et 229. (Note de l’éditeur.)
FN:Dans cette réponse aux protectionistes, qu’il leur adressait au moment de son départ pour les Landes, l’auteur, obligé d’indiquer rapidement ses vues sur le domaine rationnel de la législation, sentit le besoin de les exposer avec plus d’étendue. C’est ce qu’il fit, peu de jours après, pendant un court séjour à Mugron, en écrivant La Loi, pamphlet compris dans le précédent volume. (Note de l’éditeur.)
Réflexions sur l'amendement de M. Mortimer-Ternaux. [1 April 1850]↩
BWV
1850.04.01 “Réflexions sur l’amendement de M. Mortimer-Ternaux” (Reflections on the Amendment of M. Mortimer-Ternaux) [part of the debate in the Legislative Assembly on 1 April 1850] [OC5.12, p. 513] [CW2.18]
Source
<abc>
Réflexions sur l'amendement de M. Mortimer-Ternaux
Aux démocrates [1]
Non, je ne me trompe pas ; je sens battre dans ma poitrine un cœur démocratique. Comment donc se fait-il que je me trouve si souvent en opposition avec ces hommes qui se proclament les représentants exclusifs de la Démocratie ?
Il faut pourtant s’entendre. Ce mot a-t-il deux significations opposées ?
Il me semble, à moi, qu’il y a un enchaînement entre cette aspiration qui pousse tous les hommes vers leur perfectionnement matériel, intellectuel et moral, et les facultés dont ils ont été doués pour réaliser cette aspiration.
Dès lors, je voudrais que chaque homme eût, sous sa responsabilité, la libre disposition, administration et contrôle de sa propre personne, de ses actes, de sa famille, de ses transactions, de ses associations, de son intelligence, de ses facultés, de son travail, de son capital et de sa propriété.
C’est de cette manière qu’aux États-Unis on entend la liberté, la démocratie. Chaque citoyen veille avec un soin jaloux à rester maître de lui-même. C’est par là que le pauvre espère sortir de la pauvreté ; c’est par là que le riche espère conserver la richesse.
Et, en effet, nous voyons qu’en très-peu de temps ce régime a fait parvenir les Américains à un degré d’énergie, de sécurité, de richesse et d’égalité dont les annales du genre humain n’offrent aucun autre exemple.
Cependant, là, comme partout, il y a des hommes qui ne se feraient pas scrupule de porter atteinte, pour leur avantage personnel, à la liberté et à la propriété de leurs concitoyens.
C’est pourquoi la loi intervient, sous la sanction de la Force commune, pour prévenir et réprimer ce penchant désordonné.
Chacun concourt, en proportion de sa fortune, au maintien de cette Force. Ce n’est pas là, comme on l’a dit, sacrifier une partie de sa liberté pour conserver l’autre. C’est, au contraire, le moyen le plus simple, le plus juste, le plus efficace et le plus économique de garantir la liberté de tous.
Et un des problèmes les plus difficiles de la politique, c’est de mettre les dépositaires de cette Force commune hors d’état de faire eux-mêmes ce qu’ils sont chargés d’empêcher.
Les Démocrates français, à ce qu’il parait, voient les choses sous un jour tout différent.
Sans doute, comme les Démocrates américains, ils condamnent, repoussent et flétrissent la Spoliation que les citoyens seraient tentés d’exercer de leur chef, les uns à l’égard des autres, — toute atteinte portée à la propriété, au travail, à la liberté par un individu au préjudice d’un autre individu.
Mais cette Spoliation, qu’ils repoussent entre individus, ils la regardent comme un moyen d’égalisation ; et en conséquence ils la confient à la Loi, à la Force commune, que je croyais instituées pour l’empêcher.
Ainsi, pendant que les Démocrates américains, après avoir chargé la Force commune de châtier la Spoliation individuelle, sont très-préoccupés de la crainte que cette Force ne devienne elle-même spoliatrice, faire de cette Force un instrument de Spoliation, paraît être le fond même et l’âme du système des Démocrates français.
À ce système, ils donnent les grands noms d’organisation, association, fraternité, solidarité. Par là, ils ôtent tout scrupule aux appétits les plus brutaux.
« Pierre est pauvre, Mondor est riche ; ne sont-ils pas frères ? ne sont-ils pas solidaires ? ne faut-il pas les associer, les organiser ? Donc, qu’ils partagent et tout sera pour le mieux. Il est vrai que Pierre ne doit pas prendre à Mondor, ce serait inique. Mais nous ferons des Lois, nous créerons des Forces qui se chargeront de l’opération. Ainsi, la résistance de Mondor deviendra factieuse, et la Conscience de Pierre pourra être tranquille. »
Dans le cours de cette législature, il s’est présenté des occasions où la Spoliation se montre sous un aspect spécialement hideux. C’est celle que la Loi met en œuvre au profit du riche et au détriment du pauvre.
Eh bien ! Même dans ce cas, on voit la Montagne battre des mains. Ne serait-ce pas qu’elle veut, avant tout, s’assurer le principe ? Une fois qu’avec l’appui de la majorité, la Spoliation légale du pauvre au profit du riche sera systématisée, comment repousser la Spoliation légale du riche au profit du pauvre ?
Malheureux pays, où les Forces sacrées qui devaient être instituées pour maintenir chacun dans son droit, sont détournées à accomplir elles-mêmes la violation des droits !
Nous avons vu hier à l’Assemblée législative une scène de cette abominable et funeste comédie, qu’on pourrait bien appeler la comédie des dupes.
Voici de quoi il s’agissait :
Tous les ans, 300,000 enfants arrivent à l’âge de 12 ans. Sur ces 300,000 enfants, 10,000 peut-être entrent dans les colléges et lycées de l’État. Leurs parents sont-ils tous riches ? Je n’en sais rien. Mais ce qu’on peut affirmer de la manière la plus certaine, c’est qu’ils sont les plus riches de la nation.
Naturellement, ils devraient payer les frais de nourriture, d’instruction et d’entretien de leurs enfants. Mais ils trouvent que c’est fort cher. En conséquence, ils ont demandé et obtenu que la Loi, par l’impôt des boissons et du sel, prît de l’argent aux millions de parents pauvres, pour ledit argent leur être distribué, à eux parents riches, à titre de gratification, encouragement, indemnité, subvention, etc., etc.
M. Mortimer-Ternaux a demandé la cessation d’une pareille monstruosité, mais il a échoué dans ses efforts. L’extrême droite trouve très-doux de faire payer par les pauvres l’éducation des enfants riches, et l’extrême gauche trouve très politique de saisir une telle occasion de faire passer et sanctionner le système de la Spoliation légale.
Sur quoi je me demande : où allons-nous ? Il faut que l’Assemblée se dirige par quelque principe ; il faut qu’elle s’attache à la justice partout et pour tous, ou bien qu’elle se jette dans le système de la Spoliation légale et réciproque, jusqu’à parfaite égalisation de toutes les conditions, c’est-à-dire dans le communisme.
Hier, elle a déclaré que les pauvres paieraient des impôts pour soulager les riches. De quel front repoussera-t-elle les impôts qu’on lui proposera bientôt de frapper sur les riches pour soulager les pauvres ?
Pour moi, je ne puis oublier que lorsque je me suis présenté devant les électeurs, je leur ai dit :
« Approuveriez-vous un système de gouvernement qui consisterait en ceci : Vous auriez la responsabilité de votre propre existence. Vous demanderiez à votre travail, à vos efforts, à votre énergie, les moyens de vous nourrir, de vous vêtir, de vous loger, de vous éclairer, d’arriver à l’aisance, au bien-être, peut-être à la fortune. Le gouvernement ne s’occuperait de vous que pour vous garantir contre tout trouble, contre toute agression injuste. D’un autre côté, il ne vous demanderait que le très modique impôt indispensable pour accomplir cette tâche ? »
Et tous de s’écrier : « Nous ne lui demandons pas autre chose. »
Et maintenant, quelle serait ma position si j’avais à me présenter de nouveau devant ces pauvres laboureurs, ces honnêtes artisans, ces braves ouvriers, pour leur dire :
« Vous payez plus d’impôts que vous ne vous y attendiez. Vous avez moins de liberté que vous ne l’espériez. C’est un peu de ma faute, car je me suis écarté du système de gouvernement en vue duquel vous m’aviez nommé, et, le 1er avril, j’ai voté un surcroît d’impôt sur le sel et les boissons, afin de venir en aide au petit nombre de nos compatriotes qui envoient leurs enfants dans les colléges de l’État ? »
Quoi qu’il arrive, j’espère ne me mettre jamais dans la triste et ridicule nécessité de tenir aux hommes qui m’ont investi de leur confiance un semblable langage.
FN:À l’assemblée législative, dans la séance du 1er avril 1850, pendant la discussion du budget de l’instruction publique, M. Mortimer-Ternaux, représentant du peuple, proposa, par voie d’amendement, une diminution de 300,000 francs sur la dépense des lycées et des colléges, établissements fréquentés par les enfants de la classe moyenne.
Sur cette question, les représentants de l’extrême gauche votèrent avec l’extrême droite. L’amendement mis aux voix fut rejeté par une faible majorité.
Dès le lendemain, Bastiat publia, sur ce vote, dans une feuille quotidienne, l’opinion que nous reproduisons.
(Note de l’éditeur.)
Nouvelle politique coloniale de l'Angleterre. Plan de Lord John Russel [15 avril 1850]↩
BWV
1850.04.15 “Nouvelle politique coloniale de l'Angleterre. Plan de Lord John Russel" (England’s New Colonial Policy. The Plan of Lord John Russell) [*Journal des Économistes*, 15 avril 1850, T. XXVI, pp. 8-15]
Si l'on se demandait quel est le phénomène économique qui, dans les temps modernes, a exercé le plus d'influence sur les destinées de l'Europe, peut-être pourrait-on répondre : c'est l'aspiration de certains peuples, et particulièrement du peuple anglais, vers les colonies.
Existe-t-il au monde une source qui ait vomi sur l'humanité autant de guerres, de luttes, d'oppression, de coalitions, d'intrigues diplomatiques, de haines, de jalousies internationales, de sang versé, de travail déplacé, de crises industrielles, de préjugés sociaux, de déceptions, de monopoles, de misères de toutes sortes?
Le premier coup porté volontairement, scientifiquement au système colonial, dans le pays même où il a été pratiqué avec le plus de succès, est donc un des plus grands faits que puissent présenter les annales delà civilisation. Il faudrait être dépourvu de la faculté de rattacher les effets aux causes pour n'y point voir l'aurore d'une ère nouvelle dans l'industrie, le commerce et la politique des peuples.
Avoir de nombreuses colonies et constituer ces colonies, à l'égard delà mère patrie, sur les bases du monopole réciproque, telle est la pensée qui domine depuis des siècles la politique de la Grande-Bretagne. Or, ai-je besoin de dire quelle est cette politique? S'emparer d'un territoire, briser pour toujours ses communications avec le reste du monde, c'est là un acte de violence qui ne peut être accompli que par la force. [I provoque la réaction du pays conquis, celle des pays exclus, et la résistance de la nature même des choses. Un peuple qui entre dans cette voie se met dans la nécessité d'être partout et toujours le plus Tort, de travailler sans cesse à affaiblir les autres peuples.
Supposez qu'au bout de ce système, l'Angleterre ait rencontré une déception? Supposez qu'elle ait constaté, pour ainsi dire arithmétiquement, que ses colonies, organisées sur ce principe, ont été pour elle un fardeau; qu'en conséquence, son intérêt est de les laisser se gouverner elles-mêmes , autrement dit, de les affranchir ; — il est aisé de voir que, dans cette hypothèse , l'action funeste que la puissance britannique a exercée sur la marche des événements humains, se transformerait en une action bienfaisante.
Or, il est certain qu'il y a en Angleterre des hommes qui, acceptant dans tout leur ensemble les enseignements de la science économique, réclament, non par philanthropie, mais par intérêt, en vue de ce qu'ils considèrent comme le bien général de l'Angleterre elle-même , la rupture du lien qui enchaîne la métropole à ses cinquante colonies.
Mais ils ont à lutter contre deux grandes puissances : l'orgueil national et l'intérêt aristocratique.
La lutte est commencée. Il appartenait à M. Cobden de frapper le premier coup. Nous avons porté à la connaissance de nos lecteurs le discours prononcé au meeting de Bradfort, par l'illustre réformateur (n° du 15 février), aujourd'hui nous avons à leur faire connaître le plan adopté par le gouvernement anglais, tel qu'il a été exposé par le chef du cabinet, lord John Russell, à la Chambre des communes, dans la séance 8 février dernier.
Le premier ministre commence par faire l'énumération des colonies anglaises.
Ensuite il signale les principes sur lesquels elles ont été organisées:
En premier lieu, dit-il, l'objet de l'Angleterre semble avoir été d'envoyer de ce pays des émigrants pour coloniser ces contrées lointaines. Mais en second lieu, ce fut évidemment le système de ce pays, — comme celui de toutes les nations européennes à cette époque , — de maintenir strictement le monopole commercial entre la mère patrie et ses possessions. Par une multitude de statuts, nous avons eu soin de centraliser en Angleterre tout le commerce des colonies, de faire arriver ici toutes leurs productions, et de ne pas souffrir qu'aucune autre nation pût aller les acheter pour les porter ici ou ailleurs. C'était l'opinion universelle, que nous tirions de grands avantages de ce monopole, et cette opinion persistait encore en 1796, comme on le voit par un discours de M. Dundas, qui disait: « Si nous ne nous assurons pas, par le monopole, le commerce des colonies, leurs denrées trouveront d'autres débouchés, au grand détriment de la nation.
Un autre trait fort remarquable caractérisait nos rapports avec nos colonies, et c'est celui-ci : il était de principe que partout où des citoyens anglais jugeaient à propos de s'établir, ils portaient en eux-mêmes la liberté des institutions de la mère patrie.
Ace propos, lord John Russell cite des lettres patentes émanées de Charles Ier, desquelles il résulte que les premiers fondateurs des colonies avaient le droit de faire des lois, avec le consentement, l'assentiment et l'approbation des habitants libres desdites provinces; que leurs successeurs auraient les mêmes droits, comme s'ils étaient nés en Angleterre, possédant toutes les libertés, franchises et privilèges attachés à la qualité de citoyens anglais.
Il est aisé de comprendre que ces deux principes, savoir : 1° le monopole réciproque commercial; 2° le droit pour les colonies de se gouverner elles-mêmes , ne pouvaient pas marcher ensemble. Le premier a anéanti le second, ou du moins il n'en est resté que la faculté assez illusoire de décider ces petites affaires municipales, qui ne sauraient froisser les préjugés restrictifs dominants à cette époque.
Mais ces préjugés ont succombé dans l'opinion publique. Ils ont aussi succombé dans la législation par la réforme commerciale accomplie dans ces dernières années.
En vertu de cette réforme, les Anglais de la mère patrie et les Anglais des colonies sont rentrés dans la liberté d'acheter et de vendre selon leurs convenances respectives et leurs intérêts. Le lien du monopole est donc brisé, et la franchise commerciale étant réalisée, rien ne s'oppose plus à proclamer aussi la franchise politique.
Je pense qu'il est absolument nécessaire que le gouvernement et la Chambre proclament les principes qui doivent désormais les diriger; s'il est de notre devoir, comme je le crois fermement, de conserver notre grand et précieux empire colonial, veillons à ce qu'il ne repose que sur des principes justes, propres à faire honneur à ce pays et à contribuer au bonheur, à la prospérité de nos possessions.
En ce qui concerne notre politique commerciale, j'ai déjà dit que le système entier du monopole n'est plus. La seule précaution que nous ayons désormais à prendre, c'est que nos colonies n'accordent aucun privilège à une nation au détriment d'une autre, et qu'elles n'imposent pas des droits assez élevés sur nos profits pour équivaloir à une prohibition. Je crois que nous sommes fondés à leur faire cette, demande en retour de la sécurité que nous leur procurons.
J'arrive maintenant au mode de gouvernement de nos colonies. Je crois que, comme règle générale, nous ne' pouvons mieux faire que de nous référer à ces maximes de politique qui guidaient nos ancêtres en cette matière. Il me semble qu'ils agissaient avec justice et sagesse quand ils prenaient soin que partout où les Anglais s'établissaient, ils jouissent de la liberté anglaise et qu'ils eussent des institutions anglaises. Une telle politique était certainement calculée pour faire naître des sentiments de bienveillance entre la mère patrie et les colonies ; et elle mettait ceux de nos concitoyens qui se transportaient dans des contrées lointaines, à même de jeter les semences de vastes communautés, dont l'Angleterre peut être fière
…..
Canada. — Jusqu'en 1828, il y a eu de graves dissensions entre les ministres de la couronne et le peuple canadien. Le gouvernement de ce pays crut pouvoir régler les impôts du Canada sans l'autorité et le consentement des habitants de la colonie. M. Huskisson proposa une enquête à ce sujet. Le Parlement s'en occupa longuement: des comités furent réunis, des commissions furent envoyées sur les lieux; mais à la fin une insurrection éclata. Le gouvernement, dont je faisais partie, jugea à propos de suspendre, pour un temps, la constitution de la colonie. Plus tard , il proposa de réunir les deux provinces et de leur donner d'amples pouvoirs législatifs. En établissant ce mode de gouvernement dans une colonie si importante, nous rencontrâmes une question, qui, je l'espère, a été résolue à la satisfaction du peuple canadien, quoiqu'elle ne pût pas être tranchée de la même manière dans une province moins vaste et moins peuplée. Le parti populaire du Canada réclamait ce qu'il appelait un gouvernement responsable, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas d'une législature librement élue, mais il voulait encore que le gouverneur général, au lieu de nommer son ministère , abstraction faite de l'opinion de la législature, ainsi que cela était devenu l'usage, fût obligé de le choisir dans la majorité de l’Assemblée. Ce plan fut adopté.
… Dans ces dernières années, le gouvernement a été dirigé, en conformité de ce que les ministres de Sa Majesté croient être l'opinion du peuple canadien. Quand lord Elgin vit que son ministère n'avait qu'une majorité insignifiante, il proposa, soit de le maintenir jusqu'à ce qu'il rencontrât des votes décidément adverses, soit de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée fut dissoute. Les élections donnèrent la majorité à l'opposition, et lord Elgin donna les portefeuilles à ses adversaires. Je ne crois pas qu'il fût possible de respecter plus complètement et plus loyalement le principe de laisser !a colonie s'administrer elle-même.
New-Brunswick et Nouvelle-Ecosse. —Le ministre rappelle que, dans ces provinces, le conseil exécutif est récemment devenu électif, de telle sorte que les affaires du pays se traitent par les habitants eux-mêmes, ce qui a fait cesser lès malheureuses dissensions qui agitaient ces provinces.
Cap de Bonne-Espérance. — Le ministre annonce qu'après de longues discussions et malgré de sérieuses difficultés, il a été décidé que le gouvernement représentatif serait introduit au cap de Bonne-Espérance. L'Assemblée représentative sera élue par les habitants qui présenteront certaines garanties. On demandera des garanties plus étendues pour élire les membres du Conseil. Les membres de l'Assemblée seront élus pour cinq ans, ceux du Conseil pour dix ans, renouvelables, par moitié , tous les cinq ans.
Australie. — Je ne propose pas, pour l'Australie, une Assemblée et un Conseil, en imitation de nos institutions métropolitaines, mais un seul Conseil élu, pour les deux tiers, par le peuple, et pour un tiers, par le gouverneur. Ce qui m'a fait arriver à cette résolution , c'est que cette forme a prévalu avec succès dans la Nouvelle-Galles du Sud, et autant que nous pouvons en juger, elle y est préférée par l'opinion populaire à des institutions plus analogues à celles de la mère patrie (écoutez, écoutez, et cris: non, non). Tout ce que je puis dire, c'est que nous avons cru adopter la forme la plus agréable à la colonie, et s'il eût existé, dans la NouvelleGalles du Sud, une opinion bien arrêtée sur la convenance de substituer un Conseil et une Assemblée à la constitution actuelle, nous nous serions hâtés d'accéder à ce vœu.... J'ajoute que, tout en proposant pour la colonie cette forme de gouvernement, notre intention est de lui laisser la faculté d'en changer. Si c'est l'opinion des habitants, qu'ils se trouveraient mieux d'un Conseil et d'une Assemblée, ils ne rencontreront pas d'opposition de la part de la couronne.
L'année dernière nous avions proposé que les droits de douane actuellement existant à la Nouvelle-Galles du Sud fussent étendus, par acte du Parlement, à toutes les colonies australiennes. Quelque désirable que soit cette uniformité, nous ne croyons pas qu'il soit convenable de l'imposer par l'autorité du Parlement, et nous préférons laisser chacune de ces colonies voter son propre tarif, et décider pour elle-même.
Nous proposons qu'un Conseil électif, semblable à celui de la NouvelleGalles du Sud, soit accordé au district de Port-Philippe, un autre à la terre de Van-Diémen , un autre à l'Australie Méridionale.
Nous proposons, en outre, que sur la demande de deux de ces colonies, il y ait une réunion générale de tous les Conseils australiens, afin de régler, en commun, des affaires communes, comme l'uniformité du tarif, l'uniformité de la mise à prix des terres à vendre.
Je n'entrerai pas dans plus de détails sur la portée de ce bill, puisqu'il est sous vos yeux. J'en ai dit assez pour montrer notre disposition à introduire , soit dans nos colonies américaines, soit dans nos colonies australiennes , des institutions représentatives, de donner pleine carrière à la volonté de leurs habitants, afin qu'ils apprennent à se frayer eux-mêmes la voie vers leur propre prospérité, d'une manière beaucoup plus sûre que si leurs affaires étaient réglementées et contrôlées par des décrets émanés de la mère patrie.
Nouvelle-Zélande. — En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, nous montrâmes dès 1846, et peut-être d'une manière un peu précipitée, notre disposition à introduire dans ce pays des institutions représentatives. L'homme supérieur qui gouverne en ce moment la colonie nous a signalé la différence qui existe entre les naturels de la Nouvelle-Zélande et ceux de nos autres possessions, soit en Amérique, soit en Afrique, dans la NouvelleHollande, ou la terre de Van-Diémen. Il nous a fait remarquer leur aptitude à la civilisation et avec quelle répugnance ils supporteraient la suprématie d'un petit nombre de personnes de race anglaise, seules chargées de l'autorité législative. Ces objections ont frappé le gouvernement par leur justesse, et en conséquence, nous proposâmes de suspendre la Constitution. Maintenant le gouverneur écrit qu'il a institué un Conseil législatif dans la partie méridionale de la Nouvelle-Zélande. Il nous informe en outre que, dans son opinion, les institutions représentatives peuvent être introduites sans danger et avec utilité dans toute la colonie. En conséquence, et croyant son opinion fondée, nous n'attendons plus, pour agir, que quelques nouvelles informations de détail et le terme fixé par l'acte du Parlement.
Le ministre expose ensuite le. plan qu'il se propose de suivre à l'égard de la Jamaïque, des Barbades, delà Guyane anglaise, de la Trinité, de Maurice et de Malte. Il parle de la répugnance que manifestent toutes les colonies à recevoir les condamnés à la transportation, et en conclut à la nécessité de restreindre ce mode de châtiment.
Quant à l'émigration qui, dans ces dernières années surtout, a acquis des proportions énormes, il se félicite de ce que le gouvernement s'est abstenu de toute intervention au delà de quelques primes et secours temporaires. « L'émigration, dit-il, s'est élevée, depuis trois ans, à deux cent soixante-cinq mille personnes annuellement. » Il n'estime pas à moins de 1,500,000 livres sterling la dépense qu'elle a entraînée.
Les classes laborieuses ont trouvé pour elles-mêmes les combinaisons les plus ingénieuses. Par les relations qui existent entre les anciens émigrants et ceux qui désirent émigrer, des fonds se trouvent préparés, des moyens de travail et d'existence assurés à ces derniers, au moment même où ils mettent le pied sur ces terres lointaines. Si nous avions mis à la charge du trésor cette somme de 1,500,000 livres sterling, indépendamment du fardeau qui en serait résulté pour le peuple de ce pays, nous aurions provoqué toutes sortes d'abus. Nous aurions facilité l'émigration de personnes impropres ou dangereuses, qui auraient été accueillies avec malédiction aux Etats-Unis et dans nos propres colonies. Ces contrées n'auraient pas manqué de nous dire : « Ne nous envoyez pas vos paresseux, vos impotents, vos estropiés, la lie de votre population. Si tel est le caractère de votre émigration, nous aurons certainement le droit d'intervenir pour la repousser. » Telle eût été, je n'en doute pas, la conséquence de l'intervention gouvernementale exercée sur une grande échelle.
Après quelques autres considérations, lord John Russell termine ainsi:
Voici ce qui résulte de tout ce que je viens de dire. En premier lieu, quelque soit le mécontentement, souvent bien fondé, qu'a fait naître la transition pénible pour nos colonies du système du monopole au système du libre-échange, nous ne reviendrons pas sur cette résolution que désormais votre commerce avec les colonies est fondé sur ce principe : vous êtes libres de recevoir les produits de tous les pays qui peuvent vous les fournir à meilleur marché et de meilleure qualité que les colonies, et d'un autre côté les colonies sont libres de commercer avec toutes les parties du globe, de la manière qu'elles jugeront la plus avantageuse à leurs intérêts. C'est là, dis-je, qu'est pour l'avenir le point cardinal de notre politique.
En second lieu, conformément à la politique que vous avez suivie à l'égard des colonies de l'Amérique du Nord, vous agirez sur ce principe d'introduire et maintenir, autant que possible, la liberté politique dans toutes vos colonies. Je crois que toutes les fois que vous affirmerez que la liberté politique ne peut pas être introduite, c'est à vous de donner des raisons pour l'exception; et il vous incombe de démontrer qu'il s'agit d'une race qui ne peut encore admettre les institutions libres; que la colonie n'est pas composée de citoyens anglais, ou qu'ils n'y sont qu'en trop faible proportion pour pouvoir soutenir de telles institutions avec quelque sécurité. A moins que vous ne fassiez cette preuve, et chaque fois qu'il s'agira d'une population britannique capable de se gouverner elle-même, si vous continuez à être leurs représentants en ce qui concerne la politique extérieure, vous n'avez plus à intervenir dans leurs affaires domestiques au delà de ce qui est clairement et décidément indispensable pour prévenir un conflit dans la colonie elle-même.
Je crois que ce sont là les deux principes sur lesquels vous devez agir. Je suis sûr au moins que ce sont ceux que le gouvernement actuel a adoptés, et je ne doute pas qu'ils n'obtiennent l'assentiment de la Chambre …
Non-seulement je crois que ces principes sont ceux qui doivent vous diriger, sans aucun danger pour le présent, mais je pense encore qu'ils serviront à résoudre, dans l'avenir, de graves questions, sans nous exposer à une collision aussi malheureuse que celle qui marqua la fin du dernier siècle. En revenant sur l'origine de cette guerre fatale avec les contrées qui sont devenues les Etats-Unis de l'Amérique, je ne puis m'empêcher de croire qu'elle fut le résultat non d'une simple erreur, d'une simple faute, mais d'une série répétée de fautes et d'erreurs, d'une politique malheureuse de concessions tardives et d'exigences inopportunes. J'ai la confiance que nous n'aurons plus à déplorer de tels conflits. Sans doute je prévois, avec tous les bons esprits, que quelques-unes de nos colonies grandiront tellement en population et en richesse qu'elles viendront nous dire un jour: « Nous avons assez de force pour être indépendantes de l'Angleterre. Le lien qui nous attache à elle nous est devenu onéreux et le moment est arrivé où, en toute amitié et en bonne alliance avec la mère patrie, nous voulons maintenir notre indépendance. » Je ne crois pas que ce temps soit très-rapproché, mais faisons tout ce qui est en nous pour les rendre aptes à se gouverner elles-mêmes. Donnons-leur autant que possible la faculté de diriger leurs propres affaires. Qu'elles croissent en nombre et en bien-être, et, quelque chose qui arrive, nous, citoyens de ce grand empire, nous aurons la consolation de dire que nous avons contribué au bonheur du monde.
Il n'est pas possible d'annoncer de plus grandes choses avec plus de simplicité, et c'est ainsi que, sans la chercher, on rencontre la véritable éloquence.
A MM. les protectionnistes du Conseil général des manufactures [15 mai 1850] [see Spoliation et loi [CW2.4]]↩
BWV
1850.05.15 “A MM. les protectionnistes du Conseil général des manufactures” (To the Protectionists on the General Council of Manufactures) [*Journal des Économistes, T. XXVI, N° 110, 15 mai 1850, p. 160-67]. Published as Spoliation et loi [15 mai 1850] [CW2.4]
La loi [June 1850] ↩
BWV
1850.06 “La Loi” (The Law) [Mugron, July 1850] [OC4.6, p. 324] [CW2]
Source
OC vol. 4 Sophismes économiques — Petits pamphlets, I (1863 ed.): <http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat,_Guillaumin,_4.djvu>.
La loi pervertie ! La loi — et à sa suite toutes les forces collectives de la nation, — la Loi, dis-je, non seulement détournée de son but, mais appliquée à poursuivre un but directement contraire ! La Loi devenue l’instrument de toutes les cupidités, au lieu d’en être le frein ! La Loi accomplissant elle-même l’iniquité qu’elle avait pour mission de punir ! Certes, c’est là un fait grave, s’il existe, et sur lequel il doit m’être permis d’appeler l’attention de mes concitoyens.
Nous tenons de Dieu le don qui pour nous les renferme tous, la Vie, — la vie physique, intellectuelle et morale.
Mais la vie ne se soutient pas d’elle-même. Celui qui nous l’a donnée nous a laissé le soin de l’entretenir, de la développer, de la perfectionner.
Pour cela, il nous a pourvus d’un ensemble de Facultés merveilleuses ; il nous a plongés dans un milieu d’éléments divers. C’est par l’application de nos facultés à ces éléments que se réalise le phénomène de l’Assimilation, de l’Appropriation, par lequel la vie parcourt le cercle qui lui a été assigné.
Existence, Facultés, Assimilation — en d’autres termes, Personnalité, Liberté, Propriété, — voilà l’homme.
C’est de ces trois choses qu’on peut dire, en dehors de toute subtilité démagogique, qu’elles sont antérieures et supérieures à toute législation humaine.
Ce n’est pas parce que les hommes ont édicté des Lois que la Personnalité, la Liberté et la Propriété existent. Au contraire, c’est parce que la Personnalité, la Liberté et la Propriété préexistent que les hommes font des Lois.
Qu’est-ce donc que la Loi ? Ainsi que je l’ai dit ailleurs, c’est l’organisation collective du Droit individuel de légitime défense [2].
Chacun de nous tient certainement de la nature, de Dieu, le droit de défendre sa Personne, sa Liberté, sa Propriété, puisque ce sont les trois éléments constitutifs ou conservateurs de la Vie, éléments qui se complètent l’un par l’autre et ne se peuvent comprendre l’un sans l’autre. Car que sont nos Facultés, sinon un prolongement de notre Personnalité, et qu’est-ce que la Propriété si ce n’est un prolongement de nos Facultés ?
Si chaque homme a le droit de défendre, même par la force, sa Personne, sa Liberté, sa Propriété, plusieurs hommes ont le Droit de se concerter, de s’entendre, d’organiser une Force commune pour pourvoir régulièrement à cette défense.
Le Droit collectif a donc son principe, sa raison d’être, sa légitimité dans le Droit individuel ; et la Force commune ne peut avoir rationnellement d’autre but, d’autre mission que les forces isolées auxquelles elle se substitue.
Ainsi, comme la Force d’un individu ne peut légitimement attenter à la Personne, à la Liberté, à la Propriété d’un autre individu, par la même raison la Force commune ne peut être légitimement appliquée à détruire la Personne, la Liberté, la Propriété des individus ou des classes.
Car cette perversion de la Force serait, en un cas comme dans l’autre, en contradiction avec nos prémisses. Qui osera dire que la Force nous a été donnée non pour défendre nos Droits, mais pour anéantir les Droits égaux de nos frères ? Et si cela n’est pas vrai de chaque force individuelle, agissant isolément, comment cela serait-il vrai de la force collective, qui n’est que l’union organisée des forces isolées ?
Donc, s’il est une chose évidente, c’est celle-ci : La Loi, c’est l’organisation du Droit naturel de légitime défense ; c’est la substitution de la force collective aux forces individuelles, pour agir dans le cercle où celles-ci ont le droit d’agir, pour faire ce que celles-ci ont le droit de faire, pour garantir les Personnes, les Libertés, les Propriétés, pour maintenir chacun dans son Droit, pour faire régner entre tous la Justice.
Et s’il existait un peuple constitué sur cette base, il me semble que l’ordre y prévaudrait dans les faits comme dans les idées. Il me semble que ce peuple aurait le gouvernement le plus simple, le plus économique, le moins lourd, le moins senti, le moins responsable, le plus juste, et par conséquent le plus solide qu’on puisse imaginer, quelle que fût d’ailleurs sa forme politique.
Car, sous un tel régime, chacun comprendrait bien qu’il a toute la plénitude comme toute la responsabilité de son Existence. Pourvu que la personne fût respectée, le travail libre et les fruits du travail garantis contre toute injuste atteinte, nul n’aurait rien à démêler avec l’État. Heureux, nous n’aurions pas, il est vrai, à le remercier de nos succès ; mais malheureux, nous ne nous en prendrions pas plus à lui de nos revers que nos paysans ne lui attribuent la grêle ou la gelée. Nous ne le connaîtrions que par l’inestimable bienfait de la Sûreté.
On peut affirmer encore que, grâce à la non-intervention de l’État dans des affaires privées, les Besoins et les Satisfactions se développeraient dans l’ordre naturel. On ne verrait point les familles pauvres chercher l’instruction littéraire avant d’avoir du pain. On ne verrait point la ville se peupler aux dépens des campagnes, ou les campagnes aux dépens des villes. On ne verrait pas ces grands déplacements de capitaux, de travail, de population, provoqués par des mesures législatives, déplacements qui rendent si incertaines et si précaires les sources mêmes de l’existence, et aggravent par là, dans une si grande mesure, la responsabilité des gouvernements.
Par malheur, il s’en faut que la Loi se soit renfermée dans son rôle. Même il s’en faut qu’elle ne s’en soit écartée que dans des vues neutres et discutables. Elle a fait pis : elle a agi contrairement à sa propre fin ; elle a détruit son propre but ; elle s’est appliquée à anéantir cette Justice qu’elle devait faire régner, à effacer, entre les Droits, cette limite que sa mission était de faire respecter ; elle a mis la force collective au service de ceux qui veulent exploiter, sans risque et sans scrupule, la Personne, la Liberté ou la Propriété d’autrui ; elle a converti la Spoliation en Droit, pour la protéger, et la légitime défense en crime, pour la punir.
Comment cette perversion de la Loi s’est-elle accomplie ? Quelles en ont été les conséquences ?
La Loi s’est pervertie sous l’influence de deux causes bien différentes : l’égoïsme inintelligent et la fausse philanthropie.
Parlons de la première.
Se conserver, se développer, c’est l’aspiration commune à tous les hommes, de telle sorte que si chacun jouissait du libre exercice de ses facultés et de la libre disposition de leurs produits, le progrès social serait incessant, ininterrompu, infaillible.
Mais il est une autre disposition qui leur est aussi commune. C’est de vivre et de se développer, quand ils le peuvent, aux dépens les uns des autres. Ce n’est pas là une imputation hasardée, émanée d’un esprit chagrin et pessimiste. L’histoire en rend témoignage par les guerres incessantes, les migrations de peuples, les oppressions sacerdotales, l’universalité de l’esclavage, les fraudes industrielles et les monopoles dont ses annales sont remplies.
Cette disposition funeste prend naissance dans la constitution même de l’homme, dans ce sentiment primitif, universel, invincible, qui le pousse vers le bien-être et lui fait fuir la douleur.
L’homme ne peut vivre et jouir que par une assimilation, une appropriation perpétuelle, c’est-à-dire par une perpétuelle application de ses facultés sur les choses, ou par le travail. De là la Propriété.
Mais, en fait, il peut vivre et jouir en s’assimilant, en s’appropriant le produit des facultés de son semblable. De là la Spoliation.
Or, le travail étant en lui-même une peine, et l’homme étant naturellement porté à fuir la peine, il s’ensuit, l’histoire est là pour le prouver, que partout où la spoliation est moins onéreuse que le travail, elle prévaut ; elle prévaut sans que ni religion ni morale puissent, dans ce cas, l’empêcher.
Quand donc s’arrête la spoliation ? Quand elle devient plus onéreuse, plus dangereuse que le travail.
Il est bien évident que la Loi devrait avoir pour but d’opposer le puissant obstacle de la force collective à cette funeste tendance ; qu’elle devrait prendre parti pour la propriété contre la Spoliation.
Mais la Loi est faite, le plus souvent, par un homme ou par une classe d’hommes. Et la Loi n’existant point sans sanction, sans l’appui d’une force prépondérante, il ne se peut pas qu’elle ne mette en définitive cette force aux mains de ceux qui légifèrent.
Ce phénomène inévitable, combiné avec le funeste penchant que nous avons constaté dans le cœur de l’homme, explique la perversion à peu près universelle de la Loi. On conçoit comment, au lieu d’être un frein à l’injustice, elle devient un instrument et le plus invincible instrument d’injustice. On conçoit que, selon la puissance du législateur, elle détruit, à son profit, et à divers degrés, chez le reste des hommes, la Personnalité par l’esclavage, la Liberté par l’oppression, la Propriété par la spoliation.
Il est dans la nature des hommes de réagir contre l’iniquité dont ils sont victimes. Lors donc que la Spoliation est organisée par la Loi, au profit des classes qui la font, toutes les classes spoliées tendent, par des voies pacifiques ou par des voies révolutionnaires, à entrer pour quelque chose dans la confection des Lois. Ces classes, selon le degré de lumière où elles sont parvenues, peuvent se proposer deux buts bien différents quand elles poursuivent ainsi la conquête de leurs droits politiques : ou elles veulent faire cesser la spoliation légale, ou elles aspirent à y prendre part.
Malheur, trois fois malheur aux nations où cette dernière pensée domine dans les masses, au moment où elles s’emparent à leur tour de la puissance législative !
Jusqu’à cette époque la spoliation légale s’exerçait par le petit nombre sur le grand nombre, ainsi que cela se voit chez les peuples où le droit de légiférer est concentré en quelques mains. Mais le voilà devenu universel, et l’on cherche l’équilibre dans la spoliation universelle. Au lieu d’extirper ce que la société contenait d’injustice, on la généralise. Aussitôt que les classes déshéritées ont recouvré leurs droits politiques, la première pensée qui les saisit n’est pas de se délivrer de la spoliation (cela supposerait en elles des lumières qu’elles ne peuvent avoir), mais d’organiser, contre les autres classes et à leur propre détriment, un système de représailles, — comme s’il fallait, avant que le règne de la justice arrive, qu’une cruelle rétribution vînt les frapper toutes, les unes à cause de leur iniquité, les autres à cause de leur ignorance.
Il ne pouvait donc s’introduire dans la Société un plus grand changement et un plus grand malheur que celui-là : la Loi convertie en instrument de spoliation.
Quelles sont les conséquences d’une telle perturbation ? Il faudrait des volumes pour les décrire toutes. Contentons-nous d’indiquer les plus saillantes.
La première, c’est d’effacer dans les consciences la notion du juste et de l’injuste.
Aucune société ne peut exister si le respect des Lois n’y règne à quelque degré ; mais le plus sûr, pour que les lois soient respectées, c’est qu’elles soient respectables. Quand la Loi et la Morale sont en contradiction, le citoyen se trouve dans la cruelle alternative ou de perdre la notion de Morale ou de perdre le respect de la Loi, deux malheurs aussi grands l’un que l’autre et entre lesquels il est difficile de choisir.
Il est tellement de la nature de la Loi de faire régner la Justice, que Loi et Justice, c’est tout un, dans l’esprit des masses. Nous avons tous une forte disposition à regarder ce qui est légal comme légitime, à ce point qu’il y en a beaucoup qui font découler faussement toute justice de la Loi. Il suffit donc que la Loi ordonne et consacre la Spoliation pour que la spoliation semble juste et sacrée à beaucoup de consciences. L’esclavage, la restriction, le monopole trouvent des défenseurs non seulement dans ceux qui en profitent, mais encore dans ceux qui en souffrent. Essayez de proposer quelques doutes sur la moralité de ces institutions. « Vous êtes, dira-t-on, un novateur dangereux, un utopiste, un théoricien, un contempteur des lois ; vous ébranlez la base sur laquelle repose la société. » Faites-vous un cours de morale, ou d’économie politique ? Il se trouvera des corps officiels pour faire parvenir au gouvernement ce vœu :
« Que la science soit désormais enseignée, non plus au seul point de vue du Libre-Échange (de la Liberté, de la Propriété, de la Justice), ainsi que cela a eu lieu jusqu’ici, mais aussi et surtout au point de vue des faits et de la législation (contraire à la Liberté, à la Propriété, à la Justice) qui régit l’industrie française. »
« Que, dans les chaires publiques salariées par le Trésor, le professeur s’abstienne rigoureusement de porter la moindre atteinte au respect dû aux lois en vigueur [3], etc. »
En sorte que s’il existe une loi qui sanctionne l’esclavage ou le monopole, l’oppression ou la spoliation sous une forme quelconque, il ne faudra pas même en parler ; car comment en parler sans ébranler le respect qu’elle inspire ? Bien plus, il faudra enseigner la morale et l’économie politique au point de vue de cette loi, c’est-à-dire sur la supposition qu’elle est juste par cela seul qu’elle est Loi.
Un autre effet de cette déplorable perversion de la Loi, c’est de donner aux passions et aux luttes politiques, et, en général, à la politique proprement dite, une prépondérance exagérée.
Je pourrais prouver cette proposition de mille manières. Je me bornerai, par voie d’exemple, à la rapprocher du sujet qui a récemment occupé tous les esprits : le suffrage universel.
Quoi qu’en pensent les adeptes de l’École de Rousseau, laquelle se dit très avancée et que je crois reculée de vingt siècles, le suffrage universel (en prenant ce mot dans son acception rigoureuse) n’est pas un de ces dogmes sacrés, à l’égard desquels l’examen et le doute même sont des crimes.
On peut lui opposer de graves objections.
D’abord le mot universel cache un grossier sophisme. Il y a en France trente-six millions d’habitants. Pour que le droit de suffrage fût universel, il faudrait qu’il fût reconnu à trente-six millions d’électeurs. Dans le système le plus large, on ne le reconnaît qu’à neuf millions. Trois personnes sur quatre sont donc exclues et, qui plus est, elles le sont par cette quatrième. Sur quel principe se fonde cette exclusion ? sur le principe de l’Incapacité. Suffrage universel veut dire : suffrage universel des capables. Restent ces questions de fait : quels sont les capables ? l’âge, le sexe, les condamnations judiciaires sont-ils les seuls signes auxquels on puisse reconnaître l’incapacité ?
Si l’on y regarde de près, on aperçoit bien vite le motif pour lequel le droit de suffrage repose sur la présomption de capacité, le système le plus large ne différant à cet égard du plus restreint que par l’appréciation des signes auxquels cette capacité peut se reconnaître, ce qui ne constitue pas une différence de principe, mais de degré.
Ce motif, c’est que l’électeur ne stipule pas pour lui, mais pour tout le monde.
Si, comme le prétendent les républicains de la teinte grecque et romaine, le droit de suffrage nous était échu avec la vie, il serait inique aux adultes d’empêcher les femmes et les enfants de voter. Pourquoi les empêche-t-on ? Parce qu’on les présume incapables. Et pourquoi l’Incapacité est-elle un motif d’exclusion ? Parce que l’électeur ne recueille pas seul la responsabilité de son vote ; parce que chaque vote engage et affecte la communauté tout entière ; parce que la communauté a bien le droit d’exiger quelques garanties, quant aux actes d’où dépendent son bien-être et son existence.
Je sais ce qu’on peut répondre. Je sais aussi ce qu’on pourrait répliquer. Ce n’est pas ici le lieu d’épuiser une telle controverse. Ce que je veux faire observer, c’est que cette controverse même (aussi bien que la plupart des questions politiques) qui agite, passionne et bouleverse les peuples, perdrait presque toute son importance, si la Loi avait toujours été ce qu’elle devrait être.
En effet, si la Loi se bornait à faire respecter toutes les Personnes, toutes les Libertés, toutes les Propriétés, si elle n’était que l’organisation du Droit individuel de légitime défense, l’obstacle, le frein, le châtiment opposé à toutes les oppressions, à toutes les spoliations, croit-on que nous nous disputerions beaucoup, entre citoyens, à propos du suffrage plus ou moins universel ? Croit-on qu’il mettrait en question le plus grand des biens, la paix publique ? Croit-on que les classes exclues n’attendraient pas paisiblement leur tour ? Croit-on que les classes admises seraient très jalouses de leur privilége ? Et n’est-il pas clair que l’intérêt étant identique et commun, les uns agiraient, sans grand inconvénient, pour les autres ?
Mais que ce principe funeste vienne à s’introduire, que, sous prétexte d’organisation, de réglementation, de protection, d’encouragement, la Loi peut prendre aux uns pour donner aux autres, puiser dans la richesse acquise par toutes les classes pour augmenter celle d’une classe, tantôt celle des agriculteurs, tantôt celle des manufacturiers, des négociants, des armateurs, des artistes, des comédiens ; oh ! certes, en ce cas, il n’y a pas de classe qui ne prétende, avec raison, mettre, elle aussi, la main sur la Loi ; qui ne revendique avec fureur son droit d’élection et d’éligibilité ; qui ne bouleverse la société plutôt que de ne pas l’obtenir. Les mendiants et les vagabonds eux-mêmes vous prouveront qu’ils ont des titres incontestables. Ils vous diront : « Nous n’achetons jamais de vin, de tabac, de sel, sans payer l’impôt, et une part de cet impôt est donnée législativement en primes, en subventions à des hommes plus riches que nous. D’autres font servir la Loi à élever artificiellement le prix du pain, de la viande, du fer, du drap. Puisque chacun exploite la Loi à son profit, nous voulons l’exploiter aussi. Nous voulons en faire sortir le Droit à l’assistance, qui est la part de spoliation du pauvre. Pour cela, il faut que nous soyons électeurs et législateurs, afin que nous organisions en grand l’Aumône pour notre classe, comme vous avez organisé en grand la Protection pour la vôtre. Ne nous dites pas que vous nous ferez notre part, que vous nous jetterez, selon la proposition de M. Mimerel, une somme de 600 000 francs pour nous faire taire et comme un os à ronger. Nous avons d’autres prétentions et, en tout cas, nous voulons stipuler pour nous-mêmes comme les autres classes ont stipulé pour elles-mêmes ! »
Que peut-on répondre à cet argument ? Oui, tant qu’il sera admis en principe que la Loi peut être détournée de sa vraie mission, qu’elle peut violer les propriétés au lieu de les garantir, chaque classe voudra faire la Loi, soit pour se défendre contre la spoliation, soit pour l’organiser aussi à son profit. La question politique sera toujours préjudicielle, dominante, absorbante ; en un mot, on se battra à la porte du Palais législatif. La lutte ne sera pas moins acharnée au-dedans. Pour en être convaincu, il est à peine nécessaire de regarder ce qui se passe dans les Chambres en France et en Angleterre ; il suffit de savoir comment la question est y posée.
Est-il besoin de prouver que cette odieuse perversion de la Loi est une cause perpétuelle de haine, de discorde, pouvant aller jusqu’à la désorganisation sociale ? Jetez les yeux sur les États-Unis. C’est le pays du monde où la Loi reste le plus dans son rôle, qui est de garantir à chacun sa liberté et sa propriété. Aussi c’est le pays du monde où l’ordre social paraît reposer sur les bases les plus stables. Cependant, aux États-Unis même, il est deux questions, et il n’en est que deux, qui, depuis l’origine, ont mis plusieurs fois l’ordre politique en péril. Et quelles sont ces deux questions ? Celle de l’Esclavage et celle des Tarifs, c’est-à-dire précisément les deux seules questions où, contrairement à l’esprit général de cette république, la Loi a pris le caractère spoliateur. L’Esclavage est une violation, sanctionnée par la loi, des droits de la Personne. La Protection est une violation, perpétrée par la loi, du droit de Propriété ; et certes, il est bien remarquable qu’au milieu de tant d’autres débats, ce double fléau légal, triste héritage de l’ancien monde, soit le seul qui puisse amener et amènera peut-être la rupture de l’Union. C’est qu’en effet on ne saurait imaginer, au sein d’une société, un fait plus considérable que celui-ci : La Loi devenue un instrument d’injustice. Et si ce fait engendre des conséquences si formidables aux États-Unis, où il n’est qu’une exception, que doit-ce être dans notre Europe, où il est un Principe, un Système ?
M. de Montalembert, s’appropriant la pensée d’une proclamation fameuse de M. Carlier, disait : Il faut faire la guerre au Socialisme. — Et par Socialisme, il faut croire que, selon la définition de M. Charles Dupin, il désignait la Spoliation.
Mais de quelle Spoliation voulait-il parler ? Car il y en a de deux sortes. Il y a la spoliation extra-légale et la spoliation légale.
Quant à la spoliation extra-légale, celle qu’on appelle vol, escroquerie, celle qui est définie, prévue et punie par le Code pénal, en vérité, je ne pense pas qu’on la puisse décorer du nom de Socialisme. Ce n’est pas celle qui menace systématiquement la société dans ses bases. D’ailleurs, la guerre contre ce genre de spoliation n’a pas attendu le signal de M. de Montalembert ou de M. Carlier. Elle se poursuit depuis le commencement du monde ; la France y avait pourvu, dès longtemps avant la révolution de février, dès longtemps avant l’apparition du Socialisme, par tout un appareil de magistrature, de police, de gendarmerie, de prisons, de bagnes et d’échafauds. C’est la Loi elle-même qui conduit cette guerre, et ce qui serait, selon moi, à désirer, c’est que la Loi gardât toujours cette attitude à l’égard de la Spoliation.
Mais il n’en est pas ainsi. La Loi prend quelquefois parti pour elle. Quelquefois elle l’accomplit de ses propres mains, afin d’en épargner au bénéficiaire la honte, le danger et le scrupule. Quelquefois elle met tout cet appareil de magistrature, police, gendarmerie et prison au service du spoliateur, et traite en criminel le spolié qui se défend. En un mot, il y a la spoliation légale, et c’est de celle-là sans doute que parle M. de Montalembert.
Cette spoliation peut n’être, dans la législation d’un peuple, qu’une tache exceptionnelle et, dans ce cas, ce qu’il y a de mieux à faire, sans tant de déclamations et de jérémiades, c’est de l’y effacer le plus tôt possible, malgré les clameurs des intéressés. Comment la reconnaître ? C’est bien simple. Il faut examiner si la Loi prend aux uns ce qui leur appartient pour donner aux autres ce qui ne leur appartient pas. Il faut examiner si la Loi accomplit, au profit d’un citoyen et au détriment des autres, un acte que ce citoyen ne pourrait accomplir lui-même sans crime. Hâtez-vous d’abroger cette Loi ; elle n’est pas seulement une iniquité, elle est une source féconde d’iniquités ; car elle appelle les représailles, et si vous n’y prenez garde, le fait exceptionnel s’étendra, se multipliera et deviendra systématique. Sans doute, le bénéficiaire jettera les hauts cris ; il invoquera les droits acquis. Il dira que l’État doit Protection et Encouragement à son industrie ; il alléguera qu’il est bon que l’État l’enrichisse, parce qu’étant plus riche il dépense davantage, et répand ainsi une pluie de salaires sur les pauvres ouvriers. Gardez-vous d’écouter ce sophiste, car c’est justement par la systématisation de ces arguments que se systématisera la spoliation légale.
C’est ce qui est arrivé. La chimère du jour est d’enrichir toutes les classes aux dépens les unes des autres ; c’est de généraliser la Spoliation sous prétexte de l’organiser. Or, la spoliation légale peut s’exercer d’une multitude infinie de manières ; de là une multitude infinie de plans d’organisation : tarifs, protection, primes, subventions, encouragements, impôt progressif, instruction gratuite, Droit au travail, Droit au profit, Droit au salaire, Droit à l’assistance, Droit aux instruments de travail, gratuité du crédit, etc., etc. Et c’est l’ensemble de tous ces plans, en ce qu’ils ont de commun, la spoliation légale, qui prend le nom de Socialisme.
Or le Socialisme, ainsi défini, formant un corps de doctrine, quelle guerre voulez-vous lui faire, si ce n’est une guerre de doctrine ? Vous trouvez cette doctrine fausse, absurde, abominable. Réfutez-la. Cela vous sera d’autant plus aisé qu’elle est plus fausse, plus absurde, plus abominable. Surtout, si vous voulez être fort, commencez par extirper de votre législation tout ce qui a pu s’y glisser de Socialisme, — et l’œuvre n’est pas petite.
On a reproché à M. de Montalembert de vouloir tourner contre le Socialisme la force brutale. C’est un reproche dont il doit être exonéré, car il a dit formellement : Il faut faire au Socialisme la guerre qui est compatible avec la loi, l’honneur et la justice.
Mais comment M. de Montalembert ne s’aperçoit-il pas qu’il se place dans un cercle vicieux ? Vous voulez opposer au Socialisme la Loi ? Mais précisément le Socialisme invoque la Loi. Il n’aspire pas à la spoliation extra-légale, mais à la spoliation légale. C’est de la Loi même, à l’instar des monopoleurs de toute sorte, qu’il prétend se faire un instrument ; et une fois qu’il aura la Loi pour lui, comment voulez-vous tourner la Loi contre lui ? Comment voulez-vous le placer sous le coup de vos tribunaux, de vos gendarmes, de vos prisons ?
Aussi que faites-vous ? Vous voulez l’empêcher de mettre la main à la confection des Lois. Vous voulez le tenir en dehors du Palais législatif. Vous n’y réussirez pas, j’ose vous le prédire, tandis qu’au-dedans on légiférera sur le principe de la Spoliation légale. C’est trop inique, c’est trop absurde.
Il faut absolument que cette question de Spoliation légale se vide, et il n’y a que trois solutions.
Que le petit nombre spolie le grand nombre.
Que tout le monde spolie tout le monde.
Que personne ne spolie personne.
Spoliation partielle, Spoliation universelle, absence de Spoliation, il faut choisir. La Loi ne peut poursuivre qu’un de ces trois résultats.
Spoliation partielle, — c’est le système qui a prévalu tant que l’électorat a été partiel, système auquel on revient pour éviter l’invasion du Socialisme.
Spoliation universelle, — c’est le système dont nous avons été menacés quand l’électorat est devenu universel, la masse ayant conçu l’idée de légiférer sur le principe des législateurs qui l’ont précédée.
Absence de Spoliation, — c’est le principe de justice, de paix, d’ordre, de stabilité, de conciliation, de bon sens que je proclamerai de toute la force, hélas ! bien insuffisante, de mes poumons, jusqu’à mon dernier souffle.
Et, sincèrement, peut-on demander autre chose à la Loi ? La Loi, ayant pour sanction nécessaire la Force, peut-elle être raisonnablement employée à autre chose qu’à maintenir chacun dans son Droit ? Je défie qu’on la fasse sortir de ce cercle, sans la tourner, et, par conséquent, sans tourner la Force contre le Droit. Et comme c’est là la plus funeste, la plus illogique perturbation sociale qui se puisse imaginer, il faut bien reconnaître que la véritable solution, tant cherchée, du problème social est renfermée dans ces simples mots : la Loi, c’est la Justice Organisée.
Or, remarquons-le bien : organiser la Justice par la Loi, c’est-à-dire par la Force, exclut l’idée d’organiser par la Loi ou par la Force une manifestation quelconque de l’activité humaine : Travail, Charité, Agriculture, Commerce, Industrie, Instruction, Beaux-Arts, Religion ; car il n’est pas possible qu’une de ces organisations secondaires n’anéantisse l’organisation essentielle. Comment imaginer, en effet, la Force entreprenant sur la Liberté des citoyens, sans porter atteinte à la Justice, sans agir contre son propre but ?
Ici je me heurte au plus populaire des préjugés de notre époque. On ne veut pas seulement que la Loi soit juste ; on veut encore qu’elle soit philanthropique. On ne se contente pas qu’elle garantisse à chaque citoyen le libre et inoffensif exercice de ses facultés, appliquées à son développement physique, intellectuel et moral ; on exige d’elle qu’elle répande directement sur la nation le bien-être, l’instruction et la moralité. C’est le côté séduisant du Socialisme.
Mais, je le répète, ces deux missions de la Loi se contredisent. Il faut opter. Le citoyen ne peut en même temps être libre et ne l’être pas. M. de Lamartine m’écrivait un jour : « Votre doctrine n’est que la moitié de mon programme ; vous en êtes resté à la Liberté, j’en suis à la Fraternité. » Je lui répondis : « La seconde moitié de votre programme détruira la première. » Et, en effet, il m’est tout à fait impossible de séparer le mot fraternité du mot volontaire. Il m’est tout à fait impossible de concevoir la Fraternité légalement forcée, sans que la Liberté soit légalement détruite, et la Justice légalement foulée aux pieds.
La Spoliation légale a deux racines : l’une, nous venons de le voir, est dans l’Égoïsme humain ; l’autre est dans la fausse Philanthropie.
Avant d’aller plus loin, je crois devoir m’expliquer sur le mot Spoliation.
Je ne le prends pas, ainsi qu’on le fait trop souvent, dans une acception vague, indéterminée, approximative, métaphorique : je m’en sers au sens tout à fait scientifique, et comme exprimant l’idée opposée à celle de la Propriété. Quand une portion de richesses passe de celui qui l’a acquise, sans son consentement et sans compensation, à celui qui ne l’a pas créée, que ce soit par force ou par ruse, je dis qu’il y a atteinte à la Propriété, qu’il y a Spoliation. Je dis que c’est là justement ce que la Loi devrait réprimer partout et toujours. Que si la Loi accomplit elle-même l’acte qu’elle devrait réprimer, je dis qu’il n’y a pas moins Spoliation, et même, socialement parlant, avec circonstance aggravante. Seulement, en ce cas, ce n’est pas celui qui profite de la Spoliation qui en est responsable, c’est la Loi, c’est le législateur, c’est la société, et c’est ce qui en fait le danger politique.
Il est fâcheux que ce mot ait quelque chose de blessant. J’en ai vainement cherché un autre, car en aucun temps, et moins aujourd’hui que jamais, je ne voudrais jeter au milieu de nos discordes une parole irritante. Aussi, qu’on le croie ou non, je déclare que je n’entends accuser les intentions ni la moralité de qui que ce soit. J’attaque une idée que je crois fausse, un système qui me semble injuste, et cela tellement en dehors des intentions, que chacun de nous en profite sans le vouloir et en souffre sans le savoir. Il faut écrire sous l’influence de l’esprit de parti ou de la peur pour révoquer en doute la sincérité du Protectionnisme, du Socialisme et même du Communisme, qui ne sont qu’une seule et même plante, à trois périodes diverses de sa croissance. Tout ce qu’on pourrait dire, c’est que la Spoliation est plus visible, par sa partialité, dans le Protectionnisme [4], par son universalité, dans le Communisme ; d’où il suit que des trois systèmes le Socialisme est encore le plus vague, le plus indécis, et par conséquent le plus sincère.
Quoi qu’il en soit, convenir que la spoliation légale a une de ses racines dans la fausse philanthropie, c’est mettre évidemment les intentions hors de cause.
Ceci entendu, examinons ce que vaut, d’où vient et où aboutit cette aspiration populaire qui prétend réaliser le Bien général par la Spoliation générale.
Les socialistes nous disent : puisque la Loi organise la justice, pourquoi n’organiserait-elle pas le travail, l’enseignement, la religion ?
Pourquoi ? Parce qu’elle ne saurait organiser le travail, l’enseignement, la religion, sans désorganiser la Justice.
Remarquez donc que la Loi, c’est la Force, et que, par conséquent, le domaine de la Loi ne saurait dépasser légitimement le légitime domaine de la Force.
Quand la loi et la Force retiennent un homme dans la Justice, elles ne lui imposent rien qu’une pure négation. Elles ne lui imposent que l’abstention de nuire. Elles n’attentent ni à sa Personnalité, ni à sa Liberté, ni à sa Propriété. Seulement elles sauvegardent la Personnalité, la Liberté et la Propriété d’autrui. Elles se tiennent sur la défensive ; elles défendent le Droit égal de tous. Elles remplissent une mission dont l’innocuité est évidente, l’utilité palpable, et la légitimité incontestée.
Cela est si vrai qu’ainsi qu’un de mes amis me le faisait remarquer, dire que le but de la Loi est de faire régner la Justice, c’est se servir d’une expression qui n’est pas rigoureusement exacte. Il faudrait dire : Le but de la Loi est d’empêcher l’Injustice de régner. En effet, ce n’est pas la Justice qui a une existence propre, c’est l’Injustice. L’une résulte de l’absence de l’autre.
Mais quand la Loi, — par l’intermédiaire de son agent nécessaire, la Force, — impose un mode de travail, une méthode ou une matière d’enseignement, une foi ou un culte, ce n’est plus négativement, c’est positivement qu’elle agit sur les hommes. Elle substitue la volonté du législateur à leur propre volonté, l’initiative du législateur à leur propre initiative. Ils n’ont plus à se consulter, à comparer, à prévoir ; la Loi fait tout cela pour eux. L’intelligence leur devient un meuble inutile ; ils cessent d’être hommes ; ils perdent leur Personnalité, leur Liberté, leur Propriété.
Essayez d’imaginer une forme de travail imposée par la Force, qui ne soit une atteinte à la Liberté ; une transmission de richesse imposée par la Force, qui ne soit une atteinte à la Propriété. Si vous n’y parvenez pas, convenez donc que la Loi ne peut organiser le travail et l’industrie sans organiser l’Injustice.
Lorsque, du fond de son cabinet, un publiciste promène ses regards sur la société, il est frappé du spectacle d’inégalité qui s’offre à lui. Il gémit sur les souffrances qui sont le lot d’un si grand nombre de nos frères, souffrances dont l’aspect est rendu plus attristant encore par le contraste du luxe et de l’opulence.
Il devrait peut-être se demander si un tel état social n’a pas pour cause d’anciennes Spoliations, exercées par voie de conquête, et des Spoliations nouvelles, exercées par l’intermédiaire des Lois. Il devrait se demander si, l’aspiration de tous les hommes vers le bien-être et le perfectionnement étant donnée, le règne de la justice ne suffit pas pour réaliser la plus grande activité de Progrès et la plus grande somme d’Égalité, compatibles avec cette responsabilité individuelle que Dieu a ménagée comme juste rétribution des vertus et des vices.
Il n’y songe seulement pas. Sa pensée se porte vers des combinaisons, des arrangements, des organisations légales ou factices. Il cherche le remède dans la perpétuité et l’exagération de ce qui a produit le mal.
Car, en dehors de la Justice, qui, comme nous l’avons vu, n’est qu’une véritable négation, est-il aucun de ces arrangements légaux qui ne renferme le principe de la Spoliation ?
Vous dites : « Voilà des hommes qui manquent de richesses, » — et vous vous adressez à la Loi. Mais la Loi n’est pas une mamelle qui se remplisse d’elle-même, ou dont les veines lactifères aillent puiser ailleurs que dans la société. Il n’entre rien au trésor public, en faveur d’un citoyen ou d’une classe, que ce que les autres citoyens et les autres classes ont été forcés d’y mettre. Si chacun n’y puise que l’équivalent de ce qu’il y a versé, votre Loi, il est vrai, n’est pas spoliatrice, mais elle ne fait rien pour ces hommes qui manquent de richesses, elle ne fait rien pour l’égalité. Elle ne peut être un instrument d’égalisation qu’autant qu’elle prend aux uns pour donner aux autres, et alors elle est un instrument de Spoliation. Examinez à ce point de vue la Protection des tarifs, les primes d’encouragement, le Droit au profit, le Droit au travail, le Droit à l’assistance, le Droit à l’instruction, l’impôt progressif, la gratuité du crédit, l’atelier social, toujours vous trouverez au fond la Spoliation légale, l’injustice organisée.
Vous dites : « Voilà des hommes qui manquent de lumières, » — et vous vous adressez à la Loi. Mais la Loi n’est pas un flambeau répandant au loin une clarté qui lui soit propre. Elle plane sur une société où il y a des hommes qui savent et d’autres qui ne savent pas ; des citoyens qui ont besoin d’apprendre et d’autres qui sont disposés à enseigner. Elle ne peut faire que de deux choses l’une : ou laisser s’opérer librement ce genre de transactions, laisser se satisfaire librement cette nature de besoins ; ou bien forcer à cet égard les volontés et prendre aux uns de quoi payer des professeurs chargés d’instruire gratuitement les autres. Mais elle ne peut pas faire qu’il n’y ait, au second cas, atteinte à la Liberté et à la Propriété, Spoliation légale.
Vous dites : « Voilà des hommes qui manquent de moralité ou de religion, » — et vous vous adressez à la Loi. Mais la Loi c’est la Force, et ai-je besoin de dire combien c’est une entreprise violente et folle que de faire intervenir la force en ces matières ?
Au bout de ses systèmes et de ses efforts, il semble que le Socialisme, quelque complaisance qu’il ait pour lui-même, ne puisse s’empêcher d’apercevoir le monstre de la Spoliation légale. Mais que fait-il ? Il le déguise habilement à tous les yeux, même aux siens, sous les noms séducteurs de Fraternité, Solidarité, Organisation, Association. Et parce que nous ne demandons pas tant à la Loi, parce que nous n’exigeons d’elle que Justice, il suppose que nous repoussons la fraternité, la solidarité, l’organisation, l’association, et nous jette à la face l’épithète d’individualistes.
Qu’il sache donc que ce que nous repoussons, ce n’est pas l’organisation naturelle, mais l’organisation forcée.
Ce n’est pas l’association libre, mais les formes d’association qu’il prétend nous imposer.
Ce n’est pas la fraternité spontanée, mais la fraternité légale.
Ce n’est pas la solidarité providentielle, mais la solidarité artificielle, qui n’est qu’un déplacement injuste de Responsabilité.
Le Socialisme, comme la vieille politique d’où il émane, confond le Gouvernement et la Société. C’est pourquoi, chaque fois que nous ne voulons pas qu’une chose soit faite par le Gouvernement, il en conclut que nous ne voulons pas que cette chose soit faite du tout. Nous repoussons l’instruction par l’État ; donc nous ne voulons pas d’instruction. Nous repoussons une religion d’État ; donc nous ne voulons pas de religion. Nous repoussons l’égalisation par l’État ; donc nous ne voulons pas d’égalité, etc. C’est comme s’il nous accusait de ne vouloir pas que les hommes mangent, parce que nous repoussons la culture du blé par l’État.
Comment a pu prévaloir, dans le monde politique, l’idée bizarre de faire découler de la Loi ce qui n’y est pas : le Bien, en mode positif, la Richesse, la Science, la Religion ?
Les publicistes modernes, particulièrement ceux de l’école socialiste, fondent leurs théories diverses sur une hypothèse commune, et assurément la plus étrange, la plus orgueilleuse qui puisse tomber dans un cerveau humain.
Ils divisent l’humanité en deux parts. L’universalité des hommes, moins un, forme la première ; le publiciste, à lui tout seul, forme la seconde et, de beaucoup, la plus importante.
En effet, ils commencent par supposer que les hommes ne portent en eux-mêmes ni un principe d’action, ni un moyen de discernement ; qu’ils sont dépourvus d’initiative ; qu’ils sont de la matière inerte, des molécules passives, des atomes sans spontanéité, tout au plus une végétation indifférente à son propre mode d’existence, susceptible de recevoir, d’une volonté et d’une main extérieures, un nombre infini de formes plus ou moins symétriques, artistiques, perfectionnées.
Ensuite chacun d’eux suppose sans façon qu’il est lui-même, sous les noms d’Organisateur, de Révélateur, de Législateur, d’Instituteur, de Fondateur, cette volonté et cette main, ce mobile universel, cette puissance créatrice dont la sublime mission est de réunir en société ces matériaux épars, qui sont des hommes.
Partant de cette donnée, comme chaque jardinier, selon son caprice, taille ses arbres en pyramides, en parasols, en cubes, en cônes, en vases, en espaliers, en quenouilles, en éventails, chaque socialiste, suivant sa chimère, taille la pauvre humanité en groupes, en séries, en centres, en sous-centres, en alvéoles, en ateliers sociaux, harmoniques, contrastés, etc., etc.
Et de même que le jardinier, pour opérer la taille des arbres, a besoin de haches, de scies, de serpettes et de ciseaux, le publiciste, pour arranger sa société, a besoin de forces qu’il ne peut trouver que dans les Lois ; loi de douane, loi d’impôt, loi d’assistance, loi d’instruction.
Il est si vrai que les socialistes considèrent l’humanité comme matière à combinaisons sociales, que si, par hasard, ils ne sont pas bien sûrs du succès de ces combinaisons, ils réclament du moins une parcelle d’humanité comme matière à expériences : on sait combien est populaire parmi eux l’idée d’expérimenter tous les systèmes, et on a vu un de leurs chefs venir sérieusement demander à l’assemblée constituante une commune avec tous ses habitants, pour faire son essai.
C’est ainsi que tout inventeur fait sa machine en petit avant de la faire en grand. C’est ainsi que le chimiste sacrifie quelques réactifs, que l’agriculteur sacrifie quelques semences et un coin de son champ pour faire l’épreuve d’une idée.
Mais quelle distance incommensurable entre le jardinier et ses arbres, entre l’inventeur et sa machine, entre le chimiste et ses réactifs, entre l’agriculteur et ses semences !… Le socialiste croit de bonne foi que la même distance le sépare de l’humanité.
Il ne faut pas s’étonner que les publicistes du dix- neuvième siècle considèrent la société comme une création artificielle sortie du génie du Législateur.
Cette idée, fruit de l’éducation classique, a dominé tous les penseurs, tous les grands écrivains de notre pays.
Tous ont vu entre l’humanité et le législateur les mêmes rapports qui existent entre l’argile et le potier.
Bien plus, s’ils ont consenti à reconnaître, dans le cœur de l’homme, un principe d’action et, dans son intelligence, un principe de discernement, ils ont pensé que Dieu lui avait fait, en cela, un don funeste, et que l’humanité, sous l’influence de ces deux moteurs, tendait fatalement vers sa dégradation. Ils ont posé en fait qu’abandonnée à ses penchants l’humanité ne s’occuperait de religion que pour aboutir à l’athéisme, d’enseignement que pour arriver à l’ignorance, de travail et d’échanges que pour s’éteindre dans la misère.
Heureusement, selon ces mêmes écrivains, il y a quelques hommes, nommés Gouvernants, Législateurs, qui ont reçu du ciel, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les autres, des tendances opposées.
Pendant que l’humanité penche vers le Mal, eux inclinent au Bien ; pendant que l’humanité marche vers les ténèbres, eux aspirent à la lumière ; pendant que l’humanité est entraînée vers le vice, eux sont attirés par la vertu. Et, cela posé, ils réclament la Force, afin qu’elle les mette à même de substituer leurs propres tendances aux tendances du genre humain.
Il suffit d’ouvrir, à peu près au hasard, un livre de philosophie, de politique ou d’histoire pour voir combien est fortement enracinée dans notre pays cette idée, fille des études classiques et mère du Socialisme, que l’humanité est une matière inerte recevant du pouvoir la vie, l’organisation, la moralité et la richesse ; ou bien, ce qui est encore pis, que d’elle-même l’humanité tend vers sa dégradation et n’est arrêtée sur cette pente que par la main mystérieuse du Législateur. Partout le Conventionalisme classique nous montre, derrière la société passive, une puissance occulte qui, sous les noms de Loi, Législateur, ou sous cette expression plus commode et plus vague de on, meut l’humanité, l’anime, l’enrichit et la moralise.
Bossuet. « Une des choses qu’on (qui ?) imprimait le plus fortement dans l’esprit des Égyptiens, c’était l’amour de la patrie… Il n’était pas permis d’être inutile à l’État ; la Loi assignait à chacun son emploi, qui se perpétuait de père en fils. On ne pouvait ni en avoir deux ni changer de profession… Mais il y avait une occupation qui devait être commune, c’était l’étude des lois et de la sagesse. L’ignorance de la religion et de la police du pays n’était excusée en aucun état. Au reste, chaque profession avait son canton qui lui était assigné (par qui ?)… Parmi de bonnes lois, ce qu’il y avait de meilleur, c’est que tout le monde était nourri (par qui ?) dans l’esprit de les observer… Leurs mercures ont rempli l’Égypte d’inventions merveilleuses, et ne lui avaient presque rien laissé ignorer de ce qui pouvait rendre la vie commode et tranquille. »
Ainsi, les hommes, selon Bossuet, ne tirent rien d’eux-mêmes : patriotisme, richesses, activité, sagesse, inventions, labourage, sciences, tout leur venait par l’opération des Lois ou des Rois. Il ne s’agissait pour eux que de se laisser faire. C’est à ce point que Diodore ayant accusé les Égyptiens de rejeter la lutte et la musique, Bossuet l’en reprend. Comment cela est-il possible, dit-il, puisque ces arts avaient été inventés par Trismégiste ?
De même chez les Perses :
« Un des premiers soins du prince était de faire fleurir l’agriculture… Comme il y avait des charges établies pour la conduite des armées, il y en avait aussi pour veiller aux travaux rustiques… Le respect qu’on inspirait aux Perses pour l’autorité royale allait jusqu’à l’excès. »
Les Grecs, quoique pleins d’esprit, n’en étaient pas moins étrangers à leurs propres destinées, jusque-là que, d’eux-mêmes, ils ne se seraient pas élevés, comme les chiens et les chevaux, à la hauteur des jeux les plus simples. Classiquement, c’est une chose convenue que tout vient du dehors aux peuples.
« Les Grecs, naturellement pleins d’esprit et de courage, avaient été cultivés de bonne heure par des Rois et des colonies venues d’Égypte. C’est de là qu’ils avaient appris les exercices du corps, la course à pied, à cheval et sur des chariots… Ce que les Égyptiens leur avaient appris de meilleur était à se rendre dociles, à se laisser former par des lois pour le bien public. »
Fénelon. Nourri dans l’étude et l’admiration de l’antiquité, témoin de la puissance de Louis XIV, Fénelon ne pouvait guère échapper à cette idée que l’humanité est passive, et que ses malheurs comme ses prospérités, ses vertus comme ses vices lui viennent d’une action extérieure, exercée sur elle par la Loi ou celui qui la fait. Aussi, dans son utopique Salente, met-il les hommes, avec leurs intérêts, leurs facultés, leurs désirs et leurs biens, à la discrétion absolue du Législateur. En quelque matière que ce soit, ce ne sont jamais eux qui jugent pour eux-mêmes, c’est le Prince. La nation n’est qu’une matière informe, dont le Prince est l’âme. C’est en lui que résident la pensée, la prévoyance, le principe de toute organisation, de tout progrès et, par conséquent, la Responsabilité.
Pour prouver cette assertion, il me faudrait transcrire ici tout le Xme livre de Télémaque. J’y renvoie le lecteur, et me contente de citer quelques passages pris au hasard dans ce célèbre poème, auquel, sous tout autre rapport, je suis le premier à rendre justice.
Avec cette crédulité surprenante qui caractérise les classiques, Fénelon admet, malgré l’autorité du raisonnement et des faits, la félicité générale des Égyptiens, et il l’attribue, non à leur propre sagesse, mais à celle de leurs Rois.
« Nous ne pouvions jeter les yeux sur les deux rivages sans apercevoir des villes opulentes, des maisons de campagne agréablement situées, des terres qui se couvrent tous les ans d’une moisson dorée, sans se reposer jamais ; des prairies pleines de troupeaux ; des laboureurs accablés sous le poids des fruits que la terre épanchait de son sein ; des bergers qui faisaient répéter les doux sons de leurs flûtes et de leurs chalumeaux à tous les échos d’alentour. Heureux, disait Mentor, le peuple qui est conduit par un sage Roi.
« Ensuite Mentor me faisait remarquer la joie et l’abondance répandues dans toute la campagne d’Égypte, où l’on comptait jusqu’à vingt-deux mille villes ; la justice exercée en faveur du pauvre contre le riche ; la bonne éducation des enfants qu’on accoutumait à l’obéissance, au travail, à la sobriété, à l’amour des arts et des lettres ; l’exactitude pour toutes les cérémonies de la religion, le désintéressement, le désir de l’honneur, la fidélité pour les hommes et la crainte pour les dieux, que chaque père inspirait à ses enfants. Il ne se lassait point d’admirer ce bel ordre. Heureux, me disait-il, le peuple qu’un sage Roi conduit ainsi. »
Fénelon fait, sur la Crète, une idylle encore plus séduisante. Puis il ajoute, par la bouche de Mentor :
« Tout ce que vous verrez dans cette île merveilleuse est le fruit des lois de Minos. L’éducation qu’il faisait donner aux enfants rend le corps sain et robuste. On les accoutume d’abord à une vie simple, frugale et laborieuse ; on suppose que toute volupté amollit le corps et l’esprit ; on ne leur propose jamais d’autre plaisir que celui d’être invincibles par la vertu et d’acquérir beaucoup de gloire… Ici on punit trois vices qui sont impunis chez les autres peuples, l’ingratitude, la dissimulation et l’avarice. Pour le faste et la mollesse, on n’a jamais besoin de les réprimer, car ils sont inconnus en Crète… on n’y souffre ni meubles précieux, ni habits magnifiques, ni festins délicieux, ni palais dorés. »
C’est ainsi que Mentor prépare son élève à triturer et manipuler, dans les vues les plus philanthropiques sans doute, le peuple d’Ithaque, et, pour plus de sûreté, il lui en donne l’exemple à Salente.
Voilà comment nous recevons nos premières notions politiques. On nous enseigne à traiter les hommes à peu près comme Olivier de Serres enseigne aux agriculteurs à traiter et mélanger les terres.
Montesquieu. « Pour maintenir l’esprit de commerce, il faut que toutes les lois le favorisent ; que ces mêmes lois, par leurs dispositions, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu’il ait besoin de travailler pour conserver ou pour acquérir… »
Ainsi les Lois disposent de toutes les fortunes.
« Quoique dans la démocratie l’égalité réelle soit l’âme de l’État, cependant elle est si difficile à établir qu’une exactitude extrême à cet égard ne conviendrait pas toujours. Il suffit que l’on établisse un cens qui réduise ou fixe les différences à un certain point. Après quoi c’est à des lois particulières à égaliser pour ainsi dire les inégalités, par les charges qu’elles imposent aux riches et le soulagement qu’elles accordent aux pauvres… »
C’est bien là encore l’égalisation des fortunes par la loi, par la force.
« Il y avait dans la Grèce deux sortes de républiques. Les unes étaient militaires, comme Lacédémone ; d’autres étaient commerçantes, comme Athènes. Dans les unes on voulait que les citoyens fussent oisifs ; dans les autres on cherchait à donner de l’amour pour le travail. »
« Je prie qu’on fasse un peu d’attention à l’étendue du génie qu’il fallut à ces législateurs pour voir qu’en choquant tous les usages reçus, en confondant toutes les vertus, ils montreraient à l’univers leur sagesse. Lycurgue, mêlant le larcin avec l’esprit de justice, le plus dur esclavage avec l’extrême liberté, les sentiments les plus atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité à sa ville. Il sembla lui ôter toutes les ressources, les arts, le commerce, l’argent, les murailles : on y a de l’ambition sans espérance d’être mieux ; on y a les sentiments naturels, et on n’y est ni enfant, ni mari, ni père ; la pudeur même est ôtée à la chasteté. C’est par ce chemin que Sparte est menée à la grandeur et à la gloire… »
« Cet extraordinaire que l’on voyait dans les institutions de la Grèce, nous l’avons vu dans la lie et la corruption des temps modernes. Un législateur honnête homme a formé un peuple où la probité paraît aussi naturelle que la bravoure chez les Spartiates. M. Penn est un véritable Lycurgue, et quoique le premier ait eu la paix pour objet comme l’autre a eu la guerre, ils se ressemblent dans la voie singulière où ils ont mis leur peuple, dans l’ascendant qu’ils ont eu sur des hommes libres, dans les préjugés qu’ils ont vaincus, dans les passions qu’ils ont soumises. »
« Le Paraguay peut nous fournir un autre exemple. On a voulu en faire un crime à la Société, qui regarde le plaisir de commander comme le seul bien de la vie ; mais il sera toujours beau de gouverner les hommes en les rendant plus heureux… »
« Ceux qui voudront faire des institutions pareilles établiront la communauté des biens de la République de Platon, ce respect qu’il demandait pour les dieux, cette séparation d’avec les étrangers pour la conservation des mœurs, et la cité faisant le commerce et non pas les citoyens ; ils donneront nos arts sans notre luxe, et nos besoins sans nos désirs. »
L’engouement vulgaire aura beau s’écrier : c’est du Montesquieu, donc c’est magnifique ! c’est sublime ! j’aurai le courage de mon opinion et de dire :
Quoi ! vous avez le front de trouver cela beau !
Mais c’est affreux ! abominable ! et ces extraits, que je pourrais multiplier, montrent que, dans les idées de Montesquieu, les personnes, les libertés, les propriétés, l’humanité entière ne sont que des matériaux propres à exercer la sagacité du Législateur.
Rousseau. Bien que ce publiciste, suprême autorité des démocrates, fasse reposer l’édifice social sur la volonté générale, personne n’a admis, aussi complétement que lui, l’hypothèse de l’entière passivité du genre humain en présence du Législateur.
« S’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. »
Et que sont les hommes en tout ceci ? La machine qu’on monte et qui marche, ou plutôt la matière brute dont la machine est faite !
Ainsi entre le Législateur et le Prince, entre le Prince et les sujets, il y a les mêmes rapports qu’entre l’agronome et l’agriculteur, l’agriculteur et la glèbe. À quelle hauteur au-dessus de l’humanité est donc placé le publiciste, qui régente les Législateurs eux-mêmes et leur enseigne leur métier en ces termes impératifs :
« Voulez-vous donner de la consistance à l’État ? rapprochez les degrés extrêmes autant qu’il est possible. Ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux.
« Le sol est-il ingrat ou stérile, ou le pays trop serré pour les habitants, tournez-vous du côté de l’industrie et des arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent… Dans un bon terrain, manquez-vous d’habitants, donnez tous vos soins à l’agriculture, qui multiplie les hommes, et chassez les arts, qui ne feraient qu’achever de dépeupler le pays… Occupez-vous des rivages étendus et commodes, couvrez la mer de vaisseaux, vous aurez une existence brillante et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des rochers inaccessibles, restez barbares et ichthyophages, vous en vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-être, et, à coup sûr, plus heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelque cause qui les ordonne d’une manière particulière, et rend sa législation propre à lui seul. C’est ainsi qu’autrefois les Hébreux, et récemment les Arabes, ont eu pour principal objet la religion ; les Athéniens, les lettres ; Carthage et Tyr, le commerce ; Rhodes, la marine ; Sparte, la guerre, et Rome, la vertu. L’auteur de l’Esprit des Lois a montré par quel art le législateur dirige l’institution vers chacun de ces objets… Mais si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, que l’un tende à la servitude et l’autre à la liberté ; l’un aux richesses, l’autre à la population ; l’un à la paix, l’autre aux conquêtes, on verra les lois s’affaiblir insensiblement, la constitution s’altérer, et l’État ne cessera d’être agité jusqu’à ce qu’il soit détruit ou changé, et que l’invincible nature ait repris son empire. »
Mais si la nature est assez invincible pour reprendre son empire, pourquoi Rousseau n’admet-il pas qu’elle n’avait pas besoin du Législateur pour prendre cet empire dès l’ origine ? Pourquoi n’admet-il pas qu’obéissant à leur propre initiative les hommes se tourneront d’eux-mêmes vers le commerce sur des rivages étendus et commodes, sans qu’un Lycurgue, un Solon, un Rousseau s’en mêlent, au risque de se tromper ?
Quoi qu’il en soit, on comprend la terrible responsabilité que Rousseau fait peser sur les inventeurs, instituteurs, conducteurs, législateurs et manipulateurs de Sociétés. Aussi est-il, à leur égard, très exigeant.
« Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu qui, par lui-même, est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout, dont cet individu reçoive, en tout ou en partie, sa vie et son être ; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses propres forces pour lui en donner qui lui soient étrangères… »
Pauvre espèce humaine, que feraient de ta dignité les adeptes de Rousseau ?
Raynal. « Le climat, c’est-à-dire le ciel et le sol, est la première règle du législateur. Ses ressources lui dictent ses devoirs. C’est d’abord sa position locale qu’il doit consulter. Une peuplade jetée sur les côtes maritimes aura des lois relatives à la navigation… Si la colonie est portée dans les terres, un législateur doit prévoir et leur genre et leur degré de fécondité… »
« C’est surtout dans la distribution de la propriété qu’éclatera la sagesse de la législation. En général, et dans tous les pays du monde, quand on fonde une colonie, il faut donner des terres à tous les hommes, c’est-à-dire à chacun une étendue suffisante pour l’entretien d’une famille… »
« Dans une île sauvage qu’on peuplerait d’enfants, on n’aurait qu’à laisser éclore les germes de la vérité dans les développements de la raison… Mais quand on établit un peuple déjà vieux dans un pays nouveau, l’habileté consiste à ne lui laisser que les opinions et les habitudes nuisibles dont on ne peut le guérir et le corriger. Veut-on empêcher qu’elles ne se transmettent, on veillera sur la seconde génération par une éducation commune et publique des enfants. Un prince, un législateur, ne devrait jamais fonder une colonie sans y envoyer d’avance des hommes sages pour l’instruction de la jeunesse… Dans une colonie naissante, toutes les facilités sont ouvertes aux précautions du Législateur qui veut épurer le sang et les mœurs d’un peuple. Qu’il ait du génie et de la vertu, les terres et les hommes qu’il aura dans ses mains inspireront à son âme un plan de société, qu’un écrivain ne peut jamais tracer que d’une manière vague et sujette à l’instabilité des hypothèses, qui varient et se compliquent avec une infinité de circonstances trop difficiles à prévoir et à combiner… »
Ne semble-t-il pas entendre un professeur d’agriculture dire à ses élèves : « Le climat est la première règle de l’agriculteur ? Ses ressources lui dictent ses devoirs. C’est d’abord sa position locale qu’il doit consulter. Est-il sur un sol argileux, il doit se conduire de telle façon. A-t-il affaire à du sable, voici comment il doit s’y prendre. Toutes les facilités sont ouvertes à l’agriculteur qui veut nettoyer et améliorer son sol. Qu’il ait de l’habileté, les terres, les engrais qu’il aura dans ses mains lui inspireront un plan d’exploitation, qu’un professeur ne peut jamais tracer que d’une manière vague et sujette à l’instabilité des hypothèses, qui varient et se compliquent avec une infinité de circonstances trop difficiles à prévoir et à combiner. »
Mais, ô sublimes écrivains, veuillez donc vous souvenir quelquefois que cette argile, ce sable, ce fumier, dont vous disposez si arbitrairement, ce sont des Hommes, vos égaux, des êtres intelligents et libres comme vous, qui ont reçu de Dieu, comme vous, la faculté de voir, de prévoir, de penser et de juger pour eux-mêmes !
Mably. (Il suppose les lois usées par la rouille du temps, la négligence de la sécurité, et poursuit ainsi) :
« Dans ces circonstances, il faut être convaincu que les ressorts du gouvernement se sont relâchés. Donnez-leur une nouvelle tension (c’est au lecteur que Mably s’adresse), et le mal sera guéri… Songez moins à punir des fautes qu’à encourager les vertus dont vous avez besoin. Par cette méthode vous rendrez à votre république la vigueur de la jeunesse. C’est pour n’avoir pas été connue des peuples libres qu’ils ont perdu la liberté ! Mais si les progrès du mal sont tels que les magistrats ordinaires ne puissent y remédier efficacement, ayez recours à une magistrature extraordinaire, dont le temps soit court et la puissance considérable. L’imagination des citoyens a besoin alors d’être frappée… »
Et tout dans ce goût durant vingt volumes.
Il a été une époque où, sous l’influence de tels enseignements, qui sont le fond de l’éducation classique, chacun a voulu se placer en dehors et au-dessus de l’humanité, pour l’arranger, l’organiser et l’instituer à sa guise.
Condillac. — « Érigez-vous, Monseigneur, en Lycurgue ou en Solon. Avant que de poursuivre la lecture de cet écrit, amusez-vous à donner des lois à quelque peuple sauvage d’Amérique ou d’Afrique. Établissez dans des demeures fixes ces hommes errants ; apprenez-leur à nourrir des troupeaux… ; travaillez à développer les qualités sociales que la nature a mises en eux… Ordonnez-leur de commencer à pratiquer les devoirs de l’humanité… Empoisonnez par des châtiments les plaisirs que promettent les passions, et vous verrez ces barbares, à chaque article de votre législation, perdre un vice et prendre une vertu. »
« Tous les peuples ont eu des lois. Mais peu d’entre eux ont été heureux. Quelle en est la cause ? C’est que les législateurs ont presque toujours ignoré que l’objet de la société est d’unir les familles par un intérêt commun. »
« L’impartialité des lois consiste en deux choses : à établir l’égalité dans la fortune et dans la dignité des citoyens… À mesure que vos lois établiront une plus grande égalité, elles deviendront plus chères à chaque citoyen… Comment l’avarice, l’ambition, la volupté, la paresse, l’oisiveté, l’envie, la haine, la jalousie agiteraient-elles des hommes égaux en fortune et en dignité, et à qui les lois ne laisseraient pas l’espérance de rompre l’égalité ? » (Suit l’idylle.)
« Ce qu’on vous a dit de la République de Sparte doit vous donner de grandes lumières sur cette question. Aucun autre État n’a jamais eu des lois plus conformes à l’ordre de la nature et de l’égalité [5]. »
Il n’est pas surprenant que les dix-septième et dix- huitième siècles aient considéré le genre humain comme une matière inerte attendant, recevant tout, forme, figure, impulsion, mouvement et vie d’un grand Prince, d’un grand Législateur, d’un grand Génie. Ces siècles étaient nourris de l’étude de l’Antiquité, et l’Antiquité nous offre en effet partout, en Égypte, en Perse, en Grèce, à Rome, le spectacle de quelques hommes manipulant à leur gré l’humanité asservie par la force ou par l’imposture. Qu’est-ce que cela prouve ? Que, parce que l’homme et la société sont perfectibles, l’erreur, l’ignorance, le despotisme, l’esclavage, la superstition doivent s’accumuler davantage au commencement des temps. Le tort des écrivains que j’ai cités n’est pas d’avoir constaté le fait, mais de l’avoir proposé, comme règle, à l’admiration et à l’imitation des races futures. Leur tort est d’avoir, avec une inconcevable absence de critique, et sur la foi d’un conventionalisme puéril, admis ce qui est inadmissible, à savoir la grandeur, la dignité, la moralité et le bien-être de ces sociétés factices de l’ancien monde ; de n’avoir pas compris que le temps produit et propage la lumière ; qu’à mesure que la lumière se fait, la force passe du côté du Droit, et la société reprend possession d’elle-même.
Et en effet, quel est le travail politique auquel nous assistons ? Il n’est autre que l’effort instinctif de tous les peuples vers la liberté [6]. Et qu’est-ce que la Liberté, ce mot qui a la puissance de faire battre tous les cœurs et d’agiter le monde, si ce n’est l’ensemble de toutes les libertés, liberté de conscience, d’enseignement, d’association, de presse, de locomotion, de travail, d’échange ; d’autres termes, le franc exercice, pour tous, de toutes les facultés inoffensives ; en d’autres termes encore, la destruction de tous les despotismes, même le despotisme légal, et la réduction de la Loi à sa seule attribution rationnelle, qui est de régulariser le Droit individuel de légitime défense ou de réprimer l’injustice.
Cette tendance du genre humain, il faut en convenir, est grandement contrariée, particulièrement dans notre patrie, par la funeste disposition, — fruit de l’enseignement classique, — commune à tous les publicistes, de se placer en dehors de l’humanité pour l’arranger, l’organiser et l’instituer à leur guise.
Car, pendant que la société s’agite pour réaliser la Liberté, les grands hommes qui se placent à sa tête, imbus des principes des dix-septième et dix-huitième siècles, ne songent qu’à la courber sous le philanthropique despotisme de leurs inventions sociales et à lui faire porter docilement, selon l’expression de Rousseau, le joug de la félicité publique, telle qu’ils l’ont imaginée.
On le vit bien en 1789. À peine l’Ancien Régime légal fut-il détruit, qu’on s’occupa de soumettre la société nouvelle à d’autres arrangements artificiels, toujours en partant de ce point convenu : l’omnipotence de la Loi.
Saint-Just. « Le Législateur commande à l’avenir. C’est à lui de vouloir le bien. C’est à lui de rendre les hommes ce qu’il veut qu’ils soient. »
Robespierre. « La fonction du gouvernement est de diriger les forces physiques et morales de la nation vers le but de son institution. »
Billaud-Varennes. « Il faut recréer le peuple qu’on veut rendre à la liberté. Puisqu’il faut détruire d’anciens préjugés, changer d’antiques habitudes, perfectionner les affections dépravées, restreindre des besoins superflus, extirper des vices invétérés ; il faut donc une action forte, une impulsion véhémente… Citoyens, l’inflexible austérité de Lycurgue devint à Sparte la base inébranlable de la République ; le caractère faible et confiant de Solon replongea Athènes dans l’esclavage. Ce parallèle renferme toute la science du gouvernement. »
Lepelletier. « Considérant à quel point l’espèce humaine est dégradée, je me suis convaincu de la nécessité d’opérer une entière régénération et, si je puis m’exprimer ainsi, de créer un nouveau peuple. »
On le voit, les hommes ne sont rien que de vils matériaux. Ce n’est pas à eux de vouloir le bien ; — ils en sont incapables, — c’est au Législateur, selon Saint-Just. Les hommes ne sont que ce qu’il veut qu’ils soient.
Suivant Robespierre, qui copie littéralement Rousseau, le Législateur commence par assigner le but de l’institution de la nation. Ensuite les gouvernements n’ont plus qu’à diriger vers ce but toutes les forces physiques et morales. La nation elle-même reste toujours passive en tout ceci, et Billaud-Varennes nous enseigne qu’elle ne doit avoir que les préjugés, les habitudes, les affections et les besoins que le Législateur autorise. Il va jusqu’à dire que l’inflexible austérité d’un homme est la base de la république.
On a vu que, dans le cas où le mal est si grand que les magistrats ordinaires n’y peuvent remédier, Mably conseillait la dictature pour faire fleurir la vertu. « Ayez recours, dit-il, à une magistrature extraordinaire, dont le temps soit court et la puissance considérable. L’imagination des citoyens a besoin d’être frappée. » Cette doctrine n’a pas été perdue. Écoutons Robespierre :
« Le principe du gouvernement républicain, c’est la vertu, et son moyen, pendant qu’il s’établit, la terreur. Nous voulons substituer, dans notre pays, la morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l’empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la vanité, l’amour de la gloire à l’amour de l’argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l’éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l’homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole, misérable ; c’est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. »
À quelle hauteur au-dessus du reste de l’humanité se place ici Robespierre ! Et remarquez la circonstance dans laquelle il parle. Il ne se borne pas à exprimer le vœu d’une grande rénovation du cœur humain ; il ne s’attend même pas à ce qu’elle résultera d’un gouvernement régulier. Non, il veut l’opérer lui-même et par la terreur. Le discours, d’où est extrait ce puéril et laborieux amas d’antithèses, avait pour objet d’exposer les principes de morale qui doivent diriger un gouvernement révolutionnaire. Remarquez que, lorsque Robespierre vient demander la dictature, ce n’est pas seulement pour repousser l’étranger et combattre les factions ; c’est bien pour faire prévaloir par la terreur, et préalablement au jeu de la Constitution, ses propres principes de morale. Sa prétention ne va à rien moins que d’extirper du pays, par la terreur, l’égoïsme, l’honneur, les usages, les bienséances, la mode, la vanité, l’amour de l’argent, la bonne compagnie, l’intrigue, le bel esprit, la volupté et la misère. Ce n’est qu’après que lui, Robespierre, aura accompli ces miracles — comme il les appelle avec raison, — qu’il permettra aux lois de reprendre leur empire. — Eh ! misérables, qui vous croyez si grands, qui jugez l’humanité si petite, qui voulez tout réformer, réformez-vous vous-mêmes, cette tâche vous suffit.
Cependant, en général, messieurs les Réformateurs, Législateurs et Publicistes ne demandent pas à exercer sur l’humanité un despotisme immédiat. Non, ils sont trop modérés et trop philanthropes pour cela. Ils ne réclament que le despotisme, l’absolutisme, l’omnipotence de la Loi. Seulement ils aspirent à faire la Loi.
Pour montrer combien cette disposition étrange des esprits a été universelle, en France, de même qu’il m’aurait fallu copier tout Mably, tout Raynal, tout Rousseau, tout Fénelon, et de longs extraits de Bossuet et Montesquieu, il me faudrait aussi reproduire le procès-verbal tout entier des séances de la Convention. Je m’en garderai bien et j’y renvoie le lecteur.
On pense bien que cette idée dut sourire à Bonaparte. Il l’embrassa avec ardeur et la mit énergiquement en pratique. Se considérant comme un chimiste, il ne vit dans l’Europe qu’une matière à expériences. Mais bientôt cette matière se manifesta comme un réactif puissant. Aux trois quarts désabusé, Bonaparte, à Sainte-Hélène, parut reconnaître qu’il y a quelque initiative dans les peuples, et il se montra moins hostile à la liberté. Cela ne l’empêcha pas cependant de donner par son testament cette leçon à son fils : « Gouverner, c’est répandre la moralité, l’instruction et le bien-être. »
Est-il nécessaire maintenant de faire voir par de fastidieuses citations d’où procèdent Morelly, Babeuf, Owen, Saint-Simon, Fourier ? Je me bornerai à soumettre au lecteur quelques extraits du livre de Louis Blanc sur l’organisation du travail.
« Dans notre projet, la société reçoit l’impulsion du pouvoir » (Page 126).
En quoi consiste l’impulsion que le Pouvoir donne à la société ? À imposer le projet de M. L. Blanc.
D’un autre coté, la société, c’est le genre humain.
Donc, en définitive, le genre humain reçoit l’impulsion de M. L. Blanc.
Libre à lui, dira-t-on. Sans doute le genre humain est libre de suivre les conseils de qui que ce soit. Mais ce n’est pas ainsi que M. L. Blanc comprend la chose. Il entend que son projet soit converti en Loi, et par conséquent imposé de force par le pouvoir.
« Dans notre projet, l’État ne fait que donner au travail une législation (excusez du peu), en vertu de laquelle le mouvement industriel peut et doit s’accomplir en toute liberté. Il (l’État) ne fait que placer la liberté sur une pente (rien que cela) qu’elle descend, une fois qu’elle y est placée, par la seule force des choses et par une suite naturelle du mécanisme établi. »
Mais quelle est cette pente ? — Celle indiquée par M. L. Blanc. — Ne conduit-elle pas aux abîmes ? — Non, elle conduit au bonheur. — Comment donc la société ne s’y place-t-elle pas d’elle-même ? — Parce qu’elle ne sait ce qu’elle veut et qu’elle a besoin d’impulsion. — Qui lui donnera cette impulsion ? — Le pouvoir. — Et qui donnera l’impulsion au pouvoir ? — L’inventeur du mécanisme, M. L. Blanc.
Nous ne sortons jamais de ce cercle : l’humanité passive et un grand homme qui la meut par l’intervention de la Loi.
Une fois sur cette pente, la société jouirait-elle au moins de quelque liberté ? — Sans doute. — Et qu’est-ce que la liberté ?
« Disons-le une fois pour toutes : la liberté consiste non pas seulement dans le Droit accordé, mais dans le Pouvoir donné à l’homme d’exercer, de développer ses facultés, sous l’empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi. »
« Et ce n’est point là une distinction vaine : le sens en est profond, les conséquences en sont immenses. Car dès qu’on admet qu’il faut à l’homme, pour être vraiment libre, le Pouvoir d’exercer et de développer ses facultés, il en résulte que la société doit à chacun de ses membres l’instruction convenable, sans laquelle l’esprit humain ne peut se déployer, et les instruments de travail, sans lesquels l’activité humaine ne peut se donner carrière. Or, par l’intervention de qui la société donnera-t-elle à chacun de ses membres l’instruction convenable et les instruments de travail nécessaires, si ce n’est par l’intervention de l’État ? »
Ainsi la liberté, c’est le pouvoir. — En quoi consiste ce Pouvoir ? — À posséder l’instruction et les instruments de travail. — Qui donnera l’instruction et les instruments de travail ? — La société, qui les doit. — Par l’intervention de qui la société donnera-t-elle des instruments de travail à ceux qui n’en ont pas ? — Par l’intervention de l’État. — À qui l’État les prendra-t-il ?
C’est au lecteur de faire la réponse et de voir où tout ceci aboutit.
Un des phénomènes les plus étranges de notre temps, et qui étonnera probablement beaucoup nos neveux, c’est que la doctrine qui se fonde sur cette triple hypothèse — l’inertie radicale de l’humanité — l’omnipotence de la Loi — l’infaillibilité du Législateur, — soit le symbole sacré du parti qui se proclame exclusivement démocratique.
Il est vrai qu’il se dit aussi social.
En tant que démocratique, il a une foi sans limite en l’humanité.
Comme social, il la met au-dessous de la boue.
S’agit-il de droits politiques, s’agit-il de faire sortir de son sein le Législateur, oh ! alors, selon lui, le peuple a la science infuse ; il est doué d’un tact admirable ; sa volonté est toujours droite, la volonté générale ne peut errer. Le suffrage ne saurait être trop universel. Nul ne doit à la société aucune garantie. La volonté et la capacité de bien choisir sont toujours supposées. Est-ce que le peuple peut se tromper ? Est-ce que nous ne sommes pas dans le siècle des lumières ? Quoi donc ! Le peuple sera-t-il éternellement en tutelle ? N’a-t-il pas conquis ses droits par assez d’efforts et de sacrifices ? N’a-t-il pas donné assez de preuves de son intelligence et de sa sagesse ? N’est-il pas arrivé à sa maturité ? N’est-il pas en état de juger pour lui-même ? Ne connaît-il pas ses intérêts ? Y a-t-il un homme ou une classe qui ose revendiquer le droit de se substituer au peuple, de décider et d’agir pour lui ? Non, non, le peuple veut être libre, et il le sera. Il veut diriger ses propres affaires, et il les dirigera.
Mais le Législateur est-il une fois dégagé des comices par l’élection, oh ! alors le langage change. La nation rentre dans la passivité, dans l’inertie, dans le néant, et le Législateur prend possession de l’omnipotence. À lui l’invention, à lui la direction, à lui l’impulsion, à lui l’organisation. L’humanité n’a plus qu’à se laisser faire ; l’heure du despotisme a sonné. Et remarquez que cela est fatal ; car ce peuple, tout à l’heure si éclairé, si moral, si parfait, n’a plus aucunes tendances, ou, s’il en a, elles l’entraînent toutes vers la dégradation. Et on lui laisserait un peu de Liberté ! Mais ne savez-vous pas que, selon M. Considérant, la liberté conduit fatalement au monopole ? Ne savez-vous pas que la liberté c’est la concurrence ? et que la concurrence, suivant M. L. Blanc, c’est pour le peuple un système d’extermination, pour la bourgeoisie une cause de ruine ? Que c’est pour cela que les peuples sont d’autant plus exterminés et ruinés qu’ils sont plus libres, témoin la Suisse, la Hollande, l’Angleterre et les États-Unis ? Ne savez-vous pas, toujours selon M. L. Blanc, que la concurrence conduit au monopole, et que, par la même raison, le bon marché conduit à l’exagération des prix ? Que la concurrence tend à tarir les sources de la consommation et pousse la production à une activité dévorante ? Que la concurrence force la production à s’accroître et la consommation à décroître ; — d’où il suit que les peuples libres produisent pour ne pas consommer ; — qu’elle est tout à la fois oppression et démence, et qu’il faut absolument que M. L. Blanc s’en mêle ?
Quelle liberté, d’ailleurs, pourrait-on laisser aux hommes ? Serait-ce la liberté de conscience ? Mais on les verra tous profiter de la permission pour se faire athées. La liberté d’enseignement ? Mais les pères se hâteront de payer des professeurs pour enseigner à leurs fils l’immoralité et l’erreur ; d’ailleurs, à en croire M. Thiers, si l’enseignement était laissé à la liberté nationale, il cesserait d’être national, et nous élèverions nos enfants dans les idées des Turcs ou des Indous, au lieu que, grâce au despotisme légal de l’université, ils ont le bonheur d’être élevés dans les nobles idées des Romains. La liberté du travail ? Mais c’est la concurrence, qui a pour effet de laisser tous les produits non consommés, d’exterminer le peuple et de ruiner la bourgeoisie. La liberté d’échanger ? Mais on sait bien, les protectionnistes l’ont démontré à satiété, qu’un homme se ruine quand il échange librement et que, pour s’enrichir, il faut échanger sans liberté. La liberté d’association ? Mais, d’après la doctrine socialiste, liberté et association s’excluent, puisque précisément on n’aspire à ravir aux hommes leur liberté que pour les forcer de s’associer.
Vous voyez donc bien que les démocrates-socialistes ne peuvent, en bonne conscience, laisser aux hommes aucune liberté, puisque, par leur nature propre, et si ces messieurs n’y mettent ordre, ils tendent, de toute part, à tous les genres de dégradation et de démoralisation.
Reste à deviner, en ce cas, sur quel fondement on réclame pour eux, avec tant d’instance, le suffrage universel.
Les prétentions des organisateurs soulèvent une autre question, que je leur ai souvent adressée, et à laquelle, que je sache, ils n’ont jamais répondu. Puisque les tendances naturelles de l’humanité sont assez mauvaises pour qu’on doive lui ôter sa liberté, comment se fait-il que les tendances des organisateurs soient bonnes ? Les Législateurs et leurs agents ne font-ils pas partie du genre humain ? Se croient-ils pétris d’un autre limon que le reste des hommes ? Ils disent que la société, abandonnée à elle-même, court fatalement aux abîmes parce que ses instincts sont pervers. Ils prétendent l’arrêter sur cette pente et lui imprimer une meilleure direction. Ils ont donc reçu du ciel une intelligence et des vertus qui les placent en dehors et au-dessus de l’humanité ; qu’ils montrent leurs titres. Ils veulent être bergers, ils veulent que nous soyons troupeau. Cet arrangement présuppose en eux une supériorité de nature, dont nous avons bien le droit de demander la preuve préalable.
Remarquez que ce que je leur conteste, ce n’est pas le droit d’inventer des combinaisons sociales, de les propager, de les conseiller, de les expérimenter sur eux-mêmes, à leurs frais et risques ; mais bien le droit de nous les imposer par l’intermédiaire de la Loi, c’est-à-dire des forces et des contributions publiques.
Je demande que les Cabétistes, les Fouriéristes, les Proudhoniens, les Universitaires, les Protectionnistes renoncent non à leurs idées spéciales, mais à cette idée qui leur est commune, de nous assujettir de force à leurs groupes et séries, à leurs ateliers sociaux, à leur banque gratuite, à leur moralité gréco-romaine, à leurs entraves commerciales. Ce que je leur demande, c’est de nous laisser la faculté de juger leurs plans et de ne pas nous y associer, directement ou indirectement, si nous trouvons qu’ils froissent nos intérêts, ou s’ils répugnent à notre conscience.
Car la prétention de faire intervenir le pouvoir et l’impôt, outre qu’elle est oppressive et spoliatrice, implique encore cette hypothèse préjudicielle : l’infaillibilité de l’organisateur et l’incompétence de l’humanité.
Et si l’humanité est incompétente à juger pour elle-même, que vient-on nous parler de suffrage universel ?
Cette contradiction dans les idées s’est malheureusement reproduite dans les faits, et pendant que le peuple français a devancé tous les autres dans la conquête de ses droits, ou plutôt de ses garanties politiques, il n’en est pas moins resté le plus gouverné, dirigé, administré, imposé, entravé et exploité de tous les peuples.
Il est aussi celui de tous où les révolutions sont le plus imminentes, et cela doit être.
Dès qu’on part de cette idée, admise par tous nos publicistes et si énergiquement exprimée par M. L. Blanc en ces mots : « La société reçoit l’impulsion du pouvoir » ; dès que les hommes se considèrent eux-mêmes comme sensibles mais passifs, incapables de s’élever par leur propre discernement et par leur propre énergie à aucune moralité, à aucun bien-être, et réduits à tout attendre de la Loi ; en un mot, quand ils admettent que leurs rapports avec l’État sont ceux du troupeau avec le berger, il est clair que la responsabilité du pouvoir est immense. Les biens et les maux, les vertus et les vices, l’égalité et l’inégalité, l’opulence et la misère, tout découle de lui. Il est chargé de tout, il entreprend tout, il fait tout ; donc il répond de tout. Si nous sommes heureux, il réclame à bon droit notre reconnaissance ; mais si nous sommes misérables, nous ne pouvons nous en prendre qu’à lui. Ne dispose-t-il pas, en principe, de nos personnes et de nos biens ? La Loi n’est-elle pas omnipotente ? En créant le monopole universitaire, il s’est fait fort de répondre aux espérances des pères de famille privés de liberté ; et si ces espérances sont déçues, à qui la faute ? En réglementant l’industrie, il s’est fait fort de la faire prospérer, sinon il eût été absurde de lui ôter sa liberté ; et si elle souffre, à qui la faute ? En se mêlant de pondérer la balance du commerce, par le jeu des tarifs, il s’est fait fort de le faire fleurir ; et si, loin de fleurir, il se meurt, à qui la faute ? En accordant aux armements maritimes sa protection en échange de leur liberté, il s’est fait fort de les rendre lucratifs ; et s’ils sont onéreux, à qui la faute ?
Ainsi, il n’y a pas une douleur dans la nation dont le gouvernement ne se soit volontairement rendu responsable. Faut-il s’étonner que chaque souffrance soit une cause de révolution ?
Et quel est le remède qu’on propose ? C’est d’élargir indéfiniment le domaine de la Loi, c’est-à-dire la Responsabilité du gouvernement.
Mais si le gouvernement se charge d’élever et de régler les salaires et qu’il ne le puisse ; s’il se charge d’assister toutes les infortunes et qu’il ne le puisse ; s’il se charge d’assurer des retraites à tous les travailleurs et qu’il ne le puisse ; s’il se charge de fournir à tous les ouvriers des instruments de travail et qu’il ne le puisse ; s’il se charge d’ouvrir à tous les affamés d’emprunts un crédit gratuit et qu’il ne le puisse ; si, selon les paroles que nous avons vues avec regret échapper à la plume de M. de Lamartine, « l’État se donne la mission d’éclairer, de développer, d’agrandir, de fortifier, de spiritualiser, et de sanctifier l’âme des peuples », et qu’il échoue ; ne voit-on pas qu’au bout de chaque déception, hélas ! plus que probable, il y a une non moins inévitable révolution ?
Je reprends ma thèse et je dis : immédiatement après la science économique et à l’entrée de la science politique [7], se présente une question dominante. C’est celle-ci :
Qu’est-ce que la Loi ? que doit-elle être ? quel est son domaine ? quelles sont ses limites ? où s’arrêtent, par suite, les attributions du Législateur ?
Je n’hésite pas à répondre : La Loi, c’est la force commune organisée pour faire obstacle à l’Injustice, — et pour abréger, la Loi, c’est la Justice.
Il n’est pas vrai que le Législateur ait sur nos personnes et nos propriétés une puissance absolue, puisqu’elles préexistent et que son œuvre est de les entourer de garanties.
Il n’est pas vrai que la Loi ait pour mission de régir nos consciences, nos idées, nos volontés, notre instruction, nos sentiments, nos travaux, nos échanges, nos dons, nos jouissances.
Sa mission est d’empêcher qu’en aucune de ces matières le droit de l’un n’usurpe le droit de l’autre.
La Loi, parce qu’elle a pour sanction nécessaire la Force, ne peut avoir pour domaine légitime que le légitime domaine de la force, à savoir : la Justice.
Et comme chaque individu n’a le droit de recourir à la force que dans le cas de légitime défense, la force collective, qui n’est que la réunion des forces individuelles, ne saurait être rationnellement appliquée à une autre fin.
La Loi, c’est donc uniquement l’organisation du droit individuel préexistant de légitime défense.
La Loi, c’est la Justice.
Il est si faux qu’elle puisse opprimer les personnes ou spolier les propriétés, même dans un but philanthropique, que sa mission est de les protéger.
Et qu’on ne dise pas qu’elle peut au moins être philanthropique, pourvu qu’elle s’abstienne de toute oppression, de toute spoliation ; cela est contradictoire. La Loi ne peut pas ne pas agir sur nos personnes ou nos biens ; si elle ne les garantit, elle les viole par cela seul qu’elle agit, par cela seul qu’elle est.
La Loi, c’est la Justice.
Voilà qui est clair, simple, parfaitement défini et délimité, accessible à toute intelligence, visible à tout œil, car la Justice est une quantité donnée, immuable, inaltérable, qui n’admet ni plus ni moins.
Sortez de là, faites la Loi religieuse, fraternitaire, égalitaire, philanthropique, industrielle, littéraire, artistique, aussitôt vous êtes dans l’infini, dans l’incertain, dans l’inconnu, dans l’utopie imposée, ou, qui pis est, dans la multitude des utopies combattant pour s’emparer de la Loi et s’imposer ; car la fraternité, la philanthropie n’ont pas comme la justice des limites fixes. Où vous arrêterez-vous ? Où s’arrêtera la Loi ? L’un, comme M. de Saint-Cricq, n’étendra sa philanthropie que sur quelques classes d’industriels, et il demandera à la Loi qu’elle dispose des consommateurs en faveur des producteurs. L’autre, comme M. Considérant, prendra en main la cause des travailleurs et réclamera pour eux de la Loi un minimum assuré, le vêtement, le logement, la nourriture et toutes choses nécessaires à l’entretien de la vie. Un troisième, M. L. Blanc, dira, avec raison, que ce n’est là qu’une fraternité ébauchée et que la Loi doit donner à tous les instruments de travail et l’instruction. Un quatrième fera observer qu’un tel arrangement laisse encore place à l’inégalité et que la Loi doit faire pénétrer, dans les hameaux les plus reculés, le luxe, la littérature et les arts. Vous serez conduits ainsi jusqu’au communisme, ou plutôt la législation sera… ce qu’elle est déjà : — le champ de bataille de toutes les rêveries et de toutes les cupidités.
La Loi, c’est la Justice.
Dans ce cercle, on conçoit un gouvernement simple, inébranlable. Et je défie qu’on me dise d’où pourrait venir la pensée d’une révolution, d’une insurrection, d’une simple émeute contre une force publique bornée à réprimer l’injustice. Sous un tel régime, il y aurait plus de bien-être, le bien-être serait plus également réparti, et quant aux souffrances inséparables de l’humanité, nul ne songerait à en accuser le gouvernement, qui y serait aussi étranger qu’il l’est aux variations de la température. A-t-on jamais vu le peuple s’insurger contre la cour de cassation ou faire irruption dans le prétoire du juge de paix pour réclamer le minimum de salaires, le crédit gratuit, les instruments de travail, les faveurs du tarif, ou l’atelier social ? Il sait bien que ces combinaisons sont hors de la puissance du juge, et il apprendrait de même qu’elles sont hors de la puissance de la Loi.
Mais faites la Loi sur le principe fraternitaire, proclamez que c’est d’elle que découlent les biens et les maux, qu’elle est responsable de toute douleur individuelle, de toute inégalité sociale, et vous ouvrez la porte à une série sans fin de plaintes, de haines, de troubles et de révolutions.
La Loi, c’est la Justice.
Et il serait bien étrange qu’elle pût être équitablement autre chose ! Est-ce que la justice n’est pas le droit ? Est-ce que les droits ne sont pas égaux ? Comment donc la Loi interviendrait-elle pour me soumettre aux plans sociaux de MM. Mimerel, de Melun, Thiers, Louis Blanc, plutôt que pour soumettre ces messieurs à mes plans ? Croit-on que je n’aie pas reçu de la nature assez d’imagination pour inventer aussi une utopie ? Est-ce que c’est le rôle de la Loi de faire un choix entre tant de chimères et de mettre la force publique au service de l’une d’elles ?
La Loi, c’est la Justice.
Et qu’on ne dise pas, comme on le fait sans cesse, qu’ainsi conçue la Loi, athée, individualiste et sans entrailles, ferait l’humanité à son image. C’est là une déduction absurde, bien digne de cet engouement gouvernemental qui voit l’humanité dans la Loi.
Quoi donc ! De ce que nous serons libres, s’ensuit-il que nous cesserons d’agir ? De ce que nous ne recevrons pas l’impulsion de la Loi, s’ensuit-il que nous serons dénués d’impulsion ? De ce que la Loi se bornera à nous garantir le libre exercice de nos facultés, s’ensuit-il que nos facultés seront frappées d’inertie ? De ce que la Loi ne nous imposera pas des formes de religion, des modes d’association, des méthodes d’enseignement, des procédés de travail, des directions d’échange, des plans de charité, s’ensuit-il que nous nous empresserons de nous plonger dans l’athéisme, l’isolement, l’ignorance, la misère et l’égoïsme ? S’ensuit-il que nous ne saurons plus reconnaître la puissance et la bonté de Dieu, nous associer, nous entraider, aimer et secourir nos frères malheureux, étudier les secrets de la nature, aspirer aux perfectionnements de notre être ?
La Loi, c’est la Justice.
Et c’est sous la Loi de justice, sous le régime du droit, sous l’influence de la liberté, de la sécurité, de la stabilité, de la responsabilité, que chaque homme arrivera à toute sa valeur, à toute la dignité de son être, et que l’humanité accomplira avec ordre, avec calme, lentement sans doute, mais avec certitude, le progrès, qui est sa destinée.
Il me semble que j’ai pour moi la théorie ; car quelque question que je soumette au raisonnement, qu’elle soit religieuse, philosophique, politique, économique ; qu’il s’agisse de bien-être, de moralité, d’égalité, de droit, de justice, de progrès, de responsabilité, de solidarité, de propriété, de travail, d’échange, de capital, de salaires, d’impôts, de population, de crédit, de gouvernement ; à quelque point de l’horizon scientifique que je place le point de départ de mes recherches, toujours invariablement j’aboutis à ceci : la solution du problème social est dans la Liberté.
Et n’ai-je pas aussi pour moi l’expérience ? Jetez les yeux sur le globe. Quels sont les peuples les plus heureux, les plus moraux, les plus paisibles ? Ceux où la Loi intervient le moins dans l’activité privée ; où le gouvernement se fait le moins sentir ; où l’individualité a le plus de ressort et l’opinion publique le plus d’influence ; où les rouages administratifs sont les moins nombreux et les moins compliqués ; les impôts les moins lourds et les moins inégaux ; les mécontentements populaires les moins excités et les moins justifiables ; où la responsabilité des individus et des classes est la plus agissante, et où, par suite, si les mœurs ne sont pas parfaites, elles tendent invinciblement à se rectifier ; où les transactions, les conventions, les associations sont le moins entravées ; où le travail, les capitaux, la population, subissent les moindres déplacements artificiels ; où l’humanité obéit le plus à sa propre pente ; où la pensée de Dieu prévaut le plus sur les inventions des hommes ; ceux, en un mot, qui approchent le plus de cette solution : dans les limites du droit, tout par la libre et perfectible spontanéité de l’homme ; rien par la Loi ou la force que la Justice universelle.
Il faut le dire : il y a trop de grands hommes dans le monde ; il y a trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-dessus de l’humanité pour la régenter, trop de gens font métier de s’occuper d’elle.
On me dira : Vous vous en occupez bien, vous qui parlez. C’est vrai. Mais on conviendra que c’est dans un sens et à un point de vue bien différents, et si je me mêle aux réformateurs c’est uniquement pour leur faire lâcher prise.
Je m’en occupe non comme Vaucanson, de son automate, mais comme un physiologiste, de l’organisme humain : pour l’étudier et l’admirer.
Je m’en occupe, dans l’esprit qui animait un voyageur célèbre.
Il arriva au milieu d’une tribu sauvage. Un enfant venait de naître et une foule de devins, de sorciers, d’empiriques l’entouraient, armés d’anneaux, de crochets et de liens. L’un disait : cet enfant ne flairera jamais le parfum d’un calumet, si je ne lui allonge les narines. Un autre : il sera privé du sens de l’ouïe, si je ne lui fais descendre les oreilles jusqu’aux épaules. Un troisième : il ne verra pas la lumière du soleil, si je ne donne à ses yeux une direction oblique. Un quatrième : il ne se tiendra jamais debout, si je ne lui courbe les jambes. Un cinquième : il ne pensera pas, si je ne comprime son cerveau. Arrière, dit le voyageur. Dieu fait bien ce qu’il fait ; ne prétendez pas en savoir plus que lui, et puisqu’il a donné des organes à cette frêle créature, laissez ses organes se développer, se fortifier par l’exercice, le tâtonnement, l’expérience et la Liberté.
Dieu a mis aussi dans l’humanité tout ce qu’il faut pour qu’elle accomplisse ses destinées. Il y a une physiologie sociale providentielle comme il y a une physiologie humaine providentielle. Les organes sociaux sont aussi constitués de manière à se développer harmoniquement au grand air de la Liberté. Arrière donc les empiriques et les organisateurs ! Arrière leurs anneaux, leurs chaînes, leurs crochets, leurs tenailles ! arrière leurs moyens artificiels ! arrière leur atelier social, leur phalanstère, leur gouvernementalisme, leur centralisation, leurs tarifs, leurs universités, leurs religions d’État, leurs banques gratuites ou leurs banques monopolisées, leurs compressions, leurs restrictions, leur moralisation ou leur égalisation par l’impôt ! Et puisqu’on a vainement infligé au corps social tant de systèmes, qu’on finisse par où l’on aurait dû commencer, qu’on repousse les systèmes, qu’on mette enfin à l’épreuve la Liberté, — la Liberté, qui est un acte de foi en Dieu et en son œuvre.
FN:Ce fut en juin 1850 que l’auteur, pendant quelques jours passés dans sa famille à Mugron, écrivit ce pamphlet. (Note de l’éditeur)
FN:Voy. au tome V, les deux dernières pages du pamphlet, Spoliation et Loi. (Note de l’éditeur)
FN:Conseil général des manufactures, de l’agriculture et du commerce. (Séance du 6 mai 1850.)
FN:Si la protection n’était accordée, en France, qu’à une seule classe, par exemple, aux maîtres de forges, elle serait si absurdement spoliatrice qu’elle ne pourrait se maintenir. Aussi voyons nous toutes les industries protégées se liguer, faire cause commune et même se recruter de manière à paraître embrasser l’ensemble du travail national. Elles sentent instinctivement que la Spoliation se dissimule en se généralisant.
FN:Dans le pamphlet Baccalauréat et Socialisme (le 5me d’après notre classement), l’auteur, par une série de citations analogues, montre encore la filiation de la même erreur. (Note de l’éditeur.)
FN:Pour qu’un peuple soit heureux, il est indispensable que les individus qui le composent aient de la prévoyance, de la prudence, et de cette confiance les uns dans les autres qui naît de la sûreté.
Or, il ne peut guère acquérir ces choses que par l’expérience. Il devient prévoyant quand il a souffert pour n’avoir pas prévu ; prudent, quand sa témérité a été souvent punie, etc.
Il résulte de là que la liberté commence toujours par être accompagnée des maux qui suivent l’usage inconsidéré qu’on en fait.
À ce spectacle, des hommes se lèvent qui demandent que la liberté soit proscrite.
« Que l’État, disent-ils, soit prévoyant et prudent pour tout le monde. »
Sur quoi, je pose ces questions :
1o Cela est-il possible ? Peut-il sortir un État expérimenté d’une nation inexpérimentée ?
2o En tout cas, n’est-ce pas étouffer l’expérience dans son germe ?
Si le pouvoir impose les actes individuels, comment l’individu s’instruira-t-il par les conséquences de ses actes ? Il sera donc en tutelle à perpétuité ?
Et l’État ayant tout ordonné sera responsable de tout.
Il y a là un foyer de révolutions, et de révolutions sans issue, puisqu’elles seront faites par un peuple auquel, en interdisant l’expérience, on a interdit le progrès. (Pensée tirée des manuscrits de l’auteur)
FN:L’économie politique précède la politique ; celle-là dit si les intérêts humains sont naturellement harmoniques ou antagoniques ; ce que celle-ci devrait savoir avant de fixer les attributions du gouvernement.
T.278 (1850.09.10) SEP: Séance de 10 sept. 1850 (SEP farewell to FB) (Fr, PDF1)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against ASEP PDF: 26 Nov. 2015
Translation:
Footnotes and Glossaries:
Introduction:
Source Info
T.278 (1850.09.10) FB's comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 sept. 1850) (SEP farewell to FB). In “Chronique,” JDE, T. 27, no. 114, 15 sept. 1850, p. 197; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), p. 124. Not in OC.
[need to compare with JDE version]
Text: JDE version↩
CHRONIQUE.
SOMMAIRE : Le télégraphe électrique à travers la Manche. - Un vœu du Conseil général contre le libre échange.- Abréviation de la durée légale des exercices financiers. –Départ de M. Frédéric Bastiat. - La question des sucres à la Société d'économie politique. - Il faut s'occuper de la contrefaçon. - Enquête sur le crédit foncier. Réponses économistes de M. le président de la République. - Faits économiques du règne de Louis-Philippe. - Bruit d'un plan de Zollverein austro-italien. - Votes du Parlement anglais. - Réforme de la loi de navigation en Hollande. - Importation en 1850. - Nombre d'exposants français à Londres.
– M. Frédéric Bastiat, représentant du peuple, était venu à la dernière réunion des économistes pour faire ses adieux aux membres de cette société. Cédant aux sages avis du docteur Andral, M. Bastiat va passer l'hiver à Pise, et rétablir sa santé altérée par le climat de Paris et un travail trop ardent : il est en ce moment atteint d'un mal de gorge persistant, qui le prive complétement de la voix. Nous espérons que le brillant auteur des Sophismes et des Harmonies économiques, sous l'heureuse influence du climat d'Italie, pourra bientôt terminer le second volume de ce dernier ouvrage, déjà bien avancé.
Dans cette même réunion, présidée par M. Horace Say, récemment arrivé de voyage, la discussion s'est engagée sur la question des sucres, qui a été soumise tout récemment aux délibérations du Conseil d'État, et qui doit être portée bientôt devant l'Assemblée législative. M. Rodet, l'undes hommes de notre pays qui connaissent le mieux les détails pratiques de cette question, est entré dans quelques développements pleins d'intérêt sur la production et le commerce du sucre dans les diverses parties du monde. Il ne croit pas que la réforme des tarifs puisse jamais avoir en France les mêmes résultats qu'en Angleterre, et y étendre la consommation du sucre au même degré, parce que les habitudes du pays sont autres. M. Villermé fils a combattu ces conclusions et soutenu que l'élévation des prix est le seul obstacle à l'extension de la consommation en France. Il a produit, à l'appui de ses assertions, plusieurs faits dont M. Rodet conteste la juste application. M. Coquelin a insisté, à deux reprises, sur la nécessité d'une réforme immédiate et radicale de nos tarifs, et particulièrement de la suppression entière de la surtaxe qui frappe les sucres étrangers. C'est à cette condition seulement, dit-il, que l'on obtiendra des résultats sérieux, et cette solution, qui paraît au premier abord trop absolue et trop hardie, est réclamée tout à la fois par l'intérêt de nos finances publiques, par l'intérêt de notre marine marchande et même par l'intérêt bien entendu des colonies, en un mot, par tous les intérêts engagés dans la question. Ces conclusions ont été combattues par M. Gabriel Lafond, qui proteste, au nom des colonies, contre tout changement trop brusque.A cette occasion, M. Gabriel Lafond s'est livré à quelques interprétations sur les réformes libérales de l'Angleterre, dont plusieurs lui paraissent avoir été dictées par un esprit machiavélique. Sans se prononcer sur le fond du débat, M. Horace Say a redressé ce qu'il peut y avoir d'erroné dans les interprétations de M. Gabriel Lafond, et a rétabli dans leur vrai jour les intentions du gouvernement anglais, soit dans la réforme des tarifs, soit dans l'acte encore plus éclatant de l'abolition de l'esclavage.
En l'absence de M. Joseph Garnier, M. Guillaumin, seul membre présent qui eût assisté aux séances du Congrès de la paix, à Francfort, a fourni à la Société quelques détails intéressants sur la tenue du Congrès et sur les divers incidents qui en ont signalé la marche.
Text: ASEP version↩
[124]
Séance du 10 septembre 1850.
M. Frédéric Bastiat, représentant du peuple, était venu, à cette réunion, pour faire ses adieux aux membres de la Société. Cédant aux sages avis du docteur Andral, M. Bastiat va passer l'hiver à Pise, et rétablir sa santé altérée par le climat de Paris et un travail trop ardent : il est en ce moment atteint d'un mal de gorge persistant, qui le prive complètement de la voix. Nous espérons que le brillant auteur des Sophismes et des Harmonies économiques, sous l'heureuse influence du climat d'Italie, pourra bientôt terminer le second volume de ce dernier ouvrage, déjà bien avancé.
Dans cette même réunion, présidée par M. Horace Say, récemment arrivé de voyage, la discussion s'est engagée sur la question des sucres, qui a été soumise tout récemment aux délibérations du conseil d'État, et qui doit être portée bientôt devant l'Assemblée législative. M. Rodet, l'un des hommes de notre pays, qui connaissent le mieux les détails pratiques de cette question, est entré dans quelques développements pleins d'intérêt sur la production et le commerce du sucre dans les diverses parties du monde. Il ne croit pas que la réforme des tarifs puisse jamais avoir en France les mêmes résultats qu'en Angleterre, et y étendre la consommation du sucre au même degré, parce que les habitudes du pays sont autres. M. Villermé fils a combattu ces conclusions et soutenu que l'élévation des prix est le seul obstacle à l'extension de la consommation en France. Il a produit, à l'appui de ses assertions, plusieurs faits dont M. Rodet conteste la juste application. M. Coquelin a insisté, à deux reprises, sur la nécessité d'une réforme immédiate et radicale de nos tarifs, et particulièrement de la suppression entière de la surtaxe qui frappe les sucres étrangers. C'est à cette condition seulement, dit-il, que l'on obtiendra des résultats sérieux, et cette solution, qui paraît au premier abord trop absolue et trop hardie, est réclamée tout à la fois par l'intérêt de nos finances publiques, par l'intérêt de notre marine marchande et même par l'intérêt bien entendu des colonies; en un mot, par tous les intérêts engagés dans la question. Ces conclusions ont été combattues par M. Gabriel Lafond, qui proteste, au nom des colonies, contre tout changement trop brusque. A cette occasion, M. Gabriel Lafond s'est livré à quelques interprétations sur les réformes libérales de l'Angleterre, dont plusieurs lui paraissent avoir été dictées par un esprit machiavélique. Sans se prononcer sur le fond du débat, M. Horace Say a redressé ce qu'il peut y avoir d'erroné dans les interprétations de M. Gabriel Lafond, et a rétabli dans leur vrai jour les intentions du gouvernement anglais, soit dans la réforme des tarifs, soit dans l'acte encore plus éclatant de l'abolition de l'esclavage.
En l'absence de M. Joseph Garnier, M. Guillaumin, seul membre présent qui eût assisté aux séances du Congrès de la paix, à Francfort, a fourni à la Société quelques détails intéressants sur la tenue du Congrès et sur les divers incidents qui en ont signalé la marche.
Abondance [Sept. 1850] ↩
BWV
1850.?? “Abondance” (Abundance) [written sometime in 1850 (Sept.) before Bastiat's departure for Italy] [Published as “Abondance”, *Dictionnaire de l'économie politique* (Paris: Guillaumin, 1852), vol. 1, pp. 2-4] [OC5.7, pp. 393-401]
Abondance [211]
1850
C’est une vaste et noble science, en tant qu’exposition, que l’économie politique. Elle scrute les ressorts du mécanisme social et les fonctions de chacun des organes qui constituent ces corps vivants et merveilleux, qu’on nomme des sociétés humaines. Elle étudie les lois générales selon lesquelles le genre humain est appelé à croître en nombre, en richesse, en intelligence, en moralité. Et néanmoins, reconnaissant un libre arbitre social comme un libre arbitre personnel, elle dit comment les lois providentielles peuvent être méconnues ou violées ; quelle responsabilité terrible naît de ces expérimentations fatales, et comment la civilisation peut se trouver ainsi arrêtée, retardée, refoulée et pour longtemps étouffée.
Qui le croirait ? Cette science si vaste et si élevée, comme exposition, en est presque réduite, en tant que controverse, et dans sa partie polémique, à l’ingrate tâche de démontrer cette proposition, qui semble puérile à force d’être claire : « L’abondance vaut mieux que la disette. »
Car, qu’on y regarde de près, et l’on se convaincra que la plupart des objections et des doutes qu’on oppose à l’économie politique impliquent ce principe : « La disette vaut mieux que l’abondance. »
C’est ce qu’expriment ces locutions si populaires :
« La production surabonde. »
« Nous périssons de pléthore. »
« Tous les marchés sont engorgés et toutes les carrières encombrées. »
« La faculté de consommer ne peut plus suivre la faculté de produire. »
Voici un détracteur des machines. Il déplore que les miracles du génie de l’homme étendent indéfiniment sa puissance de produire. Que redoute-t-il ? L’abondance.
Voici un protectioniste. Il gémit de la libéralité de la nature envers d’autres climats. Il craint que la France n’y participe par l’échange et ne veut pas qu’elle soit libre, parce que, si elle l’était, elle ne manquerait pas d’attirer sur elle-même le fléau de l’invasion et de l’inondation… Que redoute-t-il ? L’abondance.
Voici un homme d’État. Il s’effraie de tous les moyens de satisfaction que le travail accumule dans le pays, et croyant apercevoir, dans les profondeurs de l’avenir, le fantôme d’un bien-être révolutionnaire et d’une égalité séditieuse, il imagine de lourds impôts, de vastes armées, des dissipations de produits sur une grande échelle, de grandes existences, une puissante aristocratie artificielle chargée de remédier, par son luxe et son faste, à l’insolent excès de fécondité de l’industrie humaine. Que redoute-t-il ? L’abondance.
Enfin, voici un logicien qui, dédaignant les voies tortueuses et allant droit au but, conseille de brûler périodiquement Paris, pour offrir au travail l’occasion et l’avantage de le reconstruire. Que redoute t-il ? L’abondance.
Comment de telles idées ont-elles pu se former, et, il faut bien le dire, prévaloir quelquefois, non point sans doute dans la pratique personnelle des hommes, mais dans leurs théories et leurs législations ? Car s’il est une assertion qui semble porter sa preuve en elle-même, c’est bien celle-ci : « En fait de choses utiles, il vaut mieux avoir que manquer. » Et s’il est incontestable que l’abondance est un fléau, quand elle porte sur des objets malfaisants, destructifs, importuns comme les sauterelles, les chenilles, la vermine, les vices, les miasmes délétères, il ne peut pas être moins vrai qu’elle est un bienfait, quand il s’agit de ces choses qui apaisent des besoins, procurent des satisfactions, — de ces objets que l’homme recherche, poursuit au prix de ses sueurs, qu’il consent à acheter par le travail ou par l’échange, qui ont de la valeur, tels que les aliments, les vêtements, les logements, les œuvres d’art, les moyens de locomotion, de communication, d’instruction, de diversion, en un mot tout ce dont s’occupe l’économie politique.
Si l’on veut comparer la civilisation de deux peuples ou de deux siècles, est-ce qu’on ne demande pas à la statistique lequel des deux présente, proportionnellement à la population, plus de moyens d’existence, plus de productions agricoles, industrielles ou artistiques, plus de routes, de canaux, de bibliothèques et de musées ? Est-ce qu’on ne décide pas, si je puis m’exprimer ainsi, par l’activité comparée des consommations, c’est-à-dire par l’abondance.
On dira peut-être qu’il ne suffit pas que les produits abondent ; qu’il faut encore qu’ils soient équitablement répartis. Rien n’est plus vrai. Mais ne confondons pas les questions. Quand nous défendons l’abondance, quand nos adversaires la décrient, les uns et les autres nous sous-entendons ces mots : cæteris paribus, toutes choses égales d’ailleurs, l’équité dans la répartition étant supposée la même.
Et puis remarquez que l’abondance est par elle-même une cause de bonne répartition. Plus une chose abonde, moins elle a de valeur ; moins elle a de valeur, plus elle est à la portée de tous, plus les hommes sont égaux devant elle. Nous sommes tous égaux devant l’air, parce qu’il est, relativement à nos besoins et à nos désirs, d’une abondance inépuisable. Nous sommes un peu moins égaux devant l’eau, parce qu’étant moins abondante elle commence à coûter ; moins encore devant le blé, devant les fruits délicats, devant les primeurs, devant les raretés, l’exclusion se faisant toujours en raison inverse de l’abondance.
Nous ajouterons, pour répondre aux scrupules sentimentalistes de notre époque, que l’abondance n’est pas seulement un bien matériel. Les besoins se développent, au sein de l’humanité, dans un certain ordre ; ils ne sont pas tous également impérieux, et l’on peut même remarquer que leur ordre de priorité n’est pas leur ordre de dignité. Les besoins les plus grossiers veulent être satisfaits les premiers, parce qu’à cette satisfaction tient la vie, et que, quoi qu’en disent les déclamateurs, avant de vivre dignement, il faut vivre. Primò vivere, deindè philosophare.
Il suit de là que c’est l’abondance des choses propres à répondre aux nécessités les plus vulgaires, qui permet à l’humanité de spiritualiser de plus en plus ses jouissances, de s’élever dans la région du Vrai et du Beau. Elle ne peut consacrer au perfectionnement de la forme, au culte de l’art, aux investigations de la pensée que le temps et les forces qui, en vertu du progrès, cessent d’être absorbés par les exigences de la vie animale. L’abondance, fruit de longs travaux et de patientes économies, ne peut être instantanément universelle, dès l’origine des sociétés. Elle ne peut se faire en même temps sur toute la ligne des productions possibles. Elle suit un ordre successif, passant du matériel au spirituel. Malheureux les peuples, quand des impulsions extérieures, comme celles des gouvernements, s’efforcent d’intervertir cet ordre, substituent à des désirs grossiers mais impérieux d’autres désirs plus élevés mais prématurés, changent la direction naturelle du travail et rompent cet équilibre des besoins et des satisfactions, d’où naissent les garanties de la stabilité sociale.
Au reste, si l’abondance était un fléau, cela serait aussi malheureux qu’étrange, car, quelque facile que soit le remède (s’abstenir de produire et détruire, quoi de plus aisé ?), jamais on n’y déterminera l’individualité. On a beau déclamer contre l’abondance, la surabondance, la pléthore, l’encombrement, on a beau faire la théorie de la disette, lui donner l’appui des lois, proscrire les machines, gêner, entraver, contrarier les échanges, cela n’empêche personne, pas même les coryphées de ces systèmes, de travailler à réaliser l’abondance. Sur toute la surface du globe, on ne rencontrerait pas un seul homme dont la pratique ne proteste contre ces vaines théories. On n’en rencontrerait pas un qui ne cherche à tirer le meilleur parti possible de ses forces, à les ménager, à les économiser, à en augmenter le résultat par la coopération des forces naturelles ; on n’en trouverait pas un, même parmi ceux qui déclament le plus contre la liberté des transactions, qui ne se conduise sur ce principe (tout en voulant l’interdire aux autres) : vendre le plus cher et acheter au meilleur marché possible ; — de telle sorte que la théorie de la disette qui prévaut dans les livres, dans les journaux, dans les conversations, dans les parlements, et, par là, dans les lois, est réfutée et démentie par la manière d’agir de toutes les individualités, sans aucune exception, qui composent le genre humain, ce qui est certes la plus péremptoire réfutation qu’il soit possible d’imaginer.
Mais en face de ce problème : l’abondance vaut-elle mieux que la disette, d’où vient que tous les hommes, après s’être virtuellement prononcés pour l’abondance, par leur manière d’agir, de travailler et d’échanger, se constituent théoriquement les défenseurs de la disette, jusque-là qu’ils forment dans ce sens l’opinion publique et en font jaillir toutes sortes de lois restrictives et compressives ?
C’est ce qu’il nous reste à expliquer.
Au fond, ce à quoi nous aspirons tous, c’est que chacun de nos efforts réalise pour nous la plus grande somme possible de bien-être. Si nous n’étions pas sociables, si nous vivions dans l’isolement, nous ne connaîtrions, pour atteindre ce but, qu’une règle : travailler plus et mieux, règle qui implique l’abondance progressive.
Mais, à cause de l’Échange et de la séparation des occupations, qui en est la suite, ce n’est pas immédiatement à nous-mêmes, c’est à autrui que nous consacrons notre travail, nos efforts, nos produits, nos services. Dès lors, sans perdre de vue la règle : produire plus, nous en avons une autre toujours plus actuellement présente à notre esprit : produire plus de valeur. Car c’est de là que dépend la quantité de services que nous avons à recevoir en retour des nôtres.
Or, créer plus de produits, ou créer plus de valeur, ce n’est pas la même chose. Il est bien clair que si, par force ou par ruse, nous parvenions à raréfier beaucoup le service spécial ou le produit qui font l’objet de notre profession, nous nous enrichirions sans augmenter ni perfectionner notre travail. Si un cordonnier, par exemple, pouvait, par un acte de sa volonté, faire évaporer tous les souliers du monde, excepté ceux de sa boutique, ou frapper de paralysie quiconque sait manœuvrer le tranchet et le tire-pied, il deviendrait un Crésus ; son sort s’améliorerait, non point avec le sort général de l’humanité, mais en raison inverse de la destinée universelle.
Voilà tout le secret — et tout l’odieux — de la théorie de la disette, telle qu’elle se manifeste dans les restrictions, les monopoles et les priviléges. Elle ne fait que traduire et voiler, par un commentaire scientifique, ce sentiment égoïste que nous portons tous au fond du cœur : les concurrents m’importunent.
Quand nous apportons un produit sur le marché, deux circonstances sont également de nature à en surhausser la valeur : la première, c’est qu’il y rencontre une très-grande abondance des choses contre lesquelles il peut s’échanger, c’est-à-dire de tout ; la seconde, c’est qu’il y rencontre une très-grande rareté de ses similaires.
Or, ni par nous-mêmes, ni par l’intermédiaire des lois et de la force publique, nous ne pouvons rien sur la première de ces circonstances. L’abondance universelle ne se décrète malheureusement pas ; il y faut d’autres façons ; les législateurs, les douaniers et les entraves n’y peuvent rien.
Si donc nous voulons élever artificiellement la valeur du produit, force nous est d’agir sur l’autre élément de cette valeur. En ceci, la volonté individuelle n’est pas aussi impuissante. Avec des lois ad hoc, avec de l’arbitraire, avec des baïonnettes, avec des chaînes, avec des entraves, avec des châtiments et des persécutions, il n’est pas impossible de chasser les concurrents, de créer la rareté et cette hausse artificielle qui est l’objet de nos désirs.
Les choses étant ainsi, il est aisé de comprendre ce qui peut et doit arriver dans un temps d’ignorance, de barbarie et de cupidité effrénée.
Chacun s’adresse à la législature, et par cet intermédiaire à la force publique, pour lui demander de créer artificiellement, par tous les moyens en son pouvoir, la rareté de la chose qu’il produit. L’agriculteur demande la rareté du blé ; l’éleveur, la rareté du bétail ; le maître de forges, la rareté du fer ; le colon, la rareté du sucre ; le tisseur, la rareté du drap, etc., etc. Chacun donne les mêmes raisons, ce qui finit par faire un corps de doctrine qu’on peut bien appeler la théorie de la disette ; et la force publique emploie le fer et le feu au triomphe de cette théorie.
Mais, sans parler des masses, ainsi soumises au régime de la privation universelle, il est aisé de voir à quelle mystification viennent se heurter les inventeurs de ce régime, et quel terrible châtiment attend leur rapacité sans scrupule.
Nous avons vu que, relativement à chaque produit spécial, la valeur avait deux éléments : 1° la rareté de ce qui lui est similaire ; 2° l’abondance de tout ce qui ne lui est pas similaire.
Or, qu’on veuille bien remarquer ceci : par cela même que la législature, esclave de l’égoïsme individuel, travaille à réaliser le premier de ces deux éléments de la valeur, elle détruit le second, sans pouvoir l’éviter, puisque c’est une seule et même chose. Elle a successivement satisfait les vœux de l’agriculteur, de l’éleveur, du maître de forges, du fabricant, du colon, en produisant artificiellement la rareté du blé, de la viande, du fer, du drap, du sucre, etc. ; mais cela qu’est-ce autre chose que détruire cette abondance générale, qui est la seconde condition de la valeur de chaque produit particulier ? Ainsi, après avoir soumis la communauté à des privations effectives, impliquées dans la disette, dans le but d’exhausser la valeur des produits, il se trouve qu’on n’a pas même réussi à atteindre cette ombre, à étreindre ce fantôme, à exhausser cette valeur nominale, parce que précisément ce que la rareté du produit spécial opère en sa faveur, dans ce sens, la rareté des autres produits le neutralise. Est-il donc si difficile de comprendre que le cordonnier dont nous parlions tout à l’heure, parvînt-il à détruire, par un seul acte de sa volonté, tous les souliers du monde, excepté ceux de sa façon, ne serait pas plus avancé, même au point de vue puéril de la valeur nominale, si du même coup tous les objets, contre lesquels les souliers s’échangent se raréfiaient dans la même proportion ? Il n’y aurait que ceci de changé : tous les hommes, y compris notre cordonnier, seraient plus mal chaussés, vêtus, nourris, logés, encore que les produits conservassent entre eux la même valeur relative.
Et il faut bien qu’il en soit ainsi. Où en serait la société, si l’injustice, l’oppression, l’égoïsme, la cupidité et l’ignorance n’entraînaient aucun châtiment ? Heureusement il n’est pas possible que quelques hommes puissent, sans inconvénient pour eux-mêmes, faire tourner la force publique et l’appareil gouvernemental au profit de la disette, et à comprimer l’universel élan de l’humanité vers l’abondance. [212]
FN:Article destiné au Dictionnaire de l’Économie politique. Il fut écrit peu de jours avant le départ de l’auteur pour l’Italie, — d’où il ne devait pas revenir !… (Note de l’éditeur.)
Books and Printed Pamphlets↩
Table of Contents↩
Books:
- *Harmonies économiques* (Economic Harmonies) [1st ten chapters, Jan/Feb 1850]
- *Intérêt et principale* (Interest and Principal) or *Gratuité du crédit* (Free Credit) [March 1850]
- *Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas* (What is Seen and What is Not Seen) [July 1850]
Pamphlets:
- *Sur la balance du commerce* (On the Balance of Trade) [after March 1850]
- *Baccalauréat et socialisme* (The Baccalaureat and Socialism) [early 1850]
- *Réflexion sur l'amendement Ternaux-Mortimer* (Thoughts on Ternaux-Mortimer’s Amendment to the Law) [after April 1850]
- *Spoliation et Loi* (Plunder and Law) [after May 1850]
- *La Loi* (The Law) [after July 1850]
*Harmonies économiques* [1st ten chapters, Jan/Feb 1850]↩
1850.1 *Harmonies économiques. Par M. Fr. Bastiat. Membre correspondant de l’Institut, Représentant de Peuple à l’Assemblée Législative.* (Paris: Guillaumin, 1850). [January, 1850] [1st 10 chapters] [OC6]
Appeared in Jan. 1850 (see letter 158 to Coudroy) but not reviewed by Clément in the JDE until June 1850. Possibly reluctantly.
“Harmonies économies, par M. Frédéric Bastiat. (Compte rendu par. M. A. Clément), JDE, T. 26, no. 111, 15 juin 1850, pp. 235-47.
1851.? *Harmonies économiques. 2me Édition augmentées des manuscrits laissés par l’auteur. Publiée par la Société des amis de Bastiat* (Paris: Guillaumin, 1851). Introduction by Prosper Paillottet and Roger de Fontenay. [orignal 10 chapters plus 15 reconstructed from his papers]
Reviewed by J. Garnier in JDE Aug. 1851.
Joseph Garnier, “La deuxième édition des *Harmonies économiques de Frédéric Bastiat,” JDE, T. 29, no. 124, 15 août 1851, pp. 312-16.
- A la jeunesse française
- I. Organisation naturelle Organisation artificielle.
- II. Besoins, Efforts, Satisfactions
- III. Des besoins de l'homme
- IV. Échange
- V. De la Valeur
- VI. Richesse
- VII. Capital
- VIII. Propriété, Communauté
- IX. Propriété foncière
- X. Concurrence
- XI. Producteur, Consommateur
- XII. Les deux Devises
- XIII. De la Rente
- XIV. Des salaires
- XV. De l'épargne
- XVI. De la Population
- XVII. Services privés, services publics
- XVIII. Causes perturbatrices
- XIX. Guerre
- XX. Responsabilité
- XXI. Solidarité
- XXII. Moteur social
- XXIII. Le Mal
- XXIV. Perfectibilité
- XXV. Rapports de l'économie Politique avec la morale, avec la politique, avec la législation, avec la religion.
First 10 chapters published in FB’s lifetime [Jan. 1850]. Chaps. 11-25 published by Paillottet in 1851 from FB’s notes and papers.
Some chapters appeared in the JDE prior to the appearance of the book:
- 1848.01.15 I. Organisation naturelle Organisation artificielle. - JDE, T. XIX, No. 74, Jan 1848, pp. 113-26.
- 1848.09.15 and 1848.12.15 II. Besoins, Efforts, Satisfactions and III. Des besoins de l'homme - JDE Sept. and Dec. 1848
- 1848.09.15 “Harmonie économiques. I, II, III (Des besoins de l’homme)”, JDE, T. XXI, No. 87, 1e Sept. 1848, pp. 105-20.
- 1848.12.15 “Harmonie économiques. IV”, JDE, T. XXII, No. 93, 15 Dec. 1848, pp. 7-18.
*Intérêt et principale* or *Gratuité du crédit* [Oct. 1849 - March 1850]↩
1850.?? *Intérêt et principale. Discussion entre M. Proudhon et M. Bastiat sur l’intérêt des capitaux* (Extraits de la Voix de Peuple) [Interest and Principle. A Discussion between M. Proudhon and M. Bastiat on Interest from Capital (Originally The Voice of the People)] (Paris: Garnier frères, 1850) [first 13 Letters]. With Bastiat’s 14th Letter (7 March 1850), Gratuité du crédit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon [Free Credit. A Discussion between M. Fr. Bastiat and M. Proudhon] (Paris: Guillaumin, 1850).
- PREMIÈRE LETTRE. - F. C. Chevé, l'un des rédacteurs de la Voix du Peuple, à Frédéric Bastiat
- DEUXIÈME LETTRE. - F. Bastiat au rédacteur de la Voix du peuple
- TROISIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- QUATRIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- CINQUIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- SIXIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- SEPTIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- HUITIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- NEUVIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- DIXIÈME LETTRE - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- ONZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- DOUZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
- TREIZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat
- QUATORZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon
Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas↩
1850.07 *Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas* (What is Seen and What is Not Seen) [OC5.6, p. 336] [CW3]
- I. “La vitre cassée” (The Broken Window)
- II. “Le licenciement” (Dismissing Members of the Armed Forces)
- II. “L’impôt” (Taxes)
- IV. “Théâtres. Beaux-arts” (Theatres and the Fine Arts)
- V. “Travaux publics” (Public Works)
- VI. “Les intermédiaires” (The Middlemen)
- VIII. “Restriction” (Trade Restrictions)
- VIII. “Les machines” (Machines)
- IX. “Crédit” (Credit)
- X. “L’Algérie” (Algeria)
- XI. “Épargne et Luxe” (Thrift and Luxury)
- XII. “Droit au travail, droit au profit” (The Right to Work and the Right to Profit)
*Spoliation et loi*↩
*Spoliation et loi* is a collection of essays published in 1850 with editorial comment (not by Bastiat):
*Spoliation et loi*, par M. F. Bastiat. Membre correspondant de l’Institut. Représentant du peuple à l’Assemblée nationale (Paris: Guillaumin, 1850).
* Avertissement de l’éditeur
* I. Aux Démocrates, pp. 8-15 [2 April 1850, originally “Reflections on the Amendment of M. Mortimer-Ternaux” (Réflexions sur l’amendement de M. Mortimer-Ternaux)]
* II. À MM. les Protectionnistes du Conseil général des Manufactures, pp. 20-40 [JDE, 15 mai 1850]
* III. La guerre aux chaires d’Économie politique, en 1847, pp. 42-52 [June 1847. n.p.] [OC5.2, p. 16]
* IV. Balance du Commerce, pp. 54-61 [29 March, 1850] [OC5.8, pp. 402-406]
I. 1850.04.01 “Réflexions sur l’amendement de M. Mortimer-Ternaux” (Reflections on the Amendment of M. Mortimer-Ternaux) [part of the debate in the Legislative Assembly on 1 April 1850] [OC5.12, p. 513] [CW2]
II. 1850.05.15 “A MM. les protectionnistes du Conseil général des manufactures” (To the Protectionists on the General Council of Manufactures) [*Journal des Économistes, T. XXVI, N° 110, 15 mai 1850, p. 160-67].
III. 1847.06 “Guerre aux chaires d’économie politique” (The War against Chairs of Political Economy) [June 1847. n.p.] [OC5.2, p. 16] [CW2]
IV. 1850.03.29 “Balance du commerce” (Balance of Trade) [29 March 1850] [written on 29 March 1850 for an unnamed journal] [OC5.8, pp. 402-406]
Gratuité du crédit [Oct. 1849 - March 1850] ↩
BWV
1850.03 *Intérêt et principale. Discussion entre M. Proudhon et M. Bastiat sur l’intérêt des capitaux* (Extraits de la Voix de Peuple) [Interest and Principle. A Discussion between M. Proudhon and M. Bastiat on Interest from Capital (Originally The Voice of the People)] (Paris: Garnier frères, 1850) [first 13 Letters]. With Bastiat’s 14th Letter (7 March 1850), Gratuité du crédit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon [Free Credit. A Discussion between M. Fr. Bastiat and M. Proudhon] (Paris: Guillaumin, 1850). [G5]
PREMIÈRE LETTRE. - F. C. Chevé, l'un des rédacteurs de la Voix du Peuple, à Frédéric Bastiat[213] ↩
F. C. Chevé, l’un des rédacteurs de la Voix du Peuple, à Frédéric Bastiat
Adhésion à la formule : le prêt est un service qui doit s’échanger contre un service. — Distinction sur la nature des services. — Le service qui consiste à céder l’usage temporaire d’une propriété ne doit pas être rémunéré par la cession définitive d’une propriété. — Conséquences funestes de l’intérêt pour l’emprunteur, pour le prêteur lui-même et pour la société tout entière.
22 octobre 1849.
Tous les principes d’économie sociale que vous avez propagés avec un talent si remarquable concluent forcément, inévitablement, à l’abolition de l’intérêt ou de la rente. Curieux de savoir par quelle étrange contradiction votre logique, toujours si vive et si sûre, reculait devant cette conclusion définitive, j’interrogeai votre pamphlet intitulé : Capital et Rente, et je m’aperçus, avec une surprise mêlée de joie, qu’il n’y avait plus entre vous et nous que l’épaisseur d’une simple équivoque.
— Cette équivoque porte tout entière sur la confusion de deux choses cependant bien distinctes, l’usage et la propriété.
Comme nous, vous partez de ce principe fondamental et incontesté : réciprocité, mutualité, équivalence des services. Seulement, en confondant l’usage et la propriété, et en identifiant ces deux ordres de nature diverse et sans équivalence possible, vous détruisez toute mutualité, toute réciprocité, toute équivalence véritable, renversant ainsi, de vos propres mains, le principe que vous avez posé.
C’est ce principe qui vient se réclamer de vous-même contre vous-même. Comment récuseriez-vous, en faveur de l’abolition de la rente, ce juge que vous avez invoqué contre elle ?
Vous ne nous accuserez pas, Monsieur, de manquer de courtoisie. Nous, les premiers attaqués, nous vous laissons le choix du lieu, de l’heure et des armes, et, sans nous plaindre des désavantages du terrain, nous acceptons la discussion dans les termes où vous l’avez posée. Bien plus, nous contentant de suivre un à un tous les exemples, toutes les démonstrations de votre écrit Capital et Rente, nous ne ferons que rectifier le malentendu, la malheureuse équivoque qui seule vous a empêché de conclure contre la rente. Les clauses de ce débat vous semblent-elles, ou non, loyales ?
Entrons donc en matière.
Paul échange avec Pierre dix pièces de 50 centimes contre 100 sous : voilà le troc pour troc, l’échange de propriété contre propriété. — Mais Pierre dit Paul : « Tu me donneras les dix pièces de 10 sous actuellement, et moi je te donnerai la pièce de 100 sous dans un an. » Voilà « un service nouveau et d’une autre espèce que Pierre demande à Paul. »
— Mais quelle est la nature de ce service ? Pierre demande-t-il à Paul de lui céder la propriété d’une nouvelle somme quelle qu’elle soit ? non, mais simplement de lui laisser l’usage de celle-ci pendant un an. Or, puisque tout service doit être payé par un service équivalent, un service d’usage doit donc être échangé contre un service d’usage : rien de moins, rien de plus. — Pierre dira à Paul : Tu me donnes l’usage de dix pièces de 10 sous pendant un an, je te devrai donc en retour le même service, c’est-à-dire l’usage de dix pièces de 10 sous pendant un an aussi. Est-ce juste, oui ou non ?
Un homme échange un navire contre une maison : voilà le troc pour troc, l’échange de propriété contre propriété. — Mais l’armateur veut, en outre, avoir l’usage de la maison pendant un an, avant de livrer son navire. Le propriétaire lui dit : « C’est un service nouveau que vous me demandez, j’ai droit de vous refuser ou de vous demander en compensation un service équivalent. » — Évidemment, répond l’armateur, vous me donnez, une année durant, l’usage d’une valeur de 20,000 fr., je suppose, je vous devrais donc en échange l’usage d’une égale valeur de 20,000. Rien de plus juste. Mais comme je paie votre propriété par celle de mon navire, ce n’est pas une propriété nouvelle, mais un simple usage que vous me concédez, je ne dois donc vous concéder aussi que l’usage d’une même valeur, et pour un temps égal. « Les services échangés se valent. » Exiger plus serait un vol.
Mathurin prête un sac de blé « à Jérôme qui promet de rendre, au bout de l’an, un sac de blé de même qualité, de même poids, sans qu’il en manque un seul grain. » — Mathurin voudrait, en outre, cinq litres de blé en sus de l’hectolitre, pour le service qu’il rend à Jérôme. — Non, reprend celui-ci, ce serait une injustice et une spoliation, tu ne me donnes la propriété de rien, car, au bout de l’an, je dois te remettre la valeur exacte de ce que tu me livres aujourd’hui. Ce que tu me concèdes, c’est l’usage pendant un an de ton sac de blé, tu as donc droit à l’usage de la même valeur pendant une année aussi. Rien au delà ; sinon il n’y aurait plus mutualité, réciprocité, équivalence des services.
De son côté, Mathurin, qui est quelque peu clerc, fait ce raisonnement : « Ce que m’objecte Jérôme est incontestable ; et, en effet, si au bout de l’an, il me rentre cinq litres de blé en sus des cent litres que je viens de prêter, et que dans quelques temps je puisse prêter deux sacs de blé, puis trois, puis quatre, lorsque j’en aurai placé un assez grand nombre pour vivre sur la somme de ces rétributions, » je pourrai manger en ne faisant rien, et sans jamais dépenser mon avoir. Or, ce que je mangerai, ce sera pourtant quelqu’un qui l’aura produit. Ce quelqu’un n’étant pas moi, mais autrui, je vivrai donc aux dépens d’autrui, ce qui est un vol. Et cela se comprend, car le service que j’aurai rendu n’est qu’un prêt ou l’usage d’une valeur, tandis que le service qu’on m’aurait remis en échange serait un don ou la propriété d’une chose. Il n’y a donc justice, égalité, équivalence de services que dans le sens où l’entend Jérôme.
Valère veut occuper, un an durant, la maison de Mondor. « Il sera tenu de se soumettre à trois conditions. La première, de déguerpir au bout de l’an, et de rendre la maison en bon état, sauf les dégradations inévitables qui résultent de la seule durée. La seconde, de rembourser à Mondor les 300 francs que celui-ci paie annuellement à l’architecte pour réparer les outrages du temps ; car ces outrages survenant pendant que la maison est au service de Valère, il est de toute justice qu’il en supporte les conséquences. La troisième, c’est de rendre à Mondor un service équivalent à celui qu’il en reçoit. » Or, ce service est l’usage d’une maison pendant un an. Valère devra donc à Mondor l’usage de la même valeur pendant le même laps de temps. Cette valeur devra être librement débattue entre les deux contractants.
Jacques vient d’achever la confection d’un rabot. Guillaume dit à Jacques :
— Il faut que tu me rendes un service.
— Lequel ?
— Prête-moi ce rabot pour un an.
— Y penses-tu, Guillaume ! Et, si je te rends ce service, quel service me rendras-tu de ton côté ?
— Le même, bien entendu ; et si tu me prêtes une valeur de 20 francs pour un an, je devrai te prêter, à mon tour, la même valeur pendant une égale durée.
— D’abord, dans un an, il faudra mettre le rabot au rebut : il ne sera plus bon à rien. Il est donc juste que tu m’en rendes un autre exactement semblable, ou que tu me donnes assez d’argent pour le faire réparer, ou que tu me remplaces les deux journées que je devrai consacrer à le refaire. De manière ou d’autre, il faut que le rabot me revienne en bon état, comme je te le livre.
— C’est trop juste, je me soumets à cette condition ; je m’engage à te rendre, ou un rabot semblable, ou la valeur.
— Indépendamment de la restitution intégrale déjà stipulée, il faut que tu me rendes un service que nous allons débattre.
— Le service est bien simple. De même que pour ton rabot cédé, je dois te rendre un rabot pareil, ou égale valeur en argent ; de même pour l’usage de cette valeur pendant un an, je te dois l’usage de pareille somme pendant un an aussi. Dans l’un comme dans l’autre cas « les services échangés se valent. »
Cela posé, voici, ce me semble, une série de conséquences dont il est impossible de contester la justesse :
1° Si l’usage paie l’usage, et si la cession purement temporaire par l’emprunteur de l’usage d’une valeur égale « est une rétribution naturelle, équitable, juste prix d’un service d’usage, nous pouvons en conclure, en généralisant, qu’il est contraire à la nature du capital de produire un intérêt. » En effet, il est bien clair qu’après l’usage réciproque des deux services échangés, chaque propriétaire n’étant rentré que dans la valeur exacte de ce qu’il possédait auparavant, il n’y a intérêt ou productivité du capital ni pour l’un ni pour l’autre. Et il n’en saurait être autrement, puisque le prêteur ne pourrait tirer un intérêt de la valeur prêtée qu’autant que l’emprunteur ne tirerait lui-même aucun intérêt de la valeur rendue ; qu’ainsi, l’intérêt du capital est la négation de lui-même et qu’il n’existe pour Paul, Mathurin, Mondor et Jacques qu’à la condition d’être supprimé pour Pierre, Jérôme, Valère et Guillaume. Toutes choses étant, en réalité, instruments de production au même titre, les premiers ne peuvent prélever l’intérêt de la valeur prêtée qu’autant que les seconds prélèvent en retour l’intérêt de la valeur remise en échange, ce qui détruit l’intérêt du capital par lui-même et le réduit à un simple droit d’usage contre l’usage. Vouloir échanger l’usage contre la propriété, c’est dépouiller, spolier l’un au profit de l’autre, « c’est légaliser, organiser, systématiser l’injustice elle-même. » Posons donc en fait que l’intérêt est illégitime, inique et spoliateur.
2° Une seconde conséquence, non moins remarquable que la première, c’est que l’intérêt nuit à l’emprunteur, au prêteur lui-même, et à la société tout entière. Il nuit à l’emprunteur et le spolie, car il est évident que si Pierre, Jérôme, Valère et Guillaume doivent rendre une valeur plus grande que celle qu’ils ont reçue, il n’y a pas équivalence de services, et que la valeur qu’ils rendent en plus étant produite par eux et prélevée par d’autres, ils sont spoliés d’autant. Il nuit au prêteur, parce que, quand celui-ci a recours à l’emprunt, il est victime de la même spoliation. Il nuit à l’un et à l’autre et à la société tout entière, parce que l’intérêt ou la rente, augmentant considérablement le prix de revient de tous les produits, chaque consommateur se trouve spolié d’autant sur tout ce qu’il achète ; que les travailleurs, ne pouvant plus racheter leurs produits au prix de leur salaire, sont forcés de réduire leur consommation ; que cette réduction de consommation amène le chômage ; que ce chômage entraîne une réduction nouvelle de consommation, et qu’il exige le don improductif de sommes énormes englouties par l’assistance publique ou privée, et la répression des crimes toujours croissants enfantés par le manque de travail et la misère. D’où une perturbation effroyable dans la loi de l’offre et de la demande, et dans tous les rapports d’économie sociale ; un obstacle infranchissable « à la formation, à la multiplication, à l’abondance des capitaux ; » l’autocratie absolue du capital, la servitude radicale des travailleurs, l’oppression partout, la liberté nulle part. Que la société « comprenne donc le dommage qu’elle s’inflige quand elle proclame la légitimité de l’intérêt. »
3° Les anecdotes que nous avons racontées mettent aussi sur la voie d’expliquer tout ce qu’a de monstrueux ce phénomène qu’on appelle la pérennité ou la perpétuité de l’intérêt. Dès qu’infidèles au principe de l’équivalence des services, Paul, Mathurin, Mondor, et Jacques veulent échanger, non plus l’usage contre l’usage, mais l’usage contre la propriété, il arrive qu’en quatorze ans environ, ils ont reçu la valeur de leur bien, en un siècle dix fois cette valeur et que, le prêtant ainsi indéfiniment, ils en recevront mille, cent mille, un million de fois la valeur, sans jamais cesser d’en être propriétaires. De sorte que le simple usage du sac de blé, de la maison, du rabot, équivaudra à la propriété, non pas d’un, mais d’un million, d’un milliard et ainsi de suite, de sacs de blé, de maisons, de rabots. C’est la faculté de vendre toujours de nouveau le même objet et d’en recevoir toujours de nouveau le prix, sans jamais céder la propriété de ce qu’on vend. Les valeurs échangées sont-elles égales ? Les services réciproques se valent-ils ? Car remarquez bien ceci : les instruments de production sont un service pour les prêteurs comme pour les emprunteurs, et si Pierre, Jérôme, Valère et Guillaume ont reçu un service qui consiste dans l’usage d’une pièce de cent sous, d’un sac de blé, d’une maison, d’un rabot, ils ont rendu, en échange, un service qui consiste dans la propriété d’un milliard de pièces de cent sous, de sacs de blé, de maisons, de rabots. Or, à moins de démontrer que l’usage de 5 francs égale la propriété de 5 milliards, il faut reconnaître que l’intérêt du capital est un vol.
Dès que, par l’intérêt ou la rente, un individu ou une succession d’individus peuvent échanger 5 francs, un sac de blé, une maison, un rabot contre un milliard et plus de pièces de 5 francs, de sacs de blé, de maisons, de rabots, il y a un homme dans le monde qui reçoit un milliard de plus qu’il n’a produit. — Or, ce milliard, c’est la subsistance de cent, de mille autres ; et en supposant que le salaire qui reste à ces mille spoliés suffise encore à les nourrir, en travaillent jusqu’à leur dernière heure, c’est le loisir de mille individus qu’un seul engloutit, c’est-à-dire leur vie morale et intellectuelle. — Ces hommes auxquels on enlève ainsi, au profit d’un seul, toute vie de l’âme et de la pensée fussent peut-être devenus des Newtons, des Fénelons, des Pascals, réalisant de merveilleuses découvertes dans les sciences et dans les arts, et avançant d’un siècle les progrès de l’humanité. — Mais non, « grâce à la rente et à sa monstrueuse pérennité, » le loisir est interdit précisément à tous ceux qui travaillent du berceau jusqu’à la tombe, et devient le privilége exclusif des quelques oisifs qui, par intérêt du capital, s’approprient, sans rien faire, le fruit du labeur accablant des travailleurs. — La presque totalité de « l’humanité est réduite à croupir dans la vie végétative et stationnaire, dans l’ignorance éternelle, » par suite de cette spoliation de la rente, qui lui enlève la subsistance d’abord et le loisir ensuite. — Sans la rente, au contraire, personne ne recevant exactement que ce qu’il a produit, un nombre immense d’hommes, maintenant oisifs ou livrés à un travail improductif et souvent destructeur, seraient contraints de travailler, ce qui augmenterait d’autant la somme de la richesse générale ou du loisir possible, et ce loisir appartiendrait toujours à ceux qui l’ont réellement acquis par leur propre travail ou par celui de leurs pères.
Mais, dit-on : « Si le capital ne doit plus produire d’intérêt, qui voudra créer les instruments de travail, les matériaux et les provisions de toute espèce dont il se compose ? Chacun les consommera à mesure, et l’humanité ne fera jamais un pas en avant. Le capital ne se formera plus puisqu’il n’y aura plus intérêt à le former. » Singulière équivoque en vérité ! Est-ce que le laboureur n’a pas avantage à produire le plus possible, bien qu’il n’échange sa récolte au marché que contre une valeur égale une fois payée, sans aucune rente ou intérêt du capital ? Est-ce que l’industriel n’a pas avantage à doubler et à tripler ses produits, bien qu’il ne les vende que pour une somme équivalente une seule fois donnée, sans aucun intérêt du capital ? Est-ce que 100,000 francs écus cesseront de valoir 100,000 francs, parce qu’ils ne produisent plus intérêt ? Est-ce que 500,000 francs en terres, en maisons, en machines ou autrement cesseront d’être 500,000 francs parce que l’on n’en tirera plus la rente ? En un mot, la richesse acquise, sous quelque forme et de quelque manière qu’elle le soit, ne sera-t-elle plus une richesse parce que je ne pourrai m’en servir pour spolier autrui ? — Qui voudra créer la richesse ? Mais tous ceux qui désireront être riches. — Qui épargnera ? Mais tous ceux qui voudront vivre le lendemain sur le travail de la veille. — Quel intérêt y aura-t-il à former le capital ? L’intérêt de posséder 10,000 francs quand on aura produit 10,000 francs, d’en posséder 100,000, quand on en aura produit 100,000, et ainsi de suite.
« La loi, dites-vous, nous ravira la perspective d’amasser un peu de bien, puisqu’elle nous interdira d’en tirer aucun parti. » Tout au contraire, la loi assurera à tous la perspective d’amasser autant de richesses qu’ils ont produit de travail, en interdisant à chacun de spolier son voisin du fruit de ses labeurs, et en voulant que les services échangés se vaillent : usage contre usage et propriété contre propriété. « Elle détruira en nous, ajoutez-vous, et le stimulant de l’épargne dans le présent et l’espérance du repos dans l’avenir. Nous aurons beau nous exténuer de fatigues, il faut renoncer à transmettre à nos fils et à nos filles un petit pécule, puisque la science moderne le frappe de stérilité, puisque nous deviendrions des exploiteurs d’hommes si nous prêtions à intérêt. » Tout au contraire, l’abolition de l’intérêt du capital ravive en vous le stimulant de l’épargne dans le présent et vous assure l’espérance du repos dans l’avenir, puisqu’elle vous empêche, vous, travailleurs, d’être dépouillés, par la rente, de la plus grande part du fruit de votre travail, et qu’en vous obligeant à ne pouvoir dépenser que la somme exacte de ce que vous avez gagné, elle rend l’épargne plus indispensable encore à tous, riches ou pauvres. Non seulement vous pourrez transmettre à vos fils et à vos filles un petit pécule, sans devenir exploiteurs d’hommes, mais ce pécule, vous l’obtiendrez avec bien moins de fatigues qu’aujourd’hui ; car, si gagnant 10 fr. par jour et en dépensant 5, les 5 autres vous sont actuellement enlevés par toutes les formes de la rente et de l’intérêt du capital, vous n’avez, après quarante années des plus rudes travaux, pas une obole à laisser à vos enfants ; tandis que, la rente abolie, vous aurez plus de 60,000 francs à leur léguer.
Tous les sophismes économiques, à l’endroit de l’intérêt du capital, tiennent uniquement à ce qu’on se borne toujours à prendre la question par un seul côté, au lieu de l’envisager sous ses deux faces réciproques. On démontre à merveille que la valeur prêtée est un service, un moyen de travail et de production pour l’emprunteur ; mais on oublie que la valeur rendue est également un service, un moyen de travail et de production au même titre pour le prêteur, et qu’ainsi l’usage du même service se balançant dans le même temps donné, l’intérêt du capital est une absurdité non moins qu’une spoliation. On énumère avec pompe les bénéfices d’une épargne qui, en se multipliant indéfiniment par la rente, produit l’opulence scandaleuse de quelques oisifs ; mais on oublie que ces bénéfices, prélevés par celui qui ne fait rien sur celui qui travaille, produisent la misère effroyable des masses, auxquelles ils enlèvent souvent la subsistance, toujours au moins l’épargne, le loisir et la possibilité de laisser quelque chose à leur fils. On proclame à grand frais la nécessité de la formation des capitaux, et l’on ne voit pas que l’intérêt restreint cette formation en un nombre presque imperceptible de mains, tandis que l’abolition de la rente y appellerait tout le monde sans exception, et que les capitaux se multiplieraient dans une proportion d’autant plus grande que chacun devrait compenser par le chiffre de la valeur du fonds l’intérêt supprimé. « Dire que l’intérêt s’anéantira, c’est donc dire qu’il y aura un motif de plus d’épargner, de se priver, de former de nouveaux capitaux et de conserver les anciens, » puisque d’abord toute richesse acquise restera toujours une richesse ; qu’ensuite chacun pouvant toujours s’enrichir en proportion exacte de son travail et de son épargne, nul ne sera conduit par l’opulence et la misère excessives à la dissipation et à l’imprévoyance ; qu’enfin tous vivant, non plus sur l’intérêt, mais sur le fonds, il faudra nécessairement que l’importance du capital compense le chiffre de la rente abolie.
Tout le monde sait que le zéro, bien que n’ayant par lui-même aucune valeur intrinsèque et absolue, a cependant une valeur de service et d’usage dans la numérisation ou la multiplication des valeurs, puisque chaque nombre s’accroît d’une dizaine, selon les zéros qui le suivent. Dire que le taux naturel et vrai de l’intérêt est zéro, c’est donc dire simplement que l’usage ne peut s’échanger que contre l’usage et jamais contre la propriété. De même qu’une paire de bas se paie sa valeur, soit 2 fr., par exemple, de même l’usage d’une valeur ne doit se payer que par l’usage pendant le même temps d’une valeur égale. C’est là sans doute empêcher la spoliation de la propriété par la propriété, mais, à coup sûr, ce n’est pas la rente acéphale.
Vous voulez l’épargne qui constitue la formation des capitaux. Supprimez donc la rente qui enlève l’épargne des travailleurs, rend l’épargne superflue au riche qui retrouve toujours dans le revenu la richesse qu’il dépense toujours, et impossible au pauvre dont le salaire ne dépasse jamais, s’il égale, les besoins de sa subsistance. Vous voulez l’abondance des capitaux. Supprimez donc la rente qui empêche les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des travailleurs de pouvoir jamais acquérir et conserver le capital ou la richesse. Vous voulez la conciliation du capital et du travail. Supprimez donc la rente qui éternise l’antagonisme de ces deux choses, en détruisant l’équivalence et la réciprocité des services, et en amenant une exploitation du travail par le capital telle, qu’en un temps donné, le premier paie au second 5 milliards pour l’usage d’une seule pièce de cent sous, comme nous l’avons montré plus haut. Vous voulez l’harmonie des classes. Supprimez donc la rente, afin que, les services s’échangeant sans cesse contre des services égaux et de même nature, chacun reste toujours possesseur de la somme exacte de son travail, et qu’ainsi il ne puisse plus y avoir ni exploitants ni exploités, ni maîtres ni esclaves.
Alors la sécurité sera partout, parce que l’injustice ne sera nulle part. Alors les travailleurs seront les premiers à se porter les gardiens naturels de cette société, dont ils ne conspirent aujourd’hui la ruine que parce qu’elle réalise la leur. Alors on ne parlera plus d’organisation artificielle du travail, parce qu’on aura l’organisation naturelle et vraie. Alors on repoussera les arrangements de la contrainte, parce qu’on possédera ceux de la liberté. Alors tomberont, comme d’elles-mêmes, « les jalousies de classe, les malveillances, les haines sans fondement, les défiances injustes ; » car la parfaite égalité de l’échange, l’incontestable équivalence des services « sera susceptible d’être rigoureusement, mathématiquement démontrée, » et la justice absolue qu’elle consacrera « n’en sera pas moins sublime, parce qu’elle satisfera autant l’intelligence que le sentiment. »
Vous le voyez, Monsieur, j’ai suivi pas à pas, et je pourrais dire lettre à lettre, chacun des exemples, chacune des démonstrations contenues dans votre écrit Capital et Rente, et il m’a suffi de rétablir la distinction entre l’usage et la propriété, et d’éviter ainsi l’équivoque qui nous sépare, pour conclure de vos propres pensées et de vos propres paroles à l’abolition de la rente. Ce n’est pas ma lettre, c’est votre ouvrage lui-même qui contient cette conclusion depuis la première ligne jusqu’à la dernière. Aussi n’ai-je fait que le reproduire, souvent littéralement et en n’en changeant que les termes qui ont donné lieu à cette malheureuse équivoque. Cette réfutation n’est pas de moi, mais de vous. Comment donc pourriez-vous récuser votre propre témoignage ?
C’est le principe même de la rente que vous avez voulu justifier. Là se bornait votre tâche.
C’est le principe même de l’abolition de la rente que j’ai, ce me semble, mathématiquement démontré par vos propres aphorismes. Là doit se borner aussi mon œuvre.
Je me suis arrêté où vous avez jugé nécessaire de vous arrêter vous-même.
La question de principe une fois vidée, s’il arrivait, ce que Dieu veuille, que vous reconnaissiez en droit l’injustice et l’illégitimité de l’intérêt, il resterait sans doute à traiter la question d’application.
Je ne veux point la préjuger ici, puisqu’elle sort évidemment du cercle que vous-même avez tracé. Cependant, quelques mots seront utiles peut-être pour démontrer, non pas seulement la possibilité, mais la facilité pratique de réaliser l’abolition de la rente par la liberté seule, et même avant que la loi la sanctionne. Au fond, tout le problème se réduit à ceci : Donner aux travailleurs le moyen d’acquérir, soit par à-compte, soit de toute autre manière, la propriété de toutes les choses dont l’intérêt, le louage, fermage ou loyer leur fait éternellement payer la valeur pour n’en avoir que le simple usage. Or, ce moyen est possible.
En effet, supposez, — et ce fait n’est plus une supposition, mais une œuvre maintenant en plein cours d’exécution ; — supposez qu’une sorte de banque privée se forme afin d’émettre des billets que les associations ouvrières de toutes les professions indispensables s’engagent à recevoir pour le montant d’un cinquième, par exemple, de tous les achats qui leur seront faits. Supposez que ces billets, échangés contre de l’argent par tous les hommes qui veulent l’abolition de l’intérêt, et qui en trouvent l’écoulement immédiat dans les associations, produisent une somme nécessaire pour construire des maisons où la rente sera abolie, et où le prix de loyer donnera toujours droit à une valeur égale sur le montant de la propriété elle-même qu’on acquerra ainsi, en vingt-cinq ans, par le seul payement des termes.
Supposez que l’opération se continue ainsi indéfiniment par l’émission, soit des anciens, soit de nouveaux billets, et qu’elle embrasse, non-seulement les maisons, mais tous les instruments de production et les terres, où le prix de louage et de fermage rembourserait de la même manière la valeur de la propriété elle-même. Voici la rente abolie sous toutes ses formes, non-seulement pour les capitaux sur lesquels opère cette banque, et qui arriveront nécessairement à un chiffre colossal, mais bientôt pour tous les autres, qui, par la loi inexorable de la concurrence, tomberont au même taux, c’est-à-dire au simple échange de valeurs égales contre valeurs égales, sans aucun intérêt ou rente de part ni d’autre.
J’élimine tous détails pour être bref, et je me contente de résumer en deux mots le principe sommaire de l’opération. Toutes les idées économiques vous sont trop familières, Monsieur, pour que vous ne saisissiez pas de suite le résultat de ce mécanisme, d’ailleurs si simple. C’est assez pour que vous puissiez voir d’un regard comment il est possible, sinon même facile, de tuer la rente par l’abolition de la rente, l’intérêt du capital par la suppression de cet intérêt, et d’amener librement, pacifiquement, sans secousse, le jour où le prêt, louage, fermage ou loyer ne seront plus qu’une des formes de l’échange dont ils constituent aujourd’hui une déviation monstrueuse, et où se réaliseront dans toute la plénitude de leur vérité vos propres principes : mutualité, réciprocité, équivalence des services.
Le principe du moyen d’application posé, variez-en les formes, les éléments, les conditions, le mécanisme ; simplifiez, perfectionnez-en la base ; étendez, universalisez-en l’action ; substituez librement, partout, au signe monétaire, un signe d’échange qui ne puisse permettre l’intérêt ; frappez dans toute circulation le capital du caractère d’improductivité ; solidarisez volontairement le travail ; en un mot, reproduisez cette combinaison de l’abolition de la rente sous tous les modes du possible : c’est là le domaine de la liberté. Il suffit de montrer que le moyen pratique existe ; laissez le génie de l’homme agir, et vous verrez s’il ne sait pas s’en servir.
Quoi qu’il en soit, et indépendamment de toute opinion sur les moyens pratiques, l’égalité, la justice, n’en restent pas moins toujours ce qu’elles sont, la vérité n’en est pas moins la vérité, et l’intérêt du capital, illégitime en droit, absurde et monstrueux en principe, spoliateur en fait, commande l’anathème de tous les hommes de bien, la malédiction des races opprimées, et la juste indignation de quiconque porte une âme généreuse et pleine de sympathie pour tout ce qui souffre et pleure. C’est à ce titre, Monsieur, que je le dénonce à vos coups, persuadé qu’après l’avoir envisagé de nouveau, et dans sa hideuse iniquité, vous ne trouverez point de plus noble tâche que de consacrer votre talent si remarquable de verve, de lucidité, de pittoresque et d’incisif, à combattre ce fléau, source de toutes ces indescriptibles misères auxquelles le monde est en proie.
Permettez-moi dons de terminer cette trop longue épître par les paroles suivantes de votre écrit, qui sont comme la pierre d’attente et le préambule de cette grande œuvre de réhabilitation à laquelle l’égalité, la justice et l’amour du peuple vous convient :
Voilà deux hommes. L’un travaille soir et matin, d’un bout de l’année à l’autre, et s’il a consommé tout ce qu’il a gagné, fût-ce par force majeure, il reste pauvre. Quand vient la Saint Sylvestre, il ne se trouve pas plus avancé qu’au premier de l’an, et sa seule perspective est de recommencer. L’autre ne fait rien de ses bras ni de son intelligence, du moins, s’il s’en sert, c’est pour son plaisir ; il lui est loisible de n’en rien faire, car il a une rente. Il ne travaille pas ; et cependant il vit bien, tout lui arrive en abondance, mets délicats, meubles somptueux, élégants équipages, c’est-à-dire qu’il détruit chaque jour des choses que les travailleurs ont dû produire à la sueur de leur front ; car ces choses ne sont pas faites d’elles-mêmes, et, quant à lui, il n’y a pas mis les mains. C’est nous, travailleurs, qui avons fait germer ce blé, verni ces meubles, tissé ces tapis : ce sont nos femmes et nos filles qui ont filé, découpé, cousu, brodé ces étoffes. Nous travaillons donc pour lui et pour nous ; pour lui d’abord, et pour nous s’il en reste.
Mais voici quelque chose de plus fort : si le premier de ces deux hommes, le travailleur, consomme dans l’année ce qu’on lui a laissé de profit dans l’année, il en est toujours au point de départ, et sa destinée le condamne à tourner sans cesse dans un cercle éternel et monotone de fatigues. Le travail n’est donc rémunéré qu’une fois. Mais si le second, le rentier, consomme dans l’année sa rente de l’année, il a, l’année d’après, et les années suivantes, et pendant l’éternité entière, une rente toujours égale, intarissable, perpétuelle. Le capital est donc rémunéré non pas une fois ou deux fois, mais un nombre indéfini de fois ! En sorte qu’au bout de cent ans, la famille qui a placé 20,000 fr. à 5 pour 100 aura touché 100,000 fr., ce qui ne l’empêchera pas d’en toucher encore 100,000 dans le siècle suivant. En d’autres termes, pour 20,000 fr. qui représentent son travail, elle aura prélevé, en deux siècles, une valeur décuple sur le travail d’autrui.
N’y a-t-il pas dans cet ordre social un vice monstrueux à réformer ?
Ce n’est pas tout encore. S’il plaît à cette famille de restreindre quelque peu ses jouissances, de ne dépenser, par exemple, que 900 fr. au lieu de 1,000, — sans aucun travail, sans autre peine que celle de placer 100 francs par an, elle peut accroître son capital et sa rente dans un progression si rapide, qu’elle sera bientôt en mesure de consommer autant que cent familles d’ouvriers laborieux.
Tout cela ne dénote-t-il pas que la société actuelle porte dans son sein un cancer hideux qu’il faut extirper, au risque de quelques souffrances passagères ?
C’est ce cancer hideux que vous nous aiderez, Monsieur, à extirper. Vous voulez pour l’échange la liberté, veuillez donc aussi l’égalité, afin que la fraternité, en les couronnant toutes deux, amène sur le monde le règne de la justice, de la paix et de la conciliation universelle.
16769. F. 16770.Chevé.
DEUXIÈME LETTRE. - F. Bastiat au rédacteur de la Voix du peuple ↩
L’usage d’une propriété est une valeur. — Toute valeur peut s’échanger contre une autre. — Fécondité du capital. — Sa coopération n’est pas rémunérée aux dépens du travail. — Cette rémunération n’est pas exclusivement attachée à la circonstance du prêt.
12 novembre 1849.
L’ardeur extrême avec laquelle le peuple, en France, s’est mis à creuser les problèmes économiques, et l’inconcevable indifférence des classes aisées à l’égard de ces problèmes, forment un des traits les plus caractéristiques de notre époque. Pendant que les anciens journaux, organes et miroirs de la bonne société, s’en tiennent à la guerroyante et stérile politique de parti, les feuilles destinées aux classes ouvrières agitent incessamment ce qu’on peut appeler les questions de fond, les questions sociales. Malheureusement, je le crains bien, elles s’égarent dès leurs premiers pas dans cette voie. Mais en pouvait-il être autrement ? Elles ont du moins le mérite de chercher la vérité. Tôt ou tard la possession de la vérité sera leur récompense.
Puisque vous voulez bien, Monsieur, m’ouvrir les colonnes de la Voix du Peuple, je poserai devant vos lecteurs, et m’efforcerai de résoudre ces deux questions :
1° L’intérêt des capitaux est-il légitime ?
2° Est-il prélevé aux dépens du travail et des travailleurs ?
Nous différons sur la solution ; mais il est un point sur lequel nous sommes certainement d’accord : c’est que l’esprit humain ne peut s’attaquer (sauf les problèmes religieux) à des questions plus graves.
Si c’est moi qui me trompe, si l’intérêt est une taxe abusive, prélevée par le capital sur tous les objets de consommation, j’aurai à me reprocher d’avoir, à mon insu, étançonné par mes arguments le plus ancien, le plus effroyable et le plus universel abus que le génie de la spoliation ait jamais imaginé ; abus auquel ne se peuvent comparer, quant à la généralité des résultats, ni le pillage systématique des peuples guerriers, ni l’esclavage, ni le despotisme sacerdotal. Une déplorable erreur économique aurait tourné contre la démocratie cette flamme démocratique que je sens brûler dans mon cœur.
Mais si l’erreur est de votre côté, si l’intérêt est non-seulement naturel, juste et légitime, mais encore utile et profitable, même à ceux qui le paient, vous conviendrez que votre propagande ne peut que faire, malgré vos bonnes intentions, un mal immense. Elle induit les travailleurs à se croire victimes d’une injustice qui n’existe pas ; à prendre pour un mal ce qui est un bien. Elle sème l’irritation dans une classe et la frayeur dans l’autre. Elle détourne ceux qui souffrent de découvrir la vraie cause de leurs souffrances en les mettant sur une fausse piste. Elle leur montre une prétendue spoliation qui les empêche de voir et de combattre les spoliations réelles. Elle familiarise les esprits avec cette pensée funeste que l’ordre, la justice et l’union ne peuvent renaître que par une transformation universelle (aussi détestable qu’impossible dans l’hypothèse) de tout le système selon lequel s’accomplissent, depuis le commencement du monde, le Travail et les Échanges.
Il n’est donc pas de question plus grave. Je la reprendrai au point où la discussion l’a amenée.
Oui, Monsieur, vous avez raison. Comme vous dites, nous ne sommes séparés que par l’épaisseur d’une Équivoque portant sur les mots Usage et Propriété. Mais cette équivoque suffit pour que vous croyiez devoir marcher, plein de confiance, vers l’Occident, tandis que ma foi me pousse vers l’Orient. Entre nous, au point de départ, la distance est imperceptible, mais elle ne tarde pas à devenir un abîme incommensurable.
La première chose à faire, c’est de revenir sur nos pas, jusqu’à ce que nous ayons retrouvé le point de départ sur lequel nous sommes d’accord. Ce terrain qui nous est commun, c’est la mutualité des services.
J’avais dit : Celui qui prête une maison, un sac de blé, un rabot, une pièce de monnaie, un navire, en un mot une valeur, pour un temps déterminé, rend un service. Il doit donc recevoir, outre la restitution de cette valeur à l’échéance, un service équivalent. — Vous convenez qu’il doit, en effet, recevoir quelque chose. C’est un grand pas vers la solution, car c’est ce quelque chose que j’appelle intérêt.
Voyons, Monsieur, nous accordons-nous sur ce point de départ ? Vous me prêtez, pour toute l’année 1849, 1,000 fr. en écus, ou un instrument de travail estimé 1,000 fr., — ou un approvisionnement valant 1,000 fr., — ou une maison valant 1,000 fr. C’est en 1849 que je recueillerai tous les avantages que peut procurer cette valeur créée par votre travail et non par le mien. C’est en 1849 que vous vous priverez volontairement, en ma faveur, de ces avantages que vous pourriez très-légitimement vous réserver. Suffira-t-il, pour que nous soyons quittes, pour que les services aient été équivalents et réciproques, pour que la justice soit satisfaite, suffira-t-il qu’au premier de l’an 1850, je vous restitue intégralement, mais uniquement, vos écus, votre machine, votre blé, votre maison ? Prenez garde, s’il en doit être ainsi, je vous avertis que le rôle que je me réserverai toujours, dans ces sortes de transactions, sera celui d’emprunteur : ce rôle est commode, il est tout profit ; il me met à même d’être logé et pourvu toute ma vie aux dépens d’autrui ; — à la condition toutefois de trouver un préteur, ce qui, dans ce système, ne sera pas facile ; car qui bâtira des maisons pour les louer gratis et se contenter, de terme en terme, de la pure restitution ?
Aussi n’est-ce pas là ce que vous prétendez. Vous reconnaissez (et c’est ce que je tiens à bien constater) que celui qui a prêté une maison ou une valeur quelconque, a rendu un service dont il n’est pas rémunéré par la simple remise des clefs au terme, ou le simple remboursement à l’échéance. Il y a donc, d’après vous comme d’après moi, quelque chose à stipuler en sus de la restitution. Nous pouvons ne pas nous accorder sur la nature et le nom de ce quelque chose ; mais quelque chose est dû par l’emprunteur. Et puisque vous admettez, d’une part, la mutualité des services, puisque, d’autre part, vous avouez que le préteur a rendu service, permettez-moi d’appeler provisoirement cette chose due par l’emprunteur un service.
Eh bien ! Monsieur, il me semble que la question a fait un pas, et même un grand pas, car voici où nous en sommes :
Selon votre théorie, tout aussi bien que selon la mienne, entre le prêteur et l’emprunteur, cette convention est parfaitement légitime qui stipule :
1° La restitution intégrale, à l’échéance, de l’objet prêté ;
2° Un service à rendre par l’emprunteur au prêteur, en compensation du service qu’il en a reçu.
Maintenant, quels seront la nature et le nom de ce service dû par l’emprunteur ? Je n’attache pas à ces questions l’importance scientifique que vous y mettez. Elles peuvent être abandonnées aux contractants eux-mêmes, dans chaque cas particulier. C’est véritablement leur affaire de débattre la nature et l’équivalence des services à échanger, aussi bien que leur appellation spéciale. La science a fini quand elle en a montré la cause, l’origine et la légitimité. L’emprunteur s’acquittera en blé, en vin, en souliers, en main-d’œuvre, selon son état. Dans la plupart des circonstances, et seulement pour plus de commodité, il paiera en argent ; et comme on ne se procure l’argent qu’avec du travail, on pourra dire qu’il paie avec du travail. Ce paiement, juste et légitime d’après vous-même, pourquoi me défendriez-vous de le baptiser loyer, fermage, escompte, rente, prêt, intérêt, selon l’occurrence ?
Mais venons-en à l’équivoque qui nous sépare, à la prétendue confusion que je fais, dites-vous, entre l’usage et la propriété, entre le prêt de la chose et une cession absolue.
Vous dites : Celui qui emprunte une propriété, une valeur, étant tenu de la rendre intégralement à l’échéance, n’a reçu, au fond, qu’un usage. Ce qu’il doit, ce n’est pas une propriété, une valeur, mais l’usage d’une propriété, d’une valeur équivalente. Identifier ces deux ordres de nature diverse sans équivalence possible, c’est détruire la mutualité des services.
Pour aller à la racine de l’objection, il faudrait remuer tous les fondements de l’économie sociale. Vous n’attendez pas de moi un tel travail, mais je vous demanderai si, selon vous, l’usage d’une valeur n’a pas lui-même une valeur ? s’il n’est pas susceptible d’être évalué ? D’après quelle règle, sur quel principe, empêcherez-vous deux contractants de comparer un usage à une somme d’argent, à une quantité de main-d’œuvre, et d’échanger sur ces bases, si cela les arrange ?
Vous me prêtez une maison de 20,000 francs ; par là vous me rendez un service. Entendez-vous dire que, malgré mon consentement et le vôtre, je ne puis m’acquitter, au nom de la science, qu’en vous prêtant aussi une maison de même valeur ? Mais cela est absurde, car si nous avions tous des maisons, nous resterions chacun dans la nôtre, et quelle serait la raison d’être du prêt ? Si vous allez jusqu’à prétendre que mutualité des services implique que les deux services échangés doivent être non-seulement égaux en valeur, mais identiques en nature, vous supprimez l’échange aussi bien que le prêt. Un chapelier devra dire à son client : Ce que je vous cède, ce n’est pas de l’argent, mais un chapeau ; ce que vous me devez, c’est un chapeau, et non de l’argent.
Que si vous reconnaissez que les services s’évaluent et s’échangent, précisément parce qu’ils diffèrent de nature, vous devez convenir que la cession d’un usage qui est un service, peut très-légitimement s’évaluer en blé, en argent, en main-d’œuvre. Prenez-y garde, votre théorie, tout en laissant parfaitement subsister le principe de l’intérêt, ne tend à rien moins qu’à frapper d’inertie toutes les transactions.
Vous ne réformez pas, vous paralysez.
Je suis cordonnier. Mon métier doit me faire vivre ; mais pour l’exercer, il faut que je sois logé, et je n’ai pas de maison. D’un autre côté, vous avez consacré votre travail à en bâtir une ; mais vous ne savez pas faire vos souliers ni ne voulez aller pieds nus. Nous pouvons nous arranger : vous me logerez, je vous chausserai. Je profiterai de votre travail comme vous du mien ; nous nous rendrons réciproquement service. Le tout est d’arriver à une juste évaluation, à une parfaite équivalence, et je n’y vois d’autre moyen que le libre débat.
Et, sous prétexte qu’il y a cession d’un objet matériel, d’un côté, et que, de l’autre, il n’y a cession que d’un usage, la théorie viendrait nous dire : Cette transaction ne se fera pas, elle est illégitime, abusive et spoliatrice ; il s’agit de deux services qui n’ont pas d’équivalence possible, et que vous n’avez ni la faculté d’évaluer, ni le droit d’échanger !
Ne voyez-vous pas, Monsieur, qu’une telle théorie tue à la fois et l’échange et la liberté ? Quelle est donc l’autorité qui viendra anéantir ainsi notre commun et libre consentement ? Sera-ce la loi ? sera-ce l’État ? Mais je croyais, moi, que nous faisions la loi, que nous payions l’État pour protéger nos droits et non pour les supprimer.
Ainsi, nous étions d’accord tout à l’heure sur ce point, que l’emprunteur doit quelque chose en sus de la simple restitution. Accordons-nous maintenant sur cet autre point, que ce quelque chose est susceptible d’être évalué, et par conséquent d’être acquitté, selon la convenance des contractants, sous une des formes quelconques que peut affecter la valeur.
La conséquence qui s’ensuit, c’est que, à l’échéance, le prêteur doit recouvrer :
1° La valeur intégrale prêtée ;
2° La valeur du service rendu par le prêt.
Je n’ai pas besoin de répéter ici comment la restitution intégrale de l’objet prêté implique nécessairement la pérennité de l’intérêt.
Examinons maintenant, en peu de mots, cette seconde question :
L’intérêt du capital est-il prélevé aux dépens du travail ?
Vous le savez aussi bien que moi, Monsieur, on se ferait une idée bien circonscrite de l’intérêt, si l’on supposait qu’il n’apparaît qu’à l’occasion du prêt. — Quiconque fait concourir un capital à la création d’un produit entend être rémunéré non-seulement pour son travail, mais pour son capital ; de telle sorte que l’intérêt entre comme élément dans le prix de tous les objets de consommation.
Il ne suffit peut-être pas de démontrer la légitimité de l’intérêt aux hommes qui n’ont pas de capitaux. Ils seraient sans doute tentés de dire : puisque l’intérêt est légitime, il faut bien que nous le subissions ; mais c’est un grand malheur, car sans cela nous obtiendrions toutes choses à meilleur marché.
Ce grief est complétement erroné ; ce qui fait que les jouissances humaines se rapprochent de plus en plus de la gratuité et de la communauté, c’est l’intervention du capital. Le capital c’est la puissance démocratique, philanthropique et égalitaire par excellence. Aussi, celui qui en fera comprendre l’action rendra le plus signalé service à la société, car il fera cesser cet antagonisme de classes qui n’est fondé que sur une erreur.
Il m’est de toute impossibilité de faire entrer dans un article de journal la théorie des capitaux. [214] Je dois me borner à indiquer ma pensée par un exemple, une anecdote, une hypothèse qui est l’image de toutes les transactions humaines.
Plaçons-nous au point de départ de l’humanité, à cette époque où nous pouvons supposer qu’il n’existait aucun capital. Quelle était alors la valeur, mesurée au travail, d’un objet quelconque, d’une paire de bas, d’un sac de blé, d’un meuble, d’un livre, etc. ; en d’autres termes, au prix de quel travail ces objets auraient-ils été achetés ? Je ne crains pas de dire que la réponse est contenue dans ce mot : l’Infini. De tels objets étaient alors tout à fait inaccessibles à l’humanité.
Qu’il s’agisse d’une paire de bas de coton. Aucun homme ne serait parvenu à la produire avec cent ni avec mille journées de travail.
D’où vient qu’aujourd’hui, en France, il n’y a pas un ouvrier si malheureux qui ne puisse obtenir une paire de bas de coton avec son travail d’une journée ? — C’est justement parce que du capital concourt à la création de ce produit. Le gente humain a inventé des instruments qui forcent la nature à une collaboration gratuite.
Il est bien vrai qu’en décomposant le prix de cette paire de bas, vous trouvez qu’une partie assez considérable de ce prix se rapporte au capital. Il faut bien payer le squatter qui a défriché la terre de la Caroline ; il faut bien payer la voile qui pousse le navire de New-York au Havre ; il faut bien payer la machine qui fait tourner dix mille broches. Mais c’est justement parce que nous payons ces instruments, qu’ils font concourir la nature et qu’ils substituent son action gratuite à l’action onéreuse du travail. Si nous supprimions successivement cette série d’intérêts à payer, nous supprimerions par cela même les instruments et la collaboration naturelle qu’ils mettent en œuvre ; en un mot, nous reviendrions au point de départ, à l’époque où mille journées de travail n’auraient pas suffi pour se procurer une paire de bas. Il en est ainsi de toutes choses.
Vous pensez que l’intérêt est prélevé par celui qui ne fait rien sur celui qui travaille. Ah ! Monsieur, avant de laisser tomber une seconde fois dans le public cette triste et irritante assertion, scrutez-la jusque dans la racine. Demandez-lui ce qu’elle contient, et vous vous assurerez qu’elle ne porte en elle que des erreurs et des tempêtes. Vous invoquez mon apologue du rabot, permettez-moi d’y revenir.
Voilà un homme qui veut faire des planches. Il n’en fera pas une dans l’année, car il n’a que ses dix doigts. Je lui prête une scie et un rabot, — deux instruments, ne le perdez pas de vue, qui sont le fruit de mon travail et dont je pourrais tirer parti pour moi-même. Au lieu d’une planche, il en fait cent et m’en donne cinq. Je l’ai donc mis à même, en me privant de ma chose, d’avoir quatre-vingt-quinze planches au lieu d’une, — et vous venez dire que je l’opprime et le vole ! Quoi ! grâce à une scie et à un rabot que j’ai fabriqués à la sueur de mon front, une production centuple est, pour ainsi dire, sortie du néant, la société entre en possession d’une jouissance centuple, un ouvrier qui ne pouvait pas faire une planche en a fait cent ; et parce qu’il me cède librement et volontairement, un vingtième de cet excédant, vous me représentez comme un tyran et un voleur ! L’ouvrier verra fructifier son travail, l’humanité verra s’élargir le cercle de ses jouissances ; et je suis le seul au monde, moi, l’auteur de ces résultats, à qui il sera défendu d’y participer, même du consentement universel !
Non, non ; il ne peut en être ainsi. Votre théorie est aussi contraire à la justice, à l’utilité générale, à l’intérêt même des ouvriers, qu’à la pratique de tous les temps et de tous les lieux. Permettez-moi d’ajouter qu’elle n’est pas moins contraire au rapprochement des classes, à l’union des cœurs, à la réalisation de la fraternité humaine, qui est plus que la justice, mais ne peut se passer de la justice.
Frédéric Bastiat.
TROISIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat ↩
Désaveu de la distinction introduite par M. Chevé. — Adhésion à la Subscription : le prêt est un service ; un service est une valeur. — Antinomie. — Le prêteur ne se prive pas. — Nécessité d’organiser le crédit gratuit. — Interrogations catégoriques.
19 novembre 1849.
La révolution de Février a pour but, dans l’ordre politique et dans l’ordre économique, de fonder la liberté absolue de l’homme et du citoyen.
La formule de cette Révolution est, dans l’ordre politique, l’organisation du suffrage universel, soit l’absorption du pouvoir dans la société ; — dans l’ordre économique, l’organisation de la circulation et du crédit, soit encore l’absorption de la qualité de capitaliste dans celle de travailleur.
Sans doute, cette formule ne donne pas, à elle seule, l’intelligence complète du système : elle n’en est que le point de départ, l’aphorisme. Mais elle suffit pour expliquer la Révolution dans son actualité et son immédiateté ; elle nous autorise, par conséquent, à dire que la Révolution n’est et ne peut être autre chose que cela.
Tout ce qui tend à développer la Révolution ainsi conçue, tout ce qui en favorise l’essor, de quelque part qu’il vienne, est essentiellement révolutionnaire : nous le classons dans la catégorie du mouvement.
Tout ce qui s’oppose à l’application de cette idée, tout ce qui la nie ou qui l’entrave, qu’il soit le produit de la démagogie ou de l’absolutisme, nous l’appelons résistance. — Si cette résistance a pour auteur le gouvernement, ou qu’elle agisse de connivence avec le gouvernement, elle devient réaction.
La résistance est légitime quand elle est de bonne foi et qu’elle s’accomplit dans les limites de la liberté républicaine : elle n’est alors que la consécration du libre examen, la sanction du suffrage universel. La réaction, au contraire, tendant, au nom de l’autorité publique et dans l’intérêt d’un parti, à supprimer violemment la manifestation des idées, est une atteinte à la liberté ; se traduit-elle en loi d’exil, de déportation, de transportation, etc., elle est alors un crime contre la souveraineté du peuple. L’ostracisme est le suicide des républiques.
En rendant compte, dans la Voix du Peuple, du projet d’impôt sur le capital présenté par M. de Girardin, nous n’avons point hésité à y reconnaître l’une des manifestations les plus hardies de l’idée révolutionnaire ; et bien que l’auteur de ce projet ait été, et soit peut-être encore attaché à la dynastie d’Orléans ; bien que ses tendances personnelles fassent de lui un homme éminemment gouvernemental ; bien qu’enfin il se soit constamment rangé dans le parti de la Conservation contre celui de la Révolution, nous n’en pensons pas moins que son idée appartient au mouvement ; à ce titre, nous l’avons revendiquée comme nôtre ; et si M. de Girardin était capable de renier sa propre pensée, nous la reprendrions en sous-œuvre, et nous nous en ferions un argument de plus contre les adversaires de la Révolution.
C’est d’après cette règle de critique élevée, et pour ainsi dire, impersonnelle, que nous allons répondre à M. Bastiat.
M. Bastiat, au rebours de M. de Girardin, est un écrivain tout pénétré de l’esprit démocratique : si l’on ne peut encore dire de lui qu’il est socialiste, à coup sûr c’est déjà plus qu’un philanthrope. La manière dont il entend et expose l’économie politique le place, ainsi que M. Blanqui, sinon fort au-dessus, du moins fort en avant des autres économistes, fidèles et immuables disciples de J. B. Say. M. Bastiat, en un mot, est dévoué corps et âme à la République, à la liberté, à l’égalité, au progrès : il l’a prouvé mainte fois avec éclat par ses votes à l’Assemblée nationale.
Malgré cela, nous rangeons M. Bastiat parmi les hommes de la résistance : sa théorie du capital et de l’intérêt, diamétralement opposée aux tendances les plus authentiques, aux besoins les plus irrésistibles de la Révolution, nous en fait une loi. Puissent nos lecteurs, à notre exemple, séparer toujours ainsi les questions de personnes d’avec les questions de principes : la discussion et la charité y gagneront.
M. Bastiat commence sa réponse par une observation d’une justesse frappante, que nous croyons d’autant plus utile de rappeler, qu’elle tombe d’aplomb sur lui :
« L’ardeur extrême, dit M. Bastiat, avec laquelle le peuple, en France, s’est mis à creuser les problèmes économiques, et l’inconcevable indifférence des classes aisées à l’égard de ces problèmes, forment un des traits les plus caractéristiques de notre époque. Pendant que les anciens journaux, organes et miroirs de la bonne société, s’en tiennent à la guerroyante et stérile politique de parti, les feuilles destinées aux classes ouvrières agitent incessamment ce qu’on peut appeler les questions de fond, les questions sociales. »
Et bien ! nous dirons à M. Bastiat :
Vous êtes vous-même, sans vous en douter, un exemple de cette indifférence inconcevable avec laquelle les hommes de la classe aisée étudient les problèmes sociaux ; et tout économiste de premier ordre que vous puissiez vous dire, vous ignorez complétement où en est cette question du capital et de l’intérêt, que vous vous êtes chargé de défendre. Aussi en arrière des idées que des faits, vous nous parlez exactement comme ferait un rentier d’avant 89. Le socialisme, qui, depuis dix ans, proteste contre le capital et l’intérêt, est totalement inconnu de vous ; vous n’en avez pas lu les mémoires ; car si vous les avez lus, comment se fait-il que, vous préparant à le réfuter, vous passiez sous silence toutes ses preuves ?
Vraiment, à vous voir raisonner contre le socialisme de notre âge, on vous prendrait pour un Épiménide se réveillant en sursaut, après quatre-vingts ans de sommeil. Est-ce bien à nous que vous adressez vos dissertations patriarcales ? Est-ce le prolétaire de 1849 que vous voulez convaincre ? Commencez donc par étudier ses idées ; placez-vous, avec lui, dans l’actualité des doctrines : répondez aux raisons, vraies ou fausses, qui le déterminent, et ne lui apportez pas les vôtres, qu’il sait depuis un temps immémorial. Cela vous surprendra sans doute d’entendre dire que vous, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, [215] lorsque vous parlez de capital et d’intérêt, vous n’êtes plus à la question ! C’est pourtant ce que nous nous chargeons, pour aujourd’hui, de vous prouver. Après, nous reprendrons la question elle-même, si vous en avez le désir.
Nous nions d’abord, ceci vous le savez de reste, nous nions avec le christianisme et l’Evangile, la légitimité en soi du prêt à l’intérêt ; nous la nions avec le judaïsme et le paganisme ; avec tous les philosophes et législateurs de l’antiquité. Car vous remarquerez ce premier fait, qui a bien aussi sa valeur ; l’usure n’a pas plutôt paru dans le monde, qu’elle a été niée. Les législateurs et les moralistes n’ont cessé de la combattre, et s’ils ne sont parvenus à l’étreindre, du moins ont-ils réussi jusqu’à certain point à lui rogner les ongles, en fixant une limite, un taux légal à l’intérêt.
Telle est donc notre première proposition, la seule dont, à ce qu’il semble, vous ayez entendu parler : Tout ce qui, dans le remboursement de prêt, est donné en sus du prêt, est usure, spoliation : Quodcumque sorti accedit, usura est.
Mais ce que vous ne savez point, et qui vous émerveillera peut-être, c’est que cette négation fondamentale de l’intérêt ne détruit point, à nos yeux, le principe, le droit, si vous voulez, qui donne naissance à l’intérêt, et qui, malgré les condamnations de l’autorité séculière et ecclésiastique, l’a fait perdurer jusqu’à nos jours ; en sorte que le véritable problème pour nous n’est pas de savoir si l’usure, en soi, est illicite, nous sommes à cet égard de l’avis de l’Église, — ou si elle a une raison d’existence, nous sommes, sous ce rapport, de l’opinion des économistes. Le problème est de savoir comment on parviendra à supprimer l’abus sans endommager le droit : comment, en un mot, on sortira de cette contradiction.
Expliquons mieux cela, s’il est possible.
D’un côté, il est très-vrai, ainsi que vous l’établissez vous-même péremptoirement, que le prêt est un service. Et comme tout servie est une valeur, conséquemment comme il est de la nature de tout service d’être rémunéré, il s’ensuit que le prêt doit avoir son prix, ou, pour employer le mot technique, qu’il doit porter intérêt.
Mais il est vrai aussi, et cette vérité subsisté à côté de la précédente, que celui qui prête, dans les conditions ordinaires du métier de prêteur, ne se prive pas, comme vous le dites, du capital qu’il prête. Il le prête, au contraire, précisément parce que ce prêt ne constitue pas pour lui une privation ; il le prête, parce qu’il n’en a que faire pour lui-même, étant suffisamment d’ailleurs pourvu de capitaux ; il le prête, enfin, parce qu’il n’est ni dans son intention, ni dans sa puissance de le faire personnellement valoir ; parce qu’en le gardant entre ses mains, ce capital, stérile de sa nature, resterait stérile, tandis que par le prêt et par l’intérêt qui en résulte, il produit un bénéfice qui permet au capitaliste de vivre sans travailler. Or, vivre sans travailler, c’est en économie politique aussi bien qu’en morale, une proposition contradictoire, une chose impossible.
Le propriétaire qui possède deux domaines, l’un à Tours, l’autre à Orléans, et qui est forcé de fixer sa résidence dans l’un qu’il exploite, par conséquent d’abandonner l’autre ; ce propriétaire-là peut-il dire qu’il se prive de sa chose, parce qu’il n’a pas, comme Dieu, l’ubiquité d’action et de domicile ? Autant vaudrait dire que nous sommes privés du séjour de New-York parce que nous habitons à Paris. Convenez donc que la privation du capitaliste est comme la privation du maître qui a perdu son esclave, comme la privation du prince chassé par ses sujets, comme la privation du voleur qui, voulant escalader une maison, trouve les chiens aux aguets et les habitants aux fenêtres.
Or, en présence de cette affirmation et de cette négation diamétralement opposées, appuyées l’une et l’autre de raisons égales, mais qui, ne se répondant pas, ne peuvent s’entre-détruire, quel parti prendre ? Vous persistez dans votre affirmation, et vous dites : vous ne voulez pas me payer d’intérêt ? Soit ! je ne veux pas vous prêter mon capital. Tâchez de travailler sans capitaux ! De notre côté, nous persistons dans notre négation, et nous disons : Nous ne vous paierons pas d’intérêt, parce que l’intérêt, dans l’économie sociale, est le prix de l’oisiveté, la cause première de l’inégalité des fortunes et de la misère. Aucun de nous ne voulant céder, nous arrivons à l’immobilisme.
Tel est donc le point auquel le socialisme saisit la question. D’un côté, la justice commutative de l’intérêt ; de l’autre, l’impossibilité organique, l’immoralité de ce même intérêt. Et, pour vous le dire tout d’abord, le socialisme n’a la prétention de convertir personne, ni l’Église, qui nie l’intérêt, ni l’économie politique, qui l’affirme ; d’autant moins qu’il est convaincu qu’elles ont raison toutes deux. Voici seulement comment il analyse le problème, et ce qu’il propose à son tour, par-dessus les arguments des vieux prêteurs, trop intéressés pour qu’on les croie sur parole, et les déclarations des Pères de l’Église, restées sans effet.
Puisque la théorie de l’usure a fini par prévaloir dans les habitudes chrétiennes, comme dans l’usage des païens ; puisque l’hypothèse ou la fiction de la productivité du capital est entrée dans la pratique des peuples, acceptons cette fiction économique comme nous avons accepté pendant trente-trois ans la fiction constitutionnelle ; et voyons ce que cette fiction peut produire, développée dans toutes ses conséquences. Au lieu de repousser purement et simplement l’idée, comme a fait l’Église, ce qui ne pouvait mener à rien, faisons-en la déduction historique et philosophique ; et puisque le mot est plus que jamais à la mode, décrivons-en la révolution. Aussi bien, faut-il que cette idée réponde à quelque chose de réel, qu’elle indique un besoin quelconque de l’esprit mercantile, pour que les peuples n’aient jamais hésité à lui faire le sacrifice de leurs croyances les plus vives et les plus sacrées.
Voici donc comment le socialisme, parfaitement convaincu de l’insuffisance de la théorie économique, aussi bien que de la doctrine ecclésiastique, traite à son tour la question de l’usure.
D’abord il observe que le principe de la productivité du capital ne fait aucune acception de personnes, ne constitue pas un privilége : ce principe est vrai de tout capitaliste, sans distinction de titre ou de dignité. Ce qui est légitime pour Pierre est légitime pour Paul : tous deux ont le même droit à l’usure, ainsi qu’au travail. Lors donc, — je reprends ici l’exemple dont vous vous êtes servi, — que vous me prêtez, moyennant intérêt, le rabot que vous avez fabriqué pour polir vos planches, si, de mon côté, je vous prête la scie que j’ai montée pour débiter mes souches, j’aurai droit pareillement à un intérêt. Le droit du capital est le même pour tous : tous, dans la mesure de leurs prestations et de leurs emprunts, doivent percevoir et acquitter l’intérêt. Telle est la première conséquence de votre théorie, qui ne serait pas une théorie sans la généralité, sans la réciprocité du droit qu’elle crée : cela est d’une évidence intuitive et immédiate.
Supposons donc que de tout le capital que j’emploie, soit sous la forme d’instrument de travail, soit sous celle de matière première, la moitié me soit prêtée par vous ; supposons en même temps que de tout le capital que vous mettez en œuvre, la moitié vous soit prêtée par moi, il est clair que les intérêts que nous devrons nous payer mutuellement se compenseront ; et si, de part et d’autre, les capitaux avancés sont égaux, les intérêts se balançant, le solde ou la redevance sera nul.
Dans la société, les choses ne se passent pas tout à fait ainsi, sans doute. Les prestations que se font réciproquement les producteurs sont loin d’être égales ; partant, les intérêts qu’ils ont à se payer ne le sont pas non plus : de là, l’inégalité des conditions et des fortunes.
Mais la question est de savoir si cet équilibre de la prestation en capital, travail et talent ; si, par conséquent, l’égalité du revenu pour tous les citoyens, parfaitement admissible en théorie, peut se réaliser dans la pratique ; si cette réalisation est dans les tendances de la société ; si, enfin, et contre toute attente, elle n’est pas la conclusion fatale de la théorie de l’usure elle-même ?
Or, c’est ce qu’affirme le socialisme quand il est parvenu à se comprendre lui-même, socialisme qui ne se distingue plus alors de la science économique, étudiée à la fois dans son expérience acquise et dans la puissance de ses séductions. En effet, que nous dit, sur cette grande question de l’intérêt, l’histoire de la civilisation, l’histoire de l’économie politique ?
C’est que la prestation mutuelle de capitaux, matériels et immatériels, tend à s’équilibrer de plus en plus, et cela par diverses causes que nous allons énumérer, et que les économistes les plus rétrogrades ne peuvent méconnaître :
1° La division du travail, ou séparation des industries, qui, multipliant à l’infini les instruments de travail et les matières premières, multiplie dans la même proportion le prêt des capitaux ;
2° L’accumulation des capitaux, accumulation qui résulte de la variété des industries, et dont l’effet est de produire entre les capitalistes une concurrence analogue à celle des marchands, par conséquent d’opérer insensiblement la baisse du loyer des capitaux et la réduction du taux de l’intérêt ;
3° La faculté toujours plus grande de circulation qu’acquièrent les capitaux, par le numéraire et la lettre de change ;
4° Enfin, la sécurité publique.
Telles sont les causes générales qui, depuis des siècles, ont amené entre les producteurs une réciprocité de prestations de plus en plus équilibrée, par suite, une compensation de plus en plus égale des intérêts, une baisse continue du prix des capitaux.
Ces faits ne peuvent être niés : vous les avouez vous-même ; seulement, vous en méconnaissez le principe et la signification, quand vous attribuez au capital le mérite du progrès opéré dans le domaine de l’industrie et de la richesse ; tandis que ce progrès a pour cause, non le capital, mais la circulation du capital.
Les faits étant de la sorte analysés et classés, le socialisme se demande si, pour provoquer cet équilibre du crédit et du revenu, il ne serait pas possible d’agir directement, non sur les capitaux, remarquez-le bien, mais sur la circulation ; s’il ne serait pas possible d’organiser cette circulation, de manière à produire tout d’un coup entre les capitalistes et les producteurs, deux termes actuellement en opposition, mais que la théorie démontre devoir être synonymes, l’équivalence des prestations, en d’autres termes, l’égalité des fortunes.
À cette question, le socialisme répond encore : Oui, cela est possible, et de plusieurs manières.
Supposons d’abord, pour nous renfermer dans les conditions du crédit actuel, lequel s’effectue surtout par l’entremise du numéraire ; supposons que tous les producteurs de la République, au nombre de plus de dix millions, se cotisent chacun pour une somme représentant 1 pour 100 seulement de leur capital. Cette cotisation de 1 pour 100 sur la totalité du capital mobilier et immobilier du pays, formerait une somme de un milliard.
Supposons qu’à l’aide de cette cotisation une banque soit fondée, en concurrence de la Banque mal nommée de France, et faisant l’escompte et le crédit sur hypothèque, à 1/2 pour 100.
Il est évident, en premier lieu, que l’escompte des valeurs de commerce se faisant à 1/2 pour 100, le prêt sur hypothèque à 1/2 pour 100, la commandite, etc., à 1/2 pour 100, le capital monnaie serait immédiatement frappé, entre les mains de tous les usuriers et prêteurs d’argent, d’improductivité absolue ; l’intérêt serait nul, le crédit gratuit.
Si le crédit commercial et hypothécaire, en autres termes, si le capital argent, le capital dont la fonction est exclusivement de circuler était gratuit, le capital maison le deviendrait lui-même bientôt ; les maisons ne seraient plus en réalité capital, elles seraient marchandise, cotée à la Bourse comme les eaux-de-vie et les fromages, et louée ou vendues, deux termes devenus alors synonymes, à prix de revient.
Si le capital maison, de même que le capital argent, était gratuit, ce qui revient à dire, si l’usage en était payé à titre d’échange, non de prêt, le capital terre ne tarderait pas à devenir gratuit à son tour ; c’est-à-dire que le fermage, au lieu d’être la redevance payée au propriétaire non exploitant, serait la compensation du produit entre les terres de qualité supérieure et les terres de qualité inférieure ; ou, pour mieux dire, il n’y aurait plus, en réalité, ni fermiers, ni propriétaires, il y aurait seulement des laboureurs et des vignerons, comme il y a des menuisiers et des mécaniciens.
Voulez-vous une autre preuve de la possibilité de ramener, par le développement des institutions économiques, tous les capitaux à la gratuité ?
Supposons qu’au lieu de ce système d’impôts, si compliqué, si onéreux, si vexatoire, que nous a légué la féodalité nobiliaire, un seul impôt soit établi, non plus sur la production, la circulation, la consommation, l’habitation, etc. ; mais, comme la justice l’exige et comme le veut la science économique, sur le capital net afférent à chaque individu. Le capitaliste perdant par l’impôt autant ou plus qu’il ne gagne par la rente et l’intérêt, serait obligé ou de faire valoir par lui-même, ou de vendre : l’équilibre économique, par cette intervention si simple, et, d’ailleurs inévitable du fisc, se rétablirait encore.
Telle est, en somme, la théorie du socialisme sur le capital et l’intérêt.
Non-seulement nous affirmons, d’après cette théorie qui, d’ailleurs, nous est commune avec les économistes, et sur la foi du développement industriel, que telles sont la tendance et la portée du prêt à intérêt ; nous prouvons encore, par les résultats subversifs de l’économie actuelle, et par la démonstration des causes de la misère, que cette tendance est nécessaire, et l’extinction de l’usure inévitable.
En effet, le prix du prêt, loyer de capitaux, intérêt d’argent, usure, en un mot, faisant, comme il a été dit, partie intégrante du prix des produits, et cette usure n’étant pas égale pour tous, il s’ensuit que le prix des produits, composé qu’il est de salaire et d’intérêts, ne peut pas être acquitté par ceux qui n’ont pour le payer que leur salaire et point d’intérêt ; en sorte que, par le fait de l’usure, le travail est condamné au chômage et le capital à la banqueroute.
Cette démonstration, dans le genre de celles que les mathématiciens appellent réduction à l’absurde, de l’impossibilité organique du prêt à intérêt, a été reproduite cent fois dans le socialisme : pourquoi les économistes n’en parlent-ils pas ?
Voulez-vous donc sérieusement réfuter les idées socialistes sur le prêt à intérêt ? Voici les questions auxquelles vous avez à répondre :
1° Est-il vrai que si, au for extérieur, la prestation du capital est un service qui a sa valeur, qui par conséquent doit être payé ; — au for intérieur, cette prestation n’entraîne point pour le capitaliste une privation réelle ; conséquemment qu’elle ne suppose pas le droit de rien exiger pour prix du prêt ?
2° Est-il vrai que l’usure, pour être irréprochable, doit être égale : que la tendance de la société conduit à cette égalisation, en sorte que l’usure n’est irréprochable que lorsqu’elle est devenue égale pour tous, c’est-à-dire nulle ?
3° Est-il vrai qu’une banque nationale, faisant le crédit et l’escompte gratis, soit chose possible ?
4° Est-il vrai que par l’effet de cette gratuité du crédit et de l’escompte, comme par l’action de l’impôt simplifié et ramené à sa véritable forme, la rente immobilière disparaît, ainsi que l’intérêt de l’argent ?
5° Est-il vrai qu’il y ait contradiction et impossibilité mathématique dans l’ancien système ?
6° Est-il vrai que l’économie politique, après avoir, sur la question de l’usure, contredit pendant plusieurs milliers d’années la théologie, la philosophie, la législation, arrive, par sa propre théorie, au même résultat ?
7° Est-il vrai, enfin, que l’usure n’a été, dans son institution providentielle, qu’un instrument d’égalité et de progrès ; absolument comme dans l’ordre politique, la monarchie absolue a été un instrument de liberté et de progrès ; comme dans l’ordre judiciaire, l’épreuve de l’eau bouillante, le duel et la question ont été, à leur tour, des instruments de conviction et de progrès ?
Voilà ce que nos adversaires sont tenus d’examiner, avant de nous accuser d’infirmité scientifique et intellectuelle ; voilà, monsieur Bastiat, sur quels points devra porter à l’avenir votre controverse, si vous voulez qu’elle aboutisse. La question est clairement et catégoriquement posée : permettez-nous de croire qu’après en avoir pris lecture, vous reconnaîtrez qu’il y a dans le socialisme du dix-neuvième siècle quelque chose qui dépasse la porté de votre vielle économie politique.
P. J. Proudhon.
QUATRIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon ↩
Circonscription logique du débat. — Dire oui et non n’est pas répondre. — Futilité de l’objection fondée sur ce que le capitaliste ne se prive pas. — Productivité naturelle et nécessaire du capital démontrée par des exemples. — Considérations sur le loisir.
26 novembre 1849.
Monsieur, vous me posez sept questions. Veuillez vous rappeler qu’entre nous il ne s’agit en ce moment que d’une seule :
L’intérêt du capital est-il légitime ?
Cette question est grosse de tempêtes. Il faut la vider. En acceptant la loyale hospitalité de vos colonnes, je n’ai pas eu en vue d’analyser toutes les combinaisons possibles de crédit que le fertile génie des socialistes peut enfanter. Je me suis demandé si l’intérêt, qui entre dans le prix de toutes choses, est une spoliation ; si, par conséquent, le monde se partage entre des capitalistes voleurs et des travailleurs volés. Je ne le crois pas, mais d’autres le croient. Selon que la vérité est de mon côté ou du leur, l’avenir réservé à notre chère patrie est la concorde, ou une lutte sanglante et inévitable. La question vaut donc la peine d’être sérieusement étudiée.
Que ne sommes-nous d’accord sur ce point de départ ! Notre œuvre se bornerait à détruire, dans l’esprit des masses, des erreurs funestes et des préventions dangereuses. Nous montrerions au peuple le capital, non comme un parasite avide, mais comme une puissance amie et féconde. Nous le lui montrerions, — et ici je reproduis presque vos expressions, — s’accumulant par l’activité, l’ordre, l’épargne, la prévoyance, la séparation des travaux, la paix et la sécurité publique ; se distribuant, en vertu de la liberté, entre toutes les classes ; se mettant de plus en plus à la portée de tous, par la modicité croissante de sa rémunération ; rachetant l’humanité enfin du poids de la fatigue et du joug des besoins.
Mais comment nous élever à d’autres vues du problème social, lorsque, à cette première question : L’intérêt du capital est-il légitime ? vous répondez : Oui et Non.
Oui : car — « il est très-vrai que le prêt est un service, et comme tout service est une valeur, conséquemment, comme il est de sa nature d’être rémunéré, il s’ensuit que le prêt doit avoir son prix, qu’il doit porter intérêt. »
Non : car — « le prêt, par l’intérêt qui en résulte, produit un bénéfice qui permet au capitaliste de vivre sans travailler. Or, vivre sans travailler, c’est, en économie politique aussi bien qu’en morale, une proposition contradictoire, une chose impossible. »
Oui : car — « la négation fondamentale de l’intérêt ne détruit pas à nos yeux le principe, le droit qui donne naissance à l’intérêt. Le véritable problème, pour nous, n’est pas de savoir si l’usure a une raison d’existence ; nous sommes, sous ce rapport, de l’opinion des économistes. »
Non : car — « nous nions, avec le christianisme et l’Evangile, la légitimité en soi du prêt à intérêt. »
Oui : car — « l’usure n’a été, dans son institution providentielle, qu’un instrument d’utilité et de progrès. »
Non : car — « tout ce qui, en remboursement du prêt, est donné en sus du prêt est usure, spoliation. »
Oui et Non, enfin : car — « le socialisme n’a la prétention de convertir personne, ni l’Église, qui nie l’intérêt, ni l’économie politique, qui l’affirme, d’autant moins qu’il est convaincu qu’elles ont raison toutes deux. »
Il y en a qui disent : Ces solutions contradictoires sont un amusement que M. Proudhon donne à son esprit. D’autres : Il ne faut voir là que des coups de pistolet que M. Proudhon tire dans la rue, pour faire mettre le public aux fenêtres. Pour moi, qui sais que vous les appliquez à tous les sujets : liberté, propriété, concurrence, machines, religion, je les tiens pour une conception sincère et sérieuse de votre intelligence.
Mais, Monsieur, pensez-vous que le peuple puisse vous suivre longtemps dans le dédale de vos Antinomies ? Son génie ne s’est pas façonné sur les bancs vermoulus de la Sorbonne. Les fameux : Quidquid dixeris, argumentabor, — Ego verò contrà — ne vont pas à ses franches allures ; il veut voir le fond des choses, et il sent instinctivement qu’au fond des choses il y a un Oui ou un Non, mais qu’il ne peut y avoir un Oui et un Non fondus ensemble. Pour ne pas sortir du sujet qui nous occupe, il vous dira : Il faut pourtant bien que l’intérêt soit légitime ou illégitime, juste ou injuste, providentiel ou satanique, propriété ou spoliation.
La contradiction, soyez-en sûr, est ce qu’il y a de plus difficile à faire accepter, même aux esprits subtils, à plus forte raison au peuple.
Si je m’arrête à la première moitié, j’ose dire à la bonne moitié de votre thèse, en quoi différez-vous des économistes ?
Vous convenez qu’avancer un capital, c’est rendre un service, qui donne droit à un service équivalent, lequel est susceptible d’évaluation et s’appelle intérêt.
Vous convenez que le seul moyen de dégager l’équivalence de ces deux services, c’est de les laisser s’échanger librement, puisque vous repoussez l’intervention de l’État, et proclamez, dès le début de votre article, la liberté de l’homme et du citoyen.
Vous convenez que l’intérêt a été, dans son institution providentielle, un instrument d’égalité et de progrès.
Vous convenez que, par l’accumulation des capitaux (qui certes ne s’accumuleraient pas si toute rémunération leur était déniée), l’Intérêt tend à baisser, à mettre l’instrument du travail, la matière première et l’approvisionnement, toujours à la porté plus facile de classes plus nombreuses.
Vous convenez que les obstacles, qui arrêtent cette désirable diffusion du capital, sont artificiels et se nomment priviléges, restrictions, monopoles ; qu’ils ne peuvent être la conséquence fatale de la liberté, puisque vous invoquez la liberté.
Voilà une doctrine qui, par sa simplicité, sa grandeur, sa concordance, le parfum de justice qui s’en exhale, s’impose aux convictions, entraîne les cœurs, et fait pénétrer, dans tous les replis de l’intelligence, le sentiment de la certitude. Que reprochez-vous donc à l’économie politique ? Est-ce d’avoir repoussé les formules diverses — et par suite refusé de prendre le nom — du socialisme ? Oui, elle a combattu le saint-simonisme et le fouriérisme ; vous les avez combattus comme elle. Oui, elle a réprouvé les théories du Luxembourg ; vous les avez réprouvées comme elle. Oui, elle a lutté contre le communisme ; vous avez fait plus, vous l’avez écrasé.
D’accord avec l’économie politique sur le capital, son origine, sa mission, son droit, ses tendances ; — d’accord avec elle sur le principe à promouvoir, la liberté ; — d’accord avec elle sur l’ennemi à combattre, l’intervention abusive de l’État dans les transactions honnêtes ; — d’accord avec elle dans ses luttes contre les manifestations passées du socialisme ; — d’où vient que vous vous retournez contre elle ? C’est que vous avez trouvé au socialisme une nouvelle formule : la contradiction, ou, si vous aimez mieux, l’antinomie. C’est pourquoi vous apostrophez l’économie politique et lui dites :
Tu es vielle d’un siècle. Tu n’es plus au courant des questions du jour. Tu n’envisages la question que sous une face. Tu te fondes sur la légitimité et l’utilité de l’intérêt, et tu as raison, car il est utile et légitime ; mais ce que tu ne comprends pas, c’est qu’en même temps il est nuisible et illégitime. Cette contradiction t’émerveille ; la gloire du néo-socialisme est de l’avoir découverte, et c’est par là qu’il dépasse ta portée.
Avant de chercher, ainsi que vous m’y invitez, à faire sortir une solution de ces prémisses contradictoires, il faut savoir si la contradiction existe, et nous sommes ramenés par là à creuser de plus en plus ce problème :
L’intérêt du capital est-il légitime ?
Mais que puis-je dire ? Mon œil se fixe sur l’épée de Damantioclès que vous tenez suspendue sur ma tête. Plus concluantes seront mes raisons, plus vous vous frotterez les mains, disant : On ne saurait mieux prouver ma thèse. Que si, des bas-fonds du communisme, il s’élève contre mes arguments une réfutation spécieuse, vous vous frotterez les mains encore, disant : Voici du secours qui arrive à mon anti-thèse. O antinomie ! tu es vraiment une citadelle imprenable ; tu ressembles, trait pour trait, au scepticisme. Comment convaincre Pyrrhon, qui vous dit : Je doute si tu me parles ou si je te parle ; je doute si tu es et si je suis ; je doute si tu affirmes ; je doute si je doute ?
Voyons néanmoins sur quelle base vous faites reposer la seconde moitié de l’antinomie.
Vous invoquez d’abord les Pères de l’Église, le judaïsme et le paganisme. Permettez-moi de les récuser en matière économique. Vous l’avouez vous-même, Juifs et gentils ont parlé dans un sens et agi dans un autre. Quand il s’agit d’étudier les lois générales auxquelles obéit la société, la manière dont les hommes agissent universellement a plus de poids que quelques sentences.
Vous dites : « Celui qui prête ne se prive pas du capital qu’il prête. Il le prête, au contraire, parce que ce prêt ne constitue pas pour lui une privation ; il le prête, parce qu’il n’en a que faire pour lui-même, étant suffisamment pourvu, d’ailleurs, de capitaux. Il le prête, enfin, parce qu’il n’est ni dans son intention ni dans sa puissance de le faire personnellement valoir [1]. » [216]
Et qu’importe, s’il l’a créé par son travail, précisément pour le prêter ? Il n’y a là qu’une équivoque sur l’effet nécessaire de la séparation des occupations. Votre argument attaque la vente aussi bien que le prêt. En voulez vous la preuve ? Je vais reproduire votre phrase, en substituant Vente à Prêt et Chapelier à Capitaliste.
« Celui qui vend, dirai-je, ne se prive pas du chapeau qu’il vend. Il le vend, au contraire, parce que cette vente ne constitue pas pour lui une privation. Il le vend parce qu’il n’en a que faire pour lui-même, étant d’ailleurs suffisamment pourvu de chapeaux. Il le vend enfin parce qu’il n’est ni dans son intention, ni dans sa puissance de le faire personnellement servir. »
En faveur de votre antithèse, vous alléguez encore la compensation.
« Vous me prêtez, moyennant intérêt, le rabot que vous avez fabriqué pour polir vos planches. Si, de mon côté, je vous prête la scie que j’ai montée pour débiter mes souches, j’aurai droit pareillement à un intérêt… Si, de part et d’autre, les capitaux avancés sont égaux, les intérêts se balançant, le solde sera nul. »
Sans doute ; — et si les capitaux avancés sont inégaux, un solde légitime apparaîtra. C’est précisément ainsi que les choses se passent. Encore ici, ce que vous dites du prêt, on peut le dire de l’échange et même du travail : parce que des travaux échangés se compensent, en concluez-vous que le travail a été anéanti ?
Le socialisme moderne aspire, dites-vous, à réaliser cette prestation mutuelle des capitaux, afin que l’intérêt, partie intégrante du prix de toutes choses, se compense pour tous et, par conséquent, s’annule. — Qu’il se compense, ce n’est pas idéalement impossible, et je ne demande pas mieux. Mais il y faut d’autres façons qu’une Banque d’invention nouvelle. Que le socialisme égalise chez tous les hommes l’activité, l’habileté, la probité, l’économie, la prévoyance, les besoins, les goûts, les vertus, les vices et même les chances, et alors il aura réussi. Mais alors il importera peu que l’intérêt se cote à demi pour cent ou à cinquante pour cent.
Vous nous reprochez de méconnaître la signification du socialisme, parce que nous ne fondons pas de grandes espérances sur ses rêves de crédit gratuit. Vous nous dites : « Vous attribuez au capital le mérite et le progrès opéré dans le domaine de l’industrie et de la richesse, tandis que le progrès a pour cause non le capital, mais la circulation du capital. »
Je crois que c’est vous qui prenez ici l’effet pour la cause. Pour que le capital circule, il faut d’abord qu’il existe ; et, pour qu’il existe, il faut qu’il soit provoqué à naître par la perspective des récompenses attachées aux vertus qui l’engendrent. Ce n’est pas parce qu’il circule que le capital est utile ; c’est parce qu’il est utile qu’il circule. Son utilité intrinsèque fait que les uns le demandent, que les autres l’offrent ; de là la circulation qui n’a besoin que d’une chose : être libre.
Mais ce que je déplore surtout, c’est de voir séparer en deux classes antagoniques les capitalistes et les travailleurs, comme s’il y avait un seul travailleur au monde qui ne fût, à quelque degré, capitaliste, comme si capital et travail n’étaient pas une même chose ; comme si rémunérer l’un ce n’était pas rémunérer l’autre. Ce n’est certes pas à vous qu’il faut démontrer cette proposition. Permettez-moi, cependant, de l’élucider par un exemple ; car vous le savez bien, nous n’écrivons pas l’un pour l’autre, mais pour le public.
Deux ouvriers se présentent, égaux d’activité, de force, d’adresse. L’un n’a que ses bras ; l’autre a une hache, une scie, une herminette. Je paie au premier 3 fr. par jour, au second 3 fr. 75 c. Il semble que le salaire soit inégal ; creusons la matière, et nous nous convaincrons que cette inégalité apparente est de l’égalité réelle.
D’abord, il faut bien que je rembourse au charpentier l’usure des outils qu’il use à mon service et à mon profit. Il faut bien qu’il trouve, dans un accroissement de salaire, de quoi entretenir cet outillage et maintenir sa position. De ce chef, je lui donne 5 sous de plus par jour qu’au simple manœuvre, sans que l’égalité soit le moins du monde blessée.
Ensuite, — et j’invoque ici l’attention du lecteur, car nous sommes au vif de la question ; — pourquoi le charpentier a-t-il des outils ? Apparemment parce qu’il les a faits avec du travail ou payés par du travail, ce qui est tout un. Supposons qu’il les ait faits en consacrant à cette création tout le premier mois de l’année. Le manœuvre, qui n’a pas pris cette peine, pourra me louer ses services pendant 300 jours, tandis que le charpentier-capitaliste n’aura plus que 270 journées disponibles ou rémunérables. Il faut donc que 270 journées, avec outils, lui produisent autant que 300 journées sans outils ; en d’autres termes, que les premiers se paient 5 sous de plus.
Ce n’est pas tout encore. Quand le charpentier s’est décidé à faire ses outils, il a eu un but, assurément fort légitime, celui d’améliorer sa condition. On ne peut lui mettre dans la bouche ce raisonnement : « Je vais accumuler des approvisionnements, m’imposer des privations, afin de pouvoir travailler tout un mois sans rien gagner. Ce mois, je le consacrerai à fabriquer des outils qui me mettront à même de débiter beaucoup plus d’ouvrage au profit de mon client ; ensuite, je lui demanderai de régler mon salaire pour les onze mois suivants, de manière à gagner juste autant, tout compris, que si j’étais resté manœuvre. » Non, cela ne peut être ainsi. Il est évident que ce qui a stimulé, dans cet artisan, la sagacité, l’habileté, la prévoyance, la privation, c’est l’espoir, le très-juste espoir d’obtenir pour son travail une meilleure récompense.
Ainsi nous arrivons à ce que la rétribution du charpentier se décompose comme il suit :
| 1° | 3 | fr. | ” | c., | salaire brut. |
| 2° | ” | 25 | usure des outils. | ||
| 3° | ” | 25 | compensation du temps consacré à faire les outils. | ||
| 4° | ” | 25 | juste rémunération de l’habileté, de la prévoyance, de la privation. | ||
| 3 | fr. | 75 | c. | ||
Où peut-on voir là injustice, iniquité, spoliation ? Que signifient toutes ces clameurs si absurdement élevées contre notre charpentier devenu capitaliste ?
Et remarquez bien que l’excédant de salaire qu’il reçoit n’est obtenu aux dépens de personne ; moi qui le paie, j’ai moins que personne à m’en plaindre. Grâce aux outils, une production supplémentaire a été pour ainsi dire tirée du néant. Cet excédant d’utilité se partage entre le capitaliste et moi qui, comme consommateur, représente ici la communauté, l’humanité tout entière.
Autre exemple, — car il me semble que ces analyses directes des faits instruisent plus que la controverse.
Le laboureur a un champ rendu presque improductif par la surabondance d’humidité. En homme primitif, il prend un vase et va puiser l’eau qui noie ses sillons. Voilà un travail excessif ; qui doit le payer ? évidemment l’acquéreur de la récolte. Si l’homme n’avait jamais imaginé d’autre procédé de desséchement, le blé serait si cher, quoiqu’il n’y eut pas de capital à rémunérer (ou plutôt parce que), que l’on n’en produirait pas ; et tel a été le sort de l’humanité pendant des siècles.
Mais notre laboureur s’avise de faire une rigole. Voilà le capital qui paraît. Qui doit payer les frais de cet ouvrage ? Ce n’est pas l’acquéreur de la première récolte. Cela serait injuste, puisque la rigole doit favoriser un nombre indéterminé de récoltes successives. Comment donc se réglera la répartition ? Par la loi de l’intérêt et de l’amortissement. Il faut que le laboureur, comme le charpentier, retrouve les quatre éléments de rémunération que j’énumérais tout à l’heure, ou il ne fera pas la rigole.
Et, encore que le prix du blé se trouve ici grevé d’un intérêt, ce serait tomber dans un hérésie économique que de dire : cet intérêt est une perte pour le consommateur. Bien au contraire ; c’est parce que le consommateur paie l’intérêt de ce capital, sous forme de rigole, qu’il ne paie pas l’épuisement, beaucoup plus dispendieux, à force de bras. — Et, si vous observez la chose de près, vous verrez que c’est toujours du travail qu’il paie ; seulement, dans le second cas, il intervient une coopération de la nature, très-utile, très-productive, mais qui ne se paie pas.
Votre plus grand grief contre l’intérêt est qu’il permet aux capitalistes de vivre sans travailler. « Or, dites-vous, vivre sans travailler, c’est, en économie politique comme en morale, une proposition contradictoire, une chose impossible. »
Sans doute, vivre sans travailler, pour l’homme tel qu’il a plu à Dieu de le faire, est, d’une manière absolue, chose impossible. Mais ce qui n’est pas impossible à l’homme, c’est de vivre deux jours sur le travail d’un seul. Ce qui n’est pas impossible à l’humanité, ce qui est même une conséquence providentielle de sa nature perfectible, c’est d’accroître incessamment la proportion des résultats obtenus aux efforts employés. Si un artisan a pu améliorer son sort en fabriquant de grossiers outils, pourquoi ne l’améliorerait-il pas davantage encore en créant des machines plus compliquées, en déployant plus d’activité, plus de génie, plus de prévoyance ; en se soumettant à de plus longues privations ? Que si le talent, la persévérance, l’ordre, l’économie, l’exercice de toutes les vertus, se perpétuent dans la famille ; pourquoi ne parviendrait-elle pas, à la longue, au loisir relatif, ou, pour mieux dire, à s’initier à des travaux d’un ordre plus élevé ?
Pour que ce loisir provoquât avec justice, chez ceux qui n’y sont pas encore parvenus, l’irritation et l’envie, il faudrait qu’il fût acquis aux dépens d’autrui, et j’ai prouvé qu’il n’en était pas ainsi. Il faudrait, de plus, qu’il ne fût pas l’éternelle aspiration de tous les hommes.
Je terminerai cette lettre, déjà trop longue, par une considération sur le loisir. [217]
Quelle que soit mon admiration sincère pour les admirables lois de l’économie sociale, quelque temps de ma vie que j’aie consacré à étudier cette science, quelque confiance que m’inspirent ses solutions, je ne suis pas de ceux qui croient qu’elle embrasse toute la destinée humaine. Production, distribution, circulation, consommation des richesses, ce n’est pas tout pour l’homme. Il n’est rien, dans la nature, qui n’ait sa cause finale ; et l’homme aussi doit avoir une autre fin que celle de pourvoir à son existence matérielle. Tout nous le dit. D’où lui viennent et la délicatesse de ses sentiments, et l’ardeur de ses aspirations ; sa puissance d’admirer et de s’extasier ? D’où vient qu’il trouve dans la moindre fleur un sujet de contemplation ? que ses organes saisissent avec tant de vivacité et rapportent à l’âme, comme les abeilles à la ruche, tous les trésors de beauté et d’harmonie que la nature et l’art ont répandus autour de lui ? D’où vient que des larmes mouillent ses yeux au moindre trait de dévouement qu’il entend raconter ? D’où viennent ces flux et des reflux d’affection que son cœur élabore comme il élabore le sang et la vie ? D’où lui viennent son amour de l’humanité et ses élans vers l’infini ? Ce sont là les indices d’une noble destination qui n’est pas circonscrite dans l’étroit domaine de la production industrielle. L’homme a donc une fin. Quelle est-elle ? Ce n’est pas ici le lieu de soulever cette question. Mais quelle qu’elle soit, ce qu’on peut dire, c’est qu’il ne la peut atteindre si, courbé sous le joug d’un travail inexorable et incessant, il ne lui reste aucun loisir pour développer ses organes, ses affections, son intelligence, le sens du beau, ce qu’il y a de plus pur et de plus élevé dans sa nature ; ce qui est en germe chez tous les hommes, mais latent et inerte, faute de loisir, chez un trop grand nombre d’entre eux [2]. [218]
Quelle est la puissance qui allégera pour tous, dans une certaine mesure, le fardeau de la peine ? [219] Qui abrégera les heures de travail ? Qui desserrera les liens de ce joug pesant qui courbe aujourd’hui vers la matière, non-seulement les hommes, mais les femmes et les enfants qui n’y semblaient pas destinés ? — C’est le capital ; le capital qui, sous la forme de roue, d’engrenage, de rail, de chute d’eau, de poids, de voile, de rame, de charrue, prend à sa charge une si grande partie de l’œuvre primitivement accomplie aux dépens de nos nerfs et de nos muscles ; le capital qui fait concourir, de plus en plus, au profit de tous, les forces gratuites de la nature. Le capital est donc l’ami, le bienfaiteur de tous les hommes, et particulièrement des classes souffrantes. Ce qu’elles doivent désirer, c’est qu’il s’accumule, se multiplie, se répande sans compte ni mesure. — Et s’il y a un triste spectacle au monde, — spectacle qu’on ne pourrait définir que par ces mots : suicide matériel, moral et collectif, — c’est de voir ces classes, dans leur égarement, faire au capital une guerre acharnée. — Il ne serait ni plus absurde, ni plus triste, si nous voyions tous les capitalistes du monde se concerter pour paralyser les bras et tuer le travail.
En me résumant, monsieur Proudhon, je vous dira ceci : Le jour où nous serons d’accord sur cette première donnée, l’intérêt du capital, déterminé par le libre débat, est légitime ; — je me ferai un plaisir et un devoir de discuter loyalement avec vous les autres questions que vous me posez.
Frédéric Bastiat.
CINQUIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat ↩
Réclamations sur les limites du débat. — L’intérêt a été mais n’est plus légitime. — Inductions tirées de l’histoire. — L’illégitimité succède à la légitimité. — Impéritie et mauvais vouloir de la société. — C’est de la circulation du capital, et non du capital même, que naît le progrès de la richesse sociale.
3 décembre 1849.
Monsieur, votre dernière lettre se termine par ces paroles :
« Le jour où nous serons d’accord sur cette première donnée : l’intérêt du capital est légitime ; — je me ferai un plaisir et un devoir de discuter loyalement avec vous les autres questions que vous me posez. »
Je vais, Monsieur, tâcher de vous donner satisfaction.
Mais permettez-moi d’abord de vous adresser cette question, que je voudrais pouvoir rendre moins brusque : Qu’êtes-vous venu faire à la Voix du peuple ? — Réfuter la théorie du crédit gratuit, la théorie de l’abolition de tout intérêt des capitaux, de toute rente de la propriété.
Pourquoi donc refusez-vous de vous placer tout de suite sur le terrain de cette théorie ? de la suivre dans son principe, sa méthode, son développement ? d’examiner ce qui la constitue, les preuves de vérité qu’elle apporte, le sens des faits qu’elle cite, et qui contredisent, abrogent, d’une manière éclatante, le fait, ou plutôt la fiction que vous vous efforcez de soutenir de la productivité du capital ? Cela est-il d’une discussion sérieuse et loyale ? Depuis quand a-t-on vu les philosophes répondre à un système de philosophie par cette fin de non-recevoir : Mettons-nous premièrement d’accord sur le système en vogue, après quoi nous examinerons le nouveau ? Depuis quand est-il reçu dans les sciences que l’on doit repousser impitoyablement, par la question préalable, tout fait, toute idée, toute théorie qui contredit la théorie généralement admise ?
Quoi ! vous entreprenez de me réfuter et de me convaincre ; et puis, au lieu de saisir mon système corps à corps, vous me présentez le vôtre ! Pour me répondre, vous commencez par exiger que je tombe d’accord avec vous de ce que je nie positivement ! En vérité, n’aurais-je pas, dès ce moment, le droit de vous dire : Gardez votre théorie du prêt à intérêt, puisqu’elle vous agrée, et laissez-moi ma théorie du prêt gratuit, que je trouve plus avantageuse, plus morale, plus utile et beaucoup plus pratique ? Au lieu de discuter, comme nous l’avions espéré, nous en serons quittes pour médire l’un de l’autre, et nous décrier réciproquement. À l’avantage !…
Voilà, Monsieur, comment se terminerait la discussion, si, par malheur pour votre théorie, elle n’était forcée, afin de se maintenir, de renverser la mienne. C’est ce que je vais avoir l’honneur de vous démontrer, en suivant votre lettre de point en point.
Vous commencez par plaisanter, fort spirituellement sans doute, sur la loi de contradiction dont je me suis servi pour tracer la marche de la théorie socialiste. Croyez-moi, Monsieur, il y a toujours peu de gloire à acquérir, pour un homme d’intelligence, à rire des choses qu’il n’entend pas, surtout quand elles reposent sur des autorités aussi respectables que la loi de contradiction. La dialectique, fondée par Kant et ses successeurs, est aujourd’hui comprise et employée par une moitié de l’Europe, et ce n’est pas un titre d’honneur pour notre pays assurément, quand nos voisins ont porté si loin la spéculation philosophique, d’en être resté à Proclus et à saint Thomas. À force d’éclectisme et de matérialisme, nous avons perdu jusqu’à l’intelligence de nos traditions ; nous n’entendons pas même Descartes ; car, si nous entendions Descartes, il nous conduirait à Kant, Fichte, Hegel, et au delà.
Quittons, toutefois, la contradiction, puisqu’elle vous est importune, et revenons à l’ancienne méthode. Vous savez ce que l’on entend, dans la logique ordinaire, par distinction. À défaut de professeur de philosophie, Diafoirus le jeune vous l’aurait appris. C’est le procédé qui vous est le plus familier, et qui témoigne le mieux de la subtilité de votre esprit. Je vais donc, pour répondre à votre question, faire usage du distinguo : peut-être alors ne vous sera-t-il plus possible de dire que vous ne me comprenez pas.
Vous demandez : l’intérêt du capital est-il légitime, oui ou non ? Répondez à cela, sans antinomie et sans antithèse.
Je réponds : Distinguons, s’il vous plaît. Oui, l’intérêt du capital a pu être considéré comme légitime dans un temps ; non, il ne peut plus l’être dans un autre. Cela vous offre-t-il quelque ambage, quelque équivoque ? Je vais tâcher de dissiper toutes les ombres.
La monarchie absolue a été légitime dans un temps : ce fut une des conditions du développement politique. Elle a cessé d’être légitime à une autre époque, parce qu’elle était devenue un obstacle au progrès. — Il en a été de même de la monarchie constitutionnelle : c’était, en 89 et jusqu’en 1830, la seule forme politique qui convînt à notre pays ; ce serait aujourd’hui une cause de perturbation et de décadence.
La polygamie a été légitime à une époque : c’était le premier pas fait hors de la promiscuité communautaire. Elle est condamnée de nos jours comme contraire à la dignité de la femme : nous la punissons des galères.
Le combat judiciaire, l’épreuve de l’eau bouillante, la torture elle-même, lisez M. Rossi, eurent également leur légitimité. C’était la première forme donnée à la justice. Nous y répugnons maintenant, et tout magistrat qui y aurait recours se rendrait coupable d’un attentat.
Sous saint Louis, les arts et métiers étaient féodalisés, organisés corporativement, et hérissés de priviléges. Cette réglementation était alors utile et légitime ; elle avait pour but de faire surgir, en face de la féodalité terrienne et nobiliaire, la féodalité du travail. Elle a été abandonnée depuis, et avec raison : depuis 89 l’industrie est libre.
Je vous répète donc, et, en conscience, je crois parler clair : Oui, le prêt à intérêt a été, dans un temps, légitime, lorsque toute centralisation démocratique du crédit et de la circulation était impossible : il ne l’est plus, maintenant que cette centralisation est devenue une nécessité de l’époque, partant un devoir de la société, un droit du citoyen. C’est pour cela que je m’élève contre l’usure ; je dis que la société me doit le crédit et l’escompte sans intérêt : l’intérêt je l’appelle vol.
Bon gré, mal gré, il faut donc que vous descendiez sur le terrain où je vous appelle : car, si vous refusez de le faire, si vous vous renfermiez dans la bonne foi de votre ancienne possession, alors j’accuserai votre mauvais vouloir ; je crierai partout, comme le Mascarille de Molière : Au voleur ! au voleur ! au voleur !
Pour en finir tout à fait avec l’antinomie, je vais maintenant, à l’aide des exemples précédemment cités, vous dire en peu de mots ce qu’elle ajoute à la distinction. Cela ne sera pas inutile à notre controverse.
Vous concevez donc qu’une chose peut être vraie, juste, légitime, dans un temps, et fausse, inique, criminelle, dans un autre. Vous ne pouvez pas ne pas le concevoir, puisque cela est.
Or, se demande le philosophe, comment une chose, vraie un jour, ne l’est-elle pas un autre jour ? La vérité peut-elle changer ainsi ? La vérité n’est-elle pas la vérité ? Faut-il croire qu’elle n’est qu’une fantaisie, une apparence, un préjugé ? Y a-t-il, enfin, ou n’y a-t-il pas une cause à ce changement ? Au-dessus de la vérité qui change, existerait-il, par hasard, une vérité qui ne change point, une vérité absolue, immuable ?
En deux mots, la philosophie ne s’arrête point au fait tel que le lui révèlent l’expérience et l’histoire ; elle cherche à l’expliquer.
Eh bien ! la philosophie a trouvé, ou, si vous aimez mieux, elle a cru voir que cette altération des institutions sociales, ce revirement qu’elles éprouvent après un certain nombre de siècles, provient de ce que les idées dont elles sont l’expression, possèdent en elles-mêmes une sorte de faculté évolutive, un principe de mobilité perpétuelle, provenant de leur essence contradictoire.
C’est ainsi que l’intérêt du capital, légitime alors que le prêt est un service rendu de citoyen à citoyen, mais qui cesse de l’être quand la société a conquis le pouvoir d’organiser le crédit gratuitement pour tout le monde, cet intérêt, dis-je, est contradictoire dans son essence, en ce que, d’une part, le service rendu par le prêteur a droit à une rémunération ; et que, d’un autre côté, tout salaire suppose produit ou privation, ce qui n’a pas lieu dans le prêt. La révolution qui s’opère dans la légitimité du prêt vient de là. Voici comment le socialisme, pose la question ; voilà aussi sur quel terrain les défenseurs de l’ancien régime doivent se placer.
Se renfermer dans la tradition, se borner à dire : Le prêt est un service rendu, donc il doit être payé ; sans vouloir entrer dans les considérations qui tendent à abroger l’intérêt, ce n’est pas répondre. Le socialisme, redoublant d’énergie, proteste et vous dit : Je n’ai que faire de votre service, service pour vous, spoliation pour moi, tandis qu’il est loisible à la société de me faire jouir des mêmes avantages que vous m’offrez, et cela sans rétribution. M’imposer un tel service, malgré moi, en refusant d’organiser la circulation des capitaux, c’est me faire supporter un prélèvement injuste, c’est me voler.
Ainsi, toute votre argumentation en faveur de l’intérêt, consiste à confondre les époques, je veux dire à confondre ce qui, dans le prêt, est légitime avec ce qui ne l’est pas, tandis que moi, au contraire, je les distingue soigneusement. C’est ce que vais achever de vous rendre intelligible par l’analyse de votre lettre.
Je prends un à un tous vos arguments.
Dans ma première réponse, je vous avais fait observer que celui qui prête ne se prive pas de son capital. — Vous me répondez : Qu’importe, s’il a créé son capital tout exprès pour le prêter ?
En disant cela, vous trahissez votre propre cause. Vous acquiescez, par ces paroles, à mon antithèse, qui consiste à dire : La cause secrète pour laquelle le prêt à intérêt, légitime hier, ne l’est plus aujourd’hui, c’est ce que le prêt, en lui-même, n’entraîne pas privation. Je prends acte de cet aveu.
Mais vous vous accrochez à l’intention : Qu’importe, dites-vous, si le prêteur a créé ce capital tout exprès pour le prêter ?
À quoi je réplique : Et que me fait à mon tour votre intention, si je n’ai pas réellement besoin de votre service, si le prétendu service que vous voulez me rendre ne me devient nécessaire que par le mauvais vouloir et l’impéritie de la société ? Votre crédit ressemble à celui que fait le corsaire à l’esclave, quand il lui donne la liberté contre rançon. Je proteste contre votre crédit à 5 pour 100, parce que la société a le pouvoir et le devoir de me le faire à 0 pour 100 ; et, si elle me refuse, je l’accuse, ainsi que vous, de vol ; je dis qu’elle est complice, fautrice, organisatrice du vol.
Assimilant le prêt à la vente, vous dites : votre argument s’attaque à celle-ci aussi bien qu’à celui-là. En effet, le chapelier qui vend des chapeaux ne s’en prive pas.
Non, car il reçoit de ses chapeaux, il est censé du moins en recevoir immédiatement la valeur, ni plus ni moins. Mais le capitaliste prêteur, non-seulement n’est pas privé, puisqu’il rentre intégralement dans son capital ; il reçoit plus que le capital, plus que ce qu’il apporte à l’échange ; il reçoit, en sus du capital, un intérêt qu’aucun produit positif de sa part ne représente. Or, un service qui ne coûte pas de travail à celui qui le rend, est un service susceptible de devenir gratuit : c’est ce que vous-même vous nous apprendrez tout à l’heure.
Après avoir reconnu la non-privation qui accompagne le prêt, vous convenez cependant « qu’il n’est pas idéalement impossible que l’intérêt, qui, aujourd’hui, fait partie intégrante du prix des choses, se compense pour tout le monde, et, par conséquent, s’annule. » — « Mais, ajoutez-vous, il y faut d’autres façons qu’une banque nouvelle. Que le socialisme égalise, chez tous les hommes, l’activité, l’habileté, la probité, l’économie, la prévoyance, les besoins, les goûts, les vertus, les vices, et même les chances, et alors il aura réussi. »
En sorte que vous n’entrez dans la question que pour l’éluder aussitôt. Le socialisme, au point où il est parvenu, prétend justement que c’est à l’aide d’une réforme de la banque et de l’impôt que l’on peut arriver à cette compensation. Au lieu de passer, comme vous faites, sur cette prétention du socialisme, arrêtez-vous-y, et réfutez-la : vous en aurez fini avec toutes les utopies du monde. Car, le socialisme affirme, — et sans cela le socialisme n’existerait pas, il en serait rien, — que ce n’est point en égalisant chez tous les hommes « l’activité, l’habileté, la probité, l’économie, la prévoyance, les besoins, les goûts, les vertus, les vices et mêmes les chances, » qu’on parviendra à compenser l’intérêt et égaliser le revenu net ; il soutient qu’il faut, au contraire, commencer par centraliser le crédit et annuler l’intérêt, pour égaliser les facultés, les besoins et les chances. Qu’il n’y ait plus parmi nous de voleurs, et nous serons tous vertueux, tous heureux ! Voilà la profession de foi du socialisme ! J’éprouve le plus vif regret à vous le dire : mais vous connaissez si peu le socialisme, que vous vous heurtez contre lui sans le voir.
Vous persistez à attribuer au capital tous les progrès de la richesse sociale, que j’attribue, moi, à la circulation ; et vous me dites, à ce propos, que je prends l’effet pour la cause.
Mais, en soutenant une pareille proposition, vous ruinez, sans vous en apercevoir, votre propre thèse. J. B. Say a démontré, et vous ne l’ignorez pas, que le transport d’une valeur, que cette valeur s’appelle argent ou marchandise, constitue lui-même une valeur ; que c’est un produit aussi réel que le blé et le vin ; qu’en conséquence, le service du commerçant et du banquier mérite d’être rémunéré tout comme le service du laboureur et du vigneron. C’est sur ce principe que vous vous appuyez vous-même quand vous réclamez un salaire pour le capitaliste, qui, par la prestation de son capital, dont on lui garantit la rentrée, fait office de transport, de circulation. Par cela seul que je prête, disiez-vous dans votre première lettre, je rends un service, je crée une valeur. Telles étaient vos paroles, que nous avons admises : en cela, nous étions l’un et l’autre d’accord avec le maître.
Je suis donc fondé à dire que ce n’est pas le capital lui-même, mais la circulation du capital : c’est cette nature de service, produit, marchandise, valeur, réalité, qu’on appelle en économie politique mouvement ou circulation, et qui, au fond, constitue toute la matière de la science économique, qui est la cause de la richesse. Ce service, nous le payons à tous ceux qui le rendent ; mais nous affirmons qu’en ce qui concerne les capitaux proprement dits, ou l’argent, il dépend de la société de nous en faire jouir elle-même, et gratuitement ; que si elle ne le fait pas, il y a fraude et spoliation. — Comprenez-vous maintenant où est le véritable point de la question sociale ?…
Après avoir déploré de voir les capitalistes et les travailleurs séparés en deux classes antagoniques, ce qui n’est pas la faute du socialisme assurément, — vous prenez la peine, fort inutile, de me démontrer par des exemples que tout travailleur est, à quelque degré, capitaliste, et fait œuvre de capitalisation, c’est-à-dire d’usure. Qui donc a jamais songé à le nier ? Qui vous a dit que ce que nous reconnaissons comme légitime, en un temps, chez le capitaliste, nous le réprouvons, dans le même temps, chez l’ouvrier ?
Oui, nous savons que le prix de toute marchandise et service se décompose actuellement de la manière suivante :
1° Matière première ;
2° Amortissement des instruments de travail et frais ;
3° Salaire du travail ;
4° Intérêt du capital.
Il en est ainsi dans toutes les professions, agriculture, industrie, commerce, transports. Ce sont les fourches caudines de tout ce qui n’est point parasite, capitaliste ou manœuvre. Vous n’avez que faire de nous donner à ce sujet de longs détails, très-intéressants du reste, et où l’on voit que se complaît votre imagination.
Je vous le répète : la question, pour le socialisme, est de faire que ce quatrième élément qui entre dans la composition du prix des choses, à savoir, l’intérêt du capital, se compense entre tous les producteurs, et, par conséquent, s’annule. Nous soutenons que cela est possible ; que si cela est possible, c’est un devoir à la société de procurer la gratuité du crédit à tous ; qu’autrement, ce ne serait pas une société, mais une conspiration des capitalistes contre les travailleurs, un pacte de rapine et d’assassinat.
Concevez donc, une fois, qu’il ne s’agit point pour vous de nous expliquer comment les capitaux se forment, comment ils se multiplient par l’intérêt, comment l’intérêt entre dans la composition du prix des produits, comment tous les travailleurs sont eux-mêmes coupables du péché d’usure : nous savons dès longtemps toutes ces choses, autant que nous sommes convaincus de la bonne foi des rentiers et des propriétaires.
Nous disons : Le système économique fondé sur la fiction de la productivité du capital, justifiable à une autre époque, est désormais illégitime. Son impuissance, sa malfaisance sont démontrées ; c’est lui qui est la cause de toutes les misères actuelles, lui qui soutient encore cette vielle fiction du gouvernement représentatif, dernière formule de la tyrannie parmi les hommes.
Je ne vous suivrai point dans les considérations, toutes religieuses, par lesquelles vous terminez votre lettre. La religion, permettez-moi de vous le dire, n’a rien à faire avec l’économie politique. Une véritable science se suffit à elle-même, hors de cette condition elle n’est pas. S’il faut à l’économie politique une sanction religieuse pour suppléer à l’impuissance de ses théories, et si, de son côté, la religion, pour excuser la stérilité de son dogme, allègue les exigences de l’économie politique, il arrivera que l’économie politique et la religion, au lieu de se soutenir mutuellement, s’accuseront l’une l’autre ; elles périront toutes deux.
Commerçons par faire justice, et nous aurons de surcroît la liberté, la fraternité, la richesse ; le bonheur même de l’autre vie n’en sera que plus assuré. L’inégalité du revenu capitaliste est-elle, oui ou non, la cause première de la misère physique, morale et intellectuelle qui afflige aujourd’hui la société ? Faut-il compenser le revenu entre tous les hommes, rendre gratuite la circulation des capitaux, en l’assimilant à l’échange des produits, et annuler l’intérêt ? Voilà ce que demande le socialisme, et à quoi il faut répondre.
Le socialisme, dans ses conclusions les plus positives, vous fournit la solution dans la centralisation démocratique et gratuite du crédit, combinée avec un système d’impôt unique, remplaçant tous les autres impôts, et assis sur le capital.
Qu’on vérifie cette solution ; qu’on essaie de l’appliquer. C’est la seul manière de réfuter le socialisme ; hors de là, nous ferons retentir plus fort que jamais notre cri de guerre : La propriété c’est le vol !
P.-J. Proudhon.
SIXIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon ↩
Est-il vrai que prêter n’est plus aujourd’hui rendre un service ? — La société est-elle un capitaliste tenu de prêter gratuitement ? — Explication sur la circulation des capitaux. — Chimères appelées par leur nom. — Ce qui est vrai, c’est que l’intérêt dispense d’une rémunération plus onéreuse.
10 décembre 1849.
Je veux rester sur mon terrain ; vous voulez m’attirer sur le vôtre, et vous me dites : Qu’êtes-vous venu faire à la Voix du Peuple, si ce n’est réfuter la théorie du crédit gratuit, etc. ?
Il y a là un malentendu. Je n’ai point été à la Voix du Peuple ; la Voix du Peuple est venue à moi. De tous côtés, on parlait du crédit gratuit, et chaque jour voyait éclore un plan nouveau pour la réalisation de cette idée.
Alors je me dis : Il est inutile de combattre ces plans l’un après l’autre. Prouver que le capital a un droit légitime et indestructible à être rémunéré, c’est les ruiner tous à la fois, c’est renverser leur base commune.
Et je publiai la brochure Capital et Rente.
La Voix du Peuple, ne trouvant pas ma démonstration concluante, l’a réfutée. J’ai demandé à la maintenir, vous y avez consenti loyalement : c’est donc sur mon terrain que doit se continuer la discussion.
D’ailleurs, la société s’est développée perpétuellement et universellement sur le principe que j’invoque. C’est à ceux qui veulent que, à partir d’aujourd’hui, elle se développe sur le principe opposé, à prouver qu’elle a eu tort. L’onus probandi leur incombe.
Et après tout, de quelle importance réelle est ce débat préalable ? Prouver que l’intérêt est légitime, juste, utile, bienfaisant, indestructible, n’est-ce pas prouver que la gratuité du crédit est une chimère ?
Permettez-moi donc, Monsieur, de m’en tenir à cette question dominante : l’intérêt est-il légitime et utile ?
Par pitié pour l’ignorance où vous me voyez (ainsi que bon nombre de nos lecteurs) de la philosophie germanique, vous voulez bien, métamorphosant Kant en Diafoirus, substituer à la loi de la contradiction celle de la distinction.
Je vous remercie de cette condescendance. Elle me met à l’aise. Mon esprit se refuse invinciblement, je l’avoue, à admettre que deux assertions contradictoires puissent être vraies en même temps. Je respecte, comme je le dois, quoique de confiance, Kant, Fichte et Hegel. Mais si leurs livres entraînent l’esprit du lecteur à admettre des propositions comme celles-ci : Le Vol, c’est la propriété ; la Propriété, c’est le vol ; le jour, c’est la nuit ; je bénirai le Ciel, tous les jours de ma vie, de n’avoir pas fait tomber ces livres sous mes yeux. À ces sublimes subtilités, votre intelligence s’est aiguisée ; la mienne y eût infailliblement succombé, et bien loin de me faire comprendre des autres, je ne pourrais plus me comprendre moi-même.
Enfin, à cette question : l’intérêt est-il légitime ? Vous répondez, non plus en allemand : Oui et non, mais en latin : Distinguo. « Distingons ; oui, l’intérêt du capital a pu être considéré comme légitime dans un temps ; non, il ne peut plus l’être dans un autre. »
Eh bien ! votre condescendance hâte, ce me semble, la conclusion de ce débat. Elle prouve surtout que j’avais bien choisi le terrain ; car, que prétendez-vous ? Vous dites qu’à un moment donné, la rémunération du capital passe de la légitimité à l’illégitimité ; c’est-à-dire que le capital lui-même se dépouille de sa nature pour revêtir une nature opposée. Certes, la présomption n’est pas pour vous, et c’est à celui qui veut bouleverser la pratique universelle sur la foi d’une affirmation si étrange, à la prouver.
J’avais fait résultat la légitimité de l’intérêt de ce que le prêt est un service, lequel est susceptible d’être évalué, a, par conséquent, une valeur et peut s’échanger contre toute autre valeur égale. Je croyais même que vous étiez convenu de la vérité de cette doctrine, en ces termes :
« Il est très-vrai, comme vous l’établissez vous-même péremptoirement, que le prêt est un service. Et comme tout service est une valeur, comme il est de la nature de tout service d’être rémunéré, il s’ensuit que le prêt doit avoir son prix, ou, pour employer le mot technique, qu’il doit porter intérêt. »
Voilà ce que vous disiez, il y a quinze jours. Aujourd’hui vous dites : Distinguons, prêter c’était rendre service autrefois, ce n’est plus rendre service maintenant.
Or, si prêter n’est pas rendre service, il va sans dire que l’intérêt est, je ne dis pas illégitime, mais impossible.
Votre argumentation nouvelle implique ce dialogue :
l’emprunteur. Monsieur, je voudrais monter un magasin, j’ai besoin de dix mille francs, veuillez me les prêter.
le prêteur. Volontiers, nous allons débattre les conditions.
l’emprunteur. Monsieur, je n’accepte pas de conditions. Je garderai votre argent un an, deux ans, vingt ans, après quoi je vous le rendrai purement et simplement, attendu que tout ce qui, dans le remboursement du prêt, est donné en sus de prêt, est usure, spoliation.
le prêteur. Mais puisque vous venez me demander un service, il est bien naturel que je vous en demande un autre.
l’emprunteur. Monsieur, je n’ai que faire de votre service.
le prêteur. En ce cas, je garderai mon capital, dussé-je le manger.
l’emprunteur. « Monsieur, je suis socialiste, et le socialisme, redoublant d’énergie, proteste et vous dit par ma bouche : je n’ai que faire de votre service, service pour vous et spoliation pour moi, tandis qu’il est loisible à la société de me faire jouir des mêmes avantages que vous m’offrez, et cela sans rétribution. M’imposer un tel service, malgré moi, en refusant d’organiser la circulation des capitaux, c’est me faire supporter un prélèvement injuste, c’est me voler. »
le prêteur. Je ne vous impose rien malgré vous. Dès que vous ne voyez pas, dans le prêt, un service, abstenez-vous d’emprunter, comme moi de prêter. Que si la société vous offre des avantages sans rétribution, adressez-vous à elle, c’est bien plus commode ; et, quant à organiser la circulation des capitaux, ainsi que vous me sommez de le faire, si vous entendez par là que les miens vous arrivent gratis, par l’intermédiaire de la société, j’ai contre ce procédé indirect tout juste les mêmes objections qui m’ont fait vous refuser le prêt direct et gratuit.
La société ! J’ai été surpris, je l’avoue, de voir apparaître dans un écrit émané de vous, ce personnage nouveau, ce capitaliste accommodant.
Eh quoi ! Monsieur, vous qui, dans la même feuille où vous m’adressez votre lettre, avez combattu avec une si rude énergie les systèmes de Louis Blanc et de Pierre Leroux, n’avez-vous dissipé la fiction de l’État que pour y substituer la fiction de la Société ?
Qu’est-ce donc que la société, en dehors de quiconque prête ou emprunte, perçoit ou paie l’intérêt inhérent au prix de toutes choses ? Quel est ce Deus ex machinâ que vous faites intervenir d’une manière si inattendue pour donner le mot du problème ? Y a-t-il, d’un côté, la masse entière des travailleurs, marchands, artisans, capitalistes, et, de l’autre, la Société, personnalité distincte, possédant des capitaux en telle abondance qu’elle en peut prêter à chacun sans compte ni mesure, et cela sans rétribution ?
Ce n’est pas ainsi que vous l’entendez ; je n’en veux pour preuve que votre article sur l’État. Vous savez bien que la société n’a d’autres capitaux que ceux qui sont entre les mains des capitalistes grands et petits. Serait-ce que la Société doit s’emparer de ces capitaux et les faire circuler gratuitement, sous prétexte de les organiser ? En vérité, je m’y perds, et il me semble que, sous votre plume, cette limite s’efface sans cesse, qui sépare, aux yeux de la conscience publique, la propriété du vol.
En cherchant à pénétrer jusqu’à la racine de l’erreur que je combats ici, je crois la trouver dans la confusion que vous faites entre les frais de circulation des capitaux et les intérêts des capitaux. Vous croyez qu’on peut arriver à la circulation gratuite, et vous en concluez que le prêt sera gratuit. C’est comme si l’on disait que lorsque les frais de transport de Bordeaux à Paris seront anéantis, les vins de Bordeaux se donneront pour rien à Paris. Vous n’êtes pas le premier qui se soit fait cette illusion. Law disait : « La loi de la circulation est la seule qui puisse sauver les empires. » Il agit sur ce principe, et, au lieu de sauver la France, il la perdit.
Je dis : une chose est la circulation des capitaux et les frais qu’elle entraîne ; autre chose est l’intérêt des capitaux. Les capitaux d’une nation consistent en matériaux de toutes sortes, approvisionnements, outils, marchandises, espèces, et ces choses-là ne se prêtent pas pour rien. Selon que la société est plus ou moins avancée, il y a plus ou moins de facilité à faire passer un capital donné, ou sa valeur, d’un lieu à un autre lieu, d’une main à une autre main ; mais cela n’a rien de commun avec l’abolition de l’intérêt. Un Parisien désire prêter, un Bayonnais désire emprunter. Mais le premier n’a pas la chose qui convient au second. D’ailleurs, ils ne connaissent pas réciproquement leurs intentions ; ils ne peuvent s’aboucher, s’accorder, conclure. Voilà les obstacles à la circulation. Ces obstacles vont diminuant sans cesse, d’abord par l’intervention du numéraire, puis par celle de la lettre de change, successivement par celle du banquier, de la Banque nationale, des banques libres.
C’est une circonstance heureuse pour les consommateurs des capitaux, comme il est heureux pour les consommateurs de vin, que les moyens de transport se perfectionnent. Mais, d’une part, jamais les frais de circulation ne peuvent descendre à zéro, puisqu’il y a toujours là un intermédiaire qui rend service ; et, d’autre part, ces frais fussent-ils complétement anéantis, l’Intérêt subsisterait encore, et n’en serait même pas sensiblement affecté. Il y a des banques libres aux États-Unis ; elles sont sous l’influence des ouvriers eux-mêmes, qui en sont les actionnaires ; et, de plus, elles sont, vu leur nombre, toujours à leur portée ; chaque jour, les uns y déposent leurs économies, les autres y reçoivent les avances qui leur sont nécessaires ; la circulation est aussi facile, aussi rapide que possible. Est-ce à dire que le crédit y soit gratuit, que les capitaux ne produisent pas d’intérêt à ceux qui prêtent, et n’en coûtent pas à ceux qui empruntent ? Non, cela signifie seulement que prêteurs et emprunteurs s’y rencontrent plus facilement qu’ailleurs.
Ainsi, gratuité absolue de la circulation, — chimère.
Gratuité du crédit, — chimère.
Imaginer que la première de ces gratuités, si elle était possible, impliquerait la seconde, — troisième chimère.
Vous voyez que je me suis laissé entraîner sur votre terrain, et, puisque j’y ai fait trois pas, j’en ferai deux autres.
Vous voulez organiser la circulation de telle sorte que chacun perçoive autant d’intérêts qu’il en paie, et c’est là ce qui réalisera, dites-vous, l’égalité des fortunes.
Or, je dis :
Compensation universelle des intérêts, — chimère.
Égalité absolue des fortunes, comme conséquence de cette chimère, — autre chimère.
Toute valeur se compose de deux éléments : la rémunération du travail et la rémunération du capital. Pour que ces deux éléments entrassent, en proportion identique, dans toutes valeurs égales, il faudrait que toute œuvre humaine admît le même emploi de machines, la même consommation d’approvisionnements, le même contingent de travail actuel et de travail accumulé.
Votre banque fera-t-elle jamais que le commissionnaire du coin, dont toute l’industrie consiste à louer son temps et ses jambes, fasse intervenir autant de capital dans ses services que l’imprimeur ou le fabriquant de bas ? Remarquez que, pour qu’une paire de bas de coton arrive à ce commissionnaire, il a fallu l’intervention d’une terre, qui est un capital ; d’un navire, qui est un capital ; d’une filature, qui est un capital. Direz-vous que lorsque le commissionnaire échange son service, estimé 3 francs, contre un livre estimé 3 francs, il est dupe en ce que l’élément travail actuel domine dans le service, et l’élément travail accumulé dans le livre ? Qu’importe, si les deux objets de l’échange se valent, si leur équivalence est déterminée par le libre débat ? Pourvu que ce qui vaut cent s’échange contre ce qui vaut cent, qu’importe la proportion des deux éléments qui constituent chacune de ces valeurs égales ? Nierez-vous la légitimité de la rémunération afférente au capital ? Ce serait revenir sur un point déjà acquis à la discussion. D’ailleurs, sur quel fondement le travail ancien serait-il, plus que le travail actuel, exclu de toute rétribution ?
Le travail se divise en deux catégories bien distinctes :
Ou il est exclusivement consacré à la production d’un objet, comme lorsque l’agriculteur sème, sarcle, moissonne et égrène son blé, lorsque le tailleur coupe et coud un habit, etc. ;
Ou il sert à la production d’une série indéterminée d’objets semblables, comme quand l’agriculteur clôt, amende, dessèche son champ, ou que le tailleur meuble son atelier.
Dans le premier cas, tout le travail doit être payé par l’acquéreur de la récolte ou de l’habit ; dans le second, il doit être payé sur un nombre indéterminé de récoltes ou d’habits. Et certes, il serait absurde de dire que le travail de cette seconde catégorie ne doit pas être payé du tout, parce qu’il prend le nom de capital.
Or, comment parvient-il à répartir la rémunération qui lui est due sur un nombre indéfini d’acheteurs successifs ? par les combinaisons de l’amortissement et de l’intérêt, combinaisons que l’humanité a inventées dès l’origine, combinaisons ingénieuses, que les socialistes seraient bien embarrassés de remplacer. Aussi tout leur génie se borne à les supprimer, et ils ne s’aperçoivent pas que c’est tout simplement supprimer l’humanité.
Mais quand on accorderait comme réalisable tout ce qui vient d’être démontré chimérique : gratuité de circulation, gratuité de prêt, compensation d’intérêts, je dis qu’on n’arriverait pas encore à l’égalité absolue des fortunes. Et la raison en est simple. Est-ce que la Banque du Peuple aurait la prétention de changer le cœur humain ? Fera-t-elle que tous les hommes soient également forts, actifs, intelligents, ordonnés, économes, prévoyants ? fera-t-elle que les goûts, les penchants, les aptitudes, les idées ne varient à l’infini ? que les uns ne préfèrent dormir au soleil, pendant que les autres s’épuisent au travail ? qu’il n’y ait des prodigues et des avares, des gens ardents à poursuivre les biens de ce monde, et d’autres plus préoccupés de la vie future ? Il est clair que l’égalité absolue des fortunes ne pourrait être que la résultante de toutes ces égalités impossibles et de bien d’autres.
Mais si l’égalité absolue des fortunes est chimérique, ce qui ne l’est pas, c’est l’approximation constante de tous les hommes vers un même niveau physique, intellectuel et moral, sous le régime de la liberté. Parmi toutes les énergies qui concourent à ce grand nivellement, une des plus puissantes, c’est celle du capital. Et puisque vous m’avez offert vos colonnes, permettez-moi d’appeler un moment l’attention de vos lecteurs sur ce sujet. Ce n’est pas tout de démontrer que l’intérêt est légitime, il faut encore prouver qu’il est utile, même à ceux qui le supportent. Vous avez dit que l’intérêt a été autrefois « un instrument d’égalité et de progrès. » Ce qu’il a été, il l’est encore et le sera toujours, parce qu’en se développant il ne change pas de nature.
Les travailleurs seront peut-être étonnés de m’entendre affirmer ceci :
De tous les éléments qui entrent dans le prix des choses, celui qu’ils doivent payer avec le plus de joie, c’est précisément l’intérêt ou la rémunération du capital, parce que ce paiement leur en épargne toujours un plus grand.
Pierre est un artisan parisien. Il a besoin qu’un fardeau soit transporté à Lille ; c’est un présent qu’il veut faire à sa mère. S’il n’y avait pas de capital au monde (et il n’y en aurait pas si toute rémunération lui était déniée), ce transport coûterait à Pierre au moins deux mois de fatigues, soit qu’il le fît lui-même, soit qu’il se fît rendre ce service par un autre ; car il ne pourrait l’exécuter lui-même qu’en charriant le fardeau par monts et par vaux, sur ses épaules, et nul ne pourrait l’exécuter pour lui que de la même manière.
Pourquoi se rencontre-t-il des entrepreneurs qui ne demandent à Pierre qu’une journée de son travail pour lui en épargner soixante ? Parce que le capital est intervenu sous forme de char, de chevaux, de rails, de wagons, de locomotives. Sans doute, Pierre doit payer tribut à ce capital ; mais c’est justement pour cela qu’il fait ou fait faire en un jour ce qui lui aurait demandé deux mois.
Jean est maréchal ferrant, fort honnête homme, mais qu’on entend souvent déclamer contre la propriété. Il gagne 3 francs par jour ; c’est peu, c’est trop peu ; mais enfin, comme le blé vaut environ 18 francs l’hectolitre, Jean peut dire qu’il fait jaillir de son enclume un hectolitre de blé par semaine ou la valeur, soit 52 hectolitres par an. Je suppose maintenant qu’il n’y eût pas de capital, et que, mettant notre maréchal en face de 1,000 hectares de terre, on lui dît : Disposez de ce sol, qui est doué d’une grande fertilité ; tout le blé que vous ferez croître est à vous. Jean répondrait sans doute : « Sans chevaux, sans charrue, sans hache, sans instruments d’aucune sorte, comment voulez-vous que je débarrasse le sol des arbres, des racines, des herbes, des pierres, des eaux stagnantes qui l’obstruent ? je n’y ferai pas pousser une gerbe de blé en dix ans. » Donc, que Jean fasse enfin cette réflexion : « Ce que je ne pourrais faire en dix ans, d’autres le font pour moi, et ne me demandent qu’une semaine de travail. Il est clair que c’est un avantage pour moi de rémunérer le capital, car si je ne le rémunérerais pas, il n’y en aurait pas, et les autres seraient aussi embarrassés devant ce sol que je le suis moi-même. »
Jacques achète tous les matins, pour un sou, la Voix du Peuple. Comme il gagne 100 sous par jour, ou 50 centimes par heure, c’est six minutes de travail qu’il échange contre le prix d’un numéro, prix dans lequel se trouvent comprises deux rémunérations, celle du travail et celle du capital. Comment Jacques ne se dit-il pas quelquefois : « Si aucun capital n’intervenait dans l’impression de la Voix du Peuple, je ne l’obtiendrais ni à un sou ni à 100 francs ? »
Je pourrais passer en revue tous les objets qui satisfont les besoins des travailleurs, et la même réflexion reviendrait sans cesse. Donc le capital n’est pas le tyran que l’on dit. Il rend des services, de grands services ; il est de toute justice qu’il en soit rémunéré. Cette rémunération diminue de plus en plus à mesure que le capital abonde. Pour qu’il abonde, il faut qu’on soit intéressé à le former, et pour qu’on soit intéressé à le former, il faut être soutenu par l’espoir d’une rémunération. Quel est l’artisan, quel est l’ouvrier qui portera ses économies à la Caisse d’épargne, ou même qui fera des économies, si l’on commence par déclarer que l’intérêt est un vol et qu’il faut le supprimer ?
Non, non, c’est là une propagande insensée ; elle heurte la raison, la morale, la science économique, les intérêts du pauvre, les croyances unanimes du genre humain manifestées par la pratique universelle. Vous ne prêchez pas, il est vrai, la tyrannie du capital, mais vous prêchez la gratuité du crédit, ce qui est tout un. Dire que toute rémunération accordée au capital est un vol, c’est dire que le capital doit disparaître de la surface du globe, c’est dire que Pierre, Jean, Jacques, doivent exécuter les transports, se procurer le blé, les livres, avec autant de travail qu’il leur en faudrait pour produire ces choses directement et sans autre ressource que leurs mains.
Marche, marche, capital ! poursuis ta carrière, réalisant du bien pour l’humanité ! C’est toi qui as affranchi les esclaves ; c’est toi qui as renversé les châteaux forts de la féodalité ! Grandis encore ; asservis la nature : fais concourir aux jouissances humaines la gravitation, la chaleur, la lumière, l’électricité ; prends à ta charge ce qu’il y a de répugnant et d’abrutissant dans le travail mécanique ; élève la démocratie, transforme les machines humaines en hommes, en hommes doués de loisirs, d’idées, de sentiment et d’espérances !
Permettez-moi, Monsieur, en finissant, de vous adresser un reproche. Au début de votre lettre, vous m’aviez promis de renoncer pour aujourd’hui à l’antinomie ; vous la terminez cependant par cette antinomie que vous appelez votre cri de guerre : La propriété, c’est le vol.
Oui, vous l’avez bien caractérisée ; c’est, en effet, un lugubre tocsin, un sinistre cri de guerre. Mais j’ai l’espoir que, sous ce rapport, elle a perdu quelque chose de sa puissance. Il y a dans l’esprit des masses un fond de bon sens qui ne perd pas ses droits, et se révolte enfin contre ces paradoxes étranges donnés pour de sublimes découvertes. Oh ! que n’avez-vous établi votre active propagande sur cet autre axiome, assurément plus impérissable que le vôtre : Le vol, c’est le contraire de la propriété ! Alors, avec votre indomptable énergie, votre style populaire, votre dialectique invincible, je ne puis mesurer le bien qu’il vous eût été donné de répandre sur notre chère patrie et sur l’humanité.
Frédéric Bastiat.
SEPTIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat ↩
Reproches. — Les commissionnaires de roulage et les chemins de fer. — Excursion rétrospective chez les Hébreux, les Grecs et les Romains. — Neschek, Tokos, Fœnus, Interesse. — L’intérêt issu du contrat de pacotille. — Intervention des monnaies et conséquences. — Moïse, Solon, Lycurgue. — La force seule maintient l’intérêt. — Deux apologues.
17 décembre 1849.
Notre discussion n’avance pas, et la faute en est à vous seul. Par votre refus systématique de vous placer sur le terrain où je vous appelle, et votre obstination à m’attirer sur le vôtre, vous méconnaissez en ma personne le droit qu’a tout novateur à l’examen ; vous manquez au devoir qu’impose à tout économiste, défenseur naturel de la tradition et des usages établis, l’apparition des idées nouvelles ; vous compromettez, enfin, la charité publique, en m’obligeant à attaquer ce que je reconnaissais, dans une certaine mesure, comme irréprochable et légitime.
Vous l’avez voulu : que votre désir soit accompli !
Permettez-moi d’abord de résumer notre controverse.
Dans une première lettre, vous avez essayé de montrer, par la théorie et par de nombreux exemples, que le prêt était un service, et que, tout service ayant une valeur, il avait le droit de se faire payer : d’où vous déduisiez immédiatement, contre moi, cette conclusion, que la gratuité du crédit était une chimère, partant, le socialisme une protestation sans principes comme sans motifs.
Ainsi peu importe de savoir si c’est vous qui avez sollicité l’entrée de la Voix du Peuple, ou si c’est moi qui vous ai offert la publicité de ses colonnes : en fait, et chacune de vos lettres en témoigne, vous n’avez eu d’autre but que de renverser, par une fin de non-recevoir, la théorie du crédit gratuit.
Je vous ai donc répondu, et j’ai dû vous répondre, sans entrer dans l’examen de votre théorie de l’intérêt, que si vous vouliez combattre utilement et sérieusement le socialisme, il fallait l’attaquer en lui-même et dans ses propres doctrines ; que le socialisme, sans nier d’une manière absolue la légitimité de l’intérêt considéré à un certain point de vue et à une certaine époque de l’histoire, affirmait la possibilité, dans l’état actuel de l’économie sociale, d’organiser, par le concours des travailleurs, un système de prêt sans rétribution, et, par suite, de donner à tous la garantie du crédit et du travail. J’ai dit, enfin, que c’était là ce que vous aviez à examiner, si vous vouliez que la discussion aboutît.
Dans votre seconde lettre, vous avez péremptoirement refusé de suivre cette marche, alléguant que pour vous, et d’après mon aveu, l’intérêt ne constituant dans son principe ni crime, ni délit, il était impossible d’admettre que le prêt pût s’effectuer sans intérêt ; qu’il était inconcevable qu’une chose pût être vraie et fausse tout à la fois ; bref, que tant que la criminalité de l’intérêt ne vous serait pas démontrée, vous tiendriez la théorie du crédit gratuit comme non avenue. Tout cela assaisonnée de force plaisanteries sur la loi de contradiction, que vous ne comprenez point, et flanqué d’exemples très-propres, je l’avoue, à faire comprendre le mécanisme de l’intérêt, mais qui ne prouvent absolument rien contre la gratuité.
Dans ma réplique, je crois vous avoir prouvé, en me servant de votre propre méthode, que rien n’est moins rare, dans la société, que de voir une institution, un usage, d’abord libéral et légitimité, devenir, avec le temps, une entrave à la liberté et une atteinte à la justice ; qu’il en était ainsi du prêt à intérêt le jour où il était démontré que le crédit peut être donné à tous sans rétribution ; que d’ores et déjà, refuser d’examiner cette possibilité du crédit gratuit constituait un déni de justice, une offense à la foi publique, un défi au prolétariat. Je renouvelai donc auprès de vous mes instances, et je vous dis : Ou vous examinerez les diverses propositions du socialisme, ou je déclare que l’intérêt de l’argent, la rente de la terre, le loyer des maisons et des capitaux est une spoliation, et que la propriété, ainsi constituée, est un vol.
Chemin faisant, j’indiquais sommairement les causes qui, selon moi, altèrent la moralité de l’intérêt, et les moyens de le supprimer.
Certes, il semblait que, pour justifier votre théorie désormais accusée de vol et de larcin, vous ne pouviez plus vous dispenser d’aborder enfin la doctrine nouvelle, qui prétend donner l’exclusion à l’intérêt. C’était, j’ose le dire, ce à quoi s’attendaient tous nos lecteurs. En évitant de faire la critique de l’intérêt, je faisais preuve de conciliation et d’amour de la paix. Il me répugnait d’incriminer la bonne foi des capitalistes, et de jeter la suspicion sur les propriétaires. Je désirais surtout abréger une dispute fatigante, et hâter la conclusion définitive. Vraie ou fausse, vous disais-je, légitime ou illégitime, morale ou immorale, j’accepte l’usure, je l’approuve, je la loue même ; je renonce à toutes les illusions du socialisme, et me refais chrétien, si vous me démontrez que la prestation des capitaux, de même que la circulation des valeurs, ne saurait, dans aucun cas, être gratuite. C’était, comme l’on dit, faire rondement les choses, et couper court à bien des discussions tout à fait oiseuses dans un journal, et, permettez-moi de le dire, fort périlleuses en ce moment.
Est-il, oui ou non, possible d’abolir l’intérêt de l’argent, par suite, la rente de la terre, le loyer des maisons, le produit des capitaux, d’une part, en simplifiant l’impôt, et de l’autre, en organisant une banque de circulation et de crédit, au nom et pour le compte du Peuple ? C’est ainsi, selon moi, que la question devait être posée entre nous. L’amour de l’humanité, de la vérité, de la concorde, nous en faisait à tous deux une loi. Que fait le Peuple depuis Février ? Qu’a fait l’Assemblée constituante ? Que fait aujourd’hui la Législative ? si ce n’est de rechercher les moyens d’améliorer le sort du travailleur, sans alarmer les intérêts légitimes, sans infirmer le droit du propriétaire. Cherchons donc si la gratuité du crédit ne serait point, par hasard, un de ces moyens.
Telles étaient mes paroles. J’osai croire qu’elles seraient entendues. Au lieu d’y répondre, comme je l’espérais, vous vous retranchez dans votre fin de non-recevoir. À cette interrogation de ma part : « Prouver que la gratuité du crédit est chose possible, facile, pratique, n’est-ce pas prouver que l’intérêt du crédit est désormais chose nuisible et illégitime ? » — vous répondez, en retournant la phrase : « Prouver que l’intérêt est (ou a été) légitime, juste, utile, bienfaisant, indestructible, n’est-ce pas prouver que la gratuité du crédit est une chimère ? » Vous raisonnez juste comme les entrepreneurs de roulage à l’égard des chemins de fer.
Voyez-les, en effet, adresser leurs doléances au public qui les délaisse et qui court à la concurrence : — Est-ce que le chariot et la malbrouck ne sont pas des institutions utiles, légitimes, bienfaisantes, indestructibles ? Est-ce qu’en transportant vos personnes et vos produits, nous ne vous rendons pas un service ? Est-ce que ce service n’est pas une valeur ? Est-ce que toute valeur ne doit pas être payée ? Est-ce qu’en faisant le transport à 25 c. par tonne et kilomètre, tandis que la locomotive le fait, il est vrai, à 10 c., nous sommes des voleurs ? Est-ce que le commerce ne s’est pas développé perpétuellement et universellement par le roulage, la bête de somme, la navigation à voiles ou à rames ? Que nous importent donc et la vapeur, et la pression atmosphérique, et l’électricité ? Prouver la réalité et la légitimité de la voiture à quatre roues, n’est-ce pas prouver que l’invention des chemins de fer est une chimère ?
Voilà, Monsieur, où vous conduit votre argumentation. Votre dernière lettre n’a, comme les précédentes, et du commencement à la fin, pas d’autre sens. Pour conserver au capital l’intérêt que je lui refuse, vous me répondez par la question préalable, vous opposez à mon idée novatrice votre routine ; vous protestez contre le rail et la machine à vapeur. Je serais désolé de vous dire rien de blessant ; mais, en vérité, Monsieur, il me semble que j’aurais le droit, dès ce moment, de briser là et de vous tourner le dos.
Je ne le ferai point : je veux vous donner satisfaction jusqu’à la fin, en vous montrant comment, pour me servir de vos paroles, la rémunération du capital passe de la légitimé à l’illégitimité, et comment la gratuité du crédit est la conclusion finale de la pratique de l’intérêt. Cette discussion, par elle-même, ne manque pas d’importance ; je m’efforcerai surtout de la rendre pacifique.
Ce qui fait que l’intérêt du capital, excusable, juste même, au point de départ de l’économie des sociétés, devient, avec le développement des institutions industrielles, une vraie spoliation, un vol, c’est que cet intérêt n’a pas d’autre principe, d’autre raison d’être, que la nécessité et la force. La nécessité, voilà ce qui explique l’exigence du prêteur ; la force, voilà ce qui fait la résignation de l’emprunteur. Mais, à mesure que, dans les relations humaines, la nécessité fait place à la liberté, et qu’à la force succède le droit, le capitaliste perd son excuse, et la revendication s’ouvre pour le travailleur contre le propriétaire.
Au commencement, la terre est indivise ; chaque famille vit de sa chasse, pêche, cueillette, ou pâture ; l’industrie est toute domestique ; l’agriculture, pour ainsi dire, nomade. Il n’y a ni commerce, ni propriété.
Plus tard, les tribus s’agglomérant, les nations commencent à se former ; la caste apparaît née de la guerre et du patriarcat. La propriété s’établit peu à peu ; mais, selon le droit héroïque, le maître, quand il ne cultive pas de ses propres mains, exploite par ses esclaves, comme plus tard le seigneur par ses serfs. Le fermage n’existe point encore ; la rente, qui indique ce rapport, est inconnue.
À cette époque, le commerce se fait surtout en échanges. Si l’or et l’argent apparaissent dans les transactions, c’est plutôt comme marchandise que comme agent de circulation et unité de valeur : on les pèse, on ne les compte pas. Le change, l’agio qui en est la conséquence, le prêt à intérêt, la commandite, toutes ces opérations d’un commerce développé, auxquelles donne lieu la monnaie, sont inconnues. Longtemps ces mœurs primitives se sont conservées parmi les populations agricoles. Ma mère, simple paysanne, nous racontait qu’avant 89, elle se louait l’hiver pour filer le chanvre, recevant, pour salaire de six semaines de travail, avec sa nourriture, une paire de sabots et un pain de seigle.
C’est dans le commerce de mer qu’il faut rechercher l’origine de prêt à intérêt. Le contrat à la grosse, variété ou plutôt démembrement du contrat de pacotille, fut sa première forme ; de même que le bail à ferme ou à cheptel fut l’analogue de la commandite.
Qu’est-ce que le contrat de pacotille ? Un traité par lequel un industriel et un patron de navire conviennent de mettre en commun, pour le commerce étranger, le premier, une certaine quantité de marchandises qu’il se charge de procurer ; le second, son travail de navigateur : le bénéfice résultant de la vente devant être partagé par portions égales, ou suivant une proportion convenue ; les risques et avaries mis à la charge de la société.
Le bénéfice ainsi prévu, quelque considérable qu’il puisse être, est-il légitime ? On ne saurait le révoquer en doute. Le bénéfice, à cette première époque des relations commerciales, n’est pas autre chose que l’incertitude qui règne, entre les échangistes, sur la valeur de leurs produits respectifs : c’est un avantage qui existe plutôt dans l’opinion que dans la réalité, et qu’il n’est pas rare de voir les deux parties, avec une égale raison, s’attribuer l’une et l’autre. Combien un once d’or vaut-elle de livres d’étain ? Quel rapport de prix entre la pourpre de Tyr et la peau de zibeline ? Nul ne le sait, nul ne le peut dire. Le Phénicien, qui, pour un ballot de fourrures, livre dix palmes de son étoffe, s’applaudit de son marché : autant en pense, de son côté, le chasseur hyperboréen, fier de sa casaque rouge. Et telle est encore la pratique des Européens avec les sauvages de l’Australie, heureux de donner un porc pour une hache, une poule pour un clou ou un grain de verre.
L’incommensurabilité des valeurs : telle est, à l’origine, la source des bénéfices du commerce. L’or et l’argent entrent donc dans le trafic, d’abord comme marchandises ; puis bientôt, en vertu de leur éminente échangeabilité, comme termes de comparaison, comme monnaies. Dans l’un et l’autre cas, l’or et l’argent portent bénéfice à l’échange, en premier lieu, par le fait même de l’échange ; ensuite, pour le risque couru. Le contrat d’assurance apparaît ici comme le frère jumeau du contrat à la grosse ; la prime stipulée dans le premier est corrélative, identique, à la part de bénéfice convenue dans le second.
Cette part de bénéfice, par laquelle s’exprime la participation du capitaliste ou industriel, qui engage ses produits ou ses fonds, c’est tout un dans le commerce, a reçu le nom latin d’interesse, c’est-à-dire participation, intérêt.
À ce moment donc, et dans les conditions que je viens de définir, qui pourrait accuser de dol la pratique de l’intérêt ? L’intérêt, c’est l’alea, le gain obtenu contre la fortune ; c’est le bénéfice aléatoire du commerce, bénéfice irréprochable tant que la comparaison des valeurs n’a pas fourni les idées corrélatives de cherté, de bon marché, de proportion, de prix. La même analogie, la même identité, que l’économie politique a signalée de tout temps et avec raison, entre l’intérêt de l’agent et la rente de la terre, existe, au début des relations commerciales, entre ce même intérêt et le bénéfice du commerce : au fond, l’échange est la forme commune, le point de départ de toutes ces transactions.
Vous voyez, Monsieur, que l’opposition énergique que je fais au capital, ne m’empêche point de rendre justice à la bonne foi originelle de ses opérations. Ce n’est pas moi qui marchanderai jamais avec la vérité. Je vous ai dit qu’il existait dans le prêt à intérêt un côté vrai, honnête, légitime ; je viens de l’établir d’une façon qui, ce me semble, vaut encore mieux que la vôtre, en ce qu’elle ne sacrifie rien à l’égoïsme, n’ôte rien à la charité. C’est l’impossibilité d’évaluer les objets avec exactitude, qui fonde, au commencement, la légitimé de l’intérêt, comme, plus tard, c’est la recherche des métaux précieux qui la soutient. Il faut bien que le prêt à l’intérêt ait eu sa raison positive et nécessitante pour qu’il se soit développé et généralisé comme on l’a vu ; il le faut, dis-je, à peine de damner, avec les théologiens, l’humanité toute entière, que je fais profession, quant à moi, de considérer comme infaillible et sainte.
Mais qui ne voit déjà que le bénéfice du commerçant doit diminuer progressivement avec le risque couru et avec l’arbitraire des valeurs, pour n’être plus à la fin que le juste prix du service rendu par lui, le salaire de son travail ? Qui ne voit pareillement que l’intérêt doit s’atténuer avec les chances que court le capital, et la privation qu’éprouve le capitaliste ; en sorte que s’il y a garantie de remboursement de la part du débiteur, et si la peine de créancier est zéro, l’intérêt doit devenir zéro ?
Une autre cause, qu’il importe ici de ne point omettre, parce qu’elle marque le point de transition ou de séparation entre la part de bénéfice, interesse, afférente au capitaliste dans le contrat à la grosse, et l’usure proprement dite ; une autre cause, dis-je, tout à fait accidentelle, contribua singulièrement à vulgariser la fiction de la productivité du capital, et par suite la pratique de l’intérêt. Ce furent, chez les gens de commerce, les exigences de la compatibilité, la nécessité de presser les rentrées ou remboursements. Quel stimulant plus énergique, je vous le demande, pouvait-on imaginer à l’égard du débiteur indolent et retardataire, que cette aggravation, fœnus, cet enfantement, tokos, incessant du principal ? Quel huissier plus inflexible que ce serpent de l’usure, comme dit l’hébreu ? L’usure, disent les vieux rabbins, est appelée serpent, nescheck, parce que le créancier mord le débiteur, lorsqu’il lui réclame plus qu’il ne lui a donné. Et c’est cet instrument de police, cette espèce de garde du commerce lancé par le créancier à la gorge de son débiteur, dont on a voulu faire un principe de justice commutative, une loi de l’économie sociale ! Il faut n’avoir jamais mis le pied dans une maison de négoce, pour méconnaître à ce point l’esprit et le but de cette invention vraiment diabolique du génie mercantile.
Suivons maintenant le progrès de l’institution, car nous touchons au moment où le nescheck, le tokos, le fœnus, l’usure, enfin, se distinguant du bénéfice aléatoire, ou interesse, de l’expéditeur, va devenir une institution : et voyons d’abord comment s’en est généralisée la pratique. Nous tâcherons, après, de déterminer les causes qui doivent en amener l’abolition.
Nous venons de voir que ce fut chez les peuples navigateurs, faisant pour les autres le courtage et l’entrepôt, et opérant surtout sur les marchandises précieuse et les métaux, que se développa d’abord la spéculation mercantile ; et du même coup la spéculation de l’interesse, ou contrat à la grosse. C’est de là que l’usure, comme une peste, s’est propagée, sous toutes les formes, chez les nations agricoles.
L’opération, irréprochable en soi, de l’interesse, avait créé un précédent justificatif ; la méthode, qu’on pourrait appeler de coercition et sûreté, du fœnus, aggravation progressive du capital, donnait le moyen ; la prépondérance acquise par l’or et l’argent sur les autres marchandises, le privilége qu’ils reçurent, du consentement universel, de représenter la richesse et de servir d’évaluateur commun à tous les produits, fournit l’occasion. Quand l’or fut devenu le roi de l’échange, le symbole de la puissance, l’instrument de toute félicité, chacun voulut avoir de l’or ; et comme il était impossible qu’il y en eût pour tout le monde, il ne se donna plus qu’avec prime ; son usage fut mis à prix. Il se loua au jour, à la semaine et à l’an, comme le joueur de flûte et la prostituée. C’était une conséquence de l’invention de la monnaie, de faire estimer à vil prix, en comparaison de l’or, tous les autres biens, et de faire consister la richesse réelle, comme l’épargne, dans les écus. L’exploitation capitaliste, honnie de toute l’antiquité, mieux renseignée que nous assurément, sur cette matière, car elle touchait aux origines, fut ainsi fondée : il était réservé à notre siècle de lui fournir des docteurs et des avocats.
Tant que, se confondant avec la prime de l’assurance ou la part de bénéfice du contrat à la grosse, l’user s’était renfermée dans la spéculation maritime, et n’avait eu d’action que sur l’étranger, elle avait paru inoffensive aux législateurs. Ce n’est que lorsqu’elle commença de s’exercer entre concitoyens et compatriotes, que les lois divines et humaines fulminèrent contre elle l’interdit. Tu ne placeras point ton argent à intérêt sur notre frère, dit la loi de Moïse, mais oui bien sur l’étranger : Non fœnerabis proximo tuo, sed alieno. Comme si le législateur avait dit : de peuple à peuple, le bénéfice du commerce et le croît des capitaux n’expriment qu’un rapport entre valeurs d’opinion, valeurs qui, par conséquent, s’équilibrent : de citoyen à citoyen, le produit devant s’échanger contre le produit, le travail contre le travail, et le prêt d’argent n’étant qu’une anticipation de cet échange, l’intérêt constitue une différence qui rompt l’égalité commerciale, enrichit l’un au détriment de l’autre, et entraîne, à la longue, la subversion de la société.
Aussi fut-ce d’après ce principe que le même Moïse voulut que toute dette fut périmée et cessât d’être exigible à chaque cinquantième année : ce qui voulait dire que cinquante années d’intérêt ou cinquante annuités, en supposant que le prêt eût été fait la première année après le jubilé, remboursaient le capital.
C’est pour cela que Solon, appelé à la présidence de la république par ses concitoyens, et chargés d’apaiser les troubles qui agitaient la cité, commença par abolir les dettes, c’est-à-dire par liquider toutes les usures. La gratuité du crédit fut pour lui la seule solution du problème révolutionnaire posé de son temps, la condition sine quâ non d’une république démocratique et sociale.
C’est pour cela, enfin, que Lycurgue, esprit peu versé dans les questions de crédit et de finance, poussant à l’extrême ses appréhensions, avait banni de Lacédémone le commerce et la monnaie : ne trouvant pas, contre la subalternisation des citoyens et l’exploitation de l’homme par l’homme, d’autre remède que cette solution Icarienne.
Mais tous ces efforts, mal concertés, plus mal encore secondés, des anciens moralistes et législateurs, devaient rester impuissants. Le mouvement usuraire les débordait, sans cesse activé par le luxe et la guerre, et bientôt par l’analogie tirée de la propriété elle-même. D’un côté, l’état antagonique des peuples, entretenant les périls de la circulation, fournissait sans cesse de nouveaux prétextes à l’usure ; de l’autre, l’égoïsme des castes régnantes devait étouffer les principes d’organisation égalitaire. À Tyr, à Carthage, à Athènes, à Rome, partout dans l’antiquité comme de nos jours, ce furent les hommes libres, les patriciens, les bourgeois, qui prirent l’usure sous leur protection, et exploitèrent, par le capital, la plèbe et les affranchis.
Le christianisme parut alors, et après quatre siècles de combat, commença l’abolition de l’esclavage. C’est à cette époque qu’il faut placer la grande généralisation du prêt à intérêt sous la forme du bail à ferme et à loyer.
J’ai dit plus haut que, dans l’antiquité, le propriétaire foncier, lorsqu’il ne faisait pas valoir par lui-même et par sa famille, comme cela avait lieu chez les Romains, dans les premiers temps de la république, exploitait par ses esclaves : telle fut généralement la pratique des maisons patriciennes. Alors le sol et l’esclave étaient enchaînés l’un à l’autre ; le colon était dit : adscriptus glebœ, attaché à la glèbe : la propriété de l’homme et de la chose était indivise. Le prix d’une métairie était à la fois en raison, 1° de la superficie et de la qualité du sol, 2° de la quantité du bétail, 3° du nombre des esclaves.
Quand l’émancipation de l’esclave fut proclamée, le propriétaire perdit l’homme et garda la terre ; absolument, comme aujourd’hui, en affranchissant les noirs, nous réservons au maître la propriété du sol et du matériel. Pourtant, au point de vue de l’antique jurisprudence, comme du droit naturel et chrétien, l’homme, né pour le travail, ne peut se passer d’instruments de travail ; le principe de l’émancipation impliquait une loi agraire qui en fût la garantie et la sanction ; sans cela, cette prétendue émancipation n’était qu’un acte d’odieuse cruauté, une infâme hypocrisie. Et si, d’après Moïse, l’intérêt ou l’annuité du capital rembourse le capital, ne pouvait-on dire que le servage rembourse la propriété ? Les théologiens et les légistes du temps ne le comprirent pas. Par une contradiction inexplicable, et qui dure encore, ils continuèrent à déblatérer contre l’usure, mais ils donnèrent l’absolution au fermage et au loyer.
Il résultat de là que l’esclave émancipé, et quelques siècles plus tard, le serf affranchi, sans moyens d’existence, dut se faire fermier, et payer tribut. Le maître ne s’en trouva que plus riche. Je te fournirai, dit-il, la terre ; tu fourniras le travail : et nous partagerons. C’était une imitation rurale des us et coutumes du négoce : je te prêterai dix talents, disait au travailleur l’homme aux écus ; tu les feras valoir : et puis, ou nous partagerons le bénéfice ; ou bien, tant que tu garderas mon argent, tu me paieras un 20e ; ou bien, enfin, si tu l’aimes mieux, à l’échéance tu me le rendras double. De là naquit la rente foncière, inconnue des Russes et des Arabes. L’exploitation de l’homme par l’homme, grâce à cette métamorphose, passa en force de loi : l’usure, condamnée dans le prêt à intérêt, tolérée dans le contrat à la grosse, fut canonisée dans le fermage. Dés lors les progrès du commerce et de l’industrie ne servirent qu’à la faire entrer de plus en plus dans les mœurs. Il fallait qu’il en fût ainsi pour mettre en lumière toutes les variétés de la servitude et du vol, et poser la vraie formule de la liberté humaine.
Une fois engagée dans cette pratique de l’interesse, si étrangement compris, si abusivement appliqué, la société commença de tourner dans le cercle de ses misères. C’est alors que l’inégalité des conditions parut une loi de la civilisation, et le mal une nécessité de notre nature.
Deux issues, cependant, semblaient ouvertes aux travailleurs, pour s’affranchir de l’exploitation du capitaliste : c’étaient d’une part, comme nous l’avons dit plus haut, l’équilibration progressive des valeurs, et par suite, la baisse de prix des capitaux ; de l’autre, la réciprocité de l’intérêt.
Mais il est évident que le revenu du capital, représenté surtout par l’argent, ne peut totalement s’annihiler par la baisse ; car, comme vous le dites très-bien, Monsieur, si mon capital ne doit me rapporter plus rien, au lieu de le prêter, je le garde, et, pour avoir voulu refuser la dîme, le travailleur chômera. Quant à la réciprocité des usures, on conçoit, à toute force, qu’elle puisse exister d’entrepreneur à entrepreneur, de capitaliste à capitaliste, de propriétaire à propriétaire ; mais de propriétaire, capitaliste ou entrepreneur, à celui qui n’est qu’ouvrier, cette réciprocité est impossible. Il est impossible, dis-je, que, l’intérêt du capital s’ajoutant, dans le commerce, au salaire de l’ouvrier pour composer le prix de la marchandise, l’ouvrier puisse racheter ce qu’il a lui-même produit. Vivre en travaillant est un principe qui, sous le régime de l’intérêt, implique contradiction.
La société une fois acculée dans cette impasse, l’absurdité de la théorie capitaliste est démontrée par l’absurdité de ses conséquences ; l’iniquité, en soi, de l’intérêt, résulte de ses effets homicides ; et, tant que la propriété aura pour corollaire et postulatum la rente et l’usure, son affinité avec le vol sera établie. Peut-elle exister dans d’autres conditions ? Quant à moi, je le nie ; mais cette recherche est étrangère à la question qui nous occupe en ce moment, et je ne m’y engagerai point.
Considérez, maintenant, dans quelle situation se trouvent à la fois, — par suite de l’invention de la monnaie, de la prépondérance du numéraire, et de l’assimilation faite entre le prêt d’argent et la location de la terre et des immeubles, — et le capitaliste et le travailleur.
Le premier, — car je tiens à le justifier, même à vos yeux, — obligé par le préjugé monétaire, ne peut se dessaisir gratuitement de son capital en faveur de l’ouvrier. Non que ce dessaisissement lui cause une privation, puisque, dans ses mains, le capital est stérile ; non qu’il coure risque de le perdre, puisque, par les précautions de l’hypothèque, il est assuré du remboursement ; non que cette prestation lui coûte la moindre peine, à moins que vous ne considériez comme peine le compte des écus et la vérification du gage ; mais c’est qu’en se dessaisissant, pour un temps quelconque, de son argent, de cet argent qui, par sa prérogative, est, comme on l’a si justement dit, du pouvoir, le capitaliste diminue sa puissance et sa sécurité.
Ce serait toute autre chose, si l’or et l’argent n’étaient qu’une marchandise ordinaire, si l’on ne tenait pas plus à la possession des écus qu’à du blé, du vin, de l’huile ou du cuir ; si la simple faculté de travailler donnait à l’homme la même sécurité que la possession de l’argent. Sous ce monopole de la circulation et de l’échange, l’usure devient, pour le capitaliste, une nécessité. Son intention, devant la justice, n’est point incriminable : dès que son argent est sorti de son coffre, il n’est plus en sûreté.
Or, cette nécessité qui, par le fait d’un préjugé involontaire et universellement répandu, incombe au capitaliste, constitue pour le travailleur la plus indigne spoliation, comme la plus odieuse des tyrannies, la tyrannie de la force.
Quelles sont, en effet, pour la classe travailleuse, pour cette partie vivante, productrice, morale, des sociétés, les conséquences théoriques et pratiques du prêt à intérêt et de son analogie, le fermage ? Je me borne, pour aujourd’hui, à vous en énumérer quelques-unes, sur lesquelles j’appelle votre attention, et qui pourront, si vous y tenez, devenir l’objet ultérieur de notre débat.
C’est qu’en vertu du principe de l’intérêt, ou du produit net, un individu peut réellement et légitiment vivre sans travailler : c’est la conclusion de votre avant-dernière lettre, et telle est, en effet, la condition à laquelle aujourd’hui tout le monde aspire.
C’est que, si le principe du produit net est vrai de l’individu, il doit l’être aussi de la nation ; qu’ainsi, le capital mobilier et immobilier de la France, par exemple, étant évalué à 132 milliards, ce qui donne, à 5 pour 100 par an d’intérêts, 6 milliards 600 millions, la moitié au moins du peuple français pourrait, si elle voulait, vivre sans rien faire ; qu’en Angleterre, où le capital accumulé est beaucoup plus considérable qu’en France, et la population beaucoup moindre, il ne tiendrait qu’à la nation tout entière, depuis la reine Victoria jusqu’au dernier attacheur de fils de Liverpool, de vivre en rentière, se promenant la canne à la main, ou grognant dans les meetings. Ce qui conduit à cette proposition, évidemment absurde, que, grâce à son capital, une nation a plus de revenu que son travail n’en produit.
C’est que la totalité des salaires en France, étant annuellement d’environ 6 milliards, et la somme des revenus du capital aussi de 6 milliards, ce qui porte à 12 milliards la valeur marchande de la production annuelle, le peuple producteur, qui est en même temps le peuple consommateur, peut et doit acheter, avec 6 milliards de salaires qui lui sont alloués, les 12 milliards que le commerce lui demande pour prix de ses marchandises, sans quoi le capitaliste se trouverait sans revenu.
C’est que l’intérêt étant de sa nature perpétuel, et ne pouvant, en aucun cas, ainsi que le voulait Moïse, être porté en remboursement du capital ; de plus, chaque année d’intérêt pouvant être replacée à usure, et former un nouveau prêt, et engendrer, par conséquent, un nouvel intérêt, le plus petit capital peut, avec le temps, produire des sommes prodigieuses, que ne représenterait pas même une masse d’or aussi grosse que le globe que nous habitons. Price l’a démontré dans sa théorie de l’amortissement.
C’est que la productivité du capital étant la cause immédiate, unique, de l’inégalité des fortunes, et de l’accumulation incessante des capitaux dans un petit nombre de mains, il faut admettre, malgré le progrès des lumières, malgré la révélation chrétienne et l’extension des libertés publiques, que la société est naturellement et nécessairement divisée en deux castes, une caste de capitalistes exploiteurs, et une caste de travailleurs exploités.
C’est que ladite caste de capitalistes, disposant souverainement, par la prestation intéressée de ses capitaux, des instruments de production et des produits, a le droit, selon son bon plaisir, d’arrêter le travail et la circulation, comme nous la voyons faire depuis deux ans, au risque de faire mourir le peuple ; — de changer la direction naturelle des choses, comme cela se voit dans les États du Pape, où la terre cultivable est, depuis un temps immémorial, livrée, pour la convenance des propriétaires, à la vaine pâture, et où le peuple ne vit que des aumônes et de la curiosité des étrangers ; — de dire à une masse de citoyens : Vous êtes de trop sur la terre ; au banquet de la vie, il n’y a pas de place pour vous, comme fit la comtesse de Strafford, lorsqu’elle expulsa de ses domaines, en une seule fois, 17,000 paysans ; et comme fit, l’année dernière, le gouvernement français, quand il transporta en Algérie, 4,000 familles de bouches inutiles.
Je vous le demande à présent : si le préjugé de l’or, si la fatalité de l’institution monétaire excuse, justifie le capitaliste, n’est-il pas vrai qu’elle crée pour le travailleur ce régime de force brutale, qui ne se distingue de l’esclavage antique que par une plus profonde et une plus scélérate hypocrisie !
La force, Monsieur, voilà le premier et le dernier mot d’une société organisée sur le principe de l’intérêt, et qui, depuis 3,000 ans, fait effort contre l’intérêt. Vous le constatez vous-même, sans retenue comme sans scrupule, quand vous reconnaissez avec moi que le capitaliste ne se prive point ; avec J. B. Say, que sa fonction est de ne rien faire ; quand vous lui faites tenir ce langage effronté que réprouve toute conscience humaine :
« Je ne vous impose rien malgré vous. Dès que vous ne voyez pas dans le prêt un service, abstenez-vous d’emprunter, comme moi de prêter. Que si la société vous offre des avantages sans rétribution, adressez-vous à elle, c’est bien plus commode. Et quant à organiser la circulation des capitaux, ainsi que vous me sommez de le faire, si vous entendez par là que les miens vous arrivent gratis par l’intermédiaire de la société, j’ai contre ce procédé indirect tout juste les mêmes objections qui m’ont fait vous refuser le prêt direct et gratuit. »
Prenez-y garde, Monsieur ; le peuple n’est que trop disposé à croire que c’est uniquement par amour de ses priviléges que la caste capitaliste, en ce moment dominante, repousse l’organisation du crédit qu’il réclame ; et le jour où le mauvais vouloir de cette caste lui serait démontré, toute excuse disparaissant à ses yeux, sa vengeance ne connaîtrait plus de bornes.
Voulez-vous savoir quelle démoralisation épouvantable vous créez parmi les travailleurs, avec votre théorie du capital, qui n’est autre, comme je viens de vous le dire, que la théorie du droit de la force ? Il me suffira de reproduire vos propres arguments. Vous aimez les apologues : Je vais, pour concréter ma pensé, vous en proposer quelques-uns.
Un millionnaire se laisse tomber dans la rivière. Un prolétaire vient à passer ; le capitaliste lui fait signe : le dialogue suivant s’établit :
le millionnaire. Sauvez moi, ou je péris.
le prolétaire. Je suis à vous, mais je veux pour ma peine un million.
le millionnaire. Un million pour tendre la main à ton frère qui se noie ! Qu’est-ce que cela te coûte ? Une heure de retard ! Je te rembourserai, je suis généreux, un quart de journée.
le prolétaire. Dites-moi, n’est-il pas vrai que je vous rends un service en vous tirant de là ?
le millionnaire. Oui.
le prolétaire. Tout service a-t-il droit à une récompense ?
le millionnaire. Oui.
le prolétaire. Ne suis-je pas libre ?
le millionnaire. Oui.
le prolétaire. Alors, je veux un million : c’est mon dernier prix. Je ne vous force pas, je ne vous impose rien malgré vous ; je ne vous empêche point de crier : À la barque ! et d’appeler quelqu’un. Si le pêcheur, que j’aperçois là-bas, à une lieue d’ici, veut vous faire cet avantage sans rétribution, adressez-vous à lui : c’est plus commode.
le millionnaire. Malheureux ! tu abuses de ma position. La religion, la morale, l’humanité !…
le prolétaire. Ceci regarde ma conscience. Au reste, l’heure m’appelle, finissons-en. Vivre prolétaire, ou mourir millionnaire : lequel voulez-vous ?
Sans doute, Monsieur, vous me direz que la religion, la morale, l’humanité, qui nous commandent de secourir notre semblable dans la détresse, n’ont rien de commun avec l’intérêt. Je le pense comme vous : mais que trouvez-vous à redire à l’exemple suivant ?
Un missionnaire anglais, allant à la conversion des infidèles, fait naufrage en route, et aborde dans un canot, avec sa femme et quatre enfants, à l’île de … — Robinson, propriétaire de cette île par droit de première occupation, par droit de conquête, par droit de travail, ajustant le naufragé avec son fusil, lui défend de porter atteinte à sa propriété. Mais comme Robinson est humain, qu’il a l’âme chrétienne, il veut bien indiquer à cette famille infortunée un rocher voisin, isolé au milieu des eaux, où elle pourra se sécher et reposer, sans crainte de l’Océan.
Le rocher ne produisant rien, le naufragé prie Robinson de lui prêter sa bêche et un petit sac de semences.
J’y consens, dit Robinson ; mais à une condition : c’est que tu me rendras 99 boisseaux de blé sur 100 que tu récolteras.
le naufragé. C’est une avanie ! Je vous rendrai ce que vous m’aurez prêté, et à charge de revanche.
robinson. As-tu trouvé un gain de blé sur ton rocher ?
le naufragé. Non.
robinson. Est-ce que je te rends service en te donnant les moyens de cultiver ton île, et de vivre en travaillant ?
le naufragé. Oui
robinson. Tout service mérite-t-il rémunération ?
le naufragé. Oui.
robinson. Eh bien ! la rémunération que je demande, c’est 99 pour 100. Voilà mon prix.
le naufragé. Transigeons : je rendrai le sac de blé et la bêche, avec 5 pour 100 d’intérêt. C’est le taux légal.
robinson. Oui, taux légal, lorsqu’il y a concurrence, et que la marchandise abonde, comme le prix légal du pain est de 30 centimes le kilogramme, quand il n’y a pas disette.
le naufragé. 99 pour 100 de ma récolte ! mais c’est un vol, un brigandage !
robinson. Est-ce que je te fais violence ? est-ce que je t’oblige à prendre ma bêche et mon blé ? Ne sommes-nous pas libres l’un et l’autre ?
le naufragé. Il le faut. Je périrai à la tâche ; mais ma femme, mes enfants !… Je consens à tout ; je signe. Prêtez-moi, par-dessus le marché, votre scie et votre hache, pour que je me fasse une cabane.
robinson. Oui-dà! J’ai besoin de ma hache et de ma scie. Il m’en a coûté huit jours de peine pour les fabriquer. Je te les prêterai cependant, mais à la condition que tu me donneras 99 planches sur 100 que tu fabriqueras.
le naufragé. Eh parbleu ! je vous rendrai votre hache et votre scie, et vous ferai cadeau de cinq de mes planches en reconnaissance de votre peine.
robinson. Alors, je garde ma scie et ma hache. Je ne t’oblige point. Je suis libre.
le naufragé. Mais vous ne croyez donc point en Dieu ! Vous êtes un exploiteur de l’humanité, un malthusien, un juif !
robinson. La religion, mon père, nous enseigne que « l’homme a une noble destination, qui n’est point circonscrite dans l’étroit domaine de la production industrielle. Quelle est cette fin ? Ce n’est pas en ce moment le lieu de soulever cette question. Mais, quelle qu’elle soit, ce que je puis te dire, c’est que nous ne pouvons l’atteindre, si, courbés sous le joug d’un travail inexorable et incessant, il ne nous reste aucun loisir pour développer nos organes, nos affections, notre intelligence, notre sens du beau, ce qu’il y a de plus pur et de plus élevé dans notre nature… Quelle est donc la puissance qui nous donnera ce loisir bienfaisant, image et avant-goût de l’éternelle félicité ? C’est le capital. » J’ai travaillé jadis ; j’ai épargné, précisément en vue de te prêter : tu feras un jour comme moi.
le naufragé. Hypocrite !
robinson. Tu m’injuries : adieu ! Tu n’as qu’à couper les arbres avec tes dents, et scier tes planches avec tes ongles.
le naufragé. Je cède à la force. Mais, du moins, moi l’aumône de quelques médicaments pour ma pauvre fille qui est malade. Cela ne vous coûtera aucune peine ; j’irai les cueillir moi-même dans votre propriété.
robinson. Halte-là ! ma propriété est sacrée. Je te défends d’y mettre le pied : sinon tu auras affaire avec ma carabine. Cependant, je suis bon homme ; je te permets de venir cueillir tes herbes : mais tu m’amèneras ton autre fille, qui me paraît jolie…
le naufragé. Infâme ! tu oses tenir à un père un pareil langage !
robinson. Est-ce un service que je vous rends à tous, à toi et à tes filles, en vous sauvant la vie par mes remèdes ? Oui ou non ?
le naufragé. Assurément ; mais le prix que tu y mets ?
robinson. Est-ce que je la prends de force, ta fille ? — N’est-elle pas libre ? ne l’es-tu pas toi-même ?… Et puis, ne sera-t-elle pas heureuse de partager mes loisirs ? Ne prendra-t-elle pas sa part du revenu que tu me paies ? En faisant d’elle ma fille de compagnie, ne deviens-je pas votre bienfaiteur ? Va, tu n’es qu’un ingrat !
le naufragé. Arrête, propriétaire ! J’aimerais mieux voir ma fille morte que déshonorée. Mais je la sacrifie pour sauver l’autre. Je ne te demande plus qu’une chose : c’est de me prêter tes outils de pêche ; car avec le blé que tu nous laisses, il nous est impossible de vivre. Un de mes fils, en pêchant, nous procurera quelque supplément.
robinson. Soit : je te rendrai encore ce service. Je ferai plus : je te débarrasserai de ton autre fils, et me chargerai de sa nourriture et de son éducation. Il faut que je lui apprenne à tirer le fusil, à manier le sabre, et à vivre comme moi, sans rien faire. Car, comme je me défie de vous tous, et que vous pourriez fort bien ne me pas payer, je suis bien aise, à l’occasion, d’avoir main-forte. Coquins de pauvres, qui prétendez qu’on vous prête sans intérêt ! Impies, qui ne voulez pas de l’exploitation de l’homme par l’homme !
Un jour, Robinson, s’échauffant à la chasse, prend un refroidissement, et tombe malade. Sa concubine, dégoûtée de lui, et qui entretenait, avec son jeune compagnon, des relations intimes, lui dit : Je vous soignerai et vous guérirai, mais à une condition : c’est que vous me ferez donation de tous vos biens. Autrement, je vous laisse.
robinson. O toi que j’ai tant aimée, à qui j’ai sacrifié honneur, conscience, humanité, voudrais-tu me laisser sur le lit de douleur ?
la servante. Et moi, je ne vous aimais pas, c’est pour cela que je vous dois rien. Si vous m’avez entretenue, je vous ai livré ma personne : nous sommes quittes. Ne suis-je pas libre ? Et suis-je obligée, après vous avoir servi de maîtresse, de vous servir encore de garde-malade ?
robinson. Mon enfant, ma chère enfant, je te prie, calme-toi. Sois bonne, sois douce, soit gentille ; je vais, en ta faveur, faire mon testament.
la servante. Je veux une donation, ou je pars.
robinson. Tu m’assassines ! Dieu et les hommes m’abandonnent. Malédiction sur l’univers ! Que le tonnerre m’écrase, et que l’enfer m’engloutisse !
Il meurt désespéré.
P. J. Proudhon.
HUITIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon ↩
La preuve de l’impossibilité dispense d’examiner la possibilité. — Protestation contre le fatalisme. — Vérités immuables. — Jugement sur les pérégrinations à travers les champs de l’histoire. — Apologues retournés contre leur auteur. — Lois des capitaux résumés en cinq propositions.
24 décembre 1849.
La gratuité du crédit est-elle possible ?
La gratuité du crédit est-elle impossible ?
Il est clair que, résoudre une de ces questions, c’est résoudre l’autre.
Vous me reprochez de manquer à la charité parce que je maintiens le débat sur la seconde.
Voici mon motif :
Rechercher si la gratuité du crédit est possible, c’eût été me laisser entraîner à discuter la Banque du Peuple, l’impôt sur le capital, les ateliers nationaux, l’organisation du travail, en un mot, les mille moyens par lesquels chaque école prétend réaliser cette gratuité. Tandis que, pour s’assurer qu’elle est impossible, il suffisait d’analyser la nature intime du capital ; ce qui atteint mon but, et, à ce qu’il me semble, le vôtre.
On pose à Galilée cinquante arguments contre la rotation de la terre. Faut-il qu’il les réfute tous ? Non ; il prouve qu’elle tourne, et tout est dit : E pur si muove.
Comme novateur, dites-vous, j’ai droit à l’examen. — Sans doute ; mais, avant tout, la société, comme défenderesse, a droit qu’on lui prouve son tort. Vous traduisez le capital et l’intérêt au tribunal de l’opinion, les accusant d’injustice, de spoliation. À vous à prouver leur culpabilité ; à eux à prouver leur innocence. — Vous avez, dites-vous, plusieurs moyens de les faire rentrer dans le droit. Il faut d’abord savoir s’ils en sont sortis. L’examen de vos inventions ne peut venir qu’après, puisqu’il suppose l’accusation fondée, ce qu’ils nient.
Cette marche est tellement logique, que vous y acquiescez en ces termes :
« Vrai ou fausse, légitime ou illégitime, morale ou immorale, j’accepte l’usure, je l’approuve, je la loue même ; je renonce à toutes les illusions du socialisme, et me refais chrétien, si vous me démontrez que la prestation des capitaux, de même que la circulation des valeurs, ne saurait, en aucun cas, être gratuite. »
Or, que fais-je autre chose ? C’est bien là mon terrain : prouver que le capital porte en lui-même l’indestructible principe de la rémunérabilité.
Cette doctrine, vous l’avez d’abord combattue par la théorie des contradictions, ensuite par celle des distinctions. L’intérêt, avez-vous dit, a eu sa raison d’existence autrefois, il ne l’a plus aujourd’hui. Il fut un instrument d’égalité et de progrès, il n’est plus que vol et oppression. — Et, là-dessus, vous citez plusieurs institutions et usages d’abord légitimes et libéraux, devenus plus tard injustes et funestes à la liberté, entre autres, la torture, le jugement par l’eau bouillante, l’esclavage, etc.
Je repousse, quant à moi, ce fatalisme cruel qui consiste à justifier tous les excès comme ayant servi la cause de la civilisation. L’esclavage, la torture, les épreuves judiciaires, n’ont pas avancé, mais retardé la marche de l’humanité. Il en eût été de même de l’intérêt, s’il n’avait été, comme vous le dites, qu’un abus de la force.
En outre, s’il y a des choses qui changent, il y en a qui ne changent pas. Depuis la création, il a été vrai que les trois angles d’un triangle sont égaux à deux angles droits, et cela sera vrai jusqu’au jugement dernier et au delà. De même, il a toujours été vrai, il le sera toujours, que le travail accumulé, ou le capital, mérite récompense.
Vous comparez ma logique à celle d’un entrepreneur qui dirait : « Que m’importent la vapeur, la pression atmosphérique, l’électricité ? Prouver la légitimé du char à quatre roues, n’est-ce pas prouver que l’invention des chemins de fer est une chimère ? »
J’accepte la similitude ; mais voici comment :
Je reconnais que le chemin de fer est un progrès. Je me réjouis de ce qu’il fait baisser le prix des transports ; mais si l’on en voulait conclure à la gratuité des transports, si l’on disait : un prix quelconque pour les transports a pu être légitime autrefois, mais le temps est venu où ils doivent s’exécuter gratuitement, je répondrais : la conclusion est fausse. De progrès en progrès, ce prix peut diminuer sans cesse, mais il ne peut arriver à zéro, parce qu’il y aura toujours là une intervention de travail humain, un service humain, qui porte en lui-même le principe de la rémunérabilité.
De même, je reconnais que le loyer des capitaux va baissant en raison de leur abondance. Je le reconnais et m’en réjouis, car ils pénètrent ainsi de plus en plus dans toutes les classes, et les soulagent, pour chaque satisfaction donnée, du poids du travail. Mais, de cette baisse constante de l’intérêt, je ne puis conclure à son anéantissement absolu, parce que jamais les capitaux ne naîtront spontanément, qu’ils seront toujours un service plus ou moins grand, et que dès lors ils portent en eux-mêmes, ainsi que les transports, le principe de la rémunérabilité.
Ainsi, Monsieur, je ne vois aucun motif de déplacer ce débat au moment de le clore ; et il me semble qu’il n’est pas un de nos lecteurs qui ne considérât ma tâche comme remplie, si je prouvais ces propositions :
Tout capital (quelle que soit sa forme, moissons, outils, machines, maisons, etc.), tout capital résulte d’un travail antérieur, et féconde un travail ultérieur.
Parce qu’il résulte d’un travail antérieur, celui qui le cède reçoit une rémunération.
Parce qu’il féconde un travail ultérieur, celui qui l’emprunte doit une rémunération.
Et vous le dites vous-même : « Si la peine du créancier est zéro, l’intérêt doit devenir zéro. »
Donc, qu’avons-nous à rechercher ? Ceci :
Est-il possible qu’un capital se forme sans peine ?
Si c’est possible, j’ai tort ; le crédit doit être gratuit.
Si c’est impossible, c’est vous qui avez tort, le capital doit être rémunéré. Vous avez beau faire ; la question se réduit à ces termes : Le temps est-il arrivé, arrivera-t-il jamais où les capitaux écloront spontanément sans la participation d’aucun effort humain ?
Mais, dans une revue rétrospective pleine de verve, vous élançant vers la Palestine, vers Athènes, Sparte, Tyr, Rome, Carthage, vous m’entraînez par la tangente hors du cercle où je ne puis vous retenir. Eh bien! avant d’y rentrer, j’essaierai, sinon de vous suivre, du moins de faire quelques pas avec vous.
Vous débutez ainsi :
« Ce qui fait que l’intérêt du capital, excusable, juste même au point de départ de l’économie des sociétés, devient, avec le développement des institutions industrielles, une vraie spoliation, un vol, c’est que cet intérêt n’a pas d’autre principe, d’autre raison d’être, que la nécessité et la force. La nécessité, voilà ce qui explique l’exigence du prêteur ; la force, voilà ce qui fait la résignation de l’emprunteur. Mais à mesure que, dans les relations humaines, la nécessité fait place à la vérité, et qu’à la force succède le droit, le capitaliste perd son excuse. »
Il perd plus que cela ; il perd le seul titre que vous lui reconnaissez. Si, sous l’empire de la liberté et du droit, l’intérêt persiste, c’est sans doute qu’il a, quoi que vous en disiez, une autre raison d’être que la force.
En vérité, je ne comprends plus votre distinguo. Vous disiez : « L’intérêt a été juste autrefois, il ne l’est plus aujourd’hui. » Et quelle raison en donnez-vous ? Celle-ci : « Jadis la force régnait, aujourd’hui c’est le droit. » Loin de conclure de là que l’intérêt a passé de la légitimité à l’illégitimité, n’est-ce pas le contraire qui se déduit de vos prémisses ?
Et certes, le fait confirmerait cette déduction ; car l’usure a pu être odieuse quand on devenait capitaliste par la rapine, et l’intérêt est justifié depuis qu’on le devient par le travail.
« C’est dans le commerce de mer qu’il faut chercher l’origine de l’intérêt. Le contrat à la grosse, variété ou plutôt démembrement du contrat de pacotille, fut sa première forme. »
Je crois que le capital a une nature qui lui est propre, parfaitement indépendante de l’élément par lequel les hommes exécutent leurs transports. Qu’ils voyagent et fassent voyager leurs marchandises par terre, par eau ou par l’air, en char, en barque ou en ballon, cela ne confère ni ne retire aucun droit au capital.
Il est d’ailleurs permis de penser que la pratique de l’intérêt a été antérieure à celle du commerce maritime. Très-probablement le patriarche Abraham ne prêtait pas des troupeaux sans se réserver une part quelconque dans le croît, et ceux qui, après le déluge, bâtirent à Babylone les premières maisons, n’en cédaient sans doute pas l’usage sans rétribution.
Eh quoi ! Monsieur, ces transactions, qui ont prévalu et s’accomplissent volontairement depuis le commencement du monde, sous les noms de location, intérêt, fermage, baux, loyer, ne seraient pas sorties des entrailles mêmes de l’humanité ! Elles seraient nées du Contrat de pacotille !
Ensuite, à propos du contrat à la grosse, vous faites une théorie du bénéfice qu’en vérité je crois inadmissible. — Mais la discuter ici, ce serait nous écarter du sujet.
Enfin vous arrivez à cette tige de toutes les erreurs économiques, à savoir : la confusion entre les capitaux et le numéraire ; confusion à l’aide de laquelle il est aisé d’embrouiller la question. Mais vous n’y croyez pas vous-même, et je n’en veux pour preuve que ce que vous disiez naguère à M. Louis Blanc : « L’argent n’est pas une richesse pour la société : c’est tout simplement un moyen de circulation qui pourrait très-avantageusement être remplacé par du papier, par une substance de nulle valeur. »
Veuillez donc croire que lorsque je parle de la productivité du capital (outils, instruments, etc.) mis en œuvre par le travail, je n’entends pas attribuer une merveilleuse vertu prolifique à l’argent.
Vous suivrai-je, Monsieur, en Palestine, à Athènes et Lacédémone ? Vraiment, cela n’est pas nécessaire. Un mot seulement sur le non fœnerabis de Moïse.
J’admire la dévotion qui a saisi certains socialistes (avec lesquels je ne vous confonds pas), depuis qu’ils ont découvert, à l’appui de leur thèse, quelques textes dans l’ancien et le nouveau Testament, les conciles et les Pères de l’Église. Je me permettrai de leur adresser cette question : Entendent-ils nous donner ces autorités comme infaillibles en matière de sciences et d’économie sociale ?
Certes, ils n’iront pas jusqu’à me répondre : Nous tenons pour infaillibles les textes qui nous conviennent, et pour faillibles ceux qui ne nous conviennent pas. — Quand on invoque les livres sacrés, à ce titre et comme dépositaires de la volonté indiscutable de Dieu, il faut tout prendre, sous peine de jouer une puérile comédie. Eh bien ! sans parler d’une multitude de sentences de l’ancien Testament, qui ne peuvent, sans danger, être prises au pied de la lettre, il y a, dans l’Évangile, d’autres textes que le fameux mutuum date, dont ils veulent déduire la gratuité du crédit, entre autres ceux-ci :
« Heureux ceux qui pleurent.
Heureux ceux qui souffrent.
Il y aura toujours des pauvres parmi vous.
Rendez à César ce qui appartient à César.
Obéissez aux puissances.
Ne vous préoccupez pas du lendemain.
Faites comme le lis, qui ne file ni ne tisse.
Faites comme l’oiseau, qui ne laboure ni ne sème.
Si on vous frappe sur la joue gauche, tendez encore la joue droite.
Si on vous vole votre manteau, donnez encore votre robe. »
Que diraient messieurs les socialistes, si nous fondions sur un de ces textes la politique et l’économie sociale ?
Il est permis de croire que lorsque le fondateur du christianisme a dit à ses disciples : Mutuum date, il a entendu leur donner un conseil de charité et non faire un cours d’économie politique. Jésus était charpentier, il travaillait pour vivre. Dès lors, il ne pouvait faire du don une prescription absolue. Je crois pouvoir ajouter, sans irrévérence, qu’il se faisait payer très-légitimement, non-seulement pour le travail consacré à faire des planches, mais aussi pour le travail consacré à faire des scies et des rabots, c’est-à-dire pour le capital.
Enfin, je ne dois pas laisser passer les deux apologues par lesquels vous terminez votre lettre, sans vous faire observer que, loin d’infirmer ma doctrine, ils condamnent la vôtre ; car on n’en peut déduire la gratuité du crédit qu’à la condition d’en déduire aussi la gratuité du travail. Votre second drame me porte un grand coup d’épée ; mais, par le premier, vous m’avez charitablement muni d’une cuirasse à toute épreuve.
En effet, par quel artifice voulez-vous m’amener à reconnaître qu’il est des circonstances où on est tenu en conscience de prêter gratuitement ? Vous imaginez une de ces situations extraordinaires qui font taire tous les instincts personnels et mettent en jeu le principe sympathique, la pitié, la commisération, le dévouement, le sacrifice. — Un insulaire est bien pourvu de toutes choses. Il rencontre des naufragés que la mer a jetés nus sur la plage. Vous me demandez s’il est permis à cet insulaire de tirer, dans son intérêt, tout le parti possible de sa position, de pousser ses exigences jusqu’aux dernières limites, de demander mille pour cent de ses capitaux, et même de les louer au prix de l’honneur.
Je vois le piége. Si je réponds : Oh ! dans ce cas, il faut voler, sans conditions, au secours de son frère, partager avec lui jusqu’à la dernière bouchée de pain. Vous triompherez, disant : Enfin mon adversaire a avoué qu’il est des occasions où le crédit doit être gratuit.
Heureusement, vous m’avez fourni vous-même la réponse dans le premier apologue, que j’aurais inventé, si vous ne m’aviez prévenu.
Un homme passe sur le bord d’un fleuve. Il aperçoit un de ses frères qui se noie, et, pour le sauver, n’a qu’à lui tendre la main. Pourra-t-il, en conscience, profiter de l’occasion pour stipuler les conditions les plus extrêmes, pour dire au malheureux qui se débat dans le torrent : Je suis libre, je dispose de mon travail. Meurs ou donne-moi toute ta fortune !
Je me figure, Monsieur, que si un brave ouvrier se rencontre dans ces circonstances, il se jettera dans l’eau sans hésiter, sans calculer, sans spéculer sur son salaire et même sans y songer.
Mais ici, veuillez le remarquer, il n’est pas question de capital ; il s’agit de travail. C’est du travail qui, en conscience, doit être sacrifié. Est-ce que vous déduirez de là, comme règle normale des transactions humaines, comme loi de l’économie politique, la gratuité du travail ? Et parce que, dans un cas extrême, le service doit être gratuit, renoncerez-vous théoriquement à votre axiome : mutualité des services ?
Et cependant, si de votre second apologue vous concluez qu’on est toujours tenu de prêter pour rien, du premier vous devez conclure qu’on est toujours obligé de travailler gratis.
La vérité est que, pour élucider une question d’économie politique, vous avez imaginé deux cas où toutes les lois de l’économie politique sont suspendues. Qui jamais a songé à nier que, dans certaines circonstances, nous ne soyons tenus de sacrifier capital, intérêt, travail, vie, réputation, affections, santé, etc. ? Mais est-ce là la loi des transactions ordinaires ? Et recourir à de tels exemples pour faire prévaloir la gratuité du crédit, ou la gratuité du travail, n’est-ce pas avouer son impuissance à faire résulter cette gratuité de la marche ordinaire des choses ?
Vous recherchez, Monsieur, quelles sont, pour la classe travailleuse, les conséquences du prêt à intérêt, et vous en énumérez quelques-unes, m’invitant à en faire l’objet ultérieur de ce débat.
Je ne disconviens pas que, parmi vos objections, il n’y en ait de très-spécieuses et même de très-sérieuses. Il est même impossible, dans une lettre, de les relever une à une ; j’essaierai de les réfuter toutes à la fois, par la simple exposition de la loi selon laquelle se répartissent, suivant moi, entre le capital et le travail, les produits de leur coopération ; et c’est par là que je rentrerai dans ma modeste circonférence économique.
Permettez-moi d’établir cinq propositions qui me semblent susceptibles d’être mathématiquement démontrées.
1° Le capital féconde le travail.
Il est bien clair qu’on obtient de plus grands résultats avec une charrue que sans charrue ; avec une scie que sans scie ; avec une route que sans route ; avec des approvisionnements que sans approvisionnements, etc., d’où nous pouvons conclure que l’intervention du capital accroît la masse des produits à partager.
2° Le capital est du travail.
Charrues, scies, routes, approvisionnements, ne se font pas tout seuls, et le travail à qui on les doit a droit à être rémunéré.
Je suis obligé de rappeler ici ce que j’ai dit dans ma dernière lettre sur la différence dans le mode de rétribution quand elle s’applique au capital ou au travail.
La peine que prend chaque jour le porteur d’eau doit lui être payée par ceux qui profitent de cette peine quotidienne. Mais la peine qu’il a prise pour fabriquer sa brouette et son tonneau doit lui être payée par un nombre indéterminé de consommateurs.
De même l’ensemencement, le labourage, le sarclage, la moisson, ne regardent que la récolte actuelle. Mais les clôtures, les défrichements, les desséchements, les bâtisses entrent dans le prix de revient d’une série indéfinie de récoltes successives.
Autre chose est le travail actuel du cordonnier qui fait des souliers, du tailleur qui fait des habits, du charpentier qui fait des madriers, de l’avocat qui fait des mémoires ; autre chose est le travail accumulé qu’ont exigé la forme, l’établi, la scie, l’étude du droit.
C’est pourquoi le travail de la première catégorie se rémunère par le salaire, celui de la seconde catégorie par les combinaisons de l’intérêt et de l’amortissement, qui ne sont autre chose qu’un salaire ingénieusement réparti sur une multitude de consommateurs.
3° À mesure que le capital s’accroît l’intérêt baisse, mais de telle sorte que le revenu total du capitaliste augmente.
Ce qui a lieu sans injustice et sans préjudice pour le travail, parce que, ainsi que nous allons le voir, l’excédant de revenu du capitaliste est pris sur l’excédant de produit dû au capital.
Ce que j’affirme ici, c’est que, quoique l’intérêt baisse, le revenu total du capitaliste augmente de toute nécessité, et voici comment :
Soit 100 le capital, et le taux de l’intérêt 5. Je dis que l’intérêt ne peut descendre à 4 sans que le capital s’accumule au moins au-dessus de 120. En effet, on ne serait pas stimulé à accroître le capital, s’il en devait résulter diminution, ou même stationnement du revenu. Il est absurde de dire que le capital étant 100 et le revenu 5, le capital peut être porté à 200 et le taux descendre à 2 ; car, dans le premier cas, on aurait 5 francs de rente, et dans le second on n’aurait que 4 francs. Le moyen serait trop simple et trop commode : on mangerait la moitié du capital pour faire reparaître le revenu.
Ainsi, quand l’intérêt baisse de 5 à 4, de 4 à 3, de 3 à 2, cela veut dire que le capital s’est accru de 100 à 200, de 200 à 400, de 400 à 800, et que le capitaliste touche successivement pour revenu 5, 8 et 12. Et le travail n’y perd rien, bien au contraire : car il n’avait à sa disposition qu’une force égale à 100, puis il a eu une force égale à 200, et enfin une force égale à 800, avec cette circonstance qu’il paie de moins en moins cher une quantité donnée de cette force.
Il suit de là que ces calculateurs sont bien malhabiles qui vont disant : « L’intérêt baisse, donc il doit cesser. » Eh morbleu ! il baisse, relativement à chaque 100 fr. ; mais c’est justement parce que le nombre de 100 fr. augmente que l’intérêt baisse. Oui, le multiplicateur s’amoindrit, mais ce n’est que par la raison même qui fait grossir le multiplicande, et je défile le dieu de l’arithmétique lui-même d’en conclure que le produit arrivera ainsi à zéro [1].
4° À mesure que les capitaux augmentent (et avec eux les produits), la part absolue qui revient au capital augmente, et sa part proportionnelle diminue.
Cela n’a plus besoin de démonstration. Le capital retire successivement 5, 4, 3 pour chaque 100 fr. qu’il met dans l’association ; donc son prélèvement relatif diminue. Mais comme il met successivement dans l’association 100 fr., 200 fr., 400 fr., il se trouve qu’il retire, pour sa part totale, d’abord 5, puis 8, ensuite 12, et ainsi de suite ; donc son prélèvement absolu augmente.
5° À mesure que les capitaux augmentent (et avec eux les produits), la part proportionnelle et la part absolue du travail augmentent.
Comment pourrait-il en être autrement ? puisque le capital voit grossir sa part absolue, encore qu’il ne prélève successivement que 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 du produit total, le travail, à qui successivement il revient 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, entre évidemment dans le partage pour une part progressive, dans le sens proportionnel comme dans le sens absolu.
La loi de cette répartition peut être figurée aux yeux par les chiffres suivants, qui n’ont pas la prétention d’être précis, mais que je produis pour élucider ma pensée.
| Produit total. | Part du capital. | Part du travail. | ||
| 1re | période. | 1000 | 1/2 ou 500 | 1/2 ou 500 |
| 2e | — | 1800 | 1/3 ou 600 | 1/2 ou 1200 |
| 3e | — | 2800 | 1/4 ou 700 | 3/2 ou 2100 |
| 4e | — | 4000 | 1/5 ou 800 | 4/5 ou 3200 |
On voit par là comment l’accroissement successif des produits, correspondant à l’accumulation progressive des capitaux, explique ce double phénomène, à savoir, que la part absolue du capital augmente, encore que sa part proportionnelle diminue, tandis que la part du travail augmente à la fois dans les deux sens.
De tout ce qui précède, il résulte ceci :
Pour que le sort des masses s’améliore, il faut que le loyer des capitaux baisse.
Pour que l’intérêt baisse, il faut que les capitaux se multiplient.
Pour que les capitaux se multiplient, il faut cinq choses : activité, économie, liberté, paix et sécurité.
Et ces biens, qui importent à tout le monde, importent encore plus à la classe ouvrière.
Ce n’est pas que je nie les souffrances des travailleurs, mais je dis qu’ils sont sur une fausse piste quand ils les attribuent à l’infâme capital.
Telle est ma doctrine. Je la livre avec confiance à la bonne foi des lecteurs. On a dit que je m’étais constitué l’avocat du privilége capitaliste. Ce n’est pas à moi, c’est à elle de répondre.
Cette doctrine, j’ose le dire, est consolante et concordante. Elle tend à l’union des classes ; elle montre l’accord des principes ; elle détruit l’antagonisme des personnes et des idées ; elle satisfait l’intelligence et le cœur.
En est-il de même de celle qui sert de nouveau pivot au socialisme ? qui dénie au capital tout droit à une récompense ? qui ne voit partout que contradiction, antagonisme et spoliation ? qui irrite les classes les unes contre les autres ? qui représente l’iniquité comme un fléau universel, dont tout homme, à quelque degré, est coupable et victime ?
Que si néanmoins le principe de la gratuité du crédit est vrai, il faut bien l’admettre : Fiat justitia, ruat cœlum. Mais s’il est faux !!
Quant à moi, je le tiens pour faux, et, en terminant, je vous remercie de m’avoir loyalement fourni l’occasion de la combattre.
Frédéric Bastiat.
FN:Cette loi, d’une décroissance qui, quoique indéfinie, n’arrive jamais à zéro, loi bien connue des mathématiciens, gouverne une foule de phénomènes économiques et n’a pas été assez observée.
Citons-en un exemple familier.
Tout le monde sait que dans une grande ville, dans un quartier riche et populeux, on peut gagner davantage tout en réduisant les prix de vente. C’est ce qu’on exprime familièrement par cette locution : Se retrouver sur la quantité.
Supposons quatre marchands de couteaux, l’un au village, l’autre à Bayonne, le troisième à Bordeaux, le quatrième à Paris.
Nous pourrons avoir le tableau suivant :
| Nombre des couteaux vendus | Bénéfice par couteau | Bénéfice total | ||||
| Village | 100 | 1 | fr. | » | 100 | fr. |
| Bayonne | 200 | » | 75 | 150 | ||
| Bordeaux | 400 | » | 50 | 200 | ||
| Paris | 1,000 | » | 25 | 250 | ||
On voit ici un multiplicateur (deuxième colonne) décroître sans cesse, parce que le multiplicande (première colonne) s’accroît toujours ; la progression constante du produit total (troisième colonne) exclut l’idée que le multiplicateur arrive jamais à zéro, alors même qu’on passerait de Paris à Londres, et à des villes de plus en plus grandes et riches.
Ce qu’il faut bien observer ici, c’est que l’acheteur n’a pas à se plaindre de l’accroissement progressif du bénéfice total réalisé par le marchand, car ce qui l’intéresse, lui acheteur, c’est le profit proportionnel prélevé sur lui comme rémunérateur du service rendu, et ce profit diminue sans cesse. Ainsi, à des points de vue divers, le vendeur et l’acheteur progressent en même temps.
C’est la loi des capitaux. Bien connue, elle révèle aussi l’harmonie des intérêts entre le capitaliste et le prolétaire, et leur progrès simultané.
NEUVIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat ↩
Grave imputation. — Négation de cinq propositions. — Arguments tirés des opérations de la Banque de France. — Méfaits de cette Banque.
31 décembre 1849.
Vous m’avez trompé.
J’attendais de vous une controverse sérieuse : vos lettres ne sont qu’une perpétuelle et insipide mystification. Quand vous auriez fait un pacte avec l’usure, pour embrouiller la question et empêcher notre débat d’aboutir, en l’embarrassant d’incidents, de hors-d’œuvre, de vétilles et de chicanes, vous n’eussiez pu vous y prendre autrement.
De quoi s’agit-il entre nous, s’il vous plaît ? de savoir si l’intérêt de l’argent doit ou non être aboli. Je vous l’ai dit moi-même : c’est là le pivot du socialisme, la cheville ouvrière de la Révolution.
Une question préjudicielle s’élève donc tout d’abord, celle de savoir si, en fait, il y a possibilité d’abolir cet intérêt. Vous le niez ; je l’affirme : lequel croire de nous deux ? Évidemment, ni l’un ni l’autre. Il faut examiner la chose : voilà ce que dicte le sens commun, ce que la plus simple notion d’équité prescrit. Vous, au contraire, vous repoussez cet examen. Depuis deux mois que nous avons ouvert, dans la Voix du Peuple, cette assise solennelle où le capital devait être jugé, et l’usure condamnée ou absoute, vous ne cessez de me répéter sur tous les tons cette ritournelle :
« Le capital, tel que je le comprends, tel qu’il m’apparaît dans sa nature intime, est productif. Cette conviction me suffit : je ne veux pas en savoir davantage. D’ailleurs, vous reconnaissez qu’en prêtant à intérêt, je rends service et ne suis point voleur ; qu’ai-je donc besoin de vous entendre ? Quand j’ai prouvé, dans mon système, que la gratuité du crédit est impossible, et que vous accordez qu’un honnête homme peut, en toute sûreté de conscience, tirer de son fonds un revenu, vous devez tenir cette même gratuité pour impossible. Ce qui est démontré vrai, dans un système, ne peut devenir faux dans un autre : autrement, il faudrait dire qu’une même chose peut être vraie et fausse tout à la fois, ce que mon esprit se refuse absolument à comprendre. Je ne sors pas de là. »
Où donc, monsieur, avez-vous appris, je ne dis pas à raisonner, car il appert dès le commencement de cette polémique que le raisonnement en vous se réduit à affirmer et confirmer toujours votre proposition, sans infirmer celle de votre adversaire, — mais à discuter ? Le dernier clerc de procureur vous dirait qu’en tout débat, il faut examiner successivement et contradictoirement le dire de chaque partie ; et, puisque nous avons pris le public pour juge, il est évident qu’une fois votre système exposé et débattu, il faut aborder le mien.
Avec vous les choses ne se passent point ainsi. Satisfait de la concession que je vous ai faite, à savoir, que dans l’état actuel des choses le prêt à intérêt ne peut être considéré comme un acte illicite, vous tenez la nécessité de l’intérêt pour démontrée, et là-dessus, sous prétexte que vous n’entendez rien à l’antinomie, me fermant la bouche, vous faites défaut au débat. Est-ce discuter, je vous le demande ?
Forcé par une conduite si étrange, je fais alors un pas vers vous. Ma méthode de démonstration avait paru vous faire quelque peine : je quitte cette méthode, et vous montre, en employant la forme ordinaire de raisonnement, que tout change dans la société ; que ce qui à une époque fut un progrès, à une autre devient une entrave ; qu’ainsi, en faisant abstraction du temps, la même idée, le même fait, change complétement de caractère, selon l’aspect sous lequel on le considère ; que rien n’empêche de croire que l’intérêt soit précisément dans ce cas ; qu’en conséquence votre fin de non-recevoir ne peut être admise, et qu’il faut décidément examiner avec moi l’hypothèse de la gratuité du crédit, de l’abolition de l’intérêt.
À cela que répondez-vous ? c’est à peine si j’ose vous le rappeler. Parce que, par égard pour vous, j’avais cru devoir changer de méthode, vous m’accusez, d’abord de tergiversation, ensuite de fatalisme ! J’ai fait avec vous, permettez-moi cette comparaison, ce que le professeur de mathématiques fait avec ses élèves, lorsqu’à une démonstration difficile, il en substitue une autre plus saisissable à leur intelligence. Car, sachez-le bien, monsieur, la dialectique hégélienne, qui cependant n’est pas toute la logique, est au syllogisme et à l’induction ce que le calcul différentiel est à la géométrie ordinaire. Il vous est permis d’en rire ; c’est le droit de l’esprit humain de rire de tout ce qu’il a une fois compris et deviné ; mais il faut comprendre, sans quoi le rire n’est que la grimace de l’insensé. Et vous, pour prix de ma complaisance, vous me décernez le sarcasme : je ne suis, à vous entendre, qu’un sophiste. Est-ce sérieux ?
Je fais plus encore. Vous aviez dit, — je cite vos propres paroles : — Montrez-moi comment l’intérêt, de légitime devient illégitime, et je consens à discuter la théorie du crédit gratuit.
Pour satisfaire à ce désir, d’ailleurs très-légitime, je fais l’historique de l’intérêt, j’écris la biographie de l’usure. Je montre que cette pratique a sa cause dans un concours de circonstances politiques et économiques, indépendant de la volonté des contractants, et inévitable à l’origine des sociétés, savoir : 1° L’incommensurabilité des valeurs, résultant de la non-séparation des industries, et de l’absence des termes de comparaison ; 2° les risques du commerce ; 3° l’habitude, introduite de bonne heure parmi les négociants et devenue peu à peu constante et générale, de compter un excédant proportionnel à titre d’amende ou indemnité (dommage-intérêt), à tout débiteur retardataire ; 4° la prépondérance des métaux précieux et monnayés sur les autres marchandises ; 5° la pratique combinée des contrats de pacotille, d’assurance, et à la grosse ; 6° enfin, l’établissement de la rente foncière, imité de l’intérêt de l’argent, et qui, admise sans contestation par les casuistes, devait servir plus tard à la justification de ce même intérêt.
Pour rendre la démonstration complète, je prouve ensuite, par un simple rapport arithmétique, que l’intérêt, excusable comme accident, dans les conditions où il a pris naissance, et où il s’est ensuite développé, devient absurde et spoliateur, dès qu’on prétend le généraliser et en faire une règle d’économie publique ; qu’il est en contradiction formelle avec le principe économique, que dans la société le produit net est identique au produit brut, en sorte que tout prélèvement exercé par le capital sur le travail constitue, dans la balance sociale, une erreur de compte et une impossibilité. Je prouve, enfin, que si, à une autre époque, l’intérêt a servi de mobile à la circulation des capitaux, il n’est plus aujourd’hui pour cette circulation, de même que l’impôt sur le sel, le vin, le sucre, la viande, de même que la douane elle-même, qu’une entrave ; que c’est à lui qu’il faut rapporter la stagnation des affaires, le chômage de l’industrie, la détresse de l’agriculture, et l’imminence toujours grandissante d’une banqueroute universelle.
Tout cela était d’histoire, de théorie et de pratique, comme de calcul : vous avez remarqué vous-même que je n’avais pas une seule fois fait appel, contre l’intérêt, à la fraternité, à la philanthropie, à l’autorité de l’Évangile et des pères de l’Église. J’ai peu de foi à la philanthropie ; quant à l’Église, elle n’a jamais rien entendu à cette matière, et sa casuistique, depuis le Christ jusqu’à Pie IX, est tout simplement absurde. Absurde, dis-je, soit quand elle condamne l’intérêt, sans aucune considération des circonstances qui l’excusent, qui l’exigent ; soit quand elle restreint ses anathèmes à l’usure d’argent, et fait, pour ainsi dire, acception de l’usure terrienne.
À cette exposition, dont vous avez vous-même apprécié l’intérêt, que répondez-vous, dans votre quatrième lettre ? — Rien.
Niez-vous l’histoire ? — Point.
Contestez-vous mes calculs ? — Non.
Que dites-vous donc ? — Vous rebattez votre éternel refrain : Celui qui prête rend service ; dès lors il est prouvé que le capital porte en soi l’indestructible principe de la rémunération. Sur quoi, vous me donnez, comme expression de la sagesse des siècles, cinq ou six aphorismes, excellents pour endormir les mauvaises consciences, mais qui, je vous le prouverai tout à l’heure, sont tout ce que la routine la plus brute a fait jamais dire de plus absurde. Puis, faisant votre signe de croix, vous déclarez la discussion close. Amen !
Vous êtes économiste, monsieur Bastiat, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, membre du comité des finances, membre du congrès de la Paix, membre de la ligue anglo-française pour le libre-échange, et, ce qui vaut mieux que tout cela, honnête homme et homme d’esprit. Eh bien ! je suis forcé, pour mettre à couvert votre intelligence et votre loyauté, de vous prouver, par A plus B, que vous ne savez pas le premier mot des choses dont vous avez entrepris de parler, ni du capital, ni de l’intérêt, ni du prix, ni de la valeur, ni de la circulation, ni de la finance, ni de toute l’économie politique, pas plus que de la métaphysique allemande.
Avez-vous, dans votre vie, entendu parler de la Banque de France ? Faites-moi le plaisir, quelque jour, d’y jeter le pied ; ce n’est pas loin de l’Institut. Vous trouverez là M. d’Argout, qui, en fait de capital et d’intérêt, en sait plus que vous et que tous les économistes de Guillaumin. La Banque de France est une compagnie de capitalistes, formée, il y a une cinquantaine d’années, à la sollicitation de l’État, et par privilége de l’État, pour exercer l’usure sur tout le territoire de France. Depuis sa fondation, elle n’a cessé de prendre de continuels accroissements : la révolution de Février en a fait, par l’adjonction des banques départementales, le premier pouvoir de la République. Le principe sur lequel cette compagnie s’est formée est exactement le vôtre. Il ont dit : Nous avons acquis nos capitaux par notre travail, ou par le travail de nos pères. Pourquoi donc, en les faisant servir à la circulation générale, en les mettant au service de notre pays, n’en tirerions-nous pas un salaire légitime, quand le propriétaire foncier tire un revenu de sa terre ; quand le constructeur de maisons tire loyer de ses maisons ; quand l’entrepreneur tire de sa marchandise un bénéfice supérieur aux frais de sa gestion ; quand l’ouvrier qui assemble nos parquets fait entrer dans le prix de sa journée un quantum pour l’usure de ses outils, lequel quantum dépasse assurément ce qui serait nécessaire pour amortir la somme qu’ils lui ont coûtée ?
Cette augmentation, vous le voyez, est on ne peut plus plausible. C’est celle qu’on a opposée de tout temps, et avec juste raison, à l’Église, quand elle a voulu condamner l’intérêt exclusivement à la rente ; c’est le thème qui revient dans chacune de vos lettres.
Or, savez-vous où ce beau raisonnement a conduit les actionnaires, que je tiens tous, ainsi que M. d’Argout, pour très-honnêtes gens, de la Banque de France ? — Au vol, oui, monsieur, au vol le plus manifeste, le plus éhonté, le plus détestable : car c’est ce vol qui, lui seul, depuis Février, arrête le travail, empêche les affaires, fait périr le peuple du choléra, de la faim et du froid, et qui, dans le but secret d’une restauration monarchique, souffle le désespoir parmi les classes travailleuses.
C’est ici surtout que je me propose de vous faire voir comment l’intérêt, de légitime devient illégitime ; et, ce qui vous surprendra bien davantage encore, comment le crédit payé, dès l’instant qu’il ne se fait pas voleur, qu’il ne réclame que le prix qui lui est légitiment dû, devient crédit gratuit.
Quel est le capital de la Banque de France ?
D’après le dernier inventaire, 90 millions.
Quel est le taux légal, convenu entre la Banque et l’État, pour les escomptes ? — 4 p. 100 l’an.
Donc le produit annuel, légal et légitime de la Banque de France, le juste prix de ses services, c’est, pour un capital de 90 millions à 4 p. 100 l’an, 3 millions 600 mille francs de revenu.
3,600,000 francs, voilà suivant la fiction de la productivité du capital, ce que le commerce français doit chaque année à la Banque de France en rémunération de son capital, qui est de 90 millions.
Dans ces conditions, les actions de la Banque de France sont comme des immeubles qui rendraient régulièrement 40 francs de revenu : émises à 1,000 francs, elles valent 1,000 francs.
Or, savez-vous ce qui arrive ?
Consultez le même inventaire : vous y verrez que lesdites actions, au lieu d’être cotées 1,000 fr., le sont à 2,400. — Elles étaient, la semaine dernière, à 2,445 ; et, pour peu que le portefeuille se remplit, elle monteraient à 2,500 et 3,000 fr. — Ce qui veut dire que le capital de la Banque, au lieu de lui rapporter 4 pour 100, taux légal et convenu, produit 8, 10 et 12 pour 100.
Le capital de la Banque s’est donc doublé, triplé ? — C’est, en effet, ce qui devrait avoir lieu d’après la théorie énoncée dans vos troisième et quatrième propositions, savoir, que l’intérêt baisse à mesure que le capital s’accroît, mais de telle sorte que le revenu total du capitaliste augmente.
Eh bien, il n’en est rien. Le capital de la Banque est resté le même, 90 millions. Seulement, la Compagnie, en vertu de son privilége, et à l’aide de son mécanisme financier, a trouvé moyen d’opérer avec le commerce comme si son capital était, non plus seulement de 90 millions, mais de 450, c’est-à-dire cinq fois plus grand.
Est-il possible, direz-vous ? — Voici le procédé ; il est fort simple, et j’en puis parler : c’est précisément un de ceux que se proposait d’employer la Banque du Peuple, pour arriver à l’annihilation de l’intérêt.
Pour éviter les ports d’espèces, et la manipulation encombrante des écus, la Banque de France fait usage de bons de crédit, représentatifs de l’argent qu’elle a dans ses caves, et qu’on appelle Billets de Banque. Ce sont ces billets qu’elle remet d’ordinaire à ses clients, contre les lettres de change et billets à ordre qu’ils lui portent, et dont elle se charge d’opérer, sous garantie toutefois des tireurs comme des tirés, le recouvrement.
Le papier de la Banque a, de la sorte, un double gage : le gage des écus qui sont dans la caisse, et le gage des valeurs de commerce qui sont dans le portefeuille. La sécurité donnée par ce double gage est si grande, qu’il est reçu dans le commerce de préférer le papier aux espèces, que chacun aime autant savoir à la Banque que dans le tiroir de sa commode.
On conçoit même, en thèse absolue, qu’à l’aide de ce procédé, la Banque de France puisse se passer entièrement de capital et faire l’escompte sans numéraire : en effet, les valeurs de commerce qu’elle reçoit à l’escompte, et contre lesquelles elle donne ses billets, devant lui être remboursées, à l’échéance, par pareille somme, soit en argent, soit en billets, il suffirait que les porteurs de billets n’eussent jamais la fantaisie de les convertir en écus, pour que le roulement s’effectuât tout en papier. Alors, la circulation aurait pour base, non plus le crédit de la Banque, dont le capital serait ainsi hors de service, mais le crédit public, par l’acceptation générale des billets.
Dans la pratique, les faits ne se passent pas tout à fait comme l’indique la théorie. Jamais on n’a vu le papier de Banque se substituer entièrement au numéraire ; il y a seulement tendance à cette substitution. Or, voici ce qui résulte de cette tendance.
La Banque spéculant, et avec pleine sécurité, sur le crédit public, sûre d’ailleurs de ses recouvrements, ne limite pas ses escomptes au montant de son encaisse ; elle émet toujours plus de billets qu’elle n’a d’argent : ce qui signifie que pour une partie de ses crédits, au lieu de remettre une valeur réelle et d’opérer un véritable change, elle ne fait qu’un transport d’écritures, ou virement de parties, sans aucun emploi de capital. Ce qui tient ici lieu de capital à la Banque, c’est, je le répète, l’usage établi, la confiance du commerce, en un mot, le crédit public.
Il semble donc qu’alors le taux de l’escompte doive baisser dans la proportion de la surémission des billets ; que si, par exemple, le capital de la Banque est 90 millions, et la somme des billets 112 millions, le capital fictif étant le quart du capital réel, l’intérêt de 4 pour 100 devra se réduire, pour les escomptes, à 3. Quoi de plus juste, en effet ? Le crédit public n’est-il pas une propriété publique ? Les billets surémis par la Banque n’ont-ils pas pour gage unique les obligations réciproques des citoyens ? L’acceptation de ce papier, sans gage métallique, ne repose-t-elle pas exclusivement sur leur confiance mutuelle ? N’est-ce pas cette confiance qui crée seule toute la probabilité du signe ? En quoi le capital de la Banque y est-il intervenu ? En quoi la garantie y paraît-elle ?
Vous pouvez déjà, par ce simple aperçu, juger combien est fausse votre proposition n°3, suivant laquelle : baisse d’intérêt suppose augmentation corrélative de capitaux. Rien n’est plus faux que cette proposition : il est démontré, au contraire, par la théorie et par la pratique de toutes les banques, qu’une banque peut très-bien tirer un intérêt de 4 pour 100 de ses capitaux en mettant à 3 pour 100 le taux de ses escomptes : nous verrons tout à l’heure qu’elle peut descendre beaucoup plus bas.
Pourquoi donc la Banque, qui, avec 90 millions de capital, émet, par hypothèse, pour 112 millions de billets ; qui, par conséquent, opère, à l’aide du crédit public, comme si son capital s’était accru de 90 millions à 112 ; pourquoi, dis-je, ne réduit-elle pas ses escomptes dans la même proportion ? Pourquoi cet intérêt de 4 pour 100, encaissé par la Banque, pour loyer d’un capital qui n’est pas le sien ? Me donnerez-vous une raison qui justifie ce trop perçu de 1 pour 100 sur 112 millions ? Quant à moi, monsieur,
J’appelle un chat un chat, et Rollet un fripon.
et je dis tout uniquement que la Banque vole.
Mais ceci n’est rien.
Tandis que la Banque de France émet, en place d’écus, des billets, une partie de ses recouvrements continue à s’opérer en numéraire : en sorte que, le capital de fondation restant toujours le même, 90 millions, l’encaisse, soit le montant des espèces présentes à la Banque, s’élève progressivement à 100, 200, 300 millions : il est aujourd’hui de 431 millions !
Cette accumulation d’espèces, dont certaines gens ont la manie de s’affliger, est le fait décisif qui anéantit la théorie de l’intérêt, et qui démontre de la manière la plus palpable la nécessité du crédit gratuit. Il est facile de s’en rendre compte.
C’est un point admis en théorie, que l’échange des produits peut très-bien s’opérer sans monnaie : vous le reconnaissez vous-même, et tous les économistes le savent. Or, ce que démontre la théorie est justement ce que la pratique réalise sous nos yeux. La circulation fiduciaire remplaçant peu à peu la circulation métallique, le papier étant préféré à l’écu, le public aimant mieux s’acquitter avec le numéraire qu’avec les billets, et la Banque étant toujours provoquée, soit par les besoins de l’État qui lui emprunte, soit par ceux du commerce qui vient en masse à l’escompte, soit par toute autre cause, à faire sans cesse des émissions nouvelles ; il en résulte que l’or et l’argent sortent de la circulation et vont s’engouffrer à la Banque, et que là, s’ajoutant sans cesse à l’encaisse, la faculté de multiplier les billets devient littéralement illimitée.
C’est par cette conversion que l’encaisse de la Banque est arrivé à la somme énorme de 431 millions. De ce fait, il résulte que la compagnie de la Banque, malgré le renouvellement de son privilége, n’est plus seule en titre : elle a acquis, par le fait de l’augmentation de son encaisse, un associé plus puissant qu’elle : cet associé, c’est le pays, le pays, qui figure chaque semaine, dans le bilan de la Banque de France, pour un capital variable de 340 à 350 millions. Et, comme les intérêts sont conjoints et indivisibles, on peut dire, en toute vérité, que ce n’est plus la compagnie privilégiée de 1803, qui est banquière ; ce n’est pas non plus l’État qui lui a donné son brevet : c’est le commerce, c’est l’industrie, ce sont les producteurs, c’est toute la nation, qui, en acceptant le papier de la Banque, de préférence aux écus, l’a véritablement gagée, et fondée, à la place de l’ancienne Banque de France, au capital de 90 millions, une Banque nationale au capital de 431.
Un décret de l’Assemblée nationale, qui aurait pour objet de rembourser les actions de la Banque de France, et de la convertir en une Banque centrale, commanditée par tous les citoyens français, ne serait qu’une déclaration de ce fait, maintenant accompli, de l’absorption de la compagnie dans la nation.
Ceci posé, je reprends mon raisonnement de tout à l’heure.
L’intérêt, convenu entre la Compagnie et l’État, est 4 pour 100 l’an de son capital.
Ce capital est de 90 millions.
L’encaisse est aujourd’hui, 31 décembre 1849, de 431 millions.
Le montant des billets émis, de 436 millions.
Le capital, réel ou fictif, sur lequel la Banque opère, ayant presque quintuplé, le taux de l’escompte devrait être réduit au cinquième de l’intérêt stipulé dans le contrat d’institution de la Banque, quelque chose comme 3/4 pour 100.
Vous devez vous apercevoir, monsieur, qu’il s’en faut que vos propositions soient aussi sûres que celles d’Euclide. Il n’est pas vrai, et les faits que je viens de vous citer le prouvent sans réplique, que l’intérêt ne baisse qu’au fur et à mesure de l’augmentation des capitaux. Entre le prix de la marchandise et l’intérêt du capital, il n’y a point la moindre analogie ; la loi de leurs oscillations n’est pas la même ; et tout ce que vous avez ressassé depuis six semaines, à propos du capital et de l’intérêt, est entièrement dépourvu de raison. La pratique universelle des banques et la raison spontanée du peuple vous donnent, sur tous ces points, le plus humiliant démenti.
Croiriez-vous maintenant, monsieur, car, en vérité, vous ne me paraissez au courant de rien, que la Banque de France, compagnie d’honnêtes gens, de philanthropes, d’hommes craignant Dieu, incapables de transiger avec leur conscience, continue à prendre 4 p. 100 sur tous ses escomptes, sans faire jouir le public de la plus légère bonification ? Croiriez-vous que c’est sur ce pied de 4 p. 100 sur un capital de 431 millions, dont elle n’est pas propriétaire, qu’elle règle les dividendes de ses actionnaires, et qu’elle fait coter ses actions à la Bourse ? Est-ce du vol, cela, oui ou non ?
Nous ne sommes pas au bout. Je ne vous ai dit que la moindre partie des méfaits de cette société d’agioteurs, instituée par Napoléon tout exprès dans le but de faire fleurir le parasitisme gouvernemental et propriétaire, et de sucer le sang du peuple. Ce ne sont pas quelques millions de plus ou de moins qui peuvent atteindre d’une manière dangereuse un peuple de 36 millions d’hommes. Ce que je vous ai révélé des larcins de la Banque de France n’est que bagatelle : ce sont les conséquences qu’il faut surtout considérer.
La Banque de France tient aujourd’hui dans ses mains la fortune et la destinée du pays.
Si elle faisait remise à l’industrie et au commerce d’une différence sur le taux de ses escomptes, proportionnelle à l’augmentation de son encaisse ; si, en autres termes, le prix de son crédit était réduit à 3/4 p. 100, ce qu’elle devrait faire pour s’exempter de tout vol, cette réduction produirait instantanément, sur toute la face de la République, et en Europe, des conséquences incalculables. Un livre ne suffirait pas à les énumérer : je me bornerai à vous en signaler quelques-unes.
Si donc le crédit de la Banque de France, devenue Banque nationale, était de 3/4 p. 100 au lieu de 4, les banquiers ordinaires, les notaires, les capitalistes, et jusqu’aux actionnaires de la Banque même, seraient bientôt forcés, par la concurrence, de réduire leurs intérêts, escomptes et dividendes au maximum de 1 p. 100, frais d’acte et commission compris. Quel mal, pensez-vous, ferait cette réduction aux débiteurs chirographaires, ainsi qu’au commerce et à l’industrie, dont la charge annuelle, de ce seul fait, est d’au moins deux milliards ?
Si la circulation financière s’opérait à un taux d’escompte représentant seulement les frais d’administration et de rédaction, enregistrement, etc., l’intérêt compté dans les achats et ventes qui se font à terme, tomberait à son tour de 6 p. 100 à zéro, ce qui veut dire qu’alors les affaires se feraient au comptant : il n’y aurait plus de dettes. De combien pensez-vous encore que s’en trouverait diminué le chiffre honteux des suspensions de payements, faillites et banqueroutes ?
Mais, de même que dans la société le produit net ne se distingue pas du produit brut ; de même, dans l’ensemble des faits économiques, le capital ne se distingue pas du produit. Ces deux termes ne désignent point en réalité deux choses distinctes ; ils ne désignent que des relations. Produit, c’est capital ; capital, c’est produit : il n’y a de différence entre eux que dans l’économie domestique ; elle est nulle dans l’économie publique. Si donc l’intérêt, après être tombé, pour le numéraire, à 3/4 p. 100, c’est-à-dire à zéro, puisque 3/4 p. 100 ne représentent plus que le service de la Banque, tombait encore à zéro pour les marchandises ; par l’analogie des principes et des faits, il tomberait encore à zéro pour les immeubles : le fermage et le loyer finiraient par se confondre dans l’amortissement. — Croyez-vous, monsieur, que cela empêchât d’habiter les maisons et de cultiver la terre ?…
Si, grâce à cette réforme essentielle de l’appareil circulatoire, le travail n’avait plus à payer au capital qu’un intérêt représentant le juste prix du service que rend le capitaliste, l’argent et les immeubles n’ayant plus aucune valeur reproductive, n’étant plus estimés que comme produits, comme choses consommables et fongibles, la faveur qui s’attache à l’argent et aux capitaux se porterait tout entière sur les produits ; chacun, au lieu de resserrer sa consommation, ne songerait qu’à l’étendre. Tandis qu’aujourd’hui, grâce à l’interdiction mise sur les objets de consommation par l’intérêt, le débouché reste toujours, et de beaucoup, insuffisant ; ce serait la production, qui, à son tour, ne suffirait pas : le travail serait donc de fait, comme de droit, garanti.
La classe travailleuse gagnant d’un seul coup 3 milliards environ d’intérêt, qu’on lui prend sur les 10 qu’elle produit, plus de 5 milliards que le même intérêt lui fait perdre en chômage, plus 5 milliards que la classe parasite, coupée aux vivres, serait alors forcée de produire : la production nationale se trouverait doublée, et le bien-être du travailleur quadruplerait. — Et vous, monsieur, que le culte de l’intérêt n’empêche point d’élever votre pensée vers un autre monde, que dites-vous de cet amendement aux choses d’ici-bas ? Est-il clair, à présent, que ce n’est pas la multiplication des capitaux qui fait baisser l’intérêt, mais bien, au contraire, la baisse de l’intérêt qui multiplie les capitaux ?
Mais tout cela déplaît à MM. les capitalistes, et n’est point du goût de la Banque. La Banque tient à la main la corne d’abondance que lui a confié le peuple : ce sont ces 341 millions de numéraire accumulé dans ses caves, et qui témoignent si haut de la puissance du crédit public. Pour ranimer le travail et répandre partout la richesse, la Banque n’aurait à faire qu’une chose : ce serait de réduire le taux de ses escomptes au chiffre voulu pour la production d’un intérêt à 4 p. 100 sur 90 millions. Elle ne le veut pas. Pour quelques millions de plus à distribuer à ses actionnaires, et qu’elle vole, elle préfère faire perdre au pays, sur la production de chaque année, 10 milliards. Afin de payer le parasitisme, de solder les vices, d’assouvir la crapule de deux millions de fonctionnaires, d’agioteurs, d’usuriers, de prostituées, de mouchards, et d’entretenir cette lèpre du gouvernement, elle fera pourrir, s’il le faut, dans la misère, trente-quatre millions d’hommes. — Encore une fois, est-ce du vol, cela ? Est-ce de la rapine, du brigandage, de l’assassinat avec préméditation et guet-apens ?
Ai-je tout dit ? — Non ; j’en aurais pour dix volumes ; mais il faut en finir. Je terminerai par un trait qui me paraît, à moi, le chef-d’œuvre du genre, et sur lequel j’appelle toute votre attention. Avocat du capital, vous ne connaissez pas toutes les roueries du capital.
La somme de numéraire, je ne dirai pas existant, mais circulant en France, y compris l’encaisse de la Banque, ne dépasse pas, suivant l’évaluation la plus commune, 1 milliard.
À 4 pour 100 d’intérêt, — je raisonne toujours dans l’hypothèse du crédit payé, — c’est donc une somme de 40 millions que le peuple travailleur doit chaque année pour le service de ce capital.
Sauriez-vous, monsieur, me dire pourquoi, au lieu de 40 millions, nous payons 1,600 millions, — je dis seize cents millions, — le louage dudit capital ?
1,600 millions, 160 pour 100 ! dites-vous : Impossible !… — Quand je vous dis, monsieur, que vous n’entendez rien à l’économie politique. Voici le fait qui, pour vous, j’en suis sûr, est encore une énigme.
| La somme des créances hypothécaires, d’après les auteurs les mieux informés, est de 12 milliards, quelques-uns la portent à 16 milliards, ci : | 12 milliards. |
| Celle des créances chirographaires, au moins | 6 |
| La commandite, environ | 2 |
| À quoi il convient d’ajouter la dette publique, | 8 |
| Total. | 28 milliards, |
que l’agriculture, l’industrie, le commerce, en un mot, le travail, qui produit tout, et l’État, qui ne produit rien, et pour qui le travail paye, doivent au capital.
Toutes ces dettes, notez ce point, proviennent d’argent prêté, ou censé l’avoir été, qui à 4 pour 100, qui à 5, qui à 6, qui à 8, qui à 12, et jusqu’à 15.
Je prends pour moyenne de l’intérêt, en ce qui concerne les trois premières catégories, 6 pour 100 : soit donc, sur 20 milliards, 1,200 millions. — Ajoutez l’intérêt de la dette publique, environ 400 millions : en tout 1,600 millions d’intérêt annuel, pour un capital de 1 milliard.
Or ça, dites-moi, est-ce aussi la rareté de l’argent qui est cause de la multiplication exorbitante de ces usures ? Non, puisque toutes ces sommes ont été prêtées, comme nous venons de le dire, à un taux moyen de 6 pour 100. Comment donc un intérêt, stipulé à 6 pour 100, est-il devenu un intérêt de 160 pour 100 ? Je m’en vais vous le dire.
Vous saurez, monsieur, vous qui croyez que tout capital est naturellement et nécessairement productif, que cette productivité n’a pas lieu également pour tous ; qu’elle ne s’exerce d’habitude que sous deux espèces, l’espèce dite immeubles (terre et maison), quand on en trouve le placement, ce qui n’est ni toujours facile, ni toujours sûr : et l’espèce argent. L’argent, l’argent surtout ! Voilà le capital par excellence, le capital qui se prête, c’est-à-dire qui se loue, qui se fait payer, qui produit toutes ces merveilles financières, que nous voyons s’élaborer à la Banque, à la Bourse, dans tous les ateliers de l’usure et de l’intérêt.
Mais l’argent n’est point chose qui s’exploite comme la terre, ni qui se consomme par l’usage comme une maison ou un habit. Ce n’est pas autre chose qu’un bon d’échange, ayant créance chez tous les négociants et producteurs, et avec lequel, vous qui faites des sabots, vous pouvez vous procurer une casquette. En vain, par le ministère de la Banque, le papier se substitue peu à peu, et du consentement de tous, au numéraire : le préjugé tient bon, et si le papier de banque est reçu à l’égal de l’argent, c’est qu’on se flatte de pouvoir, à volonté, l’échanger contre de l’argent. On ne veut que de l’argent.
Lorsque je loue de l’argent, c’est donc, au fond, la faculté d’échanger mon produit, présent ou futur, mais non encore vendu, que je loue : l’argent, en lui-même, m’est inutile. Je ne le prends que pour le dépenser ; je ne le consomme ni ne le cultive. L’échange conclu, l’argent redevient disponible, capable, par conséquent, de donner lieu à une nouvelle location. C’est aussi ce qui a lieu ; et comme, par l’accumulation des intérêts, le capital-argent, d’échange en échange, revient toujours à sa source, il s’ensuit que la relocation, toujours faite par la même main, profite toujours au même personnage.
Direz-vous que, l’argent servant à l’échange des capitaux et des produits, l’intérêt qu’on lui paye s’adresse moins à lui qu’aux capitaux échangés ; et qu’ainsi 1,600 millions d’intérêts payés pour 1 milliard de numéraire, représentent en réalité le loyer de 25 à 30 milliards de capitaux ? Cela a été dit ou écrit quelque part par un économiste de votre école [1].
Une pareille allégation ne peut se soutenir un instant. D’où vient, je vous prie, que les maisons se louent, que les terres s’afferment, que les marchandises vendues à terme portent intérêt ? Cela vient précisément de l’usage de l’argent ; de l’argent, qui intervient, comme un agent fiscal, dans toutes les transactions ; de l’argent, qui empêche les maisons et les terres, au lieu de se louer, de s’échanger, et les marchandises de se placer au comptant. L’argent, donc, intervenant partout comme capital supplémentaire, agent de circulation, instrument de garantie, c’est bien lui qu’il s’agit de payer, c’est bien le service qu’il rend qu’il est question de rémunérer.
Et, puisque d’un autre côté nous avons vu, d’après l’exposé du mécanisme de la Banque de France et les conséquences de l’accumulation de son encaisse, qu’un capital de 90 millions espèces, devant produire un intérêt de 4 p. 100 l’an, ne comporte, selon la masse d’affaires traités par la Banque, qu’un escompte de 3, de 2, de 1, de 3/4 p. 100, il est bien évident que les 1,600 millions d’intérêts que le peuple paye à ses usuriers, banquiers, rentiers, notaires et commanditaires ont uniquement pour objet d’acquitter le loyer d’un milliard, or et argent, à moins que vous ne préfériez reconnaître, avec moi, que ces 1,600 millions sont le produit du vol…
Je vous l’ai dit, monsieur, dès le commencement de cette dispute, et je le répète, il n’est jamais entré dans ma pensée d’accuser les hommes. Ce que j’incrimine, ce sont les idées et les institutions. Sous ce rapport, j’ai été, dans toute cette discussion, plus juste que l’Église, plus charitable que l’Évangile même. Vous avez vu avec quel soin j’ai séparé, dans la question du prêt à intérêt, l’homme de l’institution, la conscience de la théorie. Jamais je n’accuserai la société : en dépit de tous les crimes de mes semblables, et des vices de mon propre cœur, je crois à la sainteté du genre humain.
Cependant, quand je réfléchis que c’est contre des folies pareilles que la Révolution se débat aujourd’hui ; quand je vois des millions d’hommes sacrifiés à de si exécrables utopies, je suis près de céder à ma misanthropie, et je ne me sens plus le courage de la réfutation. Alors, j’essaye d’élever et d’ennoblir, par la sublimité de la dialectique, les misères de mon sujet : votre impitoyable routine me ramène sans cesse à la hideuse réalité.
La production à doubler,
Le bien-être du travailleur à quadrupler :
Voilà ce qu’en vingt-quatre heures, par une simple réforme de banque, nous pourrions, si nous le voulions, réaliser, sans dictature, sans communisme, sans phalanstère, sans Icarie et sans Triade. Un décret, en douze articles, de l’Assemblée nationale ; une simple déclaration de ce fait, que la Banque de France, par l’augmentation de son numéraire, est devenue Banque nationale ; qu’en conséquence elle doit fonctionner au nom et pour le compte de la nation, et le taux des escomptes être réduit à 3/4 p. 100, — et la Révolution est aux trois quarts faite.
Mais c’est ce que nous ne voulons pas, ce que nous refusons de comprendre, tant nos bavardages politiques et nos hâbleries parlementaires ont étouffé en nous à la fois le sens moral et le sens pratique ;
C’est ce que ne veut pas la Banque de France, citadelle du parasitisme ;
Ce que ne veut pas le gouvernement, créé tout exprès pour soutenir, protéger, encourager le parasitisme ;
Ce que ne veut pas la majorité de l’Assemblée nationale, composée de parasites et de fauteurs de parasites ;
Ce que ne veut pas la minorité, entêtée de gouvernement, et qui se demande ce que deviendra la société quand elle n’aura plus de parasites ;
Ce que ne veulent pas les socialistes eux-mêmes, prétendus révolutionnaires, à qui la liberté, l’égalité, la richesse, le travail, ne sont rien, s’il leur faut abandonner ou seulement ajourner leurs chimères, et renoncer à l’espoir du gouvernement ;
Ce que ne sait pas demander le prolétariat, ahuri de théories sociales, de toasts à l’amour et d’homélies fraternelles.
Va donc, capital, va, continue d’exploiter ce misérable peuple ! Consume cette bourgeoisie hébétée, pressure l’ouvrier, rançonne le paysan, dévore l’enfance, prostitue la femme, et garde tes faveurs pour le lâche qui dénonce, pour le juge qui condamne, pour le soldat qui fusille, pour l’esclave qui applaudit. La morale des marchands de cochons est devenue celle des honnêtes gens. Malédiction sur mes contemporains !
P. J. Proudhon.
FN:Que M. Proudhon se soit fait illusion sur la valeur très-douteuse des chiffres et des arguments employés dans cette lettre, cela se conçoit à la rigueur. Mais il est bien difficile de regarder comme une erreur involontaire l’incroyable confusion qu’il fait ici entre le numéraire et le capital de la nation. (Note de l’éditeur.)
DIXIÈME LETTRE - F. Bastiat à P. J. Proudhon ↩
À qui le droit de se plaindre d’avoir été trompé ? Dialogue. — Les inductions tirées d’un établissement privilégié, la Banque de France, ne prouvent rien dans le débat. — Ouvertures conciliantes. — Prendre la liberté du crédit pour juge en dernier ressort de la question de la gratuité. — Souvenir à l’antinomie.
6 janvier 1850.
Je vous ai trompé, dites-vous ; non, je me suis trompé.
Admis sous votre tente, à votre foyer, pour discuter, au milieu de vos propres amis, une question grave, si mes arguments tombaient sous votre critique, je devais croire, du moins, que ma personne vous serait sacrée. Vous négligez mes arguments et qualifiez ma personne. — Je me suis trompé.
En écrivant dans votre journal, m’adressant à vos lecteurs, mon devoir était de me renfermer sévèrement dans le sujet en discussion. J’ai cru que, comprenant la gêne de ma position, vous vous croiriez tenu de vous imposer, chez vous, sous votre toit, la même gêne. — Je me suis trompé.
Je me disais : M. Proudhon a un esprit indépendant. Rien au monde ne l’entraînera à manquer aux devoirs de l’hospitalité. Mais M. Louis Blanc vous ayant fait honte de votre urbanité envers un économiste, vous en avez eu honte, en effet. — Je me suis trompé.
Je me disais encore : la discussion sera loyale. Le droit à une rémunération est-il inhérent au capital comme au travail lui-même ? Telle était la question à résoudre, afin d’en conclure pour ou contre la gratuité du crédit. Sans espérer tomber d’accord avec vous sur la solution, je croyais du moins que nous nous accorderions sur la question. Mais voici, chose étrange, que ce que vous me reprochez sans cesse avec amertume, presque avec colère, c’est de l’approfondir et de m’y renfermer. Nous avions avant tout à vérifier un PRINCIPE d’où dépend, selon vous, la valeur du socialisme, et vous redoutez la lumière que je cherche à concentrer sur ce principe. Vous êtes mal à l’aise sur le terrain du débat ; vous le fuyez sans cesse. — Je me suis trompé.
Quel singulier spectacle ne donnons-nous pas à nos lecteurs, et sans qu’il y ait de ma faute, par ce débat qui peut se résumer ainsi :
— Il fait jour.
— Il fait nuit.
— Voyez : le soleil brille au-dessus de l’horizon. Tous les hommes, sur la surface entière du pays, vont, viennent, marchent, se conduisent de manière à rendre témoignage à la lumière.
— Cela prouve qu’il fait jour. Mais j’affirme qu’en même temps il fait nuit.
— Comment cela se peut-il ?
— En vertu de la belle loi des Contradictions. N’avez-vous pas lu Kant, et ne savez-vous pas qu’il n’y a de vrai au monde que les propositions qui se contredisent ?
— Alors, cessons de discuter ; car, avec cette logique, nous ne saurions nous entendre.
— Eh bien ! puisque vous ne comprenez pas la sublime clarté des contradictions, je vais condescendre à votre ignorance et vous prouvez ma thèse par la méthode des distinctions. Il y a du jour qui éclaire et du jour qui n’éclaire pas.
— Je ne suis pas plus avancé.
— Il me reste encore pour ressource le système des digressions. Suivez-moi, et je vous ferai faire du chemin.
— Je n’ai pas à vous suivre. J’ai prouvé qu’il fait jour ; vous en convenez, tout est dit.
— Vous ressassez toujours même assertion et mêmes preuves : vous avez prouvé qu’il fait jour, soit, maintenant, prouvez-moi qu’il ne fait pas nuit.
Cela est-il sérieux ?
Quand un homme se lève, et, s’adressant au peuple, lui dit : Le moment est venu où la société te doit le capital gratis, où tu dois avoir des maisons, des outils, des instruments, des matériaux, des approvisionnements pour rien ; quand un homme, dis-je, tient ce langage, il doit s’attendre à rencontrer un adversaire qui lui demande quelle est la nature intime du capital. Vous aurez beau invoquer la contradiction, la distinction et la digression, je vous ramènerai au sujet principal et essentiel. C’est mon rôle ; et peut-être, est-ce le vôtre de dire que je suis un ignorant opiniâtre, et que je ne sais pas raisonner.
Car enfin, pour qu’il y ait entre nous une divergence si profonde, il faut bien que nous ne nous entendions pas sur la signification de ce mot : Capital.
Dans votre lettre du 17 décembre vous disiez : « Si la peine du créancier est zéro, l’intérêt du créancier doit devenir zéro. »
Soit. Mais il en résulte ceci :
Si la peine du créancier est quelque chose, l’intérêt doit être quelque chose.
Prouvez donc que le temps est venu où les maisons, les outils, les provisions naissent spontanément. Hors de là, vous n’êtes pas fondé à dire que la peine du capitaliste est zéro, et que, par ce motif, sa rémunération doit être zéro.
En vérité, je ne sais pas ce que vous entendez par ce mot : Capital ; car vous en donnez, dans votre lettre, deux définitions toutes différentes.
D’un côté, le capital d’une nation, ce serait le numéraire qu’elle possède. C’est de cette donnée que vous partez pour prouver que le taux de l’intérêt, en France, est de 160 pour 100. Vous calculez ainsi : La somme du numéraire est de un milliard. On paye pour les intérêts de toutes les dettes hypothécaires, chirographaires, commanditaires et publiques 1,600 millions. Donc le capital se fait payer au taux de 100 pour 100.
Il résulte de là qu’à vos yeux capital et numéraire c’est une seule et même chose.
Partant de cette donnée, je trouve votre évaluation de l’intérêt bien modérée. Vous eussiez dû dire que le capital prélève encore quelque chose sur le prix de tout produit, et vous seriez arrivé ainsi à estimer l’intérêt à 4 ou 500 pour 100.
Mais voici qu’après avoir raisonné de la sorte sur cette singulière définition du capital, vous la renversez vous-même en ces termes :
« Le capital ne se distingue pas du produit. Ces deux termes ne désignent point, en réalité, deux choses distinctes ; ils ne désignent que des relations. Produit, c’est capital ; capital, c’est produit. »
Voici une base autrement large que celle du numéraire. Si le Capital est le produit ou l’ensemble des produits (terres, maisons, marchandises, argent, etc.), assurément le capital national est de plus d’un milliard, et votre évaluation du taux de l’intérêt est un non-sens.
Convaincu que tout ce débat repose sur la notion du capital, souffrez que, au risque de vous ennuyer, je dise ce que j’en pense, non par voie de définition, mais par voie de description.
Un menuisier travaille pendant trois cents jours, gagne et dépense 5 fr. par jour.
Cela veut dire qu’il rend des services à la société et que la société lui rend des services équivalents, les uns et les autres estimés 1,500 fr., les pièces de cent sous n’étant ici qu’un moyen de faciliter les échanges.
Supposons que cet artisan économise 1 franc par jour. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’il rend à la société des services pour 1,500 francs, et qu’il n’en retire actuellement des services que pour 1,200. Il acquiert le droit de puiser dans le milieu social, où, quand et sous la forme qu’il lui plaira, des services, bien et dûment gagnés, jusqu’à concurrence de 300 fr. Les soixante pièces de cent sous qu’il a conservées sont à la fois le titre et le moyen d’exécution de son droit.
Au bout de l’an, notre menuisier peut donc, s’il le juge à propos, revendiquer son droit acquis sur la société. Il peut lui demander des satisfactions. Il peut choisir entre le cabaret, le spectacle, la boutique ; il peut encore augmenter son outillage, acquérir des instruments plus parfaits, se mettre à même de rendre son travail ultérieur plus productif. C’est ce droit acquis que j’appelle capital.
Les choses en sont là, quand le forgeron, son voisin, vient dire au menuisier : Tu as acquis, par ton travail, tes économies, tes avances, le droit de retirer du milieu social des services jusqu’à concurrence de 300 fr. ; substitue-moi à ton droit pour un an ; car j’en userai de manière à avoir plus de marteaux, plus de fer, plus de houille, en un mot, à améliorer ma condition et mon industrie.
— Je suis dans le même cas, dit le menuisier ; cependant je veux bien te céder mes droits et m’en priver pour un an, si tu veux me faire participer pour quelque chose à l’excédant des profits que tu vas faire.
Si ce marché, profitable aux deux parties, est librement conclu, qui osera le déclarer illégitime ?
Voilà donc l’intérêt défini, et, comme vous l’avez dit, il a dû se présenter, à l’origine, sous forme d’un partage de bénéfices, d’une part accordée au capital sur l’excédant des profits qu’il a aidé à réaliser.
C’est cette part afférente au capital que je dis être d’autant plus grande ou plus petite, que le capital lui-même est plus rare ou plus abondant.
Plus tard, les parties contractantes, pour leur commodité, pour n’avoir pas à se surveiller réciproquement, à débattre des comptes, etc., ont traité à forfait sur cette part. Comme le métayage s’est transformé en fermage, la prime incertaine de l’assurance en prime fixe, de même l’intérêt, au lieu d’être une participation variable aux bénéfices, est devenu une rémunération déterminée. Il a un taux, et ce taux, grâce au ciel, tend à baisser en proportion de l’ordre, de l’activité, de l’économie, de la sécurité qui règnent dans la société !
Et certes, si vous voulez la gratuité du crédit, vous êtes tenu de prouver que le capital n’est pas né du travail de celui qui le prête et qu’il ne féconde pas le travail de celui qui l’emprunte.
Qu’on dise donc qui perd à cet arrangement. Est-ce le menuisier qui en tire un profit ? Est-ce le forgeron qui y trouve un moyen d’accroître la production et ne cède qu’une partie de l’excédant ? Est-ce un tiers quelconque dans la société ? Est-ce la société elle-même qui obtient de la forge plus de produits et des produits moins chers ?
Il est vrai que les transactions relatives au capital peuvent donner lieu à des tromperies, à des abus de force ou de ruse, à des escroqueries, à des extorsions. L’ai-je jamais nié et est-ce là l’objet de notre débat ? N’y a-t-il pas beaucoup de transactions relatives au travail, où le capital n’est pour rien, et auxquelles on peut adresser le même reproche ? Et serait-il plus logique de conclure de ces abus, dans le premier cas, à la gratuité du crédit, que dans le second à la gratuité du travail ?
Ceci m’amène à dire quelques mots de la nouvelle série d’arguments que vous cherchez dans les procédés de la Banque de France. Si même je me décide à revenir sur la résolution que j’avais prise de clore cette discussion, c’est que je suis bien aise de saisir cette occasion de protester énergiquement contre une imputation qui a été mal à propos dirigée contre moi.
On a dit que je m’étais constitué le défenseur du privilége capitaliste.
Non ; je ne défends aucun privilége ; je ne défends autre chose que les droits du capital considéré en lui-même. Vous serez assez juste, monsieur, pour reconnaître qu’il ne s’agissait pas entre nous de questions de faits particuliers, mais d’une question de science.
Ce que je défends, c’est la liberté des transactions.
Par votre théorie des contradictions, vous rendez contradictoire ce qui est identique, est-ce que vous voudriez aussi, par une théorie de conciliation non moins étrange, rendre identique ce qui est contradictoire ; par exemple, la liberté et le privilége ?
Qu’avait donc à faire le privilége de la Banque de France dans notre débat ? Quand, où ai-je justifié ce privilége et le mal qu’il engendre ? Ce mal a-t-il été contesté par aucun de mes amis ? Lisez plutôt le livre de M. Ch. Coquelin.
Mais quand, pour atteindre la légitime rémunération du capital, vous frappez les illégitimes extorsions du privilége, cet artifice ne renferme-t-il pas l’aveu que vous êtes impuissant contre les droits du Capital exercés sous l’empire de la liberté ?
L’émission d’une chose que le public recherche, — à savoir, les Bons au porteur, — est interdite à tous les Français, hors un. Ce privilége met celui qui en est investi en situation de faire de gros profits. Quel rapport cela a-t-il avec la question de savoir si le capital a droit de recevoir une récompense librement consentie ?
Remarquez ceci : le capital, qui, comme vous dites, ne se distingue pas du produit, représente du travail, tellement que, depuis le début de cette discussion, vous ne portez jamais un coup à l’un qui ne retombe sur l’autre ; c’est ce que je vous ai montré, dans ma dernière lettre, à propos de deux apologues : Pour prouver qu’il est des cas où on est tenu, en conscience, de prêter gratis, vous supposez un riche capitaliste en face d’un pauvre naufragé. — Et vous-même, un instant avant, vous aviez placé un ouvrier en présence d’un capitaliste près d’être englouti dans les flots. Que s’ensuit-il ? qu’il est des circonstances où le capital, comme le travail, doivent se donner. Mais on n’en peut pas plus conclure à la gratuité normale de l’un, qu’à la gratuité normale de l’autre.
Maintenant, vous me parlez des méfaits du capital, et me citez en exemple un capital privilégié. Je vous répondrai, en vous citant du travail privilégié.
Je suppose qu’un réformateur, plus radical que vous, se lève au milieu du peuple et lui dise : « Le travail doit être gratuit, le salaire est un vol. Mutuum date, nil indè sperantes. Et, pour vous prouver que les produits du travail sont illégitimes, je vous signale cet agent de change qui exploite le privilége exclusif de faire des courtages, ce boucher qui a le droit exclusif d’alimenter la ville, ce fabriquant qui a fait fermer toutes les boutiques, excepté la sienne : vous voyez bien que le travail ne porte pas en lui-même le principe de la rémunération, qu’il vole tout ce qu’on lui paye, et que le salaire doit être aboli. »
Assurément, en entendant le réformateur assimiler les rétributions forcées aux rétributions libres, vous seriez fondé à lui adresser cette question : Où avez-vous appris à raisonner ?
Eh bien ! monsieur, si vous concluez du privilége de la Banque à la gratuité du crédit, je crois pouvoir retourner contre vous cette question que vous m’adressez dans votre dernière lettre : Où avez-vous appris à raisonner ?
« Dans Hégel, direz-vous. Il m’a fourni une logique infaillible. » Malebranche aussi avait imaginé une méthode de raisonnement, au moyen de laquelle il ne devait jamais se tromper… et il s’est trompé toute sa vie, au point qu’on a pu dire de ce philosophe :
Lui qui voit tout en Dieu, n’y voit pas qu’il est fou.
Laissons donc là la Banque de France. Que vous appréciiez bien ou mal ses torts, que vous exagériez ou non son action funeste, elle a un privilége, cela suffit pour qu’elle ne puisse en rien éclairer ce débat.
Peut-être, néanmoins, pourrions-nous trouver là un terrain de conciliation. N’y a-t-il pas un point sur lequel nous sommes d’accord ? C’est de réclamer et poursuivre avec énergie la liberté des transactions, aussi bien celles qui sont relatives aux capitaux, au numéraire, aux billets de banque, que toutes les autres. Je voudrais qu’on pût librement ouvrir partout des boutiques d’argent, des bureaux de prêt et d’emprunt, comme on ouvre boutique de souliers ou de comestibles.
Vous croyez à la gratuité du crédit ; je n’y crois pas. Mais enfin, à quoi bon disputer, si nous sommes d’accord sur ce fait que les transactions de crédit doivent être libres ?
Assurément, s’il est dans la nature du capital de se prêter gratuitement, ce sera sous le régime de la liberté, et sans doute vous ne demandez pas cette révolution à la contrainte.
Attaquons donc le privilége de la Banque de France, ainsi que tous les priviléges. Réalisons la liberté et laissons-la agir. Si vous avez raison, s’il est dans la nature du crédit d’être gratuit, la liberté développera cette nature, — et soyez bien convaincu que je serai, si je vis encore, le premier à m’en réjouir. J’emprunterai gratis, et pour le reste de mes jours, une belle maison sur le boulevard, avec un mobilier assorti et un million au bout. Mon exemple sera sans doute contagieux, et il y aura emprunteurs dans le monde. Pourvu que les prêteurs ne fassent pas défaut, nous mènerons tous joyeuse vie.
Et puisque le sujet m’y entraîne, voulez-vous, tout profane que je suis, que je dise un mot, en terminant, de la métaphysique des antinomies ? Je n’ai pas étudié Hégel, mais je vous ai lu, et voici l’idée que je m’en suis formée.
Oui, il est une multitude de choses dont on peut dire avec vérité qu’elles sont un bien et un mal, selon qu’on les considère dans leur rapport avec l’infirmité humaine ou au point de vue de la perfection absolue.
Nos jambes sont un bien, car elles nous permettent de nous transporter d’un lieu à un autre. Elles sont un mal aussi, car elles attestent que nous n’avons pas le don de l’ubiquité.
Il en est ainsi de tout remède douloureux et efficace ; il est un bien et un mal : un bien parce qu’il est efficace ; un mal parce qu’il est douloureux.
Il est donc vrai que l’on peut voir des antinomies dans chacune de ces idées : Capital, intérêt, propriété, concurrence, machines, État, travail, etc.
Oui, si l’homme était absolument parfait, il n’aurait pas à payer d’intérêts, car les capitaux naîtraient pour lui spontanément et sans mesure, ou plutôt il n’aurait pas besoin de capitaux.
Oui, si l’homme était absolument parfait, il n’aurait pas à travailler : un fiat suffirait à satisfaire ses désirs.
Oui, si l’homme était absolument parfait, nous n’aurions que faire de gouvernement ni d’État. Comme il n’y aurait pas de procès, il ne faudrait pas de juges. Comme il n’y aurait ni crimes ni délits, il ne faudrait pas de police. Comme il n’y aurait pas de guerres, il ne faudrait pas d’armées.
Oui, si l’homme était absolument parfait, il n’y aurait pas de propriété, car chacun ayant, comme Dieu, la plénitude des satisfactions, on ne pourrait imaginer la distinction du tien et du mien.
Les choses étant ainsi, on conçoit qu’une métaphysique subtile, abusant du dogme incontestable de la perfectibilité humaine, vienne dire : Nous marchons vers un temps où le crédit sera gratuit, où l’État sera anéanti. Ce n’est même qu’alors que la société sera parfaite, car les idées intérêt, État, sont exclusives de l’idée : Perfection.
Autant elle en pourrait dire des idées : travail, bras, jambes, yeux, estomac, intelligence, vertu, etc.
Et certes, cette métaphysique tomberait dans le plus grossier sophisme, si elle ajoutait : Puisque la société ne sera arrivée à la perfection que lorsqu’elle ne connaîtra plus l’intérêt et l’État, supprimons l’État et l’intérêt, et nous aurons la société parfaite.
C’est comme si elle disait : Puisque l’homme n’aura plus que faire de ses jambes quand il aura le don de l’ubiquité, pour le rendre ubiquiste, coupons-lui les jambes.
Le sophisme consiste à dissimuler que ce qu’on nomme ici un mal est un remède ; que ce n’est pas la suppression du remède qui fait la perfection, que c’est, au contraire, la perfection qui rend le remède inutile [1].
Mais on conçoit combien la métaphysique dont je parle peut troubler et égarer les esprits, si elle est habilement maniée par un vigoureux publiciste.
Il lui sera aisé, en effet, de montrer, tour à tour, comme un bien et comme un mal, la propriété, la liberté, le travail, les machines, le capital, l’intérêt, la magistrature, l’État.
Il pourra intituler son livre : Contradictions économiques. Tout y sera alternativement attaqué et défendu. Le faux y revêtira toujours les couleurs du vrai. Si l’auteur est un grand écrivain, il couvrira les principes du bouclier le plus solide, en même temps qu’il tournera contre eux les armes les plus dangereuses.
Son livre sera un inépuisable arsenal pour et contre toutes les causes. Le lecteur arrivera au bout sans savoir où est la vérité, où est l’erreur. Effrayé de se sentir envahi par le scepticisme, il implorera le maître et lui dira ce qu’on disait à Kant : De grâce, dégagez l’inconnue. mais l’inconnue ne se dégagera pas.
Que si, joueur téméraire, vous entrez dans la lice, vous ne saurez par où prendre le terrible athlète, car celui-ci s’est ménagé, par son système, un monde de refuges.
Lui diriez-vous : Je viens défendre la propriété ? Il vous répondra : Je l’ai défendue mieux que vous. — Et cela est vrai. Lui diriez-vous : Je viens attaquer la propriété ? Il vous répondra : Je l’ai attaquée avant vous. — Et c’est encore vrai. Soyez pour ou contre le crédit, l’État, le travail, la religion, vous le trouverez toujours prêt à approuver ou à contredire, son livre à la main.
Et tout cela, pour avoir faussement conclu de la perfectibilité indéfinie à la perfection absolue, ce qui n’est, certes jamais permis, quand on traite de l’homme.
Mais ce que vous pouvez dire, monsieur Proudhon, et ce que ma faible voix répétera avec vous, c’est ceci : Approchons de la perfection, pour rendre de plus en plus inutiles l’intérêt, l’État, le travail, tous les remèdes onéreux et douloureux.
Créons autour de nous l’ordre, la sécurité, les habitudes d’économie et de tempérance, afin que les capitaux se multiplient et que l’intérêt baisse.
Créons parmi nous l’esprit de justice, de paix et de concorde, afin de rendre de plus en plus inutiles l’armée, la marine, la police, la magistrature, la répression, en un mot l’état.
Et surtout, réalisons la LIBERTÉ, par qui s’engendrent toutes les puissances civilisatrices.
Aujourd’hui même, 6 janvier 1850, la Voix du Peuple interpelle la Patrie en ces termes :
« La Patrie veut-elle demander avec nous la suppression du privilége des banques, la suppression des monopoles des notaires, des agents de change, des avoués, des huissiers, des imprimeurs, des boulangers ; la liberté du transport des lettres, de la fabrication des sels, des poudres et des tabacs ; l’abolition de la loi sur les coalitions, l’abolition de la douane, de l’octroi, de l’impôt sur les boissons, de l’impôt sur les sucres ? La Patrie veut-elle appuyer l’impôt sur le capital, le seul proportionnel ; le licenciement de l’armée et son remplacement par la garde nationale ; la substitution du jury à la magistrature, la liberté de l’enseignement à tous les degrés ? »
C’est mon programme ; je n’en eus jamais d’autre. Qu’en résulte-t-il ? C’est que le capital doit se prêter non gratuitement, mais librement.
Frédéric Bastiat.
FN:L’auteur avait déjà présenté, sous une autre forme, la réfutation de ce sophisme. Voy. page 57. (Note de l’éditeur.)
ONZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat ↩
Maintien de l’imputation d’ignorance. — Définition du capital substituée aux définitions inexactes des économistes. — Appel à l’autorité de la tenue des livres en partie double. — Comptabilité des classes sociales. — Preuve qui en dérive. — Concession conciliante sur le risque des capitaux. — Révolution politique, économique et scientifique.
21 janvier 1850.
Vous ne m’avez pas trompé : le ton de bonne foi et d’extrême sincérité, qui éclate à chaque ligne de votre dernière lettre, m’en est une preuve. Aussi, est-ce avec une joie bien franche que je rétracte mes paroles.
Je ne vous ai pas trompé non plus ; je n’ai pas manqué, comme vous dites, au devoir de l’hospitalité. Toutes vos lettres ont été, comme je l’avais promis, religieusement insérées dans la Voix du Peuple, sans réserves, sans réflexions, sans commentaires. De mon côté, j’ai fait les plus grands efforts pour donner à la discussion une marche régulière, me plaçant, pour cela, tantôt dans la métaphysique, tantôt dans l’histoire, tantôt, enfin, dans la pratique, dans la routine même. Vous seul, et nos lecteurs en sont témoins, avez résisté à toute espèce de méthode. Enfin, quant au ton général de notre polémique, vous reconnaissez que la manière dont j’en ai usé avec vous défenseur du capital, a fait envie à ceux de mes coreligionnaires qui soutiennent en ce moment contre moi une cause plus malheureuse encore que celle de l’intérêt, et qui, par malheur, ont à défendre, dans cette cause, quelque chose de plus que leur opinion, qui ont à venger leur amour-propre. Si, dans ma dernière réplique, mon style s’est empreint de quelque amertume, vous ne devez l’attribuer qu’à l’impatience, certes bien naturelle, où j’étais de voir mes efforts se briser sans cesse contre cette obstination, cette force d’inertie intellectuelle qui, ne faisant compte ni de la philosophie, ni du progrès, ni de la finance, se borne à reproduire éternellement cette question puérile : Quand j’ai épargné cent écus, et que pouvant les utiliser dans mon industrie, je les prête moyennant intérêt ou part de bénéfice, est-ce que je vole ?…
Je rends donc pleine justice à votre loyauté ; j’ose dire que ma courtoisie vis-à-vis de vous ne s’est pas démentie un instant. Mais, aujourd’hui plus que jamais, je suis forcé d’insister sur mon dernier jugement : Non, monsieur Bastiat, vous ne savez pas l’économie politique.
Laissons de côté, je vous prie, la loi de contradiction, à laquelle, décidément, votre esprit répugne ; laissons l’histoire, ou plutôt le progrès, dont vous méconnaissez la tendance, dont vous récusez l’autorité ; laissons la Banque, au moyen de laquelle je vous prouve que l’on peut, sans y rien changer, réduire instantanément l’intérêt des capitaux à 1/2 pour 100. Je vais, puisque tel est votre désir, me renfermer dans la notion pure du capital. J’analyserai cette notion ; j’en ferai, au point de vue de l’intérêt, la déduction théorique et mathématique ; après avoir établi ma thèse par la métaphysique, par l’histoire et par la Banque, je l’établirai une quatrième fois ; je justifierai chacune de mes assertions, par la comptabilité, cette science modeste et trop dédaignée, qui est à l’économie sociale ce que l’algèbre est à la géométrie. Peut-être, cette fois, mon esprit parviendra-t-il à saisir le vôtre : mais qui me garantit que vous n’allez pas me reprocher encore de changer, pour la quatrième fois, de méthode ?
Qu’est-ce que le capital ?
Les auteurs ne sont point d’accord de la définition : à peine s’ils s’entendent même sur la chose.
J. B. Say définit le capital : La simple accumulation des produits.
Rossi : Un produit épargné, et destiné à la reproduction.
J. Garnier, qui les cite : Du travail accumulé ; ce qui rentre dans la définition de J. B. Say, accumulation des produits.
Ce dernier, toutefois, s’exprime ailleurs d’une façon plus explicite : On entend, dit-il, par capital, une somme de valeurs consacrées à faire des avances à la production.
Suivant vous enfin, le capital est un excédant ou reste de produit non consommé, et destiné à la reproduction. — C’est ce qui résulte de votre apologue de l’ouvrier qui gagne 1,500 fr. par an, en consomme 1,200, et réserve les 300 fr. restants, soit pour les mettre dans son fonds d’exploitation, soit, ce qui revient, selon vous, au même, pour les prêter à intérêt.
Il est visible, d’après cette incertitude des définitions, que la notion de capital conserve quelque chose de louche, et la grande majorité de nos lecteurs ne sera pas peu surprise d’apprendre que l’économie politique, science, suivant ceux qui font profession de l’enseigner, et vous êtes du nombre, positive, réelle, exacte, en est encore à trouver ses définitions !
J. Garnier désespérant, par la parole, de donner l’idée de la chose, essaye, comme vous, de la montrer : « Ce sont produits, dit-il, tels que marchandises, outils, bâtiments, bestiaux, sommes de monnaie, etc., fruits d’une industrie antérieure, et qui servent à la reproduction. »
Plus loin il fait observer, tant il y a d’hésitation en son esprit, que dans la notion de capital entre celle d’avance. « Or, qu’est-ce qu’une avance ? — Une avance est une valeur employée de telle sorte qu’elle se trouvera rétablie plus tard. » Ainsi dit M. Granier ; et je pense que le lecteur, après cette explication, n’en sera lui-même guère plus avancé.
Essayons de venir au secours des économistes.
Ce qui résulte jusqu’ici des définitions des auteurs, c’est qu’ils ont tous le sentiment d’un quelque chose qui a nom capital ; mais ce quelque chose, ils sont impuissants à le déterminer, il ne le savent pas. À travers le fatras de leurs explications, on entrevoit l’idée qui leur est commune, mais cette idée, faute de philosophie, ils ne savent point la dégager, ils n’en trouvent pas le mot, la formule. Eh bien, Monsieur, vous allez voir que la dialectique, même hégélienne, peut être bonne à quelque chose.
Vous remarquerez d’abord que l’idée de produit se trouve implicitement ou explicitement dans toutes les définitions qu’on a essayé de donner du capital. C’est déjà un premier pas. Mais à quelle condition, comment et quand le produit peut-il se dire capital ? Voilà ce qu’il s’agit de déterminer. Reprenons nos auteurs, et, corrigeant leurs définitions les unes par les autres, nous viendrons peut-être à bout de leur faire nommer ce que tous ont dans la conscience, mais que l’esprit d’aucun d’eux ne perçoit.
Ce qui fait le capital, suivant J. B. Say, c’est la simple accumulation des produits.
L’idée d’accumulation, comme celle de produit, entre donc dans la notion de capital. Voilà un second pas. Or, tous les produits sont susceptibles d’accumulation ; donc tous les produits peuvent devenir capitaux ; donc l’énumération que M. Joseph Garnier a faite des différentes formes que prend le capital, est incomplète, partant inexacte, en ce qu’elle exclut de la notion les produits servant à la subsistance des travailleurs, tels que blé, vin, huile, provisions de bouche, etc. Ces produits peuvent être réputés capitaux aussi bien que les bâtiments, les outils, les bestiaux, l’argent, et tout ce que l’on considère comme instrument ou matière première.
Rossi : Le capital est un produit épargné, destiné à la reproduction.
La reproduction, c’est-à-dire la destination du produit, voilà une troisième idée contenue dans la notion de capital. Produit, accumulation, reproduction : trois idées qui entrent déjà dans la notion de capital.
Or, de même que tous les produits peuvent être accumulés, de même ils peuvent servir, et servent effectivement, quand c’est le travailleur qui les consomme, à la reproduction. Le pain qui sustente l’ouvrier, le fourrage qui alimente les animaux, la houille qui produit la vapeur, aussi bien que la terre, les chariots et les machines, tout cela sert à la reproduction, tout cela, au moment où il se consomme, est du capital. Tout ce qui se consomme, en effet, se consomme, du moins est censé se consommer reproductivement. Ce qui sert à entretenir ou à faire mouvoir l’instrument, aussi bien que l’instrument même ; ce qui nourrit le travailleur, aussi bien que la matière même du travail. Tout produit devient donc, à un moment donné, capital : la théorie qui distingue entre consommation productive et improductive, et qui entend par celle-ci la consommation quotidienne du blé, du vin, de la viande, des vêtements, etc., est fausse. Nous verrons plus bas qu’il n’y a de consommation improductive que celle du capitaliste même.
Ainsi le capital n’est point chose spécifique et déterminée, ayant une existence ou réalité propre, comme la terre, qui est une chose ; le travail, qui en est une autre ; et le produit, qui est la façon donnée par le travail aux choses de la nature, lesquelles deviennent par là une troisième chose. Le capital ne forme point, comme l’enseignent les économistes, une quatrième catégorie avec la terre, le travail et le produit : il indique simplement, comme j’ai dit, un état, un rapport ; c’est, de l’aveu de tous les auteurs, du produit accumulé et destiné à la reproduction.
Un pas de plus, et nous tenons notre définition.
Comment le produit devient-il capital ? Car il ne suffit pas, il s’en faut bien, que le produit ait été accumulé, emmagasiné, pour être censé capital. Il ne suffit pas même qu’il soit destiné à la reproduction : tous les produits ont cette destination. N’entendez-vous pas dire tous les jours que l’industrie regorge de produits, tandis qu’elle manque de capitaux ? Or, c’est ce qui n’aurait pas lieu si la simple accumulation de produits, comme dit Say, ou la destination reproductive de ces produits, comme le veut Rossi, suffisait à les faire réputer capitaux. Chaque producteur n’aurait alors qu’à reprendre son propre produit, et à se créditer lui-même de ce que ce produit lui coûte, pour être en mesure de produire encore, sans fin et sans limite. Je réitère donc ma question : Qu’est-ce qui fait que la notion de produit se transforme tout à coup en celle de capital ? Voilà ce que les économistes ne disent pas, ce qu’ils ne savent point, je dirai même, ce qu’aucun d’eux ne se demande.
C’est ici que se place une idée intermédiaire dont la vertu particulière est de convertir le produit en capital, comme, au souffle du vent d’ouest, la neige, tombée à Paris ces jours derniers, est passée à l’état de liquide : cette idée est l’idée de valeur.
Voilà ce qu’entrevoyait Garnier, quand il définissait le capital une somme de valeurs consacrées à faire des avances à la production ; — ce que vous sentiez vous-même, quand vous cherchiez la notion de capital, non pas simplement, avec J. B. Say, dans l’accumulation des produits, ni, avec Rossi, dans l’épargne destinée à la reproduction, mais dans la partie non consommée du salaire de l’ouvrier, c’est-à-dire, évidemment, dans la valeur de son travail ou produit.
Cela veut dire que le produit, pour devenir capital, doit avoir passé par une évaluation authentique, avoir été acheté, vendu, apprécié ; son prix débattu et fixé par une sorte de convention légale. En sorte que l’idée de capital indique un rapport essentiellement social, un acte synallagmatique, hors duquel le produit reste produit.
Ainsi le cuir, sortant de la boucherie, est le produit du boucher : quand vous en empliriez une halle, ce ne serait jamais que du cuir, ce ne serait point une valeur, je veux dire une valeur faite ; ce ne serait point capital, ce serait toujours produit. — Ce cuir est-il acheté par le tanneur, aussitôt celui-ci le porte, ou, pour parler plus exactement, en porte la valeur à son fonds d’exploitation, dans son avance, conséquemment la répute capital. Par le travail du tanneur, ce capital redevient produit ; lequel produit, acquis à son tour, à prix convenu, par le bottier, passe de nouveau à l’état de capital, pour redevenir encore, par le travail du bottier, produit. Ce dernier n’étant plus susceptible de recevoir une façon nouvelle, sa consommation est dite, par les économistes, improductive, ce qui est une aberration de la théorie. La chaussure faite par le bottier, et acquise par le travailleur, devient, par le fait de cette acquisition, comme le cuir passant du boucher au tanneur, et du tanneur au bottier, de simple produit valeur : cette valeur entre dans l’avance de l’acheteur, et lui sert, comme les autres objets de sa consommation, comme le logement qu’il habite, comme les outils dont il se sert, mais d’une autre manière, à créer de nouveaux produits. La consommation est donc toujours production ; il suffit, pour cela, que le consommateur travaille. Ce mouvement, une fois commencé, se perpétue à l’infini.
Tel est le capital. Ce n’est pas simplement une accumulation de produits, comme dit Say : — ce n’est pas même encore une accumulation de produits faite en vue d’une reproduction ultérieure, comme le veut Rossi : tout cela ne répond point à la notion du capital. Pour que le capital existe, il faut que le produit ait été, si j’ose ainsi dire, authentiqué par l’échange. C’est ce que savent parfaitement tous les comptables, lorsque, par exemple, ils portent dans leurs écritures, les cuirs verts achetés par le tanneur, à son débit, ce qui veut dire à son capital ; et les cuirs tannés ou corroyés à son crédit ou avoir, ce qui veut dire à son produit ; ce que comprennent encore mieux le commerçant et l’industriel, quand, à la moindre émotion de la politique, ils se voient périr à côté des marchandises accumulées dans leurs magasins, sans qu’ils puissent les employer à aucune reproduction : situation douloureuse, que l’on exprime en disant que le capital engagé ne se dégage plus.
Tout ce qui est capital est nécessairement produit ; mais tout ce qui est produit, même accumulé, même destiné à la reproduction, comme les instruments de travail qui sont dans les magasins des constructeurs, n’est pas pour cela capital. Le capital, encore une fois, suppose une évaluation préalable, opération de change, ou mise en circulation, hors de laquelle pas de capital. S’il n’existait au monde qu’un seul homme, un travailleur unique, produisant tout pour lui seul, les produits qui sortiraient de ses mains resteraient produits : ils ne deviendraient pas capitaux. Son esprit ne distinguerait point entre ces termes : produit, valeur, capital, avance, reproduction, fonds de consommation, fonds de roulement, etc. De telles notions ne naîtraient jamais dans l’esprit d’un solitaire.
Mais, dans la société, le mouvement d’échange une fois établi, la valeur contradictoirement fixée, le produit de l’un devient incessamment le capital de l’autre ; puis, à son tour, ce capital, soit comme matière première, soit comme instrument de travail, soit comme subsistance, se transforme de nouveau en produit. En deux mots, la notion de capital, opposée à celle de produit, indique la situation des échangistes les uns à l’égard des autres. Quant à la société, l’homme collectif, qui est justement ce travailleur solitaire, dont je parlais tout à l’heure, la distinction n’existe plus ; il y a identité entre le capital et le produit, de même qu’entre le produit net et le produit brut.
J’ai donc eu raison de dire, et je m’étonne qu’après l’exégèse que vous avez faite vous-même du capital, vous n’ayez su comprendre mes paroles :
« Le capital ne se distingue pas du produit. Ces deux termes ne désignent point, en réalité, deux choses distinctes ; ils ne désignent que des relations. Produit, c’est capital ; capital, c’est produit. »
Et mon ami Duchêne, soutenant la même thèse contre Louis Blanc, a eu bien plus raison encore de dire :
« Les distinctions de capital et de produit, retenez-le bien une fois pour toutes, n’indiquent que des relations d’individu à individu : dans la société, il y a simplement production, consommation, échange. On peut dire de toutes les industries qu’elles créent des capitaux ou des produits, indistinctement. Le mécanicien est fabricant de capitaux pour les chemins de fer, les usines, les manufactures ; le drapier est fabricant de capitaux pour les tailleurs ; le taillandier est fabricant de capitaux pour la menuiserie, la charpente, la maçonnerie ; une charrue est produit pour le charron qui la vend, et capital pour le cultivateur qui l’achète. Toutes les professions ont besoin de produits pour produire, ou, ce qui revient au même, de capitaux pour confectionner des capitaux. »
Cela vous semblerait-il donc inintelligible ? Il n’y a pas d’antinomie, cependant.
Au point de vue des intérêts privés, le capital indique un rapport d’échange, précédé d’une évaluation synallagmatique. C’est le produit apprécié, pour ainsi dire, juridiquement, par deux arbitres responsables, qui sont le vendeur et l’acheteur, et déclaré, à la suite de cette appréciation, instrument ou matière de reproduction. — Au point de vue social, capital et produit ne se distinguent plus. Les produits s’échangent contre des produits, ou bien : Les capitaux s’échangent contre les capitaux, sont deux propositions parfaitement synonymes. Quoi de plus simple, de plus clair, de plus positif, de plus scientifique, enfin, que tout cela ?
J’appelle donc capital, toute valeur faite, en terres, instruments de travail, marchandises, subsistances, ou monnaies, et servant ou étant susceptible de servir à la production.
La langue usuelle confirme cette définition. Le capital est dit libre, quand le produit quel qu’il soit, ayant été seulement évalué entre les parties, peut être considéré comme réalisé, ou immédiatement réalisable, c’est-à-dire converti en tel autre produit qu’on voudra : dans ce cas, la forme que le capital affecte le plus volontiers, est celle de monnaie. Le capital est dit engagé, au contraire, quand la valeur qui le constitue est entrée définitivement dans la production : dans ce cas, il prend toutes les formes possibles.
La pratique est aussi d’accord avec moi. Dans toute entreprise qui se fonde, l’entrepreneur, qui, au lieu d’argent, engage dans son industrie des instruments ou des matières premières, commence par en faire l’estimation vis-à-vis de lui-même, à ses risques et périls ; et cette estimation pour ainsi dire unilatérale, constitue son capital, ou sa mise de fonds : c’est la première chose dont il soit passé écriture.
Nous savons ce qu’est le capital : il s’agit maintenant de tirer les conséquences de cette notion, en ce qui concerne l’intérêt. Ce sera peut-être un peu long, quant à l’exposé graphique, mais très-simple de raisonnement.
Les produits s’échangent contre les produits, a dit J. B. Say ; ou bien, les capitaux s’échangent contre des capitaux ; ou bien encore, les capitaux s’échangent contre des produits, et vice versa : voilà le fait brut.
La condition absolue, sine qua non, de cet échange ; ce qui en fait l’essence et la règle, est l’évaluation contradictoire et réciproque des produits. Otez de l’échange l’idée de prix, et l’échange disparaît. Il y a transposition ; il n’y a pas transaction, il n’y a pas échange. Le produit, sans le prix, est comme s’il n’existait pas : tant qu’il n’a pas reçu, par le contrat de vente et d’achat, sa valeur authentique, il est censé non avenu, il est nul. Voilà le fait intelligible.
Chacun donne et reçoit, d’après la formule de J. B. Say, énonciative du fait matériel ; — mais, d’après la notion du capital, telle que nous la fournit l’analyse, chacun doit donner et recevoir une valeur égale. Un échange inégal est une idée contradictoire : le consentement universel l’a appelé fraude et vol.
Or, de ce fait primitif que les producteurs sont entre eux en rapport perpétuel d’échange, qu’ils sont les uns pour les autres, tour à tour et tout à la fois producteurs et consommateurs, travailleurs et capitalistes, et de l’appréciation numériquement égalitaire qui constitue l’échange, il résulte que les comptes de tous les producteurs et consommateurs doivent se balancer les uns les autres ; que la société, considérée au point de vue de la science économique, n’est autre chose que cet équilibre général des produits, services, salaires, consommations et fortunes ; que, hors de cet équilibre, l’économie politique n’est qu’un mot, et l’ordre public, le bien-être des travailleurs, la sécurité des capitalistes et propriétaires, une utopie.
Or, cet équilibre, duquel doivent naître l’accord des intérêts et l’harmonie dans la société, aujourd’hui n’existe pas : il est rompu par diverses causes, selon moi, faciles à détruire, et au nombre desquelles je signale, en première ligne, l’usure, l’intérêt, la rente. Il y a, comme je l’ai dit tant de fois, erreur et malversation dans les comptes, falsification dans les écritures de la société : de là le luxe mal acquis des uns, la misère croissante des autres ; de là, dans les sociétés modernes, l’inégalité des fortunes et toutes les agitations révolutionnaires. Je vais, Monsieur, vous en donner, par écriture de commerce, la preuve et la contre-preuve.
Constatons d’abord les faits.
Les produits s’échangent contre des produits, ou, pour parler plus juste, les valeurs s’échangent contre les valeurs : telle est la loi.
Mais cet échange ne se fait pas toujours, comme l’on dit, donnant donnant ; la tradition des objets échangés n’a pas toujours lieu simultanément de part et d’autre ; souvent, et c’est le cas le plus ordinaire, il y a entre les deux livraisons, un intervalle. Or, il se passe dans cet intervalle des choses curieuses, des choses qui dérangent l’équilibre, et faussent la balance. Vous allez voir.
Tantôt l’un des échangistes n’a pas le produit qui convient à l’autre, ou, ce qui revient au même, celui-ci, qui consent bien à vendre, veut se réserver d’acheter. Il veut bien recevoir le prix de sa chose, mais il ne veut, pour le moment du moins, rien accepter en échange. Dans l’un et l’autre cas, les échangistes ont recours à une marchandise intermédiaire, faisant, dans le commerce l’office de proxénète, toujours acceptable et toujours acceptée : c’est la monnaie. Et comme la monnaie, recherchée de tout le monde, manque pour tout le monde, l’acheteur s’en procure, contre son obligation, auprès du banquier, moyennant une prime plus ou moins considérable, appelé escompte. — L’escompte se compose de deux parties : la commission, qui est le salaire du service rendu par le banquier, et l’intérêt. Nous dirons tout à l’heure ce que c’est que l’intérêt.
Tantôt l’acheteur n’a ni produit, ni argent à donner en échange du produit ou du capital dont il a besoin, mais il offre de payer dans un certain laps de temps, en un ou plusieurs termes. Dans les deux cas sus-mentionnés la vente était faite au comptant ; dans celui-ci, elle a lieu à crédit. Ici donc, la condition du vendeur était moins avantageuse que celle de l’acheteur, on compense l’inégalité en faisant porter au produit vendu, et jusqu’à parfait paiement, un intérêt. C’est cet intérêt compensatoire, origine première de l’usure, que j’ai signalé dans une de mes précédentes lettres comme l’agent coercitif du remboursement. Il dure autant que le crédit ; il est la rémunération du crédit : mais il a surtout pour objet, notez ce point, d’abréger la durée du crédit. Tel est le sens, la signification légitime de l’intérêt.
Souvent il arrive, et c’est l’extrémité où se trouvent généralement les travailleurs, que le capital est absolument indispensable au producteur, et que cependant celui-ci n’espère pouvoir de longtemps, ni par son travail, ni par son épargne, bien moins encore par les sommes de monnaie dont il dispose, en recomposer l’équivalent, en un mot, le rembourser. Il lui faudrait 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle quelquefois ; et le capitaliste ou propriétaire ne veut point accorder un si long terme. Comment sortir de cette difficulté ?
Ici commence la spéculation usuraire. Tout à l’heure nous avons vu l’intérêt imposé au débiteur comme indemnité du crédit, et moyen de hâter le remboursement : à présent nous allons voir l’intérêt cherché pour lui-même, l’usure pour l’usure, comme la guerre pour la guerre, ou l’art pour l’art. Par convention expresse, légale, authentique, consacrée par toutes les jurisprudences, toutes les législations, toutes les religions, le demandeur s’engage envers le bailleur à lui payer — à perpétuité, l’intérêt de son capital, terre, meuble ou argent ; il s’inféode, corps et âme, lui et les siens, au capitaliste, et devient son tributaire ad vitam æternam. C’est ce qu’on appelle Constitution de rente, et, dans certains cas, emphytéose. Par cette espèce de contrat, l’objet passe en la possession du demandeur, qui n’en peut plus être dépossédé ; qui en jouit comme acquéreur et propriétaire ; mais qui en doit, à tout jamais, payer le revenu, comme un amortissement sans fin. Telle est l’origine économique du système féodal.
Mais voici qui est mieux.
La constitution de rente et l’emphytéose sont aujourd’hui, presque partout, hors d’usage. On a trouvé qu’un produit ou capital échangé contre un intérêt perpétuel était encore trop de la part du capitaliste : le besoin d’un perfectionnement se faisait sentir dans le système. De nos jours, les capitaux et immeubles ne se placent plus en rente perpétuelle, si ce n’est sur l’État : ils se louent, c’est-à-dire se prêtent, toujours contre intérêt, mais à courte échéance. Cette nouvelle espèce d’usure a nom loyer ou fermage.
Concevez-vous, Monsieur, ce que c’est que le prêt à intérêt (loyer ou fermage) à courte échéance ? Dans l’emphytéose et la constitution de rente, dont je parlais tout à l’heure, si la rente était perpétuelle, la cession du capital l’était aussi : entre le paiement et la jouissance, il y avait encore une sorte de parité. Ici, le capital ne cesse jamais d’appartenir à celui qui le loue et qui peut en exiger, à volonté, la restitution. En sorte que le capitaliste n’échange point capital contre capital, produit contre produit : il ne donne rien, il garde tout, ne travaille pas, et vit de ses loyers, intérêts et usures, comme 1,000, 10,000 et 100,000 travailleurs réunis ne vivent pas de leur production.
Par le prêt à intérêt, — fermage ou loyer, — avec faculté d’exiger, à volonté, le remboursement de la somme prêtée, et d’éliminer le fermier ou locataire, le capitaliste a imaginé quelque chose de plus grand que l’espace, de plus durable que le temps. Il n’y a pas d’infini qui égale l’infini de l’usure locative, de cette usure qui dépasse autant la perpétuité de la rente, que la perpétuité de la rente elle-même dépasse le remboursement à terme et au comptant. L’emprunteur à intérêt et courte échéance paie, paie encore, paie toujours ; et il ne jouit point de ce qu’il paie ; il n’en a que la vue, il n’en possède que l’ombre. N’est-ce pas à cette image de l’usurier, que le théologien a imaginé son Dieu, ce Dieu atroce, qui fait éternellement payer le pécheur, et qui jamais ne lui fait remise de sa dette ! Toujours ! Jamais ! Voilà le Dieu du catholicisme, voilà l’usurier !…
Eh bien, je dis que tout échange de produits et de capitaux peut s’effectuer au comptant ;
Qu’en conséquence, l’escompte du banquier doit se réduire aux frais de bureaux et à l’indemnité du métal improductivement engagé dans la monnaie ;
Partant, que tout intérêt, loyer, fermage ou rente, n’est qu’un déni de remboursement, un vol à l’égard de l’emprunteur ou locataire, la cause première de toutes les misères et subversions de la société.
Je vous ai prouvé, en dernier lieu, par l’exemple de la Banque de France, que c’était chose facile et pratique d’organiser l’égalité dans l’échange, soit la circulation gratuite des capitaux et des produits. Vous n’avez voulu voir, dans ce fait catégorique et décisif, qu’un cas particulier de monopole, étranger à la théorie de l’intérêt. Que me fait, répondez-vous avec nonchalance, la Banque de France et son privilége ? Je vous parle de l’intérêt des capitaux. — Comme si le crédit foncier et commercial étant organisé partout sur le pied de 1/2 pour 100, il pouvait exister quelque part encore un intérêt !… Je vais vous montrer à présent, à la façon des teneurs de livres, que ce solde particulier, qui vient se placer constamment entre les deux termes de l’échange, ce péage imposé à la circulation, ce droit établi sur la conversion des produits en valeurs, et des valeurs en capitaux, cet intérêt, enfin, ou pour l’appeler par son nom, cet entremetteur (interesse) du commerce, dont vous vous obstinez à prendre la défense, est précisément le grand faussaire qui, pour s’approprier, frauduleusement et sans travail, des produits qu’il ne crée pas, des services qu’il ne rend jamais, falsifie les comptes, fait des surcharges et des suppositions dans les écritures, détruit l’équilibre des transactions, met le désordre dans les affaires, et produit fatalement dans les nations le désespoir et la misère.
Vous trouverez, dans ce qui va suivre, la représentation graphique des opérations de la société, exposées tour à tour dans les deux systèmes, le système de l’intérêt, actuellement régnant, et le système de la gratuité, qui est celui que je propose. Tout raisonnement, toute dialectique, toute controverse tombe devant cette image intelligible du mouvement économique.
I. — Système de l’intérêt.
Dans ce système, la production, la circulation et la consommation des richesses s’opèrent par le concours de deux classes de citoyens, distinctes et séparées : les propriétaires, capitalistes et entrepreneurs d’une part, et les travailleurs salariés d’autre part. Ces deux classes, quoiqu’en état flagrant d’antagonisme, constituent ensemble un organisme clos, qui agit en lui-même, sur lui-même, et par lui-même.
Il suit de là que toutes les opérations d’agriculture, de commerce, d’industrie, qui peuvent se traiter dans un pays, tous les comptes de chaque manufacture, fabrique, banque, etc., peuvent se résumer et être représentés par un seul compte, dont je vais donner les parties.
Je désigne par A la classe entière des propriétaires, capitalistes et entrepreneurs que je considère comme une personne unique, et par B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, la classe des travailleurs salariés.
COMPTES
entre A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur, et B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, travailleurs salariés.
CHAPITRE PREMIER.
Compte et résumé des opérations personnelles à A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur.
À l’ouverture du compte, A commence sa spéculation avec un capital que je suppose de 10,000 fr. Cette somme forme sa mise de fonds ; c’est avec cela qu’il va travailler et entamer des opérations de commerce. Cet acte d’installation de A s’exprime de la manière suivante :
1. Caisse doit à A. 1er janvier, compte de capital…10,000 fr.
Le capital formé, que va faire A ? Il louera des ouvriers, dont il payera les produits et services avec ses 10,000 fr. ; c’est-à-dire qu’il convertira ces 10,000 fr. en marchandises, ce que le comptable exprime comme suit :
2. Marchandises générales, à Caisse.
Achat au comptant, ou par anticipation, des produits de l’année courante, des travailleurs ci-après dénommés :
| De B, | x (journées de travail ou produit) : ensemble. | 1,000 fr. |
| De C, | — | 1,000 |
| De D, | — | 1,000 |
| De E, | — | 1,000 |
| De F, | — | 1,000 |
| De G, | — | 1,000 |
| De H, | — | 1,000 |
| De I, | — | 1,000 |
| De K, | — | 1,000 |
| De L, | — | 1,000 |
| Total… | 10,000 fr. | |
L’argent converti en marchandises, il s’agit, pour le propriétaire-capitaliste-entrepreneur A, de faire l’opération inverse, et de convertir ses marchandises en argent. Cette conversion suppose un bénéfice (agio, intérêt, etc.), puisque, par l’hypothèse et d’après la théorie de l’intérêt, la terre et les maisons ne se prêtent pas pour rien, les capitaux pour rien, la garantie et la considération de l’entrepreneur pour rien. Admettons, suivant les règles ordinaires du commerce, que le bénéfice soit 10 pour 100.
A qui se fera la vente des produits de A ? Nécessairement à B, C, D, etc., travailleurs : puisque la société tout entière se compose de A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur, et de B, C, D, etc., travailleurs salariés, hors desquels il n’y a personne. Voici comment s’établit le compte :
3. Les Suivants, à Marchandises générales :
| B, | mes ventes à lui faites dans le courant de l’année, | 1,100 fr. |
| C, | — | 1,100 |
| D, | — | 1,100 |
| E, | — | 1,100 |
| F, | — | 1,100 |
| G, | — | 1,100 |
| H, | — | 1,100 |
| I, | — | 1,100 |
| K, | — | 1,100 |
| L, | — | 1,100 |
| Total… | 11,000 fr. | |
La vente terminée, reste à faire l’encaissement des sommes dues par les acheteurs. Nouvelle opération que le comptable couche sur son livre, en la façon ci-après :
4. Doit Caisse aux Suivants :
| à B, | son versement en espèces pour solde de son compte au 31 décembre… | 1,100 fr. |
| à C, | — | 1,100 |
| à D, | — | 1,100 |
| à E, | — | 1,100 |
| à F, | — | 1,100 |
| à G, | — | 1,100 |
| à H, | — | 1,100 |
| à I, | — | 1,100 |
| à K, | — | 1,100 |
| à L, | — | 1,100 |
| Somme égale… | 11,000 fr. | |
Ainsi, le capital avancé par A, — après conversion de ce capital en produits, puis vente de ces produits aux travailleurs-consommateurs B, C, D etc., et, enfin, payement de la vente, — lui rentre augmenté d’un dixième, ce qui s’exprime à l’inventaire par la balance ci-dessous :
5. Résumé des opérations de A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur, pour son inventaire au 31 décembre.
| Doivent. | MARCHANDISES GÉNÉRALES. | Avoir. | ||
| 10,000 fr. | Débit de ce compte au 31 décembre. | Crédit de ce compte au 31 décembre… | 11,000 fr. | |
| 1,000 | Bénéfice sur ce compte à porter au crédit du compte du capital A. | |||
| 11,000 fr. | Balance… | 11,000 fr. | ||
On voit ici, pour le dire en passant, comment et à quelle condition les produits deviennent capitaux. Ce ne sont pas les marchandises en magasin qui, à l’inventaire, sont portées au crédit du compte de capital, c’est le bénéfice. Le bénéfice, c’est-à-dire le produit vendu, livré, dont le prix a été encaissé ou doit l’être prochainement : en deux mots, c’est le produit fait valeur.
Passons à la contre-partie de ce compte, au compte des travailleurs.
CHAPITRE DEUXIÈME.
Compte des opérations de B, travailleur, avec A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur.
B, travailleur, sans propriété, sans capital, sans ouvrage, est embauché par A, qui lui donne de l’occupation et acquiert son produit. Première opération, que l’on fait figurer au compte de B, ainsi :
1. Doit Caisse, 1er janvier, à B. — Compte de Capital.
Vente au comptant ou par anticipation de tout le produit de son travail de l’année, à A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur, ci… 1,000 fr.
En échange de son produit, le travailleur reçoit donc 1,000 fr., somme égale à celle que nous avons vue figurer au chapitre précédent, art. 2, Compte de marchandises générales.
Mais B vit de son salaire, c’est-à-dire qu’avec l’argent que lui donne A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur, il se pourvoit chez ledit A de tous les objets nécessaires à la consommation de lui B, objets qui lui sont facturés, comme nous l’avons vu plus haut, chap. 1er, art. 3, à 10 pour 100 de bénéfice en sus du prix de revient. L’opération a donc pour B le résultat que voici :
2. Doit B, compte de Capital, à A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur :
Montant des fournitures de toute espèce de ce dernier dans le cours de l’année…1,100 fr.
3. Résumé des opérations de B, pour son inventaire :
| Doit. | COMPTE DE CAPITAL. | Avoir. |
| 1,100 fr. | Débit de ce compte au 21 décembre. | |
| Crédit de ce compte au 31 décembre… | 1,000 fr. | |
| Perte sur ce compte, que B ne peut payer qu’au moyen d’un emprunt… | 100 | |
| 1,100 fr. | 1,100 fr. |
Tous les autres travailleurs se trouvant dans les mêmes conditions que B, leurs comptes présentent individuellement le même résultat. Pour l’intelligence du fait que j’ai voulu faire ressortir, savoir, le défaut d’équilibre dans la circulation générale, par suite des prélèvements du capital, il est donc inutile de reproduire chacun de ces comptes.
Le tableau qui précède, bien autrement instructif et démonstratif que celui de Quesnay, est l’image fidèle, présentée algébriquement, de l’économie actuelle de la société. C’est là qu’on peut se convaincre que le prolétariat et la misère sont l’effet, non pas seulement de causes accidentelles, telles qu’inondation, guerre, épidémie ; mais qu’ils résultent aussi d’une cause organique, inhérente à la constitution de la société.
Par la fiction de la productivité du capital, et par les prérogatives sans nombre que s’arroge le monopoleur, il arrive toujours et nécessairement l’une de ces deux choses :
Ou bien c’est le monopoleur qui enlève au salarié partie de son capital social. B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, ont produit dans l’année comme 10, et ils n’ont consommé que comme 9. En autres termes, le capitaliste a mangé un travailleur. — En outre, par la capitalisation de l’intérêt, la position des travailleurs s’aggrave chaque année de plus en plus ; de telle sorte qu’en poussant la démonstration jusqu’au bout on arrive, vers la septième année, à trouver que tout l’apport primitif des travailleurs est passé, à titre d’intérêts et de bénéfices, entre les mains du propriétaire-capitaliste-entrepreneur, ce qui signifie que les travailleurs salariés, s’ils voulaient payer leurs dettes, devraient travailler chaque septième année pour rien.
Ou bien, c’est le travailleur qui, ne pouvant donner de son produit que le prix qu’il en a lui-même reçu, pousse le monopoleur à la baisse, et par conséquent le met à découvert de tout le montant des intérêts, loyers et bénéfices dont l’exercice de la propriété lui faisait un droit et une nécessité.
On est donc amené à reconnaître que le crédit, dans le système de l’intérêt, a pour résultat inévitable la spoliation du travailleur, et pour correctif non moins inévitable, la banqueroute de l’entrepreneur, la ruine du capitaliste propriétaire. L’intérêt est comme une épée à deux tranchants : de quelque côté qu’il frappe, il tue.
Je viens de vous montrer comment les choses se passent dans le régime de l’intérêt. Voyons maintenant comment elles se passeraient sous le régime de la gratuité.
II. — Système de gratuité.
D’après la théorie du crédit gratuit, la qualité de travailleur salarié et celle de propriétaire-capitaliste-entrepreneur sont identiques l’une à l’autre et adéquates : elles se confondent sous celle de producteur-consommateur. L’effet de ce changement est de ramener toutes les opérations du crédit actuel, prêt, vente à terme, agio, loyer, fermage, etc., à la simple forme de l’échange ; comme toutes les opérations de banque à un simple virement de parties.
Admettons donc que la Banque de France, organe principal de ce système, ait été réorganisée suivant les idées du crédit gratuit, et le taux de ses escomptes réduit à 1 pour 100, taux que nous regarderons provisoirement comme le juste salaire du service particulier de la Banque, et, conséquemment, comme représentant un intérêt égal à zéro. Et voyons les changements qui en résultent pour la comptabilité générale. C’est par l’entremise de la Banque et de ses succursales, remplaçant toutes les variétés du crédit usuraire, que s’effectuent désormais les transactions : c’est donc avec la Banque que B, C, D, etc., travailleurs, associés, groupés ou libres, entrent d’abord, et directement, en compte.
CHAPITRE PREMIER.
1. Compte des opérations de B, travailleur, avec x, Banque nationale.
Doit Caisse, 1er janvier, à x, Banque nationale,
Avance de celle-ci sur tous les produits de mon travail de l’année, à lui rembourser au fur et à mesure de mes ventes, 1,000 fr. ; escompte 1 pour 100 déduit, ci. 990 fr.
Ainsi qu’on l’a vu plus haut, B vit exclusivement de son travail : c’est-à-dire que sur la garantie de son produit, il obtient de x, Banque nationale, soit des billets, soit des espèces, avec lesquels il achète chez A, — travailleur comme lui, mais qui dans les opérations de vente ou échange dont nous parlerons tout à l’heure, remplit le rôle de propriétaire-capitaliste-entrepreneur, — tous les objets nécessaires à son industrie et à sa consommation. Par le fait, B achète tous ces objets au comptant : il peut donc, et d’autant plus rigoureusement, en débattre le prix.
Cet achat, fait avec les billets ou espèces de la Banque, donne ouverture au compte suivant sur les livres de B :
2. Doivent Marchandises générales à Caisse,
Achat au comptant, chez A, de tout ma consommation de l’année… 990 fr.
Au fur et à mesure de sa fabrication, B vend ses produits. Mais la production se règle sur la consommation : or, celle-ci n’étant plus entravée, comme sous le régime de l’intérêt, par l’usure, c’est-à-dire par la vente à terme, par le loyer des instruments de travail et les charges qui en résultent, surtout par le préjugé de la monnaie, devenue improductive, et même inutile ; il s’ensuit que B, comme tous les autres travailleurs, peut non-seulement racheter, à une fraction minime près, son propre produit, mais donner carrière à son énergie, à sa puissance productive, sans crainte de créer des non-valeurs ou d’amener l’avilissement des prix, avec l’espoir légitimement fondé, au contraire, de se compenser, par ce surcroît de production et d’échange, de la faible rétribution qu’il paye à la Banque, pour la négociation de ses valeurs. C’est ce qui va paraître dans l’article suivant du compte de B.
Tout travail doit laisser un excédant ; cet aphorisme est un des premiers de l’économie politique. Il est fondé sur ce principe que, dans l’ordre économique, quel que soit le capital mis en œuvre, toute valeur est créée, par le travail, de rien ; de même que, selon le théologie chrétienne, toutes choses dans la nature ont été créées de Dieu, également de rien. En effet, le produit étant défini : l’utilité ajoutée par le travail aux objets que fournit la nature (J. B. Say et tous les économistes), il est clair que le produit tout entier est le fait des travailleurs ; et si l’objet auquel s’ajoute l’utilité nouvelle est déjà lui-même un produit, la valeur reproduite est nécessairement plus grande que la valeur consommée. Admettons que par son travail, B ait augmenté de 10 pour 100 la valeur qu’il consomme, et constatons, par ses écritures, le résultat :
3. Doit Caisse à Marchandises générales,
Mes ventes au comptant à divers, courant de l’année, 1,089 fr.
Il appert de ce compte que l’usure est une cause de misère, en ce qu’elle empêche la consommation et la reproduction, d’abord en élevant le prix de vente des produits d’une quantité plus forte que l’excédant obtenu par le travail reproducteur : la somme des usures, en France, sur un produit total de 10 milliards, est de 6 milliards, 60 pour 100 ; — puis en entravant la circulation par toutes les formalités de l’escompte, de l’intérêt, du loyer, du fermage, etc. : — toutes difficultés qui disparaissent sous le régime du crédit gratuit.
Nous voici au moment où B a réalisé tout le produit de son travail de l’année. Il faut qu’il se liquide avec x, Banque nationale, ce qui donne lieu à l’opération que voici :
4. Doit x, Banque nationale, à Caisse,
Mon versement pour solde… 1,000 fr.
Maintenant B doit se rendre compte : il le fait de la manière suivante :
5. Résumé des opérations de B pour son inventaire.
| Doit. | COMPTE DE MARCHANDISES GÉNÉRALES. | Avoir. | ||
| 990 fr. | Débit de ce compte au 31 décembre. | Crédit de ce compte au 31 décembre… | 1,089 fr. | |
| 99 | Bénéfice sur ce compte. | |||
| 1,089 fr. | Somme égale. | 1,089 fr. | ||
L’année suivante, B, au lieu d’opérer sur un produit de 1,000 opérera sur un produit de 1,089, ce qui lui donnera un nouveau surcroît de bénéfice ; puis le même mouvement se renouvelant la 3e, la 4e, la 5e, etc., année, le progrès de sa richesse suivra le progrès de son industrie ; il ira à l’infini.
Les autres travailleurs, C, D, E, F, etc., étant dans les mêmes conditions que B, leurs comptes présentent individuellement le même résultat ; il est inutile de les reproduire.
Je passe à la contre-partie des comptes ouverts chez B, et tout d’abord à celui de la Banque.
CHAPITRE II.
On a vu plus haut que x, Banque nationale, a fait à B une avance sur son travail ou produit ; qu’elle en a usé de même avec tous les autres travailleurs ; et qu’ensuite elle s’est couverte et rémunérée, par le remboursement des valeurs qu’ils lui avaient remises, et par la déduction, faite à son profit, de 1 pour 100 d’escompte. Voici comment se traduiraient ces diverses opérations sur les livres de la Banque.
Doivent les Suivants à Caisse :
| B, | mes avances sur le produit de son travail de l’année, contre son engagement de 1,000 fr. ; escompte déduit… | 990 fr. |
| C, | — | 990 |
| D, | — | 990 |
| E, | — | 990 |
| F, | — | 990 |
| C, | — | 990 |
| G, | — | 990 |
| H, | — | 990 |
| I, | — | 990 |
| K, | — | 990 |
| L, | — | 990 |
| 9,900 fr. | ||
Lors du remboursement par les débiteurs, nouvelle opération que le comptable coucherait sur les livres comme suit :
Doit Caisse aux Suivants :
| à B, | son versement pour solde… | 990 fr. |
| à C, | — | 990 |
| à D, | — | 990 |
| à E, | — | 990 |
| à F, | — | 990 |
| à G, | — | 990 |
| à H, | — | 990 |
| à I, | — | 990 |
| à K, | — | 990 |
| à L, | — | 990 |
| à Profits et pertes, reçu desdits pour escompte 1 pour 100… | 100 | |
| Total… | 10,000 fr. | |
Le crédit donné par x, Banque nationale, — après conversion de la somme créditée, en produits, puis vente de ces produits à tous les membres de la société, producteurs-consommateurs, depuis A jusqu’à L, et enfin paiement de la vente au moyen de la même somme fournie par la Banque ; — ce crédit, disons-nous, lui rentre, sous forme de billets ou espèces, augmenté de l’escompte de 1 pour 100, avec lequel la Banque paye ses employés et acquitte ses frais. Si même, après avoir couvert ses dépenses, il restait à la Banque un bénéfice net tant soit peu considérable, elle réduirait proportionnellement le taux de son escompte, de manière à ce qu’il lui restât toujours, pour intérêt du capital, zéro.
Résumé des opérations de x, Banque nationale, pour son inventaire au 21 décembre.
| Doit. | PROFITS ET PERTES. | Avoir. | |
| 100 fr. | Bénéfice sur ce compte. | Produit des escomptes de l’année… | 100 fr. |
En se reportant au compte de caisse de x, Banque nationale, on voit tout d’abord que l’excédant du débit de ce compte sur le crédit est de fr. 100, somme égale à celle du bénéfice d’escompte constatée par le compte de profits et pertes.
CHAPITRE III.
Venons enfin au compte de A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur, lequel ne se distingue plus, comme nous l’avons dit, de B, C, D, etc., travailleurs salariés, et ne prend ce titre que fictivement, par suite de ses opérations avec ces derniers.
Dans le régime du crédit gratuit, A ne prête plus les matières premières, l’instrument du travail, le capital, en un mot ; il ne le donne pas non plus pour rien ; il le vend. Dès qu’il en a reçu le prix, il est déchu de ses droits sur son capital ; il ne peut plus s’en faire payer éternellement, et au delà de l’éternité même, l’intérêt.
Voyons donc comment se comportera le compte de A, dans ce nouveau système.
D’abord, la monnaie n’étant qu’un instrument de circulation, devenu, par son accumulation à la Banque et la substitution presque générale du papier au numéraire, une propriété commune, dont l’usage, partout dédaigné, est gratuit, les producteurs-consommateurs B, C, D etc., n’ont plus que faire des écus de A. Ce qu’il leur faut, ce sont les matières premières, instruments de travail et subsistances dont A est détenteur.
A commence donc ses opérations avec son capital, marchandises, que par hypothèse nous fixerons à 10,000 fr. Cette ouverture d’opérations de A s’exprime sur ses livres de la manière suivante :
1. Doivent Marchandises à A, compte de Capital :
Marchandises en magasin, au 1er janvier dernier, suivant inventaire… 10,000 fr.
Que fera A de cette marchandise ? Il la vend aux travailleurs B, C, D, etc., c’est-à-dire à la société consommatrice et reproductrice qu’ici ils représentent, de même que lui, A, représente, pour le moment, la société capitaliste et propriétaire. C’est ce que le comptable de A constatera comme suit :
| 2. | Vente au comptant | à B… | 990 | |
| — | à C… | 990 | ||
| — | à D… | 990 | ||
| — | à E… | 990 | ||
| — | à F… | 990 | ||
| — | à G… | 990 | ||
| — | à H… | 990 | ||
| — | à I… | 990 | ||
| — | à K… | 990 | ||
| — | à L… | 990 | ||
| Total… | 9,990 fr. | |||
Mais si les travailleurs B, C, D, etc., consomment les articles de A, à son tour le propriéraire-capitaliste-entrepreneur A consomme les produits des travailleurs B, C, D, etc., de qui il doit les acheter, comme ils achètent eux-mêmes les siens. Or, nous avons vu, chapitre 1er, article 3, que la mieux-value donnée aux valeurs consommées par B, C, D, etc., étant, par hypothèse, dans un régime exempt de tout chômage, stagnation, avilissement de prix, de 10 pour 100, le capital de 990 fr. que B a obtenu, par crédit, de la Banque, reproductivement consommé, se transforme en un autre de 1,089 fr. : c’est donc d’après ce prix que A fait ses achats auprès de B, et en acquitte les factures. Ce qui se traduit dans les écritures comme suit :
3. Doit Marchandise générale à Caisse :
Achat au comptant, aux travailleurs ci-après :
| à B, | ses livraisons de divers articles pour ma consommation… | 1,089 fr |
| C, | — | 1,089 |
| D, | — | 1,089 |
| E, | — | 1,089 |
| F, | — | 1,089 |
| G, | — | 1,089 |
| H, | — | 1,089 |
| I, | — | 1,089 |
| K, | — | 1,089 |
| L, | — | 1,089 |
| Total… | 10,890 fr. |
Pour achever la démonstration, nous n’avons plus qu’à dresser l’inventaire de A.
Résumé des opérations de A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur pour son inventaire au 31 décembre.
| Doit. | MARCHANDISE GÉNÉRALE. | Avoir. | ||
| 10,890 fr. | Débit de ce compte au 31 décembre. | Crédit de ce compte au 31 décembre… | 9,900 fr. | |
| Restant en magasin des marchandises inventoriées au 1er janvier dernier… | 100 | |||
| Perte sur ce compte… | 890 fr. | |||
| 10,890 fr. | Somme égale. | 10,890 fr. | ||
Maintenant que nous avons établi notre double comptabilité, rapprochons les comptes, et notons les différences : 1° Sous le régime de l’usure, le compte de chaque travailleur se solde par une perte de 100 fr., soit pour les 10 : 1,000 fr.
En même temps, celui de A, propriétaire-capitaliste-entrepreneur, se solde par un bénéfice de 1,000 fr. ; ce qui prouve que dans la société capitaliste le déficit, soit la misère, est en raison de l’agio.
2° Sous le régime du crédit gratuit, au contraire, le compte de chaque travailleur se solde par un boni de 99 fr., soit pour les dix, 990 fr. ; et celui de A, propriétaire-capitaliste, par un déficit, de 890 fr., qui, avec les 100 fr. de marchandises restant en magasin et venant en couverture du déficit de l’année, font bien les 990 fr. dont la fortune des dix travailleurs s’est augmentée. Ce qui prouve que, dans la société mutuelliste, c’est-à-dire de l’égal échange, la fortune de l’ouvrier augmente en raison directe de son travail, tandis que celle du capitaliste diminue aussi en raison directe de sa consommation improductive, et qui détruit le reproche que m’adressait Pierre Leroux, qu’il n’a cessé depuis deux mois de reproduire dans sa polémique, savoir, que le crédit gratuit, la Banque du peuple, la mutualité ne sont aussi que du propriétarisme, du bourgeoisisme, de l’exploitation, enfin, comme le régime que la Banque du peuple avait la prétention d’abolir.
Dans le régime mutuelliste, la fortune de l’ouvrier augmente en raison directe de son travail, tandis que celle du propriétaire-capitaliste diminue en raison directe de sa consommation improductive : — cette proposition, mathématiquement démontrée, répond à toutes les divagations de Pierre Leroux et de Louis Blanc, sur la communauté, la fraternité et la solidarité.
Renversons maintenant la formule :
Sous le régime de l’usure, la fortune de l’ouvrier décroît en raison directe de son travail, tandis que celle du propriétaire-capitaliste augmente en raison directe de sa consommation improductive : — Cette proposition, démontrée comme la précédente, mathématiquement, répond à toutes les divagations des jésuites, malthusiens et philanthropes, sur l’inégalité des talents, les compensations de l’autre vie, etc., etc.
Comme corollaire à ce qui précède, et en nous basant toujours sur la logique des chiffres, nous disons encore :
Dans la société capitaliste, l’ouvrier ne pouvant jamais racheter son produit pour le prix qu’il l’a vendu, est constamment en déficit. D’où, nécessité pour lui de réduire indéfiniment sa consommation, et, par suite, nécessité pour la société entière de réduire indéfiniment la production ; partant, interdiction de la vie, obstacle à la formation des capitaux, comme des subsistances.
Dans la société mutuelliste, au contraire, l’ouvrier échangeant, sans retenue, produit contre produit, valeur contre valeur, ne supportant qu’un droit léger d’escompte largement compensé par l’excédant que lui laisse, au bout de l’année, son travail, l’ouvrier profite exclusivement de son produit. D’où, faculté pour lui de produire indéfiniment, et, pour la société, accroissement indéfini de la vie et de la richesse.
Diriez-vous qu’une pareille révolution dans les rapports économiques ne ferait, après tout, que déplacer la misère ; qu’au lieu de la misère du travailleur salarié, qui ne peut racheter son propre produit, et qui devient d’autant plus pauvre qu’il travaille davantage, nous aurions la misère du propriétaire-capitaliste-entrepreneur, qui se verrait forcé d’entamer son capital, et, partant, de détruire incessamment, avec la matière du produit, l’instrument du travail même ?
Mais qui ne voit que si, comme cela est inévitable dans le régime de la gratuité, les deux qualités de travailleur salarié d’une part, et de propriétaire-capitaliste-entrepreneur, de l’autre, deviennent égales et inséparables dans la personne de chaque ouvrier, le déficit qu’éprouve A dans les opérations qu’il fait comme capitaliste, il le couvre immédiatement par le bénéfice qu’il obtient à son tour comme travailleur : de sorte que, tandis que d’un côté, par l’annihilation de l’intérêt, la somme des produits du travail s’accroît indéfiniment ; de l’autre, par les facilités de la circulation, ces produits se convertissent incessamment en valeur, et les valeurs en CAPITAUX ?
Que chacun, au lieu de crier à la spoliation contre le socialisme, fasse donc son propre compte ; que chacun dresse l’inventaire de sa fortune et de son industrie, de ce qu’il gagne comme capitaliste-propriétaire, et de ce qu’il peut obtenir comme travailleur : et, je me trompe fort, ou sur les 10 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales il ne s’en trouvera pas 200,000, 1 sur 50, qui aient intérêt à conserver le régime usuraire et à repousser le crédit gratuit. Quiconque, encore une fois, gagne plus par son travail, par son talent, par son industrie, par sa science, que par son capital, est directement et surabondamment intéressé à l’abolition la plus immédiate et la plus complète de l’usure ; celui-là, dis-je, qu’il le sache ou qu’il l’ignore, est, au premier chef, partisan de la République démocratique et sociale ; il est, dans l’acception la plus large, la plus conservatrice, révolutionnaire. Quoi donc ! Serait-il vrai, parce qu’ainsi l’a dit Malthus et qu’ainsi le veut, à sa suite, une poignée de pédants, que 10 millions de travailleurs, avec leurs enfants et leurs femmes, doivent servir éternellement de pâture à 200,000 parasites, et que c’est afin de protéger cette exploitation de l’homme par l’homme, que l’État existe, qu’il dispose d’une force armée de 500,000 soldats, d’un million de fonctionnaires, et que nous lui payons deux milliards d’impôts ?…
Mais qu’ai-je besoin, après tout ce qui a été dit le cours de cette polémique, d’entretenir plus longtemps l’opposition purement factice de travailleurs-salariés et capitalistes-propriétaires ? Le moment est venu de faire cesser tout antagonisme entre les classes, et d’intéresser à l’abolition de la rente et de l’intérêt, jusqu’aux propriétaires et aux capitalistes eux-mêmes. La Révolution, ayant assuré son triomphe par la justice, peut, sans manquer à sa dignité, s’adresser aux intérêts.
N’avons-nous pas vu que l’intérêt est né des risques de l’industrie et du commerce, qu’il s’est manifesté d’abord dans les contrats plus ou moins aléatoires de pacotille et à la grosse ? Or, ce qui fut au commencement l’effet inévitable de l’état de guerre, ce qui devait, de toute nécessité, apparaître dans une société antagoniste, se reproduira encore et toujours, dans la société harmonique et pacifiée. Le progrès, dans l’industrie comme dans la science, est sans fin ; le travail ne connaît pas de bornes à ses aventureuses entreprises. Mais qui dit entreprise, dit toujours chose plus ou moins aléatoire, par conséquent, risque plus ou moins grand du capital engagé, partant nécessité d’un intérêt compensateur.
Au loyer, au fermage, à la rente, au prêt sur hypothèque, à l’agio mercantile, aux spéculations de bourse, à la spoliation bancocratique, doit succéder pour le capital, dans des conditions de plus en plus heureuses, la Commandite. Alors le capital, divisé par actions et fourni par les masses ouvrières, au lieu de spolier le travail, produira pour le travail ; alors le dividende ne sera qu’une manière de faire participer la société tout entière aux bénéfices des spéculations privées : ce sera le gain légitime du génie contre la fortune. Que les capitalistes actuels, au lieu de s’entasser à la Bourse, de comprimer la révolution et de mettre l’embargo sur les bras, osent donc se faire nos chefs de file ; qu’ils deviennent, comme en 92, nos généraux dans cette nouvelle guerre du travail contre la misère, dans cette grande croisade de l’industrie contre la nature. N’y a-t-il donc plus rien à découvrir, plus rien à oser, plus rien à faire pour le développement de notre nationalité, pour l’augmentation de notre richesse et de notre gloire ?…
Je m’arrête : il est temps. Malgré moi, Monsieur, vous m’avez poussé à cette déduction abstraite, fatigante pour le public et peu facile pour les colonnes d’un journal populaire. Fallait-il donc m’entraîner à cette dissertation épineuse, quand il était si facile, si simple de nous renfermer dans cette question péremptoire autant que positive : Le crédit peut-il ou ne peut-il pas être gratuit ? Au risque de rebuter les lecteurs de la Voix du Peuple, j’ai voulu satisfaire votre désir : vous me direz, si vous le jugez convenable, ce que vous trouvez à reprendre, d’abord à l’analyse que j’ai faite de la notion de capital ; puis à la définition que j’en ai fait sortir ; enfin aux théorèmes et aux corollaires qui en ont fait le développement.
Dans ce que vous venez de lire il y a, vous ne le nierez pas, toute une révolution non-seulement politique et économique, mais encore, ce qui doit vous être, ainsi qu’à moi-même, beaucoup plus sensible, scientifique. À vous de voir si vous acceptez, pour votre compte et pour celui de vos coreligionnaires, la conclusion qui ressort avec éclat de toute cette discussion, savoir, que ni vous, monsieur Bastiat, ni personne de votre école, n’entendez rien à l’économie politique.
Je suis, etc.
P. J. Proudhon.
DOUZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon ↩
Le système de la gratuité du crédit se réduit au papier-monnaie. — Quelles conséquences tirer de la comptabilité établie par M. Proudhon ? — Des billets de banque. — Des profits qu’ils procurent. — Pénétration de J. B. Say. — Le vrai moyen de faire profiter du crédit le public, qui lui-même l’accorde, c’est la liberté. — Analyse du crédit et de l’intérêt. — Exhortation à M. Proudhon de changer sa bannière.
4 février 1850.
Vous venez de rendre à la société un signalé service. Jusqu’ici la gratuité du crédit était demeurée enveloppée de nuages philosophiques, métaphysiques, économiques, antinomiques, historiques. En la soumettant à la simple épreuve de la comptabilité, vous la faites descendre de ces vagues régions ; vous l’exposez nue à tous les regards ; chacun pourra la reconnaître : c’est la monnaie de papier.
Multiplier et égaliser les richesses sur la terre en y jetant une pluie de papier-monnaie, voilà tout le mystère. Voilà le conclusum, l’ultimatum et le desideratum du socialisme.
La gratuité du crédit, c’est son dernier mot, sa dernière formule, son dernier effort. Vous l’avez dit cent fois avec raison. D’autres, il est vrai, donnent à ce mot un autre sens. Est socialiste, disait, ces jours-ci, la Démocratie pacifique, quiconque aspire à réaliser un peu de bien. — Certes, si la définition est vague, elle est du moins compréhensive et surtout prudente. Ainsi défini, le socialisme est impérissable.
Mais un désir, non plus que vingt aspirations qui s’entredétruisent, ne constituent pas une science. Qu’est devenue l’Icarie ? Où en sont le phalanstère, l’atelier national, la triade ? Ces formules sont mortes, et vous n’avez pas peu contribué à les tuer. Si quelques autres ont fait récemment leur entrée dans le monde, sous des noms sanscrits (que j’ai oubliés), il est permis de croire qu’elles ne sont pas nées viables. Une seule survivait encore : gratuité du crédit. Il m’a semblé qu’elle puisait sa vie dans le mystère. Vous l’exposez au grand jour : survivra-t-elle longtemps ?
L’altération des monnaies, pouvant aller jusqu’à la monnaie fictive, c’est une invention qui n’est ni neuve, ni d’origine très-démocratique. Jusqu’ici cependant, on avait pris la peine de donner ou de supposer au papier-monnaie quelques garanties, les futures richesses du Mississipi, le sol national, les forêts de l’État, les biens des émigrés, etc. On comprenait bien que le papier n’a pas de valeur intrinsèque, qu’il ne vaut que comme promesse, et qu’il faut que cette promesse inspire quelque confiance pour que le papier qui la constate soit volontairement reçu en échange de réalités. De là le mot crédit (credere, croire, avoir foi). Vous ne paraissez pas vous être préoccupé de ces nécessités. Une fabrique inépuisable de papier-monnaie, voilà votre solution.
Permettez-moi d’intervertir l’ordre de la discussion que vous m’indiquez, et d’examiner d’abord votre mécanisme social, exposé sous ce titre : Gratuité du crédit.
Il est bon de constater que vous définissez ainsi le capital : Toute valeur faite, en terres, instruments de travail, marchandises, subsistances ou monnaies, et servant ou pouvant servir à la production. Cette définition, je l’accepte. Elle suffit à la discussion actuelle.
Ceci posé, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, etc., sont tout à la fois capitalistes et travailleurs.
Vous faites le compte de l’un d’eux, A, pris en sa qualité de capitaliste ; puis celui de B, représentant tous les travailleurs ; enfin vous dressez la comptabilité de la Banque.
A est détenteur de capitaux, de valeurs faites, en terres, instruments, subsistances, etc. ; B désire se les approprier, mais il n’a rien à donner en échange et ne doit pas les emprunter sous peine de payer un intérêt.
Il se présente à la Banque et lui dit : Livrez-moi pour mille francs de billets, je vous rembourserai sur le produit de mon travail futur au fur et à mesure de mes ventes. La banque s’exécute et donne des billets pour 990 fr. [1]. Muni de ces précieux talismans, B se présente à A et lui dit : « Vous espériez peut-être me prêter vos capitaux, mais vous voilà réduit à me les vendre, car je suis en mesure de les payer. » A s’empresse de livrer ses capitaux (terres, marchandises, subsistances) à B contre les billets. B entreprend son travail. En vertu de l’aphorisme : Tout travail doit laisser un excédant, il ajoute 10 pour 100 à la valeur qu’il vient d’acheter, court à la Banque payer (en billets sans doute) les 990 fr. qu’il lui doit, et se trouve avoir réalisé 99 fr. de profits. Ainsi de C, D, E, F, etc., en un mot de tous les hommes.
Ayant imaginé ces données, vous dressez la comptabilité de A, de B et celle de la Banque. Certes, cette compatibilité, les données étant admises, est irréprochable.
Mais peut-on admettre vos données ? Sont-elles conformes à la nature des hommes et des choses ? C’est ce qu’il s’agit d’examiner.
Les billets de la Banque offriront-ils quelques garanties ? en d’autres termes, inspireront-ils ou non de la confiance ? En d’autres termes encore, la Banque aura-t-elle ou n’aura-t-elle pas un capital primitif et des valeurs faites suffisantes pour répondre de toutes ses émissions ?
Comment réunira-t-elle le capital en valeurs faites ? Si elle a des actionnaires, dans l’ordre de choses actuel, qui est notre point de départ, ils voudront toucher un intérêt, et comment la Banque prêtera-t-elle, à titre gratuit, ce qu’elle emprunte à titre onéreux ?
On s’emparera du capital de la Banque de France, dites-vous, et on remboursera les actionnaires en rentes sur l’État. Ceci recule la difficulté sans la résoudre. C’est la masse, la nation qui empruntera le capital à 5 pour 100 pour le prêter gratis. L’intérêt ne sera pas anéanti, mais mis sur le dos du contribuable.
Mais enfin, admettons que ce capital de 10,000 fr., sur lequel vous opérez fictivement, soit réuni, et mettons de côté ce cercle vicieux qui consiste à supposer la gratuité pour la réaliser. Puisque vous l’avez cru nécessaire, vous jugez sans doute indispensable qu’il se conserve.
Pour cela vous raisonnez sur cette hypothèse que B, C, D, E, etc., rembourseront chaque année à la Banque les billets qu’ils lui auront pris. Mais si cette hypothèse fait défaut ? Si B est un débauché qui va dépenser ses 1,000 fr. au cabaret ? Si C les donne à sa maîtresse ? Si D les jette dans une entreprise ridicule ? Si E fait une fugue en Belgique ? etc., etc., que deviendra la Banque ? À qui A s’adressera-t-il pour avoir la contre-valeur des capitaux dont il se sera défait ?
Car enfin votre Banque n’aura pas la vertu de changer notre nature, de réformer nos mauvaises inclinations. Bien au contraire, et il faut reconnaître que l’extrême facilité de se procurer du papier-monnaie, sur la simple promesse de travailler à le rembourser ultérieurement, serait un puissant encouragement au jeu, aux entreprises folles, aux opérations hasardeuses, aux spéculations téméraires, aux dépenses immorales ou inconsidérées. C’est une chose grave que de placer tous les hommes en situation de se dire : « Tentons la fortune avec le bien d’autrui ; si je réussis, tant mieux pour moi ; si j’échoue, tant pis pour les autres. » Je ne puis concevoir, quant à moi, le jeu régulier des transactions humaines en dehors de la loi de responsabilité. Mais, sans rechercher ici les effets moraux de votre invention, toujours est-il qu’elle ôte à la Banque nationale toute condition de crédit et de durée.
Vous me direz peut-être qu’avant de livrer ses billets la Banque s’enquerra avec soin du degré de confiance que méritent les demandeurs. Propriété, moralité, activité, intelligence, prudence, tout sera scruté et pesé avec soin. Mais prenez garde ; si, d’un côté, vous exigez que la Banque ait un capital primitif de garantie, si, de l’autre, elle ne prête qu’en toute sécurité, que fera-t-elle de plus que ne font aux États-Unis les Banques libres ? Et celui qui est pauvre diable aujourd’hui ne sera-t-il pas pauvre diable sous votre régime ?
Je ne crois pas que vous puissiez sortir de ces alternatives :
Ou la Banque aura un capital dont elle paiera l’intérêt, et alors elle ne pourra, sans se ruiner, prêter sans intérêt.
Ou elle disposera d’un capital gratuit, et, en ce cas, expliquez-nous d’où elle le tirera, en dehors de A, B, C, D, etc., qui forment toute la nation ?
Dans l’une et l’autre hypothèse, ou elle prêtera avec mesure et discernement, et alors vous n’aurez pas le crédit universel ; ou elle prêtera sans garantie, et en ce cas elle fera faillite avant deux mois.
Mais passons sur ces premières difficultés.
A, que vous mettez en scène, est capitaliste, partant avisé, prudent, timoré, peureux même. Ce n’est pas vous qui le nierez. Après tout, cela lui est bien permis. Tout ce qu’il a, il l’a acquis au prix de ses sueurs, et ne veut pas s’exposer à le perdre. Ce sentiment, au point de vue social, est éminemment conservateur. Avant donc de livrer ses capitaux contre des billets, A tournera et retournera bien souvent ces billets dans ses mains. Peut-être finira-t-il par les refuser, et voilà votre système en fumée. Que ferez-vous ? Décréterez-vous le cours forcé ? Que devient alors la liberté, dont vous êtres le champion ? Après avoir fait de la Banque une inquisition, en ferez-vous une gendarmerie ? Ce n’était pas la peine de supprimer l’État.
Mais je vous concède, pour la discussion seulement, le cours forcé. Vous n’empêcherez pas A de calculer ses risques. Il est vrai qu’il n’y a guère de risques qu’un vendeur n’affronte, pourvu qu’il trouve dans l’élévation du prix une prime d’assurance satisfaisante. A, capitaliste, c’est-à-dire menuisier, cordonnier, forgeron, tailleur, etc., etc., dira donc à B, C, D : Messieurs, si vous voulez mes meubles, mes souliers, mes clous, mes habits, qui sont des valeurs faites, donnez-moi une valeur faite, c’est-à-dire 20 fr. en argent. — Voilà 20 fr. en billets, répond B. — Ce n’est qu’une promesse, répond A, et je n’y ai pas confiance. — Le cours forcé est décrété, réplique B. — Soit, riposte A, mais je veux 100 fr. de ma marchandise.
Comment arrêtez-vous cette hausse de prix, évidemment destructive de tous les bienfaits que vous attendez de la Banque ? Que ferez-vous ? Décréterez-vous le maximum ?
L’universelle cherté se manifestera encore par une autre cause. Certes, vous ne doutez pas que la Banque, dès qu’elle aura fait battre le rappel par tous les organes de la publicité, dès qu’elle aura annoncé qu’elle prête pour rien, n’attire à elle de nombreux clients. Tous ceux qui ont des dettes, dont ils payent l’intérêt, voudront profiter de cette belle occasion de se libérer. En voilà pour une vingtaine de milliards. L’État voudra s’acquitter aussi des 5 milliards qu’il doit. La Banque sera encore assaillie de tout négociant qui a conçu une opération, de tout manufacturier qui veut fonder ou agrandir une fabrique, de tout monomane qui a fait une découverte merveilleuse, de tout ouvrier, compagnon, ou apprenti qui veut devenir maître.
Je ne crains pas de trop m’avancer en disant que l’émission des billets, si elle a la prétention de satisfaire tous les appétits, toutes les cupidités, toutes les rêveries, dépassera 50 milliards dès les six premiers mois. Voilà de quel poids la demande des capitaux pèsera sur le marché. Mais où en sera l’offre ? Dans six mois, la France n’aura pas créé assez de valeurs faites (terres, instruments, marchandises, subsistances), pour satisfaire à ce prodigieux accroissement de prétentions ; car les valeurs faites, les réalités, ne tombent pas aussi facilement dans le tablier de dame Offre, que les valeurs fictives dans celui de dame Demande. Cependant vendre et acheter sont des termes corrélatifs ; ils expriment deux actes qui s’impliquent, et, à vrai dire, ne font qu’un. Quel sera le résultat ? Une hausse exorbitante de tous les prix, ou, pour mieux dire, une désorganisation sociale telle que le monde n’en a jamais vu. — Et, soyez-en sûr, si quelqu’un en réchappe, ce ne sera pas le moins fripon, ce ne sera pas surtout le pauvre diable à qui la Banque a refusé crédit.
Ainsi, mesures arbitraires pour fonder la Banque, inquisition si elle veut mesurer la confiance, cours forcé, maximum, et, en définitive, banqueroute et désorganisation, dont les plus pauvres et les moins roués seront les premières victimes ; voilà les conséquences logiques du papier-monnaie. Ce n’est pas tout.
Vous pourriez me dire : Votre critique porte sur les moyens d’exécution. On y avisera. Il ne s’agit que du principe. Or, vous ne pouvez nier que ma Banque, sauf les moyens d’exécution, détruit l’intérêt. Donc la gratuité du crédit est au moins possible.
Je pourrais répondre : Non, si les moyens d’exécution ne le sont pas. Mais je vais droit au fond, et je dis : Votre invention n’eût-elle pas tous les dangers que j’ai signalés, n’atteint pas votre but. Elle ne réalise pas la gratuité du crédit.
Vous savez aussi bien que moi, Monsieur, que cette rémunération du capital, qu’on nomme intérêt, ne s’attache pas seulement au prêt. Elle est aussi comprise dans le prix de revient des produits. Et puisque vous invoquez la comptabilité, je l’invoque à mon tour. Ouvrons les livres du premier entrepreneur venu. Nous y verrons qu’il n’opère jamais sans s’être assuré, non-seulement le salaire de son travail, mais encore la rentrée, l’amortissement et l’intérêt de son capital. Cet intérêt se trouve confondu dans le prix de vente. En réduisant toutes les transactions à des achats et des ventes, votre Banque ne résout donc pas, ne touche même pas le problème de la suppression de l’intérêt.
Eh quoi ! Monsieur, vous prétendez arriver à des arrangements tels, que celui qui travaille sur son propre capital ne gagne pas plus que celui qui travaille sur le capital d’autrui emprunté pour rien ! Vous poursuivez une impossibilité et une injustice.
Je vais plus loin, et je dis qu’eussiez-vous raison sur tout le reste, vous auriez encore tort de prendre pour devise ces mots : gratuité du crédit. Prenez-y garde en effet, vous n’aspirez pas à rendre le crédit gratuit, mais à le tuer. Vous voulez tout réduire à des achats et des ventes, à des virements de parties. Vous croyez que, grâce à votre papier-monnaie, il n’y aura plus occasion de prêter ni d’emprunter ; que tout crédit sera inutile, nul, aboli, éteint faute d’occasion. Mais peut-on dire d’une chose qui n’existe pas, ou qui a cessé d’exister, qu’elle est gratuite ?
Et ceci n’est point une querelle de mots. Après tout, d’ailleurs, les mots sont les véhicules des idées. En annonçant la gratuité du crédit, vous donnez certainement à entendre, que ce soit ou non votre intention, que chacun pourra jouir, pendant un temps indéterminé, de la propriété d’autrui sans rien payer. Les malheureux, qui n’ont pas le temps d’approfondir les choses et de discerner en quoi vos expressions manquent d’exactitude, ouvrent de grands yeux. Ils sentent se remuer en eux les plus déplorables appétits. Mettre la main sur le bien d’autrui, et cela sans injustice, quelle attrayante perspective ! Aussi vous avez eu et vous deviez avoir d’abord beaucoup d’adeptes.
Mais si votre mot d’ordre eut été anéantissement du crédit, qui exprime votre pensée réelle, on aurait compris que sous votre régime, on n’aura rien pour rien. La cupidité, ce grand organe de la créance, comme dit Pascal, eût été neutre. On se serait borné à examiner froidement, d’abord, si votre système est un progrès sur ce qui est, ensuite, s’il est praticable. Le mot gratuité est toujours fort séduisant ; mais je ne crains pas de dire que, s’il a été un leurre pour beaucoup de vos adeptes, il a été un piége pour votre esprit.
Il explique les hésitations qu’on a pu remarquer dans votre polémique. Quand je m’attachais à circonscrire le débat dans cette question de la gratuité, vous étiez mal à l’aise. Vous sentiez bien, au fond de votre conscience et de votre science, que le crédit, tant qu’il existe, ne peut être gratuit ; que le remboursement d’une valeur empruntée ne peut être identique, soit qu’on l’opère immédiatement, soit qu’on l’ajourne indéfiniment. Vous faisiez à cet égard des concessions loyales qui vous ont été reprochées dans votre église. D’un autre côté, entraîné, engagé par votre devise : gratuité du crédit, vous faisiez des efforts incroyables pour vous tirer de ce mauvais pas. Vous invoquiez l’antinomie, vous alliez jusqu’à dire que le oui et le non peuvent être vrais de la même chose et en même temps. Après la dialectique, venait la rhétorique. Vous apostrophiez l’intérêt, le qualifiant de vol, etc., etc.
Et tout cela pour avoir revêtu votre pensée d’une expression fausse. Notre débat eût été bien abrégé, si vous m’aviez dit : Tant que le crédit existe, il ne peut être gratuit ; mais j’ai trouvé le moyen de faire qu’il n’existe pas, et dorénavant j’écrirai sur mon drapeau, au lieu de ces mots : Gratuité du crédit, ceux-ci : Anéantissement du crédit.
La question ainsi posée, je n’aurais eu qu’à examiner vos moyens d’exécution. C’est ce que, par votre dernière lettre, vous m’avez mis à même de faire. J’ai prouvé que ces moyens d’exécution se résument en un mot : papier-monnaie.
J’ai prouvé, en outre :
Que, pour que les billets d’une Banque soient reçus, il faut qu’ils inspirent confiance ;
Que, pour qu’ils inspirent confiance, il faut que la Banque ait des capitaux ;
Que, pour que la Banque ait des capitaux, il faut qu’elle les emprunte précisément à A, B, C, D, qui sont le peuple, et en paie l’intérêt au cours ;
Que si elle en paie l’intérêt, elle ne peut les prêter sans intérêt ;
Que, si elle les prête à A, B, C, D, gratis, après les leur avoir pris de force sous forme de contribution, il n’y a rien de changé dans le monde, si ce n’est une oppression de plus ;
Et enfin que, dans aucune hypothèse, même en réduisant toutes les transactions à des ventes, vous ne détruisez pas cette rémunération du capital, toujours confondue avec le prix de vente.
Il résulte de là, que si votre Banque n’est qu’une fabrique de papier-monnaie, elle amènera la désorganisation sociale.
Que si, au contraire, elle est établie sur les bases de la justice, de la prudence et de la raison, elle ne fera rien que ne puisse faire mieux qu’elle la liberté des Banques.
Est-ce à dire, Monsieur, qu’il n’y ait rien de vrai, selon moi, dans les idées que vous soutenez ? En m’expliquant à cet égard, je vais faire un mouvement vers vous. Puisse-t-il vous déterminer à en faire un vers moi, ou plutôt vers la vraie solution : la liberté des Banques.
Mais, pour être compris, j’ai besoin, au risque de me répéter, d’établir quelques notions fondamentales sur le crédit.
Le Temps est précieux. Time is money, disent les Anglais. Le temps, c’est l’étoffe dont la vie est faite, dit le Bonhomme Richard.
C’est de cette vérité incontestable que se déduit la notion et la pratique de l’intérêt.
Car faire crédit, c’est accorder du temps.
Sacrifier du temps à autrui, c’est lui sacrifier une chose précieuse [“précieuse” = valuable] , et il n’est pas possible de soutenir qu’en affaires un tel sacrifice doive être gratuit.
A dit à B : Consacrez cette semaine à faire pour moi un chapeau ; je l’emploierai à faire pour vous des souliers. — Souliers et chapeau se valent, répond B, j’accepte.
Un instant après, B s’étant ravisé dit à A : J’ai réfléchi que le temps m’est précieux ; je désire me consacrer à moi-même cette semaine et les suivantes ; ainsi, faites-moi les souliers tout de suite, je vous ferai le chapeau dans un an. — J’y consens, répond A, mais, dans un an, vous me donnerez une semaine et deux heures.
Je le demande à tout homme de bonne foi, A fait-il acte de piraterie en plaçant une nouvelle condition à son profit à côté d’une nouvelle condition à sa charge ?
Ce fait primitif contient en germe toute la théorie du crédit.
Je sais que, dans la société, les transactions ne sont pas aussi simples que celle que je viens de décrire, mais elles sont identiques par leur essence.
Ainsi, il est possible que A vende les souliers à un tiers pour 10 fr. et remette cette somme à B en lui disant : Donnez-moi le chapeau immédiatement, ou, si vous voulez un délai d’un an, vous me restituerez une semaine de travail, plus deux heures, ou bien 10 fr., plus un vingtième en sus. Nous rentrons tout à fait dans l’hypothèse précédente.
D’accord, je l’espère du moins, sur la légitimité du crédit, voyons maintenant à quels arrangements il peut donner lieu.
B peut n’avoir pris qu’un engagement verbal, et cependant, il n’est pas impossible que A ne le transmette et ne l’escompte. Il peut dire à C : Je vous dois 10 fr. B m’a donné sa parole qu’il me donnerait 10 fr. et 10 sous dans un an. Voulez-vous accepter en paiement mes droits sur B ? — Si C a confiance, s’il croit, l’opération pourra se faire. Mais qui oserait dire que, pour multiplier les souliers et les chapeaux, il suffit de multiplier les promesses de ce genre, indépendamment de la confiance qui s’y attache ?
B peut livrer un titre écrit. Le titre, sous cette forme, évitera les contestations et dénégations ; il inspirera plus de confiance et circulera plus facilement que la promesse verbale. Mais ni la nature ni les effets du crédit n’auront changé.
Enfin un tiers, une Banque, peut garantir B, se charger de son titre et émettre à la place son propre billet. Ce sera une nouvelle facilité à la circulation. Mais pourquoi ? précisément parce que la signature de la Banque inspire au public plus de confiance que celle de B. Comment donc peut-on penser qu’une Banque soit bonne à quelque chose, si elle n’a pas pour base la confiance, et comment l’aurait-elle, si ses billets offrent moins de garantie que ceux de B ?
Il ne faut donc pas que ces titres divers nous fassent illusion. Il ne faut pas y voir valeur propre, mais la simple promesse de livrer une valeur, promesse souscrite par quelqu’un qui est en mesure de la tenir.
Mais ce que je veux faire remarquer, car c’est ici que s’opère le rapprochement que j’ai annoncé entre votre opinion et la mienne, c’est un singulier déplacement du droit à l’intérêt, qui s’opère par l’intervention des Banques.
Dans le cas d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, qui paie l’intérêt ? Évidemment l’emprunteur, celui à qui d’autres ont sacrifié du temps. Et qui profite de cet intérêt ? Ceux qui ont fait ce sacrifice. Ainsi, si B a emprunté, pour un an, 1,000 fr. à A, et lui a souscrit un billet de 1,040 fr., c’est A qui profite des 40 fr. S’il négocie immédiatement ce billet, à 4 pour 100 d’escompte, c’est le preneur qui gagne l’intérêt, comme il est juste, puisque c’est lui qui fait l’avance ou le sacrifice du temps. Si A négocie son billet au bout de six mois à C, celui-ci ne lui en donne que 1,020 fr., et l’intérêt se partage entre A et C, parce que chacun a sacrifié six mois.
Mais quand la Banque intervient, les choses se passent différemment.
C’est toujours B, l’emprunteur, qui paie l’intérêt. Mais ce n’est plus A et C qui en profitent, c’est la Banque.
En effet, A vient de recevoir son titre. S’il le gardait, à quelque époque qu’il le négociât, il toucherait toujours l’intérêt pour tout le temps où il aurait été privé de son capital. Mais il le porte à la Banque. Il remet à celle-ci un titre de 1,040 fr., et elle lui donne en échange un billet de 1,000 fr. C’est donc elle qui gagne les 40 fr.
Quelle est la raison de ce phénomène ? Il s’explique par la disposition où sont les hommes de faire des sacrifices à la commodité. Le billet de banque est un titre très-commode. Quand on le prend, on ne se propose pas de le garder. On se dit : il ne restera pas en mes mains plus de huit à dix jours, et je puis bien sacrifier l’intérêt de 1,000 fr. pendant une semaine en vue des avantages que le billet me procure. Au reste, les billets ont cela de commun avec l’argent ; celui qu’on a dans sa bourse ou dans sa caisse ne rapporte pas d’intérêt, ce qui montre, pour le dire en passant, l’absurdité des personnes qui déclament sans cesse contre la productivité de l’argent, rien au monde n’étant plus improductif d’intérêts que la monnaie.
Ainsi, si un billet de banque reste un an dans la circulation, et passe par quarante mains, séjournant neuf jours dans chacune, c’est quarante personnes qui ont renoncé, en faveur de la Banque, aux droits qu’elles avaient sur les 40 fr. d’intérêts dus et payés par B. Chacune d’elles a fait un sacrifice de 1 fr.
Dès lors on a pu se demander si cet arrangement était juste, s’il n’y aurait pas moyen d’organiser une Banque nationale, commune, qui fît profiter le public du sacrifice supporté par le public, en un mot, qui ne perçût pas d’intérêts.
Si je ne me trompe, Monsieur, c’est sur l’observation de ce phénomène que se fonde votre invention. Elle n’est pas nouvelle. Ricardo avait conçu un plan moins radical, mais analogue [2], et je trouve dans Say (Commentaires sur Storch) ces lignes remarquables :
« Cette idée ingénieuse ne laisse qu’une question non résolue. Qui devra jouir de l’intérêt de cette somme considérable mise dans la circulation ? Serait-ce le Gouvernement ? Ce ne serait pour lui qu’un moyen d’augmenter les abus, tels que les sinécures, la corruption parlementaire, le nombre des délateurs de la police et les armées permanentes. Serait-ce une compagnie financière, comme la Banque d’Angleterre, la Banque de France ? Mais à quoi bon faire à une compagnie financière déjà riche le cadeau des intérêts payés en détail par le public ?… Telles sont les questions qui naissent à ce sujet. Peut-être ne sont-elles pas insolubles. Peut-être y a-t-il des moyens de rendre hautement profitable au public l’économie qui en résulterait ; mais je ne suis pas appelé à développer ici ce nouvel ordre d’idées. »
Puisque c’est le public qui paie en détail ces intérêts, c’est au public d’en profiter. Certes, il n’y avait qu’un pas de ces prémisses à la conclusion. Quant au moyen, je le crois tout trouvé ; ce n’est pas la Banque nationale, mais la liberté des banques.
Remarquons d’abord que la Banque ne bénéficie pas de la totalité de l’intérêt.
Outre les frais, elle a un capital. Et puis elle est dans la nécessité de tenir toujours prête dans ses caisses, une somme d’argent improductive.
Les billets d’une banque, on ne saurait trop le répéter, sont des titres de confiance. Le jour où elle les émet, la Banque proclame hautement qu’elle est prête à les rembourser à bureau ouvert et à toute heure. Rigoureusement, elle devrait donc tenir toujours en disponibilité une valeur faite égale à la valeur représentative lancée dans la circulation, et alors l’intérêt payé par B serait perdu pour tout le monde. Mais l’expérience ayant appris à la Banque que ses billets courent le monde pendant un temps déterminé, elle ne prend ses précautions qu’en conséquence. Au lieu de garder 1,000 fr. elle n’en garde que 400 (par hypothèse), et fait valoir 600 fr. C’est l’intérêt de ces 600 fr. qui est supporté par le public, par les détenteurs successifs du billet, et gagné par la Banque.
Or, cela ne devrait pas être. Elle ne devrait gagner que ses frais, l’intérêt de tout capital de fondation, et les justes profits de tout travail, de toute spéculation. C’est ce qui arriverait avec la liberté des banques ; car la concurrence, tendant à rendre uniforme le taux de l’intérêt, ne permettrait pas aux actionnaires d’une banque d’être mieux traités que les actionnaires de toute autre entreprise analogue. En d’autres termes, les banques rivales seraient forcées de réduire le taux des escomptes à ce qui est nécessaire pour placer leurs capitaux dans la condition commune, et ce phénomène étrange que j’ai signalé, je veux dire l’abandon volontaire des intérêts, auxquels se soumettent les détenteurs successifs de ces billets, profiterait au public sous forme de réduction dans le taux des escomptes. Pour être plus précis, je dirai que l’intérêt d’un billet de 1,000 fr. mis en circulation, se partagerait. Une partie irait à la Banque pour couvrir la somme qu’elle est obligée de tenir en réserve, les frais, et la rente de son capital primitif ; — l’autre partie serait forcée, par la concurrence, à se convertir en diminution d’escompte.
Et cela, prenez-y garde, ne veut pas dire que l’intérêt tendra à devenir gratuit ou à s’anéantir. Cela veut dire seulement qu’il tendrait à être perçu par celui qui y a droit.
Mais le privilége est intervenu qui en a disposé autrement, et la Banque de France, n’ayant pas de concurrents, au lieu de retenir la partie, empoche le tout.
Je voudrais, Monsieur, montrer la liberté des banques sous un autre aspect ; mais cette lettre est déjà trop longue. Je me bornerai à indiquer ma pensée.
Ce qu’on nomme vulgairement l’intérêt [3] comprend trois éléments qu’on a trop l’habitude de confondre :
1° L’intérêt proprement dit, qui est la rémunération du délai, le prix du temps ;
2° Les frais de circulation ;
3° La prime d’assurance.
La liberté des banques agirait à la fois d’une manière favorable, et dans le sens de la réduction, sur ces trois éléments. Elle maintiendrait au taux le plus bas, par les raisons que j’ai dites, l’intérêt proprement dit, sans jamais l’anéantir. Elle ferait tomber les frais de circulation à un chiffre qui, dans la pratique, se confondrait avec zéro. Enfin elle tendrait à diminuer et surtout à égaliser la prime d’assurance, qui est de beaucoup l’élément le plus onéreux, — principalement pour les classes laborieuses, — dont se compose l’intérêt total.
Si, en effet, les hommes qui jouissent de la plénitude du crédit en France, comme les Mallet, les Hottinger, les Rothschild, trouvent des capitaux à 3 pour 100, on peut dire que c’est là l’élément intérêt, et que tout ce que les autres payent en sus représente l’élément frais, et surtout l’élément prime d’assurance ; ce n’est plus le prix du temps, c’est le prix du risque, ou de la difficulté et de l’incertitude du recouvrement.
Comment la liberté des banques améliorerait-elle et égaliserait-elle la condition des emprunteurs sous ces rapports ? Que le lecteur veuille bien résoudre la question. J’aime mieux lui laisser cette fatigue que de la lui donner.
En cette matière, comme en toutes, la véritable solution est donc la liberté. La liberté fera surgir des banques partout où il y a un centre d’activité, et associera ces banques entre elles ; elle mettra à porté de chaque marchand, de chaque artisan, ces deux grands leviers du progrès, l’épargne et le crédit. Elle restreindra l’intérêt au taux le plus bas où il puisse descendre. Elle répandra les habitudes les plus favorables à la formation des capitaux. Elle fera disparaître toute ligne de démarcation entre les classes et réalisera la mutualité des services, sans anéantir ce prix du temps, qui est un des éléments légitimes et nécessaires des transactions humaines.
Liberté des banques ! Liberté du crédit ! Oh ! pourquoi, monsieur Proudhon, votre brûlante propagande n’a-t-elle pas pris cette direction ? Est-ce qu’à tous autres égards, vous ne réclamez pas ce qui est pour tous les hommes un droit, un attribut, un enseignement, la liberté ? Est-ce que vous ne demandez pas la liberté des achats et des ventes ? Et qu’est-ce, après tout, que le prêt, si ce n’est la vente d’un usage, la vente du temps ? Pourquoi faut-il que cette transaction seule soit réglementée par l’État ou renfermée dans le cercle de vos conceptions ? Avez-vous foi dans l’humanité ? Travaillez à faire tomber ses chaînes et non à lui en forger de nouvelles. Admettez que le mobile qui la pousse vers son perfectionnement indéfini réside en elle-même et non dans le cerveau du législateur. Réalisons la liberté, et l’humanité saura bien en faire sortir tout le progrès que sa nature comporte. S’il est possible et bon que le crédit soit jamais gratuit ou anéanti, comme vous le croyez, l’humanité libre accomplira cette œuvre plus sûrement que votre banque. Si cela n’est ni bon ni possible, comme j’en suis convaincu, l’humanité libre évitera les abîmes où votre banque la pousse.
Au nom du droit, au nom de la justice, au nom de votre foi dans les destinées humaines, au nom de cette concordance qu’il est toujours désirable de mettre entre toutes les parties d’une propagande, je vous adjure donc de substituer sur votre drapeau à ces mots : Gratuité du crédit, ceux de Liberté du crédit. — Mais j’oublie qu’il ne m’appartient pas de donner des conseils. D’ailleurs à quoi serviraient-ils ? A-t-on jamais vu un chef d’école revenir sur ses pas et braver ce mot injuste, mais terrible : Apostasie ? — Il y en a qui ont fait dans leur vie bien des témérités ; ils ne feront pas celle-là, encore qu’elle soit plus digne que toutes les autres de flatter l’orgueil d’un noble cœur.
Frédéric Bastiat.
FN:Cette retenue de 10 fr., n’ayant pour objet que les frais de bureau, cet improprement nommée escompte. Elle pourrait être réduite à quelques centimes. Peut-être même eût-il mieux valu, dans la théorie et la comptabilité, ne point s’en préoccuper.
FN: Proposals for an economical and secure currency.
FN:Quant à la rémunération du capital indépendante de la circonstance du prêt, voyez, à la quatrième lettre, les pages 140 et suiv. (Note de l’éditeur.)
TREIZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat ↩
Consultation psychologique. — Récapitulation. — La comptabilité est une méthode infaillible. — Clôture de la discussion.
11 février 1850.
Monsieur Bastiat,
Votre dernière lettre justifie toutes mes prévisions. J’étais si sûr de ce qui m’arrive, qu’avant même d’avoir reçu la Voix du Peuple du 4 février, j’avais écrit les trois quarts de la réponse que vous allez lire, et à laquelle je n’ai plus qu’à mettre une fin.
Vous êtes de bonne foi, monsieur Bastiat, vous ne souffrez pas qu’on en doute ; je l’ai d’ailleurs reconnu et ne prétends point me rétracter. Mais il faut bien que je vous le dise, votre intelligence sommeille, ou plutôt elle n’a jamais vu le jour : c’est ce que je vais avoir l’honneur de vous démontrer à vous-même, en faisant le résumé de notre débat. Je souhaite que l’espèce de consultation psychologique à laquelle vous allez assister, et dont le sujet sera votre propre esprit, commence pour vous cette éducation intellectuelle, sans laquelle un homme, quelque dignité de caractère qui le distingue, quelque talent qu’il déploie, n’est et ne sera jamais autre chose qu’un animal parlant, comme dit Aristote.
Ce qui constitue dans l’homme l’intelligence, c’est l’exercice complet, harmonique, suivi, des quatre facultés suivantes : Attention, Comparaison, Mémoire, Jugement. — Voilà du moins ce qu’on m’a appris au collége, et que vous trouverez dans toutes les philosophies.
Deux ou plusieurs jugements enchaînés l’un à l’autre, et formant un tout systématique sont une opération. — Les opérations de l’entendement sont de plusieurs espèces, syllogisme, induction, sorite, dilemme, etc. On leur donne à toutes le nom commun de raisonnement.
L’art de raisonner s’appelle la logique : c’est, à proprement parler, la mécanique intellectuelle. — L’ensemble des facultés est la Raison.
L’induction de Platon, le syllogisme d’Aristote, la contradiction des sophistes, l’identité de Condillac, l’antinomie de Kant et Hégel, ne sont que des formes variées du raisonnement, des applications particulières de la logique : c’est ainsi que l’emploi de la vapeur comme force motrice a fait inventer des machines de toute espèce, locomotives, bateaux à vapeur, machines fixes, machines à haute ou basse pression, etc. ; mais qui toutes découlent du même principe, la vapeur.
Toutes les sciences, sans exception, sont fondées sur la logique, c’est-à-dire sur l’exercice des quatre facultés primordiales : attention, comparaison, mémoire, jugement. C’est pourquoi la science est essentiellement démonstrative : la spontanéité, l’intuition, l’imagination, ne sont d’aucune autorité scientifique. C’est pour cela aussi, c’est en vertu de leurs facultés rationnelles, que les hommes deviennent capables de se communiquer leurs pensées et de converser entre eux : ôtez-leur l’attention, la comparaison, la mémoire et le jugement ; ils parlent l’un après l’autre ou tous à la fois, ils ne se répondent pas, ils ne s’entendent plus.
Appliquons ces règles de la raison humaine, notre commun critérium.
Dès le commencement de cette dispute, répondant catégoriquement à la question que vous m’avez posée, savoir, si l’intérêt du prêt est légitime, je vous ai dit que, dans les conditions économiques actuelles, et tant que le crédit ne serait pas démocratiquement organisé, l’affirmative me paraissait indubitable ; qu’ainsi les démonstrations que vous preniez la peine de me faire étaient inutiles ; que je les acceptais d’avance ; que toute la question, pour moi, était de savoir si le milieu économique pouvait être changé, et que le socialisme, au nom duquel je prenais la parole, affirmait cette possibilité. J’ajoutais que le changement des conditions du crédit était une nécessité de la tradition elle-même, le dernier terme de cette routine que vous défendez avec tant d’obstination et si peu de philosophie.
Ainsi donc, à la question que vous m’adressiez, l’intérêt du capital est-il légitime ? j’ai répondu sans hésiter : — oui, dans l’ordre actuel des choses, l’intérêt est légitime. Mais j’affirme que cet ordre peut et doit être modifié, et qu’inévitablement, de gré ou de force, il le sera. Était-ce donc une réponse obscure ? Et n’avais-je pas le droit d’espérer qu’après avoir répondu si nettement à votre question, vous répondriez à votre tour à la mienne ?
Mais j’avais affaire à un homme dont l’intelligence est hermétiquement fermée, et pour qui la logique n’existe pas. C’est en vain que je vous crie : Oui, l’intérêt est légitime dans certaines conditions indépendantes de la volonté du capitaliste ; non, il ne l’est pas dans telles autres, qu’il dépend aujourd’hui de la société de faire naître ; et c’est pour cela que l’intérêt, excusable dans le prêteur, est, au point de vue de la société et de l’histoire, une spoliation ! Vous n’entendez rien, vous ne comprenez pas, vous n’écoutez seulement pas ma réponse. Vous manquez de la première faculté de l’intelligence, l’attention.
C’est ce qui résulte, au surplus, de votre seconde lettre, dont voici le début : « Monsieur, vous me posez sept questions. Rappelez-vous qu’il ne s’agit en ce moment que d’une seule : L’intérêt du capital est-il légitime ? » Tout le reste de votre épître n’est qu’une reproduction des arguments de la première ; arguments auxquels je n’avais pas répondu, parce que je n’avais que faire d’y répondre. Changez le milieu, vous disais-je, et vous changez le principe, vous changez la pratique. — Vous n’avez pas tenu compte de mes paroles. Vous avez cru plus utile de plaisanter sur la contradiction et l’antinomie, sur la thèse, l’antithèse et la synthèse, mettant de votre côté, à si peu de frais, les usuriers et les sots, heureux de rire de ce qu’ils tremblent de concevoir.
Que fais-je alors ?
Pour exciter en vous cette attention rebelle, je prends divers termes de comparaison. Je vous montre, par l’exemple de la monarchie, de la polygamie, du combat judiciaire, des corporations industrielles, qu’une même chose peut très-bien avoir été bonne, utile, légitime, respectable, puis après devenir mauvaise, illicite et funeste, tout cela suivant les circonstances qui l’environnent ; que le progrès, la grande loi de l’humanité, n’est pas autre chose que cette transformation incessante du bien en mal, et du mal en bien ; qu’il en est ainsi, entre autres, de l’intérêt ; que l’heure est venue pour lui de disparaître, ainsi qu’il est facile d’en juger aux signes politiques, historiques et économiques, que je me contente de vous indiquer en les résumant.
C’était faire appel à la plus précieuse de vos facultés. C’était vous dire : Quand j’affirme que les conditions qui rendent le prêt excusable et licite ont disparu, je n’affirme point une chose extraordinaire, je ne fais qu’énoncer un cas particulier du progrès social. Observez, comparez ; et, la comparaison faite, l’analogie reconnue, revenons à la question posée par moi à la suite de la vôtre. Les formes du crédit peuvent-elles, doivent-elles être modifiées, de manière à amener la suppression de l’intérêt ? Voilà, sans préjudice de l’absolution que la science doit à tous prêteurs, spéculateurs, capitalistes et usuriers, ce que nous avons à examiner.
Mais, bah ! est-ce que M. Bastiat compare, lui ? Est-ce que seulement il est capable de comparaison, plus que d’attention ? Les analogies de l’histoire, vous ne les saisissez point ; le mouvement des institutions et la loi générale qui en ressort, vous l’appelez du fatalisme. — « Je veux, dites-vous dans votre troisième lettre, rester sur mon terrain ! » Et là-dessus, faisant tourner votre crécelle, vous accrochant à tous les mots qui peuvent vous fournir un prétexte, vous reproduisez, comme arguments nouveaux, quelques faits dont je n’attaque point la légitimité dans la routine établie, mais dont je conteste la nécessité, dont, par conséquent, je demande la révision, la réforme.
Quand un homme, qui se dit économiste, qui a la prétention de raisonner, de démontrer, de soutenir une discussion scientifique, en est là, j’ose dire, Monsieur, que c’est un homme désespéré. Ni attention, ni comparaison ; incapacité absolue d’écouter et de répondre ! Que puis-je désormais tirer de vous ? Vous êtes hors de la philosophie, hors de la science, hors de l’humanité.
Cependant je ne me rebute pas. Peut-être, me dis-je, l’attention et la comparaison s’éveilleront-elles en M. Bastiat, à l’aide d’une autre faculté. Observer avec attention une idée, comparer ensuite cette idée avec une autre, c’est chose trop subtile, trop abstraite. Essayons de l’histoire : l’histoire est la série des observations et des expériences du genre humain. Montrons à M. Bastiat le progrès : pour saisir le progrès dans son unité, et conséquemment dans sa loi, il ne faut que de la mémoire.
Quand je parle de la mémoire, comme faculté de l’entendement humain, je la distingue essentiellement du souvenir. Les animaux se souviennent, ils n’ont pas la mémoire. La mémoire est la faculté d’enchaîner et classer les souvenirs ; de considérer plusieurs faits consécutifs comme un seul et même fait, d’y mettre de la série et de l’unité. C’est l’attention appliquée à une suite de choses accomplies dans le temps et généralisées.
J’écris donc la monographie de l’usure. Je vous montre l’usure dans son origine, ses causes, ses prétextes, ses analogies, son développement, ses effets, ses conséquences. Je prouve que les résultats du principe de l’usure sont tout à l’impossible et à l’absurde, qu’ils engendrent fatalement l’immoralité et la misère. Cela fait, je vous dis : Vous voyez que l’ordre et la conservation de la société sont désormais incompatibles avec l’usure ; que les conditions du crédit ne peuvent plus rester les mêmes ; que l’intérêt, licite au commencement, excusable encore aujourd’hui dans le prêteur, dont il ne dépend pas de s’en priver, est devenu, au point de vue de la conscience sociale, une loi spoliatrice, une institution monstrueuse, qui appelle invinciblement une réforme.
C’était le cas, si je ne me trompe, d’étudier enfin l’histoire, les conditions nouvelles du crédit, la possibilité, attestée par moi, de le rendre gratuit. Et rappelez-vous qu’écartant avec le plus grand soin la question de personnes, je vous disais sans cesse : Je n’accuse point les capitalistes ; je ne me plains pas des propriétaires ; je n’ai garde de condamner, comme a fait l’Église, les banquiers et les usuriers : je reconnais la bonne foi de tous ceux qui profitent de l’intérêt. Je dénonce une erreur exclusivement collective, une utopie antisociale et pleine d’iniquité. Eh bien ! m’avez-vous seulement compris ? Car pour ce qui est de me réfuter, vous n’y songez seulement pas.
J’ai sous les yeux votre quatrième lettre : y a-t-il ombre de cette aperception historique, qui est, comme je vous le dis, la mémoire ? Non. Les faits accomplis existent pour vous uniquement comme souvenirs : c’est-à-dire qu’ils ne sont rien. Vous ne les niez point : mais comme il vous est impossible d’en suivre la filière et de les généraliser, vous n’en dégagez pas le contenu ; leur intelligence vous échappe. Votre faculté mnémonique, comme votre faculté d’attention et de comparaison, est nulle. Vous ne savez que répéter toujours la même chose : Celui qui prête à intérêt n’est point un voleur ; et nul ne peut être contraint de prêter. Que sert, après cela, de savoir si le crédit peut être organisé sur d’autres bases, ou d’examiner ce qui résulte pour les classes travailleuses de la pratique de l’intérêt ? — Votre thème est fait : vous ne vous en départez point. Et sur cela, après avoir exposé la routine usuraire, sous forme d’exemples, vous la reproduisez sous forme de propositions, et vous dites : Voilà la science !
Je vous l’avoue, Monsieur, j’ai douté un instant qu’il y eût sur la terre un homme aussi disgracié de la nature sous le rapport de l’intellect, et j’ai accusé votre volonté. Pour ma part, je préférerais mille fois être suspect dans ma franchise, que de me voir dépouillé du plus bel apanage de l’homme, de ce qui fait sa force et son essence [1]. C’est sous cette impression pénible qu’a été écrite ma lettre du 31 décembre, dont il vous est facile à présent d’apprécier la signification.
Je me suis dit : Puisque M. Bastiat ne daigne ni honorer de son attention ma réponse, ni comparer les faits qui la motivent, ni faire état du mouvement historique qui met à néant sa théorie ; puisqu’il est incapable d’entrer avec moi en dialogue et d’entendre les raisons de son contradicteur, il faut croire qu’il y a en lui excès de personnalité. C’est un homme, comme l’on dit, qui abonde dans son propre jugement, et qui, à force de n’écouter que soi, s’est séquestré de toute conversation avec ses semblables. Attaquons-le donc dans son jugement, c’est-à-dire dans sa conscience, dans sa personnalité, dans son moi.
Voilà comment, Monsieur, j’ai été conduit à m’en prendre, non plus à vos raisonnements, radicalement nuls dans la question, mais à votre volonté. J’ai accusé votre bonne foi : c’était une expérience, je vous en demande pardon, que je me permettais sur votre individu. Pour donner corps et figure à mon accusation, j’ai concentré toute notre discussion sur un fait contemporain, palpable, décisif, avec lequel j’ai identifié, non-seulement votre théorie, mais vous-même, sur la Banque de France.
La Banque de France, vous ai-je fait observer, est la preuve vivante de ce que je ne cesse de vous répéter depuis six semaines, savoir, que si l’intérêt fut un jour nécessaire et licite, il y a aujourd’hui, pour la société, devoir et possibilité de l’abolir.
Il est prouvé, en effet, par la comparaison du capital de la Banque avec son encaisse, que tout en servant à ses actionnaires l’intérêt dudit capital à 4 pour 100, elle peut faire le crédit et l’escompte à 1 pour 100, et réaliser encore de beaux bénéfices. Elle le peut, elle le doit : en ne le faisant pas, elle vole. Elle est cause, par son refus, que le taux des intérêts, loyers et fermages, qui devrait descendre partout à 1 pour 100, en maximum, reste élevé à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 15 pour 100. Elle est cause que le peuple paie chaque année aux classes improductives plus de six milliards de gratifications et pots-de-vin, et que, tandis qu’il pourrait produire chaque année vingt milliards de valeurs, il n’en produit que dix. Donc, ou vous justifierez la Banque de France, ou, si vous ne le pouvez pas, si vous ne l’osez pas, vous reconnaîtrez que la pratique de l’intérêt n’est qu’une pratique de transition, qui doit disparaître dans une société supérieure.
Voilà, monsieur, ce que je vous ai dit, et en termes assez vifs pour provoquer de votre part, à défaut d’attention, de comparaison, de mémoire, sur la question tout historique que je vous avais jusqu’alors soumise, cet acte simple et tout intuitif de la pensée, lorsqu’elle se trouve en présence d’un fait, et interrogée par oui ou par non, je veux dire, un jugement. Vous n’aviez qu’à répondre, en deux mots, cela est, ou cela n’est pas, et le procès était fini.
Cela est, c’est-à-dire, oui, la Banque de France peut, sans faire tort à ses actionnaires et se nuire à elle-même, faire l’escompte à 1 pour 100 ; elle peut donc, en vertu de la concurrence qu’elle créerait par cette diminution, faire baisser le loyer de tous les capitaux, et du sien propre, au-dessous de 1 pour 100. Et puisque le mouvement de décroissance, une fois commencé, ne s’arrêterait plus, elle peut, si elle veut, faire disparaître tout à fait l’intérêt. Donc le crédit payé, quand il ne prend que ce qui lui est dû, mène droit au crédit gratuit ; donc l’intérêt n’est qu’un fait d’ignorance et de barbarie ; donc l’usure et la rente, dans une démocratie organisée, sont illicites.
Cela n’est pas, c’est-à-dire, non, il n’est pas vrai, quoi qu’en dise le bilan publié chaque semaine par la Banque de France, qu’elle ait un capital de 90 millions et un encaisse de 460 millions ; il n’est pas vrai que cet encaisse énorme vienne de la substitution du papier de banque au numéraire dans la circulation commerciale, etc. etc. Dans ce cas, je vous renvoyais à M. d’Argout, à qui revenait le débat.
L’eût-on jamais cru, si vous ne nous l’aviez fait voir ? À ce fait si catégorique, si palpitant de la Banque de France, vous ne répondez ni oui ni non. Vous ne vous doutez seulement pas de l’identité qui existe entre le fait soumis à votre jugement et votre théorie de l’intérêt. Vous n’apercevez point la synonymie de ces deux propositions : Oui, la Banque de France peut faire crédit à 1 pour 100, donc ma théorie est fausse ; — Non, la Banque de France ne peut pas faire crédit à 1 pour 100, donc ma théorie est vraie.
Votre réponse, monument irrécusable d’une intelligence que le Verbe divin n’illumina jamais, c’est : qu’il ne s’agit pas pour vous de la Banque de France, mais du capital ; que vous ne défendez point le privilége de la Banque, mais seulement la légitimité de l’intérêt ; que vous êtes pour la liberté des banques, comme pour la liberté du prêt ; que, s’il est possible à la Banque de France de faire le crédit et l’escompte pour rien, vous ne l’empêchez point ; que vous vous bornez à affirmer une chose, à savoir, que la notion du capital suppose et implique nécessairement celle de l’intérêt ; que le premier ne va pas sans le second, bien que le second existe quelquefois sans le premier, etc.
Ainsi, vous êtes aussi impuissant à juger qu’à observer, comparer et vous remémorer. Il vous manque cette conscience juridique qui, en présence de deux faits identiques ou contraires, prononce : Oui, l’identité existe ; non, l’identité n’existe pas. Sans doute, puisque vous êtes un être pensant, vous avez des intuitions, des illuminations, des révélations ; je ne me charge pas, quant à moi, de dire ce qui se passe dans votre cerveau. Mais, à coup sûr, vous ne raisonnez pas, vous ne réfléchissez pas. Quelle espèce d’homme êtes-vous, monsieur Bastiat ? Êtes-vous seulement un homme ?…
Comment ! après m’avoir abandonné successivement la métaphysique, à laquelle vous n’entendez rien ; la philosophie de l’histoire, que vous traitez de fatalisme ; le progrès économique, dont le dernier terme est la réduction à l’absurde de l’intérêt ; vous m’abandonnez encore la pratique financière, dont le plus magnifique corollaire est précisément la conversion du crédit payé en crédit gratuit ; et vous n’en persistez pas moins à soutenir la vérité absolue de votre théorie, que vous avez ainsi détruite de vos propres mains ! Vous lâchez pied partout ; la métaphysique, l’histoire, l’économie sociale, la banque, font successivement défaut à votre thèse, comme l’attention, la comparaison, la mémoire et le jugement à votre intelligence : encore une fois, quelle dialectique est la vôtre, et comment voulez-vous qu’on vous prenne ?
Et cependant, je ne me suis point découragé. J’ai voulu aller jusqu’au bout et tenter un dernier effort. J’ai cru que cette inertie des facultés intellectuelles pouvait provenir de l’absence de notions, et je me suis flatté de l’espérance de faire jaillir enfin l’étincelle dans votre âme. Vous-même paraissiez m’indiquer cette marche, quand vous me disiez : Convaincu que tout ce débat repose sur la notion du capital ; et, qu’en conséquence, vous essayiez de m’expliquer ce que vous entendez par capital ; puis donc qu’il est inabordable par la logique, me dis-je, attaquons-le par les notions. Il serait honteux qu’une pareille discussion finit sans que les deux adversaires pussent se rendre le témoignage, que s’ils n’ont pu s’accorder, au moins il se sont compris !
J’analyse donc, pour vous exprès, la notion de capital. Cette analyse terminée, je donne la définition ; j’en déduis les corollaires ; puis afin de ne laisser aucune ambiguïté dans les termes, j’appelle à moi la science du comptable. Je représente par écritures de commerce, sur deux tableaux comparatifs, d’un côté, la théorie du capital d’après vos idées ; de l’autre, cette même théorie d’après les miennes. Je consacre treize colonnes de la Voix du Peuple à cette exposition, toute de complaisance, mais de laquelle, selon moi, doit sortir une révolution économique, mieux que cela, une science nouvelle.
C’était une dernière fois vous dire :
Prenez garde ! les temps sont changés. Le principe de l’intérêt a épuisé toutes ses conséquences ; elles sont aujourd’hui reconnues immorales, destructives de la félicité publique, mathématiquement fausses ; la tenue de livres les dément, et, ce qui ne vous laisse aucune ressource, avec la tenue de livres, la notion même du capital. Pour Dieu, soyez donc attentif aux faits que je vous signale ; observez, comparez, synthétisez, jugez, remontez aux notions : alors seulement vous aurez le droit d’exprimer une opinion. Vous persisterez dans votre erreur, sans doute, mais du moins votre erreur sera raisonnée ; vous vous tromperez en connaissance de cause.
Comment êtes-vous sorti de cette épreuve ? C’est ce que je vais examiner, en répondant à votre dernière.
Je laisse de côté votre exorde, magnifique et pompeux, dans lequel vous félicitez la société du service que je lui ai rendu en dévoilant le dernier mot du socialisme, et célébrez votre victoire. Je ne relèverai pas davantage certaines plaisanteries sur les hésitations et oscillations de ma polémique : nos lecteurs sont à cet égard suffisamment instruits. Ils savent que ce que vous appelez en moi hésitation, n’est autre que la distinction fondamentale que j’ai faite, dès le premier jour, sur le passé et le présent de l’économie des sociétés, distinction que j’ai appuyée successivement de toutes les preuves que me fournissaient la métaphysique, l’histoire, le progrès, la routine même, et sur laquelle je m’efforce, mais inutilement, depuis deux mois, d’appeler votre attention. Je néglige, en un mot, tout ce qui, dans votre épître, n’a point directement trait à la question, et ne m’attache qu’à l’essentiel.
J’avais défini le capital : Toute valeur faite, en terres, instruments de travail, marchandises, subsistances, ou monnaies, et servant, ou pouvant servir à la production.
Chose singulière ! cette définition vous agrée ; vous l’acceptez, vous vous en emparez. Hélas ! mieux eût valu pour vous cent fois la rejeter, avec l’antinomie et la philosophe de l’histoire, que d’encombrer d’une pareille formule votre entendement ! Il faut voir quel affreux ravage cette terrible définition a fait sur votre esprit !
D’abord, vous ne l’avez point du tout comprise. Malgré la peine que je me suis donnée de vous l’expliquer, vous ignorez ce que c’est qu’une valeur faite : sans cela, eussiez-vous fait tenir, à l’un des personnages que vous mettez en scène, le discours suivant : « Messieurs, si vous voulez mes meubles, mes souliers, mes clous, mes habits, qui sont des valeurs faites, donnez-moi une valeur faite, c’est-à-dire vingt francs d’argent ? »
On appelle valeur faite, dans le commerce, une lettre de change, par exemple, ayant une cause réelle, revêtue des formes légales, émanée d’une source connue et solvable, acceptée, et au besoin endossée par des personnes également solvables et connues, offrant ainsi triple, quadruple, etc., garantie, et susceptible, par le nombre et la solidité des cautions, de circuler comme numéraire. Plus il y a de cautions et d’acceptations, mieux la valeur est faite : elle serait parfaite, si elle avait pour garants et pour accepteurs tous les citoyens. Telle est la monnaie, la mieux faite de toutes les valeurs : car, outre qu’elle porte son gage en elle-même, elle est revêtue de la signature de l’État, qui la lance dans la circulation comme une lettre de change, et assurée de l’acceptation du public. Par analogie, je dis que des meubles, des souliers, et tous autres produits, sont reconnus valeurs faites, non pas lorsque la confection en est achevée et qu’ils sont exposés à la vente, comme vous le dites ; mais après qu’ils ont été appréciés contradictoirement, que la valeur en a été fixée, la livraison effectuée ; et cela encore, seulement, pour celui qui les achète, ou qui consent à les reprendre au même prix. C’est ainsi, vous ai-je dit, que le produit devient capital ; et il n’est capital que pour l’acquéreur, qui s’en fait soit un instrument, soit un élément de reproduction. Pour celui-là, dis-je, et pour lui seul, le produit devient valeur faite, en un mot, capital.
Ici, Monsieur, j’ai du moins l’avantage que vous ne me contredirez point. Je suis l’auteur de la définition ; je sais ce que j’ai voulu dire ; vos paroles déposent de ce que vous avez entendu. Vous ne me comprenez pas.
Quoi qu’il en soit, et sans y regarder de si près, vous prenez ma définition du capital pour bonne ; vous dites qu’elle suffit à la discussion. Vous reconnaissez donc, implicitement, que capital et produit sont, dans la société, termes synonymes ; conséquemment, que toute opération de crédit se résout, à peine de fraude, dans un échange : deux choses que vous aviez d’abord niées, et que je vous féliciterais d’avoir enfin comprises, s’il m’était possible de croire que vous donnez à mes paroles le sens que je leur applique. Quoi de plus fécond, en effet, que cette analyse : Puisque la valeur n’est autre chose qu’une proportion, et que tous les produits sont nécessairement proportionnels entre eux, il s’ensuit qu’au point de vue social les produits sont toujours valeurs et valeurs faites : la différence, pour la société, entre capital et produit, n’existe pas. Cette différence est toute subjective aux individus : elle vient de l’impuissance où ils se trouvent d’exprimer la proportionnalité des produits en nombre exact et de leurs efforts pour arriver à une approximation. Car, ne l’oublions pas, la loi secrète de l’échange, la règle absolue des transactions, loi non écrite mais intuitive, règle non de convention mais de nature, c’est de conformer, le plus possible, les actes de la vie privée aux formules de la vie sociale.
Or, et c’est ce qui fait naître mes doutes, cette définition, si profonde et si nette, du capital, que vous trouvez bon d’accepter ; cette identité du capital et du produit, du crédit et de l’échange, tout cela, Monsieur, est la négation de votre théorie de l’intérêt ; et certes, vous ne vous en doutiez pas ? Dès lors, en effet, que la formule de J. B. Say, les produits s’échangent contre les produits, est synonyme de cette autre, les capitaux s’échangent contre les capitaux ; que la définition du capital, par vous acceptée, n’est autre chose que cette synonymie ; que tout concourt, dans la société, à rendre les faits de commerce de plus en plus conformes à cette loi ; il est évident, à priori, qu’un jour doit venir où les relations de prêt, loyer, fermage, intérêt, et autres analogues, seront abolies et converties en rapports d’échange ; et qu’ainsi la prestation des capitaux, devenant simplement échange de capitaux, et toutes les affaires se réglant au comptant, l’intérêt devra disparaître. L’idée d’usure, dans cette définition du capital, implique contradiction.
C’est ce que vous eussiez infailliblement compris, si, tout en adoptant ma définition du capital, vous lui aviez accordé une seule minute de réflexion. Mais croire que vous allez réfléchir sur vos propres notions ; s’imaginer qu’après avoir admis un principe, vous en adopterez les conséquences, le mouvement et les lois ; c’est, j’en ai fait la triste expérience, se tromper étrangement. Raisonner, pour vous, c’est contredire à tort et à travers, sans suite et sans méthode. La notion glisse sur votre esprit sans le pénétrer. Vous prenez le mot, que vous appliquez ensuite à votre guise, et suivant les préoccupations de votre esprit : vous laissez l’idée, le germe, qui seul féconde l’intelligence et dénoue les difficultés.
Je n’avais rien épargné, cependant, pour vous éclairer sur le sens et la portée de ma définition, et vous mettre en garde contre elle. Désespérant de vous la faire concevoir par la seule métaphysique du langage, je l’avais réduite en équations, pour ainsi dire, algébriques. Car, qu’est-ce que la science du comptable, dont j’ai fait usage à cette occasion, sinon une sorte d’algèbre ? Mais voici bien une autre affaire. Vous raisonnez de la tenue des livres absolument comme de la valeur faite : il vous était réservé, après avoir accepté une définition sans en comprendre les termes, sans en apercevoir les conséquences, d’en nier encore la démonstration. Mais, Monsieur, la démonstration, c’est la définition : où donc en êtes-vous ?
Je lis dans votre lettre du 3 février :
« Ayant imaginé ces données, vous dressez la comptabilité de A, de B, et celle de la Banque. Certes cette comptabilité, les données étant admises, est irréprochable. Mais peut-on admettre vos données ? sont-elles conformes à la nature des hommes et des choses ? »
Ceci, j’ose vous le dire, est le renversement de l’arithmétique et du sens commun. Mais, Monsieur, si vous aviez eu la plus légère teinture de comptabilité, vous n’eussiez pas écrit de pareilles lignes. Vous auriez su que si, comme vous êtes forcé de l’avouer, ma comptabilité est irréprochable, les données économiques sur lesquelles je l’ai établie sont, dans le premier système, qui est le vôtre, nécessairement fausses ; dans le second, qui est le mien, nécessairement vraies. Telle est l’essence de la comptabilité, qu’elle ne dépend pas de la certitude de ses données ; elle ne souffre pas de données fausses ; elle est, par elle-même, et malgré la volonté du comptable, la démonstration de la vérité ou de la fausseté de ses propres données. C’est en vertu de cette propriété que les livres du négociant font foi en justice, non-seulement pour lui, mais contre lui ; l’erreur, la fraude, le mensonge, les fausses données, enfin, sont incompatibles avec la tenue des livres. Le banqueroutier est condamné sur le témoignage de ses écritures beaucoup plus que sur la dénonciation du ministère public. Telle est, vous dis-je, l’incorruptibilité de cette science, que j’ai signalée, dans mon Système des contradictions économiques, comme la plus belle application de la métaphysique moderne.
Vous parlez de fausses données. Mais la donnée sur laquelle j’ai établi ma comptabilité est précisément la vôtre, la donnée du capital productif d’intérêt. Cette donnée étant pour vous réputée vraie, je la soumets à l’épreuve de la comptabilité. J’en fais autant pour la donnée contraire, qui est celle que je défends. L’opération faite, vous la proclamez irréprochable ; mais comme elle conclut contre vous, vous vous en récriez que les données sont fausses. Je vous demande, monsieur Bastiat, ce que vous avez voulu dire ?
Certes, je ne m’étonne plus, à présent, qu’à force de ne pas voir dans une définition ce qui y est, vous ayez fini par découvrir ce qui n’y est point, et que, de bévue en bévue, vous soyez tombé dans la plus inconcevable hallucination. Ou donc avez-vous vu, dans cette comptabilité irréprochable, bien que, selon vous, la donnée en soit fausse, que le système de crédit que je défends, c’est le papier-monnaie ? Je vous défie de citer un seul mot de moi, dans cette longue controverse, qui vous autorise à dire, comme vous le faites, et, je crois, pour vous tirer d’embarras, que la théorie du crédit gratuit, c’est la théorie des assignats. Je n’ai pas dit un mot du système que je voudrais voir substitué à celui qui nous gouverne et dans lequel je persiste à voir la cause de tous les malheurs de la société. Vous n’avez pas voulu qu’il fût mis en discussion, ce système ; vous êtes resté sur votre terrain ; tout ce que j’ai pu faire, ç’a été de vous prouver, sans toutefois me faire comprendre, que la pratique de l’intérêt mène droit à la pratique de la gratuité, et que l’heure est sonnée d’accomplir cette révolution. De mon système, à moi, il n’en a jamais été question. J’ai raisonné constamment sur vos données ; je me suis tenu, avec vous, dans les us et coutumes du capital. Relisez ma lettre du 31 décembre ; il ne s’agit point là de la Banque du Peuple, mais bien de la Banque de France, de cette Banque privilégiée, gouvernée par M. d’Argout, que vous ne soupçonnez point, sans doute, d’être partisan du papier-monnaie, ni de la monnaie de papier, ni des assignats ; de cette Banque, enfin, qui, depuis la réunion des Banques départementales, et l’émission des billets à 100 francs, a vu continuellement augmenter son encaisse ; qui possède aujourd’hui 460 millions de lingots et d’espèces ; qui finira par engloutir dans ses caves un milliard de numéraire, pour peu que l’administration réduise encore la coupure des billets, établisse d’autres succursales, et que les affaires reprennent ; c’est de cette Banque-là que je vous ai entretenu : l’auriez-vous prise, par hasard, pour une hypothèse, et ses 460 millions d’espèces pour une utopie ?
Voici ce que je vous ai dit :
Le capital de la Banque de France est de 90 millions ; son encaisse de 460 millions ; ses émissions de 472 : soit donc un capital, réalisé ou garanti, de 382 millions, appartenant au peuple français, et sur lequel la Banque ne doit percevoir aucun intérêt.
Or, les intérêts dus par la Banque à ses actionnaires étant de 4 pour 100 sur un capital de 90 millions ; les frais d’administration, risque compris, 1/2 pour 100 ; l’accumulation des espèces se faisant d’une manière progressive, et la somme des émissions pouvant, sans danger, être d’un tiers supérieure à celle de l’encaisse : je dis que la Banque de France peut, que si elle peut elle doit, à peine de concussion et de vol, réduire le taux de ses escomptes à 1 pour 100, et organiser le crédit foncier, en même temps que le crédit commercial. Que me parlez-vous donc de papier-monnaie, d’assignats, de cours forcé, de maximum, de débiteurs insolvables, d’emprunteurs sans bonne foi, de travailleurs débauchés, et autres balivernes ? Que la Banque de France fasse son métier avec prudence et sévérité, comme elle a fait jusqu’à présent ; ce n’est pas mon affaire. Je dis qu’elle a le pouvoir et le devoir de faire le crédit et l’escompte, à ceux à qui elle a coutume de le faire, à 1 pour 100 l’an, commission comprise. M. Bastiat me fera-t-il une fois l’honneur de m’entendre ?
M. Bastiat. « Pour que les billets d’une Banque soient reçus, il faut qu’ils inspirent confiance ;
Pour qu’ils inspirent confiance, il faut que la Banque ait des capitaux ;
Pour que la Banque ait des capitaux, il faut qu’elle les emprunte, et conséquemment qu’elle en paie l’intérêt ;
Si elle en paie l’intérêt, elle ne peut les prêter sans intérêt. »
Moi. Et bien ! Monsieur, la Banque de France a trouvé des capitaux sans intérêts ; elle possède, en ce moment, 382 millions qui ne lui appartiennent pas ; elle en aura, quand elle voudra, le double à pareille condition. — Doit-elle faire payer un intérêt ?
M. Bastiat. « Le temps est précieux. Le temps, c’est de l’argent, disent les Anglais. Le temps, c’est l’étoffe dont la vie est faite, dit le Bonhomme Richard.
Faire crédit, c’est accorder du temps.
Sacrifier du temps à autrui, c’est lui sacrifier une chose précieuse ; un pareil sacrifice ne peut être gratuit. »
Moi. Vous n’y arriverez donc jamais ! Je vous ai dit, et je vous répète, qu’en matière de crédit, ce qui fait qu’on a besoin de temps, c’est la difficulté de se procurer de l’argent ; que cette difficulté tient surtout à l’intérêt exigé par les détenteurs d’argent ; en sorte que si l’intérêt était zéro, le temps du crédit serait aussi zéro. Or, la Banque de France, dans les conditions que lui fait le public depuis la révolution de Février, peut réduire son intérêt presque à zéro ; qui de vous ou de moi tourne dans le cercle ?
M. Bastiat. « Ah ! oui… il semble… je crois comprendre enfin ce que vous voulez dire. Le public a renoncé, en faveur de la Banque, à l’intérêt de 382 millions de billets qui circulent sous sa seule garantie. Vous demandez s’il n’y aurait pas moyen de faire profiter le public de cet intérêt, ou, ce qui revient au même, d’organiser une Banque nationale qui ne perçût pas d’intérêts. Si je ne me trompe pas, c’est sur l’observation de ce phénomène que se fonde votre invention. Ricardo avait conçu un plan moins radical, mais analogue, et je trouve dans Say ces lignes remarquables :
Cette idée ingénieuse ne laisse qu’une question non résolue. Qui devra jouir de l’intérêt de cette somme considérable, mise dans la circulation ? Serait-ce le gouvernement ? Ce ne serait pour lui qu’un moyen d’augmenter les abus, tels que les sinécures, la corruption parlementaire, le nombre des délateurs de la police, et les armées permanentes. Serait-ce une compagnie financière, comme la Banque d’Angleterre, la Banque de France ? Mais à quoi bon faire à une compagnie financière le cadeau des intérêts payés en détail par le public ?… Telles sont les questions qui naissent à ce sujet : peut-être ne sont-elles pas insolubles. Peut-être y a-t-il des moyens de rendre hautement profitable au public l’économie qui en résulterait ; mais je ne suis pas appelé à développer ici ce nouvel ordre d’idées. »
Moi. Eh ! Monsieur, votre J. B. Say, avec tout son génie, est un imbécile. La question est toute résolue ; c’est que le peuple, qui fait les fonds, le peuple, qui est ici le seul capitaliste, le seul commanditaire, le vrai propriétaire ; le peuple, qui seul doit profiter de l’intérêt, le peuple, dis-je, ne doit pas payer d’intérêts. Est-il au monde quelque chose de plus simple et de plus juste ?
Ainsi, vous convenez, sur la foi du Ricardo et de J. B. Say, qu’il existe un moyen de faire profiter le public, je cite vos propres expressions, des intérêts qu’il paie à la Banque, et que ce moyen, c’est d’organiser une Banque nationale, faisant crédit à zéro d’intérêt ?
M. Bastiat. Non pas cela, Dieu m’en préserve ! Je reconnais, il est vrai, que la Banque ne doit pas profiter des intérêts payés par le public pour un capital appartenant au public ; je conviens de plus qu’il existe un moyen de faire profiter desdits intérêts le public. Mais je nie que ce moyen soit celui que vous indiquez ; à savoir, l’organisation d’une Banque nationale ; je dis et j’affirme que ce moyen, c’est la liberté des Banques !
« Liberté des banques ! Liberté du crédit ! Oh ! pourquoi, monsieur Proudhon, votre brûlante propagande n’a-t-elle pas pris cette direction ? »
Je fais grâce au lecteur de votre péroraison, dans laquelle vous déplorez mon endurcissement, et m’adjurez, avec un sérieux comique, de substituer à ma formule : Gratuité du crédit, la vôtre : Liberté du crédit, comme si le crédit pouvait être plus libre que lorsqu’il ne coûte rien ! Je n’ai veine au corps, sachez-le bien, qui résiste à la liberté du crédit : en fait de banque, comme en fait d’enseignement, la liberté est ma loi suprême. Mais je dis que, jusqu’à ce que la liberté des banques et la concurrence des banquiers fasse jouir le public des intérêts qu’il leur paie, il serait bon, utile, constitutionnel, et d’une économie tout à fait républicaine, de créer, au milieu des autres banques, et en concurrence avec elles, une Banque nationale faisant provisoirement crédit à 1 ou 1/2 pour 100, au risque de ce qui en arriverait. Vous répugne-t-il de faire de la Banque de France, par le remboursement de ses actionnaires, cette Banque nationale que je propose ? Alors que la Banque de France restitue les 382 millions d’espèces qui appartiennent au public, et dont elle n’est que la détentrice. Avec 382 millions on peut très-bien organiser une banque ; qu’en pensez-vous ? Et la plus grosse de l’univers. En quoi donc cette banque, formée par la commandite de tout le peuple, ne serait-elle pas libre ? Faites cela seulement, et quand vous aurez attaché ce grelot révolutionnaire, quand vous aurez de la sorte édicté le premier acte de la République démocratique et sociale, je me charge de vous déduire les conséquences de cette grande innovation. Vous saurez alors quel est mon système.
Quant à vous, monsieur Bastiat, qui, économiste, vous moquez de la métaphysique, dont l’économie politique n’est que l’expression concrète ; qui, membre de l’Institut, ne savez pas même où en est la philosophie de votre siècle ; qui, auteur d’un livre intitulé Harmonies économiques, probablement par opposition aux Contradictions économiques [2], ne concevez rien aux harmoniques de l’histoire, et ne voyez dans le progrès qu’un désolant fatalisme ; qui, champion du capital et de l’intérêt, ignorez jusqu’aux principes de la comptabilité commerciale ; qui, concevant enfin, à travers les ambages d’une imagination effarée, et sur la foi de vos auteurs beaucoup plus que d’après votre intime conviction, qu’il est possible d’organiser, avec les fonds du public, une banque faisant crédit sans intérêt, continuez cependant à protester, au nom de la Liberté du Crédit, contre la Gratuité du Crédit : vous êtes sans doute un bon et digne citoyen, un économiste honnête, un écrivain consciencieux, un représentant loyal, un républicain fidèle, un véritable ami du peuple : mais vos dernières paroles me donnent le droit de vous le dire, scientifiquement, monsieur Bastiat, vous être un homme mort.
P. J. Proudhon.
FN:Quelques mois après la clôture de cette discussion, M. Proudhon, au nom d’une compagnie industrielle, demandait au gouvernement une garantie de 5 pour % d’intérêt, pour certaine entreprise de transports, entre Châlons et Avignon. Choqué d’une telle demande de la part de l’apôtre du crédit gratuit et de l’anarchie, Bastiat manifesta son impression par une lettre restée inédite, dont nous reproduisons les dernières lignes.
« M. Proudhon, déplorant la faiblesse de mes facultés intellectuelles, disait : — Pour ma part, je préférerais mille fois être suspect dans ma franchise que de me voir dépouillé du plus bel apanage de l’homme, de ce qui fait sa force et son essence. — Que M. Proudhon le sache bien : j’accepte le partage. À moi l’humble intelligence qu’il a plu à Dieu de me départir ; à lui, puisqu’il le préfère, d’être suspecté dans sa franchise. » (Note de l’éditeur.)
FN:M. Proudhon s’est trompé dans sa conjecture. Bastiat n’a pas écrit les Harmonies par opposition aux Contradictions économiques, car, le 5 juin 1845, c’est-à-dire antérieurement à l’apparition des Contradictions, il communiquait par lettre à un ami le projet d’écrire les Harmonies sociales. Rappelons aussi que Bastiat était seulement membre correspondant de l’Institut. (Note de l’éditeur.)
QUATORZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon ↩
Droit légitime de la défense. — Origine et résumé d’une discussion, dont le public est seul juge.
7 mars 1850.
La cause est entendue et le débat est clos, dit M. Proudhon, de partie se faisant juge. M. Bastiat est condamné… à mort. Je le condamne dans son intelligence ; je le condamne dans son attention, dans ses comparaisons, dans sa mémoire et dans son jugement ; je le condamne dans sa raison ; je le condamne dans sa logique ; je le condamne par induction, par syllogisme, par contradiction, par identité et par antinomie.
Oh ! monsieur Proudhon, vous deviez être bien en colère quand vous avez jeté sur moi ce cruel anathème !
Il me rappelle la formule de l’excommunication :
Maledictus sit vivendo, moriendo, manducando, bibendo.
Maledictus sit intus et exterius.
Maledictus sit in capillis et in cerebro.
Maledictus sit in vertice, in oculis, in auriculis, in brachiis, etc., etc. ; maledictus sit in pectore et in corde, in renibus, in genubus, in cruribus, in pedibus, et in unguibus.
Hélas ! toutes les Églises se ressemblent, quand elles ont tort elles se fâchent.
Cependant je récuse l’arrêt, et je proteste contre la clôture du débat.
Je récuse l’arrêt, parce qu’il n’appartient pas à mon adversaire de le prononcer. Je ne reconnais pour juge que le public.
Je proteste contre la clôture du débat, parce que, défendeur, je dois avoir le dernier mot. M Chevé m’a écrit, j’ai répondu ; — M. Proudhon m’a écrit, j’ai répondu ; — il m’a écrit de nouveau, j’ai répondu derechef ; — il lui plaît de m’adresser une quatrième, une cinquième, une sixième lettre. Il me convient de lui faire autant de réponses ; et il a beau dire, à moins que la justice et les convenances ne soient aussi des antinomies, je suis dans mon droit.
Au reste, je me bornerai à me résumer. Outre que je ne puis continuer à discuter avec M. Proudhon, malgré lui, et moins encore quand les personnalités commencent à remplacer les arguments, je serais aujourd’hui dans une situation trop défavorable.
M. Proudhon est persécuté ; partant toutes les préventions, toutes les sympathies publiques passeraient de son côté. Il avait compromis la cause du crédit gratuit, voici que le pouvoir la relève en la plaçant sur le piédestal de la persécution. Je n’avais qu’un adversaire, j’en aurais trois : M. Proudhon, la police et la popularité.
M. Proudhon me reproche deux choses : d’abord, de m’en tenir toujours à défendre mon assertion, la légitimité de l’intérêt ; ensuite, de ne pas discuter son système, la gratuité du crédit.
Oui, dans chacune de mes lettres, je me suis attaché à pénétrer, sous des points de vue divers, la nature intime du capital pour en déduire la légitimité de l’intérêt. Pour tout esprit logique, cette manière de procéder était décisive : car il est bien clair que la chimère du crédit gratuit s’évapore, si une fois il est démontré que l’intérêt est légitime, utile, indestructible, de même essence que toute autre rémunération, profit ou salaire ; — la juste récompense d’un sacrifice de temps et de travail, volontairement allouée à celui qui fait le sacrifice par celui qui en profite ; — en d’autres termes, que le prêt est une des variétés de la vente. D’ailleurs, ne devais-je pas m’efforcer de donner à cette polémique une portée utile ? Et quand les classes laborieuses égarées attribuent leurs souffrances au Capital, quand les flatteurs du peuple, abondant lâchement dans le sens de ses préjugés, ne cessent de l’irriter contre l’infâme capital, l’infernal capital, que pouvais-je faire de mieux que d’exposer à tous les yeux l’origine et les effets de cette puissance si mal comprise, puisque aussi bien j’atteignais du même coup l’objet précis de notre polémique ?
En procédant ainsi, j’ai fait quelque preuve de patriotisme et d’abnégation. Si je n’avais écouté que l’amour-propre de l’écrivain, je me serais borné à discuter et réfuter les arguties de M. Proudhon. Critiquer est un rôle facile et brillant ; exposer une doctrine sans y être obligé, c’est abandonner ce beau rôle pour le céder à son adversaire. Je l’ai fait, cependant, parce que je me préoccupais plus de la polémique que du polémiste, et des lecteurs que de moi-même [1].
Est-ce à dire que j’aie négligé les arguments de M. Proudhon ? Je montrerai que j’ai répondu à tous, et d’une manière si catégorique, qu’il les a tous successivement abandonnés. Je n’en veux que cette preuve : M. Proudhon a fini par où on finit quand on a tort ; il s’est fâché.
Je reprends donc la même marche, et après avoir de nouveau appelé l’attention du lecteur sur la nature du capital, je passerai en revue les arguments de M. Proudhon.
Qu’on me permette de remonter un peu haut, seulement… au Déluge.
Les eaux s’étant retirées, Deucalion jeta derrière lui des pierres, et il en naquit des hommes.
Et ces hommes étaient bien à plaindre, car ils n’avaient pas de capital. Ils étaient dépourvus d’armes, de filets, d’instruments, et ils ne pouvaient en fabriquer, parce que, pour cela, il aurait fallu qu’ils eussent quelques provisions. Or, c’est à peine s’ils réussissaient à prendre chaque jour assez de gibier pour satisfaire la faim de chaque jour. Ils se sentaient dans un cercle difficile à franchir, et ils comprenaient qu’ils n’en auraient été tirés, ni par tout l’or de la Californie, ni par autant de billets que la Banque du peuple en pourrait imprimer dans un an, et ils se disaient entre eux : le capital n’est pas ce qu’on dit.
Cependant, un de ces infortunés, nommé Hellen, plus énergique que les autres, se dit : je me lèverai plus matin, je me coucherai plus tard ; je ne reculerai devant aucune fatigue ; je souffrirai la faim et ferai tant que j’aurai une avance de trois jours de vivres. Ces trois jours, je les consacrerai à fabriquer un arc et des flèches.
Et il réussit. À force de travailler et d’épargner, il eut une provision de gibier. C’est le premier capital qui ait paru dans le monde depuis le déluge. C’est le point de départ de tous les progrès.
Et plusieurs se présentèrent pour l’emprunter. Prêtez-nous ces provisions, disaient-ils à Hellen, nous vous en rendrons tout juste autant dans un an. — Mais Hellen répondit : Si je vous prêtais mes provisions, je demanderais à partager les avantages que vous en retireriez ; mais j’ai un dessein, j’ai pris assez de peine pour me mettre en mesure de l’accomplir, et je l’accomplirai.
Et, en effet, il vécut trois jours sur son travail accumulé, et, pendant ces trois jours, il fit un arc et des flèches.
Un de ses compagnons se présenta de nouveau, et lui dit : Prête-moi tes armes, je te les rendrai dans un an. À quoi Hellen répondit : Mon capital est précieux. Nous sommes mille ; un seul peut en jouir, et il est naturel que ce soit moi, puisque je l’ai créé.
Mais, grâce à son arc et à ses flèches, Hellen put beaucoup plus facilement que la première fois accumuler d’autres provisions et fabriquer d’autres armes.
C’est pourquoi il prêtait les unes ou les autres à ses compagnons, stipulant chaque fois une part pour lui dans l’excédant de gibier qu’il les mettait à même de prendre.
Et malgré ce partage, les emprunteurs voyaient leur travail facilité. Ils accumulaient aussi des provisions, ils fabriquaient aussi des flèches, des filets et d’autres instruments, en sorte que le capital, devenant de plus en plus abondant, se louait à des conditions de moins en moins onéreuses. Le premier mouvement avait été imprimé à la roue du progrès, elle tournait avec une rapidité toujours croissante.
Cependant, et bien que la facilité d’emprunter s’accrût sans cesse, les retardataires se mirent à murmurer, disant : Pourquoi ceux qui ont des provisions, des flèches, des filets, des haches, des scies, stipulent-ils une part pour eux quand ils nous prêtent ces choses ? N’avons-nous pas aussi le droit de vivre et de bien vivre ? La société ne doit-elle pas nous donner tout ce qui est nécessaire au développement de nos facultés physiques, intellectuelles et morales ? Évidemment, nous serions plus heureux si nous empruntions pour rien. C’est donc l’infâme capital qui cause notre misère.
Et Hellen les ayant assemblés leur dit : Examinez attentivement ma conduite et celle de tous ceux qui, comme moi, ont réussi à se créer des ressources ; vous resterez convaincus que, non-seulement elle ne vous fait aucun tort, mais qu’elle vous est utile, alors même que nous aurions assez mauvais cœur pour ne pas le vouloir. Quand nous chassons ou pêchons, nous attaquons une classe d’animaux que vous ne pouvez atteindre, de telle sorte que nous vous avons délivré de notre rivalité. Il est vrai que, quand vous venez nous emprunter nos instruments, nous nous réservons une part dans le produit de votre travail. Mais d’abord cela est juste, car il faut bien que le nôtre ait aussi sa récompense. Ensuite, cela est nécessaire, car si vous décidez que désormais on prêtera les armes et les filets pour rien, qui fera des armes et des filets ? Enfin, et c’est ici ce qui vous intéresse surtout, malgré la rémunération convenue, l’emprunt, quand vous le faites, vous est toujours profitable, sans quoi vous ne le feriez pas. Il peut améliorer votre condition, il ne peut jamais l’empirer ; car, considérez que la part que vous cédez n’est qu’une portion de l’excédant que vous obtenez du fait de notre capital. Ainsi, après cette part payée, il vous reste plus, grâce à l’emprunt, que si vous ne l’aviez pas fait, et cet excédant vous facilite les moyens de faire vous-mêmes des provisions et des instruments, c’est-à-dire du capital. D’où il suit que les conditions du prêt deviennent tous les jours plus avantageuses aux emprunteurs, et que vos fils seront, à cet égard, mieux partagés que vous.
Ces hommes primitifs se mirent à réfléchir sur ce discours, et ils le trouvèrent sensé.
Depuis, les relations sociales se sont bien compliquées. Le capital a pris mille formes diverses : les transactions ont été facilitées par l’introduction de la monnaie, des promesses écrites, etc., etc. ; mais à travers toutes ces complications, il est deux faits qui sont restés et resteront éternellement vrais, savoir :
1° Chaque fois qu’un travail antérieur et un travail actuel s’associent dans l’œuvre de la production, le produit se partage entre eux, selon certaines proportions.
2° Plus le capital est abondant, plus sa part proportionnelle dans le produit est réduite. Et comme les capitaux, en augmentant, augmentent la facilité d’en créer d’autres, il s’ensuit que la condition de l’emprunteur s’améliore sans cesse.
J’entends qu’on me dit : Qu’avons-nous à faire de vos démonstrations ? Qui vous conteste l’utilité du capital ?
Aussi, ce sur quoi j’appelle la réflexion du lecteur, ce n’est pas sur l’utilité absolue et non contestée du capital, ni même sur son utilité relativement à celui qui le possède, mais bien sur l’utilité dont il est à ceux qui ne le possèdent pas. C’est là qu’est la science économique, c’est là que se montre l’harmonie des intérêts.
Si la science est impassible, le savant porte dans sa poitrine un cœur d’homme ; toutes ses sympathies sont pour les déshérités de la fortune, pour ceux de ses frères qui succombent sous le triple joug des nécessités physiques, intellectuelles et morales non satisfaites. Ce n’est pas au point de vue de ceux qui regorgent de richesses que la science des richesses offre de l’intérêt. Ce que nous désirons, c’est l’approximation constante de tous les hommes vers un niveau qui s’élève toujours. La question est de savoir si cette évolution humanitaire s’accomplit par la liberté ou par la contrainte. Si donc je n’apercevais pas distinctement comment le capital profite à ceux même qui ne le possèdent pas, comment, sous un régime libre, il s’accroît, s’universalise et se nivelle sans cesse ; si j’avais le malheur de ne voir dans le capital que l’avantage de capitalistes, et de ne saisir ainsi qu’un côté, et, assurément, le côté le plus étroit et le moins consolant de la science économique, je me ferais Socialiste ; car de manière ou d’autre, il faut que l’inégalité s’efface progressivement, et si la liberté ne renfermait pas cette solution, comme les socialistes je la demanderais à la loi, à l’État, à la contrainte, à l’art, à l’utopie. Mais c’est ma joie de reconnaître que les arrangements artificiels sont superflus là où la liberté suffit, que la pensée de Dieu est supérieure à celle du législateur, que la vraie science consiste à comprendre l’œuvre divine, non à en imaginer une autre à la place ; car c’est bien Dieu qui a créé les merveilles du monde social comme celles du monde matériel, et sans doute il n’a pas moins souri à un de ces ouvrages qu’à l’autre : Et vidit Deus quod esset bonum. Il ne s’agit donc pas de changer les lois naturelles, mais de les connaître pour nous y conformer.
Le capital est comme la lumière.
Dans un hospice, il y avait des aveugles et des clairvoyants. Ceux-là étaient sans doute plus malheureux, mais leur malheur ne provenait pas de ce que d’autres avaient la faculté de voir. Bien au contraire, dans les arrangements journaliers, ceux qui voyaient rendaient à ceux qui ne voyaient pas des services que ceux-ci n’auraient jamais pu se rendre à eux-mêmes, et que l’habitude les empêchait d’assez apprécier.
Or, la haine, la jalousie, la défiance vinrent à éclater entre les deux classes. Les clairvoyants disaient : Gardons-nous de déchirer le voile qui couvre les yeux de nos frères. Si la vue leur était rendue, ils se livreraient aux mêmes travaux que nous ; il nous feraient concurrence, ils paieraient moins cher nos services, et que deviendrons-nous ?
De leur côté, les aveugles s’écriaient : Le plus grand des biens, c’est l’égalité ; et, si comme nos frères, nous ne pouvons voir, il faut que, comme nous, ils perdent la vue.
Mais un homme, qui avait étudié la nature et les effets des transactions qui s’accomplissaient dans cet hospice, leur dit :
La passion vous égare. Vous qui voyez, vous souffrez de la cécité de vos frères, et la communauté atteindrait à une somme de jouissances matérielles et morales bien supérieure, bien moins chèrement achetée, si le don de voir avait été fait à tous. Vous qui ne voyez pas, rendez grâces au Ciel de ce que d’autres voient. Ils peuvent exécuter, et vous aider à exécuter une multitude de choses dont vous profitez et dont vous seriez éternellement privés.
La comparaison cependant pèche par un point essentiel. La solidarité entre les aveugles et les clairvoyants est loin d’être aussi intime que celle qui lie les prolétaires aux capitalistes ; car si ceux qui voient rendent des services à ceux qui ne voient pas, ces services ne vont pas jusqu’à leur rendre la vue, et l’égalité est à jamais impossible. Mais les capitaux de ceux qui possèdent, outre qu’ils sont actuellement utiles à ceux qui ne possèdent pas, facilitent à ces derniers les moyens d’en acquérir.
Il serait donc plus juste de comparer le capital au langage. Quelle folie ne serait-ce pas aux enfants [2] de jalouser, dans les adultes, la faculté de parler, et de voir là un principe d’inégalité irrémédiable ; puisque c’est précisément parce que les adultes parlent aujourd’hui que les enfants parleront demain !
Supprimez la parole chez les adultes, et vous aurez l’égalité dans l’abrutissement. Laissez la parole libre, et vous ouvrez des chances à l’égalité dans le progrès intellectuel.
De même, supprimez le capital (et ce serait certes le supprimer que d’en supprimer la récompense), et vous aurez l’égalité dans la misère. Laissez le capital libre, et vous aurez la plus grande somme possible de chances d’égalité dans le bien-être.
Voilà l’idée que je me suis efforcé de faire sortir de cette polémique. M. Proudhon me le reproche. Si j’ai un regret, c’est de n’avoir pas donné à cette idée assez de place. J’en ai été empêché par la nécessité de répondre aux arguments de mon adversaire qui me reproche maintenant de n’y avoir rien répondu. C’est ce qui nous reste à voir.
La première objection qui m’a été adressée (elle est de M. Chevé) consiste à dire que je confonds la propriété avec l’usage. Celui qui prête, disait-il, ne cède que l’usage d’une propriété et ne peut recevoir, en retour, une propriété définitive.
J’ai répondu que l’échange est légitime quand il se fait librement et volontairement entre deux valeurs égales, que l’une de ces valeurs fût attachée ou non à un objet matériel. Or, l’usage d’une propriété utile a une valeur. Si je prête, pour un an, le champ que j’ai clos, défriché, desséché ; j’ai droit à une rémunération susceptible d’être évaluée. Pourvu qu’elle soit évaluée encore qu’on me la paie en objets matériels, comme du froment et de la monnaie, qu’avez-vous à dire ? Voulez-vous donc prohiber les trois quarts des transactions que les hommes font volontairement entre eux et probablement parce que cela leur convient ? Vous nous parlez toujours de nous affranchir, et ne nous présentez jamais que de nouvelles entraves.
Ici, M. Proudhon intervenant, a abandonné la théorie de M. Chevé et m’a opposé l’antinomie. L’intérêt est à la fois légitime et illégitime, a-t-il dit. Il implique une contradiction, comme la propriété, comme la liberté, comme tout ; car la contradiction est l’essence même des phénomènes. J’ai répondu que, sur ce principe, ni lui, ni moi, ni aucun homme, ne pouvait jamais avoir ni tort ni raison, sur ce sujet ; qu’adopter ce point de départ, c’était s’interdire d’arriver jamais à aucune solution, puisque c’était proclamer d’avance que toute proposition est à la fois vraie et fausse. Une telle théorie ne discrédite pas seulement tout raisonnement, mais elle récuse jusqu’à la faculté de raisonner. Quel est, dans une discussion, le signe auquel on peut reconnaître qu’un des deux adversaires a tort ? C’est d’être forcé d’avouer que ses propres arguments se contredisent. Or, c’est justement quand M. Proudhon en est réduit là qu’il triomphe. Je me contredis, donc je suis dans le vrai, car la contradiction est l’essence des phénomènes. Certes, je pouvais refuser le combat, si M. Proudhon eût insisté à m’imposer pour arme une telle logique.
J’ai été plus loin, cependant, et je me suis donné la peine de rechercher comment M. Proudhon avait succombé à la théorie des contradictions. Je l’attribue à ce qu’il conclut de la perfectibilité à la perfection absolue. Or, il est très-vrai que la perfection absolue est pour nous contradictoire et incompréhensible ; et c’est pourquoi nous croyons en Dieu, mais nous ne pouvons l’expliquer. Nous ne pouvons rien concevoir sans limites, et toute limite est une imperfection. Oui, l’intérêt atteste une imperfection sociale. Il en est de même du travail. Nos membres, nos organes, nos yeux, nos oreilles, notre cerveau, nos nerfs attestent de même une imperfection humaine. L’être parfait n’est pas emprisonné dans de tels appareils.
Mais il n’y a pas de raisonnement plus vicieux que celui qui consisterait à dire : Puisque l’intérêt atteste une imperfection sociale, pour réaliser la perfection sociale, supprimons l’intérêt. C’est justement supprimer le remède au mal. Autant voudrait dire, puisque nos nerfs, nos organes, notre cerveau attestent une limite, et par suite une imperfection humaine, supprimons toutes ces choses, et l’homme sera parfait.
Voilà ce que j’ai répondu, et M. Proudhon, que je sache, n’a pas répliqué.
Il n’a pas répliqué, mais il a invoqué la théorie des compensations.
Nous ne demandons pas, dit-il, qu’on prête pour rien, mais qu’il n’y ait plus occasion de prêter. Ce à quoi nous aspirons, ce n’est pas précisément l’abolition, mais la compensation des intérêts. Nous voulons arriver à ce que, dans tout échange, la mise en capital et travail soit la même de toutes parts.
Chimère et despotisme, ai-je répondu. Vous ne ferez jamais qu’un facteur de M. Bidault fasse entrer dans ses services du travail accumulé et du travail actuel en mêmes proportions que le fabricant de bas. Pourvu que les valeurs échangées soient égales, que vous importe le reste ? Vous voulez la compensation ? mais vous l’avez sous le régime de l’échange libre. Évaluer, c’est comparer du travail actuel à du travail actuel, du travail antérieur à du travail antérieur, ou bien enfin, du travail actuel à du travail antérieur. De quel droit voulez-vous supprimez cette dernière nature d’évaluation ; et en quoi les hommes seront-ils plus heureux quand ils seront moins libres ?
Voilà ce que j’ai répondu, et M. Proudhon, que je sache, n’a rien répliqué.
Il n’a rien répliqué, mais se fendant à fond contre le capitaliste, il lui a porté cette botte terrible et bien connue : Le capitaliste n’a pas droit à une rémunération, parce qu’il ne se prive pas. Il ne se prive pas de la chose qu’il cède, puisqu’il ne pourrait l’utiliser personnellement.
J’ai répondu que c’était là une misérable équivoque, qui incrimine la vente aussi bien que le prêt. Si l’homme n’était pas un être sociable, il serait obligé de produire directement tous les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Mais il est sociable : il échange. De là la division du travail, et la séparation des occupations. C’est pourquoi chacun ne fait qu’une chose, et en fait beaucoup plus qu’il n’en peut personnellement consommer. Cet excédant, il le troque contre d’autres choses qu’il ne fait pas, et qui lui sont indispensables. Il travaille pour les autres et les autres travaillent pour lui. Sans doute, celui qui a fait deux maisons et n’en habite qu’une ne se prive pas personnellement, en louant l’autre. Il ne s’en priverait pas davantage en la vendant ; et si, par ce motif, le prix de location est un vol, il en est de même du prix de vente. Le chapelier, qui a cent chapeaux dans sa boutique, quand il en vend un, ne se prive pas personnellement, dans ce sens qu’il ne se réduit pas à aller tête nue. L’éditeur des livres de M. Proudhon, qui en a mille exemplaires dans ses magasins, ne se prive pas personnellement, à mesure de ses ventes, car un seul exemplaire suffirait à son instruction ; l’avocat et le médecin qui donnent des conseils, ne se privent pas. Ainsi votre objection attaque non-seulement l’intérêt, mais le principe même des transactions et de la société. C’est certainement une chose déplorable d’en être réduit, au dix-neuvième siècle, à réfuter sérieusement de telles équivoques, de telles puérilités. Voilà ce que j’ai répondu, et M. Proudhon, que je sache, n’a rien répliqué.
Il n’a rien répliqué ; mais il s’est mis à invoquer ce qu’on pourrait appeler la doctrine des métamorphoses :
L’intérêt était légitime autrefois, du temps où la violence entachait toutes les transactions. Il est illégitime aujourd’hui sous le régime du droit. Combien n’y a-t-il pas d’institutions qui ont été bonnes, justes, utiles à l’humanité, et seraient maintenant abusives ? Tels sont l’esclavage, la torture, la polygamie, le combat judiciaire, etc. Le progrès, la grande loi de l’humanité, n’est pas autre chose que cette transformation du bien en mal et du mal en bien.
J’ai répondu que c’était là un fatalisme aussi pernicieux en morale que l’antinomie est funeste en logique. Quoi ! selon le caprice des circonstances, ce qui était respectable devient odieux, et ce qui était inique devient juste ! Je repousse de toutes mes forces cette indifférence au bien et au mal. Les actes sont bons ou mauvais, moraux ou immoraux, légitimes ou illégitimes par eux-mêmes, par les mobiles qui les déterminent, par les conséquences qu’ils entraînent, et non par des considérations de temps et de lieux. Jamais je ne conviendrai que l’esclavage ait été autrefois légitime et bon ; qu’il a été utile que des hommes en réduisissent d’autres en servitude. Jamais je ne conviendrai que soumettre un accusé à d’inexprimables tourments, ait été un moyen légitime et bon de lui faire dire la vérité. Que l’humanité n’ai pu échapper à ces horreurs, soit. La perfectibilité étant son essence, le mal doit se trouver à ses commencements ; mais il n’en est pas moins le mal, et au lieu de seconder la civilisation, il la retarde.
La rémunération volontairement attribuée au travail antérieur, la récompense librement accordée à un sacrifice de temps, en un mot, l’intérêt est-il une atrocité comme l’esclavage, une absurdité comme la torture ? Il ne suffit pas de l’affirmer, il faut le prouver. De ce qu’il y avait dans l’antiquité des abus qui ont cessé, il ne s’ensuit pas que tous les usages de ces époques étaient des abus et doivent cesser.
Voilà ce que j’ai répondu à M. Proudhon, qui n’a pas insisté.
Il n’a pas insisté ; mais il a fait une nouvelle et non moins étrange fugue dans l’histoire.
L’intérêt, a-t-il dit, est né du contrat de pacotille. Quand, pour une expédition maritime, un homme donnait Navire et Marchandises, et un autre Talent et Travail, le profit se partageait entre eux dans des proportions convenues.
Rien de plus naturel et de plus juste, ai-je répondu, qu’un tel partage. Seulement, il n’est pas nécessairement attaché aux opérations qui se font par mer. Il embrasse la totalité des transactions humaines. Vous faites ici une exception de ce qui est la règle universelle ; et par là vous sapez l’intérêt, parce que l’exception est toujours prévenue d’être illégitime, tandis que rien ne prouve mieux la légitimité d’une règle que son universalité. Le jour où un sauvage a prêté ses armes sous condition d’avoir une part dans le gibier, le jour où un pasteur a prêté son troupeau à la condition d’avoir une part dans le croît ; ce jour-là, et il remonte sans doute à l’origine des sociétés, le principe de l’intérêt est né ; car l’intérêt n’est que cet arrangement fait entre le travail antérieur et le travail actuel, qu’il s’agisse d’exploiter la terre, la mer ou l’air. Depuis, et quand l’expérience a permis ce progrès, la part du capital, d’aléatoire qu’elle était, est devenue fixe, comme le métayage s’est transformé en fermage ; l’intérêt s’est régularisé sans changer de nature.
Voilà ce que j’ai répondu, et M. Proudhon n’a pas répliqué.
Il n’a pas répliqué ; mais il s’est jeté, contre son habitude, dans l’argument sentimentaliste. Il fallait qu’il fût bien à bout de ressources pour recourir à celle-là.
Donc, il m’a proposé des cas extrêmes, où un homme ne pourrait, sans faire horreur, exiger du prêt une rémunération. Par exemple, un riche propriétaire habitant la côte, qui recueillerait un naufragé et lui prêterait des vêtements, pourrait-il pousser ses exigences jusqu’à l’extrême limite ?
J’ai répondu à M. Proudhon… ou plutôt M. Proudhon s’était répondu à lui-même par un autre exemple, d’où il résulte que dans certains cas extrêmes, la rémunération de la vente, ou même celle du travail, serait tout aussi abominable que celle du prêt. Il en serait ainsi de l’homme qui, pour tendre la main à son frère près d’être englouti dans les flots, exigerait le plus grand prix qu’on puisse obtenir dans ces circonstances.
Ainsi cet argument de M. Proudhon n’attaque pas seulement l’intérêt, mais toute rémunération : moyen certain d’établir la gratuité universelle.
De plus, il ouvre la porte à toutes ces théories sentimentalistes (que M. Proudhon combat avec tant de force et de raison) qui veulent à toute force faire reposer les affaires de ce monde sur le principe de l’abnégation.
Enfin, comme le Protée de la Fable, dont on disait : « Pour le vaincre, il faut l’épuiser, » M. Proudhon, chassé de la contradiction à la compensation, de la compensation à la privation, de la privation à la transformation, de la transformation à l’abnégation, a quitté tout à coup la controverse et est venu à l’exécution.
Le moyen d’exécution qu’il propose pour réaliser la gratuité du crédit, c’est le papier-monnaie. — Je ne l’ai pas nommé, dit-il. — C’est vrai. Mais qu’est-ce donc qu’une banque nationale prêtant à qui en désire, et gratuitement, de prétendus capitaux sous forme de billets ?
Évidemment nous retrouvons ici cette erreur funeste et si invétérée qui fait confondre l’instrument de l’échange avec les objets échangés, erreur dont M. Proudhon, dans ses précédentes lettres, laissait apercevoir le germe, quand il disait : Ce ne sont pas les choses qui font la richesse, mais la circulation. — Et encore, quand il calculait que l’intérêt en France était à 160 pour 100, parce qu’il comparait toutes les rentes payées au capital en numéraire.
J’avais posé à M. Proudhon ce dilemme : ou votre Banque nationale prêtera indistinctement des billets à tous ceux qui se présenteront ; et en ce cas, la circulation en sera tellement saturée, qu’ils seront dépréciés, — ou bien elle ne les livrera qu’avec discernement ; et alors votre but n’est pas atteint.
Il est clair, en effet, que si chacun peut aller se pourvoir gratis de monnaie fictive à la Banque, et si cette monnaie est reçue à sa valeur normale, les émissions n’auront pas de limite et s’élèveront à plus de cinquante milliards, dès la première année. L’effet sera le même que si l’or et l’argent devenaient aussi communs que la boue. — L’illusion qui consiste à croire que la richesse se multiplie, ou même que la circulation s’active à mesure qu’on accroît l’instrument de l’échange, ne devrait pas entrer dans la tête d’un publiciste qui, de nos jours, discute des questions économiques. Nous savons tous, par notre propre expérience, que le numéraire, non plus que les billets de banque, ne portant pas intérêt, chacun n’en garde dans son coffre ou son portefeuille que le moins possible ; et par conséquent la quantité que le public en demande est limitée. On ne peut l’accroître sans la déprécier, et tout ce qui résulte de cet accroissement, c’est que, pour chaque échange, il faut deux écus ou deux billets au lieu d’un.
Ce qui se passe à la Banque de France est une leçon qui ne peut être perdue. Elle a émis depuis deux ans beaucoup de billets. Mais le nombre des transactions ne s’en est pas accru. Il dépend d’autres causes, et ces causes ont agi dans le sens d’une diminution d’affaires. Aussi, qu’est-il arrivé ? C’est qu’à mesure que la Banque émettait des billets, le numéraire affluait dans ses caves, de telle sorte qu’un instrument d’échange s’est substitué à un autre. Voilà tout.
Je vais plus loin, il se peut que les transactions augmentent sans que l’instrument des échanges s’accroisse. Il se fait plus d’affaires en Angleterre qu’en France, et cependant la somme réunie des billets et des espèces y est moindre. Pourquoi ? Parce que les Anglais, par l’intermédiaire des banquiers, font beaucoup de compensations, de virements de parties.
Dans les idées de M. Proudhon, sa banque a pour objet de réduire les payements à des virements de parties. C’est précisément ce que font les écus, d’une manière, à la vérité, assez dispendieuse. Les billets de banque sont un appareil qui arrive au même résultat à moins de frais ; et le clearing house des Anglais est moins coûteux encore. Mais de quelque manière qu’on s’y prenne pour compenser les paiements, qu’ont de commun ces procédés divers, plus ou moins perfectionnés, avec le principe de l’intérêt ? Y en a-t-il un seul qui fasse que le travail antérieur ne doive pas être rémunéré et que le temps n’ait pas son prix ?
Gorger la circulation de billets n’est donc le moyen ni d’accroître la richesse, ni de détruire la rente. De plus, livrer des billets à tout venant, c’est mettre la banque en faillite avant six mois.
Aussi M. Proudhon fuit le premier membre de mon dilemme et se réfugie dans le second.
« Que la Banque fasse son métier avec prudence et sévérité, dit-il, comme elle a fait jusqu’à présent. Cela ne me regarde pas. »
Cela ne vous regarde pas ! quoi ! vous imaginez une banque nouvelle qui doit réaliser le crédit gratuit pour tout le monde, et quand je vous demande si elle prêtera à tout le monde, vous me répondez, pour échapper à la conclusion dont je vous menace, cela ne me regarde pas !
Mais tout en disant que cela ne vous regarde pas, vous ajoutez « que la nouvelle banque fera son métier avec prudence et sévérité. » Cela ne signifie rien, ou cela veut dire qu’elle prêtera à ceux qui peuvent répondre du remboursement.
Mais alors que devient l’Égalité qui est votre idole ? et ne voyez-vous pas qu’au lieu de rendre les hommes égaux devant le crédit, vous constituez une inégalité plus choquante que celle que vous prétendez détruire ?
En effet, dans votre système, les riches emprunteront gratis, et les pauvres ne pourront emprunter à aucun prix.
Quand un riche se présentera à la banque, on lui dira : Vous êtes solvable, voilà des capitaux, nous vous les prêtons pour rien.
Mais qu’un ouvrier ose se montrer. On lui dira : Où sont vos garanties, vos terres, vos maisons, vos marchandises ? — Je n’ai que mes bras et ma probité. — Cela ne nous rassure pas, nous devons agir avec prudence et sévérité, nous ne pouvons vous prêter gratis. — Eh bien : prêtez-nous, à mes compagnons et à moi, aux taux de 4, 5 et 6 pour cent, ce sera une prime d’assurance dont le produit couvrira vos risques. — Y pensez-vous ? notre loi est de prêter gratis ou de ne prêter pas du tout. Nous sommes trop bons philanthropes pour rien faire payer à qui que ce soit, pas plus au pauvre qu’au riche. Voilà pourquoi le riche obtient chez nous du crédit gratuit, et pourquoi vous n’en aurez ni en payant ni sans payer.
Pour nous faire comprendre les merveilles de son invention, M. Proudhon la soumet à une épreuve décisive, celle de la comptabilité commerciale.
Il compare deux systèmes.
Dans l’un, le travailleur emprunte gratis (nous venons de voir comment), puis, en vertu de l’axiome, tout travail laisse un excédant, il réalise 10 pour cent de profit.
Dans l’autre, le travailleur emprunte à 10 pour cent. L’axiome économique ne reparaît pas, et il s’ensuit une perte.
Appliquant la comptabilité à ces hypothèses, M. Proudhon nous prouve, par des chiffres, que le travailleur est beaucoup plus heureux dans un cas que dans l’autre.
Je n’avais pas besoin de la partie double pour en être convaincu.
Mais je fais observer à M. Proudhon que ses comptes décident la question. Je n’ai jamais mis en doute qu’il ne fût très-agréable d’avoir, sans rien payer, l’usage de maisons bien meublées, de terres bien préparées, d’outils et de machines bien puissantes. Il serait plus agréable encore que les alouettes nous tombassent toutes rôties dans la bouche, et quand M. Proudhon voudra, je le lui prouverai par doit et avoir. — La question est précisément de savoir si tous ces miracles sont possibles.
Je me suis donc permis de faire observer à M. Proudhon que je ne contestais pas l’exactitude de sa comptabilité, mais bien la réalité des données sur lesquelles elle repose.
Sa réponse est curieuse :
« Telle est l’essence de la comptabilité qu’elle ne dépend pas de la certitude de ses données. Elle ne souffre pas de données fausses. Elle est par elle-même, et malgré la volonté du comptable, la démonstration de la vérité ou de la fausseté de ses propres données. C’est en vertu de cette propriété que les livres du négociant font foi en justice. »
J’en demande pardon à M. Proudhon, mais je suis forcé de lui dire que la justice ne se borne pas, comme la Cour des comptes, à examiner si la tenue des livres est régulière et si les comptes se balancent. Elle recherche de plus si on n’y a pas introduit des données fausses.
Mais, vraiment, M. Proudhon a une imagination sans pareille pour inventer des moyens commodes de s’enrichir, et, à sa place, je me hâterais d’abandonner le crédit gratuit, comme un appareil suranné, compliqué et contestable. Il est distancé, et de bien loin, par la comptabilité, qui est par elle-même la démonstration de la vérité de ses propres données.
Ayez deux sous dans la poche, c’est tout ce qu’il faut. Achetez une feuille de papier. Écrivez dessus un compte simulé, le plus californien que vous puissiez trouver dans votre cervelle. Supposez, par exemple, que vous achetez à bon marché et à crédit un navire, que vous le chargez de sable et de galets ramassés sur le rivage, que vous expédiez le tout en Angleterre, qu’on vous donne en échange un poids égal en or, argent, dentelles, pierres précieuses, cochenille, vanille, parfums, etc. ; que de retour en France les acheteurs se disputent votre opulente cargaison. Mettez à tout cela des chiffres. Dressez votre comptabilité en parties doubles. Ayez soin qu’elle soit exacte, — et vous voilà à même de dire de Crésus ce que M. Rothschild disait d’Aguado : « Il a laissé trente millions, je le croyais plus à l’aise. » — Car votre comptabilité, si elle est conforme aux lois de M. Juvigny, impliquera la vérité de vos données.
Il n’est encore parvenu à ma connaissance aucun moyen de s’enrichir plus commode que celui-là ; si ce n’est pourtant celui du fils d’Éole. Je le recommande à M. Proudhon.
« Il s’avisa d’aller dans tous les carrefours, où il criait sans cesse, d’une voix rauque : Peuples de Bétique, voulez-vous être riches ? Imaginez-vous que je le suis beaucoup et que vous l’êtes beaucoup aussi. Mettez-vous tous les matins dans l’esprit que votre fortune a doublé pendant la nuit. Levez-vous ensuite, et si vous avez des créanciers, allez les payer avec ce que vous aurez imaginé, et dites-leur d’imaginer à leur tour [3]. »
Mais je laisse là M. Proudhon, et, en terminant cette polémique, je m’adresse aux socialistes, et les adjure d’examiner impartialement, non au point de vue des capitalistes, mais dans l’intérêt des travailleurs, les questions suivantes :
La rémunération légitime d’un homme doit-elle être identique, soit qu’il consacre à la production sa journée actuelle, soit qu’il y consacre, en outre, des instruments, fruits d’un travail antérieur ?
Personne n’osera le soutenir. Il y a là deux éléments de rémunération, et qui peut s’en plaindre ? Sera-ce l’acheteur du produit ? Mais qui n’aime mieux payer 3 fr. par jour à un menuisier pourvu d’une scie, que 2 f. 50 c. au même menuisier, faisant des planches avec ses dix doigts ?
Ici les deux éléments de travail et de rémunération sont dans les mêmes mains. Mais s’ils sont séparés et s’associent, n’est-il pas juste, utile, inévitable que le produit se partage entre eux selon certaines proportions ?
Quand c’est le capitaliste qui fait l’entreprise à ses risques, la rémunération du travail se fixe souvent et se nomme salaire. Quand le travailleur entreprend et court les chances, c’est la rémunération du capital qui se fixe, et elle se nomme intérêt [4].
On peut croire à des arrangements plus perfectionnés, à une association de risques et de récompenses plus étroite. C’était naguère la voie qu’explorait le socialisme. Cette fixité de l’un des deux termes lui paraissait rétrograde. Je pourrais démontrer qu’elle est un progrès ; mais non est hic locus.
Voici une école — et elle se dit le socialisme tout entier, — qui va bien plus loin. Elle affirme que toute récompense doit être déniée à l’un des éléments de la production, au capital. Et cette école a écrit sur son drapeau : Crédit gratuit à la place de son ancienne devise : La propriété, c’est le vol !
Socialistes, j’en appelle à votre bonne foi, n’est-ce pas un même sens sous d’autres mots ?
Il n’est pas possible de contester, en principe, la justice et l’utilité d’une répartition entre le capital et le travail.
Reste à savoir quelle est la loi de cette répartition.
Et vous ne tarderez pas à la trouver dans cette formule : plus l’un des deux éléments abonde relativement à l’autre, plus sa part proportionnelle se réduit, et réciproquement.
Et s’il en est ainsi, la propagande du crédit gratuit est une calamité pour la classe ouvrière.
Car, de même que les capitalistes se feraient tort à eux-mêmes si, après avoir proclamé l’illégitimité du salaire, ils réduisaient les travailleurs à mourir ou à s’expatrier ; de même, les travailleurs se suicident quand, après avoir proclamé l’illégitimité de l’intérêt, ils forcent le capital à disparaître.
Si cette doctrine funeste se répand, si la voix du suffrage universel peut faire supposer qu’elle ne tardera pas à invoquer le secours de la loi, c’est-à-dire de la force organisée, n’est-il pas évident que le capital effrayé, menacé de perdre son droit à toute récompense, sera contraint de fuir, de se cacher, de se dissiper ? Il y aura moins d’entreprises de tout genre pour un nombre de travailleurs resté le même. Le résultat peut s’exprimer en deux mots : hausse de l’intérêt et baisse des salaires.
Il y a des pessimistes qui affirment que c’est là ce que veulent les socialistes : que l’ouvrier souffre ; que l’ordre ne puisse renaître ; que le pays soit toujours sur le bord d’un abîme. — S’il existe des êtres assez pervers pour former de tels vœux, que la société les flétrisse et que Dieu les juge !
Quant à moi, je n’ai pas à me prononcer sur des intentions auxquelles d’ailleurs je ne puis croire.
Mais je dis : La gratuité du crédit, c’est l’absurdité scientifique, l’antagonisme des intérêts, la haine des classes, la barbarie.
La liberté du crédit, c’est l’harmonie sociale, c’est le droit, c’est le respect de l’indépendance et de la dignité humaine, c’est la foi dans le progrès et les destinées de la société.
Frédéric Bastiat.
FN:Quelques personnes ont trouvé excessive la patience de Bastiat pendant le cours de cette discussion. Ce paragraphe et le précédent motivent parfaitement son attitude. Il attachait un grand prix à faire pénétrer, parmi les ouvriers, quelques vérités salutaires, à l’aide même de la Voix du Peuple. Ce résultat, il fut encouragé bientôt à s’applaudir de l’avoir poursuivi. Un matin, peu de jours avant la clôture du débat, il reçut la visite de trois ouvriers, délégués d’un certain nombre de leurs camarades qui s’étaient rangés sous la bannière du Crédit gratuit. Ces ouvriers venaient le remercier de ses bonnes intentions, de ses efforts pour les éclairer sur une question importante. Ils n’étaient point convertis à la légitimité et à l’utilité de l’intérêt ; mais leur foi dans le principe contraire était fort ébranlée et ne tenait plus qu’à leurs vives sympathies pour M. Proudhon. « Il nous veut beaucoup de bien, M. Proudhon, disaient-ils, et nous lui devons une grande reconnaissance. C’est dommage qu’il aille souvent chercher des mots et des phrases si difficiles à comprendre. » Finalement, ils émirent le vœu que MM. Bastiat et Proudhon pussent se mettre d’accord, et se déclarèrent prêts à accepter les yeux fermés une solution quelconque, si elle était proposée de concert par l’un et l’autre. (Note de l’éditeur.)
FN:Enfant, in fans, non parlant.
FN:CXLIIe lettre persane.
FN:Voir le chap. Salaires. — Harmonies écon., tome VI. (Note de l’éditeur.)
Harmonies économiques (1850, 1851) ↩
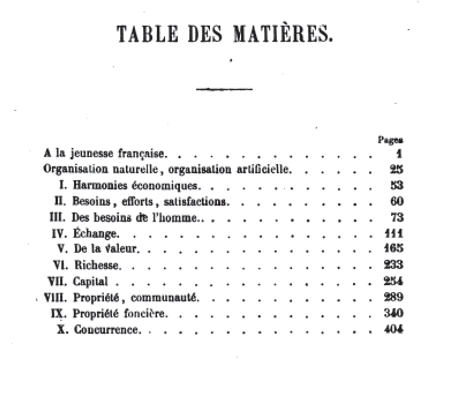
ToC of 1850 ed. 2nd intro chap. “Org. naturelle, org. artificielle”
Foreword to the Second Enlarged Edition by Prosper Paillottet and Roger de Fontenay (La Société des amis de Bastiat) (1851) [to be trans.]↩
[Translate pp. v-xi of 2nd edition]
AVERTISSEMENT.
Peu de temps après la mort si regrettable de F. Bastiat, quelques-uns de ses amis, autant pour honorer sa mémoire que dans la pensée de propager sa doctrine, résolurent d'acquérir la propriété littéraire de ses œuvres complètes, et de mettre le pris de ses excellents ouvrages à la portée de tout le monde.
Une souscription intime fut rapidement couverte; les héritiers se prêtèrent avec une grâce parfaite à cet arrangement; et l'on convint de commencer cette publication à bon marché par la réimpression des Harmonies Économiques, dont la première édition venait d'être épuisée en un an.
Bastiat, à ses derniers moments, nous avait confié à tous deux les manuscrits destinés, à la continuation des Harmonies, et le soin d'en extraire ce qui. nous paraîtrait utile. Nous devons compte au public de notre' travail':
Cette nouvelle édition est augmentée de plus de moitié par les nombreux et importants fragments que nous avons trouvés. Ils comprennent, — outre trois notes ajoutées à chacun des chapitres Échange, Valeur et Richesse, — tous les chapitres à partir du XIme.
Nous devons le dire, dans la pensée de Bastiat aucun de ces morceaux n'avait encore sa forme ni quelquefois sa place définitive; il ne les regardait que comme des ébauches. Le lecteur en jugera. Quant à nous, la plupart de ces prétendues esquisses nous ont paru pleines de largeur et de simplicité puissante. Dans d'autres fragments d'allure un peu plus vagabonde, on voit l'homme qui laisse causer sa pensée. Quelques-uns enfin ne sont que des jalons, des noies rapides, des phrases rompues ; en rassemblant celles qui se rattachaient visiblement à son sujet, nous avouons que nous nous sommes peu préoccupés de la question de forme, très-secondaire à nos yeux ; nous n'avons pensé qu'à conserver dans leur enveloppe élégante ou rudimentaire tous les germes de vérités.
Nous ne pouvions, sur un tableau si précieux, essayer des restaurations qui eussent fait tache. Nous avons laissé les lacunes; sauf deux ou trois indications qu'il nous a paru nécessaire de développer un peu, nos notes se bornent à des renvois aux autres ouvrages de l'auteur; et partout nous les avons signées de nos initiales pour les distinguer de celles de Bastiat.
On doit s'attendre à rencontrer quelques répétitions. D'abord Bastiat s'y laissait aller assez volontiers (bis repetita docent, dit-il quelque part) ; et d'ailleurs il en eût fait disparaître une partie s'il eût pu, suivant son intention, remanier entièrement son œuvre. Voici une note curieuse sur le plan qu'il comptait définitivement adopter :
« J'avais d'abord pensé à commencer par l'exposition des Harmonies Économiques, et par conséquent à ne traiter que des sujets purement économiques: Valeur, Propriété, Richesse, Concurrence, Salaire, Population, Monnaie , Crédit, etc. — Plus tard, si j'en avais eu le temps et la force, j'aurais appelé l'attention du lecteur sur un sujet plus vaste: les Harmonies sociales. C'est là que j'aurais parlé de la Constitution humaine, du Moteur social, de la Responsabilité, de la Solidarité, etc.. L'œuvre ainsi conçue était commencée, quand je me suis aperçu qu'il était mieux de fondre ensemble que de séparer ces deux ordres de considérations. Mais alors la logique voulait que l'étude de l'homme précédât les recherches économiques. Il n'était plus temps ; puissé-je réparer ce défaut dans une autre édition! ... »
L'auteur seul pouvait remanier son livre. Nous avons suivi tout simplement l'ordre indiqué dans une table des chapitres écrite de la main de Bastiat, qu'il nous avait communiquée avant son départ pour l'Italie, et qu'on trouvera au commencement du chapitre XI, (page 335).
L'ouvrage ainsi divisé eût formé trois volumes au moins.
Il est à remarquer que, dans ses manuscrits, Bastiat a laissé peu de choses sur les questions économiques de détail. — La partie nouvelle des Harmonies présente surtout des vues d'ensemble, de précieux morceaux de philosophie sociale, comme Responsabilité et Solidarité, Moteur social. Services privés, Services publics, etc. On dirait que, pressé par le temps, il s'est hâté de jalonner de haut les contours et les grandes divisions du champ de la science, bien assuré qu'avec ces points de repère les géomètres sauraient mesurer les détails et fouiller les recoins oubliés.
La vie et les écrits de Bastiat méritent d'occuper et occuperont bientôt une haute intelligence, une plume exercée. En attendant, qu'il nous soit permis, comme manifestation de nos sentiments pour un ami qui n'est plus, de dire un mot de sa carrière scientifique. — Elle a été bien courte (de 1845 à 1850). Mais du jour où la question du libre échange l'a fait sortir du fond de ses Landes, une activité dévorante s'est emparée de cette nature studieuse et modeste; sa plume ne s'est plus reposée; il a jeté ses vérités à pleines mains et à tout venant, comme s'il eût pressenti qu'il n'aurait pas le temps de dépenser un trésor amassé par vingt ans de travaux obscurs.
Les deux charmants volumes des Sophismes Économiques, l'ouvrage sur la Ligue anglaise, d'importants travaux dans le Journal des Économistes et ailleurs, environ cent articles dans le Journal du Libre Échange, qu'il dirigeait, des excursions et des discours dans les grandes villes de commerce, une volumineuse correspondance, des plans de propagande et d'association, un cours gratuit d'Économie Politique commencé dans la salle Taranne, etc., tout cela n'est qu'une partie du vaste travail qu'accusent ses ébauches manuscrites. Après la révolution de février, qui l'envoya à la chambre, son talent grandit avec la sphère où il se développait, et les dangers qu'it avait à combattre.
Ses petits livres sont des chefs-d'œuvre; tour à tour, ou tout à la fois Économiste précis, philosophe profond , politique à larges vues, la lumière semble jaillir de la question qu'il touche, et là où il a passé il n'y a plus rien à faire. Sa manière plus ample a bien toujours la bonhomie rieuse (cheerful bonhommie), la boutade de raison imprévue (witticism/joke of unexpected reason??), le goût de terroir méridional de Montaigne (the tastes of the southern lands of Montaigne); mais il ne joue plus avec la forme comme dans les Sophismes, il ne s'amuse plus à donner au bon sens les facettes du paradoxe ; il va simplement au but; c'est l'homme qui a pris son rang par la force des choses, il sait ce qu'il vaut, il est lui-même. Bastiat, en même temps, jetait aux journaux quelques vives répliques, et allait combattre Proudhon jusque dans les colonnes de la Voix du peuple.
A la chambre, où son attitude d'inflexible raison était honorée de tous mais isolée, il parla peu; mais on trouve dans ses manuscrits des notes et des fragments de discours sur la plupart des importantes questions qui s'agitaient alors. La faiblesse de son organe, déjà gravement affecté, l'éloignait de la tribune. Il n'y parut que deux ou trois fois, et toujours d'une manière remarquable. Au reste, l'atmosphère tumultueuse de la polique (sic) ne lui convenait pas. Sa nature nerveuse et impatiente du faux devait y être étrangement torturée.... Il se réfugia dans une œuvre d'avenir en écrivant les Harmonies.
Le lecteur tient le livre, il serait ridicule de l'analyser ici. Signalons seulement cette vive clarté, jetée dès le début sur toute la science par la distinction radicale entre l'utilité et la valeur. De là résulte l'accord de la Propriété et de la Communauté, et l'accroissement continu du fonds commun et gratuit, qui se développe comme la surface d'un cercle immense, — pendant que la propriété, pionnier infatigable, occupe tout le périmètre extérieur, qu'elle pousse sans cesse en avant par ses conquêtes.
L'école anglaise, partie d'un point de vue trop matériel, avait prêté le flanc au socialisme. Il était temps de se dégager de la solidarité dangereuse d'une partie de ses doctrines. Bastiat l'a compris ; comme philosophie, il se rattache aux physiocrates. La richesse pour lui n'est qu'une forme, un accident; la réalité, le but, il les voit, comme Quesnay, dans l'utilité, le bien-être, disons mieux, dans le développement intellectuel et moral de l'homme. Plus explicite encore dans ses manuscrits, il dit que la science doit exposer « comment se crée, se distribue, se consomme (expression éminemment juste) — le bien-être. » Remarquez qu'il ne dit pas, comme l'école anglaise, la richesse et la valeur: car, au contraire, « la valeur, c'est le mal, le signe de l'obstacle. La fin de l'activité humaine est d'anéantir sans cesse la valeur au profit de l'utilité et du bien-être pour chaque résultat donné. » Point de vue dont l'importance originelle n'a pas été peut-être assez sentie : car, si vous posez la valeur comme fin de l'évolution, pour être conséquents, il faut que vous établissiez la prédominance de l'intérêt du producteur; et c'est là le triste écueil où sont venus, à propos des machines, de la concurrence, de la liberté des échanges, échouer Sismondi et Proudhon. —Si, au contraire, la valeur n'est que l'accident, si le but c'est l'utilité, la satisfaction; la contradiction disparaît, et vous n'avez devant vous que l'intérêt de l'homme en tant que consommateur, l'intérêt de tous, l'intérêt éminemment social.
Mais la pensée supérieure qui a conduit Bastiat, le flambeau qui lui a permis de porter jusque dans les questions de détail cette lucidité, cette précision mathématique dont il aie secret, c'est qu'avant toute chose il s'est attaché au principe de Justice ; c'est qu'il a affirmé l'identité absolue de ces trois mots vrai, juste et utile. Quand l'école qui prétend partir du fait dit : « la Propriété est nécessaire à l'ordre social, ses conséquences sont admirables, mais en principe c'est un privilége, un monopole, une usurpation, etc. ; » elle tombe dans une contradiction flagrante. Car — ou la propriété est une base nécessaire de la société, une loi de Dieu, et alors elle est nécessairement juste et logique; reste à la mieux comprendre ; — ou la propriété est en effet un privilége, une injustice, et alors ce n'est plus qu'une forme contingente, conventionnelle, imparfaite, que l'homme peut et doit changer.
Bastiat, lui, s'est posé a priori cet axiome, ou, si l'on veut, cet acte de foi : Toutes les lois naturelles, toutes les vérités, de quelque ordre qu'elles soient, sont nécessairement harmoniques; toutes les connaissances auxquelles il est donné à l'homme d'atteindre sont, selon la belle image de Proudhon, les projections d'une même vérité idéale, inaccessible, sur des plans plus ou moins fuyants, plus ou moins rapprochés de nous. « Ainsi, a dit Bastiat, les sciences, sans sortir de leurs sphères, se vérifient l'une par l'autre: l'utile n'est que l'aspect pratique du juste.» El quand la science semblera conduite à une dissidence quelconque entre le juste et l'utile, c'est qu'elle se sera trompée; il faut qu'elle revoie ses prémisses et les change.
Les hommes forts disent les grandes choses naturellement; cette simplicité est le caractère propre du génie, et il ne faut pas que le lecteur se méprenne sur la forme modeste que Bastiat donne à sa pensée. L'idée première de l'harmonie universelle est immense; c'est le terrain commun où se donneront la main tant d'écoles antagoniques qui toutes s'attirent par quelque vérité et s'excluent par quelque erreur. Quant à l'application qu'il en a faite aux théories de la valeur, de la propriété, etc., il se peut qu'on essaye encore de la discuter; il le faut même pour qu'elle fasse son chemin plus rapidement. Mais nous avons pleine confiance dans son avenir.
Bastiat ne devait pas achever son œuvre. Sa santé, déjà profondément altérée, déclinait rapidement sans qu'il parût s'en préoccuper, sans qu'il voulût quitter son poste de combat. Pourtant, à certaines phrases empreintes de tristes pressentiments, et plus encore peut-être à l'entassement d'idées qu'on remarque dans les chapitres IX et X de son livre, il est facile de voir qu'il ne se décida à l'écrire qu'au moment où il comprit que ses jours étaient comptés. A la fin de l'été de 1850 il ne pouvait déjà plus parler. Les médecins l'envoyèrent en Italie...—Jusqu'au dernier moment sa science chérie fut sa grande préoccupation: l'idée Chrétienne et l'idée Économique pour lui se confondaient en une mèine aspiration, en une même foi. Maître de son intelligence jusqu'au bout, son dernier mot fut l’Eurèka d'Archimède: La vérité, disait-il de cette voix qui était à peine un mouvement des lèvres, la vérité, je la vois, je ne puis plus la dire....
Il faut longtemps pour classer un homme, et Bastiat a disparu avant qu'on l'ait mis à sa vraie place. Peut-être l'éclat même de ses débuts a-t-il contribué à faire autour de son nom une sorte de malentendu qui dure encore:
La vivacité, la fraîcheur de son talent semblait donner un démenti au sérieux de ses études, comme sa place à la tête d'une ligue brillante et remuante contrastait avec ses goûts de solitude et sa constante passion pour l'obscurité. — Son esprit généralisateur a été un moment englouti dans une question spéciale ; pour bien des publicistes, Bastiat est le synonyme de Libre Échange. Certes, la liberté est une grande chose, surtout quand on la fait, comme Cobden, passer du principe au fait ; mais Bastiat a d'autres titres encore, et dans sa vie comme dans son œuvre le Libre Échange n'est qu'un chapitre de détail. — Que de gens superficiels l'ont pris, à la forme de ses premiers essais, pour un pamphlétaire mordant de l'école de Paul-Louis, un polémiste tapageur et paradoxal; lui, nature modeste et bonne, dont la malice est toujours caressante, dont l'originalité est le pur bon sens! — Que d'honnêtes conservateurs se figurent comme un révolutionnaire et un utopiste l'homme qui a frappé au cœur le principe même des révolutions et des utopies! — Et ne trouverait-on pas encore quelques personnes qui regardent, ou affectent de regarder comme un habile vulgarisateur, cet économiste éminent qu'un seul volume (nous devrions presque dire un essai) a mis au niveau des plus grands noms de la science?
Ces hésitations de l'opinion n'ont rien qui nous étonne. Quand un homme n'a jamais exploité une passion, ni flatté une coterie; quand, insoucieux de l'effet et content d'être utile, il a toujours accepté le poste qu'on lui assignait, toujours couru sans condition au danger du moment ; quand, au lieu de se dire orgueilleusement : Les intelligences d'élite me devineront,— il veut, au contraire, que tous le comprennent, et met sa science au niveau du sol, il est tout simple qu'on le prenne au mot, qu'on le mesure à la taille qu'il se fait, qu'on le laisse un peu de côté pendant qu'il s'efface. L'abnégation isole, et les astres qui gravitent sur eux-mêmes ont seuls des planètes et des satellites autour d'eux.
Non, on ne passe pas pour grand homme quand on est si bon homme. Mais aussi, il faut en convenir, cette haute bonté, cette exquise droiture de cœur est comme le riche terrain où germe naturellement la vérité. De la justesse de conscience morale, qui fait l'honnête homme, à cette pureté de conscience intellectuelle, qui fait le penseur, il n'y a qu'une nuance insensible, et l'on peut dire qu'une remarquable intelligence, quand elle se joint à un admirable cœur, devient du génie. Bastiat était une de ces organisations heureuses à qui le vrai devait arriver par affinité naturelle, comme l'oxygène aux poumons; le mal, le désaccord, l'antagonisme, le doute répugnaient à son tempérament; il lui fallait l'harmonie, il la lui fallait en tout et partout comme à Dieu. Et voilà pourquoi il s'est acharné à presser le dualisme des problèmes sociaux jusqu'à ce qu'il l'eût réduit à l'unité. Il n'a eu la vérité que parce qu'il l'a voulue de toute son âme.
Partout, dans les Harmonies, vous retrouverez ce double caractère d'aspiration et d'étude positive, de Foi religieuse et de rigueur scientifique. On sent à chaque page palpiter le cœur qui a soif de l'Ordre et veut voir le Bien ; mais tout à côté veille la raison qui se défie ; et la conscience de l'analyste ne prendra jamais un sentiment pour une preuve. C'est quelque chose de remarquable que cette nature expansive et sympathique, sans cesse contenue par le frein d'une logique inflexible. Il en résulte, dans toute l'œuvre, une sorte de sérénité communicative; c'est une Science consolante comme la Religion, ou une Religion positive comme la Science; et l'on ne pose pas le livre sans se sentir plus confiant et plus fort.
J. de Maistre a dit un joli mot qu'on croirait fait pour Bastiat : « Il y a des vérités qu'un homme ne peut trouver qu'avec l'esprit de son cœur, mente cordis sui. »
Prosper Paillottet. Roger de Fontenay.
À la jeunesse française↩
Amour de l’étude, besoin de croyances, esprit dégagé de préventions invétérées, cœur libre de haine, zèle de propagande, ardentes sympathies, désintéressement, dévouement, bonne foi, enthousiasme de tout ce qui est bon, beau, simple, grand, honnête, religieux, tels sont les précieux attributs de la jeunesse. C’est pourquoi je lui dédie ce livre. C’est une semence qui n’a pas en elle le principe de vie, si elle ne germe pas sur le sol généreux auquel je la confie.
J’aurais voulu vous offrir un tableau, je ne vous livre qu’une ébauche ; pardonnez-moi : qui peut achever une œuvre de quelque importance en ce temps-ci ? Voici l’esquisse. En la voyant, puisse l’un d’entre vous s’écrier comme le grand artiste : Anch’io son pittore ! et, saisissant le pinceau, jeter sur cette toile informe la couleur et la chair, l’ombre et la lumière, le sentiment et la vie.
Jeunes gens, vous trouverez le titre de ce livre bien ambitieux. Harmonies économiques ! Aurais-je eu la prétention de révéler le plan de la Providence dans l’ordre social, et le mécanisme de toutes les forces dont elle a pourvu l’humanité pour la réalisation du progrès ?
Non, certes ; mais je voudrais vous mettre sur la voie de cette vérité : Tous les intérêts légitimes sont harmoniques. C’est l’idée dominante de cet écrit, et il est impossible d’en méconnaitre l’importance.
Il a pu être de mode, pendant un temps, de rire de ce qu’on appelle le problème social ; et, il faut le dire, quelques-unes des solutions proposées ne justifiaient que trop cette hilarité railleuse. Mais, quant au problème lui-même, il n’a certes rien de risible ; c’est l’ombre de Banquo au banquet de Macbeth, seulement ce n’est pas une ombre muette, et, d’une voix formidable, elle crie à la société épouvantée : Une solution ou la mort !
Or cette solution, vous le comprendrez aisément, doit être toute différente selon que les intérêts sont naturellement harmoniques ou antagoniques.
Dans le premier cas, il faut la demander à la Liberté ; dans le second, à la Contrainte. Dans l’un, il suffit de ne pas contrarier ; dans l’autre, il faut nécessairement contrarier.
Mais la Liberté n’a qu’une forme. Quand on est bien convaincu que chacune des molécules qui composent un liquide porte en elle-même la force d’où résulte le niveau général, on en conclut qu’il n’y a pas de moyen plus simple et plus sûr pour obtenir ce niveau que de ne pas s’en mêler. Tous ceux donc qui adopteront ce point de départ : Les intérêts sont harmoniques, seront aussi d’accord sur la solution pratique du problème social : s’abstenir de contrarier et de déplacer les intérêts.
La Contrainte peut se manifester, au contraire, par des formes et selon des vues en nombre infini. Les écoles qui partent de cette donnée : Les intérêts sont antagoniques, n’ont donc encore rien fait pour la solution du problème, si ce n’est qu’elles ont exclu la Liberté. Il leur reste encore à c hercher, parmi les formes infinies de la Contrainte, quelle est la bonne, si tant est qu’une le soit. Et puis, pour dernière difficulté, il leur restera à faire accepter universellement par des hommes, par des agents libres, cette forme préférée de la Contrainte.
Mais, dans cette hypothèse, si les intérêts humains sont poussés par leur nature vers un choc fatal, si ce choc ne peut être évité que par l’invention contingente d’un ordre social artificiel, le sort de l’Humanité est bien chanceux, et l’on se demande avec effroi :
1° Se rencontrera-t-il un homme qui trouve une forme satisfaisante de la Contrainte ?
2° Cet homme ramènera-t-il à son idée les écoles innombrables qui auront conçu des formes différentes ?
3° L’Humanité se laissera-t-elle plier à cette forme, laquelle, selon l’hypothèse, contrariera tous les intérêts individuels ?
4° En admettant que l’Humanité se laisse affubler de ce vêtement, qu’arrivera-t-il, si un nouvel inventeur se présente avec un vêtement plus perfectionné ? Devra-t-elle persévérer dans une mauvaise organisation, la sachant mauvaise ; ou se résoudre à changer tous les matins d’organisation, selon les caprices de la mode et la fécondité des inventeurs ?
5° Tous les inventeurs, dont le plan aura été rejeté, ne s’uniront-ils pas contre le plan préféré, avec d’autant plus de chances de troubler la société que ce plan, par sa nature et son but, froisse tous les intérêts ?
6° Et, en définitive, y a-t-il une force humaine capable de vaincre un antagonisme qu’on suppose être l’essence même des forces humaines ?
Je pourrais multiplier indéfiniment ces questions et proposer, par exemple, cette difficulté :
Si l’intérêt individuel est opposé à l’intérêt général, où placerez-vous le principe d’action de la Contrainte ? Où sera le point d’appui ? Sera-ce en dehors de l’humanité ? Il le faudrait pour échapper aux conséquences de votre loi. Car, si vous confiez l’arbitraire à des hommes, prouvez donc que ces hommes sont pétris d’un autre limon que nous ; qu’ils ne seront pas mus aussi par le fatal principe de l’intérêt, et que, placés dans une situation qui exclut l’idée de tout frein, de toute résistance efficace, leur esprit sera exempt d’erreurs, leurs mains de rapacité et leur cœur de convoitise.
Ce qui sépare radicalement les diverses écoles socialistes (j’entends ici celles qui cherchent dans une organisation artificielle la solution du problème social) de l’École économiste, ce n’est pas telle ou telle vue de détail, telle ou telle combinaison gouvernementale ; c’est le point de départ, c’est cette question préliminaire et dominante : Les intérêts humains, laissés à eux-mêmes, sont-ils harmoniques ou antagoniques ?
Il est clair que les socialistes n’ont pu se mettre en quête d’une organisation artificielle que parce qu’ils ont jugé l’organisation naturelle mauvaise ou insuffisante ; et ils n’ont jugé celle-ci insuffisante et mauvaise que parce qu’ils ont cru voir dans les intérêts un antagonisme radical, car sans cela ils n’auraient pas eu recours à la Contrainte. Il n’est pas nécessaire de contraindre à l’harmonie ce qui est harmonique de soi.
Aussi ils ont vu l’antagonisme partout :
Entre le propriétaire et le prolétaire,
Entre le capital et le travail,
Entre le peuple et la bourgeoisie,
Entre l’agriculture et la fabrique,
Entre le campagnard et le citadin,
Entre le regnicole et l’étranger,
Entre le producteur et le consommateur,
Entre la civilisation et l’organisation,
Et, pour tout dire en un mot :
Entre la Liberté et l’Harmonie.
Et ceci explique comment il se fait qu’encore qu’une sorte de philanthropie sentimentaliste habite leur cœur, la haine découle de leurs lèvres. Chacun d’eux réserve tout son amour pour la société qu’il a rêvée ; mais, quant à celle où il nous a été donné de vivre, elle ne saurait s’écrouler trop tôt à leur gré, afin que sur ses débris s’élève la Jérusalem nouvelle.
J’ai dit que l’École économiste, partant de la naturelle harmonie des intérêts, concluait à la Liberté.
Cependant, je dois en convenir, si les économistes, en général, concluent à la Liberté, il n’est malheureusement pas aussi vrai que leurs principes établissent solidement le point de départ : l’harmonie des intérêts.
Avant d’aller plus loin et afin de vous prémunir contre les inductions qu’on ne manquera pas de tirer de cet aveu, je dois dire un mot de la situation respective du Socialisme et de l’Économie politique.
Il serait insensé à moi de dire que le Socialisme n’a jamais rencontré une vérité, que l’Économie politique n’est jamais tombée dans une erreur.
Ce qui sépare profondément les deux écoles, c’est la différence des méthodes. L’une, comme l’astrologie et l’alchimie, procède par l’Imagination ; l’autre, comme l’astronomie et la chimie, procède par l’observation.
Deux astronomes, observant le même fait peuvent ne pas arriver au même résultat.
Malgré cette dissidence passagère, ils se sentent liés par le procédé commun qui tôt ou tard la fera cesser. Ils se reconnaissent de la même communion. Mais, entre l’astronome qui observe et l’astrologue qui imagine, l’abîme est infranchissable, encore que, par hasard, ils se puissent quelquefois rencontrer.
Il en est ainsi de l’Économie politique et du Socialisme.
Les Économistes observent l’homme, les lois de son organisation et les rapports sociaux qui résultent de ces lois. Les Socialistes imaginent une société de fantaisie et ensuite un cœur humain assorti à cette société.
Or, si la science ne se trompe pas, les savants se trompent. Je ne nie donc pas que les Économistes ne puissent faire de fausses observations, et j’ajoute même qu’ils ont nécessairement dû commencer par là.
Mais voici ce qui arrive. Si les intérêts sont harmoniques, il s’ensuit que toute observation mal faite conduit logiquement à l’antagonisme. Quelle est donc la tactique des Socialistes ? C’est de ramasser dans les écrits des Économistes quelques observations mal faites, d’en exprimer toutes les conséquences et de montrer qu’elles sont désastreuses. Jusque-là ils sont dans leur droit. Ensuite ils s’élèvent contre l’observateur qui s’appellera, je suppose, Malthus ou Ricardo. Ils sont dans leur droit encore. Mais ils ne s’en tiennent pas là. Ils se tournent contre la science, l’accusant d’être impitoyable et de vouloir le mal. En ceci ils heurtent la raison et la justice ; car la science n’est pas responsable d’une observation mal faite. Enfin, ils vont bien plus loin encore. Ils s’en prennent à la société elle-même, ils menacent de la détruire pour la refaire, — et pourquoi ? Parce que, disent-ils, il est prouvé par la science que la société actuelle est poussée vers un abîme. En cela ils choquent le bon sens : car, ou la science ne se trompe pas ; et alors pourquoi l’attaquent-ils ? ou elle se trompe ; et, en ce cas, qu’ils laissent la société en repos, puisqu’elle n’est pas menacée.
Mais cette tactique, tout illogique qu’elle est, n’en est pas moins funeste à la science économique, surtout si ceux qui la cultivent avaient la malheureuse pensée, par une bienveillance très-naturelle, de se rendre solidaires les uns des autres et de leurs devanciers. La science est une reine dont les allures doivent être franches et libres. L’atmosphère de la coterie la tue.
Je l’ai déjà dit : il n’est pas possible, en économie politique, que l’antagonisme ne soit au bout de toute proposition erronée. D’un autre côté, il n’est pas possible que les nombreux écrits des économistes, même les plus éminents, ne renferment quelque proposition fausse. — C’est à nous à les signaler et à les rectifier dans l’intérêt de la science et de la société. Nous obstiner à les soutenir, pour l’honneur du corps, ce serait non-seulement nous exposer, ce qui est peu de chose, mais exposer la vérité même, ce qui est plus grave, aux coups du socialisme.
Je reprends donc et je dis : La conclusion des économistes est la liberté. Mais, pour que cette conclusion obtienne l’assentiment des intelligences et attire à elle les cœurs, il faut qu’elle soit solidement fondée sur cette prémisse : Les intérêts, abandonnés à eux-mêmes, tendent à des combinaisons harmoniques, à la prépondérance progressive du bien général.
Or plusieurs d’entre eux, parmi ceux qui font autorité, ont émis des propositions qui, de conséquence en conséquence, conduisent logiquement au mal absolu, à l’injustice nécessaire, — à l’inégalité fatale et progressive, — au paupérisme inévitable, etc.
Ainsi il en est bien peu, à ma connaissance, qui n’aient attribué de la valeur aux agents naturels, aux dons que Dieu avait prodigués gratuitement à sa créature. Le mot valeur implique que ce qui en est pourvu, nous ne le cédons que moyennant rémunération. Voilà donc des hommes, et en particulier les propriétaires du sol, vendant contre du travail effectif les bienfaits de Dieu, et recevant une récompense pour des utilités auxquelles leur travail est resté étranger. — Injustice évidente, mais nécessaire, disent ces écrivains.
Vient ensuite la célèbre théorie de Ricardo. Elle se résume ainsi : Le prix des subsistances s’établit sur le travail que demande pour les produire le plus pauvre des sols cultivés. Or l’accroissement de la population oblige de recourir à des sols de plus en plus ingrats. Donc l’humanité tout entière (moins les propriétaires) est forcée de donner une somme de travail toujours croissante contre une égale quantité de subsistances ; ou, ce qui revient au même, de recevoir une quantité toujours décroissante de subsistances contre une somme égale de travail ; tandis que les possesseurs du sol voient grossir leurs rentes chaque fois qu’on attaque une terre de qualité inférieure. Conclusion : — Opulence progressive des hommes de loisir ; misère progressive des hommes de travail, — soit : Inégalité fatale.
Apparaît enfin la théorie plus célèbre encore de Malthus. La population tend à s’accroître plus rapidement que les subsistances, et cela, à chaque moment donné de la vie de l’humanité. Or, les hommes ne peuvent être heureux et vivre en paix s’ils n’ont pas de quoi se nourrir. Il n’y a que deux obstacles à cet excédant toujours menaçant de population : la diminution des naissances, ou l’accroissement de la mortalité, dans toutes les horribles formes qui l’accompagnent et la réalisent. La contrainte morale, pour être efficace, devrait être universelle, et nul n’y compte. Il ne reste donc que l’obstacle répressif, le vice, la misère, la guerre, la peste, la famine et la mortalité, soit : Paupérisme inévitable.
Je ne mentionnerai pas d’autres systèmes d’une portée moins générale et qui aboutissent aussi à une désespérante impasse. Par exemple, M. de Tocqueville et beaucoup d’autres comme lui disent : Si l’on admet le droit de primogéniture, on arrive à l’aristocratie la plus concentrée ; si on ne l’admet pas, on arrive à la pulvérisation et à l’improductivité du territoire.
Et ce qu’il y a de remarquable, c’est que ces quatre désolants systèmes ne se heurtent nullement. S’ils se heurtaient, nous pourrions nous consoler en pensant qu’ils sont tous faux, puisqu’ils se détruisent l’un par l’autre. Mais non, ils concordent, ils font partie d’une même théorie générale, laquelle, appuyée de faits nombreux et spécieux, paraissant expliquer l’état convulsif de la société moderne et forte de l’assentiment de plusieurs maîtres de la science, se présente à l’esprit découragé et confondu, avec une autorité effrayante.
Il reste à comprendre comment les révélateurs de cette triste théorie ont pu poser comme principe l’harmonie des intérêts, et comme conclusion la Liberté.
Car, certes, si l’humanité est fatalement poussée par les lois de la Valeur vers l’Injustice, — par les lois de la Rente vers l’Inégalité, — par les lois de la Population vers la Misère, — et par les lois de l’Hérédité vers la Stérilisation, — il ne faut pas dire que Dieu a fait du monde social, comme du monde matériel, une œuvre harmonique ; il faut avouer, en courbant la tête, qu’il s’est plu à le fonder sur une dissonance révoltante et irrémédiable.
Il ne faut pas croire, jeunes gens, que les socialistes aient réfuté et rejeté ce que j’appellerai, pour ne blesser personne, la théorie des dissonances. Non, quoi qu’ils en disent, ils l’ont tenue pour vraie ; et c’est justement parce qu’ils la tiennent pour vraie qu’ils proposent de substituer la Contrainte à la Liberté, l’organisation artificielle à l’organisation naturelle, l’œuvre de leur invention à l’œuvre de Dieu. Ils disent à leurs adversaires (et en cela je ne sais s’ils ne sont pas plus conséquents qu’eux) : Si, comme vous l’aviez annoncé, les intérêts humains laissés à eux-mêmes tendaient à se combiner harmonieusement, nous n’aurions rien de mieux à faire qu’à accueillir et glorifier, comme vous, la Liberté. Mais vous avez démontré d’une manière invincible que les intérêts, si on les laisse se développer librement, poussent l’humanité vers l’injustice, l’inégalité, le paupérisme et la stérilité. Eh bien ! nous réagissons contre votre théorie précisément parce qu’elle est vraie ; nous voulons briser la société actuelle précisément parce qu’elle obéit aux lois fatales que vous avez décrites ; nous voulons essayer de notre puissance, puisque la puissance de Dieu a échoué.
Ainsi, on s’accorde sur le point de départ, on ne se sépare que sur la conclusion.
Les Économistes auxquels j’ai fait allusion disent : Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal ; mais il faut se garder de troubler leur action, parce qu’elle est heureusement contrariée par d’autres lois secondaires qui retardent la catastrophe finale, et toute intervention arbitraire ne ferait qu’affaiblir la digue sans arrêter l’élévation fatale du flot.
Les Socialistes disent : Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal ; il faut les abolir et en choisir d’autres dans notre inépuisable arsenal.
Les catholiques disent : Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal ; il faut leur échapper en renonçant aux intérêts humains, en se réfugiant dans l’abnégation, le sacrifice, l’ascétisme et la résignation.
Et, au milieu de ce tumulte, de ces cris d’angoisse et de détresse, de ces appels à la subversion ou au désespoir résigné, j’essaye de faire entendre cette parole devant laquelle, si elle est justifiée, toute dissidence doit s’effacer : Il n’est pas vrai que les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal.
Ainsi toutes les écoles se divisent et combattent à propos des conclusions qu’il faut tirer de leur commune prémisse. Je nie la prémisse. N’est-ce pas le moyen de faire cesser la division et le combat ?
L’idée dominante de cet écrit, l’harmonie des intérêts, est simple. La simplicité n’est-elle pas la pierre de touche de la vérité ? Les lois de la lumière, du son, du mouvement, nous semblent d’autant plus vraies qu’elles sont plus simples ; pourquoi n’en serait-il pas de même de la loi des intérêts ?
Elle est conciliante. Quoi de plus conciliant que ce qui montre l’accord des industries, des classes, des nations et même des doctrines ?
Elle est consolante, puisqu’elle signale ce qu’il y a de faux dans les systèmes qui ont pour conclusion le mal progressif.
Elle est religieuse, car elle nous dit que ce n’est pas seulement la mécanique céleste, mais aussi la mécanique sociale qui révèle la sagesse de Dieu et raconte sa gloire.
Elle est pratique, et l’on ne peut certes rien concevoir de plus aisément pratique que ceci : Laissons les hommes travailler, échanger, apprendre, s’associer, agir et réagir les uns sur les autres, puisque aussi bien, d’après les décrets providentiels, il ne peut jaillir de leur spontanéité intelligente qu’ordre, harmonie, progrès, le bien, le mieux, le mieux encore, le mieux à l’infini.
— Voilà bien, direz-vous, l’optimisme des économistes ! Ils sont tellement esclaves de leurs propres systèmes, qu’ils ferment les yeux aux faits de peur de les voir. En face de toutes les misères, de toutes les injustices, de toutes les oppressions qui désolent l’humanité, ils nient imperturbablement le mal. L’odeur de la poudre des insurrections n’atteint pas leurs sens blasés ; les pavés des barricades n’ont pas pour eux de langage ; et la société s’écroulera qu’ils répéteront encore : « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. »
Non certes, nous ne pensons pas que tout soit pour le mieux.
J’ai une foi entière dans la sagesse des lois providentielles, et, par ce motif, j’ai foi dans la Liberté.
La question est de savoir si nous avons la Liberté.
La question est de savoir si ces lois agissent dans leur plénitude, si leur action n’est pas profondément troublée par l’action opposée des institutions humaines.
Nier le Mal ! nier la douleur ! qui le pourrait ? Il faudrait oublier qu’on parle de l’homme. Il faudrait oublier qu’on est homme soi-même. Pour que les lois providentielles soient tenues pour harmoniques, il n’est pas nécessaire qu’elles excluent le mal. Il suffit qu’il ait son explication et sa mission, qu’il se serve de limite à lui-même, qu’il se détruise par sa propre action, et que chaque douleur prévienne une douleur plus grande en réprimant sa propre cause.
La société a pour élément l’homme qui est une force libre. Puisque l’homme est libre, il peut choisir ; puisqu’il peut choisir, il peut se tromper ; puisqu’il peut se tromper, il peut souffrir.
Je dis plus : il doit se tromper et souffrir ; car son point de départ est l’ignorance, et devant l’ignorance s’ouvrent des routes infinies et inconnues qui toutes, hors une, mènent à l’erreur.
Or, toute Erreur engendre souffrance. Ou la souffrance retombe sur celui qui s’est égaré, et alors elle met en œuvre la Responsabilité. Ou elle va frapper des êtres innocents de la faute, et, en ce cas, elle fait vibrer le merveilleux appareil réactif de la Solidarité.
L’action de ces lois, combinée avec le don qui nous a été fait de lier les effets aux causes, doit nous ramener, par la douleur même, dans la voie du bien et de la vérité.
Ainsi non-seulement nous ne nions pas le Mal, mais nous lui reconnaissons une mission, dans l’ordre social comme dans l’ordre matériel.
Mais, pour qu’il la remplisse cette mission, il ne faut pas étendre artificiellement la Solidarité de manière à détruire la Responsabilité ; en d’autres termes, il faut respecter la Liberté.
Que si les institutions humaines viennent contrarier en cela les lois divines, le Mal n’en suit pas moins l’erreur, seulement il se déplace. Il frappe qui il ne devait pas frapper ; il n’avertit plus ; il n’est plus un enseignement ; il ne tend plus à se limiter et à se détruire par sa propre action ; il persiste, il s’aggrave, comme il arriverait dans l’ordre physiologique, si les imprudences et les excès commis par les hommes d’un hémisphère ne faisaient ressentir leurs tristes effets que sur les hommes de l’hémisphère opposé.
Or c’est précisément là la tendance non-seulement de la plupart de nos institutions gouvernementales, mais encore et surtout de celles qu’on cherche à faire prévaloir comme remèdes aux maux qui nous affligent. Sous le philanthropique prétexte de développer entre les hommes une Solidarité factice, on rend la Responsabilité de plus en plus inerte et inefficace. On altère, par une intervention abusive de la force publique, le rapport du travail à sa récompense, on trouble les lois de l’industrie et de l’échange, on violente le développement naturel de l’instruction, on dévoie les capitaux et les bras, on fausse les idées, on enflamme les prétentions absurdes, on fait briller aux yeux des espérances chimériques, on occasionne une déperdition inouïe de forces humaines, on déplace les centres de population, on frappe d’inefficacité l’expérience même, bref on donne à tous les intérêts des bases factices, on les met aux prises, et puis on s’écrie : Voyez, les intérêts sont antagoniques. C’est la Liberté qui fait tout le mal. Maudissons et étouffons la Liberté.
Et cependant, comme ce mot sacré a encore la puissance de faire palpiter les cœurs, on dépouille la Liberté de son prestige en lui arrachant son nom ; et c’est sous le nom de concurrence que la triste victime est conduite à l’autel, aux applaudissements de la foule tendant ses bras aux liens de la servitude.
Il ne suffisait donc pas d’exposer, dans leur majestueuse harmonie, les lois naturelles de l’ordre social, il fallait encore montrer les causes perturbatrices qui en paralysent l’action. C’est ce que j’ai essayé de faire dans la seconde partie de ce livre.
Je me suis efforcé d’éviter la controverse. C’était perdre, sans doute, l’occasion de donner aux principes que je voulais faire prévaloir cette stabilité qui résulte d’une discussion approfondie. Mais l’attention, attirée sur les digressions, n’aurait-elle pas été détournée de l’ensemble ? Si je montre l’édifice tel qu’il est, qu’importe comment d’autres l’ont vu, alors même qu’ils m’auraient appris à le voir ?
Et maintenant je fais appel, avec confiance, aux hommes de toutes les écoles qui mettent la justice, le bien général et la vérité au-dessus de leurs systèmes.
Économistes, comme vous, je conclus à la Liberté ; et si j’ébranle quelques-unes de ces prémisses qui attristent vos cœurs généreux, peut-être y verrez-vous un motif de plus pour aimer et servir notre sainte cause.
Socialistes, vous avez foi dans l’Association. Je vous adjure de dire, après avoir lu cet écrit, si la société actuelle, moins ses abus et ses entraves, c’est-à-dire sous la condition de la Liberté, n’est pas la plus belle, la plus complète, la plus durable, la plus universelle, la plus équitable de toutes les Associations.
Égalitaires, vous n’admettez qu’un principe, la Mutualitédes services. Que les transactions humaines soient libres, et je dis qu’elles ne sont et ne peuvent être autre chose qu’un échange réciproque de services toujours décroissants en valeur, toujours croissants en utilité.
Communistes, vous voulez que les hommes, devenus frères, jouissent en commun des biens que la Providence leur a prodigués. Je prétends démontrer que la société actuelle n’a qu’à conquérir la Liberté pour réaliser et dépasser vos vœux et vos espérances : car tout y est commun à tous, à la seule condition que chacun se donne la peine de recueillir les dons de Dieu, ce qui est bien naturel ; ou restitue librement cette peine à ceux qui la prennent pour lui, ce qui est bien juste.
Chrétiens de toutes les communions, à moins que vous ne soyez les seuls qui mettiez en doute la sagesse divine, manifestée dans la plus magnifique de celle de ses œuvres qu’il nous soit donné de connaître, vous ne trouverez pas une expression dans cet écrit qui heurte votre morale la plus sévère ou vos dogmes les plus mystérieux.
Propriétaires, quelle que soit l’étendue de vos possessions, si je prouve que le droit qui vous est aujourd’hui contesté se borne, comme celui du plus simple manœuvre, à recevoir des services contre des services réels par vous ou vos pères positivement rendus, ce droit reposera désormais sur une base inébranlable.
Prolétaires, je me fais fort de démontrer que vous obtenez les fruits du champ que vous ne possédez pas, avec moins d’efforts et de peine que si vous étiez obligés de les faire croître par votre travail direct ; que si on vous donnait ce champ à son état primitif et tel qu’il était avant d’avoir été préparé, par le travail, à la production.
Capitalistes et ouvriers, je me crois en mesure d’établir cette loi : « À mesure que les capitaux s’accumulent, le prélèvement absolu du capital dans le résultat total de la production augmente, et son prélèvement proportionnel diminue ; le travail voit augmenter sa part relative et à plus forte raison sa part absolue. L’effet inverse se produit quand les capitaux se dissipent[220] » — Si cette loi est établie, il en résulte clairement l’harmonie des intérêts entre les travailleurs et ceux qui les emploient.
Disciples de Malthus, philanthropes sincères et calomniés, dont le seul tort est de prémunir l’humanité contre une loi fatale, la croyant fatale, j’aurai à vous soumettre une autre loi plus consolante : « Toutes choses égales d’ailleurs, la densité croissante de population équivaut à une facilité croissante de production. » — Et s’il en est ainsi, certes, ce ne sera pas vous qui vous affligerez de voir tomber du front de notre science chérie sa couronne d’épines.
Hommes de spoliation, vous qui, de force ou de ruse, au mépris des lois ou par l’intermédiaire des lois, vous engraissez de la substance des peuples ; vous qui vivez des erreurs que vous répandez, de l’ignorance que vous entretenez, des guerres que vous allumez, des entraves que vous imposez aux transactions ; vous qui taxez le travail après l’avoir stérilisé, et lui faites perdre plus de gerbes que vous ne lui arrachez d’épis ; vous qui vous faites payer pour créer des obstacles, afin d’avoir ensuite l’occasion de vous faire payer pour en lever une partie ; manifestations vivantes de l’égoïsme dans son mauvais sens, excroissances parasites de la fausse politique, préparez l’encre corrosive de votre critique : à vous seuls je ne puis faire appel, car ce livre a pour but de vous sacrifier, ou plutôt de sacrifier vos prétentions injustes. On a beau aimer la conciliation, il est deux principes qu’on ne saurait concilier : la Liberté et la Contrainte.
Si les lois providentielles sont harmoniques, c’est quand elles agissent librement, sans quoi elles ne seraient pas harmoniques par elles-mêmes. Lors donc que nous remarquons un défaut d’harmonie dans le monde, il ne peut correspondre qu’à un défaut de liberté, à une justice absente. Oppresseurs, spoliateurs, contempteurs de la justice, vous ne pouvez donc entrer dans l’harmonie universelle, puisque c’est vous qui la troublez.
Est-ce à dire que ce livre pourra avoir pour effet d’affaiblir le pouvoir, d’ébranler sa stabilité, de diminuer son autorité ? J’ai en vue le but directement contraire. Mais entendons-nous.
La science politique consiste à discerner ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être dans les attributions de l’État ; et, pour faire ce grand départ, il ne faut pas perdre de vue que l’État agit toujours par l’intermédiaire de la Force. Il impose tout à la fois et les services qu’il rend et les services qu’il se fait payer en retour sous le nom de contributions.
La question revient donc à ceci : Quelles sont les choses que les hommes ont le droit de s’imposer les uns aux autres par la force ? Or je n’en sais qu’une dans ce cas, c’est la justice. Je n’ai pas le droit de forcer qui que ce soit à être religieux, charitable, instruit, laborieux ; mais j’ai le droit de le forcer à être juste ; c’est le cas de légitime défense.
Or il ne peut exister, dans la collection des individus, aucun droit qui ne préexiste dans les individus eux-mêmes. Si donc l’emploi de la force individuelle n’est justifié que par la légitime défense, il suffit de reconnaître que l’action gouvernementale se manifeste toujours par la Force pour en conclure qu’elle est essentiellement bornée à faire régner l’ordre, la sécurité, la justice.
Toute action gouvernementale en dehors de cette limite est une usurpation de la conscience, de l’intelligence, du travail, en un mot de la Liberté humaine.
Cela posé, nous devons nous appliquer sans relâche et sans pitié à dégager des empiétements du pouvoir le domaine entier de l’activité privée ; c’est à cette condition seulement que nous aurons conquis la liberté ou le libre jeu des lois harmoniques, que Dieu a préparées pour le développement et le progrès de l’humanité.
Le Pouvoir sera-t-il pour cela affaibli ? Perdra-t-il de sa stabilité parce qu’il aura perdu de son étendue ? Aura-t-il moins d’autorité, parce qu’il aura moins d’attributions ? S’attirera-t-il moins de respect, parce qu’il s’attirera moins de plaintes ? Sera-t-il davantage le jouet des factions, quand on aura diminué ces budgets énormes et cette influence si convoitée, qui sont l’appât des factions ? Courra-t-il plus de dangers, quand il aura moins de responsabilité ?
Il me semble évident, au contraire, que renfermer la force publique dans sa mission unique, mais essentielle, incontestée, bienfaisante, désirée, acceptée de tous, c’est lui concilier le respect et le concours universel. Je ne vois plus alors d’où pourraient venir les oppositions systématiques, les luttes parlementaires, les insurrections des rues, les révolutions, les péripéties, les factions, les illusions, les prétentions de tous à gouverner sous toutes les formes, les systèmes aussi dangereux qu’absurdes qui enseignent au peuple à tout attendre du gouvernement, cette diplomatie compromettante, ces guerres toujours en perspective, ou ces paix armées presque aussi funestes, ces taxes écrasantes et impossibles à répartir équitablement, cette immixtion absorbante et si peu naturelle de la politique en toutes choses, ces grands déplacements factices de capital et de travail, source de frottements inutiles, de fluctuations, de crises et de dommages. Toutes ces causes et mille autres de troubles, d’irritation, de désaffection, de convoitise et de désordre n’auraient plus de raison d’être ; et les dépositaires du pouvoir, au lieu de la troubler, concourraient à l’universelle harmonie. Harmonie qui n’exclut pas le mal, mais ne lui laisse que la place de plus en plus restreinte que lui font l’ignorance et la perversité de notre faible nature, que sa mission est de prévenir ou de châtier.
Jeunes gens, dans ce temps où un douloureux Scepticisme semble être l’effet et le châtiment de l’anarchie des idées, je m’estimerais heureux si la lecture de ce livre faisait arriver sur vos lèvres, dans l’ordre des idées qu’il agite, ce mot si consolant, ce mot d’une saveur si parfumée, ce mot qui n’est pas seulement un refuge, mais une force, puisqu’on a pu dire de lui qu’il remue les montagnes, ce mot qui ouvre le symbole des chrétiens : Je crois. — « Je crois, non d’une foi soumise et aveugle, car il ne s’agit pas du mystérieux domaine de la révélation ; mais d’une foi scientifique et raisonnée, comme il convient à propos des choses laissées aux investigations de l’homme. — Je crois que celui qui a arrangé le monde matériel n’a pas voulu rester étranger aux arrangements du monde social. — Je crois qu’il a su combiner et faire mouvoir harmonieusement des agents libres aussi bien que des molécules inertes. — Je crois que sa providence éclate au moins autant, si ce n’est plus, dans les lois auxquelles il a soumis les intérêts et les volontés que dans celles qu’il a imposées aux pesanteurs et aux vitesses. — Je crois que tout dans la société est cause de perfectionnement et de progrès, même ce qui la blesse. — Je crois que le Mal aboutit au Bien et le provoque, tandis que le Bien ne peut aboutir au Mal, d’où il suit que le Bien doit finir par dominer. — Je crois que l’invincible tendance sociale est une approximation constante des hommes vers un commun niveau physique, intellectuel et moral, en même temps qu’une élévation progressive et indéfinie de ce niveau. — Je crois qu’il suffit au développement graduel et paisible de l’humanité que ses tendances ne soient pas troublées et qu’elles reconquièrent la liberté de leurs mouvements. — Je crois ces choses, non parce que je les désire et qu’elles satisfont mon cœur, mais parce que mon intelligence leur donne un assentiment réfléchi. »
Ah ! si jamais vous prononcez cette parole : Je crois, vous serez ardents à la propager, et le problème social sera bientôt résolu, car il est, quoi qu’on en dise, facile à résoudre. — Les intérêts sont harmoniques, — donc la solution est tout entière dans ce mot : Liberté.
I. Organisation naturelle, organisation artificielle[221] ↩
Est-il bien certain que le mécanisme social, comme le mécanisme céleste, comme le mécanisme du corps humain, obéisse à des lois générales ? Est-il bien certain que ce soit un ensemble harmonieusement organisé ? Ce qui s’y fait remarquer surtout, n’est-ce pas l’absence de toute organisation ? N’est-ce pas précisément une organisation que recherchent aujourd’hui tous les hommes de cœur et d’avenir, tous les publicistes avancés, tous les pionniers de la pensée ? Ne sommes-nous pas une pure juxtaposition d’individus agissant en dehors de tout concert, livrés aux mouvements d’une liberté anarchique ? Nos masses innombrables, après avoir recouvré péniblement et l’une après l’autre toutes les libertés, n’attendent-elles pas qu’un grand génie les coordonne dans un ensemble harmonieux ? Après avoir détruit, ne faut-il pas fonder ?
Si ces questions n’avaient d’autre portée que celle-ci : La société peut-elle se passer de lois écrites, de règles, de mesures répressives ? chaque homme peut-il faire un usage illimité de ses facultés, alors même qu’il porterait atteinte aux libertés d’autrui, ou qu’il infligerait un dommage à la communauté tout entière ? en un mot, faut-il voir dans cette maxime : Laissez faire, laissez passer, la formule absolue de l’économie politique ? si, dis-je, c’était là la question, la solution ne pourrait être douteuse pour personne. Les économistes ne disent pas qu’un homme peut tuer, saccager, incendier, que la société n’a qu’à le laisser faire ; ils disent que la résistance sociale à de tels actes se manifesterait de fait, même en l’absence de tout code ; que, par conséquent, cette résistance est une loi générale de l’humanité ; ils disent que les lois civiles ou pénales doivent régulariser et non contrarier l’action de ces lois générales qu’elles supposent. Il y a loin d’une organisation sociale fondée sur les lois générales de l’humanité à une organisation artificielle, imaginée, inventée, qui ne tient aucun compte de ces lois, les nie ou les dédaigne, telle enfin que semblent vouloir l’imposer plusieurs écoles modernes.
Car, s’il y a des lois générales qui agissent indépendamment des lois écrites et dont celles-ci ne doivent que régulariser l’action, il faut étudier ces lois générales ; elles peuvent être l’objet d’une science, et l’économie politique existe. Si, au contraire, la société est une invention humaine, si les hommes ne sont que de la matière inerte, auxquels un grand génie, comme dit Rousseau, doit donner le sentiment et la volonté, le mouvement et la vie, alors il n’y a pas d’économie politique ; il n’y a qu’un nombre indéfini d’arrangements possibles et contingents, et le sort des nations dépend du fondateur auquel le hasard aura confié leurs destinées.
Pour prouver que la société est soumise à des lois générales, je ne me livrerai pas à de longues dissertations. Je me bornerai à signaler quelques faits qui, pour être un peu vulgaires, n’en sont pas moins importants.
Rousseau a dit : « Il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont trop près de nous. »
Tels sont les phénomènes sociaux au milieu desquels nous vivons et nous nous mouvons. L’habitude nous a tellement familiarisés avec ces phénomènes, que nous n’y faisons plus attention, pour ainsi dire, à moins qu’ils n’aient quelque chose de brusque et d’anormal qui les impose à notre observation.
Prenons un homme appartenant à une classe modeste de la société, un menuisier de village, par exemple, et observons tous les services qu’il rend à la société et tous ceux qu’il en reçoit ; nous ne tarderons pas à être frappés de l’énorme disproportion apparente.
Cet homme passe sa journée à raboter des planches, à fabriquer des tables et des armoires, il se plaint de sa condition, et cependant que reçoit-il en réalité de cette société en échange de son travail ?
D’abord, tous les jours, en se levant il s’habille, et il n’a personnellement fait aucune des nombreuses pièces de son vêtement. Or, pour que ces vêtements, tout simples qu’ils sont, soient à sa disposition, il faut qu’une énorme quantité de travail, d’industrie, de transports, d’inventions ingénieuses, ait été accomplie. Il faut que des Américains aient produit du coton, des Indiens de l’indigo, des Français de la laine et du lin, des Brésiliens du cuir ; que tous ces matériaux aient été transportés en des villes diverses, qu’ils y aient été ouvrés, filés, tissés, teints, etc.
Ensuite il déjeune. Pour que le pain qu’il mange lui arrive tous les matins, il faut que des terres aient été défrichées, closes, labourées, fumées, ensemencées ; il faut que les récoltes aient été préservées avec soin du pillage ; il faut qu’une certaine sécurité ait régné au milieu d’une innombrable multitude ; il faut que le froment ait été récolté, broyé, pétri et préparé ; il faut que le fer, l’acier, le bois, la pierre aient été convertis par le travail en instruments de travail ; que certains hommes se soient emparés de la force des animaux, d’autres du poids d’une chute d’eau, etc. ; toutes choses dont chacune, prise isolément, suppose une masse incalculable de travail mise en jeu, non-seulement dans l’espace, mais dans le temps.
Cet homme ne passera pas sa journée sans employer un peu de sucre, un peu d’huile, sans se servir de quelques ustensiles.
Il enverra son fils à l’école, pour y recevoir une instruction qui, quoique bornée, n’en suppose pas moins des recherches, des études antérieures, des connaissances dont l’imagination est effrayée.
Il sort : il trouve une rue pavée et éclairée.
On lui conteste une propriété : il trouvera des avocats pour défendre ses droits, des juges pour l’y maintenir, des officiers de justice pour faire exécuter la sentence ; toutes choses qui supposent encore des connaissances acquises, par conséquent des lumières et des moyens d’existence.
Il va à l’église : elle est un monument prodigieux, et le livre qu’il y porte est un monument peut-être plus prodigieux encore de l’intelligence humaine. On lui enseigne la morale, on éclaire son esprit, on élève son âme ; et, pour que tout cela se fasse, il faut qu’un autre homme ait pu fréquenter les bibliothèques, les séminaires, puiser à toutes les sources de la tradition humaine, qu’il ait pu vivre sans s’occuper directement des besoins de son corps.
Si notre artisan entreprend un voyage, il trouve que, pour lui épargner du temps et diminuer sa peine, d’autres hommes ont aplani, nivelé le sol, comblé des vallées, abaissé des montagnes, joint les rives des fleuves, amoindri tous les frottements, placé des véhicules à roues sur des blocs de grès ou des bandes de fer, dompté les chevaux ou la vapeur, etc.
Il est impossible de ne pas être frappé de la disproportion, véritablement incommensurable, qui existe entre les satisfactions que cet homme puise dans la société et celles qu’il pourrait se donner, s’il était réduit à ses propres forces. J’ose dire que, dans une seule journée, il consomme des choses qu’il ne pourrait produire lui-même en dix siècles.
Ce qui rend le phénomène plus étrange encore, c’est que tous les autres hommes sont dans le même cas que lui. Chacun de ceux qui composent la société a absorbé des millions de fois plus qu’il n’aurait pu produire ; et cependant ils ne se sont rien dérobé mutuellement. Et si l’on regarde les choses de près, on s’aperçoit que ce menuisier a payé en services tous les services qui lui ont été rendus. S’il tenait ses comptes avec une rigoureuse exactitude, on se convaincrait qu’il n’a rien reçu sans le payer au moyen de sa modeste industrie ; que quiconque a été employé à son service, dans le temps ou dans l’espace, a reçu ou recevra sa rémunération.
Il faut donc que le mécanisme social soit bien ingénieux, bien puissant, puisqu’il conduit à ce singulier résultat, que chaque homme, même celui que le sort a placé dans la condition la plus humble, a plus de satisfactions en un jour qu’il n’en pourrait produire en plusieurs siècles.
Ce n’est pas tout, et ce mécanisme social paraîtra bien plus ingénieux encore, si le lecteur veut bien tourner ses regards sur lui-même.
Je le suppose simple étudiant. Que fait-il à Paris ? Comment y vit-il ? On ne peut nier que la société ne mette à sa disposition des aliments, des vêtements, un logement, des diversions, des livres, des moyens d’instruction, une multitude de choses enfin, dont la production, seulement pour être expliquée, exigerait un temps considérable, à plus forte raison pour être exécutée. Et, en retour de toutes ces choses, qui ont demandé tant de travail, de sueurs, de fatigues, d’efforts physiques ou intellectuels, de transports, d’inventions, de transactions, quels services cet étudiant rend-il à la société ? Aucun ; seulement il se prépare à lui en rendre. Comment donc ces millions d’hommes qui se sont livrés à un travail positif, effectif et productif, lui en ont-ils abandonné les fruits ? Voici l’explication : c’est que le père de cet étudiant, qui était avocat, médecin ou négociant, avait rendu autrefois des services, — peut-être à la société chinoise, — et en avait retiré, non des services immédiats, mais des droits à des services qu’il pourrait réclamer dans le temps, dans le lieu et sous la forme qu’il lui conviendrait. C’est de ces services lointains et passés que la société s’acquitte aujourd’hui ; et, chose étonnante ! si l’on suivait par la pensée la marche des transactions infinies qui ont dû avoir lieu pour atteindre le résultat, on verrait que chacun a été payé de sa peine ; que ces droits ont passé de main en main, tantôt se fractionnant, tantôt se groupant jusqu’à ce que, par la consommation de cet étudiant, tout ait été balancé. N’est-ce pas là un phénomène bien étrange ?
On fermerait les yeux à la lumière, si l’on refusait de reconnaître que la société ne peut présenter des combinaisons si compliquées, dans lesquelles les lois civiles et pénales prennent si peu de part, sans obéir à un mécanisme prodigieusement ingénieux. Ce mécanisme est l’objet qu’étudie l’Économie politique.
Une chose encore digne de remarque, c’est que dans ce nombre, vraiment incalculable, de transactions qui ont abouti à faire vivre pendant un jour un étudiant, il n’y en a peut-être pas la millionième partie qui se soit faite directement. Les choses dont il a joui aujourd’hui, et qui sont innombrables, sont l’œuvre d’hommes dont un grand nombre ont disparu depuis longtemps de la surface de la terre. Et pourtant ils ont été rémunérés comme ils l’entendaient, bien que celui qui profite aujourd’hui du produit de leur travail n’ait rien fait pour eux. Il ne les a pas connus, il ne les connaîtra jamais. Celui qui lit cette page, au moment même où il la lit, a la puissance, quoiqu’il n’en ait peut-être pas conscience, de mettre en mouvement des hommes de tous les pays, de toutes les races, et je dirai presque de tous les temps, des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes ; il fait concourir à ses satisfactions actuelles des générations éteintes, des générations qui ne sont pas nées ; et cette puissance extraordinaire, il la doit à ce que son père a rendu autrefois des services à d’autres hommes qui, en apparence, n’ont rien de commun avec ceux dont le travail est mis en œuvre aujourd’hui. Cependant il s’est opéré une telle balance, dans le temps et dans l’espace, que chacun a été rétribué et a reçu ce qu’il avait calculé devoir recevoir.
En vérité, tout cela a-t-il pu se faire, des phénomènes aussi extraordinaires ont-ils pu s’accomplir sans qu’il y eût, dans la société, une naturelle et savante organisation qui agit pour ainsi dire à notre insu ?
On parle beaucoup de nos jours d’inventer une nouvelle organisation. Est-il bien certain qu’aucun penseur, quelque génie qu’on lui suppose, quelque autorité qu’on lui donne, puisse imaginer et faire prévaloir une organisation supérieure à celle dont je viens d’esquisser quelques résultats ?
Que serait-ce, si j’en décrivais aussi les rouages, les ressorts et les mobiles ?
Ces rouages sont des hommes, c’est-à-dire des êtres capables d’apprendre, de réfléchir, de raisonner, de se tromper, de se rectifier, et par conséquent d’agir sur l’amélioration ou sur la détérioration du mécanisme lui-même. Ils sont capables de satisfaction et de douleur, et c’est en cela qu’ils sont non-seulement les rouages, mais les ressorts du mécanisme. Ils en sont aussi les mobiles, car le principe d’activité est en eux. Ils sont plus que cela encore, ils en sont l’objet même et le but, puisque c’est en satisfactions et en douleurs individuelles que tout se résout en définitive.
Or on a remarqué, et malheureusement il n’a pas été difficile de remarquer, que, dans l’action, le développement et même le progrès (par ceux qui l’admettent) de ce puissant mécanisme, bien des rouages étaient inévitablement, fatalement écrasés ; que, pour un grand nombre d’êtres humains, la somme des douleurs imméritées surpassait de beaucoup la somme des jouissances.
À cet aspect, beaucoup d’esprits sincères, beaucoup de cœurs généreux ont douté du mécanisme lui-même. Ils l’ont nié, ils ont refusé de l’étudier, ils ont attaqué, souvent avec violence, ceux qui en avaient recherché et exposé les lois ; ils se sont levés contre la nature des choses, et enfin ils ont proposé d’organiser la société sur un plan nouveau, où l’injustice, la souffrance et l’erreur ne sauraient trouver place.
À Dieu ne plaise que je m’élève contre des intentions manifestement philanthropiques et pures ! Mais je déserterais mes convictions, je reculerais devant les injonctions de ma propre conscience, si je ne disais que, selon moi, ces hommes sont dans une fausse voie.
En premier lieu ils sont réduits, par la nature même de leur propagande, à la triste nécessité de méconnaître le bien que la société développe, de nier ses progrès, de lui imputer tous les maux, de les rechercher avec un soin presque avide et de les exagérer outre mesure.
Quand on croit avoir découvert une organisation sociale différente de celle qui est résultée des naturelles tendances de l’humanité, il faut bien, pour faire accepter son invention, décrire sous les couleurs les plus sombres les résultats de l’organisation qu’on veut abolir. Aussi les publicistes auxquels je fais allusion, après avoir proclamé avec enthousiasme et peut-être exagéré la perfectibilité humaine, tombent dans l’étrange contradiction de dire que la société se détériore de plus en plus. À les entendre, les hommes sont mille fois plus malheureux qu’ils ne l’étaient dans les temps anciens, sous le régime féodal et sous le joug de l’esclavage ; le monde est devenu un enfer. S’il était possible d’évoquer le Paris du dixième siècle, j’ose croire qu’une telle thèse serait insoutenable.
Ensuite ils sont conduits à condamner le principe même d’action des hommes, je veux dire l’intérêt personnel, puisqu’il a amené un tel état de choses. Remarquons que l’homme est organisé de telle façon, qu’il recherche la satisfaction et évite la peine ; c’est de là, j’en conviens, que naissent tous les maux sociaux, la guerre, l’esclavage, le monopole, le privilége ; mais c’est de là aussi que viennent tous les biens, puisque la satisfaction des besoins et la répugnance pour la douleur sont les mobiles de l’homme. La question est donc de savoir si ce mobile qui, par son universalité, d’individuel devient social, n’est pas en lui-même un principe de progrès.
En tout cas, les inventeurs d’organisations nouvelles ne s’aperçoivent-ils pas que ce principe, inhérent à la nature même de l’homme, les suivra dans leurs organisations, et que là il fera bien d’autres ravages que dans notre organisation naturelle, où les prétentions injustes et l’intérêt de l’un sont au moins contenus par la résistance de tous ? Ces publicistes supposent toujours deux choses inadmissibles : la première, que la société telle qu’ils la conçoivent sera dirigée par des hommes infaillibles et dénués de ce mobile, — l’intérêt ; la seconde, que la masse se laissera diriger par ces hommes.
Enfin les Organisateurs ne paraissent pas se préoccuper le moins du monde des moyens d’exécution. Comment feront-ils prévaloir leurs systèmes ? Comment décideront-ils tous les hommes à la fois à renoncer à ce mobile qui les fait mouvoir : l’attrait pour les satisfactions, la répugnance pour les douleurs ? Il faudrait donc, comme disait Rousseau, changer la constitution morale et physique de l’homme ?
Pour déterminer tous les hommes à la fois à rejeter comme un vêtement incommode l’ordre social actuel, dans lequel l’humanité a vécu et s’est développée depuis son origine jusqu’à nos jours, à adopter une organisation d’invention humaine et à devenir les pièces dociles d’un autre mécanisme, il n’y a, ce me semble, que deux moyens : la Force, ou l’Assentiment universel.
Il faut, ou bien que l’organisateur dispose d’une force capable de vaincre toutes les résistances, de manière à ce que l’humanité ne soit entre ses mains qu’une cire molle qui se laisse pétrir et façonner à sa fantaisie ; ou obtenir, par la persuasion, un assentiment, si complet, si exclusif, si aveugle même, qu’il rende inutile l’emploi de la force.
Je défie qu’on me cite un troisième moyen de faire triompher, de faire entrer dans la pratique humaine un phalanstère ou toute autre organisation sociale artificielle.
Or, s’il n’y a que ces deux moyens et si l’on démontre que l’un est aussi impraticable que l’autre, on prouve par cela même que les organisateurs perdent leur temps et leur peine.
Quant à disposer d’une force matérielle qui leur soumette tous les rois et tous les peuples de la terre, c’est à quoi les rêveurs, tout rêveurs qu’ils sont, n’ont jamais songé. Le roi Alphonse avait bien l’orgueil de dire : « Si j’étais entré dans les conseils de Dieu, le monde planétaire serait mieux arrangé. » Mais s’il mettait sa propre sagesse au-dessus de celle du Créateur, il n’avait pas au moins la folie de vouloir lutter de puissance avec Dieu ; et l’histoire ne rapporte pas qu’il ait essayé de faire tourner les étoiles selon les lois de son invention. Descartes aussi se contenta de composer un petit monde de dés et de ficelles, sachant bien qu’il n’était pas assez fort pour remuer l’univers. Nous ne connaissons que Xerxès qui, dans l’enivrement de sa puissance, ait osé dire aux flots : « Vous n’irez pas plus loin. » Les flots cependant ne reculèrent pas devant Xerxès ; mais Xerxès recula devant les flots, et, sans cette humiliante mais sage précaution, il aurait été englouti.
La Force manque donc aux Organisateurs pour soumettre l’humanité à leurs expérimentations. Quand ils gagneraient à leur cause l’autocrate russe, le schah de Perse, le kan des Tartares et tous les chefs des nations qui exercent sur leurs sujets un empire absolu, ils ne parviendraient pas encore à disposer d’une force suffisante pour distribuer les hommes en groupes et séries, et anéantir les lois générales de la propriété, de l’échange, de l’hérédité et de la famille ; car, même en Russie, même en Perse et en Tartarie, il faut compter plus ou moins avec les hommes. Si l’empereur de Russie s’avisait de vouloir altérer la constitution morale et physique de ses sujets, il est probable qu’il aurait bientôt un successeur, et que ce successeur ne serait pas tenté de poursuivre l’expérience.
Puisque la force est un moyen tout à fait hors de la portée de nos nombreux Organisateurs, il ne leur reste d’autre ressource que d’obtenir l’assentiment universel.
Il y a pour cela deux moyens : la persuasion et l’imposture.
La persuasion ! mais on n’a jamais vu deux intelligences s’accorder parfaitement sur tous les points d’une seule science. Comment donc tous les hommes, de langues, de races, de mœurs diverses, répandus sur la surface du globe, la plupart ne sachant pas lire, destinés à mourir sans entendre parler du réformateur, accepteront-ils unanimement la science universelle ? De quoi s’agit-il ? De changer le mode de travail, d’échanges, de relations domestiques, civiles, religieuses, en un mot, d’altérer la constitution physique et morale de l’homme ; — et l’on espérerait rallier l’humanité tout entière par la conviction !
Vraiment la tâche paraît bien ardue.
Quand on vient dire à ses semblables :
« Depuis cinq mille ans, il y a eu un malentendu entre Dieu et l’humanité ;
Depuis Adam jusqu’à nous, le genre humain fait fausse route, et pour peu qu’il me croie, je le vais mettre en bon chemin ;
Dieu voulait que l’humanité marchât différemment, elle ne l’a pas voulu, et voilà pourquoi le mal s’est introduit dans le monde. Qu’elle se retourne tout entière à ma voix pour prendre une direction inverse, et le bonheur universel va luire sur elle. »
Quand, dis-je, on débute ainsi, c’est beaucoup si l’on est cru de cinq ou six adeptes ; de là à être cru d’un milliard d’hommes, il y a loin, bien loin ! si loin, que la distance est incalculable.
Et puis songez que le nombre des inventions sociales est aussi illimité que le domaine de l’imagination ; qu’il n’y a pas un publiciste, qui, se renfermant pendant quelques heures dans son cabinet, n’en puisse sortir avec un plan d’organisation artificielle à la main ; que les inventions de Fourier, Saint-Simon, Owen, Cabet, Blanc, etc., ne se ressemblent nullement entre elles ; qu’il n’y a pas de jour qui n’en voie éclore d’autres encore ; que, véritablement, l’humanité a quelque peu raison de se recueillir et d’hésiter avant de rejeter l’organisation sociale que Dieu lui a donnée, pour faire, entre tant d’inventions sociales, un choix définitif et irrévocable. Car, qu’arriverait-il, si, lorsqu’elle aurait choisi un de ces plans, il s’en présentait un meilleur ? Peut-elle chaque jour constituer la propriété, la famille, le travail, l’échange sur des bases différentes ? Doit-elle s’exposer à changer d’organisation tous les matins ?
« Ainsi donc, comme dit Rousseau, le législateur ne pouvant employer ni la force, ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. »
Quelle est cette autorité ? L’imposture. Rousseau n’ose pas articuler le mot ; mais, selon son usage invariable en pareil cas, il le place derrière le voile transparent d’une tirade d’éloquence :
« Voilà, dit-il, ce qui força de tous les temps les Pères des nations de recourir à l’intervention du ciel, et d’honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples soumis aux lois de l’État comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui l’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, etc. »
Et pour qu’on ne s’y trompe pas, il laisse à Machiavel, en le citant, le soin d’achever sa pensée : Mai non fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in un popolo che non ricorresse a Dio.
Pourquoi Machiavel conseille-t-il de recourir à Dieu, et Rousseau aux dieux, aux immortels ? Je laisse au lecteur à résoudre la question.
Certes je n’accuse pas les modernes Pères des nations d’en venir à ces indignes supercheries. Cependant il ne faut pas se dissimuler que, lorsqu’on se place à leur point de vue, on comprend qu’ils se laissent facilement entraîner par le désir de réussir. Quand un homme sincère et philanthrope est bien convaincu qu’il possède un secret social, au moyen duquel tous ses semblables jouiraient dans ce monde d’une félicité sans bornes ; quand il voit clairement qu’il ne peut faire prévaloir son idée ni par la force ni par le raisonnement, et que la supercherie est sa seule ressource, il doit éprouver une bien forte tentation. On sait que les ministres mêmes de la religion qui professe au plus haut degré l’horreur du mensonge, n’ont pas reculé devant les fraudes pieuses ; et l’on voit, par l’exemple de Rousseau, cet austère écrivain qui a inscrit en tête de tous ses ouvrages cette devise : Vitam impendere vero, que l’orgueilleuse philosophie elle-même peut se laisser séduire à l’attrait de cette maxime bien différente : La fin justifie les moyens. Qu’y aurait-il de surprenant à ce que les Organisateurs modernes songeassent aussi à honorer les dieux de leur propre sagesse, à mettre leurs décisions dans la bouche des immortels, à entraîner sans violence et à persuader sans convaincre ?
On sait qu’à l’exemple de Moïse, Fourier a fait précéder son Deutéronome d’une Genèse. Saint-Simon et ses disciples avaient été plus loin dans leurs velléités apostoliques. D’autres, plus avisés, se rattachent à la religion la plus étendue, en la modifiant selon leurs vues, sous le nom de néo-christianisme ; et il n’y a personne qui ne soit frappé du ton d’afféterie mystique que presque tous les Réformateurs modernes introduisent dans leur prédication.
Mais les efforts qui ont été essayés dans ce sens n’ont servi qu’à prouver une chose qui a, il est vrai, son importance : c’est que, de nos jours, n’est pas prophète qui veut. On a beau se proclamer Dieu, on n’est cru de personne, ni du public, ni de ses compères, ni de soi-même.
Puisque j’ai parlé de Rousseau, je me permettrai de faire ici quelques réflexions sur cet organisateur, d’autant qu’elles serviront à faire comprendre en quoi les organisations artificielles diffèrent de l’organisation naturelle. Cette digression n’est pas d’ailleurs tout à fait intempestive, puisque, depuis quelque temps, on signale le Contrat social comme l’oracle de l’avenir.
Rousseau était convaincu que l’isolement était l’état de nature de l’homme, et que, par conséquent, la société était d’invention humaine. « L’ordre social, dit-il en débutant, ne vient pas de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. »
En outre, ce philosophe, quoique aimant avec passion la liberté, avait une triste opinion des hommes. Il les croyait tout à fait incapables de se donner une bonne institution. L’intervention d’un fondateur, d’un législateur, d’un père des nations, était donc indispensable.
« Le peuple soumis aux lois, dit-il, en doit être l’auteur. Il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société ; mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite ? Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu’elle veut, parce que rarement elle sait ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ?… Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent, le public veut le bien qu’il ne voit pas ; tout ont également besoin de guides… Voilà d’où naît la nécessité d’un législateur. »
Ce législateur, on l’a déjà vu, « ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, » c’est-à-dire, en bon français, à la fourberie.
Rien ne peut donner une idée de l’immense hauteur au-dessus des autres hommes où Rousseau place son législateur :
« Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes… Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine…, d’altérer la constitution de l’homme pour le renforcer… Il faut qu’il ôte à l’homme ses propres forces pour lui en donner qui lui soient étrangères… Le législateur est, à tous égards, un homme extraordinaire dans l’État… son emploi est une fonction particulière et supérieure, qui n’a rien de commun avec l’empire humain… S’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit lui proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine ; celui-là n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. »
Et qu’est donc l’humanité dans tout cela ? La vile matière dont la machine est composée.
En vérité, n’est-ce pas là l’orgueil porté jusqu’au délire ? Ainsi les hommes sont les matériaux d’une machine que le prince fait marcher ; le législateur en propose le modèle ; et le philosophe régente le législateur, se plaçant ainsi à une distance incommensurable du vulgaire, du prince et du législateur lui-même : il plane sur le genre humain, le meut, le transforme, le pétrit, ou plutôt enseigne aux Pères des nations comment il faut s’y prendre.
Cependant le fondateur d’un peuple doit se proposer un but. Il a de la matière humaine à mettre en œuvre, et il faut bien qu’il l’ordonne à une fin. Comme les hommes sont dépourvus d’initiative, et que tout dépend du législateur, celui-ci décidera si un peuple doit être ou commerçant, ou agriculteur, ou barbare et ichthyophage, etc. ; mais il est à désirer que le législateur ne se trompe pas et ne fasse pas trop violence à la nature des choses.
Les hommes, en convenant de s’associer, ou plutôt en s’associant par la volonté du législateur, ont donc un but très-précis. « C’est ainsi, dit Rousseau, que les Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal objet la religion ; les Athéniens, les lettres ; Carthage et Tyr, le commerce ; Rhodes, la marine ; Sparte, la guerre, et Rome, la vertu. »
Quel sera l’objet qui nous décidera, nous Français, à sortir de l’isolement ou de l’état de nature pour former une société ?
Ou plutôt (car nous ne sommes que la matière inerte, les matériaux de la machine), vers quel objet nous dirigera notre grand Instituteur ?
Dans les idées de Rousseau, ce ne pouvait guère être ni les lettres, ni le commerce, ni la marine. La guerre est un plus noble but, et la vertu un but plus noble encore. Cependant il y en a un très-supérieur. Ce qui doit être la fin de tout système de législation, « c’est la liberté et l’égalité ».
Mais il faut savoir ce que Rousseau entendait par la liberté. Jouir de la liberté, selon lui, ce n’est pas être libre, c’est donner son suffrage, alors même qu’on serait « entraîné sans violence, et persuadé sans être convaincu, » car alors « on obéit avec liberté et l’on porte docilement le joug de la félicité publique. »
« Chez les Grecs, dit-il, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même ; il était sans cesse assemblé sur la place, il habitait un climat doux, il n’était point avide, des esclaves faisaient tous ses travaux, sa grande affaire était sa liberté. »
« Le peuple anglais, dit-il ailleurs, croit être libre ; il se trompe fort. Il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. »
Le peuple doit donc faire par lui-même tout ce qui est service public, s’il veut être libre, car c’est en cela que consiste la liberté. Il doit toujours nommer, toujours être sur la place publique. Malheur à lui, s’il songe à travailler pour vivre ! Sitôt qu’un seul citoyen s’avise de soigner ses propres affaires, à l’instant (c’est une locution que Rousseau aime beaucoup) tout est perdu.
Mais, certes, la difficulté n’est pas petite. Comment faire ? Car enfin, même pour pratiquer la vertu, même pour exercer la liberté, encore faut-il vivre.
On a vu tout à l’heure sous quelle enveloppe oratoire Rousseau avait caché le mot imposture. On va le voir maintenant recourir à un trait d’éloquence pour faire passer la conclusion de tout son livre, l’esclavage.
« Vos durs climats vous donnent des besoins, six mois de l’année la place publique n’est pas tenable ; vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en plein air, et vous craignez bien moins l’esclavage que la misère. »
« Vous voyez bien que vous ne pouvez être libres. »
« Quoi ! la liberté ne se maintient qu’à l’appui de la servitude ? Peut-être. »
Si Rousseau s’était arrêté à ce mot affreux, le lecteur eût été révolté. Il fallait recourir aux déclamations imposantes. Rousseau n’y manque pas.
« Tout ce qui n’est point dans la nature (c’est de la société qu’il s’agit) a ses inconvénients, et la société civile plus que tout le reste. Il y a des positions malheureuses où l’on ne peut conserver sa liberté qu’aux dépens de celle d’autrui, et où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l’esclave ne soit extrêmement esclave. Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves, mais vous l’êtes ; vous payez leur liberté de la vôtre… Vous avez beau vanter cette préférence, j’y trouve plus de lâcheté que d’humanité. »
Je le demande, cela ne veut-il pas dire : Peuples modernes, vous feriez bien mieux de n’être pas esclaves et d’en avoir.
Que le lecteur veuille bien excuser cette longue digression, j’ai cru qu’elle n’était pas inutile. Depuis quelque temps, on nous représente Rousseau et ses disciples de la Convention comme les apôtres de la fraternité humaine. — Des hommes pour matériaux, un prince pour mécanicien, un père des nations pour inventeur, un philosophe par-dessus tout cela, l’imposture pour moyen, l’esclavage pour résultat ; est-ce donc là la fraternité qu’on nous promet ?
Il m’a semblé aussi que cette étude du Contrat social était propre à faire voir ce qui caractérise les organisations sociales artificielles. Partir de cette idée que la société est un état contre nature ; chercher les combinaisons auxquelles on pourrait soumettre l’humanité ; perdre de vue qu’elle a son mobile en elle-même ; considérer les hommes comme de vils matériaux ; aspirer à leur donner le mouvement et la volonté, le sentiment et la vie ; se placer ainsi à une hauteur incommensurable au-dessus du genre humain : voilà les traits communs à tous les inventeurs d’organisations sociales. Les inventions diffèrent, les inventeurs se ressemblent.
Parmi les arrangements nouveaux auxquels les faibles humains sont conviés, il en est un qui se présente en termes qui le rendent digne d’attention. Sa formule est : Association progressive et volontaire.
Mais l’économie politique est précisément fondée sur cette donnée, que société n’est autre chose qu’association (ainsi que ces trois mots le disent), association fort imparfaite d’abord, parce que l’homme est imparfait, mais se perfectionnant avec lui, c’est-à-dire progressive. Veut-on parler d’une association plus étroite entre le travail, le capital et le talent, d’où doivent résulter pour les membres de la famille humaine plus de bien et un bien-être mieux réparti ? À la condition que ces associations soient volontaires ; que la force et la contrainte n’interviennent pas ; que les associés n’aient pas la prétention de faire supporter les frais de leur établissement par ceux qui refusent d’y entrer, en quoi répugnent-elles à l’économie politique ? Est-ce que l’économie politique, comme science, n’est pas tenue d’examiner les formes diverses par lesquelles il plaît aux hommes d’unir leurs forces et de se partager les occupations, en vue d’un bien-être plus grand et mieux réparti ? Est-ce que le commerce ne nous donne pas fréquemment l’exemple de deux, trois, quatre personnes formant entre elles des associations ? Est-ce que le métayage n’est pas une sorte d’association informe, si l’on veut, du capital et du travail ? Est-ce que nous n’avons pas vu, dans ces derniers temps, se produire les compagnies par actions, qui donnent au plus petit capital le pouvoir de prendre part aux plus grandes entreprises ? Est-ce qu’il n’y a pas à la surface du pays quelques fabriques où l’on essaye d’associer tous les co-travailleurs aux résultats ? Est-ce que l’économie politique condamne ces essais et les efforts que font les hommes pour tirer un meilleur parti de leurs forces ? Est-ce qu’elle a affirmé quelque part que l’humanité a dit son dernier mot ? C’est tout le contraire, et je crois qu’il n’est aucune science qui démontre plus clairement que la société est dans l’enfance.
Mais, quelques espérances que l’on conçoive pour l’avenir, quelques idées que l’on se fasse des formes que l’humanité pourra trouver pour le perfectionnement de ses relations et la diffusion du bien-être, des connaissances et de la moralité, il faut pourtant bien reconnaître que la société est une organisation qui a pour élément un agent intelligent, moral, doué de libre arbitre et perfectible. Si vous en ôtez la liberté, ce n’est plus qu’un triste et grossier mécanisme.
La liberté ! il semble qu’on n’en veuille pas de nos jours. Sur cette terre de France, empire privilégié de la mode, il semble que la liberté ne soit plus de mise. Et moi, je dis : Quiconque repousse la liberté n’a pas foi dans l’humanité. On prétend avoir fait récemment cette désolante découverte que la liberté conduit fatalement au monopole[222]. Non, cet enchaînement monstrueux, cet accouplement contre nature n’existe pas ; il est le fruit imaginaire d’une erreur qui se dissipe bientôt au flambeau de l’économie politique. La liberté engendrer le monopole ! L’oppression naître naturellement de la liberté ! mais prenons-y garde, affirmer cela, c’est affirmer que les tendances de l’humanité sont radicalement mauvaises, mauvaises en elles-mêmes, mauvaises par nature, mauvaises par essence ; c’est affirmer que la pente naturelle de l’homme est vers sa détérioration, et l’attrait irrésistible de l’esprit vers l’erreur. Mais alors à quoi bon nos écoles, nos études, nos recherches, nos discussions, sinon à nous imprimer une impulsion plus rapide sur cette pente fatale, puisque, pour l’humanité, apprendre à choisir, c’est apprendre à se suicider ? Et, si les tendances de l’humanité sont essentiellement perverses, où donc, pour les changer, les organisateurs chercheront-ils leur point d’appui ! D’après les prémisses, ce point d’appui devrait être placé en dehors de l’humanité. Le chercheront-ils en eux-mêmes, dans leur intelligence, dans leur cœur ? mais ils ne sont pas des dieux encore ; ils sont hommes aussi, et par conséquent poussés avec l’humanité tout entière vers le fatal abîme. Invoqueront-ils l’intervention de l’État ? Mais l’État est composé d’hommes ; et il faudrait prouver que ces hommes forment une classe à part, pour qui les lois générales de la société ne sont pas faites, puisque c’est eux qu’on charge de faire ces lois. Sans cette preuve, la difficulté n’est pas même reculée.
Ne condamnons pas ainsi l’humanité avant d’en avoir étudié les lois, les forces, les énergies, les tendances. Depuis qu’il eut reconnu l’attraction, Newton ne prononçait plus le nom de Dieu sans se découvrir. Autant l’intelligence est au-dessus de la matière, autant le monde social est au-dessus de celui qu’admirait Newton : car la mécanique céleste obéit à des lois dont elle n’a pas la conscience. Combien plus de raison aurons-nous de nous incliner devant la Sagesse éternelle, à l’aspect de la mécanique sociale, où vit aussi la pensée universelle, mens agitat molem, mais qui présente de plus ce phénomène extraordinaire que chaque atome est un être animé, pensant, doué de cette énergie merveilleuse, de ce principe de toute moralité, de toute dignité, de tout progrès, attribut exclusif de l’homme, — la Liberté !
II. Besoins, Efforts, Satisfactions[223] ↩
Quel spectacle profondément affligeant nous offre la France !
Il serait difficile de dire si l’anarchie a passé des idées aux faits ou des faits aux idées, mais il est certain qu’elle a tout envahi.
Le pauvre s’élève contre le riche ; le prolétariat contre la propriété ; le peuple contre la bourgeoisie ; le travail contre le capital ; l’agriculture contre l’industrie ; la campagne contre la ville ; la province contre la capitale ; le régnicole contre l’étranger.
Et les théoriciens surviennent, qui font un système de cet antagonisme. « Il est, disent-ils, le résultat fatal de la nature des choses, c’est-à-dire de la liberté. L’homme s’aime lui-même, et voilà d’où vient tout le mal, car puisqu’il s’aime, il tend vers son propre bien-être, et il ne le peut trouver que dans le malheur de ses frères. Empêchons donc qu’il n’obéisse à ses tendances ; étouffons sa liberté ; changeons le cœur humain ; substituons un autre mobile à celui que Dieu y a placé ; inventons et dirigeons une société artificielle ! »
Quand on en est là, une carrière sans limites s’ouvre devant la logique ou l’imagination. Si l’on est doué d’un esprit dialecticien combiné avec une nature chagrine, on s’acharne dans l’analyse du mal ; on le dissèque, on le met au creuset, on lui demande son dernier mot, on remonte à ses causes, on le poursuit dans ses conséquences ; et comme, à raison de notre imperfection native, il n’est étranger à rien, il n’est rien qu’on ne dénigre. On ne montre la propriété, la famille, le capital, l’industrie, la concurrence, la liberté, l’intérêt personnel, que par un de leurs aspects, par le côté qui détruit ou qui blesse ; on fait, pour ainsi dire, contenir l’histoire naturelle de l’homme dans la clinique. On jette à Dieu le défi de concilier ce qu’on dit de sa bonté infinie avec l’existence du mal. On souille tout, on dégoûte de tout, on nie tout ; et l’on ne laisse pas cependant que d’obtenir un triste et dangereux succès auprès de ces classes que la souffrance n’incline que trop vers le désespoir.
Si, au contraire, on porte un cœur ouvert à la bienveillance, un esprit qui se complaise aux illusions, on s’élance vers la région des chimères. On rêve des Océana, des Atlantide, des Salente, des Spensonie, des Icarie, des Utopie, des Phalanstère ; on les peuple d’êtres dociles, aimants, dévoués, qui n’ont garde de faire jamais obstacle à la fantaisie du rêveur. Celui-ci s’installe complaisamment dans son rôle de Providence. Il arrange, il dispose, il fait les hommes à son gré ; rien ne l’arrête, jamais il ne rencontre de déceptions ; il ressemble à ce prédicateur romain qui, après avoir transformé son bonnet carré en Rousseau, réfutait chaleureusement le Contrat social, et triomphait d’avoir réduit son adversaire au silence. C’est ainsi que le réformateur fait briller, aux yeux de ceux qui souffrent, les séduisants tableaux d’une félicité idéale bien propre à dégoûter des rudes nécessités de la vie réelle.
Cependant il est rare que l’utopiste s’en tienne à ces innocentes chimères. Dès qu’il veut y entraîner l’humanité, il éprouve qu’elle n’est pas facile à se laisser transformer. Elle résiste, il s’aigrit. Pour la déterminer, il ne lui parle pas seulement du bonheur qu’elle refuse, il lui parle surtout des maux dont il prétend la délivrer. Il ne saurait en faire une peinture trop saisissante. Il s’habitue à charger sa palette, à renforcer ses couleurs. Il cherche le mal, dans la société actuelle, avec autant de passion qu’un autre en mettrait à y découvrir le bien. Il ne voit que souffrances, haillons, maigreur, inanition, douleurs, oppression. Il s’étonne, il s’irrite de ce que la société n’ait pas un sentiment assez vif de ses misères. Il ne néglige rien pour lui faire perdre son insensibilité, et, après avoir commencé par la bienveillance, lui aussi finit par la misanthropie[224] .
À Dieu ne plaise que j’accuse ici la sincérité de qui que ce soit ! Mais, en vérité, je ne puis m’expliquer que ces publicistes, qui voient un antagonisme radical au fond de l’ordre naturel des sociétés, puissent goûter un instant de calme et de repos. Il me semble que le découragement et le désespoir doivent être leur triste partage. Car enfin, si la nature s’est trompée en faisant de l’intérêt personnel le grand ressort des sociétés humaines (et son erreur est évidente, dès qu’il est admis que les intéréts sont fatalement antagoniques), comment ne s’aperçoivent-ils pas que le mal est irrémédiable ? Ne pouvant recourir qu’à des hommes, hommes nous-mêmes, où prendrons-nous notre point d’appui pour changer les tendances de l’humanité ? Invoquerons-nous la Police, la Magistrature, l’État, le Législateur ? Mais c’est en appeler à des hommes, c’est-à-dire à des êtres sujets à l’infirmité commune. Nous adresserons-nous au Suffrage Universel ? Mais c’est donner le cours le plus libre à l’universelle tendance.
Il ne reste donc qu’une ressource à ces publicistes. C’est de se donner pour des révélateurs, pour des prophètes, pétris d’un autre limon, puisant leurs inspirations à d’autres sources que le reste de leurs semblables ; et c’est pourquoi, sans doute, on les voit si souvent envelopper leurs systèmes et leurs conseils dans une phraséologie mystique. Mais s’ils sont des envoyés de Dieu, qu’ils prouvent donc leur mission. En définitive, ce qu’ils demandent, c’est la puissance souveraine, c’est le despotisme le plus absolu qui fut jamais.
Non-seulement ils veulent gouverner nos actes, mais ils prétendent altérer jusqu’à l’essence même de nos sentiments. C’est bien le moins qu’ils nous montrent leurs titres. Espèrent-ils que l’humanité les croira sur parole, alors surtout qu’ils ne s’entendent pas entre eux ?
Mais avant-même d’examiner leurs projets de sociétés artificielles, n’y a-t-il pas une chose dont il faut s’assurer, à savoir, s’ils ne se trompent pas dès le point de départ ? Est-il bien certain que les intérêts soient naturellement antagoniques, qu’une cause irrémédiable d’inégalité se développe fatalement dans l’ordre naturel des sociétés humaines, sous l’influence de l’intérêt personnel, et que, dès lors, Dieu se soit manifestement trompé quand il a ordonné que l’homme tendrait vers le bien-être ?
C’est ce que je me propose de rechercher.
Prenant l’homme tel qu’il a plu à Dieu de le faire, susceptible de prévoyance et d’expérience, perfectible, s’aimant lui-même, c’est incontestable, mais d’une affection tempérée par le principe sympathique, et, en tout cas, contenue, équilibrée par la rencontre d’un sentiment analogue universellement répandu dans le milieu où elle agit, je me demande quel ordre social doit nécessairement résulter de la combinaison et des libres tendances de ces éléments.
Si nous trouvons que ce résultat n’est autre chose qu’une marche progressive vers le bien-être, le perfectionnement et l’égalité ; une approximation soutenue de toutes les classes vers un même niveau physique, intellectuel et moral, en même temps qu’une constante élévation de ce niveau, l’œuvre de Dieu sera justifiée. Nous apprendrons avec bonheur qu’il n’y a pas de lacune dans la création, et que l’ordre social, comme tous les autres, atteste l’existence de ces lois harmoniques devant lesquelles s’inclinait Newton et qui arrachaient au Psalmiste ce cri : Cœli enarrant gloriam Dei.
Rousseau disait : Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire, je le ferais, ou je me tairais.
Je ne suis pas prince, mais la confiance de mes concitoyens m’a fait législateur. Peut-être me diront-ils que c’est pour moi le temps d’agir et non d’écrire.
Qu’ils me pardonnent ; que ce soit la vérité elle-même qui me presse ou que je sois dupe d’une illusion, toujours est-il que je sens le besoin de concentrer dans un faisceau des idées que je n’ai pu faire accepter jusqu’ici pour les avoir présentées éparses et par lambeaux. Il me semble que j’aperçois dans le jeu des lois naturelles de la société de sublimes et consolantes harmonies. Ce que je vois ou crois voir, ne dois-je pas essayer de le montrer à d’autres, afin de rallier ainsi, autour d’une pensée de concorde et de fraternité, bien des intelligences égarées, bien des cœurs aigris ? Si, quand le vaisseau adoré de la patrie est battu par la tempête, je parais m’éloigner quelquefois, pour me recueillir, du poste auquel j’ai été appelé, c’est que mes faibles mains sont inutiles à la manœuvre. Est-ce d’ailleurs trahir mon mandat que de réfléchir sur les causes de la tempête elle-même, et m’efforcer d’agir sur ces causes ? Et puis, ce que je ne ferais pas aujourd’hui, qui sait s’il me serait donné de le faire demain ?
Je commencerai par établir quelques notions économiques. M’aidant des travaux de mes devanciers, je m’efforcerai de résumer la Science dans un principe vrai, simple et fécond qu’elle entrevit dès l’origine, dont elle s’est constamment approchée et dont peut-être le moment est venu de fixer la formule. Ensuite, à la clarté de ce flambeau, j’essayerai de résoudre quelques-uns des problèmes encore controversés, concurrence, machines, commerce extérieur, luxe, capital, rente, etc. Je signalerai quelques-unes des relations, ou plutôt des harmonies de l’économie politique avec les autres sciences morales et sociales, en jetant un coup d’œil sur les graves sujets exprimés par ces mots : Intérêt personnel, Propriété, Communauté, Liberté, Égalité, Responsabilité, Solidarité, Fraternité, Unité. Enfin j’appellerai l’attention du lecteur sur les obstacles artificiels que rencontre le développement pacifique, régulier et progressif des sociétés humaines. De ces deux idées : Lois naturelles harmoniques, causes artificielles perturbatrices, se déduira la solution du Problème social.
Il serait difficile de ne pas apercevoir le double écueil qui attend cette entreprise. Au milieu du tourbillon qui nous emporte, si ce livre est abstrait, on ne le lira pas ; s’il obtient d’être lu, c’est que les questions n’y seront qu’effleurées. Comment concilier les droits de la science avec les exigences du lecteur ? Pour satisfaire à toutes les conditions de fond et de forme, il faudrait peser chaque mot et étudier la place qui lui convient. C’est ainsi que le cristal s’élabore goutte à goutte dans le silence et l’obscurité. Silence, obscurité, temps, liberté d’esprit, tout me manque à la fois ; et je suis réduit à me confier à la sagacité du public en invoquant son indulgence.
L’économie politique a pour sujet l’homme.
Mais elle n’embrasse pas l’homme tout entier. Sentiment religieux, tendresse paternelle et maternelle, piété filiale, amour, amitié, patriotisme, charité, politesse, la Morale a envahi tout ce qui remplit les attrayantes régions de la Sympathie. Elle n’a laissé à sa sœur, l’Économie politique, que le froid domaine de l’intérêt personnel. C’est ce qu’on oublie injustement quand on reproche à cette science de n’avoir pas le charme et l’onction de la morale. Cela se peut-il ? Contestez-lui le droit d’être, mais ne la forcez pas de se contrefaire. Si les transactions humaines, qui ont pour objet la richesse, sont assez vastes, assez compliquées pour donner lieu à une science spéciale, laissons-lui l’allure qui lui convient et ne la réduisons pas à parler des Intérêts dans la langue des Sentiments. Je ne crois pas, quant à moi, qu’on lui ait rendu service, dans ces derniers temps, en exigeant d’elle un ton de sentimentalité enthousiaste qui, dans sa bouche, ne peut être que de la déclamation. De quoi s’agit-il ? De transactions accomplies entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne se doivent rien que la Justice, qui défendent et cherchent à faire prévaloir des intérêts. Il s’agit de prétentions qui se limitent les unes par les autres, où l’abnégation et le dévouement n’ont que faire. Prenez donc une lyre pour parler de ces choses. Autant j’aimerais que Lamartine consultât la table des logarithmes pour chanter ses odes[225] .
Ce n’est pas que l’économie politique n’ait aussi sa poésie. Il y en a partout où il y a ordre et harmonie. Mais elle est dans les résultats, non dans la démonstration. Elle se révèle, on ne la crée pas. Keppler ne s’est pas donné pour poëte, et certes les lois qu’il a découvertes sont la vraie poésie de l’intelligence.
Ainsi l’économie politique n’envisage l’homme que par un côté, et notre premier soin doit être d’étudier l’homme à ce point de vue. C’est pourquoi nous ne pouvons nous dispenser de remonter aux phénomènes primordiaux de la Sensibilité et de l’Activité humaines. Que le lecteur se rassure néanmoins. Notre séjour ne sera pas long dans les nuageuses régions de la métaphysique, et nous n’emprunterons à cette science que des notions simples, claires, et, s’il se peut, incontestées.
L’âme (ou pour ne pas engager la question de spiritualité), l’homme est doué de Sensibilité. Que la sensibilité soit dans l’âme ou dans le corps, toujours est-il que l’homme comme être passif éprouve des sensations pénibles ou agréables. Comme être actif, il fait effort pour éloigner les unes et multiplier les autres. Le résultat, qui l’affecte encore comme être passif, peut s’appeler Satisfaction.
De l’idée générale Sensibilité naissent les idées plus précises : peines, besoins, désirs, goûts, appétits, d’un côté ; et, de l’autre, plaisirs, jouissances, consommation, bien-être.
Entre ces deux extrêmes s’interpose le moyen, et de l’idée générale Activité naissent des idées plus précises : peine, effort, fatigue, travail, production.
En décomposant la Sensibilité et l’Activité, nous retrouvons un mot commun aux deux sphères, le mot Peine. C’est une peine que d’éprouver certaines sensations, et nous ne pouvons la faire cesser que par un effort qui est aussi une peine. Ceci nous avertit que nous n’avons guère ici-bas que le choix des maux.
Tout est personnel dans cet ensemble de phénomènes, tant la sensation, qui précède l’effort que la Satisfaction qui le suit.
Nous ne pouvons donc pas douter que l’Intérêt personnel ne soit le grand ressort de l’humanité. Il doit être bien entendu que ce mot est ici l’expression d’un fait universel, incontestable, résultant de l’organisation de l’homme, et non point un jugement critique, comme serait le mot égoïsme. Les sciences morales seraient impossibles, si l’on pervertissait d’avance les termes dont elles sont obligées de se servir.
L’effort humain ne vient pas se placer toujours et nécessairement entre la sensation et la satisfaction. Quelquefois la satisfaction se réalise d’elle-même. Plus souvent l’effort s’exerce sur des matériaux, par l’intermédiaire de forces que la nature a mises gratuitement à la disposition des hommes.
Si l’on donne le nom d’Utilité à tout ce qui réalise la satisfaction des besoins, il y a donc des utilités de deux sortes. Les unes nous ont été accordées gratuitement par la Providence ; les autres veulent être, pour ainsi parler, achetées par un effort.
Ainsi l’évolution complète embrasse ou peut embrasser ces quatre idées :
| Besoin | Utilité gratuite | Satisfaction. |
| Utilité onéreuse |
L’homme est pourvu de facultés progressives. Il compare, il prévoit, il apprend, il se réforme par l’expérience. Puisque si le besoin est une peine, l’effort est une peine aussi, il n’y a pas de raison pour qu’il ne cherche à diminuer celle-ci, quand il le peut faire sans nuire à la satisfaction qui en est le but. C’est à quoi il réussit quand il parvient à remplacer de l’utilité onéreuse par de l’utilité gratuite, et c’est l’objet perpétuel de ses recherches.
Il résulte de la nature intéressée de notre cœur que nous cherchons constamment à augmenter le rapport de nos Satisfactions à nos Efforts ; et il résulte de la nature intelligente de notre esprit que nous y parvenons, pour chaque résultat donné, en augmentant le rapport de l’Utilité gratuite à l’Utilité onéreuse.
Chaque fois qu’un progrès de ce genre se réalise, une partie de nos efforts est mise, pour ainsi dire, en disponibilité ; et nous avons l’option ou de nous abandonner à un plus long repos, ou de travailler à la satisfaction de nouveaux désirs, s’il s’en forme dans notre cœur d’assez puissants pour stimuler notre activité.
Tel est le principe de tout progrès dans l’ordre économique ; c’est aussi, il est aisé de le comprendre, le principe de toute déception, car progrès et déceptions ont leur racine dans ce don merveilleux et spécial que Dieu a fait aux hommes : le libre arbitre.
Nous sommes doués de la faculté de comparer, de juger, de choisir et d’agir en conséquence ; ce qui implique que nous pouvons porter un bon ou mauvais jugement, faire un bon ou mauvais choix. Il n’est jamais inutile de le rappeler aux hommes quand on leur parle de Liberté.
Nous ne nous trompons pas, il est vrai, sur la nature intime de nos sensations, et nous discernons avec un instinct infaillible si elles sont pénibles ou agréables. Mais que de formes diverses peuvent prendre nos erreurs ? Nous pouvons nous méprendre sur la cause et poursuivre avec ardeur, comme devant nous donner une satisfaction, ce qui doit nous infliger une peine ; ou bien sur l’enchaînement des effets, et ignorer qu’une satisfaction immédiate sera suivie d’une plus grande peine ultérieure ; on encore sur l’importance relative de nos besoins et de nos désirs.
Non-seulement nous pouvons donner ainsi une fausse direction à nos efforts par ignorance, mais encore par perversion de volonté. « L’homme, dit M. de Bonald, est une intelligence servie par des organes. » Eh quoi ! n’y a-t-il pas autre chose en nous ? N’y a-t-il pas les passions ?
Quand donc nous parlons d’harmonie, nous n’entendons pas dire que l’arrangement naturel du monde social soit tel que l’erreur et le vice en aient été exclus ; soutenir cette thèse en face des faits, ce serait pousser jusqu’à la folie la manie du système. Pour que l’harmonie fût sans dissonance, il faudrait ou que l’homme n’eût pas de libre arbitre, ou qu’il fût infaillible. Nous disons seulement ceci : les grandes tendances sociales sont harmoniques, en ce que, toute erreur menant à une déception et tout vice à un châtiment, les dissonances tendent incessamment à disparaître.
Une première et vague notion de la propriété se déduit de ces prémisses. Puisque c’est l’individu qui éprouve la sensation, le désir, le besoin, puisque c’est lui qui fait l’Effort, il faut bien que la satisfaction aboutisse à lui, sans quoi l’effort n’aurait pas sa raison d’être.
Il en est de même de l’Hérédité. Aucune théorie, aucune déclamation ne fera que les pères n’aiment leurs enfants. Les gens qui se plaisent à arranger des sociétés imaginaires peuvent trouver cela fort déplacé, mais c’est ainsi. Un père fait autant d’Efforts, plus peut-être, pour la satisfaction de ses enfants, que pour la sienne propre. Si donc une loi contre nature interdisait la transmission de la propriété, non-seulement elle la violerait par cela même, mais encore elle l’empêcherait de se former, en frappant d’inertie la moitié au moins des Efforts humains.
Intérêt personnel, Propriété, Hérédité, nous aurons occasion de revenir sur ces sujets. Cherchons d’abord la circonscription de la science qui nous occupe.
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’une science a, par elle-même, des frontières naturelles et immuables. Dans le domaine des idées, comme dans celui des faits, tout se lie, tout s’enchaîne, toutes les vérités se fondent les unes dans les autres, et il n’y a pas de science qui, pour être complète, ne dût les embrasser toutes. On a dit avec raison que, pour une intelligence infinie, il n’y aurait qu’une seule vérité. C’est donc notre faiblesse qui nous réduit à étudier isolément un certain ordre de phénomènes, et les classifications qui en résultent ne peuvent échapper à un certain arbitraire.
Le vrai mérite est d’exposer avec exactitude les faits, leurs causes et leurs conséquences. C’en est un aussi, mais beaucoup moindre et purement relatif, de déterminer d’une manière, non point rigoureuse, cela est impossible, mais rationnelle, l’ordre de faits que l’on se propose d’étudier.
Je dis ceci pour qu’on ne suppose pas que j’entends faire la critique de mes devanciers, s’il m’arrive de donner à l’économie politique des limites un peu différentes de celles qu’ils lui ont assignées.
Dans ces derniers temps, on a beaucoup reproché aux économistes de s’être trop attachés à étudier la Richesse. On aurait voulu qu’ils fissent entrer dans la science tout ce qui, de près ou de loin, contribue au bonheur ou aux souffrances de l’humanité ; et on a été jusqu’à supposer qu’ils niaient tout ce dont ils ne s’occupaient pas, par exemple, les phénomènes du principe sympathique, aussi naturel au cœur de l’homme que le principe de l’intérêt personnel. C’est comme si l’on accusait le minéralogiste de nier l’existence du règne animal. Eh quoi ! la richesse, les lois de sa production, de sa distribution, de sa consommation, n’est-ce pas un sujet assez vaste, assez important pour faire l’objet d’une science spéciale ? Si les conclusions de l’économiste étaient en contradiction avec celles de la politique ou de la morale, je concevrais l’accusation. On pourrait lui dire : « En vous limitant, vous vous êtes égaré, car il n’est pas possible que deux vérités se heurtent. » Peut-être résultera-t-il du travail que je soumets au public que la science de la richesse est en parfaite harmonie avec toutes les autres.
Des trois termes qui renferment les destinées humaines : Sensation, Effort, Satisfaction, le premier et le dernier se confondent toujours et nécessairement dans la même individualité. Il est impossible de les concevoir séparés. On peut concevoir une sensation non satisfaite, un besoin inassouvi ; jamais personne ne comprendra le besoin dans un homme et sa satisfaction dans un autre.
S’il en était de même pour le terme moyen, l’Effort, l’homme serait un être complétement solitaire. Le phénomène économique s’accomplirait intégralement dans l’individu isolé. Il pourrait y avoir une juxtaposition de personnes, il n’y aurait pas de société. Il pourrait y avoir une Économie personnelle, il ne pourrait exister d’Économie politique.
Mais il n’en est pas ainsi. Il est fort possible et fort fréquent que le Besoin de l’un doive sa Satisfaction à l’Effort de l’autre. C’est un fait. Si chacun de nous veut passer en revue toutes les satisfactions qui aboutissent à lui, il reconnaîtra qu’il les doit, pour la plupart, à des efforts qu’il n’a pas faits ; et de même, le travail que nous accomplissons, chacun dans notre profession, va presque toujours satisfaire des désirs qui ne sont pas en nous.
Ceci nous avertit que ce n’est ni dans les besoins ni dans les satisfactions, phénomènes essentiellement personnels et intransmissibles, mais dans la nature du terme moyen, des Efforts humains, qu’il faut chercher le principe social, l’origine de l’économie politique.
C’est, en effet, cette faculté donnée aux hommes, et aux hommes seuls, entre toutes les créatures, de travailler les uns pour les autres ; c’est cette transmission d’efforts, cet échange de services, avec toutes les combinaisons compliquées et infinies auxquelles il donne lieu à travers le temps et l’espace, c’est là précisément ce qui constitue la science économique, en montre l’origine et en détermine les limites.
Je dis donc :
Forment le domaine de l’économie politique tout effort susceptible de satisfaire, à charge de retour, les besoins d’une personne autre que celle qui l’a accompli, — et, par suite, les besoins et satisfactions relatifs à cette nature d’efforts.
Ainsi, pour citer un exemple, l’action de respirer, quoiqu’elle contienne les trois termes qui constituent le phénomène économique, n’appartient pourtant pas à cette science, et l’on en voit la raison : c’est qu’il s’agit ici d’un ensemble de faits dans lequel non-seulement les deux extrêmes : besoin et satisfaction, sont intransmissibles (ils le sont toujours), mais où le terme moyen, l’Effort, est intransmissible aussi. Nous n’invoquons l’assistance de personne pour respirer ; il n’y a là ni service à recevoir ni service à rendre ; il y a un fait individuel par nature et non social, qui ne peut, par conséquent, entrer dans une science toute de relation, comme l’indique son nom même.
Mais que, dans des circonstances particulières, des hommes aient à s’entr’aider pour respirer, comme lorsqu’un ouvrier descend dans une cloche à plongeur, ou quand un médecin agit sur l’appareil pulmonaire, ou quand la police prend des mesures pour purifier l’air ; alors il y a un besoin satisfait par l’effort d’une autre personne que celle qui l’éprouve, il y a service rendu, et la respiration même entre, sous ce rapport du moins, quant à l’assistance et à la rémunération, dans le cercle de l’économie politique.
Il n’est pas nécessaire que la transaction soit effectuée, il suffit qu’elle soit possible pour que le travail soit de nature économique. Le laboureur qui cultive du blé pour son usage accomplit un fait économique par cela seul que le blé est susceptible d’être échangé.
Accomplir un effort pour satisfaire le besoin d’autrui, c’est lui rendre un service. Si un service est stipulé en retour, il y a échange de services ; et, comme c’est le cas le plus ordinaire, l’économie politique peut être définie : la théorie de l’échange.
Quelle que soit pour l’une des parties contractantes la vivacité du besoin, pour l’autre l’intensité de l’effort, si l’échange est libre, les deux services échangés se valent. La valeur consiste donc dans l’appréciation comparative des services réciproques, et l’on peut dire encore que l’économie politique est la théorie de la valeur.
Je viens de définir l’économie politique et de circonscrire son domaine, sans parler d’un élément essentiel : l’utilité gratuite.
Tous les auteurs ont fait remarquer que nous puisons une foule de satisfactions à cette source. Ils ont appelé ces utilités, telles que l’air, l’eau, la lumière du soleil, etc., richesses naturelles, par opposition aux richesses sociales, après quoi ils ne s’en sont plus occupés ; et, en effet, il semble que, ne donnant lieu à aucun effort, à aucun échange, à aucun service, n’entrant dans aucun inventaire comme dépourvues de valeur, elles ne doivent pas entrer dans le cercle d’étude de l’économie politique.
Cette exclusion serait rationnelle, si l’utilité gratuite était une quantité fixe, invariable, toujours séparée de l’utilité onéreuse ; mais elles se mêlent constamment et en proportions inverses. L’application soutenue de l’homme est de substituer l’une à l’autre, c’est-à-dire d’arriver, à l’aide des agents naturels et gratuits, aux mêmes résultats avec moins d’efforts. Il fait faire par le vent, par la gravitation, par le calorique, par l’élasticité du gaz, ce qu’il n’accomplissait à l’origine que par sa force musculaire.
Or qu’arrive-t-il ? Quoique l’effet utile soit égal, l’effort est moindre. Moindre effort implique moindre service, et moindre service implique moindre valeur. Chaque progrès anéantit donc de la valeur ; mais comment ? Non point en supprimant l’effet utile, mais en substituant de l’utilité gratuite à de l’utilité onéreuse, de la richesse naturelle à de la richesse sociale. À un point de vue, cette portion de valeur ainsi anéantie sort du domaine de l’économie politique comme elle est exclue de nos inventaires ; car elle ne s’échange plus, elle ne se vend ni ne s’achète, et l’humanité en jouit sans efforts, presque sans en avoir la conscience ; elle ne compte plus dans la richesse relative, elle prend rang parmi les dons de Dieu. Mais, d’un autre côté, si la science n’en tenait plus aucun compte, elle se fourvoierait assurément, car elle perdrait de vue justement ce qui est l’essentiel, le principal en toutes choses : le résultat, l’effet utile ; elle méconnaitrait les plus fortes tendances communautaires et égalitaires ; elle verrait tout dans l’ordre social, moins l’harmonie. Et si ce livre est destiné à faire faire un pas à l’économie politique, c’est surtout en ce qu’il tiendra les yeux du lecteur constamment attachés sur cette portion de valeur successivement anéantie et recueillie sous forme d’utilité gratuité par l’humanité tout entière.
Je ferai ici une remarque qui prouvera combien les sciences se touchent et sont près de se confondre.
Je viens de définir le service. C’est l’effort dans un homme, tandis que le besoin et la satisfaction sont dans un autre. Quelquefois le service est rendu gratuitement, sans rémunération, sans qu’aucun service soit exigé en retour. Il part alors du principe sympathique plutôt que du principe de l’intérêt personnel. Il constitue le don et non l’échange. Par suite, il semble qu’il n’appartienne pas à l’économie politique (qui est la théorie de l’échange), mais à la morale. En effet, les actes de cette nature sont, à cause de leur mobile, plutôt moraux qu’économiques. Nous verrons cependant que, par leurs effets, ils intéressent la science qui nous occupe. D’un autre côté, les services rendus à titre onéreux, sous condition de retour, et, par ce motif, essentiellement économiques, ne restent pas pour cela, quant à leurs effets, étrangers à la morale.
Ainsi ces deux branches de connaissances ont des points de contact infinis ; et, comme deux vérités ne sauraient être antagoniques, quand l’économiste assigne à un phénomène des conséquences funestes en même temps que le moraliste lui attribue des effets heureux, on peut affirmer que l’un ou l’autre s’égare. C’est ainsi que les sciences se vérifient l’une par l’autre.
III. Des Besoins de l’homme↩
Il est peut-être impossible, et, en tout cas, il ne serait pas fort utile de présenter une nomenclature complète et méthodique des besoins de l’homme. Presque tous ceux qui ont une importance réelle sont compris dans l’énumération suivante :
Respiration (je maintiens ici ce besoin comme marquant la limite où commence la transmission du travail ou l’échange des services). — Alimentation. — Vêtement. — Logement. — Conservation et rétablissement de la santé. — Locomotion. — Sécurité. — Instruction. — Diversion. — Sensation du beau.
Les besoins existent. C’est un fait. Il serait puéril de rechercher s’il vaudrait mieux qu’ils n’existassent pas et pourquoi Dieu nous y a assujettis.
Il est certain que l’homme souffre et même qu’il meurt lorsqu’il ne peut satisfaire aux besoins qu’il tient de son organisation. Il est certain qu’il souffre et même qu’il peut mourir lorsqu’il satisfait avec excès à certains d’entre eux.
Nous ne pouvons satisfaire la plupart de nos besoins qu’à la condition de nous donner une peine, laquelle peut être considérée comme une souffrance. Il en est de même de l’acte par lequel, exerçant un noble empire sur nos appétits, nous nous imposons une privation.
Ainsi la souffrance est pour nous inévitable, et il ne nous reste guère que le choix des maux. En outre, elle est tout ce qu’il y a au monde de plus intime, de plus personnel ; d’où il suit que l’intérêt personnel, ce sentiment qu’on flétrit de nos jours sous les noms d’égoïsme, d’individualisme, est indestructible. La nature a placé la sensibilité à l’extrémité de nos nerfs, à toutes les avenues du cœur et de l’intelligence, comme une sentinelle avancée, pour nous avertir quand il y a défaut, quand il y a excès de satisfaction. La douleur a donc une destination, une mission. On a demandé souvent si l’existence du mal pouvait se concilier avec la bonté infinie du Créateur, redoutable problème que la philosophie agitera toujours et ne parviendra probablement jamais à résoudre. Quant à l’économie politique, elle doit prendre l’homme tel qu’il est, d’autant qu’il n’est pas donné à l’imagination elle-même de se figurer, — encore moins à la raison de concevoir, — un être animé et mortel exempt de douleur. Tout nos efforts seraient vains pour comprendre la sensibilité sans la douleur ou l’homme sans la sensibilité.
De nos jours, quelques écoles sentimentalistes rejettent comme fausse toute science sociale qui n’est pas arrivée à une combinaison au moyen de laquelle la douleur disparaisse de ce monde. Elles jugent sévèrement l’économie politique, parce qu’elle admet ce qu’il est impossible de nier : la souffrance. Elles vont plus loin, elles l’en rendent responsable. C’est comme si l’on attribuait la fragilité de nos organes au physiologiste qui les étudie.
Sans doute, on peut se rendre pour quelque temps populaire, on peut attirer à soi les hommes qui souffrent et les irriter contre l’ordre naturel des sociétés, en annonçant qu’on a dans la tête un plan d’arrangement social artificiel où la douleur, sous aucune forme, ne peut pénétrer. On peut même prétendre avoir dérobé le secret de Dieu et interprété sa volonté présumée en bannissant le mal de dessus la terre. Et l’on ne manque pas de traiter d’impie la science qui n’affiche pas une telle prétention, l’accusant de méconnaître ou de nier la prévoyance ou la puissance de l’auteur des choses.
En même temps, ces écoles font une peinture effroyable des sociétés actuelles, et elles ne s’aperçoivent pas que, s’il y a impiété à prévoir la souffrance dans l’avenir, il n’y en a pas moins à la constater dans le passé ou dans le présent. Car l’infini n’admet pas de limites ; et si, depuis la création, un seul homme a souffert dans le monde, cela suffit pour qu’on puisse admettre, sans impiété, que la douleur est entrée dans le plan providentiel.
Il est certainement plus scientifique et plus viril de reconnaitre l’existence des grands faits naturels qui non-seulement existent, mais sans lesquels l’humanité ne se peut concevoir.
Ainsi l’homme est sujet à la souffrance, et, par conséquent, la société aussi.
La souffrance a une fonction dans l’individu, et, par conséquent, dans la société aussi.
L’étude des lois sociales nous révélera que la mission de la souffrance est de détruire progressivement ses propres causes, de se circonscrire elle-même dans des limites de plus en plus étroites, et, finalement, d’assurer, en nous la faisant acheter et mériter, la prépondérance du bien et du beau.
La nomenclature qui précède met en première ligne les besoins matériels.
Nous vivons dans un temps qui me force de prémunir encore ici le lecteur contre une sorte d’afféterie sentimentaliste fort à la mode.
Il y a des gens qui font très-bon marché de ce qu’ils appellent dédaigneusement besoins matériels, satisfactions matérielles. Ils me diront, sans doute, comme Bélise à Chrysale :
Le corps, cette guenille, est-il d’une importance,
D’un prix à mériter seulement qu’on y pense ?
Et, quoique en général bien pourvus de tout, ce dont je les félicite sincèrement, ils me blâmeront d’avoir indiqué comme un de nos premiers besoins celui de l’alimentation, par exemple.
Certes je reconnais que le perfectionnement moral est d’un ordre plus élevé que la conservation physique. Mais enfin, sommes-nous tellement envahis par cette manie d’affectation déclamatoire, qu’il ne soit plus permis de dire que, pour se perfectionner, encore faut-il vivre ? Préservons-nous de ces puérilités qui font obstacle à la science. À force de vouloir passer pour philanthrope, on devient faux ; car c’est une chose contraire au raisonnement comme aux faits que le développement moral, le soin de la dignité, la culture des sentiments délicats, puissent précéder les exigences de la simple conservation. Cette sorte de pruderie est toute moderne. Rousseau, ce panégyriste enthousiaste de l’état de nature, s’en était préservé ; et un homme doué d’une délicatesse exquise, d’une tendresse de cœur pleine d’onction, spiritualiste jusqu’au quiétisme et stoïcien pour lui-même, Fénélon, disait : « Après tout, la solidité de l’esprit consiste à vouloir s’instruire exactement de la manière dont se font les choses qui sont le fondement de la vie humaine. Toutes les grandes affaires roulent là-dessus. »
Sans prétendre donc classer les besoins dans un ordre rigoureusement méthodique, nous pouvons dire que l’homme ne saurait diriger ses efforts vers la satisfaction des besoins moraux de l’ordre le plus noble et le plus élevé qu’après avoir pourvu à ceux qui concernent la conservation et l’entretien de la vie. D’où nous pouvons déjà conclure que toute mesure législative qui rend la vie matérielle difficile nuit à la vie morale des nations, harmonie que je signale en passant à l’attention du lecteur.
Et, puisque l’occasion s’en présente, j’en signalerai une autre.
Puisque les nécessités irrémissibles de la vie matérielle sont un obstacle à la culture intellectuelle et morale, il s’ensuit que l’on doit trouver plus de vertus chez les nations et parmi les classes aisées que parmi les nations et les classes pauvres. Bon Dieu ! que viens-je de dire, et de quelles clameurs ne suis-je pas assourdi ! C’est une véritable manie, de nos jours, d’attribuer aux classes pauvres le monopole de tous les dévouements, de toutes les abnégations, de tout ce qui constitue dans l’homme la grandeur et la beauté morale ; et cette manie s’est récemment développée encore sous l’influence d’une révolution qui, faisant arriver ces classes à la surface de la société, ne pouvait manquer de susciter autour d’elles la tourbe des flatteurs.
Je ne nie pas que la richesse, et surtout l’opulence, principalement quand elle est très-inégalement répartie, ne tende à développer certains vices spéciaux.
Mais est-il possible d’admettre d’une manière générale que la vertu soit le privilége de la misère, et le vice le triste et fidèle compagnon de l’aisance ? Ce serait affirmer que la culture intellectuelle et morale, qui n’est compatible qu’avec un certain degré de loisir et de bien-être, tourne au détriment de l’intelligence et de la moralité.
Et ici, j’en appelle à la sincérité des classes souffrantes elles-mêmes. À quelles horribles dissonances ne conduirait pas un tel paradoxe ?
Il faudrait donc dire que l’humanité est placée dans cette affreuse alternative, ou de rester éternellement misérable, ou de s’avancer vers l’immoralité progressive. Dès lors toutes les forces qui conduisent à la richesse, telles que l’activité, l’économie, l’ordre, l’habileté, la bonne foi, sont les semences du vice ; tandis que celles qui nous retiennent dans la pauvreté, comme l’imprévoyance, la paresse, la débauche, l’incurie, sont les précieux germes de la vertu. Se pourrait-il concevoir, dans le monde moral, une dissonance plus décourageante ? et, s’il en était ainsi, qui donc oserait parler au peuple et formuler devant lui un conseil ? Tu te plains de tes souffrances, faudrait-il dire, et tu as hâte de les voir cesser. Tu gémis d’être sous le joug des besoins matériels les plus impérieux, et tu soupires après l’heure de l’affranchissement ; car tu voudrais aussi quelques loisirs pour développer tes facultés intellectuelles et affectives. C’est pour cela que tu cherches à faire entendre ta voix dans la région politique et à y stipuler pour tes intérêts. Mais sache bien ce que tu désires et combien le succès de tes vœux te serait fatal. Le bien-être, l’aisance, la richesse, développent le vice. Garde donc précieusement ta misère et ta vertu.
Les flatteurs du peuple tombent donc dans une contradiction manifeste, quand ils signalent la région de la richesse comme un impur cloaque d’égoïsme et de vice, et qu’en même temps ils le poussent, — et souvent, dans leur empressement, par les moyens les plus illégitimes, — vers cette néfaste région.
Non, un tel désaccord ne se peut rencontrer dans l’ordre naturel des sociétés. Il n’est pas possible que tous les hommes aspirent au bien-être, que la voie naturelle pour y arriver soit l’exercice des plus rudes vertus, et qu’ils n’y arrivent néanmoins que pour tomber sous le joug du vice. De telles déclamations ne sont propres qu’à allumer et entretenir les haines de classes. Vraies, elles placeraient l’humanité entre la misère ou l’immoralité. Fausses, elles font servir le mensonge au désordre, et, en les trompant, elles mettent aux prises les classes qui se devraient aimer et entr’aider.
Oui, l’inégalité factice, l’inégalité que la loi réalise en troublant l’ordre naturel du développement des diverses classes de la société, cette inégalité est pour toutes une source féconde d’irritation, de jalousie et de vices. C’est pourquoi il faut s’assurer enfin si cet ordre naturel ne conduit pas vers l’égalisation et l’amélioration progressive de toutes les classes : et nous serions arrêtés dans cette recherche par une fin de non-recevoir insurmontable, si ce double progrès matériel impliquait fatalement une double dégradation morale.
J’ai à faire sur les besoins humains une remarque importante, fondamentale même, en économie politique : c’est que les besoins ne sont pas une quantité fixe, immuable. Ils ne sont pas stationnaires, mais progressifs par nature.
Ce caractère se remarque même dans nos besoins les plus matériels : il devient plus sensible à mesure qu’on s’élève à ces désirs et à ces goûts intellectuels qui distinguent l’homme de la brute.
Il semble que, s’il est quelque chose en quoi les hommes doivent se ressembler, c’est le besoin d’alimentation, car, sauf les cas anormaux, les estomacs sont à peu près les mêmes.
Cependant les aliments qui auraient été recherchés à une époque sont devenus vulgaires à une autre époque, et le régime qui suffit à un lazzarone soumettrait un Hollandais à la torture. Ainsi ce besoin, le plus immédiat, le plus grossier, et, par conséquent, le plus uniforme de tous, varie encore suivant l’âge, le sexe, le tempérament, le climat et l’habitude.
Il en est ainsi de tous les autres. À peine l’homme est abrité qu’il veut se loger ; à peine il est vêtu, qu’il veut se décorer ; à peine il a satisfait les exigences de son corps, que l’étude, la science, l’art, ouvrent devant ses désirs un champ sans limites.
C’est un phénomène bien digne de remarque que la promptitude avec laquelle, par la continuité de la satisfaction, ce qui n’était d’abord qu’un vague désir devient un goût, et ce qui n’était qu’un goût se transforme en besoin et même en besoin impérieux.
Voyez ce rude et laborieux artisan. Habitué à une alimentation grossière, à d’humbles vêtements, à un logement médiocre, il lui semble qu’il serait le plus heureux des hommes, qu’il ne formerait plus de désirs, s’il pouvait arriver à ce degré de l’échelle qu’il aperçoit immédiatement au-dessus de lui. Il s’étonne que ceux qui y sont parvenus se tourmentent encore. En effet, vienne la modeste fortune qu’il a rêvée, et le voilà heureux ; heureux, — hélas ! pour quelques jours.
Car bientôt il se familiarise avec sa nouvelle position, et peu à peu il cesse même de sentir son prétendu bonheur. Il revêt avec indifférence ce vêtement après lequel il a soupiré. Il s’est fait un autre milieu, il fréquente d’autres personnes, il porte de temps en temps ses lèvres à une autre coupe, il aspire à monter un autre degré, et, pour peu qu’il fasse un retour sur lui-même, il sent bien que, si sa fortune a changé, son âme est restée ce qu’elle était, une source intarissable de désirs.
Il semble que la nature ait attaché cette singulière puissance à l’habitude, afin qu’elle fût en nous ce qu’est la roue à rochet en mécanique, et que l’humanité, toujours poussée vers des régions de plus en plus élevées, ne pût s’arrêter à aucun degré de civilisation.
Le sentiment de la dignité agit peut-être avec plus de force encore dans le même sens. La philosophie stoïcienne a souvent blâmé l’homme de vouloir plutôt paraître qu’être. Mais, en considérant les choses d’une manière générale, est-il bien sûr que le paraître ne soit pas pour l’homme un des modes de l’être ?
Quand, par le travail, l’ordre, l’économie, une famille s’élève de degré en degré vers ces régions sociales où les goûts deviennent de plus en plus délicats, les relations plus polies, les sentiments plus épurés, l’intelligence plus cultivée, qui ne sait de quelles douleurs poignantes est accompagné un retour de fortune qui la force à descendre ? C’est qu’alors le corps ne souffre pas seul. L’abaissement rompt des habitudes qui sont devenues, comme on dit, une seconde nature ; il froisse le sentiment de la dignité et avec lui toutes les puissances de l’âme. Aussi il n’est pas rare, dans ce cas, de voir la victime, succombant au désespoir, tomber sans transition dans un dégradant abrutissement. Il en est du milieu social comme de l’atmosphère. Le montagnard habitué à un air pur dépérit bientôt dans les rues étroites de nos cités.
J’entends qu’on me crie : Économiste, tu bronches déjà. Tu avais annoncé que ta science s’accordait avec la morale, et te voilà justifiant le sybaritisme. — Philosophe, dirai-je à mon tour, dépouille ces vêtements qui ne furent jamais ceux de l’homme primitif, brise tes meubles, brûles tes livres, nourris-toi de la chair crue des animaux, et je répondrai alors à ton objection. Il est trop commode de contester cette puissance de l’habitude dont on consent bien à être soi-même la preuve vivante.
On peut critiquer cette disposition que la nature a donnée à nos organes ; mais la critique ne fera pas qu’elle ne soit universelle. On la constate chez tous les peuples, anciens et modernes, sauvages et civilisés, aux antipodes comme en France. Sans elle il est impossible d’expliquer la civilisation. Or, quand une disposition du cœur humain est universelle et indestructible, est-il permis à la science sociale de n’en pas tenir compte ?
L’objection sera faite par des publicistes qui s’honorent d’être les disciples de Rousseau. Mais Rousseau n’a jamais nié le phénomène dont je parle. Il constate positivement et l’élasticité indéfinie des besoins, et la puissance de l’habitude, et le rôle même que je lui assigne, qui consiste à prévenir dans l’humanité un mouvement rétrograde. Seulement, ce que j’admire, il le déplore, et cela devait être. Rousseau suppose qu’il a été un temps où les hommes n’avaient ni droits, ni devoirs, ni relations, ni affections, ni langage, et c’est alors, selon lui, qu’ils étaient heureux et parfaits. Il devait donc abhorrer ce rouage de la mécanique sociale qui éloigne sans cesse l’humanité de la perfection idéale. Ceux qui pensent qu’au contraire la perfection n’est pas au commencement, mais à la fin de l’évolution humaine, admirent le ressort qui nous pousse en avant. Mais quant à l’existence et au jeu du ressort lui-même, nous sommes d’accord.
« Les hommes, dit-il, jouissant d’un fort grand loisir, employèrent à se procurer plusieurs sortes de commodités inconnues à leurs pères, et ce fut là le premier joug qu’ils s’imposèrent sans y songer, et la première source des maux qu’ils préparèrent à leurs descendants ; car, outre qu’ils continuèrent ainsi à s’amollir le corps et l’esprit, ces commodités ayant, par l’habitude, perdu presque tout leur agrément, et étant en même temps dégénérées en de vrais besoins, la privation en devint beaucoup plus cruelle que la possession n’en était douce, et l’on était malheureux de les perdre sans être heureux de les posséder. »
Rousseau était convaincu que Dieu, la nature et l’humanité avaient tort. Je sais que cette opinion domine encore beaucoup d’esprits, mais ce n’est pas la mienne.
Après tout, à Dieu ne plaise que je veuille m’élever ici contre le plus noble apanage, la plus belle vertu de l’homme, l’empire sur lui-même, la domination sur ses passions, la modération de ses désirs, le mépris des jouissances fastueuses ! Je ne dis pas qu’il doit se rendre esclave de tel ou tel besoin factice. Je dis que le besoin, considéré d’une manière générale et tel qu’il résulte de la nature à la fois corporelle et immatérielle de l’homme, combiné avec la puissance de l’habitude et le sentiment de la dignité, est indéfiniment expansible, parce qu’il naît d’une source intarissable, le désir. Qui blâmera l’homme opulent, s’il est sobre, peu recherché dans ses vêtements, s’il fuit le faste et la mollesse ? Mais n’est-il pas des désirs plus élevés auxquels il est permis de céder ? Le besoin de l’instruction a-t-il des limites ? Des efforts pour rendre service à son pays, pour encourager les arts, pour propager des idées utiles, pour secourir des frères malheureux, ont-ils rien d’incompatible avec l’usage bien entendu des richesses ?
Au surplus, que la philosophie le trouve bon ou mauvais, le besoin humain n’est pas une quantité fixe et immuable. C’est là un fait certain, irrécusable, universel. Sous aucun rapport, quant à l’alimentation, au logement, à l’instruction, les besoins du quatorzième siècle n’étaient ceux du nôtre, et l’on peut prédire que les nôtres n’égalent pas ceux auxquels nos descendants seront assujettis.
C’est, du reste, une observation qui est commune à tous les éléments qui entrent dans l’économie politique : richesses, travail, valeur, services, etc., toutes choses qui participent de l’extrême mobilité du sujet principal, l’homme. L’économie politique n’a pas, comme la géométrie ou la physique, l’avantage de spéculer sur les objets qui se laissent peser ou mesurer ; et c’est là une de ses difficultés d’abord, et puis une perpétuelle cause d’erreurs ; car, lorsque l’esprit humain s’applique à un ordre de phénomènes, il est naturellement enclin à chercher un criterium, une mesure commune à laquelle il puisse tout rapporter, afin de donner à la branche de connaissances dont il s’occupe le caractère d’une science exacte. Aussi nous voyons la plupart des auteurs chercher la fixité, les uns dans la valeur, les autres dans la monnaie, celui-ci dans le blé, celui-là dans le travail, c’est-à-dire dans la mobilité même.
Beaucoup d’erreurs économiques proviennent de ce que l’on considère les besoins humains comme une quantité donnée ; et c’est pourquoi j’ai cru devoir m’étendre sur ce sujet : Je ne crains pas d’anticiper en disant brièvement comment on raisonne. On prend toutes les satisfactions générales du temps où l’on est, et l’on suppose que l’humanité n’en admet pas d’autres. Dès lors, si la libéralité de la nature, ou la puissance des machines, ou des habitudes de tempérance et de modération viennent rendre disponible, pour un temps, une portion du travail humain, on s’inquiète de ce progrès, on le considère comme un désastre, on se retranche derrière des formules absurdes, mais spécieuses, telles que celles-ci : La production surabonde, nous périssons de pléthore ; la puissance de produire a dépassé la puissance de consommer, etc.
Il n’est pas possible de trouver une bonne solution à la question des machines, à celle de la concurrence extérieure, à celle du luxe, quand on considère le besoin comme une quantité invariable, quand on ne se rend pas compte de son expansibilité indéfinie.
Mais, si dans l’homme, le besoin est indéfini, progressif, doué de croissance comme le désir, source intarissable où il s’alimente sans cesse, il faut, sous peine de discordance et de contradiction dans les lois économiques de la société, que la nature ait placé dans l’homme et autour de lui des moyens indéfinis et progressifs de satisfaction, l’équilibre entre les moyens et la fin étant la première condition de toute harmonie. C’est ce que nous allons examiner.
J’ai dit, en commençant cet écrit, que l’économie politique avait pour l’objet l’homme considéré au point de vue de ses besoins et des moyens par lesquels il lui est donné d’y pourvoir.
Il est donc naturel de commencer par étudier l’homme et son organisation.
Mais nous avons vu aussi qu’il n’est pas un être solitaire ; si ses besoins et ses satisfactions, en vertu de la nature de la sensibilité, sont inséparables de son être, il n’en est pas de même de ses efforts qui naissent du principe actif. Ceux-ci sont susceptibles de transmission. En un mot, les hommes travaillent les uns pour les autres.
Or il arrive une chose fort singulière.
Quand on considère d’une manière générale et, pour ainsi dire, abstraite, l’homme, ses besoins, ses efforts, ses satisfactions, sa constitution, ses penchants, ses tendances, on aboutit à une série d’observations qui paraissent à l’abri du doute et se montrent dans tout l’éclat de l’évidence, chacun en trouvant la preuve en soi-même. C’est au point que l’écrivain ne sait trop comment s’y prendre pour soumettre au public des vérités si palpables et si vulgaires, il craint de provoquer le sourire du dédain. Il lui semble, avec quelque raison, que le lecteur courroucé va jeter le livre, en s’écriant : « Je ne perdrai pas mon temps à apprendre ces trivialités. »
Et cependant ces vérités, tenues pour si incontestables tant qu’elles sont présentées d’une manière générale, que nous souffrons à peine qu’elles nous soient rappelées, ne passent plus que pour des erreurs ridicules, des théories absurdes, aussitôt qu’on observe l’homme dans le milieu social. Qui jamais, en considérant l’homme isolé, s’aviserait de dire : La production surabonde ; la faculté de consommer ne peut suivre la faculté de produire ; le luxe et les goûts factices sont la source de la richesse ; l’invention des machines anéantit le travail ; et autres apophthegmes de la même force qui, appliqués à des agglomérations humaines, passent cependant pour des axiomes si bien établis, qu’on en fait la base de nos lois industrielles et commerciales ? L’échange produit à cet égard une illusion dont ne savent pas se préserver les esprits de la meilleure trempe, et j’affirme que l’économie politique aura atteint son but et rempli sa mission quand elle aura définitivement démontré ceci : Ce qui est vrai de l’homme est vrai de la société. L’homme isolé est à la fois producteur et consommateur, inventeur et entrepreneur, capitaliste et ouvrier ; tous les phénomènes économiques s’accomplissent en lui, et il est comme un résumé de la société. De même l’humanité, vue dans son ensemble, est un homme immense, collectif, multiple, auquel s’appliquent exactement les vérités observées sur l’individualité même.
J’avais besoin de faire cette remarque, qui, je l’espère, sera mieux justifiée par la suite, avant de continuer ces études sur l’homme. Sans cela, j’aurais craint que le lecteur ne rejetât, comme superflus, les développements, les véritables truismes qui vont suivre.
Je viens de parler des besoins de l’homme, et, après en avoir présenté une énumération approximative, j’ai fait observer qu’ils n’étaient pas d’une nature stationnaire, mais progressive ; cela est vrai, soit qu’on les considère chacun en lui-même, soit surtout qu’on embrasse leur ensemble dans l’ordre physique, intellectuel et moral. Comment en pourrait-il être autrement ? Il est des besoins dont la satisfaction est exigée, sous peine de mort, par notre organisation ; et, jusqu’à un certain point, on pourrait soutenir que ceux-là sont des quantités fixes, encore que cela ne soit certes pas rigoureusement exact : car, pour peu qu’on veuille bien ne pas négliger un élément essentiel, la puissance de l’habitude, et pour peu qu’on condescende à s’examiner soi-même avec quelque bonne foi, on sera forcé de convenir que les besoins, même les plus grossiers, comme celui de manger, subissent, sous l’influence de l’habitude, d’incontestables transformations ; et tel qui déclamera ici contre cette remarque, la taxant de matérialisme et d’épicurisme, se trouverait bien malheureux si, le prenant au mot, on le réduisait au brouet noir des Spartiates ou à la pitance d’un anachorète. Mais, en tout cas, quand les besoins de cet ordre sont satisfaits d’une manière assurée et permanente, il en est d’autres qui prennent leur source dans la plus expansible de nos facultés, le désir. Conçoit-on un moment où l’homme ne puisse plus former de désirs, même raisonnables ? N’oublions pas qu’un désir qui est déraisonnable à un certain degré de civilisation, à une époque où toutes les puissances humaines sont absorbées pour la satisfaction des besoins inférieurs, cesse d’être tel quand le perfectionnement de ces puissances ouvre devant elles un champ plus étendu. C’est ainsi qu’il eût été déraisonnable, il y a deux siècles, et qu’il ne l’est pas aujourd’hui, d’aspirer à faire dix lieues à l’heure. Prétendre que les besoins et les désirs de l’homme sont des quantités fixes et stationnaires, c’est méconnaitre la nature de l’âme, c’est nier les faits, c’est rendre la civilisation inexplicable.
Elle serait inexplicable encore, si, côté du développement indéfini des besoins, ne venait se placer, comme possible, le développement indéfini des moyens d’y pourvoir. Qu’importerait, pour la réalisation du progrès, la nature expansible des besoins, si, à une certaine limite, nos facultés ne pouvaient plus avancer, si elles rencontreraient une borne immuable ?
Ainsi, à moins que la nature, la Providence, quelle que soit la puissance qui préside à nos destinées, ne soit tombée dans la plus choquante, la plus cruelle contradiction, nos désirs étant indéfinis, la présomption est que nos moyens d’y pourvoir le sont aussi.
Je dis indéfinis et non point infinis, car rien de ce qui tient à l’homme n’est infini. C’est précisément parce que nos désirs et nos facultés se développent dans l’infini, qu’ils n’ont pas de limites assignables, quoiqu’ils aient des limites absolues. On peut citer une multitude de points, au-dessus de l’humanité, auxquels elle ne parviendra jamais, sans qu’on puisse dire pour cela qu’il arrivera un instant où elle cessera de s’en approcher[226] .
Je ne voudrais pas dire non plus que le désir et le moyen marchent parallèlement et d’un pas égal. Le désir court, et le moyen suit en boitant.
Cette nature prompte et aventureuse du désir, comparée à la lenteur de nos facultés, nous avertit qu’à tous les degrés de la civilisation, à tous les échelons du progrès, la souffrance dans une certaine mesure est et sera toujours le partage de l’homme. Mais elle nous enseigne aussi que cette souffrance a une mission, puisqu’il serait impossible de comprendre que le désir fût l’aiguillon de nos facultés, s’il les suivait au lieu de les précéder. Cependant n’accusons pas la nature d’avoir mis de la cruauté dans ce mécanisme, car il faut remarquer que le désir ne se transforme en véritable besoin, c’est-à-dire en désir douloureux, que lorsqu’il a été fait tel par l’habitude d’une satisfaction permanente, en d’autres termes, quand le moyen a été trouvé et mis irrévocablement à notre portée[227] .
Nous avons aujourd’hui à examiner cette question : Quels sont les moyens que nous avons de pourvoir à nos besoins ?
Il me semble évident qu’il y en a deux : la Nature et le Travail, les dons de Dieu et les fruits de nos efforts, ou si l’on veut, l’application de nos facultés aux choses que la nature a mises à notre service.
Aucune école, que je sache, n’a attribué à la nature 'seule la satisfaction de nos besoins. Une telle assertion est trop démentie par l’expérience, et nous n’avons pas à étudier l’économie politique pour nous apercevoir que l’intervention de nos facultés est nécessaire.
Mais il y a des écoles qui ont rapporté au travail seul ce privilége. Leur axiome est : Toute richesse vient du travail ; le travail, c’est la richesse.
Je ne puis m’empêcher de prévenir ici que ces formules, prises au pied de la lettre, ont conduit à des erreurs de doctrine énormes et, par suite, à des mesures législatives déplorables. J’en parlerai ailleurs.
Ici je me borne à établir, en fait, que la nature et le travail coopèrent à la satisfaction de nos besoins et de nos désirs.
Examinons les faits.
Le premier besoin que nous avons placé en tête de notre nomenclature, c’est celui de respirer. À cet égard, nous avons déjà constaté que la nature fait, en général, tous les frais, et que le travail humain n’a à intervenir que dans certains cas exceptionnels, comme, par exemple, quand il est nécessaire de purifier l’air.
Le besoin de nous désaltérer est plus ou moins satisfait par la Nature, selon qu’elle nous fournit une eau plus ou moins rapprochée, limpide, abondante ; et le Travail a à concourir d’autant plus, qu’il faut aller chercher l’eau plus loin, la clarifier, suppléer à sa rareté par des puits et des citernes.
La nature n’est pas non plus uniformément libérale envers nous quant à l’alimentation ; car qui dira que le travail qui reste à notre charge soit toujours le même, si le terrain est fertile ou s’il est ingrat, si la forêt est giboyeuse, si la rivière est poissonneuse, ou dans les hypothèses contraires ?
Pour l’éclairage, le travail humain a certainement moins à faire là où la nuit est courte que là où il a plu au soleil qu’elle fût longue.
Je n’oserais pas poser ceci comme une règle absolue, mais il me semble qu’à mesure qu’on s’élève dans l’échelle des besoins, la coopération de la nature s’amoindrit et laisse plus de place à nos facultés. Le peintre, le statuaire, l’écrivain même sont réduits à s’aider de matériaux et d’instruments que la nature seule fournit ; mais il faut avouer qu’ils puisent dans leur propre génie ce qui fait le charme, le mérite, l’utilité et la valeur de leurs œuvres. Apprendre est un besoin que satisfait presque exclusivement l’exercice bien dirigé de nos facultés intellectuelles. Cependant, ne pourrait-on pas dire qu’ici encore la nature nous aide en nous offrant, à des degrés divers, des objets d’observation et de comparaison ? À travail égal, la botanique, la géologie, l’histoire naturelle peuvent-elles faire partout des progrès égaux ?
Il serait superflu de citer d’autres exemples. Nous pouvons déjà constater que la Nature nous donne des moyens de satisfaction à des degrés plus ou moins avancés d’utilité (ce mot est pris dans le sens étymologique, propriété de servir). Dans beaucoup de cas, dans presque tous les cas, il reste quelque chose à faire au travail pour rendre cette utilité complète ; et l’on comprend que cette action du travail est susceptible de plus ou moins, dans chaque circonstance donnée, selon que la nature a elle-même plus ou moins avancé l’opération.
On peut donc poser ces deux formules :
1° L’utilité est communiquée, quelquefois par la nature seule, quelquefois par le travail seul, presque toujours par la coopération de la Nature et du Travail.
2° Pour amener une chose à son état complet d’utilité, l’action du Travail est en raison inverse de l’action de la Nature.
De ces deux propositions combinées avec ce que nous avons dit de l’expansibilité indéfinie des besoins, qu’il me soit permis de tirer une déduction dont la suite démontrera l’importance. Si deux hommes supposés être sans relations entre eux se trouvent placés dans des situations inégales, de telle sorte que la nature, libérale pour l’un, ait été avare pour l’autre, le premier aura évidemment moins de travail à faire pour chaque satisfaction donnée ; s’ensuit-il que cette partie de ses forces, pour ainsi dire laissées ainsi en disponibilité, sera nécessairement frappée d’inertie, et que cet homme, à cause de la libéralité de la nature, sera réduit à une oisiveté forcée ? Non ; ce qui s’ensuit, c’est qu’il pourra, s’il le veut, disposer de ces forces pour agrandir le cercle de ses jouissances ; qu’à travail égal il se procurera deux satisfactions au lieu d’une ; en un mot, que le progrès lui sera plus facile.
Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble qu’aucune science, pas même la géométrie, ne présente, à son point de départ, des vérités plus inattaquables. Que si l’on venait à me prouver, cependant, que toutes ces vérités sont autant d’erreurs, on aurait détruit en moi non-seulement la confiance qu’elles m’inspirent, mais la base de toute certitude et la foi en l’évidence même ; car de quel raisonnement se pourrait-on servir, qui méritât mieux l’acquiescement de la raison que celui qu’on aurait renversé ? Le jour où l’on aura trouvé un axiome qui contredise cet autre axiome : La ligne droite est le plus court chemin d’un point à un autre, ce jour-là l’esprit humain n’aura plus d’autre refuge, si c’en est un, que le scepticisme absolu.
Aussi j’éprouve une véritable confusion à insister sur des vérités primordiales si claires qu’elles en semblent puériles.
Cependant, il faut bien le dire, à travers les complications des transactions humaines, ces simples vérités ont été méconnues ; et, pour me justifier auprès du lecteur de le retenir si longtemps sur ce que les Anglais appellent des truismes, je lui signalerai ici le singulier égarement auquel d’excellents esprits se sont laissé entraîner. Mettant de côté, négligeant entièrement la coopération de la nature, relativement à la satisfaction de nos besoins, ils ont posé ce principe absolu : Toute richesse vient du travail. Sur cette prémisse ils ont bâti le syllogisme suivant :
« Toute richesse vient du travail ;
Donc la richesse est proportionnelle au travail.
Or le travail est en raison inverse de la libéralité de la nature ;
Donc la richesse est en raison inverse de la libéralité de la nature ! »
Et, qu’on le veuille ou non, beaucoup de nos lois économiques ont été inspirées par ce singulier raisonnement. Ces lois ne peuvent qu’être funestes au développement et à la distribution des richesses. C’est là ce qui me justifie de préparer d’avance, par l’exposition de vérités fort triviales en apparence, la réfutation d’erreurs et de préjugés déplorables, sous lesquels se débat la société actuelle.
Décomposons maintenant ce concours de la nature.
Elle met deux choses à notre disposition : des matériaux et des forces.
La plupart des objets matériels qui servent à la satisfaction de nos besoins et de nos désirs ne sont amenés à l’état d’utilité qui les rend propres à notre usage que par l’intermédiaire du travail, par l’application des facultés humaines. Mais, en tout cas, les éléments, les atomes, si l’on veut, dont ces objets sont composés, sont des dons, et j’ajoute, des dons gratuits de la nature. Cette observation est de la plus haute importance, et jettera, je crois, un jour nouveau sur la théorie de la richesse.
Je désire que le lecteur veuille bien se rappeler que j’étudie ici d’une manière générale la constitution physique et morale de l’homme, ses besoins, ses facultés et ses relations avec la nature, abstraction faite de l’échange, que je n’aborderai que dans le chapitre suivant ; nous verrons alors en quoi et comment les transactions sociales modifient les phénomènes.
Il est bien évident que si l’homme isolé doit, pour parler ainsi, acheter la plupart de ses satisfactions par un travail, par un effort, il est rigoureusement exact de dire qu’avant qu’aucun travail, aucun effort de sa part soit intervenu, les matériaux qu’il trouve à sa portée sont des dons gratuits de la nature. Après le premier effort, quelque léger qu’il soit, ils cessent d’être gratuits ; et, si le langage de l’économie politique eût toujours été exact, c’est à cet état des objets matériels, antérieurement à toute action humaine, qu’eût été réservé le nom de matières premières.
Je répète ici que cette gratuité des dons de la nature, avant l’intervention du travail, est de la plus haute importance. En effet, j’ai dit dans le second chapitre que l’économie politique était la théorie de la valeur. J’ajoute maintenant, et par anticipation, que les choses ne commencent à avoir de la valeur que lorsque le travail leur en donne. Je prétends démontrer, plus tard, que tout ce qui est gratuit pour l’homme isolé reste gratuit pour l’homme social, et que les dons gratuits de la nature, quelle qu’en soit l’utilité, n’ont pas de valeur. Je dis qu’un homme qui recueille directement et sans aucun effort un bienfait de la nature, ne peut être considéré comme se rendant à lui-même un service onéreux, et que, par conséquent, il ne peut rendre aucun service à autrui à l’occasion de choses communes à tous. Or, où il n’y a pas de services rendus et reçus, il n’y a pas de valeur.
Tout ce que je dis ici des matériaux s’applique aussi aux forces que nous fournit la nature. La gravitation, l’élasticité des gaz, la puissance des vents, les lois de l’équilibre, la vie végétale, la vie animale, ce sont autant de forces que nous apprenons à faire tourner à notre avantage. La peine, l’intelligence que nous dépensons pour cela sont toujours susceptibles de rémunération, car nous ne pouvons être tenus de consacrer gratuitement nos efforts à l’avantage d’autrui. Mais ces forces naturelles, considérées en elles-mêmes, et abstraction faite de tout travail intellectuel ou musculaire, sont des dons gratuits de la Providence ; et, à ce titre, elles restent sans valeur à travers toutes les complications des transactions humaines. C’est la pensée dominante de cet écrit.
Cette observation aurait peu d’importance, je l’avoue, si la coopération naturelle était constamment uniforme, si chaque homme, en tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances, recevait de la nature un concours toujours égal, invariable. En ce cas, la science serait excusable de ne pas tenir compte d’un élément qui, restant toujours et partout le même, affecterait les services échangés dans des proportions exactes de toutes parts. Comme on élimine, en géométrie, les portions de lignes communes aux deux figures comparées, elle pourrait négliger cette coopération immuablement présente, et se contenter de dire, ainsi qu’elle l’a fait jusqu’ici : « Il y a des richesses naturelles ; l’économie politique le constate une fois pour toutes et ne s’en occupe plus. »
Mais les choses ne se passent pas ainsi. La tendance invincible de l’intelligence humaine, en cela stimulée par l’intérêt et secondée par la série des découvertes, est de substituer le concours naturel et gratuit au concours humain et onéreux, de telle sorte qu’une utilité donné, quoique restant la même quand à son résultat, quant à la satisfaction qu’elle procure, répond cependant à un travail de plus en plus réduit. Certes il est impossible de ne pas apercevoir l’immense influence de ce merveilleux phénomène sur la notion de la Valeur. Car qu’en résulte-t-il ? C’est qu’en tout produit la partie gratuite tend à remplacer la partie onéreuse. C’est que l’utilité étant une résultante de deux collaborations, dont l’une se rémunère et l’autre ne se rémunère pas, la Valeur, qui n’a de rapport qu’avec la première de ces collaborations, diminue pour une utilité identique, à mesure que la nature est contrainte à un concours plus efficace. En sorte qu’on peut dire que l’humanité a d’autant plus de satisfactions ou de richesses, qu’elle a moins de valeurs. Or, la plupart des auteurs ayant établi une sorte de synonymie entre ces trois expressions, utilité, richesses, valeurs, il en est résulté une théorie non-seulement fausse, mais en sens inverse de la vérité. Je crois sincèrement qu’une description plus exacte de cette combinaison des forces naturelles et des forces humaines, dans l’œuvre de la production, autrement dit une définition plus juste de la Valeur, fera cesser des confusions théoriques inextricables, et conciliera des écoles aujourd’hui divergentes ; et si j’anticipe aujourd’hui sur la suite de cette exposition, c’est pour me justifier auprès du lecteur de m’arrêter sur des notions dont il lui serait difficile sans cela de s’expliquer l’importance.
Après cette digression je reprends mon étude sur l’homme considéré uniquement au point de vue économique.
Une autre observation due à J. B. Say, et qui saute aux yeux par son évidence, quoique trop souvent négligée par beaucoup d’auteurs, c’est que l’homme ne crée ni les matériaux ni les forces de la nature, si l’on prend le mot créer dans son acception rigoureuse. Ces matériaux, ces forces, existent par eux-mêmes. L’homme se borne à les combiner, à les déplacer pour son avantage ou pour l’avantage d’autrui. Si c’est pour son avantage, il se rend service à lui-même. Si c’est pour l’avantage d’autrui, il rend service à son semblable, et est en droit d’en exiger un service équivalent ; d’où il suit encore que la valeur est proportionnelle au service rendu, et non point du tout à l’utilité absolue de la chose. Car cette utilité peut être, en très-grande partie, le résultat de l’action gratuite de la nature, auquel cas le service humain, le service onéreux et rémunérable, est de peu de valeur. Cela résulte de l’axiome établi ci-dessus : Pour amener une chose à l’état complet d’utilité, l’action de l’homme est en raison inverse de l’action de la nature.
Cette observation renverse la doctrine qui place la valeur dans la matérialité des choses. C’est le contraire qui est vrai. La matérialité est une qualité donnée par la nature, et par conséquent gratuite, dépourvue de valeur, quoique d’une utilité incontestable. L’action humaine, laquelle ne peut jamais arriver à créer de la matière, constitue seule le service que l’homme isolé se rend à lui-même ou que les hommes en société se rendent les uns aux autres, et c’est la libre appréciation de ces services qui est le fondement de la valeur ; bien loin donc que, comme le voulait Smith, la Valeur ne se puisse concevoir qu’incorporée dans la Matière, entre matière et valeur il n’y a pas de rapports possibles.
La doctrine erronée à laquelle je fais allusion avait rigoureusement déduit de son principe que ces classes seules sont productives qui opèrent sur la matière. Smith avait ainsi préparé l’erreur des socialistes modernes qui ne cessent de représenter comme des parasites improductifs ce qu’ils appellent les intermédiaires entre le producteur et le consommateur, tels que le négociant, le marchand, etc. Rendent-ils des services ? Nous épargnent-ils une peine en se la donnant pour nous ? En ce cas, ils créent de la valeur, quoiqu’ils ne créent pas de la matière ; et même, comme nul ne crée de la matière, comme nous nous bornons tous à nous rendre des services réciproques, il est très-exact de dire que nous sommes tous, y compris les agriculteurs et les fabricants, des intermédiaires à l’égard les uns des autres.
Voilà ce que j’avais à dire, pour le moment, sur le concours de la nature. Elle met à notre disposition, dans une mesure fort diverse selon les climats, les saisons et l’avancement de nos connaissances, mais toujours gratuitement, des matériaux et des forces. Donc ces matériaux et ces forces n’ont pas de valeur : il serait bien étrange qu’ils en eussent. D’après quelle règle l’estimerions-nous ? Comment comprendre que la nature se fasse payer, rétribuer, rémunérer ? Nous verrons plus tard que l’échange est nécessaire pour déterminer la valeur. Nous n’achetons pas les biens naturels, nous les recueillons, et si, pour les recueillir, il faut faire un effort quelconque, c’est dans cet effort, non dans le don de la nature, qu’est le principe de la valeur.
Passons à l’action de l’homme, désigné d’une manière générale sous le nom de travail.
Le mot travail, comme presque tous ceux qu’emploie l’économie politique, est fort vague ; chaque auteur lui donne un sens plus ou moins étendu. L’économie politique n’a pas eu, comme la plupart des sciences, la chimie par exemple, l’avantage de faire son vocabulaire. Traitant de choses qui occupent les hommes depuis le commencement du monde et font le sujet habituel de leurs conversations, elle a trouvé des expressions toutes faites, et est forcée de s’en servir.
On restreint souvent le sens du mot travail à l’action presque exclusivement musculaire de l’homme sur les choses. C’est ainsi qu’on appelle classes travailleuses celles qui exécutent la partie mécanique de la production.
Le lecteur comprendra que je donne à ce mot un sens plus étendu. J’entends par travail l’application de nos facultés à la satisfaction de nos besoins. Besoin, effort, satisfaction, voilà le cercle de l’économie politique. L’effort peut être physique, intellectuel ou même moral, comme nous allons le voir.
Il n’est pas nécessaire de montrer ici que tous nos organes, toutes ou presque toutes nos facultés peuvent concourir et concourent en effet à la production. L’attention, la sagacité, l’intelligence, l’imagination, y ont certainement leur part.
M. Dunoyer, dans son beau livre sur la Liberté du travail, a fait entrer, et cela avec toute la rigueur scientifique, nos facultés morales parmi les éléments auxquels nous devons nos richesses ; c’est une idée neuve et féconde autant que juste ; elle est destinée à agrandir et ennoblir le champ de l’économie politique.
Je n’insisterai ici sur cette idée qu’autant qu’elle me fournit l’occasion de jeter une première lueur sur l’origine d’un puissant agent de production, dont je n’ai pas encore parlé : le capital.
Si nous examinons successivement les objets matériels qui servent à la satisfaction de nos besoins, nous reconnaîtrons sans peine que tous ou presque tous exigent, pour être confectionnés, plus de temps, une plus grande portion de notre vie que l’homme n’en peut dépenser sans réparer ses forces, c’est-à-dire sans satisfaire des besoins. Cela suppose donc que ceux qui ont exécuté ces choses avaient préalablement réservé, mis de côté, accumulé des provisions pour vivre pendant l’opération.
Il en est de même pour les satisfactions où n’apparaît rien de matériel. Un prêtre ne pourrait se consacrer à la prédication, un professeur à l’enseignement, un magistrat au maintien de l’ordre, si par eux-mêmes ou par d’autres ils ne trouvaient à leur portée des moyens d’existence tout créés.
Remontons plus haut. Supposons un homme isolé et réduit à vivre de chasse. Il est aisé de comprendre que si, chaque soir, il avait consommé tout le gibier pris dans la journée, jamais il ne pourrait entreprendre aucun autre ouvrage, bâtir une hutte, réparer ses armes ; tout progrès lui serait à jamais interdit.
Ce n’est pas ici le lieu de définir la nature et les fonctions du Capital ; mon seul but est de faire voir que certaines vertus morales concourent très-directement à l’amélioration de notre condition, même au point de vue exclusif des richesses, et, entre autres, l’ordre, la prévoyance, l’empire sur soi-même, l’économie.
Prévoir est un des beaux priviléges de l’homme, et il est à peine nécessaire de dire que, dans presque toutes les circonstances de la vie, celui-là a des chances plus favorables qui sait le mieux quelles seront les conséquences de ses déterminations et de ses actes.
Réprimer ses appétits, gouverner ses passions, sacrifier le présent à l’avenir, se soumettre à une privation actuelle en vue d’un avantage supérieur mais éloigné, ce sont des conditions essentielles pour la formation des capitaux ; et les capitaux, nous l’avons entrevu, sont eux-mêmes la condition essentielle de tout travail un peu compliqué ou prolongé. Il est de toute évidence que si deux hommes étaient placés dans des conditions parfaitement identiques, si on leur supposait, en outre, le même degré d’intelligence et d’activité, celui-là ferait plus de progrès qui, accumulant des provisions, se mettrait à même d’entreprendre des ouvrages de longue haleine, de perfectionner ses instruments, et de faire concourir ainsi les forces de la nature à la réalisation de ses desseins.
Je n’insisterai pas là-dessus ; il suffit de jeter un regard autour de soi pour rester convaincu que toutes nos forces, toutes nos facultés, toutes nos vertus, concourent à l’avancement de l’homme et de la société.
Par la même raison, il n’est aucun de nos vices qui ne soit une cause directe ou indirecte de misère. La paresse paralyse le nerf même de la production, l’effort. L’ignorance et l’erreur lui donnent une fausse direction ; l’imprévoyance nous prépare des déceptions ; l’abandon aux appétits du moment empêche l’accumulation ou la formation du capital ; la vanité nous conduit à consacrer nos efforts à des satisfactions factices, aux dépens de satisfactions réelles ; la violence, la ruse, provoquant des représailles, nous forcent à nous environner de précautions onéreuses, et entraînent ainsi une plus grande déperdition de forces.
Je terminerai cette étude préliminaire de l’homme par une observation que j’ai déjà faite à l’occasion des besoins. C’est que les éléments signalés dans ce chapitre, qui entrent, dans la science économique et la constituent, sont essentiellement mobiles et divers. Besoins, désirs, matériaux et puissances fournis par la nature, forces musculaires, organes, facultés intellectuelles, qualités morales ; tout cela est variable selon l’individu, le temps et le lieu. Il n’y a pas deux hommes qui se ressemblent sous chacun de ces rapports, ni, à plus forte raison, sur tous ; bien plus, aucun homme ne se ressemble exactement à lui-même deux heures de suite ; ce que l’un sait, l’autre l’ignore ; ce que celui-ci apprécie, celui-là le dédaigne ; ici, la nature a été prodigue, là, avare ; une vertu qui est difficile à pratiquer à un certain degré de température devient facile sous un autre climat. La science économique n’a donc pas, comme les sciences dites exactes, l’avantage de posséder une mesure, un absolu auquel elle peut tout rapporter, une ligne graduée, un mètre qui lui serve à mesurer l’intensité des désirs, des efforts et des satisfactions. Si nous étions voués au travail solitaire, comme certains animaux, nous serions tous placés dans des circonstances différant par quelques points, et, ces circonstances extérieures fussent-elles semblables, le milieu dans lequel nous agirions fût-il identique pour tous, nous différerions encore par nos désirs, nos besoins, nos idées, notre sagacité, notre énergie, notre manière d’estimer et d’apprécier les choses, notre prévoyance, notre activité ; en sorte qu’une grande et inévitable inégalité se manifesterait parmi les hommes. Certes l’isolement absolu, l’absence de toutes relations entre les hommes, ce n’est qu’une vision chimérique née dans l’imagination de Rousseau. Mais à supposer que cet état antisocial dit état de nature ait jamais existé, je me demande par quelle série d’idées Rousseau et ses adeptes sont arrivés à y placer l’égalité ? Nous verrons plus tard qu’elle est, comme la richesse, comme la liberté, comme la fraternité, comme l’unité, une fin et non un point de départ. Elle surgit du développement naturel et régulier des sociétés. L’humanité ne s’en éloigne pas, elle y tend. C’est plus consolant et plus vrai.
Après avoir parlé de nos besoins et des moyens que nous avons d’y pourvoir, il me reste à dire un mot de nos satisfactions. Elles sont la résultante du mécanisme entier. C’est par le plus ou moins de satisfactions physiques, intellectuelles et morales dont jouit l’humanité, que nous reconnaissons si la machine fonctionne bien ou mal. C’est pourquoi le mot consommation, adopté par les économistes, aurait un sens profond, si, lui conservant sa signification étymologique, on en faisait le synonyme de fin, accomplissement. Par malheur, dans le langage vulgaire et même dans la langue scientifique, il présente à l’esprit un sens matériel et grossier, exact sans doute quant aux besoins physiques, mais qui cesse de l’être à l’égard des besoins d’un ordre plus élevé. La culture du blé, le tissage de la laine, se terminent par une consommation. En est-il de même des travaux de l’artiste, des chants du poëte, des méditations du jurisconsulte, des enseignements du professeur, des prédications du prêtre ? Ici encore nous retrouvons les inconvénients de cette erreur fondamentale qui détermina A. Smith à circonscrire l’économie politique dans un cercle de matérialité : et le lecteur me pardonnera de me servir souvent du mot satisfaction, comme s’appliquant à tous nos besoins et à tous nos désirs, comme répondant mieux au cadre élargi que j’ai cru pouvoir donner à la science.
On a souvent reproché aux économistes de se préoccuper exclusivement des intérêts du consommateur : « Vous oubliez le producteur, » ajoutait-on. Mais la satisfaction étant le but, la fin de tous les efforts, et comme la grande consommation des phénomènes économiques, n’est-il pas évident que c’est en elle qu’est la pierre de touche du progrès ? Le bien-être d’un homme ne se mesure pas à ses efforts, mais à ses satisfactions ; cela est vrai aussi pour les agglomérations d’hommes. C’est encore là une de ces vérités que nul ne conteste quand il s’agit de l’homme isolé, et contre laquelle on dispute sans cesse dès qu’elle est appliquée à la société. La phrase incriminée n’a pas un autre sens que celui-ci : toute mesure économique s’apprécie, non par le travail qu’elle provoque, mais par l’effet définitif qui en résulte, lequel se résout en accroissement ou diminution du bien-être général.
Nous avons dit, à propos des besoins et des désirs, qu’il n’y a pas deux hommes qui se ressemblent. Il en est de même pour nos satisfactions. Elles ne sont pas également appréciées par tous ; ce qui revient à cette banalité : les goûts diffèrent. Or c’est la vivacité des désirs, la variété des goûts, qui déterminent la direction des efforts. Ici l’influence de la morale sur l’industrie est manifeste. On peut concevoir un homme isolé, esclave de goûts factices, puérils, immoraux. En ce cas, il saute aux yeux que ses forces, qui sont limitées, ne satisferont des désirs dépravés qu’aux dépens de désirs plus intelligents et mieux entendus. Mais est-il question de la société, cet axiome évident est considéré comme une erreur. On est porté à croire que les goûts factices, les satisfactions illusoires, que l’on reconnaît être une source de misère individuelle, sont néanmoins une source de richesses nationales, parce qu’ils ouvrent des débouchés à une foule d’industries. S’il en était ainsi, nous arriverions à une conclusion bien triste : c’est que l’état social place l’homme entre la misère et l’immoralité. Encore une fois, l’économie politique résout de la manière la plus satisfaisante et la plus rigoureuse ces apparentes contradictions.
IV. Échange↩
L’Échange, c’est l’Économie politique, c’est la Société tout entière ; car il est impossible de concevoir la Société sans Échange, ni l’Échange sans Société. Aussi n’ai-je pas la prétention d’épuiser dans ce chapitre un si vaste sujet. À peine le livre entier en offrira-t-il une ébauche.
Si les hommes, comme les colimaçons, vivaient dans un complet isolement les uns des autres, s’ils n’échangeaient pas leurs travaux et leurs idées, s’il n’opéraient pas entre eux de transactions, il pourrait y avoir des multitudes, des unités humaines, des individualités juxtaposées ; il n’y aurait pas de Société.
Que dis-je ? il n’y aurait pas même d’individualités. Pour l’homme, l’isolement c’est la mort. Or, si, hors de la société, il ne peut vivre, la conclusion rigoureuse, c’est que son état de nature c’est l’état social.
Toutes les sciences aboutissent à cette vérité si méconnue du XVIIIe siècle, qui fondait la politique et la morale sur l’assertion contraire. Alors on ne se contentait pas d’opposer l’état de nature à l’état social, on donnait au premier sur le second une prééminence décidée. « Heureux les hommes, avait dit Montaigne, quand ils vivaient sans liens, sans lois, sans langage, sans religion ! » On sait que le système de Rousseau, qui a exercé et exerce encore une si grande influence sur les opinions et sur les faits, repose tout entier sur cette hypothèse qu’un jour les hommes, pour leur malheur, convinrent d’abandonner l’innocent état de nature pour l’orageux état de société.
Il n’entre pas dans l’objet de ce chapitre de rassembler toutes les réfutations qu’on peut faire de cette erreur fondamentale, la plus funeste qui ait jamais infecté les sciences politiques ; car, si la société est d’invention et de convention, il s’ensuit que chacun peut inventer une nouvelle forme sociale, et telle a été en effet, depuis Rousseau, la direction des esprits. Il me serait, je crois, facile de démontrer que l’isolement exclut le langage, comme l’absence du langage exclut la pensée ; et certes l’homme moins la pensée, bien loin d’être l’homme de la nature, n’est pas même l’homme.
Mais une réfutation péremptoire de l’idée sur laquelle repose la doctrine de Rousseau sortira directement, sans que nous la cherchions, de quelques considérations sur l’Échange.
Besoin, effort, satisfaction : voilà l’homme, au point de vue économique.
Nous avons vu que les deux termes extrêmes étaient essentiellement intransmissibles, car ils s’accomplissent dans la sensation, ils sont la sensation même, qui est tout ce qu’il y a de plus personnel au monde, aussi bien celle qui précède l’effort et le détermine, que celle qui le suit et en est la récompense.
C’est donc l’Effort qui s’échange, et cela ne peut être autrement, puisque échange implique activité, et que l’effort seul manifeste notre principe actif. Nous ne pouvons souffrir ou jouir les uns pour les autres, encore que nous soyons sensibles aux peines et aux plaisirs d’autrui. Mais nous pouvons nous entr’aider, travailler les uns pour les autres, nous rendre des services réciproques, mettre nos facultés, ou ce qui en provient, au service d’autrui, à charge de revanche. C’est la société. Les causes, les effets, les lois de ces échanges constituent l’économie politique et sociale.
Non-seulement nous le pouvons, mais nous le faisons nécessairement. Ce que j’affirme, c’est ceci : Que notre organisation est telle que nous sommes tenus de travailler les uns pour les autres, sous peine de mort et de mort immédiate. Si cela est, la société est notre état de nature, puisque c’est le seul où il nous soit donné de vivre.
Il y a, en effet, une remarque à faire sur l’équilibre des besoins et des facultés, remarque qui m’a toujours saisi d’admiration pour le plan providentiel qui régit nos destinées.
Dans l’isolement, nos besoins surpassent nos facultés.
Dans l’état social, nos facultés surpassent nos besoins.
Il suit de là que l’homme isolé ne peut vivre ; tandis que, chez l’homme social, les besoins les plus impérieux font place à des désirs d’un ordre plus élevé, et ainsi progressivement dans une carrière de perfectibilité à laquelle nul ne saurait assigner de limites.
Ce n’est pas là de la déclamation, mais une assertion susceptible d’être rigoureusement démontrée par le raisonnement et par l’analogie, sinon par l’expérience. Et pourquoi ne peut-elle être démontrée par l’expérience, par l’observation directe ? Précisément parce qu’elle est vraie, précisément parce que, l’homme ne pouvant vivre dans l’isolement, il devient impossible de montrer, sur la nature vivante, les effets de la solitude absolue. Les sens ne peuvent saisir une négation. On peut prouver à mon esprit qu’un triangle n’a jamais quatre côtés ; on ne peut, à l’appui, offrir à mes yeux un triangle tétragone. Si on le faisait, l’assertion serait détruite par cette exhibition même. De même, me demander une preuve expérimentale, exiger de moi que j’étudie les conséquences de l’isolement sur la nature vivante, c’est m’imposer une contradiction, puisque, pour l’homme, isolement et vie s’excluant, on n’a jamais vu et on ne verra jamais des hommes sans relations.
S’il y a des animaux, ce que j’ignore, destinés par leur organisme à parcourir dans l’isolement absolu le cercle de leur existence, il est bien clair que la nature a dû mettre entre leurs besoins et leurs facultés une proportion exacte. On pourrait encore comprendre que leurs facultés fussent supérieures ; en ce cas, ces animaux seraient perfectibles et progressifs. L’équilibre exact en fait des être stationnaires, mais la supériorité des besoins ne se peut concevoir. Il faut que dès leur naissance, dès leur première apparition dans la vie, leurs facultés soient complètes relativement aux besoins auxquels elles doivent pourvoir, ou, du moins, que les unes et les autres se développent dans un même rapport. Sans cela ces espèces mourraient en naissant et, par conséquent, ne s’offriraient pas à l’observation.
De toutes les espèces de créatures vivantes qui nous environnent, aucune, sans contredit, n’est assujettie à autant de besoins que l’homme. Dans aucune, l’enfance n’est aussi débile, aussi longue, aussi dénuée, la maturité chargée d’une responsabilité aussi étendue, la vieillesse aussi faible et souffrante. Et, comme s’il n’avait pas assez de ses besoins, l’homme a encore des goûts dont la satisfaction exerce ses facultés autant que celle de ses besoins mêmes. À peine il sait apaiser sa faim, qu’il veut flatter son palais ; à peine se couvrir, qu’il veut se décorer ; à peine s’abriter, qu’il songe à embellir sa demeure. Son intelligence n’est pas moins inquiète que son corps nécessiteux. Il veut approfondir les secrets de la nature, dompter les animaux, enchaîner les éléments, pénétrer dans les entrailles de la terre, traverser d’immenses mers, planer au-dessus des vents, supprimer le temps et l’espace ; il veut connaitre les mobiles, les ressorts, les lois de sa volonté et de son cœur, régner sur ses passions, conquérir l’immortalité, se confondre avec son Créateur, tout soumettre à son empire, la nature, ses semblables, lui-même ; en un mot, ses désirs se dilatent sans fin dans l’infini.
Aussi, dans aucune autre espèce, les facultés ne sont susceptibles d’un aussi grand développement que dans l’homme. Lui seul paraît comparer et juger, lui seul raisonne et parle ; seul il prévoit ; seul il sacrifie le présent à l’avenir ; seul il transmet de génération en génération ses travaux, ses pensées et les trésors de son expérience ; seul enfin il est capable d’une perfectibilité dont la chaîne incommensurable semble attachée au delà même de ce monde.
Plaçons ici une observation économique. Quelque étendu que soit le domaine de nos facultés, elles ne sauraient nous élever jusqu’à la puissance de créer. Il n’appartient pas à l’homme, en effet, d’augmenter ou de diminuer le nombre des molécules existantes. Son action se borne à soumettre les substances répandues autour de lui à des modifications, à des combinaisons qui les approprient à son usage (J. B. Say).
Modifier les substances de manière à accroître, par rapport à nous, leur utilité, c’est produire, ou plutôt c’est une manière de produire. J’en conclus que la valeur, ainsi que nous le verrons plus tard, ne saurait jamais être dans ces substances elles-mêmes, mais dans l’effort intervenu pour les modifier et comparé, par l’échange, à d’autres efforts analogues. C’est pourquoi la valeur n’est que l’appréciation des services échangés, soit que la matière intervienne ou n’intervienne pas. Il est complétement indifférent, quant à la notion de la valeur, que je rende à mon semblable un service direct, par exemple en lui faisant une opération chirurgicale, ou un service indirect en préparant pour lui une substance curative. Dans ce dernier cas, l’utilité est dans la substance, mais la valeur est dans le service, dans l’effort intellectuel et matériel fait par un homme en faveur d’un autre homme. C’est par pure métonymie qu’on a attribué la valeur à la matière elle-même, et, en cette occasion comme en bien d’autres, la métaphore a fait dévier la science.
Je reviens à l’organisation de l’homme. Si l’on s’arrêtait aux notions qui précèdent, il ne différerait des autres animaux que par la plus grande étendue des besoins et la supériorité des facultés. Tous, en effet, sont soumis aux uns et pourvus des autres. L’oiseau entreprend de longs voyages pour chercher la température qui lui convient ; le castor traverse le fleuve sur le pont qu’il a construit ; l’épervier poursuit ouvertement sa proie ; le chat la guette avec patience ; l’araignée lui dresse des embûches ; tous travaillent pour vivre et se développer.
Mais tandis que la nature a mis une exacte proportion entre les besoins des animaux et leurs facultés, si elle a traité l’homme avec plus de grandeur et de munificence, si, pour le forcer d’être sociable, elle a décrété que dans l’isolement ses besoins surpasseraient ses facultés, tandis qu’au contraire dans l’état social ses facultés, supérieures à ses besoins, ouvriraient un champ sans limites à ses nobles jouissances, nous devons reconnaître que, comme dans ses rapports avec le Créateur l’homme est élevé au-dessus des bêtes par le sentiment religieux, dans ses rapports avec ses semblables par l’Équité, dans ses rapports avec lui-même par la Moralité, de même, dans ses rapports avec ses moyens de vivre et de se développer, il s’en distingue par un phénomène remarquable. Ce phénomène, c’est l’Échange.
Essayerai-je de peindre l’état de misère, de dénûment et d’ignorance où, sans la faculté d’échange, l’espèce humaine aurait croupi éternellement, si même elle n’eût disparu du globe ?
Un des philosophes les plus populaires, dans un roman qui a le privilége de charmer l’enfance de génération en génération, nous a montré l’homme surmontant par son énergie, son activité, son intelligence, les difficultés de la solitude absolue. Voulant mettre en lumière tout ce qu’il y a de ressources dans cette noble créature, il l’a supposée, pour ainsi dire, accidentellement retranchée de la civilisation. Il entrait donc dans le plan de Daniel de Foë de jeter dans l’île du Désespoir Robinson seul, nu, privé de tout ce qu’ajoutent aux forces humaines l’union des efforts, la séparation des occupations, l’échange, la société.
Cependant, et quoique les obstacles ne soient qu’un jeu pour l’imagination, Daniel de Foë aurait ôté à son roman jusqu’à l’ombre de la vraisemblance, si, trop fidèle à la pensée qu’il voulait développer, il n’eût pas fait à l’état social des concessions obligées, en admettant que son héros avait sauvé du naufrage quelques objets indispensables, des provisions, de la poudre, un fusil, une hache, un couteau, des cordes, des planches, du fer, etc. ; preuve décisive que la société est le milieu nécessaire de l’homme, puisqu’un romancier même n’a pu le faire vivre hors de son sein.
Et remarquez que Robinson portait avec lui dans la solitude un autre trésor social mille fois plus précieux et que les flots ne pouvaient engloutir, je veux parler de ses idées, de ses souvenirs, de son expérience, de son langage même, sans lequel il n’aurait pu s’entretenir avec lui-même, c’est-à-dire penser.
Nous avons la triste et déraisonnable habitude d’attribuer à l’État social les souffrances dont nous sommes témoins. Nous avons raison jusqu’à un certain point, si nous entendons comparer la société à elle-même, prise à deux degrés divers d’avancement et de perfection ; mais nous avons tort, si nous comparons l’État social, même imparfait, à l’isolement. Pour pouvoir affirmer que la société empire la condition, je ne dirai pas de l’homme en général, mais de quelques hommes et des plus misérables d’entre eux, il faudrait commencer par prouver que le plus mal partagé de nos frères a à supporter, dans l’État social, un plus lourd fardeau de privations et de souffrances que celui qui eût été son partage dans la solitude. Or, examinez la vie du plus humble manouvrier. Passez en revue, dans tous leurs détails, les objets de ses consommations quotidiennes. Il est couvert de quelques vêtements grossiers ; il mange un peu de pain noir ; il dort sous un toit et au moins sur des planches. Maintenant demandez-vous si l’homme isolé, privé des ressources de l’Échange, aurait la possibilité la plus éloignée de se procurer ces grossiers vêtements, ce pain noir, cette rude couche, cet humble abri ? L’enthousiaste le plus passionné de l’État de nature, Rousseau lui-même, avouait cette impossibilité radicale. On se passait de tout, dit-il, on allait nu, on dormait à la belle étoile. Aussi Rousseau, pour exalter l’état de nature, était conduit à faire consister le bonheur dans la privation. Mais encore j’affirme que ce bonheur négatif est chimérique et que l’homme isolé mourrait infailliblement en très-peu d’heures. Peut-être Rousseau aurait-il été jusqu’à dire que c’est là la perfection. Il eût été conséquent ; car si le bonheur est dans la privation, la perfection est dans le néant.
J’espère que le lecteur voudra bien ne pas conclure de ce qui précède que nous sommes insensibles aux souffrances sociales de nos frères. De ce que ces souffrances sont moindres dans la société imparfaite que dans l’isolement, il ne s’ensuit pas que nous n’appelions de tous nos vœux le progrès qui les diminue sans cesse ; mais si l’isolement est quelque chose de pire que ce qu’il y a de pire dans l’État social, j’avais raison de dire qu’il met nos besoins, à ne parler que des plus impérieux, tout à fait au-dessus de nos facultés.
Comment l’Échange, renversant cet ordre à notre profit, place-t-il nos facultés au-dessus de nos besoins ?
Et d’abord, le fait est prouvé par la civilisation même. Si nos besoins dépassaient nos facultés, nous serions des êtres invinciblement rétrogrades ; s’il y avait équilibre, nous serions des êtres invinciblement stationnaires. Nous progressons ; donc chaque période de la vie sociale, comparée à une époque antérieure, laisse disponible, relativement à une somme donnée de satisfactions, une portion quelconque de nos facultés.
Essayons de donner l’explication de ce merveilleux phénomène.
Celle que nous devons à Condillac me semble tout à fait insuffisante, empirique, ou plutôt elle n’explique rien. « Par cela seul qu’un échange s’accomplit, dit-il, il doit y avoir nécessairement profit pour les deux parties contractantes, sans quoi il ne se ferait pas. Donc chaque échange renferme deux gains pour l’humanité. »
En tenant la proposition pour vraie, on n’y peut voir que la constatation d’un résultat. C’était ainsi que le malade imaginaire expliquait la vertu narcotique de l’opium :
Quia est in eo
Virtus dormitiva
Quæ facit dormire.
L’échange constitue deux gains, dites-vous. La question est de savoir pourquoi et comment. — Cela résulte du fait même qu’il s’est accompli. — Mais pourquoi s’est-il accompli ? Par quel mobile les hommes ont-ils été déterminés à l’accomplir ? Est-ce que l’échange a, en lui-même, une vertu mystérieuse, nécessairement bienfaisante et inaccessible à toute explication ?
D’autres font résulter l’avantage de ce que l’on donne ce qu’on a de trop pour recevoir ce dont on manque. Échange, disent-ils, c’est troc du superflu contre le nécessaire. Outre que cela est contraire aux faits qui se passent sous nos yeux — car qui osera dire que le paysan, en cédant le blé qu’il a cultivé et dont il ne mangera jamais, donne son superflu ? — je vois bien dans cet axiome comment deux hommes s’arrangent accidentellement ; mais je n’y vois pas l’explication du progrès.
L’observation nous donnera de la puissance de l’échange une explication plus satisfaisante.
L’échange a deux manifestations : Union des forces, séparation des occupations.
Il est bien clair qu’en beaucoup de cas la force unie de plusieurs hommes est supérieure, du tout au tout, à la somme de leurs forces isolées. Qu’il s’agisse de déplacer un lourd fardeau. Où mille hommes pourraient successivement échouer, il est possible que quatre hommes réussissent en s’unissant. Essayez de vous figurer les choses qui ne se fussent jamais accomplies dans le monde sans cette union !
Et puis ce n’est rien encore que le concours vers un but commun de la force musculaire ; la nature nous a dotés de facultés physiques, morales, intellectuelles très-variées. Il y a dans la coopération de ces facultés des combinaisons inépuisables. Faut-il réaliser une œuvre utile, comme la construction d’une route ou la défense du pays ? L’un met au service de la communauté sa vigueur ; l’autre son agilité ; celui-ci, son audace ; celui-là, son expérience, sa prévoyance, son imagination et jusqu’à sa renommée. Il est aisé de comprendre que les mêmes hommes, agissant isolément, n’auraient pu ni atteindre ni même concevoir le même résultat.
Or union des forces implique Échange. Pour que les hommes consentent à coopérer, il faut bien qu’ils aient en perspective une participation à la satisfaction obtenue. Chacun fait profiter autrui de ses efforts et profite des efforts d’autrui dans des proportions convenues, ce qui est échange.
On voit ici comment l’échange, sous cette forme, augmente nos satisfactions. C’est que des efforts égaux en intensité aboutissent, par le seul fait de leur union, à des résultats supérieurs. Il n’y a là aucune trace de ce prétendu troc du superflu contre le nécessaire, non plus que du double et empirique profit allégué par Condillac.
Nous ferons la même remarque sur la division du travail. Au fait, si l’on y regarde de près, se distribuer les occupations, ce n’est, pour les hommes, qu’une autre manière, plus permanente, d’unir leurs forces, de coopérer, de s’associer ; et il est très-exact de dire, ainsi que cela sera démontré plus tard, que l’organisation sociale actuelle, à la condition de reconnaître l’échange libre, est la plus belle, la plus vaste des associations : association bien autrement merveilleuse que celles rêvées par les socialistes, puisque, par un mécanisme admirable, elle se concilie avec l’indépendance individuelle. Chacun y entre et en sort, à chaque instant, d’après sa convenance. Il y apporte le tribut qu’il veut ; il en retire une satisfaction comparativement supérieure et toujours progressive, déterminée, selon les lois de la justice, par la nature même des choses et non par l’arbitraire d’un chef. — Mais ce point de vue serait ici une anticipation. Tout ce que j’ai à faire pour le moment, c’est d’expliquer comment la division du travail accroît notre puissance.
Sans nous étendre beaucoup sur ce sujet, puisqu’il est du petit nombre de ceux qui ne soulèvent pas d’objections, il n’est pas inutile d’en dire quelque chose. Peut-être l’a-t-on un peu amoindri. Pour prouver la puissance de la division du travail, on s’est attaché à signaler les merveilles qu’elle accomplit dans certaines manufactures, les fabriques d’épingles par exemple. La question peut être élevée à un point de vue plus général et plus philosophique. Ensuite la force de l’habitude a ce singulier privilége de nous dérober la vue, de nous faire perdre la conscience des phénomènes au milieu desquels nous sommes plongés. Il n’y a pas de mot plus profondément vrai que celui de Rousseau : « Il faut beaucoup de philosophie pour observer ce qu’on voit tous les jours. » Ce n’est donc pas une chose oiseuse que de rappeler aux hommes ce que, sans s’en apercevoir, ils doivent à l’échange.
Comment la faculté d’échanger a-t-elle élevé l’humanité à la hauteur où nous la voyons aujourd’hui ? Par son influence sur le travail, sur le concours des agents naturels, sur les facultés de l’homme et sur les capitaux.
Adam Smith a fort bien démontré cette influence sur le travail.
« L’accroissement, dans la quantité d’ouvrage que peut exécuter le même nombre d’hommes par suite de la division du travail, est dû à trois circonstances, dit ce célèbre économiste : 1° au degré d’habileté qu’acquiert chaque travailleur ; 2° à l’économie du temps, qui se perd naturellement à passer d’un genre d’occupation à un autre ; 3° à ce que chaque homme a plus de chances de découvrir des méthodes aisées et expéditives pour atteindre un objet, lorsque cet objet est le centre de son attention, que lorsqu’elle se dissipe sur une infinie variété de choses. »
Ceux qui, comme Adam Smith, voient dans le Travail la source unique de la richesse, se bornent à rechercher comment il se perfectionne en se divisant. Mais nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu’il n’est pas le seul agent de nos satisfactions. Les forces naturelles concourent. Cela est incontestable.
Ainsi, en agriculture, l’action du soleil et de la pluie, les sucs cachés dans le sol, les gaz répandus dans l’atmosphère, sont certainement des agents qui coopèrent avec le travail humain à la production des végétaux.
L’industrie manufacturière doit des services analogues aux qualités chimiques de certaines substances ; à la puissance des chutes d’eau, de l’élasticité de la vapeur, de la gravitation, de l’électricité.
Le commerce a su faire tourner au profit de l’homme la vigueur et l’instinct de certaines races animales, la force du vent qui enfle les voiles de ses navires, les lois du magnétisme qui, agissant sur la boussole, dirigent leur sillage à travers l’immensité des mers.
Il est deux vérités hors de toute contestation. La première, c’est que l’homme est d’autant mieux pourvu de toutes choses, qu’il tire un meilleur parti des forces de la nature.
Il est palpable, en effet, qu’on obtient plus de blé, à égalité d’efforts, sur une bonne terre végétale que sur des sables arides ou de stériles rochers.
La seconde, c’est que les agents naturels sont répartis sur le globe d’une manière inégale.
Qui oserait soutenir que toutes terres sont également propres aux mêmes cultures, toutes contrées au même genre de fabrication ?
Or, s’il est vrai que les forces naturelles diffèrent sur les divers points du globe, et si, d’un autre côté, les hommes sont d’autant plus riches qu’ils s’en font plus aider, il s’ensuit que la faculté d’échanger augmente, dans une proportion incommensurable, l’utile concours de ces forces.
Ici nous retrouvons en présence l’utilité gratuite et l’utilité onéreuse, celle-là se substituant à celle-ci, en vertu de l’échange. N’est-il pas clair, en effet, que si, privés de la faculté d’échanger, les hommes étaient réduits à produire de la glace sous l’équateur et du sucre près des pôles, ils devraient faire avec beaucoup de peine ce que le chaud et le froid font aujourd’hui gratuitement pour eux, et qu’à leur égard une immense proportion de forces naturelles resterait dans l’inertie ? Grâce à l’échange, ces forces sont utilisées partout où on les rencontre. La terre à blé est semée en blé ; la terre à vigne est plantée en vigne ; il y a des pêcheurs sur les côtes et des bûcherons sur les montagnes. Ici on dirige l’eau, là le vent sur une roue qui remplace dix hommes. La nature devient un esclave qu’il ne faut ni nourrir ni vêtir, dont nous ne payons ni ne faisons payer les services, qui ne coûte rien ni à notre bourse ni à notre conscience[228] . La même somme d’efforts humains, c’est-à-dire les mêmes services, la même valeur réalise une somme d’utilité toujours plus grande. Pour chaque résultat donné une portion seulement de l’activité humaine est absorbée ; l’autre, par l’intervention des forces naturelles, est rendue disponible, elle se prend à de nouveaux obstacles, satisfait à de nouveaux désirs, réalise de nouvelles utilités.
Les effets de l’échange sur nos facultés intellectuelles sont tels, qu’il n’est pas donné à l’imagination la plus vigoureuse d’en calculer la portée.
« Nos connaissances, dit M. Tracy, sont nos plus précieuses acquisitions, puisque ce sont elles qui dirigent l’emploi de nos forces et le rendent plus fructueux, à mesure qu’elles sont plus saines et plus étendues. Or nul homme n’est à portée de tout voir, et il est bien plus aisé d’apprendre que d’inventer. Mais quand plusieurs hommes communiquent ensemble, ce qu’un d’eux a observé est bientôt connu de tous les autres, et il suffit que parmi eux il s’en trouve un fort ingénieux pour que des découvertes précieuses deviennent promptement la propriété de tous. Les lumières doivent donc s’accroître bien plus rapidement que dans l’état d’isolement, sans compter qu’elles peuvent se conserver et, par conséquent, s’accumuler de générations en générations. »
Si la nature a varié autour de l’homme les ressources qu’elle met à sa disposition, elle n’a pas été plus uniforme dans la distribution des facultés humaines. Nous ne sommes pas tous doués, au même degré, de vigueur, de courage, d’intelligence, de patience, d’aptitudes artistiques, littéraires, industrielles. Sans l’échange, cette diversité, loin de tourner au profit de notre bien-être, contribuerait à notre misère, chacun ressentant moins les avantages des facultés qu’il aurait que la privation de celles qu’il n’aurait pas. Grâce à l’échange, l’être fort peut, jusqu’à un certain point, se passer de génie, et l’être intelligent de vigueur : car, par l’admirable communauté qu’il établit entre les hommes, chacun participe aux qualités distinctives de ses semblables.
Pour donner satisfaction à ses besoins et à ses goûts, il ne suffit pas, dans la plupart des cas, de travailler, d’exercer ses facultés sur ou par des agents naturels. Il faut encore des outils, des instruments, des machines, des provisions, en un mot des capitaux. Supposons une petite peuplade, composée de dix familles, dont chacune, travaillant exclusivement pour elle-même, est obligée d’exercer dix industries différentes. Il faudra à chaque chef de famille dix mobiliers industriels. Il y aura dans la peuplade dix charrues, dix paires de bœufs, dix forges, dix ateliers de charpente et de menuiserie, dix métiers à tisser, etc. ; avec l’échange une seule charrue, une seule paire de bœufs, une seule forge, un seul métier à tisser pourront suffire. Il n’y a pas d’imagination qui puisse calculer l’économie de capitaux due à l’échange.
Le lecteur voit bien maintenant ce qui constitue la vraie puissance de l’échange. Ce n’est pas, comme dit Condillac, qu’il implique deux gains, parce que chacune des parties contractantes estime plus ce qu’elle reçoit que ce qu’elle donne. Ce n’est pas non plus que chacune d’elle cède du superflu pour acquérir du nécessaire. C’est tout simplement que, lorsqu’un homme dit à un autre : « Ne fait que ceci, je ne ferai que cela, et nous partagerons, » il y a meilleur emploi du travail, des facultés, des agents naturels, des capitaux, et, par conséquent, il y a plus à partager. À plus forte raison si trois, dix, cent, mille, plusieurs millions d’hommes entrent dans l’association.
Les deux propositions que j’ai avancées sont donc rigoureusement vraies, à savoir :
Dans l’isolement, nos besoins dépassent nos
Dans l’état social, nos facultés dépassent nos besoins.
La première est vraie, puisque toute la surface de la France ne pourrait faire subsister un seul homme à l’état d’isolement absolu.
La seconde est vraie, puisque, en fait, la population de cette même surface croît en nombre et en bien-être.
Progrès de l’échange. La forme primitive de l’échange, c’est le troc. Deux personnes, dont chacune éprouve un désir et possède l’objet qui peut satisfaire le désir de l’autre, se font cession réciproque, ou bien elles conviennent de travailler séparément chacune à une chose, sauf à partager dans des proportions débattues le produit total. — Voilà le troc, qui est, comme diraient les socialistes, l’échange, le trafic, le commerce embryonnaire. Nous remarquons ici deux désirs comme mobiles, deux efforts comme moyens, deux satisfactions comme résultat ou comme consommation de l’évolution entière, et rien ne diffère essentiellement de la même évolution accomplie dans l’isolement, si ce n’est que les désirs et les satisfactions sont demeurés, selon leur nature, intransmissibles, et que les efforts seuls ont été échangés ; en d’autres termes, deux personnes ont travaillé l’une pour l’autre, elles se sont rendu mutuellement 'service.
Aussi c’est là que commence véritablement l’économie politique, car c’est là que nous pouvons observer la première apparition de la valeur. Le troc ne s’accomplit qu’à la suite d’une convention, d’un débat ; chacune des parties contractantes se détermine par la considération de son intérêt personnel, chacune d’elles fait un calcul dont la portée est celle-ci : « Je troquerai si le troc me fait arriver à la satisfaction de mon désir avec un moindre Effort. » — C’est certainement un merveilleux phénomène que des efforts amoindris puissent faire face à des désirs et à des satisfactions égales, et cela s’explique par les considérations que j’ai présentées dans le premier paragraphe de ce chapitre.
Quand les deux produits ou les deux services se troquent, on peut dire qu’ils se valent. Nous aurons à approfondir ultérieurement la notion de valeur. Pour le moment, cette vague définition suffit.
On peut concevoir le Troc circulaire, embrassant trois parties contractantes. Paul rend un service à Pierre, lequel rend un service équivalent à Jacques, qui rend à son tour un service équivalent à Paul, moyennant quoi tout est balancé. Je n’ai pas besoin de dire que cette rotation ne se fait que parce qu’elle arrange toutes les parties, sans changer ni la nature ni les conséquences du troc.
L’essence du Troc se retrouverait dans toute sa pureté, alors même que le nombre des contractants serait plus grand. Dans ma commune, le vigneron paye avec du vin les services du forgeron, du barbier, du tailleur, du bedeau, du curé, de l’épicier. Le forgeron, le barbier, le tailleur livrent aussi à l’épicier, contre les marchandises consommées le long de l’année, le vin qu’ils ont reçu du vigneron.
Ce Troc circulaire, je ne saurais trop le répéter, n’altère en rien les notions primordiales posées dans les chapitres précédents. Quand l’évolution est terminée, chaque coopérant a offert ce triple phénomène : désir, effort, satisfaction. Il n’y a eu qu’une chose de plus, l’échange des efforts, la transmission des services, la séparation des occupations avec tous les avantages qui en résultent, avantages auxquels chacun a pris part, puisque le travail isolé est un pis aller toujours réservé, et qu’on n’y renonce qu’en vue d’un avantage quelconque.
Il est aisé de comprend que le Troc circulaire et en nature ne peut s’étendre beaucoup, et je n’ai pas besoin d’insister sur les obstacles qui l’arrêtent. Comment s’y prendrait, par exemple, celui qui voudrait donner sa maison contre les mille objets de consommation dont il aura besoin pendant toute l’année ! En tout cas, le Troc ne peut sortir du cercle étroit de personnes qui se connaissent. L’humanité serait bien vite arrivée à la limite de la séparation des travaux, à la limite du progrès, si elle n’eût pas trouvé un moyen de faciliter les échanges.
C’est pourquoi, dès l’origine même de la société, on voit les hommes faire intervenir dans leurs transactions une marchandise intermédiaire, du blé, du vin, des animaux et presque toujours des métaux. Ces marchandises remplissent plus ou moins commodément cette destination, mais aucune ne s’y refuse par essence, pourvu que l’Effort y soit représenté par la valeur, puisque c’est ce dont il s’agit d’opérer la transmission.
Avec le recours à cette marchandise intermédiaire apparaissent deux phénomènes économiques qu’on nomme Vente et Achat. Il est clair que l’idée de vente et d’achat n’est pas comprise dans le Troc simple, ni même dans le Troc circulaire. Quand un homme donne à un autre de quoi boire pour en recevoir de quoi manger, il n’y a là qu’un fait indécomposable. Or ce qu’il faut bien remarquer, au début de la science, c’est que l’échange qui s’accomplit par un intermédiaire ne perd en rien la nature, l’essence, la qualité du Troc ; seulement c’est un troc composé. Selon la remarque très-judicieuse et très-profonde de J. B. Say, c’est un troc à deux facteurs, dont l’un s’appelle vente et l’autre achat, facteurs dont la réunion est indispensable pour constituer un troc complet.
En effet, l’apparition dans le monde d’un moyen commode de troquer ne change ni la nature des hommes ni celle des choses. Il reste toujours pour chacun le besoin qui détermine l’effort, et la satisfaction qui le récompense. L’échange n’est complet que lorsque l’homme qui a fait un effort en faveur d’autrui en a obtenu un service équivalent, c’est-à-dire la satisfaction. Pour cela, il vend son service contre la marchandise intermédiaire, et puis, avec cette marchandise intermédiaire, il achète des services équivalents, et alors les deux facteurs reconstituent pour lui le troc simple.
Considérez un médecin, par exemple. Pendant plusieurs années, il a appliqué son temps et ses facultés à l’étude des maladies et des remèdes. Il a visité des malades, il a donné des conseils, en un mot, il a rendu des services. Au lieu de recevoir de ses clients, en compensation, des services directs, ce qui eût constitué le simple troc, il en a reçu une marchandise intermédiaire, des métaux avec lesquels il s’est procuré les satisfactions qui étaient en définitive l’objet qu’il avait en vue. Ce ne sont pas les malades qui lui ont fourni le pain, le vin, le mobilier, mais ils lui en ont fourni la valeur. Ils n’ont pu céder des écus que parce qu’eux-mêmes avaient rendu des services. Il y a donc balance de services quant à eux, il y a aussi balance pour le médecin ; et, s’il était possible de suivre par la pensée cette circulation jusqu’au bout, on verrait que l’Échange par intervention de la monnaie se résout en une multitude de trocs simples.
Sous le régime du troc simple, la valeur c’est l’appréciation de deux services échangés et directement comparés entre eux. Sous le régime de l’échange composé, les deux services s’apprécient aussi l’un l’autre, mais par comparaison à ce terme moyen, à cette marchandise intermédiaire qu’on appelle Monnaie. Nous verrons ailleurs quelles difficultés, quelles erreurs sont nées de cette complication. Il nous suffit de faire remarquer ici que la présence de cette marchandise intermédiaire n’altère en rien la notion de valeur.
Une fois admis que l’échange est à la fois cause et effet de la séparation des occupations, une fois admis que la séparation des occupations multiplie les satisfactions proportionnellement aux efforts, par les motifs exposés au commencement de ce chapitre, le lecteur comprendra facilement les services que la Monnaie a rendus à l’humanité par ce seul fait qu’elle facilite les échanges. Grâce à la monnaie, l’échange a pu prendre un développement vraiment indéfini. Chacun jette dans la société ses services, sans savoir à qui ils procurent la satisfaction qui y est attachée. De même il retire de la société non des services immédiats, mais des écus avec lesquels il achètera en définitive des services, où, quand et comme il lui plaira. En sorte que les transactions définitives se font à travers le temps et l’espace, entre inconnus, sans que personne sache, au moins dans la plupart des circonstances, par l’effort de qui ses besoins seront satisfaits, aux désirs de qui ses propres efforts procureront satisfaction. L’Échange, par l’intermédiaire de la Monnaie, se résume en trocs innombrables dont les parties contractantes s’ignorent.
Cependant l’Échange est un si grand bienfait pour la société (et n’est-il pas la société elle-même ?) qu’elle ne s’est pas bornée, pour le faciliter, pour le multiplier, à l’introduction de la monnaie. Dans l’ordre logique, après le Besoin et la Satisfaction unis dans le même individu par l’effort isolé, — après le troc simple, — après le troc à deux facteurs, ou l’Échange composé de vente et achat, — apparaissent encore les transactions étendues dans le temps et l’espace par le moyen du crédit, titres hypothécaires, lettres de change, billets de banque, etc. Grâce à ces merveilleux mécanismes, éclos de la civilisation, la perfectionnant et se perfectionnant eux-même avec elle, un effort exécuté aujourd’hui à Paris ira satisfaire un inconnu, par delà les océans et par delà les siècles ; et celui qui s’y livre n’en reçoit pas moins sa récompense actuelle, par l’intermédiaire de personnes qui font l’avance de cette rémunération et se soumettent à en aller demander la compensation à des pays lointains ou à l’attendre d’un avenir reculé. Complication étonnante autant que merveilleuse, qui, soumise à une exacte analyse, nous montre, en définitive, l’intégrité du phénomène économique, besoin, effort, satisfaction, s’accomplissant dans chaque individualité selon la loi de justice.
Bornes de l’Échange. Le caractère général de l’Échange est de diminuer le rapport de l’effort à la satisfaction. Entre nos besoins et nos satisfactions, s’interposent des obstacles que nous parvenons à amoindrir par l’union des forces ou par la séparation des occupations, c’est à dire par l’Échange. Mais l’Échange lui-même rencontre des obstacles, exige des efforts. La preuve en est dans l’immense masse de travail humain qu’il met en mouvement. Les métaux précieux, les routes, les canaux, les chemins de fer, les voitures, les navires, toutes ces choses absorbent une part considérable de l’activité humaine. Voyez, d’ailleurs, que d’hommes uniquement occupés à faciliter des échanges, que de banquiers, négociants, marchands, courtiers, voituriers, marins ! Ce vaste et coûteux appareil prouve mieux que tous les raisonnements ce qu’il y a de puissance dans la faculté d’échanger ; sans cela comment l’humanité aurait-elle consenti à se l’imposer ?
Puisqu’il est dans la nature de l’Échange d’épargner des efforts et d’en exiger, il est aisé de comprendre quelles sont ses bornes naturelles. En vertu de cette force qui pousse l’homme à choisir toujours le moindre de deux maux, l’Échange s’étendra indéfiniment, tant que l’effort exigé par lui sera moindre que l’effort par lui épargné. Et il s’arrêtera naturellement, quand, au total, l’ensemble des satisfactions obtenues par la séparation des travaux serait moindre, à raison des difficultés de l’échange, que si on les demandait à la production directe.
Voici une peuplade. Si elle veut se procurer la satisfaction, il faut qu’elle fasse l’effort. Elle peut s’adresser à une autre peuplade et lui dire : « Faites cet effort pour nous, nous en ferons un autre pour vous. » La stipulation peut arranger tout le monde, si, par exemple, la seconde peuplade est en mesure, par sa situation, de faire concourir à l’œuvre une plus forte proportion de forces naturelles et gratuites. En ce cas, elle réalisera le résultat avec un effort égal à 8, quand la première ne le pouvait qu’avec un effort égal à 12. Ne demandant que 8, il y a économie de 4 pour la première. Mais vient ensuite le transport, la rémunération des agents intermédiaires, en un mot, l’effort exigé par l’appareil de l’échange. Il faut évidemment l’ajouter au chiffre 8. L’échange continuera à s’opérer tant que lui-même ne coûtera pas 4. Aussitôt arrivé à ce chiffre, il s’arrêtera. Il n’est pas nécessaire de légiférer à ce sujet ; car, — ou la loi intervient avant que ce nivellement soit atteint, et alors elle est nuisible, elle prévient une économie d’efforts, — ou elle arrive après, et, en ce cas, elle est superflue. Elle ressemble à un décret qui défendrait d’allumer les lampes à midi.
Quand l’Échange est ainsi arrêté parce qu’il cesse d’être avantageux, le moindre perfectionnement dans l’appareil commercial lui donne une nouvelle activité. Entre Orléans et Angoulême, il s’accomplit un certain nombre de transactions. Ces deux villes échangent toutes les fois qu’elles recueillent plus de satisfactions par ce procédé que par la production directe. Elles s’arrêtent quand la production par échange, aggravée des frais de l’échange lui-même, dépasse ou atteint l’effort de la production directe. Dans ces circonstances, si l’on améliore l’appareil de l’échange, si les négociants baissent le prix de leurs concours, si l’on perce une montagne, si l’on jette un pont sur la rivière, si l’on pave une route, si l’on diminue l’obstacle, l’Échange se multipliera, parce que les hommes veulent tirer parti de tous les avantages que nous lui avons reconnus, parce qu’ils veulent recueillir de l’utilité gratuite. Le perfectionnement de l’appareil commercial équivaut donc à un rapprochement matériel des deux villes. D’où il suit que le rapprochement matériel des hommes équivaut à un perfectionnement dans l’appareil de l’échange. — Et ceci est très-important ; c’est là qu’est la solution du problème de la population ; c’est là, dans ce grand problème, l’élément négligé par Malthus. Là où Malthus avait vu Discordance, cet élément nous fera voir Harmonie.
Quand les hommes échangent, c’est qu’ils arrivent par ce moyen à une satisfaction égale avec moins d’efforts, et la raison en est que, de part et d’autre, ils se rendent des services qui servent de véhicule à une plus grande proportion d’utilité gratuite.
Or ils échangent d’autant plus que l’échange même rencontre de moindres obstacles, exige de moindres efforts.
Et l’Échange rencontre des obstacles, exige des efforts d’autant moindres que les hommes sont plus rapprochés. La plus grande densité de la population est donc nécessairement accompagnée d’une plus grande proportion d’utilité gratuite. Elle donne plus de puissance à l’appareil de l’échange, elle met en disponibilité une portion d’efforts humains ; elle est une cause de progrès.
Et, si vous le voulez, sortons des généralités et voyons les faits :
Une rue d’égale longueur ne rend-elle pas plus de services à Paris que dans une ville déserte ? Un chemin de fer d’un kilomètre ne rend-il pas plus de services dans le département de la Seine que dans le département des Landes ? Un marchand de Londres ne peut-il pas se contenter d’une moindre rémunération sur chaque transaction qu’il facilite, à cause de la multiplicité ? En toutes choses, nous verrons deux appareils d’échange, quoique identiques, rendre des services bien différents selon qu’ils fonctionnent au milieu d’une population dense ou d’une population disséminée.
La densité de la population ne fait pas seulement tirer un meilleur parti de l’appareil de l’échange, elle permet encore d’accroître et de perfectionner cet appareil. Il est telle amélioration avantageuse au sein d’une population condensée, parce que là elle épargnera plus d’efforts qu’elle n’en exige, qui n’est pas réalisable au milieu d’une population disséminée, parce qu’elle exigerait plus d’efforts qu’elle n’en pourrait épargner.
Lorsqu’on quitte momentanément Paris pour aller habiter une petite ville de province, on est étonné du nombre de cas où l’on ne peut se procurer certains services qu’à force de frais, de temps et à travers mille difficultés.
Ce n’est pas seulement la partie matérielle de l’appareil commercial qui s’utilise et se perfectionne par le seul fait de la densité de la population, mais aussi la partie morale. Les hommes rapprochés savent mieux se partager les occupations, unir leurs forces, s’associer pour fonder des écoles et des musées, bâtir des églises, pourvoir à leur sécurité, établir des banques ou des compagnies d’assurances, en un mot, se procurer des jouissances communes avec une beaucoup moins forte proportion d’efforts pour chacun.
Mais ces considérations reviendront quand nous en serons à la population. Bornons-nous à cette remarque :
L’Échange est un moyen donné aux hommes de tirer un meilleur parti de leurs facultés, d’économiser les capitaux, de faire concourir davantage les agents gratuits de la nature, d’accroître la proportion de l’utilité gratuite à l’utilité onéreuse, de diminuer par conséquent le rapport des efforts aux résultats, de laisser à leur disposition une partie de leurs forces, de manière à en soustraire une portion toujours plus grande au service des besoins les plus impérieux et les premiers dans l’ordre de priorité, pour les consacrer à des jouissances d’un ordre de plus en plus élevé.
Si l’Échange épargne des efforts, il en exige aussi. Il s’étend, il gagne, il se multiplie, jusqu’au point où l’effort qu’il exige devient égal à celui qu’il épargne, et s’arrête là jusqu’à ce que, par le perfectionnement de l’appareil commercial, ou seulement par le seul fait de la condensation de la population et du rapprochement des hommes, il rentre dans les conditions nécessaires de sa marche ascendante. D’où il suit que les lois qui bornent les Échanges sont toujours nuisibles ou superflues.
Les gouvernements, toujours disposés à se persuader que rien de bien ne se fait sans eux, se refusent à comprendre cette loi harmonique :
L’échange se développe naturellement jusqu’au point où il serait plus onéreux qu’utile, et s’arrête naturellement à cette limite.
En conséquence, on les voit partout fort occupés de le favoriser ou de le restreindre.
Pour le porter au delà de ses bornes naturelles, ils vont à la conquête de débouchés et de colonies. Pour le retenir en deçà, ils imaginent toutes sortes de restrictions et d’entraves.
Cette intervention de la Force dans les transactions humaines est accompagnée de maux sans nombre.
L’Accroissement même de cette force est déjà un premier mal ; car il est bien évident que l’État ne peut faire des conquêtes, retenir sous sa domination des pays lointains, détourner le cours naturel du commerce par l’action des douanes, sans multiplier beaucoup le nombre de ses agents.
La Déviation de la Force Publique est un mal plus grand encore que son Accroissement. Sa mission rationnelle était de protéger toutes les Libertés et toutes les Propriétés, et la voilà appliquée à violer elle-même la Liberté et la Propriété des citoyens. Ainsi les gouvernements semblent prendre à tâche d’effacer des intelligences toutes les notions et tous les principes. Dès qu’il est admis que l’Oppression et la Spoliation sont légitimes pourvu qu’elles soient légales, pourvu qu’elles ne s’exercent entre citoyens que par l’intermédiaire de la Loi ou de la Force publique, on voit peu à peu chaque classe venir demander de lui sacrifier toutes les autres.
Soit que cette intervention de la Force dans les échanges en provoque qui ne se seraient pas faits, ou en prévienne qui se seraient accomplis, il ne se peut pas qu’elle n’occasionne tout à la fois Déperdition et Déplacement de travail et de capitaux, et par suite perturbation dans la manière dont la population se serait naturellement distribuée. Des intérêts naturels disparaissent sur un point, des intérêts factices se créent sur un autre, et les hommes suivent forcément le courant des intérêts. C’est ainsi qu’on voit de vastes industries s’établir là où elles ne devaient pas naître, la France faire du sucre, l’Angleterre filer du coton venu des plaines de l’Inde. Il a fallu des siècles de guerre, des torrents de sang répandu, d’immenses trésors dispersés, pour arriver à ce résultat : substituer en Europe des industries précaires à des industries vivaces, et ouvrir ainsi des chances aux crises, aux chômages, à l’instabilité et, en définitive, au Paupérisme.
Mais je m’aperçois que j’anticipe. Nous devons d’abord connaître les lois du libre et naturel développement des sociétés humaines. Plus tard, nous aurons à en étudier les perturbations.
Force morale de l’échange. Il faut le répéter, au risque de froisser le sentimentalisme moderne : l’économie politique se tient dans la région de ce qu’on nomme les affaires, et les affaires se font sous l’influence de l’intérêt personnel… Les puritains du socialisme ont beau crier : « C’est affreux, nous changerons tout cela ; » leurs déclamations à cet égard se donnent à elles-mêmes un démenti permanent. Allez donc les acheter, quai Voltaire, au nom de la fraternité !
Ce serait tomber dans un autre genre de déclamation que d’attribuer de la moralité à des actes déterminés et gouvernés par l’intérêt personnel. Mais certes l’ingénieuse nature peut avoir arrangé l’ordre social de telle sorte que ces mêmes actes, destitués de moralité dans leur mobile, aboutissent néanmoins à des résultats moraux. N’en est-il pas ainsi du travail ? Or je dis que l’Échange, soit à l’état de simple troc, soit devenu vaste commerce, développe dans la société des tendances plus nobles que son mobile.
À Dieu ne plaise que je veuille attribuer à une seule énergie tout ce qui fait la grandeur, la gloire et le charme de nos destinées ! Comme il y a deux forces dans le monde matériel, l’une qui va de la circonférence au centre, l’autre, du centre à la circonférence, il y a aussi deux principes dans le monde social : l’intérêt privé et la sympathie. Qui donc est assez malheureux pour méconnaître les bienfaits et les joies du principe sympathique, manifesté par l’amitié, l’amour, la piété filiale, la tendresse paternelle, la charité, le dévouement patriotique, le sentiment religieux, l’enthousiasme du bon et du beau ? Il y en a qui disent que le principe sympathique n’est qu’une magnifique forme du principe individualiste, et qu’aimer les autres, ce n’est, au fond, qu’une intelligente manière de s’aimer soi-même. Ce n’est pas ici le lieu d’approfondir ce problème. Que nos deux énergies natives soient distinctes ou confondues, il nous suffit de savoir que, loin de se heurter, comme on le dit sans cesse, elles se combinent et concourent à la réalisation d’un même résultat, le Bien général.
J’ai établi ces deux propositions :
Dans l’isolement, nos besoins surpassent nos facultés.
Par l’échange, nos facultés surpassent nos besoins.
Elles donnent la raison de la société. En voici deux autres qui garantissent son perfectionnement indéfini :
Dans l’isolement, les prospérités se nuisent.
Par l’échange, les prospérités s’entr’aident.
Est-il besoin de prouver que, si la nature eût destiné les hommes à la vie solitaire, la prospérité de l’un ferait obstacle à la prospérité de l’autre ? Plus ils seraient nombreux, moins ils auraient de chances de bien-être. En tous cas, on voit clairement en quoi leur nombre pourrait nuire, on ne comprend pas comment il pourrait profiter. Et puis je demande sous quelle forme se manifesterait le principe sympathique ? À quelle occasion prendrait-il naissance ? Pourrions-nous même le concevoir ?
Mais les hommes échangent. L’échange, nous l’avons vu, implique la séparation des occupations. Il donne naissance aux professions, aux métiers. Chacun s’attache à vaincre un genre d’obstacles au profit de la Communauté. Chacun se consacre à lui rendre un genre de services. Or une analyse complète de la valeur démontre que chaque service vaut d’abord en raison de son utilité intrinsèque, ensuite en raison de ce qu’il est offert dans un milieu plus riche, c’est-à-dire au sein d’une communauté plus disposée à le demander, plus en mesure de le payer. L’expérience, en nous montrant l’artisan, le médecin, l’avocat, le négociant, le voiturier, le professeur, le savant tirer pour eux-mêmes un meilleur parti de leurs services à Paris, à Londres, à New-York que dans les landes de Gascogne, ou dans les montagnes du pays de Galles, ou dans les prairies du Far West, l’expérience, dis-je, ne nous confirme-t-elle pas cette vérité : L’homme a d’autant plus de chances de prospérer qu’il est dans un milieu plus prospère ?
De toutes les harmonies qui se rencontrent sous ma plume, celle-ci est certainement la plus importante, la plus belle, la plus décisive, la plus féconde. Elle implique et résume toutes les autres. C’est pourquoi je n’en pourrai donner ici qu’une démonstration fort incomplète. Heureux si elle jaillit de l’esprit de ce livre. Heureux encore si elle en sortait du moins avec un caractère de probabilité suffisant pour déterminer le lecteur à s’élever par ses propres efforts à la certitude !
Car, il n’en faut pas douter, c’est là qu’est la raison de décider entre l’Organisation naturelle et les Organisations artificielles : c’est là, exclusivement là, qu’est le Problème Social. Si la prospérité de tous est la condition de la prospérité de chacun, nous pouvons nous fier non-seulement à la puissance économique de l’échange libre, mais encore à sa force morale. Il suffira que les hommes comprennent leurs vrais intérêts pour que les restrictions, les jalousies industrielles, les guerres commerciales, les monopoles, tombent sous les coups de l’opinion ; pour qu’avant de solliciter telle ou telle mesure gouvernementale on se demande non pas : « Quel bien m’en reviendra-t-il ? » mais : « Quel bien en reviendra-t-il à la communauté ? » Cette dernière question, j’accorde qu’on se la fait quelquefois en vertu du principe sympathique, mais que la lumière se fasse, et on se l’adressera aussi par Intérêt personnel. Alors il sera vrai de dire que les deux mobiles de notre nature concourent vers un même résultat : le Bien Général ; et il sera impossible de dénier à l’intérêt personnel, non plus qu’aux transactions qui en dérivent, du moins quant à leurs effets, la Puissance Morale.
Que l’on considère les relations d’homme à homme, de famille à famille, de province à province, de nation à nation, d’hémisphère à hémisphère, de capitaliste à ouvrier, de propriétaire à prolétaire, — il est évident, ce me semble, qu’on ne peut ni résoudre ni même aborder le problème social, à aucun de ses points de vue, avant d’avoir choisi entre ces deux maximes :
Le profit de l’un est le dommage de l’autre.
Le profit de l’un est le profit de l’autre.
Car, si la nature a arrangé les choses de telle façon que l’antagonisme soit la loi des transactions libres, notre seule ressource est de vaincre la nature et d’étouffer la Liberté. Si, au contraire, ces transactions libres sont harmoniques, c’est-à-dire si elles tendent à améliorer et à égaliser les conditions, nos efforts doivent se borner à laisser agir la nature et à maintenir les droits de la liberté humaine.
Et c’est pourquoi je conjure les jeunes gens à qui ce livre est dédié de scruter avec soin les formules qu’il renferme, d’analyser la nature intime et les effets de l’échange. Oui, j’en ai la confiance, il s’en rencontrera un parmi eux qui arrivera enfin à la démonstration rigoureuse de cette proposition : Le bien de chacun favorise le bien de tous, comme le bien de tous favorise le bien de chacun ; — qui saura faire pénétrer cette vérité dans toutes les intelligences à force d’en rendre la preuve simple, lucide, irréfragable. — Celui-là aura résolu le problème social ; celui-là sera le bienfaiteur du genre humain.
Remarquons ceci en effet : Selon que cet axiome est vrai ou faux, les lois sociales naturelles sont harmoniques ou antagoniques. — Selon qu’elles sont harmoniques ou antagoniques, il est de notre intérêt de nous y conformer ou de nous y soustraire. — Si donc il était une fois bien démontré que, sous le régime de la liberté, les intérêts concordent et s’entre-favorisent, tous les efforts que nous voyons faire aujourd’hui aux gouvernements pour troubler l’action de ces lois sociales naturelles, nous les leur verrions faire pour laisser à ces lois toute leur puissance, ou plutôt ils n’auraient pas pour cela d’efforts à faire, si ce n’est celui de s’abstenir. — En quoi consiste l’action contrariante des gouvernements ? Cela se déduit du but même qu’ils ont en vue. — De quoi s’agit-il ? de remédier à l’Inégalité qui est censée naître de la liberté. — Or il n’y a qu’un moyen de rétablir l’équilibre, c’est de prendre aux uns pour donner aux autres. — Telle est en effet la mission que les gouvernements se sont donnée ou ont reçue, et c’est une conséquence rigoureuse de la formule : Le profit de l’un est le dommage de l’autre. Cet axiome étant tenu pour vrai, il faut bien que la force répare le mal que fait la liberté. — Ainsi les gouvernements, que nous croyions institués pour garantir à chacun sa liberté et sa propriété, ont entrepris la tâche de violer toutes les libertés et toutes les propriétés, et cela avec raison, si c’est en elles que réside le principe même du mal. Ainsi partout nous les voyons occupés de déplacer artificiellement le travail, les capitaux et les responsabilités.
D’un autre côté, une somme vraiment incalculable de forces intellectuelles se perd à la poursuite d’organisations sociales factices. Prendre aux uns pour donner aux autres, violer la liberté et la propriété, c’est un but fort simple ; mais les procédés peuvent varier à l’infini. De là ces multitudes de systèmes qui jettent l’effroi dans toutes les classes de travailleurs, puisque, par la nature même de leur but, ils menacent tous les intérêts.
Ainsi : gouvernements arbitraires et compliqués, négation de la liberté et de la propriété, antagonisme des classes et des peuples, tout cela est logiquement renfermé dans cet axiome : Le profit de l’un est le dommage de l’autre. — Et, par là même raison : simplicité dans les gouvernements, respect de la dignité individuelle, liberté du travail et de l’échange, paix entre les nations, sécurité pour les personnes et les propriétés, tout cela est contenu dans cette vérité : Les intérêts sont harmoniques, — à une condition cependant, c’est que cette vérité soit généralement admise.
Or il s’en faut bien qu’elle le soit. En lisant ce qui précède, beaucoup de personnes sont portées à me dire : Vous enfoncez une porte ouverte ; qui a jamais songé à contester sérieusement la supériorité de l’échange sur l’isolement ? Dans quel livre, si ce n’est peut-être dans ceux de Rousseau, avez-vous rencontré cet étrange paradoxe ?
Ceux qui m’arrêtent par cette réflexion n’oublient que deux choses, deux symptômes ou plutôt deux aspects de nos sociétés modernes : les doctrines dont les théoriciens nous inondent et les pratiques que les gouvernements nous imposent. Il faut pourtant bien que l’Harmonie des intérêts ne soit pas universellement reconnue, puisque, d’un côté, la force publique est constamment occupée à intervenir pour troubler leurs combinaisons naturelles ; et, que d’une autre part, le reproche qu’on lui adresse surtout, c’est de ne pas intervenir assez.
La question est celle-ci : Le Mal (il est clair que je parle ici du mal qui n’est pas la conséquence nécessaire de notre infirmité native) est-il imputable à l’action des lois sociales naturelles ou au trouble que nous faisons subir à cette action ?
Or deux faits coexistent : Le Mal, — la force publique occupée à contrarier les lois sociales naturelles. Le premier de ces faits est-il la conséquence du second ? Pour moi, je le crois ; je dirai même : J’en suis sûr. Mais en même temps je suis témoin de ceci : à mesure que le mal se développe, les gouvernements cherchent le remède dans de nouveaux troubles apportés à l’action de ces lois ; les théoriciens leur reprochent de ne pas les troubler assez. Ne suis-je pas autorisé à en conclure qu’on n’a guère confiance en elles ?
Oui, sans doute, si l’on pose la question entre l’isolement et l’échange, on est d’accord. Mais si on la pose entre l’échange libre et l’échange forcé, en est-il de même ? N’y a-t-il rien d’artificiel, de forcé, de restreint ou de contraint, en France, dans la manière dont s’y échangent les services relatifs au commerce, au crédit, aux transports, aux arts, à l’instruction, à la religion ? Le travail et les capitaux se sont-ils répartis naturellement entre l’agriculture et les fabriques ? Quand les intérêts se déplacent, obéissent-ils toujours à leur propre impulsion ? Ne rencontrons-nous pas de toute part des entraves ? Est-ce qu’il n’a pas cent professions qui sont interdites au plus grand nombre d’entre nous ? Est-ce que le catholique ne paye pas forcément les services du rabbin juif, et le juif les services du prêtre catholique ? Est-ce qu’il y a un seul homme, en France, qui a reçu l’éducation que ses parents lui eussent donnée s’ils eussent été libres ? Est-ce que notre intelligence, nos mœurs, nos idées, notre industrie ne se façonnent pas sous le régime de l’arbitraire ou du moins de l’artificiel ? Or, je le demande, troubler l’échange libre des services, n’est-ce pas nier l’harmonie des intérêts ? Sur quel fondement me vient-on ravir ma liberté, si ce n’est qu’on la juge nuisible aux autres ? Dira-t-on que c’est à moi-même qu’elle nuit ? Mais alors c’est un antagonisme de plus. Et où en sommes-nous, grand Dieu ! si la nature a placé dans le cœur de tout homme un mobile permanent, indomptable, en vertu duquel il blesse tout le monde et se blesse lui-même ?
Oh ! on a essayé tant de choses, quand est-ce donc qu’on essayera la plus simple de toutes : la Liberté ? La liberté de tous les actes qui ne blessent pas la justice ; la liberté de vivre, de se développer, de se perfectionner ; le libre exercice des facultés ; le libre échange des services. — N’eût-ce pas été un beau et solennel spectacle que le Pouvoir né de la révolution de Février se fût adressé ainsi aux citoyens :
« Vous m’avez investi de la Force publique. Je ne l’emploierai qu’aux choses dans lesquelles l’intervention de la Force soit permise ; or, il n’en est qu’une seule, c’est la Justice. Je forcerai chacun à rester dans la limite de ses droits. Que chacun de vous travaille en liberté le jour et dorme en paix la nuit. Je prends à ma charge la sécurité des personnes et des propriétés : c’est ma mission, je la remplirai, — mais je n’en accepte pas d’autre. Qu’il n’y ait donc plus de malentendu entre nous. Désormais vous ne me payerez que le léger tribut indispensable pour le maintien de l’ordre et la distribution de la justice. Mais aussi, sachez-le bien, désormais chacun de vous est responsable envers lui-même de sa propre existence et de son perfectionnement. Ne tournez plus sans cesse vos regards vers moi. Ne me demandez pas de vous donner de la richesse, du travail, du crédit, de la religion, de la moralité ; n’oubliez pas que le mobile en vertu duquel vous vous développez est en vous ; que, quant à moi, je n’agis jamais que par l’intermédiaire de la force ; que je n’ai rien, absolument rien que je ne tienne de vous ; et que, par conséquent, je ne puis conférer le plus petit avantage aux uns qu’aux dépens des autres. Labourez donc vos champs, fabriquez et transportez leurs produits, faites le commerce, donnez-vous réciproquement du crédit, rendez et recevez librement des services, faites élever vos fils, trouvez-leur une carrière, cultivez les arts, perfectionnez votre intelligence, épurez vos sentiments, rapprochez-vous les uns des autres, formez des associations industrielles ou charitables, unissez vos efforts pour le bien individuel comme pour le bien général ; obéissez à vos tendances, accomplissez vos destinées selon vos facultés, vos vues, votre prévoyance. N’attendez de moi que deux choses : Liberté, Sécurité, — et comprenez bien que vous ne pouvez, sans les perdre toutes deux, m’en demander une troisième. »
Oui, j’en suis convaincu, si la révolution de Février eût proclamé ce principe, elle eût été la dernière. Comprend-on que les citoyens, d’ailleurs parfaitement libres, aspirent à renverser le Pouvoir, alors que son action se borne à satisfaire le plus impérieux, le mieux senti de tous les besoins sociaux, le besoin de la Justice ?
Mais il n’était malheureusement pas possible que l’Assemblée nationale entrât dans cette voie, et fît entendre ces paroles. Elles ne répondaient ni à sa pensée, ni à l’attente publique. Elles auraient jeté l’effroi au sein de la société autant peut-être que pourrait le faire la proclamation du Communisme. Être responsables de nous-mêmes ! eût-on dit. Ne plus compter sur l’État que pour le maintien de l’ordre et de la paix ! N’attendre de lui ni nos richesses, ni nos lumières ! N’avoir plus à rejeter sur lui la responsabilité de nos fautes, de notre incurie, de notre imprévoyance !
Ne compter que sur nous-mêmes pour nos moyens de subsistance, pour notre amélioration physique, intellectuelle, et morale ! Grand Dieu ! qu’allons-nous devenir ? La société ne va-t-elle pas être envahie par la misère, l’ignorance, l’erreur, l’irréligion et la perversité ?
On en conviendra, telles eussent été les craintes qui se fussent manifestées de toute part, si la révolution de Février eût proclamé la Liberté, c’est-à-dire le règne des lois sociales naturelles. Donc, ou nous ne connaissons pas ces lois, ou nous n’avons pas confiance en elles. Nous ne pouvons nous défendre de l’idée que les mobiles que Dieu a mis dans l’homme sont essentiellement pervers ; qu’il n’y a de rectitude que dans les intentions et les vues des gouvernants ; que les tendances de l’humanité mènent à la désorganisation, à l’anarchie ; en un mot, nous croyons à l’antagonisme fatal des intérêts.
Aussi, loin qu’à la révolution de Février la société française ait manifesté la moindre aspiration vers une organisation naturelle, jamais peut-être ses idées et ses espérances ne s’étaient tournées avec autant d’ardeur vers des combinaisons factices. Lesquelles ? On ne le savait trop. Il s’agissait, selon le langage du temps, de faire des essais : Faciamus experimentum in corpore vili. Et l’on semblait arrivé à un tel mépris de l’individualité, à une si parfaite assimilation de l’homme à la matière inerte, qu’on parlait de faire des expériences sociales avec des hommes comme on fait des expériences chimiques avec des alcalis et des acides. Une première expérimentation fut commencée au Luxembourg, on sait avec quel succès. Bientôt l’Assemblée constituante institua un comité du travail où vinrent s’engloutir des milliers de plans sociaux. On vit un représentant fouriériste demander sérieusement de la terre et de l’argent (il n’aurait pas tardé sans doute à demander aussi des hommes) pour manipuler sa société-modèle. Un autre représentant égalitaire offrit aussi sa recette qui fut refusée. Plus heureux, les manufacturiers ont réussi à maintenir la leur. Enfin, en ce moment, l’Assemblée législative a nommé une commission pour organiser l’assistance.
Ce qui surprend en tout ceci, c’est que les dépositaires du Pouvoir ne soient pas venus de temps en temps, dans l’intérêt de sa stabilité, faire entendre ces paroles : « Vous habituez trente-six millions de citoyens à s’imaginer que je suis responsable de tout ce qui leur arrive en bien ou en mal dans ce monde. À cette condition, il n’y a pas de gouvernement possible. »
Quoi qu’il en soit, si ces diverses inventions sociale, décorées du nom d’organisation, diffèrent entre elles par leurs procédés, elles partent toutes du même principe : Prendre aux uns pour donner aux autres. — Or il est bien clair qu’un tel principe n’a pu rencontrer des sympathies si universelles, au sein de la nation, que parce que l’on y est très-convaincu que les intérêts sont naturellement antagoniques et les tendances humaines essentiellement perverses.
Prendre aux uns pour donner aux autres ! — Je sais bien que les choses se passent ainsi depuis longtemps. Mais, avant d’imaginer, pour guérir la misère, divers moyens de réaliser ce bizarre principe, ne devrait-on pas se demander si la misère ne provient pas précisément de ce que ce principe a été réalisé sous une forme quelconque ? Avant de chercher le remède dans de nouvelles perturbations apportées à l’empire des lois sociales naturelles, ne devrait-on pas s’assurer si ces perturbations ne constituent pas justement le mal dont la société souffre et qu’on veut guérir ?
Prendre aux uns pour donner aux autre ! — Qu’il me soit permis de signaler ici le danger et l’absurdité de la pensée économique de cette aspiration, dite sociale, qui fermentait au sein des masses et qui a éclaté avec tant de force à la révolution de Février[229] .
Quand il y a encore plusieurs couches dans la société, on conçoit que la première jouisse de priviléges aux dépens de toutes les autres. C’est odieux, mais ce n’est pas absurde.
La seconde couche ne manquera pas alors de battre en brèche les priviléges ; et, à l’aide des masses populaires, elle parviendra tôt ou tard à faire une Révolution. En ce cas, la Force passant en ses mains, on conçoit encore qu’elle se constitue des Priviléges. C’est toujours odieux, mais ce n’est pas absurde, ce n’est pas du moins impraticable, car le Privilége est possible tant qu’il a au-dessous de lui, pour l’alimenter, le gros du public. Si la troisième, la quatrième couche font aussi leur révolution, elles s’arrangeront aussi, si elles le peuvent, de manière à exploiter les masses au moyen de Priviléges très-habilement combinés. Mais voici que le gros du public, foulé, pressuré, exténué, fait aussi sa révolution. Pourquoi ? Que va-t-il faire ? Vous croyez peut-être qu’il va abolir tous les priviléges, inaugurer le règne de la justice universelle ? qu’il va dire : « Arrière les restrictions ; arrière les entraves ; arrière les monopoles ; arrière les interventions gouvernementales au profit d’une classe ; arrière les lourds impôts ; arrière les intrigues diplomatiques et politiques ! » Non, sa prétention est bien autre, il se fait solliciteur, il demande, lui aussi, à être privilégié. Lui, le gros du public, imitant les classes supérieures, implore à son tour des priviléges ! Il veut le droit au travail, le droit au crédit, le droit à l’instruction, le droit à l’assistance ! Mais aux dépens de qui ? C’est ce dont il ne se met pas en peine. Il sait seulement que, si on lui assurait du travail, du crédit, de l’instruction, du repos pour ses vieux jours, le tout gratuitement, cela serait fort heureux, et, certes, personne ne le conteste. Mais est-ce possible ? Hélas ! non, et c’est pourquoi je dis qu’ici l’odieux disparaît ; mais l’absurde est à son comble.
Des Priviléges aux masses ! Peuple, réfléchis donc au cercle vicieux où tu te places. Privilége suppose quelqu’un pour en jouir et quelqu’un pour le payer. On comprend un homme privilégié, une classe privilégiée ; mais peut-on concevoir tout un peuple privilégié ? Est-ce qu’il y a au-dessous de toi une autre couche sociale sur qui rejeter le fardeau ? Ne comprendras-tu jamais la bizarre mystification dont tu es dupe ? Ne comprendras-tu jamais que l’État ne peut rien te donner d’une main qu’il ne t’ait pris un peu davantage de l’autre ? que, bien loin qu’il y ait pour toi, dans cette combinaison, aucun accroissement possible de bien-être, le résidu de l’opération c’est un gouvernement arbitraire, plus vexatoire, plus responsable, plus dispendieux et plus précaire, des impôts plus lourds, des injustices plus nombreuses, des faveurs plus blessantes, une liberté plus restreinte, des forces perdues, des intérêts, du travail et des capitaux déplacés, la convoitise excitée, le mécontentement provoqué et l’énergie individuelle éteinte ?
Les classes supérieures s’alarment, et ce n’est pas sans raison, de cette triste disposition des masses. Elles y voient le germe de révolutions incessantes ; car quel gouvernement peut tenir quand il a eu le malheur de dire : « J’ai la force, et je l’emploierai à faire vivre tout le monde aux dépens de tout le monde. J’assume sur moi la responsabilité du bonheur universel ! » — Mais l’effroi dont ces classes sont saisies n’est-il pas un châtiment mérité ? N’ont-elles pas elles-mêmes donné au peuple le funeste exemple de la disposition dont elles se plaignent ? N’ont-elles pas toujours tourné leurs regards vers les faveurs de l’État ? Ont-elles jamais manqué d’assurer quelque privilége grand ou petit aux fabriques, aux banques, aux mines, à la propriété foncière, aux arts, et jusqu’à leurs moyens de délassement et de diversion, à la danse, à la musique, à tout enfin, excepté au travail du peuple, au travail manuel ? N’ont-elles pas poussé à la multiplication des fonctions publiques pour accroître, aux dépens des masses, leurs moyens d’existence, et y a-t-il aujourd’hui un père de famille qui ne songe à assurer une place à son fils ? Ont-elles jamais fait volontairement disparaître une seule des inégalités reconnues de l’impôt ? N’ont-elles pas longtemps exploité jusqu’au privilége électoral ? — Et maintenant elles s’étonnent, elles s’affligent de ce que le peuple s’abandonne à la même pente ! Mais, quand l’esprit de mendicité a si longtemps prévalu dans les classes riches, comment veut-on qu’il n’ait pas pénétré au sein des classes souffrantes ?
Cependant une grande révolution s’est accomplie. La puissance politique, la faculté de faire des lois, la disposition de la force, ont passé virtuellement, sinon de fait encore, aux mains du Peuple, avec le suffrage universel. Ainsi ce peuple qui pose le problème sera appelé à le résoudre ; et malheur au pays si, suivant l’exemple qui lui a été donné, il cherche la solution dans le Privilége, qui est toujours une violation du droit d’autrui. Certes il aboutira à une déception et par là à un grand enseignement ; car, s’il est possible de violer le droit du grand nombre en faveur du petit nombre, comment pourrait-on violer le droit de tous pour l’avantage de tous ? — Mais à quel prix cet enseignement sera-t-il acheté ? Pour prévenir cet effrayant danger, que devraient faire les classes supérieures ? Deux choses : renoncer pour elles-mêmes à tout privilége, éclairer les masses, — car il n’y a que deux choses qui puissent sauver la société : la Justice et la Lumière. Elles devraient rechercher avec soin si elles ne jouissent pas de quelque monopole, pour y renoncer ; — si elles ne profitent pas de quelques inégalités factices, pour les effacer ; — si le Paupérisme ne peut pas être attribué, en partie du moins, à quelque perturbation des lois sociales naturelles, pour la faire cesser, — afin de pouvoir dire en montrant leurs mains au peuple : Elles sont pleines, mais elles sont pures. — Est-ce là ce qu’elles font ? Si je ne m’aveugle, elles font tout le contraire. — Elles commencent par garder leurs monopoles, et on les a vues même profiter de la révolution pour essayer de les accroître. Après s’être ainsi ôté jusqu’à la possibilité de dire la vérité et d’invoquer les principes, pour ne pas se montrer trop inconséquentes, elles promettent au peuple de le traiter comme elles se traitent elles-mêmes, et font briller à ses yeux l’appât des Priviléges. Seulement elles se croient très-rusées en ce qu’elles ne lui concèdent aujourd’hui qu’un petit privilége : le droit à l’assistance, dans l’espoir de le détourner d’en réclamer un gros : le droit au travail. Et elles ne s’aperçoivent pas qu’étendre et systématiser de plus en plus l’axiome : Prendre aux uns pour donner aux autres, — c’est renforcer l’illusion qui crée les difficultés du présent et les dangers de l’avenir.
N’exagérons rien toutefois. Quand les classes supérieures cherchent dans l’extension du privilége le remède aux maux que le privilége a faits, elles sont de bonne foi et agissent, j’en suis convaincu, plutôt par ignorance que par injustice. C’est un malheur irréparable, que les gouvernements qui se sont succédé en France aient toujours mis obstacle à l’enseignement de l’économie politique. C’en est un bien plus grand encore, que l’éducation universitaire remplisse toutes nos cervelles de préjugés romains, c’est-à-dire de tout ce qu’il y a de plus antipathique à la vérité sociale. C’est là ce qui fait dévier les classes supérieures. Il est de mode aujourd’hui de déclamer contre elles. Pour moi, je crois qu’à aucune époque elles n’ont eu des intentions plus bienveillantes. Je crois qu’elles désirent avec ardeur résoudre le problème social. Je crois qu’elles feraient plus que de renoncer à leurs priviléges et qu’elles sacrifieraient volontiers, en œuvres charitables, une partie de leurs propriétés acquises, si, par là, elles croyaient mettre un terme définitif aux souffrances des classes laborieuses. On dira, sans doute, que l’intérêt ou la peur les anime et qu’il n’y a pas grande générosité à abandonner une partie de son bien pour sauver le reste. C’est la vulgaire prudence de l’homme qui fait la part du feu. — Ne calomnions pas ainsi la nature humaine. Pourquoi refuserions-nous de reconnaître un sentiment moins égoïste ? N’est-il pas bien naturel que les habitudes démocratiques, qui prévalent dans notre pays, rendent les hommes sensibles aux souffrances de leurs frères ? Mais, quel que soit le sentiment qui domine, ce qui ne se peut nier, c’est que tout ce qui peut manifester l’opinion, la philosophie, la littérature, la poésie, le drame, la prédication religieuse, les discussions parlementaires, le journalisme, tout révèle dans la classe aisée plus qu’un désir, une soif ardente de résoudre le grand problème. Pourquoi donc ne sort-il rien de nos Assemblées législatives ? Parce qu’elles ignorent. L’économie politique leur propose cette solution : justice légale, — charité privée. Elles prennent le contre-pied ; et obéissant, sans s’en apercevoir, aux influences socialistes, elles veulent mettre la charité dans la loi, c’est-à-dire en bannir la justice, au risque de tuer du même coup la charité privée, toujours prompte à reculer devant la charité légale.
Pourquoi donc nos législateurs bouleversent-ils ainsi toutes les notions ? Pourquoi ne laissent-ils pas chaque chose à sa place : la Sympathie dans son domaine naturel qui est la Liberté ; — et la Justice dans le sien, qui est la Loi ? Pourquoi n’appliquent-ils pas la loi exclusivement à faire régner la justice ? Serait-ce qu’ils n’aiment pas la justice ? Non, mais ils n’ont pas confiance en elle. Justice, c’est liberté et propriété. Or ils sont socialistes sans le savoir ; pour la réduction progressive de la misère, pour l’expansion indéfinie de la richesse, ils n’ont foi, quoi qu’ils en disent, ni à la liberté, ni à la propriété, ni, par conséquent, à la justice. — Et c’est pourquoi on les voit de très-bonne foi chercher la réalisation du Bien par la violation perpétuelle du droit.
On peut appeler lois sociales naturelles l’ensemble des phénomènes, considérés tant dans leurs mobiles que dans leurs résultats, qui gouvernent les libres transactions des hommes.
Cela posé, la question est celle-ci :
Faut-il laisser agir ces lois, — ou faut-il les empêcher d’agir ?
Cette question revient à celle-ci :
Faut il reconnaitre à chacun sa propriété et sa liberté, son droit de travailler et d’échanger sous sa responsabilité, soit qu’elle châtie, soit qu’elle récompense, et ne faire intervenir la Loi, qui est la Force, que pour la protection de ces droits ? — Ou bien, peut-on espérer arriver à une plus grande somme de bonheur social en violant la propriété et la liberté, en réglementant le travail, troublant l’échange et déplaçant les responsabilités ?
En d’autres termes :
La loi doit-elle faire prévaloir la Justice rigoureuse, ou être l’instrument de la Spoliation organisée avec plus ou moins d’intelligence ?
Il est bien évident que la solution de ces questions est subordonnée à l’étude et à la connaissance des lois sociales naturelles. On ne peut se prononcer raisonnablement avant de savoir si la propriété, la liberté, les combinaisons des services volontairement échangés poussent les hommes vers leur amélioration, comme le croient les économistes, ou vers leur dégradation, comme l’affirment les socialistes. — Dans le premier cas, le mal social doit être attribué aux perturbations des lois naturelles, aux violations légales de la propriété et de la liberté. Ce sont ces perturbations et ces violations qu’il faut faire cesser, et l’Économie politique a raison. — Dans le second, nous n’avons pas encore assez d’intervention gouvernementale ; les combinaisons factices et forcées ne sont pas encore assez substituées aux combinaisons naturelles et libres ; ces trois funestes principes : Justice, Propriété, Liberté, ont encore trop d’empire. Nos législateurs ne leur ont pas encore porté d’assez rudes coups. On ne prend pas encore assez aux uns pour donner aux autres. Jusqu’ici on a pris au grand nombre pour donner au petit nombre. Maintenant il faut prendre à tous pour donner à tous. En un mot, il faut organiser la spoliation, et c’est du Socialisme que nous viendra le salut[230] .
---------
Fatales illusions qui naissent de l’échange. — L’échange, c’est la société. Par conséquent, la vérité économique c’est la vue complète, et l’erreur économique c’est la vue partielle de l’échange.
Si l’homme n’échangeait pas, chaque phénomène économique s’accomplirait dans l’individualité, et il nous serait très-facile de constater par l’observation ses bons et ses mauvais effets.
Mais l’échange a amené la séparation des occupations, et, pour parler la langue vulgaire, l’établissement des professions et des métiers. Chaque service (ou chaque produit) a donc deux rapports, l’un avec celui qui le livre, l’autre avec celui qui le reçoit.
Sans doute, à la fin de l’évolution, l’homme social, comme l’homme isolé, est tout à la fois producteur et consommateur. Mais il faut bien voir la différence. L’homme isolé est toujours producteur de la chose même qu’il consomme. Il n’en est presque jamais ainsi de l’homme social. C’est un point de fait incontestable, et que chacun peut vérifier sur soi-même. Cela résulte d’ailleurs de ce que la société n’est qu’échange de services.
Nous sommes tous producteurs et consommateurs non de la chose, mais de la valeur que nous avons produite. En échangeant les choses, nous restons toujours propriétaires de leur valeur.
C’est de cette circonstance que naissent toutes les illusions et toutes les erreurs économiques. Il n’est certes pas superflu de signaler ici la marche de l’esprit humain à cet égard.
On peut donner le nom général d’obstacles à tout ce qui, s’interposant entre nos besoins et nos satisfactions, provoque l’intervention de nos efforts.
Les rapports de ces quatre éléments : besoin, obstacle, effort, satisfaction, sont parfaitement visibles et compréhensibles dans l’homme isolé. Jamais, au grand jamais, il ne nous viendrait dans la pensée de dire :
« Il est fâcheux que Robinson ne rencontre pas plus d’obstacles ; car, en ce cas, il aurait plus d’occasions de déployer ses efforts : il serait plus riche.
Il est fâcheux que la mer ait jeté sur le rivage de l’île du Désespoir des objets utiles, des planches, des vivres, des armes, des livres ; car cela ôte à Robinson l’occasion de déployer des efforts : il est moins riche.
Il est fâcheux que Robinson ait inventé des filets pour prendre le poisson ou le gibier ; car cela diminue d’autant les efforts qu’il accomplit pour un résultat donné : il est moins riche.
Il est fâcheux que Robinson ne soit pas plus souvent malade. Cela lui fournirait l’occasion de faire de la médecine sur lui-même, ce qui est un travail ; et, comme toute richesse vient du travail, il serait plus riche.
Il est fâcheux que Robinson ait réussi à éteindre l’incendie qui menaçait sa cabane. Il a perdu là une précieuse occasion de travail : il est moins riche.
Il est fâcheux que dans l’île du Désespoir la terre ne soit pas plus ingrate, la source plus éloignée, le soleil moins longtemps sur l’horizon. Pour se nourrir, s’abreuver, s’éclairer, Robinson aurait plus de peine à prendre : il serait plus riche. »
Jamais, dis-je, on ne mettrait en avant, comme des oracles de vérité, des propositions aussi absurdes. Il serait d’une évidence trop palpable que la richesse ne consiste pas dans l’intensité de l’effort pour chaque satisfaction acquise, et que c’est justement le contraire qui est vrai. On comprendrait que la richesse ne consiste ni dans le besoin, ni dans l’obstacle, ni dans l’effort, mais dans la satisfaction ; et l’on n’hésiterait pas à reconnaître qu’encore que Robinson soit tout à la fois producteur et consommateur, pour juger de ses progrès, ce n’est pas à son travail, mais aux résultats qu’il faut regarder. Bref, en proclamant cet axiome : L’intéret dominant est celui du consommateur, — on croirait n’exprimer qu’un véritable truisme.
Heureuses les nations quand elles verront clairement comment et pourquoi ce que nous trouvons faux, ce que nous trouvons vrai, quant à l’homme isolé, ne cesse pas d’être faux ou vrai pour l’homme social !…
Ce qui est certain cependant, c’est que les cinq ou six propositions qui nous ont paru absurdes, appliquées à l’île du Désespoir, paraissent si incontestables, quand il s’agit de la France, qu’elles servent de base à toute notre législation économique. Au contraire, l’axiome qui nous semblait la vérité même, quant à l’individu, n’est jamais invoqué au nom de la société sans provoquer le sourire du dédain.
Serait-il donc vrai que l’échange altère à ce point notre organisation individuelle, que ce qui fait la misère de l’individu fasse la richesse sociale ?
Non, cela n’est pas vrai. Mais il faut le dire, cela est spécieux, très-spécieux même, puisque c’est si généralement cru.
La société consiste en ceci : que nous travaillons les uns pour les autres. Nous recevons d’autant plus de services que nous en rendons davantage, ou que ceux que nous rendons sont plus appréciés, plus recherchés, mieux rémunérés. D’un autre côté, la séparation des occupations fait que chacun de nous applique ses efforts à vaincre un obstacle qui s’oppose aux satisfactions d’autrui. Le laboureur combat l’obstacle appelé faim ; le médecin, l’obstacle appelé maladie ; le prêtre, l’obstacle appelé vice ; l’écrivain, l’obstacle appelé ignorance ; le mineur, l’obstacle appelé froid, etc., etc.
Et comme tous ceux qui nous entourent sont d’autant plus disposés à rémunérer nos efforts, qu’ils sentent plus vivement l’obstacle qui les gêne, il s’ensuit que nous sommes tous disposés, à ce point de vue et comme producteurs, à vouer un culte à l’obstacle que nous faisons profession de combattre. Nous nous regardons comme plus riches si ces obstacles augmentent, et nous concluons aussitôt de notre avantage particulier à l’avantage général[231] .
V. De la Valeur↩
Dissertation, ennui. — Dissertation sur la Valeur, ennui sur ennui.
Aussi quel novice écrivain, placé en face d’un problème économique, n’a essayé de le résoudre, abstraction faite de toute définition de la valeur ?
Mais il n’aura pas tardé à reconnaître combien ce procédé est insuffisant. La théorie de la Valeur est à l’économie politique ce que la numération est à l’arithmétique. Dans quels inextricables embarras ne se serait pas jeté Bezout, si, pour épargner quelque fatigue à ses élèves, il eût entrepris de leur enseigner les quatre règles et les proportions, sans leur avoir préalablement expliqué la valeur que les chiffres empruntent à leur figure ou à leur position ?
Si encore le lecteur pouvait pressentir les belles conséquences qui se déduisent de la théorie de la valeur ! Il accepterait l’ennui de ces premières notions, comme on se résigne à étudier péniblement les éléments de la géométrie, en vue du magnifique champ qu’ils ouvrent à notre intelligence.
Mais cette sorte de prévision intuitive n’est pas possible. Plus je me donnerai de soin pour distinguer la Valeur, soit de l’Utilité, soit du Travail, pour montrer combien il était naturel que la science commençât par trébucher à ces écueils, plus, sans doute, on sera porté à ne voir dans cette délicate discussion que de stériles et oiseuses subtilités, bonnes tout au plus à satisfaire la curiosité des hommes du métier.
Vous recherchez laborieusement, me dira-t-on, si la richesse est dans l’utilité des choses, ou dans leur valeur ou dans leur rareté. N’est-ce pas une question, comme celle de l’école : La forme est-elle dans la substance ou dans l’accident ? Et ne craignez-vous pas qu’un Molière de carrefour ne vous expose aux risées du public des Variétés ?
Et cependant, je dois le dire : au point de vue économique, Société c’est Échange. La première création de l’échange, c’est la notion de valeur, en sorte que toute vérité ou toute erreur introduite dans les intelligences par ce mot est une vérité ou une erreur sociale.
J’entreprends de montrer dans cet écrit l’Harmonie des lois providentielles qui régissent la société humaine. Ce qui fait que ces lois sont harmoniques et non discordantes, c’est que tous les principes, tous les mobiles, tous les ressorts, tous les intérêts concourent vers un grand résultat final, que l’humanité n’atteindra jamais à cause de son imperfection native, mais dont elle approchera toujours en vertu de sa perfectibilité indomptable ; et ce résultat est : le rapprochement indéfini de toutes les classes vers un niveau qui s’élève toujours ; en d’autres termes : l’égalisation des individus dans l’amélioration générale.
Mais pour réussir il faut que je fasse comprendre deux choses, savoir :
1° Que l’Utilité tend à devenir de plus en plus gratuite, commune, en sortant progressivement du domaine de l’appropriation individuelle ;
2° Que la Valeur, au contraire, seule appropriable, seule constituant la propriété de droit et de fait, tend à diminuer de plus en plus relativement à l’utilité à laquelle elle est attachée.
En sorte que, si elle est bien faite, une telle démonstration fondée sur la Propriété, mais seulement sur la propriété de la Valeur, — et sur la Communauté, mais seulement sur la communauté de l’utilité, — une telle démonstration, dis-je, doit satisfaire et concilier toutes les écoles, en leur concédant que toutes ont entrevu la vérité, mais la vérité partielle prise à des points de vue divers.
Économistes, vous défendez la propriété. Il n’y a, dans l’ordre social, d’autre propriété que celle des valeurs, et celle-là est inébranlable.
Communistes, vous rêvez la communauté. Vous l’avez. L’ordre social rend toutes les utilités communes, à la condition que l’échange des valeurs appropriées soit libre.
Vous ressemblez à des architectes qui disputent sur un monument, dont chacun n’a observé qu’une face. Ils ne voient pas mal, mais ils ne voient pas tout. Pour les mettre d’accord, il ne faut que les décider à faire le tour de l’édifice.
Mais cet édifice social, comment le pourrais-je reconstruire, aux yeux du public, dans toute sa belle harmonie, si je rejette ses deux pierres angulaires : Utilité, Valeur ? Comment pourrais-je amener la désirable conciliation de toutes les écoles, sur le terrain de la vérité, si je recule devant l’analyse de ces deux idées, alors que la dissidence est née de la malheureuse confusion qui en a été faite ?
Cette manière d’exorde était nécessaire pour déterminer, s’il se peut, le lecteur à un instant d’attention, de fatigue, et probablement, hélas ! d’ennui. Ou je me fais bien illusion, ou la consolante beauté des conséquences rachètera la sécheresse des prémisses. Si Newton s’était laissé rebuter, à l’origine, par le dégoût des premières études mathématiques, jamais son cœur n’eût battu d’admiration à l’aspect des harmonies de la mécanique céleste ; et je soutiens qu’il suffit de traverser virilement quelques notions élémentaires pour reconnaître que Dieu n’a pas déployé, dans la mécanique sociale, moins de bonté touchante, d’admirable simplicité et de magnifique splendeur.
Dans le premier chapitre nous avons vu que l’homme est passif et actif ; que le Besoin et la Satisfaction, n’affectant que la sensibilité, étaient, de leur nature, personnels, intimes, intransmissibles ; que l’Effort, au contraire, lien entre le Besoin et la Satisfaction, moyen entre le principe et la fin, partant de notre activité, de notre spontanéité, de notre volonté, était susceptible de conventions, de transmission. Je sais qu’on pourrait, au point de vue métaphysique, contester cette assertion et soutenir que l’Effort aussi est personnel. Je n’ai pas envie de m’engager sur le terrain de l’idéologie, et j’espère que ma pensée sera admise sans controverse sous cette forme vulgaire : nous ne pouvons sentir les besoins des autres ; nous ne pouvons sentir les satisfactions des autres ; mais nous pouvons nous rendre service les uns aux autres.
C’est cette transmission d’efforts, cet échange de services qui fait la matière de l’économie politique et, puisque, d’un autre côté, la science économique se résume dans le mot Valeur, dont elle n’est que la longue explication, il s’ensuit que la notion de valeur sera imparfaitement, faussement conçue si on la fonde sur les phénomènes extrêmes qui s’accomplissent dans notre sensibilité : Besoins et Satisfactions, phénomènes intimes, intransmissibles, incommensurables d’un individu à l’autre, — au lieu de la fonder sur les manifestations de notre activité, sur les efforts, sur les services réciproques qui s’échangent, parce qu’ils sont susceptibles d’être comparés, appréciés, évalués, parce qu’ils sont susceptibles d’être évalués précisément parce qu’ils s’échangent.
Dans le même chapitre nous sommes arrivés à ces formules :
« L’utilité (la propriété qu’ont certains actes ou certaines choses de nous servir) est composée : une partie est due à l’action de la nature, une autre à l’action de l’homme. » — « Il reste d’autant moins à faire au travail humain, pour un résultat donné, que la nature a plus fait. » — « La coopération de la nature est essentiellement gratuite ; la coopération de l’homme, intellectuelle ou matérielle, échangée ou non, collective ou solitaire, est essentiellement onéreuse, ainsi que l’implique ce mot même : Effort. »
Et comme ce qui est gratuit ne saurait avoir de valeur, puisque l’idée de valeur implique celle d’acquisition à titre onéreux, il s’ensuit que la notion de Valeur sera encore mal conçue, si on l’étend, en tout ou partie, aux dons ou à la coopération de la nature, au lieu de la restreindre exclusivement à la coopération humaine.
Ainsi, de deux côtés, par deux routes différentes, nous arrivons à cette conclusion que la valeur doit avoir trait aux efforts que font les hommes pour donner satisfaction à leurs besoins.
Au troisième chapitre, nous avons constaté que l’homme ne pouvait vivre dans l’isolement. Mais si, par la pensée, nous évoquons cette situation chimérique, cet état contre nature que le dix-huitième siècle exaltait sous le nom d’état de nature, nous ne tardons pas à reconnaître qu’il ne révèle pas encore la notion de Valeur, bien qu’il présente cette manifestation de notre principe actif que nous avons appelée Effort. La raison en est simple : Valeur implique comparaison, appréciation, évaluation, mesure. Pour que deux choses se mesurent l’une par l’autre, il faut qu’elles soient commensurables, et, pour cela, il faut qu’elles soient de même nature. Dans l’isolement, à quoi pourrait-on comparer l’effort ? au besoin, à la satisfaction ? Cela ne peut conduire qu’à lui reconnaître plus ou moins d’à-propos, d’opportunité. Dans l’état social, ce que l’on compare (et c’est de cette comparaison que naît l’idée de Valeur), c’est l’effort d’un homme à l’effort d’un autre homme, deux phénomènes de même nature et, par conséquent, commensurables.
Ainsi la définition du mot valeur, pour être juste, doit avoir trait non-seulement aux efforts humains, mais encore à ces efforts échangés ou échangeables. L’échange fait plus que de constater et de mesurer les valeurs, il leur donne l’existence. Je ne veux pas dire qu’il donne l’existence aux actes et aux choses qui s’échangent, mais il la donne à la notion de valeur.
Or quand deux hommes se cèdent mutuellement leur effort actuel, ou les résultats de leurs efforts antérieurs, ils se servent l’un l’autre, ils se rendent réciproquement service.'
Je dis donc : La valeur, c’est le rapport de deux services échangés.
L’idée de valeur est entrée dans le monde la première fois qu’un homme ayant dit à son frère : Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi, — ils sont tombés d’accord ; car alors pour la première fois on a pu dire : Les deux services échangés se valent.
Il est assez singulier que la vraie théorie de la valeur, qu’on cherche en vain dans maint gros livre, se rencontre dans la jolie fable de Florian, l’Aveugle et le Paralytique :
Aidons-nous mutuellement,
La charge des malheurs en sera plus légère.
. . . . . À nous deux
Nous possédons le bien à chacun nécessaire.
J’ai des jambes, et vous des yeux.
Moi, je vais vous porter ; vous, vous serez mon guide :
Ainsi, sans que jamais notre amitié décide
Qui de nous deux remplit le plus utile emploi,
Je marcherai pour vous ; vous y verrez pour moi.
Voilà la valeur trouvée et définie. La voilà dans sa rigoureuse exactitude économique, sauf le trait touchant relatif à l’amitié, qui nous transporte dans une autre sphère. On conçoit que deux malheureux se rendent réciproquement service, sans trop rechercher lequel des deux remplit le plus utile emploi. La situation exceptionnelle imaginée par le fabuliste explique assez que le principe sympathique, agissant avec une grande puissance, vienne absorber, pour ainsi dire, l’appréciation minutieuse des services échangés, appréciation indispensable pour dégager complétement la notion de Valeur. Aussi elle apparaitrait entière, si tous les hommes ou la plupart d’entre eux étaient frappés de paralysie ou de cécité ; car alors l’inexorable loi de l’offre et de la demande prendrait le dessus, et, faisant disparaître le sacrifice permanent accepté par celui qui remplit le plus utile emploi, elle replacerait la transaction sur le terrain de la justice.
Nous sommes tous aveugles ou perclus en quelque point. Nous comprenons bientôt qu’en nous entr’aidant la charge des malheurs en sera plus légère. De là l’Échange. Nous travaillons pour nous nourrir, vêtir, abriter, éclairer, guérir, défendre, instruire les uns les autres. De là les services réciproques. Ces services, nous les comparons, nous les discutons, nous les évaluons : de là la Valeur.
Une foule de circonstances peuvent augmenter l’importance relative d’un Service. Nous le trouvons plus ou moins grand, selon qu’il nous est plus ou moins utile, que plus ou moins de personnes sont disposées à nous le rendre ; qu’il exige d’elles plus ou moins de travail, de peine, d’habileté, de temps, d’études préalables ; qu’il nous en épargne plus ou moins à nous-mêmes. Non-seulement la valeur dépend de ces circonstances, mais encore du jugement que nous en portons : car il peut arriver, et il arrive souvent, que nous estimons très-haut un service, parce que nous le jugeons fort utile, tandis qu’en réalité il nous est nuisible. C’est pour cela que la vanité, l’ignorance, l’erreur ont leur part d’influence sur ce rapport essentiellement élastique et mobile que nous nommons valeur ; et l’on peut affirmer que l’appréciation des services tend à se rapprocher d’autant plus de la vérité et de la justice absolues, que les hommes s’éclairent, se moralisent et se perfectionnent davantage.
On a jusqu’ici cherché le principe de la Valeur dans une de ces circonstances qui l’augmentent ou qui la diminuent, matérialité, durée, utilité, rareté, travail, difficulté d’acquisition, jugement, etc. ; fausse direction imprimée dès l’origine à la science, car l’accident qui modifie le phénomène n’est pas le phénomène. De plus, chaque auteur s’est fait, pour ainsi dire, le parrain d’une de ces circonstances qu’il croyait prépondérante, résultat auquel on arrive toujours à force de généraliser ; car tout est dans tout, et il n’y a rien qu’on ne puisse faire entrer dans un mot à force d’en étendre le sens. Ainsi le principe de la valeur est pour Smith dans la matérialité et la durée, pour Say dans l’utilité, pour Ricardo dans le travail, pour Senior dans la rareté, pour Storch dans le jugement, etc.
Qu’est-il arrivé et que devait-il arriver ? C’est que ces auteurs ont innocemment porté atteinte à l’autorité et à la dignité de la science, en paraissant se contredire, quand, au fond, ils avaient raison chacun à son point de vue. En outre, ils ont enfoncé la première notion de l’économie politique dans un dédale de difficultés inextricables, car les mêmes mots ne représentaient plus pour les auteurs les mêmes idées ; et d’ailleurs, quoiqu’une circonstance fût proclamée fondamentale, les autres agissaient d’une manière trop évidente pour ne pas se faire faire place, et l’on voyait les définitions s’allonger sans cesse.
Ce livre n’est pas destiné à la controverse, mais à l’exposition. Je montre ce que je vois, et non ce que les autres ont vu. Je ne pourrai m’empêcher cependant d’appeler l’attention du lecteur sur les circonstances dans lesquelles on a cherché le fondement de la Valeur. Mais avant, je dois la faire poser elle-même devant lui dans une série d’exemples. C’est par des applications diverses que l’esprit saisit une théorie.
Je montrerai comment tout se réduit à un troc de services. Je prie seulement qu’on se rappelle ce qui a été dit du troc dans le chapitre précédent. Il est rarement simple ; quelquefois il s’accomplit par circulation entre plusieurs contractants, plus souvent par l’intermédiaire de la monnaie, et il se décompose alors en deux facteurs, vente et achat ; mais comme cette complication ne change pas sa nature, il me sera permis, pour plus de facilité, de supposer le troc immédiat et direct. Cela ne peut nous induire à aucune méprise sur la nature de la Valeur.
Nous naissons tous avec un impérieux besoin matériel qui doit être satisfait sous peine de mort, celui de respirer. D’un autre côté, nous sommes tous plongés dans un milieu qui pourvoit à ce besoin, en général, sans l’intervention d’aucun effort de notre part. L’air atmosphérique a donc de l’utilité sans avoir de valeur. Il n’a pas de Valeur, parce que, ne donnant lieu à aucun Effort, il n’est l’occasion d’aucun service. Rendre service à quelqu’un, c’est lui épargner une peine ; et là où il n’y a pas de peine à prendre pour réaliser la satisfaction, il n’y en a pas à épargner.
Mais si un homme descend au fond d’un fleuve, dans une cloche à plongeur, un corps étranger s’interpose entre l’air et ses poumons ; pour rétablir la communication, il faut mettre la pompe en mouvement ; il y a là un effort à faire, une peine à prendre ; certes, cet homme y sera tout disposé, car il y va de la vie, et il ne saurait se rendre à lui-même un plus grand service.
Au lieu de faire cet effort, il me prie de m’en charger ; et, pour m’y déterminer, il s’engage à prendre lui-même une peine dont je recueillerai la satisfaction. Nous débattons et concluons. Que voyons-nous ici ? Deux besoins, deux satisfactions qui ne se déplacent pas ; deux efforts qui sont l’objet d’une transaction volontaire, deux services qui s’échangent — et la valeur apparaît.
Maintenant on dit que l’utilité est le fondement de la valeur ; et comme l’utilité est inhérente à l’air, on induit l’esprit à penser qu’il en est de même de la valeur. Il y a là évidente confusion. L’air, par sa constitution, a des propriétés physiques en harmonie avec un de nos organes physiques, le poumon. Ce que j’en puise dans l’atmosphère pour en remplir la cloche à plongeur ne change pas de nature, c’est toujours de l’oxygène et de l’azote ; aucune nouvelle qualité physique ne s’y est combinée, aucun réactif n’en ferait sortir un élément nouveau appelé valeur. La vérité est que celle-ci naît exclusivement du service rendu.
Quand on pose cet axiome : L’Utilité est le fondement de la Valeur, si l’on entend dire : Le Service a de la Valeur parce qu’il est utile à celui qui le reçoit et le paye, je ne disputerai pas. C’est là un truisme dont le mot service tient suffisamment compte.
Mais ce qu’il ne faut pas confondre, c’est l’utilité de l’air avec l’utilité du service. Ce sont là deux utilités distinctes, d’un autre ordre, d’une autre nature, qui n’ont entre elles aucune proportion, aucun rapport nécessaire. Il y a des circonstances où je puis, avec un très-léger effort, en lui épargnant une peine insignifiante, en lui rendant par conséquent un très-mince service, mettre à la portée de quelqu’un une substance d’une très-grande utilité intrinsèque.
Chercherons-nous à savoir comment les deux contractants s’y prendront pour évaluer le service que l’un rend à l’autre en lui envoyant de l’air ? Il faut un point de comparaison, et il ne peut être que dans le service que le plongeur s’est engagé à rendre en retour. Leur exigence réciproque dépendra de leur situation respective, de l’intensité de leurs désirs, de la facilité plus ou moins grande de se passer l’un de l’autre, et d’une foule de circonstances qui démontrent que la Valeur est dans le Service, puisqu’elle s’accroît avec lui.
Et si le lecteur veut prendre cette peine, il lui sera facile de varier cette hypothèse, de manière à reconnaître que la Valeur n’est pas nécessairement proportionnelle à l’intensité des efforts ; remarque que je place ici comme une pierre d’attente qui a sa destination, car j’ai à prouver que la Valeur n’est pas plus dans le travail que dans l’utilité.
Il a plu à la nature de m’organiser de telle façon que je mourrai si je ne me désaltère de temps en temps, et la source est à une lieue du village. C’est pourquoi tous les matins je me donne la peine d’aller chercher ma petite provision d’eau, car c’est à l’eau que j’ai reconnu ces qualités utiles qui ont la propriété de calmer la souffrance qu’on appelle la Soif. — Besoin, Effort, Satisfaction, tout s’y trouve. Je connais l’Utilité, je ne connais pas encore la Valeur.
Cependant, mon voisin allant aussi à la fontaine, je lui dis : « Épargnez-moi la peine de faire le voyage ; rendez-moi le service de me porter de l’eau. Pendant ce temps, je ferai quelque chose pour vous, j’enseignerai à votre enfant à épeler. » Il se trouve que cela nous arrange tous deux. Il y a là échange de deux services ; et l’on peut dire que l’un vaut l’autre. Remarquez que ce qui a été comparé ici, ce sont les deux efforts, et non les deux besoins et les deux satisfactions ; car d’après quelle mesure comparerait-on l’avantage de boire à celui de savoir épeler ?
Bientôt je dis à mon voisin : « Votre enfant m’importune, j’aime mieux faire autre chose pour vous ; vous continuerez à me porter de l’eau, et je vous donnerai cinq sous. » Si la proposition est agréée, l’économiste, sans craindre de se tromper, pourra dire : Le service vaut cinq sous.
Plus tard, mon voisin n’attend plus ma requête. Il sait, par expérience, que tous les jours j’ai besoin de boire. Il va au-devant de mes désirs. Du même coup, il pourvoit d’autres villageois. Bref, il se fait marchand d’eau. Alors on commence à s’exprimer ainsi : l’eau vaut cinq sous.
Mais, en vérité, l’eau a-t-elle changé de nature ? La Valeur, qui était tout à l’heure dans le service, s’est-elle matérialisée, pour aller s’incorporer dans l’eau et y ajouter un nouvel élément chimique ? Une légère modification dans la forme des arrangements intervenus entre mon voisin et moi a-t-elle eu la puissance de déplacer le principe de la valeur et d’en changer la nature ? Je ne suis pas assez puriste pour m’opposer à ce qu’on dise : L’eau vaut cinq sous, comme on dit : Le soleil se couche. Mais il faut qu’on sache que ce sont là des métonymies ; que les métaphores n’affectent pas la réalité des faits ; que scientifiquement, puisque enfin nous faisons de la science, la Valeur ne réside pas plus dans l’eau que le soleil ne se couche dans la mer.
Laissons donc aux choses les qualités qui leur sont propres : à l’eau, à l’air, l’Utilité ; aux services, la Valeur. Disons : c’est l’eau qui est utile, parce qu’elle a la propriété d’apaiser la soif ; c’est le service qui vaut, parce qu’il est le sujet de la convention débattue. Cela est si vrai, que, si la source s’éloigne ou se rapproche, l’Utilité de l’eau reste la même, mais la valeur augmente ou diminue. Pourquoi ? Parce que le service est plus grand ou plus petit. La valeur est donc dans le service, puisqu’elle varie avec lui et comme lui.
Le diamant joue un grand rôle dans les livres des économistes. Il s’en servent pour élucider les lois de la valeur ou pour signaler les prétendues perturbations de ces lois. C’est une arme brillante avec laquelle toutes les écoles se combattent. L’école anglaise dit-elle : « La valeur est dans le travail », l’école française lui montre un diamant : « Voilà, dit-elle, un produit qui n’exige aucun travail et renferme une valeur immense. » L’école française affirme-t-elle que la valeur est dans l’utilité, aussitôt l’école anglaise met en opposition le diamant avec l’air, la lumière et l’eau. « L’air est fort utile, dit-elle, et n’a pas de valeur ; le diamant n’a qu’une utilité fort contestable, et vaut plus que toute l’atmosphère. » — Et le lecteur de dire comme Henri IV : Ils ont, ma foi, tous deux raison. Enfin, on finit par s’accorder dans cette erreur, qui surpasse les deux autres : Il faut avouer que Dieu met de la valeur dans ses œuvres et qu’elle est matérielle.
Ces anomalies s’évanouissent, ce me semble, devant ma simple définition, qui est confirmée plutôt qu’infirmée par l’exemple en question.
Je me promène au bord de la mer. Un heureux hasard me fait mettre la main sur un superbe diamant. Me voilà en possession d’une grande valeur. Pourquoi ? Est-ce que je vais répandre un grand bien dans l’humanité ? Serait-ce que je me sois livré à un long et rude travail ? Ni l’un ni l’autre. Pourquoi donc ce diamant a-t-il tant de valeur ? C’est sans doute que celui à qui je le cède estime que je lui rends un grand service, d’autant plus grand que beaucoup de gens riches le recherchent et que moi seul puis le rendre. Les motifs de son jugement sont controversables, soit. Ils naissent de la vanité, de l’orgueil, soit encore. Mais ce jugement existe dans la tête d’un homme disposé à agir en conséquence, et cela suffit.
Bien loin qu’ici ce jugement soit fondé sur une raisonnable appréciation de l’utilité, on pourrait dire que c’est tout le contraire. Montrer qu’elle sait faire de grands sacrifices pour l’inutile, c’est précisément le but que se propose l’ostentation.
Bien loin que la Valeur ait ici une proportion nécessaire avec le travail accompli par celui qui rend le service, on peut dite qu’elle est plutôt proportionnelle au travail épargné à celui qui le reçoit ; c’est du reste la loi des valeurs, loi générale et qui n’a pas été, que je sache, observée par les théoriciens, quoiqu’elle gouverne la pratique universelle. Nous dirons plus tard par quel admirable mécanisme la Valeur tend à se proportionner au travail quand il est libre ; mais il n’en est pas moins vrai qu’elle a son principe moins dans l’effort accompli par celui qui sert que dans l’effort épargné à celui qui est servi.
En effet, la transaction relative à notre pierre précieuse suppose le dialogue suivant :
— Monsieur, cédez-moi votre diamant.
— Monsieur, je veux bien ; cédez-moi en échange votre travail de toute une année.
— Mais, Monsieur, vous n’avez pas sacrifié une minute à votre acquisition.
— Eh bien, Monsieur, tâchez de rencontrer une minute semblable.
— Mais, en bonne justice, nous devrions échanger à travail égal.
— Non, en bonne justice, vous appréciez vos services, et moi les miens. Je ne vous force pas ; pourquoi me forceriez-vous ? Donnez-moi un an tout entier, ou cherchez vous-même un diamant.
— Mais cela m’entraînerait à dix ans de pénibles recherches, sans compter une déception probable au bout. Je trouve plus sage, plus profitable d’employer ces dix ans d’une autre manière.
— C’est justement pour cela que je crois vous rendre encore service en ne vous demandant qu’un an. Je vous en épargne neuf, et voilà pourquoi j’attache beaucoup de valeur à ce service. Si je vous parais exigeant, c’est que vous ne considérez que le travail que j’ai accompli ; mais considérez aussi celui que je vous épargne, et vous me trouverez débonnaire.
— Il n’en est pas moins vrai que vous profitez d’un travail de la nature.
— Et si je vous cédais ma trouvaille pour rien ou pour peu de chose, c’est vous qui en profiteriez. D’ailleurs, si ce diamant a beaucoup de valeur, ce n’est pas parce que la nature l’élabore depuis le commencement des siècles, autant elle en fait pour la goutte de rosée.
— Oui, mais si les diamants étaient aussi nombreux que les gouttes de rosée, vous ne me feriez pas la loi.
— Sans doute, parce qu’en ce cas vous ne vous adresseriez pas à moi, ou vous ne seriez pas disposé à me récompenser chèrement pour un service que vous pourriez vous rendre si facilement à vous-même.
Il résulte de ce dialogue que la Valeur, que nous avons vu n’être ni dans l’eau ni dans l’air, n’est pas davantage dans le diamant ; elle est tout entière dans les services rendus et reçus à l’occasion de ces choses, et déterminée par le libre débat des contractants.
Prenez la collection des Économistes ; lisez, comparez toutes les définitions. S’il y en a une qui aille à l’air et au diamant, à deux cas en apparence si opposés, jetez ce livre au feu. Mais si la mienne, toute simple qu’elle est, résout la difficulté ou plutôt la fait disparaître, lecteur, en bonne conscience, vous êtes tenu d’aller jusqu’au bout ; car ce ne peut être en vain qu’une bonne étiquette est placée à l’entrée de la science.
Qu’il me soit permis de multiplier ces exemples, tant pour élucider ma pensée que pour familiariser le lecteur avec une définition nouvelle. En le montrant sous tous ses aspects, cet exercice sur le principe prépare d’ailleurs la voie à l’intelligence des conséquences, qui seront, j’ose l’annoncer, aussi importantes qu’inattendues.
Parmi les besoins auxquels nous assujettit notre constitution physique, se trouve celui de l’alimentation ; et un des objets les plus propres à le satisfaite, c’est le Pain.
Naturellement, comme le besoin de manger est en moi, je devrais faire toutes les opérations relatives à la production de la quantité de pain qui m’est nécessaire. Je puis d’autant moins exiger de mes frères qu’ils me rendent gratuitement ce service, qu’ils sont eux-mêmes soumis au même besoin et condamnés au même effort.
Si je faisais moi-même mon pain, j’aurais à me livrer à un travail infiniment plus compliqué, mais tout à fait analogue à celui que m’impose la nécessité d’aller chercher l’eau à la source. En effet, les éléments du pain existent partout dans la nature. Selon la judicieuse observation de J. B. Say, il n’y a ni nécessité ni possibilité pour l’homme de rien créer. Gaz, sels, électricité, force végétale, tout cela existe ; il s’agit pour moi de réunir, aider, combiner, transporter, en me servant de ce grand laboratoire qu’on nomme la terre, et dans lequel s’accomplissent des mystères dont à peine la science humaine a soulevé le voile. Si l’ensemble des opérations auxquelles je me livre, à la poursuite de mon but, est fort compliqué, chacune d’elles, prise isolément, est aussi simple que l’action d’aller puiser à la fontaine l’eau que la nature y a mise. Chacun de mes efforts n’est donc autre chose qu’un service que je me rends à moi-même ; et si, par convention librement débattue, il arrive que d’autres personnes m’épargnent quelques-uns ou la totalité de ces efforts, ce sont autant de services que je reçois. L’ensemble de ces services, comparés à ceux que je rends en retour, constitue la valeur du Pain et la détermine.
Un intermédiaire commode est survenu pour faciliter cet échange de services, et même pour en mesurer l’importance relative : c’est la monnaie. Mais le fond des choses reste le même, comme la transmission des forces est soumise à la même loi, qu’elle s’opère par un ou plusieurs engrenages.
Cela est si vrai que, lorsque le Pain vaut quatre sous, par exemple, si un bon teneur de livres voulait décomposer cette valeur, il parviendrait à retrouver, à travers des transactions fort multipliées sans doute, tous ceux dont les services ont concouru à la former, tous ceux qui ont épargné une peine à celui qui, en définitive, paye parce qu’il consommera. Il trouvera d’abord le boulanger, qui en retient un vingtième, et sur ce vingtième rémunère le maçon qui a bâti son four, le bûcheron qui a préparé ses fagots, etc. ; viendra ensuite le meunier, qui recevra non seulement la récompense de son propre travail, mais de quoi rembourser le carrier qui a fait la meule, le terrassier qui a élevé les digues, etc. D’autres parties de la valeur totale iront au batteur en grange, au moissonneur, au laboureur, au semeur, jusqu’à ce que compte soit rendu de la dernière obole. Il n’y en a pas une, une seule, qui ira rémunérer Dieu ou la nature. Une telle supposition est absurde par elle-même, et cependant elle est impliquée rigoureusement dans la théorie des économistes qui attribuent à la matière ou aux forces naturelles une part quelconque dans la valeur du produit. Non, encore ici, ce qui vaut, ce n’est pas le Pain, c’est la série des services par lesquels il est mis à ma portée.
Il est bien vrai que, parmi les parties élémentaires de la valeur du pain, notre teneur de livres en rencontrera une qu’il aura peine à rattacher à un service, du moins à un service exigeant un effort. Il trouvera que sur ces 20 cent., il y en a un ou deux qui sont la part du propriétaire du sol, de celui qui détient le laboratoire. Cette petite portion de la valeur du pain constitue ce qu’on nomme la rente de la terre ; et, trompé par la locution, par cette métonymie que nous retrouvons encore ici, notre comptable sera peut-être tenté de croire que cette part est afférente à des agents naturels, au sol lui-même.
Je soutiens que, s’il est habile, il découvrira que c’est encore le prix de services très-réels de même nature que tous les autres. C’est ce qui sera démontré avec la dernière évidence quand nous traiterons de la Propriété foncière. Pour le moment, je ferai remarquer que je ne m’occupe pas ici de la propriété, mais de la valeur. Je ne recherche pas si tous les services sont réels, légitimes, et si des hommes sont parvenus à se faire payer pour des services qu’ils ne rendent pas. Eh ! mon Dieu ! le monde est plein de telles injustices, parmi lesquelles ne doit pas figurer la rente.
Tout ce que j’ai à démontrer ici, c’est que la prétendue Valeur des choses n’est que la Valeur des services, réels ou imaginaires, reçus et rendus à leur occasion ; qu’elle n’est pas dans les choses mêmes, pas plus dans le pain que dans le diamant, ou dans l’eau ou dans l’air ; qu’aucune part de rémunération ne va à la nature ; qu’elle se distribue tout entière, par le consommateur définitif, entre des hommes, et qu’elle ne peut leur être par lui accordée que parce qu’ils lui ont rendu des services, sauf le cas de fraude ou de violence.
Deux hommes jugent que la glace est une bonne chose en été, et la houille une meilleure chose en hiver. Elles répondent à deux de nos besoins : l’une nous rafraîchit, l’autre nous réchauffe. Ne nous lassons pas de faire remarquer que l’Utilité de ces corps consiste en certaines propriétés matérielles,' qui sont en rapport de convenance avec nos organes matériels. Remarquons en outre que, parmi ces propriétés, que la physique et la chimie pourraient énumérer, ne se trouve pas la valeur, ni rien de semblable. Comment donc est-on arrivé à penser que la Valeur était dans la matière et matérielle ?
Si nos deux personnages se veulent satisfaire sans se concerter, chacun d’eux travaillera à faire sa double provision. S’ils s’entendent, l’un ira chercher de la houille pour deux dans la mine, l’autre de la glace pour deux dans la montagne. Mais, en ce cas, il y aura lieu à convention. Il faudra bien régler le rapport des deux services échangés. On tiendra compte de toutes les circonstances : difficultés à vaincre, dangers à braver, temps à perdre, peine à prendre, habileté à déployer, chances à courir, possibilité de se satisfaire d’une autre façon, etc. Quand on sera d’accord, l’économiste dira : Les deux services échangés se valent ; la langue vulgaire, par métonymie : Telle quantité de houille vaut telle quantité de glace, comme si la valeur avait matériellement passé dans les corps. Mais il est aisé de reconnaître que si la locution vulgaire suffit pour exprimer les résultats, l’expression scientifique révèle seule la vérité des causes.
Au lieu de deux services et deux personnes, la convention peut en embrasser un grand nombre, substituant l’Échange composé au Troc simple. En ce cas, la monnaie interviendra pour faciliter l’exécution. Ai-je besoin de dire que le principe de la Valeur n’en sera ni déplacé ni changé ?
Mais je dois ajouter une observation à propos de la houille. Il se peut qu’il n’y ait qu’une mine dans le pays, et qu’un homme s’en soit emparé. Si cela est, cet homme fera la loi, c’est-à-dire qu’il mettra à haut prix ses services ou ses prétendus services.
Nous n’en sommes pas encore à la question de droit et de justice, à séparer les services loyaux des services frauduleux. Cela viendra. Ce qui importe en ce moment, c’est de consolider la vraie théorie de la Valeur, et de la débarrasser d’une erreur dont la science économique est affectée. Quand nous disons : — Ce que la nature a fait ou donné, elle l’a fait ou donné gratuitement, cela n’a pas par conséquent de valeur, — on nous répond en décomposant le prix de la houille ou de tout autre produit naturel. On reconnaît bien que ce prix, pour la plus grande partie, est afférent à des services humains. L’un a creusé la terre, l’autre a épuisé l’eau ; celui-ci a monté le combustible, celui-là l’a transporté ; et c’est la totalité de ces travaux qui constitue, dit-on, presque toute la valeur. Cependant il reste encore une portion de valeur qui ne répond à aucun travail, à aucun service. C’est le prix de la houille gisant sous le sol, encore vierge, comme on dit, de tout travail humain ; il forme la part du propriétaire ; et puisque cette portion de valeur n’est pas de création humaine, il faut bien qu’elle soit de création naturelle.
Je repousse une telle conclusion, et je préviens le lecteur que, s’il l’admet de près ou de loin, il ne peut plus faire un pas dans la science. Non, l’action de la nature ne crée pas la valeur, pas plus que l’action de l’homme ne crée la matière. De deux choses l’une : ou le propriétaire a utilement concouru au résultat final et a rendu des services réels, et alors la part de Valeur qu’il a attachée à la houille rentre dans ma définition ; ou bien il s’est imposé comme un parasite, et, en ce cas, il a eu l’adresse de se faire payer pour des services qu’il n’a pas rendus ; le prix de la houille s’est trouvé indûment augmenté. Cette circonstance prouve bien qu’une injustice s’est introduite dans la transaction ; mais elle ne saurait renverser la théorie au point d’autoriser à dire que cette portion de valeur est matérielle, qu’elle est combinée, comme un élément physique, avec les dons gratuits de la Providence. En voici la preuve : qu’on fasse cesser l’injustice, si injustice il y a, et la valeur correspondante disparaîtra. Il n’en serait certes pas ainsi, si elle était inhérente à la matière et de création naturelle.
Passons maintenant à un de nos besoins les plus impérieux, celui de la sécurité.
Un certain nombre d’hommes abordent une plage inhospitalière. Ils se mettent à travailler. Mais chacun d’eux se trouve à chaque instant détourné de ses occupations par la nécessité de se défendre contre les bêtes féroces ou des hommes plus féroces encore. Outre le temps et les efforts qu’il consacre directement à sa défense, il en emploie beaucoup à se pourvoir d’armes et de munitions. On finit par reconnaître que la déperdition totale des efforts serait infiniment moindre, si quelques-uns, abandonnant les autres travaux, se chargeaient exclusivement de ce service. On y affecterait ceux qui ont le plus d’adresse, de courage et de vigueur. Ils se perfectionneraient dans un art dont ils feraient leur occupation constante ; et pendant qu’ils veilleraient sur le salut de la communauté, celle-ci recueillerait de ses travaux, désormais non interrompus, plus de satisfactions pour tous que ne lui en peut faire perdre le détournement de dix de ses membres. En conséquence, l’arrangement se fait. Que peut-on voir là, si ce n’est un nouveau progrès dans la séparation des occupations, amenant et exigeant un échange de services ?
Les services de ces militaires, soldats, miliciens, gardes, comme on voudra les appeler, sont-ils productifs ? Sans doute, puisque l’arrangement n’a eu lieu que pour augmenter le rapport des Satisfactions totales aux efforts généraux.
Ont-ils une valeur ? Il le faut bien, puisqu’on les estime, on les cote, on les évalue, et, en définitive, on les paye par d’autres services auxquels ils sont comparés.
La forme sous laquelle cette rémunération est stipulée, le mode de cotisation, le procédé par lequel on arrive à débattre et conclure l’arrangement, rien de tout cela n’altère le principe. Y a-t-il efforts épargnés aux uns par les autres ? Y a-t-il satisfactions procurées aux uns par les autres ? En ce cas il y a services échangés, comparés, évalués, il y a valeur.
Ce genre de services amène souvent, au milieu des complications sociales, de terribles phénomènes. Comme la nature même des services qu’on demande à cette classe de travailleurs exige que la communauté remette en leurs mains la Force, et une force capable de vaincre toutes les résistances, il peut arriver que ceux qui en sont dépositaires, en abusant, la tournent contre la communauté elle-même. — Il peut arriver encore que, tirant de la communauté des services proportionnés au besoin qu’elle a de sécurité, ils provoquent l’insécurité même, afin de se rendre plus nécessaires, et engagent leurs compatriotes, par une diplomatie trop habile, dans des guerres continuelles.
Tout cela s’est vu et se voit encore. Il en résulte, j’en conviens, d’énormes perturbations dans le juste équilibre des services réciproques. Mais il n’en résulte aucune altération dans le principe fondamental et la théorie scientifique de la Valeur.
Encore un exemple ou deux. Je prie le lecteur de croire que je sens, au moins autant que lui, ce qu’il y a de fatigant et de lourd dans cette série d’hypothèses, toutes ramenant les mêmes preuves, aboutissant à la même conclusion, exprimée dans les mêmes termes. Il voudra bien comprendre que ce procédé, s’il n’est pas le plus divertissant, est au moins le plus sûr pour établir la vraie théorie de la Valeur et dégager ainsi la route que nous aurons à parcourir.
Nous sommes à Paris. Dans cette vaste métropole fermentent beaucoup de désirs ; elle abonde aussi en moyens de les satisfaire. Une multitude d’hommes riches ou aisés se livrent à l’industrie, aux arts, à la politique ; et le soir, ils recherchent avec ardeur une heure de délassement. Parmi les plaisirs dont ils sont le plus avides, figure au premier rang celui d’entendre la belle musique de Rossini chantée par madame Malibran, ou l’admirable poésie de Racine interprétée par Rachel. Il n’y a que deux femmes, dans le monde entier, capables de procurer ces délicates et nobles jouissances ; et, à moins qu’on ne fasse intervenir la torture, ce qui probablement ne réussirait pas, il faut bien s’adresser à leur volonté. Ainsi les services qu’on attend de Malibran et de Rachel auront une grande valeur. Cette explication est bien prosaïque, elle n’en est pas moins vraie.
Qu’un opulent banquier veuille donc, pour gratifier sa vanité, faire entendre dans ses salons une de ces grandes artistes, il éprouvera, par expérience, que ma théorie est exacte de tous points. Il recherche une vive satisfaction, il la recherche avec ardeur ; une seule personne au monde peut la lui procurer. Il n’a d’autre moyen de l’y déterminer que d’offrir une rémunération considérable.
Quelles sont les limites extrêmes entre lesquelles oscillera la transaction ? Le banquier ira jusqu’au point où il préfère se priver de la satisfaction que de la payer ; la cantatrice, jusqu’au point où elle préfère la rémunération offerte à n’être pas rémunérée du tout. Ce point d’équilibre déterminera la Valeur de ce service spécial, comme de tous les autres. Il se peut que, dans beaucoup de cas, l’usage fixe ce point délicat. On a trop de goût dans le beau monde pour marchander certains services. Il se peut même que la rémunération soit assez galamment déguisée pour voiler ce que la loi économique a de vulgarité. Cette loi ne plane pas moins sur cette transaction comme sur les transactions les plus ordinaires, et la Valeur ne change pas de nature parce que l’expérience ou l’urbanité dispense de la débattre en toute rencontre.
Ainsi s’explique la grande fortune à laquelle peuvent parvenir les artistes hors ligne. Une autre circonstance les favorise. Leurs services sont de telle nature, qu’ils peuvent les rendre, par un même Effort, à une multitude de personnes. Quelque vaste que soit une enceinte, pourvu que la voix de Rachel la remplisse, chacun des spectateurs reçoit dans son âme toute l’impression qu’y peut faire naître une inimitable déclamation. On conçoit que c’est la base d’un nouvel arrangement. Trois, quatre mille personnes éprouvant le même désir peuvent s’entendre, se cotiser ; et la masse des services que chacun apporte en tribut à la grande tragédienne fait équilibre au service unique rendu par elle à tous les auditeurs à la fois. Voilà la Valeur.
Comme un grand nombre d’auditeurs s’entendent pour écouter, plusieurs acteurs peuvent s’entendre pour chanter un opéra ou représenter un drame. Des entrepreneurs peuvent intervenir pour dispenser les contractants d’une foule de petits arrangements accessoires. La Valeur se multiplie, se complique, se ramifie, se distribue ; elle ne change pas de nature.
Terminons par ce qu’on nomme des cas exceptionnels. Ils sont l’épreuve des bonnes théories. Quand la règle est vraie, l’exception ne l’infirme pas, elle la confirme.
Voici un vieux prêtre qui chemine, pensif, bâton en main, bréviaire sous le bras. Que ses traits sont sereins ! que sa physionomie est expressive ! que son regard est inspiré ! Où va-t-il ? Ne voyez-vous pas ce clocher à l’horizon ? Le jeune desservant du village ne se fie pas encore à ses propres forces ; il a appelé à son aide le vieux missionnaire. Mais, auparavant, il y avait quelques dispositions à prendre. Le prédicateur trouvera bien au presbytère le vivre et le couvert. Mais d’un carême à l’autre il faut vivre ; c’est la loi commune. Donc, M. le curé a provoqué, parmi les riches du village, une cotisation volontaire, modeste, mais suffisante ; car le vieux pasteur n’a pas été exigeant, et à ce qu’on lui a écrit à ce sujet il a répondu : « Du pain pour moi, voilà mon nécessaire ; une obole pour le pauvre, voilà mon superflu. »
Ainsi les préalables économiques sont remplis ; car cette importune économie politique se glisse partout et se mêle à tout, et je crois vraiment que c’est elle qui a dit : « Nil humani à me alienum puto. »
Dissertons un peu sur cet exemple, bien entendu au point de vue qui nous occupe.
Voici bien un échange de services. D’un côté, un vieillard va consacrer son temps, sa force, ses talents, sa santé, à faire pénétrer quelque clarté dans l’intelligence d’un petit nombre de villageois, à relever leur niveau moral. D’un autre côté, du pain pour quelques jours, une superbe soutane d’alépine et un tricorne neuf sont assurés à l’homme de la parole.
Mais il y a autre chose ici. Il y a un assaut de sacrifices. Le vieux prêtre refuse tout ce qui ne lui est pas strictement indispensable. Cette maigre pitance, le desservant en prend la moitié à sa charge ; et l’autre moitié, les Crésus du village en dispensent leurs frères, qui profiteront pourtant de la prédication.
Ces sacrifices infirment-ils notre définition de la Valeur ? Pas le moins du monde. Chacun est libre de ne céder ses efforts qu’aux conditions qui lui conviennent. Si l’on est facile sur ces conditions, ou si même on n’en exige aucune, qu’en résulte-t-il ? Que le service, en conservant son utilité, perd de sa valeur. Le vieux prêtre est persuadé que ses efforts trouveront leur récompense ailleurs. Il ne tient pas à ce qu’ils la trouvent ici-bas. Il sait sans doute qu’il rend service à ses auditeurs en leur parlant ; mais il croit aussi que ses auditeurs lui rendent service à lui-même en l’écoutant. Il suit de là que la transaction se fait sur des bases avantageuses à l’une des parties contractantes, du consentement de l’autre. Voilà tout. En général, les échanges de services sont déterminés et évalués par l’intérêt personnel. Mais ils le sont quelquefois, grâce au ciel, par le principe sympathique. Alors, ou nous cédons à autrui une satisfaction que nous avions le droit de nous réserver, ou nous faisons pour lui un effort que nous pouvions nous consacrer à nous-mêmes. La générosité, le dévouement, l’abnégation, sont des impulsions de notre nature qui, comme beaucoup d’autres circonstances, influent sur la valeur actuelle d’un service déterminé, mais qui ne changent pas la loi générale des valeurs.
En opposition avec ce consolant exemple, j’en pourrais placer d’un tout autre caractère. Pour qu’un service ait de la valeur dans le sens économique du mot, une valeur de fait, il n’est pas indispensable qu’il soit réel, consciencieux, utile : il suffit qu’on l’accepte et qu’on le paye par un autre service. Le monde est plein de gens qui font accepter et payer par le public des services d’un aloi plus que douteux. Tout dépend du jugement qu’on en porte, et c’est pourquoi la morale sera toujours le meilleur auxiliaire de l’économie politique.
Des fourbes parviennent à faire prévaloir une fausse croyance. Ils sont, disent-ils, les envoyés du ciel. Ils ouvrent à leur gré les portes du paradis ou de l’enfer. Quand cette croyance est bien enracinée : « Voici, disent-ils, de petites images auxquelles nous avons communiqué la vertu de rendre éternellement heureux ceux qui les porteront sur eux. Vous céder une de ces images, c’est vous rendre un immense service ; rendez-nous donc des services en retour. » Voilà une valeur créée. Elle tient à une fausse appréciation, dira-t-on ; cela est vrai. Autant on en peut dire de bien des choses matérielles et qui ont une valeur certaine, car elles trouveraient des acquéreurs, fussent-elles mises aux enchères. La science économique ne serait pas possible, si elle n’admettait comme valeurs que les valeurs judicieusement appréciées. À chaque pas, elle devrait renouveler un cours de sciences physiques et morales. Dans l’isolement, un homme peut, en vertu de désirs dépravés ou d’une intelligence faussée, poursuivre par de grands efforts une satisfaction chimérique, une déception. De même, en société, il nous arrive, comme disait un philosophe, d’acheter fort cher un regret. S’il est dans la nature de l’intelligence humaine d’avoir une plus naturelle proportion avec la vérité qu’avec l’erreur, toutes ces fraudes sont destinées à disparaître, tous ces faux services à être refusés, à perdre leur valeur. La civilisation mettra, à la longue, chacun et chaque chose à sa place.
Il faut pourtant clore cette trop longue analyse. Besoin de respirer, de boire, de manger ; besoin de la vanité, de l’intelligence, du cœur, de l’opinion, des espérances fondées ou chimériques, nous avons cherché partout la Valeur, nous l’avons constatée partout où elle existe, c’est-à-dire partout où il y a échange de services ; nous l’avons trouvée partout identique à elle-même, fondée sur un principe clair, simple, absolu, quoique influencée par une multitude de circonstances diverses. Nous aurions passé en revue tous nos autres besoins : nous aurions fait comparaître le menuisier, le maçon, le fabricant, le tailleur, le médecin, l’huissier, l’avocat, le négociant, le peintre, le juge, le président de la république, que nous n’aurions jamais trouvé autre chose : souvent de la matière, quelquefois des forces fournies gratuitement par la nature, toujours des services humains s’échangeant entre eux, se mesurant, s’estimant, s’appréciant, s’évaluant les uns par les autres, et manifestant seuls le résultat de cette évaluation ou la Valeur.
Il est néanmoins un de nos besoins, fort spécial de sa nature, ciment de la société, cause et effet de toutes nos transactions, éternel problème de l’économie politique, dont je dois dire ici quelques mots : je veux parler du besoin d’échanger.
Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les merveilleux effets de l’échange. Ils sont tels, que les hommes doivent éprouver naturellement le désir de le faciliter, même au prix de grands sacrifices. C’est pour cela qu’il y a des routes, des canaux, des chemins de fer, des chars, des vaisseaux, des négociants, des marchands, des banquiers ; et il est impossible de croire que l’humanité se serait soumise, pour faciliter l’échange, à un si énorme prélèvement sur ses forces, si elle n’eût dû trouver dans l’échange lui-même une large compensation.
Nous avons vu aussi que le simple troc ne pouvait donner lieu qu’à des transactions fort incommodes et fort restreintes.
C’est pour cela que les hommes ont imaginé de décomposer le troc en deux facteurs : vente et achat, au moyen d’une marchandise intermédiaire, facilement divisible, et, surtout pourvue de valeur, afin qu’elle portât avec elle son titre à la confiance publique. C’est la Monnaie.
Ce que je veux faire observer ici, c’est que ce qu’on appelle, par ellipse ou métonymie, la Valeur de l’or et de l’argent, repose sur le même principe que la valeur de l’air, de l’eau, du diamant, des sermons de notre vieux missionnaire, ou des roulades de Malibran, c’est-à-dire sur des services rendus et reçus.
L’or, en effet, qui se trouve répandu sur les heureux rivages du Sacramento, tient de la nature beaucoup de qualités précieuses : ductilité, pesanteur, éclat, brillant, utilité même, si l’on veut. Mais il y a une chose que la nature ne lui a pas donnée, parce que cela ne la regarde pas : c’est la valeur. Un homme sait que l’or répond à un besoin bien senti, qu’il est très-désiré. Il va en Californie pour chercher de l’or, comme mon voisin allait tout à l’heure à la fontaine pour chercher de l’eau. Il se livre à de rudes efforts, il fouille, il pioche, il lave, il fond, et puis il vient me dire : Je vous rendrai le service de vous céder cet or ; quel service me rendrez-vous en retour ? Nous débattons, chacun de nous pèse toutes les circonstances qui peuvent le déterminer ; enfin nous concluons, et voilà la Valeur manifestée et fixée. Trompé par cette locution abrégée : L’or vaut, on pourra bien croire que la valeur est dans l’or au même titre que la pesanteur et la ductilité, et que la nature a pris soin de l’y mettre. J’espère que le lecteur est maintenant convaincu que c’est là un malentendu. Il se convaincra plus tard que c’est un malentendu déplorable.
Il y en a un autre au sujet de l’or ou plutôt de la monnaie. Comme elle est l’intermédiaire habituel dans toutes les transactions, le terme moyen entre les deux facteurs du troc composé, que c’est toujours à sa valeur qu’on compare celle des deux services qu’il s’agit d’échanger, elle est devenue la mesure des valeurs. Dans la pratique cela ne peut être autrement. Mais la science ne doit jamais perdre de vue que la monnaie est soumise, quant à la valeur, aux mêmes fluctuations que tout autre produit ou service. Elle l’oublie souvent, et cela n’a rien de surprenant. Tout semble concourir à faire considérer la monnaie comme la mesure des valeurs au même titre que le litre est la mesure de capacité. — Elle joue un rôle analogue dans les transactions. — On n’est pas averti de ses propres fluctuations parce que le franc, ainsi que ses multiples et ses sous-multiples, conservent toujours la même dénomination. — Enfin l’arithmétique elle-même conspire à propager la confusion, en rangeant le franc, comme mesure, parmi le mètre, le litre, l’are, le stère, le gramme, etc.
J’ai défini la Valeur, telle du moins que je la conçois. J’ai soumis ma définition à l’épreuve de faits très-divers ; aucun, ce me semble, ne l’a démentie ; enfin le sens scientifique que j’ai donné à ce mot se confond avec l’acception vulgaire, ce qui n’est ni un méprisable avantage ni une mince garantie ; car qu’est-ce que la science, sinon l’expérience raisonnée ? Qu’est-ce que la théorie, sinon la méthodique exposition de l’universelle pratique ?
Il doit m’être permis maintenant de jeter un rapide coup d’œil sur les systèmes qui ont jusqu’ici prévalu. Ce n’est pas en esprit de controverse, encore moins de critique, que j’entreprends cet examen, et je l’abandonnerais volontiers, si je n’étais convaincu qu’il peut jeter de nouvelles clartés sur la pensée fondamentale de cet écrit.
Nous avons vu que les auteurs avaient cherché le principe de la Valeur dans un ou plusieurs des accidents qui exercent sur elle une notable influence, matérialité, conservabilité, utilité, rareté, travail, etc., — comme un physiologiste qui chercherait le principe de la vie dans un ou plusieurs des phénomènes extérieurs qui la développent, dans l’air, l’eau, la lumière, l’électricité, etc.
Matérialité. « L’homme, dit M. de Bonald, est une intelligence servie par des organes. » Si les économistes de l’école matérialiste avaient seulement voulu dire que les hommes ne se peuvent rendre des services réciproques que par l’entremise de leurs organes corporels, pour en conclure qu’il y a toujours quelque chose de matériel dans ces services et, par suite, dans la Valeur, je n’irais pas au delà, ayant en horreur les disputes de mots et ces subtilités dont l’esprit aime trop souvent à se montrer fécond.
Mais ce n’est pas ainsi qu’ils l’ont entendu. Ce qu’ils ont cru, c’est que la Valeur était communiquée à la matière, soit par le travail de l’homme, soit par l’action de la nature. En un mot, trompés par cette locution elliptique : L’or vaut tant, le blé vaut tant, ils ont été conduits à voir dans la matière une qualité nommée valeur, comme le physicien y reconnaît l’impénétrabilité, la pesanteur, — et encore ces attributs lui sont-ils contestés.
Quoi qu’il en soit, je lui conteste formellement la valeur.
Et d’abord, on ne peut nier que Matière et Valeur ne soient souvent séparées. Quand nous disons à un homme : — Portez cette lettre à son adresse, allez-moi chercher de l’eau, enseignez-moi cette science ou ce procédé, donnez-moi un conseil sur ma maladie ou mon procès, veillez à ma sûreté pendant que je me livrerai au travail ou au sommeil ; — ce que nous réclamons c’est un Service, et à ce service nous reconnaissons, à la face de l’univers, une Valeur, puisque nous le payons volontairement par un service équivalent. Il serait étrange que la théorie refusât d’admettre ce qu’admet dans la pratique le consentement universel.
Il est vrai que nos transactions portent souvent sur des objets matériels ; mais qu’est-ce que cela prouve ? C’est que les hommes, par prévoyance, se préparent à rendre des services qu’ils sauront être demandés ; que j’achète un habit tout fait, ou que je fasse venir chez moi un tailleur pour travailler à la journée, en quoi cela change-t-il le principe de la Valeur, au point surtout de faire qu’il réside tantôt dans l’habit, tantôt dans le service ?
On pourrait poser ici cette question subtile : Faut-il voir le principe de la Valeur dans l’objet matériel, et de là l’attribuer, par analogie, aux services ? Je dis que c’est tout le contraire : il faut le reconnaître dans les services, et l’attribuer ensuite, si l’on veut, par métonymie, aux objets matériels.
Du reste, les nombreux exemples que j’ai soumis au lecteur, en manière d’exercice, me dispensent d’insister davantage sur cette discussion. Mais je ne puis m’empêcher de me justifier de l’avoir abordée en montrant à quelles conséquences funestes peut conduire une erreur ou, si l’on veut, une vérité incomplète, placée à l’entrée d’une science.
Le moindre inconvénient de la définition que je combats a été d’écourter et mutiler l’économie politique. Si la valeur réside dans la matière, là où il n’y a pas de matière il n’y a pas de valeur. Les physiocrates appelaient classes stériles, et Smith, adoucissant l’expression, classes improductives, les trois quarts de la population.
Et comme en définitive les faits sont plus forts que les définitions, il fallait bien, par quelque côté, faire rentrer ces classes dans le cercle des études économiques. On les y appelait par voie d’analogie ; mais la langue de la science, faite sur une autre donnée, se trouvait d’avance matérialisée au point de rendre cette extension choquante. Qu’est-ce que : « Consommer un produit immatériel ? L’homme est un capital accumulé ? La sécurité est une marchandise ? » etc., etc.
Non-seulement on matérialisait outre mesure la langue, mais on était réduit à la surcharger de distinctions subtiles, afin de réconcilier les idées qu’on avait faussement séparées. On imaginait la valeur d’usage par opposition à la valeur d’échange, etc.
Enfin, et ceci est bien autrement grave, grâce à cette confusion des deux grands phénomènes sociaux, la propriété et la communauté, l’un restait injustifiable et l’autre indiscernable.
En effet, si la valeur est dans la matière, elle se confond avec les qualités physiques des corps qui les rendent utiles à l’homme. Or ces qualités y sont souvent mises par la nature. Donc la nature concourt à créer la valeur, et nous voilà attribuant de la Valeur à ce qui est gratuit et commun par essence. Où est donc alors la base de la propriété ? Quand la rémunération que je cède pour acquérir un produit matériel, du blé, par exemple, se distribue entre tous les travailleurs qui, à l’occasion de ce produit, m’ont, de près ou de loin, rendu quelque service, à qui va cette part de rémunération correspondante à la portion de Valeur due à la nature et étrangère à l’homme ? Va-t-elle à Dieu ? Nul ne le soutient, et l’on n’a jamais vu Dieu réclamer son salaire. Va-t-elle à un homme ? À quel titre, puisque, dans l’hypothèse, il n’a rien fait ?
Et qu’on n’imagine pas que j’exagère, que, dans l’intérêt de ma définition, je force les conséquences rigoureuses de la définition des économistes. Non, ces conséquences, ils les ont très-explicitement tirées eux-mêmes sous la pression de la logique.
Ainsi, Senior en est arrivé à dire : « Ceux qui se sont emparés des agents naturels reçoivent, sous forme de rente, une récompense sans avoir fait de sacrifices. Leur rôle se borne à tendre la main pour recevoir les offrandes du reste de la communauté. » Scrope : « La propriété de la terre est une restriction artificielle mise à la jouissance des dons que le Créateur avait destinés à la satisfaction des besoins de tous. » Say : « Les terres cultivables sembleraient devoir être compromises parmi les richesses naturelles, puisqu’elles ne sont pas de création humaine, et que la nature les donne gratuitement à l’homme. Mais comme cette richesse n’est pas fugitive, ainsi que l’air et l’eau, comme un champ est un espace fixe et circonscrit que certains hommes ont pu s’approprier, à l’exclusion de tous les autres qui ont donné leur consentement à cette appropriation, la terre, qui était un bien naturel et gratuit, est devenue une richesse sociale dont l’usage a dû se payer. »
Certes, s’il en est ainsi, Proudhon est justifié d’avoir posé cette terrible interrogation, suivie d’une affirmation plus terrible encore :
« À qui est dû le fermage de la terre ? Au producteur de la terre sans doute. Qui a fait la terre ? Dieu. En ce cas, propriétaire, retire-toi. »
Oui, par une mauvaise définition, l’économie politique a mis la logique du côté des communistes. Cette arme terrible, je la briserai dans leurs mains, ou plutôt ils me la rendront joyeusement. Il ne restera rien des conséquences quand j’aurai anéanti le principe. Et je prétends démontrer que si, dans la production des richesses, l’action de la nature se combine avec l’action de l’homme, la première, gratuite et commune par essence, reste toujours gratuite et commune à travers toutes nos transactions ; que la seconde représente seule des services, de la valeur ; que, seule, elle se rémunère ; que, seule, elle est le fondement, l’explication et la justification de la Propriété. En un mot, je prétends que, relativement les uns aux autres, les hommes ne sont propriétaires que de la valeur des choses, et qu’en se passant de main en main les produits ils stipulent uniquement sur la valeur, c’est-à-dire sur les services réciproques, se donnant, par-dessus le marché, toutes les qualités, propriétés et utilités que ces produits tiennent de la nature.
Si, jusqu’ici, l’économie politique, en méconnaissant cette considération fondamentale, a ébranlé le principe tutélaire de la propriété, présentée comme une institution artificielle, nécessaire, mais injuste ; du même coup elle a laissé dans l’ombre, complétement inaperçu, un autre phénomène admirable, la plus touchante dispensation de la Providence envers sa créature, le phénomène de la communauté progressive.
La richesse, en prenant ce mot dans son acception générale, résulte de la combinaison de deux actions, celle de la nature et celle de l’homme. La première est gratuite et commune, par destination providentielle, et ne perd jamais ce caractère. La seconde est seule pourvue de valeur, et par conséquent appropriée. Mais, par suite du développement de l’intelligence et du progrès de la civilisation, l’une prend une part de plus en plus grande, l’autre prend une part de plus en plus petite à la réalisation de toute utilité donnée ; d’où il suit que le domaine de la Gratuité et de la Communauté se dilate sans cesse, au sein de la race humaine, proportionnellement au domaine de la Valeur et de la Propriété : aperçu fécond et consolant, entièrement soustrait à l’œil de la science tant qu’elle attribue de la valeur à la coopération de la nature.
Dans toutes les religions on remercie Dieu de ses bienfaits ; le père de famille bénit le pain qu’il rompt et distribue à ses enfants : touchant usage que la raison ne justifierait pas s’il n’y avait rien de gratuit dans les libéralités de la Providence.
Conservabilité. Cette prétendue condition sine quâ non de la Valeur se rattache à celle que je viens de discuter. Pour que la Valeur existe, pensait Smith, il faut qu’elle soit fixée en quelque chose qui se puisse échanger, accumuler, conserver, par conséquent en quelque chose de matériel.
« Il y a un genre de travail, dit-il, qui ajoute [232] à la valeur du sujet sur lequel il s’exerce. Il y en a un autre qui n’a pas cet effet. »
« Le travail manufacturier, ajoute Smith, se fixe et se réalise dans quelque marchandise vendable, qui dure au moins quelque temps après que le travail est passé. Le travail des domestiques, au contraire (auquel l’auteur assimile sous ce rapport celui des militaires, magistrats, musiciens, professeurs, etc.), ne se fixe en aucune marchandise vendable. Les services s’évanouissent à mesure qu’ils sont rendus, et ne laissent pas trace de Valeur après eux. »
On voit qu’ici la Valeur se rapporte plutôt à la modification des choses qu’à la satisfaction des hommes ; erreur profonde : car s’il est bon que les choses soient modifiées, c’est uniquement pour arriver à cette satisfaction qui est le but, la fin, la consommation de tout Effort. Si donc nous la réalisons par un effort immédiat et direct, le résultat est le même ; si, en outre, cet effort est susceptible de transactions, d’échanges, d’évaluation, il renferme le principe de la valeur.
Quant à l’intervalle qui peut s’écouler entre l’effort et la satisfaction, en vérité Smith lui donne trop de gravité quand il dit que l’existence ou la non-existence de la Valeur en dépend. — « La Valeur d’une marchandise vendable, dit-il, dure au moins quelque temps. » — Oui, sans doute, elle dure jusqu’à ce que cet objet ait rempli sa destination, qui est de satisfaire au besoin, et il en est exactement de même d’un service. Tant que cette assiette de fraises restera dans le buffet, elle conservera sa valeur. — Mais pourquoi ? parce qu’elle est le résultat d’un service que j’ai voulu me rendre à moi-même ou que d’autres m’ont rendu moyennant compensation, et dont je n’ai pas encore usé. Sitôt que j’en aurai usé en mangeant les fraises, la valeur disparaîtra. Le service se sera évanoui et ne laissera pas trace de valeur après lui. C’est tout comme dans le service personnel. Le consommateur fait disparaîre la Valeur, car elle n’a été créée qu’à cette fin. Il importe peu à la notion de valeur que la peine prise aujourd’hui satisfasse le besoin immédiatement, ou demain, ou dans un an.
Quoi ! je suis affligé de la cataracte. J’appelle un oculiste. L’instrument dont il se sert aura de la Valeur, parce qu’il a de la durée, et l’opération n’en a pas, encore que je la paye, que j’en aie débattu le prix, que j’aie mis plusieurs opérateurs en concurrence ? Mais cela est contraire aux faits les plus usuels, aux notions les plus unanimement reçues ; et qu’est-ce qu’une théorie qui, ne sachant pas rendre compte de l’universelle pratique, la tient pour non avenue ?
Je vous prie de croire, lecteur, que je ne me laisse pas emporter par un goût désordonné pour la controverse. Si j’insiste sur ces notions élémentaires, c’est pour préparer votre esprit à des conséquences d’une haute gravité qui se manifesteront plus tard. Je ne sais si c’est violer les lois de la méthode que de faire pressentir, par anticipation, ces conséquences ; mais je me permets cette légère infraction, dans la crainte où je suis de voir la patience vous échapper. C’est ce qui m’a porté tout à l’heure à vous parler prématurément de propriété et de communauté. Par le même motif, je dirai un mot du Capital.
Smith, faisant résider la richesse dans la matière, ne pouvait concevoir le Capital que comme une accumulation d’objets matériels. Comment donc attribuer de la Valeur à des Services non susceptibles d’être accumulés, capitalisés ?
Parmi les capitaux, on place en première ligne les outils, machines, instruments de travail. Ils servent à faire concourir les forces naturelles à l’œuvre de la production, et puisqu’on attribuait à ces forces la faculté de créer de la valeur, on était amené à penser que les instruments de travail étaient, par eux-mêmes, doués de la même faculté, indépendamment de tout service humain. Ainsi la bêche, la charrue, la machine à vapeur, étaient censées concourir simultanément avec les agents naturels et les forces humaines à créer non-seulement de l’Utilité, mais encore de la Valeur. Mais toute valeur se paye dans l’échange. À qui donc revenait cette part de valeur indépendante de tout service humain ?
C’est ainsi que l’école de Proudhon, après avoir contesté la rente de la terre, a été amenée à contester l’intérêt des capitaux, thèse plus large, puisqu’elle embrasse l’autre. J’affirme que l’erreur proudhonnienne, au point de vue scientifique, a sa racine dans l’erreur de Smith. Je démontrerai que les capitaux, comme les agents naturels, considérés en eux-mêmes et dans leur action propre, créent de l’utilité, mais jamais de valeur. Celle-ci est, par essence, le fruit d’un légitime service. Je démontrerai aussi que, dans l’ordre social, les capitaux ne sont pas une accumulation d’objets matériels, tenant à la conservabilité matérielle, mais une accumulation de valeurs, c’est-à-dire de services. Par là se trouvera détruite, virtuellement du moins et faute de raison d’être, cette lutte récente contre la productivité du capital, et cela à la satisfaction de ceux-là mêmes qui l’ont soulevée ; car si je prouve qu’il ne se passe rien dans le monde des échanges qu’une mutualité de services, M. Proudhon devra se tenir pour vaincu par la victoire même de son principe.
Travail. Ad. Smith et ses élèves ont assigné le principe de la Valeur au Travail, sous la condition de la Matérialité. Ceci est contradictoire à cette autre opinion, que les forces naturelles prennent une part quelconque dans la production de la Valeur. Je n’ai pas ici à combattre ces contradictions qui se manifestent dans toutes leurs conséquences funestes, quand ces auteurs parlent de la rente des terres ou de l’intérêt des capitaux.
Quoi qu’il en soit, quand ils font remonter le principe de la Valeur au Travail, ils approcheraient énormément de la vérité, s’ils ne faisaient pas allusion au travail manuel. J’ai dit, en effet, en commençant ce chapitre, que la valeur devait se rapporter à l’Effort, expression que j’ai préférée à celle de Travail, comme plus générale et embrassant toute la sphère de l’activité humaine. Mais je me suis hâté d’ajouter qu’elle ne pouvait naître que d’efforts échangés, ou de Services réciproques, parce qu’elle n’est pas une chose existant par elle-même, mais un rapport.
Il y a donc, rigoureusement parlant, deux vices dans la définition de Smith. Le premier, c’est qu’elle ne tient pas compte de l’échange, sans lequel la valeur ne se peut ni produire ni concevoir ; le second, c’est qu’elle se sert d’un mot trop étroit, travail, à moins qu’on ne donne à ce mot une extension inusitée en y comprenant des idées, non-seulement d’intensité et de durée, mais d’habileté, de sagacité et même de chances plus ou moins heureuses.
Remarquez que le mot service, que je substitue dans la définition, fait disparaître ces deux défectuosités. Il implique nécessairement l’idée de transmission, puisqu’un service ne peut être rendu qu’il ne soit reçu ; et il implique aussi l’idée d’un Effort sans préjuger que la valeur lui soit proportionnelle.
Et c’est là surtout en quoi pèche la définition des économistes anglais. Dire que la valeur est dans le travail, c’est induire l’esprit à penser qu’ils se servent de mesure réciproque, qu’ils sont proportionnels entre eux. En cela, elle est contraire aux faits, et une définition contraire aux faits est une définition défectueuse.
Il est très-fréquent qu’un travail considéré comme insignifiant en lui-même soit accepté dans le monde pour une valeur énorme (exemples : le diamant, le chant d’une prima donna, quelques traits de plume d’un banquier, la spéculation heureuse d’un armateur, le coup de pinceau d’un Raphaël, une bulle d’indulgence plénière, le facile rôle d’une reine d’Angleterre, etc.) ; il est plus fréquent encore qu’un travail opiniâtre, accablant, n’aboutisse qu’à une déception, à une non-valeur. S’il en est ainsi, comment pourrait-on établir une corrélation, une proportion nécessaire entre la Valeur et le Travail ?
Ma définition lève la difficulté. Il est clair qu’il est des circonstances où l’on peut rendre un grand Service en se donnant peu de peine ; d’autres, où, après s’être donné beaucoup de peine, on trouve qu’elle ne rend service à personne, et c’est pourquoi il est plus exact de dire, sous ce rapport encore, que la Valeur est dans le Service plutôt que dans le Travail, puisqu’elle est proportionnelle à l’un et pas à l’autre.
J’irai plus loin. J’affirme que la valeur s’estime au moins autant par le travail épargné au cessionnaire que par le travail exécuté par le cédant. Que le lecteur veuille bien se rappeler le dialogue intervenu entre deux contractants, à propos d’une pierre précieuse. Il n’est pas né d’une circonstance accidentelle, et j’ose dire qu’il est, tacitement, au fond de toutes les transactions. Il ne faut pas perdre de vue que nous supposons ici aux deux contractants une entière liberté, la pleine possession de leur volonté et de leur jugement. Chacun d’eux se détermine à accepter l’échange par des considérations nombreuses, parmi lesquelles figure certainement en première ligne la difficulté pour le cessionnaire de se procurer directement la satisfaction qui lui est offerte. Tous deux ont les yeux sur cette difficulté et en tiennent compte, l’un pour être plus ou moins facile, l’autre pour être plus ou moins exigeant. La peine prise par le cédant exerce aussi une influence sur le marché, c’en est un des éléments, mais ce n’est pas le seul. Il n’est donc pas exact de dire que la Valeur est déterminée par le travail. Elle l’est par une foule de considérations, toutes comprises dans le mot service.
Ce qui est très-vrai, c’est que, par l’effet de la concurrence, les Valeurs tendent à se proportionner aux Efforts, ou les récompenses aux mérites. C’est une des belles Harmonies de l’ordre social. Mais, relativement à la valeur, cette pression égalitaire exercée par la concurrence est tout extérieure ; et il n’est pas permis, en bonne logique, de confondre l’influence que subit un phénomène d’une cause externe avec le phénomène même. [233]
***
Long footnote: C’est parce que, sous l’empire de la liberté, les efforts se font concurrence entre eux qu’ils obtiennent cette rémunération à peu près proportionnelle à leur intensité. Mais, je le répète, cette proportionnalité n’est pas inhérente à la notion de valeur.
Et la preuve, c’est que là où la concurrence n’existe pas, la proportionnalité n’existe pas davantage. On ne remarque, en ce cas, aucun rapport entre les travaux de diverse nature et leur rémunération.
L’absence de concurrence peut provenir de la nature des choses ou de la perversité des hommes.
Si elle vient de la nature des choses, on verra un travail comparativement très-faible donner lieu à une grande valeur, sans que personne ait raisonnablement à se plaindre. C’est le cas de la personne qui trouve un diamant ; c’est le cas de Rubini, de Malibran, de Taglioni, du tailleur en vogue, du propriétaire du Clos-Vougeot, etc., etc. Les circonstances les ont mis en possession d’un moyen extraordinaire de rendre service ; ils n’ont pas de rivaux et se font payer cher. Le service lui-même étant d’une rareté excessive, cela prouve qu’il n’est pas essentiel au bien-être et au progrès de l’humanité. Donc c’est un objet de luxe, d’ostentation : que les riches se le procurent. N’est-il pas naturel que tout homme attende, avant d’aborder ce genre de satisfactions, qu’il se soit mis à même de pourvoir à des besoins plus impérieux et plus raisonnables ?
Si la concurrence est absente par suite de quelque violence humaine, alors les mêmes effets se produisent, mais avec cette différence énorme qu’ils se produisent où et quand ils n’auraient pas dû se produire. Alors on voit aussi un travail comparativement faible donner lieu à une grande valeur ; mais comment ? En interdisant violemment cette concurrence qui a pour mission de proportionner les rémunérations aux services. Alors, de même que Rubini peut dire à un dilettante : « Je veux une très-grande récompense, ou je ne chante pas à votre soirée, » se fondant sur ce qu’il s’agit là d’un service que lui seul peut rendre, — de même un boulanger, un boucher, un propriétaire, un banquier peut dire : « Je veux une récompense extravagante, ou vous n’aurez pas mon blé, mon pain, ma viande, mon or ; et j’ai pris des précautions, j’ai organisé des baïonnettes pour que vous ne puissiez pas vous pourvoir ailleurs, pour que nul ne puisse vous rendre des services analogues aux miens. »
Les personnes qui assimilent le monopole artificiel et ce qu’elles appellent le monopole naturel, parce que l’un et l’autre ont cela de commun, qu’ils accroissent la valeur du travail, ces personnes, dis-je, sont bien aveugles et bien superficielles.
Le monopole artificiel est une spoliation véritable. Il produit des maux qui n’existeraient pas sans lui. Il inflige des privations à une portion considérable de la société, souvent à l’égard des objets les plus nécessaires. En outre, il fait naître l’irritation, la haine, les représailles, fruits de l’injustice.
Les avantages naturels ne font aucun mal à l’humanité. Tout au plus pourrait-on dire qu’ils constatent un mal préexistant et qui ne leur est pas imputable. Il est fâcheux, peut-être, que le tokay ne soit pas aussi abondant et à aussi bas prix que la piquette. Mais ce n’est pas là un fait social ; il nous a été imposé par la nature.
Il y a donc entre l’avantage naturel et le monopole artificiel cette différence profonde :
L’un est la conséquence d’une rareté préexistante, inévitable ;
L’autre est la cause d’une rareté factice, contre nature.
Dans le premier cas, ce n’est pas l’absence de concurrence qui fait la rareté, c’est la rareté qui explique l’absence de concurrence. L’humanité serait puérile, si elle se tourmentait, se révolutionnait, parce qu’il n’y a, dans le monde, qu’une Jenny Lind, un Clos-Vougeot et un Régent.
Dans le second cas, c’est tout le contraire. Ce n’est pas à cause d’une rareté providentielle que la concurrence est impossible, mais c’est parce que la force a étouffé la concurrence qu’il s’est produit parmi les hommes une rareté qui ne devait pas être.
(Note extraite des manuscrits de l’auteur.)
***
Utilité. J. B. Say, si je ne me trompe, est le premier qui ait secoué le joug de la matérialité. Il fit très-expressément de la valeur une qualité morale, expression qui peut-être dépasse le but, car la valeur n’est guère ni physique ni morale, c’est simplement — un rapport.
Mais le grand économiste français avait dit lui-même : « Il n’est donné à personne d’arriver aux confins de la science. Les savants montent sur les épaules les uns des autres pour explorer du regard un horizon de plus en plus étendu. » Peut-être la gloire de M. Say (en ce qui concerne la question spéciale qui nous occupe, car, à d’autres égards, ses titres de gloire sont aussi nombreux qu’impérissables) est-elle d’avoir légué à ses successeurs un aperçu fécond.
L’axiome de M. Say était celui-ci : La valeur a pour fondement l’utilité.
S’il était ici question de l’utilité relative des services humains, je ne contesterais pas. Tout au plus pourrais-je faire observer que l’axiome est superflu à force d’être évident. Il est bien clair en effet que nul ne consent à rémunérer un service que parce qu’à tort ou à raison il le juge utile. Le mot service renferme tellement l’idée d’utilité, qu’il n’est autre chose que la traduction en français, et même la reproduction littérale du mot latin uti, servir.
Mais malheureusement ce n’est pas ainsi que Say l’entendait. Il trouvait le principe de la valeur non-seulement dans les services humains rendus à l’occasion des choses, mais encore dans les qualités utiles, mises par la nature dans les choses elles-mêmes. — Par là il se replaçait sous le joug de la matérialité. Par là, il faut bien le dire, il était loin de déchirer le voile funeste que les économistes anglais avaient jeté sur la question de propriété.
Avant de discuter en lui-même l’axiome de Say, j’en dois faire voir la portée logique, afin qu’il ne me soit pas reproché de me lancer et d’entraîner le lecteur dans d’oiseuses dissertations.
On ne peut pas douter que l’Utilité dont parle Say est celle qui est dans les choses. Si le blé, le bois, la houille, le drap ont de la valeur, c’est que ces produits ont des qualités qui les rendent propres à notre usage, à satisfaire le besoin que nous avons de nous nourrir, de nous chauffer, de nous vêtir.
Dès lors, comme la nature crée de l’Utilité, elle crée de la Valeur ; — funeste confusion dont les ennemis de la propriété se sont fait une arme terrible.
Voilà un produit, du blé, par exemple. Je l’achète à la halle pour seize francs. Une grande partie de ces seize francs se distribue, par des ramifications infinies, par une inextricable complication d’avances et de remboursements, entre tous les hommes qui, de près ou de loin, ont concouru à mettre ce blé à ma portée. Il y a quelque chose pour le laboureur, le semeur, le moissonneur, le batteur, le charretier, ainsi que pour le forgeron, le charron qui ont préparé les instruments. Jusqu’ici il n’y a rien à dire, que l’on soit économiste ou communiste.
Mais j’aperçois que quatre francs sur mes seize francs vont au propriétaire du sol, et j’ai bien le droit de demander si cet homme, comme tous les autres, m’a rendu un Service pour avoir, comme tous les autres, droit incontestable à une rémunération.
D’après la doctrine que cet écrit aspire à faire prévaloir, la réponse est catégorique. Elle consiste en un oui très-formel. Oui, le propriétaire m’a rendu un service. Quel est-il ? Le voici : Il a, par lui-même ou par son aïeul, défriché et clôturé le champ ; il l’a purgé de mauvaises herbes et d’eaux stagnantes ; il a donné plus d’épaisseur à la couche végétale ; il a bâti une maison, des étables, des écuries. Tout cela suppose un long travail qu’il a exécuté en personne, ou, ce qui revient au même, qu’il a payé à d’autres. Ce sont certainement là des services qui, en vertu de la juste loi de réciprocité, doivent lui être remboursés. Or, ce propriétaire n’a jamais été rémunéré, du moins intégralement. Il ne pouvait pas l’être par le premier qui est venu lui acheter un hectolitre de blé. Quel est donc l’arrangement qui est intervenu ? Assurément le plus ingénieux, le plus légitime et le plus équitable qu’on pût imaginer. Il consiste en ceci : Quiconque voudra obtenir un sac de blé, payera, outre les services des différents travailleurs que nous avons énumérés, une petite portion des services rendus par le propriétaire ; en d’autres termes, la Valeur des services du propriétaire se répartira sur tous les sacs de blé qui sortiront de ce champ.
Maintenant on peut demander si cette rémunération, supposée être ici de quatre francs, est trop grande ou trop petite. Je réponds : Cela ne regarde pas l’économie politique. Cette science constate que la valeur des services du propriétaire foncier se règle absolument par les mêmes lois que la valeur de tous les autres services, et cela suffit.
On peut s’étonner aussi que ce système de remboursement morcelé n’arrive pas à la longue à un amortissement intégral, par conséquent à l’extinction du droit du propriétaire. Ceux qui font cette objection ne savent pas qu’il est dans la nature des capitaux de produire une rente perpétuelle ; c’est ce que nous apprendrons plus tard.
Pour le moment, je ne dois pas m’écarter plus longtemps de la question, et je ferai remarquer (car tout est là) qu’il n’y a pas dans mes seize francs une obole qui n’aille rémunerer des services humains, pas une qui corresponde à la prétendue valeur que la nature aurait introduite dans le blé eu y mettant l’utilité.
Mais si, vous appuyant sur l’axiome de Say et des économistes anglais, vous dites : Sur les seize francs, il y en a douze qui vont aux laboureurs, semeurs, moissonneurs, charretiers, etc., deux qui récompensent les services personnels du propriétaire ; enfin, deux autres francs représentent une valeur qui a pour fondement l’utilité créée par Dieu, par des agents naturels, et en dehors de toute coopération humaine ; — ne voyez-vous pas qu’on vous demandera de suite : Qui doit profiter de cette portion de valeur ? qui a droit à cette rémunération ? Dieu ne se présente pas pour la recevoir. Qui osera se présenter à sa place ?
Et plus Say veut expliquer la propriété sur cette donnée, plus il prête le flanc à ses adversaires. Il compare d’abord, avec raison, la terre à un laboratoire, où s’accomplissent des opérations chimiques dont le résultat est utile aux hommes. « Le sol, ajoute-t-il, est donc producteur d’une utilité, et lorsqu’il (le sol) la fait payer sous la forme d’un profit ou d’un fermage pour son propriétaire, ce n’est pas sans rien donner au consommateur en échange de ce que le consommateur lui (au sol) paye. Il (toujours le sol) lui donne une utilité produite, et c’est en produisant cette utilité que la terre est productive aussi bien que le travail. »
Ainsi, l’assertion est nette. Voilà deux prétendants qui se présentent pour se partager la rémunération due par le consommateur du blé, savoir : la terre et le travail. Ils se présentent au même titre, car le sol, dit M. Say, est productif comme le travail. Le travail demande à être rémunéré d’un service ; le sol demande à être rémunéré d’une utilité, et cette rémunération, il ne la demande pas pour lui (sous quelle forme la lui donnerait-on ?), il la réclame pour son propriétaire.
Sur quoi Proudhon somme ce propriétaire, qui se dit chargé de pouvoirs du sol, de montrer sa procuration.
On veut que je paye, en d’autres termes, que je rende un service, pour recevoir l’utilité produite par les agents naturels, indépendamment du concours de l’homme déjà payé séparément.
Mais je demanderai toujours : Qui profitera de mon service ?
Sera-ce le producteur de l’utilité, c’est-à-dire le sol ? Cela est absurde, et je puis attendre tranquillement qu’il m’envoie un huissier.
Sera-ce un homme ? mais à quel titre ? Si c’est pour m’avoir rendu un service, à la bonne heure. Mais alors vous êtes à mon point de vue. C’est le service humain qui vaut, et non le service naturel ; c’est la conclusion à laquelle je veux vous amener.
Cependant, cela est contraire à votre hypothèse même. Vous dites que tous les services humains sont rémunérés par quatorze francs, et que les deux francs qui complètent le prix du blé répondent à la valeur créée par la nature. En ce cas, je répète ma question : À quel titre un homme quelconque se présente-t-il pour les recevoir ? Et n’est-il pas malheureusement trop clair que, si vous appliquez spécialement le nom de propriétaire à l’homme qui revendique le droit de toucher ces deux francs, vous justifiez cette trop fameuse maxime : La propriété, c’est le vol ?
Et qu’on ne pense pas que cette confusion entre l’utilité et la valeur se borne à ébranler la propriété foncière. Après avoir conduit à contester la rente de la terre, elle conduit à contester l’intérêt du capital.
En effet, les machines, les instruments de travail sont, comme le sol, producteurs d’utilité. Si cette utilité a une valeur, elle se paye, car le mot Valeur implique droit à payement. Mais à qui se paye-t-elle ? au propriétaire de la machine, sans doute. Est-ce pour un service personnel ? alors dites donc que la valeur est dans le service. Mais si vous dites qu’il faut faire un premier payement pour le service, et un second pour l’utilité produite par la machine, indépendamment de toute action humaine déjà rétribuée, on vous demandera à qui va ce second payement, et comment l’homme, qui est déjà rémunéré de tous ses services, a-t-il droit de réclamer quelque chose de plus ?
La vérité est que l’utilité produite par la nature est gratuite, partant commune, ainsi que celle produite par les instruments de travail. Elle est gratuite et commune à une condition : c’est de se donner la peine, c’est de se rendre à soi-même le service de la recueillir, ou, si l’on donne cette peine, si l’on demande ce service à autrui, de céder en retour un service équivalent. C’est dans ces services comparés qu’est la valeur, et nullement dans l’utilité naturelle. Cette peine peut être plus ou moins grande, ce qui fait varier la valeur et non l’utilité. Quand nous sommes auprès d’une source abondante, l’eau est gratuite pour nous tous, à la condition de nous baisser pour la prendre. Si nous chargeons notre voisin de prendre cette peine pour nous, alors je vois apparaître une convention, un marché, une valeur, mais cela ne fait pas que l’eau ne reste gratuite. Si nous sommes à une heure de la source, le marché se fera sur d’autres bases quant au degré, mais non quant au principe. La valeur n’aura pas passé pour cela dans l’eau ni dans son utilité. L’eau continuera d’être gratuite, à la condition de l’aller chercher, ou de rémunérer ceux qui, après libre débat, consentent à nous épargner cette peine en la prenant eux-mêmes.
Il en est ainsi pour tout. Les utilités nous entourent, mais il faut se baisser pour les prendre ; cet effort, quelquefois très-simple, est souvent fort compliqué. Rien n’est plus facile, dans la plupart des cas, que de recueillir l’eau dont la nature a préparé l’utilité. Il ne l’est pas autant de recueillir le blé dont la nature prépare également l’utilité ; c’est pourquoi la valeur de ces deux efforts diffère par le degré, non par le principe. Le service est plus ou moins onéreux ; partant, il vaut plus ou moins ; l’utilité est et reste toujours gratuite.
Que s’il intervient un instrument de travail, qu’en résulte-t-il ? que l’utilité est plus facilement recueillie. Aussi le service a-t-il moins de valeur. Nous payons certainement moins cher les livres depuis l’invention de l’imprimerie. Phénomène admirable et trop méconnu ! Vous dites que les instruments de travail produisent de la Valeur ; vous vous trompez, c’est de l’Utilité et de l’Utilité gratuite qu’il faut dire. Quant à de la Valeur, ils en produisent si peu, qu’ils l’anéantissent de plus en plus.
Il est vrai que celui qui a fait la machine a rendu service. Il reçoit une rémunération dont s’augmente la valeur du produit. C’est pourquoi nous sommes disposés à nous figurer que nous rétribuons l’utilité produite par la machine : c’est une illusion. Ce que nous rétribuons, ce sont les 'services que nous rendent tous ceux qui ont concouru à la faire confectionner ou fonctionner. La valeur est si peu dans l’utilité produite, que, même après avoir rétribué ces nouveaux services, l’utilité nous est acquise à de meilleures conditions qu’avant.
Habituons-nous donc à distinguer l’Utilité de la Valeur. Il n’y a de science économique qu’à ce prix. Loin que l’Utilité et la Valeur soient identiques ou même assimilables, j’ose affirmer, sans crainte d’aller jusqu’au paradoxe, que ce sont des idées opposées. Besoin, Effort, Satisfaction, voilà l’homme, avons-nous dit, au point de vue économique. Le rapport de l’Utilité est avec le Besoin et la Satisfaction. Le rapport de la Valeur est avec l’Effort. L’Utilité est le Bien qui fait cesser le Besoin par la satisfaction. La Valeur est le mal, car elle naît de l’obstacle qui s’interpose entre le besoin et la satisfaction ; sans ces obstacles il n’y aurait pas d’efforts à faire et à échanger, l’utilité serait infinie, gratuite et commune sans condition, et la notion de valeur ne se serait jamais introduite dans ce monde. Par la présence de ces obstacles, l’utilité n’est gratuite qu’à la condition d’efforts échangés, qui, comparés entre eux, constatent la valeur. Plus les obstacles s’abaissent devant la libéralité de la nature ou les progrès des sciences, plus l’utilité s’approche de la gratuité et de la communauté absolues, car la condition onéreuse et par conséquent la valeur diminuent avec ces obstacles. Je m’estimerais heureux si, à travers toutes ces dissertations qui peuvent paraître subtiles, et dont je suis condamné à redouter tout à la fois la longueur et la concision, je parviens à établir cette vérité rassurante : propriété légitime de la valeur, — et cette autre vérité consolante : communauté progressive de l’utilité.
Encore une remarque : Tout ce qui sert est utile (uti, servir) ; à ce titre, il est fort douteux qu’il existe rien dans l’univers ; force ou matière, qui ne soit utile à l’homme.
Nous pouvons affirmer du moins, sans crainte de nous tromper, qu’une foule de choses nous sont utiles à notre insu. Si la lune était placée plus haut ou plus bas, il est fort possible que le règne inorganique, par suite, le règne végétal, par suite encore, le règne animal, fussent profondément modifiés. Sans cette étoile qui brille au firmament pendant que j’écris, peut-être le genre humain ne pourrait-il exister. La nature nous a environnés d’utilités. Cette qualité d’être utiles, nous la reconnaissons dans beaucoup de substances et de phénomènes ; dans d’autres, la science et l’expérience nous la révèlent tous les jours ; dans d’autres encore, elle existe quoique complétement et peut-être pour toujours ignorée de nous.
Quand ces substances et ces phénomènes exercent sur nous, mais sans nous, leur action utile, nous n’avons aucun intérêt à comparer le degré d’utilité dont ils nous sont, et, qui plus est, nous n’en avons guère les moyens. Nous savons que l’oxygène et l’azote nous sont utiles, mais nous n’essayons pas, et nous essayerions probablement en vain de déterminer dans quelle proportion. Il n’y a pas là les éléments de l’évaluation, de la valeur. J’en dirai autant des sels, des gaz, des forces répandues dans la nature. Quand tous ces agents se meuvent et se combinent de manière à produire pour nous, mais sans notre concours, de l’utilité, cette utilité, nous en jouissons sans l’évaluer. C’est quand notre coopération intervient et surtout quand elle s’échange, c’est alors et seulement alors qu’apparaissent l’Évaluation et la valeur, portant non pas sur l’utilité de substances et de phénomènes souvent ignorés, mais sur cette coopération même.
C’est pourquoi je dis : la valeur, c’est l’appréciation des services échangés. Ces services peuvent être fort compliqués, ils peuvent avoir exigé une foule de travaux divers anciens et récents, ils peuvent se transmettre d’un hémisphère ou d’une génération à une autre génération et à un autre hémisphère, embrassant de nombreux contractants, nécessitant des crédits, des avances, des arrangements variés, jusqu’à ce que la balance générale se fasse ; toujours est-il que le principe de la valeur est en eux et non dans l’utilité à laquelle ils servent de véhicule, utilité gratuite par essence, et qui passe de main en main, qu’on me permette le mot, par-dessus le marché.
Après tout, si l’on persiste à voir dans l’Utilité le fondement de la Valeur, je le veux bien ; mais qu’il soit bien entendu qu’il ne s’agit pas de cette utilité qui est dans les choses et les phénomènes par la dispensation de la Providence ou la puissance de l’art, mais de l’utilité des services humains comparés et échangés.
Rareté. Selon Senior, de toutes les circonstances qui influent sur la Valeur, la rareté est la plus décisive. Je n’ai aucune objection à faire contre cette remarque, si ce n’est qu’elle suppose, par sa forme, que la valeur est inhérente aux choses mêmes ; hypothèse dont je combattrai toujours jusqu’à l’apparence. Au fond, le mot rareté, dans le sujet qui nous occupe, exprime d’une manière abrégée cette pensée : Toutes choses égales d’ailleurs, un service a d’autant plus de valeur que nous aurions plus de difficulté à nous le rendre à nous-mêmes, et que, par conséquent, nous rencontrons plus d’exigence quand nous le réclamons d’autrui. La rareté est une de ces difficultés. C’est un obstacle de plus à surmonter. Plus il est grand, plus nous rémunérons ceux qui le surmontent pour nous. — La rareté donne souvent lieu à des rémunérations considérables ; et c’est pourquoi je refusais d’admettre tout à l’heure avec les économistes anglais que la Valeur fût proportionnelle au travail. Il faut tenir compte de la parcimonie avec laquelle la nature nous a traités à certains égards. Le mot service embrasse toutes ces idées et nuances d’idées.
Jugement. Storch voit la valeur dans le jugement qui nous la fait reconnaître. — Sans doute, chaque fois qu’il s’agit d’un rapport, il faut comparer et juger. Mais le rapport n’en est pas moins une chose et le jugement une autre. Quand nous comparons la hauteur de deux arbres, leur grandeur et la différence de leur grandeur sont indépendantes de notre appréciation.
Mais dans la détermination de la valeur, quel est le rapport qu’il s’agit de juger ? C’est le rapport de deux services échangés. La question est de savoir ce que valent, l’un à l’égard de l’autre, les services rendus et reçus, à l’occasion des actes transmis ou des choses cédées, en tenant compte de toutes les circonstances, et non ce que ces actes ou ces choses contiennent d’utilité intrinsèque, car cette utilité peut être en partie étrangère à toute action humaine et par conséquent étrangère à la valeur.
Storch reste donc dans l’erreur fondamentale que je combats ici, quand il dit :
« Notre jugement nous fait découvrir le rapport qui existe entre nos besoins et l’utilité des choses. L’arrêt que notre jugement porte sur l’utilité des choses constitue leur valeur. »
Et plus loin :
« Pour créer une valeur, il faut la réunion de trois circonstances : 1° que l’homme éprouve ou conçoive un besoin ; 2° qu’il existe une chose propre à satisfaire ce besoin ; 3° que le jugement se prononce en faveur de l’utilité de la chose. Donc la valeur des choses, c’est leur utilité relative. »
Le jour, j’éprouve le besoin de voir clair. Il existe une chose propre à satisfaire ce besoin, qui est la lumière du soleil. Mon jugement se prononce en faveur de l’utilité de cette chose, et… elle n’a pas de valeur. Pourquoi ? Parce que j’en jouis sans réclamer le service de personne.
La nuit j’éprouve le même besoin. Il existe une chose propre à le satisfaire très-imparfaitement, une bougie. Mon jugement se prononce sur l’utilité, mais sur l’utilité relative beaucoup moindre de cette chose, et elle a une valeur. Pourquoi ? Parce que celui qui s’est donné la peine de faire la bougie ne veut pas me rendre le service de me la céder, si je ne lui rends un service équivalent.
Ce qu’il s’agit de comparer et de juger, pour déterminer la valeur, ce n’est donc pas l’utilité relative des choses, mais le rapport de deux services.
En ces termes, je ne repousse pas la définition de Storch.
Résumons ce paragraphe, afin de montrer que ma définition contient tout ce qu’il y a de vrai dans celles de mes prédécesseurs, et élimine tout ce qu’elles ont d’erroné par excès ou défaut.
Le principe de la Valeur, ai-je dit, est dans un service humain. Elle résulte de l’appréciation de deux services comparés.
La Valeur doit avoir trait à l’effort : — Service implique un effort quelconque.
Elle suppose comparaison d’efforts échangés, au moins échangeables : — Service implique les termes : donner et recevoir.
En fait, elle n’est cependant pas proportionnelle à l’intensité des efforts : — Service n’implique pas nécessairement cette proportion.
Une foule de circonstances extérieures influent sur la valeur sans être la valeur même : — Le mot Service tient compte de toutes ces circonstances dans la mesure convenable.
Matérialité. Quand le service consiste à céder une chose matérielle, rien n’empêche de dire, par métonymie, que c’est cette chose qui vaut. Mais il ne faut pas perdre de vue que c’est là un trope qui attribue aux choses mêmes la valeur des services dont elles sont l’occasion.
Conservabilité. Matière ou non, la valeur se conserve jusqu’à la satisfaction, et pas plus loin. Elle ne change pas de nature selon que la satisfaction suit l’effort de plus ou moins près, selon que le service est personnel ou réel.
Accumulabilité. Ce que l’épargne accumule, dans l’ordre social, ce n’est pas la matière, mais la valeur ou les services. [234]
Utilité. J’admettrai avec M. Say que l’Utilité est le fondement de la Valeur, pourvu qu’on convienne qu’il ne s’agit nullement de l’utilité qui est dans les choses, mais de l’utilité relative des services.
Travail. J’admettrai avec Ricardo que le Travail est le fondement de la Valeur, pourvu d’abord qu’on prenne le mot travail dans le sens le plus général, et ensuite qu’on ne conclue pas à une proportionnalité contraire à tous les faits, en d’autres termes, pourvu qu’on substitue au mot travail le mot service.
Rareté. J’admets avec Senior que la rareté influe sur la valeur. Mais pourquoi ? Parce qu’elle rend le service d’autant plus précieux.
Jugement. J’admets avec Storch que la valeur résulte d’un jugement, pourvu qu’on convienne que c’est du jugement que nous portons, non sur l’utilité des choses, mais sur l’utilité des services.
Ainsi les Économistes de toutes nuances devront se tenir pour satisfaits. Je leur donne raison à tous, parce que tous ont aperçu la vérité par un côté. Il est vrai que l’erreur était sur le revers de la médaille. C’est au lecteur de décider si ma définition tient compte de toutes les vérités et rejette toutes les erreurs.
Je ne dois pas terminer sans dire un mot de cette quadrature de l’Économie politique : la mesure de la valeur ; — et ici je répéterai, avec bien plus de force encore, l’observation qui termine les précédents chapitres.
J’ai dit que nos besoins, nos désirs, nos goûts n’ont ni bornes ni mesure précise.
J’ai dit que nos moyens d’y pourvoir, dons de la nature, facultés, activité, prévoyance, discernement, n’avaient pas de mesure précise. Chacun de ces éléments est variable en lui-même ; il diffère d’homme à homme, il diffère dans chaque individu de minute en minute, en sorte que tout cela forme un ensemble qui est la mobilité même.
Si maintenant l’on considère quelles sont les circonstances qui influent sur la valeur, utilité, travail, rareté, jugement, et si l’on reconnaît qu’il n’est aucune de ces circonstances qui ne varie à l’infini, comment s’obstinerait-on à chercher à la valeur une mesure fixe ?
Il serait curieux qu’on trouvât la fixité dans un terme moyen composé d’éléments mobiles, et qui n’est autre chose qu’un Rapport entre deux termes extrêmes plus mobiles encore !
Les économistes qui poursuivent une mesure absolue de la valeur courent donc après une chimère, et, qui plus est, après une inutilité. La pratique universelle a adopté l’or et l’argent, encore qu’elle n’ignorât pas combien la valeur de ces métaux est variable. Mais qu’importe la variabilité de la mesure, si, affectant de la même manière les deux objets échangés, elle ne peut altérer la loyauté de l’échange ? C’est une moyenne proportionnelle qui peut hausser ou baisser, sans manquer pour cela à sa mission, qui est d’accuser exactement le Rapport des deux extrêmes.
La science ne se propose pas pour but, comme l’échange, de chercher le Rapport actuel de deux services, car en ce cas la monnaie lui suffirait. Ce qu’elle cherche surtout, c’est le Rapport de l’effort à la satisfaction ; et, à cet égard, une mesure de la valeur, existât-elle, ne lui apprendrait rien, car l’effort apporte toujours à la satisfaction une proportion variable d’utilité gratuite qui n’a pas de valeur. C’est parce que cet élément de bien-être a été perdu de vue, que la plupart des écrivains ont déploré l’absence d’une mesure de la valeur. Ils n’ont pas vu qu’elle ne ferait aucune réponse à la question proposée : Quelle est la Richesse ou le bien-être comparatif de deux classes, de deux peuples, de deux générations ?
Pour résoudre cette question, il faut à la science une mesure qui lui révèle, non pas le rapport de deux services, lesquels peuvent servir de véhicule à des doses très-diverses d’utilité gratuite, mais le rapport de l’effort à la satisfaction, et cette mesure ne saurait être autre que l’effort lui-même ou le travail.
Mais comment le travail servira-t-il de mesure ? N’est-il pas lui-même un des éléments les plus variables ? N’est-il pas plus ou moins habile, pénible, chanceux, dangereux, répugnant ? N’exige-t-il pas plus ou moins l’intervention de certaines facultés intellectuelles, de certaines vertus morales ? et ne conduit-il pas, en raison de toutes ces circonstances, à des rémunérations d’une variété infinie ?
Il y a une nature de travail qui, en tout temps, en tous lieux, est identique à lui-même, et c’est celui-là qui doit servir de type. C’est le travail le plus simple, le plus brut, le plus primitif, le plus musculaire, celui qui est le plus dégagé de toute coopération naturelle, celui que tout homme peut exécuter, celui qui rend des services que chacun peut se rendre à soi-même, celui qui n’exige ni force exceptionnelle, ni habileté, ni apprentissage ; le travail tel qu’il s’est manifesté au point de départ de l’humanité, le travail, en un mot, du simple journalier. Ce travail est partout le plus offert, le moins spécial, le plus homogène et le moins rétribué. Toutes les rémunérations s’échelonnent et se graduent à partir de cette base ; elles augmentent avec toutes les circonstances qui ajoutent à son mérite.
Si donc on veut comparer deux états sociaux, il ne faut pas recourir à une mesure de la valeur, par deux motifs aussi logiques l’un que l’autre : d’abord parce qu’il n’y en a pas ; ensuite parce qu’elle ferait à l’interrogation une réponse trompeuse, négligeant un élément considérable et progressif du bien-être humain : l’utilité gratuite.
Ce qu’il faut faire, c’est au contraire oublier complétement la valeur, particulièrement la monnaie, et se demander : Quelle est, dans tel pays, à telle époque, la quantité de chaque genre d’utilité spéciale, et la somme de toutes les utilités qui répond à chaque quantité donnée de travail brut ; en d’autres termes : Quel est le bien-être que peut se procurer par l’échange le simple journalier ?
On peut affirmer que l’ordre social naturel est perfectible et harmonique, si, d’un côté, le nombre des hommes voués au travail brut, et recevant la plus petite rétribution possible, va sans cesse diminuant, et si, de l’autre, cette rémunération mesurée non en valeur ou en monnaie, mais en satisfaction réelle, s’accroît sans cesse. [235]
Les anciens avaient bien décrit toutes les combinaisons de l’Échange :
Do ut des (produit contre produit), Do ut facias (produit contre service), Facio ut des (service contre produit), Facio ut facias (service contre service).
Puisque produits et services s’échangent entre eux, il faut bien qu’ils aient quelque chose de commun, quelque chose par quoi ils se comparent et s’apprécient, à savoir la valeur.
Mais la Valeur est une chose identique à elle-même. Elle ne peut donc qu’avoir, soit dans le produit, soit dans le service, la même origine, la même raison d’être.
Cela étant ainsi, la valeur est-elle originairement, essentiellement dans le produit, et est-ce par analogie qu’on en a étendu la notion au service ?
Ou bien, au contraire, la valeur réside-t-elle dans le service, et ne s’incarne-t-elle pas dans le produit, précisément et uniquement parce que le service s’y incarne lui-même ?
Quelques personnes paraissent croire que c’est là une question de pure subtilité. C’est ce que nous verrons tout à l’heure. Provisoirement je me bornerai à faire observer combien il serait étrange qu’en économie politique une bonne ou une mauvaise définition de la valeur fût indifférente.
Il ne me paraît pas douteux qu’à l’origine l’économie politique a cru voir la valeur dans le produit, bien plus, dans la matière du produit. Les Physiocrates l’attribuaient exclusivement à la terre, et appelaient stériles toutes les classes qui n’ajoutent rien à la matière : tant à leurs yeux matière et valeur étaient étroitement liées ensemble.
Il semble qu’Adam Smith aurait dû briser cette notion, puisqu’il faisait découler la valeur du travail. Les purs services n’exigent-ils pas du travail, par conséquent n’impliquent-ils pas de la valeur ? Si près de la vérité, Smith ne s’en rendit pas maître encore : car, outre qu’il dit formellement que, pour que le travail ait de la valeur, il faut qu’il s’applique à la matière, à quelque chose de physiquement tangible et accumulable, tout le monde sait que, comme les Physiocrates, il range parmi les classes improductives celles qui se bornent à rendre des services.
À la vérité, Smith s’occupe beaucoup de ces classes dans son traité des Richesses. Mais qu’est-ce que cela prouve, si ce n’est qu’après avoir donné une définition, il s’y trouvait à l’étroit, et que par conséquent cette définition était fausse ? Smith n’eût pas conquis la vaste et juste renommée qui l’environne, s’il n’eût écrit ses magnifiques chapitres sur l’Enseignement, le Clergé, les Services publics, et si, traitant de la Richesse, il se fût circonscrit dans sa définition. Heureusement il échappa, par l’inconséquence, au joug de ses prémisses. Cela arrive toujours ainsi. Jamais un homme de quelque génie, partant d’un faux principe, n’échappera à l’inconséquence ; sans quoi il serait dans l’absurde progressif, et, loin d’être un homme de génie, il ne serait pas même un homme.
Comme Smith avait fait un pas en avant sur les Physiocrates, Say en fit un autre sur Smith. Peu à peu, il fut amené à reconnaître de la valeur aux services, mais seulement par analogie, par extension. C’est dans le produit qu’il voyait la valeur essentielle, et rien ne le prouve mieux que cette bizarre dénomination donnée aux services : « Produits immatériels, » deux mots qui hurlent de se trouver ensemble. Say est parti de Smith, et ce qui le prouve, c’est que toute la théorie du maître se retrouve dans les dix premières lignes qui ouvrent les travaux du disciple. [236] Mais il a médité et progressé pendant trente ans. Aussi il s’est approché de la vérité, sans jamais l’atteindre complétement.
Au reste, on aurait pu croire qu’il remplissait sa mission d’économiste, aussi bien en étendant la valeur du produit au service, qu’en la ramenant du service au produit, si la propagande socialiste, fondée sur ses propres déductions, ne fût venue révéler l’insuffisance et le danger de son principe.
M’étant donc posé cette question : Puisque certains produits ont de la valeur, puisque certains services ont de la valeur, et puisque la valeur identique à elle-même ne peut avoir qu’une origine, une raison d’être, une explication identique ; cette origine, cette explication est-elle dans le produit ou dans le service ?
Et, je le dis bien hautement, la réponse ne me paraît pas un instant douteuse, par la raison sans réplique que voici : C’est que tout produit qui a de la valeur implique un service, tandis que tout service ne suppose pas nécessairement un produit.
Ceci me parait décisif, mathématique.
Voilà un service : qu’il revête ou non une forme matérielle, il a de la valeur ; puisqu’il est service.
Voilà de la matière : si en la cédant on rend service, elle a de la valeur, mais si on ne rend pas service, elle n’a pas de valeur.
Donc la valeur ne va pas de la matière au service, mais du service à la matière.
Ce n’est pas tout. Rien ne s’explique plus aisément que cette prééminence, cette priorité donnée au service, au point de vue de la valeur, sur le produit. On va voir que cela tient à une circonstance qu’il était aisé d’apercevoir, et qu’on n’a pas observée, précisément parce qu’elle crève les yeux. Elle n’est autre que cette prévoyance naturelle à l’homme, en vertu de laquelle, au lieu de se borner à rendre les services qu’on lui demande, il se prépare d’avance à rendre ceux qu’il prévoit devoir lui être demandés. C’est ainsi que le facio ut facias se transforme en do ut des, sans cesser d’être le fait dominant et explicatif de toute transaction.
Jean dit à Pierre : Je désire une coupe. Ce serait à moi de la faire ; mais si tu veux la faire pour moi, tu me rendras un service que je payerai par un service équivalent.
Pierre accepte. En conséquence, il se met en quête de terres convenables, il les mélange, il les manipule ; bref, il fait ce que Jean aurait dû faire.
Il est bien évident ici que c’est le service qui détermine la valeur. Le mot dominant de la transaction c’est facio. Et si plus tard la valeur s’incorpore dans le produit, ce n’est que parce qu’elle découlera du service, lequel est la combinaison du travail exécuté par Pierre et du travail épargné à Jean.
Or il peut arriver que Jean fasse souvent à Pierre la même proposition, que d’autres personnes la lui fassent aussi, de telle sorte que Pierre puisse prévoir avec certitude que ce genre de services lui sera demandé, et se préparer à le rendre. Il peut se dire : J’ai acquis une certaine habileté à faire des coupes. Or l’expérience m’avertit que les coupes répondent à un besoin qui veut être satisfait. Je puis donc en fabriquer d’avance.
Dorénavant Jean devra dire à Pierre, non plus : Facio ut facias, mais : Facio ut des. Si même il a, de son côté, prévu les besoins de Pierre et travaillé d’avance à y pourvoir, il dira : Do ut des.
Mais en quoi, je le demande, ce progrès qui découle de la prévoyance humaine change-t-il la nature et l’origine de la Valeur ? Est-ce qu’elle n’a pas toujours pour raison d’être et pour mesure le service ? Qu’importe, quant à la vraie notion de la valeur, que, pour faire une coupe, Pierre ait attendu qu’on la lui demandât, ou qu’il l’ait faite d’avance, prévoyant qu’elle lui serait demandée ?
Remarquez ceci : dans l’humanité, l’inexpérience et l’imprévoyance précèdent l’expérience et la prévoyance. Ce n’est qu’avec le temps que les hommes ont pu prévoir leurs besoins réciproques, au point de se préparer à y pourvoir. Logiquement, le facio ut facias a dû précéder le do ut des. Celui-ci est en même temps le fruit et le signe de quelques connaissances répandues, de quelque expérience acquise, de quelque sécurité politique, de quelque confiance en l’avenir, en un mot, d’une certaine civilisation. Cette prévoyance sociale, cette foi en la demande qui fait qu’on prépare l’offre, cette sorte de statistique intuitive dont chacun a une notion plus ou moins précise, et qui établit un si surprenant équilibre entre les besoins et les approvisionnements, est un des ressorts les plus efficaces de la perfectibilité humaine. C’est à lui que nous devons la séparation des occupations, ou du moins les professions et les métiers. C’est à lui que nous devons un des biens que les hommes recherchent avec le plus d’ardeur : la fixité des rémunérations, sous forme de salaire quant au travail, et d’intérêt quant au capital. C’est à lui que nous devons le crédit, les opérations à longue échéance, celles qui ont pour objet le nivellement des risques, etc. Il est surprenant qu’au point de vue de l’économie politique ce noble attribut de l’homme, la Prévoyance, n’ait pas été plus remarqué. C’est toujours, ainsi que le disait Rousseau, à cause de la difficulté que nous éprouvons à observer le milieu dans lequel nous sommes plongés et qui forme notre atmosphère naturelle. Il n’y a que les faits anormaux qui nous frappent, et nous laissons passer inaperçus ceux qui, agissant autour de nous, sur nous et en nous d’une manière permanente, modifient profondément l’homme et la société.
Pour en revenir au sujet qui nous occupe, il se peut que la prévoyance humaine, dans sa diffusion infinie, tende de plus en plus à substituer le do ut des au facio ut facias ; mais n’oublions pas néanmoins que c’est dans la forme primitive et nécessaire de l’échange que se trouve pour la première fois la notion de valeur, que cette forme primitive est le service réciproque, et, qu’après tout, au point de vue de l’échange, le produit n’est qu’un service prévu.
Après avoir constaté que la valeur n’est pas inhérente à la matière et ne peut être classée parmi ses attributs, je suis loin de nier qu’elle ne passe du service au produit, de manière pour ainsi dire à s’y incarner. Je prie mes contradicteurs de croire que je ne suis pas assez pédant pour exclure du langage ces locutions familières : l’or vaut, le froment vaut, la terre vaut. Je me crois seulement en droit de demander à la science le pourquoi ; et si elle me répond : Parce que l’or, le froment, la terre portent en eux-mêmes une valeur intrinsèque, — je me crois en droit de lui dire : « Tu te trompes et ton erreur est dangereuse. Tu te trompes, car il y a de l’or et de la terre sans valeur ; c’est l’or et la terre qui n’ont encore été l’occasion d’aucun service humain. Ton erreur est dangereuse, car elle induit à voir une usurpation des dons gratuits de Dieu dans un simple droit à la réciprocité des services. »
Je suis donc prêt à reconnaître que les produits ont de la valeur, pourvu qu’on m’accorde qu’elle ne leur est pas essentielle, qu’elle se rattache à des services et en provient.
Et cela est si vrai, qu’il s’ensuit une conséquence très-importante, — fondamentale en économie politique, — qui n’a pas été et ne pouvait être remarquée, c’est celle-ci :
Quand la valeur a passé du service au produit, elle subit dans le produit toutes les chances auxquelles elle reste assujettie dans le service lui-même.
Elle n’est pas fixe dans le produit, comme cela serait si c’était une de ses qualités intrinsèques ; non, elle est essentiellement variable, elle peut s’élever indéfiniment, elle peut s’abaisser jusqu’à l’annulation, suivant la destinée du genre de services auxquels elle doit son origine.
Celui qui fait actuellement une coupe, pour la vendre dans un an, y met de la valeur sans doute ; et cette valeur est déterminée par celle du service, — non par la valeur qu’a actuellement le service, mais par celle qu’il aura dans un an. Si, au moment de vendre la coupe, le genre de services dont il s’agit est plus recherché, la coupe vaudra plus ; elle sera dépréciée dans le cas contraire.
C’est pourquoi l’homme est constamment stimulé à exercer sa prévoyance, à en faire un utile usage. Il a toujours en perspective, dans l’amélioration ou la dépréciation de la valeur, pour ses prévisions justes une récompense, pour ses prévisions erronées un châtiment. Et remarquez que ses succès comme ses revers coïncident avec le bien et le mal général. S’il a bien dirigé ses prévisions, il s’est préparé d’avance à jeter dans le milieu social des services plus recherchés, plus appréciés, plus efficaces, qui répondent à des besoins mieux sentis ; il a contribué à diminuer la rareté, à augmenter l’abondance de ce genre de services, à le mettre à la portée d’un plus grand nombre de personnes avec moins de sacrifices. Si au contraire il s’est trompé dans son appréciation de l’avenir, il vient, par sa concurrence, déprimer des services déjà délaissés ; il ne fait, à ses dépens, qu’un bien négatif ; c’est d’avertir qu’un certain ordre de besoins n’exige pas actuellement une grande part d’activité sociale, qu’elle n’a pas à prendre cette direction où elle ne serait pas récompensée.
Ce fait remarquable — que la valeur incorporée, si je puis m’exprimer ainsi, ne cesse pas d’avoir une destinée commune avec celle du genre de service auquel elle se rattache, — est de la plus haute importance, non-seulement parce qu’il démontre de plus en plus cette théorie : que le principe de la valeur est dans le service ; mais encore parce qu’il explique avec la plus grande facilité des phénomènes que les autres systèmes considèrent comme anormaux.
Une fois le produit lancé sur le marché du monde, y a-t-il, au sein de l’humanité, des tendances générales qui poussent sa valeur plutôt vers la baisse que vers la hausse ? C’est demander si le genre de services qui a engendré cette valeur tend à être plus ou moins bien rémunéré. L’un est aussi possible que l’autre, et c’est ce qui ouvre une carrière sans bornes à la prévoyance humaine.
Cependant on peut remarquer que la loi générale des êtres susceptibles d’expérimenter, d’apprendre et de se rectifier, c’est le progrès. La probabilité est donc qu’à une époque donnée, une certaine dépense de temps et de peine obtienne plus de résultats qu’à une époque antérieure ; d’où l’on peut conclure que la tendance dominante de la valeur incorporée est vers la baisse. Par exemple, si la coupe dont je parlais tout à l’heure comme symbole des produits est faite depuis plusieurs années, selon toute apparence elle aura subi quelque dépréciation. En effet, pour confectionner une coupe identique, on a aujourd’hui plus d’habileté, plus de ressources, de meilleurs outils, des capitaux moins exigeants, une division du travail mieux entendue. Or, s’adressant au détenteur de la coupe, celui qui la désire ne dit pas : Faites-moi savoir quel est, en quantité et qualité, le travail qu’elle vous a coûté afin que je vous rémunère en conséquence. Non, il dit : Aujourd’hui, grâce aux progrès de l’art, je puis faire moi-même ou me procurer par l’échange une coupe semblable, avec tant de travail de telle qualité ; et c’est la limite de la rémunération que je consens à vous donner.
Il résulte de là que toute valeur incorporée, autrement dit tout travail accumulé, ou tout capital tend à se déprécier devant les services naturellement perfectibles et progressivement productifs ; et que, dans l’échange du travail actuel contre du travail antérieur, l’avantage est généralement du côté du travail actuel, ainsi que cela doit être puisqu’il rend plus de services.
Et c’est pour cela qu’il y a quelque chose de si vide dans les déclamations que nous entendons diriger sans cesse contre la valeur des propriétés foncières :
Cette valeur ne diffère en rien des autres, ni par son origine ni par sa nature, ni par la loi générale de sa lente dépréciation.
Elle représente des services anciens : desséchements, défrichements, épierrements, nivellements, clôtures, accroissement des couches végétales, bâtisses, etc. ; elle est là pour réclamer les droits de ces services. Mais ces droits ne se règlent pas par la considération du travail exécuté. Le propriétaire foncier ne dit pas : « Donnez-moi en échange de cette terre autant de travail qu’elle en a reçu » (c’est ainsi qu’il s’exprimerait si, selon la théorie de Smith, la valeur venait du travail et lui était proportionnelle). Encore moins vient-il dire, comme le supposent Ricardo et nombre d’économistes : « Donnez-moi d’abord autant de travail que ce sol en a reçu, puis en outre une certaine quantité de travail pour équivaloir aux forces naturelles qui s’y trouvent. » Non, le propriétaire foncier, lui qui représente les possesseurs qui l’ont précédé et jusqu’aux premiers défricheurs, en est réduit à tenir en leur nom cet humble langage :
« Nous avons préparé des services, et nous demandons à les échanger contre des services équivalents. Nous avons autrefois beaucoup travaillé : car de notre temps on ne connaissait pas vos puissants moyens d’exécution ; il n’y avait pas de routes ; nous étions forcés de tout faire à force de bras. Bien des sueurs, bien des vies humaines sont enfouies dans ces sillons. Mais nous ne demandons pas travail pour travail ; nous n’aurions aucun moyen pour obtenir une telle transaction. Nous savons que le travail qui s’exécute aujourd’hui sur la terre, soit en France, soit au dehors, est beaucoup plus parfait et plus productif. Ce que nous demandons et ce qu’on ne peut évidemment nous refuser, c’est que notre travail ancien et le travail nouveau s’échangent proportionnellement, non à leur durée ou leur intensité, mais à leurs résultats, de telle sorte que nous recevions même rémunération pour même service. Par cet arrangement nous perdons, au point de vue du travail, puisqu’il en faut deux fois et peut-être trois fois plus du nôtre que du vôtre pour rendre le même service ; mais c’est un arrangement forcé ; nous n’avons pas plus les moyens d’en faire prévaloir un autre que vous de nous le refuser. »
Et, en point de fait, les choses se passent ainsi. Si l’on pouvait se rendre compte de la quantité d’efforts, de fatigues, de sueurs sans cesse renouvelées qu’il a fallu pour amener chaque hectare du sol français à son état de productivité actuelle, on resterait bien convaincu que celui qui l’achète ne donne pas travail pour travail, — au moins dans quatre-vingt-dix-neuf circonstances sur cent.
Je mets ici cette restriction, parce qu’il ne faut pas perdre ceci de vue : qu’un service incorporé peut acquérir de la valeur comme il peut en perdre. Et encore que la tendance générale soit vers la dépréciation, néanmoins le phénomène contraire se manifeste quelquefois, dans des circonstances exceptionnelles, à propos de terre comme à propos de toute autre chose, sans que la loi de justice soit blessée et sans qu’on puisse crier au monopole.
Au fait, ce qui est toujours en présence, pour dégager la valeur, ce sont les services. C’est une chose très-probable que du travail ancien, dans une application déterminée, rend moins de services que du travail nouveau ; mais ce n’est pas une loi absolue. Si le travail ancien rend moins de services, comme c’est presque toujours le cas, que le travail nouveau, il faut dans l’échange plus du premier que du second pour établir l’équivalence, puisque, je le répète, l’équivalence se règle par les services. Mais aussi, quand il arrive que le travail ancien rend plus de services que le nouveau, il faut bien que celui-ci subisse la compensation du sacrifice de la quantité…
Long FN inserted in OC6 (1855)
C’est parce que, sous l’empire de la liberté, les efforts se font concurrence entre eux qu’ils obtiennent cette rémunération à peu près proportionnelle à leur intensité. Mais, je le répète, cette proportionnalité n’est pas inhérente à la notion de valeur.
Et la preuve, c’est que là où la concurrence n’existe pas, la proportionnalité n’existe pas davantage. On ne remarque, en ce cas, aucun rapport entre les travaux de diverse nature et leur rémunération.
L’absence de concurrence peut provenir de la nature des choses ou de la perversité des hommes.
Si elle vient de la nature des choses, on verra un travail comparativement très-faible donner lieu à une grande valeur, sans que personne ait raisonnablement à se plaindre. C’est le cas de la personne qui trouve un diamant ; c’est le cas de Rubini, de Malibran, de Taglioni, du tailleur en vogue, du propriétaire du Clos-Vougeot, etc., etc. Les circonstances les ont mis en possession d’un moyen extraordinaire de rendre service ; ils n’ont pas de rivaux et se font payer cher. Le service lui-même étant d’une rareté excessive, cela prouve qu’il n’est pas essentiel au bien-être et au progrès de l’humanité. Donc c’est un objet de luxe, d’ostentation : que les riches se le procurent. N’est-il pas naturel que tout homme attende, avant d’aborder ce genre de satisfactions, qu’il se soit mis à même de pourvoir à des besoins plus impérieux et plus raisonnables ?
Si la concurrence est absente par suite de quelque violence humaine, alors les mêmes effets se produisent, mais avec cette différence énorme qu’ils se produisent où et quand ils n’auraient pas dû se produire. Alors on voit aussi un travail comparativement faible donner lieu à une grande valeur ; mais comment ? En interdisant violemment cette concurrence qui a pour mission de proportionner les rémunérations aux services. Alors, de même que Rubini peut dire à un dilettante : « Je veux une très-grande récompense, ou je ne chante pas à votre soirée, » se fondant sur ce qu’il s’agit là d’un service que lui seul peut rendre, — de même un boulanger, un boucher, un propriétaire, un banquier peut dire : « Je veux une récompense extravagante, ou vous n’aurez pas mon blé, mon pain, ma viande, mon or ; et j’ai pris des précautions, j’ai organisé des baïonnettes pour que vous ne puissiez pas vous pourvoir ailleurs, pour que nul ne puisse vous rendre des services analogues aux miens. »
Les personnes qui assimilent le monopole artificiel et ce qu’elles appellent le monopole naturel, parce que l’un et l’autre ont cela de commun, qu’ils accroissent la valeur du travail, ces personnes, dis-je, sont bien aveugles et bien superficielles.
Le monopole artificiel est une spoliation véritable. Il produit des maux qui n’existeraient pas sans lui. Il inflige des privations à une portion considérable de la société, souvent à l’égard des objets les plus nécessaires. En outre, il fait naître l’irritation, la haine, les représailles, fruits de l’injustice.
Les avantages naturels ne font aucun mal à l’humanité. Tout au plus pourrait-on dire qu’ils constatent un mal préexistant et qui ne leur est pas imputable. Il est fâcheux, peut-être, que le tokay ne soit pas aussi abondant et à aussi bas prix que la piquette. Mais ce n’est pas là un fait social ; il nous a été imposé par la nature.
Il y a donc entre l’avantage naturel et le monopole artificiel cette différence profonde :
L’un est la conséquence d’une rareté préexistante, inévitable ;
L’autre est la cause d’une rareté factice, contre nature.
Dans le premier cas, ce n’est pas l’absence de concurrence qui fait la rareté, c’est la rareté qui explique l’absence de concurrence. L’humanité serait puérile, si elle se tourmentait, se révolutionnait, parce qu’il n’y a, dans le monde, qu’une Jenny Lind, un Clos-Vougeot et un Régent.
Dans le second cas, c’est tout le contraire. Ce n’est pas à cause d’une rareté providentielle que la concurrence est impossible, mais c’est parce que la force a étouffé la concurrence qu’il s’est produit parmi les hommes une rareté qui ne devait pas être.
(Note extraite des manuscrits de l’auteur.)
VI. Richesse↩
Ainsi, en tout ce qui est propre à satisfaire nos besoins et nos désirs, il y a à considérer, à distinguer deux choses, ce qu’a fait la nature et ce que fait l’homme, — ce qui est gratuit et ce qui est onéreux, — le don de Dieu et le service humain, — l’utilité et la valeur. Dans le même objet, l’une peut être immense et l’autre imperceptible. Celle-là restant invariable, celle-ci peut diminuer indéfiniment et diminue en effet, chaque fois qu’un procédé ingénieux nous fait obtenir un résultat identique avec un moindre effort.
On peut pressentir ici une des plus grandes difficultés, une des plus abondantes sources de malentendus, de controverses et d’erreurs placées à l’entrée même de la science.
Qu’est-ce que la richesse ?
Sommes-nous riches en proportion des utilités dont nous pouvons disposer, c’est-à-dire des besoins et des désirs que nous pouvons satisfaire ? « Un homme est pauvre ou riche, dit A. Smith, selon le plus ou moins de choses utiles dont il peut se procurer la jouissance. »
Sommes-nous riches en proportion des valeurs que nous possédons, c’est-à-dire des services que nous pouvons commander ? « La richesse, dit J. B. Say, est en proportion de la valeur. Elle est grande, si la somme de valeur dont elle se compose est considérable ; elle est petite, si les valeurs le sont. »
Les ignorants donnent les deux sens au mot Richesse. Quelquefois on les entend dire : « L’abondance des eaux est une Richesse pour telle contrée, » alors ils ne pensent qu’à l’Utilité. Mais quand l’un d’entre eux veut connaître sa propre richesse, il fait ce qu’on nomme un inventaire où l’on ne tient compte que de la Valeur.
N’en déplaise aux savants, je crois que les ignorants ont raison cette fois. La richesse, en effet, est effective ou relative. Au premier point de vue elle se juge par nos satisfactions ; l’humanité devient d’autant plus Riche qu’elle acquiert plus de bien-être, quelle que soit la valeur des objets qui le procurent. Mais veut-on connaître la part proportionnelle de chaque homme au bien-être général, en d’autres termes, la richesse relative ? C’est là un simple rapport que la valeur seule révèle, parce qu’elle est elle-même un rapport.
La science se préoccupe du bien-être général des hommes, de la proportion qui existe entre leurs Efforts et leurs Satisfactions, proportion que modifie avantageusement la participation progressive de l’utilité gratuite à l’œuvre de la production. Elle ne peut donc pas exclure cet élément de l’idée de la Richesse. À ses yeux la Richesse effective ce n’est pas la somme des valeurs, mais la somme des utilités gratuites ou onéreuses attachées à ces valeurs. Au point de vue de la satisfaction, c’est-à-dire de la réalité, nous sommes riches autant de la valeur anéantie par le progrès que de celle qui lui survit encore.
Dans les transactions ordinaires de la vie, on ne tient plus compte de l’utilité à mesure qu’elle devient gratuite par l’abaissement de la valeur. Pourquoi ? parce que ce qui est gratuit est commun, et ce qui est commun n’altère en rien la part proportionnelle de chacun à la richesse effective. On n’échange pas ce qui est commun ; et comme, dans la pratique des affaires, on n’a besoin de connaître que cette proportion qui est constatée par la valeur, on ne s’occupe que d’elle.
Un débat s’est élevé entre Ricardo et J. B. Say à ce sujet. Ricardo donnait au mot Richesse le sens d’Utilité ; J. B. Say, celui de Valeur. Le triomphe exclusif de l’un des champions était impossible, puisque ce mot a l’un et l’autre sens, selon qu’on se place au point de vue de l’effectif ou du relatif.
Mais il faut bien le dire, et d’autant plus que l’autorité de Say est plus grande en ces matières, si l’on assimile la Richesse (au sens de bien-être effectif) à la Valeur, si l’on affirme surtout que l’une est proportionnelle à l’autre, on s’expose à fourvoyer la science. Les livres des économistes de second ordre et ceux des socialistes ne nous en offrent que trop la preuve. C’est un point de départ malheureux qui dérobe au regard justement ce qui forme le plus beau patrimoine de l’humanité ; il fait considérer comme anéantie cette part de bien-être que le progrès rend commun à tous, et fait courir à l’esprit le plus grand des dangers, — celui d’entrer dans une pétition de principe sans issue et sans fin, de concevoir une économie politique à rebours, où le but auquel nous aspirons est perpétuellement confondu avec l’obstacle qui nous arrête.
En effet, il n’y a de Valeur que par ces obstacles. Elle est le signe, le symptôme, le témoin, la preuve de notre infirmité native. Elle nous rappelle incessamment cet arrêt prononcé à l’origine : Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Pour l’Être tout-puissant ces mots, Effort, Service, et, par conséquent, Valeur, n’existent pas. Quant à nous, nous sommes plongés dans un milieu d’utilités, dont un grand nombre sont gratuites, mais dont d’autres ne nous sont livrées qu’à titre onéreux. Des obstacles s’interposent entre ces utilités et les besoins auxquels elles peuvent satisfaire. Nous sommes condamnés à nous passer de l’Utilité ou à vaincre l’Obstacle par nos efforts. Il faut que la sueur tombe de notre front, ou pour nous ou pour ceux qui l’ont répandue à notre profit.
Plus donc il y a de valeurs dans une société, plus cela prouve sans doute qu’on y a surmonté d’obstacles, mais plus cela prouve aussi qu’il y avait des obstacles à surmonter. Ira-t-on jusqu’à dire que ces obstacles font la Richesse, parce que sans eux les Valeurs n’existeraient pas ?
On peut concevoir deux nations. L’une a plus de satisfactions que l’autre, mais elle a moins de valeurs, parce que la nature l’a favorisée et qu’elle rencontre moins d’obstacles. Quelle sera la plus riche ?
Bien plus : prenons le même peuple à deux époques. Les obstacles à vaincre sont les mêmes. Mais aujourd’hui il les surmonte avec une telle facilité, il exécute, par exemple, ses transports, ses labours, ses tissages, avec si peu d’efforts, que les valeurs s’en trouvent considérablement réduites. Il a donc pu prendre un de ces deux partis : ou se contenter des mêmes satisfactions qu’autrefois, ses progrès se traduisant en loisirs ; et en ce cas dira-t-on que sa Richesse est rétrograde parce qu’il possède moins de valeurs ? — ou bien, consacrer ses efforts devenus disponibles à accroître ses jouissances ; et s’avisera-t-on, parce que la somme de ses valeurs sera restée stationnaire, d’en conclure que sa richesse est restée stationnaire aussi ? C’est à quoi l’on aboutit, si l’on assimile ces deux choses : Richesse et Valeur.
L’écueil est ici bien dangereux pour l’économie politique. Doit-elle mesurer la richesse par les satisfactions réalisées ou par les valeurs créées ?
S’il n’y avait jamais d’obstacles entre les utilités et les désirs, il n’y aurait ni efforts, ni services, ni Valeurs, non plus qu’il n’y en a pour Dieu ; et pendant que, dans le premier sens, l’humanité serait, comme Dieu, en possession de la Richesse infinie, suivant la seconde acception, elle serait dépourvue de toutes Richesses. De deux économistes dont chacun adopterait une de ces définitions, l’un dirait : Elle est infiniment riche, — l’autre : Elle est infiniment pauvre.
L’infinie, il est vrai, n’est sous aucun rapport l’attribut de l’humanité. Mais enfin elle se dirige de quelque côté, elle fait des efforts, elle a des tendances, elle gravite vers la Richesse progressive ou vers la Progressive Pauvreté. Or, comment les Économistes pourront-ils s’entendre, si cet anéantissement successif de l’effort par rapport au résultat, de la peine à prendre ou à rémunérer, de la Valeur, est considéré par les uns comme un progrès vers la Richesse, par les autres comme une chute dans la Misère ?
Encore si la difficulté ne concernait que les économistes, on pourrait dire : Entre eux les débats. — Mais les législateurs, les gouvernements ont tous les jours à prendre des mesures qui exercent sur les intérêts humains une influence réelle. Et où en sommes-nous, si ces mesures sont prises en l’absence d’une lumière qui nous fasse distinguer la Richesse de la Pauvreté ?
Or, j’affirme ceci : La théorie qui définit la Richesse par la valeur n’est en définitive que la glorification de l’Obstacle. Voici son syllogisme : « La Richesse est proportionnelle aux valeurs, les valeurs aux efforts, les efforts, aux obstacles ; donc les richesses sont proportionnelles aux obstacles. » — J’affirme encore ceci : À cause de la division du travail, qui a renfermé tout homme dans un métier ou profession, cette illusion est très-difficile à détruire. Chacun de nous vit des services qu’il rend à l’occasion d’un obstacle, d’un besoin, d’une souffrance : le médecin sur les maladies, le laboureur sur la famine, le manufacturier sur le froid, le voiturier sur la distance, l’avocat sur l’iniquité, le soldat sur le danger du pays ; de telle sorte qu’il n’est pas un obstacle dont la disparition ne fût très-inopportune et très-importune à quelqu’un, et même ne paraisse funeste, au point de vue général, parce qu’elle semble anéantir une source de services, de valeurs, de richesses. Fort peu d’économistes se sont entièrement préservés de cette illusion, et, si jamais la science parvient à la dissiper, sa mission pratique dans le monde sera remplie ; car je fais encore cette troisième affirmation : Notre pratique officielle s’est imprégnée de cette théorie, et chaque fois que les gouvernements croient devoir favoriser une classe, une profession, une industrie, ils n’ont pas d’autre procédé que d’élever des Obstacles, afin de donner à une certaine nature d’efforts l’occasion de se développer, afin d’élargir artificiellement le cercle des services auxquels la communauté sera forcée d’avoir recours, d’accroître ainsi la valeur, et, soi-disant, la Richesse.
Et, en effet, il est très-vrai que ce procédé est utile à la classe favorisée ; on la voit se féliciter, s’applaudir, et que fait-on ? On accorde successivement la même faveur à toutes les autres.
Assimiler d’abord l’Utilité à la Valeur, puis la Valeur à la Richesse, quoi de plus naturel ? La science n’a pas rencontré de piége dont elle se soit moins défiée. Car que lui est-il arrivé ? À chaque progrès, elle a raisonné ainsi : « L’obstacle diminue ; donc l’effort diminue ; donc la valeur diminue ; donc l’utilité diminue ; donc la richesse diminue ; donc nous sommes les plus malheureux des hommes pour nous être avisés d’inventer, d’échanger, d’avoir cinq doigts au lieu de trois, et deux bras au lieu d’un ; donc il faut engager le gouvernement, qui a la force, à mettre ordre à ces abus. »
Cette économie politique à rebours défraye un grand nombre de journaux et les séances de nos assemblées législatives. Elle a égaré l’honnête et philanthrope Sismondi ; on la trouve très-logiquement exposée dans le livre de M. de Saint-Chamans.
« Il y a deux sortes de richesse pour une nation, dit-il. Si l’on considère seulement les produits utiles sous le rapport de la quantité, de l’abondance, on s’occupe d’une richesse qui procure des jouissances à la société, et que j’appellerai Richesse de jouissance.
Si l’on considère les produits sous le rapport de leur Valeur échangeable ou simplement de leur valeur, l’on s’occupe d’une Richesse qui procure des valeurs à la société, et que je nomme Richesse de valeur.
C’est de la richesse de valeur que s’occupe spécialement l’Économie politique ; c’est celle-là surtout dont peut s’occuper le Gouvernement. »
Ceci posé, que peuvent l’économie politique et le gouvernement ? L’une, indiquer les moyens d’accroître cette Richesse de valeur ; l’autre, mettre ces moyens en œuvre.
Mais la richesse de Valeur est proportionnelle aux efforts, et les efforts sont proportionnels aux obstacles. L’Économie politique doit donc enseigner, et le Gouvernement s’ingénier à multiplier les obstacles. M. de Saint-Chamans ne recule en aucune façon devant cette conséquence.
L’Échange facilite-t-il aux hommes les moyens d’acquérir plus de Richesse de jouissance avec moins de Richesse de valeur ? — Il faut contrarier l’échange (page 438).
Y a-t-il quelque part de l’Utilité gratuite qu’on pourrait remplacer par de l’Utilité onéreuse, par exemple en supprimant un outil ou une machine ? Il n’y faut pas manquer : car il est bien évident, dit-il, que si les machines augmentent la Richesse de jouissance, elles diminuent la Richesse de valeur. « Bénissons les obstacles que la cherté du combustible oppose chez nous à la multiplicité des machines à vapeur » (page 263).
La nature nous a-t-elle favorisés en quoi que ce soit ? c’est pour notre malheur, car, par là, elle nous a ôté une occasion de travailler. « J’avoue qu’il est fort possible pour moi de désirer voir faire avec les mains, les sueurs, et un travail forcé, ce qui peut être produit sans peine et spontanément » (page 456).
Aussi quel dommage qu’elle ne nous ait pas laissé fabriquer l’eau potable ! C’eût été une belle occasion de produire de la Richesse de valeur. Fort heureusement nous prenons notre revanche sur le vin. « Trouvez le secret de faire sortir de la terre des sources de vin aussi abondamment que les sources d’eau, et vous verrez que ce bel ordre de choses ruinera un quart de la France » (page 456).
D’après la série d’idées que parcourt avec tant de naïveté notre économiste, il y a une foule de moyens, tous très-simples, de réduire les hommes à créer de la Richesse de valeur.
Le premier, c’est de la leur prendre à mesure. « Si l’impôt prend l’argent où il abonde pour le porter où il manque, il sert, et, loin que ce soit une perte pour l’État, c’est un gain » (page 161).
Le second, c’est de la dissiper. « Le luxe et la prodigalité, si nuisibles aux fortunes des particuliers, sont avantageux à la richesse publique. Vous prêchez là une belle morale, me dira-t-on. Je n’en ai pas la prétention. Il s’agit d’économie politique et non de morale. On cherche les moyens de rendre les nations plus riches, et je prêche le luxe » (page 168).
Un moyen plus prompt encore, c’est de la détruire par de bonnes guerres. « Si l’on reconnaît avec moi que la dépense des prodigues est aussi productive qu’une autre ; que la dépense des gouvernements est également productive… on ne s’étonne plus de la richesse de l’Angleterre, après cette guerre si dispendieuse » (page 168).
Mais pour pousser à la création de la Richesse de valeur, tous ces moyens, impôts, luxe, guerre, etc., sont forcés de baisser pavillon devant une ressource beaucoup plus efficace : c’est l’incendie.
« C’est une grande source de richesses que de bâtir, parce que cela fournit des revenus aux propriétaires qui vendent des matériaux, aux ouvriers, et à diverses classes d’artisans et d’artistes. Melon cite le chevalier Petty, qui regarde comme profit de la nation le travail pour le rétablissement des édifices de Londres, après le fameux incendie qui consuma les deux tiers de la ville, et il l’apprécie (ce profit !) à un million sterling par an (valeur de 1866), pendant quatre années, sans que cela ait altéré en rien les autres commerces. Sans regarder, ajoute M. de Saint-Chamans comme bien assurée l’évaluation de ce profit à une somme fixe, il est certain du moins que cet événement n’a pas eu une influence fâcheuse sur la richesse anglaise à cette époque… Le résultat du chevalier Petty n’est pas impossible, puisque la nécessité de rebâtir Londres a dû créer une immense quantité de nouveaux revenus » (page 63).
Les économistes qui partent de ce point : La Richesse, c’est la Valeur, arriveraient infailliblement aux mêmes conclusions, s’ils étaient logiques ; mais ils ne le sont pas, parce que sur le chemin de l’absurdité, on s’arrête toujours, un peu plus tôt, un peu plus tard, selon qu’on a l’esprit plus ou moins juste. M. de Saint-Chamans lui-même semble avoir reculé enfin quelque peu devant les conséquences de son principe, quand elles le conduisent jusqu’à l’éloge de l’incendie. On voit qu’il hésite et se contente d’un éloge négatif. Logiquement il devait aller jusqu’au bout, et dire ouvertement ce qu’il donne fort clairement à entendre.
De tous les économistes, celui qui a succombé de la manière la plus affligeante à la difficulté dont il est ici question, c’est certainement M. Sismondi. Comme M. de Saint-Chamans, il a pris pour point de départ cette idée que la valeur était l’élément de la richesse ; comme lui, il a bâti sur cette donnée une Économie politique à rebours, maudissant tout ce qui diminue la valeur. Lui aussi exalte l’obstacle, proscrit les machines, anathématise l’échange, la concurrence, la liberté, glorifie le luxe et l’impôt, et arrive enfin à cette conséquence, que plus est grande l’abondance de toutes choses, plus les hommes sont dénués de tout.
Cependant M. de Sismondi, d’un bout à l’autre de ses écrits, semble porter au fond de sa conscience le sentiment qu’il se trompe, et qu’un voile qu’il ne peut percer, s’interpose entre lui et la vérité. Il n’ose tirer brutalement, comme M. de Saint-Chamans, les conséquences de son principe ; il se trouble, il hésite. Il se demande quelquefois s’il est possible que tous les hommes, depuis le commencement du monde, soient dans l’erreur et sur la voie du suicide, quand ils cherchent à diminuer le rapport de l’effort à la satisfaction, c’est-à-dire la valeur. Ami et ennemi de la liberté, il la redoute, puisqu’elle conduit à l’universelle misère par l’abondance qui déprécie la valeur ; et en même temps, il ne sait comment s’y prendre pour détruire cette liberté funeste. Il arrive ainsi sur les confins du socialisme et des organisations artificielles, il insinue que le gouvernement et la science doivent tout régler et comprimer, puis il comprend le danger de ses conseils, les rétracte et finit enfin par tomber dans le désespoir, disant : La liberté mène au gouffre, la Contrainte est aussi impossible qu’inefficace ; il n’y a pas d’issue. — Il n’y en a pas, en effet, si la Valeur est la Richesse, c’est-à-dire si l’obstacle au bien-être est le bien-être, c’est-à-dire si le mal est le bien.
Le dernier écrivain qui ait, à ma connaissance, remué cette question, c’est M. Proudhon. Elle était pour son livre des Contradictions économiques une bonne fortune. Jamais plus belle occasion de saisir aux cheveux une antinomie et de narguer la science. Jamais plus belle occasion de lui dire : « Vois-tu dans l’accroissement de la valeur un bien ou un mal ? Quidquid dixeris argumentabor. » — Je laisse à penser quelle fête ! [237]
« Je somme tout économiste sérieux, dit-il, de me dire autrement qu’en traduisant et répétant la question, par quelle cause la valeur décroît à mesure que la production augmente, et réciproquement… En termes techniques, la valeur utile et la valeur échangeable, quoique nécessaires l’une à l’autre, sont en raison inverse l’une de l’autre… La valeur utile et la valeur échangeable restent donc fatalement enchainées l’une à l’autre, bien que par leur nature elles tendent continuellement à s’exclure. »
« Il n’y a pas, sur la contradiction inhérente à la notion de valeur, de cause assignable ni d’explication possible… Étant donné pour l’homme le besoin d’une grande variété de produits avec l’obligation d’y pourvoir par son travail, l’opposition de valeur utile à valeur échangeable en résulte nécessairement, et de cette opposition, une contradiction sur le seuil même de l’économie politique. Aucune intelligence, aucune volonté divine et humaine ne saurait l’empêcher. Ainsi, au lieu de chercher une explication inutile, contentons-nous de bien constater la nécessité de la contradiction. »
On sait que la grande découverte due à M. Proudhon est que tout est à la fois vrai et faux, bon et mauvais, légitime et illégitime, qu’il n’y a aucun principe qui ne se contredise, et que la contradiction n’est pas seulement dans les fausses théories, mais dans l’essence même des choses et des phénomènes ; « elle est l’expression pure de la nécessité, la loi intime des être, etc. ; » en sorte qu’elle est inévitable et serait incurable rationnellement sans la série et, en pratique, sans la Banque du peuple. Dieu, antinomie ; liberté, antinomie ; concurrence, antinommie ; propriété, antinomie ; valeur, crédit, monopole, communauté, antinomie et toujours antinomie. Quand M. Proudhon fit cette fameuse découverte, son cœur dut certainement bondir de joie ; car, puisque la Contradiction est en tout et partout, il y a toujours matière à contredire, ce qui est pour lui le bien suprême. Il me disait un jour : Je voudrais bien aller en paradis, mais j’ai peur que tout le monde n’y soit d’accord et de n’y trouver personne avec qui disputer.
Il faut avouer que la Valeur lui fournissait une excellente occasion de faire tout à son aise de l’antinomie. — Mais, je lui en demande bien pardon, les contradictions et oppositions que ce mot fait ressortir sont dans les fausses théories, et pas du tout, ainsi qu’il le prétend, dans la nature même du phénomène.
Les théoriciens ont d’abord commencé par confondre la Valeur avec l’utilité, c’est-à-dire le mal avec le bien (car l’utilité, c’est le résultat désiré, et la Valeur vient de l’obstacle qui s’interpose entre le résultat et le désir) ; c’était une première faute, et quand ils en ont aperçu les conséquences, ils ont cru sauver la difficulté en imaginant de distinguer la Valeur d’utilité de la Valeur d’échange, tautologie encombrante qui avait le tort d’attacher le même mot — Valeur — à deux phénomènes opposés.
Mais si, mettant de côté ces subtilités, nous nous attachons aux faits, que voyons-nous ? — Rien assurément que de très-naturel et de fort peu contradictoire.
Un homme travaille exclusivement pour lui-même. S’il acquiert de l’habileté, si sa force et son intelligence se développent, si la nature devient plus libérale ou s’il apprend à la mieux faire concourir à son œuvre, il a plus de bien-être avec moins de peine. Où voyez-vous la Contradiction, et y a-t-il là tant de quoi se récrier ?
Maintenant, au lieu d’être isolé, cet homme a des relations avec d’autres hommes. Ils échangent, et je répète mon observation : à mesure qu’ils acquièrent de l’habileté, de l’expérience, de la force, de l’intelligence, à mesure que la nature plus libérale ou plus asservie prête une collaboration plus efficace, ils ont plus de bien-être avec moins de peine, il y a à leur disposition une plus grande somme d’utilité gratuite ; dans leurs transactions ils se transmettent les uns aux autres une plus grande somme de résultats utiles pour chaque quantité donnée de travail. Où donc est la contradiction ?
Ah ! si vous avez le tort, à l’exemple de Smith et de tous ses successeurs, d’attacher la même dénomination, — celle de valeur, — et aux résultats obtenus et à la peine prise, — en ce cas, l’antinomie ou la contradiction se montre. —
Mais, sachez-le bien, elle est tout entière dans vos explications erronées, et nullement dans les faits.
M. Proudhon aurait donc dû établir ainsi sa proposition : Étant donné pour l’homme le besoin d’une grande variété de produits, la nécessité d’y pourvoir par son travail et le don précieux d’apprendre et de se perfectionner, rien au monde de plus naturel que l’accroissement soutenu des résultats par rapports aux efforts, et il n’est nullement contradictoire qu’une valeur donnée serve de véhicule à plus d’utilités réalisées.
Car, encore une fois, pour l’homme, l’Utilité c’est le beau côté, la Valeur c’est le triste revers de la médaille. L’Utilité n’a de rapports qu’avec nos Satisfactions, la Valeur qu’avec nos peines. L’Utilité réalise nos jouissances et leur est proportionnelle ; la Valeur atteste notre infirmité native, naît de l’obstacle et lui est proportionnelle.
En vertu de la perfectibilité humaine, l’utilité gratuite tend à se substituer de plus en plus à l’utilité onéreuse exprimée par le mot valeur. Voilà le phénomène, et il ne présente assurément rien de contradictoire.
Mais reste toujours la question de savoir si le mot Richesse doit comprendre ces deux utilités réunies ou la dernière seulement.
Si l’on pouvait faire, une fois pour toutes, deux classes d’utilités, mettre d’un côté toutes celles qui sont gratuites, et de l’autre toutes celles qui sont onéreuses, on ferait aussi deux classes de Richesses, qu’on appellerait richesses naturelles et richesses sociales avec M. Say ; ou bien, richesses de jouissance et richesses de valeur avec M. de Saint-Chamans. Après quoi, comme ces écrivains le proposent, on ne s’occuperait plus des premières.
« Les biens accessibles à tous, dit M. Say, dont chacun peut jouir à sa volonté, sans être obligé de les acquérir, sans crainte de les épuiser, tels que l’air, l’eau, la lumière du soleil, etc., nous étant donnés gratuitement par la nature, peuvent être appelés richesses naturelles. Comme elles ne sauraient être ni produites, ni distribuées, ni consommées, elles ne sont pas du ressort de l’économie politique.
Celles dont l’étude est l’objet de cette science se composent des biens qu’on possède et qui ont une valeur reconnue. On peut les nommer Richesses sociales, parce qu’elles n’existent que parmi les hommes réunis en société. »
« C’est de la richesse de valeur, dit M. de Saint-Chamans, que s’occupe spécialement l’économie politique, et toutes les fois que dans cet ouvrage je parlerai de la richesse sans spécifier, c’est de celle-là seulement qu’il est question. »
Presque tous les économistes l’ont vu ainsi :
« La distinction la plus frappante qui se présente d’abord, dit Storch, c’est qu’il y a des valeurs qui sont susceptibles d’appropriation, et qu’il y en a qui ne le sont point. [238] Les premières seules sont l’objet de l’économie politique, car l’analyse des autres ne fournirait aucun résultat qui fût digne de l’attention de l’homme d’État. »
Pour moi, je crois que cette portion d’utilité qui, par suite du progrès, cesse d’être onéreuse, cesse d’avoir de la valeur, mais ne cesse pas pour cela d’être utilité et va tomber dans le domaine commun et gratuit, est précisément celle qui doit constamment attirer l’attention de l’homme d’État et de l’économiste. Sans cela, au lieu de pénétrer et de comprendre les grands résultats qui affectent et élèvent l’humanité, la science reste en face d’une chose tout à fait contingente, mobile, tendant à diminuer, sinon à disparaître, d’un simple rapport, de la Valeur en un mot ; sans s’en apercevoir, elle se laisse aller à ne considérer que la peine, l’obstacle, l’intérêt du producteur, qui pis est, à le confondre avec l’intérêt public, c’est-à-dire à prendre justement le mal pour le bien, et à aller tomber, sous la conduite des Saint-Chamans et des Sismondi, dans l’utopie socialiste ou l’antinomie Proudhonienne.
Et puis cette ligne de démarcation entre les deux utilités n’est-elle pas tout à fait chimérique, arbitraire, impossible ? Comment voulez-vous disjoindre ainsi la coopération de la nature et celle de l’homme, quand elles se mêlent, se combinent, se confondent partout, bien plus, quand l’une tend incessamment à remplacer l’autre, et que c’est justement en cela que consiste le progrès ? Si la science économique, si aride à quelques égards, élève et enchante l’intelligence sous d’autres rapports, c’est précisément qu’elle décrit les lois de cette association entre l’homme et la nature ; c’est qu’elle montre l’utilité gratuite se substituant de plus en plus à l’utilité onéreuse, la proportion des jouissances de l’homme s’accroissant eu égard à ses fatigues, l’obstacle s’abaissant sans cesse, et avec lui la Valeur, les perpétuelles déceptions du producteur plus que compensées par le bien-être croissant des consommateurs, la richesse naturelle, c’est-à-dire gratuite et commune, venant prendre la place de la richesse personnelle et appropriée. Eh quoi ! on exclurait de l’économie politique ce qui constitue sa religieuse Harmonie !
L’air, l’eau, la lumière sont gratuits, dites-vous. C’est vrai, et si nous n’en jouissions que sous leur forme primitive, si nous les faisions concourir à aucun de nos travaux, nous pourrions les exclure de l’économie politique, comme nous en excluons l’utilité possible et probable des comètes. Mais observez l’homme au point d’où il est parti et au point où il est arrivé. D’abord il ne savait faire concourir que très-imparfaitement l’eau, l’air, la lumière et les autres agents naturels. Chacune de ses satisfactions était achetée par de grands efforts personnels, exigeait une très-grande proportion de travail, ne pouvait être cédée que comme un grand service, représentait en un mot beaucoup de valeur. Peu à peu cette eau, cet air, cette lumière, la gravitation, l’élasticité, le calorique, l’électricité, la vie végétale sont sortis de cette inertie relative. Ils se sont de plus en plus mêlés à notre industrie. Ils s’y sont substitués au travail humain. Ils ont fait gratuitement ce qu’il faisait à titre onéreux. Ils ont, sans nuire aux satisfactions, anéanti de la valeur. Pour parler en langue vulgaire, ce qui coûtait cent francs n’en coûte que dix, ce qui exigeait dix jours de labeur n’en demande qu’un. Toute cette valeur anéantie est passée du domaine de la Propriété dans celui de la Communauté. Une proportion considérable d’efforts humains ont été dégagés et rendus disponibles pour d’autres entreprises : c’est ainsi qu’à peine égale, à services égaux, à valeurs égales, l’humanité a prodigieusement élargi le cercle de ses jouissances, et vous dites que je dois éliminer de la science cette utilité gratuite, commune, qui seule explique le progrès tant en hauteur qu’en surface, si je puis m’exprimer ainsi, tant en bien-être qu’en égalité !
Concluons qu’on peut donner et qu’on donne légitimement deux sens au mot Richesse :
La Richesse effective, vraie, réalisant des satisfactions, ou la somme des Utilités que le travail humain, aidé du concours de la nature, met à la portée des sociétés.
La Richesse relative, c’est-à-dire la quote-part proportionnelle de chacun à la Richesse générale, quote-part qui se détermine par la Valeur.
Voici donc la loi Harmonique enveloppée dans ce mot :
Par le travail, l’action des hommes se combine avec l’action de la nature.
L’Utilité résulte de cette coopération.
Chacun prend à l’utilité générale une part proportionnelle à la valeur qu’il crée, c’est-à-dire aux services qu’il rend, — c’est-à-dire, en définitive, à l’utilité dont il est lui-même. [239]
[end of EH1 - what follows was added to EH2 by PP]
Moralité de la richesse. Nous venons d’étudier la richesse au point de vue économique : il n’est peut-être pas inutile de dire quelque chose de ses effets moraux.
À toutes les époques, la richesse, au point de vue moral, a été un sujet de controverse. Certains philosophes, certaines religions ont ordonné de la mépriser ; d’autres ont surtout vanté la médiocrité. Aurea mediocritas. Il en est bien peu, s’il en est, qui aient admis comme morale une ardente aspiration vers les jouissances de la fortune.
Qui a tort ? qui a raison ? Il n’appartient pas à l’économie politique de traiter ce sujet de morale individuelle. Je dirai seulement ceci : Je suis toujours porté à croire que, dans les choses qui sont du domaine de la pratique universelle, les théoriciens, les savants, les philosophes sont beaucoup plus sujets à se tromper que cette pratique universelle elle-même, lorsque dans ce mot, Pratique, on fait entrer non-seulement les actions de la généralité des hommes, mais encore leurs sentiments et leurs idées.
Or, que nous montre l’universelle pratique ? Elle nous montre tous les hommes s’efforçant de sortir de la misère, qui est notre point de départ ; préférant tous à la sensation du besoin celle de la satisfaction, au dénûment la richesse, tous, dis-je, et même, à bien peu d’exceptions près, ceux qui déclament contre elle.
L’aspiration vers la richesse est immense, incessante, universelle, indomptable ; elle a triomphé sur presque tout le globe de notre native aversion pour le travail ; elle se manifeste, quoi qu’on en dise, avec un caractère de basse avidité plus encore chez les sauvages et les barbares que chez les peuples civilisés. Tous les navigateurs qui sont partis d’Europe, au xviiie siècle, imbus de ces idées mises en vogue par Rousseau, qu’ils allaient rencontrer aux Antipodes l’homme de la nature, l’homme désintéressé, généreux, hospitalier, ont été frappés de la rapacité dont ces hommes primitifs étaient dévorés. Nos militaires ont pu constater, de nos jours, ce qu’il fallait penser du désintéressement si vanté des peuplades arabes.
D’un autre côté, l’opinion de tous les hommes, même de ceux qui n’y conforment pas leur conduite, s’accorde à honorer le désintéressement, la générosité, l’empire sur soi, et à flétrir cet amour désordonné des richesses qui nous porte à ne reculer devant aucun moyen de nous les procurer. — Enfin la même opinion environne d’estime celui qui, dans quelque condition que ce soit, applique son travail persévérant et honnête à améliorer son sort, à élever la condition de sa famille. — C’est de cet ensemble de faits, d’idées et de sentiments qu’on doit conclure, ce me semble, le jugement à porter sur la richesse, au point de vue de la morale individuelle.
Il faut d’abord reconnaître que le mobile qui nous pousse vers elle est dans la nature ; il est de création providentielle et par conséquent moral. Il réside dans ce dénûment primitif et général, qui serait notre lot à tous, s’il ne créait en nous le désir de nous en affranchir. — Il faut reconnaître, en second lieu, que les efforts que font les hommes pour sortir de ce dénûment primitif, pourvu qu’ils restent dans les limites de la justice, sont respectables et estimables, puisqu’ils sont universellement estimés et respectés. Il n’est personne d’ailleurs qui ne convienne que le travail porte en lui-même un caractère moral. Cela s’exprime par ce proverbe qui est de tous les pays : « L’oisiveté est la mère de tous les vices. » Et l’on tomberait dans une contradiction choquante, si l’on disait, d’un côté, que le travail est indispensable à la moralité des hommes, et, de l’autre, que les hommes sont immoraux quand ils cherchent à réaliser la richesse par le travail.
Il faut reconnaître, en troisième lieu, que l’aspiration vers la richesse devient immorale quand elle est portée au point de nous faire sortir des bornes de la justice, et aussi, que l’avidité devient plus impopulaire à mesure que ceux qui s’y abandonnent sont plus riches.
Tel est le jugement porté, non par quelques philosophes ou quelques sectes, mais par l’universalité des hommes, et je m’y tiens.
Je ferai remarquer néanmoins que ce jugement peut n’être pas le même aujourd’hui et dans l’antiquité, sans qu’il y ait contradiction.
Les Esséniens, les Stoïciens vivaient au milieu d’une société où la richesse était toujours le prix de l’oppression, du pillage, de la violence. Non-seulement elle était immorale en elle-même, mais par l’immoralité des moyens d’acquisition, elle révélait l’immoralité des hommes qui en étaient pourvus. Une réaction même exagérée contre les richesses, était bien naturelle. Les philosophes modernes qui déclament contre la richesse, sans tenir compte de la différence des moyens d’acquisition, se croient des Sénèques, des Christs. Ils ne sont que des perroquets répétant ce qu’ils ne comprennent pas.
Mais la question que se pose l’économie politique est celle-ci : La richesse est-elle un bien moral ou un mal moral pour l’humanité ? Le développement progressif de la richesse implique-t-il, au point de vue moral, un perfectionnement ou une décadence ?
Le lecteur pressent ma réponse, et il comprend que j’ai dû dire quelques mots de la question de morale individuelle pour échapper à cette contradiction ou plutôt à cette impossibilité : Ce qui est une immoralité individuelle est une moralité générale.
Sans recourir à la statistique, sans consulter les écrous de nos prisons, on peut aborder un problème qui s’énonce en ces termes :
L’homme se dégrade-t-il à mesure qu’il exerce plus d’empire sur les choses et la nature, qu’il la réduit à le servir, qu’il se crée ainsi des loisirs, et que, s’affranchissant des besoins les plus impérieux de son organisation, il peut tirer de l’inertie, où elles sommeillaient, des facultés intellectuelles et morales qui ne lui ont pas été sans doute accordées pour rester dans une éternelle léthargie ?
L’homme se dégrade-t-il à mesure qu’il s’éloigne, pour ainsi dire, de l’état le plus inorganique, pour s’élever vers l’état le plus spiritualiste dont il puisse approcher ?
Poser ainsi le problème, c’est le résoudre.
Je conviendrai volontiers que lorsque la richesse se développe par des moyens immoraux, elle a une influence immorale, comme chez les Romains.
Je conviendrai encore que lorsqu’elle se développe d’une manière fort inégale, creusant un abîme de plus en plus profond entre les classes, elle a une influence immorale et crée des passions subversives.
Mais en est-il de même quand elle est le fruit du travail honnête, de transactions libres, et qu’elle se répand d’une manière uniforme sur toutes les classes ? Cela n’est vraiment pas soutenable.
Cependant les livres socialistes sont pleins de déclamations contre les riches.
Je ne comprends vraiment pas comment ces écoles, si diverses à d’autres égards, mais si unanimes en ceci, ne s’aperçoivent pas de la contradiction où elles tombent.
D’une part, la richesse, suivant les chefs de ces écoles, a une action délétère, démoralisante, qui flétrit l’âme, endurcit le cœur, ne laisse survivre que le goût des jouissances dépravées. Les riches ont tous les vices. Les pauvres ont toutes les vertus. Ils sont justes, sensés, désintéressés, généreux ; voilà le thème adopté.
Et d’un autre côté, tous les efforts d’imagination des Socialistes, tous les systèmes qu’ils inventent, toutes les lois qu’ils veulent nous imposer, tendent, s’il faut les en croire, à convertir la pauvreté en richesse . . . . . . . . .
Moralité de la richesse prouvée par cette maxime : Le profit de l’un est le profit de l’autre. [240] . . . . . . . . . .
VII. Capital↩
Les lois économiques agissent sur le même principe, qu’il s’agisse d’une nombreuse agglomération d’hommes, de deux individus, ou même d’un seul, condamné par les circonstances à vivre dans l’isolement.
L’individu, s’il pouvait vivre quelque temps isolé, serait à la fois capitaliste, entrepreneur, ouvrier, producteur et consommateur. Toute l’évolution économique s’accomplirait en lui. En observant chacun des éléments qui la composent : le besoin, l’effort, la satisfaction, l’utilité gratuite et l’utilité onéreuse, il se ferait une idée du mécanisme tout entier, quoique réduit à sa plus grande simplicité.
Or s’il y a quelque chose d’évident au monde, c’est qu’il ne pourrait jamais confondre ce qui est gratuit avec ce qui exige des efforts. Cela implique contradiction dans les termes. Il saurait bien quand une matière ou une force lui sont fournies par la nature, sans la coopération de son travail, alors même qu’elles s’y mêlent pour le rendre plus fructueux.
L’individu isolé ne songerait jamais à demander une chose à son travail tant qu’il pourrait la recueillir directement de la nature. Il n’irait pas chercher de l’eau à une lieue, s’il avait une source près de sa hutte. Par le même motif, chaque fois que son travail aurait à intervenir, il chercherait à y substituer le plus possible de collaboration naturelle.
C’est pourquoi, s’il construisait un canot, il le ferait du bois le plus léger, afin de mettre à profit le poids de l’eau. Il s’efforcerait d’y adapter une voile, afin que le vent lui épargnât la peine de ramer, etc.
Pour faire concourir ainsi des puissances naturelles, il faut des instruments.
Ici, on sent que l’individu isolé aura un calcul à faire. Il se posera cette question : Maintenant j’obtiens une satisfaction avec un effort donné ; quand je serai en possession de l’instrument, obtiendrai-je la même satisfaction avec un effort moindre, en ajoutant à celui qui me restera à faire celui qu’exige la confection de l’instrument lui-même ?
Nul homme ne veut dissiper ses forces pour le plaisir de les dissiper. Notre Robinson ne se livrera donc à la confection de l’instrument qu’autant qu’il apercevra, au bout, une économie définitive d’efforts à satisfaction égale, ou un accroissement de satisfactions à efforts égaux.
Une circonstance qui influe beaucoup sur le calcul, c’est le nombre et la fréquence des produits auxquels devra concourir l’instrument pendant sa durée. Robinson a un premier terme de comparaison. C’est l’effort actuel, celui auquel il est assujetti chaque fois qu’il veut se procurer la satisfaction directement et sans nulle aide. Il estime ce que l’instrument lui épargnera d’efforts dans chacune de ces occasions ; mais il faut travailler pour faire l’instrument, et ce travail il le répartira, par la pensée, sur le nombre total des circonstances où il pourra s’en servir. Plus ce nombre sera grand, plus sera puissant aussi le motif déterminant à faire concourir l’agent naturel. — C’est là, c’est dans cette répartition d’une avance sur la totalité des produits, qu’est le principe et la raison d’être de l’Intérêt.
Une fois que Robinson est décidé à fabriquer l’instrument, il s’aperçoit que la bonne volonté et l’avantage ne suffisent pas. Il faut des instruments pour faire des instruments ; il faut du fer pour battre le fer, et ainsi de suite, en remontant de difficulté en difficulté vers une difficulté première qui semble insoluble. Ceci nous avertit de l’extrême lenteur avec laquelle les capitaux ont dû se former à l’origine et dans quelle proportion énorme l’effort humain était sollicité pour chaque satisfaction.
Ce n’est pas tout. Pour faire les instruments de travail, eût-on les outils nécessaires, il faut encore des matériaux. S’ils sont fournis gratuitement par la nature, comme la pierre, encore faut-il les réunir, ce qui est une peine. Mais presque toujours la possession de ces matériaux suppose un travail antérieur, long et compliqué, comme s’il s’agit de mettre en œuvre de la laine, du lin, du fer, du plomb, etc.
Ce n’est pas tout encore. Pendant que l’homme travaille ainsi, dans l’unique vue de faciliter son travail ultérieur, il ne fait rien pour ses besoins actuels. Or, c’est là un ordre de phénomènes dans lequel la nature n’a pas voulu mettre d’interruption. Tous les jours il faut se nourrir, se vêtir, s’abriter. Robinson s’apercevra donc qu’il ne peut rien entreprendre, en vue de faire concourir des forces naturelles, qu’il n’ait préalablement accumulé des provisions. Il faut que chaque jour il redouble d’activité à la chasse, qu’il mette de côté une partie du gibier, puis qu’il s’impose des privations, afin de se donner le temps nécessaire à l’exécution de l’instrument de travail qu’il projette. Dans ces circonstances, il est plus que vraisemblable que sa prétention se bornera à faire un instrument imparfait et grossier, c’est-à-dire très-peu propre à remplir sa destination.
Plus tard, toutes les facultés s’accroîtront de concert. La réflexion et l’expérience auront appris à notre insulaire à mieux opérer ; le premier instrument lui-même lui fournira les moyens d’en fabriquer d’autres et d’accumuler des provisions avec plus de promptitude.
Instruments, matériaux, provisions, voilà sans doute ce que Robinson appellera son capital ; et il reconnaîtra aisément que plus ce capital sera considérable, plus il asservira de forces naturelles, plus il les fera concourir à ses travaux, plus enfin il augmentera le rapport de ses satisfactions à ses efforts.
Plaçons-nous maintenant au sein de l’ordre social. Le Capital se composera aussi des instruments de travail, des matériaux et des provisions sans lesquels, ni dans l’isolement ni dans la société, il ne se peut rien entreprendre de longue haleine. Ceux qui se trouveront pourvus de ce capital ne l’auront que parce qu’ils l’auront créé par leurs efforts ou par leurs privations, et ils n’auront fait ces efforts (étrangers aux besoins actuels), ils ne se seront imposé ces privations qu’en vue d’avantages ultérieurs, en vue, par exemple, de faire concourir désormais une grande proportion de forces naturelles. De leur part, céder ce capital, ce sera se priver de l’avantage cherché, ce sera céder cet avantage à d’autres, ce sera rendre service. Dès lors, ou il faut renoncer aux plus simples éléments de la justice, il faut même renoncer à raisonner, ou il faut reconnaître qu’ils auront parfaitement le droit de ne faire cette cession qu’en échange d’un service librement débattu, volontairement consenti. Je ne crois pas qu’il se rencontre un seul homme sur la terre qui conteste l’équité de la mutualité des services, car mutualité des services signifie, en d’autres termes, équité. Dira-t-on que la transaction ne devra pas se faire librement, parce que celui qui a des capitaux est en mesure de faire la loi à celui qui n’en a pas ? Mais comment devra-t-elle se faire ? À quoi reconnaître l’équivalence des services, si ce n’est quand de part et d’autre l’échange est volontairement accepté ? Ne voit-on pas d’ailleurs que l’emprunteur, libre de le faire, refusera, s’il n’a pas avantage à accepter, et que l’emprunt ne peut jamais empirer sa condition ? Il est clair que la question qu’il se posera sera celle-ci : L’emploi de ce capital me donnera-t-il des avantages qui fassent plus que compenser les conditions qui me sont demandées ; ou bien : L’effort que je suis maintenant obligé de faire, pour obtenir une satisfaction donnée, est-il supérieur ou moindre que la somme des efforts auxquels je serai contraint par l’emprunt, d’abord pour rendre les services qui me sont demandés, ensuite pour poursuivre cette satisfaction à l’aide du capital emprunté ? — Que si, tout compris, tout considéré, il n’y a pas avantage, il n’empruntera pas, il conservera sa position ; et, en cela, quel tort lui est-il infligé ? Il pourra se tromper, dira-t-on. Sans doute. On peut se tromper dans toutes les transactions imaginables. Est-ce à dire qu’il ne doit y en avoir aucune de libre ? Qu’on aille donc jusque-là, et qu’on nous dise ce qu’il faut mettre à la place de la libre volonté, du libre consentement. Sera-ce la contrainte, car je ne connais que la contrainte en dehors de la liberté ? Non, dit-on, ce sera le jugement d’un tiers. Je le veux bien, à trois conditions. C’est que la décision de ce personnage, quelque nom qu’on lui donne, ne sera pas exécutée par la contrainte. La seconde, qu’il sera infaillible, car pour remplacer une faillibilité par une autre ce n’est pas la peine ; et celle dont je me défie le moins est celle de l’intéressé. Enfin, la troisième condition, c’est que ce personnage ne se fasse pas payer ; car ce serait une singulière manière de manifester sa sympathie pour l’emprunteur que de lui ravir d’abord sa liberté et de lui mettre ensuite une charge de plus sur les épaules, en compensation de ce philanthropique service. Mais laissons la question de droit, et rentrons dans l’économie politique.
Un capital, qu’il se compose de matériaux, de provisions ou d’instruments, présente deux aspects : l’Utilité et la Valeur. J’aurais bien mal exposé la théorie de la Valeur, si le lecteur ne comprenait pas que celui qui cède un capital ne s’en fait payer que la valeur, c’est-à-dire le service rendu à son occasion, c’est-à-dire la peine prise par le cédant combinée avec la peine épargnée au cessionnaire. Un capital, en effet, est un produit comme un autre. Il n’emprunte ce nom qu’à sa destination ultérieure. C’est une grande illusion de croire que le capital soit une chose existant par elle-même. Un sac de blé est un sac de blé, encore que, selon les points de vue, l’un le vende comme revenu et l’autre l’achète comme capital. L’échange s’opère sur ce principe invariable : valeur pour valeur, service pour service ; et tout ce qui entre dans la chose d’utilité gratuite est donné par-dessus le marché, attendu que ce qui est gratuit n’a pas de valeur, et que la valeur seule figure dans les transactions. En cela, celles relatives aux capitaux ne diffèrent en rien des autres.
Il résulte de là, dans l’ordre social, des vues admirables et que je ne puis qu’indiquer ici. L’homme isolé n’a de capital que lorsqu’il a réuni des matériaux, des provisions et des instruments. Il n’en est pas de même de l’homme social. Il suffit à celui-ci d’avoir rendu des services, et d’avoir ainsi la faculté de retirer de la société, par l’appareil de l’échange, des services équivalents. Ce que j’appelle l’appareil de l’échange, c’est la monnaie, les billets à ordre, les billets de banque et même les banquiers. Quiconque a rendu un service et n’a pas encore reçu la satisfaction correspondante est porteur d’un titre, soit pourvu de valeur, comme la monnaie, soit fiduciaire, comme les billets de banque, qui lui donne la faculté de retirer du milieu social, quand il voudra, où il voudra, et sous la forme qu’il voudra, un service équivalent. Ce qui n’altère en rien, ni dans les principes, ni dans les effets, ni au point de vue du droit, la grande loi que je cherche à élucider : Les services s’échangent contre les services. C’est toujours le troc embryonnaire qui s’est développé, agrandi, compliqué, sans cesser d’être lui-même.
Le porteur du titre peut donc retirer de la société, à son gré, soit une satisfaction immédiate, soit un objet qui, à son point de vue, ait le caractère d’un capital. C’est ce dont le cédant ne se préoccupe en aucune façon. On examine l’équivalence des services, voilà tout.
Il peut encore céder son titre à un autre pour en faire ce qu’il voudra, sous la double condition de la restitution et d’un service, au temps fixé. Si l’on pénètre le fond des choses, on trouve qu’en ce cas le cédant se prive en faveur du cessionnaire ou d’une satisfaction immédiate qu’il recule de plusieurs années, ou d’un instrument de travail qui aurait augmenté ses forces, fait concourir les agents naturels, et augmenté à son profit le rapport des satisfactions aux efforts. Ces avantages, il s’en prive pour en investir autrui. C’est là certainement rendre service, et il n’est pas possible d’admettre, en bonne équité, que ce service soit sans droit à la mutualité. La restitution pure et simple, au bout d’un an, ne peut être considérée comme la rémunération de ce service spécial. Ceux qui le soutiennent ne comprennent pas qu’il ne s’agit pas ici d’une vente, dans laquelle, comme la livraison est immédiate, la rémunération est immédiate aussi. Il s’agit d’un délai. Et le délai, à lui seul, est un service spécial, puisqu’il impose un sacrifice à celui qui l’accorde, et confère un avantage à celui qui le demande. Il y a donc lieu à rémunération, ou il faut renoncer à cette loi suprême de la société : Service pour service. C’est cette rémunération qui prend diverses dénominations selon les circonstances : loyer, fermage, rente, mais dont le nom générique est Intérêt. [241]
Ainsi, chose admirable, et grâce au merveilleux mécanisme de l’échange, tout service est ou peut devenir un capital. Si des ouvriers doivent commencer dans dix ans un chemin de fer, nous ne pouvons pas épargner dès aujourd’hui, et en nature, le blé qui les nourrira, le lin qui les vêtira, et les brouettes dont ils s’aideront pendant cette opération de longue haleine. Mais nous pouvons épargner et leur transmettre la valeur de ces choses. Il suffit pour cela de rendre à la société des services actuels, et de n’en retirer que des titres, lesquels dans dix ans se convertiront en blé, en lin. Il n’est pas même indispensable que nous laissions sommeiller improductivement ces titres dans l’intervalle. Il y a des négociants, il y a des banquiers, il y a des rouages dans la société qui rendront, contre des services, le service de s’imposer ces privations à notre place.
Ce qui est plus surprenant encore, c’est que nous pouvons faire l’opération inverse, quelque impossible qu’elle semble au premier coup d’œil. Nous pouvons convertir en instrument de travail, en chemin de fer, en maisons, un capital qui n’est pas encore né, utilisant ainsi des services, qui ne seront rendus qu’au XXe siècle. Il y a des banquiers qui en font l’avance sur la foi que les travailleurs et les voyageurs de la troisième ou quatrième génération pourvoiront au payement ; et ces titres sur l’avenir se transmettent de main en main sans rester jamais improductifs. Je ne pense pas, je l’avoue, que les inventeurs de sociétés artificielles, quelque nombreux qu’ils soient, imaginent jamais rien de si simple à la fois et de si compliqué, de si ingénieux et de si équitable. Certes, ils renonceraient à leurs fades et lourdes utopies, s’ils connaissaient les belles Harmonies de la mécanique sociale instituée par Dieu. Un roi d’Aragon cherchait aussi quel avis il aurait donné à la Providence sur la mécanique céleste, s’il eût été appelé à ses conseils. Ce n’est pas Newton qui eût conçu cette pensée impie.
Mais, il faut le dire, toutes les transmissions de services, d’un point à un autre point de l’espace et du temps, reposent sur cette donnée qu’accorder délai c’est rendre service ; en d’autres termes, sur la légitimité de l’Intérêt. L’homme qui, de nos jours, a voulu supprimer l’intérêt n’a pas compris qu’il ramenait l’échange à sa forme embryonnaire, le troc actuel sans avenir et sans passé. Il n’a pas compris que, se croyant le plus avancé, il était le plus rétrograde des hommes, puisqu’il reconstruisait la société sur son ébauche la plus primitive. Il voulait, disait-il, la mutualité des services. Mais il commençait par ôter le caractère de services justement à cette nature de services qui rattache, lie et solidarise tous les lieux et tous les temps. De tous les socialistes, c’est celui qui, malgré l’audace de ses aphorismes à effet, a le mieux compris et le plus respecté l’ordre actuel des sociétés. Ses réformes se bornent à une seule qui est négative. Elle consiste à supprimer dans la société le plus puissant et le plus merveilleux de ses rouages.
J’ai expliqué ailleurs la légitimité et la perpétuité de l’intérêt. Je me contenterai de rappeler ici que :
1° La légitimité de l’intérêt repose sur ce fait : Celui qui accorde terme rend service. Donc l’intérêt est légitime, en vertu du principe Service pour service.
2° La perpétuité de l’intérêt repose sur cet autre fait : Celui qui emprunte doit restituer intégralement à l’échéance. Or, si la chose ou la valeur est restituée à son propriétaire, il la peut prêter de nouveau. Elle lui sera rendue une seconde fois, il la pourra prêter une troisième, et ainsi de suite à perpétuité. Quel est celui des emprunteurs successifs et volontaires qui peut avoir à se plaindre ?
Puisque la légitimité de l’intérêt a été assez contestée dans ces derniers temps pour effrayer le capital, et le déterminer à se cacher et à fuir, qu’il me soit permis de montrer combien cette étrange levée de boucliers est insensée.
Et d’abord, ne serait-il pas aussi absurde qu’injuste que la rémunération fût identique, soit qu’on demandât et obtînt un an, deux ans, dix ans de terme, ou qu’on n’en prît pas du tout ? Si, malheureusement, sous l’influence de la doctrine prétendue égalitaire, notre Code l’exigeait ainsi, toute une catégorie de transactions humaines serait à l’instant supprimée. Il y aurait encore des trocs, des ventes au comptant, il n’y aurait plus de ventes à terme ni de prêts. Les égalitaires déchargeraient les emprunteurs du poids de l’intérêt, c’est vrai, mais en les frustrant de l’emprunt. Sur cette donnée, on peut aussi soustraire les hommes à l’incommode nécessité de payer ce qu’ils achètent. Il n’y a qu’à leur défendre d’acheter, ou, ce qui revient au même, à faire déclarer par la loi que les prix sont illégitimes.
Le principe égalitaire a quelque chose d’égalitaire en effet. D’abord il empêcherait le capital de se former ; car qui voudrait épargner ce dont on ne peut tirer aucun parti ? et ensuite, il réduirait les salaires à zéro ; car où il n’y a pas de capital (instruments, matériaux et provisions), il ne saurait y avoir ni travail d’avenir, ni salaires. Nous arriverions donc bientôt à la plus complète des égalités, celle du néant.
Mais quel homme peut-être assez aveugle pour ne pas comprendre que le délai est par lui-même une circonstance onéreuse et, par suite, rémunérable ? Même en dehors du prêt, chacun ne s’efforce-t-il pas d’abréger les délais ? Mais c’est l’objet de nos préoccupations continuelles. Tout entrepreneur prend en grande considération l’époque où il rentrera dans ses avances. Il vend plus ou moins cher, selon que cette époque est prochaine ou éloignée. Pour rester indifférent sur ce point, il faudrait ignorer que le capital est une force ; car si on sait cela, on désire naturellement qu’elle accomplisse le plus tôt possible l’œuvre où on l’a engagée, afin de l’engager dans une œuvre nouvelle.
Ce sont de bien pauvres économistes que ceux qui croient que nous ne payons l’intérêt des capitaux que lorsque nous les empruntons. La règle générale, fondée sur la justice, est que celui qui recueille la satisfaction doit supporter toutes les charges de la production, délais compris, soit qu’il se rende le service à lui-même, soit qu’il se le fasse rendre par autrui. L’homme isolé, qui ne fait, lui, de transactions avec personne, considérerait comme onéreuse toute circonstance qui le priverait de ses armes pendant un an. Pourquoi donc une circonstance analogue ne serait-elle pas considérée comme onéreuse dans la société ? Que si un homme s’y soumet volontairement pour l’avantage d’un autre qui stipule volontairement une rémunération, en quoi cette rémunération est-elle illégitime ?
Rien ne se ferait dans le monde, aucune entreprise qui exige des avances ne s’accomplirait, on ne planterait pas, on ne sèmerait pas, on ne labourerait pas, si le délai n’était, en lui-même, considéré comme une circonstance onéreuse, traité et rémunéré comme tel. Le consentement universel est si unanime sur ce point, qu’il n’est pas un échange où ce principe ne domine. Les délais, les retards entrent dans l’appréciation des services, et, par conséquent, dans la constitution de la valeur.
Ainsi, dans leur croisade contre l’intérêt, les égalitaires foulent aux pieds non-seulement les plus simples notions d’équité, non-seulement leur propre principe : Service pour service, mais encore l’autorité du genre humain et la pratique universelle. Comment osent-ils étaler à tous les yeux l’incommensurable orgueil qu’une telle prétention suppose ? et n’est-ce pas une chose bien étrange et bien triste que des sectaires prennent cette devise implicite et souvent explicite : Depuis le commencement du monde, tous les hommes se trompent, hors moi ? Omnes, ego non.
Qu’on me pardonne d’avoir insisté sur la légitimité de l’intérêt fondée sur cet axiome : Puisque délai coûte, il faut qu’il se paye, coûter et payer étant corrélatifs. La faute en est à l’esprit de notre époque. Il faut bien se porter du côté des vérités vitales, admises par le genre humain, mais ébranlées par quelques novateurs fanatiques. — Pour un écrivain qui aspire à montrer un ensemble harmonieux de phénomènes, c’est une chose pénible, qu’on le croie bien, d’avoir à s’interrompre à chaque instant pour élucider les notions les plus élémentaires. Laplace aurait-il pu exposer dans toute sa simplicité le système du monde planétaire, si, parmi ses lecteurs, il n’y eût pas eu des notions communes et reconnues ; si, pour prouver que la terre tourne, il lui eût fallu préalablement enseigner la rémunération ? — Telle est la dure alternative de l’Économiste à notre époque. S’il ne scrute pas les éléments, il n’est pas compris ; et s’il les explique, le torrent des détails fait perdre de vue la simplicité et la beauté de l’ensemble.
Et vraiment, il est heureux pour l’humanité que l’Intérêt soit légitime.
Sans cela elle serait, elle aussi, placée dans une rude alternative : Périr en restant juste, ou progresser par l’injustice.
Toute industrie est un ensemble d’efforts. Mais il y a entre ces efforts une distinction essentielle à faire. Les uns se rapportent aux services qu’il s’agit de rendre actuellement, les autres à une série indéfinie de services analogues. Je m’explique.
La peine que prend, dans une journée, le porteur d’eau doit lui être payée par ceux qui profitent de cette peine ; mais celle qu’il a prise pour faire sa brouette et son tonneau doit être répartie, quant à la rémunération, sur un nombre indéterminé de consommateurs.
De même, ensemencement, sarclage, labourage, hersage, moisson, battage, ne regardent que la récolte actuelle ; mais clôtures, défrichements, desséchements, bâtisses, amendements, concernent et facilitent une série indéterminée de récoltes ultérieures.
D’après la loi générale Service pour service, ceux à qui doit aboutir la satisfaction ont à restituer les efforts qu’on a fait pour eux. Quant aux efforts de la première catégorie, pas de difficulté. Ils sont débattus et évalués entre celui qui les fait et celui qui en profite. Mais les services de la seconde catégorie, comment seront-ils évalués ? Comment une juste proportion des avances permanentes, frais généraux, capital fixe, comme disent les économistes, sera-t-elle répartie sur toute la série des satisfactions qu’elles sont destinées à réaliser ? Par quel procédé en fera-t-on retomber le poids d’une manière équitable sur tous les acquéreurs d’eau, jusqu’à ce que la brouette soit usée ; sur tous les acquéreurs de blé, tant que le champ en fournira ?
J’ignore comment on résoudrait le problème en Icarie ou au Phalanstère. Mais il est permis de croire que messieurs les inventeurs de sociétés, si féconds en arrangements artificiels et si prompts à les imposer par la loi, c’est-à-dire, qu’ils en conviennent ou non, par la Contrainte, n’imagineraient pas une solution plus ingénieuse que le procédé tout naturel que les hommes ont trouvé d’eux-mêmes (les audacieux !) depuis le commencement du monde, et qu’on voudrait aujourd’hui leur interdire. Ce procédé, le voici : il découle de la loi de l’'Intérêt.
Soient mille francs ayant été employés en améliorations foncières ; soient le taux de l’intérêt à cinq pour cent et la récolte moyenne de cinquante hectolitres. Sur ces données, chaque hectolitre de blé devra être grevé d’un franc.
Ce franc est évidemment la récompense légitime d’un service réel rendu par le propriétaire (qu’on pourrait appeler travailleur), aussi bien à celui qui acquerra un hectolitre de blé dans dix ans qu’à celui qui l’achète aujourd’hui. La loi de stricte justice est donc observée.
Que si l’amélioration foncière, ou la brouette et le tonneau, ne doivent avoir qu’une durée approximativement appréciable, un amortissement vient s’ajouter à l’intérêt, afin que le propriétaire ne soit pas dupe et puisse encore recommencer. C’est toujours la loi de justice qui domine.
Il ne faudrait pas croire que ce franc d’intérêt dont est grevé chaque hectolitre de blé est invariable. Non, il représente une valeur et est soumis à la loi des valeurs. Il s’accroît ou décroît selon la variation de l’offre et de la demande, c’est-à-dire selon les exigences des temps et le plus grand bien de la société.
On est généralement porté à croire que cette nature de rémunération tend à s’accroître, sinon quant aux améliorations industrielles, du moins quant aux améliorations foncières. En admettant que cette rente fût équitable à l’origine, dit-on, elle finit par devenir abusive, parce que le propriétaire, qui reste désormais les bras croisés, la voit grossir d’année en année, par le seul fait de l’accroissement de la population, impliquant un accroissement dans la demande du blé.
Cette tendance existe, j’en conviens, mais elle n’est pas spéciale à la rente foncière, elle est commune à tous les genres de travaux. Il n’en est pas un dont la valeur ne s’accroisse avec la densité de la population, et le simple manouvrier gagne plus à Paris qu’en Bretagne.
Ensuite, relativement à la rente foncière, la tendance qu’on signale est énergiquement balancée par une tendance opposée, c’est celle du progrès. Une amélioration réalisée aujourd’hui par des moyens perfectionnés, obtenue avec moins de travail humain, et dans un temps où le taux de l’intérêt a baissé, empêche toutes les anciennes améliorations d’élever trop haut leurs exigences. Le capital fixe du propriétaire, comme celui du manufacturier, se détériore à la longue, par l’apparition d’instruments de plus en plus énergiques à valeur égale. C’est là une magnifique Loi qui renverse la triste théorie de Ricardo ; elle sera exposée avec plus de détails quand nous en serons à la propriété foncière.
Remarquez que le problème de la répartition des services rémunératoires dus aux améliorations permanentes ne pouvait se résoudre que par la loi de l’intérêt. Le propriétaire ne pouvait répartir le Capital même sur un certain nombre d’acquéreurs successifs ; car où se serait-il arrêté, puisque le nombre en est indéterminé ? Les premiers auraient payé pour les derniers, ce qui n’est pas juste. En outre, un moment serait arrivé où le propriétaire aurait eu à la fois et le capital et l’amélioration, ce qui ne l’est pas davantage. Reconnaissons donc que le mécanisme social naturel est assez ingénieux pour que nous puissions nous dispenser de lui substituer un mécanisme artificiel.
J’ai présenté le phénomène sous sa forme la plus simple afin d’en faire comprendre la nature. Dans la pratique les choses ne se passent pas tout à fait ainsi.
Le propriétaire n’opère pas lui-même la répartition, ce n’est pas lui qui décide que chaque hectolitre de blé sera grevé d’un franc plus ou moins. Il trouve toutes choses établies dans le monde, tant le cours moyen du blé que le taux de l’intérêt. C’est sur cette donnée qu’il décide de la destination de son capital. Il le consacrera à l’amélioration foncière s’il calcule que le cours du blé lui permet de retrouver le taux normal de l’intérêt. Dans le cas contraire, il le dirige sur une industrie plus lucrative, et qui, par cela même, exerce sur les capitaux, dans l’intérêt social, une plus grande force d’attraction. Cette marche, qui est la vraie, arrive au même résultat et présente une harmonie de plus.
Le lecteur comprendra que je ne me suis renfermé dans un fait spécial que pour élucider une loi générale, à laquelle sont soumises toutes les professions.
Un avocat, par exemple, ne peut se faire rembourser les frais de son éducation, de son stage, de son premier établissement, — soit une vingtaine de mille francs, — par le premier plaideur qui lui tombe sous la main. Outre que ce serait inique, ce serait inexécutable ; jamais ce premier plaideur ne se présenterait, et notre Cujas serait réduit à imiter ce maître de maison qui, voyant que personne ne se rendait à son premier bal, disait : L’année prochaine je commencerai par le second.
Il en est ainsi du négociant, du médecin, de l’armateur, de l’artiste. En toute carrière, se rencontrent les deux catégories d’efforts ; la seconde exige impérieusement une répartition sur une clientèle indéterminée, et je défie qu’on puisse imaginer une telle répartition en dehors du mécanisme de l’intérêt.
Dans ces derniers temps, de grands efforts ont été faits pour soulever les répugnances populaires contre le capital, l’infâme, l’infernal capital ; on le représente aux masses comme un monstre dévorant et insatiable, plus destructeur que le choléra, plus effrayant que l’émeute, exerçant sur le corps social l’action d’un vampire dont la puissance de succion se multiplierait indéfiniment par elle-même. Vires acquirit eundo. La langue de ce monstre s’appelle Rente, Usure, Loyer, Fermage, Intérêt. Un écrivain, qui pouvait devenir célèbre par ses fortes facultés et qui a préféré l’être par ses paradoxes, s’est plu à jeter celui-là au milieu d’un peuple déjà tourmenté de la fièvre révolutionnaire. J’ai aussi un apparent paradoxe à soumettre au lecteur, et je le prie d’examiner s’il n’est pas une grande et consolante vérité.
Mais avant, je dois dire un mot de la manière dont M. Proudhon et son école expliquent ce qu’ils nomment l’illégitimité de l’intérêt.
Les capitaux sont des instruments de travail. Les instruments de travail ont pour destination de faire concourir les forces gratuites de la nature. Par la machine à vapeur on s’empare de l’élasticité des gaz ; par le ressort de montre, de l’élasticité de l’acier ; par des poids ou des chutes d’eau, de la gravitation ; par la pile de Volta, de la rapidité de l’étincelle électrique ; par le sol, des combinaisons chimiques et physiques qu’on appelle végétation, etc., etc. — Or, confondant l’Utilité avec la Valeur, on suppose que ces agents naturels ont une valeur qui leur est propre, et que par conséquent ceux qui s’en emparent s’en font payer l’usage, car valeur implique payement. On s’imagine que les produits sont grevés d’un item pour les services de l’homme, ce qu’on admet comme juste, et d’un autre item pour les services de la nature, ce qu’on repousse comme inique. Pourquoi, dit-on, faire payer la gravitation, l’électricité, la vie végétale, l’élasticité ? etc.
La réponse se trouve dans la théorie de la valeur. Cette classe de socialistes qui prennent le nom d’Égalitaires confond la légitime valeur de l’instrument, fille d’un service humain, avec son résultat utile, toujours gratuit, sous déduction de cette légitime valeur ou de l’intérêt y relatif. Quand je rémunère un laboureur, un meunier, une compagnie de chemin de fer, je ne donne rien, absolument rien, pour le phénomène végétal, pour la gravitation, pour l’élasticité de la vapeur. Je paye le travail humain qu’il a fallu consacrer à faire des instruments au moyen desquels ces forces sont contraintes à agir ; ou, ce qui vaut mieux pour moi, je paye l’intérêt de ce travail. Je rends service contre service, moyennant quoi l’action utile de ces forces est toute à mon profit et gratuitement. C’est comme dans l’échange, comme dans le simple troc. La présence du capital ne modifie pas cette loi, car le capital n’est autre chose qu’une accumulation de valeurs, de services auxquels est donnée la mission spéciale de faire coopérer la nature.
Et maintenant voir mon paradoxe :
De tous les éléments qui composent la valeur totale d’un produit quelconque, celui que nous devons payer le plus joyeusement, c’est cet élément même qu’on appelle intérêt des avances ou du capital.
Et pourquoi ? parce que cet élément ne nous fait payer un qu’en nous épargnant deux. Parce que, par sa présence même, il constate que des forces naturelles ont concouru au résultat final sans faire payer leur concours ; parce qu’il en résulte que la même utilité générale est mise à notre disposition, avec cette circonstance, qu’une certaine proportion d’utilité gratuite a été substituée, heureusement pour nous, à de l’utilité onéreuse, et, pour tout dire en un mot, parce que le produit a baissé de prix. Nous l’acquérons avec une moindre proportion de notre propre travail, et il arrive à la société tout entière ce qui arriverait à l’homme isolé qui aurait réalisé une ingénieuse invention.
Voici un modeste ouvrier qui gagne quatre francs par jour. Avec deux francs, c’est-à-dire avec une demi-journée de travail, il achète une paire de bas de coton. S’il voulait se procurer ces bas directement et par son propre travail, je crois vraiment que sa vie entière n’y suffirait pas. Comment se fait-il donc que sa demi-journée acquitte tous les services humains qui lui sont rendus en cette occasion ? D’après la loi Service pour service, comment n’est-il pas obligé de livrer plusieurs années de travail ?
C’est que cette paire de bas est le résultat de services humains dont les agents naturels, par l’intervention du Capital, ont énormément diminué la proportion. Notre ouvrier paye cependant, non-seulement le travail actuel de tous ceux qui ont concouru à l’œuvre, mais encore l’intérêt des capitaux qui y ont fait concourir la nature ; et ce qu’il faut remarquer, c’est que, sans cette dernière rémunération, ou si elle était tenue pour illégitime, le capital n’aurait pas sollicité les agents naturels, il n’y aurait dans le produit que de l’utilité onéreuse, il serait le résultat unique du travail humain, et notre ouvrier serait placé au point de départ, c’est-à-dire dans l’alternative ou de se priver de bas, ou de les payer au prix de plusieurs années de labeur.
Si notre ouvrier a appris à analyser les phénomènes, certes il se réconciliera avec le Capital en voyant combien il lui est redevable. Il se convaincra surtout que la gratuité des dons de Dieu lui a été complétement réservée, que ces dons lui sont même prodigués avec une libéralité qu’il ne doit pas à son propre mérite, mais au beau mécanisme de l’ordre social naturel. Le Capital, ce n’est pas la force végétative qui a fait germer et fleurir le coton, mais la peine prise par le planteur ; le Capital, ce n’est pas le vent qui a gonflé les voiles du navire, ni le magnétisme qui a agi sur la boussole, mais la peine prise par le voilier et l’opticien ; le Capital, ce n’est pas l’élasticité de la vapeur qui a fait tourner les broches de la fabrique, mais la peine prise par le constructeur de machines. Végétation, force des vents, magnétisme, élasticité, tout cela est certes gratuit ; et voilà pourquoi les bas ont si peu de valeur. Quant à cet ensemble de peines prises par le planteur, le voilier, l’opticien, le constructeur, le marin, le fabricant, le négociant, elles se répartissent, ou plutôt, en tant que c’est le Capital qui agit, l’intérêt s’en répartit entre d’innombrables acquéreurs de bas ; et voilà pourquoi la portion de travail cédée en retour par chacun d’eux est si petite.
En vérité, réformateurs modernes, quand vous voulez remplacer cet ordre admirable par un arrangement de votre invention, il y a deux choses (et elles n’en font qu’une) qui me confondent : votre manque de foi en la Providence et votre foi en vous-mêmes ; votre ignorance et votre orgueil.
De ce qui précède, il résulte que le progrès de l’humanité coïncide avec la rapide formation des Capitaux ; car dire que de nouveaux capitaux se forment, c’est dire en d’autres termes que des obstacles, autrefois onéreusement combattus par le travail, sont aujourd’hui gratuitement combattus par la nature ; et cela, remarquez-le bien, non au profit des capitalistes, mais au profit de la communauté.
S’il en est ainsi, l’intérêt dominant de tous les hommes (bien entendu au point de vue économique), c’est de favoriser la rapide formation du Capital. Mais le Capital s’accroît pour ainsi dire de lui-même sous la triple influence de l’activité, de la frugalité et de la sécurité. Nous ne pouvons guère exercer d’action directe sur l’activité et la frugalité de nos frères, si ce n’est par l’intermédiaire de l’opinion publique, par une intelligente dispensation de nos antipathies et de nos sympathies. Mais nous pouvons beaucoup pour la sécurité, sans laquelle les capitaux, loin de se former, se cachent, fuient, se détruisent ; et par là on voit combien il y a quelque chose qui tient du suicide dans cette ardeur que montre quelquefois la classe ouvrière à troubler la paix publique. Qu’elle le sache bien, le Capital travaille depuis le commencement à affranchir les hommes du joug de l’ignorance, du besoin, du despotisme. Effrayer le Capital, c’est river une triple chaîne aux bras de l’humanité.
Le vires acquirit eundo s’applique avec une exactitude rigoureuse au Capital et à sa bienfaisante influence. Tout capital qui se forme laisse nécessairement disponibles et du travail et de la rémunération pour ce travail. Il porte donc en lui-même une puissance de progression. Il y a en lui quelque chose qui ressemble à la loi des vitesses. — Et c’est là ce que la science a peut-être omis jusqu’à ce jour d’opposer à cette autre progression remarquée par Malthus. C’est une harmonie que nous ne pouvons traiter ici. Nous la réservons pour le chapitre de la Population.
Je dois prémunir le lecteur contre une objection spécieuse. Si la mission du capital, dira-t-il, est de faire exécuter par la nature ce qui s’exécutait par le travail humain, quelque bien qu’il confère à l’humanité, il doit nuire à la classe ouvrière, spécialement à celle qui vit de salaire ; car tout ce qui met des bras en disponibilité active la concurrence qu’ils se font entre eux, et c’est sans doute là la secrète raison de l’opposition que les prolétaires font aux capitalistes. — Si l’objection était fondée, il y aurait en effet un ton discordant dans l’harmonie sociale.
L’illusion consiste en ce qu’on perd de vue ceci : Le Capital, à mesure que son action s’étend, ne met en disponibilité une certaine quantité d’efforts humains qu’en mettant aussi en disponibilité une quantité de rémunération correspondante, de telle sorte que ces deux éléments se retrouvant, se satisfont l’un par l’autre. Le travail n’est pas frappé d’inertie ; remplacé dans une œuvre spéciale par l’énergie gratuite, il se prend à d’autres obstacles dans l’œuvre générale du progrès, avec d’autant plus d’infaillibilité que sa récompense est déjà toute préparée au sein de la communauté.
Et en effet, reprenant l’exemple ci-dessus, il est aisé de voir que le prix des bas (comme celui des livres, des transports et de toutes choses) ne baisse, sous l’action du capital, qu’en laissant entre les mains de l’acheteur une partie du prix ancien. C’est même là un pléonasme presque puéril ; l’ouvrier, qui paye 2 francs ce qu’il aurait payé 6 francs autrefois, a donc 4 francs en disponibilité. Or c’est justement dans cette proportion que le travail humain a été remplacé par des forces naturelles. Ces forces sont donc une pure et simple conquête, qui n’altère en rien le rapport du travail à la rémunération disponible. Que le lecteur veuille bien se rappeler que la réponse à cette objection avait été d’avance préparée (page 68 et suiv.), lorsque, observant l’homme dans l’isolement, ou bien réduit encore à la primitive loi du troc, je le mettais en garde contre l’illusion si commune que j’essaye ici de détruire.
Laissons donc sans scrupules les capitaux se créer, se multiplier suivant leurs propres tendances et celles du cœur humain. N’allons pas nous imaginer que lorsque le rude travailleur économise pour ses vieux jours, lorsque le père de famille songe à la carrière de son fils ou à la dot de sa fille, ils n’exercent cette noble faculté de l’homme, la Prévoyance, qu’au préjudice du bien général. Il en serait ainsi, les vertus privées seraient en antagonisme avec le bien public, s’il y avait incompatibilité entre le Capital et le Travail.
Loin que l’humanité ait été soumise à cette contradiction, disons plus, à cette impossibilité (car comment concevoir le mal progressif dans l’ensemble résultant du bien progressif dans les fractions ?), il faut reconnaître qu’au contraire la Providence, dans sa justice et sa bonté, a réservé, dans le progrès, une plus belle part au Travail qu’au Capital, un stimulant plus efficace, une récompense plus libérale à celui qui verse actuellement la sueur de son front, qu’à celui qui vit sur la sueur de ses pères.
En effet, étant admis que tout accroissement de capital est suivi d’un accroissement nécessaire de bien-être général, j’ose poser comme inébranlable, quant à la distribution de ce bien-être, l’axiome suivant :
« À mesure que les capitaux s’accroissent, la part absolue des capitalistes dans les produits totaux augmente et leur part relative diminue. Au contraire, les travailleurs voient augmenter leur part dans les deux sens. »
Je ferais mieux comprendre ma pensée par des chiffres.
Représentons les produits totaux de la société, à des époques successives, par les chiffres 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, etc.
Je dis que le prélèvement du capital descendra successivement de 50 p. 100 à 40, 35, 30 p. 100, et celui du travail s’élèvera par conséquent de 50. p. 100 à 60, 65, 70 p. 100. — De telle sorte néanmoins que la part absolue du capital soit toujours plus grande à chaque période, bien que sa part relative soit plus petite.
Ainsi le partage se fera de la manière suivante :
| Produit total. | Part du capital. | Part du travail. | |
| Première période… | 1000 | 500 | 500 |
| Deuxième période… | 2000 | 800 | 1200 |
| Troisième période… | 3000 | 1050 | 1950 |
| Quatrième période… | 4000 | 1200 | 2800 |
Telle est la grande, admirable, consolante, nécessaire et inflexible loi du capital. La démontrer c’est, ce me semble, frapper de discrédit ces déclamations dont on nous rebat les oreilles depuis si longtemps contre l’avidité, la tyrannie du plus puissant instrument de civilisation et d’égalisation qui sorte des facultés humaines.
Cette démonstration se divise en deux. Il faut prouver d’abord que la part relative du capital va diminuant sans cesse.
Ce ne sera pas long, car cela revient à dire : Plus les capitaux abondent, plus l’intérêt baisse. Or c’est un point de fait incontestable et incontesté. Non-seulement la science l’explique, mais il crève les yeux. Les Écoles les plus excentriques l’admettent ; celle qui s’est spécialement posée comme l’adversaire de l’infernal capital, en fait la base de sa théorie, car c’est de cette baisse visible de l’intérêt qu’elle conclut à son anéantissement fatal ; or, dit-elle, puisque cet anéantissement est fatal, puisqu’il doit arriver dans un temps donné, puisqu’il implique la réalisation du bien absolu, il faut le hâter et le décréter. — Je n’ai pas à réfuter ici ces principes et les inductions qu’on en tire. Je constate seulement que toutes les Écoles économistes, socialistes, égalitaires et autres, admettent, en point de fait, que, dans l’ordre naturel des sociétés, l’intérêt baisse d’autant plus que les capitaux abondent davantage. Leur plût-il de ne point l’admettre, le fait n’en serait pas moins assuré. Le fait a pour lui l’autorité du genre humain et l’acquiescement, involontaire peut-être, de tous les capitalistes du monde. Il est de fait que l’intérêt des capitaux est moins élevé en Espagne qu’au Mexique, en France qu’en Espagne, en Angleterre qu’en France, et en Hollande qu’en Angleterre. Or, quand l’intérêt descend de 20 p. 100 à 15 p. 100, et puis à 10, à 8, à 6, à 5, à 4 1/2, à 4, à 3 1/2, à 3 p. 100, qu’est-ce que cela veut dire relativement à la question qui nous occupe ? Cela veut dire que le capital, pour son concours, dans l’œuvre industrielle, à la réalisation du bien-être, se contente, ou, si l’on veut, est forcé de se contenter d’une part de plus en plus réduite à mesure qu’il s’accroît. Entrait-il pour un tiers dans la valeur du blé, des maisons, des lins, des navires, des canaux ? en d’autres termes, quand on vendait ces choses, revenait-il un tiers aux capitalistes et deux tiers aux travailleurs ? Peu à peu les capitalistes ne reçoivent plus qu’un quart, un cinquième, un sixième ; leur part relative va décroissant ; celle des travailleurs augmente dans la même proportion, et la première partie de ma démonstration est faite.
Il me reste à prouver que la part absolue du capital s’accroît sans cesse. Il est bien vrai que l’intérêt tend à baisser. Mais quand et pourquoi ? Quand et parce que le capital augmente. Il est donc fort possible que le produit total s’accroisse, bien que le percentage diminue, Un homme a plus de rentes avec 200,000 francs à 4 p. 100 qu’avec 100,000 francs à 5 p. 100, encore que, dans le premier cas, il fasse payer moins cher aux travailleurs l’usage du capital. Il en est de même d’une nation et de l’humanité tout entière. Or je dis que le percentage dans sa tendance à baisser, ne doit ni ne peut suivre une progression tellement rapide que la somme totale des intérêts soit moins grande alors que les capitaux abondent que lorsqu’ils sont rares. J’admets bien que si le capital de l’humanité est représenté par 100 et l’intérêt par 5, — cet intérêt ne sera plus que 4 alors que le capital sera monté à 200. — Ici l’on voit la simultanéité des deux effets. Moindre part relative, plus grande part absolue. — Mais je n’admets pas, dans l’hypothèse, que l’élévation du capital de 100 à 200 puisse faire tomber l’intérêt de 5 p. 100 à 2 p. 100, par exemple. — Car, s’il en était ainsi, le capitaliste qui avait 5,000 francs de rentes avec 100,000 francs de capital, n’aurait plus que 4,000 francs de rentes avec 200,000 de capital. — Résultat contradictoire et impossible, anomalie étrange qui rencontrerait le plus simple et le plus agréable de tous les remèdes ; car alors, pour augmenter ses rentes, il suffirait de manger la moitié de son capital. Heureuse et bizarre époque où il nous sera donné de nous enrichir en nous appauvrissant !
Il ne faut donc pas perdre de vue que la combinaison de ces deux faits corrélatifs : accroissement du capital, abaissement de l’intérêt, s’accomplit nécessairement de telle façon que le produit total augmente sans cesse.
Et, pour le dire en passant, ceci détruit d’une manière radicale et absolue l’illusion de ceux qui s’imaginent que parce que l’intérêt baisse il tend à s’anéantir. Il en résulterait qu’un jour viendra où le capital se sera tellement développé qu’il ne donnera plus rien à ses possesseurs. Qu’on se tranquillise ; avant ce temps-là, ceux-ci se hâteront de dissiper le fonds pour faire reparaître le revenu.
Ainsi la grande loi du Capital et du Travail, en ce qui concerne le partage du produit de la collaboration, est déterminée. Chacun d’eux a une part absolue de plus en plus grande, mais la part proportionnelle du Capital diminue sans cesse comparativement à celle du Travail.
Cessez donc, capitalistes et ouvriers, de vous regarder d’un œil de défiance et d’envie. Fermez l’oreille à ces déclamations absurdes, dont rien n’égale l’orgueil si ce n’est l’ignorance, qui, sous promesse d’une philanthropie en perspective, commencent par soulever la discorde actuelle. Reconnaissez que vos intérêts sont communs, identiques, quoi qu’on en dise, qu’ils se confondent, qu’ils tendent ensemble vers la réalisation du bien général, que les sueurs de la génération présente se mêlent aux sueurs des générations passées, qu’il faut bien qu’une part de rémunération revienne à tous ceux qui concourent à l’œuvre, et que la plus ingénieuse comme la plus équitable répartition s’opère entre vous, par la sagesse des lois providentielles, sous l’empire de transactions libres et volontaires, sans qu’un Sentimentalisme parasite vienne vous imposer ses décrets aux dépens de votre bien-être, de votre liberté, de votre sécurité et de votre dignité.
Le Capital a sa racine dans trois attributs de l’homme : la Prévoyance, l’Intelligence et la Frugalité. Pour se déterminer à former un capital, il faut en effet prévoir l’avenir, lui sacrifier le présent, exercer un noble empire sur soi-même et sur ses appétits, résister non-seulement à l’appât des jouissances actuelles, mais encore aux aiguillons de la vanité et aux caprices de l’opinion publique, toujours si partiale envers les caractères insouciants et prodigues. Il faut encore lier les effets aux causes, savoir par quels procédés, par quels instruments la nature se laissera dompter et assujettir à l’œuvre de la production. Il faut surtout être animé de l’esprit de famille, et ne pas reculer devant des sacrifices dont le fruit sera recueilli par les êtres chéris qu’on laissera après soi. Capitaliser, c’est préparer le vivre, le couvert, l’abri, le loisir, l’instruction, l’indépendance, la dignité aux générations futures. Rien de tout cela ne se peut faire sans mettre en exercice les vertus les plus sociales, qui plus est, sans les convertir en habitudes.
Il est cependant bien commun d’attribuer au Capital une sorte d’efficace funeste, dont l’effet serait d’introduire l’égoïsme, la dureté, le machiavélisme dans le cœur de ceux qui y aspirent ou le possèdent. Mais ne fait-on pas confusion ? Il y a des pays où le travail ne mène pas à grand’chose. Le peu qu’on gagne, il faut le partager avec le fisc. Pour vous arracher le fruit de vos sueurs, ce qu’on nomme l’État vous enlace d’une multitude d’entraves. Il intervient dans tous vos actes, il se mêle de toutes vos transactions ; il régente votre intelligence et votre foi ; il déplace tous les intérêts, et met chacun dans une position artificielle et précaire ; il énerve l’activité et l’énergie individuelle en s’emparant de la direction de toutes choses ; il fait retomber la responsabilité des actions sur ceux à qui elle ne revient pas ; en sorte que, peu à peu, la notion du juste et de l’injuste s’efface ; il engage la nation, par sa diplomatie, dans toutes les querelles du monde, et puis il y fait intervenir la marine et l’armée ; il fausse autant qu’il est en lui l’intelligence des masses sur les questions économiques, car il a besoin de leur faire croire que ses folles dépenses, ses injustes agressions, ses conquêtes, ses colonies, sont pour elles une source de richesses. Dans ces pays le capital a beaucoup de peine à se former par les voies naturelles. Ce à quoi l’on aspire surtout, c’est à le soutirer par la force et par la ruse à ceux qui l’ont crée. Là, on voit les hommes s’enrichir par la guerre, les fonctions publiques, le jeu, les fournitures, l’agiotage, les fraudes commerciales, les entreprises hasardées, les marchés publics, etc. Les qualités requises pour arracher ainsi le capital aux mains de ceux qui le forment sont précisément l’opposé de celles qui sont nécessaires pour le former. Il n’est donc pas surprenant que dans ces pays-là il s’établisse une sorte d’association entre ces deux idées : capital et égoïsme ; et cette association devient indestructible, si toutes les idées morales de ce pays se puisent dans l’histoire de l’antiquité et du moyen âge.
Mais lorsqu’on porte sa pensée, non sur la soustraction des capitaux, mais sur leur formation par l’activité intelligente, la prévoyance et la frugalité, il est impossible de ne pas reconnaître qu’une vertu sociale et moralisante est attachée à leur acquisition.
S’il y a de la sociabilité morale dans la formation du capital, il n’y en a pas moins dans son action. Son effet propre est de faire concourir la nature ; de décharger l’homme de ce qu’il y a de plus matériel, de plus musculaire, de plus brutal dans l’œuvre de la production ; de faire prédominer de plus en plus le principe intelligent ; d’agrandir de plus en plus la place, je ne dis pas de l’oisiveté, mais du loisir ; de rendre de moins en moins impérieuse, par la facilité de la satisfaction, la voix des besoins grossiers, et d’y substituer des jouissances plus élevées, plus délicates, plus pures, plus artistiques, plus spirituelles.
Ainsi, à quelque point de vue qu’on se place, qu’on considère le Capital dans ses rapports avec nos besoins qu’il ennoblit, avec nos efforts qu’il soulage, avec nos satisfactions qu’il épure, avec la nature qu’il dompte, avec la moralité qu’il change en habitude, avec la sociabilité qu’il développe, avec l’égalité qu’il provoque, avec la liberté dont il vit, avec l’équité qu’il réalise par les procédés les plus ingénieux, partout, toujours et à la condition qu’il se forme et agisse dans un ordre social qui ne soit pas détourné de ses voies naturelles, nous reconnaîtrons en lui ce qui est le cachet de toutes les grandes lois providentielles : l’Harmonie.
VIII. Propriété, Communauté↩
Reconnaissant à la terre, aux agents naturels, aux instruments de travail, ce qui est incontestablement en eux : le don d’engendrer l’Utilité, je me suis efforcé de leur arracher ce qui leur a été faussement attribué : la faculté de créer de la Valeur, faculté qui n’appartient qu’aux Services que les hommes échangent entre eux.
Cette rectification si simple, en même temps qu’elle raffermira la propriété en lui restituant son véritable caractère, révèlera à la science un fait prodigieux, et, si je ne me trompe, par elle encore inaperçu le fait d’une Communauté réelle, essentielle, progressive, résultat providentiel de tout ordre social qui a pour régime la Liberté, et dont l’évidente destination est de conduire, comme des frères, tous les hommes, de l’Égalité primitive, celle du dénûment et de l’ignorance, vers l’Égalité finale dans la possession du bien-être et de la vérité.
Si cette radicale distinction entre l’Utilité des choses et la Valeur des services est vraie en elle-même ainsi que dans ses déductions, il n’est pas possible qu’on en méconnaisse la portée ; car elle ne va à rien moins qu’à l’absorption de l’utopie dans la science, et à réconcilier les écoles antagoniques dans une commune foi qui donne satisfaction à toutes les intelligences comme à toutes les aspirations.
Hommes de propriété et de loisir, à quelque degré de l’échelle sociale que vous soyez parvenus à force d’activité, de probité, d’ordre, d’économie, d’où vient le trouble qui vous a saisis ? Ah ! voici que le souffle parfumé mais empoisonné de l’Utopie menace votre existence. On dit, on vocifère que le bien par vous amassé pour assurer un peu de repos à votre vieillesse, du pain, de l’instruction et une carrière à vos enfants, vous l’avez acquis aux dépens de vos frères ; on dit que vous êtes placés entre les dons de Dieu et les pauvres ; que, comme des collecteurs avides, vous avez prélevé, sous le nom de Propriété, Intérêt, Rente, Loyer, une taxe sur ces dons ; que vous avez intercepté, pour les vendre, les bienfaits que le Père commun avait prodigués à tous ses enfants ; on vous appelle à restituer, et ce qui augmente votre effroi, c’est que dans la défense de vos avocats se trouve trop souvent cet aveu implicite : l’usurpation est flagrante, mais elle est nécessaire. Et moi je dis : Non, vous n’avez pas intercepté les dons de Dieu. Vous les avez gratuitement recueillis des mains de la nature, c’est vrai ; mais aussi vous les avez gratuitement transmis à vos frères sans en rien réserver. Ils ont agi de même envers vous, et les seules choses qui aient été réciproquement compensées, ce sont les efforts physiques ou intellectuels, les sueurs répandues, les dangers bravés, l’habileté déployée, les privations acceptées, la peine prise, les services reçus et rendus. Vous n’avez peut-être songé qu’à vous, mais votre intérêt personnel même a été l’instrument d’une Providence infiniment prévoyante et sage pour élargir sans cesse, au sein du genre humain, le domaine de la Communauté ; car, sans vos efforts, tous ces effets utiles que vous avez sollicités de la nature pour les répandre, sans rémunération, parmi les hommes, seraient restés dans une éternelle inertie. Je dis : sans rémunération, parce que celle que vous avez reçue n’est qu’une simple restitution de vos efforts, et non point du tout le prix des dons de Dieu. Vivez donc en paix, sans crainte et sans scrupule. Vous n’avez d’autre Propriété au monde que votre droit à des services, en échange de services par vous loyalement rendus, par vos frères volontairement acceptés. Cette propriété-là est légitime, inattaquable ; aucune utopie ne prévaudra contre elle, car elle se combine et se confond avec l’essence même de notre nature. Aucune théorie ne parviendra jamais ni à l’ébranler ni à la flétrir.
Hommes de labeur et de privations, vous ne pouvez fermer les yeux sur cette vérité que le point de départ du genre humain est une entière Communauté, une parfaite Égalité de misère, de dénûment et d’ignorance. Il se rachète à la sueur de son front, et se dirige vers une autre Communauté, celle des dons de Dieu successivement obtenus avec de moindres efforts ; vers une autre Égalité, celle du bien-être, des lumières et de la dignité morale. Oui, les pas des hommes sur cette route de perfectibilité sont inégaux, et vous ne pourriez vous en plaindre qu’autant que la marche plus précipitée de l’avant-garde fût de nature à retarder la vôtre. Mais c’est tout le contraire. Il ne jaillit pas une étincelle dans une intelligence qui n’éclaire à quelque degré votre intelligence ; il ne s’accomplit pas un progrès, sous le mobile propriétaire, qui ne soit pour vous un progrès ; il ne se forme pas une richesse qui ne tende à votre affranchissement, pas un capital qui n’augmente la proportion de vos jouissances à votre travail, pas une acquisition qui ne soit pour vous une facilité d’acquisition, pas une Propriété dont la mission ne soit d’élargir, à votre profit, le domaine de la Communauté. L’ordre social naturel a été si artistement arrangé par le divin Ouvrier, que les plus avancés dans la voie de la rédemption vous tendent une main secourable, volontairement ou à leur insu, qu’ils en aient ou non la conscience ; car il a disposé les choses de telle sorte qu’aucun homme ne peut travailler honnêtement pour lui-même sans travailler en même temps pour tous. Et il est rigoureusement vrai de dire que toute atteinte portée à cet ordre merveilleux ne serait pas seulement de votre part un homicide, mais un suicide. L’humanité est une chaîne admirable où s’accomplit ce miracle, que les premiers chaînons communiquent à tous les autres un mouvement progressif de plus en plus rapide jusqu’au dernier.
Hommes de philanthropie, amants de l’égalité, aveugles défenseurs, dangereux amis de ceux qui souffrent attardés sur la route de la civilisation, vous qui cherchez le règne de la Communauté en ce monde, pourquoi commencez-vous par ébranler les intérêts et les consciences ? Pourquoi, dans votre orgueil, aspirez-vous à ployer toutes les volontés sous le joug de vos inventions sociales ? Cette Communauté après laquelle vous soupirez, comme devant étendre le royaume de Dieu sur la terre, ne voyez-vous pas que Dieu lui-même y a songé et pourvu ? qu’il ne vous a pas attendus pour en faire le patrimoine de ses enfants ? qu’il n’a pas besoin de vos conceptions ni de vos violences ? qu’elle se réalise tous les jours en vertu de ses admirables décrets ? que pour l’exécution de sa volonté, il ne s’en est rapporté ni à la contingence de vos puérils arrangements, ni même à l’expression croissante du principe sympathique manifesté par la charité ; mais qu’il a confié la réalisation de ses desseins à la plus active, à la plus intime, à la plus permanente de nos énergies, l’Intérêt personnel, sûr que celle-là ne se repose jamais ? Étudiez donc le mécanisme social, tel qu’il est sorti des mains du grand Mécanicien ; vous resterez convaincus qu’il témoigne d’une universelle sollicitude qui laisse bien loin derrière elle vos rêves et vos chimères. Peut-être alors, au lieu de prétendre refaire l’œuvre divine, vous vous contenterez de la bénir.
Ce n’est pas à dire qu’il n’y ait pas de place sur cette terre pour les réformes et les réformateurs. Ce n’est pas à dire que l’humanité ne doive appeler de ses vœux, encourager de sa reconnaissance les hommes d’investigation, de science et de dévouement, les cœurs fidèles à la démocratie. Ils ne lui sont encore que trop nécessaires, non point pour renverser les lois sociales, mais, au contraire, pour combattre les obstacles artificiels qui en troublent et pervertissent l’action. En vérité, il est difficile de comprendre comment on répète sans cesse ces banalités : « L’économie politique est optimiste quant aux faits accomplis ; elle affirme que ce qui doit être est ; à l’aspect du mal comme à l’aspect du bien, elle se contente de dire : laissez faire. » Quoi ! nous ignorerions que le point de départ de l’humanité est la misère, l’ignorance, le règne de la force brutale, ou nous serions optimistes à l’égard de ces faits accomplis ! Quoi ! nous ignorerions que le moteur des êtres humains est l’aversion de toute douleur, de toute fatigue, et que, le travail étant une fatigue, la première manifestation de l’intérêt personnel parmi les hommes a été de s’en rejeter les uns aux autres le pénible fardeau ! Les mots Anthropophagie, Guerre, Esclavage, Privilége, Monopole, Fraude, Spoliation, Imposture, ne seraient jamais parvenus à notre oreille, ou nous verrions dans ces abominations des rouages nécessaires à l’œuvre du progrès ! Mais n’est-ce pas un peu volontairement que l’on confond ainsi toutes choses pour nous accuser de les confondre ? Quand nous admirons la loi providentielle des transactions, quand nous disons que les intérêts concordent, quand nous en concluons que leur gravitation naturelle tend à réaliser l’égalité relative et le progrès général, apparemment c’est de l’action de ces lois et non de leur perturbation que nous attendons l’harmonie. Quand nous disons : laissez faire, apparemment nous entendons dire : laissez agir ces lois, et non pas : laissez troubler ces lois. Selon qu’on s’y conforme ou qu’on les viole, le bien ou le mal se produisent ; en d’autres termes, les intérêts sont harmoniques, pourvu que chacun reste dans son droit, pourvu que les services s’échangent librement, volontairement, contre les services. Mais est-ce à dire que nous ignorons la lutte perpétuelle du Tort contre le Droit ? Est-ce à dire que nous perdons de vue ou que nous approuvons les efforts qui se sont faits en tous temps et qui se font encore pour altérer, par la force ou la ruse, la naturelle équivalence des services ? C’est là justement ce que nous repoussons sous le nom de violation des lois sociales providentielles, sous le nom d’attentats à la propriété ; car, pour nous, libre échange de services, justice, propriété, liberté, sécurité, c’est toujours la même idée sous divers aspects. Ce n’est pas le principe de la propriété qu’il faut combattre, mais, au contraire, le principe antagonique, celui de la spoliation. Propriétaires à tous les degrés, réformateurs de toutes les écoles, c’est là la mission qui doit nous concilier et nous unir.
Et il est temps, il est grand temps que cette croisade commence. La guerre théorique à la Propriété n’est ni la plus acharnée ni la plus dangereuse. Il y a contre elle, depuis le commencement du monde, une conspiration pratique qui n’est pas près de cesser. Guerre, esclavage, imposture, taxes abusives, monopoles, priviléges, fraudes commerciales, colonies, droit au travail, droit au crédit, droit à l’assistance, droit à l’instruction, impôts progressifs en raison directe ou en raison inverse des facultés, autant de béliers qui frappent à coups redoublés la colonne chancelante ; et pourrait-on bien me dire s’il y a beaucoup d’hommes en France, même parmi ceux qui se croient conservateurs, qui ne mettent la main, sous une forme ou sous une autre, à l’œuvre de destruction ?
Il y a des gens aux yeux de qui la Propriété n’apparaît jamais que sous l’apparence d’un champ ou d’un sac d’écus. Pourvu qu’on ne déplace pas les bornes sacrées et qu’on ne vide pas matériellement les poches, les voilà fort rassurés.
Mais n’y a-t-il pas la Propriété des bras, celle des facultés, celle des idées, n’y a-t-il pas, en un mot, la Propriété des services ? Quand je jette un service dans le milieu social, n’est-ce pas mon droit qu’il s’y tienne, si je puis m’exprimer ainsi, en suspension, selon les lois de sa naturelle équivalence ? qu’il y fasse équilibre à tout autre service qu’on consent à me céder en échange ? Nous avons, d’un commun accord, institué une force publique pour protéger la propriété ainsi comprise. Où en sommes-nous donc si cette force même croit avoir et se donne la mission de troubler cet équilibre, sous le prétexte socialiste que le monopole naît de la liberté, que le laissez-faire est odieux et sans entrailles ? Quand les choses vont ainsi, le vol individuel peut être rare, sévèrement réprimé, mais la spoliation est organisée, légalisée, systématisée. Réformateurs, rassurez-vous, votre œuvre n’est pas terminée ; tâchez seulement de la comprendre.
Mais, avant d’analyser la spoliation publique ou privée, légale ou illégale, son rôle dans le monde, sa portée comme élément du problème social, il faut nous faire, s’il est possible, des idées justes sur la communauté et la Propriété : car, ainsi que nous allons le voir, la spoliation n’est autre chose que la limite de la propriété, comme la propriété est la limite de la communauté.
Des chapitres précédents et notamment de celui où il a été traité de l’Utilité et de la Valeur, nous pouvons déduire cette formule :
Tout homme jouit gratuitement de toutes les utilités fournies ou élaborées par la nature, à la condition de prendre la peine de les recueillir ou de restituer un service équivalent à ceux qui lui rendent le service de prendre cette peine pour lui.
Il y a là deux faits combinés, fondus ensemble, quoique distincts par leur essence.
Il y a les dons naturels, les matériaux gratuits, les forces gratuites ; c’est le domaine de la Communauté.
Il y a de plus les efforts humains consacrés à recueillir ces matériaux, à diriger ces forces ; efforts qui s’échangent, s’évaluent et se compensent ; c’est le domaine de la Propriété.
En d’autres termes, à l’égard les uns des autres, nous ne sommes pas propriétaires de l’Utilité des choses, mais de leur valeur, et la valeur n’est que l’appréciation des services réciproques.
Propriété, communauté, sont deux idées corrélatives à celles d’onérosité et de gratuité, d’où elles procèdent.
Ce qui est gratuit est commun, car chacun en jouit et est admis à en jouir sans conditions.
Ce qui est onéreux est approprié, parce qu’une peine à prendre est la condition de la satisfaction, comme la satisfaction est la raison de la peine prise.
L’échange intervient-il ? il s’accomplit par l’évaluation de deux peines ou de deux services.
Ce recours à une peine implique l’idée d’un Obstacle. On peut donc dire que l’objet cherché se rapproche d’autant plus de la gratuité et de la communauté que l’Obstacle est moindre, puisque, d’après nos prémisses, l’absence complète de l’obstacle entraîne la gratuité et la communauté parfaites.
Or devant le genre humain progressif et perfectible, l’obstacle ne peut jamais être considéré comme une quantité invariable et absolue. Il s’amoindrit. Donc la peine s’amoindrit avec lui, — et le service avec la peine, — et la valeur avec le service, — et la propriété avec la valeur.
Et l’Utilité reste la même : — donc la gratuité et la communauté ont gagné tout ce que l’onérosité et la propriété ont perdu.
Pour déterminer l’homme au travail, il faut un mobile ; ce mobile, c’est la satisfaction qu’il a en vue, ou l’utilité. Sa tendance incontestable et indomptable, c’est de réaliser la plus grande satisfaction possible avec le moindre travail possible, c’est de faire que la plus grande utilité corresponde à la plus petite propriété, — d’où il suit que la mission de la Propriété ou plutôt de l’esprit de propriété est de réaliser de plus en plus la Communauté.
Le point de départ du genre humain étant le maximum de la misère, ou le maximum d’obstacles à vaincre, il est clair que tout ce qu’il gagne d’une époque à l’autre, il le doit à l’esprit de propriété.
Les choses étant ainsi, se rencontrera-t-il dans le monde entier un seul adversaire théorique de la propriété ? Ne voit-on pas qu’il ne se peut imaginer une force sociale à la fois plus juste et plus démocratique ? Le dogme fondamental de Proudhon lui-même est la mutualité des services. Nous sommes d’accord là-dessus. En quoi nous différons, c’est en ceci : ce dogme, je l’appelle propriété, parce qu’en creusant le fond des choses, je m’assure que les hommes, s’ils sont libres, n’ont et ne peuvent avoir d’autre propriété que celle de la valeur ou de leurs services. Au contraire, Proudhon, ainsi que la plupart des économistes, pense que certains agents naturels ont une valeur qui leur est propre, et qu’ils sont par conséquent appropriés. Mais quant à la propriété des services, loin de la contester, elle est toute sa foi. Y a-t-il quelqu’un qui veuille encore aller au-delà ? Ira-t-on jusqu’à dire qu’un homme ne doit pas être propriétaire de sa propre peine ? que, dans l’échange, ce n’est pas assez de céder gratuitement la coopération des agents naturels, il faut encore céder gratuitement ses propres efforts ? Mais qu’on y prenne garde ! ce serait glorifier l’esclavage ; car, dire que certains hommes doivent rendre, c’est dire que certains autres doivent recevoir des services non rémunérés, ce qui est bien l’esclavage. Que si l’on dit que cette gratuité doit être réciproque, on articule une logomachie incompréhensible ; car, ou il y aura quelque justice dans l’échange, et alors les services seront, de manière ou d’autre, évalués et compensés ; ou ils ne seront pas évalués et compensés, et, en ce cas, les uns en rendront beaucoup, les autres peu, et nous retombons dans l’esclavage.
Il est donc impossible de contester la légitime Propriété des services échangés sur le principe de l’équivalence. Pour expliquer cette légitimité, nous n’avons besoin ni de philosophie, ni de science du droit, ni de métaphysique. Socialistes, Économistes, Égalitaires, Fraternitaires, je vous défie, tous tant que vous êtes, d’élever même l’ombre d’une objection contre la légitime mutualité des services volontaires, par conséquent contre la propriété, telle que je l’ai définie, telle qu’elle existe dans l’ordre social naturel.
Certes, je le sais, dans la pratique, la Propriété est encore loin de régner sans partage ; en face d’elle il y a le fait antagonique ; il y a des services qui ne sont pas volontaires, dont la rémunération n’est pas librement débattue ; il y a des services dont l’équivalence est altérée par la force ou par la ruse ; en un mot, il y a la Spoliation. Le légitime principe de la Propriété n’en est pas infirmé, mais confirmé ; on le viole, donc il existe. Ou il ne faut croire à rien dans le monde, ni aux faits, ni à la justice, ni à l’assentiment universel, ni au langage humain, ou il faut admettre que ces deux mots, Propriété et Spoliation, expriment des idées opposées, inconciliables qu’on ne peut pas plus identifier qu’on ne peut identifier le oui avec le non, la lumière avec les ténèbres, le bien avec le mal, l’harmonie avec la discordance. Prise au pied de la lettre, la célèbre formule : la propriété, c’est le vol, est donc l’absurdité portée à sa dernière puissance. Il ne serait pas plus exorbitant de dire : le vol, c’est la propriété ; le légitime est illégitime ; ce qui est n’est pas, etc. Il est probable que l’auteur de ce bizarre aphorisme a voulu saisir fortement les esprits, toujours curieux de voir comment on justifie un paradoxe, et qu’au fond ce qu’il voulait exprimer, c’est ceci : Certains hommes se font payer, outre le travail qu’ils ont fait, le travail qu’ils n’ont pas fait, s’appropriant ainsi exclusivement les dons de Dieu, l’utilité gratuite, le bien de tous. — En ce cas, il fallait d’abord prouver l’assertion, et puis dire : le vol, c’est le vol.
Voler, dans le langage ordinaire, signifie : s’emparer par force ou par fraude d’une valeur au préjudice et sans le consentement de celui qui l’a créée. On comprend comment la fausse économie politique a pu étendre le sens de ce triste mot, voler.
On a commencé par confondre l’Utilité avec la Valeur. Puis, comme la nature coopère à la création de l’utilité, on en a conclu qu’elle concourait à la création de la valeur, et on a dit : Cette portion de valeur, n’étant le fruit du travail de personne, appartient à tout le monde. Enfin, remarquant que la valeur ne se cède jamais sans rémunération, on a ajouté : Celui-là vole qui se fait rétribuer pour une valeur qui est de création naturelle, qui est indépendante de tout travail humain, qui est inhérente aux choses, et est, par destination providentielle, une de leurs qualités intrinsèques, comme la pesanteur ou la porosité, la forme ou la couleur.
Une exacte analyse de la valeur renverse cet échafaudage de subtilités, d’où l’on voudrait déduire une assimilation monstrueuse entre la Spoliation et la Propriété.
Dieu a mis des Matériaux et des Forces à la disposition des hommes. Pour s’emparer de ces matériaux et de ces forces, il faut une Peine ou il n’en faut pas. S’il ne faut aucune peine, nul ne consentira librement à acheter d’autrui, moyennant un effort, ce qu’il peut recueillir sans effort des mains de la nature. Il n’y a là ni services, ni échange, ni valeur, ni propriété possibles. S’il faut une peine, en bonne justice elle incombe à celui qui doit éprouver la satisfaction, d’où il suit que la satisfaction doit aboutir à celui qui a pris la peine. Voilà le principe de la Propriété. Cela posé, un homme prend la peine pour lui-même ; il devient propriétaire de toute l’utilité réalisée par le concours de cette peine et de la nature. Il la prend pour autrui ; en ce cas, il stipule en retour la cession d’une peine équivalente servant aussi de véhicule à de l’utilité, et le résultat nous montre deux Peines, deux Utilités qui ont changé de mains, et deux Satisfactions. Mais ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que la transaction s’accomplit par la comparaison, par l’évaluation, non des deux utilités (elles sont inévaluables), mais des deux services échangés. Il est donc exact de dire qu’au point de vue personnel, l’homme, par le travail, devient propriétaire de l’utilité naturelle (il ne travaille que pour cela), quel que soit le rapport, variable à l’infini, du travail à l’utilité. Mais au point de vue social, à l’égard les uns des autres, les hommes ne sont jamais propriétaires que de la valeur, laquelle n’a pas pour fondement la libéralité de la nature, mais le service humain, la peine prise, le danger couru, l’habileté déployée pour recueillir cette libéralité ; en un mot, en ce qui concerne l’utilité naturelle et gratuite, le dernier acquéreur, celui à qui doit aboutir la satisfaction, est mis, par l’échange, exactement au lieu et place du premier travailleur. Celui-ci s’était trouvé en présence d’une utilité gratuite qu’il s’est donné la peine de recueillir ; celui-là lui restitue une peine équivalente, et se substitue ainsi à tous ses droits ; l’utilité lui est acquise au même titre, c’est-à-dire à titre gratuit sous la condition d’une peine. Il n’y a là ni le fait ni l’apparence d’une interception abusive des dons de Dieu.
Ainsi j’ose dire que cette proposition est inébranlable :
À l’égard les uns des autres, les hommes ne sont propriétaires que de valeurs, et les valeurs ne représentent que des services comparés, librement reçus et rendus.
Que d’un côté ce soit là le vrai sens du mot valeur, c’est ce que j’ai déjà démontré (chapitre V) ; que d’autre part les hommes ne soient jamais et ne puissent jamais être, à l’égard les uns des autres, propriétaires que de la valeur, c’est ce qui résulte aussi bien du raisonnement que de l’expérience. Du raisonnement ; car comment irais-je acheter d’un homme, moyennant une peine, ce que je puis sans peine, ou avec une moindre peine, obtenir de la nature ? De l’expérience universelle, qui n’est pas d’un poids à dédaigner dans la question, rien n’étant plus propre à donner confiance à une théorie que le consentement raisonné et pratique des hommes de tous les temps et de tous les pays. Or je dis que le consentement universel ratifie le sens que je donne ici au mot Propriété. Quand l’officier public fait un inventaire après décès, ou par autorité de justice ; quand le négociant, le manufacturier, le fermier, font, pour leur propre compte, la même opération, ou qu’elle est confiée aux syndics d’une faillite, qu’inscrit-on sur les rôles timbrés à mesure qu’un objet se présente ? Est-ce son utilité, son mérite intrinsèque ? Non, c’est sa valeur ; c’est-à-dire l’équivalent de la peine que tout acheteur, pris au hasard, devrait prendre pour se procurer un objet semblable. Les experts s’occupent-ils de savoir si telle chose est plus utile que telle autre ? Se placent-ils au point de vue des satisfactions qu’elles peuvent procurer ? Estiment-ils un marteau plus qu’une chinoiserie, parce que le marteau fait tourner d’une manière admirable, au profit de son possesseur, la loi de gravitation ? ou bien un verre d’eau plus qu’un diamant, parce que, d’une manière absolue, il peut rendre de plus réels services ? ou le livre de Say plus que celui de Fourier, parce qu’on peut puiser dans le premier plus de sérieuses jouissances et de solide instruction ? Non ; ils évaluent, ils relèvent la valeur, en se conformant rigoureusement, remarquez-le bien, à ma définition. — Pour mieux dire, c’est ma définition qui se conforme à leur pratique. — Ils tiennent compte, non point des avantages naturels ou de l’utilité gratuite attachée à chaque objet, mais du service que tout acquéreur aurait à se rendre à lui-même ou à réclamer d’autrui pour se le procurer. Ils n’estiment pas, qu’on me pardonne cette expression hasardée, la peine que Dieu a prise, mais celle que l’acheteur aurait à prendre. — Et quand l’opération est terminée, quand le public connaît le total des Valeurs portées au bilan, il dit d’une voix unanime : Voilà ce dont l’héritier est propriétaire.
Puisque les propriétés n’embrassent que des valeurs, et puisque les valeurs n’expriment que des rapports, il s’ensuit que les propriétés ne sont elles-mêmes que des rapports.
Quand le public, à la vue des deux inventaires, prononce : « Cet homme est plus riche que cet autre, » il n’entend pas dire pour cela que le rapport des deux propriétés exprime celui des deux richesses absolues ou du bien-être. Il entre dans les satisfactions, dans le bien-être absolu, une part d’utilité commune qui change beaucoup cette proportion. Tous les hommes, en effet, sont égaux devant la lumière du jour, devant l’air respirable, devant la chaleur du soleil ; et l’Inégalité, — exprimée par la différence des propriétés ou des valeurs, — ne doit s’entendre que de l’utilité onéreuse.
Or, je l’ai déjà dit bien des fois, et je le répéterai sans doute bien des fois encore, car c’est la plus grande, la plus belle, peut-être la plus méconnue des harmonies sociales, celle qui résume toutes les autres : il est dans la nature du progrès, — et le progrès ne consiste qu’en cela, — de transformer l’utilité onéreuse en utilité gratuite ; de diminuer la valeur sans diminuer l’Utilité ; de faire que, pour se procurer les mêmes choses, chacun ait moins de peine à prendre ou à rémunérer ; d’accroître incessamment la masse de ces choses communes, dont la jouissance, se distribuant d’une manière uniforme entre tous, efface peu à peu l’Inégalité qui résulte de la différence des propriétés.
Ne nous lassons pas d’analyser le résultat de ce mécanisme.
Combien de fois, en contemplant les phénomènes du monde social, n’ai-je pas eu l’occasion de sentir la profonde justesse de ce mot de Rousseau : « Il faut beaucoup de philosophie pour observer ce qu’on voit tous les jours ! » C’est ainsi que l’accoutumance, ce voile étendu sur les yeux du vulgaire, et dont ne parvient pas toujours à se délivrer l’observateur attentif, nous empêche de discerner le plus merveilleux des phénomènes économiques : la richesse réelle tombant incessamment du domaine de la Propriété dans celui de la Communauté.
Essayons cependant de constater cette démocratique évolution, et même, s’il se peut, d’en mesurer la portée.
J’ai dit ailleurs que, si nous voulions comparer deux époques, au point de vue du bien-être réel, nous devions tout rapporter au travail brut mesuré par le temps, et nous poser cette question : Quelle est la différence de satisfaction que procure, selon le degré d’avancement de la société, une durée déterminée de travail brut, par exemple : la journée d’un simple manouvrier ?
Cette question en implique deux autres :
Quel est, au point de départ de l’évolution, le rapport de la satisfaction au travail le plus simple ?
Quel est ce même rapport aujourd’hui ?
La différence mesurera l’accroissement qu’ont pris l’utilité gratuite relativement à l’utilité onéreuse, le domaine commun relativement au domaine approprié.
Je ne crois pas que l’homme politique se puisse prendre à un problème plus intéressant, plus, instructif. Que le lecteur veuille me pardonner si, pour arriver à une solution satisfaisante, je le fatigue de trop nombreux exemples.
J’ai fait, en commençant, une sorte de nomenclature des besoins humains les plus généraux : respiration, alimentation, vêtement, logement, locomotion, instruction, diversion, etc.
Reprenons cet ordre, et voyons ce qu’un simple journalier pouvait à l’origine et peut aujourd’hui se procurer de satisfactions par un nombre déterminé de journées de travail.
Respiration. Ici la gratuité et la communauté sont complètes dès l’origine. La nature, s’étant chargée de tout, ne nous laisse rien à faire. Il n’y a ni efforts, ni services, ni valeur, ni propriété, ni progrès possibles. Au point de vue de l’utilité, Diogène est aussi riche qu’Alexandre ; au point de vue de la valeur, Alexandre est aussi riche que Diogène.
Alimentation. Dans l’état actuel des choses, la valeur d’un hectolitre de blé fait équilibre, en France, à celle de quinze à vingt journées du travail le plus vulgaire. Voilà un fait, et on a beau le méconnaître, il n’en est pas moins digne de remarque. Il est positif qu’aujourd’hui, en considérant l’humanité sous son aspect le moins avancé, et représentée par le journalier-prolétaire, nous constatons qu’elle obtient la satisfaction attachée à un hectolitre de blé avec quinze journées du travail humain le plus brut. On calcule qu’il faut trois hectolitres de blé pour l’alimentation d’un homme. Le simple manœuvre produit donc, sinon sa subsistance, au moins (ce qui revient au même pour lui) la valeur de sa subsistance, en prélevant de quarante-cinq à soixante journées sur son travail annuel. Si nous représentons par Un le type de la valeur (qui pour nous est une journée de travail brut), la valeur d’un hectolitre de blé s’exprimera par 15, 18 ou 20, selon les années.
Le rapport de ces deux valeurs est de un à quinze.
Pour savoir si un progrès a été accompli et pour le mesurer, il faut se demander quel était ce même rapport au jour de départ de l’humanité. En vérité, je n’ose hasarder un chiffre ; mais il y a un moyen de dégager cet x. Quand vous entendez un homme déclamer contre l’ordre social, contre l’appropriation du sol, contre la rente, contre les machines, conduisez-le au milieu d’une forêt vierge ou en face d’un marais infect. Je veux, direz-vous, vous affranchir du joug dont vous vous plaignez ; je veux vous soustraire aux luttes atroces de la concurrence anarchique, à l’antagonisme des intérêts, à l’égoïsme des riches, à l’oppression de la propriété, à l’écrasante rivalité des machines, à l’atmosphère étouffante de la société. Voilà de la terre semblable à celle que rencontrent devant eux les premiers défricheurs. Prenez-en tant qu’il vous plaira par dizaines, par centaines d’hectares. Cultivez-la vous-même. Tout ce que vous lui ferez produire est à vous. Je n’y mets qu’une condition : c’est que vous n’aurez pas recours à cette société dont vous vous dites victime.
Cet homme, remarquez-le bien, serait mis en face du sol dans la même situation où était, à l’origine, l’humanité elle-même. Or, je ne crains pas d’être contredit en avançant qu’il ne produira pas un hectolitre de blé tous les deux ans. Rapport : 15 à 600.
Et voilà le progrès mesuré. Relativement au blé, — et malgré qu’il soit obligé de payer la rente du sol, l’intérêt du capital, le loyer des outils, — ou plutôt parce qu’il les paye, — un journalier obtient avec quinze jours de travail ce qu’il aurait eu peine à recueillir avec six cents journées. La valeur du blé, mesurée par le travail le plus brut, est donc tombée de 600 à 15 ou de 40 à 1. Un hectolitre de blé a, pour l’homme, exactement la même utilité qu’il aurait eue le lendemain du déluge ; il contient la même quantité de substance alimentaire ; il satisfait au même besoin et dans la même mesure. — Il est une égale richesse réelle, il n’est plus une égale richesse relative. Sa production a été mise en grande partie à là charge de la nature : on l’obtient avec un moindre effort humain ; on se rend un moindre service en se le passant de main en main, il a moins de valeur ; et, pour tout dire en un mot, il est devenu gratuit, non absolument, mais dans la proportion de quarante à un.
Et non-seulement il est devenu gratuit, mais encore commun dans cette proportion. Car ce n’est pas au profit de celui qui le produit que les 39/40 de l’effort ont été anéantis ; mais au profit de celui qui le consomme, quel que soit le genre de travail auquel il se voue.
Vêtement. Même phénomène. Un simple manœuvre entre dans un magasin du Marais et y reçoit un vêtement qui correspond à vingt journées de son travail, que nous supposons être de la qualité la plus inférieure. S’il devait faire ce vêtement lui-même, il n’y parviendrait pas de toute sa vie. S’il eût voulu s’en procurer un semblable du temps d’Henri IV, il lui en eût coûté trois ou quatre cents journées. Qu’est donc devenue, quant aux étoffes, cette différence de valeur rapportée à la durée du travail brut ? Elle a été anéantie, parce que des forces naturelles gratuites se sont chargées de l’œuvre ; et elle a été anéantie au profit de l’humanité tout entière.
Car il ne faut pas cesser de faire remarquer ceci : Chacun doit à son semblable un service équivalent à celui qu’il en reçoit. Si donc l’art du tisserand n’avait fait aucun progrès, si le tissage n’était exécuté en partie par des forces gratuites, le tisserand mettrait deux ou trois cents journées à fabriquer l’étoffe, et il faudrait bien que notre manœuvre cédât deux ou trois cents journées pour l’obtenir. Et puisque le tisserand ne peut parvenir, malgré sa bonne volonté, à se faire céder deux ou trois cents journées, à se faire rétribuer pour l’intervention des forces gratuites, pour le progrès accompli, il est parfaitement exact de dire que ce progrès a été accompli au profit de l’acquéreur, du consommateur, de la satisfaction universelle, de l’humanité.
Transport. Antérieurement à tout progrès, quand le genre humain en était réduit, comme le journalier que nous avons mis en scène, à du travail brut et primitif, si un homme avait voulu qu’un fardeau d’un quintal fût transporté de Paris à Bayonne, il n’aurait eu que cette alternative : ou mettre le fardeau sur ses épaules et accomplir l’œuvre lui-même, voyageant par monts et par vaux, ce qui eût exigé au moins un an de fatigues ; ou bien prier quelqu’un de faire pour lui cette rude besogne ; et comme, d’après l’hypothèse, le nouveau porte-balle aurait employé les mêmes moyens et le même temps, il aurait réclamé en paiement un an de travail. À cette époque donc, la valeur du travail brut étant un, celle du transport était de 300 pour un poids d’un quintal et une distance de 200 lieues.
Les choses ont bien changé. En fait, il n’y a aucun manœuvre à Paris qui ne puisse atteindre le même résultat par le sacrifice de deux journées. L’alternative est bien la même. Il faut encore exécuter le transport soi-même ou le faire faire par d’autres en les rémunérant. Si notre journalier l’exécute lui-même, il lui faudra encore un an de fatigues ; mais, s’il s’adresse à des hommes du métier, il trouvera vingt entrepreneurs qui s’en chargeront pour 3 ou 4 francs, c’est-à-dire pour l’équivalent de deux journées de travail brut. Ainsi, la valeur du travail brut étant un, celle du transport, qui était de 300, n’est plus que de deux.
Comment s’est accomplie cette étonnante révolution ? Oh ! elle a exigé bien des siècles. On a dompté certains animaux, on a percé des montagnes, on a comblé des vallées, on a jeté des ponts sur les fleuves ; on a inventé le traineau d’abord, ensuite la roue, on a amoindri les obstacles, ou l’occasion du travail, des services, de la valeur ; bref on est parvenu à faire, avec une peine égale à deux, ce qu’on ne pouvait faire, à l’origine, qu’avec une peine égale à trois cents. Ce progrès à été réalisé par des hommes qui ne songeaient qu’à leurs propres intérêts. Et cependant qui en profite aujourd’hui ? notre pauvre journalier, et avec lui tout le monde.
Qu’on ne dise pas que ce n’est pas là de la Communauté. Je dis que c’est de la Communauté dans le sens le plus strict du mot. A l’origine, la satisfaction dont il s’agit faisait équilibre, pour tous les hommes, à 300 journées de travail brut ou à un nombre moindre, mais proportionnel, de travail intelligent. Maintenant, 298 parties de cet effort sur 300 ont été mises à la charge de la nature, et l’humanité se trouve exonérée d’autant. Or, évidemment, tous les hommes sont égaux devant ces obstacles détruits, devant cette distance effacée, devant cette fatigue annulée, devant cette valeur anéantie, puisque tous obtiennent le résultat sans avoir à le rémunérer. Ce qu’ils rémunéreront, c’est l’effort humain qui reste encore à faire, mesuré par 2, exprimant le travail brut. En d’autres termes, celui qui ne s’est pas perfectionné, et qui n’a à offrir que la force musculaire, a encore deux journées de travail à céder pour obtenir la satisfaction. Tous les autres hommes l’obtiennent avec un travail de moindre durée : l’avocat de Paris, gagnant 30,000 francs par an, avec la vingt-cinquième partie d’une journée, etc. ; par où l’on voit que les hommes sont égaux devant la valeur anéantie, et que l’inégalité se restreint dans les limites qui forment encore le domaine de la Valeur qui survit, ou de la Propriété.
C’est un écueil pour la science de procéder par voie d’exemple. L’esprit du lecteur est porté à croire que le phénomène qu’elle veut décrire n’est vrai qu’aux cas particuliers invoqués à l’appui de la démonstration. Mais il est clair que ce qui a été dit du blé, du vêtement, du transport, est vrai de tout. Quand l’auteur généralise, c’est au lecteur de particulariser ; et, quand celui-là se dévoue à la lourde et froide analyse, c’est bien le moins que celui-ci se donne le plaisir de la synthèse.
Après tout, cette loi synthétique, nous la pouvons formuler ainsi :
La valeur, qui est la propriété sociale, naît de l’effort et de l’obstacle.
À mesure que l’obstacle s’amoindrit, l’effort, la valeur, ou le domaine de la propriété, s’amoindrissent avec lui.
La propriété recule toujours, pour chaque satisfaction donnée, et la Communauté avance sans cesse.
Faut-il en conclure, comme fait M. Proudhon, que la Propriété est destinée à périr ? De ce que, pour chaque effet utile à réaliser, pour chaque satisfaction à obtenir, elle recule devant la Communauté, est-ce à dire qu’elle va s’y absorber et s’y anéantir ?
Conclure ainsi, c’est méconnaître complétement la nature même de l’homme. Nous rencontrons ici un sophisme analogue à celui que nous avons déjà réfuté au sujet de l’intérêt des capitaux. L’intérêt tend à baisser, disait-on, donc sa destinée est de disparaître. — La valeur et la propriété diminuent, dit-on maintenant, donc leur destinée est de s’anéantir.
Tout le sophisme consiste à omettre ces mots : pour chaque effet déterminé. Oui, il est très-vrai que les hommes obtiennent des effets déterminés avec des efforts moindres ; c’est en cela qu’ils sont progressifs et perfectibles ; c’est pour cela qu’on peut affirmer que le domaine relatif de la propriété se rétrécit, en l’examinant au point de vue d’une satisfaction donnée.
Mais il n’est pas vrai que tous les effets possibles à obtenir soient jamais épuisés, et dès lors il est absurde de penser qu’il soit dans la nature du progrès d’altérer le domaine absolu de la Propriété.
Nous l’avons dit plusieurs fois et sous toutes les formes : chaque effort, avec le temps, peut servir de véhicule à une plus grande somme d’utilité gratuite, sans qu’on soit autorisé à en conclure que les hommes cesseront jamais de faire des efforts. Tout ce qu’on en doit déduire, c’est que leurs forces devenues disponibles s’attaqueront à d’autres obstacles, réalisant, à travail égal, des satisfactions jusque-là inconnues.
J’insisterai encore sur cette idée. Il doit être permis, par le temps qui court, de ne rien laisser à l’interprétation abusive quand on s’est avisé d’articuler ces terribles mots : Propriété, Communauté.
À un moment donné de son existence, l’homme isolé ne peut disposer que d’une certaine somme d’efforts. Il en est de même de la société.
Quand l’homme isolé réalise un progrès, en faisant concourir à son œuvre une force naturelle, la somme de ses efforts se trouve réduite d’autant, par rapport à l’effet utile cherché. Elle serait réduite aussi d’une manière absolue, si cet homme, satisfait de sa première condition, convertissait son progrès en loisir, et s’abstenait de consacrer à de nouvelles jouissances cette portion d’efforts rendue désormais disponible. Mais cela suppose que l’ambition, le désir, l’aspiration, sont des forces limitées ; que le cœur humain n’est pas indéfiniment expansible. Or, il n’en est rien. À peine Robinson a mis une partie son travail à la charge de la nature, qu’il le consacre à de nouvelles entreprises. L’ensemble de ses efforts reste le même ; seulement il y en a un entre autres qui est plus productif, plus fructueux, aidé par une plus grande proportion de collaboration naturelle et gratuite. — C’est justement le phénomène qui se réalise au sein de la société.
De ce que la charrue, la herse, le marteau, la scie, les bœufs et les chevaux, la voile, les chutes d’eau, la vapeur, ont successivement exonéré l’humanité d’une masse énorme d’efforts pour chaque résultat obtenu, il ne s’ensuit pas nécessairement que ces efforts mis en disponibilité aient été frappés d’inertie. Rappelons-nous ce qui a été dit de l’expansibilité indéfinie des besoins et des désirs. Jetons d’ailleurs un regard sur le monde, et nous n’hésiterons pas à reconnaître qu’à chaque fois que l’homme a pu vaincre un obstacle avec de la force naturelle, il a tourné sa force propre contre d’autres obstacles. On imprime plus facilement, mais on imprime davantage. Chaque livre répond à moins d’effort humain, à moins de valeur, à moins de propriété ; mais il y a plus de livres, et, au total, autant d’efforts, autant de valeurs, autant de Propriétés. J’en pourrais dire autant des vêtements, des maisons, des chemins de fer, de toutes les productions humaines. Ce n’est pas l’ensemble des valeurs qui a diminué, c’est l’ensemble des utilités qui a augmenté. Ce n’est pas le domaine absolu de la Propriété qui s’est rétréci, c’est le domaine absolu de la Communauté qui s’est élargi. Le progrès n’a pas paralysé le travail, il a étendu le bien-être.
La gratuité et la Communauté, c’est le domaine des forces naturelles, et ce domaine s’agrandit sans cesse. C’est une vérité de raisonnement et de fait.
La Valeur et la Propriété, c’est le domaine des efforts humains, des services réciproques ; et ce domaine se resserre incessamment pour chaque résultat donné, mais non pour l’ensemble des résultats, — pour chaque satisfaction déterminée, mais non pour l’ensemble des satisfactions, parce que les satisfactions possibles ouvrent devant l’humanité un horizon sans limites.
Autant donc il est vrai que la Propriété relative fait successivement place à la Communauté, autant il est faux que la Propriété absolue tende à disparaître de ce monde. C’est un pionnier qui accomplit son œuvre dans un cercle et passe dans un autre. Pour qu’elle s’évanouît, il faudrait que tout obstacle fît défaut au travail ; que tout effort humain devînt inutile ; que les hommes n’eussent plus occasion d’échanger, de se rendre des services ; que toute production fût spontanée, que la satisfaction suivît immédiatement le désir ; il faudrait que nous fussions tous égaux aux dieux. Alors, il est vrai, tout serait gratuit, tout serait commun : effort, service, valeur, propriété, rien de ce qui constate notre native infirmité n’aurait sa raison d’être.
Mais l’homme a beau s’élever, il est toujours aussi loin de l’omnipotence. Que sont les degrés qu’il parcourt sur l’échelle de l’infini ? Ce qui caractérise la Divinité, autant qu’il nous est donné de le comprendre, c’est qu’entre sa volonté et l’accomplissement de sa volonté, il n’y a pas d’obstacles : Fiat lux, et lux facta est. Encore est-ce son impuissance à exprimer ce qui est étranger à l’humaine nature qui a réduit Moïse à supposer, entre la volonté divine et la lumière, l’obstacle d’un mot à prononcer. Mais, quels que soient les progrès que réserve à l’humanité sa nature perfectible, on peut affirmer qu’ils n’iront jamais jusqu’à faire disparaître tout obstacle sur la route du bien-être infini, et à frapper ainsi d’inutilité le travail de ses muscles et de son intelligence. La raison en est simple : c’est qu’à mesure que certains obstacles sont vaincus, les désirs se dilatent, rencontrent de nouveaux obstacles qui s’offrent à de nouveaux efforts. Nous aurons donc toujours du travail à accomplir, à échanger, à évaluer. La propriété existera donc jusqu’à la consommation des temps, toujours croissante quant à la masse, à mesure que les hommes deviennent plus actifs et plus nombreux, encore que chaque effort, chaque service, chaque valeur, chaque propriété relative passant de main en main serve de véhicule à une proportion croissante d’utilité gratuite et commune.
Le lecteur voit que nous donnons au mot Propriété un sens très-étendu et qui n’en est pas pour cela moins exact. La propriété, c’est le droit de s’appliquer à soi-même ses propres efforts, ou de ne les céder que moyennant la cession en retour d’efforts équivalents. La distinction entre Propriétaire et Prolétaire est donc radicalement fausse ; — à moins qu’on ne prétende qu’il y a une classe d’hommes qui n’exécute aucun travail, ou n’a pas droit sur ses propres efforts, sur les services qu’elle rend ou sur ceux qu’elle reçoit en échange.
C’est à tort que l’on réserve le nom de Propriété à une de ses formes spéciales, au capital, à la terre, à ce qui procure un intérêt ou une rente ; et c’est sur cette fausse définition qu’on sépare ensuite les hommes en deux classes antagoniques. L’analyse démontre que l’intérêt et la rente sont le fruit de services rendus, et ont même origine, même nature, mêmes droits que la main-d’œuvre.
Le monde est un vaste atelier où la Providence a prodigué des matériaux et des forces ; c’est à ces matériaux et à ces forces que s’applique le travail humain. Efforts antérieurs, efforts actuels, même efforts ou promesses d’efforts futurs s’échangent les uns contre les autres. Leur mérite relatif, constaté par l’échange et indépendamment des matériaux et forces gratuites, révèle la valeur ; et c’est de la valeur par lui produite, que chacun est Propriétaire.
On fera cette objection : Qu’importe qu’un homme ne soit propriétaire, comme vous dites, que de la valeur ou du mérite reconnu de son service ? La propriété de la valeur emporte celle de l’utilité qui y est attachée. Jean a deux sacs de blé, Pierre n’en a qu’un. Jean, dites-vous, est le double plus riche en valeur. Eh ! morbleu ! il l’est bien aussi en utilité, et même en utilité naturelle. Il peut manger une fois davantage.
Sans doute, mais n’a-t-il pas accompli le double de travail ?
Allons néanmoins au fond de l’objection.
La richesse essentielle, absolue, nous l’avons déjà dit, réside dans l’utilité. C’est ce qu’exprime ce mot lui-même. Il n’y a que l’utilité qui serve (uti, servir). Elle seule est en rapport avec nos besoins, et c’est elle seule que l’homme a en vue quand il travaille. C’est du moins elle qu’il poursuit en définitive, car les choses ne satisfont pas notre faim et notre soif parce qu’elles renferment de la valeur, mais de l’utilité.
Cependant il faut se rendre compte du phénomène que produit à cet égard la société.
Dans l’isolement, l’homme aspirerait à réaliser de l’utilité sans se préoccuper de la valeur dont la notion même ne pourrait exister pour lui.
Dans l’état social, au contraire, l’homme aspire à réaliser de la valeur sans se préoccuper de l’utilité. La chose qu’il produit n’est pas destinée à ses propres besoins. Dès lors peu lui importe qu’elle soit plus ou moins utile. C’est à celui qui éprouve le désir à la juger à ce point de vue. Quant à lui, ce qui l’intéresse, c’est qu’on y attache, sur le marché, la plus grande valeur possible, certain qu’il retirera de ce marché, et à son choix, d’autant plus d’utilités qu’il y aura apporté plus de valeur.
La séparation des occupations amène cet état de choses que chacun produit ce qu’il ne consommera pas, et consomme ce qu’il n’a pas produit. Comme producteurs, nous poursuivons la valeur ; comme consommateurs, l’utilité. Cela est d’expérience universelle. Celui qui polit un diamant, brode de la dentelle, distille de l’eau-de-vie, ou cultive du pavot, ne se demande pas si la consommation de ces choses est bien ou mal entendue. Il travaille, et, pourvu que son travail réalise de la valeur, cela lui suffit.
Et, pour le dire en passant, ceci prouve que ce qui est moral ou immoral, ce n’est pas le travail, mais le désir ; et que l’humanité se perfectionne, non par la moralisation du producteur, mais par celle du consommateur. Combien ne s’est-on pas récrié contre les Anglais de ce qu’ils récoltaient de l’opium dans l’Inde avec l’idée bien arrêtée, disait-on, d’empoisonner les Chinois ! C’était méconnaître et déplacer le principe de la moralité. Jamais on n’empêchera de produire ce qui, étant recherché, a de la valeur. C’est à celui qui aspire à une satisfaction d’en calculer les effets, et c’est bien en vain qu’on essayerait de séparer la prévoyance de la responsabilité. Nos vignerons font du vin et en feront tant qu’il aura de la valeur, sans se mettre en peine de savoir si avec ce vin on s’enivre en France et on se tue en Amérique. C’est le jugement que les hommes portent sur leurs besoins et leurs satisfactions qui décide de la direction du travail. Cela est vrai même de l’homme isolé ; et si une sotte vanité eût parlé plus haut que la faim à Robinson, au lieu d’employer son temps à la chasse, il l’eût consacré à arranger les plumes de sa coiffure. De même un peuple sérieux provoque des industries sérieuses, un peuple futile, des industries futiles. (Voir chapitre XI.)
Mais revenons. Je dis :
L’homme qui travaille pour lui-même a en vue l’utilité.
L’homme qui travaille pour les autres a en vue la valeur.
Or la Propriété, telle que je l’ai définie, repose sur la valeur ; et la valeur n’étant qu’un rapport, il s’ensuit que la propriété n’est elle-même qu’un rapport.
S’il n’y avait qu’un homme sur la terre, l’idée de Propriété ne se présenterait jamais à son esprit. Maître de s’assimiler toutes les utilités dont il serait environné, ne rencontrant jamais un droit analogue pour servir de limite au sien, comment la pensée lui viendrait-elle de dire : Ceci est à moi ? Ce mot suppose ce corrélatif : Ceci n’est pas à moi, ou ceci est à autrui. Le Tien et le Mien ne se peuvent concevoir isolés, et il faut bien que le mot Propriété implique relation, car il n’exprime aussi énergiquement qu’une chose est propre à une personne qu’en faisant comprendre qu’elle n’est propre à aucune autre.
Le premier qui, ayant clos un terrain, dit Rousseau, s’avisa de dire : « Ceci est à moi , fut le vrai fondateur de la société civile. »
Que signifie cette clôture, si ce n’est une pensée d’exclusion et par conséquent de relation ? Si elle n’avait pour objet que de défendre le champ contre les animaux, c’était une précaution, non un signe de propriété ; une borne, au contraire, est un signe de propriété, non une précaution.
Ainsi les hommes ne sont véritablement Propriétaires que relativement les uns aux autres ; et, cela posé, de quoi sont-ils propriétaires ? de valeurs, — ainsi qu’on le discerne fort bien dans les échanges qu’ils font entre eux.
Prenons, selon notre procédé habituel, un exemple très-simple.
La nature travaille, de toute éternité peut-être, à mettre dans l’eau de la source ces qualités qui la rendent propre à étancher la soif et qui font pour nous son utilité. Ce n’est certainement pas mon œuvre, car elle a été élaborée sans ma participation et à mon insu. Sous ce rapport, je puis bien dire que l’eau est pour moi un don gratuit de Dieu. Ce qui est mon œuvre propre, c’est l’effort auquel je me suis livré pour aller chercher ma provision de la journée.
Par cet acte, de quoi suis-je devenu propriétaire ?
Relativement à moi, je suis propriétaire, si l’on peut s’exprimer ainsi, de toute l’utilité que la nature a mise dans cette eau. Je puis la faire tourner à mon avantage comme je l’entends. Ce n’est même que pour cela que j’ai pris la peine de l’aller chercher. Contester mon droit, ce serait dire que, bien que les hommes ne puissent vivre sans boire, ils n’ont pas le droit de boire l’eau qu’ils se sont procurée par leur travail. Je ne pense pas que les communistes, quoiqu’ils aillent fort loin, aillent jusque-là ; et, même sous le régime Cabet, il sera permis sans doute aux agneaux icariens, quand ils auront soif, de s’aller désaltérer dans le courant d’une onde pure.
Mais relativement aux autres hommes, supposés libres de faire comme moi, je ne suis et je ne puis être propriétaire que de ce qu’on nomme, par métonymie, la valeur de l’eau, c’est-à-dire la valeur du service que je rendrai en la cédant. Puisqu’on me reconnaît le droit de boire cette eau, il n’est pas possible qu’on me conteste le droit de la céder. — Et puisqu’on reconnaît à l’autre contractant le droit d’aller, comme moi, en chercher à la source, il n’est pas possible qu’on lui conteste le droit d’accepter la mienne. Si l’un a le droit de céder, l’autre d’accepter moyennant payement librement débattu, le premier est donc propriétaire à l’égard du second. — En vérité, il est triste d’écrire à une époque où l’on ne peut faire un pas en économie politique sans s’arrêter à de si puériles démonstrations.
Mais sur quelle base se fera l’arrangement ? C’est là ce qu’il faut surtout savoir pour apprécier toute la portée sociale de ce mot Propriété, si malsonnant aux oreilles du sentimentalisme démocratique.
Il est clair qu’étant libres tous deux, nous prendrons en considération la peine que je me suis donnée et celle qui lui sera épargnée, ainsi que toutes les circonstances qui constituent la valeur. Nous débattrons nos conditions, et, si le marché se conclut, il n’y a ni exagération ni subtilité à dire que mon voisin aura acquis gratuitement, ou, si l’on veut, aussi gratuitement que moi, toute l’utilité naturelle de l’eau. Veut-on la preuve que les efforts humains, et non l’utilité intrinsèque, déterminent les conditions plus ou moins onéreuses de la transaction ? On conviendra que cette utilité reste identique, que la source soit rapprochée ou éloignée. C’est la peine prise ou à prendre qui diffère selon les distances, et puisque la rémunération varie avec elle, c’est en elle, non dans l’utilité, qu’est le principe de la valeur, de la Propriété relative.
Il est donc certain que, relativement aux autres, je ne suis et ne puis être Propriétaire que de mes efforts, de mes services qui n’ont rien de commun avec les élaborations mystérieuses et inconnues par lesquelles la nature a communiqué de l’utilité aux choses qui sont l’occasion de ces services. J’aurais beau porter plus loin mes prétentions, là se bornera toujours ma Propriété de fait ; car, si j’exige plus que la valeur de mon service, mon voisin se le rendra à lui-même. Cette limite est absolue, infranchissable, décisive. Elle explique et justifie pleinement la Propriété, forcément réduite au droit bien naturel de demander un service pour un autre. Elle implique que la jouissance des utilités naturelles n’est appropriée que nominalement et en apparence ; que l’expression : Propriété d’un hectare de terre, d’un quintal de fer, d’un hectolitre de blé, d’un mètre de drap, est une véritable métonymie, de même que Valeur de l’eau, du fer, etc. ; qu’en tant que la nature a donné ces biens aux hommes, ils en jouissent gratuitement et en commun ; qu’en un mot, la Communauté se concilie harmonieusement avec la Propriété, les dons de Dieu restant dans le domaine de l’une, et les services humains formant seuls le très-légitime domaine de l’autre.
De ce que j’ai choisi un exemple très-simple pour montrer la ligne de démarcation qui sépare le domaine commun du domaine approprié, on ne serait pas fondé à conclure que cette ligne se perd et s’efface dans les transactions plus compliquées. Non, elle persiste et se montre toujours dans toute transaction libre. L’action d’aller chercher de l’eau à la source est très-simple, sans doute, mais qu’on y regarde de près, et l’on se convaincra que l’action de cultiver du blé n’est plus compliquée que parce qu’elle embrasse une série d’actions tout aussi simples, dans chacune desquelles la collaboration de la nature et celle de l’homme se combinent, en sorte que l’exemple choisi est le type de tout autre fait économique. Qu’il s’agisse d’eau, de blé, d’étoffes, de livres, de transports, de tableaux, de danse, de musique, certaines circonstances, nous l’avons avoué, peuvent donner beaucoup de valeur à certains services, mais nul ne peut jamais se faire payer autre chose, et notamment le concours de la nature, tant qu’un des contractants pourra dire à l’autre : Si vous me demandez plus que ne vaut votre service, je m’adresserai ailleurs ou me le rendrai moi-même.
Ce n’est pas assez de justifier la Propriété, je voudrais la faire chérir même par les Communistes les plus convaincus. Pour cela que faut-il ? décrire son rôle démocratique, progressif et égalitaire ; faire comprendre que non-seulement elle ne monopolise pas entre quelques mains les dons de Dieu, mais qu’elle a pour mission spéciale d’agrandir sans cesse le cercle de la Communauté. Sous ce rapport, elle est bien autrement ingénieuse que Platon, Morus, Fénelon ou M. Cabet.
Qu’il y ait des biens dont les hommes jouissent gratuitement et en commun sur le pied de la plus parfaite égalité, qu’il y ait, dans d’ordre social, au-dessous de la propriété, une Communauté très-réelle, c’est ce que nul ne conteste. Il ne faut d’ailleurs, qu’on soit économiste ou socialiste, que des yeux pour le voir. Tous les enfants de Dieu sont traités de même à certains égards. Tous sont égaux devant la gravitation, qui les attache au sol, devant l’air respirable, la lumière du jour, l’eau des torrents. Ce vaste et incommensurable fonds commun, qui n’a rien à démêler avec la Valeur ou la Propriété, Say le nomme richesse naturelle, par opposition à la richesse sociale ; Proudhon, biens naturels, par opposition aux biens acquis ; Considérant, Capital naturel, par opposition au Capital créé ; Saint-Chamans, richesse de jouissance, par opposition à la richesse de valeur ; nous l’avons nommé utilité gratuite, par opposition à l’utilité onéreuse. Qu’on l’appelle comme on voudra, il existe : cela suffit pour dire : Il y a parmi les hommes un fonds commun de satisfactions gratuites et égales.
Et si la richesse sociale, acquise, créée, de valeur, onéreuse, en un mot la Propriété, est inégalement répartie, on ne peut pas dire qu’elle le soit injustement, puisqu’elle est pour chacun proportionnelle aux services d’où elle procède et dont elle n’est que l’évaluation. En outre, il est clair que cette inégalité est atténuée par l’existence du fonds commun, en vertu de cette règle mathématique ; l’inégalité relative de deux nombres inégaux s’affaiblit si l’on ajoute à chacun d’eux des nombres égaux. Lors donc que nos inventaires constatent qu’un homme est le double plus riche qu’un autre, cette proportion cesse d’être exacte si l’on prend en considération leur part dans l’utilité gratuite, et même l’inégalité s’effacerait progressivement, si cette masse commune était elle-même progressive.
La question est donc de savoir si ce fonds commun est une quantité fixe, invariable, accordée aux hommes dès l’origine et une fois pour toutes par la Providence, au-dessus de laquelle se superpose le fonds approprié, sans qu’il puisse y avoir aucune relation, aucune action entre ces deux ordres de phénomènes.
Les économistes ont pensé que l’ordre social n’avait aucune influence sur cette richesse naturelle et commune, et c’est pourquoi ils l’ont exclue de l’économie politique.
Les socialistes vont plus loin : ils croient que l’ordre social tend à faire passer le fonds commun dans le domaine de la propriété, qu’il consacre au profit de quelques-uns l’usurpation de ce qui appartient à tous ; et c’est pourquoi ils s’élèvent contre l’économie politique qui méconnaît cette funeste tendance et contre la société actuelle qui la subit.
Que dis-je ? le Socialisme taxe ici, et avec quelque fondement, l’économie politique d’inconséquence ; car, après avoir déclaré qu’il n’y avait pas de relation entre la richesse commune et la richesse appropriée, elle a infirmé sa propre assertion et préparé le grief socialiste, le jour où, confondant la valeur avec l’utilité, elle a dit que les matériaux et les forces de la nature, c’est-à-dire les dons de Dieu, avaient une valeur intrinsèque, une valeur qui leur était propre ; — car valeur implique toujours et nécessairement appropriation. Ce jour-là, l’Économie politique a perdu le droit et le moyen de justifier logiquement la Propriété.
Ce que je viens dire, ce que j’affirme avec une conviction qui est pour moi une certitude absolue, c’est ceci : Oui, il y a une action constante du fonds approprié sur le fonds commun, et sous ce rapport la première assertion économiste est erronée. Mais la seconde assertion, développée et exploitée par le socialisme, est plus funeste encore ; car l’action dont il s’agit ne s’accomplit pas en ce sens qu’elle fait passer le fonds commun dans le fonds approprié, mais au contraire qu’elle fait incessamment tomber le domaine approprié dans le domaine commun. La Propriété, juste et légitime en soi, parce qu’elle correspond toujours à des services, tend à transformer l’utilité onéreuse en utilité gratuite. Elle est cet aiguillon qui force l’intelligence humaine à tirer de l’inertie des forces naturelles latentes. Elle lutte à son profit sans doute, contre les obstacles qui rendent l’utilité onéreuse. Et quand l’obstacle est renversé dans une certaine mesure, il se trouve qu’il a disparu dans cette mesure au profit de tous. Alors l’infatigable Propriété s’attaque à d’autres obstacles, et ainsi de suite et toujours, élevant sans cesse le niveau humain, réalisant de plus en plus la Communauté et avec elle l’Égalité au sein de la grande famille.
C’est en cela que consiste l’Harmonie vraiment merveilleuse de l’ordre social naturel. Cette harmonie, je ne puis la décrire sans combattre des objections toujours renaissantes, sans tomber dans de fatigantes redites. N’importe, je me dévoue ; que le lecteur se dévoue aussi un peu de son côté.
Il faut bien se pénétrer de cette notion fondamentale : Quand il n’y a pour personne aucun obstacle entre le désir et la satisfaction (il n’y en a pas, par exemple, entre nos yeux et la lumière du jour), il n’y a aucun effort à faire, aucun service à se rendre à soi-même ou à rendre aux autres, aucune valeur, aucune Propriété possible. Quand un obstacle existe, toute la série se construit. Nous voyons apparaître d’abord l’Effort ; — puis l’échange volontaire des efforts et des services ; — puis l’appréciation comparée des services ou la Valeur ; enfin, le droit pour chacun de jouir des utilités attachées à ces valeurs ou la Propriété.
Si, dans cette lutte contre des obstacles toujours égaux, le concours de la nature et celui du travail étaient aussi toujours respectivement égaux, la Propriété et la Communauté suivraient des lignes parallèles sans jamais changer de proportions.
Mais il n’en est pas ainsi. L’aspiration universelle des hommes, dans leurs entreprises, est de diminuer le rapport de l’effort au résultat, et, pour cela, d’associer à leur travail une proportion toujours croissante d’agents naturels. Il n’y a pas sur toute la terre un agriculteur, un manufacturier, un négociant, un ouvrier, un armateur, un artiste dont ce ne soit l’éternelle préoccupation. C’est à cela que tendent toutes leurs facultés ; c’est pour cela qu’ils inventent des outils ou des machines, qu’ils sollicitent les forces chimiques et mécaniques des éléments, qu’ils se partagent leurs travaux, qu’ils unissent leurs efforts. Faire plus avec moins, c’est l’éternel problème qu’ils se posent en tous temps, en tous lieux, en toutes situations, en toutes choses. Qu’en cela ils soient mus par l’intérêt personnel, qui le conteste ? Quel stimulant les inciterait avec la même énergie ? Chaque homme ayant d’abord ici-bas la responsabilité de sa propre existence et de son développement, était-il possible qu’il portât en lui-même un mobile permanent autre que l’intérêt personnel ? Vous vous récriez ; mais attendez la fin, et vous verrez que, si chacun s’occupe de soi, Dieu pense à tous.
Notre constante application est donc de diminuer l’effort proportionnellement à l’effet utile cherché. Mais quand l’effort est diminué, soit par la destruction de l’obstacle, soit par l’invention des machines, la séparation des travaux, l’union des forces, l’intervention d’un agent naturel, etc., cet effort amoindri est moins apprécié comparativement aux autres ; on rend un moindre service en le faisant pour autrui ; il a moins de Valeur, et il est très-exact de dire que la Propriété a reculé. L’effet utile est-il pour cela perdu ? Non, d’après l’hypothèse même. Où est-il donc passé ? dans le domaine de la Communauté. Quant à cette portion d’effort humain que l’effet utile n’absorbe plus, elle n’est pas pour cela stérile ; elle se tourne vers d’autres conquêtes. Assez d’obstacles se présentent et se présenteront toujours devant l’expansibilité indéfinie de nos besoins physiques, intellectuels et moraux, pour que le travail, libre d’un côté, trouve à quoi se prendre de l’autre. — Et c’est ainsi que, le fonds approprié restant le même, le fonds commun se dilate comme un cercle dont le rayon s’allongerait toujours.
Sans cela, comment pourrions-nous expliquer le progrès, la civilisation, quelque imparfaite qu’elle soit ? Tournons nos regards sur nous-mêmes ; considérons notre faiblesse ; comparons notre vigueur et nos connaissances avec la vigueur et les connaissances que supposent les innombrables satisfactions qu’il nous est donné de puiser dans le milieu social. Certes, nous resterons convaincus que, réduits à nos propres efforts, nous n’en atteindrions pas la cent-millième partie, mît-on à la disposition de chacun de nous des millions d’hectares de terre inculte. Il est donc certain qu’une quantité donnée d’efforts humains réalise immensément plus de résultats aujourd’hui qu’au temps des Druides. Si cela n’était vrai que d’un individu, l’induction naturelle serait qu’il vit et prospère aux dépens d’autrui. Mais puisque le phénomène se manifeste dans tous les membres de la famille humaine, il faut bien arriver à cette conclusion consolante, que quelque chose qui n’est pas de nous est venu à notre aide ; que la coopération gratuite de la nature s’est progressivement ajoutée à nos propres efforts, et qu’elle reste gratuite à travers toutes nos transactions ; — car, si elle n’était pas gratuite, elle n’expliquerait rien.
De ce qui précède, nous devons déduire ces formules :
Toute propriété est une Valeur ; toute Valeur est une Propriété.
Ce qui n’a pas de valeur est gratuit ; ce qui est gratuit est commun.
Baisse de valeur, c’est approximation vers la gratuité.
Approximation vers la gratuité, c’est réalisation partielle de Communauté.
Il est des temps où l’on ne peut prononcer certains mots sans s’exposer à de fausses interprétations. Il ne manquera pas de gens prêts à s’écrier, dans une intention laudative ou critique, selon le camp : « L’auteur parle de communauté, donc il est communiste. » Je m’y attends, et je m’y résigne. Mais en acceptant d’avance le calice, je n’en dois pas moins m’efforcer de l’éloigner.
Il faudra que le lecteur ait été bien inattentif (et c’est pourquoi la classe de lecteurs la plus redoutable est celle qui ne lit pas), s’il n’a pas vu l’abîme qui sépare la Communauté et le Communisme. Entre ces deux idées, il y a toute l’épaisseur non-seulement de la propriété, mais encore du droit, de la liberté, de la justice, et même de la personnalité humaine.
La Communauté s’entend des biens dont nous jouissons en commun, par destination providentielle, sans qu’il y ait aucun effort à faire pour les appliquer à notre usage ; — ils ne peuvent donc donner lieu à aucun service, à aucune transaction, à aucune Propriété. Celle-ci a pour fondement le droit que nous avons de nous rendre des services à nous-mêmes, ou d’en rendre aux autres à charge de revanche.
Ce que le Communiste veut mettre en commun, ce n’est pas le don gratuit de Dieu, c’est l’effort humain, c’est le service.
Il veut que chacun porte à la masse le fruit de son travail, et il charge ensuite l’autorité de faire de cette masse une répartition équitable.
Or, de deux choses l’une : ou cette répartition se fera proportionnellement aux mises, ou elle sera assise sur une autre base.
Dans le premier cas, le communisme aspire à réaliser, quant au résultat, l’ordre actuel, se bornant à substituer l’arbitraire d’un seul à la liberté de tous.
Dans le second cas, quelle sera la base de la répartition ? Le Communisme répond : L’égalité. — Quoi ! l’égalité sans avoir égard à la différence des peines ! On aura part égale, qu’on ait travaillé six heures ou douze, machinalement ou avec intelligence ! — Mais c’est de toutes les inégalités la plus choquante ; en outre, c’est la destruction de toute activité, de toute liberté, de toute dignité, de toute sagacité. Vous prétendez tuer la concurrence ; mais prenez garde, vous ne faites que la transformer. On concourt aujourd’hui à qui travaillera plus et mieux. On concourra, sous votre régime, à qui travaillera plus mal et moins.
Le communisme méconnaît la nature même de l’homme. L’effort est pénible en lui-même. Qu’est-ce qui nous y détermine ? Ce ne peut être qu’un sentiment plus pénible encore, un besoin à satisfaire, une douleur à éloigner, un bien à réaliser. Notre mobile est donc l’intérêt personnel. Quand on demande au communisme ce qu’il y veut substituer, il répond par la bouche de Louis Blanc : Le point d’honneur, — et par celle de M. Cabet : La fraternité. Faites donc que j’éprouve les sensations d’autrui, afin que je sache au moins quelle direction je dois imprimer à mon travail.
Et puis qu’est-ce qu’un point d’honneur, une fraternité, mis en œuvre dans l’humanité entière par l’incitation et sous l’inspection de MM. Louis Blanc et Cabet ?
Mais je n’ai pas ici à réfuter le communisme. Tout ce que je veux faire remarquer, c’est qu’il est justement l’opposé, en tous points, du système que j’ai cherché à établir.
Nous reconnaissons à l’homme le droit de se servir lui-même, ou de servir les autres à des conditions librement débattues. Le communisme nie ce droit, puisqu’il centralise tous les services dans les mains d’une autorité arbitraire.
Notre doctrine est fondée sur la Propriété. Le Communisme est fondé sur la spoliation systématique, puisqu’il consiste à livrer à l’un, sans compensation, le travail de l’autre. En effet, s’il distribuait à chacun selon son travail, il reconnaîtrait la propriété, il ne serait plus le Communisme.
Notre doctrine est fondée sur la liberté. À vrai dire, propriété et liberté, c’est à nos yeux une seule et même chose ; car ce qui fait qu’on est propriétaire de son service, c’est le droit et la faculté d’en disposer. Le communisme anéantit la liberté, puisqu’il ne laisse à personne la libre disposition de son travail.
Notre doctrine est fondée sur la justice ; le Communisme, sur l’injustice. Cela résulte de ce qui précède.
Il n’y a donc qu’un point de contact entre les communistes et nous : c’est une certaine similitude des syllabes qui entrent dans les mots communisme et communauté.
Mais que cette similitude n’égare pas l’esprit du lecteur. Pendant que le Communisme est la négation de la Propriété, nous voyons dans notre doctrine sur la Communauté l’affirmation la plus explicite et la démonstration la plus péremptoire de la Propriété.
Car si la légitimité de la propriété a pu paraître douteuse et inexplicable, même à des hommes qui n’étaient pas communistes, c’est qu’ils croyaient qu’elle concentrait entre les mains de quelques-uns, à l’exclusion de quelques autres, les dons de Dieu communs à l’origine. Nous croyons avoir radicalement dissipé ce doute, en démontrant que ce qui était commun par destination providentielle reste commun à travers toutes les transactions humaines, le domaine de la propriété ne pouvant jamais s’étendre au delà de la valeur, du droit onéreusement acquis par des services rendus.
Et, dans ces termes, qui peut nier la propriété ? Qui pourrait, sans folie, prétendre que les hommes n’ont aucun droit sur leur propre travail, qu’ils reçoivent, sans droit, les services volontaires de ceux à qui ils ont rendu de volontaires services ?
Il est un autre mot sur lequel je dois m’expliquer, car dans ces derniers temps on en a étrangement abusé. C’est le mot gratuité. Ai-je besoin de dire que j’appelle gratuit, non point ce qui ne coûte rien à un homme, parce qu’on l’a pris à un autre, mais ce qui ne coûte rien à personne ?
Quand Diogène se chauffait au soleil, on pouvait dire qu’il se chauffait gratuitement, car il recueillait de la libéralité divine une satisfaction qui n’exigeait aucun travail, ni de lui ni d’aucun de ses contemporains. J’ajoute que cette chaleur des rayons solaires reste gratuite alors que le propriétaire la fait servir à mûrir son blé et ses raisins, attendu qu’en vendant ses raisins et son blé, il se fait payer ses services et non ceux du soleil. Cette vue peut être erronée (en ce cas, il ne nous reste qu’à nous faire communiste) ; mais, en tous cas, tel est le sens que je donne et qu’emporte évidemment le mot gratuité.
On parle beaucoup, depuis la République, de crédit gratuit, d’instruction gratuite. Mais il est clair qu’on enveloppe un grossier sophisme dans ce mot. Est-ce que l’État peut faire que l’instruction se répande, comme la lumière du jour, sans qu’il en coûte aucun effort à personne ? Est-ce qu’il peut couvrir la France d’institutions et de professeurs qui ne se fassent pas payer de manière ou d’autre ? Tout ce que l’État peut faire, c’est ceci : au lieu de laisser chacun réclamer et rémunérer volontairement ce genre de services, l’État peut arracher, par l’impôt, cette rémunération aux citoyens, et leur faire distribuer ensuite l’instruction de son choix, sans exiger d’eux une seconde rémunération. En ce cas, ceux qui n’apprennent pas payent pour ceux qui apprennent, ceux qui apprennent peu pour ceux qui apprennent beaucoup, ceux qui se destinent aux travaux manuels pour ceux qui embrasseront les carrières libérales. C’est le Communisme appliqué à une branche de l’activité humaine. Sous ce régime, que je n’ai pas à juger ici, on pourra dire, on devra dire : l’instruction est commune, mais il serait ridicule de dire : l’instruction est gratuite. Gratuite ! oui, pour quelques-uns de ceux qui la reçoivent, mais non pour ceux qui la payent, sinon au professeur, du moins au percepteur.
Il n’est rien que l’État ne puisse donner gratuitement à ce compte ; et si ce mot n’était pas une mystification, ce n’est pas seulement l’instruction gratuite qu’il faudrait demander à l’État, mais la nourriture gratuite, le vêtement gratuit, le vivre et le couvert gratuits, etc. Qu’on y prenne garde. Le peuple en est presque là ; du moins il ne manque pas de gens qui demandent en son nom le crédit gratuit, les instruments de travail gratuits, etc., etc. Dupes d’un mot, nous avons fait un pas dans le Communisme ; quelle raison avons-nous de n’en pas faire un second, puis un troisième, jusqu’à ce que toute liberté, toute propriété, toute justice y aient passé ? Dira-t-on que l’instruction est si universellement nécessaire qu’on peut, en sa faveur, faire fléchir le droit et les principes ? Mais quoi ! est-ce que l’alimentation n’est pas plus nécessaire encore ? Primo vivere, deinde philosophari, dira le peuple, et je ne sais en vérité ce qu’on aura à lui répondre.
Qui sait ? ceux qui m’imputeront à communisme d’avoir constaté la communauté providentielle des dons de Dieu seront peut-être les mêmes qui violeront le droit d’apprendre et d’enseigner, c’est-à-dire la propriété dans son essence. Ces inconséquences sont plus surprenantes que rares.
IX. Propriété foncière↩
Si l’idée dominante de cet écrit est vraie, voici comment il faut se représenter l’Humanité dans ses rapports avec le monde extérieur.
Dieu a créé la terre. Il a mis à sa surface et dans ses entrailles une foule de choses utiles à l’homme, en ce qu’elles sont propres à satisfaire ses besoins.
En outre, il a mis dans la matière des forces : gravitation, élasticité, porosité, compressibilité, calorique, lumière, électricité, cristallisation, vie végétale.
Il a placé l’homme en face de ces matériaux et de ces forces. Il les lui a livrés gratuitement.
Les hommes se sont mis à exercer leur activité sur ces matériaux et ces forces ; par là ils se sont rendu service à eux-mêmes. Ils ont aussi travaillé les uns pour les autres ; par là ils se sont rendu des services réciproques. Ces services comparés dans l’échange ont fait naître l’idée de Valeur, et la Valeur celle de Propriété.
Chacun est donc devenu propriétaire en proportion de ses services. Mais les forces et les matériaux, donnés par Dieu gratuitement à l’homme dès l’origine, sont demeurés, sont encore et seront toujours gratuits, à travers toutes les transactions humaines ; car dans les appréciations auxquelles donnent lieu les échanges, ce sont les services humains, et non les dons de Dieu, qui s’évaluent.
Il résulte de là qu’il n’y en a pas un seul parmi nous, tant que les transactions sont libres, qui cesse jamais d’être usufruitier de ces dons. Une seule condition nous est posée, c’est d’exécuter le travail nécessaire pour les mettre à notre portée, ou, si quelqu’un prend cette peine pour nous, de prendre pour lui une peine équivalente.
Si c’est là la vérité, certes la Propriété est inébranlable.
L’universel instinct de l’Humanité, plus infaillible qu’aucune élucubration individuelle, s’en tenait, sans l’analyser, à cette donnée, quand la théorie est venue scruter les fondements de la Propriété.
Malheureusement elle débuta par une confusion : elle prit l’Utilité pour la Valeur. Elle attribua une valeur propre indépendante de tout service humain, soit aux matériaux, soit aux forces de la nature. À l’instant la propriété fut aussi injustifiable qu’inintelligible.
Car Utilité est un rapport entre la chose et notre organisation. Elle n’implique nécessairement ni efforts, ni transactions, ni comparaisons ; elle se peut concevoir en elle-même et relativement à l’homme isolé. Valeur, au contraire, est un rapport d’homme à homme ; pour exister, il faut qu’elle existe en double, rien d’isolé ne se pouvant comparer. Valeur implique que celui qui la détient ne la cède que contre une valeur égale. — La théorie qui confond ces deux idées arrive donc à supposer qu’un homme, dans l’échange, donne de la prétendue valeur de création naturelle contre de la vraie valeur de création humaine, de l’utilité qui n’a exigé aucun travail contre de l’utilité qui en a exigé, en d’autres termes, qu’il peut profiter du travail d’autrui sans travailler. — La théorie appela la Propriété ainsi comprise d’abord monopole nécessaire, puis monopole tout court, ensuite illégitimité, et finalement vol.
La Propriété foncière reçut le premier choc. Cela devait être. Ce n’est pas que toutes les industries ne fassent intervenir dans leur œuvre des forces naturelles ; mais ces forces se manifestent d’une manière beaucoup plus éclatante, aux yeux de la multitude, dans les phénomènes de la vie végétale et animale, dans la production des aliments et de ce qu’on nomme improprement matières premières, œuvres spéciales de l’agriculture.
D’ailleurs, si un monopole devait plus que tout autre révolter la conscience humaine, c’était sans doute celui qui s’appliquait aux choses les plus nécessaires à la vie.
La confusion dont il s’agit, déjà fort spécieuse au point de vue scientifique, puisque aucun théoricien que je sache n’y a échappé, devenait plus spécieuse encore par le spectacle qu’offre le monde.
On voyait souvent le Propriétaire foncier vivre sans travailler, et l’on en tirait cette conclusion assez plausible : « Il faut bien qu’il ait trouvé le moyen de se faire rémunérer pour autre chose que pour son travail. » Cette autre chose, que pouvait-elle être, sinon la fécondité, la productivité, la coopération de l’instrument, le sol ? C’est donc la rente du sol qui fut flétrie, selon les époques, des noms de monopole nécessaire, privilége, illégitimité, vol.
Il faut le dire : la théorie a rencontré sur son chemin un fait qui a dû contribuer puissamment à l’égarer. Peu de terres, en Europe, ont échappé à la conquête et à tous les abus qu’elle entraîne. La science a pu confondre la manière dont la Propriété foncière a été acquise violemment avec la manière dont elle se forme naturellement.
Mais il ne faut pas imaginer que la fausse définition du mot valeur se soit bornée à ébranler la Propriété foncière. C’est une terrible et infatigable puissance que la logique, qu’elle parte d’un bon ou d’un mauvais principe ! Comme la terre, a-t-on dit, fait concourir à la production de la valeur la lumière, la chaleur, l’électricité, la vie végétale, etc., de même le capital ne fait-il pas concourir à la production de la valeur le vent, l’élasticité, la gravitation ? Il y a donc des hommes, outre les agriculteurs, qui se font payer aussi l’intervention des agents naturels. Cette rémunération leur arrive par l’intérêt du capital, comme aux propriétaires fonciers par la rente du sol. Guerre donc à l’intérêt comme à la Rente !
Voici donc la gradation des coups qu’a subis la Propriété, au nom de ce principe faux selon moi, vrai selon les économistes et les égalitaires, à savoir : les agents naturels ont ou créent de la valeur. — Car, il faut bien le remarquer, c’est une prémisse sur laquelle toutes les écoles sont d’accord. Leur dissidence consiste uniquement dans la timidité ou la hardiesse des déductions.
Les Économistes ont dit : la propriété (du sol) est un privilége ; mais il est nécessaire, il faut le maintenir.
Les Socialistes : la propriété (du sol) est un privilége ; mais il est nécessaire, il faut le maintenir — en lui demandant une compensation, le droit au travail.
Les Communistes et les Égalitaires : la propriété (en général) est un privilége, il faut la détruire.
Et moi, je crie à tue-tête : La Propriété n’est pas un privilége. Votre commune prémisse est fausse, donc vos trois conclusions, quoique diverses, sont fausses. La Propriété n’est pas un privilége, donc il ne faut ni la tolérer par grâce, ni lui demander une compensation, ni la détruire.
Passons brièvement en revue les opinions émises sur ce grave sujet par les diverses écoles.
On sait que les économistes anglais ont posé ce principe sur lequel ils semblent unanimes : la valeur vient du travail. Qu’ils s’accordent entre eux, c’est possible ; mais s’accordent-ils avec eux-mêmes ? C’est là ce qui eût été désirable, et le lecteur va en juger. Il verra s’ils ne confondent pas toujours et partout l’Utilité gratuite, non rémunérable, sans valeur, avec l’Utilité onéreuse, seule due au travail, seule, d’après eux-mêmes, pourvue de valeur.
Ad. Smith. « Dans la culture de la terre, la nature travaille conjointement avec l’homme, et, quoique le travail de la nature ne coûte aucune dépense, ce qu’il produit n’en a pas moins sa Valeur, aussi bien que ce que produisent les ouvriers les plus chers. »
Voici donc la nature produisant de la Valeur. Il faut bien que l’acheteur du blé la paye, quoiqu’elle n’ait rien coûté à personne, pas même du travail. Qui donc ose se présenter pour recevoir cette prétendue valeur ? À la place de ce mot, mettez le mot utilité, et tout s’éclaircit, et la Propriété est justifiée, et la justice est satisfaite.
« On peut considérer la rente comme le produit de cette puissance de la nature dont le propriétaire prête la jouissance au fermier… Elle est (la rente !) l’œuvre de la nature, qui reste après qu’on a déduit ou compensé tout ce qu’on peut regarder comme l’œuvre de l’homme. C’est rarement moins du quart et souvent plus du tiers du produit total. Jamais une quantité égale de travail humain, employé dans les manufactures, ne saurait opérer une aussi grande reproduction. Dans celles-ci, la nature ne fait rien, c’est l’homme qui fait tout. »
Peut-on accumuler en moins de mots plus d’erreurs dangereuses ? Ainsi le quart ou le tiers de la valeur des subsistances est dû à l’exclusive puissance de la nature. Et cependant le propriétaire se fait payer par le fermier, et le fermier par le prolétaire, cette prétendue valeur qui reste après que l’œuvre de l’homme est rémunérée. Et c’est sur cette base que vous voulez asseoir la propriété ! Que faites-vous d’ailleurs de l’axiome : Toute valeur vient du travail ?
Puis voici la nature qui ne fait rien dans les fabriques ! Quoi ! la gravitation, l’élasticité des gaz, la force des animaux n’aident pas le manufacturier ! Ces forces agissent dans les fabriques exactement comme dans les champs, elles produisent gratuitement, non de la valeur, mais de l’utilité. Sans quoi la propriété des capitaux ne serait pas plus à l’abri que celle du sol des inductions communistes.
Buchanan. Ce commentateur, adoptant la théorie du maitre sur la Rente, poussé par la logique, le blâme de l’avoir jugée avantageuse.
« Smith, en regardant la portion de la production territoriale qui représente le profit du fonds de terre (quelle langue !) comme avantageuse à la société, n’a pas réfléchi que la Rente n’est que l’effet de la cherté, et que ce que le propriétaire gagne de cette manière, il ne le gagne qu’aux dépens du consommateur. La société ne gagne rien par la reproduction du profit des terres. C’est une classe qui profite aux dépens des autres. »
On voit apparaître ici la déduction logique : la rente est une injustice.
Ricardo. « La rente est cette portion du produit de la terre que l’on paye au propriétaire pour avoir le droit d’exploiter les facultés productives et impérissables du sol. »
Et, afin qu’on ne s’y trompe pas, l’auteur ajoute :
« On confond souvent la rente avec l’intérêt et le profit du capital… Il est évident qu’une portion de la rente représente l’intérêt du capital consacré à amender le terrain, à ériger les constructions nécessaires, etc., le reste est payé pour exploiter les propriétés naturelles et indestructibles du sol. — C’est pourquoi, quand je parlerai de rente, dans la suite de cet ouvrage, je ne désignerai sous ce nom que ce que le fermier paye au propriétaire pour le droit d’exploiter les facultés primitives et indestructibles du sol. »
Mac Culloch. « Ce qu’on nomme proprement la Rente, c’est la somme payée pour l’usage des forces naturelles et de la puissance inhérente au sol. Elle est entièrement distincte de la somme payée à raison des constructions, clôtures, routes, et autres améliorations foncières. La rente est donc toujours un monopole. »
Scrope. « La valeur de la terre et la faculté d’en tirer une Rente sont dues à deux circonstances : 1° à l’appropriation de ses puissances naturelles ; 2° au travail appliqué à son amélioration. »
La conséquence ne s’est pas fait longtemps attendre :
« Sous le premier rapport, la rente est un monopole. C’est une restriction à l’usufruit des dons que le Créateur a faits aux hommes pour la satisfaction de leurs besoins. Cette restriction n’est juste qu’autant qu’elle est nécessaire pour le bien commun. »
Quelle ne doit pas être la perplexité des bonnes âmes qui se refusent à admettre que rien soit nécessaire qui ne soit juste ?
Enfin Scrope termine par ces mots :
« Quand elle dépasse ce point, il la faut modifier en vertu du principe qui la fit établir. »
Il est impossible que le lecteur n’aperçoive pas que ces auteurs nous ont menés à la négation de la Propriété, et nous y ont menés très-logiquement en partant de ce point : le propriétaire se fait payer les dons de Dieu. Voici que le fermage est une injustice que la Loi a établie sous l’empire de la nécessité, qu’elle peut modifier ou détruire sous l’empire d’une autre nécessité. Les Communistes n’ont jamais dit autre chose.
Senior. « Les instruments de la production sont le travail et les agents naturels. Les agents naturels ayant été appropriés, les propriétaires s’en font payer l’usage, sous forme de Rente, qui n’est la récompense d’aucun sacrifice quelconque, et est reçue par ceux qui n’ont ni travaillé ni fait des avances, mais qui se bornent à tendre la main pour recevoir les offrandes de la communauté. »
Après avoir porté ce rude coup à la propriété, Senior explique qu’une partie de la Rente répond à l’intérêt du capital, puis il ajoute :
« Le surplus est prélevé par le propriétaire des agents naturels, et forme sa récompense, non pour avoir travaillé ou épargné, mais simplement pour n’avoir pas gardé quand il pouvait garder, pour avoir permis que les dons de la nature fussent acceptés. »
On le voit, c’est toujours la même théorie. On suppose que le propriétaire s’interpose entre la bouche qui a faim et l’aliment que Dieu lui avait destiné, sous la condition du travail. Le propriétaire, qui a concouru à la production, se fait payer pour ce travail, ce qui est juste, et il se fait payer une seconde fois pour le travail de la nature, pour l’usage des forces productives, des puissances indestructibles du sol, ce qui est inique.
Cette théorie, développée par les économistes anglais, Mill, Malthus, etc., on la voit avec peine prévaloir aussi sur le continent.
« Quand un franc de semence, dit Scialoja, donne cent francs de blé, cette augmentation de valeur est due, en grande partie, à la terre. »
C’est confondre l’Utilité et la valeur. Autant vaudrait dire : Quand l’eau, qui ne coûtait qu’un sou à dix pas de la source, coûte dix sous à cent pas, cette augmentation de valeur est due en partie à l’intervention de la nature.
Florez Estrada. « La rente est cette partie du produit agricole qui reste après que tous les frais de la production ont été couverts. »
Donc le propriétaire reçoit quelque chose pour rien.
Les économistes anglais commencent tous par poser ce principe : La valeur vient du travail. Ce n’est donc que par une inconséquence qu’ils attribuent ensuite de la valeur aux puissances du sol.
Les économistes français, en général, voient la valeur dans l’utilité ; mais, confondant l’utilité gratuite avec l’utilité onéreuse, ils ne portent pas à la Propriété de moins rudes coups.
J.-B. Say. « La terre n’est pas le seul agent de la nature qui soit productif ; mais c’est le seul, ou à peu près, que l’homme ait pu s’approprier. L’eau de mer, des rivières, par la faculté qu’elle a de mettre en mouvement nos machines, de nourrir des poissons, de porter nos bateaux, a bien aussi un pouvoir productif. Le vent, et jusqu’à la chaleur du soleil, travaillent pour nous ; mais, heureusement, personne n’a pu dire : Le vent et le soleil m’appartiennent, et le service qu’ils rendent doit m’être payé. »
Say semble déplorer ici que quelqu’un ait pu dire : La terre m’appartient, et le service qu’elle rend doit m’être payé. — Heureusement, dirai-je, il n’est pas plus au pouvoir du propriétaire de se faire payer les services du sol que ceux du vent et du soleil.
« La terre est un atelier chimique admirable, où se combinent et s’élaborent une foule de matériaux et d’éléments qui en sortent sous la forme de froment, de fruits, de lin, etc. La nature a fait présent gratuitement à l’homme de ce vaste atelier, divisé en une foule de compartiments propres à diverses productions. Mais certains hommes, entre tous, s’en sont emparés, et ont dit : À moi ce compartiment, à moi cet autre ; ce qui en sortira sera ma propriété exclusive. Et chose étonnante ! ce privilége usurpé, loin d’avoir été funeste à la communauté, s’est trouvé lui être avantageux. »
Oui, sans doute, cet arrangement lui a été avantageux ; mais pourquoi ? parce qu’il n’est ni privilégié ni usurpé ; parce que celui qui a dit : « À moi ce compartiment, » n’a pas pu ajouter : « Ce qui en sortira sera ma propriété exclusive ; » mais bien : Ce qui en sortira sera la propriété exclusive de quiconque voudra l’acheter, en me restituant simplement la peine que j’aurai prise, celle que je lui aurai épargnée ; la collaboration de la nature, gratuite pour moi, le sera aussi pour lui.
Say, qu’on le remarque bien, distingue, dans la valeur du blé, la part de la Propriété, la part du Capital et la part du Travail. Il se donne beaucoup de peine, à bonne intention, pour justifier cette première part de rémunération qui revient au propriétaire, et qui n’est la récompense d’aucun travail antérieur ou actuel. Mais il n’y parvient pas, car, comme Scrope, il se rabat sur la dernière et la moins satisfaisante des ressources : la nécessité.
« S’il est impossible que la production ait lieu non seulement sans fonds de terre et sans capitaux, mais sans que ces moyens de production soient des propriétés, ne peut-on pas dire que leurs propriétaires exercent une fonction productive, puisque, sans elle, la production n’aurait pas lieu ? fonction commode, à la vérité, mais qui, cependant, dans l’état actuel de nos sociétés, a exigé une accumulation, fruit d’une production ou d’une épargne, etc. »
La confusion saute aux yeux. Ce qui a exigé une accumulation, c’est le rôle du propriétaire, en tant que capitaliste, et celui-là n’est pas contesté ni en question. Mais ce qui est commode, c’est le rôle du propriétaire, en tant que propriétaire, en tant que se faisant payer les dons de Dieu. C’est ce rôle-là qu’il fallait justifier, et il n’y a là ni accumulation ni épargne à alléguer.
« Si donc les propriétés territoriales et capitales (pourquoi assimiler ce qui est différent ?) sont le fruit d’une production, je suis fondé à représenter ces propriétés comme des machines travaillantes, productives, dont les auteurs, en se croisant les bras, tireraient un loyer. »
Toujours même. Celui qui a fait une machine a une propriété capitale, dont il tire un loyer légitime, parce qu’il se fait payer, non le travail de la machine, mais le travail qu’il a exécuté lui-même pour la faire. Mais le sol, propriété territoriale, n’est pas le fruit d’une production humaine. À quel titre se fait-on payer pour sa coopération ? L’auteur a accolé ici deux propriétés de natures diverses pour induire l’esprit à innocenter l’une par les motifs qui innocentent l’autre.
Blanqui. « Le cultivateur, qui laboure, fume, ensemence et moissonne son champ, fournit un travail sans lequel il ne saurait rien recueillir. Mais l’action de la terre qui fait fermenter la semence, et celle du soleil qui conduit la plante à sa maturité, sont indépendantes de ce travail et concourent à la formation des valeurs que représente la récolte… Smith et plusieurs économistes ont prétendu que le travail de l’homme était l’unique source des valeurs. Non, certes, l’industrie du laboureur n’est pas l’unique source de la valeur d’un sac de blé, ni d’un boisseau de pommes de terre. Jamais son talent n’ira jusqu’à créer le phénomène de la germination, pas plus que la patience des alchimistes n’a découvert le secret de faire de l’or. Cela est évident. »
Il n’est pas possible de faire une confusion plus complète, d’abord entre l’utilité et la valeur, ensuite entre l’utilité gratuite et l’utilité onéreuse.
Joseph Garnier. « La rente du propriétaire diffère essentiellement des rétributions payées à l’ouvrier pour son travail, ou à l’entrepreneur pour le profit des avances par lui faites, en ce que ces deux genres de rétribution sont l’indemnité, l’un d’une peine, l’autre d’une privation et d’un risque auquel on s’est soumis, au lieu que la Rente est reçue par le propriétaire, plus gratuitement et en vertu seulement d’une convention légale qui reconnaît et maintient à certains individus le droit de propriété foncière. » (Eléments de l’économie politique, 2e édit., p. 293.)
En d’autres termes, l’ouvrier et l’entrepreneur sont payés, de par l’équité, pour des services qu’ils rendent ; le propriétaire est payé, de par la loi, pour des services qu’il ne rend pas.
« Les plus hardis novateurs ne font autre chose que proposer le remplacement de la propriété individuelle par la propriété collective… Ils ont bien, ce nous semble, raison en droit humain : mais ils auront tort pratiquement tant qu’ils n’auront pas su montrer les avantages d’un meilleur système économique… » (Ibid., pag. 377 et 378.)
« Mais longtemps encore, en avouant que la propriété est un privilége, un monopole, on ajoutera que c’est un monopole utile, naturel… »
« En résumé, on semble admettre, en économie politique (hélas ! oui, et voilà le mal) que la propriété ne découle pas du droit divin, du droit domanial ou de tout autre droit spéculatif, mais bien de son utilité. Ce n’est qu’un monopole toléré dans l’intérêt de tous, etc. »
C’est identiquement l’arrêt prononcé par Scrope et répété par Say en termes adoucis.
Je crois avoir suffisamment prouvé que l’économie politique, partant de cette fausse donnée : « Les agents naturels ont ou créent de la valeur, » était arrivée à cette conclusion : « La propriété (en tant qu’elle accapare et se fait payer cette valeur étrangère à tout service humain) est un privilége, un monopole, une usurpation. Mais c’est un privilége nécessaire, il le faut maintenir. »
Il me reste à faire voir que les Socialistes partent de la même donnée ; seulement, ils modifient ainsi la conclusion : « La propriété est un privilége nécessaire ; il le faut maintenir, mais en demandant au propriétaire une compensation, sous forme de droit au travail, en faveur des prolétaires. »
Ensuite je ferai comparaître les communistes, qui disent, toujours en se fondant sur la même donnée : La propriété est un privilége, il la faut abolir.
Et enfin, au risque de me répéter, je terminerai en renversant, s’il est possible, la commune prémisse de ces trois conclusions : les agents naturels ont ou créent de la valeur. Si j’y parviens, si je démontre que les agents naturels, même appropriés, ne produisent pas de la Valeur, mais de l’Utilité qui, passant par la main du propriétaire, sans y rien laisser, arrive gratuitement au consommateur, — en ce cas, économistes, socialistes, communistes, tous devront enfin s’accorder pour laisser, à cet égard, le monde tel qu’il est.
M. Considérant [242] . « Pour voir comment et à quelles conditions la Propriété particulière peut se manifester et se développer Légitimement, il nous faut posséder le Principe fondamental du droit de Propriété. Le voici :
« Tout homme possède Légitimement la chose que son travail, son intelligence ou plus généralement que son activité a créée.
Ce Principe est incontestable, et il est bon de remarquer qu’il contient implicitement la reconnaissance du Droit de tous à la Terre. En effet, la terre n’ayant pas été créée par l’homme, il résulte du Principe fondamental de la Propriété que la Terre, le fonds commun livré à l’Espèce, ne peut en aucune façon être légitimement la propriété absolue et exclusive de tels ou tels individus qui n’ont pas créé cette valeur. — Constituons donc la vraie théorie de la Propriété, en la fondant exclusivement sur le principe irrécusable qui assoit la Légitimité de la Propriété sur le fait de la création de la chose ou de la valeur possédée. Pour cela faire, nous allons raisonner sur la création de l’Industrie, c’est-à dire sur l’origine et sur le développement de la culture, de la fabrication, des arts, etc., dans la Société humaine.
Supposons que sur le terrain d’une île isolée, sur le sol d’une nation, ou sur la terre entière (l’étendue du théâtre de l’action ne change rien à l’appréciation des faits), une génération humaine se livre pour la première fois à l’industrie, pour la première fois elle cultive, fabrique, etc. — Chaque génération, par son travail, par son intelligence, par l’emploi de son activité propre, crée des produits, développe des valeurs qui n’existaient pas sur la terre brute. N’est-il pas parfaitement évident que la Propriété sera conforme au Droit dans cette première génération industrieuse, SI la valeur ou la richesse produite par l’activité de tous est répartie entre les producteurs en proportion du concours de chacun à la création de la richesse générale ? Cela n’est pas contestable.
Or, les résultats du travail de cette génération se divisent en deux catégories qu’il importe de bien distinguer.
La première catégorie comprend les produits du sol, qui appartenait à cette première génération en sa qualité d’usufruitière, augmentés, raffinés ou fabriqués par son travail, par son industrie. Ces produits, bruts ou fabriqués, consistent, soit en objets de consommation, soit en instruments de travail. Il est clair que ces produits appartiennent en toute et légitime propriété à ceux qui les ont créés par leur activité. Chacun de ceux-ci a donc Droit, soit à consommer immédiatement ces produits, soit à les mettre en réserve pour en disposer plus tard à sa convenance, soit à les employer, les échanger, ou les donner et les transmettre à qui bon lui semble, sans avoir besoin pour cela de l’autorisation de qui que ce soit. Dans cette hypothèse, cette Propriété est évidemment Légitime, respectable, sacrée. On ne peut y porter atteinte sans attenter à la Justice, au Droit et à la Liberté individuelle, enfin sans exercer une spoliation.
Deuxième catégorie. Mais les créations dues à l’activité industrieuse de cette première génération ne sont pas toutes contenues dans la catégorie précédente. Non seulement cette génération a créé les produits que nous venons de désigner (objets de consommation et instruments de travail), mais encore elle a ajouté une Plus-value à la valeur primitive du sol par la culture, par les constructions, par tous les travaux de fonds et immobiliers qu’elle a exécutés.
Cette Plus-value constitue évidemment un produit, une valeur due à l’activité de la première génération. Or, si, par un moyen quelconque (ne nous occupons pas ici de la question des moyens), si, par un moyen quelconque, la propriété de cette Plus-value est équitablement, c’est-à dire proportionnellement au concours de chacun dans la création distribuée aux divers membres de la société, chacun de ceux-ci possédera Légitimement la part qui lui sera revenue. Il pourra donc disposer de cette Propriété-individuelle légitime comme il l’entendra, l’échanger, la donner, la transmettre sans qu’aucun des autres individus, c’est-à-dire la Société, puisse jamais avoir, sur ces valeurs, un droit et une autorité quelconques.
Nous pouvons donc parfaitement concevoir que, quand la seconde génération arrivera, elle trouvera sur la terre deux sortes de capitaux :
A. Le capital Primitif ou Naturel qui n’a pas été créé par les hommes de la première génération, — c’est-à-dire la valeur de la terre brute ;
B. Le Capital créé par la première génération, comprenant : 1° les produits, denrées et instruments, qui n’auront pas été consommés ou usés par la première génération ; 2° la Plus-value que le travail de la première génération aura ajoutée à la valeur de la terre brute.
Il est donc évident, et il résulte clairement et nécessairement du Principe fondamental du Droit de Propriété, tout à l’heure établi, que chaque individu de la deuxième génération a un Droit égal au Capital Primitif ou Naturel, tandis qu’il n’a aucun droit à l’autre Capital, au Capital Créé par le travail de la première génération. Chaque individu de celle-ci pourra donc disposer de sa part du Capital Créé en faveur de tels ou tels individus de la seconde génération qu’il lui plaira choisir, enfants, amis, etc., sans que personne, sans que l’État lui-même, comme nous venons déjà de le dire, ait rien à prétendre (au nom du Droit de Propriété) sur les dispositions que le donateur ou le légateur aura faites. »
Remarquons que, dans notre hypothèse, l’individu de la seconde génération est déjà avantagé par rapport à celui de la première, puisque, outre le Droit au Capital Primitif qui lui est conservé, il a la chance de recevoir une part du Capital Créé, c’est-à-dire une valeur qu’il n’aura pas produite, et qui représente un travail antérieur.
Si donc nous supposons les choses constituées dans la Société de telle sorte :
1° Que le Droit au Capital Primitif, c’est-à-dire à l’Usufruit du sol dans son état brut, soit conservé, ou qu’un Droit équivalent soit reconnu à chaque individu qui naît sur la terre à une époque quelconque ;
2° Que le Capital Créé soit réparti continuellement entre les hommes, à mesure qu’il se produit, en proportion du concours de chacun à la production de ce Capital ;
Si, disons-nous, le mécanisme de l’organisation sociale satisfait à ces deux conditions, la Propriété, sous un pareil régime, serait constituée dans sa Légitimité absolue. — Le Fait serait conforme au Droit. » (Théorie du droit de propriété et du droit au travail, 3e édit., p. 15.)
On voit ici l’auteur socialiste distinguer deux sortes de valeur : la valeur créée, qui est l’objet d’une propriété légitime, et la valeur incréée, nommée encore valeur de la terre brute, capital primitif, capital naturel, qui ne saurait devenir propriété individuelle que par usurpation. Or, selon la théorie que je m’efforce de faire prévaloir, les idées exprimées par ces mots : incréé, primitif, naturel, excluent radicalement ces autres idées : valeur, capital. C’est pourquoi la prémisse est fausse qui conduit M. Considérant à cette triste conclusion :
« Sous le Régime qui constitue la Propriété dans toutes les nations civilisées, le fonds commun, sur lequel l’espèce tout entière a plein droit d’usufruit, a été envahi ; il se trouve confisqué par le petit nombre à l’exclusion du grand nombre. Eh bien ! n’y eût-il en fait qu’un seul homme exclu de son Droit à l’Usufruit du fonds commun par la nature du Régime de la Propriété, cette exclusion constituerait à elle seule une atteinte au Droit, et le régime de Propriété qui la consacrerait serait certainement injuste, illégitime. »
Cependant M. Considérant reconnaît que la terre ne peut être cultivée que sous le régime de la propriété individuelle. Voilà le monopole nécessaire. Comment donc faire pour tout concilier, et sauvegarder les droits des prolétaires au capital primitif, naturel, incréé, à la valeur de la terre brute ?
« Eh bien ! qu’une Société industrieuse, qui a pris possession de la Terre et qui enlève à l’homme la faculté d’exercer à l’aventure et en liberté, sur la surface du sol, ses quatre Droits naturels ; que cette Société reconnaisse à l’individu, en compensation de ses Droits dont elle le dépouille, le Droit au travail. »
S’il y a quelque chose d’évident au monde, c’est que cette théorie, sauf la conclusion, est exactement celle des économistes. Celui qui achète un produit agricole rémunère trois choses : 1° Le travail actuel, rien de plus légitime ; 2° la plus-value donnée au sol par le travail antérieur, rien de plus légitime encore ; 3° enfin, le capital primitif ou naturel ou incréé, ce don gratuit de Dieu, appelé par Considérant valeur de la terre brute ; par Smith, puissances indestructibles du sol ; par Ricardo, facultés productives et impérissables de la terre ; par Say, agents naturels. C’est là ce qui a été usurpé, selon M. Considérant ; c’est là ce qui a été usurpé d’après J.-B. Say. C’est là ce qui constitue l’illégitimité et la spoliation aux yeux des socialistes ; c’est là ce qui constitue le monopole et le privilége aux yeux des économistes. L’accord se poursuit encore quant à la nécessité, à l’utilité de cet arrangement. Sans lui, la terre ne produirait pas, disent les disciples de Smith ; sans lui, nous reviendrions à l’état sauvage, répètent les disciples de Fourier.
On voit qu’en théorie, en droit, l’entente entre les deux écoles est beaucoup plus cordiale (au moins sur cette grande question) qu’on n’aurait pu l’imaginer. Elles ne se séparent que sur les conséquences à déduire législativement du fait sur lequel on s’accorde. « Puisque la propriété est entachée d’illégitimité en ce qu’elle attribue aux propriétaires une part de rémunération qui ne leur est pas due, et puisque, d’un autre côté, elle est nécessaire, respectons-la et demandons-lui des indemnités. — Non, disent les Économistes, quoiqu’elle soit un monopole, puisqu’elle est nécessaire, respectons-la et laissons-la en repos. » Encore présentent-ils faiblement cette molle défense, car un de leurs derniers organes, J. Garnier, ajoute : « Vous avez raison en droit humain, mais vous aurez tort pratiquement, tant que vous n’aurez pas montré les effets d’un meilleur système. » À quoi les socialistes ne manquent pas de répondre : « Nous l’avons trouvé, c’est le droit au travail, essayez-en. »
Sur ces entrefaites, arrive M. Proudhon. Vous croyez peut-être que ce fameux contradicteur va contredire la grande prémisse Économiste ou Socialiste ? Point du tout. Il n’a pas besoin de cela pour démolir la Propriété. Il s’empare, au contraire, de cette prémisse ; il la serre, il la presse, il en exprime la conséquence la plus logique. « Ah ! dit-il, vous avouez que les dons gratuits de Dieu ont non-seulement de l’utilité, mais de la valeur ; vous avouez que les propriétaires les usurpent et les vendent. Donc, la propriété, c’est le vol. Donc, il ne faut ni la maintenir, ni lui demander des compensations, il la faut abolir. »
M. Proudhon a accumulé beaucoup d’arguments contre la Propriété foncière. Le plus sérieux, le seul sérieux est celui que lui ont fourni les auteurs en confondant l’utilité et la valeur.
« Qui a droit, dit-il, de faire payer l’usage du sol, de cette richesse qui n’est pas le fait de l’homme ? À qui est dû le fermage de la terre ? au producteur de la terre, sans doute. Qui a fait la terre ? Dieu. En ce cas, propriétaire, retire-toi.
… Mais le créateur de la terre ne la vend pas, il la donne ; et, en la donnant, il ne fait aucune acception de personnes. Comment donc parmi tous ses enfants, ceux-là se trouvent-ils traités en aînés, ceux-ci en bâtards ? Comment, si l’égalité des lots fut le droit originel, l’inégalité des conditions est-elle le droit posthume ? »
Répondant à J.-B. Say, qui avait assimilé la terre à un instrument, il dit :
« Je tombe d’accord que la terre est un instrument ; mais quel est l’ouvrier ? Est-ce le propriétaire ? Est-ce lui qui, par la vertu efficace du droit de propriété, lui communique la vigueur et la fécondité ? Voilà précisément en quoi consiste le monopole du propriétaire, que, n’ayant pas fait l’instrument, il s’en fait payer le service. Que le créateur se présente et vienne lui-même réclamer le fermage de la terre, nous compterons avec lui ; ou bien que le propriétaire, soi-disant fondé de pouvoirs, montre sa procuration. »
Cela est évident. Ces trois systèmes n’en font qu’un. Économistes, Socialistes, Égalitaires, tous adressent à la Propriété foncière un reproche, et le même reproche, celui de faire payer ce qu’elle n’a pas le droit de faire payer. Ce tort, les uns l’appellent monopole, les autres illégitimité, et les troisièmes vol ; ce n’est qu’une gradation dans le même grief.
Maintenant, j’en appelle à tout lecteur attentif, ce grief est-il fondé ? N’ai-je pas démontré qu’il n’y a qu’une chose qui se place entre le don de Dieu et la bouche affamée, c’est le service humain ?
Économistes, vous dites : « La rente est ce qu’on paye au propriétaire, pour l’usage des facultés productives et indestructibles du sol. » Je dis : Non. La rente, c’est ce qu’on paye au porteur d’eau pour la peine qu’il s’est donnée à faire une brouette et des roues, et l’eau nous coûterait davantage s’il la portait sur son dos. De même, le blé, le lin, la laine, le bois, la viande, les fruits nous coûteraient plus cher, si le propriétaire n’eût pas perfectionné l’instrument qui les donne.
Socialistes, vous dites : « Primitivement les masses jouissaient de leurs droits à la terre sous la condition du travail, maintenant elles sont exclues et spoliées de leur patrimoine naturel. » Je réponds : Non, elles ne sont pas exclues ni spoliées ; elles recueillent gratuitement l’utilité élaborée par la terre, sous la condition du travail, c’est-à-dire en restituant ce travail à ceux qui le leur épargnent.
Égalitaires, vous dites : « C’est en cela que consiste le monopole du propriétaire, que, n’ayant pas fait l’instrument, il s’en fait payer le service. » Je réponds : Non. L’instrument-terre, en tant que Dieu l’a fait, produit de l’utilité, et cette utilité est gratuite ; il n’est pas au pouvoir du propriétaire de se la faire payer. L’instrument-terre, en tant que le propriétaire l’a préparé, travaillé, clos, desséché, amendé, garni d’autres instruments nécessaires, produit de la valeur, laquelle représente des services humains effectifs, et c’est la seule chose dont le propriétaire se fasse payer. Ou vous devez admettre la légitimité de ce droit, ou vous devez rejeter votre propre principe : la mutualité des services.
Afin de savoir quels sont les vrais éléments de la valeur territoriale, assistons à la formation de la Propriété foncière, non point selon les lois de la violence et de la conquête, mais selon les lois du travail et de l’échange. Voyons comment les choses se passent aux États-Unis.
Frère Jonathan, laborieux porteur d’eau de New-York, partit pour le Far-West, emportant dans son escarcelle un millier de dollars, fruits de son travail et de ses épargnes.
Il traversa bien des fertiles contrées où le sol, le soleil, la pluie accomplissent leurs miracles et qui néanmoins n’ont aucune valeur dans le sens économique et pratique du mot.
Comme il était quelque peu philosophe, il se disait : « Il faut pourtant, quoi qu’en disent Smith et Ricardo, que la valeur soit autre chose que la puissance productive naturelle et indestructible du sol. »
Enfin, il arriva dans l’État d’Arkansas, et il se trouva en face d’une belle terre d’environ cent acres que le gouvernement avait fait piqueter pour la vendre au prix d’un dollar l’acre.
— Un dollar l’acre ! se dit-il, c’est bien peu, si peu qu’en vérité cela se rapproche de rien. J’achèterai cette terre, je la défricherai, je vendrai mes moissons, et, de porteur d’eau que j’étais, je deviendrai, moi aussi, propriétaire !
Frère Jonathan, logicien impitoyable, aimait à se rendre raison de tout. Il se disait : Mais pourquoi cette terre vaut-elle même un dollar l’acre ? Nul n’y a encore mis la main. Elle est vierge de tout travail. Smith et Ricardo, après eux la série des théoriciens jusqu’à Proudhon, auraient-ils raison ? La terre aurait-elle une valeur indépendante de tout travail, de tout service, de toute intervention humaine ? Faudrait-il admettre que les puissances productives et indestructibles du sol valent ? En ce cas, pourquoi ne valent-elles pas dans les pays que j’ai traversés ? Et, en outre, puisqu’elles dépassent, dans une proportion si énorme, le talent de l’homme, qui n’ira jamais jusqu’à créer le phénomène de la germination, suivant la judicieuse remarque de M. Blanqui, pourquoi ces puissances merveilleuses ne valent-elles qu’un dollar ?
Mais il ne tarda pas à comprendre que cette valeur, comme toutes les autres, est de création humaine et sociale. Le gouvernement américain demandait un dollar pour la cession de chaque acre, mais d’un autre côté il promettait de garantir, dans une certaine mesure, la sécurité de l’acquéreur ; il avait ébauché quelque route aux environs, il facilitait la transmission des lettres et journaux, etc., etc. Service pour service, disait Jonathan : le gouvernement me fait payer un dollar, mais il me rend bien l’équivalent. Dès lors, n’en déplaise à Ricardo, je m’explique humainement la Valeur de cette terre, valeur qui serait plus grande encore si la route était plus rapprochée, la poste plus accessible, la protection plus efficace.
Tout en dissertant, Jonathan travaillait ; car il faut lui rendre cette justice qu’il mène habituellement ces deux choses de front.
Après avoir dépensé le reste de ses dollars en bâtisses, clôtures, défrichements, défoncements, dessèchements, arrangements, etc., après avoir foui, labouré, hersé, semé et moissonné, vint le moment de vendre la récolte. « Je vais enfin savoir, s’écria Jonathan toujours préoccupé du problème de la valeur, si, en devenant propriétaire foncier, je me suis transformé en monopoleur, en aristocrate privilégié, en spoliateur de mes frères, en accapareur des libéralités divines. »
Il porta donc son grain au marché, et, s’étant abouché avec un Yankee : — Ami, lui dit-il, combien me donnerez-vous de ce maïs ?
— Le prix courant, fit l’autre.
— Le prix courant ? Mais cela me donnera-t-il quelque chose au delà de l’intérêt de mes capitaux et, de la rémunération de mon travail ?
— Je suis marchand, dit le Yankee, et il faut bien que je me contente de la récompense de mon travail ancien ou actuel.
— Et je m’en contentais quand j’étais porteur d’eau, repartit Jonathan, mais me voici Propriétaire foncier. Les économistes anglais et français m’ont assuré qu’en cette qualité, outre la double rétribution dont s’agit, je devais tirer profit des puissances productives et indestructibles du sol, prélever une aubaine sur les dons de Dieu.
— Les dons de Dieu appartiennent à tout le monde, dit le marchand. Je me sers bien de la puissance productive du vent pour pousser mes navires, mais je ne la fais pas payer.
— Et moi j’entends que vous me payiez quelque chose pour ces forces, afin que MM. Senior, Considérant et Proudhon ne m’aient pas en vain appelé monopoleur et usurpateur. Si j’en ai la honte, c’est bien le moins que j’en aie le profit.
— En ce cas, adieu, frère ; pour avoir du maïs, je m’adresserai à d’autres propriétaires, et si je les trouve dans les mêmes dispositions que vous, j’en cultiverai moi-même.
Jonathan comprit alors cette vérité que, sous un régime de liberté, n’est pas monopoleur qui veut. Tant qu’il y aura des terres à défricher dans l’Union, se dit-il, je ne serai que le metteur en œuvre des fameuses forces productives et indestructibles. On me payera ma peine, et voilà tout, absolument comme quand j’étais porteur d’eau on me payait mon travail et non celui de la nature. Je vois bien que le véritable usufruitier des dons de Dieu, ce n’est pas celui qui cultive le blé, mais celui que le blé nourrit.
Au bout de quelques années, une autre entreprise ayant séduit Jonathan, il se mit à chercher un fermier pour sa terre. Le dialogue qui intervint entre les deux contractants fut très-curieux, et jetterait un grand jour sur la question, si je le rapportais en entier.
En voici un extrait :
Le propriétaire. Quoi ! vous ne me voulez payer pour fermage que l’intérêt, au cours, du capital que j’ai déboursé ?
Le fermier. Pas un centime au delà.
Le propriétaire. Pourquoi cela, s’il vous plaît ?
Le fermier. Parce qu’avec un capital égal je puis mettre une terre juste dans l’état où est la vôtre.
Le propriétaire. Ceci paraît décisif. Mais considérez que, lorsque vous serez mon fermier, ce n’est pas seulement mon capital qui travaillera pour vous, mais encore la puissance productive et indestructible du sol. Vous aurez à votre service les merveilleux effets du soleil et de la lune, de l’affinité et de l’électricité. Faut-il que je vous cède tout cela pour rien ?
Le fermier. Pourquoi pas, puisque cela ne vous a rien coûté, que vous n’en tirez rien, et que je n’en tirerai rien non plus ?
Le propriétaire. Je n’en tire rien ? J’en tire tout, morbleu ! sans ces phénomènes admirables, toute mon industrie ne ferait pas pousser un brin d’herbe.
Le fermier. Sans doute. Mais rappelez-vous le Yankee. Il n’a pas voulu vous donner une obole pour toute cette coopération de la nature, pas plus que, quand vous étiez porteur d’eau, les ménagères de New-York ne voulaient vous donner une obole pour l’admirable élaboration au moyen de laquelle la nature alimente la source.
Le propriétaire. Cependant Ricardo et Proudhon…
Le fermier. Je me moque de Ricardo. Traitons sur les bases que j’ai dites, ou je vais défricher de la terre à côté de la vôtre. Le soleil et la lune m’y serviront gratis.
C’était toujours même argument, et Jonathan commençait à comprendre que Dieu a pourvu avec quelque sagesse à ce qu’il ne fût pas facile d’intercepter ses dons.
Un peu dégoûté du métier de propriétaire, Jonathan voulut porter ailleurs son activité. Il se décida à mettre sa terre en vente.
Inutile de dire que personne ne voulut lui donner plus qu’elle ne lui avait coûté à lui-même. Il avait beau invoquer Ricardo, alléguer la prétendue valeur inhérente à la puissance indestructible du sol, on lui répondait toujours : « Il y a des terres à côté. » Et ce seul mot mettait à néant ses exigences comme ses illusions.
Il se passa même, dans cette transaction, un fait qui a une grande importance économique et qui n’est pas assez remarqué.
Tout le monde comprend que si un manufacturier voulait vendre, après dix ou quinze ans, son matériel, même à l’état neuf, la probabilité est qu’il serait forcé de subir une perte. La raison en est simple : dix ou quinze ans ne se passent guère sans amener quelque progrès en mécanique. C’est pourquoi celui qui expose sur le marché un appareil qui a quinze ans de date ne peut pas espérer qu’on lui restitue exactement tout le travail que cet appareil a exigé ; car avec un travail égal l’acheteur peut se procurer, vu les progrès accomplis, des machines plus perfectionnées, — ce qui, pour le dire en passant, prouve de plus en plus que la valeur n’est pas proportionnelle au travail, mais aux services.
Nous pouvons conclure de là qu’il est dans la nature des instruments de travail de perdre de leur valeur par la seule action du temps, indépendamment de la détérioration qu’implique l’usage, et poser cette formule : « Un des effets du progrès, c’est de diminuer la valeur de tous les instruments existants. »
Il est clair, en effet, que plus le progrès est rapide, plus les instruments anciens ont de peine à soutenir la rivalité des instruments nouveaux.
Je ne m’arrêterai pas ici à signaler les conséquences harmoniques de cette loi ; ce que je veux faire remarquer, c’est que la Propriété foncière n’y échappe pas plus que toute autre propriété.
Frère Jonathan en fit l’épreuve. Car, ayant tenu à son acquéreur ce langage : — « Ce que j’ai dépensé sur cette terre en améliorations permanentes représente mille journées de travail. J’entends que vous me remboursiez d’abord l’équivalent de ces mille journées, et ensuite quelque chose en sus pour la valeur inhérente au sol et indépendante de toute œuvre humaine. »
L’acquéreur lui répondit :
« En premier lieu, je ne vous donnerai rien pour la valeur propre du sol, qui est tout simplement de l’utilité dont la terre à côté est aussi bien pourvue que la vôtre. Or, cette utilité native, extra-humaine, je puis l’avoir gratis, ce qui prouve qu’elle n’a pas de valeur.
En second lieu, puisque vos livres constatent que vous avez employé mille journées à mettre votre domaine dans l’état où il est, je ne vous en restituerai que huit cents, et ma raison est qu’avec huit cents journées je puis faire aujourd’hui sur la terre à côté ce qu’avec mille vous avez fait autrefois sur la vôtre. Veuillez considérer que, depuis quinze ans, l’art de dessécher, de défricher, de bâtir, de creuser des puits, de disposer les étables, d’exécuter les transports a fait des progrès. Chaque résultat donné exige moins de travail, et je ne veux pas me soumettre à vous donner dix de ce que je puis avoir pour huit, d’autant que le prix du blé a diminué dans la proportion de ce progrès, qui ne profite ni à vous ni à moi, mais à l’humanité tout entière. »
Ainsi Jonathan fut placé dans l’alternative de vendre sa terre à perte ou de la garder.
Sans doute la valeur des terres n’est pas affectée par un seul phénomène. D’autres circonstances, comme la construction d’un canal ou la fondation d’une ville, pourront agir dans le sens de la hausse. Mais celle que je signale, qui est très-générale et inévitable, agit toujours et nécessairement dans le sens de la baisse.
La conclusion de tout ce qui précède, la voici : Aussi longtemps que dans un pays il y a abondance de terre à défricher, le propriétaire foncier, qu’il cultive, afferme ou vende, ne jouit d’aucun privilége, d’aucun monopole, d’aucun avantage exceptionnel, et notamment il ne prélève aucune aubaine sur les libéralités gratuites de la nature. Comment en serait-il ainsi, les hommes étant supposés libres ? Est-ce que quiconque a des capitaux et des bras, n’a pas le droit de choisir entre l’agriculture, la fabrique, le commerce, la pêche, la navigation, les arts ou les professions libérales ? Est-ce que les capitaux et les bras ne se dirigeraient pas avec plus d’impétuosité vers celle de ces carrières qui donnerait des profits extraordinaires ? Est-ce qu’ils ne déserteraient pas celles qui laisseraient de la perte ? Est-ce que cette infaillible distribution des forces humaines ne suffit pas pour établir, dans l’hypothèse où nous sommes, l’équilibre des rémunérations ? Est-ce qu’on voit aux États-Unis les agriculteurs faire plus promptement fortune que les négociants, les armateurs, les banquiers ou les médecins, ce qui arriverait infailliblement s’ils recevaient d’abord, comme les autres, le prix de leur travail, et en outre, de plus que les autres, ainsi qu’on le prétend, le prix du travail incommensurable de la nature ?
Oh ! veut-on savoir comment le propriétaire foncier pourrait se constituer, même aux États-Unis, un monopole ? J’essayerai de le faire comprendre.
Je suppose que Jonathan réunît tous les propriétaires fonciers de l’Union et leur tînt ce langage :
J’ai voulu vendre mes récoltes, et je n’ai pas trouvé qu’on m’en donnât un prix assez élevé. J’ai voulu affermer ma terre, et mes prétentions ont rencontré des limites. J’ai voulu l’aliéner, et je me suis heurté à la même déception. Toujours on a arrêté mes exigences par ce mot : il y a des terres à côté. De telle sorte, chose horrible, que mes services dans la communauté sont estimés, comme tous les autres, ce qu’ils valent, malgré les douces promesses des théoriciens. On ne m’accorde rien, absolument rien pour cette puissance productive et indestructible du sol, pour ces agents naturels, rayons solaires et lunaires, pluie, vent, rosée, gelée, que je croyais ma propriété, et dont je ne suis au fond qu’un propriétaire nominal. N’est-ce pas une chose inique que je ne sois rétribué que pour mes services, et encore au taux où il plaît à la concurrence de les réduire ? Vous subissez tous la même oppression, vous êtes tous victimes de la concurrence anarchique. Il n’en serait pas ainsi, vous le comprenez aisément, si nous organisions la propriété foncière, si nous nous concertions pour que nul désormais ne fût admis à défricher un pouce de cette terre d’Amérique. Alors la population, par son accroissement, se pressant sur une quantité à peu près fixe de subsistances, nous ferions la loi des prix, nous arriverions à d’immenses richesses : ce qui serait un grand bonheur pour les autres classes, car, étant riches, nous les ferions travailler.
Si, à la suite de ce discours, les propriétaires coalisés s’emparaient de la législature, s’ils décrétaient un acte par lequel tout nouveau défrichement serait interdit, il n’est pas douteux qu’ils accroîtraient, pour un temps, leurs profits. Je dis pour un temps : car les lois sociales manqueraient d’harmonie, si le châtiment d’un tel crime ne naissait naturellement du crime même. Par respect pour la rigueur scientifique, je ne dirai pas que la loi nouvelle aurait communiqué de la valeur à la puissance du sol ou aux agents naturels (s’il en était ainsi, la loi ne ferait tort à personne), mais je dirai : L’équilibre des services est violemment rompu ; une classe spolie les autres classes ; un principe d’esclavage s’est introduit dans le pays.
Passons à une autre hypothèse, qui, à vrai dire, est la réalité pour les nations civilisées de l’Europe, celle où tout le sol est passé dans le domaine de la propriété privée.
Nous avons à rechercher si, dans ce cas encore, la masse des consommateurs, ou la communauté, continue à être usufruitière, à titre gratuit, de la force productive du sol, et des agents naturels ; si les détenteurs de la terre sont propriétaires d’autre chose que de sa valeur, c’est-à-dire de leurs loyaux services appréciés selon les lois de la concurrence ; et s’ils ne sont pas forcés, comme tout le monde, quand ils se font rémunérer pour ces services, de donner par-dessus le marché les dons de Dieu.
Voici donc tout le territoire de l’Arkansas aliéné par le gouvernement, divisé en héritages privés et soumis à la culture. Jonathan, lorsqu’il met en vente son blé ou même sa terre, se prévaut-il de la puissance productive du sol, et veut-il la faire entrer pour quelque chose dans la valeur ? On ne peut plus, comme dans le cas précédent, l’arrêter par cette réponse accablante : « Il y a des terres en friche autour de la vôtre. »
Ce nouvel état de choses implique que la population s’est accrue. Elle se divise en deux classes : 1° celle qui apporte à la communauté les services agricoles ; 2° celle qui y apporte des services industriels, intellectuels ou autres.
Or je dis ceci qui me semble évident. Les travailleurs (autres que les propriétaires fonciers) qui veulent se procurer du blé, étant parfaitement libres de s’adresser à Jonathan ou à ses voisins, ou aux propriétaires des États limitrophes, pouvant même aller défricher les terres incultes hors des frontières de l’Arkansas, il est absolument impossible à Jonathan de leur imposer une loi injuste. Le seul fait qu’il existe des terres sans valeur quelque part oppose au privilége un obstacle invincible, et nous nous retrouvons dans l’hypothèse précédente. Les services agricoles subissent la loi de l’universelle compétition, et il est radicalement impossible de les faire accepter pour plus qu’ils ne valent. J’ajoute qu’ils ne valent pas plus (cœteris paribus) que les services de toute autre nature. De même que le manufacturier, après s’être fait payer de son temps, de ses soins, de ses peines, de ses risques, de ses avances, de son habileté (toutes choses qui constituent le service humain et sont représentées par la valeur), ne peut rien réclamer pour la loi de la gravitation et de l’expansibilité de la vapeur dont il s’est fait aider, de même Jonathan ne peut faire entrer, dans la valeur de son blé, que la totalité de ses services personnels anciens ou récents, et non point l’assistance qu’il trouve dans les lois de la physiologie végétale. L’équilibre des services n’est pas altéré tant qu’ils s’échangent librement les uns contre les autres à prix débattu, et les dons de Dieu, auxquels ces services servent de véhicule, donnés de part et d’autre par-dessus le marché, restent dans le domaine de la communauté.
On dira sans doute qu’en fait la valeur du sol s’accroît sans cesse. Cela est vrai. À mesure que la population devient plus dense et plus riche, que les moyens de communication sont plus faciles, le propriétaire foncier tire un meilleur parti de ses services. Est-ce que c’est là une loi qui lui soit particulière, et n’est-elle pas la même pour tous les travailleurs ? À égalité de travail, un médecin, un avocat, un chanteur, un peintre, un manœuvre ne se procurent-ils pas plus de satisfactions au dix-neuvième siècle qu’au quatrième, à Paris qu’en Bretagne, en France qu’au Maroc ? Mais ce surcroît de satisfaction n’est acquis aux dépens de personne. Voilà ce qu’il faut comprendre. Au reste, nous approfondirons cette loi de la valeur (métonymique) du sol dans une autre partie de ce travail et quand nous en serons à la théorie de Ricardo. (V. tome II, discours du 29 septembre 1846.)
Pour le moment, il nous suffit de constater que Jonathan, dans l’hypothèse que nous étudions, ne peut exercer aucune oppression sur les classes industrielles, pourvu que l’échange des services soit libre, et que le travail puisse, sans aucun empêchement légal, se distribuer, soit dans l’Arkansas, soit ailleurs, entre tous les genres de production. Cette liberté s’oppose à ce que les propriétaires puissent intercepter à leur profit les bienfaits gratuits de la nature.
Il n’en serait pas de même si Jonathan et ses confrères, s’emparant du droit de légiférer, proscrivaient ou entravaient la liberté des échanges, s’ils faisaient décider, par exemple, que pas un grain de blé étranger ne pourra pénétrer dans le territoire de l’Arkansas. En ce cas, la valeur des services échangés entre les propriétaires et les non-propriétaires ne serait plus réglée par la justice. Les seconds n’auraient aucun moyen de contenir les prétentions des premiers. Une telle mesure législative serait aussi inique que celle à laquelle nous faisions allusion tout à l’heure. L’effet serait absolument le même que si Jonathan, ayant porté sur le marché un sac de blé qui se serait vendu quinze francs, tirait un pistolet de sa poche, et, ajustant son acquéreur, lui disait : Donne-moi trois francs de plus, ou je te brûle la cervelle.
Cet effet (il faut bien l’appeler par son nom) s’appelle extorsion. Brutale ou légale, cela ne change pas son caractère. Brutale, comme dans le cas du pistolet, elle viole la propriété. Légale, comme dans le cas de la prohibition, elle viole encore la propriété, et, en outre, elle en nie le principe. On n’est, nous l’avons vu, propriétaire que de valeurs, et Valeur, c’est appréciation de deux services qui s’échangent librement. Il ne se peut donc rien concevoir de plus antagonique au principe même de la propriété que ce qui altère, au nom du droit, l’équivalence des services.
Il n’est peut-être pas inutile de faire remarquer que les lois de cette espèce sont iniques et désastreuses, quelle que soit à cet égard l’opinion des oppresseurs et même celle des opprimés. On voit, en certains pays, les classes laborieuses se passionner pour ces restrictions parce qu’elles enrichissent les propriétaires. Elles ne s’aperçoivent pas que c’est à leurs dépens, et, je le sais par expérience, il n’est pas toujours prudent de le leur dire.
Chose étrange ! le peuple écoute volontiers les sectaires qui lui prêchent le Communisme, qui est l’esclavage, puisque n’être pas propriétaire de ses services c’est être esclave ; — et il dédaigne ceux qui défendent partout et toujours la Liberté, qui est la Communauté des bienfaits de Dieu.
Nous arrivons à la troisième hypothèse, celle où la totalité de la surface cultivable du globe sera passée dans le domaine de l’appropriation individuelle.
Nous avons encore ici deux classes en présence : celle qui possède le sol et celle qui ne le possède pas. La première ne sera t-elle pas en mesure d’opprimer la seconde ? et celle-ci ne sera-t-elle pas réduite à donner toujours plus de travail contre une égale quantité de subsistances ?
Si je réponds à l’objection, c’est, on le comprendra, pour l’honneur de la science ; car nous sommes séparés par plusieurs centaines de siècles de l’époque où l’hypothèse sera une réalité.
Mais enfin, tout annonce que le temps arrivera où il ne sera plus possible de contenir les exigences des propriétaires par ces mots : Il y a des terres à défricher.
Je prie le lecteur de remarquer que cette hypothèse en implique une autre : c’est qu’à cette époque la population sera arrivée à la limite extrême de ce que la terre peut faire subsister.
C’est là un élément nouveau et considérable dans la question. C’est à peu près comme si l’on me demandait : Qu’arrivera-t-il quand il n’y aura plus assez d’air dans l’atmosphère pour les poitrines devenues trop nombreuses ?
Quoi qu’on pense du principe de la population, il est au moins certain qu’elle peut augmenter, et même qu’elle tend à augmenter, puisqu’elle augmente. Tout l’arrangement économique de la société semble organisé en prévision de cette tendance. C’est avec cette tendance qu’il est en parfaite harmonie. Le propriétaire foncier aspire toujours à se faire payer l’usage des agents naturels qu’il détient ; mais il est sans cesse déçu dans sa folle et injuste prétention par l’abondance d’agents naturels analogues qu’il ne détient pas. La libéralité, relativement indéfinie, de la nature fait de lui un simple détenteur. Maintenant vous m’acculez à l’époque où les hommes ont trouvé la limite de cette libéralité. Il n’y a plus rien à attendre de ce côté-là. Il faut inévitablement que la tendance humaine à s’accroître soit paralysée, que la population s’arrête. Aucun régime économique ne peut l’affranchir de cette nécessité. Dans l’hypothèse donnée, tout accroissement de population serait réprimé par la mortalité ; il n’y a pas de philanthropie, quelque optimiste qu’elle soit, qui aille jusqu’à prétendre que le nombre des êtres humains peut continuer sa progression, quand la progression des subsistances a irrévocablement fini la sienne.
Voici donc un ordre nouveau ; et les lois du monde social ne seraient pas harmoniques, si elles n’avaient pourvu à un état de choses possible, quoique si différent de celui où nous vivons.
La difficulté proposée revient à ceci : Étant donné, au milieu de l’Océan, un vaisseau qui en a pour un mois avant d’atteindre la terre et où il n’y a de vivres que pour quinze jours, que faut-il faire ? Évidemment réduire la ration de chaque matelot. Ce n’est pas dureté de cœur, c’est prudence et justice.
De même, quand la population sera portée à l’extrême limite de ce que peut entretenir le globe entier soumis à la culture, cette loi ne sera ni dure ni injuste, qui prendra les arrangements les plus doux et les plus infaillibles pour que les hommes ne continuent pas de multiplier. Or c’est la propriété foncière qui offre encore la solution. C’est elle qui, sous le stimulant de l’intérêt personnel, fera produire au sol la plus grande quantité possible de subsistances. C’est elle qui, par la division des héritages, mettra chaque famille en mesure d’apprécier, quant à elle, le danger d’une multiplication imprudente. Il est bien clair que tout autre régime, le Communisme par exemple, serait tout à la fois pour la production un aiguillon moins actif et pour la population un frein moins puissant.
Après tout, il me semble que l’économie politique a rempli sa tâche quand elle a prouvé que la grande et juste loi de la mutualité des services s’accomplira d’une manière harmonique, tant que le progrès ne sera pas interdit à l’humanité. N’est-il pas consolant de penser que jusque-là, et sous le régime de la liberté, il n’est pas en la puissance d’une classe d’en opprimer une autre ? La Science économique est-elle tenue de résoudre cette autre question : Etant donnée la tendance des hommes à multiplier, qu’arrivera-t-il quand il n’y aura plus d’espace sur la terre pour de nouveaux habitants ? Dieu tient-il en réserve, pour cette époque, quelque cataclysme créateur, quelque merveilleuse manifestation de sa puissance infinie ? Ou bien faut-il croire, avec le dogme chrétien, à la destruction de ce monde ? Évidemment ce ne sont plus là des problèmes économiques, et il n’y a pas de science qui n’arrive à des difficultés analogues. Les physiciens savent bien que tout corps qui se meut sur la surface du globe descend et ne remonte plus. D’après cela, un jour doit arriver où les montagnes auront comblé les vallées, où l’embouchure des fleuves sera sur le même niveau que leur source, où les eaux ne pourront plus couler, etc., etc. : que surviendra-t-il dans ces temps-là ? La physique doit-elle cesser d’observer et d’admirer l’harmonie du monde actuel, parce qu’elle ne peut deviner par quelle autre harmonie Dieu pourvoira à un état de choses très-éloigné sans doute, mais inévitable ? Il me semble que c’est bien ici le cas, pour l’Économiste comme pour le physicien, de substituer à un acte de curiosité un acte de confiance. Celui qui a si merveilleusement arrangé le milieu où nous vivons, saura bien préparer un autre milieu pour d’autres circonstances.
Nous jugeons de la productivité du sol et de l’habileté humaine par les faits dont nous sommes témoins. Est-ce là une règle rationnelle ? Même en l’adoptant, nous pourrions nous dire : Puisqu’il a fallu six mille ans pour que la dizième partie du globe arrivât à une chétive culture, combien s’écoulera-t-il de centaines de siècles avant que toute sa surface soit convertie en jardin ?
Encore dans cette appréciation, déjà fort rassurante, nous supposons simplement la généralisation de la science ou plutôt de l’ignorance actuelle en agriculture. Mais est-ce là, je le répète, une règle admissible ; et l’analogie ne nous dit-elle pas qu’un voile impénétrable nous cache la puissance, peut être indéfinie, de l’art ? Le sauvage vit de chasse, et il lui faut une lieue carrée de terrain. Quelle ne serait pas sa surprise, si on venait lui dire que la vie pastorale peut faire subsister dix fois plus d’hommes sur le même espace ! Le pasteur nomade, à son tour, serait tout étonné d’apprendre que la culture triennale admet aisément une population encore décuple. Dites au paysan routinier qu’une autre progression égale sera le résultat de la culture alterne, et il ne vous croira pas. La culture alterne elle-même, qui est le dernier mot pour nous, est-elle le dernier mot pour l’humanité ? Rassurons-nous donc sur son sort, les siècles s’offrent devant elle par mille : et, en tout cas, sans demander à l’économie politique de résoudre des problèmes qui ne sont pas de son domaine, remettons avec confiance les destinées des races futures entre les mains de celui qui les aura appelées à la vie.
Résumons les notions contenues dans ce chapitre.
Ces deux phénomènes, Utilité et Valeur, concours de la nature et concours de l’homme, par conséquent Communauté et Propriété, se rencontrent dans l’œuvre agricole comme dans toute autre.
Il se passe dans la production du blé qui apaise notre faim quelque chose d’analogue à ce qu’on remarque dans la formation de l’eau qui étanche notre soif. Économistes, l’Océan qui inspire le poëte ne nous offre-t-il pas aussi un beau sujet de méditations ? C’est ce vaste réservoir qui doit désaltérer toutes les créatures humaines. Et comment cela se peut-il faire si elles sont placées à une si grande distance de son eau, d’ailleurs impotable ? C’est ici qu’il faut admirer la merveilleuse industrie de la nature. Voici que le soleil échauffe cette masse agitée et la soumet à une lente évaporation. L’eau prend la forme gazeuse, et, dégagée du sel qui l’altère, elle s’élève dans les hautes régions de l’atmosphère. Des brises, se croisant dans toutes les directions, la poussent vers les continents habités. Là, elle rencontre le froid qui la condense et l’attache, sous forme solide, aux flancs des montagnes. Bientôt la tiédeur du printemps la liquéfie. Entraînée par son poids, elle se filtre et s’épure à travers des couches de schistes et de graviers ; elle se ramifie, se distribue et va alimenter des sources rafraîchissantes sur tous les points du globe. Voilà certes une immense et ingénieuse industrie accomplie par la nature au profit de l’humanité. Changement de formes, changement de lieux, utilité, rien n’y manque. Où est cependant la valeur ? Elle n’est pas née encore, et si ce qu’on pourrait appeler le travail de Dieu se payait (il se payerait s’il valait), qui peut dire ce que vaudrait une seule goutte d’eau ?
Cependant tous les hommes n’ont pas à leurs pieds une source d’eau vive. Pour se désaltérer, il leur reste une peine à prendre, un effort à faire, une prévoyance à avoir, une habileté à exercer. C’est ce travail humain complémentaire qui donne lieu à des arrangements, à des transactions, à des évaluations. C’est donc en lui qu’est l’origine et le fondement de la valeur.
L’homme ignore avant de savoir. À l’origine, il est donc réduit à aller chercher l’eau, à accomplir le travail complémentaire que la nature a laissé à sa charge avec le maximum possible de peine. C’est le temps où, dans l’échange, l’eau a la plus grande valeur. Peu à peu, il invente la brouette et la roue, il dompte le cheval, il invente les tuyaux, il découvre la loi du siphon, etc. ; bref, il reporte sur des forces naturelles gratuites une partie de son travail, et, à mesure, la valeur de l’eau, mais non son utilité, diminue.
Et il se passe ici quelque chose qu’il faut bien constater et comprendre, si l’on ne veut pas voir la discordance là où est l’harmonie. C’est que l’acheteur de l’eau l’obtient à de meilleures conditions, c’est-à-dire cède une moins grande proportion de son travail pour en avoir une quantité donnée, à chaque fois qu’un progrès de ce genre se réalise, encore que, dans ce cas, il soit tenu de rémunérer l’instrument au moyen duquel la nature est contrainte d’agir. Autrefois il payait le travail d’aller chercher l’eau ; maintenant il paye et ce travail et celui qu’il a fallu faire pour confectionner la brouette, la roue, le tuyau, — et cependant, tout compris, il paye moins ; par où l’on voit quelle est la triste et fausse préoccupation de ceux qui croient que la rétribution afférente au capital est une charge pour le consommateur. Ne comprendront-ils donc jamais que le capital anéantit plus de travail, pour chaque effet donné, qu’il n’en exige ?
Tout ce qui vient d’être décrit s’applique exactement à la production du blé. Là aussi, antérieurement à l’industrie humaine, il y a une immense, une incommensurable industrie naturelle dont la science la plus avancée ignore encore les secrets. Des gaz, des sels sont répandus dans le sol et dans l’atmosphère. L’électricité, l’affinité, le vent, la pluie, la lumière, la chaleur, la vie sont successivement occupés, souvent à notre insu, à transporter, transformer, rapprocher, diviser, combiner ces éléments ; et cette industrie merveilleuse, dont l’activité et l’utilité échappent à notre appréciation et même à notre imagination, n’a cependant aucune valeur. Celle-ci apparait avec la première intervention de l’homme qui a, dans cette affaire autant et plus que dans l’autre, un travail complémentaire à accomplir.
Pour diriger ces forces naturelles, écarter les obstacles qui gênent leur action, l’homme s’empare d’un instrument qui est le sol, et il le fait sans nuire à personne, car cet instrument n’a pas de valeur. Ce n’est pas là matière à discussion, c’est un point de fait. Sur quelque point du globe que ce soit, montrez-moi une terre qui n’ait pas subi l’influence directe ou indirecte de l’action humaine, et je vous montrerai une terre dépourvue de valeur.
Cependant l’agriculteur, pour réaliser, concurremment avec la nature, la production du blé, exécute deux genres de travaux bien distincts. Les uns se rapportent immédiatement, directement, à la récolte de l’année, ne se rapportent qu’à elle, et doivent être payés par elle : tels sont la semaille, le sarclage, la moisson, le dépiquage. Les autres, comme les bâtisses, desséchements, défrichements, clôtures, etc., concourent à une série indéterminée de récoltes successives : la charge doit s’en répartir sur une suite d’années, ce à quoi on parvient avec exactitude par les combinaisons admirables qu’on appelle lois de l’intérêt et de l’amortissement. Les récoltes forment la récompense de l’agriculteur s’il les consomme lui-même. S’il les échange, c’est contre des services d’un autre ordre, et l’appréciation des services échangés constitue leur valeur.
Maintenant il est aisé de comprendre que toute cette catégorie de travaux permanents, exécutés par l’agriculteur sur le sol, est une valeur qui n’a pas encore reçu toute sa récompense, mais qui ne peut manquer de la recevoir. Il ne peut être tenu de déguerpir et de laisser une autre personne se substituer à son droit sans compensation. La valeur s’est incorporée, confondue dans le sol ; c’est pourquoi on pourra très bien dire par métonymie : le sol vaut. — Il vaut, en effet, puisque nul ne peut plus l’acquérir sans donner en échange l’équivalent de ces travaux. Mais ce que je soutiens, c’est que cette terre, à laquelle la puissance naturelle de produire n’avait originairement communiqué aucune valeur, n’en a pas davantage aujourd’hui à ce titre. Cette puissance naturelle, qui était gratuite, l’est encore et le sera toujours. On peut bien dire : Cette terre vaut, mais au fond ce qui vaut, c’est le travail humain qui l’a améliorée, c’est le capital qui y a été répandu. Dès lors il est rigoureusement vrai de dire que son propriétaire n’est en définitive propriétaire que d’une valeur par lui créée, de services par lui rendus ; et quelle propriété pourrait être plus légitime ? Celle-là n’est créée aux dépens de qui que ce soit : elle n’intercepte ni ne taxe aucun don du ciel.
Ce n’est pas tout. Loin que le capital avancé, et dont l’intérêt doit se distribuer sur les récoltes successives, en augmente le prix et constitue une charge pour les consommateurs, ceux-ci acquièrent les produits agricoles à des conditions toujours meilleures à mesure que le capital augmente, c’est-à-dire à mesure que la valeur du sol s’accroît. Je ne doute pas qu’on ne prenne cette assertion pour un paradoxe entaché d’optimisme exagéré, tant on est habitué à considérer la valeur du sol comme une calamité, si ce n’est comme une injustice. Et moi j’affirme ceci : Ce n’est pas assez dire, que la valeur du sol n’est créée aux dépens de qui que ce soit ; ce n’est pas assez dire, qu’elle ne nuit à personne ; il faut dire qu’elle profite à tout le monde. Elle n’est pas seulement légitime, elle est avantageuse, même aux prolétaires.
Ici nous voyons en effet se reproduire le phénomène que nous constations tout à l’heure à propos de l’eau. Le jour où le porteur d’eau, disions-nous, a inventé la brouette et la roue, il est bien vrai que l’acquéreur de l’eau à dû payer deux genres de travaux au lieu d’un : 1° le travail accompli pour exécuter la roue et la brouette, ou plutôt l’intérêt et l’amortissement de ce capital ; 2° le travail direct qui reste encore à la charge du porteur d’eau. Mais ce qui est également vrai, c’est que ces deux travaux réunis n’égalent pas le travail unique auquel l’humanité était assujettie avant l’invention. Pourquoi ? parce qu’elle a rejeté une partie de l’œuvre sur les forces gratuites de la nature. Ce n’est même qu’à raison de ce décroissement de labeur humain que l’invention a été provoquée et adoptée.
Les choses se passent exactement de même à propos de la terre et du blé. À chaque fois que l’agriculteur met du capital en améliorations permanentes, il est incontestable que les récoltes successives se trouvent grevées de l’intérêt de ce capital. Mais ce qui n’est pas moins incontestable, c’est que l’autre catégorie de travail, le travail brut et actuel est frappée d’inutilité dans une proportion bien plus forte encore ; de telle sorte que chaque récolte s’obtient par le propriétaire, et par conséquent par les acquéreurs, à des conditions moins onéreuses, l’action propre du capital consistant précisément à substituer de la collaboration naturelle et gratuite à du travail humain et rémunérable.
Exemple. Pour que la récolte arrive à bien, il faut que le champ soit débarrassé de la surabondance d’humidité. Supposons que ce travail soit encore dans la première catégorie : supposons que l’agriculteur aille tous les matins, avec un vase, épuiser l’eau stagnante là où elle nuit. Il est clair qu’au bout de l’an le sol n’aura acquis par ce fait aucune valeur, mais le prix de la récolte se trouvera énormément surchargé. Il en sera de même de celles qui suivront tant que l’art en sera à ce procédé primitif. Si le propriétaire fait un fossé, à l’instant le sol acquiert une valeur, car ce travail appartient à la seconde catégorie. Il est de ceux qui s’incorporent à la terre, qui doivent être remboursés par les produits des années suivantes, et nul ne peut prétendre acquérir le sol sans rémunérer cet ouvrage. N’est-il pas vrai cependant qu’il tend à abaisser la valeur des récoltes ? N’est-il pas vrai que, quoiqu’il ait exigé, la première année, un effort extraordinaire, il en épargne cependant en définitive plus qu’il n’en occasionne ? N’est-il pas vrai que désormais le dessèchement se fera, par la loi gratuite de l’hydrostatique, plus économiquement qu’il ne se faisait à force de bras ? N’est-il pas vrai que les acquéreurs de blé profiteront de cette opération ? N’est-il pas vrai qu’ils devront s’estimer heureux que le sol ait acquis cette valeur nouvelle ? Et, en généralisant, n’est-il pas vrai enfin que la valeur du sol atteste un progrès réalisé, non au profit de son propriétaire seulement, mais au profit de l’humanité ? Combien donc ne serait-elle pas absurde et ennemie d’elle-même, si elle disait : Ce dont on grève le prix du blé pour l’intérêt et l’amortissement de ce fossé, ou pour ce qu’il représente dans la valeur du sol, est un privilége, un monopole, un vol ? — À ce compte, pour cesser d’être monopoleur et voleur, le propriétaire n’aurait qu’à combler son fossé et reprendre la manœuvre du vase. Prolétaires, en seriez-vous plus avancés ?
Passez en revue toutes les améliorations permanentes dont l’ensemble constitue la valeur du sol, et vous pourrez faire sur chacune la même remarque. Après avoir détruit le fossé, détruisez aussi la clôture, réduisant l’agriculteur à monter la garde autour de son champ ; détruisez le puits, la grange, le chemin, la charrue, le nivellement, l’humus artificiel ; replacez dans le champ les cailloux, les plantes parasites, les racines d’arbres, alors vous aurez réalisé l’utopie égalitaire. Le sol, et le genre humain avec lui, sera revenu à l’état primitif : il n’aura plus de valeur. Les récoltes n’auront plus rien à démêler avec le capital. Leur prix sera dégagé de cet élément maudit qu’on appelle intérêt. Tout, absolument tout, se fera par du travail actuel, visible à l’œil nu. L’économie politique sera fort simplifiée. La France fera vivre un homme par lieue carrée. Tout le reste aura péri d’inanition ; — mais on ne pourra plus dire : La propriété est un monopole, une illégitimité, un vol.
Ne soyons donc pas insensibles à ces harmonies économiques qui se déroulent à nos yeux, à mesure que nous analysons les idées d’échange, de valeur, de capital, d’intérêt, de propriété, de communauté. — Oh ! me sera-t-il donné d’en parcourir le cercle tout entier ? — Mais peut-être sommes-nous assez avancés pour reconnaître que le monde social ne porte pas moins que le monde matériel l’empreinte d’une main divine, d’où découlent la sagesse et la bonté, vers laquelle doivent s’élever notre admiration et notre reconnaissance.
Je ne puis m’empêcher de revenir ici sur une pensée de M. Considérant.
Partant de cette donnée que le sol a une valeur propre, indépendante de toute œuvre humaine, qu’il est un capital primitif et incréé, il conclut, avec raison à son point de vue, de l’appropriation à l’usurpation. Cette prétendue iniquité lui inspire de véhémentes tirades contre le régime des sociétés modernes. D’un autre côté, il convient que les améliorations permanentes ajoutent une plus-value à ce capital primitif, accessoire tellement confondu avec le principal qu’on ne peut les séparer. Que faire donc ? car on est en présence d’une Valeur totale composée de deux éléments, dont l’un, fruit du travail, est propriété légitime, et l’autre, œuvre de Dieu, est une inique usurpation.
La difficulté n’est pas petite. M. Considérant la résout par le droit au travail.
« Le développement de l’Humanité sur la Terre exige évidemment que le sol ne soit pas laissé dans l’état inculte et sauvage. La Destinée de l’Humanité elle-même s’oppose donc à ce que le Droit de l’homme à la Terre conserve sa Forme primitive et brute.
Le sauvage jouit, au milieu des forêts et des savanes, des quatre Droits naturels, Chasse, Pêche, Cueillette, Pâture. Telle est la première forme du Droit.
Dans toutes les sociétés civilisées, l’homme du peuple, le Prolétaire qui n’hérite de rien et ne possède rien, est purement et simplement dépouillé de ces droits. On ne peut donc pas dire que le Droit primitif ait ici changé de forme, puisqu’il n’existe plus. La forme a disparu avec le Fond.
Or, quelle serait la forme sous laquelle le Droit pourrait se concilier avec les conditions d’une Société industrieuse ? La réponse est facile.
Dans l’état sauvage, pour user de son Droit, l’homme est obligé d’agir. Les Travaux de la Pêche, de la Chasse, de la Cueillette, de la Pâture sont les conditions de l’exercice de son Droit. Le Droit primitif n’est donc que le Droit à ces travaux.
Eh bien ! qu’une Société industrieuse, qui a pris possession de la Terre et qui enlève à l’homme la faculté d’exercer à l’aventure et en liberté, sur la surface du Sol, ses quatre Droits naturels, que cette Société reconnaisse à l’individu, en compensation de ces Droits dont elle le dépouille, le Droit au Travail : alors, en principe et sauf application convenable, l’individu n’aura plus à se plaindre.
La condition sine quâ non pour la Légitimité de la Propriété est donc que la Société reconnaisse au Prolétaire le Droit au Travail, et qu’elle lui assure au moins autant de moyens de subsistance, pour un exercice d’activité donné, que cet exercice eût pu lui en procurer dans l’état primitif. »
Je ne veux pas, me répétant à satiété, discuter la question du fond avec M. Considérant. Si je lui démontrais que ce qu’il appelle capital incréé n’est pas un capital du tout ; que ce qu’il nomme plus-value du sol n’en est pas la plus-value, mais la toute-value, il devrait reconnaître que son argumentation s’écroule tout entière, et, avec elle, tous ses griefs contre le mode selon lequel l’humanité a jugé à propos de se constituer et de vivre depuis Adam. Mais cette polémique m’entraînerait à redire tout ce que j’ai déjà dit sur la gratuité essentielle et indélébile des agents naturels.
Je me bornerai à faire observer que si M. Considérant porte la parole au nom des prolétaires, en vérité il est si accommodant qu’ils pourront se croire trahis. Quoi ! les propriétaires ont usurpé et la terre et tous les miracles de végétation qui s’y accomplissent ! ils ont usurpé le soleil, la pluie, la rosée, l’oxygène, l’hydrogène et l’azote, en tant du moins qu’ils concourent à la formation des produits agricoles, — et vous leur demandez d’assurer au prolétariat, en compensation, au moins autant de moyens de subsistance, pour un exercice d’activité donné, que cet exercice eût pu lui en procurer dans l’état primitif ou sauvage !
Mais ne voyez-vous pas que la propriété foncière n’a pas attendu vos injonctions pour être un million de fois plus généreuse ? car, enfin, à quoi se borne votre requête ?
Dans l’état primitif, vos quatre droits, pêche, chasse, cueillette et pâture, faisaient vivre ou plutôt végéter dans toutes les horreurs du dénûment à peu près un homme par lieue carrée. L’usurpation de la terre sera donc légitimée, d’après vous, si ceux qui s’en sont rendus coupables font vivre un homme par lieue carrée, et encore en exigeant de lui autant d’activité qu’en déploie un Huron ou un Iroquois. Veuillez remarquer que la France n’a que trente mille lieues carrées ; que, par conséquent, pourvu qu’elle entretienne trente mille habitants à cet état de bien-être qu’offre la vie sauvage, vous renoncez, au nom des prolétaires, à rien exiger de plus de la propriété. Or, il y a trente millions de Français qui n’ont pas un pouce de terre ; et dans le nombre il s’en rencontre plusieurs : président de la république, ministres, magistrats, banquiers, négociants, notaires, avocats, médecins, courtiers, soldats, marins, professeurs, journalistes, etc., qui ne changeraient pas leur sort contre celui d’un Yoway. Il faut donc que la propriété foncière fasse beaucoup plus que vous n’exigez d’elle. Vous lui demandez le droit au travail jusqu’à une limité déterminée, jusqu’à ce qu’elle ait répandu dans les masses, — et cela contre une activité donnée, — autant de subsistance que pourrait le faire la sauvagerie. Elle fait mieux : elle donne plus que le droit au travail, elle donne le travail lui-même, et, ne fit-elle qu’acquitter l’impôt, c’est cent fois plus que vous n’en demandez.
Hélas ! à mon grand regret, je n’en ai pas fini avec la propriété foncière et sa valeur. Il me reste à poser et réfuter, en aussi peu de mots que possible, une objection spécieuse et même sérieuse.
On dira :
— « Votre théorie est démentie par les faits. Sans doute, tant qu’il y a, dans un pays, abondance de terres incultes, leur seule présence empêche que le sol cultivé n’y acquière une valeur abusive. Sans doute encore, alors même que tout le territoire est passé dans le domaine approprié, si les nations voisines ont d’immenses espaces à livrer à la charrue, la liberté des transactions suffit pour contenir dans de justes bornes la valeur de la propriété foncière. Dans ces deux cas, il semble que le Prix des terres ne peut représenter que le capital avancé, et la Rente que l’intérêt de ce capital. De là, il faut conclure, comme vous faites, que l’action propre de la terre et l’intervention des agents naturels, ne comptant pour rien et ne pouvant grever le prix des récoltes, restent gratuites et partant communes. Tout cela est spécieux. Nous pouvons être embarrassés pour découvrir le vice de cette argumentation, et pourtant elle est vicieuse. Pour s’en convaincre, il suffit de constater ce fait, qu’il y a en France des terres cultivées qui valent depuis cent francs jusqu’à six mille francs l’hectare, différence énorme qui s’explique bien mieux par celle des fertilités que par celle des travaux antérieurs. Ne niez donc pas que la fertilité n’ait sa valeur propre : il n’y a pas un acte de vente qui ne l’atteste. Quiconque achète une terre examine sa qualité et paye en conséquence. Si, de deux champs placés à côté l’un de l’autre et présentant les mêmes avantages de situation, l’un est une grasse alluvion, l’autre un sable, à coup sûr le premier vaudra plus que le second, encore que l’un et l’autre aient pu absorber le même capital ; et, à vrai dire, l’acquéreur ne s’inquiète en aucune façon de cette circonstance. Ses yeux sont fixés sur l’avenir et non sur le passé. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas ce que la terre a coûté, mais ce qu’elle rapportera, et il sait qu’elle rapportera en proportion de sa fécondité. Donc cette fécondité a une valeur propre, intrinsèque, indépendante de tout travail humain. Soutenir le contraire, c’est vouloir faire sortir la légitimité de l’appropriation individuelle d’une subtilité ou plutôt d’un paradoxe. »
— Cherchons donc la vraie cause de la valeur du sol.
Et que le lecteur veuille bien ne pas perdre de vue que la question est grave au temps où nous sommes. Jusqu’ici elle a pu être négligée ou traitée légèrement par les économistes ; elle n’avait guère pour eux qu’un intérêt de curiosité. La légitimité de l’appropriation individuelle n’était pas contestée. Et sur quoi ces théories fondent-elles leurs griefs ? précisément sur l’allégation contenue dans l’objection que je viens de poser. Précisément sur ce fait, malheureusement admis par toutes les écoles, que le sol tient de sa fécondité, de la nature, une valeur propre qui ne lui a pas été humainement communiquée. Or la valeur ne se cède pas gratuitement. Son nom même exclut l’idée de gratuité. On dit donc au propriétaire : Vous me demandez une valeur qui est le fruit de mon travail, et vous m’offrez en échange une autre valeur qui n’est le fruit ni de votre travail, ni d’aucun travail, mais de la libéralité de la nature.
Et ce grief, qu’on le sache bien, serait terrible s’il était fondé. Il n’a pas été mis en avant par MM. Considérant et Proudhon. On le retrouve dans Smith, dans Ricardo, dans Senior, dans tous les économistes sans exception, non comme théorie seulement, mais comme grief. Ces auteurs ne se sont pas bornés à attribuer au sol une valeur extra-humaine, ils ont encore assez hautement déduit la conséquence et infligé à la propriété foncière les noms de privilége, de monopole, d’usurpation. À la vérité, après l’avoir ainsi flétrie, ils l’ont défendue au nom de la nécessité. Mais qu’est-ce qu’une telle défense, si ce n’est un vice de dialectique que les logiciens du communisme se sont hâtés de réparer ?
Ce n’est donc pas pour obéir à un triste penchant vers les dissertations subtiles que j’aborde ce sujet délicat. J’aurais voulu épargner au lecteur et m’épargner à moi-même l’ennui que d’avance je sens planer sur la fin de ce chapitre.
La réponse à l’objection que je me suis adressée se trouve dans la théorie de la valeur exposée au chapitre V. Là j’ai dit : La valeur n’implique pas essentiellement le travail ; encore moins lui est-elle nécessairement proportionnelle. J’ai montré que la valeur avait pour fondement moins la peine prise par celui qui la cède que la peine épargnée à celui qui la reçoit, et c’est pour cela que je l’ai fait résider dans quelque chose qui embrasse ces deux éléments : le service. On peut rendre, ai-je dit, un grand service avec un très-léger effort, comme avec un grand effort on peut ne rendre qu’un très-médiocre service. Tout ce qui en résulte, c’est que le travail n’obtient pas nécessairement une rémunération toujours proportionnelle à son intensité. Cela n’est pas pour l’homme isolé plus que pour l’homme social.
La valeur se fixe à la suite d’un débat entre deux contractants. Or chacun d’eux apporte à ce débat son point de vue. Vous m’offrez du blé. Que m’importent le temps et la peine qu’il vous a coûté ? Ce qui me préoccupe surtout, c’est le temps et la peine qu’il m’en coûterait pour m’en procurer ailleurs. La connaissance que vous avez de ma situation peut vous rendre plus ou moins exigeant ; celle que j’ai de la vôtre peut me rendre plus ou moins empressé. Donc il n’y a pas une mesure nécessaire à la récompense que vous tirerez de votre labeur. Cela dépend des circonstances et du prix qu’elles donnent aux deux services qu’il s’agit d’échanger entre nous. Bientôt nous signalerons une force extérieure, appelée Concurrence, dont la mission est de régulariser les valeurs et de les rendre de plus en plus proportionnelles aux efforts. Toujours est-il que cette proportionnalité n’est pas de l’essence même de la valeur, puisqu’elle ne s’établit que sous la pression d’un fait contingent.
Ceci rappelé, je dis que la valeur du sol naît, flotte, se fixe comme celle de l’or, du fer, de l’eau, du conseil de l’avocat, de la consultation du médecin, du chant, de la danse ou du tableau de l’artiste, comme toutes les valeurs ; qu’elle n’obéit pas à des lois exceptionnelles ; qu’elle forme une propriété de même origine, de même nature, aussi légitime que toute autre propriété. — Mais il ne s’ensuit nullement, — on doit maintenant le comprendre, — que de deux travaux appliqués au sol, l’un ne puisse être beaucoup plus heureusement rémunéré que l’autre.
Revenons encore à cette industrie, la plus simple de toutes, et la plus propre à nous montrer le point délicat qui sépare le travail onéreux de l’homme et la coopération gratuite de la nature, je veux parler de l’humble industrie du porteur d’eau.
Un homme a recueilli et porté chez lui une tonne d’eau. Est-il propriétaire d’une valeur nécessairement proportionnelle à son travail ? En ce cas, cette valeur serait indépendante du service qu’elle peut rendre. Bien plus, elle serait immuable, car le travail passé n’est plus susceptible de plus ou de moins.
Eh bien, le lendemain du jour où la tonne d’eau a été recueillie et transportée, elle peut perdre toute valeur, si, par exemple, il a plu pendant la nuit. En ce cas, chacun est pourvu ; elle ne peut rendre aucun service ; on n’en veut plus. En langage économique, elle n’est pas demandée.
Au contraire, elle peut acquérir une valeur considérable si des besoins extraordinaires, imprévus et pressants se manifestent.
Que s’ensuit-il ? que l’homme, travaillant pour l’avenir, ne sait pas au juste d’avance le prix que cet avenir réserve à son travail. La valeur incorporée dans un objet matériel sera plus ou moins élevée, selon qu’il rendra plus ou moins de services, ou, pour mieux dire, le travail humain, origine de cette valeur, recevra, selon les circonstances, une récompense plus ou moins grande. C’est sur de telles éventualités que s’exerce la prévoyance qui, elle aussi, a droit à être rémunérée.
Mais, je le demande, quel rapport y a-t-il entre ces fluctuations de valeurs, entre cette variabilité dans la récompense qui attend le travail, et la merveilleuse industrie naturelle, les admirables lois physiques qui, sans notre participation, ont fait arriver l’eau de l’Océan à la source ? Parce que la valeur de cette tonne d’eau peut varier avec les circonstances, faut-il en conclure que la nature se fait payer quelquefois beaucoup, quelquefois peu, quelquefois pas du tout, l’évaporation, le transport des nuages de l’Océan aux montagnes, la congélation, la liquéfaction, et toute cette admirable industrie qui alimente la source ?
Il en est de même des produits agricoles.
La valeur du sol, ou plutôt du capital engagé dans le sol, n’a pas qu’un élément : elle en a deux. Elle dépend non-seulement du travail qui y a été consacré, mais encore de la puissance qui est dans la société de rémunérer ce travail ; de la Demande aussi bien que de l’Offre.
Voici un champ. Il n’est pas d’année où l’on n’y jette quelque travail dont les effets sont d’une nature permanente, et, de ce chef, résulte un accroissement de valeur.
En outre, les routes se rapprochent et se perfectionnent, la sécurité devient plus complète, les débouchés s’étendent, la population s’accroît en nombre et en richesse ; une nouvelle carrière s’ouvre à la variété des cultures, à l’intelligence, à l’habileté ; et de ce changement de milieu, de cette prospérité générale, résulte pour le travail actuel ou antérieur un excédant de rémunération ; par contre-coup, pour le champ, un accroissement de valeur.
Il n’y a là ni injustice ni exception en faveur de la propriété foncière. Il n’est aucun genre de travail, depuis la banque jusqu’à la main d’œuvre, qui ne présente le même phénomène. Il n’en est aucun qui ne voie améliorer sa rémunération par le seul fait de l’amélioration du milieu où il s’exerce. Cette action et cette réaction de la prospérité de chacun sur la prospérité de tous, et réciproquement, est la loi même de la valeur. Il est si faux qu’on en puisse conclure à une prétendue valeur qu’aurait revêtue le sol lui-même ou ses puissances productives, que le travail intellectuel, que les professions et métiers où n’interviennent ni la matière ni le concours des lois physiques, jouissent du même avantage, qui n’est pas exceptionnel, mais universel. L’avocat, le médecin, le professeur, l’artiste, le poëte, sont mieux rémunérés, à travail égal, à mesure que la ville et la nation à laquelle ils appartiennent croissent en bien-être, que le goût ou le besoin de leurs services se répand, que le public les demande davantage, et est à la fois plus obligé et plus en mesure de les mieux rétribuer. La simple cession d’une clientèle, d’une étude, d’une chalandise se fait sur ce principe. Bien plus, le géant basque et Tom Pouce, qui vivent de la simple exhibition de leur stature anormale, l’exposent avec plus d’avantage à la curiosité de la foule nombreuse et aisée des grandes métropoles qu’à celle de quelques rares et pauvres villageois. Ici, la demande ne contribue pas seulement à la valeur, elle la fait tout entière. Comment pourrait-on trouver exceptionnel ou injuste que la demande influât aussi sur la valeur du sol ou des produits agricoles ?
Alléguera-t-on que le sol peut atteindre ainsi une valeur exagérée ? Ceux qui le disent n’ont sans doute jamais réfléchi à l’immense quantité de travail que la terre cultivable a absorbée. J’ose affirmer qu’il n’est pas un champ en France qui vaille ce qu’il a coûté, qui puisse s’échanger contre autant de travail qu’il en a exigé pour être mis à l’état de productivité où il se trouve. Si cette observation est fondée, elle est décisive. Elle ne laisse pas subsister le moindre indice d’injustice à la charge de la propriété foncière. C’est pourquoi j’y reviendrai lorsque j’aurai à examiner la théorie de Ricardo sur la rente. J’aurai à montrer qu’on doit aussi appliquer aux capitaux fonciers cette loi générale que j’ai exprimée en ces termes : À mesure que le capital s’accroît, les produits se partagent entre les capitalistes ou propriétaires et les travailleurs, de telle sorte que la part relative des premiers va sans cesse diminuant, quoique leur part absolue augmente, tandis que la part des seconds augmente dans les deux sens.
Cette illusion qui fait croire aux hommes que les puissances productives ont une valeur propre, parce qu’elles ont de l’utilité, a entraîné après elle bien des déceptions et bien des catastrophes. C’est elle qui les a souvent poussés vers des colonisations prématurées dont l’histoire n’est qu’un lamentable martyrologe. Ils ont raisonné ainsi : Dans notre pays, nous ne pouvons obtenir de la valeur que par le travail ; et quand nous avons travaillé, nous n’avons qu’une valeur proportionnelle à notre travail. Si nous allions dans la Guyane, sur les bords du Mississipi, en Australie, en Afrique, nous prendrions possession de vastes terrains incultes, mais fertiles. Nous deviendrions propriétaires, pour notre récompense, et de la valeur que nous aurions créée, et de la valeur propre, inhérente à ces terrains. On part, et une cruelle expérience ne tarde pas à confirmer la vérité de la théorie que j’expose ici. On travaille, on défriche, on s’exténue ; on est exposé aux privations, à la souffrance, aux maladies ; et puis, si l’on veut revendre la terre qu’on a rendue propre à la production, on n’en tire pas ce qu’elle a coûté, et l’on est bien forcé de reconnaître que la valeur est de création humaine. Je défie qu’on me cite une colonisation qui n’ait été, à l’origine, un désastre.
« Plus de mille ouvriers furent dirigés sur la rivière du Cygne ; mais l’extrême bas prix de la terre (1 sh. 6 d. l’acre ou moins de 2 fr.) et le taux extravagant de la main-d’œuvre leur donna le désir et la facilité de devenir propriétaires. Les capitalistes ne trouvèrent plus personne pour travailler. Un capital de cinq millions y périt, et la colonie devint une scène de désolation. Les ouvriers ayant abandonné leurs patrons, pour obéir à l’illusoire satisfaction d’être propriétaires de terre, les instruments d’agriculture se rouillèrent, les semences moisirent, les troupeaux périrent faute de soins. Une famine affreuse put seule guérir les travailleurs de leur infatuation. Ils revinrent demander du travail aux capitalistes, mais il n’était plus temps. » (Proceedings of the South Australian association.)
L’association, attribuant ce désastre au bon marché des terres, en porta le prix à 12 sh. Mais, ajoute Carey à qui j’emprunte cette citation, la véritable cause c’est que les ouvriers, s’étant persuadé que la terre a une Valeur propre, indépendante du travail, s’étaient empressés de s’emparer de cette prétendue Valeur à laquelle ils supposaient la puissance de contenir virtuellement une Rente.
La suite me fournit un argument plus péremptoire encore.
« En 1836, les propriétés foncières de la rivière du Cygne s’obtenaient des acquéreurs primitifs à un schelling l’acre. » (New Monthly Magazine.)
Ainsi, ce sol vendu par la compagnie à 12 sh. — sur lequel les acquéreurs avaient jeté beaucoup de travail et d’argent, ils le revendirent à un schelling ! Où était donc la valeur des puissances productives naturelles et indestructibles ? [243]
Ce vaste et important sujet de la valeur des terres n’est pas épuisé, je le sens, par ce chapitre écrit à bâtons rompus, au milieu d’occupations incessantes : j’y reviendrai ; mais je ne puis terminer sans soumettre une observation aux lecteurs et particulièrement aux économistes.
Ces savants illustres qui ont fait faire tant de progrès à la science, dont les écrits et la vie respirent la bienveillance et la philanthropie, qui ont révélé, au moins sous un certain aspect et dans le cercle de leurs recherches, la véritable solution du problème social, les Quesnay, les Turgot, les Smith, les Malthus, les Say n’ont pas échappé cependant, je ne dis pas à la réfutation, elle est toujours de droit, mais à la calomnie, au dénigrement, aux grossières injures. Attaquer leurs écrits, et même leurs intentions, est devenu presque une mode. — On dira peut-être que dans ce chapitre je fournis des armes à leurs détracteurs, et certes le moment serait très-mal choisi de me tourner contre ceux que je regarde, j’en fais la déclaration solennelle, comme mes initiateurs, mes guides, mes maîtres. Mais, après tout, le droit suprême n’appartient-il pas à la Vérité, ou à ce que, sincèrement, je regarde comme la Vérité ? Quel est le livre, au monde, où ne se soit glissée aucune erreur ? Or une erreur, en économie politique, si on la presse, si on la tourmente, si on lui demande ses conséquences logiques, les contient toutes ; elle aboutit au chaos. Il n’y a donc pas de livre dont on ne puisse extraire une proposition isolée, incomplète, fausse, et qui ne renferme par conséquent tout un monde d’erreurs et de désordres. En conscience, je crois que la définition que les économistes ont donnée du mot Valeur est de ce nombre. On vient de voir que cette définition les a conduits eux-mêmes à jeter sur la légitimité de la Propriété foncière, et, par voie de déduction, sur le capital, un doute dangereux ; et ils ne se sont arrêtés dans cette voie funeste que par une inconséquence. Cette inconséquence les a sauvés. Ils ont repris leur marche dans la voie du Vrai, et leur erreur, si c’en est une, est dans leurs livres une tache isolée. Le socialisme est venu qui s’est emparé de la fausse définition, non pour la réfuter, mais pour l’adopter, la corroborer, en faire le point de départ de sa propagande, et en exprimer toutes les conséquences. Il y avait là, de nos jours, un danger social imminent, et c’est pourquoi j’ai cru qu’il était de mon devoir de dire toute ma pensée, de remonter jusqu’aux sources de la fausse théorie. Que si l’on en voulait induire que je me sépare de mes maîtres Smith et Say, de mes amis Blanqui et Garnier, uniquement parce que, dans une ligne perdue au milieu de leurs savants et excellents écrits, ils auraient fait une fausse application, selon moi, du mot Valeur ; si l’on en concluait que je n’ai plus foi dans l’économie politique et les économistes, je ne pourrais que protester, — et, au reste, il y a la plus énergique des protestations dans le titre même de ce livre.
X. Concurrence↩
L’économie politique n’a pas, dans tout son vocabulaire, un mot qui ait autant excité la fureur des réformateurs modernes que le mot Concurrence, auquel, pour le rendre plus odieux, ils ne manquent jamais d’accoler l’épithète: anarchique.
Que signifie Concurrence anarchique ? Je l’ignore. Que peut-on mettre à sa place ? Je ne le sais pas davantage.
J’entends bien qu’on me crie : Organisation ! Association ! Mais qu’est-ce à dire ? Il faut nous entendre une fois pour toutes. Il faut enfin que je sache quel genre d’autorité ces écrivains entendent exercer sur moi et sur tous les hommes vivant à la surface du globe ; car, en vérité, je ne leur en reconnais qu’une, celle de la raison s’ils peuvent la mettre de leur côté. Eh bien ! veulent-ils me priver du droit de me servir de mon jugement quand il s’agit de mon existence ? Aspirent-ils à m’ôter la faculté de comparer les services que je rends à ceux que je reçois ? Entendent-ils que j’agisse sous l’influence de la contrainte par eux exercée et non sous celle de mon intelligence ? S’ils me laissent ma liberté, la Concurrence reste. S’ils me la ravissent, je ne suis que leur esclave. L’association sera libre et volontaire, disent-ils. À la bonne heure ! Mais alors chaque groupe d’associés sera à l’égard des autres groupes ce que sont aujourd’hui les individus entre eux, et nous aurons encore la Concurrence. — L’association sera intégrale. — Oh ! ceci passe la plaisanterie. Quoi ! La concurrence anarchique désole actuellement la société ; et il nous faut attendre, pour guérir de cette maladie, que, sur la foi de votre livre, tous les hommes de la terre, Français, Anglais, Chinois, Japonais, Cafres, Hottentots, Lapons, Cosaques, Patagons, se soient mis d’accord pour s’enchaîner à tout jamais à une des formes d’association que vous avez imaginées ? Mais prenez garde, c’est avouer que la Concurrence est indestructible ; et oseriez-vous dire qu’un phénomène indestructible, par conséquent providentiel, puisse être malfaisant ?
Et après tout, qu’est-ce que la Concurrence ? Est-ce une chose existant et agissant par elle-même comme le choléra ? Non, Concurrence, ce n’est qu’absence d’oppression. En ce qui m’intéresse, je veux choisir pour moi-même et ne veux pas qu’un autre choisisse pour moi, malgré moi ; voilà tout. Et si quelqu’un prétend substituer son jugement au mien dans les affaires qui me regardent, je demanderai de substituer le mien au sien dans les transactions qui le concernent. Où est la garantie que les choses en iront mieux ? Il est évident que la Concurrence, c’est la liberté. Détruire la liberté d’agir, c’est détruire la possibilité et par suite la faculté de choisir, de juger, de comparer ; c’est tuer l’intelligence, c’est tuer la pensée, c’est tuer l’homme. De quelque coté qu’ils partent, voilà où aboutissent toujours les réformateurs modernes ; pour améliorer la société, ils commencent par anéantir l’individu, sous prétexte que tous les maux en viennent, comme si tous les biens n’en venaient pas aussi. Nous avons vu que les services s’échangent contre les services. Au fond, chacun de nous porte en ce monde la responsabilité de pourvoir à ses satisfactions par ses efforts. Donc un homme nous épargne une peine ; nous devons lui en épargner une à notre tour. Il nous confère une satisfaction résultant de son effort ; nous devons faire de même pour lui.
Mais qui fera la comparaison ? car, entre ces efforts, ces peines, ces services échangés, il y a, de toute nécessité, une comparaison à faire pour arriver à l’équivalence, à la justice, à moins qu’on ne nous donne pour règle l’injustice, l’inégalité, le hasard, ce qui est une autre manière de mettre l’intelligence humaine hors de cause. Il faut donc un juge ou des juges. Qui le sera ? N’est-il pas bien naturel que, dans chaque circonstance, les besoins soient jugés par ceux qui les éprouvent, les satisfactions par ceux qui les recherchent, les efforts par ceux qui les échangent ? Et est-ce sérieusement qu’on nous propose de substituer à cette universelle vigilance des intéressés une autorité sociale (fût-ce celle du réformateur lui-même), chargée de décider sur tous les points du globe les délicates conditions de ces échanges innombrables ? Ne voit-on pas que ce serait créer le plus faillible, le plus universel, le plus immédiat, le plus inquisitorial, le plus insupportable, le plus actuel, le plus intime, et disons, fort heureusement, le plus impossible de tous les despotismes que jamais cervelle de pacha ou de mufti ait pu concevoir ?
Il suffit de savoir que la Concurrence n’est autre chose que l’absence d’une autorité arbitraire comme juge des échanges, pour en conclure qu’elle est indestructible. La force abusive peut certainement restreindre, contrarier, gêner la liberté de troquer, comme la liberté de marcher ; mais elle ne peut pas plus anéantir l’une que l’autre sans anéantir l’homme. Cela étant ainsi, reste à savoir si la Concurrence agit pour le bonheur ou le malheur de l’humanité ; question qui revient à celle-ci : L’humanité est-elle naturellement progressive ou fatalement rétrograde ?
Je ne crains pas de le dire : la Concurrence, que nous pourrions bien nommer la Liberté, malgré les répulsions qu’elle soulève, en dépit des déclamations dont on la poursuit, est la loi démocratique par essence. C’est la plus progressive, la plus égalitaire, la plus communautaire de toutes celles à qui la Providence a confié le progrès des sociétés humaines. C’est elle qui fait successivement tomber dans le domaine commun la jouissance des biens que la nature ne semblait avoir accordés gratuitement qu’à certaines contrées. C’est elle qui fait encore tomber dans le domaine commun toutes les conquêtes dont le génie de chaque siècle accroît le trésor des générations qui le suivent, ne laissant ainsi en présence que des travaux complémentaires s’échangeant entre eux, sans réussir, comme ils le voudraient, à se faire rétribuer pour le concours des agents naturels ; et si ces travaux, comme il arrive toujours à l’origine, ont une valeur qui ne soit pas proportionnelle à leur intensité, c’est encore la Concurrence qui, par son action inaperçue, mais incessante, ramène un équilibre sanctionné par la justice et plus exact que celui que tenterait vainement d’établir la sagacité faillible d’une magistrature humaine. Loin que la Concurrence, comme on l’en accuse, agisse dans le sens de l’inégalité, on peut affirmer que toute inégalité factice est imputable à son absence ; et si l’abîme est plus profond entre le grand lama et un paria qu’entre le président et un artisan des États-Unis, cela tient à ce que la Concurrence (ou la liberté), comprimée en Asie, ne l’est pas en Amérique. Et c’est pourquoi, pendant que les Socialistes voient dans la Concurrence la cause de tout mal, c’est dans les atteintes qu’elle reçoit qu’il faut chercher la cause perturbatrice de tout bien. Encore que cette grande loi ait été méconnue des Socialistes et de leurs adeptes, encore qu’elle soit souvent brutale dans ses procédés, il n’en est pas de plus féconde en harmonies sociales, de plus bienfaisante dans ses résultats généraux, il n’en est pas qui atteste d’une manière plus éclatante l’incommensurable supériorité des desseins de Dieu sur les vaines et impuissantes combinaisons des hommes.
Je dois rappeler ici ce singulier mais incontestable résultat de l’ordre social, sur lequel j’ai déjà attiré l’attention du lecteur, [244] et que la puissance de l’habitude dérobe trop souvent à notre vue. C’est que : La somme des satisfactions qui aboutit à chaque membre de la société est de beaucoup supérieure à celle qu’il pourrait se procurer par ses propres 'efforts. — En d’autres termes, il y a une disproportion évidente entre nos consommations et notre travail. Ce phénomène, que chacun de nous peut aisément constater, s’il veut tourner un instant ses regards sur lui-même, devrait, ce me semble, nous inspirer quelque reconnaissance pour la Société à qui nous en sommes redevables.
Nous arrivons dénués de tout sur cette terre, tourmentés de besoins sans nombre, et pourvus seulement de facultés pour y faire face. Il semble, à priori, que tout ce à quoi nous pourrions prétendre, c’est d’obtenir des satisfactions proportionnelles à notre travail. Si nous en avons plus, infiniment plus, à qui devons-nous cet excédant ? Précisément à cette organisation naturelle contre laquelle nous déclamons sans cesse, quand nous ne cherchons pas à la détruire.
En lui-même, le phénomène est vraiment extraordinaire. Que certains hommes consomment plus qu’ils ne produisent, rien de plus aisément explicable, si, d’une façon ou d’une autre, ils usurpent les droits d’autrui, s’ils reçoivent des services sans en rendre. Mais comment cela peut-il être vrai de tous les hommes à la fois ? Comment se fait-il qu’après avoir échangé leurs services sans contrainte, sans spoliation, sur le pied de l’équivalence, chaque homme puisse se dire avec vérité : Je détruis en un jour plus que je ne pourrais créer en un siècle !
Le lecteur comprend que cet élément additionnel qui résout le problème, c’est le concours toujours plus efficace des agents naturels dans l’œuvre de la production ; c’est l’utilité gratuite venant tomber sans cesse dans le domaine de la communauté ; c’est le travail du chaud, du froid, de la lumière, de la gravitation, de l’affinité, de l’élasticité venant progressivement s’ajouter au travail de l’homme et diminuer la valeur des services en les rendant plus faciles.
J’aurais, certes, bien mal exposé la théorie de la valeur, si le lecteur pensait qu’elle baisse immédiatement et d’elle-même par le seul fait de la coopération, à la décharge du travail humain, d’une force naturelle. Non, il n’en est pas ainsi ; car alors on pourrait dire, avec les économistes anglais : La valeur est proportionnelle au travail. Celui qui se fait aider par une force naturelle et gratuite rend plus facilement ses services ; mais pour cela il ne renonce pas volontairement à une portion quelconque de sa rémunération accoutumée. Pour l’y déterminer, il faut une coercition extérieure, sévère sans être injuste. Cette coercition, c’est la Concurrence qui l’exerce. Tant qu’elle n’est pas intervenue, tant que celui qui a utilisé un agent naturel est maître de son secret, son agent naturel est gratuit, sans doute, mais il n’est pas encore commun ; la conquête est réalisée, mais elle l’est au profit d’un seul homme ou d’une seule classe. Elle n’est pas encore un bienfait pour l’humanité entière. Il n’y a encore rien de changé dans le monde, si ce n’est qu’une nature de services, bien que déchargée en partie du fardeau de la peine, exige cependant la rétribution intégrale. Il y a, d’un côté, un homme qui exige de tous ses semblables le même travail qu’autrefois, quoiqu’il ne leur offre que son travail réduit ; il y a, de l’autre, l’humanité entière qui est encore obligée de faire le même sacrifice de temps et de labeur pour obtenir un produit que désormais la nature réalise en partie.
Si les choses devaient rester ainsi, avec toute invention un principe d’inégalité indéfinie s’introduirait dans le monde. Non-seulement on ne pourrait pas dire : La valeur est proportionnelle au travail, mais on ne pourrait pas dire davantage : La valeur tend à se proportionner au travail. Tout ce que nous avons dit dans les chapitres précédents de l’utilité gratuite, de la communauté progressive, serait chimérique. Il ne serait pas vrai que les services s’échangent contre les services, de telle sorte que les dons de Dieu se transmettent de main en main par-dessus le marché, jusqu’au destinataire qui est le consommateur. Chacun se ferait payer à tout jamais, outre son travail, la portion des forces naturelles qu’il serait parvenu à exploiter une fois ; en un mot, l’humanité serait constituée sur le principe du monopole universel, au lieu de l’être sur le principe de la Communauté progressive.
Mais il n’en est pas ainsi ; Dieu, qui a prodigué à toutes ses créatures la chaleur, la lumière, la gravitation, l’air, l’eau, la terre, les merveilles de la vie végétale, l’électricité et tant d’autres bienfaits innombrables qu’il ne m’est pas donné d’énumérer, Dieu, qui a mis dans l’individualité l’intérêt personnel qui, comme un aimant, attire toujours tout à lui, Dieu, dis-je, a placé aussi, au sein de l’ordre social, un autre ressort auquel il a confié le soin de conserver à ses bienfaits leur destination primitive : la gratuité, la communauté. Ce ressort, c’est la Concurrence.
Ainsi l’Intérêt personnel est cette indomptable force individualiste qui nous fait chercher le progrès, qui nous le fait découvrir, qui nous y pousse l’aiguillon dans le flanc, mais qui nous porte aussi à le monopoliser. La Concurrence est cette force humanitaire non moins indomptable qui arrache le progrès, à mesure qu’il se réalise, des mains de l’individualité, pour en faire l’héritage commun de la grande famille humaine. Ces deux forces qu’on peut critiquer, quand on les considère isolément, constituent dans leur ensemble, par le jeu de leurs combinaisons, l’Harmonie sociale.
Et, pour le dire en passant, il n’est pas surprenant que l’individualité, représentée par l’intérêt de l’homme en tant que producteur, s’insurge depuis le commencement du monde contre la Concurrence, qu’elle la réprouve, qu’elle cherche à la détruire, appelant à son aide la force, la ruse, le privilége, le sophisme, le monopole, la restriction, la protection gouvernementale, etc. La moralité de ses moyens dit assez la moralité de son but. Mais ce qu’il y a d’étonnant et de douloureux, c’est que la science elle-même, — la fausse science, il est vrai, — propagée avec tant d’ardeur par les écoles socialistes, au nom de la philanthropie, de l’égalité, de la fraternité, ait épousé la cause de l’Individualisme dans sa manifestation la plus étroite, et déserté celle de l’humanité.
Voyons maintenant agir la Concurrence.
L’homme, sous l’influence de l’intérêt personnel, recherche toujours et nécessairement les circonstances qui peuvent donner le plus de valeur à ses services. Il ne tarde pas à reconnaître qu’à l’égard des dons de Dieu, il peut être favorisé de trois manières : (V. la note de la page 160.)
1° Ou s’il s’empare seul de ces dons eux-mêmes ;
2° Ou s’il connaît seul le procédé par lequel il est possible de les utiliser ;
3° Ou s’il possède seul l’instrument au moyen duquel on peut les faire concourir.
Dans l’une ou l’autre de ces circonstances, il donne peu de son travail contre beaucoup de travail d’autrui. Ses services ont une grande valeur relative, et l’on est disposé à croire que cet excédant de valeur est inhérent à l’agent naturel. S’il en était ainsi, cette valeur serait irréductible. La preuve que la valeur est dans le service, c’est que nous allons voir la Concurrence diminuer l’une en même temps que l’autre.
1° Les agents naturels, les dons de Dieu, ne sont pas répartis d’une manière uniforme sur la surface du globe. Quelle infinie succession de végétaux depuis la région du sapin jusqu’à celle du palmier ! Ici la terre est plus féconde, là la chaleur plus vivifiante ; sur tel point on rencontre la pierre, sur tel autre le plâtre, ailleurs le fer, le cuivre, la houille. Il n’y a pas partout des chutes d’eau ; on ne peut pas profiter également partout de l’action des vents. La seule distance où nous nous trouvons des objets qui nous sont nécessaires différencie à l’infini les obstacles que rencontrent nos efforts ; il n’est pas jusqu’aux facultés de l’homme qui ne varient, dans une certaine mesure, avec les climats et les races.
Il est aisé de comprendre que, sans la loi de la Concurrence, cette inégalité dans la distribution des dons de Dieu amènerait une inégalité correspondante dans la condition des hommes.
Quiconque serait à portée d’un avantage naturel en profiterait pour lui, mais n’en ferait pas profiter ses semblables. Il ne permettrait aux autres hommes d’y participer, par son intermédiaire, que moyennant une rétribution excessive dont sa volonté fixerait arbitrairement la limite. Il attacherait à ses services la valeur qu’il lui plairait. Nous avons vu que les deux limites extrêmes entre lesquelles elle se fixe sont la peine prise par celui qui rend le service et la peine épargnée à celui qui le reçoit. Sans la Concurrence, rien n’empêcherait de la porter à la limite supérieure. Par exemple, l’homme des tropiques dirait à l’Européen : « Grâce à mon soleil, je puis obtenir une quantité donnée de sucre, de café, de cacao, de coton avec une peine égale à dix, tandis qu’obligé, dans votre froide région, d’avoir recours aux serres, aux poêles, aux abris, vous ne le pouvez qu’avec une peine égale à cent. Vous me demandez mon sucre, mon café, mon coton, et vous ne seriez pas fâché que, dans la transaction, je ne tinsse compte que de la peine que j’ai prise. Mais moi je regarde surtout celle que je vous épargne ; car, sachant que c’est la limite de votre résistance, j’en fais celle de ma prétention. Comme ce que je fais avec une peine égale à dix, vous pouvez le faire chez vous avec une peine égale à cent, si je vous demandais en retour de mon sucre un produit qui vous coûtât une peine égale à cent un, il est certain que vous me refuseriez ; mais je n’exige qu’une peine de quatre vingt-dix-neuf. Vous pourrez bien bouder pendant quelque temps ; mais vous y viendrez, car à ce taux il y a encore avantage pour vous dans l’échange. Vous trouvez ces bases injustes ; mais après tout ce n’est pas à vous, c’est à moi que Dieu a fait don d’une température élevée. Je me sais en mesure d’exploiter ce bienfait de la Providence en vous en privant, si vous ne consentez à me payer une taxe, car je n’ai pas de concurrents. Ainsi voilà mon sucre, mon cacao, mon café, mon coton. Prenez-les aux conditions que je vous impose, ou faites-les vous-même, ou passez-vous-en. »
Il est vrai que l’Européen pourrait à son tour tenir à l’homme des tropiques un langage analogue : « Bouleversez votre sol, dirait-il, creusez des puits, cherchez du fer et de la houille, et félicitez-vous si vous en trouvez : car, sinon, c’est ma résolution de pousser aussi à l’extrême mes exigences. Dieu nous a fait deux dons précieux. Nous en prenons d’abord ce qu’il nous faut, puis nous ne souffrons pas que d’autres y touchent sans nous payer un droit d’aubaine. »
Si les choses se passaient ainsi, la rigueur scientifique ne permettrait pas encore d’attribuer aux agents naturels la Valeur qui réside essentiellement dans les services. Mais il serait permis de s’y tromper, car le résultat serait absolument le même. Les services s’échangeraient toujours contre des services, mais ils ne manifesteraient aucune tendance à se mesurer par les efforts, par le travail. Les dons de Dieu seraient des priviléges personnels et non des biens communs, et peut-être pourrions-nous, avec quelque fondement, nous plaindre d’avoir été traités par l’Auteur des choses d’une manière si irrémédiablement inégale. Serions-nous frères ici-bas ? Pourrions-nous nous considérer comme les fils d’un Père commun ? Le défaut de Concurrence, c’est-à-dire de Liberté, serait d’abord un obstacle invincible à l’Égalité. Le défaut d’égalité exclurait toute idée de Fraternité. Il ne resterait rien de la devise républicaine.
Mais vienne la Concurrence, et nous la verrons frapper d’impossibilité absolue ces marchés léonins, ces accaparements des dons de Dieu, ces prétentions révoltantes dans l’appréciation des services, ces inégalités dans les efforts échangés.
Et remarquons d’abord que la Concurrence intervient forcément, provoquée qu’elle est par ces inégalités mêmes. Le travail se porte instinctivement du côté où il est le mieux rétribué, et ne manque pas de faire cesser cet avantage anormal ; de telle sorte que l’Inégalité n’est qu’un aiguillon qui nous pousse malgré nous vers l’Égalité. C’est une des plus belles intentions finales du mécanisme social. Il semble que la Bonté infinie, qui a répandu ses biens sur la terre, ait choisi l’avide producteur pour en opérer entre tous la distribution équitable ; et certes c’est un merveilleux spectacle que celui de l’intérêt privé réalisant sans cesse ce qu’il évite toujours. L’homme, en tant que producteur, est attiré fatalement, nécessairement vers les grosses rémunérations, qu’il fait par cela même rentrer dans la règle. Il obéit à son intérêt propre, et qu’est-ce qu’il rencontre sans le savoir, sans le vouloir, sans le chercher ? L’intérêt général.
Ainsi, pour revenir à notre exemple, par ce motif que l’homme des tropiques, exploitant les dons de Dieu, reçoit une rémunération excessive, il s’attire la Concurrence. Le travail humain se porte de ce côté avec une ardeur proportionnelle, si je puis m’exprimer ainsi, à l’amplitude de l’inégalité ; et il n’aura pas de paix qu’il ne l’ait effacée. Successivement, on voit le travail tropical égal à dix s’échanger, sous l’action de la Concurrence, contre du travail européen égal à quatre-vingt, puis à soixante, puis à cinquante, à quarante, à vingt, et enfin à dix. Il n’y a aucune raison, sous l’empire des lois spéciales naturelles, pour que les choses n’en viennent pas là, c’est-à-dire pour que les services échangés ne puissent pas se mesurer par le travail, par la peine prise, les dons de Dieu se donnant de part et d’autre par-dessus le marché. Or, quand les choses en sont là, il faut bien apprécier, pour la bénir, la révolution qui s’est opérée. — D’abord les peines prises de part et d’autre sont égales, ce qui est de nature à satisfaire la conscience humaine toujours avide de justice. — Ensuite, qu’est devenu le don de Dieu ? — Ceci mérite toute l’attention du lecteur. — Il n’a été retiré à personne. À cet égard, ne nous en laissons pas imposer par les clameurs du producteur tropical ; le Brésilien, en tant qu’il consomme lui-même du sucre, du coton, du café, profite toujours de la chaleur de son soleil ; car l’astre bienfaisant n’a pas cessé de l’aider dans l’œuvre de la production. Ce qu’il a perdu, c’est seulement l’injuste faculté de prélever une aubaine sur la consommation des habitants de l’Europe. Le bienfait providentiel, parce qu’il était gratuit, devait devenir et est devenu commun : Car gratuité et communauté sont de même essence.
Le don de Dieu est devenu commun, — et je prie le lecteur de ne pas perdre de vue que je me sers ici d’un fait spécial pour élucider un phénomène universel, — il est devenu, dis-je, commun à tous les hommes. Ce n’est pas là de la déclamation, mais l’expression d’une vérité mathématique. Pourquoi ce beau phénomène a-t-il été méconnu ? Parce que la communauté se réalise sous forme de valeur anéantie, et que notre esprit a beaucoup de peine à saisir les négations. Mais, je le demande, lorsque, pour obtenir une quantité de sucre, de café ou de coton, je ne cède que le dixième de la peine qu’il me faudrait prendre pour les produire moi-même, et cela parce qu’au Brésil le soleil fait les neuf dixièmes de l’œuvre, n’est-il pas vrai que j’échange du travail contre du travail ? Et n’obtiens-je pas très-positivement, en outre du travail brésilien, et par-dessus le marché, la coopération du climat des tropiques ? Ne puis-je pas affirmer avec une exactitude rigoureuse que je suis devenu, que tous les hommes sont devenus, au même titre que les Indiens et les Américains, c’est-à-dire à titre gratuit, participants de la libéralité de la nature, en tant qu’elle concerne les productions dont il s’agit ?
Il y a un pays, l’Angleterre, qui a d’abondantes mines de houille. C’est là, sans doute, un grand avantage local, surtout si l’on suppose, comme je le ferai pour plus de simplicité dans la démonstration, qu’il n’y a pas de houille sur le continent. — Tant que l’échange n’intervient pas, l’avantage qu’ont les Anglais, c’est d’avoir du feu en plus grande abondance que les autres peuples, de s’en procurer avec moins de peine, sans entreprendre autant sur leur temps utile. Sitôt que l’échange apparaît, abstraction faite de la Concurrence, la possession exclusive des mines les met à même de demander une rémunération considérable et de mettre leur peine à haut prix. Ne pouvant ni prendre cette peine nous-mêmes, ni nous adresser ailleurs, il faudra bien subir la loi. Le travail anglais, appliqué à ce genre d’exploitation, sera très-rétribué ; en d’autres termes, la houille sera chère, et le bienfait de la nature pourra être considéré comme conféré à un peuple et non a l’humanité.
Mais cet état de choses ne peut durer ; il y a une grande loi naturelle et sociale qui s’y oppose, la Concurrence. Par cela même que ce genre de travail sera très-rémunéré en Angleterre, il y sera très recherché, car les hommes recherchent toujours les grosses rémunérations. Le nombre des mineurs s’accroîtra à la fois par adjonction et par génération ; ils s’offriront au rabais ; ils se contenteront d’une rémunération toujours décroissante jusqu’à ce qu’elle descende à l’état normal, au niveau de celle qu’on accorde généralement, dans le pays, à tous les travaux analogues. Cela veut dire que le prix de la houille anglaise baissera en France ; cela veut dire qu’une quantité donnée de travail français obtiendra une quantité de plus en plus grande de houille anglaise, ou plutôt de travail anglais incorporé dans de la houille ; cela veut dire enfin, et c’est là ce que je prie d’observer, que le don que la nature semblait avoir fait à l’Angleterre, elle l’a conféré, en réalité, à l’humanité tout entière. La houille de Newcastle est prodiguée gratuitement à tous les hommes. Ce n’est là ni un paradoxe ni une exagération : Elle leur est prodiguée à titre gratuit, comme l’eau du torrent, à la seule condition de prendre la peine de l’aller chercher ou de restituer cette peine à ceux qui la prennent pour nous. Quand nous achetons la houille, ce n’est pas la houille que nous payons, mais le travail qu’il a fallu exécuter pour l’extraire et la transporter. Nous nous bornons à donner un travail égal que nous avons fixé dans du vin ou de la soie. Il est si vrai que la libéralité de la nature s’est étendue à la France, que le travail que nous restituons n’est pas supérieur à celui qu’il eût fallu accomplir si le dépôt houiller eût été en France. La Concurrence a amené l’égalité entre les deux peuples par rapport à la houille, sauf l’inévitable et légère différence qui résulte de la distance et du transport.
J’ai cité deux exemples, et, pour rendre le phénomène plus frappant par sa grandeur, j’ai choisi des relations internationales opérées sur une vaste échelle. Je crains d’être ainsi tombé dans l’inconvénient de dérober à l’œil du lecteur le même phénomène agissant incessamment autour de nous et dans nos transactions les plus familières. Qu’il veuille bien prendre dans ses mains les plus humbles objets, un verre, un clou, un morceau de pain, une étoffe, un livre. Qu’il se prenne à méditer sur ces vulgaires produits. Qu’il se demande quelle incalculable masse d’utilité gratuite serait, à la vérité, sans la Concurrence, demeurée gratuite pour le producteur, mais n’aurait jamais été gratuite pour l’humanité, c’est-à-dire ne serait jamais devenue commune. Qu’il se dise bien que, grâce à la Concurrence, en achetant ce pain, il ne paye rien pour l’action du soleil, rien pour la pluie, rien pour la gelée, rien pour les lois de la physiologie végétale, rien même pour l’action propre du sol, quoi qu’on en dise ; rien pour la loi de la gravitation mise en œuvre par le meunier, rien pour la loi de la combustion mise en œuvre par le boulanger, rien pour la force animale mise en œuvre par le voiturier ; qu’il ne paye que des services rendus, des peines prises par les agents humains ; qu’il sache que, sans la concurrence, il lui aurait fallu en outre payer une taxe pour l’intervention de tous ces agents naturels ; que cette taxe n’aurait eu d’autre limite que la difficulté qu’il éprouverait lui-même à se procurer du pain par ses propres efforts ; que, par conséquent, une vie entière de travail ne lui suffirait pas pour faire face à la rémunération qui lui serait demandée ; qu’il songe qu’il n’use pas d’un seul objet qui ne puisse et ne doive provoquer les mêmes réflexions, et que ces réflexions sont vraies pour tous les hommes vivant sur la face du globe : et il comprendra alors le vice des théories socialistes, qui, ne voyant que la superficie des choses, l’épiderme de la société, se sont si légèrement élevées contre la Concurrence, c’est-à-dire contre la liberté humaine ; il comprendra que la Concurrence, maintenant aux dons que la nature a inégalement répartis sur le globe le double caractère de la gratuité et de la communauté, il faut la considérer comme le principe d’une juste et naturelle égalisation ; il faut admirer comme la force qui tient en échec l’égoïsme de l’intérêt personnel, avec lequel elle se combine si artistement, qu’elle est en même temps un frein pour son avidité et un aiguillon pour son activité ; il faut la bénir comme la plus éclatante manifestation de l’impartiale sollicitude de Dieu envers toutes ses créatures.
De ce qui précède, on peut déduire la solution d’une des questions les plus controversées, celle de la liberté commerciale de peuple à peuple. S’il est vrai, comme cela me paraît incontestable, que les diverses nations du globe soient amenées par la Concurrence à n’échanger entre elles que du travail, de la peine de plus en plus nivelée, et à se céder réciproquement, par-dessus le marché, les avantages naturels que chacune d’elles a à sa portée ; combien ne sont-elles pas aveugles et absurdes celles qui repoussent législativement les produits étrangers, sous prétexte qu’ils sont à bon marché, qu’ils ont peu de valeur relativement à leur utilité totale, c’est-à-dire précisément parce qu’ils renferment une grande portion d’utilité gratuite !
Je l’ai déjà dit et je le répète : une théorie m’inspire de la confiance quand je la vois d’accord avec la pratique universelle. Or, il est positif que les nations feraient entre elles certains échanges si on ne le leur interdisait par la force. Il faut la baïonnette pour les empêcher, donc on a tort de les empêcher.
2° Une autre circonstance qui place certains hommes dans une situation favorable et exceptionnelle quant à la rémunération, c’est la connaissance exclusive des procédés par lesquels il est possible de s’emparer des agents naturels. Ce qu’on nomme une invention est une conquête du génie humain. Il faut voir comment ces belles et pacifiques conquêtes, qui sont, à l’origine, une source de richesses pour ceux qui les font, deviennent bientôt, sous l’action de la Concurrence, le patrimoine commun et gratuit de tous les hommes.
Les forces de la nature appartiennent bien à tout le monde. La gravitation, par exemple, est une propriété commune ; elle nous entoure, elle nous pénètre, elle nous domine : cependant, s’il n’y a qu’un moyen de la faire concourir à un résultat utile et déterminé, et qu’un homme qui connaisse ce moyen, cet homme pourra mettre sa peine à haut prix, ou refuser de la prendre, si ce n’est en échange d’une rémunération considérable. Sa prétention, à cet égard, n’aura d’autres limites que le point où il exigerait des consommateurs un sacrifice supérieur à celui que leur impose le vieux procédé. Il sera parvenu, par exemple, à anéantir les neuf dixièmes du travail nécessaire pour produire l’objet x. — Mais x a actuellement un prix courant déterminé par la peine que sa production exige selon la méthode ordinaire. L’inventeur vend x au cours ; en d’autres termes, sa peine lui est payée dix fois plus que celle de ses rivaux. C’est là la première phase de l’invention.
Remarquons d’abord qu’elle ne blesse en rien la justice. Il est juste que celui qui révèle au monde un procédé utile reçoive sa récompense : À chacun selon sa capacité.
Remarquons encore que jusqu’ici l’humanité, moins l’inventeur, n’a rien gagné que virtuellement, en perspective pour ainsi dire, puisque, pour acquérir le produit x, elle est tenue aux mêmes sacrifices qu’il lui coûtait autrefois.
Cependant l’invention entre dans sa seconde phase, celle de l’imitation. Il est dans la nature des rémunérations excessives d’éveiller la convoitise. Le procédé nouveau se répand, le prix de x va toujours baissant, et la rémunération décroît aussi, d’autant plus que l’imitation s’éloigne de l’époque de l’invention, c’est-à-dire d’autant plus qu’elle devient plus facile, moins chanceuse, et, partant, moins méritoire. Il n’y a certes rien là qui ne pût être avoué par la législation la plus ingénieuse et la plus impartiale.
Enfin l’invention parvient à sa troisième phase, à sa période définitive, celle de la diffusion universelle, de la communauté, de la gratuité ; son cycle est parcouru lorsque la Concurrence a ramené la rémunération des producteurs de x au taux général et normal de tous les travaux analogues. Alors les neuf dixièmes de la peine épargnée par l’invention, dans l’hypothèse, sont une conquête au profit de l’humanité entière. L’utilité de x est la même ; mais les neuf dixièmes y ont été mis par la gravitation, qui était autrefois commune à tous en principe, et qui est devenue commune à tous dans cette application spéciale. Cela est si vrai, que tous les consommateurs du globe sont admis à acheter x par le sacrifice du dixième de la peine qu’il coûtait autrefois. Le surplus a été entièrement anéanti par le procédé nouveau.
Si l’on veut bien considérer qu’il n’est pas une invention humaine qui n’ait parcouru ce cercle, que x est ici un signe algébrique qui représente le blé, le vêtement, les livres, les vaisseaux, pour la production desquels une masse incalculable de Peine ou de valeur a été anéantie par la charrue, la machine à filer, l’imprimerie et la voile ; que cette observation s’applique au plus humble des outils comme au mécanisme le plus compliqué, au clou, au coin, au levier, comme à la machine à vapeur et au télégraphe électrique ; on comprendra, j’espère, comment se résout dans l’humanité ce grand problème : Qu’une masse, toujours plus considérable et toujours plus également répartie, d’utilités ou de jouissances, vienne rémunérer chaque quantité fixe de travail humain.
3° J’ai fait voir que la Concurrence fait tomber, dans le domaine de la communauté et de la gratuité, et les forces naturelles et les procédés par lesquels on s’en empare ; il me reste à faire voir qu’elle remplit la même fonction, quant aux instruments au moyen desquels on met ces forces en œuvre.
Il ne suffit pas qu’il existe dans la nature une force, chaleur, lumière, gravitation, électricité ; il ne suffit pas que l’intelligence conçoive le moyen de l’utiliser ; il faut encore des instruments pour réaliser cette conception de l’esprit, et des approvisionnements pour entretenir pendant l’opération l’existence de ceux qui s’y livrent.
C’est une troisième circonstance favorable à un homme ou à une classe d’hommes, relativement à la rémunération, que de posséder des capitaux. Celui qui a en ses mains l’outil nécessaire au travailleur, les matériaux sur lesquels le travail va s’exercer et les moyens d’existence qui doivent se consommer pendant le travail, celui-là a une rémunération à stipuler ; le principe en est certainement équitable, car le capital n’est qu’une peine antérieure, laquelle n’a pas encore été rétribuée. Le capitaliste est dans une bonne position pour imposer la loi, sans doute ; mais remarquons que, même affranchi de toute Concurrence, il est une limite que ses prétentions ne peuvent jamais dépasser ; cette limite est le point où sa rémunération absorberait tous les avantages du service qu’il rend. Cela étant, il n’est pas permis de parler, comme on le fait si souvent, de la tyrannie du capital, puisque jamais, même dans les cas les plus extrêmes, sa présence ne peut nuire plus que son absence à la condition du travailleur. Tout ce que peut faire le capitaliste, comme l’homme des tropiques qui dispose d’une intensité de chaleur que la nature a refusée à d’autres, comme l’inventeur qui a le secret d’un procédé inconnu à ses semblables, c’est de leur dire : « Voulez-vous disposer de ma peine, j’y mets tel prix ; le trouvez-vous trop élevé, faites comme vous avez fait jusqu’ici, passez-vous-en. »
Mais la Concurrence intervient parmi les capitalistes. Des instruments, des matériaux, des approvisionnements n’aboutissent à réaliser des utilités qu’à la condition d’être mis en œuvre ; il y a donc émulation parmi les capitalistes pour trouver de l’emploi aux capitaux. Tout ce que cette émulation les force de rabattre sur les prétentions extrêmes dont je viens d’assigner les limites, se résolvant en une diminution dans le prix du produit, est donc un profit net, un gain gratuit pour le consommateur, c’est-à-dire pour l’humanité !
Ici, il est clair que la gratuité ne peut jamais être absolue ; puisque tout capital représente une peine, il y a toujours en lui le principe de la rémunération.
Les transactions relatives au Capital sont soumises à la loi universelle des échanges, qui ne s’accomplissent que parce qu’il y a pour les deux contractants avantage à les accomplir, encore que cet avantage, qui tend à s’égaliser, puisse être accidentellement plus grand pour l’un que pour l’autre. Il y a à la rétribution du capital une limite au delà de laquelle on n’emprunte plus ; cette limite est zéro-service pour l’emprunteur. De même, il y a une limite en deçà de laquelle on ne prête pas ; cette limite, c’est zéro-rétribution pour le prêteur. Cela est évident de soi. Que la prétention d’un des contractants soit poussée au point de réduire à zéro l’avantage de l’autre, et le prêt est impossible. La rémunération du capital oscille entre ces deux termes extrêmes, poussée vers la limite supérieure par la Concurrence des emprunteurs, ramenée vers la limite inférieure par la Concurrence des prêteurs ; de telle sorte que, par une nécessité en harmonie avec la justice, elle s’élève quand le capital est rare et s’abaisse quand il abonde.
Beaucoup d’économistes pensent que le nombre des emprunteurs s’accroît plus rapidement qu’il n’est possible au capital de se former, d’où il s’ensuivrait que la tendance naturelle de l’intérêt est vers la hausse. Le fait est décisif en faveur de l’opinion contraire, et nous voyons partout la civilisation faire baisser le loyer des capitaux. Ce loyer se payait, dit-on, 30 ou 40 pour cent à Rome ; il se paye encore 20 pour cent au Brésil, 10 pour cent à Alger, 8 pour cent en Espagne, 6 pour cent en Italie, 5 pour cent en Allemagne, 4 pour cent en France, 3 pour cent en Angleterre et moins encore en Hollande. Or tout ce que le progrès anéantit sur le loyer des capitaux, perdu pour les capitalistes, n’est pas perdu pour l’humanité. Si l’intérêt, parti de 40, arrive à 2 pour cent, c’est 38 parties sur 40 dont tous les produits seront dégrévés pour cet élément des frais de production. Ils parviendront au consommateur affranchis de cette charge dans la proportion des 19 vingtièmes ; c’est une force qui, comme les agents naturels, comme les procédés expéditifs, se résout en abondance, en égalisation, et, définitivement, en Élévation du niveau général de l’espèce humaine.
Il me reste à dire quelques mots de la Concurrence que le travail se fait à lui-même, sujet qui, dans ces derniers temps, a suscité tant de déclamations sentimentalistes. Mais quoi ! n’est-il pas épuisé, pour le lecteur attentif, par tout ce qui précède ? J’ai prouvé que, grâce à l’action de la Concurrence, les hommes ne pouvaient pas longtemps recevoir une rémunération anormale pour le concours des forces naturelles, pour la connaissance des procédés, ou la possession des instruments au moyen desquels on s’empare de ces forces. C’est prouver que les efforts tendent à s’échanger sur le pied de l’égalité, ou, en d’autres termes, que la valeur tend à se proportionner au travail. Dès lors, je ne vois vraiment pas ce qu’on peut appeler la Concurrence des travailleurs ; je vois moins encore comment elle pourrait empirer leur condition, puisque, à ce point de vue, les travailleurs, ce sont les consommateurs eux-mêmes ; la classe laborieuse, c’est tout le monde, c’est justement cette grande Communauté qui recueille, en définitive, les bienfaits de la Concurrence et tout le bénéfice des valeurs successivement anéanties par le progrès.
L’évolution est celle-ci : Les services s’échangent contre les services, ou les valeurs contre les valeurs. Quand un homme (ou une classe d’hommes) s’empare d’un agent naturel ou d’un procédé, sa prétention se règle, non sur la peine qu’il prend, mais sur la peine qu’il épargne aux autres. Il pousse ses exigences jusqu’à l’extrême limite, sans jamais pouvoir néanmoins empirer la condition d’autrui. Il donne à ses services la plus grande valeur possible. Mais graduellement, par l’action de la Concurrence, cette valeur tend à se proportionner à la peine prise ; en sorte que l’évolution se conclut quand des peines égales s’échangent contre des peines égales, chacune d’elles servant de véhicule à une masse toujours croissante d’utilité gratuite au profit de la communauté entière. Cela étant ainsi, ce serait tomber dans une contradiction choquante que de venir dire : La Concurrence fait du tort aux travailleurs.
Cependant, on le répète sans cesse, on en est même très-convaincu. Pourquoi ? Parce que par ce mot travailleur on n’entend pas la grande communauté laborieuse, mais une classe particulière. On divise la communauté en deux. On met d’un côté tous ceux qui ont des capitaux, qui vivent en tout ou en partie sur des travaux antérieurs, ou sur des travaux intellectuels, ou sur l’impôt ; de l’autre, on place les hommes qui n’ont que leurs bras, les salariés, et, pour me servir de l’expression consacrée, les prolétaires. On considère les rapports de ces deux classes, et l’on se demande si, dans l’état de ces rapports, la Concurrence que se font entre eux les salariés ne leur est pas funeste.
On dit : La situation des hommes de cette dernière classe est essentiellement précaire. Comme ils reçoivent leur salaire au jour le jour, ils vivent aussi au jour le jour. Dans le débat, qui, sous un régime libre, précède toute stipulation, ils ne peuvent pas attendre, il faut qu’ils trouvent du travail pour demain à quelque condition que ce soit, sous peine de mort ; si ce n’est pas rigoureusement vrai de tous, c’est vrai de beaucoup d’entre eux, et cela suffit pour abaisser la classe entière, car ce sont les plus pressés, les plus misérables qui capitulent les premiers et font le taux général des salaires. Il en résulte que le salaire tend à se mettre au niveau de ce qui est rigoureusement nécessaire pour vivre ; et, dans cet état de choses, l’intervention du moindre surcroît de Concurrence entre les travailleurs est une véritable calamité, car il ne s’agit pas pour eux d’un bien-être diminué, mais de la vie rendue impossible.
Certes, il y a beaucoup de vrai, beaucoup trop de vrai en fait, dans cette allégation. Nier les souffrances et l’abaissement dans cette classe d’hommes qui accomplit la partie matérielle dans l’œuvre de la production, ce serait fermer les yeux à la lumière. — À vrai dire, c’est à cette situation déplorable d’un grand nombre de nos frères que se rapporte ce qu’on a nommé avec raison le problème social, car, encore que les autres classes de la société soient visitées aussi par bien des inquiétudes, bien des souffrances, des péripéties, des crises, des convulsions économique, il est pourtant vrai de dire que la liberté serait probablement acceptée comme solution du problème, si elle ne paraissait impuissante à guérir cette plaie douloureuse qu’on nomme le Paupérisme.
Et puisque c’est là surtout que réside le problème social, le lecteur comprendra que je ne puis l’aborder ici. Plût à Dieu que la solution sortit du livre tout entier, mais évidemment elle ne peut sortir d’un chapitre !
J’expose maintenant des lois générales que je crois harmoniques, et j’ai la confiance que le lecteur commence à se douter aussi que ces lois existent, qu’elles agissent dans le sens de la communauté et par conséquent de l’égalité. Mais je n’ai pas nié que l’action de ces lois ne fût profondément troublée par des causes perturbatrices. Si donc nous rencontrons en ce moment un fait choquant d’inégalité, comment le pourrions-nous juger avant de connaître et les lois régulières de l’ordre social et les causes perturbatrices de ces lois ?
D’un autre côté, je n’ai nié ni le mal ni sa mission. J’ai cru pouvoir annoncer que, le libre arbitre ayant été donné à l’homme, il ne fallait pas réserver le nom d’harmonie à un ensemble d’où le malheur serait exclu ; car le libre arbitre implique l’erreur, au moins comme possible, et l’erreur, c’est le mal. L’Harmonie sociale, comme tout ce qui concerne l’homme, est relative ; le mal est un de ses rouages nécessaires destinés à vaincre l’erreur, l’ignorance, l’injustice, en mettant en œuvre deux grandes lois de notre nature : la responsabilité et la solidarité.
Maintenant le paupérisme existant de fait, faut-il l’imputer aux lois naturelles qui régissent l’ordre social — ou bien à des institutions humaines qui agiraient en sens contraire de ces lois, — ou, enfin, à ceux-là mêmes qui en sont les victimes et qui auraient appelé sur leurs têtes ce sévère châtiment de leurs erreurs et de leurs fautes ?
En d’autres termes : le paupérisme existe-t-il par destination providentielle, — ou, au contraire, par ce qu’il reste d’artificiel dans notre organisation politique — ou comme rétribution personnelle ? Fatalité, — Injustice, — Responsabilité, à laquelle de ces trois causes faut-il attribuer l’effroyable plaie ?
Je ne crains pas de dire : Elle ne peut résulter des lois naturelles qui ont fait jusqu’ici l’objet de nos études, puisque ces lois tendent toutes à l’égalisation dans l’amélioration, c’est-à-dire à rapprocher tous les hommes d’un même niveau qui s’élève sans cesse. Ce n’est donc pas le moment d’approfondir le problème de la misère.
En ce moment, si nous voulons considérer à part cette classe de travailleurs qui exécute la partie la plus matérielle de la production et qui, en général, désintéressée de l’œuvre, vit sur une rétribution fixe qu’on nomme salaire, la question que nous aurions à nous poser serait celle-ci : abstraction faite des bonnes ou mauvaises institutions économiques, abstraction faite des maux que les prolétaires peuvent encourir par leur faute — quel est, à leur égard, l’effet de la Concurrence ?
Pour cette classe comme pour toutes, l’action de la Concurrence est double. Ils la sentent comme acheteurs et comme vendeurs de services. Le tort de tous ceux qui écrivent sur ces matières est de ne jamais voir qu’un côté de la question, comme des physiciens qui, ne connaissant que la force centrifuge, croient et prophétisent sans cesse que tout est perdu. Passez-leur la fausse donnée, et vous verrez avec quelle irréprochable logique ils vous mèneront à leur sinistre conclusion. Il en est ainsi des lamentations que les socialistes fondent sur l’observation exclusive de la Concurrence centrifuge, si je puis parler ainsi ; ils oublient de tenir compte de la Concurrence centripète, et cela suffit pour réduire leurs doctrines à une puérile déclamation. Ils oublient que le travailleur, quand il se présente sur le marché avec le salaire qu’il a gagné, est un centre où aboutissent des industries innombrables, et qu’il profite alors de la Concurrence universelle dont elles se plaignent toutes tour à tour.
Il est vrai que le prolétaire, quand il se considère comme producteur, comme offreur de travail ou de services, se plaint aussi de la concurrence. Admettons donc qu’elle lui profite d’une part, et qu’elle le gêne de l’autre ; il s’agit de savoir si la balance lui est favorable, ou défavorable, ou s’il y a compensation.
Je me serais bien mal expliqué si le lecteur ne comprenait pas que, dans ce mécanisme merveilleux, le jeu des concurrences, en apparence antagoniques, aboutit à ce résultat singulier et consolant qu’il y a balance favorable pour tout le monde à la fois, à cause de l’Utilité gratuite agrandissant sans cesse le cercle de la production et tombant sans cesse dans le domaine de la Communauté. Or, ce qui devient commun profite à tous sans nuire à personne ; on peut même ajouter, et cela est mathématique, profite à chacun en proportion de sa misère antérieure. C’est cette portion d’utilité gratuite, forcée par la Concurrence de devenir commune, qui fait que les valeurs tendent à devenir proportionnelles au travail, ce qui est au profit évident du travailleur. C’est elle aussi qui explique cette solution sociale, que je tiens constamment sous les yeux du lecteur, et qui ne peut nous être voilée que par les illusions de l’habitude : pour un travail déterminé chacun obtient une somme de satisfactions qui tend à s’accroître et à s’égaliser.
Au reste, la condition du travailleur ne résulte pas d’une loi économique, mais de toutes ; la connaître, découvrir ses perspectives, son avenir, c’est l’économie politique tout entière ; car peut-il y avoir autre chose, au point de vue de cette science, que des travailleurs ?… Je me trompe, il y a encore des spoliateurs. Qu’est-ce qui fait l’équivalence des services ? La liberté. Qu’est-ce qui altère l’équivalence des services ? L’oppression. Tel est le cercle que nous avons à parcourir.
Quant au sort de cette classe de travailleurs qui accomplit l’œuvre la plus immédiate de la production, il ne pourra être apprécié que lorsque nous serons en mesure de connaître comment la loi de la Concurrence se combine avec celles des Salaires et de la Population, et aussi avec les effets perturbateurs des taxes inégales et des monopoles.
Je n’ajouterai que quelques mots relativement à la Concurrence. Il est bien clair que diminuer la masse des satisfactions qui se répartissent entre les hommes, est un résultat étranger à sa nature. Affecte-t-elle, dans le sens de l’inégalité, cette répartition ? S’il est quelque chose d’évident au monde, c’est qu’après avoir, si je puis m’exprimer ainsi, attaché à chaque service, à chaque valeur une plus grande proportion d’utilité, la Concurrence travaille incessamment à niveler les services eux-mêmes, à les rendre proportionnels aux efforts. N’est-elle pas, en effet, l’aiguillon qui pousse vers les carrières fécondes, hors des carrières stériles ? Son action propre est donc de réaliser de plus en plus l’égalité, tout en élevant le niveau social.
Entendons-nous cependant sur ce mot égalité. Il n’implique pas pour tous les hommes des rémunérations identiques, mais proportionnelles à la quantité et même à la qualité de leurs efforts.
Une foule de circonstances contribue à rendre inégale la rémunération du travail (je ne parle ici que du travail libre, soumis à la Concurrence) ; si l’on y regarde de près, on s’aperçoit que, presque toujours juste et nécessaire, cette inégalité prétendue n’est que de l’égalité réelle.
Toutes choses égales d’ailleurs, il y a plus de profits aux travaux dangereux qu’à ceux qui ne le sont pas ; aux états qui exigent un long apprentissage et des déboursés longtemps improductifs, ce qui suppose, dans la famille, le long exercice de certaines vertus, qu’à ceux où suffit la force musculaire ; aux professions qui réclament la culture de l’esprit et font naître des goûts délicats, qu’aux métiers où il ne faut que des bras. Tout cela n’est-il pas juste ? Or, la Concurrence établit nécessairement ces distinctions ; la société n’a pas besoin que Fourier ou M. L. Blanc en décident.
Parmi ces circonstances, celle qui agit de la manière la plus générale, c’est l’inégalité de l’instruction ; or, ici comme partout, nous voyons la Concurrence exercer sa double action, niveler les classes et élever la société.
Si l’on se représente la société comme composée de deux couches superposées, dans l’une desquelles domine le principe intelligent, et dans l’autre le principe de la force brute, et si l’on étudie les rapports naturels de ces deux couches, on distingue aisément une force d’attraction dans la première, une force d’aspiration dans la seconde, qui concourent à leur fusion. L’inégalité même des profits souffle dans la couche inférieure une ardeur inextinguible vers la région du bien-être et des loisirs, et cette ardeur est secondée par le rayonnement des clartés qui illuminent les classes élevées. Les méthodes d’enseignement se perfectionnent ; les livres baissent de prix ; l’instruction s’acquiert en moins de temps et à moins de frais ; la science, monopolisée par une classe ou même une caste, voilée par une langue morte ou scellée dans une écriture hiéroglyphique, s’écrit et s’imprime en langue vulgaire, pénètre, pour ainsi dire, l’atmosphère et se respire comme l’air.
Mais ce n’est pas tout ; en même temps qu’une instruction plus universelle et plus égale rapproche les deux couches sociales, des phénomènes économiques très-importants et qui se rattachent à la grande loi de la Concurrence viennent accélérer la fusion. Le progrès de la mécanique diminue sans cesse la proportion du travail brut. La division du travail, en simplifiant et isolant chacune des opérations qui concourent à un résultat productif, met à la portée de tous les industries qui ne pouvaient d’abord être exercées que par quelques-uns. Il y a plus : un ensemble de travaux qui suppose, à l’origine, des connaissances très-variées, par le seul bénéfice des siècles, tombe, sous le nom de routine, dans la sphère d’action des classes les moins instruites ; c’est ce qui est arrivé pour l’agriculture. Des procédés agricoles qui, dans l’antiquité, méritèrent à ceux qui les ont révélés au monde les honneurs de l’apothéose, sont aujourd’hui l’héritage et presque le monopole des hommes les plus grossiers, et à tel point que cette branche si importante de l’industrie humaine est, pour ainsi dire, entièrement soustraite aux classes bien élevées.
De tout ce qui précède, on peut tirer une fausse conclusion et dire : « Nous voyons bien la Concurrence abaisser les rémunérations dans tous les pays, dans toutes les carrières, dans tous les rangs et les niveler par voie de réduction ; mais alors c’est le salaire du travail brut, de la peine physique, qui deviendra le type, l’étalon de toute rémunération. »
Je n’aurais pas été compris, si l’on ne voyait que la Concurrence, qui travaille à ramener toutes les rémunérations excessives vers une moyenne de plus en plus uniforme, élève nécessairement cette moyenne ; elle froisse, j’en conviens, les hommes en tant que producteurs ; mais c’est pour améliorer la condition générale de l’espèce humaine au seul point de vue qui puisse raisonnablement la relever, celui du bien-être, de l’aisance, des loisirs, du perfectionnement intellectuel et moral, et, pour tout dire en un mot, au point de vue de la consommation.
Dira-t-on qu’en fait l’humanité n’a pas fait les progrès que cette théorie semble impliquer ?
Je répondrai d’abord que, dans les sociétés modernes, la Concurrence est loin de remplir la sphère naturelle de son action ; nos lois la contrarient au moins autant qu’elles la favorisent ; et, quand on se demande si l’inégalité des conditions est due à sa présence ou à son absence, il suffit de voir quels sont les hommes qui tiennent le haut du pavé et nous éblouissent par l’éclat de leur fortune scandaleuse, pour s’assurer que l’inégalité, en ce qu’elle a d’artificiel et d’injuste, a pour base la conquête, les monopoles, les restrictions, les offices privilégiés, les hautes fonctions, les grandes places, les marchés administratifs, les emprunts publics, toutes choses auxquelles la Concurrence n’a rien à voir.
Ensuite, je crois que l’on méconnaît le progrès réel qu’a fait l’humanité depuis l’époque très récente à laquelle on doit assigner l’affranchissement partiel du travail. On a dit, avec raison, qu’il fallait beaucoup de philosophie pour discerner les faits dont on est sans cesse témoin. Ce que consomme une famille honnête et laborieuse de la classe ouvrière ne nous étonne pas, parce que l’habitude nous a familiarisés avec cet étrange phénomène. Si cependant nous comparions le bien-être auquel elle est parvenue avec la condition qui serait son partage, dans l’hypothèse d’un ordre social d’où la Concurrence serait exclue ; si les statisticiens, armés d’un instrument de précision, pouvaient mesurer, comme avec un dynamomètre, le rapport de son travail avec ses satisfactions à deux époques différentes, nous reconnaîtrions que la liberté, toute restreinte qu’elle est encore, a accompli en sa faveur un prodige que sa perpétuité même nous empêche de remarquer. Le contingent d’efforts humains qui, pour un résultat donné, a été anéanti, est vraiment incalculable. Il a été un temps où la journée de l’artisan n’aurait pu suffire à lui procurer le plus grossier almanach. Aujourd’hui, avec cinq centimes, ou la cinquantième partie de son salaire d’un jour, il obtient une gazette qui contient la matière d’un volume. Je pourrais faire la même remarque pour le vêtement, la locomotion, le transport, l’éclairage, et une multitude de satisfactions. À quoi est dû ce résultat ? À ce qu’une énorme proportion du travail humain rémunérable a été mise à la charge des forces gratuites de la nature. C’est une valeur anéantie, il n’y a plus à la rétribuer. Elle a été remplacée, sous l’action de la Concurrence, par de l’utilité commune et gratuite. Et, qu’on le remarque bien : quand, par suite du progrès, le prix d’un produit quelconque vient à baisser, le travail, épargné, pour l’obtenir, à l’acquéreur pauvre, est toujours proportionnellement plus grand que celui épargné à l’acquéreur riche ; cela est mathématique.
Enfin, ce flux toujours grossissant d’utilités que le travail verse et que la concurrence distribue dans toutes les veines du corps social ne se résume pas tout en bien-être ; il s’absorbe, en grande partie, dans le flot de générations de plus en plus nombreuses ; il se résout en accroissement de population, selon des lois qui ont une connexité intime avec le sujet qui nous occupe et qui seront exposées dans un autre chapitre.
Arrêtons-nous un moment et jetons un coup d’œil rapide sur l’espace que nous venons de parcourir.
L’homme a des besoins qui n’ont pas de limites ; il forme des désirs qui sont insatiables. Pour y pourvoir, il a des matériaux et des agents qui lui sont fournis par la nature, des facultés, des instruments, toutes choses que le travail met en œuvre. Le travail est la ressource qui a été le plus également départie à tous ; chacun cherche instinctivement, fatalement, à lui associer le plus de forces naturelles, le plus de capacité innée ou acquise, le plus de capitaux qu’il lui est possible, afin que le résultat de cette coopération soit plus d’utilités produites, ou, ce qui revient au même, plus de satisfactions acquises. Ainsi le concours toujours plus actif des agents naturels, le développement indéfini de l’intelligence, l’accroissement progressif des capitaux, amènent ce phénomène, étrange au premier coup d’œil, qu’une quantité de travail donnée fournisse une somme d’utilités toujours croissante, et que chacun puisse, sans dépouiller personne, atteindre à une masse de consommation hors de proportion avec ce que ses propres efforts pourraient réaliser.
Mais ce phénomène, résultat de l’harmonie divine que la Providence a répandue dans le mécanisme de la société, aurait tourné contre la société elle-même, en y introduisant le germe d’une inégalité indéfinie, s’il ne se combinait avec une autre harmonie non moins admirable, la Concurrence, qui est une des branches de la grande loi de la solidarité humaine.
En effet, s’il était possible que l’individu, la famille, la classe, la nation, qui se trouvent à portée de certains avantages naturels, ou qui ont fait dans l’industrie une découverte importante, ou qui ont acquis par l’épargne les instruments de la production, s’il était possible dis-je, qu’ils fussent soustraits d’une manière permanente à la loi de la Concurrence, il est clair que cet individu, cette famille, cette nation auraient à tout jamais le monopole d’une rémunération exceptionnelle, aux dépens de l’humanité. Où en serions-nous, si les habitants des régions équinoxiales, affranchis entre eux de toute rivalité, pouvaient, en échange de leur sucre, de leur café, de leur coton, de leurs épiceries, exiger de nous, non pas la restitution d’un travail égal au leur, mais une peine égale à celle qu’il nous faudrait prendre nous-mêmes pour produire ces choses sous notre rude climat ? Quelle incalculable distance séparerait les diverses conditions des hommes, si la race de Cadmus était la seule qui sût lire ; si nul n’était admis à manier une charrue à moins de prouver qu’il descend en droite ligne de Triptolème ; si seuls, les descendants de Guttenberg pouvaient imprimer, les fils d’Arkwright mettre en mouvement une filature, les neveux de Watt faire fumer la cheminée d’une locomotive ? Mais la Providence n’a pas voulu qu’il en fût ainsi. Elle a placé dans la machine sociale un ressort qui n’a rien de plus surprenant que sa puissance, si ce n’est sa simplicité ; ressort par l’opération duquel toute force productive, toute supériorité de procédé, tout avantage, en un mot, qui n’est pas du travail propre, s’écoule entre les mains du producteur, ne s’y arrête, sous forme de rémunération exceptionnelle, que le temps nécessaire pour exciter son zèle, et vient, en définitive, grossir le patrimoine commun et gratuit de l’humanité, et s’y résoudre en satisfactions individuelles toujours progressives, toujours plus également réparties ; ce ressort, c’est la Concurrence. Nous avons vu ses effets économiques ; il nous resterait à jeter un rapide regard sur quelques-unes de ses conséquences politiques et morales. Je me bornerai à indiquer les plus importantes.
Des esprits superficiels ont accusé la Concurrence d’introduire l’antagonisme parmi les hommes. Cela est vrai et inévitable tant qu’on ne les considère que dans leur qualité de producteurs ; mais placez-vous au point de vue de la consommation, et vous verrez la Concurrence elle-même rattacher les individus, les familles, les classes, les nations et les races, par les liens de l’universelle fraternité.
Puisque les biens qui semblent être d’abord l’apanage de quelques-uns deviennent, par un admirable décret de la munificence divine, le patrimoine commun de tous ; puisque les avantages naturels de situation, de fertilité, de température, de richesses minéralogiques et même d’aptitude industrielle, ne font que glisser sur les producteurs, à cause de la Concurrence qu’ils se font entre eux, et tournent exclusivement au profit des consommateurs ; il s’ensuit qu’il n’est aucun pays qui ne soit intéressé à l’avancement de tous les autres. Chaque progrès qui se fait à l’Orient est une richesse en perspective pour l’Occident. Du combustible découvert dans le Midi, c’est du froid épargné aux hommes du Nord. La Grande-Bretagne a beau faire faire des progrès à ses filatures, ce ne sont pas ses capitalistes qui en recueillent le bienfait, car l’intérêt de l’argent ne hausse pas ; ce ne sont pas ses ouvriers, car le salaire reste le même ; mais à la longue, c’est le Russe, c’est le Français, c’est l’Espagnol, c’est l’humanité, en un mot, qui obtient des satisfactions égales avec moins de peine, ou ce qui revient au même, des satisfactions supérieures, à peine égale.
Je n’ai parlé que des biens ; j’aurais pu en dire autant des maux qui frappent certains peuples ou certaines régions. L’action propre de la Concurrence est de rendre général ce qui était particulier. Elle agit exactement sur le principe des assurances. Un fléau ravage-t-il les terres des agriculteurs, ce sont les mangeurs de pain qui en souffrent. Un impôt injuste atteint-il la vigne en France, il se traduit en cherté de vin pour tous les buveurs de la terre : ainsi les biens et les maux qui ont quelque permanence ne font que glisser sur les individualités, les classes, les peuples ; leur destinée providentielle est d’aller, à la longue, affecter l’humanité tout entière, et élever ou abaisser le niveau de sa condition. Dès lors, envier à quelque peuple que ce soit la fertilité de son sol, ou la beauté de ses ports et de ses fleuves, ou la chaleur de son soleil, c’est méconnaître des biens auxquels nous sommes appelés à participer ; c’est dédaigner l’abondance qui nous est offerte ; c’est regretter la fatigue qui nous est épargnée. Dès lors, les jalousies nationales ne sont pas seulement des sentiments pervers, ce sont encore des sentiments absurdes. Nuire à autrui, c’est se nuire à soi-même ; semer des obstacles dans la voie des autres, tarifs, coalitions ou guerres, c’est embarrasser sa propre voie. Dès lors, les passions mauvaises ont leur châtiment comme les sentiments généreux ont leur récompense. L’inévitable sanction d’une exacte justice distributive parle à l’intérêt, éclaire l’opinion, proclame et doit faire prévaloir enfin, parmi les hommes, cette maxime d’éternelle vérité : L’utile, c’est un des aspects du juste ; la liberté, c’est la plus belle des harmonies sociales ; l’équité, c’est la meilleure politique.
Le christianisme a introduit dans le monde le grand principe de la fraternité humaine. Il s’adresse au cœur, au sentiment, aux nobles instincts. L’économie politique vient faire accepter le même principe à la froide raison, et, montrant l’enchaînement des effets aux causes, réconcilier, dans un consolant accord, les calculs de l’intérêt le plus vigilant avec les inspirations de la morale la plus sublime.
Une seconde conséquence qui découle de cette doctrine, c’est que la société est une véritable communauté. MM. Owen et Cabet peuvent s’épargner le soin de rechercher la solution du grand problème communiste ; elle est toute trouvée : elle résulte, non de leurs despotiques combinaisons, mais de l’organisation que Dieu a donnée à l’homme et à la société. Forces naturelles, procédés expéditifs, instruments de production, tout est commun entre les hommes, ou tend à le devenir, tout, hors la peine, le travail, l’effort individuel, il n’y a, il ne peut y avoir entre eux qu’une inégalité que les communistes les plus absolus admettent, celle qui résulte de l’inégalité des efforts. Ce sont ces efforts qui s’échangent les uns contre les autres à prix débattu. Tout ce que la nature, le génie des siècles et la prévoyance humaine ont mis d’utilité dans les produits échangés, est donné par-dessus le marché. Les rémunérations réciproques ne s’adressent qu’aux efforts respectifs, soit actuels sous le nom de travail, soit préparatoires sous le nom de capital ; c’est donc la communauté dans le sens le plus rigoureux du mot, à moins qu’on ne veuille prétendre que le contingent personnel de la satisfaction doit être égal, encore que le contingent de la peine ne le soit pas, ce qui serait, certes, la plus inique et la plus monstrueuse des inégalités : j’ajoute, et la plus funeste, car elle ne tuerait pas la Concurrence ; seulement elle lui donnerait une action inverse ; on lutterait encore, mais on lutterait de paresse, d’intelligence et d’imprévoyance.
Enfin la doctrine si simple, et, selon notre conviction, si vraie que nous venons de développer, fait sortir du domaine de la déclamation, pour le faire entrer dans celui de la démonstration rigoureuse, le grand principe de la perfectibilité humaine. — De ce mobile interne, qui ne se repose jamais dans le sein de l’individualité, et qui la porte à améliorer sa condition, naît le progrès des arts, qui n’est autre chose que le concours progressif de forces étrangères par leur nature à toute rémunération. — De la Concurrence naît l’attribution à la communauté des avantages d’abord individuellement obtenus. L’intensité de la peine requise pour chaque résultat donné va se restreignant sans cesse au profit du genre humain, qui voit ainsi s’élargir, de génération en génération, le cercle de ses satisfactions, de ses loisirs, et s’élever le niveau de son perfectionnement physique, intellectuel et moral ; et par cet arrangement, si digne de notre étude et de notre éternelle admiration, on voit clairement l’humanité se relever de sa déchéance.
Qu’on ne se méprenne pas à mes paroles. Je ne dis point que toute fraternité, toute communauté, toute perfectibilité sont renfermées dans la Concurrence. Je dis qu’elle s’allie, qu’elle se combine à ces trois grands dogmes sociaux, qu’elle en fait partie, qu’elle les manifeste, qu’elle est un des plus puissants agents de leur sublime réalisation.
Je me suis attaché à décrire les effets généraux et, par conséquent, bienfaisants de la Concurrence ; car il serait impie de supposer qu’aucune grande loi de la nature ne pût en produire qui fussent à la fois nuisibles et permanents ; mais je suis loin de nier que son action ne soit accompagnée de beaucoup de froissements et de souffrances. Il me semble même que la théorie qui vient d’être exposée explique et ces souffrances et les plaintes inévitables qu’elles excitent. Puisque l’œuvre de la Concurrence consiste à niveler, nécessairement elle doit contrarier quiconque élève au-dessus du niveau sa tête orgueilleuse. On comprend que chaque producteur afin de mettre son travail à plus haut prix, s’efforce de retenir le plus longtemps possible l’usage exclusif d’un agent, d’un procédé, ou d’un instrument de production. Or la Concurrence ayant justement pour mission et pour résultat d’enlever cet usage exclusif à l’individualité pour en faire une propriété commune, il est fatal que tous les hommes, en tant que producteurs, s’unissent dans un concert de malédictions contre la Concurrence. Ils ne se peuvent réconcilier avec elle qu’en appréciant leurs rapports avec la consommation ; en se considérant non point en tant que membres d’une coterie, d’une corporation, mais en tant qu’hommes.
L’économie politique, il faut le dire, n’a pas encore assez fait pour dissiper cette funeste illusion, source de tant de haines, de calamités, d’irritations et de guerres ; elle s’est épuisée, par une préférence peu scientifique, à analyser les phénomènes de la production ; sa nomenclature même, toute commode qu’elle est, n’est pas en harmonie avec son objet. Agriculture, manufacture, commerce, c’est là une classification excellente peut-être, quand il s’agit de décrire les procédés des arts ; mais cette description, capitale en technologie, est à peine accessoire en économie sociale : j’ajoute qu’elle y est essentiellement dangereuse. Quand on a classé les hommes en agriculteurs, fabricants et négociants, de quoi peut-on leur parler, si ce n’est de leurs intérêts de classe, de ces intérêts spéciaux que heurte la Concurrence et qui sont mis en opposition avec le bien général ? Ce n’est pas pour les agriculteurs qu’il y a une agriculture, pour les manufacturiers qu’il y a des manufactures, pour les négociants qu’il se fait des échanges, mais afin que les hommes aient à leur disposition le plus possible de produits de toute espèce. Les lois de la consommation, ce qui la favorise, l’égalise et la moralise : voilà l’intérêt vraiment social, vraiment humanitaire ; voilà l’objet réel de la science ; voilà sur quoi elle doit concentrer ses vives clartés : car c’est là qu’est le lien des classes, des nations, des races, le principe et l’explication de la fraternité humaine. C’est donc avec regret que nous voyons les économistes vouer des facultés puissantes, dépenser une somme prodigieuse de sagacité à l’anatomie de la production, rejetant au fond de leurs livres, dans des chapitres complémentaires, quelques brefs lieux communs sur les phénomènes de la consommation. Que dis-je ! on a vu naguère un professeur, célèbre à juste titre, supprimer entièrement cette partie de la science, s’occuper des moyens sans jamais parler du résultat, et bannir de son cours tout ce qui concerne la consommation des richesses, comme appartenant, disait-il, à la morale, et non a l’économie politique. Faut-il être surpris que le public soit plus frappé des inconvénients de la Concurrence que de ses avantages, puisque les premiers l’affectent au point de vue spécial de la production dont on l’entretient sans cesse, et les seconds au point de vue général de la consommation dont on ne lui dit jamais rien ?
Au surplus, je le répète, je ne nie point, je ne méconnais pas et je déplore comme d’autres les douleurs que la Concurrence inflige aux hommes ; mais est-ce une raison pour fermer les yeux sur le bien qu’elle réalise ? Ce bien, il est d’autant plus consolant de l’apercevoir, que la Concurrence, je le crois, est, comme les grandes lois de la nature, indestructible ; si elle pouvait mourir, elle aurait succombé sans doute sous la résistance universelle de tous les hommes qui ont jamais concouru à la création d’un produit, depuis le commencement du monde, et spécialement sous la levée en masse de tous les réformateurs modernes. Mais s’ils ont été assez fous, ils n’ont pas été assez forts.
Et quel est, dans le monde, le principe progressif dont l’action bienfaisante ne soit pas mêlée, surtout à l’origine, de beaucoup de douleurs et de misères ? — Les grandes agglomérations d’êtres humains favorisent l’essor de la pensée, mais souvent elles dérobent la vie privée au frein de l’opinion, et servent d’abri a la débauche et au crime. — La richesse unie au loisir enfante la culture de l’intelligence, mais elle enfante aussi le luxe et la morgue chez les grands, l’irritation et la convoitise chez les petits. — L’imprimerie fait pénétrer la lumière et la vérité dans toutes les couches sociales, mais elle y porte aussi le doute douloureux et l’erreur subversive. — La liberté politique a déchaîné assez de tempêtes et de révolutions sur le globe, elle a assez profondément modifié les simples et naïves habitudes des peuples primitifs, pour que de graves esprits se soient demandé s’ils ne préféraient pas la tranquillité à l’ombre du despotisme. — Et le christianisme lui-même a jeté la grande semence de l’amour et de la charité sur une terre abreuvée du sang des martyrs.
Comment est-il entré dans les desseins de la bonté et de la justice infinies que le bonheur d’une région ou d’un siècle soit acheté par les souffrances d’un autre siècle ou d’une autre région ? Quelle est la pensée divine qui se cache sous cette grande et irrécusable loi de la solidarité, dont la Concurrence n’est qu’un des mystérieux aspects ? La science humaine l’ignore. Ce qu’elle sait, c’est que le bien s’étend toujours et le mal se restreint sans cesse. À partir de l’état social, tel que la conquête l’avait fait, où il n’y avait que des maîtres et des esclaves, et où l’inégalité des conditions était extrême, la Concurrence n’a pu travailler à rapprocher les rangs, les fortunes, les intelligences, sans infliger des maux individuels dont, à mesure que l’œuvre s’accomplit, l’intensité va toujours s’affaiblissant comme les vibrations du son, comme les oscillations du pendule. Aux douleurs qu’elle lui réserve encore, l’humanité apprend chaque jour à opposer deux puissants remèdes, la prévoyance, fruit de l’expérience et des lumières, et l’association, qui est la prévoyance organisée.
Conclusion de la première édition↩
Dans cette première partie de l’œuvre, hélas ! trop hâtive, que je soumets au public, je me suis efforcé de tenir son attention fixe sur la ligne de démarcation, toujours mobile, mais toujours distincte, qui sépare les deux régions du monde économique : — La collaboration naturelle et le travail humain, — la libéralité de Dieu et l’œuvre de l’homme, — la gratuité et l’onérosité, — ce qui dans l’échange se rémunère et ce qui se cède sans rémunération, — l’utilité totale et l’utilité fractionnelle et complémentaire qui constitue la Valeur, — la richesse absolue et la richesse relative, — le concours des forces chimiques ou mécaniques, contraintes d’aider la production par les instruments qui les asservissent, et la juste rétribution due au travail qui a créé ces instruments eux-mêmes — la Communauté et la Propriété.
Il ne suffisait pas de signaler ces deux ordres de phénomènes, si essentiellement différents par nature, il fallait encore décrire leurs relations, et, si je puis m’exprimer ainsi, leurs évolutions harmoniques. J’ai essayé d’expliquer comment l’œuvre de la Propriété consistait à conquérir pour le genre humain de l’utilité, à la jeter dans le domaine commun, pour voler à de nouvelles conquêtes, — de telle sorte que chaque effort donné, et, par conséquent, l’ensemble de tous les efforts — livre sans cesse à l’humanité des satisfactions toujours croissantes. C’est en cela que consiste le progrès, que les services humains échangés, tout en conservant leur valeur relative, servent de véhicule à une proportion toujours plus grande d’utilité gratuite et, partant, commune. Bien loin donc que les possesseurs de la valeur, quelque forme qu’elle affecte, usurpent et monopolisent les dons de Dieu, ils les multiplient sans leur faire perdre ce caractère de libéralité qui est leur destination providentielle, — la Gratuité.
À mesure que les satisfactions, mises par le progrès à la charge de la nature, tombent à raison de ce fait même dans le domaine commun, elles deviennent égales, l’inégalité ne se pouvant concevoir que dans le domaine des services humains qui se comparent, s’apprécient les uns par les autres et s’évaluent pour s’échanger. — D’où il résulte que l’Égalité, parmi les hommes, est nécessairement progressive. — Elle l’est encore sous un autre rapport, l’action de la Concurrence ayant pour résultat inévitable de niveler les services et de proportionner de plus en plus leur rétribution à leur mérite.
Jetons maintenant un coup d’œil sur l’espace qu’il nous reste à parcourir.
À la lumière de la théorie dont les bases ont été jetées dans ce volume, nous aurons à approfondir :
Les rapports de l’homme, considéré comme producteur et comme consommateur, avec les phénomènes économiques ;
La loi de la Rente foncière ;
Celle des Salaires ;
Celle du Crédit ;
Celle d’Impôt, qui, nous initiant dans la Politique proprement dite, nous conduira à comparer les services privés et volontaires aux services publics et contraints ;
Celle de la population.
Nous serons alors en mesure de résoudre quelques problèmes pratiques encore controversés : Liberté commerciale, Machines, Luxe, Loisir, Association, Organisation du travail, etc.
Je ne crains pas de dire que le résultat de cette exposition peut s’exprimer d’avance en ces termes : Approximation constante de tous les hommes vers un niveau qui s’élève toujours, — en d’autres termes : Perfectionnement et égalisation, — en un seul mot : Harmonie.
Tel est le résultat définitif des arrangements providentiels, des grandes lois de la nature, alors qu’elles règnent sans obstacles, quand on les considère en elles-mêmes et abstraction faite du trouble que font subir à leur action l’erreur et la violence. À la vue de cette Harmonie, l’économiste peut bien s’écrier, comme fait l’astronome au spectacle des mouvements planétaires, ou le physiologiste en contemplant l’ordonnance des organes humains : Digitus Dei est hic !
Mais l’homme est une puissance libre, par conséquent faillible. Il est sujet à l’ignorance, à la passion. Sa volonté, qui peut errer, entre comme élément dans le jeu des lois économiques ; il peut les méconnaître, les oblitérer, les détourner de leur fin. De même que le physiologiste, après avoir admiré la sagesse infinie dans chacun de nos organes et de nos viscères, ainsi que dans leurs rapports, les étudie aussi à l’état anormal, maladif et douloureux, nous aurons à pénétrer dans un monde nouveau, le monde des perturbations sociales.
Nous nous préparerons à cette nouvelle étude par quelques considérations sur l’homme lui-même. Il nous serait impossible de nous rendre compte du mal social, de son origine, de ses effets, de sa mission, des bornes toujours plus étroites dans lesquelles il se resserre par sa propre action (ce qui constitue ce que j’oserais presque appeler une dissonance harmonique), si nous ne portions notre examen sur les conséquences nécessaires du Libre Arbitre, sur les égarements toujours châtiés de l’Intérêt personnel, sur les grandes lois de la Responsabilité et de la Solidarité humaines.
Nous avons vu toutes les Harmonies sociales contenues en germe dans ces deux principes : Propriété, Liberté. — Nous verrons que toutes les dissonances sociales ne sont que le développement de ces deux autres principes antagoniques aux premiers : Spoliation, Oppression.
Et même, les mots Propriété, Liberté n’expriment que deux aspects de la même idée. Au point de vue économique, la liberté se rapporte à l’acte de produire, la Propriété aux produits. — Et puisque la Valeur a sa raison d’être dans l’acte humain, on peut dire que la liberté implique et comprend la Propriété. — Il en est de même de l’Oppression à l’égard de la Spoliation.
Liberté ! voilà, en définitive, le principe harmonique. Oppression ! voilà le principe dissonant ; la lutte de ces deux puissances remplit les annales du genre humain.
Et comme l’Oppression a pour but de réaliser une appropriation injuste, — comme elle se résout et se résume en spoliation, c’est la Spoliation que je mettrai en scène.
L’homme arrive sur cette terre attaché au joug du besoin, qui est une peine.
Il n’y peut échapper qu’en s’asservissant au joug du travail, qui est une peine.
Il n’a donc que le choix des douleurs, et il hait la douleur.
C’est pourquoi il jette ses regards autour de lui, et s’il voit que son semblable a accumulé des richesses, il conçoit la pensée de se les approprier. De là la fausse propriété ou la Spoliation.
La Spoliation ! voici un élément nouveau dans l’économie des sociétés.
Depuis le jour où il a fait son apparition dans le monde jusqu’au jour, si jamais il arrive, où il aura complétement disparu, cet élément affectera profondément tout le mécanisme social ; il troublera, au point de les rendre méconnaissables, les lois harmoniques que nous nous sommes efforcés de découvrir et de décrire.
Notre tâche ne sera donc accomplie que lorsque nous aurons fait la complète monographie de la Spoliation.
Peut-être pensera-t-on qu’il s’agit d’un fait accidentel, anormal, d’une plaie passagère, indigne des investigations de la science.
Mais qu’on y prenne garde. La Spoliation occupe, dans la tradition des familles, dans l’histoire des peuples, dans les occupations des individus, dans les énergies physiques et intellectuelles des classes, dans les arrangements de la société, dans les prévisions des gouvernements, presque autant de place que la Propriété elle-même.
Oh ! non, la Spoliation n’est pas un fléau éphémère, affectant accidentellement le mécanisme social, et dont il soit permis à la science économique de faire abstraction.
Cet arrêt a été prononcé sur l’homme dès l’origine : Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Il semble que, par là, l’effort et la satisfaction sont indissolublement unis, et que l’une ne puisse jamais être que la récompense de l’autre. Mais partout nous voyons l’homme se révolter contre cette loi, et dire à son frère : À toi le travail ; à moi le fruit du travail.
Pénétrez dans la hutte du chasseur sauvage, ou sous la tente du nomade pasteur. Quel spectacle s’offre à vos regards ? La femme, maigre, défigurée, terrifiée, flétrie, avant le temps, porte tout le poids des soins domestiques, pendant que l’homme se berce dans son oisiveté. Où est l’idée que nous pouvons nous faire des Harmonies familiales ? Elle a disparu, parce que la Force a rejeté sur la Faiblesse le poids de la fatigue. Et combien faudra-t-il de siècles d’élaboration civilisatrice avant que la Femme soit relevée de cette effroyable déchéance !
La Spoliation, sous sa forme la plus brutale, armée de la torche et de l’épée, remplit les annales du genre humain. Quels sont les noms qui résument l’histoire ? Cyrus, Sésostris, Alexandre, Scipion, César, Attila, Tamerlan, Mahomet, Pizarre, Guillaume le Conquérant ; c’est la Spoliation naïve par voie de conquêtes. À elle les lauriers, les monuments, les statues, les arcs de triomphe, le chant des poëtes, l’enivrant enthousiasme des femmes !
Bientôt le vainqueur s’avise qu’il y a un meilleur parti à tirer du vaincu que de le tuer, et l’Esclavage couvre la terre. Il a été, presque jusqu’à nos jours, sur toute la surface du globe, le mode d’existence des sociétés, semant après lui des haines, des résistances, des luttes intestines, des révolutions. Et l’Esclavage, qu’est-ce autre chose que l’oppression organisée dans un but de spoliation ?
Si la spoliation arme la Force contre la Faiblesse, elle ne tourne pas moins l’Intelligence contre la Crédulité. Quelles sont sur la terre les populations travailleuses qui aient échappé à l’exploitation des théocraties sacerdotales, prêtres égyptiens, oracles grecs, augures romains, druides gaulois, bramines indiens, muphtis, ulémas, bonzes, moines, ministres, jongleurs, sorciers, devins, spoliateurs de tous costumes et de toutes dénominations ? Sous cette forme, le génie de la spoliation place son point d’appui dans le ciel, et se prévaut de la sacrilége complicité de Dieu ! Il n’enchaîne pas seulement le bras, mais aussi les esprits. Il sait imprimer le fer de la servitude aussi bien sur la conscience de Séide que sur le front de Spartacus, réalisant ce qui semble irréalisable : l’Esclavage Mental.
Esclavage Mental ! quelle effrayante association de mots ! — Ô liberté ! On t’a vue traquée de contrée en contrée, écrasée par la conquête, agonisant sous l’esclavage, insultée dans les cours, chassée dans les écoles, raillée dans les salons, méconnue dans les ateliers, anathématisée dans les temples. Il semblait que tu devais trouver dans la pensée un refuge inviolable. Mais si tu succombes dans ce dernier asile, que devient l’espoir des siècles et la valeur de la nature humaine ?
Cependant, à la longue (ainsi le veut la nature progressive de l’homme), la Spoliation développe, dans le milieu même où elle s’exerce, des résistances qui paralysent sa force et des lumières qui dévoilent ses impostures. Elle ne se rend pas pour cela : elle se fait seulement plus rusée, et, s’enveloppant dans des formes de gouvernement, des pondérations, des équilibres, elle enfante la Politique, mine longtemps féconde. On la voit alors usurper la liberté des citoyens pour mieux exploiter leurs richesses, et tarir leurs richesses pour mieux venir à bout de leur liberté. L’activité privée passe dans le domaine de l’activité publique. Tout se fait par des fonctionnaires ; une bureaucratie inintelligente et tracassière couvre le pays. Le trésor public devient un vaste réservoir où les travailleurs versent leurs économies, qui, de là, vont se distribuer entre les hommes à places. Le libre débat n’est plus la règle des transactions, et rien ne peut réaliser ni constater la mutualité des services.
Dans cet état de choses, la vraie notion de la Propriété s’éteint, chacun fait appel à la Loi pour qu’elle donne à ses services une valeur factice.
On entre ainsi dans l’ère des priviléges. La Spoliation, toujours plus subtile, se cantonne dans les Monopoles et se cache derrière les Restrictions ; elle déplace le courant naturel des échanges, elle pousse dans des directions artificielles le capital, avec le capital le travail, et avec le travail la population elle-même. Elle fait produire péniblement au Nord ce qui se ferait avec facilité au Midi ; elle crée des industries et des existences précaires ; elle substitue aux forces gratuites de la nature les fatigues onéreuses du travail ; elle fomente des établissements qui ne peuvent soutenir aucune rivalité, et invoque contre leurs compétiteurs l’emploi de la force ; elle provoque les jalousies internationales, flatte les orgueils patriotiques, et invente d’ingénieuses théories, qui lui donnent pour auxiliaires ses propres dupes ; elle rend toujours imminentes les crises industrielles et les banqueroutes ; elle ébranle dans les citoyens toute confiance en l’avenir, toute foi dans la liberté, et jusqu’à la conscience de ce qui est juste. Et quand enfin la science dévoile ses méfaits, elle ameute contre la science jusqu’à ses victimes, et s’écriant : À l’Utopie ! Bien plus, elle nie non-seulement la science qui lui fait obstacle, mais l’idée même d’une science possible, par, cette dernière sentence du scepticisme : Il n’y a pas de principes !
Cependant, sous l’aiguillon de la souffrance, la masse des travailleurs s’insurge, elle renverse tout ce qui est au-dessus d’elle. Gouvernement, impôts, législation, tout est à sa merci, et vous croyez peut-être que c’en est fait du règne de la Spoliation ; vous croyez que la mutualité des services va être constituée sur sa seule base possible, et même imaginable, la Liberté. — Détrompez-vous ; hélas ! cette funeste idée s’est infiltrée dans la masse : Que la Propriété n’a d’autre origine, d’autre sanction, d’autre légitimité, d’autre raison d’être que la Loi ; et voici que la masse se prend à se spolier législativement elle-même. Souffrante des blessures qui lui ont été faites, elle entreprend de guérir chacun de ses membres en lui concédant un droit d’oppression sur le membre voisin ; cela s’appelle Solidarité, Fraternité. — « Tu as produit ; je n’ai pas produit ; nous sommes solidaires ; partageons. » — « Tu as quelque chose ; je n’ai rien ; nous sommes frères ; partageons. » — Nous aurons donc à examiner l’abus qui a été fait dans ces derniers temps des mots association, organisation du travail, gratuité du crédit, etc. Nous aurons à les soumettre à cette épreuve : Renferment-ils la Liberté ou l’Oppression ? En d’autres termes : Sont-ils conformes aux grandes lois économiques, ou sont-ils la perturbation de ces lois ?
La spoliation est un phénomène trop universel, trop persistant, pour qu’il soit permis de lui reconnaître un caractère purement accidentel. En cette matière, comme en bien d’autres, on ne peut séparer l’étude des lois naturelles de celle de leur perturbation.
— Mais, dira-t-on, si la spoliation entre nécessairement dans le jeu du mécanisme social comme dissonance, comment osez-vous affirmer l’Harmonie des lois économiques ?
Je répéterai ici ce que j’ai dit ailleurs : En tout ce qui concerne l’homme, cet être qui n’est perfectible que parce qu’il est imparfait, l’Harmonie ne consiste pas dans l’absence absolue du mal, mais dans sa graduelle réduction. Le corps social, comme le corps humain, est pourvu d’une force curative, vis medicatrix, dont on ne peut étudier les lois et l’infaillible puissance sans s’écrier encore : Digitus Dei est hic. [245]
Listes des chapitres destinées à completer les Harmonies économique [incomplete ???]↩
Insert table and note. [246]
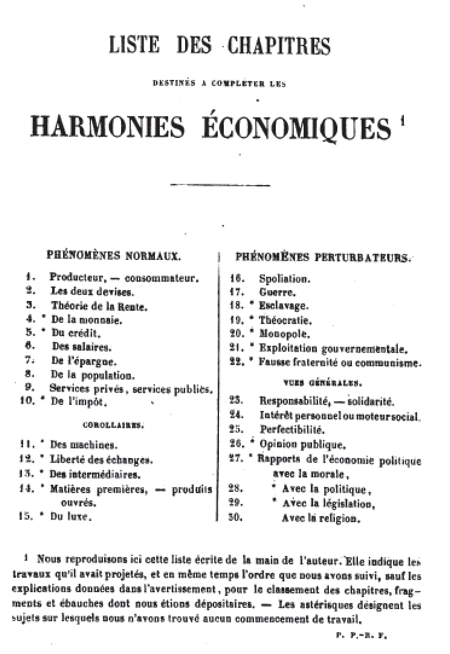
XI. Producteur, Consommateur↩
Si le niveau de l’humanité ne s’élève pas sans cesse, l’homme n’est pas perfectible.
Si la tendance sociale n’est pas une approximation constante de tous les hommes vers ce niveau progressif, les lois économiques ne sont pas harmoniques.
Or comment le niveau humain peut-il s’élever si chaque quantité donnée de travail ne donne pas une proportion toujours croissante de satisfactions, phénomène qui ne peut s’expliquer que par la transformation de l’utilité onéreuse en utilité gratuite ?
Et, d’un autre côté, comment cette utilité, devenue gratuite, rapprocherait-elle tous les hommes d’un commun niveau, si en même temps elle ne devenait commune ?
Voilà donc la loi essentielle de l’harmonie sociale.
Je voudrais, pour beaucoup, que la langue économique me fournît, pour désigner les services rendus et reçus, deux autres mots que production et consommation, lesquels sont trop entachés de matérialité. Évidemment il y a des services qui, comme ceux du prêtre, du professeur, du militaire, de l’artiste, engendrent la moralité, l’instruction, la sécurité, le sentiment du beau, et qui n’ont rien de commun avec l’industrie proprement dite, si ce n’est qu’ils ont pour fin des satisfactions.
Les mots sont admis, et je ne veux pas me faire néologiste. Mais qu’il soit au moins bien entendu que par production j’entends ce qui confère l’utilité, et par consommation, la jouissance produite par cette utilité.
Que l’école protectioniste, — variété du communisme, — veuille bien nous croire. Quand nous prononçons les mots producteur, consommateur, nous ne sommes pas assez absurdes pour nous figurer, ainsi qu’elle nous en accuse, le genre humain partagé en deux classes distinctes, l’une ne s’occupant que de produire, l’autre que de consommer. Le naturaliste peut diviser l’espèce humaine en blancs et noirs, en hommes et femmes, et l’économiste ne la peut classer en producteurs et consommateurs, parce que, comme le disent avec une grande profondeur de vues MM. les protectionistes, le producteur et le consommateur ne font qu’un.
Mais c’est justement parce qu’ils ne font qu’un que chaque homme doit être considéré par la science en cette double qualité. Il ne s’agit pas de diviser le genre humain, mais d’étudier deux aspects très-différents de l’homme. Si les protectionistes défendaient à la grammaire d’employer les pronoms je et tu, sous prétexte que chacun de nous est tour à tour celui à qui l’on parle et celui qui parle, on leur ferait observer qu’encore qu’il soit parfaitement vrai que l’on ne peut mettre toutes les langues d’un côté et toutes les oreilles de l’autre, puisque nous avons tous oreilles et langue, il ne s’ensuit pas que, relativement à chaque proposition émise, la langue n’appartienne à un homme et l’oreille à un autre. De même, relativement à tout service, celui qui le rend est parfaitement distinct de celui qui le reçoit. Le producteur et le consommateur sont en présence, et tellement en présence qu’ils se disputent toujours.
Les mêmes personnes, qui ne veulent pas nous permettre d’étudier l’intérêt humain, au double point de vue du producteur et du consommateur, ne se gênent pas pour faire cette distinction quand elles s’adressent aux assemblées législatives. On les voit alors demander le monopole ou la liberté selon qu’il s’agit de la chose qu’elles vendent ou de la chose qu’elles achètent.
Sans donc nous arrêter à la fin de non-recevoir des protectionistes, reconnaissons que, dans l’ordre social, la séparation des occupations a fait à chacun deux situations assez distinctes pour qu’il en résulte un jeu et des rapports dignes d’être étudiés.
En général, nous nous adonnons à un métier, à une profession, à une carrière ; et ce n’est pas à elle que nous demandons directement les objets de nos satisfactions. Nous rendons et nous recevons des services ; nous offrons et demandons des valeurs ; nous faisons des achats et des ventes ; nous travaillons pour les autres, et les autres travaillent pour nous : en un mot, nous sommes producteurs et consommateurs.
Selon que nous nous présentons sur le marché en l’une ou l’autre de ces qualités, nous y apportons un esprit fort différent, on peut même dire tout opposé. S’agit-il de blé, par exemple, le même homme ne fait pas les mêmes vœux quand il va en acheter que lorsqu’il va en vendre. Acheteur, il souhaite l’abondance ; vendeur, la disette. Ces vœux ont leur racine dans le même fond, l’intérêt personnel ; mais comme vendre ou acheter, donner ou recevoir, offrir ou demander, sont des actes aussi opposés que possible, il ne se peut pas qu’ils ne donnent lieu, en vertu du même mobile, à des vœux opposés.
Des vœux qui se heurtent ne peuvent pas coïncider à la fois avec le bien général. J’ai cherché à faire voir, dans un autre ouvrage, [247] que ce sont les vœux que font les hommes en qualité de consommateurs qui s’harmonisent avec l’intérêt public, et cela ne peut être autrement. Puisque la satisfaction est le but du travail, puisque le travail n’est déterminé que par l’obstacle, il est clair que le travail est le mal, et que tout doit tendre à le diminuer ; — que la satisfaction est le bien, et que tout doit concourir à l’accroître.
Ici se présente la grande, l’éternelle, la déplorable illusion qui est née de la fausse définition de la valeur et de la confusion qui en a été faite avec l’utilité.
La valeur n’étant qu’un rapport, autant elle a d’importance pour chaque individu, autant elle en a peu pour la masse.
Pour la masse, il n’y a que l’utilité qui serve ; et la valeur n’en est nullement la mesure.
Pour l’individu, il n’y a non plus que l’utilité qui serve. Mais la valeur en est la mesure ; car, avec toute valeur déterminée, il puise dans le milieu social l’utilité de son choix, dans la mesure de cette valeur.
Si l’on considérait l’homme isolé, il serait clair comme le jour que la consommation est l’essentiel, et non la production ; car consommation implique suffisamment travail, mais travail n’implique pas consommation.
La séparation des occupations a amené certains économistes à mesurer le bien-être général non par la consommation, mais par le travail. Et l’on est arrivé, en suivant leurs traces, à cet étrange renversement des principes : favoriser le travail aux dépens de ses résultats.
On a raisonné ainsi :
Plus il y a de difficultés vaincues, mieux cela vaut. Donc augmentons les difficultés à vaincre.
Le vice de ce raisonnement saute aux yeux.
Oui, sans doute, une somme de difficultés étant donnée, il est heureux qu’une quantité aussi donnée de travail en surmonte le plus possible. — Mais diminuer la puissance du travail ou augmenter celle des difficultés, pour accroître la valeur, c’est une monstruosité.
L’individu, dans la société, est intéressé à ce que ses services, même en conservant le même degré d’utilité, augmentent de valeur. Supposons ses désirs réalisés, il est aisé de voir ce qui arrive. Il a plus de bien-être, mais ses frères en ont moins, puisque l’utilité totale n’est pas accrue.
On ne peut donc conclure du particulier au général et dire : Prenons telle mesure dont le résultat satisfasse l’inclination de tous les individus à voir augmenter la valeur de leurs services.
Valeur étant rapport, — on n’aurait rien fait si l’accroissement était proportionnel partout à la valeur antérieure ; — s’il était arbitraire et inégal pour les services différents, on n’aurait fait qu’introduire l’injustice dans la répartition des utilités.
Il est dans la nature de chaque transaction de donner lieu à un débat. Grand Dieu ! quel mot viens-je de prononcer ? Ne me suis-je pas mis sur les bras toutes les écoles sentimentalistes, si nombreuses de nos jours ? Débat implique antagonisme, diront-elles. Vous convenez donc que l’antagonisme est l’état naturel des sociétés. — Me voilà forcé de rompre encore une lance. En ce pays-ci la science économique est si peu sue, qu’elle ne peut prononcer un mot sans faire surgir un adversaire.
On m’a reproché, avec raison, d’avoir écrit cette phrase : « Entre le vendeur et l’acheteur, il existe un antagonisme radical. » Le mot antagonisme, surtout renforcé du mot radical, dépasse de beaucoup ma pensée. Il semble indiquer une opposition permanente d’intérêts, et par conséquent une indestructible dissonance sociale, — tandis que je ne voulais parler que de ce débat passager qui précède tout marché, et qui est inhérent à l’idée même de la transaction.
Tant qu’il restera, au grand chagrin de l’utopiste sentimental, l’ombre d’une liberté en ce monde, le vendeur et l’acheteur discuteront leurs intérêts, débattront leurs prix, marchanderont, comme on dit, — sans que pour cela les lois sociales cessent d’être harmoniques. Est-il possible de concevoir que l’offreur et le demandeur d’un service s’abordent sans avoir une pensée momentanément différente relativement à sa valeur ? Et pense-t-on que, pour cela, le monde sera en feu ? Ou il faut bannir toute transaction, tout échange, tout troc, toute liberté de cette terre, ou il faut admettre que chacun des contractants défende sa position, fasse valoir ses motifs. C’est même de ce libre débat tant décrié, que sort l’équivalence des services et l’équité des transactions. Comment les organisateurs arriveront-ils autrement à cette équité si désirable ? Enchaîneront-ils par leurs lois la liberté de l’une des parties seulement ? Alors elle sera à la discrétion de l’autre. Les dépouilleront-ils toutes deux de la faculté de régler leurs intérêts, sous prétexte qu’elles doivent désormais vendre et acheter sur le principe de la fraternité ? Mais que les socialistes permettent qu’on le leur dise, c’est là du galimatias ; car enfin il faut bien que ces intérêts se règlent. Le débat aura-t-il lieu en sens inverse, l’acheteur prenant fait et cause pour le vendeur et réciproquement ? Les transactions seront fort divertissantes, il faut en convenir. « Monsieur, ne me donnez que 10 fr. de ce drap. — Que dites-vous ? je veux vous en donner 20 fr. — Mais, Monsieur, il ne vaut rien ; il est passé de mode ; il sera usé dans quinze jours, dit le marchand. — Il est des mieux portés et durera deux hivers, répond le client. — Eh bien ! Monsieur, pour vous complaire, j’y ajouterai 5 fr. ; c’est tout ce que la fraternité me permet de faire. — Il répugne à mon socialisme de le payer moins de 20 fr. ; mais il faut savoir faire des sacrifices, et j’accepte. » Ainsi la bizarre transaction arrivera juste au résultat ordinaire, et les organisateurs auront le regret de voir cette maudite liberté survivre encore, quoique se manifestant à rebours et engendrant un antagonisme retourné.
Ce n’est pas là ce que nous voulons, disent les organisateurs, ce serait de la liberté. — Que voulez-vous donc, car encore faut-il que les services s’échangent et que les conditions se règlent ? — Nous entendons que le soin de les régler nous soit confié. — Je m’en doutais…
Fraternité ! lien des âmes, étincelle divine descendue du ciel dans le cœur des hommes, a-t-on assez abusé de ton nom ? C’est en ton nom qu’on prétend étouffer toute liberté. C’est en ton nom qu’on prétend élever un despotisme nouveau et tel que le monde n’en a jamais vu ; et l’on pourrait craindre qu’après avoir servi de passe-port à tant d’incapacités, de masque à tant d’ambitions, de jouet à tant d’orgueilleux mépris de la dignité humaine, ce nom souillé ne finisse par perdre sa grande et noble signification.
N’ayons donc pas la prétention de tout bouleverser, de tout régenter, de tout soustraire, hommes et choses, aux lois de leur propre nature. Laissons le monde tel que Dieu l’a fait. Ne nous figurons pas, nous, pauvres écrivassiers, que nous soyons autre chose que des observateurs plus ou moins exacts. Ne nous donnons pas le ridicule de prétendre changer l’humanité, comme si nous étions en dehors d’elle, de ses erreurs, de ses faiblesses. Laissons les producteurs et les consommateurs avoir des intérêts, les discuter, les débattre, les régler par de loyales et paisibles conventions. Bornons-nous à observer leurs rapports et les effets qui en résultent. C’est ce que je vais faire, toujours au point de vue de cette grande loi que je prétends être celle des sociétés humaines : l’égalisation graduelle des individus et des classes combinée avec le progrès général.
Une ligne ne ressemble pas plus à une force, à une vitesse qu’à une valeur ou une utilité. Néanmoins le mathématicien s’en sert avec avantage. Pourquoi l’économiste n’en ferait-il pas de même ?
Il y a des valeurs égales, il y a des valeurs qui ont entre elles des rapports connus, la moitié, le quart, le double, le triple. Rien n’empêche de représenter ces différences par des lignes de diverses longueurs.
Il n’en est pas ainsi de l’utilité. L’utilité générale, nous l’avons vu, se décompose en utilité gratuite et utilité onéreuse ; celle qui est due à l’action de la nature, celle qui est le résultat du travail humain. Cette dernière s’évaluant, se mesurant, peut être représentée par une ligne à dimension déterminée ; l’autre n’est pas susceptible d’évaluation, de mesure. Il est certain que la nature fait beaucoup pour la production d’un hectolitre de blé, d’une pièce de vin, d’un bœuf, d’un kilogramme de laine, d’un tonneau de houille, d’un stère de bois. Mais nous n’avons aucun moyen de mesurer le concours naturel d’une multitude de forces, la plupart inconnues et agissant depuis la création. De plus, nous n’y avons aucun intérêt. Nous devons donc représenter l’utilité gratuite par une ligne indéfinie.
Soient donc deux produits, dont l’un vaut le double de l’autre, ils peuvent être représentés par les lignes ci-après :
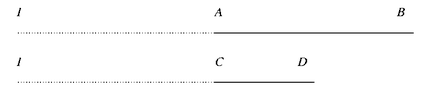
| IB, | ID, | le produit total, l’utilité générale, ce qui satisfait le besoin, la richesse absolue ; |
| IA, | IC, | le concours de la nature, l’utilité gratuite, la part de la communauté ; |
| AB, | CD, | le service humain, l’utilité onéreuse, la valeur, la richesse relative, la part de la propriété. |
Je n’ai pas besoin de dire que AB, à la place de quoi vous pouvez mettre, par la pensée, ce que vous voudrez, une maison, un meuble, un livre, une cavatine chantée par Jenny Lind, un cheval, une pièce d’étoffe, une consultation de médecin, etc., s’échangera contre deux fois CD, et que les deux contractants se donneront réciproquement, par-dessus le marché sans même s’en apercevoir, l’un une fois IA, l’autre deux fois IC.
L’homme est ainsi fait que sa préoccupation perpétuelle est de diminuer le rapport de l’effort au résultat, de substituer l’action naturelle à sa propre action, en un mot, de faire plus avec moins. C’est l’objet constant de son habileté, de son intelligence et de son ardeur.
Supposons donc que Jean, producteur de IB, trouve un procédé au moyen duquel il accomplisse son œuvre avec la moitié du travail qu’il y mettait avant, en calculant tout, même la confection de l’instrument destiné à faire concourir une force naturelle.
Tant qu’il conservera son secret, il n’y aura rien de changé dans les figures ci-dessus. AB et CD représenteront les mêmes valeurs, les mêmes rapports ; car, connaissant seul au monde le procédé expéditif, Jean le fera tourner à son seul avantage. Il se reposera la moitié de la journée, ou bien il fera deux IB par jour au lieu d’un ; son travail sera mieux rémunéré. La conquête sera faite au profit de l’humanité, mais l’humanité sera représentée, sous ce rapport, par un seul homme.
Pour le dire en passant, le lecteur doit voir ici combien est glissant l’axiome des économistes anglais : — la valeur vient du travail, — s’il a pour objet de donner à penser que valeur et travail soient choses proportionnelles. Voici un travail diminué de moitié, sans que la valeur ait changé, et cela arrive à chaque instant. Pourquoi ? Parce que le service est le même. Avant comme après l’invention, tant qu’elle est un secret, celui qui cède IB rend un service identique. Il n’en sera plus de même le jour où Pierre, producteur de ID, pourra lui dire : « Vous me demandez deux heures de mon travail contre une du vôtre ; mais je connais votre procédé, et, si vous mettez votre service à si haut prix, je me le rendrai à moi-même. »
Or ce jour arrivera nécessairement. Un procédé réalisé n’est pas longtemps un mystère. Alors la valeur du produit IB baissera de moitié, et nous aurons les deux figures :
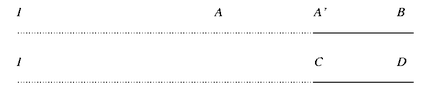
AA’, valeur anéantie, richesse relative disparue, propriété devenue communauté, utilité autrefois onéreuse, aujourd’hui gratuite.
Car, quant à Jean, qui est ici le symbole du producteur, il est replacé dans sa condition première. Avec le même effort qu’il mettait jadis à faire IB, il le fait maintenant deux fois. Pour avoir deux fois ID, le voilà contraint de donner deux fois IB, soit le meuble, le livre, la maison, etc.
Qui profite en tout ceci ? C’est évidemment Pierre, le producteur de ID, symbole ici de tous les consommateurs, y compris Jean lui-même. Si, en effet, Jean veut consommer son propre produit, il recueillera l’économie de temps représentée par la suppression de AA’. Quant à Pierre, c’est-à-dire quant à tous les consommateurs du monde, ils achèteront IB avec la moitié du temps, de l’effort, du travail, de la valeur qu’il fallait y mettre avant l’intervention de la force naturelle. Donc cette force est gratuite, et, de plus, commune.
Puisque je me suis hasardé dans les figures géométriques, qu’il me soit permis d’en faire encore une fois usage, heureux si ce procédé un peu bizarre, j’en conviens, en économie politique, facilitait au lecteur l’intelligence du phénomène que j’ai à décrire.
Comme producteur ou comme consommateur tout homme est un centre d’où rayonnent les services qu’il rend, et auquel aboutissent les services qu’il reçoit en échange.
Soit donc placé en A (fig. 1) un producteur, par exemple un copiste, symbole de tous les producteurs ou de la production en général. Il livre à la société quatre manuscrits. Si, au moment ou nous faisons l’observation, la valeur de chacun de ces manuscrits est de 15, il rend des services égaux à 60, et reçoit une valeur égale, diversement répartie sur une multitude de services. Pour simplifier la démonstration, je n’en mets que quatre partant des quatre points de la circonférence BCDE.
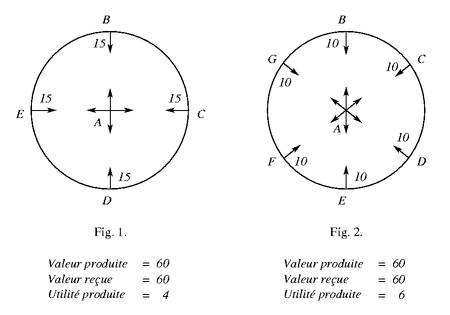
Cet homme invente l’imprimerie. Il fait désormais en quarante heures ce qui en exigeait soixante. Admettons que la concurrence l’a forcé à réduire proportionnellement le prix de ses livres ; au lieu de 15, ils ne valent plus que 10. Mais aussi, au lieu de quatre, notre travailleur en peut faire six. D’un autre côté, le fonds rémunératoire, parti de la circonférence, et qui était de 60, n’a pas changé. Il y a donc de la rémunération pour six livres, valant chacun 10, par la raison qu’il y en avait avant pour quatre manuscrits valant chacun 15.
Je ferai remarquer brièvement que c’est là ce qu’on perd toujours de vue dans la question des machines, du libre échange et à propos de tout progrès. On voit du travail rendu disponible par le procédé expéditif, et l’on s’alarme. On ne voit pas qu’une proportion semblable de rémunération est rendue disponible aussi du même coup.
Les nouvelles transactions seront donc représentées par la figure 2, où nous voyons rayonner du centre A une valeur totale de 60, répartie sur six livres au lieu de quatre manuscrits. De la circonférence continue à partir une valeur égale de 60, nécessaire aujourd’hui comme autrefois pour la balance.
Qui a donc gagné à ce changement ? Au point de vue de la valeur, personne. Au point de vue de la richesse réelle, des satisfactions effectives, la classe innombrable des consommateurs rangés à la circonférence. Chacun d’eux achète un livre avec une quantité de travail réduite d’un tiers. — Mais les consommateurs, c’est l’humanité. — Car remarquez que A lui-même, s’il ne gagne rien en tant que producteur, s’il est tenu, comme avant, à soixante heures de travail pour obtenir l’ancienne rémunération, gagne cependant, en tant que consommateur de livres, c’est-à-dire au même titre que les autres hommes. Comme eux tous, s’il veut lire, il peut se procurer cette satisfaction avec une économie de travail égale au tiers.
Que si, en qualité de producteur, il voit le bénéfice de ses propres inventions lui échapper à la longue, par le fait de la concurrence, où donc est pour lui la compensation ?
Elle consiste 1° en ce que, tant qu’il a pu garder son secret, il a continué de vendre quinze ce qui ne lui coûtait plus que dix ;
2° En ce qu’il obtient des livres pour son propre usage, à moins de frais, et participe ainsi aux avantages qu’il a procurés à la société.
3° Mais sa compensation consiste surtout en ceci : de même qu’il a été forcé de faire profiter l’humanité de ses progrès, il profite des progrès de l’humanité.
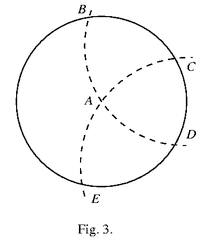
De même que les progrès accomplis en A ont profité à B, C, D, E, les progrès réalisés en B, C, D, E profiteront à A. Tour à tour A se trouve au centre et à la circonférence de l’industrie universelle, car il est tour à tour producteur et consommateur. Si B, par exemple, est un fileur de coton qui substitue la broche au fuseau, le profit ira en A comme en C, D. — Si C est un marin qui remplace la rame par la voile, l’économie profitera à B, A, E.
En définitive, le mécanisme repose sur cette loi :
Le progrès ne profite au producteur, en tant que tel, que le temps nécessaire pour récompenser son habileté. Bientôt il amène une baisse de valeur, qui laisse aux premiers imitateurs une juste quoique moindre récompense. Enfin la valeur se proportionne au travail réduit, et toute l’économie est acquise à l’humanité.
Ainsi tous profitent du progrès de chacun, chacun profite du progrès de tous. — Le chacun pour tous, tous pour chacun, mis en avant par les socialistes, et qu’ils donnent an monde comme une nouveauté contenue en germe dans leurs organisations fondées sur l’oppression et la contrainte, Dieu même y a pourvu ; il a su le faire sortir de la liberté.
Dieu, dis-je, y a pourvu ; et il ne fait pas prévaloir sa loi dans une commune modèle, dirigée par M. Considérant, ou dans un phalanstère de six cents harmoniens, ou dans une Icarie à l’essai, sous la condition que quelques fanatiques se soumettent au pouvoir discrétionnaire d’un monomane, et que les incrédules payent pour les croyants. Non, Dieu y a pourvu d’une manière générale, universelle, par un mécanisme merveilleux dans lequel la justice, la liberté, l’utilité, la sociabilité se combinent et se concilient à un degré qui devrait décourager les entrepreneurs d’organisations sociales.
Remarquez que cette grande loi, chacun pour tous, tous pour chacun, est beaucoup plus universelle que ma démonstration ne le suppose. Les paroles sont lourdes et la plume plus lourde encore. L’écrivain est réduit à montrer successivement l’un après l’autre, avec une désespérante lenteur, des phénomènes qui ne s’imposent à l’admiration que par leur ensemble.
Ainsi je viens de parler d’inventions. On pourrait en conclure que c’est le seul cas où le progrès réalisé échappe au producteur pour aller grossir le fonds commun de l’humanité. Il n’en est pas ainsi. C’est une loi générale que tout avantage quelconque, provenant de la situation des lieux, du climat ou de quelque libéralité naturelle que ce soit, glisse rapidement entre les mains de celui qui le premier l’aperçoit et s’en empare, sans être perdu pour cela, mais pour aller alimenter l’immense réservoir où se puisent les communes satisfactions des hommes. Une seule condition est attachée à ce résultat : c’est que le travail et les transactions soient libres. Contrarier la liberté, c’est contrarier le vœu de la Providence, c’est suspendre l’effet de sa loi, c’est borner le progrès dans ses deux sens.
Ce que je viens de dire des biens est vrai aussi des maux. Rien ne s’arrête sur le producteur, ni avantages, ni inconvénients. Les uns comme les autres tendent à se répartir sur la société tout entière.
Nous venons de voir avec quelle avidité le producteur recherche ce qui peut faciliter son œuvre, et nous nous sommes assurés qu’en très-peu de temps le profit lui en échappe. Il semble qu’il ne soit entre les mains d’une intelligence supérieure que l’aveugle et docile instrument du progrès général.
C’est avec la même ardeur qu’il évite tout ce qui entrave son action, et cela est heureux pour l’humanité, car c’est à elle, à la longue, que nuisent ces obstacles. Par exemple, supposons qu’on frappe A, le producteur d’un livre, d’une forte taxe. Il faudra qu’il l’ajoute au prix de ses livres. Elle entrera, comme partie constitutive, dans leur valeur, ce qui veut dire que B, C, D, E, devront donner plus de travail pour acheter une satisfaction égale. La compensation sera pour eux dans l’emploi que le gouvernement fera de la taxe. S’il en fait un bon usage, ils pourront ne pas perdre, ils pourront même gagner à l’arrangement. S’il s’en sert pour les opprimer, ce sera deux vexations multipliées l’une par l’autre. Mais A, quant à lui, s’est débarrassé de la taxe, encore qu’il en fasse l’avance.
Ce n’est pas à dire que le producteur ne souffre souvent beaucoup des obstacles quels qu’ils soient, et entre autres des taxes. Il en souffre quelquefois jusqu’à en mourir, et c’est justement pour cela qu’elles tendent à se déplacer et à retomber en définitive sur la masse.
Ainsi, en France, on a soumis le vin à une foule d’impôts et d’entraves. Ensuite on a inventé pour lui un régime qui l’empêche de se vendre au dehors.
Voici par quels ricochets le mal tend à passer du producteur au consommateur. Immédiatement après que l’impôt et l’entrave sont mis en œuvre, le producteur tend à se faire dédommager. Mais la demande des consommateurs, ainsi que la quantité de vin, restant la même, il ne peut en hausser le prix. Il n’en tire d’abord pas plus après la taxe qu’avant. Et comme, avant la taxe, il n’en obtenait qu’une rémunération normale déterminée par la valeur des services librement échangés, il se trouve en perte de tout le montant de la taxe. Pour que les prix s’élèvent, il faut qu’il y ait diminution dans la quantité de vin produite [248]…
. . . . .
Le consommateur, le public est donc, relativement à la perte ou au bénéfice qui affectent d’abord telle ou telle classe de producteurs, ce que la terre est à l’électricité : le grand réservoir commun. Tout en sort ; et, après quelques détours plus ou moins longs, après avoir engendré des phénomènes plus ou moins variés, tout y rentre.
Nous venons de constater que les résultats économiques ne font que glisser, pour ainsi dire, sur le producteur pour aboutir au consommateur, et que, par conséquent, toutes les grandes questions doivent être étudiées au point de vue du consommateur, si l’on veut en saisir les conséquences générales et permanentes.
Cette subordination du rôle de producteur à celui de consommateur, que nous avons déduite de la considération d’utilité, est pleinement confirmée par la considération de moralité.
En effet, la responsabilité partout incombe à l’initiative. Or où est l’initiative ? Dans la demande.
La demande (qui implique les moyens de rémunération) détermine tout : la direction du capital et du travail, la distribution de la population, la moralité des professions, etc. C’est que la demande répond au Désir, tandis que l’offre répond à l’Effort. — Le Désir est raisonnable ou déraisonnable, moral ou immoral. — L’Effort, qui n’est qu’un effet, est moralement neutre ou n’a qu’une moralité réfléchie.
La demande ou consommation dit au producteur : « Fais ceci pour moi. » Le producteur obéit à l’impulsion d’autrui. — Et cela serait évident pour tous, si toujours et partout le producteur attendait la demande.
Mais en fait les choses se passent différemment.
Que ce soit l’échange qui ait amené la division du travail, ou la division du travail qui ait déterminé l’échange, — c’est une question subtile et oiseuse. Disons que l’homme échange parce qu’étant intelligent et sociable, il comprend que c’est un moyen d’augmenter le rapport du résultat à l’effort. Ce qui résulte seulement de la division du travail et de la prévoyance, c’est qu’un homme n’attend pas la proposition de travailler pour autrui. L’expérience lui enseigne qu’elle est tacite dans les relations humaines et que la demande existe.
Il fait d’avance l’effort qui doit y satisfaire, et c’est ainsi que naissent les professions. D’avance on fabrique des souliers, des chapeaux ; on se prépare à bien chanter, à enseigner, à plaider, à guérir, etc. Mais est-ce réellement l’offre qui prévient ici la demande et la détermine ?
Non. — C’est parce qu’il y a certitude suffisante que ces différents services seront demandés qu’on s’y prépare, encore qu’on ne sache pas toujours précisément de qui viendra la demande. Et la preuve, c’est que le rapport entre ces différents services est assez connu, c’est que leur valeur est assez généralement expérimentée, pour qu’on se livre avec quelque sécurité à telle fabrication, pour qu’on embrasse telle ou telle carrière.
L’impulsion de la demande est donc préexistante, puisqu’on a pu en calculer la portée avec tant de précision.
Aussi, quand un homme prend un état, une profession, quand il se met à produire, de quoi se préoccupe-t-il ? Est-ce de l’utilité de la chose qu’il produit, de ses résultats bons ou mauvais, moraux ou immoraux ? — Pas du tout ; il ne pense qu’à sa valeur : c’est le demandeur qui regarde à l’utilité. L’utilité répond à son besoin, à son désir, à son caprice. La valeur, au contraire, ne répond qu’à l’effort cédé, au service transmis. C’est seulement lorsque, par l’échange, l’offreur devient demandeur à son tour, que l’utilité l’intéresse. Quand je me décide à faire des souliers plutôt que des chapeaux, ce n’est pas que je me sois posé cette question : Les hommes ont-ils plus d’intérêt à garantir leurs pieds que leur tête ? Non ; cela regarde le demandeur et détermine la demande. — La demande, à son tour, détermine la Valeur ou l’estime en laquelle le public tient le service. — La valeur, enfin, décide l’effort ou l’offre.
De là résultent des conséquences morales très-remarquables. Deux nations peuvent être également pourvues de valeurs, c’est-à-dire de richesses relatives (Voir chap. VI), et très-inégalement pourvues d’utilités réelles, de richesses absolues ; cela arrive quand l’une forme des désirs plus déraisonnables que l’autre, quand celle-ci pense à ses besoins réels, et que celle-là se crée des besoins factices ou immoraux.
Chez un peuple peut dominer le goût de l’instruction, chez l’autre celui de la bonne chère. En ce cas, on rend service au premier quand on a quelque chose à lui enseigner ; au second, quand on sait flatter son palais.
Or les hommes rémunèrent les services selon l’importance qu’ils y attachent. S’ils n’échangeaient pas, ils se rendraient le service à eux-mêmes ; et par quoi seraient-ils déterminés, si ce n’est par la nature et l’intensité de leurs désirs ?
Chez l’une de ces nations, il y aura beaucoup de professeurs ; chez l’autre, beaucoup de cuisiniers.
Dans l’une et dans l’autre les services échangés peuvent être égaux en somme, et par conséquent représenter des valeurs égales, la même richesse relative, mais non la même richesse absolue. Cela ne veut pas dire autre chose, si ce n’est que l’une emploie bien son travail et l’autre mal.
Et le résultat, sous le rapport des satisfactions, sera celui-ci : l’un de ces peuples aura beaucoup d’instruction, l’autre fera de bons repas. Les conséquences ultérieures de cette diversité de goûts auront une très-grande influence, non-seulement sur la richesse réelle, mais même sur la richesse relative ; car l’instruction, par exemple, peut développer des moyens nouveaux de rendre des services, ce que les bons repas ne peuvent faire.
On remarque, parmi les nations, une prodigieuse diversité de goûts, fruit de leurs précédents, de leur caractère, de leurs convictions, de leur vanité, etc.
Sans doute, il y a des besoins si impérieux, par exemple celui de boire et de manger, qu’on pourrait presque les considérer comme des quantités données. Cependant il n’est pas rare de voir un homme se priver de manger à sa faim pour avoir des habits propres, et un autre ne songer à la propreté des vêtements qu’après avoir satisfait ses appétits. — Il en est de même des peuples.
Mais une fois ces besoins impérieux satisfaits, tout ce qui est au delà dépend beaucoup plus de la volonté ; c’est affaire de goût, et c’est dans cette région que l’empire de la moralité et du bon sens est immense.
L’énergie des divers désirs nationaux détermine toujours la quantité de travail que chaque peuple prélève sur l’ensemble de ses efforts pour satisfaire chacun de ses désirs. L’Anglais veut avant tout être bien nourri. Aussi consacre-t-il une énorme quantité de son travail à produire des subsistances ; et s’il fait autre chose, c’est pour l’échanger au dehors, contre des aliments ; en définitive, ce qui se consomme en Angleterre de blé, de viande, de beurre, de lait, de sucre, etc., est effrayant. Le Français veut être amusé. Il aime ce qui flatte les yeux et se plaît au changement. La direction de ses travaux obéit docilement à ses désirs. En France, il y a beaucoup de chanteuses, de baladins, de modistes, d’estaminets, de boutiques élégantes, etc. En Chine, on aspire à se donner des rêves agréables par l’usage de l’opium. C’est pourquoi une grande quantité de travail national est consacrée à se procurer, soit directement, par la production, soit indirectement, par l’échange, ce précieux narcotique. En Espagne, où l’on est porté vers la pompe du culte, les efforts des populations viennent en grand nombre aboutir à la décoration des édifices religieux, etc.
Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il n’y a jamais d’immoralité dans l’Effort qui a pour but de rendre des services correspondant à des désirs immoraux ou dépravés. Mais il est évident que le principe de l’immoralité est dans le désir même.
Cela ne ferait pas matière de doute si l’homme était isolé. Cela ne peut non plus être douteux pour l’humanité associée, car l’humanité associée, c’est l’individualité élargie.
Aussi, voyez : qui songe à blâmer nos travailleurs méridionaux de faire de l’eau-de-vie ? Ils répondent à une demande. Ils bêchent la terre, soignent leurs vignes, vendangent, distillent le raisin sans se préoccuper de ce qu’on fera du produit. C’est à celui qui recherche la satisfaction à savoir si elle est honnête, morale, raisonnable, bienfaisante. La responsabilité lui incombe. Le monde ne marcherait pas sans cela. Où en serions-nous si le tailleur devait se dire : « Je ne ferai pas un habit de cette forme qui m’est demandée, parce qu’elle pèche par excès de luxe, ou parce qu’elle compromet la respiration, etc., etc. ? »
Est-ce que cela regarde nos pauvres vignerons, si les riches viveurs de Londres s’enivrent avec les vins de France ? Et peut-on plus sérieusement accuser les Anglais de récolter de l’opium dans l’Inde avec l’idée bien arrêtée d’empoisonner les Chinois ?
Non, un peuple futile provoque toujours des industries futiles, comme un peuple sérieux fait naître des industries sérieuses. Si l’humanité se perfectionne, ce n’est pas par la moralisation du producteur, mais par celle du consommateur.
C’est ce qu’a parfaitement compris la religion, quand elle a adressé au riche, — au grand consommateur, un sévère avertissement sur son immense responsabilité. D’un autre point de vue, et dans une autre langue, l’Économie politique formule la même conclusion. Elle affirme qu’on ne peut pas empêcher d’offrir ce qui est demandé ; que le produit n’est pour le producteur qu’une valeur, une sorte de numéraire qui ne représente pas plus le mal que le bien, tandis que, dans l’intention du consommateur, il est utilité, jouissance morale ou immorale ; que, par conséquent, il incombe à celui qui manifeste le désir et fait la demande d’en assumer les conséquences utiles ou funestes, et de répondre devant la justice de Dieu, comme devant l’opinion des hommes, de la direction bonne ou mauvaise qu’il a imprimée au travail.
Ainsi, à quelque point de vue qu’on se place, on voit que la consommation est la grande fin de l’économie politique ; que le bien et le mal, la moralité et l’immoralité, les harmonies et les discordances, tout vient se résoudre dans le consommateur, car il représente l’humanité.
[??? not in 1851 ed.: V. au tome IV la note de la page 72. (Note de l’éditeur.)]
XII. Les deux Devises↩
Les modernes moralistes qui opposent l’axiome : Chacun pour tous, tous pour chacun, à l’antique proverbe: Chacun pour soi, chacun chez soi, se font de la Société une idée bien incomplète, et, par cela seul, bien fausse ; j’ajouterais même, ce qui va les surprendre, bien triste.
Éliminons d’abord, de ces deux célèbres devises, ce qui surabonde. Tous pour chacun est un hors-d’œuvre, placé là par l’amour de l’antithèse, car il est forcément compris dans Chacun pour tous. Quant au chacun chez soi, c’est une pensée qui n’a pas de rapport direct avec les trois autres ; mais comme elle a une grande importance en économie politique, nous lui demanderons aussi plus tard ce qu’elle contient.
Reste la prétendue opposition entre ces deux membres de proverbes : Chacun pour tous, — chacun pour soi. L’un, dit-on, exprime le principe sympathique ; l’autre, le principe individualiste. Le premier unit, le second divise.
Si l’on veut parler seulement du mobile qui détermine l’effort, l’opposition est incontestable. Mais je soutiens qu’il n’en est pas de même, si l’on considère l’ensemble des efforts humains dans leurs résultats. Examinez la Société telle qu’elle est, obéissant en matière de services rémunérables au principe individualiste, et vous vous assurerez que chacun, en travaillant pour soi, travaille en effet pour tous. En fait, cela ne peut pas être contesté. Si celui qui lit ces lignes exerce une profession ou un métier, je le supplie de tourner un moment ses regards sur lui-même. Je lui demande si tous ses travaux n’ont pas pour objet la satisfaction d’autrui, et si d’un autre côté, ce n’est pas au travail d’autrui qu’il doit toutes ses satisfactions.
Évidemment, ceux qui disent que chacun pour soi et chacun pour tous s’excluent, croient qu’une incompatibilité existe entre l’individualisme et l’association. Ils pensent que chacun pour soi implique isolement ou tendance à l’isolement ; que l’intérêt personnel désunit au lieu d’unir, et qu’il aboutit au chacun chez soi,qq c’est à dire à l’absence de toutes relations sociales.
En cela, je le répète, ils se font de la Société une vue tout à fait fausse, à force d’être incomplète. Alors même qu’ils ne sont mus que par leur intérêt personnel, les hommes cherchent à se rapprocher, à combiner leurs efforts, à unir leurs forces, à travailler les uns pour les autres, à se rendre des services réciproques, à socier ou s’associer. Il ne serait pas exact de dire qu’ils agissent ainsi malgré l’intérêt personnel ; non, ils agissent ainsi par intérêt personnel. Ils socient, parce qu’ils s’en trouvent bien. S’il devaient s’en mal trouver, ils ne socieraient pas. L’individualisme accomplit donc ici l’œuvre que les sentimentalistes de notre temps voudraient confier à la Fraternité, à l’abnégation, ou je ne sais à quel autre mobile opposé à l’amour de soi. — Et ceci prouve, c’est une conclusion à laquelle nous arrivons toujours, que la Providence a su pourvoir à la sociabilité beaucoup mieux que ceux qui se disent ses prophètes. — Car, de deux choses l’une : ou l’union nuit à l’individualité, ou elle lui est avantageuse. — Si elle nuit, comment s’y pendront messieurs les Socialistes, et quels motifs raisonnables peuvent-ils avoir pour réaliser ce qui blesse tout le monde ? Si, au contraire, l’union est avantageuse, elle s’accomplira en vertu de l’intérêt personnel, le plus fort, le plus permanent, le plus uniforme, le plus universel de tous les mobiles, quoi qu’on dire.
Et voyez comment les choses se passent. Un Squatter s’en va défricher une terre dans le Far-west. Il n’y a pas de jour où il n’éprouve combien l’isolement lui crée de difficultés. Bientôt un second Squatter se dirige aussi vers le désert. Où plantera-t-il sa tente ? S’éloignera-t-il naturellement du premier ? Non, il s’en rapprochera naturellement. Pourquoi ? Parce qu’il sait tous les avantages que les hommes tirent, à efforts égaux, de leur simple rapprochement. Il sait que, dans une multitude de circonstances, ils pourront s’emprunter et se prêter des instruments, unir leur action, vaincre des difficultés inabordables pour des forces individuelles, se créer réciproquement des débouchés, se communiquer leurs idées et leurs vues, pourvoir à la défense commune. Un troisième, un quatrième, un cinquième Squatter pénètrent dans le désert, et invariablement leur tendance est de se laisser attirer par la fumée des premiers établissements. D’autres peuvent alors survenir avec des capitaux plus considérables, sachant qu’ils trouveront des bras à mettre en œuvre. La colonie se forme. On peut varier un peu les cultures ; tracer un sentier vers la route où passe la malle-poste ; importer et exporter ; songer à construire une église, une maison d’école, etc., etc. En un mot, la puissance des colons s’augmente, par le fait seul de leur rapprochement, de manière à dépasser dans des proportions incalculables la somme de leurs forces isolées. C’est là le motif qui les a attirés les uns vers les autres.
Mais, dira-t-on, chacun pour soi est une maxime bien triste, bien froide. Tous les raisonnements, tous les paradoxes du monde n’empêcheront pas qu’elle ne soulève nos antipathies, qu’elle ne sente l’égoïsme d’une lieue ; et l’égoïsme, n’est-ce pas plus qu’un mal dans la Société, n’est-ce pas la source de tous les maux ?
Entendons-nous, s’il vous plaît.
Si l’axiome chacun pour soi est entendu dans ce sens qu’il doit diriger toutes nos pensées, tous nos actes, toutes nos relations, qu’on doit le trouver au fond de toutes nos affections de père, de fils, de frère, d’époux, d’ami, de citoyen, ou plutôt qu’il doit étouffer toutes ces affections ; il est affreux, il est horrible, et je ne crois pas qu’il y ait sur la terre un seul homme, en fît-il la règle de sa propre conduite, qui ose le proclamer en théorie.
Mais les Socialistes se refuseront-ils toujours à reconnaître, malgré l’autorité des faits universels, qu’il y a deux ordres de relations humaines : les unes dépendant du principe sympathique, — et que nous laissons au domaine de la morale ; les autres naissant de l’intérêt personnel, accomplies entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne se doivent rien que la justice, — réglées par des conventions volontaires et librement débattues ? Ce sont précisément les conventions de cette dernière espèce, qui forment le domaine de l’économie politique. Or il n’est pas plus possible de fonder ces transactions sur le principe sympathique qu’il ne serait raisonnable de fonder les rapports de famille et d’amitié sur le principe de l’intérêt. Je dirais éternellement aux socialistes : Vous voulez confondre deux choses qui ne peuvent pas être confondues. Si vous êtes assez fous, vous ne serez pas assez forts. — Ce forgeron, ce charpentier, ce laboureur, qui s’épuisent à de rudes travaux, peuvent être d’excellents pères, des fils admirables, ils peuvent avoir le sens moral très-développé, et porter dans leur poitrine le cœur le plus expansif ; malgré cela, vous ne les déterminerez jamais à travailler du matin au soir, à répandre leurs sueurs, à s’imposer de dures privations sur le principe du dévouement. Vos prédications sentimentalistes sont et seront toujours impuissantes. Que si, par malheur, elles séduisaient un petit nombre de travailleurs, elles en feraient autant de dupes. Qu’un marchand se mette à vendre sur le principe de la fraternité, je ne lui donne pas un mois pour voir ses enfants réduits à la mendicité.
La Providence a donc bien fait de donner à la Sociabilité d’autres garanties. L’homme étant donné, la sensibilité étant inséparable de l’individualité, il est impossible d’espérer, de désirer et de comprendre que l’intérêt personnel puisse être universellement aboli. C’est ce qu’il faudrait cependant, pour le juste équilibre des relations humaines ; car si vous ne brisez ce ressort que dans quelques âmes d’élite, vous faites deux classes, — les méchants induits à faire des victimes, les bons à qui le rôle de victimes est réservé.
Puisque, en matière de travail et d’échanges, le principe chacun pour soi devait inévitablement prévaloir comme mobile, ce qui est admirable, ce qui est merveilleux, c’est que l’auteur des choses s’en soit servi pour réaliser au sein de l’ordre social l’axiome fraternitaire chacun pour tous ; c’est que son habile main ait fait de l’obstacle l’instrument ; que l’intérêt général ait été confié à l’intérêt personnel, et que le premier soit devenu infaillible, par cela même que le second est indestructible. Il me semble que, devant ces résultats, les communistes et autres inventeurs de sociétés artificielles peuvent reconnaître, — sans en être trop humiliés, à la rigueur, — qu’en fait d’organisation, leur rival de là-haut est décidément plus fort qu’eux.
Et remarquez bien que, dans l’ordre naturel des sociétés, le chacun pour tous naissant du chacun pour soi est beaucoup plus complet, beaucoup plus absolu, beaucoup plus intime qu’il ne le serait au point de vue communiste ou socialiste. Non-seulement nous travaillons pour tous, mais nous ne pouvons pas réaliser un progrès, de quelque nature qu’il soit, que nous n’en fassions profiter la communauté tout entière. (Voir les chapitres X et XI.) Les choses sont arrangées d’une façon si merveilleuse, que lorsque nous avons imaginé un procédé, ou découvert une libéralité de la nature, quelque nouvelle fécondité dans le sol, quelque nouveau mode d’action dans une des lois du monde physique, le profit est pour nous momentanément, passagèrement, comme cela était juste au point de vue de la récompense, utile au point de vue de l’encouragement, — après quoi l’avantage échappe de nos mains, malgré nos efforts pour le retenir ; d’individuel il devient social, et tombe pour toujours dans le domaine de la communauté gratuite. Et, en même temps que nous faisons ainsi jouir l’humanité de nos progrès, nous-mêmes nous jouissons des progrès que tous les autres hommes ont accomplis.
En définitive, avec le chacun pour soi, tous les efforts de l’individualisme surexcité agissent dans le sens du chacun pour tous, et chaque progrès partiel vaut à la Société, en utilité gratuite, des millions de fois ce qu’il a rapporté à son inventeur en bénéfices.
Avec le chacun pour tous, personne n’agirait même pour soi. Quel producteur s’aviserait de doubler son travail pour recueillir, en plus, un trente-millionième de son salaire ?
On dira peut-être : À quoi bon réfuter l’axiome Socialiste ? Quel mal peut-il faire ? Sans doute, il ne fera pas pénétrer dans les ateliers, dans les comptoirs, dans les magasins, il ne fera pas prévaloir dans les foires et marchés le principe de l’abnégation. Mais enfin, ou il n’aboutira à rien, et alors vous pouvez le laisser dormir en paix, ou il assouplira quelque peu cette roideur du principe égoïste qui, exclusif de toute sympathie, n’a guère droit à la notre.
Ce qui est faux est toujours dangereux. Il est toujours dangereux de représenter comme condamnable et damnable un principe universel, éternel, que Dieu a évidemment préposé à la conservation et à l’avancement de l’humanité ; principe, j’en conviens, qui, en tant que mobile, ne parle pas à notre cœur, mais qui, par ses résultats, étonne et satisfait notre intelligence ; principe, d’ailleurs, qui laisse le champ parfaitement libre aux autres mobiles d’un ordre plus élevé, que Dieu a mis aussi dans le cœur des hommes.
Mais sait-on ce qui arrive ? C’est que le public des socialistes ne prend de leur axiome que la moitié, la dernière moitié, tous pour chacun. On continue comme devant à travailler pour soi, mais on exige en outre que tous travaillent aussi pour soi.
Et cela devait être. Lorsque les rêveurs ont voulu changer le grand ressort de l’activité humaine, pour substituer la fraternité à l’individualisme, qu’ont-ils imaginé ? Une contradiction doublée d’hypocrisie. Ils se sont mis à crier aux masses : « Étouffez dans votre cœur l’intérêt personnel et suivez nous ; vous en serez récompensés par tous les biens, par tous les plaisirs de ce monde. » Quand on essaye de parodier le ton de l’Évangile, il faut conclure comme lui. L’abnégation de la fraternité implique sacrifice et douleur. « Dévouez-vous, » cela veut dire : « Prenez la dernière place, soyez pauvre et souffrez volontairement. » Mais sous prétexte de renoncement, promettre la jouissance ; montrer derrière le sacrifice prétendu le bien-être et la richesse ; pour combattre la passion, qu’on flétrit du nom d’égoïsme, s’adresser à ses tendances les plus matérielles, — ce n’était pas seulement rendre témoignage à l’indestructible vitalité du principe qu’on voulait abattre, c’était l’exalter au plus haut point, tout en déclamant contre lui ; c’était doubler les forces de l’ennemi au lieu de le vaincre, substituer la convoitise injuste à l’individualisme légitime, et malgré l’artifice de je ne sais quel jargon mystique, surexciter le sensualisme le plus grossier. La cupidité devait répondre à cet appel. [249]
Et n’est-ce pas là que nous en sommes ? Quel est le cri universel dans tous les rangs, dans toutes les classes ? Tous pour chacun. — En prononçant le mot chacun, nous pensons à nous, et ce que nous demandons c’est de prendre une part imméritée dans le travail de tous. — En d’autres termes, nous systématisons la spoliation. — Sans doute, la spoliation naïve et directe est tellement injuste qu’elle nous répugne ; mais, grâce à la maxime tous pour chacun, nous apaisons les scrupules de notre conscience. Nous plaçons dans les autres le devoir de travailler pour nous, puis nous mettons en nous le droit de jouir du travail des autres ; nous sommons l’État, la loi d’imposer le prétendu devoir, de protéger le prétendu droit, et nous arrivons à ce résultat bizarre de nous dépouiller mutuellement au nom de la fraternité. Nous vivons aux dépens d’autrui, et c’est à ce titre que nous nous attribuons l’héroïsme du sacrifice. Ô bizarrerie de l’esprit humain ! Ô subtilité de la convoitise ! Ce n’est pas assez que chacun de nous s’efforce de grossir sa part aux dépens de celle des autres, ce n’est pas assez de vouloir profiter d’un travail que nous n’avons pas fait, nous nous persuadons encore que par là nous nous montrons sublimes dans la pratique du dévouement ; peut s’en faut que nous ne comparions à Jésus-Christ, et nous nous aveuglons au point de ne pas voir que ces sacrifices, qui nous font pleurer d’admiration en nous contemplant nous-mêmes, nous ne les faisons pas, mais nous les exigeons. [250]
La manière dont la grande mystification s’opère mérite d’être observée.
Voler ! Fi donc, c’est abject ; d’ailleurs cela mène au bagne, car la loi le défend. — Mais si la loi l’ordonnait et prêtait son aide, ne serait-ce pas bien commode?… Quelle lumineuse inspiration!…
Aussitôt on demande à la loi un petit privilége, un petit monopole, et comme, pour le faire respecter, il en coûterait quelques peines, on prie l’État de s’en charger. L’État et la loi s’entendent pour réaliser précisément ce qu’ils avaient mission de prévenir ou de punir. Peu à peu, le goût des monopoles gagne. Il n’est pas de classe qui ne veuille le sien. Tous pour chacun, s’écrient-elles, nous voulons aussi nous montrer philanthropes et faire voir que nous comprenons la solidarité.
Il arrive que les classes », se volant réciproquement, perdent au moins autant, par les exactions qu’elles subissent, qu’elles gagnent aux exactions qu’elles exercent. En outre, la grande masse des travailleurs, à qui l’on n’a pas pu accorder de priviléges, souffre, dépérit et n’y peut résister. Elle s’insurge, couvre les rues de barricades et de sang, et voici qu’il faut compter avec elle.
Que va-t-elle demander ? Exigera-t-elle l’abolition des abus, des priviléges, des monopoles, des restrictions sous lesquels elle succombe ? Pas du tout. On l’a imbue, elle aussi, de philanthropisme. On lui a dit que le fameux tous pour chacun, c’était la solution du problème social ; on lui a démontré, par maint exemple, que le privilége (qui n’est qu’un vol) est néanmoins très-moral s’il s’appuie sur la loi. En sorte qu’on voit le peuple demander… Quoi?… — Des priviléges !… Lui aussi somme l’État de lui fournir de l’instruction, du travail, du crédit, de l’assistance, aux dépens du peuple. — Oh ! quelle illusion étrange ! et combien de temps durera-t-elle ? — On conçoit bien que toutes les classes élevées, à commencer par la plus haute, puissent venir l’une après l’autre réclamer des faveurs, des priviléges. Au-dessous d’elles, il y a la grande masse populaire sur qui tout cela retombe. Mais que le peuple, une fois vainqueur, se soit imaginé d’entrer lui aussi tout entier dans la classe des privilégiés, de se créer des monopoles à lui-même et sur lui-même, d’élargir la base des abus pour en vivre ; qu’il n’ait pas vu qu’il n’y a rien au-dessous de lui pour alimenter ces injustices, c’est là un des phénomènes les plus étonnants de notre époque et d’aucune époque.
Qu’est-il arrivé ? C’est que sur cette voie la Société était conduite à un naufrage général. Elle s’est alarmée avec juste raison. Le peuple a bientôt perdu sa puissance, et l’ancien partage des abus a provisoirement repris son assiette ordinaire.
Cependant la leçon n’a pas été tout à fait perdue pour les classes élevées. Elles sentent qu’il faut faire justice aux travailleurs. Elles désirent vivement y parvenir, non-seulement parce que leur propre sécurité en dépend, mais encore, il faut le reconnaître, par esprit d’équité. Oui, je le dis avec conviction entière, la classe riche ne demande pas mieux que de trouver la grande solution. Je suis convaincu que si l’on réclamait de la plupart des riches l’abandon d’une portion considérable de leur fortune, en garantissant que désormais le peuple sera heureux et satisfait, ils en feraient avec joie le sacrifice. Ils cherchent donc avec ardeur le moyen de venir, selon l’expression consacrée, au secours des classes laborieuses. Mais pour cela qu’imaginent-ils?… Encore le communisme des priviléges ; un communisme mitigé toutefois, et qu’ils se flattent de soumettre au régime de la prudence. Voilà tout ; ils ne sortent pas de là. . . . . . . . . . . . . .
XIII. De la Rente [251] ↩
Quand la valeur du sol augmente, si une augmentation correspondante se faisait sentir sur le prix des produits du sol, je comprendrais l’opposition que rencontre la théorie exposée dans ce livre (chapitre IX). On pourrait dire : « À mesure que la civilisation se développe, la condition du travailleur empire relativement à celle du propriétaire. C’est peut-être une nécessité fatale, mais assurément ce n’est pas une loi harmonique. »
Heureusement il n’en est pas ainsi. En général, les circonstances qui font augmenter la valeur du sol diminuent en même temps le prix des subsistances… Expliquons ceci par un exemple.
Soit à dix lieues de la ville un champ valant 100 fr. ; on fait une route qui passe près de ce champ, c’est un débouché ouvert aux récoltes, et aussitôt la terre vaut 150 fr. — Le propriétaire, ayant acquis par là des facilités soit pour y amener des amendements, soit pour en extraire des produits plus variés, fait des améliorations à sa propriété, et elle arrive à valoir 200 fr.
La valeur du champ est donc doublée. Examinons cette plus-value, au point de vue — de la justice d’abord, — ensuite de l’utilité recueillie, non par le propriétaire, mais par les consommateurs de la ville.
Quant à l’accroissement de valeur provenant des améliorations que le propriétaire a faites à ses frais, pas de doute. C’est un capital qui suit la loi de tous les capitaux.
J’ose dire qu’il en est ainsi de la route. L’opération fait un circuit plus long, mais le résultat est le même.
En effet, le propriétaire concourt, à raison de son champ, aux dépenses publiques ; pendant bien des années, il a contribué à des travaux d’utilité générale exécutés sur des portions éloignées du territoire ; enfin une route a été faite dans une direction qui lui est favorable. La masse des impôts par lui payés peut être assimilée à des actions qu’il aurait prises dans les entreprises gouvernementales, et la rente annuelle, qui lui arrive par suite de la nouvelle route, comme le dividende de ces actions.
Dira-t-on qu’un propriétaire doit toujours payer l’impôt pour n’en jamais rien retirer ?… Ce cas rentre donc dans le précédent ; et l’amélioration, quoique faite par la voie compliquée et plus ou moins contestable de l’impôt, peut être considérée comme exécutée par le propriétaire et à ses frais, dans la mesure de l’avantage partiel qu’il en retire.
J’ai parlé d’une route : remarquez que j’aurais pu citer toute autre intervention gouvernementale. La sécurité, par exemple, contribue à donner de la valeur aux terres comme aux capitaux, comme au travail. Mais qui paye la sécurité ? Le propriétaire, le capitaliste, le travailleur. — Si l’État dépense bien, la valeur dépensée doit se reformer et se retrouver, sous une forme quelconque, entre les mains du propriétaire, du capitaliste, du travailleur. Pour le propriétaire, elle ne peut apparaître que sous forme d’accroissement du prix de sa terre. — Que si l’État dépense mal, c’est un malheur ; l’impôt est perdu ; c’était aux contribuables à y veiller. En ce cas, il n’y a pas pour la terre accroissement de valeur, et certes la faute n’en est pas au propriétaire.
Mais les produits du sol qui a ainsi augmenté de valeur, et par l’action gouvernementale, et par l’industrie particulière, — ces produits sont-ils payés plus cher par les acheteurs de la ville ? en d’autres termes, l’intérêt de ces cent francs vient-il grever chaque hectolitre de froment qui sortira du champ ? Si on le payait 15 fr., le payera-t-on désormais 15 fr. plus une fraction ? — C’est là une question des plus intéressantes, puisque la justice et l’harmonie universelle des intérêts en dépendent.
Or je réponds hardiment : non.
Sans doute, le propriétaire recouvrera désormais 5 fr. de plus (je suppose le taux du profit à 5 p. 100) ; mais il ne les recouvrera aux dépens de personne. Bien au contraire, l’acheteur, de son côté, fera un bénéfice plus grand encore.
En effet, le champ que nous avons pris pour exemple était autrefois éloigné des débouchés, on lui faisait peu produire ; à cause des difficultés du transport, les produits parvenus sur le marché se vendaient cher. — Aujourd’hui la production est activée, le transport économique ; une plus grande quantité de froment arrive sur le marché, y arrive à moins de frais et s’y vend à meilleur compte. Tout en laissant au propriétaire un profit total de 5 fr., l’acheteur peut faire un bénéfice encore plus fort.
En un mot, une économie de forces a été réalisée. — Au profit de qui ? au profit des deux parties contractantes. — Quelle est la loi du partage de ce gain sur la nature ? La loi que nous avons souvent citée à propos des capitaux, puisque cette augmentation de valeur est un capital.
Quand le capital augmente, la part du propriétaire ou capitaliste — augmente en valeur absolue, — diminue en valeur relative ; la part du travailleur (ou du consommateur) augmente — et en valeur absolue et en valeur relative…
Remarquez comment les choses se passent. À mesure que la civilisation se fait, les terres les plus rapprochées du centre d’agglomération augmentent de valeur. Les productions d’un ordre inférieur y font place à des productions d’un ordre plus élevé. D’abord le pâturage disparaît devant les céréales ; puis celles-ci sont remplacées par le jardinage. Les approvisionnements arrivent de plus loin à moindres frais, de telle sorte, — et c’est un point de fait incontestable, — que la viande, le pain, les légumes, même les fleurs, y sont à un prix moindre que dans les contrées moins avancées, malgré que la main-d’œuvre y soit mieux rétribuée qu’ailleurs…
le clous-vougeot.
… Les services s’échangent contre les services. Souvent des services préparés d’avance s’échangent contre des services actuels ou futurs.
Les services valent, non pas suivant le travail qu’ils exigent ou ont exigé, mais suivant le travail qu’ils épargnent.
Or il est de fait que le travail humain se perfectionne.
De ces prémisses se déduit un phénomène très-important en Économie sociale : C’est qu’en général le travail antérieur perd dans l’échange avec le travail actuel. [252]
J’ai fait, il y a vingt ans, une chose qui m’a coûté cent journées de travail. Je propose un échange, et je dis à mon acheteur : Donnez-moi une chose qui vous coûte également cent journées. Probablement il sera en mesure de me répondre : Depuis vingt ans on a fait des progrès. Ce qui vous avait demandé cent journées, on le fait à présent avec soixante-dix. Or je ne mesure pas votre service par le temps qu’il vous a coûté, mais par le service qu’il me rend : ce service n’est plus que de soixante-dix journées, puisque avec ce temps je puis me le rendre à moi-même, ou trouver qui me le rende.
Il résulte de là que la valeur des capitaux se détériore incessamment, et que le capital ou le travail antérieur n’est pas aussi favorisé que le croient les Économistes superficiels.
Il n’y a pas de machine un peu vieille qui ne perde, abstraction faite du dépérissement à l’user, par ce seul motif qu’on en fabrique aujourd’hui de meilleures.
Il en est de même des terres. Et il y en a bien peu qui, pour être amenées à l’état de fertilité où elles sont, n’aient coûté plus de travail qu’il n’en faudrait aujourd’hui, où l’on a des moyens d’action plus énergiques.
Telle est la marche générale, mais non nécessaire.
Un travail antérieur peut rendre aujourd’hui de plus grands services qu’autrefois. C’est rare, mais cela se voit. Par exemple, j’ai gardé du vin qui représente vingt journées de travail. — Si je l’avais vendu tout de suite, mon travail aurait reçu une certaine rémunération. J’ai gardé mon vin ; il s’est amélioré, la récolte suivante a manqué, bref, le prix a haussé, et ma rémunération est plus grande. Pourquoi ? Parce que je rends plus de services, — que les acquéreurs auraient plus de peine à se procurer ce vin que je n’en ai eu, — que je satisfais à un besoin devenu plus grand, plus apprécié, etc…
C’est ce qu’il faut toujours examiner.
Nous sommes mille. Chacun a son hectare de terre et le défriche ; le temps s’écoule, et l’on vend. Or, il arrive que sur 1,000 il y en a 998 qui ne reçoivent ou ne recevront jamais autant de journées de travail actuel, en échange de la terre, qu’elle leur en a coûté autrefois ; et cela parce que le travail antérieur plus grossier ne rend pas comparativement autant de services que le travail actuel. Mais il se trouve deux proprietaires dont le travail a été plus intelligent ou, si l’on veut, plus heureux. Quand ils l’offrent sur le marché, il se trouve qu’il y représente d’inimitables services. Chacun se dit : Il m’en coûterait beaucoup de me rendre ce service à moi-même ; donc je le payerai cher ; et, pourvu qu’on ne me force pas, je suis toujours bien sûr qu’il ne me coûtera pas autant que si je me le rendais par tout autre moyen.
C’est l’histoire du Clos-Vougeot. C’est le même cas que l’homme qui trouve un diamant, qui possède une belle voix, ou une taille à montrer pour cinq sous, etc. . . 19760.. . . . . . . . . . . . . . .
Dans mon pays il y a beaucoup de terres incultes. L’étranger ne manque pas de dire : Pourquoi ne cultivez-vous pas cette terre ? — Parce qu’elle est mauvaise. — Mais voilà à côté de la terre absolument semblable et qui est cultivée. — À cette objection, le naturel du pays ne trouve pas de réponse.
C’est qu’il s’est trompé dans la première : Elle est mauvaise ?
Non ; la raison qui fait qu’on ne défriche pas de nouvelles terres, ce n’est pas qu’elles soient mauvaises, et il y en a d’excellentes qu’on ne défriche pas davantage. Voici le motif : c’est qu’il en coûte plus pour amener cette terre inculte à un état de productivité pareille à celle du champ voisin qui est cultivé, que pour acheter ce champ voisin lui-même.
Or, pour qui sait réfléchir, cela prouve invinciblement que la terre n’a pas de valeur par elle-même…
(Développer tous les points de vue de cette idée. [253][254]
XIV. Des Salaires↩
Les hommes aspirent avec ardeur à la fixité. Il se rencontre bien dans le monde quelques individualités inquiètes, aventureuses, pour lesquelles l’aléatoire est une sorte de besoin. On peut affirmer néanmoins que les hommes pris en masse aiment à être tranquilles sur leur avenir, à savoir sur quoi compter, à pouvoir disposer d’avance tous leurs arrangements. Pour comprendre combien ils tiennent la fixité pour précieuse, il suffit de voir avec quel empressement ils se jettent sur les fonctions publiques. Qu’on ne dise pas que cela tient à l’honneur qu’elles confèrent. Certes, il y a des places dont le travail n’a rien de très-relevé. Il consiste, par exemple, à surveiller, fouiller, vexer les citoyens. Elles n’en sont pas moins recherchées. Pourquoi ? Parce qu’elles constituent une position sûre. Qui n’a entendu le père de famille dire de son fils : « Je sollicite pour lui une aspirance au surnumérariat de telle administration. Sans doute il est fâcheux qu’on exige de lui une éducation qui m’a coûté fort cher. Sans doute encore, avec cette éducation, il eût pu embrasser une carrière plus brillante. Fonctionnaire, il ne s’enrichira pas, mais il est certain de vivre. Il aura toujours du pain. Dans quatre ou cinq ans, il commencera à toucher 800 fr. de traitement ; puis il s’élèvera par degrés jusqu’à 3 ou 4,000 fr. Après trente années de service, il aura droit à sa retraite. Son existence est donc assurée : c’est à lui de savoir la tenir dans une obscure modération, etc. »
La fixité a donc pour les hommes un attrait tout-puissant.
Et cependant, en considérant la nature de l’homme et de ses travaux, il semble que la fixité soit incompatible avec elle.
Quiconque se placera, par la pensée, au point de départ des sociétés humaines aura peine à comprendre comment une multitude d’hommes peuvent arriver à retirer du milieu social une quantité déterminée, assurée, constante de moyens d’existence. C’est encore là un de ces phénomènes qui ne nous frappent pas assez, précisément parce que nous les avons toujours sous les yeux. Voilà des fonctionnaires qui touchent des appointements fixes, des propriétaires qui savent d’avance leurs revenus, des rentiers qui peuvent calculer exactement leurs rentes, des ouvriers qui gagnent tous les jours le même salaire. — Si l’on fait abstraction de la monnaie, qui n’intervient là que pour faciliter les appréciations et les échanges, on apercevra que ce qui est fixe, c’est la quantité de moyens d’existence, c’est la valeur des satisfactions reçues par ces diverses catégories de travailleurs. Or, je dis que cette fixité, qui peu à peu s’étend à tous les hommes, à tous les ordres de travaux, est un miracle de la civilisation, un effet prodigieux de cette société si sottement décriée de nos jours.
Car reportons-nous à un état social primitif ; supposons que nous disions à un peuple chasseur, ou pêcheur, ou pasteur, ou guerrier, ou agriculteur : « À mesure que vous ferez des progrès, vous saurez de plus en plus d’avance quelle somme de jouissance vous sera assurée pour chaque année. » Ces braves gens ne pourraient nous croire. Ils nous répondraient : « Cela dépendra toujours de quelque chose qui échappe au calcul, — l’inconstance des saisons, etc. » C’est qu’ils ne pourraient se faire une idée des efforts ingénieux au moyen desquels les hommes sont parvenus à établir une sorte d’assurance entre tous les lieux et tous les temps.
Or cette mutuelle assurance contre les chances de l’avenir est tout à fait subordonnée à un genre de science humaine que j’appellerai statistique expérimentale. Et cette statistique faisant des progrès indéfinis, puisqu’elle est fondée sur l’expérience, il s’ensuit que la fixité fait aussi des progrès indéfinis. Elle est favorisée par deux circonstances permanentes : 1° les hommes y aspirent ; 2° ils acquièrent tous les jours les moyens de la réaliser.
Avant de montrer comment la fixité s’établit dans les transactions humaines, où l’on semble d’abord ne point s’en préoccuper, voyons comment elle résulte de cette transaction dont elle est spécialement l’objet. Le lecteur comprendra ainsi ce que j’entends par statistique expérimentale.
Des hommes ont chacun une maison. L’une vient à brûler, et voilà le propriétaire ruiné. Aussitôt l’alarme se répand chez tous les autres. Chacun se dit : « Autant pouvait m’en arriver. » Il n’y a donc rien de bien surprenant à ce que tous les propriétaires se réunissent et répartissent autant que possible les mauvaises chances, en fondant une assurance mutuelle contre l’incendie. Leur convention est très-simple. En voici la formule : « Si la maison de l’un de nous brûle, les autres se cotiseront pour venir en aide à l’incendié. »
Par là, chaque propriétaire acquiert une double certitude : d’abord, qu’il prendra une petite part à tous les sinistres de cette espèce ; ensuite, qu’il n’aura jamais à essuyer le malheur tout entier.
Au fond, et si l’on calcule sur un grand nombre d’années, on voit que le propriétaire fait, pour ainsi dire, un arrangement avec lui-même. Il économise de quoi réparer les sinistres qui le frappent.
Voilà l’association. C’est même à des arrangements de cette nature que les socialistes donnent exclusivement le nom d’association. Sitôt que la spéculation intervient, selon eux, l’association disparaît. Selon moi, elle se perfectionne, ainsi que nous allons le voir.
Ce qui a porté nos propriétaires à s’associer, à s’assurer mutuellement, c’est l’amour de la fixité, de la sécurité. Ils préfèrent des chances connues à des chances inconnues, une multitude de petits risques à un grand.
Leur but n’est pas cependant complétement atteint, et il est encore beaucoup d’aléatoire dans leur position. Chacun d’eux peut se dire : « Si les sinistres se multiplient, ma quote-part ne deviendra-t-elle pas insupportable ? En tout cas, j’aimerais bien à la connaître d’avance et à faire assurer par le même procédé mon mobilier, mes marchandises, etc. »
Il semble que ces inconvénients tiennent à la nature des choses et qu’il est impossible à l’homme de s’y soustraire.
On est tenté de croire, après chaque progrès, que tout est accompli. Comment, en effet, supprimer cet aléatoire dépendant de sinistres qui sont encore dans l’inconnu ?
Mais l’assurance mutuelle a développé au sein de la société une connaissance expérimentale, à savoir : la proportion, en moyenne annuelle, entre les valeurs perdues par sinistres et les valeurs assurées.
Sur quoi un entrepreneur ou une société, ayant fait tous ses calculs, se présente aux propriétaires et leur dit :
« En vous assurant mutuellement, vous avez voulu acheter votre tranquillité ; et la quote-part indéterminée que vous réservez annuellement pour couvrir les sinistres est le prix que vous coûte un bien si précieux. Mais ce prix ne vous est jamais connu d’avance ; d’un autre côté, votre tranquillité n’est point parfaite. Eh bien ! je viens vous proposer un autre procédé. Moyennant une prime annuelle fixe que vous me payerez, j’assume toutes vos chances de sinistres ; je vous assure tous, et voici le capital qui vous garantit l’exécution de mes engagements. »
Les propriétaires se hâtent d’accepter, même alors que cette prime fixe coûterait un peu plus que le quantum moyen de l’assurance mutuelle ; car ce qui leur importe le plus, ce n’est pas d’économiser quelques francs, c’est d’acquérir le repos, la tranquillité complète.
Ici les socialistes prétendent que l’association est détruite. J’affirme, moi, qu’elle est perfectionnée et sur la voie d’autres perfectionnements indéfinis.
Mais, disent les socialistes, voilà que les assurés n’ont plus aucun lien entre eux. Ils ne se voient plus, ils n’ont plus à s’entendre. Des intermédiaires parasites sont venus s’interposer au milieu d’eux, et la preuve que les propriétaires payent maintenant plus qu’il ne faut pour couvrir les sinistres, c’est que les assureurs réalisent de gros bénéfices.
Il est facile de répondre à cette critique.
D’abord, l’association existe sous une autre forme. La prime servie par les assurés est toujours le fonds qui réparera les sinistres. Les assurés ont trouvé le moyen de rester dans l’association sans s’en occuper. C’est là évidemment un avantage pour chacun d’eux, puisque le but poursuivi n’en est pas moins atteint ; et la possibilité de rester dans l’association, tout en recouvrant l’indépendance des mouvements, le libre usage des facultés, est justement ce qui caractérise le progrès social.
Quant au profit des intermédiaires, il s’explique et se justifie parfaitement. Les assurés restent associés pour la réparation des sinistres. Mais une compagnie est intervenue, qui leur offre les avantages suivants : 1° elle ôte à leur position ce qu’il y restait d’aléatoire ; 2° elle les dispense de tout soin, de tout travail à l’occasion des sinistres. Ce sont des services. Or, service pour service. La preuve que l’intervention de la compagnie est un service pourvu de valeur, c’est qu’il est librement accepté et payé. Les socialistes ne sont que ridicules quand ils déclament contre les intermédiaires. Est-ce que ces intermédiaires s’imposent par la force ? Est-ce que leur seul moyen de se faire accepter n’est pas de dire : « Je vous coûterai quelque peine, mais je vous en épargnerai davantage ? » Or, s’il en est ainsi, comment peut-on les appeler parasites, ou même intermédiaires ?
Enfin, je dis que l’association ainsi transformée est sur la voie de nouveaux progrès en tous sens.
En effet, les compagnies, qui espèrent des profits proportionnels à l’étendue de leurs affaires, poussent aux assurances. Elles ont pour cela des agents partout, elles font des crédits, elles imaginent mille combinaisons pour augmenter le nombre des assurés, c’est-à-dire des associés. Elles assurent une multitude de risques qui échappaient à la primitive mutualité. Bref, l’association s’étend progressivement sur un plus grand nombre d’hommes et de choses. À mesure que ce développement s’opère, il permet aux compagnies de baisser leurs prix ; elles y sont même forcées par la concurrence. Et ici nous retrouvons la grande loi : le bien glisse sur le producteur pour aller s’attacher au consommateur.
Ce n’est pas tout. Les compagnies s’assurent entre elles par les réassurances, de telle sorte qu’au point de vue de la réparation des sinistres, qui est le fond du phénomène, mille associations diverses, établies en Angleterre, en France, en Allemagne, en Amérique, se fondent en une grande et unique association. Et quel est le résultat ? Si une maison vient à brûler à Bordeaux, Paris, ou partout ailleurs, — les propriétaires de l’univers entier, anglais, belges, hambourgeois, espagnols, tiennent leur cotisation disponible et sont prêts à réparer le sinistre.
Voilà un exemple du degré de puissance, d’universalité, de perfection où peut parvenir l’association libre et volontaire. Mais, pour cela, il faut qu’on lui laisse la liberté de choisir ses procédés. Or qu’est-il arrivé quand les socialistes, ces grands partisans de l’association, ont eu le pouvoir ? Ils n’ont rien eu de plus pressé que de menacer l’association, quelque forme qu’elle affecte, et notamment l’association des assurances. Et pourquoi ? Précisément parce que pour s’universaliser elle emploie ce procédé qui permet à chacun de ses membres de rester dans l’indépendance. — Tant ces malheureux socialistes comprennent peu le mécanisme social ! Les premiers vagissements, les premiers tâtonnements de la société, les formes primitives et presque sauvages d’association, voilà le point auquel ils veulent nous ramener. Tout progrès, ils le suppriment sous prétexte qu’il s’écarte de ces formes.
Nous allons voir que c’est par suite des mêmes préventions, de la même ignorance, qu’ils déclament sans cesse, soit contre l’intérêt, soit contre le salaire, formes fixes et par conséquent très-perfectionnées de la rémunération qui revient au capital et au travail.
Le salariat a été particulièrement en butte aux coups des socialistes. Peu s’en faut qu’ils ne l’aient signalé comme une forme à peine adoucie de l’esclavage ou du servage. En tout cas, ils y ont vu une convention abusive et léonine, qui n’a de la liberté que l’apparence, une oppression du faible par le fort, une tyrannie exercée par le capital sur le travail.
Éternellement en lutte sur les institutions à fonder, ils montrent dans leur commune haine des institutions existantes, et notamment du salariat, une touchante unanimité ; car s’ils ne peuvent se mettre d’accord sur l’ordre social de leur préférence, il faut leur rendre cette justice qu’ils s’entendent toujours pour déconsidérer, décrier, calomnier, haïr et faire haïr ce qui est. J’en ai dit ailleurs la raison. [257]
Malheureusement, tout ne s’est point passé dans le domaine de la discussion philosophique ; et la propagande socialiste, secondée par une presse ignorante et lâche, qui, sans s’avouer socialiste, n’en cherchait pas moins la popularité dans des déclamations à la mode, est parvenue à faire pénétrer la haine du salariat dans la classe même des salariés. Les ouvriers se sont dégoûtés de cette forme de rémunération. Elle leur a paru injuste, humiliante, odieuse. Ils ont cru qu’elle les frappait du sceau de la servitude. Ils ont voulu participer selon d’autres procédés à la répartition de la richesse. De là à s’engouer des plus folles utopies, il n’y avait qu’un pas, et ce pas a été franchi. À la Révolution de Février, la grande préoccupation des ouvriers a été de se débarrasser du salaire. Sur le moyen, ils ont consulté leurs dieux ; mais quand leurs dieux ne sont pas restés muets, ils n’ont, selon l’usage, rendu que d’obscurs oracles, dans lesquels on entendait dominer le grand mot association, comme si association et salaire étaient incompatibles. Alors, les ouvriers ont voulu essayer toutes les formes de cette association libératrice, et, pour lui donner plus d’attraits, ils se sont plu à la parer de tous les charmes de la Solidarité, à lui attribuer tous les mérites de la Fraternité. Un moment, on aurait pu croire que le cœur humain lui-même allait subir une grande transformation et secouer le joug de l’intérêt pour n’admettre que le principe du dévouement. Singulière contradiction ! On espérait recueillir dans l’association tout à la fois la gloire du sacrifice et des profits inconnus jusque-là. On courait à la fortune, et on sollicitait, on se décernait à soi-même les applaudissements dus au martyre. Il semble que ces ouvriers égarés, sur le point d’être entraînés dans une carrière d’injustice, sentaient le besoin de se faire illusion, de glorifier les procédés de spoliation qu’ils tenaient de leurs apôtres, et de les placer couverts d’un voile dans le sanctuaire d’une révélation nouvelle. Jamais peut-être tant d’aussi dangereuses erreurs, tant d’aussi grossières contradictions n’avaient pénétré aussi avant dans l’esprit humain.
Voyons donc ce qu’est le salaire. Considérons-le dans son origine, dans sa forme, dans ses effets. Reconnaissons sa raison d’être ; assurons-nous s’il fut, dans le développement de l’humanité, une rétrogradation ou un progrès. Vérifions s’il porte en lui quelque chose d’humiliant, de dégradant, d’abrutissant, et s’il est possible d’apercevoir sa filiation prétendue avec l’esclavage.
Les services s’échangent contre des services. Ce que l’on cède comme ce qu’on reçoit, c’est du travail, des efforts, des peines, des soins, de l’habileté naturelle ou acquise ; ce que l’on se confère l’un à l’autre, ce sont des satisfactions ; ce qui détermine l’échange, c’est l’avantage commun, et ce qui le mesure, c’est la libre appréciation des services réciproques. Les nombreuses combinaisons auxquelles ont donné lieu les transactions humaines ont nécessité un volumineux vocabulaire économique ; mais les mots Profits, Intérêts, Salaires, qui expriment des nuances, ne changent pas le fond des choses. C’est toujours le do ut des, ou plutôt le facio ut facias, qui est la base de toute l’évolution humaine au point de vue économique.
Les salariés ne font pas exception à cette loi. Examinez bien. Rendent-ils des services? cela n’est pas douteux. En reçoivent-ils? ce ne l’est pas davantage. Ces services s’échangent-ils volontairement, librement? Aperçoit-on dans ce mode de transaction la présence de la fraude, de la violence? C’est ici peut-être que commencent les griefs des ouvriers. Ils ne vont pas jusqu’à se prétendre dépouillés de la liberté, mais ils affirment que cette liberté est purement nominale et même dérisoire, parce que celui dont la nécessité force les déterminations n’est pas réellement libre. Reste donc à savoir si le défaut de la liberté ainsi entendue ne tient pas plutôt à la situation de l’ouvrier qu’au mode selon lequel il est rémunéré.
Quand un homme met ses bras au service d’un autre, sa rémunération peut consister en une part de l’œuvre produite, ou bien en un salaire déterminé. Dans un cas comme dans l’autre, il faut qu’il traite de cette part, — car elle peut être plus ou moins grande, — ou de ce salaire, — car il peut être plus ou moins élevé. Et si cet homme est dans le dénûment absolu, s’il ne peut attendre, s’il est sous l’aiguillon d’une nécessité urgente, il subira la loi, il ne pourra se soustraire aux exigences de son associé. Mais il faut bien remarquer que ce n’est pas la forme de la rémunération qui crée pour lui cette sorte de dépendance. Qu’il coure les chances de l’entreprise ou qu’il traite à forfait, sa situation précaire est ce qui le place dans un état d’infériorité à l’égard du débat qui précède la transaction. Les novateurs qui ont présenté aux ouvriers l’association comme un remède infaillible, les ont donc égarés et se sont trompés eux-mêmes. Ils peuvent s’en convaincre en observant attentivement des circonstances où le travailleur pauvre reçoit une part du produit et non un salaire. Assurément il n’y a pas en France d’hommes plus misérables que les pêcheurs ou les vignerons de mon pays, encore qu’ils aient l’honneur de jouir de tous les bienfaits de ce que les socialistes nomment exclusivement l’association.
Mais, avant de rechercher ce qui influe sur la quotité du salaire, je dois définir ou plutôt décrire la nature de cette transaction.
C’est une tendance naturelle aux hommes, — et par conséquent cette tendance est favorable, morale, universelle, indestructible, — d’aspirer à la sécurité relativement aux moyens d’existence, de rechercher la fixité, de fuir l’aléatoire.
Cependant, à l’origine des sociétés, l’aléatoire règne pour ainsi dire sans partage ; et je me suis étonné souvent que l’économie politique ait négligé de signaler les grands et heureux efforts qui ont été faits pour le restreindre dans des limites de plus en plus étroites.
Et voyez : Dans une peuplade de chasseurs, au sein d’une tribu nomade ou d’une colonie nouvellement fondée, y a-t-il quelqu’un qui puisse dire avec certitude ce que lui vaudra le travail du lendemain? Ne semble-t-il pas même qu’il y ait incompatibilité entre ces deux idées, et que rien ne soit de nature plus éventuelle que le résultat du travail, qu’il s’applique à la chasse, a la pêche ou à la culture?
Aussi serait-il difficile de trouver, dans l’enfance des sociétés, quelque chose qui ressemble à des traitements, des appointements, des gages, des salaires, des revenus, des rentes, des intérêts, des assurances, etc., toutes choses qui ont été imaginées pour donner de plus en plus de fixité aux situations personnelles, pour éloigner de plus en plus de l’humanité ce sentiment pénible : la terreur de l’inconnu en matière de moyens d’existence.
Et, vraiment, le progrès qui a été fait dans ce sens est admirable, bien que l’accoutumance nous ait tellement familiarisés avec ce phénomène qu’elle nous empêche de l’apercevoir. En effet, puisque les résultats du travail, et par suite les jouissances humaines, peuvent être si profondément modifiés par les événements, les circonstances imprévues, les caprices de la nature, l’incertitude des saisons et les sinistres de toute sorte, comment se fait-il qu’un si grand nombre d’hommes se trouvent affranchis pour un temps, et quelques-uns pour toute leur vie, par des salaires fixes, des rentes, des traitements, des pensions de retraite, de cette part d’éventualité qui semble être l’essence même de notre nature?
La cause efficiente, le moteur de cette belle évolution du genre humain, c’est la tendance de tous les hommes vers le bien-être, dont la Fixité est une partie si essentielle. Le moyen c’est le traité à forfait pour les chances appréciables, ou l’abandon graduel de cette forme primitive de l’association qui consiste à attacher irrévocablement tous les associés à toutes les chances de l’entreprise, — en d’autres termes, le perfectionnement de l’association. Il est au moins singulier que les grands réformateurs modernes nous montrent l’association comme brisée juste par l’élément qui la perfectionne.
Pour que certains hommes consentent à assumer sur eux-mêmes, à forfait, des risques qui incombent naturellement à d’autres, il faut qu’un certain genre de connaissances, que j’ai appelé statistique expérimentale, ait fait quelque progrès ; car il faut bien que l’expérience mette à même d’apprécier, au moins approximativement, ces risques, et par conséquent la valeur du service qu’on rend à celui qu’on en affranchit. C’est pourquoi les transactions et les associations des peuples grossiers et ignorants n’admettent pas de clauses de cette nature, et dès lors, ainsi que je le disais, l’aléatoire exerce sur eux tout son empire. Qu’un sauvage, déjà vieux, ayant quelque approvisionnement en gibier, prenne un jeune chasseur à son service, il ne lui donnera pas un salaire fixe, mais une part dans les prises. Comment, en effet, l’un et l’autre pourraient-ils statuer du connu sur l’inconnu? Les enseignements du passé n’existent pas pour eux au degré nécessaire pour permettre d’assurer l’avenir d’avance.
Dans les temps d’inexpérience et de barbarie, sans doute les hommes socient, s’associent, puisque, nous l’avons démontré, ils ne peuvent pas vivre sans cela ; mais l’association ne peut prendre chez eux que cette forme primitive, élémentaire, que les socialistes nous donnent comme la loi et le salut de l’avenir.
Plus tard, quand deux hommes ont longtemps travaillé ensemble à chances communes, il arrive un moment où, le risque pouvant être apprécié, l’un d’eux l’assume tout entier sur lui-même, moyennant une rétribution convenue.
Cet arrangement est certainement un progrès. Pour en être convaincu, il suffit de savoir qu’il se fait librement, du consentement des deux parties, ce qui n’arriverait pas s’il ne les accommodait toutes deux. Mais il est aisé de comprendre en quoi il est avantageux. L’une y gagne, en prenant tous les risques de l’entreprise, d’en avoir le gouvernement exclusif ; l’autre, d’arriver à cette fixité de position si précieuse aux hommes. Et quant à la société, en général, elle ne peut que se bien trouver de ce qu’une entreprise, autrefois tiraillée par deux intelligences et deux volontés, va désormais être soumise à l’unité de vues et d’action.
Mais, parce que l’association est modifiée, peut-on dire qu’elle est dissoute, alors que le concours de deux hommes persiste et qu’il n’y a de changé que le mode selon lequel le produit se partage? Peut-on dire surtout qu’elle s’est dépravée, alors que la novation est librement consentie et satisfait tout le monde?
Pour réaliser de nouveaux moyens de satisfaction, il faut presque toujours, je pourrais dire toujours, le concours d’un travail antérieur et d’un travail actuel. D’abord, en s’unissant dans une œuvre commune, le Capital et le Travail sont forcés de se soumettre, chacun pour sa part, aux risques de l’entreprise. Cela dure jusqu’à ce que ces risques puissent être expérimentalement appréciés. Alors deux tendances aussi naturelles l’une que l’autre au cœur humain se manifestent ; je veux parler des tendances à l’unité de direction et à la fixité de situation. Rien de plus simple que d’entendre le Capital dire au Travail : « L’expérience nous apprend que ton profit éventuel constitue pour toi une rétribution moyenne de tant. Si tu veux, je t’assurerai ce quantum et dirigerai l’opération, dont m’appartiendront les chances bonnes ou mauvaises. »
Il est possible que le Travail réponde : « Cette proposition m’arrange. Tantôt, dans une année, je ne gagne que 300 fr. ; une autre fois j’en gagne 900. Ces fluctuations m’importunent ; elles m’empêchent de régler uniformément mes dépenses et celles de ma famille. C’est un avantage pour moi de me soustraire à cet imprévu perpétuel et de recevoir une rétribution fixe de 600 fr. »
Sur celle réponse, les termes du contrat sont changés. On continuera bien d’unir ses efforts, d’en partager les produits, et par conséquent l’association ne sera pas dissoute ; mais elle sera modifiée, en ce sens que l’une des parties, le Capital, prendra la charge de tous les risques et la compensation de tous les profits extraordinaires, tandis que l’autre partie, le Travail, s’assurera les avantages de la fixité. Telle est l’origine du Salaire.
La convention peut s’établir en sens inverse. Souvent, c’est l’entrepreneur qui dit au capitaliste : « Nous avons travaillé à chances communes. Maintenant que ces chances nous sont plus connues, je te propose d’en traiter à forfait. Tu as 20,000 fr. dans l’entreprise, pour lesquels tu as reçu une année 500 fr., une autre 1,500 fr. Si tu y consens, je te donnerai 1,000 fr. par an, ou 5 pour 100, et je te dégagerai de tout risque, à condition que je gouvernerai l’œuvre comme je l’entendrai. »
Probablement, le capitaliste répondra : « Puisqu’à travers de grands et fâcheux écarts, je ne reçois pas, en moyenne, plus de 1,000 fr. par an, j’aime mieux que cette somme me soit régulièrement assurée. Ainsi je resterai dans l’association par mon capital, mais affranchi de toutes chances. Mon activité, mon intelligence peuvent désormais, avec plus de liberté, se livrer à d’autres soins. »
Au point de vue social, comme au point de vue individuel, c’est un avantage.
On le voit, il est au fond de l’humanité une aspiration vers un état stable, il se fait en elle un travail incessant pour restreindre et circonscrire de toute part l’aléatoire. Quand deux personnes participent à un risque commun, ce risque existant par lui-même ne peut être anéanti, mais il y a tendance à ce qu’une de ces deux personnes s’en charge à forfait. Si le capital le prend pour son compte, c’est le travail dont la rémunération se fixe sous le nom de salaire. Si le travail veut assumer les chances bonnes et mauvaises, alors c’est la rémunération du capital qui se dégage et se fixe sous le nom d’intérêt.
Et comme les capitaux ne sont autre chose que des services humains, on peut dire que capital et travail sont deux mots qui, au fond, expérimentent une idée commune ; par conséquent, il en est de même des mots intérêt et salaire. Là donc où la fausse science ne manque jamais de trouver des oppositions, la vraie science arrive toujours à l’identité.
Ainsi, considéré dans son origine, sa nature et sa forme, le salaire n’a en lui-même rien de dégradant, rien d’humiliant, pas plus que l’intérêt. L’un et l’autre sont la part revenant au travail actuel et au travail antérieur dans les résultats d’une entreprise commune. Seulement il arrive presque toujours, à la longue, que les deux associés traitent à forfait pour une de ces parts. Si c’est le travail actuel qui aspire à une rémunération uniforme, il cède sa part aléatoire contre un salaire. Si c’est le travail antérieur, il cède sa part éventuelle contre un intérêt.
Pour moi, je suis convaincu que cette stipulation nouvelle, intervenue postérieurement à l’association primitive, loin d’en être la dissolution, en est le perfectionnement. Je n’ai aucun doute à cet égard quand je considère qu’elle naît d’un besoin très-senti, d’un penchant naturel à tous les hommes vers la stabilité, et que, de plus, elle satisfait toutes les parties sans blesser, bien au contraire, en servant l’intérêt général.
Les réformateurs modernes qui, sous prétexte d’avoir inventé l’association, voudraient nous ramener à ses formes rudimentaires, devraient bien nous dire en quoi les traités à forfait blessent le droit ou l’équité ; comment ils nuisent au progrès, et en vertu de quel principe ils prétendent les interdire. Ils devraient aussi nous dire comment, si de telles stipulations sont empreintes de barbarie, ils en concilient l’intervention constante et progressive avec ce qu’ils proclament de la perfectibilité humaine.
À mes yeux, ces stipulations sont une des plus merveilleuses manifestations comme un des plus puissants ressorts du progrès. Elles sont à la fois le couronnement, la récompense d’une civilisation fort ancienne dans le passé, et le point de départ d’une civilisation illimitée dans l’avenir. Si la société s’en fût tenue à cette forme primitive de l’association qui attache aux risques de l’entreprise tous les intéressés, les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des transactions humaines n’auraient pu s’accomplir. Celui qui aujourd’hui participe à vingt entreprises aurait été enchaîné pour toujours à une seule. L’unité de vues et de volontés aurait fait défaut à toutes les opérations. Enfin, l’homme n’eût jamais goûté ce bien si précieux qui peut être la source du génie, — la stabilité.
C’est donc d’une tendance naturelle et indestructible qu’est né le salariat. Remarquons toutefois qu’il ne satisfait qu’imparfaitement à l’aspiration des hommes. Il rend plus uniforme, plus égale, plus rapprochée d’une moyenne la rémunération des ouvriers ; mais il est une chose qu’il ne peut pas faire, pas plus que n’y parviendrait d’ailleurs l’association des risques, c’est de leur assurer le travail.
Et ici je ne puis m’empêcher de faire remarquer combien est puissant le sentiment que j’invoque dans tout le cours de cet article, et, dont les modernes réformateurs ne semblent pas soupçonner l’existence : je veux parler de l’aversion pour l’incertitude. C’est précisément ce sentiment qui a rendu si difficile aux déclamateurs socialistes la tâche de faire prendre aux ouvriers le salaire en haine.
On peut concevoir trois degrés dans la condition de l’ouvrier : la prédominance de l’aléatoire ; la prédominance de la stabilité ; un état intermédiaire, d’où l’aléatoire en partie exclu ne laisse pas encore à la stabilité une place suffisante.
Ce que les ouvriers n’ont pas compris, c’est que l’association, telle que les socialistes la leur prêchent, c’est l’enfance de la société, la période des tâtonnements, l’époque des brusques écarts, des alternatives de pléthore et de marasme, en un mot, le règne absolu de l’aléatoire. Le salariat, au contraire, est ce degré intermédiaire qui sépare l’aléatoire de la stabilité.
Or les ouvriers ne se sentant pas encore, à beaucoup près, dans la stabilité, mettaient, comme tous les hommes soumis à un malaise, leurs espérances dans un changement quelconque de position. C’est pourquoi il a été très-facile au socialisme de leur en imposer avec le grand mot d’association. Les ouvriers se croyaient poussés en avant, quand, en réalité, ils étaient refoulés en arrière.
Oui, les malheureux étaient refoulés vers les premiers tâtonnements de l’évolution sociale : car l’association telle qu’on la leur prêchait, qu’est-ce autre chose que l’enchaînement de tous à tous les risques? — Combinaison fatale dans les temps d’ignorance absolue, puisque le traité à forfait suppose au moins un commencement de statistique expérimentale. — Qu’est-ce autre chose que la restauration pure et simple du règne de l’aléatoire?
Aussi les ouvriers qui s’étaient enthousiasmés pour l’association, tant qu’ils ne l’avaient aperçue qu’à l’état théorique, se sont-ils ravisés dès que la Révolution de Février a paru rendre la pratique possible.
À ce moment, beaucoup de patrons, soit qu’ils fussent sous l’influence de l’engouement universel, soit qu’ils cédassent à la peur, offrirent de substituer au salaire le compte en participation. Mais les ouvriers reculèrent devant cette solidarité des risques. Ils comprirent que ce qu’on leur offrait, pour le cas où l’entreprise serait en perte, c’était l’absence de toute rémunération sous une forme quelconque, c’était la mort.
On vit alors une chose qui ne serait pas honorable pour la classe ouvrière de notre pays, si le blâme ne devait pas être reporté aux prétendus réformateurs, en qui malheureusement elle avait mis sa confiance. On vit la classe ouvrière réclamer une association bâtarde où le salaire serait maintenu, et selon laquelle la participation aux profits n’entraînerait nullement la participation aux pertes.
Il est fort douteux que jamais les ouvriers eussent songé d’eux-mêmes à mettre en avant de telles prétentions. Il y a dans la nature humaine un fonds de bon sens et de justice qui répugne à l’iniquité évidente. Pour dépraver le cœur de l’homme, il faut commencer par fausser son esprit.
C’est ce que n’avaient pas manqué de faire les chefs de l’École socialiste, et, à ce point de vue, je me suis souvent demandé s’ils n’avaient pas des intentions perverses. L’intention est un asile que je suis toujours disposé à respecter ; cependant il est bien difficile d’exonérer complétement, en cette circonstance, celle des chefs socialistes.
Après avoir, par les déclamations aussi injustes que persévérantes dont leurs livres abondent, irrité contre les patrons la classe ouvrière ; après lui avoir persuadé qu’il s’agissait d’une guerre, et qu’en temps de guerre tout est permis contre l’ennemi ; ils ont, pour le faire passer, enveloppé l’ultimatum des ouvriers dans des subtilités scientifiques et même dans les nuages du mysticisme. Ils ont imaginé un être abstrait, la Société, devant à chacun de ses membres un minimum, c’est-à-dire des moyens d’existence assurés. « Vous avez donc le droit, ont-ils dit aux ouvriers, de réclamer un salaire fixe. » Par là ils ont commencé à satisfaire le penchant naturel des hommes vers la stabilité. Ensuite ils ont enseigné qu’indépendamment du salaire, l’ouvrier devait avoir une part dans les bénéfices ; et quand on leur a demandé s’il devait aussi supporter une part des pertes, ils ont répondu qu’au moyen de l’intervention de l’État et grâce à la garantie du contribuable, ils avaient imaginé un système d’industrie universelle à l’abri de toute perte. C’était le moyen de lever les derniers scrupules des malheureux ouvriers, qu’on vit, ainsi que je l’ai dit, à la révolution de Février, très-disposés à stipuler en leur faveur ces trois clauses :
1° Continuation du salaire,
2° Participation aux profits,
3° Affranchissement de toute participation aux pertes.
On dira peut-être que cette stipulation n’est ni si injuste ni si impossible qu’elle le paraît, puisqu’elle s’est introduite et maintenue dans beaucoup d’entreprises de journaux, de chemins de fer, etc.
Je réponds qu’il y a quelque chose de véritablement puéril à se duper soi-même, en donnant de très grands noms à de très petites choses ; avec un peu de bonne foi, on conviendra sans doute que cette répartition des profits, que quelques entreprises font aux ouvriers salariés, ne constitue pas l’association, n’en mérite pas le titre, et n’est pas une grande révolution survenue dans les rapports de deux classes sociales. C’est une gratification ingénieuse, un encouragement utile donné aux salariés, sous une forme qui n’est pas précisément nouvelle, bien qu’on veuille la faire passer pour une adhésion au socialisme. Les patrons qui, adoptant cet usage, consacrent un dixième, un vingtième, un centième de leurs profits, quand ils en ont, à cette largesse, peuvent en faire grand bruit et se proclamer les généreux rénovateurs de l’ordre social ; mais cela ne vaut réellement pas la peine de nous occuper. — Et je reviens à mon sujet.
Le Salariat fut donc un progrès. D’abord le travail antérieur et le travail actuel s’associèrent, à risques communs, pour des entreprises communes dont le cercle, sous une telle formule, dut être bien restreint. Si la Société n’avait pas trouvé d’autres combinaisons, jamais œuvre importante ne se fût exécutée dans le monde. L’humanité en serait restée à la chasse, à la pèche et à quelques ébauches d’agriculture.
Plus tard, obéissant à un double sentiment, celui qui nous fait aimer et rechercher la stabilité, celui qui nous porte à vouloir diriger les opérations dont nous courons les chances, les deux associés, sans rompre l’association, traitèrent à forfait du risque commun. Il fut convenu que l’une des parties donnerait à l’autre une rémunération fixe, et qu’elle assumerait sur elle-même tous les risques comme la direction de l’entreprise. Quand cette fixité échoit au travail antérieur, au capital, elle s’appelle Intérêt ; quand elle échoit au travail actuel, elle se nomme Salaire.
Mais, ainsi que je l’ai fait observer, le salaire n’atteint qu’imparfaitement le but de constituer, pour une certaine classe d’hommes, un état de stabilité ou de sécurité relativement aux moyens d’existence. C’est un degré, c’est un pas très-prononcé, très-difficile, qu’à l’origine on aurait pu croire impossible, vers la réalisation de ce bienfait ; mais ce n’est pas son entière réalisation.
Il n’est peut-être pas inutile de le dire en passant, la fixité des situations, la stabilité ressemble à tous les grands résultats que l’humanité poursuit. Elle en approche toujours, elle ne les atteindra jamais. Par cela seul que la stabilité est un bien, nous ferons toujours des efforts pour étendre de plus en plus parmi nous son empire ; mais il n’est pas dans notre nature d’en avoir jamais la possession complète. On peut même aller jusqu’à dire que cela n’est pas désirable, au moins pour l’homme tel qu’il est. En quelque genre que ce soit, le bien absolu serait la mort de tout désir, de tout effort, de toute combinaison, de toute pensée, de toute prévoyance, de toute vertu ; la perfection exclut la perfectibilité.
Les classes laborieuses s’étant donc élevées, par la suite des temps, et grâce au progrès de la civilisation, jusqu’au Salariat, ne se sont pas arrêtées là dans leurs efforts pour réaliser la stabilité.
Sans doute le salaire arrive avec certitude à la fin d’un jour occupé ; mais quand les circonstances, les crises industrielles ou simplement les maladies ont forcé les bras de chômer, le salaire chôme aussi, et alors l’ouvrier devrait-il soumettre au chômage son alimentation, celle de sa femme et de ses enfants?
Il n’y a qu’une ressource pour lui. C’est d’épargner, aux jours de travail, de quoi satisfaire aux besoins des jours de vieillesse et de maladie.
Mais qui peut d’avance, eu égard à l’individu, mesurer comparativement la période qui doit aider et celle qui doit être aidée?
Ce qui ne se peut pour l’individu devient plus praticable pour les masses, en vertu de la loi des grands nombres. Voilà pourquoi ce tribut, payé par les périodes de travail aux périodes de chômage, atteint son but avec beaucoup plus d’efficacité, de régularité, de certitude, quand il est centralisé par l’association que lorsqu’il est abandonné aux chances individuelles.
De là les sociétés de secours mutuels, institution admirable, née des entrailles de l’humanité longtemps avant le nom même de Socialisme. Il serait difficile de dire quel est l’inventeur de cette combinaison. Je crois que le véritable inventeur c’est le besoin, c’est cette aspiration des hommes vers la fixité, c’est cet instinct toujours inquiet, toujours agissant, qui nous porte à combler les lacunes que l’humanité rencontre dans sa marche vers la stabilité des conditions.
Toujours est-il que j’ai vu surgir spontanément des sociétés de secours mutuels, il y a plus de vingt-cinq ans, parmi les ouvriers et les artisans les plus dénués, dans les villages les plus pauvres du département des Landes.
Le but de ces sociétés est évidemment un nivellement général de satisfaction, une répartition sur toutes les époques de la vie des salaires gagnés dans les bons jours. Dans toutes les localités où elles existent, elles ont fait un bien immense. Les associés s’y sentent soutenus par le sentiment de la sécurité, un des plus précieux et des plus consolants qui puissent accompagner l’homme dans son pèlerinage ici-bas. De plus, ils sentent tous leur dépendance réciproque, l’utilité dont ils sont les uns pour les autres ; ils comprennent à quel point le bien et le mal de chaque individu ou de chaque profession deviennent le bien et le mal communs ; ils se rallient autour de quelques cérémonies religieuses prévues par leurs statuts ; enfin ils sont appelés à exercer les uns sur les autres cette surveillance vigilante, si propre à inspirer le respect de soi-même en même temps que le sentiment de la dignité humaine, ce premier et difficile échelon de toute civilisation.
Ce qui a fait jusqu’ici le succès de ces sociétés, — succès lent à la vérité comme tout ce qui concerne les masses, — c’est la liberté, et cela s’explique.
Leur écueil naturel est dans le déplacement de la Responsabilité. Ce n’est jamais sans créer pour l’avenir de grands dangers et de grandes difficultés qu’on soustrait l’individu aux conséquences de ses propres actes. [258] Le jour où tous les citoyens diraient : « Nous nous cotisons pour venir en aide à ceux qui ne peuvent travailler ou ne trouvent pas d’ouvrage, » il serait à craindre qu’on ne vît se développer, à un point dangereux, le penchant naturel de l’homme vers l’inertie, et que bientôt les laborieux ne fussent réduits à être les dupes des paresseux. Les secours mutuels impliquent donc une mutuelle surveillance, sans laquelle le fonds des secours serait bientôt épuisé. Cette surveillance réciproque, qui est pour l’association une garantie d’existence, pour chaque associé une certitude qu’il ne joue pas le rôle de dupe, fait en outre la vraie moralité de l’institution. Grâce à elle, on voit disparaître peu à peu l’ivrognerie et la débauche, car quel droit aurait au secours de la caisse commune un homme à qui l’on pourrait prouver qu’il s’est volontairement attiré la maladie et le chômage, par sa faute et par suite d’habitudes vicieuses? C’est cette surveillance qui rétablit la Responsabilité, dont l’association, par elle-même, tendait à affaiblir le ressort.
Or, pour que cette surveillance ait lieu et porte ses fruits, il faut que les sociétés de secours soient libres, circonscrites, maîtresses de leurs statuts comme de leurs fonds. Il faut qu’elles puissent faire plier leurs règlements aux exigences de chaque localité.
Supposez que le gouvernement intervienne. Il est aisé de deviner le rôle qu’il s’attribuera. Son premier soin sera de s’emparer de toutes ces caisses sous prétexte de les centraliser ; et, pour colorer cette entreprise, il promettra de les grossir avec des ressources prises sur le contribuable. [259] « Car, dira-t-il, n’est-il pas bien naturel et bien juste que l’État contribue à une œuvre si grande, si généreuse, si philanthropique, si humanitaire? » Première injustice : faire entrer de force dans la société, et par le côté des cotisations, des citoyens qui ne doivent pas concourir aux répartitions de secours. Ensuite, sous prétexte d’unité, de solidarité (que sais-je?), il s’avisera de fondre toutes les associations en une seule soumise a un règlement uniforme.
Mais, je le demande, que sera devenue la moralité de l’institution quand sa caisse sera alimentée par l’impôt ; quand nul, si ce n’est quelque bureaucrate, n’aura intérêt à défendre le fonds commun ; quand chacun, au lieu de se faire un devoir de prévenir les abus, se fera un plaisir de les favoriser ; quand aura cessé toute surveillance mutuelle, et que feindre une maladie ce ne sera autre chose que jouer un bon tour au gouvernement? Le gouvernement, il faut lui rendre cette justice, est enclin à se défendre ; mais, ne pouvant plus compter sur l’action privée, il faudra bien qu’il y substitue l’action officielle. Il nommera des vérificateurs, des contrôleurs, des inspecteurs. On verra des formalités sans nombre s’interposer entre le besoin et le secours. Bref, une admirable institution sera, dès sa naissance, transformée en une branche de police.
L’État n’apercevra d’abord que l’avantage d’augmenter la tourbe de ses créatures, de multiplier le nombre des places à donner, d’étendre son patronage et son influence électorale. Il ne remarquera pas qu’en s’arrogeant une nouvelle attribution, il vient d’assumer sur lui une responsabilité nouvelle, et, j’ose le dire, une responsabilité effrayante. Car bientôt qu’arrivera-t-il? Les ouvriers ne verront plus dans la caisse commune une propriété qu’ils administrent, qu’ils alimentent, et dont les limites bornent leurs droits. Peu à peu, ils s’accoutumeront à regarder le secours en cas de maladie ou de chômage, non comme provenant d’un fonds limité préparé par leur propre prévoyance, mais comme une dette de la Société. Ils n’admettront pas pour elle l’impossibilité de payer, et ne seront jamais contents des répartitions. L’État se verra contraint de demander sans cesse des subventions au budget. Là, rencontrant l’opposition des commissions de finances, il se trouvera engagé dans des difficultés inextricables. Les abus iront toujours croissant, et on en reculera le redressement d’année en année, comme c’est l’usage, jusqu’à ce que vienne le jour d’une explosion. Mais alors on s’apercevra qu’on est réduit à compter avec une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d’un ministre ou d’un préfet même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d’avoir perdu jusqu’à la notion du Droit, de la Propriété, de la Liberté et de la Justice.
Telles sont quelques-unes des raisons qui m’ont alarmé, je l’avoue, quand j’ai vu qu’une commission de l’assemblée législative était chargée de préparer un projet de loi sur les sociétés de secours mutuels. J’ai cru que l’heure de la destruction avait sonné pour elles, et je m’en affligeais d’autant plus qu’à mes yeux un grand avenir les attend, pourvu qu’on leur conserve l’air fortifiant de la liberté. Eh quoi ! est-il donc si difficile de laisser les hommes essayer, tâtonner, choisir, se tromper, se rectifier, apprendre, se concerter, gouverner leurs propriétés et leurs intérêts, agir pour eux-mêmes, à leurs périls et risques, sous leur propre responsabilité ; et ne voit-on pas que c’est ce qui les fait hommes? Partira-t-on toujours de cette fatale hypothèse, que tous les gouvernants sont des tuteurs et tous les gouvernés des pupilles?
Je dis que, laissées aux soins et à la vigilance des intéressés, les sociétés de secours mutuels ont devant elles un grand avenir, et je n’en veux pour preuve que ce qui se passe de l’autre côté de la Manche.
« En Angleterre la prévoyance individuelle n’a pas attendu l’impulsion du gouvernement pour organiser une assistance puissante et réciproque entre les deux classes laborieuses. Depuis longtemps, il s’est fondé dans les principales villes de la Grande-Bretagne des associations libres, s’administrant elles-mêmes, etc.
Le nombre total de ces associations, pour les trois royaumes, s’élève à 33,223, qui ne comprennent pas moins de trois millions cinquante deux mille individus. C’est la moitié de la population adulte de la Grande-Bretagne…
Cette grande confédération des classes laborieuses, cette institution de fraternité effective et pratique, repose sur les bases les plus solides. Leur revenu est de 125 millions, et leur capital accumulé atteint 280 millions.
C’est dans ce fonds que puisent tous les besoins quand le travail diminue ou s’arrête. On s’est étonné quelquefois de voir l’Angleterre résister au contrecoup des immenses et profondes perturbations qu’éprouve de temps en temps et presque périodiquement sa gigantesque industrie. L’explication de ce phénomène est, en grande partie, dans le fait que nous signalons.
M. Roebuck [260] voulait qu’à cause de la grandeur de la question, le gouvernement fît acte d’initiative et de tutelle en prenant lui-même cette question en main… Le chancelier de l’Échiquier s’y est refusé.
Là où les intérêts individuels suffisent à se gouverner librement eux-mêmes, le pouvoir, en Angleterre, juge inutile de faire intervenir son action. Il veille de haut à ce que tout se passe régulièrement ; mais il laisse à chacun le mérite de ses efforts et le soin d’administrer sa propre chose, selon ses vues et ses convenances. C’est à cette indépendance des citoyens que l’Angleterre doit certainement une partie de sa grandeur comme nation. [261] »
L’auteur aurait pu ajouter : C’est encore à cette indépendance que les citoyens doivent leur expérience et leur valeur personnelle. C’est à cette indépendance que le gouvernement doit son irresponsabilité relative, et par suite sa stabilité.
Parmi les institutions qui peuvent naître des sociétés de secours mutuels, quand celles-ci auront accompli l’évolution qu’elles commencent à peine, je mets au premier rang, à cause de son importance sociale, la caisse de retraite des travailleurs.
Il y a des personnes qui traitent une telle institution de chimère. Ces personnes, sans doute, ont la prétention de savoir où sont, en fait de Stabilité, les bornes qu’il n’est pas permis à l’Humanité de franchir. Je leur adresserai ces simples questions : Si elles n’avaient jamais connu que l’état social des peuplades qui vivent de chasse ou de pêche, auraient-elles pu prévoir, je ne dis pas les revenus fonciers, les rentes sur l’État, les traitements fixes, mais même le Salariat, ce premier degré de fixité dans la condition des classes les plus pauvres? Et plus tard, si elles n’avaient jamais vu que le salariat, tel qu’il existe dans les pays où ne s’est pas encore montré l’esprit d’association, auraient-elles osé prédire les destinées réservées aux sociétés de secours mutuels, telles que nous venons de les voir fonctionner en Angleterre? Ou bien ont-elles quelque bonne raison de croire qu’il était plus facile aux classes laborieuses de s’élever d’abord au salariat, puis aux sociétés de secours, que de parvenir aux caisses de retraite? Ce troisième pas serait-il plus infranchissable que les deux autres?
Pour moi, je vois que l’Humanité a soif de stabilité ; je vois que, de siècle en siècle, elle ajoute à ses conquêtes incomplètes, au profit d’une classe ou d’une autre, par des procédés merveilleux, qui semblent bien au-dessus de toute invention individuelle, et je n’oserais certes pas dire où elle s’arrêtera dans cette voie.
Ce qu’il y a de positif, c’est que la Caisse de retraite est l’aspiration universelle, unanime, énergique, ardente de tous les ouvriers ; et c’est bien naturel.
Je les ai souvent interrogés, et j’ai toujours reconnu que la grande douleur de leur vie ce n’est ni le poids du travail, ni la modicité du salaire, ni même le sentiment d’irritation que pourrait provoquer dans leur âme le spectacle de l’inégalité. Non ; ce qui les affecte, ce qui les décourage, ce qui les déchire, ce qui les crucifie, c’est l’incertitude de l’avenir. À quelque profession que nous appartenions, que nous soyons fonctionnaires, rentiers, propriétaires, négociants, médecins, avocats, militaires, magistrats, nous jouissons, sans nous en apercevoir, par conséquent sans en être reconnaissants, des progrès réalisés par la Société, au point de ne plus comprendre, pour ainsi dire, cette torture de l’incertitude. Mais mettons-nous à la place d’un ouvrier, d’un artisan que hante tous les matins, à son réveil, cette pensée :
« Je suis jeune et robuste ; je travaille, et même il me semble que j’ai moins de loisirs, que je répands plus de sueurs que la plupart de mes semblables. Cependant c’est à peine si je puis arriver à pourvoir à mes besoins, à ceux de ma femme et de mes enfants. Mais que deviendrai-je, que deviendront-ils, quand l’âge ou la maladie auront énervé mes bras? Il me faudrait un empire sur moi-même, une force, une prudence surhumaines pour épargner sur mon salaire de quoi faire face à ces jours de malheur. Encore, contre la maladie, j’ai la chance de jouer de bonheur ; et puis il y a des sociétés de secours mutuels. Mais la vieillesse n’est pas une éventualité ; elle arrivera fatalement. Tous les jours je sens son approche, elle va m’atteindre ; et alors, après une vie de probité et de labeur, quelle est la perspective que j’ai devant les yeux? L’hospice, la prison ou le grabat pour moi ; pour ma femme, la mendicité ; pour ma fille ; pis encore. Oh! que n’existe-t-il quelque institution sociale qui me ravisse, même de force, pendant ma jeunesse, de quoi assurer du pain à mes vieux jours! »
Il faut bien nous dire que cette pensée, que je viens d’exprimer faiblement, tourmente, au moment où j’écris, et tous les jours, et toutes les nuits, et à toute heure, l’imagination épouvantée d’un nombre immense de nos frères. — Et quand un problème se pose dans de telles conditions devant l’humanité, soyons-en bien assurés, c’est qu’il n’est pas insoluble.
Si, dans leurs efforts pour donner plus de stabilité à leur avenir, les ouvriers ont semé l’alarme parmi les autres classes de la société, c’est qu’ils ont donné à ces efforts une direction fausse, injuste, dangereuse. Leur première pensée, — c’est l’usage en France, — a été de faire irruption sur la fortune publique ; de fonder la caisse des retraites sur le produit des contributions ; de faire intervenir l’État ou la Loi, c’est-à-dire d’avoir tous les profits de la spoliation sans en avoir ni les dangers ni la honte.
Ce n’est pas de ce côté de l’horizon social que peut venir l’institution tant désirée par les ouvriers. La caisse de retraite, pour être utile, solide, louable, pour que son origine soit en harmonie avec sa fin, doit être le fruit de leurs efforts, de leur énergie, de leur sagacité, de leur expérience, de leur prévoyance. Elle doit être alimentée par leurs sacrifices ; elle doit croître arrosée de leurs sueurs. Ils n’ont rien a demander au gouvernement, si ce n’est liberté d’action et répression de toute fraude.
Mais le temps est-il arrivé où la fondation d’une caisse de retraite pour les travailleurs est possible? Je n’oserais l’affirmer ; j’avoue même que je ne le crois pas. Pour qu’une institution qui réalise un nouveau degré de stabilité en faveur d’une classe puisse s’établir, il faut qu’un certain progrès, qu’un certain degré de civilisation se soit réalisé dans le milieu social où cette institution aspire à la vie. Il faut qu’une atmosphère vitale lui soit préparée. Si je ne me trompe, c’est aux sociétés de secours mutuels, par les ressources matérielles qu’elles créeront, par l’esprit d’association, l’expérience, la prévoyance, le sentiment de la dignité qu’elles feront pénétrer dans les classes laborieuses, c’est, dis-je, aux sociétés de secours qu’il est réservé d’enfanter les caisses de retraite.
Car voyez ce qui se passe en Angleterre, et vous resterez convaincu que tout se lie, et qu’un progrès, pour être réalisable, veut être précédé d’un autre progrès.
En Angleterre, tous les adultes que cela intéresse sont successivement arrivés, sans contrainte, aux sociétés de secours, et c’est là un point très-important quand il s’agit d’opérations qui ne présentent quelque justesse que sur une grande échelle, en vertu de la loi des grands nombres.
Ces sociétés ont des capitaux immenses, et recueillent en outre tous les ans des revenus considérables.
Il est permis de croire, ou il faudrait nier la civilisation, que l’emploi de ces prodigieuses sommes à titre de secours se restreindra proportionnellement de plus en plus.
La salubrité est un des bienfaits que la civilisation développe. L’hygiène, l’art de guérir font quelque progrès ; les machines prennent à leur charge la partie la plus pénible du travail humain ; la longévité s’accroît. Sous tous ces rapports, les charges des associations de secours tendent à diminuer.
Ce qui est plus décisif et plus infaillible encore, c’est la disparition des grandes crises industrielles en Angleterre. Elles ont eu pour cause tantôt ces engouements subits, qui de temps en temps saisissent les Anglais, pour des entreprises plus que hasardées et qui entraînent une dissipation immense de capitaux ; tantôt les écarts de prix qu’avaient à subir les moyens de subsistance, sous l’action du régime restrictif : car il est bien clair que, quand le pain et la viande sont fort chers, toutes les ressources du peuple sont employées à s’en procurer, les autres consommations sont délaissées, et le chômage des fabriques devient inévitable.
La première de ces causes, on la voit succomber aujourd’hui sous les leçons de la discussion publique et sous les leçons plus rudes de l’expérience ; et l’on peut déjà prévoir que cette nation, qui se jetait naguère dans les emprunts américains, dans les mines du Mexique, dans les entreprises de chemins de fer avec une si moutonnière crédulité, sera beaucoup moins dupe que d’autres des illusions californiennes.
Que dirai-je du Libre Échange, dont le triomphe est dû à Cobden [38], non à Robert Peel ; car l’apôtre aurait toujours fait surgir un homme d’État, tandis que l’homme d’État ne pouvait se passer de l’apôtre? Voilà une puissance nouvelle dans le monde, et qui portera, j’espère, un rude coup à ce monstre qu’on nomme chômage. La restriction a pour tendance et pour effet (elle ne le nie pas) de placer plusieurs industries du pays, et par suite une partie de sa population, dans une situation précaire. Comme ces vagues amoncelées, qu’une force passagère tient momentanément au-dessus du niveau de la mer, aspirent incessamment à descendre, de même ces industries factices, environnées de toute part d’une concurrence victorieuse, menacent sans cesse de s’écrouler. Que faut-il pour déterminer leur chute? Une modification dans l’un des articles d’un des innombrables tarifs du monde. De là une crise. En outre, les variations de prix sur une denrée sont d’autant plus grandes que le cercle de la concurrence est plus étroit. Si l’on entourait de douanes un département, un arrondissement, une commune, on rendrait les fluctuations des prix considérables. La liberté agit sur le principe des assurances. Elle compense, pour les divers pays et pour les diverses années, les mauvaises récoltes par les bonnes. Elle maintient les prix rapprochés d’une moyenne ; elle est donc une force de nivellement et d’équilibre. Elle concourt à la stabilité ; donc elle combat l’instabilité, cette grande source des crises et des chômages. Il n’y a aucune exagération à dire que la première partie de l’œuvre de Cobden affaiblira beaucoup les dangers qui ont fait naître, en Angleterre, les sociétés de secours mutuels.
Cobden a entrepris une autre tâche (et elle réussira, parce que la vérité bien servie triomphe toujours) qui n’exercera pas moins d’influence sur la fixité du sort des travailleurs. Je veux parler de l’abolition de la guerre, ou plutôt (ce qui revient au même) de l’infusion de l’esprit de paix dans l’opinion qui décide de la paix et de la guerre. La guerre est toujours la plus grande des perturbations que puisse subir un peuple dans son industrie, dans le courant de ses affaires, la direction de ses capitaux, même jusque dans ses goûts. Par conséquent, c’est une cause puissante de dérangement, de malaise, pour les classes qui peuvent le moins changer la direction de leur travail. Plus cette cause s’affaiblira, moins seront onéreuses les charges des sociétés de secours mutuels.
Et d’un autre côté, par la force du progrès, par le seul bénéfice du temps, leurs ressources deviendront de plus en plus abondantes. Le moment arrivera donc où elles pourront entreprendre sur l’instabilité inhérente aux choses humaines, une nouvelle et décisive conquête, en se transformant, en s’instituant caisses de retraite ; et c’est ce qu’elles feront sans doute, puisque c’est là l’aspiration ardente et universelle des travailleurs.
Il est à remarquer qu’en même temps que les circonstances matérielles préparent cette création, les circonstances morales y sont aussi inclinées par l’influence même des sociétés de secours. Ces sociétés développent chez les ouvriers des habitudes, des qualités, des vertus dont la possession et la diffusion sont, pour les caisses de retraite, comme un préliminaire indispensable. Qu’on y regarde de près, on se convaincra que l’avénement de cette institution suppose une civilisation très-avancée. Il en doit être à la fois l’effet et la récompense. Comment serait-il possible, si les hommes n’avaient pas l’habitude de se voir, de se concerter, d’administrer des intérêts communs : ou bien, s’ils étaient livrés à des vices qui les rendraient vieux avant l’âge ; ou encore s’ils en étaient à penser que tout est permis contre le public et qu’un intérêt collectif est légitimement le point de mire de toutes les fraudes?
Pour que l’établissement des caisses de retraite ne soit pas un sujet de trouble et de discorde, il faut que les travailleurs comprennent bien qu’ils ne doivent en appeler qu’à eux-mêmes, que le fonds collectif doit être volontairement formé par ceux qui ont chance d’y prendre part ; qu’il est souverainement injuste et antisocial d’y faire concourir par l’impôt, c’est-à-dire par la force, les classes qui restent étrangères à la répartition. Or nous n’en sommes pas là, de beaucoup s’en faut, et les fréquentes invocations à l’État ne montrent que trop quelles sont les espérances et les prétentions des travailleurs. Ils pensent que leur caisse de retraite doit être alimentée par des subventions de l’État, comme l’est celle des fonctionnaires. C’est ainsi qu’un abus en provoque toujours un autre.
Mais si les caisses de retraite doivent être entretenues exclusivement par ceux qu’elles intéressent, ne peut-on pas dire qu’elles existent déjà, puisque les compagnies d’assurances sur la vie présentent des combinaisons qui permettent à tout ouvrier de faire profiter l’avenir de tous les sacrifices du présent?
Je me suis longuement étendu sur les sociétés de secours, et les caisses de retraite, encore que ces institutions ne se lient qu’indirectement au sujet de ce chapitre. J’ai cédé au désir de montrer l’Humanité marchant graduellement à la conquête de la stabilité, ou plutôt (car stabilité implique quelque chose de stationnaire) sortant victorieuse de sa lutte contre l’aléatoire ; l’aléatoire, cette menace incessante qui suffit à elle seule pour troubler toutes les jouissances de la vie ; cette épée de Damoclès qui semblait si inévitablement suspendue sur les destinées humaines. Que cette menace puisse être progressivement et indéfiniment écartée, par la réduction à une moyenne des chances de tous les temps, de tous les lieux et de tous les hommes, c’est certainement une des plus admirables harmonies sociales qui puissent s’offrir à la contemplation de l’économiste philosophe.
Et il ne faut pas croire que cette victoire dépende de deux institutions plus ou moins contingentes. Non ; l’expérience les montrerait impraticables, que l’Humanité n’en trouverait pas moins sa voie vers la fixité. Il suffit que l’incertitude soit un mal pour être assuré qu’il sera incessamment et, tôt ou tard, efficacement combattu, car telle est la loi de notre nature.
Si, comme nous l’avons vu, le salariat a été, au point de vue de la stabilité, une forme plus avancée de l’association entre le capital et le travail, il laisse encore une trop grande place à l’aléatoire. À la vérité, tant qu’il travaille, l’ouvrier sait sur quoi il peut compter. Mais jusqu’à quand aura-t-il de l’ouvrage, et pendant combien de temps aura-t-il la force de l’accomplir? Voilà ce qu’il ignore et ce qui met dans son avenir un affreux problème. L’incertitude du capitaliste est autre. Elle n’implique pas une question de vie et de mort. « Je tirerai toujours un intérêt de mes fonds ; mais cet intérêt sera-t-il plus ou moins élevé? » Telle est la question que se pose le travail antérieur.
Les philanthropes sentimentalistes, qui voient là une inégalité choquante, qu’ils voudraient faire disparaître par des moyens artificiels, et je pourrais dire injustes et violents, ne font pas attention qu’après tout on ne peut empêcher la nature des choses d’être la nature des choses. Il ne se peut pas que le travail antérieur n’ait pas plus de sécurité que le travail actuel, parce qu’il ne se peut pas que des produits créés n’offrent pas des ressources plus certaines que des produits à créer ; que des services déjà rendus, reçus et évalués ne présentent une base plus solide que des services encore à l’état d’offre. Si vous n’êtes pas surpris que, de deux pêcheurs, celui-là soit plus tranquille sur son avenir, qui, ayant travaillé et épargné depuis longtemps, possède lignes, filets, bateaux et approvisionnement de poisson, tandis que l’autre n’a absolument rien que la bonne volonté de pêcher, pourquoi vous étonnez-vous que l’ordre social manifeste, à un degré quelconque, les mêmes différences? Pour que l’envie, la jalousie, le simple dépit de l’ouvrier à l’égard du capitaliste fussent justifiables, il faudrait que la stabilité relative de l’un fut une des causes de l’instabilité de l’autre. Mais c’est le contraire qui est vrai, et c’est justement ce capital existant entre les mains d’un homme qui réalise pour un autre la garantie du salaire, quelque insuffisante qu’elle vous paraisse. Certes, sans le capital, l’aléatoire serait bien autrement imminent et rigoureux. Serait-ce un avantage pour les ouvriers que sa rigueur s’accrût, si elle devenait commune à tous, égale pour tous?
Deux hommes couraient des risques égaux, pour chacun, à 40. L’un fit si bien par son travail et sa prévoyance, qu’il réduisit à 10 les risques qui le regardaient. Ceux de son compagnon se trouvèrent, du même coup, et par suite d’une mystérieuse solidarité, réduits non pas à 10, mais à 20. Quoi de plus juste que l’un, celui qui avait le mérite, recueillît une plus grande part de la récompense? quoi de plus admirable que l’autre profitât des vertus de son frère? Eh bien! voilà ce que repousse la philanthropie sous prétexte qu’un tel ordre blesse l’égalité.
Le vieux pêcheur dit un jour à son camarade :
« Tu n’as ni barque, ni filets, ni d’autre instrument que tes mains pour pécher, et tu cours grand risque de faire une triste pêche. Tu n’as pas non plus d’approvisionnement, et cependant, pour travailler, il ne faut pas avoir l’estomac vide. Viens avec moi ; c’est ton intérêt comme le mien. C’est le tien, car je te céderai une part de notre pêche, et, quelle qu’elle soit, elle sera toujours plus avantageuse pour toi que le fruit de tes efforts isolés. C’est aussi le mien, car ce que je prendrai de plus, grâce à ton aide, dépassera la portion que j’aurai à te céder. En un mot, l’union de ton travail, du mien et de mon capital, comparativement à leur action isolée, nous vaudra un excédant, et c’est le partage de cet excédant qui explique comment l’association peut nous être à tous deux favorable. »
Cela fut fait ainsi. Plus tard le jeune pêcheur préféra recevoir, chaque jour, une quantité fixe de poisson. Son profit aléatoire fut ainsi converti en salaire, sans que les avantages de l’association fussent détruits, et, à plus forte raison, sans que l’association fût dissoute.
Et c’est dans de telles circonstances que la prétendue philanthropie des socialistes vient déclamer contre la tyrannie des barques et des filets, contre la situation naturellement moins incertaine de celui qui les possède, parce qu’il les a fabriqués précisément pour acquérir quelque certitude! C’est dans ces circonstances qu’elle s’efforce de persuader au pauvre dénué qu’il est victime de son arrangement volontaire avec le vieux pécheur, et qu’il doit se hâter de rentrer dans l’isolement!
Oui, l’avenir du capitaliste est moins chanceux que celui de l’ouvrier ; ce qui revient à dire que celui qui possède déjà est mieux que celui qui ne possède pas encore. Cela est ainsi et doit être ainsi, car c’est la raison pour laquelle chacun aspire à posséder.
Les hommes tendent donc à sortir du salariat pour devenir capitalistes. C’est la marche conforme à la nature du cœur humain. Quel travailleur ne désire avoir un outil à lui, des avances à lui, une boutique, un atelier, un champ, une maison à lui? Quel ouvrier n’aspire à devenir patron? Qui n’est heureux de commander après avoir longtemps obéi? Reste à savoir si les grandes lois du monde économique, si le jeu naturel des organes sociaux favorisent ou contrarient cette tendance. C’est la dernière question que nous examinerons à propos des salaires.
Et peut-il à cet égard exister quelque doute?
Qu’on se rappelle l’évolution nécessaire de la production : l’utilité gratuite se substituant incessamment à l’utilité onéreuse ; les efforts humains diminuant sans cesse pour chaque résultat, et, mis en disponibilité, s’attaquant à de nouvelles entreprises ; chaque heure de travail correspondant à une satisfaction toujours croissante. Comment de ces prémisses ne pas déduire l’accroissement progressif des effets utiles à répartir, par conséquent l’amélioration soutenue des travailleurs, et par conséquent encore une progression sans fin dans cette amélioration?
Car, ici, l’effet devenant cause, nous voyons le progrès non-seulement marcher, mais s’accélérer par la marche : vires acquirere eundo. En effet, de siècle en siècle, l’épargne devient plus facile, puisque la rémunération du travail devient plus féconde. Or l’épargne accroît les capitaux, provoque la demande des bras et détermine l’élévation des salaires. L’élévation des salaires, à son tour, facilite l’épargne et la transformation du salarié en capitaliste. Il y a donc entre la rémunération du travail et l’épargne une action et une réaction constantes, toujours favorables à la classe laborieuse, toujours appliquées à alléger pour elle le joug des nécessités urgentes.
On dira peut-être que je rassemble ici tout ce qui peut faire luire l’espérance aux yeux des prolétaires, et que je dissimule ce qui est de nature à les plonger dans le découragement. S’il y a des tendances vers l’égalité, me dira-t-on, il en est aussi vers l’inégalité. Pourquoi ne les analysez-vous pas toutes, afin d’expliquer la situation vraie du prolétariat, et de mettre ainsi la science d’accord avec les tristes faits qu’elle semble refuser de voir? Vous nous montrez l’utilité gratuite se substituant à l’utilité onéreuse, les dons de Dieu tombant de plus en plus dans le domaine de la communauté, et, par ce seul fait, le travail humain obtenant une récompense toujours croissante. De cet accroissement de rémunération vous déduisez une facilité croissante d’épargne ; de cette facilité d’épargne, un nouvel accroissement de rémunération amenant de nouvelles épargnes plus abondantes encore, et ainsi de suite à l’infini. Il se peut que ce système soit aussi logique qu’il est optimiste, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de lui opposer une réfutation scientifique. Mais où sont les faits qui le confirment? Où voit-on se réaliser l’affranchissement du prolétariat? Est-ce dans les grands centres manufacturiers? Est-ce parmi les manouvriers des campagnes? Et, si vos prévisions théoriques ne s’accomplissent pas, ne serait-ce point qu’à côté des lois économiques que vous invoquez, il y a d’autres lois, qui agissent en sens contraire, et dont vous ne parlez pas? Par exemple, pourquoi ne nous dites-vous rien de cette concurrence que les bras se font entre eux et qui les force de se louer au rabais ; de ce besoin urgent de vivre, qui presse le prolétaire et l’oblige à subir les conditions du capital, de telle sorte que c’est l’ouvrier le plus dénué, le plus affamé, le plus isolé, et par suite le moins exigeant, qui fixe pour tous le taux du salaire? Et si, à travers tant d’obstacles, la condition de nos malheureux frères vient cependant à s’adoucir, pourquoi ne nous montrez-vous pas la loi de la population venant interposer son action fatale, multiplier la multitude, raviver la concurrence, accroître l’offre des bras, donner gain de cause au capital, et réduire le prolétaire à ne recevoir, contre un travail de douze ou seize heures, que ce qui est indispensable (c’est le mot consacré) au maintien de l’existence?
Si je n’ai pas abordé toutes ces faces de la question, c’est qu’il n’est guère possible de tout accumuler dans un chapitre. J’ai déjà exposé la loi générale de la Concurrence, et on a pu voir qu’elle était loin de fournir à aucune classe, surtout à la moins heureuse, des motifs sérieux de découragement. Plus tard j’exposerai celle de la Population, et l’on s’assurera, j’espère, que dans ses effets généraux elle n’est pas impitoyable. Ce n’est pas ma faute si chaque grande solution, comme est, par exemple, la destinée future de toute une portion de l’humanité, résulte non d’une loi économique isolée, et, par suite, d’un chapitre de cet ouvrage, mais de l’ensemble de ces lois ou de l’ouvrage tout entier.
— Ensuite, et j’appelle l’attention du lecteur sur cette distinction, qui n’est certes pas une subtilité ; quand on est en présence d’un effet, il faut bien se garder de l’attribuer aux lois générales et providentielles, s’il provient au contraire de la violation de ces lois.
Je ne nie certes pas les calamités qui, sous toutes les formes, — labeur excessif, insuffisance de salaire, incertitude de l’avenir, sentiment d’infériorité, — frappent ceux de nos frères qui n’ont pu s’élever encore, par la Propriété, à une situation plus douce. Mais il faut bien reconnaître que l’incertitude, le dénûment et l’ignorance, c’est le point de départ de l’humanité tout entière. Cela étant ainsi, la question, ce me semble, est de savoir : 1° si les lois générales providentielles ne tendent pas à alléger, pour toutes les classes, ce triple joug ; 2° si les conquêtes accomplies par les classes les plus avancées ne sont pas une facilité préparée aux classes attardées. Que si la réponse à ces questions est affirmative, on peut dire que l’harmonie sociale est constatée, et que la Providence serait justifiée à nos yeux, si elle avait besoin de l’être.
Après cela, l’homme étant doué de volonté et de libre arbitre, il est certain que les bienfaisantes lois de la Providence ne lui profitent qu’autant qu’il s’y conforme ; et, quoique j’affirme sa nature perfectible, je n’entends certes pas dire qu’il progresse même alors qu’il méconnaît ou viole ces lois. Ainsi, je dis que les transactions mutuelles, libres, volontaires, exemptes de fraude et de violence, portent en elles-mêmes un principe progressif pour tout le monde. Mais ce n’est pas là affirmer que le progrès est inévitable et qu’il doit jaillir de la guerre, du monopole et de l’imposture. Je dis que le salaire tend à s’élever, que cette élévation facilite l’épargne, et que l’épargne, à son tour, élève le salaire. Mais si le salarié, par des habitudes de dissipation et de débauche, neutralise à l’origine cette cause d’effets progressifs, je ne dis pas que les effets se manifesteront de même, car le contraire est impliqué dans mon affirmation.
Pour soumettre à l’épreuve des faits la déduction scientifique, il faudrait prendre deux époques : par exemple 1750 et 1850.
Il faudrait d’abord constater quelle est, à ces deux époques, la proportion des prolétaires aux propriétaires. On trouverait, je le présume, que, depuis un siècle, le nombre des gens qui ont quelques avances s’est beaucoup accru, relativement au nombre de ceux qui n’en ont pas du tout.
Il faudrait ensuite établir la situation spécifique de chacune de ces deux classes, ce qui ne se peut qu’en observant leurs satisfactions. Très-probablement on trouverait que, de nos jours, elles tirent beaucoup plus de satisfactions réelles, l’une de son travail accumulé, l’autre de son travail actuel, que cela n’était possible sous la régence.
Si ce double progrès respectif et relatif n’a pas été ce que l’on pourrait désirer, surtout pour la classe ouvrière, il faut se demander s’il n’a pas été plus ou moins retardé par des erreurs, des injustices, des violences, des méprises, des passions, en un mot par la faute de l’Humanité, par des causes contingentes qu’on ne peut confondre avec ce que je nomme les grandes et constantes lois de l’économie sociale. Par exemple, n’y a-t-il pas eu des guerres et des révolutions qui auraient pu être évitées? Ces atrocités n’ont-elles pas absorbé d’abord, dissipé ensuite une masse incalculable de capitaux, par conséquent diminué le fonds des salaires et retardé pour beaucoup de familles de travailleurs l’heure de l’affranchissement? N’ont-elles pas en outre détourné le travail de son but, en lui demandant, non des satisfactions, mais des destructions ? N’y a-t-il pas eu des monopoles, des priviléges, des impôts mal répartis ? N’y a-t-il pas eu des consommations absurdes, des modes ridicules, des déperditions de force qu’on ne peut attribuer qu’à des sentiments et à des préjugés puérils ?
Et voyez quelles sont les conséquences de ces faits.
Il y a des lois générales auxquelles l’homme peut se conformer ou qu’il peut violer.
S’il est incontestable que les Français ont souvent contrarié, depuis cent ans, l’ordre naturel du développement social ; si l’on ne peut s’empêcher de rattacher à des guerres incessantes, à des révolutions périodiques, à des injustices, des priviléges, des dissipations, des folies de toutes sortes, une déperdition effrayante de forces, de capitaux et de travail ;
Et si, d’un autre côté, malgré ce premier fait bien manifeste, on a constaté un autre fait, à savoir que pendant cette même période de cent ans la classe propriétaire s’est recrutée dans la classe prolétaire, et qu’en même temps toutes deux ont à leur disposition plus de satisfactions respectives ; n’arrivons-nous pas rigoureusement à cette conclusion :
Les lois générales du monde social sont harmoniques, elles tendent dans tous les sens au perfectionnement de l’humanité.
Car enfin, puisque, après une période de cent ans, pendant laquelle elles ont été si fréquemment et si profondément violées, l’Humanité se trouve plus avancée, il faut que leur action soit bienfaisante, et même assez pour compenser encore l’action des causes perturbatrices.
Comment, d’ailleurs, en pourrait-il être autrement? N’y a-t-il pas une sorte d’équivoque ou plutôt de pléonasme sous ces expressions : Lois générales bienfaisantes ? Peuvent-elles ne pas l’être?… Quand Dieu a mis dans chaque homme une impulsion irrésistible vers le bien, et, pour le discerner, une lumière susceptible de se rectifier, dès cet instant il a été décidé que l’Humanité était perfectible et qu’à travers beaucoup de tâtonnements, d’erreurs, de déceptions, d’oppressions, d’oscillations, elle marcherait vers le mieux indéfini. Cette marche de l’Humanité, en tant que les erreurs, les déceptions, les oppressions en sont absentes, c’est justement ce qu’on appelle les lois générales de l’ordre social. Les erreurs, les oppressions, c’est ce que je nomme la violation de ces lois ou les causes perturbatrices. Il n’est donc pas possible que les unes ne soient bienfaisantes et les autres funestes, à moins qu’on n’aille jusqu’à mettre en doute si les causes perturbatrices ne peuvent agir d’une manière plus permanente que les lois générales. Or cela est contradictoire à ces prémisses : notre intelligence, qui peut se tromper, est susceptible de se rectifier. Il est clair que le monde social étant constitué comme il l’est, l’erreur rencontre tôt ou tard pour limite la Responsabilité, l’oppression se brise tôt ou tard à la Solidarité ; d’où il suit que les causes perturbatrices ne sont pas d’une nature permanente, et c’est pour cela que ce qu’elles troublent mérite le nom de lois générales.
Pour se conformer à des lois générales, il faut les connaître. Qu’il me soit donc permis d’insister sur les rapports, si mal compris, du capitaliste et du travailleur.
Le capital et le travail ne peuvent se passer l’un de l’autre. Perpétuellement en présence, leurs arrangements sont un des faits les plus importants et les plus intéressants que l’économiste puisse observer. Et qu’on y songe bien, des haines invétérées, des luttes ardentes, des crimes, des torrents de sang peuvent sortir d’une observation mal faite, si elle se popularise.
Or, je le dis avec la conviction la plus entière, on a saturé le public, depuis quelques années, des théories les plus fausses sur cette matière. On a professé que, des transactions libres du capital et du travail, il devait sortir, non pas accidentellement, mais nécessairement, le monopole pour le capitaliste, l’oppression pour le travailleur, d’où l’on n’a pas craint de conclure que la liberté devait être partout étouffée ; car, je le répète, quand on a accusé la liberté d’avoir engendré le monopole, on n’a pas seulement prétendu constater un fait, mais exprimer une Loi. À l’appui de cette thèse, on a invoqué l’action des machines et celle de la concurrence. M. de Sismondi, je crois, a été le fondateur, et M. Buret, le propagateur de ces tristes doctrines, bien que celui-ci n’ait conclu que fort timidement et que le premier n’ait pas osé conclure du tout. Mais d’autres sont venus qui ont été plus hardis. Après avoir soufflé la haine du capitalisme et du propriétarisme, après avoir fait accepter des masses comme un axiome incontestable cette découverte : La liberté conduit fatalement au monopole, ils ont, volontairement ou non, entraîné le peuple à mettre la main sur cette liberté maudite. [262] Quatre jours d’une lutte sanglante l’ont dégagée, mais non rassurée ; car ne voyons-nous pas, à chaque instant, la main de l’État, obéissant aux préjugés vulgaires, toujours prête à s’immiscer dans les rapports du capital et du travail?
L’action de la concurrence a déjà été déduite de notre théorie de la valeur. Nous ferons voir de même l’effet des machines. Ici nous devons nous borner à exposer quelques idées générales sur les rapports du capitaliste et du travailleur.
Le fait qui frappe d’abord beaucoup nos réformateurs pessimistes, c’est que les capitalistes sont plus riches que les ouvriers, qu’ils se procurent plus de satisfactions, d’où il résulte qu’ils s’adjugent une part plus grande, et par conséquent injuste, dans le produit élaboré en commun. C’est à quoi aboutissent les statistiques plus ou moins intelligentes, plus ou moins impartiales, dans lesquelles ils exposent la situation des classes ouvrières.
Ces messieurs oublient que la misère absolue est le point de départ fatal de tous les hommes, et qu’elle persiste fatalement tant qu’ils n’ont rien acquis ou que personne n’a rien acquis pour eux. Remarquer en bloc que les capitalistes sont mieux pourvus que les simples ouvriers, c’est constater simplement que ceux qui ont quelque chose ont plus que ceux qui n’ont rien.
Les questions que l’ouvrier doit se poser ne sont pas celles-ci :
« Mon travail me produit-il beaucoup? Me produit-il peu? Me produit-il autant qu’à un autre? Me produit-il ce que je voudrais? »
Mais bien celles-ci :
« Mon travail me produit-il moins parce que je l’ai mis au service du capitaliste? Me produirait-il plus, si je l’isolais, ou bien si je l’associais à celui d’autres travailleurs dénués comme moi? Je suis mal, mais serais-je mieux s’il n’y avait pas de capital au monde? Si la part que j’obtiens, par mon arrangement avec le capital, est plus grande que celle que j’obtiendrais sans cet arrangement, en quoi suis-je fondé à me plaindre? Et puis, selon quelles lois nos parts respectives vont-elles augmentant ou diminuant dans le cas des transactions libres? S’il est dans la nature de ces transactions de faire que, à mesure que le total à partager s’accroît, j’aie à prendre dans l’excédant une proportion toujours croissante (chapitre VII, page 249), au lieu de vouer haine au capital, n’ai-je pas à le traiter en bon frère? S’il est bien avéré que la présence du capital me favorise, et que son absence me ferait mourir, suis-je bien prudent et bien avisé quand je le calomnie, l’épouvante, le force à se dissiper ou à fuir? »
On allègue sans cesse que, dans le débat qui précède le traité, les situations ne sont pas égales, parce que le capital peut attendre et que le travail ne le peut pas. Le plus pressé, dit-on, est bien forcé de céder le premier, en sorte que le capitaliste fixe le taux du salaire.
Sans doute, en s’en tenant à la superficie des choses, celui qui s’est créé des approvisionnements, et qui à raison de sa prévoyance peut attendre, a l’avantage du marché. À ne considérer qu’une transaction isolée, celui qui dit : Do ut facias, n’est pas aussi pressé d’arriver à une conclusion que celui qui répond : Facio ut des. Car quand on peut dire, do, on possède et, quand on possède, on peut attendre.
Il ne faut pourtant pas perdre de vue que la valeur a le même principe dans le service que dans le produit. Si l’une des parties dit do, au lieu de facio, c’est qu’elle a eu la prévoyance d’exécuter le facio par anticipation. Au fond, c’est le service de part et d’autre qui mesure la valeur. Or, si pour le travail actuel tout retard est une souffrance, pour le travail antérieur il est une perte. Il ne faut donc pas croire que celui qui dit do, le capitaliste, s’amusera ensuite, surtout si l’on considère l’ensemble de ses transactions, à différer le marché. Au fait, voit-on beaucoup de capitaux oisifs pour cette cause? Sont-ils fort nombreux les manufacturiers qui arrêtent leur fabrication, les armateurs qui arrêtent leurs expéditions, les agriculteurs qui retardent leurs récoltes, uniquement pour déprécier le salaire, en prenant les ouvriers par la famine?
Mais, sans nier ici que la position du capitaliste à l’égard de l’ouvrier ne soit favorable sous ce rapport, n’y a-t-il rien autre chose à considérer dans leurs arrangements? Et, par exemple, n’est-ce pas une circonstance tout en faveur du travail actuel que le travail accumulé perde de sa valeur par la seule action du temps? J’ai déjà fait ailleurs allusion à ce phénomène. Cependant il importe de le soumettre ici de nouveau à l’attention des lecteurs, puisqu’il a une grande influence sur la rémunération du travail actuel.
Ce qui, selon moi, rend fausse ou du moins incomplète cette théorie de Smith, que la valeur vient du travail, c’est qu’elle n’assigne à la valeur qu’un élément, tandis qu’étant un rapport, elle en a nécessairement deux. En outre, si la valeur naissait uniquement du travail et le représentait, elle lui serait proportionnelle, ce qui est contraire à tous les faits.
Non, la valeur vient du service reçu et rendu ; et le service dépend autant, si ce n’est plus, de la peine épargnée à celui qui le reçoit que de la peine prise par celui qui le rend. À cet égard, les faits les plus usuels confirment le raisonnement. Quand j’achète un produit, je puis bien me demander : « Combien de temps a-t-on mis à le faire? » Et c’est là sans doute un des éléments de mon évaluation ; mais je me demande encore et surtout : « Combien de temps mettrais-je à le faire? Combien de temps ai-je mis à faire la chose qu’on me demande en échange? » Quand j’achète un service, je ne me demande pas seulement : Combien en coûtera-t-il à mon vendeur pour me le rendre? nais encore : Combien m’en coûtera-t-il pour me le rendre à moi-même?
Ces questions personnelles et les réponses qu’elles provoquent font tellement partie essentielle de l’évaluation, que le plus souvent elles la déterminent.
Marchandez un diamant trouvé par hasard. On vous cédera fort peu ou point de travail ; on vous en demandera beaucoup. Pourquoi donc donnerez-vous votre consentement? parce que vous prendrez en considération le travail qu’on vous épargne, celui que vous seriez obligé de subir pour satisfaire, par toute autre voie, le désir de posséder un diamant.
Quand donc le travail antérieur et le travail actuel s’échangent, ce n’est nullement sur le pied de leur intensité ou de leur durée, mais sur celui de leur valeur, c’est-à-dire du service qu’ils se rendent, de l’utilité dont ils sont l’un pour l’autre. Le capital viendrait dire : « Voici un produit qui m’a coûté autrefois dix heures de travail ; » si le travail actuel était en mesure de répondre : « Je puis faire le même produit en cinq heures ; » force serait au capital de subir cette différence : car, encore une fois, peu importe à l’acquéreur actuel de savoir ce que le produit a demandé jadis de labeur ; ce qui l’intéresse, c’est de connaître ce qu’il lui en épargne aujourd’hui, le service qu’il en attend.
Le capitaliste, au sens très général, est l’homme qui, ayant prévu que tel service serait demandé, l’a préparé d’avance et en a incorporé la mobile valeur dans un produit.
Quand le travail a été ainsi exécuté par anticipation, en vue d’une rémunération future, rien ne nous dit qu’à n’importe quel jour de l’avenir il rendra exactement le même service, épargnera la même peine, et conservera par conséquent une valeur uniforme. C’est même hors de toute vraisemblance. Il pourra être très-recherché, très-difficile à remplacer de toute autre manière, rendre des services mieux appréciés ou appréciés par plus de monde, acquérir une valeur croissante avec le temps, en d’autres termes, s’échanger contre une proportion toujours plus grande de travail actuel. Ainsi, il n’est pas impossible que tel produit, un diamant, un violon de Stradivarius, un tableau de Raphaël, un plant de vignes à Château-Lafitte, s’échange contre mille fois plus de journées de travail qu’il n’en a demandé. Cela ne veut pas dire autre chose, si ce n’est que le travail antérieur est bien rémunéré dans ce cas parce qu’il rend beaucoup de services.
Le contraire est possible aussi. Il se peut que ce qui avait exigé quatre heures de travail ne se vende plus que pour trois heures d’un travail de même intensité.
Mais, — et voici ce qui me paraît extrêmement important au point de vue et dans l’intérêt des classes ouvrières, de ces classes qui aspirent avec tant d’ardeur et de raison à sortir de l’état précaire qui les épouvante, — quoique les deux alternatives soient possibles et se réalisent tour à tour, quoique le travail accumulé puisse quelquefois gagner, quelquefois perdre de sa valeur relativement au travail actuel, cependant le premier cas est assez rare pour être considéré comme accidentel, exceptionnel, tandis que le second est le résultat d’une loi générale inhérente à l’organisation même de l’homme.
Que l’homme, avec ses acquisitions intellectuelles et expérimentales, soit de nature progressive, au moins industriellement parlant (car, au point de vue moral, l’assertion pourrait rencontrer des contradicteurs), cela n’est pas contestable. Que la plupart des choses qui se faisaient jadis avec un travail donné ne demandent plus aujourd’hui qu’un travail moindre, à cause du perfectionnement des machines, de l’intervention gratuite des forces naturelles, cela est certainement hors de doute ; et l’on peut affirmer, sans crainte de se tromper, qu’à chaque période de dix ans, par exemple, une quantité donnée de travail accomplira, dans la plupart des cas, de plus grands résultats que ne pouvait le faire la même quantité de travail à la période décennale précédente.
Et quelle est la conclusion à tirer de là? C’est que le travail antérieur va toujours se détériorant relativement au travail actuel ; c’est que dans l’échange, sans nulle injustice, et pour réaliser l’équivalence des services, il faut que le premier donne au second plus d’heures qu’il n’en reçoit. C’est là une conséquence forcée du progrès.
Vous me dites : « Voici une machine ; elle a dix ans de date, mais elle est encore neuve. Il en a coûté 1,000 journées de travail pour la faire. Je vous la cède contre un nombre égal de journées. » À quoi je réponds : Depuis dix ans, on a inventé de nouveaux outils, on a découvert de nouveaux procédés, si bien que je puis faire aujourd’hui, ou faire faire, ce qui revient au même, une machine semblable avec 600 journées ; donc, je ne vous en donnerai pas davantage. — « Mais je perdrai 400 journées. » — Non, car 6 journées d’aujourd’hui en valent 10 d’autrefois. En tout cas, ce que vous m’offrez pour 1,000, je puis me le procurer pour 600. Ceci finit le débat ; si le temps a frappé la valeur de votre travail de détérioration, pourquoi serait-ce à moi d’assumer cette perte?
Vous me dites : « Voilà un champ. Pour l’amener à l’état de productivité où il est, moi et mes ancêtres avons dépensé 1,000 journées. À la vérité, ils ne connaissaient ni hache, ni scie, ni bêche, et faisaient tout à force de bras. N’importe, donnez-moi d’abord 1,000 de vos journées, pour équivaloir aux 1,000 que je vous cède, puis ajoutez-en 300 pour la valeur de la puissance productive du sol, et prenez ma terre. » Je réponds : Je ne vous donnerai pas 1,300 ni même 1,000 journées, et voici mes motifs : Il y a sur la surface du globe une quantité indéfinie de puissances productives sans valeur. D’une autre part, on connaît aujourd’hui la bêche, la hache, la scie, la charrue et bien d’autres moyens d’abréger et féconder le travail ; de telle sorte qu’avec 600 journées je puis, soit mettre une terre inculte dans l’état où est la vôtre, soit (ce qui revient absolument au même pour moi) me procurer par l’échange tous les avantages que vous retirez de votre champ. Donc, je vous donnerai 600 journées et pas une heure en sus. — « En ce cas, non-seulement je ne bénéficie pas de la prétendue valeur des forces productives de cette terre, mais encore je ne rentre pas dans le nombre des journées effectives, par moi et mes ancêtres, consacrées à son amélioration. N’est-il pas étrange que je sois accusé par Ricardo de vendre les puissances de la nature ; par Senior, d’accaparer au passage les dons de Dieu ; par tous les économistes, d’être un monopoleur ; par Proudhon, d’être un voleur, alors que c’est moi qui suis dupe? » — Vous n’êtes pas plus dupe que monopoleur. Vous recevez l’équivalent de ce que vous donnez. Or il n’est ni naturel, ni juste, ni possible qu’un travail grossier, exécuté à la main il y a des siècles, s’échange, journée par journée, contre du travail actuel plus intelligent et plus productif.
Ainsi, on le voit, par un admirable effet du mécanisme social, quand le travail antérieur et le travail actuel sont en présence, quand il s’agit de savoir dans quelle proportion sera réparti entre eux le produit de leur collaboration, il est tenu compte à l’un et à l’autre de leur supériorité spécifique ; ils participent à cette distribution selon les services comparatifs qu’ils rendent. Or il peut bien arriver quelquefois, exceptionnellement, que cette supériorité soit du côté du travail antérieur. Mais la nature de l’homme, la loi du progrès font que, dans la presque universalité des cas, elle se manifeste dans le travail actuel. Le progrès profite a celui-ci ; la détérioration incombe au capital.
Indépendamment de ce résultat, qui montre combien sont vides et vaines les déclamations inspirées à nos réformateurs modernes par la prétendue tyrannie du capital, il est une considération plus propre encore à éteindre, dans le cœur des ouvriers, cette haine factice et désolante contre les autres classes, qu’on a tenté avec succès d’y allumer.
Cette considération, la voici :
Le capital, jusqu’où qu’il porte ses prétentions, et quelque heureux qu’il soit dans ses efforts pour les faire triompher, ne peut jamais placer le travail dans une condition pire que l’isolement. En d’autres termes, le capital favorise toujours plus le travail par sa présence que par son absence.
Rappelons-nous l’exemple que j’invoquais tout à l’heure.
Deux hommes sont réduits à pêcher pour vivre. L’un a des filets, des lignes, une barque et quelques provisions pour attendre les fruits de ses prochains travaux. L’autre n’a rien que ses bras. Il est de leur intérêt de s’associer. [263] Quelles que soient les conditions de partage qui interviendront, elles n’empireront jamais le sort de l’un de ces deux pêcheurs, pas plus du riche que du pauvre, car dès l’instant que l’un d’eux trouverait l’association onéreuse comparée à l’isolement, il reviendrait à l’isolement.
Dans la vie sauvage comme dans la vie pastorale, dans la vie agricole comme dans la vie industrielle, les relations du capital et du travail ne font que reproduire cet exemple.
Ainsi l’absence du capital est une limite qui est toujours à la disposition du travail. Si les prétentions du Capital allaient jusqu’à rendre, pour le Travail, l’action commune moins profitable que l’action isolée, celui-ci serait maître de se réfugier dans l’isolement, asile toujours ouvert (excepté sous l’esclavage) contre l’association volontaire et onéreuse ; car le travail peut toujours dire au capital : Aux conditions que tu m’offres, je préfère agir seul.
On objecte que ce refuge est illusoire et dérisoire, que l’action isolée est interdite au travail par une impossibilité radicale, et qu’il ne peut se passer d’instruments sous peine de mort.
Cela est vrai, mais confirme la vérité de mon assertion, à savoir : que le capital, parvînt-il à porter ses exigences jusqu’aux extrêmes limites, fait encore du bien au travail, par cela seul qu’il se l’associe. Le travail ne commence à entrer dans une condition pire que la pire association qu’au moment où l’association cesse, c’est-à-dire quand le capital se retire. Cessez donc, apôtres de malheur, de crier à la tyrannie du capital, puisque vous convenez que son action est toujours, — plus ou moins sans doute, mais toujours bienfaisante. Singulier tyran, dont la puissance est secourable à tous ceux qui en veulent ressentir l’effet, et n’est nuisible que par abstention!
Mais on insiste sur l’objection en disant : Cela pouvait être ainsi dans l’origine des sociétés. Aujourd’hui le capital a tout envahi ; il occupe tous les postes ; il s’est emparé de toutes les terres. Le prolétaire n’a plus ni air, ni espace, ni sol où mettre ses pieds, ni pierre où poser sa tête, sans la permission du capital. Il en subit donc la loi, vous ne lui donnez pour refuge que l’isolement, qui, vous en convenez, est la mort!
Il y a là une ignorance complète de l’économie sociale et une déplorable confusion.
Si, comme on le dit, le capital s’est emparé de toutes les forces de la nature, de toutes les terres, de tout l’espace, je demande au profit de qui. À son profit sans doute. Mais alors, comment se fait-il qu’un simple travailleur, qui n’a que ses bras, se procure, en France, en Angleterre, en Belgique, mille et un million de fois plus de satisfactions qu’il n’en recueillerait dans l’isolement, — non point dans l’hypothèse sociale qui vous révolte, mais dans cette autre hypothèse que vous chérissez, celle où le capital n’aurait encore rien usurpé?
Je tiendrai toujours le débat sur ce fait, jusqu’à ce que vous l’expliquiez avec votre nouvelle science, car, quant à moi, je crois en avoir donné la raison (chapitre VII).
Oui, prenez à Paris le premier ouvrier venu. Constatez ce qu’il gagne et les satisfactions qu’il se procure. Quand vous aurez bien déblatéré l’un et l’autre contre le maudit capital, j’interviendrai et dirai à cet ouvrier :
Nous allons détruire le capital et tout ce qu’il a créé. Je vais te mettre au milieu de cent millions d’hectares de la terre la plus fertile, que je te donnerai en toute propriété et jouissance, avec tout ce qu’elle contient dessus et dessous. Tu ne seras coudoyé par aucun capitaliste. Tu jouiras pleinement de tes quatre droits naturels, chasse, pêche, cueillette et pâture. Il est vrai que tu n’auras pas de capital ; car si tu en avais, tu serais précisément dans cette position que tu critiques chez les autres. Mais enfin tu n’auras plus à te plaindre du propriétarisme, du capitalisme, de l’individualisme, des usuriers, des agioteurs, des banquiers, des accapareurs, etc. La terre entière sera à toi. Vois si tu veux accepter cette position.
D’abord notre ouvrier rêvera le sort d’un monarque puissant. En y réfléchissant néanmoins, il est probable qu’il se dira : Calculons. Même quand on a cent millions d’hectares de bonne terre, encore faut-il vivre. Faisons donc le compte de pain, dans les deux situations.
Maintenant je gagne 3 francs par jour. Le blé étant à 15 francs, je puis avoir un hectolitre de blé tous les cinq jours. C’est comme si je le semais et récoltais moi-même.
Quand je serai propriétaire de cent millions d’hectares de terre, c’est tout au plus si je ferai, sans capital, un hectolitre de blé dans deux ans, et d’ici là, j’ai le temps de mourir de faim cent fois… Donc je m’en tiens à mon salaire.
Vraiment on ne médite pas assez sur le progrès que l’humanité a dû accomplir, même pour entretenir la chétive existence des ouvriers. [264] . . . . . . . . .
L’amélioration du sort des ouvriers se trouve dans le salaire même et dans les lois naturelles qui le régissent.
1° L’ouvrier tend à s’élever au rang d’entrepreneur capitaliste.
2° Le salaire tend à hausser.
Corollaire. — Le passage du salariat à l’entreprise devient toujours moins désirable et plus facile. . . . . . . . . . . .
XV. De l’Épargne↩
Épargner, ce n’est pas accumuler des quartiers de gibier, des grains de blé ou des pièces de monnaie. Cet entassement matériel d’objets fongibles, restreint par sa nature à des bornes fort étroites, ne représente l’épargne que pour l’homme isolé. Tout ce que nous avons dit jusqu’ici de la valeur, des services, de la richesse relative nous avertit que, socialement, l’épargne, quoique née de ce germe, prend d’autres développements et un autre caractère.
Épargner, c’est mettre volontairement un intervalle entre le moment où l’on rend des services à la société et celui où l’on en retire des services équivalents. Ainsi, par exemple, un homme peut tous les jours, depuis l’âge de vingt ans jusqu’à l’âge de soixante, rendre à ses semblables des services dépendant de sa profession, égaux à quatre, et ne leur demander que des services égaux à trois. En ce cas, il s’est donné la faculté de retirer du milieu social, dans sa vieillesse, quand il ne pourra plus travailler, le payement du quart de tout son travail de quarante ans.
La circonstance qu’il a reçu et successivement accumulé des titres de reconnaissance, consistant en lettres de change, billets à ordre, billets de banque, monnaies, est tout à fait secondaire et de forme. Elle n’a de rapport qu’aux moyens d’exécution. Elle ne peut changer la nature ni les effets de l’épargne. L’illusion que nous fait la monnaie à cet égard n’en est pas moins une illusion, encore que nous en soyons presque tous dupes.
En effet, difficilement nous pouvons nous défendre de croire que celui qui épargne retire une valeur de la circulation, et, par conséquent, porte à la société un certain préjudice.
Et là se rencontre une de ces contradictions apparentes qui rebutent la logique, une de ces impasses qui semblent opposer au progrès un obstacle infranchissable, une de ces dissonances qui contristent le cœur en paraissant accuser l’auteur des choses dans sa puissance ou dans sa volonté.
D’un côté, nous savons que l’humanité ne peut s’élargir, s’élever, se perfectionner, réaliser le loisir, la stabilité, par conséquent le développement intellectuel et la culture morale, que par l’abondante création et la persévérante accumulation des capitaux. C’est aussi de la multiplication rapide du capital que dépendent la demande des bras, l’élévation du salaire et par suite le progrès vers l’égalité.
Mais, d’autre part, épargner n’est-ce pas le contraire de dépenser, et si celui qui dépense provoque et active le travail, celui qui épargne ne fait-il pas l’opposé ? — Si chacun se prenait à économiser le plus possible, on verrait le travail languir en proportion, et il s’arrêterait entièrement si l’épargne pouvait être intégrale.
Que faut-il donc conseiller aux hommes ? Et quelle base certaine l’économie politique offre-t-elle à la morale, alors que nous n’en voyons sortir que cette alternative contradictoire et funeste :
« Si vous n’épargnez pas, le capital ne se reformera pas, il se dissipera ; les bras se multiplieront, mais le moyen de les payer restant stationnaire, ils se feront concurrence, ils s’offriront au rabais, le salaire se déprimera, et l’humanité sera par ce côté sur son déclin. Elle y sera aussi sous un autre aspect, car si vous n’épargnez pas, vous n’aurez pas de pain dans votre vieillesse, vous ne pourrez ouvrir une plus large carrière à votre fils, doter votre fille, agrandir vos entreprises, etc. »
« Si vous épargnez, vous diminuez le fonds des salaires, vous nuisez à un nombre immense de vos frères, vous portez atteinte au travail, ce créateur universel des satisfactions humaines ; vous abaissez par conséquent le niveau de l’humanité. »
Ces choquantes contradictions disparaissent devant l’explication que nous donnons de l’épargne, explication fondée sur les idées auxquelles nous ont conduit nos recherches sur la valeur.
Les services s’échangent contre les services.
La valeur est l’appréciation de deux services comparés.
D’après cela, épargner c’est avoir rendu un service, accorder du temps pour recevoir le service équivalent, ou, d’une manière plus générale, c’est mettre un laps de temps entre le service rendu et le service reçu.
Or en quoi celui qui s’abstient de retirer du milieu social un service auquel il a droit fait-il tort à la société ou nuit-il au travail ? Je ne retirerai la valeur qui m’est due que dans un an, quand je pourrais l’exiger sur l’heure. Je donne donc à la Société un an de répit. Pendant cet intervalle, le travail continue à s’exécuter, les services à s’échanger comme si je n’existais pas. Je n’y ai porté aucun trouble. Au contraire, j’ai ajouté une satisfaction à celles de mes semblables, et ils en jouissent gratuitement pendant un an.
Gratuitement n’est pas le mot, car il faut achever de décrire le phénomène.
Le laps de temps qui sépare les deux services échangés est lui-même matière à transaction comme à échange, car il a une valeur. C’est là l’origine et l’explication de l’intérêt.
En effet, un homme rend un service actuel. Sa volonté est de ne recevoir que dans dix ans le service équivalent. Voilà une valeur dont il se refuse la jouissance immédiate. Or le caractère de la valeur, c’est de pouvoir affecter toutes les formes possibles. Avec une valeur déterminée, on est sûr d’obtenir tout service imaginable d’une valeur égale, soit improductif, soit productif. Celui qui ajourne à dix ans la rentrée d’une créance, n’ajourne donc pas seulement une jouissance ; il ajourne la possibilité d’une production. C’est pour cela qu’il se rencontrera dans le monde des hommes disposés à traiter de cet ajournement. L’un d’eux dira à notre économe : « Vous avez droit à recevoir immédiatement une valeur, et il vous convient de ne la recevoir que dans dix ans. Eh bien ! pendant ces dix ans substituez-moi à votre droit, mettez-moi à votre lieu et place. Je toucherai pour vous la valeur dont vous êtes créancier ; je l’emploierai pendant dix ans sous une forme productive, et vous la restituerai à l’échéance. Par là vous me rendrez un service, et comme tout service a une valeur, qui s’apprécie en le comparant à un autre service, il ne reste plus qu’à estimer celui que je sollicite de vous, à en fixer la valeur. Ce point débattu et réglé, j’aurai à vous remettre, à l’échéance, non-seulement la valeur du service dont vous êtes créancier, mais encore la valeur du service que vous allez me rendre. »
C’est la valeur de cette cession temporaire de valeurs épargnées qu’on nomme intérêt.
Par la même raison qu’un tiers peut désirer qu’on lui cède, à titre onéreux, la jouissance d’une valeur épargnée, le débiteur originaire peut aussi solliciter la même transaction. Dans l’un et l’autre cas, cela s’appelle demander crédit. Accorder crédit, c’est donner du temps pour l’acquit d’une valeur, c’est se priver en faveur d’autrui de la jouissance de cette valeur, c’est rendre service, c’est acquérir des droits à un service équivalent.
Mais, pour en revenir aux effets économiques de l’épargne, maintenant que nous connaissons tous les détails de ce phénomène, il est bien évident qu’il ne porte aucune atteinte à l’activité générale, au travail humain. Alors même que celui qui réalise l’économie et qui, en échange des services rendus, reçoit des écus, alors même, dis-je, qu’il entasserait des écus les uns sur les autres, il ne ferait aucun tort à la société, puisqu’il n’a pu retirer de son sein ces valeurs qu’en y versant des valeurs équivalentes. J’ajoute que cet entassement est invraisemblable, exceptionnel, anormal, puisqu’il blesse l’intérêt personnel de ceux qui voudraient le pratiquer. Entre les mains d’un homme, les écus signifient : « Celui qui nous possède a rendu des services à la société et n’en a pas été payé. La société nous a remis entre ses mains pour lui servir de titre. Nous sommes à la fois une reconnaissance, une promesse et une garantie. Le jour où il voudra, il pourra, en nous exhibant et restituant, retirer du milieu social les services dont il est créancier. »
Or cet homme n’est pas pressé. Sensuit-il qu’il conservera ses écus ? Non, puisque, nous l’avons vu, le laps de temps qui sépare deux services échangés devient lui-même matière à transaction. Si notre économe a l’intention de rester dix ans sans retirer de la Société les services qui lui sont dus, son intérêt est de se substituer un représentant, afin d’ajouter à la valeur dont il est créancier la valeur de ce service spécial. — L’épargne n’implique donc en aucune façon entassement matériel.
Que les moralistes ne soient plus arrêtés par cette considération. . . . . . .
XVI. De la Population↩
Il me tardait d’aborder ce chapitre, ne fût-ce que pour venger Malthus des violentes attaques dont il a été l’objet. C’est une chose à peine croyable que des écrivains sans aucune portée, sans aucune valeur, d’une ignorance qu’ils étalent à chaque page, soient parvenus, à force de se répéter les uns les autres, à décrier dans l’opinion publique un auteur grave, consciencieux, philanthrope, et à faire passer pour absurde un système qui, tout au moins, mérite d’être étudié avec une sérieuse attention.
Il se peut que je ne partage pas en tout les idées de Malthus. Chaque question a deux faces, et je crois que Malthus a tenu ses regards trop exclusivement fixés sur le côté sombre. Pour moi, je l’avoue, dans mes études économiques, il m’est si souvent arrivé d’aboutir à cette conséquence : Dieu fait bien ce qu’il fait, que, lorsque la logique me mène à une conclusion différente, je ne puis m’empêcher de me défier de ma logique. Je sais que c’est un danger pour l’esprit que cette foi aux intentions finales. — Le lecteur pourra juger plus tard si mes préventions m’ont égaré. — Mais cela ne m’empêchera jamais de reconnaître qu’il y a énormément de vérité dans l’admirable ouvrage de cet économiste ; cela ne m’empêchera pas surtout de rendre hommage à cet ardent amour de l’humanité qui en anime toutes les lignes.
Malthus, qui connaissait à fond l’Économie sociale, avait la claire vue de tous les ingénieux ressorts dont la nature a pourvu l’humanité pour assurer sa marche dans la voie du progrès. En même temps, il croyait que le progrès humain pouvait se trouver entièrement paralysé par un principe, celui de la Population. En contemplant le monde, il se disait tristement : « Dieu semble avoir pris beaucoup de soin des espèces et fort peu des individus. En effet, de quelque classe d’êtres animés qu’il s’agisse, nous la voyons douée d’une fécondité si débordante, d’une puissance de multiplication si extraordinaire, d’une si surabondante profusion de germes, que la destinée de l’espèce paraît sans doute bien assurée, mais que celle des individus semble bien précaire ; car tous les germes ne peuvent être en possession de la vie : il faut qu’ils manquent à naître ou qu’ils meurent prématurément. »
« L’homme ne fait pas exception à cette loi. (Et il est surprenant que cela choque les socialistes, qui ne cessent de répéter que le droit général doit primer le droit individuel.) Il est positif que Dieu a assuré la conservation de l’humanité en la pourvoyant d’une grande puissance de reproduction. Le nombre des hommes arriverait donc naturellement à surpasser ce que le sol en peut nourrir, sans la prévoyance. Mais l’homme est prévoyant, et c’est sa raison, sa volonté qui seules peuvent mettre obstacle à cette progression fatale. »
Partant de ces prémisses, qu’on peut contester si l’on veut, mais que Malthus tenait pour incontestables, il devait nécessairement attacher le plus haut prix à l’exercice de la prévoyance. Car il n’y avait pas de milieu, il fallait que l’homme prévînt volontairement l’excessive multiplication, ou bien qu’il tombât, comme toutes les autres espèces, sous le coup des obstacles répressifs.
Malthus ne croyait donc jamais faire assez pour engager les hommes à la prévoyance ; plus il était philanthrope, plus il se sentait obligé de mettre en relief, afin de les faire éviter, les conséquences funestes d’une imprudente reproduction. Il disait : Si vous multipliez inconsidérément, vous ne pourrez vous soustraire au châtiment sous une forme quelconque et toujours hideuse : la famine, la guerre, la peste, etc… L’abnégation des riches, la charité, la justice des lois économiques ne seraient que des remèdes inefficaces.
Dans son ardeur, Malthus laissa échapper une phrase qui, séparée de tout son système et du sentiment qui l’avait dictée, pouvait paraître dure. C’était à la première édition de son livre, qui alors n’était qu’une brochure et depuis est devenu un ouvrage en quatre volumes. On lui fit observer que la forme donnée à sa pensée dans cette phrase pouvait être mal interprétée. Il se hâta de l’effacer, et elle n’a jamais reparu dans les éditions nombreuses du Traité de la population.
Mais un de ses antagonistes, M. Godwin, l’avait relevée. — Qu’est-il arrivé ? C’est que M. de Sismondi (un des hommes qui, avec les meilleures intentions du monde, ont fait le plus de mal) a reproduit cette phrase malencontreuse. Aussitôt tous les socialistes s’en sont emparés, et cela leur a suffi pour juger, condamner et exécuter Malthus. Certes ils ont à remercier Sismondi de son érudition ; car, quant à eux, ils n’ont jamais lu ni Malthus ni Godwin.
Les socialistes ont donc fait de la phrase retirée par Malthus lui-même la base de son système. Ils la répètent à satiété : dans un petit volume in-18, M. Pierre Leroux la reproduit au moins quarante fois ; elle défraye les déclamations de tous les réformateurs de deuxième ordre.
Le plus célèbre et le plus vigoureux de cette école ayant fait un chapitre contre Malthus, un jour que je causais avec lui, je lui citai des opinions exprimées dans le Traité de la population, et je crus m’apercevoir qu’il n’en avait aucune connaissance. Je lui dis : « Vous, qui avez réfuté Malthus, ne l’auriez-vous pas lu d’un bout à l’autre? » — « Je ne l’ai pas lu du tout, me répondit-il. Tout son système est renfermé dans une page et résumé par la fameuse progression arithmétique et géométrique : cela me suffit. » — « Apparemment, lui dis-je, vous vous moquez du public, de Malthus, de la vérité, de la conscience et de vous-même…. »
Voilà comment, en France, une opinion prévaut. Cinquante ignares répètent en chœur une méchanceté absurde mise en avant par un plus ignare qu’eux ; et, pour peu que cette méchanceté abonde dans le sens de la vogue et des passions du jour, elle devient un axiome.
La science, il faut pourtant le reconnaître, ne peut pas aborder un problème avec la volonté arrêtée d’arriver à une conclusion consolante. Que penserait-on d’un homme qui étudierait la physiologie, bien résolu d’avance à démontrer que Dieu n’a pas pu vouloir que l’homme fût affligé par la maladie ? Si un physiologiste bâtissait un système sur ces bases et qu’un autre se contentât de lui opposer des faits, il est assez probable que le premier se mettrait en colère, peut-être qu’il taxerait son confrère d’impiété ; — mais il est difficile de croire qu’il allât jusqu’à l’accuser d’être l’auteur des maladies.
C’est cependant ce qui est arrivé pour Malthus. Dans un ouvrage nourri de faits et de chiffres, il a exposé une loi qui contrarie beaucoup d’optimistes : Les hommes qui n’ont pas voulu admettre cette loi ont attaqué Malthus avec un acharnement haineux, avec une mauvaise foi flagrante, comme s’il avait lui-même et volontairement jeté devant le genre humain les obstacles qui, selon lui, découlent du principe de la population. — Il eut été plus scientifique de prouver simplement que Malthus se trompe et que sa prétendue loi n’en est pas une.
La population, il faut bien le dire, est un de ces sujets, fort nombreux du reste, qui nous rappellent que l’homme n’a guère que le choix des maux. Quelle qu’ait été l’intention de Dieu, la souffrance est entrée dans son plan. Ne cherchons pas l’harmonie dans l’absence du mal, mais dans son action pour nous ramener au bien et se restreindre lui-même progressivement. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il faut que nous apprenions, — ce qui est long et difficile, — et puis que nous agissions en conformité des lumières acquises, ce qui n’est guère plus aisé. À cette condition, nous nous affranchirons progressivement de la souffrance, mais sans jamais y échapper tout à fait ; car même quand nous parviendrions à éloigner le châtiment d’une manière complète, nous aurions à subir d’autant plus l’effort pénible de la prévoyance. Plus nous nous délivrons du mal de la répression, plus nous nous soumettons à celui de la prévention.
Il ne sert à rien de se révolter contre cet ordre de choses ; il nous enveloppe, il est notre atmosphère. C’est en restant dans cette donnée de la misère et de la grandeur humaines, dont nous ne nous écarterons jamais, que nous allons, avec Malthus, aborder le problème de la population. Sur cette grande question, nous ne serons d’abord que simple rapporteur, en quelque sorte : ensuite nous dirons notre manière de voir. Si les lois de la population peuvent se résumer en un court aphorisme, ce sera certes une circonstance heureuse pour l’avancement et la diffusion de la science. Mais si, à raison du nombre et de la mobilité des données du problème, nous trouvons que ces lois répugnent à se laisser renfermer dans une formule brève et rigoureuse, nous saurons y renoncer. L’exactitude même prolixe est préférable à une trompeuse concision.
Nous avons vu que le progrès consiste à faire concourir de plus en plus les forces naturelles à la satisfaction de nos besoins, de manière qu’à chaque nouvelle époque, la même somme d’utilité est obtenue en laissant à la Société — ou plus de loisirs — ou plus de travail à tourner vers l’acquisition de nouvelles jouissances.
D’un autre côté, nous avons démontré que chacune des conquêtes ainsi faites sur la nature, après avoir profité d’abord plus directement à quelques hommes d’initiative, ne tarde pas à devenir, par la loi de la concurrence, le patrimoine commun et gratuit de l’humanité tout entière.
D’après, ces prémisses, il semble que le bien-être des hommes aurait dû s’accroître et en même temps s’égaliser rapidement.
Il n’en a pas été ainsi pourtant ; c’est un point de fait incontestable. Il y a dans le monde une multitude de malheureux qui ne sont pas malheureux par leur faute.
Quelles sont les causes de ce phénomène ?
Je crois qu’il y en a plusieurs. L’une s’appelle spoliation, ou, si vous voulez, injustice. Les économistes n’en ont parlé qu’incidemment, et en tant qu’elle implique quelque erreur, quelque fausse notion scientifique. Exposant les lois générales, ils n’avaient pas, pensaient-ils, à s’occuper de l’effet de ces lois, quand elles n’agissent pas, quand elles sont violées. Cependant la spoliation a joué et joue encore un trop grand rôle dans le monde pour que, même comme économiste, nous puissions nous dispenser d’en tenir compte. Il ne s’agit pas seulement de vols accidentels, de larcins, de crimes isolés. — La guerre, l’esclavage, les impostures théocratiques, les priviléges, les monopoles, les restrictions, les abus de l’impôt, voilà les manifestations les plus saillantes de la spoliation. On comprend quelle influence des forces perturbatrices d’une aussi vaste étendue ont dû avoir et ont encore, par leur présence ou leurs traces profondes, sur l’inégalité des conditions ; nous essayerons plus tard d’en mesurer l’énorme portée.
Mais une autre cause qui a retardé le progrès, et surtout qui l’a empêché de s’étendre d’une manière égale sur tous les hommes, c’est, selon quelques auteurs, le principe de la population.
En effet, si, à mesure que la richesse s’accroît, le nombre des hommes entre lesquels elle se partage s’accroît aussi plus rapidement, la richesse absolue peut être plus grande et la richesse individuelle moindre.
Si, de plus, il y a un genre de services que tout le monde puisse rendre, comme ceux qui n’exigent qu’un effort musculaire, et si c’est précisément la classe à qui est dévolue cette fonction, la moins rétribuée de toutes, qui multiplie avec le plus de rapidité, le travail se fera à lui-même une concurrence fatale. Il y aura une dernière couche sociale qui ne profitera jamais du progrès, si elle s’étend plus vite qu’il ne peut se répandre.
On voit de quelle importance fondamentale est le principe de la population.
Ce principe a été formulé par Malthus en ces termes :
La population tend à se mettre au niveau des moyens de subsistance.
Je ferai observer en passant qu’il est surprenant qu’on ait attribué à Malthus l’honneur ou la responsabilité de cette loi vraie ou fausse. Il n’y a peut-être pas un publiciste, depuis Aristote, qui ne l’ait proclamée, et souvent dans les mêmes termes.
C’est qu’il ne faut que jeter un coup d’œil sur l’ensemble des êtres animés pour apercevoir, — sans conserver à cet égard le moindre doute, — que la nature s’est beaucoup plus préoccupée des espèces que des individus.
Les précautions qu’elle a prises pour la perpétuité des races sont prodigieuses, et parmi ces précautions figure la profusion des germes. Cette surabondance paraît calculée partout en raison inverse de la sensibilité, de l’intelligence et de la force avec laquelle chaque espèce résiste à la destruction.
Ainsi, dans le règne végétal, les moyens de reproduction par semences, boutures, etc., que peut fournir un seul individu, sont incalculables. Je ne serais pas étonné qu’un ormeau, si toutes les graines réussissaient, ne donnât naissance chaque année à un million d’arbres. Pourquoi cela n’arrive-t-il pas ? parce que toutes ces graines ne rencontrent pas les conditions qu’exige la vie : l’espace et l’aliment. Elles sont détruites ; et comme les plantes sont dépourvues de sensibilité, la nature n’a ménagé ni les moyens de reproduction ni ceux de destruction.
Les animaux dont la vie est presque végétative se reproduisent aussi en nombre immense. Qui ne s’est demandé quelquefois comment les huîtres pouvaient multiplier assez pour suffire à l’étonnante consommation qui s’en fait ?
À mesure qu’on s’avance dans l’échelle des êtres, on voit bien que la nature a accordé les moyens de reproduction avec plus de parcimonie.
Les animaux vertébrés ne peuvent pas multiplier aussi rapidement que les autres, surtout dans les grandes espèces. La vache porte neuf mois, ne donne naissance qu’à un petit à la fois, et doit le nourrir quelque temps. Cependant il est évident que, dans l’espèce bovine, la faculté reproductive surpasse ce qui serait absolument nécessaire. Dans les pays riches, comme l’Angleterre, la France, la Suisse, le nombre des animaux de cette race s’accroît, malgré l’énorme destruction qui s’en fait ; et si nous avions des prairies indéfinies, il n’est pas douteux que nous pourrions arriver tout à la fois à une destruction plus forte et à une reproduction plus rapide. Je mets en fait que, si l’espace et la nourriture ne faisaient pas défaut, nous pourrions avoir dans quelques années dix fois plus de bœufs et de vaches, quoiqu’en mangeant dix fois plus de viande. La faculté reproductive de l’espèce bovine est donc bien loin de nous avoir donné la mesure de toute sa puissance, abstraction faite de toute limite étrangère à elle-même et provenant du défaut d’espace et d’aliment.
Il est certain que la faculté de reproduction, dans l’espèce humaine, est moins puissante que dans toute autre ; et cela devait être. La destruction est un phénomène auquel l’homme ne devait pas être soumis au même degré que les animaux, dans les conditions supérieures de sensibilité, d’intelligence et de sympathie où la nature l’a placé. Mais échappe-t-il physiquement à cette loi, en vertu de laquelle toutes les espèces ont la faculté de multiplier plus que l’espace et l’aliment ne le permettent ? c’est ce qu’il est impossible de supposer.
Je dis physiquement, parce que je ne parle ici que de la loi physiologique.
Il existe une différence radicale entre la puissance physiologique de multiplier et la multiplication réelle.
L’une est la puissance absolue organique, dégagée de tout obstacle, de toute limitation étrangère. — L’autre est la résultante effective de cette force combinée avec l’ensemble de toutes les résistances qui la contiennent et la limitent. Ainsi la puissance de multiplication du pavot sera d’un million par an, peut-être, — et dans un champ de pavots la reproduction réelle sera stationnaire ; elle pourra même décroître.
C’est cette loi physiologique que Malthus a essayé de formuler. Il a recherché dans quelle période un certain nombre d’hommes pourrait doubler, si l’espace et l’aliment étaient toujours illimités devant eux.
On comprend d’avance que cette hypothèse de la satisfaction complète de tous les besoins n’étant jamais réalisée, la période théorique est nécessairement plus courte qu’aucune période observable de doublement réel.
L’observation, en effet, donne des nombres très-divers. D’après les recherches de M. Moreau de Jonnès, en prenant pour base le mouvement actuel de la population, le doublement exigerait — 555 ans en Turquie, — 227 en Suisse, — 138 en France, — 106 en Espagne, — 100 en Hollande, — 76 en Allemagne, — 43 en Russie et en Angleterre, — 25 aux États-Unis, en défalquant le contingent fourni par l’immigration.
Pourquoi ces différences énormes ? Nous n’avons aucune raison de croire qu’elles tiennent à des causes physiologiques. Les femmes suisses sont aussi bien constituées et aussi fécondes que les femmes américaines.
Il faut que la puissance génératrice absolue soit contenue par des obstacles étrangers. Et ce qui le prouve incontestablement, c’est qu’elle se manifeste aussitôt que quelque circonstance vient à écarter ces obstacles. Ainsi une agriculture perfectionnée, une industrie nouvelle, une source quelconque de richesses locales amène invariablement autour d’elle une génération plus nombreuse. Ainsi, lorsqu’un fléau comme la peste, la famine ou la guerre, détruit une grande partie de la population, on voit aussitôt la multiplication prendre un développement rapide.
Quand donc elle se ralentit ou s’arrête, c’est que l’espace et l’aliment lui manquent ou vont lui manquer ; c’est qu’elle se brise contre l’obstacle, ou que, le voyant devant elle, elle recule.
En vérité, ce phénomène, dont l’énoncé a excité tant de clameurs contre Malthus, me paraît hors de contestation.
Si l’on mettait un millier de souris dans une cage, avec ce qui est indispensable chaque jour pour les faire vivre, malgré la fécondité connue de l’espèce, leur nombre ne pourrait pas dépasser mille ; ou, s’il allait au delà, il y aurait privation et souffrance, deux choses qui tendent à réduire le nombre. En ce cas, certes, il serait vrai de dire qu’une cause extérieure limite non pas la puissance de fécondité, mais le résultat de la fécondité. Il y aurait certainement antagonisme entre la tendance physiologique et la force limitante d’où résulte la permanence du chiffre. La preuve, c’est que, si l’on augmentait graduellement la ration jusqu’à la doubler, on verrait très-promptement deux mille souris dans la cage.
Veut-on savoir ce qu’on répond à Malthus ? On lui oppose le fait. On lui dit : La preuve que la puissance de reproduction n’est pas indéfinie dans l’homme, c’est qu’en certains pays la population est stationnaire. Si la loi de progression était vraie, si la population doublait tous les vingt-cinq ans, la France, qui avait 30 millions d’habitants en 1820, en aurait aujourd’hui plus de 60 millions.
Est-ce là de la logique ?
Quoi ! je commence par constater moi-même que la population, en France, ne s’est accrue que d’un cinquième en vingt-cinq ans, tandis qu’elle a doublé ailleurs. J’en cherche la cause. Je la trouve dans le défaut d’espace et d’aliment. Je vois que, dans les conditions de culture, de population et de mœurs où nous sommes aujourd’hui, il y a difficulté de créer assez rapidement des subsistances pour que des générations virtuelles naissent, ou que, nées, elles subsistent. Je dis que les moyens d’existence ne peuvent pas doubler — ou au moins ne doublent pas — en France tous les vingt-cinq ans. C’est précisément l’ensemble de ces forces négatives qui contient, selon moi, la puissance physiologique ; — et vous m’opposez la lenteur de la multiplication pour en conclure que la puissance physiologique n’existe pas ! Une telle manière de discuter n’est pas sérieuse.
Est-ce avec plus de raison qu’on a contesté la progression géométrique indiquée par Malthus ? Jamais Malthus n’a posé cette inepte prémisse : « Les hommes multiplient, en fait, suivant une progression géométrique. » Il dit au contraire que le fait ne se manifeste pas, puisqu’il cherche quels sont les obstacles qui s’y opposent, et il ne donne cette progression que comme formule de la puissance organique de multiplication.
Recherchant en combien de temps une population donnée pourrait doubler, dans la supposition que la satisfaction de tous les besoins ne rencontrât jamais d’obstacles, il a fixé cette période à vingt-cinq ans. Il l’a fixée ainsi, parce que l’observation directe la lui avait révélée chez le peuple qui, bien qu’infiniment loin de son hypothèse, s’en rapproche le plus, — chez le peuple américain. Une fois cette période trouvée, et comme il s’agit toujours de la puissance virtuelle de propagation, il a dit que la population tendait à augmenter dans une progression géométrique.
On le nie. Mais, en vérité, c’est nier l’évidence. — On peut bien dire que la période de doublement ne serait pas partout de vingt-cinq ans ; qu’elle serait de 30, de 40, de 50 ; qu’elle varierait suivant les races. Tout cela est plus ou moins discutable ; mais, à coup sûr, on ne peut pas dire que, dans l’hypothèse, la progression ne serait pas géométrique. Si, en effet, cent couples en produisent deux cents pendant une période donnée, pourquoi deux cents n’en produiront-ils pas quatre cents dans un temps égal ?
— Parce que, dit-on, la multiplication sera contenue.
— C’est justement ce que dit Malthus.
Mais par quoi sera-t-elle contenue ?
Malthus assigne deux obstacles généraux à la multiplication indéfinie des hommes : il les appelle l’obstacle préventif et l’obstacle répressif.
La population ne pouvant être contenue au-dessous de sa tendance physiologique que par défaut de naissances ou accroissement de décès, il n’est pas douteux que la nomenclature de Malthus ne soit complète.
En outre, quand les conditions de l’espace et de l’aliment sont telles que la population ne peut dépasser un certain chiffre, il n’est pas douteux que l’obstacle destructif a d’autant plus d’action que l’obstacle préventif en a moins. Dire que les naissances peuvent progresser sans que les décès s’accroissent, quand l’aliment est stationnaire, c’est tomber dans une contradiction manifeste.
Il n’est pas moins évident, à priori, et indépendamment d’autres considérations économiques extrêmement graves, que dans cette situation l’abstention volontaire est préférable à la répression forcée.
Jusqu’ici donc, et sur tous les points, la théorie de Malthus est incontestable.
Peut-être Malthus a-t-il eu tort d’adopter comme limite de la fécondité humaine cette période de vingt-cinq ans, constatée aux États-Unis. Je sais bien qu’il a cru par là éviter tout reproche d’exagération ou d’abstraction. Comment osera-t-on prétendre, s’est-il dit, que je donne trop de latitude au possible, si je me fonde sur le réel ? Il n’a pas pris garde qu’en mêlant ici le virtuel, et le réel, et qu’en donnant pour mesure à la loi de multiplication, abstraction faite de la loi de limitation, une période résultant de faits régis par ces deux lois, il s’exposait à n’être pas compris. Et c’est ce qui est arrivé. On s’est moqué de ses progressions géométriques et arithmétiques ; on lui a reproché de prendre les États-Unis pour type du reste du monde ; en un mot, on s’est servi de la confusion qu’il a faite de deux lois distinctes pour lui contester l’une par l’autre.
Lorsqu’on cherche quelle est la puissance abstraite de propagation, il faut mettre pour un moment en oubli tout obstacle physique ou moral, provenant du défaut d’espace, d’aliments et de bien-être. Mais, la question une fois posée en ces termes, il est véritablement superflu de la résoudre avec exactitude. — Dans l’espèce humaine, comme dans tous les êtres organisés, cette puissance surpasse, dans une proportion énorme, tous les phénomènes de rapide multiplication que l’on a observés dans le passé, ou qui pourront se montrer dans l’avenir. — Pour le froment, en admettant cinq tiges par semence et vingt grains par tige, un grain a la puissance virtuelle d’en produire dix milliards en cinq années.
Pour l’espèce canine, en raisonnant sur ces deux bases, quatre produits par portée et six ans de fécondité, on trouvera qu’un couple peut donner naissance en douze ans à huit millions d’individus.
— Dans l’espèce humaine, en fixant la puberté à seize ans et la cessation de la fécondité à trente ans, chaque couple pourrait donner naissance à huit enfants. C’est beaucoup que de réduire ce nombre de moitié, à raison de la mortalité prématurée, puisque nous raisonnons dans l’hypothèse de tous les besoins satisfaits, ce qui restreint beaucoup l’empire de la mort. Toutefois ces prémisses nous donnent par période de vingt-quatre ans :
2 — 4 — 8 — 16 — 32 — 64 — 128 — 256 — 512, etc. ; enfin deux millions en deux siècles.
Si l’on calcule selon les bases adoptées par Euler, la période de doublement sera de douze ans et demi ; huit périodes feront justement un siècle, et l’accroissement dans cet espace de temps sera comme 512: 2.
À aucune époque, dans aucun pays, on n’a vu le nombre des hommes s’accroître avec cette effrayante rapidité. Selon la Genèse, les Hébreux entrèrent en Égypte, au nombre de soixante et dix couples ; on voit dans le livre des Nombres que le dénombrement fait par Moïse, deux siècles après, constate la présence de six cent mille hommes au-dessus de vingt et un ans, ce qui suppose une population de deux millions au moins. On peut en déduire le doublement par période de quatorze ans. — Les tables du Bureau des longitudes ne sont guère recevables à contrôler des faits bibliques. Dira-t-on que six cent mille combattants supposent une population supérieure à deux millions, et en conclura-t-on une période de doublement moindre que celle calculée par Euler ? — On sera le maître de révoquer en doute le dénombrement de Moïse ou les calculs d’Euler ; mais on ne prétendra pas assurément que les Hébreux ont multiplié plus qu’il n’est possible de multiplier. C’est tout ce que nous demandons.
Après cet exemple, qui est vraisemblablement celui où la fécondité de fait s’est le plus rapprochée de la fécondité virtuelle, nous avons celui des États-Unis. On sait que, dans ce pays, le doublement s’opère en moins de vingt-cinq ans.
Il est inutile de pousser plus loin ces recherches ; il suffit de reconnaître que, dans notre espèce, comme dans toutes, la puissance organique de multiplication est supérieure à la multiplication. D’ailleurs il implique contradiction que le réel dépasse le virtuel.
En regard de cette force absolue, qu’il n’est pas besoin de déterminer plus rigoureusement, et que l’on peut, sans inconvénient, considérer comme uniforme, il existe, avons-nous dit, une autre force qui limite, comprime, suspend, dans une certaine mesure, l’action de la première, et lui oppose des obstacles bien différents, suivant les temps et les lieux, les occupations, les mœurs, les lois ou la religion des différents peuples.
J’appelle loi de limitation cette seconde force, et il est clair que le mouvement de la population, dans chaque pays, dans chaque classe, est le résultat de l’action combinée de ces deux lois.
Mais en quoi consiste la loi de limitation ? On peut dire d’une manière très-générale, que la propagation de la vie est contenue ou prévenue par la difficulté d’entretenir la vie. Cette pensée, que nous avons déjà exprimée sous la formule de Malthus, il importe de l’approfondir. Elle constitue la partie essentielle de notre sujet. [265]
Les êtres organisés, qui ont vie et qui n’ont pas de sentiment, sont rigoureusement passifs dans cette lutte entre les deux principes. Pour les végétaux, il est exactement vrai que le nombre, dans chaque espèce, est limité par les moyens de subsistance. La profusion des germes est infinie, mais les ressources d’espace et de fertilité territoriale ne le sont pas. Les germes se nuisent, se détruisent entre eux ; ils avortent, et, en définitive, il n’en réussit qu’autant que le sol en peut nourrir. — Les animaux sont doués de sentiment, mais ils paraissent, en général, privés de prévoyance ; ils propagent, ils pullulent, ils foisonnent, sans se préoccuper du sort de leur postérité. La mort, une mort prématurée, peut seule borner leur multiplication, et maintenir l’équilibre entre leur nombre et leurs moyens d’existence.
Lorsque M. de Lamennais, s’adressant au peuple, dans son inimitable langage, dit :
« Il y a place pour tous sur la terre, et Dieu l’a rendue assez féconde pour fournir abondamment aux besoins de tous. » — Et plus loin: — « L’auteur de l’univers n’a pas fait l’homme de pire condition que les animaux ; tous ne sont-ils pas conviés au riche banquet de la nature ? un seul d’entre eux en est-il exclu ? » — Et encore : — « Les plantes des champs étendent l’une près de l’autre leurs racines dans le sol qui les nourrit toutes, et toutes y croissent en paix, aucune d’elles n’absorbe la séve d’une autre. »
Il est permis de ne voir là que des déclamations fallacieuses, servant de prémisses à de dangereuses conclusions, et de regretter qu’une éloquence si admirable soit consacrée à populariser la plus funeste des erreurs.
Certes, il n’est pas vrai qu’aucune plante ne dérobe la séve d’une autre, et que toutes étendent leurs racines sans se nuire dans le sol. Des milliards de germes végétaux tombent chaque année sur la terre, y puisent un commencement de vie, et succombent étouffés par des plantes plus fortes et plus vivaces. — Il n’est pas vrai que tous les animaux qui naissent soient conviés au banquet de la nature et qu’aucun d’eux n’en soit exclu. Parmi les espèces sauvages, ils se détruisent les uns les autres, et, dans les espèces domestiques, l’homme en retranche un nombre incalculable. — Rien même n’est plus propre à montrer l’existence et les relations de ces deux principes : celui de la multiplication et celui de la limitation. Pourquoi y a-t-il en France tant de bœufs et de moutons malgré le carnage qu’il s’en fait ? Pourquoi y a-t-il si peu d’ours et de loups, quoiqu’on en tue bien moins et qu’ils soient organisés pour multiplier bien davantage ? C’est que l’homme prépare aux uns et soustrait aux autres la subsistance ; il dispose à leur égard de la loi de limitation de manière à laisser plus ou moins de latitude à la loi de fécondité.
Ainsi, pour les végétaux comme pour les animaux, la force limitative ne paraît se montrer que sous une forme, la destruction. — Mais l’homme est doué de raison, de prévoyance ; et ce nouvel élément modifie, change même à son égard le mode d’action de cette force.
Sans doute, en tant qu’être pourvu d’organes matériels, et, pour trancher le mot, en tant qu’animal, la loi de limitation par voie de destruction lui est applicable. Il n’est pas possible que le nombre des hommes dépasse les moyens d’existence : cela voudrait dire qu’il existe plus d’hommes qu’il n’en peut exister, ce qui implique contradiction. Si donc la raison, la prévoyance sont assoupies en lui, il se fait végétal, il se fait brute ; alors il est fatal qu’il multiplie, en vertu de la grande loi physiologique qui domine toutes les espèces ; et il est fatal aussi qu’il soit détruit, en vertu de la loi limitative à l’action de laquelle il demeure, en ce cas, étranger.
Mais, s’il est prévoyant, cette seconde loi entre dans la sphère de sa volonté ; il la modifie, il la dirige ; elle n’est vraiment plus la même : ce n’est plus une force aveugle, c’est une force intelligente ; ce n’est plus seulement une loi naturelle, c’est de plus une loi sociale. — L’homme est le point où se rencontrent, se combinent et se confondent ces deux principes, la matière et l’intelligence ; il n’appartient exclusivement ni à l’un ni à l’autre. Donc la loi de limitation se manifeste, pour l’espèce humaine, sous deux influences, et maintient la population à un niveau nécessaire, par la double action de la prévoyance et de la destruction.
Ces deux actions n’ont pas une intensité uniforme ; au contraire, l’une s’étend à mesure que l’autre se restreint. Il y a un résultat qui doit être atteint, la limitation : il l’est plus ou moins par répression ou par prévention, selon que l’homme s’abrutit ou se spiritualise, selon qu’il est plus matière ou plus intelligence, selon qu’il participe davantage de la vie végétative ou de la vie morale ; la loi est plus ou moins hors de lui ou en lui, mais il faut toujours qu’elle soit quelque part.
On ne se fait pas une idée exacte du vaste domaine de la prévoyance, que le traducteur de Malthus a beaucoup circonscrit en mettant en circulation cette vague et insuffisante expression, contrainte morale, dont il a encore amoindri la portée par la définition qu’il en donne : « C’est la vertu, dit-il, qui consiste à ne point se marier quand on n’a pas de quoi faire subsister une famille, et toutefois à vivre dans la chasteté. » Les obstacles que l’intelligente société humaine oppose à la multiplication possible des hommes prennent bien d’autres formes que celle de la contrainte morale ainsi définie. Et par exemple, qu’est-ce que cette sainte ignorance du premier âge, la seule ignorance sans doute qu’il soit criminel de dissiper, que chacun respecte, et sur laquelle la mère craintive veille comme sur un trésor ? Qu’est-ce que la pudeur qui succède à l’ignorance, arme mystérieuse de la jeune fille, qui enchante et intimide l’amant, et prolonge, en l’embellissant, la saison des innocentes amours ? N’est-ce point une chose merveilleuse, et qui serait absurde en toute autre matière, que ce voile ainsi jeté d’abord entre l’ignorance et la vérité, et ces magiques obstacles placés ensuite entre la vérité et le bonheur ? Qu’est-ce que cette puissance de l’opinion qui impose des lois si sévères aux relations des personnes de sexe différent, flétrit la plus légère transgression de ces lois, et poursuit la faiblesse, et sur celle qui succombe, et, de génération en génération, sur ceux qui en sont les tristes fruits ? Qu’est-ce que cet honneur si délicat, cette rigide réserve, si généralement admirée même de ceux qui s’en affranchissent, ces institutions, ces difficultés de convenances, ces précautions de toutes sortes, si ce n’est l’action de la loi de limitation manifestée dans l’ordre intelligent, moral, préventif, et, par conséquent, exclusivement humain ?
Que ces barrières soient renversées, que l’espèce humaine, en ce qui concerne l’union des sexes, ne se préoccupe ni de convenances, ni de fortune, ni d’avenir, ni d’opinion, ni de mœurs, qu’elle se ravale à la condition des espèces végétales et animales : peut-on douter que, pour celles-là comme pour celles-ci, la puissance de multiplication n’agisse avec assez de force pour nécessiter bientôt l’intervention de la loi de limitation, manifestée cette fois dans l’ordre physique, brutal, répressif, c’est-à-dire par le ministère de l’indigence, de la maladie et de la mort ?
Est-il possible de nier que, abstraction faite de toute prévoyance et de toute moralité, il n’y ait assez d’attrait dans le rapprochement des sexes pour le déterminer, dans notre espèce comme dans toutes, dès la première apparition de la puberté ? Si on la fixe à seize ans, et si les actes de l’état civil prouvent qu’on ne se marie pas, dans un pays donné, avant vingt-quatre ans, ce sont donc huit années soustraites par la partie morale et préventive de la loi de limitation à l’action de la loi de la multiplication ; et, si l’on ajoute à ce chiffre ce qu’il faut attribuer au célibat absolu, on restera convaincu que l’humanité intelligente n’a pas été traitée par le Créateur comme l’animalité brutale, et qu’il est en sa puissance de transformer la limitation répressive en limitation préventive.
Il est assez singulier que l’école spiritualiste et l’école matérialiste aient, pour ainsi dire, changé de rôle dans cette grande question : la première, tonnant contre la prévoyance, s’efforce de faire prédominer le principe brutal ; la seconde, exaltant la partie morale de l’homme, recommande l’empire de la raison sur les passions et les appétits.
C’est qu’il y a en tout ceci un véritable malentendu. Qu’un père de famille consulte, pour la direction de sa maison, le prêtre le plus orthodoxe ; assurément il en recevra, pour le cas particulier, des conseils entièrement conformes aux idées que la science érige en principes, et que ce même prêtre repousse comme tels. « Cachez votre fille, dira le vieux prêtre ; dérobez-la le plus que vous pourrez aux séductions du monde ; cultivez, comme une fleur précieuse, la sainte ignorance, la céleste pudeur qui font à la lois son charme et sa défense. Attendez qu’un parti honnête et sortable se présente ; travaillez cependant, mettez-vous à même de lui assurer un sort convenable. Songez que le mariage, dans la pauvreté, entraîne beaucoup de souffrances et encore plus de dangers. Rappelez-vous ces vieux proverbes qui sont la sagesse des nations et qui nous avertissent que l’aisance est la plus sûre garantie de l’union et de la paix. Pourquoi vous presseriez-vous ? Voulez-vous qu’à vingt-cinq ans, votre fille soit chargée de famille, qu’elle ne puisse l’élever et l’instruire selon votre rang et votre condition ? Voulez-vous que le mari, incapable de surmonter l’insuffisance de son salaire, tombe d’abord dans l’affliction, puis dans le désespoir, et peut-être enfin dans le désordre ? Le projet qui vous occupe est le plus grave de tous ceux auxquels vous puissiez donner votre attention. Pesez-le, mûrissez-le ; gardez-vous de toute précipitation, etc. »
Supposez que le père, empruntant le langage de M. de Lamennais, répondît : « Dieu adressa dans l’origine ce commandement à tous les hommes : Croissez et multipliez, et remplissez la terre et subjuguez-la. Et vous, vous dites à une fille : Renonce à la famille, aux chastes douceurs du mariage ; aux saintes joies de la maternité ; abstiens-toi, vis seule ; que pourrais-tu multiplier que tes misères ? » — Croit-on que le vieux prêtre n’aurait rien à opposer à ce raisonnement ?
Dieu, dirait-il, n’a pas ordonné aux hommes de croître sans discernement et sans mesure, de s’unir comme les bêtes, sans nulle prévoyance de l’avenir ; il n’a pas donné la raison à sa créature de prédilection pour lui en interdire l’usage dans les circonstances les plus solennelles : il a bien ordonné à l’homme de croître, mais pour croître il faut vivre, et pour vivre il faut en avoir les moyens ; donc dans l’ordre de croître est impliqué celui de préparer aux jeunes générations des moyens d’existence. — La religion n’a pas mis la virginité au rang des crimes ; bien loin de là, elle en a fait une vertu, elle l’a honorée, sanctifiée et glorifiée ; il ne faut donc point croire qu’on viole le commandement de Dieu parce qu’on se prépare à le remplir avec prudence, en vue du bien, du bonheur et de la dignité de la famille. — Eh bien, ce raisonnement et d’autres semblables, dictés par l’expérience, que l’on entend répéter journellement dans le monde, et qui règlent la conduite de toute famille morale et éclairée, que sont-ils autre chose que l’application, dans des cas particuliers, d’une doctrine générale ? ou plutôt, qu’est-ce que cette doctrine, si ce n’est la généralisation d’un raisonnement qui revient dans tous les cas particuliers ? Le spiritualiste qui repousse, en principe, l’intervention de la limitation préventive, ressemble an physicien qui dirait aux hommes : « Agissez en toute rencontre comme si la pesanteur existait, mais n’admettez pas la pesanteur en théorie. »
Jusqu’ici nous ne nous sommes pas éloignés de la théorie malthusienne ; mais il est un attribut de l’humanité dont il me semble que la plupart des auteurs n’ont pas tenu un compte proportionné à son importance, qui joue un rôle immense dans les phénomènes relatifs à la population, qui résout plusieurs des problèmes que cette grande question a soulevés, et fait renaître dans l’âme du philanthrope une sérénité et une confiance que la science incomplète semblait en avoir bannies ; cet attribut compris, du reste, sous les notions de raison et prévoyance, c’est la perfectibilité. — L’homme est perfectible ; il est susceptible d’amélioration et de détérioration : si, à la rigueur, il peut demeurer stationnaire, il peut aussi monter et descendre les degrés infinis de la civilisation. Cela est vrai des individus, des familles, des nations et des races.
C’est pour n’avoir pas assez tenu compte de toute la puissance de ce principe progressif que Malthus a été conduit à des conséquences décourageantes, qui ont soulevé la répulsion générale.
Car, ne voyant l’obstacle préventif que sous une forme ascétique en quelque sorte, et peu acceptée, il faut en convenir, il ne pouvait pas lui attribuer beaucoup de force. Donc, selon lui, c’est en général l’obstacle répressif qui agit ; en d’autres termes, le vice, la misère, la guerre, le crime, etc.
Il y a là, selon moi, une erreur, et nous allons reconnaître que l’action de la force limitative se présente aux hommes non pas uniquement comme un effort de chasteté, un acte d’abnégation, mais encore et surtout comme une condition de bien-être, un mouvement instinctif qui les préserve de déchoir, eux et leur famille.
La population, a-t-on dit, tend à se mettre au niveau des moyens de subsistance. Je remarquerai qu’à cette expression, moyens de subsistance, autrefois universellement admise, J.-B. Say en a substitué une autre beaucoup plus correcte : moyens d’existence. Il semble d’abord que la subsistance soit seule engagée dans la question. Cela n’est pas ; l’homme ne vit pas seulement de pain, et l’étude des faits montre clairement que la population s’arrête ou est retardée lorsque l’ensemble de tous les moyens d’existence, y compris le vêtement, le logement et les autres choses que le climat ou même l’habitude rendent nécessaires, viennent à faire défaut.
Nous disons donc : La population tend à se mettre au niveau des moyens d’existence.
Mais ces moyens sont-ils une chose fixe, absolue, uniforme ? Non, certainement : à mesure que l’homme se civilise, le cercle de ses besoins s’étend, on peut le dire même de la simple subsistance. Considérés au point de vue de l’être perfectible, les moyens d’existence, en quoi il faut comprendre la satisfaction des besoins physiques, intellectuels et moraux, admettent autant de degrés qu’il y en a dans la civilisation elle-même, c’est-à-dire dans l’infini. Sans doute, il y a une limite inférieure : apaiser sa faim, se garantir d’un certain degré de froid, c’est une condition de la vie, et cette limite, nous pouvons l’apercevoir dans l’état des sauvages d’Amérique et des pauvres d’Europe ; mais une limite supérieure, je n’en connais pas, il n’y en a pas. Les besoins naturels satisfaits, il en naît d’autres, qui sont factices d’abord, si l’on veut, mais que l’habitude rend naturels à leur tour, et, après ceux-ci, d’autres encore, et encore, sans terme assignable.
Donc, à chaque pas de l’homme dans la voie de la civilisation, ses besoins embrassent un cercle plus étendu, et les moyens d’existence, ce point où se rencontrent les deux grandes lois de multiplication et de limitation, se déplace pour s’exhausser. — Car, quoique l’homme soit susceptible de détérioration aussi bien que de perfectionnement, il répugne à l’une et aspire à l’autre : ses efforts tendent à le maintenir au rang qu’il a conquis, à l’élever encore ; et l’habitude, qu’on a si bien nommée une seconde nature, faisant les fonctions des valvules de notre système artériel, met obstacle à tout pas rétrograde. Il est donc tout simple que l’action intelligente et morale qu’il exerce sur sa propre multiplication se ressente, s’imprègne, s’inspire de ces efforts et se combine avec ces habitudes progressives.
Les conséquences qui résultent de cette organisation de l’homme se présentent en foule : nous nous bornerons à en indiquer quelques-unes. — D’abord nous admettrons bien avec les économistes que la population et les moyens d’existence se font équilibre ; mais le dernier de ces termes étant d’une mobilité infinie, et variant avec la civilisation et les habitudes, nous ne pourrions pas admettre qu’en comparant les peuples et les classes, la population soit proportionnelle à la production, comme dit J.-B. Say, [266] ou aux revenus, comme l’affirme M. de Sismondi. — Ensuite, chaque degré supérieur de culture impliquant plus de prévoyance, l’obstacle moral et préventif doit neutraliser de plus en plus l’action de l’obstacle brutal et répressif, à chaque phase de perfectionnement réalisé dans la société ou dans quelques-unes de ses fractions. — Il suit de là que tout progrès social contient le germe d’un progrès nouveau, vires acquirit eundo, puisque le mieux-être et la prévoyance s’engendrent l’un l’autre dans une succession indéfinie. — De même, quand, par quelque cause, l’humanité suit un mouvement rétrograde, le malaise et l’imprévoyance sont entre eux cause et effet réciproques, et la déchéance n’aurait pas de terme, si la société n’était pas pourvue de cette force curative, vis medicatrix, que la Providence a placée dans tous les corps organisés. Remarquons, en effet, qu’à chaque période dans la déchéance, l’action de la limitation dans son mode destructif devient à la fois plus douloureuse et plus facile à discerner. D’abord il ne s’agit que de détérioration, d’abaissement ; ensuite c’est la misère, la famine, le désordre, la guerre, la mort ; tristes mais infaillibles moyens d’enseignement.
Nous voudrions pouvoir nous arrêter à montrer combien ici la théorie explique les faits, combien, à leur tour, les faits justifient la théorie. Lorsque, pour un peuple ou une classe, les moyens d’existence sont descendus à cette limite inférieure où ils se confondent avec les moyens de pure subsistance, comme en Chine, en Irlande et dans les dernières classes de tous pays, les moindres oscillations de population ou de ressources alimentaires se traduisent en mortalité ; les faits confirment à cet égard l’induction scientifique. — Depuis longtemps, la famine ne visite plus l’Europe, et l’on attribue la destruction de ce fléau à une multitude de causes. Il y en a plusieurs sans doute, mais la plus générale c’est que les moyens d’existence se sont, par suite du progrès social, exhaussés fort au-dessus des moyens de subsistance. Quand viennent des années disetteuses, on peut sacrifier beaucoup de satisfactions avant d’entreprendre sur les aliments eux-mêmes. — Il n’en est pas ainsi en Chine et en Irlande : quand les hommes n’ont rien au monde qu’un peu de riz ou de pommes de terre, avec quoi achèteront-ils d’autres aliments, si ce riz et ces pommes de terre viennent à manquer ?
Enfin il est une troisième conséquence de la perfectibilité humaine, que nous devons signaler ici, parce qu’elle contredit, en ce qu’elle a de désolant, la doctrine de Malthus. — Nous avons attribué à cet économiste cette formule : — « La population tend à se mettre au niveau des moyens de subsistance. » — Nous aurions dû dire qu’il était allé fort au delà, et que sa véritable formule, celle dont il a tiré des conclusions si affligeantes, est celle-ci : — La population tend à dépasser les moyens de subsistance. — Si Malthus avait simplement voulu exprimer par là que, dans la race humaine, la puissance de propager la vie est supérieure à la puissance de l’entretenir, il n’y aurait pas de contestation possible. Mais ce n’est pas là, sa pensée : il affirme que, prenant en considération la fécondité absolue, d’une part, de l’autre, la limitation manifestée par ses deux modes, répressif et préventif, le résultat n’en est pas moins la tendance de la population à dépasser les moyens de vivre. [267] — Cela est vrai de toutes les espèces animées, excepté de l’espèce humaine. L’homme est intelligent, et peut faire de la limitation préventive un usage illimité. Il est perfectible, il aspire au perfectionnement, il répugne à la détérioration ; le progrès est son état normal ; le progrès implique un usage de plus en plus éclairé de la limitation préventive : donc les moyens d’existence s’accroissent plus vite que la population. Non-seulement ce résultat dérive du principe de la perfectibilité, mais encore il est confirmé par le fait, puisque partout le cercle des satisfactions s’est étendu. — S’il était vrai, comme le dit Malthus, qu’à chaque excédant de moyens d’existence corresponde un excédant supérieur de population, la misère de notre race serait fatalement progressive, la civilisation serait à l’origine, et la barbarie à la fin des temps. Le contraire a lieu ; donc la loi de limitation a eu assez de puissance pour contenir le flot de la multiplication des hommes au-dessous de la multiplication des produits.
On voit par ce qui précède combien est vaste et difficile la question de la population. Il est à regretter sans doute que l’on n’en ait pas donné la formule exacte, et naturellement je regrette encore plus de ne pouvoir la donner moi-même. Mais ne voit-on pas combien le sujet répugne aux étroites limites d’un axiome dogmatique ? Et n’est-ce point une vaine tentative que de vouloir exprimer par une équation inflexible les rapports de données essentiellement variables ? — Rappelons ces données.
1° Loi de multiplication. Puissance absolue, virtuelle, physiologique, qui est en la race humaine de propager la vie, abstraction faite de la difficulté de l’entretenir. — Cette première donnée, la seule susceptible de quelque précision, est la seule où la précision soit superflue ; car qu’importe où est cette limite supérieure de multiplication dans l’hypothèse, si elle ne peut jamais être atteinte dans la condition réelle de l’homme, qui est d’entretenir la vie à la sueur de son front ?
2° Il y a donc une limite à la loi de multiplication. Quelle est cette limite ? Les moyens d’existence, dit-on. Mais qu’est-ce que les moyens d’existence ? C’est un ensemble de satisfactions insaisissable. Elles varient, et, par conséquent, déplacent la limite cherchée, selon les lieux, les temps, les races, les rangs, les mœurs, l’opinion et les habitudes.
3° Enfin, en quoi consiste la force qui restreint la population à cette borne mobile ? Elle se décompose en deux pour l’homme : celle qui réprime, et celle qui prévient. Or l’action de la première, inaccessible par elle-même à toute appréciation rigoureuse, est, de plus, entièrement subordonnée à l’action de la seconde, qui dépend du degré de civilisation, de la puissance des habitudes, de la tendance des institutions religieuses et politiques, de l’organisation de la propriété, du travail et de la famille, etc., etc. — Il n’est donc pas possible d’établir entre la loi de multiplication et la loi de limitation une équation dont on puisse déduire la population réelle. En algèbre, a et b représentent des quantités déterminées qui se nombrent, se mesurent, et dont on peut fixer les proportions ; mais moyens d’existence, empire moral de la volonté, action fatale de la mortalité, ce sont là trois données du problème de la population, des données flexibles en elles-mêmes, et qui, en outre, empruntent quelque chose à l’étonnante flexibilité du sujet qu’elles régissent, l’homme, cet être, selon Montaigne, si merveilleusement ondoyant et divers. Il n’est donc pas surprenant qu’en voulant donner à cette équation une précision qu’elle ne comporte pas, les économistes aient plus divisé que rapproché les esprits, parce qu’il n’est aucun des termes de leurs formules qui ne prête le flanc à une multitude d’objections de raisonnement et de fait.
Entrons maintenant dans le domaine de l’application : l’application, outre qu’elle sert à élucider la doctrine, est le vrai fruit de l’arbre de la science.
Le travail, avons-nous dit, est l’objet unique de l’échange. Pour acquérir une utilité (à moins que la nature ne nous la donne gratuitement), il faut prendre la peine de la produire, ou restituer cette peine à celui qui l’a prise pour nous. L’homme ne crée absolument rien : il arrange, dispose, transporte pour une fin utile ; il ne fait rien de tout cela sans peine, et le résultat de sa peine est sa propriété ; s’il la cède, il a droit à restitution, sous forme d’un service jugé égal après libre débat. C’est là le principe de la valeur, de la rémunération, de l’échange, principe qui n’en est pas moins vrai pour être simple. — Dans ce qu’on appelle produits, il entre divers degrés d’utilité naturelle, et divers degrés d’utilité artificielle ; celle-ci, qui seule implique du travail, est seule la matière des transactions humaines ; et sans contester en aucune façon la célèbre et si féconde formule de J.-B. Say. : « Les produits s’échangent contre des produits, » je tiens pour plus rigoureusement scientifique celle-ci : Le travail s’échange contre du travail, ou mieux encore : Les services s’échangent contre des services.
Il ne faut pas entendre par là que les travaux s’échangent entre eux en raison de leur durée ou de leur intensité ; que toujours celui qui cède une heure de peine, ou bien que celui dont l’effort aurait poussé l’aiguille du dynamomètre à 100 degrés, peut exiger qu’on fasse en sa faveur un effort semblable. La durée, l’intensité, sont deux éléments qui influent sur l’appréciation du travail, mais ils ne sont pas les seuls ; il y a encore du travail plus ou moins répugnant, dangereux, difficile, intelligent, prévoyant, heureux même. Sous l’empire des transactions libres, là où la propriété est complétement assurée, chacun est maître de sa propre peine, et maître, par conséquent, de ne la céder qu’à son prix. Il y a une limite à sa condescendance, c’est le point où il a plus d’avantage à réserver son travail qu’à l’échanger ; il y a aussi une limite à ses prétentions, c’est le point où l’autre partie contractante a intérêt à refuser le troc.
Il y a dans la société autant de couches, si je puis m’exprimer ainsi, qu’il y a de degrés dans le taux de la rémunération. — Le moins rémunéré de tous les travaux est celui qui se rapproche le plus de l’action brute, automatique ; c’est là une disposition providentielle, à la fois juste, utile et fatale. Le simple manouvrier a bientôt atteint cette limite des prétentions dont je parlais tout à l’heure, car il n’est personne qui ne puisse exécuter le travail mécanique qu’il offre ; et il est lui-même acculé à la limite de sa condescendance, parce qu’il est incapable de prendre la peine intelligente qu’il demande. La durée, l’intensité, attributs de la matière, sont bien les seuls éléments de rémunération pour cette espèce de travail matériel ; et voilà pourquoi il se paye généralement, à la journée. — Tous les progrès de l’industrie se résument en ceci : remplacer dans chaque produit une certaine somme d’utilité artificielle et, par conséquent, onéreuse, par une même somme d’utilité naturelle et partant gratuite. Il suit de là que, s’il y a une classe de la société intéressée plus que toute autre à la libre concurrence, c’est surtout la classe ouvrière. Quel serait son sort, si les agents naturels, les procédés et les instruments de la production n’étaient pas constamment amenés, par la compétition, à conférer gratuitement, à tous, les résultats de leur coopération ? Ce n’est pas le simple journalier qui sait tirer parti de la chaleur, de la gravitation, de l’élasticité, qui invente les procédés et possède les instruments par lesquels ces forces sont utilisées. À l’origine de ces découvertes, le travail des inventeurs, intelligent au plus haut degré, est très-rémunéré ; en d’autres termes, il fait équilibre à une masse énorme de travail brut ; en d’autres termes encore, son produit est cher. Mais la concurrence intervient, le produit baisse, le concours des services naturels ne profite plus au producteur, mais au consommateur, et le travail qui les utilisa se rapproche, quant à la rémunération, de celui où elle se calcule par la durée. — Ainsi, le fonds commun des richesses gratuites s’accroît sans cesse ; les produits de toute sorte tendent à revêtir et revêtent positivement, de jour en jour, cette condition de gratuité sous laquelle nous sont offerts l’eau, l’air et la lumière : donc le niveau de l’humanité aspire à s’élever et à s’égaliser ; donc, abstraction faite de la loi de la population, la dernière classe de la société est celle dont l’amélioration est virtuellement la plus rapide. — mais nous avons dit abstraction faite des lois de la population ; ceci nous ramène à notre sujet.
Représentons-nous un bassin dans lequel un orifice, qui s’agrandit sans cesse, amène des eaux toujours plus abondantes. À ne tenir compte que de cette circonstance, le niveau devra constamment s’élever ; mais si les parois du bassin sont mobiles, susceptibles de s’éloigner et de se rapprocher, il est clair que la hauteur de l’eau dépendra de la manière dont cette nouvelle circonstance se combinera avec la première. Le niveau baissera, quelque rapide que soit l’accroissement du volume d’eau qui alimente le bassin, si sa capacité s’agrandit plus rapidement encore ; il haussera, si le cercle du réservoir ne s’élargit proportionnellement qu’avec une grande lenteur, plus encore s’il demeure fixe, et surtout s’il se rétrécit.
C’est là l’image de la couche sociale dont nous cherchons les destinées, et qui forme, il faut le dire, la grande masse de l’humanité. La rémunération, les objets propres à satisfaire les besoins, à entretenir la vie, c’est l’eau qui lui arrive par l’orifice élastique. La mobilité des bords du bassin, c’est le mouvement de la population. — Il est certain [268] que les moyens d’existence lui parviennent dans une progression toujours croissante ; mais il est certain aussi que son cadre peut s’élargir suivant une progression supérieure. Donc, dans cette classe, la vie sera plus ou moins heureuse, plus ou moins digne, selon que la loi de limitation, dans sa partie morale, intelligente et préventive, y circonscrira plus ou moins le principe absolu de la multiplication. — Il y a un terme à l’accroissement du nombre des hommes de la classe laborieuse : c’est celui où le fonds progressif de la rémunération est insuffisant pour les faire vivre. Il n’y en a pas à leur amélioration possible, parce que, des deux éléments qui la constituent, l’un, la richesse, grossit sans cesse, l’autre, la population, tombe dans la sphère de leur volonté.
Tout ce que nous venons de dire de la dernière couche sociale, celle où s’exécute le travail le plus brut, s’applique aussi à chacune des autres couches superposées et classées entre elles en raison inverse, pour ainsi dire, de leur grossièreté, de leur matérialité spécifique. À ne considérer chaque classe qu’en elle-même, toutes sont soumises aux mêmes lois générales. Dans toutes, il y a lutte entre la puissance physiologique de multiplication et la puissance morale de limitation. La seule chose qui diffère d’une classe à l’autre, c’est le point de rencontre de ces deux forces, la hauteur où la rémunération porte, où les habitudes fixent, entre les deux lois, cette limite qu’on nomme moyens d’existence.
Mais si nous considérons les diverses couches, non plus en elles-mêmes, mais dans leurs rapports réciproques, je crois que l’on peut discerner l’influence de deux principes agissant en sens inverse, et c’est là qu’est certainement l’explication de la condition réelle de l’humanité. — Nous avons établi comment tous les phénomènes économiques, et spécialement la loi de la concurrence, tendaient à l’égalité des conditions ; cela ne nous paraît pas théoriquement contestable, Puisque aucun avantage naturel, aucun procédé ingénieux, aucun des instruments par lesquels ces procédés sont mis en œuvre, ne peuvent s’arrêter définitivement aux producteurs en tant que tels ; puisque les résultats, par une dispensation irrésistible de la Providence, tendent à devenir le patrimoine commun, gratuit, et par conséquent égal de tous les hommes, il est clair que la classe la plus pauvre est celle qui tire le plus de profit relatif de cette admirable disposition des lois de l’économie sociale. Comme le pauvre est aussi libéralement traité que le riche à l’égard de l’air respirable, de même il devient l’égal du riche pour toute cette partie du prix des choses que le progrès anéantit sans cesse. Il y a donc au fond de la race humaine une tendance prodigieuse vers l’égalité. Je ne parle pas ici d’une tendance d’aspiration, mais de réalisation. — Cependant l’égalité ne se réalise pas, ou elle se réalise si lentement qu’à peine, en comparant deux siècles éloignés, s’aperçoit-on de ses progrès. Ils sont même si peu sensibles, que beaucoup de bons esprits les nient, quoique certainement à tort. — Quelle est la cause qui retarde cette fusion des classes dans un niveau commun et toujours progressif ?
Je ne pense pas qu’il faille la chercher ailleurs que dans les divers degrés de cette prévoyance qui anime chaque couche sociale à l’égard de la population. — La loi de la limitation, avons-nous dit, est à la disposition des hommes en ce qu’elle a de moral et de préventif. L’homme, avons-nous dit encore, est perfectible, et, à mesure qu’il se perfectionne, il fait un usage plus intelligent de cette loi. Il est donc naturel que les classes, à mesure qu’elles sont plus éclairées, sachent se soumettre à des efforts plus efficaces, s’imposer des sacrifices mieux entendus pour maintenir leur population respective au niveau des moyens d’existence qui lui sont propres.
Si la statistique était assez avancée, elle convertirait probablement en certitude cette induction théorique en montrant que les mariages sont moins précoces dans les hautes que dans les basses régions de la société. — Or, s’il en est ainsi, il est aisé de comprendre que, dans le grand marché où toutes les classes portent leurs services respectifs, où s’échangent les travaux de diverses natures, le travail brut s’offre en plus grande abondance relative que le travail intelligent, ce qui explique la persistance de cette inégalité des conditions, que tant et de si puissantes causes d’un autre ordre tendent incessamment à effacer.
La théorie que nous venons d’exposer succinctement conduit à ce résultat pratique, que les meilleures formes de la philanthropie, les meilleures institutions sociales sont celles qui, agissant dans le sens du plan providentiel tel que les harmonies sociales nous le révèlent, à savoir, l’égalité dans le progrès, font descendre dans toutes les couches de l’humanité, et spécialement dans la dernière, la connaissance, la raison, la moralité, la prévoyance.
Nous disons les institutions, parce qu’en effet, la prévoyance résulte autant des nécessités de position que de délibérations purement intellectuelles. Il est telle organisation de la propriété, ou, pour mieux dire, de l’exploitation, qui favorise plus qu’une autre ce que les économistes nomment la connaissance du marché et, par conséquent, la prévoyance. Il paraît certain, par exemple, que le métayage est beaucoup plus efficace que le fermage [269] pour opposer l’obstacle préventif à l’exubérance de la population dans la classe inférieure. Une famille de métayers est beaucoup mieux en mesure qu’une famille de journaliers de sentir les inconvénients des mariages précoces et d’une multiplication désordonnée.
Nous disons encore les formes de la philanthropie. En effet, l’aumône peut faire un bien actuel et local, mais elle ne peut avoir qu’une influence bien restreinte, si même elle n’est funeste, sur le bien-être de la classe laborieuse ; car elle ne développe pas, peut-être même paralyse-t-elle la vertu la plus propre à élever cette classe, la prévoyance. Propager des idées saines, et surtout les habitudes empreintes d’une certaine dignité, c’est là le plus grand bien, le bien permanent que l’on peut conférer aux classes inférieures.
Les moyens d’existence, nous ne saurions trop le répéter, ne sont pas une quantité fixe ; ils dépendent des mœurs, de l’opinion, des habitudes. À tous les degrés de l’échelle sociale, on éprouve la même répugnance à descendre du milieu dont on a l’habitude qu’on en peut ressentir au degré le plus inférieur. Peut-être même la souffrance est-elle plus grande chez l’aristocrate dont les nobles rejetons se perdent dans la bourgeoisie, que chez le bourgeois dont les fils se font manœuvres, ou chez les manœuvres dont les errants sont réduits à la mendicité. L’habitude d’un certain bien-être, d’une certaine dignité dans la vie, est donc le plus fort des stimulants pour mettre en œuvre la prévoyance ; et si la classe ouvrière s’élève une fois à certaines jouissances, elle n’en voudra pas descendre, dût-elle, pour s’y maintenir et conserver un salaire en harmonie avec ses nouvelles habitudes, employer l’infaillible moyen de la limitation préventive.
C’est pourquoi je considère comme une des plus belles manifestations de la philanthropie la résolution, qui paraît avoir été prise en Angleterre par beaucoup de propriétaires et de manufacturiers, d’abattre les cottages de boue et de chaume, pour y substituer des maisons de briques, propres, spacieuses, bien éclairées, bien aérées, et convenablement meublées. Si cette mesure était générale, elle élèverait le ton de la classe ouvrière, convertirait en besoins réels ce qui aujourd’hui est un luxe relatif, elle exhausserait cette limite qu’on nomme moyens d’existence, et, par suite, l’étalon de la rémunération à son degré inférieur. — Pourquoi pas ? La dernière classe dans les pays civilisés est bien au-dessus de la dernière classe des peuples sauvages. Elle s’est élevée ; pourquoi ne s’élèverait-elle pas encore ?
Cependant il ne faut pas se faire illusion ; le progrès ne peut être que très-lent parce qu’il faut qu’il soit général, à quelque degré. On concevrait qu’il pût se réaliser rapidement sur un point du globe, si les peuples n’exerçaient aucune influence les uns sur les autres ; mais il n’en est pas ainsi : il y a une grande loi de solidarité, pour la race humaine, dans le progrès comme dans la détérioration. Si en Angleterre, par exemple, la condition des ouvriers s’améliorait sensiblement, par suite d’une hausse générale des salaires, l’industrie française aurait plus de chances de surmonter sa rivale, et, par son essor, modérerait le mouvement progressif qui se serait manifesté de l’autre côté du détroit. Il semble que la Providence n’a pas voulu qu’un peuple pût s’élever au-dessus d’un autre au delà de certaines limites ; ainsi, dans le vaste ensemble, comme dans les moindres détails de la société humaine, nous trouvons toujours que des forces admirables et inflexibles tendent à conférer, en définitive, à la masse, des avantages individuels ou collectifs, et à ramener toutes les supériorités sous le joug d’un niveau commun, qui, comme celui de l’Océan dans les heures du flux, s’égalise sans cesse et s’élève toujours.
En résumé, la perfectibilité, qui est le caractère distinctif de l’homme, étant donnée, l’action de la concurrence et la loi de la limitation étant connues, le sort de la race humaine, au seul point de vue de ses destinées terrestres, nous semble pouvoir se résumer ainsi : 1° élévation de toutes les couches sociales à la fois, ou du niveau général de l’humanité ; 2° rapprochement indéfini de tous les degrés, et annihilation successive des distances qui séparent les classes, jusqu’à une limite posée par la justice absolue ; 3° diminution relative, quant au nombre, de la dernière et de la première couche sociale, et extension des couches intermédiaires. — On dira que ces lois doivent amener l’égalité absolue. — Pas plus que le rapprochement éternel de la droite et de l’asymptote n’en doivent amener la fusion. . . . . . . . . . . .
[The following is not in 1851 ed.???]
Ce chapitre, écrit en grande partie dès 1846, ne traduit peut-être pas assez nettement l’opposition de l’auteur aux idées de Malthus.
Bastiat y fait bien ressortir l’action inaperçue et naturellement préventive du mobile individualiste, — le désir progressif du bien-être l’ambition du mieux ; et l’habitude qui fait à chacun du bien-être acquis un véritable besoin, une limite inférieure des moyens d’existence, au-dessous de laquelle personne ne veut voir tomber sa famille. Mais ce n’est là que le côté négatif en quelque sorte de la loi ; il montre seulement que, dans toute société fondée sur la propriété et la famille, la population ne peut être un danger,
Il restait à faire voir que la population est par elle-même une force, à prouver l’accroissement nécessaire de puissance productive qui résulte de la densité de la population. C’est là, comme l’auteur l’a dit lui-même, page 115, l’élément important négligé par Malthus, et qui, là où Malthus avait vu discordance, nous fera voir harmonie.
Des, prémisses indiquées au chapitre De l’échange, pages 115 et 116, prémisses qu’il se proposait de développer en traitant de la population, voici la conclusion tout à fait anti-malthusienne que voulait tirer Bastiat. Nous la trouvons dans une des dernières notes qu’il ait écrites, et il recommande d’y insister :
« Au chapitre sur l’échange, on a démontré que, dans l’isolement, les besoins étaient supérieurs aux facultés ; que, dans l’état social, les facultés étaient supérieures aux besoins.
Cet excédant des facultés sur les besoins provient de l’échange qui est — association des efforts, — séparation des occupations.
De là une action et une réaction de causes et d’effets dans un cercle de progrès infini.
La supériorité des facultés sur les besoins, créant à chaque génération un excédant de richesse, lui permet d’élever une génération plus nombreuse. — Une génération plus nombreuse, c’est une meilleure et plus profonde séparation d’occupations, c’est un nouveau degré de supériorité donné aux facultés sur les besoins.
Admirable harmonie !
Ainsi, à une époque donnée, l’ensemble des besoins généraux étant représenté par 100, et celui des facultés par 110, l’excédant 10 se partage, — 5, par exemple, à améliorer le sort des hommes, à provoquer des besoins plus élevés, à développer en eux le sentiment de la dignité, etc., — et 5 à augmenter leur nombre.
À la seconde génération, les besoins sont 110, — savoir : 5 de plus en quantité et 5 de plus en qualité.
Mais par cela même (par la double raison du développement physique, intellectuel et moral plus complet, et de la densité plus grande, qui rend la production plus facile), les facultés ont augmenté aussi en puissance. Elles seront représentées, par exemple, par le chiffre 120 ou 130.
Nouvel excédant, nouveau partage, etc.
Et qu’on ne craigne pas le trop-plein ; l’élévation dans les besoins, qui n’est autre chose que le sentiment de la dignité, est une limite naturelle…..
(Note de l’éditeur.)
Long Note by “R.F.” [1851 ed.]↩
Fonteyraud’s Long Note [from 2nd ed. 1851]
[long version by R.F. (Fonteyraud) appears in 2nd ed. 1851, pp. 454-464; trans in FEE edition but not by LF]
[534]
Le commencement seul du chapitre précédent est de date récente; le reste est un article qui a paru en 1846 dans le Journal des Économistes. Depuis cette époque, les idées de l'auteur sur ce grave sujet avaient pris plus de précision, et on nous pardonnera d'essayer, d'après quelques notes, de compléter l'exposé de la doctrine.
Et d'abord, Bastiat ne reconnaît comme obstacle au principe multiplicateur que cette loi si énergiquement signalée par Malthus, dans laquelle la volonté immuable du Créateur et la volonté libre de la créature pensante interviennent pour ainsi dire à parts égales, où l'homme est actif par sa prévoyance, sauf à être passif et puni s'il n'a su ni voulu prévoir. Pour Bastiat comme pour Malthus, le contre-poids à la tendance physiologique de la reproduction, c'est le ressort de la Responsabilité individuelle, — Responsabilité du travail, ou Propriété,— — Responsabilité de la procréation, ou Héritage et Famille.
On peut dire même qu'ici Bastiat est plus nettement économiste que son devancier : car, au lieu de placer comme lui l'obstacle préventif dans le domaine de la morale pure, il l'établit scientifiquement sur le sentiment de la personnalité, l'ambition progressive du bien-être, l’Individualisme, en un mot, — base de la Société propriétaire, irréconciliable négation du Socialisme.
Hors de cette condition première de l'ordre social, et dans toute combinaison qui voudrait supprimer ou affaiblir la Responsabilité par une extension factice de la Solidarité, le principe de l'action préventive est détruit, l'homme retombe sous la loi fatale de la répression, et nous nous retrouvons dans cette série de phénomènes inévitables, dans cet entraînement de conséquences écrasantes que Malthus a victorieusement opposées aux systèmes communistes de son temps et de tous les temps. [270]
[435]
Comme nous vivons à une époque où il faut moins que jamais désarmer une vérité pour en armer une autre, nous tenions à bien constater, avant tout, l'accord des deux maîtres contre ceux qui veulent « la communauté du mal, l'imputation faite à la Société de toutes les fautes individuelles la Solidarité entre tous les délits de chacun. [271] »
Mais de cette prémisse commune : l'effort moral de l'homme sur lui-même, chacun des deux économistes a tiré des conclusions bien différentes. Car, pour le premier, cet effort se réduisait à la contrainte vertueuse; et il n'osait l'espérer de la moralité imparfaite de l'espèce humaine. Le second la voit surtout dans la prévoyance, dans cet esprit de conduite que développe le désir du bien-être, qu'impose la crainte de déchoir, que dirigent et soutiennent les usages, les devoirs et les instincts moraux du milieu même où l'on vit. Selon lui, par conséquent, chaque pas fait dans la voie du bien-être tend, par le besoin du mieux, à encourager cette réserve prudente, — l'homme, à mesure que la vie lui devient plus facile, devenant lui-même plus difficile sur les conditions de sa vie. Ainsi ce cercle vicieux où Malthus semblait enfermer l'humanité, Bastiat, par un redressement insensible, l'a ouvert, pour ainsi dire, en une spirale indéfinie comme le progrès; et ce problème de la Population, sombre comme une menace de mort, est devenu de son point de vue une loi d'Harmonie et de Perfectibilité, comme toutes les autres lois Sociales.
Il y a dans la théorie de Bastiat deux parties bien distinctes.
Dans la première il fait voir que Malthus a beaucoup trop rétréci la portée de l'obstacle préventif en le désignant sous le nom de contrainte morale, et que la limite des moyens d'existence, qui semble se présenter à première vue comme un minimum fatal et inflexible, est, tout au contraire, en théorie comme en fait, une barrière mobile que le progrès déplace sans cesse — dans toute société au moins fondée sur la Justice et la Liberté.
Il est inutile de revenir sur une chose démontrée; et d'ailleurs ici il y a coïncidence avec les beaux développements de Rossi sur la population. Tout en convenant, avec Malthus, que « d'après la manière imparfaite dont a été observé jusqu'ici le précepte du moral restraint, ce serait s'exposer à passer pour visionnaire que d'espérer à cet égard aucune amélioration importante, » on nous permettra, sans nous [456] regarder comme visionnaires, d'admettre et de constater que les hommes, une fois possesseurs d'un certain bien-être, sont très-attentifs à éviter ce qui peut les en faire déchoir, et que ce principe de contrainte inaperçue existe à un très-haut degré dans les habitudes, les idées, les obligations sociales des classes supérieures. Certainement un jeune homme de 24 ans, qui commence son stage ou qui sort d'une école spéciale, n'a jamais réfléchi sur la loi de Malthus; il pense tout simplement à se faire une position, avant de se charger d'une famille. Allez complimenter sur sa vertu un jeune capitaine au long cours, qui navigue toute l'année du Havre ou de Nantes aux Grandes Indes, — il se mettra à rire, il vous dira qu'ayant une bonne éducation et peu de fortune, il prétend n'épouser qu'une femme qu'il puisse aimer, c’est-à-dire bien élevée comme lui, élégante d'esprit et de manières, etc.... Pour cela, il faut qu'il arrive à une certaine aisance, et il va consacrer cinq ou six ans de sa jeunesse à préparer laborieusement le bonheur de son avenir. —Au lieu de cinq ou six ans seulement, il pourra bien en mettre dix ou douze, et, peut-être, prenant goût à son état de marin, finira-t-il par rester garçon. Tout ceci n'est pas contestable.
Mais Bastiat va plus loin que Rossi. Celui-ci, accordant la prépondérance évidente de l'obstacle préventif dans les classes supérieures, pense néanmoins que dans les classes ouvrières le principe répressif fonctionne à peu près seul.
Cette distinction est trop exclusive. Sans doute, il y a moins de prudence chez le prolétaire que dans la bourgeoisie (il serait d'autant plus maladroit de le nier que ce fait prouve combien le sentiment de la dignité, développé par le progrès, donne de puissance naturelle à l'obstacle préventif). Mais enfin il est facile de constater, avec Bastiat, que le prolétariat insoucieux et imprudent diminue, que la dernière classe a constamment progressé en bien-être. Or, pour que ce double effet ait pu se produire dans une masse qui non-seulement pullule par sa propre tendance, mais qui de plus sert de réceptacle aux déchéances des castes plus élevées et d'exutoire en quelque sorte à leurs vices, il faut nécessairement que l'obstacle purement préventif ait réagi sur elle beaucoup plus qu'on ne l'aperçoit au premier coup d'oeil. Comment cela s'est-il fait? le voici : C'est tout simplement que le prolétaire rencontre, dans les conditions même du travail, une foule d'obstacles tout établis qui le contiennent sans qu'il s'en doute? Que citerai-je? La domesticité, par exemple, — l'industrie du nourrissage qui semble destiné à user la fécondité exubérante des femmes de la campagne. — Pour les hommes, le recrutement et ces couvents militaires qu'on appelle des camps et des casernes, — les grandes [457] émigrations des travailleurs qui en rompant leurs relations naturelles de voisinage et de famille, les tiennent isolés, par les usages et quelquefois par la langue du pays où ils vont chercher de l'ouvrage, —l'agglomération dans les centres industriels, autour des fonderies, des mines, des fabriques de machines, etc., et cette camaraderie de l'atelier qui remplace l'intimité de famille, — le compagnonnage et ses pérégrinations, — l'existence nomade de tout ce qui tient au commerce proprement dit, etc., etc.
Il y aurait bien des choses à ajouter ici sur l'apprentissage et les conditions de plus en plus élevées que lui impose le progrès. « Pour être à la hauteur de la vie dans les sociétés modernes, dit Proudhon, il faut un immense développement scientifique, esthétique et industriel ... 35 ans ne suffisent plus à l'éducation des privilégiés. Que « sera-ce? etc.. [272] » On voit sous combien de formes inaperçues l'obstacle préventif s'impose au prolétaire.
Il n'est pas besoin, au reste, de faire de grands efforts d'analyse et d'observation pour prouver la diminution continue de l'action répressive; ce résultat ressort matériellement et incontestablement des chiffres mêmes qui expriment en Europe le mouvement de la population. Il y a en effet un point d'une importance extrême, acquis maintenant à la statistique: c'est l'accroissement de la vie moyenne depuis un siècle. En Angleterre, M. Finlaison a constaté que la mortalité générale, qui en 1805 était de 1 sur 42, est à présent de 1 sur 46. Selon M. Farr, la probabilité de la vie pour les personnes âgées de 20 ans, qui n'était en 1698 que de 29 années, est maintenant de 40. En France, MM. Moreau de Jonnès, Bienaymé, etc., ont émis des conclusions analogues.
Or, accroissement de la vie moyenne, ou diminution de l'action répressive, c'est un seul et même fait économique sous deux formules à peine différentes.
A-t-on pu déjà nettement spécifier la part qui revient à chaque classe sociale dans cette conquête commune sur la mort? Je ne sais, mais il est impossible que toutes n'y aient pas participé; eten voyant ce qu'on a fait depuis quelque temps, en France et surtout en Angleterre, pour améliorer l'hygiène des classes pauvres, mettre les médecins et les médicaments à la portée des malheureux, détruire les logements insalubres, changer les industries malsaines, réglementer le travail des enfants, placer à côté de chaque danger une [458] institution spéciale de bienfaisance, etc, etc., je crois que nous sommes autorisés à présumer que cette décroissance de la mortalité s'est fait sentir dans les classes inférieures plus peut-être, toute proportion gardée, que dans aucune autre. La vie active accrue de 5 ou 10 ans en moyenne! Je voudrais montrer et chiffrer (car on le peut) l'immense valeur de ce magnifique résultat. J'ose affirmer que de toutes les conquêtes de la civilisation c'est celle qui mérite au plus haut degré l'attention profonde des économistes. A vrai dire, elle est le résumé, l'expression sommaire de tous les progrès acquis, comme elle est le gage certain, la source immanquable de progrès nouveaux, —cause et effet dans un cercle infini... Mais il nous faut résister à cette étude si tentante, et qui jetterait un jour si vif sur le fond même de la question qui nous occupe: nous devons retourner à Bastiat.
Dans la première partie, il a fait sortir des faits la preuve de la prédominance du progrès. — Dans la seconde, il en pose a priori la raison et la loi théorique.
Dans cette partie entièrement neuve de sou système, Bastiat montre, — ou plutôt, hélas ! devait montrer, — que l'accroissement de la population (en le supposant toujours contenu dans les limites naturelles que lui assigne la responsabilité personnelle) est, par lui-même, une cause de progrès, une puissance donnée à la production. Voici comment il a formulé cette belle loi, dans le chapitre de l'échange:
« Toutes choses égales d'ailleurs, la densité croissante de population équivaut à une facilité croissante dans la production. »
Ce principe, qui a paru paradoxal à quelques économistes trop impatients, est tout simplement une incontestable vérité, un axiome fondamental déjà reçu dans la science sous une autre forme. On va en juger.
Si l'on devait concevoir un peuple, une société, comme une série de groupes parsemés sur un vaste territoire et sans rapports d'échange entre eux, si de plus on supposait que le doublement consistât à intercaler entre chacune de ces peuplades isolées d'autres peuplades égales en richesse et en nombre, n'ayant pas plus de rapports entre elles qu'avec les premières, — certainement alors l'accroissement de ce qu'on appellerait la population totale et la richesse générale (richesse et population n'ont pas de sens, puisqu'ici l'unité manquerait), cet accroissement n'aurait rien changé à l'aisance relative et au bien-être individuel de chaque producteur. Mais les choses se passent autrement dans la réalité: l'échange, les communications, les rapports [459] réciproques existent dans une nation d'homme à homme, de village à village, de villes à campagnes, de provinces à provinces, etc.
Or, supposez que dans ce réseau déjà existant nous ayons un accroissement proportionnel de population et de capital, que nous intercalions pour ainsi dire une seconde population toute pareille avec d'autres instruments, d'autres maisons, d'autres champs cultivés, ou les mêmes champs donnant deux fois plus de subsistances, etc. (c'est ce que nous entendons par toutes choses égales d'ailleurs). Pense-t-on que, parce que le chiffre des hommes et celui des moyens de produire serait resté dans le même rapport numérique, le bien-être absolu de chacun des travailleurs n'aurait pas changé? Ce serait une erreur très-grave, et je dis que, par le fait seul de la condensation, il y a facilité plus grande pour produire, c'est-à-dire bien-être et richesse réelle augmentés dans une proportion considérable.
Et d'abord, sans changer rien encore à la distribution des fonctions, « le rapprochement seul donne immédiatement un usage plus avantageux du même appareil d'échange. [273] »
Il est clair comme le jour, par exemple, que beaucoup de frais de transport et de voiturage sont diminués de moitié. Et certes c'est là déjà un immense bénéfice : car à quoi tendent les efforts immenses que nous faisons pour tracer des routes, creuser des canaux, construire des chemins de fer, etc., sinon à rapprocher les choses et les' hommes, à opérer en définitive une densité factice de population?
Voici, par exemple, un colporteur qui dans sa journée parcourt sa balle sur le dos un périmètre de 6 à 8 lieues, dans un pays de petites métairies isolées; il vend quelques aunes de fil, de rubans ou de colonnades, quelques épices, quelques quincailleries grossières; le soir il aura fait une douzaine de marchés. Supposez une population double agglomérée dans le même espace. De deux choses l'une : ou bien il se contentera de la même clientèle, et alors trouvant ses douze acheteurs dans un circuit réduit à 3 ou 4 lieues, il lui restera la moitié de la journée pour faire autre chose : ou bien, embrassant le même espace, il vendra deux fois plus. Dans l'une et l'autre hypothèse, la même peine lui procure double profit, ou, si vous l'aimez mieux, il peut, en conservant le même bénéfice absolu, diminuer de moitié le bénéfice relatif qu'il prélevait sur chaque objet vendu.
J'ai habité un village où un tailleur pour m'apporter un pantalon de coutil, un pauvre cordonnier pour une paire de souliers de chasse, étaient obligés de faire 3 lieues (aller et retour), et de perdre un bon [460] tiers de leur journée. Si la population doublait, il y aurait dans chacun des deux villages un tailleur et un cordonnier ; je prendrais le mien à ma porte, et l'autre trouverait dans un rayon d'un kilomètre la même clientèle qu'il avait auparavant. L'ouvrier y gagnerait son tiers de journée, et moi la bouteille de mauvais vin dont je payais sa peine, — toutes choses égales d'ailleurs.
L'importance des distances est énorme, elle se retrouve dans tous les détails de la production même. Je connais nombre de terres situées à 3 ou 4 kilom. de la ferme qui les exploite. On cultive avec des bœufs; il faut à ces animaux tranquilles deux heures pour faire le trajet. Donc, voilà 4 heures perdues pour chaque journée de labeur, 4 heures par jour pour les semailles, 4 heures par jour pour les moissons, etc.... Il est inutile de dire qu'on ne peut pas songer à porter des engrais à cette distance, et que ces terres se reposent 5 ou 6 ans. Que la population ait les moyens de doubler, quelques fermes se bâtiront à proximité de ces champs, on les cultivera sans peine, on les fumera, et en disant qu'on leur fera facilement rendre 3, 4, 5 fois plus dans ces conditions, je pense que je ne serai contredit par aucun agriculteur. Je pourrais multiplier ces preuves à l'infini.
Ce n'est pas tout. « La densité de la population ne fait pas seulement tirer un meilleur parti de l'appareil de l'échange, elle permet d'accroître et de perfectionner cet appareil même par la division du travail '.»
Quel est l'effet de l'isolement? c'est l'impossibilité de séparer les occupations. Dans une nation primitive, un colon va couper un arbre dans la forêt, le charrie, le débite, en fait une porte, un manche d'outil, une paire de sabots, etc..
C'est non-seulement beaucoup de temps et de frais perdus, il faut encore compter tous les instruments, tous les apprentissages incomplets de ces différentes espèces de travaux. Au lieu de cabanes isolées, qu'il y ait un village; vous aurez des bûcherons qui s'établiront dans la forêt, des voituriers qui amèneront le bois à pleine charge, des scieurs de long qui le détailleront, des charrons, des menuisiers, des sabotiers, etc.... Tout cela fonctionnera d'une manière continue, régulière, sans perte de temps et de forces, avec un petit nombre d'outils, un apprentissage moins long et meilleur, une dextérité et un savoir-faire d'habitude qui est une économie immense.
Je parle de séparation, j'aurais pu parler d'association. Pour agir sur la nature, l'homme a besoin d'une puissance et d'une continuité [461] d’action que le nombre seul lui donne. 5 ouvriers pendant trois siècles ne pousseraient pas une jetée à un mètre dans la mer; mettez-en 500, et dans (i mois vous aurez tout un quai. Les hommes, suivant les occurrences, convergent ou divergent; tantôt ils condensent leurs efforts en un faisceau irrésistible, tantôt ils éparpillent autour de chaque difficulté de détail leurs aptitudes variées. Et qu'on ne cherche pas une limite à ce bénéfice du rapprochement. Presque chaque année, si l'on veut y faire attention, nos capitales même nous montrent des progrès dus — ou à une division nouvelle, ou à une gigantesque concentration des forces, dans quelque industrie.
Mais, tout incontestés que soient les résultats de la répartition du travail par fractions ou par masses, le grand, le suprême avantage, c'est le progrès des méthodes, l'invention des instruments et des machines. Or, le perfectionnement ne peut naître que de la division du travail, comme la division du travail ne peut résulter que de la densité de la population.
Comment le colon isolé dont nous parlions tout à l'heure aurait-il, je ne dis pas la possibilité, mais même la pensée de chercher à perfectionner les moyens primitifs qu'il emploie pour se faire un outil, une porte, une chaussure? Mais que la besogne une fois partagée, celui-ci n'ait plus qu'à tailler des planches, celui-là à marteler des clous, un autre à préparer des cuirs, etc., et de ce moment, avec 20 fois moins de génie inventif que le demi-sauvage qui était obligé de pourvoir à tout lui-même, chacun des travailleurs parcellaires, l'esprit incessamment tendu vers un but restreint qu'il embrasse et domine, rapportant à son art tout ce qu'il voit, tout ce qu'il apprend, va graduellement perfectionner ses instruments et ses méthodes. Il inventera la scie,la doloire, le rabot, les tarières, la forge, le soufflet, etc., et plus tard les machines que meuvent l'eau et la vapeur, les fourneaux gigantesques, les cisailles et les scies tournantes qui coupent les barres de fer ou les arbres, comme un couteau tranche un fruit...
Tout ce travail va être soutenu, pressé, engrené dans ce mouvement sans fin que communique à l'homme le contact de l'homme, chauffé à une tension continue par la concurrence, éclairé par le rayonnement mutuel des découvertes, par la science, ce grand foyer commun de lumière où converge chaque lueur isolée de l'expérience... Arrêtons-nous, nous tombons dans les banalités, et je le constate très-volontiers. C'est qu'en effet la formule de Bastiat n'est pas autre chose que le fameux axiome de la division du travail. La densité de la race humaine fait sa puissance de production, c'est la définition de la civilisation même.
[462]
Oui, jusqu'à la fin des siècles il y aura une filiation réciproque et nécessaire entre les deux termes de cette grande parole : Multiplicamini et subjicite universam terram ; partout où l'homme multipliera (dans les conditions voulues de son développement social), ses moyens d'action sur la nature se multiplieront dans une progression encore plus rapide.
Si deux provinces limitrophes se trouvaient séparées par un obstacle longtemps infranchissable, et qu'enfin on parvint à le percer sur deux ou trois points, le bien-être de chaque province serait-il accru par cette communication ? Tout économiste répondra affirmativement. Les avantages réciproques ne s'augmenteraient-ils pas notablement si, au lieu de deux ou trois points de contact, on en créait dix ou vingt? — si les deux provinces s'enveloppaient et se pénétraient l'une l’autre? — Ne seraient-ils pas au maximum s'il était possible de les superposer, de les fondre l'une dans l'autre de manière que la communication s'établit dans les moindres détails de village à village, de maison à maison et d'homme à homme?Or, cette superposition hypothétique, c'est ce que réalise précisément la densité croissante de la population, toutes choses égales d'ailleurs. Concluez.
Remarquons, en passant, que cet amoindrissement des difficultés naturelles parle fait du rapprochement et de l'agglomération des travailleurs, non-seulement modifie profondément les tristes conclusions de Malthus, mais suffirait pour renverser la funeste théorie de Ricardo sur la Rente. II est hors de doute que les erreurs ou les terreurs des deux économistes contemporains se sont aggravées l'une par l'autre: pendant que Ricardo, préoccupé de la pression des hommes contre les subsistances, posait en principe cet accroissement progressif de la valeur des aliments que rien en fait ne justifie, Malthus, de son côté, trouvait dans la théorie de la rente qu'il prenait au sérieux, une légitimation de ses craintes exagérées.
Je crois qu'en voyant mieux les choses nous conclurons tout à l'inverse, et que les deux lois collatérales de la population et de la rente (ou plus généralement du capital) nous paraîtront ce qu'elles sont en effet — une approximation constante de l'humanité vers la gratuité et le bien-être par l'emploi de plus en plus facile, de plus en plus puissant, des forces et des agents naturels.
Quand la statistique sera en mesure, elle vérifiera de tous points cette conclusion de Bastiat: qu'une nation ne se developpe en nombre qu'avec un développement infiniment supérieur dans la production. Et, pour n'en citer qu'une preuve, M. Moreau de Jonnès a constaté que si la population a doublé en France depuis 1700, la [463] consommation de grains s'y est élevée par tête de 472 litres à 541, à quoi il faut ajouter environ 240 litres de pommes de terre et légumes farineux. [274] Et certes, si la plus animale des consommations, la moins susceptible d'accroissement en poids et en volume a néanmoins augmenté dans une proportion si notable, quel prodigieux essor n'a pas dû prendre la consommation industrielle, l'usage des produits et des jouissances d'un ordre plus élevé!
L'Angleterre nous fournirait des preuves bien autrement puissantes par l'énorme accroissement qu'a pris depuis un demi-siècle sa consommation en céréales, charbons, métaux, produits manufacturés, etc. Ce que nous avons indiqué peut suffire ; simple écho d'une pensée supérieure, plus de développements ne conviendraient pas à notre rôle.
Nous avons donc, en résumé, à opposer aux prétendus envahissements de la population : — 1° L'action du mobile individualiste qui fait que chaque homme tend à élever pour lui et pour sa famille le niveau de son bien-être; — 2° l'habitude qui change pour lui en besoin et nécessité tout bien-être déjà acquis, l'empêche de redescendre et le fait progresser à son insu, par cela seul qu'il se maintient dans un milieu progressif; — 3° enfin l'accroissement indéfini de puissance qui résulte pour chacun des producteurs de l'accroissement même de leur nombre.
Et voici la belle série harmonique qui découle de la combinaison de ces lois, et sur laquelle Bastiat veut qu'on insiste: (Ici je transcris simplement une des dernières notes qu'il ait écrites).
« Au chapitre sur l'échange, on a démontré que dans l'isolement les besoins étaient supérieurs aux facultés, que dans l'état social, les facultés étaient supérieures aux besoins.
« Cet excédant des facultés sur les besoins provient de l'échange qui est — association des efforts, — séparation des occupations.
« De là une action et une réaction de causes et d'effets dans un cercle de progrès infini.
« La supériorité des facultés sur les besoins, créant à chaque gênération un excédant de richesses, lui permet d'élever une génération plus nombreuse. — Une génération plus nombreuse, c'est une meilleure et plus profonde séparation d'occupations, c'est un nouveau degré de supériorité donné aux facultés sur les besoins.
« Admirable harmonie!
«Ainsi, à une époque donnée, l'ensemble des besoins généraux [464] étant représenté par 100, et celui des facultés par 110, l'excédant 10 se partage,— 5, par exemple, à améliorer le sort des hommes, à provoquer des besoins plus élevés, à développer en eux le sentiment de la dignité — et 5 à augmenter leur nombre.
« A la seconde génération, les besoins sont 110, — savoir: 5 de plus en quantité, et 5 de plus en qualité.
« Mais par cela même (par la double raison du développement physique, intellectuel, moral plus complet, et de la densité plus grande qui rend la production plus facile), les facultés se sont augmentées aussi en puissance. Elles seront, par exemple, représentées parle chiffre 120 ou 130.
« Nouvel excédant, nouveau partage, etc..
« Et qu'on ne craigne pas le trop plein. L'élévation dans les besoins, qui n'est autre chose que le sentiment de la dignité, est une limite naturelle .. »
Donc, dirons-nous en finissant, partout où les institutions seront basées sur les conditions naturelles de l'ordre social: la famille, —conséquence de la propriété, — la propriété, conséquence de la liberté,—et la liberté, qui est identique avec la responsabilité personnelle; — le développement de la population en nombre sera toujours accompagné d'un développement plus rapide en bien-être et en puissance productive.
Dieu fait bien tout ce qu'il fait, et toute la science sociale n'est maintenant qu'une seule et même harmonie.
R. F.
XVII. Services privés, services publics↩
Les services s’échangent contre des services.
L’équivalence des services résulte de l’échange volontaire et du libre débat qui le précède.
En d’autres termes, chaque service jeté dans le milieu social vaut autant que tout autre service auquel il fait équilibre, pourvu que toutes les offres et toutes les demandes aient la liberté de se produire, de se comparer, de se discuter.
On aura beau épiloguer et subtiliser, il est impossible de concevoir l’idée de valeur sans y associer celle de liberté.
Quand aucune violence, aucune restriction, aucune fraude ne vient altérer l’équivalence des services, on peut dire que la justice règne.
Ce n’est pas à dire que l’humanité soit alors arrivée au terme de son perfectionnement ; car la liberté laisse toujours une place ouverte aux erreurs des appréciations individuelles. L’homme est dupe souvent de ses jugements et de ses passions ; il ne classe pas toujours ses désirs dans l’ordre le plus raisonnable. Nous avons vu qu’un service peut être apprécié à sa valeur sans qu’il y ait une proportion raisonnable entre sa valeur et son utilité ; il suffit pour cela que nous donnions le pas à certains désirs sur d’autres. C’est le progrès de l’intelligence, du bon sens et des mœurs qui réalise de plus en plus cette belle proportion, en mettant chaque service à sa place morale, si je puis m’exprimer ainsi. Un objet futile, un spectacle puéril, un plaisir immoral, peuvent avoir un grand prix dans un pays et être dédaignés et flétris dans un autre. L’équivalence des services est donc autre chose que la juste appréciation de leur utilité. Mais, encore sous ce rapport, c’est la liberté, le sens de la responsabilité qui corrigent et perfectionnent nos goûts, nos désirs, nos satisfactions et nos appréciations.
Dans tous les pays du monde, il y a une classe de services qui, quant à la manière dont ils sont rendus, distribués et rémunérés, accomplissent une évolution tout autre que les services privés ou libres. Ce sont les services publics.
Quand un besoin a un caractère d’universalité et d’uniformité suffisant pour qu’on puisse l’appeler besoin public, il peut convenir à tous les hommes qui font partie d’une même agglomération (Commune, Province, Nation) de pourvoir à la satisfaction de ce besoin par une action ou par une délégation collective. En ce cas, ils nomment des fonctionnaires chargés de rendre et de distribuer dans la communauté le service dont il s’agit, et ils pourvoient à sa rémunération par une cotisation qui est, du moins en principe, proportionnelle aux facultés de chaque associé.
Au fond, les éléments primordiaux de l’économie sociale ne sont pas nécessairement altérés par cette forme particulière de l’échange, surtout quand le consentement de toutes les parties est supposé. C’est toujours transmission d’efforts, transmission de services. Les fonctionnaires travaillent pour satisfaire les besoins des contribuables ; les contribuables travaillent pour satisfaire les besoins des fonctionnaires. La valeur relative de ces services réciproques est déterminée par un procédé que nous aurons à examiner ; mais les principes essentiels de l’échange, du moins abstraitement parlant, restent intacts.
C’est donc à tort que quelques auteurs, dont l’opinion était influencée par le spectacle de taxes écrasantes et abusives, ont considéré comme perdue toute valeur consacrée aux services publics [275]. Cette condamnation tranchante ne soutient pas l’examen. En tant que perte ou gain, le service public ne diffère en rien, scientifiquement, du service privé. Que je garde mon champ moi-même, que je paye l’homme qui le garde, que je paye l’État pour le faire garder, c’est toujours un sacrifice mis en regard d’un avantage. D’une manière ou de l’autre je perds l’effort, sans doute, mais je gagne la sécurité. Ce n’est pas une perte, c’est un échange.
Dira-t-on que je donne un objet matériel, et ne reçois rien qui ait corps et figure ? Ce serait retomber dans la fausse théorie de la valeur. Tant qu’on a attribué la valeur à la matière, non aux services, on a dû croire que tout service public était sans valeur ou perdu. Plus tard, quand on a flotté entre le vrai et le faux au sujet de la valeur, on a dû flotter aussi entre le vrai et le faux au sujet de l’impôt.
Si l’impôt n’est pas nécessairement une perte, encore moins est-il nécessairement une spoliation. [276] Sans doute, dans les sociétés modernes, la spoliation par l’impôt s’exerce sur une immense échelle. Nous le verrons plus tard ; c’est une des causes les plus actives entre toutes celles qui troublent l’équivalence des services et l’harmonie des intérêts. Mais le meilleur moyen de combattre et de détruire les abus de l’impôt, c’est de se préserver de cette exagération qui le représente comme spoliateur par essence.
Ainsi considérés en eux-mêmes, dans leur nature propre, à l’état normal, abstraction faite de tout abus, les services publics sont, comme les services privés, de purs échanges.
Mais les procédés par lesquels, dans ces deux formes de l’échange, les services se comparent, se débattent, se transmettent, s’équilibrent et manifestent leur valeur, sont si différents en eux-mêmes et quant à leurs effets, que le lecteur me permettra sans doute de traiter avec quelque étendue ce difficile sujet, un des plus intéressants qui puissent s’offrir aux méditations de l’économiste et de l’homme d’État. À vrai dire, c’est ici qu’est le nœud par lequel la politique se rattache à l’économie sociale. C’est ici qu’on peut marquer l’origine et la portée de cette erreur, la plus funeste qui ait jamais infecté la science, et qui consiste à confondre la société et le gouvernement — la société, ce tout qui embrasse à la fois les services privés et les services publics, et le gouvernement, cette fraction dans laquelle n’entrent que les services publics.
Quand, par malheur, en suivant l’école de Rousseau et de tous les républicains français ses adeptes, on se sert indifféremment des mots gouvernement et société, on décide implicitement, d’avance, sans examen, que l’État peut et doit absorber l’activité privée tout entière, la liberté, la responsabilité individuelles ; on décide que tous les services privés doivent être convertis en services publics ; on décide que l’ordre social est un fait contingent et conventionnel auquel la loi donne l’existence ; on décide l’omnipotence du législateur et la déchéance de l’humanité.
En fait, nous voyons les services publics ou l’action gouvernementale s’étendre ou se restreindre selon les temps, les lieux, les circonstances, depuis le communisme de Sparte ou des Missions du Paraguay, jusqu’à l’individualisme des États-Unis, en passant par la centralisation française.
La première question qui se présente à l’entrée de la Politique, en tant que science, est donc celle-ci :
Quels sont les services qui doivent rester dans le domaine de l’activité privée ? — quels sont ceux qui doivent appartenir à l’activité collective ou publique ?
Question qui revient à celle-ci :
Dans le grand cercle qui s’appelle société, tracer rationnellement le cercle inscrit qui s’appelle gouvernement.
Il est évident que cette question se rattache à l’économie politique, puisqu’elle exige l’étude comparée de deux formes très-différentes de l’échange.
Une fois ce problème résolu, il en reste un autre : Quelle est la meilleure organisation des services publics ? Celui-ci appartient à la politique pure, nous ne l’aborderons pas.
Examinons les différences essentielles qui caractérisent les services privés et les services publics, étude préalable nécessaire pour fixer la ligne rationnelle qui doit les séparer.
Toute la partie de cet ouvrage qui précède ce chapitre a été consacrée à montrer l’évolution du service privé. Nous l’avons vu poindre dans cette proposition formelle ou tacite : Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi ; ce qui implique, soit quant à ce qu’on cède, soit quant à ce qu’on reçoit, un double consentement réciproque. Les notions de troc, échange, appréciation, valeur, ne se peuvent donc concevoir sans liberté, non plus que celle-ci sans responsabilité. En recourant à l’échange, chaque partie consulte, à ses risques et périls, ses besoins, ses goûts, ses désirs, ses facultés, ses affections, ses convenances, l’ensemble de sa situation ; et nous n’avons nié nulle part qu’à l’exercice du libre arbitre ne s’attache la possibilité de l’erreur, la possibilité d’un choix déraisonnable ou insensé. La faute n’en est pas à l’échange, mais à l’imperfection de la nature humaine ; et le remède ne saurait être ailleurs que dans la responsabilité elle-même (c’est-à-dire dans la liberté), puisqu’elle est la source de toute expérience. Organiser la contrainte dans l’échange, détruire le libre arbitre sous prétexte que les hommes peuvent se tromper, ce ne serait rien améliorer ; à moins que l’on ne prouve que l’agent chargé de contraindre ne participe pas à l’imperfection de notre nature, n’est sujet ni aux passions ni aux erreurs, et n’appartient pas à l’humanité. N’est-il pas évident, au contraire, que ce serait non-seulement déplacer la responsabilité, mais encore l’anéantir, du moins en ce qu’elle a de plus précieux, dans son caractère rémunérateur, vengeur, expérimental, correctif et par conséquent progressif ? Nous avons vu encore que les échanges libres, ou les services librement reçus et rendus étendent sans cesse, sous l’action de la concurrence, le concours des forces gratuites proportionnellement à celui des forces onéreuses, le domaine de la communauté proportionnellement au domaine de la propriété ; et nous sommes arrivés ainsi à reconnaître, dans la liberté, la puissance qui réalise de plus en plus l’égalité en tous sens progressive, ou l’Harmonie sociale.
Quant aux procédés de l’échange libre, ils n’ont pas besoin d’être décrits, car si la contrainte a des formes infinies, la liberté n’en a qu’une. Encore une fois, la transmission libre et volontaire des services privés est définie par ces simples paroles : « Donne-moi ceci, je te donnerai cela ; — fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. » Do ut des ; facio ut facias.
Ce n’est pas ainsi que s’échangent les services publics. Ici, dans une mesure quelconque, la contrainte est inévitable, et nous devons rencontrer des formes infinies, depuis le despotisme le plus absolu, jusqu’à l’intervention la plus universelle et la plus directe de tous les citoyens.
Encore que cet idéal politique n’ait été réalisé nulle part, encore que peut-être il ne le soit jamais que d’une manière bien fictive, nous le supposerons cependant. Car que cherchons-nous ? Nous cherchons les modifications qui affectent les services quand ils entrent dans le domaine public ; et, au point de vue de la science, nous devons faire abstraction des violences particulières et locales, pour considérer le service public en lui-même et dans les circonstances les plus légitimes. En un mot, nous devons étudier la transformation qu’il subit par cela seul qu’il devient public, abstraction faite de la cause qui l’a rendu tel et des abus qui peuvent se mêler aux moyens d’exécution.
Le procédé consiste en ceci :
Les citoyens nomment des mandataires. Ces mandataires réunis décident, à la majorité, qu’une certaine catégorie de besoins, par exemple, le besoin d’instruction, ne sera plus satisfaite par le libre effort ou par le libre échange des citoyens, mais qu’il y sera pourvu par une classe de fonctionnaires spécialement délégués à cette œuvre. Voilà pour le service rendu. Quant au service reçu, comme l’État s’empare du temps et des facultés des nouveaux fonctionnaires au profit des citoyens, il faut aussi qu’il prenne des moyens d’existence aux citoyens au profit des fonctionnaires. Ce qui s’opère par une cotisation ou contribution générale.
En tout pays civilisé, cette contribution se paye en argent. Il est à peine nécessaire de faire remarquer que derrière cet argent il y a du travail. Au fond, on s’acquitte en nature. Au fond, les citoyens travaillent pour les fonctionnaires, et les fonctionnaires pour les citoyens, de même que dans les services libres les citoyens travaillent les uns pour les autres.
Nous plaçons ici cette observation pour prévenir un sophisme très-répandu, né de l’illusion monétaire. On entend souvent dire : L’argent reçu par les fonctionnaires retombe en pluie sur les citoyens. Et l’on infère de là que cette prétendue pluie est un second bien ajouté à celui qui résulte du service. En raisonnant ainsi, on est arrivé à justifier les fonctions les plus parasites. On ne prend pas garde que, si le service fut resté dans le domaine de l’activité privée, l’argent qui, au lieu d’aller au trésor et de là aux fonctionnaires, aurait été directement aux hommes qui se seraient chargés de rendre librement le service, cet argent, dis-je, serait aussi retombé en pluie dans la masse. Ce sophisme ne résiste pas quand on porte la vue au-delà de la circulation des espèces, quand on voit qu’au fond il y a du travail échangé contre du travail, des services contre des services. Dans l’ordre public, il peut arriver que des fonctionnaires reçoivent des services sans en rendre ; alors il y a perte pour le contribuable, quelque illusion que puisse nous faire à cet égard le mouvement des écus.
Quoi qu’il en soit, reprenons notre analyse :
Voici donc un échange sous une forme nouvelle. Échange implique deux termes : donner et recevoir. Examinons donc comment est affectée la transaction, de privée devenue publique, au double point de vue des services rendus et reçus.
En premier lieu, nous constatons que toujours ou presque toujours le service public éteint, en droit ou en fait, le service privé de même nature. Quand l’État se charge d’un service, généralement il a soin de décréter que nul autre que lui ne le pourra rendre, surtout s’il a en vue de se faire du même coup un revenu. Témoin la poste, le tabac, les cartes à jouer, la poudre à canon, etc. Ne prit-il pas cette précaution, le résultat serait le même. Quelle industrie peut s’occuper de rendre au public un service que l’État rend pour rien ? On ne voit guère personne chercher des moyens d’existence dans l’enseignement libre du droit ou de la médecine, dans l’exécution de grandes routes, dans l’élève d’étalons pur sang, dans la fondation d’écoles d’arts et métiers, dans le défrichement des terres algériennes, dans l’exhibition de Musées, etc., etc. Et la raison en est que le public n’ira pas acheter ce que l’État lui donne pour rien. Ainsi que le disait M. de Cormenin, l’industrie des cordonniers tomberait bien vite, fût-elle déclarée inviolable par le premier article de la Constitution, si le gouvernement s’avisait de chausser gratuitement tout le monde.
À la vérité, le mot gratuit appliqué aux services publics renferme le plus grossier et, j’ose dire, le plus puéril des sophismes.
J’admire, pour moi, l’extrême gobe-moucherie avec laquelle le public se laisse prendre à ce mot. Ne voulez-vous pas, nous dit-on, l’instruction gratuite, les haras gratuits ?
Certes, oui, j’en veux, et je voudrais aussi l’alimentation gratuite, le logement gratuit… si c’était possible.
Mais il n’y a de vraiment gratuit que ce qui ne coûte rien à personne. Or les services publics coûtent à tout le monde ; c’est parce que tout le monde les a payés d’avance qu’ils ne coûtent plus rien à celui qui les reçoit. Celui-ci, qui a payé sa part de la cotisation générale, se gardera bien d’aller se faire rendre le service, en payant, par l’industrie privée.
Ainsi le service public se substitue au service privé. Il n’ajoute rien au travail général de la nation, ni à sa richesse. Il fait faire par des fonctionnaires ce qu’eût fait l’industrie privée. Reste à savoir encore laquelle des deux opérations entraînera le plus d’inconvénients accessoires. Le but de ce chapitre est de résoudre ces questions.
Dès que la satisfaction d’un besoin devient l’objet d’un service public, elle est soustraite en grande partie au domaine de la liberté et de la responsabilité individuelles. L’individu n’est plus libre d’en acheter ce qu’il en veut, quand il le veut, de consulter ses ressources, ses convenances, sa situation, ses appréciations morales, non plus que l’ordre successif selon lequel il lui semble raisonnable de pourvoir à ses besoins. Bon gré, mal gré, il faut qu’il retire du milieu social, non cette mesure du service qu’il juge utile, ainsi qu’il le fait pour les services privés, mais la part que le gouvernement a jugé à propos de lui préparer, quelles qu’en soient la quantité et la qualité. Peut-être n’a-t-il pas du pain à sa faim, et cependant on lui prend une partie de ce pain, qui lui serait indispensable, pour lui donner une instruction ou des spectacles dont il n’a que faire. Il cesse d’exercer un libre contrôle sur ses propres satisfactions, et, n’en ayant plus la responsabilité, naturellement il cesse d’en avoir l’intelligence. La prévoyance lui devient aussi inutile que l’expérience. Il s’appartient moins, il a perdu une partie de son libre arbitre, il est moins progressif, il est moins homme. Non-seulement il ne juge plus par lui-même dans un cas donné, mais il se déshabitue de juger pour lui-même. Cette torpeur morale, qui le gagne, gagne par la même raison tous ses concitoyens ; et l’on a vu ainsi des nations entières tomber dans une funeste inertie. [277]
Tant qu’une catégorie de besoins et de satisfactions correspondantes reste dans le domaine de la liberté, chacun se fait à cet égard sa propre loi et la modifie à son gré. Cela semble naturel et juste, puisqu’il n’y a pas deux hommes qui se trouvent dans des circonstances identiques, ni un homme pour lequel les circonstances ne varient d’un jour à l’autre. Alors toutes les facultés humaines, la comparaison, le jugement, la prévoyance, restent en exercice. Alors toute bonne détermination amène sa récompense comme toute erreur son châtiment ; et l’expérience, ce rude suppléant de la prévoyance, remplit au moins sa mission, de telle sorte que la société ne peut manquer de se perfectionner.
Mais quand le service devient public, toutes les lois individuelles disparaissent pour se fondre, se généraliser dans une loi écrite, coercitive, la même pour tous, qui ne tient nul compte des situations particulières, et frappe d’inertie les plus nobles facultés de la nature humaine.
Si l’intervention de l’État nous enlève le gouvernement de nous-mêmes, relativement aux services que nous en recevons, il nous l’ôte bien plus encore quant aux services que nous lui rendons en retour. Cette contre-partie, ce complément de l’échange est encore soustrait à la liberté, pour être uniformément réglementé par une loi décrétée d’avance, exécutée par la force, et à laquelle nul ne peut se soustraire. En un mot, comme les services que l’État nous rend nous sont imposés, ceux qu’il nous demande en payement nous sont imposés aussi, et prennent même dans toutes les langues le nom d’impôts.
Ici se présentent en foule les difficultés et les inconvénients théoriques ; car pratiquement l’État surmonte tous les obstacles, au moyen d’une force armée qui est le corollaire obligé de toute loi. Pour nous en tenir à la théorie, la transformation d’un service privé en service public fait naître ces graves questions :
L’État demandera-t-il en toutes circonstances à chaque citoyen un impôt équivalent aux services rendus ? Ce serait justice, et c’est précisément cette équivalence qui se dégage avec une sorte d’infaillibilité des transactions libres, du prix débattu qui les précède. Il ne valait donc pas la peine de faire sortir une classe de services du domaine de l’activité privée, si l’État aspirait à réaliser cette équivalence, qui est la justice rigoureuse. Mais il n’y songe même pas et ne peut y songer. On ne marchande pas avec les fonctionnaires. La loi procède d’une manière générale, et ne peut stipuler des conditions diverses pour chaque cas particulier. Tout au plus, et quand elle est conçue en esprit de justice, elle cherche une sorte d’équivalence moyenne, d’équivalence approximative entre les deux natures de services échangés. Deux principes, la proportionnalité et la progression de l’impôt, ont paru, à des titres divers, porter aux dernières limites cette approximation. Mais la plus légère réflexion suffit pour montrer que l’impôt proportionnel, pas plus que l’impôt progressif, ne peut réaliser l’équivalence rigoureuse des services échangés. Les services publics, après avoir ravi aux citoyens la liberté, au double point de vue des services reçus et rendus, ont donc encore le tort de bouleverser la valeur de ces services.
Ce n’est pas un moindre inconvénient à eux de détruire le principe de la responsabilité ou du moins de la déplacer. La responsabilité ! Mais c’est tout pour l’homme : c’est son moteur, son professeur, son rémunérateur et son vengeur. Sans elle, l’homme n’a plus de libre arbitre, il n’est plus perfectible, il n’est plus un être moral, il n’apprend rien, il n’est rien. Il tombe dans l’inertie, et ne compte plus que comme une unité dans un troupeau.
Si c’est un malheur que le sens de la responsabilité s’éteigne dans l’individu, c’en est un autre qu’elle se développe exagérément dans l’État. À l’homme, même abruti, il reste assez de lumière pour apercevoir d’où lui viennent les biens et les maux ; et quand l’État se charge de tout, il devient responsable de tout. Sous l’empire de ces arrangements artificiels, un peuple qui souffre ne peut s’en prendre qu’à son gouvernement ; et son seul remède comme sa seule politique est de le renverser. De là un inévitable enchaînement de révolutions. Je dis inévitable, car sous ce régime le peuple doit nécessairement souffrir : la raison en est que le système des services publics, outre qu’il trouble le nivellement des valeurs, ce qui est injustice, amène aussi une déperdition fatale de richesse, ce qui est ruine ; ruine et injustice, c’est souffrance et mécontentement — quatre funestes ferments dans la société, lesquels, combinés avec le déplacement de la responsabilité, ne peuvent manquer d’amener ces convulsions politiques dont nous sommes, depuis plus d’un demi-siècle, les malheureux témoins.
Je ne voudrais pas m’écarter de mon sujet. Je ne puis cependant m’empêcher de faire remarquer que, lorsque les choses sont ainsi organisées, lorsque le gouvernement a pris des proportions gigantesques par la transformation successive des transactions libres en services publics, il est à craindre que les révolutions, qui sont, par elles-mêmes, un si grand mal, n’aient pas même l’avantage d’être un remède, sinon à force d’expériences. Le déplacement de la responsabilité a faussé l’opinion populaire. Le peuple, accoutumé à tout attendre de l’État, ne l’accuse pas de trop faire, mais de ne pas faire assez. Il le renverse et le remplace par un autre, auquel il ne dit pas : Faites moins, mais : Faites plus ; et c’est ainsi que l’abîme se creuse et se creuse encore.
Le moment vient-il enfin où les yeux s’ouvrent ? Sent-on qu’il faut en venir à diminuer les attributions et la responsabilité de l’État ? On est arrêté par d’autres difficultés. D’un côté, les Droits acquis [FEE = vested interests, p. 453] se soulèvent et se coalisent ; on répugne à froisser une foule d’existences auxquelles on a donné une vie artificielle. — D’un autre côté, le public a désappris à agir par lui-même. Au moment de reconquérir cette liberté qu’il a si ardemment poursuivie, il en a peur, il la repousse. Allez donc lui offrir la liberté d’enseignement ? [278] Il croira que toute science va s’éteindre. Allez donc lui offrir la liberté religieuse ? Il croira que l’athéisme va tout envahir. On lui a tant dit et répété que toute religion, toute sagesse, toute science, toute lumière, toute morale réside dans l’État ou en découle !
Mais ces considérations reviendront ailleurs, et je rentre dans mon sujet. [50]
Nous nous sommes appliqués à découvrir le vrai rôle de la concurrence dans le développement des richesses. Nous avons vu qu’il consistait à faire glisser le bien sur le producteur, à faire tourner le progrès au profit de la communauté, à élargir sans cesse le domaine de la gratuité et, par suite, de l’égalité.
Mais quand les services privés deviennent publics, ils échappent à la concurrence, et cette belle harmonie est suspendue. En effet, le fonctionnaire est dénué de ce stimulant qui pousse au progrès, et comment le progrès tournerait-il à l’avantage commun quand il n’existe même pas ? Le fonctionnaire n’agit pas sous l’aiguillon de l’intérêt, mais sous l’influence de la loi. La loi lui dit : « Vous rendrez au public tel service déterminé, et vous recevrez de lui tel autre service déterminé. » Un peu plus, un peu moins de zèle ne change rien à ces deux termes fixes. Au contraire, l’intérêt privé souffle à l’oreille du travailleur libre ces paroles : « Plus tu feras pour les autres, plus les autres feront pour toi. » Ici la récompense dépend entièrement de l’effort plus ou moins intense, plus ou moins éclairé. Sans doute l’esprit de corps, le désir de l’avancement, l’attachement au devoir, peuvent être pour le fonctionnaire d’actifs stimulants. Mais jamais ils ne peuvent remplacer l’irrésistible incitation de l’intérêt personnel. L’expérience confirme à cet égard le raisonnement. Tout ce qui est tombé dans le domaine du fonctionnarisme est à peu près stationnaire ; il est douteux qu’on enseigne mieux aujourd’hui que du temps de François Ier ; et je ne pense pas que personne s’avise de comparer l’activité des bureaux ministériels à celle d’une manufacture.
À mesure donc que des services privés entrent dans la classe des services publics, ils sont frappés, au moins dans une certaine mesure, d’immobilisme et de stérilité, non au préjudice de ceux qui les rendent (leurs appointements ne varient pas), mais au détriment de la communauté tout entière.
À côté de ces inconvénients, qui sont immenses tant au point de vue moral et politique qu’au point de vue économique, inconvénients que je n’ai fait qu’esquisser, comptant sur la sagacité du lecteur, il y a quelquefois avantage à substituer l’action collective à l’action individuelle. Il y a telle nature de services dont le principal mérite est la régularité et l’uniformité. Il se peut même, qu’en quelques circonstances, cette substitution réalise une économie de ressorts et épargne, pour une satisfaction donnée, une certaine somme d’efforts à la communauté. La question à résoudre est donc celle-ci : Quels services doivent rester dans le domaine de l’activité privée ? quels services doivent appartenir à l’activité collective ou publique ? L’étude que nous venons de faire des différences essentielles qui caractérisent les deux natures de services nous facilitera la solution de ce grave problème.
Et d’abord, y a-t-il quelque principe au moyen duquel on puisse distinguer ce qui peut légitimement entrer dans le cercle de l’activité collective, et ce qui doit rester dans le cercle de l’activité privée ?
Je commence par déclarer que j’appelle ici activité collective cette grande organisation qui a pour règle la loi et pour moyen d’exécution la force, en d’autres termes, le gouvernement. Qu’on ne me dise pas que les associations libres et volontaires manifestent aussi une activité collective. Qu’on ne suppose pas que je donne aux mots activité privée le sens d’action isolée. Non. Mais je dis que l’association libre et volontaire appartient encore à l’activité privée, car c’est un des modes, et le plus puissant, de l’échange. Il n’altère pas l’équivalence des services, il n’affecte pas la libre appréciation des valeurs, il ne déplace pas les responsabilités, il n’anéantit pas le libre arbitre, il ne détruit ni la concurrence ni ses effets, en un mot, il n’a pas pour principe la contrainte.
Mais l’action gouvernementale se généralise par la contrainte. Elle invoque nécessairement le compelle intrare. Elle procède en vertu d’une loi, et il faut que tout le monde se soumette, car loi implique sanction. Je ne pense pas que personne conteste ces prémisses ; je les mettrais sous la sauvegarde de la plus imposante des autorités, celle du fait universel. Partout il y a des lois et des forces pour y ramener les récalcitrants.
Et c’est de là, sans doute, que vient cet axiome à l’usage de ceux qui, confondant le gouvernement avec la Société, croient que celle-ci est factice et de convention comme celui-là : « Les hommes, en se réunissant en société, ont sacrifié une partie de leur liberté pour conserver l’autre. »
Évidemment cet axiome est faux dans la région des transactions libres et volontaires. Que deux hommes, déterminés par la perspective d’un résultat plus avantageux, échangent leurs services ou associent leurs efforts au lieu de travailler isolément : où peut-on voir là un sacrifice de liberté ? Est-ce sacrifier la liberté que d’en faire un meilleur usage ?
Tout au plus pourrait-on dire : « Les hommes sacrifient une partie de leur liberté pour conserver l’autre, non point quand ils se réunissent en société, mais quand ils se soumettent à un gouvernement, puisque le mode nécessaire d’action d’un gouvernement, c’est la force. »
Or, même avec cette modification, le prétendu axiome est encore une erreur, quand le gouvernement reste dans ses attributions rationnelles.
Mais quelles sont ces attributions ?
C’est justement ce caractère spécial, d’avoir pour auxiliaire obligé la force, qui doit nous en révéler l’étendue et les limites. Je dis : Le gouvernement n’agit que par l’intervention de la force, donc son action n’est légitime que là où l’intervention de la force est elle-même légitime.
Or, quand la force intervient légitimement, ce n’est pas pour sacrifier la liberté, mais pour la faire respecter.
De telle sorte que cet axiome, qu’on a donné pour base à la science politique, déjà faux de la société, l’est encore du gouvernement. C’est toujours avec bonheur que je vois ces tristes discordances théoriques disparaître devant un examen approfondi.
Dans quel cas l’emploi de la force est-il légitime ? Il y en a un, et je crois qu’il n’y en a qu’un : le cas de légitime défense. S’il en est ainsi, la raison d’être des gouvernements est trouvée, ainsi que leur limite rationnelle. [279]
Quel est le droit de l’individu ? C’est de faire avec ses semblables des transactions libres, d’où suit pour ceux-ci un droit réciproque. Quand est-ce que ce droit est violé ? Quand l’une des parties entreprend sur la liberté de l’autre. En ce cas il est faux de dire, comme on le fait souvent : « Il y a des excès, abus de liberté. » Il faut dire : « Il y a défaut, destruction de liberté. » Excès de liberté sans doute si on ne regarde que l’agresseur ; destruction de liberté si l’on regarde la victime, ou même si l’on considère, comme on le doit, l’ensemble du phénomène.
Le droit de celui dont on attaque la liberté, ou, ce qui revient au même, la propriété, les facultés, le travail, est de les défendre même par la force ; et c’est ce que font tous les hommes, partout et toujours quand ils le peuvent.
De là découle, pour un nombre d’hommes quelconque, le droit de se concerter, de s’associer, pour défendre, même par la force commune, les libertés et les propriétés individuelles.
Mais l’individu n’a pas le droit d’employer la force à une autre fin. Je ne puis légitimement forcer mes semblables à être laborieux, sobres, économes, généreux, savants, dévots ; mais je puis légitimement les forcer à être justes.
Par la même raison, la force collective ne peut être légitimement appliquée à développer l’amour du travail, la sobriété, l’économie, la générosité, la science, la foi religieuse ; mais elle peut l’être légitimement à faire régner la justice, à maintenir chacun dans son droit.
Car où pourrait-on chercher l’origine du droit collectif ailleurs que dans le droit individuel ?
C’est la déplorable manie de notre époque de vouloir donner une vie propre à de pures abstractions, d’imaginer une cité en dehors des citoyens, une humanité en dehors des hommes, un tout en dehors de ses parties, une collectivité en dehors des individualités qui la composent. J’aimerais autant que l’on me dise : « Voilà un homme, anéantissez par la pensée ses membres, ses viscères, ses organes, son corps et son âme, tous les éléments dont il est formé ; il reste toujours un homme. »
Si un droit n’existe dans aucun des individus dont, pour abréger, on nomme l’ensemble une nation, comment existerait-il dans la nation ? Comment existerait-il surtout dans cette fraction de la nation qui n’a que des droits délégués, dans le gouvernement ? Comment les individus peuvent-ils déléguer des droits qu’ils n’ont pas ?
Il faut donc regarder comme le principe fondamental de toute politique cette incontestable vérité :
Entre individus, l’intervention de la force n’est légitime que dans le cas de légitime défense. La collectivité ne saurait recourir légalement à la force que dans la même limite.
Or, il est dans l’essence même du gouvernement d’agir sur les citoyens par voie de contrainte. Donc il ne peut avoir d’autres attributions rationnelles que la légitime défense de tous les droits individuels, il ne peut être délégué que pour faire respecter les libertés et les propriétés de tous.
Remarquez que, lorsqu’un gouvernement sort de ces bornes, il entre dans une carrière sans limite, sans pouvoir échapper à cette conséquence, non-seulement d’outre-passer sa mission, mais de l’anéantir, ce qui constitue la plus monstrueuse des conditions.
En effet, quand l’État a fait respecter cette ligne fixe, invariable, qui sépare les droits des citoyens, quand il a maintenu parmi eux la justice, que peut-il faire de plus sans violer lui-même cette barrière dont la garde lui est confiée, sans détruire de ses propres mains, et par la force, les libertés et les propriétés qui avaient été placées sous sa sauvegarde ? Au delà de la justice, je défie qu’on imagine une intervention gouvernementale qui ne soit une injustice. Alléguez tant que vous voudrez des actes inspirés par la plus pure philanthropie, des encouragements à la vertu, au travail, des primes, des faveurs, des protections directes, des dons prétendus gratuits, des initiatives dites généreuses ; derrière ces belles apparences, ou, si vous voulez, derrière ces belles réalités, je vous montrerai d’autres réalités moins satisfaisantes : les droits des uns violés pour l’avantage des autres, des libertés sacrifiées, des propriétés usurpées, des facultés limitées, des spoliations consommées. Et le monde peut-il être témoin d’un spectacle plus triste, plus douloureux, que celui de la force collective occupée à perpétrer les crimes qu’elle était chargée de réprimer ?
En principe, il suffit que le gouvernement ait pour instrument nécessaire la force pour que nous sachions enfin quels sont les services privés qui peuvent être légitimement convertis en services publics. Ce sont ceux qui ont pour objet le maintien de toutes les libertés, de toutes les propriétés, de tous les droits individuels, la prévention des délits et des crimes, en un mot, tout ce qui concerne la sécurité publique.
Les gouvernements ont encore une autre mission.
En tous pays, il y a quelques propriétés communes, des biens dont tous les citoyens jouissent par indivis, des rivières, des forêts, des routes. Par contre, et malheureusement, il y a aussi des dettes. Il appartient au gouvernement d’administrer cette portion active et passive du domaine public.
Enfin, de ces deux attributions en découle une autre :
Celle de percevoir les contributions indispensables à la bonne exécution des services publics.
Ainsi :
Veiller à la sécurité publique ;
Administrer le domaine commun ;
Percevoir les contributions.
Tel est, je crois, le cercle rationnel dans lequel doivent être circonscrites ou ramenées les attributions gouvernementales.
Cette opinion, je le sais, heurte beaucoup d’idées reçues.
« Quoi ! dira-t-on, vous voulez réduire le gouvernement au rôle de juge et de gendarme ? Vous le dépouillez de toute initiative ! Vous lui interdisez de donner une vive impulsion aux lettres, aux arts, au commerce, à la navigation, à l’agriculture, aux idées morales et religieuses ; vous le dépouillez de son plus bel attribut, celui d’ouvrir au peuple la voie du progrès ! »
À ceux qui s’expriment ainsi, j’adresserai quelques questions.
Où Dieu a-t-il placé le mobile des actions humaines et l’aspiration vers le progrès ? Est-ce dans tous les hommes ? ou seulement dans ceux d’entre eux qui ont reçu ou usurpé un mandat de législateur ou un brevet de fonctionnaire ? Est-ce que chacun de nous ne porte pas dans son organisation, dans tout son être, ce moteur infatigable et illimité qu’on appelle le désir ? Est-ce qu’à mesure que les besoins les plus grossiers sont satisfaits, il ne se forme pas en nous des cercles concentriques et expansifs de désirs d’un ordre de plus en plus élevé ? Est-ce que l’amour des arts, des lettres, des sciences, de la vérité morale et religieuse, est-ce que la soif des solutions, qui intéressent notre existence présente ou future, descend de la collectivité à l’individualité, c’est-à-dire de l’abstraction à la réalité, et d’un pur mot aux êtres sentants et vivants ?
Si vous partez de cette supposition déjà absurde, que l’activité morale est dans l’État et la passiveté dans la nation, ne mettez-vous pas les mœurs, les doctrines, les opinions, les richesses, tout ce qui constitue la vie individuelle, à la merci des hommes qui se succèdent au pouvoir ?
Ensuite, l’État, pour remplir la tâche immense que vous voulez lui confier, a-t-il quelques ressources qui lui soient propres ? N’est-il pas obligé de prendre tout ce dont il dispose, jusqu’à la dernière obole, aux citoyens eux-mêmes ? Si c’est aux individualités qu’il demande des moyens d’exécution, ce sont donc les individualités qui ont réalisé ces moyens. C’est donc une contradiction de prétendre que l’individualité est passive et inerte. Et pourquoi l’individualité avait-elle créé des ressources ? Pour aboutir à des satisfactions de son choix. Que fait donc l’État quand il s’empare de ces ressources ? Il ne donne pas l’être à des satisfactions, il les déplace. Il en prive celui qui les avait méritées pour en doter celui qui n’y avait aucun droit. Il systématise l’injustice, lui qui était chargé de le châtier.
Dira-t-on qu’en déplaçant les satisfactions, il les épure et les moralise ? Que des richesses que l’individualité aurait consacrées à des besoins grossiers, l’État les voue à des besoins moraux ? Mais qui osera affirmer que c’est un avantage d’intervertir violemment par la force, par voie de spoliation, l’ordre naturel selon lequel les besoins et les désirs se développent dans l’humanité ? qu’il est moral de prendre un morceau de son pain au paysan qui a faim, pour mettre à la portée du citadin la douteuse moralité des spectacles ?
Et puis on ne déplace pas les richesses sans déplacer le travail et la population. C’est donc toujours un arrangement factice et précaire, substitué à cet ordre solide et régulier qui repose sur les immuables lois de la nature.
Il y en a qui croient qu’un gouvernement circonscrit en est plus faible. Il leur semble que de nombreuses attributions et de nombreux agents donnent à l’État la stabilité d’une large base. Mais c’est là une pure illusion. Si l’État ne peut sortir d’un cercle déterminé sans se transformer en instrument d’injustice, de ruine et de spoliation, sans bouleverser la naturelle distribution du travail, des jouissances, des capitaux et des bras, sans créer des causes actives de chômages, de crises industrielles et de paupérisme, sans augmenter la proportion des délits et des crimes, sans recourir à des moyens toujours plus énergiques de répression, sans exciter le mécontentement et la désaffection, comment sortira-t-il une garantie de stabilité de ces éléments amoncelés de désordre ?
On se plaint des tendances révolutionnaires des hommes. Assurément on n’y réfléchit pas. Quand on voit, chez un grand peuple, les services privés envahis et convertis en services publics, le gouvernement s’emparer du tiers des richesses produites par les citoyens, la loi devenue une arme de spoliation entre les mains des citoyens eux-mêmes, parce qu’elle a pour objet d’altérer, sous prétexte de l’établir, l’équivalence des services ; quand on voit la population et le travail législativement déplacés, un abîme de plus en plus profond se creuser entre l’opulence et la misère, le capital ne pouvant s’accumuler pour donner du travail aux générations croissantes, des classes entières vouées aux plus dures privations ; quand on voit les gouvernements, afin de pouvoir s’attribuer le peu de bien qui se fait, se proclamer mobiles universels, acceptant ainsi la responsabilité du mal, on est étonné que les révolutions ne soient pas plus fréquentes, et l’on admire les sacrifices que les peuples savent faire à l’ordre et à la tranquillité publique.
Que si les Lois et les Gouvernements qui en sont les organes se renfermaient dans les limites que j’ai indiquées, je me demande d’où pourraient venir les révolutions. Si chaque citoyen était libre, il souffrirait moins sans doute, et si, en même temps, il sentait la responsabilité qui le presse de toutes parts, comment lui viendrait l’idée de s’en prendre de ses souffrances à une Loi, à un Gouvernement qui ne s’occuperait de lui que pour réprimer ses injustices et le protéger contre les injustices d’autrui ? A-t-on jamais vu un village s’insurger contre son juge de paix ?
L’influence de la liberté sur l’ordre est sensible aux États-Unis. Là, sauf la Justice, sauf l’administration des propriétés communes, tout est laissé aux libres et volontaires transactions des hommes, et nous sentons tous instinctivement que c’est le pays du monde qui offre aux révolutions le moins d’éléments et de chances. Quel intérêt, même apparent, y peuvent avoir les citoyens à changer violemment l’ordre établi, quand d’un côté cet ordre ne froisse personne, et que d’autre part il peut être légalement modifié au besoin avec la plus grande facilité ?
Je me trompe, il y a deux causes actives de révolutions aux États-Unis : l’Esclavage et le Régime restrictif. Tout le monde sait qu’à chaque instant ces deux questions mettent en péril la paix publique et le lien fédéral. Or, remarquez-le bien, peut-on alléguer, en faveur de ma thèse, un argument plus décisif ? Ne voit-on pas ici la loi agissant en sens inverse de son but ? Ne voit-on pas ici la Loi et la Force publique, dont la mission devrait être de protéger les libertés et les propriétés, sanctionner, corroborer, perpétuer, systématiser et protéger l’oppression et la spoliation ? Dans la question de l’esclavage, la loi dit : « Je créerai une force, aux frais des citoyens, non afin qu’elle maintienne chacun dans son droit, mais pour qu’elle anéantisse dans quelques-uns tous les droits. » Dans la question des tarifs la loi dit : « Je créerai une force, aux frais des citoyens, non pour que leurs transactions soient libres, mais pour qu’elles ne le soient pas, pour que l’équivalence des services soit altérée, pour qu’un citoyen ait la liberté de deux, et qu’un autre n’en ait pas du tout. Je me charge de commettre ces injustices, que je punirais des plus sévères châtiments si les citoyens se les permettaient sans mon aveu. »
Ce n’est donc pas parce qu’il y a peu de lois et de fonctionnaires, autrement dit, peu de services publics, que les révolutions sont à craindre. C’est, au contraire, parce qu’il y a beaucoup de lois, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de services publics. Car, par leur nature, les services publics, la loi qui les règle, la force qui les fait prévaloir, ne sont jamais neutres. Ils peuvent, ils doivent s’étendre sans danger, avec avantage, autant qu’il est nécessaire pour faire régner entre tous la justice rigoureuse : au delà, ce sont autant d’instruments d’oppression et de spoliation légales, autant de causes de désordre, autant de ferments révolutionnaires.
Parlerai-je de cette délétère immoralité qui filtre dans toutes les veines du corps social, quand, en principe, la loi se met au service de tous les penchants spoliateurs ? Assistez à une séance de la Représentation nationale, le jour où il est question de primes, d’encouragements, de faveurs, de restrictions. Voyez avec quelle rapacité éhontée chacun veut s’assurer une part du vol, vol auquel, certes, on rougirait de se livrer personnellement. Tel se considérerait comme un bandit s’il m’empêchait, le pistolet au poing, d’accomplir à la frontière une transaction conforme à mes intérêts ; mais il ne se fait aucun scrupule de solliciter et de voter une loi qui substitue la force publique à la sienne, et me soumette, à mes propres frais, à cette injuste interdiction. Sous ce rapport, quel triste spectacle offre maintenant la France ! Toutes les classes souffrent, et, au lieu de demander l’anéantissement, à tout jamais, de toute spoliation légale, chacune se tourne vers la loi, lui disant : « Vous qui pouvez tout, vous qui disposez de la Force, vous qui convertissez le mal en bien, de grâce, spoliez les autres classes à mon profit. Forcez-les à s’adresser à moi pour leurs achats, ou bien à me payer des primes, ou bien à me donner l’instruction gratuite, ou bien à me prêter sans intérêts, etc, etc…. » C’est ainsi que la loi devient une grande école de démoralisation ; et si quelque chose doit nous surprendre, c’est que le penchant au vol individuel ne fasse pas plus de progrès, quand le sens moral des peuples est ainsi perverti par leur législation même.
Ce qu’il y a de plus déplorable, c’est que la spoliation, quand elle s’exerce ainsi à l’aide de la loi, sans qu’aucun scrupule individuel lui fasse obstacle, finit par devenir toute une savante théorie qui a ses professeurs, ses journaux, ses docteurs, ses législateurs, ses sophismes, ses subtilités. Parmi les arguties traditionnelles qu’on fait valoir en sa faveur, il est bon de discerner celle-ci : Toutes choses égales d’ailleurs, un accroissement de demande est un bien pour ceux qui ont un service à offrir ; puisque ce nouveau rapport entre une demande plus active et une offre stationnaire est ce qui augmente la valeur du service. De là on tire cette conclusion : La spoliation est avantageuse à tout le monde : à la classe spoliatrice qu’elle enrichit directement, aux classes spoliées qu’elle enrichit par ricochet. En effet, la classe spoliatrice, devenue plus riche, est en mesure d’étendre le cercle de ses jouissances. Elle ne le peut sans demander, dans une plus grande proportion, les services des classes spoliées. Or, relativement à tout service, accroissement de demande, c’est accroissement de valeur. Donc les classes légèrement volées sont trop heureuses de l’être, puisque le produit du vol concourt à les faire travailler.
Tant que la loi s’est bornée à spolier le grand nombre au profit du petit nombre, cette argutie a paru fort spécieuse et a toujours été invoquée avec succès. « Livrons aux riches des taxes mises sur les pauvres, disait-on ; par là nous augmenterons le capital des riches. Les riches s’adonneront au luxe, et le luxe donnera du travail aux pauvres. » Et chacun, les pauvres compris, de trouver le procédé infaillible. Pour avoir essayé d’en signaler le vice, j’ai passé longtemps, je passe encore pour un ennemi des classes laborieuses.
Mais, après la Révolution de Février, les pauvres ont eu voix au chapitre quand il s’est agi de faire la loi. Ont-ils demandé qu’elle cessât d’être spoliatrice ? Pas le moins du monde ; le sophisme des ricochets était trop enraciné dans leur tête. Qu’ont-ils donc demandé ? Que la loi, devenue impartiale, voulût bien spolier les classes riches à leur tour. Ils ont réclamé l’instruction gratuite, des avances gratuites de capitaux, des caisses de retraite fondées par l’État, l’impôt progressif, etc. Les riches se sont mis à crier : « O scandale ! Tout est perdu ! De nouveaux barbares font irruption dans la société ! » Ils ont opposé aux prétentions des pauvres une résistance désespérée. On s’est battu d’abord à coups de fusil ; on se bat à présent à coups de scrutin. Mais les riches ont-ils renoncé pour cela à la spoliation ? Ils n’y ont pas seulement songé. L’argument des ricochets continue à leur servir de prétexte.
On pourrait cependant leur faire observer que si, au lieu d’exercer la spoliation par l’intermédiaire de la loi, ils l’exerçaient directement, leur sophisme s’évanouirait : Si, de votre autorité privée, vous preniez dans la poche d’un ouvrier un franc qui facilitât votre entrée au théâtre, seriez-vous bien venu à dire à cet ouvrier : « Mon ami, ce franc va circuler et va donner du travail à toi et à tes frères ? » Et l’ouvrier ne serait-il pas fondé à répondre : « Ce franc circulera de même si vous ne me le volez pas ; il ira au boulanger au lieu d’aller au machiniste ; il me procurera du pain au lieu de vous procurer des spectacles ? »
Il faut remarquer, en outre, que le sophisme des ricochets pourrait être aussi bien invoqué par les pauvres. Ils pourraient dire aux riches : « Que la loi nous aide à vous voler. Nous consommerons plus de drap, cela profitera à vos manufactures ; nous consommerons plus de viande, cela profitera à vos terres ; nous consommerons plus de sucre, cela profitera à vos armements. »
Malheureuse, trois fois malheureuse la nation où les questions se posent ainsi ; où nul ne songe à faire de la loi la règle de la justice ; où chacun n’y cherche qu’un instrument de vol à son profit, et où toutes les forces intellectuelles s’appliquent à trouver des excuses dans les effets éloignés et compliqués de la spoliation !
À l’appui des réflexions qui précédent, il ne sera peut-être pas inutile de donner ici un extrait de la discussion qui eut lieu au Conseil général des Manufactures, de l’Agriculture et du Commerce, le samedi 27 avril 1850. [280]
XVIII. Causes perturbatrices↩
Où en serait l’humanité si jamais et sous aucune forme la force, la ruse, l’oppression, la fraude ne fussent venues entacher les transactions qui s’opèrent dans son sein ?
La Justice et la Liberté auraient-elles produit fatalement l’Inégalité et le Monopole ?
Pour le savoir, il fallait, ce me semble, étudier la nature même des transactions humaines, leur origine, leur raison, leurs conséquences et les conséquences de ces conséquences jusqu’à l’effet définitif ; et cela, abstraction faite des perturbations contingentes que peut engendrer l’injustice ; — car on conviendra bien que l’Injustice n’est pas l’essence des transactions libres et volontaires.
Que l’injustice se soit fatalement introduite dans le monde, que la société n’ait pas pu y échapper, on peut le soutenir ; et, l’homme étant donné avec ses passions, son égoïsme, son ignorance et son imprévoyance primitives, je le crois. — Nous aurons à étudier aussi la nature, l’origine et les effets de l’Injustice.
Mais il n’en est pas moins vrai que la science économique doit commencer par exposer la théorie des transactions humaines supposées libres et volontaires, comme la physiologie expose la nature et les rapports des organes, abstraction faite des causes perturbatrices qui modifient ces rapports.
Nous croyons que les services s’échangent contre les services ; nous croyons que le grand desideratum, c’est l’équivalence des services échangés :
Nous croyons que la meilleure chance peut arriver à cette équivalence, c’est qu’elle se produise sous l’influence de la Liberté et que chacun juge par lui-même.
Nous savons que les hommes peuvent se tromper ; mais nous savons aussi qu’ils peuvent se rectifier ; et nous croyons que plus l’erreur a persisté, plus la rectification approche.
Nous croyons que tout ce qui gêne la Liberté trouble l’équivalence des services, et que tout ce qui trouble l’équivalence des services engendre l’inégalité exagérée, l’opulence imméritée des uns, la misère non moins imméritée des autres, avec une déperdition générale de richesses, les haines, les discordes, les luttes, les révolutions.
Nous n’allons pas jusqu’à dire que la Liberté — ou l’équivalence des services — produit l’égalité absolue ; car nous ne croyons à rien d’absolu en ce qui concerne l’homme. Mais nous pensons que la liberté tend à rapprocher tous les hommes d’un niveau mobile qui s’élève toujours.
Nous croyons que l’inégalité qui peut rester encore sous un régime libre est ou le produit de circonstances accidentelles, ou le châtiment des fautes et des vices, ou la compensation d’autres avantages opposés à ceux de la richesse ; et que par conséquent elle ne saurait introduire parmi les hommes le sentiment de l’irritation.
Enfin nous croyons que Liberté c’est Harmonie…
Mais pour savoir si cette harmonie existe dans la réalité ou dans notre imagination, si elle est en nous une perception ou une simple aspiration, il fallait soumettre les transactions libres à l’épreuve d’une étude scientifique ; il fallait étudier les faits, leurs rapports et leurs conséquences.
C’est ce que nous avons fait.
Nous avons vu que si des obstacles sans nombre s’interposaient entre les besoins de l’homme et ses satisfactions, de telle sorte que dans l’isolement il devait succomber, — l’union des forces, la séparation des occupations, en un mot l’échange, développait assez de facultés pour qu’il pût successivement renverser les premiers obstacles, s’attaquer aux seconds, les renverser encore, et ainsi de suite, dans une progression d’autant plus rapide que par la densité de la population l’échange devient plus facile.
Nous avons vu que son intelligence met à sa disposition des moyens d’action de plus en plus nombreux, énergiques et perfectionnés ; qu’à mesure que le Capital s’accroît, sa part absolue dans la production augmente, mais sa part relative diminue, tandis que la part absolue comme la part relative du travail actuel va toujours croissant ; première et puissante cause d’égalité.
Nous avons vu que cet instrument admirable qu’on nomme la terre, ce laboratoire merveilleux où se prépare tout ce qui sert à alimenter, vêtir et abriter les hommes, leur avait été donné gratuitement par le Créateur ; qu’encore qu’il fût nominalement approprié, son action productive ne pouvait l’être, qu’elle restait gratuite à travers toutes les transactions humaines.
Nous avons vu que la Propriété n’avait pas seulement cet effet négatif de ne pas entreprendre sur la Communauté, mais qu’elle travaillait directement et sans cesse à l’élargir ; seconde cause d’égalité, puisque, plus le fonds commun est abondant, plus l’inégalité des propriétés s’efface.
Nous avons vu que sous l’influence de la liberté les services tendent à acquérir leur valeur normale, c’est-à-dire proportionnelle au travail ; troisième cause d’égalité.
Nous nous sommes ainsi assuré qu’un niveau naturel tendait à s’établir parmi les hommes, non en les refoulant vers un état rétrograde ou en les laissant dans une situation stationnaire, mais en les appelant vers un milieu constamment progressif.
Enfin nous avons vu que ni les lois de la Valeur, de l’Intérêt, de la Rente, de la Population, ni aucune autre grande loi naturelle, ne venaient, ainsi que l’assure la science incomplète, introduire la dissonance dans ce bel ordre social, puisqu’au contraire l’harmonie résultait de ces lois.
Parvenu à ce point, il me semble que j’entends le lecteur s’écrier : « Voilà bien l’optimisme des Économistes ! C’est en vain que la souffrance, la misère, le prolétariat, le paupérisme, l’abandon des enfants, l’inanition, la criminalité, la rébellion, l’inégalité, leur crèvent les yeux ; ils se complaisent à chanter l’harmonie des lois sociales, et détournent leurs regards des faits pour qu’un hideux spectacle ne trouble pas la jouissance qu’ils trouvent dans leur système. Ils fuient le monde des réalités pour se réfugier, eux aussi, comme les utopistes qu’ils blâment, dans le monde des chimères. Plus illogiques que les Socialistes, que les Communistes eux-mêmes, — qui voient le mal, le sentent, le décrivent, l’abhorrent, et n’ont que le tort d’indiquer des remèdes inefficaces, impraticables ou chimériques, — les économistes ou nient le mal ou y sont insensibles, si même ils ne l’engendrent pas, en criant à la société malade : « Laissez faire, laissez passer ; tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. »
Au nom de la science, je repousse de toute mon énergie de tels reproches, de telles interprétations de nos paroles. Nous voyons le mal comme nos adversaires, comme eux nous le déplorons, comme eux nous nous efforçons d’en comprendre les causes, comme eux nous sommes prêts à les combattre. Mais nous posons la question autrement qu’eux. La société, disent-ils, telle que l’a faite la liberté du travail et des transactions, c’est-à-dire le libre jeu des lois naturelles, est détestable. Donc il faut arracher du mécanisme ce rouage malfaisant, la liberté (qu’ils ont soin de nommer concurrence, et même concurrence anarchique), et y substituer par force des rouages artificiels de notre invention. — Là-dessus, des millions d’inventions se présentent. C’est bien naturel, car les espaces imaginaires n’ont pas de limites.
Nous, après avoir étudié les lois providentielles de la société, nous disons : Ces lois sont harmoniques. Elles admettent le mal, car elles sont mises en œuvre par des hommes, c’est-à-dire, par des êtres sujets à l’erreur et à la douleur. Mais le mal aussi a, dans le mécanisme, sa mission qui est de se limiter et de se détruire lui-même en préparant à l’homme des avertissements, des corrections, de l’expérience, des lumières, toutes choses qui se résument en ce mot : Perfectionnement.
Nous ajoutons : Il n’est pas vrai que la liberté règne parmi les hommes ; il n’est pas vrai que les lois providentielles exercent toute leur action, ou du moins, si elles agissent, c’est pour réparer lentement, péniblement l’action perturbatrice de l’ignorance et de l’erreur. — Ne nous accusez donc pas quand nous disons laissez faire ; car nous n’entendons pas dire par là : laissez faire les hommes, alors même qu’ils font le mal. Nous entendons dire : étudiez les lois providentielles, admirez-les et laissez-les agir. Dégagez les obstacles qu’elles rencontrent dans les abus de la force et de la ruse, et vous verrez s’accomplir au sein de l’humanité cette double manifestation du progrès : l’égalisation dans l’amélioration.
Car enfin, de deux choses l’une : ou les intérêts des hommes sont concordants, ou ils sont discordants par essence. Qui dit Intérêt dit une chose vers laquelle les hommes gravitent invinciblement, sans quoi ce ne serait pas l’intérêt ; et s’ils gravitaient vers autre chose, c’est cette autre chose qui serait l’intérêt. Donc, si les intérêts sont concordants, il suffit qu’ils soient compris pour que le bien et l’harmonie se réalisent, puisque les hommes s’y abandonnent naturellement. C’est ce que nous soutenons, et c’est pourquoi nous disons : Éclairez et laissez faire. — Si les intérêts sont discordants par nature, alors vous avez raison ; il n’y a d’autre moyen de produire l’harmonie que de violenter, froisser et contrarier tous les intérêts. Bizarre harmonie néanmoins que celle qui ne peut résulter que d’une action extérieure et despotique contraire aux intérêts de tous ! Car vous comprenez bien que les hommes ne se laisseront pas froisser docilement ; et, pour qu’ils se plient à vos inventions, il faut que vous commenciez par être plus forts qu’eux tous ensemble, — ou bien il faut que vous parveniez à les tromper sur leurs véritables intérêts. En effet, dans l’hypothèse où les intérêts sont naturellement discordants, ce qu’il y aurait de plus heureux c’est que les hommes se trompassent tous à cet égard.
La force et l’imposture, voilà donc vos seules ressources. Je vous défie d’en trouver d’autres, à moins de convenir que les intérêts sont concordants ; et, si vous en convenez, vous êtes avec nous, et comme nous vous devez dire : Laissez agir les lois providentielles.
Or vous ne le voulez pas. — Il faut bien le répéter : Votre point de départ est que les intérêts sont antagoniques ; c’est pourquoi vous ne voulez pas les laisser s’entendre et s’arranger entre eux ; c’est pourquoi vous ne voulez pas la liberté ; c’est pourquoi vous voulez l’arbitraire. — Vous êtes conséquents.
Mais prenez garde. La lutte ne va pas s’établir seulement entre vous et l’humanité. Celle-là vous l’acceptez, puisque votre but est justement de froisser les intérêts. Elle va s’établir aussi au milieu de vous, entre vous, inventeurs, entrepreneurs de sociétés ; car vous êtes mille, et vous serez bientôt dix mille, tous avec des vues différentes. — Que ferez-vous ? Je le vois bien ; vous vous efforcerez de vous emparer du gouvernement. C’est là qu’est la seule force capable de vaincre toutes les résistances. L’un de vous réussira-t-il ? Pendant qu’il s’occupera de contrarier les gouvernés, il se verra attaquer par tous les autres inventeurs, pressés aussi de s’emparer de l’instrument gouvernemental. Ceux-ci auront d’autant plus de chances de succès que la désaffection publique leur viendra en aide, puisque, ne l’oublions pas, celui-là aura blessé tous les intérêts. Nous voilà donc lancés dans des révolutions perpétuelles, ayant pour unique objet de résoudre cette question : Comment et par qui les intérêts de l’humanité seront-ils froissés ?
Ne m’accusez pas d’exagération. Tout cela est forcé si les intérêts des hommes sont discordants ; car, dans l’hypothèse, vous ne pourrez jamais sortir de ce dilemme : ou les intérêts seront laissés à eux-mêmes, et alors le désordre s’ensuivra ; — ou il faudra que quelqu’un soit assez fort pour les contrarier ; et en ce cas naît encore le désordre.
Il est vrai qu’il y a une troisième voie, je l’ai déjà indiquée. Elle consiste à tromper tous les hommes sur leurs véritables intérêts ; et la chose n’étant pas facile à un simple mortel, le plus court est de se faire Dieu. C’est à quoi les utopistes ne manquent jamais, quand ils l’osent, en attendant qu’ils soient Ministres. Le langage mystique domine toujours dans leurs écrits ; c’est un ballon d’essai pour tâter la crédulité publique. Malheureusement ce moyen ne réussit guère au dix-neuvième siècle.
Avouons-le donc franchement : il est à désirer, pour sortir de ces inextricables difficultés, qu’après avoir étudié les intérêts humains, nous les trouvions harmoniques. Alors la tâche des écrivains comme celle des gouvernements, devient rationnelle et facile.
Comme l’homme se trompe souvent sur ses propres intérêts, notre rôle comme écrivains sera de les expliquer, de les décrire, de les faire comprendre, bien certains qu’il lui suffit de les voir pour les suivre. — Comme l’homme en se trompant sur ses intérêts nuit aux intérêts généraux (cela résulte de la concordance), le gouvernement sera chargé de ramener le petit nombre des dissidents, des violateurs des lois providentielles, dans la voie de la justice se confondant avec celle de l’utilité. — En d’autres termes, la mission unique du gouvernement sera de faire régner la justice. Il n’aura plus à s’embarrasser de produire péniblement, à grands frais, en empiétant sur la liberté individuelle, une Harmonie qui se fait d’elle-même et que l’action gouvernementale détruit.
D’après ce qui précède, on voit que nous ne sommes pas tellement fanatique de l’harmonie sociale que nous ne convenions qu’elle peut être et qu’elle est souvent troublée. Je dois même dire que, selon moi, les perturbations apportées à ce bel ordre par les passions aveugles, par l’ignorance et l’erreur, sont infiniment plus grandes et plus prolongées qu’on ne pourrait le supposer. Ce sont ces causes perturbatrices que nous allons étudier.
L’homme est jeté sur cette terre. Il porte invinciblement en lui-même l’attrait vers le bonheur, l’aversion de la douleur. — Puisqu’il agit en vertu de cette impulsion, on ne peut nier que l’Intérêt personnel ne soit le grand mobile de l’individu, de tous les individus, et par conséquent de la société. — Puisque l’intérêt personnel, dans la sphère économique, est le mobile des actions humaines et le grand ressort de la société, le Mal doit en provenir comme le Bien ; c’est en lui qu’il faut chercher l’harmonie et ce qui la trouble.
L’éternelle aspiration de l’intérêt personnel est de faire taire le besoin, ou plus généralement le désir, par la satisfaction.
Entre ces deux termes, essentiellement intimes et intransmissibles, le besoin et la satisfaction, s’interpose le moyen transmissible, échangeable : l’effort.
Et au-dessus de l’appareil, plane la faculté de comparer, de juger : l’intelligence. Mais l’intelligence humaine est faillible. Nous pouvons nous tromper. Cela n’est pas contestable ; car si quelqu’un nous disait : L’homme ne peut se tromper, nous lui répondrions : Ce n’est pas à vous qu’il faut démontrer l’harmonie.
Nous pouvons nous tromper de plusieurs manières ; nous pouvons mal apprécier l’importance relative de nos besoins. En ce cas, dans l’isolement, nous donnons à nos efforts une direction qui n’est pas conforme à nos intérêts bien entendus. Dans l’ordre social, et sous la loi de l’échange, l’effet est le même ; nous faisons porter la demande et la rémunération vers un genre de services futiles ou nuisibles, et déterminons de ce côté le courant du travail humain.
Nous pouvons nous tromper encore, en ignorant qu’une satisfaction ardemment cherchée ne fera cesser une souffrance qu’en ouvrant la source de souffrances plus grandes. Il n’y a guère d’effet qui ne devienne cause. La prévoyance nous a été donnée pour embrasser l’enchaînement des effets, pour que nous ne fassions pas au présent le sacrifice de l’avenir ; mais nous manquons souvent de prévoyance.
L’erreur déterminée par la faiblesse de notre jugement ou par la force de nos passions, voilà la première source du mal. Elle appartient principalement au domaine de la morale. Ici, comme l’erreur et la passion sont individuelles, le mal est, dans une certaine mesure, individuel aussi. La réflexion, l’expérience, l’action de la responsabilité en sont les correctifs efficaces.
Cependant les erreurs de cette nature peuvent prendre un caractère social et engendrer un mal très-étendu, quand elles se systématisent. Il est des pays, par exemple, où les hommes qui les gouvernent sont fortement convaincus que la prospérité des peuples se mesure, non par les besoins satisfaits, mais par les efforts quels qu’en soient les résultats. La division du travail aide beaucoup à cette illusion. Comme on voit chaque profession s’attaquer à un obstacle, on s’imagine que l’existence de l’obstacle est une source de richesses. Dans ces pays, quand la vanité, la futilité, le faux amour de la gloire sont des passions dominantes, provoquent des désirs analogues et déterminent dans ce sens une portion de l’industrie, les gouvernants croiraient tout perdu si les gouvernés venaient à se réformer et se moraliser. Que deviendraient, disent-ils, les coiffeurs, les cuisiniers, les grooms, les brodeuses, les danseurs, les fabricants de galons, etc. ? — Ils ne voient pas que le cœur humain contiendra toujours assez de désirs honnêtes, raisonnables et légitimes pour donner de l’aliment au travail ; que la question ne sera jamais de supprimer des goûts, mais de les épurer et de les transformer ; que, par conséquent, le travail suivant la même évolution pourra se déplacer, non s’arrêter. Dans les pays où règnent ces tristes doctrines, on entendra dire souvent : « Il est fâcheux que la morale et l’industrie ne puissent marcher ensemble. Nous voudrions bien que les citoyens fussent moraux, mais nous ne pouvons permettre qu’ils deviennent paresseux et misérables. C’est pourquoi nous continuerons à faire des lois dans le sens du luxe. Au besoin, nous mettrons des impôts sur le peuple ; et, dans son intérêt, pour lui assurer du travail, nous chargerons des Rois, des Présidents, des Diplomates, des Ministres, de Représenter. » — Cela se dit et se fait de la meilleure foi du monde. Le peuple même s’y prête de bonne grâce. — Il est clair que, lorsque le luxe et la frivolité deviennent ainsi une affaire législative, réglée, ordonnée, imposée, systématisée par la force publique, la loi de la Responsabilité perd toute sa force moralisatrice [281]…
[FB is just warming up and he stopped!!]
XIX. Guerre↩
Dans toutes les circonstances qui contribuent à donner à un peuple sa physionomie, son état moral, son caractère, ses habitudes, ses lois, son génie, celle qui domine de beaucoup toutes les autres, parce qu’elle les renferme virtuellement presque toutes, c’est la manière dont il pourvoit à ses moyens d’existence. C’est une observation due à Charles Comte, et il y a lieu d’être surpris qu’elle n’ait pas eu plus d’influence sur les sciences, morales et politiques.
En effet, cette circonstance agit sur le genre humain de deux manières également puissantes : par la continuité et par l’universalité. Vivre, se conserver, se développer, élever sa famille, ce n’est pas une affaire de temps et de lieu, de goût, d’opinion, de choix ; c’est la préoccupation journalière, éternelle et irrésistible de tous les hommes, à toutes les époques et dans tous les pays.
Partout, la plus grande partie de leurs forces physiques, intellectuelles et morales est consacrée directement ou indirectement à créer et remplacer les moyens de subsistance. Le chasseur, le pêcheur, le pasteur, l’agriculteur, le fabricant, le négociant, l’ouvrier, l’artisan, le capitaliste, tous pensent à vivre d’abord (quelque prosaïque que soit l’aveu), et ensuite à vivre de mieux en mieux s’il se peut. La preuve qu’il en est ainsi, c’est qu’ils ne sont chasseurs, pêcheurs, fabricants, agriculteurs, etc., que pour cela. De même, le fonctionnaire, le soldat, le magistrat n’entrent dans ces carrières qu’autant qu’elles leur assurent la satisfaction de leurs besoins. Il ne faut pas en vouloir à l’homme du dévouement et de l’abnégation, s’il invoque lui aussi le proverbe : le prêtre vit de l’autel, — car, avant d’appartenir au sacerdoce, il appartient à l’humanité. Et si, en ce moment, il se fait un livre contre la vulgarité de cet aperçu, ou plutôt de la condition humaine, ce livre en se vendant plaidera contre sa propre thèse.
Ce n’est pas, à Dieu ne plaise, que je nie les existences d’abnégation. Mais on conviendra qu’elles sont exceptionnelles ; ce qui justement constitue leur mérite et détermine notre admiration. Que si l’on considère l’humanité dans son ensemble, à moins d’avoir fait un pacte avec le démon du sentimentalisme, il faut bien convenir que les efforts désintéressés ne peuvent nullement se comparer, quant au nombre, à ceux qui sont déterminés par les dures nécessités de notre nature. Et c’est parce que ces efforts qui constituent l’ensemble de nos travaux, occupent une si grande place dans la vie de chacun de nous, qu’ils ne peuvent manquer d’exercer une grande influence sur les manifestations de notre existence nationale.
M. Saint-Marc Girardin dit quelque part qu’il a appris à reconnaître l’insignifiance relative des formes politiques, comparativement à ces grandes lois générales qu’imposent aux peuples leurs besoins et leurs travaux. « Voulez-vous savoir ce qu’est un peuple ? dit-il, ne demandez pas comment il se gouverne, mais ce qu’il fait. » [282]
Cette vue générale est juste. L’auteur ne manque pas de la fausser bientôt en la convertissant en système. L’importance des formes politiques a été exagérée ; que fait-il ? Il la réduit à rien, il la nie ou ne la reconnaît que pour en rire. Les formes politiques, dit-il, ne nous intéressent qu’un jour d’élection ou pendant l’heure consacrée à la lecture du journal. Monarchie ou République, Aristocratie ou Démocratie, qu’importe ? — Aussi il faut voir à quel résultat il arrive. Soutenant que les peuples enfants se ressemblent, quelle que soit leur constitution politique, il assimile les États-Unis à l’ancienne Égypte, parce que dans l’un et l’autre de ces pays on a exécuté des ouvrages gigantesques. Mais quoi ! les Américains défrichent des terres, creusent des canaux, font des chemins de fer, le tout pour eux-mêmes, parce qu’ils sont une démocratie et s’appartiennent ! Les Égyptiens élevaient des temples, des pyramides, des obélisques, des palais pour leurs rois et leurs prêtres, parce qu’ils étaient des esclaves ! — Et c’est là une légère différence, une affaire de forme, qu’il ne vaut pas la peine de constater ou qu’il ne faut constater que pour en rire !… Ô culte du classique ! contagion funeste, combien tu as corrompu tes superstitieux sectaires !
Bientôt M. Saint-Marc Girardin, partant toujours de ce point que les occupations dominantes d’un peuple déterminent son génie, dit : Autrefois on s’occupait de guerre et de religion ; aujourd’hui c’est de commerce et d’industrie. Voilà pourquoi les générations qui nous ont précédés portaient une empreinte guerrière et religieuse.
Déjà Rousseau avait affirmé que le soin de l’existence n’était une occupation dominante que pour quelques peuples et des plus prosaïques ; que d’autres nations, plus dignes de ce nom, s’étaient vouées à de plus nobles travaux.
M. Saint-Marc Girardin et Rousseau n’auraient-ils pas été dupes ici d’une illusion historique ? N’auraient-ils pas pris les amusements, les diversions ou les prétextes et instruments de despotisme de quelques-uns pour les occupations de tous ? Et cette illusion ne proviendrait-elle pas de ce que les historiens nous parlent toujours de la classe qui ne travaille pas, et jamais de celle qui travaille, de telle sorte que nous finissons par voir dans la première toute la nation ?
Je ne puis m’empêcher de croire que chez les Grecs, comme chez les Romains, comme dans le moyen âge, l’humanité était faite comme aujourd’hui, c’est-à-dire assujettie à des besoins si pressants, si renaissants, qu’il fallait s’occuper d’y pourvoir sous peine de mort. Dès lors je ne puis m’empêcher de croire que c’était, alors comme aujourd’hui, l’occupation principale et absorbante de la portion la plus considérable du genre humain.
Ce qui paraît positif, c’est qu’un très-petit nombre d’hommes étaient parvenus à vivre, sans rien faire, sur le travail des masses assujetties. Ce petit nombre d’oisifs se faisaient construire par leurs esclaves de somptueux palais, de vastes châteaux ou de sombres forteresses. Ils aimaient à s’entourer de toutes les sensualités de la vie, de tous les monuments des arts. Ils se plaisaient à disserter sur la philosophie, la cosmogonie ; et enfin ils cultivaient avec soin les deux sciences auxquelles ils devaient leur domination et leurs jouissances : la science de la force et la science de la ruse.
Bien qu’au-dessous de cette aristocratie il y eût les multitudes innombrables occupées à créer, pour elles-mêmes, les moyens d’entretenir la vie, et, pour, leurs oppresseurs, les moyens de les saturer de plaisirs ; — comme les historiens n’ont jamais fait la moindre allusion à ces multitudes, nous finissons par oublier leur existence, nous en faisons abstraction complète. Nous n’avons des yeux que pour l’aristocratie ; c’est elle que nous appelons la société antique ou la société féodale ; nous nous imaginons que de telles sociétés se soutenaient par elles-mêmes, sans avoir recours au commerce, à l’industrie, au travail, au vulgarisme ; nous admirons leur désintéressement, leur générosité, leur goût pour les arts, leur spiritualisme, leur dédain des occupations serviles, l’élévation de leurs sentiments et de leurs pensées ; nous affirmons, d’un ton déclamatoire, qu’à une certaine époque les peuples ne s’occupaient que de gloire, à une autre d’arts, à une autre de philosophie, à une autre de religion, à une autre de vertus ; nous pleurons sincèrement sur nous-mêmes, nous nous adressons toutes sortes de sarcasmes de ce que, malgré de si sublimes modèles, ne pouvant nous élever à une telle hauteur, nous sommes réduits à donner au travail, ainsi qu’à tous les mérites vulgaires qu’il implique, une place considérable dans notre vie moderne.
Consolons-nous en pensant qu’il occupait une place non moins large dans la vie antique : Seulement, celui dont quelques hommes s’étaient affranchis retombait d’un poids accablant sur les multitudes assujetties, au grand détriment de la justice, de la liberté, de la propriété, de la richesse, de l’égalité, du progrès ; et c’est la première des causes perturbatrices que j’ai à signaler au lecteur.
Les procédés par lesquels les hommes se procurent des moyens d’existence ne peuvent donc manquer d’exercer une grande influence sur leur condition physique, morale, intellectuelle, économique et politique. Qui doute que si l’on pouvait observer plusieurs peuplades dont l’une fût exclusivement vouée à la chasse, une autre à la pêche, une troisième à l’agriculture, une quatrième à la navigation, qui doute que ces peuplades ne présentassent des différences considérables dans leurs idées, leurs opinions, leurs usages, leurs coutumes, leurs mœurs, leurs lois, leur religion ? Sans doute le fond de la nature humaine se retrouverait partout ; aussi dans ces lois, ces usages, ces religions il y aurait des points communs, et je crois bien que ce sont ces points communs qu’on peut appeler les lois générales de l’humanité.
Quoi qu’il en soit, dans nos grandes sociétés modernes, tous ou presque tous les procédés de production, pêche, agriculture, industrie, commerce, sciences et arts, sont mis simultanément en œuvre, quoiqu’en proportions variées selon les pays. C’est pourquoi il ne saurait y avoir entre les nations des différences aussi grandes que si chacune se vouait à une occupation exclusive.
Mais, si la nature des occupations d’un peuple exerce une grande influence sur sa moralité ; ses désirs, ses goûts, sa moralité exercent à leur tour une grande influence sur la nature de ses occupations, ou du moins sur les proportions de ces occupations entre elles. Je n’insisterai pas sur cette remarque qui a été présentée dans une autre partie de cet ouvrage, [283] et j’arrive au sujet principal de ce chapitre.
Un homme (il en est de même d’un peuple) peut se procurer des moyens d’existence de deux manières : en les créant ou en les volant.
Chacune de ces deux grandes sources d’acquisition a plusieurs procédés.
On peut créer des moyens d’existence par la chasse, la pêche, la culture, etc.
On peut les voler par la mauvaise foi, la violence, la force, la ruse, la guerre, etc.
S’il suffit, sans sortir du cercle de l’une ou de l’autre de ces deux catégories, de la prédominance de l’un des procédés qui lui sont propres pour établir entre les nations des différences considérables, combien cette différence ne doit-elle pas être plus grande entre le peuple qui vit de production, et un peuple qui vit de spoliation ?
Car il n’est pas une seule de nos facultés, à quelque ordre qu’elle appartienne, qui ne soit mise en exercice par la nécessité qui nous a été imposée de pourvoir à notre existence ; et que peut-on concevoir de plus propre à modifier l’état social des peuples que ce qui modifie toutes les facultés humaines ?
Cette considération, toute grave qu’elle est, a été si peu observée, que je dois m’y arrêter un instant.
Pour qu’une satisfaction se réalise, il faut qu’un travail ait été exécuté, d’où il suit que la Spoliation, dans toutes ses variétés, loin d’exclure la Production, la suppose.
Et ceci, ce me semble, est de nature à diminuer un peu l’engouement que les historiens, les poëtes et les romanciers manifestent pour ces nobles époques, où, selon eux, ne dominait pas ce qu’ils appellent l’industrialisme. À ces époques on vivait ; donc le travail accomplissait, tout comme aujourd’hui, sa rude tâche. Seulement, des nations, des classes, des individualités étaient parvenues à rejeter sur d’autres nations, d’autres classes, d’autres individualités, leur lot de labeur et de fatigue.
Le caractère de la production, c’est de tirer pour ainsi dire du néant les satisfactions qui entretiennent et embellissent la vie, de telle sorte qu’un homme ou un peuple peut multiplier à l’infini ces satisfactions, sans infliger une privation quelconque aux autres hommes et aux autres peuples ; — bien, au contraire, l’étude approfondie du mécanisme économique nous a révélé que le succès de l’un dans son travail ouvre des chances de succès au travail de l’autre.
Le caractère de la spoliation est de ne pouvoir conférer une satisfaction sans qu’une privation égale y corresponde ; car elle ne crée pas, elle déplace ce que le travail a créé. Elle entraîne après elle, comme déperdition absolue, tout l’effort qu’elle-même coûte aux deux parties intéressées. Loin donc d’ajouter aux jouissances de l’humanité, elle les diminue, et, en outre, elle les attribue à qui ne les a pas méritées.
Pour produire, il faut diriger toutes ses facultés vers la domination de la nature ; car c’est elle qu’il s’agit de combattre, de dompter et d’asservir. C’est pourquoi le fer converti en charrue est l’emblème de la production.
Pour spolier, il faut diriger toutes ses facultés vers la domination des hommes ; car ce sont eux qu’il faut combattre, tuer ou asservir. C’est pourquoi le fer converti en épée est l’emblème de la spoliation.
Autant il y a d’opposition entre la charrue qui nourrit et l’épée qui tue, autant il doit y en avoir entre un peuple de travailleurs et un peuple de spoliateurs. Il n’est pas possible qu’il y ait entre eux rien de commun. Ils ne sauraient avoir ni les mêmes idées, ni les mêmes règles d’appréciation, ni les mêmes goûts, ni le même caractère, ni les mêmes mœurs, ni les mêmes lois, ni la même morale, ni la même religion.
Et certes, un des plus tristes spectacles qui puissent s’offrir à l’œil du philanthrope, c’est de voir un siècle producteur faire tous ses efforts pour s’inoculer, — par l’éducation, — les idées, les sentiments, les erreurs, les préjugés et les vices d’un peuple spoliateur. On accuse souvent notre époque de manquer d’unité, de ne pas montrer de la concordance entre sa manière de voir et d’agir ; on a raison, et je crois que je viens d’en signaler la principale cause.
La spoliation par voie de guerre, c’est-à-dire la spoliation toute naïve, toute simple, toute crue, a sa racine dans le cœur humain, dans l’organisation de l’homme, dans ce moteur universel du monde social : l’attrait pour les satisfactions et la répugnance pour la douleur ; en un mot, dans ce mobile que nous portons tous en nous-mêmes : l’intérêt personnel.
Et je ne suis pas fâché de me porter son accusateur. Jusqu’ici on a pu croire que j’avais voué à ce principe un culte idolâtre, que je ne lui attribuais que des conséquences heureuses pour l’humanité, peut-être même que je l’élevais dans mon estime au-dessus du principe sympathique, du dévouement, de l’abnégation. — Non, je ne l’ai pas jugé ; j’ai seulement constaté son existence et son omnipotence. Cette omnipotence, je l’aurais mal appréciée, et je serais en contradiction avec moi-même, quand je signale l’intérêt personnel comme le moteur universel de l’humanité, si je n’en faisais maintenant découler les causes perturbatrices, comme précédemment j’en ai fait sortir les lois harmoniques de l’ordre social.
L’homme, avons-nous dit, veut invinciblement se conserver, améliorer sa condition, saisir le bonheur tel qu’il le conçoit, ou du moins en approcher. Par la même raison, il fuit la peine, la douleur.
Or le travail, cette action qu’il faut que l’homme exerce sur la nature pour réaliser la production, est une peine, une fatigue. Par ce motif, l’homme y répugne et ne s’y soumet que lorsqu’il s’agit pour lui d’éviter un mal plus grand encore.
Philosophiquement, il y en a qui disent : Le travail est un bien. Ils ont raison, en tenant compte de ses résultats. C’est un bien relatif, en d’autres termes, c’est un mal qui nous épargne de plus grands maux. Et c’est justement pourquoi les hommes ont une si grande tendance à éviter le travail, quand ils croient pouvoir, sans y recourir, en recueillir les résultats.
D’autres disent que le travail est un bien en lui-même ; qu’indépendamment de ses résultats producteurs, il moralise l’homme, le renforce, et est pour lui une source d’allégresse et de santé. Tout cela est très-vrai, et révèle une fois de plus la merveilleuse fécondité d’intentions finales que Dieu a répandues dans toutes les parties de son œuvre. Oui, même abstraction faite de ses résultats comme production, le travail promet à l’homme, pour récompenses supplémentaires, la force du corps et la joie de l’âme ; puisqu’on a pu dire que l’oisiveté était la mère de tous les vices, il faut bien reconnaître que le travail est le père de beaucoup de vertus.
Mais tout cela, sans préjudice des penchants naturels et invincibles du cœur humain ; sans préjudice de ce sentiment qui fait que nous ne recherchons pas le travail pour lui-même ; que nous le comparons toujours à son résultat ; que nous ne poursuivons pas par un grand travail ce que nous pouvons obtenir par un travail moindre ; que, placés entre deux peines, nous ne choisissons pas la plus forte, et que notre tendance universelle est d’autant plus de diminuer le rapport de l’effort au résultat, que si par là nous conquérons quelque loisir, rien ne nous empêche de le consacrer, en vue de récompenses accessoires, à des travaux conformes à nos goûts.
D’ailleurs, à cet égard le fait universel est décisif. En tous lieux, en tous temps nous voyons l’homme considérer le travail comme le côté onéreux, et la satisfaction comme le côté compensateur de sa condition. En tous lieux, en tous temps, nous le voyons se décharger, autant qu’il le peut, de la fatigue du travail soit sur les animaux, sur le vent, sur l’eau, la vapeur, les forces de la nature, soit, hélas ! sur la force de son semblable, quand il parvient à le dominer. Dans ce dernier cas, je le répète parce qu’on l’oublie trop souvent, le travail n’est pas diminué, mais déplacé. [284]
L’homme, étant ainsi placé entre deux peines, celle du besoin et celle du travail, pressé par l’intérêt personnel, cherche s’il n’aurait pas un moyen de les éviter toutes les deux, au moins dans une certaine mesure. Et c’est alors que la spoliation se présente à ses yeux comme la solution du problème.
Il se dit : Je n’ai, il est vrai, aucun moyen de me procurer les choses nécessaires à ma conservation, à mes satisfactions, la nourriture, le vêtement, le gîte, sans que ces choses aient été préalablement produites par le travail. Mais il n’est pas indispensable que ce soit par mon propre travail. Il suffit que ce soit par le travail de quelqu’un, pourvu que je sois le plus fort.
Telle est l’origine de la guerre.
Je n’insisterai pas beaucoup sur ses conséquences.
Quand les choses vont ainsi, quand un homme ou un peuple travaille et qu’un autre homme ou un autre peuple attend, pour se livrer à la rapine, que le travail soit accompli, le lecteur aperçoit d’un coup d’œil ce qui se perd de forces humaines.
D’un côté, le spoliateur n’est point parvenu, comme il l’aurait désiré, à éviter toute espèce de travail. La spoliation armée exige aussi des efforts, et quelque fois d’immenses efforts. Ainsi, pendant que le producteur consacre son temps à créer les objets de satisfactions, le spoliateur emploie le sien à préparer le moyen de les dérober. Mais lorsque l’œuvre de la violence est accomplie ou tentée, les objets de satisfactions ne sont ni plus ni moins abondants. Ils peuvent répondre aux besoins de personnes différentes, et non à plus de besoins. Ainsi tous les efforts que le spoliateur a faits pour la spoliation, et en outre tous ceux qu’il n’a pas faits pour la production, sont entièrement perdus, sinon pour lui, du moins pour l’humanité.
Ce n’est pas tout ; dans la plupart des cas une déperdition analogue se manifeste du côté du producteur. Il n’est pas vraisemblable, en effet, qu’il attendra, sans prendre aucune précaution, l’événement dont il est menacé ; et toutes les précautions, armes, fortifications, munitions, exercice, sont du travail, et du travail à jamais perdu, non pour celui qui en attend sa sécurité, mais pour le genre humain.
Que si le producteur, en faisant ainsi deux parts de ses travaux, ne se croit pas assez fort pour résister à la spoliation, c’est bien pis et les forces humaines se perdent sur une bien autre échelle ; car alors le travail cesse, nul n’étant disposé à produire pour être spolié.
Quant aux conséquences morales, à la manière dont les facultés sont affectées des deux côtés, le résultat n’est pas moins désastreux.
Dieu a voulu que l’homme livrât à la nature de pacifiques combats et qu’il recueillit directement d’elle les fruits de la victoire. — Quand il n’arrive à la domination de la nature que par l’intermédiaire de la domination de ses semblables, sa mission est faussée ; il donne à ses facultés une direction tout autre. Voyez seulement la prévoyance, cette vue anticipée de l’avenir, qui nous élève en quelque sorte jusqu’à la providence, — car prévoir, c’est aussi pourvoir, — voyez combien elle diffère chez le producteur et le spoliateur.
Le producteur a besoin d’apprendre la liaison des causes aux effets. Il étudie à ce point de vue les lois du monde physique, et cherche à s’en faire des auxiliaires de plus en plus utiles. S’il observe ses semblables, c’est pour prévoir leurs désirs et y pourvoir, à charge de réciprocité.
Le spoliateur n’observe pas la nature. S’il observe les hommes, c’est comme l’aigle guette une proie, cherchant le moyen de l’affaiblir, de la surprendre.
Mêmes différences se manifestent dans les autres facultés et s’étendent aux idées…. [285]
La spoliation par la guerre n’est pas un fait accidentel, isolé, passager ; c’est un fait très-général et très-constant, qui ne le cède en permanence qu’au travail.
Indiquez-moi donc un point du globe où deux races, une de vainqueurs et une de vaincus, ne soient pas superposées l’une à l’autre. Montrez-moi en Europe, en Asie, dans les îles du grand Océan, un lieu fortuné encore occupé par la race primitive. Si les migrations de peuples n’ont épargné aucun pays, la guerre a été un fait général.
Les traces n’en sont pas moins générales. Indépendamment du sang versé, du butin conquis, des idées faussées, des facultés perverties, elle a laissé partout des stigmates, au nombre desquels il faut compter l’esclavage et l’aristocratie…
L’homme ne s’est pas contenté de spolier la richesse à mesure qu’elle se formait ; il s’est emparé des richesses antérieures, du capital sous toutes les formes ; il a particulièrement jeté les yeux sur le capital, sous la forme la plus immobile, la propriété foncière. Enfin, il s’est emparé de l’homme même. — Car les facultés humaines étant des instruments de travail, il a été trouvé plus court de s’emparer de ces facultés que de leurs produits…
Combien ces grands événements n’ont-ils pas agi comme causes perturbatrices, comme entraves sur le progrès naturel des destinées humaines ! Si l’on tient compte de la déperdition de travail occasionnée par la guerre, si l’on tient compte de ce que le produit effectif, qu’elle amoindrit, se concentre entre les mains de quelques vainqueurs, on pourra comprendre le dénûment des masses, dénûment inexplicable de nos jours par la liberté…
Comment l’esprit guerrier se propage.
Les peuples agresseurs sont sujets à des représailles. Ils attaquent souvent ; quelquefois ils se défendent. Quand ils sont sur la défensive, ils ont le sentiment de la justice et de la sainteté de leur cause. Alors ils peuvent exalter le courage, le dévouement, le patriotisme. Mais, hélas ! ils transportent ces sentiments et ces idées dans leurs guerres offensives. Et qu’est-ce alors qui constitue le patriotisme ?…
Quand deux races, l’une victorieuse et oisive, l’autre vaincue et humiliée, occupent le sol, tout ce qui éveille les désirs, les sympathies, est le partage de la première. À elle loisirs, fêtes, goût des arts, richesses, exercices militaires, tournois, grâce, élégance, littérature, poésie. À la race conquise, des mains calleuses, des huttes désolées, des vêtements répugnants…
Il suit de là que ce sont les idées et les préjugés de la race dominante, toujours associés à la domination militaire, qui font l’opinion. Hommes, femmes, enfants, tous mettent la vie militaire avant la vie laborieuse, la guerre avant le travail, la spoliation avant la production. La race vaincue partage elle-même ce sentiment, et quand elle surmonte ses oppresseurs, aux époques de transition, elle se montre disposée à les imiter. Que dis-je ! pour elle cette imitation est une frénésie…
Comment la guerre finit…
La Spoliation comme la Production ayant sa source dans le cœur humain, les lois du monde social ne seraient pas harmoniques, même au sens limité que j’ai dit, si celle-ci ne devait, à la longue, détrôner celle-là…
XX. Responsabilité↩
Il y a dans ce livre une pensée dominante ; elle plane sur toutes ses pages, elle vivifie toutes ses lignes. Cette pensée est celle qui ouvre le symbole chrétien : Je crois en dieu.
Oui, s’il diffère de quelques économistes, c’est que ceux-ci semblent dire : « Nous n’avons guère foi en Dieu ; car nous voyons que les lois naturelles mènent à l’abîme. — Et cependant nous disons : Laissez faire ! parce que nous avons encore moins foi en nous-mêmes, et nous comprenons que tous les efforts humains pour arrêter le progrès de ces lois ne font que hâter la catastrophe. »
S’il diffère des écrits socialistes, c’est que ceux-ci disent : « Nous feignons bien de croire en Dieu ; mais au fond nous ne croyons qu’en nous-mêmes, — puisque nous ne voulons pas laisser faire, et que nous donnons tous chacun de nos plans sociaux comme infiniment supérieur à celui de la Providence. »
Je dis : Laissez faire, en d’autres termes, respectez la liberté, l’initiative humaine…. [286]
****
Very long note (created bu Fontenay, not FB’s words??:
…parce que je crois qu’une impulsion supérieure la dirige, parce que Dieu ne pouvant agir dans l’ordre moral que par l’intermédiaire des intérêts et des volontés, il est impossible que la résultante naturelle de ces intérêts, que la tendance commune de ces volontés, aboutisse au mal définitif : — car alors ce ne serait pas seulement l’homme ou l’humanité qui marcherait à l’erreur ; c’est Dieu lui-même, impuissant ou mauvais, qui pousserait au mal sa créature avortée.
Nous croyons donc à la liberté, parce que nous croyons à l’harmonie universelle, c’est-à-dire à Dieu. Proclamant au nom de la foi, formulant au nom de la science les lois divines, souples et vivantes, du mouvement moral, nous repoussons du pied ces institutions étroites, gauches, immobiles, que des aveugles jettent tout à travers l’admirable mécanisme. Du point de vue de l’athée, il serait absurde de dire : laissez faire le hasard ! Mais nous, croyants, nous avons le droit de crier : laissez passer l’ordre et la justice de Dieu ! Laissez marcher librement cet agent du moteur infaillible, ce rouage de transmission qu’on appelle l’initiative humaine ! — Et la liberté ainsi comprise n’est plus l’anarchique déification de l’individualisme ; ce que nous adorons, par delà l’homme qui s’agite, c’est Dieu qui le mène.
Nous savons bien que l’esprit humain peut s’égarer : oui, sans doute, de tout l’intervalle qui sépare une vérité acquise d’une vérité qu’il pressent. Mais puisque sa nature est de chercher, sa destinée est de trouver. Le vrai, remarquons-le, a des rapports harmoniques, des affinités nécessaires non-seulement avec la forme de notre entendement et les instincts de notre cœur, mais aussi avec toutes les conditions physiques et morales de notre existence ; en sorte que, lors même qu’il échapperait à l’intelligence de l’homme comme vrai absolu, à ses sympathies innées comme juste, ou comme beau à ses aspirations idéales, il finirait encore par se faire accepter sous son aspect pratique et irrécusable d’utile.
Nous savons que la liberté peut mener au Mal. — Mais le Mal a lui-même sa mission. Dieu ne l’a certes pas jeté au hasard devant nos pas pour nous faire tomber ; il l’a placé en quelque sorte de chaque côté du chemin que nous devions suivre, afin qu’en s’y heurtant l’homme fût ramené au bien par le mal même.
Les volontés, comme les molécules inertes, ont leur loi de gravitation. Mais, — tandis que les êtres inanimés obéissent à des tendances préexistantes et fatales, — pour les intelligences libres, la force d’attraction et de répulsion ne précède pas le mouvement ; elle naît de la détermination volontaire qu’elle semble attendre, elle se développe en vertu de l’acte même, et réagit alors pour ou contre l’agent, par un effort progressif de concours ou de résistance qu’on appelle récompense ou châtiment, plaisir ou douleur. Si la direction de la volonté est dans le sens des lois générales, si l’acte est bon, le mouvement est secondé, le bien-être en résulte pour l’homme. — S’il s’écarte au contraire, s’il est mauvais, quelque chose le repousse ; de l’erreur naît la souffrance, qui en est le remède et le terme. Ainsi le Mal s’oppose constamment au Mal, comme le Bien provoque incessamment le Bien. Et l’on pourrait dire que, vus d’un peu haut, les écarts du libre arbitre se bornent à quelques oscillations, d’une amplitude déterminée, autour d’une direction supérieure et nécessaire ; toute rébellion persistante qui voudrait forcer cette limite n’aboutissant qu’à se détruire elle-même, sans parvenir à troubler en rien l’ordre de sa sphère.
Cette force réactive de concours ou de répulsion, qui par la récompense et la peine régit l’orbite à la fois volontaire et fatale de l’humanité, cette loi de gravitation des êtres libres (dont le Mal n’est que la moitié nécessaire), se manifeste par deux grandes expressions, — la Responsabilité et la Solidarité : l’une qui fait retomber sur l’individu, — l’autre qui répercute sur le corps social les conséquences bonnes ou mauvaises de l’acte : l’une qui s’adresse à l’homme comme à un tout solitaire et autonome, — l’autre qui l’enveloppe dans une inévitable communauté de biens et de maux, comme élément partiel et membre dépendant d’un être collectif et impérissable, l’Humanité. — Responsabilité, sanction de la liberté individuelle, raison des droits de l’homme, — Solidarité, preuve de sa subordination sociale et principe de ses devoirs…
(Un feuillet manquait au manuscrit de Bastiat. On me pardonnera d’avoir essayé de continuer la pensée de cette religieuse introduction.) R. F.
****
… Responsabilité, solidarité ; mystérieuses lois dont il est impossible, en dehors de la Révélation, d’apprécier la cause, mais dont il nous est donné d’apprécier les effets et l’action infaillible sur les progrès de la société : lois qui, par cela même que l’homme est sociable, s’enchaînent, se mêlent, concourent, encore qu’elles semblent parfois se heurter ; et qui demanderaient à être vues dans leur ensemble, dans leur action commune, si la science aux yeux faibles, à la marche incertaine, n’était réduite à la méthode, — cette triste béquille qui fait sa force tout en révélant sa faiblesse.
***
Nosce te ipsum. Connais-toi toi-même ; c’est, dit l’oracle, le commencement, le milieu et la fin des sciences morales et politiques.
Nous l’avons dit ailleurs : En ce qui concerne l’homme ou la société humaine, Harmonie ne peut signifier Perfection, mais Perfectionnement. Or la perfectibilité implique toujours, à un degré quelconque, l’imperfection dans l’avenir comme dans le passé. Si l’homme pouvait jamais entrer dans cette terre promise du Bien absolu, il n’aurait que faire de son intelligence, de ses sens, il ne serait plus l’homme.
Le Mal existe. Il est inhérent à l’infirmité humaine ; il se manifeste dans l’ordre moral comme dans l’ordre matériel, dans la masse comme dans l’individu, dans le tout comme dans la partie. Parce que l’œil peut souffrir et s’éteindre, le physiologiste méconnaîtra-t-il l’harmonieux mécanisme de cet admirable appareil ? Niera-t-il l’ingénieuse structure du corps humain, parce que ce corps est sujet à la douleur, à la maladie, à la mort, et parce que le Psalmiste, dans son désespoir, a pu s’écrier : « Ô tombe, vous êtes ma mère ! Vers du sépulcre, vous êtes mes frères et mes sœurs ! » — De même, parce que l’ordre social n’amènera jamais l’humanité au fantastique port du bien absolu, l’économiste refusera-t-il de reconnaître ce que cet ordre social présente de merveilleux dans son organisation, préparée en vue d’une diffusion toujours croissante de lumières, de moralité et de bonheur ?
Chose étrange, qu’on conteste à la science économique le droit d’admiration qu’on accorde à la physiologie ! Car, après tout, quelle différence, au point de vue de l’harmonie, dans les causes finales, entre l’être individuel et l’être collectif ! — Sans doute l’individu naît, grandit, se développe, s’embellit, se perfectionne, sous l’influence de la vie, jusqu’à ce que soit venu le moment où d’autres flambeaux s’allumeront à ce flambeau. À ce moment tout en lui revêt les couleurs de la beauté ; tout en lui respire la joie et la grâce ; il est tout expansion, affection, bienveillance, amour, harmonie. Puis, pendant quelque temps encore, son intelligence s’élargit et s’affermit, comme pour guider, dans les tortueux sentiers de l’existence, celles qu’il y vient d’appeler. Mais bientôt sa beauté s’efface, sa grâce s’évanouit, ses sens s’émoussent, son corps décline, sa mémoire se trouble, ses idées s’affaiblissent, hélas ! et ses affections mêmes, sauf en quelques âmes d’élite, semblent s’imprégner d’égoïsme, perdent ce charme, cette fraîcheur, ce naturel sincère et naïf, cette profondeur, cet idéal, cette abnégation, cette poésie, ce parfum indéfinissable, qui sont le privilége d’un autre âge. Et malgré les précautions ingénieuses que la nature a prises pour retarder sa dissolution, précautions que la physiologie résume par le mot vis medicatrix, — seules et tristes harmonies dont il faut bien que cette science se contente, — il repasse en sens inverse la série de ses perfectionnements, il abandonne l’une après l’autre sur le chemin toutes ses acquisitions, il marche de privations en privations vers celle qui les comprend toutes. Oh ! le génie de l’optimisme lui-même ne saurait rien découvrir de consolant et d’harmonieux dans cette lente et irrémissible dégradation, à voir cet être, autrefois si fier et si beau, descendre tristement dans la tombe… La tombe !… Mais n’est-ce pas une porte à l’autre séjour !… C’est ainsi, quand la science s’arrête, que la religion renoue [287], même pour l’individu, dans une autre patrie, les concordances harmoniques interrompues ici-bas. [288]
Malgré ce dénoûment fatal, la physiologie cesse-t-elle de voir, dans le corps humain, le chef-d’œuvre le plus accompli qui soit sorti des mains du Créateur ?
Mais si le corps social est assujetti à la souffrance, si même il peut souffrir jusqu’à en mourir, il n’y est pas fatalement condamné. Quoi qu’on en ait dit, il n’a pas en perspective, après s’être élevé à son apogée, un inévitable déclin. L’écroulement même des empires, ce n’est pas la rétrogradation de l’humanité ; et les vieux moules de la civilisation ne se dissolvent que pour faire place à une civilisation plus avancée. Les dynasties peuvent s’éteindre, les formes du pouvoir peuvent changer ; le genre humain n’en progresse pas moins. La chute des États ressemble à la chute des feuilles en automne. Elle fertilise le sol, se coordonne au retour du printemps, et promet aux générations futures une végétation plus riche et des moissons plus abondantes. Que dis-je ! même au point de vue purement national, cette théorie de la décadence nécessaire est aussi fausse que surannée. Il est impossible d’apercevoir dans le mode de vie d’un peuple aucune cause de déclin inévitable. L’analogie, qui a si souvent fait comparer une nation à un individu et attribuer à l’une comme à l’autre une enfance et une vieillesse, n’est qu’une fausse métaphore. Une communauté se renouvelle incessamment. Que ses institutions soient élastiques et flexibles, qu’au lieu de venir en collision avec les puissances nouvelles qu’enfante l’esprit humain, elles soient organisées de manière à admettre cette expansion de l’énergie intellectuelle et à s’y accommoder ; et l’on ne voit aucune raison pour qu’elle ne fleurisse pas dans une éternelle jeunesse. Mais, quoi qu’on pense de la fragilité et du fracas des empires, toujours est-il que la société, qui, dans son ensemble, se confond avec l’humanité, est constituée sur des bases plus solides. Plus on l’étudie, plus on reste convaincu qu’elle aussi a été pourvue, comme le corps humain, d’une force curative qui la délivre de ses maux, et qu’en outre elle porte dans son sein une force progressive. Elle est poussée par celle-ci vers un perfectionnement auquel on ne peut assigner de limites.
Si donc le mal individuel n’infirme pas l’harmonie physiologique, encore moins le mal collectif infirme-t-il l’harmonie sociale.
Mais comment concilier l’existence du mal avec l’infinie bonté de Dieu ? Ce n’est pas à moi d’expliquer ce que je ne comprends pas. Je ferai seulement observer que cette solution ne peut pas plus être imposée à l’économie politique qu’à l’anatomie. Ces sciences, toutes d’observation, étudient l’homme tel qu’il est, sans demander compte à Dieu de ses impénétrables secrets.
Ainsi, je le répète, dans ce livre harmonie ne répond pas à l’idée de perfection absolue, mais à celle de perfectionnement indéfini… Il a plu à Dieu d’attacher la douleur à notre nature, puisqu’il a voulu qu’en nous la faiblesse fût antérieure à la force, l’ignorance à la science, le besoin à la satisfaction, l’effort au résultat, l’acquisition à la possession, le dénûment à la richesse, l’erreur à la vérité, l’expérience à la prévoyance. Je me soumets sans murmurer à cet arrêt, ne pouvant d’ailleurs imaginer une autre combinaison. Que si, par un mécanisme aussi simple qu’ingénieux, il a pourvu à ce que tous les hommes se rapprochassent d’un niveau commun qui s’élève toujours, s’il leur assure ainsi, — par l’action même de ce que nous appelons le Mal, — et la durée et la diffusion du progrès, alors je ne me contente pas de m’incliner sous cette main aussi généreuse que puissante, je la bénis, je l’admire et je l’adore.
***
Nous avons vu surgir des écoles qui ont profité de l’insolubilité (humainement parlant) de cette question pour embrouiller toutes les autres, comme s’il était donné à notre intelligence finie de comprendre et de concilier les infinis. Plaçant à l’entrée de la science sociale cette sentence : Dieu ne peut vouloir le mal,' elles arrivent à cette série de conclusions : « Il y a du mal dans la société, donc elle n’est pas organisée selon les desseins de Dieu. Changeons, changeons encore, changeons toujours cette organisation ; essayons, expérimentons jusqu’à ce que nous ayons trouvé une forme qui efface de ce monde toute trace de souffrance. À ce signe, nous reconnaîtrons que le règne de Dieu est arrivé. »
Ce n’est pas tout. Ces écoles sont entraînées à exclure de leurs plans sociaux la liberté au même titre que la souffrance, car la liberté implique la possibilité de l’erreur, et par conséquent la possibilité du mal. « Laissez-nous vous organiser, disent-elles aux hommes, ne vous en mêlez pas ; ne comparez, ne jugez, ne décidez rien par vous-mêmes et pour vous-mêmes ; nous avons en horreur le laissez faire, mais nous demandons que vous vous laissiez faire et que vous nous laissiez faire. Si nous vous conduisons au bonheur parfait, l’infinie bonté de Dieu sera justifiée. »
Contradiction, inconséquence, orgueil, on ne sait ce qui domine dans un tel langage.
Une secte, entre autres, fort peu philosophique, mais très-bruyante, promet à l’humanité un bonheur sans mélange. Qu’on lui livre le gouvernement de l’humanité, et, par la vertu de quelques formules, elle se fait fort d’en bannir toute sensation pénible.
Que si vous n’accordez pas une foi aveugle à ses promesses, soulevant aussitôt ce redoutable et insoluble problème, qui fait depuis le commencement du monde le désespoir de la philosophie, elle vous somme de concilier l’existence du mal avec la bonté infinie de Dieu. Hésitez-vous ? elle vous accuse d’impiété.
Fourrier épuise toutes les combinaisons de ce thème.
« Ou Dieu n’a pas su nous donner un code social d’attraction, justice, vérité, unité ; dans ce cas il est injuste en nous créant ce besoin sans avoir les moyens de nous satisfaire.
Ou il n’a pas voulu ; et dans ce cas il est persécuteur avec préméditation, nous créant à plaisir des besoins qu’il est impossible de contenter.
Ou il a su et n’a pas voulu ; dans ce cas il est l’émule du diable, sachant faire le bien et préférant le règne du mal.
Ou il a voulu et n’a pas su ; dans ce cas il est incapable de nous régir, connaissant et voulant le bien qu’il ne saura pas faire.
Ou il n’a ni su ni voulu ; dans ce cas il est au-dessous du diable, qui est scélérat et non pas bête.
Ou il a su et voulu ; dans ce cas le code existe, il a dû le révéler, etc. »
Et Fourier est le prophète. Livrons-nous à lui et à ses disciples ; la Providence sera justifiée, la sensibilité changera de nature, et la douleur disparaîtra de la terre.
Mais comment les apôtres du bien absolu, ces hardis logiciens qui vont sans cesse disant : « Dieu étant parfait, son œuvre doit être parfaite, » et qui nous accusent d’impiété parce que nous nous résignons à l’imperfection humaine, — comment, dis-je, ne s’aperçoivent-ils pas que, dans l’hypothèse la plus favorable, ils seraient encore aussi impies que nous ? — Je veux bien que, sous le règne de MM. Considérant, Hennequin, etc., pas un homme sur la surface de la terre ne perde sa mère ou ne souffre des dents, — auquel cas il pourrait lui aussi chanter la litanie : Ou Dieu n’a pas su ou il n’a pas voulu ; — je veux que le mal redescende dans les abîmes infernaux à partir du grand jour de la révélation socialiste ; — qu’un de leurs plans, phalanstère, crédit gratuit, anarchie, triade, atelier social, etc., ait la vertu de faire disparaitre tous les maux dans l’avenir. Aura-t-il celle d’anéantir la souffrance dans le passé ? Or l’infini n’a pas de limite ; et s’il y a eu sur la terre un seul malheureux depuis la création, cela suffit pour rendre le problème de l’infinie bonté de Dieu insoluble à leur point de vue.
Ne rattachons donc pas la science du fini aux mystères de l’infini. Appliquons à l’une l’observation et la raison ; laissons les autres dans le domaine de la révélation et de la foi.
Sous tous les rapports, à tous les points de vue, l’homme est imparfait. Sur cette terre du moins, il rencontre des limites dans toutes les directions et touche au fini par tous les points. Sa force, son intelligence, ses affections, sa vie n’ont rien d’absolu et tiennent à un appareil matériel sujet à la fatigue, à l’altération, à la mort.
Non-seulement cela est ainsi, mais notre imperfection est si radicale que nous ne pouvons même nous figurer une perfection quelconque en nous ni hors de nous. Notre esprit a si peu de proportion avec cette idée, qu’il fait de vains efforts pour la saisir. Plus il l’étreint, plus elle lui échappe et se perd en inextricables contradictions. Montrez-moi un homme parfait ; vous me montrerez un homme qui ne peut souffrir, qui par conséquent n’a ni besoins, ni désirs, ni sensations, ni sensibilité, ni nerfs, ni muscles ; qui ne peut rien ignorer, et par conséquent n’a ni attention, ni jugement, ni raisonnement, ni mémoire, ni imagination, ni cerveau ; en un mot vous me montrerez un être qui n’est pas.
Ainsi, sous quelque aspect que l’on considère l’homme, il faut voir en lui un être sujet à la douleur. Il faut admettre que le mal est entré comme ressort dans le plan providentiel ; et, au lieu de chercher les chimériques moyens de l’anéantir, il s’agit d’étudier son rôle et sa mission.
Quand il a plu à Dieu de créer un être composé de besoins et de facultés pour y satisfaire, ce jour-là il a été décidé que cet être serait assujetti à la souffrance ; car sans la souffrance nous ne pouvons concevoir les besoins, et sans les besoins nous ne pouvons comprendre ni l’utilité, ni la raison d’être d’aucune de nos facultés, — tout ce qui fait notre grandeur a sa racine dans ce qui fait notre faiblesse.
Pressés par d’innombrables impulsions, doués d’une intelligence qui éclaire nos efforts et apprécie leurs résultats, nous avons encore, pour nous déterminer, le libre arbitre.
Le libre arbitre implique l’erreur comme possible, et à son tour l’erreur implique la souffrance comme son effet inévitable. Je défie qu’on me dise ce que c’est que choisir librement, si ce n’est courir la chance de faire un mauvais choix ; et ce que c’est que faire un mauvais choix, si ce n’est se préparer une peine.
Et c’est pourquoi sans doute les écoles, qui ne se contentent de rien moins pour l’humanité que du bien absolu, sont toutes matérialistes et fatalistes. Elles ne peuvent admettre le libre arbitre. Elles comprennent que de la liberté d’agir naît la liberté de choisir ; — que la liberté de choisir suppose la possibilité d’errer ; — que la possibilité d’errer c’est la contingence du mal. — Or, dans la société artificielle telle que l’invente un organisateur, le mal ne peut paraître. Pour cela, il faut que les hommes y soient soustraits à la possibilité d’errer ; et le plus sûr moyen, c’est qu’ils soient privés de la liberté d’agir et de choisir ou du libre arbitre. On l’a dit avec raison, le socialisme c’est le despotisme incarné.
En présence de ces folies, on se demande en vertu de quoi l’organisateur ose penser, agir et choisir, non-seulement pour lui, mais pour tout le monde ; car enfin il appartient à l’humanité, et à ce titre il est faillible. — Il l’est d’autant plus qu’il prétend étendre plus loin la sphère de sa science et de sa volonté.
Sans doute l’organisateur trouve que l’objection pèche par sa base, en ce qu’elle le confond avec le reste des hommes. — Puisqu’il a reconnu les vices de l’œuvre divine et entrepris de la refaire, il n’est pas homme ; il est Dieu et plus que Dieu…
Le Socialisme a deux éléments : le délire de l’inconséquence et le délire de l’orgueil !
Mais dès que le libre arbitre, qui est le point de départ de toutes nos études, rencontre une négation, ne serait-ce pas ici le lieu de le démontrer ? Je m’en garderai bien. Chacun le sent, cela suffit. Je le sens, non pas vaguement, mais plus intimement cent fois que s’il m’était démontré par Aristote ou par Euclide. Je le sens à la joie de ma conscience quand j’ai fait un choix qui m’honore ; à ses remords, quand j’ai fait un choix qui m’avilit. En outre, je suis témoin que tous les hommes affirment le libre arbitre par leur conduite, encore que quelques-uns le nient dans leurs écrits. Tous comparent les motifs, délibèrent, se décident, se rétractent, cherchent à prévoir ; tous donnent des conseils, s’irritent contre l’injustice, admirent les actes de dévouement. Donc tous reconnaissent en eux-mêmes et dans autrui le libre arbitre, sans lequel il n’y a ni choix, ni conseils, ni prévoyance, ni moralité, ni vertu possibles. Gardons-nous de chercher à démontrer ce qui est admis par la pratique universelle. Il n’y a pas plus de fatalistes absolus même à Constantinople, qu’il n’y avait de sceptiques absolus même à Alexandrie. Ceux qui se disent tels peuvent être assez fous pour essayer de persuader les autres, — ils ne sont pas assez forts pour se convaincre eux-mêmes. Ils prouvent très-subtilement qu’ils n’ont pas de volonté ; — mais comme, ils agissent comme s’ils en avaient une, ne disputons pas avec eux.
***
Nous voici donc placés au sein de la nature, au milieu de nos frères ; — pressés par des impulsions, des besoins, des appétits, des désirs, — pourvus de facultés diverses pour agir soit sur les choses, soit sur les hommes, — déterminés à l’action par notre libre arbitre, — doués d’une intelligence perfectible, partant imparfaite, et qui, si elle nous éclaire, peut aussi nous tromper sur les conséquences de nos actes.
Toute action humaine, — faisant jaillir une série de conséquences bonnes ou mauvaises, dont les unes retombent sur l’auteur même de l’acte, et dont les autres vont affecter sa famille, ses proches, ses concitoyens et quelquefois l’humanité tout entière, — met, pour ainsi dire, en vibration deux cordes dont les sons rendent des oracles : la Responsabilité et la Solidarité.
La responsabilité, c’est l’enchaînement naturel qui existe, relativement à l’être agissant, entre l’acte et ses conséquences ; c’est un système complet de Peines et de Récompenses fatales, qu’aucun homme n’a inventé, qui agit avec toute la régularité des grandes lois naturelles, et que nous pouvons par conséquent regarder comme d’institution divine. Elle a évidemment pour objet de restreindre le nombre des actions funestes, de multiplier celui des actions utiles.
Cet appareil à la fois correctif et progressif, à la fois rémunérateur et vengeur, est si simple, si près de nous, tellement identifié avec tout notre être, si perpétuellement en action, que non-seulement nous ne pouvons le nier, mais qu’il est, comme le mal, un de ces phénomènes sans lesquels toute vie est pour nous inintelligible.
La Genèse raconte que le premier homme ayant été chassé du paradis terrestre parce qu’il avait appris à distinguer le Bien et le Mal, sciens bonum et malum, Dieu prononça sur lui cet arrêt : In laboribus comedes ex terrâ cunctis diebus vitæ tuæ. — Spinas et tribulos germinabit tibi. - In sudore vultûs tui vesceris pane, donec revertaris in terram de quâ sumptus es : quia pulvis es et in pulverem reverteris.
Voilà donc le bien et le mal — ou l’humanité. Voilà les actes et les habitudes produisant des conséquences bonnes ou mauvaises — ou l’humanité. Voilà le travail, la sueur, les épines, les tribulations et la mort — ou l’humanité.
L’humanité, dis-je : car choisir, se tromper, souffrir, se rectifier, en un mot tous les éléments qui composent l’idée de responsabilité, sont tellement inhérents à notre nature sensible, intelligente et libre, ils sont tellement cette nature même, que je défie l’imagination la plus féconde de concevoir pour l’homme un autre mode d’existence.
Que l’homme ait vécu dans un Éden, in paradiso voluptatis, ignorant le bien et le mal, scientiam boni et mali, nous pouvons bien le croire, mais nous ne pouvons le comprendre, tant notre nature a été profondément transformée.
Il nous est impossible de séparer l’idée de vie de celle de sensibilité, celle de sensibilité de celle de plaisir et douleur, celle de plaisir et de douleur de celle de peine et récompense, celle d’intelligence de celle de liberté et choix, et toutes ces idées de celle de Responsabilité ; car c’est l’ensemble de toutes ces idées qui nous donne celle d’Être, de telle sorte que lorsque nous pensons à Dieu, la raison nous disant qu’il ne peut souffrir, elle reste confondue, tant l’être et la sensibilité sont pour nous inséparables.
Et c’est là sans doute ce qui fait de la Foi le complément nécessaire de nos destinées. Elle est le seul lien possible entre la créature et le Créateur, puisqu’il est et sera toujours pour la raison le Dieu incompréhensible, Deus absconditus.
Pour voir combien la responsabilité nous tient de près et nous serre de tous côtés, il suffit de donner son attention aux faits les plus simples.
Le feu nous brûle, le choc des corps nous brise ; si nous n’étions pas doués de sensibilité, ou si notre sensibilité n’était pas affectée péniblement par l’approche du feu et le rude contact des corps, nous serions exposés à la mort à chaque instant.
Depuis la première enfance jusqu’à l’extrême vieillesse, notre vie n’est qu’un long apprentissage. Nous apprenons à marcher à force de tomber ; nous apprenons par des expériences rudes et réitérées à éviter le chaud, le froid, la faim, la soif, les excès. Ne nous plaignons pas de ce que les expériences sont rudes ; si elles ne l’étaient pas, elles ne nous apprendraient rien.
Il en est de même dans l’ordre moral. Ce sont les tristes conséquences de la cruauté, de l’injustice, de la peur, de la violence, de la fourberie, de la paresse, qui nous apprennent à être doux, justes, braves, modérés, vrais et laborieux. L’expérience est longue ; elle durera même toujours, mais elle est efficace.
L’homme étant fait ainsi, il est impossible de ne pas reconnaître dans la responsabilité le ressort auquel est confié spécialement le progrès social. C’est le creuset où s’élabore l’expérience. Ceux donc qui croient à la supériorité des temps passés, comme ceux qui désespèrent de l’avenir, tombent dans la contradiction la plus manifeste. Sans s’en apercevoir, ils préconisent l’erreur, ils calomnient la lumière. C’est comme s’ils disaient : « Plus j’ai appris, moins je sais ; plus je discerne ce qui peut me nuire, plus je m’y exposerai. » Si l’humanité était constituée sur une telle donnée, il y a longtemps qu’elle eût cessé d’exister.
Le point de départ de l’homme c’est l’ignorance et l’inexpérience ; plus nous remontons la chaîne des temps, plus nous le rencontrons dépourvu de cette lumière propre à guider ses choix et qui ne s’acquiert que par un de ces moyens : la réflexion ou l’expérimentation.
Or il arrive que chaque acte humain renferme non une conséquence, mais une série de conséquences. Quelquefois la première est bonne et les autres mauvaises ; quelquefois la première est mauvaise et les autres bonnes. D’une détermination humaine il peut sortir des combinaisons de biens et de maux, en proportions variables. Qu’on nous permette d’appeler vicieux les actes qui produisent plus de maux que de biens, et vertueux ceux qui engendrent plus de biens que de maux.
Quand un de nos actes produit une première conséquence qui nous agrée, suivie de plusieurs autres conséquences qui nuisent, de telle sorte que la somme des maux l’emporte sur celle des biens, cet acte tend à se restreindre et à disparaître à mesure que nous acquérons plus de prévoyance.
Les hommes aperçoivent naturellement les conséquences immédiates avant les conséquences éloignées. D’où il suit que ce que nous avons appelé les actes vicieux sont plus multipliés dans les temps d’ignorance. Or la répétition des mêmes actes forme les habitudes. Les siècles d’ignorance sont donc le règne des mauvaises habitudes.
Par suite, c’est encore le règne des mauvaises lois, car les actes répétés, les habitudes générales constituent les mœurs sur lesquelles se modèlent les lois, et dont elles sont, pour ainsi parler, l’expression officielle.
Comment cesse cette ignorance ? Comment les hommes apprennent-ils à connaître les secondes, les troisièmes et jusqu’aux dernières conséquences de leurs actes et de leurs habitudes ?
Ils ont pour cela un premier moyen : c’est l’application de cette faculté de discerner et de raisonner qu’ils tiennent de la Providence.
Mais il est un moyen plus sûr, plus efficace, c’est l’expérience. — Quand l’acte est commis, les conséquences arrivent fatalement. La première est bonne, on le savait, c’est justement pour l’obtenir qu’on s’est livré à l’acte. Mais la seconde inflige une souffrance, la troisième une souffrance plus grande encore, et ainsi de suite.
Alors les yeux s’ouvrent, la lumière se fait. On ne renouvelle pas l’acte ; on sacrifie le bien de la première conséquence par crainte du mal plus grand que contiennent les autres. Si l’acte est devenu une habitude et si l’on n’a pas la force d’y renoncer, du moins on ne s’y livre qu’avec hésitation et répugnance, à la suite d’un combat intérieur. On ne le conseille pas, on le blâme ; on en détourne ses enfants. On est certainement dans la voie du progrès.
Si, au contraire, il s’agit d’un acte utile, mais dont on s’abstenait, — parce que la première conséquence, la seule connue, est pénible et que les conséquences ultérieures favorables étaient ignorées, — on éprouve les effets de l’abstention. Par exemple, un sauvage est repu. Il ne prévoit pas qu’il aura faim demain. Pourquoi travaillerait-il aujourd’hui ? Travailler est une peine actuelle, il n’est pas besoin de prévoyance pour le savoir. Donc il demeure dans l’inertie. Mais le jour fuit, un autre lui succède, il amène la faim, il faut travailler sous cet aiguillon. — C’est une leçon qui souvent réitérée ne peut manquer de développer la prévoyance. Peu à peu la paresse est appréciée pour ce qu’elle est. On la flétrit ; on en détourne la jeunesse. L’autorité de l’opinion publique passe du côté du travail.
Mais pour que l’expérience soit une leçon, pour qu’elle remplisse sa mission dans le monde, pour qu’elle développe la prévoyance, pour qu’elle expose la série des effets, pour qu’elle provoque les bonnes habitudes et restreigne les mauvaises, en un mot pour qu’elle soit l’instrument propre du progrès et du perfectionnement moral, il faut que la loi de Responsabilité agisse. Il faut que les mauvaises conséquences se fassent sentir, et, lâchons le grand mot, il faut que momentanément le mal sévisse.
Sans doute, il vaudrait mieux que le mal n’existât pas ; — et cela serait peut-être si l’homme était fait sur un autre plan. — Mais, l’homme étant donné avec ses besoins, ses désirs, sa sensibilité, son libre arbitre, sa faculté de choisir et de se tromper, sa faculté de mettre en action une cause qui renferme nécessairement des conséquences, qu’il n’est pas possible d’anéantir, tant que la cause existe ; la seule manière d’anéantir la cause, c’est d’éclairer le libre arbitre, de rectifier le choix, de supprimer l’acte ou l’habitude vicieuse ; et rien de cela ne se peut que par la loi de Responsabilité.
On peut donc affirmer ceci : l’homme étant ce qu’il est, le mal est non-seulement nécessaire, mais utile. Il a une mission ; il entre dans l’harmonie universelle. Il a une mission qui est de détruire sa propre cause, de se limiter ainsi lui-même, de concourir à la réalisation du bien, de stimuler le progrès.
Éclaircissons ceci par quelques exemples pris dans l’ordre d’idées qui nous occupe, c’est-à-dire dans l’économie politique.
Épargne, Prodigalité.
Monopoles.
Population [289] …
La Responsabilité se manifeste par trois sanctions :
1° La sanction naturelle. C’est celle dont je viens de parler. C’est la peine ou la récompense nécessaires que contiennent les actes et les habitudes.
2° La sanction religieuse. Ce sont les peines et les récompenses promises dans un autre monde aux actes et aux habitudes, selon qu’ils sont vicieux ou vertueux.
3° La sanction légale. Les peines et les récompenses préparées d’avance par la société.
De ces trois sanctions, j’avoue que celle qui me paraît fondamentale c’est la première. En m’exprimant ainsi, je ne puis manquer de heurter des sentiments que je respecte ; mais je demande aux chrétiens de me permettre de dire mon opinion.
Ce sera probablement le sujet d’un débat éternel, entre l’esprit philosophique et l’esprit religieux, de savoir si un acte est vicieux parce qu’une révélation venue d’en haut l’a déclaré tel, indépendamment de ses conséquences, — ou bien si cette révélation l’a déclaré vicieux parce qu’il produit des conséquences mauvaises.
Je crois que le christianisme peut se ranger à cette dernière opinion. Il dit lui-même qu’il n’est pas venu contrarier la loi naturelle, mais la renforcer. On ne peut guère admettre que Dieu, qui est l’ordre suprême, ait fait une classification arbitraire des actes humains, ait promis le châtiment aux uns et les récompenses aux autres, et cela sans aucune considération de leurs effets, c’est-à-dire de leur discordance ou de leur concordance dans l’harmonie universelle.
Quand il a dit : « Tu ne tueras point, — Tu ne déroberas point, » sans doute il avait en vue d’interdire certains actes parce qu’ils nuisent à l’homme et à la société, qui sont son ouvrage.
La considération des conséquences est si puissante sur l’homme, que, s’il appartenait à une religion qui défendît des actes dont l’expérience universelle révélerait l’utilité, ou qui ordonnât des habitudes dont la nuisibilité serait palpable, je crois que cette religion à la longue ne pourrait se soutenir et succomberait devant le progrès des lumières. Les hommes ne pourraient longtemps supposer en Dieu le dessein prémédité de faire le mal et d’interdire le bien.
La question que j’effleure ici n’a peut-être pas une grande importance à l’égard du christianisme, puisqu’il n’ordonne que ce qui est bien en soi et ne défend que ce qui est mauvais.
Mais ce que j’examine, c’est la question de savoir si, en principe, la sanction religieuse vient confirmer la sanction naturelle, ou si la sanction naturelle n’est rien devant la sanction religieuse, et doit lui céder le pas quand elles viennent à se contredire.
Or, si je ne me trompe, la tendance des ministres de la religion est de se préoccuper fort peu de la sanction naturelle. Ils ont pour cela une raison irréfutable : « Dieu a ordonné ceci, Dieu a défendu cela. » Il n’y a plus à raisonner, car Dieu est infaillible et tout-puissant. L’acte ordonné amenât-il la destruction du monde, il faut marcher en aveugles, absolument comme vous feriez si Dieu vous parlait directement à vous-même et vous montrait le ciel et l’enfer.
Il peut arriver, même dans la vraie religion, que des actes innocents soient défendus sous l’autorité de Dieu. Par exemple, prélever un intérêt a été déclaré un péché. Si l’humanité s’était conformée à cette prohibition, il y a longtemps qu’elle aurait disparu du globe. Car, sans l’intérêt, il n’y a pas de capital possible ; sans le capital, il n’y a pas de concours du travail antérieur avec le travail actuel ; sans ce concours, il n’y a pas de société ; et sans société, il n’y a pas d’homme.
D’un autre côté, en examinant de près l’intérêt, on reste convaincu que non-seulement il est utile dans ses effets généraux, niais encore qu’il n’a rien de contraire à la charité ni à la vérité, — pas plus que les appointements d’un ministre du culte, et certainement moins que certaines parties du casuel.
Aussi toute la puissance de l’Église n’a pu suspendre une minute, à cet égard, la nature des choses. C’est tout au plus si elle est parvenue à faire déguiser, dans un nombre de cas infiniment petit, une des formes et la moins usuelle de l’intérêt.
De même pour les prescriptions. — Quand l’Évangile nous dit : « Si l’on te frappe sur une joue, présente l’autre, » il donne un précepte qui, pris au pied de la lettre, détruirait le droit de légitime défense dans l’individu et par conséquent dans la société. Or, sans ce droit, l’existence de l’humanité est impossible.
Aussi qu’est-il arrivé ? Depuis dix-huit siècles on répète ce mot comme un vain conventionnalisme.
Mais ceci est plus grave. Il y a des religions fausses dans ce monde. — Celles-ci admettent nécessairement des préceptes et des prohibitions en contradiction avec la sanction naturelle correspondant à tels ou tels actes. Or, de tous les moyens qui nous ont été donnés pour discerner, dans une matière aussi importante, le vrai du faux, et ce qui émane de Dieu, de ce qui nous vient de l’imposture, aucun n’est plus certain, plus décisif, que l’examen des conséquences bonnes ou mauvaises qu’une doctrine peut avoir sur la marche et le progrès de l’humanité : a fructibus eorum cognoscetis eos.
Sanction légale. La nature ayant préparé tout un système de châtiments et de récompenses, sous la forme des effets qui sortent nécessairement de chaque action et de chaque habitude, que doit faire la loi humaine ? Elle n’a que trois partis à prendre : laisser agir la Responsabilité, abonder dans son sens, ou la contrarier.
Il me semble hors de doute que lorsqu’une sanction légale est mise en œuvre, ce ne doit être que pour donner plus de force, de régularité, de certitude et d’efficacité à la sanction naturelle. Ce sont deux puissances qui doivent concourir et non se heurter.
Exemple : si la fraude est d’abord profitable à celui qui s’y livre, le plus souvent elle lui est funeste à la longue ; car elle nuit à son crédit, à sa considération, à son honneur. Elle crée autour de lui la défiance et le soupçon. En outre, elle est toujours nuisible à celui qui en est victime. Enfin, elle alarme la société, et l’oblige à user une partie de ses forces à des précautions onéreuses. La somme des maux l’emporte donc de beaucoup sur celle des biens. C’est ce qui constitue la Responsabilité naturelle, qui agit incessamment comme moyen préventif et répressif. On conçoit cependant que la communauté ne s’en remette pas exclusivement à l’action lente de la responsabilité nécessaire, et qu’elle juge à propos d’ajouter une sanction légale à la sanction naturelle. En ce cas, on peut dire que la sanction légale n’est que la sanction naturelle organisée et régularisée.
Elle rend le châtiment plus immédiat et plus certain ; elle donne aux faits plus de publicité et d’authenticité ; elle entoure le prévenu de garanties, lui donne une occasion régulière de se disculper s’il y a lieu, prévient les erreurs de l’opinion, et calme les vengeances individuelles en leur substituant la vindicte publique. Enfin, et c’est peut-être l’essentiel, elle ne détruit pas la leçon de l’expérience.
Ainsi on ne peut pas dire que la sanction légale soit illogique en principe, quand elle marche parallèlement à la sanction naturelle et concourt au même résultat.
Il ne s’ensuit pas cependant que la sanction légale doive, dans tous les cas, se substituer à la sanction naturelle, et que la loi humaine soit justifiée par cela seul qu’elle agit dans le sens de la Responsabilité.
La répartition artificielle des peines et des récompenses renferme en elle-même, à la charge de la communauté, une somme d’inconvénients dont il faut tenir compte. L’appareil de la sanction légale vient des hommes, fonctionne par des hommes, et est onéreux.
Avant de soumettre une action ou une habitude à la répression organisée, il y a donc toujours cette question à se poser :
Cet excédant de bien, obtenu par l’addition d’une répression légale à la répression naturelle, compense-t-il le mal inhérent à l’appareil répressif ?
Ou, en d’autres termes, le mal de la répression artificielle est-il supérieur ou inférieur au mal de l’impunité ?
Dans le cas du vol, du meurtre, de la plupart des délits et des crimes, la question n’est pas douteuse. Aussi, tous les peuples de la terre les répriment par la force publique.
Mais lorsqu’il s’agit d’une habitude difficile à constater, qui peut naître de causes morales dont l’appréciation est fort délicate, la question change ; et il peut très-bien arriver qu’encore que cette habitude soit universellement tenue pour funeste et vicieuse, la loi reste neutre et s’en remette à la responsabilité naturelle.
Disons d’abord que la loi doit prendre ce parti toutes les fois qu’il s’agit d’une action ou d’une habitude douteuse, quand une partie de la population trouve bon ce que l’autre trouve mauvais. Vous prétendez que j’ai tort de pratiquer le culte catholique ; moi je prétends que vous avez tort de pratiquer le culte luthérien. Laissons à Dieu le soin de juger. Pourquoi vous frapperais-je ou pourquoi me frapperiez-vous ? S’il n’est pas bon que l’un de nous frappe l’autre, comment peut-il être bon que nous déléguions à un tiers, dépositaire de la force publique, le soin de frapper l’un de nous pour la satisfaction de l’autre ?
Vous prétendez que je me trompe en enseignant à mon enfant les sciences naturelles et morales, je crois que vous avez tort d’enseigner exclusivement au vôtre le grec et le latin. Agissons de part et d’autre selon notre conscience. Laissons agir sur nos familles la loi de la Responsabilité. Elle punira celui de nous qui se trompe. N’invoquons pas la loi humaine ; elle pourrait bien punir celui qui ne se trompe pas.
Vous affirmez que je ferais mieux de prendre telle carrière, de travailler selon tel procédé, d’employer une charrue en fonte au lieu d’une charrue en bois, de semer clair au lieu de semer dru, d’acheter en Orient plutôt qu’en Occident. Je soutiens tout le contraire. — J’ai fait tous mes calculs ; en définitive, je suis plus intéressé que vous à ne pas me tromper sur des matières d’où dépendent mon bien-être, mon existence, le bonheur de ma famille, et qui n’intéressent que votre amour-propre ou vos systèmes. Conseillez-moi, mais ne m’imposez rien. Je me déciderai à mes périls et risques, cela suffit, et l’intervention de la loi serait ici tyrannique.
On voit que, dans presque tous les actes importants de la vie, il faut respecter le libre arbitre, s’en remettre au jugement individuel des hommes, à cette lumière intérieure que Dieu leur a donnée pour s’en servir, et après cela laisser la Responsabilité faire son œuvre.
L’intervention de la loi, dans des cas analogues, outre l’inconvénient très-grand de donner des chances à l’erreur autant qu’à la vérité, aurait encore l’inconvénient bien autrement grave de frapper d’inertie l’intelligence même, d’éteindre ce flambeau qui est l’apanage de l’humanité et le gage de ses progrès.
Mais alors même qu’une action, une habitude, une pratique est reconnue mauvaise, vicieuse, immorale par le bon sens public, quand il n’y a pas doute à cet égard, quand ceux qui s’y livrent sont les premiers à se blâmer eux-mêmes, cela ne suffit pas encore pour justifier l’intervention de la loi humaine. Ainsi que je l’ai dit tout à l’heure, il faut savoir de plus si, en ajoutant aux mauvaises conséquences de ce vice les mauvaises conséquences inhérentes à tout appareil légal, on ne produit pas, en définitive, une somme de maux, qui excède le bien que la sanction légale ajoute à la sanction naturelle.
Nous pourrions examiner ici les biens et les maux que peut produire la sanction légale appliquée à réprimer la paresse, la prodigalité, l’avarice, l’égoïsme, la cupidité, l’ambition.
Prenons pour exemple la paresse.
C’est un penchant assez naturel, et il ne manque pas d’hommes qui font écho aux Italiens quand ils célèbrent le dolce far niente, et à Rousseau quand il dit : Je suis paresseux avec délices. Il n’est donc pas douteux que la paresse ne procure quelque satisfaction, sans quoi il n’y aurait pas de paresseux au monde.
Cependant, il sort de ce penchant une foule de maux, à ce point que la Sagesse des nations a pu signaler l’Oisiveté comme la mère de tous les vices.
Les maux surpassent infiniment les biens ; et il faut que la loi de la Responsabilité naturelle ait agi, en cette matière, avec quelque efficacité, soit comme enseignement, soit comme aiguillon, puisqu’en fait le monde est arrivé par le travail au point de civilisation où nous le voyons de nos jours.
Maintenant, soit comme enseignement, soit comme aiguillon, qu’ajouterait à la sanction providentielle une sanction légale ? — Supposons une loi qui punisse les paresseux. Quel est au juste le degré d’activité dont cette loi accroîtrait l’activité nationale ?
Si l’on pouvait le savoir, on aurait la mesure exacte du bienfait de la loi. J’avoue que je ne puis me faire aucune idée de cette partie du problème. Mais il faut se demander à quel prix ce bienfait serait acheté ; et, pour peu qu’on y réfléchisse, on sera disposé à croire que les inconvénients certains de la répression légale surpasseraient de beaucoup ses avantages problématiques.
En premier lieu, il y a en France trente-six millions de citoyens. Il faudrait exercer sur tous une surveillance rigoureuse ; les suivre aux champs, à l’atelier, au sein du foyer domestique. Je laisse à penser le nombre de fonctionnaires, le surcroît d’impôts, etc.
Ensuite, ceux qui sont aujourd’hui laborieux, et Dieu merci le nombre en est grand, ne seraient pas moins que les paresseux soumis à cette inquisition insupportable. C’est un inconvénient immense de soumettre cent innocents à des mesures dégradantes pour punir un coupable que la nature se charge de punir.
Et puis, quand commence la paresse ? Dans chaque cas soumis à la justice, il faudra une enquête des plus minutieuses et des plus délicates. Le prévenu était-il réellement oisif, ou bien prenait-il un repos nécessaire ? Était-il malade, en méditation, en prière, etc. ? Comment apprécier toutes ces nuances ? Avait-il forcé son travail du matin pour se ménager un peu de loisir le soir ? Que de témoins, que d’experts, que de juges, que de gendarmes, que de résistances, que de délations, que de haines !…
Vient le chapitre des erreurs judiciaires. Que de paresseux échapperont ! et, en compensation, que de gens laborieux iront racheter en prison, par une inactivité d’un mois, leur inactivité d’un jour !
Ce que voyant, et bien d’autres choses, on s’est dit : Laissons faire la Responsabilité naturelle. Et on a bien fait.
Les socialistes, qui ne reculent jamais devant le despotisme pour arriver à leurs fins, — car ils ont proclamé la souveraineté du but, — ont flétri la Responsabilité sous le nom d’individualisme ; puis ils ont essayé de l’anéantir et de l’absorber dans la sphère d’action de la Solidarité étendue au delà de ses limites naturelles.
Les conséquences de cette perversion des deux grands mobiles de la perfectibilité humaine sont fatales. Il n’y a plus de dignité, plus de liberté pour l’homme. Car du moment que celui qui agit ne répond plus personnellement des suites bonnes ou mauvaises de son acte, son droit d’agir isolément n’existe plus. Si chaque mouvement de l’individu va répercuter la série de ses effets sur la société tout entière, l’initiative de chaque mouvement ne peut plus être abandonnée à l’individu ; elle appartient à la société. La communauté seule doit décider de tout, régler tout : éducation, nourriture, salaires, plaisirs, locomotion, affections, familles, etc., etc. — Or la société s’exprime par la loi, la loi c’est le législateur. Donc voilà un troupeau et un berger, — moins que cela encore, une matière inerte et un ouvrier. On voit où mène la suppression de la Responsabilité et de l’individualisme.
Pour cacher cet effroyable but aux yeux du vulgaire, il fallait flatter, en déclamant contre l’égoïsme, les plus égoïstes passions. Le socialisme a dit aux malheureux : « N’examinez pas si vous souffrez en vertu de la loi de Responsabilité. Il y a des heureux dans le monde, et, en vertu de la loi de Solidarité, ils vous doivent le partage de leur bonheur. » Et pour aboutir à cet abrutissant niveau d’une solidarité factice, officielle, légale, contrainte, détournée de son sens naturel, on érigeait la spoliation en système, on faussait toute notion du juste, on exaltait ce sentiment individualiste, — qu’on était censé proscrire, — jusqu’au plus haut degré de puissance et de perversité. Ainsi tout s’enchaîne : négation des harmonies de la liberté dans le principe, — despotisme et esclavage en résultat, — immoralité dans les moyens.
***
Toute tentative pour détourner le cours naturel de la responsabilité est une atteinte à la justice, à la liberté, à l’ordre, à la civilisation ou au progrès.
À la justice. Un acte ou une habitude étant donnés, les conséquences bonnes ou mauvaises s’ensuivent nécessairement. Oh ! s’il était possible de supprimer ces conséquences, il y aurait sans doute quelque avantage à suspendre la loi naturelle de la responsabilité. Mais le seul résultat auquel on puisse arriver par la loi écrite, c’est que les conséquences bonnes d’une action mauvaise soient recueillies par l’auteur de l’acte, et que les conséquences mauvaises retombent sur un tiers, ou sur la communauté ; — ce qui est, certes le caractère spécial de l’injustice.
Ainsi les sociétés modernes sont constituées sur ce principe que le père de famille doit soigner et élever les enfants auxquels il a donné le jour. — Et c’est ce principe qui maintient dans de justes bornes l’accroissement et la distribution de la population, chacun se sentant en présence de la responsabilité. Les hommes ne sont pas tous doués du même degré de prévoyance, et [290], dans les grandes villes, à l’imprévoyance se joint l’immoralité. Maintenant il y a tout un budget et une administration pour recueillir les enfants que leurs parents abandonnent ; aucune recherche ne décourage cette honteuse désertion, et une masse toujours croissante d’enfants délaissés inonde nos plus pauvres campagnes.
Voici donc un paysan qui s’est marié tard pour n’être pas surchargé de famille, et qu’on force à nourrir les enfants des autres. — Il ne conseillera pas à son fils la prévoyance. Cet autre a vécu dans la continence, et voilà qu’on lui fait payer pour élever des bâtards. — Au point de vue religieux sa conscience est tranquille, mais au point de vue humain il doit se dire qu’il est un sot…
Nous ne prétendons pas aborder ici la grave question de la charité publique, nous voulons seulement faire cette remarque essentielle que plus l’État centralise, plus il transforme la responsabilité naturelle en solidarité factice, plus il ôte à des effets, qui frappent dès lors ceux qui sont étrangers à la cause, leur caractère providentiel de justice, de châtiment et d’obstacle préventif.
Quand le gouvernement ne peut pas éviter de se charger d’un service qui devrait être du ressort de l’activité privée, il faut du moins qu’il laisse la responsabilité aussi rapprochée que possible de celui à qui naturellement elle incombe.
Ainsi, dans la question des enfants trouvés, le principe étant que le père et la mère doivent élever l’enfant, la loi doit épuiser tous les moyens pour qu’il en soit ainsi. — À défaut des parents, que ce soit la commune ; — à défaut de la commune, le département. Voulez-vous multiplier à l’infini les enfants trouvés ? Déclarez que l’État s’en charge. Ce serait bien pis encore, si la France nourrissait les enfants chinois ou réciproquement…
C’est une chose singulière, en vérité, qu’on veuille faire des lois pour dominer les maux de la responsabilité ! N’apercevra-t-on jamais que ces maux on ne les anéantit pas, on les détourne seulement ? Le résultat est une injustice de plus et une leçon de moins…
Comment veut-on que le monde se perfectionne, si ce n’est à mesure que chacun remplira mieux ses devoirs ? Et chacun ne remplira-t-il pas mieux ses devoirs à mesure qu’il aura plus à souffrir en les violant ? Si l’action sociale avait à s’immiscer dans l’œuvre de la responsabilité, ce devrait être pour en seconder et non en détourner, en concentrer et non en éparpiller au hasard les effets.
On l’a dit : l’opinion est la reine du monde. Assurément pour bien gouverner son empire, il faut qu’elle soit éclairée ; et elle est d’autant plus éclairée que chacun des hommes qui concourent à la former aperçoit mieux la liaison des effets aux causes. Or rien ne fait mieux sentir cet enchaînement que l’expérience, et l’expérience, comme on le sait, est toute personnelle ; elle est le fruit de la responsabilité.
Il y a donc, dans le jeu naturel de cette grande loi, tout un système précieux d’enseignements auquel il est très-imprudent de toucher.
Que si vous soustrayez, par des combinaisons irréfléchies, les hommes à la responsabilité de leurs actes, ils pourront bien encore être instruits par la théorie, — mais non plus par l’expérience. Et je ne sais si une instruction que l’expérience ne vient jamais consolider et sanctionner n’est pas plus dangereuse que l’ignorance même…
Le sens de la responsabilité' est éminemment perfectible.
C’est un des plus beaux phénomènes moraux. Il n’est rien que nous admirions plus dans un homme, une classe ou une nation, que le sens de la responsabilité ; il indique une grande culture morale et une exquise sensibilité aux arrêts de l’opinion. Mais il peut arriver que le sens de la responsabilité soit très-développé en une matière et très-peu en une autre. En France, dans les classes élevées, on mourrait de honte si on était surpris trichant au jeu ou s’adonnant solitairement à la boisson. On en rit parmi les paysans. Mais trafiquer de ses droits politiques, exploiter son vote, se mettre en contradiction avec soi-même, crier tour à tour : Vive le Roi ! vive la Ligue ! selon l’intérêt du moment… Ce sont des choses qui n’ont rien de honteux dans nos mœurs.
Le développement du sens de la responsabilité a beaucoup à attendre de l’intervention des femmes.
Elles y sont extrêmement soumises. Il dépend d’elles de créer cette force moralisatrice parmi les hommes ; car il leur appartient de distribuer efficacement le blâme et l’éloge… Pourquoi ne le font-elles pas ? parce qu’elles ne savent pas assez la liaison des effets aux causes en morale…
La morale est la science de tout le monde, mais particulièrement des femmes, parce qu’elles font les mœurs…
XXI. Solidarité↩
Si l’Homme était parfait, s’il était infaillible, la société offrirait une harmonie toute différente de celle que nous devons y chercher. La nôtre n’est pas celle de Fourier. Elle n’exclut pas le mal ; elle admet les dissonances ; seulement nous reconnaîtrons qu’elle ne cesse pas d’être harmonie, si ces dissonances préparent l’accord et nous y ramènent.
Nous avons pour point de départ ceci : L’homme est faillible, et Dieu lui a donné le libre arbitre ; et avec la faculté de choisir, celle de se tromper, de prendre le faux pour le vrai, de sacrifier l’avenir au présent, de céder aux désirs déraisonnables de son cœur, etc.
L’homme se trompe. Mais tout acte, toute habitude a ses conséquences.
Par la Responsabilité, nous l’avons vu, ces conséquences retombent sur l’auteur de l’acte ; un enchaînement naturel de récompenses ou de peines l’attire donc au bien et l’éloigne du mal.
Si l’homme avait été destiné par la nature à la vie et au travail solitaires, la Responsabilité serait sa seule loi.
Mais il n’en est pas ainsi, il est sociable par destination. Il n’est pas vrai, comme le dit Rousseau, que l’homme soit naturellement un tout parfait et solitaire, et que la volonté du législateur ait dû le transformer en fraction d’un plus grand tout. La famille, la commune, la nation, l’humanité sont des ensembles avec lesquels l’homme a des relations nécessaires. Il résulte de là que les actes et les habitudes de l’individu produisent, outre les conséquences qui retombent sur lui-même, d’autres conséquences bonnes ou mauvaises qui s’étendent à ses semblables. — C’est ce qu’on appelle la loi de solidarité, qui est une sorte de Responsabilité collective.
Cette idée de Rousseau, que le législateur a inventé la société, — idée fausse en elle-même, — a été funeste en ce qu’elle a induit à penser que la solidarité est de création législative ; et nous verrons bientôt les modernes législateurs se fonder sur cette doctrine pour assujettir la société à une Solidarité artificielle, agissant en sens inverse de la Solidarité naturelle. En toutes choses, le principe de ces grands manipulateurs du genre humain est de mettre leur œuvre propre à la place de l’œuvre de Dieu, qu’ils méconnaissent.
Constatons d’abord l’existence naturelle de la loi de Solidarité.
Dans le dix-huitième siècle, on n’y croyait pas ; on s’en tenait à la maxime de la personnalité des fautes. Ce siècle, occupé surtout de réagir contre le catholicisme, aurait craint, en admettant le principe de la Solidarité, d’ouvrir la porte à la doctrine du Péché Originel. Chaque fois que Voltaire voyait dans les Écritures un homme portant la peine d’un autre, il disait ironiquement : « C’est affreux, mais la justice de Dieu n’est pas celle des hommes. »
Nous n’avons pas à discuter ici le péché originel. Mais ce dont Voltaire se moquait est un fait non moins incontestable que mystérieux. La loi de Solidarité éclate en traits si nombreux dans l’individu et dans les masses, dans les détails et dans l’ensemble, dans les faits particuliers et dans les faits généraux, qu’il faut, pour le méconnaître, tout l’aveuglement de l’esprit de secte ou toute l’ardeur d’une lutte acharnée.
La première règle de toute justice humaine est de concentrer le châtiment d’un acte sur son auteur, en vertu de ce principe : Les fautes sont personnelles. Mais cette loi sacrée des individus n’est ni la loi de Dieu, ni même la loi de la société.
Pourquoi cet homme est-il riche ? parce que son père fut actif, probe, laborieux, économe. Le père a pratiqué les vertus, le fils a recueilli les récompenses.
Pourquoi cet autre est-il toujours souffrant, malade, faible, craintif et malheureux ? parce que son père, doué d’une puissante constitution, en a abusé dans les débauches et les excès. Au coupable les conséquences agréables de la faute, à l’innocent les conséquences funestes.
Il n’y a pas un homme sur la terre dont la condition n’ait été déterminée par des milliards de faits auxquels ses déterminations sont étrangères ; ce dont je me plains aujourd’hui a peut-être pour cause un caprice de mon bisaïeul, etc.
La solidarité se manifeste sur une plus grande échelle encore et à des distances plus inexplicables, quand on considère les rapports des divers peuples, ou des diverses générations d’un même peuple.
N’est-il pas étrange que le dix-huitième siècle ait été si occupé des travaux intellectuels ou matériels dont nous jouissons aujourd’hui ? N’est-il pas merveilleux que nous-mêmes nous nous mettions à la gêne pour couvrir le pays de chemins de fer, sur lesquels aucun de nous ne voyagera peut-être ? Qui peut méconnaître la profonde influence de nos anciennes révolutions sur ce qui se passe aujourd’hui ? Qui peut prévoir quel héritage de paix ou de discordes nos débats actuels légueront à nos enfants ?
Voyez les emprunts publics. Nous nous faisons la guerre ; nous obéissons à des passions barbares ; nous détruisons par là des forces précieuses ; et nous trouvons le moyen de rejeter le fléau de cette destruction sur nos fils, qui peut-être auront la guerre en horreur et ne pourront comprendre nos passions haineuses.
Jetez les yeux sur l’Europe ; contemplez les événements qui agitent la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, et dites si la loi de la Solidarité est une loi chimérique.
Il n’est pas nécessaire de pousser plus loin cette énumération. D’ailleurs il suffit que l’action d’un homme, d’un peuple, d’une génération, exerce quelque influence sur un autre homme, sur un autre peuple, sur une autre génération, pour que la loi soit constatée. La société tout entière n’est qu’un ensemble de solidarités qui se croisent. Cela résulte de la nature communicable de l’intelligence. Exemples, discours, littérature, découvertes, sciences, morale, etc., tous ces courants inaperçus par lesquels correspondent les âmes, tous ces efforts sans liens visibles dont la résultante cependant pousse le genre humain vers un équilibre, vers un niveau moyen qui s’élève sans cesse, tout ce vaste trésor d’utilités et de connaissances acquises, où chacun puise sans le diminuer, que chacun augmente sans le savoir, tout cet échange de pensées, de produits, de services et de travail, de maux et de biens, de vertus et de vices qui font de la famille humaine une grande unité, et de ces milliards d’existences éphémères une vie commune, universelle, continue, tout cela c’est la Solidarité.
Il y a donc naturellement et dans une certaine mesure Solidarité incontestable entre les hommes. En d’autres termes, la Responsabilité n’est pas exclusivement personnelle, elle se partage ; l’action émane de l’individualité, les conséquences se distribuent sur la communauté…
Or il faut remarquer qu’il est dans la nature de chaque homme de vouloir être heureux. — Qu’on dise tant qu’on voudra que je célèbre ici l’égoïsme ; je ne célèbre rien, je constate, — je constate ce sentiment inné, universel, qui ne peut pas ne pas être : — l’intérêt personnel, le penchant au bien-être, la répugnance à la douleur.
Il suit de là que l’individualité est portée à s’arranger de telle sorte que les bonnes conséquences de ses actes lui reviennent et que les mauvaises retombent sur autrui ; autant que possible, elle cherche à répartir celles-ci sur un plus grand nombre d’hommes, afin qu’elles passent plus inaperçues et provoquent une moindre réaction.
Mais l’opinion, cette reine du monde, qui est fille de la solidarité, rassemble tous ces griefs épars, groupe tous ces intérêts lésés en un faisceau formidable de résistances. Quand les habitudes d’un homme sont funestes à ceux qui l’entourent, la répulsion se manifeste contre cette habitude. On la juge sévèrement, on la critique, on la flétrit ; celui qui s’y livre devient un objet de défiance, de mépris et de haine. S’il y rencontrait quelques avantages, ils se trouvent bientôt plus que compensés par les souffrances qu’accumule sur lui l’aversion publique ; aux conséquences fâcheuses qu’entraîne toujours une mauvaise habitude, en vertu de la loi de Responsabilité, viennent s’ajouter d’autres conséquences plus fâcheuses encore en vertu de la loi de Solidarité.
Le mépris pour l’homme s’étend bientôt à l’habitude, au vice ; et comme le besoin de considération est un de nos plus énergiques mobiles, il est clair que la solidarité, par la réaction qu’elle détermine contre les actes vicieux, tend à les restreindre et à les détruire.
La Solidarité est donc, comme la responsabilité, une force progressive ; et l’on voit que, relativement à l’auteur de l’acte, elle se résout en responsabilité répercutée, si je puis m’exprimer ainsi ; — que c’est encore un système de peines et de récompenses réciproques, admirablement calculé pour circonscrire le mal, étendre le bien et pousser l’humanité dans la voie qui mène au progrès.
Mais pour qu’elle fonctionne dans ce sens, — pour que ceux qui profitent ou souffrent d’une action, qu’ils n’ont pas faite, réagissent sur son auteur par l’approbation ou l’improbation, la gratitude ou la résistance, l’estime, l’affection, la louange, ou le mépris, la haine et la vengeance, — une condition est indispensable : c’est que le lien qui existe entre un acte et tous ses effets soit connu et apprécié.
Quand le public se trompe à cet égard, la loi manque son but.
Un acte nuit à la masse ; mais la masse est convaincue que cet acte lui est avantageux. Qu’arrive-t-il alors ? C’est qu’au lieu de réagir contre cet acte, au lieu de le condamner et par là de le restreindre, le public l’exalte, l’honore, le célèbre et le multiplie.
Rien n’est plus fréquent, et en voici la raison :
Un acte ne produit pas seulement sur les masses un effet, mais une série d’effets. Or il arrive souvent que le premier effet est un bien local, parfaitement visible, tandis que les effets ultérieurs font filtrer insensiblement dans le corps social un mal difficile à discerner ou à rattacher à sa cause.
La guerre en est un exemple. Dans l’enfance des sociétés on n’aperçoit pas toutes les conséquences de la guerre. — Et, à vrai dire, dans une civilisation où il y a moins de travaux antérieurs exposés à la destruction, moins de science et d’argent sacrifiés à l’appareil de la guerre, etc., ces conséquences sont moins funestes que plus tard. — On ne voit que la première campagne, le butin qui suit la victoire, l’ivresse du triomphe ; alors la guerre et les guerriers sont fort populaires. Plus tard on verra l’ennemi, vainqueur à son tour, brûler les moissons et les récoltes, imposer des contributions et des lois. — On verra, dans les alternatives de succès et de revers, périr les générations, s’éteindre l’agriculture, s’appauvrir les deux peuples. — On verra la portion la plus vitale de la nation mépriser les arts de la paix, tourner les armes contre les institutions du pays, servir de moyen au despotisme, user son énergie inquiète dans les séditions et les discordes civiles, faire la barbarie et la solitude chez elle après les avoir faites chez ses voisins. On dira : La guerre c’est le brigandage agrandi… — Non, on verra ses effets sans en vouloir comprendre la cause ; et comme ce peuple en décadence aura été envahi à son tour par quelque essaim de conquérants, bien des siècles après la catastrophe, des historiens graves écriront : Ce peuple est tombé parce qu’il s’est énervé dans la paix, parce qu’il a oublié la science guerrière et les vertus farouches de ses ancêtres.
Je pourrais montrer les mêmes illusions sur le régime de l’esclavage…
Cela est vrai encore des erreurs religieuses…
De nos jours le régime prohibitif donne lieu à la même surprise…
Ramener, par la diffusion des lumières, par la discussion approfondie des effets et des causes, l’opinion publique dans cette direction intelligente qui flétrit les mauvaises tendances et s’oppose aux mesures funestes, c’est rendre à son pays un immense service. Quand la raison publique égarée honore ce qui est méprisable, méprise ce qui est honorable, punit la vertu et récompense le vice, encourage ce qui nuit et décourage ce qui est utile, applaudit au mensonge et étouffe le vrai sous l’indifférence ou l’insulte, une nation tourne le dos au progrès, et n’y peut être ramenée que par les terribles leçons des catastrophes.
Nous avons indiqué ailleurs le grossier abus que font certaines écoles socialistes du mot Solidarité…
Voyons maintenant dans quel esprit doit être conçue la loi humaine.
Il me semble que cela ne peut faire l’objet d’un doute. La loi humaine doit abonder dans le sens de la loi naturelle : elle doit hâter et assurer la juste rétribution des actes ; en d’autres termes, circonscrire la solidarité, organiser la réaction pour renforcer la responsabilité. La loi ne peut pas poursuivre d’autre but que de restreindre des actions vicieuses et de multiplier les actions vertueuses, et pour cela elle doit favoriser la juste distribution des récompenses et des peines, de manière à ce que les mauvais effets d’un acte se concentrent le plus possible sur celui qui le commet…
En agissant ainsi, la loi se conforme à la nature des choses : la solidarité entraîne une réaction contre l’acte vicieux, la loi ne fait que régulariser cette réaction.
La loi concourt ainsi au progrès ; plus rapidement elle ramène l’effet mauvais sur l’auteur de l’acte, plus sûrement elle restreint l’acte lui-même.
Prenons un exemple. La violence a des conséquences funestes : chez les sauvages la répression est abandonnée au cours naturel des choses ; qu’arrive-t-il ? C’est qu’elle provoque une réaction terrible. Quand un homme a commis un acte de violence contre un autre homme, une soif inextinguible de vengeance s’allume dans la famille du dernier et se transmet de génération en génération. Intervient la loi ; que doit-elle faire ? Se bornera-t-elle à étouffer l’esprit de vengeance, à le réprimer, à le punir ? Il est clair que ce serait encourager la violence en la mettant à l’abri de toutes représailles. Ce n’est donc pas ce que doit faire la loi. Elle doit se substituer, pour ainsi dire, à l’esprit de vengeance en organisant à sa place la réaction contre la violence ; elle doit dire à la famille lésée : Je me charge de la répression de l’acte dont vous avez à vous plaindre. — Alors la tribu tout entière se considère comme lésée et menacée. Elle examine le grief, elle interroge le coupable, elle s’assure qu’il n’y a pas erreur de fait ou de personne, et réprime ainsi avec régularité, certitude, un acte qui aurait été puni irrégulièrement [291]…
XXII. Moteur social↩
Il n’appartient à aucune science humaine de donner la dernière raison des choses.
L’homme souffre ; la société souffre. On demande pourquoi. C’est demander pourquoi il a plu à Dieu de donner à l’homme la sensibilité et le libre arbitre. Nul ne sait à cet égard que ce que lui enseigne la révélation en laquelle il a foi.
Mais, quels qu’aient été les desseins de Dieu, ce qui est un fait positif, que la science humaine peut prendre pour point de départ, c’est que l’homme a été créé sensible et libre.
Cela est si vrai, que je défie ceux que cela étonne de concevoir un être vivant, pensant, voulant, aimant, agissant, quelque chose enfin ressemblant à l’homme, et destitué de sensibilité ou de libre arbitre.
Dieu pouvait-il faire autrement ? sans doute la raison nous dit oui, mais l’imagination nous dira éternellement non ; tant il nous est radicalement impossible de séparer par la pensée l’humanité de ce double attribut. Or être sensible c’est être capable de recevoir des sensations discernables, c’est-à-dire agréables ou pénibles. De là le bien-être et le mal-être. Dès l’instant que Dieu a créé la sensibilité, il a donc permis le mal ou la possibilité du mal.
En nous donnant le libre arbitre, il nous a doués de la faculté, au moins dans une certaine mesure, de fuir le mal et de rechercher le bien. Le libre arbitre suppose et accompagne l’intelligence. Que signifierait la faculté de choisir, si elle n’était liée à la faculté d’examiner, de comparer, de juger ? Ainsi tout homme venant au monde y porte un moteur et une lumière.
Le moteur, c’est cette impulsion intime, irrésistible, essence de toutes nos forces, qui nous porte à fuir le Mal et à rechercher le Bien. On le nomme instinct de conservation, intérêt personnel ou privé.
Ce sentiment a été tantôt décrié, tantôt méconnu, mais quant à son existence, elle est incontestable. Nous recherchons invinciblement tout ce qui selon nos idées peut améliorer notre destinée ; nous évitons tout ce qui doit la détériorer. Cela est au moins aussi certain qu’il l’est que toute molécule matérielle renferme la force centripète et la force centrifuge. Et comme ce double mouvement d’attraction et de répulsion est le grand ressort du monde physique, on peut affirmer que la double force d’attraction humaine pour le bonheur, de répulsion humaine pour la douleur, est le grand ressort de la mécanique sociale.
Mais il ne suffit pas que l’homme soit invinciblement porté à préférer le bien au mal, il faut encore qu’il le discerne. Et c’est à quoi Dieu a pourvu en lui donnant cet appareil complexe et merveilleux appelé l’intelligence. Fixer son attention, comparer, juger, raisonner, enchaîner les effets aux causes, se souvenir, prévoir ; tels sont, si j’ose m’exprimer ainsi, les rouages de cet instrument admirable.
La force impulsive, qui est en chacun de nous, se meut sous la direction de notre intelligence. Mais notre intelligence est imparfaite. Elle est sujette à l’erreur. Nous comparons, nous jugeons, vous agissons en conséquence ; mais nous pouvons nous tromper, faire un mauvais choix, tendre vers le mal le prenant pour le bien, fuir le bien le prenant pour le mal. C’est la première source des dissonances sociales ; elle est inévitable par cela même que le grand ressort de l’humanité, l’intérêt personnel, n’est pas, comme l’attraction matérielle, une force aveugle, mais une force, guidée par une intelligence imparfaite. Sachons donc bien que nous ne verrons l’Harmonie que sous cette restriction. Dieu n’a pas jugé à propos d’établir l’ordre social ou l’Harmonie sur la perfection, mais sur la perfectibilité humaine. Oui, si notre intelligence est imparfaite, elle est perfectible. Elle se développe, s’élargit, se rectifie ; elle recommence et vérifie ses opérations ; à chaque instant, l’expérience la redresse, et la Responsabilité suspend sur nos têtes tout un système de châtiments et de récompenses. Chaque pas que nous faisons dans la voie de l’erreur nous enfonce dans une douleur croissante, de telle sorte que l’avertissement ne peut manquer de se faire entendre, et que le redressement de nos déterminations, et par suite de nos actes, est tôt ou tard infaillible.
Sous l’impulsion qui le presse, ardent à poursuivre le bonheur, prompt à le saisir, l’homme peut chercher son bien dans le mal d’autrui. C’est une seconde et abondante source de combinaisons sociales discordantes. Mais le terme en est marqué ; elles trouvent leur tombeau fatal dans la loi de la Solidarité. La force individuelle ainsi égarée provoque l’opposition de toutes les autres forces analogues, lesquelles, répugnant au mal par leur nature, repoussent l’injustice et la châtient.
C’est ainsi que se réalise le progrès, qui n’en est pas moins du progrès pour être chèrement acheté. Il résulte d’une impulsion native, universelle, inhérente à notre nature, dirigée par une intelligence souvent erronée et soumise à une volonté souvent dépravée. Arrêté dans sa marche par l’Erreur et l’Injustice, il rencontre pour surmonter ces obstacles l’assistance toute-puissante de la Responsabilité et de la Solidarité, et ne peut manquer de la rencontrer, puisqu’elle surgit de ces obstacles mêmes.
Ce mobile interne, impérissable, universel, qui réside en toute individualité et la constitue être actif, cette tendance de tout homme à rechercher le bonheur, à éviter le malheur, ce produit, cet effet, ce complément nécessaire de la sensibilité, sans lequel elle ne serait qu’un inexplicable fléau, ce phénomène primordial qui est l’origine de toutes les actions humaines, cette force attractive et répulsive que nous avons nommée le grand ressort de le Mécanique sociale, a eu pour détracteurs la plupart des publicistes ; et c’est certes une des plus étranges aberrations que puissent présenter les annales de la science.
Il est vrai que l’intérêt personnel est la cause de tous les maux comme de tous les biens imputables à l’homme. Cela ne peut manquer d’être ainsi, puisqu’il détermine tous nos actes. Ce que voyant certains publicistes, ils n’ont rien imaginé de mieux, pour couper le mal dans sa racine, que d’étouffer l’intérêt personnel. Mais comme par là ils auraient détruit le mobile même de notre activité, ils ont pensé à nous douer d’un mobile différent : le dévouement, le sacrifice. Ils ont espéré que désormais toutes les transactions et combinaisons sociales s’accompliraient, à leur voix, sur le principe du renoncement à soi-même. On ne recherchera plus son propre bonheur, mais le bonheur d’autrui ; les avertissements de la sensibilité ne compteront plus pour rien, non plus que les peines et les récompenses de la responsabilité. Toutes les lois de la nature seront renversées ; l’esprit de sacrifice sera substitué à l’esprit de conservation ; en un mot, nul ne songera plus à sa propre personnalité que pour se hâter de la dévouer au bien commun. C’est de cette transformation universelle du cœur humain que certains publicistes, qui se croient très-religieux, attendent la parfaite harmonie sociale. Ils oublient de nous dire comment ils entendent opérer ce préliminaire indispensable, la transformation du cœur humain.
S’ils sont assez fous pour l’entreprendre, certes ils ne seront pas assez forts. En veulent-ils la preuve ? Qu’ils essayent sur eux-mêmes ; qu’ils s’efforcent d’étouffer dans leur cœur l’intérêt personnel, de telle sorte qu’il ne se montre plus dans les actes les plus ordinaires de la vie. Ils ne tarderont pas à reconnaître leur impuissance. Comment donc prétendent-ils imposer à tous les hommes sans exception une doctrine à laquelle eux-mêmes ne peuvent se soumettre ?
J’avoue qu’il m’est impossible de voir quelque chose de religieux, si ce n’est l’apparence et tout au plus l’intention, dans ces théories affectées, dans ces maximes inexécutables qu’on prêche du bout des lèvres, sans cesser d’agir comme le vulgaire. Est-ce donc la vraie religion qui inspire à ces économistes catholiques cette pensée orgueilleuse, que Dieu a mal fait son œuvre, et qu’il leur appartient de la refaire ? Bossuet ne pensait pas ainsi quand il disait : « L’homme aspire au bonheur, il ne peut pas ne pas y aspirer. »
Les déclamations contre l’intérêt personnel n’auront jamais une grande portée scientifique ; car il est de sa nature indestructible, ou du moins on ne le peut détruire dans l’homme sans détruire l’homme lui-même. Tout ce que peuvent faire la religion, la morale, l’économie politique, c’est d’éclairer cette force impulsive, de lui montrer non seulement les premières, mais encore les dernières conséquences des actes qu’elle détermine en nous. Une satisfaction supérieure et progressive derrière une douleur passagère, une souffrance longue et sans cesse aggravée après un plaisir d’un moment, voilà en définitive le bien et le mal moral. Ce qui détermine le choix de l’homme vers la vertu, ce sera l’intérêt élevé, éclairé, mais ce sera toujours au fond l’intérêt personnel.
S’il est étrange que l’on ait décrié l’intérêt privé considéré non pas dans ses abus immoraux, mais comme mobile providentiel de toute activité humaine, il est bien plus étrange encore que l’on en tienne aucun compte, et qu’on croie pouvoir, sans compter avec lui, faire de la science sociale.
Par une inexplicable folie de l’orgueil, les publicistes, en général, se considèrent comme les dépositaires et les arbitres de ce moteur. Le point de départ de chacun d’eux est toujours celui-ci : Supposons que l’humanité est un troupeau, et que je suis le berger, comment dois-je m’y prendre pour rendre l’humanité heureuse ? — Ou bien : Étant donné d’un côté une certaine quantité d’argile, et de l’autre un potier, que doit faire le potier pour tirer de l’argile tout le parti possible ?
Nos publicistes peuvent différer quand il s’agit de savoir quel est le meilleur potier, celui qui pétrit le plus avantageusement l’argile ; mais ils s’accordent en ceci, que leur fonction est de pétrir l’argile humaine, comme le rôle de l’argile est d’être pétrie par eux. Ils établissent entre eux, sous le titre de législateurs, et l’humanité, des rapports analogues à ceux de tuteur à pupille. Jamais l’idée ne leur vient que l’humanité est un corps vivant, sentant, voulant et agissant selon des lois qu’il ne s’agit pas d’inventer, puisqu’elles existent, et encore moins d’imposer, mais d’étudier ; qu’elle est une agglomération d’êtres en tout semblables à eux-mêmes, qui ne leur sont nullement inférieurs ni subordonnées ; qui sont doués, et d’impulsion pour agir, et d’intelligence pour choisir ; qui sentent en eux, de toutes parts, les atteintes de la Responsabilité et de la Solidarité ; et enfin, que de tous ces phénomènes, résulte un ensemble de rapports existants par eux-mêmes, que la science n’a pas à créer, comme ils l’imaginent, mais à observer.
Rousseau est, je crois, le publiciste qui a le plus naïvement exhumé de l’antiquité cette omnipotence du législateur renouvelée des Grecs. Convaincu que l’ordre social est une invention humaine, il le compare à une machine, les hommes en sont les rouages, le prince la fait fonctionner ; le législateur l’invente sous l’impulsion du publiciste, qui se trouve être, en définitive, le moteur et le régulateur de l’espèce humaine. C’est pourquoi le publiciste ne manque jamais de s’adresser au législateur sous la forme impérative ; il lui ordonne d’ordonner. « Fondez votre peuple sur tel principe ; donnez-lui de bonnes mœurs ; pliez-le au joug de la religion ; dirigez-le vers les armes ou vers le commerce, ou vers l’agriculture, ou vers la vertu, etc., etc. » Les plus modestes se cachent sous l’anonyme des on . « On ne souffrira pas d’oisifs dans la république ; on distribuera convenablement la population entre les villes et les campagnes ; on avisera à ce qu’il n’y ait ni des riches ni des pauvres, etc., etc. »
Ces formules attestent chez ceux qui les emploient un orgueil incommensurable. Elles impliquent une doctrine qui ne laisse pas au genre humain un atome de dignité.
Je n’en connais pas de plus fausse en théorie et de plus funeste en pratique. Sous l’un et l’autre rapport, elle conduit à des conséquences déplorables.
Elle donne à croire que l’économie sociale est un arrangement artificiel, qui naît dans la tête d’un inventeur. Dès lors, tout publiciste se fait inventeur. Son plus grand désir est de faire accepter son mécanisme ; sa plus grande préoccupation est de faire détester tous les autres, et principalement celui qui naît spontanément de l’organisation de l’homme et de la nature des choses. Les livres conçus sur ce plan ne sont et ne peuvent être qu’une longue déclamation contre la Société.
Cette fausse science n’étudie pas l’enchaînement des effets aux causes. Elle ne recherche pas le bien et le mal que produisent les actes, s’en rapportant ensuite, pour le choix de la route à suivre, à la force motrice de la Société. Non, elle enjoint, elle contraint, elle impose, et si elle ne le peut, du moins elle conseille ; comme un physicien qui dirait à la pierre : « Tu n’es pas soutenue, je t’ordonne de tomber, ou du moins je te le conseille. » C’est sur cette donnée que M. Droz a dit : « Le but de l’économie politique est de rendre l’aisance aussi générale que possible ; » définition qui a été accueillie avec une grande faveur par le Socialisme, parce qu’elle ouvre la porte à toutes les utopies et conduit à la réglementation. Que dirait-on de M. Arago s’il ouvrait ainsi son cours : « Le but de l’astronomie est de rendre la gravitation aussi générale que possible ? » Il est vrai que les hommes sont des êtres animés, doués de volonté, et agissant sous l’influence du libre arbitre. Mais il y a aussi en eux une force interne, une sorte de gravitation ; la question est de savoir vers quoi ils gravitent. Si c’est fatalement vers le mal, il n’y a pas de remède, et à coup sûr il ne nous viendra pas d’un publiciste soumis comme homme à la tendance commune. Si c’est vers le bien, voilà le moteur tout trouvé ; la science n’a pas besoin d’y substituer la contrainte ou le conseil. Son rôle est d’éclairer le libre arbitre, de montrer les effets des causes, bien assurée que, sous l’influence de la vérité, « le bien-être tend à devenir aussi général que possible. »
Pratiquement, la doctrine qui place la force motrice de la Société non dans la généralité des hommes et dans leur organisation propre, mais dans les législateurs et les gouvernements, a des conséquences plus déplorables encore. Elle tend à faire peser sur le gouvernement une responsabilité écrasante qui ne lui revient pas. S’il y a des souffrances, c’est la faute du gouvernement ; s’il y a des pauvres, c’est la faute du gouvernement. N’est-il pas le moteur universel ? Si ce moteur n’est pas bon, il faut le briser, et en choisir un autre. — Ou bien, on s’en prend à la science elle-même, et dans ces derniers temps nous avons entendu répéter à satiété : « Toutes les souffrances sociales sont imputables à l’économie politique. [292] » Pourquoi pas, quand elle se présente comme ayant pour but de réaliser le bonheur des hommes sans leur concours ? Quand de telles idées prévalent, la dernière chose dont les hommes s’avisent, c’est de tourner un regard sur eux-mêmes, et de chercher si la vraie cause de leurs maux n’est pas dans leur ignorance et leur injustice ; leur ignorance qui les place sous le coup de la Responsabilité, leur injustice qui attire sur eux les réactions de la solidarité . Comment l’humanité songerait-elle à chercher dans ses fautes la cause de ses maux, quand on lui persuade qu’elle est inerte par nature, que le principe de toute action, et par conséquent de toute responsabilité, est placé en dehors d’elle, dans la volonté du prince et du législateur ?
Si j’avais à signaler le trait caractéristique qui différencie le Socialisme de la science économique, je le trouverais là. Le Socialisme compte une foule innombrable de sectes. Chacune d’elles a son utopie, et l’on peut dire qu’elles sont si loin de s’entendre, qu’elles se font une guerre acharnée. Entre l’atelier social organisé de M. Blanc, et l’an-archie de M. Proudhon, entre l’association de Fourier et le communisme de M. Cabet, il y a certes aussi loin que de la nuit au jour. Comment donc des chefs d’école se rangent-ils sous la dénomination commune de Socialistes, et quel est le lien qui les unit contre la société naturelle ou providentielle ? Il n’y en a pas d’autre que celui-là : Ils ne veulent pas la société naturelle. Ce qu’ils veulent, c’est une société artificielle, sortie toute faite du cerveau de l’inventeur. Il est vrai que chacun d’eux veut être le Jupiter de cette Minerve ; il est vrai que chacun d’eux caresse son artifice et rêve de son ordre social. Mais il y a entre eux cela de commun, qu’ils ne reconnaissent dans l’humanité ni la force motrice qui la porte vers le bien, ni la force curative qui la délivre du mal. Ils se battent pour savoir à qui pétrira l’argile humaine ; mais ils sont d’accord que c’est une argile à pétrir. L’humanité n’est pas à leurs yeux un être vivant et harmonieux, que Dieu lui-même a pourvu de forces progressives et conservatrices ; c’est une matière inerte qui les a attendus, pour recevoir d’eux le sentiment et la vie ; ce n’est pas un sujet d’études, c’est une matière à expériences.
L’économie politique, au contraire, après avoir constaté dans chaque homme les forces d’impulsion et de répulsion, dont l’ensemble constitue le moteur social ; après s’être assurée que ce moteur tend vers le bien, ne songe pas à l’anéantir pour lui en substituer un autre de sa création. Elle étudie les phénomènes sociaux si variés, si compliqués, auxquels il donne naissance.
Est-ce à dire que l’économie politique est aussi étrangère au progrès social que l’est l’astronomie à la marche des corps célestes ? Non certes. L’économie politique s’occupe d’êtres intelligents et libres, et comme tels, — ne l’oublions jamais, — sujets à l’erreur. Leur tendance est vers le bien ; mais ils peuvent se tromper. La science intervient donc utilement, non pour créer des causes et des effets, non pour changer les tendances de l’homme, non pour le soumettre à des organisations, à des injonctions, ni même à des conseils ; mais pour lui montrer le bien et le mal qui résultent de ses déterminations.
Ainsi l’économie politique est une science toute d’observation et d’exposition. Elle ne dit pas aux hommes : « Je vous enjoins, je vous conseille de ne point vous trop approcher du feu ; » — ou bien : « J’ai imaginé une organisation sociale, les dieux m’ont inspiré des institutions qui vous tiendront suffisamment éloignés du feu. » Non ; elle constate que le feu brûle, elle le proclame, elle le prouve, et fait ainsi pour tous les autres phénomènes analogues de l’ordre économique ou moral, convaincue que cela suffit. La répugnance à mourir par le feu est considérée par elle comme un fait primordial, préexistant, qu’elle n’a pas créé, qu’elle ne saurait altérer.
Les économistes peuvent n’être pas toujours d’accord ; mais il est aisé de voir que leurs dissidences sont d’une tout autre nature que celles qui divisent les socialistes. Deux hommes qui consacrent toute leur attention à observer un même phénomène et ses effets, comme, par exemple, la rente, l’échange, la concurrence, — peuvent ne pas arriver à la même conclusion ; et cela ne prouve pas autre chose sinon que l’un des deux, au moins, a mal observé. C’est une opération à recommencer. D’autres investigateurs aidant, la probabilité est que la vérité finira par être découverte. C’est pourquoi, — à la seule condition que chaque économiste, comme chaque astronome, se tienne au courant du point où ses prédécesseurs sont parvenus, — la science ne peut être que progressive, et, partant, de plus en plus utile, rectifiant sans cesse les observations mal faites, et ajoutant indéfiniment des observations nouvelles aux observations antérieures.
Mais les socialistes, — s’isolant les uns des autres, pour chercher chacun de son côté, des combinaisons artificielles dans leur propre imagination, — pourraient s’enquérir ainsi pendant l’éternité sans s’entendre et sans que le travail de l’un servit de rien aux travaux de l’autre. Say a profité des recherches de Smith, Rossi de celles de Say, Blanqui et Joseph Garnier de celles de tous leurs devanciers. Mais Platon, Morus, Harrington, Fénelon, Fourier peuvent se complaire à organiser suivant leur fantaisie leur République, leur Utopie, leur Océana, leur Salente, leur Phalanstère, sans qu’il y ait aucune connexité entre leurs créations chimérique. Ces rêveurs tirent tout de leur tête, hommes et choses. Ils imaginent un ordre social en dehors du cœur humain, puis un cœur humain pour aller avec leur ordre social. . . . . . . . . . . . .
XXIII. Le Mal↩
Dans ces derniers temps, on a fait reculer la science ; on l’a faussée, en lui imposant pour ainsi dire l’obligation de nier le mal, sous peine d’être convaincue de nier Dieu.
Des écrivains qui tenaient sans doute à montrer une sensibilité exquise, une philanthropie sans bornes, et une religion incomparable, se sont mis à dire : « Le mal ne peut entrer dans le plan providentiel. La souffrance n’a été décrétée ni par Dieu ni par la nature, elle vient des institutions humaines. »
Comme cette doctrine abondait dans le sens des passions qu’on voulait caresser, elle est bientôt devenue populaire. Les livres, les journaux ont été remplis de déclamations contre la société. Il n’a plus été permis à la science d’étudier impartialement les faits. Quiconque a osé avertir l’humanité que tel vice, telle habitude entraînaient nécessairement telles conséquences funestes, a été signalé comme un homme sans entrailles, un impie, un athée, un malthusien, un économiste.
Cependant le socialisme a bien pu pousser la folie jusqu’à annoncer la fin de toute souffrance sociale, mais non de toute souffrance individuelle. Il n’a pas encore osé prédire que l’homme arriverait à ne plus souffrir, vieillir et mourir.
Or, je le demande, est-il plus facile de concilier avec l’idée de la bonté infinie de Dieu, le mal frappant individuellement tout homme venant au monde que le mal s’étendant sur la société tout entière ? Et puis n’est-ce pas une contradiction si manifeste qu’elle en est puérile de nier la douleur dans les masses, quand on l’avoue dans les individus ?
L’homme souffre et souffrira toujours. Donc la société souffre et souffrira toujours. Ceux qui lui parlent doivent avoir le courage de le lui dire. L’humanité n’est pas une petite-maîtresse, aux nerfs agacés, à qui il faut cacher la lutte qui l’attend, alors surtout qu’il lui importe de la prévoir pour en sortir triomphante. Sous ce rapport, tous les livres dont la France a été inondée à partir de Sismondi et de Buret, me paraissent manquer de virilité. Ils n’osent pas dire la vérité ; que dis-je ? ils n’osent pas l’étudier, de peur de découvrir que la misère absolue est le point de départ obligé du genre humain, et que, par conséquent, bien loin qu’on puisse l’attribuer à l’ordre social, c’est à l’ordre social qu’on doit toutes les conquêtes qui ont été faites sur elle. Mais, après un tel aveu, on ne pourrait pas se faire le tribun et le vengeur des masses opprimées par la civilisation.
Après tout, la science constate, enchaîne, déduit les faits ; elle ne les crée pas ; elle ne les produit pas ; elle n’en est pas responsable. N’est-il pas étrange qu’on ait été jusqu’à émettre et même vulgariser ce paradoxe : Si l’humanité souffre, c’est la faute de l’économie politique ? Ainsi, après l’avoir blâmée d’observer les maux de la société, on l’a accusée de les avoir engendrés en vertu de cette observation même.
Je dis que la science ne peut qu’observer et constater. Quand elle viendrait à reconnaître que l’humanité, au lieu d’être progressive, est rétrograde, que des lois insurmontables et fatales la poussent vers une détérioration irrémédiable ; quand elle viendrait à s’assurer de la loi de Malthus, de celle de Ricardo, dans leur sens le plus funeste ; quand elle ne pourrait nier ni la tyrannie du capital, ni l’incompatibilité des machines et du travail, ni aucune de ces alternatives contradictoires dans lesquelles Chateaubriand et Tocqueville placent l’espèce humaine, — encore la science, en soupirant, devrait le dire, et le dire bien haut.
Est-ce qu’il sert de rien de se voiler la face pour ne pas voir l’abîme, quand l’abîme est béant ? Exige-t-on du naturaliste, du physiologiste, qu’ils raisonnent sur l’homme individuel comme si ses organes étaient à l’abri de la douleur ou de la destruction ? « Pulvis es, et in pulverem reverteris. » Voilà ce que crie la science anatomique appuyée de l’expérience universelle. Certes, c’est là une vérité dure pour nos oreilles, aussi dure pour le moins que les douteuses propositions de Malthus et de Ricardo. Faudra-t-il donc, pour ménager cette sensibilité délicate qui s’est développée tout à coup parmi les publicistes modernes et a créé le socialisme, faudra-t-il aussi que les sciences médicales affirment audacieusement notre jeunesse sans cesse renaissante et notre immortalité ? Que si elles refusent de s’abaisser à ces jongleries, faudra-t-il, comme on le fait pour les sciences sociales, s’écrier, l’écume à la bouche : « Les sciences médicales admettent la douleur et la mort ; donc elles sont misanthropiques et sans entrailles, elles accusent Dieu de mauvaise volonté ou d’impuissance. Elles sont impies, elles sont athées. Bien plus, elles font tout le mal qu’elles s’obstinent à ne pas nier ? »
Je n’ai jamais douté que les écoles socialistes n’eussent entraîné beaucoup de cœurs généreux et d’intelligences convaincues. À Dieu ne plaise que je veuille humilier qui que ce soit ! Mais enfin le caractère général du socialisme est bien bizarre, et je me demande combien de temps la vogue peut soutenir un tel tissu de puérilités.
Tout en lui est affectation. [293]
Il affecte des formes et un langage scientifiques, et nous avons vu où il en est de la science.
Il affecte dans ses écrits une délicatesse de nerfs si féminine qu’il ne peut entendre parler de souffrances sociales. En même temps qu’il a introduit dans la littérature la mode de cette fade sensiblerie, il a fait prévaloir dans les arts le goût du trivial et le l’horrible ; — dans la tenue, la mode des épouvantails, la longue barbe, la physionomie refrognée, des airs de Titan ou de Prométhée bourgeois ; dans la politique (ce qui est un enfantillage moins innocent), c’est la doctrine des moyens énergiques de transition, les violences de la pratique révolutionnaire, la vie et les intérêts matériels sacrifiés en masse à l’idée. Mais ce que le socialisme affecte surtout, c’est la religiosité ! Ce n’est qu’une tactique, il est vrai, mais une tactique est toujours honteuse pour une école quand elle l’entraîne vers l’hypocrisie.
Ils nous parlent toujours du Christ, de Christ ; mais je leur demanderai pourquoi ils approuvent que Christ, l’innocent par excellence, ait pu souffrir et s’écrier dans son angoisse : « Dieu, détournez de moi le calice, mais que votre volonté soit faite ; » — et pourquoi ils trouvent étrange que l’humanité tout entière ait aussi à faire le même acte de résignation.
Assurément, si Dieu eût eu d’autres desseins sur l’humanité, il aurait pu arranger les choses de telle sorte que, comme l’individu s’avance vers une mort inévitable, elle marchât vers une destruction fatale. Il faudrait bien se soumettre, et la science, la malédiction ou la bénédiction sur les lèvres, serait bien tenue de constater le sombre dénoûment social, comme elle constate le triste dénoûment individuel.
Heureusement il n’en est pas ainsi.
L’homme et l’humanité ont leur rédemption.
À lui une âme immortelle. À elle une perfectibilité indéfinie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIV. Perfectibilité↩
Que l’humanité soit perfectible ; qu’elle progresse vers un niveau de plus en plus élevé ; que sa richesse s’accroisse et s’égalise ; que ses idées s’étendent et s’épurent ; que ses erreurs disparaissent, et avec elles les oppressions auxquelles elles servent de support ; que ses lumières brillent d’un éclat toujours plus vif ; que sa moralité se perfectionne ; qu’elle apprenne, par la raison ou par l’expérience, l’art de puiser, dans le domaine de la responsabilité, toujours plus de récompenses, toujours moins de châtiments ; par conséquent, que le mal se restreigne sans cesse et que le bien se dilate toujours dans son sein, c’est ce dont on ne peut pas douter quand on a scruté la nature de l’homme et du principe intellectuel qui est son essence, qui lui fut soufflé sur la face avec la vie, et en vue duquel la révélation Mosaïque a pu dire l’homme fait à l’image de Dieu.
Car l’homme, nous ne le savons que trop, n’est pas parfait. S’il était parfait, il ne refléterait pas une vague ressemblance de Dieu, il serait Dieu lui-même. Il est donc imparfait, soumis à l’erreur et à la douleur ; que si, de plus, il était stationnaire, à quel titre pourrait-il revendiquer l’ineffable privilége de porter en lui-même l’image de l’Être parfait ?
D’ailleurs, si l’intelligence, qui est la faculté de comparer, de juger, de se rectifier, d’apprendre, ne constitue pas une perfectibilité individuelle, qu’est-ce qu’elle est ?
Et si l’union de toutes les perfectibilités individuelles, surtout chez des êtres susceptibles de se transmettre leurs acquisitions, ne garantit pas la perfectibilité collective, il faut renoncer à toute philosophie, à toute science morale et politique.
Ce qui fait la perfectibilité de l’homme, c’est son intelligence ou la faculté qui lui est donnée de passer de l’erreur, mère du mal, à la vérité génératrice du bien.
Ce qui fait que l’homme abandonne, dans son esprit, l’erreur pour la vérité, et plus tard, dans sa conduite, le mal pour le bien, c’est la science et l’expérience ; c’est la découverte qu’il fait, dans les phénomènes et dans les actes, d’effets qu’il n’y avait pas soupçonnés.
Mais, pour qu’il acquière cette science, il faut qu’il soit intéressé à l’acquérir. Pour qu’il profite de cette expérience, il faut qu’il soit intéressé à en profiter. C’est donc, en définitive, dans la loi de la responsabilité qu’il faut chercher le moyen de réalisation de la perfectibilité humaine.
Et comme la responsabilité ne se peut concevoir sans liberté ; comme des actes qui ne seraient pas volontaires ne pourraient donner aucune instruction ni aucune expérience valable ; comme des êtres qui se perfectionneraient ou se détérioreraient par l’action exclusive de causes extérieures, sans aucune participation de la volonté, de la réflexion, du libre arbitre, ainsi que cela arrive à la matière organique brute, ne pourraient pas être dits perfectibles, dans le sens moral du mot, il faut conclure que la liberté est l’essence même du progrès. Toucher à la liberté de l’homme, ce n’est pas seulement lui nuire, l’amoindrir, c’est changer sa nature ; c’est le rendre, dans la mesure où l’oppression s’exerce, imperfectible ; c’est le dépouiller de sa ressemblance avec le Créateur ; c’est ternir, sur sa noble figure, le souffle de vie qui y resplendit depuis l’origine.
Mais de ce que nous proclamons bien haut, et comme notre article de foi le plus inébranlable, la perfectibilité humaine, le progrès nécessaire dans tous les sens, et, par une merveilleuse correspondance, d’autant plus actif dans un sens qu’il l’est davantage dans tous les autres, — est-ce à dire que nous soyons utopistes, que nous soyons même optimistes, que nous croyions tout pour le mieux dans le meilleur des mondes, et que nous attendions, pour un des prochains levers du soleil, le règne du Millenium ?
Hélas ! quand nous venons à jeter un coup d’œil sur le monde réel, où nous voyons se remuer dans l’abjection et dans la fange une masse encore si énorme de souffrances, de plaintes, de vices et de crimes ; quand nous cherchons à nous rendre compte de l’action morale qu’exercent, sur la société, des classes qui devraient signaler aux multitudes attardées les voies qui mènent à la Jérusalem nouvelle ; quand nous nous demandons ce que font les riches de leur fortune, les poëtes de l’étincelle divine que la nature avait allumée dans leur génie, les philosophes de leurs élucubrations, les journalistes du sacerdoce dont ils se sont investis, les hauts fonctionnaires, les ministres, les représentants, les rois, de la puissance que le sort a placée dans leurs mains ; quand nous sommes témoins de révolutions telles que celle qui a agité l’Europe dans ces derniers temps, et où chaque parti semble chercher ce qui, à la longue, doit être le plus funeste à lui-même et à l’humanité ; quand nous voyons la cupidité sous toutes les formes et dans tous les rangs, le sacrifice constant des autres à soi et de l’avenir au présent, et ce grand et inévitable moteur du genre humain, l’intérêt personnel, n’apparaissant encore que par ses manifestations les plus matérielles et les plus imprévoyantes ; quand nous voyons les classes laborieuses, rongées dans leur bien-être et leur dignité par le parasitisme des fonctions publiques, se tourner dans les convulsions révolutionnaires, non contre ce parasitisme desséchant, mais contre la richesse bien acquise, c’est-à-dire contre l’élément même de leur délivrance et le principe de leur propre droit et de leur propre force ; quand de tels spectacles se déroulent sous nos yeux, en quelque pays du monde que nous portions nos pas, oh ! nous avons peur de nous-mêmes, nous tremblons pour notre foi, il nous semble que cette lumière est vacillante, près de s’éteindre, nous laissant dans l’horrible nuit du Pessimisme.
Mais non, il n’y a pas lieu de désespérer. Quelles que soient les impressions que fassent sur nous des circonstances trop voisines, l’humanité marche et s’avance. Ce qui nous fait illusion, c’est que nous mesurons sa vie à la nôtre ; et parce que quelques années sont beaucoup pour nous, il nous semble que c’est beaucoup pour elle. Eh bien, même à cette mesure, il me semble que le progrès de la société est visible par bien des côtés. J’ai à peine besoin de rappeler qu’il est merveilleux en ce qui concerne certains avantages matériels, la salubrité des villes, les moyens de locomotion et de communication, etc.
Au point de vue politique, la nation française n’a-t-elle acquis aucune expérience ? quelqu’un oserait-il affirmer que si toutes les difficultés qu’elle vient de traverser s’étaient présentées il y a un demi-siècle, ou plus tôt, elle les aurait dénouées avec autant d’habileté, de prudence, de sagesse, avec aussi peu de sacrifices ? J’écris ces lignes dans un pays qui a été fertile en révolutions. Tous les cinq ans, Florence était bouleversée, et à chaque fois la moitié des citoyens dépouillait et massacrait l’autre moitié. Oh ! si nous avions un peu plus d’imagination, non de celle qui crée, invente et suppose des faits, mais de celle qui les fait revivre, nous serions plus justes envers notre temps et nos contemporains ! Mais ce qui reste vrai, et d’une vérité dont personne peut-être ne se rend mieux compte que l’économiste, — c’est que le progrès humain, surtout à son aurore, est excessivement lent, d’une lenteur bien faite pour désespérer le cœur du philanthrope…
Les hommes qui tiennent de leur génie le sacerdoce de la publicité devraient, ce me semble, y regarder de près avant de jeter, au sein de la fermentation sociale, une de ces décourageantes sentences qui impliquent pour l’humanité l’alternative entre deux modes de dégradation.
Nous en avons vu quelques exemples à propos de la population, de la rente, des machines, de la division des héritages, etc.
En voici un autre tiré de M. de Chateaubriand, que ne fait, du reste, que formuler un conventionnalisme fort accrédité :
« La corruption des mœurs marche de front avec la civilisation des peuples. Si la dernière présente des moyens de liberté, la première est une source inépuisable d’esclavage. »
Il n’est pas douteux que la civilisation ne présente des moyens de liberté. Il ne l’est pas non plus que la corruption ne soit une source d’esclavage. Mais ce qui est douteux, plus que douteux, — et quant à moi, je le nie formellement, — c’est que la civilisation et la corruption marchent de front. Si cela était, un équilibre fatal s’établirait entre les moyens de liberté et les sources d’esclavage ; l’immobilité serait le sort du genre humain.
En outre, je ne crois pas qu’il puisse entrer dans le cœur une pensée plus triste, plus décourageante, plus désolante, qui pousse plus au désespoir, à l’irréligion, à l’impiété, à la malédiction, au blasphème, que celle-ci : Toute créature humaine, qu’elle le veuille ou ne le veuille pas, qu’elle s’en doute ou ne s’en doute pas, agit dans le sens de la civilisation, et… la civilisation c’est la corruption !
Ensuite, si toute civilisation est corruption, en quoi consistent donc ses avantages ? Car prétendre que la civilisation n’a aucun avantage matériel, intellectuel et moral, cela ne se peut, ce ne serait plus de la civilisation. Dans la pensée de Chateaubriand, civilisation signifie progrès matériel, accroissement de population, de richesses, de bien-être, développement de l’intelligence, accroissement des sciences ; — et tous ces progrès impliquent, selon lui, et déterminent une rétrogradation correspondante du sens moral.
Oh ! il y aurait là de quoi entraîner l’humanité à un vaste suicide ; car enfin, je le répète, le progrès matériel et intellectuel n’a pas été préparé et ordonné par nous. Dieu même l’a décrété en nous donnant des désirs expansibles et des facultés perfectibles. Nous y poussons tous sans le vouloir, sans le savoir. Chateaubriand avec ses pareils, s’il en a, plus que personne. — Et ce progrès nous enfoncerait de plus en plus dans l’immoralité et l’esclavage par la corruption !…
J’ai cru d’abord que Chateaubriand avait, comme font souvent les poëtes, lâché une phrase sans trop l’examiner. Pour cette classe d’écrivains, la forme emporte le fond. Pourvu que l’antithèse soit bien symétrique, qu’importe que la pensée soit fausse et abominable ? Pourvu que la métaphore fasse de l’effet, qu’elle ait un air d’inspiration et de profondeur, qu’elle arrache les applaudissements du public, qu’elle donne à l’auteur une tournure d’oracle, que lui importe l’exactitude, la vérité ?
Je croyais donc que Chateaubriand, cédant à un accès momentané de misanthropie, s’était laissé aller à formuler un conventionnalisme, un vulgarisme qui traîne les ruisseaux. « Civilisation et corruption marchent de front ; » cela se répète depuis Héraclite, et n’en est pas plus vrai.
Mais, à bien des années de distance, le même grand écrivain a reproduit la même pensée sous une forme à prétention didactique ; ce qui prouve que c’était chez lui une opinion bien arrêtée. Il est bon de la combattre, non parce qu’elle vient de Chateaubriand, mais parce qu’elle est très-répandue.
« L’état matériel s’améliore (dit-il), le progrès intellectuel s’accroît, et les nations, au lieu de profiter, s’amoindrissent. — Voici comment s’expliquent le dépérissement de la société et l’accroissement de l’individu. Si le sens moral se développait en raison du développement de l’intelligence, il y aurait contre-poids, et l’humanité grandirait sans danger. Mais il arrive tout le contraire. La perception du bien et du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence s’éclaire ; la conscience se rétrécit à mesure que les idées s’élargissent. » (Mémoires d’Outre-Tombe, vol. XI.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXV. Rapports de l’économie politique avec la morale, avec la politique, avec la législation, …. avec la religion. [294] ↩
Un phénomène se trouve toujours placé entre deux autres phénomènes, dont l’un est sa cause efficiente et l’autre sa cause finale ; et la science n’en a pas fini avec lui tant que l’un ou l’autre de ces rapports lui reste caché.
Je crois que l’esprit humain commence généralement par découvrir les causes finales, parce qu’elles nous intéressent d’une manière plus immédiate. Il n’est pas d’ailleurs de connaissance qui nous porte avec plus de force vers les idées religieuses, et soit plus propre à faire éprouver, à toutes les fibres du cœur humain, un vif sentiment de gratitude envers l’inépuisable bonté de Dieu.
L’habitude, il est vrai, nous familiarise tellement avec un grand nombre de ces intentions providentielles, que nous en jouissons sans y penser. Nous voyons, nous entendons, sans songer au mécanisme ingénieux de l’oreille et de l’œil ; les rayons du soleil, les gouttes de rosée ou de pluie nous prodiguent leurs effets utiles ou leurs douces sensations, sans éveiller notre surprise et notre reconnaissance. Cela tient uniquement à l’action continue sur nous de ces admirables phénomènes. Car qu’une cause finale, comparativement insignifiante, vienne à nous être révélée, que le botaniste nous enseigne pourquoi cette plante affecte telle forme, pourquoi cette autre revêt telle couleur, aussitôt nous sentons dans notre cœur l’enchantement ineffable que ne manquent jamais d’y faire pénétrer les preuves nouvelles de la puissance de Dieu, de sa bonté et de sa sagesse.
La région des intentions finales est donc, pour l’imagination de l’homme, comme une atmosphère imprégnée d’idées religieuses.
Mais, après avoir aperçu ou entrevu cet aspect du phénomène, il nous reste à l’étudier sous l’autre rapport, c’est-à-dire à rechercher sa cause efficiente.
Chose étrange ! il nous arrive quelquefois, après avoir pris pleine connaissance de cette cause, de trouver qu’elle entraîne si nécessairement l’effet que nous avions d’abord admiré, que nous refusons de lui reconnaître plus longtemps le caractère d’une cause finale ; et nous disons : J’étais bien naïf de croire que Dieu avait pourvu à tel arrangement dans tel dessein ; je vois maintenant que la cause que j’ai découverte étant donnée (et elle est inévitable), cet arrangement devait s’ensuivre de toute nécessité, abstraction faite d’une prétendue intention providentielle.
C’est ainsi que la science incomplète, avec son scalpel et ses analyses, vient parfois détruire dans nos âmes le sentiment religieux qu’y avait fait naître le simple spectacle de la nature.
Cela se voit souvent chez l’anatomiste ou l’astronome. Quelle chose merveilleuse, dit l’ignorant, que, lorsqu’un corps étranger pénètre dans notre tissu, où sa présence ferait de grands ravages, il s’établisse une inflammation et une suppuration qui tendent à l’expulser ! — Non, dit l’anatomiste, cette expulsion n’a rien d’intentionnel. Elle est un effet nécessaire de la suppuration, et la suppuration est elle-même un effet nécessaire de la présence d’un corps étranger dans nos tissus. Si vous voulez, je vais vous expliquer le mécanisme, et vous reconnaîtrez vous-même que l’effet suit la cause, mais que la cause n’a pas été arrangée intentionnellement pour produire l’effet, puisqu’elle est elle-même un effet nécessaire d’une cause antérieure.
Combien j’admire, dit l’ignorant, la prévoyance de Dieu, qui a voulu que la pluie ne s’épanchât pas en nappe sur le sol, mais tombât en gouttes, comme si elle venait de l’arrosoir du jardinier ! Sans cela toute végétation serait impossible. — Vous faites une vaine dépense d’admiration, répond le savant physicien. Le nuage n’est pas une nappe d’eau ; elle ne pourrait être supportée par l’atmosphère. C’est un amas de vésicules microscopiques semblables aux bulles de savon. Quand leur épaisseur s’augmente ou qu’elles crèvent sous une compression, ces milliards de gouttelettes tombent, s’accroissent en route de la vapeur d’eau qu’elles précipitent, etc… Si la végétation s’en trouve bien, c’est par accident ; mais il ne faut pas croire que Dieu s’amuse à vous envoyer de l’eau par le crible d’un immense arrosoir.
Ce qui peut donner quelque plausibilité à la science, lorsqu’elle considère ainsi l’enchaînement des causes et des effets, c’est que l’ignorance, il faut l’avouer, attribue très-souvent un phénomène à une intention finale qui n’existe pas et qui se dissipe devant la lumière.
Ainsi, au commencement, avant qu’on eût aucune connaissance de l’électricité, les peuples, effrayés par le bruit du tonnerre, ne pouvaient guère reconnaître, dans cette voix imposante retentissant au milieu des orages, qu’un symptôme du courroux céleste. C’est une association d’idées qui, non plus que bien d’autres, n’a pu résister aux progrès de la physique.
L’homme est ainsi fait. Quand un phénomène l’affecte, il en cherche la cause, et s’il la trouve, il la nomme. Puis il se met à chercher la cause de cette cause, et ainsi de suite jusqu’à ce que, ne pouvant plus remonter, il s’arrête et dise : C’est Dieu, c’est la volonté de Dieu. Voilà notre ultima ratio. Cependant le temps d’arrêt de l’homme n’est jamais que momentané. La science progresse, et bientôt cette seconde, ou troisième, ou quatrième cause, qui était restée inaperçue, se révèle à ses yeux. Alors la science dit : Cet effet n’est pas dû, comme on le croyait, à la volonté immédiate de Dieu, mais à cette cause naturelle que je viens de découvrir. — Et l’humanité, après avoir pris possession de cette découverte, se contentant, pour ainsi parler, de déplacer d’un cran la limite de sa foi, se demande : Quelle est la cause de cette cause ? — Et ne la voyant pas, elle persiste dans son universelle explication : C’est la volonté de Dieu. — Et ainsi pendant des siècles indéfinis, dans une succession innombrable de révélations scientifiques et d’actes de foi.
Cette marche de l’humanité doit paraître aux esprits superficiels destructive de toute idée religieuse ; car n’en résulte-t-il pas qu’à mesure que la science avance, Dieu recule ? Et ne voit-on pas clairement que le domaine des intentions finales se rétrécit à mesure que s’agrandit celui des causes naturelles ?
Malheureux sont ceux qui donnent à ce beau problème une solution si étroite. Non, il n’est pas vrai qu’à mesure que la science avance, l’idée de Dieu recule ; bien au contraire, ce qui est vrai, c’est que cette idée grandit, s’étend et s’élève dans notre intelligence. Quand nous découvrons une cause naturelle là où nous avions cru voir un acte immédiat, spontané, surnaturel, de la volonté divine, est-ce à dire que cette volonté est absente ou indifférente ? Non, certes ; tout ce que cela prouve, c’est qu’elle agit par des procédés différents de ceux qu’il nous avait plu d’imaginer. Tout ce que cela prouve, c’est que le phénomène que nous regardions comme un accident dans la création, occupe sa place dans l’universel arrangement des choses, et que tout, jusqu’aux effets les plus spéciaux, a été prévu de toute éternité dans la pensée divine. Eh quoi ! l’idée que nous nous faisons de la puissance de Dieu est-elle amoindrie quand nous venons à découvrir que chacun des résultats innombrables que nous voyons, ou qui échappe à nos investigations, non-seulement a sa cause naturelle, mais se rattache au cercle infini des causes ; de telle sorte qu’il n’est pas un détail de mouvement, de force, de forme, de vie, qui ne soit le produit de l’ensemble et se puisse expliquer en dehors du tout ?
Et maintenant pourquoi cette dissertation étrangère, à ce qu’il semble, à l’objet de nos recherches ? C’est que les phénomènes de l’économie sociale ont aussi leur cause efficiente et leur intention providentielle. C’est que, dans cet ordre d’idées, comme en physique, comme en anatomie, ou en astronomie, on a souvent nié la cause finale précisément parce que la cause efficiente apparaissait avec le caractère d’une nécessité absolue.
Le monde social est fécond en harmonies dont on n’a la perception complète que lorsque l’intelligence a remonté aux causes, pour y chercher l’explication, et est descendue aux effets, pour savoir la destination des phénomènes…
Endnotes↩
FN:Je rendrai cette loi sensible par des chiffres. Soient trois époques pendant lesquelles le capital s’est accru, le travail restant le même. Soit la production totale aux trois époques, comme : 80 — 100 — 120. Le partage se fera ainsi :
| Part du capital. | Part du travail. | Total. | |
| Première époque : | 45 | 35 | 80 |
| Deuxième époque : | 50 | 50 | 100 |
| Troisième époque : | 55 | 65 | 120 |
Bien entendu, ces proportions n’ont d’autre but que d’élucider la pensée.
FN:Ce chapitre fut publié pour la première fois dans le Journal des Économistes, numéro de janvier 1848. (Note de l’éditeur.)
FN:« Il est avéré que notre régime de libre concurrence, réclamé par une Économie politique ignorante, et décrété pour abolir les monopoles, n’aboutit qu’à l’organisation générale des grands monopoles en toutes branches. » (Principes du socialisme, par M. Considérant, page 15.)
FN:Ce chapitre et le suivant furent insérés en septembre et décembre 1848 dans le Journal des Économistes. (Note de l’éditeur.)
FN:« Notre régime industriel, formé sur la concurrence sans garantie et sans organisation, n’est donc qu’un enfer social, une vaste réalisation de tous les tourments et de tous les supplices de l’antique Ténare. Il y a une différence pourtant : les victimes. » (V. Considérant.)
FN:V. au tome IV, le chap. ii de la seconde série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
FN:Loi mathématique très-fréquente et très-méconnue en économie politique.
FN:Un des objets indirects de ce livre est de combattre des écoles sentimentalistes modernes qui, malgré les faits, n’admettent pas que la souffrance, à un degré quelconque, ait un but providentiel. Comme ces écoles disent procéder de Rousseau, je dois leur citer ce passage du maître : « Le mal que nous voyons n’est pas un mal absolu ; et, loin de combattre directement le bien, il concourt avec lui à l’harmonie universelle. »
FN:Bien plus, cet esclave-là, à cause de sa supériorité, finit à la longue par déprécier et affranchir tous les autres. C’est une harmonie dont je laisse à la sagacité du lecteur de suivre les conséquences.
FN:Voir au tome II, Funestes illusions, et au tome IV, la fin du chapitre i de la seconde série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
FN:Ce qui va suivre est la reproduction d’une note trouvée dans les papiers de l’auteur. S’il eût vécu, il en eût lié la substance au corps de sa doctrine sur l’échange. Notre mission doit se borner à placer cette note à la fin du présent chapitre. (Note de l’éditeur.)
FN:Voir, pour la réfutation de cette erreur, le chapitre Producteur et Consommateur, ci-après, ainsi que les chapitres ii et iii des Sophismes économiques, première série, tome IV, page 15 et 19.(Note de l’éditeur.)
FN:Ajoute ! Le sujet avait donc de la valeur par lui-même, antérieurement au travail. Il ne pouvait la tenir que de la nature. L’action naturelle n’est donc pas gratuite. Qui donc a l’audace de se faire payer cette portion de valeur extra-humaine ?
FN:C’est parce que, sous l’empire de la liberté, les efforts se font concurrence entre eux qu’ils obtiennent cette rémunération à peu près proportionnelle à leur intensité. Mais, je le répète, cette proportionnalité n’est pas inhérente à la notion de valeur.
Et la preuve, c’est que là où la concurrence n’existe pas, la proportionnalité n’existe pas davantage. On ne remarque, en ce cas, aucun rapport entre les travaux de diverse nature et leur rémunération.
L’absence de concurrence peut provenir de la nature des choses ou de la perversité des hommes.
Si elle vient de la nature des choses, on verra un travail comparativement très-faible donner lieu à une grande valeur, sans que personne ait raisonnablement à se plaindre. C’est le cas de la personne qui trouve un diamant ; c’est le cas de Rubini, de Malibran, de Taglioni, du tailleur en vogue, du propriétaire du Clos-Vougeot, etc., etc. Les circonstances les ont mis en possession d’un moyen extraordinaire de rendre service ; ils n’ont pas de rivaux et se font payer cher. Le service lui-même étant d’une rareté excessive, cela prouve qu’il n’est pas essentiel au bien-être et au progrès de l’humanité. Donc c’est un objet de luxe, d’ostentation : que les riches se le procurent. N’est-il pas naturel que tout homme attende, avant d’aborder ce genre de satisfactions, qu’il se soit mis à même de pourvoir à des besoins plus impérieux et plus raisonnables ?
Si la concurrence est absente par suite de quelque violence humaine, alors les mêmes effets se produisent, mais avec cette différence énorme qu’ils se produisent où et quand ils n’auraient pas dû se produire. Alors on voit aussi un travail comparativement faible donner lieu à une grande valeur ; mais comment ? En interdisant violemment cette concurrence qui a pour mission de proportionner les rémunérations aux services. Alors, de même que Rubini peut dire à un dilettante : « Je veux une très-grande récompense, ou je ne chante pas à votre soirée, » se fondant sur ce qu’il s’agit là d’un service que lui seul peut rendre, — de même un boulanger, un boucher, un propriétaire, un banquier peut dire : « Je veux une récompense extravagante, ou vous n’aurez pas mon blé, mon pain, ma viande, mon or ; et j’ai pris des précautions, j’ai organisé des baïonnettes pour que vous ne puissiez pas vous pourvoir ailleurs, pour que nul ne puisse vous rendre des services analogues aux miens. »
Les personnes qui assimilent le monopole artificiel et ce qu’elles appellent le monopole naturel, parce que l’un et l’autre ont cela de commun, qu’ils accroissent la valeur du travail, ces personnes, dis-je, sont bien aveugles et bien superficielles.
Le monopole artificiel est une spoliation véritable. Il produit des maux qui n’existeraient pas sans lui. Il inflige des privations à une portion considérable de la société, souvent à l’égard des objets les plus nécessaires. En outre, il fait naître l’irritation, la haine, les représailles, fruits de l’injustice.
Les avantages naturels ne font aucun mal à l’humanité. Tout au plus pourrait-on dire qu’ils constatent un mal préexistant et qui ne leur est pas imputable. Il est fâcheux, peut-être, que le tokay ne soit pas aussi abondant et à aussi bas prix que la piquette. Mais ce n’est pas là un fait social ; il nous a été imposé par la nature.
Il y a donc entre l’avantage naturel et le monopole artificiel cette différence profonde :
L’un est la conséquence d’une rareté préexistante, inévitable ;
L’autre est la cause d’une rareté factice, contre nature.
Dans le premier cas, ce n’est pas l’absence de concurrence qui fait la rareté, c’est la rareté qui explique l’absence de concurrence. L’humanité serait puérile, si elle se tourmentait, se révolutionnait, parce qu’il n’y a, dans le monde, qu’une Jenny Lind, un Clos-Vougeot et un Régent.
Dans le second cas, c’est tout le contraire. Ce n’est pas à cause d’une rareté providentielle que la concurrence est impossible, mais c’est parce que la force a étouffé la concurrence qu’il s’est produit parmi les hommes une rareté qui ne devait pas être.
(Note extraite des manuscrits de l’auteur.)
FN:V. ci-après le chap. XV.
L’accumulation est une circonstance de nulle considération en économie politique.
Que la satisfaction soit immédiate ou retardée, qu’elle puisse être ajournée ou ne se puisse séparer de l’effort, en quoi cela change-t-il la nature des choses ?
Je suis disposé à faire un sacrifice pour me donner le plaisir d’entendre une belle voix, je vais au théâtre et je paye ; la satisfaction est immédiate. Si j’avais consacré mon argent à acheter un plat de fraises, j’aurais pu renvoyer la satisfaction à demain ; voilà tout.
On dira sans doute que les fraises sont de la richesse, parce que je puis les échanger encore. Cela est vrai. Tant que l’effort ayant eu lieu la satisfaction n’est pas accomplie, la richesse subsiste. C’est la satisfaction qui la détruit. Quand le plat de fraises sera mangé, cette satisfaction ira rejoindre celle que m’a procurée la voix d’Alboni.
Service reçu, service rendu : voilà l’économie politique.
(Note extraite des manuscrits de l’auteur.)
FN:Ce qui suit était destiné par l’auteur à trouver place dans le présent chapitre. (Note de l’éditeur.)
FN: Traité d’Écon. pol., p. 1.
FN:Prenez parti pour la concurrence, vous aurez tort ; prenez parti contre la concurrence, vous aurez encore tort : ce qui signifie que vous aurez toujours raison. » (P.-J. Proudhon, Contradictions économiques, p. 182.)
FN:Toujours cette perpétuelle et maudite confusion entre la Valeur et l’Utilité. Je puis bien vous montrer des utilités non appropriées, mais je vous défie de me montrer dans le monde entier une seule valeur qui n’ait pas de propriétaire.
FN:Ce qui suit est un commencement de note complémentaire trouvé dans les papiers de l’auteur. (Note de l’éditeur.)
FN:Cette dernière indication de l’auteur n’est accompagnée d’aucun développement. Mais divers chapitres de ce volume y suppléent. Voir notamment Propriété et Communauté, Rapport de l’économie politique avec la morale, et Solidarité. (Note de l’éditeur.)
FN:Voir ma brochure intitulée Capital et Rente.
FN:Les mots en italiques et capitales sont ainsi imprimés dans le texte original.
FN:Ricardo.
FN:Ici se terminaient les Harmonies économiques, à leur première édition. (Note de l’éditeur.)
FN:Sophismes économiques, chapitre i, tome IV, page 5.
FN:Voir le discours de l’auteur sur l’impôt des boissons, tome V, p. 468. (Note de l’éditeur.)
FN:Quand l’avant-garde icarienne partit du Havre, j’interrogeai plusieurs de ces insensés, et cherchai à connaître le fond de leur pensée. Un facile bien-être, tel était leur espoir et leur mobile. L’un d’eux me dit : « Je pars, et mon frère est de la seconde expédition. Il a huit enfants : et vous sentez quel grand avantage ce sera pour lui de n’avoir plus à les élever et à les nourrir. » — « Je le comprends aisément, dis-je ; mais il faudra que cette lourde charge retombe sur d’autres. » — Se débarrasser sur autrui de ce qui nous gêne, voilà la façon fraternitaire dont ces malheureux entendaient la devise tous pour chacun.
FN:Voir le pamphlet Spoliation et Loi, tome V, pag.2 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:Deux ou trois courts fragments, voilà tout ce que l’auteur a laissé sur cet important chapitre. Cela s’explique : il se proposait ainsi qu’il l’a déclaré, de s’appuyer principalement sur les travaux de M. Carey de Philadelphie pour combattre la théorie de Ricardo. (Note de l’éditeur.)
FN:La même idée a été présentée à la fin du complément ajouté au chapitre v, p. 202 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:De ces développements projetés, aucun n’existe ; mais voici sommairement les deux principales conséquences du fait cité par l’auteur :
1° Deux terres, l’une cultivée A, l’autre inculte B, étant supposées de nature identique, la mesure du travail autrefois sacrifié au défrichement de A est donnée par le travail nécessaire au défrichement de B. On peut dire même qu’à cause de la supériorité de nos connaissances, de nos instruments, de nos moyens de communication, etc., il faudrait moins de journées pour mettre B en culture qu’il n’en a fallu pour A. Si la terre avait une valeur par elle-même, A vaudrait tout ce qu’a coûté sa mise en culture, plus quelque chose pour ses facultés productives naturelles ; c’est-à-dire beaucoup plus que la somme nécessaire actuellement pour mettre B en rapport. Or, c’est tout le contraire : la terre A vaut moins, puisqu’on l’achète plutôt que de défricher B. En achetant A, on ne paye donc rien pour la force naturelle, puisqu’on ne paye pas même le travail de défrichement ce qu’il a primitivement coûté.
2° Si le champ A rapporte par an 1,000 mesures de blé, la terre B défrichée en rapporterait autant. Puisqu’on a cultivé A, c’est qu’autrefois 1,000 mesures de blé rémunéraient amplement tout le travail exigé, soit par le défrichement, soit par la culture annuelle. Puisqu’on ne cultive pas B, c’est que maintenant 1,000 mesures de blé ne payeraient pas un travail identique, — ou même moindre, comme nous le remarquions plus haut.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Évidemment c’est que la valeur du travail humain a haussé par rapport à celle du blé ; c’est que la journée d’un ouvrier vaut et obtient plus de blé pour salaire. En d’autres termes, le blé s’obtient par un moindre effort, s’échange contre un moindre travail ; et la théorie de la cherté progressive des subsistances est fausse. — V. au tome I, le post-scriptum de la lettre adressée au Journal des économistes, en date du 8 décembre 1850. — V. aussi, sur ce sujet, l’ouvrage d’un disciple de Bastiat : Du revenu foncier, par R. de Fontenay. (Note de l’éditeur.)
FN:Chap. Ier, pages 30 et 31, et chap. i, page 45 et suiv.
FN:Voir ci-après le chapitre Responsabilité.
FN:Voir, au tome IV, le pamphlet La Loi, et notamment page 360 et suiv. (Note de l’éditeur.)
FN:Il est à remarquer que M. Roebuck est, à la Chambre des communes, un député de l’extrême gauche. À ce titre, il est l’adversaire né de tous les gouvernements imaginables ; et en même temps il pousse à l’absorption de tous les droits, de toutes les facultés par le gouvernement. Le proverbe est donc faux, qui dit que les montagnes ne se rencontrent pas.
FN:Extrait de la Presse du 22 juin 1850. (Note de l’éditeur.)
FN:Voir tome III, pages 442 à 445. (Note de l’éditeur.)
FN:Journées de juin 1848.
FN:Voyez chapitre iv.
FN:Ici s’arrête le manuscrit rapporté de Rome. La courte note qui suit, nous l’avons trouvée dans les papiers de l’auteur restés à Paris. Elle nous apprend comment il se proposait de terminer et de résumer ce chapitre. (Note de l’éditeur.)
FN:Tout ce qui suit était écrit en 1846. (Note de l’éditeur.)
FN:Il est juste de dire que J.-B. Say a fait remarquer que les moyens d’existence étaient une quantité variable.
FN:Il existe peu de pays dont les populations n’aient une tendance à se multiplier au delà des moyens de subsistance. Une tendance aussi constante que celle-là doit nécessairement engendrer la misère des classes inférieures, et empêcher toute amélioration durable dans leur condition… Le principe de la population… accroîtra le nombre des individus avant qu’un accroissement dans les moyens de subsistance ait eu lieu, etc. (Malthus, cité par Rossi.)
FN:Voyez chapitre xi, pages 405 et suiv.
FN:Qui nécessite la classe des journaliers.
FN:« Du moment que cette valeur est payée par le contribuable, elle est perdue pour lui ; du moment qu’elle est consommée par le gouvernement, elle est perdue pour tout le monde et ne se reverse point dans la société. » (J.-B. Say, Traité d’économie politique, liv. III, chap. ix, p. 504.)
Sans doute ; mais la société gagne en retour le service qui lui est rendu, la sécurité, par exemple. Du reste, Say rétablit, quelques lignes plus bas, la vraie doctrine en ces termes :
« Lever un impôt, c’est faire tort à la société, tort qui n’est compensé par aucun avantage, toutes les fois qu’on ne lui rend aucun service en échange. »
(Ibidem.)
FN:« Les contributions publiques, même lorsqu’elles sont consenties par la nation, sont une violation des propriétés, puisqu’on ne peut prélever des valeurs que sur celles qu’ont produites les terres, les capitaux et l’industrie des particuliers. Aussi, toutes les fois qu’elles excèdent la somme indispensable pour la conservation de la société, il est permis de les considérer comme une spoliation. » (Ibidem.)
Ici encore la proposition incidente corrige ce que le jugement aurait de trop absolu. La doctrine que les services s’échangent contre les services simplifie beaucoup le problème et la solution.
FN:Les effets de cette transformation ont été rendus sensibles par un exemple que citait M. le ministre de la guerre d’Hautpoul. « Il revient à chaque soldat, disait-il, 16 centimes pour son alimentation. Le gouvernement leur prend ces 16 centimes, et se charge de les nourrir. Il en résulte que tous ont la même ration, composée de même manière, qu’elle leur convienne ou non. L’un a trop de pain et le jette. L’autre n’a pas assez de viande, etc. Nous avons fait un essai : nous laissons aux soldats la libre disposition de ces 16 centimes et nous sommes heureux de constater une amélioration sensible sur leur sort. Chacun consulte ses goûts, son tempérament, le prix des marchés. Généralement ils ont d’eux-mêmes substitué en partie la viande au pain. Ils achètent ici plus de pain, là plus de viande, ailleurs plus de légumes, ailleurs plus de poisson. Leur santé s’en trouve bien ; ils sont plus contents et l’État est délivré d’une grande responsabilité. »
Le lecteur comprend qu’il n’est pas là question de juger cette expérience au point de vue militaire. Je la cite comme propre à marquer une première différence entre le service public et le service privé, entre la réglementation et la liberté. Vaut-il mieux que l’État nous prenne les ressources au moyen desquelles nous nous alimentons et se charge de nous nourrir, ou bien qu’il nous laisse à la fois et ces ressources et le soin de pourvoir à notre subsistance ? La même question se présente à propos de chacun de nos besoins.
FN:Voir le pamphlet intitulé Baccalauréat et Socialisme, tome IV, p. 442. (Note de l’éditeur.)
FN:L’auteur, dans un de ses précédents articles, s’est proposé de résoudre la même question. Il a reherché quel était le légitime domaine de la loi. Tous les développements que contient le pamphlet intitulé la Loi s’appliquent à sa thèse actuelle. Nous renvoyons le lecteur au tome IV, page 342. (Note de l’éditeur.)
FN:Ici s’arrête le manuscrit. Nous renvoyons nos lecteurs au pamphlet intitulé Spoliation et loi, dans la seconde partie duquel l’auteur a fait justice des sophismes émis à cette séance du conseil général. (Tome V, pages i et suiv.)
À l’égard des six chapitres qui devraient suivre, sous les titres d’Impôts, — Machines, — Liberté des échanges, — Intermédiaires, — Matières premières, — Luxe, nous renvoyons : 1° au discours sur l’impôt des boissons inséré dans la seconde édition du pamphlet Incompatibilités parlementaires (tome V, page 468) ; 2° au pamphlet intitulé Ce qu’on voit, et ce qu’on ne voit pas (tome V, page 336) ; 3° aux Sophismes économiques (tome IV, page i.)
(Note de l’éditeur.)
FN:L’auteur n’a pu continuer cet examen des erreurs qui sont, pour ceux qu’elles égarent, une cause presque immédiate de souffrance, ni décrire une autre classe d’erreurs, manifestées par la violence et la ruse, dont les premiers effets s’appesantissent sur autrui. Ses notes ne contiennent rien d’applicable aux Causes perturbatrices, si ce n’est le fragment qui précède et celui qui va suivre. Nous renvoyons pour le surplus au chapitre Ier de la seconde série des Sophismes, intitulé Physiologie de la Spoliation (tome IV, page 127). (Note de l’éditeur.)
FN:Voir la fin du chapitre XI.
FN:On l’oublie quand on pose cette question : Le travail des esclaves revient-il plus cher ou meilleur marché que le travail salarié ?
FN:Voyez Baccalauréat et Socialisme, tome IV, page 442. (Note de l’éditeur.)
FN:…parce que je crois qu’une impulsion supérieure la dirige, parce que Dieu ne pouvant agir dans l’ordre moral que par l’intermédiaire des intérêts et des volontés, il est impossible que la résultante naturelle de ces intérêts, que la tendance commune de ces volontés, aboutisse au mal définitif : — car alors ce ne serait pas seulement l’homme ou l’humanité qui marcherait à l’erreur ; c’est Dieu lui-même, impuissant ou mauvais, qui pousserait au mal sa créature avortée.
Nous croyons donc à la liberté, parce que nous croyons à l’harmonie universelle, c’est-à-dire à Dieu. Proclamant au nom de la foi, formulant au nom de la science les lois divines, souples et vivantes, du mouvement moral, nous repoussons du pied ces institutions étroites, gauches, immobiles, que des aveugles jettent tout à travers l’admirable mécanisme. Du point de vue de l’athée, il serait absurde de dire : laissez faire le hasard ! Mais nous, croyants, nous avons le droit de crier : laissez passer l’ordre et la justice de Dieu ! Laissez marcher librement cet agent du moteur infaillible, ce rouage de transmission qu’on appelle l’initiative humaine ! — Et la liberté ainsi comprise n’est plus l’anarchique déification de l’individualisme ; ce que nous adorons, par delà l’homme qui s’agite, c’est Dieu qui le mène.
Nous savons bien que l’esprit humain peut s’égarer : oui, sans doute, de tout l’intervalle qui sépare une vérité acquise d’une vérité qu’il pressent. Mais puisque sa nature est de chercher, sa destinée est de trouver. Le vrai, remarquons-le, a des rapports harmoniques, des affinités nécessaires non-seulement avec la forme de notre entendement et les instincts de notre cœur, mais aussi avec toutes les conditions physiques et morales de notre existence ; en sorte que, lors même qu’il échapperait à l’intelligence de l’homme comme vrai absolu, à ses sympathies innées comme juste, ou comme beau à ses aspirations idéales, il finirait encore par se faire accepter sous son aspect pratique et irrécusable d’utile.
Nous savons que la liberté peut mener au Mal. — Mais le Mal a lui-même sa mission. Dieu ne l’a certes pas jeté au hasard devant nos pas pour nous faire tomber ; il l’a placé en quelque sorte de chaque côté du chemin que nous devions suivre, afin qu’en s’y heurtant l’homme fût ramené au bien par le mal même.
Les volontés, comme les molécules inertes, ont leur loi de gravitation. Mais, — tandis que les êtres inanimés obéissent à des tendances préexistantes et fatales, — pour les intelligences libres, la force d’attraction et de répulsion ne précède pas le mouvement ; elle naît de la détermination volontaire qu’elle semble attendre, elle se développe en vertu de l’acte même, et réagit alors pour ou contre l’agent, par un effort progressif de concours ou de résistance qu’on appelle récompense ou châtiment, plaisir ou douleur. Si la direction de la volonté est dans le sens des lois générales, si l’acte est bon, le mouvement est secondé, le bien-être en résulte pour l’homme. — S’il s’écarte au contraire, s’il est mauvais, quelque chose le repousse ; de l’erreur naît la souffrance, qui en est le remède et le terme. Ainsi le Mal s’oppose constamment au Mal, comme le Bien provoque incessamment le Bien. Et l’on pourrait dire que, vus d’un peu haut, les écarts du libre arbitre se bornent à quelques oscillations, d’une amplitude déterminée, autour d’une direction supérieure et nécessaire ; toute rébellion persistante qui voudrait forcer cette limite n’aboutissant qu’à se détruire elle-même, sans parvenir à troubler en rien l’ordre de sa sphère.
Cette force réactive de concours ou de répulsion, qui par la récompense et la peine régit l’orbite à la fois volontaire et fatale de l’humanité, cette loi de gravitation des êtres libres (dont le Mal n’est que la moitié nécessaire), se manifeste par deux grandes expressions, — la Responsabilité et la Solidarité : l’une qui fait retomber sur l’individu, — l’autre qui répercute sur le corps social les conséquences bonnes ou mauvaises de l’acte : l’une qui s’adresse à l’homme comme à un tout solitaire et autonome, — l’autre qui l’enveloppe dans une inévitable communauté de biens et de maux, comme élément partiel et membre dépendant d’un être collectif et impérissable, l’Humanité. — Responsabilité, sanction de la liberté individuelle, raison des droits de l’homme, — Solidarité, preuve de sa subordination sociale et principe de ses devoirs…
(Un feuillet manquait au manuscrit de Bastiat. On me pardonnera d’avoir essayé de continuer la pensée de cette religieuse introduction.) R. F.
FN:Religion (religare, relier), ce qui rattache la vie actuelle à la vie future, les vivants aux morts, le temps à l’éternité, le fini à l’infini, l’homme à Dieu.
FN:Ne dirait-on pas que la justice divine, si incompréhensible quand on considère le sort des individus, devient éclatante quand on réfléchit sur les destinées des nations ? La vie de chaque homme est un drame qui se noue sur un théâtre et se dénoue sur un autre ; mais il n’en est pas ainsi de la vie des nations. Cette instructive tragédie commence et finit sur la terre. Voilà pourquoi l’histoire est une lecture sainte ; c’est la justice de la Providence. (De Custines, La Russie.)
FN:Les développements intéressants que l’auteur voulait présenter ici, par voie d’exemples, et dont il indiquait d’avance le caractère, il ne les a malheureusement pas écrits. Le lecteur pourra y suppléer en se reportant au chapitre xvi de ce livre, ainsi qu’aux chapitres vii et xi du pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, t. V, pages 363 et 383. (Note de l’éditeur.)
FN:La fin de ce chapitre n’est plus guère qu’une suite de notés jetées sur le papier sans transitions ni développements.(Note de l’éditeur.)
FN:Cette ébauche se termine ici brusquement ; le côté économique de la loi de solidarité n’est pas indiqué. On peut renvoyer le lecteur aux chap. x et xi, Concurrence, Producteur et Consommateur.
Au reste, qu’est-ce au fond que l’ouvrage entier des Harmonies ; qu’est-ce que la concordance des intérêts, et les grandes maximes : La prospérité de chacun est la prospérité de tous, — La prospérité de tous est la prospérité de chacun, etc. ; — qu’est-ce que l’accord de la propriété et de la communauté, les services du capital, l’extension de la gratuité, etc. ; — sinon le développement au point de vue utilitaire du titre même de ce chapitre : Solidarité ? (Note de l’éditeur.)
FN:La misère est le fait de l’économie politique… l’économie politique a besoin que la mort lui vienne en aide… c’est la théorie de l’instabilité et du vol. (Proudhon, Contradictions économiques, t. II, p. 214.)
Si les subsistances manquent au peuple… c’est la faute de l’économie politique. (Ibidem, p. 430.)
FN:L’auteur n’a malheureusement rien laissé sur les quatre chapitres qui viennent d’être indiqués (et qu’il avait compris dans le plan de ses travaux), sauf une introduction pour le dernier. (Note de l’éditeur.)
Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas [July 1850] [CW3]↩
Introduction↩
Dans la sphère économique, un acte, une habitude, une institution, une loi n’engendrent pas seulement un effet, mais une série d’effets. De ces effets, le premier seul est immédiat ; il se manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les autres ne se déroulent que successivement, on ne les voit pas ; heureux si on les prévoit.
Entre un mauvais et un bon Économiste, voici toute la différence : l’un s’en tient à l’effet visible ; l’autre tient compte et de l’effet qu’on voit et de ceux qu’il faut prévoir.
Mais cette différence est énorme, car il arrive presque toujours que, lorsque la conséquence immédiate est favorable, les conséquences ultérieures sont funestes, et vice versa. — D’où il suit que le mauvais Économiste poursuit un petit bien actuel qui sera suivi d’un grand mal à venir, tandis que le vrai Économiste poursuit un grand bien à venir, au risque d’une petit mal actuel.
Du reste, il en est ainsi en hygiène, en morale. Souvent, plus le premier fruit d’une habitude est doux, plus les autres sont amers. Témoin : la débauche, la paresse, la prodigalité. Lors donc qu’un homme, frappé de l’effet qu’on voit, n’a pas encore appris à discerner ceux qu’on ne voit pas, il s’abandonne à des habitudes funestes, non seulement par penchant, mais par calcul.
Ceci explique l’évolution fatalement douloureuse de l’humanité. L’ignorance entoure son berceau ; donc elle se détermine dans ses actes par leurs premières conséquences, les seules, à son origine, qu’elle puisse voir. Ce n’est qu’à la longue qu’elle apprend à tenir compte des autres.[295] Deux maîtres, bien divers, lui enseignent cette leçon : l’Expérience et la Prévoyance. L’expérience régente efficacement mais brutalement. Elle nous instruit de tous les effets d’un acte en nous les faisant ressentir, et nous ne pouvons manquer de finir par savoir que le feu brûle, à force de nous brûler. À ce rude docteur, j’en voudrais, autant que possible, substituer un plus doux : la Prévoyance. C’est pourquoi je rechercherai les conséquences de quelques phénomènes économiques, opposant à celles qu’on voit celles qu’on ne voit pas.
I. La vitre cassée↩
Avez-vous jamais été témoin de la fureur du bon bourgeois Jacques Bonhomme, quand son fils terrible est parvenu à casser un carreau de vitre ? Si vous avez assisté à ce spectacle, à coup sûr vous aurez aussi constaté que tous les assistants, fussent-ils trente, semblent s’être donné le mot pour offrir au propriétaire infortuné cette consolation uniforme : « À quelque chose malheur est bon. De tels accidents font aller l’industrie. Il faut que tout le monde vive. Que deviendraient les vitriers, si l’on ne cassait jamais de vitres ? »
Or, il y a dans cette formule de condoléance toute une théorie, qu’il est bon de surprendre flagrante delicto, dans ce cas très simple, attendu que c’est exactement la même que celle qui, par malheur, régit la plupart de nos institutions économiques.
À supposer qu’il faille dépenser six francs pour réparer le dommage, si l’on veut dire que l’accident fait arriver six francs à l’industrie vitrière, qu’il encourage dans la mesure de six francs la susdite industrie, je l’accorde, je ne conteste en aucune façon, on raisonne juste. Le vitrier va venir, il fera besogne, touchera six francs, se frottera les mains et bénira dans son cœur l’enfant terrible. C’est ce qu’on voit.
Mais si, par voie de déduction, on arrive à conclure, comme on le fait trop souvent, qu’il est bon qu’on casse les vitres, que cela fait circuler l’argent, qu’il en résulte un encouragement pour l’industrie en général, je suis obligé de m’écrier : halte-là ! Votre théorie s’arrête à ce qu’on voit, elle ne tient pas compte de ce qu’on ne voit pas.
On ne voit pas que, puisque notre bourgeois a dépensé six francs à une chose, il ne pourra plus les dépenser à une autre. On ne voit pas que s’il n’eût pas eu de vitre à remplacer, il eût remplacé, par exemple, ses souliers éculés ou mis un livre de plus dans sa bibliothèque. Bref, il aurait fait de ses six francs un emploi quelconque qu’il ne fera pas.
Faisons donc le compte de l’industrie en général.
La vitre étant cassée, l’industrie vitrière est encouragée dans la mesure de six francs ; c’est ce qu’on voit.
Si la vitre n’eût pas été cassée, l’industrie cordonnière (ou toute autre) eût été encouragée dans la mesure de six francs ; c’est ce qu’on ne voit pas.
Et si l’on prenait en considération ce qu’on ne voit pas, parce que c’est un fait négatif, aussi bien que ce que l’on voit, parce que c’est un fait positif, on comprendrait qu’il n’y a aucun intérêt pour l’industrie en général, ou pour l’ensemble du travail national, à ce que des vitres se cassent ou ne se cassent pas.
Faisons maintenant le compte de Jacques Bonhomme.
Dans la première hypothèse, celle de la vitre cassée, il dépense six francs, et a, ni plus ni moins que devant, la jouissance d’une vitre.
Dans la seconde, celle où l’accident ne fût pas arrivé, il aurait dépensé six francs en chaussure et aurait eu tout à la fois la jouissance d’une paire de souliers et celle d’une vitre.
Or, comme Jacques Bonhomme fait partie de la société, il faut conclure de là que, considérée dans son ensemble, et toute balance faite de ses travaux et de ses jouissances, elle a perdu la valeur de la vitre cassée.
Par où, en généralisant, nous arrivons à cette conclusion inattendue : « la société perd la valeur des objets inutilement détruits, » — et à cet aphorisme qui fera dresser les cheveux sur la tête des protectionistes : « Casser, briser, dissiper, ce n’est pas encourager le travail national, » ou plus brièvement : « destruction n’est pas profit. »
Que direz-vous, Moniteur industriel, que direz-vous, adeptes de ce bon M. de Saint-Chamans, qui a calculé avec tant de précision ce que l’industrie gagnerait à l’incendie de Paris, à raison des maisons qu’il faudrait reconstruire ?
Je suis fâché de déranger ses ingénieux calculs, d’autant qu’il en a fait passer l’esprit dans notre législation. Mais je le prie de les recommencer, en faisant entrer en ligne de compte ce qu’on ne voit pas à côté de ce qu’on voit.
Il faut que le lecteur s’attache à bien constater qu’il n’y a pas seulement deux personnages, mais trois dans le petit drame que j’ai soumis à son attention. L’un, Jacques Bonhomme, représente le Consommateur, réduit par la destruction à une jouissance au lieu de deux. L’autre, sous la figure du Vitrier, nous montre le Producteur dont l’accident encourage l’industrie. Le troisième est le Cordonnier (ou tout autre industriel) dont le travail est découragé d’autant par la même cause. C’est ce troisième personnage qu’on tient toujours dans l’ombre et qui, personnifiant ce qu’on ne voit pas, est un élément nécessaire du problème. C’est lui qui nous fait comprendre combien il est absurde de voir un profit dans une destruction. C’est lui qui bientôt nous enseignera qu’il n’est pas moins absurde de voir un profit dans une restriction, laquelle n’est après tout qu’une destruction partielle. — Aussi, allez au fond de tous les arguments qu’on fait valoir en sa faveur, vous n’y trouverez que la paraphrase de ce dicton vulgaire : « Que deviendraient les vitriers, si l’on ne cassait jamais de vitres [296]? »
II. Le licenciement↩
Il en est d’un peuple comme d’un homme. Quand il veut se donner une satisfaction, c’est à lui de voir si elle vaut ce qu’elle coûte. Pour une nation, la Sécurité est le plus grand des biens. Si, pour l’acquérir, il faut mettre sur pied cent mille hommes et dépenser cent millions, je n’ai rien à dire. C’est une jouissance achetée au prix d’un sacrifice.
Qu’on ne se méprenne donc pas sur la portée de ma thèse.
Un représentant propose de licencier cent mille hommes pour soulager les contribuables de cent millions.
Si on se borne à lui répondre : « Ces cent mille hommes et cent millions sont indispensables à la sécurité nationale : c’est un sacrifice ; mais, sans ce sacrifice, la France serait déchirée par les factions ou envahie par l’étranger. » — Je n’ai rien à opposer ici à cet argument, qui peut être vrai ou faux en fait, mais qui ne renferme pas théoriquement d’hérésie économique. L’hérésie commence quand on veut représenter le sacrifice lui-même comme un avantage, parce qu’il profite à quelqu’un.
Or, je suis bien trompé, ou l’auteur de la proposition ne sera pas plus tôt descendu de la tribune qu’un orateur s’y précipitera pour dire :
« Licencier cent mille hommes ! y pensez-vous ? Que vont-ils devenir ? de quoi vivront-ils ? sera-ce de travail ? mais ne savez-vous pas que le travail manque partout ? que toutes les carrières sont encombrées ? Voulez-vous les jeter sur la place pour y augmenter la concurrence et peser sur le taux des salaires ? Au moment où il est si difficile de gagner sa pauvre vie, n’est-il pas heureux que l’État donne du pain à cent mille individus ? Considérez, de plus, que l’armée consomme du vin, des vêtements, des armes, qu’elle répand ainsi l’activité dans les fabriques, dans les villes de garnison, et qu’elle est, en définitive, la Providence de ses innombrables fournisseurs. Ne frémissez-vous pas à l’idée d’anéantir cet immense mouvement industriel ? »
Ce discours, on le voit, conclut au maintien des cent mille soldats, abstraction faite des nécessités du service, et par des considérations économiques. Ce sont ces considérations seules que j’ai à réfuter.
Cent mille hommes, coûtant aux contribuables cent millions, vivent et font vivre leurs fournisseurs autant que cent millions peuvent s’étendre : c’est ce qu’on voit.
Mais cent millions, sortis de la poche des contribuables, cessent de faire vivre ces contribuables et leurs fournisseurs, autant que cent millions peuvent s’étendre : c’est ce qu’on ne voit pas. Calculez, chiffrez, et dites-moi où est le profit pour la masse ?
Quant à moi, je vous dirai où est la perte, et, pour simplifier, au lieu de parler de cent mille hommes et de cent millions, raisonnons sur un homme et mille francs.
Nous voici dans le village de A. Les recruteurs font la tournée et y enlèvent un homme. Les percepteurs font leur tournée aussi et y enlèvent mille francs. L’homme et la somme sont transportés à Metz, l’une destinée à faire vivre l’autre, pendant un an, sans rien faire. Si vous ne regardez que Metz, oh ! vous avez cent fois raison, la mesure est très avantageuse ; mais si vos yeux se portent sur le village de A, vous jugerez autrement, car, à moins d’être aveugle, vous verrez que ce village a perdu un travailleur et les mille francs qui rémunéraient son travail, et l’activité que, par la dépense de ces mille francs, il répandait autour de lui.
Au premier coup d’œil, il semble qu’il y ait compensation. Le phénomène qui se passait au village se passe à Metz, et voilà tout. Mais voici où est la perte. Au village, un homme bêchait et labourait : c’était un travailleur ; à Metz, il fait des tête droite et des tête gauche : c’est un soldat. L’argent et la circulation sont les mêmes dans les deux cas ; mais, dans l’un, il y avait trois cents journées de travail productif ; dans l’autre, il a trois cents journées de travail improductif, toujours dans la supposition qu’une partie de l’armée n’est pas indispensable à la sécurité publique.
Maintenant, vienne le licenciement. Vous me signalez un surcroît de cent mille travailleurs, la concurrence stimulée et la pression qu’elle exerce sur le taux des salaires. C’est ce vous voyez.
Mais voici ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que renvoyer cent mille soldats, ce n’est pas anéantir cent millions, c’est les remettre aux contribuables. Vous ne voyez pas que jeter ainsi cent mille travailleurs sur le marché, c’est y jeter, du même coup, les cent millions destinés à payer leur travail ; que, par conséquent, la même mesure qui augmente l’offre des bras en augmente aussi la demande ; d’où il suit que votre baisse des salaires est illusoire. Vous ne voyez pas qu’avant, comme après le licenciement, il y a dans le pays cent millions correspondant à cent mille hommes ; que toute la différence consiste en ceci : avant, le pays livre les cent millions aux cent mille hommes pour ne rien faire ; après, il les leur livre pour travailler. Vous ne voyez pas, enfin, que lorsqu’un contribuable donne son argent, soit à un soldat en échange de rien, soit à un travailleur en échange de quelque chose, toutes les conséquences ultérieures de la circulation de cet argent sont les mêmes dans les deux cas ; seulement, dans le second cas, le contribuable reçoit quelque chose, dans le premier, il ne reçoit rien. — Résultat : une perte sèche pour la nation.
Le sophisme que je combats ici ne résiste pas à l’épreuve de la progression, qui est la pierre de touche des principes. Si, tout compensé, tous intérêts examinés, il y a profit national à augmenter l’armée, pourquoi ne pas enrôler sous les drapeaux toute la population virile du pays ?
III. L’impôt↩
Ne vous est-il jamais arrivé d’entendre dire :
« L’impôt, c’est le meilleur placement ; c’est une rosée fécondante ? Voyez combien de familles il fait vivre, et suivez, par la pensée, ses ricochets sur l’industrie : c’est l’infini, c’est la vie ».
Pour combattre cette doctrine, je suis obligé de reproduire la réfutation précédente. L’économie politique sait bien que ses arguments ne sont pas assez divertissants pour qu’on en puisse dire : Repetita placent. Aussi, comme Basile, elle a arrangé le proverbe à son usage, bien convaincue que dans sa bouche, Repetita docent.
Les avantages que les fonctionnaires trouvent à émarger, c’est ce qu’on voit. Le bien qui en résulte pour leurs fournisseurs, c’est ce qu’on voit encore. Cela crève les yeux du corps.
Mais le désavantage que les contribuables éprouvent à se libérer, c’est ce qu’on ne voit pas, et le dommage qui en résulte pour leurs fournisseurs, c’est ce qu’on ne voit pas davantage, bien que cela dût sauter aux yeux de l’esprit.
Quand un fonctionnaire dépense à son profit cent sous de plus, cela implique qu’un contribuable dépense à son profit cent sous de moins. Mais la dépense du fonctionnaire se voit, parce qu’elle se fait ; tandis que celle du contribuable ne se voit pas, parce que, hélas ! on l’empêche de se faire.
Vous comparez la nation à une terre desséchée et l’impôt à une pluie féconde. Soit. Mais vous devriez vous demander aussi où sont les sources de cette pluie, et si ce n’est pas précisément l’impôt qui pompe l’humidité du sol et le dessèche.
Vous devriez vous demander encore s’il est possible que le sol reçoive autant de cette eau précieuse par la pluie qu’il en perd par l’évaporation ?
Ce qu’il y a de très positif, c’est que, quand Jacques Bonhomme compte cent sous au percepteur, il ne reçoit rien en retour. Quand, ensuite, un fonctionnaire dépensant ces cent sous, les rend à Jacques Bonhomme, c’est contre une valeur égale en blé ou en travail. Le résultat définitif est pour Jacques Bonhomme une perte de cinq francs.
Il est très vrai que souvent, le plus souvent si l’on veut, le fonctionnaire rend à Jacques Bonhomme un service équivalent. En ce cas, il n’y a pas perte de part ni d’autre, il n’y a qu’échange. Aussi, mon argumentation ne s’adresse-t-elle nullement aux fonctions utiles. Je dis ceci : si vous voulez créer une fonction, prouvez son utilité. Démontrez qu’elle vaut à Jacques Bonhomme, par les services qu’elle lui rend, l’équivalent de ce qu’elle lui coûte. Mais, abstraction faite de cette utilité intrinsèque, n’invoquez pas comme argument l’avantage qu’elle confère au fonctionnaire, à sa famille et à ses fournisseurs ; n’alléguez pas qu’elle favorise le travail.
Quand Jacques Bonhomme donne cent sous à un fonctionnaire contre un service réellement utile, c’est exactement comme quand il donne cent sous à un cordonnier contre une paire de souliers. Donnant donnant, partant quittes. Mais, quand Jacques Bonhomme livre cent sous à un fonctionnaire pour n’en recevoir aucun service ou même pour en recevoir des vexations, c’est comme s’il les livrait à un voleur. Il ne sert de rien de dire que le fonctionnaire dépensera ces cent sous au grand profit du travail national ; autant en eût fait le voleur ; autant en ferait Jacques Bonhomme s’il n’eût rencontré sur son chemin ni le parasite extra-légal ni le parasite légal.
Habituons-nous donc à ne pas juger des choses seulement par ce qu’on voit, mais encore par ce qu’on ne voit pas.
L’an passé, j’étais du Comité des finances, car, sous la Constituante, les membres de l’opposition n’étaient pas systématiquement exclus de toutes les Commissions ; en cela, la Constituante agissait sagement. Nous avons entendu M. Thiers dire : « J’ai passé ma vie à combattre les hommes du parti légitimiste et du parti prêtre. Depuis que le danger commun nous a rapprochés, depuis que je les fréquente, que je les connais, que nous nous parlons cœur à cœur, je me suis aperçu que ce ne sont pas les monstres que je m’étais figurés. »
Oui, les défiances s’exagèrent, les haines s’exaltent entre les partis qui ne se mêlent pas ; et si la majorité laissait pénétrer dans le sein des Commissions quelques membres de la minorité, peut-être reconnaîtrait-on, de part et d’autre, que les idées ne sont pas aussi éloignées et surtout les intentions aussi perverses qu’on le suppose.
Quoi qu’il en soit, l’an passé, j’étais du Comité des finances. Chaque fois qu’un de nos collègues parlait de fixer à un chiffre modéré le traitement du Président de la République, des ministres, des ambassadeurs, on lui répondait :
« Pour le bien même du service, il faut entourer certaines fonctions d’éclat et de dignité. C’est le moyen d’y appeler les hommes de mérite. D’innombrables infortunes s’adressent au Président de la République, et ce serait le placer dans une position pénible que de le forcer à toujours refuser. Une certaine représentation dans les salons ministériels et diplomatiques est un des rouages des gouvernements constitutionnels, etc., etc. »
Quoique de tels arguments puissent être controversés, ils méritent certainement un sérieux examen. Ils sont fondés sur l’intérêt public, bien ou mal apprécié ; et, quant à moi, j’en fais plus de cas que beaucoup de nos Catons, mus par un esprit étroit de lésinerie ou de jalousie.
Mais ce qui révolte ma conscience d’économiste, ce qui me fait rougir pour la renommée intellectuelle de mon pays, c’est quand on en vient (ce à quoi on ne manque jamais) à cette banalité absurde, et toujours favorablement accueillie :
« D’ailleurs, le luxe des grands fonctionnaires encourage les arts, l’industrie, le travail. Le chef de l’État et ses ministres ne peuvent donner des festins et des soirées sans faire circuler la vie dans toutes les veines du corps social. Réduire leurs traitements, c’est affamer l’industrie parisienne et, par contre-coup, l’industrie nationale. »
De grâce, Messieurs, respectez au moins l’arithmétique et ne venez pas dire, devant l’Assemblée nationale de France, de peur qu’à sa honte elle ne vous approuve, qu’une addition donne une somme différente, selon qu’on la fait de haut en bas ou de bas en haut.
Quoi ! je vais m’arranger avec un terrassier pour qu’il fasse une rigole dans mon champ, moyennant cent sous. Au moment de conclure, le percepteur me prend mes cent sous et les fait passer au ministre de l’intérieur ; mon marché est rompu, mais M. le ministre ajoutera un plat de plus à son dîner. Sur quoi, vous osez affirmer que cette dépense officielle est un surcroît ajouté à l’industrie nationale ! Ne comprenez-vous pas qu’il n’y a là qu’un simple déplacement de satisfaction et de travail ? Un ministre a sa table mieux garnie, c’est vrai ; mais un agriculteur a un champ moins bien desséché, et c’est tout aussi vrai. Un traiteur parisien a gagné cent sous, je vous l’accorde ; mais accordez-moi qu’un terrassier provincial a manqué de gagner cinq francs. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le plat officiel et le traiteur satisfait, c’est ce qu’on voit ; le champ noyé et le terrassier désœuvré, c’est ce qu’on ne voit pas.
Bon Dieu ! que de peine à prouver, en économie politique, que deux et deux font quatre ; et, si vous y parvenez, on s’écrie : « c’est si clair, que c’en est ennuyeux. » — Puis on vote comme si vous n’aviez rien prouvé du tout.
IV. Théâtres, Beaux-arts↩
L’État doit-il subventionner les arts ?
Il y a certes beaucoup à dire Pour et Contre.
En faveur du système des subventions, on peut dire que les arts élargissent, élèvent et poétisent l’âme d’une nation, qu’ils l’arrachent à des préoccupations matérielles, lui donnent le sentiment du beau, et réagissent ainsi favorablement sur ses manières, ses coutumes, ses mœurs et même sur son industrie. On peut se demander où en serait la musique en France, sans le Théâtre-Italien et le Conservatoire ; l’art dramatique, sans le Théâtre-Français ; la peinture et la sculpture, sans nos collections et nos musées. On peut aller plus loin et se demander si, sans la centralisation et par conséquent la subvention des beaux-arts, ce goût exquis se serait développé, qui est le noble apanage du travail français et impose ses produits à l’univers entier. En présence de tels résultats, ne serait-ce pas une haute imprudence que de renoncer à cette modique cotisation de tous les citoyens qui, en définitive, réalise, au milieu de l’Europe, leur supériorité et leur gloire ?
À ces raisons et bien d’autres, dont je ne conteste pas la force, on peut en opposer de non moins puissantes. Il y a d’abord, pourrait-on dire, une question de justice distributive. Le droit du législateur va-t-il jusqu’à ébrécher le salaire de l’artisan pour constituer un supplément de profits à l’artiste ? M. Lamartine disait : Si vous supprimez la subvention d’un théâtre, où vous arrêterez-vous dans cette voie, et ne serez-vous pas logiquement entraînés à supprimer vos Facultés, vos Musées, vos Instituts, vos Bibliothèques ? On pourrait répondre : Si vous voulez subventionner tout ce qui est bon et utile, où vous arrêterez-vous dans cette voie, et ne serez-vous pas entraînés logiquement à constituer une liste civile à l’agriculture, à l’industrie, au commerce, à la bienfaisance, à l’instruction ? Ensuite, est-il certain que les subventions favorisent le progrès de l’art ? C’est une question qui est loin d’être résolue, et nous voyons de nos yeux que les théâtres qui prospèrent sont ceux qui vivent de leur propre vie. Enfin, s’élevant à des considérations plus hautes, on peut faire observer que les besoins et les désirs naissent les uns des autres et s’élèvent dans des régions de plus en plus épurées [297], à mesure que la richesse publique permet de les satisfaire ; que le gouvernement n’a point à se mêler de cette correspondance, puisque, dans un état donné de la fortune actuelle, il ne saurait stimuler, par l’impôt, les industries de luxe sans froisser les industries de nécessité, intervertissant ainsi la marche naturelle de la civilisation. On peut faire observer que ces déplacements artificiels des besoins, des goûts, du travail et de la population, placent les peuples dans une situation précaire et dangereuse, qui n’a plus de base solide.
Voilà quelques-unes des raisons qu’allèguent les adversaires de l’intervention de l’État, en ce qui concerne l’ordre dans lequel les citoyens croient devoir satisfaire leurs besoins et leurs désirs, et par conséquent diriger leur activité. Je suis de ceux, je l’avoue, qui pensent que le choix, l’impulsion doit venir d’en bas, non d’en haut, des citoyens, non du législateur ; et la doctrine contraire me semble conduire à l’anéantissement de la liberté et de la dignité humaine.
Mais, par une déduction aussi fausse qu’injuste, sait-on de quoi on accuse les économistes ? c’est, quand nous repoussons la subvention, de repousser la chose même qu’il s’agit de subventionner, et d’être les ennemis de tous les genres d’activité, parce que nous voulons que ces activités, d’une part soient libres, et de l’autre cherchent en elles-mêmes leur propre récompense. Ainsi, demandons-nous que l’État n’intervienne pas, par l’impôt, dans les matières religieuses ? nous sommes des athées. Demandons-nous que l’État n’intervienne pas, par l’impôt, dans l’éducation ? nous haïssons les lumières. Disons-nous que l’État ne doit pas donner, par l’impôt, une valeur factice au sol, à tel ordre d’industrie ? nous sommes les ennemis de la propriété et du travail. Pensons-nous que l’État ne doit pas subventionner les artistes ? nous sommes des barbares qui jugeons les arts inutiles.
Je proteste ici de toutes mes forces contre ces déductions. Loin que nous entretenions l’absurde pensée d’anéantir la religion, l’éducation, la propriété, le travail et les arts quand nous demandons que l’État protège le libre développement de tous ces ordres d’activité humaine, sans les soudoyer aux dépens les uns des autres, nous croyons au contraire que toutes ces forces vives de la société se développeraient harmonieusement sous l’influence de la liberté, qu’aucune d’elles ne deviendrait, comme nous le voyons aujourd’hui, une source de troubles, d’abus, de tyrannie et de désordre.
Nos adversaires croient qu’une activité qui n’est ni soudoyée ni réglementée est une activité anéantie. Nous croyons le contraire. Leur foi est dans le législateur, non dans l’humanité. La nôtre est dans l’humanité, non dans le législateur.
Ainsi, M. Lamartine disait : Au nom de ce principe, il faut abolir les expositions publiques qui font l’honneur et la richesse de ce pays.
Je réponds à M. Lamartine : À votre point de vue, ne pas subventionner c’est abolir, parce que, partant de cette donnée que rien n’existe que par la volonté de l’État, vous en concluez que rien ne vit que ce que l’impôt fait vivre. Mais je retourne contre vous l’exemple que vous avez choisi, et je vous fait observer que la plus grande, la plus noble des expositions, celle qui est conçue dans la pensée la plus libérale, la plus universelle, et je puis même me servir du mot humanitaire, qui n’est pas ici exagéré, c’est l’exposition qui se prépare à Londres, la seule dont aucun gouvernement ne se mêle et qu’aucun impôt ne soudoie.
Revenant aux beaux-arts, on peut, je le répète, alléguer pour et contre le système des subventions des raisons puissantes. Le lecteur comprend que, d’après l’objet spécial de cet écrit, je n’ai ni à exposer ces raisons, ni à décider entre elles.
Mais M. Lamartine a mis en avant un argument que je ne puis passer sous silence, car il rentre dans le cercle très précis de cette étude économique.
Il a dit :
La question économique, en matière de théâtres, se résume en un seul mot : c’est du travail. Peu importe la nature de ce travail, c’est un travail aussi fécond, aussi productif que toute autre nature de travaux dans une nation. Les théâtres, vous le savez, ne nourrissent pas moins, ne salarient pas moins, en France, de quatre vingt mille ouvriers de toute nature, peintres, maçons, décorateurs, costumiers, architectes, etc., qui sont la vie même et le mouvement de plusieurs quartiers de cette capitale, et, à ce titre, ils doivent obtenir vos sympathies !
Vos sympathies ! — traduisez : vos subventions.
Et plus loin :
Les plaisirs de Paris sont le travail et la consommation des départements, et les luxes du riche sont le salaire et le pain de deux cent mille ouvriers de toute espèce, vivant de l’industrie si multiple des théâtres sur la surface de la République, et recevant de ces plaisirs nobles, qui illustrent la France, l’aliment de leur vie et le nécessaire de leurs familles et de leurs enfants. C’est à eux que vous donnerez ces 60,000 fr. (Très bien ! très bien ! marques nombreuses d’approbation.)
Pour moi, je suis forcé de dire : très mal ! très mal ! en restreignant, bien entendu, la portée de ce jugement à l’argument économique dont il est ici question.
Oui, c’est aux ouvriers des théâtres qu’iront, du moins en partie, les 60,000 fr. dont il s’agit. Quelques bribes pourront bien s’égarer en chemin. Même, si on scrutait la chose de près, peut-être découvrirait-on que le gâteau prendra une autre route ; heureux les ouvriers s’il leur reste quelques miettes ! Mais je veux bien admettre que la subvention entière ira aux peintres, décorateurs, costumiers, coiffeurs, etc. C’est ce qu’on voit.
Mais d’où vient-elle ? Voilà le revers de la question, tout aussi important à examiner que la face. Où est la source de ces 60,000 fr. ? Et où iraient-ils, si un vote législatif ne les dirigeait d’abord vers la rue Rivoli et de là vers la rue Grenelle ? C’est ce qu’on ne voit pas.
Assurément nul n’osera soutenir que le vote législatif a fait éclore cette somme dans l’urne du scrutin ; qu’elle est une pure addition faite à la richesse nationale ; que, sans ce vote miraculeux, ces soixante mille francs eussent été à jamais invisibles et impalpables. Il faut bien admettre que tout ce qu’a pu faire la majorité, c’est de décider qu’ils seraient pris quelque part pour être envoyés quelque part, et qu’ils ne recevraient une destination que parce qu’ils seraient détournés d’une autre.
La chose étant ainsi, il est clair que le contribuable qui aura été taxé à un franc, n’aura plus ce franc à sa disposition. Il est clair qu’il sera privé d’une satisfaction dans la mesure d’un franc, et que l’ouvrier, quel qu’il soit, qui la lui aurait procurée, sera privé de salaire dans la même mesure.
Ne nous faisons donc pas cette puérile illusion de croire que le vote du 16 mai ajoute quoi que ce soit au bien-être et au travail national. Il déplace les jouissances, il déplace les salaires, voilà tout.
Dira-t-on qu’à un genre de satisfaction et à un genre de travail, il substitue des satisfactions et des travaux plus urgents, plus moraux, plus raisonnables ? Je pourrais lutter sur ce terrain. Je pourrais dire : En arrachant 60,000 fr. aux contribuables, vous diminuez les salaires des laboureurs, terrassiers, charpentiers, forgerons, et vous augmentez d’autant les salaires des chanteurs, coiffeurs, décorateurs, et costumiers. Rien ne prouve que cette dernière classe soit plus intéressante que l’autre. M. Lamartine ne l’allègue pas. Il dit lui-même que le travail des théâtres est aussi fécond, aussi productif (et non plus) que tout autre, ce qui pourrait encore être contesté ; car la meilleure preuve que le second n’est pas aussi fécond que le premier, c’est que celui-ci est appelé à soudoyer celui-là.
Mais cette comparaison entre la valeur et le mérite intrinsèque des diverses natures de travaux n’entre pas dans mon sujet actuel. Tout ce que j’ai à faire ici, c’est de montrer que si M. Lamartine et les personnes qui ont applaudi à son argumentation ont vu, de l’œil gauche, les salaires gagnés par les fournisseurs des comédiens, ils auraient dû voir, de l’œil droit, les salaires perdus pour les fournisseurs des contribuables ; faute de quoi, ils se sont exposés au ridicule de prendre un déplacement pour un gain. S’ils étaient conséquents à leur doctrine, ils demanderaient des subventions à l’infini ; car ce qui est vrai d’un franc et de 60,000 fr., est vrai, dans des circonstances identiques, d’un milliard de francs.
Quand il s’agit d’impôts, messieurs, prouvez-en l’utilité par des raisons tirées du fond, mais non point par cette malencontreuse assertion : « Les dépenses publiques font vivre la classe ouvrière. » Elle a le tort de dissimuler un fait essentiel, à savoir que les dépenses publiques se substituent toujours à des dépenses privées, et que, par conséquent, elles font bien vivre un ouvrier au lieu d’un autre, mais n’ajoutent rien au lot de la classe ouvrière prise en masse. Votre argumentation est fort de mode, mais elle est trop absurde pour que la raison n’en ait pas raison.
V. Travaux publics↩
Qu’une nation, après s’être assurée qu’une grande entreprise doit profiter à la communauté, la fasse exécuter sur le produit d’une cotisation commune, rien de plus naturel. Mais la patience m’échappe, je l’avoue, quand j’entends alléguer à l’appui d’une telle résolution cette bévue économique : « C’est d’ailleurs le moyen de créer du travail pour les ouvriers. »
L’État ouvre un chemin, bâtit un palais, redresse une rue, perce un canal ; par là, il donne du travail à certains ouvriers, c’est ce qu’on voit ; mais il prive de travail certains autres ouvriers, c’est ce qu’on ne voit pas.
Voilà la route en cours d’exécution. Mille ouvriers arrivent tous les matins, se retirent tous les soirs, emportent leur salaire, cela est certain. Si la route n’eût pas été décrétée, si les fonds n’eussent pas été votés, ces braves gens n’eussent rencontré là, ni ce travail ni ce salaire ; cela est certain encore.
Mais est-ce tout ? L’opération, dans son ensemble, n’embrasse-t-elle pas autre chose ? Au moment où M. Dupin prononce les paroles sacramentelles : « L’Assemblée a adopté », les millions descendent-ils miraculeusement sur un rayon de la lune dans les coffres de MM. Fould et Bineau ? Pour que l’évolution, comme on dit, soit complète, ne faut-il pas que l’État organise la recette aussi bien que la dépense ? qu’il mette ses percepteurs en campagne et ses contribuables à contribution ?
Étudiez donc la question dans ses deux éléments. Tout en constatant la destination que l’État donne aux millions votés, ne négligez pas de constater aussi la destination que les contribuables auraient donnée — et ne peuvent plus donner — à ces mêmes millions. Alors, vous comprendrez qu’une entreprise publique est une médaille à deux revers. Sur l’une figure un ouvrier occupé, avec cette devise : Ce qu’on voit ; sur l’autre, un ouvrier inoccupé, avec cette devise : Ce qu’on ne voit pas.
Le sophisme que je combats dans cet écrit est d’autant plus dangereux, appliqué aux travaux publics, qu’il sert à justifier les entreprises et les prodigalités les plus folles. Quand un chemin de fer ou un pont ont une utilité réelle, il suffit d’invoquer cette utilité. Mais si on ne le peut, que fait-on ? On a recours à cette mystification : « Il faut procurer de l’ouvrage aux ouvriers. »
Cela dit, on ordonne de faire et de défaire les terrasses du Champ de Mars. Le grand Napoléon, on le sait, croyait faire œuvre philanthropique en faisant creuser et combler des fossés. Il disait aussi : Qu’importe le résultat ? Il ne faut voir que la richesse répandue parmi les classes laborieuses.
Allons au fond des choses. L’argent nous fait illusion. Demander le concours, sous forme d’argent, de tous les citoyens à une œuvre commune, c’est en réalité leur demander un concours en nature ; car chacun d’eux se procure, par le travail, la somme à laquelle il est taxé. Or, que l’on réunisse tous les citoyens pour leur faire exécuter, par prestation, une œuvre utile à tous, cela pourrait se comprendre ; leur récompense serait dans les résultats de l’œuvre elle-même. Mais qu’après les avoir convoqués, on les assujettisse à faire des routes où nul ne passera, des palais que nul n’habitera, et cela, sous prétexte de leur procurer du travail : voilà qui serait absurde et ils seraient, certes, fondés à objecter : de ce travail-là nous n’avons que faire ; nous aimons mieux travailler pour notre propre compte.
Le procédé qui consiste à faire concourir les citoyens en argent et non en travail ne change rien à ces résultats généraux. Seulement, par ce dernier procédé, la perte se répartirait sur tout le monde. Par le premier, ceux que l’État occupe échappent à leur part de perte, en l’ajoutant à celle que leurs compatriotes ont déjà à subir.
Il y a un article de la Constitution qui porte :
« La société favorise et encourage le développement du travail ... par l’établissement par l’État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés. »
Comme mesure temporaire, dans un temps de crise, pendant un hiver rigoureux, cette intervention du contribuable peut avoir de bons effets. Elle agit dans le même sens que les assurances. Elle n’ajoute rien au travail ni au salaire, mais elle prend du travail et des salaires sur les temps ordinaires pour en doter, avec perte il est vrai, des époques difficiles.
Comme mesure permanente, générale, systématique, ce n’est autre chose qu’une mystification ruineuse, une impossibilité, une contradiction qui montre un peu de travail stimulé qu’on voit, et cache beaucoup de travail empêché qu’on ne voit pas.
VI. Les intermédiaires↩
La société est l’ensemble des services que les hommes se rendent forcément ou volontairement les uns aux autres, c’est-à-dire des services publics et des services privés.
Les premiers, imposés et réglementés par la loi, qu’il n’est pas toujours aisé de changer quand il le faudrait, peuvent survivre longtemps, avec elle, à leur propre utilité, et conserver encore le nom de services publics, même quand ils ne sont plus des services du tout, même quand ils ne sont plus que de publiques vexations. Les seconds sont du domaine de la volonté, de la responsabilité individuelle. Chacun en rend et en reçoit ce qu’il veut, ce qu’il peut, après débat contradictoire. Ils ont toujours pour eux la présomption d’utilité réelle, exactement mesurée par leur valeur comparative.
C’est pourquoi ceux-là sont si souvent frappés d’immobilisme, tandis que ceux-ci obéissent à la loi du progrès.
Pendant que le développement exagéré des services publics, par la déperdition de forces qu’il entraîne, tend à constituer au sein de la société un funeste parasitisme, il est assez singulier que plusieurs sectes modernes, attribuant ce caractère aux services libres et privés, cherchent à transformer les professions en fonctions.
Ces sectes s’élèvent avec force contre ce qu’elles nomment les intermédiaires. Elles supprimeraient volontiers le capitaliste, le banquier, le spéculateur, l’entrepreneur, le marchand et le négociant, les accusant de s’interposer entre la production et la consommation pour les rançonner toutes deux, sans leur rendre aucune valeur. — Ou plutôt elles voudraient transférer à l’État l’œuvre qu’ils accomplissent, car cette œuvre ne saurait être supprimée.
Le sophisme des socialistes sur ce point consiste à montrer au public ce qu’il paye aux intermédiaires en échange de leurs services, et à lui cacher ce qu’il faudrait payer à l’État. C’est toujours la lutte entre ce qui frappe les yeux et ce qui ne se montre qu’à l’esprit, entre ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas.
Ce fut surtout en 1847 et à l’occasion de la disette que les écoles socialistes cherchèrent et réussirent à populariser leur funeste théorie. Elles savaient bien que la plus absurde propagande a toujours quelques chances auprès des hommes qui souffrent ; malesuada fames.
Donc, à l’aide des grands mots : Exploitation de l’homme par l’homme, spéculation sur la faim, accaparement, elles se mirent à dénigrer le commerce et à jeter un voile sur ses bienfaits.
« Pourquoi, disaient-elles, laisser aux négociants le soin de faire venir des subsistances des États-Unis et de la Crimée ? Pourquoi l’État, les départements, les communes n’organisent-ils pas un service d’approvisionnement et des magasins de réserve ? Ils vendraient au prix de revient, et le peuple, le pauvre peuple serait affranchi du tribut qu’il paye au commerce libre, c’est-à-dire égoïste, individualiste et anarchique. »
Le tribut que le peuple paye au commerce, c’est ce qu’on voit. Le tribut que le peuple payerait à l’État ou à ses agents, dans le système socialiste, c’est ce qu’on ne voit pas.
En quoi consiste ce prétendu tribut que le peuple paye au commerce ? En ceci : que deux hommes se rendent réciproquement service, en toute liberté, sous la pression de la concurrence et à prix débattu.
Quand l’estomac qui a faim est à Paris et que le blé qui peut le satisfaire est à Odessa, la souffrance ne peut cesser que le blé ne se rapproche de l’estomac. Il y a trois moyens pour que ce rapprochement s’opère : 1° Les hommes affamés peuvent aller eux-mêmes chercher le blé ; 2° ils peuvent s’en remettre à ceux qui font ce métier ; 3° ils peuvent se cotiser et charger des fonctionnaires publics de l’opération.
De ces trois moyens, quel est le plus avantageux ?
En tout temps, en tout pays, et d’autant plus qu’ils sont plus libres, plus éclairés, plus expérimentés, les hommes ayant volontairement choisi le second, j’avoue que cela suffit pour mettre, à mes yeux, la présomption de ce côté. Mon esprit se refuse à admettre que l’humanité en masse se trompe sur un point qui la touche de si près [298].
Examinons cependant.
Que trente-six millions de citoyens partent pour aller chercher à Odessa le blé dont ils ont besoin, cela est évidemment inexécutable. Le premier moyen ne vaut rien. Les consommateurs ne peuvent agir par eux-mêmes, force leur est d’avoir recours à des intermédiaires, fonctionnaires ou négociants.
Remarquons cependant que ce premier moyen serait le plus naturel. Au fond, c’est à celui qui a faim d’aller chercher son blé. C’est une peine qui le regarde ; c’est un service qu’il se doit à lui-même. Si un autre, à quelque titre que ce soit, lui rend ce service et prend cette peine pour lui, cet autre a droit à une compensation. Ce que je dis ici, c’est pour constater que les services des intermédiaires portent en eux le principe de la rémunération.
Quoi qu’il en soit, puisqu’il faut recourir à ce que les socialistes nomment un parasite, quel est, du négociant ou du fonctionnaire, le parasite le moins exigeant ?
Le commerce (je le suppose libre, sans quoi comment pourrais-je raisonner ?) le commerce, dis-je, est porté, par intérêt, à étudier les saisons, à constater jour par jour l’état des récoltes, à recevoir des informations de tous les points du globe, à prévoir les besoins, à se précautionner d’avance. Il a des navires tout prêts, des correspondants partout, et son intérêt immédiat est d’acheter au meilleur marché possible, d’économiser sur tous les détails de l’opération, et d’atteindre les plus grands résultats avec les moindres efforts. Ce ne sont pas seulement les négociants français, mais les négociants du monde entier qui s’occupent de l’approvisionnement de la France pour le jour du besoin ; et si l’intérêt les porte invinciblement à remplir leur tâche aux moindres frais, la concurrence qu’ils se font entre eux les porte non moins invinciblement à faire profiter les consommateurs de toutes les économies réalisées. Le blé arrivé, le commerce a intérêt à le vendre au plus tôt pour éteindre ses risques, à réaliser ses fonds et recommencer s’il y a lieu. Dirigé par la comparaison des prix, il distribue les aliments sur toute la surface du pays, en commençant toujours par le point le plus cher, c’est-à-dire où le besoin se fait le plus sentir. Il n’est donc pas possible d’imaginer une organisation mieux calculée dans l’intérêt de ceux qui ont faim, et la beauté de cette organisation, inaperçue des socialistes, résulte précisément de ce qu’elle est libre. — À la vérité, le consommateur est obligé de rembourser au commerce ses frais de transports, de transbordements, de magasinage, de commission, etc. ; mais dans quel système ne faut-il pas que celui qui mange le blé rembourse les frais qu’il faut faire pour qu’il soit à sa portée ? Il y a de plus à payer la rémunération du service rendu ; mais, quant à sa quotité, elle est réduite au minimum possible par la concurrence ; et, quant à sa justice, il serait étrange que les artisans de Paris ne travaillassent pas pour les négociants de Marseille, quand les négociants de Marseille travaillent pour les artisans de Paris.
Que, selon l’invention socialiste, l’État se substitue au commerce, qu’arrivera-t-il ? Je prie qu’on me signale où sera, pour le public, l’économie. Sera-t-elle dans le prix d’achat ? Mais qu’on se figure les délégués de quarante mille communes arrivant à Odessa à un jour donné et au jour du besoin ; qu’on se figure l’effet sur les prix. Sera-t-elle dans les frais ? Mais faudra-t-il moins de navires, moins de marins, moins de transbordements, moins de magasinages, ou sera-t-on dispensé de payer toutes ces choses ? Sera-t-elle dans le profit des négociants ? Mais est-ce que vos délégués fonctionnaires iront pour rien à Odessa ? Est-ce qu’ils voyageront et travailleront sur le principe de la fraternité ? Ne faudra-t-il pas qu’ils vivent ? ne faudra-t-il pas que leur temps soit payé ? Et croyez-vous que cela ne dépassera pas mille fois les deux ou trois pour cent que gagne le négociant, taux auquel il est prêt à souscrire ?
Et puis, songez à la difficulté de lever tant d’impôts, de répartir tant d’aliments. Songez aux injustices, aux abus inséparables d’une telle entreprise. Songez à la responsabilité qui pèserait sur le gouvernement.
Les socialistes qui ont inventé ces folies, et qui, aux jours de malheur, les soufflent dans l’esprit des masses, se décernent libéralement le titre d’hommes avancés, et ce n’est pas sans quelque danger que l’usage, ce tyran des langues, ratifie le mot et le jugement qu’il implique. Avancés ! ceci suppose que ces messieurs ont la vue plus longue que le vulgaire ; que leur seul tort est d’être trop en avant du siècle ; et que si le temps n’est pas encore venu de supprimer certains services libres, prétendus parasites, la faute en est au public qui est en arrière du socialisme. En mon âme et conscience, c’est le contraire qui est vrai, et je ne sais à quel siècle barbare il faudrait remonter pour trouver, sur ce point, le niveau des connaissances socialistes.
Les sectaires modernes opposent sans cesse l’association à la société actuelle. Ils ne prennent pas garde que la société, sous un régime libre, est une association véritable, bien supérieure à toutes celles qui sortent de leur féconde imagination.
Élucidons ceci par un exemple :
Pour qu’un homme puisse, en se levant, revêtir un habit, il faut qu’une terre ait été close, défrichée, desséchée, labourée, ensemencée d’une certaine sorte de végétaux ; il faut que des troupeaux s’en soient nourris, qu’ils aient donné leur laine, que cette laine ait été filée, tissée, teinte et convertie en drap ; que ce drap ait été coupé, cousu, façonné en vêtement. Et cette série d’opérations en implique une foule d’autres ; car elle suppose l’emploi d’instruments aratoires, de bergeries, d’usines, de houille, de machines, de voitures, etc.
Si la société n’était pas une association très réelle, celui qui veut un habit serait réduit à travailler dans l’isolement, c’est-à-dire à accomplir lui-même les actes innombrables de cette série, depuis le premier coup de pioche qui le commence jusqu’au dernier coup d’aiguille qui le termine.
Mais, grâce à la sociabilité qui est le caractère distinctif de notre espèce, ces opérations se sont distribuées entre une multitude de travailleurs, et elles subdivisent de plus en plus pour le bien commun, à mesure que, la consommation devenant plus active, un acte spécial peut alimenter une industrie nouvelle. Vient ensuite la répartition du produit, qui s’opère suivant le contingent de valeur que chacun a apporté à l’œuvre totale. Si ce n’est pas là de l’association, je demande ce que c’est.
Remarquez qu’aucun des travailleurs n’ayant tiré du néant la moindre particule de matière, ils se sont bornés à se rendre des services réciproques, à s’entr’aider dans un but commun, et que tous peuvent être considérés, les uns à l’égard des autres, comme des intermédiaires. Si, par exemple, dans le cours de l’opération, le transport devient assez important pour occuper une personne, le filage une seconde, le tissage une troisième, pourquoi la première serait-elle regardée comme plus parasite que les deux autres ? Ne faut-il pas que le transport se fasse ? Celui qui le fait n’y consacre-t-il pas du temps et de la peine ? n’en épargne-t-il pas à ses associés ? Ceux-ci font-ils plus ou autre chose que lui ? Ne sont-ils pas tous également soumis pour la rémunération, c’est-à-dire pour le partage du produit, à la loi du prix débattu ? N’est-ce pas, en toute liberté, pour le bien commun, que cette séparation de travaux s’opère et que ces arrangements sont pris ? Qu’avons-nous donc besoin qu’un socialiste, sous prétexte d’organisation, vienne despotiquement détruire nos arrangements volontaires, arrêter la division du travail, substituer les efforts isolés aux efforts associés et faire reculer la civilisation ?
L’association, telle que je la décris ici, en est-elle moins association, parce que chacun y entre et sort librement, y choisit sa place, juge et stipule pour lui-même sous sa responsabilité, et y apporte le ressort et la garantie de l’intérêt personnel ? Pour qu’elle mérite ce nom, est-il nécessaire qu’un prétendu réformateur vienne nous imposer sa formule et sa volonté et concentrer, pour ainsi dire, l’humanité en lui-même ?
Plus on examine ces écoles avancées, plus on reste convaincu qu’il n’y a qu’une chose au fond : l’ignorance se proclamant infaillible et réclamant le despotisme au nom de cette infaillibilité.
Que le lecteur veuille bien excuser cette digression. Elle n’est peut-être pas inutile au moment où, échappées des livres saint-simoniens, phalanstériens et icariens, les déclamations contre les Intermédiaires envahissent le journalisme et la tribune, et menacent sérieusement la liberté du travail et des transactions.
VII. Restriction↩
M. Prohibant (ce n’est pas moi qui l’ai nommé, c’est M. Charles Dupin, qui depuis… mais alors…), M. Prohibant consacrait son temps et ses capitaux à convertir en fer le minerai de ses terres. Comme la nature avait été plus prodigue envers les Belges, ils donnaient le fer aux Français à meilleur marché que M. Prohibant, ce qui signifie que tous les Français, ou la France, pouvaient obtenir une quantité donnée de fer avec moins de travail, en l’achetant aux honnêtes Flamands. Aussi, guidés par leur intérêt, ils n’y faisaient faute, et tous les jours on voyait une multitude de cloutiers, forgerons, charrons, mécaniciens, maréchaux-ferrants et laboureurs, aller par eux-mêmes, ou par des intermédiaires, se pourvoir en Belgique. Cela déplut fort à M. Prohibant.
D’abord l’idée lui vint d’arrêter cet abus par ses propres forces. C’était bien le moins, puisque lui seul en souffrait. Je prendrai ma carabine, se dit-il, je mettrai quatre pistolets à ma ceinture, je garnirai ma giberne, je ceindrai ma flamberge, et je me porterai, ainsi équipé, à la frontière. Là, le premier forgeron, cloutier, maréchal, mécanicien ou serrurier qui se présente, pour faire ses affaires et non les miennes, je le tue, pour lui apprendre à vivre.
Au moment de partir, M. Prohibant fit quelques réflexions qui tempérèrent un peu son ardeur belliqueuse. Il se dit : il n’est pas absolument impossible que les acheteur de fer, mes compatriotes et ennemis, ne prennent mal la chose, et qu’au lieu de se laisser tuer, ils ne me tuent moi-même. Ensuite, même en faisant marcher tous mes domestiques, nous ne pourrons garder tous les passages. Enfin le procédé me coûtera fort cher, plus cher que ne vaut le résultat.
M. Prohibant allait tristement se résigner à n’être que libre comme tout le monde, quand un trait de lumière vint illuminer son cerveau.
Il se rappela qu’il y a à Paris une grande fabrique de lois. Qu’est-ce qu’une loi ? se dit-il. C’est une mesure à laquelle, une fois décrétée, bonne ou mauvaise, chacun est tenu de se conformer. Pour l’exécution d’icelle, on organise une force publique, et, pour constituer ladite force publique, on puise dans la nation des hommes et de l’argent.
Si donc j’obtenais qu’il sortît de la grande fabrique parisienne une toute petite loi portant : « Le fer belge est prohibé, » j’atteindrais les résultats suivants : le gouvernement ferait remplacer les quelques valets que je voulais envoyer à la frontière par vingt mille fils de mes forgerons, serruriers, cloutiers, maréchaux, artisans, mécaniciens et laboureurs récalcitrants. Puis, pour tenir en bonne disposition de joie et de santé ces vingt mille douaniers, il leur distribuerait vingt-cinq millions de francs pris à ces mêmes forgerons, cloutiers, artisans et laboureurs. La garde en serait mieux faite ; elle ne me coûterait rien, je ne serais pas exposé à la brutalité des brocanteurs, je vendrais le fer à mon prix, et je jouirais de la douce récréation de voir notre grand peuple honteusement mystifié. Cela lui apprendrait à se proclamer sans cesse le précurseur et le promoteur de tout progrès en Europe. Oh ! le trait serait piquant et vaut la peine d’être tenté.
Donc, M. Prohibant se rendit à la fabrique de lois. — Une autre fois peut-être je raconterai l’histoire de ses sourdes menées ; aujourd’hui je ne veux parler que de ses démarches ostensibles. — Il fit valoir auprès de MM. les législateurs cette considération :
« Le fer belge se vend en France à dix francs, ce qui me force de vendre le mien au même prix. J’aimerais mieux le vendre à quinze et ne le puis, à cause de ce fer belge, que Dieu maudisse. Fabriquez une loi qui dise : — Le fer belge n’entrera plus en France. — Aussitôt j’élève mon prix de cinq francs, et voici les conséquences : »
« Pour chaque quintal de fer que je livrerai au public, au lieu de recevoir dix francs, j’en toucherai quinze, je m’enrichirai plus vite, je donnerai plus d’étendue à mon exploitation, j’occuperai plus d’ouvriers. Mes ouvriers et moi ferons plus de dépense, au grand avantage de nos fournisseurs à plusieurs lieues à la ronde. Ceux-ci, ayant plus de débouchés, feront plus de commandes à l’industrie et, de proche en proche, l’activité gagnera tout le pays. Cette bienheureuse pièce de cent sous, que vous ferez tomber dans mon coffre-fort, comme une pierre qu’on jette dans un lac, fera rayonner au loin un nombre infini de cercles concentriques. »
Charmés de ce discours, enchantés d’apprendre qu’il est si aisé d’augmenter législativement la fortune d’un peuple, les fabricants de lois votèrent la Restriction. Que parle-t-on de travail et d’économie ? disaient-ils. À quoi bon ces pénibles moyens d’augmenter la richesse nationale, puisqu’un Décret y suffit ?
Et en effet, la loi eut toutes les conséquences annoncées par M. Prohibant ; seulement elle en eut d’autres aussi, car, rendons-lui justice, il n’avait pas fait un raisonnement faux, mais un raisonnement incomplet. En réclamant un privilége, il avait signalé les effets qu’on voit, laissant dans l’ombre ceux qu’on ne voit pas. Il n’avait montré que deux personnages, quand il y en a trois en scène. C’est à nous de réparer cette oubli involontaire ou prémédité.
Oui, l’écu détourné ainsi législativement vers le coffre-fort de M. Prohibant, constitue un avantage pour lui et pour ceux dont il doit encourager le travail. — Et si le décret avait fait descendre cet écu de la lune, ces bons effets ne seraient contrebalancés par aucuns mauvais effets compensateurs. Malheureusement, ce n’est pas de la lune que sort la mystérieuse pièce de cent sous, mais bien de la poche d’un forgeron, cloutier, charron, maréchal, laboureur, constructeur, en un mot, de Jacques Bonhomme, qui la donne aujourd’hui, sans recevoir un milligramme de fer de plus que du temps où il le payait dix francs. Au premier coup d’œil, on doit bien s’apercevoir que ceci change bien la question, car, bien évidemment, le Profit de M. Prohibant est compensé par la Perte de Jacques Bonhomme, et tout ce que M. Prohibant pourra faire de cet écu pour l’encouragement du travail national, Jacques Bonhomme l’eût fait de même. La pierre n’est jetée sur un point du lac que parce qu’elle a été législativement empêchée d’être jetée sur un autre.
Donc, ce qu’on ne voit pas compense ce qu’on voit, et jusqu’ici il reste, pour résidu de l’opération, une injustice, et, chose déplorable ! une injustice perpétrée par la loi.
Ce n’est pas tout. J’ai dit qu’on laissait toujours dans l’ombre un troisième personnage. Il faut que je le fasse ici paraître afin qu’il nous révèle une seconde perte de cinq francs. Alors nous aurons le résultat de l’évolution tout entière.
Jacques Bonhomme est possesseur de 15 fr., fruit de ses sueurs. Nous sommes encore au temps où il est libre. Que fait-il de ses 15 fr. ? Il achète un article de mode pour 10 fr., et c’est avec cet article de mode qu’il paye (ou que l’Intermédiaire paye pour lui) le quintal de fer belge. Il reste encore à Jacques Bonhomme 5 fr. Il ne les jette pas dans la rivière, mais (et c’est ce qu’on ne voit pas) il les donne à un industriel quelconque en échange d’une jouissance quelconque, par exemple à un libraire contre le discours sur l’Histoire universelle de Bossuet.
Ainsi, en ce qui concerne le travail national, il est encouragé dans la mesure de 15 fr., savoir :
10 fr. qui vont à l’article Paris ;
5 fr. qui vont à la librairie.
Et quant à Jacques Bonhomme, il obtient pour ses 15 fr., deux objets de satisfaction, savoir :
1° Un quintal de fer ;
2° Un livre.
Survient le décret.
Que devient la condition de Jacques Bonhomme ? Que devient celle du travail national ?
Jacques Bonhomme livrant ses 15 fr. jusqu’au dernier centime à M. Prohibant, contre un quintal de fer, n’a plus que la jouissance de ce quintal de fer. Il perd la jouissance d’un livre ou de tout autre objet équivalent. Il perd 5 francs. On en convient ; on ne peut pas ne pas en convenir ; on ne peut pas ne pas convenir que, lorsque la restriction hausse le prix des choses, le consommateur perd la différence.
Mais, dit-on, le travail national la gagne.
Non, il ne la gagne pas ; car, depuis le décret, il n’est encouragé que comme il l’était avant, dans la mesure de 15 fr.
Seulement, depuis le décret, les 15 fr. de Jacques Bonhomme vont à la métallurgie, tandis qu’avant le décret ils se partageaient entre l’article de modes et la librairie.
La violence qu’exerce par lui-même M. Prohibant à la frontière ou celle qu’il y fait exercer par la loi peuvent être jugées fort différemment, au point de vue moral. Il y a des gens qui pensent que la spoliation perd toute son immoralité pourvu qu’elle soit légale. Quant à moi, je ne saurais imaginer une circonstance plus aggravante. Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, c’est que les résultats économiques sont les mêmes.
Tenez la chose comme vous voudrez, mais ayez l’œil sagace et vous verrez qu’il ne sort rien de bon de la spoliation légale et illégale. Nous ne nions pas qu’il n’en sorte pour M. Prohibant ou son industrie, ou si l’on veut pour le travail national, un profit de 5 fr. Mais nous affirmons qu’il en sort aussi deux pertes, l’une pour Jacques Bonhomme qui paye 15 fr. ce qu’il avait pour 10 ; l’autre pour le travail national qui ne reçoit plus la différence. Choisissez celle de ces deux pertes avec laquelle il vous plaise de compenser le profit que nous avouons. L’autre n’en constituera pas moins une perte sèche.
Moralité : Violenter n’est pas produire, c’est détruire. Oh ! si violenter c’était produire, notre France serait plus riche qu’elle n’est.
VIII. Les machines↩
« Malédiction sur les machines ! chaque année leur puissance progressive voue au Paupérisme des millions d’ouvriers en leur enlevant le travail, avec le travail le salaire, avec le salaire le Pain ! Malédiction sur les machines ! »
Voilà le cri qui s’élève du Préjugé vulgaire et dont l’écho retentit dans les journaux.
Mais maudire les machines, c’est maudire l’esprit humain !
Ce qui me confond, c’est qu’il puisse se rencontrer un homme qui se sente à l’aise dans une telle doctrine [299].
Car enfin, si elle est vraie, quelle en est la conséquence rigoureuse ? C’est qu’il n’y a d’activité, de bien-être, de richesses, de bonheur possibles que pour les peuples stupides, frappés d’immobilisme mental, à qui Dieu n’a pas fait le don funeste de penser, d’observer, de combiner, d’inventer, d’obtenir de plus grands résultats avec de moindres moyens. Au contraire, les haillons, les huttes ignobles, la pauvreté, l’inanition sont l’inévitable partage de toute nation qui cherche et trouve dans le fer, le feu, le vent, l’électricité, le magnétisme, les lois de la chimie et de la mécanique, en un mot dans les forces de la nature, un supplément à ses propres forces, et c’est bien le cas de dire avec Rousseau : « Tout homme qui pense est un animal dépravé. »
Ce n’est pas tout : si cette doctrine est vraie, comme tous les hommes pensent et inventent, comme tous, en fait, depuis le premier jusqu’au dernier, et à chaque minute de leur existence, cherchent à faire coopérer les forces naturelles, à faire plus avec moins, à réduire ou leur main-d’œuvre ou celle qu’ils payent, à atteindre la plus grande somme possible de satisfactions avec la moindre somme possible de travail, il faut bien en conclure que l’humanité tout entière est entraînée vers sa décadence, précisément par cette aspiration intelligente vers le progrès qui tourmente chacun de ses membres.
Dès lors il doit être constaté, par la statistique, que les habitants du Lancastre, fuyant cette patrie des machines, vont chercher du travail en Irlande, où elles sont inconnues, et, par l’histoire, que la barbarie assombrit les époques de civilisation, et que la civilisation brille dans les temps d’ignorance et de barbarie.
Évidemment, il y a, dans cet amas de contradictions, quelque chose qui choque et nous avertit que le problème cache un élément de solution qui n’a pas été suffisamment dégagé.
Voici tout le mystère : derrière ce qu’on voit gît ce qu’on ne voit pas. Je vais essayer de le mettre en lumière. Ma démonstration ne pourra être qu’une répétition de la précédente, car il s’agit d’un problème identique.
C’est un penchant naturel aux hommes, d’aller, s’ils n’en sont empêchés par la violence, vers le bon marché, — c’est-à-dire vers ce qui, à satisfaction égale, leur épargne du travail, — que ce bon marché leur vienne d’un habile Producteur étranger ou d’un habile Producteur mécanique.
L’objection théorique qu’on adresse à ce penchant est la même dans les deux cas. Dans l’un comme dans l’autre, on lui reproche le travail qu’en apparence il frappe d’inertie. Or, du travail rendu non inerte, mais disponible, c’est précisément ce qui le détermine.
Et c’est pourquoi on lui oppose aussi, dans les deux cas, le même obstacle pratique, la violence. Le législateur prohibe la concurrence étrangère et interdit la concurrence mécanique. — Car quel autre moyen peut-il exister d’arrêter un penchant naturel à tous les hommes que de leur ôter la liberté ?
Dans beaucoup de pays, il est vrai, le législateur ne frappe qu’une des deux concurrences et se borne à gémir sur l’autre. Cela ne prouve qu’une chose, c’est que, dans ce pays, le législateur est inconséquent.
Cela ne doit pas nous surprendre. Dans une fausse voie, on est toujours inconséquent, sans quoi on tuerait l’humanité. Jamais on n’a vu ni on ne verra un principe faux poussé jusqu’au bout. J’ai dit ailleurs : l’inconséquence est la limite de l’absurdité. J’aurais pu ajouter : elle en est en même temps la preuve.
Venons à notre démonstration ; elle ne sera pas longue.
Jacques Bonhomme avait deux francs qu’il faisait gagner à deux ouvriers.
Mais voici qu’il imagine un arrangement de cordes et de poids qui abrège le travail de moitié.
Donc il obtient la même satisfaction, épargne un franc et congédie un ouvrier.
Il congédie un ouvrier ; c’est ce qu’on voit.
Et, ne voyant que cela, on dit : « Voilà comment la misère suit la civilisation, voilà comment la liberté est fatale à l’égalité. L’esprit humain a fait une conquête, et aussitôt un ouvrier est à jamais tombé dans le gouffre du paupérisme. Il se peut cependant que Jacques Bonhomme continue à faire travailler les deux ouvriers, mais il ne leur donnera plus que dix sous à chacun, car ils se feront concurrence entre eux et s’offriront au rabais. C’est ainsi que les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Il faut refaire la société. »
Belle conclusion, et digne de l’exorde !
Heureusement, exorde et conclusion, tout cela est faux, parce que, derrière la moitié du phénomène qu’on voit, il y a l’autre moitié qu’on ne voit pas.
On ne voit pas le franc épargné par Jacques Bonhomme et les effets nécessaires de cette épargne.
Puisque, par suite de son invention, Jacques Bonhomme ne dépense plus qu’un franc en main-d’œuvre, à la poursuite d’une satisfaction déterminée, il lui reste un autre franc.
Si donc il y a dans le monde un ouvrier qui offre ses bras inoccupés, il y a aussi dans le monde un capitaliste qui offre son franc inoccupé. Ces deux éléments se rencontrent et se combinent.
Et il est clair comme le jour qu’entre l’offre et la demande du travail, entre l’offre et la demande du salaire, le rapport n’est nullement changé.
L’invention et un ouvrier, payé avec le premier franc, font maintenant l’œuvre qu’accomplissaient auparavant deux ouvriers.
Le second ouvrier, payé avec le second franc, réalise une œuvre nouvelle.
Qu’y a-t-il donc de changé dans le monde ? Il y a une satisfaction nationale de plus, en d’autres termes, l’invention est une conquête gratuite, un profit gratuit pour l’humanité.
De la forme que j’ai donnée à ma démonstration, on pourra tirer cette conséquence :
« C’est le capitaliste qui recueille tout le fruit des machines. La classe salariée, si elle n’en souffre que momentanément, n’en profite jamais, puisque, d’après vous-même, elles déplacent une portion du travail national sans le diminuer, il est vrai, mais aussi sans l’augmenter. »
Il n’entre pas dans le plan de cet opuscule de résoudre toutes les objections. Son seul but est de combattre un préjugé vulgaire, très dangereux et très répandu. Je voulais prouver qu’une machine nouvelle ne met en disponibilité un certain nombre de bras qu’en mettant aussi, et forcément, en disponibilité la rémunération qui les salarie. Ces bras et cette rémunération se combinent pour produire ce qu’il était impossible de produire avant l’invention ; d’où il suit qu’elle donne pour résultat définitif un accroissement de satisfaction, à travail égal.
Qui recueille cet excédant de satisfactions ?
Oui, c’est d’abord le capitaliste, l’inventeur, le premier qui se sert avec succès de la machine, et c’est là la récompense de son génie et de son audace. Dans ce cas, ainsi que nous venons de le voir, il réalise sur les frais de production une économie, laquelle, de quelque manière qu’elle soit dépensée (et elle l’est toujours), occupe juste autant de bras que la machine en a fait renvoyer.
Mais bientôt la concurrence le force à baisser son prix de vente dans la mesure de cette économie elle-même.
Et alors ce n’est plus l’inventeur qui recueille le bénéfice de l’invention ; c’est l’acheteur du produit, le consommateur, le public, y compris les ouvriers, en un mot, c’est l’humanité.
Et ce qu’on ne voit pas, c’est que l’Épargne, ainsi procurée à tous les consommateurs, forme un fonds où le salaire puise un aliment, qui remplace celui que la machine a tari.
Ainsi, en reprenant l’exemple ci-dessus, Jacques Bonhomme obtient un produit en dépensant deux francs en salaires.
Grâce à son invention, la main-d’œuvre ne lui coûte plus qu’un franc.
Tant qu’il vend le produit au même prix, il y a un ouvrier de moins occupé à faire ce produit spécial, c’est ce qu’on voit ; mais il y a un ouvrier de plus occupé par le franc que Jacques Bonhomme a épargné : c’est ce qu’on ne voit pas.
Lorsque, par la marche naturelle des choses, Jacques Bonhomme est réduit à baisser d’un franc le prix du produit, alors il ne réalise plus une épargne ; alors il ne dispose plus d’un franc pour commander au travail national une production nouvelle. Mais, à cet égard, son acquéreur est mis à sa place, et cet acquéreur, c’est l’humanité. Quiconque achète le produit le paye un franc de moins, épargne un franc, et tient nécessairement cette épargne au service du fonds des salaires : c’est encore ce qu’on ne voit pas.
On a donné, de ce problème des machines, une autre solution, fondée sur les faits.
On a dit : La machine réduit les frais de production, et fait baisser le prix du produit. La baisse du produit provoque un accroissement de consommation, laquelle nécessite un accroissement de production, et, en définitive, l’intervention d’autant d’ouvriers ou plus, après l’invention, qu’il en fallait avant. On cite, à l’appui, l’imprimerie, la filature, la presse, etc.
Cette démonstration n’est pas scientifique.
Il faudrait en conclure que, si la consommation du produit spécial dont il s’agit reste stationnaire ou à peu près, la machine nuirait au travail. — Ce qui n’est pas.
Supposons que dans un pays tous les hommes portent des chapeaux. Si, par une machine, on parvient à en réduire le prix de moitié, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’on en consommera le double.
Dira-t-on, dans ce cas, qu’une portion du travail national a été frappée d’inertie ? Oui, d’après la démonstration vulgaire. Non, selon la mienne ; car, alors que dans ce pays on n’achèterait pas un seul chapeau de plus, le fonds entier des salaires n’en demeurerait pas moins sauf ; ce qui irait de moins à l’industrie chapelière se retrouverait dans l’Économie réalisée par tous les consommateurs, et irait de là salarier tout le travail que la machine a rendu inutile, et provoquer un développement nouveau de toutes les industries.
Et c’est ainsi que les choses se passent. J’ai vu les journaux à 80 fr., ils sont maintenant à 48. C’est une économie de 32 fr. pour les abonnés. Il n’est pas certain ; il n’est pas, du moins, nécessaire que les 32 fr. continuent à prendre la direction de l’industrie du journaliste ; mais ce qui est certain, ce qui est nécessaire, c’est que, s’ils ne prennent cette direction, ils en prennent une autre. L’un s’en sert pour recevoir plus de journaux, l’autre pour se mieux nourrir, un troisième pour se mieux vêtir, un quatrième pour se mieux meubler.
Ainsi les industries sont solidaires. Elles forment un vaste ensemble dont toutes les parties communiquent par des canaux secrets. Ce qui est économisé sur l’une profite à toutes. Ce qui importe, c’est de bien comprendre que jamais, au grand jamais, les économies n’ont lieu aux dépens du travail et des salaires [300].
IX. Crédit↩
De tous les temps, mais surtout dans les dernières années, on a songé à universaliser la richesse en universalisant le crédit.
Je ne crois pas exagérer en disant que, depuis la révolution de Février, les presses parisiennes ont vomi plus de dix mille brochures préconisant cette solution du Problème social.
Cette solution, hélas ! a pour base une pure illusion d’optique, si tant est qu’une illusion soit une base.
On commence par confondre le numéraire avec les produits, puis on confond le papier-monnaie avec le numéraire, et c’est de ces deux confusions qu’on prétend dégager une réalité.
Il faut absolument, dans cette question, oublier l’argent, la monnaie, les billets et les autres instruments au moyen desquels les produits passent de main en main, pour ne voir que les produits eux-mêmes, qui sont la véritable matière du prêt.
Car quand un laboureur emprunte cinquante francs pour acheter une charrue, ce n’est pas en réalité cinquante francs qu’on lui prête, c’est la charrue.
Et quand un marchand emprunte vingt mille francs pour acheter une maison, ce n’est pas vingt mille francs qu’il doit, c’est la maison.
L’argent n’apparaît là que pour faciliter l’arrangement entre plusieurs parties.
Pierre peut n’être pas disposé à prêter sa charrue, et Jacques peut l’être à prêter son argent. Que fait alors Guillaume ? Il emprunte l’argent de Jacques et, avec cet argent, il achète la charrue de Pierre.
Mais, en fait, nul n’emprunte de l’argent pour l’argent lui-même. On emprunte l’argent pour arriver aux produits.
Or, dans aucun pays, il ne peut se transmettre d’une main à l’autre plus de produits qu’il n’y en a.
Quelle que soit la somme de numéraire et de papier qui circule, l’ensemble des emprunteurs ne peut recevoir plus de charrues, de maisons, d’outils, d’approvisionnements, de matières premières, que l’ensemble des prêteurs n’en peut fournir.
Car mettons-nous bien dans la tête que tout emprunteur suppose un prêteur, et que tout emprunt implique un prêt.
Cela posé, quel bien peuvent faire les institutions de crédit ? c’est de faciliter, entre les emprunteurs et les prêteurs, le moyen de se trouver et de s’entendre. Mais, ce qu’elles ne peuvent faire, c’est d’augmenter instantanément la masse des objets empruntés et prêtés.
Il le faudrait cependant pour que le but des Réformateurs fût atteint, puisqu’ils n’aspirent à rien moins qu’à mettre des charrues, des maisons, des outils, des approvisionnements, des matières premières entre les mains de tous ceux qui en désirent.
Et pour cela qu’imaginent-ils ?
Donner au prêt la garantie de l’État.
Approfondissons la matière, car il y a là quelque chose qu’on voit et quelque chose qu’on ne voit pas. Tâchons de voir les deux choses.
Supposons qu’il n’y ait qu’une charrue dans le monde et que deux laboureurs y prétendent.
Pierre est possesseur de la seule charrue qui soit disponible en France. Jean et Jacques désirent l’emprunter. Jean, par sa probité, par ses propriétés, par sa bonne renommée offre des garanties. On croit en lui ; il a du crédit. Jacques n’inspire pas de confiance ou en inspire moins. Naturellement il arrive que Pierre prête sa charrue à Jean.
Mais voici que, sous l’inspiration socialiste, l’État intervient et dit à Pierre : Prêtez votre charrue à Jacques, je vous garantis le remboursement, et cette garantie vaut mieux que celle de Jean, car il n’a que lui pour répondre de lui-même, et moi, je n’ai rien, il est vrai, mais je dispose de la fortune de tous les contribuables ; c’est avec leurs deniers qu’au besoin je vous payerai le principal et l’intérêt.
En conséquence, Pierre prête sa charrue à Jacques : c’est ce qu’on voit.
Et les socialistes se frottent les mains, disant : Voyez comme notre plan a réussi. Grâce à l’intervention de l’État, le pauvre Jacques a une charrue. Il ne sera plus obligé à bêcher la terre ; le voilà sur la route de la fortune. C’est un bien pour lui et un profit pour la nation prise en masse.
Eh non ! messieurs, ce n’est pas un profit pour la nation, car voici ce qu’on ne voit pas.
On ne voit pas que la charrue n’a été à Jacques que parce qu’elle n’a pas été à Jean.
On ne voit pas que, si Jacques laboure au lieu de bêcher, Jean sera réduit à bêcher au lieu de labourer.
Que, par conséquent, ce qu’on considérait comme un accroissement de prêt n’est qu’un déplacement de prêt.
En outre, on ne voit pas que ce déplacement implique deux profondes injustices.
Injustice envers Jean qui, après avoir mérité et conquis le crédit par sa probité et son activité, s’en voit dépouillé.
Injustice envers les contribuables, exposés à payer une dette qui ne les regarde pas.
Dira-t-on que le gouvernement offre à Jean les mêmes facilités qu’à Jacques ? Mais puisqu’il n’y a qu’une charrue disponible, deux ne peuvent être prêtées. L’argument revient toujours à dire que, grâce à l’intervention de l’État, il se fera plus d’emprunts qu’il ne peut se faire de prêts, car la charrue représente ici la masse des capitaux disponibles.
J’ai réduit, il est vrai, l’opération à son expression la plus simple ; mais, éprouvez à la même pierre de touche les institutions gouvernementales de crédit les plus compliquées, vous vous convaincrez qu’elles ne peuvent avoir que ce résultat : déplacer le crédit, non l’accroître. Dans un pays et dans un temps donné, il n’y a qu’une certaine somme de capitaux en disponibilité et tous se placent. En garantissant des insolvables, l’État peut bien augmenter le nombre des emprunteurs, faire hausser ainsi le taux de l’intérêt (toujours au préjudice du contribuable), mais, ce qu’il ne peut faire, c’est augmenter le nombre des prêteurs et l’importance du total des prêts.
Qu’on ne m’impute point, cependant, une conclusion dont Dieu me préserve. Je dis que la Loi ne doit point favoriser artificiellement les emprunts ; mais je ne dis pas qu’elle doive artificiellement les entraver. S’il se trouve, dans notre régime hypothécaire ou ailleurs, des obstacles à la diffusion et à l’application du crédit, qu’on les fasse disparaître ; rien de mieux, rien de plus juste. Mais c’est là, avec la liberté, tout ce que doivent demander à la Loi des Réformateurs dignes de ce nom [301]
X. L’Algérie↩
Mais voici quatre orateurs qui se disputent la tribune. Ils parlent d’abord tous à la fois, puis l’un après l’autre. Qu’ont-ils dit ? de fort belles choses assurément sur la puissance et la grandeur de la France, sur la nécessité de semer pour récolter, sur le brillant avenir de notre gigantesque colonie, sur l’avantage de déverser au loin le trop-plein de notre population etc., etc. ; magnifiques pièces d’éloquence, toujours ornées de cette péroraison :
« Votez cinquante millions (plus ou moins) pour faire en Algérie des ports et des routes, pour y transporter des colons, leur bâtir des maisons, leur défricher des champs. Par là vous aurez soulagé le travailleur français, encouragé le travail africain, et fait fructifier le commerce marseillais. C’est tout profit. »
Oui, cela est vrai, si l’on ne considère lesdits cinquante millions qu’à partir du moment où l’État les dépense ; si l’on regarde où ils vont, non d’où ils viennent ; si l’on tient compte seulement du bien qu’ils feront en sortant du coffre des percepteurs et non du mal qu’on a produit, non plus que du bien qu’on a empêché, en les y faisant entrer ; oui, à ce point de vue borné, tout est profit. La maison bâtie en Barbarie, c’est ce qu’on voit ; le port creusé en Barbarie, c’est ce qu’on voit ; le travail provoqué en Barbarie, c’est ce qu’on voit ; quelques bras de moins en France, c’est ce qu’on voit ; un grand mouvement de marchandises à Marseille, c’est toujours ce qu’on voit.
Mais il y a autre chose qu’on ne voit pas. C’est que les cinquante millions dépensés par l’État ne peuvent plus l’être, comme ils l’auraient été, par le contribuable. De tout le bien attribué à la dépense publique exécutée, il faut donc déduire tout le mal de la dépense privée empêchée ; — à moins qu’on n’aille jusqu’à dire que Jacques Bonhomme n’aurait rien fait des pièces de cent sous qu’il avait bien gagnée et que l’impôt lui ravit ; assertion absurde, car s’il s’est donné la peine de les gagner, c’est qu’il espérait avoir la satisfaction de s’en servir. Il aurait fait relever la clôture de son jardin et ne le peut plus, c’est ce qu’on ne voit pas. Il aurait fait marner son champ et ne le peut plus, c’est ce qu’on ne voit pas. Il aurait ajouté un étage à sa chaumière et ne le peut plus, c’est ce qu’on ne voit pas. Il aurait augmenté son outillage et ne le peut plus, c’est ce qu’on ne voit pas. Il se serait mieux nourri, mieux vêtu, il aurait mieux fait instruire ses fils, il aurait arrondi la dot de sa fille et ne le peut plus, c’est ce qu’on ne voit pas. Il se serait mis dans l’association des secours mutuels et ne le peut plus, c’est ce qu’on ne voit pas. D’une part, les jouissances qui lui sont ôtées, et les moyens d’action qu’on a détruits dans ses mains, de l’autre, le travail du terrassier, du charpentier, du forgeron, du tailleur, du maître d’école de son village, qu’il eût encouragé et qui se trouve anéanti, c’est toujours ce qu’on ne voit pas.
On compte beaucoup sur la prospérité future de l’Algérie ; soit. Mais qu’on compte aussi pour quelque chose le marasme dont, en attendant, on frappe inévitablement la France. On me montre le commerce marseillais ; mais s’il se fait avec le produit de l’impôt, je montrerai toujours un commerce égal anéanti dans le reste du pays. On dit : « Voilà un colon transporté en Barbarie ; c’est un soulagement pour la population qui reste dans le pays. » Je réponds : Comment cela se peut-il, si en transportant ce colon à Alger, on y a transporté aussi deux ou trois fois le capital qui l’aurait fait vivre en France [302] ?
Le seul but que j’ai en vue, c’est de faire comprendre au lecteur que, dans toute dépense publique, derrière le bien apparent, il y a un mal plus difficile à discerner. Autant qu’il est en moi, je voudrais lui faire prendre l’habitude de voir l’un et l’autre et de tenir compte de tous deux.
Quand une dépense publique est proposée, il faut l’examiner en elle-même, abstraction faite du prétendu encouragement qui en résulte pour le travail, car cet encouragement est une chimère. Ce que fait à cet égard la dépense publique, la dépense privée l’eût fait de même. Donc l’intérêt du travail est toujours hors de cause.
Il n’entre pas dans l’objet de cet écrit d’apprécier le mérite intrinsèque des dépenses publiques appliquées à l’Algérie.
Mais je ne puis retenir une observation générale. C’est que la présomption est toujours défavorable aux dépenses collectives par voie d’impôt. Pourquoi ? Le voici :
D’abord la justice en souffre toujours quelque peu. Puisque Jacques Bonhomme avait sué pour gagner sa pièce de cent sous, en vue d’une satisfaction, il est au moins fâcheux que le fisc intervienne pour enlever à Jacques Bonhomme cette satisfaction et la conférer à un autre. Certes, c’est alors au fisc ou à ceux qui le font agir à donner de bonnes raisons. Nous avons vu que l’État en donne une détestable quand il dit : avec ces cent sous, je ferai travailler des ouvriers, car Jacques Bonhomme (sitôt qu’il n’aura plus la cataracte) ne manquera pas de répondre : « Morbleu ! avec ces cent sous, je les ferai bien travailler moi-même. »
Cette raison mise de côté, les autres se présentent dans toute leur nudité, et le débat entre le fisc et le pauvre Jacques s’en trouve fort simplifié. Que l’État lui dise : Je te prends cent sous pour payer le gendarme qui te dispense de veiller à ta propre sûreté ; — pour paver la rue que tu traverses tous les jours ; — pour indemniser le magistrat qui fait respecter ta propriété et la liberté ; — pour nourrir le soldat qui défend nos frontières, Jacques Bonhomme paiera sans mot dire ou je me trompe fort. Mais si l’État lui dit : Je te prends ces cent sous pour te donner un sou de prime, dans le cas où tu auras bien cultivé ton champ ; — ou pour faire apprendre à ton fils ce que tu ne veux pas qu’il apprenne ; — ou pour que M. le ministre ajoute un cent unième plat à son dîner ; — je te les prends pour bâtir une chaumière en Algérie, sauf à te prendre cent sous de plus tous les ans pour y entretenir un colon ; et autres cent sous pour entretenir un général qui garde le soldat, etc., etc., il me semble entendre le pauvre Jacques s’écrier : « Ce régime légal ressemble fort au régime de la forêt de Bondy ! » Et comme l’État prévoit l’objection, que fait-il ? Il brouille toutes choses ; il fait apparaître justement cette raison détestable qui devrait être sans influence sur la question ; il parle de l’effet des cent sous sur le travail ; il montre le cuisinier et le fournisseur du ministre ; il montre un colon, un soldat, un général, vivant sur les cinq francs ; il montre enfin ce qu’on voit, et tant que Jacques Bonhomme n’aura pas appris à mettre en regard ce qu’on ne voit pas, Jacques Bonhomme sera dupe. C’est pourquoi je m’efforce de le lui enseigner à grands coups de répétitions.
De ce que les dépenses publiques déplacent le travail sans l’accroître, il en résulte contre elles une seconde et grave présomption. Déplacer le travail, c’est déplacer les travailleurs, c’est troubler les lois naturelles qui président à la distribution de la population sur le territoire. Quand 50 millions sont laissés au contribuable, comme le contribuable est partout, ils alimentent du travail dans les quarante mille communes de France ; ils agissent dans le sens d’un lien qui retient chacun sur sa terre natale ; ils se répartissent sur tous les travailleurs possibles et sur toutes les industries imaginables. Que si l’État, soutirant ces 50 millions aux citoyens, les accumule et les dépense sur un point donné, il attire sur ce point une quantité proportionnelle de travail déplacé, un nombre correspondant de travailleurs dépaysés, population flottante, déclassée, et j’ose dire dangereuse quand le fonds est épuisé ! — Mais il arrive ceci (et je rentre par là dans mon sujet) : cette activité fiévreuse, et pour ainsi dire soufflée sur un étroit espace, frappe tous les regards, c’est ce qu’on voit ; le peuple applaudit, s’émerveille sur la beauté et la facilité du procédé, en réclame le renouvellement et l’extension. Ce qu’il ne voit pas, c’est qu’une quantité égale de travail, probablement plus judicieux, a été frappée d’inertie dans tout le reste de la France.
XI. Épargne et Luxe↩
Ce n’est pas seulement en matière de dépenses publiques que ce qu’on voit éclipse ce qu’on ne voit pas. En laissant dans l’ombre la moitié de l’économie politique, ce phénomène induit à une fausse morale. Il porte les nations à considérer comme antagoniques leurs intérêts moraux et leurs intérêts matériels. Quoi de plus décourageant et de plus triste ! Voyez :
Il n’y a pas de père de famille qui ne se fasse un devoir d’enseigner à ses enfants l’ordre, l’arrangement, l’esprit de conservation, l’économie, la modération dans les dépenses.
Il n’y a pas de religion qui ne tonne contre le faste et le luxe. C’est fort bien ; mais, d’un autre côté, quoi de plus populaire que ces sentences :
« Thésauriser, c’est dessécher les veines du peuple. »
« Le luxe des grands fait l’aisance des petits. »
« Les prodigues se ruinent, mais ils enrichissent l’État. »
« C’est sur le superflu du riche que germe le pain du pauvre. »
Voilà, certes, entre l’idée morale et l’idée sociale, une flagrante contradiction. Que d’esprits éminents, après avoir constaté le conflit, reposent en paix ! C’est ce que je n’ai jamais pu comprendre ; car il me semble qu’on ne peut rien éprouver de plus douloureux que d’apercevoir deux tendances opposées dans l’humanité. Quoi ! elle arrive à la dégradation par l’une comme par l’autre extrémité ! économe, elle tombe dans la misère ; prodigue, elle s’abîme dans la déchéance morale !
Heureusement que les maximes vulgaires montrent sous un faux jour l’Épargne et le Luxe, ne tenant compte que de ces conséquences immédiates qu’on voit, et non des effets ultérieurs qu’on ne voit pas. Essayons de rectifier cette vue incomplète.
Mondor et son frère Ariste, ayant partagé l’héritage paternel, ont chacun cinquante mille francs de rente. Mondor pratique la philanthropie à la mode. C’est ce qu’on nomme un bourreau d’argent. Il renouvelle son mobilier plusieurs fois par an, change ses équipages tous les mois ; on cite les ingénieux procédés auxquels il a recours pour en avoir plus tôt fini : bref, il fait pâlir les viveurs de Balzac et d’Alexandre Dumas.
Aussi, il faut entendre le concert d’éloges qui toujours l’environne ! « Parlez-nous de Mondor ! vive Mondor ! C’est le bienfaiteur de l’ouvrier ; c’est la providence du peuple. À la vérité, il se vautre dans l’orgie, il éclabousse les passants ; sa dignité et la dignité humaine en souffrent quelque peu… Mais, bah ! s’il ne se rend pas utile par lui-même, il se rend utile par sa fortune. Il fait circuler l’argent ; sa cour ne désemplit pas de fournisseurs qui se retirent toujours satisfaits. Ne dit-on pas que si l’or est rond, c’est pour qu’il roule ! »
Ariste a adopté un plan de vie bien différent. S’il n’est pas un égoïste, il est au moins un individualiste, car il raisonne ses dépenses, ne recherche que des jouissances modérées et raisonnables, songe à l’avenir de ses enfants, et, pour lâcher le mot, il économise.
Et il faut entendre ce que dit de lui le vulgaire !
« À quoi est bon ce mauvais riche, ce fesse-mathieu ? Sans doute, il y a quelque chose d’imposant et de touchant dans la simplicité de sa vie ; il est d’ailleurs humain, bienfaisant, généreux, mais il calcule. Il ne mange pas tous ses revenus. Son hôtel n’est pas sans cesse resplendissant et tourbillonnant. Quelle reconnaissance s’acquiert-il parmi les tapissiers, les carrossiers, les maquignons et les confiseurs ? »
Ces jugements, funestes à la morale, sont fondés sur ce qu’il y a une chose qui frappe les yeux : la dépense du prodigue ; et une autre qui s’y dérobe : la dépense égale et même supérieure de l’économe.
Mais les choses ont été si admirablement arrangées par le divin inventeur de l’ordre social, qu’en ceci, comme en tout, l’Économie politique et la Morale, loin de se heurter, concordent, et que la sagesse d’Ariste est, non seulement plus digne, mais encore plus profitable que la folie de Mondor.
Et quand je dis plus profitable, je n’entends pas dire seulement profitable à Ariste, ou même à la société en général, mais plus profitable aux ouvriers actuels, à l’industrie du jour.
Pour le prouver, il suffit de mettre sous l’œil de l’esprit ces conséquences cachées des actions humaines que l’œil du corps ne voit pas.
Oui, la prodigalité de Mondor a des effets visibles à tous les regards : chacun peut voir ses berlines, ses landaws, ses phaétons, les mignardes peintures de ses plafonds, ses riches tapis, l’éclat qui jaillit de son hôtel. Chacun sait que ses purs-sangs courent sur le turf. Les dîners qu’il donne à l’hôtel de Paris arrêtent la foule sur le boulevard, et l’on se dit : Voilà un brave homme, qui, loin de rien réserver de ses revenus, ébrèche probablement son capital. — C’est ce qu’on voit.
Il n’est pas aussi aisé de voir, au point de vue de l’intérêt des travailleurs, ce que deviennent les revenus d’Ariste. Suivons-les à la trace, cependant, et nous nous assurerons que tous, jusqu’à la dernière obole, vont faire travailler des ouvriers, aussi certainement que les revenus de Mondor. Il n’y a que cette différence : La folle dépense de Mondor est condamnée à décroître sans cesse et à rencontrer un terme nécessaire ; la sage dépense d’Ariste ira grossissant d’année en année.
Et s’il en est ainsi, certes, l’intérêt public se trouve d’accord avec la morale.
Ariste dépense, pour lui et sa maison, vingt mille francs par an. Si cela ne suffisait pas à son bonheur, il ne mériterait pas le nom de sage. — Il est touché des maux qui pèsent sur les classes pauvres ; il se croit, en conscience, tenu d’y apporter quelque soulagement et consacre dix mille francs à des actes de bienfaisance. — Parmi les négociants, les fabricants, les agriculteurs, il a des amis momentanément gênés. Il s’informe de leur situation, afin de leur venir en aide avec prudence et efficacité, et destine à cette œuvre encore dix mille francs. — Enfin, il n’oublie pas qu’il a des filles à doter, des fils auxquels il doit assurer un avenir, et, en conséquence, il s’impose d’épargner et placer tous les ans dix mille francs.
Voici donc l’emploi de ses revenus.
| 1° Dépenses personnelles | 20 000 fr. |
| 2° Bienfaisance | 10 000 |
| 3° Services d’amitié | 10 000 |
| 4° Épargne | 10 000 |
Reprenons chacun de ces chapitres, et nous verrons qu’une seule obole n’échappe pas au travail national.
1° Dépense personnelle. Celle-ci, quant aux ouvriers et fournisseurs, a des effets absolument identiques à une dépense égale faite par Mondor. Cela est évident de soi ; n’en parlons plus.
2° Bienfaisance. Les dix mille francs consacrés à cette destination vont également alimenter l’industrie ; ils parviennent au boulanger, au boucher, au marchand d’habits et de meubles. Seulement le pain, la viande, les vêtements ne servent pas directement à Ariste, mais à ceux qu’il s’est substitués. Or, cette simple substitution d’un consommateur à un autre n’affecte en rien l’industrie générale. Qu’Ariste dépense cent sous ou qu’il prie un malheureux de les dépenser à sa place, c’est tout un.
3° Services d’amitié. L’ami à qui Ariste prête ou donne dix mille francs ne les reçoit pas pour les enfouir ; cela répugne à l’hypothèse. Il s’en sert pour payer des marchandises ou des dettes. Dans le premier cas, l’industrie est encouragée. Osera-t-on dire qu’elle ait plus à gagner à l’achat par Mondor d’un pur-sang de dix mille francs qu’à l’achat par Ariste ou son ami de dix mille francs d’étoffes ? Que si cette somme sert à payer une dette, tout ce qui en résulte, c’est qu’il apparaît un troisième personnage, le créancier, qui touchera les dix mille francs, mais qui certes les emploiera à quelque chose dans son commerce, son usine ou son exploitation. C’est un intermédiaire de plus entre Ariste et les ouvriers. Les noms propres changent, la dépense reste, et l’encouragement à l’industrie aussi.
4° Épargne. Restent les dix mille francs épargnés ; — et c’est ici qu’au point de vue de l’encouragement aux arts, à l’industrie, au travail, aux ouvriers, Mondor paraît très supérieur à Ariste, encore que, sous le rapport moral, Ariste se montre quelque peu supérieur à Mondor.
Ce n’est jamais sans un malaise physique, qui va jusqu’à la souffrance, que je vois l’apparence de telles contradictions entre les grandes lois de la nature. Si l’humanité était réduite à opter entre deux partis, dont l’un blesse ses intérêts et l’autre sa conscience, il ne nous resterait qu’à désespérer de son avenir. Heureusement il n’en est pas ainsi [303]. — Et, pour voir Ariste reprendre sa supériorité économique, aussi bien que sa supériorité morale, il suffit de comprendre ce consolant axiome, qui n’en est pas moins vrai, pour avoir une physionomie paradoxale : Épargner, c’est dépenser.
Quel est le but d’Ariste, en économisant dix mille francs ? Est-ce d’enfouir deux mille pièces de cent sous dans une cachette de son jardin ? Non certes, il entend grossir son capital et son revenu. En conséquence, cet argent qu’il n’emploie pas à acheter des satisfactions personnelles, il s’en sert pour acheter des terres, une maison, des rentes sur l’État, des actions industrielles, ou bien il le place chez un négociant ou un banquier. Suivez les écus dans toutes ces hypothèses, et vous vous convaincrez que, par l’intermédiaire des vendeurs ou emprunteurs, ils vont alimenter du travail tout aussi sûrement que si Ariste, à l’exemple de son frère, les eût échangés contre des meubles, des bijoux et des chevaux.
Car, lorsque Ariste achète pour 10 000 fr. de terres ou de rente, il est déterminé par la considération qu’il n’a pas besoin de dépenser cette somme, puisque c’est ce dont vous lui faites un grief.
Mais, de même, celui qui lui vend la terre ou la rente est déterminé par cette considération qu’il a besoin de dépenser les dix mille francs d’une manière quelconque.
De telle sorte que la dépense se fait, dans tous les cas, ou par Ariste ou par ceux qui se substituent à lui.
Au point de vue de la classe ouvrière, de l’encouragement au travail, il n’y a donc, entre la conduite d’Ariste et celle de Mondor, qu’une différence ; la dépense de Mondor étant directement accomplie par lui, et autour de lui, on la voit. Celle d’Ariste s’exécutant en partie par des intermédiaires et au loin, on ne la voit pas. Mais, au fait, et pour qui sait rattacher les effets aux causes, celle qu’on ne voit pas est aussi certaine que celle qu’on voit. Ce qui le prouve, c’est que dans les deux cas les écus circulent, et qu’il n’en reste pas plus dans le coffre-fort du sage que dans celui du dissipateur.
Il est donc faux de dire que l’Épargne fait un tort actuel à l’industrie. Sous ce rapport, elle est tout aussi bienfaisante que le Luxe.
Mais combien ne lui est-elle pas supérieure, si la pensée, au lieu de se renfermer dans l’heure qui fuit, embrasse une longue période !
Dix ans se sont écoulés. Que sont devenus Mondor et sa fortune, et sa grande popularité ? Tout cela est évanoui, Mondor est ruiné ; loin de répandre soixante mille francs, tous les ans, dans le corps social, il lui est peut-être à charge. En tout cas, il ne fait plus la joie de ses fournisseurs, il ne compte plus comme promoteur des arts et de l’industrie, il n’est plus bon à rien pour les ouvriers, non plus que sa race, qu’il laisse dans la détresse.
Au bout des mêmes dix ans, non-seulement Ariste continue à jeter tous ses revenus dans la circulation, mais il y jette des revenus croissants d’année en année. Il grossit le capital national, c’est-à-dire le fonds qui alimente le salaire, et comme c’est de l’importance de ce fonds que dépend la demande des bras, il contribue à accroître progressivement la rémunération de la classe ouvrière. Vient-il à mourir, il laisse des enfants qu’il a mis à même de le remplacer dans cette œuvre de progrès et de civilisation.
Sous le rapport moral, la Supériorité de l’Épargne sur le Luxe est incontestable. Il est consolant de penser qu’il en est de même, sous le rapport économique, pour quiconque, ne s’arrêtant pas aux effets immédiats des phénomènes, sait pousser ses investigations jusqu’à leurs effets définitifs.
XII. Droit au travail, droit au profit↩
« Frères, cotisez-vous pour me fournir de l’ouvrage à votre prix. » C’est le Droit au travail, le Socialisme élémentaire ou de premier degré.
« Frères, cotisez-vous pour me fournir de l’ouvrage à mon prix. » C’est le Droit au profit, le Socialisme raffiné ou de second degré.
L’un et l’autre vivent par ceux de leurs effets qu’on voit. Ils mourront par ceux de leurs effets qu’on ne voit pas.
Ce qu’on voit, c’est le travail et le profit excités par la cotisation sociale. Ce qu’on ne voit pas, ce sont les travaux et les profits auxquels donnerait lieu cette même cotisation si on la laissait aux contribuables.
En 1848, le Droit au travail se montra un moment sous deux faces. Cela suffit pour le ruiner dans l’opinion publique.
L’une de ces faces s’appelait : Atelier national.
L’autre : Quarante-cinq centimes.
Des millions allaient tous les jours de la rue de Rivoli aux ateliers nationaux. C’est le beau côté de la médaille.
Mais en voici le revers. Pour que des millions sortent d’une caisse, il faut qu’ils y soient entrés. C’est pourquoi les organisateurs du Droit au travail s’adressèrent aux contribuables.
Or, les paysans disaient : Il faut que je paie 45 centimes. Donc, je me priverai d’un vêtement, je ne marnerai pas mon champ, je ne réparerai pas ma maison.
Et les ouvriers des campagnes disaient : Puisque notre bourgeois se prive d’un vêtement, il y aura moins de travail pour le tailleur ; puisqu’il ne marne pas son champ, il y aura moins de travail pour le terrassier ; puisqu’il ne fait pas réparer sa maison, il y aura moins de travail pour le charpentier et le maçon.
Il fut alors prouvé qu’on ne tire pas d’un sac deux moutures, et que le travail soldé par le gouvernement se fait aux dépens du travail payé par le contribuable. Ce fut là la mort du Droit au travail, qui apparut comme une chimère, autant que comme une injustice.
Et cependant, le droit au profit, qui n’est que l’exagération du Droit au Travail, vit encore et se porte à merveille.
N’y a-t-il pas quelque chose de honteux dans le rôle que le protectioniste fait jouer à la société ?
Il lui dit :
Il faut que tu me donnes du travail, et, qui plus est, du travail lucratif. J’ai sottement choisi une industrie qui me laisse dix pour cent de perte. Si tu frappes une contribution de vingt francs sur mes compatriotes et si tu me la livres, ma perte se convertira en profit. Or, le profit est un Droit ; tu me le dois.
La société qui écoute ce sophiste, qui se charge d’impôts pour le satisfaire, qui ne s’aperçoit pas que la perte essuyée par une industrie n’en est pas moins une perte, parce qu’on force les autres à la combler, cette société, dis-je, mérite le fardeau qu’on lui inflige.
Ainsi, on le voit par les nombreux sujets que j’ai parcourus : Ne pas savoir l’Économie politique, c’est se laisser éblouir par l’effet immédiat d’un phénomène ; la savoir, c’est embrasser dans sa pensée et dans sa prévision l’ensemble des effets [304].
Je pourrais soumettre ici une foule d’autres questions à la même épreuve. Mais je recule devant la monotonie d’une démonstration toujours uniforme, et je termine, en appliquant à l’Économie politique ce que Chateaubriand dit de l’Histoire :
« Il y a, dit-il, deux conséquences en histoire : l’une immédiate et qui est à l’instant connue, l’autre éloignée et qu’on n’aperçoit pas d’abord. Ces conséquences souvent se contredisent ; les unes viennent de notre courte sagesse, les autres de la sagesse perdurable. L’événement providentiel apparaît après l’événement humain. Dieu se lève derrière les hommes. Niez tant qu’il vous plaira le suprême conseil, ne consentez pas à son action, disputez sur les mots, appelez force des choses ou raison ce que le vulgaire appelle Providence ; mais regardez à la fin d’un fait accompli, et vous verrez qu’il a toujours produit le contraire de ce qu’on en attendait, quand il n’a point été établi d’abord sur la morale et la justice. »
(Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe.)
Undated Material↩
Sophismes électoraux [no date] [CW1.3.1]]↩
BWV
???? “Sophismes électoraux” (Electoral Sophisms) [n.d.] [OC7.67, p. 271] [CW1]
Je suis engagé.
Je ne nomme pas M. tel, parce qu’il ne m’a pas demandé mon suffrage.
Je vote pour M. tel, parce qu’il m’a rendu service.
Je vote pour M. tel, parce qu’il a rendu des services à la France.
Je vote pour M. tel, parce qu’il m’a promis un service.
Je vote pour M. tel, parce que je désire une place.
Je vote pour M. tel, parce que je crains pour ma place.
Je vote pour M. tel, parce qu’il est du Pays.
Je vote pour M. tel, parce qu’il n’est pas du Pays.
Je vote pour M. tel, parce qu’il parlera.
Je vote pour M. tel, parce que s’il n’est pas nommé, notre préfet ou notre sous-préfet seront destitués.
Chacun de ces sophismes a son caractère spécial, mais il y a aussi au fond de chacun d’eux quelque chose qui leur est commun et qu’il s’agit de démêler.
Tous reposent sur cette double donnée :
L’élection se fait dans l’intérêt du candidat.
L’électeur est propriétaire exclusif d’une chose, à savoir : son suffrage, dont il peut disposer à sa guise et en faveur de qui il l’entend.
La fausseté de cette doctrine et l’application qui en est faite journellement ressortiront de l’examen auquel nous allons nous livrer.
I. — Je ne vote pas pour M. A., parce qu’il ne m’a pas réclamé mon suffrage.
Ce sophisme, comme tous les autres, repose sur un sentiment qui, en lui-même, n’est pas répréhensible, sur le sentiment de la dignité personnelle.
Il est rare en effet que les paradoxes par lesquels les hommes s’en imposent à eux-mêmes, pour s’encourager à une action mauvaise, soient complétement faux. C’est un tissu dans lequel on aperçoit toujours quelques fils de bon aloi. Il y a toujours en eux quelque chose de vrai, et c’est par ce côté qu’ils en imposent. S’ils étaient faux de tous points, ils ne feraient pas tant de dupes.
Celui que nous examinons revient à ceci :
« M. A. aspire à la députation. La députation est le chemin des honneurs et de la fortune. Il sait que mon suffrage peut concourir à sa nomination. C’est bien la moindre chose qu’il me le demande. S’il fait le fier, je ferai le fier à mon tour ; et quand je consens à disposer en faveur de quelqu’un d’une chose aussi précieuse que mon vote, j’entends qu’on m’en sache gré, qu’on ne dédaigne pas de venir chez moi, d’entrer en relation avec moi, de me serrer la main, etc., etc. »
Il est bien clair que l’Électeur qui raisonne ainsi tombe dans la double erreur que nous avons signalée.
1° Il croit que son vote vote est donné pour l’utilité du candidat.
2° Il pense, qu’en fait de services, il est le maître d’en rendre à qui il lui plaît.
En un mot, il fait abstraction des biens et des maux publics qui peuvent résulter de son choix.
Car s’il avait présent à l’esprit que le but de tout le mécanisme électoral est de faire arriver à la Chambre des Députés consciencieux et dévoués, il ferait probablement le raisonnement contraire et dirait :
« Je voterai pour M. A. par ce motif, entre autres, qu’il ne m’a pas demandé mon suffrage ! »
En effet, aux yeux de qui ne perd pas de vue l’objet de la députation, je ne crois pas qu’il puisse s’élever de plus forte présomption contre un candidat que son empressement à quêter des suffrages.
Car enfin, qui pousse cet homme à venir me tourmenter jusque chez moi, à s’efforcer de me prouver que je dois lui donner ma confiance ?
Lorsque je sais que tant de Députés, deux boules à la main, ont fait la loi aux ministres et se sont fait adjuger de bonnes places, ne dois-je pas craindre que ce candidat n’ait pas autre chose en vue, qui vient, quelquefois de l’autre extrémité du Royaume, implorer la confiance de gens qu’il ne connaît pas ?
On peut sans doute être trahi par le Député qu’on a spontanément choisi. Mais si nous, électeurs, allons chercher un homme dans sa retraite (et nous ne pouvons l’y aller chercher que parce que sa réputation d’intégrité est parfaitement établie), si nous l’arrachons à sa solitude pour l’investir d’un mandat qu’il ne demandait pas, ne mettrons-nous pas de notre côté toutes les chances possibles de déposer ce mandat en des mains pures et fidèles ?
Si cet homme eût voulu faire une affaire de la Députation, il l’aurait recherchée. Il ne l’a pas fait, donc il n’a point de funeste arrière-pensée.
D’ailleurs celui à qui la députation est spontanément déférée, comme le libre témoignage de la confiance générale et de l’estime universelle, celui-là doit se sentir tellement honoré, tellement reconnaissant envers sa propre renommée, qu’il se gardera de la ternir.
Et, après tout, ne serait-il pas bien naturel que les choses se passassent ainsi ?
De quoi est-il question ? S’agit-il de rendre service à M. un tel, de le favoriser, de le mettre sur le chemin de la fortune ?
Non, il s’agit de nous donner un mandataire qui ait notre confiance. Ne serait-il pas bien simple que nous nous donnassions la peine de le chercher ?
Il s’agissait d’une importante tutelle. Un nombreux conseil de famille était réuni dans le prétoire. Un homme arrive hors d’haleine, couvert de sueur, après avoir crevé plusieurs chevaux. Nul ne le connaît personnellement. Tout ce que l’on en sait, c’est qu’il gère au loin les propriétés des mineurs et que bientôt il va avoir des comptes à rendre. Cet homme supplie qu’on le nomme tuteur. Il s’adresse aux parents paternels, et puis aux parents maternels. Il fait longuement son propre éloge ; il parle de sa probité, de sa fortune, de ses alliances ; il prie, il promet, il menace. On lit sur ses traits une anxiété profonde, un désir immodéré de réussir. Vainement lui objecte-t-on que la tutelle est très chargée ; qu’elle prendra beaucoup sur le temps, sur la fortune, sur les affaires de celui à qui elle sera imposée. — Il lève toutes les difficultés. Son temps, il ne demande pas mieux que de le consacrer au service des pauvres orphelins ; — sa fortune, il est prêt à en faire le sacrifice, tant il se sent dans le cœur un désintéressement héroïque ; — ses affaires, il les verra péricliter d’un œil stoïque, pourvu que elles des mineurs prospèrent en ses mains. — Mais vous gérez leur fortune. — Raison de plus ; je me rendrai des comptes à moi-même, et qui est plus en mesure de les examiner que celui qui les a faits ?
Je le demande, le conseil de famille agirait-il d’une manière raisonnable en confiant à ce solliciteur empressé les fonctions qu’il demande ?
N’agirait-il pas plus sagement d’en investir un parent connu par sa probité, son exactitude, surtout s’il se rencontrait que ce parent eût avec les mineurs des intérêts identiques, en sorte qu’il ne pût leur faire ni bien ni mal sans en recueillir sa part ?
II — Je vote pour M. A., parce qu’il m’a rendu un service.
« La reconnaissance, a-t-on dit, est la seule vertu dont on ne puisse pas abuser. » — C’est une erreur. Il y a un moyen fort usité d’en abuser, c’est d’acquitter, aux dépens d’autrui, la dette qu’elle nous impose.
Je ne disconviens pas qu’un électeur qui a reçu de fréquents témoignages de bienveillance de la part d’un candidat, dont il ne partage pas les opinions, se trouve dans une des positions les plus délicates et les plus pénibles, si ce candidat a l’impudeur de lui demander son suffrage. L’ingratitude est en elle-même une chose qui répugne ; aller jusqu’à en faire, pour ainsi dire, un étalage officiel, cela peut devenir un véritable supplice. — Vous aurez beau colorer cette défection par les motifs politiques les mieux déduits, il y a au fond de la conscience universelle un instinct qui vous condamnera. — C’est que les mœurs politiques n’ont pas fait ni pu faire les mêmes progrès que la morale privée. C’est que le public voit toujours dans votre suffrage une propriété dont vous pouvez disposer, et il vous blâmera de ne pas le laisser diriger par une vertu aussi populaire, aussi honorable que la reconnaissance.
Cependant examinons.
La question, telle qu’elle se pose en France, devant le corps électoral, est le plus souvent tellement complexe, qu’elle laisse, ce semble, une grande latitude à la conscience. Il y a deux candidats : l’un est pour le ministère, l’autre pour l’opposition. — Oui, mais si le ministère a fait bien des fautes, l’opposition a bien des torts aussi. D’ailleurs voyez les programmes des deux compétiteurs, l’un veut l’ordre et la liberté, — l’autre demande la liberté avec l’ordre. Il n’y a de différence qu’en ce que l’un met en seconde ligne ce que l’autre place au premier rang ; au fond, ils veulent la même chose. Il ne valait pas la peine, pour de telles nuances, de trahir les droits que des bienfaits reçus donnaient sur votre vote à l’un des candidats. Vous n’êtes donc pas excusable.
Mais supposons que la question posée devant les électeurs soit moins vague, et vous verrez s’affaiblir non seulement les droits, mais encore la popularité et même les prétentions de la reconnaissance.
En Angleterre, par exemple, une longue expérience du gouvernement représentatif a appris aux électeurs qu’il ne fallait pas poursuivre toutes les réformes à la fois, mais ne passer à la seconde que lorsqu’on aurait emporté la première, et ainsi de suite.
Il en résulte qu’il y a toujours devant le public une question principale, sur laquelle se concentrent tous les efforts de la Presse, des associations, et des électeurs.
Êtes-vous pour ou contre la réforme électorale ?
Êtes-vous pour ou contre l’émancipation catholique ?
Êtes-vous pour ou contre l’affranchissement des esclaves ?
En ce moment, la question est uniquement celle-ci :
Êtes-vous pour ou contre la liberté des échanges ?
Quand elle sera vidée, on posera sans doute cette autre :
Êtes-vous pour ou contre le système volontaire en matière de religion ?
Tant que dure l’agitation relative à une de ces questions, tout le monde y prend part, tout le monde cherche à s’éclairer, tout le monde s’engage dans un parti ou dans l’autre. Sans doute, les autres grandes réformes politiques, quoique mises dans l’ombre, ne sont pas entièrement négligées. Mais c’est un débat qui s’engage dans le sein de chaque parti, et non d’un parti à l’autre.
Ainsi aujourd’hui, quand les free-traders ont à opposer un candidat aux monopoleurs, ils ont des assemblées préparatoires, et là celui-là est proclamé candidat qui, indépendamment de la conformité de ses principes avec ceux des free-traders, en matière commerciale, convient mieux en outre à la majorité à raison de ses opinions sur l’Irlande, ou le Bill de Maynooth, etc., etc. — Mais au jour de la grande lutte on ne demande aux candidats que ceci :
Êtes-vous free-traders ? — Êtes-vous monopoleurs ?
Et, par conséquent, c’est sur cela seul que les électeurs ont à se prononcer.
Or il est aisé de comprendre qu’une question posée en des termes aussi simples, ne laisse s’insinuer au sein des partis aucun des sophismes que ce livre a pour objet de combattre, et notamment le sophisme de la reconnaissance.
J’aurai rendu dans la vie privée de grands services à un électeur. Mais je sais qu’il est pour la liberté commerciale, tandis que je me présente comme le candidat des partisans du régime protecteur. L’idée même ne me viendra pas d’exiger de lui, par reconnaissance, le sacrifice d’une cause à laquelle je sais qu’il a voué tous ses efforts, pour laquelle il a souscrit, en faveur de laquelle il s’est affilié à des associations puissantes. Que si je le faisais, la réponse serait claire et logique, et elle obtiendrait l’assentiment du public, non seulement dans son parti, mais encore dans le mien. Il me dirait : Je vous ai des obligations personnelles. Je suis prêt à m’acquitter personnellement. Je n’attendrai pas que vous me le demandiez et je saisirai toutes les occasions de vous prouver que je ne suis pas un ingrat. Il est pourtant un sacrifice que je ne puis vous faire, c’est celui de ma conscience. Vous savez que je suis engagé dans la cause de la liberté commerciale, que je crois conforme à l’intérêt public. Vous, au contraire, vous soutenez le principe opposé. Nous sommes ici réunis pour savoir lequel de ces deux principes a l’assentiment de la majorité. De mon vote, peut dépendre le triomphe ou la défaite du principe que je soutiens. En conscience, je ne puis pas lever la main pour vous.
Il est évident qu’à moins d’être un malhonnête homme le candidat ne pourrait pas insister pour prouver que l’électeur est lié par un bienfait reçu.
La même doctrine doit prévaloir parmi nous. Seulement les questions étant beaucoup plus compliquées, elles donnent ouverture à une contestation pénible entre le bienfaiteur et l’obligé. Le bienfaiteur dira : Mais pourquoi me refusez-vous votre suffrage ? est-ce parce que nous sommes séparés par quelques nuances d’opinions ? Mais pensez-vous exactement comme mon compétiteur ? Ne savez-vous pas que mes intentions sont pures ? Ne veux-je pas, ainsi que vous, l’ordre, la liberté, le bien public ? Vous craignez que je ne vote telle ou telle mesure que vous désapprouvez ; et qui sait si elle sera présentée aux Chambres dans cette session ? Vous voyez bien que vous n’avez pas de motifs suffisants pour oublier ce que j’ai fait pour vous. Vous ne cherchez qu’un prétexte pour vous dégager de toute reconnaissance.
Il me semble que la méthode anglaise, celle de ne poursuivre qu’une réforme à la fois, indépendamment de ses avantages propres, a encore l’avantage très grand de classer invariablement les électeurs, de les mettre à l’abri des mauvaises influences, de ne laisser pas prise aux sophismes, en un mot de former de franches et fermes mœurs politiques. Aussi je voudrais qu’on l’adoptât en France. En ce cas il est quatre réformes qui se disputeraient la priorité.
1° La réforme électorale ;
2° La réforme parlementaire ;
3° La liberté d’enseignement ;
4° La réforme commerciale.
Je ne sais à laquelle de ces questions mon pays donnerait le pas. — Si j’avais voix au chapitre à cet égard, je désignerais la réforme parlementaire, comme la plus importante, la plus urgente, celle à laquelle l’opinion est le mieux préparée, celle qui est la plus propre à favoriser le triomphe des trois autres.
C’est par ce motif que j’en dirai quelques mots à la fin de ce livre. . . . . .
III. — Je vote pour M. A., parce qu’il a rendu de grands services au pays.
À une certaine époque, on sollicitait la voix d’un électeur pour un général de mérite. — Qui donc, dans le pays, disait-on, a rendu plus de services à la patrie. Il a versé son sang sur de nombreux champs de bataille. Il doit tous ses grades à son courage et à ses talents militaires. — Il s’est fait lui-même et qui plus est il a élevé à des postes importants ses frères, ses neveux, ses cousins. — Notre arrondissement est-il menacé ? disait l’électeur, fait-on une levée en masse ? Est-il question de choisir un chef militaire ? Ma voix est acquise à l’honorable général, tout ce que vous m’en dites et ce que j’en sais lui donnent des titres irrécusables à ma confiance.
Non, dit le solliciteur, il s’agit de nommer un député, un législateur. — Quelles seront les fonctions ? — Faire des lois, réviser le code civil, le code de procédure, le code pénal, rétablir l’ordre dans les finances, surveiller, contenir, réprimer et au besoin accuser les ministres. — Et qu’ont de commun les grands coups d’épée qu’a distribués le général aux ennemis avec les fonctions législatives ? — Il ne s’agit pas de cela ; il est question de lui décerner, dans la députation, une récompense digne de ses services. — Mais si, par ignorance, il fait de mauvaises lois, s’il vote pour des plans financiers désastreux, qui devra en subir les conséquences ?
— Vous-même et le public.
— Et puis-je en conscience investir le général du droit de faire des lois s’il doit en faire de mauvaises ?
— Vous insultez un homme d’un grand talent et d’un noble caractère. Le supposez-vous ignorant ou mal intentionné ?
— Dieu m’en garde. Je suppose que s’étant occupé toute sa vie de l’école de peloton, il est fort savant en stratégie. Je ne doute pas qu’il ne passe admirablement une revue. Mais encore une fois qu’y a-t-il de commun entre ces connaissances et celles qui sont nécessaires à un représentant ou plutôt aux représentés ?
. . . . . . . . . . . . . .
Les élections. Dialogue entre un profond Publiciste et un Campagnard [no date] [CS1.3.2]↩
BWV
???? “Les élections. Dialogue entre un profond Publiciste et un Campagnard” (The Elections. A Dialog between a deep-thinking Supporter and a Countryman) [n.d.] [OC7.68, p. 280] [CW1]
Le Publiciste.
Enfin vous allez jouir pour la première fois d’un des plus beaux résultats de la Révolution. Vous allez entrer en possession d’une portion de la souveraineté ; vous allez exercer un des plus beaux droits de l’homme.
Le Campagnard.
Je viens tout simplement donner ma procuration à celui que je croirai le plus capable de gérer cette portion de mes affaires qui sont communes à tous les Français.
Le Publiciste.
Sans doute. Mais vous voyez la chose sous le point de vue le plus trivial. Peu importe. — Vous avez sans doute réfléchi à l’acte solennel que vous êtes venu accomplir.
Le Campagnard.
Il me paraît si simple que je n’ai pas cru devoir consacrer beaucoup de temps à le méditer.
Le Publiciste.
Y pensez-vous ? C’est une chose simple que de nommer un législateur ! Vous ne savez donc pas combien notre politique extérieure est compliquée, combien de fautes a commises notre ministère, combien de factions cherchent, en sens divers, à entraîner le pouvoir. Choisir parmi les candidats l’homme le plus propre à apprécier tant de combinaisons, à méditer tant de lois qui nous manquent, à distinguer entre tous les partis le plus patriote pour le faire triompher et abattre les autres, n’est pas une chose aussi simple que vous pouvez le croire.
Le Campagnard.
À la bonne heure. Mais je n’ai ni le temps ni la capacité nécessaires pour étudier tant de choses.
Le Publiciste.
En ce cas, rapportez-vous-en à ceux qui y ont réfléchi. Venez dîner avec moi, chez le général B., je vous dirai à qui il convient que vous donniez votre vote.
Le Campagnard.
Souffrez que je n’accepte ni vos offres ni vos conseils.
J’ai ouï dire que le général B. se met sur les rangs ; je ne puis accepter son dîner, étant bien résolu à ne le point nommer.
Le Publiciste.
Vous me surprenez. Tenez, emportez cette notice biographique sur M. B. Vous verrez combien il a de titres à votre choix. Il est plébéien comme vous. Il ne doit sa fortune qu’à sa bravoure et à son épée. Il a rendu d’éclatants services à la France. C’est aux Français de le récompenser.
Le Campagnard.
Je ne m’y oppose pas. S’il a rendu des services réels à la France, que la France lui donne des croix ou même des pensions. Mais je ne vois pas que je doive lui donner mes pouvoirs pour des affaires auxquelles je le crois impropre.
Le Publiciste.
Le général impropre aux affaires, lui qui a commandé des corps d’armée, qui a gouverné des provinces, qui connaît à fond la politique de tous les cabinets, qui parle comme Démosthène !
Le Campagnard.
Raison de plus pour que je ne le nomme pas. Plus il aura de capacité, plus il sera redoutable pour moi, car je suis persuadé qu’il s’en servirait contre mes intérêts.
Le Publiciste.
Vos intérêts ne sont-ils pas ceux de votre patrie ?
Le Campagnard.
Sans doute. Mais ils ne sont pas ceux du général.
Le Publiciste.
Expliquez-vous, je ne vous comprends nullement.
Le Campagnard.
Je ne vois aucun inconvénient à m’expliquer. Comme agriculteur, j’appartiens à la classe laborieuse et paisible, et je me propose de me faire représenter par un homme paisible et laborieux, et non par un homme que sa carrière et ses habitudes ont poussé vers le pouvoir et la guerre.
Le Publiciste.
Le général affirme qu’il défendra la cause de l’agriculture et de l’industrie.
Le Campagnard.
À la bonne heure, mais, quand je ne connais pas les gens, leur parole ne me suffit pas ; il me faut une garantie plus sûre.
Le Publiciste.
Laquelle?
Le Campagnard.
Leur intérêt. Si je nomme un homme qui soit agriculteur et contribuable comme moi, j’ai la certitude qu’il défendra mes intérêts en défendant les siens.
Le Publiciste.
Le général est propriétaire comme vous. Pensez-vous qu’il sacrifie la propriété au pouvoir ?
Le Campagnard.
Un général est soldat avant tout. Ses intérêts comme payant ne peuvent être mis en balance avec ses intérêts comme payé.
Le Publiciste.
Et quand cela serait, son dévouement à la patrie n’est-il pas connu ? N’est-il pas enfant de la révolution ? Celui qui a versé son sang pour la France, la trahira-t-il pour un peu d’or ?
Le Campagnard.
J’admets que le général soit un parfait honnête homme. Mais je ne puis croire que l’homme qui n’a fait dans sa vie que commander et obéir, qui ne s’est élevé que par le pouvoir, qui ne s’est enrichi que par l’impôt, représente parfaitement celui qui paye l’impôt. Il me paraît absurde que, trouvant le pouvoir trop lourd, je nomme pour l’alléger un homme qui le partage ; que, trouvant les impôts trop onéreux, je confie le soin de les diminuer à un homme qui vit d’impôts. Le général peut avoir beaucoup de renoncement à, lui-même, mais je n’en veux pas faire l’épreuve à mes risques, et, pour tout dire en un mot, vous sollicitez de moi une inconséquence que je ne suis pas disposé à commettre.
L’Électeur campagnard, un Curé.
Le Curé.
Eh bien, mon cher ami, vous m’avez procuré une vive satisfaction. On m’a assuré que vous aviez noblement refusé votre voix au candidat de la faction libérale ; en cela vous avez fait preuve de bon sens. Est-ce quand la monarchie est en péril, quand la religion éplorée tend vers vous ses mains suppliantes, que vous consentiriez à donner une force nouvelle aux ennemis de la Religion et du Roi ?
Le Campagnard.
Pardonnez-moi, monsieur le Curé, si j’ai refusé ma voix à un général, ce n’est pas que je le croie ennemi de la Religion ni du Roi. C’est qu’au contraire, je suis convaincu que sa position ne lui permet pas de tenir entre les moyens des contribuables et les exigences du pouvoir une balance bien juste.
Le Curé.
N’importent vos motifs. Il est certain que vous avez raison de vous méfier de l’ambition de cet homme.
Le Campagnard.
Vous ne m’entendez pas, monsieur le Curé. Je ne porte aucun jugement sur le caractère du général. Je dis seulement qu’il me paraît imprudent de confier mes intérêts à un homme qui ne pourrait les défendre sans sacrifier les siens. C’est une chance qu’aucun homme raisonnable ne veut courir sans nécessité.
Le Curé.
Je vous répète que je ne scrute pas vos motifs. Vous venez de prouver votre dévouement au roi. Eh bien, achevez votre ouvrage. Vous éloignez un ennemi, c’est beaucoup ; mais ce n’est pas assez, donnez-lui un ami. Il vous l’a lui-même désigné ; nommez le digne président du collége.
Le Campagnard.
Je croirais commettre une absurdité plus grande encore. Le Roi a l’initiative et la sanction des lois, il nomme la Chambre des pairs. Les lois étant faites pour la nation, il a voulu qu’elle concourût à leur confection, et j’irais nommer ceux que le pouvoir désigne ? Mais le résultat serait une monarchie absolue avec des formes constitutionnelles.
Le Curé.
Vous supposez donc que le Roi abuserait de ce pouvoir pour faire de mauvaises lois ?
Le Campagnard.
Écoutez, monsieur le Curé, disons les choses comme elles sont réellement. Le Roi ne connaît pas personnellement les quatre cent cinquante candidats qu’il désigne ; ce sont les ministres qui réellement les offrent à nos choix. Or l’intérêt du ministère est d’augmenter sa puissance et sa richesse. Mais il ne peut augmenter sa puissance qu’aux dépens de ma liberté, et sa richesse qu’aux dépens de ma bourse. Il faut donc, si je veux l’en empêcher, que je nomme un député contribuable comme moi, qui le surveille, et mette des bornes à ses empiétements.
Le Curé.
C’est-à-dire un député de l’opposition?
Le Campagnard.
Sans doute. Entre celui qui vit d’impôts et celui qui les paye, l’opposition me paraît naturelle. Quand j’achète, je tâche de le faire à bon marché, mais quand je vends, je mets ma marchandise au plus haut prix. Entre l’acheteur et le vendeur un débat est infaillible. Si je voulais faire acheter une charrue en fabrique, donnerais-je procuration au fabricant pour en fixer le prix ?
Le Curé.
Voilà une politique bien triviale et bien intéressée. Il s’agit bien d’acheter et de vendre, de prix et de fabriques. Insensé ! il s’agit du Roi, de sa dynastie, de la paix des peuples, du maintien de notre sainte Religion.
Le Campagnard.
Eh bien, selon moi encore, il s’agit de vente et de prix. Le pouvoir est composé d’hommes, le clergé est également composé d’hommes formant un corps. — Le pouvoir et le clergé sont deux corps composés d’hommes. Or, il est dans la nature de tous les corps de tendre à leur agrandissement. Les contribuables seraient absurdes s’ils ne formaient aussi un corps pour se défendre contre les agrandissements du pouvoir et du clergé.
Le Curé.
Malheureux ! et si ce dernier corps triomphe, vous détruiriez la Monarchie et la Religion. Où en sommes-nous, bon Dieu !
Le Campagnard.
Ne vous épouvantez pas, monsieur le Curé. Jamais le peuple ne détruira le pouvoir, car le pouvoir lui est nécessaire. Jamais, il ne renversera la Religion, car elle lui est indispensable. Seulement il contiendra celui-là et celle-ci dans les limites d’où ils ne peuvent sortir sans péril pour tout le monde.
De même que j’ai fait recouvrir ma maison d’un toit pour me mettre à l’abri du soleil et de la pluie, je veux payer des magistrats et des officiers de police, pour qu’ils me préservent des malfaiteurs. De même que je m’abonne volonlairement à un médecin pour soigner mon corps, je m’abonnerai à un ministre de la Religion pour soigner mon âme. Mais de même aussi que je fais en sorte que mon toit se fasse aussi économiquement et aussi solidement que possible, de même que je débats avec mon médecin le prix de l’abonnement, je veux débattre avec le clergé et le pouvoir le prix de leurs services, puisque, grâce au ciel, j’en ai la faculté. Et comme je ne puis le faire moi-même, trouvez bon, monsieur le Curé, que j’en charge un homme qui ait les mêmes
intérêts que moi, et non un homme qui appartienne directement ou indirectement au clergé ou au pouvoir.
L’Électeur campagnard, un Candidat constitutionnel.
Le Candidat.
Je ne crains pas d’arriver trop tard pour vous demander votre voix, Monsieur, bien convaincu que vous n’aurez pas cru devoir l’accorder à ceux qui m’ont précédé. J’ai deux concurrents dont je reconnais le talent, et dont j’honore le caractère personnel, mais qui, par leur position, me paraissent n’être point vos représentants naturels. Je suis contribuable comme vous, comme vous j’appartiens non à la classe qui exerce, mais à celle sur qui s’exerce le pouvoir. Je suis profondément convaincu que ce qui nuit actuellement à l’ordre, à la liberté et à la prospérité en France, ce sont les dimensions démesurées du gouvernement. Non seulement mes opinions me font un devoir, mais encore mes intérêts me font un besoin de faire tous mes efforts pour mettre des bornes à cette effrayante étendue de l’action du pouvoir. Je pense donc que je me rends utile à la cause des contribuables en me mettant sur les rangs, et si vous partagez mes idées, j’espère que vous me donnerez votre voix.
Le Campagnard.
J’y suis bien résolu. Vos opinions sont les miennes, vos intérêts me garantissent que vous agirez selon vos opinions ; vous pouvez compter sur mon suffrage.
Untitled Fragment on Canals [no date - 1837.06??] [CW1.3.3]↩
BWV
???? [Untitled Fragment] [n.d.] [OC7.69, p. 289] [CW1]
Me promenant, oisif, dans les rues d’une de nos grandes villes, je fis rencontre d’un mien ami qui me parut de mauvaise humeur. Qu’avez-vous, lui dis-je, que vous êtes plus pâle qu’un rentier, à l’aspect d’un arrêt qui retranche un quartier ? (Sous le Grand Roi on retranchait des quartiers de rentes.) Lors mon ami tirant de sa poche une liasse de paperasses : Je suis, me dit-il, moi millième, actionnaire dans l’entreprise d’un canal. Nous avons confié l’exécution de l’entreprise à un habile homme qui nous rend ses comptes tous les ans. Chaque année, il fait de nouveaux appels de fonds, il multiplie le nombre de ses agents, et l’œuvre n’avance pas. Je me rends à une assemblée où tous les actionnaires vont nommer une commission pour vérifier, contrôler, approuver ou rectifier les comptes de notre homme. Et sans doute, répliquai-je, vous allez composer cette commission des agents de votre entrepreneur et lui donner pour chef l’entrepreneur lui-même. Vous plaisantez, répondit-il, aucun homme sur la terre ne serait capable d’une telle ânerie. — Oh ! oh ! fis-je, ne décidez pas si vite ; en mon pays, elle se renouvelle plus de cent fois par an.
Incompatibilités Parlementaires (Presse bayonnaise) (JCPD) [no date] [not available]↩
Question religieuse [no date] [CW1.4.21]↩
BWV
???? [no title “Question religieuse”] [OC7.79, p. 335] [CW1]
Question religieuse [305]
J’ai toujours pensé que la question religieuse remuerait encore le monde. Les religions positives actuelles retiennent trop d’esprit et de moyens d’exploitation pour se concilier avec l’inévitable progrès des lumières. D’un autre côté, l’abus religieux fera une longue et terrible résistance, parce qu’il est fondu et confondu avec la morale religieuse qui est le plus grand besoin de l’humanité.
Il semble donc que l’humanité n’en a pas fini avec cette triste oscillation qui a rempli les pages de l’histoire : d’une part, on attaque les abus religieux et, dans l’ardeur de la lutte, on est entraîné à ébranler la religion elle-même. De l’autre, on se pose comme le champion de la religion, et, dans le zèle de la défense, on innocente les abus.
Ce long déchirement a été décidé le jour où un homme s’est servi de Dieu pour faire d’un autre homme son esclave intellectuel, le jour où un homme a dit à un autre : « Je suis le ministre de Dieu, il m’a donné tout pouvoir sur toi, sur ton esprit, sur ton corps, sur ton cœur. »
Mais, laissant de côté ces réflexions générales, je veux attirer votre attention sur deux faits dont les journaux d’aujourd’hui font mention, et qui prouvent combien sont loin d’être résolus les problèmes relatifs à l’accord ou la séparation du spirituel et du temporel.
On dit que c’est cette complète séparation qui résoudra toutes les difficultés. Ceux qui avancent cette assertion devraient commencer par prouver que le spirituel et le temporel peuvent suivre des destinées indépendantes, et que le maître du spirituel n’est pas maître de tout.
Quoi qu’il en soit, voici les deux faits, ou le fait.
Monseigneur l’évêque de Langres, ayant été choisi par les électeurs du département de …… pour les représenter, n’a pas cru devoir tenir cette élection comme suffisante, ni même s’en remettre à sa propre décision. Il a un chef qui n’est ni Français, ni en France, et, il faut bien le dire, qui est en même temps roi étranger. C’est à ce chef que Mgr l’évêque de Langres s’adresse. Il lui dit : « Je vous promets une entière et douce obéissance ; ferai-je bien d’accepter ? » Le chef spirituel (en même temps roi temporel) répond : « L’état de la religion et de l’Église est si alarmant que vos services peuvent être plus utiles sur la scène politique que parmi votre troupeau. »
Là-dessus, Mgr de Langres fait savoir à ses électeurs qu’il accepte leur mandat ; comme évêque, il est forcé de les quitter, mais ils recevront en compensation la bénédiction apostolique. Ainsi tout s’arrange.
Maintenant, je le demande, est-ce pour défendre des dogmes religieux que le Pape confirme l’élection de… ? Mgr de Langres va-t-il à la Chambre pour combattre des hérésies ? Non, il y va pour faire des lois civiles, pour s’y occuper exclusivement d’objets temporels.
Ce que je veux faire remarquer ici, c’est que nous avons en France cinquante mille personnes, toutes très influentes par leur caractère, qui ont juré une entière et douce obéissance à leur chef spirituel qui est en même temps roi étranger, et que le spirituel et le temporel se mêlent tellement, que ces cinquante mille hommes ne peuvent rien faire, même comme citoyens, sans consulter le souverain étranger, dont les décisions sont indiscutables.
Nous frémirions, si on nous disait : On va investir un roi, Louis-Philippe, Henri V, Bonaparte, Léopold, de la puissance spirituelle. Nous penserions que c’est fonder un despotisme sans limites. Cependant qu’on ajoute la puissance spirituelle à la temporelle, ou qu’on superpose celle-ci à celle-là, n’est-ce pas la même chose ? Comment se fait-il que nous ne pensions pas sans horreur à l’usurpation du gouvernement des âmes par l’autorité civile, et que nous trouvions si naturelle l’usurpation de la puissance civile par l’autorité sacerdotale ?
Après tout, S. S. Pie IX n’est pas le seul homme en Europe revêtu de cette double autorité. Nicolas est empereur et pape ; Victoria est reine et papesse.
Supposons qu’un Français professant la religion anglicane soit nommé représentant. Supposons qu’il écrive et fasse publier dans les journaux une lettre ainsi conçue :
Gracieuse souveraine,
Je ne vous dois rien comme reine ; mais, placée à la tête de ma religion, je vous dois mon entière et douce obéissance. Veuillez me faire savoir, après avoir consulté votre gouvernement, s’il est dans les intérêts de l’État et de l’Église d’Angleterre que je sois législateur en France.
Supposez que Victoria fasse et publie cette réponse :
« Mon gouvernement est d’avis que vous acceptiez la députation. Par là vous pourrez rendre de grands services directement à ma puissance spirituelle et, par suite, indirectement à ma puissance temporelle ; car il est bien clair que chacune d’elles sert à l’autre. »
Je le demande, cet homme pourrait-il être considéré comme un loyal et sincère représentant de la France ?…
Deux articles sur la langue basque (JCPD) [no date] [not available]↩
Posthumous Material↩
T.279 (1851.01.10) SEP: Séance de 10 jan. 1851 (announcement of FB's death) (Fr, PDF1)↩
French text acquired: 25 Nov. 2015
Checked against PDF: 26 Nov. 2015
Source Info
T.279 (1851.01.10) Comments at a "Meeting of the Political Economy Society" (Séance de 10 jan. 1851) (announcement of FB's death). In “Chronique,” JDE, T. 28, no. 117, 15 jan. 1851, p.104-5; also Annales de la Société d’Économie Politique (1889), p. 141. Not in OC.
Text: Much longer JDE account↩
[104]
Les journaux quotidiens ont déjà annoncé la grande et douloureuse perte que la science a faite par la mort de Frédéric Bastiat. Notre illustre et tant regrettable ami a succombé le 24 décembre , à Rome. L'air et le soleil d'Italie n'ont pu arrêter les ravages du mal qui le consumait depuis longtemps, et dont il était déjà atteint, il y a six ans, lorsqu'il commençait, dans le Journal des Économistes, cette série d'écrits remplis de savoir, de bon sens et de verve éclatante, qui en peu de temps lui ont fait un si beau nom, et laisseront dans la science une trace lumineuse et profonde.
Il y a trois mois cependant, lorsqu'il se décidait à s'éloigner de Paris et à quitter les tracas de la vie parlementaire, bien que la maladie eût gagné le larynx, et qu'il ne pût plus parler qu'à voix basse, son esprit n'avait rien perdu de sa vigueur; son énergique constitution résistait; et nous espérions que le repos et la douceur du climat éloigneraient pour quelques années encore la fin de cette puissante organisation.
Hélas! le mal n'a fait qu'empirer, et lorsque M. Paillotet, qui avait pour lui le plus tendre attachement, est accouru de Paris pour lui prodiguer les soins d'une pieuse amitié, il a compris qu'il n'y avait plus d'illusion à se faire.
Ce pauvre martyr ne pouvait plus prendre de nourriture qu'avec de douloureux efforts provoquant une toux cruelle et prolongée. Mais il ne voulait recevoir son ami que lorsque cette désolante crise était passée ; et alors, si la souffrance lui laissait quelques intervalles de calme, il lui dictait encore la suite de l'œuvre qui l'a préoccupé jusqu'au dernier moment.
Sans le séjour de Paris et la vie parlementaire, Frédéric Bastiat eût pu fournir une plus longue carrière. Ce climat-ci ne lui convenait point ; et ce qui lui convenait peut-être moins, c'est le spectacle des agitations, des intrigues et [105] des faiblesses qui s'opposent à la réalisation des réformes utiles, au triomphe de la vérité, à la pratique du bien.
L'Assemblée législative perd en lui un modèle de probité et d'indépendance; la science, un charmant écrivain qui avait reçu le rare et précieux don d'en faire comprendre la grandeur et de la rendre populaire : la France et le monde entier, on peut le dire, perdent une de ces nobles et fécondes intelligences dont le caractère et les travaux consolent et honorent l'humanité.
Text: ASEP version↩
[141]
Séance du 10 janvier 1851.
Dans cette réunion, M. Horace Say et plusieurs autres membres ont entretenu la Société des services éminents rendus par Frédéric Bastiat, et de la perte considérable que la science et le pays ont faite par sa mort. M. Horace Say a donné lecture d'une affectueuse lettre de M. Cobden.
La Société, touchée du dévouement de M. Paillottet pour son ami, a prié plusieurs de ses membres d'aller lui en témoigner sa vive reconnaissance.
La conversation s'est ensuite fixée sur le rapport légal des deux métaux monétaires, à propos de la diminution de la valeur de l'or. Une savante et instructive discussion historique a eu lieu surtout entre MM. Michel Chevalier, Ch. Coquelin et Quijano, mais elle a été trop technique et trop mêlée de faits numériques pour que nous puissions la reproduire.
Lettre non datée [1851 ???] [missing]↩
1851.?? 209 “Lettre non datée” (Undated letter) [*Journal des Économistes*] [CW1.209] [OC1]
Lettre de M. Carey, réponse de MM. Frédéric Bastiat et A. Clément [15 Jan. 1851] [missing]↩
1851.01.15 “Les Harmonies économiques. Lettre de M. Carey, réponse de MM. Frédéric Bastiat et A. Clément” (The Economic Harmonies. A Letter from M. Carey and Responses by Frédéric Bastiat and A. Clément) [*Journal des Économistes*, T. XXVIII, N° 117, 15 janvier 1851, p. 38-54]
Producteur — Consommateur [15 June 1851] [missing]↩
1851.06.15 “Producteur — Consommateur (article inédit) de Frédéric Bastiat” (Producer, Consumer. An unpublished article by Frédéric Bastiat) [*Journal des Économistes*, T. XXIX, N° 122, 15 juin 1851, pp. 97-110] [EH.11]
Lettre inédite de Frédéric Bastiat à Fonteyraud [Septembre et Octobre 1852]↩
1852.10.15 “Lettre inédite de Frédéric Bastiat à Fonteyraud” [An unpublished Letter from Frédéric Bastiat to Fonteyraud) [*Journal des Économistes*, T. XXXIII, N(os) 137 et 138, Septembre et Octobre 1852, pp. 189-94]
Lettres d’un habitant des Landes (1877)
Frédéric Bastiat, Lettres d’un habitant des Landes (Paris: A. Quantin, 1877). Anonymous editor. Probably Madame de Cheuvreux.
The Preface and Postface to this book have been removed because they were not written by Bastiat.
Table of Contents
- Novembre 1848 p. 9
- Janvier 1849 p. 10
- Vendredi, février 1849 p. 11
- Mercredi, février 1849 p. 12
- Lundi, mars 1849 p. 13
- 3 mai 1849 p. 16
- Juin 1849, Bruxelles, hôtel de Bellevue p. 19
- Juin 1849, Bruxelles p. 25
- Juin 1849, Notes prises d’Anvers p. 27
- 30 août 1849, Mont-de-Marsan p. 31
- 12 septembre 1849, Mugron p. 34
- 16 septembre 1849, Mugron p. 39
- 18 septembre 1849, Mugron p. 41
- 7 octobre 1849, Paris p. 48
- 8 octobre 1849 p. 50
- Novembre 1849, Paris p. 52
- 2 janvier 1850 p. 53
- Janvier 1850 p. 57
- Février 1850 p. 58
- Mars 1850, Paris p. 59
- Vendredi, avril 1850, Paris p. 62
- Mai 1850, Bordeaux p. 65
- 20 mai 1850, Mugron p. 69
- 23 mai 1850, Mugron p. 73
- 27 mai 1850, Mugron p. 76
- 11 juin 1850, Mugron p. 80
- 15 juin 1850 p. 85
- 23 juin 1850, Eaux-Bonnes p. 89
- 4 juillet 1850 p. 95
- 14 juillet 1850, Mugron p. 100
- [Editor's Note]
- 9 septembre, Paris p. 104
- 14 septembre 1850, Lyon p. 107
- Le soir, 14 septembre 1850, Lyon p. 113
- 18 septembre 1850, Marseille p. 115
- 22 septembre 1850, Marseille (à bord du Castor) p. 117
- 2 octobre 1850, Pise p. 120
- 14 octobre 1850, Pise p. 124
- 29 octobre 1850, Pise p. 127
- 8 décembre 1850, Rome p. 130
- Samedi 14 décembre 1850, Rome p. 132
- Lettre de M. Paillotet à Madame Cheuvreux, Rome, 22 décembre 1850 p. 135
[9]
LETTRES
Novembre 1848.↩
Madame,
Il y a, à l’hôtel Saint-Georges, trois santés tellement sympathiques entre elles que si l’une décline, les autres sont menacées. Permettez-moi de faire demander comment vous vous portez. À Mugron, dès neuf heures du matin, nous savions des nouvelles de tous nos amis. Ah ! croyez que la monotonie provinciale a ses compensations.
Si vous avez sous la main l’adresse du savant pharmacien qui a trouvé l’art de rendre supportable l’huile de foie de morue, veuillez me l’envoyer. Je voudrais bien que [10] ce précieux alchimiste pût m’enseigner le secret de faire aussi de l’économie politique épurée ; c’est un remède dont notre société malade a bon besoin, mais elle refuse d’en prendre la moindre cuillerée tant il est répugnant.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Janvier 1849. ↩
Madame,
On vient de me dire que, demain mardi, à deux heures, on exécutera dans l’église Saint-Louis d’Antin de la musique très-curieuse. Ce sont des chants du xiiie siècle, retrouvés aux archives de la sainte chapelle, et empreints de toute la naïveté de l’époque. D’autres assurent que ces chants ne peuvent être anciens, attendu qu’au xiiie siècle on ne connaissait pas l’art de noter la musique.
Quoi qu’il en soit, la solennité offrira un vif intérêt ; il y a là une question moins difficile à juger par impression que par érudition.
J’ai repris hier soir cet affreux breuvage, non sans un terrible combat entre mon [11] estomac et ma volonté. Est—il possible que quelque chose de si détestable soit bon, et messieurs les Médecins ne se moquent-ils pas de nous ?
Au reste, tous les remèdes sont désagréables.
Que faudrait-il à ma chère mademoiselle Louise ? Un peu plus de mouvement physique, un peu moins d’exercice mental : mais elle ne veut pas. Que faudrait-il à sa mère ? Rechercher un peu moins le martyre du salon : mais elle ne veut pas. Que m’ordonne-t-on ? L’huile de foie de morue ? décidément l’art de se bien porter, c’est l’art de se bien contrarier.
F. Bastiat.
Vendredi, février 1849. ↩
Madame,
Je viens de relancer Faucher au sujet de votre protégé ; il l’avait perdu de vue, hélas ! Combien peut-il contenir de pitié sous un front chargé des destinées de la République ! Cependant, il a promis.
Je n’ai aperçu hier aux Italiens ni M. Say, ni Léon, ni M. Cheuvreux ; avez-vous été [12] malade ? Mademoiselle Louise était-elle fatiguée de chant ou de correspondance ? ou bien est-ce pure fantaisie, déesse, dit-on, des Parisiennes ? Au reste, le spectacle était horriblement maussade : Alboni lourde, Ronconi faux, Bordogni nul, toilettes disgracieuses, etc., etc.
Voudriez-vous me faire savoir si vous désirez voir dimanche, en passant, le portail l’Auxerrois et ensuite la sainte Chapelle. Il me semble que Mlle Louise, qui aime tout ce qui est beau, admirera ce monument. Il marque, selon moi, le point extrême où soit parvenu l’art de substituer le vide au plein et le jour à la pierre, art qui paraît être perdu, à en juger par l’architecture moderne.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Mercredi, février 1849. ↩
Madame,
C’est avec un peu de confusion que je vous communique l’issue ressemblant à un fisaco, de ma démarche auprès de Faucher ; mais que voulez-vous, je suis le plus [13] mauvais solliciteur du monde. C’est peut-être heureux. En fait de sollicitations, si j’avais l’habitude du succès, qui sait où je m’arrêterais, puisqu’il est bien reconnu que je n’ai pas d’empire sur moi-même.
M. Ramel peut faire toucher au ministère de l’intérieur, 150 francs ; les formes administratives obligent de donner à cela le nom de secours et non de pension !
J’ai eu toute la nuit la musique d’hier soir dans la tête : Io vorrei saper perche et autres chants délicieux.
Adieu, Madame, je suis votre dévoué et celui de Mlle Louise.
F. Bastiat.
Lundi, mars 1849. ↩
Madame,
Décidément, j’ai laissé chez vous quelque chose de bien précieux ; quelque chose dont les hommes de mon âge ne devraient plus se séparer ; quelque chose que nous devrions toujours sentir sous la main, quand elle se porte sur le côté gauche de notre poitrine, quelque chose dont la [14] perte nous transforme en étourdis et en aveugles, en un mot, mes lunettes.
Si par hasard on les a retrouvées dans votre salon, je vous serai obligé de les faire remettre à ma messagère.
Je profite de cette occasion, pour avoir des nouvelles de la santé de votre Louisette, puisque c’est le nom que vous aimez à lui donner ; je serai heureux d’apprendre qu’elle pourra nous faire entendre demain sa douce voix ; avouez donc que vous en êtes orgueilleuse ?
Oh ! vous avez bien raison ; je n’ose pas trop le répéter ; mais j’aime mieux une romance chantée par elle, qu’un concert tout entier renforcé de vocalises et de tours de force ; après tout, n’est-ce pas la bonne règle de juger des choses et surtout des arts, par l’impression que nous en recevons ? Quand votre enfant chante, tous les cœurs sont attentifs, toutes les haleines suspendues, d’où je conclus que c’est la vraie musique.
Je défends intrépidement ma santé ; j’y tiens beaucoup, ayant la faiblesse de croire qu’elle pourrait encore être bonne à quelque chose.
Hier, je fus voir Mme de Planat. À travers [15] quelques brouillards germaniques, son intelligence laisse distinguer un grand fonds de bon sens, des appréciations neuves ; tout juste assez d’érudition pour qu’il n’y en ait pas trop ; et une parfaite impartialité : nos malheureuses discordes civiles ne troublent pas la sûreté de ses jugements ; c’est une femme qui pense par elle-même ; je voudrais que vous la connussiez. Mais elle m’a fait parler un peu trop.
Je n’ai pas été chez Victor Hugo, croyant qu’il demeurait au Marais ; si j’avais su qu’il habitât vos quartiers, j’aurais fait mon entrée dans son salon, qui doit être curieux, car la pente vers cette région de Paris est facile.
Adieu, je serre la main affectueusement à ce que vous nommez le Trio, que j’aime de tout mon cœur.
F. Bastiat.
[16]
3 mai 1849. ↩
Madame,
Permettez-moi de vous envoyer une copie de ma lettre aux électeurs. Ce n’es certes pas pour avoir votre avis politique, mais ces documents sont surtout une affaire de tact et de délicatesse. Il y fait parler beaucoup de soi, comment éviter la fausse modestie ou la vanité blessante ? Comment se montrer sensible à l’ingratitude, sans tomber dans la ridicule classe des incompris ? Il est bien difficile de concilier à la fois la dignité et la vérité. Il me semble qu’une femme est surtout propre à signaler les fautes de ce genre si elle veut avoir la franchise de les dire. C’est pour cela que je vous envoie ce factum, espérant que vous voudrez bien le lire et m’aider au besoin à éviter des inconvenances. J’ai appris que vous rouvriez vos salons ce soir. Si je puis m’échapper d’une réunion où je serai retenu un peu tard, j’irai recevoir vos conseils. N’est-ce pas une singulière mission que je vous donne, et le cas de dire avec Faucher : « Il faut bien venir des grandes Landes pour être galant de cette manière. »
[17]
Avez-vous eu la patience de lire la séance d’hier [2] ? Quelle triste lutte ! Selon moi, un acte d’une moralité plus que douteuse serait devenu excusable par un simple aveu, d’autant que la responsabilité en remontait aux prédécesseurs de Faucher. C’est le système de défense qui est pitoyable. Et puis les représentants, aspirants ministres, sont venus envenimer et exploiter la faute. Ah ! madame, suis-je condamné à tomber ici de déception en déception ! Faudra-t-il que, parti croyant de mon pays, j’y rentre sceptique ? Ce n’est pas ma foi en l’humanité que je crains de perdre ; elle est inébranlable ; mais j’ai besoin de croire aussi en quelques-uns de mes contemporains, aux personnes que je vous et qui m’entourent. La foi en une généralité ne suffit pas.
Voici une brochure sur Biarritz, je suis sûr qu’en la lisant vous direz : C’est là qu’il fait nous rendre [3] pour faire une forte constitution à ma bien-aimée Louise. »
L’auteur de cette brochure voulait que je [18] la remisse à un de mes amis placé auprès du président de la République (toujours ce Protée de la sollicitation) ; je n’ai pu m’acquitter de sa commission à cause du mot prince, effacé maladroitement devant le mot Joinville ; cet auteur médecin m’avait aussi prié de faire sa préface en matière de réclame. « Mais je n’entends rien en médecine, lui dis-je. — Eh bien, cachez la science derrière le sentiment. » Je me mis donc à l’œuvre. Cette introduction n’a d’autre mérite qu’une certaine sobriété de descriptions, sobriété peu à la mode. Comme je suis passionné pour Biarritz, je cherche à faire de la propagande.
Mais quelle longue lettre ! je vais distancer M. Blondel.
Adieu, madame.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
[19]
Bruxelles, hôtel de Bellevue, juin 1849. ↩
Madame,
Vous avez désiré que je vous envoie mes impressions de voyage jetées pêle-mêle sur le papier ; ne saviez-vous pas que le journal a ses dangers ? Il ressemble aux mémoires, on n’y parle que de soi. Oh ! que j’aimerais mieux vous entretenir de vous, de votre Louise bien-aimée, de ses occupations, de ses plaisirs, de ses perspectives, de la Jonchère et quelque peu aussi du Buttard [4] : là tout est poésie, on n’en peut dire autant du Brabant, cette terre classique du travail, de l’ordre, de l’économie et des estomacs satisfaits ; au reste, je n’en parle que par ouï dire, car je n’y suis que depuis hier soir, et ne l’ai vue que par la fenêtre ; à la vérité elle me sert bien puisqu’elle étale devant mes yeux le palais du roi. Ainsi, il y a quelques [20] heures, je respirais un air infecté de républicanisme ; et, me voici plongé dans une atmosphère monarchique ; et bien ! le croiriez-vous, je ne me suis pas même aperçu de la transition ; le dernier mot que j’ai entendu de l’autre côté de la frontière est justement le même qu’on m’a adressé de celui-ci : « Votre passe-port. » Hélas ! je n’en avais pas. Un moment, j’ai espéré qu’on allait me renvoyer à Paris et le cœur m’a battu ; mais tout se civilise, même le gendarme, même le douanier ; bref, on m’a laissé passer, en me recommandant de venir faire une déclaration au ministère de la justice, car, ajoutait le gendarme, « nous y avons été pris plusieurs fois et récemment encore nous avons failli laisser échapper M. Proudhon. » — « Je ne suis pas surpris, ai-je répondu, que vous soyez devenu si avisé, et certes j’irai faire ma déclaration pour encourager la gendarmerie dans cette voie. »
Mais reprenons les choses de plus haut ; samedi, en sortant de la séance (vous voyez que j’écris un journal consciencieux) j’articule le mot Bruxelles : « J’y vais demain, à huit heures et demie, dit Barthélemy Saint-Hilaire, partons ensemble. » Là-dessus je me [21] rends rue La Fayette, croyant arriver à l’heure dite ; le convoi était parti, il m’a fallu attendre celui de midi. Que faire dans l’intervalle ? La butte Montmartre n’est pas loin et l’horizon y est sans bornes. Vers cinq heures, nous avons passé de France à Belgique et j’ai été surpris de n’éprouver aucune émotion ; ce n’est pas ainsi que je franchis pour la première fois notre frontière ; mais, j’avais dix-huit ans et j’entrais en Espagne ! C’était au temps de la guerre civile ; j’étais monté sur un superbe coursier navarrais, et toujours homme de précaution, j’avais mis une paire de pistolets dans mon porte-manteau ; car l’Ibérie est la terre des grandes aventures ; ces distractions sont inconnues en Belgique ; serait-il vrai que la bonne police tue la poésie ? Je me rappelle encore l’impression que faisaient sur moi les fiers Castillans quand je les rencontrais sur une route, à cheval, et flanqués de deux escopettes. Ils avaient l’air de dire : Je ne paie personne pour me protéger, mais je me protége moi-même. Dans tous les genres, il semble que la civilisation qui élève le niveau des masses diminue la valeur des caractères individuels ; je crains que ce pays-ci ne confirme l’observation.
[22]
Il est impossible de n’être pas frappé de l’aspect d’aisance et de bien-être qu’offre la Belgique : d’immenses usines qu’on rencontre à chaque pas, annoncent au voyageur une heureuse confiance en l’avenir ; je me demande si le monde industriel, avec ses monuments, son confort, ses chemins de fer, sa vapeur, ses télégraphes électriques, ses torrents de livres et de journaux, réalisant l’ubiquité, la gratuité et la communauté des biens matériels et intellectuels, n’aura pas aussi sa poésie, poésie collective, bien entendu. N’y a-t-il d’idéal que dans les mœurs bibliques, guerrières ou féodales ? Faut-il, sous ce rapport, regretter la sauvagerie, la barbarie, la chevalerie ? Ne ce cas, c’est en vain que je cherche l’harmonie dans la civilisation ; car l’harmonie est incompatible avec le prosaïsme. Mais, je crois que ce qui nous fait apparaître sous des couleurs si poétiques les temps passés, la tente de l’Arabe, la grotte de l’anachorète, le donjon du châtelain, c’est la distance ; c’est l’illusion de l’optique ; nous admirons ce qui tranche sur nos habitudes ; la vie du désert nous émeut, pendant qu’Abd-el-Kader s’extasie sur les merveilles de la civilisation. Croyez-vous [21] qu’il y ait jamais eu autant de poésie dans une des héroïnes de l’antiquité que dans une femme de notre époque ? Que leur esprit fût aussi cultivé, leurs sentiments aussi délicats, qu’elles eussent la même tendresse de cœur, la même grâce de mouvements et de langage ?
Oh ! ne calomnions pas la civilisation !
Pardonnez-moi, mesdames, cette dissertation, vous l’avez voulue, en me disant d’écrire au hasard, avec abandon ; c’est ce que je fais ; il faut bien que je laisse aller la tête, car deux sources d’idées me sont fermées : les yeux et le cœur ; mes pauvres yeux ne savent pas voir ; la nature leur a refusé l’étendue et la rapidité ; je ne puis donc faire ni descriptions de villes ou de paysages. Quant à mon cœur, il en est réduit à essayer d’aimer une abstraction, à se passionner pour l’humanité, pour la science ; d’autres portent leurs aspirations vers Dieu ; ce n’est pas trop des deux ; c’est ce que je pensais, tout à l’heure en sortant d’une salle d’asile dirigée par des religieuses vouées à soigner des enfants malades, idiots, rachitiques, scrofuleux ; quel dévouement ! quelle abnégation ! Et après tout cette vie de sacrifice [24] ne doit pas être douloureuse, puisqu’elle laisse sur la physionomie de telles empreintes de sérénité. Quelques économistes nient le bien que font ces saintes femmes ; ce dont on ne peut douter, c’est la sympathique influence d’un tel spectacle : il touche, il attendrit, il élève ; on se sent meilleur, on se sent capable d’une lointaine imitation, à l’aspect d’une vertu si sublime et si modeste.
Le papier me manque, sans quoi vous n’échapperiez pas à un long commentaire sur le catholicisme, le protestantisme, le pape et M. de Falloux.
Donnez-moi des nouvelles de M. Cheuvreux ; puisse-t-il trouver aux aux la santé et le calme moral, si troublé par les agitations de notre triste politique ! Il n’est pas comme moi, un être isolé et sans responsabilité. Il pense à vous et à sa Louise ; je comprends son irritation contre les perturbateurs et me reproche de ne l’avoir pas toujours assez respectée.
Adieu, je présente mes hommages à la mère et à la fille.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
[25]
Bruxelles, Juin 1849. ↩
Madame,
L’absence de votre beau-frère fera un mauvais effet sur les amis de la paix ; ils s’attendent à une réception qu’ils ne trouveront pas. M. Say est du nombre de ceux qui ont signé l’invitation. Sur cette circulaire plusieurs centaines d’étrangers vont se rendre à Paris, les uns traversant la Manche, les autres l’Océan ; ils s’imaginent trouver chez nous un zèle ardent. Quelle déception, quand on verra la cause de la paix en France représentée pas Guillaumin, Garnier et Bastiat. En Angleterre elle met en mouvement les populations entières, hommes et femmes, prêtres et laïques ; faut-il que mon pays se laisse toujours devancer ?
Je rentrerai à Paris en passant par Gand et Bruges ; je voudrais arriver deux jours avant le Congrès, pour savoir quelles dispositions ont été prises ; car, je vous avoue, que je me sens inquiet sur ce point ; il faut, au moins, que je m’acquitte des devoirs de l’hospitalité envers Cobden ; pour cela peut-être aurais-je recours à votre inépuisable [26] bonté ; je vous demanderai la permission de vous présenter un des hommes les plus remarquables de notre temps. Si je parviens, comme je l’espère, à arriver à Paris samedi, je prendrai la liberté d’aller dimanche à la Jonchère ; n’y trouverais-je rien de changé ?
Mlle Louise sera-t-elle en pleine possession de sa santé et de sa voix ? C’est une bien douce, mais bien impérieuse habitude, que celle d’être informé, jour par jour, de ce qui intéresse ; elle rend pénible la plus courte absence.
Tout bien considéré, mesdames, permettez-moi de ne pas abuser de votre indulgence et de retenir la relation de ma pointe sur Anvers. À quoi bon vous l’envoyer et vous donner la fatigue d’une lecture quand je pourrai y suppléer bientôt par quelques minutes de conversation. D’ailleurs en relisant ces notes, je m’aperçois qu’elles parlent de tout, excepté d’Anvers. J’ai trouvé les Belges très-fiers du bon sens dont ils ont fait preuve pendant ces deux dernières années de troubles européens ; ils se sont hâtés de mettre fin à leurs discordes par des concessions réciproques ; le Roi a donné l’exemple, les Chambres et le peuple ont suivi ; bref, ils [27] sont tous enchantés les uns des autres et d’eux-mêmes. Cependant les doctrines socialistes et communistes ne cessent de continuer leur œuvre souterraine et il me semble qu’on en est assez effrayé. Cela a fait surgir dans ma tête un projet que je vous communiquerai ; mais qu’est-ce que des projets ? Ils ressemblent à ces petites bulles qui paraissent et disparaissent à la surface d’une eau agitée.
Adieu, madame ; n’allez pas croire qu’il en est des sentiments comme des projets ; l’affection que je sens pour vous, pour votre famille, est trop profonde, elle a des bases trop solides pour ne pas durer autant que ma vie et j’espère au delà.
F. Bastiat.
Juin 1849. ↩
notes prises d’anvers
Les extrêmes se touchent. C’est ce qu’on éprouve en chemin de fer : l’extrême multiplicité des impressions les annule. On [28] voit trop de choses pour voir quelque chose. Singulière manière de voyager ; on ne parle pas ; l’œil et l’oreille s’endorment ; on se renferme avec sa pensée, dans la solitude. Le présent qui devrait être tout, n’est rien. Mais aussi, avec quel attendrissement le cœur revient sur le passé ; avec quelle avidité il s’élance vers l’avenir. « Il y a huit jours… dans huit jours. » Ne voilà-t-il pas des textes de méditations bien choisis, quand, pour la première fois, et Vilvorde, et Malines, et le Brabant fuient sous un regard qui ne regarde pas ! Ce matin j’étais à Bruxelles ; ce soir à cinq heures j’étais encore à Bruxelles ; dans l’intervalle j’ai vu Anvers, ses églises, son musée, son port, ses fortifications. Est-ce là voyager ? J’appelle voyager, pénétrer la société qu’on visite ; connaître l’état des esprits, les goûts, les occupations, les plaisirs, les relations des classes, le niveau moral, intellectuel et artistique auquel elles sont parvenues ; ce qu’ont peut en attendre pour l’avancement de l’humanité ; je voudrais interroger les hommes d’État, les négociants, les laboureurs, les ouvriers, les enfants, les femmes surtout, puisque ce sont les femmes [29] qui préparent les générations et dirigent les mœurs.
Au lieu de cela, on me montre une centaine de tableaux, cinquante confessionnaux, vingt clochers, je ne sais combien de statues en pierre, en marbre, en bois ; et l’on me dit : Voilà la Belgique.
À la vérité, il y a pour l’observateur une ressource c’est la table d’hôte ; elle réunissait aujourd’hui autour d’elle, soixante dîneurs, dont pas un belge ; on y remarquait cinq Français et cinq longues barbes ; les cinq longues barbes appartenaient aux cinq Français, ou plutôt les cinq Français aux cinq barbes, car il ne faut pas prendre le principal pour l’accessoire.
Aussitôt, je me suis posé cette question : Pourquoi les Belges, les Anglais, les Hollandais, les Allemands se rasent-ils ? Et pourquoi les Français ne se rasent-ils pas ? En tout pays les hommes aiment à laisser croire qu’ils possèdent les qualités qu’on y prise le plus ; si la mode tournait aux perruques blondes, je me dirais que ce peuple est efféminé ; si dans les portraits je remarquais un développement exagéré du front, je penserais : ce peuple a voué un culte à l’intelligence ; quand [30] les sauvages se défigurent pour se rendre effroyables, j’en conclus qu’ils placent au-dessus de tout la force brutale. C’est pourquoi, j’éprouvais aujourd’hui un sentiment d’humiliation pénible, en voyant tous les efforts de mes compatriotes pour se donner l’air farouche : pourquoi cette barbe et ces moustaches ? Pourquoi ce tatouage militaire ? À qui veulent-ils faire peur et pourquoi ? La peur ! Est-ce là le tribut que mon pays apporte à la civilisation ?
Ce ne sont pas seulement les commis voyageurs qui donnent dans ce ridicule travers ; ne serait-ce pas aux femmes à le combattre ? Mais, est-ce là tout ce que je rapporte d’Anvers ? Il valait bien la peine de faire des lieues sans fin ni compte. J’ai vu des Rubens dans leur patrie ; vous pensez bien que j’ai cherché dans la nature vivante les modèles de ces amples carnations que reproduit si complaisamment le maître de l’école flamande. Je ne les ai pas trouvés, car vraiment, je crois que la race brabançonne est au-dessous de la race normande. On me dit d’aller à Bruges ; j’irais à Amsterdam si c’était mon type de prédilection ; ces chairs rouges ne sont pas mon idéal. Le sentiment, [31] la grâce : voilà le femme, ou du moins la femme digne du pinceau.
F. Bastiat.
Mont-de-Marsan, 30 août 1849. ↩
Madame,
Les organisation un peu éthériques ont le malheur d’être fort sensibles aux contrariétés et aux déceptions ; mais combien elles le sont aussi aux joies inattendues qui leur arrivent ! Qui m’aurait dit que je recevrais aujourd’hui des nouvelles de la Jonchère. L’espace fait l’effet du temps, et parce que je suis séparé de mon cher Buttard par beaucoup de lieues, il me semble que j’en suis séparé aussi par beaucoup de jours passés et à venir ; vous et Mlle Louise, qui êtres si indulgentes, vous me pardonnerez mon expansion à ce sujet ; c’est peut-être parce que je me sens profondément dégoûté du sentimentalisme politique et sociale que je suis devenu un peu sentimental en affection : que voulez-vous, le cœur a besoin de revanche, et puis, mère et fille, je ne sais comment vous faites, vous [32] avez le don et l’art de rendre si contents, si heureux tous ceux qui vous approchent, qu’ils sont bien excusables d’en laisser paraître quelque chose. J’étais sûre que M. Cheuvreux regretterait ne n’avoir pu s’associer à vous pour le bon accueil fait à Cobden chez lui… Mais je suis bien aise de l’apprendre. N’aurait-il pas pu trouver un peu indiscrète ma manière d’exercer l’hospitalité ? Je voulais que la France et l’Angleterre se présentassent l’une à l’autre sous leur plus beau jour. Avec les dames Cheuvreux j’étais fier de Cobden ; avec Cobden j’étais fier des dames Cheuvreux. Il fait que ces insulaires sachent bien que chacun des deux pays a quelque chose à envier à l’autre. C’est d’un bon augure que M. Cheuvreux prolonge son séjour aux eaux, cela prouve qu’il s’en trouve bien.
Le voyage aurait dû me fatiguer davantage ; deux diligences marchaient toujours de conserve, la nôtre à la suite, c’est-à-dire dans un nuage de poussière. J’avais de tristes compagnons de route ; grâce au ciel je me parle à moi-même, et l’imagination me suffit ; elle a produit le plus beau plan, le plus utile à l’humanité qu’on puisse concevoir ; il ne [33] manque plus que la mise en œuvre ; mais encore cette fois j’en serai pour les bonnes intentions. — Que Dieu m’en tienne compte, et je suis sauvé !
Jugez, mesdames, comme je dois trouver amusant d’être retenu ici par le conseil général, sachant que ma tante et mon ami m’attendent à Mugron : ce n’est pas tout, je porte le poids de ma renommée ; ne m’avait-on point réservé les dossiers les plus ardus pour me faire les honneurs de la session ? C’était le cas d’être modeste et Gascon ; j’ai été l’un et l’autre ; et, pour me délivrer de cette étrange politesse, j’ai parlé de ma fatigue ; cependant je en perds pas l’occasion de faire de la propagande économiste, attendu que notre préfet vient d’infecter son discours de socialisme ; cette lèpre prend partout. Demain je saurai laquelle des deux écoles aura la majorité au conseil. Mes concitoyens sont excellents pour moi : ils ont bien des petites peccadilles à me reprocher, mais ils me traitent en enfant gâté, et semble comprendre qu’il faut me laisser agir, travailler et voter capricieusement.
Je voudrais porter à Mlle Louise un souvenir de nos Landes, mais quoi ? Irai-je [34] chercher à Bayonne quelques romances très-tendres du temps de la Restauration, ou bien des boléros espagnols ?
Mesdames, prenez pitié d’un pauvre exilé : n’est-pas singulier d’être exilé quand on est chez soi ? Pour le coup, vous allez me dire que j’aime les paradoxes, celui-là est une vérité bien sentie. Donc écrivez-moi de temps en temps ; je n’ose trop demander ce sacrifice à Mlle Louise : je vous prie d’agréer l’une et l’autre l’expression de mon attachement.
F. Bastiat.
Mugron, 12 septembre 1849. ↩
Madame,
Il me semble que vingt courriers sont arrivés sans m’apporter de lettres. Le temps, comme ma montre, s’est-il arrêté depuis mon retour ici ? ou bien Mlle Louise m’a-t-elle pris au mot ? Mais un savant calcul, déjà refait cent fois, m’avertit qu’il n’y a pas huit jours que ma lettre est partie. Ce n’est pas votre chère fille qui a tort, c’est mon impatience. Je voudrais savoir si M. Cheuvreux [35] vous est revenu en possession de toute sa santé, si vous-même êtes délivrée de ces tristes insomnies ; enfin, s’il y a autant de bonheur à la Jonchère qu’en on mérite, et que j’en souhaite ? Que le télégraphe électrique sera une bonne invention quand on le mettra au service de l’amitié !! Peut-être un jour aura-t-elle une lorgnette qui lui permette de voir à deux cent lieues. L’éloignement alors serait supportable ; maintenant, par exemple, je la tournerais vers votre salon. Mlle Louise est au piano ; je devine, à sa physionomie, la romance qu’elle chante. M. Cheuvreux et vous éprouvez la plus douce joie qu’on puisse ressentir sur cette terre, vos amis oublient que le dernier convoi va passer. — Ce tableau fait du bien au cœur. — Est-ce qu’il y aurait quelque chose de déplacé et de par trop provincial à vous dire que ce spectacle de vertus, de bonheur et d’union, dont votre famille m’a rendu témoin, a été pour moi un antidote contre le scepticisme à la mode, et un préservatif contre le préjugé anti-parisien. Que signifie cette apostrophe de Rousseau : « Paris, ville de boue, etc. ? » Tout à l’heure il m’est tombé sous la main un roman de Jules Janin. Quelle triste et [36] funeste peinture de la société ! — « L’écurie et l’Église se tiennent, » dit-il, pour exprimer qu’on est estimé à Paris que par le cheval qu’on fait parader au bois, ou par l’hypocrisie. Dites-moi, je vous prie, que vous n’avez jamais connu cet homme, ou plutôt qu’il ne vous a jamais connus. — Ces romanciers, à force de présenter la richesse et l’égoïsme comme deux faces d’une même médaille, ont fourni des armes aux déclamations socialistes. J’avais besoin pour mes harmonies de m’assurer que la fortune non-seulement est compatible avec les qualités du cœur, mais qu’elle les perfectionne. Je suis fixé maintenant, et me sens proof, comme disent les Anglais, contre le scepticisme.
À présent, madame, voulez-vous que je vous passe un instant ma lorgnette merveilleuse ? Vraiment, je voudrais que vous pussiez voir derrière le rideau ces scènes de la vie de province : le matin, nous nous promenons dans ma chambre, Félix et moi, lisant quelques pages de Mme de Staël ou un psaume de David ; à la nuit tombante, je vais cherche au cimetière une tombe, mon pied la sait, la voilà ! Le soir, quatre heures de [37] tête-à-tête avec ma bonne tante. Pendant que je suis enfoncé dans mon Shakespeare, elle parle avec l’animation la plus sincère, ayant la complaisance de faire les demandes et les réponses. Mais voici que la femme de chambre, qui se doute que les heures sont longues, se croit obligée de les varier ; elle survient et nous raconte ses tribulations électorales. La pauvre fille a fait de la propagande pour moi : on lui objectait toujours le libre échange ; elle, d’argumenter. Hélas ! quels arguments ; elle me les répète avec orgueil, et pendant qu’elle disserte en jargon basque, patois et français, je me rappelle ce mot de Patru : « Rien de tel qu’un mauvais avocat pour gâter une bonne cause. » Enfin l’heure du souper arrive, chiens et chats font irruptions dans la salle, escortant la garbure. Ma tante entre en fureur. « Maudites bêtes ! s’écrie-t-elle, voyez comme elles s’enhardissent dès que Monsieur arrive ! » Pauvre tante ! cette grande colère n’est qu’une ruse de sa tendresse ; traduisez : voyez comme Frédéric est bon. Je ne dis pas que cela soit, mais ma tante veut qu’on le pense.
Je vous le disais bien, madame, que des lettres du village sont redoutables, nous ne [38] pouvons trouver nos sujets épistolaires que dans le milieu qui nous environne ou dans notre propre fonds.
Quel milieu que Paris pour celui qui écrit ! arts, politique, nouvelles, tout abonde ; mais ici l’extérieur est stérile. Il faut avoir recours à l’autre monde, celui de l’intimité. En un mot, il faut parler de soi ; cette considération aurait dû me déterminer à choisir le plus petit format ; au lieu de cela, je vous envoie maladroitement un arpent de bavardage ; ce qui me rassure, c’est que mon indiscrétion aura beau faire, elle n’épuisera pas votre indulgence.
Je crois que la prorogation a calmé quelque peu l’effervescence politique ; ce serait un grand bien et, sous ce rapport, il faudrait désirer qu’elle ne fût pas si près de son terme. Je voudrais qu’à notre retour le ministère nous livrât en pâture une foule de loi pour absorber notre temps et nous détourner de débats stériles, ou plutôt fertiles, seulement, en haines et exagération.
Veuillez exprimer à M. Cheuvreux et à Mlle Louise tout le plaisir que je me promets de les revoir bientôt. Peut-être le dimanche [39] 30 septembre me retrouverai-je à la Jonchère.
Si je suis à Paris, j’irai m’offrir pour cavalier à Mme Girard, heureux d’être le confident de ses joies et de ses sollicitudes maternelles. Quant aux touristes, je me propose d’écrire prochainement à M. Say.
Adieu, madame, permettez-moi de vous assurer de ma respectueuse affection.
F. Bastiat.
Mugron, 16 septembre 1849. ↩
Vous êtes probablement de retour des eaux, mon cher monsieur Cheuvreux. Je suis un peu surpris d’en être réduit aux conjectures.
Il est de triste époques où les imaginations ébranlées se frappent aisément ; peut-on s’éloigner de Paris sans songer qu’on y a laissé le choléra ? Le silence de nos amis, pénible en tout temps, devient aujourd’hui difficile à supporter.
[40]
La pureté de la Jonchère me rassure. Mais vous avez de nombreux parents à Paris, et vous-même n’y êtes-vous pas retenu presque tous les jours par vos devoirs judiciaires ? Ces dames n’ont pas songé, sans doute, à m’épargner ce genre d’inquiétude. J’aime à attribuer leur silence à des causes moins lugubres : affaires, plaisirs, promenades, visites, musique, causeries, etc., et puis elles ont tant de correspondants ! Il faut bien que chacun attende son tour ; cependant je serais heureux d’apprendre que l’on jouit d’une bonne santé chez vous, chez M. Say, chez les Renouard, à Croissy, etc.
En arrivant ici, j’ai organisé une chasse aux ortolans. J’en partage le produit entre l’hôtel Saint-Georges et la rue Boursault.
Hier, pour mettre de l’ordre dans cette affaire de chasse, je suis allé passer la journée à la campagne, où j’ai vécu autrefois tantôt seul, tantôt entouré. Il y a une grande similitude entre ce pays-ci et celui que vous habitez : chaîné de coteaux, rivière au pied et plaines indéfinies au delà ; le village est au sommet du coteau, ma propriété sur la rive opposée au fleuve. Mais si l’art a plus [41] fait sur les bords de la Seine, la nature est plus nature sur ceux de l’Adour. Il me serait impossible de vous dire l’impression que j’ai éprouvée en revoyant ces longues avenues de vieux chènes, cette maison aux appartements immenses, qui n’ont de meubles que les souvenirs, ces paysans aux vêtements de couleur tranchée, parlant une langue naïve que ne ne puis m’empêcher d’associer avec la vie des champs ; car il me semble toujours qu’un homme en blouse et en casquette, parlant français, n’est pas paysan pour de bon ; et puis ces rapports bienveillants de propriétaire à métayer me paraissent, par l’habitude, une autre condition indispensable pour constituer la vraie campagne. Quel ciel ! quelles nuits ! quelles ténèbres ! quel silence, interrompu seulement par l’aboiement lointain des chiens qui se répondent, ou par la note vibrante et prolongée que projette dans l’espace la voix mélancolique de quelque bouvier attardé ! Ces scènes parlent plus au cœur qu’aux yeux.
Mais me voici de retour au village. Le village ! c’est devenu un degré vers Paris. On y lit la gazette. On y dispute, selon le temps, sur Taïti, ou Saint-Jean d’Acre, sur Rome [42] ou Comorn [5] . Je comptais sur les vacances pour calmer un peu les effervescences politiques ; mais voici que le souffle des passions se ranime. La France est de nouveau placée entre deux impossibilités. La république a été amenée par la ruse et la violence sur un terrain où le légitimisme la battra très-logiquement. Il est triste de penser que M. de Falloux est conséquent et que la France du xixe ne l’est pas. La population a pourtant du bon sens ; elle veut le bien et le comprend ; mais elle a désappris à agir par elle-même. Quelques mouches du coche parviennent toujours à la lancer dans des difficultés inextricables. Mais laissons ce triste sujet.
J’espérais avancer ici mon livre [6] , nouvelle déception. Du reste, je ne suis plus si pressé, car au lieu d’une actualité, il s’est transformé en un ouvrage de pure doctrine et ne pourra avoir d’effet, s’il en a, que sur quelques théoriciens. La véritable solution du problème social aurait besoin, tout en s’appuyant sur un gros livre, d’être propagée par un journal. J’ai quelque idée d’entreprendre une [43] publication mensuelle comme celles de Lamartine et de Louis Blanc. Il me semble que notre doctrine gagnerait comme un incendie, ou plutôt comme une lumière, car elle n’a certes rien d’incendiaire. Partout où je la prêche, je trouve les esprits merveilleusement disposés à la recevoir. J’en ai fait l’expérience sur mes collègues du conseil général. Deux obstacles m’effrayent : la santé et le cautionnement. Nous en causerons bientôt, car j’ai l’espoir de passer avec vous la journée du 30 septembre.
Adieu, mon cher monsieur, si vous avez un moment à perdre, épargnez à ces dames la peine de m’écrire. Veuillez les assurer que le régime de privation où elles me tiennent ne me fait pas oublier leur bienveillance inépuisable.
F. Bastiat.
Mugron 18 septembre 1849. ↩
Madame,
Il y a un fond de tristesse dans votre lettre, madame, c’est bien naturel. Vous veniez de perdre une amie d’enfance. Dans ces circonstances, le premier sentiment est [44] celui du regret, ensuite on jette un regard troublé sur son entourage, et on finit par faire un retour sur soi-même ; l’esprit interroge le grand inconnu et, ne recevant aucune réponse, il s’épouvante ; c’est qu’il y a là un mystère qui n’est pas accessible à l’esprit, mais au cœur. — Peut-on douter sur un tombeau ? Madame, permettez-moi de vous rappeler que que vous n’avez pas le droit d’être longtemps triste. Votre âme est un diapazon pour tous ceux qui vous chérissent et vous être tenue d’être heureuse, sous peine de rendre malheureux votre mère, votre mari et cette délicieuse enfant que vous aimez tant que vous forceriez tout le monde à l’aimer, si elle n’y pourvoyait fort bien elle-même.
Mes idées ont pris la même direction, car nous avons aussi nos épreuves ; le choléra n’a pas visité ce pays, mais li y a envoyé un fâcheux émissaire : la femme de chambre de ma tante est gravement atteinte ; on espère pourtant la sauver ; du même coup il semble que ma tante a perdu vingt ans, car elle est sur pied nuit et jour. Pour moi, je m’humilie devant de tels dévouements, et je vous soutiendrai toujours, mesdames, que [45] vous valez cent fois plus que nous. Il est vrai que je ne suis pas d’accord avec les autres économistes sur le sens du mot valeur [7] .
Vouliez-vous me railler, madame, en me reprochant de ne pas écrire ? — Cinq lettres en quatre semaines ! Mais qu’est donc devenue la précieuse missive dont vous me parlez ? Je ne me consolerais pas qu’elle fût définitivement égarée.
Quel sujet traitait M. Augier pour que vous ayez eu l’aimable attention de m’adresser son œuvre ? J’aime bien les vers du jeune poëte, et je me rappellerai la vive impression que nous avons ressentie à la lecture de son drame [8] . Enfin cette pièce pourra se retrouver ; il en a sans doute conservé la copie, et li voudra bien me la communiquer.
Mais votre lettre, celle de Mlle Louise sont-elles perdues pour toujours ? En ce cas serez-vous en état de me les réciter ? Soyez sûre que je vous le demanderai.
C’est samedi que je pars pour Bayonne ; je n’ai plus que quatre jours à rester ici. Quoique Mugron soit la monotonie réalisée, [46] je regretterai ce séjour de calme, cette parfaite indépendance, cette libre disposition de tout mon temps, ces heures si semblables l’une à l’autre qu’on ne les distingue pas.
L’uniforme habitude
Qui lie au jour le jour ;
Point de gloire ou d’étude,
Rien que la solitude,
La prière et. . . .
Je n’achète pas le vers, car mon maître de littérature m’a appris qu’il ne fallait jamais sacrifier la raison à la rime.
Le 19. — Dans deux heures, j’irai moi-même à Tartas pour remettre au courrier les boîtes contenant des ortolans. Ils partiront jeudi matin et arriveront à Paris samedi ; si, par hasard, on ne les portait pas à l’hôtel Saint-Georges, il faudrait que vous prissiez la peine de faire passer à la poste ; car la ponctualité est nécessaire envers ces petites bêtes.
Je souhaite que mes compatriotes ne se laissent pas corrompre en route, et que vous n’ayez pas à répéter le mot de Faucher à propos des incompatibilités : « Que peut-il venir de bon des grandes Landes ? » Notre ami de [47] Labadie est déjà une bonne protestation ; qu’en pensez-vous, mademoiselle Louise ? Puisque je m’adresse à vous, laissez-moi dire que mes pauvres oreilles sont ici comme dans le vide. Elles ont faim et soif de musique. Réservez-moi une jolie romance, tout ce qu’il y a de plus mineur. Ne voudrez-vous pas aussi perfectionner cette « Nuit des Tropiques » ? Elle finira par vous plaire.
De la musique aux Harmonies la transition est bien tentante. Mais comme il s’agit d’harmonies économiques, cela refroidit un peu. Aussi je ne vous en parlerai pas ; seulement je vous avouerai que mon livre, à cause des développements auxquels j’ai été entraîné, ne touchera plus que les hommes du métier ; je suis donc à peu près résolu, ainsi que je l’ai dit à M. Cheuvreux, à entreprendre une publication mensuelle. Je m’adresserai à vous pour placer des billets. En fait de journaux le placement importe au moins autant que la confection. C’est ce que nos confrères oublient trop. Il faudra que vous intéressiez les femmes à cette œuvre.
Adieu, madame, rappelez-moi au souvenir de M. Cheuvreux. Je ne suis pas surpris qu’il trouve que l’air de la Jonchère vaut mieux [48] que celui de Vichy. Je prie Mlle Louise de me permettre le mot amitié. On est toujours embarrassé avec ces charmantes créatures ; hommages, c’est bien respectueux ; affection, c’est bien familier. Il y a de tout cela ; et on ne sait comment l’exprimer. Il faut qu’elles devinent un peu.
Votre bien dévoué,
F. Bastiat.
Paris, 7 octobre 1849. ↩
Madame,
Il m’arrive ce matin de mes chères Landes une caisse que je suppose contenir des ortolans. Je vous l’envoie sans l’ouvrir. Si c’était des bas de laine ! Oh ! je serais bien confus ; mais en fin j’en serais quitte pour quelques plaisanteries. Hier soir, dans mon empressement et avec le tact qui me caractérise, je suis arrivé chez M. Say au beau milieu du dîner. Pour célébrer la réouverture des lundis, tous les amis se trouvaient là. L’entrain était grand à en juger par les éclats qui me parvenaient au salon. Le vestibule [49] orné de nombreuses pelisses noires, blanches, roses, annonçait qu’il n’y avait pas que des économistes. Après le dîner je m’approche de la belle-sœur de M. D… et, sachant qu’elle arrivait de Belgique, je lui demande si ce voyage avait été agréable. Voici sa réponse : « Monsieur, j’ai éprouvé l’indicible bonheur de ne voir la figure d’aucun républicain parce que je les déteste. » La conversation ne pouvait se soutenir longtemps sur ce texte, je m’adresse donc à sa voisine, qui se met à me parler des douces impressions que lui avait fait éprouver le royalisme belge. « Quand le roi passe, disait-elle, tout est fête : cris de joie, devises, banderoles, rubans et lampions. » Je vois bien que pour ne pas trop déplaire aux dames il faut se hâter d’élire un roi. L’embarras est de savoir lequel, car nous en avons trois en perspective ; qui l’emportera (après une guerre civile) ?
Force m’a été de me réfugier vers les groupes masculins, car vraiment la passion politique grimace sur la figure des femmes. Ces messieurs mettaient leur scepticisme en commun. Fameux propagandistes qui ne croient pas à ce qu’ils prêchent. Ou, plutôt [50] ils ne doutent pas, seulement ils affectent de douter. Dites-moi ce qu’il y a de pire, l’affectation du doute ou l’affectation de la foi ? Vraiment il faut que les économistes cessent cette comédie. Demain il y aura beaucoup de convives au dîner. J’y poserai la question d’un journal destiné à propager un principe absolu. Je regrette que M. Cheuvreux ne puisse être des nôtres. Quoiqu’en dissidence avec lui sur des faits particuliers, sur des appréciations d’hommes ou de circonstances, nous sommes d’accord sur les idées et le fond des choses. Il m’appuierait.
Adieu, madame ; permettez-moi de me dire le plus dévoué comme le plus respectueux de vos amis.
F. Bastiat.
8 octobre 1849. ↩
Madame,
Le hasard fait que le journal des Landes indique la manière traditionnelle dans mon pays d’accompagner les orolans ; le [51] seigneur Trompette ne se blessera pas, sans doute, si je lui adresse par votre intermédiaire un document aussi précieux. Hier, quand je fus porter ma boîte, rue Saint-Georges, M. Cheuvreux n’avait point paru, c’était pourtant jour d’audience. Aujourd’hui nous avions rendez-vous pour aller visiter le télégraphe électrique. Il ne vient pas, serait-il indisposé ?
La discussion sur le socialisme a été très-belle ; Ch. Dupin fort au-dessus de ce qu’on pouvait attendre. Dufaure admirable, la Montagne violente, insensée, ignorante. Quelle triste arène pour cette Chambre ! combien elle est au-dessous, pour les intentions, de la Constituante ! Alors l’immense majorité avait la passion du bien. À présent chacun ne rêve que de révolution et l’on n’est retenu que par le choix. Quoi qu’il en soit, la société progresse. Nul ne peut répondre des accidents particuliers, et je suis fâché que cela contrarie l’aimable Mme Alexandre, mais certainement le mouvement général est vers l’ordre et la sécurité.
Pour vous, mesdames, vous vous êtes préparé, à tout événement, des ressources de bonheur dans l’affection de ceux qui vous [52] approchent, et la mère et la fille ne seront-elles pas toujours l’une pour l’autre des anges de consolation ?
Permettez-moi aussi d’espérer que vous compterez pour quelque chose l’inaltérable dévouement de votre respectueux ami.
F. Bastiat.
Paris, novembre 1849. ↩
Madame,
Voici un document qui vous intéressera. Pour moi, je n’ai pu le lire sans être touché jusqu’aux larmes (nature de montagne n’est pas toujours nature de rocher ) ; pour faire partager mes impressions, à qui m’adresser, si ce n’est à vous ?
Je vais être obligé de discuter l’opinion de mes amis, cela me coûte. Mais je ne sais quel Grec disait : « J’aime Platon, mais j’aime mieux la vérité. » Il me semble à présent indubitable que l’économie politique a ouvert la porte au communisme ; c’est à elle à la fermer.
Si vous avez cinq minutes à perdre, [53] oserais-je vous prier de me donner des nouvelles du trio ?
Votre bien dévoué,
F. Bastiat.
Le 2 janvier 1850. ↩
Madame,
On me tire de mon assoupissement pour me remettre trois volumes, que vous me renvoyez sans les accompagner d’un seul mot ; aurais-je été assez malheureux pour vous déplaire ?
Hier, vous avez réuni autour de votre table votre famille et quelques amis, pour inaugurer le nouvel an ; ce repas ne devait être que fête, joie et cordialité ; hélas ! la politique s’en est mêlée ; il est bien vrai que, sans moi, la politique n’eût pu y jeter ses sombres reflets, car tout le monde peut-être eût été d’accord.
Mais suis-je coupable ? N’ai-je pas longtemps gardé le silence, et n’ai-je pas mis sur le compte de généralités ce que j’aurais pu prendre pour des personnalités ? Des paroles [54] qui ressemblaient à des provocations ?… — Que deviendrais-je, madame, si cette réserve ne suffit pas ?
Isolé, retenant à peine pour le travail un reste de force qui m’échappe, faudra-t-il perdre encore les douceurs de l’intimité, seul charme qui me rattache à l’existence ?
Entre M. Cheuvreux et moi, qu’importe une dissidence d’opinion, alors surtout qu’elle ne porte pas sur le but, sur aucun principe essentiel, mais seulement sur les moyens de surmonter les difficultés du moment ?
C’est par égard pour lui, autant que pour vous, madame, que j’ai dévoré le calice que ces messieurs ont approché de mes lèvres. Et, après tout, ces opinions qu’on me reproche, sont-elles donc si extravagantes ?
Je souhaiterais bien que l’on consentît à me considérer comme un solitaire, un philosophe, un rêveur, si vous voulez, qui ne veut se livrer à un parti, mais qui les étudie tous, pour voir où est le péril et si l’on peut essayer de le conjurer.
Je vois, en France, deux grandes classes qui, chacune, se subdivise en deux. Pour me [55] servir de termes consacrés, quoique improprement, je les appellerai le peuple et la bourgeoisie.
Le peuple, c’est une multitude de millions d’êtres humains, ignorants et souffrants, par conséquent dangereux ; comme je l’ai dit, il se partage en deux, la grande masse assez attachée à l’ordre, à la sécurité, à tous les principes conservateurs ; mais, à cause de son ignorance et de sa souffrance, proie facile des ambitieux et des sophistes ;cette masse est travaillée par quelques fous sincères et par un plus grand nombre d’agitateurs, de révolutionnaires, de gens qui ont un penchant inné pour le désordre, ou qui comptent sur le désordre pour s’élever à la fortune et à la puissance.
La bourgeoisie, il ne faudrait jamais l’oublier ; c’est le très-petit nombre ; cette classe a aussi son ignorance et sa souffrance, quoiqu’à un autre degré ; elle offre aussi des dangers d’une autre nature. Elle se décompose aussi en un grand nombre de gens paisibles, tranquilles, amis de la justice et de la liberté, et un petit nombre de meneurs. La bourgeoisie a gouverné ce pays-ci, comment s’est-elle conduite ? Le petit nombre a fait le [56] mal, le grand nombre l’a laissé faire ; non sans en profiter à l’occasion.
Voilà la statistique morale et sociale de notre pays.
Tenant très-peu et croyant encore moins aux formes politiques, irai-je consumer mes efforts et déclamer contre la république ou la monarchie ? Conspirer pour changer des institutions que je regarde comme sans importance ? Non ; mais quand j’ai l’occasion de m’adresser au peuple, je lui parle de ses erreurs, de ses fausses aspirations ; je cherche à démasquer à ses yeux les imposteurs qui l’égarent, je lui dis : « Ne demande que justice, car il n’y a que la justice qui puisse t’être bonne à quelque chose. » — Et quand je parle à la bourgeoisie, je lui dis : « Ce ne sont pas les fureurs ni les déclamations qui te sauveront, il faut en toutes rencontres accorder au peuple ce que la justice exige, afin d’être assez fort pour lui refuser tout ce qui dépasse la justice. »
Et c’est pourquoi les catholiques me disent que j’ai une doctrine à deux tranchants ; et c’est pourquoi le « Journal des Débats » dit que je dois m’habituer à déplaire aux deux partis. Eh ! mon Dieu, ne serait-il pas plus [57] commode pour moi de me lancer corps et âme dans un des deux camps, d’en épouser les haines et les illusions, de me faire le flagorneur du peuple ou de la bourgeoisie, de m’affilier aux mauvaises fractions des deux armées.
F. Bastiat.
Janvier 1850. ↩
Madame,
Je viens de rencontrer le commandant Matt, qui prétend qu’on sera souffrant demain à l’hôtel Saint-Georges. Puisse-t-il être aussi mauvais prophète que brave soldat ! Soyez assez bonne pour me faire savoir la vérité. Vous ne permettrez pas que je parle de santé sans dire quelque chose de la mienne. Je suis mieux et Charruau, comme Sgnarelle, assure que je dois être guéri. Cependant hier soir, une quinte fatigante a déterminé ce symptôme rouge aussi effrayant en physiologie qu’en politique. Malgré tout, j’aurais encore bien assez de force pour me charger de ce qu’il peut rester de toux à votre Louisette, si cela était possible ; mais [58] l’affection ne peut faire ce miracle, c’est une harmonie qui manque à ce monde.
Adieu, madame.
F. Bastiat.
Samedi.
Février 1850. ↩
Madame,
Je vous rends, à regret, le discours prononcé par M. de Boislembert, à l’occasion de l’inauguration du buste de M. Girard, en vous rappelant que vous m’en avez promis un exemplaire. Je l’ai lu avec enthousiasme, et voudrais le relire une fois par mois, pour me retremper. C’est une vie de Plutarque, en harmonie avec notre siècle. Que j’admire cette vie si belle, si digne, si bien remplie ! Quelle magnifique réunion de toutes les qualités qui honorent le plus la nature humaine : génie, talent, activité, courage, persévérance, désintéressement, grandeur, force d’âme dans les revers ! Jusque-là, pourtant, le portrait est bien imposant et ne représente que des lignes pures, mais sévères ; on admire, on n’aime pas encore ; mais bientôt la [59] sympathie est complète quand l’auteur nous peint, avec trop de sobriété peut-être, sa verve étincelante, cette gaieté douce, cette inépuisable bienveillance, que M. Girard rapportait toujours au foyer domestique, dons du ciel les plus précieux de tous, que votre père n’a pas emportés dans la tombe. Ces nobles figures, madame, font paraître les hommes bien petits, et l’humanité bien grande.
F. Bastiat.
Paris, mars 1850. ↩
Madame,
Comment voulez-vous guérir ? Votre rhume est la proie de tous ceux à qui il plaît de le faire jaser, et le nombre en est grand.
Depuis samedi jusqu’à hier matin, je n’ai eu qu’une quinte. Elle a duré douze heures. Je ne puis comprendre comment les fragiles enveloppes de la respiration et de la pensée n’éclatent pas sous ces secousses violents et prolongées. Au moins je n’ai rien à me reprocher, j’obéis docilement à mon médecin. [60] Retenu pendant ces deux jours, il faudra bien que j’aille, ce soir, chez M. Say, me mêler à mes coreligionnaires. C’est un effort. Vous ne sauriez croire avec quelle vivacité mon indisposition fait renaître en moi mes vieux penchants solitaires, mes inclinaisons provinciales. Une chambre paisible pleine de soleil, une plume, quelques livres, un ami de cœur, une douce affection : c’était tout ce qu’il me fallait pour vivre. En faut-il davantage pour mourir ? Ce peu, je l’avais au village, et quand le temps sera venu dans beaucoup d’années je ne le retrouverai plus.
J’envoie à Mlle Louise quelques stances sur la femme qui m’ont plu. Elles sont pourtant d’un poëte économiste, car il a été surnommé The free-trade rhymer : le poëte du libre échange. Si j’en avais la force je ferais de cette pièce une traduction libre en prose et en trente pages ; cela ferait bien dans le journal de Guillaumin. Votre chère petite railleuse (je n’oublie pas qu’elle possède au plus haut degré l’art de railler, non-seulement sans blesser, mais presqu’en caressant) n’a pas grande foi dans la poésie industrielle ; elle a bien raison. C’est que j’aurais dû dire Poésie sociale, celle qui désormais, je [61] l’espère, ne prendra plus pour sujet de ses chants les qualités destructives de l’homme, les exploits de la guerre, le carnage, la violation des lois divines et la dégradation de la dignité morale, mais les biens et les maux de le vie réelle, les luttes de la pensée, toutes les combinaisons et affinités intellectuelles, industrielles, politiques, religieuses, tous les sentiments qui élèvent, perfectionnent et glorifient l’humanité. Dans cette épopée nouvelle, la femme occupera une place digne d’elle et non celle qui lui est faite dans les vieilles Iliades. Son rôle était-il de compter parmi le butin ?
Aux premières phases de l’humanité, la force étant le principe dominant, l’action de la femme s’efface. Elle a été successivement bête de somme, esclave, servante, pur instrument de plaisir. Quand le principe de la force cède à celui de l’opinion et des mœurs, elle recouvre son titre à l’égalité, son influence, son empire ; c’est ce qu’exprime bien le dernier trait de la petite pièce de vers que j’adresse Mlle Louise.
Vous voyez combien les lettres des pauvres reclus sont dangereuses et indiscrètes. Pardonnez-moi ce bavardage, pour toute réponse [62] je ne demande qu’à être rassuré sur la santé de votre fille.
F. Bastiat.
Lundi.
Paris, avril, vendredi, 1850. ↩
Bien chère madame Cheuvreux,
Pardonnez-moi ce mot échappé à un moment d’effusion. Nous autres souffreteux, nous avons, comme les enfants, besoin d’indulgence, car, plus le corps est faible, plus l’âme s’amollit et il semble que la vie, à son dernier comme à son premier crépuscule, souffle au cœur le besoin de cherche partout des attaches. Ces attendrissements involontaires sont l’effet de tous les déclins ; fin du jour, fin de l’année, demi-jour de basiliques, etc., etc., je l’éprouvais hier sous les sombres allées des Tuileries. Ne vous alarmez pas, cependant, de ce diapason élégiaque. Je ne suis point Millevoie, et les feuilles qui s’ouvrent à peine ne sont pas près de tomber. Bref, je ne me trouve pas plus mal, au contraire, mais seulement plus faible, et je ne puis guère reculer devant la demande d’un congé. C’est, en perspective, une solitude [63] encore plus solitaire ; autrefois je l’aimais ; je savais la peupler de lectures, de travaux capricieux, de rêves politiques, avec intermèdes de violoncelle ; momentanément, tous ces vieux amis me délaissent, même cette fidèle compagne de l’isolement, la méditation. Ce n’est pas que ma pensée sommeille, elle n’a jamais été si active ; à chaque instant elle saisit de nouvelles harmonies et il semble que le livre de l’humanité s’ouvre devant elle ; mais c’est un tourment de plus, puisque je ne puis continuer à transcrire les pages de ce livre mystérieux, sur un livre plus palpable édité par Guillaumin ; je chasse donc ces chers fantômes, et comme ce tambour-major grognard qui disait : « Je donne ma démission, que le gouvernement s’arrange comme il le pourra ; » moi aussi, je donne ma démission d’économiste et que la postérité s’en tire, si elle peut. Bon, voilà une jérémiade pour expliquer une maladresse. On dit des malheurs, qu’ils n’arrivent jamais seuls ; cela est encore plus vrai des maladresses ; que de mots pour en justifier un que vous auriez pardonné, sans tous ces commentaires, car vous ne m’en voudrez pas si, dans cette indigence [64] d’occupations, ma pensée se réfugie vers l’hôtel Saint-Georges, où l’on est toujours si bon pour moi. Ce cher hôtel ! il est maintenant tout plein d’une préoccupation très-grave. L’avenir de votre Louise s’y décide peut-être, et par conséquent le vôtre et celui de M. Cheuvreux. L’idée que tant de paix, d’union et de bonheur domestique vont être domestique vont être mis à l’épreuve d’une révolution décisive est vraiment effrayante. Mais prenez courage, vous avez tant de bonnes chances !
Vraiment, mes lettres dépassent de cent coudées celles de M. B… Je vous prie, madame, d’accepter mes excuses. La plus valable, c’est que je n’ose guère paraître chez vous ce soir ; n’est-ce pas bien de l’égoïsme d’aller chercher des distractions là où on ne peut apporter de quintenses importunités ? Bien entendu, je ne dis pas cela pour mes amis ; ce serait de l’ingratitude. Mais la société est-elle solidaire de votre bienveillance ?
Adieu, madame ; croyez-moi votre dévoué,
F. Bastiat.
Mme Shwabe vient d’arriver sans ses [65] enfants. Je désire vous faire faire sa connaissance.
Bordeaux, mai 1850. ↩
Me voici à Bordeaux plongé avec délice dans l’atmosphère du midi. Quoique je quitte le tumulte parisien pour aller retrouver le calme du toit paternel, je vous assure que ma pensée, tout le long de la route, s’est retournée bien plus souvent en arrière qu’elle ne s’est portée en avant ; aussi je m’empresse de déployer le secrétaire de voyage que je dois aux soins si délicats de M. Cheuvreux.
En être réduit à faire de ma santé le premier chapitre de mes lettres, m’humilie un peu, mais votre bonté l’exige ; je le comprends, les maladies dont la toux se mêle ont le tort de trop alarmer nos amis. Elles portent avec elles comme une cloche importune qui ne cesse de poser cette question : qui l’emportera, du rhume ou de l’enrhumé ? Le voyage, au lieu de me fatiguer, m’a soulagé ; il est vrai que j’ai eu à ma disposition, pendant trois jours, un excellent remède, le [66] silence ; ce n’est que depuis Ruffec que je me suis un peu écarté à cet égard de vos prescriptions ; mes deux compagnons, montés tour à tour dans le cabriolet du courrier, pour se livrer aux douceurs du cigare, ont eu la curiosité de visiter la feuille de route. — Or il s’est rencontré que c’étaient deux enthousiastes d’économie politique ; en reprenant leur place, ils ont tenu à me montrer qu’ils connaissaient mes opuscules (car le titre même des harmonies ne leur était pas parvenu) et, alors l’occasion, l’herbe tendue, et sans doute quelque diable aussi me poussant, j’ai tondu de ce pré (la causerie) la largeur de ma langue ; je n’en avais nul doit, puisqu’on me l’avait défendu. Mais, j’ai donc succombé et le larynx n’a pas manqué de m’en punir ; ne me grondez pas, madame ; est-ce que le silence n’est pas un régime qui vous conviendrait quelquefois, autant qu’à moi ? et pourtant c’est le dernier auquel vous vous soumettiez.
Que Mme Girard, maintenant près de vous, interpose son autorité pour vous mettre sous le séquestre ; que vous sert de rester dans vos appartements si vous en faites ouvrir les portes à deux battants depuis [67] dix heures du matin ? Ne sauriez-vous sacrifier à votre santé quelques moments de conversation ? Mais vous savez que le sacrifice retomberait sur les autres, et c’est pour cela que vous ne voulez pas le faire. Vous voyez que je connais la vieille tactique qui est de gronder le premier afin de n’être pas grondé. Après tout, je vois bien que nous descendons tous de notre mère Ève. Votre fille, elle-même, qui a tant de raison, se laisse souvent prendre au piége de la musique. À propos de musique, on a bien tort de s’imaginer qu’un son s’éteint dans l’étroit espace d’un salon et d’une seconde ; une note, ou plutôt un cri de l’âme que j’ai entendu samedi, a fait avec moi deux cents lieues ; il vibre encore dans mon oreille, pour ne pas dire plus.
Pauvre chère enfant, je crois bien avoir deviné la pensée dont elle a empreint le triste chant de Pergolèse ; cette voix touchante, dont les derniers accents semblaient se perdre dans une larme, ne disait-elle pas adieu aux illusions du jeune âge, aux beaux rêves d’une félicité idéale ? Oui, il semblait que votre chère Louise se sentait amenée par les circonstances à cette limite fatale et [68] solennelle qui sépare la région des songes du monde de la réalité. Puisse la vie réelle lui apporter au moins un bonheur calme, solide, quoiqu’un peu grave ; pour cela, que faut-il ? Un bon cœur et du bon sens dans celui qui sera chargé de ses destinées ; c’est la première condition ; les hommes dont l’imagination ardente et artistique jette un grand éclat, offrent des chances souvent dangereuses ; mais n’en doutons pas, les nobles aspirations de votre enfant trouveront un jour satisfaction.
Comment allez-vous passer le mois prochain ? Resterez-vous à Paris ? Irez-vous à Auteuil, à Saint-Germain ou à Londres ? Je voterais assez pour l’Angleterre, c’est là que vous trouveriez une désirable combinaison de tranquillité et de distraction ; à la vérité, mes votes ne sont pas en bonne odeur, quoiqu’ils aient consciencieusement pour but d’éloigner les malheurs que vous redoutez ; mais ne glissons pas sur la pente de la politique. Il y a tant d’imprévu dans vos résolutions qu’il me tarde de savoir à quoi vous vous arrêterez. Je crains d’apprendre votre départ pour Moscou ou Constantinople. De grâce, que je vous retrouve confortablement installés aux environs de Paris ; la France est comme la Française, elle peut avoir quelques caprices, mais après tout, c’est la plus aimable, la plus gracieuse, la meilleur femme du monde et aussi la plus aimée.
Adieu, mesdames ; que ces deux mois d’absence ne m’effacent pas de votre mémoire ; adieu encore, monsieur Cheuvreux et mademoiselle Louise.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Mugron, 20 mai 1850. ↩
Combien je vous remercie, madame, de penser à l’exilé des Landes au milieu de toutes vos préoccupations ; j’oserais à peine vous demander de continuer cette œuvre charitable si je ne savais combien la bonté est en vous persévérante ; croyez bien qu’il n’y a ni cordial ni pectoral qui vaillent pour moi quelques lignes venues de Paris, et ma santé dépend plus du facteur que du pharmacien ; la plume, il est vrai, est une lourde et fatigante machine ; ne m’envoyez pas de [70] longues lettres, mais quelques mots le plus souvent possible, afin que je sache ce qu’on fait, ce qu’on pense, ce qu’on sent, ce qu’on résout à l’hôtel Saint-Georges.
Voici, par exemple, une péripétie que je ne puis dire complétement inattendue ; quelques paroles de M. Cheuvreux me l’avaient fait pressentir ; ce pauvre M. D… est congédié, je suis sûr que le cœur de votre Louise est bien soulagé, c’est toujours cela de gagné ; si mes vœux s’accomplissaient, elle traverserait la vie sans toutes ces épreuves.
Après vous avoir écrit de Bordeaux, je fis des visites ; heureusement plusieurs de mes amis étaient absents, car je n’aurais pu éviter de parler et de crier beaucoup ; ceux que j’ai rencontrés sont dans un tel état d’exaltation que la conversation calme n’est pas possible avec eux ; les malheureux sont persuadés que depuis deux ans on n’ose pas ouvrir les magasins à Paris ; partant de cette donnée, ils veulent à tout prix d’une pareille situation et pour cela ne reculent pas même devant l’idée d’une guerre civile ou de la guerre étrangère. Mon département m’a paru plus modéré ; notre préfet s’y consacrait sans relâche à concilier les opinions ; aussi il a été [71] destitué le jour le mon passage à Mont-de-Marsan ; on nous en envoie un qui saura chauffer un peu mieux les esprits.
J’arrivai vendredi ; en revoyant le clocher de mon village, je fus surpris de ne pas éprouver ces vives émotions que sa vue ne manquait jamais autrefois de faire naître. — Sommes-nous de la nature des végétaux et les fibres du cœur deviennent-elles ligneuses avec l’âge, ou bien ai-je maintenant deux patries ? — Je me rappelle que Mlle Louise m’avait prédit que la vie rustique aurait perdu pour moi beaucoup de ses charmes.
Dans un conseil de famille composé de ma tante, de sa femme de chambre et de moi (et je pourrais dire, résumé dans sa femme de chambre), il a été décidé que Mugron valait les Eaux-Bonnes, et qu’en tout cas il ne faisait pas encore assez chaud pour les Pyrénées ; donc me voici Landais jusqu’à nouvel ordre. Ceci conclu, notre Basquaise s’est mise à visiter ma malle ; bientôt nous l’avons vue rentrer au salon toute bouleversée et s’écriant : « Mademoiselle, le linge de Monsieur, il est tout perrec, perrec, perrec ! » Je regrette que de Labadie ne soit plus auprès de vous pour expliquer l’énergie de ce mot [72] perrec ; il renferme les trois idées de lambeaux, chiffons et haillons ; quel profond mépris doit ressentir la pauvre fille pour Paris et ses blanchisseuses ! — C’est à donner sa démission de représentant !
Samedi, je vus voir le reste de ma famille à la campagne ; j’en revins fatigué. Les quintes ont reparu assez fortes pour que la respiration n’y pût suffire ; je pensais à la description de la pêche de la baleine que vous faisait votre cousin : « Tout va bien, disait-il, quand on peut donner du câble à l’animal blessé ; » la toux est peu de chose aussi, tant que les poumons peuvent lui donner du câble ; après quoi, la position devient incommode.
Vraiment, madame, ces détails vous prouvent que je me laisse aller à l’affection que j’ai pour vous et que je compte bien sur la vôtre ; aussi que cela ne sorte pas, je vous en prie, de ce que nous appelons le trio.
Le courrier m’apporte une lettre ; comment vous exprimer ma reconnaissance ! Vous avez donc deviné mes vœux ? Ma tante et moi avons commencé à disputer sur le nord et le midi ; elle exalte la supériorité du [73] Midi, sans doute pour que j’y reste ; je lui soutiens que ce tout ce qu’il y a de bon vient du Nord, même le soleil. (C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumière), il m’envoie votre bon souvenir, des nouvelles rassurantes sur Mlle Louise, quelques détails sur ces douces scènes d’intérieur, dont j’ai été souvent témoin et que je sais si bien apprécier.
F. Bastiat.
Mugron, 23 mai 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux, ma dernière lettre a à peine atteint l’autre extrémité de la longue ligne qui nous sépare, qu’en voici une seconde prête à se lancer sur la même voie ; n’y a-t-il pas dans cet empressement indiscrétion, ou inconvenance ? Je n’en sais rien, car je ne suis par encore bien rompu aux usages du monde ; mais soyez indulgente ; bien plus, permettez-moi de vous écrire capricieusement sans trop regarder aux dates, et sous l’empire de l’impulsion, cette loi des natures faibles. Si vous saviez [74] combien Mugron est vide et triste, vous me pardonneriez de tourner toujours mes regards vers Paris. Ma pauvre tante, qui fait à peu près toute ma société, a bien vieilli, la mémoire l’abandonne ; elle n’est plus qu’un cœur ; il semble que ses facultés affectives gagnent tout ce que perdent les autres ; aussi je l’aime plus que jamais, mais, en sa présence même, je ne puis retenir mon imagination voyageuse, et puis ne suis-je pas malade ? À quoi donc les maladies seraient-elles bonnes, si elles ne donnaient le privilége de faire tolérer nos fantaisies ? Ainsi, voilà chose convenue, je mets mon indiscrétion sous le patronage de mes prétendues souffrances ; c’est une ruse dont un cœur de femme sera toujours dupe ; pourtant ceci ne doit pas m’induire à vous tromper et à me représenter comme un moribond. Voici le bulletin : la toux est moins fréquente, les forces reviennent ; je puis monter l’escalier sans être hors d’haleine ; je retrouve ma voix, qui peut fredonner dans toute l’étendue d’un octave complet ; la seule chose qui m’importune est une petite douleur au larynx, mais je ne lui en donne pas pour quatre jours ; enfin, [75] quoique je n’en sois pas encore à offrir aux regards dangereux de Mlle Louise une figure au milieu d’un visage, il me semble que j’ai meilleure mine.
Me voilà quitte envers ma conscience et obéissant à vos ordres. À propos de Mlle Louise et du visage en question, cette chère enfant est toujours destinée à être en proie à un doute douloureux pour une jeune fille : c’est d’ignorer, malgré son tact exquis, si on la recherche pour elle-même… c’est un des revers de médaille de la fortune ; mais ce qui doit la rassurer, c’est que fût-on d’abord attiré par cette fortune on l’appréciera bien vite pour sa propre valeur ; je vous ai dit que je bonté de cœur pouvait remplacer toutes les autres qualités ; je me trompais, quelque chose peut-être vaut mieux encore : c’est le sentiment du devoir ; une disposition naturelle à se conformer à la règle, disposition que le bon cœur n’implique pas toujours.
Quels que soient le nombre et le mérite de vos amis, conservez-moi une place dans votre affection ; pour moi, je puis bien vous le dire, à mesure que le temps et la mort brisent des liens autour de moi, à mesure que je perds la faculté de me réfugier dans [76] la vie politique ou studieuse, votre bienveillance, celle de votre famille, me deviennent de plus en plus nécessaires ; c’est la dernière lumière qui brille sur ma vie, c’est pour cela, sans doute, qu’elle est aussi la plus douce, la plus pure, la plus pénétrante ; après elle viendra la nuit, que ce soit au moins la nuit du tombeau.
F. Bastiat.
Mugron, le 27 mai 1850. ↩
Jétais brouillé avec le calendrier, et voilà que mon exil a opéré la réconciliation ; nous sommes au 27.
Mon congé date du 12, en sorte que le quart des deux mois est écoulé, encore trois fois autant de temps et je reverrai Paris.
Je fais, madame, un autre calcul qui me sourit moins, votre dernière lettre porte le timbre du 17. Il y a dix jours que vous l’avez écrite, et huit que je l’ai reçue ; huit jours ! Ce n’est rien pour vous, qui les passez tantôt entourée des vôtres, tantôt parcourant les [77] bords de la Seine ou de la Marne, causant presque toujours délicieusement avec votre fille et votre mari ! Si au moins je pouvais être sûr qu’aucun rhume ne vous empêche d’écrire !
Hier on reçut une dépêche télégraphique annonçant le vote de l’article Ier ; je pensai que je télégraphe pourrait être mieux employé, du moins en ce qui me touche.
Vous avez des myriades d’amis et d’amies qui, tout en vous recommandant le repos, vous poursuivent du matin au soir ; comme il me tarde d’apprendre que vous avez mis pas mal de kilomètres entre leur empressement et votre gracieuseté !
Je dois avouer, madame, que La Fontaine avait raison et que bon nombre d’hommes sont femmes à l’endroit du babil ; en venant chercher ici la santé, je n’avais pas songé que j’y rencontrerais l’impossibilité absolue d’y éviter les longues causeries ; les Mugronais n’ont rien à faire, aussi ne tiennent-ils pas compte des heures, si ce n’est de celles du dîner et du souper ; puis ils ressemblent un peu à Pope : ce sont des points d’interrogations ; je vous laisse à penser s’il faut enfiler des paroles. Par une manœuvre habile je [78] les mets bien sur les cancans du village ou sur le dada de leur originalité ; par là je gagne quelque répit, mais en définitive franchement, je parle trop et c’est ce qui m’a valu encore une crise qui heureusement n’a pas eu de suite. Maintenant je suis beaucoup mieux, et prêt à partir pour les Eaux-Bonnes, quand il plaira au soleil de jouer son rôle, mais c’est un paresseux ; nous voyons d’ici les montagnes couvertes de neige, elles ne seront guère habitables avant le mois de juin.
En regardant Mugron avec des yeux devenus citadins, je crois que j’aurais honte de vous le montrer, je rougirais pour lui de ses maisons enfumées, de son unique rue déserte, de ses mobiliers patriarcaux, de sa police négligée ; son seul charme consiste dans une rusticité naïve, une pauvreté qui ne cherche pas à se cacher, une nature toujours silencieuse et calme, une complète absence d’agitation, toutes choses qui ne plaisent et ne sont comprises que par l’habitude ; pourtant, dans cette uniformité d’existence placez deux affections et je soutiens que c’est l’uniformité de bonheur ; comme cela aussi devient l’uniformité de l’ennui et du néant, si ces [79] affections. J’y ai retrouvé celle de Félix. Il est impossible de dire avec quelle joie nous avons repris nos entretiens interrompus, et ce qu’il y a d’attrait dans ce commerce de deux âmes sympathiques, de deux intelligences parallèles nées le même jour, jetées au même monde, nourries du même lait, et portant sur toutes chose un jugement identique ; religion, philosophie, politique, économie sociale, tout y passe sans que sur aucun sujet nous réussissions à voir poindre entre nous la moindre dissidence ; cette identité d’appréciation nous est une grande garantie de certitude, d’autant que, n’ayant jamais eu que très-peu de livres, ce sont bien nos opinions propres qui sont en contact, et non l’opinion d’un maître commun ; mais, malgré les douceurs de cette société, il y a ici un vide ; Félix et moi, nous nous touchons surtout par l’intelligence ; quelque chose manque au cœur : me voilà en pleine personnalité ; j’en ai honte et pour me punir je vous quitte jusqu’à demain.
Le 28. — Le courrier arrive, les mains vides ; car qu’est-ce que ce tas de lettres et de journaux ? Pourtant je reconnais l’écriture [80] de Paillottet, que peut-il me dire ? Il ne vous connaît pas, il n’aura pas rencontré M. Cheuvreux ; je regrette maintenant de n’avoir pas osé vous le présenter, car je pressentais qu’il serait exact, qu’il serait bon pour moi. Oh ! j’espère bien qu’il n’est rien survenu d’affligeant à l’hôtel Saint-Georges.
Adieu, mesdames, je sens que je recommence à écrire en fa mineur ; il vaut mieux m’arrêter en vous assurant de mon attachement respectueux et dévoué.
F. Bastiat.
Mugron, le 11 juin 1850. ↩
Chère demoiselle,
C’était ma résolution, toujours bien arrêtée, de laisser passer une grande semaine sans vous écrire ; car, on a beau compter sur la bienveillance de l’amitié, encore faut-il n’en pas abuser ; mais il me semble que mon empressement a bien des excuses ; vous m’annoncez que votre mère est souffrante et je suis au bout du monde, [81] je ne puis plus envoyer ma rustique Franc-comtoise à l’hôtel Saint-Georges, pour y prendre des informations. Enfin, vous voilà installés à Fontainebleau, loin du bruit ; il faut espérer que huit jours de retraite et de silence rétabliront toutes les santés ébranlées ; c’est hier, pas M. Say, que j’ai appris votre disparition. Cette nouvelle m’a d’abord fait un singulier effet, comme si une autre centaine de lieues était venue se placer entre nous ; c’est que n’ayant jamais été à Fontainebleau, mon imagination est toute déroutée.
Je ne puis assez, chère demoiselle, vous remercier de tout ce que vous me dites d’affectueux ; vous m’envoyez des paroles si douces qu’elles ressemblent à ces réminiscences d’accords ou de parfums, dont les gens se souviennent quelquefois tout à coup, et auxquels se mêlent quelque souvenirs d’enfance.
Mais, je distingue dans votre lettre que la gaieté ne vous est pas encore revenue , voyons si je me trope : vous avez ce noble empire sur vous-même qui fait, dès qu’il le faut, vaincre les émotions, mais vous n’avez [82] pas cette insouciance qui les fait oublier ; votre nature excitera toujours la sympathie et l’admiration, mais elle rencontrera difficilement dans ce monde le calme, d’où naît la gaieté durable. Que dites-vous de cet essai psychologique ? Juste ou non, je vous le livre, de grâce ne cherchez pas à vous changer, vous n’y gagneriez rien.
Je pars demain pour les Eaux-Bonnes ; c’est encore une excuse dont cette lettre se précautionne ; ce mot Eaux-Bonnes me rappelle la triste chance que je cours ; qui sait si je n’en partirai pas au moment où vous y arriverez ? Qui sait si votre chaise de poste ne croisera pas l’énorme véhicule qui me reportera à Paris ? — Avouez que ce serait bien dépitant pour moi.
Oh ! venez aux Pyrénées ! venez dès à présent respirer cet air pur toujours embaumé ; venez jouir de cette nature si paisible, si imposante ; là, vous oublierez les troubles de cet hivers et la politique ; là vous éviterez les ardeurs de l’été ; tous les jours vous varierez vos promenades, vos excursions, vous contemplerez de nouvelles merveilles ; les forces, la santé, l’élasticité morale vous reviendront, vous vous réconcilierez avec l’exercice [83] physique, vous aurez la joie de voir votre père perdre de vue toutes ces inquiétudes, trop inséparables aujourd’hui de la vie parisienne ; décidez-vous donc ; je vous mènerai à Biarritz, à Saint-Sébastien, dans le pays basque ; voyage pour voyage, cela ne vaut-il pas mieux que le Belgique et la Hollande ?
Il n’y a que deux peuples au monde, dit un écrivain : « Celui de la bière et celui du vin. » Si vous voulez savoir comment on gagne de l’argent, allez étudier le peuple de la bière ; si vous préférez voir comment on rit, on chante, on danse, venez visiter le peuple du vin.
Je m’étais fait un peu d’illusion sur l’influence de l’air natal ; quoique la toux soit moins fréquente, j’ai toutes les nuits un peu de fièvre, mais la fièvre et les Eaux-Bonnes n’ont jamais pu marcher ensemble.
Je voudrais bien guérir aussi d’un noir dans l’âme, que je ne sais m’expliquer. D’où vient-il ? Est-ce des lugubres changements que Mugron a subis depuis quelques années ? Est-ce de que les idées me fuient sans que j’aie la force de les fixer sur le papier au grand dommage de la postérité ? Est-ce… [84] Est-ce ? Mais, se je le savais, cette tristesse aurait une cause et elle n’en a pas… Je m’arrête tout court, avant d’entamer la fade jérémiade des spleenitiques, des incompris, des blasés, des génies méconnus, des âmes qui cherchent une âme, race maudite que je déteste ; j’aime mieux qu’on me dise tout simplement comme à Bazile : c’est la fièvre, buono sera.
Adieu, dites à votre père et à votre mère combien je suis sensible à leur souvenir. Adieu, quand vous reverrai-je tous ? Adieu, je répète ce mot qui n’est jamais neutre ; car c’est le plus pénible ou le plus doux qui puisse sortir de mes lèvres.
Croyez, chère demoiselle, au tendre attachement de votre dévoué,
F. Bastiat.
[85]
15 juin 1850. ↩
Ma chère madame Cheuvreux,
Arrivé hier soir aux Eaux-Bonnes, je suis allé ce matin à la poste ; la raison me disait qu’il n’y aura rien, et le pressentiment murmurait il y aura quelque chose ; en effet, la raison a eu tort, comme il advient souvent malgré son nom.
Ainsi, grâce à votre bonté, je me sens un fonds de joie qui m’avait abandonné, et notre délicieuse vallée ne perdra rien à ce que je la revoie sous ces impressions.
Jeudi, j’entrai à Pau vers spet heures ; je fus à la rue du Collége, où je crois avoir deviné l’hôtel que vous avez habité. Que cette vue de Pau est à la fois riante et imposante ; de légers nuages cachaient la montagne, on ne jouissait que du premier plan : le Gave, Gélos, Bizanos, les coteaux et les villas de Jurançon.
Si mon astre, en naissant, m’avait créé poëte, au lieu de faire de moi un froid économiste, je vous adresserais des stances, car il y avait en moi un peu de Lamartine ; [86] vous et votre Louise, n’avez-vous pas envoyé bien des sourires à ce paysage, et, ne semble-t-il pas en avoir gardé le souvenir ! Mais la poésie a des a des licences que la prose n’admet pas.
J’ai pris aux Eaux-Bonnes une chambre à trois croisées, bien aérée ; bien soleillée, mon horizon est admirable. Pour la première nuit, j’ai dormi douze heures, au murmure du Valentin ; déjà en me levant, je me sentais dans la meilleure disposition, quand est survenue l’aimable surprise de votre lettre ; elle m’a accompagnée dans mon excursion matinale et me voici mieux d’esprit et de corps, que je ne l’ai été depuis longtemps. Avis à mes amis ; il ne faut jamais prendre trop au sérieux les élégies d’un homme nerveux.
Vous me grondez, mesdames, d’avoir été infidèle à mes chères Harmonies ; mais ne m’ont-elles pas montré le mauvais exemple ? — Quel gage m’ont-elles donné de leur affection ? Depuis six mois elles ne m’adressent la parole que par la bienveillante entremise de ce bon Paillotet ; — sérieusement, je vois bien que ce livre, s’il doit jamais être utile, ne le sera que dans un temps fort éloigné ; et peut-être cette appréciation est-elle encore [87] un refuge de l’amour-propre. L’occasion s’étant présentée de faire une petite brochure plus actuelle, je l’ai saisie ; j’en ai une seconde dans la tête ; je voudrais peindre tel que je le comprends l’état moral de la nation française ; analyser et disséquer les éléments très-divers qui constituent nos deux grands partis politiques : le socialisme et la réaction ; distinguer ce qu’il y a en eux de justifiable, de raisonnable de ce qu’ils contiennent de faux, d’exagéré, d’égoïste et d’imprudent ; le tout terminé par une solution, ou l’aperçu de ce qu’il y a à faire ou plutôt à défaire.
Les élections n’auront lieu qu’en 1854 ; ne portons pas pas si loin notre prévoyance ; je sais dans quel esprit les électeurs m’ont nommé et je ne m’en suis jamais écarté. Ils ont changé, c’est leur droit. Mais je suis convaincu qu’ils ont mal fait de changer ; il avait été convenu qu’on essayerait loyalement la forme républicaine, pour laquelle je n’ai, quant moi, aucun engouement ; peut-être n’eût-elle pas résisté à l’expérience même sincère ; alors, elle serait tombée naturellement, sans secousse, de bon accord, sous le poids de l’opinion politique : au lieu de cela, on [88] essaye de la renverser par l’intrigue, le mensonge, l’injustice, les frayeurs organisées, calculées, le discrédit ; on l’empêche de marcher, on lui impute ce qui n’est pas son fait ; et on agit ainsi contrairement aux conventions, sans avoir rien à mettre à la place.
Ne serait-il pas singulier qu’après tant de projets et d’hésitation, vous en revinssiez tout simplement à la Jonchère ? Cette campagne a été un peu calomniée ; demandez plutôt à la jardinière ? Au demeurant, vous y avez passé un bon été. J’irai vous y voir le plus souvent possible. M. Piscatore veut m’offrir son Buttard une seconde fois.
Votre prochaine lettre me dira ce qui a été résolu. Savez-vous que sous ce rapport, elles sont redoutables ! Jamais la précédente ne me laisse entrevoir ce qu’annonce la suivante ; passe encore pour quatre jours à Fontainebleau, mais je crains que vous ne finissiez par m’écrire de Rome ou de Spa.
Mlle Louise sera rentrée à temps pour jouir des jeunes cousines dont elle s’éloigne à regret ; pourquoi donc ne veut-elle pas s’assurer dans ce genre, un bonheur rapproché, plus direct, plus permanent ? [89] Elle devrait quelquefois se poser cette simple question : que seraient mon père et ma mère s’ils ne m’avaient pas ?
En vous disant adieu, je pense, avec une joie bien vive, que ce n’est pas un adieu à grande distance, un adieu pour plusieurs mois ; je serai à Paris à l’expiration du congé.
Votre ami respectueux et dévoué,
F. Bastiat.
Eaux-Bonnes, 23 juin 1850. ↩
Vous vous êtes donc concertée avec Mlle Louise, madame, pour me faire supporter l’éloignement. Au milieu des soucis d’une installation, vous avez trouvé le temps de m’écrire et, qui plus est, vous me faites pressentir que les absents ne perdront rien à vos loisirs de la Jonchère. Oh ! qu’il y a de bonté dans les cœurs de femmes ! Je sais bien que je dois beaucoup à ma chétive santé ; rappelez-vous que je disais un jour que les moments dont je me souvenais avec le plus de plaisir étaient ceux de la souffrance, à cause des soins touchants qu’elle [90] m’avait valus de la part de ma bonne tante ; vraiment, mesdames, vous donneriez envie d’être malade ; pourtant il ne faut pas que je fasse ici l’hypocrite ; et, dût votre prochaine lettre en être retardée de vingt-quatre heures, je dois bien avouer que je suis mieux ; je prends les eaux avec précaution, quoique sans l’assistance d’un médecin ; à quoi bon ? Les médecins des eaux sont comme les confesseurs, ils ont toujours le même remède. Mais, n’abusez pas de mon aveu, et si vous ne m’écrivez pas à cause de ma santé, écrivez-moi pour me parler des vôtres.
Vous voilà à la Jonchère ; puisque vous vous vantez d’être franches campagnardes, tâchez de vous lever plus matin et de gagner chaque jour quelques minutes ; promenez-vous beaucoup plus ; lisez un peu, le moins possible de journaux ; n’attirez près de vous qu’un petit nombre d’amis à la fois : telle est ma consultation, elle nargue celle de M. Chaumel qui a perdu ma confiance.
Les Eaux-Bonnes commencent à être fort peuplées ; ma table d’hôte n’est cependant pas aussi bien composée qu’à mon dernier voyage ; il se peut que le soin d’éviter la politique [91] refroidisse la conversation ; aujourd’hui, il est arrivé deux Hâvrais qui m’ont mis sur le chapitre de ma Solution du problème social. J’ai profité de l’occasion pour faire de la propagande à fond, récitant à peu près une brochure, que j’ai écrite à Mugron. Chose singulière ! tous disent c’est cela ! c’est cela ! jusqu’à l’application ; là, on m’abandonne. Il est déplorable que les classes qui font la loi ne veuillent pas pas être justes quoi qu’il en coûte, car alors chaque classe veut faire la loi : fabricant, agriculteur, armateur, père de famille, contribuable, artiste, ouvrier ; chacun est socialiste pour lui-même, et sollicite une part d’injustice ; puis on veut bien consentir envers les autres à l’aumône légale, qui est une seconde injustice ; tant qu’on regardera ainsi l’État comme une source de faveurs, notre histoire ne présentera que deux phases : les temps de luttes, à qui s’emparera de l’État ; et les temps de trêve qui seront le règne éphémère d’une oppression triomphante, présage d’une lutte nouvelle. Mais, Dieu me pardonne, je me crois encore à table d’hôte ; je vais me coucher, il vaut mieux jeter la plume que d’en abuser.
[92]
24 juin.
Vous avez vu les Pyrénées à Paris ; moi, je retrouve Paris aux Pyrénées ; ce ne sont que belles dames, belles toilettes, comtesses et marquises ; ce matin, des enfants ont chassé loin d’eux un de leurs camarades, parce qu’il était vêtu en coutil : vous n’êtes pas assez beau ! voilà les propres expressions ; le père, médecin, en était tout humilié.
Ces jours-ci, j’ai été au village d’Aas, vous savez qu’il faut descendre la vallée et la remonter de l’autre côté ; je fus visiter le cimetière, il est chargé de monuments : jeunes hommes et jeunes filles sont venues aux Eaux-Bonnes chercher la fin de leurs souffrances ; ils ont réussi plus qu’ils ne l’espéraient ; faut-il envier leurs sort ? Oh non ! pas encore. Je rencontrai deux dames, et me retirai avec elles ; la fille était faible, svelte, pensive, et redoutant la marche elle cheminait à cheval ; la mère était bien portante, infatigable ; ajoutez à cela le langage le plus pur, les manières les plus distinguées et vous comprendrez que cela devait me rappeler une promenade de la Jonchère.
[93]
Hier dimanche, nous avons eu quelques réjouissances ; mais, hélas ! toute couleur locale s’en va ; les montagnards faisaient leur ronde au son du violon, et des Espagnols ont dansé le fandango en blouse : tambourins, castagnettes, vestes bariolées, résilles et mantilles, qu’allez-vous devenir ? Le violon envahit tout, et pour la blouse il n’y a plus de Pyrénées. Oh ! la blouse, ce sera le symbole du siècle prochain ! Mais, après tout, ce qui nous semble une profanation, n’est-il pas un progrès ? Nous sommes plaisants, nous autres civilisés, si fiers de nos arts et de nos toilettes, de vouloir qu’ailleurs on conserve à tout jamais, pour distraire les touristes, la culotte et le galoubet.
Ai-je bien lu, mesdames, vous me parlez de l’impossibilité de revenir à Paris sans être guéri ; de la nécessité de passer l’hiver à Mugron ! Vous me trouvez donc d’une bien aimable absence ?
Ah ! vous avez beau faire, je prends vos paroles pour des marques d’intérêt, car je suis le plus complaisant interprète du monde ; aussi j’espère rentrer à Paris le 20 juillet, à moins que la Chambre ne se proroge ; ce sera un retard de huit jours sur mon congé : il [94] serait plaisant que l’Assemblée me mît en pénitence pour être revenu trop tard, tandis que vous me gronderiez pour être revenu trop tôt.
Qu’il me tarde d’avoir une lettre de la Jonchère, de savoir si M. Cheuvreux s’est décidé à prendre quelque repos ; si vous poursuivez vos projets de solitude ? Une solitude à trois ! mais c’est l’univers : et puis Croissy n’est-il pas à portée de la main ? et la famille Renouard, les Say, Mme Freppa ? En conscience, je ne puis m’apitoyer sur votre sort !
Mon Dieu ! que j’abuse du joli pupitre de M. Cheuvreux : il a résolu pour moi le problème des plumes ; aussi je n’ai jamais écrit de lettres si incommensurables !
Obtenez mon pardon de Mlle Louise ; et ce que d’autres pourraient appeler indiscrétion, appelez-le amitié.
Adieu, votre dévoué,
F. Bastiat.
[95]
4 juillet 1850. ↩
Enfin, j’ai une lettre de la Jonchère, ma chère madame, et je suis maintenant bien sûr que vous êtes quelque part. De plus, vous m’annoncez que vos débuts à la campagne ont été heureux, que vous faites de longues promenades dans les bois, et que vous recevez de fort aimables visites, puisque vous avez aujourd’hui la famille Say.
Comme j’ai votre première lettre de la Jonchère, voici, je crois, ma dernière lettre des Eaux-Bonnes. Je les quitterai le 8, à moins que d’ici-là je n’apprenne que l’Assemblée prendra des vacances. Mais, dans le doute, il faut que je parte. Ce n’est pas que je sois radicalement guéri ; si ma santé s’améliore, le larynx s’opiniâtre à souffrir.
Décidément aux Eaux-Bonnes, cette année, le ridicule de la gentilhommerie est poussé si loin qu’il gâte tout. On s’y donne un accent, une tournure et des manières dignes du pinceau de Molière ; je ne vois ici que Mme de Latour-Maubourg qui persiste à être simple. Si c’est une leçon qu’elle offre aux précieuses qui l’entourent, cette leçon est perdue ; bien [96] entendu, je n’abuse pas de ce monde-là, car j’ai remarqué qu’on n’y accueille que les personnes qui fournissent l’occasion de dire : « J’étais avec M. de … nous nous sommes promenés avec le comte de, etc. » Ma société se compose d’un lieutenant bien malade, d’un jeune Espagnol presque mort et d’un Parisien de vingt-trois ans, aussi souffrant que deux autres.
Je suis surpris que ce temps d’exil, dont je désirais si vivement le terme, m’ait paru si court : « Tout ce qui doit finir passe vite. » Ce mot est aussi vrai que triste. Au fait, ce n’est pas sans quelques charmes que j’avais retrouvé mes habitudes provinciales. Indépendance, heures libres, travaux et loisirs capricieux, lectures au hasard, pensées errantes au gré de l’impulsion, promenades solitaires, admirable nature, calme et silence, voilà ce qu’on rencontre dans nos montagnes, et la puissance d’un si, d’un seul si en ferait un paradis. Que faudrait-il autre chose qu’une goutte de cette ambroisie qui parfume tous les détail de la vie, et qu’on nomme l’amitié ?
Vous avez vu dans les journaux les succès et les ovations de MM. Scribe et Halevy ; cela vous aura réjouie et fait sans doute un peu [97] regretter de n’en pas être témoin. Mlle Louise avait le pressentiment que d’agréables diversions l’attendaient à Londres. Félicitons-nous de tout ce qui rapproche et unit les peuples : sous ce rapport, la tentative de vos amis portera de bons fruits. Elle induira de plus en plus de nos voisins à étudier le français. La réciprocité serait bien utile, car nous aurions beaucoup à apprendre de l’autre côté de la Manche. J’ai vu avec bonheur que Richard Cobden, dans une circonstance difficile, qui devait être pour lui une épreuve cruelle, n’a ni glissé ni bronché. Il est resté conséquent avec lui-même ; mais ce sont choses que nos journaux ne remarquent pas.
Avez-vous lu, dans la Revue des Deux Mondes, l’article de M. de Broglie sur Chateaubriand ? Je n’ai pas été fâché de voir ce châtiment infligé à une vanité poussée jusqu’à l’enfantillage. Avec un si exclusif égoïsme au cœur, on peut être grand écrivain, mais croyez-vous qu’on puisse être un grand homme ? Pour moi, je déteste ces aveugles orgueilleux qui passent leur vie à poser, à se draper ; qui mettent l’humanité dans le plateau d’une balance, se placent sur l’autre [98] et croient l’emporter. Je regrette que M. de Broglie n’ait pas cherché à apprécier la valeur philosophique de Chateaubriand ; il aurait trouvé qu’elle est bien légère. Dans le onzième volume de ses mémoires, j’ai copié ce paradoxe : « La perception du bien et du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence s’éclaire ; la conscience se rétrécit à mesure que les idées s’élargissent. »
S’il en est ainsi, l’humanité est condamnée à une dégradation fatale et irrémédiable : un homme qui a écrit ces lignes est un homme jugé.
Le 5 juillet.
Voici une autre lettre de la Jonchère, mais qui ne confirme pas la précédente. Dans l’intervalle, j’avais eu des nouvelles par M. Say, et je croyais que vous étiez tous en bonne santé. Je vois que le sommeil vous boude, que Mlle Louise est fatiguée par la chaleur, et que M. Cheuvreux lui-même est indisposé ! Voilà un trio bien organisé ! Ce qui me contrarie vivement, c’est que je ne saurai rien de vous d’ici au 20 juillet, à moins que vous ne soyez assez bonne pour m’écrire encore une fois, ne fût-ce qu’un billet à Mugron. [99] Décidément je quitte les Eaux-Bonnes en répétant le refrain de notre ballade :
Aigues caoutes, aigues rèdes,
Lou mein maou n’es pot guari.
« Eaux chaudes, eaux froides, rien ne peut guérir mon mal. » Il est vrai que le bon chevalier parlait sans doute de quelque blessure étrange, sur laquelle toutes les sources des Pyrénées ne peuvent rien. J’étais plus fondé à compter sur elles pour mon larynx ; il a résisté ; que faire ?
J’aurai probablement de rudes assauts à soutenir à Mugron pour obtenir là aussi un congé. Mais je résisterai, ne pouvant me dispenser de paraître à l’Assemblée.
Voulez-vous aller visiter les Cormiers [9] ! c’est un lieu bien calme, frais et solitaire. Si j’y passe deux mois, je viendrai peut-être à bout de me lancer dans le monde des Harmonies. Ici je ne m’en suis pas occupé ; mon éditeur me presse : je lui dis que la froideur du public me refroidit. En cela, j’ai le tort de mentir. Les auteurs ne perdent pas courage pour si peu. Dans ces sortes de mésaventures, l’ange ou le démon de l’orgueil [100] leur crie : « C’est le public qui se trompe, il est trop distrait pour te lire, ou trop arriéré pour te comprendre. — C’est fort bien, dis-je à mon ange, mais alors je puis me dispenser de travailler pour lui. — Il t’appréciera dans un siècle, et c’est assez pour la gloire », répond l’opiniâtre tentateur.
La gloire ! Le ciel m’est témoin que je n’y prétendais pas ; et si un de ses rayons égarés, bien faible, était tombé sur ce livre, je m’en serais réjoui pour l’avancement de la cause, et aussi quelque peu pour la satisfaction de mes amis ; qu’ils m’aiment sans cela et je n’y penserai plus.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Mugron, 14 juillet 1850. ↩
Votre bonne lettre, mon cher monsieur Cheuvreux, m’est remise à l’instant. Quelques heures plus tard, elle aurait eu à refaire le voyage de Paris dans la même malle que son destinataire, car je me prépare à partir demain. J’ai tort sans doute ; il [101] faut bien que cela soit, puisque tout le monde le dit, et j’ai essuyé déjà je ne sais combien de bourrasques verbales et épistolaires. Je ne prétends pas avoir raison contre tous, quoique Mme Cheuvreux me traite, d’avance, de sophiste. La vérité est que je ne pouvais guère me dispenser de faire acte de présence à la Chambre avant les vacances ; après cela, j’avoue que je cède un peu à la fantaisie. Depuis quelque temps, j’ai une douleur toute locale au larynx, insupportable à cause de sa continuité ; il me semble que je trouverai du soulagement en changeant de place.
Mlle Louise peut craindre que sa lettre se soit égarée dans les Pyrénées. Veuillez la rassurer, on me l’a remise ici à mon arrivée ; vraiment, c’eût été pour moi une grande privation, car votre chère enfant a l’art (si c’est un art) de mettre dans ses lettres son âme et sa bonté. Elle me parle de l’impression que fait sur elle la littérature anglaise ; puis elle déplore la perte des croyances qui caractérise la nôtre.
Je me disposais à répondre une dissertation sur ce texte, mais je la lui épargne ; puisque je pars demain ; je prendrai de vive voix ma revanche.
[102]
Vous avez raison, bien cher monsieur Cheuvreux, de m’encourager à continuer ces insaisissables Harmonies. Je sens aussi que c’est un devoir pour moi de les terminer, et je tâcherai d’y consacrer mes vacances.
Le champ est si vaste qu’il m’effraie.
En disant que les lois de l’économie politique sont harmoniques, je n’ai pas entendu seulement qu’elles sont harmoniques entre elles, mais encore avec les lois de la politique, de la morale et même de la religion (en faisant abstraction des formes particulières à chaque culte) ; s’il n’en était pas ainsi, à quoi servirait qu’un ensemble d’idées présentât de l’harmonie, si cet ensemble était en discordance avec des groupes d’idées non moins essentielles ?
Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble que c’est par là, et par là seulement, que renaîtront au sein de l’humanité ces vives et fécondes croyances que Mlle Louise déplore la perte. Les croyances éteintes ne se ranimeront plus et les efforts qu’on fait, dans un moment de frayer et de danger, pour donner cette ancre à la société sont plus méritoires qu’ils ne seront efficaces. Je crois qu’une épreuve inévitable attend le [103] catholicisme. Un acquiescement de pure apparence que chacun exige des autres, et dont chacun se dispense pour lui-même, ce ne peut être un état permanent.
Le plan que j’avais conçu exigeait que l’harmonie politique fût ramenée à la certitude rigoureuse puisque c’est la base ; cette certitude, il paraît que je l’ai mal établie, car elle n’a frappée personne, pas même les économistes de profession. Peut-être le second volume donnera-t-il plus de consistance au premier. Je me recommande à vous et à Mme pour me détourner dorénavant avant de faire autre chose.
Adieu, mon cher monsieur,
Votre dévoué,
F. Bastiat.
[Editor's Note]↩
Après avoir quitté les Pyrénées au mois de juillet, Bastiat s’établit aux environs de Paris. Il passe ses matinées en solitaire au Buttard [104] et la fin de ses journées à la Jonchère. Mais cette cruelle laryngite s’aggrave ; un travail suivi lui devient chaque jour plus difficile. Ses amis, qui l’avaient vu l’année précédente écrire plusieurs chapitres des Harmonies au milieu du bruit, du mouvement, dans un coin de leur salon, sur le bord d’une table, trempant sa plume unique au fond d’une bouteille d’encre, simple appareil qu’il tirait de sa poche ; ses amis le surprenaient alors repoussant d’un geste impatient le papier posé devant lui ; inactif, et le front courbe, Bastiat restait muet jusqu’au moment où son ardente pensait jaillissait comme une fusée brillante en paroles éloquentes. Mais cette parole ramenait bien vite la douleur de gorge et lui imposait de nouveau le silence.
Le 9 septembre 1850, le malade, avec un sang-froid stoïque, rendait compte lui-même à Richard Cobden des conséquences redoutables de sa situation.
Paris, 9 septembre.↩
Mon cher Cobden, je suis sensible à l’intérêt que vous voulez bien prendre à ma santé. Elle est toujours chancelante. En [105] ce moment, j’ai une grande inflammation, et probablement des ulcérations à ces deux tubes qui conduisent l’air aux poumons et les aliments à l’estomac. La question est de savoir si ce mal s’arrêtera ou fera des progrès. Dans ce dernier cas, il n’y aurait plus moyen de respirer, ni de manger, a very awkward situation indeed. J’espère n’être pas soumis à cette épreuve, à laquelle cependant je ne néglige pas de me préparer, en m’exerçant à la patience et à la résignation. Est-ce qu’il n’y a pas une source inépuisable de consolation et de force dans ces mots : Non sicut ego volo, sed sicut tu ? Une chose qui m’afflige plus que ces perspectives physiologiques, c’est la faiblesse intellectuelle dont je sens si bien le progrès. Il faudra que je renonce sans doute à achever l’œuvre commencée. Mais, après tout, ce livre a-t-il toute l’importance que je me plaisais à y attacher ? La postérité ne pourra-t-elle pas fort bien s’en passer ? Et s’il faut combattre l’amour désordonné de la conservation matérielle, n’est-il pas bon d’étouffer aussi les bouffées de vanité d’auteur, qui s’interposent entre notre cœur et le seul objet qui soit digne des aspirations ? [106] D’ailleurs, je commence à croire que l’idée principale que j’ai cherché à propager n’est pas perdue ; et hier un jeune homme m’a envoyé en communication un travail intitulé : Essai sur le capital. J’y ai lu cette phrase :
« Le capital est le signe caractéristique et la mesure du progrès. Il en est le véhicule nécessaire et unique, sa mission spéciale est de servir de transition de la valeur à la gratuité. Par conséquent, au lieu de peser sur le prix naturel, comme on dit, son rôle constant est de l’abaisser sans cesse. »
Or cette phrase renferme et résume le plus fécond des phénomènes économiques que j’aie essayé de décrire. En elle est le gage d’une réconciliation inévitable entre les classes propriétaires et prolétaires. Puisque ce point de vue de l’ordre social n’est pas tombé, puisqu’il a été aperçu par d’autres qui l’exposeront à tous les yeux mieux que je ne pourrais faire, je n’ai pas tout à fait perdu mon temps, et je puis chanter avec un peu moins de répugnance mon Nunc dimittis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tout en politiquant, écrit-il plus loin, j’oubliais de vous dire que, pour me [107] conformer aux ordonnances des médecins, sans y avoir grand foi, je pars pour l’Italie. Ils m’ont condamnée à passer cet hiver à Pise, en Toscane ; de là, j’irai sans doute visiter Florence et Rome. Si vous avez à quelques amis assez intimes pour que je puisse me présenter à eux, veuillez me les signaler sans vous donner la peine de faire des lettres de recommandation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Bastiat.
Lyon, 14 septembre 1850. ↩
Chère demoiselle Louise,
Me voici à Lyon depuis hier soir ; à la rigueur vous auriez pu avoir cette lettre vingt-quatre heures plus tôt, mais en arrivant j’ai hésité entre le pupitre et le lit. Le cœur me poussait vers l’un et le corps vers l’autre : qui m’eût jamais dit que celui-ci l’emporterait dans une lutte de ce genre ? Cependant à peine couché il a été en proie [108] à une forte fièvre, ce qui explique sa victoire et me justifie à ses mes propres yeux. Du reste, soyez sans inquiétude sur cette fièvre, elle est tout accidentelle et ce matin il n’y paraît plus. Mardi, après vous avoir quittés, j’assistai au dîner des Économistes. M. Say nous présidait. Par suite de cette fatigue qui me prend toujours le soir, il me fut impossible d’aller dire adieu à Mme Say, ce dont j’ai bien du regret.
Mercredi je partis à dix heures et demie. Jusqu’à Tonnerre le voyage se fait à Merveille. Nous allions si rapidement que l’on pouvait à peine jouir du paysage ; en sorte que mes yeux s’étant fixés sur un nuage probablement visible à la Jonchère, je me rappelai que vous étiez peu satisfaite des paroles qu’on a mises à la jolie mélodie de Félicien David.
J’en adressai d’autres à mon nuage. Malheureusement elles ne sont pas rimées ; il est donc inutile que je les reproduise ici. De Tonnerre à Dijon commencent des tribulations de toutes sortes. Si vous suivez cette route, comme je l’espère, il faut que M. Cheuvreux se mette en rapport épistolaire [109] avec M. G… qui procure des voitures de poste.
N’étant responsable que de moi-même, je me suis confié au hasard qui aurait pu mieux me servir. Nous étions six dans une rotonde faite pour quatre. Sur six personnes il y avait quatre femmes ; c’est vous dire que nous avions sous les pieds, sur les genoux, dans les flancs, force paquets, cabas, paniers, etc., etc. Vraiment les femmes, si adorables d’abnégation dans la vie domestique, semblent ne pas comprendre que l’on se doit aussi quelque chose, même entre inconnus, dans la vie publique.
De Châtillon à Dijon, j’ai été huché sur une impériale, en quatorzième. C’est pendant ce trajet qu’on franchit le point culminant dont un côté regarde l’Océan, l’autre la Méditerranée. Quand on traverse cette ligne, il me semble qu’on se sépare une seconde fois de ses amis, car on ne respire plus le même air, on n’est plus sous le même ciel. Enfin de Dijon à Châlon, il ne s’agit que de deux heures en chemin de fer, et de Châlon à Lyon c’est une ravissante promenade sur l’eau.
Mais est-ce que je puis dire que je voyage ? [110] J’assiste à une succession de paysages, voilà tout. Ni dans les voitures, ni sur les bateaux, ni dans les hôtels, je n’entre ne communication avec personne. Plus les physionomies paraissent sympathiques, plus je m’en éloigne. Le chapitre des aventures fortuites, des rencontres imprévues, n’existe pas pour moi. Je parcours l’espace comme un ballot de marchandises, sauf quelques jouissances pour les yeux qui en sont bientôt rassasiés.
Vous me disiez, chère demoiselle, que la poétique Italie me serait une source d’émotions nouvelles. Oh ! je crains bien qu’elle ne puisse me tirer de cet engourdissement qui s’empare peu à peu de toutes mes facultés. Vous m’avez donné bien des encouragements et des conseils, mais pour que je fusse impressionnable à la nature et à l’art, il aurait fallu me prêter votre âme, cette âme qui voudrait s’épanouir au bonheur, qui se met si vite à l’unisson de tout ce qui est beau, gracieux, doux, aimable ; qui a tant d’affinité avec ce qu’il y a d’harmonieux dans la lumière, les couleurs, les sons, la vie. Non que ce besoin de bonheur révèle en elle rien d’égoïste, au contraire ; si elle le [111] cherche, si elle l’attire, si elle le désire, c’est pour le concentrer en elle comme en un foyer, et de là le répandre autour d’elle en esprit, en fine malice, en obligeance perpétuelle, en consolations et en affection. C’est avec une telle disposition de l’âme que je voudrais voyager, car il n’y a pas de prisme qui embellisse plus les objets extérieurs. Mais je change de dieux et de ciel sous une bien autre influence.
Oh ! combien est profonde la fragilité humaine ! Me voici le jouet d’un petit bouton naissant dans mon larynx ; c’est lui qui me pousse du midi au nord et du nord au midi ; c’est lui qui ploie mes genoux et vide ma tête ; c’est lui qui me rend indifférent à ces perspectives italiennes dont vous me parlez. Bientôt je n’aurai plus de pensées et d’attention que pour lui, comme ces vieux infirmes qui remplissent toutes leurs conversations et toutes leurs lettres d’une seule idée. Il me semble que me voilà pas mal sur le chemin.
Pour en sortir, mon imagination a une voie toujours ouverte, c’est d’aller à la Jonchère. Je me figure que vous jouissez avec délice des belles journées que septembre [112] tenait en réserve. Vous voilà tous réunis ! Votre cher père et M. Édouard sont revenus de Cherbourg enchantés des magnificences dont ils ont été témoins, et bien pourvus de narrations. Ne fut-ce que la présence de Marguerite, cela suffirait pour faire de votre montagne un séjour charmant. En voilà une qui pourra se vanter d’avoir été caressée ! J’aime beaucoup entendre les parents se reprocher mutuellement de gâter les enfants, petite guerre bien innocente, car les plus gâtés, c’est-à-dire les plus aimés, sont ceux qui réussissent le mieux.
Chère demoiselle, permettez-moi de vous rappeler qu’il ne faut pas chanter trop longtemps, surtout avec les fenêtres ouvertes. Défiez-vous des fraîcheurs de l’automne, évitez de prendre un rhume en cette saison. Songez que s’il vous survenait par votre faute, ce serait comme si vous rendiez malades tous ceux qui vous aiment. Redoutez ces retours de Chatou à onze heures de la nuit. Pour concilier le soin de votre santé et votre goût pour la musique, les soirées ne pourraient-elles pas se transformer en matinées ? Adieu, chère mademoiselle Louise.
[113]
Permettez-moi de vous offrir l’expression de toute mon affection.
F. Bastiat.
Le soir, Lyon, 14 septembre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Je pars demain pour Marseille. En prenant le bateau de onze heures, on n’a que l’inconvénient de coucher à Valence, et ce n’en sera pas un pour moi puisque j’aurai le plaisir de porter des nouvelles à votre frère le capitaine.
Si vous passez à Lyon ne manquez pas de gravir Fourvières ! C’est un horizon admirable où l’on embrasse d’un coup d’œil les Alpes, les Cévennes, les montagnes du Forez et celles de l’Auvergne. Quelle image du monde que ce Fourvières ! En bas, le travail et ses insurrections ; au milieu, des canons et des soldats ; en haut, la religion avec toutes ses tristes excroissances. N’est-ce pas l’histoire de l’humanité ?
En contemplant le théâtre de tant de luttes sanglantes, je pensais qu’il n’est pas de besoin [114] plus impérieux chez l’homme que celui de la confiance dans un avenir qui offre quelque fixité. Ce qui trouble les ouvriers, ce n’est pas tant la modicité des salaires que leur incertitude ; et si les hommes qui sont arrivés à la fortune voulaient faire un retour sur eux-mêmes, en voyant avec quelle ardeur ils aiment la sécurité, ils seraient peut-être un peu indulgents pour les classes qui ont toujours, pour une cause ou une autre, le chômage en perspective. Une des plus belles harmonies économiques c’est l’accession successive de toutes les classes à une fixité de situation de jour en jour plus stable. La société réalise cette fixité à mesure que la civilisation se fait, par le salaire, le traitement, la rente, l’intérêt, enfin par toute ce que repoussent les socialistes. De telle sorte que leurs plans ne font que ramener l’humanité à son point de départ, c’est-à-dire au moment où l’incertitude arrive au plus haut degré pour tout le monde… Il y a là un sujet de recherches nouvelles pour l’économie politique… Mais de quoi vais-je vous entretenir à propos de Fourvières ! Quelle poésie, grand Dieu ! Pour l’oreille délicate d’une femme !… Aideu encore, pardonnez ce torrent de [115] paroles ; je me venge de mon silence, mais est-il juste que vous en soyez victime ?
F. Bastiat.
Marseille, 18 septembre 1850. ↩
Mon cher monsieur Cheuvreux,
Il m’a été pénible de quitter Paris sans vous serrer la main, mais je ne pouvais retarder mon départ sous peine de manquer ici le paquebot-poste. En effet, je suis arrivé hier et n’ai qu’un jour pour tous mes préparatifs, passe-port, etc.
Il n’est pas même certain que je m’embarque ; j’apprends que les voyageurs qui suivent la voie de mer sont accueillis en Italie par une quarantaine. Trois jours de lazaret, c’est fort peu séduisant !
En arrivant à Marseille, ma première visite a été pour la poste, j’espérais y trouver une lettre ; savoir que vous jouissiez tous les trois d’une bonne santé à la Jonchère m’aurait rendu si heureux ! cette lettre n’y était pas. La réflexion m’a fait comprendre mon trop [116] d’exigence, car enfin il y a à peine huit jours que j’ai quitté cette chère montagne ; le silence fait paraître le temps si long ; il n’est point étonnant que j’attache tant de prix à la réception d’une lettre.
Qu’il me tarde d’être à Pise, qu’il me tarde de savoir si ce beau climat raffermira ma tête et mettra à sa disposition deux heures de travail par jour. Deux heures ! ce n’est pas trop demander, et pourtant c’est encore là une vanité.
Sans doute comme à André Chénier, comme à tous les auteurs, il me semble que j’ai quelque chose là ; mais cette bouffée d’orgueil ne dure guère. Que j’envoie à la postérité deux volumes ou un seul, la marche des affaires humaines n’en sera pas changée.
N’importe, je réclame mes deux heures, sinon pour les générations futures, du moins dans mon propre intérêt. Car, si l’interdiction du travail doit s’ajouter à tant d’autres, que deviendrai-je dans cette tombe anticipée ! J’ai passé à Valence la nuit du dimanche au lundi. Malgré le désir que j’avais de voir le capitaine et les efforts que j’ai faits pour cela, je n’ai pu réussir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[117]
Le 19. Décidément je pars demain et par terre. Me voici lancé dans une entreprise dont je ne vois pas le terme.
Ce matin j’espérais encore une lettre, je serais parti plus gaiement ; maintenant le bon Dieu sait où et quand j’entendrai parler de vous tous ; me faudra-t-il attendre quinze jours ?
Veuillez, cher monsieur Cheuvreux, me rappeler au souvenir de la mère et de la fille, les assurer de ma profonde amitié. Ne m’oubliez pas non plus auprès de M. Édouard et de Mme Anna, qui me permettront bien d’embrasser tendrement, quoique de bien loin, leur aimable enfant.
Adieu, cher monsieur Cheuvreux.
F. Bastiat.
Marseille (à bord du Castor), 22 septembre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Avant de quitter la France, permettez-moi de vous adresser quelques lignes. La date de cette feuille va vous surprendre, en voici l’explication.
[118]
Vous savez que, résolu à prendre la voie de terre, j’ai laissé partir le bateau du 19. Dès lors un jour plus tôt ou plus tard n’importait guère, et je ne pouvais me décider à quitter Marseille, sachant qu’une de vos lettres était sur le point d’arriver. J’ai attendu et j’ai bien fait, puisque je reçois enfin vos encouragements si bienveillants, si affectueux, et de plus je sais la grande détermination prise à la Jonchère.
Bref, hier je devais partir par la diligence, mais je ne me dissimulais pas que, pour éviter le Lazaret, je tombais dans d’autres inconvénients : traverser des flots de poussière, aller d’auberge en auberge, de voiturin en voiturin, lutter du larynx avec les portefaix ; toute cela ne me souriait guère. À 11 heures, lisant le journal de Marseille, je vis que le Castor partait pour Livourne dans l’après-midi. Quoique vous me recommandiez d’éviter l’imprévu, je fis arrêter et payer une place, pensant que la quarantaine devrait s’avaler d’un trait en fermant les yeux. Le soir la mer fut si grosse que le bateau ne sortit pas, et voilà comment je griffonne maintenant cette épître pendant qu’on lève l’ancre.
[119]
Depuis que je suis à bord, je m’aperçois qu’on a bien tort d’arrêter sa place le dernier. Au lieu d’avoir une bonne cabine pour soi, on a sa part de la cabine commune.
O imprévoyant ! tu traverseras la Méditerranée dans la cabine commune d’un paquebot, tu mourras dans la salle commune d’un hôpital, et tu seras jeté dans la fosse commune d’un Campo santo ! Qu’importe ! si le bonheur que j’ai rêvé dans ce monde-ci m’attend dans l’autre. Pourtant mieux vaut avoir une cabine à soi ; c’est pour cela que je vous écris afin que vous preniez toutes vos précautions.
Votre voyage me préoccupe ; je croyais d’abord tenir une solution (qui ne cherche des solutions, aujourd’hui ?). Je pensais que Sa Sainteté, qui met son infaillibilité sous la protection de nos baïonnettes, devait épargner une quarantaine dérisoire à ses soldats. Dès lors il eût été facile à M. Cheuvreux et à M. Édouard Bertin d’obtenir passage sur un vaisseau de l’État allant à Civita-Vecchia ; mais il paraît que nos troupes mêmes sont soumises aux mesures sanitaires (mauvaise solution). Enfin, un voyage à travers les [120] Apennins me paraît bien hasardé à la fin d’octobre.
Je comptais écrire à Mlle Louise, car, ainsi qu’un bon gouvernement veut bien prélever beaucoup d’impôts mais les répartit également, je sens la nécessité de diviser le poids de mes lamentations ; ma lettre n’eût pas été aimable, hélas ! En route je n’ai su voir que le côté répréhensible et critiquable des choses. Les couleurs ne sont pas sur les objets, je le sens ben, elles sont en nous-mêmes. Selon qu’on est noir ou rose, on voit tout en noir ou en rose.
Adieu, je ne puis plus tenir la plume sous le frémissement de la vapeur.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Pise, 2 octobre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Sans doute nous nous plaignons tous deux l’un de l’autre : vous de ce déluge de lettres dont je vous accable, et moi je me [121] désole de n’en recevoir aucune. Mais je ne vous accuse pas, il est impossible que vous ayez laissé passer tout ce temps sans m’écrire ; j’attribue mon désappointement à quelque malentendu de la poste italienne. Cette explication est d’autant plus vraisemblable que je suis aussi sans nouvelles de ma famille et de Paillotet. J’ignore si vous persistez dans votre projet de voyage, quelle route vous prendrez, etc. Je suis allé à Livourne pour m’assurer de l’état du Lazaret. Ces grands appartements manquent de meubles ; mais dès que je serai fixé sur votre arrivée, je m’occuperai de préparer deux chambres. Un traiteur passable pourvoira à la nourriture, puis, si vous le permettez, je me mettrai aussi avec plaisir en quarantaine : « … et Phèdre au labyrinthe. » Malheureux ! j’oublie que je ne puis parler et que ma société n’est qu’un nuisance.
Si vous saviez, madame, combien votre entreprise me préoccupe pour Mlle Louise. Ce n’est pas qu’elle présente le moindre danger ; j’espère même du beau temps en octobre, puisque les vents soufflent au mois de septembre, mais je crains que vous ne [122] souffriez toutes deux. J’invoque les bénignes influences du ciel et de la mer !
Enfin voici un moment de bonheur ! Je l’ai lue votre lettre du 25, elle m’arrive accompagnée d’une missive de ma tante et d’une autre de Cobden. Je voudrais que vous me vissiez, je ne suis plus le même.
Est-ce bien digne d’un homme de se mettre ainsi tout entier sous la dépendance d’un événement extérieur, d’un accident de poste ? N’y a-t-il pas pour moi des circonstances atténuantes ? Ma vie n’est qu’une longue privation. La conversation, le travail, la lecture, les projets d’avenir, tout me manque. Est-il étonnant que je m’attache, peut-être avec trop d’abandon, à ceux qui veulent bien s’intéresser à ce fantôme d’existence ? Oh ! leur affection est plus surprenante que la mienne. Vous partez donc le 10 ? Si cette lettre vous parvient, répondez-y de suite.
Vous me recommandez de vous parler comme à la justice, de dire la vérité, toute la vérité ; je le voudrais bien, mais il m’est impossible de savoir si je vais mieux ou plus mal. La marche de cette maladie, qu’elle avance ou qu’elle recule, est si lente, si imperceptible qu’on n’aperçoit aucune [123] différence entre la veille et le lendemain. Il faut prendre des points de comparaison plus éloignés. Par exemple, comment étais-je il y a un an au Buttard ? comment y étais-je cette année, et comment suis-je maintenant ? Voilà trois époques, et je dois avouer que le résultat de cet examen n’est pas favorable.
Le départ de votre frère et de sa famille aura laissé un grand vide à la Jonchère, il suffit d’une gentille enfant comme Marguerite pour remplir toute une maison.
Adieu, chère madame Cheuvreux.
Venez, venez bientôt rendre un peu de mouvement à cette Italie qui me semble morte. Quand vous y serez tous j’apprécierai mieux son soleil, son climat, ses arts. Jusque-là je vais suivre votre conseil, m’occuper exclusivement de mon corps, en faire une idole, lui vouer un culte et me mettre en adoration devant lui. Puissé-je réussir à recouvrer la parole quand vous serez là ! car, madame, auprès de vous le mutisme est pénible ; vous avez une collection de paradoxes que vous défendez fort bien, mais auxquels on est bien aise de répondre.
Adieu, M. Cheuvreux ne va pas être [124] le moins occupé des trois. Je vois prie de croire à ma vive et respectueuse affection.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Pise, le 14 octobre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Enfin ! si rien n’a dérangé vos combinaisons, s’il n’y a pas eu un coup d’État à Paris, si Mlle Louise ne s’est pas laissé gagner par quelque maudite indisposition, ou M. Cheuvreux par la migraine, s’il s’est mis en règle envers son tribunal, si… si vous avez fait en ce moment le premier pas, le plus difficile, celui qui coûte le plus, vous voilà sur le rail-way, en route pour Tonnerre. Chaque soir je pourrai dire : Il y a cinquante lieues de moins entre nous. Oh ! que nos neveux seront heureux d’avoir des télégraphes électriques qui leur diront : « Le départ s’est effectué il y a une minute ! » Et maintenant, mesdames, pourquoi les vœux de l’amitié sont-ils complétement inutiles ? [125] Si les miens pouvaient être exaucés, votre voyage ne serait qu’une succession d’impressions agréables ; vous auriez un beau soleil pour constante société, sans compter d’aimables rencontres tout le long du chemin ; Mlle Louise sentirait ses forces s’accroître d’heure en heure, sa gaieté, son intérêt sympathique à tout ne se démentirait pas un instant. Cette disposition gagnerait son père et sa mère, et vous arriveriez ainsi à Marseille. Là vous trouveriez la mer unie comme une glace, la quarantaine supprimée, etc. Mais tous les souhaits du monde n’empêcheront pas que vous n’ayez choisi le jour de votre départ de manière à grossir beaucoup les difficultés du voyage. Cela tient un peu à ma mauvaise réputation. Vous êtes si convaincu que je ne sais pas discerner la gauche de la droite, à force de le répéter, vos préventions à cet égard sont tellement invétérées, que je passe pour absolument incapable d’exécuter la moindre manœuvre, et bien plus encore de conseiller les autres. C’est pourquoi vous n’avez pas lu un seul mot de tout ce que j’ai écrit à ce sujet. D’après ce que vous me dites, il est clair comme le jour que vous avez sauté à pieds joints tous les [126] passages de mes lettres où je me pose en donneur d’avis. Mais il est inutile de revenir là-dessus, puisque ces avis, en supposant que vous en fissiez cas, arriveront trop tard.
Au lieu d’un bon paquebot français, n’aurez-vous pas un petit bateau sarde bourré de marchandises, couvert de toute espèce de passagers, sans police ni discipline, où les voyageurs de seconde envahissent les premières places et viennent fumer sous le nez des dames ? ce dont on peut se plaindre d’autant moins au capitaine que celui-ci donne l’exemple de toutes les infractions à la règle. Enfin ce pèlerinage commence à la grâce de Dieu, il faut bien qu’il se termine de même.
Bien chère madame, comment finir cette lettre sans solliciter un pardon dont j’ai bien besoin ? Je me suis beaucoup récrié à propos de votre silence ; j’étais ben ingrat, bien injuste, car j’ai reçu plus de lettres, non pas que je n’en désirais, mais que je n’osais en espérer. Seulement, la première a tardé et s’est trouvée un peu laconique ; voilà la cause de tout ce bruit. Soyez indulgente pour les doléances des malades : on les plaint, on [127] les excuse, on y condescend quand on est bonne comme vous, mais on ne s’en fâche pas.
Adieu, votre dévoué,
F. Bastiat.
Pise, le 29 octobre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Que votre voyage de Florence à Rome a dû être pénible [10] ! Malgré ce fonds de philosophie avec lequel vous savez prendre les contrariétés, malgré la bonne humeur que chacun de vous aura apporté à la communauté, il n’est pas possible que vous n’ayez pas souffert avec un si horrible temps, à travers des routes défoncées et dans un pays sans ressources. Mon imagination ose à peine vous suivre dans cette Odyssée ; toutes les prédictions de M. Sturler se dressent devant elle. Combien je bénis pourtant l’heureuse inspiration qui [128] vous a fait prendre la mer à Marseille le 19 ! Deux jours plus tard la traversée est devenue dangereuse, la Méditerranée s’est soulevée au point de désorganiser tous les services, et le bateau arrivé à Gênes, qui vous a suivis, n’a pu parvenir jusqu’à Livourne. Il a relâché à la Spezzia, où il a abandonné ses passagers. Grâce au ciel, vous avez échappé à ces périls, et cette idée me console un peu de vos privations actuelles, qui heureusement finiront ce soir. La vue de la ville éternelle fait tout oublier. Cette ville éternelle, je compte y entrer samedi 2 novembre. Je partirai de Livourne par le paquebot de l’État (tempo permettendo), et vous comprenez que je ne m’arrêterai pas à Civita-Vecchia.
Chère madame, ne parlons pas de ma santé, c’est une sonate dont j’aurai tout le temps de vous étourdir à Rome. Quand je pense que vous êtes venue pour procurer à votre mari, à votre fille surtout, plaisirs et distractions, j’ai quelques remords de me jeter au milieu de vous comme un trouble-fête, car je m’aperçois bien que depuis longtemps je tourne au Victor Hugo, à ses Derniers jours d’un condamné, ce qui devient peu récréatif pour [129] mes amis. Encore je m’avise de trouver le héros de Victor Hugo bien heureux ; car enfin il pouvait penser et parler ; il était dans la même position que Socrate, pourquoi n’a-t-il pas pris les choses comme lui ?
Ce petit livre que je vous ai demandé nous montre ce philosophe athénien, condamné à mort, dissertant sur son âme et son avenir ; cependant Socrate était païen, il était réduit à se créer, par le raisonnement, des espérances incertaines. Un condamné chrétien n’a pas ce chemin à parcourir ; la révélation le lui épargne, et son point de départ est précisément cette espérance, devenue une certitude, qui pour Socrate était une conclusion. Voilà pourquoi le condamné de Victor Hugo n’est qu’un être pusillanime. Ne vaut-il pas mieux avoir devant soi un mois de force et de santé, un mois de vigueur de corps et d’âme, et la ciguë au bout, qu’un an ou deux de déclin, d’affaiblissement, de dégoût, pendant lesquels tous les liens se rompent, la nature ne semblant plus prendre d’autre soin que de vous détacher de la terrestre existence ? Enfin, à Dieu d’ordonner, à nous de nous résigner.
Il me paraît bien que je suis un peu mieux ; [130] j’ai pu faire d’assez longues séances chez M. Mure, de plus j’ai reçu un très-grand nombre de visites.
Paillotet m’a écrit ; c’est toujours le même homme, bon, obligeant, dévoué et de plus naïf, ce qui est assez rare à Paris. Ma famille me donne aussi de ses nouvelles.
Adieu, chère madame Cheuvreux, à samedi ou dimanche ; d’ici là, veuillez assurer M. Cheuvreux et votre fille de toute mon amitié, n’oubliez pas le capitaine et veuillez présenter mes compliments et mes respects à M. Édouard et à Mme Bertin.
F. Bastiat.
Rome, 8 décembre 1850. ↩
Cher Paillotet,
Suis-je mieux ? Je ne puis le dire, je me sens toujours plus faible. Mes amis croient que les forces me reviennent ; qui a raison ?
La famille Cheuvreux quitte Rome immédiatement par suite de la maladie de [131] Mme Girard. Jugez de ma douleur. J’aime à croire qu’elle vient surtout de celle de ces bons amis, mais assurément des motifs plus égoïstes y ont une grande part. Par un hasard heureux, j’écrivis hier à ma famille pour qu’on m’expédiât une espèce de Michel Morin, homme plein de gaieté et de ressources, cocher, cuisinier, etc., etc., qui m’a souvent servi et qui m’est entièrement dévoué. Dès qu’il sera ici, je serai maître de partir pour la France quand je voudrai ; car il faut que vous sachiez que le médecin et mes amis ont pris à ce sujet une délibération solennelle.
Ils ont pensé que la nature de ma maladie me crée des difficultés si nombreuses que tous les avantages du climat ne compensent pas les soins domestiques. D’après ces disposition, mon cher Paillotet, vous ne viendrez pas à Rome gagner auprès de moi les œuvres de la miséricorde. L’affection que vous m’avez vouée est telle que vous en serez contrarié, j’en suis sûr. Mais consolez-vous un peu en pensant que vous auriez pu faire bien peu pour moi, si ce n’est me tenir compagnie deux heures par jour, chose encore plus agréable que raisonnable.
[132]
Je voudrais pouvoir vous donner à ce sujet des explications, mais bon Dieu ! des explications, il faudrait beaucoup écrire et je ne puis.
Mon ami, sous des milliers de rapports, j’éprouve le supplice de Tantale. En voici un nouvel exemple, je voudrais vous dire toute ma pensée, et je n’en ai pas la force…
Rome, samedi 14 décembre 1850. ↩
Bien chère madame Cheuvreux,
J’espère m’asseoir quelquefois à ce pupitre, ajouter une ligne à une ligne pour vous envoyer un souvenir.
Je n’ai jamais été si près du néant et je voudrais être tout-puissant pour rendre la mer calme comme un lac.
Quelles émotions, quels devoirs vous attendent à Paris ! Ma seule consolation, c’est de me dire que vous êtes prête à entrer, avec une courageuse énergie, dans la voie que Dieu vous aura préparée, fût-ce la plus pénible.
Ma santé est la même. Si j’entreprenais [132] d’en parler, ce ne pourrait être que par une série de petits détails qui, le lendemain, n’ont plus aucune importance.
Au fond, je crois que le docteur Lacauchy a raison de ne pas écouter un mot de ce que je lui dis.
Je me réjouis à l’idée que M. Cheuvreux verra bientôt l’excellent, le trop excellent Paillotet et le décidera à renoncer à un acte de dévouement aujourd’hui tout à fait inutile. Je crains bien que sa présence à Paris ne me soit absolument indispensable si on réimprime les Harmonies. Je ne pourrai pas m’en occuper, tout retombera sur lui.
Dimanche, 15 décembre.
Vous voilà à Gênes, encore un peu de patience et vous voilà en France. Il est cinq heures, c’est l’heure où vous veniez me voir. Alors je savais quelle galerie Mlle Louise avait visitée, quelle ruine, quel tableau l’avait intéressée. Cela éclairait un peu ma vie. Tout est fini, je suis seul vingt-quatre-heures, sauf les deux visites de mon cousin de Monclar. L’heure à laquelle je fais allusion est devenue amère parce qu’elle était trop douce ; [134] vous me prouviez avec la science de votre père que j’avais raison d’être le plus maussade, le plus bête, le pus irritable et souvent le plus injuste des hommes. Au reste, il me semble que j’apprends la résignation et que j’y trouve un certain parfum.
Lundi, 16 décembre.
Quand Jospeh est venu me faire ses adieux, le pauvre homme s’est confondu en remercîments. Hélas ! des remercîments, personne ne m’en doit et j’en doit à tout le monde, surtout à Joseph, qui m’a été d’un secours si réel.
Nouvelle découverte ! Un mouvement précipité m’a ôté toute respiration. Une haleine ne pouvant joindre l’autre, c’est une souffrance des plus pénibles. J’en ai conclu que je devais agir en tout lentement comme un automate.
Mardi, 17 décembre [11] .
Paillotet est arrivé. Il m’annonce l’affreux événement. Oh ! pauvre femme ! pauvre [135] enfant ! vous avez reçu le coup le plus terrible, le plus inattendu. Comment l’aurez-vous supporté avec une âme si peu faite pour souffrir ? Louise saura se posséder davantage dans la douleur. Jetez-vous dans les bras de cette force divine, la seule force qui puisse soutenir en de telles épreuves. Que cette force ne vous abandonne jamais. Chers amis, je n’ai pas le courage de continuer ces mots sans suite, ces propos interrompus.
Adieu, malgré mon état d’anéantissement je retrouve encore de vives étincelles de sympathie pour le malheur qui est venu vous visiter.
Adieu, votre ami,
Frédéric Bastiat.
De M. Paillotet à Mme Cheuvreux. Rome, 22 décembre 1850. ↩
Madame,
J’acquitte une dette personnelle et remplis les intentions de notre ami en vous donnant de ses nouvelles. Vous vous faisiez [136] peu d’illusion lorsque vous l’avez quitté ; et cependant vous ne pouviez croire que le déclin de ses forces serait aussi rapide. Ce déclin est bien sensible depuis mon arrivée ici. Le pauvre malade s’en aperçoit et s’en réjouit intérieurement comme d’une faveur du ciel qui veut abréger ses souffrances. Il a d’abord protesté en paroles et en gestes contre ce qu’il appelait ma folie. Nous avons eu peine à lui faire entendre raison à ce sujet M. de Monclar et moi. Toutefois je n’ai pas tardé à reconnaître que ma présence était une consolation et je vous sais un gré infini, madame, de m’avoir mis à même de la lui procurer. « Puisque vous avez accompli ce voyage, je suis bien aise maintenant que vous soyez ici, » m’a-t-il dit le troisième jour. Il ne manque jamais d’ailleurs de me demander lorsque je le quitte : « Et à quelle heure vous verrai-je demain ? »
Voici comment, avec M. de Monclar, dont tout naturellement j’ai consulté les convenances, nous nous sommes partagé ses journées. M. de Monclar lui fait une visite matinale et se retire au moment où j’arrive, c’est-à-dire à onze heures et demie. Moi, je lui [137] tiens compagnie jusqu’à cinq heures après midi, et, dans l’après-dîner, c’est M. de Monclar qui revient.
C’est un bien douloureux spectacle que celui auquel j’assiste ; mais je regretterais beaucoup, par affection et par devoir, de n’être pas là. Presque toujours, la mort est en tiers dans nos entretiens. Nous évitons, lui et moi, d’en prononcer le nom ; lui pour ne pas m’affliger, moi pour ne pas lui donner l’exemple de l’attendrissement et des pleurs, lorsqu’il me donne celui du courage. Il meurt, en effet, comme j’ai toujours pensé qu’il devait mourir, en regardant la mort en face et avec une complète résignation.
Les sujets de nos entretiens sont les amis absents, parmi lesquels vous et les vôtres avez la première place ; puis sa science chérie, cette économie politique pour laquelle il a tant fait, pour laquelle il eût voulu tant faire encore. Je n’ai pas besoin de vous dire que ces entretiens sont fort courts et que c’est de loin en loin que j’approche mon oreille de ses lèvres. Les quelques phrases qu’il prononce, je les recueille avec un religieux respect.
[138]
Hier nous avons fait une promenade qui l’a ravi. En sortant par la porte del Popolo, nous sommes allés au ponte Molle et revenus par la porte Angelica. Un beau soleil illuminait les sites que nous avions sous les yeux. Il me répétait souvent : « Quelle délicieuse promenade ! Comme nous avons bien réussi ! » La sérénité du ciel avait passé dans son âme. Il adressait comme un dernier adieu aux splendeurs de la nature qui ont si souvent excité son enthousiasme.
Depuis le 20 de ce mois il s’est confessé. « Je veux, m’a-t-il dit, mourir dans la religion de mes pères. Je l’ai toujours aimée, quoique je n’en aie pas suivi les pratiques extérieures. »
Je me borne à ces quelques détails et peut-être même dois-je m’excuser de vous les présenter, à vous qui êtes déjà sous le poids de la plus légitime affliction causée par la plus cruelle des pertes.
Il s’en est peu fallu que je ne vous rencontrasse à Livourne, où nous étions, à ce qu’il paraît, le même jour, ce que j’ai su depuis. Je me suis d’ailleurs applaudi de ce que cette rencontre n’avait pas eu lieu, car vous aviez encore alors un reste [139] d’espoir qu’il m’eût été difficile de ne pas vous enlever.
Veuillez bien offrir, madame, à M. Cheuvreux mes affectueux souvenirs et recevoir, ainsi que Mlle Cheuvreux, l’hommage de mon respectueux dévouement.
P. Paillotet.
Endnotes
[1] Fontenay.
[2] Discussion à la Chambre, à propos d’une dépêche télégraphique adressée par le ministre de l’intérieur Faucher aux préfets quelques jours avant les élections du 18 mai 1849.
[3] Paroles de Gœthe dans Mignon.
[4] M. Pescatore, propriétaire des bois du Buttard, avait mis à la disposition de M. Bastiat le pavillon qui servait autrefois de rendez-vous de chasse. Dans ce lieu solitaire et charmant, situé tout près du château de la Jonchère, le travailleur écrivit les premiers chapitres des Harmonies.
[5] Place force de Hongrie.
[6] Les Harmonies.
[7] Voyez les Harmonies, chapitre de la valeur.
[8] Gabrielle.
[9] Bois du Buttard.
[10] Les amis de Bastiat, après avoir passé deux jours près de lui à Pise, étaient allés l’attendre à Rome.
[11] Cette lettre, la dernière qu’il ait écrite, n’a précédé sa mort que de huit jours.
Endnotes↩
[4] Ainsi, vingt ans avant son premier ouvrage, Bastiat s’occupait déjà du commencement de réforme douanière inauguré, chez nos voisins, par Huskisson. (Note de l’éditeur.)
[5] Cet écrit ne fut pas imprimé. (Note de l’éditeur.)
[6] V. au présent volume, la lettre à M. Larnac ; — au t. IV, les pp. 192 à 203 ; — et au t. V, les pp. 518 à 561. (Note de l’éditeur.)
[7] On reconnaît dans ce passage l’idée fondamentale que Bastiat devait développer vingt ans plus tard, l’Harmonie des intérêts.(Note de l’éditeur.)
[8] Dans la pensée de Bastiat, l’économie politique et la politique étaient inséparables, il rattache ici les idées libérales aux enseignements de l’illustre professeur à l’université de Glasgow, Adam Smith. (Note de l’éditeur.)
[9] C’est du cercle de Mugron qu’il s’agit. (Note de l’éditeur.)
[10] Cette lettre a été découverte par M. Paul-Dejean dans une vente aux enchères, en 2012, quelques mois seulement avant la publication de ce volume. L'eussions nous eue plus tôt, nous aurions placé ces deux textes au volume 1,"Articles d'intérêt biographique", car la lettre montre que Bastiat ne s'est pas contenté d'écrire une pétition, mais a pris une part active à la défense des réfugiés polonais.
Si nous avions décidé initialement de mettre la pétition dans ce volume, c'est que d'une part elle était impersonnelle, d'autre part, elle contenait des considérations économiques intéressantes sur le rapport entre le métier et le lieu de résidence. Ces considérations s'appliquent, mutatis, mutandis, aux effets sur l'emploi de la pénurie de logement due à l'intervention incessante de l'État dans la construction et dans les loyers depuis la fin de la guerre.
[11] Il s’agissait de fonder une compagnie d’assurance. (Note de l’éditeur.)
[12] fortifications
[13] Cette lettre, préparée sur un cahier, il y a trente ans à peu près, fut-elle mise au net et envoyée au destinataire, dont je supprime le nom ? Je l’ignore. Mais je crois utile de la reproduire, ne fût-ce que pour montrer une fois de plus combien Bastiat prenait au sérieux le gouvernement représentatif, et aimait à conformer ses actes à ses théories. Je la fais suivre d’une lettre qui fut adressée quelques années plus tard à M. Dampierre. (Note de l’éditeur.)
[14] Pour appuyer la candidature de M. Faurie. (Note de l’éditeur.)
[15] J’ai à répéter sur cet article ce que je viens de dire sur le précédent. (Note de l’édit.)
[16] Cette lettre a été découverte par M. Paul-Dejean dans une vente aux enchères, en 2012, quelques mois seulement avant la publication de ce volume. L'eussions nous eue plus tôt, nous aurions placé ces deux textes au volume 1,"Articles d'intérêt biographique", car la lettre montre que Bastiat ne s'est pas contenté d'écrire une pétition, mais a pris une part active à la défense des réfugiés polonais.
Si nous avions décidé initialement de mettre la pétition dans ce volume, c'est que d'une part elle était impersonnelle, d'autre part, elle contenait des considérations économiques intéressantes sur le rapport entre le métier et le lieu de résidence. Ces considérations s'appliquent, mutatis, mutandis, aux effets sur l'emploi de la pénurie de logement due à l'intervention incessante de l'État dans la construction et dans les loyers depuis la fin de la guerre.
[17] Cette esquisse, c’est ainsi que l’auteur la désigne en marge, restée à l’état de fragment, est postérieure à 1840. (Note de l’éditeur.)
[18] Article inédit paraissant avoir été destiné à un journal du midi de la France. Il est de 1844. (Note de l’édit.)
[19] 1st and only ref to fortifications of Paris 1841-44??
[20] La date complète n’était pas publiée dans l’édition originale. Toutefois, les autres lettres étant publiées dans l’ordre chronologique, on peut raisonnablement supposer qu’il s’agit du 18 juin 1845. (Note de Wikisource.)
[21] V. ci-après l’écrit intitulé : De l’avenir du commerce des vins entre la France et la Grande-Bretagne. (Note de l’éditeur.)
[22] La mort d’une parente. (Note de l’éditeur.)
[23] Béranger
[24] fortifications
[25] Le mot anglais repeal a été mal traduit en français par le mot rappel. Repeal signifie : abrogation, révocation, cessation. L’usage ayant maintenant donné le même sens au mot rappel, j’ai cru pouvoir le maintenir.
[26] M. P., abréviation qui signifie membre du parlement.
[27] J’ai cru pouvoir, pour alléger, transporter dans notre langue quelques-uns de ces mots composés de deux substantifs, si fréquents en anglais, et sacrifier la logique grammaticale à la commodité.
[28]
[29] Fox’s famous speech about global markets
[30] les fortifications de Paris
[31] FB’s selection by chance?? random??
[32] M. George Thompson. Voir pages 298 et 340.
[33] La coopération de plusieurs de ces personnages ne fut pas obtenue (Note de l’éditeur.)
[34] L’explication de cette circonstance se trouve dans une lettre adressée à M. Coudroy, p. 74. (Note de l’éditeur.)
[35] V. ci-après l’écrit intitulé : À MM. les électeurs de l’arrondissement de Saint-Sever. (Note de l’éditeur.)
[36] V. ce discours, t. II, p. 248. (Note de l’éditeur.)
[37] Ce discours n’a pas été prononcé. On trouvera des développements sur le même sujet, t. II, p. 177 et suiv., et t. III, p. 449 à 510. (Note de l’éditeur.)
[38] des fortifications de Paris, d’Alger
[39] M. de Sismondi, dans ses Nouveaux principes d’économie politique (1827, tome I, page 189), a aussi reconnu cette propriété au métayage quand la même famille se maintient sur le domaine. Mais il a signalé l’accroissement excessif de population qui pouvait résulter du bon plaisir du maître toujours disposé à offrir sa terre aux seconds fils qui, désirant se marier, acceptent des diminutions sur les conditions de la métairie, et arrivent, comme les paysans des rivières de Gênes, de la république de Lucques et de quelques provinces de Naples, à se contenter du Itiersˆdes récoltes au lieu de la moitié. (Note du rédacteur en chef.)
[40] Cet article a été fait pour l’Encyclopédie du dix-neuvième siècle.
[41] Je dois prévenir qu'un article sur la Population, qui suivra celui de la Concurrence, en est le complément indispensable.
[42] Mémorial bordelais, du 19 mai 1846, reproduisant la Patrie.
[43] Aux électeurs de l’arrondissement de Saint-Sever. T. Ier, p. 401.(Note de l’éditeur.)
[44] Il est facile d’inférer de ce passage et de plusieurs autres, que Bastiat eut porté deux jugements sur ce qu’on nomme aujourd’hui les candidatures officielles. 1° Il y aurait vu une dérision du régime représentatif ; 2° cette dérision lui eut semblé plus triste que nouvelle. (Note de l’éditeur.)
[45] Cet article a été fait pour l’Encyclopédie du dix-neuvième siècle.
[46] The passage in bold was added to the JDE version of the article and was not in the original Encyclopedia article.
[47] The passage in bold was added to the JDE version of the article and was not in the original Encyclopedia article.
[48]
[49] Il est juste de dire que J .-B. Say a fait remarquer que les moyens d'existence étaient une quantité variable, d'où il suit que sa formule, ainsi qu’il le déclare lui-même, n'a rien de scientifiquement rigoureux. [This footnote was added to the JDE version of the article and was not in the original Encyclopedia article.]
[50]
[51] Voyez le numéro 54, mai 1846 (tome XV, p. 106).
[52] The original Encyclopedia article ends here. What follows was added for the JDE article.
[53] le temps des lourdes taxes, des fortifications
[54]V. tome IV, page 258. (Note de l’éditeur.)
[55] Si l’auteur eût vécu, il eût probablement publié une troisième série de Sophismes. Les principaux éléments de cette publication nous ont semblé préparés dans les colonnes du Libre-Échange, et, à la fin du tome II, nous les présentons réunis. (Note de l’éditeur.)
[56] Le petit volume, contenant la première série des Sophismes économiques, parut à la fin de 1845. Plusieurs des chapitres qu’il contient avaient été publiés par le Journal des Économistes, dans les numéros d’avril, juillet et octobre de la même année. (Note de l’éditeur.)
[57] Cet aperçu a donné plus tard lieu au pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, compris dans le volume suivant. (Note de l’éditeur.)
[58] L’auteur a rectifié les termes de cette proposition dans un ouvrage postérieur. Voir Harmonies économiques, chap. xi. (Note de l’éditeur.)
[59] Nous n’avons pas en français un substantif pour exprimer l’idée opposée à celle de cherté (cheapness). Il est assez remarquable que l’instinct populaire exprime cette idée par cette périphrase : marché avantageux, bon marché. Les prohibitionistes devraient bien réformer cette locution. Elle implique tout un système économique opposé au leur.
[60] L’auteur a traité ce sujet avec plus d’étendue dans le XIe chapitre des Harmonies économiques, puis, sous une autre forme, dans l’article Abondance, écrit pour le Dictionnaire de l’économie politique, et que nous reproduisons à la fin du 5e volume. (Note de l’éditeur.)
[61] Voyez, sur le même sujet, le chapitre xiv de la seconde Série des Sophismes, et les chapitres iii et xi des Harmonies économiques. (Note de l’éditeur.)
[62] Par ce motif, nous prions le lecteur de nous excuser si, pour abréger, nous désignons dans la suite ce système sous le nom de Sisyphisme.
[63] Il est juste de dire que M. d’Argout mettait cet étrange langage dans la bouche des adversaires de la betterave. Mais il se l’appropriait formellement, et le sanctionnait d’ailleurs par la loi même à laquelle il servait de justification.
[64] À supposer que 48,000 à 50,000 hectares suffisent à alimenter la consommation actuelle, il en faudrait 150,000 pour une consommation triple, que M. d’Argout admet comme possible. — De plus, si la betterave entrait dans un assolement de six ans, elle occuperait successivement 900,000 hectares, ou 1/38e du sol cultivable.
[65] Voyez, sur le même sujet, le chapitre xvi de la seconde Série des Sophismes, et le chapitre vi des Harmonies économiques. (Note de l’éditeur.)
[66] M. le vicomte de Romanet.
[67] Mathieu de Dombasle.
[68] Il est vrai que le travail ne reçoit pas une rémunération uniforme. Il y en a de plus ou moins intense, dangereux, habile, etc. La concurrence établit pour chaque catégorie un prix courant, et c’est de ce prix variable que je parle.
[69] La théorie esquissée dans ce chapitre est celle qui, quatre ans plus tard, fut développée dans les Harmonies économiques. Rémunération exclusivement réservée au travail humain ; gratuité des agents naturels ; conquête progressive de ces agents au profit de l’humanité, dont ils deviennent ainsi le patrimoine commun ; élévation du bien-être général et tendance au nivellement relatif des conditions : on reconnaît là tous les éléments essentiels du plus important des travaux de Bastiat.(Note de l’éditeur.)
[70] Voir Harmonies, ch. xvii. (Note de l’éditeur.)
[71] Voir, au tome V, le pamphlet Paix et liberté. (Note de l’éditeur.)
[72] En mars 1850, l’auteur fut encore obligé de combattre le même sophisme, qu’il entendit produire à la tribune nationale. Il rectifia la démonstration précédente en excluant de ses calculs les frais de transport, etc. Voir la fin du tome V. (Note de l’éditeur.)
[73] Cette pensée revient souvent sous la plume de l’auteur. Elle avait à ses yeux une importance capitale et lui dictait quatre jours avant sa mort cette recommandation : « Dites à de F. de traiter les questions économiques toujours au point de vue du consommateur, car l’intérêt du consommateur ne fait qu’un avec celui de l’humanité. » (Note de l’éditeur.)
[74] V. le chapitre v de la seconde série des sophismes et le chapitre vi des Harmonies économiques. (Note de l’éditeur.)
[75] V. au tome VI, le chapitre xiv des Harmonies. (Note de l’éditeur.)
[76] De l’Administration commerciale opposée à l’économie politique, page 5.
[77] Ne pourrait-on pas dire : C’est un terrible préjugé contre MM. Ferrier et Saint-Chamans que les économistes de toutes les écoles, c’est-à-dire tous les hommes qui ont étudié la question, soient arrivés à ce résultat ; après tout, la liberté vaut mieux que la contrainte, et les lois de Dieu sont plus sages que celles de Colbert.
[78] Du Système de l’impôt, etc., par M. le vicomte de Saint-Chamans, page 11.
[79] V. ci-après le chapitre xv. (Note de l’éditeur.)
[80] V. ci-après les chap. xviii, xx, et à la fin de ce volume, la lettre à M. Thiers, intitulée Protectionisme et Communisme. (Note de l’éditeur.)
[81] V. au tome Ier, la 1re lettre à M. de Lamartine et, au tome VI, le chap. i, des Harmonies économiques. (Note de l’éditeur.)
[82] V. le pamphlet Justice et Fraternité, au présent volume. — V. aussi l’introduction de Cobden et la ligue anglaise, puis la seconde campagne de la ligue, au tome II. (Note de l’éditeur.)
[83] V. dans la seconde série des Sophismes, le chap. xiv et dans les Harmonies économiques, le chap. vi. (Note de l’éditeur.)
[84] Je ne mentionne pas explicitement cette partie de rémunération afférente à l’entrepreneur, au capitaliste, etc., par plusieurs motifs :
1° Parce que si l’on y regarde de près on verra que c’est toujours le remboursement d’avances ou le paiement de travaux antérieurs ; 2° parce que, sous le mot général travail, je comprends non-seulement le salaire de l’ouvrier, mais la rétribution légitime de toute coopération à l’œuvre de la production ; 3° enfin et surtout, parce que la production des objets fabriqués est, aussi bien que celle des matières premières, grevée d’intérêts et de rémunérations autres que celles du travail manuel, et que l’objection, futile en elle-même, s’appliquerait à la filature la plus ingénieuse, tout autant et plus qu’à l’agriculture la plus grossière.
[85] Voy., au premier volume, l’opuscule de 1834, intitulé : Réflexions sur les Pétitions de Bordeaux, le Havre, etc. (Note de l’éditeur.)
[86] Nous avons fait remarquer, à la fin du chap. iv, qu’il contient le germe très-apparent des doctrines développées dans les Harmonies économiques. Ici maintenant se manifeste, de la part de l’auteur, le désir et l’intention d’écrire ce dernier ouvrage, à la première occasion favorable. (Note de l’éditeur.)
[87] Cette pensée, qui termine la première série des Sophismes, va être reprise et développée par l’auteur, au commencement de la seconde série. L’influence de la Spoliation sur les destinées de l’humanité le préoccupait vivement. Après avoir plusieurs fois abordé ce sujet dans les Sophismes et les Pamphlets (V. notamment Propriété et Spoliation — Spoliation et Loi), il lui destinait une place étendue dans la seconde partie des Harmonies, parmi les causes perturbatrices. Enfin, dernier témoignage de l’intérêt qu’il y attachait, il disait, à la veille de sa mort : « Un travail bien important à faire, pour l’économie politique, c’est d’écrire l’histoire de la Spoliation. C’est une longue histoire dans laquelle, dès l’origine, apparaissent les conquêtes, les migrations des peuples, les invasions et tous les funestes excès de la force aux prises avec la justice. De tout cela il reste encore aujourd’hui des traces vivantes, et c’est une grande difficulté pour la solution des questions posées dans notre siècle. On n’arrivera pas à cette solution tant qu’on n’aura pas bien constaté en quoi et comment l’injustice, faisant sa part au milieu de nous, s’est impatronisée dans nos mœurs et dans nos lois. » (Note de l’éditeur.)
[88] Les cinquante volumes de la collection Custodi : Economisti classici italiani. (Note de l’éditeur.)
[89] Ébauche de 1847. L’auteur s’en est tenu à ce court préambule du chapitre qu’il promettait dans l’ébauche précédente. Il s’aperçut bien vite que, pour la réfutation projetée, un chapitre ne suffisait pas. C’était un livre qu’il fallait ; et il écrivit les Harmonies.(Note de l’édit.)
[90]V. tome IV, pages 121 à 123. (Note de l’éditeur.)
[91]V. le pamphlet Maudit argent, tome V, page 64. (Note de l’éditeur.)
[92]V. les chap. i et iv du tome VI. (Note de l’éditeur.)
[93]V. le chap. vi du pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, tome V, page 356. (Note de l’éditeur.)
[94]V. la fin du n° 41, pages 244 et 245, et le n° 53, page 359. (Note de l’éditeur.)
[95]V. au tome V, page 368, le chap. viii de Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. (Note de l’éditeur.)
[96]V. ci-dessus, le n° 39, page 219. (Note de l’éditeur.)
[97]V. tome VI, chap. ii. (Note de l’éditeur.)
[98]V. le chapitre vi du tome VI. (Note de l’éditeur.)
[99]V. tome IV, pages 36 à 45. (Note de l’éditeur.)
[100]V. tome V, pages 468 à 475. (Note de l’éditeur.)
[101] Cette ébauche est de 1847. L’auteur voulait en faire un chapitre pour la seconde série des Sophismes économiques, qui parut à la fin de l’année.
[102] Voir l’article intitulé Deux Angleterre, t. III, p. 459. (Note de l’éditeur.)
[103] On pourrait plaider, en faveur des journaux, français, une circonstance atténuante. Il y eut, ce me semble, de leur part, ignorance spéciale, prévention, inadvertance plutôt que calcul, dans la plupart des méfaits que Bastiat leur reproche. Qu’on examine, par exemple, les lettres qu’il dut adresser, en septembre et en novembre 1846, à deux des coryphées du journalisme parisien, les rédacteurs en chef de la Presse et du National, et l’on se convaincra que ces deux feuilles, n’entrevoyaient ni la marche ni l’importance du débat sur les Corn-Laws, en Angleterre. — Voir pages 148 à 166. (Note de l’édit.)
[104] Globe and Traveller.
[105]V. au tome IV, pages 15 et 251, le chap. ii de la première série des Sophismes, et le chap. xv de la seconde série, puis au tome VI le chap. xi des Harmonies. (Note de l’éditeur.)
[106]Le dimanche est le jour de la semaine où paraissait le Libre-Échange. (Note de l’éditeur.)
[107]Les bureaux du Libre-Échange étaient rue de Choiseul, et ceux du Moniteur Industriel, rue Hauteville. (Note de l’éditeur.)
[108]Le nom que l’auteur ne cite pas est celui d’un membre éminent de la ligue anglaise, le colonel Perronnet Thompson. Voir tome III, page 89, 218 et 282 (Note de l’éditeur.)
[109]V. au tome V, page 363, le chapitre vii du pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on voit pas. (Note de l’éditeur.)
[110]V. au tome IV, page 442, le pamphlet Baccalauréat et Socialisme. (Note de l’éditeur.)
[111]V. le n° 5. (Note de l’éditeur.)
[112]V. au tome V, pages 142 à 145, et tome VI, les chap. v et viii. (Note de l’éditeur.)
[113]V. le chap. Salaires, des Harmonies. (Note de l’éditeur.)
[114]V. tome V, page 383, le chap. xi du pamphlet : Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, et au tome VI, la fin du chap. vi. (Note de l’éditeur.)
[115] Sur le Sophisme des ricochets, V. au présent volume, n° 48, p. 320 ; au tome IV, les pages 74, 160, 229 ; et au tome V, indépendamment des pages 80 à 83, les pages 336 et suivantes, contenant le pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. (Note de l’éditeur.)
[116]Sur la Concurrence, V. tome IV, page 45, et au tome VI, le chap. x. (Note de l’éditeur.)
[117]V. au tome V, pag. 370, le chap. l’Algérie du pamphlet : Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. (Note de l’éditeur.)
[118] plus efficace des fortifications
[119]Soixante-dix ans après, M. de Saint-Cricq a reproduit textuellement ces paroles, afin de justifier l’avantage d’interrompre les communications.
[120] Introduction in Libre-Échange: “Obligé de perdre quelques jours en route, notre colleague, M. Bastiat, a profité de ce repos forcé pour répondre à un dernier article de l’Atelier. Voici la lettre qu’il adresse de Gray au Journal des Économistes.”
[121]L’auteur a signalé plus tard le danger d’une classification scientifique uniquement basée sur les phénomènes de la production. V. au tome VI les pages 346 et 347. (Note de l’éditeur.)
[122] Ce projet, en forme de lettre adressée à l’auteur, fut ébauché par lui vers la fin de 1847.(Note de l’éditeur.)
[123]V. ci-dessus les nos 17 à 28. (Note de l’éditeur.)
[124] La chaire de M. Michel Chevalier avait été supprimée et n’était pas encore rétablie. (Note de l’éditeur.)
[125] V. t. IV, p. 275 à 297. (Note de l’éditeur.)
[126] 60 members of the Chamber’s Finance Committee??
[127] Il s’agissait d’une réduction simultanée dans les armements, en France et en Angleterre. (Note de l’éditeur.)
[128] added footnote in EH1 and EH2 about Considerant.
[129]V. le pamphlet Spoliation et Loi, pages 1 à 15 du tome V. (Note de l’éditeur.)
[130]V. ci-dessus les nos 57 et 58, pages 377 et 384, et V. au tome IV, pages 79, 86 et 94, les chapitres xiii, xiv et xviii de la première série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
[131] Dans le t. II, p. 459 à 465, figure le contingent fourni par Bastiat aux Petites affiches de Jacques Bonhomme. Grâce à l’obligeance de M. G. de Molinari, nous pouvons reproduire maintenant de courts articles qu’écrivit Bastiat pour deux autres des feuilles publiques, qui eurent une courte existence en 1848, la République française et Jacques Bonhomme.(Note de l’éd.)
[132] La République française, n° du 27 février 1848. (Note de l’éd.)
[133] La République française, n° du 28 février 1848.(Note de l’éd.)
[134] Ici et ailleurs, l’emploi du pluriel montre que Bastiat parlait au nom de ses collaborateurs comme au sien. À ce moment, il signait avec eux le journal, et acceptait la solidarité de leurs opinions.(Note de l’édit.)
[135] La République française, n° du 29 février 1848.(Note de l’édit.)
[136] La République française, n° du 29 février 1848.
[137] N° du 1er mars 1848 de la République française.(Note de l’édit.)
[138] N° du 1er mars 1848 de la République française.(Note de l’édit.)
[139] À partir du second numéro de la République française, celui du 27 février jusqu’au n° 5, du 1er mars 1848, le nom de Bastiat figure à la dernière ligne du journal avec les noms de ses autres rédacteurs. Il n’en est plus ainsi dans les numéros suivants : Bastiat ne signe plus le journal ; il se borne à signer ses propres articles.(Note de l’édit.)
[140] N° du 2 mars 1848 de la République française.(Note de l’édit.)
[141] En ce sens qu’ils attirent le plus la concurrence.(Note de l’éd.)
[142] N° du 4 mars 1848 de la République française. (Note de l’éd.)
[143] N° du 5 mars 1848 de la République française. (Note de l’éd.)
[144] N° du 6 mars 1848 de la République française. (Note de l’éd.)
[145]Parmi les nombreux journaux que fit éclore le 24 Février 1848, et qui n’eurent qu’une existence éphémère, il faut compter le Jacques Bonhomme, à la rédaction duquel Bastiat donna son concours. Cette feuille, qui aspirait à éclairer le peuple, contenait un article final destiné à être affiché et mis ainsi gratuitement sous les yeux des passants. (Note de l’éditeur.)
[146]Jacques Bonhomme n’entend pas critiquer les mesures d’urgence.
[147] Économiste belge du 14 janvier 1860.
[148] Celle du 22 mars 1848. (Œuvres complètes, t. I, p. 506.)
[149] 1er numéro du Jacques Bonhomme, du 11 au 15 juin 1848.(Note de l’édit.)
[150] Même numéro.
[151] Même numéro.
[152] N° 3 du Jacques Bonhomme, du 20 au 23 juin 1848.
[153] Title in EH1 “I. Harmonie économiques.”
[154] added FN for EH1 “notre régime industriel.”
[155] Title in EH1 “II. Besoins, efforts, satisfactions.” pp. 60-72.
[156] First line is the same as in EH1 but opening section after this has been completely rewritten.
[157] Title in EH1 “III. Des besoins de l’homme,” pp. 73-110??
[158] Voir tome XXI, p. 105 (1er sept. 1848, no 87).
[159] Loi mathématique très-fréquente et très-méconnue en économie politique.
[160] Un des objets indirects de ces articles est de combattre des écoles sentimentalistes modernes qui, malgré les faits, n'admettent pas que la souffrance à un degré quelconque ait un but providentiel. Comme ces écoles disent procéder de Rousseau, je dois leur citer ce passage du maître : «Le mal que nous voyons n'est pas un mal absolu; et, loin de combattre directement le bien, il concourt avec lui à l'harmonie universelle.»
[161] La seconde série des Sophismes économiques, dont plusieurs chapitres avaient figuré dans le Journal des Économistes et le journal le Libre Échange, parut à la fin de janvier 1848. (Note de l’éditeur.)
[162] Voy., tome I, la lettre adressée au président du Congrès de la paix à Francfort.(Note de l’éditeur.)
[163] Key Public Choice insight.
[164] ils lui demandent des soldats, des marins, des arsenaux, des fortifications
[165] Voy., au tome I, la lettre adressée à M. Larnac, et au tome V, les Incompatibilités parlemantaires. (Note de l’éditeur.)
[166] V. au présent tome, l’État, la Loi, et au tome VI, le chapitre xvii, Services privés et services publics. (Note de l’éditeur.)
[167] Pour la distinction entre les monopoles véritables et ce qu’on a nommé les monopoles naturels, voir, au chap. v du tome VI, la note qui accompagne l’exposé de la doctrine d’Adam Smith sur la valeur. (Note de l’éditeur.)
[168] Cette cause de perturbation, l’auteur devait bientôt assister son développement et la combattre avec énergie. V. ci-après l’État, puis, au tome II, Funestes illusions et, au tome VI, les dernières pages du chap. iv. (Note de l’éditeur.)
[169] Récemment, M. Duchâtel, qui jadis demandait la liberté en vue des bas prix, a dit à la Chambre : « Il ne me serait pas difficile de prouver que la protection amène le bon marché. »
[170] L’auteur, dans le discours qu’il prononça, le 29 septembre 1846, à la salle Montesquieu, a, par une image saisissante, présenté une démonstration de la même vérité. V. ce discours au tome II. (Note de l’éditeur.)
[171] Dans le Libre-Échange du 1er août 1847, l’auteur donna sur ce sujet une explication que nous jugeons utile de reproduire ici. (Note de l’éditeur.)
[172] [There was text missing from the Wikisource version of the text.] Ce chapitre est tiré du Courrier français (no du 18 septembre 1846), dont les colonnes furent ouvertes à l'auteur pour repousser les attaques de l'Atelier. Ce ne fut que deux mois plus tard que parut la feuille du Libre-Échange. (Note de l'éditeur.)
[173] V. au tome II, la polémique directe contre divers journaux. (Note de l’éditeur.)
[174] Possédant un champ qui le fait vivre, il est de la classe des protégés. Cette circonstance devrait désarmer la critique. Elle montre que, s’il se sert d’expressions dures, c’est contre la chose et non contre les intentions.
[175] Voici le texte : « Je citerai encore les lois de douane des 9 et 11 juin dernier, qui ont en grande partie pour objet d’encourager la navigation lointaine, en augmentant sur plusieurs articles les surtaxes afférentes au pavillon étranger. Nos lois de douane, vous le savez, sont généralement dirigées vers ce but, et peu à peu la surtaxe de 10 francs, établie par la loi du 28 avril 1816 et souvent insuffisante, disparaît pour faire place… à une protection plus efficace et plus en harmonie avec la cherté relative de notre navigation. » — Ce disparaît est précieux.
(M. Cunin-Gridaine, séance du 16 décembre 1845, discours d’ouverture.)
[176] Sophismes économiques, Ire série, chap. v, pag. 49 et 50.
[177] V. au tome Ier la lettre à M. Larnac, et au tome V, les Incompatibilités parlementaires. (Note de l’éditeur.)
[178] « L’auteur avait dit en effet 5 centimes, en mai 1846, dans un article du Journal des économistes, qui est devenu le chap. xii de la seconde série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
[179] Voy. chap VI de la Ire série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
[180] Voy. chap. ii et iii de la 1re série des Sophismes et le chap. vi des Harmonies. (Note de l’éditeur.)
[181] Discussion à la Chambre, à propos d’une dépêche télégraphique adressée par le ministre de l’intérieur Faucher aux préfets quelques jours avant les élections du 18 mai 1849.
[182] Paroles de Gœthe dans Mignon.
[183] M. Pescatore, propriétaire des bois du Buttard, avait mis à la disposition de M. Bastiat le pavillon qui servait autrefois de rendez-vous de chasse. Dans ce lieu solitaire et charmant, situé tout près du château de la Jonchère, le travailleur écrivit les premiers chapitres des Harmonies.
[184] Place force de Hongrie.
[185] Les Harmonies.
[186] Voyez les Harmonies, chapitre de la valeur.
[187] Gabrielle.
[188] M. John B. Smith, membre de la Ligue. V. t. III, p. 404 et suiv. (Note de l’éditeur.)
[189] Extraite d’un cahier de l’auteur, et probablement écrite en 1849.
[190] Le mot manque dans le manuscrit. Il est probable que l’intercalation de périrait serait conforme à la pensée de l’auteur.
[191] M. Victor Lefranc.(Note de l’édit.)
[192] M. Adolphe de Lajonkaire.
[193] Jacques Bonhomme, n° du 20 au 23 juin ; au présent volume, p. 246. (Note de l’éd.)
[194] Je n’ai pas découvert qu’on ait jamais imprimé un travail de Bastiat sous le titre d’Individualisme et Fraternité. A-t-il, par mégarde, désigné l’ébauche reproduite ci-après (n° 76) comme un travail publié ? Aurait-il achevé cette ébauche pour quelque publication qui me soit restée inconnue ? Je ne sais à quelle conjecture m’arrêter.(Note de l’éd.)
[195] See my note on “The French Army and Conscription.”
[196] See my note on “French Taxes.”
[197] See my note on “The Chamber of Deputies.”
[198] “Sed Caesar in omnia praeceps, nil actum credens, cum quid superesset agendum” (But Caesar, headlong in all his designs, thought nothing done while anything remained to be done.). Lucan, Pharsalia, Book II, line 656.
[199] Michel de Montaigne (1533-92) was one of the best-known and best-admired writers of the Renaissance. His Essays (first published in 1580) were a thoughtful meditation on human nature in the form of personal anecdotes infused with deep philosophical reflections.
[200] “People, form a Holy Alliance And take each other by the hand.” This quotation comes from the refrain in Béranger’s anti-monarchical and pro-French poem “La sainte alliance des peuples” (The Holy Alliance of the People). (1818) in Oeuvres complètes de P.J. de Béranger contenant les dix chanson nouvelles, avec un Portrait gravé sur bois d’après Charlet (Paris: Perrotin, 1855), vol. 1, pp. 294-96. For a translation see, Béranger’s Songs of the Empire, the Peace, and the Restoration. Translated into English verse by Robert B. Clough (London: Addey and Co., 1856), pp. 59-62. The first verse goes as follows: “I saw fair Peace, descending from on high, Strewing the earth with gold, and corn, and flow’rs; The air was calm, and hush’d all soothingly The last faint thunder of the War-gods pow’rs. The goddess spoke: ‘Equals in worth and might, Sons of French, Germans, Russ, or British lands, Form an alliance, Peoples, and unite, In Friendship firm, your hands’.” This line was also used by Molinari at the end of his 11th Soiréé in Les Soirées de la rue Saint-Lazare (1849).
[201] This is a slightly secularized version of a verse from Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you." (King James trans.)
[202] Ce travail, au lieu de servir de complément au pamphlet Spoliation et loi, devint un pamphlet séparé, sous ce titre : La loi. — Voir t. IV, p. 342, et t. V, p. 1. (Note de l’éditeur.)
[203] Voir t. IV, p. 394.
[204] Non plus en manuscrit, mais en épreuve imprimée.
(Note de l’éditeur.)
[205] Voir au tome V la note de la page 336. (Note de l’éditeur.)
[206] Bois du Buttard.
[207] Les amis de Bastiat, après avoir passé deux jours près de lui à Pise, étaient allés l’attendre à Rome.
[208] Cette lettre, la dernière qu’il ait écrite, n’a précédé sa mort que de huit jours
[209] Après la mort de Bastiat, il fut aisé à ses amis d’édifier M. Carey sur sa parfaite loyauté. Cette lettre nous paraît mériter cependant d’être conservée, d’autant plus que le post-scriptum contient les éléments d’une importante démonstration. (Note de l’éditeur.)
[210] Ébauche publiée par l’Économiste belge, n° du 3 juin 1860. (Note de l’éditeur.)
[211] Article destiné au Dictionnaire de l’Économie politique. Il fut écrit peu de jours avant le départ de l’auteur pour l’Italie, — d’où il ne devait pas revenir !… (Note de l’éditeur.)
[212] V., tome IV, pages 5 et 163, les chap. Abondance, Disette, Cherté, Bon marché. (Note de l’éditeur)
[213] La brochure Capital et rente avait fait une certaine impression sur les classes ouvrières, à qui l’auteur s’adressait, et produit une scission dans certaine portion du socialisme. La Voix du Peuple jugea donc nécessaire de combattre cet écrit. — Au premier article de M. Chevé, Bastiat fit demander la permission de répondre et l’obtint. Mais il fut prévenu que, pour la continuation de la discussion, M. Proudhon se substituait à M. Chevé. Les répliques se succédèrent à peu près de semaine en semaine jusqu’à la treizième lettre, dans laquelle M. Proudhon déclara le débat clos. Il fit de la collection des treize lettres un volume sous ce titre : Intérêt et Principal. Bastiat, usant de son droit, publia de son côté la même collection, augmentée d’une quatorzième lettre, et lui donna pour titre : Gratuité du crédit. (Note de l’éditeur de l’édition originale.)
[214] Voy., sur la Théorie du capital, le chap vii du tome VI. (Note de l’éditeur.)
[215] Bastiat n’était pas précisément membre de l’Institut, mais seulement membre correspondant.(Note de l’éditeur.
[216] L’argument tiré de ce que le capitaliste ne se prive pas, n’est pas exclusivement à l’usage des socialistes. Considérer comme un élément important de la légitimité de l’intérêt la privation éprouvée par le prêteur, est une opinion qui fut soutenue, le 15 juin 1849, dans le Journal des Économistes, à l’occasion du pamphlet Capital et Rente, récemment publié. (Note de l’éditeur.)
[217] Very impassioned statement of FB’s view of society and mankind. Similar to his letter to himself (Draft Intro to Ec Harm??) More to life than just economics.
[218] Voy., au tome VI, la fin du chap. vi. (Note de l’éditeur.)
[219] His hymn to capital??
[220] Je rendrai cette loi sensible par des chiffres. Soient trois époques pendant lesquelles le capital s’est accru, le travail restant le même. Soit la production totale aux trois époques, comme : 80 — 100 — 120. Le partage se fera ainsi : [see pp. 11-12 of 1851 ed. for layout]
Part du capital. Part du travail. Total.
Première époque : 45 35 80
Deuxième époque : 50 50 100
Troisième époque : 55 65 120
Bien entendu, ces proportions n’ont d’autre but que d’élucider la pensée.
[221] Ce chapitre fut publié pour la première fois dans le Journal des Économistes, numéro de janvier 1848. (Note de l’éditeur.)
[222] « Il est avéré que notre régime de libre concurrence, réclamé par une Économie politique ignorante, et décrété pour abolir les monopoles, n’aboutit qu’à l’organisation générale des grands monopoles en toutes branches. » (Principes du socialisme, par M. Considérant, page 15.)
[223] Ce chapitre et le suivant furent insérés en septembre et décembre 1848 dans le Journal des Économistes. (Note de l’éditeur.)
[224] « Notre régime industriel, formé sur la concurrence sans garantie et sans organisation, n’est donc qu’un enfer social, une vaste réalisation de tous les tourments et de tous les supplices de l’antique Ténare. Il y a une différence pourtant : les victimes. » (V. Considérant.)
[225] V. au tome IV, le chap. ii de la seconde série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
[226] Loi mathématique très-fréquente et très-méconnue en économie politique.
[227] Un des objets indirects de ce livre est de combattre des écoles sentimentalistes modernes qui, malgré les faits, n’admettent pas que la souffrance, à un degré quelconque, ait un but providentiel. Comme ces écoles disent procéder de Rousseau, je dois leur citer ce passage du maître : « Le mal que nous voyons n’est pas un mal absolu ; et, loin de combattre directement le bien, il concourt avec lui à l’harmonie universelle. »
[228] Bien plus, cet esclave-là, à cause de sa supériorité, finit à la longue par déprécier et affranchir tous les autres. C’est une harmonie dont je laisse à la sagacité du lecteur de suivre les conséquences.
[229] Voir au tome II, Funestes illusions, et au tome IV, la fin du chapitre i de la seconde série des Sophismes. (Note de l’éditeur.)
[230] Ce qui va suivre est la reproduction d’une note trouvée dans les papiers de l’auteur. S’il eût vécu, il en eût lié la substance au corps de sa doctrine sur l’échange. Notre mission doit se borner à placer cette note à la fin du présent chapitre. (Note de l’éditeur.)
[231] Voir, pour la réfutation de cette erreur, le chapitre Producteur et Consommateur, ci-après, ainsi que les chapitres ii et iii des Sophismes économiques, première série, tome IV, page 15 et 19.(Note de l’éditeur.)
[232] Ajoute ! Le sujet avait donc de la valeur par lui-même, antérieurement au travail. Il ne pouvait la tenir que de la nature. L’action naturelle n’est donc pas gratuite. Qui donc a l’audace de se faire payer cette portion de valeur extra-humaine ?
[233] Long FN not in 1851 ed. See in text.
[234] FN note in 1851 ed.: V. ci-après le chap. XV.
L’accumulation est une circonstance de nulle considération en économie politique.
Que la satisfaction soit immédiate ou retardée, qu’elle puisse être ajournée ou ne se puisse séparer de l’effort, en quoi cela change-t-il la nature des choses ?
Je suis disposé à faire un sacrifice pour me donner le plaisir d’entendre une belle voix, je vais au théâtre et je paye ; la satisfaction est immédiate. Si j’avais consacré mon argent à acheter un plat de fraises, j’aurais pu renvoyer la satisfaction à demain ; voilà tout.
On dira sans doute que les fraises sont de la richesse, parce que je puis les échanger encore. Cela est vrai. Tant que l’effort ayant eu lieu la satisfaction n’est pas accomplie, la richesse subsiste. C’est la satisfaction qui la détruit. Quand le plat de fraises sera mangé, cette satisfaction ira rejoindre celle que m’a procurée la voix d’Alboni.
Service reçu, service rendu : voilà l’économie politique.
(Note extraite des manuscrits de l’auteur.)
[235] Ce qui suit était destiné par l’auteur à trouver place dans le présent chapitre. (Note de l’éditeur.)
[236] Traité d’Écon. pol., p. 1.
[237] Prenez parti pour la concurrence, vous aurez tort ; prenez parti contre la concurrence, vous aurez encore tort : ce qui signifie que vous aurez toujours raison. » (P.-J. Proudhon, Contradictions économiques, p. 182.)
[238] Toujours cette perpétuelle et maudite confusion entre la Valeur et l’Utilité. Je puis bien vous montrer des utilités non appropriées, mais je vous défie de me montrer dans le monde entier une seule valeur qui n’ait pas de propriétaire.
[239] Ce qui suit est un commencement de note complémentaire trouvé dans les papiers de l’auteur. (Note de l’éditeur.)
[240] Cette dernière indication de l’auteur n’est accompagnée d’aucun développement. Mais divers chapitres de ce volume y suppléent. Voir notamment Propriété et Communauté, Rapport de l’économie politique avec la morale, et Solidarité. (Note de l’éditeur.)
[241] Voir ma brochure intitulée Capital et Rente.
[242] Les mots en italiques et capitales sont ainsi imprimés dans le texte original.
[243] Ricardo.
[244] Voir page 17. [1851 ed.]
[245] Ici se terminaient les Harmonies économiques, à leur première édition. (Note de l’éditeur.)
[246] note ???
[247] Sophismes économiques, chapitre i, tome IV, page 5.
[248] Voir le discours de l’auteur sur l’impôt des boissons, dans la deuxième édition du pamphlet intitulé Incompatibilitiés parlementaires. [1851 note] [Later ed.:tome V, p. 468.] (Note de l’éditeur.)
[249] Quand l’avant-garde icarienne partit du Havre, j’interrogeai plusieurs de ces insensés, et cherchai à connaître le fond de leur pensée. Un facile bien-être, tel était leur espoir et leur mobile. L’un d’eux me dit : « Je pars, et mon frère est de la seconde expédition. Il a huit enfants : et vous sentez quel grand avantage ce sera pour lui de n’avoir plus à les élever et à les nourrir. » — « Je le comprends aisément, dis-je ; mais il faudra que cette lourde charge retombe sur d’autres. » — Se débarrasser sur autrui de ce qui nous gêne, voilà la façon fraternitaire dont ces malheureux entendaient la devise tous pour chacun.
[250] 1851 ed.: Voir le pamphlet Spoliation et Loi, page 22 et suiv. Later: tome V, pag.2 et suiv. (Note de l’éditeur.)
[251] Deux ou trois courts fragments, voilà tout ce que l’auteur a laissé sur cet important chapitre. Cela s’explique : il se proposait ainsi qu’il l’a déclaré, de s’appuyer principalement sur les travaux de M. Carey de Philadelphie pour combattre la théorie de Ricardo. (Note de l’éditeur.)
[252] La même idée a été présentée à la fin du complément ajouté au chapitre v, [p. 202 et suiv.] (Note de l’éditeur.)
[253] [different long footnote in 1851 ed., p. 369]
[254] Long footnote from later ed.: De ces développements projetés, aucun n’existe ; mais voici sommairement les deux principales conséquences du fait cité par l’auteur :
1° Deux terres, l’une cultivée A, l’autre inculte B, étant supposées de nature identique, la mesure du travail autrefois sacrifié au défrichement de A est donnée par le travail nécessaire au défrichement de B. On peut dire même qu’à cause de la supériorité de nos connaissances, de nos instruments, de nos moyens de communication, etc., il faudrait moins de journées pour mettre B en culture qu’il n’en a fallu pour A. Si la terre avait une valeur par elle-même, A vaudrait tout ce qu’a coûté sa mise en culture, plus quelque chose pour ses facultés productives naturelles ; c’est-à-dire beaucoup plus que la somme nécessaire actuellement pour mettre B en rapport. Or, c’est tout le contraire : la terre A vaut moins, puisqu’on l’achète plutôt que de défricher B. En achetant A, on ne paye donc rien pour la force naturelle, puisqu’on ne paye pas même le travail de défrichement ce qu’il a primitivement coûté.
2° Si le champ A rapporte par an 1,000 mesures de blé, la terre B défrichée en rapporterait autant. Puisqu’on a cultivé A, c’est qu’autrefois 1,000 mesures de blé rémunéraient amplement tout le travail exigé, soit par le défrichement, soit par la culture annuelle. Puisqu’on ne cultive pas B, c’est que maintenant 1,000 mesures de blé ne payeraient pas un travail identique, — ou même moindre, comme nous le remarquions plus haut.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Évidemment c’est que la valeur du travail humain a haussé par rapport à celle du blé ; c’est que la journée d’un ouvrier vaut et obtient plus de blé pour salaire. En d’autres termes, le blé s’obtient par un moindre effort, s’échange contre un moindre travail ; et la théorie de la cherté progressive des subsistances est fausse. — V. au tome I, le post-scriptum de la lettre adressée au Journal des économistes, en date du 8 décembre 1850. — V. aussi, sur ce sujet, l’ouvrage d’un disciple de Bastiat : Du revenu foncier, par R. de Fontenay. (Note de l’éditeur.)
[255] Voir Maudit argent!
[256] Voir Gratuité du crédit.
[257] Chap. Ier, pages 30 et 31, et chap. i, page 45 et suiv.
[258] Voir ci-après le chapitre Responsabilité.
[259] 1851 ed.: Voir le pamphlet intitulé la Loi, et notamment pages 31 et suiv. Later ed.: Voir, au tome IV, le pamphlet La Loi, et notamment page 360 et suiv. (Note de l’éditeur.)
[260] Il est à remarquer que M. Roebuck est, à la Chambre des communes, un député de l’extrême gauche. À ce titre, il est l’adversaire né de tous les gouvernements imaginables ; et en même temps il pousse à l’absorption de tous les droits, de toutes les facultés par le gouvernement. Le proverbe est donc faux, qui dit que les montagnes ne se rencontrent pas.
[261] Extrait de la Presse du 22 juin 1850. (Note de l’éditeur.)
[262] Journées de juin 1848.
[263] Voyez chapitre iv.
[264] Ici s’arrête le manuscrit rapporté de Rome. La courte note qui suit, nous l’avons trouvée dans les papiers de l’auteur restés à Paris. Elle nous apprend comment il se proposait de terminer et de résumer ce chapitre. (Note de l’éditeur.)
[265] Tout ce qui suit était écrit en 1846. (Note de l’éditeur.)
[266] Il est juste de dire que J.-B. Say a fait remarquer que les moyens d’existence étaient une quantité variable.
[267] Il existe peu de pays dont les populations n’aient une tendance à se multiplier au delà des moyens de subsistance. Une tendance aussi constante que celle-là doit nécessairement engendrer la misère des classes inférieures, et empêcher toute amélioration durable dans leur condition… Le principe de la population… accroîtra le nombre des individus avant qu’un accroissement dans les moyens de subsistance ait eu lieu, etc. (Malthus, cité par Rossi.)
[268] Voyez chapitre xi, pages 405 et suiv.
[269] Qui nécessite la classe des journaliers.
[270] Traité de la Population, livre III, chapitre 2.
[271] Définition du socialisme par Proudhon. [Contradict. Économ. 2e vol., chap. XII, p. 381, édit. Guillaumin.)
[272] Tout ce morceau de Proudhon est magnifique. (Coutrad. Écon., chapitre XIII, p. 463 à 467, 474 à 496).
[273] Bastiat, Échange.
[274] M. Passy. Annuaire de l'économie politique pour 1849, pages 558 et 559 ???.
[275] « Du moment que cette valeur est payée par le contribuable, elle est perdue pour lui ; du moment qu’elle est consommée par le gouvernement, elle est perdue pour tout le monde et ne se reverse point dans la société. » (J.-B. Say, Traité d’économie politique, liv. III, chap. ix, p. 504.)
Sans doute ; mais la société gagne en retour le service qui lui est rendu, la sécurité, par exemple. Du reste, Say rétablit, quelques lignes plus bas, la vraie doctrine en ces termes :
« Lever un impôt, c’est faire tort à la société, tort qui n’est compensé par aucun avantage, toutes les fois qu’on ne lui rend aucun service en échange. »
(Ibidem.)
[276] « Les contributions publiques, même lorsqu’elles sont consenties par la nation, sont une violation des propriétés, puisqu’on ne peut prélever des valeurs que sur celles qu’ont produites les terres, les capitaux et l’industrie des particuliers. Aussi, toutes les fois qu’elles excèdent la somme indispensable pour la conservation de la société, il est permis de les considérer comme une spoliation. » (Ibidem.)
Ici encore la proposition incidente corrige ce que le jugement aurait de trop absolu. La doctrine que les services s’échangent contre les services simplifie beaucoup le problème et la solution.
[277] Les effets de cette transformation ont été rendus sensibles par un exemple que citait M. le ministre de la guerre d’Hautpoul. « Il revient à chaque soldat, disait-il, 16 centimes pour son alimentation. Le gouvernement leur prend ces 16 centimes, et se charge de les nourrir. Il en résulte que tous ont la même ration, composée de même manière, qu’elle leur convienne ou non. L’un a trop de pain et le jette. L’autre n’a pas assez de viande, etc. Nous avons fait un essai : nous laissons aux soldats la libre disposition de ces 16 centimes et nous sommes heureux de constater une amélioration sensible sur leur sort. Chacun consulte ses goûts, son tempérament, le prix des marchés. Généralement ils ont d’eux-mêmes substitué en partie la viande au pain. Ils achètent ici plus de pain, là plus de viande, ailleurs plus de légumes, ailleurs plus de poisson. Leur santé s’en trouve bien ; ils sont plus contents et l’État est délivré d’une grande responsabilité. »
Le lecteur comprend qu’il n’est pas là question de juger cette expérience au point de vue militaire. Je la cite comme propre à marquer une première différence entre le service public et le service privé, entre la réglementation et la liberté. Vaut-il mieux que l’État nous prenne les ressources au moyen desquelles nous nous alimentons et se charge de nous nourrir, ou bien qu’il nous laisse à la fois et ces ressources et le soin de pourvoir à notre subsistance ? La même question se présente à propos de chacun de nos besoins.
[278] Voir le pamphlet intitulé Baccalauréat et Socialisme, [tome IV, p. 442.] (Note de l’éditeur.)
[279] L’auteur, dans un de ses précédents articles, s’est proposé de résoudre la même question. Il a recherché quel était le légitime domaine de la loi. Tous les développements que contient le pamphlet intitulé la Loi s’appliquent à sa thèse actuelle. Nous renvoyons le lecteur au tome IV, page 342. (Note de l’éditeur.)
[280] Ici s’arrête le manuscrit. Nous renvoyons nos lecteurs au pamphlet intitulé Spoliation et loi, dans la seconde partie duquel l’auteur a fait justice des sophismes émis à cette séance du conseil général. (Tome V, pages i et suiv.)
À l’égard des six chapitres qui devraient suivre, sous les titres d’Impôts, — Machines, — Liberté des échanges, — Intermédiaires, — Matières premières, — Luxe, nous renvoyons : 1° au discours sur l’impôt des boissons inséré dans la seconde édition du pamphlet Incompatibilités parlementaires (tome V, page 468) ; 2° au pamphlet intitulé Ce qu’on voit, et ce qu’on ne voit pas (tome V, page 336) ; 3° aux Sophismes économiques (tome IV, page i.)
(Note de l’éditeur.)
[281] L’auteur n’a pu continuer cet examen des erreurs qui sont, pour ceux qu’elles égarent, une cause presque immédiate de souffrance, ni décrire une autre classe d’erreurs, manifestées par la violence et la ruse, dont les premiers effets s’appesantissent sur autrui. Ses notes ne contiennent rien d’applicable aux Causes perturbatrices, si ce n’est le fragment qui précède et celui qui va suivre. Nous renvoyons pour le surplus au chapitre Ier de la seconde série des Sophismes, intitulé Physiologie de la Spoliation (tome IV, page 127). (Note de l’éditeur.)
[282] in essay on Etats Unis, p. 315 Essais de littérature
[283] Voir la fin du chapitre XI.
[284] On l’oublie quand on pose cette question : Le travail des esclaves revient-il plus cher ou meilleur marché que le travail salarié ?
[285] Voyez Baccalauréat et Socialisme, tome IV, page 442. (Note de l’éditeur.)
[286] Very long note. See in text.
[287] Religion (religare, relier), ce qui rattache la vie actuelle à la vie future, les vivants aux morts, le temps à l’éternité, le fini à l’infini, l’homme à Dieu.
[288] Ne dirait-on pas que la justice divine, si incompréhensible quand on considère le sort des individus, devient éclatante quand on réfléchit sur les destinées des nations ? La vie de chaque homme est un drame qui se noue sur un théâtre et se dénoue sur un autre ; mais il n’en est pas ainsi de la vie des nations. Cette instructive tragédie commence et finit sur la terre. Voilà pourquoi l’histoire est une lecture sainte ; c’est la justice de la Providence. (De Custines, La Russie.)
[289] Les développements intéressants que l’auteur voulait présenter ici, par voie d’exemples, et dont il indiquait d’avance le caractère, il ne les a malheureusement pas écrits. Le lecteur pourra y suppléer en se reportant au chapitre xvi de ce livre, ainsi qu’aux chapitres vii et xi du pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, t. V, pages 363 et 383. (Note de l’éditeur.)
[290] La fin de ce chapitre n’est plus guère qu’une suite de notés jetées sur le papier sans transitions ni développements.(Note de l’éditeur.)
[291] Cette ébauche se termine ici brusquement ; le côté économique de la loi de solidarité n’est pas indiqué. On peut renvoyer le lecteur aux chap. x et xi, Concurrence, Producteur et Consommateur.
Au reste, qu’est-ce au fond que l’ouvrage entier des Harmonies ; qu’est-ce que la concordance des intérêts, et les grandes maximes : La prospérité de chacun est la prospérité de tous, — La prospérité de tous est la prospérité de chacun, etc. ; — qu’est-ce que l’accord de la propriété et de la communauté, les services du capital, l’extension de la gratuité, etc. ; — sinon le développement au point de vue utilitaire du titre même de ce chapitre : Solidarité ? (Note de l’éditeur.)
[292] La misère est le fait de l’économie politique… l’économie politique a besoin que la mort lui vienne en aide… c’est la théorie de l’instabilité et du vol. (Proudhon, Contradictions économiques, t. II, p. 214.)
Si les subsistances manquent au peuple… c’est la faute de l’économie politique. (Ibidem, p. 430.)
L’auteur n’a malheureusement rien laissé sur les quatre chapitres qui viennent d’être indiqués (et qu’il avait compris dans le plan de ses travaux), sauf une introduction pour le dernier. (Note de l’éditeur.)
[293] “l’affectation” FEE = “sham and affectation”
[294] 1851 ed. only: L’auteur n’a malheureusement rien laissé sur les trois chapitres qui viennent d’être indiqués, et qu’il avait compris dans le plan de ses travaux, sauf une introduction pour le chapitre qui suit.
[295] V. le chap. xx du tome VI. (Note de l’éditeur)
[296] V., au tome IV, le chap. xx de la 1re série des Sophismes, p. 100 et suiv.(Note de l’éditeur.)
[297] V. le chap. iii du tome VI.(Note de l’éditeur.)
[298] L’auteur a souvent invoqué la présomption de vérité qui s’attache au consentement universel manifesté par la pratique de tous les hommes. V. notamment au tome IV, page 79, le chap. xiii des Sophismes, puis la page 441 ; et, au tome VI, l’appendice au chap. vi, intitulé Moralité de la richesse.(Note de l’éditeur.)
[299] V. au tome IV, pages 86 et 94, les chap. xiv et xviii de la 1re série des Sophismes, et page 538, les réflexions adressées à M. Thiers sur le même sujet ; puis, au présent volume, le chap. xi ci-après. (Note de l’éditeur.)
[300] V. au tome VI, les chap. iii et viii. (Note de l’éditeur.)
[301] V. la fin de la 12e lettre de Gratuité de crédit, page 282 et suiv. du présent volume. (Note de l’éditeur.)
[302] M. le ministre de la guerre a affirmé dernièrement que chaque individu transporté en Algérie a coûté à l’État 8,000 fr. Or, il est positif que les malheureux dont il s’agit auraient très bien vécu en France sur un capital de 4,000 fr. Je demande en quoi l’on soulage la population française, quand on lui ôte un homme et les moyens d’existence de deux ?
[303] V. la note de la page 369.(Note de l’éditeur.)
[304] Si toutes les conséquences d’une action retombaient sur son auteur, notre éducation serait prompte. Mais il n’en est pas ainsi. Quelquefois les bonnes conséquences visibles sont pour nous, et les mauvaises conséquences invisibles sont pour autrui, ce qui nous les rend plus invisibles encore. Il faut alors attendre que la réaction vienne de ceux qui ont à supporter les mauvaises conséquences de l’acte. C’est quelquefois fort long, et voici ce qui prolonge le règne de l’erreur.
Un homme fait un acte qui produit de bonnes conséquences égales à 10, à son profit, et de mauvaises conséquences égales à 15, réparties sur 30 de ses semblables, de manière qu’il n’en retombe sur chacun d’eux que 1/2. — Au total, il y a perte et la réaction doit nécessairement arriver. On conçoit cependant qu’elle se fasse d’autant plus attendre que le mal sera plus disséminé dans la masse et le bien plus concentré en un point.(Ébauche inédite de l’auteur.)
[305] Ce projet d’article indique sa date lui-même. (Note de l’édit.)
[306] Fontenay.
[307] over the summer and fall of 1849 when he had use of the Cheuvreux hunting lodge.
[308] Letter [CW1.165] [CH] 165 Paris, 11 avril 1850. A Madame Cheuvreux
[309] good description of his many writing styles