
Antoine Destutt de Tracy, Traité d'economie politique (1823)
 |
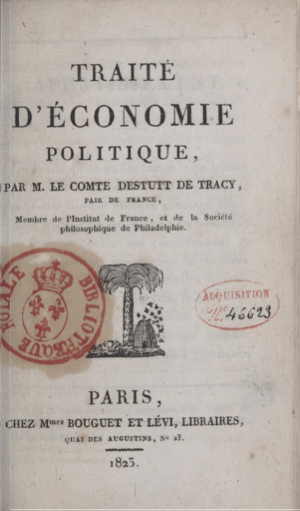 |
| Antoine Destutt de Tracy (1754–1836) |
[Created: 17 Nov. 2021]
[Updated: May 7, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Traité d'économie Politique. Par M. Le Comte Destutt de Tracy, Pair de France, Membre de L'institut de France, et de la Société Philosophique de Philadelphie. (Paris, Chez Mmes Bouguet et Lévi, Libraires, Quai des Augustins, No. 23, 1823).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Tracy/1823-TraiteEconomiePolitique/index.html
Antoine Destutt de Tracy, Traité d'économie Politique. Par M. Le Comte Destutt de Tracy, Pair de France, Membre de L'institut de France, et de la Société Philosophique de Philadelphie. (Paris, Chez Mmes Bouguet et Lévi, Libraires, Quai des Augustins, No. 23, 1823).
[355]
TABLE.
- AVERTISSEMENT. p. i
- INTRODUCTION 1
- § I. La faculté de vouloir est un mode et une conséquence de la faculté de sentir, p. 1
- § II. De la faculté de vouloir naissent les idées de personnalité et de propriété. p. 10
- § III. De la faculté de vouloir naissent tous nos besoins et tous nos moyens, p. 23
- § IV. De la faculté de vouloir naissent aussi les idées de richesse et de dénuement. p. 33
- § V. De la faculté de vouloir naissent encore les idées de liberté et de contrainte. p. 41
- § VI. Enfin, de la faculté de vouloir naissent les idées de droits et de devoirs. p. 48
- § VII. Conclusion. p. 61
- CHAPITRE PREMIER. De la Société. 65
- CHAPITRE II. De la formation de nos richesses, ou de la production d'utilité. 81
- CHAPITRE III. De la mesure de l'utilité, ou des valeurs 89
- CHAPITRE IV. Du changement de forme, ou de l'Industrie fabricante, y compris l'Agriculture. 96
- CHAPITRE V. Du Changement de lieu, ou de l'Industrie commerçante. 130
- CHAPITRE VI. De la Monnaie. 138
- CHAPITRE VII. Réflexions sur ce qui précède. 173
- CHAPITRE VIII. De la Distribution de nos richesses entre les individus 176
- CHAPITRE IX. De la Multiplication des individus, ou de la Population 188
- CHAPITRE X. Conséquences et développements des deux chapitres précédents 197
- CHAPITRE XI. De l'Emploi de nos richesses, ou de la Consommation 232
- CHAPITRE XII. Des Revenus et des Dépenses du gouvernement, et de ses Dettes 266
- CHAPITRE XIII. Conclusion 323
- EXTRAIT RAISONNÉ, SERVANT DE TABLE ANALYTIQUE 331
[I]
AVERTISSEMENT.↩
Le traité qu'on va lire forme la quatrième partie de mes Éléments d'Idéologie[1]; et peut-être tire-t-il quelque avantage d'être ainsi placé. Car après avoir vu comment se forment toutes nos connaissances et toutes nos idées, et comment de ces idées laissent tous nos besoins et tous les moyens que nous avons d'y pourvoir, le lecteur se trouve naturellement très bien disposé à examiner quelle est la meilleure manière d'employer toutes nos facultés physiques [II] et intellectuelles, à la satisfaction de nos divers besoins. Or, c'est là l'objet d'un Traité spécial d'Economie politique.
Cependant, comme beaucoup de personnes désirent étudier directement cette utile science, et ne se soucient pas de remonter plus haut et de se livrer à des recherches qu'ils croient de la métaphysique, et qui ne sont que de la vraie logique [2], je crois leur être agréable, en leur présentant cet ouvrage séparé de ses antécédents. J'ai seulement eu la précaution d'y laisser une Introduction, dans laquelle j'explique comment, de notre faculté d'avoir des volontés et des sentimens, naissent en nous les idées de [III] propriété, de richesse, de liberté, de droit et de devoirs, et quelques autres. J'espère qu'elle ne paraîtra ni inutile ni trop longue.
J'ajouterai qu'il m'a semblé que le public avait accueilli avec indulgence quelques articles relatifs à l'économie politique qui se trouvent dans différents endroits de mon Commentaire sur l'Esprit des Lois ; et cependant ces morceaux ne sont que les matériaux dont je me suis servi pour composer le présent Traité. J'espère donc qu'on sera bien aise de trouver ici ces mêmes idées mieux enchaînées, plus développées, et présentées dans un ordre méthodique et didactique. Je désire ne m'être pas trompé.
J'ose croire encore qu'on ne trouvera pas superflu l'Extrait raisonné que je place à la fin de ce Traité. La principale utilité de ce petit travail est sans doute d'avertir l'auteur lui-même de ne sauter aucun [IV] intermédiaire et de ne se permettre ni écarts ni désordre dans sa composition. Mais il me semble que le lecteur attentif n'est pas fâché d'y retrouver la chaîne des idées plus resserrée, et devenue pour ainsi dire plus rigoureuse par la concision même de la rédaction.
[1]
TRAITÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE.
INTRODUCTION.↩
§ I.
La faculté de vouloir est un mode et une conséquence de la faculté de sentir.
Les trois premières parties de mes éléments d'idéologie renferment tout ce que j'avais à dire de l'intelligence humaine, considérée sous le rapport de ses moyens de connaître et de savoir. Cette analyse de notre entendement et de celui de tout être animé, tel que nous pouvoirs en concevoir et en imaginer, n'est peut-être ni aussi parfaite, ni aussi complète qu'on pourrait le désirer. Mais je crois du moins qu'elle nous découvre bien l'origine et la source de toutes nos connaissances, et les véritables opérations intellectuelles qui entrent dans leur composition ; et qu'elle nous montre nettement [2] la nature et l'espèce de la certitude dont ces connaissances sont susceptibles, et les causes perturbatrices qui les rendent incertaines ou erronées.
Munis de ces données, nous pouvons donc essayer de nous en servir, et employer nos moyens de connaître soit à l'étude de notre volonté et de ses effets, pour achever l'histoire de nos facultés intellectuelles, soit à l'étude des êtres qui ne sont pas nous, afin de nous faire une idée juste de ce que nous pouvons savoir de ce singulier univers livré à notre avide curiosité. Je pense, par les raisons que j'ai dites dans mon traité de l'entendement, que c'est la première de ces deux recherches qui doit nous occuper d'abord. En conséquence, je me reporterai au moment où j'ai essayé d'en tracer le plan ; et je me permettrai de répéter ici ce que j'ai dit alors dans ma Logique, chap. 9, p. 432. Obligé d'être conséquent, il faut bien qu'on me pardonne de rappeler le point d'où je pars.
« Cette seconde manière, ai-je dit, de considérer nos individus, nous présente un système de phénomènes si différent du premier, que l'on a peine à croire qu'il appartienne aux mêmes êtres, vus seulement sous un autre aspect. Sans doute on pourrait concevoir l'homme ne faisant que recevoir des impressions, se les rappeler, les comparer et les combiner toujours avec une indifférence parfaite. Il ne serait alors qu'un être sachant et connaissant, sans passion proprement dite, relativement à lui, et sans action relativement aux autres êtres ; car il n'aurait aucun [3] motif pour vouloir, et aucune raison ni aucun moyen pour agir ; et certainement, dans cette supposition, quelles que fussent ses facultés pour juger et connaître, elles resteraient dans une grande stagnation, faute de stimulant et d'argent pour s'exercer. Mais l'homme n'est pas cela ; il est un être voulant en conséquence de ses impressions et de ses connaissances, et agissant en conséquence de ses volontés[3]. C'est là ce qui le constitue d'une part susceptible de souffrances et de jouissances, de bonheur et de malheur, idées corrélatives et inséparables ; et de l'autre part, capable d'influence et de puissance. C'est là ce qui fait qu'il a des besoins et des moyens, et par conséquent des droits et des devoirs, soit seulement quand il n'a affaire qu'à des êtres inanimés, soit plus encore quand il est en contact avec d'autres êtres susceptibles aussi de jouir et de souffrir. Car les droits d'un être sensible sont tous dans ses besoins, et ses devoirs dans ses moyens ; et il est à remarquer que la faiblesse dans tous les genres est toujours et essentiellement le principe des droits ; et que la puissance, dans quelque sens que l'on prenne ce mot, n'est et ne peut jamais être la source que de devoirs, c'est-à-dire de règles de la manière d'employer cette puissance.
[4]
Besoins et moyens, droits et devoirs, dérivent donc de la faculté de vouloir. Si l'homme ne voulait rien, il n'aurait rien de tout cela. Mais avoir des besoins et des moyens, des droits et des devoirs, c'est avoir, c'est posséder quelque chose. Ce sont là autant d'espèces de propriétés, à prendre ce mot dans sa plus grande généralité ; ce sont des choses qui nous appartiennent. Nos moyens sont même une vraie propriété, et la première de toutes dans le sens le plus restreint de ce terme. Ainsi, les idées besoins et moyens, droits et devoirs, supposent l’idée de propriété ; et les idées richesse et dénuement, justice et injustice dérivent de celles-là, ne sauraient exister sans cette idée propriété. Il faut donc commencer par éclaircir cette dernière : cela ne se peut qu'en remontant à son origine. Or, cette idée de propriété ne peut être fondée que sur l'idée de personnalité ; car, si un individu n'avait pas la conscience de son existence distincte et séparée de toute autre, il ne pourrait rien posséder, il ne saurait avoir rien qui lui fût propre. Il faut donc, avant tout, examiner et déterminer l'idée de personnalité. Mais avant de procéder à cet examen, il y a encore un préliminaire nécessaire : c'est d'expliquer avec netteté et précision ce que c'est que cette faculté de vouloir, de laquelle nous prétendons que naissent toutes ces idées, et à l'occasion de laquelle nous voulons en faire l'histoire. Nous n'avons pas d'autre moyen de voir clairement comment cette faculté engendre ces idées, et comment toutes les conséquences qui en résultent peuvent [5] être regardées comme ses effets. C'est ainsi que toujours en remontant, ou plutôt en descendant d'échelon en échelon, on est invinciblement ramené à l'étude et à l'observation de nos facultés intellectuelles, toutes les fois que l'ont veut creuser jusqu'au fond le sujet quelconque dont on s'occupe. Cette vérité est peut-être plus précieuse elle seule que toutes celles que nous pourrons recueillir dans le cours de notre travail. Je vais donc commencer par exposer en quoi consiste notre faculté de vouloir.
Cette faculté ou la volonté est une des quatre facultés primordiales que nous avons reconnues dans l'intelligence humaine, et même dans celle de tous les êtres animés ; et dans lesquelles nous avons vu que se résolvait nécessairement toute faculté de penser ou de sentir, quand on la décomposait jusque dans ses vrais éléments, et quand on n'y en admettait point de postiches.
Nous avons regardé la faculté de vouloir comme la quatrième et la dernière de ces quatre subdividisions primitives et nécessaires de la sensibilité, parce que dans tout désir, dans toute volonté ou volition, en un mot dans toute Propension quelconque, on peut toujours concevoir l'acte d'éprouver une impression, celui de la juger bonne à rechercher ou à éviter, et même celui de se la rappeler jusqu'à un certain point, puisque, par la nature même de l'acte de juger, nous avons vu que l'idée sujet de tout jugement peut toujours être considérée comme une représentation de la première impression que cette idée a faite. Ainsi, plus ou moins [6] confusément, plus ou moins rapidement, l'être animé a toujours dû sentir, se ressouvenir, et juger avant de vouloir.
Il ne faut pas conclure de cette analyse que la faculté de vouloir ne soit, suivant moi, que celle d'avoir de ces sentiments prononcés et réfléchis auxquels on donne spécialement le nom de volontés, et que on pourrait appeler volontés expresses et formelles. Au contraire, je crois que, pour en avoir une idée juste, il faut s'en faire une idée beaucoup plus étendue ; et rien de ce que nous avons établi précédemment ne nous en empêche. Car puisque nous avons dit que dans le désir le plus machinal et le plus soudain, et dans la détermination la plus instinctive, la plus purement organique, nous devons toujours concevoir les actes de sentir, de se ressouvenir et de juger comme y étant implicitement et imperceptiblement renfermés, et comme l'ayant nécessairement précédée, ne fût-ce que d'un instant inappréciable, nous pouvons, sans nous contredire, regarder toutes ces propensions, même les plus subites et les plus irréfléchies, comme appartenant à la faculté de vouloir, quoique nous en ayons fait la quatrième et la dernière des facultés élémentaires de notre intelligence. Je pense même qu'il le faut, et que la volonté est réellement et proprement la faculté générale et universelle de trouver une chose quelconque préférable à une autre, celle d'être affecté de manière à aimer mieux telle impression, tel sentiment, telle action, telle possession, tel objet que tel autre. Aimer et haïr sont des mots [7] uniquement relatifs à cette faculté, qui n'auraient aucune signification si elle n'existait pas ; et son action a lieu toutes les fois que notre sensibilité éprouve une attraction ou une répulsion quelconque. Du moins c'est ainsi que je conçois la volonté dans toute sa généralité, et c'est en partant de cette manière de la concevoir que j'essaierai d'expliquer ses effets et ses conséquences.
Sans doute la volonté, ainsi conçue, est une partie de la sensibilité ; la faculté d'être affecte d'une certaine manière ne peut pas ne pas faire partie de la faculté d'être affecté en général ; mais elle en est un mode distinct, et que l'on peut en séparer par la pensée. On ne peut pas vouloir sans cause (c'est même une chose à bien remarquer et à ne jamais oublier) : ainsi on ne peut pas vouloir sans avoir senti ; mais on pourrait sentir toujours de manière à ne vouloir jamais. Nous l'avons déjà dit, on peut imaginer l'homme, ou tout autre être animé et sensible, sentant de façon que tout lui serait égal ; que toutes ses affections, bien que diverses, lui seraient indifférentes ; et que par conséquent il ne pourrait ni rien désirer, ni rien craindre, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas vouloir : car désirer et craindre, c'est vouloir, et vouloir n'est jamais que désirer quelque chose et craindre le contraire, ou réciproquement. Dans cette supposition, l'être animé et sensible serait encore un être sentant ; il pourrait même être discernant et connaissant, c'est-à-dire jugeant. Il suffirait pour cela qu'il sentît les différences de ces diverses perceptions, et les différentes [8] circonstances de chacune, quoique incapable de prédilection pour aucune d'elles, ni pour aucune des combinaisons qu'il en pourrait faire. Seulement, et nous en avons fait la remarque précédemment, les connaissances de l'être animé, ainsi constitué, seraient nécessairement bien bornées ; car sa faculté de connaître n'aurait point de motifs pour entrer en action, et sa facilité d'agir, si même elle existait, ne pourrait s'exercer avec intention, puisque pour avoir une intention il faut avoir un désir, et tout désir suppose une préférence quelconque.
J'observerai, en passant, que cette supposition d'une indifférence parfaite dans la sensibilité montre bien clairement, suivant moi, que c'est à tort que certaines personnes veulent faire de ce qu'elles appellent nos sentiments et nos affections, des modifications de notre être essentiellement différentes de celles qu'elles nomment perceptions ou idées, et refusent de les comprendre sous ces dénominations générales de perceptions ou d'idées ; car la propriété d'être affectives, qu'ont certaines de nos perceptions, n'est qu'une circonstance particulière, une qualité accidentelle dont toutes nos modifications pourraient être douées, et dont, comme on vient de le voir, toutes aussi pourraient être privées ; mais elles n'en seraient pas moins toutes, tommes elles sont en effet, des perceptions, c'est-à-dire des choses perçues ou senties. La preuve en est qu'il y a de ces modifications qui, après avoir possédé la qualité d'être affectives, la perdent par l'effet de l'habitude, et d'autres qui l'acquièrent par l'effet de la réflexion ; [9] le tout sans cesser d'être perçues, et par conséquent d'être des perceptions. Je crois donc que le mot perception est véritablement le terme générique.
Quant à la distinction que l'on établit aussi entre les mots perception et idée, je ne la crois pas plus légitime, si on la fonde sur la prétendue propriété qu'a l'idée d'être une image ; car l'idée poirier n'est pas plus l'image d'un arbre que la perception des rapport de trois à quatre n'est l'image de la différence de ces deux chiffres ; et aucune des modifications de notre sensibilité n'est l'image de rien de ce qui se passe hors de nous. Je pense donc encore que l'on peut regarder les mots perception et idée comme synonymes dans leur sens le plus étendu ; et par les mêmes raisons les mots penser et sentir comme équivalents aussi, quand ils sont pris dans toute leur généralité. Car toutes nos pensées sont des choses senties, et si elles n'étaient pas senties elles ne seraient rien ; et la sensibilité est le phénomène général qui constitue et comprend toute l'existence de l'être animé, du moins pour lui-même, en tant qu'être animé, seule condition qui puisse le rendre être pensant.
Quoi qu'il en soit, aucun des êtres animés que nous connaissons, ni même de ceux que nous imaginons, n'est indifférent à toutes ses perceptions ; il est toujours compris dans leur sensibilité, dans leur faculté d'être affectés, de l'être d'une manière telle que certaines perceptions leur paraissent ce que l'on appelle agréables, et certaines autres, ce que l'on appelle désagréables. Or c'est là ce qui constitue la faculté de vouloir. Actuellement que nous nous [10] en sommes fait une idée bien nette, nous pouvons voir facilement comment cette faculté produit les idées de personnalité et de propriété.
§ II.
De la faculté de vouloir naissent les idées de personnalité et de propriété.
Tout homme qui prononce le mot moi, sans être métaphysicien, entend très bien ce qu'il veut dire ; et néanmoins, même étant métaphysicien, il réussit souvent fort mal à s'en rendre compte et à l'expliquer. Nous allons tâcher d'y parvenir à l'aide de quelques réflexions très simples.
Ce n'est pas notre corps tel qu'il est pour les autres, et tel qu'il leur apparaît, que nous appelons notre moi. La preuve en est que nous savons fort bien dire comment sera notre corps quand nous n'existerons plus, c'est-à-dire quand notre moi ne sera plus. Ce sont donc là deux êtres bien distincts.
Ce n'est pas non plus aucune des facultés particulières que nous possédons qui est pour nous la même chose que notre moi ; car nous disons : J'ai la faculté de marcher, j'ai celle de manger, de dormir, de respirer. Ainsi, je ou moi qui possède est une chose distincte de la chose possédée.
En est-il de même de la faculté générale de sentir ? Au premier coup d'œil il paraît que oui, puisque je dis de même : J'ai la faculté de sentir. Cependant ici nous trouvons une grande différence, pour peu[10] que nous pénétrions plus avant. Car, si je me demande comment je sais que j'ai la faculté de marcher, je réponds : Je le sais parce que je le sens, ou parce que je l'éprouve, parce que je le vois, ce qui est encore le sentir. Mais si je me demande comment je sais que je sens, je suis obligé de répondre : Je le sais parce que je le sens. La faculté de sentir est donc celle qui nous manifeste toutes les autres, sans laquelle aucune d'elles n'existerait pour nous, tandis qu'elle se manifeste qu'elle est celle au-delà de laquelle nous ne saurions remonter et qui constitue notre existence, qu'elle est tout pour nous, qu'elle est la même chose que nous. Je sens parce que je sens, je sens parce que j'existe, et je n'existe que parce que je sens. Donc mon existence et ma sensibilité sont une seule et même chose ; ou, si l'on veut, l'existence de moi et la sensibilité de moi sont deux êtres identiques.
Si nous faisions attention que, dans le discours, je ou moi signifie toujours l'être ou la personne morale qui parle, nous trouverions que, pour nous exprimer avec exactitude, au lieu de dire : J'ai la faculté de marcher, je devrais dire : La faculté de sentir, qui constitue la personne morale qui vous parle, a la propriété de réagir sur ses jambes de manière que son corps marche ; et au lieu de dire : J'ai la faculté de sentir, je devrais dire : La faculté de sentir, qui constitue la personne morale qui vous parle, existe dans le corps par lequel elle vous parle. Ces locutions sont bizarres et peu usuelles, j'en conviens ; mais, à mon avis, elles peignent le fait avec beaucoup de [12] vérité ; car, dans tous nos entretiens comme dans toutes nos relations, c'est toujours une faculté de sentir qui s'adresse à une autre.
Le moi de chacun de nous est donc pour lui sa propre sensibilité, quelle que soit la nature de cette sensibilité, ou ce qu'il appelle son âme, s'il a une opinion arrêtée sur la nature du principe de cette même sensibilité. Il est si vrai que c'est là ce que nous entendons tous par notre moi, que nous regardons tous la mort apparente comme la fin de notre être, ou comme un passage à une autre existence, suivant que nous pensons qu'elle éteint ou qu'elle n'éteint pas tout sentiment. C'est donc le fait seul de la sensibilité qui nous donne l'idée de la personnalité, c'est-à-dire qui nous fait apercevoir que nous sommes un être, et qui constitue pour nous notre moi, notre être.
Il y a pourtant ; et nous en avons déjà fait la remarque ailleurs[4], une autre de nos facultés avec laquelle nous identifions souvent notre moi c'est notre volonté. Nous disons indifféremment : Il dépend de moi, ou il dépend de ma volonté de faire telle ou telle chose. Mais cette observation, bien loin de contredire l'analyse précédente, la confirme ; car la faculté de vouloir n'est qu'un mode de la faculté de sentir ; c'est notre faculté de sentir modifiée de la manière qui la rend capable de jouir ou de souffrir, et de réagir sur nos organes. Ainsi, prendre sa [13] volonté pour l'équivalent de son moi, c'est prendre la partie pour le tout ; c'est regarder comme l'équivalent de ce moi la portion de sa sensibilité qui en constitue toute énergie, celle dont nous ne pouvons guère la concevoir séparée, et sans laquelle elle serait presque nulle, si même elle n'était pas tout à fait anéantie. Il n'y a donc là rien de contraire à ce que nous venons d'établir.
Il demeure donc bien entendu et convenu que le moi ou la personne morale de tout être animé, conçue comme distincte des organes qu'elle fait mouvoir, est ou simplement l'être abstrait que nous appelons la sensibilité de cet individu, lequel résulte de son organisation, on une monade sans étendue, qui est supposée posséder éminemment cette sensibilité, et qui est bien aussi un être abstrait (si toutefois l'on comprend cette supposition), ou un petit corps subtil, éthéré, imperceptible, impalpable, doué de cette sensibilité, et qui est bien encore à peu près une abstraction. Ces trois suppositions sont indifférentes pour tout ce qui va suivre ; dans toutes trois la sensibilité se retrouve, et dans toutes trois aussi elle seule constitue le moi ou la personne morale de l'individu, soit qu'elle ne soit qu'un phénomène résultant de son organisation, soit qu'elle soit une propriété d'une âme spirituelle ou corporelle résidante en lui.
Il ne reste donc plus qu'une question : c'est de savoir si cette idée de personnalité, cette conscience de moi, naîtrait en nous de notre sensibilité, dans le cas où elle ne serait pas suivie de volonté, dans [14] le cas où elle serait dépourvue de ce mode, qui fait qu'elle jouit ou souffre, et qu'elle réagit sur nos organes, qui en un mot la rend capable d'action et de passion. Cette question ne peut pas être résolue par les faits ; car nous ne connaissons aucune sensibilité de ce genre, et s'il en existait une qui fût telle, elle ne pourrait pas se manifester à nos moyens de connaître. Par la même raison, la question est plus curieuse qu'utile ; mais tout ce qui est curieux a une utilité indirecte, surtout dans ces matières ; qu'on ne saurait jamais envisager de trop de côtés différents : il ne faut donc pas le négliger.
Sur le point dont il s'agit, nous ne pouvons certainement pas prononcer avec assurance, qu'un être qui sentirait sans affection proprement dite et sans réaction sur ses organes n'aurait pas l'idée de personnalité et celle de l'existence de son moi ; il me paraît même vraisemblable qu'il aurait l'idée de l'existence de ce moi. Car enfin, sentir quoi que ce soit, c'est sentir son moi sentant, c'est se connaître soi-même sentant ; c'est avoir la possibilité de distinguer soi de ce que soi sent, des modifications de soi. Mais en même temps il est hors de doute que l'être qui connaîtrait ainsi son moi ne le connaîtrait pas par opposition avec d'autres êtres, dont il pût le distinguer et le séparer, puisqu'il ne connaîtrait que lui et ses modes. Il serait pour lui-même, comme je l'ai dit ailleurs[5], le véritable [15] infini ou indéfini, sans terme et sans limite d'aucun genre, ne connaissant rien autre chose. Il ne se connaîtrait donc pas proprement, dans le sens que mous attachons à ce mot connaître, qui emporte toujours l'idée de circonscription et de spécialité, et par conséquent il n'aurait pas l'idée d'individualité et de personnalité, par opposition et distinction avec d'autres êtres, comme nous l'avons. On peut donc déjà assurer que cette idée, telle qu'elle est en nous et pour nous, est une création et un effet de notre faculté de vouloir ; et cela explique très bien pourquoi, encore que la seule faculté de sentir simplement constitue et établisse notre existence, cependant nous confondons et identifions de préférence notre moi avec notre volonté. Voilà, je crois, un premier point éclairci.
Une chose encore plus certaine, peut-être, et qui va nous faire faire un pas de plus, c'est que s'il est possible que l'idée d'individualité et de personnalité existe de la manière que nous l'avons dit, dans un être conçu doué de sensibilité sans volonté, au moins il est impossible qu'elle y fasse naître l'idée de propriété, telle que nous l'avons ; car notre idée de propriété est privative et exclusive ; elle emporte l'idée que la chose possédée appartient à un être sensible, et n'appartient qu'à lui, à l'exclusion de tout autre. Or, il ne se peut pas qu'elle existe ainsi dans la pensée d'un être qui ne connaît que lui, qui ne sait pas qu'il existe d'autres êtres que lui. Quand donc on supposerait que cet être connaît son moi assez nettement pour le distinguer [16] de ses modes, et pour regarder ses modifications diverses comme des attributs de ce moi, comme des choses que ce moi possède, cet être n'aurait pas encore complètement notre idée de propriété. Il faut pour cela avoir l'idée de personnalité bien complète, et telle que nous venons de voir que nous la formons quand nous sommes susceptibles de passion et d'action. Il est donc prouvé que cette idée de propriété est un effet et un produit de notre faculté de vouloir.
Mais ce qu'il faut bien remarquer, car cela a bien des conséquences, c'est que, s'il est certain que l'idée de propriété ne peut naître que dans un être doué de volonté, il est tout aussi certain qu'elle y naît nécessairement et inévitablement dans toute sa plénitude ; car dès que cet individu connaît nettement son moi ou sa personne morale, et sa capacité de jouir ou de souffrir et d'agir, nécessairement il voit nettement aussi que ce moi est propriétaire exclusif du corps qu'il anime, des organes qu'il meut, de toutes leurs facultés, de toutes leurs forces, de tous les effets qu'ils produisent, de toutes leurs passions et leurs actions ; car tout cela finit et commence avec ce moi, n'existe que par lui, n'est mu que par ses actes ; et nulle autre personne morale ne peut employer ces mêmes instruments, ni être affectée de même de leurs effets. L'idée de propriété et de propriété exclusive naît donc nécessairement, dans l'être sensible, par cela seul qu'il est susceptible de passion et d'action, et elle y naît parce que [17] la nature l'a doué d'une propriété inévitable et inaliénable, celle de son individu.
Il fallait bien qu'il y eût ainsi une propriété naturelle et nécessaire, puisqu'il en existe d'artificielles et conventionnelles ; car il ne peut jamais y avoir rien dans l'art qui n'ait pas son principe radical dans la nature : nous en avons déjà fait l'observation ailleurs[6]. Si nos gestes et nos cris n'avaient pas l'effet naturel et inévitable de dénoter les idées qui nous affectent, ils n'en seraient jamais devenus les signes artificiels et conventionnels. S'il n'était pas dans la nature que tout corps solide soutenu au-dessus de nos têtes nous fasse nécessairement un abri, nous n'aurions jamais eu de maison faite exprès pour nous abriter. De même, s'il n'y avait pas de propriété naturelle et inévitable, il n'y en aurait jamais eu d'artificielle et conventionnelle. Il en est de même dans tous les genres, et on ne saurait trop le redire, l'homme ne crée rien, il ne fait rien d'absolument nouveau et d'extra-naturel, si l'on peut s'exprimer ainsi ; il ne fait jamais que tirer des conséquences et faire des combinaisons de ce qui est ; il lui est aussi impossible de créer une idée ou une relation qui n'ait pas sa source dans la nature, que de se donner un sens qui n'ait aucun rapport avec ses sens naturels. Il suit de là aussi que, dans toute recherche qui [18] concerne l'homme, il faut arriver jusqu'à ce premier type ; car tant que l'on ne voit pas le modèle naturel d'une institution artificielle qu'on examine, on peut être sûr qu'on n'a pas découvert sa génération, et que par conséquent on ne la connaît pas complètement.
Cette observation trouvera bien des applications ; il me semble qu'on n'y a pas toujours assez pris garde, et que c'est ce qui fait qu'on a souvent discouru, sur le sujet qui nous occupe, d'une manière fort inutile et fort vague. On a instruit solennellement le procès de la propriété, et apporté les raisons pour et contre, comme s'il dépendait de nous de faire qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas de propriété dans ce monde ; mais c'est là méconnaître tout à fait notre mature. Il semble, à entendre certains philosophes et certains législateurs, qu'à un instant précis, on a imaginé, spontanément et sans cause, de dire tien et mien, et que l'on aurait même pu et même dû s'en dispenser. Mais le tien et le mien n'ont jamais été inventés ; ils ont été reconnus le jour où on a pu dire toi et moi, et l'idée de moi et toi, ou plutôt de moi et autre que moi, est née, sinon le jour même où un être sentant a éprouvé des impressions, du moins celui où en conséquence de ces impressions il a éprouvé le sentiment de vouloir, la possibilité d'agir, qui en est la suite, et une résistance à ce sentiment et à cet acte. Quand ensuite, parmi ces êtres résistants, par conséquent autres que lui, l'être sentant et voulant a reconnu qu'il y en avait de sentants comme lui, [19] il a bien fallu qu'il leur accordât une personnalité autre que la sienne, un moi autre que le sien et différent du sien, et il a toujours été impossible, comme cela le sera toujours, que ce qui est sien ne soit pas différent pour lui de ce qui est leur. Il ne s'agissait donc pas de discuter d'abord s'il est bon ou mauvais qu'il existe telle ou telle espèce de propriété, dont nous verrons par la suite les avantages et les inconvénients ; mais il fallait, avant tout, reconnaître qu'il y a une propriété fondamentale, antérieure et supérieure à toute institution, de laquelle naîtront toujours tous les sentiments et les dissentiments qui dérivent de toutes les autres ; car il y a propriété, sinon précisément partout où il y a individu sentant, du moins partout où il y a individu voulant en conséquence de son sentiment, et agissant en conséquence de sa volonté. Ce sont là, ou je m'abuse beaucoup, d'éternelles vérités contre lesquelles viendront toujours échouer toutes les déclamations qui n'ont pour base que l'ignorance de notre véritable existence, et qui n'ont dû qu'à cette ignorance le grand crédit dont elles ont joui dans différents temps et dans différents pays.
Comme aucune autorité ne saurait m'en imposer quand elle est contraire à l'évidence, je dirai naïvement que le même oubli des vraies conditions de notre être se retrouve dans ce fameux précepte tant vanté : Aimez votre prochain comme vous-même. Il nous exhorte à un sentiment qui est certainement très bon et très utile à propager, mais qui certainement aussi est très mal exprimé car, à prendre [20] cette expression à la rigueur, l'injonction est inexécutable. C'est comme si on nous disait : Avec vos yeux, tels qu'ils sont, voyez votre visage comme vous voyez celui des autres. Cela ne se peut pas. Sans doute on peut aimer un autre autant et même plus que soi-même, en ce sens qu'on peut aimer mieux mourir en emportant l'espérance de lui conserver la vie, que vivre en souffrant la douleur de le perdre ; mais l'aimer exactement comme soi et autrement que relativement à soi, encore une fois cela est impossible ; il faudrait pour cela vivre de sa vie comme de la nôtre [7]. Cela n'a point de sens pour des êtres constitués comme nous le sommes ; cela est contraire à l'œuvre de notre création, de quelque manière qu'elle ait été opérée.
Je suis bien éloigné de dire les mêmes choses de cet autre précepte, que l'on regarde comme presque, synonyme du premier : Aimez-vous les uns les autres, et la loi est accomplie : Celui-là est, vraiment admirable, pour la forme comme pour le fond ; il est aussi conforme à notre nature que l'autre y est contraire, et il énonce parfaitement une vérité très profonde. Effectivement, les sentiments bienveillants étant pour nous, sous tous les rapports imaginables, la source de tous les biens [21] de tous genres, et le moyen universel de diminuer tous nos maux et d'y remédier autant que possible, tant que nous les entretenons entre nous, la grande loi de notre bonheur est accomplie autant qu'elle peut l'être.
On accusera peut-être de futilité cette distinction que j'établis entre deux maximes auxquelles on attribue communément à peu près le même sens. On aura tort : il est si différent de présenter aux hommes, comme règle de leur conduite, un principe général pris dans leur nature intime, ou un qui y répugne, et cela mène à des conséquences si distinctes entre elles, qu'il faut n'y avoir pas du tout réfléchi pour n'en pas sentir toute l'importance. Pour moi, elle me paraît telle, que je ne conçois pas que deux maximes si dissemblables soient émanées de la même source[8][9]; car l'une me manifeste la plus profonde ignorance, et l'autre la plus profonde connaissance de la nature humaine ; l'une doit mener à faire le roman de l'homme, et l'autre à en faire l'histoire ; l'une consacre l'existence de [22] la propriété naturelle résultante de l'individualité, et l'autre semble la méconnaître.
Peut-être aussi on aura été étonné de me voir traiter en même temps la question de la propriété de toutes nos richesses, et de celle de tous nos sentiments, et mêler ainsi ensemble l'économie et la morale. C'est que quand on pénètre jusqu'à leurs bases fondamentales, il ne me paraît pas possible de séparer ni ces deux ordres de choses, ni leur étude. À mesure que l'on avance, les objets s'éloignent et se subdivisent, et il faut les examiner séparément ; mais dans le principe, ils sont intimement unis. Nous n'aurions la propriété d'aucun de nos biens quelconques, si nous n'avions pas celle de nos besoins, laquelle n'est autre chose que celle de nos sentiments ; et toutes ces propriétés dérivent inévitablement du sentiment de personnalité, de la conscience de notre moi.
Il est donc tout aussi inutile, à propos de la morale ou de l'économie, de discuter s’il ne vaudrait pas mieux que rien ne fût propre à chacun de nous, qu'il le serait, à propos de la grammaire, de chercher s'il ne serait pas plus avantageux que nos actions ne fussent pas les signes des idées et des sentiments qui nous les font faire. Dans tous les cas, c'est demander s'il ne serait pas désirable que nous fussions tout autres que nous ne sommes ; et même c'est chercher s'il ne serait pas mieux que nous ne fussions pas du tout ; car, ces conditions-là changées, notre existence ne serait pas concevable ; elle ne serait pas altérée, elle serait anéantie.
[23]
Il demeure donc constant que le tien et le mien sont établis nécessairement entre les hommes, par cela seul qu'ils sont des individus sentants, voulants et agissants distinctement les uns des autres ; qu'ils ont chacun la propriété inaliénable, incommutable et inévitable de leur individu et de ses facultés, et que par conséquent l'idée de propriété est une suite nécessaire, sinon du seul phénomène de la sensibilité pure, du moins de celui de la sensibilité unies la volonté. Ainsi voilà que nous avons trouvé comment le sentiment de personnalité, ou l'idée de moi, et celle de propriété, qui s'ensuit nécessairement, dérivent de notre faculté de vouloir. Actuellement nous pouvons rechercher avec succès comment cette même faculté produit tous nos besoins et tous nos moyens.
§ III.
De la faculté de vouloir naissent tous nos besoins et tous nos moyens.
Si nous n'avions pas l'idée de personnalité et celle de propriété, c’est-à-dire la conscience de notre moi et celle de la possession de ses modifications, nous n'aurions certainement jamais ni besoins, ni moyens ; car à qui appartiendrait cette souffrance et cette puissance ; nous n'existerions pas pour nous-mêmes. Mais dès que nous nous reconnaissons possesseurs de notre existence et de ses modes, nous sommes nécessairement, par cela même, un [24] composé de faiblesse et de force, de besoins et de moyens, de souffrance et de puissance, de passion et d'action, et, par suite, de droits et de devoirs. C'est ce qu'il s'agit maintenant d'expliquer.
Je commencerai par prévenir que, conformément, à l'idée que j'ai donnée ci-dessus de la faculté de vouloir, je donnerai indifféremment le nom de désir ou de volonté à tous les actes de cette faculté, depuis la propension la plus instinctive jusqu'à la, détermination la plus réfléchie ; et je demande ensuite qu'on se rappelle que c'est uniquement parce que nous faisons de tels actes, que nous avons les idées de personnalité et de propriété. Or, tout désir est un besoin, et tous nos besoins consistent dans un désir quelconque. Ainsi les mêmes actes intellectuels, émanés de la faculté de vouloir, qui nous font acquérir l'idée distincte et complète de notre personnalité, de notre moi et de la propriété exclusive de tous ses modes, sont aussi ceux qui nous rendent susceptibles de besoins, et qui constituent tous nos besoins. C'est ce qui va se voir très clairement.
D'abord tout désir est un besoin. Cela n'est pas douteux, puisqu'un être sensible qui désire une chose quelconque a, par cela même, le besoin de posséder la chose désirée ; ou plus et plus généralement on peut dire qu'il éprouve le besoin de la cessation de son désir ; car tout désir est en lui-même une souffrance tant qu'il dure ; il ne devient jouissance que quand il est satisfait, c'est-à-dire quand il cesse.
[25]
On a de la peine en général à croire d'abord que tout désir soit une souffrance, parce qu'il y a certains désirs dont la naissance, dans l'être animé, est toujours ou presque toujours accompagnée d'un sentiment de bien-être. Le désir de manger, par exemple, celui de jouir du plaisir physique de l'amour, sont en général, dans un individu, les résultats d'un état de santé dont il a une conscience qui lui est agréable. Beaucoup d'autres sont dans le même cas. Mais il ne faut pas que cette circonstance nous fasse illusion. Ce sont là de ces manières d'être simultanées dont nous avons parlé dans la Logique[10], qui se mêlent aux idées qui viennent en même temps qu'elles, et qui les altèrent, mais qu'il ne faut pas confondre avec elles, et que par conséquent il faut bien distinguer du désir en lui-même ; car, premièrement, elles ne coexistent pas toujours avec lui. On a souvent le besoin de manger, et même un penchant violent à l'acte de la reproduction, en vertu de dispositions maladives, et sans aucun sentiment de bien-être ; et il en est de même des autres exemples qu'on voudra choisir. Secondement, quand cela n'arriverait pas, il n'en serait pas moins vrai que le sentiment de bien-être est distinct et différent de celui du désir, et que celui du désir est toujours en lui-même un tourment, un sentiment pénible tant qu'il dure. La preuve en est qu'il est [26] toujours le désir de sortir de l'état quelconque où l'on est actuellement ; lequel, par conséquent, paraît actuellement un état de malaise plus ou moins déplaisant. Or, dans ce sens, une manière d'être est toujours en effet telle qu'elle paraît, puisqu'elle ne consiste que dans ce qu'elle paraît être à celui qui l'éprouve. Un désir est donc toujours une souffrance, ou légère ou profonde, suivant sa force, et par suite un besoin quelconque. Il n'est pas nécessaire, pour que cela soit vrai, que ce désir soit fondé sur un besoin réel c'est-à-dire sur un sentiment juste de nos vrais intérêts ; car, bien ou mal motivé, tant qu'il existe il est une manière d'être, sentie et commode, et dont par conséquent on a le besoin de se délivrer. Ainsi tout désir est un besoin.
Mais il y a plus : tous nos besoins, depuis le plus purement machinal jusqu'au plus spiritualisé, ne sont jamais que le besoin de satisfaire un désir. La faim n'est que le désir de manger, ou du moins de sortir de l'état de langueur que nous éprouvons ; comme le besoin, la soif des richesses ou celle de la gloire, n'est que le désir de posséder ces biens ; et d'éviter l'indigence ou l'obscurité.
Il est vrai cependant que si nous éprouvons des désirs sans besoins réels, nous avons souvent aussi de vrais besoins sans éprouver des désirs, en ce sens, que bien des choses sont souvent très nécessaires à notre plus grand bien-être et même à notre conservation, sans que nous nous en apercevions, et par conséquent sans que nous les désirions. Ainsi, par exemple, il est constant que j'ai le plus grand [27] intérêt, et, si l'on veut, le besoin qu'il ne s'opère pas en moi certaines combinaisons dont je ne me doute pas, et dont il résultera que j'aurai la fièvre ce soir. Mais, à parler exactement, je n'ai pas présentement le besoin effectif de déranger ces combinaisons funestes, puisque je ne m'aperçois pas de leur existence ; au lieu que j'aurai réellement le besoin actuel d'être débarrassé de la fièvre quand j'en sentirai les angoisses, et parce que j'en sentirai les angoisses. Car, si la fièvre n'était pas de nature à faire naître en moi, par une raison ou par une autre, le désir de sa cessation, quand je m'aperçois de ses effets prochains ou éloignés, je n'aurais en aucune manière le besoin de la faire cesser. On peut dire absolument les mêmes choses de toutes les combinaisons qui s'opèrent, soit dans l'ordre physique, soit dans l'ordre moral, sans que nous nous en apercevions, ou sans que nous en prévoyions les conséquences. Si donc il est vrai, comme nous l'avons vu, que tout désir est un besoin, il ne l'est pas moins que tout besoin actuel est un désir. Ainsi l'on peut dire, en thèse générale, que nos désirs sont la source de tous nos besoins, dont aucun n'existerait sans eux. Car, on ne saurait trop le répéter, nous serions véritablement impassibles si nous n'avions nuls désirs ; et si nous étions impassibles, nous n'aurions aucun besoin. Il ne faut pas que l'on me reproche de m'être arrêté à cette explication. On ne saurait marcher trop lentement d'abord et si je ne saute aucun intermédiaire, je [28] néglige encore bien des accessoires, du moins tous ceux qui ne sont pas indispensables.
Voilà donc une première propriété de nos désirs bien éclaircie, et c'est la seule qu'ils aient, tant que notre système sensitif n'agit et ne réagit que sur lui-même ; mais à l'instant où il réagit sur notre système musculaire, le sentiment de vouloir acquiert une seconde propriété bien différente de la première, et qui n'est pas moins importante : c'est de diriger toutes nos actions, et par là d'être la source de tous nos moyens.
Quand je dis que nos désirs dirigent toutes nos actions, ce n'est pas qu'il ne s'opère en nous beaucoup de mouvements que le sentiment de vouloir ne précède en aucune manière, et qui par conséquent ne sont l'effet d'aucun désir. De ce nombre sont nommément tous ceux qui sont nécessaires au commencement, au maintien et à la continuité de notre vie. Mais premièrement, il est permis de douter si d'abord et dans l'origine, ils n'ont pas eu lieu en vertu de certaines déterminations ou tendances senties réellement par les molécules vivantes, ce qui les ramènerait encore à être les effets d'une volonté plus ou moins obscure ; si ce n'est pas par l'effet tout- puissant de l'habitude, ou par la prépondérance de certains sentiments plus généraux et prédominants, qu'ils deviennent insensibles à l'individu animé, c'est-à-dire au tout résultant des combinaisons qu'ils opèrent ; et si enfin ce n'est pas par cette raison qu'ils se trouvent entièrement [29] soustraits à l'empire de sa volonté sentie, ou de son sentiment de désirer et de vouloir. Ce sont là des choses sur lesquelles il nous est impossible d'avoir certitude complète. D'ailleurs ces mouvements nommés vulgairement, et avec raison, involontaires, sont bien la cause et la base de notre existence vivante ; mais ils ne nous fournissent aucun secours pour la modifier, la varier, la secourir, la défendre, l'améliorer. Ils ne peuvent donc pas être mis proprement au rang de nos moyens, à moins que l'on ne veuille dire que notre existence elle- même est notre premier moyen, ce qui est très vrai, mais très insignifiant ; car elle est la donnée sans laquelle nous n'aurions rien à dire et ne dirions certainement rien. Ainsi, cette première observation n'empêche pas qu'il ne soit vrai que notre volonté dirige toutes celles de nos actions qui peuvent être regardées comme des moyens de pourvoir à nos besoins.
Les mouvements dont nous venons de parler ne sont pas les seuls en nous qui soient involontaires. Ils sont tous continus ou du moins très fréquents, et en général réguliers. Mais il en est d'autres involontaires aussi, qui sont plus rares, moins réglés, et qui tiennent plus ou moins de l'état convulsif ou maladif. Les mouvements involontaires de cette seconde espèce ne peuvent, pas plus que les autres, être regardés comme faisant partie de la puissance de nos individus. La plupart du temps ils n'ont aucun but déterminé ; souvent même ils ont des effets fâcheux et pernicieux pour nous, et qui ont lieu bien qu’ils soient prévus et contraires à nos désirs. [30] Leur indépendance de notre volonté n'empêche donc pas encore que notre observation générale ne soit juste. Ainsi, mettant à part ces deux espèces de mouvements involontaires, on peut dire avec vérité que nos désirs ont l'effet éminemment remarquable de diriger toutes nos actions, du moins toutes celles qui méritent réellement ce nom, et qui sont pour nous des moyens de moyens de nous procurer des jouissances ou des connaissances, lesquelles connaissances sont encore des jouissances, puisque ce sont des choses désirées et utiles ; et il faut comprendre au nombre de ces actions nos opérations intellectuelles ; car elles sont aussi pour nous des moyens, et même les plus importants de tous, puisqu'elles dirigent l'emploi de tous les autres.
Maintenant, pour achever de prouver que les actes de notre volonté sont la source de tous nos moyens, sans exception, il ne reste qu'à montrer que les actions soumises à notre volonté sont absolument les seuls moyens que nous ayons pour pourvoir à nos besoins, ou, autrement, pour satisfaire nos désirs ; c'est-à-dire que nos forces physiques et morales, et l'usage que nous en faisons, composent exactement toute notre richesse.
Pour reconnaître cette vérité dans tous ses détails, il faudrait déjà avoir suivi toutes les conséquences des divers emplois que nous faisons de nos facultés, et avoir vu leurs effets dans la formation de ce que nous appelons nos richesses de tous genres. Or, c'est ce que nous n'avons pas pu faire encore et ce que nous ferons par la suite ; ce sera [31] même une partie considérable de notre étude. Mais dès ce moment nous pouvons bien voir que la nature, en jetant l'homme dans un coin de ce vaste univers, où il ne paraît qu'un insecte imperceptible et éphémère, ne lui a rien donné en propre que ses facultés individuelles et personnelles, tant physiques qu'intellectuelles. C'est là sa seule dot, sa seule richesse originaire, et l'unique source de toutes celles qu'il se procure. En effet, quand même on voudrait admettre que tous les êtres dont nous sommes environnés ont été créés pour nous, et assurément il faut une grande dose de vanité pour l'imaginer, et même pour le croire ; quand, dis-je, cela serait, il n'en serait pas moins vrai que nous ne pouvons nous approprier un seul de ces êtres, ni en convertir la moindre parcelle à notre usage, que par notre action sur lui et par l'emploi de nos facultés à cet effet.
Pour ne prendre des exemples que dans l'ordre physique, un champ n'est un moyen de subsistance qu'autant qu'on le cultive. Le gibier ne nous est utile que quand on lui donne la chasse. Un lac, une rivière, ne fournissent à notre nourriture que parce qu'on y pêche. Le bois ou tout autre produit spontané de la nature ne nous sert à quoi que ce soit, que lorsque nous l'avons façonné ou du moins recueilli. Pour pousser les choses jusqu'à l'extrême, quand on supposerait qu'une matière alimentaire est tombée dans notre bouche, toute préparée, encore faudrait-il, pour l'assimiler à notre substance, que nous la mâchions que nous l'avalions, que nous [32] la digérions. Or, toutes ces opérations sont autant d'emplois de nos forces individuelles. Certes, si jamais l'homme a été condamné au travail, c'est à dater du jour où il a été créé être sensible et ayant des membres et des organes ; car il n'est pas même possible de concevoir qu'un être quelconque lui devienne utile, sans quelque action de sa part ; et l'on peut dire non seulement, comme le bon et admirable La Fontaine, que le travail est un trésor, mais même que le travail est notre seul trésor. Au reste, ce trésor est bien grand, car il surpasse, tous nos besoins. La preuve en est que, semblable à la fortune d'un homme riche dont le revenu est plus grand que la dépense, le fonds de jouissance et de puissance de l'espèce humaine, prise en masse, s'accroît tous les jours, quoique souvent et même toujours bien mal ménagé.
Nous verrons tout cela bientôt avec plus de développement ; et nous verrons en même temps que l'application de nos forces à différents êtres est la seule cause de la valeur de tous ceux qui en ont une pour nous, et par conséquent est la source de toute valeur, comme la propriété de ces mêmes forces, qui appartient nécessairement à l'individu qui en est doué et qui les dirige par sa volonté, est la source de toute propriété. Mais dès à présent nous pouvons bien conclure, je crois, que dans l'emploi de nos facultés, dans nos actions volontaires, consiste tout ce que nous avons de pouvoir ; et que par conséquent les actes de notre volonté qui dirigent ces actions sourit la source de tous nos moyens, comme [33] nous avons vu déjà qu'ils constituent tous nos besoins. Ainsi cette faculté, quatrième et dernier mode de notre sensibilité, à qui nous devons les idées complètes de personnalité et de propriété, est celle qui nous rend propriétaires de besoins et de moyens, de passion et d'action, de souffrance et de puissance. De ces idées naissent celles de richesse et de dénuement. Avant d'aller plus loin, voyons en quoi consistent ces dernières.
§ IV.
De la faculté de vouloir naissent aussi les idées de richesse et de dénuement.
Si nous n'avions pas la conscience distincte de notre moi, et par suite les idées de personnalité et de propriété, nous n'aurions pas de besoins (tout cela naît de nos désirs) ; et si nous n'avions pas de besoins, nous n'aurions pas les idées de richesse et de dénuement ; car être riche, c'est posséder des moyens de pourvoir à ses besoins, et être pauvre, c'est être dénué de ces moyens. Une chose utile ou agréable, c'est-à-dire une chose dont la possession est une richesse, n'est jamais qu'un moyen prochain ou éloigné de satisfaire un besoin, un désir quelconque ; et si nous n'avions ni besoins, ni désirs, ce qui est la même chose, nous n'aurions ni la possession, ni la privation des moyens de les satisfaire.
À prendre les choses dans cette généralité, on sent bien que nos richesses ne se composent pas [34] seulement d'une pierre précieuse ou d'une masse de métal, d'un fonds de terre ou d'un outil, ou même d'un amas de comestibles ou d'un logement. La connaissance d'une loi de la nature, l'habitude d'un procédé technique, l'usage d'une langue pour communiquer avec nos semblables et accroître nos forces par les leurs, ou du moins pour n'être pas troublé par les leurs dans l'exercice des nôtres, la jouissance de conventions faites et d'institutions créées dans cet esprit, sont autant de richesses de l'individu et de l'espèce ; car ce sont autant de choses utiles pour accroître nos moyens, ou du moins pour en user librement, c'est-à-dire suivant notre volonté et avec le, moins d'obstacles possible, soit de la part des hommes, soit de celle de la nature, ce qui est encore augmenter leur puissance, leur énergie et leur effet.
Nous appelons tout cela des biens ; car, par contraction, nous donnons le nom de biens à toutes les, choses qui contribuent à nous faire du bien, à augmenter notre bien-être, à rendre notre manière d'être bonne on meilleure, c'est-à-dire à toutes les choses dont la possession est un bien. Or, d'où viennent tous ces biens ?
Nous l'avons déjà vu sommairement, et nous le verrons plus en détail par la suite : c'est de l'emploi juste, c'est-à-dire légitime suivant les lois de la nature, que nous faisons de nos facultés. Nous ne trouvons fréquemment un diamant que parce que nous le cherchons avec intelligence ; nous n'avons une masse de métal que parce que nous avons étudié les moyens de nous la procurer ; nous ne possédons [35] un bon champ ou un bon outil que parce que nous avons bien reconnu les propriétés de la matière première, et rendu facile la manière de la rendre utile ; nous n'avons une provision quelconque ou seulement un abri que parce que nous avons simplifié les opérations nécessaires pour former l'une ou pour construire l'autre. C'est donc toujours de l'emploi de nos facultés que viennent tous ces biens.
Maintenant, ces biens ont tous parmi nous une valeur déterminée et fixe jusqu'à un certain point ; ils en ont même toujours deux : l'une est celle des sacrifices que nous coûte leur acquisition ; l'autre, celle des avantages que nous procure leur possession. Quand je fabrique un outil pour mon usage, il a pour moi la double valeur du travail qu'il me coûte d'abord, et de celui qu'il va m'épargner par la suite. Je fais un mauvais emploi de mes forces en le construisant, si sa construction m'en dépense plus que sa possession ne m'en épargnera. Il en est de même quand, au lieu de faire cet outil, je l'achète. Si les choses que je donne en retour m'ont coûté plus de peine que cet outil ne m'en coûterait pour le faire, ou si elles m'en éviteraient plus qu'il ne m'en épargnera, je fais un mauvais marché, je perds plus que je ne gagne, je délaisse plus que je n'acquiers : cela est évident. Dans le cas de l'acquisition de tout autre bien qu'un instrument de travail, la chose n'est pas aussi claire. Cependant, puisqu'il est certain que nos facultés physiques et morales sont notre seule richesse originaire, que l'emploi de ces facultés, le travail quelconque, est notre seul trésor [36] primitif, et que c'est toujours de cet emploi que naissent toutes les choses que nous appelons des biens, depuis la plus nécessaire jusqu'à la plus purement agréable, il est certain de même que tous ces biens ne font que représenter le travail qui leur a donné naissance, et que s'ils ont une valeur, ou même deux distinctes, ils ne peuvent tenir ces valeurs que de celle du travail dont ils émanent. Le travail lui-même a donc une valeur ; il en a donc même deux différentes, car aucun être ne peut communiquer une propriété qu'il n'a pas ? Oui, le travail a ces deux valeurs, l'une naturelle et nécessaire, l'autre plus ou moins conventionnelle et éventuelle : c'est ce qui va se voir très clairement.
Un être animé, c'est-à-dire sensible et voulant, a des besoins sans cesse renaissants, à la satisfaction desquels est attachée la continuation de son existence. Il ne peut y pourvoir que par l'emploi de ses facultés, de ses moyens et si cet emploi, son travail, cessait pendant un certain temps de faire face à ses besoins, son existence finirait. La masse de ces besoins est donc la mesure naturelle et nécessaire de la masse de travail qu'il peut opérer pendant qu'ils se font sentir ; car s'il emploie cette masse de travail à son utilité directe et immédiate, il faut qu'elle suffise à son service. S'il la consacre à un autre, il faut que cet autre fasse au moins pour lui pendant ce temps ce qu'il aurait fait pour lui-même. S'il l'emploie à des objets d'une utilité moins instante et plus éloignée, il faut que cette utilité, quand elle sera réalisée, remplace au moins [37] les objets d'une utilité urgente qu'il aura consommés pendant qu'il se sera occupé de ceux moins nécessaires. Ainsi cette somme de besoins indispensables, ou plutôt celle de la valeur des objets nécessaires pour les satisfaire, est la mesure naturelle et nécessaire de la valeur du travail qui s'opère dans le même temps. Cette valeur est celle de ce que ce travail coûte inévitablement ; celle-là est la première des deux valeurs dont nous avons annoncé l'existence ; elle est purement naturelle et nécessaire.
La seconde valeur de notre travail, celle de ce qu'il produit, est, de sa nature, éventuelle ; elle est souvent conventionnelle, et toujours plus variable que la première. Elle est éventuelle, car nul homme, en commençant un travail quelconque, même lorsque c'est pour son propre compte, ne peut s'assurer entièrement de son produit ; mille circonstances qui ne dépendent pas de lui, et que souvent il ne peut prévoir, augmentent ou diminuent ce produit. Elle est souvent conventionnelle, car quand ce même homme entreprend un travail pour un autre, la quantité du produit qui lui en reviendra dépend de ce que cet autre sera convenu de lui abandonner en retour de sa peine, soit que la convention soit faite avant le travail exécuté, comme avec les journaliers et les salariés ; soit qu'elle ne s'opère qu'après le travail fait et parfait, comme avec les marchands et les fabricants. Enfin, cette seconde valeur du travail est plus variable que sa valeur naturelle et nécessaire, parce qu'elle est déterminée, non pas par [38] les besoins de celui qui fait le travail, mais par les besoins et les moyens de celui qui en profite, et qu'elle est influencée par mille causes concourantes qu'il n'est pas encore temps de développer.
Au reste, même la valeur naturelle du travail n'est pas d'une fixité absolue ; car, premièrement, les besoins d'un homme dans un temps donné, même ceux que l'on peut regarder comme les plus urgents, sont susceptibles d'une certaine latitude, et la flexibilité de notre nature est telle, que ces besoins se restreignent ou s'étendent considérablement par l'empire de la volonté et l'effet de l'habitude. Secondement, par l'influence de circonstances favorables, d'un climat doux, d'un sol fertile, ces besoins pourront être largement satisfaits, pour un temps donné, par l'effet de très peu de peine ; tandis que, dans des circonstances moins heureuses, sous un sol rude, sur un sol ingrat, il faudra beaucoup plus d'efforts pour y pourvoir. Ainsi, suivant les cas, il faut que le travail du même homme pendant le même temps lui procure plus ou moins d'objets ou des objets plus ou moins difficiles à acquérir, seulement pour qu'il continue d'exister.
Par ce petit nombre de réflexions générales, nous voyons donc que les idées de richesse et de dénuement naissent de nos besoins, c'est-à-dire de nos désirs ; car la richesse consiste à posséder des moyens de satisfaire ses désirs, et la pauvreté à en manquer. Nous appelons ces moyens des biens, parce qu’ils nous font du bien. Ils sont tous le produit et la [39] représentation d'une certaine quantité de travail, et ils font naître en nous l'idée de valeur, parce qu'ils ont tous deux valeurs, celle des biens qu'ils coûtent et celle des biens qu'ils procurent. Puisque ces biens ne sont que la représentation du travail qui les produit, c'est donc du travail qu'ils tiennent ces deux valeurs, il les a donc lui-même. En effet, le travail a nécessairement ces deux valeurs ; la seconde est éventuelle, le plus souvent conventionnelle, et toujours très variable. La première est naturelle et nécessaire ; elle n'est pourtant pas d'une fixité absolue, mais elle est toujours renfermée dans certaines limites.
Tel est l'enchaînement des idées générales qui suivent nécessairement les unes des autres, à la première inspection de ce sujet : il nous montre l'application et la preuve de plusieurs grandes vérités établies précédemment. D'abord nous avons vu que nous ne créons jamais rien d'absolument nouveau et extra-naturel. Ainsi, puisque nous avons l'idée de valeur, et puisqu'il existe parmi nous des valeurs artificielles et conventionnelles, il fallait qu'il y eût quelque part une valeur naturelle et nécessaire. Aussi le travail, d'où émanent tous nos biens, a une valeur de cette espèce et la leur communique. Cette valeur est celle des objets nécessaires à la satisfaction des besoins qui naissent inévitablement dans l'être animé, pendant que son travail s'opère.
Secondement, nous avons vu encore que mesurer une quantité quelconque, c'est toujours la comparer à une quantité donnée de même espèce qu'elle, [40] et qu'il faut absolument que cette quantité soit de même espèce, sans quoi elle ne pourrait pas servir d'unité et de terme de comparaison[11]. Aussi quand nous disons que la valeur naturelle et nécessaire du travail qu'opère un être animé pendant un temps donné est mesurée par les besoins indispensables qui naissent dans cet être pendant le même temps, nous donnons réellement pour mesure à cette valeur la valeur d'une certaine quantité de travail ; car les biens nécessaires à la satisfaction de ces besoins ne tirent eux-mêmes leur valeur nécessaire et naturelle que du travail qu'a coûté leur acquisition. Ainsi le travail, notre seul bien originaire, n'est évalué que par lui-même, et l'unité est de même espèce que les quantités calculées.
Troisièmement enfin, nous avons vu que pour qu'un calcul quelconque soit juste et certain, il faut que l'unité soit déterminée de la manière la plus rigoureuse et absolument invariable[12]. Ici, malheureusement, nous sommes obligés d'avouer que notre unité de valeur est sujette à variation, quoique renfermée dans certaines limites. C'est un mal auquel nous ne pouvons remédier, puisqu'il dérive de la nature même de l'être animé, de sa flexibilité et de sa souplesse. Il ne faut jamais nous dissimuler ce mal. Il était essentiel de le reconnaître ; [41] mais il ne doit pas nous empêcher de faire des combinaisons des effets de nos facultés, en prenant les précautions convenables ; car puisque les variations de notre nature sensible sont renfermées dans certaines limites, nous pouvons toujours y appliquer les considérations tirées de la théorie des limites des nombres. Mais cette observation doit nous apprendre combien le calcul de toutes les quantités morales et économiques est délicat et savant, combien il exige de ménagement, et combien il est imprudent de vouloir y appliquer indiscrètement l'échelle rigoureuse des nombres.
Quoi qu'il en soit, puisque ce coup d'œil rapide sur les idées de richesse et de dénuement dérivées du sentiment de nos besoins nous a menés à parler sommairement de tous nos biens, nous ne devons pas passer sous silence le plus grand de tous, celui qui les renferme tous, sans lequel aucun d'eux n'existe, qu'on peut appeler le bien unique de l'être voulant, la liberté. Elle mérite un article à part.
§ V.
De la faculté de vouloir naissent encore les idées de liberté et de contrainte.
Rien ne serait plus aisé que d'inspirer quelque intérêt à toutes les âmes généreuses, en commençant ce chapitre par une espèce d'hymne à ce premier de tous les biens de la nature sensible, la [42] liberté. Mais ces explosions de sentiment n'ont pour objet que de s'électriser soi-même, ou d'émouvoir ceux à qui l'on s'adresse. Or, un homme qui se voue sincèrement à la recherche de la vérité est suffisamment animé par le but qu'il se propose, et compte sur la même disposition dans tous ceux par qui il est bien aise d'être lu. L'amour du bien et du vrai est une véritable passion. Cette passion est, je crois, assez nouvelle ; du moins il me semble qu'elle n'a pu exister dans toute sa force que depuis qu'il est prouvé par le raisonnement et par les faits, que le bonheur de l'homme est proportionné à la masse de ses lumières, et que l'un et l'autre s'accroissent et peuvent s'accroître indéfiniment. Mais depuis que ces deux vérités sont démontrées, cette passion nouvelle qui caractérise l'époque où nous vivons n'est point rare, quoi qu'on en dise ; et elle est aussi énergique et plus constante qu'aucune autre. Ne cherchons donc pas à l'exciter, mais à la satisfaire, et parlons de la liberté aussi froidement que si ce mot seul ne mettait pas en mouvement toutes les puissances de l'âme.
Je dis que l'idée de liberté naît de la faculté de vouloir ; car, avec Locke, j'entends, par liberté, la puissance d'exécuter sa volonté, d'agir conformément à son désir ; et je soutiens qu'il est impossible d'attacher une idée nette à ce mot, quand on veut lui donner un autre sens. Ainsi, il n'y aurait pas de liberté s'il n'y avait pas de volonté ; et il ne peut pas exister de liberté avant la naissance de la volonté. C'est donc un véritable non-sens de prétendre que la volonté [43] est libre de naître [13]; et telles étaient presque toutes les fameuses décisions qui subjuguaient les esprits avant la naissance de la véritable étude de l'intelligence humaine. Aussi les conséquences que l'on tirait de ces prétendus principes, et nommément de celui-ci, étaient-elles la plupart d'une absurdité complète ; mais ce n'est pas le moment de nous en occuper.
Sans nul doute, on ne saurait trop le redire, l'être sensible ne peut vouloir sans motif ; il ne peut vouloir qu'en vertu de la manière dont il est affecté : ainsi sa volonté suit de ses impressions antérieures, tout aussi nécessairement que tout effet suit de la cause qui a les propriétés nécessaires pour le produire. Cette nécessité n'est ni un bien ni un mal pour l'être sensible : c'est la conséquence de sa nature, c'est la condition de son existence ; c'est la donnée qu'il ne peut changer, et de laquelle il doit toujours partir dans toute ses spéculations.
Mais lorsqu'une volonté est née dans l'être animé, lorsqu'il a conçu une détermination quelconque, ce sentiment de vouloir, qui est toujours une souffrance, tant qu'il n'est pas satisfait, a, en récompense, l'admirable propriété de réagir sur les organes, de régler la plupart de leurs mouvements, de diriger l'emploi de presque toutes les facultés et par là de créer tous les moyens de jouissance et [44] de puissance de l’être sensible, quand aucune force étrangère ne l'en empêche, c'est-à-dire quand l'être voulant est libre.
La liberté, prise dans ce sens le plus général de tous (et le seul raisonnable), signifiant la puissance d'exécuter notre volonté, est donc le remède à tous nos maux, l'accomplissement de tous nos désirs, la satisfaction de tous nos besoins, et, par suite, le premier de tous nos biens, celui qui les produit tous, qui les renferme tous. Elle est la même chose que notre bonheur ; elle a les mêmes limites ; ou plutôt notre bonheur ne saurait avoir ni plus ni moins d'étendue que notre liberté, c'est-à-dire que notre pouvoir de satisfaire nos désirs. La contrainte, au contraire, quelle qu'elle soit, est l'opposé de la liberté ; elle est la cause de toutes nos souffrances ; elle est la source de tous nos maux ; elle est même rigoureusement notre seul mal ; car tout mal est toujours la contrariété d'un désir. Nous n'en aurions assurément aucun si nous étions libres de nous en délivrer dès que nous le souhaitons : c'est là vraiment Oromaze et Ahrimane.
La contrainte dont nous souffrons, ou plutôt que nous souffrons, puisque c'est elle-même qui constitue toute souffrance, peut être de différents degrés : elle est directe et immédiate, ou seulement médiate et indirecte ; elle nous vient d'êtres animés ou d'êtres inanimés ; elle est invincible ou peut être surmontée. Celle qui est l'effet de forces physiques qui enchaînent l'action de nos facultés est immédiate ; tandis que celle qui est le résultat de diverses combinaisons de notre intelligence, ou de certaines [45] considérations morales, n'est qu'indirecte et médiate, quoique très réelle aussi. L'une et l'autre, suivant les circonstances, peuvent être insurmontables, ou susceptibles de céder à nos efforts.
Dans tous ces cas divers, nous avons différentes manières de nous conduire pour échapper à la souffrance de la contrainte, pour effectuer l’accomplissement de nos désirs ; en un mot, pour parvenir à notre satisfaction, à notre bonheur ; car, encore une fois, ces trois choses sont une seule et même. De ces différentes manières d'arriver à ce but unique de tous nos efforts comme de tous nos désirs, de tous nos besoins comme de tous nos moyens, nous devons toujours prendre celles qui sont les plus capables de nous y conduire. C'est là aussi notre devoir unique, celui qui renferme tous les autres. Le moyen de le remplir, ce devoir unique, c'est premièrement, si nos désirs sont susceptibles d'être satisfaits, d'étudier la nature des obstacles qui s'y opposent, et de faire tout ce qui dépend de nous pour les surmonter ; secondement, si nos désirs ne peuvent être accomplis qu'en nous soumettant à d'autres maux, c'est-à-dire en renonçant à d'autres choses que nous désirons, de balancer les inconvénients, et de nous décider pour le moindre ; troisièmement, si le succès de nos désirs est tout à fait impossible, il faut y renoncer, et nous renfermer sans murmures dans l'étendue de notre pouvoir. Ainsi tout se réduit à employer nos facultés intellectuelles, d'abord à bien apprécier nos besoins, ensuite à étendre nos moyens autant que possible, et enfin à nous [46] soumettre à la nécessité de notre nature, à la condition invincible de notre existence.
Mais je m'aperçois que j'ai prononcé le mot de devoir. L'idée que ce mot exprime mérite bien un chapitre à part. Il me suffit, dans celui-ci, d'avoir terminé l'examen de tous nos biens, en montrant que, puisque dans l'emploi volontaire de nos facultés consistent tous nos moyens de bonheur, la liberté, la puissance d'agir suivant notre volonté, renferme tous nos biens, est notre bien unique, et que notre devoir unique est d'accroître cette puissance et d'en bien user, c'est-à-dire encore d'en user de manière à ne la gêner ni ne la restreindre ultérieurement.
Voudrait-on encore, avant de quitter ce sujet, appliquer à ce premier de tous les biens, la liberté, l'idée de valeur que nous avons vue naître nécessairement de l'idée de biens ? et demanderait-on quelle est la valeur de la liberté ? Il est évident que, la liberté totale d'un être sentant et voulant n'étant autre chose que la puissance d'user a son gré des facultés qu'il a, la valeur entière de cette liberté est égale à la valeur entière de l'emploi des facultés de cet être ; que si de cette liberté totale on ne lui en retranche qu'une portion, la valeur de cette portion retranchée est égale à la valeur des facultés dont on lui interdit l'exercice, et que la valeur de ce qui lui en reste est la même que celle des facultés dont il conserve l'usage ; et enfin il est manifeste encore que, quelque faibles que soient les facultés d'un être animé, la perte absolue de sa liberté est une perte vraiment infinie pour lui, et à laquelle [47] il ne peut mettre aucun prix, puisqu'elle est absolument tout pour lui, qu'elle est l'extinction de toute possibilité de bonheur, qu'elle est la perte de la totalité de son être, qu'elle ne peut admettre aucune compensation, et qu'elle lui enlève la disposition de tout ce qu'il pourrait recevoir en retour.
Ces notions générales suffisent pour le moment : je n'y ajouterai qu'une réflexion. On dit communément que l'homme, en entrant dans l'état de société, sacrifie une portion de sa liberté pour s'assurer le reste. D'après ce que nous venons de dire, cette expression n'est pas exacte ; elle ne donne une idée juste ni de la cause, ni de l'effet, ni même de la naissance des sociétés humaines. D'abord, l'homme ne vit jamais complètement isolé ; il ne pourrait pas exister ainsi, au moins dans sa première enfance. Ainsi l'état de société ne commence pas pour lui à un jour fixe et de dessein prémédité : il s'établit insensiblement et par degrés. Secondement, l'homme, en s'associant toujours plus à ses semblables, et en se liant chaque jour davantage avec eux par des conventions ou tacites ou expresses, ne compte jamais diminuer sa liberté antérieure, affaiblir la puissance totale d'exécuter sa volonté, qu'il avait auparavant. Il a toujours pour but de l'accroître ; s'il renonce à quelques manières de l'employer, c'est afin d'être secouru, ou du moins de n'être pas contrarié dans d'autres usages qu'il veut en faire, et qu'il juge plus importants pour lui. Il consent que sa volonté soit un peu gênée, dans certains cas, par celle de ses semblables ; mais c’est afin qu'elle soit beaucoup plus puissante sur tous [48] les autres êtres, et même sur eux dans d'autres occasions, en sorte que la masse totale de puissance ou de liberté qu'il possède en soit augmentée. Voilà, je crois, l'idée qu'il faut se faire de l'effet et du but de l'établissement graduel de l'état social. Toutes les fois qu'il ne produirait pas ce résultat, il ne remplirait pas sa destination ; mais il la remplit toujours plus ou moins, malgré ses universelles et énormes imperfections. Nous développerons ailleurs les conséquences de ces observations : maintenant passons a l'examen de l'idée de devoir.
§ VI.
Enfin, de la faculté de vouloir naissent les idées de droits et de devoirs.
Les idées de droits et de devoirs sont, dit-on, correspondantes et corrélatives. Je ne nie point que cela ne soit ainsi dans nos relations sociales ; mais cette vérité, si c'en est une, demande beaucoup d'explications. Examinons des cas divers.
Faisons d'abord une supposition absolument idéale. Imaginons un être sentant et voulant, mais incapable de toute actien ; une simple monade douée de la faculté de vouloir, mais dépourvue de corps et de tout organe sur lesquels sa volonté puisse réagir, et par lesquels elle puisse produire aucun effet, et influer sur aucun être. Il est manifeste qu'un tel être n'a aucun droit dans le sens que l'on donne souvent à ce mot, c'est-à-dire aucun de ces droits [49] qui renferment l'idée d'un devoir correspondant dans un autre être sensible, puisqu'il n'est en contact avec aucun être quelconque. Cependant aux yeux de la raison et de la justice universelle, telles que l'esprit humain peut les concevoir (car nous ne pouvons jamais parler d'autre chose), cette monade a bien le droit de satisfaire ses désirs, et d'apaiser ses besoins ; car c'est là ne blesser aucune loi naturelle, ni artificielle : c'est au contraire suivre les lois de sa nature, et obéir aux conditions de son existence.
En même temps, cette monade, n'ayant aucun pouvoir d'action, aucun moyen de travailler à la satisfaction de ses besoins, n'a aucun devoir ; car elle ne saurait avoir le devoir d'employer d'une manière plutôt que d'une autre ces moyens qu'elle n'a pas, de faire plutôt une action qu'une autre, puisqu'elle ne peut faire aucune action.
Cette supposition nous montre donc deux choses : premièrement, comme nous l'avons déjà dit, que tous les droits naissent des besoins, et tous les devoirs, des moyens ; secondement, qu'il peut exister des droits, dans le sens le plus général de ce mot, sans devoirs correspondants de la part d'autres êtres, ni même de la part de l'être possesseur de ces droits : par conséquent ces deux idées ne sont pas aussi essentiellement et aussi nécessairement correspondantes et corrélatives qu'on le croit communément, car elles ne le sont pas à leur origine. Maintenant faisons une autre hypothèse.
Supposons un être sentant et voulant, constitué comme nous, c'est-à-dire doué d'organes et de [50] facultés que sa volonté met en action, mais complètement séparé de tout autre être sensible, et n'étant en contact qu'avec des êtres inanimés, s'il y en a, ou du moins qu'avec des êtres qui ne lui manifestent pas le phénomène du sentiment, comme il y en a beaucoup pour nous. Dans cet état, cet être n'a point encore de ces droits, pris dans le sens restreint de ce mot, qui renferment l'idée d'un devoir correspondant dans un autre être sensible, puisqu'il n'est en relation avec aucun être de ce genre. Cependant il a bien le droit général, comme la monade dont nous parlions tout à l'heure, de se procurer l'accomplissement de ses désirs, ou, ce qui est la même chose, de pourvoir à ses besoins ; car c'est pour lui, comme pour elle, obéir aux lois de sa nature, et se conformer aux conditions de son existence ; et cet être est tel, qu'il ne peut être mu par aucune autre impulsions, ni avoir aucun autre principe d'action. Cet être voulant a donc alors tous les droits imaginables. On peut même dire que ces droits sont vraiment infinis, puisqu'ils ne sont bornés par rien ; du moins ils n'ont pas d'autres limites que celles de ses désirs eux-mêmes, dont ils émanent et qui en sont la source unique.
Mais ici il y a quelque chose de plus que dans la première hypothèse. Cet être, doué comme nous d'organes et de facultés que sa volonté met en mouvement, n'est pas comme la simple monade dont nous avons parlé d'abord, il a des moyens, donc il a des devoirs car il a le devoir de bien employer ces moyens ; mais tout devoir suppose une [51] peine qu'entraîne son infraction, une loi qui prononce cette peine, un tribunal qui applique cette loi. Aussi, dans le cas dont il s'agit, la punition, pour l'être dont nous parlons, de mal employer ses moyens, est de leur voir produire des effets moins favorables à sa satisfaction, ou même de leur en voir produire qui en soient tout à fait destructifs. Les lois qui prononcent cette peine, ce sont celles de l'organisation de cet être voulant et agissant ; ce sont les conditions de son existence. Le tribunal qui applique ces lois, c'est celui de la nécessité elle-même, contre lequel il ne peut se pourvoir. Ainsi l'être qui nous occupe a incontestablement le devoir e de bien employer ses moyens, puisqu'il en a ; et observez que ce devoir général renferme ceux de bien apprécier d'abord les désirs ou les besoins que ses moyens sont destinés à satisfaire, de bien étudier ensuite ces moyens eux-mêmes, leur étendue et leurs limites, et enfin de travailler en conséquence a restreindre les uns et à étendre les autres le plus possible ; car son malheur ne viendra jamais que de l'infériorité des moyens relativement aux besoins, puisque, si les besoins étaient toujours satisfaits, il n'y aurait pas même possibilité à la souffrance.
L'être isolé dont il s'agit a donc des droits venant tous de ses besoins, et des devoirs naissant tous de ses moyens ; et dans quelque position que vous le placiez, il n'aura jamais ni des droits, ni des devoirs d'une autre nature ; car tous ceux dont il pourra devenir susceptible naîtront tous de ceux-là et n'en seront que des conséquences. On peut même dire [52] que tout vient de ses besoins ; car s'il n'avait pas de besoins, il n'aurait pas besoin de moyens pour les satisfaire ; il ne serait pas même possible qu'il eût aucun moyen : ainsi il ne serait pas concevable qu'il eût un devoir quelconque. Si vous voulez vous en convaincre, essayez de punir un être impassible. J'ai donc eu raison de dire que de la faculté de vouloir naissent les idées de droits et de devoirs, et je puis ajouter avec assurance que ces idées de droits et de devoirs ne sont pas si exactement correspondantes et corrélatives entre elles qu'on le dit communément, mais que celle de devoirs est subordonnée à celle de droits, comme celle de moyens l'est à celle de besoins, puisqu'on peut concevoir des droits sans devoirs, comme dans notre première hypothèse, et que dans la seconde il n'y a des devoirs que parce qu'il y a des besoins, et qu'ils ne consistent que dans le devoir général de satisfaire ces besoins.
Pour mieux nous convaincre de ces deux vérités, faisons une troisième supposition. Plaçons cet être organisé comme nous, en relation avec d'autres êtres sentants et voulants comme lui, et agissant de même en vertu de leur volonté, mais qui soient tels, qu'ils ne puissent pas s'entendre pleinement avec eux, ni comprendre parfaitement leurs idées et leurs motifs. Ces êtres animes ont leurs droits aussi, venant de leurs besoins ; mais cela ne change rien à ceux de l'être dont nous suivons la destinée ; il a les mêmes droits qu'auparavant, puisqu'il a les mêmes besoins.
[53]
Il a en outre le même devoir général d'employer ses moyens de manière à se procurer la satisfaction de ses besoins. Ainsi il a le devoir de se conduire avec ces êtres qui se montrent sentants et voulants, autrement qu'avec ceux qui lui paraissaient inanimés ; car comme ils agissent en conséquence de leur volonté, il a le devoir de captiver ou de subjuguer cette volonté, pour les amener à contribuer à la satisfaction de ses désirs ; et comme il est supposé ne pouvoir pas communiquer complètement avec eux, et par conséquent ne pouvoir faire avec eux aucune convention, il n'a d'autres moyens pour diriger leur volonté vers l'accomplissement de ses désirs et la satisfaction de ses besoins, que la persuasion immédiate ou la violence directe : aussi il emploie et doit employer l'une et l'autre suivant les occasions, sans autre considération que celle de produire les effets qu'il désire.
À la vérité, cet être organisé comme nous est tel, que la vue de la nature sensible lui inspire le désir de compatir avec elle ; qu'il jouit de ses jouissances et souffre de ses maux : c'est là un nouveau besoin qu'elle fait naître en lui ; et nous verrons par la suite que ce n'est pas un de ceux dont il doit chercher s'affranchir, car il lui est utile d'y être soumis. Il doit donc le satisfaire comme les autres, et par suite il a le devoir de s'épargner la peine que lui causent les souffrances des êtres sensibles, autant que ses autres besoins ne l'obligent pas à supporter cette peine. Ceci est encore une conséquence du devoir général de satisfaire tous ses besoins.
[54]
Le tableau que nous venons de tracer, d'après la théorie, se trouve être le simple exposé de nos relations pratiques avec les animaux, prises en général, lesquelles relations se modifient ensuite dans les cas particuliers, suivant le degré d'intelligence que nous avons de leurs sentiments, et suivant les rapports d'habitude et de bienveillance réciproques qui s'établissent entre eux et nous, comme entre nous et nos semblables. Je crois ce tableau la représentation très fidèle de ces relations car il est également éloigné de l'exagération sentimentale qui voudrait nous faire un crime de la destruction quelconque de ces animaux, et de la barbarie systématique qui prétend nous faire regarder comme légitimes leurs souffrances les plus inutiles, ou même nous persuader que la douleur que manifeste un être sensible n'est pas de la douleur, quand cet être sensible n'est pas fait exactement comme nous.
En effet, ces deux systèmes sont également faux. Le premier est insoutenable, puisque dans la pratique il est absolument impossible de le suivre à la rigueur. Il est manifeste que nous serions détruits violemment, ou lentement affamés et rongés par les autres êtres animés, si nous ne les détruisions jamais ; et que, même avec les attentions les plus minutieuses, il nous est impossible d'éviter d'en faire continuellement souffrir et mourir un grand nombre, plus ou moins perceptibles à nos sens. Or, nous avons incontestablement le droit d'agir et de vivre, puisque nous sommes nés pour cela et comme cela.
[55]
Le second système n'est pas moins erroné ; car en théorie il établit témérairement entre les divers états de la nature sensible une ligne de séparation qu'aucun phénomène ne nous autorise à admettre. Il n'y a absolument aucun fait qui nous mette en droit d'affirmer, ni même de soupçonner que l'état de souffrance n'est pas, dans les êtres animés avec lesquels nous communiquons imparfaitement, exactement la même chose que dans nous ou dans nos semblables[14]; et d'après cette supposition gratuite ce système nous condamne à combattre et à détruire, comme une faiblesse, le sentiment, le besoin le plus général et le plus impérieux de la nature humaine, celui de la sympathie et de la commisération ; besoins que nous verrons bientôt être le résultat le plus heureux de notre organisation, et celui sans lequel notre existence deviendrait très misérable, et même impossible. De plus, dans la pratique, ce système est opposé à l'usage le plus universel de tous les temps et de tous les individus ; car il n'y a jamais eu, je crois, d'animal à face humaine qui ait senti sincèrement et originairement que le spectacle de la souffrance nettement exprimée soit une chose indifférente. L'indifférence, fruit de l'habitude, et le plaisir même de la cruauté pour la cruauté, plaisir affreux qui a pu naître dans quelques êtres dénaturés par des causes accidentelles, prouvent même qu'il s'agit [56] là d'une pente naturelle surmontée par le temps ; ou vaincue avec effort ou avec le plaisir qui naît en nous de tout effort suivi de succès. Quant à la cruauté, produit de la vengeance, elle est une preuve de plus de la thèse que je soutiens. Car c'est à cause même du sentiment profond que l'être vindicatif a de la souffrance, qu'il veut la produire dans celui qui lui est odieux, et toujours il partage plus ou moins, involontairement et forcément, le mal qu'il cause.
Ces deux systèmes opposés, mais tous deux fruits du dérèglement de l'imagination, sont donc également absurdes en théorie et en pratique. C'est déjà un grand préjugé en faveur de l'opinion moyenne que j'établis, laquelle d'ailleurs se trouve être conforme à l'usage de tous les temps et de tous les lieux, et rendre raison, par les conditions de notre nature bien observée, de tout ce que notre manière d'être avec les animaux a de singulier et de contradictoire au premier coup d'œil. Mais ce qui est plus fort et absolument convaincant, ce me semble, c'est que le même principe que j'ai posé, que nos droits sont toujours sans bornes, ou du moins égaux à nos besoins, et que nos devoirs ne sont jamais que le devoir général de satisfaire nos besoins, va nous expliquer toutes nos relations avec nos semblables, et les établir sur des bases inébranlables, et telles, qu'elles seront les mêmes partout et toujours, dans tous les pays et dans tous les temps où notre nature intime n'aura pas changé.
Faisons actuellement une quatrième hypothèse, [57] qui est celle dans laquelle nous sommes tous placés. Supposons l'être animé qui nous occupe, en contact avec d'autres êtres semblables à lui. Ces êtres ont des besoins et par conséquent des droits comme lui ; mais cela ne change rien aux siens. Il a toujours autant de droits que de besoins, et le devoir général de satisfaire ces besoins. S'il ne pouvait pas communiquer complètement avec ces êtres semblables à lui, et faire avec eux des conventions, il serait à leur égard dans l'état où nous sommes tous, et où nous avons raison d'être, comme on vient de le voir, avec les autres animaux.
Dira-t-on que c'est un état de guerre ? On aurait tort ; ce serait une exagération. L'état de guerre est celui dans lequel on cherche incessamment la destruction l'un de l'autre, parce que l'on ne peut s'assurer de sa propre conservation que par l'anéantissement de son ennemi. Nous ne sommes dans une telle relation qu'avec les animaux que leur instinct entraîne constamment à nous nuire : il n'en est pas de même avec les autres. Ceux même que nous sacrifions à nos besoins, nous ne les attaquons qu'autant que ces besoins plus ou moins pressants nous y forcent. Il en est qui vivent avec nous dans un état d'asservissement paisible ; d'autres, dans une indifférence parfaite. En tout, nous ne blessons leur volonté que parce qu'elle est contraire à la nôtre, et non pas pour le plaisir de la blesser. Il y a même, à l'égard de tous, ce besoin général de sympathiser avec la nature sensible, qui nous fait une peine de la vue de leur souffrance, et qui nous unit plus ou [59] moins avec eux. Cet état n'est donc pas essentiellement état d'hostilité. Il devient tel fréquemment, mais c'est par accident. Il est essentiellement l'état d'étrangeté, si l'on peut s'exprimer ainsi ; il est celui d'êtres voulants et agissants séparément, chacun pour sa propre satisfaction, sans pouvoir s'expliquer ensemble, ni faire des conventions pour régler les cas où leurs volontés sont opposées.
Telles seraient, comme nous l'avons dit, les relations de l'homme avec ses semblables, s'il n'avait que des moyens très imparfaits de communiquer avec eux. Il ne serait pas précisément pour eux un ennemi, mais un étranger indifférent. Ses rapports avec eux seraient même déjà adoucis par le besoin de sympathiser, qui est beaucoup plus fort en lui quand il s'agit d'animaux de son espèce ; et il faut encore ajouter à ce besoin celui de l'amour, qui le renforce extrêmement dans beaucoup de circonstances ; car l'amour n'a point de jouissance parfaite sans consentement mutuel, sans sympathie très vive ; et quand cette sympathie nécessaire à la pleine satisfaction du désir a existé, elle donne fréquemment naissance à des habitudes de bienveillance, d'où naît le sentiment de paternité, qui produit à son tour des liaisons plus durables et plus tendres.
Toutefois, dans cet état, les querelles sont fréquentes, et il n'y a pas proprement de juste et d'injuste. Les droits de l'un ne font rien aux droits de l'autre. Tous ont chacun autant de droits que de besoins, et le devoir général de satisfaire ces besoins sans aucune considération étrangère. Il ne [59] commence à y avoir de restriction à ces droits et à ce devoir, ou plutôt à la manière de remplir ce devoir, qu'au moment où il s'établit des moyens de s'entendre, et par suite, des conventions tacites ou formelles. Là seulement est la naissance de la justice et de l'injustice, c'est- à-dire de la balance entre les droits de l'un et les droits de l'autre, qui nécessairement étaient égaux jusqu'à cet instant. Les Grecs, qui avaient appelé Cérès législatrice, s'étaient mépris : c'est à la grammaire, au langage, qu'ils auraient dû donner ce titre. Ils avaient placé l'origine des lois et de la justice au moment où les hommes ont entre eux des relations plus stables et des conventions plus multipliées ; mais ils auraient dû remonter jusqu'à la naissance des premières conventions informes ou explicites. Dans tous les genres, le devoir des modernes est de pénétrer plus loin et plus profondément que les anciens. Hobbes a donc eu pleinement raison d'établir le fondement de toute justice sur les conventions ; mais il a en tort de dire auparavant, que l'état antérieur est rigoureusement et absolument l'état de guerre, et que c'est là notre véritable instinct et le vœu de notre nature. Si cela était, nous n'en serions jamais sortis[15]. Un faux [60] principe l'a conduit à une excellente conséquence. Il m'a toujours paru singulièrement remarquable que ce philosophe, qui de tous les hommes qui ont jamais écrit est peut-être le plus recommandable par le rigoureux enchaînement et l'étroite liaison de ses idées, ne soit cependant arrivé à cette belle conception de la nécessité des conventions, source de toute justice, qu'en partant d'un principe faux, ou du moins inexact d'état de guerre, état naturel) ; et que du sentiment profond et juste du besoin de la paix entre les hommes, il ait été conduit à une idée fausse, la nécessité de la servitude. Quand on voit de telles exemples, combien ne doit-on pas trembler d'émettre une opinion [16]!
Cependant je ne puis m'empêcher de croire vraie celle que je viens d'exposer. Il me semble prouvé que de notre faculté de vouloir naissent les idées de droits et de devoirs ; que de nos besoins naissent tous nos droits et de nos moyens tous nos devoirs ; [61] que nous avons toujours autant de droits que de besoins, et le devoir unique de pourvoir à ces besoins ; que les besoins et les droits des autres êtres sensibles, soit d'une autre espèce, soit de la nôtre, ne font rien aux nôtres ; que nos droits ne commencent à être restreints qu'au moment de la naissance des conventions ; que notre devoir général n'est pas changé pour Cela au fond, mais seulement dans la manière de le remplir, et que c'est à cet instant seul que commencent le juste et l'injuste proprement dits.
Ce n'est pas encore le moment de développer toutes les conséquences de ces principes ; mais il est temps de terminer ces longs préliminaires par les réflexions auxquelles ils donnent lieu.
§ VII.
Conclusion.
Les considérations générales auxquelles nous venons de nous livrer sont celles qui se présentent les premières à notre esprit quand nous commençons à observer notre volonté. Pour peu qu'on y réfléchisse, on voit d'abord qu'elle est un mode de notre sensibilité qui naît d'un jugement exprès ou confus que nous portons sur ce que nous sentons ; que si notre sensibilité pure et simple commence à nous donner une idée obscure de notre moi et de la possession de ses affections, ce mode admirable de notre sensibilité que nous appelons [62] vouloir, par les mouvements qu'il nous fait faire et par les résistances qu'il éprouve, nous fait connaître des êtres différents de nous, et complète notre idée d'individualité, de personnalité et de propriété exclusive de tout ce qui nous affecte [17]. Il n'est pas moins visible que cette faculté de vouloir est la source de tous nos besoins et de toutes nos misères ; car l'être indifférent serait impassible ; et il est également manifeste que cette même faculté, par le merveilleux pouvoir qu'elle a de mettre en action nos organes et d'imprimer du mouvement à nos membres, est aussi la source de tous nos moyens et de toutes nos ressources ; car toute notre puissance consiste dans l'emploi de nos forces physiques et intellectuelles. Il suit de là que tout être animé, en vertu des lois de sa nature, a le droit de satisfaire tous ses désirs, qui sont ses besoins, et le devoir unique d'employer ses moyens le mieux possible pour atteindre ce but : car, doué de passion, il ne peut être condamné à souffrir que le moins qu'il lui est possible, et doué d'action, il doit s'en servir à cette fin. Il suit de là encore que la liberté, le pouvoir d'exécuter sa volonté, est pour l'être voulant le premier des biens et les renferme tous ; car il serait toujours heureux s'il avait toujours la puissance de contenter tous ses désirs, [63] et tous ses maux consistent toujours dans la contrainte, c'est-à-dire dans l'impuissance de se satisfaire. On voit, de plus, que l'emploi de nos forces, le travail de tout genre, est notre seule richesse primitive, la source de tous les autres, la cause première de leur valeur, et que le travail lui-même a toujours deux valeurs. L'une est naturelle et nécessaire : c'est celle de tout ce qui est indispensable à la satisfaction des besoins de l'être animé qui exécute ce travail, pendant le temps qu'il l'exécute ; l'autre est éventuelle et souvent conventionnelle : elle consiste dans la masse d'utilités qui résulte de ce même travail. Enfin on voit tout aussi nettement, que la manière de remplir notre devoir unique, celui de bien employer nos moyens, varie en vertu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, soit lorsque nous ne sommes en contact, qu'avec des êtres qui ne nous manifestent aucune sensibilité, soit lorsque nous avons affaire à des êtres animés, mais avec qui nous ne pouvons nous entendre qu'à demi, soit lorsque nous sommes en rapport avec des êtres sensibles comme nous, avec lesquels nous pouvons correspondre parfaitement et faire des conventions. Là commence le juste et l'injuste, proprement dits, et la vraie société, dont le but et le motif sont toujours d'augmenter la puissance de chacun en faisant concourir celle des autres avec elle, et en les empêchant de se nuire réciproquement.
Tous ces premiers aperçus sont bons et sains (du moins je le crois), et commencent déjà à répandre [64] quelque lumière sur le sujet qui nous occupe ; mais ils sont bien loin d'être suffisants : ils ne nous font pas assez connaître quels sont les nombreux résultats de l'emploi de nos forces, de notre travail, de nos actions en un mot ; et quels nouveaux intérêts leurs combinaisons font naître entre nous, ni quels sont les sentiments divers qui germent de nos premiers désirs, et ce qu'ils ont d'utile ou de nuisible pour le bonheur de tous et de chacun, ni enfin quelle est la manière de diriger le mieux possible ces actions et ces sentiments. Ce sont pourtant autant de sujets nécessaires à traiter pour faire une histoire complète de la volonté et de ses effets, et c'est là que se retrouve la division que nous avons annoncée. Il convient donc d'entrer dans plus de détails, et je vais commencer par parler de nos actions.
C'est ce dernier sujet qui constitue le Traité d'économie politique que j'offre en ce moment au public, séparé de tout ce qui le précède et de ce qui le suit dans mes Éléments d'Idéologie.
[65]
CHAPITRE PREMIER.↩
De la Société.
L'introduction que l'on vient de lire est consacrée tout entière à examiner la génération de quelques idées très générales, à jeter un premier coup d'œil sur la nature de ce mode de notre sensibilité que nous appelons volonté ou faculté de vouloir, et à indiquer quelques-unes de ses conséquences immédiates et universelles.
Nous y avons vu sommairement, 1° ce que sont des êtres inanimés ou insensibles, tels que beaucoup nous paraissent, qui peuvent bien exister pour les êtres sensibles qu'ils affectent, mais qui n'existent pas pour eux-mêmes, puisqu'ils ne le sentent pas ; 2° ce que seraient des êtres sentants, mais sentant tout avec une indifférence telle, que de leur sensibilité il ne résulterait aucun choix, aucune préférence, aucun désir, en un mot aucune volonté ; 3° ce que sont des êtres sentants et voulants comme tous les animaux que nous connaissons, et spécialement comme nous, mais isolés ; 4° et enfin ce que deviennent des êtres sentants et voulants à notre manière, lorsqu'ils sont en contact et en relation avec d'autres êtres de leur espèce, semblables à eux, et avec lesquels ils peuvent correspondre pleinement.
[66]
Ces préliminaires étaient nécessaires pour que le lecteur pût bien suivre la série des idées. Mais il serait inconvenant, dans un Traité de la Volonté, de parler plus longtemps des êtres qui ne sont pas doués de cette faculté intellectuelle ; et il ne serait pas moins superflu, ayant principalement en vue espèce humaine, de nous occuper davantage d'êtres qui seraient sentants et voulants, mais qui vivraient isolés.
L'homme ne peut exister ainsi : cela est prouvé par le fait ; car on n'a jamais vu, dans aucun coin du monde, d'animal à figure humaine, tel brut qu'il soit, qui n'ait aucune espèce de relation avec aucun autre animal de son espèce. Cela n'est pas moins démontré par le raisonnement ; car un tel individu peut bien, à la rigueur, subsister quoique très misérablement, mais il ne peut certainement pas se reproduire. Pour que l'espèce se perpétue, il faut que les deux sexes se réunissent ; il faut même que l'enfant qui est le produit de leur union reçoive longtemps les soins de ses pareils ou au moins ceux de sa mère. Or, nous sommes faits de telle façon, que nous avons tous plus ou moins un penchant naturel et inné à sympathiser, c'est-à-dire que nous éprouvons tous du plaisir à faire partager nos impressions, nos affections, nos sentiments, et à partager ceux de nos semblables. Peut-être ce penchant existe-t-il plus on moins dans tous les êtres animés ; peut-être même est-il en nous, des l'origine, une partie considérable de celui qui attire si [67] puissamment les deux sexes l'un vers l'autre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ensuite il l'augmente prodigieusement : il est donc impossible que des rapprochements que notre organisation rend inévitables ne développent pas en nous cette disposition naturelle à sympathiser, ne la fortifient pas par l'exercice, et n'établissent pas entre nous des relations sociales et morales. De plus, noue sommes encore tous faits de manière que nous portons des jugements de ce que nous éprouvons, de ce que nous sentons, de ce que nous voyons, en un mot, de tout ce qui nous affecte ; nous y distinguons des parties, des circonstances, des causes, des conséquences ; et c'est là en juger. Il est donc impossible que nous ne nous apercevions pas bientôt de l'utilité que nous pouvons tirer du secours de nos semblables, de leur assistance dans nos besoins, du concours de leurs volontés et de leurs forces avec les nôtres. Nouvelle raison pour que des rapprochements, d'abord fortuits, deviennent durables et permanents entre nous. C'est aussi ce qui est arrivé toujours et partout ; c'est ce qui toujours et partout aussi a produit cette admirable et savante invention d'un langage plus ou moins perfectionné, mais toujours, à ce qu'il paraît, plus circonstancié et plus capable d'explications détaillées que celui d'aucun autre animal ; c'est donc l'état social qui est notre état naturel, et celui dont nous devons uniquement nous occuper.
Je ne considérerai cependant pas ici la société sous le rapport moral ; je n'examinerai pas comment [68] elle développe, multiplie et complique toutes nos passions et nos affections, ni quels sont les nombreux devoirs qu'elle nous imposé, ni d'où naît pour nous l'obligation fondamentale de respecter les conventions sur lesquelles elle repose et sans lesquelles elle ne peut subsister. Je n'envisagerai l'état social que sous le rapport économique, c'est-à-dire relativement à nos besoins les plus directs, et aux moyens que nous avons d'y pourvoir.
Maintenant, qu'est-ce donc que la société vue sous cet aspect ? Je ne crains point de le dire : la société est purement et uniquement une série continuelle d'échanges ; elle n'est jamais autre chose dans aucune époque de sa durée, depuis son commencement le plus informe jusqu'à sa plus grande perfection ; et c'est là le plus grand éloge qu'on en puisse faire, car l'échange est une transaction admirable dans laquelle les deux contractants gagnent toujours tous deux : par conséquent la société est une suite non interrompue d'avantages sans cesse renaissants pour tous ses membres. Ceci demande à être expliqué.
D'abord la société n'est qu'une suite d'échanges : en effet, commençons par les premières conventions sur lesquelles elle est fondée. Tout homme, avant d'entrer dans l'état de société, a, comme nous l'avons vu, tous les droits et nul devoir, pas même celui de ne pas nuire aux autres, et les autres sont de même à son égard. Il est évident qu'ils ne pourraient pas vivre ensemble, si, par une [69] convention formelle ou tacite, ils ne se promettaient pas réciproquement sûreté. Eh bien ! cette convention formelle est un véritable échange. Chacun renonce à une certaine manière d'employer ses forces, et reçoit en retour le même sacrifice de la part de tous les autres. Une fois la sécurité établie par ce moyen, les hommes ont entre eux une multitude de relations qui viennent toutes se ranger sous une des trois classes suivantes. Elles consistent ou à rendre des services pour recevoir un salaire, ou à troquer une marchandise quelconque contre une autre, ou à exécuter quelque ouvrage en commun. Dans les deux premiers cas, l'échange est manifeste ; dans le troisième, il n'est pas moins réel : car, quand plusieurs hommes se réunissent pour travailler en commun, chacun d'eux fait le sacrifice aux autres de ce qu'il aurait pu faire pendant ce temps-là pour son utilité particulière, et il reçoit pour équivalent sa part de l'utilité commune résultante du travail commun. Il échange une manière de s'occuper contre une autre qui lui devient plus avantageuse à lui-même que ne l'aurait été la première. Il est donc vrai que la société ne consiste que dans une suite continuelle d'échanges.
Je ne prétends pas dire que les hommes ne se rendent jamais de services gratuits. Loin de moi l'idée de nier la bienfaisance, ou de la bannir de leurs cœurs ; mais je dis que ce n'est point sur elle que repose toute la marche de la société, et même que les heureuses conséquences de cette aimable vertu sont bien plus importantes sous le rapport [70] moral[18], dont nous ne parlons pas en ce moment, que sous le rapport économique qui nous occupe. J'ajoute que si l'on presse le sens du mot échange, et si l'on veut, comme on le doit, le prendre dans toute l'étendue de sa signification, on peut dire avec justesse, qu'un bienfait est encore un échange dans lequel on sacrifie une portion de sa propriété ou de son temps pour se procurer un plaisir moral très vif et très doux, celui d'obliger, ou pour s'exempter d'une peine très affligeante, la vue de la souffrance, absolument comme l'on emploie quelque argent pour se donner un feu d'artifice qui divertit, ou pour éloigner de soi quelque chose qui incommode.
Il est également vrai qu'un échange est une transaction dans laquelle les deux contractants gagnent tous deux. Toutes les fois que je fais librement et sans contrainte un échange quelconque, c'est que je désire plus la chose que je reçois que celle que je donne, et qu'au contraire celui avec qui je traite désire plus ce que je lui offre que ce qu'il me rend. Quand je donne mon travail pour un salaire, c'est que j'estime plus ce salaire que ce que j'aurais pu faire en travaillant pour moi-même, et que celui qui me paie prise davantage les services que je lui rends que ce qu'il me donne en retour. Quand je donne une mesure de blé pour une mesure de vin, c'est que j'ai surabondamment de [71] quoi manger, et que je n'ai pas de quoi boire ; et que celui avec qui je traite est dans le cas contraire. Quand nous sommes plusieurs qui nous soumettons à faire un travail quelconque en commun, soit pour nous défendre contre un ennemi, soit pour détruire des animaux malfaisants, soit pour nous préserver des ravages de la mer, d'une inondation, d'une contagion, soit même pour faire un pont ou un chemin, c'est que chacun de nous préfère l'utilité particulière qui lui en revient, à ce qu'il aurait pu faire pour lui-même pendant ce temps. Nous sommes tous satisfaits dans toutes ces espèces d'échange, chacun de nous trouve son avantage dans l'arrangement proposé.
À la vérité, il est possible que, dans un échange, un des contractants, ou même tous deux, aient tort de désirer l'affaire qu'ils consomment. Il se peut qu'ils donnent une chose que bientôt ils regretteront, pour une chose dont bientôt ils ne se soucieront plus. Il se peut aussi que l'un des deux n'ait pas obtenu, pour ce qu'il sacrifie, tout ce qu'il aurait pu prétendre, en sorte qu'il fasse une perte relative, tandis que l'autre fait un gain exagéré. Mais ce sont là des cas particuliers qui ne tiennent pas à la nature de la transaction, et il n'en est pas moins vrai qu'il est de l'essence de l'échange libre d'être avantageux aux deux parties, et que la véritable utilité de la société est de rendre possible entre nous une multitude de pareils arrangements.
C'est cette foule innombrable de petits avantages particuliers sans cesse renaissants qui compose le [72] bien général, et qui produit à la longue les merveilles de la société perfectionnée, et l'immense différence que l'on voit entre elle et la société informe ou presque nulle, telle qu'elle existe chez les sauvages. Il n'est pas mal d'arrêter un moment notre attention sur ce tableau, qui ne la fixe pas assez parce que nous y sommes trop accoutumés.
Qu'est-ce en effet qu'offre à nos regards un pays anciennement civilisé ? Les campagnes sont défrichées et nettoyées, débarrassées des grands végétaux qui les ont couvertes originairement, purgées de plantes et d'animaux malfaisants, et disposées de tous points à recevoir les soins annuels que leur donne le cultivateur. Les marais sont desséchés ; les eaux stagnantes qui y croupissaient ont cessé de remplir l'air de vapeurs pestilentielles ; des issues leur ont été ouvertes, ou leur étendue a été circonscrite, et les terrains qu'elles infectaient sont devenus d'abondants pâturages ou des réservoirs utiles. Le chaos des montagnes a été débrouillé ; leur base a été appropriée aux besoins de la culture ; leur partie la moins accessible, jusqu'à la région des neiges éternelles, a été destinée à la nourriture de nombreux troupeaux. Les forêts, que l'on a laissées subsister, ne sont point restées impénétrables ; les bêtes féroces qui s'y retiraient ont été poursuivies et presque détruites ; les bois qu'elles produisent ont été extraits et conservés ; on a même assujetti leur exploitation à la périodicité la plus favorable à leur reproduction, et les soins qu'on leur a donnés presque partout équivalent à une espèce de culture, [73] et ont même été portés quelquefois jusqu'à la culture la plus recherchée. Les eaux courantes qui traversent tous ces terrains ne sont point demeurées non plus dans leur état primitif. Les grandes rivières ont été débarrassées de tous les obstacles qui s'opposaient à leur cours ; elles ont été contenues par des digues et des quais, lorsque cela a été nécessaire ; et leurs rivages ont été disposés de manière à former des ports commodes dans les endroits convenables. Les cours d'eaux moins considérables ont été retenus pour servir des moulins ou d'autres usines, ou détournés pour arroser des pentes qui en avaient besoin et les rendre productives. Sur toute la surface du sol il a été construit, de distance en distance, dans les positions favorables, des habitations à l'usage de ceux qui cultivent les terres et exploitent leurs produits. Ces habitations ont été entourées des clôtures et des plantations qui pouvaient les rendre plus agréables et plus utiles. Des chemins ont été pratiqués pour y arriver et en extraire les productions de la terre. Dans les points où plusieurs intérêts divers se sont trouvés réunis, et où d'autres hommes sont devenus assez nécessaires au service des cultivateurs pour pouvoir subsister du salaire de ce service, les habitations se sont multipliées et agglomérées, et ont formé des villages et des petites villes. Sur les bords des grandes rivières et sur les côtes de la mer, dans des positions où les relations de plusieurs de ces villes venaient coïncider, il s'est élevé de grandes cités qui elles-mêmes, avec le temps, ont donné naissance à [74] une plus grande encore, laquelle est devenue leur capitale et leur centre commun, parce qu'elle s'est trouvée la mieux placée pour unir toutes les autres, et être approvisionnée et défendue par elles. Enfin toutes ces villes communiquent entre elles et avec les mers voisines et les pays étrangers, par le moyen de ports, de ponts, de chaussées, de canaux, où se déploie toute l'industrie humaine. Tels sont les objets qui nous frappent au premier aspect d'une contrée où les hommes ont exercé toute leur puissance, et qu'ils se sont appropriée de longue main.
Si nous pénétrons dans l'intérieur de leurs habitations, nous y trouvons une foule immense d'animaux utiles, élevés, nourris, domptés par l'homme, multipliés par lui à un point inconcevable ; une quantité prodigieuse d'approvisionnements de toute espèce, de denrées, de meubles, d'outils, d'instruments, de vêtements, de matières brutes ou manufacturées, de métaux nécessaires ou précieux, enfin de tout ce qui peut servir, de près ou de loin, à la satisfaction de nos besoins. Nous y admirons surtout une population réellement étonnante, dont tous les individus ont l'usage d'un langage perfectionné, ont une raison développée jusqu'à un certain point, ont des mœurs assez adoucies et une industrie assez intelligente pour vivre en si grand, nombre près les uns des autres, et parmi lesquels en général les plus dénués sont secourus, les plus faibles sont défendus. Nous remarquons avec plus de surprise encore, que beaucoup de ces hommes sont parvenus à un degré de connaissances très-difficiles à acquérir, qu'ils [75] possèdent une infinité d'arts agréables ou utiles, qu'ils connaissent plusieurs des lois de la nature, qu'ils savent en calculer les effets et les faire tourner à leur avantage ; qu'ils ont même entrevu la plus difficile de toutes les sciences, puisqu'ils sont arrivés à démêler, au moins en partie, les véritables intérêts de l'espèce en général, et en particulier ceux de leur société et de ses membres ; qu'en conséquence ils ont imaginé des lois souvent justes, des institutions passablement sages, et créé une foule d'établissements propres à répandre et à accroître encore l'instruction et les lumières ; et qu'enfin, non contents d'avoir ainsi assuré la prospérité intérieure, ils ont exploré le reste de la terre, établi des relations avec les nations étrangères et pourvu à leur sûreté à l'extérieur.
Quelle immense accumulation de moyens de bien-être ! quels prodigieux résultats de la partie des travaux de nos prédécesseurs, qui n'a pas été immédiatement nécessaire à soutenir leur existence, et qui ne s'est pas anéantie avec eux ! L’imagination même en est effrayée, et elle l'est d'autant plus, que plus on y réfléchit ; car il faut encore considérer que beaucoup de ces ouvrages sont peu durables ; que les plus solides ont été renouvelés bien des fois pendant le cours des siècles, et qu'il n'en est presque aucun qui n'exige des soins et un entretien continuel pour sa conservation. Il faut observer que, de ces merveilles, ce qui frappe nos regards n'est pas ce qu'il y a de plus étonnant. C'est la partie matérielle, pour ainsi dire, mais la partie [76] intellectuelle, si l'on peut s'exprimer ainsi, est encore plus surprenante. Il a toujours été bien plus difficile d'apprendre et de découvrir, que d'agir en conséquence de ce que l'on sait. Les premiers pas, surtout dans la carrière de l'invention, sont d'une difficulté extrême. Le travail que l'homme a été obligé de faire sur ses propres facultés intellectuelles, l'immensité des recherches auxquelles il a été forcé de se livrer, celles des observations qu'il a eu besoin de recueillir, lui ont coûté bien plus de peine et de temps que tous les ouvrages qu'il a pu exécuter en conséquence de ces progrès de son esprit. Il faut enfin remarquer que jamais les efforts des hommes pour l'amélioration de leur sort n'ont été à beaucoup près aussi bien dirigés qu'ils auraient pu l'être ; que toujours une grande partie de la puissance humaine a été employée à empêcher les progrès de l'autre ; que ces progrès ont été troublés et interrompus par tous les grands désordres de la nature et de la société, et que maintes fois peut-être tout a été perdu et détruit, même les lumières acquises, même la capacité de recommencer ce qui avait déjà été fait. Ces dernières considérations pourraient devenir décourageantes ; mais nous verrons ailleurs par combien de raisons nous devons être rassurés contre la crainte de pareils malheurs à l'avenir. Nous examinerons aussi jusqu'à quel point les progrès de l'espèce prise en masse augmentent le bonheur des individus, condition nécessaire pour qu'on puisse s'en féliciter. Mais dans ce moment, qu'il nous suffise d'avoir montré la prodigieuse puissance [77] qu'acquièrent les hommes réunis, tandis que séparés ils peuvent à peine soutenir leur misérable existence.
Smith, si je ne me trompe, est le premier qui ait remarqué que l'homme seul fait des échanges proprement dits. Voyez l'admirable chapitre second du premier livre de son Traité des Richesses. Je regrette qu'en remarquant ce fait, il n'en ait pas recherché plus curieusement la cause. Ce n'était pas à l'auteur de la Théorie des Sentiments moraux à regarder comme inutile de scruter les opérations de notre intelligence. Ses succès et ses fautes devaient contribuer également à lui faire penser le contraire. Malgré cette négligence, son assertion n'en est pas moins vraie. On voit bien certains animaux exécuter des travaux qui concourent a un but commun et qui paraissent concertés jusqu'à un certain peint, ou se battre pour la possession de ce qu'ils désirent, ou supplier pour l'obtenir ; mais rien n'annonce qu'ils fassent réellement des échanges formels. La raison en est, je pense, qu'ils n'ont pas un langage assez développé pour pouvoir faire des conventions expresses ; et je crois que cela vient (comme je l'ai expliqué dans le second volume des Eléments d'Idéologie, article des Interjections, et dans le premier, à propos des signes) de ce qu'ils sont incapables de décomposer assez leurs idées pour les généraliser, pour les abstraire et pour les exprimer séparément, en détail, et sous la forme d'une proposition : d'où il arrive que celles dont ils sont susceptibles sont toutes particulières, confuses avec leurs attributs, et se manifestent en masse par des interjections qui [78] ne peuvent rien expliquer explicitement. L'homme, au contraire, qui a les moyens intellectuels qui leur manquent, est naturellement porté à s'en servir pour faire des conventions avec ses semblables. Ils ne font point d'échanges, et il en fait : aussi lui seul a-t-il une véritable société ; car le commerce est toute la société, comme le travail est toute la richesse.
On a peine à concevoir d'abord que les grands effets que nous venons de décrire puissent n'avoir pas d'autre cause que la seule réciprocité des services et la multiplicité des échanges ; cependant cette suite continuelle d'échanges a trois avantages bien remarquables.
Premièrement, le travail de plusieurs hommes réunis est plus fructueux que celui de ces mêmes hommes agissant séparément. S'agit-il de se défendre ? dix hommes vont résister aisément à un ennemi qui les aurait tous détruits en les attaquant l'un après l'autre. Faut-il remuer un fardeau ? celui dont le poids aurait opposé une résistance invincible aux efforts d'un seul individu cède tout de suite à ceux de plusieurs qui agissent ensemble. Est-il question d'exécuter un travail compliqué ? plusieurs choses doivent être faites simultanément ; l'un en fait une pendant que l'autre en fait une autre, et toutes contribuent à l'effet qu'un seul homme n'aurait pu produire. L'un rame pendant que l'autre tient le gouvernail, et qu'un troisième jette le filet ou harponne le poisson, et la pêche a un succès impossible sans ce concours.
[79]
Secondement, nos connaissances sont nos plus précieuses acquisitions, puisque ce sont elles qui dirigent l'emploi de nos forces et le rendent plus fructueux, à mesure qu'elles sont plus saines et plus étendues. Or, nul homme n'est à portée de tout voir, et il est bien plus aise d'apprendre que d'inventer. Mais quand plusieurs hommes communiquent ensemble, ce qu'un d'eux a observé est bientôt connu de tous les autres, et il suffit que parmi eux il s'en trouve un fort ingénieux, pour que des découvertes précieuses deviennent promptement la propriété de tous. Les lumières doivent donc s'accroître bien plus rapidement que dans l'état d'isolement, sans compter qu'elles peuvent se conserver et par conséquent s'accumuler de générations en générations ; et sans compter encore, ce qui est bien prouvé par l'étude de notre intelligence, que l'invention et l'emploi du langage et de ses signes, qui n'auraient pas lieu sans la société, fournissent à notre esprit beaucoup de nouveaux moyens de combinaison et d'action.
Troisièmement, et ceci mérite encore attention, quand plusieurs hommes travaillent réciproquement les uns pour les autres, chacun peut se livrer exclusivement à l'occupation pour laquelle il a le plus d'avantages, soit par ses dispositions naturelles, soit par le hasard des circonstances ; et ainsi il y réussira. Le chasseur, le pêcheur, le pasteur, le laboureur, l'artisan, ne faisant chacun qu'une chose, deviendront plus habiles, perdront moins de temps et auront plus de succès. C'est là ce que l'on appelle [80] la division du travail, qui, dans les sociétés civilisées est quelquefois portée à un point inconcevable, et toujours avec avantage. Les écrivains économistes ont tous attaché une importance extrême à la division du travail, et ils ont fait grand bruit de cette observation, qui n'est pas ancienne : ils ont eu raison. Cependant il s'en faut bien que ce troisième avantage de la société soit d'un intérêt aussi éminent que les deux premiers, le concours des forces et la communication des lumières. Dans tous les genres, ce qu'il y a de plus difficile est d'assigner aux choses leur véritable valeur ; il faut pour cela les connaître parfaitement.
Concours des force, accroissement et conservation des lumières et division du travail, voilà les trois grands bienfaits de la société, ils se font sentir, dès son origine, aux hommes les plus grossiers ; mais ils augmentent dans une proportion incalculable, à mesure qu'elle se perfectionne, et chaque degré d'amélioration dans l'ordre social ajoute encore à la possibilité de les accroître et d'en mieux user. L'énergie de ces trois causes de prospérité se montrera encore avec plus d'évidence, quand nous aurons vu plus en détail la manière dont se forment nos richesses.
[81]
CHAPITRE II.↩
De la formation de nos richesses, ou de la production d'utilité.
Il est si vrai qu'on ne peut faire aucun raisonnement juste tant que le sens des mots n'est pas bien déterminé, que c'est une chose très importante en économie politique de savoir ce que l'on doit entendre par le mot production, dans le langage de cette science. Cette question, qui en elle- même n'est pas sans difficulté, a encore été très embrouillée par l'esprit de système et les préventions. Elle a été traitée par beaucoup d'hommes habiles, à la tête desquels on doit placer Turgot et Smith. Mais, suivant moi, personne n'y a répandu plus de lumières que M. Say, l'auteur du meilleur livre que je connaisse, sur ces matières[19].
Toutes les opérations de la nature et de l'art se réduisent à des transmutations, à des changements de formes et de lieux.
Non seulement nous ne créons jamais rien, mais il nous est même impossible de concevoir ce que c'est que créer ou anéantir, si nous entendons [82] rigoureusement par ces mots, faire quelque chose de rien, ou réduire quelque chose à rien ; car nous n'avons jamais vu un être quelconque sortir du néant ni y rentrer. De là cet axiome admis par toute l'antiquité : rien ne vient de rien, et ne peut redevenir rien. Que faisons-nous donc par notre travail, par notre action sur tous les êtres qui nous entourent ? Jamais rien qu'opérer dans ces êtres des changements de forme ou de lieu qui les approprient à notre usage, qui les rendent utiles à la satisfaction de nos besoins. Voilà ce que nous devons entendre par produire : c'est donner aux choses une utilité qu'elles n'avaient pas. Quel que soit notre travail, s'il n'en résulte point d'utilité, il est infructueux ; s'il en résulte, il est productif.
Il semble d'abord, et beaucoup de personnes le croient encore, qu'il y a une production plus réelle dans le travail qui a pour objet de se procurer les matières premières, que dans celui qui consiste à les façonner ou à les transporter ; mais c'est une illusion. Lorsque je mets quelques graines en contact avec l'air, la terre et différents engrais, de manière que du concours et des combinaisons de ces éléments il résulte du blé, du chanvre, du tabac, il n'y a pas plus de création opérée que quand je vais prendre le grain de ce blé pour le convertir en farine et en pain ; les filaments de ce chanvre, pour en faire successivement du fil, de la toile et des vêtements ; et les feuilles de ce tabac, pour les préparer de façon à pouvoir les fumer, les mâcher ou les prendre par le nez. Dans [83] l’un et l'autre cas il y a production d'utilité, car tous ces travaux sont également nécessaires pour remplir le but désiré, la satisfaction de quelques-uns de nos besoins.
L'homme qui tire du fond de la mer des poissons, n'est pas plus créateur que ceux qui les font sécher ou saler, qui en tirent l'huile, les œufs, etc., etc., et qui m'apportent tous ces produits. Il en est de même de celui qui fouille la mine, à l'égard de ceux qui convertissent le minerai en métal, et le métal en outils ou en meubles, et qui apportent ces instruments à ceux qui en ont besoin. Chacun d’eux ajoute une utilité nouvelle à l'utilité déjà produite : par conséquent chacun d'eux est également producteur.
Tous étudient également les lois qui régissent les différents êtres, pour les faire tourner à leur profit. Tous emploient, pour produire l'effet qu'ils désirent, les forces chimiques et mécaniques de la nature. Ce que nous appelons sa force végétative n'est pas d'une autre nature ; ce n'est qu'une série d'attractions électives, de véritables affinités chimiques, que sans doute nous ne connaissons pas dans toutes leurs circonstances, mais que nous savons pourtant favoriser par nos travaux, et diriger de manière qu'elles nous deviennent utiles.
C'est donc a tort que l'on a fait de l'industrie agricole une chose essentiellement différente de toutes les autres branches de l'industrie humaine, et dans laquelle l'action de la nature intervenait d'une manière particulière. Aussi a-t-on toujours été [84] bien embarrassé pour savoir précisément ce que l'on devait entendre par l'industrie agricole, prise dans ce sens. On y a compris la pêche et la chasse ; mais pour quoi n'y pas comprendre aussi l'industrie des pâtres nomades ? Y a-t-il une si grande différence entre élever des animaux pour s'en nourrir, et les tuer ou les prendre tout élevés pour s'en nourrir de même ? Si celui qui retire du sel de l'eau de la mer, en l'exposant à l'action des rayons du soleil, est un producteur, pourquoi celui qui retire ce même sel de l'eau d'une fontaine, par le moyen de l'action du feu, et de celle du vent dans des bâtiments de graduation, ne serait-il pas un producteur aussi ? Et cependant quelle différence spécifique y a-t-il entre sa manufacture et toutes celles qui donnent d'autres produits chimiques ? Si l'on range dans cette même classe productrice celui qui retire de la terre le minerai, pourquoi n'y pas comprendre aussi celui qui retire de ce minerai le métal ? Si l'un produit le minerai, l'autre produit le métal ; et cependant où s'arrêter, dans les différentes transformations que subit cette matière, jusqu'à ce qu'elle devienne un meuble ou un bijou ? à quel degré de ces travaux successifs peut-on dire : Là on cesse de produire, et on ne fait plus que façonner ? On en peut dire autant de ceux qui vont chercher du bois dans une forêt, ou de la tourbe dans un pré, ou qui ramassent sur les bords de la mer ou des rivières les choses utiles que les eaux y ont déposées. Sont-ils des agriculteurs, des fabricants, ou des voituriers ? et [85] s'ils sont tout cela à la fois, pourquoi sont-ils plus producteurs sous une de ces dénominations que sens les deux autres ? Enfin, pour ne parler, que de la culture proprement dite, je demande que l'on détermine précisément quel est le véritable producteur, l'agriculteur par excellence, de celui qui sème ou de celui qui récolte, de celui qui laboure ou de celui qui fait les clôtures nécessaires, de celui qui conduit les fumiers dans le champ ou de celui qui y mène les troupeaux qui y parquent, etc. ? Pour moi, je déclare que je vois là tout autant d'ouvriers différents, qui concourent à une même fabrication. Je m'arrête, parce que l'on pourrait faire aux partisans de l'opinion que je combats mille questions tout aussi insolubles que celles-ci dans leur système. Quand on part d'un principe faux, les difficultés naissent en foule. Peut-être est-ce là une des grandes causes du langage obscur, embarrassé et presque mystérieux que l'on remarque dans les écrits des anciens économistes. Lorsque les idées ne sont pas nettes, il est impossible que les expressions soient claires.
Le vrai est tout uniment que tous nos travaux utiles sont productifs, et que ceux relatifs à l'agriculture le sont comme les autres, de la même manière que les autres, par les mêmes raisons que les autres, et n'ont en cela rien de particulier. Une ferme est une véritable manufacture ; tout s'y opère de même, par les mêmes principes et pour le même but. Un champ est un véritable outil, ou, si l'on veut, un amas de matières [86] premières, que l'on peut prendre s'il n'appartient à personne, et qu'il faut acheter, ou louer, ou emprunter, s'il a déjà un maître. Il ne change point de nature, soit que je l'emploie à faire fructifier des graines, ou à y étendre des toiles pour blanchir, ou à tout autre usage. Dans tous les cas, c'est un instrument nécessaire pour un effet qu'on veut produire, comme un fourneau, ou un marteau, ou un vaisseau. La seule différence de cet instrument à tout autre, c’est que, pour s'en servir, comme il ne peut pas se déplacer, il faut l'aller trouver, au lieu de le faire venir à soi.
Encore une fois, l'industrie agricole est une branche de l'industrie manufacturière, qui n'a aucun caractère spécifique qui la sépare de toutes les autres. Veut-on généraliser tellement ce terme, qu'il s'étende à tous les travaux qui ont pour objet de se procurer les matières premières ? alors, il est certain que l'industrie agricole est la première en date et la plus nécessaire de toutes ; car il faut s'être procuré une chose avant de l'adapter à son usage ; mais elle n'est pas pour cela exclusivement productive ; car la plupart de ses produits ont encore besoin d'être travaillés pour nous devenir utiles ; et d'ailleurs il faut alors comprendre dans l'industrie agricole non seulement celle des chasseurs, des pêcheurs, des pasteurs, des mineurs, etc., mais encore celle du sauvage le plus brut, et, même celle de toutes les bêtes qui vivent des productions spontanées de la terre, puisque ce sont des matières premières que ces créatures-là se procurent ; [87] à la vérité elles les consomment tout de suite, mais cela ne change pas la thèse. Certainement ce sont là de singuliers agriculteurs et de singuliers producteurs.
Veut-on n'entendre par industrie agricole que l'agriculture proprement dite ? alors elle n'est pas la première dans l'ordre chronologique ; car les hommes sont longtemps pêcheurs, chasseurs, pasteurs, simples vagabonds à la manière des brutes, avant d'être agriculteurs. Elle n'est plus même la seule industrie productive de matières premières, car nous en employons beaucoup que nous ne lui devons pas. Elle est toujours très importante sans doute, et la principale source de nos subsistances, si ce n'est pas de nos richesses ; mais elle ne peut pas être regardée comme exclusivement productive.
Concluons que tout travail utile est réellement productif, et que toute la classe laborieuse de la société mérite également le nom de productive. La vraie classe stérile est celle des oisifs, qui ne font rien que vivre ce que l'on appelle noblement, du produit des travaux exécutés avant eux, soit que ces produits soient réalisés en fonds de terre qu'ils afferment, c'est-à-dire qu'ils louent à un travailleur, soit qu'ils consistent en argent ou effets qu'ils prêtent moyennant rétribution, ce qui est encore louer. Ceux-là sont les vrais frelons de la ruche (fruges consumere nati), à moins qu'ils ne se rendent recommandables par les fonctions qu'ils remplissent, ou par les lumières qu'ils répandent ; car [88] ce sont là encore des travaux utiles et producteurs ; quoique d'une utilité qui n'est pas immédiate sous le rapport de la richesse : nous en parlerons dans la suite.
Quand à la classe laborieuse et directement productive de toutes nos richesses, comme son action sur tous les êtres de la nature se réduit toujours à les changer de forme ou de lieu, elle se partage naturellement en deux : les manufacturiers (y compris les agriculteurs), qui fabriquent et façonnent ; et les commerçants, qui transportent, car c'est là la véritable utilité de ces derniers : s'ils ne faisaient qu'acheter et revendre, sans transporter, sans détailler, sans rien faciliter, ils ne seraient que des parasites incommodes, des joueurs, des agioteurs. Nous parlerons bientôt des uns et des autres, et nous verrons promptement combien notre manière de considérer les choses répand de lumières sur toute la marche de la société. Pour le moment, il est encore nécessaire d'expliquer un peu davantage en quoi consiste cette utilité, notre seule production, laquelle résulte de tout travail bien entendu, et de voir comment elle s'apprécie, et comment elle seule constitue la valeur de tout ce que nous appelons nos richesses.
[89]
CHAPITRE III.↩
De la mesure de l'utilité, ou des valeurs.
Ce mot utilité a une signification bien étendue, car il est bien abstrait ; ou plutôt il est bien abstrait parce qu'il est abstrait d'une multitude de significations différentes. En effet, il existe des utilités de bien des genres : il y en a de réelles, il y en a d'illusoires. S'il y en a de solides, il y en a de bien futiles, et souvent nous nous y trompons lourdement. J'en pourrais citer beaucoup d'exemples, mais ils ne seraient peut-être pas du goût de tous les lecteurs : il vaut mieux que chacun choisisse ceux qui lui plaisent. En général on peut dire que tout ce qui est capable de procurer un avantage quelconque, même un plaisir frivole, est utile. Je crois que c'est là la véritable valeur de ce mot ; car, en définitive, tout ce que nous désirons, c'est de multiplier nos jouissances et de diminuer nos souffrances ; et certainement le sentiment de plaisir et de satisfaction est un bien ; tous les biens ne sont même que celui-là diversement modifié : ce qui nous le procure est donc utile.
S'il n'est pas aisé de bien dire ce que c'est que l'utilité dont nous parlons, il semble encore bien plus difficile d'en déterminer les degrés ; car la mesure de l'utilité réelle ou supposée d'une chose est la vivacité avec laquelle elle est désirée généralement. [90] Or, comment fixer les degrés d'une chose aussi inappréciable que la vivacité de nos désirs ? Nous avons cependant une manière très sûre d'y parvenir : c'est d'observer les sacrifices auxquels ces désirs nous déterminent : Si, pour obtenir une chose quelconque, je suis disposé à donner trois mesures de blé qui m'appartiennent, et si, pour en obtenir une autre, je suis prêt à me détacher de douze mesures pareilles, il est évident que je désire cette dernière quatre fois plus que l'autre. De même si je donne à un homme un salaire triple de celui que j'offre à un autre, il est clair que je prise les services du premier trois fois plus que ceux du second, ou que si moi, personnellement, je ne les estime pas autant, c'est pourtant la valeur qu'on leur donne généralement : en sorte que je ne pourrais pas me les procurer a un moindre prix ; et puisque enfin je fais ce sacrifice librement, c'est une preuve que ce qui en est l'objet le mérite, même pour moi.
Dans l'état de société, qui n'est qu'une suite continuelle d'échanges, c'est ainsi que se déterminent les valeurs de tous les produits de notre industrie. Cette fixation, sans doute, n'est pas toujours fondée sur de bien bonnes raisons ; nous somme souvent de très mauvais appréciateurs du vrai mérite des choses ; mais enfin, sous le rapport de la richesse, elles n'en ont pas moins la valeur que leur assigne l'opinion générale. D'où l'on voit, soit dit en passant, que le plus grand producteur est celui qui exécute le travail le plus chèrement payé ; peu, importe que ce travail soit du ressort de l’industrie [91] agricole, ou de l'industrie manufacturière, ou de l'industrie commerçante ; et d'où l'on voit encore que de deux nations, celle qui a plus de richesses et de jouissances est celle dont les ouvriers sont les plus laborieux et les plus habiles dans chaque genre, ou s'adonnent aux genres de travail les plus fructueux, en un mot, celle dont les travailleurs produisent le plus de valeurs dans le même temps.
Ceci nous ramène au sujet que nous avons déjà commencé à traiter dans l'Introduction, paragraphes III et IV. Notre seule propriété originaire, ce sont nos forces physiques et intellectuelles. L'emploi de nos forces, notre travail, est notre seule richesse primitive. Tous les êtres existants dans la nature, susceptibles de nous devenir utiles, ne le sont pas encore actuellement : ils ne le deviennent que par l'action que nous exerçons sur eux, que par le travail plus ou moins grand, ou très simple, ou très compliqué, que nous exécutons pour les convertir à notre usage. Ils n'ont de valeur pour nous et parmi nous que par ce travail et à proportion de son succès. Ce n'est pas à dire que s'ils sont déjà devenus la propriété de quelqu'un, il ne faille commencer par faire un sacrifice pour les obtenir de lui avant d'en disposer ; mais ils ne sont devenus la propriété de quelqu'un que parce qu'il y a précédemment appliqué un travail quelconque, dont les conventions sociales lui ont assuré le fruit. Ainsi ce sacrifice même est le prix d'un travail ; et antérieurement à tout travail, ces êtres n'avaient aucune valeur actuelle, et celle qu'ils ont, ils ne la [92] tiennent jamais que d'un emploi quelconque de nos, forces dont ils ont été l'objet.
Cet emploi de nos forces, ce travail, nous l'avons vu encore, a une valeur naturelle et, nécessaire, sans quoi il n'en aurait jamais eu une artificielle et conventionnelle. Cette valeur nécessaire en la somme des besoins : indispensables dont la satisfaction est nécessaire à l'existence de celui qui exécute, ce travail, pendant, le temps qu'il l'exécute. Mais, ici où nous parlons de la valeur qui résulte des transactions libres de la société, on voit bien qu'il s'agit de la valeur conventionnelle et vénale, de celle que l'opinion générale attache aux choses, à tort ou à raison. Si elle est inférieure aux besoins du travailleur, il faut qu'il se livre à une autre industrie, ou il s'éteint ; si elle leur est strictement égale, il subsiste avec peine ; si elle leur est supérieure, il s'enrichit, pourvu toutefois qu'il soit économe. Dans tous les cas, cette valeur conventionnelle et vénale est la véritable sous le rapport de la richesse ; elle est la vraie mesure de l'utilité de la production, puisqu'elle en fixe le prix.
Cependant cette valeur de convention, ce prix vénal, n'est pas uniquement l'expression de l'estime qu'on fait généralement d'une chose. Elle varie suivant les besoins et les moyens du producteur et du consommateur, de l'acheteur et du vendeur ; car le produit de mon travail m'eût-il coûté beaucoup de peine et de temps, si je suis pressé de m'en défaire s'il y en a beaucoup de semblable à vendre, ou si l'on a peu de moyen de le payer, il faut bien [93] que je le donne à bas prix. Au contraire, si les acheteurs sont nombreux, empressés, riches, je puis vendre très cher ce que je me suis procuré très facilement[20]. C'est donc de différentes circonstances, et du balancement de la résistance des vendeurs et des acheteurs, que dépend le prix vénal ; mais il n'en est pas moins vrai qu'il est la mesure de la valeur des choses et de l'utilité du travail qui les produit.
Il y a cependant une autre manière de considérer l'utilité du travail, mais celle-là est moins relative à l'individu qu'à l'espèce humaine en général. Je m'explique par un exemple. Avant l'invention du métier à bas, un homme on une femme, en tricotant, pouvait faire une paire de bas dans un temps donné, et recevait un salaire proportionné au degré d'intérêt que l'on mettait à se procurer le produit de son travail, et à la difficulté de ce travail, comparativement avec tous les autres. Les choses ainsi réglées, on invente le métier à bas ; et je suppose qu'au moyen de cette machine, la même personne, sans plus de peine ni plus d'intelligence, puisse faire précisément trois fois plus d'ouvrage qu'auparavant et de même qualité : il n'est pas douteux [94] que d'abord elle sera trois fois plus payée ; car à ceux qui portent des bas, la manière dont ils sont produits est indifférente. Mais bientôt cette machine, et le petit talent de la faire mouvoir, se multipliant, puisque l'industrie de ceux qui s’adonnent à ce travail est supposée n'être ni plus pénible, ni plus difficile que l'industrie de ceux qui tricotaient, il est certain qu'ils n'auront pas des salaires plus forts, quoiqu'ils fassent trois fois plus d'ouvrage[21]. Leur travail ne sera donc pas plus productif pour eux, mais il le sera plus pour la société prise en masse ; car il y aura trois fois plus de personnes chaussées pour la même somme ; ou plutôt, à ne considérer que la façon des bas, chacun pourra en avoir autant qu'auparavant avec le tiers de l'argent qu'il y employait, et par conséquent aura les deux autres tiers de reste pour pourvoir à d'autres besoins. On peut en dire autant de celui qui écrasait le blé entre deux pierres, avant l'invention des moulins, par rapport au garçon meunier, qui ne gagne peut-être pas davantage, mais qui moud cent fois plus et mieux. C'est là le grand avantage des sociétés civilisées et éclairées ; chacun s'y trouve, mieux pourvu en tout genre, avec moins de sacrifices, parce que les travailleurs produisent une plus grande masse d'utilité dans le même temps.
C'est aussi, pour le dire en passant, ce qui montre [95] l'erreur de ceux qui, pour juger du plus ou moins d'aisance des classes pauvres de la société dans des temps différents, ne font que comparer le prix des journées au prix des grains, et qui, s'ils trouvent que le premier soit moins augmenté que le second, en concluent que les ouvriers sont plus malheureux qu'ils n'étaient. Cela n'est pas exact et n'est vraisemblablement pas vrai ; car, premièrement, on ne mange pas le grain en nature, et il se peut qu'il soit augmenté de prix sans que le pain le soit, si on moud et si on cuit plus économiquement. De plus, quoique le pain soit la principale dépense du pauvre, il a encore d'autres besoins. Si les arts ont fait des progrès, il peut être mieux logé, mieux vêtu, mieux abreuvé pour le même prix. Si la société est mieux ordonnée, il peut trouver plus régulièrement à employer son travail et être plus sûr de n'être point troublé dans la possession de ce qu'il gagne ; enfin, il se peut très bien que pour la même somme il jouisse davantage, ou du moins qu'il souffre moins. Les éléments de ce calcul sont si nombreux, qu'il est très difficile et peut-être impossible de le faire directement. Nous verrons dans la suite d'autres moyens de décider cette question ; mais à cette heure elle nous éloigne de l'objet qui nous occupe. Revenons.
Nous avons vu que la seule et unique source de toutes nos jouissances, de toutes nos richesses, c'est remploi de nos forces, notre travail, notre industrie ; que la vraie production de cette industrie, c'est l’utilité ; que la mesure de cette utilité est le [96] salaire qu'elle obtient ; et en outre, que la quantité de cette utilité produite est ce qui compose la somme de nos moyens d'existence et de jouissance. Maintenant examinons les deux grandes branches de cette industrie, le changement de forme et le changement de lieu, la fabrication et le transport, ou ce que l'on appelle l'industrie fabricante et l'industrie commerçante.
CHAPITRE IV.↩
Du changement de forme, ou de l'Industrie fabricante, y compris l'Agriculture.
Puisque la société tout entière n'est qu'une suite continuelle d'échanges, nous sommes tous plus ou moins commerçants. De même, puisque le résultat de tous nos travaux n'est jamais qu'une production d'utilité, et puisque le dernier effet de toutes nos fabriques est toujours de produire de l'utilité, nous sommes tous producteurs ou fabricants ; car il n'y a personne assez malheureux pour ne jamais rien faire d'utile ; mais par l'effet des combinaisons sociales, et par la séparation des différents genres d'occupations qui en est la suite, chacun se voue à une espèce d'industrie particulière. Celle qui a pour objet de façonner et de modifier tous les êtres qui nous entourent, pour les convertir à notre usage, nous l'appelons spécialement [97] l'industrie manufacturière ou fabricante ; et par les raisons que nous avons dites, nous comprenons dans celle-là celle qui consiste à extraire les matières premières des éléments qui les recèlent c'est-à-dire celle que l'on appelle l'industrie agicole. Examinons quels sont les procédés et la manière d'agir de l'industrie fabricante en général.
M. Say a très bien remarqué que dans toute industrie quelconque il y a trois choses distinctes : premièrement, connaître les propriétés des êtres que l'on peut employer, et les lois de la nature qui les régissent ; secondement, entreprendre de tirer parti de cette connaissance pour produire un effet utile ; troisièmement, exécuter le travail nécessaire pour atteindre ce but ; c'est-à-dire que dans tout il y a, comme il le dit, théorie, application et exécution.
Avant l'existence de la société, ou pendant son enfance, tout homme est fabricant pour lui- même de tout ce dont il a besoin, et dans chaque espèce de fabrication il est obligé de remplir tout seul les trois fonctions dont nous venons de parler ; mais dans la société plus avancée, par l'effet de l'heureuse possibilité des échanges, non seulement chacun se voue exclusivement à l'industrie particulière pour laquelle il a le plus d'avantages, mais encore dans chaque genre d'industrie, les trois fonctions dont il s'agit se séparent. La théorie est le fait du savant ; l'application, celui de l'entrepreneur ; et l'exécution, celui de l'ouvrier.
[98]
Ces trois espèces de travailleurs doivent trouver un profit dans la peine qu'ils se donnent. Car un homme naît nu et dénué ; il ne peut amasser qu'après avoir gagné ; et avant d'avoir amassé, il n'a pour subsister que ses facultés physiques et morales. Si l'usage qu'il en fait ne lui produit rien, il faut qu'il trouve à en faire un autre emploi, ou qu'il s'éteigne. Il faut donc que chacun des travailleurs dont nous parlons trouve un salaire dans les profits résultant de la fabrication à laquelle ils coopèrent.
Mais tous ont besoin plus ou moins d'avances avant de commencer à recevoir ce salaire ; car ce n'est pas en un instant et sans préparation que leur service devient assez fructueux pour mériter récompense.
Le savant, ou celui que dans ce moment nous considérons comme tel, avant d'avoir découvert ou appris des vérités immédiatement utiles et applicables, a eu besoin de longues études ; il a dû faire des recherches, des expériences ; il lui a fallu des livres, des machines ; en un mot, il a été obligé de faire des frais et des dépenses avant d'en tirer aucun avantage.
L'entrepreneur n'éprouve pas moins la nécessité de quelques connaissances préliminaires et d'une éducation préparatoire plus ou moins étendue. De plus, avant de commencer à fabriquer, il faut qu'il se procure un local, un établissement, des magasins, des machines, des matières premières, et encore des [99] moyens pour payer les ouvriers jusqu'au moment des premières rentrées : ce sont là d'énormes avances.
Enfin, le pauvre ouvrier lui-même n'a pas sans doute de grands fonds ; pourtant il n'y a guère de métier où il ne soit obligé d'avoir en propre quelques outils. Il a toujours ses habits et son petit mobilier. Quant il n'aurait fait que vivre jusqu'au moment où son travail va commencer à valoir sa subsistance la plus stricte, il faut toujours que ce soit le fruit de quelque travail antérieur, c’est- à-dire quelques richesses déjà acquises, qui y aient pourvu. Que ce soit l'économie de ses parents, quelque établissement public, ou même le produit de l'aumône qui en ait fait les frais, ce sont toujours des avances qui ont été faites pour lui, si ce n'est pas par lui ; et elles n'auraient pu avoir lieu si tout le monde avant lui avait vécu au jour le jour, exactement comme les animaux, et n'avait eu absolument rien de reste du produit de son travail.
Maintenant, qu'est-ce donc que toutes ces avances grandes ou petites ? C'est ce que l'on appelle ordinairement des capitaux, et que moi, je nomme tout simplement des économies. C'est l'excédent de la production de tous ceux qui nous ont précédés sur leur consommation ; car si l'une avait toujours été exactement égale à l'autre, il ne serait rien resté, pas même de quoi élever des enfants. Nous n'avons hérité de nos devanciers que de cet excédent ; et c'est cet excédent longtemps accumulé dans tous [100] les genres, et qui va toujours croissant dans une progression accélérée, qui fait toute la différence entre une nation civilisée et une horde sauvage, différence dont nous avons esquissé le tableau ci-dessus.
Les écrivains économistes sont entrés dans beaucoup de détails sur la nature et l'emploi des capitaux. Ils en ont reconnu de bien des genres différents. Ils ont distingué des capitaux productifs et des capitaux improductifs, des capitaux fixes, d'autres circulants, de mobiliers, d'immobiliers, de permanents, de destructibles. Je ne vois pas une grande utilité à toutes ces subdivisions. Les unes sont très contestables, les autres se fondent sur des circonstances très variables, d'autres enfin sont tout à fait superflues. Il me semble suffisant, pour l'objet que nous nous proposons, de remarquer que des économies antérieures sont nécessaires au commencement de toute entreprise industrielle, même peu étendue : et c'est pour cela que dans tout pays, les premiers progrès de l'industrie sont d'abord si lents ; car c'est dans les commencements surtout que les économies sont difficiles. Comment n'avoir pas de peine à faire des accumulations quelconques, quand personne n'a presque rien au-delà du strict nécessaire ?
Cependant petit à petit, à l'aide du temps et de quelques circonstances heureuses, il se forme de ces capitaux. Ils ne sont pas tous du même genre, ils ne sont pas tous égaux, et c’est ce qui donne naissance aux trois classes de travailleurs qui coopèrent à toute fabrication, chacun s'élevant à celle à [101] laquelle il a pu parvenir, ou se casant dans celle qu'il n'a pas pu dépasser. Il est aisé d'apercevoir que voilà la source d'une grande diversité dans les salaires. Le savant, celui qui peut éclairer les travaux de la fabrication et les rendre moins dispendieux et plus fructueux, sera nécessairement recherché et bien payé. Il est vrai que si ses connaissances ne sont pas d'une utilité immédiate, ou si, étant utiles, elles commencent à se répandre et à devenir communes, il court le risque de se voir négligé ou même sans emploi ; mais enfin, tant qu'on aura besoin de lui, ses salaires seront forts.
Le pauvre ouvrier qui n'a que ses bras à offrir n'a pas cette espérance ; il sera toujours réduit au moindre prix, qui pourra s'élever un peu si l'on demande beaucoup plus de travail qu'on n'en offre, mais qui tombera même au-dessous du nécessaire s'il se présente plus de travailleurs qu'on n'en peut employer. C'est dans ce cas-là qu'ils s'éteignent, par l'effet de leur détresse.
Ces deux espèces de coopérateurs à la fabrication, le savant et l'ouvrier, seront toujours à la solde de l'entrepreneur. Ainsi le veut la nature des choses ; car il ne suffit pas de savoir servir une entreprise de sa tête ou de ses bras, il faut avant tout qu'il y ait une entreprise, et celui qui la fait est nécessairement celui qui choisit, emploie et salarie ceux qui y coopèrent. Or, qui est-ce qui peut la faire ? C'est l'homme qui a déjà des fonds avec lesquels il veut faire les premiers frais d’établissement et [102] d'approvisionnement, et payer des salaires jusqu'au moment des premières rentrées.
Pour celui-là, quelle sera la mesure de sa récompense ? Ce sera uniquement la quantité d'utilité qu'il aura produite et fait produire ; il ne saurait y en avoir d'autre. Si, ayant acheté pour cent francs de choses quelconques ; et si, ayant dépensé cent autres francs à les changer de forme, il arrive que ce qui sort de sa fabrique paraisse avoir assez d'utilité pour que l'on veuille bien lui donner quatre cents francs pour se le procurer, il a gagné deux cents francs ; si on ne lui en offre que deux cents francs, il a perdu son temps et sa peine ; si on ne lui en offre que cent, il a de plus perdu la moitié de ses fonds. Toutes ces chances sont possibles ; il est soumis à cette incertitude, laquelle ne saurait atteindre le salarié, qui reçoit toujours le prix convenu, quelque chose qui arrive.
On dit communément que les bénéfices de l'entrepreneur, mal à propos appelés salaires, puisque personne ne lui a rien promis, doivent représenter le prix de son travail, les intérêts de ses fonds et le dédommagement des risques qu'il a courus, que cela est nécessaire, et qu'il est juste que cela soit ainsi. J'accorde, si l'on veut, que cela est juste, quoique le mot juste soit ici mal appliqué, puisque, personne n'ayant contracté vis-à-vis de cet entrepreneur l'obligation de lui fournir ces bénéfices, il n'y a point d'injustice commise s'ils lui manquent. Je conviens, en outre, que cela est nécessaire pour [103] qu'il continue son entreprise et ne se dégoûte pas de sa profession ; mais je dis que ce ne sont pas du tout ces calculs qui sont cause de ses bons ou mauvais succès ; ils dépendent uniquement de la quantité d'utilité qu'il a su produire, du besoin que l'on a de se la procurer, et enfin des moyens que l'on a de la lui payer ; car pour qu'une chose soit demandée, il faut qu'elle soit désirée, et pour l'acheter, il ne suffit pas d'avoir le désir de la posséder, il faut encore en avoir une autre a céder en retour.
Dans ce simple exposé, vous trouvez déjà tout le mécanisme et les ressorts secrets de cette partie de la production qui consiste dans la fabrication. Vous y découvrez même le germe des intérêts opposés qui s'établissent entre l'entrepreneur et les salariés, d'une part, et l'entrepreneur et les consommateurs, de l'autre ; parmi les salariés entre eux, parmi les entrepreneurs du même genre, parmi même les entrepreneurs de différents genres, puisque c'est entre eux tous que se partagent plus ou moins inégalement les moyens de la masse des consommateurs, et enfin parmi les consommateurs eux-mêmes, puisque c'est aussi entre eux tous que se partage la jouissance de toute l'utilité produite. Vous y apercevez que les salariés désirent qu'il y ait peu de salariés et beaucoup d'entrepreneurs ; et les entrepreneurs, qu'il y ait peu d'entrepreneurs, surtout du même genre qu'eux, mais beaucoup de salariés et aussi beaucoup de consommateurs ; et que les consommateurs veulent au contraire beaucoup [104] d'entrepreneurs et de salariés, et s'il se peut, peu de consommateurs ; car chacun craint la concurrence dans son genre, et voudrait être seul pour être maître : Si vous suivez plus loin la complication de ces intérêts divers dans les progrès de la société, et le jeu des passions qu'ils font naître, vous verrez bientôt tous ces hommes implorer l'appui de la force en faveur de l'idée dont ils sont préoccupés ; ou du moins, sous différents prétextes, provoquer des règlements prohibitifs, pour gêner ceux qui leur nuisent dans cette lutte universelle.
S'il y a une classe qui ne suive pas cette direction, ce sera celle des consommateurs, parce que tout le monde étant consommateur, tous ne peuvent pas se réunir pour former une coterie et demander des exceptions ; car c'est la loi générale, ou plutôt la liberté, qui est leur sauvegarde. Ainsi c'est précisément parce que leur intérêt est l'intérêt universel, qu'il n'a point de représentants spéciaux et de solliciteurs acharnés. Il arrive même que des illusions les divisent, leur font perdre de vue l'objet principal, et qu'ils sollicitent partiellement et en divers sens, contre leur intérêt réel ; car il faut beaucoup de lumières pour le connaître, puisqu'il est général ; et de justice pour le respecter, puisque tout le monde veut des préférences. Tous ceux, au contraire, qui ont un intérêt particulier prédominant, sont réunis par lui, forment corporation, ont des agents actifs, ne manquent jamais de prétextes pour exiger qu'on le fasse prévaloir, et en ont bien des moyens, s'ils sont riches, ou s'ils sont redoutables, [105] comme le sont les pauvres dans les temps de troubles, c'est-à-dire quand on leur révèle le secret de leur force et qu'on les excite à en abuser.
Dans ce moment il n'est pas nécessaire de suivre si loin les conséquences des faits que nous avons établis. Observons seulement que les travaux les plus nécessaires sont les plus généralement demandés et les plus constamment employés ; mais aussi qu'il est dans la nature des choses qu'ils soient toujours les plus mal payés : cela ne peut être autrement. En effet, les choses nécessaires à tous les hommes sont d'un usage universel et continuel ; mais par cela même, beaucoup d'hommes s'occupent constamment de leur fabrication ; et on a dû parvenir bientôt à les produire, par des procédés très connus et qui n'exigent qu'une intelligence commune. Ainsi elles ont dû devenir à aussi bon marché qu'il soit possible. D'ailleurs il est indispensable qu'elles ne soient pas chères ; car la presque totalité de leur consommation est toujours faite par des gens qui ont peu de moyens, attendu que les pauvres sont partout le très grand nombre, et que partout ils sont aussi les plus grands consommateurs des choses nécessaires, lesquels même composent presque toute leur dépense. Si donc elles n'étaient pas à bas prix, elles cesseraient d'être consommées, et le pauvre ne pourrait subsister. C'est sur le plus bas prix auquel elles peuvent parvenir, que se règle le plus bas prix des salaires ; et les ouvriers qui travaillent à leur fabrication sont [106] nécessairement compris dans cette dernière classe des plus faibles salariés.
Remarquez encore qu'il n'y a rien dans tout ce que nous venons de dire de l'industrie manufacturière, qui ne convienne à l'agriculture comme à tous les autres genres de fabrication. Il y a de même, dans l'agriculture, théorie, application et exécution, et on y retrouve les trois espèces de travailleurs relatifs à ces trois objets. Mais ce qui s'applique éminemment à l'agriculture, c'est la vérité générale que nous avons établie, que les travaux les plus nécessaires sont par cela même nécessairement les plus mal payés. En effet, le plus important et le plus considérable des produits de l'agriculture, ce sont les plantes céréales nécessaires à notre nourriture. Or, je demande à quel prix reviendrait le blé si tous ceux qui sont employés à sa production étaient payés aussi chèrement que ceux qui travaillent pour les arts de luxe les plus recherchés ? Certainement les pauvres ouvriers de tous les métiers communs n'y pourraient atteindre ; il faudrait qu'ils mourussent absolument de faim, ou que le prix de leur salaire montât au niveau de celui des ouvriers de l'agriculture. Mais alors celui des autres monterait de même à proportion, puisqu'ils sont plus recherchés : ainsi les premiers n'en seraient pas plus avancés ; ils seraient toujours au taux le plus bas possible. Telle est la loi de la nécessité.
Ce qui est vrai des ouvriers employés à l'agriculture, comparativement aux autres ouvriers, est vrai des entrepreneurs de culture, relativement aux [107] autres entrepreneurs. Leurs procédés sont très connus ; il ne faut qu'une intelligence médiocre pour les employer. Résultats d'une longue expérience, pendant la durée de laquelle il a été fait beaucoup d’essais et plus qu'on ne croit communément, ils sont en général assez bien adaptés aux localités ; et il y a peu de moyens de les améliorer assez pour augmenter sensiblement les bénéfices, quoi qu'en disent de temps en temps quelques spéculateurs téméraires, qui ne manquent guère de se ruiner. De là il arrive qu'à moins de circonstances extraordinaires [22], les profits des entrepreneurs de culture sont très faibles en proportion de leurs fonds, de leurs risques et de leurs peines. De plus, ces procédés très connus et très simples sont pourtant très embarrassants dans la pratique ; ils demandent beaucoup de soins et de temps, en sorte que dans cet état un homme ne peut jamais suffire à employer de grands fonds. Il ne pourrait pas, par exemple, diriger à la fois cinq à six fermes, quand [108] même il aurait cinq ou six fois trente ou quarante mille francs pour les monter ; et cependant ce n'est encore là qu'une somme assez modique, en comparaison de certains commerces. Ainsi cet homme qui ne peut pas faite de gros bénéfices, à proportion de ses fonds, est en même temps réduit à ne pouvoir faire travailler des fonds considérables. Il est donc impossible qu'il fasse jamais une vraie fortune. Voilà pourquoi il y a et il y aura toujours assez peu de capitaux employés à la culture, en comparaison de ceux qui existent dans la société. Prouvons cette vérité par des faits : ils nous montreront en même temps pourquoi les exploitations agricoles prennent souvent différentes formes, qui n'ont ou qui ne paraissent point avoir d'analogues dans les autres arts. C'est une chose intéressante, que je n'ai encore vue bien expliquée dans aucun de nos livres d'agronomie ou d'économie.
Vous ne voyez jamais, ou du moins fort rarement, un homme ayant des fonds, de l'activité et de l'envie d'augmenter sa fortune, employer son argent à acheter une étendue de terre pour se mettre à la cultiver et en faire son état toute sa vie. S'il l'achète, c'est pour la revendre, ou pour y trouver des ressources nécessaires à quelque autre entreprise, ou pour y prélever une coupe de bois ou pour quelque autre spéculation plus ou moins passagère ; en un mot, c'est une affaire de commerce et non pas d'agriculture. Au contraire, vous voyez souvent un homme ayant un bon fonds de terre, le vendre pour en employer le prix à faire quelque [109] entreprise, ou à se procurer quelque état lucratif : c'est qu'effectivement la culture n'est pas le chemin de la fortune.
Aussi presque tous les gens riches qui achètent des terres, s'ils sont dans les affaires, c'est parce qu'ils ont plus de fonds qu'ils n'en peuvent employer dans leurs spéculations, ou parce qu'ils veulent en mettre une partie à l'abri des événements ; s'ils remplissent des fonctions publiques ou s'ils ne font rien que jouir de leur aisance, c'est pour placer leurs fonds d'une manière solide et agréable. Mais ni les uns ni les autres ne se proposent de faire valoir eux-mêmes les terres qu'ils achètent ; soit plaisirs, soit affaires, ils ont toujours des choses qui les intéressent davantage. Ils espèrent bien n'y penser jamais que pour les louer à des entrepreneurs de culture, comme ils loueraient [23] l'argent qui a servi à les acheter, et en toucheraient l'intérêt, sans s'embarrasser [110] si son emploi a porté perte ou profit à l'entrepreneur qui le fait travailler.
Il est peut-être heureux que les gens riches achètent ainsi des terres pour les louer ; car l'agriculture étant une profession pénible et peu fructueuse, les gens qui s'y vouent ont en général peu de moyens, comme nous venons de l'observer. S'ils étaient obligés de commencer par acheter le terrain qu'ils veulent travailler, tous leurs fonds seraient absorbés ; il ne leur en resterait plus pour les autres avances nécessaires à la culture, et encore ils ne pourraient faire que de bien petites entreprises. Il leur est donc plus commode de trouver des terres à louer que d'être forcés de les acheter ; mais cela ne leur est plus commode que comme il est commode aux autres entrepreneurs et à eux-mêmes de trouver de l'argent à emprunter, quand ils en ont besoin pour donner plus d'étendue à leurs entreprises ; et cela ne leur est avantageux que sous les mêmes restrictions, c'est-à-dire que cela resserre leurs profits et rend leur existence plus précaire ; car il est bien connu qu'un négociant qui ne fait pas au moins la plus grande partie de ses affaires sur ses propres fonds est dans une situation bien dangereuse et a rarement un grand succès. Cependant telle est la position même de ce que nous appelons les gros fermiers.
En un mot, les propriétaires qui afferment sont des prêteurs, et rien de plus. Il est bien singulier qu'on ait presque toujours confondu et identifié leur intérêt avec celui de l'agriculture, auquel [111] est aussi étranger que l'est celui des prêteurs d'argent à toutes les entreprises que font ceux à qui ils prêtent. On ne peut assez s'étonner de voir que presque tous les hommes, et particulièrement les agronomes ; ne parlent des grands propriétaires de terre qu'avec un amour et un respect vraiment superstitieux ; qu'ils les regardent comme les colonnes de l'État, l'âme de la société [24], les pères nourriciers de l'agriculture, tandis que le plus souvent ils prodiguent l'horreur et le mépris aux prêteurs d'argent, qui font exactement le même service qu'eux[25]. Un gros bénéficier qui vient de louer sa ferme exorbitamment cher se croit un homme très habile, et, qui plus est, très utile ; il n'a pas le moindre doute sur sa scrupuleuse probité, et il ne s'aperçoit pas qu'il est exactement la même chose que l'usurier le plus âpre qu'il condamne sans hésitation et sans pitié. Peut-être même son fermier, qu'il ruine, ne voit pas cette parfaite similitude, tant les hommes sont dupes des mots. Il est vrai que tant qu'ils le sont, ils entendent mal les choses ; et réciproquement, tant qu'ils entendent mal [112] les choses dont ils parlent, ils ne comprennent qu'imparfaitement les mots dont ils se servent. Je ne puis m'empêcher de revenir souvent sur ce fait ; car c'est un grand inconvénient pour raisonner juste, ce à quoi il faut pourtant tâcher d'arriver en toute matière.
Quoi qu'il en soit, beaucoup de serres étant entre les mains des riches, il y a beaucoup de terres à louer ; et, comme nous l'avons dit, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir un très grand nombre d'entreprises d'agriculture, quoiqu'il n'y ait pas une masse de fonds proportionnée entre les mains des gens qui se consacrent à cet état. À la longue ces terres à louer s'arrangent et se distribuent de la manière la plus favorable aux convenances de ceux qui se destinent à les exploiter. De là naissent sur les grandes propriétés différentes espèces d'exploitations rurales, qui ne sont pas des effets du caprice ou du hasard, comme on le croit quand on n'y a pas réfléchi, mais qui ont leurs causes dans la nature des choses ; comme nous allons le voir.
Dans les pays fertiles, la fécondité de la terre ne tourne pas directement au profit de celui qui la cultive ; car le propriétaire ne manque pas d'en exiger un loyer d'autant plus fort qu'il la sait plus productive. Mais cette terre rendant beaucoup, la quantité qu'un homme en peut exploiter fournit une masse de productions considérable. Or, comme, toutes choses égales d'ailleurs, les bénéfices de tout entrepreneur sont toujours proportionnels à [113] l'étendue de sa fabrication, ici les bénéfices peuvent être assez forts pour attirer l'attention d'hommes ayant un certain degré d'aisance et de capacité. Ce n'est pas, encore une fois, la fécondité de la terre qui les a enrichis et éclairés ; mais c'est cette fécondité qui les attire et les empêche de porter leurs moyens dans d'autres spéculations. Ces hommes veulent tirer parti de tous leurs moyens ; ils ne s'accommoderaient pas d'une mince exploitation qui laisserait inutile une partie de leurs fonds et de leur activité personnelle, et ne leur permettrait que de trop faibles profits. Pour leur convenance, les grandes propriétés se distribuent donc en gros mas de terre dont la mesure commune est environ de trois cents à cinq cents arpents, avec une bonne habitation à portée. Ils ne demandent pas autre chose. Ils apportent là harnais, attelages, bestiaux, provisions suffisantes pour attendre. Ils ne craignent point d'être longtemps sans recevoir pour recevoir ensuite davantage. Ils font des essais, ils découvrent quelquefois quelques nouveaux moyens de productions ou de débit. En un mot, ils fabriquent et commercent, et tiennent leur rang parmi les entrepreneurs d'industrie. Ce sont là nos grosses fermes et notre grande culture. Malgré ces beaux noms, une grosse ferme est encore sans doute une assez petite manufacture ; mais si elle est à peu près le minimum de l'industrie fabricante en général, elle est le maximum de l'industrie agricole en particulier.
Quand le sol est moins fertile, cette industrie [114] ne peut pas s'élever jusqu'à ce point. Mettez dans une ferme le même nombre d'arpents, les productions sont insuffisantes ; mettez-y le double, un homme ne peut plus suffire à les exploiter par lui-même[26]. D'ailleurs, les frais et les risques augmentent dans une plus grande proportion ; l'entreprise n'en vaut plus la peine. Vous ne pouvez donc pas trouver la même espèce d'hommes pour s'en charger ; et s'il y a des capitaux un peu forts et de l'intelligence dans le pays, ces moyens se portent ailleurs. Qu'arrive-t-il ? Ces terres, qui déjà rendent moins, les propriétaires les partagent encore par plus petites portions, pour les mettre à portée de plus de gens, de gens qui ont peu de moyens, et qui souvent même ne font pas de ces locations leur seule occupation. C'est dans ces pays que vous voyez fréquemment de petites fermes, ou de simples maisons avec très peu de territoire, ou même des mas de terre sans aucun bâtiment d'exploitation. Cependant ces emplacements se louent ; ceux qui les prennent y amènent même les instruments et les animaux indispensables ; enfin ils en tirent parti par leurs propres forces ; mais il ne faut pas s'attendre qu'ils y déploient les mêmes moyens physiques et moraux que les gros fermiers dont nous [115] venons de parler. Ce sont en général de petits propriétaires ruraux qui se trouvent dans le pays, qui joignent ces exploitations à leurs occupations antérieures, et qui se contentent que le tout ensemble leur fournisse les moyens de vivre et d'élever leur famille, sans prétendre à augmenter beaucoup leur aisance, et sans en avoir la possibilité, à moins de hasards extraordinaires. C'est là ce que bien des écrivains appellent déjà la petite culture, par opposition à celle dont nous venons de parler. Cependant nous allons voir qu'il y a encore plusieurs cultures plus petites, ou, si l'on veut, plus misérables que celles-là. Observez toutefois, que cette espèce de petite culture, et même celle à bras, dont nous parlerons bientôt, rend ordinairement aux propriétaires de plus forts loyers que la grande, à proportion de l'étendue et de la qualité des terres, par l'effet de la concurrence de ceux qui se présentent en grand nombre pour les exploiter, parce qu'ils n'ont pas d'autre industrie à leur portée ; mais c'est précisément cette cherté des loyers qui fixe irrévocablement ces cultivateurs dans l'état de pénurie qui rend leur culture si médiocre.
Quand le sol est encore plus ingrat, ou quand par l'effet de différentes circonstances, les petits propriétaires ruraux sont rares, les grands propriétaires de terre n'ont pas cette ressource de former de petites fermes. Elles ne vaudraient pas la peine d'être exploitées, et il n'y aurait personne pour les leur demander. Ils prennent donc un autre [116] parti ; ils forment ce que l'on appelle communément des domaines ou des métairies, et ils y attachent fréquemment autant et plus de terres qu'il n'y en a dans les grandes fermes, surtout si l'on ne dédaigne pas de mettre en ligne de compte les terres vagues, qui ordinairement ne sont pas rares dans ces pays, et qui ne sont pas tout à fait sans utilité, puisqu'on s'en sert pour le pacage, ou même pour y faire de temps en temps quelques emblavures, afin de laisser reposer les champs plus habituellement cultivés. Ces métairies sont, comme l'on voit, assez grandes pour l'étendue et très petites pour le produit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peine à y prendre et peu de profit à y faire : aussi ne trouve-t-on pas d'hommes, ayant des fonds, qui veuillent venir les occuper et y amener des domestiques, un mobilier, des attelages et des troupeaux. On ne fait point tant de frais pour ne rien gagner. C'est tout au plus si ces métairies en vaudraient la peine, quand on les abandonnerait pour rien ; sans en demander aucun loyer. Le propriétaire est donc réduit à les garnir lui-même de bestiaux, d'ustensiles et de tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, et à y établir une famille de paysans qui n'ont que leurs bras, et avec lesquels il convient ordinairement, au lieu de leur donner des gages, de leur abandonner la moitié du produit pour le salaire de leurs peines. C'est de là qu'ils sont appelés métayers, travailleurs à moitié.
Si la terre est trop mauvaise, cette moitié des produits est manifestement insuffisante pour faire [117] vivre, même misérablement, le nombre d'hommes nécessaire pour la travailler ; ils s'endettent bientôt, et on est obligé de les renvoyer. Cependant on en trouve toujours pour les remplacer, parce qu'il y a toujours des malheureux qui ne savent que devenir. Ceux-là même vont ailleurs, où ils ont souvent le même sort. Je connais de ces métairies qui, de mémoire d'homme, n'ont jamais nourri leurs laboureurs, au moyen de leur moitié des fruits. Si la métairie est un peu meilleure, les métayers végètent tant bien que mal, ou même font quelques petites économies, mais jamais assez pour les élever à l'état de véritables entrepreneurs. Cependant, dans les temps et les cantons où le peuple des campagnes est un peu moins misérable, il se trouve dans cette classe d'hommes quelques individus qui ont de faibles avances, comme, par exemple, de quoi se nourrir pendant un an, en attendant la première récolte, et qui aiment mieux prendre une métairie à bail, moyennant un loyer fixe, que d'en partager les fruits ; ils espèrent, en travaillant beaucoup, y trouver un peu plus de profit. Ceux-là, en général, sont plus actif, et gagnent quelque chose si le local le permet, s'ils sont heureux, si leur famille n'est pas trop nombreuse, s'ils n'out pas donné de la terre un loyer trop fort, c'est-à-dire si beaucoup de circonstances invraisemblables se trouvent réunies en leur faveur. Cependant on ne peut pas les regarder comme de vrais fermiers, comme de véritables entrepreneurs, puisque c'est toujours le propriétaire qui fournit les harnais, les bestiaux, etc., [118] et qu'ils ne donnent que leur peine ; ainsi convient de les ranger encore dans la classe des métayers.
Cette masse de bestiaux que le propriétaire livre et confie au métayer s'appelle cheptel. Elle s'augmente tous les ans par la voie de la génération, dans les pays on l'on fait des élèves, et le métayer en partage le croît comme il partage les moissons. Mais il faut qu'en sortant il rende un cheptel d'une valeur égale à celui qu'il a reçu en entrant ; et comme il n'a rien pour en répondre, le propriétaire ou son agent exerce sur lui une active surveillance pour empêcher qu'il n'entame le fonds par des ventes trop nombreuses. Dans quelques endroits, le propriétaire ne voulant ou ne pouvant pas faire les fonds du cheptel, ce sont des marchands de bestiaux, des capitalistes étrangers qui le fournissent, qui surveillent de même le métayer, et qui lui prennent la moitié du croît pour l'intérêt de leurs fonds. Au reste, il est bien indifférent au métayer que ce soit eux ou le propriétaire. Dans tous les cas, on ne peut voir en lui qu'un misérable entrepreneur sans moyens, pressuré par deux prêteurs très chers, celui qui fournit la terre et celui qui fournit les bestiaux, lesquels lui enlèvent tous ses bénéfices, et ne lui laissent que sa subsistance très stricte et quelquefois insuffisante. C'est ce qui fait que cette manière de cultiver est aussi appelée à très juste titre petite culture, quoiqu'elle s'exerce sur d'assez grandes masses de propriété.
Il existe encore une autre espèce d'exploitation [119] à laquelle on donne aussi le nom de petite culture. C'est celle des petits propriétaires ruraux qui font valoir eux-mêmes leur bien. Presque toutes les nations de l'Europe moderne sont parties d'un ordre de choses tel, que la totalité du sol était la propriété exclusive d'un petit nombre de grands propriétaires, et tout le reste de la population travaillait uniquement pour eux comme domestiques, comme serfs, ou comme salariés. Mais par l'effet de l'industrie toujours agissante, et d'aliénations successives, il s'est formé dans presque tous les pays un plus ou moins grand nombre de ces petits propriétaires de terre, qui ont tous cela de commun, qu'ils vivent sur leur bien et que leur métier est de le cultiver. Cependant, sous le rapport de la culture, on a tort de les ranger tous dans une même classe ; car parmi eux il y en a qui ont une étendue de terrain assez considérable ; et c'est surtout dans les terres maigres qu'on les trouve, parce que ce sont celles que les riches ont aliénées de préférence, ne pouvant souvent en rien tirer par eux-mêmes. Ceux-là ne font pas sans doute les mêmes frais de culture que les riches fermiers des grosses fermes ; mais cependant ils labourent avec des animaux de trait de plus ou moins bonne qualité, et ils ont quelques troupeaux. En un mot, leur exploitation est absolument semblable à celles des petites fermes dont nous avons parlé ci-dessus[27]. [120] Il y en a d'autres, au contraire, qui n'ont qu'une très petite étendue de terrain, et qui la cultivent a bras, soit en légumes, soit en grains, soit en vignes. Celles-ci même exigent positivement cette manière de travailler, qui, comme on le voit, est bien différente de la précédente. D'ailleurs la plupart de ceux qui s'y livrent ne peuvent pas vivre uniquement du produit, de leur sol, et vont en journée une partie de l'année. Il faut assimiler à ces derniers tous ceux qui tiennent à loyer, des gens riches, de petites habitations avec quelques morceaux de terre, et qui sont connus sous les noms de louagers, de manouvriers, de cottagers, etc., etc. Leur industrie est absolument la même et leur existence toute semblable, à cela près, que le petit loyer qu'ils paient représente l'intérêt du capital que les autres possèdent. Voilà donc une troisième chose que l’on appelle encore petite culture, et qui en comprend deux très différentes entre elles.
Ce n'est pas tout ; il y a beaucoup d'écrivains qui appellent grande culture celle qui se fait avec les chevaux, et petite culture celle qui se fait avec [121] des bœufs, et qui croient que cette division répond exactement à celle des fermiers et des métayers. Cependant il s'en faut bien que ces deux désignations soient équivalentes ; car d'une part les manouvriers labourent avec leurs bras ; rien n'empêche que les fermiers des petites fermes et les petits propriétaires de la première des deux espèces que nous avons distinguées, ne labourent quelquefois avec des chevaux ou des mulets ; et ces cultures n'en méritent pas moins le nom de petites. De plus, il se peut très bien, si les convenances locales s'y trouvent, que de gros fermiers labourent avec des bœufs, et je crois que cela se voit dans plusieurs pays. D'une autre part, il est vrai qu'en général les métayers labourent avec des bœufs, 1° parce que, ce moyen étant moins dispendieux, la plupart des propriétaires le préfèrent ; 2° parce qu'ordinairement les mauvais pays, qui sont ceux où l'on voit des métayers, produisent du mauvais foin, peu ou point d'arôme, et se refusent aux prés artificiels ; parce que, ces métayers étant négligents et maladroits, il est difficile de leur confier des animaux aussi délicats que les chevaux. Mais ce n'est pas tout cela qui les constitue métayers et qui les différencie d'avec les fermiers. Leur caractère spécifique est d'être des misérables sans moyens, ne pouvant faire aucune avance. C'est là ce qui les réduit à n'être que métayers, et ce qui fait que leur culture est bien réellement petite, quoiqu'à raison de l'étendue de leurs métairies, qui occupent ordinairement de grands espaces, il y ait des gens qui l'appellent encore grande culture, par opposition à celle des petits fermiers et des petits manouvriers, ou par opposition seulement avec la culture à bras.
Enfin, pour que rien ne manque à la confusion des idées, il y a quelques auteurs anglomanes, comme Arthur Young, qui s'amusent à appeler petite culture celle de nos plus grosses fermes, parce qu'ils y voient des jachères, réservant exclusivement le nom de grande culture à celle où l'on suit le système d'assolement qui leur plaît, sans songer que la plus petite des cultures, celle à bras, est celle où l'on voit le plus souvent des terres qui ne se reposent jamais.
Ainsi, voilà de compte fait cinq ou six manières d'employer les mêmes mots, dont deux ou trois au moins séparent des choses absolument semblables, et en réunissent qui sont totalement différentes ; et on se sert continuellement de ces mots, sans dire dans quel sens on les prend. En procédant ainsi, ce serait un grand miracle si l'on s'entendait.
Je crois donc que si l'on veut écrire avec quelque précision sur l'agriculture, il faut bannir les expressions grande et petite culture, comme sujettes à trop d'équivoques, mais distinguer soigneusement quatre sortes de cultures qui ont des caractères bien tranchés, parce qu'elles sont essentiellement différentes, et auxquelles on peut rapporter toutes les cultures imaginables [28]. Ce sont, 1° les grosses fermes, [123] ou la culture des entrepreneurs riches et intelligents qui font largement toutes les avances nécessaires : on ne les voit que dans les pays qui en valent la peine ; 2° Les petites fermes, ou la culture des entrepreneurs qui labourent encore avec des animaux de trait qui leur appartiennent, mais dont les moyens de tous genres sont moins étendus : on les trouve en général dans les terres plus maigres. (Cette classe renferme les petits fermiers et les petits propriétaires de la première des deux classes que j'ai distinguées.) 3° Les métairies, ou la culture par métayers, qui labourent aussi avec des animaux de trait, mais qui ne leur appartiennent pas : c'est le propre des mauvais pays. 4° Les manouvriers, ou la culture à bras, tant celle des propriétaires que celle des locataires : on en trouve partout, et surtout dans les vignobles ; mais ils sont moins nombreux, en général, dans les pays très bons ou très mauvais : dans les premiers, parce que les gens riches ont gardé presque toutes les terres dans les autres, parce que la terre ne paierait pas leurs peines, et qu'ils aiment, mieux aller chercher à gagner [124] des journées ailleurs. Cette division me paraît plus nette que toutes les autres et plus instructive, parce qu'elle montre les causes des effets. Servons-nous en donc pour ce qui nous reste à dire.
Je crois avoir prouvé que les propriétaires de terre, quand ils ne la font pas valoir eux-mêmes, n'ont absolument rien de commun avec l'agriculture, ni avec les lois qui la régissent, ni avec les intérêts qui la dirigent ; qu'ils sont purement et uniquement des rentiers et des prêteurs d'une espèce particulière ; que par conséquent, ayant à rendre compte de la fabrication des produits, je devais les mettre à l'écart et ne considérer que les entrepreneurs de culture.
Alors j'ai montré qu'il est indispensable que les entrepreneurs des fabrications les plus nécessaires soient, de tous, ceux qui fassent les bénéfices les plus faibles à proportion de la quantité de leurs avances et de leurs productions ; et que de plus, les entreprises d'agriculture ont l'inconvénient particulier qu'un homme ne peut pas suffire à leur donner assez d'extension pour que la modicité des bénéfices soit compensée par la grande étendue des affaires.
J'ai fait voir ensuite, premièrement, que les pays les plus fertiles sont les seuls où les produits de la quantité de terre qu'un homme peut faire valoir soient assez considérables pour faire un sort passable à l'entrepreneur, que c'est par ces raisons que ces pays sont aussi les seuls où l'on voie des entrepreneurs de culture ayant des moyens et une [125] capacité suffisante, et qu'encore ils ne travaillent presque pas sur leurs propres fonds, mais sur ceux d'autrui, ce qui est toujours une position fâcheuse pour des fabricants : nous les appelons pourtant gros fermiers.
Secondement, que quand les terres sont moins bonnes, les bonifiées deviennent si minces, qu'on ne peut plus trouver que des entrepreneurs médiocre et insuffisants : ce sont les petits fermiers.
Troisièmement, que quand le sol est encore plus mauvais, les bénéfices devenant absolument nuls, on est réduit à n'avoir plus d'entrepreneurs ; car les métayers ne sont réellement que des salariés, puisqu'ils ne font aucune avance et ne fournissent que leur travail.
Quatrièmement, enfin que d'autres circonstances font que l'entreprise est si petite, que l'entrepreneur et l'ouvrier sont nécessairement une seule ee même personne, qui n'emploie pas d'autres machines que ses bras, et encore les emploie souvent ailleurs : tels sont les manouvriers. Il est difficile qu'une telle affaire tente un capitaliste.
Il y a cependant une exception à faire à ces vérités générales : c'est en faveur de la culture des productions très précieuses, telles que certaines drogues pour la teinture, ou les vins très estimés. Il peut y avoir là de grands profits à faire ; aussi voit-on quelquefois de gros capitalistes acheter les terrains propres à ces productions, les faire valoir eux-mêmes, en retenir tous les produits, et en faire d'immenses et heureuses spéculations. Mais cette [126] exception-là même confirme la règle ; car ces productions ont le mérite et le prix de la rareté ; ce sont de véritables marchandises de luxe. Ainsi ces spéculations, bien qu'agricoles, ne sont pas dans la classe des fabriques de choses de première nécessite.
Si ce tableau est exact, s'il est la représentation fidèle des faits, s'il est vrai que l'agriculture, même dans les circonstances les plus favorables, n'est et ne peut être qu'une profession pénible et peu fructueuse, il ne faut pas s'étonner qu'elle ne tienne pas le premier rang dans la société, et que les capitaux n'y affluent pas : on doit sentir qu'on ne les y destine et qu'on ne les y destinera jamais que lorsqu'on ne pourra pas ou qu'on ne saura pas les employer autrement. Le seul moyen de faire que beaucoup de capitaux se portent vers l'agriculture est donc de faire qu'ils surabondent ailleurs ; ce mal, si c'en est un, est incurable, et il est très utile de le connaître ; car on aura beau dire que l'agriculture est le premier des arts, que c'est la mère nourrice de l'homme, que c'est sa destination naturelle, que nous avons tort de ne pas l'honorer davantage, que l'empereur de la Chine trace un sillon tous les ans, et mille belles choses semblables, tout cela ne servira de rien et ne changera rien à la marche de la société. Ce sont de vaines déclamations qui ne méritent pas de nous occuper. Faisons seulement quelques courtes réflexions sur la première de ces phrases, parce qu'elle cache une erreur : la mettre au jour, c'est la réfuter.
Certainement l'agriculture est le premier des arts [127] sous le rapport de la nécessité ; car avant tout il faut manger pour vivre. Si l'on n'a voulu dire que cela, on a dit une chose incontestable, mais bien insignifiante.
Si l'on a entendu par ces paroles que l'agriculture est le seul art absolument nécessaire, l'assertion devient déjà très inexacte ; car nous avons encore d'autres besoins très pressants, outre celui de manger, comme, par exemple, celui d'être vêtus et logés ; et d'ailleurs la culture elle- même, pour prendre un peu de développement, a besoin du secours de bien d'autres arts, tels que celui de fondre les métaux et de façonner le bois ; et ses produits, pour être complètement appropriés à notre usage, exigent encore au moins celui du meunier et du boulanger : voilà donc beaucoup d'autres arts indispensables.
Enfin, si l'on a prétendu affirmer, comme bien des gens le veulent, que l'agriculture est le premier des arts sous le rapport de la richesse, le soi-disant axiome est complètement faux. D'abord, à l'égard des individus, nous avons vu que ceux qui se vouent à l'agriculture sont inévitablement du nombre de ceux qui font les moindres bénéfices, ainsi ils ne peuvent pas être des plus riches. Or, ce qui est vrai de chaque individu ne peut pas être faux des nations, qui ne sont que des collections d'individus. Si vous doutez de la force de cette démonstration, mettez d'un côté vingt mille hommes occupés à faire du blé poue le vendre, et de l'autre pareil nombre d'hommes occupés à faire des montres ; supposez que les uns [128] et les autres trouvent le débit de leur marchandise, et voyez quels seront les plus riches : c'est Genève et la Pologne.
Une des choses qui ont le plus contribué à faire méconnaître une vérité si manifeste, c'est encore une équivoque. On prend très fréquemment nos moyens de subsistance pour nos moyens d'existence. Ce sont deux choses très différentes. Nos moyens de subsistance sont sans contredit les matières alimentaires, et la quantité de celles qu'on peut se procurer dans un pays est la limite nécessaire du nombre d'hommes qui peuvent y vivre. Mais nos moyens d'existence sont la somme des profits que nous pouvons faire par notre travail et avec lesquels, nous pouvons nous procurer et subsistances et autres jouissances. Le Polonais a beau faire venir beaucoup de blé, l'excédent de ce qu'il en consomme, qu'il est obligé de livrer à vil prix aux étrangers, fournit à peine à ses autres besoins : n'en vit pas mieux et n'en multiplie pas davantage. Le Genevois au contraire, qui ne recueille pas une pomme de terre, mais qui fait de gros profits sur les montres qu'il fabrique, a de quoi acheter les grains et toutes les autres choses qui lui sont nécessaires, de quoi élever des enfants, et encore de, quoi économiser. Le premier, malgré la grande quantité des moyens de subsistance, a très peu de moyens d'existence ; le second, ayant de grands moyens d'existence, se procure abondamment les subsistances qui lui manquent et tout ce qu'il lui faut d’ailleurs. Il est donc vrai que ce sont là deux [129] choses que l'on a grand tort de ne pas distinguer soigneusement. Cette faute se rencontre dans beaucoup d'ouvrages, excellents d'ailleurs, et nommément dans celui de M. Malthus, sur la population, où elle jette du louche sur quelques explications très précieuses à tous autres égards : c'est donc un point qu'il était bon d'éclaircir.
Que l'on ne m'accuse pas néanmoins de méconnaître l'importance de l'agriculture, et de vouloir qu'on la néglige. D'abord je sais fort bien que la richesse, quoique utile en elle-même, n'est pas la seule chose à désirer, ni pour les particuliers ni pour les sociétés, et qu'une nation, malgré de grands moyens, n'a qu'une existence précaire si elle dépend des étrangers pour sa subsistance ; je sais de plus que, quoique chacune des entreprises de culture ne puisse être regardée que comme une très petite manufacture, comme dans un grand pays leur nombre est immense en comparaison de celui de toutes ces autres fabriques, elle n'en compose pas moins une très grande portion de l'industrie et de la richesse nationales. Les grands détails dans lesquels je viens d'entrer pour démêler le jeu de tous les ressorts de l'industrie agricole prouvent assez tout l'intérêt que j'y attache ; et certainement, bien faire voir qu'une profession est en même temps très nécessaire et très ingrate, c’est la meilleure manière de prouver qu'il faut la favoriser. Mais nous n'en sommes pas encore là ; il ne s'agit pour le moment que de constater les faits, nous en tirerons ensuite des conséquences ; et si la première de [130] ces opérations a été bien faite, la seconde ne sera pas difficile. Bornons-nous donc à ces généralités sur l'industrie fabricante, et parlons de l'industrie commerçante.
CHAPITRE V.↩
Du Changement de lieu, ou de l'Industrie commerçante.
L'homme isolé fabriquerait jusqu'à un certain point, car il travaillerait pour lui-même ; mais il ne commercerait point, car avec qui aurait-il commerce ? Commerce et société sont une seule et même chose : aussi nous avons vu dans le chapitre premier que la société, dès son origine, n'est essentiellement qu'un commerce continuel, qu'une série perpétuelle d'échanges de tous genres, dont nous avons indiqué rapidement les principaux avantages et les prodigieux effets. Il y a donc commerce bien longtemps avant qu'il y ait des commerçants proprement dits. Ceux-ci sont des agents qui le facilitent, qui le servent, mais qui ne le constituent pas. On peut même dire que les échanges qu'ils font en leur qualité de commerçants ne sont que des échanges préparatoires ; car l'échange utile n'est consommé, il n'a pleinement atteint son but, que quand la marchandise est passée de celui qui l'a fabriquée à celui qui en a besoin, soit pour la consommer, soit [131] pour en faire le sujet d'une nouvelle fabrication ; et celui-là encore doit être regardé dans ce moment comme un consommateur. Le commerçant proprement dit s'interpose entre ces deux hommes (le producteur et le consommateur), mais ce n'est point pour leur nuire. Il n'est ni parasite, ni incommode ; au contraire, il facilite les relations, le commerce, la société, car encore une fois tout cela est une seule et même chose entre ce producteur et ce consommateur. Il est donc utile et par conséquent producteur aussi ; car nous avons vu, chapitre second, que quiconque est utile est producteur, et qu'il n'y a pas d'autre manière de l'être. Il s'agit actuellement de faire voir comment le commerçant est producteur ; mais auparavant donnons encore quelques explications préparatoires, qui nous serviront par la suite. Nous n'avons fait voir, dans le chapitre premier, que les avantages généraux de l'échange et ceux du commerce d'homme à homme ; rendons sensibles ici ceux du commerce de canton à canton et de pays à pays, et, pour cet effet, prenons pour exemple la France, parce que c'est une contrée très vaste et très connue.
Supposons la nation française seule dans le monde, ou environnée de déserts impossibles à traverser. Elle a des portions de son territoire très fertiles en grains ; d'autres plus humides, qui ne sont bonnes qu'en pâturages ; d'autres formées de coteaux arides, qui ne sont propres qu'à la culture des vignes ; d'autres enfin plus montagneuses, qui ne peuvent guère produire que des bois. [132] Si chacun de ces pays est réduit à lui-même, qu'arrive-t-il ? Il est clair que dans le pays à blé il peut encore subsister un peuple assez nombreux, parce que du moins il a le moyen de satisfaire largement au premier de tous les besoins, la nourriture. Cependant ce besoin n'est pas le seul ; il faut le vêtement, le couvert, etc. Ce peuple sera donc obligé de sacrifier en bois, en pâturages, en mauvaises vignes, beaucoup de ces bonnes terres, dont une bien moindre quantité aurait suffi pour lui procurer, par voie d'échange, ce qui lui manque, et dont le reste aurait encore nourri beaucoup d'autres hommes, ou servi à mieux approvisionner ceux qui y existent. Ainsi ce peuple ne sera déjà pas si nombreux que s'il avait eu du commerce, et pourtant il manquera de bien des choses. Cela est encore bien plus vrai de celui qui habite les coteaux propres aux vignes. Celui-là, si même il en a l'industrie, ne fera du vin que pour son usage, n'ayant où le vendre ; il s'épuisera dans des travaux ingrats pour faire produire à ses côtes arides quelques mauvais grains, ne sachant où en acheter ; il manquera de tout le reste. Sa population, quoique encore agricole, sera misérable et rare. Dans le pays de marais et de prairies, trop humide pour le blé, trop froid pour le riz, ce sera bien pis ; il faudrait nécessairement renoncer à cultiver, se réduire à être pasteur, et même ne nourrir d'animaux qu'autant qu'on en peut manger. Il est vrai que dans cette position, ayant des bêtes de somme, de trait et de selle pour se rendre redoutable, on se fera [133] bientôt brigand comme tous les peuples pasteurs, mais ce sera un mal de plus. Pour le pays de bois, il n'y a de moyen d'y vivre que la chasse, à mesure et autant qu'on y trouve des animaux sauvages, sans songer seulement à amasser leurs peaux ; car qu'en ferait-on ? Voilà pourtant l'état de la France, si vous supprimez toute correspondance entre ses parties. Une moitié sera sauvage, et l'autre mal pourvue.
Supposons, au contraire, cette correspondance active et facile, quoique toujours sans relations extérieures. Alors la production propre à chaque canton ne sera plus arrêtée par le défaut de débouchés et par la nécessite de se livrer, en dépit des localités, à des travaux très ingrats, mais nécessaires, faute d'échanges, pour pourvoir par soi-même, tant bien que mal, à tous ses besoins, ou du moins aux plus pressants. Le pays de bonne terre produira du blé autant que possible, et en enverra au pays de vignobles, qui produira des vins tout autant qu'il trouvera à en vendre. Tous deux approvisionneront le pays de pâturages, où les animaux se multiplieront à proportion du débit, et les homes à proportion des moyens d'existence que leur procurera ce débit ; et ces trois pays réunis alimenteront, jusque dans les montagnes les plus âpres, des habitants industrieux qui leur fourniront des bois et des métaux. On multipliera les lins et les chanvres dans le nord, pour envoyer des toiles dans le midi, qui multipliera ses soieries et ses huiles pour les payer. Les moindres avantages locaux [134] seront mis à profit. Une commune tout en cailloux fournira des pierres à fusil à toutes les autres qui n'en ont pas, et ses habitants vivront du produit de cette fourniture. Une autre tout en rochers enverra des meules de moulins dans plusieurs provinces. Un petit pays de sable va produire de la garance pour toutes les teintures. Quelques champs d'une certaine argile donneront de la terre pour toutes les poteries. Les habitants des côtes ne mettront point de bornes à leurs pêches, pouvant envoyer dans l'intérieur leurs poissons salés ; il en sera de même du sel marin, des alkalis des plantes maritimes, des gommes des arbres résineux. On verra naître partout de nouvelles industries, non seulement par l'échange des marchandises, mais encore par la communication des lumières ; car si nul pays ne produit tout, nul n'invente tout. Quand on communique, ce qui est connu dans un endroit l'est partout ; il est bien plus tôt fait d'apprendre ou même de perfectionner que d'inventer. D'ailleurs c'est le commerce lui-même qui inspire l'envie d'inventer ; c'est même sa grande étendue qui seule rend possibles bien des industries. Cependant ces nouveaux arts occupent une foule d'hommes qui ne vivent de leur travail que parce que celui de leurs voisins, étant devenu plus fructueux, peut suffire à les payer. Voilà donc cette même France tout à l'heure si indigente et si déserte, remplie d'une population nombreuse et bien approvisionnée. Tout cela est uniquement dû au meilleur emploi des avantages de chaque localité et des facultés de chaque [135] individu, sans qu'il soit nécessaire que la nation française ait fait le moindre profit aux dépens d'aucune autre nation, sans même que cela soit possible, puisque dans l'hypothèse elle est supposée seule au monde. Nous verrons ailleurs ce que l'on doit penser de ces prétendus profits qu'un peuple fait aux dépens d'un autre, et comment on doit les apprécier ; mais nous pouvons affirmer d'avance qu'ils sont illusoires ou bien faibles, et que la véritable utilité du commerce extérieur, celle en comparaison de laquelle toutes les autres ne sont rien, c'est d'établir entre les différentes nations les mêmes relations que le commerce intérieur établit entre les différentes parties de la même, de les constituer pour ainsi dire en état de société entre elles, d'agrandir ainsi l'étendue du marché pour toutes, et par là d'accroître encore les avantages du commerce intérieur de chacune.
Ce commerce sans doute peut exister et existe jusqu'à un certain point, avant qu'il y ait des commerçants proprement dits, c'est-à-dire des hommes faisant leur état unique de servir le commerce ; mais il ne saurait prendre un grand développement sans leur secours. Dès qu'un homme a fabriqué ou possède quelque chose d'utile, il peut à la rigueur l'échanger lui-même, et sans intermédiaire, contre une autre chose utile que possède un autre homme ; mais cela n'est souvent ni aisé ni commode. Cet autre homme peut n'avoir pas envie de vendre quand on a envie d'acheter ; il peut ne vouloir [136] vendre que beaucoup à la fois ; il peut ne pas se soucier de ce qu'on a à lui offrir en échange ; il peut être très éloigné ; on peut même ignorer qu'il a ce que l'on désire. Enfin, dans le cours de la vie, on a besoin d'une multitude presque infinie de choses différentes. S'il fallait tirer directement chacune d'elles de son producteur immédiat, on passerait tout son temps en courses et même en voyages lointains, dont les inconvénients surpasseraient de beaucoup l'utilité des choses qui en seraient l'objet ; il faudrait donc s'en passer.
Le commerçant vient ; il tire de tous les pays les choses qui y surabondent, et il y porte celles qui y manquent ; il est toujours prêt à acheter quand on veut vendre, et à vendre quand on veut acheter ; il garde ses marchandises jusqu'à l'instant du besoin ; il les détaille s'il le faut ; enfin il en débarrasse le producteur qui en est encombré ; il les met à la portée du consommateur qui les désire, et toutes les relations sont devenues faciles et commodes. Qu'a-t-il fait cependant ? En sa qualité de commerçant, il n'a opéré aucun changement de forme ; mais il a opéré des changements de lieu, et une grande utilité est produite. En effet, puisque les valeurs sont la mesure du degré d'utilité (voyez le chap. III), il est manifeste qu'une chose portée de l'endroit où elle est à vil prix, et arrivée dans celui où elle se vend cher, a acquis par le transport un degré d'utilité qu'elle n'avait pas.
Je sais que cette explication est si simple, qu'elle [137] semble niaise, et que tout ceci paraît écrit pour des enfants, car des hommes ne sont pas supposés ignorer des faits si communs et des vérités si triviales Cependant ces vérités triviales en démontrent une autre très contestée : c'est que quiconque produit de l'utilité est producteur, et que le commerçant l'est tout comme ceux à qui on a voulu donner exclusivement ce titre. Maintenant, cherchons quelle est pour lui la récompense de l'utilité qu'il a produite.
Si nous examinons l'industrie commerçante, elle nous offre les mêmes aspects que l'industrie fabricante. Là aussi il y a théorie, application et exécution ; et par conséquent trois espèces de travailleurs, le savant, l'entrepreneur et l'ouvrier. Là encore il est vrai que ceux dont le travail s'applique aux choses les plus nécessaires sont inévitablement les plus mal récompensés ; mais ce n'est pas comme dans les entreprises d'agriculture : l'entrepreneur peut augmenter indéfiniment ses spéculations autant que le permet le débit, et compenser ainsi la modicité des bénéfices par l'étendue des affaires. De là vient le proverbe qu'il n'y a point de petit commerce dans une grande ville. Le chef d'une entreprise de commerce salarie aussi tous ceux qu'il emploie ; c'est lui qui fait toutes les avances, et il est récompensé de ses peines, de ses frais et de ses risques, par l'augmentation de valeur que son travail a donnée aux choses, augmentation qui fait que ses ventes surpassent ses achats ; il est vrai que, comme l'entrepreneur de fabrique, il perd au lieu de gagner, si, s'étant trompé dans [138] ses spéculations, son travail est infructueux ; comme lui encore, il travaille tantôt sur ses propres fonds, tantôt sur ceux qu'il loue ; enfin la parité est complète : c'est ce qui me dispense d'entrer dans plus de détails. Il ne s'agit pas encore de discuter les questions délicates, ni d'apprécier le mérite de certaines combinaisons compliquées. Il suffit jusqu'à présent de voir d'un coup d'œil général la marche de la société et le train des affaires. Si nous nous en sommes fait une idée juste, nous verrons bientôt que des choses que l'on croit très savantes ne sont qu'embrouillées par les préjugés et le charlatanisme, et que le plus gros bon sens suffit souvent pour résoudre des difficultés qui paraissent bien embarrassantes quand on n'est pas remonté aux principes. Pour achever de poser nos bases, disons un mot de la monnaie.
CHAPITRE VI.↩
De la Monnaie.
J’ai déjà parlé du développement de l'industrie et même de celui du commerce, et je n'ai pas dit un mot de la monnaie. C'est qu'en effet elle n'est pas plus indispensable au commerce que les commerçants ; ils en sont les agents, elle en est l'instrument ; mais il peut exister et il existe jusqu'à un certain point avant et sans ces deux secours, quoiqu'ils lui soient très utiles.
[139]
Nous avons vu dans le paragraphe III de l'Introduction, et dans le chapitre III, qui traite des valeurs, que toutes les choses utiles ont une valeur déterminée ; elles en ont même deux, mais dans ce moment je ne parle que de la valeur conventionnelle ou du prix vénal. Toutes ces valeurs se mesurent les unes par les autres. Quand, pour se procurer une chose quelconque, on est disposé à donner une quantité double d'une autre chose quelle qu'elle soit, il est évident que la première est deux fois plus prisée que la seconde. Ainsi le rapport de leur valeur est fixé, et l'on peut échanger et négocier ces deux choses sur ce pied, sans avoir recours à une matière intermédiaire. On peut donner du foin pour du blé, du blé pour du bois, un charroi de terre à pots ou à briques pour quelques assiettes ou quelques tuiles, et ainsi de suite. Mais il est évident que cela est très incommode, que cela entraîne des déplacements si pénibles, qu'ils rendent impossibles la plupart des affaires ; que beaucoup de ces marchandises ne sont pas divisibles de manière à bien correspondre avec les autres ; que beaucoup d'entre elles ne sauraient se conserver indéfiniment jusqu'à l'instant où on en peut trouver l'emploi, et que, les eût-on conservées, on est encore bien embarrassé s'il se trouve, comme cela doit arriver continuellement, que celle que l'on a n'est pas précisément celle qui convient à celui qui possède celle que l'on désire, ou s'il n'en veut qu'une très petite quantité quand vous avez besoin d'une très grande de la sienne. Au milieu de toutes ces difficultés, le commerce [140] doit donc être extrêmement languissant, et l'industrie aussi par conséquent. Il est bon de s'appesantir un peu sur ces inconvénients, car nous sommes toujours peu frappés de ceux que nous n'avons jamais éprouvés ; nous ne les imaginons seulement pas. N’ayant jamais vu un tel ordre de choses, nous n'en avons aucune idée vive ; il nous paraît presque chimérique. Cependant il a existé, et vraisemblablement très longtemps, avant celui dont nous nous plaignons encore, et même avec raison, quoiqu'il soit beaucoup meilleur.
Heureusement, parmi toutes les choses utiles, il y en a une qui se distingue, ce sont les métaux précieux. Ils sont une marchandise comme une autre, en ce qu'ils ont la valeur nécessaire qui résulte du travail qu'a coûté leur extraction et leur transport, et la valeur vénale que leur donne la possibilité d'en faire des vases et des ornements ou divers meubles et divers instruments ; mais ils ont de plus la propriété d'être facilement affinés, de manière que l’on sait très exactement la quantité que l'on en a, et que toutes leurs parties sont similaires, ce qui les rend très comparables et ne laisse pas la crainte qu'elles soient de différentes qualités en outre ils sont inaltérables et, susceptibles d'être divisés en portions aussi grandes et aussi petites que l'on veut ; enfin ils sont faciles à transporter. Ces qualités doivent faire que tout le monde préfère ces métaux à toute autre chose utile, toutes les fois que l'on ne veut que conserver la valeur que l'on possède pendant un temps indéfini, jusqu'au moment [141] du besoin ; car toute personne qui a une marchandise sujette à s'avarier, dont la qualité peut être incertaine ou variable, qui est d'un grand encombrement, ou peu susceptible d'être détaillée dans l'occasion, est naturellement disposée à l'échanger contre une autre qui n'a aucun de ces inconvénients. De cette disposition générale il doit nécessairement résulter que cette marchandise qui a tant d'avantages pour cela devient petit à petit la mesure commune de toutes les autres. C'est aussi ce qui est arrivé partout. Cela paraît singulier quand on ne sait pas pourquoi, et inévitable quand on en voit les causes. Il en est de même dans tous les genres. Dès qu'une chose est, soyez sûr qu'il y a des raisons victorieuses pour qu'elle soit, ce qui ne veut pourtant pas dire qu'on ne puisse pas par la suite découvrir des raisons plus fortes pour qu'elle ne soit plus. Mais ici ce n'est pas le cas. Les métaux précieux, une fois devenus mesure commune et générale, type universel de tous les échanges, acquièrent encore un avantage qu'ils n'avaient pas auparavant ; c’est d'abord d'avoir une valeur vénale plus forte, puisqu'ils acquièrent un nouveau genre d'utilité (mais cela ne ferait rien pour l'objet qui nous occupe) ; c'est ensuite que leur valeur vénale, leur prix, devient plus constant que celui d'aucune autre marchandise. Etant constamment demandés en tous lieux et en toute occasion, ils ne sont pas sujets aux variations qu'éprouve une chose tantôt recherchée, tantôt repoussée. D'ailleurs ils ne dépendent point de l'inconstance des saisons, et très-peu de [142] celle des événements ; leur quantité totale ne change que par des causes lentes et rares ; ils sont donc chaque jour plus confirmés dans leur possession d'être la mesure commune des échanges. Cependant ils ne sont pas encore monnaie ; on ne les transmet encore qu'en barres ou en lingots, et à chaque changement de main il faut les essayer et les peser : c'est un embarras.
Quand la société est un peu plus perfectionnée, l'autorité compétente intervient pour donner à ce moyen d'échanges un degré de commodité de plus. Elle partage ces métaux en portions adaptées aux usages les plus ordinaires ; elle leur imprime une marque qui en constate le poids total, et dans ce poids la quantité de matière étrangère qu'il a été convenable d'y laisser pour la facilité de la fabrication, mais qu'il ne faut pas compter pour valeur réelle. C'est ce que l'on appelle le poids et le titre. Dans cet état les métaux sont devenus complètement monnaie, et l'autorité a fait un bien en leur donnant ce caractère. Nous verrons par, la suite qu'elle n'a fait que trop souvent du mal par d'autres actes de sa puissance dans ce genre.
Cette courte explication de la nature de la monnaie nous montre d'abord qu'il ne peut y avoir qu'un métal qui soit réellement monnaie, c'est-à-dire à la valeur duquel on rapporte toutes les autres valeurs ; car dans tout calcul il ne peut y avoir qu'une espèce d'unité qui serve de base. Ce, métal, c'est l'argent, parce que c'est celui qui se prête le mieux au plus grand nombre des subdivisions [143] dont on a besoin dans les échanges : l'or est trop rare, les autres métaux sont trop communs.
L'or cependant vient secourir l'argent pour le paiement des sommes les plus fortes, comme le feraient les pierres précieuses si elles étaient divisibles sans perdre de leur valeur. Mais ce n'est que subsidiairement qu'on s'en sert, ce n'est qu'en rapportant la valeur de l'or à celle de l'argent. La proportion, en Europe, est à peu près de quinze ou seize à un ; mais elle varie comme toutes les autres proportions de valeurs, suivant les demandes. À la Chine, elle est ordinairement de douze ou treize à un, tandis que dans l'Hindoustan, au contraire, elle est, dit-on, environ de dix- huit ou vingt à un ; ce qui fait qu'il y a du profit à porter de l'argent à la Chine, parce que pour douze onces d'argent vous avez une onze d'or, qui, de retour en Europe, vaut quinze onces d'argent, et ainsi vous en avez gagné trois ; et au contraire, il y a profit à porter de l'or dans l'Hindoustan, parce que pour une once d'or vous y avez dix-huit d'argent, et ainsi vous avez encore gagné trois onces de ce dernier métal. Les autorités politiques peuvent bien cependant frapper de la monnaie d'or, et en fixer la proportion avec celle de l'argent, c'est-à-dire statuer que toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires, on recevra indifféremment une once d'or on quinze ou seize onces d'argent. C'est comme elles établissent que dans les actions judiciaires, quand il y a des sommes qui doivent porter un intérêt qui n'a pas pu être stipulé par les parties, cet [144] intérêt sera de tant pour cent. Mais elles ne peuvent ou du moins elles ne doivent pas plus empêcher les particuliers de régler entre eux la quantité d'or qu'ils veulent donner ou recevoir pour une certaine quantité d'argent, que de déterminer de gré à gré le taux de l'intérêt de la somme qu'ils prêtent ou qu'ils empruntent. Aussi c'est ainsi que ces deux choses se font toujours dans les grandes opérations du commerce, même en dépit de toute loi contraire, parce que sans cela les affaires ne se feraient pas.
Quant à la monnaie de cuivre ou de billon [29], partout où il y en a une d'argent, ce n'est point une véritable monnaie, c'en est une fausse. Si elle contenait la quantité de cuivre suffisante pour qu'elle valût réellement la quantité d'argent à laquelle on l'a fait correspondre, elle serait cinq on six fois plus pesante qu'elle n'est, ce qui la rendrait fort incommode. Encore cette proportion varierait-elle comme celle de l'or, et plus fréquemment, à cause des usages multipliés auxquels on emploie le cuivre. Ainsi la monnaie de cuivre ne vaut que par la quantité d'argent qu'on est convenu de donner en troc. Aussi elle ne doit servir que pour faciliter de petits appoints dans lesquels cette exagération de valeur est de nulle importance, parce que le moment d'après on la donne sur le même [145] pied en lui faisant remplir la même fonction. Mais quand on autorise, comme cela est arrivé quelquefois, à payer de grosses sommes en monnaie de cuivre, c'est fortement léser celui qui la reçoit, parce qu'il ne peut jamais trouver de gré à gré à réaliser ces grandes masses en argent pour leur valeur nominale, mais seulement pour leur valeur réelle, qui est cinq ou six fois moindre. Concluons donc qu'il ne peut jamais y avoir qu'un seul métal qui soit le terme commun de comparaison auquel on rapporte toutes les valeurs, et que ce métal c'est l'argent.
Puisque l’utilité de l'empreinte qui fait d'un morceau de métal une pièce de monnaie est d'en constater le titre et le poids, on voit encore qu'il était fort superflu d'inventer, pour faire nos comptes, des monnaies imaginaires, telles que livres, sous et deniers, et autres de ce genre, que pourtant on appelle monnaies de compte [30]. Il aurait été beaucoup plus clair de dire une pièce d'une once, d'une demi-once, d'un gros, d'un grain d'argent, qu'une pièce de six livres, de trois livres, de douze sous ou de quinze sous. On aurait toujours su de quelle quantité d'argent on voulait parler. Cette idée se présente si naturellement, que je suis porté à croire qu'elle aurait prévalu si toutes les monnaies eussent été au même titre. [146] Mais comme leur degré de pureté a toujours été très différent, on a peut-être voulu se ménager un moyen d'exprimer que telle once d'argent vaut un sixième de plus que telle autre, en disant que l'une vaut six livres et l'autre cinq. Peut-être aussi l'expression dont je parle a-t-elle été rejetée précisément parce qu'elle était trop claire ; car ceux qui se sont mêlés de ces matières ont toujours voulu qu'on n'y entendît rien, et ils ont eu leurs bonnes raisons pour cela : nous en verrons bien des preuves.
Quoi qu'il en soit, une fois que ces dénominations arbitraires sont admises et qu'on s'en est servi dans toutes les obligations contractées, il faut bien se garder d'y rien changer ; car quand j'ai reçu trente mille livres et que j'ai promis de les rendre dans tel temps, si dans l'intervalle le gouvernement vient à dire que la quantité d'argent qu'on appelait trois livres s'appellera six, ou, ce qui est la même chose, s'il fait des écus de six livres qui ne contiennent pas plus d'argent que n'en contenaient les écus de trois, moi qui paie avec ces nouveaux écus, je ne rends réellement que la moitié de l'argent que j'ai reçu. C'est aussi la facilité que le législateur obéré veut se donner vis-à-vis de ses nombreux créanciers, et c'est pour la voiler et la déguiser qu'il me la donne vis-à-vis des miens et vis-à-vis de lui-même, si par hasard je suis son débiteur. Il est vrai qu'il sait bien qu'il n'en a guère ; mais cela a un air de généralité et de réciprocité qui ressemble à l'équité et qui éblouit. Malgré ces [147] prestiges, tranchons le mot, c'est là permettre à tout le monde de voler pour pouvoir voler soi-même ; et c'est, il faut l'avouer, ce que presque tous les gouvernements ont fait si souvent, avec tant d'audace et si peu de mesure, que, par exemple, ce que l’on appelle actuellement en France une livre, et qui était réellement autrefois une livre d'argent de douze onces, en est à peine la quatre-vingt-unième partie aujourd'hui que le marc vaut cinquante-quatre livres. Donc à différentes fois on a volé les quatre-vingts quatre-vingt-unièmes de ce que l'on devait ; et s'il existe encore une rente perpétuelle d'une livre constituée dans ces temps anciens pour vingt livres reçues, on l'acquitte aujourd'hui avec la quatre-vingt-unième partie de ce qu'on a promis originairement et de ce qu'on doit loyalement. Si actuellement il ne subsiste plus guère de ces rentes, c'est qu'elles ont toutes été successivement remboursées de la même manière qu'on en sert aujourd'hui les intérêts. Ce qu'il y a de plus affreux dans une telle iniquité légale, c'est que ce n'est pas seulement permettre l'injustice, c'est l'ordonner, c'est y contraindre ; car à moins de circonstances rares, le particulier le plus probe est obligé de profiter de l'odieuse faculté qu'on lui donne ; puisque, tout le monde en usant vis-à-vis de lui, il serait bientôt ruiné et même insolvable. Ainsi il n'a que le choix entre deux banqueroutes, et il doit se décider pour celle que la loi autorise.
Nous ne suivrons pas plus loin les effets moraux de pareilles lois ; ce n'est pas ici le lieu, et d'ailleurs [148] ils sont assez sensibles. Quant à leurs effets économiques, les voici. Premièrement, tous les créanciers que l'on rembourse sont subitement appauvris, et tous les débiteurs, y compris le gouvernement, sont enrichis de leurs pertes. Ainsi c'est une levée extraordinaire d'argent sur une seule classe de citoyens, laquelle est même très inégalement répartie entre eux, et est augmentée encore inutilement de toute la portion dont profitent d'autres citoyens qui se trouvent dans une position semblable à celle du gouvernement, de qui les intérêts apparents sont le motif de la mesure.
Secondement, tous les créanciers à qui on ne rembourse pas actuellement leurs capitaux sont appauvris de même, parce qu'on leur en dessert la rente avec la même valeur nominale, mais avec une valeur réelle moindre. Ici la thèse change pour le gouvernement. Il est du nombre de ces créanciers frustrés pour tout ce qu'il reçoit d'impôts annuels ; car on les lui paie avec la même quantité de monnaie, mais avec moitié moins d'argent effectif, s'il a diminué de moitié la valeur de cette monnaie. À la vérité, comme il a la force en main, il double bientôt les impôts existants, et par là il se croit au pair, et avoir en pur gain ce qu'il a évité de payer.
Cependant il n'en est pas ainsi ; car le troisième effet de cette opération est de faire craindre qu'à tout moment elle ne recommence, et qu'on ne puisse plus s'assurer sur la foi jurée ; de jeter par là de l'inquiétude dans tentes les relations ; et par suite, de [149] diminuer considérablement toutes les spéculations industrielles et commerciales. Ainsi le public souffre, la richesse nationale est diminuée, et une grande partie des impôts tombe en non-valeur ; car le travail qui les payait est diminué, et qui ne gagne rien ne peut rien donner. De plus, le gouvernement a toujours besoin qu'on lui fasse beaucoup de fournitures et d'avances qu'il ne saurait exiger de force. Les prix en sont doublés, si la valeur de la monnaie est diminuée de moitié. Cela est tout simple. Mais en outre, tout est devenu cher et rare ; et de plus, pour se déterminer à traiter avec lui, on lui fait payer encore la crainte qu'il ne manque de foi une seconde fois. Ainsi ses dépenses sont augmentées dans une plus grande proportion que ses revenus, même après qu'il a doublé les impôts.
En dernier résultat, il a fait un vol qui a causé beaucoup plus de mal qu'il ne lui a produit de bien. C'est pourtant là ce qui a été longtemps regardé très généralement comme une savante opération de finances. C'est bien ici le lieu d'admirer comme les hommes sont dupes des mots. À la honte de l'esprit humain, il eût peut-être suffi, pour les garantir d'une telle illusion, que les pièces de monnaie eussent été, comme nous l'avons dit, désignées seulement par leur poids, au lieu de porter des noms insignifiants. Il est vraisemblable qu'alors on eût vu qu'une demi-once ne peut jamais devenir une once.
Cependant, en vérité, cela devient douteux, quand on voit des prestiges aussi grossiers et plus funestes que ceux-ci réussir encore auprès de bien [150] des gens, ou du moins n'être qu'imparfaitement démêlés. Cette réflexion nous amène directement aux papiers-monnaie dont l'Europe est inondée au moment où nous parlons (en 1810), et auxquels on a toujours recours, malgré l'expérience constante de leurs effets inévitables.
Pour défendre une injustice, il faut toujours s'appuyer sur une erreur : c'est une règle universelle. Ceux qui ont voulu frustrer leurs créanciers d'une partie de l'argent qu'ils leur devaient, en diminuant la quantité d'argent contenue dans les monnaies avec lesquelles ils comptaient les payer, ont tous prétendu que l'argent n'a aucune valeur par lui-même, vu qu'on ne le boit ni ne le mange ; qu'il n'est que le signe des valeurs réelles ; que c'est l'empreinte du monarque qui lui donne cette qualité de signe, et qu'ainsi il est indifférent qu'elle soit appliquée sur une plus ou moins grande quantité de métal. On aurait pu leur répondre : Si l’argent n'a aucune valeur, pourquoi donc retenez-vous celui que vous devez ? vous n'en avez que faire. Donnez-le nous d'abord ; puis vous mettrez votre empreinte sur des morceaux de bois, si vous voulez, et vous verrez l'effet qu'elle fera. Il ne semble pas qu'il fallût être bien habile pour trouver cette réponse accablante ; cependant elle n'a point été faite, parce qu'il n'était pas aussi aisé de prouver directement que l'argent, comme toutes les choses utiles, a une valeur propre et nécessaire ; même, pour le démontrer invinciblement, il fallait remonter, comme nous avons fait, et comme peut-être on ne l'a jamais [151] fait, jusqu'à la cause première et unique de toute valeur, le travail.
Cette balourdise (il faut bien appeler les choses par leur nom), que l'argent n'est que signe, s'est donc soutenue, et on la répète encore tous les jours. Maints écrivains ne donnent pas d'autre nom à l’argent ; et des gens qui se croient des historiens et des politiques vous rendent compte gravement du système de Law, et le discutent à perte de vue, sans s'apercevoir, après cent ans de réflexions, que c'est uniquement là-dessus qu'il était fondé, et que tout le reste ne consiste que dans des accessoires imaginés pour masquer ce fonds[31]. Le beau principe dont il s'agit n'est donc ni abandonné ni proscrit. Si l'on ne s'en prévaut plus guère pour altérer les monnaies, ce n'est pas que l'on en ait honte, c'est qu'on a trouvé le moyen d'en faire une application plus complète. Car enfin dans la plus fausse monnaie il reste toujours un peu d'argent. Dans ce qu'on y substitue actuellement il n'y en a pas du tout, encore mieux. On n'a pas suivi le conseil que nous donnions tout à l'heure, de mettre l'empreinte du prince sur des morceaux de bois. On la met sur du papier, cela revient au même. Les relations multipliées de la société perfectionnée ont suggéré cette idée, et servent encore à masquer la fraude. Expliquons ceci.
[152]
Le papier, comme toute autre chose, n'a de valeur nécessaire que ce qu'il en coûte pour le fabriquer, et n'a de valeur vénale que son prix dans la boutique comme papier. Quand je tiens un billet, une obligation quelconque d'un homme solvable, de me payer à vue cent onces d'argent ce papier n'a que la valeur réelle d'une feuille de papier. Il n'a point celle de cent onces d'argent qu'il me promet. Il n'est pour moi que le signe que je recevrai ces cent onces d'argent quand je voudrai. À la vérité, quand ce signe est d'une certitude indubitable, je ne suis point inquiet de le réaliser. Je pourrai même, sans prendre cette peine, le passer de gré à gré à une autre personne qui sera aussi tranquille que moi, et qui même aimera mieux le signe que la chose signifiée, parce qu'il est moins lourd et plus transportable. Nous n'avons réellement encore ni l'un ni l'autre aucune valeur (je compte pour rien celle de la feuille de papier) ; mais nous sommes aussi sûrs d'en avoir quand nous voudrons, que nous sommes sûrs, avec de l’argent, d'avoir à dîner quand nous aurons faim : c'est ce qui nous fait dire à tous deux que ce papier est la même chose que de l'argent. Cependant cela n'est pas exact ; car le papier ne fait que promettre, et l'argent seul vaut par lui-même.
Partant de cette équivoque, le gouvernement vient, qui dit : Vous convenez tous que le papier d'un homme riche vaut de l'argent. Le mien, à bien plus forte raison, doit avoir la même [153] propriété ; car je suis plus riche qu'aucun particulier, et de plus vous avouez que c'est mon empreinte seule qui donne à l'argent la qualité de signe de toutes les valeurs. Ma signature communique à ce papier la même vertu : ainsi il est à tous égards une véritable monnaie. Par surcroît de précaution, on ne manque jamais d'inventions pour prouver que le papier que l'on va émettre représente réellement des valeurs immenses. On l'hypothèque tantôt sur une masse très considérable de biens domaniaux, tantôt sur les profits d'une compagnie de commerce qui doit avoir des succès prodigieux, tantôt sur les fonds d'une caisse d'amortissement qui ne peut manquer de produire des effets merveilleux, tantôt sur tout cela ensemble. Pressés par des arguments si solides, tous ceux qui espèrent que cette opération mettra l'autorité à même de leur faire des dons, et tous ses créanciers actuels, qui craignent sans cet expédient de n'être pas payés du tout, qui espèrent avoir ce papier des premiers, et s'en défaire bien vite, avant qu'il soit discrédité, et qui d'ailleurs comptent bien, s'ils y perdent quelque chose, s'en dédommager amplement dans les affaires subséquentes, ne manquent pas de dire qu'ils sont pleinement convaincus que ce papier est excellent ; que c'est une invention admirable qui sera le salut de l'État ; qu'ils sont tout prêts à le prendre ; qu'ils l'aiment autant que de l'argent ; que leur seul embarras serait s'ils rencontraient des esprits revêches et défiants comme il y en a toujours, qui ne voulussent pas le recevoir ; que pour prévenir cet [154] inconvénient, il faudrait ordonner à tout le monde de faire comme eux, et qu'alors toutes difficultés sont évanouies. Le public même, prévenu par tant de sophismes qui reçoivent de si nombreuses approbations, goûte d'abord la mesure, la désire, et se persuade qu'il faut être absurde ou mal intentionné pour ne la pas approuver. Ainsi l'on fait du véritable papier-monnaie, c'est-à-dire du papier que tout le monde a le droit de donner et est obligé de prendre comme de la bonne monnaie, et l'on ne s'aperçoit pas que c'est précisément cette violence à laquelle on s'est porté pour rendre ce papier meilleur, qui le vicie radicalement.
En effet, l'autorité, qui ne l'a créé que pour se libérer, en fait d'abord assez pour éteindre toutes ses dettes. Il est ordonné de le recevoir ; on y est disposé ; il se répand avec facilité, il est dans toutes les mains concurremment avec l'argent ; il paraît même dans le premier moment accroître l'activité du commerce en multipliant les capitaux. D'ailleurs on ne l'emploie que dans les gros paiements et dans les placements de fonds. Ainsi le service journalier et cette multitude infinie de petits échanges qui constitue la marche habituelle de la société se font comme a l'ordinaire ; tout le monde est content.
Ensuite la même autorité use du même moyen pour ses dépenses ordinaires ; elle y met nécessairement moins d'économie, se sentant des ressources toujours prêtes ; elle s'embarque dans des entreprises soit de guerre, soit de politique, soit d'administration, auxquelles elle n'aurait pas osé songer, sentant [155] bien qu'elles auraient dépassé ses forces sans cette facilité. Le papier se multiplie donc extrêmement. Les fournisseurs du gouvernement sont les premiers à dire que tout est très renchéri, qu'il leur faut des prix beaucoup plus forts ; ils se gardent bien d'avouer que c'est parce que promesse ne vaut pas argent, et que la promesse commence à paraître douteuse ; ils attribuent ce fait, dont ils paraissent surpris, à un encombrement momentané qu'il sera aisé de faire disparaître en ralentissant tous les paiements, excepté le leur ; aux intrigues d'un parti de mécontents qu'il faut subjuguer ; à la malveillance des étrangers, qui, pour nous embarrasser, ne veulent traiter avec eux que l'argent à la main pour les objets qu'ils sont obligés de tirer d'eux. Il est impossible de ne pas se rendre à de si bonnes raisons, et surtout à la nécessité : les dépenses augmentent donc prodigieusement, et le papier de même.
On le reçoit toujours, car on y est forcé ; mais tout le monde en demande beaucoup plus pour les mêmes choses. Bientôt il s'établit une proportion avouée et connue entre le papier et l'argent. Elle devient si désavantageuse au papier, que les salariés, les rentiers, les propriétaires de biens affermés, que l'on paie dans cette monnaie, sont très grevés. On augmente les premiers, et particulièrement tous les employés du gouvernement qui en est d'autant plus chargé ; les autres souffrent horriblement. À cette époque de la dépréciation du papier, le gouvernement éprouve déjà sur ses impôts la même perte que les particuliers sur leurs rentes et leurs fermages ; cela [156] le gène ; mais ce n'est pas le moment d'augmenter les charges publiques. Il lui est aisé de faire du papier pour combler le déficit qu'il éprouve ; il préfère ce moyen. De là une nouvelle cause d'émission et de dépréciation.
La différence entre le papier et l'argent croissant progressivement, on n'ose plus faire aucun crédit ni aucun prêt ; on n'ose plus même acheter pour revendre, parce qu'on ne sait à quel prix on pourra revendre ; tout commerce languit. La proportion ou plutôt la disproportion augmentant toujours, elle arrive au point que les transactions journalières pour les choses de première nécessité, qui ne comportent que de petites sommes qui se paient en argent, deviennent impossibles ; car on aimerait autant donner cent francs de papier que vingt-cinq de monnaie ; et par la même raison, si vous devez douze francs, personne ne voudra vous rendre sur un billet de cent francs. Tout le monde crie et se plaint. Les querelles sont interminables, puisque les deux parties ont raison. On croit remédier à ce mal en faisant des billets pour les plus petites sommes, et on en fait [32], mais on n'y gagne rien ; car de ce moment on ne voit plus un écu ; et dès que les choses les plus usuelles se paient en papier, elles montent à un prix proportionné au discrédit du papier, c'est-à-dire tel que [157] personne n'y peut atteindre. On est donc inévitablement forcé d'en venir à taxer d'autorité toutes les denrées nécessaires.
Alors il n'y a plus de société, mais un brigandage universel ; tout est fraude ou supplice. Le gouvernement frappe des réquisitions partout, et le peuple pille ; car il n'y a que la violence qui puisse obliger de vendre à perte, ou de se dessaisir de choses dont on craint de manquer soi- même bientôt. En effet tout manque ; car personne ne fait de nouvelles provisions ni de nouvelles fabrications, de peur d'éprouver de nouvelles spoliations. Tous les métiers sont abandonnés. Il ne s'agit plus de songer à vivre du produit d'une industrie réglée ; chacun subsiste de ce qu'il peut cacher ou de ce qu'il peut attraper comme en pays ennemi. Les plus dénués meurent en foule. On peut dire dans le sens le plus strict que la société est dissoute, car il n'y a presque plus d'échanges libres.
Il n’est plus besoin alors de s'occuper de petits billets, car les plus forts suffisent à peine pour les plus petites sommes. Nous avons vu payer une paire de souliers trois mille francs, et être très heureux de l'obtenir en secret à ce prix ; car la force peut bien obliger à la donner pour rien quand elle existe, mais elle ne peut pas contraindre à la faire. Arrivé à ce point, il faut au contraire que le gouvernement donne une valeur nominale très forte à chaque feuille de son papier, non pas seulement pour qu'elle soit de quelque usage, mais pour qu'à lui-même elle lui représente un peu plus de valeur réelle qu'il [158] ne lui en coûte pour la fabriquer. C'est ce qui a fait qu'en France, dans les derniers temps du papier-monnaie, on s'est avisé de faire des mandats qui n'étaient que des assignats d'une forme nouvelle, mais auxquels on avait attribué une valeur centuple de celle des autres, sans quoi ils n'auraient pas valu leur prix de fabrication. Ainsi on en était venu au point qu'un billet de cent francs assignats, par exemple, n'avait effectivement pas la valeur réelle de la feuille de papier sur laquelle il était écrit, et qu'il aurait mieux valu pour celui qui la recevait qu'on la lui donnât toute blanche, ou plutôt qu'on lui donnât le prix qu'elle avait coûté [33].
Un tel fait paraît incroyable ; cependant nous en avons tous été témoins ; et il prouve bien deux vérités importantes : l'une, que quand on veut aller contre la nature des choses on est inévitablement poussé aux extrémités les plus monstrueuses ; l'autre, qu'il est aussi impossible de donner aux choses une valeur réelle qu'elles n'ont pas, que d'ôter à aucunes d'elles la valeur naturelle et nécessaire qu'elles ont, laquelle consiste, on ne saurait trop le répéter, dans le prix du travail que coûte leur production.
En vain dirait-on qu'on peut user du papier-monnaie sans en abuser à cet excès. L'expérience [159] constante prouve le contraire ; et, indépendamment de l'expérience, le raisonnement démontre que dès qu'on en a abusé on est forcé d'en abuser toujours davantage, et qu'on ne le fait monnaie, c'est-à-dire ayant un cours forcé, que pour en abuser. Car quand vous lui laissez un cours libre, le moment où la crainte que vous ne puissiez pas remplir vos engagements fait qu'on répugne à le recevoir vous montre le moment où effectivement vous commencez à prendre des engagements au-dessus de vos forces, c'est-à-dire à abuser. Quand vous lui donnez un cours forcé, c'est que vous ne voulez pas être averti de ce moment et que vous êtes déterminé à passer outre, c'est-à-dire à prendre des engagements que vous ne pouvez remplir. En un mot, quand votre papier est bon, il est inutile d'obliger à le recevoir ; quand il est mauvais, il est inique et absurde de forcer à le prendre pour bon. On ne répondra jamais rien de solide à ce dilemme. Mirabeau a donc eu grande raison de dire cette phrase célèbre qu'il a trop oubliée : Tout papier-monnaie est une orgie du despotisme en délire.
On a vu que les suites de ce délire sont encore bien plus funestes que celles de l'altération des monnaies. La raison en est simple. Cette altération, quand elle ne se répète pas, n'a qu'un effet momentané, dont beaucoup de personnes souffrent comme d'une grêle, et dont d'autres profitent comme d'une aubaine. Mais tout reprend bientôt son cours ordinaire. Au contraire, la dépréciation graduelle du papier-monnaie, pendant tout le temps qu'il dure, [160] fait l'effet d'un nombre infini d'altérations successives continuées jusqu'à l'annihilation totale ; et pendant tout ce temps, personne ne sachant sur quoi compter, la marche de la société est tout à fait intervertie. Ajoutez à cela que l'on fait toujours du papier pour de bien plus grandes sommes que l'on ne frappe de la monnaie, même mauvaise. Ainsi le mal est encore beaucoup plus grand.
Concluons que le papier-monnaie est la plus coupable et la plus funeste de toutes les banqueroutes frauduleuses ; que l'altération des monnaies métalliques vient ensuite ; et que quand un gouvernement est assez malheureux pour ne pouvoir plus remplir ses engagements, il n'a rien de mieux à faire qu'à déclarer franchement sa faillite, et composer loyalement avec ses créanciers, comme un négociant imprudent, mais honnête. Le mal est beaucoup moindre ; la réputation reste, et la confiance renaît bientôt ; trois avantages inappréciables. Partout où il y a candeur et probité, il y a du remède au malheur. C'est un de ces poids nombreux par lesquels l'économie et la morale se rejoignent, et qui font qu'elles ne sont que des parties différentes du même sujet, l'histoire de celle de nos facultés intellectuelles que nous appelons la volonté.
Après avoir ainsi parlé de l'argent, de ses usages, de sa valeur réelle, du danger de prétendre le remplacer par des valeurs fictives, il convient de nous occuper un moment de ce que l'on appelle l'intérêt de l'argent. Ce sujet, comme beaucoup d'autres, serait bien simple si l'on n'avait pas cherché souvent à [161] l'embrouiller, et si on ne l'avait jamais traité qu'après les préliminaires dont nous l'avons fait précéder.
Puisqu'on loue des chevaux, un carrosse, des meubles, une maison, des terres, en un mot tout ce qui est utile et a une valeur, on peut bien louer de même l'argent, qui est utile aussi, qui a aussi une valeur, et que l'on échange tous les jours contre toutes ces choses. Ce loyer de l'argent est ce que l'on nomme intérêt. Il est aussi légitime que tout autre loyer : il doit être tout aussi libre. Il n'y a pas plus de raison pour que l'autorité en détermine le taux que pour qu'elle fixe le prix du bail d'une maison ou d'une ferme. Ce principe est si évident, qu'il n'aurait jamais dû souffrir la moindre difficulté.
Il y a pourtant ce que l'on appelle l'intérêt légal. C'est celui que les tribunaux adjugent lors des actions judiciaires, dans les cas ou les parties n'ont pas pu en convenir, et où pourtant il est juste que le débiteur en paie un quelconque. Il faut bien que la loi l'ait déterminé d'avance. Il ne doit être ni trop fort ni trop faible : pas trop fort, afin que le débiteur de bonne foi qui a voulu se libérer, mais que quelques circonstances étrangères à lui en ont empêché, ne soit pas grevé pour avoir été obligé de garder son argent ; pas trop faible, pour que le débiteur de mauvaise foi, qui a cherché des chicanes pour différer de payer, ne gagne pas à avoir conservé la disposition de ses fonds. En un mot, il faut lâcher qu'il soit tel que ni le créancier ni le débiteur ne soient lésés. Pour cela il faut que la loi le fixe comme il est à présumer que les parties en [162] fussent convenues, c'est-à-dire conformément au taux le plus ordinaire dans des circonstances analogues. Mais encore une fois cet intérêt légal ne doit être d'aucune considération toutes les fois que les parties ont pu faire elles-mêmes leurs conventions. L'autorité publique ne doit jamais intervenir dans les transactions particulières que pour en assurer l'exécution, et pour porter son appui à la fidélité aux engagements.
Il est pourtant vrai qu'il est de l'intérêt de la société en général que le loyer de l'argent soit bas premièrement parce que toutes les rentes que des hommes industrieux paient à des capitalistes sont autant de fonds enlevés à la classe laborieuse, au profit des oisifs ; secondement, parce que quand ces rentes sont fortes, elles enlèvent une si grande partie des bénéfices des entreprises industrielles, que beaucoup deviennent impossibles ; troisièmement, parce que plus ces rentes sont fortes, plus il y a de gens qui en vivent sans rien faire. Mais tout cela ne fait pas qu'il faille fixer d'autorité le taux de l'intérêt car nous avons déjà vu que la société a absolument les mêmes motifs pour désirer que les fermages des terres soient à très bon marché [34], et cependant [163] personne n'a jamais proposé de déclarer usuraires et illicites les baux de ferme qui passeraient un certain prix. D'ailleurs, fixer le taux de l'intérêt n'est pas un moyen de le diminuer ; au contraire, c'est seulement inviter en quelque sorte à la dissimulation ; car le prêteur se fera toujours payer le plus qu'il pourra la jouissance de ses capitaux ; il voudra encore être indemnisé du risque qu’il court en éludant une loi imprudente et même injuste. Le seul moyen de diminuer le prix de l'intérêt de l'argent est de faire que la masse de la nation soit riche ; qu'ainsi il y ait beaucoup de fonds à placer, et que pourtant les gens industrieux aient peu besoin d'emprunter.
[164]
Au lieu de fixer le taux de l'intérêt, on pourrait peut-être étendre à ce genre de conventions le principe de la lésion d'outre-moitié, qui, dans certains cas, autorise la résiliation des engagements contractés ; mais l'application de ce principe serait souvent très embarrassante en matière de prêt. Il faudrait avoir égard à beaucoup de circonstances difficiles à évaluer, et nommément au degré de danger qu'a couru le prêteur en se dessaisissant de ses fonds. Au moins voudrais-je, dans cette supposition, qu'à plus forte raison les fermages fussent compris sous la même règle ; car là il n'y a pas le risque que l'on emporte le fonds ; mais je préfèrerais toujours qu'on laissât les particuliers entièrement libres de leurs conventions.
Pour terminer le chapitre des monnaies et de tout ce qui y a rapport, il nous reste à dire un mot du change et de la banque ; ce sont deux choses très distinctes qui se trouvent souvent mêlées ; examinons-les séparément.
Le change, ou le service du changeur, est une opération des plus simples c'est de troquer une monnaie contre une autre quand on le lui demande. Il ne faut que savoir combien chacune des deux contient d'or ou d'argent pur, en rendre la même quantité qu'il en reçoit, et prendre un salaire convenu pour le prix du petit service qu'il rend. Ou bien il s'agit de troquer des lingots contre une monnaie quelconque. C'est encore exactement la même chose ; il faut seulement, en outre, mettre en ligne de compte le petit accroissement de valeur [165] que donne au métal la qualité de monnaie qui lui est imprimée par l'effigie ou le sceau du souverain. Si le titre des métaux était aussi aisé à constater que leur poids, l'intérêt personnel le plus inventif pour pêcher en eau trouble ne pourrait parvenir à répandre la moindre obscurité sur une pareille transaction ; et malgré cette petite difficulté de l'essai, elle reste encore assez claire quand rien ne s'y mêle, parce qu'enfin les deux choses à changer sont en présence. Il ne s'agit que de les évaluer toutes deux et de troquer ; mais l'opération du changeur se complique souvent avec celle du banquier : expliquons d'abord celle-ci.
La fonction du banquier est de vous faire toucher dans une autre ville l'argent que vous lui remettez dans celle où vous êtes. Il vous rend service en cela ; car si vous avez besoin de votre argent dans cette autre ville, soit pour y payer des dettes, soit pour l'y dépenser, il faut que vous l'y envoyiez on que vous l'y portiez, et cela entraîne des frais et des risques. Le banquier qui y a un correspondant vous donne pour lui un billet appelé lettre de change, en vœu duquel ce correspondant vous remet votre somme. Dans une occasion inverse, ce même correspondant donne à une autre personne un pareil billet sur votre banquier : ainsi les voilà quittes, et ils ont obligé deux personnes ; et comme tout service vaut salaire, ils ont retenu à chaque fois pour leur récompense une portion convenue de l'argent transporté. Tel est le service et le bénéfice du banquier.
[166]
Je suis toujours émerveillé que des écrivains qui ont longuement disserté sur le négoce, qui en connaissaient l'utilité, qui en ont exagéré l'importance, aient méconnu l'accroissement de valeur que reçoivent les marchandises par le changement de lieu, et aient refusé la qualité de producteurs aux négociants qui les transportent. Car ici, qui est le cas le plus simple, il est bien clair que quand vous, qui habitez Paris, vous devez cent francs à Marseille, vous aimez bien mieux donner cent un francs à votre banquier, que de porter on d'envoyer vous-même vos cent francs à Marseille ; et réciproquement, si vous y avez cent francs, vous aimez mieux en recevoir quatre- vingt dix-neuf à Paris de ce même banquier, que d'aller chercher à Marseille votre somme entière. Les marchandises rendues à leur destination ont donc réellement une valeur, qu'elles n'avaient pas auparavant. C'est ce qui vous engage à donner une récompense à votre banquier, quoiqu'il ne lui en coûte rien pour vous rendre ce service.
À ce premier bénéfice il en joint ordinairement un autre. Vous lui donnez aujourd'hui votre argent. La lettre qu'il vous donne en retour ne sera payable que dans quinze ou vingt jours, plus ou moins. Il faut bien le temps qu'elle arrive. Il faut en prévenir le correspondant. Il pourrait n'avoir pas les fonds. On ne manque même jamais de prétextes pour allonger ce délai. Cependant ce n'est que du jour du paiement que le banquier tient compte de la somme à son confrère. Ainsi pendant tout [167] l'intervalle il jouit de votre argent gratuitement, et peut le faire travailler ; et comme l'argent porte intérêt, c'est un profit assez considérable ; car on voit bien que s'il a successivement dix-huit ou vingt-quatre commissions pareilles, il a gagné tout l'intérêt de la somme pendant un an entier.
À ces calculs il faut en ajouter encore un troisième. Quand beaucoup de Marseillais sont débiteurs envers des Parisiens, ils viennent tous demander des lettres payables à Paris. Elles deviennent rares. Les banquiers peuvent être embarrassés d'en fournir, leurs correspondants étant déjà en avance vis-à-vis d'eux. Ils en prennent occasion de vous demander, indépendamment de leur droit de commission, cent deux ou cent trois onces d'argent, pour en faire toucher cent à votre ordre à Paris ; et vous qui avez besoin de vous acquitter, vous les donnez, ne pouvant le faire à meilleur marché. Par la raison contraire, si quelques Parisiens ont dans le même temps besoin de lettres sur Marseille, les banquiers de Paris pourraient, pour cent onces d'argent, leur donner une lettre de cent deux ou cent trois onces, puisque c'est le prix qu'on y met à Marseille. Mais comme eux seuls sont bien au fait de ces mouvements, ils s'arrangent toujours pour ne pas faire profiter les particuliers de tout le bénéfice, et leur faire supporter plus que la perte nécessaire ; et c'est pour eux une nouvelle source de profit.
C'est là ce que l'on appelle assez mal à propos, à mon avis, le cours du change, et que l'on devrait plutôt, suivant moi, appeler le cours de la [168] banque ; car ces deux villes étant dans le même pays, et se servant de la même monnaie, il n'y a point de change, mais seulement transport d'espèces, ce qui est le propre de la banque. On dit que ce cours est au pair quand cent onces d'argent dans un endroit en paient cent dans l'autre, et qu'il est haut ou bas quand il en faut plus ou moins [35], toujours indépendamment du droit de commission du banquier.
L'opération du change, au contraire, se mêle à l'opération de banque et la complique, lorsqu'il s'agit de transporter des fonds d'un pays dans un autre. Car la somme que l'on reçoit à Paris, et pour laquelle on donne une lettre sur Londres, a été déposée en monnaie française ; et sera payée en [169] monnaie anglaise. Il faut donc faire la concordance de ces deux monnaies, et déterminer ce que chacune d'elles contient de métal pur, d'après les lois connues de leur fabrication. Il faut de plus évaluer, au moins d'une manière approximative, ce que les pièces de monnaies peuvent avoir perdu dans les deux pays, depuis qu'elles sont en circulation. C'est ce qui fait que, toutes choses égales d'ailleurs, on demande toujours moins pour payer la même somme dans un pays, quand sa monnaie est ancienne et par conséquent a souffert beaucoup de déchet par l'usage et par la fraude des rogneurs d'espèces, que quand elle est toute neuve et intacte ; car dans ce dernier cas elle contient réellement plus de métal, et le porteur de la lettre en recevra plus pour la même somme. Ce change est encore une nouvelle occasion de gain pour le banquier.
Voilà à quoi se réduisent toutes les opérations de change et de banque, qui, comme l'on voit, sont très simples et seraient très claires, si toutes les monnaies portaient le nom de leur poids et la marque de leur titre, et si le pédantisme et le charlatanisme n'avaient pas à l'envi caché et déguisé des notions si communes, sous une multitude de noms barbares et de termes d'argot tels, qu'il n'y a que les initiés qui puissent s'y reconnaître.
Les banquiers rendent encore une autre espèce de service. Quand le porteur d'une lettre de change qui n'est pas échue a besoin d'argent, ils la lui paient en retenant la valeur de l'intérêt de la somme pour le temps qui reste à courir jusqu'au jour de [170] l'échéance. Cela s'appelle escompter. Quelquefois ils reçoivent d'un particulier des effets non exigibles, autres que des lettres de change, comme des billets, des créances à long terme, des titres de propriété, des hypothèques sur des biens-fonds ; et munis de ces sûretés, ils lui avancent des sommes en lui en faisant payer un intérêt plus ou moins, fort. D'autres fois, connaissant un homme solvable, ils lui donnent, moyennant rétribution, un crédit sur eux jusqu’à une somme déterminée, et ils se font les agents de toutes ses affaires, se chargeant de faire rentrer toutes ses créances et d'acquitter tous ses débits. Ce sont là autant de manières d'être utiles ; mais dans tous ces cas ils sont essentiellement préteurs et agents d'affaires, et non pas proprement banquiers, quoique des services de banque, se mêlent à ces opérations. C'est néanmoins tout cela que l’on comprend ordinairement sous les noms de banque d'escomptes, de secours, de crédit, de circulation, etc., etc.
Tous ces banquiers, changeurs, agents, prêteurs, escompteurs, au moins les plus riches et les plus accrédités d'entre eux, ont une forte tendance à se réunir en grandes compagnies. Leur prétexte ordinaire est que, faisant ainsi une bien plus grande quantité d'affaires, ils pourront se contenter d'un moindre profit sur chacune, et faire tous les services à bien meilleur marché. Mais ce prétexte est illusoire : car si on fait plus d'affaires, on emploie plus de fonds ; et sûrement leur intention n'est pas que chaque partie de leurs fonds leur [171] profite moins. Le vrai est qu'au contraire ils veulent, en mettant dans leurs mains presque toutes les affaires, écarter la concurrence et faire sans obstacles des profits plus forts. Les gouvernements, de leur côté, sont très portés à favoriser l'établissement de ces grandes compagnies, et à leur donner des privilèges au détriment de leurs rivaux et du public, dans l'intention d'en tirer des prêts gratuits ou peu chers, que celles-ci ne leur refusent jamais. C'est ainsi que les uns vendent leur protection, et que les autres l'achètent. Ce serait déjà un très grand mal.
Mais ces compagnies ont un bien plus grand inconvénient : elles émettent des billets payables à vue, ne portant aucun intérêt, qu'elles donnent pour argent comptant. Tous les hommes qui dépendent d'elles ou y tiennent, et ils sont très nombreux, prennent avec empressement ces billets et les offrent. Le public même, qui a grande confiance dans leur solvabilité, les reçoit volontiers comme très commodes. Ainsi ils se répandent facilement et se multiplient extrêmement. La compagnie y trouve un gain énorme, parce que toute la somme que représentent ces billets ne lui a rien coûté que la fabrication du papier, et lui profite comme argent comptant. Cependant il n'y a pas encore d'inconvénient, parce que les billets sont toujours réalisés dès l'instant qu'on le demande.
Mais bientôt le gouvernement, qui ne l'a créée que pour cela, demande à cette compagnie des emprunts énormes ; elle n'ose ni ne peut le refuser, [172] car il dépend de lui de la culbuter en lui retirant un moment son appui. Elle est obligée, pour le satisfaire, de créer une quantité excessive de nouveaux billets. Elle les lui remet. Il les emploie bien vite. La circulation en est surchargée.
L'inquiétude suit. Tout le monde veut réaliser. Il est évident que c'est impossible, à moins que le gouvernement ne rende ce qu'il a emprunté, et c'est ce qu'il ne fait pas. La compagnie ne peut qu'invoquer son appui. Elle lui demande de l'autoriser à ne pas payer ses billets, et de leur donner un cours forcé. Elle l'obtient, et la société se trouve en plein état de papier-monnaie, dont nous avons vu les suites inévitables. C'est ainsi que la caisse d'escompte a amené les assignats en France. C'est ainsi que la banque de Londres a amené l'Angleterre au même état dans lequel elle est actuellement. C'est ainsi que finissent toutes les compagnies privilégiées : car par cela seul qu'elles sont privilégiées, elles sont radicalement vicieuses ; et tout ce qui est essentiellement mauvais finit toujours mal, malgré ses succès passagers. Tout se tient, et la nécessité est invincible.
Il serait aisé de montrer que quand ces grande machines si sophistiquées n'auraient pas l'affreux danger que nous venons de peindre, les avantage que l'on s'en promet seraient illusoires ou bien faibles, et ne pourraient ajouter que bien peu de chose à la masse de l'industrie et de la richesse nationales. Mais il n'est pas nécessaire d'entrer actuellement dans les détails. Il nous suffit d'avoir vu d'une [173] manière générale la marche des affaires. Avant d'aller plus loin, jetons un coup d'œil en arrière sur le chemin que nous avons parcouru. C'est le moyen de ne pas s'égarer en avançant.
CHAPITRE VII.↩
Réflexions sur ce qui précède.
Bien des lecteurs trouveront peut-être que j'ai suivi jusqu'ici une marche assez bizarre ; que je suis souvent remonté bien haut pour établir des vérités assez communes ; que j'ai disposé mes chapitres dans un ordre qui ne paraît pas méthodique ; que surtout j'ai abandonné les sujets que j'ai traités sans les avoir approfondis, ou du moins sans leur avoir donné tous les développements dont ils sont susceptibles. Mais je les prie de remarquer que ceci n'est point un Traité d'Economie politique comme un autre. C'est la seconde section d'un Traité de nos Facultés intellectuelles. C'est un Traité de la Volonté, faisant suite à un Traite de l'Entendement. Mon intention est bien moins d'épuiser tous les détails des sciences morales, que de voir comment elles dérivent de notre nature et des conditions de notre existence, afin de reconnaître sûrement les erreurs qui pourraient s'y être glissées, faute d'être remonté jusqu'à cette source de tout ce que nous sommes, et de tout ce que nous connaissons. [174] Or, pour exécuter un semblable dessein, ce n'est pas l'abondance des idées qui est à rechercher, mais leur sévère enchaînement et leur suite non interrompue et sans lacunes. Au reste, je me persuade que sans nous en apercevoir nous sommes déjà bien plus avancés que nous ne pensons.
En effet, nous avons vu que la faculté de vouloir, la propriété d'être doué de volonté, en nous donnant la connaissance distincte de notre individu, nous donne par cela même et nécessairement l'idée de propriété, et qu'ainsi la propriété avec toutes, ses conséquences est une suite inévitable de notre nature. Voilà déjà une grande source de divagations et de déclamations totalement tarie.
Nous avons vu ensuite que cette même volonté, qui constitue tous nos besoins, est la cause de tous les moyens d'y pourvoir ; que l'emploi de nos forces qu'elle dirige est notre seule richesse primitive et le principe unique de la valeur de tout ce qui en a une pour nous.
Avant de tirer aucune conséquence de cette seconde observation, nous avons vu encore que l'état de société non seulement nous est très avantageux, mais nous est tellement naturel, que nous ne pouvons pas exister autrement. Ainsi voilà encore un autre sujet de lieux communs bien faux épuisé.
Réunissant ces deux points, l'examen des effets de l'emploi de nos forces et celui de l'accroissement d'efficacité que leur donne l'état de société nous ont mis à même de reconnaître ce que c'est que [175] produire, pour des êtres comme nous, et ce que nous devons entendre par ce mot. C'est encore un grand sujet d'équivoques anéanti.
Forts de ces prémisses, après quelques éclaircissements sur la mesure de l'utilité des choses, il nous a été facile de conclure que toute notre industrie se réduit à des changements de formes et de lieux, et que par conséquent la culture est une fabrication comme une autre, ce qui dissipe bien des nuages répandus sur ce sujet, et nous a permis de voir très nettement la marche de toute industrie, ses intérêts, les obstacles qui s'y opposent. Cela mène encore à apprécier bien des choses et des hommes tout autrement qu'on ne le fait communément.
Enfin, parmi toutes les choses ayant une valeur, nous avons remarqué, celles qui ont les qualités propres à devenir monnaie ; et nous avons facilement reconnu les avantages et l'utilité de cette bonne et véritable monnaie, et le danger de l'altérer ou de la remplacer par une autre tout à fait fictive et fausse. Par suite nous avons même jeté un coup d'oeil rapide sur les petites opérations communément regardées comme très grandes, auxquelles donnent lieu le change de ces monnaies et leur transport économique, sous le nom de banque.
Il suit de là, si je ne me trompe, que nous nous sommes fait des idées nettes et certaines sur toutes les circonstances importantes de la formation de nos richesses. Il ne nous reste donc plus qu'à voir comment s'en fait la distribution entre les individus, et comment s'opère leur consommation, c'est-à-dire [176] comment nous en usons. Alors nous aurons un traité abrégé, mais complet, de tous les résultats de l'emploi de nos moyens d'existence.
Cette seconde partie, la distribution des richesses dans la société, est peut-être celle des trois qui donne lieu aux considérations les plus délicates, et où l'on rencontre les phénomènes les plus compliqués. Cependant si nous avons bien éclairci la première, nous verrons dans Celle-ci l'obscurité fuir devant nous, et tout se debrouiller avec facilité. Essayons de suivre constamment le fil qui nous guide.
CHAPITRE VIII.↩
De la Distribution de nos richesses entre les individus.
Jusqu'à présent nous avons considéré l'homme collectivement. Il nous reste à l'examiner distributivement. Sous ce second point de vue, il nous offre un aspect bien différent du premier. L'espèce humaine, prise en masse, est riche et puissante ; et voit tous les jours croître ses ressources et ses moyens d'existence ; mais il n'en est pas de même des individus. Tous, en leur qualité d'êtres animés, sont condamnés à souffrir et à mourir. Tous, après une courte période d'accroissement, si même ils la [177] parcourent, et après quelques succès momentanés, s'ils les obtiennent, retombent et déclinent, et les plus fortunés d'entre eux ne peuvent guère que diminuer leurs souffrances et en éloigner le terme. Leur industrie ne saurait aller plus loin. Il n’est pas inutile d'avoir présent à l'esprit ce tableau triste, mais vrai, de notre condition. Il nous apprend à ne pas vouloir l'impossible, et à ne pas prendre pour une suite de nos fautes ce qui est une conséquence nécessaire de notre nature. Il nous ramène du roman à l'histoire.
Il y a plus : ces ressources, ces richesses si insuffisantes pour le bonheur, sont encore très inégalement réparties entre nous, et cela est inévitable. Nous avons vu que la propriété est dans la nature, car il est impossible que chacun ne soit pas propriétaire de son individu et de ses facultés ; l'inégalité n'y est pas moins, car il ne se peut pas que tous les individus se ressemblent et aient le même degré de force, d'intelligence et de bonheur. Cette inégalité naturelle s'étend et se manifeste à mesure que nos moyens se développent et se diversifient. Tant qu'ils sont très bornés, elle est moins frappante, mais elle existe. C'est à tort que l'on n'a pas voulu la reconnaître ; parmi les peuples sauvages ; chez eux même elle est très funeste, car elle est celle de la force sans frein.
Si, pour bannir de la société cette inégalité naturelle, nous entreprenions de méconnaître la propriété naturelle et de nous opposer à ses conséquences nécessaires, ce serait en vain ; car rien de [178] ce qui est dans la nature ne peut être détruit par l'art. De pareilles conventions, si elles étaient faisables, seraient un esclavage trop contre nature, par conséquent trop insupportable pour être durable, et elles ne rempliraient pas leur but. Pendant qu'elles subsisteraient, on verrait naître autant de querelles pour avoir une part plus forte dans les biens communs, ou une plus petite dans la peine commune, qu'il peut en exister parmi nous pour la défense des propriétés particulières ; et le seul effet d'un tel ordre de choses serait d'établir l'égalité de misère et de dénuement, en éteignant l'activité de l'industrie personnelle. Je sais tout ce que l'on raconte de la communauté des biens des Spartiates. Mais je réponds hardiment que cela n'est pas vrai, parce que cela est impossible. Je crois bien qu'à Sparte les droits des individus étaient très peu respectés par les lois, et totalement violés à l'égard des esclaves. Mais la preuve que cependant il y avait encore des propriétés, c'est qu'il y avait des vols. Ô mes maîtres, que de choses contradictoires vous nous avez dites sans vous en apercevoir !
L'opposition fréquente d'intérêts entre nous, et l'inégalité de moyens, sont donc des conditions de notre nature, comme la souffrance et la mort. Je ne conçois pas qu'il y ait des gens assez barbares pour dire que c’est un bien ; mais je ne conçois pas non plus qu'il y en ait d'assez aveugles pour croire que ce soit un mal évitable. Je pense que ce mal est nécessaire, et qu'il faut s'y soumettre. La [179] conclusion que j'en tirerais (mais elle est encore prématurée), c'est que les lois devraient toujours tendre à protéger la faiblesse, tandis que trop souvent elles inclinent à favoriser la puissance. La raison en est facile à sentir.
D'après ces données, la société doit avoir pour base la libre disposition des facultés de l'individu, et la garantie de tout ce qu'il peut acquérir par leur moyen. Alors chacun s'évertue : l'un s'empare d'un champ en le travaillant, l'autre bâtit une maison, un troisième invente un procédé utile, un autre fabrique, un autre transporte, tous font des échanges, les plus habiles gagnent, les plus économes amassent. Une des conséquences des propriétés individuelles est, sinon que le possesseur en dispose à sa volonté après sa mort, c'est-à-dire dans un temps où il n'aura plus de volonté, du moins que la loi détermine d'une manière générale à qui elles doivent passer après lui ; et il est naturel que ce soit à ses proches. Alors hériter devient un nouveau moyen d'acquérir, et qui plus est, ou plutôt qui pis est, un moyen d'acquérir sans travail. Cependant tant que là société n'a pas occupé tout l'espace dont elle peut disposer, tous prospèrent encore facilement. Car ceux qui n'ont que leurs bras et qui ne trouvent pas un emploi assez avantageux de leur travail peuvent aller s'emparer d'un de ces terrains qui n'ont point de maîtres, et en tirer un profit d'autant plus considérable qu'ils ne sont point obligés de le louer ni de l'acheter. Aussi l'aisance est elle générale chez les nations nouvelles et [180] industrieuses. Mais quand une fois tout le pays est rempli, quand il ne reste plus un champ qui n'appartienne à personne, c’est alors que la presse commence. Alors ceux qui n'ont aucune avance ou qui en ont de trop faibles ne peuvent faire autre chose que se mettre à la solde de ceux qui en ont de suffisantes [36]. Ils offrent leur travail de toutes parts ; il baisse de prix. Cela ne les empêche pas encore de faire des enfants et de multiplier imprudemment ; bientôt ils deviennent trop nombreux. Alors il n'y a plus parmi eux que les plus habiles et les plus heureux qui puissent se tirer d'affaire. Tous ceux dont les services sont les moins recherchés ne trouvent plus à se procurer que la subsistance la plus stricte, toujours incertaine et souvent insuffisante. Ils deviennent presque aussi malheureux que s'ils étaient encore sauvages.
C'est cette classe disgrâciée de la fortune que beaucoup d'écrivains économistes appellent les non-propriétaires. Cette expression est vicieuse sous plusieurs rapports. Premièrement il n'y a pas de non-propriétaires si l'on entend par là des hommes tout à fait étrangers au droit de propriété. Ceux dont nous parlons sont plus ou moins pauvres, mais ils possèdent tous quelque chose et ils ont besoin [181] de le conserver. Quand ils ne seraient propriétaires que de leur individu de leur travail et du salaire de ce travail, ils auraient un grand intérêt à ce que cette propriété fût respectée. Elle n'est que trop souvent violée dans beaucoup de règlements faits par des gens qui ne parlent que de propriété et de justice. Quand une chose est dans la nature, nul ne peut y être étranger. Cela est si vrai du droit de propriété, que le filou même que l'on va punir pour l'avoir violé, si on ne le retranche pas tout à fait de la société, a intérêt que ce droit soit respecté. Car le lendemain du jour qu'il aura subi sa punition, il ne pourrait être sûr de rien de ce qui lui restera si la propriété n'était pas protégée.
Secondement, les mêmes écrivains n'appellent souvent propriétaires, par opposition aux prétendus non-propriétaires, que les possesseurs de fonds de terre. Cette division est tout à fait fausse et ne présente aucun sens. Car nous avons vu qu'un fonds de terre n'est qu'un capital comme un autre, comme la somme d'argent qu'il a coûté, comme tout autre effet de même valeur. On peut être très pauvre en possédant un petit champ, et très riche sans avoir en propre un pouce de terre. Il est donc ridicule d'appeler propriétaire le possesseur d'un méchant enclos, et de refuser ce titre à un millionnaire. Il serait plus raisonnable de partager la société en pauvres et en riches, si l'on savait où placer la ligne de démarcation ; mais quand cette division serait moins arbitraire, elle n'en serait pas moins illusoire [182] sous le rapport de la propriété ; car encore une fois le pauvre a autant d'intérêt à conserver ce qu'il a, que l'homme le plus opulent.
Une distinction plus réelle, eu égard à la différence des intérêts, serait entre les salariés d'une part, et de l'autre ceux qui les emploient, soit consommateurs, soit entrepreneurs. Ceux-ci sous ce rapport peuvent être regardés comme des consommateurs de travail. Cette classification aurait sans doute l'inconvénient de réunir des choses très différentes, comme par exemple de ranger parmi les salariés un ministre d'État avec un journalier, et de mettre parmi les consommateurs le moindre maître ouvrier comme l'oisif le plus riche. Mais enfin il est certain que tous les salariés ont intérêt d'être payés cher, et que tout ceux qui les emploient ont intérêt de les payer à bon marché. Il est vrai pourtant que l'entrepreneur qui a intérêt de peu payer les salariés, a lui-même, le moment d'après, l'intérêt d'être beaucoup payé par le consommateur définitif, et il est vrai surtout que nous sommes tous plus ou moins consommateurs, car le plus pauvre journalier consomme des denrées qui ont été produites par d'autres salariés. Sur quoi je fais deux réflexions.
Premièrement, l'intérêt des salariés étant celui du très grand nombre, et l'intérêt des consommateurs étant celui de tous, il est assez singulier que les gouvernements modernes soient toujours prêts à sacrifier d'abord les salariés aux entrepreneurs en gênant ceux-là par des maîtrises, des jurandes et [183] d'autres règlements, et ensuite à sacrifier les consommateurs à ces mêmes entrepreneurs en accordant à ceux-ci des privilèges et quelquefois même des monopoles.
Secondement, je remarque que, bien que chacun de nous ait des intérêts particuliers, nous changeons si fréquemment de rôles dans la société, que souvent nous avons sous un aspect un intérêt contraire à celui que nous avons sous un autre, de manière que nous nous trouvons liés avec ceux à qui nous étions opposés le moment d'auparavant, ce qui fait heureusement que nous ne pouvons pas former des groupes constamment ennemis ; mais surtout j'observe qu'au milieu de tous ces conflits momentanés, nous sommes tous et toujours réunis par les intérêts communs et immuables de propriétaires et de consommateurs, c'est-à-dire que nous avons tous et toujours intérêt, 1° que la propriété soit respectée ; 2° que l'industrie se perfectionne, ou, en d'autres termes, que la fabrication et le transport se fassent le mieux possible. Ces vérités sont utiles pour bien comprendre le jeu de la société et pour en bien sentir tous les avantages. C'est le désir de les mettre en évidence qui m'a fait entrer dans ces détails. Revenons à l'histoire de la distribution des richesses, dont ils nous ont écartés, quoiqu'ils n'y soient pas étrangers.
J'ai un peu hâté ci-dessus le moment où la détresse commence à se faire sentir au sein des sociétés nouvelles, en le fixant à l'instant où tout terrain a un maître, et où ou ne peut plus s'en [184] procurer sans l’acheter ou le louer. Certainement à cette époque un grand moyen d'aisance est épuisé ; le travail perd une occasion de s'employer d'une manière extrêmement avantageuse, et la masse des subsistances cesse de s'accroître aussi rapidement, parce qu'il ne peut plus être question d'établir des cultures nouvelles, mais seulement de perfectionner les anciennes, chose toujours plus difficile et moins fructueuse qu'on ne le veut croire communément. Cependant il reste encore d'immenses ressources. Tous les arts en offrent a l'envi, surtout si la race d'homme qui forme la nouvelle société sort d'une nation industrieuse et éclairée, et si elle a des relations avec d'autres pays civilisés ; car alors il ne s'agit pas d'inventer et de découvrir, ce qui est toujours très lent, mais de profiter de ce que l'on connaît, et de mettre en pratique ce que l'on sait, ce qui est fort aisé.
En effet, tant que l'agriculture a offert de si grands avantages, tous les hommes inoccupés, ou pas assez fructueusement occupés à leur gré, se sont portés de ce côté. Il n'a été question que d'extraire les productions de la terre et de les exporter. Observez que sans la facilité de l'exportation, les progrès de la culture eussent été beaucoup moins rapides. Mais avec cette circonstance elle a enlevé tous les bras. À peine des salaires excessivement forts ont-ils pu déterminer un nombre suffisant d'individus à rester attachés à la profession des autres arts les plus nécessaires. Mais pour toutes les choses qu'il n'est pas indispensable de fabriquer [185] dans le pays même ou on les consomme, il a été plus économique de les tirer même de très loin, et on n'y a pas manqué. Aussi le commerce de ces nations naissantes consiste d'abord uniquement à exporter des produits bruts, et à importer des objets manufacturés.
Or, qu'arrive-t-il à l'époque dont nous parlons, quand tout le territoire est occupé ? L'agriculture n'offrant plus un moyen de fortune rapide, les hommes qui s'y seraient livrés se répandent dans les autres professions ; ils offrent leur travail ; ils se nuisent les uns aux autres. Les salaires baissent, à la vérité ; mais bien avant qu'ils soient devenus aussi faibles que dans les pays anciennement civilisés d'où l'on tire les objets manufacturés, il commence à y avoir du bénéfice à fabriquer dans le pays même la plupart de ces objets. Car c'est un grand avantage pour un manufacturier d'être à portée des consommateurs, et de n'avoir à redouter pour ses marchandises ni les frais, ni les dangers d'un long voyage, ni les inconvénients qui résultent de la lenteur ou de la difficulté des communications ; et cet avantage est plus que suffisant pour compenser un degré de cherté dans la main-d’œuvre. Il s'établit donc des fabriques de tous genres. Plusieurs d'entre elles, à l'aide de quelques circonstances favorables, après avoir fourni à la consommation intérieure, s'ouvrent même des débouchés au-dehors, et donnent naissance à de nouvelles branches de commerce. Tout cela occupe une nombreuse population qui vit des produits du sol, que l’on n'exporte plus alors [186] en aussi grande quantité, parce qu'ils n'ont pas augmenté dans la même proportion. Cette nouvelle industrie est longtemps croissante comme l'a été l'industrie agricole, qui s'est développée la première ; et tant qu'elle croît, elle entretient sinon la richesse, du moins l'aisance dans les dernières classes du peuple [37]. Ce n'est que quand elle devient stationnaire ou rétrograde que la misère commence, parce que, tous les emplois lucratifs étant remplis sans possibilité d'en créer de nouveaux, il y a partout plus d'offre du travail qu'il n'y a de demande. Alors il est inévitable que les moins habiles ou les moins heureux d'entre les travailleurs ne trouvent point d'ouvrage, ou ne reçoivent qu'un salaire insuffisant pour celui qu'ils font. Il faut nécessairement que beaucoup d'eux languissent et même périssent, et qu'il existe constamment un grand nombre de misérables. Tel est le triste état des vieilles nations. Nous pourrons voir bientôt par quelles causes elles y [187] arrivent plus tôt qu'elles ne devraient, et par quels moyens on pourrait y remédier jusqu'à un certain point ; mais auparavant, quelques explications sont encore nécessaires.
En effet, j’ose croire que le tableau que je viens de tracer de la marche des sociétés depuis leur naissance est frappant de vérité. Il n'y a là ni système fait à plaisir, ni théorie établie d'avance ; c'est le simple exposé des faits. Chacun peut regarder et voir si ce n'est pas ainsi qu'ils se présentent à l'œil non prévenu. On peut même observer que j'ai peint une nation heureusement placée, jouissant de toutes sortes d'avantages et en usant bien ; et cependant nous arrivons à cette pénible conclusion que son état de pleine prospérité est nécessairement transitoire. Pour se rendre raison d'un phénomène si affligeant, il n'est pas possible de s'en tenir à ces mots vagues de dégénération, de corruption, de vieillesse des nations (comme si un être abstrait pouvait être réellement vieux ou jeune comme un individu vivant), toutes expressions métaphoriques dont on a étrangement abusé, dont on s'est souvent contenté faute de mieux, mais qui dans le vrai n'expliquent rien et qui, si elles avaient un sens précis, exprimeraient plutôt des effets que des causes. Il faut donc pénétrer plus avant. Tout événement inévitable a sa cause dans la nature. La cause de celui-ci est la fécondité de l'espèce humaine. Ainsi il faut nous occuper de la population, et ensuite nous reprendrons l'examen de la distribution des richesses.
[189]
CHAPITRE IX.↩
De la Multiplication des individus, ou de la Population.
L'amour est une passion qui trouble si violemment nos têtes, qu'il n'est pas étonnant que nous nous soyons souvent mépris sur tous ses effets. J'avoue que je ne partage pas plus le zèle des moralistes pour diminuer et gêner nos plaisirs, que celui des politiques pour accroître notre fécondité et accélérer notre multiplication. Tout cela me paraît également contraire à la raison. Quand il en sera temps, je pourrai développer mes opinions sur le premier point ; dans ce moment il ne s'agit que du second. Commençons par établir les faits en portant nos regards sur tout ce qui nous environne.
Sous ce rapport comme sous tous les autres, nous voyons la nature uniquement occupée des espèces, et nullement des individus. Sa fécondité est telle dans tous les genres, que si la presque totalité des germes qu'elle produit n'avortait pas, et si la très majeure partie des êtres qui naissent ne périssait pas presque tout de suite faute d'aliments, en très peu de temps une seule espèce de plantes suffirait, pour couvrir toute la terre, et une seule espèce d'animaux pour la peupler tout entière. L'espèce humaine est soumise à la loi commune, quoique peut-être à un moindre degré que bien d'autres L'homme est entraîné à la reproduction par le plus violent et le plus impérieux de ses penchants. Un [189] homme et une femme arrivés à un âge fait, bien constitués, et environnés des moyens de pourvoir abondamment à tous leurs besoins, peuvent produire et élever beaucoup plus d'enfants qu'il n'en faut pour les remplacer sur la scène du monde ; et si leur carrière n'est pas abrégée par quelque accident imprévu, ils meurent entourés d'une nombreuse famille qui va toujours croissant. Aussi la race humaine, quand les circonstances lui sont favorables, se multiplie très rapidement. La preuve en est les États-Unis de l'Amérique septentrionale, dont la population totale double en vingt ans, et dans quelques endroits en quinze et même en douze, sans que l'immigration y soit presque pour rien, et sans que la fécondité des femmes y soit plus grande qu'ailleurs. Encore faut-il remarquer au contraire que, quelle qu'en soit la raison, les longévités sont rares dans ce pays ; en sorte que la durée moyenne de la vie y serait plus courte que dans la plus grande partie de l'Europe, sans la grande quantité d'enfants que la misère fait périr en bas âge dans cette Europe. Voilà une donnée incontestable sur laquelle nous pouvons nous appuyer.
S'il en est ainsi, pourquoi donc la population est-elle stationnaire et quelquefois rétrograde dans tant de pays même très sains, même très fertiles ? Ici il faut se rappeler la distinction que nous avons déjà établie au chapitre IV, entre nos moyens d'existence et nos moyens de subsistance. Ceux-ci sont les matières alimentaires dont nous nous nourrissons ; ils sont le partie la plus nécessaire de nos [190] moyens d'existence, mais ils n'en soit qu'une partie. Il faut entendre par ces derniers tout ce qui contribue à nous défendre contre tous les dangers et toutes les souffrances de tout genre : ainsi ils consistent dans toutes les ressources quelconques que nous fournissent nos arts et nos sciences, c'est-à-dire la masse entière de nos connaissances. Cette distinction bien comprise, nous pouvons établir en thèse générale, que la population est toujours proportionnée aux moyens d'existence ; et ce principe unique va nous donner l'explication de tous les faits et de toutes leurs circonstances.
Chez les peuples sauvages, la population non seulement est stationnaire, mais elle est peu nombreuse, parce que leurs moyens d'existence sont très faibles. Indépendamment de ce qu'ils manquent fréquemment de subsistances, ils n'ont ni les commodités suffisantes ni les attentions nécessaires pour élever leurs enfants ; aussi la plupart périssent. Ils ne savent se défendre ni contre la rigueur des saisons, ni contre l'insalubrité du climat, ni contre les épidémies qui souvent emportent les trois quarts d'une peuplade. N'ayant aucune idée saine de l'état social, les guerres sont continuelles et destructives ; les vengeances sont atroces ; les femmes, les vieillards, sont souvent abandonnés. Ainsi c'est le malheur et la souffrance qui rendent inutile parmi eux la fécondité de l'espèce, et qui peut-être la diminuent.
Les peuples civilisés ont toutes les ressources qui manquent aux autres. Aussi leur population devient [191] nombreuse plus ou moins promptement. Mais on la voit s'arrêter partout, quand elle s'est accrue au point que beaucoup d'hommes ne peuvent plus se procurer par leur travail des salaires suffisants pour élever leurs enfants et se soigner eux-mêmes convenablement. Si en général elle est encore un peu progressive, quoique bien lentement, dans l'état actuel de nos vieilles sociétés, c’est parce que les arts et les sciences, et notamment la science sociale, y étant constamment cultivés plus ou moins bien, leurs progrès ajoutent toujours de temps en temps quelques petites facilités aux moyens de vivre, et ouvrent quelques nouveaux débouchés au commerce et à l'industrie. Il est si vrai que les choses se passent ainsi, que quand, par quelques causes naturelles ou politiques, de grandes sources de profits viennent à diminuer dans un pays, tout de suite la population devient rétrograde ; et au contraire, quand elle a été diminuée brusquement par de grandes épidémies ou des guerres cruelles, sans que les connaissances aient souffert, elle reprend très promptement son niveau, parce que, le travail étant plus demandé et plus payé, le pauvre a plus de moyens de conserver ses enfants et de se conserver lui-même.
Si de ces observations générales nous passons à des faits particuliers ; nous en trouverons la raison avec la même facilité. Prenons pour premier exemple la Russie. Je ne prétends faire ni l'éloge ni la satire de cette nation, que je ne connais pas. Mais on peut bien assurer qu'elle n'est pas plus habile que les autres nations européennes. Cependant il est [192] prouvé que sa population croît plus rapidement que celles des autres États de l'Europe. C'est parce qu'elle a de grandes étendues de terrain, qui, n'ayant point encore de maîtres, offrent de grands moyens d'existence à ceux qui s'y transplantent ou qu'on y transporte ; et si cet immense avantage n'y produit pas une multiplication des hommes aussi rapide qu'aux États-Unis, c'est que son organisation sociale et son industrie sont loin d'être aussi parfaites. Les pays fertiles, toutes choses égales d'ailleurs, sot plus peuplés que les autres, et réparent facilement leurs désastres, parce que la terre y fournit de grands moyens, c'est-à-dire que le travail qui s'applique à la terre y est très fructueux. Aussi la Lombardie et la Belgique, tant de fois ravagées, sont toujours florissantes. Cependant la Pologne, très fertile aussi, est peu peuplée et stationnaire, parce que ses habitants, étant serfs et misérables, ont, au milieu de l'abondance, de très faibles moyens d'existence. Mais supposez pour un moment le petit nombre d'hommes, à qui ces serfs appartiennent, et qui dévorent la substance, chassés du pays, et la terre devenue la propriété de ceux qui la cultivent, vous les verrez promptement devenir industrieux et multiplier rapidement. Deux autres pays en général assez bons, la Westphalie et même la Suisse, malgré que celle-ci ait des lois plus sages, sont assez peu peuplés faute d'industrie ; tandis que Genève, Hambourg, toute la Hollande, le sont excessivement. Au contraire, l'Espagne, qui est une contrée délicieuse, a très peu d'habitants relativement à son étendue. [193] Cependant il a été constaté que pendant les quarante ou cinquante années qui ont précédé le commencement de la malheureuse guerre actuelle, sa population faisait des progrès très sensibles, parce qu'on était parvenu. à débarrasser son industrie de quelques entraves, et à accroître un peu ses lumières. Il est donc bien prouvé que la population est toujours proportionnée aux moyens d'existence.
Cette vérité a déjà été avouée par beaucoup d'écrivains politiques. Mais on voit dans leurs ouvrages qu'ils n'en ont pas senti toute l'étendue. M. Say, que j'ai déjà cité, et que j'aurais pu citer bien des fois, est, je crois, le premier qui ait dit nettement, dans son livre 1er, chap. XLVI, que rien ne peut accroître la population que ce qui favorise la production, et que rien ne peut la diminuer, au moins d'une manière permanente, que ce qui attaque les sources de la production : et observez que M. Say entend par production, production d'utilité. C'est même d'après lui que j'en ai donné cette idée. Or, produire, dans ce sens, c'est bien ajouter à nos moyens d'existence ; car tout ce qui est utile pour nous est un moyen de pourvoir à nos besoins ; et même rien ne mérite le nom d'utile que par cette raison. Ainsi le principe de M. Say est exactement le même que celui que j'ai établi. Aussi en tire-t-il cette conclusion très juste, qu'il est absurde de prétendre influer sur la population par des encouragements directs, par des lois sur les mariages, par des primes accordées aux nombreuses familles, etc., etc. Il se moque avec raison, à ce [194] sujet, des fameuses ordonnances d'Auguste, de Louis XIV, et de tant d'autres législateurs trop vantés. Ce sont en effet de très fausses mesures qui ne pouvaient augmenter en rien la population. Et il ajoute, très justement à mon avis, qu'au contraire le moindre des règlements nuisibles à l'industrie faits par ces mêmes princes pouvait et devait diminuer le nombre des hommes. Je pense absolument de même.
M. Malthus va beaucoup plus loin encore. Il est, au moins à ma connaissance, de tous les auteurs qui ont écrit sur la population, celui qui a le plus approfondi le sujet, et qui en a le mieux développé toutes les conséquences. Son ouvrage, singulièrement remarquable, doit être regardé comme le dernier état de la science sur cet important objet ; et il n'y laisse presque rien à désirer.
M. Malthus ne se borne point à prouver que, bien que la population s'arrête à différents degrés dans les différents, pays, et suivant les différentes circonstances, elle est toujours, et partout, aussi grande qu'elle peut l'être, eu égard aux moyens d'existence. Il montre que toujours chez les nations civilisées, elle est trop grande pour le bonheur des hommes, parce que l'homme, et surtout le pauvre, qui fait partout le grand nombre, entraîné par ce besoin si impérieux de la reproduction, multiplie toujours imprudemment et sans prévoyance, et se plonge lui-même dans une misère inévitable, en multipliant les hommes qui demandent de l'occupation, et à qui l’on ne peut en donner. Tout ce qu'il avance est [195] appuyé, non pas seulement sur des raisonnements convaincants, mais sur des tables des morts, des naissances, des mariages, de la durée moyenne de la vie, et de la population totale, recueillies dans différents pays et discutées avec soin.
J'ajoute ce dernier point (discutées avec soin) comme très nécessaire. Car il faut observer premièrement que toutes ces données, non seulement sont souvent inexactes, mais que, même exactes, elles demandent à être examinées attentivement, et comparées les unes aux autres avec beaucoup de sagacité, avant d'en tirer des conséquences, sans quoi elles conduiraient à de graves erreurs. Secondement, que, quelque imparfaits que soient ces documents, ils n'existent que dans peu de pays, et depuis peu de temps ; en sorte qu'en économie politique comme en astronomie, on doit très peu compter sur les observations anciennes ou éloignées. Même en France, les simples registres mortuaires ne méritent presque aucune confiance avant 1700 ; et aucune des autres circonstances importantes n'a été recueillie. Aussi, dans les exemples de population que j'ai cités ci-dessus, je n'ai point fait mention de ce qu'on nous raconte de certaines contrées de l'Orient et de quelques peuples anciens ou du moyen âge. Si la Chine, si l'Espagne du temps des Romains, sont ou ont été aussi peuplées qu'on nous le dit, il faut bien qu'il y ait des raisons locales, de ce fait. Mais nous n'avons aucun moyen de le connaître suffisamment pour en bien voir les causes et oser en tirer des conséquences. Il en est de même de toutes [196] les parties de l'économie politique et domestique des anciens, fondée presque uniquement sur l'usage de l'esclavage et les profits ou les pertes de la guerre, et très peu sur le développement libre et paisible de l'industrie. C'est tout à fait un autre ordre de choses que nos sociétés modernes. Quant au prodigieux nombre d'hommes que quelques auteurs prétendent avoir existé en France, par exemple sous Charles V ou sous Charles IX, dans le quatorzième et le seizième siècles, c'est-à-dire dans des temps où l'industrie était aussi grossière et l'ordre social aussi mauvais que nous l'avons vu encore en Pologne au dix-huitième siècle, je crois que la seule réponse à faire à ces assertions est celle que j'ai opposée à la merveilleuse union qui régnait, dit-on, à Sparte, c'est que cela n'est pas vrai, parce que cela est impossible.
Quoi qu'il en soit, tous ceux qui ont réfléchi sur ces matières conviennent que la population est toujours proportionnée aux moyens d'existence. M. Say en conclut avec raison qu'il est absurde de croire pouvoir augmenter la population autrement qu'en augmentant ces moyens ; et M. Malthus prouve de plus qu'il est barbare de chercher à augmenter cette population toujours trop grande, dont l'excès est la source de touts les misères ; et que même, sous le rapport de la puissance, les chefs des nations y perdent. Car puisqu'ils ne peuvent pas faire vivre en même temps plus d'hommes qu'ils n’en peuvent sustenter, en multipliant les naissances ils ne font que multiplier les morts prématurées, [197] et augmenter la quantité des enfants en proportion de celle des adultes, ce qui produit une population plus faible à nombre égal. L'intérêt des hommes, sous tous les rapports, est donc de diminuer les effets de leur fécondité.
Je n'en dirai pas davantage sur ce sujet, qui n'est que trop clair par lui-même, et qui pourtant a donné lieu à de si fausses opinions avant qu'il fût approfondi ! Laissons au temps à les détruire…
CHAPITRE X.↩
Conséquences et développements des deux chapitres précédents.
Revenons toujours au point de départ. L'être animé, et spécialement l'homme, est doué de sensibilité et d'activité [38], de passion et d'action, c'est-à-dire de besoins et de moyens. Tant que nous nous sommes occupés de la manière dont se forment nos richesses, nous avons pu être charmés de notre puissance, de l'étendue de nos moyens. En effet, ils sont suffisants pour faire prospérer l'espèce et lui donner un très-grand accroissement en [198] nombre et en forces. Un homme et une femme ineptes et à peine formés peuvent finir par couvrir toute la terre d'une population nombreuse et industrieuse. Ce tableau est très satisfaisant ; mais il change bien de couleur quand, de l'examen de la formation de nos richesses, nous passons à celui de leur distribution entre les divers individus. Là nous retrouvons partout la supériorité des besoins sur les moyens, la faiblesse de l'individu et ses souffrances inévitables. Mais ce second aspect du même objet ne doit ni nous révolter ni nous décourager. Nous sommes ainsi faits. Telle est notre nature. Il faut nous y soumettre, et en tirer le meilleur parti possible en usant habilement de tous nos moyens, et en évitant les fautes qui aggraveraient nos maux.
Les deux chapitres que nous venons de lire, quoique très courts, renferment des faits importants ; et joints aux explications antérieures, ils nous donnent des notions assez sûres sur nos vrais intérêts. Il ne s'agit que d'en profiter.
Nous avons vu qu'il fallait nous résoudre à laisser subsister entre nous opposition d'intérêts et inégalité de moyens, et que tout ce que nous pouvions faire de mieux était de laisser à chacun le plus libre emploi de ses facultés, et d'en favoriser le plus entier développement.
Nous avons vu de plus que cet emploi et ce développement de facultés, quoique profitant inégalement aux divers individus, réussissait à les amener tous au plus grand bien-être possible, tant que [199] l'espace, la plus grande de toutes les ressources, ne leur manquait pas ; et que quand tout l'espace est occupé, d'autres ressources subsidiaires suffisaient pour entretenir longtemps encore un grand état de prospérité générale.
Nous avons vu aussi qu'une fois arrivés au moment de l'encombrement et de la gêne, il était inévitable que ceux qui avaient le moins de moyens ne pussent se procurer, par l'emploi de ces moyens, que la satisfaction stricte des besoins les plus urgents.
Nous avons vu enfin que, la multiplication des hommes continuant dans toutes les classes de la société, le superflu des premières était successivement rejeté dans les classes inférieures, et que celui de la dernière n'ayant plus où se reporter, était nécessairement détruit par la misère. C'est là ce qui cause l'état stationnaire ou même rétrograde de la population, partout où on l'observe tel, malgré la grande fécondité de l'espèce.
Ce dernier fait, la population à peu près stationnaire chez toutes les nations arrivées a un certain degré de développement, a été longtemps sans être presque remarqué, parce que ce n'est que très récemment que l'on s'occupe avec quelque succès de l'économie sociale ; il a même été voilé par les commotions politiques qui y ont produit des perturbations, et déguisé par les monuments infidèles ou insuffisants de l'histoire qui ont autorise à le méconnaître ; enfin quand il a été suffisamment observé et constaté, on a eu de la peine à l'attribuer à sa [200] véritable cause, parce que l'on n'avait pas une idée assez nette de la marche de la société et de la manière dont se forment ses richesses et sa puissance. Aujourd'hui il me semble que nous pouvons mettre tout cela hors de doute.
Rappelons-nous que la société est partagée en deux grandes classes : celle des hommes qui, sans voir aucune avance, travaillent moyennant un salaire ; et celle des hommes qui les emploient. Cela se manifeste que les premiers, pris en masse, ne vivent journellement et annuellement que sur ce que la totalité des seconds a à leur distribuer chaque jour et chaque année. Or, ceux-ci sont de deux espèces. Les uns vivent de leur revenu sans travail ce sont les prêteurs d'argent, les loueurs de fonds, de terres et de maisons, en un mot les rentiers de toutes sortes. Ces hommes-là, il est bien clair qu'à la longue ils ne peuvent donner pendant une année à tous les gens qu'ils emploient, que le montant de leurs revenus, sans quoi ils entameraient leurs fonds ; Il y en a toujours un certain nombre qui en usent ainsi et qui se ruinent. Leur consommation diminue ou cesse ; mais elle est remplacée par celle de ceux qui s'enrichissent, et le total est le même. Ce n'est là qu'un changement de main, dont même la quantité ordinaire peut s'évaluer peu près dans les différents pays. Ces hommes pris en masse ne font point de profit. Ainsi la somme totale de leurs revenus, que se partagent les salariés, est une quantité constante. Si elle fait quelques progrès insensibles, ce ne peut être que par l'amélioration [201] lente de l'agriculture, qui, faisant rendre aux terres un peu plus de production, met à même d'augmenter un peu leurs baux. Car pour la rente de leur argent prêté, elle ne varie point. Si même elle augmentait par la hausse de l'intérêt, ce serait un malheur qui, nuisant à beaucoup d'entreprises, diminuerait bien davantage les facultés de la seconde espèce de personnes qui alimentent les salariés.
Cette seconde espèce de personnes se compose de ceux qui joignent au produit de leurs capitaux celui de leur activité personnelle, c'est-à-dire des entrepreneurs d'une industrie quelconque. On dira que ceux-là font des profits et augmentent annuellement leurs moyens. Mais premièrement cela n'est pas vrai de tous. Beaucoup au contraire font mal leurs affaires et diminuent au lieu le croître. Secondement, ceux qui prospèrent cessent de travailler au bout d'un certain temps, et vont remplir les vides qu'opèrent journellement, dans la classe de ceux qui vivent sans rien faire, la chute des prodigues qui en sortent pour avoir mal ménagé leur fortune. Troisièmement enfin, et ceci est décisif, cette classe des entrepreneurs d'industrie a des limites nécessaires qu'elle ne peut franchir. Pour former une entreprise quelconque, il ne suffit pas d'en avoir l'envie et les moyens : il faut trouver à placer ses produits d'une manière avantageuse qui dédommage et au-delà des frais qu'ils coûtent. Une fois que tous les emplois profitables sont remplis, on n'en peu plus créer de nouveaux sans que d'autres [202] ne se détruisent, à moins qu'ils ne s'ouvre quelques nouveaux débouchés. Ce second fonds de l'entretien des salariés est donc aussi, dans nos anciennes sociétés, une quantité à peu près constante comme le premier.
Les choses étant ainsi, on voit clairement pourquoi le nombre des salariés n'augmente plus quand le fonds qui peut pourvoir à leur entretien cesse de croître. C'est que tout ce qui naît au- delà du nombre suffisant s'éteint faute de moyens d'existence. Cela est très aisé à concevoir. On comprend même qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Car chacun sait que si quatre personnes ont à partager journellement un pain à peine suffisant pour deux, les plus faibles périront, et les plus forts ne subsisteront que parce que bientôt ils hériteront de la part des autres.
Si ensuite l'on songe que quand les hommes qui vivent uniquement de leurs revenus se multiplient assez pour que ce revenu ne leur suffise plus, ils rentrent dans la classe de ceux qui joignent leur travail au produit de leurs fonds, c'est-à-dire de ceux que nous avons appelés entrepreneurs d'industrie, et que quand ceux-ci à leur tour deviennent trop nombreux, beaucoup se ruinent et retombent dans la classe des salariés ; on verra que cette dernière classe reçoit pour ainsi dire le trop plein de toutes les autres, et que par conséquent les limites qu'elle ne peut franchir sont celles de la population totale.
Ce seul point bien éclairci nous donne l'explication [203] de tous les phénomènes relatifs à la population. Il nous montre pourquoi elle est rétrograde dans un pays, stationnaire dans un autre, tandis qu'elle est rapidement progressive dans un troisième ; pourquoi elle s'arrête tantôt plus tôt, tantôt plus tard, suivant le degré d'intelligence et d'activité des différents peuples, et la nature de leurs gouvernements ; pourquoi elle se rétablit promptement après de grandes calamités passagères, quand les moyens d'existence ne sont pas détruits ; pourquoi, au contraire, sans secousses violentes, elle languit quelquefois et dépérit graduellement par des causes difficiles à apercevoir, par le seul changement d'une circonstance peu remarquable. En un mot, il nous donne la solution de toutes les questions de ce genre, et de plus il nous fournit les moyens d'en tirer une infinité de conséquences importantes. Je ne suis embarrassé que de leur nombre, et du choix de celles auxquelles je dois m'arrêter.
Je commencerai par remarquer avec satisfaction que l'humanité, la justice et la politique veulent également que, de tous les intérêts, celui du pauvre soit toujours le plus consulté et le plus constamment respecté ; et par les pauvres j'entends les simples salariés, et surtout ceux dont le travail est le moins payé.
D'abord l'humanité ; car il faut bien prendre garde que quand il s'agit du pauvre, le mot intérêt a un tout autre degré d'énergie que quand on parle des hommes dont les besoins sont moins urgents et [204] quelquefois même sont imaginaires. Tous les jours nous disons que les intérêts d'un ministre sont contraires à ceux d'un autre ; que tel corps a des intérêts opposés à ceux de tel autre corps ; qu'il est de l'intérêt de certains entrepreneurs que les matières premières se vendent cher, et de l'intérêt de quelques autres de les acheter à bon marché ; et souvent nous nous passionnons pour ces motifs comme s'ils en valaient la peine. Cependant cela veut dire seulement que quelques hommes croient, et souvent à tort, avoir un peu plus ou un peu moins de jouissances dans certaines circonstances que dans d'autres. Le pauvre, dans sa petite sphère, a aussi assurément des intérêts de ce genre ; mais ils disparaissent devant de plus grands. On ne les aperçoit seulement pas. Et quand on s'occupe de lui, il s'agit presque toujours de la possibilité de son existence ou de la nécessité de sa destruction, c'est-à-dire de sa vie ou de sa mort. L'humanité ne permet pas de mettre de pareils intérêts en balance avec de simples convenances.
La justice s'y oppose également, et de plus elle nous oblige à prendre en considération le nombre des intéressés. Or, comme la dernière classe de la société est partout la plus nombreuse de beaucoup, il s'ensuit que toutes les fois qu'elle se trouve en opposition avec les autres, c'est toujours ce qui lui est utile qui doit être préféré.
La politique nous amène au même résultat ; car il est bien convenu qu'il est utile à une nation, d'être nombreuse et puissante. Or, il vient d'être [205] prouvé que l'extension que peut prendre la dernière classe de la société est ce qui détermine la limite de la population totale ; et il ne l'est pas moins par l'expérience de tous les temps et de tous les pays, que partout où cette dernière classe est trop malheureuse, il n'y a ni activité, ni industrie, ni lumières, ni véritable force nationale ; on peut même dire ni tranquillité intérieure bien assurée.
Cela posé, examinons quels sont les véritables intérêts du pauvre, et nous trouverons qu'effectivement ils sont toujours conformes à la raison et à l'intérêt général. Si on les avait toujours étudiés dans cet esprit, ou se serait fait des idées plus saines de l'ordre social, et on n'aurait pas éternisé la guerre tantôt sourde, tantôt déclarée, qui a toujours existé entre les pauvres et les riches. Les préjugés font naître ces difficultés, la raison seule les dénoue.
Nous avons déjà vu que le pauvre est aussi intéressé au maintien du droit de propriété que le citoyen le plus opulent car le peu qu'il possède est tout pour lui, et par conséquent infiniment précieux à ses yeux ; et il n'est sûr de rien qu'autant que la propriété est respectée. Il a même encore une autre raison de le désirer ; c'est que le fonds sur lequel il vit, la somme des capitaux de ceux qui l'emploient, est considérablement diminuée quand les propriétés ne sont pas assurées. Ainsi il a un intérêt direct non seulement à la conservation de ce qu'il possède, mais encore à la conservation [206] de ce que possèdent les autres. Aussi, malgré que par les funestes effets de la misère, de la mauvaise éducation, du manque de délicatesse et du ressentiment de l'injustice, il soit peut-être vrai de dire que c'est dans la dernière classe qu'il se commet le plus de délits [39], il est pourtant vrai aussi que, c'est dans celle-là que l'on a la plus haute idée du droit de propriété, et que le nom de voleur est le plus odieux. Mais quand vous parlez de propriété, comprenez sous ce nom, comme le pauvre, la propriété personnelle aussi-bien que là propriété mobilière et immobilière. La première est même encore plus sacrée, puisqu'elle est la source des autres. Respectez-la en lui, comme vous voulez qu'il respecte en vous celles qui en dérivent. Laissez-lui la libre disposition de ses facultés et de leur emploi, comme vous voulez qu'il vous laisse celle de vos biens-fonds et de vos capitaux. Cette règle est aussi politique que juste et que mal observée.
Après la libre disposition de son travail, le plus grand intérêt du pauvre est que ce travail soit chèrement payé. Ici j'entends de violentes réclamations. Toutes les classes supérieures de la société, et sous ce rapport j'y comprends jusqu'au moindre chef d'atelier, désirent que les prix des salaires soient plus bas, afin de pouvoir se procurer plus de travail pour une même somme d'argent ; et elles le désirent [207] avec une telle fureur, que lorsqu'elles le peuvent et que les lois le leur permettent, elles emploient même la violence pour atteindre ce but ; et elles préfèrent le travail des esclaves ou des serfs, parce qu’il est encore à meilleur marche. Ces hommes ne manquent pas de dire et de persuader que ce qu'ils croient leur intérêt est l'intérêt général, et que le bas prix des salaires est absolument nécessaire au développement de l'industrie, à l'extension de la fabrication et du commerce, en un mot à la prospérité de l'État. Voyons ce qu'il y a de vrai dans ces assertions.
Je sais qu'il serait fâcheux que la main d'œuvre fût assez chère pour qu'il devint économique de tirer du dehors toutes les choses transportables car alors ceux qui les fabriquent souffriraient et s'éteindraient, et ce serait une population étrangère que les consommateurs soudoieraient et entretiendraient, au lieu d'une population nationale. Mais d'abord ce degré de cherté ne serait plus dans les intérêts du pauvre, puisque au lieu d'être bien payé, il manquerait d'ouvrage ; et de plus il est impossible, ou du moins il ne saurait durer, parce que d'une part les salariés baisseraient leurs prétentions dès qu'ils se verraient inoccupés ; et que de l'autre, si les prix des journées restaient encore assez élevés pour leur donner une grande aisance, ils multiplieraient bien vite assez pour être obligés de venir s'offrir au rabais. J'ajoute que si néanmoins la main- d'œuvre demeurait trop chère, ce ne serait plus à la rareté des ouvriers qu'il faudrait [208] s'en prendre, mais à la maladresse et à la malfaçon ; et alors ce serait la maladresse, l'ignorance et la paresse des hommes qu'il faudrait combattre. Ce sont effectivement là les vraies causes de la langueur de l'industrie, partout où elle se fait remarquer.
Mais où les rencontre-t-on, ces causes funestes ? N'est-ce pas toujours et contaminent là où la dernière classe du peuple est le plus misérable ? Ceci me fournit de nouvelles armes contre ceux qui croient si utile que le travail soit si mal payé. Je soutiens que leur avidité les aveugle. Voulez- vous vous en assurer ? Comparez les deux extrêmes, Saint-Domingue et les États-Unis de l'Amérique septentrionale ; ou plutôt, si vous voulez que les objets soient plus rapprochés, dans les États-Unis comparez ceux du nord à ceux du sud. Les premiers ne fournissent que des denrées très communes, la main-d’œuvre y est a un prix que l'on peut dire excessif ; pourtant ils sont pleins de vigueur et de prospérité, tandis que les autres restent dans la langueur et la stagnation, malgré qu'ils soient propres aux productions les plus précieuses, et qu'ils emploient l'espèce de travailleurs la plus mal payée, les esclaves.
Ce que nous montre cet exemple particulier, nous le voyons dans tous les temps et dans tous les lieux. Partout où la dernière classe de la société est trop malheureuse, son extrême misère et son abjection, qui en est la suite, est la mort de l'industrie, et le principe de maux infinis, même pour ses [209] oppresseurs. L'existence de l'esclavage chez les peuples anciens doit être regardée comme la source de leurs principales erreurs en économie, en morale et en politique, et la cause première pour laquelle ils n'ont jamais pu que flotter entre une anarchie turbulente et souvent féroce, ou une tyrannie atroce. L'esclavage des noirs ou des indigènes dans nos colonies, qui avaient tant de moyens de prospérité, est également la cause de leur langueur, de leur faiblesse, et des vices grossiers de leurs habitants. L'esclavage des serfs de glèbe, partout où il a existé, a également empêché le développement de toute industrie, de toute sociabilité, de toute force politique ; et de nos jours encore il a réduit la Pologne à un tel état de faiblesse, qu'une nation immense n'a existé longtemps que par la jalousie de ses voisins, et a fini par voir son territoire partagé aussi facilement que le patrimoine d'un particulier ; dès que les prétendants ont été d'accord entre eux. Si de ces cas extrêmes, sans nous arrêter aux fureurs des Cabochiens en France, aux excès de Jean de Leyde et de ses paysans en Allemagne, nous arrivons aux malheurs causés par la populace de Hollande, excitée par la maison d'Orange ; aux inquiétudes que donnent tous les jours les Lazzaronis de Naples et les Transtévérins de Rome ; et enfin aux embarras que cause même aujourd'hui en Angleterre l'énormité de la taxe des pauvres, et l'immensité de cette population misérable que rien ne peut retenir que les supplices ; je crois que tout le monde conviendra que quand une portion considérable de la société [210] est trop souffrante, et par suite trop abrutie, il n'y a ni repos, ni sûreté, ni liberté, possibles, même pour les puissants et les riches, et qu'au contraire ces premiers citoyens d'un État sont bien plus véritablement grands et heureux quand ils sont à la tête d'un peuple qui jouit d'une honnête aisance, laquelle développe en lui toutes les facultés morales et intellectuelles.
Au reste, je ne prétends pas conclure de là que le pauvre doive fixer violemment le prix qu'il peut exiger de son travail : nous avons vu que son premier intérêt est le respect de la propriété. Mais je répète que le riche ne doit pas non plus fixer ce prix d'autorité, qu'il doit lui laisser la plus libre et la plus entière disposition de ses faibles moyens ; et ici la justice prononce encore en sa faveur. Et j'ajoute que l'on doit se réjouir si l'emploi de ses moyens lui procure une honnête aisance, car la politique prouve que c’est le bien général.
Observons encore que s'il est juste et utile de laisser tout homme disposer de son travail, il l'est également et par les mêmes raisons, de lui laisser choisir son séjour. L'un est une conséquence de l'autre. Je ne connais rien de plus odieux que d'empêcher de sortir de son pays un homme qui y est assez mal pour désirer de le quitter malgré tous les sentiments de la nature et toutes les forces de l'habitude qui l'y retiennent. De plus, cela est absurde. Car puisqu'il est bien prouvé qu'il y a toujours dans un pays autant d'hommes qu'il peut y en exister dans les circonstances données, celui qui s'en [211] va ne fait autre chose que laisser sa place à un autre qui se serait éteint s'il fût demeuré. Vouloir qu'il reste, c'est comme si deux hommes étant enfermés dans une boîte où il n'y aurait assez d'air que pour un, on voulait qu'un des deux ou même tous deux y étouffassent, plutôt que de laisser sortir l'un ou l'autre. Loin que l'émigration soit un mal, elle n'est jamais un secours suffisant. On a toujours trop de peine à s'y déterminer. Pour qu'elle devienne un peu considérable, il faut que les vexations soit effroyables, et même alors le vide qu'elle opère est bientôt rempli comme celui qui résulte des grandes épidémies. Dans ces cas malheureux ce sont les souffrances des hommes dont il faut s'affliger, et non pas la diminution de leur nombre.
Quant à l'immigration, je n'en parle pas. Elle est toujours inutile et même nuisible, à moins qu'elle ne soit celle de quelques hommes qui apportent des lumières nouvelles. Mais alors ce sont leurs connaissances et non pas leurs personnes qui sont précieuses, et ces hommes-là ne sont jamais bien nombreux. On peut sans injustice défendre l'immigration, et c'est précisément à quoi les gouvernements n'ont presque jamais pensé. Il est vrai qu'ils se sont encore plus rarement avisés de donner beaucoup de motifs pour la désirer.
Après des salaires suffisants, ce qui importe le plus au pauvre, c'est que ces salaires soient constants. En effet, ce n'est pas une augmentation momentanée ou une exagération accidentelle de ses [212] profits qui peut améliorer son sort. L'imprévoyance est un de ses maux, et peut être le plus grand. Toujours une consommation désordonnée anéantit bientôt cet excédent extraordinaire de ressources, on une multiplication indiscrète le partage entre trop de têtes. Quand donc cet excédent vient, à cesser, il faut que ceux qui en vivaient s'éteignent, on que ceux qui en jouissaient se restreignent ; et dans ce dernier cas ce ne sont jamais les consommations les moins utiles qui cessent les premières, parce qu'elles sont les plus séduisantes. Alors la misère recommence dans toute son horreur avec un plus grand degré d'intensité. Ainsi on peut dire en thèse générale, que rien de ce qui est passager n'est réellement utile au pauvre. En cela encore il a les mêmes intérêts que le corps social.
Cette vérité exclut bien des fausses combinaisons politiques, surtout si on la joint à cette autre maxime tout aussi vraie, que rien de ce qui est forcé n'est durable ; elle nous apprend aussi qu'il est essentiel au bonheur de la masse d'une nation que le prix des denrées de première nécessité varie le moins possible, car ce n'est pas le prix du salaire en lui-même qui est important, c'est son prix comparé à celui des choses dont on a besoin pour vivre. Si avec deux sous de paie j'ai du pain suffisamment pour ma journée, je suis mieux nourri que si je recevais dix sous et qu'il m'en fallût douze pour que ma ration fût complète. Or, nous l'avons fait voir ci-dessus chapitre IV et ailleurs, à la longue le prix des salaires les plus faibles se règle et ne [213] peut pas manquer de se régler sur le pris des choses nécessaires à l'existence. Si le prix de ces choses nécessaires vient à diminuer subitement, les salariés profitent sans doute momentanément, mais sans utilité durable pour eux, comme nous venons de le dire. Ainsi cela n'est pas désirable. Si, au contraire, ce prix augmente, c'est bien pis, et les maux qui en résultent s'aggravent l'un l'autre. D'abord qui n'a que le nécessaire n'a rien à perdre ; ainsi tous les pauvres sont dans la détresse ; mais de plus, en vertu de cette détresse, ils font des efforts extraordinaires ; ils demandent plus à être employés, ou, en d'autres termes, ils offrent plus de travail. D'autres personnes qui vivaient sans travail ont besoin de cette ressource. On n'en a pas davantage à leur donner. Ils se nuisent les uns aux autres par la concurrence. On en prend occasion de les moins payer quand ils auraient besoin de l'être davantage. Aussi c'est une expérience constante, que, dans les temps de disette, les salaires baissent parce que l'on a plus d'ouvriers que l'on n'en peut employer, et cela dure jusqu'à ce que l'abondance renaisse ou que les hommes se soient éteints.
Il serait donc à désirer que le prix des denrées, et surtout celui des plus importantes, pût être invariable. Quand nous en serons à parler de la législation, nous verrons que le moyen que ce prix varie le moins possible est de laisser la liberté la plus entière au commerce, parce que l'activité des spéculateurs et leur concurrence font qu'ils [214] s'empressent de profiter de la moindre baisse pour acheter et de la moindre hausse pour revendre, et que par là ils empêchent l'une et l'autre de durer et de devenir excessives. Ce moyen est aussi le plus conforme et le seul conforme au respect dû à la propriété, car le juste et l'utile se trouvent toujours réunis. Pour le moment, bornons-nous à notre conclusion et étendons-la à d'autres objets.
Les variations subites dans certaines parties de l'industrie ou du commerce font, quoique d'une manière moins générale, le même effet que les variations dans le prix des denrées. Quand une branche d'industrie quelconque prend tout d'un coup un accroissement rapide, on y demande plus de travail qu'à l'ordinaire : il s'ensuit un bénéfice pour les travailleurs, et ils en usent comme de tous les bénéfices momentanés, c'est-à-dire mal ; mais ensuite cette industrie vient-elle à se ralentir ou à s'éteindre, la détresse arrive, il faut que chacun cherche des ressources. À la vérité, il y en a bien plus dans ce cas que dans celui d'une cherté, qui est un malheur universel. Les ouvriers inoccupés ici peuvent se porter ailleurs ; mais les hommes ne sont pas des êtres abstraits et insensibles ; ces déplacements ne se font pas sans souffrances, sans déchirements, sans rompre des habitudes impérieuses ; un ouvrier n'est jamais aussi propre à l'état qu'il veut prendre qu'à celui qu'il est forcé de quitter ; en outre, il y est superflu, il y produit engorgement, et par suite, baisse du salaire ordinaire : ainsi tout le monde pâtit. C'est là le grand malheur des [215] nations dominatrices du commerce, et l'inconvénient du développement exagéré de l'industrie, développement qui, par cela seul qu'il est exagéré, est sujet à des vicissitudes. C'est là du moins ce qui doit nous prouver qu'il est très imprudent à un corps politique de chercher à se procurer une prospérité factice par des moyens forcés. Elle ne peut être que fragile ; on en jouit sans bonheur, et on ne la perd jamais sans des maux extrêmes.
On a remarqué que les nations essentiellement agricoles sont moins sujettes que les autres à souffrir de ces révolutions subites de l'industrie et du commerce : en conséquence on a beaucoup vanté la stabilité de leur prospérité, et on a eu raison jusqu'à un certain point ; mais on n'a pas assez pris garde, ce me semble, qu'elles sont plus exposées que les nations commerçantes à la plus cruelle de toutes les variations, celle du prix des grains. Cela paraît ne devoir pas être, et pourtant cela est ; il est même facile d'en trouver la raison. Les peuples bornés à l'agriculture sont répandus sur un vaste territoire ; ce territoire ou est totalement méditerrané, ou, s'il confine à la mer de quelques côtés, il a nécessairement beaucoup de ses parties fort enfoncées dans les terres. Quand les récoltes viennent à y manquer, on ne peut y porter des secours que par terre ou en remontant des rivières, genre de navigation toujours fort dispendieux et souvent impossible. Or, comme les grains et les autres matières alimentaires sont des marchandises d'un grand encombrement, il arrive que, par l'effet des frais de [216] transport, quand elles sont rendues à l'endroit où l'on en a besoin, elles reviennent à un prix si élevé, que presque personne n'y peut atteindre. Aussi est-il d'expérience que toutes les importations de ce genre, faites dans des temps de calamités, n'ont jamais servi qu'à consoler et à calmer l'imagination, mais n'ont jamais été de véritables ressources. Il faut donc absolument que le pauvre restreigne sa consommation jusqu'au point de souffrir beaucoup, et que les plus dénués meurent. Il n'y a pas d'autre moyen pour que tous ne périssent pas quand la disette est très grande. C'est ainsi que dans une ville assiégée on fait sortir, si on le peut, toutes les bouches inutiles : c'est le même calcul. On prolongerait encore la défense si l'on osait se défaire de tous les défenseurs qui ne sont pas indispensables. Mais la consommation de la guerre en opère la destruction et c'est peut-être cette cruelle, mais sage combinaison, qui détermine les sorties inutiles d'ailleurs que font certains gouverneurs vers la fin d'un siège, sorties bien différentes de celles qu'on fait au commencement par pure jactance.
Les hommes augmenteraient beaucoup la sûreté de leur existence et leur possibilité d'occuper certains pays, s'ils pouvaient rendre les matières alimentaires d'un petit volume et par conséquent facilement transportables. À la vérité ils abuseraient tout de suite de cette possibilité pour se nuire comme les peuples pasteurs se servent de la facilité des transports que produit la célérité de leurs bêtes de somme, pour devenir brigands ; car rien n'est si [217] dangereux qu'un homme transportable. Il n'y a qu'à voir l'énorme avantage que la sobriété donne aux armées pour les invasions. C'est là la puissance de l'espèce mal employée, mais enfin c'est sa puissance, et c'est cette puissance qui, dans les cas de disette, manque aux nations agricoles et paisibles répandues sur un vaste territoire.
Les nations commerçantes, au contraire, sont ou insulaires ou répandues le long des côtes de la mer. Accessibles partout, elles peuvent recevoir des secours de tous les pays. Pour que la cherté devînt excessive chez elles, il faudrait que les récoltes eussent manqué dans toute la terre habitable ; encore n'atteindrait-elle que le taux moyen de la cherté générale, et jamais le taux extrême de la cherté locale des pays méditerranés les plus mal traités. Ces nations sont donc à l'abri du plus grand des désastres ; et quant aux malheurs, moins généraux, résultants des révolutions qui surviennent dans quelques branches d'industrie ou de commerce, j'observe qu'elles y sont très rarement exposées si elles ont laissé à cette industrie et à ce commerce son cours naturel, et si elles n'ont pas employé des moyens violents pour lui donner une extension exagérée. J'en conclus non seulement que leur condition est meilleure, mais encore que leurs malheurs viennent de leurs fautes, tandis que ceux des autres viennent de leur position, et qu'ainsi elles ont plus de moyens d'éviter ces malheurs. Nous devions être conduits à ce résultat, et nous aurions dû le prévoir d'avance ; car puisque la société, qui n'est [218] qu'un commerce continuel, est la cause de notre puissance et de nos ressources, il serait contradictoire que là où ce commerce est le plus perfectionné et le plus actif, nous fussions plus accessibles au malheur.
Si donc il était constant que la prospérité des nations commerçantes fût moins solide et moins durable (fait que je ne crois pas vrai, au moins chez les modernes [40]) ; il faudrait distinguer d'abord entre bonheur et puissance, et remarquer que, dans les calamités dont nous venons de parler, le bonheur, des individus, chez les nations agricoles, est extrêmement compromis. Mais la puissance subsiste, parce que la perte des hommes qui succombent par la disette est bientôt réparée par de nouvelles naissances quand elle cesse, les moyens habituels d'existence n'ayant pas été détruits ; au lieu que, dans une nation commerçante, quand une branche d'industrie s'anéantit, elle s'anéantit quelquefois sans retour et sans pouvoir être remplacée par une autre, en sorte que la partie de la population dont elle entraîne la ruine ne peut plus renaître ; mais comme nous l'avons dit, ce dernier cas est rare quand il n'est pas provoqué par des fautes. Si, indépendamment de cela, il était constaté que la [219] prospérité des nations commerçantes fût fragile raison des vices intérieurs auxquels elles seraient sujettes, il ne faudrait pas s'en prendre au commerce en lui-même, mais à des causes accidentelles, et principalement à la manière dont les richesses s'introduisent souvent dans ces États, laquelle favorise extrêmement leur très inégale répartition, qui est le plus grand de tous les maux et le plus généralement répandu. Examen fait, on trouverait là, comme toujours, le genre humain heureux du développement et de l'accroissement de ses moyens, mais tout prêt à en devenir malheureux par le mauvais usage qu'il en fait. La discussion de cette question dans toute son étendue trouvera sa place ailleurs.
Quoi qu'il en soit, il est donc certain que le pauvre est propriétaire comme le riche ; qu'en sa qualité de propriétaire de son individu, de ses facultés et de leur produit, il a intérêt qu'on lui laisse la libre disposition de sa personne et de son travail ; que ce travail lui procure des salaires suffisants, et que ces salaires varient le moins possible ; c'est-à-dire qu'il a intérêt que son capital soit respecté, que ce capital lui produise le revenu nécessaire à son existence, et que ce revenu soit, s'il se peut, toujours le même ; et, dans tous ces points, son intérêt est conforme à l'intérêt général.
Mais le pauvre n'est pas seulement propriétaire, il est encore consommateur, car tous les hommes sont l’un et l’autre. En cette dernière qualité, il a le même intérêt que tous les consommateurs, celui [220] d'être approvisionné le mieux et le moins chèrement possible. Il faut donc pour lui que la fabrication soit très habile, les communications faciles et les relations multipliées ; car nul n'a plus besoin d'être servi à bon marché que celui qui a peu de moyens.
Que faut-il donc penser de ceux qui soutiennent que l'amélioration des méthodes et l'invention des machines qui simplifient et abrègent les procédés des arts sont un malheur pour le pauvre ? Ma réponse est qu'ils n'ont aucune idée de ses véritables intérêts ni de ceux de la société ; car il faut être aveugle pour ne pas voir que, quand une chose qui exigeait quatre journées de travail, peut être faite en une journée, chacun peut, pour la même somme, s'en procurer quatre fois davantage, ou, en n'en consommant que là même quantité, avoir les trois quarts de son argent de reste pour l'employer à se procurer d'autres jouissances, et certes cet avantage est encore plus précieux au pauvre qu'au riche. Mais, dit-on, le pauvre gagnait ces quatre journées de travail, et il n'en gagnera plus qu'une. Mais, dirais-je à mon tour, vous oubliez donc que le fonds sur lequel vit la totalité des salariés est la somme des moyens de ceux qui les emploient ; que cette somme est une quantité à peu près constante ; qu'elle est toujours employée annuellement ; que si un objet particulier en absorbe une moindre partie, le surplus, qui est économisé, se reporte vers d'autres destinations ; qu'ainsi, tant qu'elle ne diminue pas, elle solde un nombre égal de [221] travailleurs, et que de plus, s'il y a un moyen de faire qu'elle augmente, c'est de rendre la fabrication plus économique, parce que c'est le moyen d'ouvrir de nouveaux débouchés et de rendre possibles de nouvelles entreprises industrielles, qui sont, comme nous l'avons vu, les seules sources de l'accroissement de nos richesses. Ces raisons me paraissent décisives. Si les raisons contraires étaient valables, il faudrait en conclure qu'il n'y a rien de plus heureux que de faire du travail inutile, parce que ce sont toujours autant de personnes occupées, et qu'il n'en reste pas moins à exécuter la même quantité de travail nécessaire. J'accorde ce second point. Mais premièrement ce travail inutile sera payé avec des fonds qui auraient payé du travail utile et qui ne le paieront pas, ainsi il n'y a rien de gagné de ce côté. Secondement, de ce travail infructueux il n'en reste rien, et, s'il avait été fructueux, il en serait resté des choses utiles, propres à procurer des jouissances, ou capables, étant exportées, d'augmenter la masse des richesses acquises. Il me semble qu'il n'y a rien à répondre à cela, une fois que l'on a vu nettement sur quel fonds vivent les salariés. Cette série de combinaisons se retrouvera lorsque nous parlerons de l'emploi de nos richesses : c'est pour cela que je l'ai développée ; car il semble qu'il ne faut pas tant de raisonnements pour prouver que du travail reconnu inutile est inutile, et qu'il est plus utile de faire du travail utile. Or c'est à cette vérité niaise que se réduit l'apologie des machines et des autres améliorations.
[222]
On a fait, contre la construction des chemins et des canaux, et généralement contre la facilité des communications et, la multiplicité des relations commerciales, les mêmes objections que je viens de réfuter. J'y fais les mêmes réponses. On a prétendu de plus que tout cela nuisait d'une autre manière au pauvre, en faisant monter le prix des denrées. Le vrai est que cela fait monter leur prix dans les temps où elles sont trop bon marché, par la difficulté de les exporter ; mais cela les fait baisser quand elles sont trop chères, par la difficulté d'en importer. Ainsi cela rend les prix plus constamment égaux ; et j'en conclus, en vertu des principes que nous avons établis, que c’est un grand bien pour le pauvre et pour la société en général.
Je conviens cependant que toutes ces innovations, avantageuses en elles-mêmes, peuvent quelquefois produire d'abord une gêne momentanée et partielle : c'est le propre de tous les changements subits. Mais comme l'utilité de ceux-ci est générale et durable, cette considération ne doit point en éloigner. Il faut seulement que la société vienne au secours de ceux qui souffrent passagèrement, et cela lui est bien aisé quand en masse elle prospère.
Il est donc vrai que, malgré l'opposition nécessaire de nos intérêts particuliers, nous sommes tous réunis par les intérêts communs de propriétaires et de consommateurs, et que par conséquent on a tort de regarder les pauvres et les riches, ou les salariés et ceux qui les emploient, comme deux classes essentiellement ennemies. Il est vrai [223] surtout que les véritables intérêts du pauvre sont toujours les mêmes que ceux de la société prise en masse. Je ne prétends pas dire que le pauvre connaisse toujours ses véritables intérêts. Qui est-ce qui a toujours des idées justes sur ces matières, même parmi les gens éclairés ? Mais enfin c'est beaucoup que les choses soient telles, et c'est une bonne chose à savoir. La plus grande difficulté pour le persuader, est peut-être de pouvoir en bien dire les causes : il me semble que c'est ce que nous venons de faire. Tout en arrivant à ce résultat, nous avons examiné, chemin faisant, plusieurs questions qui, sans nous détourner de notre route, ont ralenti notre marche. Cependant je n'ai pas cru devoir passer à côté sans m'y arrêter, parce que, dans ce genre, tous les objets sont tellement liés les uns aux autres, qu'il n'en est aucun qui, étant bien éclairé, ne jette un grand jour sur tous les autres.
Mais nous ne sommes pas seulement opposés d'intérêts, nous sommes encore inégaux en moyens. Cette seconde condition de notre nature mérite aussi d'être étudiée dans ses conséquences, sans quoi nous ne connaîtrions pas complètement les effets de la distribution de nos richesses entre les divers individus, et nous ne saurions qu'imparfaitement ce que nous devons penser des avantages et des inconvénients de l'accroissement de ces mêmes richesses par l'effet de la société. Etablissons d'abord quelques vérités générales.
Des déclamateurs ont soutenu que l'inégalité en [224] général est utile, et que c'est un bienfait dont nous devons remercier la Providence. Je n'ai qu'un mot à leur répondre. Entre des êtres sensibles fréquemment opposés d'intérêts, la justice est le plus grand des biens, car elle seule peut les concilier sans qu'aucun ait à se plaindre. Donc l'inégalité est un mal, non pas qu'elle soit une injustice en elle-même, mais parce qu'elle est un puissant appui pour l'injustice, toutes les fois que la justice est pour le faible.
Toute inégalité de moyens et de facultés est au fond une inégalité de pouvoir. Cependant, quand on veut entrer dans quelques détails, on peut et on doit distinguer l'inégalité de pouvoir proprement dite et l'inégalité de richesses.
La première est la plus fâcheuse : elle soumet la personne elle-même. Elle existe dans toute son horreur entre les hommes bruts et sauvages, elle y met le plus faible à la merci du plus fort. C'est elle qui est cause qu'il n'y a entre eux que le moins de relations qu'ils peuvent, car elle deviendrait insupportable. Si on ne l'y a pas toujours remarquée, c'est qu'elle n'y est guère accompagnée de l'inégalité de richesses, qui est celle qui nous frappe le plus, parce que nous l'avons toujours sous les yeux.
L'organisation sociale a pour objet de combattre l'inégalité de pouvoir, et le plus souvent elle la fait cesser ou du moins elle la diminue. Des hommes, révoltés des abus dont la société fourmille encore, ont prétendu qu'au contraire elle augmentait [225] cette inégalité, et il faut avouer que, quand elle perd totalement de vue sa destination, elle justifie les reproches de ses amers détracteurs. Par exemple, partout où elle conserve l'esclavage proprement dit, il est certain que l'indépendance sauvage avec tous ses dangers lui est encore préférable ; mais il faut convenir pourtant que le but de la société n'est pas cela, et qu'elle tend, le plus souvent avec succès, à diminuer l'inégalité de pouvoir.
En diminuant l'inégalité de pouvoir, et par là établissant la sûreté, la société produit le développement de toutes nos facultés et accroît nos richesses, c'est-à-dire nos moyens d'existence et de jouissances. Mais plus nos facultés se développent, plus leur inégalité paraît et augmente, et elle amène bientôt l'inégalité de richesses, qui entraîne celle d'instruction, de capacité, et d'influence. Voilà, ce me semble, en deux mots, les avantages et les inconvénients de la société. Cette vue nous montre ce que l'on a droit d'en attendre et ce que l'on doit faire pour la perfectionner.
Puisque le but de la société est de diminuer l'inégalité de pouvoir, elle doit viser à le remplir, et puisque son inconvénient est de favoriser l'inégalité de richesses, elle doit toujours s'occuper de la diminuer, toutefois par des moyens doux et jamais violents ; car il faut toujours se souvenir que la base fondamentale de la société est le respect de la propriété et sa garantie contre toute violence.
Mais, dira-t-on, quand l'inégalité est réduite à [226] n'être que l'inégalité de richesses, est-elle donc encore un si grand mal ? Je réponds hardiment que oui. Car d'abord, entraînant avec elle l'inégalité d'instruction, de capacité et d'influence, elle tend à ramener l'inégalité de pouvoir, et par conséquent à renverser la société. Ensuite, en ne la considérant que sous le rapport économique, nous avons vu que le fonds sur lequel vivent les salariés est le revenu de tous ceux qui ont des capitaux ; et que parmi ceux-ci il n'y a que les entrepreneurs d'industrie qui augmentent leurs richesses, et par conséquent les richesses de la nation. Or, ce sont précisément les possesseurs de grandes fortunes qui sont oisifs, et qui ne soldent du travail que pour leur plaisir. Ainsi plus il existe de grandes fortunes, plus la richesse nationale tend à s'altérer et la population à diminuer. L'exemple de tous les temps et de tous les pays vient à l'appui de cette théorie ; car partout où vous voyez des fortunes exagérées [41], c’est là que vous voyez la plus grande misère et la plus grande stagnation dans l'industrie.
La perfection de la société serait donc d'accroître beaucoup nos richesses en évitant leur extrême [227] inégalité. Mais cela est beaucoup plus difficile dans certains temps et dans certaines positions que dans d'autres. Un peuple méditerrané, agricole, ayant peu de relations, vivant sur un sol peu fertile, ne pouvant augmenter ses moyens de jouissance que par les progrès lents de sa culture, et les progrès plus lents encore de ses manufactures, évitera facilement et longtemps qu'il s'établisse une grande inégalité entre ses concitoyens. Si le sol est plus riche, et surtout s'il produit dans quelques endroits des denrées très recherchées, il se fera plus aisément de grandes fortunes. S'il renferme des mines de métaux précieux, beaucoup de particuliers certainement se ruineront à les exploiter, mais quelques-uns y acquerront des richesses immenses ; ou si le gouvernement se réserve ce profit, il sera bientôt en état de procurer à ses créatures une opulence exagérée, et il est bien vraisemblable qu'il n'y manquera pas. Trop de causes concourent à produire cet effet Enfin, si vous supposez que ce premier peuple encore pauvre devienne conquérant, s'empare d'un pays riche et s'y établisse en vainqueur, voilà tout d'un coup la plus grande illégalité introduite d'abord entre la nation victorieuse et la nation subjuguée, et ensuite parmi les vainqueurs eux-mêmes. Car là où la force décide, il est bien difficile que les partages soient équitables. Les lots des divers individus sont aussi différents que leurs degrés d'autorité dans l'armée ou de faveur auprès du chef. Encore sont-ils exposés à de fréquentes usurpations.
[228]
La fortune des nations maritimes est en général plus rapide ; cependant on y remarque les mêmes variétés. Des navigateurs peuvent être réduits à des bénéfices médiocres, au cabotage, à la pêche, au commerce avec des nations avec lesquelles il n'y ait pas de grands gains à faire. Alors il leur est aisé de rester longtemps à peu près égaux entre eux. Ils peuvent au contraire pénétrer dans des régions inconnues, avoir à profusion les denrées les plus rares, établir des relations avec des peuples sur lesquels on puisse faire des profits immenses, s'attribuer de grands monopoles, fonder de riches colonies sur lesquelles ils conservent un empire tyrannique, ou même devenir conquérants, et importer dans leur patrie les produits de pays très étendus soumis par leurs armes, comme les Anglais dans l'Inde, et les Espagnols dans l'Amérique méridionale. Dans chacun de ces cas il y a plus ou moins de chances, mais dans tous il y en a beaucoup, pour que ces énormes richesses se distribuent très inégalement.
Beaucoup d'autres circonstances sans doute se joignent à celles-là et en modifient les effets. Les différents caractères des peuples, la nature de leurs gouvernements, le plus ou moins d'étendue de leurs lumières, et surtout de leur connaissance de l'art social, dans les moments qui décident de leur sort, font que des événements semblables ont des conséquences très différentes. Si Vasco de Gama et ses contemporains avaient eu les mêmes vues et les mêmes mœurs que Cook ou La Pérouse, nos [229] relations avec les Indes seraient tout autres qu'elles ne sont. Il est surtout remarquable combien l'époque à laquelle un corps politique commence à se former influe sur toute la durée de son existence. Certainement des empirés fondés par Clovis ou par Cortez, ou des sociétés recevant leurs premières lois de Locke ou de Franklin, doivent prendre des directions très différentes, et l'on s'en aperçoit bien dans toutes les périodes de leur histoire [42].
Ce sont ces causes si diverses, et surtout la dernière, qui produisent l'infinie variété que l'on remarqué dans les destinées des nations ; mais enfin le fond est partout le même. La société, procurant à chacun la sûreté de sa personne et de ses propriétés, cause le développement de nos facultés ; ce développement produit l'accroissement de nos richesses ; leur accroissement amène plus ou moins vite leur très inégale répartition ; et cette inégale répartition, ramenant l'inégalité de pouvoir, que la société avait commencé par contenir et était destinée à détruire, produit son affaiblissement et quelquefois sa dissolution totale.
C'est sans doute ce cercle vicieux que les historiens ont voulu nous représenter par les mots de [230] jeunesse et de vieillesse des nations, et par ce qu'ils appellent leur vertu première, leur pureté primitive ; puis leur dégénération, leur corruption, leur amollissement. Mais ces expressions vagues, contre lesquelles j'ai déjà réclamé peignent bien mal les faits, et égarent souvent ceux même qui les emploient. On nous parle toujours de la vertu des nations pauvres. Certainement là où l'égalité rend l'injustice et l'oppression plus difficiles et plus rares, on est plus vertueux par le fait, puisqu'il y a moins de fautes commises ; mais c'est l'égalité et non la pauvreté qui en préserve. Du reste, les passions sont les mêmes qu'ailleurs. Pourquoi nous représenter incessamment les nations commerçantes comme avides, et les peuples agricoles comme des modèles de modération ? Partout les hommes tiennent à leurs intérêts et en sont occupés. Les Carthaginois n'étaient pas plus avides que les Romains ; et les Romains, dans ce que l'on appelle leurs beaux temps, qui étaient chez eux les usuriers les plus cruels, et au dehors les spoliateurs les plus insatiables, étaient tout aussi avides que sous les empereurs. L'état de la société seul était différent. Il en est de même du mot dégénération. Certainement quand une partie des hommes s'est accoutumée à se résigner à l'oppression, et l'autre à abuser de son pouvoir, on peut bien dire qu'ils sont dégénérés. Mais à la manière dont on emploie souvent cette expression, on croirait qu'ils ne naissent plus les mêmes, que leur nature est changée, que leur race est altérée, [231] qu'ils n'ont plus ni force ni courage ; tout cela est très-faux. On a encore plus abusé des mots mollesse et amollissement. Montesquieu lui-même vous dit gravement que la fertilité de la terre amollit les hommes [43]. Elle les nourrit, et voilà tout. À entendre certains auteurs, on dirait qu'il arrive un jour où tous les individus d'une nation vivent dans les délices comme ces fabuleux Sybarites on nous a tant parlé. Cela serait fort heureux, mais cela est impossible. Quand on vous dit qu'une nation est énervée par la mollesse, comprenez qu'il y en a un centième tout au plus de gâté par l'habitude du pouvoir et la facilité des jouissances, et que tout le reste est abattu par l'oppression et dévoré par la misère [44]. On ne se trompe pas moins sur le sens de ces expressions, les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise ; et les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. Voila pourquoi les unes sont fortes, et les autres sont souvent faibles. On pourrait multiplier ces [232] réflexions à l'infini. Mais tout se réduit à cette vérité, qui n'a pas toujours été assez sentie : la multiplication de nos moyens de jouissance est une très bonne chose ; leur trop inégale répartition en est une très mauvaise, et la source de tous nos maux. Sur ce point encore, l’intérêt du pauvre est le même que celui de la société. Je crois en avoir assez dit sur la distribution de nos richesses ; il est temps de parler de l'usage que nous en faisons.
CHAPITRE XI.↩
De l'Emploi de nos richesses, ou de la Consommation.
Après avoir vu comment se forment nos richesses et comment elles se distribuent nous voici arrivés au moment d'examiner comment nous nous en servons, et quelles sont les conséquences des différents usages que nous en faisons. C'est là ce qui doit achever de nous dévoiler toute la marche de la société, et de nous montrer quelles sont les choses réellement utiles ou nuisibles, tant au public qu'aux particuliers. Si dans les deux premières parties nous avons bien connu et exposé la vérité, celle-ci se débrouillera d'elle-même, et tout y sera clair et incontestable. Si au contraire nous avons mal vu les premiers faits, si nous ne sommes pas remontés [233] jusqu'aux premières causes, si nos recherches ont été superficielles ou égarées par l'esprit de système, nous allons rencontrer difficulté sur difficulté, et il restera dans tout ce que nous dirons beaucoup de choses obscures et douteuses, comme il est arrivé à beaucoup d'autres, et même des plus capables et des plus savants. C'est ce dont le lecteur jugera.
Nous ne créons rien, nous n'anéantissons rien ; mais nous opérons des changements productifs ou destructifs d'utilité. Nous ne nous procurons des moyens de jouissance que pour pourvoir à nos besoins, et nous ne pouvons les employer à la satisfaction de ces besoins qu'en les diminuant, ou même en les détruisant. Nous ne faisons des étoffes, et avec ces étoffes des habits, que pour nous vêtir, et en les portant nous les usons. Avec des graines, de l'air, de la terre, de l'eau et des fumiers, nous produisons des matières alimentaires pour nous nourrir, et en nous en nourrissant nous les convertissons en gaz et en fumiers qui en produiront d'autres. C'est là ce que nous appelons consommer. La consommation est le but de la production ; mais elle en est le contraire. Ainsi toute production augmente notre richesse, et toute consommation la diminue. Telle est la loi générale.
Cependant il y a des consommations de bien des genres. Il y en a qui ne sont qu'apparentes ; il y en a qui sont très réelles et même très destructives ; il y en a qui sont fructueuses. Elles varient suivant l'espèce de consommateurs et suivant la nature des choses consommées. Ce sont toutes ces différences [234] qu'il faut démêler et distinguer, pour bien voir les effets de la consommation générale sur la masse totale des richesses. Commençons par discuter les consommateurs : je hasarde cette expression, parce qu'elle exprime fort bien le but que je me propose.
Il est convenu que nous sommes tous consommateurs, car nous avons tous des besoins auxquels nous ne pouvons pourvoir que par une consommation quelconque ; et que de même nous sommes tous propriétaires, car nous possédons tous quelques moyens de pourvoir à nos besoins, ne fût-ce que nos forces et notre capacité individuelles. Mais nous avons vu aussi que par la manière inégale dont les richesses se distribuent à mesure qu'elles s'accumulent, beaucoup d'entre nous n'ont aucune part à ces richesses accumulées, et ne possèdent en effet que leurs forces individuelles. Ceux-là n'ont d'autre trésor que leur travail de tous les jours : Ce travail leur procure des salaires : c'est pourquoi nous les avons appelés spécialement salariés ; et c'est avec ces salaires qu'ils font face à leur consommation.
Mais sur quoi sont pris ces salaires ? Il est évident que c'est sur les propriétés de ceux à qui les salariés vendent leur travail, c'est-à-dire sur des fonds qui sont d’avance en leur possession, et qui ne sont autre chose que les produits accumulés de travaux antérieurement exécutés. Il suit de là que la consommation que paient ces richesses est bien la consommation des salariés, en ce sens que ce sont eux qu'elle substante ; mais qu'au fond ce ne sont pas eux qui la paient, ou du moins qu'ils ne la paient qu'avec [235] les fonds existants d'avance entre les mains de ceux qui les emploient. Ils ne font que recevoir d'une main et rendre de l'autre. Leur consommation doit donc être regardée comme faite par ceux qui les soudoient. Si même ils ne dépensent pas tout ce qu'ils reçoivent, ces épargnes, les élevant au rang de capitalistes, les mettent à même de faire ensuite des dépenses sur leurs propres fonds ; mais comme elles leur viennent des mêmes mains, elles doivent être regardées d'abord comme des dépenses des mêmes personnes. Ainsi, sous peine de faire des doubles emplois dans les calculs économiques, il faut compter absolument pour rien toute la consommation immédiate des salariés, en tant que salariés, et considérer non seulement tout ce qu'ils dépensent, mais même la totalité de ce qu'ils reçoivent, comme la dépense réelle et la consommation propre de ceux qui achètent leur travail. Cela est si vrai, que, pour voir si cette consommation est plus ou moins destructive de la richesse acquise, ou même si elle tend à l'augmenter, comme cela arrive souvent, tout dépend de savoir quel usage font les capitalistes du travail qu'ils achètent. Ceci nous amène à examiner la consommation de ces capitalistes.
Nous avons dit qu'ils sont de deux espèces : les uns oisifs, les autres actifs. Les premiers ont un revenu fixe indépendamment de toute action de leur part, puisqu'ils sont supposés oisifs. Ce revenu consiste dans le loyer de leurs capitaux, soit meubles, soit argent, soit biens-fonds, qu'ils louent à ceux qui les font valoir par l'effet de leur industrie. [236] Ce revenu n'est donc qu'un prélèvement qui se fait sur les produits de l'activité des citoyens industrieux ; mais ce n'est pas là ce qui nous occupe actuellement. Ce que nous voulons voir, c'est quel est l'emploi de ce revenu. Puisque les hommes à qui il appartient sont oisifs, il est manifeste qu'ils ne dirigent aucun travail productif. Tous les travailleurs qu'ils soldent sont uniquement destinés à leur procurer des jouissances. Sans doute ces jouissances sont de différents genres. Pour les moins riches elles se bornent à la satisfaction des besoins les plus urgents ; pour les autres elles s'étendent par degrés, suivant leurs goûts et leurs moyens, jusqu'aux recherches du luxe le plus raffiné et le plus effréné. Mais enfin les dépenses de toute cette classe d'hommes se ressemblent toutes, en ce point qu'elles n'ont pour objet que leur satisfaction personnelle, et qu'elles alimentent une nombreuse population qu'elles font subsister, mais dont le travail est complètement stérile. Il est vrai cependant que, parmi ces dépenses, il peut s'en trouver quelques-unes qui soient plus ou moins fructueuses, comme, par exemple, la construction d'une maison ou l'amélioration d'un fonds de terre ; mais ce sont des cas particuliers qui font que les consommateurs de ce genre rentrent momentanément dans la classe de ceux qui dirigent des entreprises utiles et soudoient du travail productif. À ces légères exceptions-là près, toute la consommation de cette espèce de capitalistes est absolument en pure perte sous le rapport de la reproduction et autant de diminué sur les richesses acquises. Aussi [237] faut-il remarquer que ces hommes-là ne peuvent dépenser que leur revenu. S'ils entament leurs fonds, rien ne les remplace, et leur consommation momentanément exagérée cesse pour toujours.
La seconde classe de capitalistes qui emploie et soudoie les salariés se compose de ceux que nous avons nommés actifs. Elle comprend tous les entrepreneurs d'une industrie quelconque, c’est-à-dire tous les hommes qui, ayant des capitaux plus ou moins forts, emploient leur talent et leur travail à les faire valoir eux-mêmes au lieu de les louer à d'autres, et qui par conséquent ne vivent ni de salaires ni de revenus, mais de profits. Ces hommes-là non seulement font valoir leurs propres capitaux, mais encore ce sont eux qui font valoir tous ceux des capitalistes oisifs. Ils leur prennent à rente leurs terres, leurs maisons et leur argent, et ils s'en servent de manière à en tirer des profits supérieurs à cette rente [45]. Ils ont donc entre les mains presque toutes les richesses de la société. Il est de plus à remarquer que ce n'est pas seulement la rente de ces richesses qu'ils dépensent annuellement, mais bien le fonds lui-même, et quelquefois [238] plusieurs fois dans l'année, quand la marche du commerce est assez rapide pour que cela se puisse. Car, comme en leur qualité d'hommes industrieux ils ne font aucune dépense que pour qu'elle leur rentre avec profit, plus ils en peuvent faire qui remplisse cette condition, plus leurs bénéfices sont grands. On voit donc que leur consommation est immense, et que le nombre des salariés qu'elle alimente est vraiment prodigieux.
Maintenant il faut distinguer deux parties dans cette énorme consommation. Toute celle que ces hommes industrieux font pour leurs propres jouissances et pour la satisfaction de leurs besoins et de ceux de leur famille est définitive et perdue sans retour, comme celle des capitalistes oisifs. Au total elle est médiocre ; car les hommes industrieux sont ordinairement modestes, et trop souvent peu riches. Mais toute celle qu'ils font pour alimenter leur industrie, et pour le service de cette industrie, n'est rien moins que définitive ; elle leur rentre avec profits ; et il faut même, pour que cette industrie se soutienne, que ces profits soient au moins égaux, non seulement à la consommation personnelle et définitive des hommes industrieux, mais encore à la rente des terres et de l'argent qu'ils tiennent des capitalistes oisifs, laquelle rente est le seul revenu de ces oisifs, et le seul fonds de leurs dépenses annuelles. Si les profits des capitalistes actifs étaient moindres que ces prélèvements nécessaires, leurs fonds seraient entamés ; ils seraient obligés de diminuer leurs entreprises, ils ne pourraient plus [239] solder la même quantité de travail, ils se dégoûteraient même de solder et de diriger ce travail infructueux. Dans le cas contraire, ils ont un accroissement de fonds au moyen duquel ils peuvent augmenter leurs affaires et leur demande de travail, si toutefois ils trouvent à l'employer utilement.
On me demandera comment ces entrepreneurs d'industrie peuvent faire de si grands profits, et de qui ils peuvent les tirer. Je réponds que c'est en vendant tout ce qu'ils produisent plus cher que cela ne leur a coûté à produire ; et qu'ils le vendent, 1° à eux-mêmes pour toute la partie de leur consommation destinée à la satisfaction de leurs besoins, laquelle ils paient avec une portion de leurs profits ; 2° aux salariés, tant ceux qu'ils soldent que ceux que soldent les capitalistes oisifs, desquels salariés ils retirent, par ce moyen, la totalité de leurs salaires, à cela près des petites économies qu'ils peuvent faire ; 3° aux capitalistes oisifs qui les paient avec la partie de leur revenu qu'ils n'ont pas déjà donnée aux salariés qu'ils emploient directement : en sorte que toute la rente qu'ils leur desservent annuellement leur revient par un de ces côtés ou par l'autre.
C'est là ce qui complète ce mouvement perpétuel de richesses, qui, bien que mal connu, a été très bien nommé circulation ; car il est véritablement circulaire [46], et revient toujours au point d'où il [240] est parti. Ce point est celui où se fait la production Les entrepreneurs d'industrie sont réellement le cœur du corps politique, et leurs capitaux en sont le sang. Avec ces capitaux ils donnent des salaires à la plus grande partie des salariés ; ils donnent leurs rentes à tous les capitalistes, oisifs possesseurs soit de terres, soit d'argent, et par eux des salaires au reste des salariés ; et tout cela leur revient par les dépenses de tous ces gens-là, qui leur paient ce qu'ils ont fait produire par leurs salariés immédiats, plus cher qu'il ne leur en a coûté pour ces salaires et pour la rente des terres et de l'argent empruntés.
Mais, me dira-t-on, si cela est, et si les entrepreneurs d'industrie recueillent en effet chaque année plus qu'ils n'ont semé, ils devraient en très peu de temps avoir attiré à eux toute la fortune publique, et bientôt il ne devrait plus rester dans un État que des salariés sans avances, et des capitalistes entrepreneurs. Cela est vrai ; et les choses seraient ainsi effectivement, si ces entrepreneurs ou leurs héritiers ne prenaient le parti de se reposer à mesure qu'ils se sont enrichis, et n'allaient ainsi continuellement recruter la classe des capitalistes oisifs ; et même, malgré cette émigration fréquente, il arrive encore que, quand l'industrie a [241] agi pendant quelque temps dans un pays, sans de trop grandes perturbations, ses capitaux se sont toujours augmentés, non seulement en raison de l'accroissement de la richesse totale, mais encore dans une bien plus grande proportion. Pour s'en assurer, il n'y a qu'à voir dans toute l'Europe combien ils étaient faibles il y a trois ou quatre siècles, en comparaison des richesses immenses de tous les hommes puissants ; et combien ils sont aujourd'hui multipliés et accrus, tandis que les autres sont diminuées. On pourrait ajouter que cet effet serait bien plus sensible encore sans les prélèvements immenses que tous les gouvernements font chaque année sur la classe industrieuse, par la voie des impôts ; mais il n'est pas temps encore de nous oceuper de cet objet.
Il ne doit pas être nécessaire d'observer que dans les commencements de la société, lorsque les richesses ne sont pas encore devenues très inégales, il n'existe presque point de simples salariés, et encore moins de capitalistes oisifs ; chacun travaillant pour soi et faisant des échanges avec ses voisins est un véritable entrepreneur, ou momentanément un salarié quand par occasion il travaille pour autrui moyennant récompense. Même dans la suite, quand les diverses conditions sont devenues plus séparées par les effets de l'inégalité, le même homme peut appartenir et appartient souvent à plusieurs en même temps. Ainsi, un simple salarié qui a quelques petites épargnes placées à intérêt, est sous ce rapport un capitaliste oisif, comme l'est aussi un [242] entrepreneur qui a une partie de ses fonds réalisée en terres affermées ; tandis qu'un propriétaire de pareilles terres, ou un rentier qui est fonctionnaire public, est à cet égard un salarié. Mais il n'en est pas moins vrai que ceux qui vivent de salaires, ceux qui vivent de rentes et ceux qui vivent de profits, forment trois classes d'hommes essentiellement différentes ; et que ce sont les derniers qui alimentent tous les autres, et qui seuls augmentent la fortune publique et créent tous nos moyens de jouissance. Cela doit être, puisque le travail est la source de toute richesse, et puisque eux seuls donnent une direction utile au travail actuel, en faisant un usage utile du travail accumulé.
On remarquera, j'espère, combien cette manière de considérer la consommation de nos richesses est concordante avec tout ce que nous avons dit à propos de leur production et de leur distribution [47], et en même temps quelle clarté elle répand sur toute la marche de la société. D'où vient cet accord et cette lucidité ? De ce que nous avons rencontré la vérité. Cela rappelle l'effet de ces miroirs où les objets se peignent nettement et dans leurs justes proportions, quand on est placé dans leur vrai point de vue, et où tout paraît confus et désuni quand [243] on en est trop près ou trop loin. De même ici, dès que vous reconnaissez que nos facultés sont notre seule richesse originaire, que notre travail seul produit toutes les autres, et que tout travail bien dirigé est productif, tout s'explique avec une facilité admirable ; mais quand vous voulez, comme beaucoup d'écrivains politiques, ne reconnaître pour productif que le travail de la culture, ou placer la source de la richesse dans la consommation, vous ne rencontrez plus en avançant qu'obscurité, confusion et embarras inextricables. J'ai déjà réfuté la première de ces deux opinions ; je discuterai bientôt la seconde. Pour le moment, concluons qu'il est trois sortes de consommateurs : les salariés, les rentiers et les entrepreneurs ; que la consommation des premiers est réelle et définitive, mais qu'il ne faut pas la compter, parce qu'elle fait partie de la consommation de ceux qui les emploient ; que celle des rentiers est définitive et destructive ; et que celle des entrepreneurs est fructueuse, parce qu'elle est remplacée par une production supérieure.
Si la consommation est fort différente suivant l'espèce de consommateur, elle varie aussi suivant la nature des choses consommées. Toutes représentent bien du travail, mais sa valeur est fixée plus solidement dans les unes que dans les autres. On peut avoir pris autant de peine pour fabriquer un feu d'artifice que pour trouver et tailler un diamant, et par conséquent l'un peut avoir autant de valeur que l'autre. Mais quand j'aurai acheté, payé [244] et employé l’un et l'autre, au bout d'une demi-heure il ne me restera rien du premier, et le second pourra être encore la ressource de mes petits-enfants dans un siècle, quand même on s'en serait paré tous les jours. Il en est de même de ce que l'on appelle les produits immatériels. Une découverte est d'une utilité éternelle. Un ouvrage d'esprit, un tableau sont encore d'une utilité plus ou moins durable ; tandis que celle d'un bal, d'un concert, d'un spectacle est instantanée et disparaît aussitôt. On en peut dire autant des services personnels des médecins, des avocats, des soldats, des domestiques, et généralement de tout ce que l’on appelle des employés. Leur utilité est celle du moment du besoin.
Toutes les choses consommables, de quelque nature qu'elles soient, se placent entre ces deux extrêmes, de la plus courte et de la plus longue durée. D'après cela, il est aisé de voir que la consommation la plus ruineuse est la plus prompte, puisque c'est celle qui détruit le plus de travail dans le même temps, ou une égale quantité de travail en moins de temps ; en comparaison de celle-là, celle qui est plus lente est une espèce de thésaurisation, puisqu'elle laisse à des temps à venir la jouissance d'une partie des sacrifices actuels. Cela est si clair, que cela n'a pas besoin d'être prouvé ; car chacun sait qu'il est plus économique d'avoir pour le même prix un habit qui dure trois ans, que d'en avoir un pareil qui ne dure que trois mois. Aussi cette vérité est-elle avouée de tout le monde. Ce qu'il y [245] a de singulier, c'est qu'elle le soit même par ceux qui regardent le luxe comme une cause de richesse ; car si détruire est une si bonne chose, il semble qu'on ne saurait trop détruire, et que l'on devrait être de l'avis de cet homme qui cassait tous ses meubles pour encourager l'industrie.
Au point où nous voici arrivés, je ne sais plus comment aborder cette prétendue grande question du luxe, tant et si souvent débattue par des philosophes célèbres et des politiques renommés ; ou plutôt je ne sais comment établir qu'il y ait là matière à un doute, ni comment faire paraître tant soit peu plausibles les raisons de ceux, très nombreux pourtant, qui soutiennent que le luxe est utile. Car quand les idées antérieures sont bien éclaircies, une question est résolue aussitôt que posée, et c'est ici le cas.
En effet, qui dit luxe dit consommation superflue et même exagérée ; consommation, c'est destruction d'utilité ; or, comment, concevoir que destruction exagérée soit cause de richesse, soit production ? Cela répugne au bon sens.
On nous dit gravement que le luxe appauvrit un petit État et en enrichit un grand. Mais que peut faire l'étendue à pareille chose ? et comment comprendre que ce qui ruine cent hommes, les enrichisse s'ils sont au nombre de deux cents ?
On dit encore que le luxe fait vivre une nombreuse population. Sans doute. Non seulement le luxe des riches, mais encore la simple consommation de tous les oisifs qui vivent de leurs revenus, [246] entretient un grand nombre de salariés. Mais que devient le travail de ces salariés ? Ceux qui les emploient en consomment le résultat, et il n'en reste rien. Et avec quoi paient-ils ce travail ? Avec leurs revenus, c'est-à-dire avec des richesses déjà acquises dont bientôt il ne reste plus rien. Il y a donc là destruction de richesses et non pas accroissement. Mais allons plus loin. D'où viennent à ces hommes oisifs leurs revenus ? N'est-ce pas de la rente que leur paient sur leurs profits ceux qui fout travailler leurs capitaux, c'est-à-dire ceux qui avec leurs fonds salarient du travail qui produit plus qu'il ne coûte, en un mot les hommes industrieux ? C'est donc toujours jusqu'à ceux-là qu'il faut remonter pour trouver la source de toute richesse. Ce sont ceux-là qui nourrissent réellement même les salariés qu'emploient les autres.
Mais, dit-on, le luxe anime la circulation. Ces paroles n'ont point de sens. On oublie donc ce que c'est que la circulation. Rappelons-le avec le temps, des richesses se sont accumulées en plus ou moins grande quantité, parce que le résultat des travaux antérieurs n'a pas été entièrement consommé aussitôt que produit. Des possesseurs de ces richesses, les uns se contentent d'en tirer une rente et de la manger. Ce sont ceux que nous avons appelés oisifs. Les autres plus actifs font travailler leurs propres fonds et ceux qu'ils louent. Ils les emploient à solder du travail qui les reproduit avec profit, avec ce profit ils paient leur propre consommation, et défraient celle des autres. Par ces consommations-là même, [247] leurs fonds leur reviennent un peu accrus, et ils recommencent. Voilà ce qui constitue la circulation. On voit qu'elle n’a pas d'autres fonds que ceux des citoyens industrieux. Elle ne peut augmenter qu'autant qu'ils augmentent, ni s'accélérer, ce qui est encore augmenter, qu'autant que leurs rentrée se rapprocheraient. Car si leurs fonds leur revenaient au bout de six mois, au lieu de leur revenir au bout d'un an, ils les emploieraient deux fois dans l'année au lieu d'une, et ce serait comme s'ils en employaient le double ; mais les rentiers oisifs ne peuvent rien à cela ; ils ne peuvent que manger leur rente d'une manière ou d'une autre. S'ils mangent plus une année, il faut qu'ils mangent moins une autre. S'ils font autrement, ils entament leurs fonds. Ils sont obligés de les vendre ; mais on ne peut les leur acheter qu'avec des capitaux appartenant aux hommes industrieux ou placés sur eux, et qui payaient là du travail qu'ils ne paieront plus, et du travail plus utile que celui qu'ont employé les prodigues. Ainsi ce n'est pas là une augmentation dans la masse totale de la dépense, ce n'est qu'un déplacement, un changement de quelques-unes de ses parties, et un changement désavantageux. Ainsi, même en se ruinant, les hommes ne vivant que de revenus ne peuvent accroître la masse des salaires et de la circulation. Ils ne le pourraient que par une conduite tout opposée, en ne consommant pas toute leur rente, et en en destinant une partie à des dépenses fructueuses. Mais alors ils seraient bien loin de s'abandonner à la consommation exagérée [248] et superflue appelée luxe. Ils se livreraient au contraire à des spéculations utiles, ils se rangeraient dans la classe industrieuse.
Montesquieu, qui au reste entendait très mal l'économie politique [48], croit les profusions des riches très utiles, « parce que, dit-il, livre VII, chapitre IV, si les riches ne dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. » On s'aperçoit à ce peu de mots et à beaucoup d'autres, qu'il ne savait ni d'où viennent les revenus de ce qu'il appelle les riches, ni ce qu'ils deviennent. Encore une fois, les revenus des riches oisifs ne sont que des rentes prélevées sur l'industrie ; c'est l'industrie seule qui les fait naître. Leurs possesseurs ne peuvent rien faire pour les augmenter ; ils ne font que les répandre, et ils ne peuvent pas ne pas les répandre. Car s'ils ne les dépensent pas tout entiers pour leurs jouissances, à moins qu'ils ne jettent le surplus dans la rivière, ou qu'ils ne l'enfouissent, ce qui est une folie rare, ils le replacent, c'est-à-dire qu'ils en forment pour l'industrie de nouveaux fonds qu'elle emploie. Ainsi, même en économisant, ils ont soldé la même quantité de travail. Toute la différence, c'est qu'ils ont soldé du travail utile au lieu de travail inutile, et que sur les profits qu'il procure ils se sont créé une nouvelle rente qui augmentera la possibilité de leur consommation à l'avenir.
[249]
Le luxe, la consommation exagérée et superflue, n'est donc jamais bon à rien, économiquement parlant. Il ne pourrait avoir qu'une utilité indirecte. Ce serait, en ruinant les riches, de faire sortir des mains des hommes oisifs, des fonds qui, en se répendant parmi ceux qui travaillent, peuvent leur donner lieu de faire des économies, et former ainsi des capitaux dans la classe industrieuse. Mais premièrement cela irait directement contre l'intention de Montesquieu, qui croit le luxe avantageux, surtout dans une monarchie, et qui en même temps pense que la conservation des mêmes familles et la perpétuité de leur splendeur est essentiellement nécessaire à ce genre de gouvernement. De plus il faut bien observer avec M. Say, que le goût des dépenses superflues a pour principe la vanité ; qu'il ne peut exister dans la classe supérieure, sans se répandre de proche en proche dans toutes les autres ; qu'il y est encore plus funeste, parce que leurs moyens sont moindres, et parce qu'il y absorbe des fonds dont elles faisaient un meilleur usage, et qu'ainsi il ne fait partout que substituer des dépenses inutiles à des dépenses utiles, et par là tarir la source des richesses. Je crois tout cela incontestable.
Aussi nos politiques ne se contentent plus de dire vaguement que le luxe fait la prospérité de l'État, qu'il anime la circulation, qu'il fait vivre le pauvre. Ils se sont fait une théorie. Ils posent en principe général, que la consommation est la cause de la production, qu'elle en est la mesure, qu'ainsi il est [250] bon qu'elle soit très forte. Ils affirment que c’est là ce qui met une grande différence entre l'économie publique et l'économie privée. Ils n'osent pas toujours dire positivement que plus une nation dépense, plus elle s'enrichit. Mais ils se persuadent et ils soutiennent qu'il ne faut pas raisonner, quand il est question de la fortune publique, comme s'il s'agissait de celle d'un particulier ; et ils regardent comme des esprits très étroits ceux qui croient tout simplement que dans tous les genres et dans tous les cas, la bonne économie est toujours d'être économe, c'est-à-dire de faire un emploi utile de ses moyens[49]. Il y a dans tout cela un renversement d'idées qu'il est bon de faire disparaître, et la clarté renaîtra.
Certainement la consommation est la cause de la production, en ce sens que nous ne produisons que pour consommer, et que si nous n'avions aucun besoin à satisfaire, nous ne nous donnerions pas la [251] peine de rien produire ; il n'y aurait même pour nous rien d'utile ni rien de nuisible. Elle en est encore la cause, en ce sens que les gens industrieux ne produisent que parce qu'ils trouvent des consommateurs de leurs productions : c'est ce qui fait dire avec raison que la vraie manière d'encourager l'industrie est d'accroître l'étendue du marché, et d'augmenter par là la possibilité du débit. Sous ce rapport, il est vrai encore de dire que la consommation est la mesure de la production ; car où le débit cesse, la production s'arrête. C'est ce qui nous a fait dire aussi qu'on ne pouvait pas multiplier les établissements d'industrie au-delà d'un certain terme, et que ce terme est celui où ils cessent de donner des profits, parce qu'alors il est manifeste que ce qu'ils produisent ne vaut plus ce qu'ils consomment. Mais de tout cela il ne suit pas, pas plus pour une nation que pour un individu, que dépenser soit s'enrichir, ni qu'on puisse augmenter sa dépense à volonté, ni même que le luxe l'augmente, [252] car il ne fait que la changer. Il faut toujours en revenir à la production ; c'est le point de départ. Pour jouir il faut produire ; voilà le premier pas. On ne produit qu'en se servant des richesses déjà acquises ; plus on en a, plus on a de moyens de produire. On les consomme en frais de production ; elles renaissent avec profit. On ne peut dépenser annuellement que ce profit annuel ; plus on en emploie en choses inutiles, moins il en reste pour les choses utiles. Si on le dépasse, le fonds est entamé ; la reproduction, et par suite la consommation à venir, seront diminuées. Elles pourront augmenter, au contraire, si on fait des économies qui forment de nouveaux capitaux. Donc, encore une fois, consommation n'est pas richesse, et il n'y a d'utile, sous le rapport économique, que celle qui se reproduit avec profit.
Jamais aucun sophisme ne pourra ébranler des vérités si constantes. Si on les a méconnues, c'est qu'on a pris l'effet pour la cause, et qui plus est, un effet fâcheux pour une cause bienfaisante. On a vu que, quand une nation devient riche, il s'établit une grande inégalité entre les fortunes, et que les possesseurs des grandes fortunes se livrent à un très grand luxe. On a cru que c'était cela qui faisait prospérer un pays, et on s'est hâté de conclure que l'inégalité et le luxe étaient deux très bonnes choses. On aurait dû voir, au contraire, que ce sont deux inconvénients attachés à la prospérité [50]; que [253] les richesses qui les causent sont acquises avant qu'ils existent, et que si elles continuent encore à s'accroître, c'est malgré l'existence de ces inconvénients, et par l'effet des bonnes habitudes d'activité et d'économie qu'ils n'ont pu détruire totalement. Mais les intérêts personnels les plus forts contribuent à accréditer l'erreur. Les hommes puissants n'ont garde de convenir que leur existence soit un mal, et que leur dépense soit aussi inutile que leur personne. Ils tâchent au contraire d'en imposer par, le faste, et il ne tient pas à eux qu'on ne croie que c'est rendre un grand service à l'État, que d'engloutir beaucoup de moyens d'existence, et qu'il y a beaucoup de mérite à savoir dissiper de grandes richesses [51]. D'un autre côté, ceux qui tiennent à [254] eux, il qui ils en imposent, et qui font des profits à leurs dépens, ne s'embarrassent guère si l'argent qu'ils en tirent serait mieux employé ailleurs, et si, étant mieux employé il ferait vivre un plus grand nombre d'hommes ; ils désirent que cette dépense dont ils vivent soit très forte, et ils croient fermement que si elle diminuait ils seraient sans ressources, car ils ne voient pas ce qui la remplacerait. C'est ainsi que l'opinion générale s'égare, et que ceux même qui en souffrent ne connaissent pas la cause de leurs maux. Cependant il est certain que la consommation vicieuse appelée luxe, et en général toute la consommation des capitalistes oisifs, bien loin d'être utile, détruit la plus grande partie des moyens de prospérité d'une nation ; et cela est si vrai, que dès qu'un pays où il y a de l'industrie et des lumières est délivré de ce fléau par une raison ou par une autre, on y voit tout de suite un accroissement de richesses et de forces vraiment prodigieux.
Ce que la raison nous démontre, l'histoire nous le prouve par les faits. Quand la Hollande a-t- elle été capable d'efforts vraiment incroyables ? C'est quand ses amiraux vivaient comme ses matelots quand tous les bras de ses citoyens étaient [255] employés à enrichir l'État ou à le défendre, et aucun à faire croître des tulipes et à payer des tableaux. Tous les événements politiques et commerciaux subséquents se sont réunis pour la faire déchoir. Elle a conservé l'esprit d'économie ; elle a encore des richesses considérables dans un pays où tout autre peuple vivrait à peine. Faites d'Amsterdam la résidence d'une cour galante et magnifique, changez ses vaisseaux en habits brodés et ses magasins en salles de bals, et vous verrez si dans très peu d'années il lui restera seulement de quoi se défendre contre les irruptions de la mer.
Quand l'Angleterre, malgré ses malheurs et ses fautes, a-t-elle pris un développement prodigieux ? Est-ce sous Cromwell ou sous Charles II ? Je sais que les causes morales ont bien plus de puissance que les calculs économiques ; mais je dis que ces causes morales n'augmentent si prodigieusement toutes les ressources, que parce qu'elles dirigent tous les efforts vers des objets solides, ce qui fait que les moyens ne manquent ni à l'État ni aux particuliers pour les grandes choses, parce qu'ils ne les ont pas employés en futilités.
Pourquoi les citoyens des États-Unis de l'Amérique septentrionale voient-ils doubler, tous les vingt-cinq ans, leur culture, leur industrie, leur commerce, leur richesse et leur population ? C'est parce qu'il n'y a presque pas un oisif parmi eux, et que les riches font très peu de dépenses superflues. Ils sont dans une position très favorable, j'en conviens ; la terre ne manque point à leur développement ; [256] elle s'offre d'elle-même à leurs travaux et les récompense ; mais enfin s'ils travaillaient peu et dépensaient beaucoup, cette terre resterait inculte ; ils s'appauvriraient ; languiraient et seraient misérables, comme les Espagnols le sont malgré tous leurs avantages.
Enfin, prenons un dernier exemple bien plus frappant encore. La France, sous son ancien gouvernement, n'était certainement pas aussi misérable que les Français eux-mêmes se sont plu à le dire ; mais elle n'était pas florissante. Sa population [52] et son agriculture n'étaient pas rétrogrades ; mais elles étaient stationnaires, ou si elles faisaient quelques faibles progrès, ils étaient moindres que ceux de plusieurs nations voisines, et par conséquent peu proportionnés aux progrès des lumières du siècle. Elle était obérée ; elle n'avait aucun crédit ; elle manquait toujours de fonds pour les dépenses utiles ; elle se sentait incapable de supporter les frais ordinaires de son gouvernement, et encore plus de faire aucun grand effort à l'extérieur. En un mot, malgré l'esprit, le nombre et l'activité de ses habitants, la richesse et l'étendue de son sol, et les [257] bienfaits d'une très longue paix très peu troublée, elle tenait avec peine son rang parmi ses rivaux, et était peu considérée et nullement redoutée au-dehors.
Sa révolution est venue. Elle a souffert tous les maux imaginables ; elle a été déchirée par des guerres atroces, civiles et étrangères ; plusieurs de ses provinces ont été dévastées et leurs villes réduites en cendres ; toutes ont été pillées par les brigands et par les fournisseurs des troupes ; son commerce extérieur a été anéanti ; ses flottes ont été totalement détruites, quoique souvent renouvelées ; ses colonies, qu'on croyait si nécessaires à sa prospérité, ont été abîmées, et, qui pis est, elle a perdu tous les hommes et tous les trésors qu'elle a prodigués pour les subjuguer ; son numéraire a été presque tout exporté, tant par l'effet de l'émigration que par celui du papier- monnaie ; elle a entretenu quatorze armées dans un temps de famine, et au milieu de tout cela, il est notoire que sa population et son agriculture ont augmenté considérablement en très peu d'années ; et, à l'époque de la création de l'empire, sans que rien fût encore amélioré pour elle du côté de la mer et du commerce étranger, auquel on attache communément une si grande importance, sans qu'elle eût en un seul instant de paix pour se reposer, elle supportait des taxes énormes ; elle faisait des dépenses immenses en travaux publies ; elle suffisait à tout sans emprunt, et elle avait une puissance colossale à laquelle rien ne pouvait résister sur le continent de l'Europe, et qui aurait subjugué [258] tout l'univers sans la marine anglaise. Qu'est-il donc arrivé dans ce pays qui ait pu produire ces inconcevables effets ? Une seule circonstance changée a suffi.
Dans l'ancien ordre de choses, la plus grande partie des travaux utiles des habitants de la France était employée chaque année à produire les richesses qui formaient les immenses revenus de la cour et de toute la classe riche de la société, et ces revenus étaient presque entièrement consommés en dépenses de luxe, c'est-à-dire à solder une masse énorme de population dont tout le travail ne produisait absolument rien que les jouissances de quelques hommes. En un moment la presque totalité de ces revenus a passé partie dans les mains du nouveau gouvernement, partie dans celles de la classe laborieuse ; elle a alimenté de même tous ceux qui en tiraient leur subsistance ; mais leur travail a été appliqué à des choses nécessaires ou utiles, et il a suffi pour défendre l'État au-dehors et accroître ses productions au-dedans [53].
Doit-on en être surpris quand on songe qu'il y a eu un temps assez long où, par l'effet même de la commotion et de la détresse générales, il y avait à peine en France un seul citoyen oisif ou occupé de [259] travaux inutiles. Ceux qui faisaient des carrosses ont fait des affûts de canons ; ceux qui faisaient des broderies et des dentelles ont fait de gros draps et de grosses toiles ; ceux qui ornaient des boudoirs ont bâti des granges et défriché des terres, et même ceux qui jouissaient en paix de toutes ces inutilités ont été forcés, pour subsister, de rendre des services dont on avait besoin. Un homme qui entretenait quarante domestiques inutiles a laissé solder ces hommes-là par la classe industrieuse ou par l'État, et est devenu lui-même commis de bureau. C'est là le secret des prodigieuses ressources que se trouve toujours un corps de nation dans ces grandes crises. On met à profit alors tout ce qu'on laissait perdre de forces, sans s'en apercevoir, dans les temps ordinaires, et l'on est effrayé de voir combien cela était considérable.
C'est là le fonds de tout ce qu'il y a de vrai dans les déclamations de collège sur la frugalité, la sobriété, l'horreur du faste, et toutes ces vertus démocratiques des nations pauvres et agrestes, que l'on nous vante si ridiculement sans en comprendre ni la cause ni l’effet. Ce n'est pas parce qu'elles sont pauvres et ignorantes que ces nations sont fortes, c'est parce que rien n'est perdu du peu de forces qu'elles ont, et qu'un homme qui a cent francs et qui les emploie bien a plus de moyens qu'un homme qui en a mille et qui les perd au jeu. Mais faites qu'il en soit de même chez une nation riche et éclairée, et vous verrez le même développement de forces que vous avez vu dans la [260] nation française, lequel a produit des effets bien supérieurs à tout ce qu'a jamais exécuté la république romaine, car il a renversé des obstacles bien plus puissants. Que l'Allemagne, par exemple, laisse seulement pendant quelques années dans les mains de la classe laborieuse les revenus qui servent au faste de toutes ses petites cours et de ses riches abbayes, et vous verrez si elle sera une nation forte et redoutable. Au contraire, supposez que l'on rétablisse entièrement en France l'ancien cours des choses ; qu'une grande masse de biens rentre dans les mains des hommes oisifs ; que le gouvernement continue à enrichir des favoris et à faire de grandes dépenses en choses inutiles, vous y verrez incessamment renaître, malgré le grand accroissement de son territoire, la langueur au milieu des ressources misère au milieu des richesses, la faiblesse au milieu de tous les moyens de force.
On me répétera que j'attribue à la seule distribution des richesses et à l'emploi du travail qu'elles soldent le résultat d'une foule de causes morales de la plus grande énergie. Encore une fois, je ne nie pas l'existence de ces causes, je la reconnais comme tout le monde ; mais de plus j'explique leur effet. Je conviens que l'enthousiasme de la liberté intérieure et de l'indépendance extérieure, et l'indignation contre une oppression injuste et une agression plus injuste encore, ont pu seules opérer en France ces grands renversements ; mais je soutiens que ces renversements n'ont fourni à ces passions tant de moyens de succès, malgré les erreurs et les [261] horreurs auxquelles leur violence les a entraînées, que parce qu'ils ont produit un meilleur emploi de toutes les forces. Tout le bien des sociétés humaines est dans la bonne application du travail ; tout le mal dans sa déperdition : ce qui, au reste, ne veut dire autre chose, si ce n'est que quand on s'occupe de pourvoir à ses besoins ils sont satisfaits, et que quand on perd son temps on souffre. On est honteux de devoir prouver une vérité si palpable ; mais il faut se rappeler que l'étendue de ses conséquences est surprenante.
On pourrait faire un ouvrage tout entier sur le luxe, et il serait utile, car ce sujet n'a jamais été bien traité. On montrerait que le luxe, c'est-à-dire le goût des dépenses superflues, est, jusqu'à un certain point, l'effet nécessaire du penchant naturel à l'homme pour se procurer incessamment des jouissances nouvelles quand il en a les moyens, et de la puissance de l'habitude, qui lui rend nécessaires les aisances dont il a joui, même alors qu'il lui devient onéreux de continuer à se les procurer ; que, par conséquent, le luxe est une suite inévitable de l'industrie, dont pourtant il arrête les progrès, et de la richesse, qu'il tend à détruire ; et que c'est pour cela aussi que quand une nation est déchue de son ancienne grandeur, soit par l'effet lent du luxe, soit par toute autre cause, il y survit à la prospérité qui l'a fait naître et en rend le retour impossible, à moins que quelque secousse violente et dirigée vers ce but ne produise une régénération brusque et complète. Il en est de même des particuliers.
[262]
Il faudrait faire voir d'après ces données que, dans la situation opposée, quand une nation prend pour la première fois son rang parmi les peuples civilisés, il faut, pour que le succès de ses efforts soit complet, que les progrès de son industrie et de ses lumières soient beaucoup plus rapides que ceux de son luxe. C’est peut-être principalement à cette circonstance que l’on doit attribuer le grand essor qu'a pris la monarchie prussienne sous son second et son troisième rois, exemple qui doit un peu embarrasser ceux qui prétendent que le luxe est nécessaire à la prospérité des monarchies [54]. C'est cette même circonstance qui me paraît assurer la durée de la félicité des États-Unis ; et l'on peut craindre que de ne pas jouir complètement de cet avantage ne rende difficiles et imparfaites la vraie prospérité et la vraie civilisation de la Russie.
Il faudrait dire quelles sont les espèces de luxe les plus nuisibles. On pourrait considérer la maladresse dans les fabriques comme un grand luxe, car elle entraîne une grande perte de temps et de travail. Il faudrait surtout expliquer comment la principale et la presque unique source du luxe, proprement dit, est dans les grandes fortunes, car à peine serait-il possible s'il n'en existait que de médiocres. L'oisiveté même, dans ce cas, ne [263] pourrait guère avoir lieu. Or c'est une espèce de luxe, puisque si elle n'est pas un emploi stérile du travail, elle en est la suppression [55]. Les branches d'industrie qui peuvent produire rapidement des richesses immenses portent donc avec elles un inconvénient qui contrebalance fortement leurs avantages. Ce ne sont pas celles-là que l'on doit désirer de se voir développer les premières dans une nation naissante. De ce genre est le commerce extérieur très étendu. L'agriculture, au contraire est bien préférable ; ses produits sont lents et bornés. L'industrie proprement dite, celle des fabriques, est encore sans danger et très utile. Ses profits ne sont pas excessifs, ses succès sont difficiles à obtenir et à perpétuer ; ils exigent beaucoup de connaissances et des qualités estimables, et ils ont des conséquences très heureuses pour le bien-être des consommateurs. La bonne fabrication des objets de première nécessité est surtout désirable. Ce n'est [264] pas que les manufactures d'objets de luxe ne puissent aussi être très avantageuses à un pays ; mais c'est quand leurs produits sont comme la religion de la cour de Rome, dont on dit qu'elle est pour elle une marchandise d'exportation et non pas de consommation ; et il est toujours à craindre de s'enivrer de la liqueur qu'on prépare pour les autres. Toutes ces observations, et beaucoup d'autres, devraient être développées dans l'ouvrage dont il s'agit, et seraient superflues ici ; elles rentrent, à beaucoup d'égards, dans les réflexions que j'ai faites ci-dessus (chap. X), à propos de la manière dont les richesses se distribuent dans un pays à mesure qu'elles s'y accumulent. D'ailleurs mon objet n'est point de faire l'histoire du luxe ; je ne voulais que montrer ses effets sur la consommation générale et sur la circulation.
Je me bornerai à ajouter que si le luxe est un grand mal sous le rapport économique, il en est un bien plus grand encore sous le rapport moral, qui est toujours le plus important de beaucoup, quand il s'agit des intérêts des hommes. Le goût des dépenses superflues, dont la principale source est la vanité, la nourrit et l'exaspère ; il rend l'esprit frivole et nuit à sa justesse ; il produit le dérèglement dans la conduite, qui engendre beaucoup de vices, de désordres, de troubles dans les familles ; il conduit aisément les femmes à la dépravation, les hommes à l'avidité, les unes et les autres au manque de délicatesse et de probité, et à l'oubli de tous les sentiments généreux et tendres ; [265] en un mot, il énerve les âmes en rapetissant les esprits, et il produit ces tristes effets non seulement sur ceux qui en jouissent, mais encore sur tous ceux qui y servent, ou qui l'admirent, ou qui l'imitent, ou qui l'envient. Tout cela se verra mieux quand nous parlerons de nos intérêts moraux : je ne pouvais que l'indiquer ici. Il ne faut point confondre les matières, quelque intimement liées qu'elles soient.
Par la même raison, l'on ne s'attend pas sans doute que je discute actuellement si, le luxe étant reconnu nuisible, on doit le combattre par les lois ou par les mœurs, ni que j'examine par quels moyens l'on peut favoriser la production et donner une direction utile à la consommation. Ce serait empiéter sur le domaine de la législation, dont peut-être je m'occuperai quelque jour ; mais dans toute cette partie-ci de mon ouvrage, je dois me borner à constater les faits.
Je crois avoir solidement établi que puisque l'on ne peut jamais dépenser que ce l'on a, la production est le seul fonds de la consommation ; que, par conséquent, on ne peut jamais augmenter la consommation et la circulation qu'en augmentant la production, et qu'enfin détruire n'est pas produire et dépenser n'est pas s'enrichir. Ce petit nombre de vérités bien simples va nous faire voir très clairement les effets des revenus et des dépenses des gouvernements sur la prospérité des nations.
[266]
CHAPITRE XII.↩
Des Revenus et des Dépenses du gouvernement, et de ses Dettes.
Ce sujet est encore très vaste, quoiqu'il ne soit qu'une partie de celui que nous venons de traiter. Beaucoup d'écrivains le partageraient en trois livres, qu'ils subdiviseraient chacun en plusieurs chapitres ; mais je préfère ne pas séparer ces matières, afin de ne pas faire perdre de vue leur mutuelle dépendance ; et je me sens le besoin de les considérer principalement dans leur ensemble, et sous un aspect général et commun. Cela ne m'empêchera pas d'entrer aussi dans les détails et de distinguer les cas particuliers qui sont réellement différents, peut-être même avec plus d'exactitude qu'on ne l'a encore fait.
Dans toute société, le gouvernement est le plus grand des consommateurs. Par cela seul il mérite un article à part dans l'histoire de la consommation, sans quoi elle serait incomplète. Mais aussi, par la même raison, on ne comprendrait jamais bien les effets économiques du gouvernement, et ceux de ses recettes et de ses dépenses, si auparavant on ne s'était pas fait une idée nette et juste de la consommation générale, de sa base et de sa marche.
Les mêmes erreurs que nous venons de combattre vont se reproduire ici. Ceux qui pensent que les [267] travaux de l'agriculture sont les seuls productifs ne manquent pas de dire qu'en définitif tous les impôts retombent sur les propriétaires des terres ; que leur revenu est la seule matière imposable ; que l'impôt territorial est le seul juste et utile, et qu'il ne devrait pas y en avoir d'autre; et ceux qui se persuadent que la consommation peut être une cause directe de richesse soutiennent que les prélèvements que le gouvernement fait sur la fortune des particuliers stimulent puissamment l'industrie ; que ses dépenses sont très utiles, en augmentant la consommation et animant la circulation, et que tout cela est très favorable à la prospérité publique. Pour voir nettement le vice de ces sophismes, il faut toujours suivre la même marche et commencer par bien établir les faits.
D'abord, il n'est pas douteux qu'un gouvernement quelconque ne soit très nécessaire à toute société politique ; car il faut bien que ses membres soient jugés, administrés, protégés, défendus, garantis de toute violence : ce n'est que pour cela qu'ils se sont réunis en société. Il n'est pas douteux non plus qu'il ne faille que ce gouvernement ait des revenus, puisqu'il a des dépenses à faire. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ; il s'agit de savoir quel effet ces revenus et ces dépenses produisent sur la richesse publique et la prospérité nationale.
Pour en juger, puisque le gouvernement est un grand consommateur, et le plus grand de tous, il faut, en cette qualité, l'examiner comme nous ayons examiné les autres consommateurs, c'est-à-dire [268] voir d'où lui viennent les fonds dont il dispose et quel usage il en fait.
Une première chose bien certaine, c'est que le gouvernement ne peut pas être rangé parmi les consommateurs de la classe industrieuse. La dépense qu'il fait ne se reproduit pas dans ses mains avec accroissement de valeur. Il ne se soutient pas par les profits qu'il fait. J'en conclus déjà que sa consommation est bien réelle et définitive ; qu'il ne reste rien du travail qu'il solde, et que les richesses qu'il emploie et qui étaient existantes sont consommées et détruites quand il s'en est servi. Reste à voir d'où elles lui viennent.
Puisque la personne morale appelée gouvernement ne vit pas de profits, elle vit de revenus. Ses revenus viennent de deux sources : il possède des biens-fonds et il lève des impôts.
Quant aux biens-fonds, il est absolument dans le même cas que les autres capitalistes que nous avons nommés oisifs. Il les afferme et en tire une rente, ou, si ce sont des bois, il en vend annuellement les coupes. Le soin que l'on prend des bois, et qui consiste principalement à les conserver, ne mérite pas le nom de travail industriel. Le véritable travail qui les met en valeur est celui de les exploiter, de les débiter, de les transporter. S'ils appartenaient à celui qui les exploite, il en tirerait tout le profit. Le prix des ventes annuelles qu'on lui en fait doit être regardé comme une rente prélevée sur l'industrie de cet exploiteur, rente absolument semblable à celle que l'on retire de la [269] pêche d'une rivière que l'on afferme tous les ans à celui qui a l'industrie d'en extraire du poisson. Ainsi, les revenus provenant des biens-fonds appartenant au gouvernement sont, comme ceux de tous les autres biens ruraux, créés par des hommes industrieux qui les exploitent, et prélevés sur leurs profits.
Beaucoup de politiques n'approuvent pas que le gouvernement possède des biens-fonds. Il est bien vrai que, comme il est nécessairement un propriétaire peu soigneux, ses régisseurs ne peuvent guère manquer d'être très chers et peu fidèles. Ainsi, il fait plus maladroitement ce qu'un autre propriétaire ferait mieux. Mais il est à remarquer que cette maladresse ne diminue point ou diminue très peu la masse totale de la production de ces fonds ; car la quantité de la production des biens-fonds ne dépend guère de ceux qui les régissent, mais presque uniquement de ceux qui les exploitent. Or rien n'empêche que ses terres ne soient aussi bien cultivées et ses bois exploités avec autant d'intelligence que ceux des particuliers. Les défauts de sa régie se bornent donc à y employer un peu plus d'hommes qu'il ne faudrait, et à les payer un peu trop cher. Or ce n'est pas là un bien grand inconvénient.
Je vois, au contraire, plusieurs avantages à ce que le gouvernement ait des possessions de ce genre. Premièrement, il est des espèces de productions que lui seul peut conserver en grande quantité. Tels sont les bois de haute-futaie, dont il faut attendre [270] le produit trop longtemps pour que le plus souvent les particuliers ne préfèrent pas, à quantité égale et même moindre, des rentrées plus fréquentes. Secondement, il peut être bon que le gouvernement possède des terres cultivées ; il en sera à portée de mieux connaitre les ressources et les intérêts des diverses localités ; et s'il est sage et bienfaisant, il pourra même en profiter pour répandre des lumières utiles. Troisièmement, quand une grande masse des biens-fonds est dans les mains du gouvernement, il en reste moins dans le commerce. Or, comme ce genre de possessions est toujours fort désiré, toutes choses égales d'ailleurs, moins il y en aura à vendre et plus ils se vendront cher, c'est-à-dire que pour une somme de cent mille francs, l'acquéreur se contentera de trouver quatre ou même trois mille francs de revenu au lieu de cinq, et cela fera baisser le taux de l'intérêt de l'argent dans tous les autres placements, ce qui est un grand bien. Quatrièmement, et cette considération est la plus importante de toutes, tout ce que le gouvernement tire annuellement de ces biens-fonds est un revenu qu'il n'enlève à personne ; il lui vient de son propre bien, comme à tous les autres propriétaires, et c'est autant de diminué sur ce qu'il est obligé de se procurer par des impôts. Enfin, dans un cas de nécessité, il peut, comme les particuliers, faire ressource en vendant de ses fonds, sans avoir recours aux emprunts, qui sont toujours un grand mal, comme nous le verrons bientôt.
Par toutes ces raisons, je crois très heureux que [271] le gouvernement soit un très gros propriétaire, surtout de bois et de grosses fermes. Je n'y aurais qu'un regret, c'est que cela empêchât ces biens de tomber dans les mains de la classe industrieuse. Mais nous avons vu, à propos de l'industrie agricole, que, par la nature des choses, les propriétés de ce genre ne peuvent guère être possédées par ceux qui les exploitent, parce que cela leur enlèverait trop de fonds. Or, je les aime mieux appartenant au gouvernement qu'à tout autre capitaliste vivant de revenus.
Au reste, nos gouvernements modernes en général possèdent peu de biens-fonds. Ce n'est pas qu'ils n'aient presque tous déclaré leur domaine inaliénable ; mais aussi ils l'ont presque tous vendu ou donné en très grande partie. Le véritable revenu sur lequel ils comptent, ce sont les impôts. C'est donc celui-là dont il faut nous occuper.
Par le moyen des impôts, le gouvernement enlève aux particuliers des richesses qui étaient à leur disposition, pour les dépenser lui-même : ainsi ce sont toujours des sacrifices qu'il leur impose.
Si ce sacrifice porte sur les hommes qui vivent de revenus et qui les emploient tout entiers à leurs jouissances personnelles, il ne change rien à la masse totale de la production, de la consommation et de la circulation générales. Toute la différence, c'est qu'une partie des salariés que ces hommes soldaient est soldée par le gouvernement avec l'argent qu'il leur a enlevé. C'est le cas le plus favorable.
Quand l'impôt porte sur les hommes industrieux [272] qui vivent de profits, il peut ne faire que diminuer leurs profits. Alors c'est la partie de ces profits que ces hommes employaient à leurs jouissances personnelles qui est attaquée ; ce sont ces jouissances qui sont diminuées, et l'impôt n'a que les mêmes effets qu'il avait dans le cas précédent ; mais s'il va jusqu'à annihiler les profits des hommes industrieux, ou même jusqu'à entamer les fonds de leur industrie, alors c'est cette industrie elle-même qui est dérangée ou détruite ; et par conséquent la production et par suite la consommation générales en sont diminuées. La souffrance est partout.
Enfin, lorsque l'impôt tombe sur les salariés, il est évident qu'ils commencent par souffrir. Si la perte reste tout entière sur eux, c’est une partie de leur consommation qui est supprimée, et qui est remplacée par celle de ceux que le gouvernement paie avec l'argent qu'il leur enlève. S'ils trouvent le moyen de la faire retomber sur ceux qui les emploient, en haussant le prix de leurs salaires, alors il faut savoir par qui ils sont employés ; et suivant qu'ils le sont par des capitalistes oisifs ou par des capitalistes industrieux, cette perte à l'un des deux effets que nous venons de décrire en parlant des capitalistes.
Cette explication préliminaire paraîtra, je crois incontestable, après les éclaircissements que nous avons donnés en parlant de la consommation. Maintenant la grande difficulté est de découvrir sur qui tombe réellement la perte occasionnée par l'impôt ; car tous les impôts ne produisent pas les mêmes [273] effets, et ils sont si multipliés, qu'il est impossible de les examiner chacun séparément. Je pense que le mieux est de ranger sous une même dénomination tous ceux qui sont essentiellement de même nature.
Tous les impôts imaginables, et je crois qu'ils ont tous été imaginés, peinent se partager en six espèces principales [56], savoir : 1° l'impôt sur le revenu des terres, tel que la taille réelle, les vingtièmes, la contribution foncière en France et le landtax en Angleterre ; 2° celui sur les loyers des maisons ; 3° celui sur les rentes dues par l'État ; 4° celui sur les personnes, comme capitation et taille personnelle, contribution somptuaire et mobilière, droit de patentes, jurandes, maîtrises, etc., etc. ; 5° celui sur les actes civils et sur certaines transactions sociales, comme droits de timbre et d'enregistrement, de lods et vente, de centième denier, d'amortissement et autres, auxquels il faut joindre l'impôt annuel qu'on voudrait mettre sur les rentes constituées à un particulier par un autre ; car on n'a d'autre moyen de connaître ces placements, ou donations, ou transmissions, que les dépôts qui conservent les actes qui les établissent ; 6° et enfin celui sur les marchandises, soit par monopole et vente exclusive ou même forcée, comme autrefois le sel et le tabac en France, soit au [274] moment de la première production, comme les droits sur les marais salants et sur les mines, et une partie de ceux sur les vins en France, et sur les brasseries en Augleterre, soit au moment de la consommation, soit dans le trajet depuis le premier producteur jusqu'au consommateur définitif, comme les douanes tant intérieures qu'extérieures, les taxes sur les routes, les canaux, les ports et aux portes des villes, etc., etc.
Chacun de ces impôts a une ou plusieurs manières qui lui sont propres, d'être onéreux.
Au premier coup d'œil, on voit que l'impôt sur le revenu des terres a l'inconvénient d'être très difficile à répartir avec justice, et d'annuler la valeur de toutes les terres dont la location ne surpasse pas la taxe, ou la surpasse de trop peu pour déterminer à courir les risques inévitables et à faire les frais nécessaires pour mettre ces terres en état d'être cultivées.
L'impôt sur le revenu des maisons louées a le défaut de diminuer le produit des spéculations de bâtisse, et par là de dégoûter de bâtir pour louer, en sorte que chaque citoyen est obligé de se contenter d'habitations moins saines et moins commodes que celles qu'il aurait eues pour le même loyer [57].
[275]
L'impôt sur les rentes dues par l'État est une vraie banqueroute si on l'établit sur des rentes déjà créées, puisque c'est une diminution de l'intérêt promis pour un capital reçu ; et il est illusoire si on le place sur des rentes au moment de leur création : car il eût été plus simple d'offrir un intérêt moins fort de toute la quotité de l'impôt, et cela serait revenu au même.
L'impôt sur les personnes donne lieu à des perquisitions très désagréables pour parvenir à le graduer suivant la fortune de chacun, et ne peut jamais reposer que sur des bases très arbitraires et des connaissances très imparfaites, tant lorsqu'on prétend l'asseoir sur des richesses acquises, que lorsqu'on veut le faire porter, sur des moyens d'en acquérir. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire lorsqu'il est motivé par la supposition d'une industrie [276] quelconque, il décourage cette industrie et il oblige à la renchérir ou à l'abandonner.
L'impôt sur les actes, et en général sur les transactions sociales, gêne la circulation des biens- fonds et diminue leur valeur vénale en rendant leur translation très coûteuse, augmente les frais de justice au point que le pauvre n'ose plus défendre ses droits, fait que toutes les affaires deviennent épineuses et difficiles, occasion des recherches inquisitoriales et des vexations de la part des agents du fisc, et oblige à faire dans les actes des réticence à ou même à y mettre des clauses et des évaluations illusoires qui ouvrent la porte à beaucoup d'iniquités, et deviennent la source d'une foule de contestations et de malheurs.
À l'égard des impôts sur les marchandises, leurs inconvénients sont encore plus nombreux et plus compliqués, et ne sont pas moins fâcheux ni moins certains.
Le monopole, ou la vente faite exclusivement par l'État, est odieux, tyrannique, contraire au droit naturel qu'a chacun d'acheter et de vendre comme il lui plaît, et nécessite une multitude de mesures violentes. C'est encore bien pis quand cette vente est forcée, c'est-à-dire quand on oblige le particulier, comme cela est arrivé quelquefois, à acheter ce dont il n'a pas besoin, sous le prétexte qu'il ne peut s'en passer, et que, s'il n'achète pas, c'est qu'il s'est approvisionné en contrebande.
L'impôt prélevé au moment de la production, [277] nécessite évidemment, de la part du producteur, une avance de fonds qui, étant longtemps sans lui rentrer, diminue beaucoup ses moyens de produire.
Il n'est pas moins clair que les impôts exigés, soit au moment de la consommation, soit pendant le transport depuis le producteur jusqu'au consommateur, gênent ou détruisent tous quelque branche d'industrie ou de commerce, rendent rares et coûteuses des denrées nécessaires ou utiles, troublent toutes les jouissances, dérangent le cours naturel des choses, et établissent, entre les différents besoins et les moyens d'y pourvoir, des proportions et des rapports qui n'existeraient pas sans ces perturbations, qui sont nécessairement variables, et qui rendent incessamment précaires les spéculations et les ressources des citoyens.
Enfin, tous ces impôts sur les marchandises, quels qu'ils soient, nécessitent une infinité de précautions et de formalités gênantes ; ils donnent lieu à une multitude de difficultés ruineuses ; ils sont nécessairement très sujets à l'arbitraire ; ils obligent à ériger en crimes des actions indifférentes en elles-mêmes, et à sévir par des punitions souvent cruelles. Leur perception est très dispendieuse, et elle entraîne l'existence d'une armée d'employés et d'une armée de fraudeurs, tous hommes perdus pour la société, qui y entretiennent continuellement une véritable guerre civile, avec toutes les funestes conséquences économiques et morales qui en résultent.
[278]
Quand on examine avec attention chacune de ces critiques des différents impôts, ou reconnaît qu'elles sont toutes fondées. Ainsi, après avoir fait voir que tout impôt est un sacrifice, nous nous trouvons avoir montré que chaque impôt a en outre une manière qui lui est propre de nuire aux contribuables. C'est déjà beaucoup ; mais cela ne nous apprend pas encore sur qui tombe précisément la perte résultante de l'impôt, et qui est-ce qui la supporte réellement et définitivement. Cependant cette dernière question est la plus importante, et absolument nécessaire à résoudre pour pouvoir juger des effets de l'impôt sur la prospérité nationale. Examinons-la donc avec attention, sans adopter aucun système, et en nous tenant scrupuleusement à l'observation des faits, comme nous avons fait jusqu'ici.
Pour l'impôt sur le revenu des terres, il est évident que c'est celui qui possède la terre au moment où l'on établit la taxe, qui la paie réellement, sans pouvoir la rejeter sur personne ; car elle ne lui donne pas le moyen d'augmenter ses produits, puisqu'elle n'ajoute rien ni à la demande de la denrée ni à la fertilité de la terre, et qu'elle ne diminue en rien les frais de culture. Tout le monde convient de cette vérité ; mais ce que l'on n'a pas assez remarqué, c’est que ce propriétaire doit être considéré moins comme étant privé d'une portion de son revenu annuel que comme ayant perdu la partie de son capital qui produirait cette portion de revenu au taux courant de l'intérêt actuel. La preuve en [279] est que, si une terre de cinq mille francs de revenu net vaut cent mille francs le lendemain du jour où on l'aura chargée d'un impôt perpétuel du cinquième, on n'en trouvera, toutes choses égales d'ailleurs, que quatre-vingt mille francs si on la met en vente, et elle ne sera de même comptée que pour quatre-vingt mille francs dans l'actif d'une succession où il se trouvera d'autres valeurs qui n'auront pas changé. En effet, quand l'État a déclaré qu'il prend à perpétuité le cinquième du revenu d'une terre, c'est comme s'il s'était déclare propriétaire du cinquième du fonds ; car nulle propriété ne vaut que par l'utilité qu'on en peut tirer. Cela est si vrai, que quand, en conséquence du nouvel impôt, l'État ouvre un emprunt aux intérêts duquel il affecte le revenu dont il s'est emparé, l'opération est consommée. Il a réellement touché le capital qu'il s'est approprié, et il l'a mangé tout d'un coup au lieu d'en dépenser actuellement le revenu. C'est comme quand M. Pitt s'est fait livrer tout d'un coup par les propriétaires le capital de l'impôt territorial dont ils étaient chargés. Ils se sont trouvés libérés, et lui, a mangé son fonds.
Il suit de là que quand toutes les terres ont changé de mains depuis l'établissement de l'impôt, il n'est plus réellement payé par personne. Les acquéreurs n'ayant acquis que ce qui restait, ils n'ont rien perdu ; les héritiers n'ayant recueilli que ce qu'ils ont trouvé, le surplus est pour eux comme si leur prédécesseur l'avait dépensé ou perdu, comme effectivement il l'a perdu ; et dans les successions [280] délaissées comme mauvaises, ce sont les créanciers qui ont perdu ce capital prélevé par l'État sur le gage de leurs créances.
Il suit de là encore que quand l'État renonce à tout ou partie d'un impôt territorial anciennement établi à perpétuité, il fait purement et simplement présent aux propriétaires actuels des terres, du capital du revenu qu'il cesse de percevoir. C'est à leur égard un don absolument gratuit, auquel ils n'ont pas plus de droits que tout autre citoyen ; car aucun d'eux n'avait compté sur ce capital dans les transactions par lesquelles il est devenu propriétaire.
Il n'en serait pas absolument de même si l'impôt n'avait été établi originairement que pour un nombre d'années déterminé. Alors il n'y aurait eu réellement d'enlevé au propriétaire que la portion du capital correspondante à ce nombre d'annuités. Aussi l'État n’aurait-il pu emprunter que cette valeur aux prêteurs à qui il aurait donné l'impôt en paiement de leur capital et de leurs intérêts, et les terres n'auraient été considérées dans les transactions que comme détériorées de cette quantité. Dans ce cas, quand l'impôt cesse, comme quand les coupons de l'emprunt qui y correspond sont épuisés, c'est de part et d'autre une dette qui s'éteint parce qu'elle est soldée. Du reste, le principe est le même que dans le cas de l'impôt et de la rente perpétuels.
Il est donc toujours vrai que quand on met un impôt sur le revenu des terres, on enlève à l'instant à ceux qui ici possèdent actuellement une valeur [281] égale au capital de cet impôt ; et quand elles ont toutes changé de mains depuis qu'il est, établi, il n'est plus réellement payé par personne. Cette observation est singulière et importante.
Il en est absolument de même de l'impôt sur le revenu des maisons. Ceux qui les possèdent au moment où on l'établit supportent la perte en entier ; car ils n'ont aucun moyen de s'en dédommager. Mais ceux qui les achètent ensuite ne les paient qu'en conséquence des charges dont elles sont grevées. Ceux qui en héritent ne les comptent de même que pour la valeur qui leur reste ; et quant à ceux qui en bâtissent postérieurement, ils font leurs calculs d'après les choses telles qu'elles sont établies. S'il ne restait plus assez de marge pour que la spéculation fût utile, ils ne la feraient pas jusqu'à ce que, par l'effet de la rareté, les loyers fussent augmentés ; comme, au contraire, si elle était encore trop avantageuse, il s'y jetterait bientôt assez de fonds pour que cet emploi ne fût plus préférable à tout autre. Concluons encore que le propriétaire sur qui tombe l'impôt en perd en entier le capital, et que, quand tous sont morts ou expropriés, l'impôt n'est plus payé que par des gens qui n'ont plus à s'en plaindre.
On en peut dire tout autant de l'impôt qu'un gouvernement se permet quelquefois de mettre sur les rentes qu'il doit pour des capitaux fournis antérieurement. Certainement le malheureux créancier à qui on fait cette retenue en souffre tout le dommage, ne pouvant le rejeter sur personne ; mais [282] de plus il perd le capital de la retenue ordonnée. La preuve en est que, s'il vend sa rente, il en trouve d'autant moins qu'elle est plus grevée, si d'ailleurs le taux général de l'intérêt de l'argent n'a pas varié. D'où il suit que les possesseurs subséquents de cette mène rente ne paient plus rien ; car ils l'ont reçue en cet état et pour la valeur qui lui reste, en vertu d'acquisitions faites librement ou de successions acceptées volontairement.
L'effet de l'impôt sur les personnes n'est déjà plus le même. Il faut distinguer entre celui qui est censé porter sur les richesses acquises et celui qui a pour motif des moyens d'en acquérir, c'est- à-dire une industrie quelconque. Dans le premier cas, c'est bien toujours la personne imposée qui supporte la perte qui en résulte ; car elle ne peut la rejeter sur aucune autre. Mais comme pour chacun la taxe cesse avec sa vie, et que tout le monde y est soumis successivement à proportion de sa fortune présumée, le premier imposé ne perd que les redevances qu'il paie et non pas le capital, et ne libère pas ceux qui viennent après lui. Ainsi, à quelque époque que l'impôt cesse, ce n'est pas un pur gain que font ceux qui y sont soumis ; c'est, une charge pesant réellement sur eux qui cesse de se prolonger.
À l'égard de l'impôt personnel qui a pour motif une industrie quelconque, il est également vrai que celui qui le paie le premier n'en perd pas le capital et ne libère pas ceux qui y sont soumis après lui ; mais il donne lieu à des considérations d'un autre genre. L'homme qui exerce une industrie au [23] moment où elle vient à être grevée par un nouvel impôt personnel, tel que l'établissement ou l'accroissement des droits de patentes, de maîtrises, de jurandes, ou autres semblables, cet homme, dis-je, n'a que deux partis à prendre, ou de renoncer à son état, ou de payer ledit impôt et de supporter la perte qui en résulte, si malgré cela il voit qu'il y ait encore des bénéfices à faire dans sa profession. Dans le premier cas il souffre certainement, mais il ne paie pas l'impôt : ainsi je ne m'en occuperai pas actuellement. Dans le second, c'est lui assurément qui paie l'imposition, puisque n'augmentant la demande ni ne diminuant les frais, elle ne lui donne aucun moyen immédiat d'accroître ses recettes ou d'atténuer ses dépenses. Mais on ne met jamais tout d'un coup un impôt assez lourd pour que tous les hommes d'un même état soient inévitablement obligés de le quitter ; car toutes les professions industrielles étant nécessaires à la société, l'extinction totale d'une seule produirait un désordre général. Ainsi, lors de l'établissement d'un impôt de l'espèce de ceux dont nous parlons, il n'y a que les hommes qui sont déjà assez riches pour ne se plus soucier d'un bénéfice qui est diminue, on ceux qui exerçaient leur profession avec assez peu de succès pour qu'ils ne leur reste plus de profit après l'impôt payé, qui renoncent à leur etat. Les autres le continuent, et ceux-là, comme nous l'avons dit, paient réellement l'impôt, au moins jusqu'à ce que, débarrassés de la concurrence de beaucoup de leurs confrères, ils puissent se prévaloir de [284] cette circonstance pour se faire payer par les consommateurs plus cher qu'ils ne le faisaient auparavant.
Voilà pour ceux qui exerçaient la profession au moment de l'établissement de l'impôt. Quant à ceux qui l'embrassent après qu'il est établi, le cas est différent. Ils trouvent la loi faite. Ou peut dire qu'ils s'engagent à cette condition. L'impôt est pour eux au nombre des frais qu'exige la profession, comme l'obligation de louer tel emplacement ou d'acheter tel outil. Ils ne prennent cette profession que parce qu'ils calculent que, malgré ces frais, c'est encore le meilleur emploi qu'ils puissent faire de la portion de capitaux et d'industrie qu'ils possèdent. Ainsi ils avancent bien l'impôt, mais il ne leur enlève réellement rien. Ceux à qui il fait un tort réel, ce sont les consommateurs qui, sans cette charge, leur auraient fait, avec moins de dépense, le sort dont ils se contentent, et qui était le meilleur qu'ils fussent à portée de se procurer dans l'état actuel de la société. Il suit de là que si l'on ôte l'impôt, ces hommes font réellement un profit sur lequel ils n'ont pas compté, au moins jusqu'à ce que cet avantage leur amène de nouveaux concurrents. Ils se trouvent transportés gratuitement et fortuitement dans une classe de la société plus favorisée de la fortune que celle où ils étaient placés, tandis que, pour ceux qui étaient en exercice antérieurement à l'impôt, ce n'est qu'un retour à leur premier état. On voit que l'impôt personnel, basé sur l'industrie, a des effets bien divers ; mais son effet général est de diminuer les jouissances des consommateurs, puisque leurs [285] fournisseurs ne leur donnent pas de marchandises pour la partie de leur argent qui passe au trésor public. Je ne puis entrer dans plus de détails ; mais on ne saurait trop s'habituer à juger ces différents ricochets de l'impôt et à les suivre par la pensée dans toutes leurs modifications. Passons à l'impôt sur les papiers, les actes, les registres et autres monuments des transactions sociales.
Celui-là exige encore une distinction. La portion de cet impôt qui tourne en accroissement de frais de justice et qui en fait partie, est certainement payée par les plaideurs sur qui les jugements font tomber ces frais, et il est difficile de dire à quelle classe de la société il est le plus nuisible.
Cependant il est aisé de voir qu'il grève particulièrement le genre de propriétés qui est le plus sujet à contention. Or, comme ce sont les biens-fonds, l'établissement d'un tel impôt diminue certainement leur valeur vénale : d'où il suit que ceux qui les ont achetés depuis que l'impôt existe en sont un peu dédommagés d'avance par le moindre prix de leur acquisition, et que ceux qui les possédaient auparavant supportent la perte tout entière s'ils plaident, et supportent même une perte sans plaider et sans payer l'impôt, puisque la valeur de leur propriété en est diminuée. Par conséquent si l'impôt cesse, ce n'est que restitution pour ces derniers, et il y a une portion de gain gratuit pour les autres ; car ils se trouvent dans une meilleure position que celle sur laquelle ils avaient compté et d'après laquelle ils avaient fait leurs spéculations.
[286]
Tout cela est encore vrai, et est vrai sans restriction de la portion de l'impôt sur les transactions qui regardent les achats et les ventes, telles que les lods et ventes, centième denier, amortissemient et autres, Cette portion de l'impôt est totalement payée par celui qui possède le bien au moment on il est ainsi grevé. Car celui qui le lui achète postérieurement ne le lui achète qu'en conséquence, et ainsi ne paie réellement rien. Tout ce que l'on peut dire, c'est que si cet impôt sur les actes de vente de certains biens est accompagné d'autres impôts sur d'autres actes qui affectent d'autres genres de propriété, d'autres emplois de capitaux, il arrive que ces biens ne sont pas les seuls qui soient détériorés, que par conséquent la proportion est conservée, du moins en partie, et qu'ainsi une portion de la perte est prévenue par celle des autres ; car le prix vénal de chaque espèce de revenu est relatif à celui de toutes les autres. Ainsi, si toutes ces pertes pouvaient se balancer exactement, la perte totale résultante de l'impôt serait exactement et très proportionnellement distribuée. C'est tout ce qu'on peut demander ; car il faut bien qu'elle existe, puisque l'impôt est toujours une somme de moyens arrachée aux gouvernés pour être mise à la disposition des gouvernants.
L'impôt sur les marchandises a encore des effets plus compliqués et plus variés. Pour les bien démêler, rappelons-nous que toute marchandise, au moment où elle est livrée à celui qui doit la consommer, a un prix naturel et nécessaire. Ce prix [287] est composé de la valeur de tout ce qui a été nécessaire à la subsistance de ceux qui ont fabriqué et voituré cette marchandise pendant le temps qu'ils y ont employé. Je dis que ce prix est naturel, parce qu'il est fondé sur la nature des choses, indépendamment de toute convention ; et qu'il est nécessaire, parce que si les gens qui font un travail quelconque n'en retirent pas leur subsistance, s'éteignent, ou se livrent à d'autres occupation ce travail n'est plus exécuté. Mais ce prix naturel et nécessaire n'a presque rien de commun avec le prix vénal on conventionnel de la marchandise, c'est-à-dire avec le prix auquel elle est fixée par l'effet d'une vente libre. Car une chose peut avoir coûté très peu de peine, ou, si elle a exigé beaucoup de peines et de soins, elle peut avoir été trouvée ou volée par celui qui la met en vente : dans les deux cas, il peut la donner à très bon marché sans y rien perdre ; mais elle peut en même temps lui être si utile qu'il ne veuille s'en défaire que pour on très grand prix ; et si beaucoup de gens la désirent, il en trouvera ce prix et fera un gain énorme. Au contraire, il se peut qu'une chose ait coûté au vendeur des peines infinies, que non seulement elle ne lui soit pas nécessaire, mais même qu'il ait un besoin pressant de s'en défaire, et que pourtant personne n'ait envie de l'acheter : dans ce cas, il sera obligé de la donner presque peur rien, et il fera une très grande perte. Le prix naturel est donc composé des sacrifices antérieurs faits par le vendeur ; et le prix conventionnel est fixé par l'offre [288] des acheteurs. Ce sont deux choses en soi étrangères l'une à l'autre. Seulement quand le prix conventionnel d'un travail est constamment au-dessous de son prix naturel et nécessaire, on cesse de s'y livrer. Alors le résultat de ce travail devenant plus rare, on fait plus de sacrifices pour se le procurer, s'il est toujours désiré ; et ainsi, pour peu qu'il soit réellement utile, le prix conventionnel ou vénal remonte au niveau du prix que la nature a attaché à ce travail, et qui est nécessaire pour qu'il continue à être exécuté. C'est de cette manière que se forment tous les prix dans l'état de société.
Il suit de là que ceux qui ne savent faire qu'un travail dont le prix conventionnel est inférieur à la valeur naturelle se détruisent ou se dispersent ; que ceux qui exécutent un travail, ou en d'autres termes, exercent une industrie quelconque, dont le prix conventionnel est strictement égal à sa valeur naturelle, c’est-à-dire ceux dont les profits balancent à peu près les besoins urgents, végètent et subsistent misérablement ; et que ceux qui possèdent un talent dont le prix conventionnel est supérieur au nécessaire absolu, jouissent, prospèrent, et par suite multiplient ; car la fécondité de toute race vivante, même parmi les végétaux, est telle, qu'il n'y a que le défaut d'aliments pour les germes éclos, qui arrête l'accroissement du nombre des individus. C'est là la cause de l'état rétrograde, stationnaire, ou progressif de la population dans la race humaine. Les fléaux passagers, tels que les famines et les pestes, y font peu. Travail improductif [289] ou productif à un degré insuffisant, voilà le poison qui infecte profondément les sources de la vie. Nous avons déjà fait à peu près toutes ces observations, soit dans le quatrième paragraphe de notre Introduction, en parlant de la nature de nos richesses, soit dans les chapitres où nous traitons des valeurs et de la population. Il était bon de les reproduire ici.
Maintenant il est aisé de voir que l'impôt sur les marchandises affecte très diversement les prix, et à différentes limites, suivant la manière dont il est levé, et suivant la nature des denrées sur lesquelles il porte. Par exemple, dans le cas du monopole, ou de la vente exclusive faite par l'État, il est clair que l'impôt est payé directement, immédiatement, et sans ressources par les consommateurs, et qu'il a la plus grande extension dont il soit susceptible. Mais cette vente, fût- elle forcée, elle ne peut cependant, ni pour le prix, ni pour la quantité, dépasser un certain terme, qui est celui de la possibilité de la payer. Elle s'arrête alors qu'il serait inutile de l'exiger, ou qu'il en coûterait plus qu'elle ne rapporterait. C'est le point où était la gabelle en France, et c'est le maximum de l'exaction possible.
Si la vente exclusive n'est pas forcée, elle varie suivant la nature de la marchandise. S'il s'agit d'une denrée qui ne soit pas nécessaire, à mesure que le prix monte la consommation diminue ; car il n'y a qu'une certaine somme de moyens dans toute la société, qui soit destinée à procurer un certain [290] genre de jouissance. Il peut même arriver qu'en élevant peu le prix, le profit diminue beaucoup, parce que beaucoup de gens renoncent tout à fait à ce genre de consommation, ou même parviennent à le remplacer par un autre. Toutefois l'impôt est toujours payé effectivement par ceux qui s'obstinent à consommer.
Si, au contraire, la vente faite exclusivement par l'État, mais de gré à gré, porte sur une marchandise de première nécessité, elle équivaut à la vente forcée. Car la consommation diminue bien mesure que le prix s'élève, c'est-à-dire qu'on souffre et qu'on meurt ; mais, comme enfin elle est nécessaire, elle s'élève toujours autant que le moyen de la payer, et elle est payée par ceux qui consomment.
Après ces moyens violents, si nous en examinons d'autres qui soient plus doux, nous leur trouverons des effets analogues, avec un moindre degré d'énergie. Le plus efficace de ceux ici est l'impôt mis sur une marchandise au moment de la production ; car aucune partie n'en échappe, pas même celle consommée par le producteur lui-même, ni celle qui pourrait s'avarier ou se perdre en magasin avant d'être employée. Tel est l'impôt sur le sel, levé dans le marais salant, celui sur le vin à l'instant de la récolte ou avant la première vente, et celui sur la bière dans la brasserie. On peut encore ranger dans la même classe l'impôt sur le sucre ou le café, ou telles autres denrées, exigé au moment où elles arrivent du pays qui les produit ; car ce [291] n'est que de ce moment qu'elles existent pour le pays qui ne peut pas les produire et qui doit les consommer.
Cet impôt levé au moment de la production, s'il est établi sur une marchandise peu nécessaire, est aussi limité que le goût que l'on a pour elle. Aussi, quand on a voulu tirer grand parti du tabac, on s'est étudié à en donner le besoin au peuple. Car si la société est instituée pour satisfaire plus aisément les besoins que nous a donnés la nature, et auxquels nous ne pouvons nous soustraire, il semble que la fiscalité soit destinée à nous créer des besoins artificiels, pour nous en refuser une partie et nous faire payer l'autre.
Lorsque ce même impôt, au moment de la production, est établi sur une denrée plus nécessaire, il est susceptible d'une plus grande extension ; cependant, si cette denrée coûte beaucoup de peines et de frais pour la produire, l'extension de l'impôt est encore arrêtée assez promptement, non plus par le manque de désir de se procurer la denrée, mais par l'impossibilité de la payer ; car il faut toujours qu'il arrive aux producteurs une assez grande portion du prix pour qu'ils puissent ne pas périr : ainsi il en reste moins pour l'État.
Mais où l'impôt déploie toute sa force, c'est quand la denrée est bien nécessaire, et qu'elle coûte bien peu, comme par exemple le sel. Là tout est profit pour le fisc ; aussi ses agents ont-ils toujours donné au sel une attention particulière. Les usines très riches font encore le même effet jusqu'à [292] un certain point ; mais en général les gouvernements s'en sont attribué la propriété, ce qui épargne la peine d'imposer, et équivaut au procédé de la vente exclusive. L'air et l'eau, si on avait pu s'en rendre maître, auraient encore été l'objet de prélèvements très forts et très fructueux pour le fisc ; mais la nature les a trop disséminés. Je ne doute pas qu'en Arabie, des traitants ne tirassent un grand parti de l'eau, et tel, que personne ne boirait sans leur permission. Quant à l'air, l'impôt sur les fenêtres fait à cet égard tout ce qui est possible.
Le vin n'est point ainsi un présent gratuit de la nature. Il coûte beaucoup de peines, de soins et de frais ; et malgré le besoin et le vif désir que l’on a de s'en procurer, on aurait peine à croire qu'il pût supporter les énormes charges dont il est grevé actuellement en France au moment de sa production, si l'on ne faisait pas attention qu'une partie de ce fardeau tombe directement sur la terre plantée en vignes, et opère seulement une grande diminution dans le prix du bail qu'ou en donnerait. Par là, il a l'effet de l'impôt foncier, qui est, comme nous l'avons vu, d'enlever au propriétaire du sol une partie de son capital, sans influer sur le prix de la denrée, ni entamer les profits du producteur. Ainsi le capitaliste est appauvri, mais rien n'est dérangé dans l'économie de la société ; et ce capitaliste est obligé d'endurer cette perte toutes les fois que sa terre lui rendrait encore moins en la changeant de culture.
Le blé pourrait être, comme le vin, l'objet d'un [293] impôt très lourd levé au moment de la production, indépendamment même de la dîme qu'ils supportent l'un et l'autre presque partout. Une partie de l'impôt tomberait de même en diminution de la rente de la terre, sans toucher au salaire de la production, et sans, par conséquent, accroître le prix de la denrée. Si en général on s'est abstenu de cet impôt, je suis persuadé que ce n'est pas par un respect superstitieux pour la nourriture principale du pauvre, laquelle on a chargée d'ailleurs de bien d'autres manières qui en renchérissent le prix, mais parce que l'on a été arrêté par la difficulté de surveiller l'entrée de toutes les granges : difficulté qui est en effet plus grande encore que celle de pénétrer dans toutes les caves. Du reste il y a similitude complète.
Observons, en finissant cet article, qu'un impôt ainsi levé au moment de la production, sur une denrée d'un usage indispensable pour tout le monde, équivaut à une véritable capitation ; mais de toutes les capitations, c'est la plus cruelle pour le pauvre. Car ce sont les pauvres qui consomment en plus grande quantité les denrées de première nécessité, parce que pour eux elles ne sont suppléées par rien, et elles font la presque totalité de leur dépense, parce qu'ils ne peuvent guère pourvoir qu'à leurs besoins les plus pressants. Ainsi une pareille capitation se trouve répartie en proportion de la misère et non pas de la richesse, en raison directe du besoin et inverse des moyens. D'après cela, on peut apprécier les impôts de ce genre. Mais ils [294] sont très productifs ; car c'est toujours le pauvre qui fait le grand nombre, et par ce grand nombre les grandes sommes ; ils affectent peu ceux dont les cris peuvent se faire entendre, et cela détermine en leur faveur. On ne peut se dissimuler que ce sont les deux seules causes de la préférence qu'on leur donne.
À l'égard des impôts qu'on lève sur les différentes marchandises, soit au moment de la consommation, soit dans leurs différentes stations, comme sur les chemins, dans les marchés, dans les ports, aux portes des villes ; dans les boutiques, etc., etc., leurs effets sont déjà indiqués par ceux que nous venons de voir résulter de la vente exclusive, et de la taxe au moment de la production. Ceux-ci sont du même genre ; seulement ils sont ordinairement moins généraux et moins absolus, parce qu'ils sont plus variés, et qu'il est rare qu'ils embrassent une aussi grande étendue de pays. En effet, la plupart de ces taxes sont des mesures locales. Un péage n'affecte que les denrées qui passent sur le chemin ou le canal sur lequel il est établi. Les entrées des villes n'influent directement que sur les consommations qui se font dans leur intérieur (je suppose que le transit est exempt de droits). Un impôt levé dans un marché ou dans une boutique n'atteint pas ce qui se vend dans la campagne, ou dans les foires extraordinaires. Ainsi, ils dérangent les prix et les industries plus irrégulièrement, mais toujours ils les dérangent dans les points où ils portent. Car dès qu'une marchandise est chargée, il faut toujours [295] que le sort du producteur ou celui du consommateur soit détérioré.
C'est ici que se retrouvent, relativement aux produits et aux effets de d'impôt, les conséquences des deux importantes conditions propres à toute marchandise : l'une d'être de première nécessité, ou seulement d'agrément et de luxe ; l'autre, que son prix conventionnel et vénal soit supérieur à son prix naturel et nécessaire, ou lui soit seulement égal ; pour inférieur, nous savons que cela n'est pas possible à la longue.
Si la marchandise imposée est de première nécessité, on ne peut s'en passer, elle sera toujours achetée tant qu'on en aura le moyen ; et si son prix conventionnel n'est qu'égal à son prix naturel, le producteur ne peut rien céder. Ainsi, toute la perte tombera sur le consommateur. D'où l'on doit conclure, si la vente et le produit de l'impôt diminuent, que c’est le consommateur qui souffre et s'éteint.
Il faut remarquer que dans nos vieilles sociétés, occupant un territoire circonscrit dès longtemps, et ne pouvant conquérir que des terrains déjà occupés, c'est le cas de toutes les marchandises de première nécessité. Car, par l'effet du long combat des intérêts contraires du producteur et du consommateur, chacun est casé dans l'ordre social suivant son degré de capacité. Ceux qui ont quelque talent assez désiré pour qu'ils puissent le faire payer au-delà du nécessaire se livrent à ces industries préférées ; il n'y a que ceux qui ne peuvent y réussir qui se vouent aux productions indispensables, parce qu'elles sont toujours demandées; mais [296] aussi elles ne sont payées qu'autant qu'il est strictement nécessaire, parce qu'il y a toujours des gens inférieurs à d'autres, qui n'ont autre chose à faire qu'à s'y adonner ; il faut même que cela soit ainsi. Car ces denrées de première nécessite sont les besoins urgents de tous, et surtout des plus pauvres de toutes les autres classes qui les consomment sans les produire, étant occupés à d'autres productions. Ainsi ces pauvres ne peuvent subsister qu'à proportion que ces denrées sont faciles à se procurer. Donc plus une profession est indispensable, plus il est inévitable que ceux qui s'y adonnent, faute d'autre capacité, soient réduits au strict nécessaire. Le seul moyen direct d'améliorer le sort de ces hommes, les derniers en rang dans la société par leur défaut de talent, serait de leur persuader de moins multiplier, et de leur laisser toujours la liberté d'aller exercer leur faible talent ailleurs où il serait plus fructueux. C'est pour cela que l'expatriation doit toujours être permise. Il est encore quelques autres mesures politiques qui pourraient concourir indirectement à défendre l'extrême faiblesse contre l'extrême misère : nous en parlerons ailleurs. Au reste, ces hommes, que nous plaignons avec justice, souffrent encore moins qu'ils ne feraient dans l'état sauvage. La preuve en est qu'ils végètent en plus grand nombre, car l'homme ne s'éteint que par l'excès de la souffrance.
Nous avons déjà dit tout cela ailleurs, à mesure que l'occasion s'en est présentée. Mais il fallait bien le répéter ici à propos de l'impôt. Car l'histoire [297] des revenus et des dépenses du gouvernement est l'abrégé de l'histoire de la production et de la consommation de la société tout entière, puisque, sous ce rapport, le gouvernement n'est autre chose qu'un très grand rentier, à qui l'autorité tient lieu de capitaux. Sans trop forcer la similitude entre la circulation des richesses et celle du sang, on pourrait dire que la circulation opérée par le gouvernement dans la société ressemble tout à fait à la circulation pulmonaire dans l'individu elle est extraite de la masse totale, et revient s'y fondre après s'être exécutée séparément, mais d'une manière absolument semblable.
Si la marchandise imposée n'est pas de première nécessité, et si pourtant son prix conventionnel n'est qu'égal à son prix nécessaire, c'est une preuve que le consommateur tient bien faiblement à cette jouissance. Alors l'impôt survenant, le producteur n'a autre chose à faire qu'à renoncer à son industrie, et tâcher de trouver son salaire dans quelque autre profession dans laquelle il va accroître la misère par sa concurrence, et dans laquelle encore il a du désavantage, parce que ce n'était pas la sienne. Ainsi il s'éteint au moins en très grande partie. Pour le consommateur, il ne perd rien qu'une jouissance à laquelle il était peu attaché, apparemment parce qu'il la remplace facilement par une autre qui donne lieu à d'autres salaires. Mais le produit de l'impôt devient nul.
Si au contraire la marchandise peu nécessaire, qui vient à être frappée par un impôt, a un prix [298] conventionnel très supérieur à son prix nécessaire, et c'est le cas de toutes les choses de luxe, il y a de la marge pour le fisc sans réduire personne précisément à la misère. La même somme totale se dépense pour cette jouissance, à moins que le goût qui la fait rechercher ne diminue, et c'est le producteur qui est obligé de céder presque en entier ce que l'impôt emporte de cette somme totale ; mais comme il gagnait plus que le nécessaire, il n'est pas encore au-dessous. Cependant il y a à dire que cela n'est vrai qu'en général : car dans ce métier supposé généralement avantageux, il y a des individus qui, faute d'habileté ou de bonheur, n'y trouvent qu'un nécessaire exigu ; et ceux-là, l'impôt survenant, sont obligés de renoncer à leur état, ce qui est toujours une grande souffrance.
C'est ainsi que l'on peut se représenter avec assez de justesse les effets directs des divers impôts partiels et locaux qu'on lève sur les marchandises, dans leur trajet du producteur au consommateur. Mais outre ces effets directs, ces impôts en ont d'indirects étrangers aux premiers, ou qui s'y mêlent et les compliquent. Ainsi un impôt onéreux sur une denrée importante, levé à l'entrée d'une ville, d'une part diminue les loyers de ses maisons, en rendant son habitation moins désirable, et de l'autre, diminue le loyer des terres qui produisent la denrée imposée, en en rendant le débit moins considérable ou moins avantageux. Voilà donc des capitalistes oisifs, quand même ils seraient absents et ne consommeraient rien, atteints dans leurs capitaux [299] comme par un impôt foncier, tandis qu'on ne croit toucher que le consommateur ou le producteur. Cela est si vrai, que ces propriétaires, si on le leur proposait, feraient des sacrifices pour rembourser une partie des fonds de l'impôt, ou fournir directement une partie de son produit annuel. Cela s'est vu mille fois.
Il y a plus : dans nos considérations économiques nous ne regardons souvent comme véritables consommateurs d'une denrée, que ceux qui effectivement la consomment pour leur satisfaction personnelle. Cependant il s'en faut bien qu'ils soient les seuls acheteurs de cette denrée. Souvent la plupart de ceux qui se la procurent ne la recherchent que comme matière première d'autres productions, et comme moyen dans leur industrie. Alors l'effet de l'impôt qui frappe cette denrée rejaillit sur toutes ces productions et toutes ces industries. C'est ce qui arrive surtout aux denrées d'une utilité très générale, ou d'une nécessité indispensable. Elles font partie des frais de tous les producteurs, mais à des degrés différents.
Enfin il faut encore observer que les impôts dont nous parlons ne chargent jamais uniquement une seule marchandise. On les met en même temps sur beaucoup d'espèces de denrées, c'est-à-dire sur beaucoup d'espèces de productions et de consommations. Sur chacune suivant sa nature, ils font quelqu'un des effets que nous venons d'expliquer, de manière que tous ces différents effets se heurtent, se balancent, et se résistent réciproquement. Car les [300] frais nouveaux dont est grevée une industrie font qu'on est moins prompt à s'y livrer de préférence à une autre qui vient d'éprouver un tort du même genre. Le fardeau qui pèse sur un genre de consommation fait qu'on ne peut pas la faire servir de remplacement à celle à laquelle on voudrait renoncer. D'où il suit que s'il était possible de prévoir assez complètement tous ses ricochets pour équilibrer parfaitement tous les poids, en sorte qu'en les plaçant tous à la fois, ils fissent partout une pression égale, nulle proportion ne serait changée par eux. Ils ne feraient tous ensemble que l'effet général inhérent à tout impôt, savoir : que le producteur ait moins d'argent pour son travail, et le consommateur moins de jouissances pour son argent. On doit regarder les impôts comme bons, quand à ce mal inévitable il ne se joint pas des maux particuliers qui soient trop fâcheux.
Je ne suivrai pas plus loin cet examen des différentes espèces d'impôts. Je crois en avoir assez dit pour mettre à même de les juger, et surtout pour montrer autant que cela est possible sur qui tombe réellement la perte qu'ils occasionnent.
En effet, l'on voit premièrement que l'impôt sur les rentes dues par l'État, et celui sur le revenu des terres, non seulement sont payés annuellement par ceux sur qui ils tombent, sans qu'ils puissent en rien rejeter sur d'autres, mais que le capital même en est perdu par eux, en sorte qu'après eux, personne ne paie réellement rien ; secondement, qu'il en est de même de l'impôt sur le loyer des [301] maisons, mais que de plus il gène les spéculations de bâtisse et diminue les aisances des locataires ; troisièmement, que l'impôt personnel, ayant pour motif des richesses acquises, ne fait de même aucun tort qu'à ceux de qui on l'exige, mais qu'ils ne libèrent pas ceux qui le paieront après eux ; quatrièmement, que la perte résultante de l'impôt sur les instruments des transactions sociales est bien réellement supporté par ceux à qui on le demande chaque fois que l'occasion de le payer se présente, mais que son existence seule nuit à d'autres, en détériorant le prix de plusieurs choses et gênant plusieurs industries ; cinquièmement, que l'impôt personnel, qui a pour motif une industrie quelconque, et tous les impôts sur les marchandises, grèvent d'abord ceux à qui on les demande, mais qu'en outre ils dérangent tous les prix et toutes les industries ; et que par l'effet de ces nombreux ricochets, ils finissent par tomber sur tous les consommateurs, sans qu'on puisse déterminer précisément dans quelle proportion.
Je sais que ces résultats séparés, distingués, modifiés, paraîtront moins satisfaisants qu'une décision bien tranchante qui, traitant la série des intérêts des hommes comme une file de boules d'ivoire, affirmerait que, quel que soit celui qui soit touché, il n'y a que le dernier qui soit mis en jeu. Mais j'ai dû représenter les choses comme je les vois, et non pas comme on peut les imaginer. Si l'extrême simplicité plaît à l'esprit en le soulageant, si même c'est pour cela qu'il crée des abstractions, [302] le bon esprit ne doit point oublier que cette simplicité extrême ne se trouve que là, et que même en mécanique, dès qu'il s'agit de corps réels, il faut avoir égard à beaucoup de considérations qui n'ont pas lieu tant qu'on ne raisonne que sur des lignes et des points mathématiques. Néanmoins, pressé par le désir d'arriver à un principe positif, on me demandera peut-être, comme on me l'a déjà demandé en pareil cas, quelle est ma conclusion, et quel est l'impôt que je préfère. Ayant exposé les faits, je pourrais laisser le lecteur tirer les conséquences ; mais je vais dire mon opinion, en la motivant, et toutefois en prévenant d'avance qu'elle ne sera jamais absolue, mais toujours relative ; car un impôt n'est jamais bon quand il est exagéré, ni même quand il n'est pas en proportion avec tous les autres.
D'abord je rappelle que la consommation des hommes industrieux, celle que j'ai appelée la consommation productive, étant la seule qui reproduise ce qu'elle détruit, et étant par là la seule source des richesses, c'est celle-là qu'on doit surtout tâcher de ne pas déranger.
Partant de cette vérité, l'impôt sur les rentes dues par l'État me semblerait le meilleur de tous ; mais il n'est pas possible d'y songer, puisque nous avons vu que c'est une vraie banqueroute. Ce n'est pas que je croie utile de ménager le crédit public. Je pense, au contraire, qu'il est très fâcheux que le gouvernement ait du crédit et puisse emprunter ; j'en dirai les raisons quand nous parlerons de ses [303] dettes. La considération morale seule me détermine invinciblement. La société tout entière n'étant fondée que sur des conventions, il n'est pas possible qu'il ne soit pas pernicieux de donner l'exemple de la violation de la foi jurée. Aucun calcul pécuniaire ne peut balancer un pareil inconvénient ; les conséquences en sont immenses et funestes. La véritable manière de taxer les rentiers est de bien administrer. Cela fait qu'ils ne trouvent qu'un faible intérêt de leur argent.
Après cet impôt, auquel on ne peut pas penser, les meilleurs, suivant moi, sont ceux qui lui ressemblent le plus, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des terres et celui sur le loyer des maisons, auxquels on peut joindre l'impôt personnel, ayant pour causes les richesses acquises. On voit que si je préfère l'impôt sur le revenu des terres, ce n'est pas par les mêmes raisons que les anciens économistes. C'est au contraire parce que je regarde les propriétaires de terres comme très étrangers à la reproduction. D'ailleurs je considère ces trois impôts-ci, qui portent principalement sur les riches, comme une compensation des impôts sur les marchandises, qui nécessairement grèvent principalement le pauvre. Je n'ai pas besoin de dire qu'il ne faut pas que l'impôt foncier soit tel, que beaucoup de terres soient négligées.
L'impôt sur les actes et les transactions sociales, malgré ses inconvénients, me paraît admissible aussi, pourvu qu'il ne soit pas exagéré. S'étendant sur beaucoup de choses, il porte sur beaucoup de points, [304] ce qui est toujours un avantage ; et il ne pèse pas immédiatement sur les premiers besoins du pauvre, ce qui est encore un grand bien.
Quant aux impôts sur les marchandises, auxquels il faut joindre l'impôt personnel, ayant pour motif l'industrie présumée, je commence par rejeter absolument toute vente exclusive, et encore plus toute vente forcée, ainsi que toute disposition tendant à gêner la liberté du travail et à blesser la propriété individuelle, c'est-à-dire l'entière disposition des facultés personnelles. Ces excès écartés, je ne vois rien qui empêche d'avoir recours aux impôts sur les marchandises. D'abord tous ceux sur les marchandises purement de luxe sont excellents, et n'ont que des avantages sans inconvénients. Ils diminuent les effets de l'excessive inégalité des fortunes, en rendant plus chères les jouissances extrêmement recherchées. Ce sont les seules lois somptuaires qu'on puisse approuver. Mais ces impôts sont ceux contre lesquels se soulèvent le plus tous les hommes puissants : d'ailleurs ils sont toujours d'un très faible produit, car dans tous les genres c'est le grand nombre, quoique trop méprisé, qui fait la force. Il faut donc en revenir aux impôts sur les marchandises plus utiles, et même sur celles de première nécessité, car enfin il faut bien des revenus publics. Ceux-là, comme nous l'avons dit, pèsent principalement sur le pauvre ; mais comme nous l'avons dit aussi, ils sont balancés par ceux qui portent uniquement sur les propriétaires de biens-fonds, et ils les justifient. D'ailleurs, placés aux portes des villes [305] ils contribuent à disséminer la population sur toute l'étendue du territoire ; levés aux frontières, ils peuvent êtres utiles à quelques combinaisons diplomatiques, tant que la saine politique ne les dirigera pas entièrement. Je ne crois donc pas devoir blâmer ces impositions. Je me borne à recommander qu'elles ne soient jamais assez lourdes pour écraser un genre d'industrie, et qu'elles soient très variées, afin qu'elles pèsent sur toutes. C'est les ménager toutes que de les charger de manière qu'elles soutiennent chacune leur part du fardeau commun ; car il ne faut pas oublier qu'il ne peut jamais être question ici que de faire le moins de mal possible, et que quand on a bien distribué le mal nécessaire, on a atteint le maximum de la perfection du genre.
La cherté de la perception et la nécessité des punitions sont encore deux maux accessoires de l'impôt, auxquels les uns sont, il est vrai, plus sujets que les autres, mais sur lesquels je n'ai rien à dire, si ce n'est que ni l'un ni l'autre ne sont portés à l'extrême, quand les impôts ne sont pas excessifs, et qu'ils ne sont pas appuyés de formes tyranniques. Ainsi je ne les regarde que comme des considérations secondaires.
Voilà ce que je pense sur les impôts. Mais veut-on une conclusion plus précise ? la voici : Les impôts les meilleurs, suivant moi, sont 1° les plus modérés, parce qu'ils obligent à moins de sacrifices, et nécessitent moins de violences ; 2° les plus variés parce qu'ils se font équilibre les uns aux autres ; les plus anciens, parce qu'ils ont pénétré dans tous les prix, [306] et que tout s'est arrangé en conséquence.
Encore une fois, je crains que l'on ne soit pas satisfait de cette décision. Elle n'est pas assez tranchante pour être brillante. Mais à la modération près (à laquelle on manque souvent par nécessité), elle est assez conforme à ce qui se fait partout ; et, si elle était juste, comme je le crois, elle serait un nouvel exemple d'un phénomène intellectuel fort ordinaire, mais qui n'a pas toujours été assez remarqué : c'est que dans les matières un peu difficiles la pratique est provisoirement assez raisonnable longtemps avant que la théorie le soit, et quand le sujet est réellement approfondi, on reconnaît que le bon sens public, je dirais presque l'instinct général, s'est moins écarté du droit chemin que les premières spéculations scientifiques. La raison en est simple. Dans la pratique, on est tout près des faits ; ils se présentent à tous moments, ils vous guident ; ils vous retiennent, ils vous ramènent continuellement à ce qui est, à la vérité ; au lieu que dans les combinaisons spéculatives, qui consistent toutes en déductions, il suffit d'une première supposition fausse, pour arriver très conséquemment aux plus graves erreurs, sans que rien vous en avertisse. C'est là ce qui motive l'attachement aveugle que l'on a généralement pour tout ce qui est en usage, et l'extrême méfiance qu'inspire toute vérité neuve qui y est trop contraire. Cette disposition est sans doute exagérée, mais elle est fondée en raisons. Quoi qu'il en soit, nous avons assez parlé des revenus du gouvernement, occupons-nous de ses dépenses.
[307]
Nous aurons peu de choses à dire sur ce sujet. Nous avons vu que le gouvernement est dans tout pays un très grand consommateur, et un consommateur du genre de ceux qui vivent de revenus et non de profits ; que c'est un très grand rentier, à qui l'autorité tient lieu de capitaux. Par conséquent, tout ce que nous avons dit de cette espèce de consommateurs lui est applicable. Sa dépense ne se reproduit pas dans ses mains avec accroissement de valeur, comme celle des hommes industrieux. Sa consommation est réelle et définitive. Il ne reste rien du travail qu'il solde. Les richesses qu'il emploie, et qui étaient existantes avant de passer dans ses mains, sont consommées et détruites quand il s'en est servi. En effet, en quoi consiste la très majeure partie de sa dépense ? À payer des soldats, des matelots, des juges, des administrateurs de toute espèce, et à faire tous les frais qu'exigent ces différents services. Tout cela est très utile, sans doute, et même nécessaire en totalité, si l'on y apporte toute l'économie désirable ; mais rien de tout cela n'est productif. La dépense que le gouvernement pourrait faire pour enrichir les favoris du pouvoir est tout aussi stérile, et n'a pas l'excuse de la nécessité, ni même celle de l'utilité. Aussi est-elle encore plus désagréable au public, qu'elle blesse au lieu de le servir. Il en est tout autrement des fonds qui sont employés en travaux publics d'une utilité générale, tels que des ponts, des ports, des chemins, des canaux, des établissements et des monuments utiles. Ces dépenses sont toujours vues de [308] bon œil quand elles ne sont pas excessives. Elles contribuent en effet très puissamment à la prospérité publique. Cependant elles ne peuvent pas être regardées comme directement productives dans les mains du gouvernement, puisqu'elles ne lui rentrent pas avec profit, et qu'elles ne lui créent pas un revenu qui représente l'intérêt des fonds qu'elles ont absorbés ; ou, si cela arrive, on en doit conclure que des particuliers auraient pu faire les mêmes choses aux mêmes conditions, si on leur avait laissé la disposition des sommes qu'on leur a enlevées pour en faire cet usage, et il est même vraisemblable qu'ils les auraient employées avec plus d'intelligence et d'économie. Enfin, on peut dire toutes les mêmes choses de ce que le gouvernement dépense en divers encouragements pour les sciences et les arts. Ces sommes sont toujours assez petites, et leur utilité est le plus souvent très contestable, car il est bien sûr qu'en général le plus puissant encouragement qu'on puisse donner à l'industrie de tout genre est de la laisser agir et de ne s'en pas mêler. L'esprit humain irait bien vite, si seulement il n'était pas gêné, et il serait amené par la force des choses à faire toujours ce qu'il y a de plus essentiel dans chaque occurrence. Le porter artificiellement d'un côté plutôt que de l'autre, c'est ordinairement le faire dévier plutôt que le conduire. Néanmoins accordons encore l'utilité constante de ce genre de dépenses, peu considérables sous le rapport de l'argent ; il n'en est pas moins vrai que, comme toutes les précédentes, elles sont de vraies dépenses qui ne rentrent pas.
[309]
De tout cela je conclus que la totalité des dépenses publiques doit être rangée dans la classe des dépenses justement nommées stériles et improductives ; et que, par conséquent tout ce qu'on paie à l'État soit à titre d’impôt, soit même à titre d'emprunt, est un résultat de travaux productifs antérieurement faits, qui doit être regardé comme entièrement consommé et anéanti le jour où il entre dans le trésor national. Encore une fois, cela ne veut pas dire que ce sacrifice ne soit pas nécessaire et même indispensable. Sans doute il faut que chaque citoyen, sur le produit de son travail actuel, ou sur le revenu de ses capitaux, qui sont le produit d'un travail plus ancien, prélève ce qui est nécessaire à l'État, comme il faut qu'il entretienne sa maison pour y loger en sûreté. Mais il faut qu'il sache que c'est un sacrifice qu'il fait ; que ce qu'il donne est incessamment perdu pour la richesse publique comme pour la sienne propre ; qu'en un mot, c'est une dépense et non pas un placement. Enfin, il faut que personne ne soit assez aveuglé pour croire que des frais quelconques sont une cause directe d'augmentation de fortune, et que chacun sache bien que, pour les sociétés politiques comme pour les sociétés commerciales, une régie dispendieuse est ruineuse, et que la meilleure est la plus économique. Au reste, c'est là une de ces vérités que le bon sens du peuple a aperçue longtemps avant qu'elle fût claire pour les plus grands politiques.
Si de l'examen des dépenses ordinaires du gouvernement, nous passons à celui de ses dépenses [310] extraordinaires, et des dettes qui en sont la suite, les mêmes principes vont nous guider. C'est encore là un sujet sur lequel le bon sens a de beaucoup devancé les lumières des prétendus adeptes. Les gens simples savent de tout temps qu'on s'appauvrit en mangeant plus que son revenu, et que, dans aucun cas, il n'est bon d'être endetté ; et des gens d'esprit croyaient et écrivaient encore, il n'y a pas longtemps, que les emprunts du gouvernement sont une cause de prospérité, et que la dette publique est une nouvelle richesse créée au sein de la société. Cependant, puisque nous nous sommes convaincus, 1° que les dépenses ordinaires du gouvernement n'ajoutent rien à la masse totale de la circulation, et ne font qu'en changer le cours d'une manière le plus souvent désavantageuse ; 2° qu'elles sont d'une nature telle, qu'elles n'ajoutent rien non plus à la masse des richesses antérieurement produites, sur lesquelles elles sont prélevées, nous devons en conclure que les dépenses extraordinaires de ce même gouvernement étant de même nature que ses dépenses ordinaires, elles sont également incapables de produire ni l'un ni l'autre de ces bons effets. Quant à la ridicule idée qu'en créant des contrats de rente sur l'État on crée réellement une nouvelle valeur, elle ne mérite pas de réfutation sérieuse. Car si ceux qui reçoivent ces titres possèdent une certaine somme de plus, il est évident que l'État qui les donne a une pareille somme de moins, sans quoi il faudrait dire que toutes les fois que je souscris une obligation de mille francs, j'augmente la [311] masse totale des richesses de mille francs, ce qui est absurde. Ainsi il est bien certain que ; dans aucun cas, on ne peut se réjouir de l'accroissement de la consommation du gouvernement et de la grandeur des dépenses publiques.
Mais enfin, quand ces dépenses sont très considérables, doit-on se féliciter de pouvoir y faire face plutôt par des emprunts que par des impôts ? ou, en d'autres termes, est-il heureux pour les gouvernés que le gouvernement fasse usage de son crédit, ou même qu'il ait du crédit ? C'est la dernière question qui me reste à traiter avant de finir ce chapitre. Je sais qu'elle est résolue pour bien des hommes d'État, et même pour beaucoup d'écrivains spéculatifs, qui pensent fermement que le crédit public fait la force et la sûreté de l'État ; qu'il est une grande cause de prospérité dans les temps ordinaires, et la seule ressource efficace dans les nécessités urgentes, et qu'ainsi c'est le vrai palladium de la société. Cependant, je crois avoir de bonnes raisons pour combattre leur opinion. Je ne les tirerai point des funestes effets des emprunts sur l'organisation sociale, de l'énorme pouvoir qu'ils procurent aux gouvernants, de la facilité qu'ils leur donnent pour faire tout ce qu'ils veulent, pour attirer tout à eux, pour enrichir leurs créatures, pour se dispenser d'assembler et de consulter les citoyens, ce qui opère rapidement le renversement de toute constitution. Ces choses-là ne sont point actuellement de mon sujet. Je ne considère en ce moment dans les emprunts que leurs effets [312] purement économiques, et c'est uniquement sous ce point de vue que je vais discuter leurs avantages et leurs inconvénients.
La première chose que l'on dit en faveur des emprunts, c'est que les fonds qu'on se procure par ce moyen ne sont arrachés violemment à personne. Je crois que c'est là se faire illusion. En effet, il est bien vrai que quand le gouvernement emprunte il ne force personne à lui prêter ; car il ne faut pas regarder les emprunts forcés comme des emprunts, mais comme des contributions. Quand donc les prêteurs portent leur argent au trésor public, c'est librement et volontairement ; mais aussi l'opération n'est pas finie là. Ces capitalistes ont prêté et non pas donné, et ils entendent bien ne perdre ni capital ni intérêts. Par conséquent ils forcent le gouvernement à lever un jour ou l'autre une somme égale à celle qu'ils lui fournissent, et aux intérêts qu'ils en exigent. Ainsi, par leur obligeance, ils ne font que grever malgré eux y non seulement les citoyens actuellement existants, mais encore les générations futures. Cela est si vrai, que l'espèce de soulagement que leur service produit pour le moment présent n'a lieu que parce qu'il reporte une partie du fardeau sur les temps à venir.
Cette circonstance donne lieu, suivant moi, à une grande question que je suis étonné de n'avoir vue discutée nulle part. Un gouvernement quelconque, soit monarchique, soit polyarchique, en un mot des hommes existants, ont-ils le droit de grever ainsi des hommes qui n'existent pas encore, et de [313] les obliger à payer un jour leurs dépenses actuelles ? Ce n'est pas seulement ici le cas des testaments contre lesquels on dit avec raison, que nul homme n'a droit à être obéi après sa mort ; car enfin la société qui, pour l'avantage général, ôte tant de différents pouvoirs à chacun de ses membres, peut bien leur concéder celui-là s'il lui est utile, et le leur garantir ; et les héritiers naturels des testateurs sont toujours les maîtres d'accepter ou de refuser leurs successions, qui au fond ne leur appartiennent qu'en vertu des lois qui les leur adjugent, et avec les conditions qu'elles y mettent. Mais quand il s'agit d'intérêts publics, il en va tout autrement. Une génération ne reçoit point d'une autre, comme un héritage, le droit de vivre en société, et d'y vivre sous les lois qui lui plaisent. La première n'est point en droit de dire à la seconde : Si vous voulez me succéder, voilà comme il faut que vous existiez et que vous vous arrangiez ; car d'un tel droit il suivrait qu'une loi une fois faite ne peut jamais être changée. Ainsi le pouvoir législatif actuel (quel qu'il soit), qui est toujours censé être l'organe de la volonté générale actuelle, ne peut ni obliger ni gêner le pouvoir législatif futur, qui sera l'organe de la volonté générale d'un temps à venir. C'est sur ce principe très raisonnable qu'il est reconnu en Angleterre qu'un parlement ne peut jamais voter des impôts que jusqu'à l'arrivée d'un autre, ou même jusqu’à une nouvelle session du même parlement. Je sais bien qu'appliquer rigoureusement ce principe aux [314] dettes d'un pays où il n'est pas admis, et où des engagements antérieurs ont été pris de bonne foi, ce serait manquer à la foi publique ; et j'ai suffisamment manifesté ci-dessus ma persuasion profonde qu'un tel acte ne peut jamais être ni juste, ni utile, deux termes absolument équivalons pour moi comme raison et vertu. Mais il n'en est pas moins vrai, pour revenir à l'exemple de l'Angleterre, qu'il est contradictoire, et par conséquent absurde, qu'un parlement croie ne pouvoir voter des impôts que pour un an, et croie pouvoir voter un emprunt à rentes perpétuelles, ou à longs remboursements ; car c'est voter la nécessité d'impôts suffisants pour payer ces rentes et ces remboursements, en déclarant qu'on n'a pas le droit d'en répondre. Je trouve bien plus sensé et plus loyal le principe autrefois admis en Espagne, que les engagements d'un roi ne lient pas son successeur. Au moins ceux qui contractent avec lui savent le risque qu'ils courent, et n'ont point à se plaindre de ce qui leur arrive. Nous verrons bientôt que ce principe, mis en pratique, est aussi bienfaisant qu'il est raisonnable.
Pour le moment, je me borne à soutenir que puisqu'en définitive le capital et les intérêts d'un emprunt ne peuvent jamais être payés que par un impôt, les fonds que le gouvernement se procure, par cette voie finissent toujours par être arrachés violemment aux individus, et qui pis est à des individus qui n'y sont point obligés, puisqu'ils ne s'y sont point engagés ni par eux-mêmes [315] ni par leurs représentants légitimes ou légaux. J’appelle légaux ceux que la loi existante autorise, et dont les actes sont valables quand même cette loi ne serait pas juste.
Le second avantage que l'on trouve aux emprunts, c'est que les sommes qu'ils fournissent ne sont point enlevées à la consommation productive, puisque ce ne sont pas des entrepreneurs d'industrie qui placent leurs fonds sur l'État mais seulement des capitalistes oisifs, vivant de leurs revenus, qui se créent cette espèce de rente au lieu de s'en créer une autre. Je réponds que ce second avantage n'est pas moins illusoire que le premier. Car quoiqu'il soit vrai que ceux qui prêtent au gouvernement ne sont pas en général des hommes qui auraient joint leur industrie personnelle à leurs capitaux, pour les faire valoir plus utilement dans des emplois productifs, cependant il arrive qu'il y a beaucoup de ces prêteurs que la facilité de se procurer une existence suffisante sans risques ni fatigues a seule dégoûtés du travail et jetés dans l'oisiveté. D'ailleurs, même en admettant que tous fussent également demeurés oisifs quand l'État n'aurait point emprunté, il est certain que s'ils ne lui avaient pas prêté leur argent, ils l'auraient prêté aux hommes industrieux. Dès lors ces hommes industrieux auraient eu plus de capitaux à faire travailler, et par l'effet de la concurrence des prêteurs, ils les auraient eus moyennant un moindre intérêt : or ce sont là deux grands biens dont les emprunts publics les privent. Enfin, on [316] ne peut nier qu'à moins de faire banqueroute, quand on a emprunté une somme il faut finir par la rendre ; et pour la rendre, il faut la lever sur les citoyens. Ainsi, tôt on tard elle affecte l'industrie autant et de la même manière que si on l'avait exigée d'abord. De plus, il faut : y ajouter tous les intérêts que l'État en a payés jusqu'au moment du remboursement ; et il est aisé de voir qu'en peu d'années ces intérêts ont doublé le capital, et par conséquent doublé le mal.
Mais aujourd’hui en Europe, on est tellement habitué à l'existence d'une dette publique, que lorsqu'on a trouvé le moyen d'emprunter une somme à rentes perpétuelles et d'assurer le paiement des intérêts, on s'imagine s'être libéré et ne plus rien devoir ; et l'on ne voit pas, ou l'on ne veut pas voir, que ces intérêts absorbant une partie du revenu publie, qui déjà était insuffisant, puisqu'on a été obligé d'emprunter, ils sont cause que ce même revenu suffit encore moins aux dépenses subséquentes ; que bientôt il faut emprunter encore pour faire face à ce nouveau déficit, et se grever de nouveaux intérêts ; et qu'ainsi, en assez peu de temps, il se trouve qu'une portion considérable de toutes les richesses annuellement produites est employée non pas au service de l'État, mais à entretenir une foule de rentiers inutiles : et pour comble de maux, quels sont ces rentiers ? des hommes non seulement oisifs comme tous les rentiers, mais encore complètement indifférents aux succès ou aux malheurs de la classe industrieuse, à laquelle ils n'ont rien prêté ; n'ayant [317] absolument d'autre intérêt que la permanence du gouvernement emprunteur, quel qu'il soit et quelque chose qu'il fasse ; et en même temps n'ayant d'autre désir que de le voir dans l'embarras, afin qu'il soit obligé de les ménager et de les mieux payer ; par conséquent, ennemis nés des véritables intérêts de la société, ou au moins leur étant absolument étrangers. Je ne prétends pas dire que tous les rentiers de l'État soient de mauvais citoyens ; mais je dis que leur position est calculée pour les rendre tels. J'ajoute que les rentes viagères tendent de plus à rompre les liens de famille, et que la grande abondance des effets publics ne peut manquer de produire une foule de joueurs effrénés. La vérité de ce que j'avance se montre d'une manière bien odieuse et bien funeste dans toutes les grandes villes sans commerce, et surtout dans toutes les capitales où cette classe d'hommes est très nombreuse et très puissante, et a beaucoup de moyens de faire prévaloir ses passions et de pervertir l'opinion générale...
On a donc autant de tort de croire que les emprunts du gouvernement ne sont pas nuisibles à l'industrie nationale, que de se persuader que les fonds qu'ils produisent ne sont enlevés à aucun individu malgré lui. Au reste, ce ne sont pas là les véritables raisons qui font attacher tant d'importance à la possibilité d'emprunter. Le grand avantage des emprunts, aux yeux de leurs partisans, est qu'ils fournissent en un moment des sommes énormes que l'on ne pourrait se procurer qu'avec [318] beaucoup de lenteur par le moyen des impôts même les plus accablants. Or, ce prétendu avantage, je n'hésite pas à déclarer que je le regarde comme le plus grand de tous les maux. Ce n'est autre chose qu'un moyen de faire faire aux hommes des efforts excessifs qui les épuisent, et tarissent en eux les sources de la vie. Montesquieu l'a bien senti. Après avoir peint très énergiquement l'état de détresse et d'anxiété auquel l'exagération des dépenses publiques avait réduit déjà de son temps les peuples de l'Europe qui auraient dû être les plus florissants par leur industrie, il ajoute :
« Et, ce qui prévient tous les remèdes à venir, on ne compte plus sur les revenus, mais on fait la guerre avec son capital. Il n'est pas inouï [58] de voir des États hypothéquer leurs fonds pendant la paix même, employer, pour se ruiner, des moyens qu'ils appellent extraordinaires, et qui le sont si fort, que le fils de famille le plus dérangé les imagine à peine [59]. »
On ne manquera pas de dire que c'est là abuser de son crédit, et non pas s'en servir, et que l'abus qu'on peut en faire n'empêche pas qu'il ne soit bon d'en avoir. Je réponds d'abord que l'abus est inséparable de l'usage, et l'expérience le prouve. Il y a à peine deux cents ans que les progrès de la civilisation, de l'industrie, du commerce, ceux de [319] l'ordre social, et peut-être aussi l'accroissement du numéraire, ont donné aux gouvernements la facilité de faire des emprunts ; et, dans ce court espace de temps, ces dangereux expédients les ont tous conduits à des banqueroutes totales ou partielles, quelquefois répétées, ou à la ressource aussi honteuse et plus funeste du papier-monnaie, ou à rester accablés sous le poids d'un fardeau qui devient chaque jour plus insupportable.
Mais je vais plus loin : je soutiens que le mal n'est pas dans l'abus mais dans l'usage même des emprunts ; c'est-à-dire que l'abus et l'usage sont une seule et même chose, et que chaque fois qu'un gouvernement emprunte, il fait un pas vers sa ruine. La raison en est simple. Un emprunt peut être une bonne opération pour un homme industrieux dont la consommation se reproduit avec profit. Au moyen des sommes qu'il a empruntées, il augmente cette consommation productive, et avec elle ses profits. Mais un gouvernement, qui est un consommateur du genre de ceux dont les dépenses sont stériles et destructives, ce qu'il emprunte il le mange, c'est autant de perdu à jamais, et il reste grevé d'une dette qui est autant de retranché sur ses moyens à venir. Cela ne peut être autrement. Dans plusieurs pays on a commencé par être longtemps sans sentir les mauvais effets de ces opérations, parce que les progrès de l'industrie et des arts étant très grands à cette époque, ils se sont trouvés plus rapides que ceux de la dette, et les moyens du gouvernement ne laissaient pas d'augmenter. Bien des gens même [320] en ont conclu qu'une dette publique était une source de prospérité, tandis que cela prouvait seulement que les particuliers faisaient plus de bien que le gouvernement ne faisait de mal ; mais ce mal n'en était pas moins réel, et actuellement personne n'est tenté de le nier.
À ces raisons pressantes on répond par la seule excuse qui reste quand on n'en a plus, la nécessité. Mais j'insiste, et je prétends que dans le cas dont il s'agit, là nécessité même n'est point une excuse ; car c'est le remède lui-même qui crée l'obligation où l'on est d'y avoir recours. Je m'explique : quand une nation est une fois engagée dans une situation périlleuse, il n'est pas douteux qu'il y a nécessité pour elle de faire les plus grands efforts pour s'en tirer. Mais un corps politique ne se trouve pas naturellement placé dans une telle position. Toujours quelque cause antérieure l'y a jeté. Ou il a excessivement mal mené ses affaires intérieures, et par là il a encouragé quelques voisins inquiets à l'attaquer pour profiter de sa faiblesse ; ou, s’il a bien conduit ses propres affaires, il a cherché à s'en prévaloir pour se mêler mal à propos de celles des autres ; il a abusé de sa prospérité pour troubler celle d'autrui, pour faire de trop grandes entreprises, pour élever des prétentions exagérées, ou seulement pour prendre une attitude menaçante qui provoque des mesures hostiles et produit la haine. Ce sont là en effet les fautes qui amènent ordinairement la nécessité de faire des efforts excessifs et d'avoir recours aux emprunts ; et s'il est vrai que [321] c'est par la folle confiance qu'a inspirée cette pernicieuse ressource qu'on a été entraîné dans ces fautes, on doit convenir que le crédit que l'on regarde comme un remède à ces maux en est la vraie cause. Or l'histoire nous apprend que c'est effectivement depuis que les gouvernements ont eu ce que l'on appelle du crédit, c'est-à-dire la possibilité d'employer en un instant les fonds de plusieurs années, qu'ils n'ont plus mis de bornes ni à leurs prodigalités, ni à leur ambition, ni à leurs projets, qu'ils ont augmenté leurs armées, qu'ils ont multiplié leurs intrigues, et qu'ils ont adopté cette politique tracassière avec laquelle on ne peut ni éviter la guerre, ni jouir de la paix. Ce sont donc là les effets de ce crédit publie que l'on regarde comme un si grand bien. Mais du moins est-il utile dans les dangers pressants ? Non. Il n'y a de danger pressant pour une nation que l'invasion subite de son territoire. Dans ce cas extrême ce n'est pas l'argent qui sauve, c'est le concours des forces, c'est la réunion des volontés. Les réquisitions donnent les choses, les levées en masse fournissent les hommes, les emprunts n'y serviraient de rien. Ce à quoi sert le crédit, c'est à soutenir des guerres lointaines c'est-à-dire à les prolonger, encore il manque quand elles deviennent désastreuses, c'est-à-dire au moment du besoin. Alors on fait la paix. On l'aurait faite plus tôt si l'on n'avait pas eu de crédit, ou plutôt l'on n'eût pas fait la guerre ; et quand cette paix tardive et forcée est signée, on s'aperçoit que, de toutes les pertes que l'on a faites, la plus regrettable, [322] après les hommes inutilement sacrifies, est celle des sommes qu'on aurait conservées si l'on n'avait pas eu la malheureuse facilité de les emprunter. Le vainqueur lui-même n'est jamais dédommagé par ses succès des sacrifices qu'ils lui ont coûté et des dettes dont il reste grevé. De tout cela je conclus tend de nouveau que ce que l'on appelle le crédit public est le poison qui tue, même assez rapidement, les gouvernements modernes.
Je ne conseillerai pas cependant de faire une loi qui défende aux gouvernants de jamais emprunter et aux gouvernés de jamais leur prêter. Une telle loi serait absurde et inutile : absurde, car elle serait fondée, comme le mal qu'elle voudrait détruire, sur ce faux principe, que le pouvoir législatif actuel peut enchaîner le pouvoir législatif à venir ; inutile, car la première chose que feraient ceux qui dans la suite voudraient emprunter, ce serait d'abolir la loi qui le leur défend ; et ils en auraient le droit. Je voudrais donc que l'on s'y prît tout différemment ; je voudrais qu'au contraire ou reconnût et on proclamât ce principe d'une éternelle vérité, que tout ce que des législateurs quelconques décrètent, leurs successeurs peuvent toujours le modifier, le changer, l'annuler ; et que l’on déclarât solennellement qu'à l'avenir ce principe salutaire sera appliqué, comme il doit l’être, aux engagements que le gouvernement pourrait prendre avec des prêteurs. Par là le mal serait coupé dans sa racine, car les capitalistes n'ayant plus de garantie ne prêteraient plus ; bien des malheurs seraient [323] prévenus ; et ce serait une nouvelle preuve que les maux de l'humanité viennent toujours de quelque erreur, et que la vérité les guérit. C'est par ce vœu que je terminerai ce que j'avais à dire des revenus et des dépenses du gouvernement, et que je finirai ce traité. Seulement je vais encore présenter au lecteur quelques réflexions sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent.
CHAPITRE XIII.↩
Conclusion.
Ma voici arrivé à un endroit remarquable du chemin que je me proposais de parcourir. Je demande la permission de m'y arrêter un moment. Je répéterai encore au lecteur que ce qu’il vient de lire n'est pas simplement un Traité d'Economie politique. C'est la première partie d'un Traité de la Volonté qui doit en avoir deux autres, et qui n'est lui-même que la suite d'un Traité de l'Entendement. Tout ici doit donc être coordonné avec ce qui précède et ce qui suivra. Ainsi on ne doit pas être étonné que je ne sois pas entré dans les détails de l'économie politique, mais on devrait l'être que je ne fusse pas remonté jusqu'à l'origine de nos besoins et de nos moyens, que je ne me fusse pas occupé de faire voir comment ces besoins et ces moyens [324] naissent de notre faculté de vouloir, et que j'eusse négligé d'indiquer les relations de nos besoins physiques avec nos besoins moraux.
C'est pour ne pas mériter ces reproches, que j'ai commencé par une Introduction très générale, qui n'appartient pas plus à l'économie qu'à la morale ou à la législation, mais dans laquelle j'ai tâché de bien expliquer quelles sont les idées dont nous sommes redevables à notre faculté de vouloir ; et sans lesquelles ces trois sciences n'existeraient pas pour nous. On me dira que cette Introduction est trop métaphysique. Je répondrai qu'elle ne pouvait être autrement, et que c'est précisément parce qu'elle est très métaphysique qu'il n'y a point de mauvaise métaphysique dans le reste de l'ouvrage. Car il n'y a rien de tel pour se préserver des sophismes et des illusions, que de commencer par bien éclaircir les idées principales. Nous n'avons pas tardé à en avoir la preuve.
En effet, après avoir bien observé manière dont nous connaissons nos besoins, notre faiblesse originaire, et notre penchant à sympathiser, nous n'avons plus eu aucun doute sur la nature de la société. Nous avons vu clairement qu'elle est notre état naturel et nécessaire, qu'elle est fondée sur la personnalité et la propriété, qu'elle consiste dans des conventions, que ces conventions sont toutes des échanges, que l'essence de l'échange est d'être utile aux deux parties contractantes, et que les avantages généraux des échanges qui constituent l'état social sont de produire le concours des forces, l'accroissement [325] et la conservation des lumières, et la division du travail.
Après avoir examiné de même nos moyens de pourvoir à nos besoins, nous avons vu que nos forces individuelles sont notre seule richesse primitive que l'emploi de ces forces, notre travail, a une valeur nécessaire qui est la seule cause de toutes les autres valeurs ; que toute notre industrie consiste à fabriquer et à transporter, et que l'effet de cette industrie est toujours uniquement d'ajouter un degré d'utilité aux choses sur lesquelles elle s'exerce y et de nous fournir des objets de consommation et des moyens d existence.
Remontant toujours à l'observation de nos facultés, puisque la personnalité et la propriété sont nécessaires, il est évident que l'inégalité est inévitable. Mais elle est un mal. Nous avons vu quelles sont les causes de son accroissement exagéré et quels en sont les funestes effets. Ceux-ci nous ont expliqué d'une manière très précise ce que l'on dit ordinairement d'une manière très vague des différents états par lesquels passe successivement le même peuple.
Puisque nous avons tous des moyens, nous sommes tous propriétaires ; puisque nous avons tous des besoins, nous sommes tous consommateurs. Ces deux grands intérêts nous réunissent toujours. Mais nous sommes naturellement inégaux : d'où il arrive avec le temps que quelques- uns ont des avances et que beaucoup d'autres n'en ont pas. Ces derniers ne peuvent vivre que sur les fonds des premiers. [326] De là deux grandes classes d'hommes, les salaries et les salariants, opposés d'intérêts en ce que les uns vendant leur travail voudraient le vendre cher, et les autres l'achetant voudraient l'acheter à bon marché.
Parmi ceux qui achètent le travail, les uns (ce sont les riches oisifs) ne l'emploient qu'à leur satisfaction personnelle ; sa valeur est détruite. Les autres (ce sont les entrepreneurs d'industrie) l'emploient d'une manière utile qui reproduit ce qu'il coûte : ce sont ceux-là seuls qui entretiennent et accroissent les richesses déjà acquises ; ce sont même eux seuls qui fournissent aux autres capitalistes le revenu qu'ils mangent, puisque ne faisant rien ils ne peuvent tirer d'autre parti de leurs capitaux, soit mobiliers, soit immobiliers, que de les louer aux hommes industrieux, moyennant une rente que ceux-ci prélèvent sur leurs bénéfices. Plus l'industrie de ces derniers se perfectionne, plus nos moyens d'existence augmentent.
Enfin nous avons remarqué que la fécondité de l'espèce humaine est telle, que le nombre des hommes est toujours proportionné à la quantité de leurs moyens d'existence ; et que partout où ce nombre n'augmente- pas continuellement et rapidement, c'est que beaucoup d'individus périssent tous les jours faute de moyens de vivre.
Telles sont les vérités principales qui suivent si immédiatement de l'observation de nos facultés, qu'il n'est pas possible de les contester. Elles nous conduisent à des conséquences qui ne sont pas moins certaines.
[327]
Après avoir bien vu ce que c'est que la société, il est impossible de ne pas rejeter l'idée de s'en passer absolument, ou de la fonder sur un renoncement entier à soi-même et sur une égalité chimérique.
Apres avoir bien démêlé les effets de notre industrie, il est impossible de ne pas voir qu'il n’y a rien de plus mystérieux dans l'industrie agricole que dans toute autre. Mais on y découvre les inconvénients qui lui sont propres et qui sont cause des différentes formes qu'elle prend suivant les temps et suivant les lieux.
Quand on a reconnu la cause nécessaire de toutes les valeurs, il faut bien en conclure qu'il est absurde de soutenir que l'argent n'est qu'un signe, et odieux, de prétendre lui donner une valeur arbitraire ou le remplacer forcément par une valeur imaginaire, et que tout établissement qui tend vers ce but est dangereux et pernicieux.
Quand on a vu comment s'opère la formation de nos richesses et leur rénovation continuelle que nous nommons circulation, on ne peut méconnaître que la consommation en elle-même n'est jamais utile, et que la consommation exagérée appelée luxe est toujours nuisible ; et l'on ne peut s'empêcher de trouver ridicule l'importance que l'on a voulu donner aux hommes qui n'ont d'autre mérite que d'être consommateurs, comme si c'était là un talent bien rare.
Des vues justes sur la consommation donnent [328] nécessairement des idées justes sur le plus grand des consommateurs, le gouvernement, sur les effets de ses dépenses, de ses dettes, et des différents impôts qui composent ses revenus, et nous conduisent à démêler sûrement les différents rejets de ses impôts, et à n'évaluer le plus ou moins de mal qu'ils font que suivant les différentes classes d'hommes sur lesquels ils tombent.
Toutes ces conséquences sont rigoureuses. Elles n'en seront pas moins contestées. Il fallait donc y arriver méthodiquement. Mais celles surtout qui éprouveront les plus grandes oppositions, ce sont celles qui nous conduisent à déterminer les degrés d'importance des différentes classes de la société. Comment persuader à ces grands propriétaires ruraux tant vantés, qu'ils ne sont que des prêteurs d'argent onéreux à l'agriculture et étrangers à tous ses intérêts ? Comment faire convenir ces riches oisifs si respectés, qu'ils né sont absolument bons à rien, et que leur existence est un mal en ce qu'elle diminue le nombre des travailleurs utiles ? Comment faire avouer à tous ceux qui paient du travail, que la cherté de la main-d’œuvre est une chose désirable, et qu'en général tous les vrais intérêts du pauvre sont exactement les mêmes que les vrais intérêts de la société tout entière ? Ce n'est pas seulement leur intérêt bien ou mal entendu qui s'oppose à ces vérités ; ce sont leurs passions, et parmi ces passions, la plus violente et la plus antisociale de toutes, la vanité. Dès lors plus [329] de démonstration ou du moins plus de conviction possible ! Car les passions savent tout obscurcir et tout embrouiller ; et c'est avec autant de raison que de finesse, que Hobbes a dit, que si les hommes avaient eu un vif désir de ne pas croire que deux et deux font quatre, ils seraient parvenus à rendre cette vérité douteuse. Ou en pourrait donner des preuves.
Dans beaucoup d'occasions il est donc plus difficile encore de faire goûter la vérité que de la découvrir. Cette observation nous fait trouver un nouveau rapport entre le sujet que nous venons de traiter et celui qui va nous occuper, entre l'étude de nos actions et celle de nos sentiments. Nous avions aperçu et dit qu'il faut bien connaître les conséquences de nos actions pour bien apprécier le mérite ou le démérite des sentiments qui nous portent à telle action ou à telle autre ; et actuellement nous voyons qu'il faut analyser nos sentiments eux-mêmes, les soumettre à un examen rigoureux, reconnaître ceux qui étant fondés sur des jugements sains, nous dirigent toujours bien, et ceux qui, prenant leur source dans des illusions et naissant des travers de notre esprit, ne peuvent que nous égarer, et forment en nous une fausse et aveugle conscience qui nous éloigne toujours plus du chemin de la raison, le seul qui conduise au bonheur. C'est ce dont nous allons nous occuper ; et si nous nous trouvons avoir bien exposé les résultats des actions des hommes et les effets de leurs [330] passions, il semble qu'il nous sera facile de leur indiquer les règles qu'ils devraient se prescrire. Ce serait là le véritable esprit des lois et la meilleure conclusion d'un Traité de la Volonté.
NOTA. De ces deux dernières parties d'un Traité complet de la Volonté, savoir, l'examen de nos passions et celui des règles à leur prescrire, il n'existe dans les œuvres de l'auteur que le premier chapitre de la première.
Au reste, ces deux Traités, importants sans doute par leurs objets, sont absolument distincts de celui qu'on vient de lire.
[331]
EXTRAIT RAISONNÉ, SERVANT DE TABLE ANALYTIQUE.↩
Introduction. § I, page 1.
La faculté de vouloir est un mode et une conséquence de la faculté de sentir.
Nous venons de terminer l'examen de nos moyens de connaître ; il faut les employer à l'étude de notre faculté de vouloir, pour achever l'histoire de nos facultés intellectuelles.
La faculté de vouloir fait naitre en nous les idées de besoins et de moyens, de richesse et de dénuement, de droits et de devoirs, de justice et d'injustice, lesquelles viennent de l'idée de propriété, laquelle elle-même dérive de l'idée de personnalité.
Il faut donc premièrement examiner cette dernière, et auparavant expliquer nettement ce que c'est que la faculté de vouloir.
La faculté de vouloir est celle de trouver une chose quelconque préférable à une autre. Elle est un mode et une conséquence de la faculté de sentir.
[332]
§ II, page 10.
De la faculté de vouloir naissent les idées de personnalité et de propriété.
Le moi de chacun de nous est pour lui sa propre sensibilité.
Ainsi, la seule sensibilité donne, jusqu'à un certain point, l'idée de personnalité.
Mais le mode de sensibilité appelé volonté ou faculté de vouloir peut seul rendre complète cette idée de personnalité, et ce n'est qu'alors qu'elle peut engendrer celle de propriété telle que nous l'avons.
L'idée de propriété naît donc uniquement de la faculté de vouloir, et de plus elle en naît nécessairement ; car on ne peut avoir l'idée de son moi sans avoir celle de la propriété de toutes les facultés de ce moi et de leurs effets.
Si cela n'était pas ainsi, s'il n'y avait pas parmi nous de propriété naturelle et nécessaire, il n'y en aurait jamais eu de conventionnelle et artificielle.
Cette vérité est la base de toute économie et de toute morale, qui ne sont, dans leur principe, qu'une seule et même science.
[333]
§ III, page 23.
De la faculté de vouloir naissent tous nos besoins et tous nos moyens.
Les mêmes actes intellectuels émanés de notre faculté de vouloir, qui nous font acquérir l'idée distincte et complète de notre moi et de la propriété exclusive de tous ses modes, sont aussi ceux qui nous rendent susceptibles de besoins et qui sont la source de tous nos moyens de pourvoir à ces besoins.
Car, 1° tout désir est un besoin, et tout besoin n'est jamais que le besoin de satisfaire un désir.
Le désir est toujours en lui-même une souffrance.
2°. Quand notre système sensitif réagit sur notre système musculaire, ces désirs ont la propriété de diriger nos actions et de produire ainsi tous nos moyens.
Le travail, l'emploi de nos forces, est notre seul trésor et notre seule puissance.
Ainsi, c'est la faculté de vouloir qui nous rend propriétaires de besoins et de moyens, de passion et d'action, de souffrance et de puissance.
De là naissent les idées de richesse et de dénuement.
[334]
§ IV, page 33.
De la faculté de vouloir naissent aussi les idées de richesse et de dénuement.
Tout ce qui sert médiatement ou immédiatement à la satisfaction de nos besoins est pour nous un bien, c'est-à-dire une chose dont la possession est un bien.
Etre riche, c'est posséder ces biens ; être pauvre, c'est en être dénué.
Ils naissent tous de l'emploi de nos facultés ; ils en sont l'effet et la représentation.
Ces biens ont tous deux valeurs parmi nous : l'une est celle des sacrifices qu'ils coûtent à celui qui les produit ; l'autre celle des avantages qu'ils procurent à celui qui les acquiert.
Le travail dont ils émanent a donc ces deux valeurs ?
Oui, le travail a ces deux valeurs. L'une est la somme des objets nécessaires à la satisfaction des besoins qui naissent inévitablement dans l'être animé pendant que son travail s'opère ; l'autre est la masse d'utilité résultante de ce travail.
Cette dernière valeur est éventuelle et variable.
La première est naturelle et nécessaire ; elle n'est cependant pas d'une fixité absolue, et c'est ce qui rend très délicats tous les calculs économiques et moraux.
[335]
On ne peut guère employer dans ces matières que des considérations tirées de la théorie des limites.
§ V, page 41.
De la faculté de vouloir naissent encore les idées de liberté et de contrainte.
La liberté est la puissance d'exécuter notre volonté.
Elle est le premier de nos biens ; elle les renferme tous, comme la contrainte comprend tous nos maux, puisqu'elle est la privation du pouvoir de satisfaire nos besoins et d'accomplir nos désirs.
Toute contrainte est souffrance, toute liberté est jouissance.
La valeur totale de la liberté d'un être animé est égale à celle de toutes ses facultés réunies.
Elle est absolument infinie pour lui et sans équivalent possible, puisque sa perte entière emporte l'impossibilité de la possession d'aucun bien.
Notre devoir unique est d'augmenter notre liberté et sa valeur. Le but de la société n'est jamais que de remplir ce devoir.
§ VI, page 48.
Enfin, de la faculté de vouloir naissent les idées de droits et de devoirs.
Les droits naissent des besoins et les devoirs des moyens.
[336]
La faiblesse dans tous les genres est la source de tous les droits, et la puissance la source de tous les devoirs, ou, si l'on veut, du devoir général do la bien employer, lequel comprend tous les autres.
Ces idées de droits et de devoirs ne sont point aussi essentiellement corrélatives qu'on le dit communément.
Celle de droits est antérieure et absolue.
L'être animé, de par les lois de sa nature, a toujours le droit de satisfaire ses besoins, et il n'a de devoirs que suivant les circonstances.
Un être sentant et voulant, mais incapable d'action, aurait tous les droits et point de devoirs.
Cet être supposé capable d'action et isolé de tout autre être sensible a encore la même plénitude de droits et le devoir unique de bien diriger ses actions, de bien employer ses moyens pour la plus grande satisfaction de ses besoins.
Placez ce même être en contact avec d'autres êtres qui lui dévoilent leur sensibilité trop imparfaitement pour qu'il puisse faire avec eux des conventions : il a toujours les mêmes droits, et ces devoirs, ou plutôt son devoir unique, n'est changé qu'en ce qu'il faut qu'il agisse sur la volonté de ces êtres, et qu'il a le besoin de compatir plus ou moins avec elle.
Telles sont nos relations avec les animaux.
Supposez ce même être sensible en relation avec des êtres avec qui il puisse correspondre complètement et faire des conventions j il a toujours les mêmes droits illimités en eux-mêmes et le même devoir unique.
Ces droits ne sont bornés, ce devoir n'est modifié [337] par les conventions qui s'établissent, que parce que ces conventions sont autant de moyens d'exercer ces droits, de remplir ce devoir, plus et mieux qu'auparavant.
La possibilité de s'expliquer et non l'agriculture, la grammaire et non Cérès, est la première législatrice.
C'est à l'établissement des conventions que commencent le juste et l'injuste proprement dits.
§ VII, page 61.
Conclusion.
Les considérations générales qu'on vient de lire commencent à répandre quelque lumière sur le sujet qui nous occupe ; mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut voir plus en détail quels sont les nombreux résultats de nos actions, quels sont les sentiments divers qui naissent de nos premiers désirs, et quelle est la manière de diriger le mieux possible ces actions et ces sentiments. C'est ici que se retrouve la division que j'ai annoncée.
Je vais commencer par parler de nos actions.
CHAPITRE PREMIER, page 65.
De la Société.
Dans l'introduction d'un Traité de la Volonté, nous avons dû indiquer la génération de quelques [338] idées générales qui sont des conséquences nécessaires de cette faculté.
Nous avons de même dû examiner sommairement,
1° Ce que sont des êtres inanimés, c'est-à-dire ne sentant ni ne voulant ; 2° Ce que seraient des êtres sentants avec indifférence, sans volonté ; 3° Ce que sont des êtres sentants et voulants, mais isolés ;
4° Enfin ce que sont des êtres sentants et voulants comme nous, mais mis en contact avec leurs semblables.
Ce sont ces derniers dont nous devons actuellement nous occuper uniquement ; car l'homme ne peut subsister qu'en société.
Le besoin de la reproduction et le penchant à la sympathie l'amènent nécessairement à cet état, et son jugement lui en fait sentir les avantages.
Je vais donc parler de la société.
Je ne la considérerai que sous le rapport économique, parce qu'il n'est question ici que de nos actions et pas encore de nos sentiments.
Sous ce rapport, la société ne consiste que dans une suite continuelle d'échanges, et l'échange est une transaction telle, que les deux contractants y gagnent toujours tous deux. (Cet aperçu jettera, par la suite un grand jour sur la nature et les effets du commerce.)
On ne peut jeter les yeux sur un pays civilisé sans voir avec étonnement tout ce que cette suite continuelle de petits avantages inaperçus, mais sans [339] cesse répétés, ajoute la puissance primitive de l'homme.
C'est que cette suite d'échanges qui constitue la société a trois propriétés remarquables : elle produit concours de forces, accroissement et conservation des lumières, et division du travail.
L'utilité de ces trois effets va toujours en augmentant. Elle sera mieux sentie quand nous aurons vu comment se forment nos richesses.
CHAPITRE II, page 81.
De la Formation de nos richesses, ou de la Production d'utilité.
Avant tout, que devons-nous entendre par le mot production ?
Nous ne créons jamais rien ; nous n'opérons que des changements de forme et de lieu. Produire, c'est donner aux choses une utilité qu'elles n'avaient pas.
Tout travail d'où résulte une utilité est productif. Ceux relatifs à l'agriculture n'ont à cet égard rien de particulier.
Une ferme est une vraie manufacture.
Un champ est un véritable outil, ou, si l'on veut, un amas de matières premières. Toute la classe laborieuse est productive.
La vraie classe stérile, ce sont les oisifs.
Les manufacturiers fabriquent, les commerçants transportent : voilà toute notre industrie ; elle consiste à produire de l'utilité.
[340]
CHAPITRE III, page 89.
De la Mesure de l'utilité, ou des Valeurs.
Ce qui est utile pour nous, c'est tout ce qui contribue à augmenter nos jouissances ou à diminuer nos souffrances.
Nous sommes souvent de très injustes appréciateurs de la véritable utilité des choses.
Mais la mesure de l'utilité qu'à tort ou à raison nous attribuons à une chose est la quantité des sacrifices que nous sommes disposés à faire pour nous en procurer la possession.
C'est ce qu'on appelle le prix de cette chose ; c'est sa vraie valeur sous le rapport de la richesse.
Le moyen de s'enrichir est donc de se livrer au travail qui se paie le plus chèrement, quelle que soit sa nature. Cela est vrai d'une nation comme d'un individu.
Observez toutefois que la valeur conventionnelle, le prix vénal des choses, étant déterminé par le balancement de la résistance des vendeurs et des acheteurs, une chose, sans être moins désirée, devient moins chère quand elle est plus facilement produite.
C'est là le grand avantage du progrès des arts ; il fait que nous sommes approvisionnés à meilleur marché, parce que nous le sommes avec moins de peine.
[341]
CHAPITRE IV, page 96.
Du Changement de forme, ou de l'Industrie fabricante, y compris l'agriculture.
Dans toute industrie quelconque il y a trois choses : théorie, application et exécution. De là trois espèces de travailleurs : le savant, l'entrepreneur et l'ouvrier.
Tous sont obligés de dépenser plus ou moins avant de recevoir, surtout l'entrepreneur.
Ces avances sont fournies par des économies antérieurement faites. C'est ce qu'on appelle des capitaux.
Le savant et l'ouvrier sont salariés régulièrement par l'entrepreneur ; mais lui n'a de bénéfice qu'à proportion du succès de sa fabrication.
Il est indispensable que les travaux les plus nécessaires soient les plus mal payés. Cela est vrai surtout de ceux relatifs à l'industrie agricole.
Elle a de plus l'inconvénient que l'entrepreneur de culture ne peut pas se dédommager de la modicité de ses bénéfices par la grande étendue de ses affaires.
Aussi cette profession n'a-t-elle aucun attrait pour les gens riches.
Les propriétaires de terre qui ne cultivent pas sont étrangers à l'industrie agricole. Ce sont de simples prêteurs de fonds.
[342]
Ils les disposent suivant les convenances de ceux qu'ils peuvent trouver pour les faire valoir.
Quatre sortes d'entrepreneurs, deux avec plus ou moins de moyens, les gros fermiers et les petits fermiers, et deux presque sans moyens, les métayers et les manouvriers.
Cela fait quatre espèces de cultures essentiellement différentes.
La division en grande et petite culture est insuffisante et sujette à équivoques.
L'agriculture est donc le premier des arts sous le rapport de la nécessité, mais non pas sous le rapport de la richesse.
C'est que nos moyens de subsistance et nos moyens d'existence sont deux choses très- différentes, que l'on a tort de confondre.
CHAPITRE V, page 130.
Du Changement de lieu, ou de l'Industrie commerçante.
L'homme isolé fabriquerait ; mais il ne pourrait commercer. Car commerce et société sont une seule et même chose.
Lui seul anime l'industrie.
Il unit entre eux d'abord les hommes d'un même canton, puis les différents cantons d'un même pays, puis enfin les différentes nations entre elles.
Le plus grand avantage du commerce extérieur, [343] le seul qui mérite attention, est de donner un plus grand développement au commerce intérieur.
Les commerçants proprement dits rendent le commerce plus facile ; mais il existe avant eux et sans eux.
Ils donnent une nouvelle valeur aux choses en les changeant de lieu, comme les fabricants en les changeant de forme.
C'est sur cet accroissement de valeur qu'ils trouvent leurs bénéfices.
L'industrie commerçante présente les mêmes phénomènes que l'industrie fabricante. Il y a de même théorie, application, exécution ; savants, entrepreneurs et ouvriers. Ces travailleurs sont payés de même ; ils ont des fonctions et des intérêts analogues, etc., etc.
CHAPITRE VI, page 138.
De la Monnaie.
Le commerce peut exister et existe jusqu'à un certain point sans monnaie.
Les valeurs de toutes les choses qui en ont une se servent de mesure réciproquement.
Les métaux précieux, qui sont une de ces choses, deviennent bientôt leur mesure commune, parce qu'ils ont beaucoup d'avantages pour cela.
Cependant ils ne sont pas encore monnaie ; c'est l'empreinte du souverain qui donne cette qualité à [344] un morceau de métal, en constatant son poids et son titre.
La monnaie d'argent est la seule vraie mesure commune.
La proportion de l'or à l'argent varie suivant les temps et suivant les lieux.
La monnaie de cuivre est une fausse monnaie, bonne seulement pour de petits appoints.
Il eût été à désirer que les monnaies n'eussent jamais porté d'autre nom que celui de leur poids, et qu'on ne se fût jamais servi de ces dénominations arbitraires qu'on appelle monnaie de compte, comme livres, sous, deniers, etc., etc.
Mais quand ces dénominations sont admises et employées dans les actes, diminuer la quantité de métal à laquelle elles répondent, en altérant les monnaies réelles, c'est voler.
Et c'est un vol qui nuit même à celui qui le fait. Un vol plus grand et plus funeste encore est de faire monnaie du papier.
Il est plus grand, parce que dans cette monnaie il ne reste absolument plus aucune valeur réelle.
Il est plus funeste, parce que ce papier se détériorant graduellement pendant tout le temps qu'il dure, il fait l'effet que ferait une infinité d'altérations successives de la monnaie.
Toutes ces iniquités sont fondées sur la fausse idée que l'argent n'est qu'un signe, tandis qu'il est valeur, et le véritable équivalent de ce qu'il paie.
L'argent étant une valeur comme toute autre [345] chose utile, on doit pouvoir le louer tout aussi librement que toute autre chose.
Le change, proprement dit, est un simple troc d'une monnaie contre une autre.
La banque, le service propre du banquier, consiste à vous faire trouver dans une autre ville l'argent que vous lui remettez dans celle où il est.
Les banquiers rendent encore d'autres services, tels que ceux d'escompter, de prêter, etc., etc.
Tous ces banquiers, changeurs, prêteurs, escompteurs, etc., etc., ont une grande tendance à se former en grandes compagnies, sous prétexte de faire le service à meilleur marché, mais dans le fait afin de le faire payer plus chèrement.
Toutes les compagnies privilégiées, après avoir émis beaucoup de billets, finissent par se faire autoriser à ne les pas payer à vue, et ainsi elles amènent forcément un papier-monnaie.
CHAPITRE VII, page 173.
Réflexions sur ce qui précède.
Jusqu'ici je crois avoir suivi la meilleure marche pour l'objet que je me propose.
Ceci n'étant point seulement un Traité d'Economie politique, mais un Traité de la Volonté, faisant suite à un Traité de l'Entendement, on ne doit pas y trouver beaucoup de détails, mais un sévère enchaînement des propositions principales.
[346]
Ce que nous avons vu détruit, déjà beaucoup d'erreurs importantes. Nous avons une idée nette de la formation de nos richesses.
Il nous reste à parler de leur distribution entre les membres de la société, et de leur
Consommation.
CHAPITRE VIII, page 176.
De la Distribution de nos richesses entre les individus.
Il faut actuellement considérer l'homme sous le rapport des intérêts des individus. L'espèce est forte et puissante, l'individu est essentiellement misérable.
La propriété et l'inégalité sont des conditions invincibles de notre nature.
Le travail, même le moins habile, est une propriété considérable, tant que toutes les terres ne sont pas occupées.
C'est à tort que quelques écrivains ont prétendu qu'il y avait des non-propriétaires.
Divisés par bien des intérêts particuliers, nous sommes tous réunis par ceux de propriétaires et de consommateurs.
Après l'agriculture les autres arts se développent.
La misère commence quand ils .ne peuvent plus suffire à la demande de travail, qui augmente.
L'état de grande aisance est nécessairement [347] transitoire. La fécondité de l'espèce humaine en est la cause.
CHAPITRE IX, page 188.
De la Multiplication des individus, ou de la Population.
L'homme multiplie rapidement partout où il a largement des moyens d'existence.
La population ne devient jamais rétrograde ou seulement stationnaire, que parce que ces moyens manquent.
Chez les sauvages, elle s'arrête de bonne heure parce qu'ils ont peu de ces moyens.
Les peuples civilisés en ont davantage ; ils deviennent plus nombreux à proportion qu'ils en ont plus ou moins et qu'ils en usent mieux ; mais leur population s'arrête aussi.
Donc il existe toujours autant d'hommes qu'il peut en exister.
Donc encore il est absurde de croire pouvoir les multiplier autrement qu'en multipliant les moyens d'existence.
Donc enfin il est barbare de le vouloir, puisqu'ils atteignent toujours la limite de la possibilité, et qu'au-delà ils ne font que s'étouffer les uns les autres.
[348]
CHAPITRE X, page 197.
Conséquences et développements des deux chapitres précédents.
Rappelons-nous, 1° que nous sommes tous opposés d'intérêts et inégaux en moyens ;
2° Que cependant nous sommes tous réunis par les intérêts communs de propriétaires et de consommateurs ;
3° Que, par conséquent, il n'y a pas dans la société de classes constamment ennemies les unes des autres.
La société se partage en deux grandes classes, les salariés et ceux qui les emploient.
Cette seconde classe renferme deux espèces d'hommes ;
Savoir, les oisifs, qui vivent de leur revenu : leurs moyens n'augmentent pas ;
Et les actifs, qui joignent leur industrie aux avances qu'ils peuvent avoir : arrivés à un certain terme, leurs moyens n'augmentent guère.
Le fonds sur lequel vivent les salariés devient donc avec le temps une quantité à peu près constante.
De plus, la classe des salariés reçoit le trop plein de toutes les autres.
Ainsi, l'extension qu'elle peut atteindre détermine celle de la-population totale, et en explique toutes les variations.
[349]
Il suit de là que tout ce qui est réellement utile au pauvre est toujours réellement utile à la société tout entière.
Comme propriétaire, le pauvre a intérêt premièrement que la propriété soit respectée. La conservation même de celles qui ne lui appartiennent pas, mais qui le soudoient, est importante pour lui. Il est juste et utile aussi de le laisser maître de son travail et de son séjour.
Secondement que les salaires soient suffisants. Il importe aussi à la société que le pauvre ne soit pas trop malheureux.
Troisièmement, que ces salaires soient constants. Les variations dans les différentes branches de l'industrie sont un malheur. Celles dans le prix des grains sont un malheur plus grand encore. Les peuples agricoles sont très exposés à ce dernier. Les peuples commerçants ne sont guère exposés à l'autre que par leur faute.
Comme consommateur, le pauvre a intérêt que la fabrication soit économique, les communications faciles et les relations commerciales nombreuses. La simplification des procédés des arts, le perfectionnement des méthodes lui font du bien et point de mal. En cela, son intérêt est encore celui de la société tout entière.
Après l'opposition de nos intérêts, examinons l'inégalité de nos moyens. Toute inégalité est un mal, car c'est un moyen d'injustice.
[350]
Distinguons l'inégalité de pouvoir et l'inégalité de richesse.
L'inégalité de pouvoir est la plus fâcheuse : c'est celle qui existe entre les sauvages.
La société diminue l'inégalité de pouvoir ; mais elle augmente celle de richesse qui, portée à l'extrême, ramène celle de pouvoir.
Cet inconvénient est plus ou moins difficile à éviter, suivant les diverses circonstances. De là la différence des destinées des nations.
C'est ce cercle vicieux qui explique l'enchaînement de beaucoup d'événements dont on a toujours parlé d'une manière bien vague et bien inexacte.
CHAPITRE XI, page 232.
De l'Emploi de nos richesses, ou de la Consommation.
Après avoir expliqué comment se forment nos richesses et comment elles se distribuent, il est aisé de voir comment nous nous en servons.
La consommation est toujours le contraire de la production.
Cependant elle varie suivant l'espèce des consommateurs et la nature des choses consommées.
Considérons d'abord les consommateurs.
La consommation des salariés doit être regardée comme faite par les capitalistes qui les soudoient.
Ces capitalistes sont ou des oisifs qui vivent de [351] revenus, ou des hommes actifs qui vivent de profits.
Les premiers ne soldent que du travail stérile. Leur consommation est toute en pure perte.
Aussi ne peuvent-ils dépenser annuellement que leurs revenus.
Les autres dépensent chaque année tous leurs fonds et tous ceux qu'ils louent aux capitalistes oisifs, et quelquefois ils les dépensent plusieurs fois dans l'année.
Leur consommation est de deux espèces.
Celle qu'ils font pour la satisfaction de leurs besoins personnels est définitive et stérile comme celle des hommes oisifs.
Celle qu'ils font en leur qualité d'hommes industrieux leur rentre avec profits.
C'est avec ces profits qu'ils paient leur dépense personnelle et les rentes des capitalistes oisifs.
Ainsi ils se trouvent avoir payé et les salariés qu'ils emploient directement, et les rentiers, et les hommes que ces rentiers salarient ; et tout cela leur revient par les achats que tous ces gens-là font de leurs productions.
C'est là ce qui constitue la circulation, dont le seul fonds est la consommation productive.
Eu égard à la nature des choses consommées, la consommation la plus lente est la plus économique, la plus prompte est la plus destructive.
On voit que le luxe (c'est-à-dire la consommation superflue) ne peut ni accélérer la circulation, ni en accroître le fonds.
[352]
Il ne fait que substituer des dépenses inutiles à des dépenses fructueuses.
Il est, comme l'inégalité, un inconvénient attaché à l'accroissement des richesses, mais il ne saurait en être la cause.
L'histoire montre bien ce qui arrive partout où on supprime les dépenses inutiles.
Toutes les théories contraires à ceci se réduisent toujours à cette proposition insoutenable : que détruire, c'est produire.
CHAPITRE XII, page 266.
Des Revenus et des dépenses du gouvernement, et de ses Dettes.
L'histoire de la consommation du gouvernement n'est qu'une partie de l'histoire de la consommation générale.
Le gouvernement est un très grand consommateur, ne vivant pas de profits, mais de revenus. Il est bon que le gouvernement possède des biens-fonds. Indépendamment d'autres raisons,
c'est autant de moins qu'il demande en impôts.
L'impôt est toujours un sacrifice que le gouvernement demande aux particuliers.
Tant qu'il n'altère que les jouissances personnelles de chacun, il ne fait que changer de main les dépenses.
Quand il entame la consommation productive, il diminue la richesse publique.
[353]
La difficulté est de bien voir quand les impôts produisent l'un ou l'autre de ces deux effets. Pour en bien juger, il faut les partager en six classes.
On fait voir d'abord que les impôts de chacune de ces six classes ont des manières de nuire qui leur sont propres.
On montre ensuite à qui précisément nuit chacun d'eux.
Demande-t-on une conclusion ? La voici : Les impôts les meilleurs sont, 1° les plus modérés, parce qu'ils obligent à moins de sacrifices et qu'ils nécessitent moins de violences ; 2° les plus variés, parce qu'ils se font équilibre les uns aux autres ; 3° les plus anciens, parce qu'ils ont pénétré dans tous les prix et que tout s'est arrangé en conséquence.
Quant aux dépenses du gouvernement, elles sont nécessaires, mais elles sont stériles. Il est à désirer qu'elles soient les plus petites possibles.
Il est encore plus à désirer que le gouvernement ne fasse pas de dettes. Il est très malheureux qu'il ait la possibilité d'en faire.
Cette possibilité, que l'on appelle le crédit public, conduit promptement tous les gouvernements qui en usent à leur ruine, n'a aucun des avantages qu'on lui attribue et repose sur un faux principe.
Il est à désirer qu'on reconnaisse universellement que les actes d'un pouvoir législatif quelconque ne peuvent jamais lier ses successeurs, et [354] que l'on déclare solennellement que ce principe s'étend aux engagements qu'il prendrait avec des prêteurs.
CHAPITRE XIII, page 323.
Conclusion.
Ceci n'est point seulement un Traité d'Économie politique, mais la première partie d'un Traité de la Volonté, qui sera suivi de deux autres parties, et qui est précédée d'une Introduction, commune à toutes trois.
Ainsi on n'a pas dû entrer dans beaucoup de détails ; mais on a dû remonter soigneusement jusqu'aux principes puisés dans l'observation de nos facultés, et indiquer autant que possible les relations de nos besoins physiques avec nos besoins totaux.
C'est ce que l'on a tâché de faire. Il en résulte des vérités incontestables.
Elles seront contestées, pourtant, moins encore par l'intérêt que par les passions.
Nouvelle liaison entre l'économie et la morale. Nouvelle raison pour bien analyser nos divers sentiments et chercher avec soin s'ils sont fondés sur des opinions justes ou fausses.
NOTA. La Morale et la Législation ne sont pas faites.
FIN.
Endnotes
[1] Les trois premières composent le Traité de l’Entendement, et celle-ci est la première du Traité de la Volonté.
[2] C'est ainsi qu'en a jugé M. Don Juan Juste Garcia, député aux cortès d'Espagne, qui m'a fait l'honneur de me traduire, et qui a intitulé son ouvrage : Éléments de vraie Logique.
[3] On en peut dire autant de tous les êtres animés que nous connaissons, et même de tous ceux que nous imaginons.
[4] Tome 1er, chap. 13 des Eléments d’Idéologie.
[5] Voyez t. 3, chap. 5, p. 273 des Eléments d’Idéologie.
[6] Voyez, sur ce sujet, le tome 1er, chap. 16, et divers endroits du 2e] et du 3e] tomes des Eléments d’Idéologie.
[7] C'est en conséquence du sentiment confus de cette vérité, que l'on n'a point imaginé d'expression plus tendre que d'appeler quelqu'un mon cœur, ma vie, mon âme ; c'est comme si on l'appelait moi. Il y a toujours quelque chose d'hyperbolique dans ces locutions.
[8] J'en conclus que l'expression de l'un ou de l'autre de ces préceptes, et peut-être de tous deux ; a été alterrée par des gens qui n'entendaient réellement ni l'un ni l'autre. J'aurai souvent occasion de faire des réflexions de ce genre, car elles s'appliquent à beaucoup de ces maximes qui passent d'âge en âge.
[9] Le premier est du Lévitique, chap. 19 ; le second est de l'évangile Saint-Jean, chap. 13. Voyez-en la remarque dans les Questions sur les miracles, Voltaire, t. LX, p. 186. Vous serez étonné que Voltaire regarde ces deux maximes comme identiques.
[10] Voyez t. 3, chap. 6, pp. 315 et suivantes des Eléments d'Idéologie.
[11] Voyez t. 1er, chap. 10, et t. 2, chap. 9, p. 463 des Eléments d'Idéologie.
[12] Voyez t. 3, chap. 9, p. 500 et suivantes des Eléments d'Idéologie.
[13] Voyez t. 1er, chap. 13, des Eléments d’Idéologie.
[14] Toutefois, peut-être, avec un degré d’énergie proportionné à la perfection de l’organisation.
[15] Il faut pourtant convenir que la nature ou l'ordre des choses, telles qu'elles sont, en créant les droits de chaque individu animé, égaux et opposés à ceux d'un autre, a virtuellement et indirectement créé l'état de guerre, et que c'est l'art qui l'a fait cesser, ou du moins fréquemment suspendu entre nous par les conventions. Cela rentre encore dans notre principe général, que nous ne créons rien. S'il n'y avait pas des guerres nécessaires et naturelles, il n'y en aurait jamais eu de conventionnelles et artificielles. L'état invinciblement permanent des rapports de l'homme avec les animaux des autres espèces est ce qui le dispose le plus à traiter hostilement son semblable.
[16] Cette dernière erreur de Hobbes n'a cependant été produite dans son excellente tête que par la trop énergique impression qu'y avaient faite les malheurs causés à sa patrie par des droits qui avaient pour objet, dans l'origine, la résistance à l'oppression.
[17] Cette vérité a été développée t. 1er, chapitre de l'Existence, et dans divers endroits des deux autres volumes des Eléments d’Idéologie.
[18] En développant et en provoquant la sympathie.
[19] Observons cependant que l'auteur ne cite ici que la première édition de l'ouvrage de M. Say, celui-ci étant écrit longtemps avant la publication de la seconde, qui a encore reçu des améliorations très importantes. (Note de l'Editeur).
[20] Les marchands savent bien que pour prospérer, il n'y a pas d'autre moyen que de rendre la marchandise agréable et d'être à portée de gens riches. Pourquoi les nations ne pensent-elles pas de même ? Elles ne rivaliseraient que d'industrie ; et n'imagineraient pas de désirer l'appauvrissement de leurs voisins ; elles seraient heureuses.
[21] Je fais abstraction ici du prix de la machine, et de l’intérêt qu’il doit rapporter.
[22] Une de ces circonstances les plus extraordinaires est, sans contredit, la découverte des avantages de l'éducation des moutons d'Espagne au lieu de ceux du pays. C'est la gloire immortelle de M. d'Aubenton, et le fruit de trente ans de persévérance. Eh bien, qu'arrive-t-il depuis que cela est constaté ? Avant même que le cultivateur se soit procuré de ces animaux, et qu'il sache bien la manière d'en tirer un parti avantageux, il donne déjà un fermage plus fort des terres sur lesquelles il espère pouvoir en élever ; c'est-à-dire qu'une partie du produit lui est enlevée d'avance, et qu'on ne manquera pas de lui arracher le reste au prochain bail.
[23] On sera étonné de m'entendre dire LOUER de l'argent comme on dit louer des terres ou une maison. Mais moi, je suis plus justement surpris que quand on dit prêter de l'argent, on ne dise pas prêter des terres, car c'est la même chose. Le vrai est qu'on ne devrait dire prêter que dans le cas du prêt gratuit.
Quand on a une propriété quelconque, il n'y a que six manières d'en user : la conserver ou la détruire, la donner on la vendre, la prêter ou la louer. On ne détruit pas précisément les terres ; mais on les garde, on les donne, on les vend, on les prête, on les loue comme toute autre chose. Il y a la même différence entre prêter et louer qu'entre donner et vendre.
[24] Si c'est en les considérant comme des hommes en général éclairés et indépendants, cela est très juste ; mais si c'est en leur qualité de propriétaires de terres, cela est absurde.
[25] Les prêteurs de terre ont même un grand avantage sur les autres : c'est que quand ils ont trouvé moyen d'obtenir une rente plus forte, ils ont par cela même augmenté leur capital ; car en général on vend les terres d'après le prix des baux. Cela n'arrive pas aux prêteurs d'argent.
[26] S'il les prenait, ce serait pour les sous-louer et les détailler. Alors il serait un être parasite, un spéculateur, et non un cultivateur. C'est ce que sont les fermiers généraux des grandes terres dans les pays de métairies : leur objet est le trafic.
[27] Voyez ce que c’est que la différence de l’emploi des fonds. Cet homme qui cultive médiocrement possède peut-être un bien dont il trouverait 30.000 francs. S’il le vendait, il aurait de quoi aller tenir une grosse ferme dans un bon pays ; il serait beaucoup mieux et gagnerait davantage. Mais il ne sait peut-être pas que cette possibilité existe loin de lui. Quand il le saurait, il craindrait les risques et son inexpérience ; et puis l’homme tient à ses habitudes et au plaisir de la propriété.
[28] Si j’ose affirmer cela, ce n’est pas que j’aie beaucoup voyagé ; mais j'ai depuis environ quarante ans des propriétés dans un pays de grosses fermes, dans un pays de vignobles, et dans un pays de mauvaises métairies ; j'en ai toujours suivi la marche avec attention, et plus encore en vue de l'intérêt général que de mon intérêt particulier ; j'ai opéré des améliorations sensibles dans les deux dernières ; et je suis persuadé que quand on a ainsi un champ suffisant d'observations, ou gagne plus à les approfondir qu'à les étendre.
[29] Le billon est un mélange de beaucoup de cuivre et de si peu d’argent, que l’extraction n’en vaudrait pas les frais.
[30] Plusieurs de ces dénominations ont été originairement des noms de monnaies réelles, comme louis, écus et ducats.
[31] C'est ce qui fait que Law quand l'abbé Terrasson lui proposa de rembourser la religion catholique avec son papier, lui répondit : « Le clergé romain n'est pas si bête. »
[32] Nous en avons vu jusqu'à cinq sous. On juge bien s'il était possible de les surveiller, et si les trois quarts n'étaient pas faux.
[33] Il est vrai que ces mandats ont été la fin de tout, qu’ils n'ont duré que peu de jours, et qu'ils n'ont jamais eu un cours réel ; car la crainte d'aucun supplice ne pouvait plus déterminer personne à les prendre pour aucun prix.
[34] L'agriculture n'est nulle part aussi florissante et croissante que dans les pays où ces fermages sont encore nuls parce qu'il y a encore des terres n'appartenant à personne ; car alors tout le produit de ces terres est à celui qui les cultive. Voyez les contrées de l'ouest des États-Unis de l'Amérique.
Cela doit nous apprendre à apprécier la sagacité de ces profonds politiques qui prétendent qu'il est très avantageux à une nation que ses biens-fonds se vendent très cher, parce que, disent-ils, il s'ensuit quy son sol, qui est une très grande partie de son capital, a une très grande valeur. Ils ne se doutent pas de la question.
Cependant il y a deux manières d'entendre ce mot TRÈS CHER. Veut-on dire qu’il est désirable que la terre se vende cher, à proportion de la rente qu'on en peut tirer ? Cela est vrai ; car cela prouve que l'intérêt de l'argent est bas, et qu'ainsi l'oisif enlève peu au travailleur.
Mais veut-on dire qu’il est bon qu'un arpent de terre se paie cher aussi à proportion de ce qu’il peut produire ? Cela est faux ; car ce prix est autant d'enlevé à celui qui va exploiter cet arpent. Ainsi c'est dire qu’il est avantageux d'enlever à cet homme utile une partie de ses moyens, et de rendre souvent son entreprise impossible, eu en augmentant les frais. L'expérience et la raison déposent également contre celle méprise.
[35] Quand il faut moins de 100 francs pour payer 100 francs ailleurs, on dit que le change est bas. C'est le cas de la ville qui, compensations faites, est restée créancière, parce qu'apparemment elle a envoyé dans l'autre plus de marchandises qu'elle n'en a reçu. Ce change bas lui donne de l'avantage pour importer, car elle peut payer les mêmes choses avec moins d'argent. Mais par la même raison il lui donne du désavantage pour continuer à exporter, car il faut plus d'argent pour s'acquitter vis-à-vis d'elle de la même quantité de marchandises. Cela équivaut à un renchérissement, et diminue les demandes.
Cette seule considération, indépendamment de bien d'autres, montre combien il est ridicule de croire pouvoir exporter toujours et constamment plus qu'on n'importe. On serait arrêté bientôt par le seul cours du change. Mais nous n'en sommes pas encore à examiner les rêveries des prétendues balances de commerce. Il suffit d'avoir fait cette observation.
[36] Encore une fois, ce n'est point uniquement à la solde des propriétaires de terres que sont les simples salariés, mais à la solde de tous ceux qui ont des avances avec lesquelles ils peuvent les payer.
[37] Combien il serait à désirer, en pareil cas, que la première classe de la société fût assez éclairée pour donner à la dernière des idées complètement saines de l'ordre social, pendant ce moment heureux et nécessairement passager où elle est le plus susceptible d'instruction ! Si les États-Unis de l'Amérique septentrionale n'en profitent pas, leur tranquillité et même leur sûreté seront très exposées, quand les obstacles et les inconvénients intérieurs et extérieurs viendront à se multiplier. On appellera cela alors leur décadence et leur corruption. Ce sera l'effet tardif, mais nécessaire, de leur imprévoyance et de leur insouciance antérieures.
[38] On pourrait dire auparavant, de nerfs et de muscles, car cela remonte jusque là.
[39] Encore cela est-il très douteux, si l’on a égard à la différence du nombre des individus.
[40] Les exemples des anciens ne prouvent rien, parce que leur économie politique était toute fondée sur la force. Les peuples méditerranés étaient brigands, les peuples maritimes étaient pirates, tous voulaient être conquérants. Alors c'est le hasard qui fait le destin.
[41] Pour juger de l'exagération de certaines fortunes, tenez compte des proportions ; car il peut y avoir de riches Anglais aussi riches et plus riches que les plus grands seigneurs russes ou polonais ; mais ils sont au milieu d'un peuple dont l'aisance générale est bien plus grande. Par conséquent la disproportion, quoique réelle, est bien moins forte.
[42] Cela est si frappant, qu’il n'y a personne, je pense, qui ne regrette que l'on ait découvert l'Amérique trois cents ans trop tôt, et qui ne doute même s’il serait temps encore de la découvrir. Il est vrai que ces événements-là même, bien que déplorables, ont servi à nos progrès intérieurs. Mais c'est les acheter bien cher. Il paraît que telle est notre destinée.
[43] Il en dit bien d'autres. Voyez son Livre 18e] des Lois, dans le rapport qu'elles ont avec la nature du terrain.
[44] Et ces fameux délices de Capoue ! et toutes ces armées amollies tout à coup pour s'être trouvées dans l'abondance Demandez à tous les généraux si leurs soldats en valent moins après avoir eu largement de quoi vivre pendant quelque temps, à moins qu'ils ne les aient laissés devenir pillards et indisciplinés, en leur en donnant l'exemple, ou que les chefs, ayant fait fortune, n'aient plus d'ambition. Si c'est là ce qui est arrivé aux Carthaginois ou à d'autres, c'est là ce qu'il fallait nous dire, et non pas de vaines phrases de rhéteur.
[45] Des capitalistes oisifs louent bien quelquefois des maisons et de l'argent à d'autres oisifs. Mais ces oisifs ne leur en paient la rente que sur leurs revenus ; et peur trouver la formation de ces revenus, il faut toujours remonter jusqu'à des capitalistes industrieux. Pour les terres, on les loue presque toujours à des entrepreneurs de culture ; car qu'est-ce qu'en feraient des oisifs ?
[46] Et pourquoi est-il circulaire et continu ? C’est que la consommation détruit continuellement ce qui a été produit. Si la reproduction ne venait pas incessamment le rétablir, tout serait fini dès le premier tour.
[47] En effet, on voit bien ici pourquoi la production s'arrête quand ou ne peut plus augmenter la consommation fructueuse de l'industrie, et pourquoi le nombre et l'aisance des hommes croissent ou décroissent comme l'industrie, etc., etc.
[48] Montesquieu était un très grand homme ; mais la science n’était pas faite de son temps ; elle est toute nouvelle.
[49] Voyez M. Germain Garnier, dans son Abrégé élémentaire des Principes de l'Economie politique. À Paris, chez Agasse, en 1796.
Dès la page xii de son Avertissement, il dit formellement : « Les principes qui peuvent servir de guides pour l'administration d’une fortune privée, et ceux sur lesquels doit se diriger la fortune publique, non seulement diffèrent entre eux, mais se trouvent DIRECTEMENT CONTRAIRES. »
Et page xiii : « La fortune d'un individu se grossit par l'épargne ; la fortune publique, AU CONTRAIRE, reçoit son accroissement de l'augmentation des consommations. » Au chapitre de la Circulation, p. 130, il dit encore : « La production annuelle doit naturellement chercher à se régler sur la consommation annuelle. »
Aussi, au chapitre des dettes publiques, p. 24o, il ajoute : « L'amendement et l'extension de la culture, et par suite les progrès de l'industrie et du commerce, n'ont pas d'AUTRE CAUSE que l'extension des besoins artificiels. » Et il en conclut que les dettes publiques sont une bonne chose, en ce qu'elles augmentent ces besoins.
La même doctrine, jointe à l'idée que la culture seule est productive, règne dans tout son ouvrage, et se retrouve dans ses notes sur Smith.
[50] Nous avons déjà vu, dans le chapitre précédemment des fortunes s'établit ou plutôt s'accroît dans la société. Quand nous traiterons de la législation, nous ferons voir de plus que l'excès de l'inégalité et du luxe est encore plus l'effet des mauvaises lois que du cours naturel des choses.
[51] Il est incroyable à quel point l'amour-propre peut faire illusion et porter à s'exagérer à soi-même son importance personnelle. J'ai vu des hommes, obligés par les troubles à quitter leurs châteaux, croire de bonne foi que tout le village allait manquer d'ouvrage, sans s'apercevoir que c'était leurs fermiers, et non pas eux qui donnaient la plus grande partie des salaires, et se persuader sincèrement que quand même leurs paysans se partageraient leurs biens ou les achèteraient à vil prix, ils n'en seraient que plus misérables.
Je ne prétends pas dire que ce fût bien fait ni de les chasser, ni de les spolier, ni même que de tels moyens puissent jamais être la cause d'une prospérité durable. J'ai fait ma profession de foi sur la nécessité du respect pour la propriété et pour la justice en général ; mais il n'en est pas moins vrai que l'absence d'un homme inutile ne change rien au cours des choses, ou tout au plus change de lieu une partie de sa petite dépense personnelle, et que la seule suppression de quelques droits féodaux produit plus de bien dans une campagne que tous les bienfaits de celui qui les percevait.
[52] Je demande que l’on se ressouvienne que je ne regarde pas l'augmentation de population comme un bien ; elle n’est que trop souvent la multiplication des misérables. Je préférerais beaucoup l'augmentation de bien-être. Je ne cite ici l'accroissement du nombre des hommes que comme un symptôme, et non comme un bonheur. L'abus de l'aisance en prouve l'existence.
[53] La seule suppression des droits féodaux et des dîmes, partie au profit des cultivateurs, partie à celui de l'État, a suffi aux uns pour accroître beaucoup leur industrie, à l'autre pour asseoir une masse énorme d'impôts nouveaux ; et ce n'était là qu'une faible portion des revenus de la classe consommatrice sans utilité.
[54] Si le luxe est nécessaire dans un État monarchique, c'est pour la sûreté du gouvernement, mais non pas pour la prospérité du pays.
[55] Les seuls oisifs que l'on devrait voir sans improbation sont ceux qui se livrent à l'étude, et surtout à l’étude de l'homme, et ce sont les seuls qu'on persécute. Il y a raison pour cela. Ils font voir combien les autres sont inutiles, et ils ne sont pas les plus forts [*].
[*] A parler sérieusement, les hommes studieux sont loin d'être des oisifs. Ce sont des producteurs d'utilité, et de la plus grande des utilités, la vérité. La note est une plaisanterie, et l'on voit qu'elle a été faite dans un temps où on affectait de jeter une grande défaveur, et même, s'il était possible, un grand ridicule sur ceux qui s'occupaient de l'étude de nos facultés intellectuelles. C'est pour cela que je la laisse subsister.
[56] C’est, suivant moi, la meilleure manière de les classer, pour se bien rendre compte de leurs effets.
[57] Je ne fais pas valoir contre cet impôt la prétention de quelques économistes, que le revenu des maisons ne doit pas être imposé, ou du moins ne doit l'être qu'à raison du produit net que diminuerait, par la culture, le terrain que ces maisons occupent, tout le reste n'étant que l'intérêt du capital employé à bâtir, lequel, suivant eux, n'est point imposable.
Cette opinion est une conséquence de celle que le travail de la culture est le seul productif, et que le revenu des terres est le seul imposable, parce qu'il y a dans le produit de la terre une portion qui est purement gratuite et entièrement due à la nature, laquelle portion, suivant ces auteurs, est le seul fonds légitime et raisonnable de l'impôt.
J'ai fait voir que tout cela est faux, ainsi je ne saurais m'en prévaloir ni contre l'impôt dont il s'agit, ni contre tous ceux qui suivent, lesquels ont tous non seulement réprouvés dans ce système, mais déclarés illusoires, comme n'étant et ne pouvant jamais être que l'impôt sur le revenu des terres, déguisé et surchargé de frais et de pertes inutiles. Pareille théorie est insoutenable, quand en sait ce que c'est que production.
[58] Il aurait dû dire : Il est FRÉQUENT.
[59] Esprit des Lois, liv. 13, chap. 17.